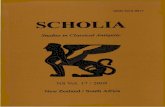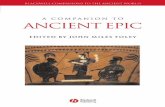R DE BALBIN,J ALCOLEA 2009 LES COLORANTS
Transcript of R DE BALBIN,J ALCOLEA 2009 LES COLORANTS
Article original
Les colorants de l’art paléolithique dans les grotteset en plein air
Colors in the palaeolithic painting in cave and outdoors
Rodrigo de Balbín Behrmann *, José Javier Alcolea GonzálezÁrea de Prehistoria, Universidad de Alcalá de Henares, C/ Colegios n8 2, 28801 Alcalá de Henares, Espagne
Disponible sur Internet le 11 novembre 2009
Résumé
Les colorants utilisés dans la fabrication des peintures paléolithiques sont un élément culturel de premierordre pour connaître les intentions des artistes, leurs points d’approvisionnement, les systèmes de mélangeet de préparation et la qualité des pigments utilisés. Mais ce n’est pas leur seul intérêt puisqu’ils conduisent àl’élaboration d’hypothèses et à l’identification de rapports culturels qui vont bien au-delà de la simpletechnique en permettant de faire apparaître la réalité de leurs références culturelles. Ce que nous savons à cejour montre l’hétérogénéité des mélanges employés et l’existence de méthodes communes qui s’adaptent àchaque site spécifique. Les couleurs sont assez bien conservées à l’intérieur des grottes, et très mal àl’extérieur, dans la version rupestre du Paléolithique. Mais nous avons isolé certains échantillons dans legisement espagnol de Siega Verde, à partir desquels nous pouvons affirmer qu’il y a une communauté desystèmes pour tout l’art paléolithique, sur et sous terre, et qui prouve que ce qui est aujourd’hui en noir etblanc, était à l’époque paléolithique en couleur.# 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
Mots clés : Couleurs dans la peinture paléolithique ; La peinture dans la grotte et à l’extérieur ; Des systèmes et desmélanges de peinture paléolithique
Abstract
The dyes used in the manufacture of Palaeolithic paintings are a cultural element of the first order to knowthe intentions of the artists, their points of supply, its systems for mixing and preparing and the quality of theused pigments. But here is not its only value, since they are used to establish possible areas and culturalrelations that go beyond the technical to constitute genuine cultural bases. What we know at the momentsuggests a degree of heterogeneity in the mixtures and systems on a common term that adapts to each specific
www.em-consulte.com
Disponible en ligne sur www.sciencedirect.com
L’anthropologie 113 (2009) 559–601
* Auteur correspondant.Adresse e-mail : [email protected] (R. de Balbín Behrmann).
0003-5521/$ – see front matter # 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.doi:10.1016/j.anthro.2009.09.012
site. The colours are fairly well preserved in the cave interior, and very badly abroad, in the Palaeolithic versionof rock shelter external art. But we were able to isolate some samples in the Spanish site of Siega Verde, leadingto affirm the general community of systems for all Palaeolithic art, underground and on it, proving that whattoday is black and white had chromatic signalling in the Palaeolithic epoch.# 2009 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
Keywords: Colors in the palaeolithic painting; Painting in cave and outdoors; Systems and mixtures in palaeolithicpaintings
1. Introduction
Les analyses des colorants employés dans les représentations graphiques paléolithiquesconstituent un outil introduit récemment dans l’investigation archéologique. Tandis que lesanalyses faisaient apparaître des indices de grand intérêt pour la connaissance des techniquesutilisées, leurs procédés de réalisation se confrontaient à de sérieux problèmes posés par leprélèvement d’une quantité suffisante pour son étude. Les systèmes de diffraction de rayons et leperfectionnement du prélèvement des échantillons ont permis finalement que cette ambitiondevienne réalité et que véritablement, nous disposions progressivement d’un corps d’analyses etde possibilités de comparaison adéquats pour permettre leur interprétation.
Une chose, cependant, est d’identifier les composants de la peinture, une autre est de découvrirleurs proportions et les agglutinants utilisés, c’est-à-dire les éléments sans doute les plus significatifsqui nous permettent de connaître avec plus de fiabilité les techniques et les procédés. Lacaractérisation du mélange ou de la recette utilisée est importante, non seulement comme élémenttechnique indicatif, mais pour permettre la comparaison avec d’autres sites, dans le but degénéraliser des pratiques qui nous paraissent difficilement généralisables. Sauf erreur ou omission,les colorants semblent provenir de lieux proches des sites où ils sont utilisés, ce qui n’exclut pasl’existence d’échanges de matières premières ou le fait que celles-ci, dans le cas qui nous occupe dessubstances colorantes, aient pu être utilisées par un même groupe dans plusieurs sites artistiques.
Si tel fut le cas, comme nous le pensons, les colorants seraient seulement comparables à uneéchelle réduite, permettant peut-être l’identification de zones géographiques occupées par unmême groupe. Par contre, les comparaisons entre recettes à grande distance seraient douteuses,puisque les composants seraient différents selon les lieux d’extraction et les proportions difficilesà établir sans une analyse de la composition et des agglutinants.
Il serait très intéressant d’établir des normes de conduite, schémas de pratique picturale àgrande distance, mais ceci nous parait compliqué comme principe général et plus difficile encoredans l’état actuel de nos connaissances. Mais ces dernières sont cumulatives et il n’y a aucundoute que la multiplication des analyses et des interprétations nous permettraient de nousapprocher progressivement à une meilleure compréhension du problème. Nous ne prétendons pasque les analyses de pigments nous permettent de déchiffrer la signification finale de l’artpaléolithique, mais connaître bien le comment nous aidera sans doute à y parvenir plus sûrement.
Dans l’article publié sur Tito Bustillo en 2003 (Balbín Behrmann et al., 2003), nous offrionsune étude critique des colorants utilisés dans la création des peintures, dont le nombre et lescaractéristiques nous permettaient d’établir quelques modèles de pratiques. En 2007, nous avonspublié un article critique sur les dates et les styles (Alcolea González et de Balbín, 2007) qui secentre sur une autre facette du thème traité en Ribadesella et que nous utiliserons commeréférence ici. Les analyses récentes réalisées par l’Instituto de Patrimonio Histórico des
R. de Balbín Behrmann, J.J.A. González / L’anthropologie 113 (2009) 559–601560
échantillons de l’art à l’air libre de Siega Verde nous permettent de reprendre ce thème,comparant des cas d’art intérieur et extérieur dans le but de les évaluer conjointement.
2. Les analyses de colorants appliquées aux graphies rupestres paléolithiques.Réflexions critiques sur un siècle d’études
L’étude des matières premières utilisées dans les peintures rupestres est devenue dans lesdernières années une des stratégies indispensables de la recherche. Cette situation, dérivée del’étude du rupestre en relation avec le contexte archéologique, ne doit pas occulter le fait que lapréoccupation de caractériser la composition et la nature des pigments utilisés naquit dès lespremières études.
Au début du siècle passé, des analyses furent pratiquées sur des peintures de sites comme Fontde Gaume ou La Mouthe (Moissan, 1902, 1903) et identifièrent l’emploi d’oxydes de fer(hématites) et de manganèse comme composants principaux des peintures rouges et noires, etd’autres minéraux associés en forme de matrice, principalement quartz et calcite. Ces analyses,peu connues, sont la base de l’hypothèse de l’utilisation des oxydes de fer, du manganèse ou ducharbon comme pigments communs pour l’élaboration des figures rupestres paléolithiques. Ilfallut attendre les années 1980 pour obtenir une confirmation scientifique grâce à lagénéralisation de l’échantillonnage direct des peintures.
En effet, durant presque trois quarts de siècle les études furent abandonnées, certainement dufait d’une déficience méthodologique qui empêchait l’obtention d’échantillons fiables sansdétériorer les objets rupestres. Durant ce temps, les études se centrèrent sur la description dessubstances colorantes des habitats et sur leur mise en rapport avec des activités diverses, depuisune fonction auxiliaire dans le travail des matériaux organiques durs (os et bois pour la confectiond’Art Mobilier) (Delporte, 1980) ou le travail des peaux (Audouin et Plisson, 1982), jusqu’à unepossible utilisation rituelle due à la présence d’ocre rouge dans les tombes (San Juan, 1985 : 83–
93).L’amélioration des techniques se cristallisa dans la décade des années 1980, rendant possible
l’obtention de petits échantillons et permettant l’étude directe des figures pariétales. Cetteamélioration se manifesta dans l’affinement des procédures (Menu et Walter, 1996 : 11), dontl’axe principal a été l’emploi coordonné du microscope électronique à balayage et de ladiffraction de rayons X pour la détermination chimique élémentaire et l’analyse de la structurecristalline des composants, unis parfois à d’autres méthodes comme, par exemple, lachromatographie de phases gazeuses, employée dans l’identification des agglutinantsorganiques.
Ces progrès ont permis qu’à partir de la fin des années 1970, les analyses de colorants ont étéintégrées aux études rupestres. Cette prise en compte a permis d’apporter des réponses à plusieursinterrogations et a permis de confirmer les hypothèses sur la composition basique, d’identifier leslieux d’approvisionnement des matières premières et même de certifier l’authenticité ou lafausseté de certaines graphies, comme ce fut le cas de la grotte de Zubialde (Menu et Walter,1992).
Les études des colorants peuvent se diviser chronologiquement en deux phases, une premièrephase formative qui a duré une décade, depuis les analyses de la grotte de Altamira (Cabrera,1979) et les ocres de Lascaux (Couraud et Laming-Emperaire, 1979 ; Ballet et al., 1979),jusqu’aux analyses directes des pigments de Niaux (Brunet et al., 1982), Cougnac et Marcenac(Lorblanchet et al., 1988). Ces cas furent le point de départ d’une pratique aujourd’hui mieuxdéveloppée et servirent à orienter la recherche des années qui suivirent.
R. de Balbín Behrmann, J.J.A. González / L’anthropologie 113 (2009) 559–601 561
Les premières analyses confirmèrent quelques-unes des hypothèses sur les figures rupestres,démontrant que les composants basiques des couleurs étaient en effet l’oxyde de fer en formed’hématite, goetite ou ocre pour les tons rouges, oranges et jaunes, et l’oxyde de manganèse et lecharbon pour les couleurs noires. Elles montrèrent aussi que ces colorants apparaissent associésde manière répétitive à d’autres matériaux, dont la fonctionnalité colorante est faible, comme lequartz, la calcite, les aluminosilicates (argiles) et même l’ambre (Cabrera, 1979 : 9). Cesmélanges, considérés comme intentionnels dans quelques cas (Ballet et al., 1979 : 174),donnèrent force à l’idée de charge ou de matrice du colorant, utilisée pour améliorer lespropriétés adhésives, la densité et la fluidité de la peinture (Ballet et al., 1979 : 173). Ceci permitde proposer, quelques années plus tard, une structure ou un modèle des peintures paléolithiquesconstitué par trois components basiques : le pigment, la charge et l’agglutinant (Clottes et al.,1990a : 171).
Le développement de cette idée est ce qui a caractérisé la deuxième phase historique desanalyses, conditionnant autant la méthodologie que les objectifs de la recherche, qui ne secentraient désormais plus seulement sur la nature des pigments basiques mais aussi sur celle desminéraux associés en forme de charge. De cette façon, les « recettes » caractéristiques desprocessus de création des différents « sanctuaires » rupestres pouvaient être connues, nonseulement du point de vue technique mais aussi du point de vue chronologique.
Ce système s’appliqua dans diverses grottes pyrénéennes, autant aux peintures rupestresqu’aux pièces meubles. Les analyses des pigments de Niaux, Reseau Clastres, Fontanet, Trois-Frères, Le Portel, Enlène, Mas d’Azil et La Vache (Buisson et al., 1989 : 189 ; Clottes et al.,1990b : 186) montrèrent l’existence de trois types de recettes avec des bases différentes (biotite,feldspath et gypse comme éléments dominants), indépendamment de la préparation de peinturerouge ou noire. La chronologie des recettes, basée sur leur apparition sur des pièces meubles biendatées, indiquait une perduration plus longue que pour la décoration de sites comme Niaux(Clottes et al., 1990b : 190) et suggérait que les datations stylistiques de A. Leroi-Gourhansouffraient d’une inexactitude importante. Les analyses de pigments entraînèrent ainsi la révisionde la chronologie rupestre, basée sur les premières datations de C14 SMA, dont la signification futalors surdimensionnée (Alcolea González et Balbín Behrmann, 2007). La contribution desanalyses directes se compléta par l’étude des processus de création des figures et la détection de laprésence d’ébauches dessinées avec du charbon végétal qui postérieurement furent recouvertsavec de la peinture à base d’oxyde de manganèse.
On peut donc observer l’hétérogénéité de certaines peintures qui mélangent charbon etmanganèse dans leur composition, due à la réalisation d’une ébauche préliminaire, mais cecin’est pas le cas dans d’autres sites, comme dans la Frise Noire de Pech-Merle (Guineau et al.,2001 : 222), où la solution n’est pas aussi simple. Dans ce cas, il est possible que le charbon ait étéajouté au manganèse pour intensifier la couleur noire, ou que le manganèse ait été brûlé, laissantainsi des traces de charbon dans le colorant. De plus, dans quelques cas, les pigments basiquesincorporent des traces d’autres éléments contradictoires, comme à Font-de-Gaume et La Mouthe(Moissan, 1902, 1903) où les rouges contiennent du manganèse et les noirs des traces d’hématite.Cette composition particulière, détectée déjà au début du siècle passé, se répète dans les sites dePergouset (Smith et al., 2001 : 176) ou Lascaux (Vignaud et al., 2006 : 486) et aussi de TitoBustillo (Balbín Behrmann et al., 2003) où d’autres auteurs ont proposé pour plusieurs figuressans spécifier que la couleur violette correspondrait à un mélange intentionnel de pyrolusite (Mn)et de petites quantités d’oxyde de fer (Fortea et Hoyos, 1999 : 239).
Les analyses pyrénéennes se combinèrent pour la première fois avec la recherche desagglutinants organiques, apportant des résultats surprenants, étant donné qu’après les études
R. de Balbín Behrmann, J.J.A. González / L’anthropologie 113 (2009) 559–601562
classiques de C. Couraud et A. Laming-Emperaire (1979 : 164), des colorants de Lascaux, s’étaitétablie l’idée que les agglutinants organiques devaient être exclus de la confection des pigmentspréhistoriques. L’analyse par chromatographie de phases gazeuses de quelques colorants deTrois-Frères, Fontanet et Enlène (Pepe et al., 1991) confirma l’existence d’agglutinants en formede graisse animale (Trois-Frères) ou végétale (Fontanet, Enlène) et découvrit la pratique d’unepeinture à l’huile particulière au Magdalénien pyrénéen (Clottes, 1994 : 229). La présenced’agglutinants organiques a depuis été confirmée de façon épisodique du fait que lescontaminations des échantillons peuvent altérer le résultat des analyses (Clottes et al., 1990a :178). En tous cas, la présence de graisse animale a été confirmée par nos analyses de troiséchantillons rouges de Tito Bustillo, une de La Lloseta (Navarro et Gómez, 2003 : 171) et unefigure de la caverne de Ekain en Guipúzcoa (Chalmin et al., 2002 : 49).
Autre exemple classique est celui du Quercy. Là, les analyses se sont centrées sur les grandescavernes de Cougnac et Pech-Merle (Lorblanchet et al., 1990a, 1990b ; Lorblanchet, 1996 ;Labeau, 1993 ; Guineau et al., 2001), auxquelles il faut ajouter les analyses pionnières deMarcenac (Lorblanchet et al., 1988). Les études de ces ensembles ont permis de proposer desschémas différents de ceux prévus, prolongeant la période d’exécution et de fréquentation descavernes, surtout dans le cas de Cougnac puisque Pech-Merle souffre de l’absence de publicationsur la plupart des données obtenues, à l’exception de quelques commentaires sur les pigments dupanneau des Chevaux Ponctués (Lorblanchet, 1996 : 155) et de l’analyse complète de la FriseNoire (Guineau et al., 2001).
Le cas de Cougnac est le plus significatif. Ici, il a été proposé une séquence longue(Lorblanchet et al., 1990a : 19) qui commencerait avec des figures rouges peintes avec unmélange de pigment rouge (hématites) avec une base de quartz, calcite et kaolinite avec destraces de phosphore et titane (Lorblanchet et al., 1990b : 125). Une phase postérieure de peinturesrouges possèderait la même composition basique à l’exception des traces de manganèse(Lorblanchet et al., 1990a : 19) et une phase finale serait formée par des peintures noiresconstituées essentiellement de charbon végétal (Labeau, 1993). Les analyses se complétèrentavec la comparaison des ocres de la caverne avec des échantillons des gisements de la région, quisuggérait une hypothèse raisonnable sur leur origine locale dans des dépôts de terresidérolithique. Cette origine locale a été renforcée par la constatation de gisements nonseulement dans les environs proches des cavernes décorées sinon à l’intérieur même de celles-ci.Ceci n’est pas exclusif des dérivés du manganèse, dont la présence naturelle dans les milieuxkarstiques est bien connue, mais s’étend aussi aux colorants rouges. Les données de Arenaza(Gárate et al., 2004 : 271), El Pendo (García, 2001 : 238) et, surtout, Tito Bustillo (BalbínBehrmann et al., 2003 : 147–148) signalent la fréquente utilisation de filons localisés dans lescavernes elles-mêmes pour la préparation des peintures.
Comme nous l’avons signalé ci-dessus, la détermination de l’origine des matières premièresfut l’un des objectifs de la recherche à partir des années 1990. Cet objectif fut favorisé par lesavancées de la méthodologie qui permettait enfin l’analyse des éléments traces, qui en théoriedevaient permettre une discrimination entre les différentes sources d’approvisionnement, bienque beaucoup d’entre elles ne soient pas encore connues. Cependant, l’analyse des composantsles plus minimes servit à consacrer un autre concept, celui de « pot de peinture » qui est souventconfondu avec celui de « recette ». Tandis que les recettes s’individualisent par les différencesobservables dans les charges ou matrices associées aux pigments, la notion de « pot de peinture »fait référence à des colorants similaires en tonalité et composition, qui se différencient par lagranulométrie ou par leurs éléments traces naturels, ce qui en essence revient à dire, desmatériaux colorants similaires mais d’origine différente (Clottes et al., 1990a : 179).
R. de Balbín Behrmann, J.J.A. González / L’anthropologie 113 (2009) 559–601 563
Cette notion fut employée de manière généralisée pour première fois dans l’analyse de Gargaset Tibiran (Clot et al., 1995 ; Menu et Walter, 1996) où aucune matrice ou charge fut identifiéepour les pigments. Ceux-ci étaient des hématites et de l’ocre pour les rouges, de l’oxyde demanganèse et du charbon végétal pour les noirs, de la goetite pour les marrons jaunes et unétrange mélange de chlorite et de talc pour la main blanche de Gargas (Clot et al., 1995 : 224). Cedernier permit de détecter pour la première et unique fois la présence d’eau comme agglutinant(Clot et al., 1995 : 225). Le concept de « pot de peinture » s’appliqua pour explorer la possibleconstruction synchronique des ensembles de mains, découvrant que seulement quelques mainsisolées et quelques paires répètent la même composition, ce qui suggère la création individualiséede chaque représentation ou paire (Menu et Walter, 1996 : 16). De plus, l’analyse minutieuse despeintures servit pour démentir en partie l’idée, répétée dans des travaux antérieurs, que les mainsfurent réalisées au moyen d’une primitive technique aérographique. Le soufflet fut identifiéseulement dans le cas des figures réalisées en charbon végétal, tandis que les autres devaient avoirété peints avec un tampon ou une broche épaisse.
Un autre exemple classique de l’utilisation du concept de « pot de peinture » se trouve dans lestravaux développés dans la Grande Grotte de Arcy-sur-Cure (Baffier et al., 1999). Dans ce cas,trois types de peinture furent identifiés : noire à base de charbon végétal sans charge, rouge à based’ocre sans charge et rouge obtenue au moyen du mélange artificiel d’hématite et d’argile. Cettedernière correspondait à trois « pots de peinture » différents (Baffier et al., 1999 : 17), définis parles différences structurales des hématites employées.
Les résultats obtenus ne paraissent pas aussi importants que dans le cas de Gargas, mais il s’endégage toutefois des aspects intéressants. Le premier est le rôle de l’argile, conçu dans ce cascomme une charge intentionnelle pour donner à la peinture une texture plus grasse et malléable(Baffier et al., 1999 : 8), ce qui se répète systématiquement dans des cas comme Lascaux(Chalmin et al., 2003 : 1594 ; Vignaud et al., 2006 : 488), Arenaza (Gárate et al., 2004 : 260),Ekain (Chalmin et al., 2002 : 43–44) ou Tito Bustillo (Navarro et Gómez, 2003 : 164–170 ;Balbín Behrmann et al., 2003 : 140–146). Cette caractérisation de l’argile comme un élément decharge ou de matrice constitue une nouveauté puisque cette fonction ne lui était pas attribuéedans les travaux antérieurs, où elle était traitée comme une impureté malgré sa présence quelquesfois importante, comme c’est le cas pour les deux échantillons de Gargas (Clot et al., 1995 : 226)(Fig. 1).
Autre aspect intéressant est la présence d’os dans la composition de certains colorants de laGrande Grotte de Arcy-sur-Cure. Concrètement, de l’os a été identifié dans 14 échantillons depeintures rouges qui représentent trois des quatre variantes présentes (Baffier et al., 1999 : 14,Table 2). La présence d’os pulvérisé en forme d’apatite, phosphate de calcium hydraté, a étésignalé dans plusieurs ensembles : Ekain (Chalmin et al., 2002 : 49), Cougnac (Lorblanchet et al.,1990a : 17), Arenaza (Gárate et al., 2004 : 269) et Lascaux (Pomiés et al., 2000 : 26) où ont aussiété identifiés des restes de bois de renne dans les colorants (Chadefaux et al., 2008) et même dansdes sites aussi éloignés que la caverne de Ignatievskaïa dans l’Oural (Paltchik, 1997 : 117). Laprésence de cet os dans la composition a reçu diverses interprétations, comme celle d’un élémenttrace du lieu d’approvisionnement du pigment (Lorblanchet et al., 1990a : 17), ou de manièreplus générale celle d’une impureté introduite par la pulvérisation et le mélange de la peintureavec un outil en os. Sans écarter aucune hypothèse, il est nécessaire de signaler que les analysesde Tito Bustillo ont détecté plus d’une fois (Navarro, 2003 : 183, Fig. 12) des restes de dents dansla matrice des colorants. Ceci suggèrerait une autre possibilité, celle de l’introductionintentionnelle de l’os dans la matrice, comme cela a été proposé pour certains échantillons deLascaux (Pomiés et al., 2000 : 27). De cette façon, sa présence dans les colorants pourrait être non
R. de Balbín Behrmann, J.J.A. González / L’anthropologie 113 (2009) 559–601564
pas accidentelle mais aussi intentionnelle. Il existerait pour autant des charges assez éloignées decelles que nous pourrions qualifier d’« orthodoxes », comme cela se dégage d’autres échantillonsde Tito Bustillo dans lesquels apparaissent du coquillage pulvérisé (Navarro et Gómez, 2003 :163) et des cas déjà connus de Altamira (Cabrera, 1979 : 9) qui incorporent de l’ambre moulue àleur composition. Dans ce dernier cas, malgré que l’analyse ne soit pas suffisamment détaillée,l’inclusion de l’ambre pourrait avoir eu lieu en état solide ou liquide, puisqu’il s’agit d’une résinefossile qui se dissout bien dans l’huile ou la graisse, ainsi nous pourrions être en présence d’unagglutinant gras, bien que de forme transformée.
Le début du XXIe siècle a vu l’intensification des travaux d’analyse de pigments pariétaux,
impulsée par l’amélioration des méthodes et par l’importance des colorants dans l’étudeartistique. Ces analyses s’appliquent maintenant aux ensembles espagnols, tous situés dans leCantabrique. Dans le même temps, en France, les travaux sur le site de Lascaux sont de grandintérêt. Ils sont encore en cours et constituent le projet le plus ambitieux pour la connaissance dela composition, la fabrication et l’application de matières picturales dans une cavernepaléolithique.
Les résultats obtenus des représentations de Lascaux publiés au jour d’aujourd’hui (Pomiéset al., 2000 ; Chalmin et al., 2003, 2004 ; Vignaud et al., 2006 ; Chadefaux et al., 2008) montrentune complexité plus grande que celle observée en d’autres sites, ce qui ne devrait pas noussurprendre, étant donné les caractéristiques de la grande caverne de la Dordogne. Une visiongénérale nous indique que les couleurs noires sont à base d’oxydes de manganèse, généralementmixtes, de type cryptomélane. Ces oxydes furent complétés avec une charge pour les figures quinécessitaient une masse de peinture étendue, comme l’un des taureaux de la Salle des Taureaux
R. de Balbín Behrmann, J.J.A. González / L’anthropologie 113 (2009) 559–601 565
Fig. 1. Les analyses des colorants dans les grottes paléolithiques françaises.Analysis of colors in French Palaeolithic caves.
(Chalmin et al., 2003 : 1594) ou l’un des bisons assis (Vignaud et al., 2006 : 489–490). Dans cescas, la charge est principalement d’argile, quelques fois complémentée de quartz et de calcite.Les figures plus petites, comme celles de la scène du Puits (Aujoulat et al., 2002 : 12) ou deszones des blasons (Chalmin et al., 2004 : 589), furent peintes avec le colorant dilué sans charge.
Le composant basique des rouges est l’hématite, parfois ceux-ci étaient mélangés avec de lamagnétite noire, peut-être pour moduler la couleur intense de l’oligiste (Vignaud, et al., 2006 :497–498). De façon similaire aux peintures noires, la charge était ajoutée pour couvrir dessurfaces étendues, comme c’est le cas des bisons assis, tandis que les figures plus petites étaienteffectuées avec le colorant pur.
Lascaux nous met en contact avec des couleurs différentes, comme les violets et les jaunes, quiapparaissent quelque fois dans les mêmes figures. Les premières semblent être obtenuesdirectement avec des variétés particulières d’hématite, mais présentent des traces de manganèse,qui pourrait provenir de couches de peintures préexistantes (Chalmin et al., 2004 : 583–585), cequi illustre bien le problème de l’analyse des pigments provenant de zones caractérisées parl’abondance de peintures. Les jaunes paraissent provenir du mélange de goetite avec de l’argile,celle-ci étant utilisée comme charge (Chalmin et al., 2004 : 585).
Les résultats se complètent avec des observations des modes d’obtention des couleurs et desdifférents « pots de peinture » appliqués, parfois dans la même figure. Dans le premier cas, il fautsignaler que l’apparition de quelques tons mixtes, comme le marron et le rouge obscur des bisonsassis, est le résultat de l’application de deux couches de couleur. La couche inférieure est noire àbase de manganèse et la couche supérieure est rouge. Dans le cas de la couleur marron, celle-ci secompose d’un mélange de goetite et d’hématite avec une charge argileuse, tandis que le rougeobscur s’obtient avec de l’hématite et une charge d’argile.
Le blason droit montre que les trois carrés jaunes furent réalisés avec des colorants deprovenances diverses, confirmées par les différences des argiles utilisées comme charge. Dans lecas des rouges, le contenu en titane de l’un des carrés indique une provenance différente desautres deux analysés. Ceci est important puisqu’il démontre que pour des raisons techniques,esthétiques ou d’autre nature, les peintres paléolithiques utilisèrent des couleurs et descompositions diverses dans la réalisation d’une même figure (Chalmin et al., 2004 : 589–591). Sinous comparons cette donnée avec les variations observées dans les recettes ou « pots depeinture » d’autres sites (Clottes et al., 1990a : 186–187), on peut suggérer que l’interprétationchronologique et organisationnelle des variantes des couleurs est peut-être allée trop loin. Cetteobservation se renforce si l’on tient compte que certaines charges appliquées aux figures faisantpartie d’une même composition, comme celle des bisons assis, montrent des différencessubstantielles. En effet, les couleurs rouges comme les noires montrent trois préparationsdifférentes : argile, argile-quartz-calcite et argile-quartz (Vignaud, et al., 2006 : 490–496). Toutparaît indiquer que les artistes paléolithiques adaptaient la composition des colorants à diversparamètres techniques, comme la qualité adhésive, la fluidité du mélange, la tonalité, la forme oula surface d’application. De cette façon, l’idée de schémas culturels qui imposaient unepréparation spécifique dans chaque époque et région perd toute sa force.
L’hypothèse présentée ci-dessus est consolidée par les données de la caverne de Arenaza(Gárate et al., 2004). Cette caverne a été l’objet d’un programme complet d’étude de ses peinturerouges qui a permis d’identifier la composition assez homogène des colorants, en essence ocre ethématites, mélangés ou non avec de l’argile, dans quelques cas avec de l’apatite, élément chaquefois plus commun dans la composition et que nous avons déjà traité en d’autres occasions (Gárateet al., 2004 : Table 2). L’analyse minutieuse des composants a permis d’isoler plusieurs recettesou « pots de peinture » (Gárate et al., 2004 : 259–260) qui, comme dans le cas de Lascaux, se
R. de Balbín Behrmann, J.J.A. González / L’anthropologie 113 (2009) 559–601566
trouvent combinés dans les mêmes figures. Les chercheurs suggèrent que cette utilisation est dueà une recherche expressive qui tend à moduler la couleur et la tonalité des animaux représentés(Gárate et al., 2004 : 278). Nous nous trouvons une fois de plus face à une utilisation de procédésdivers qui paraissent obéir à des questions de type technique ou esthétique et non pas à desconsidérations chronologiques ou culturelles strictes. Ceci se perçoit encore plus nettement dansun ensemble limité de représentations dont l’homogénéité stylistique et chronologique est claire(Gárate et al., 2000–2002 : 52).
Les analyses d’Arenaza posent cependant quelques problèmes. Ici aussi, une explication adhoc est donnée à la présence d’apatite (Gárate et al., 2004 : 269), écartant par omission que l’ospourrait avoir été incorporé intentionnellement à la charge du colorant. De plus, la présenced’argiles riches en manganèse, potassium et fer mélangés aux colorants purs, apparaît seulementdans quelques cas comme intentionnel, sans que les raisons soient spécifiées (Gárate et al., 2004 :Table 2). Comme nous l’avons commenté antérieurement, les analyses actuelles commencent àrendre compte de la fonction de matrice de la simple argile, surtout quand elle apparaît enquantités suffisantes et sans séparation microstratigraphique avec les pigments purs.
Ceci est observé de nouveau en Ekain (Chalmín et al., 2002). Une fois de plus apparaissent lespigments purs habituels : charbon végétal utilisé comme fusain ou mélangé avec une charged’argile et de quartz pour servir comme peinture, ocres et hématites, parfois accompagnés d’unecharge argileuse, de quartz ou, en de rares cas, d’apatite, pour les couleurs rouges et marrons(Idem : 43–45). Dans le cas de Ekain, on a la certitude que, dans tous les cas à l’exception d’un(Chalmín et al., 2002 : 44–45), l’argile destiné à la fabrication des charges argileuses sembleprovenir des dépôts de la caverne, (Fig. 2) comme le démontre l’analyse comparative. Noussignalions ci-dessus l’utilisation des ressources immédiatement disponibles dans les zonesdécorées, concrètement dans Tito Bustillo (Balbín Behrmann et al., 2003 : 147–148), El Pendo(García, 2001 : 238) et, précisément, Arenaza (Gárate et al., 2004 : 271). Les parallèles en ce quiconcerne la composition des pigments et les modes d’approvisionnement de Ekain et Arenazanous font penser que l’interprétation de la charge de cette dernière pêche par une certaine
R. de Balbín Behrmann, J.J.A. González / L’anthropologie 113 (2009) 559–601 567
Fig. 2. Les analyses des colorants dans les grottes paléolithiques espagnoles.Analysis of colors in Spanish Palaeolithic caves.
indéfinition et que les matériaux argileux non valorisés pourraient constituer une partintentionnelle des peintures.
Le panorama actuel des analyses de pigments se conclut avec les données d’El Pendo (García,2001 : 240), peu concluantes et limitées à l’identification d’un possible pigment à based’hématites dans la « Frise de las Figuras » et celles de Tito Bustillo (Balbín Behrmann et al.,2003 ; Navarro et Gómez, 2003 ; Navarro, 2003), et de Siega Verde qui seront traitéesspécifiquement dans des chapitres postérieurs.
3. Le rôle de la couleur dans la représentation pariétale
Par coutume et par tradition, nous différencions gravures et peintures pariétales comme deuxsystèmes techniques différents, et on prétend même qu’elles eurent des connotations culturellesplus profondes ou des chronologies différentes. Cela était le concept sous jacent dansl’organisation chronologique de Breuil (1974), dans laquelle, gravures et peintures suivaient deschemins différents, ainsi que celui exprimé dans des études de l’art des dolmens pour lesquels leszones géographiques des gravures et des peintures furent créées par Shee (1981), dotées chacuned’un contenu culturel et chronologique différent (Bueno Ramírez et al., 2008).
Dans ces cas, il est souvent oublié que les gravures que nous pouvons maintenant observersont clairement différentes de celles visibles au moment de leur création. Dans les cavernes et enextérieur, il y a l’air et celui-ci, uni à divers agents atmosphériques, entre lesquels l’humidité finitpar produire un obscurcissement du sillon incisé, d’intensité plus ou moins forte selonl’orientation, l’humidité, le type de support, etc., et que nous appelons patine. Celle-ci renddifficile la différenciation du trait du reste du support puisque leurs colorations et leur aspectexterne se confondent. Il est donc nécessaire de recourir à des systèmes d’illumination latéralequi provoquent un contraste entre les deux et permettent de discerner les gravures. Mais, en sonorigine, les lignes étaient plus claires que le support et le principe de la réalisation d’un objetgraphique comptait avec cette différence de couleur pour mettre en valeur la figure, qui étaitparfaitement visible pour très subtile qu’elle fut. Avec le temps, ce contraste a été annulé.
Les éléments gravés ont toujours été contemporains des peintures, et possèdent les mêmesthèmes et symboles que celles-ci. Les gravures comptaient non seulement avec des différences detonalité qui ne s’apprécient plus maintenant, mais faisaient partie du même apparat représentatif,possédant le même contenu culturel et chronologique. Il n’existe pas deux moments distinctspour la gravure et la peinture, mais un seul pour la représentation des formes graphiquesreconnues par le groupe, sous différentes formes. L’art paléolithique et post-paléolithiquepossèdent donc des formes peintes et gravées, généralement contemporaines et de signification etchronologie similaires (Bueno Ramírez et al., 2008).
La préservation des représentations préhistoriques n’est pas facile, comme chacun sait, enraison de la transformation des supports qui subissent des destructions et celles des formes elles-mêmes et de leurs composants dont la nature s’altère. À l’intérieur comme à l’extérieur, laconservation des peintures est difficile et dépend en grande mesure de la pénétration du support,de la condition de celui-ci et de la composition du colorant employé. Les gravures supportentmieux les aléas et les changements d’humidité et de température, et se conservent sauf quand lasurface de la roche souffre d’une détérioration importante. Dans les cavernes ou à l’air libre, il y atoujours plus de gravures que de peintures, bien que ceci varie dans les cavernes de l’époqueconsidérée et ceci du fait de la nature même de la gravure qui est un fait physique qui ne dépendpas de matériaux exogènes à la paroi. Si la surface de la paroi maintient sa condition originelle, cequi fait que la gravure peut durer presque autant que son support.
R. de Balbín Behrmann, J.J.A. González / L’anthropologie 113 (2009) 559–601568
La peinture se conserve mal dans les cavernes et pire encore en extérieur. Quand on a affaire àune représentation complexe et avancée d’un panneau principal, on observe habituellementcomment les deux techniques s’utilisent conjointement, le rapport entre la peinture à la gravure etvice versa. Ces cas nous confirment la coexistence des deux systèmes techniques, au service dudéveloppement des thèmes représentés dans le cadre d’espaces souvent abrités dans desintérieurs qui ont peu souffert de changements environnementaux. Mais, si la peinture seconserve mal, comment peut-on affirmer qu’elle n’existait pas en un moment déterminé ?Comment peut-on savoir si les restes gravés qui se conservent ne faisaient pas partie d’unecomposition plus complexe et mixte avec couleur et gravure ? Comment peut-on affirmer qu’unefigure gravée ne fut jamais peinte de couleur ? Comment peut-on savoir si cette gravure n’estautre chose que le reste d’une figure qui comptait aussi dans sa réalisation des couleursexogènes ? Les gravures dont nous disposons pourraient avoir été élaborées pour demeurercomme une forme graphique réalisée avec une technique exclusivement de gravure, mais ellespourraient être les restes de compositions qui utilisèrent la peinture et la gravure conjointement.
Ces problèmes sont particulièrement évidents dans le cas des représentations à l’air libre où laconservation de lignes repassées de couleur exogène est très difficile, bien sûr pour l’artpaléolithique mais aussi pour les représentations peintes postérieures que l’on trouvefréquemment en abris mais très rarement en extérieur. Dans le cas paléolithique, en ce quiconcerne les sites à l’air libre, seul est connu le cas de Faia, au Sud du grand ensemble du Côa quiprésente en même temps des figures avec des restes de peinture sur leurs contours. D’autresfigures se caractérisent par leurs grandes dimensions, leur tracé large et d’apparence claire, maisla couleur, si elle a jadis existé, n’a pas été conservée, pas plus sous la forme d’une différence depatine entre le support et le tracé, que sous l’aspect de formes noires sur noir, sans nuances degradation, entre couleur et profondeur. Mais ceci ne devait pas toujours être le cas.
Sous terre et sur elle, les individus du Paléolithique utilisèrent tous les moyens qu’ils avaient àleur disposition, qui étaient fondamentalement les mêmes dans l’un et l’autre cas : différences detexture et de relief, formes naturelles, tracés gravés de nature diverse, différences entre la tonalitéde la paroi et le tracé neuf, couleurs locales et couleurs exogènes. Ces dernières se conserventmal, mais l’on peut supposer qu’elles étaient présentes, puisqu’il n’y a aucune raison mécanique,physique ou culturelle qui aurait empêché leur utilisation dans un contexte social où elles étaientparfaitement connues, comme cela est démontré dans les cavernes contemporaines.
4. Tito Bustillo et les colorants des cavernes
4.1. Colorants et C14
Dans le cas de Tito Bustillo, le coquillage pulvérisé fait habituellement partie de la matrice descouleurs, non seulement des rouges mais aussi des noirs. Nous avons pris la peine d’analyseraussi les pigments noirs et de les traiter comme colorants, avec l’objectif de déterminer leurcomposition et leur possible mode de préparation. Les échantillons 17b et 18b montraient desrestes de bois brûlé, d’os brûlé et d’argiles avec du manganese et aussi des oxydes de fer commesi le premier mélange était rouge et se transformait en noir par l’addition postérieure de certainscomposants, qui possèdent trois origines différentes et qui correspondent même à de la dentpulvérisée dans le cas de l’échantillon 19b.
La préparation de la couleur montre une systématique similaire, avec divers composantsorganiques. Tous ont subi la transformation du N14 en C14, avec une vie moyenne similaire maisavec des origines et chronologies différentes. En bref, il faudrait connaître la composition exacte
R. de Balbín Behrmann, J.J.A. González / L’anthropologie 113 (2009) 559–601 569
des échantillons qui s’analysent par SMA, puisque beaucoup d’entres eux possèdent nonseulement du charbon de bois mais aussi de l’os brûlé, de la dent ou du coquillage pulvérisé. Tousces composants de la matrice ont leur propre chronologie et la date finale qui s’obtient parl’analyse n’est autre chose que le produit d’un mélange hétérogène de dates, qui de plus n’est pasnécessairement le même pour toute la surface peinte observée. Il ne s’agit pas d’une analysed’éléments purs sinon de mélanges picturaux avec divers agglutinants, par exemple de la graisseanimale, elle aussi organique. La seule manière de savoir ce que l’on date exactement seraitl’analyse en premier lieu des components de l’échantillon qui doit être daté, bien que ceci ne soitpas pour le moment une tâche facile.
La procédure du C14 SMA est bonne et nous paraît encore utile, mais fonctionne parfoispresque comme une chronologie relative. En tous cas, les analyses n’ont jamais une vie ou uneentité propre en dehors des critères archéologiques qui sont ceux qui caractérisent le modèle, larelation et la situation de l’élément analysé, qu’il soit purement matériel ou rupestre. Les datesSMA sont utiles mais pas nécessairement définitives.
Passant par l’expérience pratique, nous avons obtenu deux dates SMA pour les figures duPanneau Principal : B3, de la partie postérieure du cheval noir no 39, de 11 610 � 50 BP,échantillon no 3, Beta 170179 et B1 du dos du cheval no 63, de 11 140 � 80 BP, échantillon no 1,Beta 170177 (Balbín Behrmann et de Moure, 1982). Ces dates offrent une fourchette similaireavec une déviation standard faible et une coïncidence fondamentale dans le dixième millénaireavant J.C. Elles ne sont pas mauvaises en principe et nous situent face à un style IV avancé deLeroi-Gourhan, qui coïncide avec l’assignation stylistique que nous avons donnée et avec leséléments que sont matériaux provenant de la partie supérieure du site d’accès excavé parA. Moure.
Il existe cependant une possibilité différente, comme celle montrée par les dates obtenuespar Fortea (2002, 2007), quelques-unes d’entre elles ont été obtenues d’une même figure.L’échantillon F 16 montre une grande correspondance entre les deux dates obtenues de lafraction charbonneuse (Fig. 3), mais ceci n’est pas le cas des Figures 56 et 58 dont les datesSMA diffèrent de plusieurs millénaires pour la même figure, comme cela est illustré par latable ci-dessous. Il est vrai que la fraction analysée est parfois humique et parfoischarbonneuse, mais ceci ne justifie pas les différences observées. En effet, les deux datesobtenues du Cheval 58 de la Galerie Principale sont toutes les deux de fraction charbonneuse etdiffèrent de 4000 ans.
Les possibilités d’erreur de la datation radiocarbonique ont récemment été admises pardivers auteurs (Lorblanchet et Bahn, 1999 : 118–119). De plus, un nombre de problèmesgénéraux dans le traitement des échantillons a été mis en évidence (Pettit et Bahn, 2003 : 135)qui peuvent se résumer par la petite taille des échantillons, la présence fréquente de restes decalcite du support, une longue exposition à l’air des échantillons, leur histoire chimique variée,presque toujours inconnue et l’impossibilité de datations croisées due au manqued’associations avec d’autres matériaux datables. À ces problèmes, il faut en ajouter d’autrescomme le possible vieillissement des échantillons, comme cela a été signalé dans un article deJ. Fortea qui, se basant sur les travaux de M. Hoyos, propose cette possibilité causée par lacontamination par des microorganismes riches en charbon mais dépourvus de C14 (Fortea,2000–2001 : 196).
Les difficultés du procédé sont évidentes puisque, en plus de celles indiquées ci-dessus, lapossibilité d’une utilisation de charbons plus anciens et de contaminations diverses, existe. Il fautnoter que les différences chronologiques observées à Tito Bustillo n’ont aucune raison d’êtrearchéologiques, puisqu’en plus d’appartenir aux mêmes figures, il n’y a aucune condition
R. de Balbín Behrmann, J.J.A. González / L’anthropologie 113 (2009) 559–601570
appréciable que puisse justifier les écarts observés. Tout ceci n’invalide pas le procédé, mais ilfaut faire les précisions nécessaires, qui dans ce cas ont tout à voir avec la composition même descolorants.
4.2. Les agglutinants
En plus des éléments fondamentaux, de leur proportion et de la charge organique qui sont labase de la préparation des pigments en vue de leur utilisation postérieure, les colorants de l’artpaléolithique étaient dissouts dans une matière plus ou moins liquide qui permettait le mélangedes composants et facilitait l’application de la peinture à la surface des parois et des objets. Cettematière est l’agglutinant, qui dans le cas de Tito Bustillo montre trois variantes : l’eau, l’absenced’indices et la graisse animale. La connaissance de leur nature est très difficile puisqu’elledépend de la taille de l’échantillon. En effet, seul un échantillon plus grand que de coutumepermet leur étude et l’obtention de ce type de prélèvement n’est pas facile dans le cas despeintures pariétales. Sur la base des échantillons analysés en 2000 et 2002 par l’IPH duMinisterio de Cultura espagnol nous avons élaboré (Balbín Behrmann et al., 2003) des groupesque nous résumons ci-dessous.
4.3. Les échantillons obtenus
Les échantillons obtenues sont dans la Fig. 4.
R. de Balbín Behrmann, J.J.A. González / L’anthropologie 113 (2009) 559–601 571
Fig. 3. Cadre des dates SMA obtenues des figures pariétales de Tito Bustillo.Table of dates SMA obtained on the shelter figures of Tito Bustillo.
4.3.1. Groupe 1Formé par les échantillons dans lesquels a été détectée la présence d’un agglutinant gras. Leur
homogénéité et leur style permettent d’affirmer qu’il s’agit de formes anciennes. Étant donné lelapse de temps que nous supposons avoir été écoulé, la conservation des figures correspondantesest très bonne, comparativement meilleure que celle d’autres peintures réalisées plus tard, ce quisemble être dû à la préparation particulièrement soignée du colorant et à la matrice de contenugras (Brunet et Vouvé, 1996 : 31 et suivantes ; Clot et al., 1995 ; Menu et al., 1993 : 426–432).Dans ce groupe se trouvent des prélèvements de Tito Bustillo et de La Lloseta, caverne sœur liéeavec la première pour des raisons topographiques, chronologiques, culturelles et artistiques(Balbín Behrmann et al., 2005).
4.3.1.1. Échantillon 1a. Pigment rouge du premier disque peint sur la paroi au dessus de la zonefouillée par A. Moure dans l’ensemble XI de l’entrée ancienne. Ce disque est formé par unemanche de couleur rouge intense, dont le contour a été effacé. Dans la composition del’échantillon se trouve un petit gastéropode fragmenté, qui devait avoir été mouluintentionnellement. La calcite est prédominante et il y a peu d’hématites (Planche 1 [1]).
4.3.1.2. Échantillon 4a. Colorant rouge violacé extrait de la vulve centrale et principale del’ensemble III ou Camarín de las Vulvas. Il a été obtenu de la même manière que pourl’échantillon précédent, après avoir moulu des agrégés botryoïdes d’hématites, très purs, avec depetites proportions de calcite et de quartz (Planche 1 [2]).
4.3.1.3. Échantillon 8a. Pigment rouge violacé de la vulve située à gauche de la principale dansl’ensemble III. Il s’agit d’un agrégé de particules ferreuses cimentées par un carbonate calcique,d’organisation similaire aux précédentes, de couleur légèrement plus obscure. Dans ce cas, il a
R. de Balbín Behrmann, J.J.A. González / L’anthropologie 113 (2009) 559–601572
Fig. 4. Plan général de la grotte de Tito Bustillo avec la situation des ensembles.Plan of the cave of Tito Bustillo with the situation of the ensembles.
été impossible de déterminer l’agglutinant, mais les caractéristiques observées coïncident aveccelles de ce groupe (Planche 1 [2]).
4.3.1.4. Échantillon La Lloseta 1a. Pigment rouge extrait de la stalagmite peinte au fond de lagalerie principale, en forme de symbole phallique. La calcite est majoritaire dans sa composition,avec de petites proportions de quartz et de phyllosilicates, de petites particules d’oxydes de fer etun agglutinant gras (Planche 1 [3]).
Le groupe est aussi uni par la présence d’hématite moulue, parfois très pure, à laquelles’ajoutait de la calcite, parfois sous forme de coquillage animal. Sa couleur est rouge intense et aété utilisée pour les vulves de l’ensemble III, le disque de l’ensemble I et la stalagmite phalliquede La Lloseta. La chronologie archéologique de ces représentations est ancienne, autant pour ledisque que pour les représentations sexuelles féminines de Tito Bustillo, qui trouvent leurcontrepoint dans la représentation masculine de La Lloseta. Les figures de l’ensemble III sontsimilaires à la figure féminine, qui se trouve à la base des représentations du panneau principalqui appartient pleinement aux phases les plus anciennes de la réalisation de graphies dans lacaverne (Planche 1 [4]).
Si l’assignation chronologique que nous donnons au groupe est adéquate, comme nous lepensons, la rareté occasionnelle des hématites est liée avec la rareté des colorants en général,puisque les objets se trouvent souvent dans les zones de transit et sont les plus anciens de lacaverne. La fréquentation et le frôlement avec la peinture seraient spécialement évidents dans lecas du phallus peint de La Lloseta, par où il fallait passer obligatoirement pour accéder à ladernière salle de cette caverne.
4.3.2. Groupe 2Formé par un seul prélèvement.
4.3.2.1. Échantillon 1a bis. Colorant prélevé en dessous du panneau des mégacéros de lazone XE, à droite du panneau principal. Il s’agit d’une boule de couleur rouge avec desgrains de quartz et de possibles restes de coquillage agglutinés par de l’argile avec de lacalcite, du quartz et des phyllosilicates, et de faibles quantités d’hématites. Il se trouvaiten dessous d’un panneau stylistiquement ancien. Il présente des similitudes et desdifférences avec le groupe 1, notamment la présence de coquillage et d’un agglutinant gras.Sa couleur est similaire au pigment qui recouvre la partie inférieure du panneau mais est plusclaire que la peinture des mégacéros dont les restes de colorants sont très rares et sontrecouverts par une couche de calcite qui empêche le prélèvement direct d’un échantillon(Planche 1, Fig. 5).
Nous avons séparé cet échantillon des antérieurs parce qu’il ne correspond pas pleinementavec eux. Il possède en effet une quantité d’hématite faible, et du quartz et des phyllosilicates,inclus dans une matrice d’argile avec des restes de coquillages et un agglutinant de graisseanimale. Il existe donc une différence appréciable avec le groupe 1, mais nous pensons que leurssimilitudes sont plus marquées encore. La couleur correspond avec une couche rouge qui sesurimpose sur les figures de mégacéros de la zone XE du Panneau Principal qui doivent êtreanciens comme l’indiquent les facteurs archéologiques. La couleur de la couche rouge coincide,d’autre part, avec les caractéristiques du groupe 1, ce qui fait que son classement dans celui-ci neserait pas contradictoire.
R. de Balbín Behrmann, J.J.A. González / L’anthropologie 113 (2009) 559–601 573
R. de Balbín Behrmann, J.J.A. González / L’anthropologie 113 (2009) 559–601574
Planche 1. Échantillon 1a sur les disques de la paroi du gisement de l’ensemble XI de Tito Bustillo. Échantillons 4a et 8adu Camarín de las Vulvas, ensemble IV de Tito Bustillo. Échantillon LL.1a pris sur le phallus de La Lloseta, ensemble X.Figure féminine du Panneau Principal de Tito Bustillo, pareille à celles du Camarín de las Vulvas. Échantillon 1a bis prisde la base des mégacéros du Panneau Principal de Tito Bustillo.Sample 1a on the discs of the wall at the ensemble XI of Tito Bustillo. Samples 4a and 8a from the Camarín de las Vulvas,ensemble IV Tito Bustillo. Sample LL.1a took on the phallus of La Lloseta ensemble X. Female figure in the Main Panel ofTito Bustillo, similar to those of Camarín de las Vulvas. Sample 1a bis taken in the basis of the megaceros, Main Panel ofTito Bustillo.
4.3.3. Groupe 3Nous incluons dans ce groupe tous les échantillons dont la composition semble les rapprocher
de la grande zone de colorants de l’ensemble XI, malgré l’existence de variantes intéressantescomme cela est normal.
4.3.3.1. Échantillon 2a. Pigment rouge provenant de la patte arrière du bison peint dans le blocNord de la Plazuela de los Bisontes, à côté d’une sculpture de bison. Il se compose de particuleslimeuses de couleur marron rouge avec de la calcite comme composant principal et desphyllosilicates et de faibles quantités de quartz et d’hématite (Planche 2 [1]).
4.3.3.2. Échantillon 3a. Colorant noir extrait de la fesse du bison antérieur. Il s’agit d’une argileferrugineuse, avec de la calcite comme composant principal et avec des phyllosilicates et depetites quantités de quartz et d’hématite. La différence de couleur est due à l’addition demanganèse qui produit l’obscurcissement (Planche 2 [1]).
4.3.3.3. Échantillon 4a bis. Pigment rouge du dos du grand bison premier du panneau VII del’ensemble XI. Il s’agit de particules de couleur rouge cimentées par des carbonates. La calciteest le principal minéral identifié avec des phyllosilicates, du quartz et des traces de goetite etd’hématites (Planche 2 [1]).
4.3.3.4. Échantillon 5a. Colorant rouge extrait du sol situé sous le grand bloc à partir duqueldevaient avoir été peintes les figures du panneau Sud de l’ensemble XI. Une fois de plus, il s’agitd’une argile rouge qui contient de la calcite, suivie de quartz, de phyllosilicates et d’hématites. Il
R. de Balbín Behrmann, J.J.A. González / L’anthropologie 113 (2009) 559–601 575
Fig. 5. Échantillon 6a de la plateforme de colorant à l’ensemble XI de Tito Bustillo.Sample 6a of the platform dye, ensemble XI Tito Bustillo.
R. de Balbín Behrmann, J.J.A. González / L’anthropologie 113 (2009) 559–601576
Planche 2. Échantillons 2a, 3a, 7b, et 9a, venus de la Plazuela de los Bisontes de l’ensemble XI de Tito Bustillo.Échantillons 4a bis et 8b, pris de la paroi sud de l’ensemble XI de Tito Bustillo. Échantillon 5a du colorant de l’ensembleXI de Tito Bustillo. Échantillon 20a sur la paroi de l’ensemble I de Tito Bustillo. Échantillon 21a venant du pied duPanneau Principal de Tito Bustillo, secteur Xb.Samples 2a, 3a, 7b, and 9a, from the Plazuela de los Bisontes, ensemble XI Tito Bustillo. Samples 4a bis and 8b, taken atthe southern wall of the ensemble XI of Tito Bustillo. Sample 5a from the dye of the ensemble XI of Tito Bustillo. Sample20a on the wall of ensemble I, Tito Bustillo. Sample 21a from the ground of the Main Panel of Tito Bustillo, sector Xb.
existe cette fois un élément différent qui est la smectite qui s’ajoute à la base commune de tous leséchantillons de la salle (Planche 2 [3]).
4.3.3.5. Échantillon 6a. Pigment rouge provenant du grand bloc depuis lequel devaient avoirété peintes les figures du panneau Sud de l’ensemble XI. Il s’agit d’une argile rouge sous unecroûte de calcite. Ses composants principaux sont la calcite, le quartz, des phyllosilicates et defaibles indices d’hématites (Fig. 5).
4.3.3.6. Échantillon 7a. Pigment rouge extrait du pilon trouvé in situ aux pieds de l’ensembleXI. Argile de couleur marron rouge cimentée avec du carbonate calcique. Ses composantsbasiques sont ceux habituels : calcite, quartz et traces d’hématites (Fig. 6).
4.3.3.7. Échantillon 9a. Fragment d’un bloc de pigment recueilli sous le bison deséchantillons 2a et 3a. Il est de couleur jaune et sa composition est de quartz, calcite ethématites. Le bloc du bison sculpté situé dans cette zone a été peint avec cette même couleur(Planche 2 [1]).
4.3.3.8. Échantillon 20a. Colorant rouge extrait du rebord supérieur de l’ensemble I en formede manche oblong. Il possède une couleur marron rouge pâle et est composé de calcite, quartz,phyllosilicates et hématites (Planche 2 [4]).
4.3.3.9. Échantillon 21a. Colorant extrait du sol situé sous le panneau XB. Il est composéfondamentalement par de l’argile et des phyllosilicates (Planche 2 [5]).
R. de Balbín Behrmann, J.J.A. González / L’anthropologie 113 (2009) 559–601 577
Fig. 6. Échantillon 7a extrait du pilon au pied de l’ensemble XI de Tito Bustillo.Sample 7a extracted from the grinder at the basis of the ensemble XI of Tito Bustillo.
R. de Balbín Behrmann, J.J.A. González / L’anthropologie 113 (2009) 559–601578
Planche 3. Échantillon 3b extrait du fond du puit de la Galería de los Antropomorfos de Tito Bustillo. Échantillons 4b et5b venants de la partie supérieure de la Galería de los Antropomorfos de Tito Bustillo. Échantillon 17a extrait d’un descailloux de la fouille de l’ensemble XI de Tito Bustillo. Échantillon 18a extrait d’autres cailloux de la fouille del’ensemble XI de Tito Bustillo. Échantillon 9b qui provient de la possible figure de cheval de l’intérieur de l’alcôve 1 del’ensemble XI. Échantillons 10b, 11b, 12b et 13b, de la Cantera de Colorante à la partie supérieure de l’ensemble XI deTito Bustillo.Sample 3b extracted from the bottom of the pit in the Galería de los Antropomorfos, Tito Bustillo. Samples 4b and 5b comingfrom the upper part of the Galería de los Antropomorfos, Tito Bustillo. Sample 17a excerpt from one of the stones in theexcavation of the ensemble XI, Tito Bustillo. Sample 18a extracted from other stone in the excavation of the ensemble XI, TitoBustillo. Sample 9b comes from the possible horse figure from inside the alcove 1 of the ensemble XI, Tito Bustillo. Samples10b, 11b, 12b, and 13b of the Cantera de Colorante in the upper part of the ensemble XI of Tito Bustillo.
4.3.3.10. Échantillon 3b. Provient de la Galería de los Antropomorfos et contient des particulesde carbonates avec de l’argile rouge, de la calcite et des oxydes de fer comme l’hématite et lagoetite. Il est en rapport avec l’échantillon suivant et avec le 7b qui proviennent de l’ensemble XI,ce qui nous indique l’utilisation des mêmes pigments, probablement à la même époque (Planche3 [1]).
4.3.3.11. Échantillon 4b. Obtenu de la zone supérieure de la Galería de los Antropomorfos, ils’agit d’un agrégé de grains de carbonate calcique agglutinés avec de l’argile avec un fort contenuen oxydes de fer et de manganèse. Il possède dans sa composition de petites quantités de nickel etde cuivre, de manière très similaire à l’échantillon 3a présenté ci-dessus où la couleur noires’obtient par l’addition de manganèse à une préparation qui, sans ce dernier, serait rouge (Planche3 [2]).
On pourrait dire la même chose de la couleur noire présente sur les pilons des échantillons 17aet 18a, qui se composent de phosphates et de carbonate calcique, avec un haut contenu en oxydesde fer et de manganèse (Planche 3 [3 et 4]).
4.3.3.12. Échantillons 5b et 7b. Nous devons aussi inclure ici à ces deux échantillons, l’und’eux obtenu de la partie supérieure de la Galería de los Antropomorfos et l’autre provenant dubison peint sur la roche Nord de la Plazuela de los Bisontes de l’ensemble XI. Texture, couleur etcomposition sont en tout similaires : un agrégé très poreux de grains d’argile sparitiqueagglutinés avec de petites quantités d’argiles illitiques ferrugineuses (Planche 2 [1] et Planche 3[2]).
4.3.3.13. Échantillons 8b et 9b. Avec leurs particularités, ces deux échantillons provenant del’ensemble XI ne discordent pas non plus. Le premier provient de la bosse du grand bison dupanneau VII Sud et le second probablement de la figure de cheval de l’intérieur de l’alcôve 1 dumême ensemble XI. Les deux sont formés par un agrégé de particules de carbonates agglutinéesavec de petites proportions d’argile ferrugineuse, avec de la calcite comme élément principal, depetites quantités de phyllosilicates et d’hématite ou goetite (Planche 2 [2] et Planche 3 [5]).
4.3.3.14. Échantillons 10b, 11b, 12b et 13b. Tous proviennent de ce que nous appelons laCantera de Colorante, qui se trouve dans la partie supérieure de l’ensemble XI. Ils ont tous encommun la provenance et une possible préparation conjointe et une série de caractéristiquespétrographiques. Il s’agit de fragments de pierre calcaire de couleur rouge jaune pâle avec desveines de couleur rouge foncé dans les zones de fracture fraîche. Leur structure interne est de typebrechoïdal avec de la matière argileuse et des oxydes de fer en petites concentrations qui peuvents’utiliser comme colorant (Planche 3 [6]).
Ils possèdent aussi en commun la présence de coquillages pulvérisés d’échinodermes,foraminifères, brachiopodes et autres éléments vivants, qui constituent une part de leurcomposition et qui peuvent avoir servi dans la préparation du colorant, en tant que présencenaturelle ou comme préparation intentionnelle, ce qui nous paraît plus probable.
4.3.3.15. Échantillons 14b et 16b. Ces deux échantillons sont aussi similaires, bien que lepremier provienne de la peinture pariétale, très faible et indéchiffrable dans sa conservation, del’alcôve 3 de l’ensemble XI et que le numéro 16 provienne de la Cantera de Colorante de la partiesupérieure de cette même salle. Ils se composent de roche calcaire, argileuse sparitique
R. de Balbín Behrmann, J.J.A. González / L’anthropologie 113 (2009) 559–601 579
R. de Balbín Behrmann, J.J.A. González / L’anthropologie 113 (2009) 559–601580
Planche 4. Échantillon 14b de la Plazuela de los Bisontes de l’ensemble XI de Tito Bustillo. Échantillon 16b de la Canterade Colorante à la partie supérieure de l’ensemble XI de Tito Bustillo. Échantillons 17b et 18b sur des cailloux de la fouillede l’ensemble XI de Tito Bustillo. Plan de l’ensemble XI avec la situation de la Cantera de Colorante. ÉchantillonsS.V.1 et S.V.2 du panneau 48 à Siega Verde. Échantillon S.V.3 du panneau 89 à Siega Verde. Échantillon S.V.4 dupanneau 46 à Siega Verde. Vue générale du panneau 15 de Siega Verde de l’autre côté de la rivière Agueda.Sample 14b of the Plazuela de los Bisontes, ensemble XI of Tito Bustillo. Sample 16b of the Cantera de Colorante from theupper part of the ensemble XI of Tito Bustillo. Samples 17b and 18b on the stones from the excavation of the ensemble XI ofTito Bustillo. Plan of the ensemble XI with the situation of the Cantera de Colorante. Samples S.V.1 and S.V.2, panel 48 ofSiega Verde. Sample S.V.3, panel 89 of Siega Verde. Sample S.V.4, panel 46 of Siega Verde. Overview of the panel 15 ofSiega Verde from the other side of the river Agueda.
néomorphe, avec du quartz, des phyllosilicates et de faibles quantités de goetite et d’hématites(Planche 4 [1 et 2]).
4.3.3.16. Échantillons 17b et 18b. Ils proviennent de la petite caverne intérieure de l’ensembleXI, 17b qui présente une zone de couleur rouge possédant dans sa composition du quartz, deshématites, des phyllosilicates et des traces de gypse et de calcite. Les oxydes de fer sont dispersésen forme de grains. Sur les peintures rouges, il y a d’autres zones noires, semblables auxprécédentes mais sans hématite et avec plus de calcite et de gypse (Planche 4 [3]).
La partie noire de l’échantillon 17b correspond bien avec celle du 18b et possède une matricenoire avec des restes d’une structure qui proviendrait sans doute de bois carbonisé, en plus dephosphates qui pourraient correspondre à de l’os calciné qui accompagnerait les restes de boiscarbonisé et d’autres restes d’argile avec du manganèse. Les sources de la couleur noire sont donctrois et concourraient dans ce cas à l’obtention de la couleur finale.
4.3.3.17. Échantillon 19b. Il provient aussi de l’ensemble XI et concrètement de la zone de lapetite caverne du côté Nord-Ouest. Sa composition est argileuse, de couleur rouge intense et sesminéraux principaux sont la calcite, le quartz, les hématites, le gypse et les phyllosilicates. Desrestes significatifs de phosphates apparaissent aussi, pour des raisons similaires à celles deséchantillons précédents, c’est-à-dire dû à la pulvérisation de dents et d’os. Dans ce cas, il s’agitbien de dents, identifiées par la présence d’une lamelle de hydroxiapatite, caractéristique del’émail dentaire (Fig. 7).
Ce troisième groupe est formé par les prélèvements des ensembles I, X, IV-V et XI, avec delégères variantes et une grande similitude, due à l’utilisation de la source de colorant naturel quiexiste dans l’ensemble XI. La base commune est une argile avec de faibles quantités d’hématites
R. de Balbín Behrmann, J.J.A. González / L’anthropologie 113 (2009) 559–601 581
Fig. 7. Échantillon 19b sur une plaque de la fouille de l’ensemble XI de Tito Bustillo.Sample 19b on a plate of the excavation in the ensemble XI of Tito Bustillo.
qui, dans tous les cas, montre une grande proportion de calcite et d’autres éléments enproportions variables comme le quartz et les phyllosilicates. Les différences individuelles sontmoindres et ne contredisent pas la tonalité générale du groupe qui provient de la carrière del’ensemble XI sans grandes transformations. Aucun cas n’a montré la présence d’un agglutinantgras, ce qui pourrait indiquer sa non utilisation dans ce groupe. La composition des peinturesappliquées sur les parois (les échantillons 2a, 3a et 4a bis) est très similaire à celle de beaucoupdes pigments non appliqués (5a, 6a et 7a).
Le style des peintures qui possèdent ce colorant rouge dans l’ensemble XI est tardif. Il s’agitde bichromies qui doivent appartenir au style IV ancien de Leroi-Gourhan ou à un Magdalénienassez avancé. Cependant, leur conservation générale est plus mauvaise que celle du groupe 1,plus ancien et en quelques zones est franchement très mauvaise. Tout ceci semble être dû à lapréparation moins soignée du colorant et à l’absence d’un agglutinant gras.
Toutes les figures de l’ensemble XI ne sont pas rouges, ni tous les colorants. Nous avons despigments jaunes, qui apparaissent apparemment à l’état naturel dans la Cantera de Colorante.L’utilité de ces échantillons est à venir, puisque pour le moment, aucune figure pariétale peinte enjaune n’a été prélevée car, lorsqu’elle apparaît, elle est très effacée, avec peu de pigment, ce quiest insuffisant pour l’échantillonnage.
La question des agglutinants mérite que l’on s’y arrête un moment, bien que nous sachionsqu’il s’agit d’un sujet qu’il faudra étudier dans le futur. Tous les échantillons présentent uncomposant principal qui est la calcite, qui apparaît en proportions variables, parfoisprédominante mais toujours en quantité notable. La base des supports des peintures est lacalcite, l’existence de ce composant n’est pas surprenante. De plus, les surfaces intérieures de lacaverne sont en contact continu avec l’humidité, de là la possible formation de couches calciques.
Malgré ceci, et étant donné que nous connaissons le système de prélèvement des échantillonset la sélection réalisée, il y a des raisons suffisantes pour penser que la calcite forme partieintentionnellement de la préparation du colorant, comme matrice solide pour donner consistanceà la pâte. Ceci expliquerait la présence de coquillages pulvérisés dans quelques échantillons et lerôle assigné à la calcite qui apparaît, comme nous l’avons indiqué, dans tous les prélèvements.Les différences entre les oligoéléments des échantillons du groupe 3 pourraient être dues, pourautant, non seulement aux divers lieux de la carrière où les pigments furent extraits, mais aussi àla possible sélection et préparation de ceux-ci que nous savons avoir eu lieu dans la zonesupérieure de l’ensemble XI.
Dans les échantillons 17b et 18b, de couleur noire, apparaissent des restes d’os brûlé, et dans le19b, de couleur rouge, des restes de dent pulvérisée. La fonction de l’os brûlé peut être la mêmeque celle du charbon végétal, mais la présence de dent semble avoir le même sens que lescoquillages et l’os aussi pouvait avoir eu un rôle similaire.
Au vu des analyses, la couleur noire peut s’obtenir de diverses façons, depuis l’incorporationde manganèse à un mélange rouge, comme dans les cas de 4b et 3a, jusqu’à une compositiontripartite de charbon végétal, de charbon d’os brûlé, découvert par la présence de phosphates etd’argile avec du manganèse, ce qui implique trois sources différentes de colorants qui se trouventdans le même espace. En contraste, la présence réitérée de noir sur noir suppose un procédédifférent.
La peinture de la Cantera de Colorante a été utilisée de façon indiscutable dans l’alcôve 3 del’ensemble XI, mais ce n’est pas le seul lieu où elle semble avoir été employée. Elle apparaît eneffet dans la Galería de los Antropomorfos, où l’accumulation existante dans sa partie hauteprovient de notre carrière. Ceci est aussi le cas du bison peint sur la roche verticale Nord de laPlazuela de los Bisontes de l’ensemble XI, qui répète une composition similaire à celle de
R. de Balbín Behrmann, J.J.A. González / L’anthropologie 113 (2009) 559–601582
l’ensemble IV-V dans les échantillons 5b et 7b. La relation réelle entre les deux espaces pourraitaussi indiquer une relation chronologique en certains moments déterminés.
En Tito Bustillo, il y a deux manières principales de composer un mélange pictural, lapremière avec un agglutinant gras, comme c’est le cas dans les représentations que nous classonsdans les étapes les plus anciennes, Aurignaciennes et Gravettiennes, Styles I et II, et la secondequi semble dissoudre les components avec de l’eau et qui est utilisée pour les figures les plusavancées, Magdaléniennes, Style IV. Ceci signifie que ces deux formules semblent appartenir àdes moments précis, avec la particularité que la capacité de conservation des peintures les plusanciennes est souvent meilleure que celle des peintures les plus récentes. La matrice de calcitedes colorants, avec diverses variantes, est présente tout au long du temps.
4.4. L’éventail de couleurs
Comme nous l’avons indiqué, dans Tito Bustillo, la couleur violette correspond à un Mn avecune petite quantité d’oxyde de fer (Fortea et Hoyos, 1999 : 239). Il nous semble que les mélangesréalisés dans notre caverne sont plus simples encore, puisqu’ils font abstraction d’agglutinant, quimalheureusement seulement peut s’étudier avec une quantité d’échantillon importante. La couleurviolette si caractéristique de Tito Bustillo apparaît avec sa tonalité naturelle dans la Cantera deColorante située dans l’ensemble XI de l’entrée de la caverne originelle, aux côtés d’autres tonscomme le rouge vermillon, le pourpre, le jaune et l’orange, qui peuvent tous s’appliquerdirectement sans grandes transformations pour obtenir des variations de tonalité ou de couleur.
La couleur violette, caractéristique de Tito Bustillo, qui est un trait distingué de sapersonnalité, n’implique pas une préparation spéciale ni un mélange préconçu, sinon l’utilisationsimple et directe de l’une des couleurs qui sont présentes sous forme naturelle dans la carrière quise trouve au fond de l’ensemble XI. La variété de couleurs de notre caverne est donc à l’image decelle qui existe à l’intérieur.
4.5. La représentation spatiale
Toujours dans Tito Bustillo, les représentations les plus anciennes se trouvent concentréesdans des espaces concrets et délimités de l’intérieur de la caverne, tandis que les plus récentestendent à la décoration de tous les espaces que nous connaissons. Ceci semble indiquer quel’utilisation de l’intérieur de la caverne, au moins en ce qui concerne l’aspect graphique, a changéau cours du temps, passant de la concentration en peu de sites restreints à la décoration totale. Onpourrait argumenter que l’on ne peut pas affirmer ce que l’on ne connaît pas, dans le sens quenous ne connaissons pas bien les éléments qui furent représentés dans les époques les plusanciennes et il existe une possibilité claire de perte d’information au cours du temps. Il paraîtcependant, pour ce que nous avons affirmé antérieurement, que les peintures les plus anciennesfurent réalisées avec un agglutinant gras, assurant de cette façon leur longue durabilité. Ainsi, lespeintures conservées devraient correspondre aux lieux où elles étaient appliquées originellement.
Cet argument est viable, mais incomplet, parce que nous ne savons pas si toutes les peinturesanciennes employaient un agglutinant gras ou seulement certaines et nous ignorons enconséquence la capacité de conservation de l’ensemble ancien complet. En tous cas, notreproposition est seulement une hypothèse bien qu’elle paraisse être viable et nous permette depenser à la possibilité que différents endroits des cavernes furent utilisés selon les époques,faisant un usage plus complet de la caverne dans les époques les plus récentes, toujours du pointde vue graphique.
R. de Balbín Behrmann, J.J.A. González / L’anthropologie 113 (2009) 559–601 583
4.6. La Cantera de Colorante
Nous avons appelé Cantera de Colorante (« carrière de colorant ») la zone la plus haute del’ensemble XI et aussi la plus éloignée des excavations de celui-ci, qui se situe au-dessus desautres sur une plateforme supérieure où le toit et le sol forment un angle aigu (Planche 4 [4],Fig. 8) Il s’agit d’une surface inclinée vers le Sud qui contient un amas de pierres qui peut être misen relation avec le chaos central de la salle. Dans au moins trois cas, ces pierres possèdent dessurfaces zénithales planes qui furent utilisées dans le passé pour organiser, composer, couper etmodeler les grands fragments de terre rouge et d’autres tons ocres, spectre complet des couleursemployées dans la caverne de Tito Bustillo. Au-dessus de cette accumulation de pierres se trouveune surface lisse inclinée apparemment naturelle avec toutes les variétés d’ocre citées.
Nous avons topographié le site et analysé une partie de ses composants qui s’étendent jusqu’àla partie inférieure du même ensemble XI et qui furent utilisées aussi dans le Panneau Principal etdans la Galería de los Antropomorfos. Toute la caverne devait trouver dans ce site les pigmentsnécessaires, qui furent exploités selon les nécessités et préférences du groupe. Cette grandequantité de couleur fut sans doute importante pour la décoration pariétale, des objets et despersonnes, en plus d’être une richesse naturelle du site qui put être utilisée pour des relations etéchanges. Dans ce sens, nous analysons maintenant des échantillons provenant de La Lloseta etdu Sud du bassin du Sella, comme El Buxu o La Güelga, en collaboration avec l’équipe de
R. de Balbín Behrmann, J.J.A. González / L’anthropologie 113 (2009) 559–601584
Fig. 8. Plan général des ensembles de Siega Verde.General plan of the ensembles of Siega Verde.
l’UNED dirigée par Mario Menéndez, avec l’objectif de comparer leurs composants etd’analyser les possibles relations culturelles et groupales dans ce milieu géographique(Menendez, 2003 ; Balbín Behrmann et Alcolea González, 2008 ; Balbín Behrmann et al., souspresse ; Pascua et al., 2005).
5. Siega Verde et les colorants à l’air libre
La couleur, comme nous l’avons indiqué, joue un rôle important dans toute création graphiquepariétale, qu’elle soit souterraine ou à l’air libre. En effet, les différences de couleur avaient uneplace important dans la représentation, autant en peinture qu’en gravure. Mais à l’air libre, ce quipeut s’observer aujourd’hui est presque exclusivement la gravure comme si les pratiques àl’extérieur étaient différentes des pratiques à l’abri, comme si à l’extérieur il était seulementpossible de graver alors que peindre eut été facile et probablement fréquent, mais notre capacitéde le vérifier est maintenant limitée.
Le cas de Faia est particulièrement indicatif. Nous avons répété déjà plusieurs fois (AlcoleaGonzález et Balbín Behrmann, 2006a, 2006b ; Balbín Behrmann, 1995, 2001, 2002 ; BalbínBehrmann et Santonja, 1992 ; Balbín Behrmann et al., 1991, 1994, 1995, 1996a, 1996b), que laplupart des figures du Côa appartiennent à des moments anciens du développement de l’artpaléolithique, Styles II et III de Leroi-Gourhan, Gravettien-Magdalénien Ancien dans lachronologie des matériaux. Les fouilles de Fariseu (García et Aubry, 2002 ; Mercier et al., 2006 ;Aubry et Sampaio, 2009) ont démontré que les gravures pariétales avaient été réalisées déjà dansle Gravettien, ce qui permettait, sans recourir à une extrapolation excessive, de proposer unechronologie stylistique pour la plupart du Côa dans les époques que nous avions déjà indiquées.Faia serait simplement la version peinte de ce monde, ou au mieux, la version qui conservait lapeinture, puisque la non-existence de celle-ci sur le reste des figures ne signifie pas qu’elles ne lapossédaient pas à l’origine. En effet, Faia bénéficie d’une protection rocheuse qui a permis laconservation de la couleur en contraste avec le reste du Côa.
Mais les autres figures du fleuve portugais ne furent pas crées pour être cachées de la vue desgens, mais pour être vues et pour annoncer des messages culturels et groupaux. Toutes ne sont pascomplètement évidentes mais d’autres ne laissent pas de doute comme celles de Ribeira dePiscos, situées à une dizaine de mètres du cours du fleuve sur une paroi lisse visible à plus demille mètres de distance. Si nous imaginons l’aspect d’antan à ces figures de plus d’un mètre dehauteur, les gravures seraient de couleur presque blanche sur un fond marron foncé, ce quidonnerait aux figures la possibilité d’être vues à distance. Si en plus nous imaginons les figuresdans leur contour peint, chose qui n’est pas démontrée mais n’est pas non plus absurde, lestaureaux seraient visibles à plus d’un kilomètre, fonctionnant à la perfection comme un marqueurterritorial visible et manifeste.
Toutes les figures ne sont pas les mêmes, ni dans le Côa, ni en Siega Verde. Il y en a des pluspetites et des plus grandes, des lignes incises ou piquetées, plus ou moins visibles, mais au site deSiega Verde, il y a des ensembles qui seraient parfaitement visibles depuis l’autre rive du fleuveAgueda et même depuis la plaine qui le domine (Planche 4 [8]). Si à ces formes, on ajoute lacouleur de la gravure, leur visibilité serait très bonne depuis une grande distance. Dans le cas deSiega Verde, où se trouve l’unique gué de ce secteur du fleuve, toute la partie centrale du site estcouverte d’une couleur rouge intense qui fonctionnerait comme un signal visuel additionnel.Nous ne prétendons pas que cette couleur fut d’application artificielle ; ce n’est pas nécessaire.Une fois de plus, les graphistes utilisèrent les caractéristiques naturelles du lieu pour transmettreleur message et pour le rendre visible dans le paysage.
R. de Balbín Behrmann, J.J.A. González / L’anthropologie 113 (2009) 559–601 585
En se basant sur notre expérience de Tito Bustillo, les pigments semblent provenir del’environnement le plus proche, comme c’est le cas de la Cantera de Colorante dans la caverneasturienne. En Siega Verde, les schistes sont ferrugineux de sorte que, entre leurs couches,apparaissent des couleurs rouges intenses relativement abondantes. Cette abondance est extrêmedans le centre du site, ensembles X à XIII (Fig. 8) et semble supérieure à ce que l’on pourrait espérerd’une concentration naturelle. Cette zone serait en tous cas un bon endroit pour extraire les pigmentspour les utiliser comme peinture pariétale et corporelle. Le colorant pourrait être naturel, mais cecine l’empêcherait pas de constituer une caractéristique attractive du site et d’avoir été utilisé pourpeindre, résultant dans la même composition de la peinture et de la roche. Ceci trouverait uneréponse dans le cas où l’on pourrait identifier une manipulation du pigment naturel, en tant quecharge ou agglutinant, mais malheureusement ceux-ci n’ont pas été identifiés pour le moment.
Aussi, sur la base de notre expérience en Tito Bustillo, nous pouvons dire que dans beaucoupde cas le colorant préparé possède une base d’oxydes de fer, principalement de goetite oud’hématites, à laquelle s’ajoutait une charge de matière généralement calcique et dans le cas depeinture noire, un ingrédient additionnel comme le charbon végétal ou le manganèse. Cecisignifie que, bien que le procédé ne puisse pas être présenté comme un fait universel, nous savonsque dans le site asturien, la couleur noire correspond à la même préparation que la rouge, dans laplupart des cas, avec l’addition de pigments noirs qui lui donnent sa couleur finale.
En Siega Verde, nous avons analysé quatre échantillons en 2007 que nous détaillons ci-dessous.Comme dans le cas de Tito Bustillo, les analyses ont été réalisées par Jose Vicente Navarro Gascónde l’Instituto del Patrimonio Histórico Español du ministère de la Culture espagnol.
5.1. Échantillon 1
Colorant du panneau 48. Particules de couleur noire. La totalité des particules noiresexaminées correspond à des grains d’ilménite (TiO3Fe) avec des inclusions de quartz provenantde la roche de support qui ne peuvent donc pas être considérées comme une pigmentationdélibérée.
Particules de couleur rouge. De même que dans le cas précédent, les particules examinéessemblent correspondre à la roche de support. Elles montrent des textures clairementmétamorphiques et constituent des lamelles de phyllosilicates entre lesquelles se trouventdes minéralisations d’oxydes de fer associées à des structures laminaires. Associées aux oxydesde fer se trouvent de petites quantités de phosphore et, parfois, des traces de monazite. Quelquesunes des particules possèdent en plus des traces de soufre, d’arsenic et de cuivre (Planche 4 [5]).
5.2. Échantillon 2
Chevaux du panneau 48. Il s’agit d’une particule du substrat de schiste sur lequel s’observeune pellicule rouge. Dans la section stratigraphique obtenue, peuvent s’observer des restes d’uneéventuelle couche, mal définie, constituée par des oxydes de fer et du manganèse avec desphyllosilicates et une proportion élevée de phosphore. Le signal élevé détecté dans la lignespectral de l’aluminium est aussi notable (Planche 4 [5]).
5.3. Échantillon 3
Chevaux du panneau 89. Constitué par un matériel complètement désagrégé duquel desparticules de coloration rouge ont pu être séparées pour l’étude. Dans les deux cas, les images
R. de Balbín Behrmann, J.J.A. González / L’anthropologie 113 (2009) 559–601586
BSE obtenues permettent de constater qu’il s’agit d’une minéralisation de la roche de support,qui contient des oxydes de fer associés à des espaces intergranulaires de la roche ouinterlaminaires dans les muscovites. Des particules de phosphate de thorium apparaissentponctuellement associées aux oxydes de fer. Comme c’est le cas dans les échantillons précédentsla présence de petites quantités de P, pas toujours associées aux éléments rares (monazites), c’estune constante (Planche 4 [6]).
5.4. Échantillon 4
Panneau 46. Éclat de pierre avec un recouvrement ou une patine uniforme de couleur gris ocrefoncé, de type schiste. La section stratigraphique étudiée montre la présence d’une couchesuperficielle, très régulière et uniforme, dont la grosseur est de 45 à 60 mm et qui se caractérise parun contact net avec la roche du support (schiste). En interne, elle présente des bandes finesdéfinies par de légères variations compositionnelles. Dans quelques secteurs de l’échantillon, lazone centrale présente une texture plus poreuse. Le principal composant identifié dans lesmicroanalyses de cette couche est le dioxyde de manganèse qui est accompagné par desproportions variables de matériel argileux (Si, Al, K, Fe) et, de façon constante, par de faiblesquantités de phosphates (P). La présence de ce dernier élément pourrait être en rapport avecl’identification, dans quelques cas, de petites quantités de Ca (apatite ?) (Planche 4 [7]).
Une première observation nous permet de dire que tous les échantillons contiennent depetites et variables quantités d’argile et les trois premiers des oxydes de fer (Fig. 9). Ces oxydesde fer sont considérés dans les analyses comme une partie de la minéralisation de la roche etdonc comme un produit naturel associé à celle-ci. Comme nous le disions, les pigments quis’appliquent sur les roches, autant dans les cavernes qu’à l’air libre, proviennent généralementdes espaces proches des sites graphiques, quand ils existent dans ce milieu. La zone centrale dusite possède une concentration de colorants rouges exceptionnelle, dont l’origine doit êtrenaturelle, mais qui a pu être transformée. En tous cas, c’est un lieu probable d’origine de tout lecolorant nécessaire, qui une fois utilisé aurait comme seule différence la présence d’un élémentnouveau dans sa composition, comme agglutinant ou un autre élément exogène. Ici, nous nepouvons pas parler d’agglutinants puisque la taille des échantillons n’a pas permis leurdétection, mais nous pouvons seulement parler de colorants qui existent à l’état naturel dans lesite.
Au moins dans trois des cas, nous avons des restes d’argile dans la composition et, sur la basede nos expériences avec les matériaux des cavernes, nous savons que c’est précisément l’argile,avec d’autres types de composants, selon les cas, qui est la base du mélange utilisé pour peindre.Ceci ne confirme pas que les échantillons correspondent à une application de colorant préparé,
R. de Balbín Behrmann, J.J.A. González / L’anthropologie 113 (2009) 559–601 587
Fig. 9. Les analyses des colorants du gisement au plein air de Siega Verde.Analysis of colors from the outdoors site of Siega Verde.
mais n’exclut en aucun cas cette possibilité, puisque leur composition entre parfaitement dans lesvariables que nous connaissons dans les cavernes, avec des pigments presque toujours locaux.
Les échantillons no 2 et 4 possèdent d’autres indices que nous devons interpréter. La premièrecontient des oxydes de fer et du manganèse avec des phyllosilicates. Si elle procédait d’unecaverne, nous dirions qu’il s’agit simplement d’un échantillon de couleur normale qui possèdeune charge variée dans une matrice argileuse et qui varie en couleur entre le rouge et le noir selonla quantité plus grande ou plus faible de manganèse. C’est-à-dire, comme ci-dessus nous disionsde Tito Bustillo, que le rouge et le noir s’obtiennent par l’addition de charbon végétal ou demanganèse à un mélange de base constitué d’argile et d’oxydes de fer, le même dans le deux cas.Dans le cas de l’échantillon no 4, il existe une présence notable d’argile et d’un composantabondant et clairement exogène qui est le dioxyde de manganèse qui forme une couche decouverture sur la roche de support. Il s’agit donc d’une couleur noire appliquée artificiellement,mélange d’argile et d’oxyde de manganèse avec un faible contenu en oxyde de fer, mais qui n’estpas si différent de l’échantillon no 2. Dans les deux cas, nous pouvons conclure qu’il s’agitd’applications conscientes de colorants sur la paroi, dans le premier cas sur les lignes piquetéesqui dessinent les figures des deux chevaux principaux du panneau et dans le second cas, commebase de préparation de la roche sur laquelle s’effectuèrent des gravures et des peintures.
Reprenant l’exemple du site du Côa, où a été constatée pour la première fois la présence decouleur dans les ensembles à l’air libre, il faut conclure que la peinture à l’extérieur existait, maisn’a laissé que de rares traces. En Côa, dans les lignes de contour des figures de bovidés, en SiegaVerde dans les gravures et aussi en dehors, préparant une base qui rendrait plus visibles les figuresgravées et en quelques cas peintes. Combien de cas existe t’il ? Nous ne le savons pas parce queleur identification est particulièrement difficile sur des surfaces qui ont été lavées durantplusieurs millénaires par les agents atmosphériques, mais les données dont nous disposons nouspermettent de dire que cette formule existait et, selon nous, de façon généralisée.
6. Récapitulation
La révision d’un siècle de recherche sur la composition, l’utilisation et l’application descolorants de l’Art Rupestre Paléolithique nous conduit à une récapitulation et une réflexioncritique. Dans ce but, nous nous servons des calculs généraux sur l’ensemble analysé, sous laforme de trois cadres de résumé dédiés aux analyses françaises et espagnoles respectivement(Fig. 1, 2 et 9).
En premier lieu, la palette de pigments utilisée par les gens du paléolithique se confirme,validant les suppositions du XX
e siècle. Les couleurs noires sont obtenues principalement par desoxydes de manganèse, qui sont variables dans un même ensemble. Ces oxydes de manganèsefurent toujours utilisés comme peinture, dissouts dans un agglutinant dont on ignore la naturedans la plupart des cas et furent souvent mélangés avec une charge ou matrice qui, dans la plupartdes sites, s’obtenait des agrégés argileux qui à leur tour contenaient de la quartzite, de la calcite eten quantités plus petites des éléments rares (feldspaths, biotites, gypse, etc.). L’utilisation decharbon est moins fréquente. Dans ce cas, la peinture obtenue par la dissolution et l’addition dematières de matrice (argiles en Ekain ou Lascaux, feldspath et biotite en Niaux) coexiste avecl’application de pigment pur sous forme de fusain.
Les couleurs rouges dépendent exclusivement des oxydes de fer, entre lesquels prédominentles hématites qui se sont seulement substitués dans quelques cas à des oxydes rares comme labixbisite (Pergouset) ou combinés avec de la goetite. L’application de la couleur rouge semble selimiter à la peinture, dissoute et presque toujours avec une charge ajoutée, sauf dans le cas de
R. de Balbín Behrmann, J.J.A. González / L’anthropologie 113 (2009) 559–601588
Gargas. Les rouges ne diffèrent donc pas des couleurs noires, entre lesquelles prédominent lesmatrices argileuses obtenues dans beaucoup de cas de l’intérieur même des cavernes décorées.D’autres couleurs comme les jaunes, marrons ou violets, semblent dépendre aussi de la présenced’oxydes de fer. Les jaunes sont fabriqués à partir d’un mélange de goetite et d’argile, tandis queles couleurs violettes peuvent provenir des hématites (Lascaux), de mélanges d’oxydes ferreuxavec du manganèse ou de terres violacées (Tito Bustillo).
Les couleurs rouges et noires ne sont pas incompatibles car elles coexistent dans beaucoup desites et de manière notable à Tito Bustillo où la base de leur composition est souvent la même, sedistinguant par l’addition du composant fondamental qui rend le mélange noir : le manganèse, lecharbon végétal ou les deux à la fois.
La représentation aussi forte des hématites pourrait cependant être déterminée par laprovenance, non pas de filons naturels sinon d’un procédé de transformation artificiel de lagoetite, plus abondante dans la nature. Ce procédé, qui implique un échauffement à plus de 3008(Pomiés et al., 1999 : 506) semble probable dans le site magdalénien-azilien de Moulin deTroubat. Les données indiquent l’échauffement accidentel de la goetite en présence de feux avecun fort contenu en matière organique (Pomiés et al., 1999 : 515), comme ceux identifiés dans lesfoyers de la zone d’habitation, tandis que les pigments analysés sur des galets peints ne présententaucun signe d’échauffement intentionnel (Pomiés et al., 1999 : 515). D’autre part, les analysesactuelles de quelques ensembles (Lascaux) ont écarté l’échauffement des pigments naturels(Pomiés et al., 2000 : 25 ; Chalmin et al., 2004 : 589 ; Vignaud et al., 2006 : 497), d’ailleurs,d’autres auteurs semblent eux aussi rejeter cette possibilité.
Il existe un modèle dans l’élaboration des colorants paléolithiques qui montre une structurerépétitive de fabrication. Celle-ci se compose de pigment pur, d’un agglutinant dans le cas despeintures et, dans la plupart des cas, d’une charge ou matrice qui servait à créer une pâte decouleur et à moduler sa fluidité, son aspect et ses propriétés adhésives.
Le concept de charge du colorant est peut-être le plus complexe et difficile à analyser à causedu manque d’unité méthodologique et aussi de la pratique fréquente de jugements d’intentionsqui prétendent discriminer entre ce qui est accidentel et ce qui est intentionnel. Un coup d’œil auxFig. 1 et 2 suffit pour observer que selon la publication certains types de composants sont traitésindistinctement comme impureté ou comme charge. Ceci est évident dans le cas de l’argile, lequartz, la calcite et l’apatite. Le premier est un matériel très abondant dans les cavernes et dont ila prouvé qu’il était extrait dans quelques cas dans des endroits très proches des parois décoréespour être mélangé à des pigments purs (Ekain). Pour cette raison, le traiter comme unecontamination provenant de la paroi est improbable et, surtout, difficile de démontrer. D’autrepart, un pourcentage très élevé des échantillons présente des aluminosilicates dans leurcomposition, ce qui indiquerait plus probablement l’utilisation fréquente de ceux-ci commematrice des pigments et non pas une contamination générale des peintures. Le problème de lacalcite est pratiquement le même et sa présence dans les échantillons ne doit pas être attribuéeautomatiquement à une contamination naturelle, comme nous l’avons déjà commenté dans unautre travail (Balbín Behrmann et al., 2003 : 148).
Le quartz et l’apatite sont généralement exclus de la charge intentionnelle des colorants etqualifiés de sous-produits de la préparation, introduits durant le travail des pigments sur dessupports lithiques ou par les ustensiles employés pour mélanger la peinture. Nous avons traité leproblème de l’apatite ci-dessus, concluant que l’on ne peut pas écarter l’addition volontaire dematière organique moulue aux charges des pigments. Les cas du quartz et de la silice ressemblenten quelque sorte à ceux de l’argile ou de la calcite. Dans quelques cas, ils sont acceptés commecharge du colorant mais dans d’autres leur présence est attribuée aux impuretés introduites durant
R. de Balbín Behrmann, J.J.A. González / L’anthropologie 113 (2009) 559–601 589
la préparation du pigment. Il n’est pas bon d’affirmer ce que l’on ignore et dans la quasi-totalitédes cas analysés, nous ignorons les chaînes opératoires qui convertirent le pigment brut enpoudre, donc, qualifier les particules de quartz comme sous-produits de cette activité n’est autrechose qu’une hypothèse et probablement pas la meilleure.
Tous ces problèmes nous font penser que la confection des matrices des colorants peut avoirincorporé des éléments variés de façon intentionnelle ou généralisée. Il s’agit de matières qui ontprouvé leurs propriétés comme amalgame solide du pigment et elles sont abondantes etaccessibles. Nous pensons que les colorants se basent sur des matériaux faciles à obtenir,généralisés dans les milieux rupestres, comme les argiles et les sous-produits de l’activitékarstique. La norme serait la création de matrices stables utilisant ces éléments, auxquelless’ajouteraient d’autres matières plus rares (dents et coquillages à Tito Bustillo, ambre à Altamira)ou difficiles à obtenir (talc, gypse, etc.), selon les nécessités ou préférences dans chaque cas.L’exception, comme le démontre la Fig. 1, serait les recettes à base d’éléments plus sophistiqués,comme celles identifiées dans le Magdalénien pyrénéen.
Presque tous les chercheurs ont traité le processus de l’élaboration picturale comme celui danslequel le pigment pur est altéré ou non par d’autres composants pour obtenir le produit final. Pournous, le processus pourrait parfois être inverse, c’est-à-dire qu’en premier lieu, seconfectionnerait une matrice solide avec les propriétés adhésives et couvrantes nécessaires,et après, celle-ci serait dotée de la capacité de pigmentation grâce à l’addition de pigments purs.Ces matrices pourraient servir pour tous les types de couleurs, ce qui expliquerait leurgénéralisation indépendante de la couleur choisie, et aussi le fait que, comme nous disions ci-dessus, quelques colorants montrent des pigments contradictoires (Figs. 1 et 2), comme c’est lecas à Font-de-Gaume et La Mouthe (Moissan, 1902, 1903), Pergouset (Smith et al., 2001 : 176),Lascaux (Vignaud et al., 2006 : 486), Arenaza (Gárate et al., 2004 : Table 2) ou Pech-Merle(Guineau et al., 2001 : Table 1) et aussi à Tito Bustillo.
Le dernier aspect est celui de l’utilisation scientifique des analyses de colorants. Il est évidentque l’étude de la matière colorante est une aide pour comprendre les processus de création desensembles rupestres paléolithiques, mais aussi, comme nous l’avons commenté ci-dessus, qu’il aexisté certain degré de précipitation dans les conclusions. Les données déjà classiques desrecettes pyrénéennes semblaient pouvoir présenter un tableau de l’évolution des utilisationstechniques rupestres en même temps qu’elles nuançaient la chronologie de l’art paléolithique. Cetableau n’a pas été confirmé et les données obtenues dans d’autres zones de France ou deCantabrique n’ont pas suivi le chemin tracé dans les Pyrénées, offrant des modes plus générauxde construction comme cela peut se voir dans des sites aussi lointains dans le temps et l’espaceque Arcy-sur-Cure, Arenaza ou Ekain. Ces modes basiques s’expriment avec beaucoup denuances, fruits du manque de standardisation des systèmes unis à la tradition groupale. De plus, lefait que les diverses recettes ou pots de peinture de quelques sites (Lascaux, Arenaza)s’appliquent simultanément sur une même figure empêche ceux-ci de fonctionner comme desmarqueurs chronologiques et culturels. Au contraire, ces systèmes indiquent des stratégiesdiverses que les peintres paléolithiques adoptèrent dans chaque cas pour surmonter leursproblèmes techniques.
La réalité artistique paléolithique à l’air libre est notablement plus pauvre. Pour le moment,nous disposons seulement des récentes analyses de Siega Verde, que suggèrent des possibilitésdiverses mais intéressantes. En plus de la probable utilisation du contexte naturel du site, sousforme de couleur rouge massive en sa zone centrale, il y a des argiles et des oxydes de manganèseet de fer. Si nous suivons le modèle général que nous avons obtenu des cavernes, cette présenceserait normale et selon nous, intentionnelle, et implique un comportement similaire pour la
R. de Balbín Behrmann, J.J.A. González / L’anthropologie 113 (2009) 559–601590
fabrication de la couleur, qui se transforme dans chaque cas concret en celui voulu par laprédominance de rouge ou de noir. Même dans l’échantillon no 4 du site de Salamanque, laprésence de composants rouges et noirs existe avec une claire prédominance du noir et uneapplication extensive sur la paroi qui semble se comporter comme base pour la peinture et lagravure de figures. Celle-ci est sa principale originalité, mais il faut aussi tenir compte que,s’agissant d’un site fait pour être vu à l’air libre, l’utilisation maximum des possibilités et le jeuavec le clair-obscur ne sont pas surprenants.
En dedans et en dehors, les gens du paléolithique jouaient avec les possibilités expressives dela couleur, sous diverses apparences, mélanges, composants, agglutinants et matrices. Ce quenous connaissons à l’extérieur est bien peu, mais ces premières analyses offrent un chemin quitrace un parallèle avec les gens des cavernes, sous la forme d’une démonstration réitérée d’unmême comportement social et graphique. L’avenir nous dira si nous nous dirigeons dans la bonnedirection.
7. Analyse des échantillons provenant du site archéologique de Siega Verde(prélèvements de Septembre 2005)
7.1. Données identificatrices de l’oeuvre
� Dénomination : Siega Verde ;� Caractère : Pierre et pigments ;� Datation/attribution : Paléolithique Supérieur ;� Provenance : Salamanca ;� Communauté Autonome : Castilla y León ;� Numéro de registre IPHE ;� Information sollicitée : Identification de pigments ;� Analyses sollicitées par : Rodrigo de Balbín. Universidad de Alcalá de Henares ;� Réalisé par : José V. Navarro Gascón ;� Date de réalisation : 26 novembre 2007 ;
7.2. Dénomination des échantillons
Description :
� Colorant. Panneau 48 ;� Chevaux. Panneau 48 ;� Chevaux. Panneau 89 ;� Panneau 46. Éclat de pierre avec recouvrement ou patine de couleur gris ocre foncée.
7.3. Techniques utilisées
Le procédé analytique suivit dans l’étude fut :
� l’examen sous loupe binoculaire du matériel reçu pour analyse et sélection de particules pourleur étude postérieure ;� l’inclusion des particules dans de la résine et préparation d’une section polie transversalement
aux structures présentes dans l’échantillon ;
R. de Balbín Behrmann, J.J.A. González / L’anthropologie 113 (2009) 559–601 591
� l’examen sous microscope optique de lumière réfléchie, employant une lumière visible (MO) ;� l’examen sous microscope électronique à balayage accouplé avec microanalyse par
spectrométrie de dispersion d’énergies de rayons X (MEB-EDE). Les analyses furentréalisées avec l’aide d’images de contraste compositionnel obtenues par le signal des électronsrétrodiffusés (images BSE1).
7.4. Résultats
7.4.1. Échantillon no 1L’examen sous la loupe binoculaire permit la sélection pour analyse de plusieurs particules de
couleurs rouge et noire. Comme l’échantillon se constituait de matériel très fin, les particulessélectionnées ne furent pas incluses dans de la résine et leur analyse se réalisa de façon directe aumoyen de la fixation des particules sur des disques adhésifs et conducteurs de carbone.
R. de Balbín Behrmann, J.J.A. González / L’anthropologie 113 (2009) 559–601592
Fig. 11. Microanalyse réalisée sur un grain d’ilménite.Microanalysis performed on a grain of ilmenite.
Fig. 10. Particule de ilménite avec des inclusions de quartz.Particle of ilmenite with inclusions of quartz.
7.4.2. Particules noiresToutes les particules noires examinées correspondent à des grains de ilménite2 (TiO3Fe) avec
des inclusions de quartz provenant de la roche de support qui ne peuvent pas se considérer commeune pigmentation intentionnelle et qui ne peuvent donc pas être considérées comme unepigmentation intentionnelle (Fig. 10 et 11).
7.4.3. Particules rougesComme dans le cas précédent, les particules examinées semblent correspondre à la roche de
support et montrent des textures clairement métamorphiques constituées par des lamelles dephyllosilicates entre lesquelles apparaissent des minéralisations d’oxydes de fer associées auxstructures laminaires.
Associées aux oxydes de fer apparaissent de faibles quantités de phosphore et dans quelquescas des traces de monazite 3. Quelques particules ont aussi montré des traces de soufre, d’arsenicet de cuivre (Fig. 12 et 13).
R. de Balbín Behrmann, J.J.A. González / L’anthropologie 113 (2009) 559–601 593
Fig. 12. Détail de particule de texture de type ardoise minéralisée avec des oxydes de fer.Detail of particle texture slate type mineralized with iron oxides.
Fig. 13. Détail de particule de texture de type ardoise minéralisée avec des oxydes de fer.Detail of particle texture slate type mineralized with iron oxides.
7.4.4. Échantillon no 2L’échantillon étudié correspond à une particule du substrat d’ardoise sur laquelle s’observe
une pellicule rouge.La section stratigraphique obtenue montre les restes d’une possible couche, mal définie,
constituée par des oxydes de fer et du manganèse, avec des phyllosilicates et une grandeproportion de phosphore. Le fort signal détecté dans la ligne spectrale de l’aluminium est aussinotable (Fig. 14 et 15).
7.4.5. Échantillon no 3Échantillon constitué par un matériel complètement désagrégé duquel des particules de
coloration rouge ont été séparées. Dans les deux cas, les images BSE obtenues permettent deconstater qu’il s’agit d’une minéralisation de la roche de support, avec des oxydes de fer associés
R. de Balbín Behrmann, J.J.A. González / L’anthropologie 113 (2009) 559–601594
Fig. 14. Image BSE de l’échantillon no 2 sur laquelle sont signalées les zones d’intérêt.BSE image of the sample No. 2 where they are indicated the interesting areas.
Fig. 15. Microanalyse réalisée sur les zones signalées avec des flèches dans l’image antérieure.Microanalysis performed on the areas indicated with arrows in the earlier image.
à des espaces intergranulaires de la roche ou interlaminaires des muscovites. Ponctuellement,apparaissent aux côtés des oxydes de fer des particules de phosphate de thorium.
Comme c’est le cas des échantillons précédents la présence de faibles quantités de P est uneconstante, même quand celui-ci n’est pas associé à des terres rares 3 (monazites) (Fig. 16–19).
R. de Balbín Behrmann, J.J.A. González / L’anthropologie 113 (2009) 559–601 595
Fig. 16. Image BSE d’une particule de l’échantillon S.V.3. Toutes les zones blanches qui s’observent sont enrichies enoxydes de fer. La zone signalée par un ovale est formée par des oxydes de fer et du phosphate de thorium qui cimentent lesgrains de quartz.BSE image of a particle in the sample S.V.3. All white areas found are enriched in iron oxides. The area indicated by anoval is formed by oxides of iron and thorium phosphate that cement the grains of quartz.
Fig. 17. Microanalyse réalisée sur les zones (muscovite) enrichies en oxydes de fer.Microanalysis performed on the areas (muscovite) enriched with iron oxides.
7.4.6. Échantillon no 4Éclat de pierre, de type ardoise, qui présente une patine uniforme de couleur gris ocre foncé.Dans la section stratigraphique étudiée, s’observe la présence d’une couche superficielle, très
régulière et uniforme, avec une grosseur de 45 à 60 mm, qui forme un contact net avec la roche de
R. de Balbín Behrmann, J.J.A. González / L’anthropologie 113 (2009) 559–601596
Fig. 18. Microanalyse réalisée sur une concentration d’oxydes de fer et de phosphate de thorium.Microanalysis carried out on a concentration of oxides of iron and thorium phosphate.
Fig. 19. Image BSE de la seconde particule étudiée de l’échantillon S.V.3, où s’observe l’abondance des oxydes de fer quiapparaissent dans les espaces laminaires associés de forme préférentielle aux muscovites.BSE image of the second studied particle of the sample S.V.3, where it is observed the abundance of iron oxides thatappear in the laminar areas associated preferably to muscovites.
R. de Balbín Behrmann, J.J.A. González / L’anthropologie 113 (2009) 559–601 597
Fig. 20. Image BSE générale de la section stratigraphique dans laquelle s’observe comment la couche superficielled’oxyde de manganèse sectionne en oblique les structures planes et linéales de l’ardoise. Sur le côté inférieur droits’observe un porphyroblaste tabulaire d’ilménite avec des inclusions de quartz.BSE image of the general stratigraphic section in which it can be observed how the surface layer of manganese oxide cutsin oblique the plan and the lineal structures of the slate. On the lower right-hand side, it is seen a tabular porphyroblasteof ilmenite with inclusions of quartz.
Fig. 21. Image BSE de détail de la couche superficielle d’oxyde de manganèse dans laquelle peut s’observer salamination intérieure et la présence de particules microscopiques et dissémines de barytine (points blancs).BSE image detail of the surface layer of manganese oxide, which may occur in its internal lamination, and the presence ofmicroscopic and disseminated particles of barite (white dots).
support (ardoise). Intérieurement, il présente des bandes fines définies par de petites variationscompositionnelles. Certains secteurs montrent une zone centrale de texture plus poreuse(Fig. 20).
Le principal composant identifié dans les microanalyses de cette couche est le dioxyde demanganèse qui s’accompagne de proportions variables de matériel argileux (Si, Al, K, Fe) et, deforme constante, de faibles quantités de P. La présence de ce dernier pourrait être en rapport avecl’identification, dans quelques cas, de petites quantités de Ca (apatite 4 ?). Similairement, laprésence dans toute la couche de particules disséminées de taille microscopique de barytine 5(sulfate de baryum) est très fréquente (Fig. 21 et 22) :
� Toutes les images incluses dans ce rapport furent obtenues par ce type de signal ;� L’ilménite apparaît dans l’échantillon du panneau 46 comme un minéral accessoire principal
de la roche de support, présentant des cristaux tabulaires avec des inclusions de quartz ;� Phosphates de terres rares (La, Ce, Th) ;� Dans la roche de support se trouvent de l’apatite et des traces de monazite (phosphate de
lanthane et cérium) ;� Dans la roche de support, il y a aussi de la barytine dans les espaces interlaminaires de quelques
uns des micas.
Remerciement
Nous remercions Ruth Taylor pour sa traduction du texte en français.
Références
Alcolea González, J.J., Balbín Behrmann, R., 2006a. Siega Verde y el Arte Paleolítico al aire libre del interior peninsular.In: Delibes, G., Diez, F. (Eds.), El Paleolítico Superior en la Meseta Norte española. Studia Archaeologica 94,Valladolid, pp. 41–74.
Alcolea González, J.J., Balbín Behrmann, R., 2006b. Arte paleolítico al aire libre. El yacimiento rupestre de Siega Verde,Salamanca. Arqueología de Castilla y León 16. Junta de castilla y León.
Alcolea González, J.J., Balbín Behrmann, R., 2007. C14 et style, La chronologie de l’art pariétal à l’heure actuelle.L’Anthropologie 111, 435–466.
R. de Balbín Behrmann, J.J.A. González / L’anthropologie 113 (2009) 559–601598
Fig. 22. Microanalyse réalisée sur la couche superficielle, sur les zones homogènes (a) et microporeuses (b). Laproportion de phyllosilicates est plus grande dans ce dernier cas.Microanalysis performed on the superficial layer, on the homogeneous (a) and microporous (b) areas .The proportion ofphyllosilicates is greater in the latter case.
Aubry, T., Sampaio, J.D., 2009. Chronologie et contexte archéologique des gravures paléolithiques de plein air de laVallée du Côa (Portugal). In: Balbín Behrmann, R. de (Ed.),Arte Prehistórico al aire libre en el Sur de Europa. Juntade Castilla y León, pp. 211–224.
Audouin, F., Plisson, H., 1982. Les ocres et leurs témoins au Paléolithique en France : enquête et expériences sur lavalidité archéologique. Cahiers du centre de Recherches Préhistoriques 8, 33–80.
Aujoulat, N., Chalmin, E., Vignaud, C., Geneste, J.M., Menu, M., 2002. Lascaux : Les pigments noirs de la Scène du Puits.In: Actes du Colloque des 10e Journées d’études de la Section Française de l’Institut International de Conservation(Paris, mai 2002). pp. 5–14.
Baffier, D., Girard, M., Menu, M., Vignaud, C., 1999. La couleur à la Grande Grotte d’Arcy-sur-Cure (Yonne).L’Anthropologie 103, 1–21.
Balbín Behrmann, R., 1995. L’art paléolithique à l’air libre de la vallée du Douro. Archéologia 313, 34–41.Balbín Behrmann, R., 2001. L’Art Paléolithique en plein air dans la Péninsule Ibérique : quelques précisions sur son
contenu, chronologie et signification. In: Zilhão, J., Aubry, T., Carvalho, A.F. (Eds.), Les premiers hommes modernesde la Péninsule Ibérique. Actes du Colloque de la Commission VIII de l’UISPP, pp. 205–236.
Balbín Behrmann, R., 2002. L’Art Rupestre Paléolithique de la Meseta. Une vision chrono-culturelle d’ensemble. In:Sacchi, D. (Ed.), L’art paléolithique à l’air libre. Le paysage modifié par l’image (Tautavel-Campôme, 7–
9 octobre 1999) GAEP, GEOPRE, Saint-Estève, pp. 139–157.Balbín Behrmann, R., Alcolea González, J.J. 2008. Arte mueble en Tito Bustillo: los últimos trabajos. Homenaje a Ignacio
Barandiarán. VELEIA, 24-25 131–159.Balbín Behrmann, R., de Alcolea González, J.J., González, M.A., 2003. El macizo de Ardines, Ribadesella, España. Un
lugar mayor del arte paleolítico europeo. In: Balbín Behrmann, R. de, Bueno Ramírez, P. (Eds.), Primer SymposiumInternacional de Arte Prehistórico de Ribadesella. Associación Cultural Amigos de Ribadesella, pp. 91–151.
Balbín Behrmann, R., de Alcolea González, J.J., Gonzalez, M.A., 2005. La Lloseta : une grotte importante et presqueméconnue dans l’ensemble des Ardines, Ribadesella. L’Anthropologie 109, 641–701.
Balbín Behrmann, R. de, Alcolea González, J.J., Santonja, M., 1994. Siega Verde y el arte rupestre paleolítico al aire libre.VI Coloquio Hispano-Ruso de Historia, Madrid (pp. 5–19).
Balbín Behrmann, R., de Alcolea González, J.J., Santonja, M., 1995. El yacimiento rupestre paleolítico al aire libre deSiega Verde (Salamanca, España): una visión de conjunto. Trabalhos de Antropologia e Etnología de Porto 35, 73–
102.Balbín Behrmann, R., de Alcolea González, J.J., Santonja, M., 1996a. Siega Verde. Un art rupestre à l’air libre dans la
vallée du Douro. Dossiers d’Archéologie 209, 98–105.Balbín Behrmann, R., de Alcolea González, J.J., Santonja, M., 1996b. Arte Rupestre Paleolítico al aire libre en la cuenca
del Duero: Siega Verde y Foz Côa. Fundación Rei Afonso Henriques, Serie monografías y estudios, Zamora.Balbín Behrmann, R., de Alcolea González, J.J., Santonja, M., Perez, R., 1991. Siega Verde (Salamanca). Yacimiento
artístico paleolítico al aire libre. In: Santonja, M. (Ed.), Del Paleolítico a la Historia. Museo de Salamanca,Salamanca, pp. 33–48.
Balbín Behrmann, R. de, Foyo, A., Alcolea González, J.J., Tomillo, C., Sanchez, M.A., Pascua, J.F., Gonzalez, M.A. Elmacizo de Ardines en el Paleolítico Superior: Organización de sus cavidades y yacimientos. I mesa redonda sobrepaleolìtico superior cantábrico: San Román de Candamo (Asturias) (sous presse).
Balbín Behrmann, R., Moure, A., 1982. El panel principal de la cueva de Tito Bustillo (Ribadesella, Asturias). ArsPraehistorica I 47–97.
Balbín Behrmann, R., Santonja, M., 1992. Siega Verde (Salamanca). El Nacimiento del Arte Europa. Catalogo de laExposición de la Unión Latina, Paris (pp. 250–252).
Ballet, O., Bocquet, A., Bouchez, R., Coey, J.M.D., Cornu, A., 1979. Étude technique des poudres colorées de Lascaux.In: Leroi-Gourhan, Ar., Allain, J. (Eds.), Lascaux inconnu. XII supplément à Gallia Préhistoire. Éditions du CNRS,Paris, pp. 171–174.
Breuil, H., 1974. Quatre cents siècles d’art pariétal. Les cavernes ornées de l’Âge du Renne. Max Fourny, Paris, réédition1974.
Brunet, J., Callede, B., Orial, G., 1982. Tarascon-sur-Ariège, grotte de Niaux : mise en évidence de charbons de bois dansles tracés Préhistoriques du Salon Noir. Studies in Conservation 27, 173–179.
Brunet, J., Vouvé, J., 1996. Las conservation des grottes ornées. Ministère de la Culture. Éditions du CNRS, Paris.Bueno Ramírez, P., Balbín Behrmann, R., de Barroso, R., 2008. Models of integration of Rock Art and megalith builders
in the International Tagus. Graphical Markers and Megalith Builders in the International Tagus, Iberian Peninsula.BAR International Series 1765, 5–15.
Buisson, D., Menu, M., Pinçon, G., Walter, P., 1989. Les objets colorés du Paléolithique supérieur : cas de la grotte de LaVache (Ariège). Bulletin de la Société Préhistorique Française 86, 183–191.
R. de Balbín Behrmann, J.J.A. González / L’anthropologie 113 (2009) 559–601 599
Cabrera, J.M., 1979. Les matériaux de peinture de la caverne d’Altamira. Actes de la cinquième réunion triennale ducomité de conservation de l’ICOM. Zagreb 1–9.
Chadefaux, C., Vignaud, C., Menu, M., Reiche, I., 2008. Multianalytical study of palaeolithic reindeer antler. Discoveryof antler traces in Lascaux pigments by tem. Archaeometry 50, 516–534.
Chalmin, E., Menu, M., Altuna, J., 2002. Les matières picturales de la grotte d’Ekain (Pays Basque, Espagne). Munibe 54,35–51.
Chalmin, E., Menu, M., Pomiés, M.P., Vignaud, C., Aujoulat, N., Geneste, J.M., 2004. Les blasons de Lascaux.L’Anthropologie 108, 571–592.
Chalmin, E., Menu, M., Vignaud, C., 2003. Analysis of rock art painting and technology of Palaeolithic painters.Measurement Science and Technology 14, 1590–1597.
Clot, A., Menu, M., Walter, Ph., 1995. Manières de peindre des mains à Gargas et Tibiran (Hautes-Pyrénées).L’Anthropologie 103, 221–235.
Clottes, J., 1994. L’Art pariétal en France : dernières découvertes. Complutum 5, 221–234.Clottes, J., Menu, M., Walter, Ph., 1990a. La préparation des peintures magdaléniennes des cavernes ariégeoises. Bulletin
de la Société Préhistorique Française 87, 170–192.Clottes, J., Menu, M., Walter, P., 1990b. New light on the Niaux paintings. Rock Art Research 7, 21–26.Couraud, C., Laming-Emperaire, A., 1979. Les colorants. In: Leroi-Gourhan, A., Allain, J. (Eds.), Lascaux inconnu. XII
supplément à Gallia Préhistoire. Éditions du CNRS, Paris, pp. 152–169.Delporte, H., 1980. Comments to ‘‘Red Ochre and Human Evolution: a case for discussion’’. Current Anthropology 21,
635–636.Fortea, J., 2000–2001. Los comienzos del arte paleolítico en Asturias: aportaciones desde una perspectiva contextual no
postestilística. Zephyrus 53/54, 177–216.Fortea, J., 2002. Trente neuf dates C14-SMA pour l’art pariétal paléolithique des Asturies. Bulletin de la Société
Préhistorique Ariège-Pyrénées LVII 7–28.Fortea, J., 2007. 39 edades 14C para el arte paleolítico rupestre en Asturias. Excavaciones Arqueológicas en Asturias 5,
91–102 (1999–2002).Fortea, J., Hoyos, M., 1999. La Table Ronde de Colombres et les études de protection et conservation en Asturies réalisées
de 1992 à 1996. Bulletin de la Société Préhistorique Ariège-Pyrénées 54, 235–242.Gárate, D., Jiménez, J.M., Ortiz, J., 2000–2002. El arte rupestre paleolítico de la cueva de Arenaza (Galdames, Bizkaia).
Kobie (Paleoantropología) 26, 5–64.Gárate, D., Laval, E., Menu, M., 2004. Étude de la matière colorante de la grotte d’Arenaza (Galdames, Pays Basque,
Espagne). L’Anthropologie 108, 251–289.García, M., 2001. Estudio de la materia colorante de las pinturas del Friso de las Pinturas. In: Montes, R., Sanguino, J.
(Eds.), La cueva de El Pendo. Actuaciones Arqueológicas 1994–2000. Ayuntamiento de Camargo-Consejería deCultura. Turismo y Deporte del Gobierno e Cantabria, Santander, pp. 223–231.
García, M., Aubry, Th., 2002. Grafismo mueble en el valle de Côa (Vila Nova de Foz Côa, Portugal): la estaciónarqueológica de Fariseu. Zephyrus 55, 157–182.
Guineau, B., Lorblanchet, M., Gratuze, B., Dulin, L., Roger, P., Akrich, R., et al., 2001. Manganese black pigments inprehistoric paintings: the case of the black frieze of Pech-Merle (France). Archaeometry 43, 211–225.
Labeau, M., 1993. New analysis of the Cougnac cave pigments. In: Lorblanchet, M., Bahn, P. (Eds.), Rock art studies: thepost-stylistic era or where do we from here? Oxbow monograph, Oxford, pp. 72–73.
Lorblanchet, M., 1996. Les grottes ornées de la Préhistoire. Nouveaux regards. Éditions Errance, Paris.Lorblanchet, M., Bahn, P.G., 1999. Diez años después de la ‘‘era post-estilística’’:
?
Dónde estamos ahora? In: Cacho,R., Gálvez, N. (Eds.), 32,000 BP: Una odisea en el tiempo. Reflexiones sobre la definición cronológica del arteparietal paleolítico. Revista de historia 6. Universidad de Cantabria, Santander, pp. 115–121.
Lorblanchet, M., Labeau, M., Vernet, J.L., 1988. Première étude des pigments des grottes ornées quercinoises. Préhistoirequercinoise 3, 79–94.
Lorblanchet, M., Labeau, M., Vernet, J.L., Fitte, P., Valladas, H., Cachier, H., et al., 1990a. Étude des pigments des grottesornées paléolithiques du Quercy. Bulletin de la Société des études du Lot 2, 93–143.
Lorblanchet, M., Labeau, M., Vernet, J.L., Fitte, P., Valladas, H., Cachier, H., et al., 1990b. Palaeolithic pigments in theQuercy, France. Rock Art Research 7, 4–20.
Menu, M., Walter, P., 1992. Análisis de la materia pictórica. In: Altuna, J., Apellaniz, J.M.,Barandiarán, I. (Eds.),Estudio delas pinturas de Zubialde (Alava). Resumen de los resultados. Diputación Foral de Alava, Vitoria-Gasteiz, pp. 61–64.
Menu, M., Walter, P., 1996. Les rythmes de l’art préhistorique. Techné 3, 11–23.Menu, M., Walter, P., Vigears, D., Clottes, J., 1993. Façons de peindre au Magdalénien. Bulletin de la Société
Préhistorique Française 90, 426–432.
R. de Balbín Behrmann, J.J.A. González / L’anthropologie 113 (2009) 559–601600
Mercier, N., Valladas, H., Aubry, T., Zilhão, J., Jorons, J.L., Reyss, J.L., et al., 2006. Fariseu: first confirmed open-airpaleolithic parietal art site in the Côa Valley (Portugal). Antiquity 80(310).
Moissan, H., 1902. Comptes Rendus de l’Académie des Sciences de Paris 134, 1536–1540.Moissan, H., 1903. Comptes Rendus de l’Académie des Sciences de Paris 136, 144–146.Navarro, J.V., 2003. Nuevos resultados obtenidos en el estudio de pigmentos y posibles materiales colorantes de las
pinturas de la cueva de Tito Bustillo. In: Balbín Behrmann, R., Bueno Ramírez, P. (Eds.), El Arte Prehistórico desdelos inicios del siglo XXI. Primer Symposium Internacional de Arte Prehistórico de Ribadesella, Ribadesella, pp. 173–
184.Navarro, J.V., Gómez, M.L., 2003. Resultados analíticos obtenidos en el análisis de pigmentos y posibles materiales
colorantes de las pinturas de la cueva de Tito Bustillo. In: Balbín Behrmann, R., Bueno Ramírez, P. (Eds.), El ArtePrehistórico desde los inicios del siglo XXI. Primer Symposium Internacional de Arte Prehistórico de Ribadesella. pp.161–172.
Paltchik, N.A., 1997. La radiographie des échantillons de l’ocre et des roches de la grotte Ignatievskaïa. In: Petrine, V.(Ed.), Le sanctuaire paléolithique de la grotte Ignatievskaïa à l’Oural du sud, 81. ERAUL, pp. 117–119.
Pascua, J.F., Balbín Behrmann, R., Alcolea González, J.J., Gonzalez, M.A., 2005. La cuenca del Sella en el PaleolíticoSuperior. Un espacio cultural. VI Reunión de Cuaternario Ibérico. Cuaternario mediterráneo y poblamiento dehomínidos. AEQUA (p. 78).
Pepe, C., Clottes, J., Menu, M., Walter, Ph., 1991. Le liant des peintures préhistoriques ariégeoises. Comptes Rendus del’Académie des Sciences de Paris 312, 929–934.
Pettit, P., Bahn, P.G., 2003. Currents problems in dating Palaeolithic cave art: Candamo and Chauvet. Antiquity 77, 134–
141.Pomiés, M.P., Barbaza, M., Menu, M., Vignaud, C., 1999. Préparation des pigments rouges préhistoriques par chauffage.
L’Anthropologie 103, 503–518.Pomiés, M.P., Menu, M., Vignaud, C., 2000. Lascaux, pigments préhistoriques à base d’oxydes de fer : hématite naturelle
collectée ou goethite chauffé. In: Goupy, J. (Ed.), Art et Chimie – La couleur. Actes du congrès. Éditions du CNRS,Paris, pp. 22–27.
San Juan, C., 1985. El uso del ocre y otros colorantes en la Prehistoria de Cantabria. Memoria de Licenciatura.Universidad de Cantabria, Santander (inédita).
Shee Twohig,E. 1981:The megalithic art of Western Europe.Oxford. 260p.,290 figs.,41 Pl.Smith, D.C., Bouchard, M., Lorblanchet, M., 2001. Analyse de pigments par Microscopie Raman. In: Lorblanchet, M.
(Ed.), La grotte ornée de Pergouset (Saint-Géry, Lot). Un sanctuaire secret paléolithique. Documents d’archéologiefrançaise. Maison des Sciences de l’Homme, Paris, pp. 174–180.
Vignaud, C., Salomón, H., Chalmin, E., Geneste, J.M., Menu, M., 2006. Le groupe des « bisons adossés » de Lascaux.Étude de la technique de l’artiste par analyse des pigments. L’Anthropologie 110, 482–499.
R. de Balbín Behrmann, J.J.A. González / L’anthropologie 113 (2009) 559–601 601