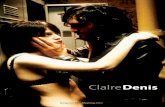Précis de philosophie des sciences (with Anouk Barberousse and Denis Bonnay, 2011)
-
Upload
xn--universit-lyon3-jnb -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Précis de philosophie des sciences (with Anouk Barberousse and Denis Bonnay, 2011)
T���� ��� ������
Les auteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
PREMIÈRE PARTIE
Philosophie générale des sciences
CHAPITRE I. L’explication scientifique (Denis Bonnay) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1. Le modèle déductif-nomologique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151.1 Expliquer, c’est déduire à partir d’une loi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151.2 Généralisation aux explications probabilistes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2. Les propriétés de l’explication (selon le modèle DN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232.1 Un modèle général de l’explication scientifique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232.2 Explication et prédiction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262.3 La temporalité de l’explication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272.4 Le problème des lois de la nature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3. Les limites du modèle déductif et comment les dépasser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333.1 Contre-exemples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333.2 À l’école des contre-exemples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373.3 Une théorie pragmatique de l’explication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
4. Deux théories de l’explication pour aller au-delà du modèle DN . . . . . . . . . . . . . . . . . 454.1 Les théories causales de l’explication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454.2 Les théories unificationnistes de l’explication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
5. Questions pour une théorie de l’explication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
CHAPITRE II. Confirmation et induction (Mikaël Cozic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
1. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621.1 Confirmation et théories de la confirmation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621.2 Confirmation et déduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631.3 Déduction et induction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641.4 Induction et confirmation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 661.5 Popper contre l’induction et la confirmation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 671.6 Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
2. Instancialisme et hypothético-déductivisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 692.1 Le paradoxe des corbeaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 692.2 Le paradoxe de Hempel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 702.3 L’instancialisme hempélien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 712.4 Difficultés de la théorie hempélienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732.5 Les théories hypothético-déductives de la confirmation (THDC) . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
3. Le bayésianisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 773.1 Degrés de croyance et calcul des probabilités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 773.2 La conditionnalisation et le théorème de Bayes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 793.3 Les justifications du bayésianisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
PP��indb 3 2 ���� 2���
I� PRÉCIS DE PHILOSOPHIE DES SCIENCES
4. La théorie bayésienne de la con%rmation (TBC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 814.1 Les différentes notions de confirmation de la TBC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 814.2 Quelques analyses bayésiennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 824.3 Les difficultés de la TBC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
5. Bayésianisme, objectivité et problème de l’induction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 915.1 Le problème de l’induction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 925.2 Quand Hume rencontre Bayes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
6. Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
CHAPITRE III. La causalité (Max Kistler) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
1. Russell et l’élimination du concept de causalité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1011.1 Le principe de causalité et la répétition des événements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1021.2 Les lois fonctionnelles des sciences mûres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1041.3 Les lois ceteris paribus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
2. La réduction de la causalité à l’explication déductive-nomologique . . . . . . . . . . . . 108
3. La conception contrefactuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
4. Méthodologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
5. La causalité comme processus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
6. L’analyse probabiliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
7. L’analyse en termes d’équations structurelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
8. Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
CHAPITRE IV. Le réalisme scientifique et la métaphysique des sciences (Michael Esfeld) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
1. Le réalisme scienti%que . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
2. La position privilégiée de la physique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
3. Quatre positions métaphysiques possibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
4. La portée philosophique de la physique quantique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
5. Le réalisme structural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
6. Structures catégoriques ou structures causales ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
7. Structures globales et structures locales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
8. Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
CHAPITRE V. Le changement scientifique (Anouk Barberousse et Marion Vorms) . . . . . . 171
1. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
2. Le changement scienti%que est-il continu ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1722.1 Le changement scientifique selon l’empirisme logique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1732.2 Les critiques historicistes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
3. Comment dé%nir le progrès scienti%que ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
4. Quel est le moteur du changement scienti%que ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1914.1 Popper et la falsifiabilité des théories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1924.2 Kuhn et la « tension essentielle » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1934.3 Nouvelles approches philosophiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
5. Le changement scienti%que est-il rationnel ? Est-il nécessaire ? . . . . . . . . . . . . . . . . 1975.1 L’argument du miracle en faveur du réalisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1975.2 Options antiréalistes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
����indb 4 �������� �����
TABLE DES MATIÈRES V
5.3 Options réalistes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025.4 L’irrationalité au cœur de la science. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
6. Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
CHAPITRE VI. Philosophie des sciences et études sur la science (Anouk Barberousse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
1. Introduction : un con*it violent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
2. Quelle est la meilleure méthode pour étudier la science ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2102.1 Un dilemme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2112.2 Des concepts historiquement situés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2162.3 Des études empiriques à tout prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2182.4 Les quatre principes du Programme fort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2202.5 Sortir par le haut de débats stériles ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
3. Comment prendre au sérieux le caractère intrinsèquement collectif
de l’activité scienti%que ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2253.1 L’épistémologie du témoignage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2273.2 Les relations de collaboration et la connaissance distribuée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2283.3 Connaissance située . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
4. Remarques conclusives : les relations de la philosophie des sciences
avec ses voisines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
CHAPITRE VII. Réduction et émergence (Pascal Ludwig) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
1. Émergentisme, pluralisme ontologique et surdétermination causale . . . . . . . . . . . 233
2. Réductionnisme classique, dualisme et émergentisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
3. La survenance et les formes minimales du physicalisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
4. Survenance et exclusion causale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
5. Versions du dualisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
6. L’émergence sans survenance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
7. Explications réductives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
8. L’échec du réductionnisme classique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
9. Fonctionnalisme et analyse conceptuelle : le physicalisme de type A . . . . . . . . . . . 256
10. Des implications a posteriori ? Le physicalisme de type B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
11. Conclusion : le physicalisme et les limites de la science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
DEUXIÈME PARTIE
Philosophie des sciences spéciales
CHAPITRE VIII. Philosophie de la logique (Philippe de Rouilhan)
Logique et contenu. Une introduction possible à la philosophie de la logique . . . 267
1. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2681.1 La logique au sens le plus large et la philosophie de la logique . . . . . . . . . . . . . . . . . 2681.2 Les paradoxes de l’indiscernabilité des identiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
2. La logique du sens et de la dénotation (LSD) (à partir de Frege,
via Church et Quine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2712.1 Frege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
����indb 5 �������� �����
�I PRÉCIS DE PHILOSOPHIE DES SCIENCES
2.2 Church . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2752.3 Quine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
3. La logique de la signi%cation et de la dénotation (LMD)
(à partir de la variante Quine de la LSD, via Kripke et Kaplan) . . . . . . . . . . . . . . . . 2803.1 Kripke, Kaplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2803.2 Un lien entre croyance de re et croyance de dicto ; le paradoxe de l’indiscernabilité
des identiques relatif aux attitudes propositionnelles et aux noms propres (second paradoxe de Ralph) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
3.3 Une simulation des opérateurs modaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
4. La logique de la signi%cation (LM) (à partir de la LMD,
via Russell et A. Smullyan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2854.1 De l’analyse éliminative des descriptions définies à la logique de la signification . . 2854.2 La double analyse des énoncés d’attitude propositionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2874.3 Le problème particulier des énoncés d’attitude conceptuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
5. Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2895.1 Considérations rétrospectives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2895.2 Considération prospective pour (ne pas) finir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
CHAPITRE IX. Philosophie des mathématiques (Denis Bonnay et Jacques Dubucs) . . . 293
1. Les mathématiques entre logique et intuition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2941.1 Vérités de raison ou généralisations empiriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2941.2 Une intuition sensible purifiée au fondement des jugements mathématiques ? . . . . 2961.3 La voie purement logique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
2. Finitisme et intuitionnisme, deux programmes antiréalistes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3022.1 La question de la cohérence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3022.2 Le finitisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3052.3 Conservativité et cohérence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3102.4 L’impact des résultats d’incomplétude de Gödel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3132.5 L’intuitionnisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
3. Pourquoi être réaliste ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3203.2 Réalisme sémantique et réalisme ontologique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3203.2 Réalisme et pratique des mathématiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3213.3 L’argument de l’indispensabilité des mathématiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
4. Variétés du platonisme et philosophie de la théorie des ensembles . . . . . . . . . . . . 3264.1 Platonisme faible et platonisme fort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3264.2 Intuition et succès . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3284.3 Ajouter de nouveaux axiomes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
5. Pourquoi ne pas être platoniste ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3345.1 Le dilemme de Benacerraf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3345.2 Arguments contre le platonisme faible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
6. Naturaliser le platonisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3396.1 Voyons-nous des ensembles ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3396.2 Structuralisme et intuition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3426.3 Arguments en faveur du structuralisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3446.4 Variétés du structuralisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
7. Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
����indb 6 �������� �����
TABLE DES MATIÈRES VII
CHAPITRE X. Philosophie de la physique (Anouk Barberousse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
1. Quelle est la nature de l’espace-temps ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3521.1 Les origines classiques du débat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3531.2 L’espace-temps à la lumière des théories de la relativité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
2. Qu’est-ce qu’un système déterministe ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3642.1 Quelques distinctions conceptuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3642.2 Une conception déflationniste du déterminisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
3. Quel sens ont les probabilités en physique ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3693.1 Les phénomènes macroscopiques : gouvernés par des lois statistiques et irréversibles 3703.2 Les corrélations quantiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
CHAPITRE XI. Philosophie de la biologie (Thomas Pradeu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378
1. Le statut de la théorie de l’évolution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
2. L’adaptation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383
3. Fonctions et téléologie en biologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
4. Le débat autour des unités de sélection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392
5. De l’œuf à l’adulte, de l’œuf à la mort : le développement des organismes . . . . . . 397
6. Le réductionnisme et la dé%nition du gène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
7. Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402
CHAPITRE XII. Philosophie de la médecine (Élodie Giroux) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404
1. Qu’est-ce que la philosophie de la médecine ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404
2. Les concepts de santé et de maladie : naturalisme versus normativisme . . . . . . . 4082.1 Les critiques du concept biomédical de la maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4092.2 La théorie bio-statistique (TBS) de Christopher Boorse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4102.3 Les critiques de la théorie bio-statistique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4152.4 Les alternatives à la théorie bio-statistique : approches pragmatiques . . . . . . . . . . . . 4172.3 Bilan et perspectives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421
3. Classi%cation, recherche causale et expérimentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4223.1 La classification des maladies et ses critères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4223.2 Recherche causale et expérimentation en médecine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4243.3 Inférence causale et multifactorialité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4283.4 Interprétation de la causalité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432
4. Quelle rationalité pour la clinique ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4354.1 Rationaliser le jugement clinique : la diversité des modèles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4354.2 La clinique : une science clinique, une science de la pratique clinique
ou une science humaine ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437
5. Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441
CHAPITRE XIII. Philosophie des sciences sociales (Jon Elster et Hélène Landemore) . . . 442
1. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442
2. Frontières des sciences sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4432.1 Obscurantisme mou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4442.2 Obscurantisme dur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4442.3 La théorie du choix rationnel est-elle la science du choix ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4452.4 Le tournant cognitif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446
����indb 7 �������� �����
�III PRÉCIS DE PHILOSOPHIE DES SCIENCES
3. Le statut des lois en sciences sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4473.1 L’explication en sciences sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4483.2 Les lois causales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4493.3 Lois conséquences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4513.4 Le futur des sciences sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454
4. L’individualisme méthodologique et la question du réductionnisme . . . . . . . . . . . . 4554.1 Définition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4564.2 L’objection anti-singulariste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4594.3 Les objections de Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4614.4 IM est-il incapable d’expliquer les phénomènes de masse irrationnels ? . . . . . . . . . 4624.5 IM, IP, IE et la question du libre-arbitre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4654.6 Le réductionnisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4654.7 Réductionnisme psychologique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4664.8 Les hypothèses de comportement rationnel et intéressé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468
5. Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472
CHAPITRE XIV. Philosophie de l’économie (Mikaël Cozic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473
1. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4731.1 La philosophie de l’économie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4731.2 L’économie « positive » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4741.3 La méthodologie de l’économie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480
2. Le déductivisme de Mill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4822.1 La méthode déductive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4822.2 Pourquoi avoir recours à la méthode déductive ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4832.3 Théorie et expérience selon la méthode déductive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485
3. L’économie comme science inexacte et séparée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4863.1 Approfondissement de la thèse d’inexactitude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4873.2 Révision de la méthode déductive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4883.3 Rejet de la thèse de séparation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4893.4 Discussion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4903.5 Clauses ceteris paribus, psychologie de sens commun et progrès de l’économie . . . 492
4. Tendances, capacités et idéalisations en économie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4944.1 Tendances et capacités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4944.2 Modèles économiques et idéalisations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4954.3 Discussion : les modèles comme mondes « crédibles » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496
5. Paul Samuelson, la théorie des préférences révélées et le réfutationnisme . . . . . 4985.1 La théorie de la préférence révélée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4985.2 Discussion de la sémantique de la préférence révélée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5005.3 Les « théorèmes opérationnellement significatifs » chez Samuelson . . . . . . . . . . . . . 5015.4 Réfutabilité et réfutationnisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503
6. Milton Friedman et le « réalisme » des hypothèses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5076.1 Le contexte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5076.2 Les thèses de Friedman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5086.3 Discussion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510
7. Économie expérimentale, économie « comportementale » et neuroéconomie . . . . 5117.1 L’économie expérimentale et ses objectifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5117.2 Questions méthodologiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5127.3 À la frontière de l’économie et des sciences cognitives : économie
comportementale et neuroéconomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515
8. Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517
����indb 8 �������� �����
TABLE DES MATIÈRES IX
CHAPITRE XV. Philosophie des sciences cognitives (Daniel Andler) . . . . . . . . . . . . . . 519
1. La structure de l’esprit : un programme de recherche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5201.1 De Gall à Fodor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5201.2 L’idée d’intelligence générale et ses difficultés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5261.3 Développement et innéisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5281.4 L’idée même de base neurale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5341.5 La distinction entre fonctions inférieures et supérieures et l’hypothèse
de la modularité massive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5361.6 La perspective évolutionniste en sciences cognitives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539
2. L’esprit comme objet de science : fondements et domaine des sciences
cognitives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5422.1 Qu’est-ce que fonder les sciences cognitives ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5422.2 Représentation et computation : le cadre fonctionnaliste et le langage de la pensée 5442.2.3 Le langage de la pensée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5492.3 Le rôle fondamental mais limité des modèles dans la recherche de fondements . . . 554
CHAPITRE XVI. Philosophie de la linguistique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572
1. Introduction : qu’est-ce que la linguistique ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5721.1 Les langues et le langage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5721.2 Les sciences du langage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574
2. Unités et règles : de la linguistique structurale à la grammaire générative . . . . . 5792.2 La conception saussurienne de la langue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5802.2 Productivité linguistique, compétence et performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5842.3 Une conception nouvelle de la syntaxe et de la phonologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5882.4 La révolution chomskyenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598
3. Description, explication et prédiction en linguistique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6013.1 Les trois niveaux chomskyens d’adéquation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6013.2 L’exemple du mouvement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6043.3 Comparaison des théories et confirmation des hypothèses en linguistique . . . . . . . 6083.4 Les explications historiques et leur limite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6163.5 Bilan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620
4. La notion d’universel linguistique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6214.1 Grammaire universelle, récursivité et compositionalité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6224.2 Différents types d’universaux linguistiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6274.3 L’explication des universaux linguistiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6324.4 Diversité linguistique, principes et paramètres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 636
5. Conclusion et perspectives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641
Références bibliographiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
����indb 9 �������� �����
L�� !"�!#�
Daniel Andler est professeur de philosophie des sciences et théorie de la connaissance à l’uni-versité Paris-Sorbonne, où il dirige l’équipe d’accueil « Rationalités contemporaines », et membre de l’Institut universitaire de France. Il a fondé en 2001 le département d’études cognitives à l’École normale supérieure. Spécialisé dans les fondements des sciences cognitives, il travaille en particulier sur l’interface entre ce domaine et les sciences sociales et la question du naturalisme. Il s’intéresse aussi à l’impact des sciences cognitives sur l’éducation. Il a notamment publié en collaboration une Introduction aux sciences cognitives (nouvelle édition, 2004) et Philosophie des sciences (2002).
E-mail : [email protected] Site web : http://andler.dec.ens.fr/
Anouk Barberousse est chargée de recherches au CNRS en philosophie des sciences et membre de l’Institut d’histoire et de philosophie des sciences et des techniques. Ses travaux portent, d’une part, sur la philosophie des systèmes complexes et de la simulation numé-rique et, d’autre part, sur les fondements de la théorie de l’évolution. Dernières publi-cations : « Computer simulation and experiments », avec Sara Franceschelli et Cyrille Imbert, Synthese 169(3), 557-574 , 2009, et « Pourquoi et comment formaliser la théorie de l’évolution ? » avec Sarah Samadi, in T. Heams, G. Lecointre, P. Huneman, M. Siberstein, 2009, Les Mondes darwiniens, Paris, Syllepse, coll. « Matériologiques », p. 245-264.
E-mail : [email protected] Site web : http://www-ihpst.univ-paris1.fr/4,anouk_barberousse.html
Denis Bonnay est maître de conférences au département de philosophie de l’université Paris-Ouest Nanterre, membre de l’Institut de recherches philosophiques et membre associé de l’Institut d’histoire et de philosophie des sciences et des techniques. Ses travaux se situent à l’intersection de la logique et de la philosophie, à la fois dans une perspec-tive épistémologique de réflexion sur la nature de la logique et des sciences formelles et dans une perspective d’application d’outils logiques en philosophie du langage et de la connaissance. Dernières publications : « Logicality and Invariance », Bulletin of Symbolic Logic, 14, 1, p. 29-68, 2008 ; « Inexact Knowledge with Introspection » (avec Paul Egré), Journal of Philosophical Logic, 38, p. 179-227, 2009, « Logical Consequence Inside Out » (avec D. Westerståhl) in Logical, Language and Meaning, M. Aloni et alii, « Lecture Notes in Computer Science », vol. 6042, Springer, 2010, p. 193-202.
E-mail : [email protected] Site web : http://lumiere.ens.fr/~dbonnay/
Mikaël Cozic est maître de conférences au département de philosophie de l’université Paris-Est Créteil-Val-de-Marne et membre de l’Institut d’histoire et de philosophie des sciences et des techniques, où il a la responsabilité de l’équipe « Décision, rationalité et interaction ». Ses travaux relèvent de la théorie de la décision, de la philosophie de l’économie et de
����indb 1 �������� �����
$ PRÉCIS DE PHILOSOPHIE DES SCIENCES
l’épistémologie formelle. Dernières publications : « Imaging and Sleeping Beauty », dans International Journal of Approximate Reasoning (Springer, à paraître), « Anti-réalisme, ratio-nalité limitée et théorie de la décision expérimentale », dans Social Science Information (SAGE-MSH), 48(1), mars 2009.
E-mail : [email protected] Site web : http://mikael.cozic.free.fr
Paul Égré est chargé de recherches au CNRS et membre de l’Institut Jean-Nicod. Ses travaux portent sur la philosophie de la connaissance, la logique, et la philosophie du langage. Depuis 2008, Paul Égré s’intéresse principalement au phénomène du vague dans le langage et dans la perception. Il est l’auteur de plusieurs articles récents sur la séman-tique des prédicats vagues, notamment « Vagueness, Uncertainty and Degrees of Clarity » (Synthese, 2010, en collaboration avec D. Bonnay) et « Tolerant, Classical, Strict » (Journal of Philosophical Logic, à paraître, en collaboration avec P. Cobreros, D. Ripley et R. van Rooij). Avec Dario Taraborelli, Christophe Heintz et Roberto Casati, Paul Egré est l’un des éditeurs et membres fondateurs de la revue internationale Review of Philosophy and Psychology (Springer).
E-mail : [email protected] Site web : http://paulegre.free.fr
Jon Elster est professeur titulaire de la chaire « Rationalité et sciences sociales » au Collège de France à Paris et professeur de sciences politiques et de philosophie à l’université de Columbia à New York. Il est membre de l’American Academy of Arts and Sciences, de l’Academia Europaea et de l’académie norvégienne des sciences ainsi que membre correspondant de la British Academy. Il est l’auteur ou l’éditeur de plus de trente-cinq ouvrages en français et en anglais traduits en dix-sept langues et portant, entre autres, sur Marx, Leibniz, Tocqueville, la philosophie des sciences sociales, la théorie du choix rationnel, la psychologie politique, la démocratie délibérative, et la justice de transition. Son dernier ouvrage sur la philosophie des sciences est Explaining Social Behavior : More Nuts and Bolts for the Social Sciences (Cambridge University Press, 2007). Il vient d’achever un Traité c ritique de l’homme économique en deux parties, dont le premier volume (Le Désintéressement, Seuil, 2009) explore la possibilité de l’action non intéressée et le second ( L’Irrationalité, Seuil, 2010) le rôle de l’irrationnel dans le comportement humain.
Michael Esfeld est titulaire de la chaire de philosophie des sciences de l’université de Lausanne. Il a publié deux livres en français : un sur la philosophie de l’esprit (Armand Colin, 2005), un autre sur la philosophie des sciences (Presses polytechniques et universitaires romandes, 2006, deuxième édition 2009). Il a reçu le prix Cogito en 2008 pour ses travaux en philosophie de la physique.
E-mail : [email protected] Site web : http://www.unil.ch/philo/page43600.html
Élodie Giroux est maître de conférences au département de philosophie de l’université Jean-Moulin Lyon 3 et membre de l’Institut de recherches philosophiques de Lyon. Ses travaux en philosophie de la médecine portent sur l’histoire et l’épistémologie de l’épidémiologie des facteurs de risque, sur l’analyse causale en épidémiologie et en médecine, et sur les concepts de santé et de maladie. Dernières publications : « Enquête de cohorte et analyse multivariée : une analyse épistémologique et historique du rôle fondateur de l’étude de
����indb 2 �������� �����
LES AUTEURS 3
Framingham », Revue d’épidémiologie et de santé publique, 56, 3, p. 177-188, 2008 ; « Définir objectivement la santé : une évaluation du concept bio-statistique de Boorse à partir de l’épidémiologie moderne », Revue philosophique, 134, 1, p. 35-58, 2009 ; Après Canguilhem : définir la santé et la maladie (PUF, « Philosophies », 2010).
E-mail : [email protected]
Max Kistler est professeur au département de philosophie à l’université Pierre- Mendès-France (Grenoble) et membre de l’Institut Jean-Nicod (Paris). Il est l’auteur de Causation and Laws of Nature (Routledge, 2006) et l’éditeur de trois recueils sur les dispositions (avec B. Gnassounou), ainsi que de numéros spéciaux de revues sur la causalité (Philosophie, 2006), la réduction et l’émergence (Synthèse, 2006), et sur la réduction de la cognition et les mécanismes (Philosophical Psychology, 2009). Ses recherches actuelles portent sur la causalité et sur la compatibilité des qualia avec le physicalisme.
E-mail : [email protected] Site web : http://max.kistler.free.fr/
Hélène Landemore est Assistant Professor en théorie politique au département de sciences poli-tiques de l’université de Yale. Formée à la philosophie en France (ENS Ulm, Sorbonne, Nanterre) et aux sciences politiques en France (Sciences-Po) et aux États-Unis (Harvard), elle est l’auteur d’une monographie sur Hume (PUF, 2004) et d’un article sur la théorie du choix rationnel (Journal of Moral Philosophy, 2004). Son travail actuel porte sur la notion d’intelligence collective appliquée à la justification de la démocratie. Dernières publi-cations : « La raison démocratique : les mécanismes de l’intelligence collective en poli-tique » (Raison publique, 12, 2010) et un volume collectif en anglais avec Jon Elster sur la notion de sagesse collective (Collective Wisdom : Principles and Mechanisms, Cambridge University Press, à paraître en 2011).
Pascal Ludwig est maître de conférences à l’université de Paris-Sorbonne, membre de l’équipe « Rationalités contemporaines ». Ses recherches portent sur la philosophie de l’esprit des sciences cognitives, plus particulièrement sur la place de l’expérience consciente dans le monde naturel, ainsi que sur la philosophie de la connaissance a priori. Il a récemment publié Kripke : référence et modalités (PUF, 2005), en collaboration avec Filipe Drapeau- Contim, ainsi que L’Individu (Vrin, 2008), un volume collectif codirigé avec Thomas Pradeu.
E-mail : [email protected] Site web : http://web.mac.com/cludwig/Site/Bienvenue.html
Thomas Pradeu est maître de conférences au département de philosophie de l’université Paris 4 Paris-Sorbonne et membre associé de l’IHPST. Ses recherches portent sur la philosophie de la biologie, et plus particulièrement sur la philosophie de l’immunologie. Publications récentes : (avec E. Carosella) « The self model and the conception of biological identity in immunology », Biology and Philosophy, 2006 ; (avec A. Barberousse et M. Morange, dir.) Mapping the future of biology. Evolving concepts and theories, Springer, 2009 ; Les Limites du soi. Immunologie et identité biologique, PUM et Vrin, 2009 ; (avec E. Carosella) L’Identité. La part de l’autre, Odile Jacob, 2010.
E-mail : [email protected] Site web : http://thomas.pradeu.free.fr
����indb 3 �������� �����
4 PRÉCIS DE PHILOSOPHIE DES SCIENCES
Philippe de Rouilhan est directeur de recherche au Centre national de la recherche scienti-fique (CNRS), et membre de l’Institut d’histoire et de philosophie des sciences et des techniques (IHPST, qu’il a longtemps dirigé) ; chargé d’enseignement et habilité à diri-ger des recherches à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ses travaux relèvent de la logique lato sensu ou, plus spécifiquement, de l’ontologie formelle, de la sémantique for-melle, de la philosophie de la logique, de la philosophie des mathématiques, de la philo-sophie du langage. Il travaille actuellement sur deux thèmes : 1°) vérité et conséquence logique ; 2°) logique hyperintentionnelle. Il est l’auteur de nombreuses publications, parmi lesquelles : Frege. Les paradoxes de la représentation, Minuit, 1988 ; Russell et le cercle des paradoxes, PUF, 1996 ; « On What There Are », Proceedings of the Aristotelian Society (2002) ; « The Basic Problem of the Logic of Meaning (I) », Revue internationale de philoso-phie (2004) ; avec Serge Bozon, « The Truth of IF : Has Hintikka Really Exorcized Tarski’s Curse ? » in The Philosophy of Jaakko Hintikka (2006) ; avec Paul Gochet, Logique épistémique et philosophie des mathé matiques, Vuibert, 2007, et « Carnap on Logical Consequence for Languages I and II » in Carnap’s Logical Syntax of Language édité par P. Wagner (2009).
Marion Vorms est post-doctorante à l’Institut d’histoire et de philosophie des sciences et des techniques. Ses travaux relèvent de la philosophie générale des sciences. Elle a soutenu une thèse proposant une approche cognitive de l’activité scientifique, centrée sur la compré hension des agents. Elle cherche actuellement à développer les apports des sciences cognitives et de la philosophie de la connaissance pour la philosophie des sciences. Dernières publications : « Formats of Representation in Scientific Theorizing », dans Representations, Models, and Simulations (à paraître chez Routledge), « Models and Formats of Representation », à paraître dans Studies in History and Philosophy of Science.
E-mail : [email protected] Site web : http://www-ihpst.univ-paris1.fr/63,marion_vorms.html
����indb 4 �������� �����
%&"#'(!)"*'&
Introduction générale
La philosophie des sciences a pour tâche de comprendre et d’évaluer la formi-dable entreprise qu’est la science. Elle cherche à répondre à un ensemble de ques-tions qui concernent la nature de l’activité scientifique, comme : quels sont les objec-tifs de la science en général, ou de telle science en particulier ? Par quelles méthodes ces objectifs sont-ils poursuivis ? Quels principes fondamentaux sont à l’œuvre ? Elle cherche aussi à comprendre les rapports internes entre les sciences, à partir de questions comme : quels rapports les différentes disciplines entretiennent-elles entre elles ? La science peut-elle et doit-elle être unifiée ? Elle prend également pour objet le rapport entre la science et le réel, en se demandant ce que la science nous dit exactement sur la réalité, et dans quelle mesure elle est justifiée dans ses affirmations.
À l’image des sciences, la philosophie des sciences est aujourd’hui riche, variée et spécialisée. Elle peut aussi bien consister dans l’élaboration d’une théorie formelle de la confirmation grâce aux outils du calcul des probabilités, que dans l’examen de l’apport des neurosciences pour la compréhension de la conscience. Il devient difficile, pour l’étudiant comme pour le chercheur non spécialiste, de connaître les acquis et les défis de tel ou tel domaine particulier de la philosophie des sciences.
Le Précis de philosophie des sciences vise à présenter, de manière pédagogique, l’état des grandes questions et des grands domaines de la philosophie des sciences. Nous le concevons volontiers comme le « chaînon manquant » entre l’initiation et la recherche. Notre but aura été atteint s’il constitue un pont entre des manuels plus introductifs et les articles ou ouvrages de recherche. Cet ouvrage est notamment destiné aux étudiants avancés qui, après une première introduction, souhaitent approfondir leurs connaissances dans le domaine. Afin de remplir au mieux cet objectif pédagogique, un site internet, accessible à l’adresse https://sites.google.com/site/ philosciences/, a été créé pour accompagner l’ouvrage : des supports de cours inspirés des différents chapitres y sont disponibles.
Nous espérons que le Précis de philosophie des sciences sera également utile à tous ceux, doctorants ou chercheurs confirmés, qui, connaissant tel ou tel domaine de la discipline, souhaitent en acquérir une vue plus complète ou actualiser leur savoir dans les domaines qui leur sont moins familiers.
����indb 5 �������� �����
6 PRÉCIS DE PHILOSOPHIE DES SCIENCES
La philosophie des sciences est devenue trop spécialisée pour qu’une seule personne puisse s’acquitter rigoureusement d’un projet de ce genre. Le présent ouvrage est donc le fruit d’un travail collectif. Les différentes questions qui animent la philosophie des sciences sont présentées comme un ensemble cohérent. À notre demande et suite à nos relectures, les différents contributeurs ont accepté d’effectuer un important travail d’harmonisation. Là où les différents chapitres d’une encyclo-pédie coexistent, parfois en s’ignorant, nous avons cherché à multiplier les complé-mentarités et les renvois. Même si chaque chapitre du Précis est l’œuvre d’un ou de deux auteurs, les deux volumes du Précis sont ainsi une œuvre pleinement collec-tive, reflétant le travail d’une communauté de chercheurs qui, pour la plupart, n’en étaient pas à leur première collaboration. Nous espérons qu’au final prévaut une unité d’approche rare pour un ouvrage collectif.
Une des originalités du Précis est enfin de couvrir en deux parties à la fois la philosophie générale des sciences et la philosophie des sciences spéciales. Cela nous a paru important, s’il est vrai que les développements récents de la philosophie des sciences spéciales gagnent à être lus à la lumière des thèmes de la philosophie générale des sciences, qui constituent toujours des domaines de recherche actifs.
Première partie : la philosophie générale des sciences
La première partie de cet ouvrage est consacrée à la philosophie générale des sciences, c’est-à-dire aux questions que pose l’activité scientifique indépendamment des disciplines particulières. Si la philosophie générale des sciences a été le cœur de la philosophie des sciences jusqu’au milieu du XXe siècle, elle a progressivement laissé la place au développement de réflexions sur les différentes branches de la science, ré-flexions de plus en plus spécialisées qui font l’objet du second volume. Les questions générales n’ont cependant pas disparu du débat, et la forte spécialisation des philo-sophies des sciences particulières rend nécessaire la consolidation de leur étude. Il est en effet requis, lorsque l’on s’engage dans une recherche sur les fondements de la physique ou de l’économie, d’être conscient des problèmes généraux que pose l’activité scientifique, sous peine de manquer certaines spécificités de son domaine.
Cette première partie a deux objectifs : faire le point sur les recherches les plus récentes sur les questions traditionnelles de la philosophie des sciences, d’une part, et proposer des points de vue originaux sur des problèmes plus récents, d’autre part. Ainsi les deux chapitres introductifs, sur l’explication et la confirmation, portent-ils sur des aspects de l’activité scientifique qui ont été particulièrement débattus au milieu du XXe siècle au sein de l’empirisme logique, et dont certains connaissent des développements originaux aujourd’hui. Le troisième chapitre, sur la causalité, porte lui aussi sur un thème traditionnel, mais qui a été développé « contre » l’empirisme logique, et qui continue d’être un domaine très vivant de la philosophie générale des sciences et de la métaphysique. Alors que le débat sur le réalisme scientifique, qui fait
����indb 6 �������� �����
INTRODUCTION 7
l’objet du chapitre 4, a été renouvelé à partir des années 1980, celui sur la métaphy-sique de la science, qui s’y rattache, est en plein essor aujourd’hui même. Enfin, la question de la réduction et de l’émergence des propriétés étudiées par les différentes disciplines, qui fait l’objet du chapitre 7, est née elle aussi au sein de l’empirisme logique, mais se développe aujourd’hui dans des directions qui rapprochent la philo-sophie des sciences de la métaphysique et de l’épistémologie au sens de philosophie de la connaissance.
Ces cinq thèmes – explication, confirmation, causalité, réalisme scientifique et réduction – forment l’ossature classique des questions portant sur les produits de l’activité scientifique, théories et modèles. Nous avons souhaité y adjoindre deux autres chapitres, dont l’un porte sur les aspects diachroniques de l’activité scienti-fique, et l’autre sur les rapports entre la philosophie générale des sciences et d’autres approches qui ont elles aussi vocation à proposer une analyse générale de l’activité scientifique, celles qui se développent aujourd’hui sous le nom de science studies ou d’études sur la science. Ainsi espérons-nous proposer un panorama pratiquement complet de l’état actuel de la philosophie générale des sciences.
Malgré la diversité des thèmes abordés, nous avons cherché à proposer une explo-ration, que nous espérons cohérente, des divers usages des théories scientifiques, dont nous considérons qu’elles structurent une large part des pratiques scientifiques. Ainsi les explications scientifiques s’appuient-elles le plus souvent sur les théories, ce qui fait l’objet du chapitre 1 ; d’autre part, les scientifiques passent une large part de leur temps à chercher à confirmer les théories, et c’est l’objet du chapitre 2. Les théories se transforment continuellement, ce qui pose les nombreuses ques-tions évoquées au chapitre 5 ; elles ont, par ailleurs, vocation à entretenir des rap-ports étroits les unes avec les autres, rapports problématiques comme en témoigne le chapitre 7. La conviction que les théories scientifiques sont capables de nous four-nir des informations sur les constituants ultimes du monde s’est développée tout au long du XXe siècle, et est discutée au chapitre 4. Durant la deuxième moitié du XXe siècle cependant, des voix se sont élevées pour insister sur l’existence de thèmes dont l’analyse est indépendante, à première vue, des théories. Le chapitre 3 porte sur l’un de ces thèmes : la causalité. Plus récemment encore, la pertinence même d’une analyse de l’activité scientifique centrée sur les théories a été vivement critiquée, comme en témoigne le chapitre 6 sur les études sur la science. Nous avons cherché à la fois à rendre compte de ces débats et du rôle des théories, que nous continuons de considérer comme central. Nous avons choisi de montrer des exemples d’usages des théories plutôt que de nous concentrer sur le débat qui porte sur la meilleure façon d’analyser les théories elles-mêmes, c’est-à-dire sur le débat entre les approches dites « syntaxiques » et les approches dites « sémantiques » des théories scientifiques, en raison des contraintes pédagogiques que nous nous sommes imposées. Le débat sur la meilleure façon d’analyser les théories scientifiques nous a paru moins important à faire figurer dans un ouvrage de ce type que ceux qui portent sur les usages des théories.
����indb 7 �������� �����
8 PRÉCIS DE PHILOSOPHIE DES SCIENCES
Deuxième partie : la philosophie des sciences spéciales
L’attention portée par les philosophes des sciences à la réalité concrète de l’entre-prise scientifique a conduit sur le devant de la scène, dans la période récente, les questions qui font l’objet de la philosophie régionale des sciences, ou philosophie des sciences spéciales. C’est à elles que ce second volume est consacré.
Ces questions particulières peuvent être des questions de philosophie générale des sciences particularisées, c’est-à-dire des questions générales que les spécificités de la discipline considérée amènent à poser à nouveaux frais. Par exemple, le problème de la justification ou de la confirmation des théories prend une dimension spéci-fique lorsque la théorie dont il s’agit n’est pas une théorie physique mais est, disons, une théorie économique ou une théorie mathématique. Ces questions particulières peuvent également être des questions spécifiques à la discipline considérée, qui sont liées aux concepts ou aux méthodes utilisés en propre par celle-ci. Le débat autour de la notion de fonction en biologie, ou celui autour de la nature des universaux linguistiques en linguistique, sont deux exemples de ce genre. Un objectif de ce volume est de faire le point sur l’ensemble de ces questions dans les domaines de la philosophie régionale des sciences les plus actifs actuellement. Un second objectif consiste, en capitalisant sur le premier volume, à articuler au mieux les questions de philosophie générale des sciences et leurs particularisations à telle ou telle discipline.
Les deux premiers chapitres sont consacrés à la philosophie des sciences dites formelles, plus précisément à la philosophie de la logique pour le premier et à la philo sophie des mathématiques pour le second. La philosophie des sciences formelles est trop souvent exclue des ouvrages consacrés à la philosophie régionale des sciences, car les problèmes posés seraient trop différents. Nous avons été sensibles aux raisons qui parlent, au contraire, en faveur de son intégration. Il s’agit, d’une part, de la convergence entre certaines questions de philosophie de la logique et des mathématiques et des questions de philosophie générale des sciences, par exemple concernant la nature de l’explication. Il s’agit, d’autre part, de la nécessité d’apporter des réponses unifiées aux questions posées en philosophie des sciences formelles et dans d’autres branches de la philosophie des sciences, par exemple la question de l’applicabilité des mathématiques, à l’intersection avec la philosophie de la physique notamment, ou la question de la cognition mathématique, à l’intersection avec la philosophie des sciences cognitives.
Les deux chapitres suivants sont consacrés aux sciences de la nature, avec la philo-sophie de la physique et la philosophie de la biologie. La philosophie de la physique a traditionnellement constitué le cœur de la philosophie régionale des sciences, et la philosophie de la biologie en est aujourd’hui un des domaines les plus actifs.
Nous avons également choisi de consacrer, en plus, un chapitre à part entière à la philosophie de la médecine. S’il nous a semblé fécond de le faire, c’est que la philo-sophie de la médecine s’attaque à un ensemble de difficultés situées à la frontière
����indb 8 �������� �����
INTRODUCTION 9
entre la philosophie des sciences et l’éthique ou la philosophie des pratiques. C’est le cas de la question du rapport aux normes dans la définition du concept de santé, ou de l’analyse de la rationalité de la clinique, qui excède les enjeux de la rationalité des disciplines purement théoriques.
Les sciences humaines et sociales se voient ici accorder une grande place, avec quatre chapitres qui leur sont consacrés en propre. Peut-être parce que ces sciences sont plus turbulentes que les sciences de la nature – les querelles méthodologiques autour des sciences humaines en général et au sein de chaque discipline sont nombreuses –, on attend plus du travail du philosophe des sciences. On en attend notamment des évaluations ou des recommandations qui ont plus rarement cours chez les philosophes des sciences de la nature.
Deux chapitres sont consacrés aux disciplines qui étudient les phénomènes sociaux ; il s’agit du chapitre sur la philosophie des sciences sociales et du chapitre dévolu à la philosophie de l’économie. Une des originalités de cet ouvrage est ainsi d’accorder une place à part entière à la philosophie de l’économie, ce qui se justifie aussi bien par l’importance de cette discipline dans la science contemporaine que par la vigueur des controverses qui traversent le champ. Deux autres chapitres sont consacrés aux disciplines qui étudient d’abord des aspects de la cognition humaine, dans une perspective plus individuelle. Le premier de ces chapitres est à nouveau un chapitre général présentant la philosophie des sciences cognitives. Comme dans le cas des sciences sociales, il nous a paru intéressant de le compléter par un éclairage plus local, apporté en l’occurrence par la philosophie de la linguistique. Si la philosophie du langage est un domaine bien constitué, les réflexions épistémologiques sur la linguistique sont parfois laissées de côté, et il nous a paru pertinent de promouvoir la philosophie de la linguistique comme un domaine propre de la philosophie régionale des sciences.
remerciements
Nous tenons à remercier les auteurs des différents chapitres ainsi que le directeur de la collection, Thierry Martin, pour leur patience et leur enthousiasme. Nous avons également une dette envers l’Institut d’histoire et de philosophie des sciences et des techniques (UMR 8590, Paris I - ENS Ulm - CNRS) qui nous offre, depuis bien des années, un cadre de travail stimulant.
Anouk Barberousse, Denis Bonnay et Mikaël CozicParis, janvier 2010
����indb 9 �������� �����