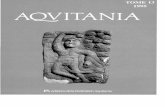PETREQUIN P., CASSEN S., ERRERA M., PAILLER Y. et GAUTHIER E., 2007.- La hache polie de Lagor...
-
Upload
univ-fcomte -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of PETREQUIN P., CASSEN S., ERRERA M., PAILLER Y. et GAUTHIER E., 2007.- La hache polie de Lagor...
-7-Archéologie des Pyrénées Occidentaleset des LandesTome 26, 2007, p. 7-20.
La hache polie de Lagor (Pyrénées-Atlantiques) :une production du Ve millénaire
par Pierre PÉTREQUIN (1) , Serge CASSEN (2) , Michel ERRERA (3) ,Yvan PAILLER (4) et Estelle GAUTHIER (5)
Résumé : La hache de Lagor, découverte hors contexte, a été produite sur un gneiss oeillé, probablement d’origine pyrénéenne ou cantabrique.Les comparaisons typologiques les plus convaincantes vont dans deux directions : - les haches-ciseau en roches alpines découvertes ensépulture ou en dépôt autour du golfe du Morbihan et datées du milieu du Ve millénaire ; - les haches-ciseau de Galice et de Catalogne souventassociées à des pendeloques et des perles en variscite, des nucléus et des lames de silex importés et des céramiques du groupe de Montbolo,également daté du Ve millénaire.La hache de Lagor, comme celles du nord de l’Espagne, représenterait alors une imitation régionale des grandes haches en roches alpines quiont circulé entre les Alpes italiennes et les franges océaniques de l’Europe ; le cas a déjà été noté pour les haches de type Cangas, centré surla Galice et imitant des lames polies à talon perforé du Morbihan. D’ailleurs, la ressemblance entre les haches de la côte sud de Bretagne etcelles de la Galice n’est pas fortuite, puisque des contacts sont démontrés entre ces deux régions, très tôt dans le Ve millénaire, avec lacirculation de la variscite de Palazuelo et l’adoption des formes les plus anciennes du mégalithisme et des stèles gravées, de part et d’autre dugolfe de Gascogne.Mots-clés : Néolithique, hache polie, Europe, Espagne, fonctionnements sociaux.Abstract: The axe from Lagor, discovered out of context, was produced from a gneiss, probably originating from the Pyrenees or theCantabrian hills. The most credible typological comparisons go in two directions : - the chisel axes made of Alpine rocks discovered in tombsor in caches around the Gulf of Morbihan dated to the middle of the 5th millennium; - the chisel axes from Galicia and Catalonia oftenassociated with variscite pendants and beads, flint blades and nuclei as well as Montbolo Group pottery, also dated to the 5th millennium.The axe from Lagor, like those from the North of Spain, would therefore represent a local imitation of the large axes made of Alpine rockswhich circulated between the Italian Alps and the Atlantic shores of Europe. A similar case has been identified concerning the Cangas-typeaxes, centred on Galicia and which imitate the polished axes with a perforated butt-end from the Morbihan. What is more, the similaritiesbetween the axes from the South of Brittany and those from Galicia are not fortuitous, since contacts have been demonstrated between thesetwo regions, very early in the 5th millennium, with the circulation of Palazuelo variscite and the adoption of the most ancient forms ofmegaliths and engraved steles from both ends of the Bay of Biscay.Key-words : Neolithic, stone axe, Europe, Spain, social functionings.
A partir des environs de 4700 av. J.-C., la circulationdes haches polies en éclogite ou en jadéitite des Alpesitaliennes ou encore, à un moindre degré, en néphrite(amphibolite calcique) du Valais, représente un phéno-mène de grande ampleur géographique en Europe occi-dentale. On retrouve en effet ces productions alpines enSicile jusqu’à 1100 km des sources exploitées (Leighton,Dixon, 1992), 1400 km en Bulgarie (Errera et al., 2006),1250 km au Danemark (Klassen, 1999, 2004), 1700 kmen Ecosse (Campbell Smith, 1963, 1965, 1972), 1000km en Bretagne (Damour, Fischer, 1878) et 800 km enEspagne (Sabada, Zaragoza, renseignement N. Le Maux2006). En tête de ces réseaux de transfert qui sont parmiles plus importants connus pour le Néolithique de nosrégions, mais qui débutent certainement dès le premierNéolithique rubané avec la production de lames d’her-minette en amphibolite en Tchéquie (Christensen et al.,
(1) UMR 6565, CNRS et Université de Franche-Comté, Besançon. 69 Grande Rue, F 70100 Gray.(2) UMR 6566, CNRS et Université de Nantes. BP 81 227. F 44312 Nantes Cedex 3.(3) Musée royal de l’Afrique centrale, Tervuren, Belgique. 13, Leuvensesteenweg, B 3080 Tervuren, Belgique.(4) post-doctorant, projet Jade, Agence Nationale de la Recherche. 9 rue Bailly, F 29200 Brest.(5) UMR 6565, CNRS et Université de Franche-Comté, Besançon. 30-32 rue Mégevand, F 25000 Besançon.
2006), plusieurs exploitations ont été découvertes en al-titude dans les massifs du Mont Viso à Oncino (Pié-mont, Italie), du Mont Beigua (Ligurie, Italie) et en Va-lais (Suisse), où l’on a exploité des blocs de matièrepremière en place ou bien de très importants dépôts se-condaires à proximité immédiate des gîtes d’origine(Pétrequin, Pétrequin et al., 2005 ; Pétrequin, Errera etal., 2005 ; Pétrequin, Pétrequin et al., 2006). Il s’agis-sait, dès les carrières alpines, de produire à la fois desoutils d’abattage de la forêt en roches très résistantes etprécieuses et des signes sociaux qui permettaient d’il-lustrer les inégalités sociales et le pouvoir des puissan-ces surnaturelles (Pétrequin, Errera et al., 2003). Cemodèle interprétatif, fondé sur des hypothèses ethno-archéologiques (Pétrequin, Pétrequin, 1993, rééditioncomplétée 1999) croisées avec la documentation archéo-logique, a ainsi permis de prolonger les hypothèses de
-8-
travail, où la question était posée des conséquences dela circulation de petites et de grandes haches alpines so-cialement valorisées en Europe occidentale, engendrantdes imitations régionales et la première ouverture de vé-ritables carrières ou minières de production de hachesen silex (Pétrequin, Jeunesse, 1995 ; Pétrequin, Cassenet al., 2002).
D’ailleurs, ces imitations régionales des productionsalpines sont d’une grande importance pour comprendrel’extraordinaire valeur qui était alors attachée à ces lon-gues lames de pierre en roche verte translucide, extrê-mement résistante, au grain fin et susceptible d’être po-lie à glace, et qui accrochait la lumière du soleil. Que cesoit dans les Vosges (Pétrequin, Jeunesse, 1995) ou surles franges atlantiques de l’Europe, les haches alpinesles plus anciennes (en particulier le type Durrington 4800-4500 av. J.-C.) ont fait l’objet d’imitations en schiste àAguiar en Galice (Leisner, Ribeiro, 1968), en fibrolitedans le Finistère (Pailler, 2005) ou en dolérite bretonne(Pailler 2004), en schiste brun probable en Irlande et enEcosse (Y. Pailler, recherche en cours), en rochesmétamorphiques au Danemark (Klassen, 2004). Il nefaut pourtant pas croire que ces imitations constituentun horizon chronologique unique et cohérent à l’échelledes littoraux océaniques. Les distances sont telles entreles carrières de jadéitite et d’éclogite d’une part et lesexportations les plus lointaines d’autre part -avec toutesles difficultés que l’on peut supposer et qui ralentissentla diffusion lorsque changeait l’ambiance sociale et cul-turelle- que certaines régions ont été atteintes beaucoupplus tard que d’autres : la Bretagne dès 4700 probable-ment si l’on en juge par l’association avec des anneauxen pierre de type Villeneuve-Saint-Germain, l’Angleterrecertainement un peu avant 4200 et la première diffusiondes haches de type Puy, le Danemark beaucoup plustard où l’on voit une hache en cuivre imiter une hachealpine de type Bégude (Klassen, Pétrequin, 2005) vers lemilieu du IVe millénaire.
C’est dans ce contexte d’expansion d’un bien socia-lement valorisé au cours du Ve millénaire que la hache deLagor doit être présentée.
1. La hache de Lagor, une découverte fortuite
La hache de Lagor (Pyrénées-Atlantiques) a été dé-couverte par Philippe Gouardères (chez qui elle est con-servée à Lagor) en 1963, lors d’un labour dans un champsitué au lieu-dit « Bazans », jouxtant le chemin de « Saint-Jacques » ou GR 65. Cette découverte n’est pas isolée :on connaît également, sur la même commune, une ébau-che de hache polie à section ovalaire (Blanc, 1989). Enélargissant le cadre géographique, on peut signaler latrès grande hache polie, longue de 34 cm, de typePauilhac, découverte à Arthez-de-Béarn à 8 km au nordde Lagor (Cordier, Bocquet, 1973). Un peu plus loinvers l’ouest, nous mentionnerons également la hache
inédite de Salies-de-Béarn (Fig. 5 et 6). La productionde sel par chauffage de la saumure dans des récipientstronconiques y est d’ailleurs attestée dès l’Age du Bronzemoyen (Saule, 1976 ; Cassen, 1987 ; Réchin, Saule,1993) ; de plus, on connaît une cinquantaine de hachespolies à Salies et dans les environs (Saule, 2006). Laprésence de trois longues haches groupées dans un es-pace géographique restreint n’est donc probablement pasfortuite si l’on en juge par certaines concentrations degrandes haches en roches alpines autour des sourcessalées de Halle et de Bad Nauheim en Allemagne, et autourdu golfe du Morbihan, pour lesquels l’exploitation dessources salées ou de l’eau de mer tend à se confirmer(Pétrequin, Croutsch et al., 1998 ; Boujot, Cassen,1992 ; Cassen, 2000 ; Cassen et al., 2004).
La lame polie de Lagor est une longue hache-ciseau àsection ovalaire épaisse et talon à méplat (Fig. 2 et 3) :
- longueur : 25,8 cm- largeur maximale : 4,1 cm- épaisseur maximale : 2,9 cm- dimensions du talon poli : 1,6 x 0,9 cm- poids : 471,72 gr- poids spécifique : 2,75Le polissage est très régulier, avec de longues facet-
tes longitudinales peu marquées et des stries longitudi-nales ou légèrement obliques à peine visibles. La surfaceest mate. Sur un côté, vers le talon, une douzaine d’im-pacts en percussion dure permettent d’évoquer uneréutilisation anecdotique.
La roche utilisée montre une structure orientée à 30°par rapport à l’axe longitudinal de l’objet (Fig. 3), unefoliation nette avec des lits bleutés sombres et des yeuxplus clairs. Une analyse spectroradiométrique (Hunt,Salisbury, 1970, 1976 ; Clark, 1999 ; Errera, 2000 ;U.S.G.C. Spectroradioscopy Lab) indique une roche dela famille des gneiss (analyse M. Errera, spectreLago_000 et Lago_001). Il s’agit donc bien d’un gneissoeillé et, a priori, la hache de Lagor n’a rien à voir avecla circulation des haches alpines en Europe occidentale.
2. Les comparaisons typologiques avec les hachesalpines
Ce serait pourtant aller un peu vite que de nier unequelconque relation entre la hache de Lagor et certainsmodèles de haches alpines.
Le premier indice est la position géographique deLagor, à peu près en limite sud de l’expansion du groupele plus ancien de haches en roches alpines : c’est-à-direle type Bégude. Le type Bégude, de forme très caracté-ristique avec sa silhouette allongée et une section ovalaireà lenticulaire (Pétrequin, Croutsch et al., 1998 ; Thirault,1999) atteint l’Atlantique, le golfe du Morbihan, le Bas-sin parisien et la Trouée de Belfort probablement dès leVilleneuve-Saint-Germain, c’est-à-dire -au minimum-vers 4700 av. J.-C. (Jeunesse, 1998). Une belle démons-
-9-
Fig. 1. Répartition des grandes haches alpines en Europe occidentale, de longueur supérieure à 14 cm. Les cercles sont proportionnels aunombre de haches dans chaque commune.
(CAO : E. Gauthier. Documentation arrêtée au 1er janvier 2007 : P. Pétrequin).
-10-
tration de l’ancienneté de ce type peut être faite avecl’ensemble de Quiberon / Fort de Quiberon (Morbihan),soit une sépulture sous une grosse roche associant deuxhaches de type Bégude (Harmois, 1928) et quatre an-neaux disques réguliers (Herbault, Pailler, 2000). Plu-sieurs fois mobilisé pour démontrer l’arrivée des ha-ches alpines en Bretagne dès la première moitié du Ve
millénaire (Cassen, Pétrequin, 1999), un travail plus ré-cent a confirmé que l’une des haches au moins avait étéproduite dans une éclogite du Mont Viso (Pétrequin,Pétrequin et al., 2005), mais que la hache a été repolieet amincie dans le golfe du Morbihan pour la transfor-mer en hache « carnacéenne » (Pétrequin, Croutsch etal., 1998).
Qui plus est, la limite entre ces haches de type Bégudeamincies à leur arrivée sur la côte sud de Bretagne et leshaches-ciseau de type Bernon (pour la typologie, voirPétrequin, Cassen et al., 2002) est parfois incertaine.Le type Bernon, en éclogite alpine ou en néphrite valai-sanne, connaît à peu près la même répartition spatialeque le type Bégude, bien qu’en chronologie absolue, sonespérance de vie soit peut-être un peu plus longue, maistoujours aux environs de 4500 av. J.-C., comme dans ledépôt d’Arzon / Bernon (Morbihan) (Passile, 1894 ;Herbault, 1996, 2000). C’est dire qu’en Europe occi-dentale la mode de ces longues haches-ciseau pourraitbien s’être développée, comme la phase ancienne de cir-culation des haches alpines, entre 4700 et 4500/4400av. J.-C.
En fait, l’identité de forme entre la hache de Lagor etle type alpin Bernon est loin d’être parfaite, à l’excep-tion de l’exemplaire -d’ailleurs unique- de Pozzuolo delFriuli / Sammardenchia (Friuli, Italie) (Fig. 4, en bas àdroite). Mais, sous des caractères communs aux deuxtypes (allongement, étroitesse, fabrication probable parsciage, parfois un méplat au talon), on distingue bien lestypes Bernon en éclogite ou en néphrite (Fig. 4).D’ailleurs la répartition méridionale des haches en ro-ches alpines s’arrête -nous l’avons dit- aux Pyrénées,justement où se situe Lagor (Fig. 1).
3. Les comparaisons typologiques avec les hachespyrénéennes et espagnoles
Si le principe de la hache-ciseau n’est certainementpas sans rapport, dans cette zone géographique et pen-dant le Ve millénaire, avec l’expansion du phénomènedes haches alpines, c’est pourtant bien dans la zone py-rénéenne, entre Catalogne et Galice, que nous pouvonsreconnaître des spécimens identiques à la hache de Lagor,sans aucune réserve.
Le terme le plus proche, à la fois géographiquementet au plan typologique, est la hache inédite de Salies-de-Béarn (Pyr.-Atlantiques), en roche vert foncé schisteusenon déterminée. La ressemblance entre les deux objetsest telle que l’on peut se demander s’il ne s’agit pas de
productions locales, ou au moins de production de mêmeorigine. La hache de Ger / Taillan (Pyr.-Atlantiques) (Fig.5, en haut) est également proche, mais avec une sectioncarrée ; elle a été découverte dans un dolmen sous tu-mulus fouillé par le général Pothier (1881 et 1900) et diteavoir été trouvée avec un poignard en silex (notablementpostérieur) et une trentaine de poteries que J. Roussot-Larroque (1987) considère comme de l’Age du Bronzeancien. Même similitude et contexte discutable pour lahache de Balansun / Pont-Long (Pyr.-Atlantiques) (Fig.5, en haut), découverte dans une fosse sous tumulusavec deux autres haches, également en schiste, et ungrand « croissant » en silex (poignard ?) (Raymond 1879,Roussot-Larroque 1987). Quant on sait qu’en Galice, laplupart des tumulus circulaires du Néolithique moyenont été largement réutilisés postérieurement, on est endroit de se demander si ce n’est pas également le cas ici,avec ces longues haches-ciseau qui sont certainementplus anciennes que l’Age du Bronze ancien ou le Néoli-thique final.
Vers l’ouest, l’aire de comparaison la plus claire estla Galice et le Portugal. Si l’on pose à part les lames àvéritable section quadrangulaire (un type très proche deLagor, mais qui reste à nommer) et si l’on restreint en-core l’enquête aux documents les mieux publiés (FabregasValcare, Vasquez Varela, 1982 ; Fabregas Valcare, FuenteAndrès, 1988 ; Eguileta Franco, 1987), il ne reste enGalice que 11 spécimens proches ou identiques au typeLagor (trois sont représentés Fig. 5) : As Pontes de Gar-cia Rodriguez / Iliade 0 (4 ex. en schistes indétermi-nés) ; Tordoia / Rechaba (1 ex. en schiste pélitique, 1autre en amphibolite à longues traces de sciage) ; SanXoan de Alba (3 ex. en schistes très polis) ; Begonte /Monte Campelos (2 ex. en schiste) ; et Vilamarin / AltoVal do Barbantiño (1 exemplaire non déterminé). Tousces sites sont des tertres funéraires, mais un seul a étéétudié en détail : le tertre 0 de la nécropole de l’Iliade dubassin d’As Pontes (Vaquero Lastres, 1999), qui conte-nait un corps allongé dans une fosse creusée dans lesubstrat, la lame de hache étant plantée verticalementaux pieds du cadavre ; un triangle de silex et une ha-chette en fibrolite furent placés sur les côtés ; unedeuxième inhumation a été superposée à ce dépôt pri-maire, accompagnée de deux perles et d’une pendeloqueen roches vertes, le tout recouvert d’un tertre circulaireen terre. Une rampe en bois conservée dans la masse dutertre a permis l’obtention de deux dates radiocarboneconcordantes, situant la phase primaire d’utilisation en-tre 4300 et 4000 av. J.-C. (Vaquero Lastres, 1999, p.178).
C’est en Catalogne, dans les Tombes en Fosse con-temporaines de Montbolo, que l’on trouve le troisièmegroupe de comparaison, bien que moins fourni que celuide Galice (Fig. 5, en bas) : San Joan Despi, une sépul-ture avec trois haches, dont un type Lagor en amphibolite ;Ripollet / Bóvila Padro, une sépulture avec une hache-
-11-
ciseau non déterminée, des perles en variscite, des la-mes et nucléi en silex ; Montornès / Bóvila d’En Joca,une sépulture avec 6 haches, dont deux de type Lagor,des perles en variscite, deux nucléi et des lames en silex(Muñoz, 1965). Dans le cas de ces Sepulcros de Fosade Catalogne, la plupart des sépultures appartiennent àla fin du du Ve millénaire ou au début du IVe : la pré-sence de nucléus et de lames de silex pré-chauffé plaideen faveur de contacts avec la Provence, via les réseauxde diffusion qui fonctionneront à plein pendant leChasséen ancien et classique (Lea, 2005). D’ailleurs lesquelques haches en roches alpines dans ces tombesmontrent des formes typologiques tardives dans la sé-quence et certainement pas antérieures à 4200 au plusancien.
4. Conclusion
Entre Galice et Catalogne (Fig. 7), 14 haches-ciseauau minimum appartiennent exactement au même groupetypologique que la lame polie de Lagor. Constatant l’uni-formité du type et la cohérence de sa répartition est-ouest, nous proposons de l’appeler type Lagor.
Le type Lagor, contrairement à ses répondants al-pins, ne montre aucune uniformité dans les roches utili-sées : gneiss, fibrolite, amphibolite, schistes ont consti-tué des supports de nature et d’origines diverses. Onreconnaît ainsi que la forme de ces outils / signes so-ciaux était plus importante que la résistance mécaniquedes matières premières ; cette fonction de signe n’estd’ailleurs pas douteuse, quand on se tourne vers cer-tains exemplaires en schistes fragiles découverts enGalice ; il n’empêche que la hache-ciseau de Lagor esten matériau de moyenne qualité et qu’elle a bel et bienété utilisée comme outil, comme on le remarque avecl’usure différentielle du tranchant. Quoi qu’il en soit, il ya longtemps que l’on sait qu’il est impossible de fixerune limite unique et définitive entre un outil efficace auplan technique et un outil socialement valorisé (Pétrequin,Pétrequin, 2006) : la recherche d’une telle limite est ty-piquement occidentale – et nous utilisons ce terme defaçon péjorative.
Le type Lagor s’étend parallèlement à la limite sudd’expansion maximale des haches en roches alpines (Fig.1) et particulièrement le long des Monts Cantabriques etdes Pyrénées, en trois groupes bien circonscrits : la Galiceà l’ouest, les Pyrénées-Atlantiques au centre et la Cata-logne à l’ouest. L’adoption du type Lagor pourrait alorscorrespondre à un effet frontière, où les haches alpineselles-mêmes sont devenues rares -voire inaccessibles- :vu leur importance sociale, on aurait alors cherché à lesimiter avec des matériaux locaux. Ce type de phéno-mène -qui demande à être étudié de près et à être expli-qué en détail- a d’ailleurs déjà été observé, dans la mêmerégion, avec le type Cangas (Fig. 8) qui est une indiscu-table imitation, également en roches locales, des magni-fiques haches en jadéitite à talon perforé du golfe du
Morbihan (Pétrequin, Cassen et al., 2006). Dans le casprécis, bien d’autres concordances apparaissent entreGalice et Morbihan : la circulation de parures en variscitede Palazuelo (Errera, 2000 ; Villalba, Edo et al., 2001 ;Herbault, Querré, 2004), les formes les plus anciennesdu mégalithisme ou encore l’identité de certains systè-mes de représentation du monde sur les stèles gravées(Cassen, Vaquero, 2000).
Dans ce cadre, les lames de type Lagor, comme cel-les de Cangas, ont une forte valeur démonstrative sur lasymétrie qui existait, de part et d’autre du golfe de Gas-cogne, entre Morbihan et Galice pendant la deuxièmemoitié du Ve millénaire av. J.-C.
Remerciements
Philippe Gouardères, l’inventeur de la hache de Lagor, a acceptéde nous la confier pour étude et analyse au Musée royal d’Afriquecentrale à Tervuren (Belgique). José Trébucq s’est chargé de réunirla documentation et de nous transmettre cet objet rare, qui a étéd’abord dessiné par Michel Blanc. M. Casteraa nous a aimable-ment informé de la découverte de la hache de Salies. N. Le Meauxa bien voulu documenter pour nous les haches du Musée de Ma-drid. J. Vaquer nous a fait profiter de son érudition pour la recher-che d’éléments de comparaison. A tous, nous exprimons nos plusvifs remerciements pour cette collaboration efficace.Ce travail a été réalisé dans le cadre du projet JADE « Inégalitéssociales et espace européen au Néolithique : la circulation des gran-des haches en jades alpins», subventionné par l’Agence Nationalede la Recherche (2007-2009) dans le cadre de la MSH Claude-Nicolas Ledoux à Besançon.
Bibliographie
BLANC C., 1989, Ebauche de hache polie (Lagor, P.-A.), Archéo.des Pyrénées occidentales, t. 9, p. 116-117.CAMPBELL SMITH W., 1963, Jade Axes from Sites in the Bri-tish Isles, Proceedings of the Prehistoric Society, t. 29, p. 133-172.CAMPBELL SMITH W., 1965, The distribution of Jade Axes inEurope, with a supplement to the catalogue of those from the Bri-tish Isles, Proceedings of the Prehistoric Society, t. 31, p. 25-33.CAMPBELL SMITH W., 1972, Second supplement to the cata-logue of jade axes from sites in the British Isles, Proceedings of thePrehistoric Society, t. 38, p. 408-411.BOUJOT (C.), CASSEN (S.)., 1992, Le Développement des premiè-res architectures funéraires monumentales en France occidentale. In :XVIIe colloque interrégional sur le Néolithique, Vannes 1990, Rennes,Rev. Archéo. de l’Ouest, supplément n° 5, p. 195-211.CASSEN S., 1987, Le Centre-Ouest de la France au IVe millénaireav. J.-C., Oxford, BAR International Series, 342.CASSEN S., 2000, La fabrication du sel. Une hypothèse fonction-nelle pour la forme céramique du caveau de Lannec er Gadouer. In :Eléments d’architecture. Exploration d’un tertre funéraire à Lannecer Gadouer, Erdeven, Morbihan, Chauvigny, Edns chauvinoises,Mémoire, XIX, p. 249-265.CASSEN S. et PETREQUIN P., 1999, La chronologie des hachespolies dites de prestige dans la moitié ouest de la France, EuropeanJournal of Archaeology, t. 2, fasc. 1, p. 7-33.
-12-
CASSEN S. et VAQUERO J., 2000, La forme d’une chose. In : S.Cassen (éd.), Eléments d’architecture. Exploration d’un tertre funé-raire à Lannec er Gadouer (Erdeven, Morbihan), Chauvigny, Asso-ciation des Publications Chauvinoises, Mémoire, XIX, p. 611-656.CASSEN S., LABRIFFE P.A. (de), MENANTEAU L., 2004, Selsde mer, sels de terre. Indices et preuves de fabrication du sel sur lesrivages de l’Europe occidentale, du Ve au IIIe millénaire, Cuadernosde Arqueologia, Universidad de Navarra, n° 12, p. 9-49.CHRISTENSEN A.M., HOLM P.M., SCHUESSLER U. etPETRASCH J., 2006, Indications of a major Neolithic trade route ?An archaeometric geochemical and Sr, Pb isotope study onamphibolithic raw material from present day Europe, Science di-rect, Applied Geochemistry, t. 21, p. 1635-1655.CLARK R.N., 1999, Spectroscopy of Rocks and Minerals, andPrinciples of Spectroscopy. In : A. Rencz (ed.), Manual of RemoteSensing, New York, John Wiley and Sons.CORDIER G. et BOCQUET A., 1973, Le dépôt de La Bégude-de-Mazenc (Drôme) et les dépôts de haches néolithiques en France,Etudes Préhistoriques, t. 6, p. 1-17.D’AMICO C., FELICE G., GASPAROTTO G., GHEDINI M.,NANNETTI M.C. et TRENTINI P., 1997, La pietra levigataneolitica di Sammardenchia (Friuli). Catalogo petrografico, Miner.Petrogr. Acta, t. XL, p. 385-426.DAMOUR A. et FISCHER H., 1878, Notice sur la distributiongéographique des haches et autres objets préhistoriques en jadenéphrite et en jadéite, Matériaux pour l’Histoire Primitive et Na-turelle de l’Homme, 2e série (9), p. 502-512.EGUILETA FRANCO J.M., 1987, Catálogo dos materiaisergoloxicos depositados no museo de Ourense procedentes detúmulos prehistóricos, Boletín Auriense, t. 17, p. 48-52.EGUILETA FRANCO J.M., ALVAREZ X.P. et RIO MARTINEZF., 1994, Breve reseña sobre duas pezas pulidas atopadas sen contextona provincia de Ourense, Revista de Guimarães, 104, p. 109-125.ERRERA M., 2000, Applications de la spectroradiométrie à deshaches en roches vertes du Musée régional de Préhistoire à Or-gnac-l’Aven (Ardèche), Musée royal de l’Afrique centrale, Dépar-tement de Géologie et de Minéralogie. Rapport Annuel 1997-1998, Tervuren, p. 221-224.ERRERA M., 2000, Déterminations spectroradiométriques deperles et autres éléments de parures néolithiques déposés au Mu-sée des Antiquités nationales à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines).Musée royal de l’Afrique centrale, Département de Géologie et deMinéralogie, Tervuren, multigraphié.ERRERA M., HAUZEUR A., PETREQUIN P. et TSONEV T.,2006, Etude spectroradiométrique d’une lame de hache trouvéedans le district de Chirpan (Bulgarie). In : Interdisciplinary Studies,t. XIX, Sofia, Archaeological Institute and Museum, p. 7-24.FABREGAS VALCARE R. et VASQUEZ VARELA J.M., 1982,Hachas de piedra pulimentada con perforacion proximal en elnoroeste de la peninsula Ibérica, Museo de Pontevedra, t. XXXVI,p. 125-142.FABREGAS VALCARE R. et FUENTE ANDRES F. (DE LA),1988, Aproximaciones a la cultura material del megalitismo gallego :la industria lítica pulimentada y el material ceramico,Arqueohistorica, t. 2, Santiago de Compostela.HARMOIS A.L., 1928, Inventaire des grandes haches en pierretrouvées en France, L’Homme Préhistorique, t. XV, fasc. 6-8, p.113-171.
HERBAUT F., 1996, Grandes haches et grands tumuluscarnacéens, DEA Préhistoire, Univ. de Toulouse Le Mirail II, Ecoledes Hautes Etudes en Sciences Sociales, multigraphié.HERBAUT F., 2000, Les haches carnacéennes. In : S. Cassen(éd.), Eléments d’architecture. Exploration d’un tertre funéraire àLannec er Gadouer (Erdeven, Morbihan), Chauvigny, Associa-tion des Publications Chauvinoises, Mémoire XIX, p. 387-395.HERBAUT F. et PAILLER Y., 2000, Les anneaux en pierre dans lemassif armoricain. In : S. Cassen (éd.) : Eléments d’architecture.Exploration d’un tertre funéraire à Lannec (Erdeven, Morbihan).Chauvigny, Association des publications Chauvinoises, MémoireXIX, p. 353-385.HERBAUT F. et QUERRE G., 2004, La parure néolithique envariscite dans le sud de l’Armorique, Bull. de la Soc. Préhist. Fran-çaise, t. 101, fasc. 3, p. 497-520.HUNT G. et SALISBURY J., 1970, Visible and near-visible spectraof minerals and rocks : I. Silicates minerals, Modern Geology, t. 1,p. 283-300.HUNT G. et SALISBURY J., 1976, Visible and near-visible spectraof minerals and rocks : XII. Metamorphic rocks, Modern Geology,t. 5, p. 219-228.JEUNESSE C., 1998, Villeneuve-Saint-Germain, Cerny,Grossgartach, Roessen et la synchronisation entre les séquencesNéolithique moyen du Rhin et du Bassin parisien, Bull. de la Soc.Préhist. Française, t. 95, fasc. 2, p. 277-285.KLASSEN L., 1999, Prestigeøkser af sjældne alpine bjergarter. Englemt og overset fundgruppe fra ældre stenalders slutning i Danmark,KUML, p. 11-51.KLASSEN L., 2004, Jade und Kupfer. Untersuchungen zumNeolithisierungprozess im westlichen Ostseeraum unter besonderenBerücksichtingung der Kulturenwicklung Europas 5500-3500 BC,Moesgård, Moesgård Museum, Jutland Archaeological Society.KLASSEN L. et PETREQUIN P., 2005, Jagten på jaden. Kronik,Skalk, t. 6, p. 20-28.LEA V., 2005, Raw, pre-heated or ready for use : discoveringspecialist supply systems for flint industries in mid-Neolithic(Chassey culture) communities in southern France, Antiquity, 79,p. 51-65.LEIGHTON R. et DIXON J.E., 1992, Jade and greenstone in theprehistory of Sicily and southern Italy, Oxford Journal ofArchaeology, t. 11, fasc. 2, p. 179-199.LEISNER V. et RIBERO L., 1968, Die dolmen von Carapito,Madrider Mitteilungen, t. 9, p. 11-62.LOBSIGER-DELLENBACH M., 1945, Quelques haches en pierrepolie et une pointe de lance en silex trouvées en Valais (Suisse), Archi-ves Suisses d’Anthropologie générale, t. XI, fasc.1, p. 142-148.MUÑOZ A.M., 1965, La cultura neolithica catalana de los «sepulcrosde fosa», Barcelona, Instituto de Arqueologia y Prehistoria,Universidad de Barcelona, Publicaciones eventuales, 9.PAILLER Y., 2004, Des dernières industries à trapèzes à l’affir-mation du Néolithique en Bretagne occidentale (5500-3500 av. J.-C.), Thèse de doctorat, Préhistoire, Brest, Université de Bretagneoccidentale, 2 vol., multigraphié.PAILLER Y., 2005, Le sciage de la fibrolite en Armorique : appro-che technique, implications culturelles et symboliques. In : G.Marchand et A. Tresset (éd.), Unité et diversité des processus denéolithisation sur la façade atlantique de l’Europe (7e-4e millénai-
-13-
res av. J.-C.), Paris, Soc. Préhist. Française, Mémoire XXXVI, p.225-243.PASSILE M., 1894, Découverte de Bernon (près Arzon), Pres-qu’île de Rhuis (Morbihan) (18 décembre 1893), Revue Archéolo-gique, 3e série, t. XXIV, p. 260-267.PESSINA A. et D’AMICO C., 1999, L’industria in pietra levigatadel sito neolitico di Sammardenchia (Pozzuolo del Friuli, Udine).Aspetti archeologici e petroarcheometrici. In : A. Ferrari et A.Pessina (ed.), Sammardenchia - Cüeis. Contributi per la conoscenzadi una comunità del primo neolithico, Udine, Edizioni del MuseoFriulano di Storia Naturale, p. 23-92.PETREQUIN A.-M. et PETREQUIN P., 2006, Objets de pou-voir en Nouvelle-Guinée. Catalogue de la donation Anne-Marie etPierre Pétrequin. Musée d’Archéologie Nationale, Saint-Germain-en-Laye, Paris, Edns de la Réunion des Musées Nationaux.PETREQUIN P., CASSEN S. et CROUTSCH C., 2006, Imitationou convergence : les haches néolithiques à talon perforé au nord-ouest des Alpes. In : Artisanats, sociétés et civilisations. Hom-mage à J.-P. Thévenot, Dijon, 24e supplément à la Rev. Archéo. del’Est, p. 163-177.PETREQUIN P., CASSEN S., CROUTSCH C. et ERRERA M.,2002, La valorisation sociale des longues haches de l’Europe néo-lithique. In : J. Guilaine (éd.), Matériaux, productions, circulationsdu Néolithique à l’Age du Bronze, Paris, Edns Errance, p. 67-98.PETREQUIN P., CROUTSCH C. et CASSEN S., 1998, A proposdu dépôt de La Bégude : haches alpines et haches carnacéennespendant le Ve millénaire, Bull. de la Soc. Préhist. Française, t. 95,fasc. 2, p. 239-254.PETREQUIN P., ERRERA M., CASSEN S. et CROUTSCH C.,2003, De la pétrographie aux approches sociales : la circulationdes grandes haches en roches alpines pendant le Néolithique. In :Les matières premières lithiques en préhistoire, Table ronde inter-nationale d’Aurillac (20-22 juin 2002), Préhistoire du Sud-Ouest,n° spécial, 5, p. 253-275.PETREQUIN P., ERRERA M., CASSEN S., BILLAND G., CO-LAS C., MARECHAL D., PRODEO F. et VANGELE F., 2005,Des Alpes italiennes à l’Atlantique : les quatre grandes hachespolies de Vendeuil et Maizy (Aisne), Brenouille (Oise). In : Hom-mages à Claudine Pommepuy, Rev. Archéolo. de Picardie, n° spé-cial, 22, p. 75-104.PETREQUIN P. et JEUNESSE C., 1995, La hache de pierre.Carrières vosgiennes et échanges de lames polies pendant le Néo-lithique (5400-2100 av. J.-C.), Paris, Edns Errance.PETREQUIN P. et PETREQUIN A.-M., 1993, Ecologie d’unoutil : la hache de pierre en Irian Jaya, Paris, CNRS, Monogra-phie du CRA, 12, réédition complétée, 1999.PETREQUIN P., PETREQUIN A.-M., ERRERA M., CASSENS., CROUTSCH C., KLASSEN L., ROSSY M., GARIBALDI P.,ISETTI E., ROSSI G. et DELCARO D., 2005, Beigua, Monviso eValais. All’origine delle grandi asce levigate di origine alpina inEuropa occidentale durante il V millenio, Rivista di ScienzePreistoriche, t. LV, p. 265-322.PETREQUIN P., PETREQUIN A.-M., ERRERA M., CASSENS., CROUTSCH C., KLASSEN L., ROSSY M., GARIBALDI P.,ISETTI E., ROSSI G. et DELCARO D., 2006, Produzione ecircolazione delle asce in rocce alpine nel Neolitico dell’ Europaoccidentale. Verso un approcio pluridisciplinare. In : Materie primee scambi nella Preistoria italiana, XXXIX Riunione scientifica,
Firenze, Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria (Firenze, 25-27 novembre 2004), p. 629-639.PETREQUIN P., PETREQUIN A.-M., ERRERA M., CASSENS. et CROUTSCH C., 2006, Complexité technique et valorisationsociale : haches polies de Nouvelle-Guinée et du Néolithique al-pin. In : L. Astruc, F. Bon, V. Léa, P.Y. Milcent et S. Philibert (ed.),Normes techniques et pratiques sociales : de la simplicité des outilla-ges pré- et protohistoriques, XXVIe Rencontres internationalesd’Archéologie et d’Histoire d’Antibes, Antibes, Editions APDCA,p. 419-433.POTHIER E., 1879, Les Tumuli de Tarbes, Hautes et BassesPyrénées, Matériaux pour l’Histoire Primitive et Naturelle del’Homme, XVIIe année, 2e série, t. XII, p. 209-215.POTHIER E., 1900, Les tumulus du plateau de Ger, Paris, Cham-pion éd.RAYMOND P., 1879, Exploration d’un tumulus à Balansun (Bas-ses-Pyrénées), Matériaux pour l’Histoire Primitive et Naturelle del’Homme, XIVe année, 2e série, t. X, p. 173-215.RECHIN F. et SAULE M., 1993, Un exemple de production et dediffusion du sel durant l’époque romaine : Salies-de-Béarn (Pyrénées-Atlantiques), Actes du Colloque International du Sel, Salies-de-Béarn(10-11 et 12 Septembre 1992), Salies-de-Béarn, p. 177-194.ROUSSOT-LARROQUE J., 1987, Les relations Aquitaine-IlesBritanniques au Bronze ancien, Actes du Colloque Bronze de Lille,Congrès de la Société Préhistorique de France, 1984, Paris, Rev.Archéo. de Picardie et Soc. Préhist.Française, p. 17-56.SAULE M., 1976, Salies-de-Béarn : une occupation du sol, uneurbanisation liées à l’exploitation du sel, Bull. Soc. des Sciences,Lettres et Arts de Pau et du Béarn, p. 91-102.SAULE M., 2006, Salies-de-Béarn, Patrimoine archéologique etorigines lointaines de la Cité du sel, Ed. du Pin à crochets, Salies-de-Béarn, 35 p.SAUTER M.R., 1950, Préhistoire du Valais des origines aux tempsmérovingiens, Vallésia, t. V.THIRAULT E., 1999, La Bégude-de-Mazenc quartier Gros-Jean(Drôme) : un dépôt de longues lames de haches polies. In : A.Beeching (ed.), Circulations et identités culturelles alpines à la finde la Préhistoire. Matériaux pour une étude Programme CICALP1997-1998, Valence,Travaux du Centre d’Archéologie Préhistori-que de Valence, 2, p. 297-313.THIRAULT E., 2001, Production, diffusion et usage des hachesnéolithiques dans les Alpes occidentales et le bassin du Rhône,Thèse de doctorat, Univ. de Lyon II - Lumière, Langues, histoire etcivilisation des Mondes anciens, 4 vol., multigraphiée.THIRAULT E., 2004, Echanges néolithiques : les haches alpines,Montagnac, Edns Monique Mergoil, Préhistoires, 10.U.S.G.C. Spectroscopy Lab.- http://speclab.cr.usgc.govVAQUERO LASTRES J.L., 1999, La Configuration de l’espacedans les sociétés ayant bâti des tertres funéraires dans le nord-ouest Ibérique, Oxford, BAR, International Series, S 821.VASQUEZ VARELA J.M., 1979, El horizonte de Rechaba. Unanueva fase de la cultura megalítica del Noroeste Peninsular, BoletínAuriense, t. IX, Orense.VILLALBA M.J., EDO M. et BLASCO A., 2001, La callaïs enEurope du Sud-Ouest. Etat de la question. In : Du monde deschasseurs à celui des métallurgistes, Rev. Archéo. de l’Ouest, sup-plément, 9, p. 267-276.
-15-
Fig. 3. La hache de Lagor a été mise en forme à partir d’un bloc allongé de gneiss oeillé.(cliché Photo Service Lescar).
-16-
Fig. 4. Comparaisons entre la hache-ciseau de Lagor et des haches d’origine alpine : Arzon / dépôt de Bernon (Morbihan, France) ;Chamoson (Valais, Suisse) ; Montornès / Bovila d’En Joca (Catalogne, Espagne) ; Pozzuolo del Friuli / Sammardenchia (Friuli, Italie).
-17-
Fig. 5. Comparaisons entre la hache-ciseau de Lagor, considérée comme un type éponyme, et des haches d’Espagne et du Sud-Ouest dela France : Salies-de-Béarn / Herre (Pyrénées-Atlantiques, France) ; Ger / Taillan (Pyrénées-Atlantiques) ; Balansun / Pont-Long
(Pyrénées-Atlantiques) ; As Pontes / Illiade (Galice, Espagne) ; Vilamarin / Alto Val do Barbantino (Galice) ; San Joan Despi(Catalogne) ; Ripollet / Bovila Padro (Catalogne) ; Vilafranca / En Salvady (Catalogne).
(dessin P. Pétrequin).
-19-
Fig. 7. Situation des haches de comparaison.Rond blanc : modèle alpin ; étoile : hache-ciseau de type Lagor.
(dessin P. Pétrequin).
-20-
Fig. 8. Pendant la deuxième moitié du Ve millénaire et le début du IVe, les haches à talon perforé de type morbihannais sont imitées enGalice et dans le nord du Portugal (type Cangas) et également en Suisse (type Zug). C’est l’illustration d’un nouveau contrecoup de la
diffusion des haches en jadéitite, mais cette fois-ci à partir du golfe du Morbihan.Répartition des haches en roche alpine : état de la documentation en 2002.
(dessin P. Pétrequin, C. Croutsch et S. Cassen).