Un premier jalon gravettien dans les Pyrénées-Orientales : le Jas-d’en-Biel-1
Transcript of Un premier jalon gravettien dans les Pyrénées-Orientales : le Jas-d’en-Biel-1
UN
CO
RR
EC
TED
PR
OO
F
+ Models
ANTHRO 2284 1–26
Article original
Un premier jalon gravettien dans lesPyrénées-Orientales : le Jas-d’en-Biel-1
First Gravettian evidence in the French easternPyrenees: Jas-d’en-Biel-1 open air site
Henry Baills a,*, Jacques Aymar b,1, Jean-Louis Lenoble c,Christian Perrenoud d, Simon Puaud e
a Centre européen de recherches préhistoriques, avenue Léon-Jean-Grégory, 66720 Tautavel, Franceb 2, rue des Chévrefeuilles, 66240 Saint-Estève, France
c Médi-Terra, 13, avenue Victor-Hugo, 66430 Bompas, Franced Département de préhistoire du Muséum national d’histoire naturelle,
centre européen de recherches préhistoriques, avenue Léon-Jean-Grégory, 66720 Tautavel, Francee Institut de paléontologie humaine, 1, rue René-Panhard, 75013 Paris, France
Résumé
Le site de plein air du Jas-d’en-Biel-1 à Tautavel (Pyrénées-Orientales) est le premier témoignage de laprésence gravettienne dans la zone Extrême-Orientale du piémont nord des Pyrénées. La série lithiqueconstituée lors de ramassages de surface engage à penser que cette occupation pourrait appartenir à unephase plutôt récente du Gravettien méridional français.# 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
Abstract
The open air site of Jas-d’en-Biel-1 (Tautavel, Pyrénées-Orientales) is the first trace of Gravettianpresence in the extreme east zone of the Northern-Pyrenees Piedmont. The lithic series made up of
http://france.elsevier.com/direct/ANTHRO/
Disponible en ligne sur www.sciencedirect.com
L’anthropologie xxx (2007) xxx–xxx1
2
3
4
56
7
8
9
10
11
12
1314
1516
17
181920
21
2223
24
25
26272829
30
3132
33
* Auteur correspondant.Adresse e-mail : [email protected] (H. Baills).
1 Avec la collaboration de.
0003-5521/$ – see front matter # 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.doi:10.1016/j.anthro.2008.02.007
Pour citer cet article : Baills, H. et al., Un premier jalon gravettien dans les Pyrénées-Orientales : le Jas-d’en-Biel-1, L’Anthropologie (2008), doi:10.1016/j.anthro.2008.02.007
UN
CO
RR
EC
TED
PR
OO
Fsurface finds indicates that this occupation could belong to a rather recent phase of southern-FrenchGravettian.# 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
Mots clés : Gravettien ; Paléolithique supérieur ; Pyrénées méditerranéennes ; Site de plein air
Keywords: Gravettian; Upper Palaeolithic; Mediterranean Pyrenees; Open air site
1. Localisation et description du gisement de plein air (J.L.L.)
Le site du Jas-d’en-Biel-1 est situé à 4 km à l’est du village de Tautavel (Pyrénées-Orientales) (Fig. 1). Il s’étend sur le replat limité par la rive droite du ravin du Jas-d’en-Bielet la base de la colline du Serrat d’en Cuix (d’après la carte IGN Top 25, 2448 OT). Ce terrainest une ancienne vigne qui sert actuellement de pacage aux chevaux du ranch du Mas de laDevèze. Son emprise concerne les parcelles AH24, AH23 et AY88 du cadastre de lacommune de Tautavel (Fig. 2).
2. Historique des recherches et constitution de la série
Le site du Jas-d’en-Biel-1 nous a été indiqué par Jacques Aymar en 1992. Il nous confia, à cetteoccasion, une série composée de 52 pièces lithiques constituant sa collection personnelle. Il futconvenu que ce matériel serait conservé au Centre européen de recherches préhistoriques deTautavel. Entre 1992 et 2004, nous engageâmes, avec l’aide d’étudiants, une prospectionsystématique du gisement qui permit de porter à 725 le total général de la série. Cette nouvellecollection constitue la matière de la présente étude.
La nature géochimique siliceuse des sédiments constituant le replat limoneux n’a pas permisla conservation des matières osseuses. Dans ces conditions, seuls les artefacts lithiques nous sont
H. Baills et al. / L’anthropologie xxx (2007) xxx–xxx2
+ Models
ANTHRO 2284 1–26
Pour citer cet article : Baills, H. et al., Un premier jalon gravettien dans les Pyrénées-Orientales : le Jas-d’en-Biel-1, L’Anthropologie (2008), doi:10.1016/j.anthro.2008.02.007
33
34
3536
37
38
39
40
4142
43
44
45
46
47
4849
50
51
52
53
5455
56
Fig. 1. Situation du site de plein air du Jas-d’en-Biel-1 dans le département des Pyrénées-Orientales. L’étoile indique lesite. En médaillon, situation en France.Fig. 1. Jas-d’en-Biel-1 open air site location (star) in the French Eastern-Pyrenees. Inset, location in France.
UN
CO
RR
EC
TED
PR
OO
Fparvenus. La collection est exclusivement constituée de ramassages de surface soit au sol, soit surune coupe stratigraphique naturelle, qui ont eu lieu en tenant compte des conditions climatiqueset du rythme de la viticulture locale. Après la taille des vignes et le ramassage des sarments, le soldevient alors visible. Les pluies de printemps dégagent les objets en silex qui se détachent par leurcouleur généralement blanchâtre sur le fond ocre de la terrasse argileuse. Au cours de cesmoments, les « récoltes » ont été plus fructueuses. Tous les objets discriminables à l’œil ont étéprélevés, ce qui explique que l’on remarque dans la série étudiée, des pièces hypermicrolithiques(1 mm). Dans ces conditions, la sous-représentation des lamelles à dos ou tronquées (nos 84 à 87de la typologie Sonneville-Bordes et Perrot, 1954–1956) (ILd = 4,4 %) ne peut être attribuée auxconditions de ramassage.
En 1997, la parcelle qui constituait la zone de plus riche récolte (AH24) a été mise en jachère,puis affectée à l’élevage de chevaux de randonnée. La végétation sauvage (folle avoine, ciste,fenouil) et les excréments des bêtes ont rapidement tapissé le sol interdisant toute nouvellerecherche. Nous avons, dans ces conditions, mis fin aux prospections de surface et entreprisl’étude de la série des pièces récoltées. Toutefois, la forte concentration du matériel lithique nousa amenés, en janvier 2005, à tester l’opportunité d’une fouille par une étude sédimentologique.
3. Étude du sédiment (S.P. et C.P.)
3.1. But de l’étude
Les formations superficielles quaternaires qui recouvrent le synclinorium marnogréseuxalbien de Saint-Paul-de-Fenouillet sont, la plupart du temps, trop peu épaisses pour figurer sur la
H. Baills et al. / L’anthropologie xxx (2007) xxx–xxx 3
+ Models
ANTHRO 2284 1–26
Pour citer cet article : Baills, H. et al., Un premier jalon gravettien dans les Pyrénées-Orientales : le Jas-d’en-Biel-1, L’Anthropologie (2008), doi:10.1016/j.anthro.2008.02.007
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
6667
68
69
70
71
72
73
7475
76
Fig. 2. Situation du site du Jas-d’en-Biel-1 dans le cadastre de la commune de Tautavel (Pyrénées-Orientales).Fig. 2. Jas-d’en-Biel-1 location on the Tautavel cadastral survey (Pyrénées-Orientales).
UN
CO
RR
EC
TED
PR
OO
F
carte géologique (Berger et al., 1993). Elles ne dépassent le mètre que sur les pentes à proximitédes falaises, sources d’apport ou dans les fonds de vallées, lieux où les matériaux s’accumulent.Le site de plein air du Jas-d’en-Biel-1, localisé en pied de colline, actuellement en rive droite d’unpetit rec (appellation commune des ruisseaux en Catalogne), semble dans une situationd’accumulation sédimentaire favorable à la conservation de traces d’occupations humainespréhistoriques. Toutefois, il ne présente qu’une stratigraphie très réduite d’une cinquantaine decentimètres d’épaisseur, observable à l’est du site (Fig. 2) grâce à l’érosion due aux crues du recainsi qu’aux activités humaines. Sur le terrain, 94 % des pièces lithiques récoltées ont étédécouverts en surface, dans une zone grossièrement circulaire de seulement 10 m de rayon(Fig. 2). Les quelques objets repérés vers le milieu de la coupe stratigraphique naturelle, à l’est dusite, laissent supposer que la surface paléolithique légèrement oblique vers l’est, comme latopographie actuelle, a été tronquée par l’érosion du rec et par l’utilisation de ce chemin naturel(Fig. 3). Ainsi, malgré cette stratigraphie réduite et la faible épaisseur sédimentaire recouvrant leniveau à objets, la concentration du matériel lithique impliquait de déterminer si le matérielarchéologique avait pu rester suffisamment en place pour justifier d’une fouille avec prise decoordonnées des objets. Dans ce but, des échantillons ont été prélevés sur le site le27 janvier 2005 (Fig. 3) sur une quarantaine de centimètres de hauteur, en continu : septéchantillons de sédiments désagrégés (JDB-05-S1 à S7) ainsi qu’un bloc plâtré de sédiments nonperturbés (JDB-05-M1), dans lequel ont été confectionnées quatre lames minces (1/4 à 4/4) aprèsimprégnation sous vide par une résine polyester fluidifiée.
Dans l’impossibilité de subdiviser la stratigraphie sur le terrain, la présence de cettehypothétique surface d’occupation est donc testée par le biais d’une étude granulométrique etmicromorphologique destinée à discerner un litage, un polyphasage de la sédimentation et àmettre en évidence des pauses sédimentaires, voire l’existence d’une véritable surfaced’occupation.
3.2. Résultats des études granulométrique et calcimétrique
La granulométrie globale du sédiment (Fig. 4A), effectuée par tamisage, montre que lesparticules fines dominent nettement : la fraction inférieure à 2 mm, de l’ordre de 80 % pour lamoitié inférieure du profil, dépasse même 90 % pour la moitié supérieure. Cette séparation endeux niveaux granulométriques s’effectue juste au-dessus de l’altitude des industries retrouvéessur la coupe (sommet du prélèvement JDB-05-S5, vers 22 cm sous la surface). Les 70 % defraction supérieure à 2 mm du prélèvement de surface ne sont dus qu’à la présence d’une pierre.Ces pourcentages, calculés à partir des masses de chaque fraction, ne traduisent pas du tout unchangement de type de sédiment.
H. Baills et al. / L’anthropologie xxx (2007) xxx–xxx4
+ Models
ANTHRO 2284 1–26
Pour citer cet article : Baills, H. et al., Un premier jalon gravettien dans les Pyrénées-Orientales : le Jas-d’en-Biel-1, L’Anthropologie (2008), doi:10.1016/j.anthro.2008.02.007
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
9697
98
99
100
101
102103
104
105
106
107
108
109
110
Fig. 3. Profil est–ouest des parcelles AH24 et AH23 sur lesquelles est positionné le site du Jas-d’en-Biel-1.Fig. 3. East–West profile of the plots AH24 and AH23, where Jas-d’en-Biel-1 is located.
UN
CO
RR
EC
TED
PR
OO
FMême si le sommet du « niveau archéologique » correspond à une limite granulométrique, il
n’en est pas de même pour sa base. Ce « niveau » ne se distingue donc pas mais peut correspondreà la fin d’une stabilité sédimentaire.
La granulométrie de la fraction fine (Fig. 4B), réalisée au granulomètre à diffraction laser(Coulter LS 230 en voie humide, pourcentages en volume de chaque classe granulométrique), nepermet pas de retrouver la distinction en deux niveaux et encore moins d’individualiser le« niveau archéologique ». Les histogrammes de résultats montrent une très grande constancedans la composition du sédiment où les limons et les sables fins dominent (limons : 48 % ; sablesfins : 32 % ; sables grossiers : 12 % et argiles : 8 %, environ).
Cette monotonie traduit l’homogénéité du sédiment et probablement une origine et un modede mise en place uniques pour la fraction fine.
Les indices granulométriques (Fig. 4C) calculés à partir des données de la fraction fineconfirment ces premières observations (excepté l’indice de classement, les paramètres sontcalculés automatiquement à partir des données du granulomètre). L’homogénéité du sédiment estmise en évidence par un indice de classement (Trask–Sorting index, Rivière, 1977) compris entre2,1 et 2,4, révélant qu’une classe granulométrique domine nettement. La moyenne donne la taillemoyenne des grains pour chaque prélèvement : elle varie de 75 à 150 mm (classe des sables fins).Les médianes montrent que chaque prélèvement se répartit en deux volumes égaux de part etd’autre de 50 mm, valeur limite entre la classe des sables fins et celle des limons. Le mode indiquequelle est la taille des grains la mieux représentée dans le prélèvement considéré : il varie, ici,entre 50 et 75 mm, ce qui correspond au début de la classe des sables fins.
H. Baills et al. / L’anthropologie xxx (2007) xxx–xxx 5
+ Models
ANTHRO 2284 1–26
Pour citer cet article : Baills, H. et al., Un premier jalon gravettien dans les Pyrénées-Orientales : le Jas-d’en-Biel-1, L’Anthropologie (2008), doi:10.1016/j.anthro.2008.02.007
110
111
112
113114
115
116
117
118
119120
121122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
Fig. 4. Résultats de l’analyse des prélèvements de sédiments désagrégés JDB-05-S1 à S7. À gauche, colonnestratigraphique de référence, constituée par les lames minces issues du bloc JDB-05-M1 et emprise des prélèvementsde sédiments en fonction de la profondeur. (A) : Granulométrie globale, effectuée au tamis ; (B) : Granulométrie de lafraction inférieure à 2 mm, effectuée au granulomètre à diffraction laser Coulter LS 230 en voie humide. (C) : Paramètresgranulométriques ; (D) : Calcimétrie. En grisé, localisation des objets archéologiques repérés sur la coupe stratigraphique.Fig. 4. Data from the bulk sample analysis JDB-05-S1 to S7. On the left, stratigraphic reference column (thin sectionsfrom sample JDB-05-M1) and loose sediment sampling location according to depth. (A): Global granulometry, sievingmethod; (B): Fine fraction granulometry (< 2 mm), Coulter LS 230 laser diffraction granulometry, fluid module; (C):Granulometric parameters; (D): Calcimetry. Shaded zone, location of the archaeological finds on the stratigraphic profile.
UN
CO
RR
EC
TED
PR
OO
FH. Baills et al. / L’anthropologie xxx (2007) xxx–xxx6
+ Models
ANTHRO 2284 1–26
Pour citer cet article : Baills, H. et al., Un premier jalon gravettien dans les Pyrénées-Orientales : le Jas-d’en-Biel-1, L’Anthropologie (2008), doi:10.1016/j.anthro.2008.02.007
Fig. 5. Colonne micromorphologique de référence (JDB-05-M1) avec l’emprise des quatre différentes lames mincesréalisées (1/4 à 4/4 de haut en bas). En grisé, localisation des objets archéologiques repérés sur la coupe stratigraphique.
UN
CO
RR
EC
TED
PR
OO
FLe prélèvement JDB-05-S5 du « niveau archéologique » ne se distingue que par sa moyennegranulométrique mais cette valeur basse de l’ordre de 75 mm se retrouve également vers le hautde la stratigraphie (prélèvements JDB-05-S2 et S1), ne permettant pas d’isoler ce « niveau ».
Le dosage du carbonate de calcium (Fig. 4D) indique des concentrations comprises entre 7 et14 %. Ces teneurs, faibles, ne sont pas très contrastées et ne déterminent pas d’horizons bienmarqués. Elles peuvent être liées à des variations locales de porosité du sédiment et d’activitéracinaire.
En conclusion, l’analyse granulométrique effectuée sur les sept échantillons de la coupeprélevée ne permet pas d’individualiser un niveau sédimentaire à l’altitude des industrieslithiques récoltées sur la coupe. La fraction inférieure à 2 mm, particulièrement homogène(limon sableux fin), possède certainement une origine identique tout le long de la stratigraphie.En revanche, l’abaissement soudain et net des proportions d’éléments supérieurs à 2 mm au-dessus du niveau à industries traduit certainement un biphasage sédimentaire, originel ou/etpostdépositionnel.
L’échantillonnage pas assez serré pouvant être à l’origine de la non-perception d’un niveauarchéologique et l’éventualité d’une microstructure préservée (anthropique, érosive. . .) ontconduit à l’étude micromorphologique de lames minces taillées dans les sédiments nonperturbés.
3.3. Résultats de l’étude micromorphologique
L’ensemble des caractères observés sous microscope ne révèle pas de coupure nette dansla stratigraphie. Les quatre lames minces peuvent être regroupées en deux lots, les deuxbasales et les deux sommitales (Fig. 5)Q1 . Elles se distinguent par leur structure et leurproportion de fraction grossière, mais conservent des caractères proches. Le niveau de récoltedes industries lithiques correspond à la moitié supérieure de la lame mince 3/4. Il ne présenteque très peu de différences avec sa base et des dissemblances faibles avec les lames mincessus-jacentes.
Les éléments grossiers, distribués de manière homogène, sont constitués par des fragmentsde grès dont la taille varie de quelques millimètres à environ 2 cm, ils sont anguleux à émoussés.Ces grès sont composés presque exclusivement de grains de quartz aux arêtes vives, dont la tailleest de l’ordre d’une cinquantaine de microns. Quelques micas ainsi que des grains de glauconieplus ou moins ferruginisés complètent leur minéralogie. La couleur et la cohésion de cesfragments de grès sont variables. Plusieurs stades d’altération de la roche sont observés, àproximité sur la même lame mince, depuis un état sain où les grains sont jointifs et la rochetranslucide, jusqu’à un état où la roche n’est plus qu’un sable à matrice argileuse, avec pourintermédiaire des fragments gréseux opaques plus ou moins compacts. Entre ces aspectsextrêmes, il existe un continuum qui montre l’évolution de cette altération responsable de ladésagrégation de la roche. Une argile brunâtre, d’aspect fibreux en lumière polarisée, sedéveloppe entre les grains et peut envahir et revêtir l’ensemble des fragments gréseux.L’altération et la désagrégation des grès de la roche mère albienne fournissent donc la fractionlimonosableuse fine révélée par l’analyse granulométrique. Les deux lames minces de la moitiésupérieure de la stratigraphie présentent des fragments de grès moins nombreux, de plus petitetaille et aux arêtes plus émoussées.
H. Baills et al. / L’anthropologie xxx (2007) xxx–xxx 7
+ Models
ANTHRO 2284 1–26
Pour citer cet article : Baills, H. et al., Un premier jalon gravettien dans les Pyrénées-Orientales : le Jas-d’en-Biel-1, L’Anthropologie (2008), doi:10.1016/j.anthro.2008.02.007
131
132
133
134135
136
137
138139
140
141
142
143
144
145146
147
148
149
150151
152
153
154
155
156
157158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
Fig. 5. Micromorphological reference column (JDB-05-M1) with the position of the four thin sections (1/4 to 4/4 from topto bottom). Shaded zone, location of the archaeological finds on the stratigraphic profile.
UN
CO
RR
EC
TED
PR
OO
FLa matrice limoneuse brun-rouge montre, à la base de la stratigraphie, une structure organiséeen agrégats polyédriques, centimétriques et subanguleux. La porosité est de deux types :fissurale, limitant les agrégats entre eux, et cavitaire, ponctuant l’intérieur de ces agrégats, elle estalors d’origine biologique. Vers le milieu de la stratigraphie, la matrice devient plus abondante etsa structure polyédrique devient plus marquée, car de plus petit calibre. Dans les deux lamesminces sommitales, les agrégats sont plus arrondis et nombreux sont ceux d’origine biologique(traits excrémentiels, Bullock et al., 1985). La bioturbation pluricentimétrique s’exprimeégalement nettement, avec des perturbations dues aux lombrics.
Au sommet de la lame mince 3/4, une cavité biologique pluricentimétrique a été rempliesecondairement par plusieurs séquences granoclassées de limons quartzeux. Elle gênepartiellement la reconnaissance d’une structuration anthropique du sédiment. Une cavitésemblable est également présente en bas de la lame mince sommitale. Aucun litage sédimentaireprimaire n’est présent, même sous forme relictuelle ou désagrégée. Des microcharbons de boissont présents à l’altitude de la découverte des industries mais également au-dessus et en dessous.Ils peuvent avoir été intégrés au sédiment plus ou moins récemment lors d’incendies naturels oude pratiques agricoles spécifiques.
En conclusion, l’étude micromorphologique n’a pas permis de déceler des microstructuressusceptibles d’attester la présence d’un « niveau d’occupation », même si le sommet du niveau àindustries n’offre pas une grande surface de lecture. L’intensité de l’occupation paléolithique, laproximité de la surface, la bioturbation et la localisation de l’échantillonnage ont pu contribuer àmarquer trop faiblement ou à oblitérer le signal archéologique.
3.4. Synthèse géologique
Les analyses effectuées à partir des sédiments prélevés sur le site du Jas-d’en-Biel-1 ontpermis de montrer qu’ils constituent un ensemble homogène aux caractères très peu variablestout au long du profil. Les sédiments proviennent de l’altération et de la désagrégation des marnesgréseuses albiennes. Les différents degrés d’altération des fragments gréseux pour le mêmeniveau indiquent que le sédiment est redéposé, mêlant des fragments de grès plus ou moinsaltérés à des sables de désagrégation de la roche mère. L’absence de litage et l’hétérométrie dusédiment renvoient à un mode de mise en place par colluvionnement. Une limite granulométriquenette divise le profil en deux niveaux. Celle-ci pourrait être considérée comme une interfaceséparant le dépôt de deux nappes colluviales distinctes. C’est au cours de l’arrêt de sédimentationlimitant les deux unités que les gravettiens occupent le bord du rec. Cette limite peut égalementêtre due à la surimposition d’un front d’altération pédogénétique dont l’altitude se confondraitavec celle du niveau d’occupation paléolithique.
L’hypothèse d’une seule nappe colluviale englobant les industries préhistoriques est à écarter.Outre le fait sédimentaire qui s’accorde mal avec ce scénario, la fraîcheur des arêtes desindustries récoltées est incompatible avec le déplacement de celles-ci au sein d’un sédiment quicomporte une fraction grossière non négligeable, favorisant le concassage.
La plus grande abondance de fraction fine dans le niveau supérieur peut donc être liée soità un enrichissement éolien, soit à une dégradation pédologique plus intense vers le sommet,soit à des conditions hydrodynamiques et topographiques favorables à l’accumulation desfines, soit à plusieurs de ces actions. Des analyses plus poussées permettraient donc peut-être de déterminer si cet enrichissement en limons est la conséquence d’une péjorationclimatique postérieure à l’occupation humaine. Un calage chronologique plus serré endécoulerait.
H. Baills et al. / L’anthropologie xxx (2007) xxx–xxx8
+ Models
ANTHRO 2284 1–26
Pour citer cet article : Baills, H. et al., Un premier jalon gravettien dans les Pyrénées-Orientales : le Jas-d’en-Biel-1, L’Anthropologie (2008), doi:10.1016/j.anthro.2008.02.007
173
174
175
176
177
178
179
180
181182
183
184
185
186
187
188
189190
191
192
193
194
195196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207208
209
210
211212
213
214
215
216
217
218
UN
CO
RR
EC
TED
PR
OO
F3.5. Conclusion de l’étude géologique
Un groupe humain gravettien s’est installé sur des colluvions à proximité d’un petit rec. Sansqu’un épisode érosif ne soit enregistré, une deuxième nappe colluviale est venue lentementrecouvrir le niveau paléolithique. Par la suite, ces sédiments ont été repris par l’activitébiologique du sol, évidemment de mieux en mieux exprimée en remontant la stratigraphie.
Au vu de la concentration actuelle du matériel archéologique, la dispersion des objets parruissellement ou colluvionnement a été particulièrement faible. La fouille éventuelle desextrémités de la zone de concentration maximale pourrait donc se révéler potentiellementintéressante : à l’est, sur la petite parcelle préservée de l’érosion du rec et à l’ouest, pour la zoneamont de la partie la plus riche en vestiges. Toutefois, l’occupation humaine gravettienne a pu nepas être suffisamment intense et le recouvrement sédimentaire localement pas assez importantpour qu’elle soit préservée de la pédogenèse et des remaniements récents de surface.
4. Étude morphotypométrique de la série lithique (H.B.)
La collection provenant du Jas-d’en-Biel-1 compte 725 pièces lithiques. La surface des objetsprésente une patine blanchâtre. Cependant, quelques pièces peu cacholonnées ou certainesfractures permettent occasionnellement d’identifier des couleurs variées. Grégoire (2000) aprécisé, pour une période plus récente (Magdalénien), la diversité des roches siliceuses utilisées(silex, jaspe, calcédoine, silexite. . .) et a pointé les gîtes de prélèvement. Deux zones ont étéfréquentées par les préhistoriques. Le bassin de Bages-Sigean, à 30 km au nord-est du Jas-d’en-Biel-1, a fourni des silex d’âge oligocène et miocène de bonne taillabilité. Plus près, à 5 km à l’estdu site, des gîtes de superficie plus modeste ont donné des silex triasiques et crétacés. La couchede cacholong qui masque les caractères originels des surfaces ne permet pas de préciser laquellede ces deux zones a été préférentiellement fréquentée par les chasseurs du Jas-d’en-Biel-1.
H. Baills et al. / L’anthropologie xxx (2007) xxx–xxx 9
+ Models
ANTHRO 2284 1–26
Pour citer cet article : Baills, H. et al., Un premier jalon gravettien dans les Pyrénées-Orientales : le Jas-d’en-Biel-1, L’Anthropologie (2008), doi:10.1016/j.anthro.2008.02.007
218
219220
221
222
223224
225
226
227
228
229
230
231232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
Tableau 1Inventaire général des produits de débitageTable 1General inventory of debitage products
Identité Débris Éclats Lames–lamelles Coupsde burin
Nucléus Total débitage Total outils Total général
n % n % n % n % n %
Jas-d’en-Biel-1 452 62,34 72 9,93 10 82 1,38 11,31 23 3,17 18 2,48 657 68 725
Tableau 2Dimensions maximales et minimales des produits de débitageTable 2Maximal and minimal dimensions of debitage products
Type de produit du débitage Longueur (mm) Largeur (mm) Épaisseur (mm)
Maximale Minimale Maximale Minimale Maximale Minimale
Débris 101 1 51 2 1 1Éclats 53 12 57 5 18 2Lames 54 42 21 15 13 7Lamelles 35 9 13 3 6 1
UN
CO
RR
EC
TED
PR
OO
F
Cependant, il semble bien, pour les quelques pièces peu cacholonnées, que le gîted’approvisionnement ait bien été celui de Bages-Sigean.
Dans la série lithique que nous étudions, les débris sont majoritaires (Idébris = 62,3) (Tableau1). Il s’agit de résidus de débitage indiquant que certaines étapes au moins de l’opération de tailleont eu lieu sur le site lui-même. Les produits bruts laminaires et lamellaires représentent 12,7 %du débitage et dominent légèrement le stock des éclats (Iéclats = 9,9).
La morphométrie des débris indique une population nettement hétérogène présentant desvaleurs extrêmes éloignées (1 mm � Ldébris � 101 mm) (Tableau 2) associées à un écart-type fort(sdébris = 7,05) (Tableau 3). En fait, nous identifions ces débris à des produits balisant des étapesdifférentes du schéma opératoire (décorticage, épannelage, retouche. . .). Les rares lames(Ilames = 1,38) et les plus abondantes lamelles (Ilamelles = 11,31) présentent des produits plusstandardisés avec des valeurs extrêmes resserrées (42 mm � Llames � 54 mm et 9 mm � Llamelles
� 35 mm) (Tableau 2 et Fig. 6) qui ont pour moyenne : Llames = 35 mm et Llamelles = 17,38 mm.Les éclats montrent également des valeurs homogènes qui signent peut-être une volonté dutailleur de standardiser également ces produits (12 mm � Léclats � 53 mm et moyenne ;Léclats = 26,94 mm).
4.1. Les nucléi
Les 18 nucléi (2,48 % de la série) sont typologiquement diversifiés (sept types reconnus)(Tableau 4 haut) et démontrent un certain opportunisme du tailleur face, peut-être, auxcontraintes de la matière première siliceuse. Les nucléi sont tous diminutifs et n’autorisent plus la
H. Baills et al. / L’anthropologie xxx (2007) xxx–xxx10
+ Models
ANTHRO 2284 1–26
Pour citer cet article : Baills, H. et al., Un premier jalon gravettien dans les Pyrénées-Orientales : le Jas-d’en-Biel-1, L’Anthropologie (2008), doi:10.1016/j.anthro.2008.02.007
241
242
243244
245
246
247248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258259
260
261
Tableau 3Dimensions moyennes des produits de débitageTable 3Average dimensions of debitage products
Type de produit Longueur (mm) Largeur (mm) Épaisseur en mm
du débitage Moyenne s Moyenne s Moyenne s
Débris 13,65 7,05 9,52 4,74 3,30 2,16Éclats 26,94 8,99 21,31 8,43 6,83 3,05Lames 35,00 12,83 19,1 6,03 7,5 2,76Lamelles 17,38 7,06 8,53 3,56 3,14 1,61
Fig. 6. Longueurs des produits bruts de débitage. La marque carrée indique la position de la moyenne.Fig. 6. Length of debitage products. The square mark indicates the average position.
UN
CO
RR
EC
TED
PR
OO
F
poursuite de l’extraction de produits (moyenne ; Lnucléi = 29,22 mm). Le type bipolaire estdominant.
4.1.1. Fracturation des piècesLa bonne qualité apparente des surfaces et des tranchants plaide en faveur de l’absence de
déplacement des pièces depuis leur dépôt initial. On ne remarque pas de traces évidentes deconcassage. Les pièces brisées l’ont été anciennement (Fig. 7(16)) comme l’atteste la patine desplans de fracturation (Ifracturation = 63) (Tableau 5).
Les roches siliceuses enregistrent certains stigmates dont l’observation permetd’approcher le mode opératoire de la technique de taille. Nous avons dressé une typologiedes suivants :
� la morphologie des talons ;� des bulbes de percussion ;� de l’extension des surfaces corticales ;� du caractère des ondulations, des esquillements et des lancettes.
Enfin, nous avons recensé le nombre d’enlèvements antérieurs repérables sur la pièce. Lesdébris n’ont pas été pris en compte dans cette étude.
4.2. La morphologie des talons
Près de 28 % des pièces sont privées de leur partie proximale, ce qui interdit l’observation dutalon. Les talons corticaux sont rares (3 %), le tailleur ayant choisi de porter ses coups sur un plat
H. Baills et al. / L’anthropologie xxx (2007) xxx–xxx 11
+ Models
ANTHRO 2284 1–26
Pour citer cet article : Baills, H. et al., Un premier jalon gravettien dans les Pyrénées-Orientales : le Jas-d’en-Biel-1, L’Anthropologie (2008), doi:10.1016/j.anthro.2008.02.007
261
262
263
264265
266
267
268269
270
271272272
273273
274274
275275
276276
277277
278278
279279
272272273
274274275
276276277
278278279
280281
282
283
284285
286
Tableau 5Fragmentation des produits de débitageTable 5Fracturation of debitage products
Éclats Lames Lamelles Total
Entiers Indéterminé Brisés Entières Brisées Entières Brisées
Longs Larges Longs Larges
13 41 2 2 14 2 8 18 64 164
Tableau 4Typologie des nucléiTable 4Core typology
Type denucleus
Bipolaire Croisé Discoïde Unipolaire Pyramidal Multidirectionnel Plat Divers Total
effectif 4 1 1 2 1 3 1 5 18
Nucléus Longueuren mm
Largeuren mm
Épaisseuren mm
Moyenne 29,22 23,50 14,17s 7,11 8,13 6,03
Moyenne et écart-type de leurs dimensions.Average dimensions and standard deviations.
UN
CO
RR
EC
TED
PR
OO
F
de frappe préparé. Cependant, cet aménagement reste sommaire, puisque les talons lisses ouréduits sont majoritaires (39 %) au détriment des morphotypes facetté (4 %) et dièdre (4 %). Dans18 % des cas, le talon a volontairement été ôté. Enfin, les talons réduits majoritaires (20 %) vontplutôt dans le sens d’une taille avec intermédiaire (Tableau 6).
H. Baills et al. / L’anthropologie xxx (2007) xxx–xxx12
+ Models
ANTHRO 2284 1–26
Pour citer cet article : Baills, H. et al., Un premier jalon gravettien dans les Pyrénées-Orientales : le Jas-d’en-Biel-1, L’Anthropologie (2008), doi:10.1016/j.anthro.2008.02.007
286
287
288
289
290
Fig. 7. Industrie lithique du Jas-d’en-Biel-1.Fig. 7. Lithic industry from Jas-d’en-Biel-1.
UN
CO
RR
EC
TED
PR
OO
F
4.3. Les bulbes de percussion
Dans la série des éclats, les bulbes de type convexe sont largement dominants (58 %), cettetendance s’inverse pour les lames et lamelles où les bulbes plats sont la règle (60 et 41 %). On
H. Baills et al. / L’anthropologie xxx (2007) xxx–xxx 13
+ Models
ANTHRO 2284 1–26
Pour citer cet article : Baills, H. et al., Un premier jalon gravettien dans les Pyrénées-Orientales : le Jas-d’en-Biel-1, L’Anthropologie (2008), doi:10.1016/j.anthro.2008.02.007
290
291292
293
Tableau 7Typologie des bulbes de percussion des produits de débitageTable 7Percussion bulb typology of debitage products
Type de produit du débitage Bulbe plat Bulbe convexe Total produits
Effectif % Effectif %
Éclats 18 25 42 58 72Lames 6 60 1 10 10Lamelles 34 41 13 16 82Total des observations 58 56 164
Tableau 6Morphologie des talons des produits de débitageTable 6Butt morphology of debitage products
Type detalon
Réduit Lisse Facetté Dièdre Cortical Absent Ôté Indéter-miné
Total
Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % Effectif %
40 20 39 19 8 4 8 4 7 3 57 28 37 18 8 4 204
Fig. 8. Diagramme radar des angles d’éclatement et de chasse des produits de débitage.Fig. 8. Radial diagram of reflection and striking angles.
UN
CO
RR
EC
TED
PR
OO
Fpeut penser que le tailleur a, dans la réalisation de son geste, associé deux techniques : pourobtenir des éclats, une frappe certainement directe au percuteur tendre et pour détacher desproduits laminaires ou lamellaires une frappe plutôt indirecte avec intermédiaire tendre(Tableau 7).
4.4. Les angles d’éclatement et de chasse
Les angles formés par le talon et les faces sont des indicateurs pour appréhender la façon dontles produits ont été détachés du nucléus. Tant pour les angles d’éclatement que de chasse, lafréquence maximale se situe entre 908 et 1008. Les produits obtenus possèdent, dans ce cas defigure, des faces sensiblement parallèles entre elles et perpendiculaires au plan de frappe(Fig. 8).
4.5. Extension des surfaces corticales
Soixante-deux des produits de débitage ne portent aucune trace visible de cortex. La plupartdes pièces corticales (74,2 %) ont une superficie de cortex comprise entre 1 et 49 %. Lessuperficies supérieures à 50 % de cortex sont peu fréquentes (25,8 %) et les pièces que nousconsidérons comme vraiment corticales (zone corticale supérieure ou égale à 79 % de la surfacede la pièce) sont rares (9,7 %). Par rapport aux éclats ou aux lamelles, les lames sont les supportsqui présentent le plus fréquemment des zones corticales. Ce phénomène est, sans doute, à mettreau compte de leurs dimensions importantes en regard de la faible taille initiale des rognons dematière première (Tableau 8).
H. Baills et al. / L’anthropologie xxx (2007) xxx–xxx14
+ Models
ANTHRO 2284 1–26
Pour citer cet article : Baills, H. et al., Un premier jalon gravettien dans les Pyrénées-Orientales : le Jas-d’en-Biel-1, L’Anthropologie (2008), doi:10.1016/j.anthro.2008.02.007
293
294
295
296
297
298299
300
301
302
303
304305
306
307
308
309
310
311
312
312
Tableau 8Organisation par classe des pièces présentant des zones résiduelles de cortexTable 8Organization by class of the artefacts presenting residual zones of cortex
Type de produitdu débitage
De 1 19 %de cortex
De 20 à 49 %de cortex
De 50 à 79 %de cortex
De 79 à 100 %de cortex
Total deproduits
Effectif % Effectif % Effectif % Effectif %
Éclats 14 19 16 22 6 8 6 8 72Lames 7 70 3 30 2 20 0 0 10Lamelles 5 6 1 1 2 2 0 0 82Total des observations 26 20 10 6 164
Tableau 9Ondulations, esquillements et lancettesTable 9Undulations, esquillements and lancets
Type deproduitdudébitage
Ondulationsnulles
Visibles Accusées Total Esquille-ments nuls
Visibles Accusés Total Lancettesnulles
Visibles Total Totaldesobservations
Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % effectif % effectif %
Éclats 49 62 27 34 3 4 79 43 57 29 38 4 5 76 73 92 6 8 79 235Lames 21 100 0 0 0 0 21 11 73 4 27 0 0 15 17 89 2 11 19 59Lamelles 49 82 11 18 0 0 60 43 86 7 14 0 0 50 53 95 3 5 56 170
UN
CO
RR
EC
TED
PR
OO
F
4.6. Caractère des ondulations, des esquillements et des lancettes
En règle générale, le morphotype dominant se caractérise par l’absence d’ondulations,d’esquillements et de lancettes à la face interne. Ces paramètres plaident en faveur d’une taille aupercuteur tendre, avec ou sans intermédiaire. Les éclats présentent, cependant, des fréquences dela variable « caractère visible » qui vont dans le sens des observations mentionnées pour latypologie des formes des bulbes de percussion (Tableaux 9 et 10).
5. Caractères généraux de la chaîne opératoire
Les occupants du Jas-d’en-Biel-1 ont utilisé des roches siliceuses de bonne taillabilité qu’ilsont récoltées sur des gîtes distants de 5 km à 30 km du site. Le caractère diminutif des nucléi etl’absence d’éclats d’entame engagent à penser que les phases initiales du débitage (mise en formedu nucléus) n’ont pas eu lieu sur le site. Les nombreux talons lisses ou réduits indiquent que lestailleurs ont peu ou pas aménagé le plan de frappe, les coups étant portés sur une surface plane. Lasuite de l’opération de plein débitage se réalise de façon différente pour l’obtention des éclats etdes lames/lamelles. Pour les premiers, la percussion a pu prendre la forme directe avec utilisationd’un percuteur tendre. Les stigmates plus lisibles (ondulations, esquillements, lancettes) et laprésence de 17 % de cas de réflexion de l’onde nous semblent de bons indicateurs pour nousprononcer en faveur de cette technique. Pour les secondes, l’utilisation de la technique de la crête(Tableau 11 et Fig. 7[14]) (6,5 % de lames/lamelles sont à crête) avec percussion indirecte semblela plus probable. Les accidents de taille (réflexion, outrepassage) sont extrêmement rares sur cesproduits (un seul cas repéré).
H. Baills et al. / L’anthropologie xxx (2007) xxx–xxx 15
+ Models
ANTHRO 2284 1–26
Pour citer cet article : Baills, H. et al., Un premier jalon gravettien dans les Pyrénées-Orientales : le Jas-d’en-Biel-1, L’Anthropologie (2008), doi:10.1016/j.anthro.2008.02.007
312
313314
315
316
317
318
319320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
Tableau 10Organisation par classe du nombre d’enlèvements sur la face supérieure des produits de débitageTable 10Organization by class of the number of removals on the upper face of debitage products
Type de produitdu débitage
0 enlèvement De 1 à 2enlèvements
De 3 à 5enlèvements
De 6 à 9enlèvements
Total desproduits
Effectif % Effectif % Effectif % Effectif %
Éclats 2 3 0 0 0 0 0 0 72Lames 0 0 9 90 15 150 0 0 10Lamelles 0 0 41 50 43 52 0 0 82Totaux des observations 2 50 58 0 164
Tableau 11État des bords des lamellasTable 11Condition of bladelet edges
Type de produit Réfléchis Outrepassés À crête Total des produits
Du débitage Effectif % Effectif % Effectif %
Éclats 12 17 0 0 0 0 72Lames 0 0 0 0 2 20 10Lamelles 0 0 1 1 4 5 82Total des observations 12 1 6 164
UN
CO
RR
EC
TED
PR
OO
F
Les valeurs des angles de chasse et d’éclatement montrent la volonté des tailleurs d’obtenirdes produits de profil rectiligne globalement standardisés.
6. État et fracturation des lamelles
L’effectif des lames (dix pièces) est trop faible pour être traité statistiquement. Les lamelles,avec 82 pièces, sont les produits de plein débitage les plus nombreux. À ce titre, elles font l’objetde ce paragraphe. Une seule lamelle porte la trace du feu. Les lamelles se présentent dans 35,5 %des cas sous la forme de fragments non orientables. Nous les avons classées indéterminables. Lesautres (Tableau 12) s’organisent en 33,9 % de proximales et proximomésiales, 24,2 % demésiales et 6,4 % de distales. On ne remarque pas, dans cette répartition, de tendance nette pourune fracturation dominante, même si les tronçons proximaux sont les plus nombreux. Les bordssont bruts dans 84 % des cas (Tableau 13), ils montrent de façon fréquente des esquillures. On neremarque pas de différence concernant la latéralisation de l’abattage (Tableau 11).
6.1. Les outilsQ2
Les outils représentent 9,38 % de l’effectif total de la série lithique. Ces outils ont pour supportdans 25 % des cas, une lame ; dans 29,4 %, une lamelle et dans 39,7 %, un éclat. Un burinnucléiforme utilise un nucléus comme support et quatre outils ont un support indéterminable.
H. Baills et al. / L’anthropologie xxx (2007) xxx–xxx16
+ Models
ANTHRO 2284 1–26
Pour citer cet article : Baills, H. et al., Un premier jalon gravettien dans les Pyrénées-Orientales : le Jas-d’en-Biel-1, L’Anthropologie (2008), doi:10.1016/j.anthro.2008.02.007
332
333
334
335336
337
338
339
340
341
342
343
344
345346
347
348
348349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
Tableau 12Fragmentation des lamellasTable 12Bladelet fracturation
Lamelles Proximales Proximomésiale Mésiales Distales Indéterminées Total
Effectif 13 8 15 4 2 62
Tableau 13Produits de débitage réfléchis, outrepassés et à crêteTable 13Resolved, plunging and crest debitage products
Sur 82 lamelles Bord gauche esquillures Retouché Brut Bord droit esquillures Retouché Brut
Effectif 12 1 69 15 5 62
Tableau 14Principaux indices typologiques du Jas-d’en-Biel-1 et de l’abri Pataud (Dordogne)Table 14Main typological indexes from Jas-d’en-Biel-1 and from abri Pataud (Dordogne)
Indices IG IB IBd IBt IP IOc IT ILR Iesq IOA Imic GP
Jas-d’en-Biel-1 11,76 35,29 13,23 16,18 1,47 4,41 1,47 14,70 5,88 10,29 5,90 8,82Pataud
Protomagdalénien3,37 24,91 17,73 4,84 3,46
PataudPérigordien VI
13,76 31,39 7,33 18,49 1,75 30,94
PataudPérigordien moyen
19,31 20,98 12,01 4,75 2,96 35,74
UN
CO
RR
EC
TED
PR
OO
FH. Baills et al. / L’anthropologie xxx (2007) xxx–xxx 17
+ Models
ANTHRO 2284 1–26
Pour citer cet article : Baills, H. et al., Un premier jalon gravettien dans les Pyrénées-Orientales : le Jas-d’en-Biel-1, L’Anthropologie (2008), doi:10.1016/j.anthro.2008.02.007
Fig. 9. Industrie lithique du Jas-d’en-Biel-1.Fig. 9. Lithic industry from Jas-d’en-Biel-1.
UN
CO
RR
EC
TED
PR
OO
FCette industrie, sans être de grandes dimensions, n’est pas microlithique (Imic = 5,9). Une seulepièce indique que la technique de fracturation par microburin (microburin proximal) (Fig. 7(12))était connue sur le site. En fait si l’on compare le rapport (fréquence d’outil sur un type desupport–fréquence de ce même type de support brut), on constate que les tailleurs ont privilégiéles lames comme support de leurs outils. Classiquement, certains outils, telles les pointes de LaGravette, sont systématiquement réalisés sur des lamelles (Tableau 14).
Les grattoirs sont moins nombreux que les burins (IG = 11,76). Le grattoir simple dominenumériquement la classe de ces outils, on y remarque la présence du type grattoir sur lameretouchée sur un bord (Fig. 9[13]) et du grattoir surélevé (Fig. 9(12)). Le grattoir peut êtreoccasionnellement associé à un burin (IOm = 4,41).
Les burins constituent la classe la plus nombreuse de l’outillage du Jas-d’en-Biel-1(IB = 35,29). Leur fabrication semble avoir eu lieu sur le site, au moins, pour une partie d’entreeux. Les chutes premières (Fig. 10[7, 8]) sont les plus abondantes (74 %), les raffûtagessuccessifs se manifestent par la présence de chutes de recoupe (Fig. 10[9]) (26 %). La forme
H. Baills et al. / L’anthropologie xxx (2007) xxx–xxx18
+ Models
ANTHRO 2284 1–26
Pour citer cet article : Baills, H. et al., Un premier jalon gravettien dans les Pyrénées-Orientales : le Jas-d’en-Biel-1, L’Anthropologie (2008), doi:10.1016/j.anthro.2008.02.007
360
361
362
363
364
365
366367
368
369
370371
372
373
374
Fig. 10. Industrie lithique du Jas-d’en-Biel-1.Fig. 10. Lithic industry from Jas-d’en-Biel-1.
UN
CO
RR
EC
TED
PR
OO
FH. Baills et al. / L’anthropologie xxx (2007) xxx–xxx 19
+ Models
ANTHRO 2284 1–26
Pour citer cet article : Baills, H. et al., Un premier jalon gravettien dans les Pyrénées-Orientales : le Jas-d’en-Biel-1, L’Anthropologie (2008), doi:10.1016/j.anthro.2008.02.007
Tableau 15Inventaire typologique des outilsTable 15Stone tool types
No Dénomination Effectif %
1 Grattoir simple 4 5,972 Grattoir atypique 1 1,473 Grattoir double 1 1,474 Grattoir ogival 0 0,005 Grattoir sur lame ou éclat retouché 1 1,476 Grattoir sur lame aurignacienne 0 0,007 Grattoir en éventail 0 0,008 Grattoir sur éclat 0 0,009 Grattoir circulaire 0 0,00
10 Grattoir unguiforme 0 0,0011 Grattoir caréné 0 0,0012 Grattoir caréné atypique 0 0,0013 Grattoir épais à museau 0 0,0014 Grattoir plat à museau ou à épaulement 0 0,0015 Grattoir nucléiforme 1 1,4716 Rabot 0 0,0017 Grattoir–burin 3 4,4118 Grattoir–lame tronquée 0 0,0019 Burin–lame tronquée 0 0,0020 Perçoir–lame tronquée 0 0,0021 Perçoir–grattoir 0 0,0022 Perçoir–burin 0 0,0023 Perçoir 1 1,4724 Perçoir atypique ou bec 0 0,0025 Perçoir atypique ou bec multiple 0 0,0026 Microperçoir 0 0,0027 Burin dièdre droit 3 4,4128 Burin dièdre déjeté 4 5,8829 Burin d’angle 2 2,94
30A Burin sur cassure 0 0,0030B Burin sur pan naturel 0 0,00
31 Burin multiple dièdre 1 1,4732 Burin busqué 0 0,0033 Burin bec de perroquet 0 0,0034 Burin sur troncature retouchée droite 1 1,4735 Burin sur troncature retouchée oblique 5 7,3536 Burin sur troncature retouchée concave 0 0,0037 Burin sur troncature retouchée convexe 2 2,9438 Burin sur troncature retouchée latérale 0 0,0039 Burin transversal sur encoche 0 0,0040 Burin mulitple sur troncature retouchée 1 1,4741 Burin multiple mixte 2 2,9442 Pointes de Noailles 0 0,0043 Burin nucléiforme 1 1,4744 Burin plan 2 2,9445 Couteau à dos, type abri Audi 0 0,0046 Couteau ou pointe de Châtelperron 0 0,0047 Pointe de Châtelperron atypique 0 0,0048 Pointe de La Gravette 1 1,4749 Pointe de La Gravette atypique 0 0,00
UN
CO
RR
EC
TED
PR
OO
Fdièdre est présente (IBd = 13,23), mais elle est dominée par celle sur troncature (IBt = 16,18).Les burins dièdres peuvent prendre un profil d’axe (Fig. 9[4]) ou être déjetés (Fig. 7[9]). Le typed’angle sur cassure est également connu (Fig. 9[8]). Les burins sur troncature sont les plusnombreux. Leur typologie est établie à partir de l’orientation de la troncature : droite (Fig. 7[15]),oblique (Fig. 9[1, 3, 6]) ou convexe (Fig. 9[5, 11]). Les formes multiples sont fréquentes :multiple sur troncature retouchée (Fig. 9[7, 10]) ou multiple mixte (Fig. 9[2]).
Les perçoirs sont rares (IP = 1,47) mais peuvent être de belle facture (Fig. 7(4)).Les pointes de La Gravette existent sans être très fréquentes (IPD = 5,88). On y note la forme
classique sur lamelle à retouche inverse envahissante de la base (Fig. 10(2)), mais également desmicrogravettes (Fig. 10(3, 5)).
Les lames retouchées sont présentes (ILR = 14,70) avec les deux variantes : à unseul bord retouché (Fig. 7[10, 11] et Fig. 10[11, 12]) et avec les deux bords retouchés (Fig. 7[2, 3, 8]).
H. Baills et al. / L’anthropologie xxx (2007) xxx–xxx20
+ Models
ANTHRO 2284 1–26
Pour citer cet article : Baills, H. et al., Un premier jalon gravettien dans les Pyrénées-Orientales : le Jas-d’en-Biel-1, L’Anthropologie (2008), doi:10.1016/j.anthro.2008.02.007
374
375
376
377
378
379
380
381382
383
384385
386
387
Tableau 15 (Continued )
No Dénomination Effectif %
50 Microgravette 3 4,4151 Pointe des Vachons 0 0,0052 Pointe de Font-Yves 0 0,0053 Pièce gibbeuse à bord abattu 0 0,0054 Fléchette 0 0,0055 Pointe à soie (de la Font-Robert) 0 0,0056 Pointe à cran périgordienne 0 0,0057 Pièce à cran 1 1,4758 Lame à bord abattu total 0 0,0059 Lame à bord abattu partiel 0 0,0060 Pièce à troncature droite 0 0,0061 Pièce à troncature oblique 0 0,0062 Pièce à troncature concave 0 0,0063 Pièce à troncature convexe 0 0,0064 Pièce bitronquée 1 1,4765 Pièce à retouches continues sur un bord 4 5,8866 Pièce à retouches continues sur deux bords 6 8,8267 Lame aurignacienne 0 0,0068 Lame aurignacienne à encoche ou étranglement 1 1,47
69–72 Outils solutréens 0 0,0073 Pic 0 0,0074 Pièce à encoche 4 5,8875 Pièce denticulée 1 1,4776 Pièce esquillée 4 5,8877 Racloir 0 0,0078 Raclette 2 2,94
79–83 Pièces géométriques 0 0,0084 Lamelle tronquée 1 1,4785 Lamelle à dos 2 2,9486 Lamelle à dos tronquée 0 0,0087 Lamelle à dos denticulée 0 0,0088 Lamelle à denticulée 0 0,0089 Lamelle à coche 0 0,0090 Lamelle Dufour 1 1,4791 Pointe azilenne 0 0,0092 Divers 0 0,00
Totaux 68 100,00
UN
CO
RR
EC
TED
PR
OO
FOn retrouve dans la liste des outils archaïques (IOA = 10,29) des encoches (Fig. 9[16]) etquelques rares pseudoraclettes partielles (Fig. 7[5]) ou totales (Fig. 10[10]). Les troncaturessont rares et on remarque l’existence d’une pièce à troncature double (Fig. 7[7]).Quelques pièces esquillées (IEsq = 5,88) se retrouvent également dans la famille des outilsarchaïques (Fig. 7[6]). Parmi les types représentés par un seul exemplaire, on trouve la lameétranglée de type aurignacien (Fig. 7[1]) et la lamelle Dufour atypique (Fig. 10[1]). Leslamelles à dos sont en nombre très réduit (ILd = 2,94) (Fig. 10[4] à retouche envahissante dudos). Une curieuse et hypothétique pièce à dos et cran adjacents (Fig. 10[6]) complète lestock.
7. Indices typologiques et éléments locaux de chronologie
La série des outils du Jas-d’en-Biel-1 se caractérise par une supériorité nette de la fréquencedes burins sur celle des grattoirs (IB = 35,29 et IG = 11,76). Parmi les premiers, les formes surtroncature retouchée dominent celles dièdres (IBt = 16,18 et IBd = 13,23). Dans cet ensembled’outils à l’indice laminaire élevé (IL = 53,7), les lames sont souvent retouchées (ILR = 14,70) etl’on note une présence modeste des pointes de La Gravette (IPD = 5,97). L’indice de groupecaractéristique périgordien (GP = 13,43) reste peu élevé à cause du faible taux des troncatures(IT = 1,47) et de celui des pointes de La Gravette. Ces indices vont, à notre avis, dans le sensd’une attribution chronoculturelle au Gravettien de l’occupation du Jas-d’en-Biel-1 (Tableau 14).Quelques indices secondaires peuvent compléter ce tableau : indice d’outils composites(Ioc = 4,41), indice d’outils archaïques (IOA = 10,29). L’indigence des outils microlithiques(Imic = 5,90) est à noter et apparaît peut-être comme un trait caractéristique de cette industrie duJas-d’en-Biel-1, au même titre que l’absence totale des burins de Noailles (Tableau 15).
Afin de confirmer l’attribution chronoculturelle du Jas-d’en-Biel-1 au Gravettien, nouscomparons son industrie lithique avec celles de gisements du Würmien récent des Pyrénées-Orientales. Nous nous proposons de confronter les données typologiques avec celles de sitesappartenant au paléolithique supérieur récent, c’est-à-dire pour l’aire que nous avons définie,avec des gisements relevant du Solutréen ou du Magdalénien. Une comparaison avec la grotte desEmbullas (Corneilla-de-Conflent) (Sacchi et Abelanet, 1969), unique site solutréen dudépartement, met en évidence un certain nombre de différences nettes dont la plus marquanteest certainement l’absence de la retouche solutréenne au Jas-d’en-Biel-1. Site récemment fouillé,la grotte des Conques (Vingrau) (Baills, 2003) permet de comparer le stock lithique du Jas-d’en-Biel-1 avec celui d’occupations correspondant aux phases moyenne et supérieure duMagdalénien (C3 14 320 � 90 ans B.P. et C2 13 335 � 40 ans B.P.). L’écrasante proportiondes lamelles à dos aux Conques (ILdC3 = 54,6 et ILdC2 = 37,9) en regard de leur très faibleprésence au Jas-d’en-Biel-1 (ILd/JB1 = 2,99) exclut notre site de la sphère d’obédiencemagdalénienne. On pourrait envisager une possible attribution à un Magdalénien inférieur ouancien microlamellaire tel qu’il a été récemment identifié dans le Sud de la France (Langlais,2004) ou sur le site de Montlléo (fouille J.M. Fullola) à Prats-i-Sansor en Espagne (15 400 � 80ans B.P.) (communication orale). L’une des caractéristiques de cette culture est son débitagemicrolamellaire à partir de supports variés dont des grattoirs-nucléi carénés. Les lamellesobtenues, souvent torses, présentent une retouche inverse d’un des bords. Certes, l’on note au Jas-d’en-Biel-1 quelques rares grattoirs surélevés, mais l’absence des microlamelles caractéristiquesproduites lors de ce type de débitage ne permet pas de les considérer comme des nucléi. Au termede ces quelques comparaisons à caractère départemental, il ressort que l’occupation du Jas-d’en-Biel-1 semble plutôt relever d’une phase ancienne du Paléolithique supérieur.
H. Baills et al. / L’anthropologie xxx (2007) xxx–xxx 21
+ Models
ANTHRO 2284 1–26
Pour citer cet article : Baills, H. et al., Un premier jalon gravettien dans les Pyrénées-Orientales : le Jas-d’en-Biel-1, L’Anthropologie (2008), doi:10.1016/j.anthro.2008.02.007
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
UN
CO
RR
EC
TED
PR
OO
F8. Le peuplement gravettien des zones limitrophes
Le stade supérieur du Périgordien ou Gravettien était, jusqu’à ce jour, inconnu sur le territoirede l’actuel département des Pyrénées-Orientales. Cette première identification vient combler trèspartiellement une lacune chronoculturelle dans la partie extrême-orientale des Pyrénées.
Les départements limitrophes de l’Aude, de l’Hérault et du Gard (Fig. 11) ont montré uneprésence gravettienne diffuse, les sites de référence ayant été anciennement fouillés. Legravettien y a été identifié plutôt sur la base des industries lithiques caractéristiques que par saposition stratigraphique. Ainsi, dans l’Aude, la couche E de la grotte de La Crouzade (Gruissan) alivré à ses fouilleurs, T. et P. Héléna (recherches 1912/1946), une série lithique au sein de laquelleon repère certains éléments gravettiens caractéristiques : fléchettes et pointes de La Gravette(Sacchi, 1986). La collection, dans son état actuel, demanderait à être réinterprétée de façon àtenter d’individualiser plus finement le matériel strictement gravettien de celui sous-jacentaurignacien. La tâche s’avère difficile, car une récente opération de rafraîchissement de la coupedu témoin résiduel (Perrenoud, 1995, 1996 ; Saos, 1995, 2003) n’a pas permis de retrouver cettecouche E. De plus, on peut douter de la validité scientifique des collections déposées à Narbonne,
H. Baills et al. / L’anthropologie xxx (2007) xxx–xxx22
+ Models
ANTHRO 2284 1–26
Pour citer cet article : Baills, H. et al., Un premier jalon gravettien dans les Pyrénées-Orientales : le Jas-d’en-Biel-1, L’Anthropologie (2008), doi:10.1016/j.anthro.2008.02.007
432
433434
435
436437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
Fig. 11. Localisation des sites gravettiens mentionnés dans le texte. 1 : l’Arbreda ; 2 : le Jas-d’en-Biel ; 3 : la Crouzade ;4 ; petite grotte de-Bize ; 5 : Bois-des-Brousses : 6 : la Salpêtrière ; 7 : la Verrière ; 8 : la Treille.Fig. 11. Localization of the Gravettian sites mentioned in the text. 1: l’Arbreda; 2: le Jas-d’en-Biel; 3: la Crouzade;4: petite grotte de Bize; 5: Bois-des-Brousses; 6: la Salpêtrière; 7: la Verrière; 8: la Treille.
UN
CO
RR
EC
TED
PR
OO
FBéziers et Tautavel dans la mesure où les auteurs des recherches ont soit globalisé les produits descouches E (Gravettien) et F (Aurignacien), soit trié les séries au profit des pièces caractéristiques.Djindjian et al. (1999), avec prudence, proposent un âge gravettien ancien pour cette couche E deLa Crouzade. On comprend cette réserve dans la mesure où ce diagnostic se fonde sur la présencede six pointes de La Gravette et d’une fléchette (total des séries Genson et Héléna).
Toujours dans l’Aude, la série lithique de la couche 6 de la petite grotte de Bize (fouilles Genson1927/1929) est également attribuée au Gravettien ancien sur les mêmes critères et avec la mêmeprudence que la couche E de La Crouzade. Dans le département du Gard, trois sites ont livré desséquences gravettiennes en stratigraphie. Bazile (1999) en a donné une approche synthétiquerécente. À la grotte de la Salpêtrière (Remoulins), les couches 32 A et 30 O-P (fouilles Escalon deFonton) et E1 (fouilles Bazile) se rapportent à un stade terminal du Périgordien supérieur. Despointes à dos et cran adjacent constituent des éléments caractéristiques de ces couches datées de22 350� 350 B.P. Le gisement de la Verrière à Pougnadoresse (Barbaza et Vigneron, 1980) estattribué à un « Gravettien supérieur évolué, contemporain ou légèrement postérieur auPérigordien VI du Sud-Ouest ». L’absence totale du burin de Noailles mérite d’y être soulignée.Enfin, la couche 3 de l’abri du Bois-des-Brousses (Aniane) serait globalement synchrone desoccupations de la Salpêtrière et de la Verrière (Barbaza et Vigneron, 1980). Plus récemment, en2000, une fouille programmée a été conduite sur le site de la Treille dans la dépression de Manduel-Redessan en Costière gardoise (Bazile, 2001). Sa position chronoculturelle correspond à unGravettien ancien caractérisé par l’absence d’ « outils spéciaux » selon la terminologie de Bosselin(1997). Les auteurs de la fouille fondent leur diagnostic sur de réelles similitudes avec le niveau 5(Périgordien IV) de l’abri Pataud. Cette occupation s’inscrirait dans une fourchette chronologiquede 28 000/26 000 B.P. S’il est clair que les industries de la Treille et du Jas-d’en-Biel-1 relèvent dephases du Gravettien caractérisées par l’absence d’outils spéciaux, on note, entre elles, quelquesdifférences sensibles. Ainsi, l’importance à la Treille des burins dièdres au détriment des formes àtroncature se trouve inversée au Jas-d’en-Biel-1. La pauvreté en pointes de la Gravette et la quasi-absence des lamelles à dos semble assez symptomatique du Jas-d’en-Biel-1. Pour ces raisons, nouspensons que le gisement catalan pourrait appartenir à une phase plus récente du Gravettienméridional, entre 24 000 et 22 000 B.P. à synchroniser peut-être avec l’interstade tempéré deTursac. En Espagne, le gisement de l’Arbreda à Serinyà (Soler, 1979) a livré une longue séquencedu Paléolithique supérieur local. Le Gravettien y est présent sous la forme de six niveaux distincts.Cette occupation est globalement attribuée au Gravettien récent et l’on n’y repère pas d’évolutioninterne.
9. Le site du Jas-d’en-Biel-1 dans le contexte national du Gravettien
Le Gravettien français a fait l’objet de plusieurs tentatives de structuration depuis celle dePeyrony (1946). La récente publication des fouilles Movius à l’abri Pataud (Dordogne) (Bricker,1995) permet de disposer d’une vision nouvelle de l’évolution interne du Gravettien du Sud-Ouest sur une base plus actuelle. Le modèle émergeant de l’interprétation chronoculturelle decette belle stratigraphie validerait la succession suivante : Périgordien moyen (niveau 5),Noaillien (niveau 4), Périgordien VI (niveau 3), Protomagdalénien (niveau 2). La confrontationdes principaux indices et les diagrammes cumulatifs de ces séries lithiques avec celle du Jas-d’en-Biel-1 (Tableau 15 et Fig. 12) permettent de remarquer que c’est avec la série du niveau 3(Périgordien VI) que l’on note les ressemblances les plus nettes. Par ailleurs, le modèle proposépar Bosselin (Bosselin, 1997) met en évidence la complexité du Gravettien français entre 28 500et 21 000 B.P. L’auteur propose une structuration en sept faciès répartis sur l’ensemble du
H. Baills et al. / L’anthropologie xxx (2007) xxx–xxx 23
+ Models
ANTHRO 2284 1–26
Pour citer cet article : Baills, H. et al., Un premier jalon gravettien dans les Pyrénées-Orientales : le Jas-d’en-Biel-1, L’Anthropologie (2008), doi:10.1016/j.anthro.2008.02.007
447
448
449
450
451
452453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
UN
CO
RR
EC
TED
PR
OO
F
territoire national. Ces derniers sont définis sur la base de la présence de fossiles directeurs(pointe de la Font-Robert, burin de Noailles, burin du Raysse) mais également sur les fréquencescomparées de certains outils caractéristiques (burin sur troncature retouchée, burin dièdre, pointede La Gravette). En considérant les dates obtenues sur quelques sites de référence, la successionsuivante est proposée : Fontirobertien, Gravettien indifférencié, Noaillien, Rayssien, Laugérienet enfin, Protomagdalénien. Le faciès dont se rapproche le plus l’industrie du Jas-d’en-Biel-1semble être le Laugérien dont les dates sont globalement synchrones avec celles obtenues pour lePérigordien VI de l’abri Pataud (24 000/22 000 B.P.).
10. Perspectives pour l’étude du Gravettien dans la partie extrême orientale desPyrénées
Le site de plein air du Jas-d’en-Biel-1 vient combler une lacune spatiotemporelle dans la zoneméditerranéenne des Pyrénées. Il confirme la présence gravettienne dans cette aire géographiqueet pointe les liens culturels avec les autres sites implantés en bordure du Golfe du Lion. Malgré unmatériel numériquement faible, ce premier site gravettien des Pyrénées-Orientales s’inscrit assezsûrement dans une phase tardive de cette culture (Gravettien récent, Périgordien VI, Laugérien).Le recensement des gisements des zones limitrophes semble indiquer que la présencegravettienne s’y serait amplifiée durant sa phase récente, peut-être en liaison avec la dégradationdes conditions climatiques du Pléniglaciaire supérieur. Les conditions de conservation inhérentesau Jas-d’en-Biel-1 nous privent de la présence des restes fauniques et des apports fondamentauxdes études paléoenvironnementales. Le site de plein air du Jas-d’en-Biel-1 constitue donc unpremier jalon signant la présence gravettienne dans cette zone. Il faut, cependant, le considérercomme un repère initial concernant un stade tardif de cette culture. Des thématiques derecherches ultérieures pourraient se centrer sur la structuration de cette culture dont d’autresrégions ont démontré la complexité. Des prospections systématiques, en multipliant le nombre desites, développeraient une meilleure compréhension du peuplement gravettien. Par ailleurs, une
H. Baills et al. / L’anthropologie xxx (2007) xxx–xxx24
+ Models
ANTHRO 2284 1–26
Pour citer cet article : Baills, H. et al., Un premier jalon gravettien dans les Pyrénées-Orientales : le Jas-d’en-Biel-1, L’Anthropologie (2008), doi:10.1016/j.anthro.2008.02.007
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
Fig. 12. Diagrammes cumulatifs des fréquences des outils du Jas-d’en-Biel-1, du Protomagdalénien, du Périgordienmoyen et du Périgordien VI de l’abri Pataud (Dordogne).Fig. 12. Cumulative diagrams of tool frequencies from Jas-d’en-Biel-1, Protomagdalenian, middle Perigordian andPerigordian VI from abri Pataud (Dordogne).
UN
CO
RR
EC
TED
PR
OO
Frévision des problématiques sur la base des mobiliers émanant de la grotte de La Crouzade(Gruissan, Aude) devrait concourir à l’actualisation des données anciennes. Sur le site, la reprisedes recherches a débuté en 1995 lors de l’échantillonnage géologique de la coupe témoin par leCentre européen de recherches préhistoriques de Tautavel (Perrenoud, 1995 ; Saos, 2003). Cetravail demanderait à être poursuivi par réduction du témoin Héléna vers le fond du réseaukarstique. On pourrait en espérer une redynamisation des études paléoenvironnementales quifont cruellement défaut ce jour.
Remerciements
Nous tenons à remercier Madame Louise Byrne pour les traductions en anglais de cet article.
Références
Baills, H. dir., 2003. Les Conquès, des chasseurs et leur territoire. Études et Recherches Archéologiques de l’Université deLiège, ERAUL 101, Liège, p. 1–222.
Barbaza, M., Vigneron, E., 1980. Le gisement périgordien supérieur de plein air de la Verrière (Le Pin, Gard). Bulletin dela Société Préhistorique Française 77, 108–114.
Bazile, F., 1999. Le Paléolithique supérieur en Languedoc Oriental de 35 000 à 12 000 avant le présent. Le Milieu, lesHommes. Mémoire en vue de l’habilitation à diriger les recherches, Université de Perpignan. (3 tomes).
Bazile, F., 2001. La Treille (Manduel, Gard) : un nouveau gisement gravettien en Languedoc rhodanien. Bulletin de laSociété Préhistorique Française 98, 545–550.
Berger, G.-M., Fonteilles, M., Leblanc, D., Clauzon, G., Marchal, J.-P., Vautrelle, C., 1993. Notice explicative de la cartegéologique de France (1/50 000), feuille Rivesaltes (1090). Orléans, BRGM, 119 p. Carte géologique parM. Fonteilles, D. Leblanc, G. Clauzon, J.-L. Vaudin et G.-M. Berger (1993).
Bosselin, B., 1997. Le Protomagdalénien du Blot. Les industries lithiques dans le contexte culturel du Gravettien français.Études et Recherches Archéologiques de l’Université de Liège, ERAUL 64, Liège, p. 1–329.
Bricker, H.M. dir., 1995. Le Paléolithique supérieur de l’abri Pataud (Dordogne) : les fouilles de H.L. Movius Jr.Documents d’Archéologie Française 50, Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme, Paris, p. 1–328.
Bullock, P., Fedoroff, N., Jongerius, A., Stoops, G., Tursina, T., 1985. Handbook for soil thin section description. WaineResearch Publication, Albrighton, Wolverhampton, UK, p. 1–152.
Djindjian, F., Koslowsky, J., Otte, M., 1999. Le Paléolithique supérieur en Europe. Éditeur Armand Colin, Paris.Grégoire, S., 2000. Origine des matières premières des industries lithiques de paléolithique pyrénéen et méditerranéen.
Contribution à la connaissance des aires de circulations humaines. Thèse de doctorat, Université de Perpignan, CentreEuropéen de Recherches Préhistoriques, Tautavel.
Langlais, M., 2004. Réflexions sur la place des différents types de productions lamellaires au sein de la culturemagdalénienne du Languedoc méditerranéen et des Pyrénées catalanes. Pyrenae 35 (1), 191–200.
Perrenoud, C., 1995. Trou de la Crouzade (Gruissan, Aude) site no 11 170 003.P. Campagne de prélèvements 1995 (21mars – 21 avril). Rapport d’intervention pour le SRA Languedoc-Roussillon, p. 1–19 (inédit).
Perrenoud, C., 1996. GRUISSAN Grotte de la Crouzade. Bilan scientifique, Ministère de la Culture, Service Régional del’Archéologie du Languedoc-Roussillon, p. 31–32.
Peyrony, D., 1946. Une mise au point au sujet de l’Aurignacien et du Périgordien. Bulletin de la Société PréhistoriqueFrançaise 47, 232–237.
Rivière, A., 1977. Méthodes granulométriques : techniques et interpretations. Collection Techniques et méthodessédimentologiques. Éditions Masson, Paris.
Sacchi, D., 1986. Le Paléolithique supérieur du Languedoc occidental et du Roussillon. XXIe supplément à Gallia-Préhistoire. Éditions du CNRS, Paris, p. 1–287.
Sacchi, D., Abelanet, J., 1969. Le Paléolithique supérieur dans les Pyrénées orientales. Cahiers Ligures de Préhistoire etd’Archéologie, Bordighera-Montpellier 18, 9–12.
Saos, T., 1995. Étude stratigraphique de la grotte de La Crouzade (Gruissan, Aude). Mémoire de DEA du MuséumNational d’Histoire Naturelle. Université de Perpignan. Centre Européen de Recherches Préhistoriques, Tautavel, 25juin 1996.
H. Baills et al. / L’anthropologie xxx (2007) xxx–xxx 25
+ Models
ANTHRO 2284 1–26
Pour citer cet article : Baills, H. et al., Un premier jalon gravettien dans les Pyrénées-Orientales : le Jas-d’en-Biel-1, L’Anthropologie (2008), doi:10.1016/j.anthro.2008.02.007
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527528
529530
531532
533534
535536
537
538539
540541
542543
544
545546
547
548549
550551
552553
554555
556557
558559
560561
562563
564
565566
UN
CO
RR
EC
TED
PR
OO
FSaos, T., 2003. Cadre stratigraphique, paléoclimatique et géochronologique du Languedoc-Roussillon au cours duPléistocène supérieur d’après l’étude des remplissages de grottes. Thèse de doctorat, Université de Perpignan, CentreEuropéen de Recherches Préhistoriques, Tautavel.
Soler, N., 1979. La secuencia estratigráfica de la Cova de l’Arbreda (Serinyà, Gerona). Actas de la IV reunión del grupo deTrabajo del Cuaternario, Banyoles, p. 223–232.
Sonneville-Bordes, D., Perrot, J., 1954–1956. Lexique typologique du Paléolithique supérieur. Bulletin de la SociétéPréhistorique Française 51 (7), 52 (2), 53 (8) et 53 (9).
H. Baills et al. / L’anthropologie xxx (2007) xxx–xxx26
+ Models
ANTHRO 2284 1–26
Pour citer cet article : Baills, H. et al., Un premier jalon gravettien dans les Pyrénées-Orientales : le Jas-d’en-Biel-1, L’Anthropologie (2008), doi:10.1016/j.anthro.2008.02.007
565566
567
568569
570571
572572


































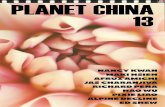




![La colección de manuscritos en lenguas de la India del Instituto Scindia de Investigaciones Orientales [Traducción]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6312a838b033aaa8b20fbc58/la-coleccion-de-manuscritos-en-lenguas-de-la-india-del-instituto-scindia-de-investigaciones.jpg)

![El mito indio del diluvio en su relación con los cuentos clásicos y próximo-orientales [The Indian Deluge Myth in its Relationship with Classical and Near-Eastern Narratives]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63136b2785333559270c3b3e/el-mito-indio-del-diluvio-en-su-relacion-con-los-cuentos-clasicos-y-proximo-orientales.jpg)





