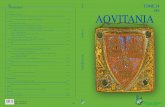Le triangle stratégique Chine-Russie-Inde : Possible contrepoids aux États-Unis en Asie centrale
« Sur les monnaies sassanides trouvées en Chine », Res Orientales, V, 1993, 89-139.
Transcript of « Sur les monnaies sassanides trouvées en Chine », Res Orientales, V, 1993, 89-139.
Circulation des monnaies, des marchandises et des biens. Res Orientales. Vol. V. 89
FRANÇOIS THIERRY Conservateur des monnaies orientales, Cabinet des Médailles-Bibliothèque Nationale
_________________________________________________________________________________________
SUR LES MONNAIES SASSANIDES TROUVEES EN CHINE
Les monnaies sassanides trouvées en Chine ont en général été utilisées comme des éléments permet-tant de conforter l’idée que l’on s’est faite des an-ciennes relations entre la Chine et l’Asie antérieure, et au delà, Rome et Byzance : une circulation monétaire allant de l’ouest vers l’est le long de la Route de la Soie, un commerce fondé sur la soie, contrôlé par la Perse sassanide (comme avant elle par la Perse arsacide), intermédiaire intraitable entre Rome-Byzance et la Chine.
L’étude a porté sur les lieux de trouvaille, sur les quantités, sur les souverains et les ateliers représen-tés, mais peu sur la nature exacte, composition précise et date d’enfouissement, des dépôts et des monnaies. Dépôts et monnaies ont été considérés comme des entités abstraites, n’ayant de lien qu’avec leur origine et aucun avec leur destination, et comme ayant circulé du lieu d’émission directement au lieu d’enfouissement. Le contexte chinois n’est pas pris en compte. On plaque sur la période qui va du IVe au VIIe siècle ap. J-C, la réalité historique, économique et culturelle de la période des Han antérieurs (IIe-Ier av. J-C.) : description de la route de la soie, statut et
état politique de l’Asie Centrale, situation politique, économique et culturelle de l’Empire chinois et rôle métropolitain de Chang’an sont considérés comme des données immuables. Or durant les quatre siècles qui nous occupent, sauf à partir du second tiers du VIIe, la réalité historique est bien différente de cette construction : division de la Chine, réduite aux terres proprement chinoises, état de guerre quasi permanent au nord, système monétaire éclaté et développement du bouddhisme sont les quatre phénomènes qui doivent être pris en compte pour donner son sens à la présence de monnaies sassanides sur les territoires qui forment aujourd’hui la Chine. De même, on considère que les systèmes monétaires sont les mêmes et reposent sur les mêmes conceptions de la monnaie ; on part du principe que les pratiques monétaires occidentales et la conception occidentale de la monnaie sont universelles. La demande chinoise n’est pas prise en compte et les conditions d’échange entre produits occidentaux recherchés par les Chinois et les produits chinois demandés par les Occidentaux ne sont pas compris autrement que dans le cadre des pratiques monétaires occidentales.
I-LES DÉCOUVERTES
1-Liste chronologique des découvertes connues. 1-1915 Astana Nécropole. Tombe I-3
Hormazd IV an 6 APL Khosro I 1 ? WHL sur les yeux du mort ; trouvées avec une imitation de monnaie byzantine (Justinien I avec la victoire au revers) et un changping wuzhu (émis à partir de 553 sous les Qi du Nord). Stein : 647, 993-994, pl CXX n°18 et 19 ; Xia 1974, pl. I.
______
1 Xia Nai la donne par erreur comme Khosro II.
90 F. T H I E R R Y
Carte 1
2-1915 Astana Nécropole. Tombe V-2
pas identifiable. dans la bouche du mort. Stein : 994 ; Xia 1974 : 110.
3-1915 Qodjo dans les ruines de la cité. non identifiée. Stein : 993.
4-1928 Yarkhoto tombe. Khosro II an 4 BYSh dans la bouche du mort, avec un kai yuan tong bao. Xia 1961 : 124
5-1928 Subashi (environs de Kutcha) dans les ruines de la cité. Arabo-sassanide, au nom de Khosro II an 29 ShY Huang 1958 : 110 ; Xia 1961 : 125.
6-ca 1950 Qodjo dans les ruines de la cité. Shapur II ShHP..../Buste à dr. dans le pyrée, RAST 4,1g Ø2,6 Shapur II ShH(P)HR(I) MZDISN BGI..../Buste à dr. dans le pyrée, RAST 3,4g Ø2,6 Shapur II BGI ShHPUH(RI)/Buste à dr. dans le pyrée, (R)AST 4,1g Ø2,9 Shapur II ShHPUHRI /Buste à dr. dans le pyrée, RAST(?) 4,3g Ø3 Shapur II ShHP(UHRI) /Buste à dr. dans le pyrée, (R)AST 4,3g Ø2,8 Shapur II (B)GI ShHPUHR /Buste à dr. dans le pyrée, RAST(?) 4,3g Ø3 Shapur II MZDIZN BGI ShHPUHRI /Buste à dr. dans le pyrée, (R)AS(T) 4,1g Ø2,6
S U R L E S M O N N A I E S S A S S A N I D E S T R O U V E E S E N C H I N E 91
Shapur II Sh(?)HPUHR..../Buste à dr. dans le pyrée, (R)AS(T) 4,1g Ø3 Shapur II BG(I) ShH(P)UHR /Buste à dr. dans le pyrée, RAS(T) 4,1g Ø2,7 Shapur II Sh(?)HPU(H)R /Buste à dr. dans le pyrée, RAST(?) 4,3g Ø2,6 Ardeshir II MZDISN BGI ARTHShTR /Buste à dr. dans le pyrée. 4,1g Ø2,6 Ardeshir II MZDISN BGI ...ML(K)AN...AN /Buste à dr. dans le pyrée 4,1g Ø2,7 Ardeshir II MZDISN BGI ARTHShT(R) /Buste à dr. dans le pyrée. 4,2g Ø2,6 Ardeshir II MZDI BGI / ARTHShTR /Buste à dr. dans le pyrée. 4,4g Ø3 Ardeshir II MZ... ARTHShTR ML...A /Buste à dr. dans le pyrée, (RA)ST(?) 4,2g Ø3 Ardeshir II ShT(?) MZDIZN BGI / ARTH(ShTR) /Buste à dr. dans le pyrée. 4,2g Ø3 Ardeshir II MZDIZN ARTHShTR MLKN /Buste à dr. dans le pyrée. 4,g Ø2,8 Shapur III MZDISN BGI Sh(H)PURI MLKAN M(LK)A / Pyrée, RAST ShH(PUHRI) .... 4,4g Ø2,9 Shapur III MZDISN BGI ShHPUH-RI MLKAN MLKA AIRAN(?)/ Pyrée,...ShH(PUHRI) ....4g Ø2,9 Shapur III MZDI(SN( BGI AR... MLKAN / Pyrée, ...(?).... 4g Ø2,9 trouvées dans une boîte. Monnaies similaires à celles de Tépé Marandjan (v. p. 000) Xia 1966 : 211-214.
7-1953 Astana dans les ruines de la cité. 2 Ardeshir II similitude avec les monnaies des N° 6 et 8. Xia 1961 : 127.
8-1955 Qodjo dans les ruines de la cité. Shapur II (Sh)H(P)R / Pyrée, buste à dr., (R)AS(T) Ø2,8 Shapur II BGI (ShH)PHR / Pyrée, buste à dr., RAS Ø3,1 Shapur II Sh(HPU)HRI / Pyrée, buste à dr., RAS Ø2,8 Shapur II ShHPUHRI / Pyrée, buste à dr., RA Ø3,1 Ardeshir II MZ(DISN) AR(TH)Sh(T)R /Pyrée, buste à dr. Ø3,1 Ardeshir II MZ(DISN) ARTHSh(T)R /Pyrée, buste à dr. Ø3,1 Ardeshir II MZ(DISN) ARTHSh(T)R /Pyrée, buste à dr. Ø3 Ardeshir II Sh MI(?) M(?) (ARTH)ShTR(?) /Pyrée, buste à dr. Ø2,8 Ardeshir II M(Z)DI(SN) BGI ARTHShTR /Pyrée, buste à dr. Ø2,8 Shapur III MZDISN BGI ShHPUH-RI MLKAN M(LK)A AI(RAN) / Pyrée, RAST-ShH.... Ø2,8 trouvées dans une boîte carrée. Monnaies similaires à celles du Tépé Marandjan (v. p.000) Xia 1961 : 117-121, pl.XXX.
9-1955 Luoyang, Beimang shan Tombe M 30. “16 monnaies de Peroz”2 dont : Peroz couronne III AY Kavad AY Xia 1961 : 128 ; Zhao GB : 94.
10-1955 Xian (banlieue) Tombe 007-M30, d’époque Tang. Khosro II an 35 SK une imitation, type de Khosro II (?). avec des kai yuan tong bao Xia 1961 : 123-124.
11-1956 Shaanxian, Henan Tombe de Liu Wei, datée 584. Khosro I an 29 MR Khosro I an 38 DA Xia 1961 : 126, pl.XXXI.
12-1956 Xining, Qinghai rue du Temple de Chenghuang 76 monnaies de Peroz, 15 avec couronne Type II et 61 avec couronne Type III, poids entre 3,8 et 4,1g, diamètre entre 2,5 et 3 cm. 9 pièces illustrées (Xia 1961 : 130-131) : Peroz, Type II, KaDI PIRUCI ML atelier AH, monogramme. Peroz, Type II, KaDI PIRUCI ML atelier ART, monogramme. Peroz, Type II, KaDI PIRUCI ML atelier AT, monogramme. Peroz, Type II, KaDI PIRUCI ML KA atelier AH, date illisible. Peroz, Type III, KADI PIRUCI ML atelier ST, monogramme. Peroz, Type III, KADI PIRUCI ML (?) atelier WA, monogramme. Peroz, Type III, KADI PIRUCI ML (?) atelier BA? , monogramme. Peroz, Type III, KADI PIRUCI ML atelier NY, monogramme.
______
2 Xia nai (Xia 1961 : 128 ) donne ces 16 monnaies comme étant toutes de Peroz, mais l’article de Zhao Guobi (Zhao GB : 94) est illustré par deux monnaies, l’une de Peroz, l’autre de Kavad.
92 F. T H I E R R Y
Peroz, Type III, KADI PIRUCI ML atelier KL, monogramme. Trouvées dans une jarre avec une vingtaine de monnaies de bronze, huoquan de Wang Mang (émis de 14 à 23 ap. J. C.) et kaiyuan tongbao (émis à partir de 621). Xia 1958 : 105 ; Wang PK : 492 ; Xia 1961 : 129-134.
13-1956 Yarkhoto tombe T6 Khosro II an ? DA Xia 1961 : 127
14-1956 Yarkhoto tombe T56 Khosro II an 11 WH Xia 1961 : 127.
15-IV 1957 Xian, Lixi, Zhangjiabo tombe n°410 (époque Sui). Peroz, Type III an ? WH Xia 1961 : 127.
16-1957 Xian, banlieue ouest Tombe de Li Jingxuan, datée de 608. Peroz (sans précision) (Ka)DI PRU MLK / WH (?) Ø2,6 3,7g trouvée avec des bijoux, de l’argenterie sassanide, de la verrerie, des étuis à ongles en argent et 5 wuzhu des Sui3. Tang JY : 471-472 ; Institut d'Archéologie : 19.
17-1958 Jinshengcun, Taiyuan, Shanxi Tombe n°5 (époque Tang). Khosro II an 11 WH contremarque “en forme d’oiseau”. trouvée avec des bijoux, 1 wuzhu et 13 kai yuan tong bao. Equipe du Shanxi : 475.
18-1959 Ulugh Art, Wuqia, Xinjiang, 947 monnaies parmi lesquelles : 2 Khosro I 567 Khosro II 281 arabo-sassanides, type Khosro II. ateliers cités par Xia Nai (Xia 1974 : 102) : ART, BLH, WH et ZL. Une pièce illustrée (Xia 1974 : pl. II) : Type de Khosro II, APDWLA (Abdullah), bismillah / an 44 atelier ST (Walker 73) trouvées avec 13 barres d’or dans un rocher fendu. Plusieurs monnaies ont des contremarques sur le rebord. Li YC : 482; Xia 1974 : pl.II.
19-1959 Astana Nécropole, tombe 302, datée 653. Yazdegerd III, Type II, avec AFZUT / an 20, BY, 2,9g Ø2,7 Yazdegerd III, Type II / an 1, LYW, 3,9g Ø3,1 La tombe contenait deux corps, les monnaies étaient placées dans la bouche. Xia 1966 : 214-216 ; Xia 1974 : 110.
20-1960 Astana Nécropole, tombe 319. non identifiable 3,45g Ø3. dans la bouche, percée. Xia 1966 : 214-216 ; Xia 1974 : 110.
21-1960 Astana Nécropole, tombe 322, datée 663. Khosro II an 33 WYH 2,9g Ø2,7. dans la bouche. Xia 1966 : 214-216 ; Xia 1974 : 110.
22-1960 Astana Nécropole, tombe 325, datée 656. Khosro II an ? atelier ? ?g Ø?. non identifiable dans la bouche de chacun des deux corps Xia 1966 : 214-216 ; Xia 1974 : 110.
23-1960 Astana Nécropole, tombe 332, datée ca. 665. Khosro II an 30 SK 2g Ø3. dans la bouche. Xia 1966 : 214-216 ; Xia 1974 : 110.
24-1960 Astana Nécropole, tombe 337, datée 657. non identifiée 2,1g Ø2,9. Xia 1966 : 214-216 ; Xia 1974 : 110.
25-1960 Astana Nécropole, tombe 338, datée 667. Khosro II an 37 AHM 3,45g Ø3. Xia 1966 : 214-216 ; Xia 1974 : 110.
______
3 L’attribution de ces 5 wuzhu aux Sui est sujette à caution dans la mesure où les wuzhu traditionnellement attribués aux Sui sont en fait des wuzhu des Wei de l’Ouest (Thierry 1988 : 349-351).
S U R L E S M O N N A I E S S A S S A N I D E S T R O U V E E S E N C H I N E 93
26-1960 Astana Nécropole, tombe 339, datée 626.
Khosro II an 31 (?) WHL 1,8g Ø3,1. Xia 1966 : 214-216 ; Xia 1974 : 110.
27-VII 1960 Yingdak, Guangdong Tombe n°8, époque des Qi du Sud, datée 497. 3 Peroz une an 11, une atelier AYL et une AL ; toutes sont percées. Xia 1961 : 128, Wang GC et Wang DM : 15.
28-IX 1963 Tianshui, Gansu terrassement. Peroz, couronne Type II, 5g Ø 2,9. Liu DY : 16-20.
29-1964 Astana Nécropole, tombe n°20, datée ca 706. Khosro II an 33 LYW 2,3g Ø2,7 dans la bouche du mort. Xia 1974 : 110.
30-1964 Astana Nécropole, tombe n°29, datée 685. Boran an 2 SK 3,9g Ø3,1 dans la bouche du mort. Xia 1974 : 110.
31-1964 Astana Nécropole, tombe KM8 (époque Tang). arabo-sassanide, type Khosro II, bismillah / an 30M(R) 3,1g Ø2,8 dans la bouche du mort. Xia 1974 : 110
32-XI 1964 Dingxian, Hebei Fondations d’un stupa Yazdegerd II KDI IeZDKRTI MLKAN / IeZDKRT(I) 3,38g Ø3,06 Yazdegerd II KDI IeZDKRTI M-LKAN / IeZDKR(TI) A 3,88g Ø3,16 Yazdegerd II KDI IeZDKRTI MLKAN MALKA / IeZDKR-... 4g Ø3,07 Au dr., de 6h à 8h, contremarque hephtalite, à 3h, tamga. Yazdegerd II KDI IeZDKRTI MLKAN / IeZDKR-? H 3,97g Ø2,91 Peroz, Type II KDI PIRUCI-MLKA / BM? 4g Ø2,89 Peroz, Type II KDI PIRUCI-MLKA / DA an 6 4,18g Ø2,81 Peroz, Type II KDI PIRU-CI / AY an ? 4,14g Ø2,77 Peroz, Type II KDI PIRUCI-MLKA / AB? an 6 4,04g Ø2,82 Peroz, Type II KDI PIRUCI-MLKA / AB an 3 4,18g Ø2,94 Peroz, Type II KDI PIRUCI-MLKA / LYW? an 14 4,17g Ø2,79 Peroz, Type II KDI PIRUCI-MLKA / WH an 9 4,15g Ø2,93 Peroz, Type II KDI PIRUC...?.../ DA an 5 4,1g Ø2,76 Peroz, Type II KDI PIRU-CI / ? an ? 4,13g Ø2,87 Peroz, Type II KDI PIRUCI...?... / AY sans date 4g Ø2,89 Peroz, Type II KDI PIRU-CI / AB an 9 4,12g Ø2,81 Peroz, Type II KDI PIRU-CI / AB an 9 4,10g Ø2,85 Peroz, Type II KDI PIRU-CI / AB an 9 3,84g Ø2,79 Peroz, Type II KDI PI...?...-CI MLK / AYL an 9 4,12g Ø2,89 Peroz, Type II KDI PIRU-CI / AB an T? 4,16g Ø2,89 Peroz, Type II KDI PIRUCI-LK... / AB an T? 4,17g Ø2,74 Peroz, Type II KDI PIRUCI-LK... / AB an T? 4,18g Ø2,94 Peroz, Type II KDI ...CI-MLK / AB an T? 3,59g Ø2,67 Peroz, Type II KDI PIRU-CI / WH an 6 4,16g Ø2,69 Peroz, Type II KDI PIRU-CI / ST? an ? 4,08g Ø2,85 Peroz, Type II illisible / AB an ? 3,9g Ø2,81 Peroz, Type II illisible / illisible 4,15g Ø2,92 Peroz, Type II illisible / AY an T? 4,38g Ø2,95 Peroz, Type II illisible / WH an 9 4g Ø2,73 Peroz, Type II illisible / illisible 4,4g Ø3,09 Peroz, Type II KDI PIRU-CI / AY an ? 4,13g Ø2,86 percée Peroz, Type II illisible / illisible 4,66g Ø3,19 Peroz, Type II KDI PIRUC-M... / AY an 6 3,9g Ø2,75 Peroz, Type II KDI PIRUCI-M... / AP? sans date 4,02g Ø3 Peroz, Type II KDI PIRUCI-M... / AS an ? 4,29g Ø2,9 Peroz, Type II illisible / ShW? an T? 4,15g Ø2,89 Peroz, Type III KDI PIRUCI-L... / Sh an T? 4,14g Ø2,8 Peroz, Type III KDI PIR-UCI / KL an T? 4,15g Ø2,88 Peroz, Type III KDI PIRUCI-MLK / WH an ? 4,03g Ø2,92 Peroz, Type III KDI PIRUCI-MLKAN / BA? an ? 4,15g Ø2,89
94 F. T H I E R R Y
Peroz, Type III KDI PIRUCI-M? / AYL? an ? 4,12g Ø2,71 Peroz, Type II illisible / illisible 4,4g Ø2,72 trouvées, avec divers objets d’or, d’argent et de jade, d’agate, de corail, avec des perles, des verreries et des monnaies chinoises dans les fondations d’une pagode des Wei du Nord, datée de 481. Xia Dingxian : 267-270 ; Equipe du Hebei : 252-259.
33-XII 1965 Chang’an, Tianziyu près du monastère de Guoqing. Khosro II an 37 NY 4g Ø3,3 Khosro II an 39 LYW 4,1g Ø3,3 Khosro II an 39 WYH 4g Ø3,3 Khosro II an 37 ShY 4,1g Ø3,3 Khosro II an 17 LD 3,6g Ø3,2 Khosro II an 25 BYSh 2,7g Ø3,2 Boran an 3 SK 4,1g Ø3,2 Trouvées dans un boîte d’argent à décor d’or. Zhu et Qin : 126-132 ; Chan-Houston : 153-160.
34-1965 nord-ouest de Hohote, Mongolie Intérieure Kavad I an 41 ARM 3,8g Ø2,8 Khosro I an 14 AY 3,6g Ø2,8 Khosro I an 41 ZL 3,8g Ø3,2 Khosro I an 14 WH 3,4g Ø3 Musée Mongolie Intérieure 1975 : 182-185.
35-1966 Astana Nécropole, tombe n°48, datée 604. Jamasp an 3 WH 4,07g Ø2,65 dans la bouche du mort, dorée, percée et munie d’un anneau. Xia 1974 : 110.
36-1966 Astana Nécropole, tombe n°73 (époque Tang). Khosro II an ? WH 3,8g Ø3 dans la bouche du mort. Xia 1974 : 110.
37-1967 Astana Nécropole, tombe n°363 (ca.710). Yazdegerd III 4 2,9g Ø3,2 dans la bouche du mort. Musée du Xinjiang (II) : 7.
38-1967 Astana Nécropole, tombe n°78, datée 638. Khosro II an ? AHM? 3,2g Ø3,1 dans la bouche du mort. Xia 1974 : 110.
39-1967 Astana Nécropole, tombe n°77 (époque Tang). Khosro II an 1 ShW? ?g Ø? dans la bouche du mort. Musée du Xinjiang (I) : 10 ; Xia 1974 : 110.
40-1967 Astana Nécropole, tombe n°92, datée 639. Khosro II an 30 WH? 3g Ø3 dans la bouche du mort, dorée, percée. Xia 1974 : 110.
41-1969 Astana Nécropole, tombe KM39 (époque Tang). une monnaie sassanide non identifiée dans la bouche du mort. Xia 1974 : 110.
42-1969 Astana Nécropole, tombe n°118 (époque Tang). Khosro II an 25 ART ?g Ø2,9 dans la bouche du mort. Musée du Xinjiang (I) : 10 ; Xia 1974 : 110.
43-1969 Xian, Hejiacun trésor et collection enfouis. Khosro II an 39 AHM drahm appartenant à une collection de monnaies comprenant des monnaies chinoises, antiques (dont un huobu doré) et du haut moyen-âge, une pièce du royaume de Gaochang, des monnaies japonaises du début du VIIIe et une mon-naie byzantine. Musée du Shaanxi : 36.
______
4 L’illustration donnée nous ferait plutôt attribuer cette monnaie à Hormazd V (Göbl : pl. XV n°233).
S U R L E S M O N N A I E S S A S S A N I D E S T R O U V E E S E N C H I N E 95
44-1970 Yaoxian, Shaanxi. Peroz,Type III sans date AW? 3,8g Ø2,75 Kavad I an 13 AS? 4,2g Ø2,9 percée Khosro I an 33 ST 4g Ø3,2 trouvées avec des wuzhu des Sui, des bracelets d’or, d’argent et de jade, des perles et des reliques bouddhiques, dans les fondations d’un stupa, daté de 604. Zhu et Qin : 126-132 ; Chan-Houston : 153-160.
45-1972 Astana Nécropole, tombe n°149 (époque Tang). Khosro II an 15 LD 4g Ø3,1 dans la bouche du mort, dorée, percée. Xia 1974 : 110
46-1973 Astana Nécropole, tombe n°206, datée 689. Khosro II an 30 WYH 3,1g Ø2,7 sur l’œil gauche du mort. Xia 1974 : 110.
47-III 1973 Kukgong, Guangdong tombe de l’époque des Dynasties du Sud (Ve s.). 9 monnaies sassanides non identifiées, et coupées en deux. tombe située à proximité de la pagode Nanhua. Nanfang ribao, 25 nov. 1973 ; Xia 1974 : 92 ; Wang GC et Wang DW : 15.
48-1973 Astana Nécropole, tombe n°115 (époque Sui). Peroz, Type III WH 2,2g Ø2,6 percée. Xia 1974 : 110.
49-1978-80 Bogdachin (royaume de Yanqi) dans la vieille cité. Peroz, Type III WH monogramme. Han X : 8-12.
50-I 1980 Anlu, Hubei tombe de la Princesse Yang (637). Peroz, Type II AS monogramme (n°246) Peroz, Type II AS monogramme (n°247) Peroz, Type II AS monogramme (n°248) Peroz, Type III AS monogramme (n°237) Peroz, Type III AY nom du roi (n°238) Peroz, Type III LA? nom du roi (n°239) Peroz, Type III ? nom du roi (n°240) Peroz, Type III AY nom du roi (n°241) Peroz, Type III AY nom du roi (n°242) Peroz, Type III AY nom du roi (n°243) Peroz, Type III AS nom du roi (n°244) Peroz, Type III AS nom du roi (n°245) Peroz, Type III WH nom du roi (n°249) Peroz, Type III NY nom du roi (n°250) Peroz, Type III BLH nom du roi (n°251) liaison de coin de revers pour les n°246 et 247. trouvées avec six kai yuan tong bao du Type I 5. La Princesse Yang était la femme de Li Ke, Prince de Wu, fils de l’Empereur Taizong des Tang. Musée d’Anlu : 83-93, pl. VI.
51-1981 Guyuan, Ningxia, tombe des Wei du Nord. Peroz, Type III 3,5g Ø2,7 (date et atelier non précisés). ZGQB 1990 II : 72/36.
52-IX 1983 Suikai, Guangdong. 20 monnaies sassanides avec des objets d’or et d’argent dans une jarre de terre. 3 Jamasp, 5 Peroz (type II), 11 Peroz (type III) et 1 Kavad (couronne du début et ans 11 à 13).6 Quatre monnaies, toutes percées, sont illustrées en photographie dans Guangdong p. 151 : Peroz, Type II KR monogramme Peroz, Type III ST an illisible Valkash RY an 1 Kavad KA an 12 Musée de Suikai : 243-246, Wang GC et Wang DW : 15.
______
5 Thierry kai yuan : 238-239 6 Attribuées par erreur, respectivement à Shapour III, Yazdegerd II, Peroz (type III) et Peroz (type II) (Musée local de Suikai :
246).
96 F. T H I E R R Y
53-1987 Guyuan, Ningxia, Yangtancun, tombe des Sui, ca. 610. Peroz, Type III 3,3g Ø2,5 (date et atelier non précisés). ZGQB 1990 II : 72/36 ; I.A. Ningxia : 19-20.
54-IX 1987 haute vallée de la Han, Shaanxi. 5 Khosro II trouvées avec deux wuzhu, vingt kai yuan tong bao et deux Qian Yuan zhong bao, dans une jarre. Sun ZW : 71.
55-1990 Ziyang, haute vallée de la Han, Shaanxi. Yezdegerd II an ? KL ?g Ø2,7. Shi 1991 : 44.
56-1991 Linxia, Gansu. Peroz, Type III 5g Ø2,4, deux trous ZGQB 1991-IV : 77.
57-III 1991 Sima Gou, canton de Yichuan, environs de Luoyang, Henan. Environ 200 monnaies trouvées dans une boîte de bois, “la plupart de Peroz”, avec quelques Khosro I et Khosro II. 12 monnaies illustrées : Peroz Types II et III, ateliers lisibles, AM, SR, NB, BBA et RA(?). Yu Q. : 128 ; Yang K. : 108-109.
58-VII 1991 Dongmagou, banlieue est de Luoyang, Henan, tombe Tang du début du VIIIe. Khosro II an ? SR percée Yu Q. : 129.
59-IX 1991 Luohe, Henan. Peroz, Type ? 3,85g Ø2,8. Peroz, Type ? 4g Ø2,7. Khosro (sans précision) 3,82g Ø2,6. Yang K. : 109. *-Yang Ke signale encore deux monnaies, Khosro I et Khosro II, dans la collection d’un numismate local, Jiao Zhengmin, mais il n’est rien dit de leur origine. Yang K. : 109.
60-1974 Zhong Taizhen, cantons de Lingtai (Gansu) 270 monnaies de plomb “portant des inscriptions en langue perse du début de la dynastie”. Comme ces pièces sont données comme de l’épargne des Han de l’Ouest (206 av.J.C.- 7 ap.J.C.), il s’agit vraisemblablement de monnaies arsacides. Yang et Yu : 81.
2-Localisation.
Parmi toutes ces monnaies trouvées sur le terri-toire de la République Populaire de Chine, certaines l’ont été dans des zones qui, au moment de leur en-fouissement, n’appartenaient pas à la Chine, ou qui, bien que soumises au pouvoir impérial, n’était pas considérées comme essentiellement chinoises. Il convient de faire la distinction entre les monnaies pro-venant de sites ou de territoires proprement chinois de celles exhumées dans des régions soumises à des pouvoirs ou à des états non-chinois. Du IVe à la seconde moitié du VIIe siècle, les territoires situés à l’ouest de Dunhuang ont été, sauf durant de très brèves périodes, indépendants du ou des pouvoirs chinois de la Chine du nord.
La géographie historique impose de diviser les régions qui nous intéressent en trois entités : la Chine, la partie occidentale de l’actuel Gansu et l’actuel Xinjiang. Les conclusions que l’on peut tirer d’un dépôt de monnaies sassanides et de sa composi-tion sont bien évidement différentes selon qu’il est
mis au jour en Chine propre (région où la circulation de ces monnaies est interdite et inusitée), au Hexi (région où elle existe) ou dans les Xiyu (région où elle est courante).
A-Les monnaies trouvées dans les Xiyu. Les “régions occidentales”, Xiyu, est le nom
traditionnellement donné par les historiographes et ar-chivistes chinois à toutes les régions situées à l’ouest de Dunhuang, depuis Gaochang jusqu’à Rome. La partie qui nous intéresse est l’ensemble des régions les plus orientales des Xiyu, formé de six royaumes principaux, Jushi-Gaochang (Yarkhoto-Qodjo), Yanqi (Karashar), Qushi (Koutcha), Shule (Kachgar), Yutian (Khotan) et Shanshan (Charlik). Ces royaumes qui avaient sous leur autorité un nombre variable de micro-états, étaient eux-mêmes les vassaux plus ou moins autonomes de grandes puissances comme les Kouchans ou la Chine ; lorsque ces deux empires furent évincés de l’Asie Centrale, ils furent remplacées, définitivement pour
S U R L E S M O N N A I E S S A S S A N I D E S T R O U V E E S E N C H I N E 97
les premiers et temporairement pour la seconde, dans leur rôle de grandes puissances par ceux qui les en avaient chassés, les Xiongnu, les Xianbei, les Rou-ran 7, les Gaoju, les Hua ou Yeta (Hephtalites), les Türks, les Türks de l’Ouest, les Tuyuhun (Togons), les Tibétains et les Türgechs (voir pp. 111-114). De l’autre côté des Pamir, existait le même type de rapport entre royaumes et principautés et entre royaumes et grandes puissances. Durant les pé-riodes de domination des nomades, les deux régions, est et ouest des Pamir, étaient soumis parfois aux mêmes maîtres, parfois à des tribus différentes. Il est arrivé que, jouant des rivalités entre les diverses grandes puissances ou entre les diverses hordes nomades, ou s’appuyant sur l’une d’elles, tel ou tel royaume se hisse au niveau de puissance régionale en attaquant et en satellisant des royaumes voisins. Mais on remarque en fin de compte la très grande stabilité de ces royaumes qui existaient déjà sous les Han, et qui, indépendants, ou vassaux fictifs, se maintiennent en dépit des envahisseurs successifs qui s’érigent en su-zerain, et qui ne disparaitront qu’avec l’islamisation. Cette région de l’Asie Centrale, soumise à l’influen-ce culturelle combinée de la Chine, de l’Inde du nord et de la Perse, est un important centre commercial, industriel et religieux ; ses caravanes vont de l’Inde à la Chine, de la Chine à la Perse et à Byzance, et de l’Inde à la Perse, ses soiries, alliant qualité chinoise et motifs sassanides se vendent aussi bien à l’est qu’à l’ouest et ses monastères et ses religieux servent de relais à la propagation du bouddhisme en Chine (Liu XR : 67-69, 72-74, 139-145 ; Watson : 548-549).
Les monnaies sassanides trouvées dans ces ré-gions sont les plus nombreuses, 1012 sur un total de 1430, mais il faut tenir compte de la présence dans ce décompte, du trésor d’Ulugh Art (Wuqia)[18], qui à lui seul compte 947 monnaies sassanides et arabo-sassanides. Hormis Ulugh Art, les lieux de mise au jour sont la nécropole d’Astana (27 ex.), le site de l’ancienne cité d’Astana (2 ex.), la vieille ville de Qodjo, ou Karakhodja (31 ex.), le site de Yarkhoto (3
______
7 Nous donnons à ce peuple de la steppe son nom originel, tout au moins celui sous lequel il apparaît d’abord dans les chroniques chinoises, Rouran. La forme Ruanruan, qui signifie “qui s’agitent comme des vers”, est le nom insultant qui leur a été donné par l’empereur Taiwudi des Wei du Nord (424-452) pour stigmatiser à la fois leur célebre saleté et leurs perpétuels mouvements dans la steppe. Dans le Song shu et le Qi shu, ils apparaissent sous le nom de Ruirui, et sous celui de Ruru, dans le Suishu.
ex.), le site de l’ancienne Yanqi (1 ex.), et la vieille ville de Subashi (1 ex.). La plupart de ces décou-vertes ont été faites dans la région de Turfan (Yarkhoto, Astana et Qodjo), qui était le centre administratif et commerçant des royaumes de Jushi puis de Gaochang. La nécropole de Yarkhoto est composée de tombes du VIe et de la première moitié du VIIe ; à Astana, s’il existe de rares tombes du IVe et du Ve siècle, leur nombre augmente au début du VIe et surtout au moment de l’occupation chinoise, jusqu’au VIIIe siècle (Maillard : 155-156). Celles d’où on a exhumé des monnaies sassanides, et qui sont datées, s’échelonnent de 604 à 710, période cor-respondant à l’époque où le royaume de Gaochang est confronté au retour des Chinois dans la région (sous les Sui), puis à sa mise en tutelle et à son an-nexion sous les Tang (640-657). Les monnaies de la nécropole d’Astana sont pour la plupart tardives, une de Peroz (459-484, couronne Type III)[48], une de Jamasp (497-499) [35], une de Hormazd IV (574-590)[1], treize de Khosro II (591-628) [21-22-23-25-26-29-36-38-39-40-42-45-46], une de Boran (630-633)[30], trois de Yazdegerd III (632-651) [19-37] et une arabo-sassanide au type de Khosro II [31] ; celles de Yarkhoto se rattachent au même ensemble : trois de Khosro II [4-13-14]. Ces monnaies étaient généralement placées dans la bouche des morts (v. p. 101-102) et relèvent des rites funéraires en vigeur à Gaochang avant et après la chute du royaume.
Les monnaies trouvées sur les sites mêmes des villes d’Astana et de Qodjo sont plus anciennes : 14 Shapur II (309-379), 14 Ardeshir II (379-383) et 4 Shapur III (383-388). Elles forment un ensemble chronologiquement et typologiquement homogène ; les deux trouvailles de Qodjo [6-8] présentent des analogies parfaites quant à leur composition et à la typologie des monnaies, dont on note qu’aucune n’est percée ou munie d’une bèlière. Ces deux dépôts sont, sur tous ces points, similaires à celui de Tépé Marandjan (Curiel : 103-105). Ils permettent de penser que Gaochang-Qodjo, c’est à dire “la ville chinoise”, puisque tel était son nom en sogdien, était au IVe siècle un centre politico-commercial plus important que la capitale royale, Yarkhoto.
Des monnaies trouvées à Yanqi [49] et à Subashi [5], il n’est pas possible de tirer de conclusions importantes, tout au plus peut on noter qu’elles sont mises au jour dans les régions métropolitaines des royaumes. Le trésor d’Ulugh Art n’a donné lieu qu’à des publications neibu, c’est à dire à diffusion interne
98 F. T H I E R R Y
et l’on sait très peu de choses de sa composition, celà obère fortement les données chiffrées et les propor-tions qui peuvent être données sur les découvertes faites dans les “Régions d’Occident”.
En résumé, on note que les monnaies sassanides trouvées dans les Xiyu appartiennent à deux pé-riodes, d’une part, les règnes de Shapur I (309-379), Ardeshir II (379-383) et Shapur III (383-389), soit le IVe siècle, et d’autre part la plupart des règnes posté-rieurs à Yazdegerd II (438-457) jusqu’aux arabo-sas-sanides, à la notable exception de Kavad (484-488/497-531). Deux périodes ne sont pas représen-tées, la fin du IVe et le début du Ve siècle (388-457) et la fin du Ve et le début du VIe siècle (484-531).
On notera, mais nous y reviendrons, que toutes ces monnaies sassanides ont été trouvées sur la route centrale de la soie.
B-Les monnaies trouvées au Hexi. La deuxième région géopolitique est celle qui
sert de pont entre les Xiyu et la Chine proprement dite : le Hexi, “l’ouest du Fleuve (Jaune)”, connu en Occident sous le nom de “corridor du Gansu”, situé entre le Fleuve Jaune et Dunhuang et coincé entre les franges septentrionales du Tibet et le sud du Désert de Gobi. Il correspond administrativement à la pré-fecture de Liang. Voie de passage entre la Chine et l’Occident, mais partie de la Chine du nord, cette préfecture subit la guerre civile et les invasions barbares, mais aussi les migrations nomades d’est en ouest, aboutissant à l’instauration de la domination de telle ou telle horde sur l’Asie Centrale et provo-quant des déplacements régionaux de tribus chassées par les nouveaux envahisseurs : Xiongnu, Di, Xian-bei du Liaotong, Gaoju, Rouran, Togons et Qiang. Durant la période qui nous occupe, le Hexi a été in-dépendant de 316 à 439, si l’on excepte les quelques années (376-383) durant lesquelles le royaume di des Qin antérieurs a tenté d’établir son contrôle sur l’Asie Centrale. Sur cet étroit territoire se sont instal-lés simultanément ou successivement divers petits royaumes, soit constitués autour d'une horde barbare de passage, comme les Liang du Nord (397-439) autour des Xiongnu, ou les Liang du Sud (397-414) autour des Xianbei, soit instaurés par un gou-erneur ou un général loyaliste resté seul après la déconfiture du pouvoir central auquel il était soumis, comme les Liang antérieurs (316-376), fondés par Zhang Shi, fils de Zhang Jiu, général des Jin de l’Ouest, ou comme les Liang postérieurs (385-403), fondés par
Lu Guang, général des Qin antérieurs, soit encore établi par un gouverneur qui se rend indépendant, comme Li Hao, général chinois au service de Juqu Mengxun, le grand chanyu des Xiongnu du Hexi, et fondateur des Liang occidentaux (400-421) à Dun-huang. Ces états, qui luttent entre eux, jouent un rôle dans les systèmes d’alliances des divers royaumes en guerre en Chine du nord, et entretiennent des rela-tions avec la dynastie impériale, Jin puis Song, qui accorde titres officiels et gratifications à ces alliés potentiels. En fait, sous les Liang antérieurs (316-376) et sous les Liang postérieurs (385-403), deux États qui ont contrôlé la plus grande partie du Hexi, cette région a bénéficié d’un calme relatif et d’une prospérité contrastant avec l'état du nord de la Chine. Le Hexi a joué durant cette période le rôle de sas entre les Xiyu et la Chine ; sa relative stabilité et sa situation géographique lui ont permis de servir de zone de transit obligatoire sur la Route de la Soie, et d’ultime étape pour les voyageurs occidentaux. Chaque état du Hexi attirait caravanes, marchands et pélerins, facilitait l’installation d’entrepôts et veillait à rendre les routes aussi sûres que possible, dans la mesure où les princes qui les dirigeaient tiraient la majeure partie de leurs ressources de cette circulation transasiatique, commerciale et religieuse (Liu XR : 43-44, Zhao YW : 85-89). Même après la réunifi-cation de la Chine du nord par les Wei (439), le Hexi constitua une région à part, où les étran-gers, Perses, Sogdiens, Koutchéens et Khotanais, étaient plus nombreux, où les mœurs et les habitudes des riches marchands “hu” (terme désignant les barbares d’Oc-cident, spécialement les Sogdiens, Tokhariens, puis les Perses) avaient une plus grande influence et où les pratiques commer-ciales centrasiatiques avaient cours 8. Sous les Zhou du Nord (577-581) les auto-rités, incapables d’empêcher la population du Hexi d’utiliser les “monnaies d’or et d’argent des Xiyu”, en autorise l’usage dans cette seule région de Chine du nord (Suishu : XXIV, 691 ; Thierry 1991 : 130). ______
8 La richesse des marchands sogdiens ou tokhariens les ex-posait parfois à la convoitise des gouverneurs ou du gouverne-ment : en 439, après la prise de Guzang, tous les marchands sogdiens de la ville furent capturés par les troupes des Wei du Nord, et, quelques années plus tard, le roi de Sogdiane dût négocier leur rançon (Weishu : CII, 2270) ; en 531, Yuan Xian, membre de la famille royale des Wei et gouverneur de la préfecture de Liang, n’eut de cesse de s’approprier la fortune des riches marchands sogdiens de sa préfecture : il s’arrangea pour en faire tuer un grand nombre et s’emparer de leurs biens (Weishu : XIX, 445).
S U R L E S M O N N A I E S S A S S A N I D E S T R O U V E E S E N C H I N E 99
À partir des Sui et des Tang, le Hexi n’a plus d’existence autonome, et est définitivement arrimé à l’ensemble chinois, dont il constitue le bastion avancé vers l’Ouest : la Chine proprement dite commence administrativement à Dunhuang, même lorsque l’empire contrôle les Xiyu. C’est pourquoi, la distinction géopolitique entre Chine du Nord et Hexi cesse alors d’être pertinente.
Malgré l’importance de son rôle économique et malgré une circulation des espèces d’argent courante, attestée et même légalisée par les autorités chinoises au VIe siècle, le Hexi n’a fourni aucun des dépôts monétaires que l’on était en droit d’espérer. La seule trouvaille qui soit signalée dans les limites géographiques du Hexi, est celle de la rue du Temple de Chenghuang à Xining [12]. Cependant, sa composition, 76 drahm de Peroz et une vingtaine de monnaies chinoises dont des kaiyuan tongbao, monnaies émises à partir de 621, le date parfaitement comme un trésor d’époque Tang, ce qui fait qu’il ne peut être historiquement considéré comme un trésor du Hexi.
Cette région, où la circulation monétaire des “pièces d’argent d’Occident” est attestée par les documents administratifs chinois, et autorisée par la loi, est donc la seule où l’on n’a pas trouvé une seule pièce. Cette absence de dépôts monétaires et même de monnaies isolées ne laisse pas de poser un certain nombre de questions : Quelles étaient les pratiques monétaires des Chinois et des populations centrasiatiques dans cette région ? Y a t-il eu “aspiration” du métal vers les centres métropolitains de Chine du nord, ou “rapatriement” vers la Chine de trésors constitués au cours des années par les Chinois dans le Hexi 9 ? Quel est le rapport entre circulation et thésaurisation ? La conception de la monnaie chez les Chinois a-t-elle joué un rôle ?
C-Les monnaies trouvées en Chine. ______
9 Cette hypothèse est étayée par le fait qu’après la réunifi-cation de la Chine, en 439, les Wei du Nord ont procédé à la dé-portation de 300 000 foyers et de 3000 moines de la préfecture de Liang vers leur première capitale, Pingcheng. Il est à noter que lorsque les Wei déplacent leur capitale de Pingcheng à Luoyang, en 493, ils déportent la population de l’ancienne mé-tropole vers la nouvelle. Les habitants du Hexi et le clergé pré-cédement déplacés se retrouvent donc au cœur de la Chine, avant d’être à nouveau déplacés par les Qi du Nord de Luoyang à Ye, en 534. Il est clair que les trésors constitués tant par les habitants que par le clergé, se sont donc trouvés eux aussi déplacés en Chine propre au gré des événements poliques.
La Chine du nord, en gros le bassin du Fleuve Jaune, le Shandong et les franges méridionales de la Mongolie Intérieure et de la Mandchourie, est, de-puis la fin du IIIe siècle, l’objet de guerres incessan-tes entre divers forces : la dynastie Jin de l’Ouest (265-316), qui contrôlait la Chine tout entière, y compris le corridor du Gansu, subit les raids puis les attaques des Xiongnu et des Qiang (apparentés aux Tibétains) qui profitent de son affaiblissement et de la guerre civile qui fait rage entre les princes de la maison impériale. Au début du IVe siècle, au Si-chuan, les barbares Di fondent l’État de Cheng tandis qu’au nord, les Xiongnu organisent celui de Han ; ac-croissant leur pression sur l’empire, ces derniers font irruption dans le centre de l’empire : en 311, Luo-yang est prise d’assaut et mise à sac, l’empereur est capturé ; en 313, c’est au tour de Chang'an d’être livrée au pillage. La partie septentrionale de l’Empire éclate en divers royaumes fondés par des barbares fé-dérés ou non. En 316-317, la dynastie Jin se replie au sud du Fleuve Bleu, abandonnant le nord aux enva-hisseurs. C’est le début de la période dite des Seize Royaumes des Cinq Barbares, du nom des cinq po-pulations non-chinoises, Xiongnu, Xianbei, Jie, Di et Qiang, qui se partagent le nord de la Chine de 304 à 439, date à laquelle l’une d’elles, la branche Tab-ghatch (Tuoba) des Xianbei du royaume des Wei du Nord (386-534), réussit à la réunifier. Durant la période des Seize Royaumes, vingt-deux états ont lutté les uns contre les autres pour la suprématie, ont eu à faire face à d’autres nomades venant du nord, comme les Dingling, les Togons, les Gaoju ou les Rouran, et ont périodiquement affronté la dynastie impériale des Jin, puis celle de leurs successeurs, les Song de Liu (420-479). Parmi ces royaumes, celui des Di, les Qin antérieurs (351-394), est celui dont l’extension territoriale fut la plus grande ; il réussit même, brièvement, de 376 à 385, à réunifier la Chine du nord et il fut le seul à tenter de reconquérir, au profit de la Chine, les “régions occidentales”, en 383-385.
Lorsque le royaume des Tabghatchs, qui avait pris le nom de Wei, eut unifié le nord, il se posa en successeur des Han et entreprit de soumettre à son pouvoir les Xiyu, mais il ne put guère dépasser Kara-shar (Yanqi), laissant même Gaochang indépendant. En fait, et jusqu’à la conquête Tang (640-659), jamais la Chine n’a été en mesure de contrôler les Xiyu. La réunification du nord ne dure qu’un petit siècle, car en 534, le royaume des Wei éclate en deux
100 F. T H I E R R Y
États, celui des Wei de l’Est (534-550) et celui des Wei de l’Ouest (535-556), auxquels succèderont res-pectivement les Qi du Nord (550-577) et les Zhou du Nord (557-581) ; ces derniers, en détruisant Qi ré-unifient le nord, et en arrachant le Sichuan et une partie du sud à la dynastie impériale des Chen (557-589), se posent en unificateurs de la Chine tout entière, pour la première fois depuis les Jin. Cette ambition ne sera réalisée que par leurs successeurs, les Sui (581-589-618) (Wan SN : 132-155, 171-189, 251-288, 321-329 ; Wang WQ : 153-173 ; Cordier : vol. I, 301-384 ; Wright : 48-73).
Les monnaies sassanides trouvées dans les terri-toires proprement chinois 10 sont au nombre de 416, pour 1012 dans les Xiyu ; les lieux de mise au jour ont une dispersion géographique bien supérieure : nous avions quatre lieux de trouvailles, Ulugh Art, Subashi, Yanqi et Turfan et ses environs, nous en avons seize, répartis comme suit : douze en Chine du nord, 2 monnaies à Guyuan (Ningxia) [51-53], 1 à Tianshui (Gansu) [28], 1 à Linxia (Gansu) [56], 12 à Xian et ses environs [10-15-16-33-43], 3 à Yaoxian (Shaanxi) [44], 6 dans la haute vallée de la Han (Shaanxi) [54-55], 2 à Shaanxian (Henan) [11], 220 à Luoyang et ses environs (Henan) [9-57-58-59], 1 à Taiyuan (Shanxi) [17], 41 à Dingxian (Hebei) [32], 15 à Anlu (Hubei) [50], 4 près de Hohote en Mongolie Intérieure [34] et 76 à Xining [12] ; trois en Chine du sud, 20 monnaies à Suikai (Guangdong) [52], 9 à Kukgong (Guangdong) [47] et 3 à Yingdak (Guangdong) [27].
La majeure partie de ces dépôts datent des Sui ou des Tang (fin du VIe et VIIe siècle) [10-11-12-15-16-17-28-33-43-44-50-53-54-57-58-59], et il est in-téressant de noter que toutes les monnaies sassanides trouvées dans les environs de l’ancienne Chang'an [10-15-16-33-43] l’ont été dans des dépôts constitués après la réunification de la Chine en 589, soit sous les Sui, soit sous les Tang ; on n’a trouvé dans cette région aucun dépôt pouvant être attribué aux deux siècles précédents. Parmi les dépôts de Chine du nord datant de la période antérieure aux Sui [9-32-34-51-56], il n’en existe pas un qui remonte au delà de 460-480.
______
10 Comme nous l’avons indiqué plus haut, nous considé-rons la région du Hexi comme territoire proprement chinois à partir des Sui et donc nous comptabilisons le trésor d’époque Tang de Xining avec les trouvailles de Chine.
On remarque que les monnaies sassanides trou-vées en Chine propre sont réparties sur sept règnes : Yazdegerd II (438-457), Peroz (457-484), Kavad (484-488/497-531), Jamasp (497-499), Khosro I (531-579), Khosro II (591-628) et Boran (630-633), ce qui fait une continuité de près de deux siècles à partir du règne de Yazdegerd II. Aucune monnaie an-térieure à ce règne n’a été découverte dans les terri-toires proprement chinois, alors qu’on a mis au jour des drahm de Shapur II, Ardeshir II et Shapur III dans les Xiyu. Cette continuité doit cependant être pondérée par l’importance de la proportion de drahm de Peroz dans cet ensemble : 369 monnaies sur 416, soit plus de 80% du total. Il y a là un élément qui mérite attention, surtout lorsque l’on constate que l’enfouissement des dépôts qui contiennent des monnaies de Peroz est parfois postérieur de plusieurs siècles à la frappe.
3-Typologie des découvertes. Le processus de constitution du dépôt monétaire
et sa composition permettent de définir le rôle ou la fonction des monnaies qui le composent. Sous ce rapport, les monnaies sassanides trouvées en Répu-blique Populaire de Chine s’ordonnent selon cinq ca-tégories, dépôt funéraire, offrande, trésor monétaire, dispersion fortuite et collection.
TYPE NOMBRE NOMBRE DE MONNAIES Dépôt funéraire 39 82 Dépôt religieux 3 51 Trésor 7 1278 Dispersion 9 15 Collection 1 1
A-Les dépôts funéraires. L’analyse des dépôts funéraires permet de mettre
en évidence la pertinence de la distinction entre Chine propre et Xiyu. Les tombes ouvertes dans cette dernière région, et en particulier celles de la nécropole d’Astana, ne contiennent généralement qu’une seule monnaie, le plus souvent placée dans la bouche du mort : 23 tombes d’Astana [2-19 à 26-29-30-31-35-36-37-38-39-40-41-42-45-46-48] et 3 à Yarkhoto [4-13-14] ; parfois elles contiennent deux pièces disposées sur les yeux du mort [1-46]. Nous avons là une intéressante indica-tion sur les rites funéraires des populations de Gaochang à la fin du VIe et au début du VIIe siècle, rites que la conquête par les Chinois au milieu du VIIe siècle, n’a pas mo-
S U R L E S M O N N A I E S S A S S A N I D E S T R O U V E E S E N C H I N E 101
difiés, puisque nous avons des tombes datées de la fin du VIIe et du début du VIIIe siècle dans lesquelles furent découverts, déposées dans la bouche du mort, des drahm sassanides [21-23-29-30-37-46]. On remarque que parmi les monnaies placées dans la bouche des morts, certaines sont percées [20-35-40-45-48-56], une porte un anneau [35] et plusieurs ont été dorées [35-40-45], ce qui tend à montrer que la pièce avait été retirée de la circulation bien avant d’être uitlisée dans le rite funéraire. Il est à noter que cette pratique semble purement centrasiatique et même purement locale, car on ne la retrouve ni en Iran ni en Chine, ni même dans les autres royaumes.
Le rite fanhan “nourrir et remplir la bouche”, ou han, “remplir la bouche”, se fait, en Chine, avant tout avec du jade ; c’est la croyance dans les vertus d’im-putrescibilité de cette pierre (Shen Nong : 21-22 ; Tang SH : 81-82 ; Li SZ : VIII, 36-39), et non la croyance en la nécessité d’un quelconque paiement 11 qui fonde la pratique rituelle du han. Cela apparaît très clairement dans la leçon classiquement bouddhiste d’un apologue du Tripitaka chinois : comme on avait placé une monnaie d’or dans la bouche d’un mort, pour obtenir les bonnes grâces du roi de la Grande Montagne (le Dieu des Enfers), la leçon dit “quand la vie prend fin, ... l’âme s’en va et transmigre ; la condition où elle se trouve est alors déterminée par ses actes ; à quoi lui servirait de faire des présents ?”Cent contes : vol. I, 249).
Dans le Zhouli, il est spécifié que le Garde des Sceaux de Jade était chargé de fournir, lors des funérailles du plus haut rang, du jade pilé que l’on mélangeait au riz que l’on introduisait dans la bouche du mort avec d’autres morceaux de jade (Zhouli : Dian rui, 58) ; une obligation similaire incombait à un autre fonctionnaire, le Garde des Magasins de Jade (Zhouli : Yufu, 16). Il était habituel que les princes s’envoient les uns aux autres, par messagers spé-ciaux, le jade requis pour le rite han (Liji : IV, 324, XX, 440). Dans les manuels de rites postérieurs, il est généralement indiqué le type de jade ou d’objet (perle ou cauris) à mettre dans la bouche du défunt, selon son rang social (Hou Han Shu : Zhi-VI, 3141 ;
______
11 Dans la pratique taoïste de la “Restauration du Destin”, qui nécessite un paiement de passage, les sommes ne sont pas fixées en fonction des actes du mort, mais en fonction de l’année de naissance (Hou : 47-48, 104-106), et les paiements sont effectués en monnaie de papier que l’on brûle ; le corps n’est physiquement accompagné d’aucun signe monétaire.
Tongdian : LXXXIV, 2268-2271 ; De Groot : vol. I, 269-274) 12. La croyance dans les propriétés prêtées au jade d’assurer la longévité et d’empêcher le pourrissement du cadavre était très vivace à l’époque qui nous occupe : dans son Baopuzi, Ge Hong (283-363) dit que “si l’on place de l’or et du jade dans les Neuf Orifices, cela a pour résultat que le corps ne se décompose pas” (Baopuzi : III , 51). Il cite également un ancien Classique du Jade qui affirme que “celui qui avale de l’or vit aussi longtemps que l’or, celui qui avale du jade vit autant que le jade. Celui qui avale l’Essence Réelle du Monde de l’Ombre jouira d’une existence éternelle ; l’Essence Réelle du Monde de l’Ombre est un autre nom du jade... les morceaux de jade, lorsqu’ils sont avalés ou pris avec de l’eau, peuvent dans les deux cas, rendre un homme immortel ” (Baopuzi : XI, 204). Un autre auteur, Tang Hongjing (Ve siècle) dit que “lorsqu’une tombe de l’ancien temps est ouverte et que le corps est trouvé comme s’il était vivant, c’est qu’il y a partout, à l’extérieur et à l’intérieur du corps une grande quantité d’or et de jade. C’était un rite établi, sous les Han, d’enterrer chaque prince ou seigneur, avec des perles et avec des morceaux de jade pour prévenir la putréfaction ” (Tang Hongjing, Ming yi bielu, cité par Li SZ : VIII, 38). Cette croyance était si profondément ancrée dans la population qu’il y avait des gens pour aller à la recherche des tombes antiques pour en extraire le jade et le consommer (Beishi : XXVII, 978-979, Weishu : XXXIII, 791) 13. À l’époque des Zhou de ______
12 L’archéologie a fourni de nombreux exemples de lin-ceuls de jade, de dépôts d’objets en jade, vases rituels, coupes, disques, obturateurs pour la bouche et pour les yeux, etc. ; la forme la plus courante que prend le morceau de jade introduit dans la bouche est celle d’une cigale plate. Les quantités de jade enfouies dans les tombes ont été très importantes et, elles ont, au même titre que les autres objets funéraires en matière pré-cieuse, fait, après les Han, l’objet de vaines interdictions : dans la troisième année de l'ère Hoang Shu (223 ap. JC), un décret stipule que “pour le rite fanhan, on n’utilisera ni perles ni jade, on ne parera pas les tuniques de perles et les fourreaux de jade.” (San Guo zhi : Weishu II, 81).
13 Un certain Li Yu s’était installé, au début des années Tai He (477-499), dans la région de Chang'an, dans le seul but de pouvoir aller fouiller les tombes antiques des environs de l’ancienne capitale des Han, dans lesquelles il prenait le jade qu’il consommait ensuite, ou qu’il offrait à ses amis. Après sa mort, survenue en plein été, et bien qu’il n’ait pas été enterré tout de suite, son corps ne changea ni de couleur ni d’aspect ; “sa femme lui ayant demandé d’ouvrir la bouche pour y placer les deux perles de jade, (le cadavre) s’exécuta sur le champ, et aucune mauvaise odeur ne sortit de sa gorge” (Beishi : XXVII,
102 F. T H I E R R Y
l’Est (770-256), l’usage du jade pour le han, a supplanté celui des cauris qui est attesté à la fois par l’archéologie et par les textes (Yili : XII, 231-232, 243 ; Liji, IV, 315, XII, 440-448), et qui se maintient ensuite pour les funé-railles du rang le plus bas, jusque sous les Tang 14. L’usage des pièces de monnaie est tardive et n’ap-paraît que sous les Song, époque à partir de laquelle, elle devient le principal objet pour le rite han dans la population 15, jusqu’à nos jours (Zhu zi : IV, 5b-11b, Dumoutier : 18). Il est clair que la pratique chinoise du han a peu à voir avec la pratique rituelle de la région de Gaochang qui consiste à mettre une monnaie dans la bouche du mort, telle que nous l’ont révélée les fouilles de la nécropole d’Astana.
Dans les tombes situées en Chine propre [9-10-11-15-16-17-27-47-50-51-53-58], les monnaies font partie des trésors enfouis avec le défunt, au même titre que le mobilier funéraire habituel, statuettes d’ani-maux et de domestiques, ce que les Chinois nomment mingqi, “objets pour le monde de l’Ombre”, ainsi que bijoux, vases, objets de jade, etc.
Le dépôt le plus important est celui de la tombe princière d’Anlu [50] ; cette tombe est celle de la Princesse née Yang, épouse de Li Ke, Prince de Wu, fils de l’empereur Taizong (627-649) des Tang, et elle est datée de 637. Les quinze monnaies sassani-des trouvées parmi le mobilier funéraire sont toutes de Peroz (459-484), et forment un ensemble remar-quablement homogène : les ateliers représentés sont ______ 979). Cette croyance restait vivace sous les Ming, puisque le grand pharmacologue Li Shizhen, auteur du Bencao gangmu (1590) écrit “le jade ne peut pas, à vrai dire, protéger le vivant de la mort, mais il peut protéger le mort de la pourriture” (Li SZ : VIII, 38). Voir également plus loin (p. 132), la découverte du corps de Zhang Jun “qui semblait vivant”, au milieu des ses jades.
14 Le Kai Yuan Li, “Code de l’ère Kai Yuan” (713-741) stipule que pour le rite funéraire han,”on utilisera, pour les fonctionnaires des trois premiers degrés, du sorgho et des pièces de jade rondes, pour ceux du quatrième et cinquième degré, du millet et du jade bleu, pour ceux du sixième degré et pour ceux qui viennent ensuite, on utilisera du sorgho et des cauris.” (Tongdian : LXXXIV, 2270)
15 On notera cependant que pour les funérailles des fonctionnaires, jusqu’à la fin de l’Empire (1911), le jade est imposé ; le Da Qing tongli, “Code de la Dynastie Qing”, indique que pour les fonctionnaires des trois premiers rangs, on doit utiliser cinq perles de jade, pour ceux du quatrième au septième rang, cinq morceaux de jade et d’or, pour les lettrés, on utilisera trois petits morceaux d’or et d’argent, et pour le peuple, on bourrera la bouche avec trois morceaux d’argent. (cité par De Groot : vol. I, 279)
AS (6 pièces), AY (4 pièces du même type), WH (1 pièce), NY (1 pièce) et BLH (1 pièce) ; sur deux monnaies l’atelier est incertain ; les trois drahm avec la couronne II de Peroz sont tous de l’atelier AS et deux présentent une liaison de coin pour le revers. Ce groupe de drahm de Peroz semble avoir été maintenu intact depuis sa sortie d’Iran jusqu’à son enfouisse-ment en Chine Centrale, presque deux siècles plus tard - remarque qui s’applique à d’autres dépôts de monnaies sassanides trouvés en Chine, et en particu-lier, celui de Xining [12] -. Il nous semble évident de rapprocher ce trésor de l’histoire de la famille Li, dont les liens avec l’Asie Centrale et le Hexi, avec les familles régnantes de Chine du nord et du Hexi sont denses, anciens et profonds 16.
______
16 Le clan Li descend de la famille des Liang Occidentaux (400-421) ; Li Hao, marquis de Gaochang, qui commandait la garnison de Dunhuang pour le compte du royaume xiongnu de Juqu Mengxun, se déclare indépendant en 400, et se proclame prince de Liang. Par de rapides conquêtes et grâce au ralliement de plusieurs garnisons, son royaume, qui couvrait à l’origine à la seule préfecture de Dunhuang, s’étend à l’ensemble du bassin du Tarim, jusqu’au Pamir ; en 405, Hao déplace sa capitale à Jiuquan ; les Liang Occidentaux contrôlent les villes de Shule, Koutcha, Khotan, Yanqi, Gaochang et Shanshan, et donc les Routes de la Soie, méridionale et centrale. Rapidement, le ro-yaume est en butte aux attaques des Rouran au nord et des Xiongnu à l’est. En 417, Li Xin succède à Li Gao, et noue, avec la dynastie des Jin de l’Est, une alliance défensive qui n’empêche pas la destruction du royaume : les nomades septen-trionaux s’emparent de Gaochang puis de Yanqi, qui sont incor-porés au Khanat des Rouran ; Juqu Mengxun, le chanyu des Xiongnu, roi des Liang du Nord, attaque Jiuquan et tue Li Xin en 420 ; l’année suivante, le nouveau roi des Liang Occi-dentaux, Li Xin, s’enfuie à Dunhuang où il est vaincu et tué en 421. Son fils, Li Zhonger, fuit en Chine avec la famille royale, et entre au service des Wei du Nord, qui le nomment préfet. Le clan Li, installé à Wu-quan, au nord de l’actuelle province du Shanxi, à proximité de la capitale des Wei, Pingcheng, devient de plus en plus puissant : Li Xi, fils de Zhonger est comman-dant de la garnison de Jinmen, qui protège la capitale, Luoyang, à l’ouest ; son fils Tianxi est ministre des Travaux Publics dans les années Da Tong (535-551) des Wei de l’Ouest. Son petit-fils, Hu, grand-père du premier empereur des Tang, est fait duc de Longxi (entre les villes act. de Lanzhou et Tianshui au Gan-su) ; vers 555-557, il fait partie de ceux qui s’associent à Yüwen Tai (arrière petit-fils de Yüwen Lu des Yan Pos-térieurs), pour mettre fin aux Wei de l’Ouest et fonder la dynastie des Zhou du Nord ; en 558, il est fait Duc de Tang et devient l’un des “Huit Piliers de l’Etat” ; son fils Li Bing, épouse la 4e fille de Tuku Xin, khan d’un très puissant clan türk, qui avait donné sa 1ère fille à Yüwen Yu, futur empereur Mingdi des Zhou du Nord (557-560), et sa 7e à Yang Jian, futur fondateur des Sui. Sous cette dynastie, Li Yuan, chef du clan Tang est l’un des plus puissants aristocrates du régime et favori de l’empereur Wen (581-604). En 618, son fils Li Shimin prend la tête des rebelles, renverse les Sui et installe son père sur le trône impérial (Jiu
S U R L E S M O N N A I E S S A S S A N I D E S T R O U V E E S E N C H I N E 103
B-Les dépôts religieux. Les dépôts religieux, de fondation, votifs ou
d’offrande, sont au nombre de trois, situés en Chine propre, celui de Dingxian [32], celui de Tianziyu [33] et celui de Yaoxian [44].
Le dépôt de Dingxian a été mis au jour dans les fondations d’une pagode de l’époque des Wei du Nord, datée de la 5e année de l’ère Tai He de Xiao-wendi, (481 ap. JC). À cette époque, Dingxian portait le nom de Dingzhou et était le siège de la comman-derie de Zhongshan. Le trésor était conservé dans un coffre de pierre et comprenait 5657 objets : en or, cinq plaques et deux boucles d’oreille ; en argent, des monnaies sassanides, un vase, des poignées de cof-fret, des clochettes, des bracelets, des boucles d’o-reille et une bague ; en bronze, des monnaies 17, un bol, trois sceaux, trois cuillères et des anneaux ; en verre, un bol, cinq flacons, des anneaux et plus de 2500 perles ; en jade, des plaques, des disques et des pendentifs ; en agate, des vases, des anneaux, des perles et des fusaïoles ; des pendentifs de cristal ; plus de 2000 pendeloques de corail ; 160 perles et des cauris (Équipe du Hebei : 253-259). Les 41 mon-naies, 4 de Yazdegerd (438-457), dont une imitation hephtalite (?), et 37 de Peroz (457-484), forment un ensemble très homogène et dont la vitesse de circu-lation depuis l’empire sassanide jusqu’à Dingzhou semble assez rapide puisqu’une des monnaies de Pe-roz est datée de l’an 14 (472). Une des monnaies de Yazdegerd porte une contremarque hephtalite, Heph-tal (?) en caractères tokhariens (Ghirshman : 16-17).
L’analyse de ce dépôt permet de le rattacher à la tradition bouddhique la plus pure. On note en effet, qu’il est composé d’un certain nombre de substances, or, argent, verre, cristal, perles, corail, agate, bronze, jade et coquillages, dont les sept premières corres-pondent à la liste des Sept Trésors bouddhiques de l’Inde du nord tels qu’ils apparaissent dans les tra-ductions chinoises du IVe siècle, et les trois der-nières, à trois symboles de richesse de la Chine, la monnaie, le jade et le cauris.
Dans la tradition bouddhique de l’Inde gangéti-que, les offrandes considérées comme les plus aptes
______ Tang shu : I, 1-6 ; Xin Tang shu : I, 1-2 ; Qi, Lu et Guo : 71-92 ; Wechsler : 150-153).
17 3 banliang, 220 wuzhu dont des monnaies rognées et des monnaies en anneaux, 20 huoquan, 4 da quan wushi et 2 xiao quan zhi yi.
à transmettre la profondeur de la vénération sont les Sept Trésors, Sapta Ratna, dont la conception a été calquée sur la liste des Sept Symboles du Boud-dhisme. Ces Septs Trésors, les sept substances pré-cieuses, sont l’or (suvana), l’argent (rupya), le lapis-lazuli (vaidurya), le cristal (sphatika), les perles (mukta), le corail (lohitika) et l’agate (musaragalva) (Liu XR : 93-95 ; Hirth : 229). L’archéologie du Ghandara a fourni nombre d’offrandes de ce type dans les stupas du nord de l’Inde, et en particulier celle de la chambre du stupa Kalawan de Taxila, dont la composition est conforme au modèle des Canons (Liu XR : 94). Le Liangshu décrit une cérémonie d’installation de reliques dans un stupa, qui reprend le modèle indien : sous Wudi des Liang, en 537, lors de la restauration du stupa du monastère Ayuwang, on découvrit un reliquaire contenant des ongles et des cheveux. L’empereur Wudi décida de procéder à une cérémonie de réinstallation de ces reliques boud-dhiques, après avoir consulté les moines éminents et les Canons sur les rites précis en la matière ; le 15 de la 9ème lune de l’année 538, au cours de cette céré-monie, “on plaça à nouveau les reliques dans un reliquaire que l’on déposa dans le stupa, parmi les Sept Trésors.” (Liangshu : LIV, 790-792). Dans les traductions chinoises des textes bouddiques, vaidu-rya a parfois été traduit par “verre”, c’est pourquoi dans la liste chinoise des Sapta Ratna, le lapis-lazuli est généralement remplacé par le verre 18. Le dépôt de Dingxian s’inscrit alors parfaitement dans la nomen-clature canonique des dépôts d’offrande bouddhi-ques. Les éléments le constituant ne sont là que com-me matière dont la présence est rendue impérative par les Canons : les deux poignées de coffret par exemple, ont perdu toute fonctionnalité quand elles ont été détachées du coffret ou du meuble, et n’ont été ajoutées au dépôt que comme morceaux d’argent ; de même, les monnaies sassanides n’y sont plus des monnaies mais bien des fragments d’argent.
Le second dépôt, celui du stupa reliquaire de Yaoxian [44], est daté par l’inscription de fondation de 604, à la fin du règne de Wendi des Sui. Il présen-te bien des similitudes avec le dépôt votif précédent. Le trésor était enfermé dans un coffre de pierre enfoui dans les fondations du stupa. Il se composait d’une boîte d’argent contenant trois monnaies sassa-nides, 27 wuzhu de la dynastie Sui, un bracelet d’or, ______
18 Sur les différentes listes des Sept Trésors dans les ca-nons chinois, voir Liu XR, p. 160 et p. 231, n.3.
104 F. T H I E R R Y
un de jade et onze d’argent, de trois reliques boud-dhiques, de perles fines et de perles de verre. La pré-sence des reliques donne tout son sens à ce dépôt, puisque le stupa est avant tout un reliquaire. Les trois monnaies appartiennent aux règnes de Peroz, de Kavad I et de Khosro I, la plus récente est datée de la 33e année de Khosro I, soit 563.
Le troisième dépôt est celui qui a été mis au jour dans les environs du monastère Guoqing [33]. Les monnaies étaient disposées dans une petite boîte d’argent à décor d’or, elle même déposée dans un bol à aumônes en porcelaine, trouvé dans les murs ruinés d’une petite pagode appartenant au site de l’ancien monastère bouddhiste de Zhishang ; elles formaient un ensemble assez homogène de la fin de la dynastie sassanide, 6 Khosro II (591-628) et 1 Boran (630-633). La monnaie de Boran, datée de l’an 3, 632, permet de situer l'enfouissement au début des Tang. L’utilisation symbolique du bol à aumônes des moines bouddhistes est une marque supplémentaire de la dévotion du donateur.
C-Les trésors monétaires. Les sept trésors sont de nature assez différentes,
deux sont des trésors de la fin du IVe siècle, décou-verts dans les ruines de Qodjo [6-8], un est de la fin du Ve [52] et les quatre autres sont des dépôts d’époque Tang [12-18-54-57]. Le plus important, celui d’Ulugh Art [18], était constitué de 13 barres d’or et de 947 monnaies d’argent. Malheureusement, cette trouvaille exceptionnelle n’a donné lieu qu’à des publications qui ne nous sont pas accessibles, et nous ne disposons à son sujet que de données frag-mentaires 19 : il serait composé de 2 Khosro I, 567 Khosro II et de 281 monnaies arabo-sassanides au type de Khosro II ; il manque 97 monnaies à ce dé-compte ; dans la liste des ateliers monétaires dont le
______
19 Il existe en Chine, une catégorie de publication dite neibu, “à diffusion interne”, dont l’exportation n’est pas autorisée ; parmi ces publications, on trouve la plupart des revues numismatiques provinciales qui regorgent d’informations sur les trouvailles monétaires et publient régulièrement d’excellentes analyses de savants locaux. On ne peut avoir accès à ces revues qu’en se rendant sur place et et grâce à la générosité des collègues chinois ; il est parfois possible d’en trouver certains numéros à Hong-Kong. Monsieur Jiang Qixiang de l’Institut archéologique du Xinjiang nous a tout récement encore confirmé l’existence d’une publication interne sur le trésor d’Ulugh Art, dont il se propose de nous faire parvenir une photocopie, que nous mettrons à la disposition de nos collègues iranologues.
nom figure sur des monnaies sassanides trouvées en Chine, Xia Nai indique que des monnaies des ateliers ART, BLH, WH et ZL se trouvent dans ce trésor (Xia 1974 : 102). Le même auteur donne une illustration d’une monnaie arabo-sassanide provenant d’Ulugh Art, il s’agit d’une pièce au type de Khosro II, APDWLA (Abdullah), atelier ST (Istakhr) et datée de l’an 44, 664 ap. JC.
Le trésor était dissimulé dans la fente d’un ro-cher, et était, à l’origine, enveloppé dans une pièce de tissu. Sa composition conduit à le considérer com-me un trésor de thésaurisation de haut niveau, et ses lieu et mode d’enfouissement indiquent une certaine précipitation, liée sans doute à l’impérieuse nécessité d’échapper à un prédateur rapproché. Les circonstan-ces dramatiques imposant une telle précaution ne manquaient pas dans le dernier tiers du VIIe siècle, en raison des guerres tibétaines. Depuis 650 environ, l’empire tibétain est devenu une grave menace qui plane sur les franges sud des protectorats chinois du bassin du Tarim. De menaçant, il est devenu conqué-rant, et en 663, il contrôle l’extrême nord-ouest du plateau tibétain, le royaume de Bâlur (Baltistan, ch. : Bolü), le royaume de Wakhân (ch. : Humi) dans l’est du Tokhârestan et la région de Kashgar. De 665 à 670, les Tibétains s’emparent des derniers états sous protectorats chinois, dont Khotan et Aksu. Durant toute la fin du VIIe, la partie occidentale du bassin du Tarim est à feu et à sang, subissant raids, pillages et campagnes militaires des Tibétains, des Türks Occidentaux et des Chinois (Beckwith : 33-48).
Le trésor du hameau de Sima Gou [57], aux en-virons de Luoyang, datant des Sui, mais plus vrai-semblablement, du début des Tang, en raison de la présence de quelques monnaies de Khosro II (591-628). Les données sur ce trésor découvert l’an passé, sont assez fragmentaires. L’inventeur n’est pas cer-tain du nombre, “plus de 200”, et les collègues chi-nois ne le sont guère plus en ce qui concerne la com-position, “une grande majorité de Peroz, avec quel-ques monnaies de Khosro I et de Khosro II” (Yu Q. : 128 ; Yang Ke : 108-109). L’article de Yu Qian ne donne que 12 illustrations qui laissent voir des drahm de Peroz de Types II et III, pour les ateliers AM, SR (3 exemplaires), NB, BBA et RA...(?) (Yu Q. : 131). Si l’on admet les données qui nous sont fournies, nous avons là un trésor “vivant”, constitué à partir d’une masse de monnaies de Peroz (459-484), aux-quelles ont été ensuite ajoutées des monnaies de Khosro I (531-579) et de Khosro II (591-628). On
S U R L E S M O N N A I E S S A S S A N I D E S T R O U V E E S E N C H I N E 105
notera l’absence de monnaies de la période 484-531. Le terminus post quem est trop imprécis pour que l’on puisse mettre l’enfouissement en rapport avec un quelconque événement.
Autre trésor tardif, celui de Xining [12] est sans doute, tout comme celui d’Ulugh Art, à mettre en rapport avec les guerres sino-tibétaines. Comme on l’a vu précédement, les Tibétains s’étaient lancé, vers 650, dans une vaste opération destinée à leur assurer le contrôle du bassin du Tarim et donc des routes de la soie. À l’extrême est du plateau tibétain, à l’ouest du Koukounor (ch. : Qinghai), s’était installée au milieu du IVe, une tribu d’origine xianbei, les Togons (ch. : Tuyuhun) ; vassale des Chinois à partir du VIe siècle, cette horde fut régulièrement attaquée par les Tibétains. En 663, pressé de toutes parts, le Kaghan des Togons, Murong Nuohebo, fait en vain appel à la Chine et, vaincu, doit se réfugier à Liangzhou. Son royaume est satellisé par les Tibétains. Cette menace tibétaine sur les préfectures du Hexi, et même sur la commanderie de Shanzhou (act. Xining) fixe momentanément l’antagonisme sino-tibétain dans la région. Après avoir écrasé les Chinois à Bughain Gol (ch. Dafeichuan) en 670, les Tibétains attaquent Guozhou et Shanzhou en 677. La mort de l’empereur tibétain Khri-man-slon et la révolte de Zan Zun qui marquent un effacement temporaire de la puissance tibétaine, sauvent la Chine d’un désastre et stabilisent la situation.
Le trésor de Xining a une composition assez pa-radoxale pour une région où les pièces d’argent ont longtemps circulé couramment : la jarre de terre con-tenait 76 monnaies d’argent de Peroz (457-484), quelques huoquan de Wang Mang, monnaies émises de 14 à 25 ap. JC, et des kaiyuan tongbao, émis à partir de 621. On constate donc une grande homogé-néïté des monnaies sassanides, alors que les mon-naies chinoises vont du Ier au VIIe siècle ap. JC. Le fait qu’il n’y ait dans ce dépôt, dont l’enfouissement peut être daté de la seconde moitié du VIIe, soit environ deux siècles après leur émission, que des drahm de Peroz, montre que le trésor a été constitué en une seule fois, qu’il a été protégé et conservé tel quel durant les deux siècles suivants. Il ne s’agit pas d’un trésor de caisse, mais bien d’une thésaurisation dans la tradition chinoise pour laquelle l’argent-métal n’est pas de la monnaie, mais une réserve de valeur, comme l’or, le jade, le corail ou les perles, quelle que soit sa mise en œuvre, monnaies, vases, lingots, bijoux, etc. À cet égard, le trésor de Suikai [52] est
particulièrement intéressant. Dans une jarre de terre cuite, découverte au nord-est de Suikai, entre la route Suikai-Huazhou et la mer, avaient été déposés des objets d’or et d’argent, coupes, bols, bijoux et mon-naies sassanides (Musée de Suikai : 243-249) 20. Les 20 drahm se répartissent en 16 de Peroz (459-484), 1 de Kavad (1er règne, 488-497) et 3 de Jamasp (497-499), soit un ensemble assez homogène de la fin du Ve siècle. Cependant, ici, il est évident qu’il ne s’agit pas d’un trésor “monétaire”, mais bien d’une réserve d’objets précieux dans laquelle les signes monétaires ne figurent que comme l’un des aspects possibles de la mise en œuvre de l’argent-métal.
Dans une certaine mesure, bien qu’il soit beau-coup moins important, le trésor de la vallée de la Han [54] est comparable à celui de Xining, et son enfouis-sement est plus précisément datable. La jarre conte-nait cinq drahm de Khosro II (590-628), deux wuzhu, non identifiés, vingt kaiyuan tongbao, et deux Qian Yuan zhongbao, fondues à la fin de l’ère Qian Yuan (758-760) de Suzong des Tang, ce qui nous donne un terminus. Compte tenu de la région où cette trou-vaille a eu lieu, qui correspond à la préfecture de Liang 21, il est fort probable que son enfouissement est lié aux troubles consécutifs à la révolte d’An Lushan 22. Durant la phase finale de cette révolte, fin 759-début 760, cette région est ravagée par une va-gue de rébellions locales, consécutive au regain d’ac-tivité des armées rebelles, et à laquelle il ne sera mis fin qu'en 763 (Peterson : 482). À ces troubles, s’ajou-tent les ravages des incursions tibétaines : en 763, les Tibétains pillent et mettent à sac Chang'an, et à partir ______
20 Le détail de la trouvaille est le suivant : deux anneaux d’or, vingt monnaies sassanides, deux tasses d’argent doré, une coupe d’argent avec inscription en parthe, une boîte d’argent, trois bracelets, deux boucles et divers petits objets d’argent.
21 Cette préfecture de Liang, située au sud-ouest du Shaanxi actuel, doit être distinguée de la préfecture de Liang du Hexi ; les deux caractères liang sont différents pour l’une et pour l’autre.
22De la fin de l’année 755 au début de 763, la dynastie Tang est soumise à la plus grave crise de son existence : An Lushan, le commandant en chef des armées Tang, se soulève, et chasse l’empereur Xuanzong de Chang'an. Une grande partie de la Chine du Nord est aux mains des rebelles, tandis que le reste est sous le contrôle de rebellions locales ou ravagé par des jac-queries. En 757, An Lushan est assassiné et, avec l’appui des Ouïghours, les Tang réussissent à reprendre la capitale. Cependant le lieutenant de An Lushan, Shi Siming et son fils, Shi Chaoyi, n’abandonnent pas la lutte et reprennent victorieu-sement l’offensive en 759 ; ce n’est qu’en 763, que la dynastie met un terme définitif à la rébellion (Peterson : 468-486, Dalby : 561-567).
106 F. T H I E R R Y
du circuit de Longyou, qu’ils viennent de conquérir, ils lancent des raids saisonniers sur les préfectures chinoises frontalières (Dalby : 568-569). On peut donc dater l’enfouissement de circa 763, et remarquer que, comme dans le cas du trésor de Xining, un laps de temps assez long le sépare de la frappe des monnaies d’argent.
Les deux trésors de Qodjo sont d’un tout autre type. Le premier [6] est constitué de 20 monnaies trouvées dans une petite boîte, 10 de Shapur II, 7 d’Ardeshir II et 3 de Shapur III. Le second [8], éga-lement contenu dans une boîte, était composé de 4 drahm de Shapur II, 5 d’Ardeshir II et 1 de Shapur III. On ne peut manquer de rapprocher la com-position de ces deux dépôts de celle du groupe des monnaies d’argent du trésor du stupa de Tépé Maran-jan en Afghanistan. Hormis les 12 scyphates d’or kushano-sassanides, ce trésor se composait de 368 pièces, 326 de Shapur II, 28 d’Ardeshir II et 14 de Shapur III (Curiel : 103-105). On note également une grande similitude en ce qui concerne les types de ces monnaies, et en particulier le style quelque peu barbare d’une grande partie d’entr’elles.
Il est intéressant de mettre en rapport ces deux dépôts, dont le terminus est fixé par les monnaies de Shapur III (383-388) avec les suites de l’offensive des Qin antérieurs contre Yanqi et Koutcha : en 376, les Qin antérieurs attaquent les Liang antérieurs, dont le territoire comprenait tout le Hexi (Gansu occi-dental) jusqu’à Dunhuang, et après avoir renversé Zhang Tianxi, roi de Liang, ils transforment la région en préfecture de Liang avec pour capitale Guzang et pour gouverneur Liang Xi. Celui ci prend contact avec les royaumes voisins d’Occident pour renouer les relations tributaires existant autrefois entre l’em-pire chinois et les Xiyu. En 382, le roi de Jushi (Gao-chang-Qodjo) et celui de Shanshan se rendent à la cour des Qin pour rendre hommage au souverain et se plaindre des rois de Yanqi et de Koutcha. Fu Jian, roi des Qin antérieurs donne l'ordre à Lu Guang de préparer une campagne pour mettre à la raison ces deux princes. En 384, Yanqi se soumet et en 385, Koutcha est prise. Cependant, ces conquêtes des Qin antérieurs à l’ouest, sont rendues vaines par la défaite de Feishui (383) face aux Jin, au sud, défaite qui amorce la fin des Qin dont les territoires sont envahis et dépecés par de nouveaux venus, par la dynastie impériale des Jin et par des rebellions. En 385, abandonnant ses conquêtes occidentales, Lu Guang revient vers l’est, s’empare de Guzang, tue Liang Xi
et se proclame Généralissime Gouverneur du Hexi et duc de Jiuquan, c’est le début du royaume des Liang Postérieurs. Après le retrait de Lu Guang, occupé à consolider son pouvoir par la conquête des villes du Hexi qui lui résistaient, comme Xiping, Zhangye, Dunhuang et Jiuquan (387-388), les royaumes d’Occident alliés, et en particulier Jushi se retrouvent sans protecteur et subissent la vindicte de Yanqi et de Koutcha combinée avec les invasions des Rouran (Jinshu : CXXII, 3053-3057 ; Qi, Lu et Guo : 50-59). Il est fort probable que c’est durant ces événements que ces deux dépôts furent enfouis.
C-La collection. L’une des trouvailles a un aspect tout à fait parti-
culier, c’est celle de la monnaie de Khosro II, décou-verte au hameau de Hejiacun [43] : il s’agit d’une monnaie appartenant à la collection d’un prince nu-mismate de l’époque Tang. Le lieu de la découverte correspond à la résidence de Li Shouli, Prince de Bin, petit-fils de Gaozong et oncle de l’empereur Xuanzong (712-756) ; en 714, il est nommé général-gouverneur de six préfectures, mais préfère résider à la capitale ; il laisse des fonctionnaires gouverner ses préfectures, pour se consacrer aux plaisirs de l’existence, la chasse, la musique, les banquets, les jeux et les arts (Jiu Tang Shu : LXXXVI, 2833, Xin Tang Shu : LXXXI, 3591-3592). À sa mort en 741, ses collections d’objets d’art passent à ses fils. Il est probable que c’est durant l’avancée des troupes d’An Lushan vers Chang'an, juste avant que la cour n’abandonne la ville, que le trésor a été enfoui.
Réparti dans deux grosses jarres de céramique et un vase d’argent, il comprenait de nombreuses pièces de vaisselle d’or et d’argent, de bijoux et d’objets en jade et pierres précieuses ou semi-précieuses, des lin-gots d’argent et des monnaies palatiales kaiyuan tongbao en or et en argent, de l’ambre et du corail, des produits rares de la pharmacopée chinoise, et une collection de monnaies (Musée du Shaanxi : 30-33).
Celle-ci se composait de monnaies chinoises an-ciennes, un couteau de Jimo du royaume de Qi (Ve-IIIe av. JC), une bêche à tête creuse de la Période des Printemps et Automnes (770-476 av. JC), quatre monnaies du début des Han de l’Ouest, dont un ban-liang (ca 175 av), des monnaies de Wang Mang (un couteau yi dao, émis de 7 à 9 ap. JC, une bêche dabu heng qian et une monnaie xiaoquan zhi yi, émises de 10 à 14 ap. JC, un huoquan et sept huobu dorés, émis de 14 à 23 ap. JC), un taihuo liuzhu émis en 579 par
S U R L E S M O N N A I E S S A S S A N I D E S T R O U V E E S E N C H I N E 107
Xuandi de la dynastie Chen, et un kaiyuan tongbao des Tang avec deux droits ; il y avait aussi des monnaies étrangères, une rare pièce Gaochang jili du royaume de Gaochang (Ve-VIe siècle), un solidus d’Héraclius (610-640), un drahm de Khosro II (590-628), et cinq monnaies japonaises en argent Wado kaichin (708-715). Il y avait aussi une amulette dorée avec les caractères Yong An wu nian (Musée du Shaanxi : 33 ; Wenhua : 68-69). La composition de cet ensemble ne laisse aucun doute sur sa nature numismatique.
Très tôt, les érudits chinois ont considéré la pièce de monnaie comme un champ d’étude particulier ; la plupart des Histoires Dynastiques ont un chapitre économique contenant des rensei-gnements intéressants sur les signes monétaires chinois et sur les monnaies etrangères 23. Les premiers ouvrages spécifiquement numismatiques ne nous sont pas parvenus, et nous ne les connaissons que par des travaux postérieurs qui les citent ou les mentionnent. Les trois premiers numismates connus sont, un certain Monsieur Liu, auteur d’un Quan zhi, “Recueil de monnaies”, qui pourrait être Liu Qian (480-550), l’auteur du Quan tu ji, “Album de monnaies”, cité dans le Suishu, Gu Xuan, son contemporain, auteur du Qian pu, “Catalogue des monnaies”, et Gu Xie (470-542), auteur d’un ouvrage du même nom. Sous les Tang, d’autres travaux voient le jour, comme le Quan pu, “Catalogue de monnaies” de Dun Sun, le Qian pu, le Quan pu, le Huoquan xiaolu et le Su qian pu de Feng Yan, ou le Qianbi kao, “Études sur les monnaies” de Yao Yuanzi. Ces travaux accompagnent et stimulent le développement du goût de la collection de monnaies, dont celle du Prince de Bin est le premier exemple qui nous soit parvenu.
Il est évident que ces monnaies n’ont strictement rien à voir avec la circulation monétaire en Chine. Il paraît hasardeux de vouloir tirer des conclusions d’ordre économique ou monétaire (Kœnig : 107 ; Musée du Shaanxi : 36), à partir de la présence, à cet endroit, d’une monnaie sassanide ou d’un solidus by-zantin, présence qui est principalement liée au goût ______
23 À titre d’exemples, on signalera le chapitre économique du Suishu qui décrit les monnaies de la période des Dynasties du Sud et du Nord (IVe-VIe siècles), avec beaucoup de détails (Suishu : XXIV, 689-690), ou le chapitre consacré aux pays d’Occident dans le Han shu, qui donne une description assez fi-dèle des monnaies des royaumes indo-grecs et de la Perse arsa-cide (Han shu : XCVI, 3889).
de la numismatique à l’époque des Tang. On ne sait d’ailleurs ni où, ni comment le prince de Bin s’est procuré ces monnaies, pas plus qu’on ne sait à quel moment et où elles ont été retirées de la circulation...24
II-ANALYSES ET RÉFLEXIONS
1-L’état politique de la Chine comme facteur déterminant.
L’étude des enfouissements et de la composition des dépôts de monnaies sassanides, en Chine comme dans les Xiyu, met en lumière le fait que c’est moins la situation sur la Route de la Soie que l’état politique et donc économique, de la Chine du nord, qui détermine la circulation sur la Route. Les dépôts des Xiyu correspondent principalement à deux périodes, d’une part des dépôts enfouis vers la fin du règne de Shapur III (383-389) et d’autre part des dépôts de la fin du VIe siècle et du début du VIIe ; les monnaies couvrent les règnes de Shapur II à Shapur III (309-389), puis la plupart des règnes à partir de Peroz (459-484), sauf Kavad (484-488/497-531) ; on note cependant que parmi les monnaies de cette dernière période, les drahm des souverains antérieurs à Khosro II (591-628) se comptent sur les doigts d’une seule main, y compris les monnaies de Peroz. Les dépôts de la Chine ne sont pas antérieurs à la seconde moitié du Ve siècle, et les monnaies s’échelonnent du règne de Yazdegerd II (438-457) à celui de Boran (630-633), mais ici, avec une nette dominante de monnaies de Peroz. On remarque donc, dans les Xiyu, une absence de monnaies antérieures à Shapur II, de monnaies de la période 389-459, et une faible représentation des monnaies de la période 459-591, et en Chine, une absence de monnaies antérieures à 438. Ces périodes non représentées correspondent-elles à une fermeture de la Route de la Soie, à un affaiblissement de la Perse sassanide ou à un effacement de la Chine ?
______
24 Li Shouli avait sous sa juridiction la Préfecture de Long, qui correspond à l’ancien Hexi, il était également gouverneur non résident de la capitale des Xiongnu, Chanyu, située au sud de l’actuelle Hohote en Mongolie Intérieure, et enfin, son fils Li Chengcai était Prince de Dunhuang ; nous avons là trois lieux où les deux monnaies, sassanide et byzantine, ont pu être collectées pour le Prince. La présence dans sa collection d’une monnaie de Gaochang, semble indiquer que du Hexi lui arrivait des pièces rares.
108 F. T H I E R R Y
En fait, le problème est moins un problème de coupure que de destination. Il existe clairement une relation entre l’état de la Chine du nord et la situation de la Route : chaque fois que la Chine du nord a été unifiée - ou chaque fois qu'une force semblait sur le point de l’unifier -, c’est à dire chaque fois qu’elle a représenté un marché solvable et une source de pro-duits, il y a eu des relations entre elle et l’Occident, malgré la présence de hordes nomades sur la Route
de la Soie, sauf peut-être, ponctuellement et loca-lement (voir p. 111-119). On a d’ailleurs la preuve de cette circulation durant la période de soi-disant fermeture, ne serait-ce que par l’existence d’ambas-sades de pays d’Occident qui se sont rendues à la cour de ceux qui, à un moment, avaient réussi à réunifier la Chine du nord, mais aussi à la cour des dynasties légitimes en Chine du sud.
Carte 2 Vers 330-332, Zhang Jun, Roi du Hexi et souve-
rain des Liang antérieurs de 324 à 346, envoie le haut fonctionnaire Ma Xian escorter les ambassadeurs de Jushi, de Khotan, de Shanshan et du Ferghana à la cour de Shi Le 25, auquel ils remettent des produits de leurs pays (Jinshu : CV, 2747). Quelque temps au-paravant, ce même Zhang Jun, effrayé par l’avance des troupes de Shi Le vers le Hexi, avait fait acte de ______
25 Shi Le, chef des tribus Jie, fonde en 319, le royaume de Zhao (Zhao postérieurs 319-350) ; en 330, il se proclame empe-reur et meurt en 333.
soumission et avait lui aussi envoyé des “produits locaux” (Jinshu : CV, 2745).
Cette première tentative de renouer le contact avec une Chine qui semble à nouveau être un marché potentiel, n’aura guère de suite, en raison des diffi-cultés du Zhao face aux attaques des Yan antérieurs à l’est et des Dai au nord, deux royaumes qui s’empa-rent d’importants territoires de ses domaines orien-taux. La seconde tentative est beaucoup plus significative.
En 376, le roi de Qin (Qin antérieurs 351-394), Fu Jian, qui a réussi à unifier la Chine du nord, sou-
S U R L E S M O N N A I E S S A S S A N I D E S T R O U V E E S E N C H I N E 109
met à son pouvoir le Hexi. Il cherche à entrer en con-tact avec les pays d’Occident pour être approvisionné en “produits extraordinaires et précieux des pays étrangers”, et pour ce faire, il charge Liang Xi, nou-veau préfet de Liangzhou d’envoyer des ambassa-deurs en Occident (Jinshu : CXIII, 2900 ; Qi, Lu et Guo : 52-53). La première ambassade mentionnée est celle du Ferghana (Da Yuan) qui offre des chevaux célestes à sueur de sang et à crinière rouge, ainsi que “500 différentes sortes de choses précieuses” (Jinshu : CXIII, 2900). En 379, arrivent à la cour des Qin des délégations de Shanshan, de Jushi, de Khotan, du Ferghana et de Sogdiane (Kangju) (Jinshu : CXIII, 2904) ; trois ans plus tard, les rois de Jushi et de Shanshan viennent à la cour de Fu Jian. Le roi de Jushi propose d’apporter le tribut chaque année, Fu Jian lui répond que la route des Xiyu étant longue, il suffirait que le tribut soit versé tous les trois ans et que le roi vienne à la cour tous les neuf ans (Jinshu : CXIV, 2911). Les ambassades cessent à partir de la défaite des Qin à la fameuse bataille de Feishui, en 383, qui voit le début du démembrement du royau-me. Il faut attendre cinquante ans avant que des am-bassades des Xiyu ne reviennent en Chine du nord.
Ces deux périodes, 330-333 et 376-383, sont les deux seules durant lesquelles un pouvoir issu des barbares installés en Chine du nord a réussi une brè-ve unification ; il est clair que ces deux périodes d’u-nification et les promesses de commerce qu’elles laissaient entrevoir, ont été, pour les marchands de Sérinde et de Sogdiane, une occasion de tenter de re-nouer les liens avec un marché traditionnel. Ces con-tacts reprennent vers 435, lorsque, comme les Zhao postérieurs et les Qin antérieurs, les Wei unifient la Chine du nord, et ils ne cessent, provisoirement, qu’avec les invasions arabes et la destruction de l’empire perse et des royaumes d’Occident. On ne peut manquer de constater que les monnaies trouvées en Chine s’intègrent dans les deux dernières de ces périodes, les dépôts de Qodjo [6, 8] correspondant bien à la première et les dépôts de Chine propre ne commençant qu’avec des monnaies de Yazdegerd II (438-457), et finissant avec celle de Boran (630-633), s’accordant parfaitement, tout comme ceux d’Astana, avec la seconde.
On voit donc clairement qu’il n’y a de relations, commerciales ou diplomatiques, que s’il y a, à l’une ou à l’autre extrêmité de la Route, une puissance, un marché potentiel ou une source de produits. La circu-
lation est interrompue parce qu’à l’une ou à l’autre des extrêmités de la Route, il y a défaillance des ac-teurs économiques ou politiques. Si, par exemple, entre 476 et 507, aucune délégation sassanide ne se rend en Chine, ce n’est pas parce que la route était coupée, puisqu’entre ces deux dates, arrivent en Chine des ambassades de Sogdiane, de Samarcande ou du Ferghana : la route est donc bien ouverte, au moins de l’Oxus à la Chine, et la route maritime reste une possibilité. Il est clair que cette absence diploma-tique est liée à un effacement momentané de la puis-sance perse confronté d’une part, à une situation inté-rieure chaotique - mouvement mazdakite et problè-mes de succession -, et d’autre part au péril extérieur représenté par les Hephtalites, vainqueurs à deux re-prises de Peroz, et arbitres dans les guerres de suc-cessions. Comme la Chine du IVe siècle, la Perse est alors occcupée par ses problèmes intérieurs, elle est un marché hasardeux et une “destination à risque”. Les ambassades reprennent à partir de 507, tant avec les Wei, c’est à dire en empruntant la route terrestre, qu’avec les Liang, c’est à dire par la route maritime.
La Chine du nord, durant la période qui va de 290 à 435, est une destination à risque, un marché insolvable et un fournisseur défaillant. Cette époque est marquée par des guerres incessantes, des raids, des razzias, des soulèvements locaux, des pillages et des massacres. De 291 à 306, sous l’impératrice Jia des Jin, la lutte entre divers princes de la maison im-périale provoque la dislocation du tissu social, la guerre civile et la famine ; c’est la période dite des “troubles des Huit Princes” (Bai SY : 190 ; Wang WQ : 49-58). Cette situation favorise l’irruption des Barbares dans la Chine du nord qui est divisée d’abord en quatre royaumes barbares qui, de 304 à 330 environ, se déchirent jusqu’à ce que celui des Jie, le Zhao, semble parvenir à unifier le pays ; il est aussitôt attaqué par son voisin septentrional, le ro-yaume de Dai des Tabghatchs et par une nouvelle horde de Xianbei qui fonde le royaume de Yan (Yan antérieurs, 337-370) ; quelques temps après, un nou-veau peuple barbare, les Di, fonde le royaume de Qin (Qin antérieurs, 351-394), qui parvient à unifier la Chine du nord vers 376 ; ce royaume, après sa dé-faite devant la dynastie Jin, en 383, à Feishui, est at-taqué de toutes parts, par des Tibétains (royaume des Qin postérieurs, 384-417), par des hordes Xianbei (royaumes des Yan de l’Ouest, 385-394, des Yan postérieurs, 384-409 et des Qin de l’Ouest, 385-431), par une horde de Dingling (royaume de Wei, 388-
110 F. T H I E R R Y
392) et par le royaume des Tabghatchs qui prend le nom de Wei en 386. Entre 386 et 435, ce dernier détruit les uns après les autres les différents États (Cordier : Vol. I, 303-338 ; Bai SY : 190-199).
L’arrivée au pouvoir des Wei du Nord met progressivement fin à l’anarchie, et permet une stabi-lisation du pays, un redressement de l’économie et le développement du Bouddhisme.
Carte 3
____________________________________________________________________________________________________________________
Cet état de guerre permanent a bien entendu des conséquences sur l’état économique du pays et il est un facteur d’insécurité pour les marchands et les caravanes. Si les princes barbares restent une clien-tèle potentielle pour les produits venant de Perse et des autres pays d’Occident (voir p. 126), la des-truction des grandes villes 26, les massacres et la fuite
______
26 On ne donnera que quelques éléments : en 311, Luoyang est prise, mise à sac et incendiée ; 30 000 habitants sont massacrés. En 313, Chang'an subit le même sort ; elle est prise à nouveau en 349, 407, et ca 430. Luoyang est prise en 364 et 423. Dunhuang est pillée par les Rouran en 473. Le changement de résidence des princes barbares s’accompagne de la déportation de la population de l’ancienne “capitale” vers la nouvelle : les Qin antérieurs déportent les habitants de Ye à Chang’an en 376. Les villes prises sont généralement pillées et vidées de leur population “utile” : en 439, 30 000 habitants de Liangzhou (Guzang) sont déportés à Pingcheng ; 3000 familles de barbares Dingling de Dingzhou suivent le même chemin en 447.
des élites et des artisans au sud ont provoqué la disparition des classes urbaines, qui formaient une part importante de la demande en produits etrangers et celle des marchés qui leur étaient liés. D’un autre côté, le déplacement perpétuel des capitales 27 a pour conséquence l’instabilité des structures commerciales ______
27 La notion de capitale doit être relativisée, dans la me-sure où chacun des vingt et un royaumes, puis les Wei et leurs successeurs, a une capitale, c’est à dire le centre politico-mili-taire de la horde (parfois le campement princier installé à proxi-mité d’une ville chinoise), qu’il déplace au gré des menaces ou des victoires ; à titre d’exemples, les Xiongnu des Han et Zhao antérieurs (304-329) ont eu cinq capitales, Zuoguocheng, Lishi, Puzi, Pingyang et Chang'an ; les Jie des Zhao postérieurs (319-350) en ont eu deux, Xiangguo et Ye ; les Xianbei des Yan an-térieurs (337-370) en ont eu trois, Longcheng, Ji et Ye ; les Di des Qin antérieurs (351-394) en ont eu trois, Ye, Chang’an et Jinyang ; les Tabghatchs des Wei (386-534) en ont eu trois, Shengle, Pingcheng et Luoyang ; les Xiongnu des Xia (407-431) en ont eu quatre, Chang’an, Tongwancheng, Pingliang et Shanggui.
S U R L E S M O N N A I E S S A S S A N I D E S T R O U V E E S E N C H I N E 111
et l’impossibilité d’établir des marchés fixes et les quartiers pour étrangers, les manyidi, qui sous les Han servaient de lieu de regroupement pour les com-merçants et les caravanes venus de toutes les régions extérieures à l’empire. Il faut attendre l’installation de la capitale à Luoyang en 493, pour que les Wei du Nord ouvre à nouveau un manyidi dans leur métro-pole (Liu XR : 45-48). D’un autre côté, les princes barbares n’ont guère de produits à offrir en échange, en raison de la désorganisation de la production agri-cole et artisanale dans les territoires qui leur servent de champs de bataille. Le principal et le plus pré-cieux des produits chinois, la soie, est le premier à pâtir de la situation.
Durant la période de division (du IVe à la 1ère moitié du VIe siècle), la zone productrice de la soie de meilleure qualité, la région de Shu, au Sichuan, est séparée du nord et dépend des dynasties légitimes du sud. Par ailleurs, les guerres causent aux plan-tations de mûriers des dégâts difficilement réparables en périodes de troubles 28 (Jinshu : CVI, 2764). Ce n’est qu’à partir du deuxième quart du Ve siècle que la production de soie retrouve ses niveaux de l’épo-que des Han, sinon pour la qualité, du moins pour les quantités. Même lorsque les Wei du Nord parvien-nent à redonner une grande ampleur à la production de soie, jamais leurs produits ne pourront se comparer à ceux du Sichuan (Liu XR : 70).
Pour leur cour et leur capitale, les différents princes et chefs de tribus cherchent à se procurer des matières précieuses et des produits exotiques. Lorsqu’ils ne peuvent les obtenir par les échanges ou par des dons à caractère diplomatique, ils se les pro-curent par les pillages et parfois même par des profanations de tombes.
2-Le rôle des nomades
L’histoire des Barbares d’Asie Centrale du IVe au VIIe siècle, peut être divisée en trois périodes, qui, pour être à peu près définissables, n’en sont pas moins chronologiquement fluctuantes selon les ré-gions envisagées. La première période, qui corres-pond, en gros, au IVe siècle, est marquée par la gran-______
28 C’est parfois à l’extérieur que les princes barbares se procurent la soie : en remerciements pour la grâce octroyée à des condamnés à mort originaires de Liangzhou (Hexi), les autorités de cette principauté offrent à Shi Le, le roi de Zhao, 10 rouleaux de soie et 10 jin de bourre de soie (Jinshu : CV, 2747-2748).
de vague des Xiongnu ; la seconde phase correspond à l’affrontement, durant le Ve et le début du VIe siècle, entre les différents barbares et nomades, mais plus particulièrement entre les Tabghatchs (Tuoba) et les Rouran, à l’intérieur d’un ensemble géographique allant de Khotan au Liaoning et de Gaochang à la Kerulen ; la troisième phase (VIe-VIIe) est celle d’une relative stabilisation dûe à l’émergence de grands empires d’origine barbare mais fortement marqués par des civilisations extérieures à la steppe, l’empire hephtalite, le khanat des Türks et le royaume tabghatch des Wei et de leurs successeurs.
La grande migration des Xiongnu débute en Orient dès l’antiquité : installés tout le long de la Grande Muraille, ces nomades, attaqués à l’est par les Xianbei, ont tenté à plusieurs reprises de pénétrer en Chine, mais devant la résistance rencontrée, ils se sont déplacés vers l’ouest, le long du corridor du Gansu, passant soit au nord, soit au sud des Pamirs ; c’est ce mouvement qui provoque la migration des Yuezhi vers les territoires indo-grecs. Sous les Han de l’Est, et malgré les campagnes de Ban Chao, les Xiongnu du Nord, les Wuhuan et des tribus de Gaoju contrôlent épisodiquement le bassin du Tarim, chas-sant vers l’ouest ou le nord ouest les Wusun et d’au-tres peuples nomades 29 (Tongdian : CXCXI, 5194-5195 ; Yü YS : 146-149 ; Cordier : 267-276). Pour ce qui concerne la Chine du nord, dès la fin du Ie siècle, la pression des Xianbei repoussait les Xiongnu vers le sud et vers l’ouest, mais jusqu’au milieu du IIIe siècle ap. JC, ces derniers avaient à peu près été con-tenus par les Han et leurs successeurs ; après la fin des Trois Royaumes (265), les raids prennent de plus en plus d’ampleur, auxquels se mêlent Dingling et Xianbei, originaires de territoires situés au delà des régions de nomadisation des Xiongnu. En 296, le chanyu des Xiongnu mène une offensive de grande
______
29 À la lecture des chroniques chinoises, il paraît très diffi-cile de tracer des équivalences entre les peuples nomades qui y sont mentionnés et ceux qui apparaissent dans les chroniques occidentales : il existe peu de peuple nomade “pur”, et l’on trouve en revanche, un nombre impressionnant de “tribus dis-persées”, de “branches détachées”, de petites peuplades absorbées par des hordes différentes. Ainsi, les “Xiongnu” qui attaquent les Xiyu et s’y maintiennent peu ou prou, sous les Han de l’Est sont en fait des Xiongnu et des Gaoju d’une part, des Xiongnu devenus Xianbei par soumission et assimilation d’autre part, sans compter des “tribus dispersées” ou “détachées” de Wusun et de Wuhuan. C’est cet ensemble qui se trouve en Sérinde au début du IVe siècle, et c’est lui qui, poussé par d’autres Xiongnu et par des Xianbei, passera les Pamirs.
112 F. T H I E R R Y
envergure contre la Chine des Jin. Au début du IVe, différentes hordes de Xiongnu s’installent derrière la Grande Muraille, et en particulier, les Xiongnu du Liaodong, chassés par des Xianbei, s’installent au Shanxi. Au nord et au sud de la Muraille, les tribus se déplacent vers l’ouest, les unes poussant les au-tres, fédérés, barbares puis Xianbei. La Grande Plaine est ravagée, Chang'an et Luoyang sont prises, pillées et incendiées, la dynastie impériale doit se replier au sud et laisser le nord aux barbares. Comme on l’a vu, la lutte entre les “Cinq types de Barbares” en Chine du nord se termine par l’éviction des Xiongnu fédérés dès 329, par des Xiongnu d’une autre horde, les Jie, qui sont eux mêmes evincés par les barbares di, d’origine tibétaine. Chassés par les Di, les Jie et les Xianbei, les Xiongnu se déplacent vers l’ouest ; les Xianbei du Liaodong poursuivent leur migration jusque sur les franges orientales du plateau tibétain, et s’installent autour du lac Koukou-nor en 333. Les Xiongnu passent par la steppe vers la mer Caspienne ou bien traversent la Sérinde, puis passent les Pamirs, poussant devant eux les divers nomades qui s’y étaient installés depuis un ou deux siècles. C’est vraisemblablement vers 350, qu’ils pé-nètrent sur les territoires sassanides dépendant des gouverneurs kouchano-sassanides. Ce sont les hordes de cette première vague qui affrontent les Sassanides, puis qui, tout au moins pour une partie d’entr’elles, s’allient à eux et vont aller lutter contre les Romains, et participer au fameux siège d’Amida en 360 (Bi-var : 210-212). Cette vague était sans doute com-posée en grande partie de Xiongnu, mais il est proba-ble qu’elle entraîna avec elle des tribus appartenant à d’autres peuples de la steppe, comme des Wusun, des Wuhuan, des Xianbei, des Dingling ou des Rouran. Il est fort probable aussi, que, pressés par les Xianbei ou les Rouran, d’autres peuplades ou d’autres tribus Xiongnu détachées de la horde principale, aient pro-voqué jusqu’à la fin du IVe, des vagues successives d’une moindre ampleur, dont la dernière parait être celle des Hua (Hephtalites), au début du Ve siècle.
Cette première période est marquée par la grande migration des Xiongnu et des Xianbei vers l’ouest et par l’éviction des premiers de la scène géopolitique de la Chine du Nord et de l’Asie Centrale orientale. Il ne reste dans ces zones que des hordes mineures de Xiongnu, celle du clan Juqu, mise en fuite par les Wei (Tabghatch) en 439-440, avant d’être dispersée par les Rouran en 460, et celle du clan Helian, qui
occupe le nord du Shaanxi et la partie orientale du Gansu de 407 à 431, sous le nom de royaume de Xia.
La seconde période est celle de la lutte acharnée entre les Tabghatchs et les Rouran pour le contrôle de l’Asie Centrale septentrionale et la Chine du nord.
Au IVe siècle, les Rouran 30 étaient installés au sud de la Kerulen et avaient pour voisins septen-trionaux, les Gaoju orientaux ; attaqués par les Tab-ghatchs en 386-390, ils se mettent en mouvement vers l’ouest et s’établissent à l’extrêmité occidentale du désert de Gobi, sur les contreforts de l’Altaï (Duan LQ : 205-208 ; Beishi : XC, 3249). Peu à peu, ils étendent leur influence vers le nord, en direction des Gaoju, orientaux et occidentaux, et vers le sud, en envahissant la région des Ordos et la Mandchou-rie. À la fin du IVe siècle, ils avaient constitué, au nord de la Muraille, une vaste confédération infor-melle comprenant les Rouran proprement dits, les Gaoju, les Yeta et divers petits peuples de moindre importance. En 402, le chef suprême des Rouran, Shelun, prend le titre de Qiudoufa Qaghan et fonde le Khanat des Rouran. C’est probablement à cette épo-que, que les tribus Hua se détachent de la confédé-ration Rouran pour aller s’installer sur les deux vers-ants des Pamirs, puis envahir la partie orientale du monde iranien et le nord de l’Inde. Ils n’intervien-nent plus dans les affaires de la Sérinde, sauf peut-être à Khotan 31.
Les régions de l’Altaï , la Mongolie, l’Ordos, le Hexi et le versant méridional du Tianshan sont le ______
30 Sur l’identification des Rouran (Ruanruan) avec les Avars, voir Chavannes : 229-231.
31 Il est intéressant de noter qu’il semble que Khotan soit, par tradition plutôt tourné vers l’ouest, et fasse partie des em-pires qui contrôle l’Inde du nord et le versant occidental des Pamirs. À l’époque kouchane, le royaume était sous l’influence des Kouchans, et c’est probablement de là que Kadphisès mena son expédition contre Ban Chao. Khotan est la seule région du Turkestan chinois où l’on a découvert des monnaies kouchanes. Le royaume, qui appartenait à la sphère d’influence indienne, devait avoir, de ce fait, des liens particuliers avec les Hephtalites, bien avant leur retour en Orient, à la fin du Ve, sans doute jusqu’en 445, date à laquelle les Togons s’en emparent. La spécificité de Khotan n’a pas échappé aux chroniqueurs chinois : “A l'ouest de Gaochang, les habitants de tous les royaumes ont les yeux foncés et un grand nez, il n’y a que dans ce pays là (Khotan) que leur aspect n’est pas tout à fait celui des Hu (Sogdiens et Iraniens), mais se rapproche quelque peu des Chinois ” (Weishu : CII, 2263) ; contrairement aux autres royaumes, comme Koutcha ou Yanqi, “ils sont principalement bouddhistes, et les pagodes, les stupas, les moines et les nonnes y sont extrêmement nombreux ” (Weishu : CII, 2262). Voir également Emmerick : 263-269.
S U R L E S M O N N A I E S S A S S A N I D E S T R O U V E E S E N C H I N E 113
champ clos des guerres entre Rouran et Tabghatchs, guerres auxquelles participent les Gaoju, les Togons, les Xiongnu des clans Juqu et Helian, les Xianbei du Liaoning, les Yueban et les Wusun, ainsi que les divers royaumes eux-mêmes, comme Koutcha et Gaochang. À la fin du premier tiers du Ve siècle, trois peuples ont réussi à éliminer ou à satelliser les autres : les Rouran, sous le règne de Data Qaghan (419-429), contrôlent la Mongolie, la Sibérie du sud, la Dzoungarie et l’Asie Centrale jusqu’à la ligne des oasis du nord du Tarim, Jushi, Yanqi et Koutcha ; les Tabghatchs, sous le règne de Taiwudi (424-452), ont unifié la Chine du nord, et s’avancent vers l’ouest, menaçant les possessions des Rouran sur la Route de la Soie ; enfin, les Togons, des Xian-bei du Liao-dong, ont conquis le sud du Tarim, et contrôlent les oasis de la Route de la Soie méridionale, jusqu’à Khotan, pris en 445, par le Qaghan Mu Liyan (436-452) (Tongdian : CXC, 5164 ; Zhou WZ : 35-36).
Bloqués à l’ouest par les Yueban qui, depuis 448, ont fait alliance avec les Tabghatchs qui eux-mêmes empêchent toute pénétration vers le sud-est, les Rouran attaquent au sud-ouest, envahissent le Gaochang (460), puis passant par Koutcha atteignent Shule (Kachgar) et enfin Khotan en 471, où ils se trouvent au contact des Hephtalites. Le Khanat des
Rouran est alors à son extension maximum, de Khotan aux rives de l’Amour. C’est à cette période que les Gaoju, qui n’étaient encore qu’un groupe de tribus de la confédération Rouran commencent à se manifester. Les Fufuluo, l’une des douze tribus des Gaoju occidentaux, se mettent en mouvement vers 470-480 et nomadisent sur les frontières des Wei, dans l’Ordos et le Hexi ; en 481, leur khan Afu-zhiluo prend Gaochang puis repasse au nord des Tianshan. En 487, il fonde le Khanat des Gaoju, avec pour capitale Beshbaliq (Hou bu, Guzheng), sur ce qui était l’ancien territoire du royaume postérieur de Jushi (Jushi hou bu wangguo) ; le khanat est divisé en deux parties, le nord est sous la direction de Afuzhiluo, et le sud sous celle de son cousin Qiong Qi. En 490, le Khanat des Gaoju envoie un marchand sogdien à la cour des Wei pour mettre sur pied une alliance contre les Rouran. Les Wei attaquent en Mongolie cependant que les tribus Gaoju, sous les ordres de Qiong Qi, passent les Tianshan, prennent Yanqi et Shanshan en 492, et Gaochang en 496 (Weishu : CIII, 2310-2313 ; Tongdian : CXCVII, 5398-5340 ; Duan LQ : 230-234). C’est alors que la situation régionale est bouleversée par le retour des Hephtalites.
Carte 4
____________________________________________________________________________________________________
114 F. T H I E R R Y
Assurés sur leur flanc occidental après leurs vic-toires sur l’empire sassanide, les Hephtalites pro-fitent des difficultés de leurs voisins Rouran : ils leur enlèvent Khotan puis arrivent au contact des Gaoju à Yanqi vers 498. Les Gaoju sont écrasés et le khan Qiong Qi est tué. Les Hephtalites intrônisent son fils Mi’etu, et lui fournissent troupes et armes pour s’em-parer de la partie nord du Khanat. Vers 502, Mi’etu devient le Qaghan suprême des Gaoju, sous suzerai-neté des Hephtalites. À partir de cette date, les hosti-lités ne cessent plus entre les Rouran et les Gaoju. Les deux hordes s’épuisent mutuellement et dispa-raissent à peu près en même temps, les Gaoju en 541, sous les coups des Rouran, des Wei et des Tölos, et les Rouran en 552-555, sous ceux des Tölos et des Türks (Zhoushu : L, 908-909 ; Chavannes : 221-222 ; Duan LQ : 241-247). Cette période, qui s’étend sur le Ve siècle et la 1ère moitié du VIe, est marquée par une activité incessante des divers peuples noma-des, mais on note que les mouvements des hordes ne se fait pas dans une grande migration d’est en ouest, comme dans la période précédente, mais par une suite d’aller et de retour, de raids et de contre-raids, d’expéditions saisonnières, de grands mouvements circulaires menant divers tribus ou fractions de tribus au sud du Gobi ou des Tianshan, avant d’y dispa-raître à nouveau. On note également qu’à cette épo-que, c’est principalement la Route de la Soie centrale qui subit les aléas de la situation militaire et politique.
La troisième période, qui correspond à peu près à la seconde moitié du VIe et au VIIe siècle, peut être caractérisée comme une période de stabilisation : en Asie Centrale, aux mouvements incessants des no-mades succède l’édification de vastes empires, celui des Hephtalites puis des Türks, et en Chine, des dy-nasties réunifient peu à peu l’empire, préparant le retour de la Chine Impériale dans les Xiyu. Cette pé-riode étant mieux connue nous n’en tracerons que les grandes lignes.
Après avoir détruit le Khanat des Rouran, Bou-min (Tumen) Qaghan, qui a fondé le Khanat des Türks, se rend maître de tous leurs territoires des steppes de Mongolie à l’Altaï. Alliés à la Chine contre les Rouran, ayant noué de solides alliances matrimoniales avec tous les pouvoirs successifs de Chine du nord 32, les Qaghan türks sauront monnayer ______
32 Voir note 16 p. 19 ; le Zhoushu donne la biographie de deux impératrices chinoises d’origine türke, une princesse du clan Tuku Xin qui avait été mariée au futur Mingdi, et une prin-
une attitude de non agression — n’excluant pas les pressions et les raids — à l’égard d’une Chine qui aurait pourtant été une proie facile, en raison de l’éclatement de l’empire des Wei entre les Wei de l’Est (534-550) et les Wei de l’Ouest (535-556), auxquels succèdent respectivement, les Qi du Nord (550-577) et les Zhou du Nord (557-581). Ils ont tourné leurs armes en direction de leurs voisins occidentaux, les Hephtalites, puis Perses.
Durant la première moitié du VIe siècle, outre leurs possessions à l’ouest des Pamirs, les Heph-talites contrôlent la partie occidentale du bassin du Tarim. Le Liangshu précise “(ce royaume) a soumis les états qui étaient ses voisins, les royaumes de Per-se, de Banban 33, de Jipin (Cachemir), de Yanqi (Karashar), de Qushi (Koutcha), de Shule (Kachgar), de Gumo (Aksu), de Yutian (Khotan) et de Gouban (Kökyar, Yarkand)” (Liangshu : LIV, 812). Le Weishu et le Beishi sont moins précis, puisqu’ils ne citent précisément que Khotan, Kachgar et “trente petits royaumes” (Weishu : CII, 2279 ; Beishi : XCVII, 3231). L’empire hephtalite est séparé de la Chine des Wei par deux khanats, celui de ses vassaux Gaoju, qui occupent Gaochang, le nord des Tianshan et la région de l’Etsin Göl, et celui des Togons qui détiennent toujours la région du Koukounor.
Au début de la seconde moitié du VIe siècle, dès 557, les Türks, pénetrent dans les territoires qui dé-pendent de l’empire des Hephtalites ; entre 562 et 568, ils le détruisent et en annexent la plus grande partie. À partir de cette période, et jusqu’à l’avène-ment des Tang, en 618, ce sont les Türks qui contrô-lent la Route de la Soie centrale, de Gaochang à Amol sur l’Oxus, en passant par Koutcha, Taş-kurgan, Satrouchana, Samarcande, et la Route du nord qui traverse la steppe 34. ______ cesse du clan Ashina, mariée au futur Wudi (Zhoushu : IX, 143-144) ; voir aussi Chavannes : 222 et 260.
33Le Banban est un royaume du sud, ici, il s’agit vraisem-blablement d’une erreur pour Kebantuo (Taşkurgan), comme le restitue les textes du Nanshi et du Tongdian (Nanshi : LXXIX, 1984 ; Tongdian : CXCIII, 5258).
34 Le lecteur occidental connaît bien la situation géo-politique de la Route par les relations des ambassades réci-proques türkes et byzantines, et les analyses qui en ont été faites pour qu’il soit ici nécessaire d’y revenir. Voir Chavannes : 233-242, Cordier : 392-395, Needham, 185-187, Sinor, 301-305 ; on consultera également H. Yule, Cathay and the Way Thither, being a collection of medieval Notices of China, 1913-1915, revu par Cordier, vol. I Preliminary Essay on the intercourse between China and the Western nations previous the Discovery of the Cape Route, Pékin 1942, 202-205.
S U R L E S M O N N A I E S S A S S A N I D E S T R O U V E E S E N C H I N E 115
Inquiets de la trop grande puissance de leurs alliés Türks, les Sui puis les Tang jouent sur l’anta-gonisme entre les différents khans, occidentaux et orientaux, occidentaux et septentrionaux. L’empereur Taizong des Tang s’allie avec les Türks occidentaux pour détruire le Khanat des Türks du Nord, résultat obtenu en 630 avec la capture de Hieli, le Qaghan suprême des Türks du nord. Les Tang s’occupent alors à faire éclater le Khanat occidental en s’ap-puyant de l’opposition entre les Cinq tribus de Nu-shebi et les Cinq Tribus de Dulu (Toulou). Les querelles internes du khanat permet à la Chine de gri-gnoter leur territoire en Asie Centrale : en 640, ils prennent Gaochang, en 644 Yanqi et en 648 Koutcha. En 649, cette ville devient le siège du protectorat d’Occident, qui contrôle tout le bassin du Tarim, aussi bien la route du centre que la route du sud. Les Türks sont évincés de l’Asie orientale (Chavannes : 259-268).
La plupart du temps, la domination barbare en Sérinde a pris la forme d’une suzeraineté assez loin-taine, principalement d’ordre fiscal, sauf dans le cas d’invasion, de mouvements de hordes ou de combats. La situation était alors plus redoutable pour les habi-tants, mais elle ne constituait pas un obstacle infran-chissable ; les caravanes avaient toujours la pos-siblité de changer d’itinéraire, et des routes locales de contournement des zones dangereuses existaient (voir p. 122).
Comme on l’a vu, c’est moins l’itinéraire et sa situation politique ou militaire, qui détermine la circulation, que l’état politique et économique des empires et des régions reliés par cet itinéraire. Cependant, la présence massive de monnaies de Peroz, et ainsi que celle d’une (au moins) monnaie portant une contremarque hephtalite, dans les dépôts de monnaies sassanides trouvés en Chine proprement dite, ne s’explique que par la présence des Hephtalites sur la Route de la Soie, et nous impose une analyse de leur rôle particulier.
Selon les sources chinoises, “à l’époque où les Wei étaient installés sur la Sanggan” (Liangshu : LIV, 812), ou “à l’époque où les Wei résidaient à Daidu” (Nanshi : LXXIX, 1984), les Hua n’étaient qu’un petit peuple soumis aux Rouran. Cette indica-tion permet de dater avec une relative précision, la période où les Hua, c’est à dire les Hephtalites, étaient encore en Asie Centrale : les Wei ayant dé-placé leur capitale de Shengle à Pingcheng (Daidu) en 398, les Hephtalites ne peuvent pas avoir effectué
leur migration vers l’ouest avant cette date. Par ailleurs, la mention du lieu de résidence des Wei, la rivière Sanggan, ne peut pas signifier durant toute la période où les Wei avaient leur capitale à Pingcheng, sur la Sanggan, c’est à dire de 398 à 493 35, puisque l’on sait que les premiers affron-tements entre Hephtalites et Perses se situent vers 427, sous le règne de Varhran V (Cunningham : 281-282 ; Drouin 1895 : 24-25 ; Ghirshman : 84 ; Göbl : vol. 2, 89). À notre avis, il faut comprendre lorsque les Wei demeuraient encore sur la Sanggan, c’est à dire quand ils n’avaient pas encore envahi le nord de la Chine, ce qu’ils font à partir de ca. 400. On peut ainsi établir que jusque vers 400, les Hua étaient en-core dans leur région d’origine, que le Weishu situe au nord de la muraille, sur le versant méridional de l’Altaï (Weishu : CII, 2278) 36. C’est de là, qu’ils font mouvement vers le sud, en passant à l’ouest de Kho-tan, pour aller s’installer sur le haut Oxus (Weishu : CII, 2278). La date de cette migration n’est pas établie avec précision, mais elle se situe entre 400, date où les Hua ne sont encore qu’un “petit peuple soumis aux Rouran”, et 427, date à laquelle ils sont au contact avec Varhran V. Plusieurs auteurs donnent la date de 425 (Cunningham : 281 ; Drouin 1895 : 8, 12 ; Duan LQ : 235) 37.
La constitution de l’empire hephtalite à l’ouest des Pamirs et les défaites sassanides sont des évé-nements suffisament connus pour n’y point revenir
______
35 “Au temps où les Wei résidaient à Sang-kan, dans le nord du Chan-si, c’est à dire de 384 à 494, les Hoa n’étaient qu'un petit peuple soumis aux Joan-joan." (Chavannes : 222). On ne peut, d’autre part, retenir la traduction de E. Specht : “Sous les Youan-Wei, ils (les Hua) demeuraient à Sangkan...” (Specht : 336), ce qui signifierait que les Hua étaient installés dans la capitale et dans la zone métropolitaine des Tabghatchs Wei.
36 Il paraît donc difficile d’admettre la thèse de R. Ghirshman qui voit les Hephtalites s’installer, dès 371, en Bactriane, avec le consentement de Shapour II (Ghishman : 82). Ces populations sont plus vraisemblablement des nomades du Tarim et des Tianshan qui continuent de migrer vers l’ouest, Xiongnu, Wusun, Wuhuan, Dingling, etc.
37Le Tongdian dit que “Chang'an est à 10 100 li à l’est de leur royaume qu’ils ont atteint à l’époque de l’empereur Wen[cheng] des Wei (= 452-465), il y a déjà 80 ou 90 ans ” (Tongdian : CXCIII, 5259). Le Tongdian ayant été rédigé au début du IXe siècle, ces 80 ou 90 ans correspondent vraisembla-blement à une annotation recopiée dans le texte original du Weishu. Le texte rend en fait compte de la date à laquelle les Chinois ont appris que les Hua avaient constitué un empire puissant, sans doute par des ambassades sogdiennes ou par l’ambassade hephtalite de 456.
116 F. T H I E R R Y
ici 38. Ce qui est intéressant à noter, c’est qu’à trois reprises, avec Peroz contre Hormazd, puis avec Ka-vad contre Valash et contre Zamasp, les Hephtalites interviennent directement dans la lutte pour le pou-voir en Iran : ils fournissent armes et troupes pour imposer leur candidat. Au début de la dernière décennie du Ve siècle, ayant réussi à placer Kavad sur le trône sassanide, les Hephtalites se retournent vers l’est. On ne sait pas quand débute précisément ce Drang nach Osten, mais on sait que vers 498, ils ont atteint Yanqi (Karachar), où ils écrasent les armées de Qiong Qi, le khan méridional des Gaoju, qui, comme Peroz, trouve la mort dans la bataille (Weishu : CIII, 2310 et CI, 2244). Yanqi est le point ultime de cette campagne d’Orient : “(les Hua) ont soumis les états qui étaient leurs voisins, les ro-yaumes de Perse, de Banban (Taşkurgan), de Jipin (Cachemire), de Yanqi (Karashar), de Qushi (Koutcha), de Shule (Kachgar), de Gumo (Aksu), de Yutian (Khotan) et de Gouban (Kökyar, Yarkand)” (Liangshu : LIV, 812).
Après avoir vaincu et tué Qiong Qi, les Heph-talites procèdent comme ils l’ont fait avec Kavad, ils intrônisent son fils, Mi’etu, comme khan méridional des Gaoju, puis lui fournissent armes et soldats pour s’emparer du khanat septentrional. En 502, Mi'etu devient le Qaghan suprême de tous les Gaoju, puis, équipé par les Hephtalites et allié aux Wei du Nord, il se lance dans une série de campagnes contre les Rouran. En 508, les Gaoju écrasent une armée rouran et tuent le Qaghan Futu ; en 516, les Rouran prennent leur revanche en détruisant l’armée gaoju et en tuant Mi’etu. Les Hephtalites fournissent au fils de Mi’etu, Yifu, armes et troupes “pour reconquérir son ro-yaume”. En 519, les Gaoju réussissent à vaincre et à disperser les Rouran chez qui la défaite provoque la remise en cause de l’autorité du Qaghan et le début des crises internes. En 521, les Gaoju pénetrent profondément dans le khanat des Rouran qui éclate en deux factions adverses, l’une autour de Anagui et l’autre autour de son oncle Poluomen. À l’invasion des Gaoju s’ajoute la guerre civile : les Rouran vain-cus se réfugient chez les Wei. Ainsi, le puissant kha-nat des Rouran vit “ses chefs fuir vers la Cour et son peuple dispersé sur le sol”. L’année suivante, les Wei reconnaissaient le protégé des Hephtalites, Yifu, comme Roi des Gaoju et Général Pacificateur de ______
38 Voir Drouin 1895 : 24-49 ; Ghirshman : 85-91 ; Frye : 144-152.
l’Ouest, en remerciement de la liquidation du khanat qui si longtemps les avait fait trembler (Weishu : IX, 232). Les Hephtalites sont à l’apogée de leur puis-sance : la Perse sassanide leur verse un tribut et leurs vassaux Gaoju atteignent les rives de l’Etsin Göl.
Les relations sino-hephtalites commencent bien avant le retour des Yeta en Orient, et avant leurs vic-toires sur les Perses ; en 456, la première ambassade hephtalite arrive à Pingcheng, en même temps qu’une ambassade byzantine (Weishu : V, 115). De même que les Han avaient pris contact avec les Kouchans pour tenter de prendre à revers les Xiong-nu (c’est l’objectif du voyage de Zhang Qian), de même, les Wei ont eu cette idée pour prendre à re-vers les Rouran. On les voit en effet, contracter des alliances offensives contre les Rouran, en 448, avec les Yueban, nomades installés à l’est du Lac Bal-khash, et en 490 avec les Gaoju, alors établis au nord des Tianshan. Il est fort probable que dans la seconde moitié du Ve siècle, les Hephtalites ont eux aussi été contactés. Quoi qu’il en soit, lorsque les Hephtalites repassent les Pamirs à la fin du Ve siècle, ils envahis-sent des territoires qui, depuis 460-471, appartien-nent aux Rouran.
On a dit que Hephtalites et Rouran étaient alliés, au motif que le roi hephtalite aurait épousé les trois sœurs du qaghan Poluomen (Chavannes : 221 ; Cordier : 351 ; Duan LQ : 238), mais le retour des Hephtalites en Orient n’est pratiquement qu’une campagne contre le khanat des Rouran, provoquant sa déchéance et lui portant un coup dont il ne se relèvera pas : invasion et annexion des territoires Rouran au sud des Tianshan entre 490 et 498, armement et fourniture de troupes aux Gaoju de 502 à 516, organisation d’un sanctuaire pour les Gaoju après leur défaite de 516, réarmement et fourniture de troupes aux mêmes Gaoju en 517, pour qu’ils récupèrent leurs territoires, soutien à la campagne victorieuse de 519-521 qui s’achève par l’éclatement et la dispersion des Rouran. C’est dans ce contexte, vers 521, c’est à dire quand les Rouran sont en pleine anarchie, que se situe le fameux “mariage”. Poluomen n’est alors que l’un des chefs de faction des Rouran, et il ne peut guère traiter avec le roi hephtalite sur un pied d’égalité. Il est bien plus probable que Poluomen, en lutte contre les Gaoju et contre Anagui, a cherché, en offrant ses sœurs, à se concilier son puissant voisin, peut-être même ce geste a-t-il été fait comme une marque de soumission.
S U R L E S M O N N A I E S S A S S A N I D E S T R O U V E E S E N C H I N E 117
Carte 5
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
On voit que le retour des Hephtalites en Orient a créé, pour les Wei du Nord, une situation favorable leur permettant, dans un premier temps, d’alléger la pression des Rouran, et dans un second, de les dé-truire en tant que puissance organisée. Les relations sino-hephtalites sont excellentes et les annales des Wei ou des Liang ne rapportent aucune action mili-taire qui les ait opposé aux Hephtalites. Leur domi-nation sur les Routes de la Soie n’a jamais eu pour conséquence une insécurité ou une fermeture des voies de communication, et les ambassades des pays situés à l’ouest ou au sud de leur empire, ainsi que celles des royaumes qui leur étaient soumis, ont pu se rendre en Chine. Eux mêmes ont eu des relations officielles régulières avec la Chine du nord comme avec la Chine du sud : après leur retour en Orient, on relève dix ambassades aux Wei, en 507, 509, 511, 512, 513, 517, 518, 519, 530, 532, deux aux Wei de l’Ouest, en 546 et 553, une aux Zhou du Nord, en 558, et cinq aux Liang, en 516, 520, 526, 535 et 541. À deux reprises, le nom du roi est mentionné : en 516, “le roi Yetaiyilituo commence à envoyer des ambassades offrir des produits de son royaume” (Liangshu : LIV, 812) ; en 535, “Anlesadanwang, roi des Hephtalites, envoie des ambassadeurs offrir des
produits de son royaume.” (Liangshu : III, 79). On note que parmi ces “produits locaux”, avec les four-rures de martres blanches et des lions, se trouvent des brocards de soie de Perse (Liangshu : LIV, 812). Unique pouvoir entre la Chine et la Perse, les Heph-talites sont les intermédiaires obligés entre les deux mondes, et c’est manifestement par leur truchement qu’une partie de l’argent sassanide est passé en Chine. Cet argent provient du paiement des troupes hephtalites, de la rançon de Kavad et du tribut 39.
Les troupes mises à la disposition de Peroz par le roi des Hephtalites, en 459, pour chasser Hormazd et s’assurer du trône, furent “comblées de marques de reconnaissance” (Drouin 1895 : 33) ; le roi sassanide a également dû verser les soldes de ces troupes durant la campagne. La rançon payée pour sa libé-ration et celle de son fils Kavad fait suite à la pre-mière défaite de Peroz vers 470 : “Phirouz s’engagea alors, par un traité, de ne plus passer la frontière ______
39 D’après Tabari, cité par Drouin, il existe une autre source de revenus pour les Hephtalites : en raison de la famine qui regna au début du règne de Peroz, celui-ci “prit l’argent de ses trésors et envoya acheter du blé et des vivres chez les peuples de Roum, de l’Inde, des Ephtalites et de l’Abyssinie.” (Drouin 1895 : 33-34).
118 F. T H I E R R Y
pour faire la guerre aux Huns, mais de retour dans ses états il viola le traité, à l’exemple de Sedécias, et repartit pour la guerre. Aussi eût-il le même sort ; il fut battu par ses ennemis ; son armée fut dissipée et détruite et lui-même pris vivant. Or, dans son or-gueil, il promit de donner pour la rançon de sa vie trente mules chargées de drachmes 40. Il envoya [des émissaires] dans son royaume, mais il ne put réunir que vingt charges, car il avait épuisé tous les trésors du roi, son prédécesseur, dans ses premières guer-res. Pour les dix charges restantes, il laissa en otage chez les Huns, son fils Quawad, jusqu’à ce qu’il les eût payées, et conclut un second traité avec ses enne-mis promettant de ne plus leur faire la guerre.” (Josué : 9-10/XVI). Après la seconde défaite et la mort de Peroz sur le champ de bataille, en 484, l’em-pire sassanide fut contraint de verser aux Hephtalites un tribut, et celà jusqu’en 545 (Drouin 1895 : 34-35 ; Ghirshman : 18, 87-88 ; Frye : 147-148). C’est de cette masse de drahm sassanides, versés comme ran-çon ou comme tribut, que proviennent les pièces de Peroz, et une bonne partie des monnaies postérieures, trouvées en Chine.
Toutes ces monnaies ne proviennent pas du tri-but annuel consécutif à la défaite de 484, puisque les monnaies de Dingxian [32] ont été enfouies en 481. Il s’agit donc vraisemblablement soit de monnaies versées en paiement de la solde des troupes heph-talites, soit des monnaies reçues en échanges de vivres durant la famine, soit encore, des monnaies de la rançon de ca. 470.
R. Ghirshman, se fondant sur la présence d’une contremarque portant le même mot, Hephtal 41, sur des monnaies allant de Kavad à Khosro I, en a déduit l’extraordinaire longueur du règne d’un roi qu’il bap-tise Hephtal III 42, dont le “nom figure sur toutes les
______
40 Sur les indications de M. Bernard Outtier, je restitue “drachmes” à la place d’“écus” donné par Paulin Martin. Le texte syriaque donne zuze, pluriel de zuza, qui est le mot utilisé dans la Vulgate Syriaque pour rendre le mot “drachme” dans la parabole de la drachme perdue (Luc XV-8/9) et dans le paiement du tribut (Matthieu XVII-24). Le mot zuza est également utilisé pour désigner le 1/4 de shekel judéen et le dirhem arabe.
41 Si l’on admet bien cette lecture, car elle n’est pas établie avec certitude (voir Göbl : vol. 2, 148-151).
42 “Le nom du roi hephtalite que portent les surfrappes est toujours le même, et comme on le verra plus bas, il existe de fortes présomptions pour croire que c’était le même roi Hephtal qui regna pendant toute cette longue période.” (Ghirshman : 18)
pièces sassanides versées au titre du tribut depuis 484 jusqu’à 545 au moins” (Ghirshman : 90). Outre cette extraordinaire longévité, il existait un argument nous avait fait douter de la thèse du grand roi Heph-tal III, c’est la mention d’une ambassade d’un roi hephtalite portant le nom de Anlesadanwang, auprès des Liang en 535, dix ans avant la fin présumée du règne d’Hephtal III (Liangshu : III, 79). Or, parmi les monnaies enfouies en 481, à Dingxian, il y s’en trou-ve une de Yazdegerd II qui porte cette fameuse con-tremarque Hephtal ; ni Drouin ni Ghirshman ne donnent cette contremarque pour ce souverain (Drouin 1890 356-357 ; Ghirshman : 15-17) ; le règne de cet hypothétique Hephtal III est donc grati-fié au minimum de trois années supplémentaires, ce qui fragilise encore cette théorie. On voit surtout que les contremarques Hephtal (?) ne commencent pas après la défaite de Peroz, mais avant. Dans l’hypo-thèse où le sens du mot serait bien Hephtal, il doit sans doute être compris comme le nom du royaume plus que comme le nom propre du roi. Les sources chinoises disent d’ailleurs clairement : “Le nom de famille 43 du roi des Hua était Yeta[lituo], c’est pourquoi, sous ses descendants, ce nom de famille devint le nom du royaume.” (Tongdian : CXCIII, 5259-5260). Ghirshman écarte cette hypothèse : “La tentative d’interpréter la surfrappe comme le nom du peuple hephtalite ne doit pas être retenue puisque les Hephtalites ne se désignaient pas sous ce nom, et que celui-ci n’apparaît dans les sources orientales ou occidentales qu’à partir de la défaite et la mort de Peroz. (Ghirshman : 18). En ce qui concerne les sources orientales, cette affirmation est erronée, puis-qu’en 456, le pays est déjà connu sous le nom de Yeta[lituo] guo, “royaume des Hephta[lites]” (Weishu : V, 115), et non plus sous celui de Hua guo, “royaume des Hua”, terme employé pour la période où les Hephtalites sont encore en Asie Centrale et n’ont pas encore franchi les Pamirs, ca. 425.
La prédominance des monnaies de Peroz dans les dépôts de Chine — environ 369 Peroz sur 416 monnaies sassanides — et l’homogénéïté des cinq plus importants dépôts de monnaies sassanides trou-vées en Chine sont la marque de la présence des Hephtalites : le trésor de Xining [12] comprend 76 monnaies, toutes de Peroz, le dépôt religieux de ______
43 Le texte chinois utilise le mot xing, qui désigne le nom de famille ou le nom du clan, et non pas le mot ming, qui correspond au nom personnel.
S U R L E S M O N N A I E S S A S S A N I D E S T R O U V E E S E N C H I N E 119
Dingxian [32] est constitué de 41 monnaies dont 37 de Peroz, les 16 monnaies de la tombe M30 de Bei-mang Shan [9] comprennent 15 Peroz et les 15 monnaies du dépôt funéraire d’Anlu [50] sont toutes des drahm de Peroz. Ce dernier dépôt, enfoui en 637, est à l’évidence un trésor constitué au Ve siècle, à partir d’un ensemble de monnaies parvenu a peu près tel quel de la Perse : pour le type à la couronne II, on a trois monnaies du même type et du même atelier (AS), avec une liaison de coin de revers pour deux de ces monnaies ; pour le type à la couronne III, on a quatre monnaies du même type et du même atelier (AY) ; la rareté des illustrations dans les sources ne nous permet pas une étude exhaustive, mais rien ne dit qu’il n’y ait pas d’autres liaisons de coins. Dans le dépôt de Dingxian, sur la dizaine de drahm de l’atelier AB, on en trouve trois du même type et de la même année, et deux d’un autre type et vraisem-blablement de la même année. La trouvaille de Xi-ning n’ayant été que partiellement étudiée, on ne peut disposer de données sur le plus important de ces trésors. Leur composition nous conduit à penser que ces dépôts proviennent vraisemblablement de lots ou de sacs, dont la composition n’a guère été modifiée depuis leur origine ; cette abondance de drahm de Peroz laisse penser qu’une partie importante de la solde de la campagne de 459 et de la rançon de ca 470 s’est retrouvée dans le Hexi et en Chine, sans doute assez rapidement, si l’on considère que dans le dépôt de Dingxian l’une des monnaies de Peroz est datée de la 14e année du règne, soit 472.
On ne peut s’empêcher de s’interroger sur cette abondance de drahm de Peroz et sur la relative rareté des pièces du tribut, ceux de Kavad à Khosro I (484-545), celà d’autant que les premiers sont, pour cer-tains, arrivés bien avant l’époque où les Hephtalites sont voisins de la Chine des Wei et avant leur retour en Orient : les pièces de Dingxian ont été ensevelies en 481, et les Hephtalites ne repassent les Pamirs que vers 490-495. Si l’on peut admettre qu’à partir de cette date, elles proviennent directement du stock ac-cumulé par les Hephtalites, force est de constater qu’ensuite, elles passent de leurs mains à celles d’au-tres intermédiaires. Il est probable que c’est par les diverses ambassades, de Sogdiane, du Ferghana ou de Samarcande, par les caravanes venant de ces mê-mes territoires, contrôlés par les Hephtalites, par les commerçants du Hexi et par certains nomades com-me les Yueban et les Gaoju, que ces lots de mon-naies sont arrivés dans le Hexi et en Chine du nord.
3-Les routes commerciales.
A-Le rôle de Jushi-Gaochang. Si l’on excepte le cas particulier du trésor
d’Ulugh Art, on remarque que la plupart des mon-naies sassanides trouvées dans les Xiyu, l’ont été à Astana, à Qodjo et à Yarkhoto, c’est à dire dans la région de Tourfan, qui a été le centre politique et administratif des royaumes de Jushi et de Gaochang : 29 monnaies à Astana, 31 à Qodjo et 3 à Yarkhoto. Ces découvertes, dépôts funéraires, dispersion for-tuite et trésors de circulation, montrent bien que l’u-sage des monnaies sassanides était relativement cou-rant dans le royaume, du moins du IVe au VIIe siècle, et confirment ce que disent les sources chinoises. “Pour les taxes et les impôts, on paye en pièces d’argent, et ceux qui n’en possèdent pas peuvent payer avec des pièces de tissus de chanvre.” (Zhoushu : L, 915). L’usage fiscal de la monnaie d’argent est relevé pour le royaume de Koutcha et pour la Perse dans les mêmes termes (Zhoushu : L, 917 et 920, Tongdian : CXCIII, 5270). Les monnaies d’argent, même si cela semble avoir frappé les Chinois, ne servaient pas uniquement à payer les im-pôts et les taxes, et le moine Xuan Zang notait qu’à Karashar et à Koutcha, “on utilise pour les échanges des monnaies d’or, des monnaies d’argent et de petites monnaies de bronze” et qu’en Perse, où il n’a pas été, on utilisait de “grandes monnaies d’argent” (Xiyuji : 48, 54 et 938). L’usage de la monnaie d’argent sassanide lie la Perse à Gaochang en une longue chaîne matérialisée par la découverte sur cette seule route, qui passe par Karashar (Yanqi) et Kout-cha, de drahm sassanides. Pour les marchands, Gao-chang est, aux portes de la Chine, l’ultime étape de cette route et “généralement, la route qu’emprun-taient [les ambassades] des pays d’Occident venant à la Cour pour remettre le tribut, passait par ce royaume.” (Xin Tang shu : CCXXI-A, 6221).
Sa situation faisait de ce royaume et de cette vil-le, un nœud de communication vers l’ouest ou vers l’est, vers le nord ou vers le sud (voir carte 6) ; à cet endroit, et par le jeu d’itinéraires secondaires, se croisaient les trois routes, du nord, du centre et de la steppe, et il était même posible de rejoindre la route du sud à Shanshan (Charlik), en passant par Yanqi (Karashar). Gaochang, comme point de contrôle de la circulation centrasiatique, a été, plus qu’aucune autre cité des Xiyu, l’objet de la convoitise des pou-
120 F. T H I E R R Y
voirs régionaux et des nomades, et l’objectif de chacune des dynasties puissantes de la Chine.
Situé à l’extrêmité orientale des Xiyu, l’oasis de Tourfan a été le centre politique et administratif de plusieurs royaumes. Sous les Han, le royaume de Jushi 44 avait sa capitale à Yarkhoto (Jiaohe), à l’ouest de la ville actuelle de Tourfan. Depuis 48 av. JC, les Chinois avaient installé à l’est de Yarkhoto, une colonie militaire nommée Gaochang qui était le siège de la préfecture de l’administration chinoise. Jusqu’en 327, l’oasis de Tourfan a donc deux ni-veaux de structure étatique, un niveau royal local et un niveau préfectoral chinois. Au début du IVe siè-cle, cette préfecture s’émancipe du pouvoir central de la dynastie Jin, qui a été repoussée dans la partie mé-ridionale de la Chine par les invasions barbares. Zhang Jun, un descendant du dernier gouverneur de Liangzhou, se fait reconnaître comme suzerain par le roi de Jushi et par ceux de Charlik et Koutcha en 335. En 345, il fonde le royaume de Liang (Liang antérieurs 320/345-376), qui contrôle le Hexi, Gao-chang et les Xiyu ; sa capitale est fixée à Guzang (Wuwei). En 376, attaqués et vaincus par les bar-bares Di (Qin antérieurs 351-394), les Liang anté-rieurs sont remplacés comme puissance régionale par les Qin. En 382, le roi de Jushi, Mitien, se rend à la cour des Qin avec son voisin de Charlik pour faire allégeance à la nouvelle puissance et lui demander d’intervenir dans les affaires de l’Asie Centrale. Le roi des Qin, Fu Jian, envoie Lu Guang pour pacifier les Xiyu : Karashar (Yanqi) et Koutcha sont conquis en 384 et 385, et une trentaine de petits royaumes locaux font acte de soumission à Fu Jian.
Mais c’est durant cette période que sur son flanc oriental, le royaume des Qin est attaqué, à la fois par de nouvelles invasions de nomades xianbei, et par la dynastie légitime des Jin. Lu Guang est contraint de se replier vers l’est, laissant ses alliés Jushi et Charlik à la vindicte de Koutcha et Karashar. Le royaume de Jushi entre alors dans une période de semi vassalité vis-à-vis des divers pouvoirs qui règnent successive-ment sur le Hexi, comme les Liang postérieurs ou les Liang occidentaux. En 421, ces derniers perdent la préfecture de Gaochang au bénéfice du chanyu des Xiongnu, Juqu Mengxun (Liang du Nord), qui doit ______
44 Le royaume de Jushi apparaît sous plusieurs noms, Jushi, Jushi jianbu, Jianbu wangguo, “royaume antérieur”, par opposition au “royaume postérieur”, Houbu wangguo, situé au nord du Tianshan (Pelliot 1912 : 579-612)
faire face aux incursions des Rouran ; ceux-ci s’em-parent du royaume en 435, avant d’en être expulsés en 442 par les Xiongnu qui refluent vers l’ouest, sous la pression des Tabghatchs (Wei du Nord). Le chanyu des Xiongnu, Juqu Wuhui, tue Kan Shuang, qui, profitant du chaos, s’était fait gouverneur géné-ral, et se proclame roi. En 450, le roi de Jushi envoie en vain deux am-bassades à la cour des Wei du Nord, à Pingcheng, pour obtenir l’aide des Tab-ghatchs contre l’occupation xiongnu, particulièrement cruelle et brutale. Il semble bien que ces dé-marches aient été la cause de la fin du royaume de Ju-shi, dont le nom disparaît des chroniques chinoises.
En 460, bloqués à l’est par les Wei du Nord, les Rouran déferlent sur l’Asie Centrale, s’emparent du royaume xiongnu de Tourfan dont il tuent le chanyu, et installent sur le trône un descendant de Kan Shuang, Kan Bozhou, qui devient roi de Gaochang 45. La capitale est transférée de Yarkhoto à Gaochang, ou Qodjo. En 481, des tribus de la horde des Gaoju, dirigées par Afuzhiluo, prennent la ville, mettent fin à la dynastie Kan et intronisent un habitant de Dunhuang, Zhang Mengming qui ne tarde pas à être renversé par une révolte de la population. Son suc-cesseur Ma Ru est à son tour détroné par son peuple qui offre le pouvoir à son ministre Qu Jia qui devient donc roi de Gaochang en 487, tout en reconnaissant la suzeraineté de Futu, Qaghan des Rouran, puis celle de Qiong Qi, khan méridional des Gaoju, lorsque celui-ci prend la ville en 496. La famille Qu règne sur Gaochang jusqu’en 640, date à laquelle les Tang transforment le royaume en préfecture de Xizhou. La raison de cette annexion provisoire est l’attitude du roi Qu Wentai, qui s’étant allié au Qaghan des Türks orientaux, Dulu, se crut assez puissant pour contrôler à son seul profit la Route de la Soie. Pour ce faire il attaqua Karashar et Hami (Yiwu), deux États qui commandaient respectivement les routes du centre et du nord. La riposte de la cour de Chang’an fut une courte campagne qui s’acheva par la fin du royaume de Gaochang (Beishi : XCVII, 3211-3216 ; Weishu : LXXXIX, 2243-2245, CII, 2264-2265 ; Zhoushu : L, 914-915 ; Tongdian : CXCI, 5201-5207 ; Jiu Tang shu : III, 50-52, CXCVIII, 5294-5297 ; Chavannes : 103-107 ; Pelliot 1912 : 579-603 ; Maillard : 34-35).
______
45 Le Tongdian note que c’est à partir de cette époque que le royaume de Jushi prend le nom de royaume de Gaochang (Tongdian : CXCI, 5203).
S U R L E S M O N N A I E S S A S S A N I D E S T R O U V E E S E N C H I N E 121
On voit donc que par son histoire, le royaume de Gaochang est lié à la Chine d’une manière beaucoup plus profonde que les autres royaumes du bassin du Tarim. Porte à la Chine, il a subi de façon lente et ré-gulière l’influence culturelle de son puissant voisin, avec lequel il a toujours régulièrement entretenu les relations diplomatiques rituelles du vassal au suze-rain 46. Cette proximité de la Chine et cette sinisation relative est perceptible dans les sources chinoises et permet de mettre en valeur la spécificité du royaume et de certains aspects culturels, comme les rites funé-raires.
B-Les itinéraires. I-La route terrestre.
Les routes commerciales qui relient la Chine à l’ouest des Pamirs et de là, la Perse et le Da Qin (les provinces orientales de l’empire romain) ont été sou-vent décrites, nous nous bornerons donc à un simple résumé. Pour le Wei lue, texte rédigé vers la fin des Trois Royaumes, ca 250 (Chavannes 1905 : 521-522), il existe trois routes ; la route méridionale part de Dunhuang pour Shanshan, Niya, Kériya, Khotan et Taşkurgan ; de là partent trois itinéraires, l’un vers la vallée du Zarafchan et Samarcande, un autre par le Badakshan et Tirmid vers Amol et Merv et un troisième vers les vallées de l’Inde du nord ; la route centrale quitte Dunhuang pour Jushi (Tourfan), puis Yanqi, Koutcha, Aksu, Shule et Taşkurgan ; la route du nord, que le Wei lue qualifie de “nouvelle”, part de Dunhuang pour Yiwu, longe la rive sud du lac Barkol, prend vers l’ouest pour atteindre Gu-zheng (Beshbaliq), puis la vallée de l’Ili, la rive nord de l’Issik Kol, Suyab (Tokmak) et Shi (Tachkent) ; de là, on peut rejoindre le sud du Ferghana et Samar-cande ou bien aller plein ouest dans le territoire des Yancai ou Alan, “qui sont voisins du Da Qin ” (San Guo zhi : XXX, 859-863 ; Chavannes 1905 : 528-563). Ces routes ne sont guère modifiées durant les siècles suivants : sous les Sui (581/589-618), Pei Ju, Responsable des Echanges avec l’Occident, rédige à l’intention de l’administration impériale, un Atlas
______
46 Pour la période qui nous intéresse (fin du IVe début du VIIe siècle), le royaume de Jushi-Gaochang a envoyé trente am-bassades en Chine : aux barbares (Qin antérieurs en 382), aux dynasties du Nord (Wei en 435, 437, 450, 497, 508, 509, 512, 513, 516, 518, 521 et 532, et Zhou en 559 et 561), à une dy-nastie du Sud (Liang en 510 et ca. 540), aux Sui (en 607 et 609) et aux Tang (en 619, 620, 629, 630, 633 et 639).
des pays d’Occident (Xiyu tuji) qui fait une descrip-tion des trois itinéraires tout à fait similaire à celle du Wei lue : la route du nord va de Dunhuang à Yiwu et passe ensuite par le lac Barkol, le territoire des Tö-los, la capitale des Türks (vallée de l’Ili), puis “fran-chit les fleuves qui coulent vers le nord” (Syr Darya et Amou Darya), et atteint le Fulin ; depuis Dun-huang, la route centrale passe par Gaochang, Yanqi, Koutcha, Shule, traverse les Pamirs, passe par tous les petits royaumes de Transoxiane, le Kang (Samar-cande), le Cao (la plaine centrale du Zaraf-shan), le He (Koshaniya), le petit et le grand An (Boukhara) et le Mu (Amol), ensuite elle entre en Perse et rejoint Byzance ; la route du sud quitte Dunhuang pour Shanshan, Khotan,Taşkurgan, traverse les Pamirs et atteint le Humi (Wakhân), puis le Tokhare-stan, le pays des Hephtalites et Bamyan, Ghazna, l’Inde du nord et la Mer Occidentale (Suishu : LXVII, 1577-1580 ; Chavannes 1905 : 534, n.3).
À ces trois itinéraires principaux, il convient d’ajouter la Route de la Steppe, qui de la région de Pingcheng (act. Datong au Shanxi), rejoint Xihai, sur la rive sud du lac Gashun (Etsin Göl), puis Beshba-liq, et de là, par la rive nord du lac Balkhash, atteint les bouches de la Volga (voir carte 7).
Il est généralement admis et répété que la Route de la Soie trouve son aboutissement (du point de vue occidental) à Chang’an, capitale de la Chine. Pour les trois siècles qui nous occupent, celà est erroné, puisque Chang’an, pillée en 307 et en 313 ne peut être considérée comme une capitale que de 376 à 383, à la fin des Qin antérieurs, puis de 535 à 581, sous les Wei de l’Ouest et les Zhou du Nord (Liu XR : 25). Elle a été brièvement et successivement la “capitale” éphémère des Zhao antérieurs, des Yan occidentaux, des Qin postérieurs, des Xia : elle fut prise et pillée plus d’une dizaine de fois, chaque nou-vel assaillant tenant autant à détruire son adversaire qu’à conserver cette ville symbole du pouvoir im-périal. Elle ne retrouve son statut de métropole impériale qu’en 618, lorsque le fondateur des Tang choisit d’y installer son administration et sa rési-dence, de préférence à Luoyang (Dongdu), capitale des Sui. L’absence de dépôts de monnaies sassanides à Chang'an avant les Sui et les Tang est également la marque d’un déplacement des centres gouver-nementaux vers d’autres “capitales”, Pingcheng, Luoyang, Xiangguo, Ye, Guyuan par exemple.
122 F. T H I E R R Y
On a avancé que la Route n’avait jamais été cou-pée 47, ou qu’elle avait été coupée jusqu’en 435 48 (Pelliot 1934 : 41 ; Ghirshman : 75). Mais comme on l’a vu plus haut, c’est moins la situation sur la Route que celle des destinations qui détermine la circula-tion. Caravanes, ambassades, moines et commer-çants pouvaient prendre un autre itinéraire, puisqu’il y avait donc quatre routes terrestres et, en dernier re-cours, la Route maritime restait ouverte. Par ailleurs, ces quatre voies ne sont pas des itinéraires absolus, elles sont reliées entre elles par des routes secondai-res : de Gaochang, sur la route du centre, on peut re-joindre la route du nord à Beshbaliq ; de Shanshan, sur la route du sud, on peut rattraper la route du cen-______
47 “As recorded in the chinese histories the majority of embassies between east and west were before 284 and after 643, but in the interim the trade was not greatly affected.” (Watson : 551). L’affirmation est pour le moins hasardeuse : les Annales ne mentionnent pas moins de 174 ambassades des pays d’Occident entre 435 et 643. On trouve sans doute la source de cette affirmation chez Needham : “After this (284) there is a very long gap. For the next 360 years there are no records of direct contact with the West. This is not to say, of course, that no chanels were open, for we read, for example, of the Alans (Sarmatians) established near the Caspian Sea, sending tribute to the Northern Wei in +435.” (Needham : 199). Si l’on suit Needham, il n’y aurait eu aucun contact direct entre Occident et Orient entre 284 et 644 ; en nous en tenant aux seuls royaumes situés à l’ouest des Pamirs, nous relevons cependant les ambassades suivantes : Sogdiane aux Jin en 287, Byzance aux Liang antérieurs vers 313, le Ferghana aux Qin antérieurs en 377, 379 et 381, la Sogdiane aux Wei du Nord en 435, 437, 439, 441, 457, 467, 474 et 479, Samarcande aux Wei en 468 (deux fois dans l’année), 473, 476, 479, 480, 487, 491, 502, 507, 509, les Hephtalites en 456, le Khwarezm et Ferghana aux Wei en 439, 449, 453, 462, 465, 502, 507, 512, la Perse aux Wei du Nord, et à leurs successeurs, en 455, 461, 466, 468, 476, 507, 517, ca 519 (avec un message personnel de Kavad à l’empereur Xiaomingdi), 521, 522, 552, et aux Liang en 530, 533, 535, Byzance aux Wei, en 456, 465 et 467 ; sous les Zhou, arrivent à Chang'an des envoyés de la Sogdiane en 564, et de Boukhara en 567 ; pour la période des Sui et des Tang, on mentionne les ambassades du Tokharestan et de diverses principautés du Khwarezm, du Ferghana et de Sogdiane en 615, en 634 et en 639, et une ambassade sassanide en 639. Si l’on songe que plusieurs de ces royaumes, comme la Sogdiane par exemple, appartiennent à l’empire sassanide jusque vers ca. 465-470, on voit que les relations directes entre la Perse et la Chine ont été nombreuses et suivies durant cette période.
48 “Ce n’est qu’en 435, le 15 juin, qu’on envoie vingt am-bassadeurs auprès des divers pays de l’Asie Centrale, et dès le 9 septembre de la même année une ambassade du Sou-t'ö (Sogdig, Sogdiane) arrivait à la Cour. L’intervalle est trop court pour qu’elle puisse être déjà une réponse aux missions parties moins de trois mois avant, et nous devons conclure seulement que la route de l’Asie Centrale s’était rouverte depuis peu et que les Sogdiens en avaient immédiatement profité, tout comme la Cour des Wei.” (Pelliot 1934 : 41).
tre à Yanqi ; les routes du sud et du centre se joignent entre Shule et Khotan, à Taşkurgan ; les routes du nord et de la steppe passent toutes les deux à Besh-baliq. Localement, des itinéraires permettent, le cas échéant, d’esquiver les zones dangereuses. La plus importante de ces voies de contournement est celle qui permettait d’éviter le nord de la Chine, lorsque celui-ci était une zone à risque : pour atteindre le territoire des dynasties légitimes du sud, Jin de l’Est puis Song de Liu, on pénetrait dans le khanat des To-gons au sortir de Shanshan, puis on on allait plein est jusqu’à la rive sud du Koukounor, on remontait le haut cours du Fleuve Jaune, et par le col de Zhangla, on atteignait Longhe puis Yizhou (act. Chengdu, Si-chuan). Dans le Hexi, une route nord-sud relie Xi-ping à Xihai par Zhangye, et, vers l’est, une autre re-lie directement Xiping à Longxi par Linxia. Gao-chang est en communication avec Shanshan par Yan-qi et avec Yiwu et Beshbaliq (voir carte 6). Il était donc toujours possible de passer à travers les Xiyu et le Hexi, quelques soient les événements politico-militaires qui s’y déroulaient. On note d’ailleurs qu’en-tre la fin des Han (220) et la fin des Chen (589), les voyages des pélerins et des prédicateurs bouddhistes n’ont pas cessé : les prédicateurs étrangers venant en Chine sont 15 entre 220 et 316, 27 entre 317 et 420, et 32 de 420 à 589 ; les moines chinois partant en pé-lerinage sont pour les mêmes dates, respectivement 3, 51 et 89 (Liu XR : 147 ; Zhao YW : 85-89).
Les documents découverts en Asie centrale, tant par Pelliot que par Aurel Stein, montrent que rares sont les marchands qui font la totalité de la route, de Perse en Chine par exemple, mais que chaque tronçon est la spécialité d’un groupe : la route de Taşkurgan à Dunhuang est une route indianisée (Raschke : 638) et dominée par les Khotanais, alors que la route du centre, contrôlée par les Koutchéens, peut être considérée comme la route de Perse. Ce sont les marchands sogdiens de Koutcha qui y dirigent le commerce, contrôlent et organisent les caravanes, fournissent les escortes et les chameliers (Pinault : 65-85). Leurs liens avec leurs frères sogdiens de Samarcande leur permettaient d’avoir des rapports privilégiés avec les terres sassanides.
C’est sur cette route, et sur celle là seulement, qu’ont été trouvées les monnaies sassanides mises au jour dans les Xiyu. Les lieux de trouvaille se distri-buent le long de la route, dans les régions métropoli-taines des royaumes, Koutcha [5], Yanqi [49] et
S U R L E S M O N N A I E S S A S S A N I D E S T R O U V E E S E N C H I N E 123
Gaochang (voir p. 119-121), et sur la route elle-même, à l’ouest de Shule [18]. Ces découvertes confirment le rôle de lien privilégié entre Chine et Perse, joué par ce segment de la Route de la Soie. Au delà de Gaochang, et jusqu’à Jincheng (act. Lanzhou au Gansu), c’est à dire sur tout le segment de la
Route qui traverse le Hexi, pas une monnaie sassanide n’a été découverte. Cela met en évidence le fait que c’est moins une circulation commerciale qui apporte les drahm, que l’usage qui en est fait localement dans les principautés situées sur ce segment de la route sous influence sassanide.
__
Carte 6 __________________________________________________________________________________________________________________________________
II-La route maritime. La Route maritime de la Soie, qui passe par
l’Océan Indien, est une voie de communication spé-cifique, mais elle a également servi d’itinéraire de contournement de la Perse pour les commerçants sy-riens et égyptiens de l’empire romain. Des sources chinoises, il ressort que c’est cette voie qui servait aux marchands du Da Qin (Rome) pour communi-quer avec l’Orient extrême : “À l’époque de de
Huandi des Han postérieurs (147-167), c’est par cette route, que le Da Qin et le Tianzhu (l’Inde centrale) envoyaient leurs ambassadeurs apporter le tribut.” (Nanshi : LXXIV, 1947 ; Liangshu : LIV, 783). Le Beishi dit que “par le sud-est, ils ont des contacts avec le Jiaozhi (Tonkin)” (Beishi : XCVII, 3228), et le Liangshu précise “les gens de ce royaume, lorsqu’ils voyagent pour faire du commerce, arrivent au Funan (Cambodge), puis au Rinan (nord du Quang Binh au Vietnam) et au Jiaozhi.” (Liangshu : LIV, 798). Selon les sources
124 F. T H I E R R Y
chinoises, c’est bien parce que les Perses faisaient obstruction au commerce direct, que les Romains utilisaient cette route : “depuis qu’ils avaient entendu parler de la Chine, ils (les Romains) désiraient envoyer des ambassades en Chine, mais le royaume de Anxi (Perse arsacide), calculant son bénéfice, ne les autorisait pas à traverser son territoire.” (San Guo zhi : XXX, 860-861). Il semble que jusqu’au IIIe siècle, les marchands du Da Qin étaient relativement présents sur cette route maritime, puisque les sources chinoises disent que ce sont eux “qui font du commerce avec la Perse et l’Inde par la mer, avec un bénéfice de dix pour un.” (Hou Han shu : LXXXVIII, 2919). Par ailleurs, dans les textes les plus anciens, comme le Wei lue, la plupart des produits d’Occident sont considérés comme venant du Da Qin (San Guo zhi : XXX, 861) 49 et le Hou Han shu dit que la Perse “produit beaucoup des différents produits rares et extraordinaires du Haixi (Rome)”, mais précise à propos du Da Qin, que “tous les produits précieux de tous les pays étrangers viennent tous de là” (Hou Han shu : LXXXVIII, 2918-2919). Or on remarque que dans les textes plus tardifs, les mêmes produits sont attribués à la Perse (Weishu : CII, 2270-2271 ; Beishi : XCVII, 3222 ; Nanshi : LXXIX, 1986 ; Zhoushu : L, 920 ; Suishu : LXXXVIII, 1857). Enfin, selon les Chinois, à cette époque, ce ne sont plus les Romains qui font le commerce dans l’Océan Indien, mais les Perses et les Indiens : “ Les Perses et les Indiens font du commerce avec le Da Qin par la mer et en tirent un bénéfice de cent pour un ” (Jinshu : XCVII, 2544).
L’itinéraire est assez bien décrit : on part du Jiaozhi (Tonkin), pour atteindre les côtes du Rinan (nord de la province du Quang Binh au Vietnam), dernière terre sous autorité chinoise ; en suivant la côte indochinoise, on relache au Linyi (Lâm-âp en vietnamien, c’est-à-dire le Champa, sud du Vietnam actuel) et au Funan (Cambodge) ; de là, on atteint, au sud-ouest, le royaume de Dunxun, vassal du Funan, installé à cheval sur le point le plus étroit de la péninsule malaise, l’isthme de Kra, au sud du Ténassérim. Grâce à cette situation, on peut, “par l’est du Dunxun, atteindre le Jiaozhi, et par l’ouest, on rejoint les pays étrangers voisins de l’Inde et de ______
49 Dans le Jinshu, la Perse n’apparaît pas parmi les pays d’Occident qui sont présentés, le khanat des Togons, Yanqi, Koutcha, le Ferghana, la Sogdiane et Rome (Jinshu : XCVII, 2537-2545).
la Perse ” (Liangshu : LIV, 787 ; Nanshi : LXXVIII, 1950). Sa situation stratégique sur l’isthme fait de ce pays un carrefour extraordinaire : “sur ses marchés, l’Orient et l’Occident se croisent et se rencontrent, et chaque jour, plus de 10 000 personnes les fréquentent ; produits précieux et trésors, il n’est rien que l’on n’y puisse trouver.” (Liangshu : LIV, 787 ; Nanshi : LXXVIII, 1950 ; Schlegel : 38 ; Pelliot Funan : 263) 50. Du Dunxun, les navires partent pour le Huangzhi (Kanchipura) et le Shiziguo (Ceylan), d’où ils appareillent pour Barbaricum et la Perse, le Da Qin et l’Abyssinie (Fang : vol. I, 140-141 ; Hirth : 159-160). Il existe une autre route, qui suit les côtes de la péninsule malaise et, par le Détroit de la Sonde, rejoint l’Océan Indien (Chen Y : 157).
À cette route s’ajoute une extension peu connue, mais signalée par le Wei lue qui dit, à propos des itinéraires qu’utilisent les marchands du Da Qin, “il existe également un itinéraire par voie d’eau par lequel ils atteignent Yizhou (act. Chengdu au Sichuan) par Yongchang ; c’est pour cela que tant de produits merveilleux viennent de Yongchang” (San Guo zhi : XXX, 861). Le siège de la commanderie de Yongchang était situé aux environs de l’actuelle ville de Baoshan, dans la partie occidentale de l’actuel Yunnan, près de la frontière birmane ; la seule voie d’eau qu’il soit possible d’utiliser pour parvenir à cet endroit reculé, est la vallée de l’Irrawouadi jusqu’à Bhamo, et de là atteindre Baoshan par Longling. Cet itinéraire, qui correspond à la route de Birmanie, avait été soupçonné par Zhang Qian au IIe siècle av. JC (Han shu : XCV, 3841 ; Fang : 142-144).
La route maritime est devenue la route des marchands perses et indiens après le IVe siècle, et c’est par elle que sont arrivés en Chine les trois dépôts méridionaux [27, 47 et 52]. Si deux d’entre eux sont des dépôts funéraires, le trésor de Suikai [52], semble lié aux activités d’un commerçant perse et sa situation comme sa composition suggèrent un enfouissement consécutif à un naufrage.
______
50 On comparera cette description de l’emporium de Dunxun avec celle qu’Ammien Marcellin fait de la ville de Batné, en haute Mésopotamie, vers 354 : “La ville de Batné (...) est pleine de riches commerçants quand une solennité, vers le début de septembre, rassemble pour une foire, une foule considérable de toutes conditions, pour acheter les marchandises qui proviennent des Indes et du pays des Sères, et beaucoup d’autres produits transportés d’ordinaire par terre et par mer.” (Ammien Marcellin, Histoire, XIV, III,3).
S U R L E S M O N N A I E S S A S S A N I D E S T R O U V E E S E N C H I N E 125
_
Carte 7 _______________________________________________________________________________________________________________
Ces monnaies sassanides ne sont pas les seules traces de la présence des marchands perses en Extrême-Orient avant le VIIIe siècle, période où ils seront nombreux à Canton. Les fouilles d’Oc-èo (sud du Vietnam, proche de la frontière cambodgienne), qui ont fait couler tant d’encre, en raison de la découverte de “monnaies” romaines 51, ont fait connaître un trésor de glyptique (Malleret : 189-199) qui renfermait un “cabochon de pâte de verre opaque d’un beau bleu turquoise qui montre une effigie à barbe et à cheveux nattés, avec une coiffure à semis de globules qui est un bonnet dont la pointe affaissée en avant, s’enroule sur lui-même” (Malleret : 193-194, pl. XLIX, n°10). Il s’agit clairement d’un por-trait sassanide, assez proche des intailles à buste hu-main de la glyptique sassanide ou de certaines ______
51 Ces prétendues monnaies romaines ne sont en fait que trois bijoux monétiformes : une feuille d’or estampée au type d’une monnaie d’Antonin le Pieux, une autre sans doute à celui d’une monnaie de Marc Aurèle, et une breloque vaguement mo-nétiforme. (Malleret 1951 : 86-87 ; Coedès : 199). Par contre on a découvert un grand bronze de Maximin (235-238), au type IMP MAXIMINUS PIUS (AUG), FIDES MILITUM, aux envi-rons de la ville de My-Thô au sud du Vietnam (Revue Numismatique, 1864 , “Chroniques”, 481).
monnaies 52. Cet objet d’origine perse est un élément de plus qui montre le rôle de port international que jouait le Funan sur la route de Chine : il prend place parmi des intailles d’origine romaine, d’autres d’origine in-dienne, des monnaies d’argent du Dunxun et un fragment de miroir chinois.
4-Les produits et les échanges.
Le nom de “Route de la Soie”, donné aux iti-néraires reliant l’Orient et l’Occident, est une dénom-mination purement occidentale ; pour les Chinois cette route est la “route des chevaux” 53, ou plus tard, ______
52 Cette pièce peut être comparée aux n° 3-16, 3-17, 3-330, 4-8, 4-17, 6-14, 6-16, 9-9 et 9-48 du catalogue de la Bibliothèque Nationale de Paris (Philippe Gignoux, Catalogue des sceaux, cammées et bulles sassanides de la Bibliothèque nationale et du musée du Louvre, II Les sceaux et bulles inscrits, Paris 1978), et aux portraits des kouchano-sassanides Hormazd et Kavad sur leur monnaies (Göbl 1984 : n°1031, pl. 115 et n°1124, pl. 120).
53 Nous n’aborderons pas l’étude du commerce des che-vaux qui fut sous les Han et jusque sous les Sui, un des moyens d’échange qu’utilisaient les populations d’Asie Centrale, sédentaires et nomades, pour obtenir la soie chinoise.
126 F. T H I E R R Y
_
Carte 8 _______________________________________________________________________________________________________________
la “route du verre”. En effet, la Chine recherche certains produits considérés comme ocidentaux, avec autant d’intérêt que l’Occident recherche la soie.
A - Les “produits rares et extraordinaires de l’Occident”.
Les “produits rares et extraordinaires des pays d’Occident” sont généralement attribués au Da Qin, c’est à dire aux provinces orientales de l’empire ro-main, puis plus tardivement au royaume de Anxi ou Bosi, la Perse arsacide et la Perse sassanide. Pour la période qui nous intéresse, la liste la plus ancienne, qui est également l’une des plus complètes, est celle du Wei lue (San guo zhi : XXX, 861 ; Hirth : 73-74) 54. À l’exception du Tongdian (CXCIII, 5271), les chroniques postérieures nous en donnent généra-lement une liste certes abrégée, mais qui a l’avantage de mettre en évidence les produits les plus recherchés : on trouve en Perse “... de l’or, de l’ar-gent, de l’orichalque (Laufer : 511), du corail (Lau-
______
54 La liste du Hou Han shu (LXXVIII, 2919) est posté-rieure de deux siècles à celle du Wei lue, puisque le premier de ces ouvrages a été rédigé par Fan Hua sous les Song de Liu (420-479), et le second presque deux siècles plus tôt, en ca. 250, par Yu Huan.
fer : 525), de l’ambre (Xie : 200), de la nacre, de l’agate, des grosses perles en grandes quantités, du verre transparent, de la pâte de verre, du cristal de roche, de la turquoise (Laufer : 516), des diamants, de l’amiante, de l’acier damasquiné (Laufer : 515), du cuivre, de l’étain, du cinabre (Xie : 200), du mer-cure, [des tissus, soie et brocards... (Laufer : 488-491)], du cuir de daim rouge, des esssences d’oliban (Boswellia thurufera, Ji Han : 79-80), de safran (Lau-fer : 312 ; Xie : 194), de storax (Laufer : 456-460 ; Xie : 199) et de bois d’aigle (aquilaria agallocha, Ji Han : 87-88), du poivre noir et du poivre long (Ji Han : 46-49 ; Laufer : 374-375), du sucre de canne (Laufer : 376-377), des dates (Laufer : 385), des ri-zhomes de cyperus rotondus (Xie : 186), des fruits du prunier myrobolan (terminalia chebula, Ji Han : 92-94 ; Xie : 216), des noix de galle (Laufer : 367), du sel vert (Laufer : 510) et de l’orpiment.” (Weishu : CII : 2270-2271). Les textes du Beishi (XCVII, 3222), du Zhoushu (L, 920), du Suishu (LXXXVIII, 1857) et du Jiu Tang shu (CXCVIII, 5312), donnent dans leur article sur la Perse, une liste à peu près identique. On ajoutera quatre produits particuliers qu’on trouve
S U R L E S M O N N A I E S S A S S A N I D E S T R O U V E E S E N C H I N E 127
régulièrement mentionnés : pour Rome, les “perles qui brillent la nuit”, ou le “jade qui brille la nuit” 55, et le corail blanc, pour la Perse, le “parfum des Arsacides”, Anxixiang, c’est à dire le benjoin, et enfin, pour Khotan, le jade.
On peut donc regrouper ces produits en trois groupes, les produits de la pharmacopée chinoise, les matières précieuses liés à une conception particulière du luxe et de la richesse, et certains produits manufacturés dont les Chinois ne semblaient pas avoir maîtrisé la technique.
Les produits de la pharmacopée sont des fruits, des graines ou des tubercules, des essences ou des minéraux auxquels sont attribués des vertus curatives : à titre d’exemple, l’ambre, hupo, est un sédatif, un diurétique et un hémostatique des voies urinaires (Xie : 200), le cinabre, zhusha, un sulfure de mer-cure, est un sédatif et un antiseptique (Xie : 200) ; les essences de storax et de benjoin sont des stimulants aromatiques (Xie : 199), les rhizomes de cyperus ro-tondus, xiangfu, sont des antispasmodiques (Xie : 186) et le fruit de myrobolan, helibo, est un remède efficace contre la dysenterie (Xie : 216) 56. Ces pro-duits médicinaux avaient une très grande valeur et il n’est pas rare d’en trouver dans les tombes (Musée du Ningxia : 14) et dans les trésors : dans le trésor du prince de Bin (voir p. 106), on note que parmi les collections d’objets d’art, la vaisselle d’or et d’ar-gent, il y a du cinabre, de l’ambre et du corail 57 (Mu-sée du Shaanxi : 33). Parmi les produits de la pharma-copée ou les végétaux, certains, comme le poivre ou le sucre de canne, ne viennent pas d’Occident, mais des Indes ou du Funan ; cependant, comme ce sont les marchands d’Occident qui, par la route maritime, les apportaient au Jiaozhi, ils ont été considérés comme des produits de Rome ou de Perse.
Les matières précieuses sont principalement l’or, l’argent, le jade, les perles, le corail et l’agate. Ce
______
55 On ne sait pas exactement ce que recouvre le mot yeguangzhu, ou yeguangbi, Hirth et Needham pencheraient pour du chlorophane, c’est à dire un spath fluor (Hirth : 243 ; Needham : vol. I, 199) et Shen Fuwei considère qu’il s’agit d’une variété de verre (95 et 99).
56 Pour une analyse plus complète de tous ces produits de la pharmacopée, on consultera le Bencao gangmu de Li Shizhen (Li SZ) et le Dictionary of traditional chinese Medecine (Xie).
57 Dans leur classification des divers objets et matières précieuses découverts à Hejiacun, les archéologues chinois ont placé le corail parmi les produits de la pharmacopée.
sont elles qui forment le gros des trésors, des dépôts religieux (voir p. 102) et des dépots funéraires.
En ce qui concerne l’or, il reste peu de traces d’une éventuelle et hypothétique importation d’or oc-cidental dans de grandes proportions : l’archéologie n’a fourni que quelques monnaies byzantines 58 et trois ou quatre bols ou coupelles d’or sassanides (Xia 1978 : 113). À lire les chroniques chinoises, les listes de dons diplomatiques et les rubriques concernant les “Barbares du sud”, l’or venait du sud plus que de l’ouest, et des nomades du nord et du nord-ouest plus que des états sédentaires d’Occident. Il est fort pro-bable que l’or qui arrivait en Chine était soit fondu en lingots, soit utilisé pour les décorations des palais et des monastères, soit encore utilisé pour l’orfè-vrerie dont on sait qu’elle prend sous les Jin un grand essor (Peng : 233-234).
Les quantités d’argent semblent avoir été beau-coup plus importantes. L’argent n’est pas, à cette époque, un métal abondant en Chine du nord, où les mines sont peu nombreuses et pauvres (Peng : 234), aussi ce métal est-il un produit demandé et recher-ché. Il parvient probablement sous la forme de lin-gots, sous celle de pièces de monnaies sassanides et sous celle d’argenterie, bols, plats, aiguières.... L’ar-chéologie chinoise des dernières années a mis en évi-dence la relative importance de la part occidentale dans la satisfaction de cette demande, soit par la dé-couverte de dépôts monétaires sassanides, soit par celle de pièces d'argenterie provenant de l’Orient ro-main, de Byzance ou de Perse : au début des années 70, on a trouvé à Datong (dans l'actuelle province du Shanxi, sur le site de Pingcheng, la seconde capitale des Wei du Nord, de 398 à 495) trois pièces d’or-fèvrerie d’argent et de bronze doré du bas empire ro-main et un bol sassanide en argent doré (Xia 1978 : 113 ; Chu SB : 4 ; Wenhua : 150-152) ; à Datong, en-core, en 1981, on a sorti de la tombe de He Fengtu (438-501) trois pièces d’argenterie sassanide dont un plat à scène de chasse au sanglier (Ma YQ : 2 ; Xia 1983 : 5-7) ; à Datong encore, dans une nécropole des Wei du Nord, située au sud de la ville, on a trou-vé, en 1988, un gobelet sassanide d’argent à décor ______
58 Dans un récent travail, Cécile Morrisson et nous-même avons dénombré 7 solidi byzantins, 6 imitations et 7 bijoux monétiformes de type byzantin exhumés sur le territoire de la République Populaire de Chine depuis 1905 (Cécile MORISSON et François THIERRY, Les monnaies byzantines trouvées en Chine, communication au XVIIIe Congrès International d’Études Byzantines, Moscou 8-15 août 1991).
128 F. T H I E R R Y
gravé dans la tombe M109 et une coupe sassanide en argent doré ornée de feuilles d’acanthe et de quatre médaillons avec buste humain (Bureau du Shanxi : 10 et pl. I) ; à Hejiacun, dans le trésor du Prince de Bin [43], il y avait trois gobelets octogonaux en argent doré d’origine perse (Musée du Shanxi : 30-31 ; Xia 1978 : 113) ; à Xian, de la tombe d’époque Sui de Li Jingxuan [16], on a exhumé un bol d’argent sassanide ; à Aohanqi (Liaoning), on a découvert deux objets sassanides en argent, une aiguière dont l’anse est surmontée par une tête humaine et un plat orné d’un lynx passant (Xia 1978 : 113 ; Aohanqi : 117-118) ; la tombe de Li Xian à Guyuan (Ningxia) renfermait une aiguière sassanide à décor antiquisant dont l’anse était surmontée d’une tête humaine (Mu-sée du Ningxia : 11-12 ; Wu : 66-76) ; parmi les ob-jets du trésor de Suikai [52], on a trouvé trois pièces d’argenterie sassanide, une tasse, une boîte et, un bol qui portait une inscription gravée en parthe, dési-gnant le propriétaire et le poids ou la valeur de l’ob-jet, comme cela se faisait en Iran (Ghirshman 1957 : 80-81) ; enfin, récement, en 1988, à Jingyuan (Gan-su), on a mis au jour un plat byzantin du Ve siècle, probablement d’origine égyptienne, orné d’une image de Bacchus sur sa panthère dans un entrelacs de vignes, et gravé d’une inscription en bactro-heph-talite (Chu SB : 1-3). Ces quelques découvertes, pour significatives qu’elles soient, ne doivent pas occulter que la plus grande partie du métal arrivant en Chine, quelle que soit sa forme, est fondue en lingots (Peng : 234) ou mise en œuvre pour satisfaire les éxigences des palais et des temples.
La demande en jade assure la richesse du royau-me de Khotan qui est le principal fournisseur de la Chine durant toute son histoire ancienne. L’agate, manao, est une pierre recherchée depuis l’antiquité, et elle apparaît dans la plupart des tombes sous la forme de perles et de pendentifs ; les Chinois impor-taient d’Occident des objets en agate comme des coupes, des bols ou parfois des sculptures “extra-ordinaires”, plus élaborées, comme le fameux rhyton du trésor du Prince de Bin (Musée du Shanxi : 31 ; Sun J : 84-92 ; Wenhua : 70). Les perles (Liu XR : 57-58) étaient utilisées en très grandes quantités, dans l’orfèvrerie et la bijouterie, pour la confection de vêtements d’apparat et surtout pour la réalisation des fameux rideaux de perles indispensables dans les palais et dans les tombes (Jinshu : CVI, 2764 et CXXII, 3067).
À ces produits précieux, les Chinois ont ajouté le verre, que l’on comparait au cristal, et que certains considéraient comme un minéral d’origine naturelle (Baopuzi : II, 21). La Chine connaissait le verre opa-que, la pâte de verre, liuli, qui servait à fabriquer des pseudo-jades, des perles colorées et de la vaisselle (Huang Q.S. : 46-48), mais ignorait, ou maîtrisait très mal la technique de fabrication du verre transparent boli 59 (Liu XR : 60 ; Raschke : 627-630). Depuis fort longtemps, les Chinois recherchaient le verre méditerrannéen (Shen FW : 96 ; Needham : 183), dont on disait que le Da Qin fabriquait dix variantes colorées différentes (San guo zhi : XXX, 861), mais après les Han, à partir du IIIe siècle, la demande devint si forte qu’on a pu parler de glass mini-boom (Liu XR : 58). De nombreuses anecdotes nous montrent l’attrait que ce produit de luxe exerçait sur les hautes classes chinoises : l’empereur Wu des Jin (265-290) raffolait des verreries que son ministre Wang Jun lui procurait (Jinshu : XLII, 1206) ; sous les Jin encore, le Secrétaire aux Archives, Cui Hong était un homme si intègre que jamais il ne parlait argent et qu’il ne voulait pas que ses mains touchent des matières précieuses, aussi refusa-t-il de saisir la coupe de verre dans laquelle le Prince Liang de Runan servait le vin lors des banquets qu’il donnait (Jinshu : XLV, 1288) ; toujours sous les Jin, à l’inter-rogation “Pourquoi ce récipient vide est-il considéré comme un joyau ?”, la réponse était : “Parce qu’il est clair et transparent” (Liu XR : 60).
On note que la plupart des tombes de quelqu’im-portance, du IVe au VIIe siècle, contiennent au moins un objet en verre transparent, bouteille à long col, flacon, vase, bol ou coupe. Les verreries provenaient sans doute de la région d’Alexandrie et des provinces romaines d’Orient (Shen FW : 98-100 ; Bureau du Shanxi : 10 et pl. I ; Wenhua : 69), mais également de l’empire sassanide, de l’Inde du nord et des vallées du versant méridional de l’Hindoukouch, comme l’ont montré un certain nombre de trouvailles (Shen FW : 97 ; Equipe du Hebei : 257).
C’est d’ailleurs de l’Inde du nord que parvient en Chine le secret de la fabrication du verre transpa-rent : “À l’époque de Shizu (424-452) les marchands de ce royaume (kidarite), venaient faire du trafic à la capitale (Pingcheng) ; d’après eux, il était possible ______
59 Sur la différence entre les mots liuli et boli, sur leur usage respectif et sur les limites de cette distinction terminolo-gique, voir Liu XR, p. 60-61.
S U R L E S M O N N A I E S S A S S A N I D E S T R O U V E E S E N C H I N E 129
de fondre certaines pierres et d’en faire du verre multicolore ; on alla donc dans les montagnes ramasser ces minéraux et on procéda à la fonte à la capitale. Quand l’opération fut achevée, l’éclat et la beauté [du verre obtenu] était identique à ceux du verre importé d’Occident ; on ordonna de l’installer dans une grande salle, et, bien que dans celle-ci se soient entassées plus de cent personnes, l’éclat et les couleurs réfléchissaient la lumière jusque dans les re-coins les plus obscurs ; parmi tous ceux qui étaient là, il n’en est aucun qui ne fut saisi d’effroi, pensant qu’il s’agissait là de l’effet d’une lumière surnatu-relle. Depuis ce temps là, en Chine, le verre perdit progressivement sa valeur et les gens cessèrent de le considérer comme une matière précieuse” (Weishu : CII, 2275). Vers le milieu du Ve siècle, la Chine du nord accéde donc à la technologie du verre ; en fait, il semble bien que ce soient l’état de guerre et d’insé-curité et les conditions du développement économi-que qui en découlent, qui aient retardé cette innova-tion, car Ge Hong (283-363), dans son Baopuzi nei-bian, rédigé vers le milieu du IVe siècle, raconte que “aujourd’hui, au Jiaozhi et au Guangdong, il y a beaucoup de gens qui sont parvenus à en connaître la technique et qui en coulent.” (Baopuzi : II, 22). On notera que le Jiaozhi (Tonkin) et le Guangdong sont des régions où les contacts et les relations avec l’Inde et l’Occident sont denses et réguliers et où les com-munautés hu sont nombreuses : il est fort probable que c’est par ces contacts que les Chinois de ces ré-gions ont appris à fabriquer du verre transparent dès le IVe siècle.
Malgré cette connaissance, on continue d’impor-ter des verreries de l’étranger, et leur valeur, contrai-rement à ce que dit le Weishu, ne décroît guère, puisqu’elles apparaissent en bonne place dans les ca-deaux offerts par les ambassades étrangères : ainsi, dans le rapport sur les quatre ambassades de Khotan aux Liang (502-557), le don d’un vase de verre est mentionné au même titre que celui d’une statue de jade sculpté (Nanshi : LXXIX, 1985).
Ces “produits extraordinaires et précieux d’Oc-cident” sont indispensables pour affirmer son rang et son pouvoir, ils sont à la fois une réserve de richesse, une marque de puissance et une nécessité sociale dans les classes riches (Liu XR : 81-85). C’est leur réunion qui établit une renommée. Tout comme le trésor du Prince de Bin contenait des pièces d’ar-genterie sassanide, un rhyton et des bijoux en agate,
un gobelet de cristal et une coupe de verre, des gobe-lets et des monnaies d’or, des monnaies d’argent, des objets de jade, de l’ambre et du corail (Musée du Shaanxi : 30-33), de même, la composition des dépôts funéraires de la tombe de Li Xian, de l’époque des Zhou du Nord, et de celle de Li Jingxuan, datée de 608, est caractéristique : on trouve dans la première, une imitation de monnaie d’or byzantine, une ai-guière sassanide d’argent, une coupe de verre, trois cigales et 76 perles d’ambre, 113 perles et pende-loques d’agate et plus de 200 perles fines (Musée du Ningxia : 14), et dans la seconde, deux coupes sur pied, l’une en or et l’autre en argent, un collier d’or et de perles sassanide, des pendeloques et des perles de cristal, d’agates et d’ambre, deux flacons et deux gobelets de verre (Institut d’Archéologie : 16-22). La composition du dépôt religieux de Dingxian (voir p. 103) n’est pas très différente de celle de ces dépôts funéraires, et de même, la description des trésors amassés dans la tombe de Zhang Jun dans le Jinshu (voir plus bas) est assez proche du rapport de fouilles de la tombe de Li Xian.
Ces matières précieuses ne sont pas seulement des éléments constitutifs de trésors de réserve, elles sont utilisées dans la production de biens de luxe et dans la construction des palais et des pagodes. Chefs nomades, donateurs princiers et empereurs rivalisent de luxe dans leurs constructions et résidences, et les monastères se couvrent d’or et de jade ; même les moins puissants se doivent de tenir leur rang : Shi Jilong, second souverain des Zhao antérieurs fait édi-fier à Xiangguo, le Hall de Taiwu, dont “les tuiles sont de laque, les chaînes en or, les piliers en argent et les colonnades en or, les rideaux de perles et les murs de jade, d’un travail d’une extrême habileté ” (Jinshu : CVI, 2764).
B-Les échanges. Pour se procurer tous ces produits, la Chine ex-
porte sa soie. À cette époque, et jusque sous les Song, la soie est la seule matière qui permette à la Chine de solder ses échanges ; elle peut certes aussi échanger quelques uns de ses produits manufacturés, tissus, vins, laques, acier, bijoux, pinceaux etc., ou même des filles, avec des états ou des populations dont le niveau de développement est inférieur au sien, comme les “Barbares du sud” ou les nomades du nord, mais pas avec des pays avancés comme la Perse ou le Da Qin. L’échange se fait soit par l’inter-
130 F. T H I E R R Y
médiaire des marchands, soit dans le cadre des échanges diplomatiques et tributaires.
On manque de données sur les relations que le gouvernement des Wei du Nord entretenait avec les marchands étrangers et sur les structures du commerce avec ces marchands (Liu XR : 78). Ce-pendant, comme on sait que le gouvernement avait établi le monopole de la fabrication de la soie de bonne qualité et celui de la fabrication des biens de luxe, et comme il avait astreint les artisans qui tra-vaillaient la soie, l’or et l’argent, à une condition quasi servile vis à vis de l’état (Liu XR : 51), on doit en déduire que l’importation des produits d’Occi-dent, parmi lesquels, l’argent, et l’exportation de la soie relevaient de bureaux de l’administration et des magasins d’état. Pour ce qui concernait les produits moins précieux, verreries, brocards de Perse, petite bijouterie, fruits, graines ou parfums, il existait à la capitale un marché spécial pour les produits im-portés, situé à côté du quartier pour étrangers (Liu XR : 48). Les commerçants chinois s’approvisi-naient soit dans les magasins d’État, soit sur le mar-ché de la capitale. Certains se rendaient dans les em-poriums de Gaochang ou de Koutcha pour y acheter directement les produits étrangers, qu’ils payaient en robes ou en pièces de soie, car les Sogdiens refu-saient la monnaie chinoise (Liu XR : 71).
Les échanges diplomatiques se font lors des am-bassades qu’envoient les pays étrangers ou tributai-res ; ces ambassades n’ont pas forcément un carac-tère diplomatique au sens où nous l’entendons et il s’agit parfois de simples délégations de marchands : on a ainsi par exemple, à une même période, des dé-légations de Samarcande, de Sogdiane et des Hephtalites, ce qui prouve bien qu’il ne s’agit pas de relations d’État à État, puisque les deux premières citées ne sont pas des entités étatiques indépendantes. Ces relations portent sur des quantités fort impor-tantes de produits ; toutes ces “ambassades” appor-tent des fangwu, “produits locaux”, c’est-à-dire les productions les plus représentatives de leur sol ou de leur industrie, ou les produits qu’ils ont pu se pro-curer par un moyen ou par un autre ; en contrepartie, elles reçoivent des rouleaux ou des vêtements de soie, des brocards, du fil et de la bourre de soie. On donnera quelques exemples de ces échanges : en 313, Zhang Gui, le fondateur des Liang antérieurs, reçoit une ambassade d’Occident (Constantinople ?) qui “offre deux vases barbares en or, tous deux faits à Byzance (Fulin), de forme extraordinaire et hauts
comme deux hommes.” (Jian Liang lu, cité in Shen FW : 87) ; Shi Le, fondateur des Zhao postérieurs, obtient du préfet de Jingzhou, qui dépend des Jin de l’Est, des produits précieux du sud du Jiang (Jinshu : CV, 2747) ; les Togons offrent 5000 chevaux et 500 jin d’or et d’argent à Fu Jian, roi des Qin antérieurs (Jinshu : CXIII, 2894) ; vers 379, le même Fu Jian reçoit des Pays d’Occident plus de 500 variétés d’ob-jets précieux (Jinshu : CXIII, 2900) ; en 465, Byzan-ce envoie parmi d’autres cadeaux, une “épée pré-cieuse” (Weishu : V, 123) ; en 478, le roi de Koutcha donne aux Wei des “trésors précieux” (Weishu : VII, 146) ; à l’époque de Shizong des Wei du Nord, le roi des Indes du Sud offre de l’or et de l’argent (Weishu : CII, 2278) ; à partir de 508, et à plus de dix reprises, le roi de Gaochang envoient des perles et des che-vaux de race (Weishu : CI, 2244 ; Beishi : XCVII, 3210 et 3213) ; par deux fois, les Gaoju donnent de l’or et de l’argent (Weishu : CIII, 2311) ; en 519, le roi de Khotan offre aux Liang un vase de verre et en 541, une statue de Bouddha de jade (Nanshi : LXXIX, 1985 ; Liangshu : LIV, 814) ; en 591, les Türks offrent aux Sui “sept vases précieux” (Suishu : II, 36).
La Perse sassanide n’est pas absente de ce type d’échange. La cour des Wei à Pingcheng reçoit des ambassades perses en 455 (Weishu : V, 115), en 461 (Weishu : V, 120), en 466 (Weishu : VI, 126), 468 (Weishu : VI, 128) et 476 (Weishu : VIIa, 142), après le déplacement de la capitale à Luoyang, elle en ac-cueille cinq, en 507 (Weishu : VIII, 205), 517 (Wei-shu : IX, 225), 518 (Weishu : IX, 228), 521 (Weishu : IX, 232) et 522 (Weishu : IX, 233) ; ces ambassades apportent les fameux fangwu, ces pro-duits locaux si recherchés. L’ambassade de 518 revêt un caractère particulier puisqu’elle est porteuse d’un message écrit de Kavad à Xiaomingdi des Wei du Nord, dont le texte a été (en partie ?) conservé : “Au Fils du Ciel du Grand Royaume, engendré par le Ciel qui a voulu Le faire résider là où le soleil se lève, afin qu’à ja-mais Il reste le Fils du Ciel des Han, le Roi de Perse Kavad présente ses respectueux hommages en Lui a-dressant mille fois ses souhaits d’une longévité de dix mille ans.” (Weishu : CII, 2272 ; Beishi : XCVII, 3223). Des délégations sassanides se rendent éga-lement en Chine du sud, auprès de la dynastie légi-time des Liang : en 530, les Perses offrent un dent de Bouddha (Liangshu : LIV, 815), que la délégation avait vraisemblablement acquise lors d’une escale aux Indes ou à Ceylan, et en 533 (Liangshu : III, 77)
S U R L E S M O N N A I E S S A S S A N I D E S T R O U V E E S E N C H I N E 131
puis en 535 (Liangshu : III, 78), ils apportent des produits de leur royaume. Sous les Wei de l’Ouest, une ambassade sassanide se rend à Chang’an, en 552 (Zhoushu : L, 920) ou en 555 (Beishi : XCVII, 3223). La dernière ambassade sassanide mentionnée est celle qui se rend à la cour des Tang, à Chang’an, en 639 (Jiu Tang shu : III, 51). On sait qu’une am-bassade chinoise a été envoyée à la cour perse par Yangdi des Sui (605-617) ; dirigée par un officier de la Garde à Cheval, Li Yu, elle rapporta des cadeaux que le roi sassanide offrait à l’empereur chinois (Sui-shu : LXXXVIII, 1857 ; Beishi : XCVII, 3223). Il est sûr qu’à l’aller, Li Yu emportait des rouleaux de soie pour le souverain sassanide.
Du IVe au VIe siècle, ce sont plusieurs centaines de délégations qui se rendent en Chine, du nord et du sud, pour pratiquer ce type de commerce diploma-tique. On ne saurait méconnaître l’ampleur économi-que de ce type d’échange : c’est dans le chapitre éco-nomique du Weishu, que sont mentionnés les bénéfi-ces de cette politique : “Depuis que la Vertu des Wei s’est répandue, les Pays d’Occident et les Barbares de l’Est (Corée et Japon) ont offert en tribut leurs produits précieux qui sont venus emplir le Trésor.” (Weishu : CIX, 2858). Cela montre clairement l’im-portance attachée par les autorités chinoises à ce type d’échange dans leur politique économique.
Lorsque l’on ne peut se procurer ces “produits extraordinaires et précieux” par les échanges, c’est-à-dire lorsque l’on a rien à offrir en contrepartie, le re-cours à la force est une solution qui a été utilisée à grande échelle dans la période qui nous occupe, et les annales chinoises en témoignent abondamment. On se contentera de quelques exemples : en 385, Lu Guang, général des Qin antérieurs, pille Koutcha, dont les demeures patriciennes étaient ornées de jade, d’or et de corail blanc (Nanshi : LIV : 813), et s’em-pare de “tous les trésors précieux des pays étran-gers” (Jinshu : CXXII, 3056) ; en 391, au début de la dynastie des Wei, ceux-ci pillent les biens et le trésor d’un chef des Xiongnu, Liu Weichen (Weishu : II, 24 et CIX, 2849) ; en 397, à Zhongshan, les Wei s’em-parent du trésor de Murong Jialin, Prince des Yan postérieurs, trésor “dont l’inventaire occupa plus de 10 000 registres.” (Weishu : II, 31) ; en 424, les Rou-ran s’emparent de Shengle et pillent le palais royal des Wei (Weishu : IV, 69) ; en 427, les Wei prennent et pillent Tongwancheng, la capitale des Xiongnu du royaume de Xia et se rendent maître du trésor de Helian Chang, avec “son trésor personnel, ses biens
les plus précieux, ses chars, ses étendards et toutes sortes d’objets, en une quantité telle qu’il fut impos-sible de les compter.” (Weishu : IV, 72-73) ; en 430, ce sont les trésors des deux frères de Helian Chang qui sont capturés (Weishu : IV, 78) ; en 439, lors de la prise de Guzang, capitale des Liang du Nord, les Wei se rendent maîtres du trésor royal et du trésor d’État dont les richesses étaient telles “qu’il fut im-possible de les compter” (Weishu : IV, 90) ; en 448, sur les ordres de l’empereur Taiwudi des Wei, le duc Chengzhou attaque et prend la ville de Yanqi dont le roi s’est enfui précipitament : “on s’empara de ses différents objets précieux, rares et extraordinaires, accumulés en quantités telles qu’on ne put les dénom-brer” (Weishu : CII : 2266 et CIX : 2851) ; sur sa lancée et à la pousuite du roi de Yanqi réfugié à Kou-tcha, le duc Chengzhou pille cette ville et s’empare “d’un nombre incalculable d’objets merveilleux et de trésors extraordinaires” (Weishu : CIX, 2851). Les pillages cessent avec l’unification de la Chine du nord et l’instauration d’un pouvoir fort qui, en réta-blissant l’économie, dote le pays d’une production de soie nécessaire au rétablissement du courant des é-changes internationaux. On note cependant que dans le chapitre économique du Weishu, le pillage est mentionné comme une pratique normale qui permet l’enrichissement de la maison impériale et du pays : “Depuis que Taizu (386-409) a pacifié la plaine cen-trale et que Shizu (424-452) a mis au pas les popula-tions frontalières, on a pillé une grande quantité de trésors précieux et on en a empli les magasins d’état jusqu’à ras bords” (Weishu : CIX, 2851) ; c’est ainsi que figurent en bonne place dans ce même chapitre, comme éléments d’une politique des revenus de l’État, le pillage des trésors et du bétail de Liu Wei-chen, celui du cheptel des Rouran et celui des trésors royaux de Yanqi et Koutcha.
Qu’ils soient acquis par l’échange ou par la vio-lence, les produits d’Occident sont l’objet d’une re-distribution à l’intérieur de la classe dominante : après les batailles et les prises de villes, on procède à une distribution du butin en fonction des mérites et des actes de bravoures des militaires et des fonction-naires ; régulièrement, les souverains puisent dans leur trésor et dans les magasins de l’État pour récom-penser les fonctionnaires méritants, ou pour faire par-tager à la cour les joies d’un anniversaire ou d’une victoire ; sous les Wei du Nord, après la stabilisation du régime, “comme à cette époque, la paix durait de-
132 F. T H I E R R Y
puis de longues années, les magasins et le trésor étaient pleins à ras bord, un décret ordonna de sortir du trésor impérial 80% des vêtements, des trésors précieux, des divers instruments en usage dans le Palais et des chars, et des magasins du Palais, 80% des arcs, des flêches, des sabres et des lances, ainsi que les vêtements, tissus et brocards prévus pour l’u-sage de l’État ; la plus grande moitié de tout celà sera distribuée en récompense aux fonctionnaires et aux officiels.” (Weishu : CIX, 2856). La présence d’armes dans cette redistribution, montre qu’elle s’est faite au bénéfice des membres de l’aristocratie sino-tab-ghatch qui monopolisaient les postes de la haute ad-ministration, les fonctions de gouverneurs de provin-ce, de commandants de corps d’armée ou de place forte, les ministères et les bureaux : les clans Yuan, Yuwen, Li, Yang, Gao, etc.
À ceux qui étaient trop pauvres et n’étaient pas de force à se mesurer à leurs voisins, il restait le pil-lage de tombes. Le Jinshu mentionne que “[Shi] Le et [Shi] Jilong (les souverains des Zhao postérieurs) étaient tous deux pauvres et ne respectaient pas les rites ; lorsqu’ils étaient rois, ils dominaient un terri-toire couvrant dix préfectures, et cependant, ils ne pouvaient parvenir à se procurer en quantités no-tables ni l’or, ni la soie, ni les perles, ni le jade, ni les différents produits rares et précieux des pays étran-gers. Alors, ils mirent au point un plan susceptible de leur en procurer : comme les tumuli des rois des an-ciennes dynasties et ceux des sages de l’antiquité étaient effondrés, mais n’avaient pas été fouillés, on pouvait s’emparer des trésors qu’ils renfermaient.” (Jinshu : CVII, 2781-2782). C’est ainsi que furent violées la sépulture du vicomte Jian de Zhao des Royaumes Combattants et celle du Premier Empe-reur Qin Shihuangdi. Au Hexi, vers 400, “Anju, chef d’une bande de barbares Jixu, viola la tombe de Zhang Jun [roi des Liang antérieurs, 324 à 346] ; quand on découvrit le corps de Jun, celui-ci parais-sait vivant ; on sortit [de la tombe] des rideaux de perles, des flacons de verre, des vases de jade blanc, des flûtes de jade rouge et d’autres de jade pourpre, des chapelets de corail, des gobelets d’agate et toutes sortes d’objets extraordinaires et précieux provenant des terres et des mers, dans des quantités telles qu’il fut impossible de les enregistrer.” (Jinshu : CXXII, 3067).
C-La circulation monétaire.
Pour qu’une monnaie étrangère circule dans un pays donné, sauf à détruire et supplanter le système monétaire local, il faut qu’elle puisse s’y insérer, et donc qu’elle ne soit pas radicalement différente, dans sa nature, des monnaies du pays d’accueil. Aussi, pour que les monnaies sassanides circulent en Chine, il faudrait qu’elles trouvent leur place dans le système monétaire chinois. Or, tout ce que l’on sait de la monnaie chinoise s’oppose à cette cohabitation.
La tradition chinoise fait de la monnaie un usten-sile destiné à échanger des produits ou à payer des services. C’est un objet qui doit donc circuler dans la société, “comme le sang dans le corps”. Si on utilise, pour fabriquer cet objet, des matières précieuses comme le jade, l’or ou l’argent, on crée les condi-tions de la thésaurisation : la valeur intrinsèque de la monnaie doit être faible pour n’avoir point ou peu de conséquences sur sa valeur faciale (Thierry mon-naie : 31-35). C’est la raison pour laquelle la mon-naie chinoise a pris la forme d’une pièce de cuivre qui circule seule, à la valeur abstraite de 1 ; aucune monnaie d’or ou d’argent ne circule ; les mé-taux précieux, au même titre que le jade, les perles ou le corail, ne sont que de la réserve, fonction qui pour les Chinois, n’appartient pas au domaine monétaire.
Lorsqu’ils veulent se procurer les produits d’Oc-cident, les Chinois ne peuvent les payer en monnaies de cuivre, espèces que les Sogdiens et les marchands étrangers refusent catégoriquement, en raison de leur faible valeur intrinsèque. Les Chinois de leur point de vue, se considèrent comme acheteurs, et ils ne peuvent accepter que les étrangers ne leur fournissent que de l’or ou de l’argent, car ce ne sont pas là les produits les plus recherchés, et les royaumes du sud, comme le Linyi et le Funan, peuvent leur en fournir abondamment.
Il y a donc là, une incompatibilité entre deux mondes, incompatibilité qui se conjugue, à l’époque envisagée, à une situation très particulière au point de vue économique : l’abandon officiel et légal, en Chine, de l’usage de la monnaie métallique durant de longues années et sur de vastes territoires. En raison de la crise de la fin des Han, l’approvisionnement de l’économie en numéraire est incertain puis défail-lant ; certaines régions utilisent alors les grains et les pièces de tissu (Peng : 240). Lorsque Cao Cao met fin à la dynastie Han en 220, il ne tarde pas à prendre acte de la situation, et, en 221, il met fin à la fonte de monnaies, et à l’usage de la monnaie métallique, est substitué celui des grains et des tissus (Jinshu :
S U R L E S M O N N A I E S S A S S A N I D E S T R O U V E E S E N C H I N E 133
XXVI, 782). Bien que, quelques années plus tard, les autorités soient revenues sur cette politique, ce retour à l’ancien système ne provoqua pas, miraculeu-sement, une augmentation de la masse monétaire. Et, faute de moyens de paiement, de nom-breuses provinces continuèrent à utiliser et les grains et les tissus. L’état de guerre qui sévissait en Chine du nord jusqu’au Ve siècle, laisse peu de possibilité au réta-blissement d’une situation classique et stable dans la circulation monétaire 60. Sur les vingt-et-un royaumes qui se sont disputé le nord de la Chine entre 300 et 500, trois seulement ont fondu des monnaies, et en-core ces émissions furent-elles très brèves et peu abondantes. Les Liang antérieurs (316-376) ont fon-du à Liangzhou, des monnaies Liang zao xinquan, dont on ne connait que quelques dizaines d’exem-plaires ; en 319, les Zhao postérieurs ont émis des Fenghuo, monnaies fort peu fréquentes et qui n’ont quasiment pas circulé (Trân : 56 ; Peng : 216). Enfin, en 495, les Wei du Nord, qui durant environ cent ans, n’ont émis aucune monnaie et qui en ont plus ou moins interdit l’usage, autorisent les particuliers à venir apporter leur métal dans les ateliers d’État où seront fondus des Tai He wuzhu (Peng : 221). Il faut attendre les Wei de l’Ouest (534-555), les Qi du Nord (550-577) et les Zhou du Nord (550-581), pour que l’on assiste à la reprise d’émissions monétaires à peu près normales.
Durant le IVe et le Ve siècle, puis de façon moins absolue, à partir de 530-540, les moyens de paiement consistent en grains, en pièces de tissu et en pièces de soie ; on utilise ces produits pour collecter les impôts, pour calculer les coûts et les revenus, pour verser le salaires des fonctionnaires et pour fixer les prix. La monnaie de référence est en général le pi de soie brute. Les pièces de soie brute sous les
______
60 L’étude des trésors monétaires d’époque Jin (265-420) est convaincante à cet égard ; on y trouve généralement une proportion de 90% de wuzhu des Han, les 10% restants se composant principalement de monnaies de Wang Mang (7-25 ap. JC) et de monnaies des Han de Shu (221-280, au Sichuan). Les monnaies de notre période, wuzhu des Jin et Fenghuo des Zhao postérieurs, y sont en quantités infimes, et la famine monétaire est rendue patente par la présence dans tous ces dépôts de monnaies découpées, dites “monnaies en anneau” et “monnaies rognées” : par une habile découpe circulaire, on parvenait à faire deux monnaies avec un seul wuzhu, l’extérieur est appelé “monnaie en anneau”, et l’intérieur “monnaie rognée” ; (Musée de Zhenjiang : 130-133 ; Équipe de Shaoxing : 568 ; Xiao : 152-153 ; Yu : 40.; Huang LC : 30-33 ; Thierry 1993 : 8 et n° 9, 10, 11, pl. II).
Wei du Nord sont de deux sortes, le pi et le duan ; le premier mesure 2 pieds et 2 pouces de large sur 4 toises de long (0,704/12,8 m) et le second a une lon-gueur de 6 toises (0,704/19,2 m). Sous les Wei, les salaires des fonctionnaires sont versés en grains et en pi de soie brute, et sous les Qi du Nord, ils sont versés en trois tiers, en grains, en tissus et en monnaies métalliques (Trân : 95-98 ; Peng : 242).
Le pi de soie brute devient une unité de compte dès le IVe siècle et des équivalences avec l’ancien système sont fixées : sous les Zhao postérieurs, à l’époque de Shi Le, le cours officiel du pi de soie brute de qualité moyenne est de 1200 pièces et celui de qualité inférieur est de 800 ; mais en raison de la crise de confiance dans la monnaie métallique et la sous-production de soie, les cours du marché sont re-spectivement de 4000 et de 2000 pièces. Sous les Wei du Nord, le pi est vaut 1000 pièces en 467, mais en 529, en raison de la stabilisation économique, de l’abondance de la production séricicole et de l’aug-mentation de la masse de monnaie métallique, sa va-leur est fixée à 200 ou 300 pièces (Peng : 242-243).
Le Hexi est la seule région de Chine du nord où la circulation des espèces d’or et d’argent soit tolérée par les autorités (Suishu : XXIV, 691). Cette circu-lation doit son origine à la proximité des royaumes d’Occident qui utilisent ces monnaies, à l’importante communauté hu, sogdienne et perse, peuplant la plu-part des grandes villes de cette région, qui en apporte l’usage, et à l’état défaillant du système monétaire chinois en Chine du nord.
En Chine du sud, bien que la situation soit plus stable, l’usage de la monnaie de cuivre ne retrouve pas son statut de l’époque des Han ; on utilise concu-ramment les grains, les tissus, la soie, les monnaies de cuivre et de fer. Ainsi, sous les Liang (479-520), on a émis des monnaies de fer et des monnaies de cuivre de différents modules, mais la monnaie métal-lique ne circulait que dans la capitale, les préfectures de Jing, de Ying, de Jiang, de Xiang, de Liang et de Yi, et dans les Trois Wu, les autres préfectures utili-saient à la fois les grains et les tissus. Dans la région de Canton et du Jiaozhi, l’or et l’argent servaient de monnaie (Suishu : XXIV, 689).
On constate donc, qu’à l’exception du Hexi et des régions méridionales de Canton et du Tonkin, l’or et l’argent n’avaient pas cours en Chine. Si le Hexi doit sa particularité à la proximité du monde iranien, dans les régions méridionales, l’usage de l’or et de l’argent repose d’une part, sur une tradition
134 F. T H I E R R Y
d’usage de l’or en pays viêt-yue, avant les Han, et d’autre part, sur la proximité des États hindouisés de la péninsule indo-chinoise, le Linyi et le Funan, où l’or et l’argent ont une fonction monétaire attestée (Tongdian : CLXXXVIII, 5093 ; Trân : 12-22) 61, et enfin, sur la présence de commerçants indiens et perses 62.
L’usage de la soie brute comme moyen de paie-ment, spécialement en Chine du nord, fait que, du point de vue chinois, les échanges avec les pays d’Occident restent de l’ordre des transactions com-merciales de type monétaire, puisqu’on les “paye” en soie, brute ou de qualité. Les Chinois achètent de l’argent métal, quel que soit la forme sous laquelle il est mis en œuvre, bijoux, vaisselle, lingots ou pièces de monnaie, comme ils se procurent d’autres produits exotiques ; bien évidement, bijoux et vaisselle avaient, par rapport aux monnaies et aux lingots, l’attrait de l’objet éxotique. Il n’est pas plus possible de parler, à ce propos, de circulation des drahm sas-sanides en Chine que de parler de la circulation du pi chinois dans l’empire sassanide, au motif que ces pi prenaient la direction de la Perse.
Les dépôts de monnaies sassanides en Chine ne sont généralement pas, on l’a vu, des dépôts moné-taires, mais des dépôts d’argent ; les monnaies ne s’y trouvent que comme métal. L’étude de ces dépôts et
______
61 On a trouvé à Oc-èo des monnaies d’argent du Dunxun — dites à tort monnaies du Funan — dont certaines étaient coupées en 8, en 4 et en 2 parties (Malleret : 1951 : 86), ce qui montre bien un usage monétaire de l’argent, puisque des fractions de métal, au pouvoir d’achat relativement faible sont le signe d’une véritable circulation sociale et non pas seulement palatiale.
62 Dans une certaine mesure, et tout en restant administra-tivement chinois, le Jiaozhi et le Rinan jouent un rôle similaire à celui du Hexi. C’est dans cette région qu’arrivaient les mar-chands indiens et perses, des communautés indiennes, sog-diennes et perses y étaient installées, et les autorités locales qui jouissaient d’une relative autonomie en matière fiscale, s’enrichissaient du négoce international. Vers 330-340, les offi-ciels du Rinan et du Jiaozhi augmentèrent les taxes sur les pro-duits étrangers entrant sur le territoire et les portèrent à 20 ou 30% de la valeur des dites marchandises. Tao Ji, préfet du Rinan les porta même à 50%, ce qui provoqua la colère et l’exaspération des états commerçants dont le fructueux négoce se trouva entravé. Le royaume de Linyi saisit le prétexte de cette situation pour intervenir au Rinan en se posant comme le défenseur de la communauté commerçante internationale. En 347, le Linyi envahit le Rinan que les Chinois ne parvinrent pas à récupérer avant de longues années (Jinshu : XCVII, 2546 ; Nanshi : LXXVIII, 1948 ; Liangshu : LIV, 784 ; Tongdian : CLXXXVIII, 5091-5092 ; Taylor : 106-108).
leur confrontation avec les données économiques et historiques que nous fournissent les sources chinoises nous ont permis de tirer un certain nombre de conclusions.
Du point de vue de la numismatique chinoise, certains de ces dépôts nous donnent une vision plus précise des modes de thésaurisation : les drahm étant les seuls objets précieux des trésors chinois datés avec précision, ils nous fournissent la preuve que le trésor de réserve “vit” sur une longue période, par-fois plusieurs siècles ; les objets accumulés au Ve siècle ne sont pas remplacés, mais rejoints, par d’autres.
À l’évidence, des quantités importantes de métal ont été transférées d’ouest en est, et le rôle des barba-res, dont les Hephtalites, dans ce transfert, semble avoir été important. La Route centrale de la Soie se trouve mise en évidence comme lien privilégié entre la Perse et la Chine.
Les types des dépôts, leur localisation et leur composition ont permis de montrer que c’est moins la situation sur la Route qui empêche la circulation que la situation en Chine du nord qui la rend sans objet. On constate cependant, que la preuve de la cir-culation des monnaies sassanides au Hexi, pourtant attestée par les textes, n’a pas encore été apportée par l’archéologie, alors que, paradoxa-lement, l’usage monétaire et la circulation des drahm sassanides en Asie du Sud-Est semblent prouvés par la découverte de Kukgong [47] : les 18 moitiés de pièce de ce dé-pôt sont la preuve qu’à un moment ou à un autre, des monnaies ont subi cette mutilation pour être utilisées comme lingotins d’argent pour une valeur monétaire donnée liée au poids de métal. On ne peut pas ne pas rapprocher les moitiés de drahm de Kukgong des moitiés, des quarts et des huitièmes de monnaies d’argent de Dunxun trouvés sur le site d’Oc-èo. À l’évidence, les moitiés de monnaies de Kukgong ont été utilisées comme moyen de paiement, soit au Fu-nan, soit au Linyi, soit encore au Jiaozhiou ou au Guangdong, et ont été par la suite enfouies en Chine.
Le dépôt de Kukgong et les deux autres dépôts méridionaux sont des éléments dont il faudra tenir compte dans l’évaluation de l’importance de la pré-sence des communautés hu en Chine du sud et en Indochine.
Les dépôts, tant au nord qu’au sud, montrent l’influence qu’exerçait la Perse sassanide sur la com-munauté commerçante iranienne (Hu, Sogdiens et Perses) en Asie Centrale et en Asie du Sud-Est. Ils
S U R L E S M O N N A I E S S A S S A N I D E S T R O U V E E S E N C H I N E 135
sont les témoins de l’importance des liens écono-miques et culturelles qui unissaient la Perse sas-sanide et la Chine, malgré la période sombre du IVe siècle. On comprend qu’après la défaite, les princes et la famille royale sassanides se soient réfugiés en
Chine, que celle-ci les ait accueillis en souverains, qu’elle ait organisé une expédition de restauration et installé, à la fin du VIIe et au début du VIIIe siècle, une fiction d’empire sassanide sous son protectorat.
SOURCES Baopuzi : GE Hong, Baopuzi nei pian (ca 35), édition annotée Baopuzi nei pian jiaoshi de Wang Ming, Zhonghua shuju, Pékin 1985. Beishi : LI Yanshou, Beishi (ca. 660), Zhonghua shuju, Pékin 1983, 10 vol.. Hou Han shu : FAN Ye, Hou Han shu (ca. 450), Zhonghua shuju, Pékin 1987, 12 vol. Ji Han : JI Han, Nan fang cao mu zhuang (304 ap. JC), texte présenté, traduit et annoté par Hui-Lin LI, Hong-Kong 1979. Jinshu : FANG Xuanling, Jinshu (648), Zhonghua shuju, Pékin 1982, 10 vol. Jiu Tang shu : LIU Xu, Jiu Tang shu (945), Zhonghua shuju, Pékin 1987, 16 vol. Josué : JOSUE le stylite, Chronique (515 ap. JC), éd. et trad. par l'Abbé Paulin MARTIN, Abhandlungen für die Kunde des
Morgenlandes, 1876 VI, N°1. Liangshu : YAO Silian, Liangshu (ca. 630), Zhonghua shuju, Pékin 1987, 3 vol. Liji : Liji in Zhouli-Yili-Liji, Yuelu éd., Changsha 1989, 279-549. San Guo zhi : CHEN Shou, San Guo Zhi (ca. 265-297 ap. JC), Zhonghua shuju, Pékin 1985, 5 vol. Shen Nong : Shen Nong bencao jing (IIe siècle av. JC), Zong He éd. Tainan 1983. Song shu : SHEN Xu, Song shu (ca. 510), Zhonghua shuju, Pékin 1974, 8 vol. Suishu : WEI Hui, Suishu (ca. 656); Zhonghua shuju, Pékin 1982, 6 vol. Tang huiyao : WANG Pu, Tang huiyao (956), Shijie shuju, Taibei 1963, 3 vol. Tongdian : DU You, Tongdian (813), éd. Zhonghua shuju, Pékin 1988, 5 vol. Weishu : WEI Shou, Weishu (554), Zhonghua shuju, Pékin 1987, 8 vol. Xin Tang shu : OUYANG Xiu, Xin Tang shu (1060), Zhonghua shuju, Pékin 1987, 20 vol. Xiyu ji : XUAN Zang, Da Tang Xiyu ji (646), édition annotée par JI Xianlin, Zhonghua shuju, Pékin 1985. Yili : Yili in Zhouli-Yili-Liji, Yuelu éd., Changsha 1989, 135-278. Zhouli : Zhouli in Zhouli-Yili-Liji, Yuelu éd., Changsha 1989, 1-134. Zhoushu : LINGHOU Defen, Zhoushu (636), Zhonghua shuju, Pékin 1971, 3 vol.
TRAVAUX Aohanqi : Centre culturel d’Aohanqi, “Aohanqi Lijiayingzi chutu de jin yin qi”, Kaogu, 1978-II, 117-118. Bai SY : BAI Shouyi, Précis d’histoire de Chine, Pékin 1988. Beckwith : BECKWITH Christopher I., The Tibetan Empire in Central Asia, Princeton University Press, 1987. Bivar : BIVAR. A. D. H., “The History of Eastern Iran”, in The Cambridge History of Iran, Cambridge 1983, Vol. 3, Part I, 181-231. Bureau du Shanxi : Bureau archéologique du Shanxi et Musée de Datong, “Datong nanjiao Bei-Wei muqun fajue jianbao”, Wenwu,
1992-VIII, 1-11. Cent contes : Cent contes et apologues extraits du Trpitaka chinois, trad. CHAVANNES Edouard, 4 vol., Paris 1910. Chan-Houston : CHAN-HOUSTON Rose, “A note on two coin hoards reported in Kaoku ”, ANS-MN, XX 1975, 153-160. Chavannes 1905 : CHAVANNES Edouard, “Les pays d’Occident d’après le Wei lio”, T'oung Pao vol. II série VI, décembre 1905,
519-571. Chavannes : CHAVANNES Edouard, Documents sur les Tou-Kiue (Turcs) Occidentaux, St Petersbourg, 1903, rééd. Maisonneuve
Paris 1956. Chen Y : CHEN Yan, “On the maritime Silk Road”, Social Sciences in China, 1983-I, 155-183. Chu SB : CHU Shibin, “Gansu Jingyuan xin chu Dong-Luoma liujin yin pan luekao”, Wenwu, 1990-V, 1-9. Coedès : COEDES George, “Fouilles de Cochinchine. Le site d’Oc-èo, ancien port du royaume de Fou-Nan”, Artibus Asiae 1947 X
3, 193-200. Cordier : CORDIER Henri, Histoire générale de la Chine et de ses relations avec les pays étrangers, 4 vol., Paris 1920. Cunningham : CUNNINGHAM Sir A., “Coins of the Tochari, Kushâns, or Yue-ti. IV”, Numismatic Chronicle 1889, 268-311. Curiel : CURIEL Raoul, “Le trésor de Tépé Maranjan”, Trésors monétaires d’Afghanistan, Tome XIV, Paris 1953, 101-130. Dalby : DALBY Michael T., “Court politics in late T'ang times”, in The Cambridge History of China, Cambridge 1979, Vol. 3, Part I,
561-681.
136 F. T H I E R R Y
De Groot : DE GROOT J. J M.,The religious system of China, Leyde 1892, 6 vol. Drouin 1890 : DROUIN E., “Notices sur quelques monnaies bilingues sassanides”, Revue Numismatique 1890, 354-365. Drouin 1895 : DROUIN E., “Mémoires sur les Huns Ephtalites dans leurs rapports avec les rois perses sassanides”, extrait du Muséon
1895, 1-58. Duan LQ : DUAN Lianqin, Dingling, Gaoju yu Tiele, Shanghaï 1988. Dumoutier : DUMOUTIER Gustave, Le rituel funéraire des Annamites, Hanoï 1904. Emmerick : EMMERICK E., “Iranian settlements east of Pamirs”, in The Cambridge History of Iran, Cambridge 1983, Vol. 3, Part I,
263-278. Équipe de Shaoxing : Équipe provinciale de conservation du Patrimoine du Shaoxing, “Zhejiang Shaoxing xian chutu yi pi jiaocang
gu qian”, Kaogu, 1979-VI, 568. Équipe du Hebei : Équipe archéologique du Hebei, "Hebei Dingxian chutu Bei-Wei shi han", Kaogu, 1966-V, 252-259. Équipe du Shanxi : Équipe provinciale de conservation du Patrimoine du Shanxi, “Taiyuan nanjiao Jinshengcun Tang mu”, Kaogu,
1959-IX, 473-476. Fang : FANG Hao, Zhong-Xi jiaotong shi, 2 vol. Shanghaï 1987. Gernet : GERNET Jacques, Les aspects économiques du Bouddhisme dans la société chinoise du Vème au Xème siècle, EFEO, Saïgon
1956. Ghirshman 1957 : GHIRSHMAN Roman, “Argenterie d’un seigneur sassanide”, Ars Orientalis, Charles Lang Freer Centenial
Volume 1957, vol. II, 77-82. Ghirshman : GHIRSHMAN Roman, Les Chionites-Hephtalites, IFAOC, Le Caire 1948. Göbl 1984: GÖBL Robert, System und Chronologie der Münzprägung des Kusanreiches, Vienne 1984. Göbl : GÖBL Robert, Dokumente zur Geschischte der iranischen Hunnen in Baktrien und Indien, 4 vol., Wiesbaden 1967. Gyselen : GYSELEN Rika, “Ateliers monétaires et cachets officiels sasanides”, Studia Iranica VIII 1979, 189-212. Han X : HAN Xiang, “Yanqiguo du, Yanqi du dufu zhi suo yu Yanqi zhencheng”, Wenwu, 1982-IV, 8-12. Hirth : HIRTH F., China and the Roman Orient, Leipzig 1885. Hou : HOU Ching-Lang, Monnaies d'offrande et la notion de trésorerie dans la religion chinoise, Paris 1975. Huang QS : HUANG Qishan, “Guangxi faxian de Han dai boli ji”, Wenwu, 1992 - IX, 46-48, pl. V. Huang 1958 : HUANG Wenbi, Talimu bandi kaogu ji, Pékin 1958. I.A. Ningxia : Institut d’Archéologie du Ningxia, “Ningxia Guyuan Sui Shi Shewu mu fajue jianbao”, Wenwu, 1992 - X, 15-22. Institut d’Archéologie : Institut d’Archéologie de l’Académie des Sciences Sociales, Tang Chang'an chengjiao Sui Tang mu, Pékin
1980. Kœnig : KOENIG Gerd G., “Frühbyzantinische und sassanidische Münzen in China”, in Gold aus China, Rheinisches Landes-
museum, Bonn, 1982, 90-109. Laufer : LAUFER Berthold, “Sino-Iranica, chinese contributions to the History of Civilisation in ancient Iran”, Field Museum of
Natural History Publications, Anthropological series, vol. XV n°3, 1919.. Li SZ : LI Shizhen, Bencao gangmu (1590), Commercial Press, Hong Kong 1982. Li YC : LI Yuchun, “Xinjiang Wuqia xian faxian jin tiao he da pi Bosi yinbi”, Kaogu, 1959-IX, 482-483. Lin G : LIN Gan, Tujue shi, Hohote 1988. Liu DY : LIU Dayou, “Tianshui faxian de Bosi Sashan chao yinbi”, Nei Menggu jinrong, 1987-VII, 16-20. Liu XR : LIU Xinru, Ancient India and ancient China, Trade and religious exchanges AD 1-600, Delhi 1988. Ma YQ : MA Yuqi, “Datong shi Xiaozhancun Huagedatai Bei Wei mu qingli jianbao”, Wenwu, 1983-VIII, 1-4. Maillard : MAILLARD Monique, “Essai sur la vie matérielle dans l’oasis de Tourfan pendant le haut moyen-âge”, Arts Asiatiques
XXIX 1973, n° spécial. Malleret 1951 : MALLERET Louis, “Les fouilles d’Oc-èo (1944). Rapport préliminaire”, BEFEO XLV 1951 (1), 75-88. Malleret : MALLERET Louis, “Aperçu de la glyptique d’Oc-èo”, BEFEO XLIV 1947-1950, 189-199. Musée d’Anlu : Musée local de Xiaogan et Musée d’Anlu, “Anlu Wangzishan Tang Wu Wang fei Yang shi mu”, Wenwu, 1985-II,
83-93. Musée de Mongolie Intérieure : Équipe du Patrimoine de Mongolie Intérieure et Musée de Mongolie Intérieure, “Huohehuote shi
fujin chutu de Waiguo jin yinbi”, Kaogu, 1975-III, 182-185. Musée de Suikai : Musée cantonnal de Suikai, “Guangdong Suikai xian faxian Nanchao jiaocang jin yin ji”, Kaogu, 1986-III, 243-
246. Musée de Zhenjiang : Musée de Zhenjiang, “Jiangsu Dantu Dong-Jin jiaocang dong qian”, Kaogu, 1978-II, 130-135. Musée du Ningxia : Musée provincial du Ningxia, “Ningxian Guyuan Beizhou Li Xian fu fu mu fajue jianbao”, Wenwu, 1985-XI, 1-
20. Musée du Shaanxi : Musée provincial du Shaanxi, “Xian nanjiao Hejiacun faxian Tang dai jiaocang wenwu”, Wenwu, 1972-I, 30-36.
S U R L E S M O N N A I E S S A S S A N I D E S T R O U V E E S E N C H I N E 137
Musée du Xinjiang (I) : Musée de la Région Autonome Ouïghoure du Xinjiang, “Tulufan xian Asitana-Halahezhuo gu muqun qingli jianbao”, Wenwu, 1972-I, 8-21.
Musée du Xinjiang (II) : Musée de la Région Autonome Ouïghoure du Xinjiang, “Tulufan Asitana 363 hao mu fajue jianbao”, Wenwu, 1972-II, 7-11.
Needham : NEEDHAM Joseph, Science and civilisation in China, Cambridge 1954+. Pelliot 1912 : PELLIOT Paul, “Kao-tchang, Qoco, Houo-tcheou et Qara-Khodja”, Journal Asiatique 1912-I, 579-613. Pelliot 1934 : PELLIOT Paul, “Tokharien et koutchéen”, Journal Asiatique 1934, 24-106. Pelliot Funan : PELLIOT Paul, “Le Fou-Nan”, BEFEO III, avril-juin 1903, 248-303. Peng : PENG Xinwei, Zhongguo huobi shi, Shanghaï 1965. Peterson : PETERSON C. A., “Court and province in mid- and late Tang”, in The Cambridge History of China, Cambridge 1979,
Vol. 3, Part I, 464-560. Pinault : PINAULT Georges, “Laisser-passer de caravanes”, Sites divers de la région de Koutcha, épigraphie koutchéenne, Mission
P. Pelliot, Documents archéologiques VIII, Paris 1900, 65-121. Qi, Lu et Guo : QI Chenjun, LU Qingfu et GUO Feng, Wu Liang shilue, Lanzhou 1988. Raschke : RASCHKE Manfred, “New studies in roman Commerce with the East”, in Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt,
H. TEMPORINI éd., Berlin 1978, II, 9.2, 604-1361. Schlegel : SCHLEGEL G., “Geographical notes”, T'oung pao, vol. X 1899,33-52. Shen FW : SHEN Fuwei, Zhong-Xi wenhua jiaolio shi, Shangaï 1985. Shi 1991 : SHI Changcheng, “Ziyang xian faxian yi mei Bosi yinbi”, Zhongguo qianbi, 1991-I, 44. Sinor : SINOR Denis., “The establishment and dissolution of the Türk Empire”, in The Cambridge History of Early Inner Asia,
Cambridge 1990, 285-316. Specht : SPECHT E., “Études sur l’Asie Centrale d’après les historiens chinois. I-Indoscythes et Ephtalites”, Journal Asiatique oct-
déc. 1883, 317-350. Stein : Sir Aurel STEIN, Innermost Asia, 1928, vol. II. Su BH : SU Beihai, Xiyu lishi dili, Ouroumtchi 1988. Sun J : SUN Ji, “Lun Xi'an Hejiacun chutu de manao shou shou bei”, Wenwu, 1991-VI, 84-92. Sun ZW : SUN Zhiwen, “Bosi yinbi yu kai yuan qian tong chu”, Shaanxi jinrong, 1988-122 (IX), 71. Tang JY : TANG Jinyu, “Xi'an xijiao Sui Li Jingxuan mu fajue jianbao”, Kaogu, 1959-IX, 471-472. Tang SH : TANG Shenhui, Zhong xiu Zheng He jing shi zheng leilue yong bencao (1116), Qinan 1982. Taylor : TAYLOR K. W., The Birth of Vietnam, Cal. Un. Press, Berkeley 1976. Thierry 1988 : THIERRY François, “Wuzhu des Sui ou wuzhu des Wei ?”, Bulletin de la Société Française de Numismatique, avril
1988, 349-351. Thierry 1991 : THIERRY François, “La politique monétaire des Zhou du Nord (557-581), génèse idéologique et nécessités
financières”, Revue belge de Numismatique, 1991, 127-140, pl. VI-VIII. Thierry 1993 : THIERRY François, “De la nature fiduciaire de la monnaie Chinoise”, Bulletin du Cercle d’Études Numismatiques,
vol. XXX, n° 1, 1993, 1-13. Thierry kai yuan : THIERRY François, “Typologie et chronologie des kai yuan tong bao des Tang”, Revue Numismatique, 1991, 209-
249, pl. XXI. Thierry monnaie : THIERRY François, “La conception de la monnaie dans la Chine antique”, Cahiers Numismatiques, N°109,
septembre 1991, 31-35. Trân : TRÂN Minh Dao, Lich su kinh tê va tiên tê Trung Quoc thoi Tân va Nam Bac Triêu, Hanoï 1943. Wan SN : WAN Shengnan, Wei, Jin, Nanbeichao shi lungao, Hefei 1983. Wang GC et Wang DW : WANG Guicheng et WANG Dawen, “Cong gudai Zhong-Wai huobi jiaoliu, kan Guangzhou hai shang
sichou zhi lu”, Liaoning jinrong, 1991-VII, 12-19. Wang PK : WANG Pikao, “Qinghai Xining de Bosi Sashan chao yinbi chutu qingkuang”, Kaogu, 1962-IX, 492. Wang WQ : WANG Wenqing, Liang Jin shihua, Pékin 1987. Watson : WATSON William, “Iran and China”, in The Cambridge History of Iran, Cambridge 1983, Vol. 3, Part I, 537-558. Wechsler : WECHSLER Howard J., “The founding of the T'ang dynasty : Kao-tsu (reign 618-26)”, in The Cambridge History of
China, Cambridge 1979, Vol. 3, Part I, 150-241. Wenhua : ss. nom d'a., Wenhua da geming qijian chutu wenwu, Pékin 1972. Wright : WRIGHT Arthur F., “The Sui dynasty (581-617)”, in The Cambridge History of China, Cambridge 1979, Vol. 3, Part I, 48-
149. Wu : WU Zhuo, “Bei Zhou Li Xian mu chutu liujin yin hu kao”, Wenwu, 1987-V, 66-76. Xia 1958 : XIA Nai, “Qinghai Xining chutu de Bosi Sashan chao yinbi”, Kaoguxuebao, 1958-I, 105. Réédité in Xinjiang kaogu
sanshi nian, Ouroumtchi 1983, 495-499.
138 F. T H I E R R Y
Xia 1961 : XIA Nai, “Zhongguo zuijin faxian de Bosi Sashan chao yinbi”, Kaoguxue lunwenji, 1961, 117-128. Réédité in Xinjiang kaogu sanshi nian, Ouroumtchi 1983, 470-480.
Xia 1966 : XIA Nai, “Xinjiang Tulufan zuijin chutu de Bosi Sashan chao yinbi”, Kaogu, 1966-IV, 211-214. Xia 1974 : XIA Nai, “Zongshu Zhongguo chutu de Bosi Sashan chao yinbi”, Kaoguxuebao, 1974-I, 91-110. Réédité in Xinjiang
kaogu sanshi nian, Ouroumtchi 1983, 480-495. Xia 1978 : XIA Nai, “Jinnian Zhongguo chutu de Sashan chao wenwu”, Kaogu, 1978-II, 111-116. Xia 1983 : XIA Nai, “Bei Wei Feng Hetu mu chutu Sashan yin pan kao”, Wenwu, 1983-VIII, 5-7. Xia Dingxian : XIA Nai, “Hebei Dingxian taqi sheli han zhong Bosi Sashan chao yinbi”, Kaogu, 1966-V, 267-270. Xia Xining : XIA Nai, “Qinghai Xining chutu de Bosi Sashan chao yinbi”, Kaoguxue lunwenji, 1961, 126-134. Xiao : XIAO Qing, Zhongguo gudai huobi shi, Pékin 1984. Xie : XIE Zhufan (sous la dir.), Dictionary of Traditional chinese Medecine, Beijing Medical College, Hong-kong 1984. Xiong CR : XIONG Cunrui, “Sui Li Jingxuan mu chutu jin xianglian jin shouzhuo de chan di wendi”, Wenwu, 1987-X, 77-79. Yang K. : YANG Ke, “Cong Henan faxian de Bosi yinbi lun sizhou zhi lu de dong duan qidian”, Xinjiang jinrong, 1991-II, 108-114. YANG Jixian et YU Tingming, “Shen, Gan chutu faxian de waiguo mingwen quanbing xin tan”, Xinjiang jinrong, 1991 - II, 80-86. Yu : YU Fengzhi, “Guangxi Lipu faxian Han-Jin jiaocang gu dong qian”, Wenwu, 1984-XI, 40. Yu Q. : YU Qian, “Luoyang xin chutu Bosi Sashan chao yinbi kaolue”, Xinjiang jinrong, 1991-II, 128-131. Yü YS : YÜ Ying-Shih., “The Hsiung-nu”, in The Cambridge History of Early Inner Asia, Cambridge 1990, 118-149. ZGQB 1990-II : ss. nom d'a., “Ningxia Guyuan chutu Bosi yinbi, Baizhanting jinbi”, Zhongguo qianbi, 1990-II, 72/36. ZGQB 1991-IV : ss. nom d’a., “Gansu Linxia faxian Bosi yinbi”, Zhongguo qianbi, 1991-IV, 77. Zhao GB : ZHAO Guobi, “Luoyang faxian de Bosi Sashan wangchao yinbi”, Wenwu, 1960-VIII/IX, 94. Zhao YW : ZHAO Yiwu, Wu Liang wenhua shulun, Lanzhou 1989. Zhou WZ : ZHOU Weizhou, Tuyuhun shi, Ningxia 1985. Zhu et Qin : ZHU Jieyuan et QIN Bo, “Shaanxi Chang'an he Yaoxian de Bosi Sashan chao yinbi”, Kaogu, 1974-II, 126-132.
LISTE DES ILLUSTRATIONS Carte 1. Localisation des dépôts de monnaies sassanides. Carte 2. L’Asie Centrale vers 335-340. Carte 3. L’Asie Centrale vers 420-430. Carte 4. L’Asie Centrale vers 502. Carte 5. L’Asie Centrale vers 570. Carte 6. Routes principales et itinéraires de contournement au Hexi. Carte 7. Les grands axes de la Route de la Soie. Carte 8. La route maritime au Ve siècle.
S U R L E S M O N N A I E S S A S S A N I D E S T R O U V E E S E N C H I N E 139
RESUMES La mise au jour en Chine, de monnaies sassanides d’argent en quantité significative,
près de 1500, permet de mesurer l’importance des liens qui, entre le IIIe et le VIIe siècle, unissent la Chine et le monde iranien. La répartion géographique des dépôts et chronologique des monnaies met en lumière des phases de relations plus ou moins intenses, qui sont liées à l’état socio-politique des deux extrêmités des Routes de la Soie, et non pas à de supposées coupures des voies de communication. La typologie et la composition des différents dépôts monétaires montrent clairement que les monnaies sassanides n’y jouent pas un rôle en rapport avec la circulation monétaire en Chine, mais qu’elles n’y figurent que comme réserve de matière précieuse, fonction qui pour les Chinois n'appartient pas au domaine de la monnaie.
F. THIERRY Cabinet des Médailles
58 rue Richelieu 75002 Paris
France






















































![Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt. Le site laténo-romain de Moyencourt au](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631babd4a906b217b90693db/etude-des-monnaies-du-sanctuaire-de-moyencourt-dans-g-prilaux-dir-canal.jpg)