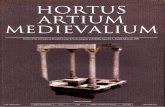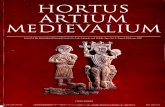Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe,...
-
Upload
univ-lille -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe,...
sous la direction de
Gilles Prilaux
Coordination Canal Seine-Nord Europedécembre 2013
Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt
Le site laténo-romain de Moyencourt au lieu dit « Le Haut du Bois de Pique » : Un lieu de culte atypique chez les Viromanduens ?
Can
al S
eine
-Nor
d Eu
rope
foui
lle 1
8ra
ppor
t de
foui
lle
695650 695675 695700 695725
6958
900
6958
925
6958
950
6958
975
6959
000
6959
025
Chemin
Couloir/Accès
Bâtiment B
Puits
Entréeprincipale
Pile
Bâtiment A
Chemin
Inrap Canal Seine-Nord Europe16 rue du Général Leclerc, 80 400 Croix-MoligneauxTél. 03 22 37 59 20
décembre 2013
Rap
port
de
foui
lleCo
de IN
SEE
8057
6
Nr s
ite
—En
tité
arch
éolo
giqu
e
—Ar
rêté
de
pres
crip
tion
SRA
2010
-9-A
9
Syst
ème
d’in
form
atio
n
9940
Code
Inra
p
GB1
9911
401
par
Gilles Prilauxsous la direction de
Gilles Prilauxavec la collaboration de
Frédéric BroesCéline CoussotMarie DerreumauxJean-David DesforgesJean-Marc DoyenStéphane DuboisAnnick ThuetGuillaume HulinBlandine Lecomte-SchmittSébastien LepetzAlexia MorelJean-Hervé Yvinec
Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt
Le site laténo-romain de Moyencourt au lieu dit « Le Haut du Bois de Pique »: un lieu de culte atypique chez les Viromanduens ?
2
Données administratives, techniques et scientifiques
8 Fiche signalétique9 Mots-clefs des thesaurus10 Intervenants
12 Notice scientifique14 État du site15 Localisation de l’opération16 Arrêté de prescription20 Cahier des charges25 Notification d’attribution30 Projet scientifique et technique42 Projet scientifique et technique phase 2
Résultats
54 1. Données générales (J.-D. Desforges et G. Prilaux)
54 1.1 Déroulement de l’opération et circonstances particulières54 1.1.1. Le cadre général de l’intervention et ses caractéristiques57 1.1.2. Les moyens affectés à l’opération57 1.1.3. Méthodologie57 1.1.4. Contexte géographique et géologique60 1.1.5. Données historiques préalables
62 2. L’occupation archéologique (G. Prilaux)
62 2.1. Phase 1. La période gauloise
64 2.2. L’armement (extrait de l’étude d’A. Morel)
68 2.3. Les rouelles (extrait de l’étude d’A. Morel)
70 2.4. Les monnaies gauloises (extrait de l’étude de J.-M. Doyen)70 2.4.1. La phase ancienne72 2.4.2. La phase récente
73 2.5. Phase 2. Le milieu du Ier siècle et le milieu du IIe siècle73 2.5.1. Les fossés de l’enclos central73 2.5.1.1. Le fossé 2004.
77 2.5.1.2. Le fossé 2055.
78 2.5.1.3. Les fossés 1001 et 1002
78 2.5.1.4. Un tronçon plus massif sur la frange est.
84 2.5.2. Les chemins, accès et zones possibles de circulation 84 2.5.2.1. Les fossés bordiers 1004/1005/1014.
Inrap · Rapport de fouille Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt
Sommaire
89 2.5.2.2. D’anciens fossés bordiers ? (1012, 1008 et 1006).
89 2.5.2.3. La zone sud, le chemin 2010 et ses structures bordières.
91 2.5.2.4. Le fossé 2006
95 2.5.3. L’accès principal de l’enclos95 2.5.3.1. L’accès 2011.
95 2.5.3.2. La porte 2002-2003.
97 2.5.3.3. Quelques observations sur la susceptibilité magnétique (par G. Hulin).
97 2.5.4. Les structures à l’intérieur de l’enclos97 2.5.4.1. Le bâtiment A
98 2.5.4.2. Le bâtiment B
98 2.5.4.3. La fondation 2012 (le soubassement d’une pile ou d’un autel ?)
101 2.5.4.4. Le puits 2016
103 2.5.4.5. La fosse 2017
103 2.5.4.6. Quelques fosses regroupées au sud-est de l’enclos
109 2.5.5. Les structures à l’extérieur de l’enclos110 2.5.5.1. La structure excavée 1016
110 2.5.5.2. La structure excavée 1017
110 2.5.5.3. Le puits 1011
114 2.5.5.4. Le puits 1009 et la structure excavée 1029
117 2.6. Phase 3. L’antiquité tardive
120 3. Les céramiques antiques (S. Dubois)
142 4. Étude des monnaies (J.-M. Doyen)
142 4.1. Les monnaies gauloises142 4.1.1. La phase ancienne144 4.1.2. La phase récente144 4.1.3. Conclusions sur les monnaies gauloises
144 4.2. Les monnaies romaines : le Haut-Empire (27 av.–260 ap. J.-C.)144 4.2.1. Les Julio-claudiens (27 av. – 68 ap. J.-C.)145 4.2.1.1. Les semisses provinciaux
146 4.2.1.2. Une contremarque militaire
146 4.2.1.3. Un pseudo-as tibéro-claudien
146 4.2.2. Les Flaviens (69-96 ap. J.-C.)148 4.2.3. Les Antonins (138-192)148 4.2.4. Les Antonins (138-192). La période 192-260149 4.2.5. Les usures149 4.2.6. Le choix des types150 4.2.7. Les falsae150 4.2.8. Les monnaies romaines : l’Antiquité tardive (260-402)151 4.2.8.1. Les périodes I-II (260-294)
154 4.2.8.2. La période III (294-318)
155 4.2.8.3. La période IV (318-330)
155 4.2.8.4. La période V (330-341)
157 4.2.8.5. La période VI (341-348)
158 4.2.8.6. La période VII (348-364)
160 4.2.8.7. Les périodes VIII et IX (364-388)
162 4.3. Conclusions
195 5. Le matériel métallique (A. Morel)
196 5. 1. Présentation du corpus
I. Données administratives, techniques et scientifiques Sommaire 3
4 Inrap · Rapport de fouille Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt
196 5.2. Analyse des objets
215 5.3 Synthèse
216 6. Des objets du quotidien en contexte cultuel : les éléments ligneux des puits (B. Lecomte-Schmitt)
216 6.1 L’analyse taxonomique216 6.1.1. Principes et méthode218 6.1.2. Résultats de l’analyse taxonomique
218 6.2 Le puits 1009218 6.2.1. La tablette à écrire219 6.2.2. La vannerie220 6.2.3. Les branchages et éclats
221 6.3 Le puits 1010221 6.3.1 Eléments de chêne
221 6.4 Le puits 2016221 6.4.1. Les bardeaux228 6.4.2. Les éléments structurels228 6.4.3. Les éléments de seau228 6.4.3.1. Les fonds
229 6.4.3.2. Les douelles
237 6.4.3.3. Les cerclages
238 6.4.3.4. Conclusion sur les seaux
239 6.4.3.5. Les branchages
239 6.5 Conclusion
242 7. Un « étui à aiguille » en matière dure animale (A. Thuet avec la contribution d’A. Morel)
242 7.1. Le contenant 242 7.2. Le contenu
244 8. Les ossements animaux (S. Lepetz)
250 9. Etude de susceptibilité magnétique (G. Hulin)
251 10. Etude carpologique (M. Derreumaux)
251 10.1 Etude du puits 2016251 10.1.1 traitement du matériel251 10.1.2. Résultats251 10.1.3. Interprétation251 10.1.3.1. Représentativité de l’assemblage carpologique
253 10.1.3.2. l’environnement végétal du puits
254 10.1.4. Conclusion
254 10.2 Etude carpologique des puits254 10.2.1. Traitement du matériel255 10.2.2. Résultats255 10.2.3. Interprétation
I. Données administratives, techniques et scientifiques Sommaire 5
255 10.2.3.1. identification des assemblages
256 10.2.2. La végétation du site 256 10.2.2.1. Le puits 1009, début IIe siècle ap. J.-C.
256 10.2.2.2 Le puits 1010, début IIe apr. J.-C.
256 10.2.2.3. Le puits 1016, IIe siècle apr. J.-C.
256 10.2.2.4. Le puits 2016, IIIe siècle apr. J.-C.
257 10.2.3 Conclusion259 10.2.4 Annexes
261 11. Etude micromorphologique de la zone externe du fossé (C. Coussot)
261 11.1 Contexte topographique et géomorphologique du site
261 11.2 Objectif de l’étude micromorphologique
261 11.3 Méthodologie
262 11.4 Séquences stratigraphiques
262 11.5 Observations micromorphologiques
264 11.6 Interprétations et conclusion
265 Conclusion et mise en perspective (G. Prilaux)
275 Annexes
280 Bibliographie
286 Liste des illustrations
292 Inventaire du mobilier
332 Inventaire des structures
335 Inventaire des photographies
70 Inrap · Rapport de fouille Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt
2.4. Les monnaies gauloises (extrait de l’étude de Jean-Marc Doyen; fig.11)
Nous avons relevé 9 monnaies gauloises au sein de l’ensemble. Un ratio élevé potins/bronzes frappés est en général un bon critère de datation haute en Gaule Belgique (Doyen, Hanotte et Michel 2011). A Moyencourt, ce rapport s’établit à 2/11 soit 18,18 %, une valeur assez moyenne. Notons cependant que l’échantillon est fort réduit, et les deux potins présents ne figurent pas parmi les émissions considérées comme les plus anciennes.
2.4.1. La phase ancienne
La phase « précoce » du site est attestée par deux monnaies coulées, auxquelles s’ajoute un bronze frappé.
Le bronze bellovaque « au lion » (n° 2), appartient à une émission qui débute apparemment vers 75/70 av. J.-C. Cette datation est fournie par une découverte dans un contexte LT D2a effectuée à Acy-Romance (Ardennes). Il s’agit d’une incinération (ARNM 92 Enclos A, incinération I.13), datée de 70/50 av. J.-C., qui nous donne un terminus ante quem de la frappe (Lambot, 2002, p. 133).
Le potin « aux chevrons » (n° 3), parfois dit « à la cigarette », appartient à un ensemble assez diffus qui a fait l’objet d’un certain nombre d’études récentes, les unes typologiques (Bodson 2009), les autres contextuelles (Doyen, Hanotte & Michel, 2011). Ce type rare, précédemment mal daté, a fait l’objet d’une synthèse récente (Doyen & Michel 2009) à propos d’une trouvaille effectuée en contexte à Sandouville (Seine-Maritime).Le type « aux chevrons » est connu dans l’Oise, en Seine-Maritime, dans le sud de la Somme et l’ouest de l’Aisne. La date très tardive généralement proposée dans la littérature ne repose sur aucun argument scientifique. A. Bodson (2009, p. 55-56), relève le manque de critères chronologiques fiables. Il faut toutefois noter le contexte apparemment tardif de l’exemplaire de Saint-Clair-sur-les-Monts (Seine-Maritime) (Villes 1985, p. 77). La pièce provient d’une couche d’occupation située à l’intérieur d’un bâtiment dont le foyer a été daté par 14C de l’époque impériale, mais il existe, au même endroit, des traces d’un habitat LT D succédant lui-même à des sépultures LT C2/D1. Une utilisation tardive ne peut être exclue mais des mélanges de niveaux sont infiniment plus vraisemblables. Un type proche apparaît, lui aussi, à une date « récente » dans un enclos quadrangulaire à Touffréville (Calvados). Il provient d’un niveau situé vers la fin du premier tiers du Ier s. avant notre ère (Guilhard 2008, p. 17).Quoi qu’il en soit, la datation tardive est globalement infirmée par le contexte de Sandouville (LT D1b ?), outre le fait que cette monnaie y est apparemment déjà usée, particulièrement à l’avers. Une émission à placer au plus tard vers 90/80 avant notre ère semble dès lors probable. D’autres contextes anciens peuvent être relevés, par exemple sur le sanctuaire de Bennecourt (Yvelines), en relations avec des couches datées de la fin du IIe et du début du Ier s. avant J.-C (Bourgeois 1999, p. 34-35). Une date haute est également proposée pour un exemplaire issu des fouilles de Bibracte (Gruel & Popovitch 2007, p. 222, n° 116.1), même si l’indication « LT C1-D1 » doit sans doute être une coquille pour LT C2-D1.Le potin « au rameau » type B. Depuis les travaux de M. Thirion, les potins dits « au rameau » ont été répartis en deux classes, numérotées III et IV par S. Scheers dans son Traité de Numismatique celtique (Thirion 1974, p. 11-12 ; Scheers 1983, p. 736). Le type B de Thirion, classe III de Scheers, fut lui-même subdivisé, dans un premier temps, en deux variétés, l’une (var. a) assez abondante et d’un style très fin, l’autre (var. b) plus rustique et apparemment plus rare. Par la suite, S. Scheers leur a consacré une étude
71II. Résultats
1.
AMBIENS : bronze « aux hippocampes adossés ».Tête à g., peu distincte. A g., deux grosses volutes formant une accolade.Deux hippocampes adossés. Au-des-sus, deux volutes accolées. De part et d’autre, une volute en forme de crosse.Ae : 2,13 g ; 12 ; 16,1 mm ; usure 2-3. Pièce légèrement scyphate (revers du côté concave).SCHEERS 122 et pl. XVIII, n° 476-477 ; DT série 52, classe I, var. 2, n° 477.Objet 23 diag. HS.
2.
BELLOVAQUES : bronze « au lion », vers 75-70 avant J.-C.Tête barbue à dr., la chevelure formée de 5 mèches. Devant le visage : des globules et ornement divers ressemblant à des mèches de cheveux.Lion à g., la crinière hirsute, la queue relevée, en forme de S ;Ae : 2,96 g ; ¾ ; 18,8 mm ; usure 1-2.SCHEERS 120 ; classe I, et pl. XVII, n° 471 ; DT série 39, n° 231. Daté d’après un ex. d’Acy-Romance.Objet 72.
3.
SEINE-MARITIME et OISE : potin « aux chevrons » : fin IIème – début Ier s. avant J.-C.Profil « luniforme » à dr., les cheveux raides, formant 6 mèches. Devant le nez, un zigzag redoublant le profil.Barre horizontale. Au-dessus, un sanglier à dr. Au-dessous : 3 chevrons ouverts à dr.Potin : 2,67 g ; 9h30 ; 17,1 mm ; usure 3-4 ; 2 attaques (12h/5h30).SCHEERS 205 et pl. XXV, n° 709 ; DT, série 60, classe I, n° 532 ; BODSON, Mélanges Scheers, classe IIIa, p. 60.Objet 91.
4.
OISE ( ?) : potin « au rameau », type B.« Rameau » constitué d’une tige verticale peu distincte.Cheval à g., symboles indistincts, dans un cercle d’annelets.Potin : 4,11 g ; - ; 21,5 mm ; 1 seule attaque ; usure ? Forte corrosion.SCHEERS 190, classe III var. B et pl. XXIV, n° 681 ; DT série 35, classe IV, cf. 218. L’exemplaire n’a pas la finesse de la classe IIIa, ni sa masse élevée. Le décalage des faces évoque plutôt la fabrication négligée du SCHEERS 190, cl. IV, attribuée aux Nerviens.Objet 34 Z2.
5.
SUESSIONS : bronze à la tête janiforme.[Tête janiforme, stylisée]Lion « raide » à g., la queue passant entre les pattes. Symboles indistincts.Ae (alliage blanc): 2,34 g ; - ; 15,8 mm ; usure 8-9. Frappé sur flan coulé (2 attaques) à bords biseautés, avers du côté étroit.SCHEERS 154, classe II, et pl. XIX, n° 545-547 ; DT série 65, n° 563.Objet 117. Accès fossé N.
6.
SUESSIONS : bronze à la légende CRICIRV, vers 50-40 avant J.-C.Dans un cercle de grènetis, tête imberbe casquée à g.Dans un cercle de grènetis, un cheval ailé sautant à g. Au-dessous : CRICIRV.Ae : 2,67 g ; 10 ; 16,4 mm ; usure 8-9. Frappé sur flan coulé (1 attaque à 1 h), avers du côté bombé.SCHEERS 27 et pl. VII, n° 191 ; DT série 63, n° 554.Objet 364.
7.
SUESSIONS : bronze à la légende CRICIRV, vers 50/40 avant J.-C.Tête imberbe ( ?), casquée à dr.]CIRVCheval ailé sautant à g. Sous le ventre : un globule.Ae : 2,55 g ; 5 ; 15,9 mm ; usure 9. Frappé sur flan coulé concave (2 attaques : 3h/9h). Avers du côté convexe.SCHEERS 27 ; DT série 63, classe III, n° 555 var. (annelet centré : ici, un globule).Objet 179.
8.
SUESSIONS : bronze à la légende CRICIRV, vers 50/40 avant J.-C.Tête casquée à g. L’oreille est visible.Légende illisible.Cheval ailé sautant à g. Symboles indistincts.Ae : 3,20 g ; 12 ; 15,9 mm ; usure 9-10. Forte corrosion. Frappé sur flan coulé (2 attaques : 2h/8h).SCHEERS 27 ; DT, série 63, cl. III, n° 554-555.Objet 345.
9.
RÈMES, bronze à la légende REMO/REMO, vers 57-35/30 avant J.-C.Légende illisible.Trois bustes drapés, accolés à g.Légende illisible.Victoire tenant un fouet et les rênes, dans un bige à g.Ae : 2,44 g ; 9 ; 14,3 mm ; usure 8 ; 2 attaques (6h/12h).SCHEERS 146 et pl. XVIII, n° 519-520 ; DT 593 ; DOYEN, 2010, p. 81, classe A1.Objet 386.
Fig.11 Les monnaies gauloises de la phase 1 (cliché © JM. Doyen)
2. L’occupation archéologique
72 Inrap · Rapport de fouille Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt
plus spécifique, dans laquelle elle intègre une classe intermédiaire, proche de la var. a, mais dans laquelle un certain nombre d’éléments adventices ont disparu (Scheers 1984).Si la classe IV (« Rameau A » classique) est clairement originaire de l’Entre-Sambre-et-Meuse, quel qu’en soit le peuple qui l’occupe (Nerviens ou Atuatuques), la classe III prise globalement connaît une distribution géographique assez différente, dont l’Entre-Sambre-et-Meuse est actuellement exclue (Scheers 1977, p. 739, fig. 205). « La carte des trouvailles montre que la dispersion de ces monnaies a été large et qu’aucun centre d’éparpillement ne se présente. Les provenances se situent dans une bande qui s’étale entre l’Escaut et la Meuse sans atteindre le cours de la Seine. La dispersion des potins au rameau B ne couvre de ce fait absolument pas le territoire de circulation des potins au rameau A, mais elle le longe du côté occidental » (Scheers 1984, p. 100). Une attribution aux Nervii est donc exclue. C’est du reste l’hypothèse suivie par DT série 35, n° 218, dont la série la plus élaborée (var. a de Scheers) constitue la classe IV. Les auteurs du Nouvel Atlas l’attribuent à ce qu’ils nomment le « Centre » (Aisne et le cours supérieur de l’Oise), et le datent de la fin du IIe ou du début du Ier s. av. J.-C. Une étude typologique et chronologique détaillée manque encore. L’exemplaire de Moyencourt est stylistiquement moins élaboré encore que la variante (c) de Scheers, elle-même totalement inconnue du Nouvel Atlas de Delestrée et Tache. Elle se rapproche plus encore de la classe IV (rameau A), à la fois typologiquement et techniquement, et l’on peut supposer que ces deux émissions sont globalement contemporaines. Le « rameau A » de la classe IV apparaît par exemple à Saint-Thomas « Vieux Laon » (Aisne), dans un contexte très clairement pré-césarien. Quoi qu’il en soit, le contexte général de Moyencourt n’est pas en faveur d’une date très haute, et l’on pourrait retenir comme hypothèse de travail le début du LT D2a.
2.4.2. La phase récente
La présence de trois bronzes suessions de CRICIRV (n° 6-8), auxquels s’ajoute le type « à la tête janiforme » (n° 5), est assez étonnante, Moyencourt se trouvant sur le territoire des Veromandui (Woimant, 1995, p. 92). La vallée de l’Oise matérialise approximativement le changement de zone monétaire entre les Bellovaques, voisins méridionaux des Veromandui, et les Suessions (Delestrée 1996, p. 129).La série trimétallique de CRICIRV et celle, typologiquement proche, « à la tête janiforme », sont traditionnellement attribuées à l’oppidum de Pommiers (Aisne) (Delestrée 1996, p. 129). Cette origine est acceptée par P. Pion, qui se fonde sur les 1 030 exemplaires récoltés sur ce site (Pion, 1996, p. 334). La présence d’un exemplaire de CRICIRV à Alésia montre que le type est antérieur à 52 av. J.-C. (Pion 2009). Pour P. Pion, la frappe se situe essentiellement au cours de son étape 6, dans les années 40/30 av. J.-C. (Pion 1996, p. 334). Les séries d’or et d’argent seraient contemporaines des bronzes, et donc largement postérieures à la Guerre des Gaules.
En définitive, deux groupes de monnaies gauloises peuvent être distingués quant à leur date d’émission. Le plus ancien se situe à LT D1b/D2a, le plus récent est de peu postérieur à la Conquête et occupe donc le début de LT D2b. Toutefois, le nombre réduit d’exemplaires récoltés et le fait qu’ils soient tous dépourvus de contexte, n’exclut pas leur circulation simultanée dans les années 60/50 – 40 av. J.-C. (chronologie basse), sans pour autant écarter une datation globale plus haute, entre 90/80 et 60/50.
142 Inrap · Rapport de fouille Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt
Les fouilles de Moyencourt ont livré 268 monnaies qui se répartissent en 9 gauloises, 252 romaines et 7 modernes.Nous aborderons ce matériel de manière globale, considérant que la circulation monétaire sur le site est reflétée par l’addition des unités stratigraphiques, même si ces dernières peuvent évoluer de manière différente au sein d’un même horizon chronologique, en fonction du type de structure ou d’activité (rejets, dépôts, favissae avec sélection). Le type de constitution du principal horizon du site, résultant d’une accumulation s’étalant sur une très longue période durant laquelle les artefacts ont été largement dispersés et mélangés par le piétinement, ne nécessite pas de découpage élaboré, par unité stratigraphique, du moins dans la plupart des cas. Nous distinguerons, entre le moment de la création du site et la fin du IIIe s., quatre phases d’activité faisant appel à la monnaie (LT D2, Julio-claudiens, Trajan-Hadrien, Antonins). Pour rappel, l’usage du numéraire n’est pas un traceur absolu de l’activité humaine : si l’abondance de monnaies est le signe évident d’un certain dynamisme, son absence ne peut en aucun cas servir d’argument pour avancer l’hypothèse de l’abandon d’un site (sauf, éventuellement, lors de l’Antiquité Tardive, où le rôle et l’usage de la monnaie se sont considérablement modifiés). Tout au plus pouvons-nous mettre en évidence des périodes pendant lesquelles l’utilisation de la monnaie se fait moins pressante. Seule la convergence entre les données de la numismatique et celles de la céramologie peut induire de manière formelle des périodes de véritable restriction de l’activité, voire d’abandon.
4.1. Les monnaies gauloises
Nous avons relevé 9 monnaies gauloises au sein de l’ensemble. Le n° 11, autrefois classé parmi celles-ci, est en réalité une production augustéenne émise à Reims en vue d’alimenter la province romaine de Gallia Belgica. Elle sera donc traitée avec les monnaies impériales.Un ratio élevé potins/bronzes frappés est en général un bon critère de datation haute en Gaule Belgique (Doyen, Hanotte et Michel 2011). A Moyencourt, ce rapport s’établit à 2/11 soit 18,18 %, une valeur assez moyenne. Notons cependant que l’échantillon est fort réduit, et les deux potins présents ne figurent pas parmi les émissions considérées comme les plus anciennes.
4.1.1. La phase ancienne
La phase « précoce » du site est attestée par deux monnaies coulées, auxquelles s’ajoute un bronze frappé.
a) Le bronze bellovaque « au lion »Le bronze bellovaque « au lion » (n° 2), appartient à une émission qui débute apparemment vers 75/70 av. J.-C. Cette datation est fournie par une découverte dans un contexte LT D2a effectuée à Acy-Romance (Ardennes). Il s’agit d’une incinération (ARNM 92 Enclos A, incinération I.13), datée
4. Étude des monnaies (Jean-Marc Doyen)
143II. Résultats
de 70/50 av. J.-C., qui nous donne un terminus ante quem de la frappe (Lambot, 2002, p. 133).
b) Le potin « aux chevrons »Le potin « aux chevrons » (n° 3), parfois dit « à la cigarette », appartient à un ensemble assez diffus qui a fait l’objet d’un certain nombre d’études récentes, les unes typologiques (Bodson 2009), les autres contextuelles (Doyen, Hanotte & Michel, 2011). Ce type rare, précédemment mal daté, a fait l’objet d’une synthèse récente (Doyen & Michel 2009) à propos d’une trouvaille effectuée en contexte à Sandouville (Seine-Maritime).Le type « aux chevrons » est connu dans l’Oise, en Seine-Maritime, dans le sud de la Somme et l’ouest de l’Aisne. La date très tardive généralement proposée dans la littérature ne repose sur aucun argument scientifique. A. Bodson (2009, p. 55-56), relève le manque de critères chronologiques fiables. Il faut toutefois noter le contexte apparemment tardif de l’exemplaire de Saint-Clair-sur-les-Monts (Seine-Maritime) (Villes 1985, p. 77). La pièce provient d’une couche d’occupation située à l’intérieur d’un bâtiment dont le foyer a été daté par 14C de l’époque impériale, mais il existe, au même endroit, des traces d’un habitat LT D succédant lui-même à des sépultures LT C2/D1. Une utilisation tardive ne peut être exclue mais des mélanges de niveaux sont infiniment plus vraisemblables. Un type proche apparaît, lui aussi, à une date « récente » dans un enclos quadrangulaire à Touffréville (Calvados). Il provient d’un niveau situé vers la fin du premier tiers du Ier s. avant notre ère (Guilhard 2008, p. 17).Quoi qu’il en soit, la datation tardive est globalement infirmée par le contexte de Sandouville (LT D1b ?), outre le fait que cette monnaie y est apparemment déjà usée, particulièrement à l’avers. Une émission à placer au plus tard vers 90/80 avant notre ère semble dès lors probable. D’autres contextes anciens peuvent être relevés, par exemple sur le sanctuaire de Bennecourt (Yvelines), en relations avec des couches datées de la fin du IIe et du début du Ier s. avant J.-C (Bourgeois 1999, p. 34-35). Une date haute est également proposée pour un exemplaire issu des fouilles de Bibracte (Gruel & Popovitch 2007, p. 222, n° 116.1), même si l’indication « LT C1-D1 » doit sans doute être une coquille pour LT C2-D1.
c) Le potin « au rameau » type BDepuis les travaux de M. Thirion, les potins dits « au rameau » ont été répartis en deux classes, numérotées III et IV par S. Scheers dans son Traité de Numismatique celtique (Thirion 1974, p.11-12 ; Scheers 1983, p.736). Le type B de Thirion, classe III de Scheers, fut lui-même subdivisé, dans un premier temps, en deux variétés, l’une (var. a) assez abondante et d’un style très fin, l’autre (var. b) plus rustique et apparemment plus rare. Par la suite, S. Scheers leur a consacré une étude plus spécifique, dans laquelle elle intègre une classe intermédiaire, proche de la var. a, mais dans laquelle un certain nombre d’éléments adventices ont disparu (Scheers 1984).Si la classe IV (« Rameau A » classique) est clairement originaire de l’Entre-Sambre-et-Meuse, quel qu’en soit le peuple qui l’occupe (Nerviens ou Atuatuques), la classe III prise globalement connaît une distribution géographique assez différente, dont l’Entre-Sambre-et-Meuse est actuellement exclue (Scheers 1977, p.739, fig.205). « La carte des trouvailles montre que la dispersion de ces monnaies a été large et qu’aucun centre d’éparpillement ne se présente. Les provenances se situent dans une bande qui s’étale entre l’Escaut et la Meuse sans atteindre le cours de la Seine. La dispersion des potins au rameau B ne couvre de ce fait absolument pas le territoire de circulation des potins au rameau A, mais elle le longe du côté occidental » (Scheers 1984, p. 100). Une attribution aux Nervii est donc exclue. C’est du reste l’hypothèse suivie par DT série 35, n°218, dont la série la plus élaborée (var. a de Scheers) constitue la classe IV. Les auteurs du Nouvel Atlas l’attribuent à ce qu’ils nomment le « Centre » (Aisne et le cours supérieur de l’Oise), et le datent de la fin du IIe ou du début du Ier s. av. J.-C.
4. Etude des monnaies (Jean-Marc Doyen)
144 Inrap · Rapport de fouille Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt
Une étude typologique et chronologique détaillée manque encore. L’exemplaire de Moyencourt est stylistiquement moins élaboré encore que la variante (c) de Scheers, elle-même totalement inconnue du Nouvel Atlas de Delestrée et Tache. Elle se rapproche plus encore de la classe IV (rameau A), à la fois typologiquement et techniquement, et l’on peut supposer que ces deux émissions sont grosso modo contemporaines. Le « rameau A » de la classe IV apparaît par exemple à Saint-Thomas « Vieux Laon » (Aisne), dans un contexte très clairement pré-césarien. Quoi qu’il en soit, le contexte général de Moyencourt n’est pas en faveur d’une date très haute, et l’on pourrait retenir comme hypothèse de travail le début du LT D2a.
4.1.2. La phase récente
La présence de trois bronzes suessions de CRICIRV (n° 6-8), auxquels s’ajoute le type « à la tête janiforme » (n° 5), est assez étonnante, Moyencourt se trouvant sur le territoire des Veromandui (Woimant, 1995, p. 92). La vallée de l’Oise matérialise approximativement le changement de zone monétaire entre les Bellovaques, voisins méridionaux des Veromandui, et les Suessions (Delestrée 1996, p. 129).La série trimétallique de CRICIRV et celle, typologiquement proche, « à la tête janiforme », sont traditionnellement attribuées à l’oppidum de Pommiers (Aisne) (Delestrée 1996, p. 129). Cette origine est acceptée par P. Pion, qui se fonde sur les 1030 exemplaires récoltés sur ce site (Pion, 1996, p. 334). La présence d’un exemplaire de CRICIRV à Alésia montre que le type est antérieur à 52 av. J.-C. (Pion 2009). Pour P. Pion, la frappe se situe essentiellement au cours de son étape 6, dans les années 40/30 av. J.-C. (Pion 1996, p. 334). Les séries d’or et d’argent seraient contemporaines des bronzes, et donc largement postérieures à la Guerre des Gaules.
4.1.3. Conclusions sur les monnaies gauloises
Apparemment, deux groupes de monnaies gauloises peuvent être distingués quant à leur date d’émission. Le plus ancien se situe au LT D1b/D2a, le plus récent est de peu postérieur à la Conquête et occupe donc le début du LT D2b. Toutefois, le nombre réduit d’exemplaires récoltés et le fait qu’ils soient tous dépourvus de contexte, n’exclut pas leur circulation simultanée dans les années 60/50 – 40 av. J.-C. (chronologie basse), sans pour autant écarter une datation globale plus haute, entre 90/80 et 60/50.
4.2. Les monnaies romaines : le Haut-Empire (27 av.–260 ap. J.-C.)
4.2.1. Les Julio-claudiens (27 av. – 68 ap. J.-C.)
La dynastie julio-claudienne est attestée par 16 monnaies. Auguste s’y taille une large part, avec pas moins de 11 exemplaires.La série débute par un dupondius coupé en deux, émis à Vienne vers 36 av. notre ère, et portant les effigies d’Octave et de César (n° 10). La moitié qui nous est parvenue porte le portrait de César ; son état d’usure extrême (indice 10)7 indique une date de perte tardive, sans doute dans le courant de la première moitié du Ier s. ap. J.-C., époque à laquelle ces dupondii fractionnés circulent au titre de l’as.La caractéristique majeure de la circulation à Moyencourt, sous les julio-claudiens, est liée à la répartition des dénominations.
7. Pour la gradation des degrés d’usure (0 = monnaie neuve, 10 = monnaie totalement lisse), voir Doyen 2007, p. 26-28.
145II. Résultats
Dénominations Nbre %
Dupondius 1 6,25
½ dupondius 1
62,50
As 9
Semis 5
31,25
Pseudo-as 1
Ce ratio, à savoir un fort pourcentage de divisionnaires de l’as, est typique des sites cultuels où la petite monnaie vaut souvent de 30 à 40 % (Doyen 2010, p. 112 et 118), voire même jusqu’à 60 % dans des cas très particuliers, comme à Bourbonne-les-Bains (Doyen 2007, p. 110, tableau 36). Dans les habitats, les semisses (et sa moitié, nettement plus rare, le quadrans) occupent sous Auguste une part extrêmement variable, allant de 0 à plus de 30 % en milieu urbain. Sous Tibère, ces divisionnaires atteignent en moyenne 13,79 %, sous Caligula : 4,94 % ; sous Claude : 23,14 % et sous Néron 14,28 % (fig.57). A Moyencourt, les semisses occupent 36,36 % des monnaies d’Auguste (4/11). Cette valeur forte est comparable aux 35,39 % observés sur le temple de Ville-sur-Lumes (Ardennes (Doyen 2010, p. 111-112 et tableau 28), aux 27,58 % du gué de Condé-sur-Aisne (Aisne)8, aux 23,94 % de la forêt de Halatte (Mangard 2008)9, aux 58,87 % du temple d’Empel, aux Pays-Bas (Doyen 2007, p. 107-1208, tableau 34). Notons toutefois que plusieurs sanctuaires livrent peu de semisses : 16,67 % à Authevernes (Eure), 13,36 % à Bennecourt (Yvelines) (Bourgois 1999, p. 77). Les données précises relatives aux sites ruraux entre la Seine et la cité des Nerviens manquent encore. Les sites proches de Cizancourt et Saint-Christ-Briost n’ont livré qu’un nombre limité de monnaies des Ier et IIe s. On peut cependant estimer que la population fréquentant le sanctuaire de Moyencourt entre le début de notre ère et le milieu du Ier s. utilisait, comme (presque) partout ailleurs10, les plus petites dénominations – semisses et asses alors que le dupondius y atteint une moyenne parfaitement dans les normes. Nous observons en effet, en Gaule intérieure, 2,41 % de dupondii sous Tibère, 7,60 % sous Caligula, 11,73 % sous Claude et 9,43 % sous Néron (Doyen 2007, tableaux 47 et 55c).Nous relèverons dans notre ensemble, quelques monnaies remarquables, ou dont la présence demande quelques explications.
4.2.1.1. Les semisses provinciaux
Nous noterons par exemple la présence de deux semisses émis à Reims. Le premier porte le nom et l’effigie d’un dynaste local du nom d’Indutillus (Germanus Indvtilli L.), émettant entre 19 et 12 av. J.-C. du numéraire destiné à la nouvelle province de Belgique (n° 11).Le second, plus rare, a été frappé au nom d’Auguste, sans doute par Drusus entre 12 et 8/5 av. J.-C. Ces semisses disparaissent de la circulation vers 10 de notre ère, moment où ils sont remplacés par leur équivalent produit à Lyon entre 9 et 14 ap. J.-C. (Doyen 2007, p. 85). A Moyencourt, nous relevons deux exemplaires de ce type, au nom de Tibère (n° 18 et 20).
8. On considère souvent que les jets de monnaies dans les gués et les fontaines étaient effectués essentiellement « pro salute augusti ». On peut donc les rapprocher des dépôts des temples plus que des « pertes » liées aux habitats.
9. Pourcentage recalculé à partir du catalogue, car les données du tab.1 p. 253, sont erronées.
10. On notera, chez les Rèmes, un certain nombre de sanctuaires (Ville-sur-Lumes, Baâlons-Bouvellemont) sur lesquels le denier d’argent occupe une place non négligeable, tout comme à Eu, dans le pagus Catuslugi (Mangard 2008). Plutôt que de parler d’une richesse particulière des habitants, nous serions tentés d’y voir une marque de dévotion particulière.
Fig.57 Répartition, par dénomination, du numéraire d’époque julio-claudienne (27 av. – 68 ap. J.C.).
4. Etude des monnaies (Jean-Marc Doyen)
146 Inrap · Rapport de fouille Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt
4.2.1.2. Une contremarque militaire
Nous relevons également un as d’un monétaire portant une contremarque militaire constituée des lettres ligatures CAESAR. Elle est développée en (Germanicus) Caesar(is) et datée des années 14-16 ap. J.-C., c’est-à-dire au tout début du règne de Tibère (Martini 2003, p. 89-90, n° 43, qui l’attribue à Caligula ; Werz 2004, p. 55, n° 50-52 ; Werz 2009, type 61.37 et ss, p. 229-308). Cette contremarque est essentiellement apposée sur des asses des monétaires d’Auguste et proviendrait de Germanie Inférieure, peut-être de Novaesium (Martini 2003, p. 90). On peut la traduire par « un cadeau de Germanicus Iulius Caesar » (Werz 2004, p. 56). Ces monnaies, fréquentes dans les camps du limes, se rencontrent de manière moins fréquente à l’intérieur de la Gaule.
4.2.1.3. Un pseudo-as tibéro-claudien
Une dernière monnaie particulière de la période julio-claudienne est un bronze (n° 21) imitant un as d’Auguste divus dont le prototype a été émis à Rome entre 22/3 et 30. Elle appartient à un vaste ensemble de monnaies de cuivre que nous avons dénommées « pseudo-asses » à partir des découvertes de Reims (Doyen 2007, p. 120-124). Le statut de ce monnayage de nécessité n’est pas encore clairement établi. Un certain nombre d’ateliers locaux a fourni un numéraire abondant qui se distribue en général dans la moitié septentrionale de la Gaule, dans les Germanies et en Bretagne. L’essentiel de l’activité de ces officines se situe sous le règne de Claude (41-54), même si les prototypes copiés sont souvent plus anciens. L’important taux d’hybridation montre que tous les types émis depuis 12 ou 7 av. J.-C. ont été reproduits.La masse de ces pièces de cuivre, tarifées comme des semisses même si les images qu’elles portent sont celles des asses, est fort standardisée (Doyen 2007, p. 121-122 ; Doyen 2009, p. 119, tabl. 31). L’exemplaire de Moyencourt, assez pesant (5,38 g), s’intègre parfaitement dans les données relevées par ailleurs (de 3,90 à 5,50 g).La chronologie est assez aisée à établir : le terminus post quem de la frappe se situe en 41/42. D’autre part, les nombreux cuivres copiant ceux de Néron émis après 64, ne sont en principe jamais liés à des revers antérieurs. La monnaie de Moyencourt est assez usée (indice 6-7), malgré la corrosion et la frappe médiocre caractérisant cette série. Nous pouvons estimer qu’elle a été perdue entre 45 et 60/65 au plus tard.
4.2.2. Les Flaviens (69-96 ap. J.-C.)
Le monnayage d’époque flavienne est attesté par six exemplaires, dont un dupondius au nom de Vespasien, un sesterce et quatre asses (dont un imité) au nom de son fils Domitien. L’état d’usure de ces monnaies (indice 6 : 1 ex., 7 : 2 ex. ; 9 : 1 ex. ; 10 : 2 ex.) montre qu’elles sont arrivées tardivement sur le site, au mieux à la fin du IIe s., mais peut-être même un siècle plus tard. Les Flaviens ne sont donc pas attestés en tant que période numismatiquement active.Nerva, Trajan et Hadrien (96-138)De nouveau, les comparaisons locales manquent, ou concernent des séries peu abondantes qui rendent difficile l’estimation du ratio entre les différentes dénominations dans la circulation courante sur les sites entourant le sanctuaire. Si nous examinons la situation sur d’autres temples situés principalement en Gallia Belgica et dans le nord-ouest de la Lugdunensis, nous relevons certaines constantes : présence des deniers d’argent, légère prédominance de l’as sur le sesterce. Si Bennecourt s’écarte des données, peut-être à cause du nombre limité d’exemplaires, Moyencourt s’inscrit parfaitement dans la norme, et la ressemblance avec les données de Genainville est flagrante. D’une manière générale, les dépôts concernent
147II. Résultats
de manière préférentielle des « petites coupures » ; la présence de quelques quadrantes, fort rares sur les sites d’habitat, en est la meilleure illustration.
Dénom. Ner./
Tra. Had. Tot % Ha % Eu % Be % Ge %
Denier - 1 1 5,26 1 5,00 2 10,00 - - 1 1,01
Sesterce 2 4 6 31,58 11 55,00 4 20,00 7 53,85 49 49,49
Dupondius 2 1* 3 15,79 2 10,00 4 20,00 4 30,77 15 15,15
As 5 3 8 42,11 6 30,00 10 50,00 1 7,69 30 30,30
Quadrans 1 - 1 5,26 - - - - 1 7,69 4 4,04
TOTAL 10 9 19 20 19 13 99
Dont un faux
Nous pouvons comparer nos données à celles disponibles pour les sites urbains de Gaule intérieure (pour la définition du concept, en opposition à la « zone des camps » et au « nord civil » : Doyen 2007, p. 21-23). Sous Trajan, le denier y atteint en moyenne 10,72 %, même si l’impact des monnaies fausses (subaerati) est considérable. Sous Hadrien ce taux tombe à 4,96 %. Les pèlerins de Moyencourt ne se distinguent pas particulièrement par leur prodigalité. Le sesterce évolue de 30,75 % (Trajan) et 43,76 % (Hadrien) ; le dupondius passe de 27,50 à 17,89 %, alors que l’as monte légèrement, de 28,49 à 32,48 % Les divisionnaires, qui valent encore 2,26 % sous Trajan, disparaissent quasi totalement, avec 0,45 %. Nous dirions donc que le gallo-romain fréquentant le sanctuaire donnait plus facilement un as qu’un dupondius ou un sesterce, mais nous ignorons si certains ne préféraient pas offrir deux monnaies plutôt qu’une seule en valant le double (fig.58).On notera la présence d’un as d’orichalque au nom de Trajan (n° 41), émis à Rome ( ?) en 116 pour la circulation en Orient. Ce numéraire y a circulé un certain temps, comme le montrent de nombreux exemplaires portant des contremarques typiquement orientales (un bucrane par exemple11). La présence relativement fréquente de ces monnaies en Gaule et en Bretagne est mise en rapport avec le retour des troupes en Occident après les guerres parthiques de Trajan12. La présence de deux exemplaires sur le site de Ville-sur-Lumes (Ardennes) nous a fourni l’occasion de dresser une liste des attestations en Gaule septentrionale (Doyen 2010, p. 125-129). D’une province à l’autre, et même d’une cité à l’autre, l’impact du monnayage oriental de Trajan est fort variable : 28 ex. chez les Tongres, 15 chez les Nerviens13, contre 5 chez les Ménapiens (Kruishoutem : 3 ; Oudenburg : 1 ; Wervicq : 1), 1 chez les Morins (Thérouanne) ; 1 chez les Atrébates (Duisans) et un dernier chez les Ambiens (Amiens). L’exemplaire de Moyencourt est le premier attesté chez les Viromanduens.La deuxième monnaie remarquable de la période est un denier d’Hadrien provenant apparemment d’un atelier d’Asie Mineure (n° 48). Le type n’est répertorié que pour Rome, et un examen des monnaies orientales d’Hadrien correctement localisées ne nous a pas permis de repérer des liaisons stylistiques. L’exemplaire de Moyencourt ne présente aucune trace d’usure.Un dernier exemplaire mérite une mention particulière. Il s’agit d’un faux dupondius d’Hadrien (n° 50), sur lequel nous reviendrons ci-dessous.
11. Cette contremarque orientale est attestée chez les Nerviens à Velzeke et à Vaulx-Vraucourt : VAN HEESCH, 1998, p. 121.et p. 126, note 700.
12. L’hypothèse est celle avancée par L. & J. ROBERT, La Carie, histoire et géographie historique avec le recueil des inscriptions antiques, vol. 2. Le plateau de Tabai et ses environs, Paris, 1954, p. 150-151.
13. Aux 14 ex. cités, il faut ajouter une pièce de Famars : Chronique Numismatique XXVIII, 2011 (à paraître).
Fig.58 Répartition par dénominations des monnaies de Nerva à Hadrien (96-138) Ha = Halatte ; Eu = Eu « Bois l’Abbé » ; Be = Bennecourt ; Ge = Genainville Répartition, par dénomination, du numéraire d’époque julio-claudienne (27 av. – 68 ap. J.C.).
4. Etude des monnaies (Jean-Marc Doyen)
148 Inrap · Rapport de fouille Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt
4.2.3. Les Antonins (138-192)
Dénom. Ant MA Co Tot % Ha % Eu % Be % Ge %
Denier - - - - - - - - - - - 2 1,94
Sesterce 5 - 2 7 43,75 22 56,41 4 23,53 4 66,67 68 66,02
Dupondius 2* 1 3 6 37,50 7 17,95 - - 1 16,67 14 13,59
As 2* - 1 3 18,75 10 25,64 13 76,47 1 16,67 19 18,45
TOTAL 9 1 6 16 39 17 6 103
* Dont 1 imitation
Par rapport à la période précédente, différentes ruptures se marquent au cours des règnes d’Antonin le Pieux (138-161), Marc-Aurèle (161-180) et Commode (180-192). D’une part, la sélection des dénominations choisies afin d’être déposées est nettement plus claire qu’auparavant. Nous relevons l’absence totale de l’argent, qui représente sur les sites 6,10 % sous Antonin, 2,91 % sous Marc-Aurèle, et 3,29 % sous Commode. En revanche, Moyencourt livre beaucoup trop peu d’asses (18,75 % contre respectivement 34,74, 23,62 et 30,26 % en moyenne). Ce manque est reporté sur les dupondii : 37,50 contre 14,24 %, 21,36 % et 18,42 % pour les trois règnes qui nous occupent. Nous avons récemment attiré l’attention sur une anomalie partiellement comparable à Ville-sur-Lumes, où le dupondius grimpe à plus de 40 % sous le règne de Marc-Aurèle (Doyen 2010, p. 134-235). On a dès lors l’impression que les dépôts en numéraire sont plus riches puisque le don « de base » vaut le double de celui observé au cours des quarante années précédentes (fig.59).D’autre part, l’absence quasi-totale du règne de Marc-Aurèle (161-180), attesté par un seul et unique bronze, est très curieuse et ne connaît aucun parallèle : on constate, aussi bien dans le « Nord civil » que dans le « Centre », un quasi équilibre entre le numéraire d’Antonin et celui de son successeur : respectivement 1311/1178, et 687/618 exemplaires répartis sur plusieurs dizaines de sites. En revanche, la représentation de Commode est anormalement élevée à Moyencourt ; il pourrait dans ce dernier cas, s’agir d’un indice chronologique, le numéraire de Commode ayant tendance à augmenter au cours du IIIe s., du fait du retrait progressif des sesterces antérieurs. Il est cependant clair qu’une rupture se marque dans les années 150, au niveau de l’usage de la monnaie : il est possible qu’aucune offrande monétaire n’ait été effectuée entre cette date et la fin du IIIe, voire le tout début du IVe s. Nous ne pouvons cependant exclure qu’une sélection drastique ait été effectuée à la fin du IIe et pendant l’essentiel du IIIe s., en choisissant comme offrande un numéraire très ancien. Toutefois, nous savons que la thésaurisation du bronze, au IIIe s., favorisait les monnaies les plus anciennes, plus lourdes et d’un aspect différent grâce à un taux de zinc plus important, au détriment du bronze sénatorial d’époque sévérienne. On s’attendrait donc à trouver plus de « mauvaise monnaie » dans les temples, comme c’est assez souvent le cas en milieu funéraire. C’est effectivement le cas à Moyencourt, comme nous le verrons plus loin, mais cet apport de numéraire frauduleux se concentre entre 80/90 et 150.
4.2.4. Les Antonins (138-192). La période 192-260
De 190/191 (n° 67) à 258/9 ap. J.-C. (n° 69), nous ne comptons qu’une seule monnaie (n° 68) dont la date de perte doit d’ailleurs être tempérée par l’état d’usure. Il s’agit d’un sesterce de Sévère Alexandre émis en 232, dont l’indice estimé à 6 reporte la perte au mieux dans les années 270. L’antoninien n° 69, à l’état neuf, peut avoir été abandonné peu après sa date de frappe, mais ce numéraire, immobilisé dans de multiples dépôt,
Fig.59 Répartition par dénominations des monnaies des Antonins (138-192). Ha = Halatte ; Eu = Eu « Bois l’Abbé » ; Be = Bennecourt ; Ge = Genainville
149II. Résultats
réapparaît parfois en excellent état dans des contextes tétrarchiques, par exemple à Vireux (Doyen & Lémant 1990, p. 29).
4.2.5. Les usures
La rupture chronologique mise en évidence ci-dessus se marque également dans la répartition des degrés d’usure14. Nous avons noté que sous les Flaviens, les usures s’étalaient de 6 à 10, avec une concentration entre 9 et 10.Sous Nerva et Trajan, nous relevons cinq pièces affichant les indices 2-3, 3-4, 4 et 5. Les trois dernières sont dans la catégorie 9-10.Sous Hadrien, deux pièces sont au niveau 0 et 3-4, une en 6-7 et pas moins de six en 9 et 10.Sous Antonin le Pieux, une seule monnaie est neuve (n° 54), et elle date de 145. Une pièce frappée en 140 est peu usée (n° 51 : indice 4). Le reste de son monnayage est très usé, comme la seule monnaie de Marc-Aurèle, et toutes celles de Commode. Au niveau des usures, nous pouvons mettre en évidence un arrivage continu de monnaies fraîches entre 98/99 et le milieu du siècle. La rupture se situe vers 145/150 : après cette date, nous ne recensons plus que des monnaies très usées, dont la période de circulation peut dépasser le siècle en ce qui concerne l’indice 9, et largement le dépasser dans le cas du 10.
4.2.6. Le choix des types
M.-L. Berdeaux-Le Brazidec et P. Durand ont mis en évidence, à propos des offrandes monétaires de Halatte, une surreprésentation du type Salus à l’époque antonine (4 asses et 1 dupondius), et les auteurs de souligner, à juste titre, « qu’une telle présence, due uniquement aux hasards de la circulation, avait peu de chance de se produire » (Collectif 2000, p. 259). Nous avons tenté une approche identique à partir du matériel de Moyencourt, mais les résultats sont décevants.Sous les Julio-claudiens, les types sont en nombre limité et les choix restreints. Nous constatons sous Néron l’utilisation de la Victoire à 7 occasions, mais comme il s’agit du type de loin le plus fréquent sur les asses de l’atelier de Lyon, il est difficile d’y voir un choix délibéré.Entre 68 et 260 de notre ère, trois types sont attestés par 3 exemplaires : Felicitas, Fortuna et Annona. Cérès et les instruments pontificaux interviennent à deux reprises. Tous les autres types sont attestés par une seule unité : Hercule/sanglier, scène de sacrifice, Pax, Rome, SC dans une couronne, Hilaritas, navire, Nilus, Hadrien et une Province (sacrifice ?), Providentia, Aeternitas, Pietas, Vénus, Jupiter, Minerve et Apollon. Salus est totalement absent, sauf sur quelques rares antoniniens tardifs où le type est banal.On peut dès lors estimer que si le choix de la dénomination est un acte délibéré, celui de l’image n’intervient pas au moment du dépôt.Après 260, les possibilités, d’abord multiples grâce aux antoniniens et imitations, se restreignent très rapidement. L’importance du type CONSECRATIO est plus un critère chronologique que le résultat d’une sélection. La prédominance de l’autel sur l’aigle (5/8) est une constante structurelle, due sans doute à la plus grande simplicité de la gravure. Un décompte portant sur plusieurs milliers d’exemplaires est éloquent (Doyen 2007, p. 293, tableau 155).
14. Cette problématique a été développée et argumentée dans Doyen 2010, p. 339.
4. Etude des monnaies (Jean-Marc Doyen)
150 Inrap · Rapport de fouille Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt
4.2.7. Les falsae
Les falsae du Haut-Empire sont au nombre de 5.
N° Type Dénom. Techn. Pds Usure
21 Auguste divus sous Tibère As Frappé 5,38 6-7
31 Domitien As Frappé 7,77 7
50 Hadrien Dupondius Frappé 11,87 3-4
59 Antonin Dupondius Frappé 4,37 ?
60 Faustine II sous Antonin ( ?) As Coulé [2,44] 9
Le pseudo-as n° 21 a été examiné plus haut. Il ne s’agit pas à proprement parler d’une monnaie frauduleuse, mais bien d’une émission de nécessité, tolérée voire organisée par des collectivités. Les quatre autres sont des faux purs et simples, destinés à tromper l’utilisateur et donc à enrichir le fabriquant.Hadrien nous apporte un faux dupondius de poids élevé (11,87 g), mais frappé dans du cuivre plutôt qu’en laiton (orichalque) comme c’est la règle pour cette dénomination. Le coin de revers de notre pièce, présentant une image particulière d’Aeternitas tenant les têtes de Sol et de Luna, est connu lié à un avers à titulature fantaisiste HADRIAN/O S AVGVSTO, sur une pièce appartenant au British Museum.Le règne d’Antonin le Pieux nous livre deux faux bronzes : le n° 59 est une copie frappée d’un dupondius réalisé en cuivre rouge, d’un poids très faible (4,37 g) valant à peine le tiers de la masse officielle. L’autre est un as coulé de Faustine II (n° 60), émis à la fin du règne, ou au début de celui de Marc-Aurèle. Cette pièce est légèrement ébréchée mais devait peser à l’origine environ 3 g, pour un poids théorique supérieur à 10 g.
Avec quatre faux notoires pour la période 68-192 ap. J.-C., Moyencourt atteint un taux de copies de 9,09 % (4/44). Cette valeur n’est pas réellement anormale. En Gaule intérieure, on relève par exemple 4,86 % de faux asses sous Antonin (16/329), et même 8,22 % (12/146) sous Marc-Aurèle (Doyen 2007, p. 182, tableau 79c). Notons seulement que les offrants ne cherchaient pas à se débarrasser systématiquement de leur numéraire problématique, mais qu’ils ne sélectionnaient pas non plus uniquement de la « bonne » monnaie (fig.60).
4.2.8. Les monnaies romaines : l’Antiquité tardive (260-402)
L’Antiquité tardive apporte à notre site un ensemble de 176 exemplaires identifiables. Les numismates qui traitent de cette longue période – que nous faisons artificiellement débuter en 260 pour des raisons essentiellement d’ordre statistique – ont depuis longtemps pris l’habitude de comparer les données à l’aide d’indices. Quelques éléments sont toutefois nécessaires pour comprendre la méthode d’approche. A côté des statistiques traditionnelles, nous faisons en effet systématiquement appel aux « indices de fréquence » (en réalité un « pourcentage pondéré »), une méthode classique mise au point par les Britanniques dès 1964 et essentiellement destinée à comparer le numéraire de manière synchronique dans une région donnée (Ravetz 1964)15. Les 142 années de production monétaire s’étalant de 260 (début du règne seul de Gallien, usurpation de Postume) à 402/403 (date d’émission des dernières monnaies de bronze parvenant en abondance en Gaule du Nord)
15. Les comparaisons diachroniques au sein d’un même site sont d’un usage plus délicat puisque généralement les monnaies des dix phases principales n’entretiennent entre-elles que des rapports métrologiques fort lointains.
Fig.60 Les imitations du Haut-Empire à Moyencourt.
151II. Résultats
ont été divisées en 10 périodes correspondant à autant de grandes phases d’émissions monétaires (Casey 1974 ; Reece 1979 ; Brulet 1990 ; Gricourt et alii, 2009)16 ; certaines sous-phases, notons-le, sont généralement regroupées. La numérotation, la longueur et le découpage chronologique actuellement utilisés sont repris dans les trois premières colonnes du tableau suivant (fig.61).L’indice de fréquence est obtenu à l’aide de la formule :(nombre de pièces par période x 1000) divisé par (nombre d’années de la période x nombre total de pièces du site).Nous avons décidé d’intégrer, dans le calcul des indices, les imitations correspondant à chaque phase chronologique, En effet, les travaux récents ont montré que, dans nos régions septentrionales du moins, les copies suivent de très près l’émission des espèces officielles dont elles s’inspirent, en respectant parfois même le ratio entre les différents types iconographiques légaux (Doyen 2010, p. 144).On trouvera, sous une forme synthétique, les données numériques propres à Moyencourt et aux deux sites de comparaison les plus proches, Cizancourt et Saint-Christ-Briost ; elles serviront de base statistique aux commentaires ultérieurs.
PÉRIODES DATES Nbre Années
MOY Ind. CIZ Ind SCB Ind.
I 260-275 15 15 5,68 2 2,42 6 3,81
II* 275-294 19 23 6,88 1 0,96 21 10,53
I + II 260-294 34 38 6,35 3 1,60 27 7,57
IIIa 294-307 13 2 0,87 1 1,40 2 1,47
IIIb 307-318 11 7 3,62 - - 2 1,73
IIIa+IIIb 294-318 24 9 2,13 1 0,76 4 1,59
IV 318-330 12 6 2,84 - - 6 4,76
Va off. 330-335 6 16 15,15 5 15,15 6 9,52
Vb off. 336-341 5 13 14,77 8 29,09 9 17,14
Va + Vb** 330-341 11 43 22,21 25 41,32 28 24,24
VI 341-348 7 13 10,55 3 7,79 5 6,80
VIIa 348-354 6 7 6,63 3 9,09 5 7,94
VIIb1 354-361 7 5 4,06 14 36,36 3 4,08
VIIb2 361-364 3 - - - - - -
VIIa + VIIb 348-364 16 12 9,74 17 19,32 8 4,76
VIII 364-378 14 47 19,07 4 5,19 16 10,88
IX 378-388 10 7 3,98 1 1,82 7 6,67
X 388-402 14 1 0,41 1 1,30 4 2,72
XI 402-435 33 - - - - - -
TOTAL - - 176 55 - 105*** -
4.2.8.1. Les périodes I-II (260-294)
Au cours de la période I (260-275), le site est alimenté, à parts égales, par l’Empire central et la dissidence gauloise (8/15). Nous avons reporté les imitations, italiennes et gauloises, dans la période II, même si quelques exemplaires peuvent avoir été émis avant 275.La date d’arrivée de ce numéraire officiel à la fin du siècle ne semble guère faire de doute : un seul antoninien de métal blanc, au nom de Postume, figure dans le lot. Il s’accompagne d’un antoninien émis en 258/9 à
16. Gricourt et alii, 2009, p. 537, précisent le découpage chronologique. Nous reprenons ici leurs subdivisions, mais en gardant la numérotation originale des périodes, afin de garder une certaine unité avec les études antérieures. Une XIe et dernière période, généralement mal attestée par le bronze, couvre les années 402-435.
Fig.61 Les indices de fréquence (période 260-402), à Moyencourt (MOY), Cizancourt (CIZ) et Saint-Christ-
Briost (SCB).
4. Etude des monnaies (Jean-Marc Doyen)
152 Inrap · Rapport de fouille Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt
Cologne, au nom de Salonin césar (n° 69). De telles monnaies figurent, en même temps que des deniers, dans des contextes constantiniens s’étendant jusqu’en 330-340 (Gorecki 1975, n° 24). Le reste est constitué des espèces médiocres de l’Empire central (fin du règne de Gallien, Claude II), et de l’Empire gaulois (Tétricus I et II).La période II (275-294) nous apporte, comme seule espèce légale, un aurelianus lyonnais au nom de Maximien Hercule (n° 107). L’essentiel du numéraire est alors constitué d’imitations radiées, parmi lesquelles deux groupes doivent être distingués.
a. Les copies gauloisesLes copies d’origine gauloise sont au nombre de 14 (fig.63). Ces monnaies nous sont parvenues tardivement, fort probablement après 280/285, comme le montre la distribution par classe (Doyen 2007 : 283, tableau 147 et fig.62 ci-dessous), favorisant les troisième et quatrième, légères, au détriment de la première.
CLASSES TYPES DE FLANS DIAMÈTRES MASSE MOYENNE
0 très larges et épais 18 – 20 mm idem officielles
1 larges et épais 15 – 20 mm 1,2 – 2,8 g
2 larges et très minces 12 – 16 mm 0,6 – 0,8 g
3 étroits et relativement minces 10 – 12 mm 0,4 – 0,6 g
4 très étroits et très épais 7 – 9 mm 0,5 – 0,8 g
Pour mémoire, la répartition par classe est une simple typologie se fondant sur les caractères physiques des flans, mais nous savons depuis longtemps qu’une évolution chronologique est sensible entre la première et la quatrième classe. La faible représentation de la classe 4, caractérisée par de très petits flans épais, est peut-être un simple critère d’origine géographique. En revanche, la bonne représentation de la classe 1, si elle n’a pas été faussée au moment de la sélection des monnaies les plus lourdes lors des dépôts, semblerait indiquer une date légèrement plus haute que celle de Saint-Christ-Briost, que nous avons placée vers 290-300, grâce à la présence d’un certain nombre de monnaies de Carausius et d’Allectus.
Classes MOY % SCB %
1 6 42,86 4 23,53
2 - - 1 5,88
3 5 35,71 12 70,59
3/4 2 14,29 - -
4 1 7,14 - -
Total 14 100,00 17 100,00
b. Les imitations italiennes du divo ClaudioNous noterons, à Moyencourt, l’importance des imitations italiennes au nom du DIVO CLAVDIO, qui représentent à elles seules 30,43 % des espèces de la période II. Si l’on regroupe les deux phases I et II, le monnayage pour Claude II divinisé, officiel ou illégal, atteint la valeur importante de 23,68 % (fig.64).Les apparentes difficultés d’attribution des divo Claudio ont été résolues assez récemment grâce au travail novateur de S. Estiot à propos du trésor de Troussey (Meuse) (Estiot 1998). À l’occasion de la publication des monnaies de Reims, nous avons eu l’occasion de nous pencher en détail sur ce matériel en général fort abondant aussi bien dans les trésors que sur les sites (Doyen 2007, p. 292-95). Nous sommes revenus en 2009 sur
Fig.62 Définition des classes pondérales d’imitations radiées (d’après DOYEN, 1980, p.78).
Fig.63 Distribution des différentes classes d’imitations à Moyencourt et à Saint-Christ-Briost.
153II. Résultats
cette problématique, en traitant des origines du sanctuaire de Matagne-la-Grande, puis en 2010 lors de l’étude des monnaies de Ville-sur-Lumes (Doyen 2009b, p. 55-58 ; Doyen 2010, p. 155-158). Il n’est cependant pas inutile de reprendre ici l’argumentation, en y ajoutant des données nouvelles. Voyons d’abord comment se répartissent les imitations du divo Claudio à Moyencourt.
TYPES Nbres % VSL
Aigle 2 28,57 28,57
Autel 4 57,14 50,00
Hybrides 1 14,29 14,29
Indéterminé - - 7,14
Total 7 100,00 100,00
Ces monnaies, surtout celles de petit module, étaient autrefois attribuées aux ateliers imitatifs gaulois qui ont produit en masse des copies aux noms de Victorin, Tétricus I et II, et plus rarement de Gallien, Postume, Tacite, Probus, Carus et suivants, voire de types postérieurs à la réforme de 294. On sait désormais, grâce aux travaux de S. Estiot principalement, que ces antoniniani à la légende DIVO CLAVDIO ont été produits frauduleusement par les graveurs de l’atelier de Rome après sa fermeture à l’été 271 (Estiot 1998, p. 197). Les multiples malversations observées dans la production officielle entre 266 et 271, celles entre autres des antoniniens célébrant la divinisation de Claude II le Gothique (270 après J.-C.) ont poussé Aurélien à des mesures draconiennes jamais observées auparavant, puisque l’atelier principal de l’Empire fut fermé pendant plusieurs années. La bellum monetariorum qui s’ensuivit provoqua la dispersion, en Italie septentrionale, des graveurs de la capitale… qui poursuivirent à titre purement personnel la production monétaire. Il faut donc distinguer les fraudes sorties de l’atelier de Rome juste avant sa fermeture par Aurélien, des imitations italiennes postérieures, généralement plus épaisses mais plus petites que les précédentes. Les graveurs étant les mêmes, les critères de style sont ici inopérants.Le module de ces copies diminuera progressivement, alors que les caractéristiques stylistiques relevées par S. Estiot demeureront remarquablement stables pendant deux décennies au moins (271-285/290), même sur des minimissimi (module < 13 mm). L’existence d’hybrides liant un avers de style italien au nom de Claude II divus, à un revers émis par Carus ou Numérien en 283, prouve que la frappe se poursuivit pendant de nombreuses années. Dans les zones qui firent partie de l’« Empire gaulois », c’est seulement après le décri du monnayage des empereurs dissidents, vers 283, que se fait sentir le besoin de « petites coupures ». Ce vide sera comblé par les séries romaines tardives de Gallien, celles de Claude II, et par les antoniniani du divo Claudio17, exportés en masse par l’État vers les provinces occidentales (Gaule, Espagne, Afrique du Nord). Une origine extérieure à la Gaule est du reste clairement démontrée grâce à la documentation statistique réunie il y a quelques années par Padrino Fernandez (2005, p. 59-61). Lorsqu’on se réfère à la composition des trésors continentaux mis en terre dans le dernier tiers du IIIe siècle, on constate que la proportion de ces divo Claudio, qui stagnait à 1 ou 2 % des ensembles datables des années 272-280,
17. Si les frappes, officielles ou non, des empereurs illégitimes (non reconnus par le Sénat), ont été officiellement retirées de la circulation (du moins en théorie : disons qu’il est probable que ces espèces n’étaient plus acceptées par les agents du fisc), celles de Claude II divus, officielles ou non, n’étaient pas concernées par cette mesure. La prétendue filiation entre Constantin I et Claude II a du reste facilité le maintien en circulation de ces espèces. Constantin est d’ailleurs le seul à avoir procédé en 317/318 à la frappe de fractions de nummi célébrant le DIVO CLAVDIO OPTIMO IMP : RIC VII, p. 180 (Trèves), p. 252 (Arles), p. 310-312 (Rome), p. 429-430 (Siscia) et p. 502-503 (Thessalonique).
Fig.64 Répartition, par types de revers, des imitations italiennes du divo Claudio à Moyencourt, comparées à celles de Ville-sur-Lumes (d’après Doyen 2010, p. 156, tabl. 67)
4. Etude des monnaies (Jean-Marc Doyen)
154 Inrap · Rapport de fouille Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt
s’élève rapidement dans les ensembles constitués à la fin du siècle, où ils occupent de 10 à 20 % du monnayage en circulation (Doyen 2010, p. 157, tableau 68). Il faut également noter qu’un certain nombre d’unités stratigraphiques homogènes ou de sites constantiniens confirment cette hypothèse de développement tardif. C’est le cas à Reims, dans un remblai de peu antérieur à 340 environ, dans certaines inhumations de la nécropole de la « Rue Perdue » à Tournai (Brulet & Coulon, 1997, t. 2, 4 et 47, cette dernière postérieure à 323/4). Le sanctuaire de Matagne-la-Grande, créé vers 320/325, avec un taux global de plus de 27 % (56/205), proche de celui de Moyencourt, se place à un niveau lui aussi fort élevé (Doyen 2009b, p. 55-58). Le numéraire issu des fossés du castellum de Liberchies-Brunehaut (Hainaut, B.), édifié après 332/333 (Brulet 1990, p. 136) affiche un taux record de 78,57 % de divo Claudio par rapport aux radiées « résiduelles », montrant l’importance toujours sensible de ce monnayage dans la circulation constantinienne tardive.
4.2.8.2. La période III (294-318)
Avec seulement 9 exemplaires, la période III s’étendant de la réforme de 294 à celle de 318, présente un indice global de 2,13. Au niveau régional pourtant, cette valeur se situe indubitablement dans la partie supérieure de la moyenne, si l’on se fonde sur les données de Cizancourt et Saint-Christ-Briost et d’autres sites de l’Artois méridional.
PÉRIODES- DATES NbreAnnées
A Ind B Ind C Ind D Ind E Ind
I 260-275 15 14 9,52 4 3,65 57 7,65 - - 36 14,12
II* 275-294 19 87 23,13 33 23,79 145 15,36 1 1,03 112 34,67
I + II 260-294 34 101 15,00 37 14,91 202 11,95 1 0,58 148 25,61
IIIa 294-307 13 1 0,39 - - - - - - - -
IIIb 307-318 11 - - - - 12 2,19 - - 4 2,14
IIIa+IIIb 294-318 24 1 0,21 - - 12 1,00 - - 4 0,98
IV 318-330 12 19 8,00 - - 14 2,35 2 3,27 3 1,47
Va off. 330-335 6 16 13,47 5 11,42 28 9 ,39 4 13,07 2 1,96
Vb off. 336-341 5 36 36,36 1 2,74 26 10,46 3 11,76 - -
Va + Vb** 330-341 11 83 38,11 16 19,93 116 21,22 16 28,52 7 3,74
VI 341-348 7 10 7,22 1 1,96 19 5,46 5 14,00 2 1,68
VIIa 348-354 6 12 10,10 2 4,57 15 5,03 4 13,07 2 1,96
VIIb1 354-361 7 3 2,16 - - 26 7,47 2 5,60 1 0,84
VIIb2 361-364 3 1 1,68 - - - - - - - -
VIIa + VIIb 348-364 16 16 5,05 2 1,71 43 5,41 6 7,35 3 1,10
VIII 364-378 14 6 2,16 1 0,98 63 9,05 10 14,00 1 0,42
IX 378-388 10 3 1,52 3 4,11 19 3,82 8 15,69 1 0,59
X 388-402 14 6 2,16 7 6,85 9 1,29 3 4,20 1 0,42
XI 402-435 33 - - - - - - - - - -
TOTAL - - 198 73 497 51 170
* + les imitations radiées ** + les imitations
On peut dès lors considérer que le sanctuaire est particulièrement actif au cours de cette période, même si la phase la plus ancienne (IIIa : 294-308) n’est attestée que par deux lourds nummi taillés au 1/32e de livre, procurant un indice très moyen de 0,87. Nous avons noté, à propos de Saint-Christ-Briost et Cizancourt, la rareté du monnayage relevant de la période IIIa dans la région, attestée seulement sur ces deux sites et à Vaulx-Vraucourt La Voie Jacqueline (Delmaire & Notte 1996) par des indices respectivement de 1,40, 1,47 et 0,39 (tableau 8). L’essentiel du numéraire se classe dès lors
Fig.65 Indices de fréquence des sites ruraux de l’Artois méridional. A = Vaulx-Vraucourt « La Voie Jacqueline » ; B = Vaulx-Vraucourt « Chemin de Morchies » ; C = Ecoust-Saint-Mein « Buisson-Saint-Mein » ; D = Ecoust-Saint-Mein « Les Epinettes » ; E = Beugnâtre « Route de Douai ».
155II. Résultats
dans la phase IIIb, postérieure à la 3e réduction pondérale, qui survient à la fin de l’année 309 ou vers le début de l’année suivante, mais la plupart de nos pièces relèvent en réalité de la 4e réduction qui intervient au printemps 313 (fig.66).
Empereur LON TR LY TOT
Constantin I 1 5 - 6
Licinius I - 1 - 1
TOTAL 1 6 - 7
Le numéraire « frais » est essentiellement originaire de Trèves, mais Londres intervient dans l’alimentation ; il s’agit d’une constante en Gaule septentrionale. Certains sites de Gaule intérieure, Reims par exemple, affichent à cette période un pourcentage considérable de monnaies originaire de Britannia (Doyen 2007, p. 304), concurrençant Lyon et même Trèves. N’oublions cependant pas que l’essentiel de la circulation est constituée d’espèces radiées.
4.2.8.3. La période IV (318-330)
Avec 6 exemplaires, la période IV (318-330) présente un indice de 2,84, valeur faible par rapport aux 4,76 points relevés à Saint-Christ-Briost (Cizancourt est inactif à ce moment). La totalité du numéraire récolté provient cette fois de Trèves. Nous avions observé, à Saint-Christ-Briost, une origine plus variée : Trèves, Lyon et Arles.
Empereurs TR
Constantin I 3
Crispus 1
Constantin II 1
Constance II 1
TOTAL 6
Chose étonnante, nous n’y relevons aucune imitation, alors que la diminution des quantités émises après la réforme de 318 provoque l’apparition d’assez nombreuses copies, coulées ou frappées. A Saint-Christ-Briost, deux des six exemplaires récoltés sont frauduleux ! Comme les imitations de la période suivante sont fort abondantes, il est difficile de mettre cette anomalie sur le compte d’une volonté délibérée ; la taille réduite de l’échantillon est sans doute responsable de cette distribution anormale qui trouve cependant un parallèle mieux documenté (19 ex.) à Vaulx-Vraucourt La Voie Jacqueline (fig.65).
4.2.8.4. La période V (330-341)
a. Les dénominations officiellesLes années 330-341 sont marquées par les réformes pondérales de 330 et 336, la dernière précédant de peu la mort de Constantin Ier, le 22 mai 337. Ceci permet de diviser métrologiquement la période en Va (330-335) et Vb (336-341).Après la dédicace officielle de Constantinople, le 11 mai 330, Constantin I change l’iconographie du nummus qui porte désormais la légende gloria exercitus accompagnée de l’image de deux étendards flanqués, de part et d’autre, d’un soldat en armes. Cette modification iconographique s’accompagne d’une réduction pondérale puisque le nouveau nummus est taillé au 1/132e de livre tandis que son titre ne dépasse plus 1 à 1,4 % d’argent, du moins dans les ateliers gaulois (Depeyrot 2001 : 87-88).
Fig.66 Répartition des monnaies de la période IIIb (307-318).
Fig.67 Répartition des monnaies de la période IV (318-330).
4. Etude des monnaies (Jean-Marc Doyen)
156 Inrap · Rapport de fouille Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt
Simultanément, Constantin met en circulation des monnaies montrant à l’avers le buste des deux capitales de l’Empire, Constantinopolis et Vrbs Roma. Ces légendes sont associées à des revers explicites : la Victoire sur une proue de navire pour Constantinople, la louve allaitant les jumeaux Romulus et Rémus pour Rome. En 336, une nouvelle réforme porte le nummus au 1/192e ou au 204e de livre. La gloria exercitus perd un étendard, et les émissions urbaines diminuent d’intensité.A Moyencourt, l’activité des phases Va et Vb est identique en ce qui concerne les dénominations officielles, avec respectivement 15,15 et 14,77. Si l’on regroupe ces deux périodes, en y ajoutant les imitations contemporaines, l’indice s’élève à 22,21. Celui-ci est identique à celui de Saint-Christ-Briost (24,24), une valeur rigoureusement dans la norme des cinq sites régionaux de comparaison, tous actifs à l’époque concernée. Les indices, exception faite du site E, s’étalent de 20 à 41 points. Dès lors, le dynamisme observé à Moyencourt est le reflet fidèle de l’activité économique régionale, correspondant à une « renaissance constantinienne » qui se marque essentiellement au cours de la dernière décennie du règne.
Empereurs TR LY AR RM SIS IND TOT
Constantin I - 2 1 1 - - 4
Constantin II - 2 - - - - 2
Constance II - - 1 1 1 1 4
Urbs Roma - - 1 - - 1 2
Constantinopolis 2 - - - - 1 3
Indéterminé - - - - - 1 1
TOTAL 2 4 3 2 1 4 16
% (12 ex. ident.) 16,67 33,33 25,00 16,67 8,33
Empereurs TR LY AR RM IND TOT
Constantin I 1 - - - - 1
Constance II 2 1 1 - - 4
Constant I 2 - - - - 2
Helena 1 - - - - 1
Theodora - - - - 2 2
Indéterminé - - - - 2 2
TOTAL 6 1 2 1 3 13
% (sur 10 ex. ident.) 60,00 10,00 20,00 10,00 -
A Moyencourt, sur douze monnaies déterminables de la période Va, Lyon domine l’approvisionnement, devant Arles et Trèves (tableau 11). La phase Vb voit en revanche la prépondérance de l’atelier trévire sur les autres, avec 60 % (tableau 12). A Reims par exemple, la situation est assez différente, étant donné la plus grande proximité de l’atelier de Trèves, qui atteint 45,44 % en Va, mais seulement 33,33 % en Vb (Doyen 2007, p. 317, tableaux 169-170).
b. Les imitationsOn connaît depuis longtemps l’impact du numéraire d’imitation au cours de la décennie 330-340. Curieusement, cette vague de copies intervient à un moment où il ne semble pas y avoir de pénurie d’espèces officielles. C’est pourquoi certains numismates n’hésitent pas à en décaler la production d’une vingtaine d’années, pour la placer entre 353 et 364 (Gricourt et alii 2009, p. 680). La composition de certains trésors, et le taux d’hybridation interne entre les séries de 330-341, 341-348 et 348-364, rendent cette
Fig.68 Répartition des monnaies de la période Va (330-335).
Fig.69 Répartition des monnaies de la période Vb (335-341).
157II. Résultats
hypothèse impossible à soutenir (Doyen 2010, p. 165-167).A Moyencourt, le ratio entre les imitations (14 ex.) et les espèces officielles (29) s’établit à 1/3 – 2/3 (tableau 13). De ce fait, le sanctuaire domine la situation avec le plus fort taux d’espèces officielles. Seul le site E, mal documenté du reste, affiche un taux quelque peu anormalement faible. On peut donc supposer qu’une certaine sélection a présidé au choix des monnaies de la période 330-341, favorisant les espèces officielles au détriment des copies.Nous avons proposé naguère de lier la prédominance du type gloria exercitus (1) avec une suprématie de Constantinopolis (Doyen 2007, p. 322, tabl. 177 ; Doyen 2010, p. 167). A Moyencourt, tout comme à Saint-Christ-Briost, ce phénomène est contredit par les données quantitatives, puisque le fort taux de GE1 s’y oppose à un bon taux d’Vrbs Roma.
STATUT MOY SCB Ciz A B C D E
officielles 29 13 13 52 7 54 7 2
% 67,44 46,43 52,00 62,65 41,18 46 ,55 43,75 28,57
imitations 14 15 12 31 9 62 9 5
% 32,56 53,57 48,00 37,35 52,94 53,45 56,25 71,43
TOTAL 43 28 25 83 17 116 16 7
Types MOY % Ciz. % SCB % A % C %
Gloria exercitus 2 3 21,43 1 8,33 - - 3 9,68 5 8,06
Gloria exercitus 1 6 42,86 4 33,33 4 30,77 18 58,07 34 54,84
Constantinopolis 1 7,14 3 25,00 3 23,08 6 19,35 13 20,97
Vrbs Roma 3 21,43 2 16,67 3 23,08 2 6,45 10 16,13
Hybr. VR/Cp - - 1 8,33 - - 1 3,23 - -
Hybr. Cp/VR - - - - 1 7,69
Hybr. PR/PP - - 1 8,33 1 7,69 1 3,23 - -
Indéterminé 1 7,14 - - 1 7,69
TOTAL 14 12 13 31 62
Les données métrologiques de notre échantillon sont peu probantes, étant donné sa faiblesse numérique. On notera cependant que les masses les plus élevées se retrouvent chez GE (2) (1,00 ; 1,31 g) et Urbs Roma (1,40 ; 1,39 g), les autres exemplaires se trouvant largement au-dessous du gramme (fig.72).
Type Nbre Moyenne
Gloria exercitus (2) 3 0,96 g
Gloria exercitus (1) 4 0,805 g
Constantinopolis 1 0,47 g
Urbs Roma 3 1,12 g
4.2.8.5. La période VI (341-348)
De 341 à 348 (période VI), le petit nummus constitue la seule espèce de bronze argenté encore frappée. Sa masse ne semble guère avoir évolué depuis la réforme de 336, et son titre de fin se maintient vers 1 %.Les ateliers occidentaux, auxquels s’ajoutent Siscia et Thessalonique, émettent des monnaies aux deux Victoires se faisant face et à la légende Victoriae dd auggq nn. Les ateliers orientaux, mal représentés dans nos régions et absentes de notre série, contrairement à la période précédente, célèbrent les Vota XX de Constance II et, à Antioche seulement, les Vota XV de son frère Constant.
Fig.70 Période V (330-341) : ratio entre nummi officiels et leurs imitations à Moyencourt, Saint-Christ-Briost, Cizancourt, et les villae de l’Artois méridional.
Fig.71 Répartition des imitations de la période 330-341.
Fig.72 Métrologie des imitations constantiniennes (330-341) de Moyencourt.
4. Etude des monnaies (Jean-Marc Doyen)
158 Inrap · Rapport de fouille Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt
Les sites de Bretagne insulaire et de Gaule septentrionale révèlent systématiquement moins de monnaies officielles émises de 341 à 348 que de pièces frappées au cours de la décennie précédente (Lallemand 1989 : 53 et note 141 pour les pourcentages).Les nummi à la légende Victoriae dd auggq nn sont proportionnellement bien représentés à Moyencourt. Notre indice s’élève à 10,55 (tab 4), une valeur plutôt élevée par rapport aux sites régionaux. Du reste, seul le site D atteint 14 points.
Empereurs TR AR IND IMIT TOT
Constant I 3 1 2 1 7
Constance II - - 1 - 1
Indéterminé 2 - - 3 5
TOTAL 5 1 3 4 13
Trèves domine largement la production, comme c’est le cas partout ailleurs en Belgica I et II et en Germania II, où nous relevons de 57 à 81 % (Doyen 2007, p. 325, tableau 180).Les imitations sont abondantes à Moyencourt, avec 30,77 % (4/13). Les pourcentages relevés en Belgica II évolue de 0 à 50 %, avec une moyenne se situant entre 11 et 25 % (Doyen 2007, p. 326, tableau 182). Ces valeurs de copies, selon D. Wigg (1987, p. 114, fig. 2) augmentent au fur et à mesure que l’on se dirige vers l’ouest. Les données de notre sanctuaire confirment effectivement cette observation.
4.2.8.6. La période VII (348-364)
La période VII, prise globalement, apporte 12 monnaies à Moyencourt. Sur le plan métrologique, ces 16 années ont fait l’objet d’un découpage assez fin en phase VII a (348-354), VII b1 (354-361) et VII b² (361-364).
Dénominations Nbre
Maiorina légère (Aes 2) 2
Demi-maiorina (Aes 3) 1
Aes 3/4 1
Imit. maiorina légère 4
Imit. (minimissimus) 4
TOTAL 12
La première phase s’étend de la réforme d’avril 348 à la seconde moitié de 353 ou au début de l’année suivante. Cette époque voit le retour à un système monétaire comprenant plusieurs dénominations de bronze, en général argenté. En effet, après quarante années de frappe du nummus dont la masse et la couverture métallique n’ont fait que décroître, Constance II et son frère Constant réforment le monnayage d’aes « argenté » en 348, sans doute à l’occasion du 1100e anniversaire de Rome (Gricourt et alii 2009: 680).Les nouvelles pièces, nettement plus lourdes que les précédentes, se répartissent en trois dénominations différentes qui portent toutes au revers la légende Fel temp reparatio.La pièce du plus grand module, la maiorina des textes de l’époque et que l’on désigne parfois sous le terme d’aes 2 lourd, pèse en moyenne 5,26 g et est taillée au 1/60e de livre ; elle contient en moyenne de 2,50 à 3 % d’argent.La plus petite pièce est un aes 3 taillé au 1/120e de livre et pesant de ce fait 2,42 g. Elle présente seulement des traces d’argent, sans doute résiduel, de l’ordre de 0,20 à 0,40 %. Il s’agit selon toute vraisemblance d’une demi-maiorina. Elle est représentée sur notre site par le n° 179.Entre ces deux valeurs vient se placer un aes 2 léger, de 4,25 g en moyenne, contenant de 1,10 à 1,50 % d’argent. Il est taillé au 1/72ème de livre.
Fig.73 Répartition des monnaies de la période VI (341-348).
Fig.74 Répartition des monnaies de la période VI (341-348).
159II. Résultats
Afin de le distinguer aisément des deux autres monnaies, le buste impérial figurant à l’avers de cet aes 2 léger (maiorina légère) est systématiquement tourné à gauche.Les ateliers gaulois cessent l’émission de la maiorina légère et de la demi-maiorina vers la fin de l’année 349 pour se consacrer à la frappe de la dénomination la plus lourde (Depeyrot 2001, pp. 112-113).
La rupture politique des années 350-353 n’implique pas de scinder la période VIIa. En effet, lors de son arrivée au pouvoir en janvier 350, le gaulois Magnence poursuit dans un premier temps le système monétaire alors en vigueur, celui d’un aes 2 lourd (maiorina lourde) taillé au 1/62e de livre, également enrichi en argent (de 1,60 à 2,50 % environ). Bien qu’affichant une masse légère due à leur état de conservation, les n° 180-181 relèvent de cette catégorie.Quelques mois plus tard, après l’association de son frère Décence comme césar, l’empereur réduit la masse de sa monnaie de bronze : de 5,30 - 4,95 g, valeur en vigueur au cours des trois premières phases, il passe finalement à 4,47 g. Il en profite également pour réduire de manière sensible la couverture en fin, qui atteint seulement de 1,10 à 1,80 %.Fin 352 ou au début de l’année suivante, Magnence réforme sa monnaie en profondeur, en introduisant une lourde pièce à la légende Salus augusti nostri, dont l’argent est absent mais qui pèse, en moyenne, 8,33 g, soit une taille au 1/38e ou 1/39e de livre. Le règne de Magnence est attesté à Moyencourt par deux aes 2 et une imitation, un ensemble quantitativement médiocre pour un monnayage souvent fort abondant. La présence d’un atelier monétaire à Amiens de janvier 350 à la fin de l’année 353 aurait laissé espérer une activité nettement plus importante.L’indice de la période VIIa, de 348 à 354, vaut 6,63 points à Moyencourt, imitations comprises.Au cours des années allant de 353 à 357/8, Constance II frappe en son nom et à celui de ses deux césars successifs, Constance Galle d’abord, puis Julien (n° 182). Après sa victoire sur Magnence (août 353), Constance II frappe dans les ateliers gaulois des aes 2 réduits, de 4,34 g en moyenne, et taillés au 1/72e de livre, au type du cavalier tombant (FH). Dès 354, cet aes 2 réduit, tout en conservant le même revers, devient un aes 3 de 2,50 g environ, masse correspondant à une taille au 1/120e de livre. Les dévaluations se succèdent et en 358, la pièce n’atteint plus que 1,96 g (1/144e de livre). Elle est pratiquement devenue un aes 4, et le revers est alors modifié et remplacé par l’image de l’empereur en tenue militaire, tenant un globe et une lance inversée, figure définie par la mention du Spes reipublice.Les années 354-361 sont en général extrêmement mal fournies en espèces officielles. Nous relevons pour notre part un unique aes 3/4 au Spes reipublice (n° 182). La phase VIIb2, comme c’est généralement le cas en Gaule septentrionale, est totalement absente de nos récoltes, tout comme de celles des sites de comparaison : sur un total de 989 exemplaires, une seule monnaie – une imitation de silique en argent doré - est attestée sur le site A !De son côté, G. Depeyrot soutient qu’après 353 et la réduction pondérale, le volume des émissions va dans un premier temps augmenter de façon globale en Gaule (Depeyrot 2001, p. 115). La fermeture d’Amiens et la destruction de Trèves vont contraindre l’administration à concentrer la frappe dans des zones mieux protégées, Lyon et surtout Arles, pendant les quelques années nécessaires à la reconstruction et la réorganisation des provinces septentrionales. Enfin, après 358 et la nouvelle réduction pondérale, les quantités émises en Gaule chutent brutalement. Trèves n’émet pas encore. Lyon voit ses émissions réduites, tout comme Arles qui reste cependant le plus important atelier gaulois. Le volume des émissions de bronze est très difficile à estimer, compte tenu de la rareté de l’aes sur les sites, et l’absence de thésaurisation. Il faut noter qu’à partir de 358, la
4. Etude des monnaies (Jean-Marc Doyen)
160 Inrap · Rapport de fouille Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt
monnaie d’argent devient la pièce maîtresse du système monétaire. La faiblesse de l’approvisionnement officiel est comblée par de nombreuses imitations dont la production débute dès 348, mais dont l’accroissement se fera particulièrement sentir après 354, par la frappe de minimissimi au type du « cavalier tombant » (le FH des anglo-saxons, pour falling horseman). Ces monnaies sont bien attestées dans la région puisque nous relevons 13 de ces copies à Cizancourt, 2 à Saint-Christ-Briost et 3 seulement à Moyencourt sur un ensemble globalement plus important que les deux autres sites mis ensembles. En totalisant les différents monnayages, légaux ou non, des années 348-364, l’indice de la période VII atteint 9,74, à comparer aux 19,32 points de Cizancourt et aux 4,76 de Saint-Christ-Briost.Ces valeurs doivent être mises en parallèle avec celles observées sur les autres sites de l’Artois, s’étalant de 1,10 à 5,41 (tableau 8). D’un point de vue métrologique, les exemplaires illégaux de Moyencourt se répartissent en deux groupes : les imitations de la maiorina lourde atteignent 3,71 g. en moyenne, avec un exemplaire de 5,11 g ! Les deux exemplaires intacts du type FTR (FH) pèsent respectivement 0,89 et 0,92 g.
4.2.8.7. Les périodes VIII et IX (364-388)
Les périodes VIII et IX constituent la dernière grande phase d’activité du sanctuaire de Moyencourt, avec respectivement 47 et 7 exemplaires. Ils nous fournissent des indices respectivement de 19,07 et 3,98, à mettre en parallèle avec les 10,88 et 6,67 de Saint-Christ-Briost, eux-mêmes très largement supérieurs aux 5,19/1,82 de Cizancourt.Il semble assuré que l’activité du site décline vers 378/380, voire dès 375 comme nous le verrons plus loin.La période VIII (364-378)La dynastie valentinienne, et plus particulièrement la période couvrant les années 364-378 est bien attestée, comme d’ailleurs sur la plupart des sites civils de Gaule septentrionale.L’aes 3, d’une masse moyenne de 2,50 g. environ et d’une taille au 120e ou 1/132e de livre, constitue à ce moment la dénomination la plus courante, et la seule relevée à Moyencourt. La circulation monétaire dans la Belgica Secunda est particulièrement homogène au niveau des dénominations. L’approvisionnement est abondant (tableau 15), et les imitations sont très rares ; la présence de trois exemplaires sur notre site est tout à fait exceptionnelle.
Empereurs TR LY AR LY/AR AQ RM IND TOTValentinien I 1 1 4 2 - - - 8
Valens - 1 2 2 1 3 3 12
Gratien 1 4 3- - - - 2 10
Indéterminé - 1 4 - 1 - 8 14
Imitations - - - - - - 3 3
TOTAL 2 7 13 4 2 3 16 47
% (sur 31 ident.) 6,45 22,58 41,94 12,90 6,45 9,68 -
En revanche la période VIII peut être scindée en trois sous-ensembles chronologiques relativement bien typés (phases a, b et c). A Ville-sur-Lumes, voici comment se répartit ce numéraire :
Phase Dates Nbre %
a 364-367 6 18,75b 367-375/6 11 34,38a/b 364-375/6 11 34,38
c 375-378 1 3,13
b/c 367-378 3 9,38
a-c 364-378 12
a. Les années 364-367Les bronzes frappés au cours du règne conjoint de Valentinien I et Valens, entre 364 et 367 (phase a), sont, d’une manière générale, assez abondants.
Fig.75 Répartition des monnaies de la période VIII (364-378).
Fig.76 Phasage des aes 3 d’époque valentinienne à Moyencourt. * Les pourcentages sont calculés sans tenir compte des 12 exemplaires non classables avec précision.
161II. Résultats
Ils atteignent par exemple à Reims 35,85 % alors que cette période de 3 ans ne représente en réalité que 21 % des 14 années qu’elle compte globalement. A Moyencourt, cette période initiale est très correctement représentée, avec un peu plus de 18 % des 32 aes 3 attribuables avec précision à l’une ou l’autre phase. Il faut sans doute y ajouter quelques bronzes placés de manière indifférenciée entre 364 et 375, au nombre de 11.
b. Les années 367-375Les aes 3 émis de l’avènement de Gratien en 367 à la mort de Valentinien I en 375 s’élèvent à Moyencourt à plus de 34 % (nous avions noté 45,28 % à Reims) pour 8 années correspondant à 57 % de la période. Nous devons bien entendu y joindre le solde de notre calcul précédent, portant sur les aes 3 indéterminés, datés globalement de 364-375.
c. Les années 375-378En revanche, les monnaies attribuables avec certitude à la troisième et dernière phase (celle postérieure au décès de Valentinien I), ne représentent plus que 3,13 % (à Reims : 3,77 %) alors que ces trois années (375-378) couvrent 21 % de l’ensemble. L’alimentation de notre site chute donc à ce moment, comme partout ailleurs en Gaule puisqu’il s’agit d’une importante rétraction de la production, mise en évidence de longue date (Lallemand 1989 : 61 ; Depeyrot 2001, p. 144 ; Doyen 2007, fig. 235).
d. Les ateliersContrairement à ce nous avons observé depuis 330, l’alimentation de notre site ne s’effectue plus au départ de Trèves, mais bien d’Arles qui occupe désormais près de 42 % de la production, plus encore si nous ajoutons 4 pièces provenant aussi bien de Lyon que d’Arles. Avec les 22,58 % de Lyon, les ateliers méridionaux dominent totalement l’alimentation de la région. Les ateliers italiens (Rome et Aquilée), sont, eux-aussi, bien présents.
SITES TR LY AR LY ou AR AQ RM SI TOT
Saint-Christ-Briost 1 2 5 1 2 1 2 14
% 7,14 14,29 35,71 7,14 14,29 7,14 14,29
Ecoust-Saint-Mein 2 9 22 1 5 7 5 51% 3,92 17,65 43,14 1,96 9,80 13,73 9,80Moyencourt 2 7 13 4 2 3 - 31
% 6,45 22,58 41,94 12,90 6,45 9,68 -
Halatte 4 10 9 - 5 1 2 31
% 12,90 32,26 29,03 - 16,13 3,23 6,45
La période 378-388A la mort de Valens (août 378) et son remplacement par Théodose I (janvier 379), Gratien modifie les revers de ses aes 3. Il introduit également des aes 4 célébrant les vota. Ces changements introduisent la période IX (378-388).Vers la mi-381, une nouvelle réforme fait apparaître des pièces de grand module, les aes 2 au revers de la Reparatio reipub, sans doute taillés au 1/60e de livre et pesant en moyenne plus de 5 g.Cette grande pièce, qui remplace très vite les anciens aes 3 dont la frappe s’interrompt à ce moment, sera rapidement imitée – signe de son succès – et thésaurisée de manière intensive. Ceci provoquera l’échec de la réforme et l’interruption de la frappe en Occident des aes 2 vers 386 ou 387 au plus tard (Depeyrot, 2001 p. 142).Les émissions de la période 378-388 comprennent donc à nouveau trois dénominations : l’aes 2, l’aes 3 et l’aes 4. L’espèce centrale est absente de notre ensemble : cet aes 3 est généralement peu courant sur l’ensemble des sites (Lallemand 1983). Du reste son émission, dès le départ peu abondante, s’interrompt dans les ateliers gaulois en 381.L’aes 2, émis en grandes quantités par Gratien, et plus encore par son successeur Magnus Maximus, l’emporte généralement sur la plus petite dénomination : à Moyencourt, nous relevons 6 aes 2 pour un seul aes 4, soit 85,71 % de grands modules. À Saint-Christ-Briost, 4 aes 2 officiels face à 3 aes 4, nous en donnent 57,14 %. L’aes 2, semble avoir été thésaurisé dès
Fig.77 Répartition, par ateliers, des aes 3 d’époque valentinienne (364-378).
4. Etude des monnaies (Jean-Marc Doyen)
162 Inrap · Rapport de fouille Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt
son apparition, comme le montre le trésor d’Hemptinne, près de Namur, qui contient de nombreuses pièces liées par les coins (Lallemand 1967 : 21-22). Peut-être à cause de cette immobilisation des grandes pièces, certains refuges fortifiés et les autres sites « ruraux » contiennent davantage d’aes 4 que les sites mieux alimentés en numéraire frais (Doyen 2007, p. 339).Les indices de fréquence de la période IX atteignent 3,98 points à Moyencourt, 1,82 à Cizancourt et 6,67 à Saint-Christ-Briost. Ce dernier figure parmi les sites les plus actifs de l’Artois méridional, derrière Ecoust-Saint-Mein « D », qui monte à plus de 15 points. Comme Moyencourt demeure encore dans l’honnête moyenne des sites régionaux encore actifs au cours de la phase suivante, on peut supposer une activité assez marquée s’étalant sur l’ensemble de la période.
Empereurs TR LY AQ IND TOT
Gratien 1 1 - - 2
Valentinien II - 1 - - 1
Théodose I - - 1 - 1
Maxime 1 - - 1 1
Indéterminé - - - 1 1
Total 2 2 1 2 7
L’absence totale d’imitations est notable : il s’agit clairement d’une sélection puisque le numéraire frauduleux occupe parfois une part appréciable de la circulation (19,23 % à Vireux, 9,09 % à Reims : Doyen 2007, p. 339, tableau 192)La période 388-[402]La dernière monnaie qui parvient sur le site (n° 245) est un aes 4 au nom d’Arcadius émis à Trèves à partir du 28 août 388. L’état d’usure de cette monnaie (indice 1-2) montre qu’elle n’a circulé que quelques mois ou tout au plus quelques années avant d’être perdue sur le site. Les émissions de ce petit numéraire furent immédiatement très abondantes, et leur absence quasi-totale sur le site montre que le sanctuaire n’a pas survécu aux alentours de 390, contrairement à d’autres pour lesquels l’occupation théodosienne est particulièrement marquée (par exemple Matagne-la-Grande et, dans une moindre mesure, la forêt d’Halatte et Saclas : Collectif 2000 p. 230). Notons que Bennecourt, dans les Yvelines, présente le même terminus d’occupation que Moyencourt, à savoir l’année 386 (Bourgeois 1999, p. 89). Estrées-Saint-Denis, Deneuvre et Ribemont-sur-Ancre ne semblent pas survivre aux années 367-375.
4.3. Conclusions
Les périodes d’activité du « sanctuaire »L’étude du numéraire de Moyencourt à mis en évidence les grandes phases d’activité du site. Deux groupes de monnaies gauloises témoignent d’une occupation unique ( ?) débutant au plus tôt vers 90/80 et s’achevant sans doute vers 40 av. J.-C. Le monnayage julio-claudien ne semble pas très précoce : il se concentre essentiellement entre 10 avant et la fin du règne de Néron (68). Suit alors un creux assez marqué qui s’achève vers 98/99, au début du règne de Trajan.Une phase très active se développe pendant une cinquantaine d’années : une rupture importante se situe sans doute vers 145/150. Le monnayage d’époque antonine postérieur, étant donné son état d’usure, doit avoir été déposé beaucoup plus tard, sans doute à la fin du IIIe, voire au début du IVe s. ap. J.-C.L’activité liée au dépôt de monnaies reprend vers 285/290 et se poursuit sans interruption jusque vers 390. Deux périodes fastes émergent clairement du lot : vers 330 au plus tard, mais peut-être dès 325, le sanctuaire reçoit
Fig.78 Répartition des monnaies de la période IX (378-388).
163II. Résultats
des offrandes caractérisées par le retrait d’une partie des imitations de petit module. Après un creux assez marqué entre 350 et 364, l’activité reprend de manière intense jusqu’en 375/378. La dernière phase d’activité monétaire (378-388) reste importante ; elle est marquée par l’usage des meilleures monnaies alors disponibles car aucune imitation n’a retenu l’attention des participants aux rites. Le site, clairement, ne connaît pas de déclin : les cultes s’achèvent de manière totalement abrupte, à un moment où d’autres sites sont, eux-aussi, abandonnés, alors que certains sanctuaires ruraux connaîtront une véritable renaissance qui leur permettra de survivre jusque dans les années 420/430.
Les ritesLe matériel étant épars et largement piétiné, les rites de déposition des monnaies ne nous sont plus perceptibles. Quelle est la part des monnaies perdues lors des activités – on pense aux éventuels banquets ‒ qui se déroulaient à l’intérieur de l’enclos ? Les offrandes monétaires étaient-elles effectuées à l’intérieur de l’enclos ? Étaient-elles jetées sur le sol de manière aléatoire ou soigneusement déposées à des endroits précis ? Sur le sol ou enfouies, comme c’est le cas à Baâlons-Bouvellemont ou d’assez nombreuses monnaies étaient déposées verticalement dans un petit trou creusé dans le remblai dans des zones spécifiques situées autour des temples ? Les monnaies étaient-elles abandonnées à l’unité ou par groupes plus importants ? D’autres offrandes étaient-elles déposées simultanément (céramique, dons alimentaires, petits objets) ?L’étude iconographique du numéraire de Moyencourt est décevante : lorsque des choix sont possibles, du milieu du Ier s. à la fin du IIe – puisque le numéraire de la période 190-260 voire 280/290 est absent ‒ il est clair qu’aucune sélection n’a été effectuée.Lorsque le numéraire devient abondant, après 294, il faut constater que la typologie restreinte des revers ne permet plus de véritable choix iconographique. Du reste la propagande impériale véhiculée par la monnaie tardo-romaine ne se prête plus à des sélections personnelles, du fait de la disparition de l’ancien panthéon devant la religion d’État, Sol Invictus d’abord, puis le christianisme. De même, la réduction du nombre de dénominations de bronze ou billon circulant de concert ne permet plus guère de choix entre forte valeur et petite monnaie. Seul le nombre de pièces déposées peut correspondre à une volonté de dépôt ostentatoire.Les monnaies n’ont généralement pas subi de traitement particulier : un exemplaire est déformé par un grand coup (n° 12, mais la pièce est contremarquée, d’où une éventuelle déformation dès l’origine). Un as de Sabine (n° 46) a été martelé et déformé, sans que l’on puisse affirmer une véritable « marque de consécration ».En revanche, les monnaies ayant subi un passage au feu sont du plus haut intérêt, étant donné leur caractère chronologiquement cohérent.
N° Règne Atelier Date Dénom.113 Constantin I Trèves 313-317 Nummus214 Valentinien I Lyon 364-375 Aes 3215 Valens Lyon ou Arles 364-375 Aes 3220 Valens Rome 367-378 Aes 3228 ? ? 364-378 Aes 3
Ainsi, aucune pièce gauloise ou du Haut-Empire n’a été brûlée : tous les cas recensés datant du IVe s. Bien plus, nous relevons quatre aes 3 d’époque valentinienne ayant subi ce traitement spécifique, soit 8,51 % des monnaies de la période 364-378 (4/47). Il ne peut en aucun cas s’agir d’un simple hasard.
Fig.79 Monnaies de Moyencourt ayant subi l’action du feu.
4. Etude des monnaies (Jean-Marc Doyen)
164 Inrap · Rapport de fouille Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt
Fig.80 Première planche des monnaies romaines (clichés © J.-M. Doyen).
10.
CÉSAR et OCTAVE, Vienne, 36 avant J.-C.→IM[Tête nue de J. César, à g.Légende illisible.Partie arrière d’une proue à dr.Dupondius (½ ) : 8,18 g ; 7 ; 28,6 mm ; usure 10.RPC 517.Objet 384.
11.
GAULE BELGIQUE, bronze au nom de GERMANVS INDVTILLI L, Reims, 19-12 avant J.-C.Anépigraphe.Tête diadémée à dr.]ANVS//INDVTI[Taureau sanglé à g., la patte antérieure g. repliée.Semis d’orichalque : [1,78] g ; 6/7 ; 16,2 mm ; usure ? Forte corrosion.RIC 249 ; RPC 506 ; DOYEN 2007, pp. 65-85.
12.
AUGUSTE : as sénatorial 18-6 avant ou 10-12 après J.-C.Légende illisible.Effigie à dr. Contremarque CAES.Revers fruste. Coup de poinçon triangulaire, très profond.As : 7,19 g ; - ; 25,5 mm ; usure 10.Objet 84.
13.
AUGUSTE, Lyon, 12 ou 7 – 3 avant J.-C.]ΛESA[Tête [laurée] à dr. Petite effigie.Revers fruste.As : [2,84] g ; - ; 23,6 mm ; usure 5 ; forte corrosion.RIC 230 ; GIARD 73.Objet 93 SD prof.
14.
AUGUSTE, Lyon, 12 ou 7-3 avant J.-C.CAESAR/PONTMAXTête laurée dr., un ruban sur le cou.]OMETAVGAutel de Lyon. Sur la tablette, 2 x 3 petits bustes de part et d’autre de deux objets en arc de cercle.As : 5,52 g ; 7 ; 22,8 mm ; usure 7-8.RIC 230 ; GIARD 73 (officine I).Objet 168.
15.
AUGUSTE, Reims, 12 – 8/5 avant J.-C.Légende illisible.Tête nue à dr.→AVGVS[Taureau sanglé chargeant à g.Semis : 1,27 g ; 11 ; 17,6 mm ; usure ? Forte corrosion.RIC 228 ; RPC 509 ; DOYEN, 2007, p. 85-87.Objet 231.
16.
AUGUSTE, atelier secondaire (Cologne ?), 5/3 avant – 9 après J.-C.]MΛXTête laurée à dr. (grande effigie).Revers fruste.As : 6,40 g ; - ; 23,5 mm ; usure 10.RIC 230 ; GIARD 117 (atelier secondaire) ; DOYEN, 2007, p. 51-57.Objet 385.
17.
TIBÈRE, Lyon, 9-14.]AVGVSTFIM[Tête laurée à dr.]OMETAV[Autel de Lyon.As : [5,88] g ; 1h30 ; 23,9 mm ; usure 9-10.Objet 69.
18. TIBÈRE, Lyon, 12-14.TICAESARAVG[ ]VS[ ]VIIAutel de Lyon.Semis : 3,53 g ; 6 ; 19,7 mm ; usure 5.RIC 246 ; GIARD 115.Objet 360.
MONNAIES ROMAINES
165II. Résultats
19.
TIBÈRE, Lyon, 12-14.TICAESARAVGVST-FIMPERATVIITête laurée à dr.ROMET[Autel de Lyon.As : 5,84 g ; 7 ; 24,5 mm ; usure 7/10.RIC 245 ; GIARD 113.Objet 181.
20.
TIBÈRE, Lyon, 9-14.TICAESAR[Tête laurée à dr.Légende illisible.Autel de Lyon.Semis : 3,82 g ; 10 ; 18,3 mm ; usure 8.Objet 144.
21.
AUGUSTE divus sous TIBÈRE : imitation d’un as.XOΛI•I•[Tête nue à dr.[ ]/+Autel dont la partie centrale est grillagée.Ae : 5,38 g ; 8/9 ; 22,9 mm ; usure 6-7.Prototype : Tibère, Rome, 22/3 – 30, RIC 80.Objet 176.
22.
CLAUDE I ( ?), Rome, 41-54.Légende illisible.Tête nue à dr.Revers fruste.Dupondius : 9,89 g ; - ; 25,8 mm ; usure 10.L’arrière de la tête et la découpe du cou font penser à Claude I.Objet 313.
23.
NÉRON, [Lyon], 64-67.]EROCA[Tête nue à dr. [un globe à la pointe du buste].S/CVictoire volant à g., posant la main sur un bouclier avec [SPQR]As : 6,85 g ; 6/7 ; 26,5 mm ; usure 7. Corrosion.Objet 206.
24. NÉRON, Lyon, 66.IMPNEROCAESARAVGPMA[Tête nue à dr., un globe à la pointe du buste.S/CVictoire volant à g., posant la main sur un bouclier portant [SPQR].As : 10,17 g ; 6 ; 28,6 mm ; usure 2.RIC 544 ou 546.Objet 170.
25.
NÉRON, Lyon, 66-67.]MPNEROCAESAR[Tête laurée à dr., un globe à la pointe du cou.S/CVictoire volant à g., posant la main sur un bouclier portant S[ ]RAs : 10,04 g ; 6/7 ; 25,8 mm ; usure 2/6.Objet 381.
26.
VESPASIEN, Lyon, 77-78.IM[ ]ESVESPASIANAVG[ ]IIIPPTête radiée à dr., un globe à la pointe du buste.]/PVBLICAFelicitas ( ?) debout à g., tenant [un caducée ?], et une corne d’abondance.Dupondius : 9,62 g ; 7 ; 26,7 mm ; usure 9.RIC – cf 1211. Le personnage du revers lève le bras droit (Felicitas ?), mais ce type n’est pas attesté à Lyon.Objet 136.
Fig.81 Deuxième planche des monnaie romaines (clichés © J.-M. Doyen).
4. Etude des monnaies (Jean-Marc Doyen)
166 Inrap · Rapport de fouille Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt
27.
DOMITIEN, Rome, 81-96.]OMIT[Tête laurée à dr.AEQVITA[ S/CAequitas debout à g., tenant [une balance], et une corne de d’abondance.As : 7,53 g ; 12 ; 25,2 mm ; usure ? Forte corrosion.Objet 143.
28.
DOMITIEN, Rome, 86.IMPCAESDOMITAVGGE[ ]CO[SX]IICENSPERPPTête laurée à dr.]/AVGVSTI S/CFortuna debout à g., tenant un gouvernail, et une corne d’abondance.As : 9,14 g ; 6 ; 27,6 mm ; usure 6.RIC 487.Objet 52.
29.
DOMITIEN, Rome, 85-96.]ERM/CO[Tête laurée à dr.Revers lisse.Sesterce : 19,78 g ; - ; 34,0 mm ; usure 10.Objet 230.
30.
DOMITIEN, Rome, 14 sept. – 31 déc. 88.Légende illisible.Tête laurée à dr.Légende illisible.Domitien debout à g., sacrifiant au-dessus d’un autel. A g., un joueur de flute et un joueur de lyre. A l’arrière-plan, un temple.As : 6,70 g ; 6 ; 26,9 mm ; usure 10.RIC 623.Objet 387.
31.
DOMITIEN : faux as.IMPCΛESDOMITΛVGGE/RMCOSX[Tête laurée à dr.]ΛΣ/ΛVGVSTI S/CFortuna debout à g., tenant un gouvernail posé sur un globe, et une corne d’abondance.Ae (frappé) : 7,77 g ; 7 ; 25,7 mm ; usure 7. Beau style d’avers.Objet 268.
32.
NERVA, Rome, 96-98.]ESAVG[Tête radiée à dr.Revers lisse.Dupondius : [7,32] g ; - ; 26,7 mm ; usure 10.Objet 204.
33.
TRAJAN, Rome, 98-117.Légende illisible.Effigie à dr.Revers fruste.As : 6,72 g ; - ; 25,0 mm ; usure ? Très forte corrosion.Objet 43 Z2.
Fig.82 Troisième planche des monnaies romaines (clichés © J.-M. Doyen).
167II. Résultats
34.
TRAJAN, Rome, 98-117.IMPCAESTRAIANAVGGERBuste d’Hercule à dr.-/-/SCSanglier à dr.Quadrans : 2,81 g ; 6 ; 15,9 mm ; usure 4.RIC 702 ; MIR 14, 602b.Objet 379.
35.
TRAJAN, Rome, 98-99.]VATRAIA/NAVG[Tête laurée à dr.Légende illisible.Pax assise à g., tenant un rameau, le coude g. reposant sur l’accoudoir.Sesterce : 20,03 g ; 7 ; 34,2 mm ; usure 10.Portrait B1 ; BN 28-32 ou 61.Objet 32 Z.2.
36.
TRAJAN, Rome, 98-99.IMPCAESNERVATRAIAN/AVGGERMPMTête laurée à dr.]/COSII[ S/CVictoire volant à g., posant la main sur un bouclier portant SP/QR.As : 9,04 g ; 6 ; 27,7 mm ; usure 2-3.BMC 727-728 ; RIC 402(a) ; MIR 14, 61a.Objet 197.
37.
TRAJAN, Rome, 98-99.IMPCAESNERVATRAIANAVGGERMPMTête laurée à dr.TRPOT/COSIIPP S/CVictoire volant à g., posant la main sur un bouclier portant SP/QR.As : 8,82 g ; 6/7 ; 27,7 mm ; usure 2-3.RIC 402 ; BMC 727-728 ; MIR 14, 61a.Objet 297.
38.
TRAJAN, Rome, 100.IMPCAESNERVATRA/IANAVGGERMPMTête laurée à dr.]/COSIIIP[ S/CVictoire volant à g., posant la main sur un bouclier portant [SP/QR].As : 8,84 g ; 5h30 ; 26,1 mm ; usure 5.BMC 740-742 ; MIR 14, 82a.Objet 380.
39.
TRAJAN, Rome, 101-102.IMPCAESNERVATRAIANAVGGERMPMTête laurée à dr., une draperie sur le cou.TRPOT/COSIIIIPP S/CVictoire volant à g., posant la main sur un bouclier portant SP/QR.As : 10,40 g ; 6 ; 29,2 mm ; usure 3-4.RIC 434 ; BMC 753-754 ; MIR 14, 113b.Objet 171.
Fig.83 Quatrième planche des monnaies romaines (clichés © J.-M. Doyen).
4. Etude des monnaies (Jean-Marc Doyen)
168 Inrap · Rapport de fouille Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt
40.
TRAJAN, Rome, 107-108.Légende illisible.Buste lauré à dr., détails indistincts.Légende illisible. S/[S]Rome debout à g., tenant une Victoire, et une lance inversée.Sesterce : 15,86 g ; 6 ; 30,8 mm ; usure ? Très forte corrosion.RIC 483 ; MIR 14, 299.Objet 222.
41.
TRAJAN, Antioche, 20 février – 9 décembre 116.IM[ ]IANOOPTIMOA[Buste radié, drapé à dr., vu de dos.]XXCOSV[SC dans une couronne.Ae « dupondius » ou as (orichalque) : 4,81 g ; 6h30 ; 22,9 mm ; usure 9-10.WOYTEK, MIR 14, 937v.Objet 41, Z2.
42.
HADRIEN, Rome, 117-138.Légende illisible.Effigie à dr.Légende illisible.Personnification assise à g.As : 4,09 g ; 7 ; 24,8 x 22,3 mm ; usure 10.Objet 189.
43.
HADRIEN, Rome, 125-128.Légende illisible.Tête laurée à dr.Revers fruste.Sesterce : 18,91 g ; - ; 33,1 mm ; usure 10 ; corrosion. Portrait Mii.Objet 24 Z2.
44.
HADRIEN, Rome, 125-137.]VS/[Effigie nu-tête à dr.Légende illisible.Personnification féminine trônant à g., tenant rameau et ( ?).Sesterce : 15,51 g ; 6/7 ; 30,0 mm ; usure 9.Objet 257.
45.
HADRIEN, Rome, 128.Légende illisible.Effigie à dr., indistincte.Légende illisible.Hilaritas debout à g., tenant une longue palme verticale posée sur le sol, soutenue par un petit personnage masculin. A dr., petit personnage féminin debout à g.Sesterce : 19,66 g ; 6 ; 33,6 mm ; usure 9. Avers très corrodé.BMC 1370-1371 ; HILL, Undated, n° 391.Objet 103.
46.
SABINE sous HADRIEN, Rome, 128.Légende illisible.Buste drapé à dr., portant la stéphanè (coiffure A).Légende illisible.Cérès assise à g., tenant [des épis], et une torche longue.As : 8,15 g ; 6 ; 25,7 mm ; usure 9. Flan martelé et déformé.BMC 1900 et pl. 99, n° 10 ; HILL, Undated, n° 360.Objet 80 Z2 HC.
47.
HADRIEN, Rome, 131.HADRIANVS/AVGVSTVSBuste nu tête, drapé à g., vu de dos.]ITATI [S]/CGalère à g. ; un personnage debout à la poupe. Autres détails indistincts.As : 8,99 g ; 6 ; 26,9 mm ; usure 6-7.BMC 1455-1462 ; HILL, Undated, 467 ou 489.Objet 139.
Fig.84 Cinquième planche des monnaies romaines (clichés © J.-M. Doyen).
169II.Résultats
48.
HADRIEN, atelier oriental, 134-138.HADRIANVS/AVGCOSIIIPPTête laurée à dr.NILVSNilus couché, tenant un rameau incliné, et une corne d’abondante (la pointe tournée vers l’extérieur).Denier : 2,42 g ; 6 ; 18,8 mm ; usure 0.BMC 865 et pl. 63, n° 20 (Rome).Objet 125 Z.2.
49.
HADRIEN, Rome, 136.]CO[Buste nu-tête, drapé à dr., vu de dos.ADVENT[ L’empereur en toge, debout à dr., levant la main dr., faisant face à une Province debout à g., tendant une patère au-dessus d’une autel, et tenant ( ?).Sesterce : 22,78 g ; 5/6 ; 30,2 mm ; usure 10.HILL, Undated, n° 690-709.Objet 318.
50.
HADRIEN : faux dupondius.IMPCΛESΛRTRΛIΛNHΛDRIΛNVSΛVGPMTBuste radié à dr., une draperie sur l’épaule g.ΛETERNIT/Λ/SΛVGVSTI S/CAeternitas debout de face, la tête à g., tenant une tête de Sol et une tête de Luna.Ae : 11,87 g ; 6/7 ; 26,3 mm ; usure 3-4. Pièce frappée, de très bon style.Même coin de revers que BMC 1835 et pl. 97, n° 10, avers à titulature HADRIAN/O•S•AVGVSTO (sic !).Objet 16.
51.
ANTONIN LE PIEUX, Rome, 140.Légende illisible.Tête à dr.Légende illisible.Instruments pontificaux (Flagellum, vase à g., bâton d’augure).As : 8,56 g ; 12 ; 26,3 mm ; usure 4. Forte corrosion.BMC 1379 et pl. 33, n° 2 ; HILL, Undated, n° 271.Objet 29.
52.
FAUSTINE I diva sous ANTONIN LE PIEUX, Rome, 141.]AAVGVSTA/FAVST[Buste drapé à dr., portant une coiffure élaborée.Légende illisible. S/CPietas debout à g., versant de l’encens au-dessus d’un candélabre, et tenant une boîte à parfum.Sesterce : 23,35 g ; 12h30 ; 31,4 mm ; usure 9.BMC 1442-1444 ; HILL, Undated, n° 382.Objet 300.
53.
ANTONIN LE PIEUX, Rome, 140-161.]VSPI/VSPP[Tête laurée à dr.Légende illisible.Personnification (assise ?) à g.Sesterce : 15,75 g ; 1 ; 30,2 mm ; usure ? Très forte corrosion.Objet 279.
Fig.85 Sixième planche des monnaies romaines (clichés © J.-M. Doyen).
4. Etude des monnaies (Jean-Marc Doyen)
170 Inrap · Rapport de fouille 170
54.
ANTONIN LE PIEUX, Rome, 145 ( ?).ANTONINVSAVGPIVSPPTête laurée à dr.TRPOT/[ ]SIIII S/CFelicitas ( ?) debout à g., tenant un globe ( ?), et [une corne d’abondance].As : 7,53 g ; 6/7 ; 26,6 mm ; usure 0/1.BMC - ; HILL, Undated, -.Objet 118 Z2 comblement fossé.
55.
FAUSTINE I diva sous ANTONIN LE PIEUX, Rome, après 148.]IVA/FAVS[Buste drapé à dr., portant une coiffure élaborée.A/VGV/STA S/CCérès debout à g., tenant des épis abaissés, et une torche inclinée.Sesterce : 19,23 g ; 11/12 ; 32,5 mm ; usure 9.BMC 1512 et pl. 36, n° 4.Objet 259.
56.
FAUSTINE II sous ANTONIN LE PIEUX, Rome, après 148.FAVSTINAEAVG/PIIAVGFILBuste drapé à dr., les cheveux en chignon.]/NC/S S/CVénus debout à g., tenant une pomme, et posant la main sur un gouvernail le long duquel est enroulé un dauphin.Sesterce : 19,47 g ; 11 ; 30,7 mm ; usure 7-8.BMC 2148 et pl. 52, n° 3 ; HILL, Undated, -.Objet 75 Z-1 HC.
57.
ANTONIN LE PIEUX, Rome, 151-154.IMPCAESTAELHADRANT/ONIVSAVGPIVSP[Tête laurée à dr.TRPOTXV[ S/C/ANNONAA[Annona assise à g., tenant deux épis au-dessus d’un modius plein d’épis, et une corne d’abondance.Sesterce : 23,07 g ; 6 ; 32,4 mm ; usure 5.BMC 1891-1894 et pl. 46, n° 9 (revers), ou BMC p. 325*.Objet 20 Z2.
58.
ANTONIN LE PIEUX, Rome, 157-158.]NVSAVGPI/VSPP[Tête radiée à dr.]XXI/C/OSIIII[ S/CAnnona debout à g., tenant des épis au-dessus [d’un modius], et tenant un gouvernail vertical.Dupondius : 10,26 g ; 12 ; 25,8 mm ; usure 8.BMC 2044.Objet 83 interzone labour.
59.
ANTONIN LE PIEUX : faux dupondius.Légende indistincte.Effigie radiée à dr.Revers fruste.Ae (cuivre rouge) : 4,37 g ; - ; 22,1 mm ; forte corrosion.Objet 110.
Fig.86 Septième planche des monnaies romaines (clichés © J.-M. Doyen).
Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt
171II. Résultats
60.
[FAUSTINE II sous ANTONIN LE PIEUX ou MARC-AURÈLE, Rome, avant 161-176 : faux as].Légende hors flan.Buste drapé à dr., les cheveux en chignon.Légende illisible.Personnification debout à g., tendant le bras dr., et tenant une corne d’abondance.Ae coulé : [2,44] g ; 6 ; 21,9 mm ; usure 9. Masse originale vers 3 g.Objet 81 Z2 HC.
61.
MARC-AURÈLE, Rome, 173-174.]NTONINVS/[ ]XXVIIIBuste radié, cuirassé ( ?) à dr., vu de dos.IMP[ ]/COS[ -/-/[SC]Jupiter trônant à g., les pieds sur un tabouret, tenant une Victoire, et un sceptre vertical.Dupondius : 10,97 g ; 12 ; 25,0 mm ; usure 8.BMC – cf. 1474, note = COHEN 253.Objet 372.
62.
COMMODE, Rome, 177-192.]MMAN[Tête radiée à dr.Revers lisse.Dupondius : 9,98 g ; - ; 23,1 mm ; usure 10.Objet 38 Z2.
63.
COMMODE, Rome, 181.]M[ ]DVS/ANTONINVSAVGTête radiée à dr.]N•AVGTRPVI•IMPIIIICOSIIIPP S/CAnnona debout à g., tendant des épis au-dessus d’un modius plein d’épis, et tenant une corne d’abondance.Dupondius : 11,50 g ; 12 ; 24,5 mm ; usure 7/4.BMC 463.Objet 50 Recherches chemin.
64.
COMMODE, Rome, 183.MCOMMODVS/ANTONINVSAVGTête laurée à dr.]IMP/VICOS[ S/CFelicitas debout à g., tenant un caducée vertical, et une corne d’abondance.Sesterce : 15,62 g ; 12h30 ; 30,8 mm ; usure 8.BMC 512-513 var (légende d’avers) ; RIC 402 var (idem).Objet 36 Z.2.
65.
COMMODE, Rome, 186.]COMM[Tête radiée à dr.]OSVP[ [S]/C/[ ]ORTR[Fortuna assise à g., tenant un gouvernail, et une corne d’abondance. Sous le siège : une roue.Dupondius : 6,22 g ; 11 ; 21,8 mm ; usure 6-7.BMC – p. 807, note †.Objet 102.
Fig.87 Huitième planche des monnaies romaines (clichés © J.-M. Doyen).
4. Etude des monnaies (Jean-Marc Doyen)
172 Inrap · Rapport de fouille
66.
COMMODE, Rome, 188-189.]ANTPFE/LIXAV[[Tête] laurée à dr.MIN[ S/CMinerve debout à g., tenant une Victoire, et une lance verticale inversée. Contre ses jambes, de part et d’autre, un bouclier. A dr. : un trophée.Sesterce : 16,36 g ; 7 ; 28,6 mm ; usure 9.BMC 628 ou 637.Objet 311.
67.
COMMODE, Rome, 190-191.]NTPFE/LIXA[Tête laurée à dr.]PXVI[ S/CApollon en robe longue, marchant à g., la tête à dr., tenant un plectre, et une lyre posée sur une colonnes.As : 6,74 g ; 11 ; 22,3 x 25,5 mm ; usure 7.BMC 675 et pl. 109, n° 17.N° 79, Z2 HC.
68.
SÉVÈRE ALEXANDRE, Rome, émission 15 : 232.IMPALEXANDERPIVSAVGTête laurée à dr., une draperie sur l’épaule g., visible à l’avant et à l’arrière.PROVIDENTIAAVG S/CAnnona (sic !) debout à g., tendant deux épis au dessus d’un modius plein d’épis, et tenant une corne d’abondance.Sesterce : 17,87 g ; 1 ; 30,1 mm ; usure 6.BMC 881-889 et pl. 29, n° 883.Objet 6.
69.
SALONIN césar sous VALÉRIEN I et GALLIEN, Cologne, 1ère période, 5ème-6ème ém. : 258 – début 259.SALONVALERIANVSCAESBuste radié, drapé à dr., vu de dos.]TASAVGInstruments pontificaux : bâton d’augure, couteau, vase anse à dr., simpulum, flagellum.Antoninien : 3,18 g ; 6 ; 23,0 mm ; usure 0.ELMER 69/107 ; Eauze 1532 ; MIR 914e.Objet 2.
70. GALLIEN, atelier indéterminé, 260-268.GAL[ ]NVS[Tête radiée à dr.Personnification debout.Antoninien : 1,33 g ; 6 ; 17,2 mm ; usure ? Corrosion.Objet 48.
71.
GALLIEN, Rome, 264-266.]LIENVSAVGTête radiée à dr.MAR[ ]FERO A/-/-Mars casqué, en habit militaire, debout à g., brandissant un rameau, tenant une lance et posant la main sur un bouclier.Antoninien : 2,50 g ; 6 ; 19,8 mm ; usure 5.RIC 236 ; Cunetio 1149 (‘good fabric’) ; Normanby 174 ; MIR 570a.Objet 280.
Fig.88 Neuvième planche des monnaies romaines (clichés © J.-M. Doyen).
Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt
173II. RésultatsInrap · Rapport de fouille
72.
GALLIEN, Rome, 264-266.GALLIENVSAVGTête radiée à dr.FID[ ]S/MILITVM -/N/-Fides debout à g., tenant deux enseignes.Antoninien : 2,40 g ; 6 ; 20,8 mm ; usure 1. Restes d’argenture.RIC 192a ; Cunetio 1261 ; Normanby 251 ; MIR 600a.Objet 362.
73.
CLAUDE II, Rome, émission II : 268-270.IMPCCLAV[ ]SAVGBuste radié, cuirassé et drapé à dr., vu de face.]AVG -/-/-Personnification debout à g.Antoninien : 1,64 g ; 1 ; 19,8 mm ; usure 1-2. Restes d’argenture. Forte corrosion.Objet 1.
74.
CLAUDE II, Rome, émission II : 269-270.IMPCCLAVDIVSAVGBuste radié, cuirassé et drapé à dr., vu de dos.VIRT/V/[ ]G -/-/-Marcs casqué, en habit militaire, debout à g., , tenant un rameau redressé, et une lance inversée. Contre sa jambe dr., un bouclier.Antoninien : 1,76 g ; 4h30 ; 20,2 x 21,9 mm ; usure 2. Restes d’argenture.RIC 109 ; Cunetio 1970 ; Normanby 645 ; SCHUTYSER 102.Objet 263.
75.
CLAUDE II divus, Rome, 270.DIVOCL[Tête radiée à dr.CONSE[ ]IOAutel allumé, à quatre compartiments.Antoninien : 1,56 g ; 5/6 ; 21,3 mm ; usure 2. Frappe faible.RIC 261 ; Cunetio 2313.Objet 64.
76.
CLAUDE II divus : hybride de Rome, après 270.IMPCL[ ]AVGBuste radié, cuirassé et drapé à dr., vu de dos.CONSECRATIOAigle à g., la tête à dr.Antoninien : 2,25 g ; 12 ; 18,2 mm ; usure 5.SCHUTYSER 69, même coin de droite que SCHUTYSER 50 (autel allumé, à 4 compartiments).Objet 316.
77.
CLAUDE II divus : imitation italienne.DIVO[Tête radiée à dr.]ECRATIOAutel allumé, orné d’une guirlande.Ae : 0,62 g ; 12 ; 13,6 mm ; usure 8/3. Classe 3. Coin d’avers usé.Objet 111 Z2 comblement fossé Nord.
78.
CLAUDE II divus : imitation italienne (ou fraude de Rome ?).D[ ]OCL[Tête radiée à dr.Légende illisible.Pax debout à g., tenant un rameau, et un sceptre vertical.Ae : 0,84 g ; 6 ; 14,9 x 16,2 mm ; usure 2. Pièce frappée à l’aide de coins probablement officiels.Objet 390.
79.
CLAUDE II divus : imitation italienne.]IIVDIOTête radiée à dr.]C[Autel allumé, orné d’une guirlande.Ae (cuivre orange) : 0,87 g ; 12 ; 12,5 mm ; usure 8/5. Classe 3.Objet 302.
80.
CLAUDE II divus : imitation italienne.DI[ ]AVDIOTête radiée à dr.]CRATIOAutel allumé, orné d’une guirlande.Ae : 1,21 g ; 11/12 ; 14,9 mm ; usure 5. Classe 3.Objet 234.
Fig.89 Dixième planche des monnaies romaines (clichés © J.-M. Doyen).
4. Etude des monnaies (Jean-Marc Doyen)
174 Inrap · Rapport de fouille
81.
CLAUDE II divus : imitation italienne.]IVOCLAIIDIOTête radiée à dr.]ΛCRATIOAigle à g., la tête à dr., sans ligne de terre.Ae : 1,27 g ; 6 ; 16,8 mm ; usure 2. Classe 3.Objet 129, Z2.
82.
CLAUDE II divus : imitation italienne.]IVOCLAVD[Tête radiée à dr.]SECRHATIOAigle à g., la tête à dr.Ae : 1,51 g ; 11 ; 16,2 mm ; usure 9/3. Classe 1 ou plutôt 3.Objet 56.
83.
CLAUDE II divus : imitation italienne.]VOCLAVD[Tête radiée à dr.]SC•CRATI[Autel allumé, à quatre compartiments ornés d’un globule.Ae : 1,74 g ; 12 ; 17,1 mm ; usure 4. Classe 1.Objet 284.
84.
POSTUME, Cologne, 263-265.IMPCPOSTVMVS•P•F•A[Buste radié, cuirassé et drapé à dr., vu de face.FELICI/T-ASAVGFelicitas debout à g., tenant un caducée long vertical, et une corne d’abondance.Antoninien : 3,09 g ; 12 ; 19,1 mm ; usure 1.ELMER 335/598 ; Cunetio 2414 ; AGK 14.Objet 328.
85.
POSTUME : imitation.]IIIVSNCBuste radié, cuirassé et drapé à dr.LΛETIT[ -/-/[ ]Galère à dr.Ae : 5,79 g ; 11 ; 20,2 mm ; usure 2. Corrosion.Objet 232.
86.
VICTORIN, « Cologne », émission III, phase 2 : 269-270.IMPCVICTORINVSPFAV[Buste radié, cuirassé et drapé à dr.]TVS [*]/-Sol radié, nu à l’exception d’une chlamyde, courant à g., [levant la main], et tenant un fouet.Antoninien : 2,25 g ; 12 ; 17,9 mm ; usure 1. Concrétions.ELMER 683 ; Cunetio 2534/2539 ; Normanby 1409 ; AGK 9b.Objet 26.
87.
TÉTRICUS I, « Cologne », émission IV : 272-273.Légende illisible.Buste radié, cuirassé et drapé à dr.Légende illisible.Pax debout à g., tenant un rameau, et un sceptre vertical.Antoninien : 2,01 g ; 5 ; 16,3 mm ; usure 8.ELMER 771/775 ; Cunetio 2603 ; Normanby 1473 ; AGK 8.Objet 188.
88.
TÉTRICUS I, « Cologne », émission IV : 272-273.IMPCTETRICVSPFAVGBuste radié, cuirassé et drapé à dr., vu de face.]A/X/[ ]GPax debout à g., tenant un rameau, et un sceptre vertical.Antoninien : 2,38 g ; 11h30 ; 18,7 mm ; usure 8.ELMER 775 ; Cunetio 2603 ; Normanby 1473 ; AGK 8b.Objet 303.
89.
TÉTRICUS I, « Cologne », émission Vb : 273-274.]GBuste radié, cuirassé et drapé à dr.]/SAV[Salus debout à g., tendant une patère à un serpent sortant d’un autel, et posant la main sur une ancre.Antoninien : [1,32] g ; 6 ; 15,2 mm ; usure 1.ELMER 779 ; Cunetio 2617 ; Normanby 1492 ; AGK 10a.Objet 193.
Fig.90 Onzième planche des monnaies romaines (clichés © J.-M. Doyen).
Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt
175II. Résultats
90.
TÉTRICUS I, « Cologne », 271-274.IMP[Buste radié, cuirassé à dr., vu de face.Légende illisible.Personnification debout à g.Antoninien : 1,60 g ; 1 ; 16,0 mm ; usure 7.Objet 4.
91.
TÉTRICUS I, « Trèves », émission VII : 273-274.]PTETRICV[Buste radié, cuirassé à dr., vu de face.]IL[Hilaritas debout à g., tenant une palme longue, et une corne d’abondance.Antoninien : 1,67 g ; 6 ; 16,7 mm ; usure 2.ELMER 789 ; Cunetio 2648 ; Normanby 1489 (« Cologne », ém. Va); AGK 4c ; attribué à « Trèves » dans TM XIV, 1993, p. 64.Objet 19 Z2.
92.
TÉTRICUS II, atelier indéterminé, 271-274.]CAE[Buste radié, drapé à dr., vu de dos.Revers fruste.Antoninien : 1,57 g ; - ; 16,5 mm ; usure ? Forte corrosion.Objet 389.
93.
TÉTRICUS I : imitation.]RIVSP[ (sic !)Effigie barbue, radiée à dr.]ΛV/SΛ[Salus ( ?) debout à g., le bras dr. abaissé tenant ( ?), le g. posé sur [une ancre ?].Ae : [0,79] g ; 6/7 ; 14,5 x 12,4 mm ; usure 3-4. Classe 3.Objet 357.
94.
TÉTRICUS I : imitation.]LIIVCBuste radié, cuirassé à dr., vu de face.]/III[Pax debout à g., tenant un rameau, et un sceptre vertical.Ae : 0,91 g ; 7 ; 15,6 mm ; usure 6-7. Classe 3.Objet 233.
95.
TÉTRICUS I : imitation.Légende hors-flan.Buste barbu, radié, cuirassé à dr. (portrait de Tétricus I).PHX/[Pax debout à g., tenant une couronne, et une palme verticale reposant sur le sol. (sic !).Ae : 1,55 g ; 12 ; 14,6 mm ; usure 4. Classe 1.Objet 195.
96.
TÉTRICUS I : imitation.]TETTRICVSPΓΛVCBuste radié, cuirassé (et drapé ?) à dr., vu de face.VIC[ ]/Λ/IIVCVictoire marchant à g., tenant une couronne, et une palme.Ae : 1,92 g ; 6 ; 17,9 mm ; usure 2. Classe 1. Très beau style.Objet 15.
97.
TÉTRICUS I : imitation.]P[ ]ICVSΛVCBuste radié à dr.]/VV[Personnification debout à g., tenant un trident vertical, et ( ?).Ae : 2,00 g ; 11 ; 15,4 x 13,4 mm ; usure 6. Classe 3.Objet 135.
98.
TÉTRICUS I : imitation.]PΛVCBuste radié, cuirassé et drapé à dr., vu de face.]ΛVCInstruments pontificaux : de g. à dr. : flagellum, couteau, vase anse à dr., simpulum.Ae : 2,13 g ; 1h30 ; 16,3 mm ; usure 7-8. Classe 1.Objet 140.
Fig.91 Douzième planche des monnaies romaines (clichés © J.-M. Doyen).
4. Etude des monnaies (Jean-Marc Doyen)
176 Inrap · Rapport de fouille
99.
IMITATION RADIÉE.Légende illisible.Effigie radiée à dr.Légende illisible.Jupiter debout à g., tenant un sceptre vertical, et un foudre abaissé.Ae : [fragment] ; 10 ; - mm ; usure 2. Classe 1.Objet 200.
100.
IMITATION RADIÉE.Légende hors-flan.Effigie (barbue ?), radiée à dr.Revers indistinct.Ae : [0,16] g ; - ; 8,0 mm ; usure 6. Classe 4. Masse originale vers 0,25 g.Objet 290.
101.
IMITATION RADIÉE.Légende hors-flan.Buste barbu, radié, cuirassé et drapé à dr., vu de face.Anépigraphe. */-Personnage radié, la tête de face, courant à g., tenant un long objet recourbé.Ae : 0,47 g ; 9 ; 11,6 mm ; usure ? Classe 3/4.Objet 89.
102.
IMITATION RADIÉE.Légende hors-flan.Buste barbu, radié, cuirassé à dr., vu de face.]V/vDPersonnage radié en robe longue, debout à dr., tenant ( ?), et une longue palme verticale.Ae : [0,50] g ; 6 ; 13,6 mm ; usure 5-6. Classe 3.Objet 244.
103.
IMITATION RADIÉE.]SP[Effigie radiée à dr.Revers indistinct.Ae : [0,57] g ; - ; 13,1 mm. Classe 3.Objet 292.
104.
IMITATION RADIÉE.Légende hors flan.Effigie barbue, radiée à dr.]C/ITOFemme debout à g., tenant [ ?], et tendant le bras g.Ae : 0,92 g ; 11 ; 11,9 mm ; usure 2-3. Classe 3/4.Objet 137.
105.
IMITATION RADIÉE.]P[Tête barbue, radiée, à dr., très stylisée.Λ/[ ]�XIPersonnification debout à dr., la tête à g., le bras dr. tendu, le g. tenant un bâton vertical.Ae : 2,11 g ; 5/6 ; 13,3 mm ; usure 1-2. Classe 1. Flan très épais et irrégulier.Objet 53.
106.
IMITATION RADIÉE.]VSII[Tête barbue, radié, à dr.]/C/[ ]VPersonnification casquée debout à dr.,tenant ( ?) du bras dr. abaissé, et tenant un bâton vertical.Ae : 2,52 g ; 1 ; 16,1 mm ; usure 3. Classe 1.Objet 310.
107.
MAXIMIEN HERCULE, Lyon, 10ème ém. : 1er mars – 20 nov. 293.IMP[ ]XIMIANVSPAVGBuste radié, cuirassé à dr., vu de face.PAX/A/VGG -/-/CPax debout à g., tenant un globe nicéphore, et un sceptre oblique.Antoninien : 2,97 g ; 5/6 ; 22,4 mm ; usure 1. Restes d’argenture, forte corrosion.RIC 3987 ; BASTIEN 515.Objet 335.
Fig.92 Planche des imitations (clichés © J.-M. Doyen).
Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt
177II. Résultats
PÉRIODE 294-318
ATELIER DE LONDRES ATELIER DE TRÈVES
108.
CONSTANTIN I, Londres, fin 309 – mi-311.IMPCONSTANTINVSPFAVGBuste lauré, cuirassé à dr.MARTICON/SERVATORI T/F/PLNMars casqué, en habit militaire, tenant une lance inversée, et posant la main sur un bouclier.Nummus : 5,22 g ; 7 ; 24,4 mm ; usure 1.RIC 119 ; DEPEYROT, 2001, p. 36.Objet 25.
109.
GALÈRE MAXIMIEN, Trèves, 296-297.MAXIMIANVSNOBCAESTête laurée à dr.GENIOPOPV/LIROMANI A/Γ/TRGénie nu à l’exception d’une chlamyde, debout à g., coiffé d’un calathos, tenant une patère, et une corne d’abondance.Nummus : 6,81 g ; 6 ; 25,2 mm ; usure 2.RIC 213b ; DEPEYROT, 2001, p. 38.Objet Z2 HC.
110.
CONSTANTIN I, Trèves, fin 309 – début 313.CONSTANTINVSPFAVGBuste lauré, cuirassé à dr.SOLIINVIC/TOCOMITI T/F/PTRSol radié, nu à l’exception d’une chlamyde, debout à g., levant la main, et tenant un globe.Nummus : 3,81 g ; 12 ; 22,3 mm ; usure 3.RIC 873 ; DEPEYROT, 2001, p. 43.Objet 159.
111.
LICINIUS I, Trèves, fin 313 – mi-317.IMPLICINIVSPFAVGBuste lauré, cuirassé à dr., vu de face.GENIO/POPROM T/F/ATRGénie nu, portant une couronne tourelée, les hanches drapées dans l’himation, tenant une patère, et une corne d’abondance.Nummus : 1,35 g ; 6/7 ; 21,3 mm ; usure 0/1.RIC 121 ; DEPEYROT, 2001, p. 73.Objet 223.
112.
CONSTANTIN I, Trèves, mi-317 – début 318.CONSTANTINVSPFAVGBuste lauré, cuirassé à dr.SOLIINVIC/TOCOMITI T/F/•ATRSol radié, nu à l’exception d’une chlamyde, debout à g., levant la main, et tenant un globe (var. A).Nummus : 2,54 g ; 12 ; 19,3 mm ; usure ? Forte corrosion.RIC 135 var A ; DEPEYROT, 2001, p. 74.Objet 337.
113.
CONSTANTIN I, Trèves, fin 313 – mi-317.CONSTANTINVSPFAVGBuste lauré, cuirassé à dr., vu de face.SOLIINVIC/TOCOMITI T/F/ATRSol radié, nu à l’exception à l’exception d’une chlamyde, debout à g., levant la main, et tenant un globe.Nummus : [2,13] g ; 5h30 ; 19,7 mm ; usure 0. Restes d’argenture. Pièce brûlée.RIC 105 ; DEPEYROT, 2001, p. 73.Objet 264.
114.
CONSTANTIN I, Trèves, 313 – mi-318.IMP[ ]STANTINVSAVGBuste lauré, cuirassé à dr.MA[ ]CON/SERVATORI T/F/[ ]Mars casqué, en habit militaire, debout à dr., la tête à g., tenant une lance pointée vers le bas, et posant la main sur un bouclier.Nummus : [1,86] g ; 6 ; 18,8 mm ; usure 0. Argenture intacte.RIC 50 ou 111 ; DEPEYROT, 2001, p. 73.Objet 283.
Fig.93 Planche des monnaies de la période 294-318 (clichés © J.-M. Doyen).
4. Etude des monnaies (Jean-Marc Doyen)
178 Inrap · Rapport de fouille
PÉRIODE 318-330
ATELIER DE TRÈVES
115.
CONSTANTIN I, Trèves, mi-317 – début 318.CONSTANTINVSPFAVGBuste lauré, cuirassé à dr.SOLIINVIC/TO[ T/F/BTRSol radié, nu à l’exception d’une chlamyde, debout à g., levant la main, et tenant un fouet (var. B).Nummus : 2,93 g ; 5/6 ; 20,6 mm ; usure 1.RIC 135, var. B ; DEPEYROT 2001, p. 74.Objet 342.
ATELIER DE LYON
116.
CONSTANCE CHLORE, Lyon, 302 – mi-304.CONSTANTIVSNOBCBuste lauré, cuirassé à g., portant un sceptre sur l’épaule dr.GENIOPOP/VLIROMANI Î/B/PLGGénie nu à l’exception d’une chlamyde, coiffé d’un modius, debout g., tenant une patère, et une corne d’abondance.Nummus : 8,12 g ; 6 ; 26,8 mm ; usure 0-1.RIC 167(a) ; BASTIEN 311.Objet 278.
117.
CONSTANTIN I, Trèves, fin 323 – 324.CONSTAN/TINVSAVGTête laurée à dr.SARMATIA/DEVICTA -/-/PTR Victoire marchant à dr., tenant une palme et un trophée sur l’épaule dr., posant le pied sur un ennemi assis à dr., retournant la tête.Nummus : 1,69 g ; 6 ; 19,9 mm ; usure 0. Argenture intacte.RIC 435 ; DEPEYROT, 2001, p. 76.Objet 196.
118.
CRISPUS, Trèves, fin 324 – mi-325.FLIVLCRISPVSNOBCAESBuste lauré, cuirassé et drapé à g.PROVIDEN/TIAEAVGG (sic !) -/-/STRPorte de camp surmontée de deux tourelles. Au-dessus : une étoile.Nummus : 3,56 g ; 12 ; 18,1 mm ; usure 0. Argenture intacte.RIC – cf 449 (Constantin I) et cf. 452 (Crispus, mais CAESS et pas AVGG). Hybride utilisant un revers de Constantin I ; DEPEYROT, 2001, p. 77 pour la date.
119.
CONSTANTIN II césar, Trèves, mi-325 – début 327.CONSTANTINVSIVNNOBCBuste lauré, cuirassé et drapé à g., vu de face.PROVIDEN/TIAECAESS -/-/PTR Porte de camp surmontée de deux tourelles. Au-dessus : une étoile.Nummus : 2,89 g ; 5/6 ; 18,9 mm ; usure 0. Argenture intacte.RIC 479 ; DEPEYROT, 2001, p. 77.Objet 250.
120.
CONSTANCE II césar, Trèves, mi-325 – début 327.FLIVLCONSTANTIVSNOBCBuste lauré, cuirassé et drapé à g.PROVIDEN/TIAECAESS -/-/STR Porte de camp surmontée de deux tourelles. Au-dessus, une étoile.Nummus : 1,74 g ; 6 ; 19,6 mm ; usure 3-4.RIC 480 ; DEPEYROT, 2001, p. 77.Objet 321.
121.
CONSTANTIN I, Trèves, mi-327 – début 329.CONSTAN/TINVSAVGTête laurée à dr.PROVIDEN/TIAEAVGG -/-/PTREPorte de camp surmontée de deux tourelles. Au-dessus : une étoile.Nummus : 2,88 g ; 6 ; 18,5 mm ; usure 0.RIC 504 ; DEPEYROT, 2001, p. 77.Objet 173.
122.
CONSTANTIN I, Trèves, mi-327 – début 329.CONSTAN/TINVSAVGTête laurée à dr.PROVIDEN/TIAEAVGG -/-/STREPorte de camp surmontée de deux tourelles. Au-dessus : une étoile.Nummus : 1,85 g ; 5/6 ; 18,5 mm ; usure 0/1.RIC 504 ; DEPEYROT, 2001, p. 77.Objet 261.
Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt
Fig.94 Planche des monnaies de la période 294-318 et 318-330 (clichés © J.-M. Doyen).
179II. Résultats
PÉRIODE 318-330
ATELIER DE TRÈVES
ATELIER D’ARLES
ATELIER DE LYON
123.
CONSTANTINOPOLIS, Trèves, mi-331 – début 333.CONSTA[ ]LISBuste casqué et lauré à g., revêtu de l’habit impérial, un sceptre sur l’épaule g.Anépigraphe. -/-/TRP•Victoire debout à g., le pied dr. sur une proue, tenant un sceptre oblique, et posant la main sur un bouclier.Nummus : 1,78 g ; 11 ; 16,2 mm ; usure 2.RIC 530 ; DEPEYROT, 2001, p. 100.Objet 312.
124.
CONSTANTINOPOLIS, Trèves, 333.CONSTAN/[ ]LISBuste casqué et lauré à g., revêtu de l’habit impérial, un sceptre sur l’épaule g.Anépigraphe. -/-/TRS*Victoire debout à g., le pied dr. sur une proue, tenant un sceptre oblique, et posant la main sur un bouclier.Nummus : 1,47 g ; 1 ; 18,1 x 15,7 mm ; usure 0-1.RIC 548 ; DEPEYROT, 2001, p. 100.Objet 185.
125.
CONSTANTIN I, Lyon, 330-335.]NSTANTI/[ ]AV[Buste diadémé (rosettes), [cuirassé et drapé] à dr.GLOR[ ]/ITVS -/-/•PL[Deux enseignes entre deux soldats.Nummus : [0,86] g ; 6/7 ; - mm ; usure 1-2. Forte corrosion.Objet 100 Z2 US 1.
126.
CONSTANTIN II césar, Lyon, 331.]NSTAN[ ]SIVNNOBCBuste lauré, cuirassé à dr., vu de face.GL[ ]ERC/ITVS -/-/ PLGDeux enseignes entre deux soldats.Nummus : [1,42] g ; 6 ; 17,0 mm ; usure 0-1.RIC 249 ; BASTIEN 209.Objet 7.
127.
CONSTANTIN II césar, Lyon, 331.CONSTANTINVSIVNNOBCBuste lauré, cuirassé à dr., vu de face.GLOR/IAEXERC/ITVS -/-/ PL[Deux enseignes entre deux soldats.Nummus : 1,69 g ; 12 ; 16,7 mm ; usure 3-4.RIC 254 ; BASTIEN 219.Objet 388.
128. CONSTANTIN I, Lyon, 332.CONSTANTI/NVSMAXAVGBuste diadémé (rosettes), cuirassé et drapé à dr.GLOR/IAEXERC/ITVS -/-/•PLGDeux enseignes entre deux soldats.Nummus : 1,32 g ; 6 ; 16,3 mm ; usure 0.RIC 243 ; BASTIEN 229.Objet 252.
129.
CONSTANCE II césar, Arles, mi-330 – mi-331.FLIVLCONSTANTIVSNO[Buste lauré, cuirassé et drapé à dr., vu de face.GLOR/IAEXERC/ITVS */SCONSTDeux enseignes entre deux soldats.Nummus : [1,33] g ; 12 ; 18,3 mm ; usure 1.RIC 347 ; DEPEYROT, Arles, n° 42/3.Objet 224.
130.
URBS ROMA, Arles, mi-330 – mi-331.VRBS/[Buste casqué à g., revêtu de l’habit impérial.Anépigraphe. -/-/PCONST[*]Louve à g., allaitant les Jumeaux. Au-dessus : 2 étoiles.Nummus : 1,10 g ; 11 ; 15,7 mm ; usure 2-3.RIC 343 ou 351 ; DEPEYROT, Arles, 41/4 ou 42/5.Objet 313.
131.
CONSTANTIN I, Arles, 334 – début 335.]STANTI/[ ]VSMAXAVGBuste diadémé (rosettes), cuirassé et drapé à dr.GLOR/[ ]/ITVS /SCONSTDeux enseignes entre deux soldats.Nummus : 1,25 g ; 11 ; 15,8 mm ; usure 1.RIC 375 ; DEPEYROT, Arles, n° 47/1.Objet 98.
Fig.95 Deuxième planche des monnaies de la période 318-330 (clichés © J.-M. Doyen).
4. Etude des monnaies (Jean-Marc Doyen)
180 Inrap · Rapport de fouille
ATELIER DE ROME ATELIER DE SISCIA
132.
CONSTANCE II césar, Rome, 330.FLIVLCONSTANTIVSNOBCBuste lauré, cuirassé et drapé à dr.GLOR/IAEXERC/ITVS -/-/RFTDeux enseignes entre deux soldats.Nummus : 2,15 g ; 6 ; 17,3 mm ; usure 6/2.RIC 329.Objet 158.
133.
CONSTANTIN I, Rome, 333-335.CONSTANTI/NVSMAX[Buste diadémé (rosettes), cuirassé et drapé à dr.]/IAEXERC/[ R PDeux enseignes entre deux soldats.Nummus : [1,27] g ; 11 ; 17,0 mm ; usure 2.RIC 350.Objet 3.
ATELIERS INDÉTERMINÉS
134.
CONSTANCE II césar, Siscia, 330-335.FLIVLCONSTANTIVSNOBCBuste lauré, cuirassé à dr., vu de face.GLOR/IAEXERC/ITVS -/-/[ ]SIS[Deux enseignes entre deux soldats.Nummus : 1,36 g ; 6 ; 18,2 mm ; usure 0-1.RIC 221 ou 237.Objet 141.
135.
CONSTANTINOPOLIS, Trèves ou Arles, 333-334.CONS[ ]AN/[Buste caqué et lauré à g., revêtu de l’habit impérial, un sceptre sur l’épaule g.Anépigraphe. /-/[ ]Victoire debout à g., le pied dr. sur une proue, tenant un sceptre oblique, posant la main sur un bouclier.Nummus : [1,06] g ; 6 ; 16,3 mm ; usure 5.Objet 142.
136.
CONSTANCE II césar, atelier indéter-miné, 330-335.FLIVLCONSTANTIVSNOBCBuste lauré, cuirassé et drapé à dr., vu de face.GLOR/IAEXERC/ITVS -/-/[ ]Deux enseignes entre deux soldats.Nummus : [1,59] g ; 5 ; 17,5 mm ; usure 1.Objet 296.
137.
Empereur et atelier indéterminés, 330-335.Légende illisible.Buste lauré, cuirassé et drapé à dr.Légende illisible. -/-/[ ]Deux enseignes entre deux soldats.Nummus : [0,72] g ; 1 ; - mm ; usure 1.Objet 255.
138.
URBS ROMA, atelier indéterminé, 330-337 ou 337-340.VRBS/[Buste casqué à g., revêtu de l’habit impérial.Anépigraphe. -/-/[ ]Victoire à g., comme type.Nummus : [0,76] g ; 6/7 ; - mm ; usure 2.Objet 201.
Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt
Fig.96 Troisième planche des monnaies de la période 318-330 (clichés © J.-M. Doyen).
181II. Résultats
PÉRIODE 330 - 337
ATELIER DE TRÈVES
ATELIER DE LYON ATELIER D’ARLES
139.
CONSTANCE II, Trèves, mi � fin 337.FLIVLCONSTANTI[Buste lauré, cuirassé à dr.GLORI/AEX[ -/-/TRS•Une enseigne entre deux soldats.Nummus : 1,68 g ; 6/7 ; 13,2 mm ; usure 0/1.RIC 50 ; DEPEYROT, p. 101. Il n’y a pas de place pour un globule à g. de la marque.Objet 269.
140.
HELENA, Trèves, mi – fin 337.FLIVLHE/LENA[Buste lauré, drapé à dr.]X[ ]BLIC[ -/-/•TRP•Pax debout à g., tenant un rameau abaissé, et un sceptre oblique.Nummus : 1,23 g ; 7 ; 15,2 mm ; usure 0-1.RIC 63 ; DEPEYROT, 2001, p. 101.Objet 97.
141.
CONSTANTIN II, Trèves, 337-340.]N/TINVSAVGBuste diadémé (rosettes), cuirassé et drapé à dr.GLORI/AEXER/[ -/-/TRS[Une enseigne entre deux soldats.Nummus : [0,84] g ; 1 ; 13,6 mm ; usure 0.Objet 294.
142.
CONSTANT I, [Trèves], 340 – mi-341.CONSTANS/[ ]VGBuste diadémé (rosettes), cuirassé et drapé à dr.]R[ ]/AEXER/CIT[ M/[ ]Une enseigne entre deux soldats.Nummus : [0,49] : 12 ; 15,9 mm ; usure 1-2.RIC 111 ; DEPEYROT, 2001, p. 102.Objet 90.
143.
CONSTANT I, Trèves, mi-340 – mi-341.]NSTANS/PFAVGBuste diadémé (rosettes), cuirassé et drapé à dr.GLOR/[ ]EXER/CITVS M/TRP Une enseigne entre deux soldats.Nummus : 1,26 g ; 12 ; 14,1 mm ; usure 0.RIC 111 ; DEPEYROT, 2001, p. 102.Objet 213.
144.
CONSTANCE II, Trèves, 337-341.]LIVLCONSTANTIVSAVGBuste lauré, cuirassé et drapé à dr.GLORI/AEXER[ ]I[ -/-/[ ]TRS[Une enseigne entre deux soldats.Nummus : 1,74 g ; 12 ; 13,5 mm ; usure 1.Objet 301.
145.
CONSTANCE II, Lyon, 341.CONSTANTI[Buste lauré, cuirassé et drapé à dr.GLOR[ I/[ ]Une enseigne entre deux soldats.Nummus : [0,87] g ; 7 ; 14,2 mm ; usure 0-1.RIC 26 ; BASTIEN 39.Objet 229.
146.
Empereur indéterminé, [Arles], début – mi-337 ou 340.Légende illisible.Buste diadémé (rosettes), [cuirassé et drapé] à dr.Légende illisible X/[ ]Une enseigne entre deux soldats.Nummus : [0,48] g ; 11/12 ; - mm ; usure 3-4.DEPEYROT, 2001, p. 109.Objet 323.
147.
CONSTANCE II, Arles, fin 337 – début 338.]ONSTA/NTIVSAVGBuste diadémé (perles), cuirassé et drapé à dr.GL[ ]ERC/ITVS C/SCONSTUne enseigne entre deux soldats.Nummus : 1,24 g ; 12h30 ; 15,2 mm ; usure 1.RIC 3 (marque O) ; DEPEYROT, Arles, n° 54/3 (marque O/PCONST). Notre pièce semble porter une lettre ouverte à dr. Erreur de graveur ou marque nouvelle ?Objet 77 Z2 labour.
Fig.97 Quatrième planche des monnaies de la période 318-330 (clichés © J.-M. Doyen).
4. Etude des monnaies (Jean-Marc Doyen)
182 Inrap · Rapport de fouille
ATELIER D’ARLES ATELIERS INDÉTERMINÉS
148.
Empereur indéterminé, [Rome], 337-340.]LCONS[Buste diadémé (rosettes), [cuirassé et drapé] à dr.]TASRE[ -/-/[ ]Securitas debout à g., les jambes croisées, tenant un sceptre, et s’appuyant sur une colonne.Nummus : fragment ; - mm ; usure 0.Objet 198.
149.
THEODORA, atelier indéterminé, 337-341.FLIV[ ]OR[ ]EAVGBuste drapé à dr.]AS/ROMAN[ -/-/[ ]Pietas debout à g., tenant un enfant dans les bras.Nummus : [0,93] g ; 6 ; 15,1 mm ; usure 1.Objet 246.
150.
THEODORA, atelier indéter-miné, 337-340.]HEO/DORAEAVGBuste drapé à dr.]ETAS/ROMANA -/-/[ ]S[Pietas debout à g., tenant un enfant dans les bras.Nummus : 1,11 g ; 6 ; 15,0 mm ; usure 4-5. Forte corrosion.Objet 331.
151.
HELENA, atelier indéter-miné, 337-340.]A[VG]Buste lauré, drapé à dr.]/XP[ -/-/[ ]Pax debout à g., tenant un rameau abaissé, et un sceptre oblique.Nummus : [0,63] g ; 12 ; - mm ; usure 1.Objet 226.
IMITATION DE LA PÉRIODE 330 - 341
152.
Imitation de Gloria exercitus (2).Avers fruste.Légende illisible. -/-/[ ]Deux enseignes entre deux soldats.Ae : 0,57 g ; - ; 11,0 mm ; usure 3-4. Corrosion.Objet 49.
153.
Imitation ( ?) de Gloria exercitus (2).Avers fruste.Légende illisible.Deux enseignes entre [2] soldats (seul celui de dr. est visible).Ae : 1,00 g ; - ; 12,8 mm ; usure ? Forte corrosion.Objet 33 Z2.
154.
Imitation de Gloria exercitus (2).]AVGBuste diadémé (rosettes), cuirassé et drapé à dr.]LOR/AEXERC/ (sic !) -/-/[ ]Deux enseignes entre deux soldats.Ae : 1,31 g ; 7 ; 13,6 mm ; usure 1-2. Ex. de très bon style.Objet 165.
155.
Imitation de Gloria exercitus (1).Légende hors-flan.Buste diadémé (perles ?), cuirassé et drapé à dr.Légende illisible. -/-/[ ]Une enseigne entre [deux] soldats.Ae : [0,38] g ; 12 ; 10,7 mm ; usure 2. Une moitié (pièce cassé).Objet 120.
156.
Imitation de Gloria exercitus (1).Légende illisible.Buste (lauré ?), cuirassé et drapé à dr.Légende illisible.Une enseigne entre deux soldats. Scène peu lisible.Ae : [0,55] g ; - ; 10,5 mm ; usure ?Objet 215.
157.
Imitation de Gloria exercitus (1).Avers fruste.Légende illisible.Une enseigne entre deux soldats.Ae (cuivre rouge) : 0,64 g ; -m 11,5 mm ; usure ? Forte corrosion.Objet 391.
158.
Imitation de Gloria exercitus (1).CONSTAN/PIAVI (sic !)IIII/II[ ]/IIIII -/-/[ ]Une enseigne entre deux soldats.Ae : 0,71 g ; 7 ; 12,1 mm ; usure 0.Objet 192.
159.
Imitation de Gloria exercitus (1).CON[ ]NOBS (B en miroir).Buste diadémé (rosettes), cuirassé et drapé à dr.]/□IXIIII/CITVII -/-/RRUne enseigne entre deux soldats.Ae : 0,89 g ; 6 ; 13,7 mm ; usure 0/1.Objet 308.
Fig.98 Cinquième planche des monnaies de la période 318-330 et imitation de la période 330-341 (clichés © J.-M. Doyen).
Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt
183II. Résultats
ATELIER DE TRÈVES
PÉRIODE 341 - 348
160.
Imitation de Gloria exercitus (1).]VLCONSTANTIVSA[ ]GBuste lauré, cuirassé et drapé à dr.GLOR[ -/-/PLGUne enseigne entre deux soldats.Ae : 0,98 g ; 5/6 ; 13,0 mm ; usure 3.Objet 371.
161.
Imitation d’Urbs Roma.VRBS/ROMABuste casqué à g., cuirassé (plutôt que drapé dans l’habit impérial).Anépigraphe. -/-/PLG[Louve à g., allaitant les Jumeaux. Au-dessus : 2 étoiles.Ae : 1,40 g ; 11h30 ; 13,6 mm ; usure 3/1. Pièce de bon style. Bastien ne recense pas, après 335, de marque non précédé d’un symbole, et après 337, le type urbain semble abandonné.Objet 131.
162.
Imitation d’Urbs Roma.]/ROMABuste casqué à g., revêtu de l’habit impérial.Anépigraphe. Louve à g., allaitant les Jumeaux. Au-dessus : deux étoiles.Ae : 1,39 g ; 6 ; 12,7 mm ; usure 3.Objet 76.
163.
Imitation d’Urbs Roma.Légende hors flan.Buste casqué à g., revêtu de l’habit impérial.Anépigraphe. X[ ]/[ ]Louve à g., allaitant les Jumeaux.Ae : 0,57 g ; 12 ; 9,7 mm ; usure 2.Objet 88.
164.
Imitation de Constantinopolis.]/V[Buste casqué, lauré à g.Anépigraphe. /-/[ ]Victoire debout à g., le pied dr. posé sur une proue, tenant un sceptre oblique, posant la main sur un bouclier.Ae : 0,47 g ; 1 ; 10,2 mm ; usure 1.Objet 324.
165.
Imitation constantinienne indéterminée.Avers fruste.Personnification debout à g.Ae : [0,15] g ; 8,7 mm.Objet 235.
166.
Empereur indéterminé, Trèves, 341.Légende illisible.Buste à dr.Légende illisible. M/[ ]Deux Victoires face à face, tenant chacune une couronne.Nummus : (fragment) ; 11 ; - mm ; usure 0.GRICOURT, RSN 77, 1998, p. 137.Objet 265.
167.
CONSTANT I, Trèves, 341-342.]/SPFAVGBuste diadémé (perles), cuirassé et drapé à dr.VICTO[ ]ED[ D/TR[Deux Victoires face à face, tenant chacune une couronne.Nummus : [0,49] g ; 1éh30 ; - mm ; usure 0.RIC 196 ; GRICOURT, RSN 77, 1998, p. 137.Objet 242.
168.
CONSTANT I, Trèves, 341-342.]AN/SPFAVGBuste diadémé (perles), cuirassé et drapé à dr.]DDAVGGQNN D/TRSDeux Victoires face à face, tenant chacune une couronne.Nummus : 0,96 g ; 7 ; 14,5 mm ; usure 0.RIC 196 ; GRICOURT, RSN 77, 1998, p. 137.Objet 304.
169. Empereur indéter-miné, [Trèves], 341.]AVGBuste diadémé (rosettes), cuirassé et drapé à dr.]DN[ M/[ ]Deux Victoires face à face, tenant chacune une couronne.Nummus : [0,51] g ; 12 ; - mm ; usure 1.Un globule au-dessus du M.RIC 180-182 ; GRICOURT, RSN 77, 1998, p. 137.Objet 241.
Fig.99 Planche des imitations de la période 330-341 et monnaies de l’atelier de trèves pour la période 341-348 (clichés © J.-M. Doyen).
4. Etude des monnaies (Jean-Marc Doyen)
184 Inrap · Rapport de fouille
170.
CONSTANT I, Trèves, 342-343.CONS[ ]AN/SPFAVGBuste diadémé (rosettes), cuirassé et drapé à dr.VICTORIAED[ /TRPDeux Victoires face à face, tenant chacune une couronne.Nummus : [0,71] g ; 1 ; 14,7 mm ; usure 1.RIC 185 ; GRICOURT, RSN 77, 1998, p. 137.Objet 382.
ATELIER D’ARLES ATELIERS INDÉTERMINÉS
171.
[CONSTAN I], Arles, fin 341 – début 342.]ON[Buste diadémé (rosettes), cuirassé et drapé à dr.VICTORIA[ MA (en ligature)/SARLDeux Victoires face à face, tenant chacune une couronne.Nummus : [0,84] g ; 12h30 ; 13,0 mm ; usure 0.RIC 80 ; DEPEYROT, Arles, 65/3.. Le buste portant un diadème de rosettes est attesté seulement pour Constant.Objet 245.
172.
CONSTANT I, atelier indéter-miné, 341-348.]ONSTAN/SPFAVGBuste diadémé (perles), cuirassé et drapé à dr.]ORIAEDDAVGGQN[ /[ ]Deux Victoires face à face, tenant chacune une couronne.Nummus : 1,31 g ; 12 ; 13,6 mm ; usure 0.Objet 40 Z2.
173.
CONSTANCE II, atelier indéterminé, 341-348.]ONSTANTI/[ ]SP[Buste lauré, cuirassé et drapé à dr.VICT[ ]GQN[ -/-/[ ]Deux Victoires face à face, tenant chacune une couronne.Nummus : [0,91] g ; 6/7 ; - mm ; usure 0/1.Objet 214.
174.
CONSTANT I, atelier indéter-miné, 341-348.]STAN/SPF[Buste diadémé (rosettes), [cuirassé et drapé] à dr.]QNN -/-[ ]P[Deux Victoires face à face, tenant chacune une couronne.Nummus : [0,98] g ; 6 ; 15,1 mm ; usure 2.Objet 216.
175.
Imitation de Victoriae dd auggq nn.Légende illisible.Buste diadémé, cuirassé et drapé à dr.Légende illisible. -/-/[ ]Deux Victoires face à face, tenant chacune une couronne.Ae : [0,45] g ; 7 ; 13,7 mm ; usure 2. Flan mince, corrodé.Masse originale vers 0,50 g.Objet 138 .
176.
Imitation de Victoriae dd auggq nn.CONSTH/[ ]HVCBuste diadémé (perles), cuirassé et drapé à dr.IIICTOR[ ]NN -/-/[ ]LCDeux Victoires face à face, tenant chacune une couronne.Ae : [0,66] g ; 3 ; 12,2 mm ; usure 1-2.Objet 87.
177.
Imitation de Victoriae dd auggq nn.C[ ]VGBuste diadémé (rosettes), cuirassé et drapé à dr.Légende illisible. /TRSDeux Victoires face à face, tenant chacune une couronne.Ae : [0,80] g ; 7 ; 13,5 mm ; usure 1-2 .Objet 258.
178.
Imitation de Victoriae dd auggq nn.CONSTA/NSPFAVGBuste lauré, cuirassé à dr., vu de face.]TORIAEDDAVGGQN (sic !) -/-/[ ]SISC[Deux Victoire face à face, tenant chacune une couronne.Ae : 1,38 g ; 7 ; 13,4 mm ; usure 1. Ex. de beau style. la marque SISC est plus tardive et n’apparaît pas avant 361 (RIC 417-422).Objet 175.
Fig.100 Planche des monnaies de la période 341-348 (clichés © J.-M. Doyen).
Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt
185II. Résultats
ATELIERS INDÉTERMINÉS
PÉRIODE 348 - 364
IMITATIONS
179.
Empereur et atelier indéterminés, 348-350.DNCONSTA/[Buste diadémé (perles), cuirassé et drapé à dr.FELTE[ -/-/[ ]L’empereur en habit militaire, tenant [un phénix] et un labarum, debout à g. dans une galère conduite par une Victoire.Aes 3 : 2,10 g ; 6 ; 16,0 mm ; usure 2-3.Objet 306.
180.
MAGNENCE, atelier indéterminé, 27 février – début mai 350.IMPCAEMA[ ]/ENTIVSAVGBuste nu-tête, cuirassé et drapé à dr.FEL[ ]AS/[ -/A/[ ]L’empereur en habit militaire, debout à g., tenant un globe nicéphore, et un labarum.Aes 2 : [2,51] g ; 6 ; 19,1 x 21,2 mm ; usure 0-1.Objet 207.
181.
MAGNENCE, atelier indéterminé, 27 février – début mai 350.]CAEMAGN/ENTIVS[Buste nu-tête, cuirassé et drapé à dr.]LICIT[ ]/REIPVB[ -/A/[ ]L’empereur en habit militaire, debout à g., tenant un globe nicéphore, et un labarum.Aes 2 : [2,20] g ; 12h30 ; 20,6 mm ; usure 1. Forte corrosion.Objet 266.
182.
JULIEN césar sous CONSTANCE II, atelier indéterminé, 355-360.Légende illisible.Buste nu-tête, cuirassé et drapé à dr.Légende illisible.L’empereur en habit militaire, debout à g., tenant un globe, et une lance verticale inversée.Aes 3/4 : [0,69] g ; 5 ; - mm ; usure 5-6.Type Spes Reipublice.Objet 10.
183.
Imitation de Fel Temp Reparatio (galère).DNCONSTAN/TIVSPFΛVC Buste diadémé (perles, cuirassé et drapé à dr. A/-TIW[ ]REPARAT\O -/-/[ ] NoL’empereur en habit militaire, tenant un phénix, et un labarum, debout à g., la tête à dr., dans un navire conduit par une Victoire.Ae : 5,11 g ; 5 ; 24,4 x 20,5 mm ; usure 5.Objet 134.
C
184.
Imitation de Fel Temp Reparatio (galère).]/CO0•VHΛΛCBuste diadémé (perles), cuirassé et drapé à dr.]/REPΛRΛ[ -/-/ROL’empereur en habit militaire, tenant un phénix sur un globe, et un labarum, debout à g., la tête à dr., dans un navire conduit par une Victoire.Ae : [3,56] g ; 7 ; 22,1 mm ; usure 2/1.Objet 299.
185.
Imitation de Fel Temp Reparatio (galère).]/NSPFAVGBuste diadémé (perles), cuirassé et drapé à dr.]/REPARATIO -/-/[ ]L’empereur en habit militaire, tenant un phénix sur un globe, et un labarum, debout à g., la tête à dr., dans un navire conduit par une Victoire.Ae : [2,47] g ; 5/6 ; 17,8 mm.Objet 12.
186.
Imitation de Victoriae dd nn aug et caes.DNMAGNE[ ]IVSPFAVGBuste nu-tête, cuirassé et drapé à dr. A/-VICTO[ ]AEDDNNAV[ ]TCAES -/-/TRSDeux Victoires face à face, tenant un bouclier portant V•T/V/[ ] (posé sur une colonne ?).Ae : 2,45 g ; 6 ; 20,1 mm ; usure 1. Corrosion.BASTIEN, Magnence, coins non répertoriés.Objet 336.
187.
Imitation de Fel Temp Reparatio (FH).]AVGBuste [diadémé], cuirassé& et drapé à dr.Légende illisible. -/-/[ ]Virtus debout à g., perçant de sa lance un ennemi tombé de cheval.Ae : [0,41] g ; 6 ; 9,3 mm ; usure 0. Bord très corrodé.Objet 256.
Fig.101 Planche de monnaies de la période 348-364 et imitations (clichés © J.-M. Doyen).
4. Etude des monnaies (Jean-Marc Doyen)
186 Inrap · Rapport de fouille
ATELIER DE TRÈVES ATELIER DE LYONPÉRIODE 364 - 378
188.
Imitation de Fel Temp Reparatio (FH).]IIIIIBuste nu-tête, drapé à dr.Légende illisible. -/-/[ ]Scène indistincte, dont on voit seulement des jambes d’un cheval.Ae (cuivre rouge) : 0,89 g ; 8 ; 10,2 mm ; usure 2. petit flan épais.Objet 344.
189.
Imitation de Fel Temp Reparatio (FH).Légende hors-flan.Buste diadémé (perles), cuirassé et drapé à dr.Légende hors flan.Virtus debout à g., perçant de sa lance un ennemi tombé de cheval.Ae (cuivre rouge) : 0,92 g ; 7 ; 11,1 mm ; usure 2-3.Objet 343.
190.
Imitation indéterminée d’époque constantinienne.Ae : 0,20 g ; 6,8 mm. Corrodée.Objet 128 Z2.
191.
VALENTINIEN I, Trèves, 364-367.DNVALENTINI/ANVSPFAVGBuste diadémé (perles), cuirassé et drapé à dr.]/MAN[ ]RVM -/-//[ ]RP*L’empereur en tenue militaire (sans manteau), marchant à dr., la tête à g., traînant un captif, et tenant un labarum.Aes 3 : 1,69 g ; 1 ; 17,1 mm ; usure 0. Coin de revers usé.RIC 5(a), marque iii(a) ; DEPEYROT, 2001, p. 154.Objet 9.
192.
GRATIEN, Trèves, 367-375.DN[ ]/NVSPFAVGBuste diadémé (perles), cuirassé et drapé à dr.SECVRITAS/REIPVBLICAE D/-//TRPVictoire marchant à g., tenant une couronne, et une palme.Aes 3 : 1,96 g ; 1 ; 17,7 mm ; usure 6/4.RIC 32(C), marque ix(a) ; DEPEYROT 2001, p. 155.Objet 22, diag. HS.
193.
VALENS, Lyon, 365-366.]LEN/SPFAVGBuste diadémé (perles), cuirassé et drapé à dr.SECVRITA[ ]/REIPVBLICAE -/-/PLVGVictoire marchant à g., tenant une couronne, et une palme.Aes 3 : 2,17 g ; 12 ; 17,5 mm ; usure 2-3.RIC 12, marque i(b) ; BASTIEN 21.Objet 392.
194.
VALENTINIEN I, Lyon, 1er groupe : 367-375.]ALENTINI/ANVSPFAVGBuste diadémé (perles), cuirassé et drapé à dr.G L O R I A R O / M A N O R V [ O/F/II//LVGSL’empereur en habit militaire marchant à dr., la tête à g., tirant un captif, et tenant un labarum.Aes 3 : 2,55 g ; 12 ; 17,3 mm ; usure 1.RIC 20(a) marque xviiib ; BASTIEN 95.Objet 167.
195.
GRATIEN, Lyon, 3ème groupe : 367-375.]GRATIAN/VSAVGGAVGBuste diadémé (perles), cuirassé et drapé à dr.]IARO/MANOR[ O|F sur R|II sur S//LVGS[L’empereur en habit militaire marchant à dr., la tête à g., tirant un captif, et tenant un labarum.Aes 3 : 2,58 g ; 7 ; 17,0 x 10,7 mm ; usure 5-6.RIC 20, marque xxviiib ; BASTIEN 141.Objet 21 Z2.
196.
GRATIEN, Lyon, 4ème groupe : 367-375.DNGRATIA/VS[Buste diadémé (perles), cuirassé et drapé à dr.SECVRITA[ ]/REIPVBLICAE OF sur S/I//[ ]VGPVictoire marchant à g., tenant une couronne, et une palme.Aes 3 : 1,83 g ; 1 ; 17,1 mm ; usure ?RIC 21(b) marque xxvi(a) ; BASTIEN 125.Objet 130 Z2.
Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt
Fig.102 Suite des imitations de la période 348-364 et monnaies de la période 364-378 (clichés © J.-M. Doyen).
187II. Résultats
ATELIER D’ARLES
197.
GRATIEN, Lyon, 4ème groupe : 367-375.DNGRATIAN/VSAVGGAVGBuste diadémé (perles), cuirassé et drapé à dr.GLORIARO/[ ]ANORV[ O/F/II sur S//LVG[L’empereur en habit militaire marchant à dr., la tête à g., tirant un captif, et tenant un labarum.Aes 3 : 3,08 g ; 6 ; 16,4 mm ; usure 1-2.RIC 20(c) ; BASTIEN 129, 132 ou 137.Objet 164.
198.
GRATIEN, Lyon, 367-375.DNGR[ ]/VSAVGGAVGBuste diadémé (perles), cuirassé et drapé à dr.GLORIARO/[ O/F sur /II/LVGSL’empereur en habit militaire marchant à dr., la tête à g., tirant un captif, et tenant un labarum.Aes 3 : [1,74] g ; 11/12 ; 16,9 mm ; usure 7/4.RIC 20(c), marque xxiib ; BASTIEN 106.Objet 368.
199.
Empereur indéterminé, Lyon, 367-375.Légende illisible.Buste diadémé (perles), cuirassé et drapé à dr.Légende illisible. OF/I sur /[ ]Victoire marchant à g., tenant une couronne, et une palme.Aes 3 : [1,37] g ; 7 ; 15,2 mm ; usure 2. Forte corrosion.Objet 65.
200.
Empereur indéterminé, Arles ( ?), mi-364.Légende illisible.Buste diadémé (perles), cuirassé et drapé à dr.]MANORVM -/B/CONT (sic !)L’empereur en habit militaire marchant à dr., la tête à g., tirant un captif, et tenant un labarum.Aes 3 : [1,89] g ; 12 ; 16,4 mm ; usure 0.RIC - ; DEPEYROT – cf. 173 (-/B/PCON). La marque -/B existe également à Constantinople, mais l’exergue ne correspond pas.Objet 208.
201.
VALENTINIEN I, Arles, mi-364.DNVALENTINI/ANVSP[Buste diadémé (perles), cuirassé et drapé à dr.SECVRITAS/[ ]CAE -/-/SCON[Victoire marchant à g., tenant une couronne, et une palme.Aes 3 : 1,71 g ; 5/6 ; 16,9 mm ; usure 3.RIC 9(a), marque i(b) ; DEPEYROT, Arles, n° 171/5.Objet 55.
202.
VALENTINIEN I, Arles, mi-364 – mi-367.DNVALENTIN/IANVSP[Buste diadémé (perles + grande gemme), cuirassé et drapé à dr.SECVRITAS/REI[ OF/II/CONS[T]Victoire marchant à g., tenant une couronne, et une palme.Aes 3 : 2,01 g ; 5 ; 17,0 mm ; usure 0.RIC 9(a) qui ne connaît cette césure d’avers qu’avec GLORIA ROMA-NORVM ; DEPEYROT, Arles, n° 174/3.Objet 251.
203.
VALENTINIEN I, Arles, mi-364 – mi-367.]ALENTINI/AN[Buste diadémé (perles), cuirassé et drapé à dr.SECVRIT[ ]/REIPVB[ OF/I/CONS[T]Victoire marchant à g., tenant une couronne, et une palme.Aes 3 : [1,11] g ; 5 ; 15,9 mm ; usure 0.RIC 9(a), marque ii(a) ; DEPEYROT, Arles, n° 174/1.Objet 291.
204.
VALENTINIEN I, Arles, 364-375.]/ANVSPFAVGBuste diadémé (perles), cuirassé et drapé à dr.SECVRITAS/[ -/-/PC[Victoire marchant à g., tenant une couronne, et une palme.Aes 3 : [1,32] g ; 12 ; 16,4 mm ; usure 5.Objet 199.
205.
VALENS, Arles, 364-378.]/SPFAVGBuste diadémé (perles), cuirassé et drapé à dr.SECVRI[ ]LICA[ -/-/[ ]CON[Victoire marchant à g., tenant une couronne, et une palme.Aes 3 : [1,79] g ; 11 ; 16,9 mm ; usure ? Forte corrosion.Objet 42.
Fig.103 Monnaies de la période 364-378 (clichés © J.-M. Doyen)
4. Etude des monnaies (Jean-Marc Doyen)
188 Inrap · Rapport de fouille
206.
GRATIEN, [Arles], 367-375.DNGRATIANVSAVGGAVGBuste diadémé (perles), cuirassé et drapé à dr.]RIANO/VISAE[ -/-/[ ]L’empereur debout à dr., tenant un labarum, et posant la main sur un bouclier.Aes 3 : 2,20 g ; 6 ; 17,0 mm ; usure 3.RIC 15, marque x(a) ou xiv(c).Objet 172.
207.
VALENS, Arles, 375-378.DNVALEN/SPFAV[Buste diadémé (perles), cuirassé et drapé à dr.SECVRITAS/[ E/[ ]/[ ]CO[Victoire marchant à g., tenant une couronne, et une palme.Aes 3 : 2,01 g ; 6 ; 16,5 mm ; usure 2.RIC 19(b), marque xvi(a) ; DEPEY-ROT, Arles, 189/3.Objet 51.
208.
GRATIEN, Arles, 371-377.DNGRATIANVSAVGGA[Buste diadémé (perles), cuirassé et drapé à dr.]LORIANO/VISAECVLI -/-/[ ]CON[L’empereur en habit militaire marchant à dr., la tête à g., tirant un captif, et tenant un labarum.Aes 3 : 2,06 g ; 6/7 ; 19,6 mm ; usure 3.RIC 15 marque xiv ; DEPEYROT, Arles, n° 188/8.Objet 62.
209.
GRATIEN, Arles, 371-377.]NVSAVGGAVGBuste diadémé (perles), cuirassé et drapé à dr.]O/VISAEC[ -/-/TC[L’empereur en habit militaire marchant à dr., la tête à g., tirant un captif, et tenant un labarum.Aes 3 : [1,22] g ; 5 ; 16,3 mm max. ; usure 3.Objet 205.
210.
Empereur indéterminé, Arles, 364-375.DN[ ]VSPF[Buste diadémé (perles), cuirassé et drapé à dr.]TAS/[ ]C[ OF/III/[ ]N[Victoire marchant à g., tenant une couronne, et une palme.Aes 3 : [1,44] g ; 5 ; 18,0 mm ; usure 3-4.Objet 46.
211.
Empereur indéterminé, Arles, 364-378.Légende illisible.Buste diadémé (perles), cuirassé et drapé à dr.Légende illisible. [ ]/I[ ]/[ ]ON[L’empereur en habit militaire marchant à dr., la tête à g., tirant un captif, et tenant un labarum.Aes 3 : [0,63] g ; 6 ; - mm ; usure 2.Objet 287.
212.
Empereur indéterminé, Arles, 364-367.Légende illisible.Buste diadémé (perles), [cuirassé et drapé] à dr.Légende illisible. [ ]/[ ]ONSTL’empereur en habit militaire marchant à dr., la tête à g., tirant un captif, et tenant un labarum.Aes 3 : [0,59] g ; 5 ; - mm ; usure ? Forte corrosion.Objet 225.
213.
VALENTINIEN I, Lyon ou Arles, 364-375.DNVAL[ ]/ANVSPFAVGBuste diadémé (perles), cuirassé et drapé à dr.GLORIARO/MANORVM O|F|II/[ ]L’empereur en habit militaire marchant à dr., la tête à g., tirant un captif, et tenant un labarum.Aes 3 : 2,19 g ; 6 ; 17,3 mm ; usure 1-2.Objet 94.
214.
VALENTINIEN I, Lyon ou Arles, 367-375.DNVA[ ]/ANVSPFAVGBuste diadémé (perles), cuirassé et drapé à dr.]RITAS/REIPVBLIC[ OF/II//[ ]Victoire marchant à g., tenant une couronne, et une palme.Aes 3 : 2,26 g ; 6 ; 18,8 mm ; usure 2. Pièce brûlée et corrodée.Objet 365.
215.
VALENS, Lyon ou Arles, 364-375.]NVA[ ]/SPFA[Buste diadémé (perles), cuirassé et drapé à dr.]EC[ ]RITAS/[ ]IPV[ OF/II/[ ]Victoire marchant à g., tenant une couronne, et une palme.Aes 3 : [1,74] g ; 6/7 ; 18,0 mm ; usure 2. Pièce brûlée.Objet 132 Z2.
ATELIER DE LYON OU D’ARLES
Fig.104 Monnaies de la période 364-378 (clichés © J.-M. Doyen).
Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt
189II. Résultats
ATELIER D’AQUILÉE
ATELIER DE ROME
216.
VALENS, Lyon ou Arles, 364-375.]VALEN/SPFAVGBuste diadémé (perles), cuirassé et drapé à dr.SECVRITAS/REIPVBLICAE OF/I/[ ]Victoire marchant à g., tenant une couronne, et une palme.Aes 3 : 2,28 g ; 12 ; 18,0 mm ; usure 4.Objet 161.
217.
Empereur indéterminé, Aquilée, 364-375.]PFAVGBuste diadémé (perles), cuirassé et drapé à dr.]ANORVM -/-/[SM]AQSL’empereur en habit militaire marchant à dr., la tête à g., tirant un captif, et tenant un labarum.Aes 3 : [1,75] g ; 11 ; 15,9 mm ; usure 2.Objet 319.
218.
VALENS, Aquilée, 367-375.DNVALEN/SPFAVGBuste diadémé (perles), cuirassé et drapé à dr.SECVRITAS/REIPVBLICAE -/-/SMAQSVictoire marchant à g., tenant une couronne et une palme.Aes 3 : 2,13 g ; 12 ; 18,3 mm ; usure 1.RIC 12(b), marque xvi(b).Objet 307.
219.
VALENS, Rome, 364-375.DNVALEN/SPFAVGBuste diadémé (perles), cuirassé et drapé à dr.S E C V R I TA S / R E I P V B L I C A E -/-/R•PRIMAAes 3 : 1,83 g ; 6h30 ; 15,6 mm ; usure 3.RIC 17b ou 24b, marque ix(b).Objet 115.
220.
VALENS, Rome, 367-378.DNVLEN/SPFAVGBuste diadémé (perles), cuirassé et drapé à dr.SECVRITAS/REIP[ ]BLICAE -/-/SM RPVictoire marchant à g., tenant une couronne, et une palme.Aes 3 : [1,62] g ; 16,6 mm ; usure 0/1. Pièce brûlée.RIC 24(b) ou 28(a), marque xiii.Objet 119, Z2.
221.
VALENS, Rome, 364-375.DNVALEN/SPFAVGBuste diadémé (perles), cuirassé et drapé à dr.S E C V R I T A S / R E I P V B L I C A E -/-/R•TERTIAVictoire marchant à g., tenant une couronne, et une palme.Aes 3 : 2,01 g ; 6 ; 18,0 mm ; usure 1.RIC 17(b) et 24(b), marque xi(b).Objet 17.
222.
[VALENS], Trèves ou Aquilée, 364-375/6.]/SPFAVGBuste diadémé (perles), cuirassé et drapé à dr.]/REIPVBLICAE /-/[ ]Victoire marchant à g., tenant une couronne, et une palme.Aes 3 : [1,00] g ; 7 ; diam. max. : 15,9 mm ; usure 2.Type frappé à Trèves (375/6) et en Aquilée (364-367).Objet 44 Z2.
223.
VALENS, atelier indéterminé, 364-375.DNVALEN/[Buste diadémé (perles), cuirassé et drapé à dr.GLORIAR[ D/-/[ ]L’empereur en habit militaire marchant à dr., la tête à g., tirant un captif, et tenant un labarum.Aes 3 : 1,53 g ; 7 ; 16,2 mm ; usure 3-4.Marque utilisée à Trèves, Aquilée et Siscia.Objet 50.
224.
VALENS, atelier indéterminé, 364-378.]VALEN/SP[Buste diadémé (perles), cuirassé et drapé à dr.]ORIAR[ -/-/[ ]L’empereur en habit militaire marchant à dr., la tête à g., tirant un captif, et tenant un labarum.Aes 3 : 1,08 g ; 6/7 ; 15,5 mm ; usure 2. Corrosion.Objet 70.
225.
GRATIEN, atelier indéterminé, 367-378.]NVSPFA[Buste diadémé (perles), cuirassé et drapé à dr.]RI[ -/-/[ ]Victoire marchant à g., tenant une couronne, et une palme.Aes 3 : [1,04] g ; 1 ; 15,8 mm ; usure 1-2. Forte corrosion.Objet 95.
Fig.105 Monnaies de la période 364-378 (clichés © J.-M. Doyen).
4. Etude des monnaies (Jean-Marc Doyen)
190 Inrap · Rapport de fouille
226.
GRATIEN, atelier indéterminé, 367-378.]RATI[ ]/NVSPFA[Buste diadémé (perles), cuirassé et drapé à dr.]EIP[ -/-/[ ]Victoire marchant à g., tenant une couronne, et une palme.Aes 3 : 1,58 g ; 7 ; 16,5 mm ; usure 2-3. Forte corrosion.Objet 58.
227.
Empereur et atelier indéterminés, 364-378.Légende illisible.Buste diadémé (perles), cuirassé et drapé à dr.]R[ -/R sur ( ?)/[ ]L’empereur en habit militaire marchant à dr., la tête à g., tirant un captif, et tenant un labarum.Aes 3 : [0,75] g ; 1 ; - mm ; usure ? Forte corrosion.Objet 288.
228.
Empereur et atelier indéterminés, 364-378.Légende illisible.Buste diadémé (perles), cuirassé et drapé à dr.Légende illisible. -/-/[ ]Victoire marchant à g., tenant une couronne, et une palme.Aes 3 : 1,47 g ; 5/6 ; 15,2 mm ; usure ? Pièce brûlée.Objet 277.
229.
Empereur et atelier indétermi-nés, 364-378.Avers fruste.]VRI[ -/[ ]//[ ]Victoire marchant à g., tenant une couronne et [une palme].Aes 3 : fragment ; - ; - mm ; usure ? Corrosion.Objet 270.
230.
Empereur et atelier indétermi-nés, 364-378.Avers fruste.Légende illisible. E/-/[ ]Victoire marchant à g., tenant une couronne, et une palme.Aes 3 : fragment ; - ; usure 3-4.Objet 67.
231.
Empereur et atelier indéter-minés, 364-378.Légende illisible.Buste diadémé (perles), cuirassé et drapé à dr.]C[ -/-/[ ]Aes 3 : [0,85] g ; - mm ; usure 1. Corrosion.Objet 260.
232.
Empereur et atelier indéterminés, 364-378.Avers fruste.Légende illisible.Victoire marchant à g., tenant [une couronne], et une palme.Aes 3 : [0,42] g ; - ; - mm ; usure 2.Objet 240.
233.
Empereur et atelier indétermi-nés, 364-378.Légende illisible.Buste diadémé (perles), cuirassé et drapé à dr.]REIPVBLICA[ -/-/[ ]Victoire marchant à g., tenant une couronne, et une palme.Aes 3 : [0,94] g ; 12 ; - mm ; usure 1.Objet 249.
234.
Empereur et atelier indétermi-nés, 364-378.Avers fruste.Légende illisible. -/-/[ ]Victoire marchant à g., tenant une couronne, et une palme.Aes 3 : [0,95] g ; - ; - mm ; usure 5-6.Objet 286.
Fig.106 Monnaies de la période 364-378.
Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt
191II. Résultats
235.
Imitation de Gloria novi saecvli.Légende illisible.Buste diadémé (perles), cuirassé et drapé à dr.]/VISA[ -/-/[ ]L’empereur debout à dr., tenant un labarum ( ?), et posant la main sur un bouclier.Ae : [0,67] g ; 5 ; 15,1 mm ; usure 9. Flan très mince mais style correct. Poids original vers 0,75 g.Objet 203.
236.
Imitation de Securitas Reipublicae ( ?).Légende illisible.Buste diadémé à dr.Légende illisible.Victoire marchant à g., tenant une couronne, et [une palme].Ae (cuivre rouge) : 0,61 g ; 12 ; 12,4 mm ; flan très mince. L’attribution à l’époque valentinienne est incertaine.Objet 274.
237.
Imitation de gloria romanorum.Légende illisible.Buste diadémé à dr.Légende illisible.L’empereur en habit militaire marchant à dr., la tête à g., tirant un captif, et tenant un labarum.Ae : 0,64 g ; 7 ; 12,0 mm ; corrosion. Petit flan mince.Objet 39.
PÉRIODE 378 - 388
ATELIER DE TRÈVES
ATELIER DE LYON
238.
GRATIEN, Trèves, 379-381.DNGRATIA/[Buste diadémé (perles), cuirassé et drapé à dr.V O T / X V / M V L T / X X -/-/SMTRdans une couronne de laurier.Aes 4 : 1,48 g ; 6/7 ; 13,2 mm ; usure 0.RIC 74(a) ; DEPEYROT, 2001, p. 156.Objet 18.
239.
MAGNUS MAXIMUS, Trèves, 383-388.DNMAGMAX/IMVSPFAVGBuste diadémé (perles), cuirassé et drapé à dr.REPARATIO/REIPVB -/-/SMTRPL’empereur en habit militaire, relevant une femme tourelée agenouillée, et tenant un globe nicéphore.Aes 2 :5,64 g ; 1 ; 22,5 mm ; usure 2. Frappe faible.RIC 85, marque i ; DEPEYROT, 2001, p. 156.Objet 177.
240.
GRATIEN, Lyon, 383.DNGRATIA/[ ]SPFAVGBuste diadémé (perles), cuirassé et drapé à dr.REP[ ]REIP[ -/S/LVGSL’empereur en habit militaire, relevant une femme tourelée agenouillée, et tenant un globe nicéphore.Aes 2 : [2,33] g ; 1 ; 22,8 mm ; usure 6.RIC 28a4 ; BASTIEN 184.Objet 253.
241.
VALENTINIEN II, [Lyon], 383.]IANVSIVN[Buste diadémé (perles), cuirassé et drapé à dr.]EPARATIO/[ -/S/[ ]L’empereur en habit militaire, relevant une femme tourelée agenouillée, et tenant un globe nicéphore.Aes 2 : 3,34 g ; 12 ; 21,2 mm ; usure 3. Forte corrosion.RIC 28(b)2 ou 3 ; BASTIEN 183 ou 185 ; DEPEYROT, 2001, p. 159.Objet 289.
Fig.107 Imitations de la période 364-378 et monnaies de la période 378-388 (clichés © J.-M. Doyen).
4. Etude des monnaies (Jean-Marc Doyen)
192 Inrap · Rapport de fouille
ATELIER D’AQUILÉE
ATELIER INDÉTERMINÉ
242.
THÉODOSE I, Aquilée, 378-383.DNTHEODOSIVSPFAVGBuste diadémé (perles), cuirassé et drapé à dr.REPARA[ ]PVB -/-/SMAQL’empereur en habit militaire, relevant une femme tourelée agenouillée, et tenant un globe nicéphore.Aes 2 : 4,50 g ; 6h30 ; 22,5 mm ; usure 3. Corrosion.RIC 30(d), marque 1.Objet 305.
243.
MAGNUS MAXIMUS, atelier indéterminé, 383 – 384/5.DNMAGMAX/IMVSPFAVGBuste diadémé (perles), cuirassé et drapé à dr.REPARAT[ ]EIPVB -/-/[ ]L’empereur en habit militaire, relevant une femme tourelée agenouillée, et tenant un globe nicéphore.Aes 2 : 3,09 g ; 12 ; 23,2 mm ; usure 0.Objet 248.
244.
Empereur et atelier indéterminés, 381-386/7.]PFAVGBuste diadémé (perles), cuirassé et drapé à dr.Légende illisible. -/-/[ ]L’empereur en habit militaire, debout à g., relevant une femme tourelée agenouillée, et tenant un globe nicéphore.Aes 2 : [2,61] g ; 5h30 ; 19,4 mm ; usure 8.Objet 71.
PÉRIODE 388 - 402
245.
ARCADIUS, Trèves, 388-402.DNARCADI/VSPFAVGBuste diadémé (perles), cuirassé et drapé à dr.VICTORI/AAVGGG -/-/TRVictoire marchant à g., tenant une couronne, et une palme.Aes 4 : 0,97 g ; 7 ; 14,4 mm ; usure 1-2.RIC 107(b).Objet 209.
Fig.108 Monnaies des périodes 378-388 et 388-402 (clichés © J.-M. Doyen).
Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt
193II. Résultats
MONNAIES INDÉTERMINÉES
246.
Empereur et atelier indéterminés (IVème s).Effigie à dr.Personnage debout (Victoire ?).Ae : 0,98 g ; 11 ; 13,7 mm ; corrosion.Objet 8.
247.
Empereur et atelier indéterminés (IVème s.).Légende illisible.Buste à dr.Revers fruste.Ae : 0,60 g ; - ; 12,8 mm. Corrosion.Objet 227.
248.
Empereur et atelier indéterminés (IVème s.).Légende illisible.Buste diadémé à dr.Revers fruste.Ae : [1,04] g ; - ; 17,5 mm. Module du nummus de 318-330 ou de l’aes 3 valenti-nien.Objet 109.
249.
Empereur et atelier indéterminés (IVème s.).Effigie à dr. Revers fruste.Ae : 1,35 g ; 14,1 mm.Objet 367.
250.
Petit ae fruste, fragmentaire. Objet 114 Z2, comblement fossé N.
251.
Petit ae fruste fragmentaire. Objet 269.
252.
Petit ae fruste fragmentaire. Objet 243.
253.
Petit ae fruste : 0,23 g ; 9,7 mm. Objet 247.
254.
Petit ae fruste : 0,37 g ; 10,6 mm. Objet 202.
255.
Petit ae fruste : 0,38 g ; 9,0 mm. Objet 124 Z2.
256.
Aes 3 ou nummus fruste, cassé en deux ou coupé : [0,82] g. Objet 281.
257.
Ae fruste : 1,22 g ; 16,1 mm. Objet 92.
258.
Ae fruste du Bas-Empire : 1,94 g ; 18,0 mm. Objet 61.
259.
Ae fruste : 2,59 g ; 20,6 mm. Objet 28.
260.
Ae fruste fragmentaire. Objet 329.
261.
Flan en plomb, apparemment non empreint.Pb : 2,74 g ; 13,6 mm. Rayure (récente) sur une des faces.Objet 27.
Fig.109 Monnaies indéterminées (clichés © J.-M. Doyen).
4. Etude des monnaies (Jean-Marc Doyen)
194 Inrap · Rapport de fouille
MONNAIES MODERNES
262.
FRANCE : LOUIS XIII, Paris, vers 1611-1630.Avers fruste.]NO[Deux lis ; au-dessous : ACu denier tournois : 0,60 g ; - ; 14,1 mm ; usure 10. Flan mince.AGK 400, 402, 406 ou 408.Objet 96.
263.
FRANCE : LOUIS XIV, atelier et date ill., 1655-1700.Légende illisible.Buste couronné à dr.LIARD/•DE•/[ ]RA[ Trois lis.Cu liard : 2,70 g ; 6 ; 21,7 mm ; usure 10.Objet 358.
264.
FRANCE : LOUIS XIV, atelier indéter-miné, 1655-1700.Légende illisible.Buste à dr.]ARD/DE/[ ]A[ ]/[ ]Trois lis.Cu liard : 1,84 g ; 6/7 ; 21,1 mm ; usure 10.Objet 82.
265.
FRANCE : LOUIS XIV, Rouen, 1655-1658.Avers fruste.LIA[ ]RANCE/B/cœur Trois lis.Cu liard : 2,88 g ; - ; 21,6 mm ; usure ? Flan déformé.Objet 11.
266.
FRANCE : SECOND EMPIRE, NAPO-LÉON III, daté 1853A.NAPOLEON III EMPEREUR -/-/1853Tête à g., au dessous, signature Barre.EMPIRE FRANÇAIS �> CINQ CENTIMESAigle à g., la tête à dr., sur un foudre. -/-/ACu 5 centimes : 4,44 g ; 6 ; 25,2 mm ; usure 8-9.Le Franc F 116/1.Objet 150.
267.
FRANCE : SECOND EMPIRE, NAPO-LÉON III, daté 1854D.NAPOLEON III EMPEREUR -/-/1854Tête à g., au dessous, signature Barre.EMPIRE FRANÇAIS �> CINQ CENTIMESAigle à g., la tête à dr., sur un foudre. -/-/DCu 5 centimes : 4,35 g ; 5/6 ; 24,9 mm ; usure 8-9.Le Franc F 116/1.Objet 149.
268.
FRANCE : IIIème République, 1916, type Dupuis.REPUBLIQUE/FRANÇAISEBuste de Marianne, à dr.LIBERTE EGALITE FRATERNITE 1916 A dr. : 10c*
Cu 10 centimes : 9,86 g ; 6 ; 30,1 mm ; usure 2-3.Le Franc, F.136/24.Objet 148.
Fig.110 Monnaies modernes (clichés © J.-M. Doyen).
Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt
265II. Résultats Conclusion et mise en perspective
Conclusion et mise en perspective (G. Prilaux)
Au terme de ce travail, plusieurs constats peuvent être dressés. Il apparait en premier lieu que la difficulté majeure d’un site tel que celui de Moyencourt tient à la définition de : son statut, sa vocation, sa caractérisation et, au final, son appellation. Ce site présente en effet quelques points de comparaisons avec les sanctuaires laténo-romains du nord de la Gaule, si l’on s’appuie sur la typologie définie par J.-L. Brunaux, mais sans toutefois en avoir toutes les caractéristiques. Ce sont ces points de convergence, mais aussi de divergence, que nous allons développer ici dans cette esquisse de conclusion et tentative de mise en perspective.
Le choix de l’implantation de ce site a porté sur le versant d’un talweg colmaté, en contrebas d’un dôme limoneux très bien marqué, formant un point remarquable dans le paysage. Des recherches ultérieures sur cette hauteur (prospections pédestres, aériennes ou géophysiques) pourraient fournir un éclairage important sur la nature des occupations humaines dans cette zone.Le site de Moyencourt se trouve à la croisée de plusieurs chemins et routes vicinales, probables témoins fossiles de la trame viaire du Moyen-Age, voire de l’antiquité. Lors des travaux de rétablissement des voiries pour le Canal Seine-Nord Europe, une attention particulière pourrait être portée sur les niveaux sous-jacents de la route qui borde le site de Moyencourt sur son flanc ouest.La présence d’un puissant enclos trapézoïdal, s’ouvrant au sud-est, et entourant un espace quasiment dépourvu de vestige, est l’élément central de la structuration de cette occupation humaine. Les sanctuaires laténiens se caractérisent par un ou plusieurs enclos fossoyés de dimensions variables (fig.212) délimitant le domaine sacré (Brunaux 1986). Les traces des « activités » cultuelles sont en général déposées à l’intérieur ou aux limites du périmètre sacré (Buchsenschutz 1991). A Moyencourt, la découverte d’armes gauloises portant des traces de mutilation représente l’élément le plus probant sur l’origine cultuelle de ce lieu pour la fin du second âge du Fer. Alors, immédiatement, se pose ici le problème de la chronologie. En effet, aucune structure n’a livré du mobilier gaulois, sans que celui-ci se trouve mêlé à des éléments gallo-romains du second et du troisième siècle de notre ère. Si l’on examine la répartition de ce mobilier, on observe qu’il se concentre au niveau de l’entrée principale, autour de la fondation massive interprétée comme le soubassement d’une pile, d’un podium ou d’un autel gallo-romain. Faut-il voir dans cette structure une construction autour de laquelle ou dans laquelle étaient entreposés des trophées d’armes (provenant d’un autre lieu, d’un autre sanctuaire, ou commémorant un évènement) ? La nature même des pièces d’armement, épées, fourreaux et un fragment de lance (on notera l’absence de casque, de bouclier…), permet d’envisager des dépôts ou des « expositions » sous forme de faisceaux, comme c’est assez souvent relaté dans l’iconographie monétaire romaine. On pense par exemple à l’avers d’un denier césarien représentant la Gaule vaincue, exhibant un captif et une captive aux pieds d’un trophée d’armes (Goudineau 1990). On reprendra par ailleurs l’analyse d’Isabelle Fauduet dans son ouvrage sur les temples de traditions celtiques et dans lequel, elle rappelle les problèmes d’identification de certains édicules carrés au cœur de sites d’habitat.
266 Inrap · Rapport de fouille Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt
0 5
0 5 10
St-Maur (Brunaux 1996)
Digeon (Delplace 1986)
Fesques (Mantel 1997)
Villers-Bretonneux (Petit 2011)
Corent (Poux 2005)
Gournay-sur-Aronde (Brunaux 1996)
Moyencourt
Ribemont-sur-Ancre (Brunaux 2004)
Fig.212 Comparatif des sanctuaires laténiens (G. Prilaux, DAO : C. Font).
267II. Résultats Conclusion et mise en perspective
L’auteur souligne qu’ils peuvent avoir une vocation ornementale ou funéraire, pour ce propos, on se rapprochera du site de Biberist-Splitalhofl où une structure carrée au centre d’une vaste cour de villa a été interprétée comme un témoin d’activités cultuelles et funéraires (Fauduet 2010).Les 507 rouelles en plomb posent à peu près le même problème. Elles se concentrent également au niveau de l’accès, et la littérature, bien qu’assez indigente sur les analyses menées sur ce type de mobilier, souligne, peut-être de manière un peu trop péremptoire, que les exemplaires en plomb sont généralement postérieurs aux modèles en bronze, les rouelles de Moyencourt pourraient bien être gallo-romaines mais de quelle période ?, Haut-Empire ou Bas-Empire ? Ces rouelles à quatre rayons coulées en chapelet, proches des types « Ra » de Piette (Piette 2008) ou au type P2 de Villeneuve-Saint-Germain (Debord 1989), sont semblables aux exemplaires rencontrés sur le sanctuaire de Nanteuil, sous les marches du temple et associés à des monnaies (Lambot, Méniel 2000). La présence de rouelles sur les lieux de culte a alimenté de nombreux débats qui ont débouché sur des hypothèses variées ; substituts de monnaies, attributs de divinités comme Jupiter/Taranis, représentations de roue de char… rien se sera tranché dans le cadre de cette étude, mais à Moyencourt, le nombre important de chapelets de rouelles, de rouelles détachées et de rejets de tiges centrales amènent à penser que ces « offrandes » faisaient l’objet d’un usage notable et régulier au cœur du lieu de culte. La présence de 6 anneaux en bronze renvoie au même questionnement.
Les 9 monnaies gauloises sont aussi présentent dans la même aire de concentration dont cinq aux abords les plus proches de la fondation massive en craie. Elles permettent de proposer une chronologie basse dans les années 60/50 – 40 av. J.-C. sans pour autant écarter une datation globale plus haute, entre 90/80 ‒ 60/50.
On doit noter que sur presque 3 000 tessons de céramique récoltés, aucun ne date de la période gauloise !
Par la nature des objets découverts, la vocation cultuelle du site semble acquise, mais, la date de sa création qui repose sur les mobiliers découverts dans les fossés, est postérieure à la période gauloise autour de la seconde moitié du Ier siècle, interroge bien évidemment sur le statut d’un tel lieu et sur son origine. On ne peut exclure l’hypothèse selon laquelle ce lieu de culte aurait été créé au cours de la période julio-claudienne et les activités qui y régnaient prolongeaient dans les premiers temps les pratiques plus anciennes en droite ligne des filiations les plus directes des commanditaires.
Selon William Van Andriga, le maintien des fossés qui délimitent les périmètres des espaces consacrés, est connu après le Ier siècle comme c’est le cas par exemple à Avenches ou à Lausanne-Vidy (Van Andriga 2002). Le même auteur souligne que le téménos, structure traditionnelle des sanctuaires (enclos délimitant une plateforme) peut perdurer pendant tout le premier siècle, cependant le fossé de clôture fait place à une palissade, préfiguration d’une phase de monumentalisation du sanctuaire.Les nombreuses réfections des fossés de l’enclos principal de Moyencourt, plaident en faveur d’une transformation de ce type, bien que ces aménagements sur l’enceinte n’aboutiront pas à une architecture maçonnée, le maintien d’une structure de terre et de bois pourrait être envisagée.
L’accès à l’intérieur de l’enclos est bien perçu. Large de 1,30 m, il se matérialise par une simple interruption des fossés. Les parois des fossés sont abruptes, et pour que ce passage se maintienne durant près de quatre siècles, l’hypothèse d’un coffrage et d’un plancher en bois ont été envisagés, bien que les arguments stratigraphiques fassent défaut. Ce franchissement débouche sur une porte dont ne subsistent que les deux fondations intégrant
268 Inrap · Rapport de fouille Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt
chacune un madrier planté verticalement. Ce système évoque clairement la possibilité de fermer l’accès par des vantaux tout en accentuant le côté ostentatoire de ce lieu.
Comme nous venons de le voir l’origine gauloise de ce site n’est pas clairement assurée, en revanche lors de la création de l’enclos central et de la mise en place des chemins qui y menaient, le site a été rapidement modelé et globalement sa structure semble avoir perduré jusqu’à l’Antiquité tardive à la fin du IVe siècle. Le plan de l’enclos est un unicum dans la typologie des sanctuaires. Il n’est ni quadrangulaire, ni circulaire. Il évoque la forme d’un étrier, tracé que l’on peut rapprocher de l’enclos central du sanctuaire de Fesques (Mantel 1997), ou de l’enclos cultuel de Villers-Bretonneux « Entre les Chemins de Corbie » (Petit 2011). Le parcours du fossé marquant la limite sud-est est rentrant, pour inciter à pénétrer dans l’enceinte et peut-être pour valoriser depuis l’extérieur l’entrée principale. La présence d’un talus intérieur est attestée par les analyses pédologiques. Ce talus pouvait être chaussé d’une palissade, mais les observations de terrain ne permettent pas d’avancer dans cette direction. On notera que le profil primitif des fossés, formant l’enclos principal, montre une partie supérieure très évasée et un talon incisé bien marqué, témoin probable d’une tranchée pour palissade. On se réfèrera pour cet aspect strictement morphologique à la fouille de Bayonvilliers au « Chemin d’Harbonnières » (80) qui a permis l’observation de poteaux conservés dans le talon d’un fossé présentant un profil en « Y » ; bords supérieurs évasés, talon incisé vertical, et fond plat (Prodéo 2000).
L’enclos central de Moyencourt est enserré par des chemins, formant une zone de circulation qui enveloppe l’enceinte, faut-il voir ici à la fois un accès et un espace dédié à la circumbulation ?
Au centre de l’enclos, un puits de 6 m de profondeur a été exploré. Il a livré de nombreux éléments en bois ; des bardeaux, des seaux (douelles et fonds) et des restes d’animaux parmi lesquels dominent le porc et des morceaux sélectionnés de bœuf, des scapula en particulier. On notera la présence d’éléments architecturaux, tegulae, moellons de craie et quelques fragments d’enduits peints. La période d’utilisation de ce puits ne pourra pas être définie précisément, on peut l’imaginer dès la fondation du lieu, on revanche il sera définitivement colmaté à la fin du IVe siècle de notre ère, comme le prouve une monnaie de Théodose I frappée en 378/383.
La position centrée de ce puits offre à cette structure un rôle de première importance dans l’organisation de l’espace interne de l’enclos. Parmi les mobiliers récoltés, il faut signaler deux lames de couteau en fer, dont l’une de grande taille était certainement destinée à la découpe de carcasse ou de grosses pièces de viande. Un métatarse de capriné, utilisé comme étui pour aiguille, était orné d’un décor d’ocelles et a pu être utilisé lors des rites sur le site (voir étude d’Annick Thuet).
On sait que les aménagements hydrauliques sont très courants dans les contextes des sanctuaires, et la proximité de ressources en eaux est requise pour leur installation :
« La convenance sera naturelle si l’on choisit des expositions très saines et des sources convenables dans les lieux où sont édifiés les sanctuaires » (Vitruve, I, 2, 7).
Selon William Van Andriga, « en Gaule comme partout ailleurs dans l’Empire, l’eau était nécessaire au fonctionnement des lieux sacrés, utilisée à chaque étape de la pratique religieuse et dans le cas des eaux salutaires,
269II. Résultats Conclusion et mise en perspective
servait au bien-être et à la guérison des visiteurs ». L’auteur indique également qu’en dehors du cas particulier des sanctuaires de sources « des aménagements hydrauliques permettaient en principe d’approvisionner en eau les lieux de culte : des conduites de captage ou de drainage alimentaient les vasques, puits et fontaines situés dans l’enceinte qui servaient aux ablutions rituelles et au service religieux. En effet, l’eau était utilisée pour la purification des victimes animales et des officiants, pour la cuisine sacrificielle et le nettoyage du sanctuaire » (Van Andringa 2002).
Le centre de l’enclos est aussi occupé par une grande fosse de 8m de diamètre qui a livré une couche riche en mobilier céramique, en éléments de toiture et en faune. Ces éléments se trouvant en position secondaire remaniée, aucune trace particulière, aucun dépôt (à l’exception de deux tuiles posées à plat au fond de la fosse) et aucun élément singulier n’est à signaler. Cette structure, colmatée au IIIe siècle évoque simplement les dépotoirs que l’on trouve régulièrement dans les habitats domestiques gallo-romains. Sa relation avec le puits central et son rôle dans les activités du sanctuaire ne seront donc pas éclaircies. L’étude des macrorestes botaniques réalisée à partir des sédiments prélevés au fond des puits éclaire l’environnement végétal immédiat du site. On peut noter en premier lieu l’absence d’offrandes végétales carbonisées, l’assemblage carpologique est issu de la végétation environnante tombée dans ces excavations. Le puits central (2016) a révélé, outre des espèces de zones herbacées anthropisées, des témoignages de haies, de bois ou de lisières forestières, notamment avec une formation près du puits formée d’aubépine et de rosiers-églantiers. Cette analyse explique peut-être le peu de structure archéologique observée au cœur de l’enclos, traduction probable d’une volonté de valoriser ce lieu en y laissant se former et se développer un environnement végétal.
Si l’on observe la répartition spatiale du mobilier métallique, on remarque deux aires de concentration. La plus dense se trouve au niveau de l’entrée, dans les fossés, sur l’axe du franchissement et autour de la structure turriforme. La seconde concentration se développe sur le flanc est de l’enclos central à l’emplacement d’un bâtiment présumé par les matériaux de construction déversés dans le comblement terminal du fossé à cet endroit. On doit noter que l’angle sud-est de l’enclos a révélé une accumulation de sédiment limoneux, épaisse d’une vingtaine de centimètres, et qui résulte, d’après les observations pédologiques de Céline Coussot, de l’existence d’un talus interne qui aurait bloqué les écoulements et l’arasement des sols. L’inclinaison du site vers l’ouest a peut-être favorisé une érosion plus forte dans la zone nord de l’enclos, c’est peut-être pour cette raison que le mobilier se raréfie jusqu’à disparaître totalement dans la zone nord de l’enclos.
Les 252 monnaies romaines découvertes à l’intérieur de l’enclos central s’apparente à la stips, l’offrande monétaire très bien attestée dans les sanctuaires antiques. On distingue deux types de dons : celui que l’on dépose et celui que l’on jette.
Ecoutons sur ce propos Sénèque : « cependant même pour les dieux, nous déposons une offrande et nous jetons une monnaie », ou encore : « Ils vénèrent les statues des dieux, ils les supplient à genoux, ils les adorent, ils restent assis ou debout devant elles pendant une journée entière, ils leur jettent une monnaie, ils leur sacrifient des victimes ».
En dehors des 9 monnaies gauloises, dont on a déjà parlé, le faciès monétaire permet d’éclairer les grandes phases d’activité sur le sanctuaire. Le corpus julio-claudien ne semble pas très précoce et à la fin du règne de
270 Inrap · Rapport de fouille Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt
Néron, le dépôt de monnaies diminue fortement pour reprendre au début du règne de Trajan, quelque part vers 98/99. Après une phase assez active d’une cinquantaine d’années, une rupture semble s’opérer vers 145/150. L’activité liée au dépôt de monnaies reprend plus fortement vers 285/290 et se poursuit sans interruption jusqu’à la désaffection du site vers 390. Pour Jean-Marc Doyen, au IVe siècle deux phases se distinguent, par l’abondance et la qualité des monnaies déposées ; vers 330 et vers 365. La dernière phase de l’activité monétaire (378/388) reste notable puisque les « offrandes » concernent les meilleures monnaies excluant les imitations. La monnaie la plus récente est un aes 4 au nom d’Arcadius émise à Trèves à partir du 28 août 388. Ces variations de la fréquentation du site de Moyencourt, à la seule lecture du faciès monétaire, font écho aux travaux d’Isabelle Fauduet, qui rappelle que les offrandes monétaires se raréfient sur les sanctuaires de la Gaule, jusqu’à disparaître à la fin du IVe siècle, elle note que l’absence ne signifie pas pour autant abandon des pratiques funéraires et souligne que nombre de sites révèlent des hiatus à la fin du IIe siècle et la fin du IIIe siècle, ou au début du IVe (Fauduet 2010). Ces oscillations sont particulièrement bien perceptibles sur le site de Moyencourt (fig.213a à c).
Les activités au cœur de l’enclos peuvent être encore éclairées par la découverte d’un fragment de tablette à écrire en bois (voir étude xylologique), témoin discret de probables ex-voto, offrandes renforcées par la présence d’une et peut-être trois lames à affûter les calames (voir étude du petit mobilier). Naturellement si des ex-voto étaient répandus dans l’aire centrale de l’enclos, comme pour les éléments métalliques, et non pas jetés dans les puits, leurs traces ne seront malheureusement pas parvenues jusqu’à nous. Enfin, la découverte d’une fibule en forme de foudre et à dédicace, neuvième exemplaire connu en France (Feugère 2010), mérite quelques commentaires. En général, les inscriptions sont variées mais se rapportent à des thèmes érotico-amoureux. La fibule de Moyencourt porte l’inscription MIHI VALEAS, qu’Alexia Morel traduit par « que tu me donnes ta force/vigueur/santé », le donateur sollicitant la faveur sentimentale/sexuelle de celui qui reçoit l’objet, mais néanmoins on ne peut exclure la dimension religieuse de protection (Alexia Morel infra).
Compte-tenu de tous ces éléments, on peut considérer que le site de Moyencourt s’apparente bien à un petit sanctuaire assez atypique fréquenté pendant une grande partie de la période gallo-romaine. L’origine gauloise ne pourra pas être définitivement tranchée, car elle repose sur des vestiges mobiliers dont le contexte stratigraphique demeurera incertain. C’est au niveau de l’entrée, ainsi que dans l’angle sud-est, que les gestes liés aux dépôts et aux dons ont été entrepris tout particulièrement. L’enclos borne une place de près de 5 000m² quasiment dépourvu de vestige à l’exception d’un puits, en position centrale, et dont le rôle a du être prépondérant dans le déroulé et l’organisation des activités du sanctuaire. L’entrée de l’enclos est également un élément important dans le dispositif, puisque le mobilier s’y concentre ainsi que les restes d’un bâtiment (dont la fonction de sera pas définie) et le soubassement d’une probable construction turriforme qui semble avoir été très attractive si l’on se réfère à la répartition spatiale des offrandes déposées.
271II. Résultats
Les Julio-claudiens (27 av. - 68 ap. J.-C.)
Nerva, Trajan, Hadrien (96 - 138 ap. J.-C.) Les Antonins (138 - 192 ap. J.-C.)
Les Flaviens (69 - 96 ap. J.-C.)
695650 695700
6958
900
6958
950
6959
000
695650 69570069
5890
069
5895
069
5900
0
695650 695700
6958
900
6958
950
6959
000
695650 695700
6958
900
6958
950
6959
000
0 50m
0 50m
0 50m
0 50m
Les Julio-claudiens (27 av. - 68 ap. J.-C.)
Nerva, Trajan, Hadrien (96 - 138 ap. J.-C.) Les Antonins (138 - 192 ap. J.-C.)
Les Flaviens (69 - 96 ap. J.-C.)
695650 695700
6958
900
6958
950
6959
000
695650 69570069
5890
069
5895
069
5900
0
695650 695700
6958
900
6958
950
6959
000
695650 695700
6958
900
6958
950
6959
000
0 50m
0 50m
0 50m
0 50m
Les Julio-claudiens (27 av. - 68 ap. J.-C.)
Nerva, Trajan, Hadrien (96 - 138 ap. J.-C.) Les Antonins (138 - 192 ap. J.-C.)
Les Flaviens (69 - 96 ap. J.-C.)
695650 695700
6958
900
6958
950
6959
000
695650 695700
6958
900
6958
950
6959
000
695650 695700
6958
900
6958
950
6959
000
695650 695700
6958
900
6958
950
6959
000
0 50m
0 50m
0 50m
0 50m
Les Julio-claudiens (27 av. - 68 ap. J.-C.)
Nerva, Trajan, Hadrien (96 - 138 ap. J.-C.) Les Antonins (138 - 192 ap. J.-C.)
Les Flaviens (69 - 96 ap. J.-C.)
695650 695700
6958
900
6958
950
6959
000
695650 695700
6958
900
6958
950
6959
000
695650 695700
6958
900
6958
950
6959
000
695650 695700
6958
900
6958
950
6959
000
0 50m
0 50m
0 50m
0 50m
Fig.213a Répartition spatiale des monnaies, par grandes périodes chronologiques, elles témoignent de variations de fréquentation du site (DAO : C. Font).
Conclusion et mise en perspective
272 Inrap · Rapport de fouille Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt
Les périodes I - II (260 - 294 ap. J.-C.)
La période IV (318 - 330 ap. J.-C.) La période V (330 - 341 ap. J.-C.)
La période III (294 - 318 ap. J.-C.)
695650 695700
6958
900
6958
950
6959
000
695650 695700
6958
900
6958
950
6959
000
695650 695700
6958
900
6958
950
6959
000
695650 695700
6958
900
6958
950
6959
000
0 50m
0 50m
0 50m
0 50m
Fig.213b Répartition spatiale des monnaies, par grandes périodes chronologiques, elles témoignent de variations de fréquentation du site (DAO : C. Font).
273II. Résultats Conclusion et mise en perspective
La période VI (341 - 348 ap. J.-C.)
Les périodes VIII et IX (364 - 388 ap. J.-C.)
La période VII (348 - 364 ap. J.-C.)
695650 695700
6958
900
6958
950
6959
000
695650 695700
6958
900
6958
950
6959
000
695650 695700
6958
900
6958
950
6959
000
0 50m
0 50m
0 50m
Fig.213c Répartition spatiale des monnaies, par grandes périodes chronologiques, elles témoignent de variations de fréquentation du site (DAO : C. Font).
280 Inrap · Rapport de fouille Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt
Argant, Bonneau, Jeannet, Argant T, Wiethold, Prost. et Argant, 2008 : ARGANT (A), BONNEAU (M), JEANNET (T), WIETHOLD (J), PROST (M), ARGANT (J)- De la diversité des contextes : les os animaux de Menestreau (Nièvre) et leur environnement. In, Lepetz S. et Van Andringa W., Archéologie du sacrifice animal en Gaule Romaine. Rituels et pratiques alimentaires. Editions Monique Merguoil, Montagnac, p.77-87.
Bayard 1980 : BAYARD (D.). - La commercialisation de la céramique commune à Amiens (Somme) du milieu du IIe siècle à la fin du IIIe siècle. Cahiers Archéologiques de Picardie, n° 7, 1980. Amiens : SAP, 1980, p. 147-210.
Bayard 2001 : BAYARD (D.), La céramique dans le bassin de la Somme du milieu du IIe siècle au milieu du IIIe siècle ap. ; J.-C. Bilan de 20 ans d’études, Actes du Congrès de Lille, SFECAG, Marseille, 2002, p. 159-182.Bataille 2008. BATAILLE (G), Les Celtes : des mobiliers au culte, Dijon, 2008.
Ben Redjeb 1985 : BEN REDJEB (T.).- La céramique gallo-romaine à Amiens (Somme) : I- La céramique gallo-belge. Revue Archéologique de Picardie, n° 3/4, 1985. Amiens : RAP, 1985, p. 143-176.
Ben Redjeb 1992 : BEN REDJEB (T.).- Une agglomération secondaire des Viromanduens : Noyon (Oise), Revue Archéologique de Picardie, n° 1/2, 1992. Amiens : SAP, 1992 : 37-74.
Berdeaux-Le Brazidec & Durand 2000. M.-L. BERDEAUX-LE
BRAZIDEC & P. DURAND, Synthèse et interprétation des études numismatiques du sanctuaire de la forêt d’Halatte, dans Le temple gallo-romain de la forêt d’Halatte (Oise), Revue archéologique de Picardie, n° spécial 18, 2000, p. 257-266.
Blondiau et alii 2001 : BLONDIAU (Lydie), CLOTUCHE (Raphaël, LORIDANT (Frédéric).– Mise en évidence de répertoires de céramiques communes sombres dans la partie méridionale de la cité des Nerviens : l’apport des fouilles récentes, in : RIVET (Lucien) éd.- SFECAG, Actes du Congrès de Lille-Bavay (24-27 mai 2001). Marseille : SFECAG, 2001, p. 41-64.
Bodson 2009 A. BODSON, Monnaies gauloises dites « aux chevrons » : éléments de typologie, dans J. van HEESCH & I. HEEREN, Coinage in the Iron Age : essays in honour of Simone Scheers, Londres, 2009, p. 53-64.
Bojnansk, Fargašova, 2007: BOJNANSKY (V), FARGASOVA (A), Atlas of seeds and fruits of Central and East-European Flora, Springer, Dordrecht, 1046 p.
Bourgeois 1999. L. BOURGEOIS (dir.), Le sanctuaire rural de Bennecourt (Yvelines), du temple celtique au temple gallo-romain (Documents d’Archéologie Française n° 77), Paris, 1999.Bozic, Feugère 2004 : BOZIC (D),, FEUGERE (M), « Les instruments de l’écriture » dans Gallia 61, 2004, p. 21-41.Buchez et Gemehl 1996 : BUCHEZ (N.) et GEMEHL (D.). – Amiens « Zac Cathédrale
Université ». D.F.S. de sauvetage urgent. Amiens : SRA Picardie, 1996.
Brulet 1990. R. BRULET, La Gaule septentrionale au Bas-Empire. Occupation du sol et défense du territoire dans l’arrière-pays du limes aux IVe et Ve siècles. Nordgallien in der Spätantike, Trèves, 1990 (Trierer Zeitschrift, Beihefte 11).
Brulet & Coulon 1997. R. BRULET et G. COULON, La nécropole gallo-romaine de la Rue Perdue à Tournai, Louvain, 1997 (Publ. d’Hist. de l’Art et d’Arch., VII).
Brunaux 1986 : BRUNAUX (JL), Les Gaulois sanctuaires et rites. Paris 1986.
Brunaux, Méniel, 1997 : BRUNAUX (JL), MENIEL (P) La résidence aristocratique de Montmartin (Oise) du IIIe au IIe s., Paris, 1997.
Bullock, Fedoroff, Jongerius, Stoops, Tursina, Babel, 1985Bullock P., Fedoroff N., Jongerius A., Stoops G., Tursina T., Babel U., 1985- Handbook for soil thin section description. Waine research publications, 152 p.
Cappers, Bekker, Jans 2006 : CAPPERS (R), BEKKER (R), JANS (J)- Digitale Zadenatlas van Nederland, Barkhuis Publishing & Groningen University Library, Groningen, 502 p.
Casey 1974. J. CASEY, The interpretation of Romano-British site finds, dans Coins and the Archaeologist, Oxford, 1974, pp. 37-51 (BAR, 4).
Bibliographie
281II. Résultats Bibliographie
Collectif 2000. Le temple gallo-romain de la forêt d’Halatte (Oise), Revue archéologique de Picardie, n° spécial 18, 2000.
Courtry, Goldberg, Mac Phail, 1989Courty M.A., Goldberg P., Mac Phail R., 1989- Soil micromorphology in archaeology. Cambridge University Press. 344 p.
Courtry, 1982Courty M.A., 1982- Etude géoarchéologique de sites archéologiques holocènes : définition des processus sédimentaires et post-sédimentaires. Caractérisation de l’impact anthropique. Essai de Méthodologie. Thèse en Géologie du Quaternaire et Préhistoire, Université de Bordeaux I, 314 p.
Deboissy 1965 : DEBOISSY (J.).-Le sanctuaire gallo-romain de Vallangoujard. Bulletin Archéologique du Vexin français, n° 1, 1965. Guiry-en-Vexin 1966, p. 71-78. Debord 1989 : DEBORD (J), « Les rouelles de Villeneuve-Saint-Germain (Aisne) dans Bulletin de la société archéologique champenoise, 82, 1989, p. 25-31.
Delestrée 1996. L.-P. DELESTRÉE, Monnayages et peuples gaulois du Nord-Ouest, Paris, Errance, 1996.
De Muylder, Desforges, Petit 2009 : DE MUYLDER (M), DESFORGES (JDD), PETIT (E)-Languevoisin-Quiquery, Moyencourt, Breuil, Ercheu, Libermont, Frétoy-le-Château, rapport de diagnostic ZD2. Canal Seine-Nord Europe. Inrap 329p.
Delmaire & Notte 1996. R. DELMAIRE, L. NOTTE et coll., Trouvailles archéologiques dans la région de Bapaume. Prospections et fouilles d’Edmond Fontaine (1926-1987), Arras, 1996 (Mém. de la Comm. départ. d’Hist. et d’Arch. du Pas-de-Calais, tome XXXII), 276 p.
Depeyrot 2001. G. DEPEYROT, Le numéraire gaulois du IVe siècle. I. Les frappes ; II. Les trouvailles, Wetteren, 2001² (Coll. Moneta, vol. 24 et 25).
Dez 2012 : DEZ J. – « Etude xylologique », in BERGA A. – Montévrain « ZAC de Courtalin », Rapport de fouille, Inrap, Centre-Ile-de-France.
Dietsch 2000 : DIETSCH (M.F)- Milieux humides pré- et protohistoriques dans le Bassin parisien : l’étude des diaspores. Thèse de doctorat, Université de Paris X. Presses Universitaires du Septentrion, Villeneuve-d’Ascq, 155p.
Doyen & Lémant 1990. J.-M. DOYEN & J.-P. LÉMANT, Les monnaies antiques de Vireux. Tome 2, Braine-L’alleud, 1990 (Amphora n° 60-61).
Doyen 2007. J.-M. DOYEN, Économie, monnaie et société à Reims sous l’Empire romain. Recherches sur la circulation monétaire en Gaule septentrionale intérieure, n° monographique du Bulletin de la Société Archéologique Champenoise, t. 100, 2007, n° 2 et 4 (2008), 4°, 624 p., 199 tableaux, 311 fig. dans le texte, [87] pl. (= Archéologie Urbaine à Reims, 7).
Doyen 2010. J.-M. DOYEN, avec la collaboration de X. DERU, B. DUCHÊNE, S. FEROOZ, A. FOSSION, B. GRATUZE, S. NIETO-PELLETIER et Ph. ROLLET, Les monnaies du sanctuaire celtique et de l’agglomération romaine de Ville-sur-Lumes / Saint-Laurent (dép. des Ardennes, France), Wetteren – Charleville-Mézières, 2010, 4°, 408 p., 33 pl. couleurs hors-texte, 81 fig. dans le texte, 99 tableaux (Collection Moneta, 106).
Doyen & Michel 2009. J.-M. DOYEN & M. MICHEL, L’oppidum de Sandouville (Seine-Maritime) : deux monnaies
gauloises, BCEN, 46, n° 3, 2009, p. 196-204.
Doyen 2009b. J.-M. DOYEN, Les monnaies, dans P. CATTELAIN & N. PARIDAENS (dir.), Le sanctuaire tardo-romain du « Bois des Noël » à Matagne-la-Grande. Nouvelles recherches (1994-2008) et réinterprétation du site, Bruxelles – Treignes, CReA – Cedarc, 2009 (Études d’Archéologie 2 – Artéfacts 12), pp. 52-76.
Doyen, Hanotte et Michel, 2011. J.-M. DOYEN, A. HANOTTE & M. MICHEL, Le sanctuaire antique d’Authevernes « Les Mureaux » (Eure, France) : contextes monétaires antiques et romains précoces de Haute-Normandie, The Journal of Archaeological Numismatics, 1, 2011
Dubois, Bourson 2001 : DUBOIS (Stéphane), BOURSON (Véronique).– Première approche des faciès céramiques de la cité des Viromanduens, in : RIVET (L.) éd.– SFECAG : Actes du Congrès de Lille (mai 2001). SFECAG : Marseille, 2002, p. 183-201.
Dubois et alii 2002 : DUBOIS (S.), MANTEL (E.), DEVILLERS(S.).- La diffusion des céramiques romano-britanniques entre Dieppe et Boulogne-sur-Mer (du IIe au début du Ve siècle). Nord-Ouest Archéologie, n° 12, 2001. Berck-sur-Mer : CRADC, 2002, p. 49-85.
Estiot 1998. S. ESTIOT, Le trésor de Troussey (Meuse): 5864 antoniniens et nummi, 303 AD, dans TM, XVII, 1998, pp. 181-303 et pl. XXII-LI.
Exaltus, Miedema, 1994Exaltus R.P., Miedema R., 1994- A micromorphological study of four Neolithic sites in the Dutch Coastal Province. J.A.S., 21, 289-301.
Fédoroff N., Courty M.A., 1994- Organisation du sol aux échelles
282 Inrap · Rapport de fouille Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt
microscopiques. In Duchauffour P. et Souchier B. (dir.), Pédologie, t.2, Constituants et propriétés du sol. Masson, 348-375.
Fauduet 2010 : FAUDUET (I)- Les temples de tradition celtique. Errance.
Feugère 1985 : FEUGERE (M), Les fibules de Gaule méridionale de la conquête à la fin du Ve siècle ap. J.-C., Paris, 1985.
Feugère 2010 : FEUGERE (M), « Coups de foudre gallo-romains ? » dans Bulletin instrumentum, 32, 2010, p. 16-17.
Fitzpatrick, 1984Fitzpatrick E.A., 1984- Micromorphology of soils. Chapman and Hall. 433 p.
Gebhardt, Langohr, 1999Gebhardt A., Langohr R., 1999- Micromorphological study of construction materials and living floors in the Medieval Motte of Werken (West Flanders, Belgium). Geoarchaeology, 14, 595-620.
Goldberg, Macphail, 2003Goldberg P., Macphail R., 2003- Short contribution : strategies and techniques in collecting micromorphology samples. Geoarchaeology, 18, 5, 571-578.
Gorecki 1975. J. GORECKI, Studien zur Sitte der Münzbeigabe in römerzeitlichen Körpergräbern zwischen Rhein, Mosel und Somme, dans BRGK, 56, 1975, p. 179-467.
Goudineau 1990 : GOUDINEAU (C)- César et la Gaule . Errance.
Greep 1995 : GREEP (S).- “Objets of bone, antler and ivory from C.A.T. sites” in Blockley, Frere and Stow, Excavations I the Marlowe car Park and Surrounding Areas. The Archaeology of Canterbury, Vol. V. 1995, p. 1112-1152.
Gricourt et alii 2009 .D. GRICOURT, J. NAUMANN &
J. SCHAUB et alii, sous la dir. de M. AMANDRY, Le mobilier numismatique de l’agglomération secondaire de Bliesbruck (Moselle). Fouilles 1978-1998, Paris, 2009 (BLESA, 5), 807 p.
Gruel & Popovitch 2007. K. GRUEL & L. POPOVITCH, Les monnaies gauloises et romaines de l’oppidum de Bibracte, Glux-en-Glenne, 2007 (Collection Bibracte 13).
Guilhard 2008 .P.-M. GUILHARD, Monnaies gauloises et circulation monétaire dans l’actuelle Normandie. Collection de la médiathèque municipale de Bayeux (Calvados), Caen, 2008, 129 p.
Guillaumet, Laude 2009 : GUILLAUMET (JP), LAUDE (G) L’art de la serrurerie gallo-romaine, L’exemple de l’agglomération de Vertault, Clamecy, 2009.
Jacques, Lepetz, Van Andringa, Matterne, Tuffreau-Libre : JACQUES (A), LEPETZ (S), VAN ANDRINGA (W), MATTERNE (V), TUFFREAU-LIBBRE (M)-Vestiges de repas et identification d’un collège à Arras-Nemetacum. In, Lepetz S. et Van Andringa W., Archéologie du sacrifice animal en Gaule Romaine. Rituels et pratiques alimentaires. Editions Monique Merguoil, Montagnac, p.237-252.
Jaoul et Goldstein 1990 : JAOUL (M.) et GOLDSTEIN (B.) - La vannerie française.‒ ‒Musée national des arts et traditions populaires, Paris, 315 p.
Lallemand 1967. J. LALLEMAND, Le trésor de Hemptinne : bronzes (aes 2) de Gratien à Magnus Maximus, dans ASAN, 54, 1967, pp. 25-59.
Lallemand 1983. J. LALLEMAND, Belgian finds of late fourth-century Roman bronze, dans C.N.L. BROOKE et alii (éd.), Studies in Numismatic method presented to Philip
Grierson, Cambridge, 1983, p. 75-94.
Lallemand 1989. J. LALLEMAND, Les monnaies antiques de la Sambre à Namur, Namur, Musée Archéologique, 1989 (Documents relatifs à l’archéologie de la région namuroise, 3).
Lambinon, de Langhe, Delvosalle, Duvigeaud 2005 : LAMBINON (J), DE LANGHE (JE), DELVOSALLE (L), DUVIGEAUD (J) -Nouvelle flore de Belgique, du Grand Duché du Luxembourg, du Nord de la France et des régions voisines (Ptéridophythes et Spermaphytes), 5ème édition, 2005, Ed. du Patrimoine du jardin botanique national de Belgique, Meise, 1092p.
Lambot 2002. B. LAMBOT, L’argent perdu des Remi d’Acy-Romance, dans P. MENIEL & B. LAMBOT (dir.), Découvertes récentes de l’Age du fer dans le massif des Ardennes et ses marges. Repas des vivants et nourriture pour les morts en Gaule. Actes du XXVe colloque international de l’AFEAF, Charleville-Mézières, 24-27 mai 2001, Reims, 2002, p. 125-142.
Lambot 1989 : LAMBOT (B), « Le sanctuaire gaulois et gallo-romain de Nanteuil-sur-Aisne (Ardennes) » dans Bulletin de la société archéologique champenoise, 82, 1989, p. 33-44.
Landes 2002. LANDES (C) – La mort des notables en Gaule romaine. Catalogue d’exposition, Musée archéologique Henri Prades. Association Imago. Lattes 256p.
Lecomte-Schmitt 2010 : LECOMTE-SCHMITT (B.) – « Artisanat du bois et environnement arboré ». In MONDOLONI (A.) dir – Lieusaint, Zac de la Pyramide, Lots E2-D4, Rapport de fouille, Vol. 1 – texte et illustrations, Annexe 8, Inrap, Centre-Ile-de-France, p. 229-249.
283II. Résultats
Lecomte-Schmitt 2011 : LECOMTE-SCHMITT (B.) – « Montévrain: eau et environnement Les 22 Arpents“». In BERGA (A.) dir – Montévrain, ZAC du Val d’Europe „Courtalin“, „les 22 Arpents“, „la Charbonnière“, Rapport de fouille, Vol. 2 – Annexes : études spécialisées, Annexe 8, Pantin : Inrap CIF, p. 131-164.
Lejars 1996 : LEJARS (T), « L’armement des Celtes en Gaule du Nord à la fin de l’époque gauloise » dans Revue archéologique de Picardie, n°3-4 1996, p. 79-103.
Lemaire 2004 : LEMAIRE (F.).- Revelles (80), « Le Trélet », 15/5/2002 au 11/4/2003, Opération archéologique A 29 ouest : site 28. 2 Volumes. SRA Picardie.
Lepetz, Sébastien (2008), ‘Boucherie, sacrifice et marché à la viande en Gaule romaine septentrionales : l’apport de l’archéozoologie’, in W. Van Andringa (ed.), Sacrifices, marchés à la viande et pratiques alimentaires dans les cités du monde romain (volume 5 -n°1 ; Tours : Food and History), 73-105.
Lepetz, Sébastien and Magnan, Danielle (2008), ‘Sanctuaires et activités de boucherie sur le site de La Bauve à Meaux’, in S. Lepetz and W. Van Andringa (eds.), Archéologie du sacrifice animal en Gaule romaine —
Manning 1985 : MANNING (W.-H), Catalogue of the Romano-British Iron Tools, fittings and weapons in the British Museum, Londres, 1985.
Mangard 2008. M. MANGARD, Le sanctuaire gallo-romain du Bois l’Abbé à Eu (Seine-Maritime), Lille, 2008 (Revue du Nord. Hors série. Collection Art et Archéologie, n° 12).
Mantel 1997 : MANTEL (E)- Le sanctuaire de Fesques « Le Mont du Val Aux Moines ». Nord-Ouest Archéologie N°8.
Martini 2003. R. MARTINI, Collezione Pangerl contromarche imperiali Romane (Augustus-Vespasianus), Milan, 2003 (Nomismata, 6).
Marot 2008. MAROT (E) : La pile gallo-romaine de Cinq-Mars-la-Pile. Réexamen à la lumière des récentes découvertes . Revue archéologique du centre de la France. Tome 47.
Megaloudi, 2007Megaloudi F., 2007, Burnt sacrificial plant offerings in Hellenistic times. Archaeobotanical case study of Messene, Peloponnese, Grece, Vegetation History and Archaeobotany 14 (4), p.329-340.Nilesse 2009 : NILESSE (O), « Activités, métiers, vie quotidienne dans les établissements ruraux de l’Ouest de la France à travers l’instrumentum (Hallstatt D / début du Haut-Empire) » dans I. Bertrand, A. Duval, J. Gomez de Soto, P. Maguer (dir.), Habitats et paysages ruraux en Gaule et regards sur d’autres régions du monde celtique (Actes du XXXIe Colloque internat. AFEAF, mai 2007, Chauvigny), Chauvigny 2009, p. 45-83.
Padrino Fernandez 2005. S. PADRINO FERNANDEZ, Una aproximacion de la circulacion monetaria de Ebusus en época romana, Eivissa, 2005.
Paridaens, Gillet, Pigière, Laurent, Udrescu : 2008 : PARIDAENS (N), GILLET (E), PIGIERE (F), LAURENT (C), UDRESCU (M) -Manger dans les sanctuaires : la cuisine de Blicquy. In, Lepetz S. et Van Andringa W., Archéologie du sacrifice animal en Gaule Romaine. Rituels et pratiques alimentaires. Editions Monique Merguoil, Montagnac, p.207-214.
Petit 2011. PETIT (E)- Un sanctuaire gallo-romain et un moulin-tour du XIXe siècle à Villers-Bretonneux « Entre les Chemins de Corbie ». Rapport de diagnostic Inrap.
Piette 1981 : TTE (J), « Le fanum de La Villeneuve-au-Châtelot (Aube) dans Mémoires de la Société Archéologique Champenoise, 2, 1981, p. 367-375.
Piette, Depeyrot 2008 : PIETTE (J), DEPEYROT (G)- Les monnaies et les rouelles du sanctuaire de La Villeneuve-au-Chatelot (Aube) (IIème s.av J-C. ap J.-C), Wetteren, 2008.
Pion 1996. P. PION, Les habitats laténiens tardifs de la vallée de l’Aisne : contribution à la périodisation de la fin du second âge du fer en Gaule nord-orientale. La Tène C2 – période augustéenne précoce IIe – Ier siècles av. J.-C., Thèse de doctorat, Université de Paris I, 1996.
Pion 2009 . P. PION, Nouveaux jalons pour une histoire monétaire des Suessiones, dans J. van HEESCH & I. HEEREN (éd.), Coinage in the Iron Age: essays in honour of Simone Scheers, Londres, 2009, p. 323-336.
Philippe 1999 : PHILIPPE (JP), Les fibules de Seine-et-Marne du Ier siècle av. J.-C. au Ve siècle ap. J.-C., Châlons-en-Champagne, 1999.
Poux 2008 : POUX (M), « Du Nord au Sud. Définition et fonction de l’espace consacré en Gaule indépendante. » dans S. Ribichini, Saturnia Tellus. Definizioni dello spazio consacrato in ambiente etrusco, italico, fenicio-punico, iberico e celtico, 2008.
Prat, Cabanis, 2006-2007 : PRAT (V), CABANIS M)- « Apports de l’archéobotanique à la compréhension de la Source des Roches, Chamalières (Puy-de-
Bibliographie
284 Inrap · Rapport de fouille Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt
Dôme) », Revue archéologique du Centre de la France [En ligne], Tome 45-46 | 2006-2007, mis en ligne le 08 avril 2008, consulté le 14 juin 2012. URL : http://racf.revues.org/663
Prodéo 2000. PRODEO (F)- Bayonvilliers “Chemin d’Harbonnières” (Somme). Un petit habitat fortifié de La Tène moyenne et finale. Table-Ronde de Ribemont-sur-Ancre 1999. RAP ½, p255/265.
Rapin, Brunaux 1988 : RAPIN (A), BRUNAUX (J.-L) Gournay II. Boucliers et lances dépôts et trophées, Paris, 1988.
Ravetz 1964. A. RAVETZ, The fourth-century inflation and Romano-British coin finds. I. Patterns of fourth-century coinage on Romano-British sites, dans Numismatic Chronicle, 1964, p. 201-231.
Reece 1979 . R. REECE, Zur Auswertung und Interpretation römischer Fundmünzen aus Siedlungen, dans Studien zu Fundmünzen der Antike, 1, 1979, p. 175-195.
Rogers 1974 : ROGERS (G. B.).– Poteries sigillées de la Gaule Centrale I. — Les motifs non figurés. Paris : CNRS, 1974 (Suppl. à Gallia ; XXVIII).
Rogers 1999 : ROGERS (Georges B.).– Poteries sigillées de la Gaule Centrale II. — Les potiers. Lezoux : Centre Archéologique de Lezoux, 1999. 2 vol. (Sites ; Hors-série n°40).
Rottoli, Castiglioni, 2011Rottoli M. et Castiglioni E., 2011, Plant offerings from Roman cremations in Northern Italy : a review. Vegetation History and Archaeobotany 20 (5), p.495-506
Rovira, Chabal, 2008Rovira N. et Chabal L., 2008, A foundation offering at the Roman port of Lattara (Lattes, France) : the plant remains. Vegetation
History and Archaeobotany 17(1), p.191-200.
Saedlou et Dupéron 2007 : SAEDLOU (N.) et DUPERON (M.) – « Etude xylologique et typologique des tablettes à écriture antiques en bois à partir des découvertes faites à Saintes (Charente-Maritime) ». In La mémoire des forêts, Actes du colloque « Forêt, Archéologie et Environnement », Nancy , 14-16 décembre 2004, co-éd. ONF / INRA : DRAC Lorraine, p. 79-86.
Scheers 1983. S. SCHEERS, Traité de Numismatique celtique, 2, la Gaule Belgique, Paris 1977 (Annales litt. de l’Université de Besançon, 195) (réimpr. Leuven, 1983), 986, p. XXVIII pl.
Scheers 1984. S. SCHEERS, Les potins au rameau B, dans A. CAHEN-DELHAYE et alii (éd.), Les Celtes en Belgique et dans le nord de la France . Les fortifications de l’Âge du Fer. Actes du sixième colloque tenu à Bavay et Mons, Lille, 1984 (Revue du Nord, n° spécial hors série), p. 99-100.
Sordoillet, 1999Sordoillet D., 1999- Géoarchéologie de sites préhistoriques holocènes. Etude sédimentologique de la grotte du Gardon (Ain), de la grotte de Montou (Pyrénées-Orientales), de l’éperon fortifié de Saint-Alban (Isère) et des sites de plaine alluviales de Rufin-sur-Seilles et de Choisey-aux-Champins (Jura). Thèse de l’ Université de Bourgogne, 297 p.
Thirion 1962. M. THIRION, Le trésor de Fraire, monnaies gauloises en potin, Revue belge de numismatique, 108, 1962, p. 67-112.
Thirion 1974. M. THIRION, Une variante du potin gaulois, type Rameau A (LT 8620), BCEN,10, n° 1, 1973, p. 11-18.
Van Andriga 2002. VAN ANDRIGA (W) : La religion en Gaule romaine. Piété et politique (Ier –IIIe siècle). Errance.
Vandorpe, Jacomet : 2011 : VANDORPE (P), JACOMET (S), Remains of burnt vegetable offerings in the temple area of Roman Oedenburg (Biesheim-Kunheim, Haut-Rhin, Alsace). First results. In, Wiethold J. (dir.), Actes des rencontres d’archéobotanique organisées par Bibracte, Centre de Recherche Archéologique Européen er le Centre de Recherche Archéologique de la Vallée de l’Oise, 9-12 juin 2005, Glux-en-Glenne. Bibracte, Collection Bibracte 20., p.87-100.
Van Vliet, 1992Van Vliet B. et al., 1992- Importance de la succession des phases écologiques anciennes et actuellement dans la différenciation des sols lessivés de la couverture loessique d’Europe occidentale : argumentation stratigraphique et archéologique. Science du sol, 30, 2, 75-93.
Villes 1985. A. VILLES dir., La civilisation gauloise en pays carnutes, cat. d’exp., Châteaudun, 16 mai – 31 juillet 1985, 112 p.
Wattez, J., 2003- Caractérisation micromorphologiques des matériaux façonnés en terre crue dans les habitats néolithiques du Sud de la France. In Echanges Transdisciplinaires sur les constructions en terre crue, 1. Table ronde de Montpellier. Ed de l’Espérou, Montpellier, 21-31.
Wattez, 1992Wattez, J., 1992- Dynamique de formation des structures de combustion de la fin du Paléolithique au Néolithique Moyen. Approche méthodologique et implications culturelles. Thèse. Univ. Paris 1. 400 p.
Wigg 1987. D. WIGG, Fragen zur Datierung und Interpretation
285II. Résultats Bibliographie
der barbarisierten Bronzemünzen des 4. Jahrhunderts n. Chr., Archäologisches Korrespondenzblatt 17, 1987, p. 111-120.
Werz 2004 . U. WERZ, Gegenstempel auf Reichs- und Provinzialprägungen der römischen Kaiserzeit. Katalog der Sammlung Dr. Konrad Bech, Mainz, Speyer, 2004 (Schriftenreihe der Numismatischen Gesellschaft Speyer, Bd. 45).
Werz 2009 . U. WERZ, Gegenstempel auf Aesprägungen der frühen römichen Kaiserzeit im Rheingebiet – Grundlagen, Systematik, Typologie, Winterthur, 2009. Thèse inédite présentée à Francfort en 2001, accessible en ligne sur http://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/volltexte/2009/6893/
Woimant 1995. G.-P. WOIMANT, Carte archéologique de la Gaule. L’Oise 60, Paris, 1995.
Zach, 2002Zach B., 2002, Vegetable offerings on the Roman sacrificial site in Mainz, Germany. Short report on the first results. Vegetation History and Archaeobotany 11, p.1001-106.
![Page 1: Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt. Le site laténo-romain de Moyencourt au](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012809/631babd4a906b217b90693db/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt. Le site laténo-romain de Moyencourt au](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012809/631babd4a906b217b90693db/html5/thumbnails/2.jpg)
![Page 3: Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt. Le site laténo-romain de Moyencourt au](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012809/631babd4a906b217b90693db/html5/thumbnails/3.jpg)
![Page 4: Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt. Le site laténo-romain de Moyencourt au](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012809/631babd4a906b217b90693db/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt. Le site laténo-romain de Moyencourt au](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012809/631babd4a906b217b90693db/html5/thumbnails/5.jpg)
![Page 6: Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt. Le site laténo-romain de Moyencourt au](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012809/631babd4a906b217b90693db/html5/thumbnails/6.jpg)
![Page 7: Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt. Le site laténo-romain de Moyencourt au](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012809/631babd4a906b217b90693db/html5/thumbnails/7.jpg)
![Page 8: Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt. Le site laténo-romain de Moyencourt au](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012809/631babd4a906b217b90693db/html5/thumbnails/8.jpg)
![Page 9: Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt. Le site laténo-romain de Moyencourt au](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012809/631babd4a906b217b90693db/html5/thumbnails/9.jpg)
![Page 10: Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt. Le site laténo-romain de Moyencourt au](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012809/631babd4a906b217b90693db/html5/thumbnails/10.jpg)
![Page 11: Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt. Le site laténo-romain de Moyencourt au](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012809/631babd4a906b217b90693db/html5/thumbnails/11.jpg)
![Page 12: Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt. Le site laténo-romain de Moyencourt au](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012809/631babd4a906b217b90693db/html5/thumbnails/12.jpg)
![Page 13: Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt. Le site laténo-romain de Moyencourt au](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012809/631babd4a906b217b90693db/html5/thumbnails/13.jpg)
![Page 14: Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt. Le site laténo-romain de Moyencourt au](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012809/631babd4a906b217b90693db/html5/thumbnails/14.jpg)
![Page 15: Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt. Le site laténo-romain de Moyencourt au](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012809/631babd4a906b217b90693db/html5/thumbnails/15.jpg)
![Page 16: Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt. Le site laténo-romain de Moyencourt au](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012809/631babd4a906b217b90693db/html5/thumbnails/16.jpg)
![Page 17: Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt. Le site laténo-romain de Moyencourt au](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012809/631babd4a906b217b90693db/html5/thumbnails/17.jpg)
![Page 18: Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt. Le site laténo-romain de Moyencourt au](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012809/631babd4a906b217b90693db/html5/thumbnails/18.jpg)
![Page 19: Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt. Le site laténo-romain de Moyencourt au](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012809/631babd4a906b217b90693db/html5/thumbnails/19.jpg)
![Page 20: Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt. Le site laténo-romain de Moyencourt au](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012809/631babd4a906b217b90693db/html5/thumbnails/20.jpg)
![Page 21: Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt. Le site laténo-romain de Moyencourt au](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012809/631babd4a906b217b90693db/html5/thumbnails/21.jpg)
![Page 22: Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt. Le site laténo-romain de Moyencourt au](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012809/631babd4a906b217b90693db/html5/thumbnails/22.jpg)
![Page 23: Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt. Le site laténo-romain de Moyencourt au](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012809/631babd4a906b217b90693db/html5/thumbnails/23.jpg)
![Page 24: Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt. Le site laténo-romain de Moyencourt au](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012809/631babd4a906b217b90693db/html5/thumbnails/24.jpg)
![Page 25: Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt. Le site laténo-romain de Moyencourt au](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012809/631babd4a906b217b90693db/html5/thumbnails/25.jpg)
![Page 26: Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt. Le site laténo-romain de Moyencourt au](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012809/631babd4a906b217b90693db/html5/thumbnails/26.jpg)
![Page 27: Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt. Le site laténo-romain de Moyencourt au](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012809/631babd4a906b217b90693db/html5/thumbnails/27.jpg)
![Page 28: Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt. Le site laténo-romain de Moyencourt au](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012809/631babd4a906b217b90693db/html5/thumbnails/28.jpg)
![Page 29: Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt. Le site laténo-romain de Moyencourt au](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012809/631babd4a906b217b90693db/html5/thumbnails/29.jpg)
![Page 30: Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt. Le site laténo-romain de Moyencourt au](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012809/631babd4a906b217b90693db/html5/thumbnails/30.jpg)
![Page 31: Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt. Le site laténo-romain de Moyencourt au](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012809/631babd4a906b217b90693db/html5/thumbnails/31.jpg)
![Page 32: Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt. Le site laténo-romain de Moyencourt au](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012809/631babd4a906b217b90693db/html5/thumbnails/32.jpg)
![Page 33: Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt. Le site laténo-romain de Moyencourt au](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012809/631babd4a906b217b90693db/html5/thumbnails/33.jpg)
![Page 34: Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt. Le site laténo-romain de Moyencourt au](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012809/631babd4a906b217b90693db/html5/thumbnails/34.jpg)
![Page 35: Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt. Le site laténo-romain de Moyencourt au](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012809/631babd4a906b217b90693db/html5/thumbnails/35.jpg)
![Page 36: Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt. Le site laténo-romain de Moyencourt au](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012809/631babd4a906b217b90693db/html5/thumbnails/36.jpg)
![Page 37: Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt. Le site laténo-romain de Moyencourt au](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012809/631babd4a906b217b90693db/html5/thumbnails/37.jpg)
![Page 38: Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt. Le site laténo-romain de Moyencourt au](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012809/631babd4a906b217b90693db/html5/thumbnails/38.jpg)
![Page 39: Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt. Le site laténo-romain de Moyencourt au](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012809/631babd4a906b217b90693db/html5/thumbnails/39.jpg)
![Page 40: Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt. Le site laténo-romain de Moyencourt au](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012809/631babd4a906b217b90693db/html5/thumbnails/40.jpg)
![Page 41: Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt. Le site laténo-romain de Moyencourt au](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012809/631babd4a906b217b90693db/html5/thumbnails/41.jpg)
![Page 42: Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt. Le site laténo-romain de Moyencourt au](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012809/631babd4a906b217b90693db/html5/thumbnails/42.jpg)
![Page 43: Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt. Le site laténo-romain de Moyencourt au](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012809/631babd4a906b217b90693db/html5/thumbnails/43.jpg)
![Page 44: Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt. Le site laténo-romain de Moyencourt au](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012809/631babd4a906b217b90693db/html5/thumbnails/44.jpg)
![Page 45: Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt. Le site laténo-romain de Moyencourt au](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012809/631babd4a906b217b90693db/html5/thumbnails/45.jpg)
![Page 46: Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt. Le site laténo-romain de Moyencourt au](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012809/631babd4a906b217b90693db/html5/thumbnails/46.jpg)
![Page 47: Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt. Le site laténo-romain de Moyencourt au](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012809/631babd4a906b217b90693db/html5/thumbnails/47.jpg)
![Page 48: Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt. Le site laténo-romain de Moyencourt au](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012809/631babd4a906b217b90693db/html5/thumbnails/48.jpg)
![Page 49: Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt. Le site laténo-romain de Moyencourt au](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012809/631babd4a906b217b90693db/html5/thumbnails/49.jpg)
![Page 50: Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt. Le site laténo-romain de Moyencourt au](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012809/631babd4a906b217b90693db/html5/thumbnails/50.jpg)
![Page 51: Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt. Le site laténo-romain de Moyencourt au](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012809/631babd4a906b217b90693db/html5/thumbnails/51.jpg)
![Page 52: Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt. Le site laténo-romain de Moyencourt au](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012809/631babd4a906b217b90693db/html5/thumbnails/52.jpg)
![Page 53: Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt. Le site laténo-romain de Moyencourt au](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012809/631babd4a906b217b90693db/html5/thumbnails/53.jpg)
![Page 54: Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt. Le site laténo-romain de Moyencourt au](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012809/631babd4a906b217b90693db/html5/thumbnails/54.jpg)
![Page 55: Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt. Le site laténo-romain de Moyencourt au](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012809/631babd4a906b217b90693db/html5/thumbnails/55.jpg)
![Page 56: Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt. Le site laténo-romain de Moyencourt au](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012809/631babd4a906b217b90693db/html5/thumbnails/56.jpg)
![Page 57: Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt. Le site laténo-romain de Moyencourt au](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012809/631babd4a906b217b90693db/html5/thumbnails/57.jpg)
![Page 58: Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt. Le site laténo-romain de Moyencourt au](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012809/631babd4a906b217b90693db/html5/thumbnails/58.jpg)
![Page 59: Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt. Le site laténo-romain de Moyencourt au](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012809/631babd4a906b217b90693db/html5/thumbnails/59.jpg)
![Page 60: Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt. Le site laténo-romain de Moyencourt au](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012809/631babd4a906b217b90693db/html5/thumbnails/60.jpg)
![Page 61: Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt. Le site laténo-romain de Moyencourt au](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012809/631babd4a906b217b90693db/html5/thumbnails/61.jpg)
![Page 62: Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt. Le site laténo-romain de Moyencourt au](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012809/631babd4a906b217b90693db/html5/thumbnails/62.jpg)
![Page 63: Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt. Le site laténo-romain de Moyencourt au](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012809/631babd4a906b217b90693db/html5/thumbnails/63.jpg)
![Page 64: Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt. Le site laténo-romain de Moyencourt au](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012809/631babd4a906b217b90693db/html5/thumbnails/64.jpg)
![Page 65: Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt. Le site laténo-romain de Moyencourt au](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012809/631babd4a906b217b90693db/html5/thumbnails/65.jpg)
![Page 66: Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt. Le site laténo-romain de Moyencourt au](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012809/631babd4a906b217b90693db/html5/thumbnails/66.jpg)
![Page 67: Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt. Le site laténo-romain de Moyencourt au](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012809/631babd4a906b217b90693db/html5/thumbnails/67.jpg)
![Page 68: Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt. Le site laténo-romain de Moyencourt au](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012809/631babd4a906b217b90693db/html5/thumbnails/68.jpg)
![Page 69: Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt. Le site laténo-romain de Moyencourt au](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012809/631babd4a906b217b90693db/html5/thumbnails/69.jpg)
![Page 70: Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt. Le site laténo-romain de Moyencourt au](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012809/631babd4a906b217b90693db/html5/thumbnails/70.jpg)
![Page 71: Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt. Le site laténo-romain de Moyencourt au](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012809/631babd4a906b217b90693db/html5/thumbnails/71.jpg)
![Page 72: Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt. Le site laténo-romain de Moyencourt au](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012809/631babd4a906b217b90693db/html5/thumbnails/72.jpg)
![Page 73: Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt. Le site laténo-romain de Moyencourt au](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012809/631babd4a906b217b90693db/html5/thumbnails/73.jpg)
![Page 74: Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt. Le site laténo-romain de Moyencourt au](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012809/631babd4a906b217b90693db/html5/thumbnails/74.jpg)
![Page 75: Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt. Le site laténo-romain de Moyencourt au](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012809/631babd4a906b217b90693db/html5/thumbnails/75.jpg)
![Page 76: Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt. Le site laténo-romain de Moyencourt au](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012809/631babd4a906b217b90693db/html5/thumbnails/76.jpg)
![Page 77: Étude des monnaies [du sanctuaire de Moyencourt], dans G. PRILAUX (dir.), Canal Seine-Nord Europe, fouille 18, Picardie, Somme, Moyencourt. Le site laténo-romain de Moyencourt au](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012809/631babd4a906b217b90693db/html5/thumbnails/77.jpg)