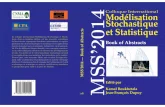Baralis et alii_ANR_Apollonia du Pont et OrgameArgamum_DHA_2010
PETREQUIN P., ERRERA M., GAUTHIER E. et JACCOTTEY L., 2007.- Néolithique (5500-2100 av. J.-C.) :...
-
Upload
univ-fcomte -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of PETREQUIN P., ERRERA M., GAUTHIER E. et JACCOTTEY L., 2007.- Néolithique (5500-2100 av. J.-C.) :...
Musée(s) de BELFORT
page 28trafics et transits
entre Vosges et Jura
(5500 - 2100 av.J-C) :une Europe des inégalités socialesNéolithique
Nécropole
Habitat
Atelier
Habitat fortifié
Découverte isolée
Lepuix-Gy
Grosmagny
Roppe “Fort” Roppe « Étang Autruche »
Evette-Salbert
Cravanche Belfort« Les Forges »
Essert
Bavilliers
Belfort « Le Mont »
Belfort « La Miotte »Belfort « Le Bramont »
DenneyPerouse
Danjoutin « Perches »
BanvillarsBermont
Trévenans
« Grammont »
Anjoutey
St-Dizier
Carte des principaux sites néolithiques dans le Territoire de Belfort(J.-F. Piningre)
Musée(s) de BELFORT
page 29trafics et transits
entre Vosges et Jura
(5500-2100 av.J-C) :une Europe des inégalités socialesNéolithique
trafics et transitsentre Vosges et Jura Néolithique
(5500 - 2100 av. J.-C.) :une Europe des inégalités sociales
Pierre PÉTREQUINUMR 6565 CNRS /Université de Franche-Comté, laboratoire de Chrono-écologie
Michel ERRERAMusée royal de l’Afrique centrale,Tervuren, Belgique
Estelle GAUTHIERUMR 6565 CNRS /Université de Franche-Comté,laboratoire de Chrono-écologie
et Luc JACCOTTEYInstitut national de recherchesarchéologiques préventives,Grand-Est Sud – Franche-Comté
Le passage à l’agriculture céréalière, à l’élevage et à l’habitat en hameaux et en villages marque l’avènement progressif du Néolithique, à partir de deux fronts de colonisation, l’un au nord par la vallée du Danube, l’autre au sud par le littoral mé-diterranéen. Entre 5500 et 5000 av. J.-C., l’adoption brutale ou progressive de ces nouvelles techniques de faire-valoir économique ne doivent pas être interprétées - selon notre « bon sens » occidental – comme la simple manifestation d’un progrès technique inéluctable. Au contraire, ce sont les fonctionnements sociaux qui sont en cause avec l’introduction de l’agriculture et de l’élevage ou l’adoption de la céramique ; il s’agissait en fait d’utiliser des innovations pour stocker et distribuer une nouvelle forme de richesse, des céréales, des pièces de viande et afficher les inégalités sociales en réservant à quelques-uns (un homme, une famille ou un lignage) la part de certains objets exotiques, détournés parfois à grands frais dans les réseaux de circulation qui animaient alors les communautés agricoles, parfois à l’échelle de l’Europe (Pétrequin, Arbogast et al. 2006). Pour prendre un exemple : la poterie, à l’origine, n’est probablement pas un simple récipient utile pour cuire les aliments à l’eau ; de fait, la poterie est une technique nouvelle, qui permet de créer de toutes pièces un objet à partir d’une matière première encore inconnue et d’offrir en public d’autres formes d’aliments ou de boissons fermentées. Dans ce sens, les dons alimentaires sont un des moyens de créer de la dépendance et de l’inégalité sociale. Plus tard, des poteries aux décors complexes ont permis d’afficher – et c’est encore un fonctionnement social - l’identité culturelle des utili-sateurs, en quelque sorte un code de reconnaissance visuelle.
fig. 1À l’origine des haches néolithiques en jade : le Mont Viso au sud-ouest de Turin (Italie). (Cliché P. Pétrequin)
Musée(s) de BELFORT
page 30trafics et transits
entre Vosges et Jura
(5500 - 2100 av.J-C) :une Europe des inégalités socialesNéolithique
Ainsi, les deux gobelets à décor géométrique poinçonné de la grotte de Cravan-che, datés ici des environs de 4600-4500 av. J.-C. (fig. 2), appartiennent à la cultu-re de Rössen (Jeunesse et Pétrequin 1977). Le même genre de magnifiques petits récipients a circulé en direction d’autres groupes culturels, et on les retrouve ainsi dans le groupe d’Egolzwil, centré sur le nord de la Suisse. Inutile de préciser que la circulation de ces petits récipients décorés permet de démontrer que leur utili-sation n’était pas simplement un acte de tous les jours et pour tous. Dans le même domaine de ces objets qui ne sont pas à la portée de chacun et qui circulent à l’échelle d’une région - entre Bâle, Strasbourg et Besançon, grosso modo -, on pourra admirer une paire d’anneaux-disque trouvés dans une sépulture de la grot-te de Cravanche (fig. 3). Ces parures étaient portées au bras. Elles ont été réalisées à partir de galets fluviatiles de serpentinite (détermination par spectroradiométrie), probablement de la vallée du Rhin juste en amont de Bâle.
Avec la petite hache en jadéitite de la grotte de Cravanche (fig. 4), nous changeons complètement d’échelle d’observation, puisque cette matière première, plaisante à l’œil, précieuse et très résistante provient des Alpes italiennes (fig. 5). Des analyses spectroradiométriques (fig. 6) (Errera, Pétrequin et al. 2007) ont permis de montrer que les deux spectres (représentant chacun une moyenne de dix mesures) obte-nus sur la hache de Cravanche sont tout à fait comparables à trois échantillons de notre référentiel d’environ 400 blocs naturels de jadéitites/omphacitites alpines. On montre donc que, selon toute vraisemblance, la petite hache de Cravanche, dont la forme évoque les styles du milieu du Ve millénaire av. J.-C., a été tirée d’un bloc de jadéitite du versant sud-est du Mont Viso (Oncino, Piémont, Italie) à 350 km de Belfort à vol d’oiseau (fig. 7) (Pétrequin, Errera et al. 2006). Le cas de la ha-
che de Cravanche n’est pas isolé ; cette lame polie appartient à un très vaste réseau de transfert (fig. 8, p. 32) qui porte des haches alpines en direction des franges maritimes de l’Europe. Dans ce contexte, les haches polies, mises en forme dans de superbes roches vertes translucides à grain très fin, ont rarement été utilisées comme outils de travail du bois et d’abat-
tage de la forêt, sauf dans la zone d’origine ; au contraire, on les a parfois plantées verticalement dans le sol pour un marquage rituel des territoires et
certains puissants se les sont réservées pour leur voyage dans l’au-delà (Pétrequin, Pétrequin et al. 2006).
Il faut donc bien comprendre qu’un tel exemple de circula-tion d’un objet socialement valorisé sur des distances qui atteignent 1800 km à vol d’oiseau, jusqu’au Danemark, en
Écosse, en Irlande, est la conséquence très directe de la com-pétition entre les hommes, dans le cadre de sociétés franche-
ment inégalitaires.
On peut s’en rendre aisément compte en comparant ce réseau complexe à l’échelle de l’Europe pour des haches surpolies et détournées de leur fonction pratique, avec le réseau de distribution des carrières de Plan-cher-les-Mines (Haute-Saône), proches de Belfort. Les carrières néolithi-ques du ruisseau de Marbranche à Plancher-les-Mines ont été découvertes en 1989 par l’un de nous (P. Pétrequin). Il s’agit d’un vaste ensemble d’enton-noirs et de fronts de taille couvrant tout un flanc de vallée entre 660 et 800 m d’altitude. De 5000 à 2200 av. J.-C. environ, on y a exploité une roche sédimen-taire formée de cendres volcaniques et très chargée en quartz, autrefois nommée aphanite, terme incorrect et aujourd’hui abandonné au profit de pélite-quartz (Pé-trequin et Jeunesse 1996). La production a porté essentiellement sur des lames
fig. 2Mobilier funéraire de la grotte
de Cravanche (Territoire de Belfort).Gobelet de style Rössen II,
vers 4600 av. J.-C.(Collection Musées de Belfort ;
Cliché P. Pétrequin)
fig. 3Mobilier funéraire de la grotte de Cravanche.
Deux anneaux disques de typeirrégulier en serpentinite.
(Collection Musées de Belfort ;cliché P. Pétrequin)
0 1 5 cm
0 1 5 cm
Musée(s) de BELFORT
page 31trafics et transits
entre Vosges et Jura
(5500-2100 av.J-C) :une Europe des inégalités socialesNéolithique
0 1 5 cm
fig. 4 Hache en jadéitite, trouvée dans la grotte de Cravanche(Collection Musées de Belfort (T325) ;Dessin A.-M. Pétrequin)
fig. 5Photographie de la hache et d’un échantillon de jadéitite d’Oncino/Rasciassa, Mont Viso (Piémont, Italie).(Clichés P. Pétrequin)
fig. 6Spectres radiospectrométriques de la hache de Cravanche comparés à trois spectres d’échantillons alpins naturels :Alps_847 = Oncino, Porco 1, dans le ruisseau (jade mixte) ; Onci_007 = Oncino, Rasciassa (jadéitite) ; Alps_834 = Oncino, Porco.(Dessins M. Errera)
fig. 7Un bloc brut de jadéitite à albite au Mont Viso (Piémont), vers 2400 m d’altitude, à Oncino/Rasciassa (échantillon Pétrequin LM 212, voir fig. 5).(Cliché P. Pétrequin)
Musée(s) de BELFORT
page 32trafics et transits
entre Vosges et Jura
(5500 - 2100 av.J-C) :une Europe des inégalités socialesNéolithique
1
5
10
Nombre de haches
Fond : Esri WBM, SRTMDonnées : ANR JADE, P. PétrequinCAO : E. GauthierCNRS et Université de Franche-ComtéJanvier 2007
0 100 500 km
Cravanche
Viso
NORD
fig. 8À l’échelle de l’Europe occidentale, répartition des haches polies en roches alpines de plus de 14 cm de longueur. Le diamètre des cercles est proportionnel au nombre de haches par commune.(Dessin E. Gauthier et P. Pétrequin, à partir de la base documentaire JADE au 01/01/2007)
Musée(s) de BELFORT
page 33trafics et transits
entre Vosges et Jura
(5500-2100 av.J-C) :une Europe des inégalités socialesNéolithique
Fond : Esri WBM, SRTM,Données: ANR JADE, P. Pétrequin dir.,
CAO : E. GauthierUMR CNRS 6565
Université de Franche-Comtémai 2007
0 100 300 km
LYON
BÂLE
METZ
TROYES
PLM
STRASBOURG
DIJON
NORD
fig. 10Carte de répartition des communes qui ont livré au moins une hache en pélite-quartz des carrières de Plancher-les-Mines(Haute-Saône) (étoile blanche). (CAO E. Gauthier, d’après fichier Programme JADE, état mai 2007)
Haches polies découvertes à Héricourt / Le Mont Vaudois (Haute-Saône). L’exemplaire de gauche, en schiste noduleux, provient de la carrière de Saint-Amarin (Haut-Rhin) ; les deux autres, en pélite-quartz, ont été fabriqués à Plancher-les-Mines. Début du IVe millénaire av. J.-C.(Collection Musées de Belfort ; cliché P. Pétrequin)
Musée(s) de BELFORT
page 34trafics et transits
entre Vosges et Jura
(5500 - 2100 av.J-C) :une Europe des inégalités socialesNéolithique
de haches et d’herminettes (fig. 9), selon une technique de taille qui mettait à profit la structure de la roche et son aptitude à être débitée en lames épaisses à section quadrangulaire. C’est par dizaines de milliers qu’à Plancher-les-Mines - et à un moindre degré dans la carrière de Saint-Amarin (Haut-Rhin), où des schistes noduleux ont été exploités, selon la même technique - on a produit des haches de pierre, abandonnant sur place un ou deux milliers de mètres cube de blocs à peine testés, d’éclats de taille et d’ébauches brisées ou non conformes aux standards du moment.
Le réseau de distribution des haches de Plancher-les-Mines (fig. 10, p. 33) était orienté est-ouest au travers de la Trouée de Belfort. Vers l’ouest, il était encore très actif jusqu’en Haute-Marne, mais des pièces isolées ont circulé jusque dans l’Yonne et l’Aube, voire les Ardennes vers le nord-ouest. En direction de l’est, les villages néolithiques des lacs de Zurich et de Constance ont été très largement touchés par le phénomène, tandis que des haches sont signalées jusqu’en Haute-Souabe et en Valais. Nous atteignons là des transferts qui atteignent la distance de 200 km des carrières, mais la dépassent rarement, car ils portent essentiellement sur des outils à vocation pratique.
La phase majeure de production des carrières vosgiennes se situe entre 4200 et 3600 av. J.-C., au moment où s’effondre la circulation des haches alpines. La production porte sur de grandes ébauches taillées, comme celles de Alle-Frégié-court/Gros Breuils (Jura, Suisse), respectivement longues de 21,2 cm et 24 cm (fig. 11) (Schifferdecker 1995). Ces pièces remarquables montrent que les ébau-ches, taillées par des spécialistes sur les fronts de carrière, partaient ensuite dans les réseaux de distribution où elles étaient progressivement bouchardées et po-lies. Le polissage était réalisé en particulier dans la région de Bâle, à 60 km des carrières à vol d’oiseau, où l’on trouve les derniers affleurements de grès, d’une remarquable résistance. La plupart des polissoirs ont aujourd’hui disparu, souvent réutilisés dans les constructions modernes. Hormis l’exemplaire d’Héricourt/Le Mont-Vaudois (Haute-Saône), conservé au musée de Belfort, nous avons pu re-connaître récemment un très bel exemple de réutilisation d’un polissoir néolithique à Hagenthal (Haut-Rhin), que nous avons identifié en 2006 : le socle d’un crucifix a été taillé sur un polissoir à plusieurs cannelures qui apparaissent encore sur un côté du monument (fig. 12).
L’exploitation des carrières de Plancher-les-Mines au début du IVe millénaire était à ce point valorisante que des groupes d’hommes, appartenant à des villages éloignés parfois de deux journées de marche, venaient en expédition à Plancher-les-Mines pour en repartir avec des ébauches prêtes à entrer dans la ronde des dons et des échanges. Cet intérêt pour l’exploitation des carrières était d’ordre social, car les Néolithiques de la région de la Trouée de Belfort ne recevaient guère de biens parti-culièrement précieux en retour. Un petit gobelet en bois de cerf (fig. 13), découvert dans une tombe d’Héricourt/Le Mont-Vaudois (Haute-Saône) est une des excep-tions d’un objet exotique, ici une production suisse de la culture de Cortaillod, qui a gagné la Trouée de Belfort à contre-courant de la circulation des haches et des ébauches en pélite-quartz ; ces gobelets sont datés du 38e siècle (Hafner et Suter 2000) ; l’exemplaire le plus occidental a été trouvé à Lusigny-sur-Ouche/Grotte du Peuh Trou (Côte-d’Or) (Gallay 1977). Au Mont-Vaudois encore, on a retrouvé une grande hache-ciseau en néphrite, une autre roche précieuse de la famille des jades qui provient, comme le montrent les comparaisons par spectroradiométrie (analyses HERI_000 à _004), d’affleurements en Valais suisse à 170 km vers le sud-est ; cette hache est aujourd’hui conservée au musée Minal à Héricourt.
fig. 9Deux grandes lames d’herminette en pélite-quartz
des carrières de Plancher-les-Mines (Haute-Saône).Au premier plan : Bart/Sous Chatillon (Doubs),
dragage de l’Allan ; en deuxième plan,Lougres (Doubs), découverte isolée.(Collection Musée de Montbéliard ;
cliché P. Pétrequin)
0 1 5 cm
0 1 5 cm
fig. 11Deux ébauches de hache en pélite-quartz découvertes
dans un lit de ruisseau à Alle (Jura, Suisse).Au premier plan : une ébauche taillée en cours de
bouchardage ; au deuxième plan : une ébauche en cours de polissage. (Cliché B. Migy, Office de la Culture, Section d’archéologie et paléontologie, Porrentruy)
Musée(s) de BELFORT
page 35trafics et transits
entre Vosges et Jura
(5500-2100 av.J-C) :une Europe des inégalités socialesNéolithique
fig. 13Gobelet en bois de cerf, trouvé dans une sépulture à Héricourt/Le Mont-Vaudois (Haute-Saône).Longueur 10,2 cm. (Collection Musée Georges-Garret de Vesoul)
Ce type de gobelet de fabrication très soignée, avec une perforation latérale, est probablement une importation de Suisse, où cet objet est caractéristique de la culture de Cortaillod pendant le 38e siècle.(Cliché P. Pétrequin)
Malgré les faibles retours en direction des producteurs de hache - sauf peut-être sous la forme de viande et de céréales qui échappent aux investigations des pré-historiens -, la région de Belfort, Montbéliard et Bâle montre - et de loin - la plus forte concentration de villages néolithiques fortifiés dans l’Est de la France : au total vingt et un sites d’habitat ont déjà été identifiés dans cette zone et la relation avec les carrières de Plancher-les-Mines n’est pas douteuse pendant la première moitié du IVe millénaire av. J.-C. (fig. 14) (Pétrequin et Jeunesse 1997). Parmi les autres matières premières qui pourraient avoir porté ombrage aux carrières de ha-ches : l’eau salée des sources du Jura, déjà exploitées dès le Ve millénaire ; mais la valeur du sel et de la saumure devait, à cette époque, y être moindre que celle d’une belle ébauche de hache (Pétrequin, Magny et al. 2005).
De ces villages d’où étaient originaires les spécialistes de la taille et de la mise en forme des haches sur les grands fronts de carrière à Plancher-les-Mines, que sait-on ? Ce sont des villages fortifiés, installés sur des hauteurs, le plus souvent en bord de plateau incliné, ou sur un éperon ; un rempart de pierres sèches venait compléter la défense naturelle que constituaient une falaise, un escarpement ou une pente vive. Un seul de ces habitats fortifiés a été fouillé récemment, celui de Bourguignon-lès-Morey (Haute-Saône) (Piningre 1999), où la majeure partie de la construction du rempart appartient à la transition du Ve au VIe millénaire. Autour de Plancher-les-Mines, c’est également à cette phase chronologique que se rat-tachent les deux grandes enceintes fortifiées à Héricourt/Le Mont-Vaudois (Hau-te-Saône) et à Désandans/Le Mont (Doubs) : pour la première, un rempart coudé de 390 m de longueur délimitait une surface de trois hectares ; pour le second, le rempart mesure 330 m de longueur et enclôt une surface d’environ quatre hecta-res. Ces deux villages, juste au débouché de la route la plus courte en direction des carrières, la vallée du Rahin, sont certainement en rapport direct avec les plus grandes exploitations, où les volumes d’éboulis excavés sont sensiblement les mêmes que ceux mis en œuvre pour l’érection des remparts et nécessitaient une main d’œuvre nombreuse (Pétrequin et Jeunesse 1997). D’autres villages fortifiés sont de moindre importance, mais on en compte à peu près sur tous les sommets et les buttes témoin : Bavans/Le Mont Bart, Bart/Chataillon, Montbéliard/Le Châ-teau (Doubs), Beaucourt/Le Grammont, Belfort/Le Mont (Territoire de Belfort) sont d’importance très diverse, mais tous montrent une première occupation néolithi-que contemporaine de la plus grande production des haches en pélite-quartz.
Pendant le ralentissement de l’activité des carrières, à partir du 36e siècle, les villages fortifiés seront désertés les uns après les autres. Seul le Mont-Vaudois connaîtra encore une occupation néolithique aux environs du 27e siècle, avec un seul tesson de la culture à Céramique Cordée, qui annonce de nouvelles popula-tions venant du nord-est et d’autres formes de fonctionnements sociaux.Vers la fin du Ve millénaire, l’impact de la première métallurgie, celle du cuivre et de l’or, commence à se faire sentir au nord des Alpes : 41e siècle en Allemagne du sud-ouest avec des imitations de disques en cuivre, 40e siècle sur la rive nord du lac de Constance avec les premières spirales en cuivre, 37e siècle dans les bassins des lacs de Constance et de Zurich, où le cuivre dit du Mondsee (Autriche) est fondu sur place dans des creusets de terre cuite pour la production des haches plates.
fig. 12 Le crucifix de Hagenthal (Haut-Rhin) montre la réutilisation d’un ancien polissoir néolithique pour les haches. Deux larges cannelures sont encore bien marquées sur le côté du monument.(Cliché P. Pétrequin)
Musée(s) de BELFORT
page 36trafics et transits
entre Vosges et Jura
(5500 - 2100 av.J-C) :une Europe des inégalités socialesNéolithique
Une de ces haches plates a été découverte à Pont-de-Roide (Doubs) au pied mé-ridional du Mont Julien (fig. 15). Longue de 9,1 cm à peine, elle appartient au type de Bottighofen, dont les exemplaires sont répartis entre le lac de Constance et la Trouée de Belfort (fig. 16) (Klassen, Pétrequin et al. 2007). La hache de Pont-de-Roide, datée des 37e-35e siècles av. J.-C., est donc le représentant le plus occi-dental de la plus ancienne métallurgie centre européenne. Le synchronisme entre l’arrivée des premières haches en cuivre et l’affaiblissement de la production des carrières de Plancher-les-Mines n’est pas un hasard. Mais plutôt que d’interpréter le phénomène en termes de progrès - très relatifs d’ailleurs, car le tranchant des ha-ches en cuivre n’était pas très résistant -, il faut plutôt considérer que ces premiers outils en métal jaune et brillant constituaient des marqueurs sociaux prestigieux et attrayants. Dans ces conditions, l’arrivée des premiers objets en cuivre vers 3700 : perle en cuivre de Besançon/La Roche d’Or (Doubs) et hache de Pont-de-Roide, puis à partir de 2600, haches plates de type atlantique probablement en cuivre de Bretagne avec les exemplaires de Myon et de Chassagne-Saint-Denis (Doubs) (fig. 15), doit être interprétée comme l’effet de la volonté d’exprimer d’abord des différenciations sociales.
La preuve en est qu’à cette époque ont circulé des objets signe sans aucune fonction technique. Le cas de la belle hache marteau d’Héricourt/Saint-Valbert (Haute-Saône) est tout à fait symptomatique (fig. 17). Cet objet de pierre (une ser-pentinite déterminée par spectroradiométrie, référence d’analyse FC_122), destiné à être emmanché, est l’imitation des haches marteau en cuivre qui circulent alors en Europe centrale ; même les arêtes de martelage du cuivre ont été représentées, comme on le voit sur la photo (fig. 17). On se rend vite compte que le tranchant d’un tel instrument a été laissé volontairement arrondi et n’offre aucune efficacité pratique. Ce qui comptait alors, c’est de pouvoir s’afficher en public avec un objet signe d’un beau poli, venu d’un contexte culturel inconnu. En effet, les haches de ce type ont été fabriquées, comme la hache en cuivre trouvée à Pont-de-Roide, dans la région du lac de Constance où l’on connaît des ébauches brisées, en parti-culier lors de l’épisode de perforation avec un segment de sureau évidé et du sable mouillé. Dès 3700-3600 av. J.-C., de telles haches marteau ont été retrouvées vers l’ouest (fig. 18), parfois très loin du lac de Constance avec l’exemplaire trouvé dans la Saône à Mâcon/Ile Saint-Jean (Saône-et-Loire), qui représente le point ultime de diffusion à 360 km à vol d’oiseau (Grisse 2006).
fig. 15 Trois grandes haches plates en cuivre du Néolithique. À gauche : Chassagne-Saint-Denis (Doubs) (longueur 14,4 cm) ; en haut : Myon (Doubs) (longueur 12,3 cm) ont été probablement fabriquées en Bretagne et sont des exemplaires tardifs, datés des environs de 2400-2100 av. J.-C.Au contraire, la hache de droite est en cuivre autrichien ; elle a été découverte à Pont-de-Roide (Doubs) ; elle remonte certainement aux 37e-35e siècles av. J.-C.(Collections particulières ; cliché P. Pétrequin)
0 1 5 cm
0 10 50 km
ALTITUDES
300-700 m
700-900 m
plus de 900 m
S U I S S E
grande enceinte
petite enceinte
BESANÇON
DOLE
VESOUL
JUSSEY
GRAY
BELFORTMONTBELIARD
sourcessalées
sourcessalées
LONS-LE-SAUNIER
SALINS
Plancher-les-Minespélites-quartz
Saint-Amarinschistes noduleux
1588 m
1723 m
NORD
fig. 14Carte de répartition des villages fortifiés
en Franche-Comté à la transition Ve et IVe millénaires. À cette époque, les carrières
néolithiques de Plancher-les-Mines représentaient un extraordinaire pôle
d’attraction, bien supérieur à celui des sources salées, qui rend compte du regroupement de
vingt et un sites d’habitat dans la seule région de Montbéliard et de Belfort.
(D’après Pétrequin, Magny et al. 2005)
Musée(s) de BELFORT
page 37trafics et transits
entre Vosges et Jura
(5500-2100 av.J-C) :une Europe des inégalités socialesNéolithique
Avec ce rapide tour d’horizon des transferts, des échanges et de la circulation des matières premières et des objets, l’idée de sociétés néolithiques à faible ni-veau de différenciation sociale doit être complètement abandonnée. Au contraire, la démonstration est maintenant faite que les matières premières techniquement indispensables, comme le silex pour les outillages du quotidien, circulaient sur des distances faibles, en général inférieures à 100 km. De même, les haches polies pour l’abattage en forêt n’ont guère été entraînées au-delà de 200 km de leurs sources. Au contraire, les réseaux complexes, qui ont drainé des objets signes for-tement valorisés dans des réseaux à l’échelle de l’Europe, concernent le marquage des hiérarchies et des inégalités sociales voulues, dans le cadre de la compétition entre les hommes et de l’affichage du principe mâle chez les leaders et les puis-sances divines.
0 50 150 km
Pont-de-RoideBottighofen
Bodman
HornstaadHaltingen
Bad Säckingen
Unteruhldingen
Trouée de Belfort
fig. 16Carte de répartition des haches en cuivre de type Bottighofen. Ces haches ont été fondues dans la région du lac de Constance à partir de cuivre exploité en Autriche. L’exemplaire de Pont-de-Roide, le plus occidental du groupe, est également la hache en cuivre la plus ancienne de France, entre 3700 et 3500 av. J.-C. (Dessin P. Pétrequin)
fig. 18Carte de répartition des haches marteau identiques à celle d’Héricourt. Vers le sud-ouest, l’exemplaire le plus éloigné est celui de Mâcon/ Ile Saint-Jean (Saône-et-Loire),non figuré sur la carte. (Dessin P. Pétrequin)
0 50 150 km
Bodman
Reute
Dingelsdorf
Besançon
ThayngenHéricourt
Broye
Muntelier
Mandeure
NORD
0 1 5 cm
fig. 17La hache marteau d’Héricourt/Saint-Valbert(Haute-Saône) est en serpentinite. Elle a été probablement fabriquée dans la partie aval du lac de Constance.(Collection musée de Montbéliard ;clichés P. Pétrequin)
Musée(s) de BELFORT
page 38trafics et transits
entre Vosges et Jura
(5500 - 2100 av.J-C) :une Europe des inégalités socialesNéolithique
Errera, Pétrequin et al. 2007 : ERRERA (M.), PÉTREQUIN (P.), PÉTREQUIN (A.-M.), CASSEN (S.) et CROUTSCH (C.). Contribution de la spec-troradiométrie à la compréhension des transferts longue distance des lames de hache au Néoli-thique. Bulletin de la Société Tournaisienne de Géologie, Préhistoire et Archéologie, 2007, X (4), p. 101-142.
Gallay 1977 : GALLAY (A.). Le Néolithique moyen du Jura et des Plaines de la Saône. Contribution à l’étude des relations Chasséen-Cortaillod-Michelsberg. Publications de la Société Suisse de Préhistoire, Frauenfeld, Verlag Huber, 1977 (Antiqua 6).
Grisse 2006 : GRISSE (A.). Früh- und mittelkup-ferzeitliche Streitäxe in westlichen Mitteleuropa. Bonn, Dr Rudolf Habelt Verlag, 2006.
Hafner et Suter 2000 : HAFNER (A.) et SUTER (P.-J.). –3000. Die Entwicklung der Bauerngesel-lschaften im 4. Jahrtausend v. Chr. Am Bielersee aufgrund der Rettungsgrabungen von Nidau und Sutz-Lattringen, Bern, Lehrmittel- und Medien-verlag, 2000.
Jeunesse et Pétrequin 1997 : JEUNESSE (C.) et PÉTREQUIN (P.). La région de la Trouée de Belfort au Ve millénaire. Évolution des styles céramiques et transformations techniques. In : C. Constantin, D. Mordant et D. Simonin (éd.), La Culture de Cerny. Nouvelle économie, nouvelle société au Néolithique, Actes du collo-que international de Nemours (1994). Nemours, éditions APRAIF, 1997, p. 593-616.
Klassen, Pétrequin et al. 2007 : KLASSEN (L.), PÉTREQUIN (P.) et GRUT (H.). Haches plates en cuivre dans le Jura français. Transferts à longue distance de biens socialement valorisés pendant les IVe et IIIe millénaires. Bulletin de la Société Préhistorique Française, 2007, 104 (1), p. 101-124.
Pétrequin, Arbogast et al. 2006 : PÉTREQUIN (P.), ARBOGAST (R.-M.), PÉTREQUIN (A.-M.), VAN WILLIGEN (S.) et BAILLY (M.) (éd.). Premiers chariots, Premiers araires. La diffusion de la trac-tion animale en Europe occidentale pendant les IVe et IIIe millénaires avant notre ère. Paris, CNRS éditions, 2006 (Monographies du CRA 29)
Pétrequin, Errera et al. 2006 : PÉTREQUIN (P.), ERRERA (M.), PÉTREQUIN (A.-M.) et ALLARD (P.). The neolithic quarries of Mont Viso (Pied-mont, Italy). Initial radiocarbon dates. European Journal of Archaeology, 2006, 9 (1), p. 7-30.
Pétrequin, Magny et al. 2005 : PÉTREQUIN (P.), MAGNY (M.) et BAILLY (M.), 2005. Habitat lacus-tre, densité de population et climat. L’exemple du Jura français. In : P. Della Casa et M. Trachsel (ed.), Wes’04. Wetland economies and societies, Proceedings of the international conference, Zurich (march 2004). Schweizerisches Landes-museum Zürich, Zürich, Chronos Verlag, 2005, p. 143-168 (Collectio archaeologica 3).
Pétrequin, Pétrequin et al. 2006 : PÉTREQUIN (P.), PÉTREQUIN (A.-M.), ERRERA (M.), CASSEN (S.) et CROUTSCH (C.). Complexité technique et valorisation sociale : haches polies de Nouvel-le-Guinée et du Néolithique alpin. In : L. Astruc, F. Bon, V. Léa, P.Y. Milcent et S. Philibert (éd.), Normes techniques et pratiques sociales : de la simplicité des outillages pré- et protohistoriques, XXVIe Rencontres internationales d’Archéologie et d’Histoire d’Antibes. Antibes, éditions APDCA, 2006, p. 419-433.
Pétrequin et Jeunesse 1995 : PÉTREQUIN (P.) et JEUNESSE (C.). La hache de pierre. Carrières vosgiennes et échanges de lames polies pendant le Néolithique (5400-2100 av. J.-C.), Paris, édi-tions Errance, 1995.
Piningre 1999 : PININGRE (J.-F.). Premiers remparts entre Vosges et Jura : Bourguignon-lès-Morey et les sites fortifiés préhistoriques et celtiques. Vesoul, éd. Société d’agriculture, lettres, sciences et arts de Haute-Saône, 1999, 24 p. (Itinéraires du Patrimoine 194).
Schifferdecker 1995 : SCHIFFERDECKER (F.). Alle JU, Gros Breuils. Annuaire de la Société Suisse de Préhistoire et d’Archéologie, 1995, vol. 79, p. 228-229.
Orientation bibliographique
Musée(s) de BELFORT
page 39trafics et transits
entre Vosges et Jura
(5500-2100 av.J-C) :une Europe des inégalités socialesNéolithique
Musée(s) de BELFORT
page 40trafics et transits
entre Vosges et Jura
(5500 - 2100 av.J-C) :une Europe des inégalités socialesNéolithique
La grottesépulcrale
de Cravanche
Entre archéologie et pratiques patrimoniale et environnementale
Annick RICHARDDRAC de Franche-Comté - service régional de l’Archéologie
Le site archéologique a été découvert fortuitement en 1876, lors de l’extraction, dans une carrière du Haut-du-Mont, de blocs de pierre destinés à la construction du fort du Salbert à proximité. Les tirs de mines ont ouvert une brèche sur une grande salle souterraine ayant servi de nécropole à des populations du Néolithi-que, durant la seconde moitié du Ve millénaire av. J.-C.Malheureusement menées pour la plupart de façon désordonnée et quelque peu incontrôlée, les fouilles, qui se sont succédé entre 1876 et la seconde guerre mon-diale, ont pourtant été l’occasion de découvertes importantes. Ossements humains et mobilier accompagnant les défunts ont été exhumés régulièrement durant une soixantaine d’années. Une partie du matériel est aujourd’hui conservée dans les musées de Belfort et Colmar.S’appuyant essentiellement sur la monographie de F. Voulot (1894), sur l’article de V. Jannesson (1893) et sur ses observations de fouilles menées en 1938, l’abbé Glory propose, dans sa thèse de doctorat sur le Néolithique en Haute-Alsace, une synthèse qui se révèle être la première étude complète et critique du site (Glory 1942). Mais, c’est surtout à partir de 1972 que la grotte suscite l’intérêt des ar-chéologues professionnels qui lui accordent alors une place privilégiée dans les études entreprises sur le Néolithique moyen, replaçant ce site dans son contexte européen (Gallay 1976 ; Jeunesse et Pétrequin 1997). L’étude approfondie du mo-bilier et des données anthropologiques met en évidence une occupation de la grotte en trois phases successives, séparées par des éboulements des parois et du plafond de la cavité :- vers 4600 av. J.-C. pour l’essentiel des vestiges (phase moyenne de la culture de Rössen), - entre 4400 et 4200 av. J.-C. (horizon post-rössen),- et une phase plus tardive rattachée à la fin du Néolithique.La fonction funéraire n’est attribuée qu’aux deux premières phases d’occupation.
Devant l’émerveillement suscité par les concrétions calcaires et l’intérêt des dé-couvertes archéologiques, la grotte est aménagée pour la visite dès 1890 et figure dans les guides touristiques de l’époque. Elle s’inscrit dans l’engouement de la fin du XIXe siècle pour l’exploration souterraine – d’où émergera la spéléologie mo-derne – et pour l’aménagement des cavités facilitant l’accès au public. La grotte est classée « Site monumental naturel de caractère artistique » en 1911 et sera mise en valeur et entretenue (éclairage électrique, mur de soutènement, escalier, passerelles, épandage de mâchefer) par la ville de Belfort, propriétaire, jusqu’en 1933. Vandalisée du fait de fréquentations anarchiques et clandestines, la grotte est peu à peu délaissée. Elle devient après la seconde guerre mondiale un véritable dépotoir.
fig. 1Belfort, grotte de Cravanche dans son état actuel.(Cliché J.-F. Piningre)
Musée(s) de BELFORT
page 41trafics et transits
entre Vosges et Jura
(5500-2100 av.J-C) :une Europe des inégalités socialesNéolithique
Aujourd’hui, eu égard à sa richesse géologique et pour en sauvegarder la mémoire, le service environnement de la Ville
de Belfort a décidé de réhabiliter la grotte de Cravanche, seul espace patrimonial souterrain visitable du Territoire de Belfort. Outil culturel, éducatif et touristique, telle est la vocation de cette « caverne » depuis sa découverte… Il n’est pas aussi interdit de penser que tous les vestiges néolithiques n’ont pas encore été fouillés, en particulier sous l’ancienne entrée naturelle.
Références bibliographiquesGallay 1976 : GALLAY (A.), Signification culturelle et chronologique du Néolithi-que de Cravanche (Territoire de Belfort, France), HOMO, 1976, 72, Heft 1/2, p. 36-49.
Glory 1942 : GLORY (A.), La civilisation du Néolithique en Haute-Alsace. Strasbourg, 1942, 412 p., 10 pl.
Jannesson 1893 : JANNESSON (V.), La grotte de Cravanche, Bulletin de la Société belfortaine d’Émulation, 1893, p. 6-14.
Jeunesse et Pétrequin 1997 : JEUNESSE (C.) PÉTREQUIN (P.), La région de la Trouée de Belfort au Ve millénaire : Évolution des styles céramiques et transformations tech-niques, In : La culture de Cerny : Nouvelle économie, nouvelle société au Néolithi-que, Actes du colloque international de Nemours, 1994, Nemours, éd. APRAIF, 1997, p. 593-616. (Mémoires du musée de Préhistoire d’Ile-de-France, n° 6).
Larger 2007 : LARGER (A.), Les grottes de Cravanche, Belfort, Dossier manuscrit, 2007, 37 p.
Voulot 1894 : VOULOT (F.) 1894, Mono-graphie de la caverne funéraire néolithique de Cravanche, Bulletin de la Société bel-fortaine d’Émulation, 1894, 13, p. 174-188, 8 pl.
fig. 3 Intérieur de la grotte de Cravanche. Gravure de A. Slom d’après une aquarelle de Baumann, fin XIXe siècle. (Collection et cliché Musées de Belfort)
fig. 2 Objets découverts sur les sépultures néolithiques de la grotte de Cravanche. Deuxième moitié du Ve millenaire. (Collection et clichés Musées de Belfort)
5 cm
Musée(s) de BELFORT
page 42trafics et transits
entre Vosges et Jura
dans la Trouéede Belfort
Les âges du Bronzeet le 1er âge du Fer
fig. 1Plan du « Camp du Grammont » de
Beaucourt. Des nécropoles sous tumulus ont été installées à proximité de l’habitat fortifié, comme
le montre entre autres le tumulus néolithiqueà coffre de dalles implanté à quelques centaines
de mètres au nord. (Relevé J.-F. Piningre)
Les habitatsde hauteur
fortifiés fig. 2Site fortifié de bord de plateau. (D’après Y. Baudouin, service régional de l’Archéologie de Franche-Comté)
La hiérarchisation de l’habitat sédentaire entre la fin du Ve millénaire av. J.-C. et le début de l’époque gauloise
On s’accorde à considérer les habitats de hauteurs fortifiés qui se développent au Néolithique, à partir du Ve millénaire av. J.-C., comme des centres de contrôle d’un territoire environnant, jouant à la fois un rôle défensif et de prestige. Une soixantai-ne d’entre eux recensés en Franche-Comté se distinguent par des superficies va-riées, comprises entre 1 ha et plus de 30 ha pour les plus étendus. L’implantation du rempart de pierres sèches destiné à protéger la partie la plus accessible du site a été adaptée à la topographie. Elle a été choisie en sommet de relief ou en bords de plateaux escarpés : éperon barré par un rempart, portion de crête isolée par deux remparts (Beaucourt « le Grammont » - fig. 1), rempart en U adossé à un bord de plateau (Belfort « le Haut du Mont » - fig. 2). Le rempart, qui se présente actuel-lement sous la forme d’un bourrelet de pierres et de terre inorganisé, correspondait initialement à un mur appareillé en pierres sèches comme l’ont montré quelques fouilles réalisées sur des sites contemporains à Bourguignon-lès-Morey (Haute-Saône) ou à Étaule (Côte-d’Or). Ces architectures de pierre représentent ainsi les premières manifestations d’un dispositif défensif organisé. Les moyens mobilisés pour ces réalisations et le transport de plusieurs milliers de m3 de matériaux re-flètent le travail d’un groupe socialement structuré. L’espace ainsi délimité était partiellement occupé par des maisons de bois et de torchis adossées au rempart.
Jean-François PININGREConservateur du PatrimoineService régional de l’Archéologie de Franche-Comté
Musée(s) de BELFORT
page 43trafics et transits
entre Vosges et Jura
dans la Trouéede Belfort
Les âges du Bronzeet le 1er âge du Fer
fig. 3Le Camp du « Bramont » contrôle l’extrêmité orientalede l’éperon du « Bois de la Miotte » et la voie de passage empruntée par l’actuelle nationale 83. (Cliche P. Augé)
fig. 4Etat actuel du rempart du « Bramont ». (Cliché J.-F. Piningre)
fig. 5Localisation et plan du camp du « Bramont » à Belfort.(DAO B. Turina)
Un espace libre pouvait être utilisé pour le stockage, le parcage du bétail ou, le cas échéant, pour le refuge des populations des villages alentour. Ces habitats fortifiés n’ont pas été occupés continuellement. Les principales phases de fréquentation correspondent au Néolithique moyen (fin du Ve, première moitié du IVe millénaire av. J.-C.), à la fin de l’âge du Bronze ancien et au Bronze moyen (milieu du IIe mil-lénaire), puis au Premier âge du Fer (VIIIe-VIe siècle av. J.-C.). Elles reflètent sans doute des périodes d’instabilité et de compétition entre les groupes de population. Plusieurs sites fortifiés sont connus dans la Trouée de Belfort : le « Haut-du-Mont » et le « Bramont » à Belfort, le « Grammont » de Beaucourt ; d’autres ont été par-tiellement fouillés et détruits à l’occasion de constructions militaires plus récentes comme le Fort de Roppe (Territoire de Belfort) ou le « Mont-Vaudois » à Héricourt (Haute-Saône) et vraisemblablement l’actuel château de Belfort.
Le Camp du Bramont (Belfort)
L’habitat fortifié du Bramont se situe à l’entrée orientale de Belfort, à l’extrémité du bois de la Miotte d’où il domine la RN 83 (fig. 3). Cette arête calcaire étroite et allongée, aux versants nord et sud escarpés, est barrée par deux bourrelets de pierres longs d’une dizaine de mètres, hauts de 1 m à 1,80 m, vestiges d’un rempart ruiné défendant les côtés les plus accessibles du plateau (fig. 4). L’espace intérieur était réservé à l’implantation de maisons de bois et de torchis maintenant disparues (fig. 5). L’édification de cet habitat remonte à la fin du Ve millénaire av. J.-C., comme le montrent les fragments de céramique néolithique, quelques outils en silex et les déchets de taille de pélites sous-vosgiennes destinées à la fabrication de lames de haches polies. Une nouvelle occupation récemment identifiée est datée de l’âge du Bronze moyen à partir de parures de bronze (pendeloques discoïde et tréflée, bagues à spirales) et de la céramique décorée de motifs incisés ou excisés caractéristiques de cette période. Cette phase d’occupation reflète la permanence de ce lieu de contrôle d’un axe de passage est-ouest dans la seconde moitié du XVe siècle av. J.-C. qui constitue à l’heure actuelle le seul site d’habitat de cette époque reconnu dans le Territoire de Belfort.