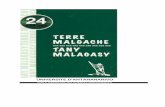“Les origines du nom de RIM (Réalisateur en informatique musicale)”
Mirecourt au Moyen Âge. Les origines d’une ville, in Rothiot (J-P.) dir., Mirecourt, tome 1....
-
Upload
univ-lorraine -
Category
Documents
-
view
9 -
download
0
Transcript of Mirecourt au Moyen Âge. Les origines d’une ville, in Rothiot (J-P.) dir., Mirecourt, tome 1....
MIRECOURT, LA VILLE, SON ARCHITECTURE ET SON HISTOIRE
1 Charles LAPRÉVOTE, Notice historique et biographique sur la ville de Mirecourt depuis son originejusqu’à 1766, Nancy, 1877, p.8.2 Pierre MARICHAL, Dictionnaire topographique du département des Vosges, Paris, 1946.
31
Cédric MOULISUniversité de LorraineEA 1132 Hiscant-MAPôle archéologique
MIRECOURT AU MOYEN ÂGELA NAISSANCE D’UNE VILLE
Pendant longtemps, seul l’emploi des sources archivistiques permettait d’é-clairer le passé de Mirecourt au Moyen Âge. En effet, les profondes mutationsurbaines que la ville a connues au XVIIIe siècle, puis du lendemain de laSeconde Guerre mondiale aux années 1980, ont effacé la quasi-totalité desvestiges du passé médiéval de Mirecourt. Pourtant, celui-ci n’a rien de négli-geable et l’on comprend même, à travers son étude, que ce petit site, devenubourg et ville, possédait toutes les infrastructures embryonnaires d’une futurepréfecture. Des observations archéologiques récentes ont par ailleurs permisde mieux cerner l’apparition de certains édifices mirecurtiens, en particulierl’église paroissiale.
La genèse d’un habitat fixeLes origines de MirecourtL’origine du nom de Mirecourt suscite de nombreuses questions qui se ratta-chent à la naissance même de la ville, ou du moins aux premières structuresétablies sur son site. Selon les érudits du XIXe siècle, Laprévote et Cornebois,qui se rallient à Dom Calmet, le nom Mirecourt vient de Mercure1, car le siteaurait été occupé par un temple dédié à ce dieu romain. Mais cette hypothèsemanque sérieusement d’accréditation, l’existence de ce supposé temple nepouvant être vérifiée.En réalité, le nom provient de la juxtaposition d’un suffixe et d’un préfixe.Dans la table des formes anciennes de l’orthographe de Mirecourt2, on s’aper-çoit que le suffixe varie très peu : Mircourt, Mirecort, Mirecour, Mirecuria,Miricour, Miricourt, Miricuria, Modoricicurte. On retrouve toujours les suf-fixes « court », « curia » qui découlent du latin « curtis » qui signifie « cour ».Ce mot désigne, sous le bas empire romain (III-Ve siècles), un centre agrico-le et ses dépendances. Cette définition perdure parfois à l’époque mérovin-gienne. Mais l’origine de Mirecourt n’est peut-être pas aussi ancienne, car leterme est en outre utilisé pour les agglomérations rurales créées au cours duHaut Moyen Âge.
JEV Mirecourt VOL 1.qxd 19/05/13 10:03 Page 31
CÉDRIC MOULIS
3 Ernest NEGRE, Toponymie générale de la France II, Genève, 1991.4 Mathieu MICHLER (dir.), Carte Archéologique de la Gaule. Les Vosges, Paris, 2004, p. 226-227.5 Philippe KUCHLER, Mirecourt, Rue du Docteur Joyeux (Vosges), 2/05/2002 – 21/06/2002, DFS de fouillepréventive, Metz, Inrap Grand-Est Nord, 2004, 131 p.6 Robert-Henri BAUTIER, Les origines de l’abbaye de Bouxières-aux-Dames au diocèse de Toul, SAL,Nancy, 1987, p.32.7 Vers 930, l’abbaye féminine de Bouxières-aux-Dames est fondée par l’évêque de Toul Gauzelin qui engarde la direction temporelle, et donc les biens donnés à l’abbaye par différents donateurs entre 941 et 965(dont ceux d’Urso), tandis que l’abbesse conserve le spirituel. Voir Robert-Henri BAUTIER, p. 11, 12, 30,33, 91, 97.8 Robert-Henri BAUTIER, p. 107.9 Robert-Henri BAUTIER, p. 111-113.
32
Quant au préfixe, il correspond la plupart du temps au nom du propriétaire dela curtis. Les formes les plus anciennes, Moricurtis, Morucocurte etModoricicurte se rapportent probablement au nom germanique Moricho3.L’agglomération mirecurtienne semble résulter du regroupement d’un habitatdisparate sur son territoire. Dès la période gallo-romaine, on atteste d’uneimplantation en plusieurs endroits4. Au nord de la ville actuelle, à la confluen-ce du Val d’Arol et du Madon, un diagnostic a révélé des remblais constituésde tegulae, d’imbrices et de tessons. Plus au sud, au niveau du toponyme « lafin du murget », les vestiges d’une villa ont été exhumés en 1957 à l’occasionde la construction d’une zone résidentielle. De l’autre côté du Madon, au Hautde Chaumont, point culminant autour de Mirecourt, deux fragments d’unestèle du IIe siècle ont été récupérés. Enfin, un diverticule de voie romaine fran-chissait le territoire communal au sud et à l’est de la ville actuelle.Pour le Haut-Moyen Âge, l’habitat reste très certainement disparate, maissemble en partie se fixer à l’emplacement même de la ville actuelle. Une sériede sondages effectués aux abords sud de l’ancien canal, aujourd’hui rebou-ché, montre l’existence de paléochenaux et d’une anthropisation au cours desXe-XIIe siècles. La nature de cette occupation reste mal définie5.Il est également possible qu’un habitat se soit installé sur la rive droite duMadon, autour de l’emplacement de la chapelle Saint-Didier, dite « de laOultre », construite au XIe siècle. Cette hypothèse peut se justifier à la lectu-re d’anciens actes de donations.Ainsi, on sait qu’un certain Urso, petit-neveu de Richilde, épouse de Charlesle Chauve6, donne à Notre-Dame de Bouxières deux manses un quart àMirecourt avec leurs dépendances et 13 familles de serfs. Cette donation estévoquée dans un acte d’Otton 1er entre décembre 941 (promulgation d’unebulle d’Etienne VII) et le 4 juin 960 (confirmation des biens de Bouxières àMirecourt par Otton Ier)7 et elle est confirmée dans les mêmes termes (« Ursodedit praedium in Murici Curte ») dès le 2 juin 9658, peut-être parce qu’uncertain Ledricus tente d’usurper les possessions de l’abbaye à Mirecourt.Finalement, le 26 octobre 966, Frédéric 1er, duc de Lorraine, tranche en faveurde Bouxières. En compensation, Ledricus reçoit de l’abbaye un manse àAbbéville et 100 sous9.
JEV Mirecourt VOL 1.qxd 19/05/13 10:03 Page 32
MIRECOURT AU MOYEN-ÂGE
10 Robert-Henri BAUTIER, p. 134-135.11 Robert-Henri BAUTIER, doc. n° 52.
33
La sentence de 966 est également intéressante car elle nous renseigne sur lesactivités de cette exploitation :
« Quocirca noverit omnium fidelium, tam praesentium quamque futurorum,sagacitas quod quidam nobilis vir, Urso vocabulo, pro salute animae suaedederit ac tradiderit mansos duos et quartam partem unius mansi in villaMurici curtis, sicut in imperatorio praecepto continetur, loco Sanctae Mariaequi Buxerias nuncupatur, in quo utique loco sacrarum virginum erga divinumcultum infatigabilis desuat sollicitudo, et quicquid ad ipsos mansos pertinerevidebatur, tam in vineis, pratis, sylvis, pascuis, terris cultis et incultis, aquisaquarumque decursibus, mancipiis utriusque sexus, quorum nomina haec sunt: Magnerus, Remboldus cum uxore et infantibus, Lietbaldus cum uxore etinfantibus, Ledema cum infantibus suis, Harduinus, Theutbaldus, Aihildis,Heldierus cum uxore et infantibus suis, Ailiulfus cum uxore et infantibus suis,Ragenerus cum uxore et infantibus, Wihardus, Valdrada cum infantibus suis,Archenradus cum uxore et infantibus. »
Ce document apprend que treize familles vivaient sur seulement deux mansesun quart. Treize chefs de familles, cinq conjoints et une quinzaine d’enfantspratiquaient l’élevage d’animaux dans les pâtures. Ils utilisaient le sol et l’eaudu Madon, des ruisseaux. Ils cultivaient la vigne, investissant pour cela lecoteau ensoleillé de la rive droite du Madon, tourné vers le sud-ouest.Quelques pieds de vignes sont toujours cultivés en ces lieux, et ce quartier dela ville s’appelle le faubourg Saint-Vincent, patron des vignerons. Les biens de l’évêque de Toul, qui a la gestion du temporel de Bouxières, sontdonc situés sur la rive droite du Madon, là où est (ou sera) implantée la cha-pelle Saint-Didier de la Oultre, le comte de Toul étant lui possessionné sur larive gauche.Le temporel de Bouxières ne change plus jusqu’au 11 avril 1137. À cette date,la confirmation des biens du monastère, faite par Innocent II, reprend l’actede 965 : « praedium quod dedit Urso in Murici curte ».10 L’abbaye possèdedonc toujours des terres à Mirecourt, et augmente même ses possessionspuisque le 27 septembre 1163, Henri, évêque de Toul confirme la donation auprofit de Bouxières d’un alleu par la comtesse de Vaudémont Adeline11.Mirecourt bourg castralÀ une époque indéterminée, la construction d’un château sur la rive gaucheengendre un regroupement de la population. Plusieurs lieux d’implantation decette fortification ont été suggérés par différents auteurs, certaines de ceshypothèses offrant même un schéma de développement urbain particulier.À l’heure actuelle, une hypothèse retient toutefois principalement l’attention.L’analyse croisée du cadastre et de la microtopographie révèle une parcellenon bâtie insérée au milieu de l’îlot entouré par les rues Chanzy et des
JEV Mirecourt VOL 1.qxd 19/05/13 10:03 Page 33
12 Charles KRAEMER, Philippe KUCHLER, Cédric MOULIS, « Mirecourt », dans Yves HENIGFELD, AmauryMASQUILIER (dir.), Archéologie des enceintes urbaines et de leurs abords en Lorraine et en Alsace (XIIe-XVe siècles), RAE, 26e supplément, 2008, p. 155-170.13 Arch. dép. Vosges14 Une transcription du latin apparaît dans l’ouvrage de Laprévote, p.165 à 167. L’acte est conservé en latinsous trois cotes : Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 811 n°119 ; B 380 n°2 ; B 419 f°125.15 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B335, f°1v°-2.16 Arch. dép. Vosges, Edpt 309/DD 2 n°2 et 3, CC 25 n°1, f°4 ; Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 7020,B 976, B 6992, B 7001, B 7018.17 Voir l’article de Philippe Kuchler concernant cette fouille dans ce volume.18 Charles KRAEMER, Philippe KUCHLER, Cédric MOULIS, « Mirecourt », op. cit., p. 155-170.
34
Remparts12. Ce terrain de 13 x 17 m de côtés est surélevé de 3 à 4 mètres parrapport au reste de l’îlot au centre duquel il se trouve. Malheureusement, iln’est pour l’heure pas possible de définir s’il s’agit d’un tertre constitué pourune fortification simple, voire en bois, telle que cela se pratique jusqu’au XIIe
siècle, ou s’il s’agit plutôt du vestige d’un élément bastionné édifié à l’époquemoderne. Ce raisonnement repose également sur l’examen d’une gravure àl’eau forte réalisée par Beaulieu en 1668. Elle représente une citadelle (quin’a visiblement jamais vu le jour) au sein de laquelle est dessiné l’emplace-ment du « vieux corps du château »13. Sur ce plan, dont la précision et la per-tinence restent à démontrer, le vieux corps du château est composé d’unegrosse tour rectangulaire, placée dans un angle. Il peut s’agir du donjon quiaurait été placé sur le tertre. Au nord de cette tour, est indiquée l’entrée duchâteau, tournée vers l’est et l’actuelle rue des Remparts. La porte orientéevers le faubourg est flanquée de tours ouvertes à la gorge telles qu’on lesconstruisait au XIIIe siècle. Une troisième tour du même type est visible àl’angle ouest du château. L’enceinte se présente comme un plan irrégulier, lesite primitif étant déjà très certainement transformé. Les sources d’archives apportent quelques renseignements supplémentaires.La plus ancienne mention remonte à la charte de franchise de 123414. On yapprend que les bourgeois ne sont pas tenus d’assurer la garde au château. En1318, une seconde mention montre qu’une tour à vocation résidentielle exis-te bel et bien au château. Le texte indique l’éventualité que la famille ducalepuisse y résider15. On apprend également que le four banal y est installé. Il fautensuite attendre les registres de comptes du XVe siècle pour obtenir de rareset nouvelles informations sur ce bâtiment. Mais il n’est jamais fait mention duchâteau lui-même, il est essentiellement cité pour situer « une place maziè-re », « une grange », « une place joindant ondit chasteau », « un pasquis »,« une maison »16.Les fouilles, menées rue du docteur Joyeux en 200217, ont montré l’existence,pour la seconde moitié du XIIe siècle, d’une enceinte urbaine constituée demoellons calcaires que l’on peut imaginer être reliée au château, légèrementplus haut, et englobant l’espace entre ce dernier et le canal. Cette premièreenceinte aurait ainsi un périmètre de 550 m pour une superficie d’environ2 hectares18. Un grand bâtiment semble accolé à l’intérieur du périmètre de
JEV Mirecourt VOL 1.qxd 19/05/13 10:03 Page 34
MIRECOURT AU MOYEN-ÂGE
19 Arch. dép. Vosges, 8 H3 4.20 Michel PARISSE, Noblesse et chevalerie en Lorraine médiévale, PUN, 1982, généalogie p. 437.
35
l’enceinte côté nord. Il pourrait s’agir d’un édifice à fonction publique, peut-être le siège de la prévôté de Mirecourt, dont le premier prévôt connu estattesté en 116519.Quelles raisons font que l’habitat disparate de ce secteur finisse par se regrou-per dans un bourg castral ? Les premiers possesseurs connus de la ville sontles comtes de Toul. Ceux-ci sont également installés à Charmes, sis sur laMoselle. Nous sommes ici dans des terres assez éloignées du comté, et les sei-gneurs alentours ont également des velléités expansionnistes, qu’il faut conte-nir. En effet, le duc de Lorraine fortifie peu à peu ses bourgs de Châtenois,Neufchâteau, Épinal. Le comte de Vaudémont est implanté à Vaudémont et àChâtel-sur-Moselle. L’évêque de Toul fonde l’abbaye féminine de Poussay àquelques kilomètres au nord de Mirecourt et possède les terrains situés sur larive droite du Madon.
Les comtes de Toul et la mainmise progressive des ducs de LorraineNous ne savons toutefois pas depuis quand les comtes disposent depossessions à Mirecourt. C’est un certain Rambaud, qui, à la fin du Xe siècle,hérite du comté, formant ainsi la famille des Toul-Dampierre20. Son petit-fils,Renard II, décède sans héritier en 1044. Le comté revient alors à son beau-frère, Frédéric Ier, comte d’Astenois (v.1049-1081). Son arrière-petit-fils,Henri Ier (1148-1149) meurt jeune, sans héritier. Le comté revient dans les
Fig. 1 : Gravure de Beaulieu de 1668 comportant les vestiges du château médiéval.Arch. dép. Vosges.
JEV Mirecourt VOL 1.qxd 19/05/13 10:03 Page 35
CÉDRIC MOULIS36
Fig. 2 : Évolution urbaine générale de Mirecourt au Moyen Âge.Croquis et D.A.0. C. Moulis.
JEV Mirecourt VOL 1.qxd 19/05/13 10:03 Page 36
MIRECOURT AU MOYEN-ÂGE
21 Michel PARISSE, Noblesse et chevalerie […] op. cit., généalogie p. 438.22 Georges POULL, Cahier 4, p. 47.23 Georges POULL, Cahier 4, p. 49.24 François CLASQUIN, Histoire de Mirecourt, 1911 rééd. Paris 1990, p. 5.25 Charles LAPRÉVOTE, Notice historique et biographique sur la ville de Mirecourt depuis son originejusqu’à 1766, Nancy, 1877, p. 15.26 François CLASQUIN, p. 5.27 Arch. dép. Meuse, B 256, f°256 v° ; Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 396, f°45r°.28 Charles LAPRÉVOTE, p. 16.29 Arch. dép. Meuse, B 256, f°146 v°.30 Arch. dép. Meuse, B 256, f°256 r° et v°.31 Charles LAPRÉVOTE, p. 16.32 Bibl. nat., Coll. de Lorraine, Vol. 67 f° 18 et vol. 122 f° 109.33 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 335, f°3.
37
mains de son suzerain Mathieu Ier, duc de Lorraine (1139-1176), en 1153. Lecousin d’Henri, Renard, comte de Dampierre, marie sa fille Béatrice àMathieu de Lorraine, fils cadet du duc et héritier du comté de Toul à la mortde son père (v.1176-v.1208). Ainsi est créée la maison des Toul-Charmes21.C’est à partir de son règne que les comtes de Toul s’affaiblissent dangereuse-ment et que le titre passe progressivement entre les mains des ducs deLorraine. En novembre 1202, Mathieu devient homme lige du comte de Bar,en second de l’évêque de Toul, pour quelques possessions22. Peu à peu, en rai-son de diverses difficultés financières, il abandonne ici et là ses biens.Son fils Ferri V (v.1208-1248) hérite ensuite du comté. Il l’engage probable-ment dès 1214, lorsqu’il décide de financer son voyage en Terre Sainte,auprès des chanoines du chapitre cathédral et son frère Renard de Coussey23.Entre 1229 et 1230, pendant la guerre entre Mathieu II de Lorraine et HenriII de Bar, les deux armées s’affrontent devant Mirecourt, sans que la ville ensubisse toutefois un seul préjudice24. Ferri, vassalisé au comte de Bar, doitaussi s’engager. En 1234, après un traité de paix signé avec le duc Mathieu25,Ferri promulgue une charte de franchise au bénéfice des habitants qui, de cefait, deviennent bourgeois. Il est stipulé qu’ils ne doivent pas s’occuper de lagarde du château, ni de l’entretien des clôtures, à l’exception des portes de laville26, et ils doivent payer toutes les redevances annuelles envers le comte.Peu après, il veut se défaire de son comté, puis il recule le 3 octobre 1235.27 Ilpromet de vendre ou d’engager son comté seulement au duc ou à l’évêque deToul Roger d’Ostenge28. Finalement, il l’engage à Mathieu II duc de Lorrainepour 300 livres de provinois forts en juillet 124029. Il récupère toutefois sonbien puisque le 16 mai 1248, il l’engage une seconde fois, pour 500 livres30,remboursées en mars 1249 par l’évêque de Toul31.Le fils de Ferri, Eudes (mort en 1268), aggrave encore la situation. Il hériteentre autres des châteaux et villes de Charmes, Fontenoy et Mirecourt, alorsque son frère, Mathieu, reçoit en héritage les possessions de sa famille sur larivière le 4 juin 125832. En avril 1256, Eudes engage Mirecourt à Richard deValleroy afin d’éponger une dette33 et en mars 1262 il vend son comté de Toul
JEV Mirecourt VOL 1.qxd 19/05/13 10:03 Page 37
CÉDRIC MOULIS
34 Arch. dép. Meuse, B 256, f°222v°.35 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 623 n°3.36 Arch. dép. Vosges, G 870, G 1112, G 1870.37 Arch. dép. Meuse, B 256, f°37v°.38 Arch. dép. Meuse, B 256, f°75 v°.39 Arch. dép. Meuse, B 256, f°60.40 Frédéric GODEFROY, Dictionnaire de l’ancienne langue française, Paris, 1881.41 Arch. dép. Meuse, B 623, f°150v°.
38
à l’évêque Gilles de Sorcy34. Mais Mirecourt ne fait pas partie des terresconcédées à l’évêque, puisqu’en 1264 Eudes remet en gage Mirecourt àRichard de Valleroy pour 370 livres de provinois35. Enfin, il finit de se débar-rasser de son héritage en avril 1268 lorsqu’il vend à Gérard de Fontenoy sespossessions à Oëlleville et à Juvaincourt36. Eudes a épousé en secondes nocesGille, fille de Wichart de Passavant, qui a des possessions depuis 1254 àMirecourt, après l’échange de sa ville de Drincourt avec les possessionsd’Aubers de Geroncourt « à Estrennes et Amesnil delez deneure et à Mandresselont Mirecort et à Mirecourt »37.Eudes décède en 1268, ses biens reviennent ensuite à son épouse Gille, quiavait en plus reçu en douaire une grande partie de Mirecourt ainsi queFontenoy, Fougerolles et Charmes. Elle épouse en secondes noces Jean dit deFontenoy (qui semble être en fait Jean du Chatelet, surnommé « Berruiers »).Ce dernier récupère l’ensemble de l’héritage. Mais, dès avril 1279, il recon-naît avoir vendu au duc de Lorraine Ferri III tout ce qu’il possédait en héri-tage et en gagières à Mirecourt pour 3000 livres tournois38. Le duc récupèreainsi des droits sur les hommes, les prés, l’eau, les bois, les rentes et les reve-nus du péage. Puis, en mai 1285, il complète ces acquis en rachetant pour 7livres et demie de toulois le péage de Mirecourt qui appartenait au couvent età l’abbé de Saint-Evre de Toul39. Isabelle, fille du premier mariage d’Eudes,avait hérité quant à elle d’une autre part de Mirecourt, à savoir : des droits surles hommes, les prés, la terre, l’eau, les bois mais surtout le ban et la justice,différents droits de seigneurie ainsi que « tous les chatelz » (rapport en argentd’un bien mobilier)40. Elle s’en défait pour 50 livres de toulois en septembre1284 au profit, là encore, du duc de Lorraine41. Le frère d’Isabelle, Ferri(1276-1296), ne sera qu’écuyer et renonce au titre de comte de Toul en ven-dant la charge à l’évêque : il reste seulement seigneur de quelques possessionsà Charmes. Ferri III, duc de Lorraine, réussit ainsi une mainmise quasi com-plète sur Mirecourt. Au début du XIVe siècle, il en est le principal possesseur.
Le développement du bourg, XIIIe-XVe sièclesL’œuvre des comtes de Toul ne doit pas être sous-estimée à Mirecourt, car ilssont à l’origine du dynamisme de la ville. Outre le château, ils sont sans douteà l’origine de l’enceinte urbaine et de l’ensemble des premiers critères de cen-tralité (marché, église, halle, atelier monétaire, etc.) qui font de Mirecourt uncentre attractif. Une fois l’ensemble passé aux mains du duc de Lorraine, la
JEV Mirecourt VOL 1.qxd 19/05/13 10:03 Page 38
MIRECOURT AU MOYEN-ÂGE
42 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 976.43 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 6992.
39
ville continue sa croissance. Celle-ci se mesure à l’aune des équipementsurbains qu’elle recèle, ou des institutions qui s’y installent.
L’extension de l’enceinte urbaineL’enceinte urbaine primitive, vraisemblablement créée dans la seconde moi-tié du XIIe siècle, est celle qui est mentionnée dans la charte de franchise de1234. Les bourgeois de la ville sont tenus d’assurer le guet et de procéder auxréparations nécessaires. Elle s’agrandit vraisemblablement au cours du XIVe
vers le nord, sur un périmètre dépassant 1100 m, englobant une superficie deplus de 6 hectares. Dans les registres de comptes, les premières mentions datent de la fin du XVe
siècle : en 1480, on mentionne « la muraille de la ville »42, puis en 1497,l’« allée des murs de la ville vers la porte de Poursas » et « les gros murs dela ville»43. Les fossés qui entourent très certainement les remparts dès l’origi-ne ne sont pas mentionnés avant le XVIe siècle.De même, aucune mention de tour n’apparaît dans les registres de comptesavant le milieu du XVIe siècle. Le dépouillement des archives nous a permisde retrouver 20 dénominations différentes de tours entre 1550 et 1623, sansqu’il soit possible de savoir si certaines d’entre elles correspondent à un seul
et même édifice. Certainespeuvent être plus ou moinsbien localisées, mais, pour laplupart d’entre elles, l’exerci-ce reste très aléatoire.Toutefois, quelques élémentsont pu être repérés, et contri-buent à mieux définir le péri-mètre d’implantation de cettenouvelle enceinte urbaine. Ilreste encore en place une tour,située à l’arrière d’une maisonbordant l’actuelle rue Thiers. Ils’agit d’un quart (tout au plus)d’une tour montée en petitsmoellons, largement recouver-te par endroit d’un enduit.Aucun élément architecturalparticulier ne s’en détache.La lecture du cadastre du XIXe
siècle fait également apparaî-tre le négatif d’une tour au sud
Fig.3 : Vestige de la tour rue Thiers depuis le parkingprivé.
JEV Mirecourt VOL 1.qxd 19/05/13 10:03 Page 39
CÉDRIC MOULIS
44 Arch. dép. Vosges, 2 Fi 2749.
40
de celle-ci. Enfin, les démolitions dans la rue Basse de Mirecourt en 1985 ontpermis d’observer, en coupe, l’élévation de l’enceinte, sans doute dans saconfiguration du XVe siècle, avec un chemin de ronde à son sommet. Commepour la tour, elle est constituée de moellons calcaires posés à plat en parementcomme dans le blocage.
Un autre document nous permet d’avoir une vision assez précise de l’encein-te médiévale. Il s’agit d’un plan du XVIIIe siècle, réalisé à l’occasion d’un dif-férend entre deux partis concernant l’évacuation des eaux usées44. Ce planretrace ainsi l’ensemble du bourg pour sa partie nord-ouest, avec l’enceinte etses abords. Le document est certes schématique et comprend de nombreusestransformations dues à l’époque moderne, mais les tours sont soigneusementreplacées. Elles sont au nombre de six. La plus septentrionale semble être àl’angle de l’enceinte du XIVe siècle, modifiée par la suite. Les cinq suivantesdescendent le long de l’enceinte ouest et semblent disposées à intervallesréguliers. Une autre tour est située derrière la maison de son altesse royale,devenue aujourd’hui l’hôtel de ville. Une autre encore est bâtie dans l’axe dela rue Rollot (actuellement rue Derise). La dernière tour représentée sur leplan se situe juste en face de l’église. On obtient ainsi un intervalle moyenentre les tours bien plus resserré que ce qui était jusqu’à présent envisagé. Surle schéma, une seule tour semble encore complète. La plupart des tours sontreprésentées, pour leur partie tournée vers la ville, en pointillés. Ce figuréindique certainement que ces parties sont manquantes. Bien que schématique,ce document représente une cadastration qui se révèle tout à fait compatibleavec le cadastre du XIXe siècle, si bien que ces tours peuvent être à peu prèsreplacées judicieusement sur un plan. En suivant cet intervalle régulier, lecôté ouest de l’enceinte a pu comporter jusqu’à neuf tours.
Fig.4 : Plan du XVIIIe siècle montrant les vestiges de l’enceinte au nord-ouest.Arch. dép. Vosges, 2 Fi 2749. Cliché J.-P. Rothiot.
JEV Mirecourt VOL 1.qxd 19/05/13 10:03 Page 40
MIRECOURT AU MOYEN-ÂGE
45 Arch. dép. Vosges, XVI H 1.46 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 6992.47 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 810 n°10.48 Histoire de la Lorraine, 1939.49 Histoire de la Lorraine, 1939.50 Histoire de la Lorraine, 1939.
41
Peu d’informations filtrent des archives médiévales à propos des portes. Surl’enceinte primitive, nous supposons l’existence d’une porte ou tour-porteouvrant sur le canal, d’une porte à l’emplacement de la tour de l’Horloge, surla rue Haute, en direction du nord. Sans véritables preuves, nous supposonségalement l’existence d’une troisième porte à l’est du château, dans la rue desRemparts, ouvrant vers le sud.Les premières mentions précises des portes n’interviennent qu’à la toute findu XVe siècle, sur l’enceinte agrandie. Face au canal, il semble y avoir eu unetour-porte primitive dont le plan a été décrit par Alexandre Rellot en 1776.Elle est augmentée d’une porte flanquée de deux tours, la porte du pont, men-tionnée comme telle à partir de 1539.La porte de Mattaincourt figure sur un document de 144045. Enfin, la porte dePoussay, qui remplace vraisemblablement la porte située sous la tour de l’hor-loge, dorénavant intra-muros, est mentionnée pour la première fois en 149746.On ne connaît pas la structure de ces portes avant la seconde moitié du XVIe
siècle, et il est donc hasardeux d’en tenter une reconstitution pour la périodequi nous intéresse. Nous pensons néanmoins qu’il s’agit de portes flanquéesde deux tours.
Les institutions de MirecourtLe bailliageMirecourt est chef-lieu du bailliage de Vosge sans doute depuis la fin du XIIIe
siècle, lorsque le poste est créé par le duc de Lorraine. La première mentiond’un bailli de Vosge date de 1283 : elle concerne Girard de Mirecourt. Le duclui octroie le four qu’il possède à Mirecourt47. Le bailliage est composé de 8prévôtés dont les sièges se trouvent à Mirecourt, Remoncourt, Châtenois,Arches, Dompaire, Valfroicourt, Charmes et Darney. Le bailli administre etexploite le domaine sous sa juridiction, perçoit les impôts, convoque les rotu-riers à l’ost pour le duc, surveille et entretient le château. Il peut de plusconvoquer le ban et l’arrière-ban48. Il est par ailleurs chargé de surveiller leprévôt. La plupart du temps, de grands personnages de la haute chevalerieoccupent cette fonction : on retrouve souvent à Mirecourt des membres de lafamille de Rosières, Haroué ou Lenoncourt49.Les baillis ne résident que très rarement dans leur circonscription et il est cou-rant au XVe siècle de les voir déléguer leur charge à des lieutenants50. Le pre-mier d’entre eux connu est Husson de Valfroicourt, en 1353. Mais c’est auXVe siècle qu’ils prennent de l’importance : ils apparaissent alors plus fré-quemment. Des membres de la famille des Pilliers sont souvent mentionnés.
JEV Mirecourt VOL 1.qxd 19/05/13 10:03 Page 41
CÉDRIC MOULIS
51 Histoire de la Lorraine, 1939.52 Arch. dép. Vosges, XX H 2.53 Arch. dép. Vosges, XVIII H 6.54 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 968. (1440).55 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 972.56 Histoire de la Lorraine, 1939.57 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 968.58 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 7037.
42
À Mirecourt, le tribunal du bailliage porte le nom de for-assises, où l’on peutappeler à la réunion des prévôts en assises51. On en retrouve trace dès 1280,dans un vidimus rédigé par la cour de Mirecourt52. Le départ en assise le plusancien connu est celui de 1308, concernant un différend entre l’abbaye Notre-Dame de Flabémont et les Templiers53.Pour pouvoir faire fonctionner l’institution, un bureau spécifique est crée. Ils’agit du tabellionnage. À Mirecourt, sa première mention date de 1297, maisles tabellions n’apparaissent pas nommément avant le XVe siècle. Un tabel-lion juré est à sa tête et dirige des auxiliaires, ou notaires. Le droit de tabel-lionnage se paie chaque année à la Saint-Martin54.La prévôté Dans le registre de comptes du receveur daté de 1476, la prévôté de Mirecourtregroupe 33 villages : Ahéville, Ambacourt, Badville-sur-Madon,Baudricourt, Bazoille, Bettoncourt, Bouzemont, Chalmoisy (Chaumousey ?),Chauvecourt, Domjulien, Estrennes, Gircourt-et-Viéville, Hymont,Mattaincourt, Mazirot, Neuveville-sous-Montfort, Oëlleville, Oevaincourt(Juvaincourt), Pont-sur-Madon, Poussay, Puzieux, Racécourt, Rancourt,Remoncourt, Segennes, Valfroicourt, le Val d’Arol, Velote, Villers, Vittel,Vroville, Yracourt55.Le prévôt exerce des prérogatives judiciaires, financières et militaires. Iladministre pour son seigneur le territoire de la prévôté. Il perçoit les impôts,convoque à l’ost et s’occupe du château. Il est quelquefois assisté par un rece-veur (qui deviendra receveur général au XIVe siècle) qui s’occupe des finan-ces et d’un gruyer qui gère le bois. À la fin du XIIIe siècle, les tabellions aug-mentent en nombre : ces fonctionnaires remplacent peu à peu l’administrationecclésiastique.56 On apprend en 1440 que l’office de prévôté de Mirecourt estvendu par le receveur pour trois ans57. Comme en 1234, le prévôt dispose desdroits de basse, moyenne et haute justice58 pour son seigneur.
La mairieLe plus vieux compte des recettes et dépenses de la ville de Mirecourt date de1539. Pour le Moyen Âge, seuls cinq maires ressortent des archives, dont leplus ancien, Fauquegnon, remonte à 1399 où il est cité comme « jadis maire ».En plus du maire, la municipalité se compose de 9 échevins. Ils sont nommésle jour des Brandons lorsque les bourgeois s’assemblent sous la halle,
JEV Mirecourt VOL 1.qxd 19/05/13 10:03 Page 42
MIRECOURT AU MOYEN-ÂGE
59 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 7037.60 Arch. dép. Vosges, Edpt 309/ BB 1, f°1v°.61 Arch. dép. Vosges, Edpt 309/. BB1, f°2.62 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B6992.
43
présidés par le bailli ou son lieutenant. Le maire est alors chargé de choisir seséchevins59.Le conseil se réunit le jeudi matin. Tous les conseillers présents en ville sonttenus d’y assister, sous peine de 9 gros d’amende60. Leur charge est de délibé-rer pour traiter de toute affaire communale et publique, de décider des cons-tructions et réparations à entreprendre, de ménager, conduire et dispenser ren-tes et revenus ou faire baux et contraindre les femmes au paiement, fixer lesprix des vivres61. Quand ils délibèrent sur la police ou autre affaire importan-te, le bailli doit être averti et peut même assister au conseil.Ces réunions se déroulent au premier étage de la tour de l’horloge, tour por-che carrée ou rectangulaire qui enjambe la rue Haute et qui était vraisembla-blement une entrée de la ville fonctionnant avec l’enceinte primitive. Ellen’est toutefois mentionnée pour la première fois qu’en 1497, lors d’un acen-sement à payer au roi à la Saint-Martin d’hiver : « Jehan Mengenot 2 sols pourune maison sous la tour du Rologe entre l’héritage maistre Nicole et la mai-son de dessus la ruelle le Vicare »62.
L’égliseMirecourt relève de l’archevêché de Trêves et est rattaché au diocèse de Toul.Le centre primitif de la paroisse se situe pendant de longs siècles à quelqueskilomètres à l’est, à Vroville. Cette paroisse rurale est une création des VIII-IXe siècles, lorsque les petites chapelles privées mérovingiennes accèdent à cestatut. La dévotion à saint Didier, patron de l’église, concorde avec cette
Fig. 5 : La chapelle Saint-Didier, dite de la Oultre. 2012, Cliché C. Moulis.
JEV Mirecourt VOL 1.qxd 19/05/13 10:03 Page 43
CÉDRIC MOULIS
63 Michel AUBRUN, La paroisse en France, des origines au XVe siècle, Paris, 1986, p. 33 à 42.64 Arch. dép. Vosges, Edpt 309/.GG 5, f°1. Ce texte se trouve en latin dans un obituaire de 1599, et esttraduit au XVIIIe siècle dans des pages précédentes rajoutées.
44
datation. Grâce à cela, Vroville prend de l’importance par rapport aux domai-nes alentour dont les chapelles ne sont alors que des succursales63. La petitechapelle du XIe siècle qui deviendra plus tard la Oultre est dans ce cas : ellepossède le même patron que sa paroisse, ce qui montre sa filiation. Mirecourtn’est pas non plus centre de doyenné, puisqu’elle fait partie de celui deJorxey.Ainsi, jusqu’au XIIe siècle, Mirecourt ne possède aucun statut religieux dequelque importance. Mais Vroville périclite et ne devient pas la ville qu’elleétait vouée à devenir, à cause de la construction du château des comtes deToul à Mirecourt. Ce lieu devient le principal attrait pour la population audétriment du chef-lieu de paroisse. Dans ce contexte, Jean de Sierck, évêquede Toul (1296-1305), vient poser en 1303 la première pierre d’une nouvelleéglise à Mirecourt, dédiée à Notre-Dame :
« Jean par la grâce de Dieu évêque de Toul […]. Se sont présentés devant nousHenri dit Henriel, fermier de la bourga-de de Mirecourt et Idate sa femme etqu’en notre présence ils ont donné etlégué […] un jardin ou fond de terrequ’ils possédaient en dehors des mursde ladite bourgade de Mirecourt, près dela place publique, […] pour y bâtir et yélever une église ou chapelle paroissialequi devra remplacer l’ancienne église ouchapelle située en dehors de murs et au-delà de la rivière dudit Mirecourt […]dont l’accès était difficile tant au curéqu’aux paroissiens à cause des inonda-tions fréquentes, de l’intempérie des sai-sons et de plusieurs autres incommodi-tés en sorte que la dévotion des parois-siens en souffrait. Et cette église […]dépendra de l’église de Vroville ainsiqu’il est relaté dans la pose de la premiè-re pierre que nous en avons faite. […]Nous voulons que l’ancienne église ouchapelle demeure en son état primitifavec son cimetière […] Donné l’an1303 de notre seigneur, le lendemain duDimanche. Esto mihi. […] »64.
Ce document est le seul élément nous permettant jusqu’à présent de compren-dre l’évolution des lieux de culte à Mirecourt au cours du Moyen Âge. On yapprend qu’il existe une chapelle, de l’autre côté du Madon, et que, au vu des
Fig. 6 : Clocher roman de l’église Notre-Dame. 2012, Cliché C. Moulis.
JEV Mirecourt VOL 1.qxd 19/05/13 10:03 Page 44
MIRECOURT AU MOYEN-ÂGE
65 Bibl. nat., 5208 ; Commentaire de Lepage sur le pouillé de 1402, Nancy, 1863, in-8.
45
complications engendrées par le franchissement de la rivière, notamment enhiver, il est décidé de procéder à la construction d’une nouvelle église, horsles murs de la ville, mais près de ceux-ci, sur un terrain donné par un habi-tant. On apprend aussi que l’église mère reste celle de Vroville, ce qui estconfirmé par le pouillé de 140265. Dans ce document, il est fait mention de« Vroville, vicaria perpetua de Mirecourt Pat. rector dictae ecclesia ob eccle-siam suam ». Elle va le rester très longtemps, apparemment jusqu’au XVIIIe
siècle. Mais le registre B2 du pouillé, daté de 1501, mentionne « Vrovilla olimecclesia parochialis de Mirecourt ». La transition semble donc faite à cetteépoque.Jusqu’à présent, les historiens ont ainsi privilégié la chronologie suivante : leclocher aurait été édifié vers 1320, les deux travées suivantes entre 1320 et1380, les trois dernières travées et le chœur entre 1450 et 1480, et le transeptau XVIIe siècle. Cependant, l’acte de fondation doit faire l’objet d’une cri-tique rigoureuse. En effet, nous ne possédons plus l’original de ce texte, iln’existe qu’une copie en latin dans un obituaire de 1599, traduite en françaisau XVIIIe siècle. Rien n’indique que les détails mentionnés dans ce texte figu-rent déjà dans le document original. Ensuite, de nouvelles considérationsarchitecturales et archéologiques nous permettent de préciser la datation del’église. En effet, le clocher est une construction dont les éléments architectu-raux (oculus, baies romanes, larmier) et architectoniques (proportions desmaçonneries) sont absolument identiques à ceux employés dans nombred’édifices de la région entre 1150 et 1250. Il semble peu probable qu’il ait puêtre construit après cette date, ou alors en invoquant un archaïsme inédit dansl’architecture retenue. On s’explique assez mal le changement de parti archi-
tectural radical opéréentre le clocher et lespremières travées dela nef. De plus, l’esca-lier à vis menant auxétages du clocher a étéremanié pour permet-tre son raccordementavec la nef actuelle, cequi prouve qu’il a étéconçu pour une distri-bution autre que cellevisible actuellement.Enfin, nous observons
sous l’actuelle toiture les vestiges d’un solin de pierre typique des XIIe-XIIIe
siècles. Il prouve l’existence d’une toiture plus basse et moins large que celle
Fig. 7 : Solin de pierre de la nef primitive de l’égliseNotre-Dame. 2012, Cliché C. Moulis.
JEV Mirecourt VOL 1.qxd 19/05/13 10:03 Page 45
CÉDRIC MOULIS
66 Nous remercions l’Inventaire général de Lorraine qui a pris en charge le coût des analyses den-drochronologiques confiées au laboratoire Dendronet (Bohlingen, Allemagne).67 François CLASQUIN, p. 159.68 Charles LAPRÉVOTE, p. 175-180. Acte conservé dans les archives de l’hôpital, mais une autre copie existedans la cote : Arch. dép. Vosges, GG 24.
46
visible actuellement et que nousavons pu dater par dendrochronologiedes années 147066. Cette datationconvient d’ailleurs bien à l’architectu-re de la nef que l’on peut dater desXIVe-XVe siècles, même si des diffé-rences entre les travées (dans leursdimensions et leur architecture)démontrent qu’elles n’ont pas étéréalisées lors d’une campagne de tra-vaux unique.Les textes semblent également men-tionner l’existence d’une importantecampagne de travaux effectués aumilieu du XVe siècle. Ainsi, le 11novembre 1456, Richard Petitgout,mescher, dit « le Favart », parle dansson testament de « l’œuvre de l’égliseparochial de Mirecourt novellementcommencée » que ledit Richard enri-chit entre autre de « cinquante livres
de métals pour faire un cels à mettre l’eauve bénicte »67.L’aspect général de ce clocher et les analyses archéologiques évoquées ci-des-sus nous obligent à reconsidérer l’authenticité du texte. L’autre hypothèse àenvisager est que la construction de cette église a été interrompue après lafinition du clocher et qu’au début du XIVe siècle, les travaux reprennent. Pourofficialiser ces travaux et leur donner un caractère fondateur, l’évêque de Toulvient lui-même poser la première pierre. Enfin, une dernière campagne situéedans la seconde moitié du XVe siècle permet la couverture du bâtiment. Uneétude plus approfondie du clocher pourrait peut-être préciser sa date d’édifi-cation.L’hôpitalEn 1455, Richard Petitgoul, dit le Favart, décide de donner des fonds pourl’implantation d’un hôpital sur la rue Haute68. On apprend ainsi que l’établis-sement accueille les « povres malades, desaisiés non puissans, venus deprosperitei en pouvretei, povres femmes gissans, norrir les povres orfelins,povres pereliez, povres prisonniers, povres trepassans ». L’acte de fondationindique qu’il devra être édifié à proximité du couvent des cordeliers, fondé
Fig. 8 : Charpente des années 1470de l’église Notre-Dame. 2012, Cliché C. Moulis.
JEV Mirecourt VOL 1.qxd 19/05/13 10:03 Page 46
MIRECOURT AU MOYEN-ÂGE
69 Ces arcades sont maintenant insérées dans les maçonneries de la pharmacie située rue des Cloîtres. Cecloître mesurait 25 m de côté. La chapelle du couvent, de 28 m de long pour 10 m de large, était située surl’actuelle place du Général de Gaulle. L’ensemble a été détruit à la fin de la Révolution française.70 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 976.71 Arch. dép. Vosges, Edpt 309/GG 5, f°3v°.72 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 6992.
47
en 1444 à l’ouest de la rue Haute et dont deux arcades du cloître sont encorevisibles69. En 1480, le receveur doit à l’hôpital des pauvres 15 francs chaqueannée à Pâques et à la Saint Martin qu’il prend sur l’office de prévôté.70 C’estla première mention de cet hôpital en dehors du texte de sa fondation. Maispour diverses raisons mal connues (espace, finances,…), l’établissement sem-ble en fait avoir été installé rue Basse, près du moulin Saint-Étienne, et nondans la rue Haute. Ainsi, en 1514 est indiquée « une maison située rue basseproche l’hospital »71.Comme il a été dit dans la fondation, l’hôpital possède des terres qui sontsources de revenus. En 1497, « Thiriet le charreton [doit] 2 denier pour unchamp au haut de Chaumont sur le chemin d’Aheyville Jehan Petit Gout etl’ospital »72.Les outils de productionLes moulinsLe moulin Saint-Étienne est sans doute le plus ancien de Mirecourt. Il estabrité derrière les remparts de la ville, le long du canal au nord de la porte del’enceinte. Il appartient aux comtes de Toul, mais Eudes l’abandonne au pro-fit de l’évêque de Toul, Gilles de Sorcy, en 1261, en même temps que de nom-breuses autres possessions. Un document de 1284 atteste que le moulin est la
Fig. 9 : Les arcades du cloître des cordeliers pendant la construction de la Caisse d’Épargne.Carte postale. coll. part.
JEV Mirecourt VOL 1.qxd 19/05/13 10:03 Page 47
CÉDRIC MOULIS
73 François CLASQUIN, p.216.74 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, G 1332, f°3.75 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, G 1332, f°17.76 Arch. dép. Vosges, Edpt 309/ CC 25 n°1, f°9v°.77 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 1920.78 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 967.79 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 6992.80 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 6992 et B 970.81 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 6996.82 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 6999.83 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 6993, B 6994, B 7010.84 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 6992.85 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle,.B 6999.86 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 7009.87 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 6994.88 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle,.B 7033.89 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 810 n°10.
48
propriété du chapitre de l’église de Toul73. On retrouve cette possession dansun acte du 6 février 1426, où il est affermé à Jehan Gralet de Mirecourt avecla maison et toutes ses dépendances. En échange, il paie 12,5 gros à Pâqueset à la Saint-Rémy pendant 12 ans74. Puis le 4 septembre 1480, une nouvellemention parle des « molins du chapitre à Mirecourt »75. Il possède des éclusesqui sont réparées en 153976. Ces écluses sont sans doute situées aux extrémi-tés du canal.Quelques centaines de mètres en amont du moulin Saint-Étienne, se trouve unautre moulin, dont la première mention remonte à 142677. Mais il est sans douteplus ancien puisque, dès 1438, Jehan Phelipin est chargé de le remettre à neuf78.Il est situé près d’un « pré desous le neuf-moulin, aloing de la rivière »79. Leduc le donne en fermage à un habitant de Mirecourt pour un bail de trois ansle plus souvent,80 à charge pour lui d’entretenir les vannes et les usines81.Il est situé sur un bief de 20 toises, régulièrement nettoyé pour que l’eau couleplus facilement82 et semble par ailleurs être bordé de murs. Des écluses enpierre fonctionnent grâce à des vannes en bois83. Le moulin est constitué d’unbattant84 en bois qui, par son contact avec le courant de l’eau, fait tourner lahampe85 sur laquelle il est fixé. Le mécanisme semble se prolonger par deuxroues en bois, dont la plus petite est appelée rouet. On arrive alors à l’action-nement du foulon en bois, composé de palmes pour écraser le tissu ou lalaine.86 Il est donc sans doute utilisé par les drapiers. En 1499, il semble mêmeêtre agrandi87, ce qui correspond au développement de la draperie à Mirecourt.Mais en 1578, on y installe deux meules neuves88. Il a donc pu aussi servir àmoudre le grain.Les foursLa charte de franchise de 1234 mentionne pour la première fois l’existenced’un ou deux fours banaux à Mirecourt. En 1283, Ferry, duc de Lorraine, sesépare des revenus de son four qu’il donne à Girard de Mirecourt, bailli deVosge.89 En 1318, alors que Ferry IV fait de Girard son homme lige, on
JEV Mirecourt VOL 1.qxd 19/05/13 10:03 Page 48
MIRECOURT AU MOYEN-ÂGE
90 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 335, f°1v°-2.91 Arch. dép. Vosges, Edpt 309/ BB 1 f°4v°.92 Arch. dép. Vosges, Edpt 309/ CC 25 n°11, f°6v°.93 Arch. dép. Vosges, Edpt 309/ BB 1, f°97v°.94 Arch. dép. Vosges, Edpt 309/ AA 1 n°2.95 Arch. dép. Vosges, Edpt 309/ HH 2 n°2.96 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 668 n°3.97 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 974.98 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 970.
49
indique également « ledit four ondit chastel »90. Ainsi, il semble se situer dansle château, au sud de la ville. C’est le seul connu pour le Moyen Âge. Lesregistres de comptes du XVIe siècle mentionnent ensuite l’existence de fourssitués près des portes de la ville, le premier étant celui de la porte du pont91,par ailleurs retrouvé lors des fouilles de 2002. Un autre est mentionné à laporte de Poussay, au nord92. Au début du XVIIe siècle, on construit les foursprès de la porte de Mattaincourt93. Son emplacement correspondont à la courdes fours banaux encore en partie visible de nos jours.
Le commerceLes foiresIl n’existe aucune mention de foire à Mirecourt au Moyen Âge. En revanche,on sait qu’au début du XVIe siècle existe une foire franche, celle desBrandons, ou des Bures, durant deux jours, du premier dimanche du carêmeà midi au mardi midi. De nombreux marchands des alentours viennent y ven-dre. Mais elle est de trop courte durée. En 1504, le duc autorise donc de laprolonger jusqu’au vendredi midi94 et lui octroie plus de franchises. Puis, en1516,95 on apprend l’existence d’une seconde foire, à la nativité Notre-Dame(8 septembre), et la création d’une troisième, à la Sainte-Lucie (13 décem-bre). Les marchands des environs de Mirecourt y disposent des mêmes droitsque dans les deux autres foires.La halleLa première mention retrouvée de la halle date de novembre 1313.96 Onconnaît assez mal son emplacement, ce n’est vraisemblablement pas le mêmeque celui des halles actuelles, datées du XVIIe siècle. Le bâtiment doit sesituer entre l’église, la tour de l’horloge et le couvent des cordeliers, sur l’em-placement central de la ville à ce moment-là. En 1478, la halle est détruite etremise à neuf pour 59 sous et 10 deniers97, conséquence de la guerre opposantRené II à Charles le Téméraire.La halle permet l’installation d’étals pour les marchands,98 principalement desmerciers, des drapiers et des bouchers. En 1554, on recense quatre étals, plusun « situé près du pillier de pierre au bout des rangs des autres estaulx de mer-ciers devers le milieu de la halle » et encore un autre « au devant la halle »
JEV Mirecourt VOL 1.qxd 19/05/13 10:03 Page 49
CÉDRIC MOULIS
99 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 7017.100 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 6997.101 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 968.
50
ainsi que d’ « autres estaulx ».99 Ceci permet de fixer le nombre minimald’étals à huit et d’estimer raisonnablement à une dizaine le nombre total.Au-delà de cette fonction marchande, la halle est un lieu public de réunion etd’échanges en tout genre. En 1505, on y crie des biens meubles, par exempleles objets d’un défunt.100 De même, la bourgeoisie s’assemble souvent sous lahalle, le conseil de ville peut aussi s’y réunir, et le bailli y rend sa justice.Le poidsLe poids de Mirecourt est mentionné pour la première fois en 1426.L’instrument sert à étalonner à la mesure en vigueur le rapport quantité / prixdes marchandises. On apprend qu’il est acensé pour un an, aux enchères, à lapersonne qui, à l’extinction de la chandelle, fait la meilleure offre. En 1440,on décide de « refaire le poids de Mirecourt tout à neuf avec des planches, descordes » car il a été détruit par les écorcheurs101.
L’ensemble de ces équipements, éclairé par le fonctionnement des institu-tions, montre le dynamisme de Mirecourt à la fin du Moyen Âge. La ville asu se moderniser et affiche son attractivité. Au XVIe siècle, elle grandit trèsvite, la population passant de 113 feux en 1489 à 439 en 1585. Cet essordémographique provoque un entassement de la population intra-muros, etfavorise la croissance des faubourgs de Poussay et de Mattaincourt qui sedéveloppent respectivement au nord et au sud de la ville.À la lumière des sources d’archives de plus en plus nombreuses et loquaces,nous constatons l’amélioration des infrastructures, des équipements urbains(fortifications, halles, etc…) renouvelés, réparés, augmentés. L’installation denouveaux couvents prouve l’attractivité de la ville, une école voit le jour, lesmétiers s’érigent en corporations. À l’aube de la Guerre de Trente ans,Mirecourt apparaît ainsi comme une ville dynamique et bien équipée, muniede fortifications adaptées.
JEV Mirecourt VOL 1.qxd 19/05/13 10:03 Page 50