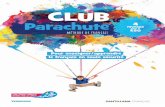La méthode de Tōno monogatari (1910) : aux origines de l’ethnologie endogène de Yanagita Kunio
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of La méthode de Tōno monogatari (1910) : aux origines de l’ethnologie endogène de Yanagita Kunio
INALCO Département de langue et civilisation japonaises
Frédéric LESIGNE
La méthode de Tōno monogatari (1910) : aux origines de l’ethnologie endogène de Yanagita Kunio
Directeur de recherche : François MACÉ (P.U.)
Mémoire pour l’obtention du master 2 de langue et civilisation japonaises
soutenu le 17 décembre 2013
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
3
Remerciements : Je voudrais exprimer toute ma gratitude à Monsieur François Macé pour avoir accepté d’être de nouveau mon directeur de mémoire en dépit des nombreuses années qui se sont écoulées depuis la maîtrise que j’ai eu l’honneur de préparer avec lui en 1997. J’espère pouvoir continuer encore de nombreuses années à collaborer avec lui ainsi qu’avec les chercheurs de l’INALCO. Merci également à Evelyne et à toute ma famille. F.L.
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
5
Table des matières
INTRODUCTION 7 OBJET DU MÉMOIRE 7 LA RÉCEPTION DE L’ŒUVRE DE YANAGITA DEPUIS L’APRÈS-‐GUERRE 11 L’ACTUALITÉ DE TŌNO MONOGATARI 14 PRINCIPALES SOURCES UTILISÉES 16
I. ENJEUX DES RECHERCHES SUR TŌNO MONOGATARI 20 1. LA MÉTHODE DE TŌNO MONOGATARI D’APRÈS SA PRÉFACE 20 2. LA QUESTION DE LA TRAJECTOIRE DE YANAGITA 27 3. TŌNO MONOGATARI, ŒUVRE LITTÉRAIRE OU TRAVAIL SCIENTIFIQUE ? 31 4. DÉFINITION DE L’ETHNOLOGIE DE YANAGITA 35 ETHNOLOGIE ENDOGÈNE : ESSAI DE DÉFINITION, ÉCART ENTRE PRINCIPE ET PRATIQUE 35 NŒUD DES DÉBATS SUR YANAGITA 42 PROBLÉMATIQUE GÉNÉRALE DU SUJET COGNITIF 45
II. LE CHAMP LITTÉRAIRE 48 LA FORMATION POÉTIQUE ET LA RENCONTRE AVEC LES MILIEUX LITTÉRAIRES 48 LE ROMANTISME EUROPÉEN : DU CERCLE DES POÈTES LAKISTES À HEINRICH HEINE 49 TOURGUENIEV ET LA CRITIQUE SOCIALE PAR LE « NATURALISME » LITTÉRAIRE 50 ANATOLE FRANCE ET L’INTUITION DE L’HISTOIRE INTROSPECTIVE 51 BILAN 53
III. LE CHAMP POLITIQUE 55 1. L’AGRONOMIE COMME SCIENCE POLITIQUE 55 L’APPORT DES RECHERCHES DE FUJII TAKASHI 55 LA PENSÉE ÉCONOMIQUE DE YANAGITA : UNE RÉFORME AGRAIRE AVORTÉE 57 2. LE POSITIONNEMENT POLITIQUE DE YANAGITA 63 LE VOYAGE DE KYŪSHŪ ET LE DÉPLACEMENT FOCAL VERS LA MONTAGNE 64 L’AFFAIRE DE « HAUTE TRAHISON » DU POINT DE VUE DE YANAGITA 68 DÉBAT SUR L’HISTOIRE OFFICIELLE ET KITA SADAKICHI 71
IV. LE CHAMP ANTHROPOLOGIQUE 74 1. LA THÈSE DES YAMABITO 74 NOCHI NO KARI KOTOBA NO KI ET LES POPULATIONS DES MONTAGNES 74 LES YAMABITO, LE PEUPLE DES MONTAGNES 76 LES SUITES DE LA THÉORIE SUR LES YAMABITO DANS LES ÉTUDES FOLKLORISTIQUES 80 2. UN TRIPTYQUE ANTHROPOLOGIQUE 85
CONCLUSION 90 POSITIONNEMENT DE YANAGITA FACE À LA MODERNITÉ 90 LE DÉPASSEMENT DIALECTIQUE ENTRE LES TROIS CHAMPS 91 TŌNO MONOGATARI COMME QUESTIONNEMENT HERMÉNEUTIQUE 93
BIBLIOGRAPHIE DES RÉFÉRENCES CITÉES 96
ANNEXE I : TRADUCTION DE LA PRÉFACE DE TŌNO MONOGATARI 98
ANNEXE II : SOURCES EN FRANÇAIS SUR L’ŒUVRE DE YANAGITA KUNIO – PAR CATÉGORIE ET ORDRE CHRONOLOGIE – 102
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
7
Introduction
Objet du mémoire
Le présent mémoire analyse les raisons et les conséquences du tournant vers
l’ethnologie opéré par Yanagita Kunio 柳田國男 (1875-1962) durant les années qui ont
précédé la publication de son œuvre Tōno monogatari 遠野物語 (Contes de Tôno)1 en
juin 1910.
Cet ouvrage a fait l’objet de nombreuses études, qui témoignent de son statut de
classique tant au sein de la littérature japonaise du XXe siècle qu’en tant que texte
fondateur de l’école d’ethnologie initiée par l’auteur, la minzokugaku 民俗学. Dans la
mesure où ces études, en langue anglaise notamment, sont en passe de devenir des
connaissances de base pour la japonologie mondiale, il nous a semblé pertinent dans le
cadre de ce mémoire de master 2 de proposer une présentation critique des principales
recherches déjà menées sur Tōno monogatari. Par ailleurs, dans la perspective d’un
travail de thèse, nous avions besoin de poser par écrit les données biographiques
importantes relevant de cette partie de la vie Yanagita, ainsi que de présenter une
première version du cadre théorique dans lequel pourrait être analysé l’ensemble de
l’œuvre ethnologique de Yanagita.
1 Le titre japonais de Tōno monogatari renvoie-t-il à une entité au singulier ou au pluriel ? Faut-il parler de « conte(s) », de « légende(s) », d’« histoire(s) » ou de « récit(s) » ? Ce mémoire n’entend pas trancher ces difficiles questions de traduction, aussi cruciales soient-elles. Provisoirement, nous nous en tiendrons au titre original en japonais. Par ailleurs, Ryôji Nakamura et René de Ceccatty ont proposé une traduction partielle de Tōno monogatari sous le titre « Contes de Tôno » dans Mille ans de littérature japonaise: une anthologie du VIIIe au XVIIIe siècle (Paris, Éditions de la Différence, 1982). Dans cette anthologie, seuls dix « récits » sur les 119 que compte l’original ont été retenus par les traducteurs : les numéros 3, 4, 7, 10, 11, 69, 91, 96, 101 et 117. Le choix d’inclure cette œuvre en appendice d’une anthologie censée s’arrêter au XVIIIe siècle se justifiait à leurs yeux « pour son caractère intemporel » (« Introduction »). L’approche retenue pour ce mémoire est sensiblement différente puisqu’elle tend à remettre en contexte la genèse de cette œuvre.
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
8
De cette volonté de croiser une étude ponctuelle sur Tōno monogatari à une
réflexion épistémologique plus générale, il résulte un plan constitué d’un 1er chapitre
qui partira de l’analyse de la préface de Tōno monogatari pour progresser vers une
problématisation d’ensemble de l’œuvre de Yanagita. Suivent trois chapitres de
présentation historique des trois champs dans lesquels Yanagita évolue durant les
années 1890-1910, et qui ont servi de terreau à Tōno monogatari : les champs littéraire,
politique (ou plus précisément la politique agronomique) et anthropologique. Nous
espérons ainsi expliciter les circonstances de l’entrée en ethnologue de Yanagita, et
rendre compte des problématiques à traiter pour une compréhension générale de son
œuvre.
Tōno monogatari est un ouvrage à la destinée insolite quand on songe à son lectorat
initial extrêmement réduit, puisqu’il s’agissait d’un court recueil tiré à compte d’auteur
à 350 exemplaires. Sa notoriété doit certainement beaucoup au talent d’écrivain dont
fait preuve Yanagita pour donner vie aux récits rapportés par Sasaki Kizen 佐々木喜善
(ou Kyōseki 鏡石, 1886-1933), son informateur originaire de la région de Tōno. Au-
delà de ses qualités stylistiques certaines, c’est bien la méthode par laquelle il a
construit l’ouvrage qui explique plus sûrement son statut actuel de classique. Tel est le
postulat de départ à partir duquel nous avons travaillé.
Lorsque l’écrivain Mizuno Yōshū 水野葉舟 (1883-1947) présente à Yanagita le
jeune Sasaki Kizen monté à la capitale pour tenter une carrière littéraire, Yanagita
comprend en l’écoutant qu’il a trouvé matière à produire une œuvre originale, et se met
rapidement au travail. Alors qu’aux yeux de Sasaki Kizen ou de Mizuno Yōshū, ces
informations relèvent d’« histoires fantastiques » (kaidan 怪談) ou d’« histoires de
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
9
fantômes » (bakebanashi 化け話), Yanagita conçoit l’idée d’en faire des « histoires de
Tōno » dès le soir de leur rencontre2. En écho au célèbre Konjaku monogatari shū 今昔
物語集, recueil d’anecdotes bouddhiques de la fin de l’époque de Heian, Yanagita
entrevoit l’occasion d’écrire un recueil d’histoires dont l’originalité résiderait dans leur
actualité, c’est-à-dire leur ancrage dans le réel vécu actuellement par les populations
locales de Tōno.
Les ambitions méthodologiques de Yanagita se révèlent dans la préface du recueil,
qui sera analysée au 1er chapitre de ce mémoire. L’ouvrage se présente comme un
véritable « manifeste »3 cherchant à imposer une autre approche du traitement de la
culture populaire. En toile de fond de ce projet scientifique, la motivation de l’auteur
relève d’une critique du processus de modernisation initié par les élites japonaises
depuis le début de l’ère Meiji. Les implications de ce projet général sont bien
« politiques » comme l’ont montré les premiers chercheurs et penseurs des années
soixante-dix qui se sont penchés sur l’œuvre de Yanagita du point de vue de l’histoire
des idées : Hashikawa Bunzō 橋川文三 (1922-1983) et son disciple Gotō Sōichirō 後藤
総一郎 (1933-2003), Kamishima Jirō 神島二郎 (1918-1998) formé par Maruyama
Masao, ou encore Tsurumi Kazuko 鶴見和子 (1918-2006) et son frère Tsurumi
Shunsuke 鶴見俊介 (1922- ). Leurs travaux, ainsi que ceux de leurs successeurs,
permettent de préciser les influences intellectuelles, anciennes et nouvelles, qui ont
incité Yanagita à s’orienter vers l’ethnologie.
Concernant les limites approximatives de cette étude, celles-ci se bornent grosso
modo aux années 1890-1910, c’est-à-dire depuis son déménagement à Tôkyô chez son
2 YKJT, p. 256. 3 NAKAZAWA Shin.ichi 中沢新一, « Kanshō. Chiisana, kageki na hon » 鑑賞—小さな、過激な本, postface ce l’édition Shūeisha bunko, 1991.
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
10
frère ainé Inoue Michiyasu en 1890 à l’âge de quinze ans, jusqu’à la parution de Tōno
monogatari en 1910 durant sa trente-sixième année. Les années 1890-1910, où Yanagita
est encore un homme jeune puisqu’il a entre 15 et 35 ans, couvrent sa période
d’apprentissage (lycée et université), son entrée dans la vie active, et ses premiers pas
d’ethnologue. Aux yeux de Yanagita, la littérature, la politique agronomique et
l’anthropologie présentent chacune à leur façon des potentialités heuristiques en termes
d’appréhension de la culture populaire. La question de savoir comment Yanagita est
passé d’un champ à l’autre entre 1890 et 1910 continue de faire débat. L’analyse du
processus de dépassement dialectique qui a eu lieu entre ces trois champs constituera le
cœur de notre problématique, et nous essayerons d’apporter une réponse originale à
cette question par une approche épistémologique.
Bien que ce phénomène de dépassement dialectique intervienne au cours des deux
décennies 1890-1910, une percée dans les années vingt et trente sera nécessaire afin de
suivre l’évolution de sa thèse anthropologique sur le « peuple des montagnes », les
yamabito 山人. Évoqués dans les légendes japonaises, ces êtres semi-fantastiques sont
mis en corrélation par Yanagita, à partir des années 1900, avec d’autres motifs présents
dans les traditions populaires comme les tengu 天狗, les enlèvements par les divinités
(kamikakushi 神隠し) ou les divinités des limites (dōsojin 道祖神). Yanagita y voit la
trace d’une antique population autochtone qui survivrait encore dans les montagnes
japonaises, repoussée au fil des siècles dans des territoires reculés en raison de la
suprématie de la « nation du Yamato » (Yamato minzoku 大和民族), arrivée plus
tardivement sur l’archipel et supposée avoir toujours formé une entité culturelle unie
autour de la famille impériale et du ritualisme lié au riz. Cette thèse sur le peuplement
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
11
japonais, que partagent partiellement d’autres chercheurs comme Kita Sadakichi 喜田
貞吉 (1871-1939), mais qui rencontre le scepticisme de l’anthropologue et biologiste
Minakata Kumagusu 南方熊楠 (1867-1941), sera finalement abandonnée par Yanagita
au cours des années 1910-1920, faute de preuves tangibles. Yanagita opèrera alors un
recentrage sur ce qu’il considère désormais comme le cœur de la culture japonaise
transmise par le « peuple ordinaire » (jōmin常民), produisant au fil des décennies
suivantes une vision de plus en plus homogéniste et particulariste de la nation japonaise.
Durant les années 1908-1909, pendant lesquels il rédige Tōno monogatari,
Yanagita est encore persuadé du bien-fondé de cette hypothèse anthropologique
incluant des éléments allogènes. Les récits de Tōno racontés par Sasaki, qui évoquent
une grande diversité d’êtres fantastiques vivant dans les montagnes, semblent étayer sa
construction historique du peuplement japonais et rendent probable la persistance d’une
confrontation actuelle entre plusieurs groupes ethniques aux confins des campagnes.
L’historique de cette thèse centrale dans l’œuvre sera analysé du point de vue politique
et du point de vue de l’anthropologie – respectivement dans le 3e chapitre et le 4e
chapitre. Les caractéristiques de la pensée ethnologique de Yanagita durant les années
1900-1910, qui convergent toutes autour de cette théorie du peuplement japonais, ne
peuvent se comprendre qu’à travers une ouverture vers les décennies suivantes.
La réception de l’œuvre de Yanagita depuis l’après-guerre
Dans la préface qui précédait sa traduction anglaise de Tōno monogatari parue en
1975, Ronald A. Morse, spécialiste et traducteur américain de l’œuvre de Yanagita,
dépeignait ce dernier comme suit :
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
12
Yanagita was schooled in literary elegance and he was never comfortable with the purely academic style that was necessary for the establishment of folklore as a “scientific” discipline. His terminology remains vague and his research projects often left incomplete. When Yanagita died in 1962 the social order into which he was born seemed to be rapidly disintegrating. The very things he had fought so hard to record and preserve had become objects of mistrust and ridicule. His final years were spent in nostalgia for the older, fast-‐vanishing Japan in which he had lived and of which he loved to write4.
Or, ce paragraphe a disparu de la nouvelle préface qu’il a remaniée pour la
réédition de sa traduction en 2008, parue à l’occasion du centenaire de Tōno
monogatari5. Cette absence ne manque pas d’intriguer et informe, en creux, des
évolutions qu’a connues la réception de l’œuvre de Yanagita au cours des trente
dernières années. En effet, si l’on peut trouver quelque pertinence dans chacune de ces
assertions, il n’est plus grand monde aujourd’hui pour présenter un tel tableau de
Yanagita sous les traits d’un poète nostalgique perdu dans la modernité du XXe siècle.
Parce que la réédition augmentée de la traduction anglaise de Tōno monogatari était
justement destinée à rappeler l’actualité de cet ouvrage cent ans après sa parution, il
n’était sans doute plus possible d’y faire figurer un tel paragraphe.
Le dépeindre sous les traits d’un lettré finissant ses jours dans la nostalgie d’un
monde disparu, intellectuel qui resta toute sa vie plus littéraire que scientifique, n’aurait
pourtant pas semblé décalé il y a cinquante ou soixante ans. Telle est peu ou prou
l’image que s’en faisait le grand public japonais d’après-guerre, quand Yanagita
apparaissait à la télévision en habit traditionnel coiffé de son chapeau de vieux maître,
4 YANAGITA Kunio, The Legends of Tōno, trad. angl. Ronald A. MORSE, Tokyo, The Japan Foundation, 1975, p. xxv. 5 YANAGITA Kunio, The Legends of Tōno, 100th anniversary ed., 1st Rowman & Littlefield ed., Lanham, Lexington Books, 2008.
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
13
ou quand sa voix au phrasé quelque peu suranné se faisait entendre sur les ondes de la
NHK. Tout dans ces apparitions renvoyait un certain décalage par rapport à la
modernité.
Ce n’est qu’au début des années soixante-dix, soit une dizaine d’années après son
décès, que le « boom » des études sur cet auteur en a renouvelé l’image. Yanagita
devient progressivement l’archétype de l’intellectuel s’opposant au centralisme
bureaucratique, ou, comme le note Ronald A. Morse dans sa thèse soutenue à
l’université de Princeton en 1974, un « hero for anti-establishment groups in Japan »6 :
People with as diverse a range of interests as Hashikawa Bunzō, Irokawa Daikichi, Kamishima Jiro, and Yoshimoto Takaaki have taken a serious interest in Yanagita. These writers, all interested in different aspects of Yanagita’s career, are unified only in their firm denunciation of the prewar emperor system and their basically anti-‐establishment attitude.” They all found Yanagita’s attempt to reconcile the manifest accomplishments of tradition with the requirement that society be made radically different supportive for their own work. Yanagita’s term jomin which fuses the words for “people” and “folk” proved a useful weapon in the criticism of the ruling elite and the bureaucracy. (1974:187-‐188)7
Dès ses premiers contacts avec les commentateurs de Yanagita dans les années
soixante-dix, Morse a ainsi conscience de l’importance que revêt Yanagita pour un
certain nombre d’intellectuels japonais. Cet auteur évoque chez eux une tout autre
figure qu’un simple littéraire aux valeurs à rebours de celles véhiculées par la
modernité. Plus le temps passe et plus Yanagita occupe une place prééminente dans
l’histoire de la pensée japonaise moderne, en tant qu’intellectuel engagé dans la
6 MORSE Ronald A., « The Search for Japan’s National Character and Distinctiveness: Yanagita Kunio (1875-1962) and the Folklore Movement », Thèse de doctorat, Princeton University, 1974. Publiée en 1990 chez Garland Publishing. 7 Cité dans : BRONSON Adam, « Japanese Folklore Studies and History: Pre-War and Post-War Inflections », Folklore Forum, 2008, vol. 38, no 1, p. 835, p. 11.
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
14
transformation de la société. Toutefois, le sens de cet engagement ne fait pas consensus,
comme le relève Morse ci-dessus. La coexistence de deux discours distincts dans ses
propres travaux, entre sa thèse à l’Université de Princeton et son introduction à Tōno
monogatari, en est une illustration, et s’explique amplement par la multiplicité des
regards portés par les commentateurs de l’époque.
Le processus de re-légitimisation de l’œuvre de Yanagita enclenché à cette époque
est corrélatif avec la transformation en profondeur des campagnes japonaises,
bouleversées par la modernité durant la période dite de « haute croissance ». En agissant
comme un miroir qui pointe les insuffisances de leur modernité, l’œuvre de Yanagita ne
cesse depuis lors de faire réfléchir les Japonais, sous la forme d’une réactualisation
constante de sa pensée à la lumière de questions d’actualité, la guerre du Viet Nam hier,
Fukushima aujourd’hui. En dépit des débats qui font rage entre spécialistes et des
critiques que les ethnologues eux-mêmes ne manquent pas d’adresser à leur « père
fondateur », dont il sera question plus loin, les « essais sur Yanagita » (Yanagita Kunio-
ron 柳田国男論) continuent de faire florès.
L’actualité de Tōno monogatari
De nombreux ouvrages ont été publiés au Japon et à l’étranger pour marquer le
centenaire de la parution de Tōno monogatari en 2010. La réédition de la traduction
anglaise de R. Morse mentionnée plus haut en est un exemple.
La maison d’édition Fujiwara Shoten a sorti en 2012 un collectif décliné en deux
langues : une pré-édition en anglais dirigée par R. Morse et disponible en ligne sous le
titre Yanagita Kunio and Japanese Folklore Studies in the 21st Century8, et l’ouvrage
8 MORSE R.A. (dir.), Yanagita Kunio and Japanese Folklore Studies in the 21st Century, Fujiwara
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
15
broché en japonais Sekai no naka no Yanagita Kunio 世界の中の柳田国男 (Yanagita
Kunio dans le monde) co-dirigé par Akasaka Norio 赤坂憲雄 (1953- ) et comportant
l’intégralité du contenu (introductions, contributions, bibliographies, etc.)9.
Concernant les publications scientifiques qui se comptent par dizaines, on notera le
lancement d’une nouvelle revue Tōno-gaku 遠野学 10, de nombreux numéros spéciaux
dans des revues scientifiques comme Tōhoku-gaku 東北学11 ou Gendai shisō現代思想
12 auquel a notamment participé l’anthropologue Kawada Junzō 川田順造 (1934- ),
disciple de Claude Lévi-Strauss.
Les éditions Kadokawa13 viennent de publier une nouvelle collection compilant un
grand nombre d’œuvres de Yanagita, et comprenant un tome consacré à la remise en
contexte de Tōno monogatari par rapport à sa théorie du « peuple des montagnes »
(yamabito-ron 山人論)14 . Comme on le voit ici avec la maison Kadokawa, les
catalogues d’autres maisons d’édition que Chikuma Shobō, laquelle assurait jusqu’alors
l’essentiel de la diffusion des œuvres de Yanagita Kunio, peuvent aujourd’hui s’enrichir
d’écrits de Yanagita de tous genres, depuis que sont arrivés à expiration les droits
d’auteur qui couraient jusqu’en 2012, la cinquantième année après son décès.
Rééditions en japonais et traductions en langues étrangères, notamment de Tōno Shoten, 2012. http://www.japanime.com/yanagita (Consulté le 04/10/2013). 9 R・A・モース, 赤坂憲雄, 菅原克也, 伊藤由紀, et 中井真木, 世界の中の柳田国男 〔Yanagita Kunio Studies Around the World〕, 藤原書店, 2012. 10 Publié par le Centre de recherches culturelles de Tōno (遠野文化研究センター, Tōno bunka kenkyū sentâ) dirigé par Akasaka Norio. Le premier numéro inaugural de mars 2012 - et unique à ce jour - portait sur le thème Shinsai to bunka (震災と文化, Désastre dû au tremblement de terre et culture). 11 Revue fondée par Akasaka Norio. 12 現代思想 2012年 10月臨時増刊号 総特集=柳田國男 『遠野物語』以前/以後, 青土社, 2012. 13 Les éditions Kadokawa ont été parmi les premières à inclure des ouvrages de Yanagita, dont Tôno monogatari, dans une anthologie de littérature japonaise : Nihon kindai bungaku taikei 日本近代文学大, volume 45, Yanagita Kunio shû, 1973. Par ailleurs, la première édition de Tôno monogatari en format de poche (bunko) parue chez Shinchôsha date également de 1973. 14 大塚英志 (dir.), 柳田国男山人論集成, 東京 : 東京, 角川学芸出版 ; 角川グループパブリッシング (発売), 2013.
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
16
monogatari, ne manqueront pas de se multiplier maintenant que ces œuvres sont entrées
dans le domaine public15.
Principales sources utilisées
Ce travail s’appuie en premier lieu sur les sources que nous avons précédemment
traduites :
• Fujii Takashi 藤井隆至 (1949- ), « Une modernité inachevée : pourquoi les
Contes de Tōno de Yanagita Kunio sont lus aujourd’hui », Ebisu, no 44, automne-hiver
2010, p. 137‑156.
• Iketani Takumi 池谷匠 (1954- ), « Musashino et les débats autour de la
recherche sur les terroirs », Ebisu, no 34, printemps-été 2005, p. 125‑146.16
• Iwata Shigenori 岩田重則 (1961- ), « La fonction impériale chez Yanagita
Kunio. Nation, riz et Okinawa », non publié17.
Moins académique que ces trois articles, La ville de Tōno et ses environs – Livret
touristique et culturel – est une petite brochure dont l’adaptation en français nous avait
été commandée par la Chambre de Commerce et d’Industrie de la ville de Tōno (Tōno-
15 La dernière ayant-droit Yanagita Fumiko, sa belle-fille, était réputée difficile à convaincre. Il faut savoir que la dote que Yanagita a laissé à son unique fils Tamenari lorsque celui-ci s’est marié à Fumiko en 1941 portait précisément sur ces droits d’auteur qu’il leur léguait après son mort sur l’ensemble de son œuvre, qu’il estimait pouvoir atteindre in fine une centaine d’ouvrages. 16 IKETANI Takumi 池谷匠, « Musashino. Kyōdo-kenkyū o meguru kattō » 武蔵野—郷土研究をめぐる葛藤—, Yanagita no musashino 柳田国男の武蔵野, Sankōsha三交社, 2003. 17 IWATA Shigenori 岩田重則, « Yanagita Kunio no tennō-ron. Minzoku, ine, Okinawa » 柳田国男の天皇論 : 民族・稲・沖縄, Hikaku minzoku kenkyū 比較民俗研究, 1992, no 6, p. 82‑109.
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
17
shi shōkō-kai 遠野市商工会) en 2010-2011, à partir d’un original en anglais rédigé par
R. Morse. Ce livret contient également quelques informations utiles pour notre sujet18.
Sources japonaises :
Les « études yanagitiennes » se sont amplement développées ses quarante dernières
années. Elles ont marqué des jalons importants dans les revues scientifiques : Yanagita
Kunio kenkyū 柳田國男研究 (1975-1978, 8 numéros), Kokubungaku 国文学 (1998),
Gendaishisō 現代思想 (2012), Esupuri エスプリ(1975), etc. Elles ont débouché sur un
dictionnaire consacré à cet auteur, Yanagita Kunio jiten 柳田国男事典19 (1998, abrégé
en YKJT ci-dessous). La biographie Yanagita Kunio den 柳田國男伝 (1988, abrégée
ci-dessous en YKD), réalisée par un groupe de recherche autour de Gotō Sōichirō, est
également un ouvrage de référence incontournable, malgré un certain biais laudateur20.
Nous avons également consulté les intéressantes notices (kaisetsu 解説) des tomes
4, 23, 30 et 31 de l’édition de poche des Œuvres complètes de Yanagita Kunio
(Chikuma bunko-ban Yanagita Kunio zenshū ちくま文庫版柳田國男全集, abrégé ici
en CBYKZS, Chikuma Shobō, 1989-1991) 21 . Pourvues d’un appareil critique
conséquent, les notices (kaisetsu 解説) des tomes 1 et 23 de la plus récente collection
18 MORSE Ronald A., La ville de Tōno et ses environs - Livret touristique et culturel -, trad. fr. Frédéric Lesigne, http://www.shokokai.com/tohno/html/gfrn0225.pdf (consulté le 4 octobre 2013). 19 野村純一 (dir.), 柳田国男事典, 東京, 勉誠出版, 1998. 20 Nous avons présenté les principaux groupes de recherche sur Yanagita Kunio actuellement en activité dans la région de Tokyo , dans la préface de l’article d’Iketani Takumi, op. cit. 21 Cette édition de poche (CBYKZS) reprend l’intégralité des ouvrages compilés dans la première collection parue chez Chikuba Shobō entre janvier 1962 et mai 1971, intitulée Teihon Yanagita Kunio shū 定本柳田國男集 (Collection définitive des œuvres de Yanagita Kunio, abrégée ici TYKS), qui comprenait 31 volumes d’œuvres et 5 d’annexes. Son grand format et sa graphie ancienne (caractères chinois non simplifiés et syllabaires dits « historiques ») en rendaient l’usage peu commode pour le grand public. Concernant l’ajout des traités économiques réunis par Fujii Takashi dans la collection de poche CBYKZS, voir infra p. 56.
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
18
des Œuvres complètes de Yanagita Kunio (Yanagita Kunio zenshū 柳田國男全集22,
abrégé ici en YKZS, Chikuma Shobō, 1997- 2014 ?23) fourmillent de détails sur la
genèse de Tōno monogatari.
Sources françaises :
En français, aucun ouvrage n’a encore été consacré exclusivement à Tōno
monogatari ni à l’ensemble de l’œuvre de Yanagita, dans la mesure où la thèse de
Junko Abe consacrée à Yanagita n’a pas été publiée24. Il existe toutefois de nombreuses
études sur lesquelles s’appuyer, bien que ce mémoire n’ait pas pour ambition d’en
proposer une synthèse : les numéros spéciaux des revues L’Homme (tome 32 no117,
1991), Ateliers d’anthropologie (no30, 2006), et Annales. Histoire, Sciences Sociales
(volume 49 no3, 1994) ; la contribution de l’ouvrage récent d’Éric Laurent25 ; l’article
de Junko Abe sur Imo no chikara 妹の力 (La force des sœurs) dans le collectif Cent ans
de pensée japonaise Tome II ; ou encore l’entrée Yanagita Kunio rédigée François
Macé par le Dictionnaire de la littérature japonaise (2000)26.
22 Le choix du caractère « kuni » 国 ou 國 pour le nom personnel de Yanagita diffère d’une collection à l’autre, d’un auteur à l’autre. Le distinguo sert parfois à différencier la collection de poche de 1989-1991 écrite alors 柳田国男全集 (abrégée ici en CBYKZS), de la nouvelle édition en cours de publication depuis 1997, toujours écrite 柳田國男全集 (YKZS). En réalité, l’édition de poche comportait déjà l’ancien caractère 國 dans son titre exact – mais non dans le corps du texte –. Jusqu’à la fin des années 1990, l’usage courant s’alignait sur le caractère simplifié 国. Depuis les années 2000, en raison des nouvelles préconisations graphiques, les spécialistes ont généralement tendance à revenir à l’usage de l’ancien caractère 國. Pour mémoire, la première collection Teihon Yanagita Kunio shū (TYKS, 1962-1971) avait officiellement pour graphie 定本柳田國男集. 23 Les derniers tomes prévus pour 2014 devraient comprendre ses journaux intimes non encore publiés et tant attendus par les connaisseurs. 24 ABE Junko, La femme médiatrice dans les œuvres de Yanagita Kunio et de Jules Michelet (Miko et Sorcière), Thèse de doctorat, Paris, 1991. 25 LAURENT Erik, «Anthropologie culturelle : vers une voie japonaise ni primitive ni occidentale », in Le Monde comme horizon - Etat des sciences humaines et sociales au Japon -, Anne Gonon et Christian Galan ed., Philippe Picquier, mars 2009, p. 201-247. 26 Les références complètes sont indiquées dans l’Annexe II de ce mémoire : « Sources en français sur l’œuvre de Yanagita Kunio – par catégorie et ordre chronologie – ».
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
19
Enfin, il convient de rappeler l’importance du numéro spécial rédigé par René
Sieffert en 1952 dans le Bulletin de la Maison franco-japonaise. S’appuyant sur des
listes bibliographiques extrêmement complètes des travaux publiés par Yanagita et ses
disciples, son panorama des différents sujets de recherches dans l’école d’ethnologie de
Yanagita n’a pas été dépassé. Mais cette présentation, exhaustive sur le plan des
thématiques, fait rétrospectivement figure, nous semble-t-il, de rendez-vous manqué en
terme de confrontation épistémologique.
Sources anglophones :
Ce mémoire s’est principalement appuyé sur les sources suivantes :
• J. Victor Koschmann, Keibō Ōiwa et Shinji Yamashita (dir.), International
perspectives on Yanagita Kunio and Japanese folklore studies, Ithaca, NY,
Cornell University East Asia Program, 1985.
• Melek Ortabasi, « Narrative Realism and the Modern Storyteller: Rereading
Yanagita Kunio’s Tōno Monogatari », Monumenta Nipponica, 2009,
vol. 64, no 1, p. 127-165.
M. Ortabasi est l’auteure de la seule thèse au monde consacrée exclusivement à
Tōno monogatari, soutenue en 2001 à l’Université de Washington: « Japanese Cultural
History as Literary Landscape: Scholarship, Authorship and Language in Yanagita
Kunio's Native Ethnology ».
Pour information, le collectif dirigé par R.A. Morse, Yanagita Kunio and Japanese
Folklore Studies in the 21st Century (2012), propose une biographie en anglais récente
et très complète.
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
20
I. Enjeux des recherches sur Tōno monogatari
1. La méthode de Tōno monogatari d’après sa préface
Avant une table des matières (« Daimoku » 題目) qui liste par rubrique les
différents types de récits inclus dans Tōno monogatari, Yanagita a placé quelques pages
liminaires qui tiennent lieu de préface. Celle-ci est constituée d’une dédicace mise en
exergue, de trois paragraphes qui forment le corps de la préface et d’un poème de
circonstance conclusif. Yanagita y revendique la pertinence de son projet et
l’importance des informations qu’il met à la disposition des lecteurs. Une forte ambition
de présenter un projet novateur et une conscience tout aussi aiguë d’avoir à justifier sa
démarche transparaissent à travers ces lignes.
Dès la phrase à valeur de dédicace qui est mise en exergue de l’ouvrage, Yanagita
se montre provocateur :
Je dédie cet ouvrage à ceux qui sont à l’étranger. 27
この書を外国に在る人々に呈す
L’auteur a livré le sens de cet énoncé quelques années plus tard28, en expliquant que
nombre de ses proches étaient alors partis ou étaient sur le point de partir pour
l’étranger. À une époque où l’attirance pour l’Occident avait le vent en poupe, Yanagita
entend montrer à ceux qui se désintéressent de leur propre pays que ce qui suit
mériterait leur attention. 27 En annexe, nous proposons une traduction française de la préface de Tōno monogatari. L’original est tiré de l’édition de poche Tōno monogatari. Yama no jinsei遠野物語・山の人生, Iwanami shoten, coll. “Iwanami bunko”, 1976 (disponible sur le site de Aozora bunko 青空文庫 www.aozora.gr.jp). 28 Dans la préface de la réédition de Tōno monogatari en 1935.
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
21
L’informateur, Sasaki Kizen, est dit de confiance. Yanagita lui-même estime avoir
assuré un travail de retranscription fidèle à l’original – point sur lequel il faudra
revenir :
Ces histoires, je les ai toutes entendues du jeune Sasaki Kyōseki [Kizen], homme de Tōno. L’an passé, en l’an 42 de l’ère Meiji (1909), vers le mois de février, commencèrent mes visites nocturnes répétées durant lesquelles je retranscris ces récits qui m’étaient contés. Le jeune Sasaki n’est pas un orateur habile, mais il est honnête dans ce qu’il dit. Je n’y ajoutai ou retranchai moi-‐même aucun mot, aucune phrase, et les retranscris tels que j’en avais connaissance.
この話はすべて遠野の人佐々木鏡石君より聞きたり。昨明治四十二年
の二月ごろより始めて夜分おりおり訪ね来たりこの話をせられしを筆記
せしなり。鏡石君は話上手にはあらざれども誠実なる人なり。自分もま
た一字一句をも加減せず感じたるままを書きたり。
Il poursuit en rappelant la richesse de ces matériaux à travers tout l’archipel :
Au juger, je dirais que le district de Tōno compte encore plusieurs centaines d’histoires de ce type. Il ne nous serait plus grand bonheur que de les entendre. D’autres villages de montagnes, d’autres lieux plus reculés encore que Tōno sur notre territoire, semblent connaître une infinité de légendes sur des divinités ou des peuples vivant dans les montagnes.
思うに遠野郷にはこの類の物語なお数百件あるならん。我々はより多
くを聞かんことを切望す。国内の山村にして遠野よりさらに物深き所に
はまた無数の山神山人の伝説あるべし。
Le premier paragraphe se termine par deux phrases devenues célèbres :
Nous en faisons ici le récit pour faire trembler les habitants des plaines. Un tel ouvrage, c’est Chen Sheng et Wu Guang !29
29 Dans l’article de Fujii Takashi « Une modernité inachevée », nous avions traduit ces phrases ainsi : « J’espère, par ces récits, faire frémir l’homme de la plaine. Ce livre n’est pas différent de Chen Sheng 陳勝 et Wu Guang 呉広. ».
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
22
願わくはこれを語りて平地人を戦慄せしめよ。この書のごときは陳勝呉
広のみ。
Par leur ton provocateur et des références énigmatiques, ces phrases sont propres à
susciter la curiosité du lecteur. La présence de ces deux personnages de l’histoire
chinoise, Chen Sheng et Wu Guang, célèbres pour avoir provoqué la chute de la
dynastie impériale des Qin en 210 avant J.C, a fait couler beaucoup d’encre. En quoi le
fait de raconter ces histoires de « peuple des montagnes » yamabito à des « habitants
des plaines » (heichi-min 平地民) serait propre à faire trembler ces derniers au point
d’ébranler l’ordre des choses ? À la suite d’autres spécialistes de l’œuvre de Yanagita
comme Ishii Masami 石井正己 (1958 -), Fujii Takashi analyse cette allusion comme
une critique voilée à l’ordre moral imposé par l’État de Meiji à travers notamment le
Rescrit sur l’éducation30. Nous reviendrons plus loin sur ces questions.
Quant à cette opposition entre « peuple des montagnes » et « habitants des
plaines », nous n’en comprenons pas l’entière signification à ce stade mais l’on peut
déjà supposer qu’il s’agit d’un ouvrage qui propose une vision autre de l’histoire du
peuplement japonais que celle répandue parmi ses contemporains.
Quels sont les faits qu’il veut nous mettre sous les yeux et par quelle méthode ?
D’abord vient un long paragraphe de description du district (gō 郷) de Tōno qu’il a
visité en août 1909. Ses descriptions sont éclairées de réflexions déduites à partir de ce
qu’il a vu et entendu sur place lors de son voyage. Ce passage se présente comme une
démonstration qui laisse à voir ce qu’un observateur avisé peut recueillir par croisement
d’informations, même si nous sommes encore loin d’un traité d’ethnographie à ce stade
de la carrière de Yanagita.
30 Ibid.
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
23
C’est surtout dans le long troisième paragraphe que sont exposées les
caractéristiques des faits exposés et les raisons pour lesquelles Yanagita a mené son
enquête. Son positionnement par rapport à un lectorat présupposé hostile à son
entreprise revient, de nouveau, en début du paragraphe :
Quand on y pense, ce genre de livres n’est en tout cas pas à la mode actuelle. Faire imprimer est certes devenue une chose aisée, mais certains prétendront qu’il est peu civil d’imposer à autrui la publication de tels ouvrages et ses propres goûts farfelus. Qu’il me soit permis de leur répondre. Qui, après avoir entendu de telles histoires et être allé observer de tels lieux, pourrait se retenir d’en faire le récit autour de lui ? Je n’en connais aucun, en tout cas parmi mes proches, qui puisse se tenir coi et réservé en pareille occasion.
思うにこの類の書物は少なくも現代の流行にあらず。いかに印刷が容
易なればとてこんな本を出版し自己の狭隘なる趣味をもって他人に強
いんとするは無作法の仕業なりという人あらん。されどあえて答う。かか
る話を聞きかかる処を見てきてのちこれを人に語りたがらざる者果して
ありや。そのような沈黙にしてかつ慎み深き人は少なくも自分の友人の
中にはあることなし。
Ces informations, en raison de leur actualité, ont trop importance pour être passées
sous silence. La comparaison suivante avec le Konjaku monogatari shū vient ensuite
appuyer sa démonstration :
Car contrairement au Konjaku monogatari, ouvrage illustre de neuf cents ans notre aîné, qui narrait des « histoires qui sont maintenant du passé » déjà pour leur époque, ce dont il est ici question se présente là, sous nos yeux.
いわんやわが九百年前の先輩『今昔物語』のごときはその当時にあり
てすでに今は昔の話なりしに反しこれはこれ目前の出来事なり。
Sans prétendre rivaliser avec la révérence et la sincérité de Maître Grand conseiller31 , de pareilles histoires que peu de gens ont
31 Le Grand conseiller Uji 宇治大納言 (Minamoto no Takakuni 源隆国, 1004-1077) a longtemps été considéré comme l’auteur du Konjaku monogatari shū .
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
24
entendues et qu’encore moins de bouches et de pinceaux ont relayées mériteraient tout l’attention d’un tel auteur réputé pour sa simplicité et son manque d’apprêt.
たとえ敬虔の意と誠実の態度とにおいてはあえて彼を凌ぐことを得とい
う能わざらんも人の耳を経ること多からず人の口と筆とを倩いたること甚
だ僅なりし点においては彼の淡泊無邪気なる大納言殿かえって来たり
聴くに値せり。
De même, les récits fantastiques de l’époque d’Edo racontés la nuit pour se faire
peur, les Otagi hyaku monogatari32, ne contiennent aucun fond de vérité et ne mérite
pas la comparaison avec les récits de Tōno :
Les mettre côte à côte me semble inconvenant.
窃にもってこれと隣を比するを恥とせり。
Vient immédiatement après la phrase par laquelle il caractérise le plus clairement
son ouvrage :
En résumé, il s’agit d’un livre de faits actuels.
要するにこの書は現在の事実なり。
Ce troisième paragraphe se termine par la même posture de défiance provocatrice :
Certes, Kyōseki [Sasaki Kizen] est un jeune homme d’à peine vingt-‐quatre ans, et moi n’ai guère qu’une dizaine d’années de plus. Que dire à ceux qui pensent que, alors que nous sommes nés à une époque où il y aurait tant à faire, nous ne savons discerner les petits des grands débats et perdons notre énergie inutilement ? Que dire à ceux qui nous accusent d’être pareils à des hiboux du bois de Myōjin, l’ouïe en alerte et les yeux écarquillés en pure perte ? Il n’est rien à leur répliquer. La responsabilité de cette entreprise, je l’assume moi-‐même.
32 Il s’agit d’une série de plusieurs ouvrages datant de l’époque d’Edo ou de la fin Muromachi. Le titre Otagi hyaku monogatari (御伽百物語, Cents contes de fées) donné ici par Yanagita est générique.
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
25
ただ鏡石子は年わずかに二十四五自分もこれに十歳長ずるのみ。今
の事業多き時代に生まれながら問題の大小をも弁えず、その力を用い
るところ当を失えりという人あらば如何。明神の山の木兎のごとくあまり
にその耳を尖らしあまりにその眼を丸くし過ぎたりと責むる人あらば如
何。はて是非もなし。この責任のみは自分が負わねばならぬなり。
Le poème final file la métaphore du hibou réputé inutilement en éveil. Ce poème
elliptique permet de conclure sur une note moqueuse, tant envers ses semblables que
lui-même33 :
La chouette au fond des bois, qui ne vole ni ne dit mot, se moque sans doute.
おきなさび飛ばず鳴かざるをちかたの森のふくろふ笑ふらんかも
En résumé, ce « livre de faits actuels » recueillis auprès d’un informateur
« honnête » et retranscrits « sans ajout[er] ou retranch[er] aucun mot, aucune phrase »34
entend porter à l’attention du public des informations généralement négligées par « ceux
qui sont à l’étranger » mentalement ou physiquement. L’intérêt est porté à ce qui « se
présente là, sous nos yeux », et non à des « histoires qui sont maintenant du passé »,
encore moins à des « fables ». Le terme générique monogatari est choisi à dessein par
Yanagita pour relever le prestige de ces récits qui « mériteraient toute l’attention d’un
33 L’interprétation généralement faite de ce poème est que Yanagita, à travers cette chouette, se moque lui-même de sa démarche scientifique, ce qui est un autre moyen rhétorique de retirer à un contradicteur la possibilité de lui adresser un reproche. 34 Dans une étude pionnière sur Tōno monogatari parue en 1983, Iwamoto Yoshiteru a proposé une interprétation toute différente de cette expression puisqu’il y voit au contraire l’idée de « ne pas lésiner sur les mots », en s’appuyant sur l’expression proche te-kagen sezu手加減せず signifiant « ne pas retenir sa main, ses coups ». Pour Iwamoto Y., Yanagita déclare ici qu’il n’a pas hésité à utiliser son matériau pour en faire une œuvre « littéraire », au sens non d’un travestissement mais d’une meilleure représentation des faits par le travail de la langue. Vu le contexte général de la préface, il nous semble impossible de suivre cette interprétation. Toutefois, la question épistémologique que pointe Yoshimoto tout au long de son ouvrage sur le rapport entre subjectivité et objectivité est cruciale et mériterait de plus amples développements. IWAMOTO Yoshiteru岩本由輝, Mō hitotsu no Tōno monogatari もう一つの遠野物語 (Un autre Tōno monogatari), Suitō shobō, 1983.
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
26
tel auteur réputé pour sa simplicité et son manque d’apprêt », le Grand conseiller Uji en
l’occurrence35, dont la référence sert par ailleurs à souligner le type d’attitude nécessaire
au traitement de ces informations de première main, quelle que soit la classe sociale
d’où elles proviennent.
Pour utiliser une terminologie contemporaine, cette méthode s’inscrit clairement
dans la catégorie des sciences sociales, et les informations recueillies sont traitées en
tant que faits sociaux. L’ambition « scientifique » de la démarche de Yanagita est bien
une caractéristique évidente de cet ouvrage. Elle en représente le caractère novateur, qui
à terme va en permettre le succès.
La dédicace, les trois paragraphes et le poème conclusif de cette préface, dans
laquelle Yanagita contre par avance toute contestation, manifestent un positionnement
expressément en marge de la norme de son époque. Ce positionnement n’est pas que
rhétorique et informe de l’état du paysage intellectuel dans lequel évoluait Yanagita et
des efforts qu’il a dû déployer pour arriver à ses fins. Or, ce point est d’autant plus
intéressant et problématique lorsqu’on sait qu’il occupait alors un poste prestigieux au
sein de l’administration centrale, en tant que fonctionnaire du service juridique du
gouvernement (naikaku hōseikyoku sanjikan 内閣法制局参事官). Le fait qu’il se
positionne en dehors de la norme intellectuelle de son époque oblige d’une part à se
pencher sur le détail de sa biographie pour comprendre les raisons personnelles ou
collectives de ce positionnement, et d’autre part à mieux cerner le statut de ce texte en
35 Que Yanagita ignore, ou feigne d’ignorer, que le Grand conseiller Uji (Minamoto no Takakuni) n’est vraisemblablement pas l’auteur du Konjaku monogatari shū, n’a aucune incidence pour le propos.
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
27
tant qu’acte de langage – à quelle stratégie Yanagita a-t-il ici recours à travers Tōno
monogatari pour imposer ses idées ? Les deux sections suivantes éclaireront ces points.
2. La question de la trajectoire de Yanagita
Le jeune Yanagita Kunio, né Matsuoka 松岡 en 1875 dans le village de Tsujikawa
辻川 situé dans l’actuel département de Hyōgo, rejoint ses frères aînés à la capitale en
1888-1890. Il est d’abord hébergé chez Kanae 鼎 (1860-1934) installé comme médecin
au bord de la rivière Tonegawa à la limite entre les départements de Chiba et d’Ibaraki,
puis à Tôkyô chez son deuxième frère Inoue Michiyasu 井上通泰 (1867-1941) qui
pratique également la médecine à Okachimachi 御徒町 dans l’ancien arrondissement de
Shitaya 下谷区, mais qui se fait surtout connaître alors comme poète de waka porte-
drapeau de l’école Keien-ha 桂園派. Encouragé par ses frères à s’inscrire au prestigieux
Premier lycée de Tokyo (第一高等学校), Yanagita gravit l’ascenseur social que le
système éducatif de Meiji met à la disposition des nouvelles générations venues de la
province. Il se fait rapidement un nom grâce à ses poèmes lyriques de style nouveau
(shintai-shi 新体詩). Pourtant, il donne un coup d’arrêt net à sa carrière littéraire et fait
le choix d’étudier la politique agronomique à l’Université impériale de Tôkyô d’où il
sort diplômé en 1900, puis de se faire adopter comme gendre par la famille Yanagita
dont le père était juge à la Cour Suprême36, avant de commencer une carrière
prometteuse dans l’administration centrale de son pays.
Cependant, ses centres d’intérêt ne limitent pas à la politique agronomique. Outre
sa curiosité toujours vivace pour les questions littéraires, une nouvelle activité de
recherche en ethnologie, « parallèle » à sa carrière de fonctionnaire, commence à
36 Nous savons que M. Eric Seizelet juge cette traduction inadaptée.
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
28
occuper une place de plus en plus importante dans sa vie. Ce second revirement
intervient de façon plus progressive en apparence que le premier, mais il se poursuit
avec constance au cours des deux décennies suivantes durant lesquelles Yanagita Kunio
abandonne ses ambitions dans la fonction publique et s’investit inversement toujours
plus dans la recherche ethnographique. Tōno monogatari se situe au moment précis où
ce second basculement s’accélère, c'est-à-dire à un moment où Yanagita commence à
s’avancer résolument en direction d’une voie inédite.
Les années 1890-1910 voient donc la maturation intellectuelle de Yanagita, depuis
la parution de ses textes poétiques, ceux relevant de sa carrière de haut fonctionnaire
spécialisé dans les questions d’agronomie, jusqu’à ses premiers travaux d’ethnographie,
en premier lieu Tōno monogatari publié en 1910. Le tournant qu’a connu la vie de
Yanagita durant ces deux décennies pourrait rétrospectivement se lire comme
l’aboutissement d’une logique interne, en dépit des multiples ruptures qui caractérisent
cette période de son existence. En effet, son abandon des salons littéraires et la volonté
de marquer sa différence tant avec la politique économique de son gouvernement
qu’avec les présupposés scientifiques de l’anthropologie de l’époque, sont l’expression
d’une forme de maturation et d’affirmation progressive de sa pensée. Au final, ces
diverses expériences dans ces trois champs semblent avoir été nécessaires à la création
de sa propre école d’ethnologie qui prendra réellement forme dans la deuxième moitié
des années vingt, après son séjour en Europe37.
37 Yanagita a été représentant du Japon à la SDN de 1921 à 1922, puis de 1922 à 1923. Il siégeait à la Commission des territoires sous mandat. Il avait été recommandé par Nitobe Inazō, dont il sera question plus loin.
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
29
Lui-même a décrit d’ailleurs cette trajectoire peu ou prou dans les mêmes termes,
dans ses mémoires parues à la fin de sa vie, Kokyō shichijū-nen 故郷七十年 (Pays natal
soixante-dix ans plus tard, 1959).
Présenté comme linéaire, logique, et exemplaire en termes de réussite, son propre
parcours y est justifié sous la forme d’un combat qui n’aurait jamais faibli pour le bien-
être collectif, ou le « bonheur de tous » pour reprendre la formule de J.M. Mill qui
semble l’avoir marqué durant ses années d’études à l’Université impériale de Tôkyô.
Cette vision quelque peu téléologique de la biographie de Yanagita, si elle est tentante
et a déjà fourni le fond de nombreuses biographies hagiographiques, doit être
relativisée.
Tout d’abord, il n’est après tout pas si rare que la jeunesse soit marquée par des
expérimentations littéraires empruntes de sentimentalisme, que le début de l’âge adulte
coïncide avec une carrière professionnelle rémunératrice, avant que l’âge mûr ne voit un
tournant vers un domaine qui corresponde mieux à la personnalité profonde de chacun.
Si tel était le tournant vers l’ethnologie dans la vie de Yanagita, il n’y aurait finalement
rien de bien original. Pourtant, le fait qu’il ait pu entraîner avec lui un grand nombre de
personnes dans la réalisation de son destin personnel en souligne déjà la singularité.
Cela amène à se poser la question des raisons de cet effet d’entraînement. Comment son
école d’ethnologie en tant que « mouvement » (undō 運動)38 a pu naître, s’accroître,
pour finir par s’implanter dans les universités après-guerre, alors que d’autres
chercheurs n’ont pas fait école ? Quelles sont les caractéristiques du projet de Yanagita
qui en ont assuré le succès ?
38 C’est le terme qu’emploie régulièrement Gotō Sōichirō, notamment dans son ouvrage : Yanagita Kunio-roin josetsu 柳田国男論序説, Tokyo : Densetsu to gendai-sha 伝統と現代社, 1972.
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
30
Reformulée ainsi, la question s’oriente vers une réflexion sur la logique de ce
parcours personnel en termes d’histoire des idées, à le repenser sous la forme d’une des
réactions intellectuelles produites par la société japonaise à partir de l’ère Meiji dans le
cadre de la « modernisation » du pays. Cette relativisation de la trajectoire personnelle
de Yanagita par l’histoire de la modernité japonaise a pour effet de mettre en lumière
une dynamique historique collective, c'est-à-dire les raisons de ce destin « exemplaire »
en termes de circonstances relevant en tout premier lieu de la naissance de l’État-nation
japonais.
L’essentiel alors est de savoir s’attaquer au « mythe yanagitien » sans tomber dans
le piège de la stigmatisation, qui en retour appelle des réfutations tout aussi stériles de la
part des admirateurs de l’œuvre de Yanagita. En d’autres termes, critiquer Yanagita
comme penseur nationaliste et culturaliste – qui aurait produit un discours culturiste en
accord avec les attentes d’une communauté nationale demandeuse d’une telle
reconstruction historique par le biais de l’ethnologie en vue de se forger une identité
nationale collective (telle est en substance la thèse de nombreux auteurs nord-
américains présentés plus loin) – est une approche tout à fait louable et nécessaire à
mettre en œuvre, mais elle n’épuise absolument pas les possibilités de la pensée de
Yanagita. En effet, la trajectoire de Yanagita montre combien son positionnement
intellectuel par rapport à ses rivaux se définit par un mode opératoire heuristique
(paradigme, objet, méthode) original qui crée un lien particulier entre sujet et objet de
connaissance. L’herméneutique du sujet propre au projet yanagitien invite à définir une
méthodologie plus adéquate qu’une simple critique univoque de son discours
nationaliste.
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
31
3. Tōno monogatari, œuvre littéraire ou travail scientifique ?
Même si Yanagita perçoit clairement les potentialités de son projet scientifique,
comme en témoigne la préface, la postérité de cette l’œuvre charnière n’est pourtant
venue que très tardivement. Publié à compte d’auteur en 350 exemplaires, ce livre n’est
connu que d’un cercle restreint de lecteurs pendant plusieurs dizaines d’années. Il a
fallu attendre 1935 pour que sa réédition le mette à la portée du grand public39. Les
proches de Yanagita qui le lisent en 1910 ont des avis partagés. Tayama Katai 田山花
袋 (1872-1930) considère notamment cette prose comme un « archaïsme de luxe »
(zeitaku na kofū ). Seul Izumi Kyōka 泉鏡花 (1873-1939) fait sur le moment un accueil
favorable à ce recueil, mais encore parce qu’il y voit « des histoires fantastiques
particulièrement étranges ». Force est de reconnaître que nul n’aurait prédit une telle
postérité à cet ouvrage à sa première parution. C’est finalement à l’occasion de la
réédition de 1935 que le spécialiste de littérature française Kuwabara Takeo 桑原武夫
(1904-1988) écrit en 1937 une première critique élogieuse rendant compte de l’intention
ethnographique de l’ouvrage :
Il y a forcément du sens dans ce que les hommes se sont transmis à travers les siècles et les siècles, touchant au plus profond de l’être humain. Lorsque ce sens est écarté de façon systématique parce qu’il est incompréhensible du point de vue des connaissances dites scientifiques qui ne sont en fait que le sens commun du moment, c’est tout simplement faire preuve de paresse d’esprit et de malveillance envers la nature humaine. 40
39 Entretemps, les exemplaires de la première édition circulent entre connaisseurs et connaissances de Yanagita. L’ouvrage jouit d’une notoriété certaine au sein de ce cercle fermé. 40 Kuwabara Takeo 桑原武夫 1980 [1937] Tōno monogatari kara『遠野物語』から (À partir de Tōno monogatari), in Kuwabara Takeo shū ̄桑原武夫集 (Œuvres de Kuwabara Takeo), volume 1, Tokyo, Iwanami shoten 岩波書店. Cité dans Fujii T., opus cite.
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
32
La qualité littéraire de ce petit recueil n’est, elle aussi, véritablement reconnue
parmi les amateurs de belles lettres qu’après la réédition. L’hommage que lui rend
Mishima Yukio 三島由紀夫 (1925-1970) est bien postérieur mais résume l’opinion
partagée par beaucoup de lecteurs aujourd’hui. Selon Mishima, Yanagita par sa
concision est un modèle de littérature41
Dès lors, la double valeur littéraire et ethnographique de Tōno monogatari, si elle
est assurée, pose à l’inverse de véritables difficultés sur le statut du texte. Yanagita n’a-
t-il pas affirmé lui-même, dans un entretien où on le questionnait sur Tōno monogatari,
que « tout cela n’avait été que littérature » ? Ce jugement rétrospectif, qui pourrait bien
passer pour une coquetterie d’auteur, n’illustre pas moins l’ambiguïté initiale du projet.
Par ailleurs, les histoires recueillies durant l’hiver 1908-1909 de la bouche de
Sasaki Kizen ont été retranscrites sans ajout, nous dit Yanagita dans son introduction,
telles qu’ « [il] en avai[t] connaissance » (kanjitaru mama 感じたるまま). Une part de
subjectivité affleure dans l’expression kanjitaru qui signifie littéralement « ressentir ».
Laissons de côté ce problème, qui a lui aussi suscité de nombreux commentaires, et
examinons le texte sous la forme qu’il nous est parvenu.
Œuvre littéraire, cet ouvrage l’est assurément tant les phrases sont ciselées dans un
style archaïsant, mêlant habilement langue classique (bungotai 文語体) et langue
parlée, d’une grande efficacité dans sa concision. Bien que discrets, les effets littéraires
sont propres à étonner ou à tenir le lecteur en haleine. L’intention de l’auteur affichée
41 Mishima Yukio 三島由紀夫 2003 [1970] Shōsetsu to ha nani ka 小説とは何か (Qu’est-ce que le roman), in Ketteiban. Mishima Yukio zenshū̄ 決定版 三島由紀夫全集 (Œuvres de Mishima Yukio. Edition définitive), tome 34, Tokyo, Shinchōsha 新潮社.
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
33
dans la préface était bien de « faire frémir les habitants des plaines », objectif qui relève
plus de la littérature que d’une analyse scientifique froidement rationnelle.
Pourtant, les prétentions ethnographiques sont tout aussi présentes dès le bref texte
introductif qui tient lieu de préface : Yanagita veut faire connaître à ses contemporains
une vérité qu’ils méconnaissent, à savoir le fait que les habitants actuels des régions
reculées du Japon comme Tōno croyaient réellement à l’existence d’êtres étranges
peuplant leurs montagnes. Yanagita est extrêmement clair sur ce sujet : il ne s’agit en
rien d’une fiction mais d’une forme de réalité telle qu’elle est vécue par les habitants
locaux vivant dans les montagnes. Il s’agit uniquement d’en rendre compte avec la plus
grande objectivité possible, sans rien y ajouter ni retrancher (ichiji ikku o mo kagensezu
一字一句をも加減せず). Yanagita précise également qu’il est conscient que certains
pourraient considérer ce genre de projet comme inopportun, et qu’en somme des jeunes
gens comme lui feraient mieux de s’intéresser à des sujets plus sérieux. Et pourtant, ces
informations lui semblent suffisamment importantes à mettre sur la place publique pour
qu’il prenne la responsabilité de s’en faire le porte-parole. L’obligation morale qui sous-
tend ce projet est par conséquent loin d’une motivation esthétique.
La part littéraire de l’œuvre ne se limite pas à des considérations stylistiques mais
relève également d’une certaine démarche heuristique et de choix thématiques que nous
examinerons plus en détail dans la section suivante. Cet aspect-là de la question est plus
complexe à démontrer et fait toujours débat. Mais quels que soient les prolongements
avec ses créations littéraires antérieures de la fin du XIXe siècle, la plupart des
commentateurs s’accordent pour reconnaître que, premièrement, l’œuvre amorce déjà
une méthode ethnographique en devenir, mais que, deuxièmement, celle-ci n’a pas
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
34
encore fait le choix de se concentrer sur le cœur de la culture japonaise (riziculture,
divinités tutélaires, culte des ancêtres, etc.). Certains auteurs, comme Fujii Takashi et
Kuwabara Takeo avant lui, peuvent donc y voir une réflexion universelle sur la nature
humaine, qui tente de comprendre les raisons intimes des peurs présentes dans toutes les
civilisations42.
Miura Suneyuki utilise une image intéressante, bien que paradoxale, pour parler de
cet ouvrage : « c’est le réveil de Yanagita », en écho à un de ses poèmes de jeunesse
dans lequel se voit dans un rêve43. Image paradoxale car il a été justement reproché à
Yanagita de confondre dans ce recueil ses rêves et la réalité ; de se complaire dans un
Japon fantasmé. Son attirance depuis son enfance pour les phénomènes surnaturels due,
avoue-t-il, à une expérience personnelle de perte de conscience qui lui rappelle les
enlèvements d’enfants par des divinités (qui constitue un motif récurrent dans le
recueil), pour les mânes des morts et autres présences venues de l’au-delà. Tout ceci se
situe dans la droite ligne des études nationales de Hirata Atsutane 平田篤胤 (1776-
1843) qui avait été une référence forte pour son père, à laquelle s’ajoute la croyance en
l’au-delà de son professeur de poésie Matsuura Tatsuo 松浦辰男 (ou Shū hei 萩坪,
1843-1909), poète de l’école Keien-ha 桂園派 dont il sera question plus loin. Il ne
faudrait pas non plus oublier de relever la vogue pour les phénomènes paranormaux et
autres histoires de fantômes qui fleurissait au tournant du siècle dans les milieux
urbains.
42 Fujii T., op.cit. 43 MIURA Sukeyuki三浦佑之, « Yanagita Kunio no mezame : “Nochi no kari kotoba no ki” to “Tōno monogatari” 柳田国男の目覚め ―「後狩詞記」と「遠野物語」(Le réveil de Yanagita Kunio : “Notes postérieures sur les mots de chasse” et “Les Contes de Tōno”) », Kokubungaku 國文學, 1993, vol. 38, no 8, p. 56‑62.
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
35
La question de ce rapport au surnaturel chez Yanagita, analysée en détails dans les
recherches d’Ōtsuka Eishi44, est l’enjeu de controverses d’une grande violence. Cette
problématique vient traverser et bouleverser le vieux clivage autour du statut de Tōno
monogatari (est-il une œuvre littéraire ou ethnographique ?), puisque ces
questionnements existentiels se retrouvent depuis les premiers poèmes romantiques de
Yanagita jusqu’à son ouvrage Senzo no hanashi 先祖の話 (À propos de nos ancêtres,
1946)45 . Avec la question de l’empereur, qui n’apparaît qu’en creux dans Tōno
monogatari, cette problématique de l’irrationnel et du surnaturel fait figure de
repoussoir pour les contempteurs de Yanagita. Elle n’a manifestement pas été traitée
avec la rigueur nécessaire par les commentateurs admiratifs du fondateur de
l’ethnologie japonaise46.
4. Définition de l’ethnologie de Yanagita
Ethnologie endogène : essai de définition, écart entre principe et pratique
Les travaux de Yanagita Kunio sur la culture populaire japonaise ont permis de
poser les fondements d’un courant autonome de recherches ethnographiques, occupant
aujourd’hui une place reconnue au sein des sciences humaines japonaises. Cette école
d’ethnologie connue dans son pays sous le nom de minzokugaku 民俗学 pose pourtant
des difficultés pour la faire entrer dans nos classifications disciplinaires. Pour la
différencier de « l’ethnologie à l’occidentale » (minzokugaku 民族学), certains auteurs
français comme Pierre-François Souyri ou Jean-Pierre Berthon ont proposé de la 44 Notamment ŌTSUKA Eishi大塚英志, Kaidan izen. Yanagita minzokugaku to shizen shugi 怪談前後―柳田民俗学と自然主義, Kadokawa gakugei shuppan 角川学芸出版, 2007. 45 Pour mémoire, ce texte a été écrit d’une traite alors que Tokyo était bombardé par l’armée américaine dans les derniers mois de la Seconde Guerre mondiale. 46 C’est le sens des critiques adressées par de Iwamoto Yoshiteru à Fujii Takashi par exemple.
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
36
traduire par « ethno-folklore »47. La terminologie anglo-saxonne la plus récente la
désigne souvent par le terme folkloristics48 ; nous nous en inspirerons pour proposer
l'équivalent français « études folkloristiques ».
D’une part, par ses objets (contes, légendes, dictons) et les outils qu’elle a
construits (recherches sur les « survivances », présupposant l’existence de « substrats »
culturels, voire raciaux, nationaux), la minzokugaku se rapproche du folklore – ou
« Folk-Lore » tel que l’orthographie à dessein Paul Sébillot pour en souligner le sens
étymologique de « savoir du peuple » –, discipline apparue en Europe au XVIe et
développée jusqu’à la première moitié du XXe siècle. D’autre part, les travaux de
l’ethnologie occidentale sur les peuples extra-européens ont également été intégré à sa
méthodologie (structures villageoises, systèmes de parenté, etc.).
La distinction courante entre « folklore » ou « ethnologie », telle que le grand
public la conçoit généralement, repose sur l’idée que le premier se distingue par des
objets d’étude désuets, des méthodes quelque peu simplistes et un paradigme passéiste.
L’avancée de la modernité et les drames du XXe siècle en Occident ont contribué à
disqualifier le « folklore » comme champ d’études, en France notamment. Tel n’a pas
toujours été le cas. Il suffit de lire Paul Sébillot pour constater que ses travaux
s’inscrivaient dans un programme moderne à portée générale49. Ces données nous
invitent, là encore, à ne pas de se contenter d’une terminologie simplificatrice.
Par ailleurs, le « soi » ou « l’autre » comme objet pourrait également sembler une
ligne de partage plus commode ou pertinente entre les différents types d’ethnologie au 47 Voir le numéro des Annales consacrés à la minzokugaku. 48 Par exemple : Kuwayama, Takami (2005) « Native Discourse in the “Academic World System”: Kunio Yanagita’s Project of Global Folkloristics Reconsidered », dans Asian Anthropology, ed. Jan van Bremen, Eyal Ben-Ari, and Farid Syed Alatas, London and New York: Routledge, p. 97-116. 49 Voir l’introduction de …. à l’ouvrage de Paul Sébillot, Le folk-lore: littérature orale et ethnographie traditionnelle, Paris, O. Doin et fils, 1913.
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
37
sens large. Cependant, si c’est bien le « soi » qui est l’objet d’études de la minzokugaku,
la relation entre l’observateur (sujet observant) et l’observé (objet observé) est posée
dans un rapport d’équivalence dans la minzokugaku, ce qui n’est pas le cas pour
« l’ethnologie de soi » de la France par exemple, laquelle se définit plus volontiers par
son travail d’éloignement par rapport à « soi » comme gage de scientificité. Le « soi »
qu’on croyait intime y devient un « autre »50. En revanche, dans la minzokugaku,
l’identité observateur/observé aboutit à une identité sujet/objet, ce qui a in fine des
conséquences méthodologiques que Yanagita a dû clarifier et théoriser dans les années
vingt et trente. Par conséquent, le paradigme de l’ethnologie de Yanagita n’est pas le
même que celui l’ethnologie de la France, quand bien même il s’agirait toutes deux
d’« ethnologie de soi ».
La génération de Yanagita est née à une époque où, pour faire advenir une
« ethnologie de soi », il fallait se positionner par rapport à un « autre » qui était
l’Occident. Parce que l’œuvre de Yanagita est indissociable du contexte de
modernisation du Japon dans lequel elle est apparue, les théories ethnologiques de
Yanagita sont en définitive une théorisation du rapport à la modernité occidentale, ayant
comme horizon la constitution d’un savoir permettant aux Japonais de comprendre par
eux-mêmes leur culture et de faire ainsi les meilleurs choix pour le futur. La génération
dont fait partie Yanagita a dû s’efforcer de proposer un regard neuf sur sa propre
culture, s’appuyant sur certains des acquis des sciences humaines occidentales. Par un
processus d’hybridation caractéristique de l’expérience de la société de l’ère Meiji, de
nouvelles « sciences humaines » voient le jour, afin d’adapter la société aux évolutions
50 Cette démarche se définit dans le prolongement du « regard éloigné » prôné par Claude Lévi-Strauss. Il n’est pas indifférent pour notre propos que Lévi-Strauss emprunte cette expression à l’introduction de R. Sieffert à La Tradition secrète du nō (Gallimard,1960), mais il faudrait plus de pages pour analyser ces échanges croisés.
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
38
en cours dans le processus de modernisation. Certains discours, rares, proposèrent de
faire table rase de l’héritage historique, d’autres justifièrent au contraire une adaptation
mesurée et motivée s’appuyant sur cet héritage. L’ethnologie de Yanagita appartient
bien à cette deuxième catégorie. Plus encore, elle en est l’illustration la plus poussée,
c’est-à-dire l’exemple particulièrement instructif sur les plans théorique et pratique, des
efforts et des difficultés qu’ont eu les Japonais de cette époque à produire une
méthodologie générale à même de faire évoluer leur société dans le cadre de la
modernité, sous forme de « méta-langage » allant au-delà des simples théories
culturalistes51.
Science du passé pour le présent, du peuple pour le peuple, son ethnologie porte un
projet à visée pratique, de connaissance de soi qui puisse déboucher à terme sur le
« politique » au sens de vie de la cité. Cette connaissance de soi en tant que processus
est conceptualisée chez lui comme une « introspection » (hansei 反省), qu’il pose
explicitement au centre de sa démarche. Par là, il affirme que les processus de
transformation de la société sont au cœur de son questionnement. Ceci explique, et nous
le développerons en détail plus loin, qu’en dépit de sa vision culturaliste et holistique de
la culture japonaise, l’histoire (rekishigaku 歴史学) n’ait cessé d’être le seul champ
disciplinaire général dans lequel il acceptait d’inscrire sa démarche. Il a toujours
revendiqué faire de l’histoire, et ses violentes critiques sur l’histoire événementielle
telle qu’elle était pratiquée par les historiens académiques de son époque ne visaient non
pas à s’exclure de la discipline historique mais au contraire à en refonder les méthodes
et les objets. L’« introspection » est ici formulée comme une orientation à réinterroger
51 Ref Torigoe. C’est cet aspect de l’œuvre de Yanagita que nous avons essayé de développer dans l’article à paraître : ….
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
39
l’histoire pour transformer la société dans le présent. On retiendra par exemple sa
célèbre injonction à « avoir un cœur d’histoire » (shishin o motsu 史心をもつ).
Proposée en premier par Tsurumi Kazuko au milieu des années soixante-dix52
comme caractéristique paradigmatique générale de la minzokugaku, la question du
caractère ou de la démarche « endogène » de celle-ci — son « endogénéité » si l’on
nous permet ce néologisme — est une porte d’entrée particulièrement pertinente pour
réfléchir de façon globale à l’œuvre de Yanagita dans la mesure où elle en éclaire ses
principaux enjeux épistémologiques. Les questions relevant du choix de ses objets
(soi/autrui notamment), de ses théories ou de ses méthodes apparaissent en effet
secondes, mais non pas secondaires, comparées à l’orientation paradigmatique et
axiomatique générale qui est l’autonomie de sa discipline, au sens le plus large du
terme.
Si la nouvelle discipline fondée par Yanagita s’est explicitement revendiquée
comme science mettant en œuvre une démarche réflexive autonome pour définir ses
propres objets et outils méthodologiques, opposée à la tendance qu’avaient la plupart
des sciences sociales japonaises à reprendre sans grande originalité les théories des
sciences humaines occidentales (ce qui en fait des sciences « exogènes » si l’on poursuit
la logique), force est de constater l’écart qui existe entre le principe d’endogénéité
scientifique énoncé par Yanagita et sa pratique (ou celle de ses disciples). Les
problèmes, méthodologiques et politiques, que posent ces écarts ont de longue date été
pointés. Les deux points fondamentaux suivants définissent parfaitement les contours de
52 Kazuko Tsurumi, « Yanagita Kunio’s Work as a Model of Endogenous Development », Japan Quarterly, 1975, vol. 22, no 3, p. 223238. En japonais : .
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
40
la question : l’apport étranger mal assumé chez Yanagita et le manque d’autonomie
laissée à ses disciples. Ils représentent réciproquement la face input et la face output en
quelque sorte du même problème.
Évoquons tout d’abord les emprunts aux auteurs occidentaux, comme James Frazer
par exemple53. Yanagita lisait énormément depuis son enfance, et son usage intensif de
la lecture s’accompagnait d’une prise de notes à la technique éprouvée. Pourtant, dans
ses travaux, il omet le plus souvent de citer les noms des auteurs et les titres des
ouvrages dont il est aujourd’hui avéré qu’ils avaient considérablement influencé sa
pensée. Les critères scientifiques de l’époque étaient certes moins stricts
qu’aujourd’hui, mais la méthode de Yanagita en la matière est si systématique que la
plupart des commentateurs actuels s’accordent à y voir une forme de camouflage. En
évitant de se montrer le débiteur d’influences étrangères, il aurait visé, selon ces
auteurs, à faire la démonstration de l’indépendance des sciences humaines japonaises.
Cet apport mal assumé des sources occidentales n’invalide pourtant par l’endogénéité
de la démarche de Yanagita dans son principe. Il illustre au contraire la cohérence de sa
stratégie, de façon certes problématique.
En revanche, le principe d’endogénéité de sa démarche est fondamentalement remis
en cause si cette dernière ne permet pas à ceux qui s’en réclament (ses collaborateurs en
premier lieu) de faire valoir leurs propres points de vue et si, à l’inverse, elle se résume
à une vision normaliste, fantasmée par Yanagita, de ce que doit être la culture japonaise.
Telle est, en substance, la critique la plus radicale formulée contre le fondateur de
l’ethnologie japonaise. Les contempteurs de Yanagita lui font le reproche d’imposer à
ceux qui ont travaillé avec lui des vues sur la culture japonaise considérées aujourd’hui
53(cf. Laurence Caillet)
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
41
comme passéistes et nationalistes. Certains critiques contemporains comme Iwata
Shigenori vont même jusqu’à lui refuser le titre d’ethnologue, qui nécessiterait selon
Iwata que Yanagita ait réellement travaillé sur le terrain pour construire son objet. En
somme, Yanagita a été le précurseur des théories sur les Japonais, nihonjin-ron, genre
qui a fleuri après-guerre, et se voit réduit à un simple « idéologue de la culture
japonais »54.
Critique intransigeant de la méthode yanagitienne, Fukuta Ajio (福田アジオ, 1941-
), l’un des plus importants chercheurs de la minzokugaku actuelle, relève également les
aprioris subjectifs de Yanagita, sur les femmes notamment, et montre combien les
opinions de Yanagita sur la culture japonaise pouvaient être marquées par son temps :
montée du nationalisme, vision idéalisée du passé, etc. Il montre surtout que la
méthodologie ethnographique mise au point par Yanagita sur vingt ans lui consacra un
statut à part dans le fonctionnement général de son école : seuls Yanagita et un groupe
restreint de disciples vivant autour de la capitale étaient autorisés à analyser les
informations ethnographiques envoyés par des informateurs régionaux à la revue
Minkan denshō 民間伝承 (Traditions populaires) fondée et dirigée par Yanagita. Cette
revue a certes contribué à créer un réseau dynamique entre les uns et les autres, mais
elle impliquait une relation déséquilibrée à l’avantage de Yanagita qui était seul amené
à produire des thèses générales. Les cadres méthodologiques (théorie de propagation
jūshutsu risshō-hō 重出立証法, théorie des aires culturelles minzoku shūken-ron 民俗周
圏論 ) mis au point au fil du temps par Yanagita, ainsi que les classifications
uniformisées qu’il a fait utiliser à ses disciples pour les enquêtes de terrains ont fini par
scléroser l’ethnologie japonaise, nous met en garde Fukuta. Il appelle donc les apprentis 54岩田重則, 「「常民」概念にみる柳田日本学とその思想」, 『ヘスティアとクリオ』第7号 , (2008年 08月刊行)
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
42
ethnologues à ne pas se laisser enfermer dans cette rhétorique bien huilée, et à faire
preuve d’initiative55.
L’ethnologie de Yanagita, à force de rejeter tout élément extérieur, a-t-elle
finalement réduit à néant le but initial de Yanagita qui était de permettre aux Japonais
de s’autonomiser par rapport au modèle dominant de modernisation occidentale ? La
normalisation a-t-elle pris le pas sur l’autonomisation ? C’est là une question essentielle,
qui appelle une réflexion épistémologiquement circonstanciée. La contradiction
apparente n’implique pas en effet qu’on doive refuser par principe à la minzokugaku le
qualificatif de science endogène. Elle pourrait bien plutôt informer sur l’écart entre
principe et pratique, c'est-à-dire sur la difficulté qu’il y a à passer d’intentions
clairement énoncées à une pratique ancrée dans le réel. Le tableau suivant de
l’opposition entre les critiques et les louanges adressées à Yanagita en apportera la
démonstration.
Nœud des débats sur Yanagita
Les historiens marxistes japonais ont été les premiers à attaquer les concepts sur
lesquels l’ethnologie yanagitienne était fondée, en tout premier lieu le terme jōmin 常民
, une notion de « peuple » hors de l’histoire et des dynamiques de classes. Par la suite, la
critique postcoloniale des années 1980 a porté un coup particulièrement dur à l’image
d’humaniste « défenseur des opprimés » dont jouissait Yanagita depuis les années
197056.
55 Fukuta Ajio, dans 鳥越皓之 (dir.), 民俗学を学ぶ人のために, 世界思想社, 1989. L’expression employée est : shutaiteki na imi 主体的な意味, qu’on peut traduire par « trouver un sens par soi-même ». L’utilisation du terme shutai 主体 (sujet) illustre selon nous à la fois la centralité de cette thématique du sujet cognitif chez les commentateurs de Yanagita et la difficulté à la problématiser clairement de façon théorique. 56 Notamment l’ouvrage de Kawamura Minato 川村湊, 「大東亜民俗学」の虛実, 東京, 講談社, 1996.
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
43
Les spécialistes nord-américains de la pensée japonaise (Bernard Bernier, Kevin M.
Doak, Harry Harootunian, Harumi Befu) ont également tendance à se montrer très
critiques, avec des nuances selon les auteurs. L’anthropologue québécois Bernard
Bernier a constamment pointé les failles de la méthode yanagitienne, et ce dans un
dialogue avec ses homologues japonais qui prenaient au contraire la défense de leur
compatriote :
And I would argue that Yanagita’s method, despite the fact that it has been presented as an attempt to comprehend people’s beliefs from the inside rather than to logically explain them, is based on the selection of facts to prove what is already a deep belief. In short, I would argue that Yanagita’s method is closer to theology than social science.57
Plus loin :
One could argue that Yanagita was aware of historical process, as many passages of Senzo no hanashi might testify (see pp. 20, 32-‐33, 61, 63 etc.). This is true, but in a very limited way. In fact, contrary to what is written in Hori and Ooms’s presentation (p. 8), the conception of history which is implicit in the book is not really evolutionary. Rather, I would argue that it bears more resemblance to a type of theological thought current in many religions, especially in Christianity, whereby the world or society are thought to be degenerated from a pure, perfect Pristine state58.
K. Doax, comme l’indique le sous-titre de son ouvrage « Placing the People », s’est
efforcé de montrer comment la pensée de Yanagita cherchait à enfermer les Japonais
dans des cases préétablies, au moyen de concepts au contenu flou (kokumin 国民
« nation »/« peuple », minzoku 民族 « race »/« nation »/« peuple »,). Quant à H.
57 Bernard Bernier, « Yanagita Kunio’s “About the Ancestors”: Is It A Model For An Indigenous Social Science? », in Keibō Ōiwa, Shinji Yamashita et J. Victor Koschmann (dir.), International perspectives on Yanagita Kunio and Japanese folklore studies, Ithaca, NY, Cornell University East Asia Program, 1985, p. 81. 58 Ibid, p. 86.
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
44
Harootunian, il a le grand mérite de montrer que Yanagita déploie une
« herméneutique » – terminologie foucaldienne fructueuse – dans son effort de
reconstitution historique. L’histoire du Japon devait être réappropriée et repensée par
ses habitants pour leur permettre de surmonter le choc de l’entrée du Japon dans le
système capitaliste mondialisé. Tel est en substance le dispositif cognitif mis au point
par Yanagita, sur lequel Harootunian ne porte pas de jugement quant au fond même s’il
semble sceptique sur sa validité59.
Or, si à l’inverse nous lisons les auteurs de référence japonais qui louent l’approche
générale de Yanagita, en premier lieu Hashikawa Bunzō60 et son disciple Gotō Sōichirō
qui ont été au point de départ du « boom Yanagita » dans les années soixante-dix, ou
d’autres spécialistes de l’histoire des idées comme Irokawa Daikichi 色川大吉 (1925- )
et surtout Kano Masao 鹿野正直 (1931- )61, ou encore les ethnologues Miyata Noboru
宮田登 (1936-2000) et Tanigawa Kenichi 谷川健一 (1922-2013), qui pourtant ne se
privent pas de pointer les insuffisances des théories yanagitiennes, tous mettent en avant
sa volonté de donner aux Japonais les moyens de leur autonomie cognitive, et partant
civilisationnelle, voire politique. De même, les auteurs contemporains ayant une
connaissance sérieuse des textes de Yanagita, des ethnologues comme Sano Kenji 佐野
賢治 (1950- )62 , des sociologues comme Satō Kenji 佐藤健二 (1957- ) ou des
anthropologues comme Kuwayama Takami 桑山敬己 (1955- )63, appellent à ne pas
59 Harry D. Harootunian, Overcome by modernity: history, culture, and community in interwar Japan, Princeton (N.J.) Oxford, Princeton university press, 2000. 60 Cf. Hashikawa Bunzō 橋川文三, 柳田 国男 その人間 思想, 東京, 講談社, 1978. Yanagita y est présenté comme un des plus grands penseurs mondiaux, à la hauteur d’un Karl Marx ou d’un Max Weber. 61 Dans Kindai Nihon no minkan-gaku (近代日本の民間学, Les sciences nées de la société civile dans le Japon moderne, Tokyo: Iwanami-shoten, 1983), Kano voit dans Yanagita l'exemple même de la réussite d'une science née dans la société civile. 62 Le manuel d’ethnologie Gendai minzokugakugaku nyū mon現代民俗学入門 (Introduction aux études folkloristiques du contemporain, Tokyo: Yoshikawa-bunkan, 1996) qu’il a dirigé se positionne clairement dans la lignée de l’œuvre de Yanagita 63 桑山敬己, ネイティヴの人類学と民俗学: 知の世界システムと日本, 東京, 弘文堂, 2008. Cet
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
45
caricaturer cette œuvre, au nom justement de la défense de la diversité culturelle —
chère pourtant elle aussi à la critique postcoloniale.
Il est frappant de constater combien les deux partis sont à fronts renversés. Ce
constat devrait inciter à se poser la question de savoir pourquoi des opinions aussi
diamétralement opposées peuvent être énoncées à partir d’un même principe
d’autonomie. L’impossibilité de conclure sur l’autonomie de la recherche dans la
minzokugaku (l’endogénéité, si l’on extrapole) appelle à présenter une analyse
ingénieuse sur la façon dont Yanagita appréhende l’autonomie cognitive du sujet,
notamment dans l’interaction entre les individus et leur environnement naturel et social.
Étudier une œuvre aussi emblématique que Tōno monogatari doit permettre de faire
avancer cette direction de recherche sur les moyens épistémologiques que Yanagita met
en œuvre pour permettre à l’homme de prendre en charge son destin.
Problématique générale du sujet cognitif
Du point de vue de l’épistémologie des sciences, c’est le traitement du sujet
cognitif qui constitue la question cruciale sur laquelle il nous semble devoir nous
pencher, que ce soit pour l’analyse de Tōno monogatari et que pour les travaux
ultérieurs de Yanagita. Les sections précédentes ont apporté des éléments légitimant
cette approche à partir des débats sur cet auteur, pour montrer que ceux-ci tournaient en
fait autour de questions d’herméneutique du sujet. Le même constat peut être fait à
partir de la terminologie que Yanagita utilise et des objectifs qu’il assigne à ses
recherches.
ouvrage a d’abord été publié en anglais : Kuwayama, T., 2004. Native anthropology: the Japanese challenge to Western academic hegemony, Melbourne, Vic: Trans Pacific.
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
46
La transmission, c’est-à-dire ce qui s’est transmis, par qui et comment, est au cœur
de la réflexion de Yanagita. Il dénomma d’ailleurs dans un premier temps son école
Mikan-denshō no kai 民間伝承の会 (Société des Traditions populaires) à l’exemple du
folkloriste français Paul Sébillot, qui dirigeait lui aussi autour du siècle une « société
des traditions populaires » en France. Ce n’est que lorsque son courant fut suffisamment
développé et reconnu pour pouvoir rivaliser avec les autres sociétés savantes japonaises
en sciences humaines, qu’elle prit le nom de Minzoku-gakkai (民俗学会, traduction
anglaise officielle : Society of Folklore Studies), en avril 194664. Derrière cette attention
première à ce que le « peuple » se transmet comme « traditions »65, se profilait une
intention programmatique forte. Il s’agissait de mettre en lumière un mode de savoir
« par le bas », de faire émerger ce qu’on peut espérer savoir si l’on part du principe que
la vérité ne se révèle pas par une source ultime et transcendantale mais à travers les
rapports qu’entretiennent les hommes avec leur milieu, qu’il soit social ou
environnemental. La question est clairement épistémologique : comment le savoir peut
émerger comme vérité dans ce genre de cadre, tant du point de vue théorique que
pratique, comment il est légitimé, transmis, etc. Dans une perspective politique, il s’agit
de réfléchir à ce que peut être un processus de démocratisation « par le bas ». Par
conséquent, la question du nationalisme de Yanagita ne peut être analysée qu’à la
lumière de ce que certains ont appelé une forme de « philosophie »66 générale de la
connaissance, explorée par Yanagita7.
64 Pour une analyse détaillée de l’évolution de la minzokugaku dans le prolongement de Tōno monogatari, voir infra. 65 Dire un mot sur le terme denshô 伝承. 66 Ref Torigoe Hiroyuki : 鳥越皓之, 柳田民俗学のフィロソフィー, 東京大学出版会, 2002.
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
47
Yanagita a cette réflexion particulièrement évocatrice en terme méthodologique
lorsqu’il se souvient du divorce qui a frappé son frère aîné, événement qui a beaucoup
marqué l’enfance de Yanagita :
Le malheur de mon frère découle selon moi d’absence de prise de conscience du fait que l’organisation de la maison japonaise existe inconsciemment, et de la façon dont on doit faire évoluer les choses.
兄の不幸は、日本の家の組織が無意識に存在し、どう変へるべきかと
いふことがなほざりにされてゐたからだと思ふのである。67
Nous voyons ici comment peut s’opérer un travail sur le rapport subjectif/objectif,
qui entraîne une objectivisation de la subjectivité. Là est sans nul doute la clé de
l’herméneutique yanagitienne qui explique qu’il reste encore d’actualité aujourd’hui,
contrairement à d’autres auteurs qui se sont à une activité académique soit cantonnée à
la collecte des faits, soit enfermée dans la production de théories dérivées des sources
occidentales68.
Du point de vue de cette problématique d’arrière-plan du traitement du sujet
cognitif, la genèse de l’œuvre Tōno monogatari est l’illustration de l’émergence d’une
stratégie herméneutique encore tâtonnante en 1910 au moment où Yanagita rédige cet
ouvrage, mais qui sera systématisée dans les décennies suivantes.
67 故郷七十年 p. ?. Cité dans 鳥越皓之, « 民俗学と近代化論 », in 鳥越皓之 (dir.), 民俗学を学ぶ人のために, 京都, 現代思想社, 1989, p. 42‑59. 68 S’il fallait développer les implications de cette problématique, il faudrait mettre en parallèle le rôle central de la réflexivité chez Yanagita (hansei 反省) avec le concept de subjectivation énoncé par Michel Foucault, ou encore avec la sociologie réflexive que prônait Pierre Bourdieu dans ses dernières œuvres. On verrait combien tous ces auteurs retombent sur les mêmes problèmes épistémologiques autour de la question l’objectivation de la subjectivité, thématique sur laquelle travaillent conjointement ethnologues et philosophies depuis un certain nombre d’années.
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
48
II. Le champ littéraire
Des trois champs entre lesquels évolue Yanagita Kunio dans les années où il
conçoit le projet de Tōno monogatari, nous aborderons en premier lieu le champ
littéraire, car c’est chronologiquement ce qui constitua sa première formation. Présenter
Yanagita en tant qu’homme de lettres, décrire son style, situer Tōno monogatari dans
l’histoire littéraire nécessiterait bien plus que les quelques pages que nous consacrerons
ici à cette question. Toutefois, afin de demeurer dans l’axe de notre problématique
générale, nous nous en tiendrons à une présentation succincte des principales sources
d’inspiration de Yanagita dans le domaine de la littérature, ainsi que de sa relation à ces
sources
Notre but est, ici encore, de mettre en valeur les questions herméneutiques liées aux
choix stylistiques et thématiques de Yanagita Kunio.
La formation poétique et la rencontre avec les milieux littéraires
Yanagita arrive en août 1887 dans le Kansai. Alors âgé de treize ans, il est hébergé
dans un premier temps chez son frère aîné Matsuoka Kanae, médecin à Fusa au bord de
la Tonegawa, puis par son frère Inoue Michiyasu qui le prend sous sa protection trois
ans plus tard, en 1890. Inoue Michiyasu était un poète de waka, et fit une grande
carrière à la cour69. Yanagita Kunio découvre auprès de lui la poésie de l’école Keien-ha
桂園派, de l’époque d’Edo. C’est également Inoue Michiyasu qui lui permet de
rencontrer Mori Ōgai en 1890. Ce fut là pour Yanagita une rencontre primordiale.
Enfin, c’est par l’intermédiaire de ce frère que Yanagita commence à publier des tanka
69 (NOTE)
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
49
dans la revue Shigarami sôshi しがらみ草紙 (Cahiers pour lutter contre le courant), la
revue du mouvement romantique, et dont la figure centrale était Ōgai.
Ces mêmes années sont aussi et surtout celles des premières rencontres de Yanagita
Kunio avec les sources occidentales qui vont profondément l’inspirer.
Le romantisme européen : du cercle des poètes lakistes à Heinrich Heine
Le romantisme européen a été la principale source d’inspiration occidentale durant
les années de formation intellectuelle du jeune poète Matsuoka Kunio. Parmi ses
lectures romantiques les plus assidues durant les années où il est au Premier lycée de
Tōkyō, on cite les noms de George Gordon Byron, William Wordsworth et Heinrich
Heine, et, à un degré moindre, Shakespeare si l’on classe ce dernier dans le courant
romantique pris dans son acception la plus large. Sur le modèle de la poésie lyrique
anglaise du cercle des « poètes lakistes », un petit groupe se forme autour de Yanagita et
de Tayama Katai70. Ensemble, ils publient un recueil intitulé Jojōshi 抒情詩 (Poèmes
lyriques, 1897), qui marque les débuts d’un nouveau genre au Japon : la poésie à vers
libres et à tonalité lyrique. C’est par ce recueil que le nom du jeune Kunio commence à
se faire connaître au sein d’un cercle assez large parmi les élites de Tokyo, toutes
largement férues de littérature. Sa réputation est faite, il est « Matsuoka Kunio, le poète
de l’amour »71.
Le panthéisme du cercle des poètes lakistes britanniques, dont William Wordsworth
(1770-1850) et Samuel Taylor Coleridge (1772-1834) sont les figures les plus célèbres,
a fourni à la jeune génération de Yanagita un outil interprétatif stimulant pour repenser
70 国木田独歩、宮崎湖処子、太田玉茗 71 (Ref)
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
50
le rapport qu’entretenaient (ou semblaient entretenir) les divinités les plus anciennes et
la civilisation moderne, en Europe comme au Japon. Cette réévaluation romantique du
panthéon antique et, au delà, de l’héritage antique, aux implications anthropologiques
utiles dans le présent est plus nettement encore affirmée chez le poète et penseur
allemand Heinrich Heine, source d’inspiration clairement revendiquée chez Yanagita.
Yanagita lut Les Dieux en exil de Heine vers 1905, probablement dans une
traduction anglaise72. L’ouvrage, peu lu aujourd’hui, propose une interprétation que l’on
pourrait qualifier d’anthropologique, de l’héritage des cultes païens préchrétiens dans la
culture occidentale. Par analogie, Yanagita reprend ce schéma à son compte pour
montrer que des cultes les plus anciens peuvent avoir des implications dans le Japon
contemporain.
Tourgueniev et la critique sociale par le « naturalisme » littéraire
Ivan Tourgueniev est une autre référence littéraire majeure qui a marqué Yanagita
durant ses années d’études à l’Université de Tōkyō73. La thématique du combat contre
l’esclavage des paysans, tant que celle des récits fantastiques narrés par le verbe du
poète, font écho aux préoccupations qui nourrissent la réflexion de Yanagita à cette
époque74.
///CITATION/// son article すずみ台 où il fait l’éloge du Journal d’un chasseur
(?) : « capacité de l’auteur à voir dans la nature un mystère caché depuis des siècles que
les religieux ne voient pas ». Ce positionnement de l’auteur russe inspirera Tōno
monogatari. 72 YKJT, p.69. 73 YKJT, p.71-72, Takahashi ? 74 Il le lisait en traduction anglaise, avant même que la sortie en japonais de Fumée. (Ajouter une note sur l’article signé KY sur Pouchkine et Tourgueniev ?)
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
51
Imprégnés des idées d’auteurs étrangers comme Tourgueniev, Maupassant,
Nietzsche, et tant d’autres, Yanagita et Tayama Katai se voyaient alors en « champions
de la nouvelle société japonaise »75, qui s’appuieraient sur leurs lectures pour proposer
une analyse « naturaliste » des problèmes sociaux que rencontrait le Japon.
Plus généralement les auteurs russes comme Tourgueniev mais aussi Tolstoï ont
marqué cette génération d’intellectuels japonais par leurs romans qui portent une
réflexion historique et sociologique forte, comme par exemple Crime et châtiment.
Il s’intéresse également à Ibsen, dont il semble avoir surtout connu les œuvres de la
premières période, celles qui mêlent folklore norvégien et critique sociale.
Anatole France et l’intuition de l’histoire introspective
Le premier texte d’Anatole France qu’ait connu Yanagita s’intitule Sur la pierre
blanche. Ce roman, qui commença à paraître en feuilleton dans le premier numéro du
quotidien L’Humanité en 1904, est peu lu de nos jours en France. Il allait pourtant avoir
une influence non négligeable sur Yanagita. La philosophie d’Anatole France, teintée de
pessimisme sur la nature humaine, propose cependant la possibilité d’un avenir
meilleur, à condition que l’homme sache s’interroger sur ses erreurs passées.
L’esprit de l’œuvre d’Anatole France semble avoir nourri la démarche ethnologique
de Yanagita au cours de nombreuses années, puisque Yanagita lisait et relisait les
romans de France. On peut parler d’une affinité de vue sur la nature humaine et surtout
sur les moyens à mettre en œuvre pour construire le futur de l’humanité. En ce sens, la
nécessité d’un retour sur soi qu’exprime l’écrivain français vient en amont de la
démarche scientifique centrée sur « l’introspection » (hansei 反省), qu’allait mettre en 75 Tayama Katai, Tōkyō no sanjū -nen (東京の三十年, Trente ans à Tokyo, ).
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
52
place Yanagita progressivement. L’amour de l’histoire qui traverse toute l’œuvre
d’Anatole France rappelle également l’injonction de Yanagita évoquée plus haut à
« posséder un cœur d’histoire » (shishin o motsu 史心をもつ).
L’influence d’Anatole France sur Yanagita est intéressante à souligner d’un point
de vue épistémologique, car elle ne se situe pas dans un emprunt à un schéma
interprétatif précis comme avec Heine ou les poètes lakistes, qui permettrait de relier le
passé au présent, ni dans le prolongement d’un combat pour la culture paysanne comme
dans le cas de Tourgueniev par exemple, ni enfin dans un emprunt stylistique des
romans à « thème » d’un Ibsen. Il s’agit bien d’une méthode, beaucoup plus générale,
qui se fonde sur le recours à l’histoire pour permettre l’introspection. L’histoire
introspective devient méthode, elle est le moyen de construire le futur à partir du passé.
Tel est le lien véritablement épistémologique qui relie les œuvres de France et de
Yanagita.
Il est fort logique de retrouver des affinités « éthiques » entre les deux auteurs : une
certaine distance par rapport aux idéologies, aux rêves du « grand soir », qui se décline
avec l’impératif de regarder la réalité en face, c’est-à-dire d’interroger les faits dans leur
complexité sans recourir à des théories préétablies. La comparaison entre les idées
politiques de Yanagita et d’Anatole France serait un sujet d’étude en soi très intéressant
à mener, mais nous nous bornerons ici à relever que l’humanisme des deux auteurs les
pousse à embrasser des thèses progressistes, qui cependant les empêchent de
s’engouffrer dans l’idéologie76, et cela précisément au nom d’une certaine vision de
l’histoire comme méthode d’introspection.
76 On rappellera que le roman Les Dieux ont soif a été mal reçu auprès de certains intellectuels de gauche qui y voyaient une critique de la Révolution française. (ref)
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
53
La comparaison entre Yanagita Kunio et Anatole France est également instructive
dans leur rapport respectif au « naturalisme ». Le dédain que nourrissait Anatole France
pour la prétention de scientificité que revendiquait le naturalisme dans son regard sur la
réalité l’a amené à s’opposer durant de nombreuses années à Zola, avant de se
réconcilier avec lui à partir de L’Assommoir. Ceci n’est pas sans rappeler les critiques
que formulait Yanagita au début du XXe siècle à l’encontre de ses camarades
d’université lorsqu’ils se lancèrent dans la création du style intimiste qui constitue le
naturalisme japonais.
Bilan
La rédaction de Tōno monogatari intervient à un moment de la vie de Yanagita où
ses liens avec les milieux littéraires se distendent, au moment même où Yanagita fait ses
« adieux à la littérature », pour reprendre une expression souvent utilisée pour désigner
le mouvement de bascule qui intervient dans son existence. La dynamique qui se cache
derrière ce paradoxe apparent est au centre de nombreuses études, notamment les
travaux récents de Melek Ortabasi77, ou les travaux menés au Japon dès les années 1980
autour du groupe emmené par Gotō Sōichirō et responsable de la biographie YKD,
groupe qui a continuellement cherché à percer ce mystère en analysant le
positionnement de Yanagita par rapport aux débats littéraires de son temps entre 1890 et
1910.
77 ORTABASI Melek, « Narrative Realism and the Modern Storyteller: Rereading Yanagita Kunio’s Tōno Monogatari », Monumenta Nipponica, 2009, vol. 64, no 1, p. 127-165.
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
54
Ces différents travaux tendent à démontrer que Yanagita a pensé et construit Tōno
monogatari comme une forme de réponse méthodologique au naturalisme de son
époque, lequel était enfermé dans le nombrilisme du genre watakushi shōsetsu 私小説
(ou shi-shōsetsu, « roman à la première personne »). Au centre du débat se trouve la
question de la restitution du réel. Les arguments que déploie M. Ortabasi dans son
article paru dans Monumenta Nipponica en 2009 illustrent parfaitement l’intérêt
contemporain suscité par cette œuvre au sein des études littéraires, dans son rapport au
naturalisme.
Pour la recherche contemporaine, l’originalité de Tōno monogatari en tant
qu’œuvre littéraire relève principalement de cette herméneutique expérimentale face au
réel, plus que de valeurs « littéraires » intrinsèques (concision, rythme, effets, etc.)
auxquelles rendait hommage Mishima Yukio, ou du fait que ce livre a joué un rôle
pionnier en tant que passeur de « littérature orale », que lui reconnaissait Kuwabara
Takeo.
L’ensemble des travaux d’analyse littéraire et biographique sur cette œuvre au
cours des quarante dernières années forme en tout cas un corpus d’une grande richesse
où les théories foisonnent.
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
55
III. Le champ politique
1. L’agronomie comme science politique
L’apport des recherches de Fujii Takashi
L’article de Takashi « Une modernité inachevée : pourquoi les Contes de Tōno de
Yanagita Kunio sont lus aujourd’hui »78, s’il ne rend pas compte des travaux les plus
pointus en agronomie politique de Fujii, résume assez bien son point de vue sur
Yanagita. Partant du constat que la postérité a amplifié une relecture « légitimisante »
des ouvrages de Yanagita, Fujii s’interroge sur le sens qu’a ce questionnement continu
des Japonais sur leur modernité à travers Tōno monogatari. Comme la plupart de ses
ouvrages, il ne s’agit pas d’une sociologie de la lecture, comme pourrait le laisser
penser son titre, car l’article repose tout entier sur la présentation de la pensée de
Yanagita dans le domaine de la politique agronomique, avec ses implications en termes
d’idées politiques au sens le plus général.
Fujii y dresse le profil d’un intellectuel « au combat »79 pour réformer sa société, en
butte à l’opposition des élites de son pays, n’hésitant pas à protéger des disciples
marxistes inquiétés par les autorités. La thèse qu’énonce Fujii Takashi, qui l’amène à
écrire que « la modernité japonaise n’est pas terminée », est que cette tension autour du
devenir de la société japonaise qui se lit en filigrane dans Tōno monogatari, explique le
succès toujours actuel de cet ouvrage auprès des lecteurs japonais. Cette approche
fondée sur l’analyse des idées économiques de Yanagita trouve sa pertinence dans la
78 opus cite. 79 Pour reprendre une expression de Iwamoto Yoshiteru (REF) : « tatakau Yanagita Kunio » (戦う柳田國男).
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
56
recontextualisation de cette œuvre et du parcours intellectuel de Yanagita dans les
débats politiques et économiques de son temps, et sur le longue terme, notamment
après-guerre.
Rappelons que les travaux de Fujii Takashi sur la pensée économique de Yanagita
avaient grandement contribué à enrichir les débats sur cet auteur. Depuis lors, les
historiens s’intéressant aux années 1900-1910 dans la carrière de Yanagita y font
largement référence. C’est le cas de Kawada Minoru 川田稔 (1947- ) dont l’ouvrage
Yanagita Kunio no shisōteki-kenkyū 柳田国男の思想史的研究 (Recherche en histoire
des idées sur Yanagita Kunio, 1985) est devenu une référence incontournable depuis
qu’il a été traduit en anglais80.
La première contribution remarquable de Fujii T. aux études yanagitiennes consista
à éditer l’ouvrage Yanagita Kunio nōron-shū 柳田国男農政論集81 qui réunit les traités
économiques de Yanagita. La plupart de ces traités avaient été exclus de la première
collection des œuvres complètes de Yanagita (TYKS), qui commença à être publiée du
vivant de celui-ci en 1962, et sous la responsabilité de ses disciples majoritairement
spécialisés en ethnologie et non en politique agronomique. Les traités d’agronomie
exhumés par Fujii vont être intégrés dans la réédition de poche de ces œuvres complètes
(CBYKZS, parue entre 1989 et 1991), au sein du volume n° 29 dont il assure également
la notice (kaisetsu). Cette collection de poche, en mettant les œuvres de Yanagita à la
portée du grand public, a grandement contribué à relancer les recherches sur Yanagita, y
compris concernant la pensée agronomique et politique, en grande partie grâce au
80 KAWADA Minoru, The origin of ethnography in Japan: Yanagita Kunio and his times, London; New York, Kegan Paul International, 1993. 81 FUJII Takashi 藤井隆至 ed., Yanagita Kunio nōseiron-shū 柳田国男農政論集, Hōsei daigaku shuppan kyoku 法政大学出版局, 1975.
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
57
travail de Fujii Takashi. On notera que ces traités économiques sont les seuls ajouts
introduits dans cette collection en poche par rapport à la première collection TYKS.
Pour mémoire enfin, Fujii est un des collaborateurs du travail d’édition toujours en
cours pour la nouvelle collection (YKZS), aux côtés de Satō Kenji et Oda Hideo (….)
notamment.
La section suivante sera consacrée à résumer la partie de l’article « Une modernité
inachevée » de Fuji T, qui analyse la genèse de Tōno monogatari. Pour le détail de
l’argumentation, nous renvoyons le lecteur à cette étude.
La pensée économique de Yanagita : une réforme agraire avortée
En 1900, dès sa sortie de l’Université impériale de Tokyo, Yanagita intègre la
Direction des politiques agricoles (Nōseika 農政課) du Ministère de l’Agriculture et du
Commerce (Nōshōmushō 農商務省). Il y est chargé de la mise en application de la loi
nouvellement votée sur les « syndicats de production » (sangyō kumiai 産業組合). Ces
« syndicats » que l’État veut promouvoir tout en en contrôlant l’activité comprennent
également les coopératives agricoles. Yanagita donne aussi des cours de politique
agricole dans des universités privées. En 1902, ses premiers cours sont publiés sous le
titre Nōseigaku 農政学 (L’agronomie politique), et il signe une étude intitulée Sangyō
kumiai 産業組合 (Les syndicats de production).
Pourtant, dès 1902, soit un an et demi après son entrée au Ministère de
l’Agriculture et du Commerce, il est muté au Service des affaires juridiques (Hōsei-
kyoku法制局) rattaché au cabinet du Premier ministre. Cette mutation n’est pas un cas
isolé car les ministères y envoyaient leurs meilleurs éléments. Toutefois, elle marque
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
58
l’arrêt de la progression de Yanagita dans les instances administratives en charge des
orientations économiques du pays. Il semble que des différents personnels et d’ordre
idéologique soient intervenus entre Yanagita et son directeur Sakō Tsuneaki 酒匂常明
(1861-1909) expliquant cette mutation. Il reste malgré tout considéré comme un expert
en matière de politique agricole durant les années qu’il passe au Service des affaires
juridiques (1902-1914). Il donne fréquemment des conférences et effectue des voyages
d’inspection à travers le pays.
Il continue également de publier des traités de politique agronomique, notamment
en 1910, soit la même année que Tōno monogatari, Jidai to nōsei 時代ト農政 (Époque
et politique agronomique) et surtout Nōgyō seisaku 農業政策 (Politiques agricoles ;
date de parution incertaine) qui est une édition de notes de cours donnés par Yanagita à
l’Université de Waseda durant cette période. Selon Fujii Takashi, le traité Nōgyō
seisaku est instructif au sens où il révèle l’analyse de Yanagita sur la situation
économique dans laquelle se trouvent les paysans, et les solutions qu’il préconise pour
en sortir. Comme nous allons le voir, ce point de vue est un des facteurs qui l’auraient
poussé à rédiger Tōno monogatari.
Nōgyō seisaku, traité qui examine les possibilités de développement à partir de
l’activité économique régionale, constitue un réquisitoire sans concession contre la
politique du gouvernement de l’époque. La cause principale du déclin de l’activité dans
les régions depuis Meiji est à chercher, selon lui, dans l’augmentation du coût du
transport. En effet, suite aux rapides transformations du réseau de transport, certains
territoires ont brutalement perdu en viabilité économiques tandis que d’autres qui ont
profité d’un essor économique grâce à de nouveaux débouchés à l’échelle nationale
voire internationale. La disparité entre régions s’en est notablement accrue.
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
59
Le transport entre centres urbains à l’époque d’Edo s’effectuait principalement à
dos d’homme ou de cheval, au mieux par bateau. Dans ces conditions, des marchés
économiques de petite taille pouvaient coexister au sein des provinces. La situation a
radicalement changé à partir de l’ère Meiji avec la construction du chemin de fer. Parce
qu’il transporte de grandes quantités de marchandises en un temps réduit, le rail a pour
effet de baisser considérablement les coûts de transport sur les longues distances, et de
développer la distribution des biens entre régions éloignées. Le bouleversement du
réseau de transport par le rail à l’ère Meiji a agrandi et renforcé le marché national, mais
il annonçait la fin des nombreux marchés intérieurs de taille intermédiaire.
On ne s’étonnera donc pas de ce que le train apparaisse dès le premier récit de Tōno
monogatari, lequel est une présentation géographique de la région. Le train joue ici le
rôle de marqueur de la mécanisation et de la modernité qui émergent dans cette région.
Mais il en est surtout le facteur du déclin économique qui allait la toucher. Alors qu’à
l’époque d’Edo, Tōno était une bourgade faisant figure de centre économique pour les
territoires environnants, la construction à l’ère Meiji de la ligne Nihon-tetsudō – ancêtre
de l’actuelle Tōhoku-honsen –, reliant les deux nouveaux nœuds ferroviaires Morioka et
Hanamaki à Tokyo, a marqué le début de sa stagnation et de son déclin économique en
tant que centre marchand.
Comment dans ces conditions espérer promouvoir le développement économique
dans les régions, s’interroge Yanagita. Il ne pouvait nier le rôle crucial et novateur joué
par le chemin de fer. Pour pallier l’enclavement géographique défavorable de certaines
régions, sa solution passe par l’augmentation du revenu des paysans en agrandissant les
exploitations. Le modèle de gestion qu’il appelle de ses vœux est « l’entreprise
agricole » (nō-kigyō 農企業, Yanagita 1995 : 684). Ce modèle doit permettre aux
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
60
exploitants de toucher de nouveaux marchés par la transition vers un mode de gestion
adapté au capitalisme. Parallèlement, cette évolution dont s’accompagner d’une
« meilleure organisation des marchés » (Yanagita 1999 : 671), à savoir que la vente des
produits devait être tournée prioritairement vers des marchés proches, afin de garantir
des coûts de transport réduits, et donc une offre à bas prix.
Selon le diagnostic de Yanagita, la pauvreté des paysans avait pour origine la taille
trop réduite des exploitations agricoles. La petitesse des parcelles impliquait de faibles
productions, qui réduisaient d’autant les ventes et les profits. Leur mode de production
vivrière, qu’il appelle dans sa terminologie « agriculture mineure » (shō-nō 小農),
restait inexorablement confiné à des transactions en nature et à une production
d’autosuffisance, alors que le reste de la société est déjà entrée dans une économie
capitaliste et fiduciaire. Il s’agissait donc de faire passer les exploitations agricoles
d’une « agriculture mineure » à une « agriculture moyenne » (chū-nō 中農). Yanagita
définissait celle-ci d’un point de vue économique comme toute activité agricole assurant
un profit, comme l’aurait fait une entreprise, et qui peut s’assurer sa taille d’exploitation
rende possible ce type d’activité.
Or, l’application de cet ambitieux programme de réformes, alliant remembrement,
création de véritables exploitations agricoles, promotion de circuits courts, etc., devait
principalement s’appuyer sur les coopératives agricoles. Sans la mutualisation du capital
par les coopératives agricoles, les paysans ne pouvaient pas financer leurs achats de
terres et leur matériel agricole. Malheureusement, les coopératives agricoles japonaises
de l’époque trompèrent les attentes de Yanagita. Le gouvernement favorisait les
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
61
propriétaires terrains et faisait peu de cas des agriculteurs réellement susceptibles de
rester dans les campagnes pour gérer une exploitation agricole82.
Fujii a montré que lorsque Yanagita dissertait sur les associations coopératives, il
avait en tête le précédent anglais des Équitables Pionniers de Rochdale (the Rochdale
Society of Equitable Pioneers). Ce premier modèle de coopérative a vu le jour en
Angleterre au milieu du XIXe siècle sous la forme d’une œuvre d’entraide sociale fondée
par des membres dépourvus initialement de moyens économiques. Yanagita, inspiré par
l’exemple britannique, restait très attaché à l’existence de liens sociaux au sein des
associations coopératives. Le lien social est la clé de voûte de l’esprit d’indépendance et
d’entraide qui doit être, selon lui, présent chez chacun des membres de ces associations.
Or, Yanagita observait que cette éthique d’entraide était déficiente à son époque et que
la paysannerie se pliait de bonne grâce à des relations de subordination qui la liaient aux
gouvernants.
En revanche, Yanagita avait la conviction que l’esprit d’indépendance et d’entraide
avait été plus vivace à l’époque d’Edo où les communautés villageoises jouissaient
d’une forme d’autonomie, pour décider des moyens de payer l’impôt notamment. Dans
le traité Nōgyō seisaku, cet état d’esprit que Yanagita enviait aux paysans de l’époque
d’Edo est désigné par l’expression « solidarité entre gens du pays » (kyōtō no konshin
郷党ノ懇親). Dans la mesure où cet esprit de solidarité fonctionnait principalement au
niveau de l’unité villageoise, le passage au niveau national posait problème, comme
l’explique Fujii T. :
82 La pensée économique des principaux acteurs de ces débats diffère de celle de Yanagita, qui occupe une place originale et par conséquent difficilement tenable au sein des rapports de force qui se dessinaient les différents acteurs. Cf. KAWADA Minoru, op. cit.
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
62
Il fallait donc que le commis de l’État qu’était Yanagita arrive à étendre cette éthique de village aux dimensions d’une éthique nationale. Le mode de vie des paysans d’Edo avait déjà disparu en 1910. Il n’en substituait plus que des « survivances » [zanson 残存] dans quelques régions reculées. Or Tōno était l’une d’entre elles.
Le lecteur de Tōno monogatari est appelé à y retrouver un mode de vie fondé sur
des relations « horizontales » entre les membres de la communauté, et en cela
fondamentalement opposé et donc réfractaire, fait remarquer Fujii, au modèle sociétal
patriarcal que tentait d’imposer l’État de Meiji à toute la société japonaise, lequel
entend la gérer selon les normes éthiques « verticales » édictées par le Rescrit sur
l’éducation.
Comme on le voit, l’aspect éthique, au sens de « civilisationnel », est central dans
la démarche économique de Yanagita. Ce dernier n’est d’ailleurs pas le seul à percevoir
un lien entre agronomie et éthique. La plupart des penseurs de cette époque, et pas
seulement au Japon, fondent leur réflexion économique sur un point de vue
philosophique ou éthique. Il convient en tout cas de relever que toute la pensée de
Yanagita en tant que spécialiste de politique agronomique tend à fonder un projet
sociétal alternatif, alliant modernité et héritage culturel du passé, où chaque membre,
par la prise de conscience des liens sociétaux qui le relient à autrui, voit son
indépendance assurée et ses droits reconnus. La philosophe politique de Yanagita est
déjà complètement définie et ne changera pas sur le fond avec le temps. Elle repose
moins sur des droits constitutionnellement définis que sur une démarche herméneutique
utilisant les outils des sciences humaines alors en gestation.
Toutefois, comme nous l’évoquions dans le chapitre précédent de problématisation
générale de l’œuvre de Yanagita, il existe un saut entre théorie et pratique. Cette tension
entre la philosophie de Yanagita et son engagement concret est indispensable à
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
63
interroger, tant pour éviter de dresser un portrait laudateur, que pour saisir l’articulation
de l’un à l’autre. Les intellectuels de cette époque ont tous été confrontés d’une façon
ou d’une autre à des choix difficiles par rapport à l’appareil d’État. Fujii T. met en
valeur l’indépendance d’esprit et le positionnement intellectuel original de Yanagita en
matière de politique économique. Mais il ne saurait y avoir d’analyse d’ensemble
pertinente sur la pensée politique de Yanagita sans examiner de quelle façon il s’est
effectivement impliqué dans les questions politiques de son temps. Le sujet est
particulièrement vaste. On pense en particulier à la question de la colonisation dont il ne
sera que peu question ici. Mais, il nous semble utile de présenter une analyse en
contrepoint à celle de Fujii, en nous appuyant sur les thèses particulièrement critiques
d’Iwata Shigenori sur le positionnement politique de Yanagita83.
2. Le positionnement politique de Yanagita
Les trois événements évoqués dans cette section – le voyage de Yanagita à Kyūshū
durant l’été 1908, l’affaire dite de « haute trahison » de 1910-1911 et le débat sur
l’histoire officielle qui voit Kita Sadakichi être censuré en 1911 – concernent Yanagita à
des degrés très divers. Par ailleurs, chronologiquement, ils n’interviennent pas tous en
amont de la rédaction de Tōno monogatari. Leur intérêt pourtant est de permettre
d’éclairer comment concrètement Yanagita se positionne à cette époque par rapport aux
acteurs politiques ou au fait politique en général.
83 La section suivante ainsi que la première partie du chapitre suivant s’appuient principalement sur l’article d’Iwata Shigenori, opus cite.
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
64
Le voyage de Kyūshū et le déplacement focal vers la montagne
Du 24 mai au 22 août 1908, Yanagita entreprend un voyage de près de trois mois
sur l’île de Kyūshū dans le cadre de son travail d’inspection en province. Arrivé à
Kyūshū par le département de Fukuoka, il traverse les départements de Kumamoto et de
Kagoshima avant d’aboutir à celui de Miyazaki. Au retour, il passe par Oita pour
rejoindre le département de Hiroshima.
Ce voyage autour de l’île de Kyūshū lui fournit l’occasion de constater l’essor de la
civilisation moderne dans les plaines, celles du nord Kyūshū en l’occurrence, qui est en
pleine expansion après la guerre contre la Russie. Les observations notées par Yanagita
au fil des étapes sont publiées dans le journal Shimin 斯民 (Cette nation), organe
officiel de l’Association Hōtoku-kai 報徳会 (renommée par la suite Chūō-hōtoku-kai
中央報徳会). Le texte le plus long de cette série de relations de voyage est intitulé
« Kyūshū-nanbu-chihō no minfū » 九州南部地方の民風 (« Mœurs populaires dans le
sud de Kyūshū », n° 4-1, avril 1909), et donne une idée assez précise de ce qui a frappé
Yanagita. Le premier passage intéressant concerne les fonderies nationales de Yahata
fondées en 1901 et les mines de charbon de Chikuhō, deux sites industriels du nord de
l’île :
L’acier et la houille règnent en maître dans le nord de Fukuoka. Tout ce que la civilisation moderne compte d’adeptes y converge.
La rapide industrialisation dans les plaines de Kyūshū frappe et trouble Yanagita. À
ses yeux, cette civilisation moderne, loin de présenter un quelconque attrait, prend la
forme d’un capharnaüm sans limite. Dans le même texte, il rapporte ainsi ses
impressions sur Taraki dans le département de Kumamoto, et sur le département de
Miyazaki.
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
65
Dans l’agglomération de Taraki, des routes de bien dix ken [20 mètres environ] de large ont été tracées, dont les deux côtés sont flanqués de grandes bâtisses avec des barreaux et des rideaux bleus en façade, tout à fait dans le goût de ces nouvelles zones de développement. (...) Miyazaki également est une de ces nouvelles zones de développement. On n’y entend plus de dialecte local, mais un mélange de toutes les langues.
Ces lignes laissent apparaître une aversion certaine pour la civilisation moderne des
plaines. La découverte de la réalité des transformations économiques en cours dans les
plaines du nord de Kyūshū l’amène à réprouver ce modèle de développement mené à
marche forcée par les élites du pays.
Inversement, l’univers de la montagne est paré de toutes les vertus. C’est durant son
périple qu’il découvre le village de Shiiba 椎葉, situé dans le département de Miyazaki
à fond de vallée, où il séjourne volontairement pendant plus d’une semaine à partir du
13 juillet. Il y recueille d’anciennes histoires de chasse que lui content les anciens, et qui
lui fourniront la matière de l’ouvrage Nochi no kari kotoba no ki 後狩詞記 (Notes
postérieures sur les mots de chasse), publié en mars 1909 à compte d’auteur comme
Tôno monogatari84. Ce tout premier « livre » d’ethnologie de Yanagita85 compile les
codes et les récits de chasse locaux que le maire du village, Nakase Jun 中瀬淳 (1865-
1950), mettra par écrit et enverra à Yanagita à la demande de ce dernier rentré à la
capitale.
84 Sur les caractéristiques communes aux trois ouvrages, Tōno monogatari, Ishigami mondō et Nochi no kari kotoba no ki, voir infra, p.80 85 Alors que certains auteurs décrivent cette expérience comme le premier terrain ethnographique mené par Yanagita, les plus critiques, dont Iwata S., font remarquer qu’en réalité il s’agit du seul terrain que Yanagita ait jamais effectué par lui-même. Si l’on met de côté l’enquête de terrain menée en /// dans la campagne de Yokohama avec les chercheurs du groupe Kyôdo kenkyû-kai, ses innombrables voyages à travers le Japon ont produit moins des descriptions ethnographiques proprement dites que des récits de voyage. Il est pourtant vrai que Yanagita était un observateur hors pair et qu’il espérait avant tout à mettre au point une méthodologie par laquelle les Japonais pourraient rendre compte de leur culture par eux-mêmes.
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
66
Durant son séjour dans le village de Shiiba, parallèlement à ce travail
ethnographique sur des matériaux qu’il juge de la première importance, Yanagita
observe la répartition des parcelles communes qu’il juge plus avantageuse pour les
pauvres que pour les riches. Il en tire la conclusion à caractère politique,
particulièrement intéressante, qui se trouve dans le rapport précité « Kyūshū-nanbu-
chihō no minfū » :
Au regard de cette répartition des parcelles communes, on constate que ce village de montagnes a déjà réalisé l’idéal socialiste d’égalité des richesses. Voilà l’utopie [ユートピア] devenue réalité, un vrai miracle. Mais les habitants n’ont pas pour autant cherché à mettre en pratique un idéal haut placé. Leur manière de penser la propriété terrienne diffère totalement de celle qu’on rencontre dans nos plaines. C’est sans complication aucune que cette méthode de répartition est appliquée.
Quoi que l’on puisse penser de la justesse d’analyse de Yanagita sur l’adéquation
de la répartition des parcelles communes dans ce village avec les thèses socialistes86, on
doit s’arrêter sur la vision idéalisée voire sublimée de l’univers de la montagne qui se
révèle ici.
D’une part, cet univers est à l’exact opposé de la vision cauchemardesque que
Yanagita découvre dans les plaines du nord de l’île de Kyûshû. Durant le même voyage
et donc dans le même cadre particulier de ce rejet de l’industrialisation à outrance, les
régions montagneuses s’imposent dans l’esprit de Yanagita comme l’archétype de la
culture japonaise87.
D’autre part, ce passage illustre clairement le point de vue de Yanagita sur le
socialisme. Ce choix politique, jugé alors extrêmement radical voire dangereux pour les
86 Cf. Iwata Shigenori, op. cit. 87 Voir infra, p. 75
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
67
cercles du pouvoir où évoluait Yanagita, semble tout simplement inutile suite d’après
les observations qu’il a pu recueillir dans le village de Shiiba. On comprend facilement
son enthousiasme. Telle est bien la nature du « miracle » dont il est question.
L’« utopie » est déjà réalisée, il suffit d’aller sur le terrain pour s’en rendre compte.
Toute l’ambiguïté de Yanagita face aux thèses socialistes (nous incluons ici la pensée
marxiste et communiste) est ici bien résumée : sympathie pour leurs idéaux égalitaires,
mais rejet fondamental de leur pertinence car elles lui paraissent fondamentalement
inutiles88.
Comme nous l’avons dit, Yanagita lie la politique à une réflexion culturelle sur
l’éthique « horizontale » des paysans. Ce type d’approche l’a constamment fait
percevoir comme un intellectuel « libéral » (au sens anglo-saxon du terme) mais qui se
serait à la fois « conservateur ». En effet, le revers de la médaille se révèle dans ce
passage. Son approche tend potentiellement à invalider tout recours à des moyens plus
radicaux de politique économique ou sociale. Autrement dit, le déplacement spatial de
la plaine vers l’univers de la montagne se dédouble d’un déplacement épistémologique
du politique vers le champ de l’anthropologie.
Au terme de ce processus de déplacement, le politique ne risque-t-il pas de
disparaître purement et simplement dans le champ anthropologique, redéfini et fondu en
lui ? Se trouvent ici en question sa cohérence voire son honnêteté intellectuelle89. Pour
88 Pour plus d’informations en français sur le rapport qu’entretenait Yanagita avec le marxisme et les marxistes, voir Fujii T., op. cit. Concernant ce qui différencie Yanagita des thèses communistes, voir FUJII Takashi藤井隆至, Yanagita Kunio ‘sangyō kumiai’ to ‘Tōno monogatari’ no aida 柳田国男 「産業組合」と「遠野物語」のあいだ, Tokyo : Nihon keizai hyōron-sha 日本経済評論社, 2008. 89 Ses chaussettes blanches (tabi) qu’il portait en toute occasion, caractéristique des classes supérieures, est un détail immanquablement cité pour illustrer la distance qu’il gardait avec les paysans qui eux n’en portaient pas, en dépit de ses discours sur la culture populaire. Cf. Funabiki. Le portrait dressé par Kuwabara Takeo montrant que Yanagita pouvait à l’occasion faire preuve d’un sens tactique proche de la roublardise pour arriver à ses fins s’inscrirait sans doute dans la ligne de cette analyse.
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
68
reprendre notre problématique épistémologique, nous dirons que se manifeste avant tout
l’écart – peut-être inévitable, en tout cas intéressant à analyser – entre théorie et pratique
dans un contexte historique de fortes tensions politiques.
L’affaire de « haute trahison » du point de vue de Yanagita
En 1908, le Premier ministre Katsura Tarō 桂太郎 (1848-1913) forme son
deuxième cabinet dans lequel le clan Yamagata Aritomo 山県有朋 (1838-1922) et les
proches de Katsura se partagent les postes. À partir du mois de juin 1910, l’exécutif fait
arrêter dans tout le pays des socialistes et des anarchistes soupçonnés d’avoir participé à
un complot contre l’empereur Mutsuhito. C’est le début de l’affaire dite de « haute
trahison » (taigyaku jiken 大逆事件, ou appelée aussi « affaire Kōtoku », Kōtoku jiken
幸徳事件). Nous savons aujourd’hui que le meneur présumé du complot, Kōtoku
Shūsui 幸徳秋水 (1871-1911), avait simplement été tenu informé des plans, et que
seuls Miyashita Takichi宮下太吉 (1875-1911), Kanno Suga管野スガ (1881-1911),
Niimura Tadao新村忠雄 (1887-1911) et Furukawa Rikisaku古河力作 (1884-1911)
ont réellement projeté d’assassiner l’empereur. Si les craintes du pouvoir n’étaient donc
pas totalement infondées, tout indique que l’affaire de haute trahison a été en large
mesure récupérée par l’exécutif, et qu’en dehors des quatre noms cités plus haut, les
autres accusés ont été victimes d’une erreur judiciaire. Par ailleurs, en août de la même
année, le Japon annexe la Corée, imposant définitivement sa mainmise coloniale sur la
péninsule. Yanagita, alors haut fonctionnaire rattaché au Service juridique (hōseikyoku
sanjikan 法制局参事官), participe à la rédaction des ordonnances qui font suite à
l’annexion de la Corée, travail qui lui vaut en juin 1911 d’être décoré de la 5e classe de
l’ordre du Trésor sacré.
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
69
L’affaire de haute trahison est jugée par la Cour Suprême, qui fait connaître son
verdict en janvier 1911. Vingt-quatre accusés sont condamnés à mort (dont douze
verront leur peine commuée en prison à perpétuité), deux autres sont condamnée à des
peines de prison. Les douze condamnés à mort, qui comptent Kōtoku Shūsui et Kanno
Suga, sont exécutés par pendaison une semaine seulement après le verdict. Le
gouvernement impérial a éliminé manu militari les fauteurs de trouble. Il faudra
longtemps à la mouvance socialiste pour se remettre de ce coup90.
Dans l’état actuel de nos connaissances, il semblerait que Yanagita n’ait jamais
commenté ou mentionné l’affaire de la haute trahison. Comme l’ont déjà fait remarquer
Hashikawa Bunzō, Irokawa Daikichi et Saeki Arikiyo佐伯有清 (1925-2005), Yanagita
a gardé le silence tout au long de cette affaire. Mais si l’on tient compte du fait qu’il a
participé activement à la politique d’annexion de la Corée en tant que haut
fonctionnaire, et qu’il était alors supposé faire partie du clan Yamagata – son frère aîné,
poète et médecin, était un proche de Yamagata Arimoto et de Mori Ōgai –, on peut
présumer que Yanagita connaissait, au moins partiellement, la nature véritable de cette
affaire.
Son silence n’est en rien la manifestation d’un désintérêt pour la politique en
général ou les questions de lutte de classe en particulier. Au contraire, comme nous
venons de le voir, Yanagita écrit un rapport après son voyage à Kyūshū durant l’été
90 Le socialiste Arahata Kanson, qui a échappé aux soupçons parce qu’il se trouvait déjà en prison pour un autre délit depuis 1908 (« affaire du drapeau rouge »), a raconté par la suite combien la répression policière avait été démesurée, au point de s’attaquer non seulement aux socialistes, mais à tout ce qui de prêt ou de loin pouvait y ressembler : « Nous (disait Arahata Kanson) étions constamment suivis, bien entendu. Il y a une histoire très connue. Un ouvrage scientifique intitulé La société des insectes a été soupçonné d’être tendancieux et finalement interdit à la vente parce que son titre comprenait le mot “société”. Une autre fois, la police a fait toute une histoire lorsqu’elle a appris l’existence d’une association appelée Pan créée par des écrivains du journal Subaru. Les policiers, qui ne connaissaient visiblement pas le mythe grec du berger à la flûte, étaient persuadés que Pan voulait dire “pain” et se sont demandé ce que cela pouvait bien cacher. » Cité dans Iwata, opus cite.
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
70
1908 (« Kyūshū-nanbu-chihō no minfū », avril 1909) où il est explicitement question
de la réalisation de « l’idéal socialiste d’égalité des richesses » dans la répartition des
parcelles communes au sein du village de Shiiba qu’il a visité. Par ailleurs, la revue
Shimin dans laquelle il publie le texte en question n’est autre que l’organe officiel de
l’association Hōtoku-kai dont les membres sont pour la plupart des fonctionnaires des
clans Yamagata et Katsura. Yanagita exprime ainsi un propos idéaliste faisant référence
à des thèses socialistes, aux yeux mêmes de ceux qui ont orchestré la récupération
politique de l’affaire de la haute trahison.
Quand bien même Yanagita, fonctionnaire d’État, aurait été un chaud partisan des
réformes brutales de société, le risque n’est pas moins grand pour lui, à une époque où
la manipulation politique peut prendre les proportions que l’on a vues et où la
répression a la main lourde, que cette terminologie socialiste soit mal interprétée91.
Yanagita prenait-il alors des risques inconsidérés ? Comme le souligne Fujii
Takashi à propos du conflit qui l’avait opposé à son supérieur Sakō Tsuneaki au
ministère de l’Agriculture et du Commerce, Yanagita ne se gênait pas pour faire
connaître son opinion quand il pouvait le faire92. Mais Yanagita savait trouver la bonne
distance par rapport à l’appareil répressif pour éviter d’en faire les frais. L’historien
américain J. V. Koschman explique ce qui pourrait passer pour un paradoxe en
rappelant qu’il était relativement fréquent parmi les hauts fonctionnaires de l’époque
d’avoir un sens de l’État qui les poussait à l’occasion à s’opposer à leur hiérarchie au
nom de l’intérêt commun ou d’une certaine idée du processus de modernisation qu’ils
estimaient bon pour leur pays. Yanagita ne faisait pas exception93. L’analyse de la 91 Iwata, opus cite. 92 Fujii Takahsi, op.cit.. 93 KOSCHMANN J. Victor, « Folklore Studies and the Conservative Anti-Establishment in Modern Japan », in J. Victor Koschmann, Keibō Ōiwa et Shinji Yamashita (dir.), International perspectives on
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
71
pensée politique de Yanagita, au sens le plus large du terme, doit donc prendre en
compte ce positionnement complexe où silence ne signifie pas nécessairement accord
ou ignorance des enjeux d’actualité. L’ethnologie apparaît de plus en plus à Yanagita
comme une alternative aux dérives d’un système qu’il connaît de l’intérieur.
Débat sur l’histoire officielle et Kita Sadakichi
La relation qu’a nouée Yanagita avec l’historien Kita Sadakichi 喜田貞吉 (1871-
1939), qui subira les foudres du pouvoir suite aux débats sur les cours du Nord et du
Sud est une autre illustration de l’attitude de Yanagita.
Un mois seulement après la pendaison de Kōtoku et de ses compagnons en janvier
1911 débute une autre affaire touchant l’empereur : la question de la révision de
l’histoire officielle sur la période des cours du nord et du sud. Les manuels scolaires,
dont Kita Sadakichi avait en charge la rédaction, avaient eu le tort de traiter la période
sans prendre parti pour l’une ou l’autre des deux cours. Le ministère de l’Éducation
décide finalement de suspendre Kita de ses fonctions. Les manuels d’histoire
indiqueront par la suite que la cour du sud est bien la seule légitime. La liberté
d’opinion dans le domaine du savoir a été muselée parce qu’on portait atteinte à la
légitimité impériale.
Yanagita entretenait jusque-là une relation plutôt amicale avec Kita. Le 15 mars
1908, lors d’une rencontre placée sous les auspices de l’Association Hōtoku, Yanagita
assiste à une conférence donnée par Kita. Celle-ci, intitulée Tokushu-buraku no kaizen
特殊部落の改善 (Amélioration des villages spéciaux [des burakumin]), donne lieu à
Yanagita Kunio and Japanese folklore studies, Ithaca, NY, Cornell University East Asia Program, 1985, p. 131164.
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
72
un débat entre les deux hommes. À Kita pour qui les burakumin « ne différent en rien
racialement aujourd’hui » des autres Japonais, Yanagita répond qu’au contraire, « il les
considère totalement différents ». De même, dans une lettre datée du 13 décembre 1909,
qui sera par la suite intégrée à l’ouvrage Ishigami mondō94, Yanagita fait part à Kita de
ses critiques à propos d’un de ses articles « Kōgo-ishi to wa nanizoya » 神籠石とは何
ぞや (« Que sont les pierres abritant des divinités ? »), paru dans la revue fondée par
Kita Rekishi to chirigaku 歴史と地理学 (Histoire et géographie, vol. 4 no 5, mars
1902). Dans la même revue, Kita fait paraître cette lettre de Yanagita sous le titre
« Kogō-ishi ni kansuru chimei » 神籠石に関する地名 (« Noms de lieu en rapport avec
les pierres abritant des divinités », vol. 15 no 3, mars 1910). Cet enchaînement montre la
fréquence et la franchise de leurs échanges dans les années précédant la parution de
Tôno monogatari95.
Après l’affaire de la révision de l’histoire officielle, les recherches de Kita
continuent de partager de nombreux thèmes communs avec les études folkloristiques de
Yanagita – et qui sont d’ailleurs toujours d’actualité pour les recherches ethnologique
contemporaines – , comme par exemple la discrimination vis-à-vis des burakumin, les
populations errantes, les personnes possédées par des êtres surnaturels, les divinités du
bonheur, les divinités liées à la sériciculture (oshiragami オシラ神), ou encore les
cimetières. Cependant Yanagita et Kita, dans les années qui suivent cette affaire, ne
coopéreront plus dans leurs travaux, bien que leurs thématiques se recoupent souvent.
Leurs rares échanges prennent plus volontiers la forme de critiques réciproques. Enfin,
Yanagita, comme dans le cas de l’affaire de la haute trahison, n’a fait aucun
94石神問答 (Questions et réponses sur le culte des pierres, mai 1910, Shūseidō 聚精堂). Voir infra, p. 80. 95 On notera par ailleurs combien les travaux de Yanagita étaient en pointe à l’époque dans le domaine des recherches historiques.
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
73
commentaire sur l’affaire provoquée par les manuels scolaires de Kita. Une certaine
distance semble séparer les deux hommes.
Dans ses propos ou dans ses actes, Yanagita n’a donc pas été sans rapport avec le
socialisme, réprimé à la suite de l’affaire de la haute trahison, ou avec l’auteur d’une
vision de l’histoire qui a subit la censure, Kita Sadakichi. Lors des deux affaires,
Yanagita est, pourrait-on dire, situé aux premières loges. Mais en 1910 comme en 1911,
il se garde de réagir, son silence est complet. Tout laisserait penser que ces événements
n’ont jamais concerné Yanagita. Encore une fois, pour comprendre cette attitude vis-à-
vis des évènements à caractère politique qui marquent cette époque et qui touchent
jusqu’aux acteurs les plus imminents des milieux académiques, les travaux
ethnographiques de Yanagita doivent être lus comme la véritable expression politique
de cet auteur, au sens de transposition vers des solutions heuristiques s’inscrivant dans
les sciences humaines à des problèmes politiques qui pesaient très spécifiquement sur le
Japon dans les années 1905-1910.
Les travaux de Yanagita dans le champ anthropologique font figure de miroir
déformant de ses vues en matière politique, et inversement. Le passage de l’un à l’autre
est constant, en dépit de ses silences et de ses précautions pour laisser croire le
contraire.
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
74
IV. Le champ anthropologique
1. La thèse des yamabito
Nochi no kari kotoba no ki et les populations des montagnes
Le voyage de trois mois qu’entreprend Yanagita dans l’île de Kyūshū du 24 mai au
22 août 1908 a servi de matrice à son ouvrage Nochi no kari kotoba no ki 後狩詞記
(Notes postérieures sur les mots de chasse) paru en mars 1909. Ce tout premier « livre »
de Yanagita dans le champ de l’anthropologie96 est publié à compte d’auteur par
Yanagita, comme par la suite Ishigami mondō en mai 1910 et Tōno monogatari en juin
1910.
Contrairement à l’agronomie, sa formation d’origine, qui se focalisait sur la
paysannerie des plaines, ses premiers travaux dans le champ anthropologique portent
sur les populations vivant dans les espaces montagneux. Ce tournant s’explique, comme
nous l’avons vu, par un sentiment d’urgence des problèmes liés à la modernisation
rapide de la société japonaise après la guerre russo-japonaise.
Dans son rapport intitulé « Kyūshū-nanbu-chihō no minfū », que nous avons déjà
cité, le développement de la civilisation moderne dans les plaines est opposé à l’univers
de la montagne dans lequel il entend retrouver l’archétype de la culture japonaise. Il
formule ainsi son analyse.
Les populations qui possédaient une forme de pensée archaïque, typiquement japonaise, ont été progressivement repoussées dans les montagnes par les gens des plaines, de sorte que l’ancienne mentalité nipponne a de nos jours peu ou prou disparu des basses terres. J’estime donc que quiconque veut savoir ce qu’est l’esprit
96 Parler de son premier recueil ?
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
75
japonais doit d’abord entreprendre des observations sur les mentalités des populations vivant dans les hautes terres.
À partir de cette époque, Yanagita est convaincu que le sujet qu’il faut étudier en
priorité n’est pas le mode de vie dans les plaines, leurs habitants étant trop prompts à
prendre en marche le train de l’histoire, mais les « populations vivant dans les hautes
terres » (sanchi-jinmin 山地人民, ou sanmin 山民).
Enfin, Yanagita s’est mis à rechercher dans les régions montagneuses ce qui
pourrait être l’archétype idéal de la « nation du Yamato », à savoir ce qui constitue la
base de son mode de vie. En l’occurrence, il est convaincu qu’il s’agit du riz. La même
année que les Nochi no kari kotoba no ki, il publie en novembre 1909 un texte intitulé
« Sanmin no seikatsu » 山民の生活 («La vie des populations dans les hautes terres»)97,
dans lequel il met en parallèle les deux principaux modes de production agricole
présents chez ces populations, à savoir la culture sur brûlis et la riziculture. Il aboutit à
la conclusion que le riz, élément indispensable du ritualisme selon lui, a de tout temps
joué un rôle central pour la « nation du Yamato ».
La culture sur brûlis comme moyen de subsistance n’est en rien une caractéristique de la nation du Yamato. Aussi faut-‐il plutôt rechercher dans la riziculture les traces des conditions de vie de nos premiers ancêtres. (...) La capacité qu’avaient nos ancêtres à s’implanter dans de nouveaux territoires était tout à fait remarquable mais se trouvait clairement limitée par une condition. Ils se seraient montré prêts à s’installer à flanc de montagne. Ils pouvaient aussi bien se nourrir de millet ou de panic. Mais seul le riz, dédié aux divinités, n’aurait pu faire défaut. (...) Que cela soit sous la forme des gâteaux de riz ou d’alcools offerts aux divinités, produits à partir du riz, il leur fallait qu’une surface agricole, aussi réduite soit-‐elle, soit consacrée à la riziculture pour pouvoir accomplir ces offrandes. L’existence d’une surface potentiellement
97 Il s’agit d’une conférence donnée par Yanagita au club d’alpinisme de l’Université de Keiō.
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
76
utilisable pour la riziculture constituait bien la condition indispensable à la création d’un nouveau village. 98
Le riz, et ce dès les premières études de Yanagita, n’est donc pas considéré comme
un simple aliment, mais comme une production au service du ritualisme de la « nation
du Yamato ».
Les yamabito, le peuple des montagnes
Les études folkloristiques de Yanagita reconnaissent également l’existence, dans
l’univers de la montagne, d’un autre type d’habitants que les « populations vivants dans
les hautes terres » (sanmin 山民), lesquelles font encore partie de la « nation du
Yamato ». Il s’agit des yamabito 山人, terme que l’on peut traduire par « hommes »
/ « êtres » / « populations » / « peuple » des montagnes. Ceux-ci descendraient des
populations autochtones présentes dans l’archipel avant l’arrivée de la « nation du
Yamato » et soumises par lui. Le passage suivant, extrait de « Tengu no hanashi » 天狗
の話 (« Histoires de tengu»), publié en mars 1909, la même année encore que Nochi no
kari kotoba no ki, les présente ainsi.
Les montagnes de nos provinces abritent encore, à notre époque même, une race qui n’a aucun lien avec nous autres Japonais. (...) Dans ces montagnes reculées, vivent encore, et en grand nombre d’après ce que l’on peut en juger, les membres d’une peuplade dont la présence précédait la conquête par Jinmu de l’est du pays. Pourchassés et rejetés au fil du temps par nous, finalement contraints depuis fort longtemps à vivre cachés, ils nourrissent envers les nouveaux arrivants civilisés une peur et une haine qu’on aurait peine à décrire, se refusant encore à nouer toute relation.
98 Cité dans Iwata, opus cité, p. …
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
77
D’après Yanagita, la « nation du Yamato » (« nous autres Japonais ») aurait soumis
les yamabito, « peuplade » (banmin 蛮民) autochtone présent sur l’archipel avant « la
conquête par Jinmu de l’est du pays » (Jinmu tōsei 神武東征), et les aurait repoussés au
fin fond des montagnes. Le point important ici est que la pensée de Yanagita et
l’approche de ses études folkloristiques prend la forme d’une théorie sur les origines de
la nation sur l’archipel japonais. Pour lui, il ne fait aucun doute que la nation japonaise
est le résultat du métissage du peuple des montagnes, yamabito, descendants des
autochtones, et de leurs conquérants, la « nation du Yamato ».
L’année suivante, en 1910, paraissent les deux ouvrages les plus représentatifs de la
première période des études folkloristiques japonaises, Ishigami mondō 石神問答
(Questions et réponses sur le culte des pierres, mai 1910, Shūseidō 聚精堂), et Tōno
monogatari (juin 1910). Dans Ishigami mondō, Yanagita, se fondant sur des études
détaillées de pierres marquant les frontières des villages, formule l’hypothèse que les
divinités des limites permettent de poser une frontière spatiale entre populations de type
« nation du Yamato » et celles de type autochtone. De même, dans Tōno monogatari, il
rapporte des légendes qui dépeignent les yamabito comme des êtres redoutables pour la
« nation du Yamato », laquelle correspond aux « populations des plaines » (heichijin 平
地人) selon ses termes. Par ailleurs, en mars, avril, août, septembre 1913, et en février
1917, Yanagita fait paraître dans la revue Kyōdo kenkyū 郷土研究 (Études sur les
terroirs) une série de travaux sur les yamabito intitulée « Sanjin gaiden shiryō » 山人外
伝資料 (« Documents apocryphes sur le peuple des montagnes», vol. 1 no 1, 2, 6 et 7 ;
vol. 4 no 11). Cette série d’articles, qui porte par ailleurs comme sous-titre « Yama-
otoko yama-onna yama-take yama-uba yama-waro yama-hime no hanashi » 山男山女
山丈山姥山童山姫の話 (« Histoires sur la montagne et ses ogres et ogresses, vieux et
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
78
vieilles, lutins et princesses »), tente d’établir, sur la base d’une abondante
documentation, que les yamabito, descendants des autochtones qui auraient fui dans les
montagnes pour échapper à la domination de la « nation du Yamato », existent encore à
l’époque de Yanagita.
Les idées de Yanagita arriveront à maturation dans les années qui suivent la
parution de Tōno monogatari. Le 18 novembre 1917, à la demande de l’historien Kita
Sadakichi, Yanagita fait une communication lors des 100es rencontres de la Société
japonaise d’histoire et de géographie (Rekishi chiri gakkai 歴史地理学会). Son exposé
intitulé « Yamabito ni tsukite » 山人に就きて (« À propos du peuple des montagnes »)
soutient la thèse que la nation japonaise est composite, la « nation du Yamato » n’en
étant qu’une des composantes, et que l’empereur, figure centrale de la « nation du
Yamato », est d’origine extérieure à l’archipel. Cette communication marque
véritablement le point d’arrivée de ses recherches sur les yamabito. Citons en ici le
début.
Pour certains, les preuves selon lesquelles la Nation japonaise n’est pas formée d’une mais de plusieurs races n’ont pas encore été fermement réunies. Mais nos études ont déjà formellement établi ce point, et nous comptons nous inspirer de ce résultat pour poursuivre nos recherches. (...) Les récits nous rapportent que lorsque les Ancêtres de notre Très Illustre Empereur sont parvenus sur les îles du Japon, plusieurs populations autochtones y étaient déjà établies. Les anciennes chroniques les nommaient alors “divinités du pays”.
Yanagita explique ensuite que la lignée impériale, identifiée aux « divinités du
ciel » (amatukami 天つ神), aurait soumis les autochtones, les « divinités du pays »
(kunitsukami 国つ神), qui se serait réfugiés dans les montagnes, pour devenir avec le
temps les yamabito. Mais si Yanagita repose le problème de la composition de la nation
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
79
japonaise, il considère que le premier représentant de la « nation du Yamato », dès
l’époque la plus lointaine de l’histoire japonaise, était un ancêtre de l’empereur actuel,
déjà chef suprême du pays. En d’autres termes, tout en affirmant la disparité du
peuplement japonais, Yanagita et ses études maintiennent un rapport de dominants à
dominés entre la « nation du Yamato » et les yamabito. On retiendra enfin que Yanagita
a préféré garder cet exposé par devers lui, sous la forme de notes. Il ne le fera imprimer
qu’une dizaine d’année plus tard, sous le titre « Yamabito-kō » 山人考 (« Réflexions
sur le peuple des montagnes ») dans le recueil Yama no jinsei 山の人生 (La vie des
montagnes, 1926, Kyōdo kenkyū sha), en même temps que le texte « Yama no
seikatsu » 山の生活 (« Mode de vie des montagnes »).
Kita Sadakichi et Yanagita Kunio, que le premier avait invité à participer à la
conférence de 1917, partageaient alors à peu près le même point de vue sur la diversité
des origines de la nation de l’archipel japonais. Kita publie en janvier 1919, dans le
premier numéro de la revue qu’il vient de fonder, Minzoku to rekishi 民族と歴史
(Nations et histoire), un article éditorial nommé « Yamato minzoku to wa nani zoya :
yamato minzoku no gainen o ronzu » 「日本民族」とは何ぞやー日本民族の概念を
論ずー (« Nation japonaise ou nation du Yamato : Critique du concept de « nation du
Yamato »). Il y défend le point de vue que la nation japonaise, réduite généralement à la
« nation du Yamato » au point que l’on accole couramment aux caractères 日本 la
lecture « yamato » やまと, est en fait d’origines multiples, résultat du métissage d’un
nation se proclamant d’ascendance céleste et de populations autochtones anciennement
connus sous le terme de « divinités du pays » (kunitsukami国つ神). Cette thèse avait
déjà été présentée par Kita le 19 juin 1917 lors des 96èmes rencontres de la Société
japonaise d’histoire et de géographie consacrées au thème « Nation d’ascendance
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
80
céleste et nation du Yamato », soit donc six mois environ avant la communication faite
par Yanagita.
Cependant, les approches de Yanagita et de Kita vont peu à peu diverger. Alors que
Yanagita se tournera vers l’étude du monde agricole, qu’il appréhendera à travers le
concept de « peuple ordinaire » (jōmin 常民), Kita développera une problématique
propre pour réfléchir sur les phénomènes de discrimination. Les deux hommes, que les
mêmes préoccupations avaient un temps réuni, emprunteront par la suite des voies
sensiblement différentes.
Les suites de la théorie sur les yamabito dans les études folkloristiques
On constate un changement dans les réflexions de Yanagita sur les yamabito après
le texte « Yamabito-kō », qui reprend son exposé « Yamabito ni tsukite » du 18
novembre 1917 et qui ne sera publié qu’en 1926 dans Yama no jinsei. Dans ce texte, il
considérait encore les yamabito comme des éléments centraux de l’histoire du
peuplement japonais et, par voie de conséquence, de la culture japonaise. Par la suite, ils
n’intéresseront plus directement les études folkloristiques de Yanagita. Lorsqu’il fait
encore appel à eux, Yanagita ne les dépeint plus désormais qu’à travers le regard de la
« nation du Yamato ». Les yamabito ne constituent plus dès lors un objet d’étude en soi,
mais une forme de « chimère »99 construite à partir du point de vue du « nation du
Yamato ». Un exemple de ce type d’approche est fournit par le texte « Yamamba
kibun » 山姥奇聞 (« Anecdotes étranges sur les vieilles des montagnes »), écrit en
janvier 1926, soit dix ans après « Yamabito-kō » (« Réflexions sur le peuple des
montagnes »).
99 Le mot est d’Iwata Shigenori, et nous sommes tout à fait pertinent, op.cit.
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
81
Si l’on considère que des hommes aux mœurs différentes, d’implantation antérieure à l’arrivée de la nation du Yamato, ont pu survivre cachés dans des endroits retirés, il ne fait alors aucun doute que leur descendance vit éparpillée sur le territoire. Le problème réside plutôt dans le fait de savoir pourquoi les habitants des terres en contrebas, détenteurs d’une civilisation bien supérieure, ont éprouvé à leur endroit une crainte révérencielle, au point de les regarder comme des demi-‐dieux.
L’objet central des recherches de Yanagita est en fait passé du « peuple des
montagnes » à la « nation du Yamato » habitant en priorité les basses terres.
La série d’articles intitulés « Yama no jinsei » 山の人生 (« La vie des
montagnes ») publiés entre les mois de janvier et d’août 1925 dans le magazine Asahi
graph アサヒグラフ avant d’être compilés dans l’ouvrageYama no jinsei100, ne traite
pas non plus de la vie des yamabito, comme aurait pu le laisser supposer son titre, mais
des populations « Yamato » implantées dans les montagnes, les sanmin. Le thème des
yamabito n’est plus central. Il apparaît encore dans la présentation de l’univers de la
montagne mais en arrière-plan, passé par le crible du regard de la « nation du Yamato ».
Par la suite, les études folkloristiques de Yanagita délaisseront presque totalement
les yamabito. Le dernier texte qui y fait référence, « Yamadachi to yamabushi » 山立と
山臥 (« Chasseurs et anachorètes des montagnes »), publié dans le recueil Sanson
seikatsu no kenkyū 山村生活の研究 (Recherches sur le mode de vie dans les villages
de montagne, 1937, Minkan-denshō no kai), traite en priorité des compagnies de
chasseurs dans les montagnes du nord de Honshū (les matagi マタギ), des yamadachi
(ancien terme pour matagi), des anachorètes (yamabushi 山臥) et des ermites (gyōja行
者). Dans ce texte, si Yanagita reconnaît que des yamabito ont pu habiter autrefois
100 Yama no jinsei 山の人生, La vie des montagnes, 1926, Kyōdo kenkyū sha. Voir supra.
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
82
l’univers de la montagne, il en décrit la disparition actuelle, et de fait clôt le cycle de ses
recherches sur les yamabito. Citons ici l’un des passages les plus significatifs.
Les récits nous rapportent que des gens vivaient autrefois dans la montagne sans recourir à l’agriculture. En quel nombre, je ne saurais le dire. Il devient aujourd’hui presque impossible de s’en faire une idée. (...) Le sang qui coulait autrefois dans leur veine n’a pu se tarir si facilement. Nul ne pourrait garantir qu’il ne se soit trouvé mêlé, ou infiltré, et que, sous une forme ou une autre, il ne batte encore dans ce qui est japonais aujourd’hui.
Yanagita laisse ouvert le débat sur la possible survivance du tempérament des
yamabito dans « ce qui est japonais » aujourd’hui, mais constate qu’ils ont de fait
disparu en tant que population. Par la suite, les études folkloristiques japonaises de
Yanagita ne mentionneront plus les yamabito. On peut donc considérer, comme le
faisait déjà remarquer Tsuboi Hirobumi 坪井洋文 (1929-1988), que Yanagita met ici
un terme final à ses recherches sur les yamabito.
Le recueil « Recherches sur le mode de vie dans les villages de montagne » cité
plus haut présente les résultats de la première campagne d’enquêtes de terrain menées
de façon systématique sous la direction de Yanagita (on peut faire abstraction de
l’enquête, d’échelle réduite, pratiquée du 15 au 25 août 1918 dans le village de Uchigō,
commune de Tsukui, département de Kanagawa). Celles-ci portent sur le folklore
(minzoku 民俗) des villages de montagne. La période durant laquelle ces enquêtes ont
été menées, juin 1937 à avril 1937, correspond approximativement au moment où les
études folkloristiques se mettent en place autour de Yanagita. À la suite d’un exposé
donné par Yanagita en septembre 1933 lors de rencontres sur les traditions populaires,
exposé-programme intitulé Minkan-denshō-ron 民間伝承論 « Théorie sur les traditions
populaires », les disciples du folkloriste réunis ce jour-là décident de lancer à partir de
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
83
l’année suivante (janvier 1934) l’Association des jeudi (Mokuyō-kai 木曜会 ),
association rebaptisée en 1947 Association d’études et de discussions de l’institut
d’études folkloristiques (民俗学研究所研究会・談話会 ), puis Association de
discussion de la Société d’études folkloristiques japonaises (日本民俗学会談話会).
Parallèlement, l’année suivante, du 31 juillet au 6 août 1935, une série de séminaires sur
les études folkloristiques japonaises est organisée à l’occasion du 60e anniversaire de
Yanagita. Ces séminaires serviront de tremplin à la création de l’Association des
traditions populaires (Minkan-denshō no kai 民間伝承の会 ), rebaptisée Société
d’études folkloristiques japonaises (Nihon minzokugakkai 日本民俗学会) après guerre,
dont la revue Minkan-denshō 民間伝承 (Traditions populaires) sera l’organe officiel de
publication. Enfin, faisant suite aux séminaires et aux discussions sur les traditions
populaires, paraissent deux ouvrages fondateurs. Minkan-denshō-ron 民間伝承論
(Théorie sur les traditions populaires), qui pose le cadre et la méthode des études
folkloristiques, est publié en 1934 chez Kyōritsusha-shoten 共立社書店 en collection
de poche. Seul le premier chapitre « Ikkoku-minzokugaku » 一国民俗学 (« Études
folkloristiques par pays ») est écrit de la main même de Yanagita, les autres reprenant
des notes prises par Gotō Kōzen lors de ces séminaires. Le second, Kyōdo-seikatsu no
kenkyū -hō 郷土生活の研究法 (Méthodologie des études sur le mode de vie dans les
terroirs) , est publié en 1935 chez Tōkō-shoin 刀江書院. L’arrêt des recherches de
Yanagita sur les yamabito coïncide avec la naissance des études folkloristiques en tant
qu’école centrée sur Yanagita. L’un et l’autre se situent sur le même axe.
À partir de cette époque, l’univers de la montagne n’apparaît dans les études
folkloristiques de Yanagita et de son école que par le biais des recherches sur la
conception de l’âme (reikon-kan 霊魂観) dans la nation japonaise. Les folkloristes
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
84
japonais se sont intéressés à l’au-delà situé dans la montagne (sanchū takai-kan山中他
界観), et aux croyances liées à la visite des divinités chez les vivants (kyorai shinkō 去
来信仰). Sur les divinités rizicoles, leurs travaux aboutissent, pour résumer, à la thèse
suivante : le dieu de la montagne descendrait chaque année au printemps dans les
villages pour se transformer en dieu des rizières, avant de reprendre à l’automne le
chemin inverse après la récolte. Dans le champ des recherches sur les lieux de culte, ils
ont tenté d’établir un lien entre sanctuaires dans la montagne (yamamiya 山宮), lieux de
séjour des âmes des morts, et sanctuaires dans les villages (sato miya里宮), lieux où
ces âmes reçoivent un culte au moment des fêtes saisonnières. Les deux ouvrages les
plus représentatifs dans ce domaine sont sans nul doute Senzo no hanashi先祖の話
(Sur les ancêtres, 1946, Chikuma-shobō ちくま書房 ) et Yamamiya-kō 山宮考
(Réflexions sur les sanctuaires de montagne, 1947, Koyama-shoten 小山書店). On
retiendra de ces travaux que l’univers de la montagne se trouve intégré dans le cadre
particulier des croyances populaires, qui étaient alors synonymes pour Yanagita de
« croyances uniques » propres au Japon (koyū-shinkō 固有信仰).
Cependant, il serait réducteur de penser que même à ce moment de l’histoire des
études folkloristiques Yanagita niait la disparité de la nation sur l’archipel japonais. En
février 1949, il participe à une rencontre consacrée aux recherches d’Oka Masao et à la
thèse d’Egami Namio sur la nation des cavaliers. Pressé par Ishida Eiichirō de prendre
position sur l’exposé commun d’Oka Masao, Yahata Ichirō, Egami Namio et Ishida,
exposé qui s’intitulait justement « Nation japonaise : origines culturelles et formation de
l’Etat japonais », Yanagita répond :
J’ai toujours considéré que la structure de la nation japonaise correspondait à un mélange de plusieurs races. Je ne pense pas qu’une seule nation homogène se soit développée. Qu’il y ait eu plusieurs acteurs, c’est un fait certain. Mais selon ma conviction, le
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
85
plus brillant d’entre eux, qui a su transmettre jusqu’à nos jours des conceptions comme les kami (divinités) ou le tamashii (l’âme), par exemple, ou des croyances uniques au monde sur la vie après la mort, cette tribu-‐là, on dira ce que l’on veut sur son nombre, sa force, ou même ses capacités intellectuelles, celle-‐là a été la plus importante.
Tout en reconnaissant la diversité de la nation de l’archipel, Yanagita insiste sur la
centralité d’une seule « tribu» (shuzoku 種族), dont on peut estimer, d’après le contexte
général, qu’il fait référence à la « nation du Yamato », la détentrice des dites
« croyances uniques/propres » au Japon.
2. Un triptyque anthropologique
Nous avons mis en évidence les liens génétiques qui existent entre Tōno
monogatari et les deux ouvrages de Yanagita qui l’ont précédé, Nochi no kari kotoba no
ki et Ishigami mondō. Ces trois textes forment ensemble une série qu’on pourrait
désigner comme un triptyque, même si d’autres articles et conférences périphériques
que Yanagita publie dans les années 1900-1910 ont également leur importance dans ce
processus. L’enchaînement chronologique des faits est le suivant.
Le voyage qu’effectue Yanagita dans l’île de Kyūshū durant l’été 1908 l’amène à
parcourir les parties montagneuses de la préfecture de Miyazaki, en particulier un
village appelé Shiiba où il rencontre des habitants qui partagent un mode de vie et des
croyances intimement liés à la montagne. Leur pratique de la chasse, qu’ils se
transmettent depuis des générations, retient plus particulièrement l’attention de
Yanagita. Pour la première fois, il entre en contact direct avec des « mœurs anciennes »
(古風, kofū) conservées dans des régions reculées qui ne sont pas encore été touchées
par la vague de modernisation déjà à l’œuvre dans le nord de Kyūshū.
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
86
Yanagita relate cette expérience fondatrice dans le rapport de voyage « Kyūshū-
nanbu-chihō no minfū », publié en avril 1909 dans la revue Shimin de la société
d’agronomie Shōtoku-kai où gravitent les hauts fonctionnaires des cercles décisionnels.
Sans ce séjour dans le village de Shiiba à Kyūshū, Yanagita n’aurait probablement pas
acquis la conviction que les régions reculées de l’archipel sont des « conservatoires » de
la culture antique, et que leur étude par le biais de l’ethnographie permettait de
reconstituer l’histoire du peuple japonais. Cette découverte l’incite à publier Nochi no
kari kotoba no ki en mars 1909.
Sa rencontre avec le jeune Sasaki Kizen est ensuite l’élément déclencheur qui
l’amène à écrire Tōno monogatari. Sasaki lui fait le récit d’histoires transmises dans sa
région de Tōno, mais Yanagita y repère des points communs avec celles qu’il avait
entendues à Shiiba. Ces récits finissent de le convaincre que les régions montagnardes
les plus reculées et excentrées partagent un même patrimoine culturel antique. La
corrélation de rencontres fortuites avec les habitants de Shiiba et Sasaki Kizen explique
la fièvre avec laquelle Yanagita s’est lancé dans la transcription des histoires de Tōno,
une bourgade perdue au fin fond du Tōhoku, sans aucune notoriété jusqu’alors101.
Parallèlement, Yanagita avait débuté une correspondance avec des personnes
versées dans les questions d’histoire et d’ethnographie, comme Yamanaka Kyōko 山中
共古 (ou Yamanaka Emu 山中笑, 1850-1928), qu’il rencontre en 1905, et Minakata
Kumagusu. Ces échanges épistolaires scientifiques reprenaient la forme qu’affectaient
les intellectuels de l’époque d’Edo pour mettre au clair des questions d’histoire. Se
plaçant dans les pas de ces « chercheurs » d’Edo, Yanagita réunit les lettres qu’il a
101 Toutefois, Yanagita avait déjà des connaissances préalables cette région puisque, lorsqu’il a travaillé au Bureau des archives du gouvernement, il a pu consulter des documents de l’époque d’Edo sur la région de Nanbu, où est situé Tōno.
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
87
échangées avec Yamanaka Kyōko ou encore avec son frère cadet Matsukoa Shizuo 松
岡静雄 (1878-1936) au sujet des stèles, pierres et autres tumulus situés aux limites des
villages, et les publie en mai 1910 sous le titre Ishigami mondō. Rappelons par ailleurs
que Yanagita avait déjà publié des articles sur ces thématiques dans des revues
d’archéologie et d’anthropologie.
Les informations contenues dans le recueil Ishigami mondō vont servir à étayer les
thèses présentées dans Tōno monogatari. Yanagita fait le choix de publier en premier
Ishigami mondō en mai 1910, alors que la préface de Tōno monogatari est déjà rédigée
depuis plusieurs mois et que les épreuves sont déjà corrigées. Le fait de différer la
parution de Tōno monogatari jusqu’en juin 1910 lui permet d’utiliser Ishigami mondō
comme caution scientifique grâce à l’ajout de notes renvoyant à cet ouvrage dans Tōno
monogatari. Ses notes à caractère scientifique, situées en marge supérieure de la page
de texte, permettent à Yanagita de jouer sur deux registres, en même temps : un énoncé
subjectif – le récit du vécu des populations par Sasaki Kizen, souvent retravaillé par des
effets littéraires –, et un énoncé objectif – informations recoupées ou inférées par des
scientifiques extérieurs à la région, le tout dans un style lapidaire 102 . L’ordre
chronologique de parution ne doit rien au hasard. La technique d’ajout de notes n’est
pas non plus celle d’un amateur. Cette stratégie éditoriale a permis à Yanagita d’étayer
ses thèses novatrices sur la culture japonaise en les instillant habillement au sein des
récits recueillis de la bouche de Sasaki Kizen, sans avoir besoin d’en modifier
significativement le contenu103.
102 A ce titre, il est tout à fait dommageable que dans la traduction anglaise de R. Morse, les notes originales aient été complètement réécrites par le traducteur. 103 Quoi qu’en dise Yanagita dans sa préface, la réécriture de Yanagita était déjà une modification par rapport aux informations livrées par Sasaki Kizen, ne serait-ce que parce que son parler dialectal est complètement oblitéré. Sasaki en convenait mais trouvait que sur le fond le résultat était conforme à ce qu’il avait lui-même entendu de la bouche de ses informateurs locaux (cf. sa lettre de remerciement à
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
88
Nochi no kari kotoba no ki, Ishigami mondō et Tōno monogatari, trois ouvrages
conçus, « co-rédigés » et financés par Yanagita, est le triptyque fondateur de la carrière
ethnologique de Yanagita, à travers lequel il se donne les moyens d’affirmer ses
convictions sur l’existence d’un substrat culturel antique conservé dans les montagnes
reculées et expose ses vues sur ce que devraient être les recherches ethnographiques sur
le Japon. Les similarités entre les trois ouvrages ont par ailleurs été soulignées par Ishii
Masami104 : un matériau central recueilli auprès d’informateur(s) (lettre du maire de
Shiiba, échanges épistolaires entre savants, histoires orales rapportées par Sasaki
Kizen) ; une préface de Yanagita agrémentée d’un poème d’intention ; la publication à
compte d’auteur.
Ces éléments chronologiques ont motivé un grand nombre de recherches génétiques
et textuelles qui ont permis de mieux mettre en rapport Tōno monogatari avec les deux
autres pans de ce triptyque – même si ce terme lui-même est de notre fait. Nous n’en
avons retenu que l’essentiel : les thématiques et la méthode de Tōno monogatari doivent
s’analyser en comparaison avec Nochi no kari kotoba no ki et Ishigami mondō. Et, le
statut apparemment ambigu de Tōno monogatari, qui n’a cessé de faire débat, ne peut se
comprendre que si lorsqu’on comprend la façon dont il a été stratégiquement placé à la
suite de Ishigami mondō pour être épaulé par des informations identifiées comme
clairement scientifiques, par le fait qu’elles soient situées en marge et rédigées sur un
autre registre. Du point de vue épistémologique, il nous semble qu’il y a là une ligne de
Yanagita en retour de l’envoi par ce dernier du premier des 350 exemplaires de Tôno monogatari). Par ailleurs, le plan général de l’œuvre, par lequel les 109 récits sont répartis de telle façon que la thèse des yamabito semble devoir s’imposer comme une évidence, est là plus encore l’illustration de choix intentionnels faits par Yanagita pour mettre la matière fournie par Sasaki Kizen en adéquation avec sa théorie. Cette question très intéressante nécessiterait une analyse qui déborderait du cadre de cette étude historique. 104 Cf. ISHII Masami 石井正己, ‘Tōno monogatari’ o yomitoku 「遠野物語」を読み解く (Lire et comprendre Tōno monogatari, Tokyo : Heibonsha 平凡社, 2009. Et YKJT, p.588.
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
89
partage d’une grande lucidité, même s’elle est sans doute expérimentale, entre ce qui est
de l’ordre du vécu subjectif et ce qui est de l’ordre de l’analyse objective. Nous ne
sommes pas là à l’extérieur ou à la marge du champ anthropologique, mais bien au cœur
même de la réflexion anthropologique sur le traitement de la subjectivité par le regard
scientifique, sur la distanciation nécessaire avec le Soi comme objet105.
105 Nous pensons au « regard distancié » de Lévi-Strauss, qui lui aurait été inspiré par la Tradition secrète du nô de Zeami, traduite et préfacée par R. Sieffert. Or, cette inspiration sur le rapport à Soi et aux autres fondant l’anthropologie lévi-straussienne serait, affirme Kawada Junzô, largement le fruit d’une fausse interprétation du propos de Zeami. Cet extraordinaire chassé-croisé serait matière à une belle étude épistémologique.
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
90
Conclusion
Positionnement de Yanagita face à la modernité
Arrivé à la capitale en 1888-1890, Yanagita monte un à un les échelons de
l’ascenseur social et de la méritocratie mis au point par le gouvernement de Meiji :
admission au Premier lycée de Tôkyô puis à l’Université impériale de Tôkyô ; il obtient
rapidement la reconnaissance des cercles littéraires. En tant que haut fonctionnaire,
carrière qu’il entame en 1900 dans le Ministère de l’Agriculture et du Commerce et
qu’il termine en 1919 en tant que secrétaire général de la Chambre des Pairs, Yanagita
est aux premières loges du processus de modernisation du Japon. Mais son travail dans
la haute administration le place rapidement en porte-à-faux par rapport à ses idéaux,
notamment en matière de reconnaissance d’une identité nationale s’appuyant sur la
ruralité. Ces idéaux s’inscrivent dans la double logique de son héritage familial par son
père (idéologie des « études nationales » kokugaku 国学) et d’une affirmation de
l’égalitarisme propre à son époque qui voit la formation de l’État-nation japonais. Or, la
situation politique dans laquelle le Japon se trouve au tournant du siècle, et plus encore
après la guerre sino-japonaise, voit les institutions de plus en plus contrôlées par une
oligarchie. Celle-ci apparaît toujours plus aux yeux de Yanagita comme un repoussoir
qui contrarie ses ambitions pour son pays.
L’échec dont il fait l’expérience dans l’application des coopératives agricoles, à
quoi s’ajoute la répression d’État – à laquelle il assiste aux premières loges – contre les
intellectuels s’opposant au discours officiel, le pousse finalement à prendre ses
distances vis-à-vis de l’appareil étatique, et à se positionner comme « franc-tireur » sans
toutefois basculer dans l’opposition radicale, socialiste notamment. Compte tenu de son
point de départ idéologique, il ne peut se reconnaître dans la mouvance socialiste. Mais
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
91
il ne peut cautionner la mise en place de politiques qui ignorent ce qu’on pourrait
dénommer le « potentiel culturel » présent dans les campagnes.
Au final, c’est sur le terrain de la science qu’il entend porter le débat. Il veut
réorienter les priorités dans le domaine scientifique vers une meilleure prise en
considération du vécu des populations rurales, afin de faire en sorte que ses
contemporains – intellectuels, hommes politiques, habitants locaux, etc. – partent des
faits sociaux observables pour définir de nouvelles lignes de développement
économique, politique et culturel.
La plupart des premiers travaux de Yanagita s’intéressent prioritairement aux
populations vivant dans les espaces montagneux, alors que l’agronomie, sa formation
d’origine, se concentrait plutôt sur la paysannerie des plaines. Nous avons montré que
ce déplacement focal était motivé par l’interprétation faite par Yanagita des problèmes
liés à la modernisation rapide de la société japonaise après la guerre russo-japonaise. Sa
théorie anthropologique sur un hypothétique « peuple des montagnes » (yamabito 山人
), qu’il va imposer comme grille de lecture dans Tōno monogatari au-dessus des récits
bruts de Sasaki Kizen, est l’illustration même de cette méthode scientifique qui se
cherche encore.
Le dépassement dialectique entre les trois champs
La chronologie des différentes publications de Yanagita durant les années 1905-
1910 montre clairement la baisse du nombre de textes concernant la politique
agronomique et l’augmentation concomitante d’articles de type ethnographique106. Cette 106 MIURA Sueyuki 三浦佑之 en avait fait la liste dans son article : « Yanagita Kunio no mezame :
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
92
progression du nombre de travaux à caractère ethnographique culmine avec la
publication des trois ouvrages fondateurs Nochi no kari kotoba no ki, Ishigami mondō et
Tōno monogatari en 1909 et 1910.
Tōno monogatari est travaillé par les questions de politique agronomique qu’il n’a
pas pu mener à bien dans la fonction publique107. Parce que cet ouvrage est marqué en
creux par la pensée économique de Yanagita, son intention première était de montrer
que les études ethnographiques permettraient potentiellement d’ouvrir d’autres voies de
développement que celles choisies par les élites de son pays, contre lesquelles il avait eu
à batailler dans l’administration centrale. Cet élément oppose un démenti à la thèse
selon laquelle la parution de Tōno monogatari ne serait qu’une fuite en avant dans la
fantasmagorie d’un Yanagita trop rêveur, après « l’échec personnel » (zasetsu 挫折)108
qu’il aurait subi dans le monde celui-ci bien réel de la politique agricole. La rupture
épistémologique marquée par son pari en faveur de l’ethnologie contre la politique
agricole exprime non pas un abandon mais la poursuite des mêmes objectifs par d’autres
moyens.
De même, concernant l’aspect littéraire du problème, Tōno monogatari est certes
une œuvre qui s’inscrit dans le champ de la littérature, comme Yanagita le reconnaîtra
lui-même en 1935. Mais elle est au service d’un projet plus général, scientifique tout en
étant fondamentalement politique. La nécessité qu’a ressentie Yanagita de publier Tōno
monogatari n’a là encore rien en commun avec du dilettantisme ou un plaisir esthétique
“Nochi no kari kotoba no ki” to “Tôno monogatari”, op.cit. 107 Il finira par quitter définitivement la fonction publique en 1919, alors qu’il est Directeur du secrétariat de la Chambre des Lords (貴族院書記官長) suite, une nouvelle fois, à un désaccord avec son supérieur hiérarchique. 108 La thématique de l’échec personnel de Yanagita (zasetsu) apparaît très tôt sous la plume de l’ethnologue Tanigawa Ken.ichi. 谷川健一「山人と平地人―ある挫折と転向―」,現代思想 3-4,1975,p. 118-123
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
93
de l’art pour l’art. Ce procès-là de l’éternel poète incapable de rentrer dans le moule
scientifique ne tient pas non plus.
S’il reste certes une marge d’interprétation sur sa « fibre littéraire » ou son
penchant pour la fantasmagorie et le religieux, l’« échec » de Yanagita à faire entendre
ses vues en matière de réformes agronomiques d’une part, et, d’autre part, son
« divorce » avec les milieux littéraires naturalistes avec lesquels il diverge sur la
question de la représentation du réel sont les véritables moteurs à l’origine de Tōno
monogatari, et plus encore appellent à s’intéresser de plus prêts aux éléments présents
dans cette œuvre qui convergent pour constituer un questionnement herméneutique sur
soi, sur la meilleure façon de émerger une science de sa propre culture.
Tōno monogatari comme questionnement herméneutique
Le statut double du texte, à la croisée de la littérature et de l’ethnologie, en redouble
clairement l’efficacité. Cet habile mélange des genres a permis à Yanagita de poser un
premier jalon essentiel à sa carrière d’ethnologie. Il s’agit d’un « manifeste » dans le
sens d’une œuvre programmatique par laquelle il fait savoir qu’il est essentiel d’aller sur
le terrain pour enquêter sur les modes de vie et de pensée des habitants des campagnes,
qui étaient alors généralement considéré comme arriérées par les élites occidentalisées
vivant dans les grandes villes. Tel est, comme nous l’avons dit plus haut, le sens
métaphorique de la mention mise en exergue de l’ouvrage : « J’offre ce livre à ceux qui
sont à l’étranger ». L’ambiguïté consubstantielle de cette œuvre se présente à la fois
comme une force grâce à la tension créative qui peut en ressortir, et comme une
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
94
difficulté qui empêche toute compréhension simple et directe de ce texte, difficulté sur
laquelle achoppent particulièrement les commentateurs et les traducteurs.
Revenons par exemple à la traduction anglaise de Tōno monogatari par R.A.
Morse. En trente ans d’écart, certains de ses choix opérés en 1975 dans sa traduction –
qui n’a été que peu modifiée pour la réédition de 2008 – paraissent aujourd’hui bien en
deçà de l’esprit combatif qui animait Yanagita. Les deux phrases suivantes dans
lesquelles Yanagita dévoile ses intentions au tout premier paragraphe de la préface en
sont une excellente illustration :
願わくはこれを語りて平地人を戦慄せしめよ。この書のごときは陳勝呉
広のみ。
I wish these legends could also be heard for they would not only make us who live in the lowlands shudder, but would also provide a fresh start like The Legends of Tōno109.
Or, le sentiment de peur que ce recueil tente de distiller ne trouve pas sa source
dans une description à caractère fantastique des créatures vivant dans les montagnes,
susceptibles de provoquer le frisson chez des Japonais vivant majoritairement dans les
plaines. Il s’agit d’examiner une thèse anthropologique complexe propre à déstabiliser
le confort intellectuel de ses contemporains. Loin d’avoir produit un simple recueil de
récits fantastiques (kaidan), Yanagita pose une pierre dans un projet plus vaste de
reconstitution historique, grâce à l’ethnologie, des échanges entre les différentes
populations qui se sont croisées et affrontées sur l’archipel japonais.
Tenant compte de ce qui précède, il nous semble indispensable de définir une
méthodologie épistémologiquement fondée, à même de rendre compte de la cohérence
109 Ref
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
95
de la démarche de cet auteur en dépit des revirements de sa carrière. Parce que les textes
de Yanagita sont complexes à analyser, cette nécessité s’impose aussi bien à une
présentation générale de la vie de Yanagita, de l’ensemble de son œuvre ethnolologique,
ou à la traduction d’un texte aussi court soit-il comme Tōno monogatari. Telle est
l’ambition qui animera nos futures recherches sur cet auteur.
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
96
Bibliographie des références citées
YANAGITA Kunio 柳田國男
���- 1995 [1910] Tōno monogatari 遠野物語 (Contes de To ̄no), in Yanagita Kunio zenshū 柳田國男全集 (Collection des œuvres complètes de Yanagita Kunio), tome 2, Tokyo, Chikuma shobō 筑摩書房.
- 1998 [1931] Meiji Taishō shi. Sesō-hen 明治大正史 世相篇 (Histoire de Meiji et Taishō. Aspects du quotidien), Yanagita Kunio zenshū, tome 5, idem.
- 1999a [?] Nōgyō seisaku 農業政策 (Politiques agricoles), Yanagita Kunio zenshū, tome 1, idem.
- 1999b [1910] Ishigami mondō 石神問答 (Questions et réponses sur les divinités de pierre), YanagitaKunio zenshū, tome 1, idem. ���
- 1999c [1911 in Yōkai dangi 妖怪談義, « Ono ga inochi no haya tsukai » 己が命の早使ひ (Le message rapide de ma vie), Yanagita Kunio zenshū, tome 20, idem.
- 2006 [1905] « Chū-nō yōsei saku » 中農養成策 (Mesures en vue de la formation d’une agriculture moyenne), Yanagita Kunio zenshū, tome 23, idem.
Fujii Takashi, 2010, « Une modernité inachevée : pourquoi les Contes de Tōno de Yanagita Kunio sont lus aujourd’hui », Ebisu, trad. fr. Frédéric Lesigne, 2010, no 44, p. 137-156.
IKETANI Takumi, 2005, « Musashino et les débats autour de la recherche sur les terroirs », Ebisu, trad. fr. Frédéric Lesigne, vol. 34, no 1, p. 125-146.
KAWADA Minoru, 1993, The origin of ethnography in Japan: Yanagita Kunio and his times, London; New York, Kegan Paul International,.
MORSE R.A. (dir.), 2012, Yanagita Kunio and Japanese Folklore Studies in the 21st Century, Fujiwara Shoten.
Ronald A. Morse, La ville de Tōno et ses environs - Livret touristique et culturel -, http://www.shokokai.com/tohno/html/gfrn0225.pdf, trad. fr. Frédéric Lesigne, consulté le 4 octobre 2013.
NAKAMURA Ryōji et de CECCATTY René, 1982, Mille ans de littérature japonaise: une anthologie du VIIIe au XVIIIe siècle, Paris, Éditions de la Différence.
Frédéric Lesigne / Mémoire de Master 2 / déc.-2013 / La méthode de Tōno monogatari
97
Sébillot Paul, Le folk-lore: littérature orale et ethnographie traditionnelle, Paris, O. Doin et fils, 1913.
三浦佑之, 柳田国男の目覚め ー「後狩詞記」と「遠野物語」, 國文學, 1993, vol. 38, no 8, p. 56‑62.
R・A・モース, 赤坂憲雄, 菅原克也, 伊藤由紀, et 中井真木, 世界の中の柳田国男 〔Yanagita Kunio Studies Around the World〕, 藤原書店, 2012.
佐野賢治, 現代民俗学入門, 東京, 吉川弘文館, 1996. 大塚英志 (dir.), 柳田国男山人論集成, 東京 : 東京, 角川学芸出版 ; 角川グループパブリッシング (発売), 2013.
大塚英志, 怪談前後―柳田民俗学と自然主義, 角川学芸出版, 2007. 天沢退二郎, 川田順造, 赤坂憲雄, 三浦佑之, 池内紀, 斎藤環, et 安藤礼二, 現代思想 2012年 10月臨時増刊号 総特集=柳田國男 『遠野物語』以前/以後, 青土社, 2012.
岩田重則, « <論文>柳田国男の天皇論 : 民族・稲・沖縄 », 比較民俗研究 : for Asian folklore studies, 1992, no 6, p. 82‑109.
川村湊, 「大東亜民俗学」の虛実, 東京, 講談社, 1996. 桑山敬己, ネイティヴの人類学と民俗学: 知の世界システムと日本, 東京, 弘文堂,
2008. 橋川文三, 柳田 国男 その人間 思想, 東京, 講談社, 1978. 野村純一 (dir.), 柳田国男事典, 東京, 勉誠出版, 1998. 鳥越皓之, 柳田民俗学のフィロソフィー, 東京大学出版会, 2002. 鳥越皓之 (dir.), 民俗学を学ぶ人のために, 世界思想社, 1989. 鳥越皓之, « 民俗学と近代化論 », 鳥越皓之 (dir.), 民俗学を学ぶ人のために, 京都, 現代思想社, 1989, p. 42‑59.
鹿野政直, 近代日本の民間学, 東京, 岩波書店, 1983.
98
ANNEXE I : Traduction de la préface de Tōno monogatari
Je dédie cet ouvrage à ceux qui sont à l’étranger. Ces histoires, je les ai toutes entendues du jeune Sasaki Kyōseki, homme
de Tōno. L’an passé, en l’an 42 de l’ère Meiji (1909), vers le mois de février, commencèrent mes visites nocturnes répétées durant lesquelles je retranscris ces récits qui m’étaient contés. Le jeune Sasaki n’est pas un orateur habile, mais il est honnête dans ce qu’il dit. Je n’y ajoutai ni n’en retranchai moi-même aucun mot, aucune phrase, et les retranscris tels que j’en avais connaissance. Au juger, je dirais que le district de Tōno compte encore plusieurs centaines d’histoires de ce type. Il ne nous serait plus grand bonheur que de les entendre. D’autres villages de montagnes, d’autres lieux plus reculés encore que Tōno sur notre territoire, semblent connaître une infinité de légendes sur des divinités ou des peuples vivant dans les montagnes. Nous en faisons ici le récit pour faire trembler les habitants des plaines. Un tel ouvrage, c’est Chen Sheng et Wu Guang !
A la fin du mois d’août dernier, je me suis rendu au district de Tōno. Depuis
Hanamachi, sur une route qui s’attire sur plus de dix lieux, se trouvaient trois relais de chevaux. Le reste n’était que montagnes verdoyantes et landes. La rareté des feux humains est plus frappante encore que dans la plaine d’Ishikari à Hokkaidō. Peut-être était-ce une route nouvelle, ce qui expliquerait pourquoi si peu de gens ne s’y étaient encore installés. La ville de Tōno est fleurissante. Après avoir emprunté un cheval au tenancier de l’auberge, je fis seul une excursion dans les villages alentour. Le cheval avait une selle/couverture faite d’algues noirâtres, car les taons sont nombreux dans la région. La combe de Saruga-ishi montrait de belles cultures, au sol épandu. L’abondance de stèles de pierre sur le bord des chemins est sans équivalent dans aucune autre région du Japon. Étant monté sur une hauteur, je contemplais le riz jeune (wase) en train de mûrir, et le riz tardif (bantō) alors en fleur. L’eau coulait de partout vers les rivières. La couleur des épis changeait d’une variété à l’autre. Trois, quatre, cinq rizières à la suite de la même couleur indiquaient qu’une même ferme en était le propriétaire, dont le nom était probablement attaché à cette parcelle (myōsho). Pour un terrain de taille plus réduite qu’un lieu-dit (koaza), il ne saurait avoir d’autre nom que celui d’un propriétaire. Les anciens certificats de vente et de concession en témoignent. Une fois passée la vallée de Tsumōshi, le Mont Hayachine apparaît, dans une légère brume ; sa forme conique rappelle un chapeau ou le katakana « he ». Dans cette vallée, le riz à la croissance plus tardive s’étendait sous mes yeux entièrement vert. Avançant sur les sentiers étroits qui séparent les rizières, je vis des oiseaux inconnus qui coupaient la route, suivis de leurs poussins. Ceux-ci avaient un plumage noir, mêlé de blanc sur les ailes. Je songeais d’abord à des poules, mais les voyant se cacher dans les herbes du fossé et disparaître à ma vue, je compris qu’il s’agissait d’oiseaux sauvages. Sur la colline de Tenjin avait lieu une fête de
99
village, une danse des lions. Un léger nuage de poussière s’élevait de la colline et, sur le fond vert formé par l’ensemble du village, un peu de rouge se dessinait. Cette danse des lions était bien plutôt une danse des daims. Des hommes portant des masques surmontés de cornes de daims, et cinq ou six enfants, sabres dégainés, dansaient de concert. Les flûtes jouaient sur un ton si haut et les chants si bas que je pouvais à peine discerner le sens de leurs paroles, bien que je fusse près d’eux. Le soleil se couchait, le vent commença à souffler ; la voix des hommes ivres hélant leurs voisins résonnait avec tristesse ; les femmes riaient, leurs enfants couraient en tous sens. Je ne pus refréner un sentiment de mélancolie comme en éprouvent les voyageurs solitaires. Une coutume veut que les familles qui pleurent un nouveau défunt à la Fête des morts (urabon) plantent de hauts étendards rouges et blancs pour inviter les mânes. J’en comptai plusieurs dizaines, monté sur un cheval à scruter l’horizon d’est en ouest depuis un col. Le villageois qui quitte à jamais son pays, le voyageur entré là pour quelque temps, et cette montagne sacrée qui s’élève majestueusement, tous sont enveloppés par l’or du soleil couchant. Dans le comté de Tōno, huit chapelles sont dédiées à Kannon. Leurs statues sont faites d’un seul bois. Ce jour-là, nombreux étaient les paroissiens venus rendre grâce, et il résonnait au loin le son des cloches horizontales. Dans les fourrés au bord du chemin, des figurines en papier à forme humaine avaient été abandonnées depuis la Fête de la Pluie. On eût dit des gens tombés de fatigue. Telles sont les impressions que je retirai du district de Tōno.
Quand on y pense, ce genre de livres n’est en tout cas pas à la mode
actuelle. Faire imprimer est certes devenue une chose aisée, mais certains jugeront qu’il est peu civil d’imposer à autrui la publication de tels ouvrages et ses propres goûts farfelus. Qu’il me soit permis de leur répondre. Qui, après avoir entendu de telles histoires et être allé observer de tels lieux, pourrait se retenir d’en faire le récit autour de lui ? Je n’en connais aucun, en tout cas parmi mes proches, qui puisse se tenir coi et réservé en pareille occasion. Car si le Konjaku monogatari, ouvrage illustre de neuf cents ans notre aîné, narrait déjà à son époque des « histoires qui sont maintenant du passé », ce dont il est question ici se présentent là, sous nos yeux. Sans prétendre rivaliser avec la révérence et la sincérité de Maître Grand conseiller, de pareilles histoires que peu de gens ont entendues et qu’encore mois de bouches et de pinceaux ont relayées mériteraient tout l’attention d’un tel auteur réputé pour sa simplicité et son manque d’apprêt. Si l’on en vient aux Otogi hyaku monogatari de l’époque d’Edo, ils sont non seulement de peu d’envergure et mal instruits, mais on ne saurait jurer qu’ils comprennent autre chose que de simples fables. Les mettre côte à côte me semble inconvenant. En résumé, il s’agit d’un livre de faits actuels. Ce qui, en soi, est une excellente raison pour qu’il existe. Certes, Kyōseki est un jeune homme d’à peine vingt-quatre ans, et moi n’en ai guère qu’une dizaine de plus. Que dire à ceux qui pensent que, bien que nous soyons nés à une époque où il y aurait tant à faire, nous ne savons discerner les petits des grands débats, et perdons notre énergie inutilement ? Que dire à ceux qui nous accusent d’être pareils à des hiboux du bois de Myōjin, l’ouïe en alerte et
100
les yeux écarquillés en pure perte ? Il n’est rien à leur répliquer. La responsabilité de cette entreprise, je l’assume moi-même.
La chouette au fond des bois, qui ne vole ni ne dit mot, se moque sans
doute.
102
ANNEXE II : Sources en français sur l’œuvre de Yanagita Kunio – par catégorie et ordre chronologie –
I. Ouvrages traduits en français 1982 Hi wo maneku hanashi 日を招く話 (1927)
Traduction et présentation par Jacqueline PIGEOT sous le titre « Le Rappel du soleil », dans Cahiers d’études et de documents sur les religions du Japon IV, EPHE Ve section 1982 Tōno monogatari 遠野物語 (1910)
Traduction partielle. Récits n° 3, 4, 7, 10, 11, 69, 91, 96, 101 et 117. Traduction et présentation par Ryōji NAKAMURA et René de CECCATTY sous le titre « Contes de Tōno », dans Mille Ans de littérature japonaise – une anthologie du VIIIe au XVIIIe siècle, Editions de la Différence 1983[1999] Nihon no mukashibanashi 日本の昔話 (1930)
Traduction et présentation par Geneviève (MOMBERT-)SIEFFERT sous le titre Contes du Japon d’autrefois, Publications orientales de France, 1983 / Réédité sous le titre Les yeux précieux du serpent, Le Serpent à plumes, 1999 1996 Imo no chikara 妹の力 (1925)
Traduction et présentation par Junko ABE sous le titre « Le Pouvoir de la sœur », dans Cent ans de pensée au Japon Tome II, Philippe Picquier
II. Dictionnaires comportant un article « Yanagita Kunio » 1963-1995 Dictionnaire historique du Japon, Maison franco-japonaise ed.,
Kinokuniya / Auteur inconnu 1996 Le Japon – Dictionnaire et Civilisation –, Louis Frédéric ed., Robert
Laffont / Auteur Louis FRÉDÉRIC 2000 Dictionnaire de la littérature japonaise, Jean-Jacques Origas ed., PUF /
Auteur François MACÉ (extrait du Dictionnaire universel des littératures, publié sous la dir. de Béatrice Didier, paru aux PUF en 1994)
III. Autres usuels indiquant une ou des entrée(s) « Yanagita Kunio » en
index 1995 [1988] L’État du Japon, Découverte
- « Le rôle de la mer dans l’histoire japonaise », Pierre-François SOUYRI : 68 - « Histoire », Pierre-François SOUYRI : 81
- « Les lettres japonaises », Jean-Jacques ORIGAS : 206 1994 Dictionnaire de la Civilisation japonaise, Hazan
- « Chronologie », Pierre-François SOUYRI : XXIII - « Littérature moderne », Jean-Jacques ORIGAS : 293, 295 - « Japonais (les) : origines, ethnies, traits culturels fondamentaux », Josef KREINER : 236,
241 - « Nippologie (Nihon-ron, Nihon-shugi) », Peter N. DALE : 356
2004 Japon, peuple et civilisation, Découverte - « Le rôle de la mer dans l’histoire japonaise », Pierre-François SOUYRI : 87 - « De l’avant-garde à la répression : 1925-1945 », Jean-Jacques ORIGAS : 162
IV. Etudes (articles, collectifs, comptes-rendus) traitant de l’œuvre de Yanagita Kunio
103
1924 Nobuhiro MATSUMOTO, « L’état actuel des études de folklore au Japon », in Japon et Extrême-Orient, n° 10
1930 Nobuhiro MATSUMOTO, «La Légende de Kogorô le charbonnier, d’après un article de Kunio Yanagida », in Bulletin de la Maison franco-japonaise, Tome 2, n° 3-4
1952 René SIEFFERT, « Etudes d’ethnographie japonaise », in Bulletin de la Maison franco- japonaise, nouvelle série tome II : 9-20
1982 Jacqueline PIGEOT, « Le Rappel du soleil », in Cahiers d’Études et de documents sur les religions du Japon IV, EPHE Ve section : 7-31
1994 Jean-Pierre BERTHON, « Orikuchi Shinobu et l'ethno-folklore », in Cipango Cahiers d'Études Japonaises, n°3 : 171-173
1995 Annales HSS 50ème année n°2, « L’Histoire du Japon sous le regard japonais » - sous la direction de Pierre-François Souyri -
- Pierre-F. SOUYRI et Hiroyuki NINOMIYA, « Présentation » : 227-233 - AMINO Yoshihiko, « Les Japonais et la mer » (traduction Gérard SIARY, Mieko SIARY et
Pierre-F. SOUYRI) : 235-258 - Jean-Pierre BERTHON, « Compte-rendu : Minoru Kawada, The Origin of Ethnography in
Japan. Yanagita Kunio and his Times » : 450-452 1996 Junko ABE, « Le Pouvoir de la sœur », in Cent ans de pensée au Japon
Tome II, Philippe Picquier 1999 Laurence CAILLET, « Yanagita Kunio, lecteur de James G. Frazer », in
Daruma revue d'études japonaises, No 5, Philippe Picquier : 183-212 2001 Laurence CAILLET, « Le Japon », in Ethnologie: concepts et aires
culturelles, - Martine Ségalen ed. -, Armand Collin : 306-314 2004 Masahiro HAMASHITA, « La forêt vue par Yanagita Kunio. Sa
contribution à une idée contemporaine de l’écologie », in Diogène, n° 207 : 15-19
2005 Ebisu no
34, Printemps-Été, MFJ - NAKANO Kiwa, « Conflits entre ‘création’ et ‘tradition’ dans une fête urbaine » (traduction
Cécile DIDIERJEAN) : 39-81 - Cécile DIDIERJEAN, « Des dons, des dieux et des hommes » : 83-123 - IKETANI Takumi , « Musashino et les débats autour de la recherche sur les terroirs »
(traduction et présentation Frédéric LESIGNE) : 125-146 2005 Pardons et Troménies de Bretagne. L’ethnographie japonaise à l’épreuve
des faits : enquête et analyse de deux célébrations traditionnelles, Sekizawa Mayami et Shintani Takinori ed.,National Museum Of Japanese History, Sakura
- SEKIZAWA Mayumi, « Les pardons – feux du pardon et feux du solstice d’été » (traduction Evelyne LESIGNE-AUDOLY) : 10-41
- SHINTANI Takanori, « Les troménies bretonnes – Légendes et réalité aujourd’hui – » (traduction et annotation Frédéric LESIGNE et Evelyne LESIGNE-AUDOLY) : 42-102 2006 Ateliers du LESC n° 30, « Ethnographies japonaises » - sous la direction
de Laurence Caillet - - Anne BOUCHY, « De l’ethnologie au Japon : par qui, où, comment ? » - Arnaud BROTONS, « Lecture ethnologique d’un lieu saint connu depuis le VIIIe siècle » - Jean-Michel BUTEL, « Le japonologue occidental est-il original ? - Considérations sur la
question et le cadre d’un travail concernant le Japon à partir de l’étude des lieux de cultes pour amoureux »
104
2007 François MACÉ, « Deux interprétations croisées du shintô, le père Martin et Katô Genchi :, in France-Japon : regards croisés. Echanges littéraires et mutations culturelles (Littératures de la langue française Vol. 7), Peter Lang, Bern : 167-174
2009 Erik LAURENT, «Anthropologie culturelle : vers une voie japonaise ni primitive ni occidentale », in Le Monde comme horizon - Etat des sciences humaines et sociales au Japon -, Anne Gonon et Christian Galan ed., Philippe Picquier, mars 2009 : 201-247.
V. Liste provisoire des chercheurs francophones en ethnologie du Japon
se référant aux travaux de Yanagita Kunio Bernard Franck, Hartmut O. Rotermund (EPHE), Anne Bouchy (EFEO), Laurence Caillet
(Paris X), Jean-Pierre Berthon (CNRS), François Macé (INALCO), Erik Laurent (Université des sciences sociales de Gifu), Fabienne Duteil-Ogata (CNRS), Sophie Houdard (CNRS), Muriel Jolivet (Université de Sophia), Jean-Michel Butel (INALCO), Cécile Didierjean (Université de Strasbourg), Arnaud Brotons (Université d’Aix-en-Provence), Matthias Hayek (Paris VII), Jean-Charles Juster (Université départementale des Arts d’Okinawa), Alexandre Mangin (Université Rikkyô ?), Alexandre Gras (Université d’Iwate), etc.