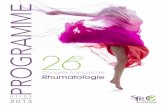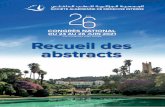La médiation : un projet de société ? Aux origines du Forum de la société civile sur la...
Transcript of La médiation : un projet de société ? Aux origines du Forum de la société civile sur la...
Camila Nicácio, Cahiers d’anthropologie du droit 2011, pp.
La médiation : un projet de société ? Aux origines du Forum de la société civile sur la
médiation (FSCM)1
Non c’è altra poesia che l’azione reale2 Pier Paolo Pasolini
Associée normalement à la résolution non judiciaire des conflits, par l’intermédiaire d’un tiers censé respecter des principes tels que l’impartialité et la confidentialité, et encourager la responsabilité et l’autonomie des parties, la médiation semble s’inscrire dans la contemporanéité avec les marques d’une justice nouvelle. Sans être « douce» (Bonafé-Schmitt 1992 : 175 et s.), elle présenterait un modus operandi particulier, capable d’une intervention non autoritaire dans le contexte de la gestion des relations sociales, où l’élargissement de l’espace de parole (rhétorique) et l’ouverture à d’autres normativités viseraient la reconstruction critique du conflit (Silva Nicácio 2010 :151-168).
Ainsi, à la suite d’un développement fulgurant dans les trente dernières années, la médiation s’est définitivement installée en tant que méthode d’administration des conflits dans les domaines sociaux les plus divers (familial, de l’entreprise, environnemental, scolaire, judiciaire, culturel et interculturel, des services publics, etc.). Si cet essor s’est fait remarquer dans différents pays et cultures, ce fut surtout dans les pays occidentaux qu’il a suscité un engouement laissant entrevoir, d’un côté, la crise du modèle étatique de gestion des conflits, jusqu’alors hégémonique et, d’un autre côté,
1 Par le privilège et la richesse du partage, l’auteure tient à remercier Étienne Le Roy, Denis Moreau et Gilda Nicolau. 2 Il n’y a pas d’autre poésie que l’action réelle.
Camila Nicácio 2
la possibilité d’émergence d’un modèle plus conforme aux contingences et aux besoins contemporains ; besoins tels que la participation citoyenne et le recours à d’autres substrats normatifs3 que les lois étatiques, lors des processus de prise de décision.
Dans son histoire brève, la médiation a cependant connu un développement très mouvementé, concernant surtout la définition de quelques-uns de ses principaux éléments, comme ses principes fondateurs, ses méthodes, ses acteurs, ses buts, ses modes de financement et par conséquent son articulation avec les initiatives d’accès à la justice déjà en place, étatiques ou non. Dans des contextes fort différents, d’innombrables acteurs, à titre individuel ou collectif, se sont improvisés médiateurs, et les critiques dénonçant le risque de charlatanisme et d’une éventuelle « panacée » (cf. surtout Six 1990 et Guillaume-Hofnung 1995) n’ont pas tardé à se manifester. De telles critiques ont surtout profité au milieu judiciaire conservateur lequel, par crainte de perdre son territoire a insisté sur le besoin de formation juridique des médiateurs. Faute d’une unité de référence déontologique et pratique, l’éclatement des expériences de médiation a ainsi posé, en France, depuis une quinzaine d’années, le besoin de trouver tant une cohérence conceptuelle et éthique (I) que d’intégration sur le territoire, en vue d’assurer aux citoyens la lisibilité et la qualité des pratiques et de la promouvoir en tant que projet rénové de société (II). Entre accommodation, rejets et mimétismes, ce nouveau projet paraît dévoiler une relation tout aussi renouvelée entre justice étatique et médiation, dont le métissage serait la marque distinctive (III).
I - L’itinéraire vers l’identité et l’unité de la m édiation
Dans les années quatre-vingt, le Centre National de la Médiation (CNM), dirigé par Jean-François Six, organisa deux colloques emblématiques sous les noms respectifs de : « L’heure des médiateurs » (1988) et « Médiation et société d’aujourd’hui » (1989), où l’importance de l’exigence déontologique a commencé à s’esquisser. Par ailleurs, l’ouvrage Le temps des médiateurs4, de ce même auteur, paru en 1990, a été depuis reconnu par ses pairs comme ayant fait progresser d’une décennie la réflexion sur quelques questions devenues centrales à la médiation, telles que la démultiplication des pratiques, le flou terminologique, le danger du mélange entre diverses 3 Ce que l’anthropologie juridique traduira en termes de juridicité. Cf. Le Roy 2007 : 1-29. 4 S’interrogeant sur les raisons de la multiplication des médiations, dans ce texte, l’auteur développe de belles lignes sur le paradoxe caché derrière la difficulté de communication qui frappe les sociétés contemporaines à l’heure de l’internet et de la communication de masse. Cf. Six, J.-F., 1990 : 247 et s.
La médiation comme projet de société : l’expérience du Forum de la société civile sur la médiation.
3
logiques d’action, comme la logique institutionnelle et la logique citoyenne, etc.
Cet ouvrage allait d’ailleurs, du fait de son caractère précurseur et original, dégager un concept de médiation qui a fini par inspirer la plupart des textes qui l’ont suivi. Ce concept déplace le nœud de la médiation vers un au-delà de la résolution des conflits qui concentre une partie importante des définitions trouvées et pratiquées actuellement en France et ailleurs. Selon son auteur, un concept de médiation est censé considérer préliminairement qu’il existe au moins quatre types de médiation : une créatrice, l’autre rénovatrice ; une préventive et l’autre curative. Les deux premières ont pour objet de faire naître ou renaître des liens relationnels, alors que les deux autres se destinent à gérer une situation conflictuelle (à venir ou en cours). Tous les quatre visent à établir ou rétablir la communication entre des personnes ou des groupes, ceci étant la nature de la médiation relationnelle (Six, 1990 : 164 et s. et 1995 : 287 et s.). Ces quatre types de médiation rehausseraient l’une de ses potentialités centrales : le fait d’allier à l’éventuelle résolution d’un conflit la création et préservation des liens relationnels.
M. Guillaume-Hofnung, partant de cette base conceptuelle, a développé une définition qui a trouvé une acceptation et perméabilité importantes tant auprès des praticiens que des magistrats, élus et des autres auteurs, ainsi que confirmée par les textes mentionnés ci-dessous. Ce que l’auteure appelle « définition globale » de la médiation est compris dans les termes suivants :
Globalement la médiation se définit avant tout comme un processus de communication éthique reposant sur la responsabilité et l’autonomie des participants, dans lequel un tiers – impartial, indépendant, sans pouvoir décisionnel ou consultatif, avec la seule autorité que lui reconnaissent les médiateurs – favorise par des entretiens confidentiels l’établissement, le rétablissement du lien social, la prévention ou le règlement de la situation en cause. (Guillaume-Hofnung 1995 : 71)
Évoquée dans ces deux concepts fondateurs, l’importance de la création, du maintien ou de la réparation du lien social pourra plus tard être considérée comme le trait diacritique des définitions françaises par rapport aux termes trouvés à l’étranger, cela du moins en ce qui concerne la médiation sociale, interculturelle et familiale5. Si une harmonisation conceptuelle complète n’a
5 Dans plusieurs textes, on trouvera la référence au lien social, à l’instar de la Charte de référence commune à la médiation sociale de 2001 (« processus de création et de réparation du lien social et de règlements des conflits de la vie quotidienne » ); du Code de déontologie
Camila Nicácio 4
été jamais atteinte, compte tenu du foisonnement des pratiques, l’effort entrepris dans ce sens ne peut pourtant pas être négligé. Ainsi, à la suite des premières formulations et rencontres, d’autres ont eu lieu offrant aux acteurs l’opportunité de travailler sur des bases déjà assez développées. Plusieurs colloques et séminaires ont suivi. Si les initiatives pionnières ont été le fait de l’organisation de la société civile, l’État sera de plus en plus représenté dans les expériences ultérieures, ratifiant une certaine logique de métissage qui allait depuis lors, entre institutionnalisation et désinstitutionalisation, marquer de son empreinte la médiation.
À cet égard, le besoin de clarification conceptuel et déontologique a été renforcé par l’initiative gouvernementale de mettre en œuvre, en 1997, le programme « emplois-jeunes », lequel a engendré, du jour au lendemain, une démultiplication sans précédent du nombre de « médiateurs », par le biais d’une présence massive sur l’espace public6. À la suite de cette initiative, d’autres médiateurs ont graduellement repris les fonctions auparavant dévolues aux conciliateurs ; la figure du « médiateur institutionnel » devenant ainsi quasi-omniprésente dans les cadres institutionnels les plus divers (La poste, banques, entreprises, etc.). Telle démultiplication a aggravé le « brouillage » conceptuel autour de la médiation et engendré la nécessité d’une clarification.
Ainsi, en vue de distinguer la médiation sociale des médiations institutionnelles alors émergentes (la médiation judiciaire en particulier), une rencontre européenne fondatrice a eu lieu à Créteil en 2000, où, à part le souci d’harmonisation déontologique et conceptuelle des pratiques, le problème du financement de la médiation s’est aussi précisé. Par ailleurs, l’année 2004 a également représenté une belle avancée dans l’état des
du médiateur, de 2008, « l’établissement et/ou le rétablissement des liens, la prévention, le règlement des conflits » ; la définition du Conseil national consultatif de la médiation familiale, CNMF, de 2002, à laquelle adhèrent d’innombrables associations « la médiation familiale est un processus de construction ou de reconstruction du lien familial ». Des réseaux fédérateurs des médiateurs, comme Femmes-Inter-Associations-Inter-Services-Migrants (FIA/ISM), regroupant des femmes-relais et médiatrices socioculturelles ; Association pour la médiation familiale (APMF) et France Médiation - réseau d’acteurs de médiation sociale, en sont également souscripteurs. Ces références peuvent être trouvées sur les sites de France Médiation et de la Fédération Nationale de la médiation familiale, FENAMEF, respectivement : www.francemediation.fr et www.mediation-familiale.org, consultés le 3 juin 2010. 6 Sous le gouvernement Jospin, la loi 97-940 du 16 octobre 1997 a prévu des contrats de travail à durée déterminée pour les jeunes âgés de moins de 26 ans. Ainsi, des milliers de personnes, après avoir suivi des courtes formations à la médiation, ont occupé de façon ostensible l’espace public. Cette nouvelle intervention s’est fait remarquer au sein des services publics en général, à l’instar des transports en commun et des établissements scolaires.
La médiation comme projet de société : l’expérience du Forum de la société civile sur la médiation.
5
réflexions, avec l’organisation d’une série de rencontres entre médiateurs, associations de médiation, responsables de services, élus, experts et professionnels du milieu judiciaire dans plusieurs villes en France. Ainsi, en janvier 2004, l’Association pour la formation, la prévention et l’accès au droit (AFPAD) de Pierrefitte-sur-Seine, à partir d’un partenariat entre société civile et collectivités locales, a initié un processus de réflexion avec le colloque De l’accès au droit à la médiation, un projet politique ?, qui a accéléré les démarches du Forum de la société civile sur la médiation (FSCM) créé quelques années plus tard. En mai 2004, à Angers, une autre rencontre a été organisée sur la même base partenariale et sous le nom de Régulation des conflits et médiation dans les villes européennes. Un mois plus tard, cette fois-ci à Marseille, une autre rencontre avait lieu sous le nom de L’accès au droit et la médiation, un projet politique pour les territoires et, en décembre de cette même année, un dernier colloque était réalisé à Tourcoing, intitulé La médiation sociale de proximité : quelle place durable dans les territoires ? Le point commun de toutes ces rencontres fut d’envisager le projet politique d’une médiation partie prenante d’une action publique locale en matière de régulation sociale. Cette démarche réclamait, par conséquent, à la fois plus d’autonomie pour les collectivités locales et plus d’engagement de l’État dans le financement d’une justice de proximité7.
À la suite de ces échanges, une ligne directrice portant sur une déontologie commune à la médiation a commencé, à son tour, à prendre forme. À cet effet, M. Guillaume-Hofnung a identifié quatre textes fondateurs comme la Charte du Centre National de la Médiation (CNM), évoquée plus haut, élaborée en 1988, dont le caractère généraliste ne laisse pas échapper l’ambition éthique et sociétale ; le texte du Conseil National Consultatif de la Médiation Familiale (CNCMF) de 2002, dirigé par Monique Sassier, où les figures du tiers et du processus sont désignées comme les deux principaux critères de la médiation, ce qui assure l’unité fondamentale de toute médiation8 ; le texte issu du Séminaire de Créteil de
7 Les actes de ces différents colloques sont actuellement hébergés par le Forum français pour la sécurité urbaine, FFSU, partenaire de quelques-unes des initiatives, pouvant être trouvées sur www.ffsu.org, consulté le 3 juin 2010. Pour la rencontre de Créteil, cf. Médiation sociale et nouveaux modes de résolution des conflits de la vie quotidienne, Actes du séminaire organisé par la Délégation interministérielle à la Ville dans le cadre de la Présidence française de l’Union européenne – Programme Oisin, Paris, Créteil, 21-23 septembre 2000, Les édition de la DIV ; consultable également sur le site www.ville.gouv.fr. 8 Ce texte insiste sur deux séries différentes de principes. La première ciblant la garantie du processus de médiation (libre volonté des parties, confidentialité, etc.) et la deuxième visant à assurer la qualité « de » médiateur (par le biais d’une formation appropriée), indépendamment
Camila Nicácio 6
2000, portant notamment sur la médiation sociale et interculturelle, qui deviendra depuis un texte de référence pour tous les domaines de la médiation9 et, finalement, le bulletin de la Cour de cassation de 2006, conçu à la suite des réflexions des magistrats composant le GEMME (Groupement Européen des Magistrats pour la médiation), dont l’objectif était de guider les magistrats dans leurs démarches de prescripteurs des médiations et qui abouti à la rédaction d’une sorte de vade-mecum de la médiation pour ces acteurs10.
À partir de ces quatre documents, une certaine orchestration déontologique et conceptuelle a pu avoir lieu et ce notamment dans les domaines de la médiation familiale, selon des principes déontologiques élaborés par le CNCMF ; de la médiation sociale, par le biais de la Charte de référence de la médiation sociale, adoptée par le Comité interministériel des villes (CIV) en 2001 et de la médiation pénale, qui, à défaut de principes établis sur le plan national, dispose d’un code de déontologie élaboré par l’Institut national d’aide aux victimes et de médiation (INAVEM), en conformité aux dispositifs légaux régissant ce domaine spécifique11. En ce qui concerne la médiation scolaire, les études démontrent que les expériences sont ponctuelles et souvent éphémères, relevant de l’initiative des établissements scolaires ou des collectivités dans le cadre de la politique de la Ville (Brabant-Delannoy 2009 : 5). Clairement moins institutionnalisée que dans les autres domaines, la médiation scolaire ne disposerait donc pas de dispositifs ou textes portant sur sa déontologie, restant le fait d’expériences le plus souvent isolées et non systématisées.
des qualités « du » médiateur. Cf. Guillaume-Hofnung, M. dans Ben Mrad, F. et alii (dir.) 2008 : 85. 9 Ce texte rappelle l’exigence de conformité et respect des droits des États, de l’Union Européenne et de toutes les garanties énoncées par la Convention européenne des droits de l’homme. À cet effet, M. Guillaume-Hofnung affirme que : « Si la médiation permet quelques assouplissements par rapport à certaines règles de droit, elle n’autorise pas l’oubli du droit, surtout sous sa forme la plus éminente dans nos sociétés européennes : le corpus des droits de l’homme […] ». Par ailleurs, le texte évoque aussi les valeurs que la médiation peut invoquer à son profit, telle que la liberté de développement. Ibid. : 87. 10 Cf. Groupement européen des magistrats pour la médiation (GEMME), Guide pratique à l'usage des magistrats prescripteurs de médiations, Éditions des Journaux Officiels, Hors série, numéro 4, 2006. Disponible également sur www.gemme.eu, consulté le 3 juin 2010. Le GEMME vise la promotion de la médiation en milieu judiciaire, par le biais de l’information/préconisation de la médiation, la formation des acteurs et l’harmonisation déontologique et méthodologique des pratiques. 11 Voir la loi du 4 janvier 1993, qui introduit la réparation pénale à tous les stades de la procédure pénale dans la justice des mineurs et, dans la justice des majeurs, la médiation pénale. Cf., également, la loi du 23 juin 1999 et la circulaire du 16 mars 2004, visant à perfectionner et unifier le recours à la médiation.
La médiation comme projet de société : l’expérience du Forum de la société civile sur la médiation.
7
Si l’éclatement des références déontologiques et conceptuelles continue d’être évoqué tant par des praticiens que par des spécialistes, un pas important semble avoir été fait par l’élaboration du Code national de déontologie du médiateur, à partir du Rassemblement des organisations de médiation (ROM), formé par dix associations distinctes de médiateurs, réunies le 5 février 2009 à l'Assemblée nationale. Ce code national vient à la suite du Code de conduite européen pour les médiateurs, qui, selon les signataires, serait devenu « ancien et perfectible », puisqu’il ne rendrait pas compte «des avancées actuelles de la pratique de la médiation » (Les annonces de la Seine 2009). Toutefois, une définition et une déontologie plus ou moins communes ayant été établies, il reste à savoir à quel point elles seront effectivement acceptées et suivies par l’ensemble des structures désireuses de les adapter sur le terrain et de conformer leurs besoins et spécificités aux principes généraux énoncés.
Le besoin de promouvoir ce qui a été présenté comme « l’unité fondamentale de la médiation » a donc engendré la mobilisation de nombreux acteurs sur le terrain, dont les rencontres évoquées plus haut ne sont qu’une démonstration rapide. À la suite de ces initiatives, une démarche originale pour affirmer l’intérêt pratique de l’unité de la médiation a été entreprise lors de la création du Forum de la société civile sur la médiation (FSCM), que cet article propose d’analyser dans la section suivante.
II - La médiation entre projet de société et projet de service
Parallèlement aux tentatives d’harmonisation conceptuelle et déontologique, des initiatives ont donc été entreprises visant la mise en ordre et la mise en relation des différentes expériences de médiation, en vue de bénéficier de leurs expériences réciproques, en récupérant et en réaffirmant des principes communs. Dans ce sens, les colloques de Créteil, Angers, Marseille, Pierrefitte-sur-Seine et Tourcoing mentionnés supra semblent avoir été l’embryon d’un projet à vocation plus large pour l’articulation et l’organisation de la médiation en France. Ainsi, afin de réfléchir à des thèmes cruciaux au développement de la médiation, l’idée d’un Forum de la société civile sur la médiation (FSCM) a été lancée, début 2009, sous l’égide d’un groupe depuis longtemps engagé, à des titres divers, sur le sujet12.
12 Le groupe de base fut composé par Michèle Guillaume-Hofnung (professeur des facultés de droit) ; Michel Marcus (délégué général au Forum français pour la sécurité urbaine) ; Denis Moreau (magistrat) ; Jacques Salzer (médiateur et formateur) et Monique Sassier, (inspectrice de l’Éducation nationale).
Camila Nicácio 8
L’objectif central des cinq signataires était d’insister sur l’idée d’un nouveau projet politique pour les territoires, dont la médiation serait porteuse, à partir d’un changement graduel de paradigme par rapport à la création et à l’application des normes, visant un surcroît de démocratie et de décentralisation.
L’idée de départ du FSCM tient à la richesse de la médiation pour la société civile, d’où la raison d’un forum « social », non rattaché institutionnellement. D’autres constatations de base semblent avoir motivé l’initiative de ce groupe : a) la croissance de l’offre de médiation est aussi importante que la difficulté du public à comprendre comment les différents types de médiation se présentent et s’organisent ; b) la demande pour les services de médiation est en deçà de l’offre proposée par les structures, compte tenu de cette illisibilité ; c) la vocation des structures de médiation converge vers l’indépendance vis-à-vis de l’État quoique l’on puisse noter un fort lien à l’appareil étatique et ce surtout du point de vue du financement ; d) la relation entre médiation et justice étatique mérite une réflexion, tant idéologique que pragmatique, pour qu’une logique de coopération entre elles remplace celle d’un simple « tutorat ».
À partir de ces présupposés, au moins quatre objectifs ont pu être fixés par le FSCM. À savoir : 1) contribuer au dialogue entre les différents types de médiation pour une meilleure communication entre eux ; 2) faciliter l’accès à la médiation ; 3) donner cohérence entre les logiques/dispositifs de médiation et d’accès au droit et 4) encourager l’utilisation de la médiation dans le cadre des politiques publiques grâce à la sensibilisation des élus.
Le coup d’envoi des discussions autour de ces questions a eu lieu en mai 2009, dans les locaux du Forum Français pour la Sécurité Urbaine (FFSU), partenaire qui a hébergé depuis lors les rencontres des médiateurs. À cette occasion, une vingtaine de personnes provenant de quasiment tous les champs de la médiation étaient présentes, parmi lesquelles professeurs, médiateurs, avocats, directeurs d’associations, etc. Depuis le début des rencontres, toute une gamme de questions a pu être évoquée comme : le manque de financement et le risque conséquent de fermeture de quelques dispositifs ; le besoin d’un continuum cohérent des différents types de médiation sur le territoire ; la place offerte par la justice étatique à la médiation comme mode alternatif de règlement des conflits ; la relation de sujétion entre médiation et droit étatique ; la médiation comme accès au droit ; le besoin de travailler sur la sémantique de la médiation, etc.
À en juger par la participation des acteurs, le FSCM semblait répondre à leur besoin d’un forum d’échange de leurs expériences et de leurs compétences, en comblant cet espace laissé vide, dans le flou d’innombrables initiatives qui avaient peu ou prou communiqué entre elles jusqu’alors. Toutefois, l’envie de partage ne dissimulait pas la difficulté à
La médiation comme projet de société : l’expérience du Forum de la société civile sur la médiation.
9
faire communiquer des acteurs dont la filiation renvoyait à différents champs de la médiation. L’écart entre les uns et les autres se faisait facilement remarquer. Le médiateur familial, par exemple, ne partage pas les mêmes inquiétudes que le médiateur social13, car la première est rémunérée et la seconde gratuite, la rencontre laissait donc figurer d’emblée la difficulté à trouver des surfaces de contact pour faire avancer la discussion.
En effet, la conscience du besoin d’articulation ne change rien au fait que les médiateurs sont tout d’abord engagés dans leurs domaines spécifiques, d’autant plus qu’au sein d’un même champ d’activité la difficulté d’intégration n’est pas non plus négligeable. L’exemple de la médiation sociale semble à cet effet très parlant. Un code déontologique à vocation nationale a été créé en octobre 2001, à partir de l’initiative de plusieurs structures allant du Nord au Sud de la France (comme Profession Banlieue et la Fédération des associations de Femmes-relais de Seine Saint-Denis ; Médiation Sociale d’Angoulême ; Points Services aux Particuliers Lille Métropole et l’Association de Médiation Sociale de Marseille). Ce code est également assorti d’une déclaration pour une médiation sociale « une et indivisible ». Il vise à entériner les principes généraux de la médiation (applicables à tous les champs, commercial, pénal, familial, etc.) tout en conservant les spécificités de la médiation sociale dont les modalités d’intervention dépassent le cadre de la gestion des conflits sous forme de « table ronde ». Aussi un référentiel d’activités et de compétences a été établi en 2002 pour déterminer les champs d’action de la médiation sociale. Néanmoins, selon ses organisateurs, l’édition d’un tel référentiel est une arme à double tranchant, car si elle « a contribué à clarifier les activités des médiateurs selon les contextes d’intervention, mais aussi, en revanche, au cloisonnement et au fractionnement de la médiation sociale » (cf. Duclos et Grésy 2009 :20). Aujourd’hui, ces champs d’action se concentrent, selon un cadre d’évaluation présenté en 2009 (cf. Duclos et Grésy 2009 :16 et s. ; France médiation, www.francemediation.fr, consulté le 8 avril 2010), sur
13 La reconnaissance octroyée par l’État, par le biais d’un diplôme accordé exclusivement aux médiateurs familiaux, ne contribue guère à l’intégration des différents types de médiation et médiateurs. Bien au contraire, elle semble prêter le flanc à la critique pour qu’une logique fratricide de concurrence s’établisse entre eux (quelques médiateurs évoquant la « couverture ou blindage derrière un diplôme d’État » des médiateurs familiaux). Reconnue institutionnellement, l’intervention des médiateurs familiaux est fréquemment demandée par les tribunaux alors que l’identité de l’action des médiateurs sociaux reste à prouver à chaque fois qu’une intervention a lieu, ce qui, selon les médiateurs sociaux, la relèguerait à une extension du service social. La médiation familiale est réglementée et sanctionnée par un diplôme officiel, et recommandée par la loi (Art. 373-2-10 C. civ. loi du 4 mars 2002 et l’Art. 255 al. 1 et 2 du C. civ. , rédaction de la loi du 26 mai 2004 art. 12-III).
Camila Nicácio 10
neuf axes différents, ce qui rend compte, sans l’épuiser, de la diversité des activités de la médiation sociale : la présence active de proximité ; la gestion de conflits en temps réel ou en temps différé ; la veille sociale territoriale ; la mise en relation avec un partenaire ; la concertation entre les habitants et les institutions ; la veille technique ; la facilitation et/ou gestion de projets ; la sensibilisation et/ou la formation et l’intermédiation culturelle.
Face à ces difficultés, deux préoccupations se sont progressivement révélées communes au sein du FSCM : d’une part, insister sur l’articulation et la cohérence des associations de médiation sur le territoire et d’autre part, trouver des issues à la pérennisation des services. En ce qui concerne la pérennisation des services, le besoin d’intégrer les élus à la discussion portant sur le financement de la médiation a été rappelé, d’autant plus que ses bénéficiaires majeurs sont justement la municipalité, les habitants, les bailleurs, etc. Dans ce sens, l’importance de la poursuite de la collaboration entre l’État et les collectivités a été réaffirmée, quoique l’État afficha « la volonté de s’appuyer sur les collectivités locales14 », compte tenu du coût des dispositifs de médiation. Cette problématique peut être illustrée par l’exemple des femmes-relais15, dont la pérennisation des services témoigne de la difficulté de financement. Ayant le statut d’adultes-relais16, ces médiatrices passent par des formations labélisées et payées par l’État et disposent d’un contrat de trois ans, renouvelable au maximum trois fois. Après, aucune suite n’est prévue. Comptant plus de quatre mille professionnelles en France, ces femmes connaissent profondément les réalités de leur quartier et la cessation de leur activité impliquerait, selon les associations concernées, un gâchis regrettable de temps, d’argent et d’expérience.
14 Forum de la société civile sur la médiation, Compte rendu de la réunion du 26 mai 2009, document interne, Paris, 2009. 15 Les femmes-relais sont des médiatrices socioculturelles, dont le travail vise à développer l’autonomie des personnes par une fonction d’interface entre les populations et les institutions, autour d’un objectif principal concernant l’accès aux droits et leur reconnaissance pour des populations en difficulté d’insertion sociale et culturelle. Cf. Profession Banlieue, www.professionbanlieue.org, consulté le 8 janvier 2010. 16Créé par le Comité interministériel des villes du 14/12/1999, le programme adultes-relais constitue un support important pour le développement des interventions de proximité basées sur l’écoute, le dialogue, la négociation et l’accompagnement, en amont et en complément des métiers traditionnels, en particulier ceux du travail social et de la prévention de la délinquance. Il permet de confier des missions de médiation sociale et culturelle à des résidents des quartiers prioritaires de la politique de la ville, âgés de plus de 30 ans, précédemment sans emploi ou en contrat aidé. Cf. Agence Nationale pour la Cohésion sociale et l’égalité des chances, ACSE, www.lacse.fr, consulté le 8 janvier 2010.
La médiation comme projet de société : l’expérience du Forum de la société civile sur la médiation.
11
Autour de ces difficultés, les participants au FSCM ont défendu la création d’un autre mode de gouvernance des dispositifs de médiation, d’autant plus que la forme associative ne semblait plus convenir du point de vue de la transparence du service. Ils ont proposé la création d’un cahier de charges visant le développement d’un « service d’intérêt général ‘nouvelle génération’17 ». L’échelle d’organisation de ce nouveau dispositif tendrait à privilégier la piste de la municipalité, l’État étant aussi appelé à y participer. À partir de cette proposition, le FSCM travaille donc sur trois axes de réflexion différents, partagés en groupes de travail distincts : « La médiation, un projet de société » ; « Quel service local de médiation ? » et « Les autorités publiques et la médiation ».
La médiation : un projet de société18
Penser la médiation en tant que projet de société répondait aux attentes de quelques médiateurs qui regrettaient le fait que la médiation soit souvent associée à une logique de « secours » ou de résolution des conflits uniquement, alors qu’elle aurait vocation à gérer mieux les liens sociaux, devenant un nouveau repère pour l’administration du vivre ensemble. En rappelant ses principaux enjeux (rassembler pour inscrire la médiation dans un processus de développement local/durable et faciliter son inscription en tant que service d’intérêt général local, vers une offre de médiation égalitaire), le FSCM s’est donc organisé en vue de promouvoir la médiation en tant que projet de société pour le développement durable des liens sociaux. D’un point de vue pratique, cela impliquerait l’élargissement et la mise en cohérence des services et la possibilité pour chaque citoyen d’y accéder. Dans la durée, un changement profond des mentalités serait
17 Les services d'intérêt général (SIG) sont, dans l'Union européenne, des services marchands et non marchands que les autorités publiques considèrent comme étant d'intérêt général et soumettent à des obligations spécifiques de service public. Il s'agit d'une notion propre à l'Union européenne. Elle ne se trouve pas dans les traités eux-mêmes, mais a été définie progressivement par la Commission comme une généralisation des services d'intérêt économique général (SIEG), qui sont mentionnés dans les traités. Cf. Livre blanc sur les services d’intérêt général de la Commission des communautés européennes, Annexe 1 : définitions terminologiques, consulté sur www.eur-lex.europa.eu, le 8 janvier 2010. 18 Les premiers travaux associant la médiation à un « nouveau projet de société » semblent en fait remonter aux années quatre-vingt-dix, tels ceux d’ Étienne Le Roy en 1995 et de Jean-Pierre Bonafé-Schmitt en 1998. Cette thématique ne sera toutefois reprise que plus de dix ans plus tard témoignage d’un certain cloisonnement entre les travaux universitaires et les logiques de terrain.
Camila Nicácio 12
envisagé ; la médiation tendrait à dépasser « l’adjudication »19 comme forme première de résolution et/ou administration des conflits. Selon les termes de Michel Marcus (2009) « […] il faudrait inverser les mécanismes : le processus autoritaire (police/justice) ne devrait intervenir qu’en cas d’échec de la médiation », celle-ci étant par excellence « un processus non autoritaire en amont » (FSCM réunion du 26 novembre 2009, document interne).
La médiation : un projet de service
À la suite de ces réflexions, un cahier des charges a été dressé afin de développer une charte de déontologie de la médiation comme service d’intérêt général (SIG); un préambule de présentation ; un guide de formation des futurs acteurs du SIG, aussi bien qu’une bourse d’emploi pour assurer la passerelle entre ces acteurs sur le terrain et une stratégie de communication pour mieux « vendre » la médiation aux partenaires. La forme du SIG devrait réaffirmer la possibilité de tous les citoyens d’avoir accès à la médiation, comme une extension du droit à la citoyenneté. Pour assurer cet accès, un « droit à la médiation » et la sensibilisation ainsi que l’engagement des élus « pour diffuser une culture de la médiation, faciliter la connaissance des services et organiser leur présence locale » (FSCM 2009) devraient être également défendus par le FSCM.
Par ailleurs, la médiation en tant que projet de service devrait prendre en compte les difficultés de financement qui minent la médiation et l’urgence de trouver une solution qui assure la pérennisation des services, comme on l’a dit ailleurs. Les principales idées qui ont nourri cette réflexion étaient déjà présentes en 2004, lors du colloque de Marseille, « De l’accès au droit à la médiation : un projet politique ? », tels la garantie de la qualité de la médiation (assurée par le respect des principes déontologiques) ; le continuum de médiation dans les villes (la sensibilisation au premier accueil y comprise) et la démocratisation de l’accès à la médiation (la médiation étant érigée comme un bien commun)20.
19 Ce terme est importé de l’anglais, adjudication, et fait référence au traitement judiciaire des litiges. 20 Outre ces questions, le colloque de Marseille s’était aussi intéressé au financement de la médiation, pour lequel les participants ont à l’époque prôné un système basé à la fois sur la gratuité des services et le financement aidé, selon le principe de l’aide juridictionnelle. Essentielles, d’autres questions étaient pourtant sous-estimées lors de cette rencontre et reprises soigneusement par le FSCM, tel le potentiel de la médiation dans la prévention des conflits.
La médiation comme projet de société : l’expérience du Forum de la société civile sur la médiation.
13
Les autorités publiques et la médiation
En ce qui concerne la relation entre médiation et autorités publiques, le FSCM a insisté sur deux points distincts.
Le premier porte sur le besoin de dévoiler les représentations que les pouvoirs publics se font de la médiation, pour mieux comprendre les relations établies entre eux. En principe, les pouvoirs publics ont tendance à n’avoir de la médiation qu’une certaine représentation liée aux services sociaux. Dans l’hypothèse envisagée par le FSCM d’inclure la médiation comme partie intégrante de « tout cadre juridique impliquant le citoyen, sous la forme d’une proposition de médiation, soit pour régler le litige, soit pour maintenir ou créer le lien entre les parties » (FSCM réunion du 23 septembre 2009), le statut de la médiation ne pourrait être assuré que par la clarification de la nature du mandat que les médiateurs seraient appelés à détenir, impliquant donc un changement de regard de la part des autorités publiques. Pour le groupe, si le développement de la médiation est une évidence, il n’en est pas moins vrai qu’il s’agit d’un développement à risque, risque de confusion et risque d’assimilation, et ce surtout du fait d’une représentation équivoque de la part de ses principaux financeurs. L’intérêt d’une interpellation des élus sur leurs représentations, leurs attentes, leurs implications dans le domaine de la médiation a été ainsi validé et sera mise en forme selon un modèle à définir (FSCM réunion du 11 février 2011).
En second point, le FSCM a affirmé le besoin de creuser la réflexion sur la relation entre médiation et justice étatique. Dans ce sens, le rôle de la médiation a été évoqué comme facilitant la compréhension des décisions de la justice aussi bien que constituant un élément de liaison entre celle-ci et la vie civile. Néanmoins, cette question n’a pas été traitée en détail par les participants du FSCM.
À partir de ces trois groupes de travail, des pistes pour la suite du FSCM ont été dégagées, à commencer par l’extension de la réflexion à l’échelle régionale, en confrontant les expériences de médiation dans au moins deux ou trois régions différentes, en vue d’engager ainsi d’autres partenaires en faveur de l’articulation des expériences de médiation21 ; la diffusion d’un
21 Une expérience semblable a été d’ailleurs mise en place par le Forum français pour la sécurité urbaine en partenariat avec la Région Île-de-France et la mairie de Pierrefitte-sur-Seine, à travers l’initiative du colloque « Franciliens tous médiateurs », qui a eu lieu le 24 novembre 2009 à Pierrefitte-sur-Seine. À cette occasion, quatre pratiques franciliennes de médiation ont été présentées et confrontées : Fontenay le Fleury, Issy-les-Moulineaux, Gif-sur-Yvette et Pierrefitte-sur-Seine. La diversité a été la marque indélébile de cette rencontre,
Camila Nicácio 14
questionnaire aux élus, avec pour but de favoriser le développement de la coopération entre les pouvoirs publics et les médiateurs et, selon Denis Moreau, promouvoir « la prise de conscience de l’importance de la médiation, non pas comme un dispositif supplémentaire, mais comme une dynamique de territoire » (FSCM, réunion du 26 novembre 2009).
III - Vers des nouveaux métissages institutionnels
Des points sensiblement positifs semblent pouvoir être dégagés des démarches entreprises par le FSCM. Le choix de l’échelle locale pour le développement d’un projet de service paraît prometteur par le fait d’associer l’idée de travailler en réseau, soit avec les différents types de médiation soit avec les services sociaux et judiciaires, et de donner la priorité à la cité comme étant « le meilleur niveau d’analyse pour penser tout ce qui concerne la citoyenneté locale et la participation22 », selon les mots de Michel Wieviorka (Wieviorka (dir.) 2002 : 32).
Par ailleurs, un projet de service laisse entrevoir un changement significatif vécu par les sociétés contemporaines par rapport au droit et à la justice. L'idée de soutenir la médiation en tant que projet de service d'intérêt général est fondée sur le présupposé selon lequel, potentiellement, n'importe qui aurait accès au service, ce qui explique le besoin de l'institutionnaliser et afin d’assurer les conditions de cet accès. Si à la fin des années soixante-dix, la question de « l’accès à la justice » a mobilisé les passions, et ce surtout à la suite des travaux développés par Mauro Cappelletti et son équipe (Capelletti dir. 1984), en faveur de l’effectivité des droits des moins favorisés, de nos jours c’est le « droit d’accès à la médiation » qui s’affirme, étant érigé comme bien commun, étendu à n’importe quel citoyen. La médiation en tant que projet de service rejoint donc la médiation en tant que projet de société dans le passage de l’accès au droit à l’accès à la médiation, indiquant une possibilité de changement incontestable dans le paradigme de l’administration de la justice.
chaque ville présentant un réseau de dispositifs de médiation adapté à sa politique locale. Dans le cadre du FSCM, une première rencontre est prévue à Rennes en 2011. 22 Dans cette même page, l’auteur cite James Holston et Arjun Appadurai, « Cities and Citizenship », Public Culture, n° 8, 1996, p. 187-405 : « Bien que l’un des projets essentiels de l’édification des nations ait été de mettre à bas la primauté historique du rattachement du citoyen à la cité pour la remplacer par l’allégeance nationale, les villes sont restées le terrain stratégique du développement de la citoyenneté […] Avec tout ce qu’elles concentrent entre leurs murs de non-local, d’étrange, de mélange et de public, les villes engagent de façon palpable le tumulte de la citoyenneté. ».
La médiation comme projet de société : l’expérience du Forum de la société civile sur la médiation.
15
L’accès à la justice et sa traduction pragmatique consistant dans l’accès au droit et aux droits furent dans les années soixante-dix la réponse à un pouvoir judiciaire d’élite, inaccessible aux plus démunis, et dont l’État Providence, en quête de justice sociale, avait fait sa clé de voûte, à partir d’un système élargi de protection des droits visant à assurer non simplement l’égalité formelle mais aussi bien l’égalité entre les citoyens. Actuellement, le droit d’accès à la médiation semble venir réclamer à son tour la participation et la reconnaissance de n’importe quel citoyen comme acteur de droit, compétent tant pour l’interprétation que pour la création normative.
Outre la perspective d’un projet de société, l’idée de penser un continuum de médiation dans les villes s’unit à celle de la médiation comme projet de service. Prendre en compte les différents types de médiation et les organiser sur le plan local de manière lisible et cohérente pour un public de citoyens, pourra contribuer à la croissance de son audience, aussi bien qu’à une amélioration sensible de la qualité des services. La prise en compte de l’idée de réseau aura été fondamentale pour aboutir à l’harmonisation recherchée. Ce processus viserait à apprendre aux services en contact avec le public certaines compétences de base de la médiation (écoute, disponibilité, reformulation, empathie, etc.), améliorant le premier accueil. En connaissant le modus operandi de la médiation (intervention non autoritaire d’un tiers ; protagonisme citoyen ; élargissement de l’espace rhétorique ; recours à d’autres normativités), ces mêmes services seraient en mesure d’orienter les citoyens vers les structures adéquates pour répondre à leurs besoins (médiation institutionnelle ou conventionnelle, accès au droit, services sociaux, etc.). La sensibilité aux questions qu’impose ou que propose le terrain semble en ce sens incontournable et incomparable. Le témoignage de Hibat Tabib23 et Denis Moreau en est convaincant : le premier accueil est fondamental pour la bonne prise en compte de la demande, quelle qu’elle soit, le continuum de médiation étant plus qu’une bonne orientation24.
Le FSCM, en tant qu’initiative citoyenne, côtoie alors les démarches institutionnelles qui ont trouvé dans le Sénat un éloquent partisan. Dans ce sens, Frédéric Marc et Matthieu Perdereau apportent des informations intéressantes sur l’initiative portant sur un « guichet unique de greffe », qui
23 Président de l’Association pour la formation, la prévention et l’accès au droit (AFPAD), de Pierrefitte-sur-Seine et membre du FSCM. 24 Selon Hibat Tabib, à Pierrefitte-sur-Seine, même les fonctionnaires de l’accueil, au rez-de-chaussée de la mairie, connaissent les principes basiques de la médiation et sont en mesure d’aiguiller les personnes vers le service adéquat à leur demande. (FSCM, Compte rendu de l’Assemblée plénière du 26 novembre, document interne, Paris, 2009).
Camila Nicácio 16
vise l’amélioration de l’accès à la justice par la délivrance d’une information de qualité et par la simplification des démarches (Marc, Perdereau 2008 : 77). Il s’agit de permettre aux justiciables d’effectuer dans un même lieu, divers actes de procédure, tels la délivrance d’informations pratiques ; l’orientation vers les modes alternatifs de règlements des litiges25 ou vers d’autres services d’informations (consultations et permanences juridiques gratuites, point d’accès au droit, maisons de justice et du droit) ; l’introduction d’une requête dans les affaires dispensées d’avocat et la possibilité de former un recours. Cette initiative a d’abord été lancée dans seize juridictions et étendue ultérieurement à une soixantaine. Selon les auteurs, ce dispositif relèverait d’une approche nouvelle du service public, tenant au fait d’associer les partenaires de l’institution judiciaire aux personnels des juridictions. Ils évoquent également le rapport Guinchard, qui préconise la généralisation de ce nouveau service, en vue de l’accroissement du traitement non juridictionnel des affaires. Sous le titre de L’ambition raisonnée d’une justice apaisée (juillet 2008), ce rapport donne une nouvelle impulsion à l’expérience des guichets uniques, proposant l’instauration d’un « guichet universel de greffe »26.
À considérer ces deux initiatives – la médiation en tant que projet de service et le guichet unique de greffe – issues chacune d’un ensemble différent d’acteurs, tant la médiation que la justice étatique passeraient de nos jours par des changements importants, faisant croire à une logique de métissage. De cette relation, un nouveau modèle, aussi bien de justice que de médiation, paraît pouvoir émerger. Dans ses divers enjeux (collaboration, récupération, concurrence, confrontation, etc.) cette relation semble pouvoir dévoiler tant les différents visages d’une justice étatique prête à s’assouplir à partir de la médiation, que d’une médiation déjà en train de se transformer à partir de logiques fréquentes d’institutionnalisation, suggérant l’existence
25 Utilisée par le texte législatif, rien ne serait plus problématique que l’expression « modes alternatifs de règlements des litiges ». Elle recouvrerait les méthodes conciliatrices de gestion des conflits, à l’instar de la négociation, la conciliation et la médiation. Nommées « alternatives », ces méthodes seraient définies a contrario de la méthode judiciaire, à laquelle, elles seraient, selon un critère de supériorité, subordonnées, laissant entrevoir ce que Louis Dumont a appelé « l’englobement du contraire ». (1983 : 121 et s.) 26 Un guichet universel de greffe reprendrait les missions déjà dévolues aux guichets uniques afin de « permettre à la fois aux justiciables et aux auxiliaires de justice d’introduire une instance et d’obtenir des informations juridiques concernant une procédure depuis n’importe quel site judiciaire (notamment par le recours aux technologies de l’information et de la communication) […] ». ( Marc et Perdereau 2008 : 78 et 79).
La médiation comme projet de société : l’expérience du Forum de la société civile sur la médiation.
17
d’une « double vie» (Faget 1995)27 non seulement de la médiation mais tout aussi de la justice étatique28.
Ainsi, en ce qui concerne les interrogations du FSCM sur les relations entre justice étatique et médiation - axe toutefois moins exploré par le groupe - tout un plan de recherche et de réflexion semble encore pouvoir être mis en œuvre. La médiation serait dans ce sens chargée, en tant que « facilitatrice », d’une part, de décrypter à l’intention du public de citoyens les mécanismes selon lesquels le droit étatique opère et d’autre part, de leur ouvrir la possibilité de ne pas simplement « comprendre et accepter une décision de justice» » (FSCM réunion du 23 septembre 2009), mais d’en proposer d’autres, à partir d’une participation citoyenne accrue et d’une ouverture à d’autres types de normativité. À son tour, la justice étatique, et ce surtout par le biais d’une formation juridique devenue plus souple et ainsi adaptée à ces changements, tendrait vers la reconnaissance d’une pluralité non seulement d’acteurs de droit, mais aussi de procédures, de sources, et, finalement, de droits.
La création du Forum de la société civile sur la médiation, aussi bien que l’ensemble des démarches visant le développement de la médiation qui l’a précédée, paraissent s’inscrire dans un contexte de profondes transformations concernant tant l’action sociale que l’accès à la justice, ou plutôt la relation de l’individu et des groupes avec la justice. L’État demeurant, certes, toujours indispensable à l’accès à la justice, est placé désormais dans un réseau très complexe de divers partenariats et initiatives (Santos, B. de Sousa et alii 2002), et invité à prendre ses responsabilités, à partir d’une politique ample et coordonnée ; alors que la société civile, et la
27 Cf. du même auteur, « Les fantômes français de la restorative justice : l’institutionnalisation conflictuelle de la médiation », consultée sur www.justicereparatrice.org, le 5 janvier 2010. 28 Tout un colloque a été réalisé pour interroger la médiation en tant qu’une « nouvelle donne sociale » porteuse de changements cruciaux pour la justice étatique. Ces travaux, développés par le Laboratoire d’anthropologie juridique de Paris I (LAJP), ne semblent guère avoir eu de répercussion dans le milieu des praticiens de la médiation, la plupart travaillant dans une logique de rupture avec le système judiciaire. Cela justifierait l’organisation d’un autre colloque (juin 2011) en vue de faire le point sur les différentes logiques régissant la relation entre médiation et justice étatique. Les travaux évoqués plus haut, issus d’un colloque organisé par le LAJP en 2000, firent l’objet d’une publication (Younes et Le Roy (dir.) 2002). Dans ce volume, vérifier plus particulièrement Le Roy : 77-100, à propos du déplacement de la médiation selon les différents ordonnancements sociaux. L’auteur, en libérant la médiation du carcan de l’ordre négocié, démontre comment, dans les sociétés complexes, par des emprunts ou métissages, elle peut être également présente dans les ordres imposé, accepté et contesté.
Camila Nicácio 18
création du FSCM le ratifie, veille et œuvre, en amont, pour un projet rénové de société, pour une société rénovée. À ce titre, les mots justes de Michel Marcus :
La médiation ne saurait survivre sans l’engagement de la société civile. […] Son développement requiert certes l’apport d’institutions comme la justice, mais sa vitalité naît bien de la légitimité que peut lui donner l’ensemble des citoyens. La médiation ne saurait par ailleurs survivre sans un engagement des pouvoirs publics. Il faut aujourd’hui passer à l’étape de la médiation ‘partenaire’ d’un certain nombre de services publics. Dans cette optique, il devient essentiel pour les pouvoirs publics d’investir dans des espaces de médiation qui permettent de transformer les consommateurs de droit en acteurs de droit. (in Pradet & Moreau 2010 : 7 et s.)
En guise de conclusion, il serait alors judicieux d’affirmer que la médiation, conçue comme un nouveau projet de société, ne saurait pas se passer d’une relation étroite avec la justice étatique, dans laquelle tant la première que la deuxième sont envisagées comme des choix possibles aux citoyens pour la gestion de leur vivre ensemble. Si la médiation semble plus adaptée à l’administration de certains conflits, compte tenu de la souplesse de son mode de fonctionnement, en vue de la création ou de la réparation des liens sociaux, la justice serait, à son tour, plus opportune lors des situations demandant la proclamation de l’interdit pour la production et reproduction d’un monde commun. Autrement dit, si la malléabilité des procédés de la médiation fait craindre à quelques défenseurs des droits fondamentaux un traitement inégalitaire, la rigidité de la justice étatique risquerait par ailleurs d’ouvrir de fractures sociales douloureuses, voire insurmontables. Ainsi, ne serait-il pas envisageable de considérer, pour une société métisse, un projet tout aussi métis et ouvert, où médiation et justice étatique, sans se dénaturer, se laissent inspirer l’une de l’autre, pour un droit qui trouve dans le sens de l’adéquation sa seule justification ?
Bibliographie
BONAFÉ-SCHMITT Jean-Pierre, 1992, La médiation, une autre justice, Paris, Syros-Alternatives, 279 p.
BONAFÉ-SCHMITT Jean-Pierre, 1998, La médiation pénale en France et aux États-Unis, Paris, L.G.D.J, 199 p.
BRABANT-DELANNOY Laetitia, 2009, Face à la conflictualité et à la violence, quelle efficacité de la médiation ?, Département Questions sociales, La note de veille, Centre d’analyse stratégique, n°147. 11 p.
La médiation comme projet de société : l’expérience du Forum de la société civile sur la médiation.
19
CAPPELLETTI Mauro (dir.), 1984, Accès à la justice et État-Providence, Paris, Economica, 361 p.
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, 2004, Livre blanc sur les services d’intérêt général, Bruxelles, COM 374, 29 aurop.
DÉLÉGATION INTERMINISTÉRIELLE À LA V ILLE , 2000, Médiation sociale et nouveaux modes de résolution des conflits de la vie quotidienne. Actes du séminaire Créteil, 21-23 septembre 2000, Paris, Les édition de la DIV, 215 p.
DUCLOS Hélène. ET GRÉSY, Jean-Edouard, 2009, Guide d’évaluation de l’utilité sociale de la médiation sociale, Culture et promotion, France médiation, Guide méthodologique, Collection Cahiers pratiques. Saint-Denis La Plaine, Éditions du CIV. 170 p.
DUMONT Louis, 1983, Essais sur l’individualisme, une perspective anthropologique sur l’idéologie moderne, Paris, Seuil, 314 p.
GROUPEMENT EUROPÉEN DES MAGISTRATS POUR LA MÉDIATION (GEMME), 2006, Guide pratique à l'usage des magistrats prescripteurs de médiations, Éditions des Journaux Officiels, Hors série, numéro 4.
GUILLAUME HOFNUNG Michèle, 2005, La médiation, 3e édition, Paris, PUF, 128 p. coll. Que sais-je ?,.
GUILLAUME HOFNUNG Michèle, 2008. « L’émergence de l’exigence déontologique ou la preuve par la déontologie : témoignage d’une pionnière. La déontologie garante de la qualité et de l’identité de la médiation », dans Fathi Ben Mrad et alii (dir.), Penser la médiation, Le travail du social, Paris, L’Harmattan. p. 75-97.
FAGET Jacques., 1995, « La double vie de la médiation », Droit et société, n° 29, Paris, L.G.D.J, p. 25-38.
FAGET Jacques, s.d., « Les fantômes français de la restorative justice : l’institutionnalisation conflictuelle de la médiation », consulté sur www.justicereparatrice.org, le 5 janvier 2010.
FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE SUR LA MÉDIATION, 2009, Compte rendu de la réunion du 26 mai, Paris, document interne.
FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE SUR LA MÉDIATION, 2009, Compte rendu de la réunion du 23 septembre, Paris, document interne.
FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE SUR LA MÉDIATION, 2009, Compte rendu de la réunion du 22 octobre, Paris, document interne.
FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE SUR LA MÉDIATION, 2009, Compte rendu de la réunion du 29 octobre, Paris, document interne.
FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE SUR LA MÉDIATION, 2009, Compte rendu de l’Assemblée plénière du 26 novembre, Paris, document interne.
FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE SUR LA MÉDIATION, 2011, Compte rendu de la réunion du 11 février, Paris, document interne
LE ROY Étienne, 1995, « La médiation mode d’emploi », Droit et société, n° 29, Paris, p. 39-55.
Camila Nicácio 20
LE ROY Étienne., 2002, « La médiation comme ‘dialogie’ entre les ordonnancements de régulation sociale », dans Younes, C. et Le Roy, É. (dir.), 2002, Médiation et diversité culturelle, Pour quelle société ?, Paris, Karthala, p. 77-100.
LE ROY Étienne, à paraître, « L’horizon de la juridicité. Comparer les différences dans leurs complémentarités pour repenser les droits dans une perspective globale de régulation des sociétés contemporaines », Communication au congrès « Les frontières avancées du savoir du juriste », Accademia delle Scienze di Torino, 25 au 27 avril 2007, 29 p.
LES ANNONCES DE LA SEINE, 2009, Code National de déontologie des médiateurs, Lundi, 11/05/2009, n° 3.
MARC Frédéric et PERDEREAU Matthieu, 2008, La Justice : un droit pour tous ?, Paris, Le Cavalier Bleu Éditions, 157 p.
MOREAU Denis, 2001, « Médiations : vers un projet politique ? », Revue Territoires, novembre, n° 422.
PRADET Alain et MOREAU Denis, 2010, Franciliens tous médiateurs !, Forum français pour la sécurité urbaine, Paris, 64 p.
SANTOS de Sousa Boaventura et PEDROSO, João. (dir.), 2002, O acesso ao direito e à justiça : um direito fundamental em questão, Coimbra, Observatório Permanente da Justiça Portuguesa, Centro de Estudos Sociais, 439 p.
SILVA NICACIO, Camila, 2010, “Mediação para a autonomia, alteridades em diálogo”, dans Maria Tereza Fonseca Dias (org.), Mediação, cidadania e emancipação social, Belo Horizonte, Editora Fórum, p. 151-168.
SIX Jean-François, 1995, Dynamique de la médiation, Paris, Desclée de Brouwer, 300 p.
SIX Jean-François, 1990, Le temps des médiateurs, Paris, Seuil, 284 p.
WIEVIORKA Michel (dir.), 2002, La médiation, une comparaison européenne. Saint Denis La Plaine, Les éditions de la DIV, Délégation interministérielle de la ville, 213 p.
YOUNES Carole et LE ROY Étienne (dir.), 2002, Médiation et diversité culturelle, Pour quelle société ?, Paris, Karthala, 311 p.
Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale (NOR: JUSX0104902L).
Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce (NOR: JUSX0300062L).
Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale (NOR: JUSX9200023L).
Loi n°99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale (NOR: JUSX9800051L).
Circulaire CRIM 04-3/E5-16-03-04 (JUS-D.04-3004C).
Sites internet consultés www.francemediation.fr, France médiation, consulté le 8 avril 2010.
www.mediation-familiale.org, Médiation familiale, consulté le 3 juin 2010.
La médiation comme projet de société : l’expérience du Forum de la société civile sur la médiation.
21
www.ffsu.org, Forum français pour la sécurité urbaine, FFSU, consulté le 3 juin 2010.
www.ville.gouv.fr, Ministère de la Ville, consulté le 3 juin 2010.
www.gemme.eu, Groupement européen des magistrats pour la médiation, consulté le 3 juin 2010.
www.professionbanlieue.org, Profession Banlieue, consulté le 8 janvier 2010.
www.lacse.fr, Agence Nationale pour la Cohésion sociale et l’égalité des chances, ACSE, consulté le 8 janvier 2010.
www.eur-lex.europa.eu, Commission européenne, consulté le 8 janvier 2010.