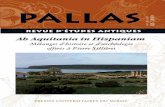Mélanges Irène Mélikoff
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Mélanges Irène Mélikoff
Mélanges
Irène Mélikoff
ÉMIGRATIONS & VOYAGES (REV)Publiée par le Laboratoire d’Études Socio-Historiques les Mouvements Migratoires,
Université Constantine 2
Avril 2014
Hors série
Laboratoire d’Études Socio-Historiques les Mouvements MigratoiresBp. : 317 Université Constantine 2 - CONSTANTINE, 25017 ALGÉRIE.
Tél. : +213 30 20 34 21E. mail : [email protected] / Site web : www.kml-filali.com
DIRECTEUR Kamel FILALI
RÉDACTEUR EN CHEFHacène SAADI
COMITÉ DE LA RÉDACTION,Kamel FILALI, Hacène SAADI, Hosni BOUKERZAZA,
Orhan KOLOĞLU, Foudil DELLIOU, Jamel ALI-KHODJA
COMITÉ SCIENTIFIQUEAl Sayyad FULAYFAL (Institut d’Études Africaines, Université du Caire), Kamel FILALI, (LERSHM, Université de Constantine), Franco Francisco
SANCHEZ (Institut d’Études Arabes, université d’Alicante), Husni BOUKERZAZA (Départ. de géographie, Université de Constantine), Khayriya QASIMI (Dept. D’Histoire, Université de DAMAS), Hacène SAADI
(LERSHM, Université de Constantine), Abdeldjallil TEMIMI (FTERSI, Tunis).
Secrétariat de rédaction Martine Dumont
Maquette (Couverture) et mise en page Zoheir BENAMIRA
CORRESPONDANCESToute la correspondance (manuscrits, livres et périodiques, etc.) doit être adressée à : Monsieur kamel FILALI Directeur de la REV, Laboratoire d’Études Socio-Historiques les Mouvements Migratoires, Bloc des Scien-
ces, 317 Université Constantine 2, CONSTANTINE, 25017 ALGÉRIE.Tél. : +213 30 20 34 21
E. Mail : kmlfilali@gmail / Site Web : http://www.kml-filali.com
ISSN :W 1112-6140Dépôt légal
Publication LERSHM 2014
RECOMMANDATIONS DE MISE EN FORME
• TITRE DE LA CONTRIBUTION : Majuscules, 16 Times New Roman Gras. Commencement de la première page au 4ème centimètre vertical.- Prénom, NOM de l’auteur : 12 Times New Roman- Sous titre : 12 Gras - Intertitres : 1er niveau en gras ; et si besoin, 2ème niveau en italiques. Justifié 1 cm comme le Texte.
• Texte : 12 Times New Roman, simple interligne.- Les citations sont placées entre guillemets.
• Références de bas de pages : 10 Times New Roman- Appels de notes : exposant, en fin de phrase (sauf si nécessaire pour citation biographique ou autre).- Numérotation continue automatique. Numéro de référence est suivi d’un point, d’un espace, puis du contenu de la note.- Ouvrages : Prénom NOM de l’auteur, titre, lieu ou ville d’édition, Maison d’édition, Année, Page. Ex : Jaques BERQUE, L’intérieur du Maghreb, Paris, Gallimard, 1978, p. 12.- Périodiques : Prénom NOM, « Titre », Revue , t , n°Ex. : Louis FERAUD, « Monographie des villes et Provinces du constantinois », Revue Africaine, t. XXVII, n° 13, juillet-septembre 1870, pp. 301-314.- Archives : fonds, localisation et référence dans la première citation avec abréviation et par la suite les abréviations seulement suivies des référen-ces. Exemple : Archives Nationales Algériennes (A.N.A, Bir Khadem, Alger, B 2) ; ou Archives départementales de Constantine (A.C, ae 21).- Le (e) après les chiffres romain de siècle est en exposant, (XIe)- Référence déjà citée :J. BERQUE, L’intérieur..., op. cit. p. 45-52 ; L. FERAUD, art. cit. p. 325.
• Références bibliographiques :Jaques BERQUE, L’intérieur du Maghreb, Paris, Gallimard, 1978, 552 p.
• Photos, Graphiques et tableaux devront être transmis séparément sous leur forme initiale (pdf, Excel, ou autres) : ne pas incorporer dans le texte sous Word. De même pour les cartes, à fournir séparément.
• Un résumé d’une dizaine de lignes en français ou en anglais est obligatoire ; un autre résumé en langue arabe pour ceux qui maîtrisent la langue arabe, pour le reste la Rédaction se charge de traduire le résumé de la langue d’origine de l’article (vers l’arabe).N. B : Les articles envoyés à la REV. doivent être inédits. L’auteur s’engage à conserver l’exclusivité pour la Revue. Après réception du texte à publier, l’auteur est avisé dans un délai maximum de trois mois. Les manuscrits des articles non retenus ne sont pas retournés.
CouvertureMaquette : Zoheir BENAMIRA
Les opinions exprimées dans les articles n’engagent que leurs auteurs.
SOMMAIRE
• PRÉSENTATION Pr. Kamel Filali
11
• Le soufisme algérien au XVIIe siècle, entre la shari’a et la haqîqa Pr. Kamel Filali
15
• Retorno a Hansala : langue, interculturalité et cinéma Dr. isabel KNOERRiCH PaRTiSaNi
29
• La sexualité a travers quelques œuvres maghrébines des années 1950 aux années 1980
Pr. Jamel ALI-KHODJA45
• Chaires arabes et études orientales en Algérie à l’époque colonia-le : entre desseins coloniaux et orientalisme maghrébin
Pr. Kamel FILALI69
• Writing of the origin : language and historicity in Assia Djebar’s “effacement sur la pièrre ”
Dr. Ayşe DENIZ TEMIZ85
• Educational technologies and language motivational instructions
Salima MAOUCHE-KETFI113
11
Irène Mélikoff éminente turcologue-ottmanisante de renommée mondiale, née le 7 novembre 1917, à St. Petersbourg, d’un père for-tuné originaire de Bakou (Azerbaïdjan). En raison des soubresauts révolutionnaires qui sévissent alors en Russie, lors de la révolution bolchevique, la famille quitte le pays et s’installe à Paris, après un court séjour en Finlande. Irène Mélikoff chemine son cursus sco-laire dans de prestigieux collèges et lycées du quartier latin. Dans ce carrefour d’élites intellectuelles de la Haute culture, la jeune russe s’imprégna vite de la littérature orientale et se fascina par les courants spirituels mystiques en l’occurrence persans et turcs. Cette fascination pour l’Orient turco-persique l’oriente, en 1940, vers l’Institut des Langues Orientales (INALCO) (conçu par Napo-léon I pour conquérir l’Orient), Dans ce fameux institut d’Etudes Orientales, elle oriente ses études vers la civilisation turque. Son cursus à l’INALCO se voit perturbé par la Seconde Guerre mondia-le (1939-1945) et la main-mise des nazis sur Paris. Après la guerre,
PRÉSENTATION
12
Irène Mélikoff termine un diplôme d’études approfondies sur le monde Turco-Iranien. Au début des années cinquante, elle quitte Paris pour Istanbul et séjourne en Turquie pendant 7 ans. Après ce périple, Irène Mélikoff rentre à Paris; elle s’intéressa tout d’abord à la littérature épique et publia son premier ouvrage «le Destan d’Umur Pacha», récit épico-historique des conquêtes d’un émir d’Asie mineure occidentale au XIVe siècle. En 1957, elle soutient son doctorat ès lettres, sous la direction de Jean Deny, consacré à : « La Gesde de Melik Damismend (publiée en 1960 Chez Adrien Maisonneuve). En 1960, elle est engagée comme chercheur perma-nent au CNRS. En 1968, elle est nommée maître de chaire à l’Uni-versité Marc Bloch de Strasbourg, et devient, grâce à ses nombreux travaux, pionnière des Études du monde turco-iranien en France ; professeur titulaire, l’année suivante, elle fait alors du Département d’études turques un des hauts lieux des Études orientales qui brilla dans les années soixante comme un grand phare.
Madame Mélikoff était très appréciée par tous ses collègues et élè-ves de Strasbourg et en l’occurrence par notre collègue Paul Du-mont, élève de la défunte, à laquelle il succéda à la tête de l’Institut deux ans avant la soutenance de notre thèse de doctorat, sous sa direction (1993). Tous les collègues de France et d’ailleurs témoi-gnent de son caractère maternel et protecteur. Personnellement j’étais émerveillé par sa générosité, sa sympathie et sa modestie. Elle a eu la gentillesse non seulement de m’offrir l’hospitalité, mais de m’ouvrir son propre fond documentaire, m’ayant permis de travailler à son domicile, situé à quelques mètres du palais de l’Université. Irène Mélikoff a formé de nombreux turcologues et ottmanisants dans le monde entier qui aujourd’hui deviennent des relais de science et de savoir. Dans le sillage de son profil aca-démique, Irène Mélikoff a fondé, en 1969, la première Revue du monde turc qu’elle baptisa « Turcica ». La revue, de rang magistral international, publie des recherches ayant trait aux peuples, lan-gues et cultures turco-ottomanes.
13
Paul Dumont, Grammont prennent le relais et assurent la di-rection avec Gilles Veinstein du Collège de France, de la revue Turcica, Le Comité international des études pré-ottomanes et ottomanes (CIEPO), créé avec le professeur ÖmerLütfiBarkan, continue également les efforts de sa co-fondatrice en organisant régulièrement des rencontres entre universitaires. Nous y avons pris part à de nombreuses occasions à (Strasbourg), Mont-Real (Canada), Aix-en-Provence (France), Wien (Autriche), Budapest (Hongrie), Ankara (Turquie) notamment, comme nous y avons aussi eu l’honneur de contribuer à ses côtés à de nombreux tra-vaux notamment à l’Encyclopédie ottomane «Osmlanli tarihi», Ed. Guler Ankara, 2006, et au grand ouvrage collectif «mysticism contested» , sous la Direction de Frederick de Young, publié à Brill, (New-York Amesterdam). Reconnue mondialement comme spécialiste de l’islam hétérodoxe turc, Irène Mélikoff a reçu de nombreuses distinctions honorifiques, dont l’Ordre des Palmes Académiques en 1983. Ses recherches sur le soufisme, qu’elle a poursuivies du haut de son âge de 90 ans, ont été maintes fois ré-compensées et à plusieurs niveaux. La mystique sunnite et chiite, l’alévisme et le bektachisme se situaient au cœur de ses travaux. Menées en Turquie et en Anatolie, ses recherches ont notamment permis de mieux faire connaître la communauté alévie, grâce aux informations recueillies sur le terrain dans des Teke et des zaouïa. De renommé mondiale, I. M. suscitera même l’intérêt des médias tel le journal «Le Monde» qui s’intéressera particulièrement à ses périples en Orient. L’association créée en son honneur, après son décés, le 9 janvier 2009, contribuera sans doute à élargir et diffu-ser ses œuvres, et mettra à la disposition des chercheurs spécia-lisés le très riche patrimoine de la grande spécialiste du monde turco-ottoman.
Pr. Kamel FILALI
15
L’idée générale de cette publication se forge essentiellement autour du phénomène de la concomitance presque totale entre la shaîca (la jurisprudence) et la haqîqa (la connaissance), parmi les rangs des ‘ulâma’/s algériens, au XVIIe siècle, qui furent à l’origine deux aspects difficilement réconciliables, depuis la constitution des écoles juridiques en Orient notamment à l’époque abbaside.
En effet, le soufisme dans sa quête de la Vérité divine (al-haqîqa) et l’Orthodoxie (al-sharî ‘a) dans sa quête de l’équité et de la jus-tice font bon ménage au Maghreb du XVIIe. Ce siècle fut consi-déré à l’unanimité, par tous les spécialistes : islamologues, arabi-sants et orientalistes, tels Robert Brunschvicg, Louis Massignon et Jacques Berque, entre autre, comme le siècle de la crise de la mystique et de l’ankylose de l’islam d’une manière générale. Pour-tant on est loin de la rupture provoquée, en Orient musulman, entre le soufisme et l’orthodoxie depuis le IIIe siècle de l’hégire et qui atteingnit son apogée au Xe siècle de l’hégire (XVIe). En
LE SOUFISME ALGERIEN AU XVIIe SIECLE, ENTRE LA SHARI’A ET LA HAQÎQA
Pr. Kamel FilaliDirecteur de Recherche au Labo. de Recherche Socio-historiques et Mouvements Migratoires (al-Rihla wa Hijra).Université de Constantine 2
Le soufisme algerien au XVIIe siecle, entre la shari’a et la haqîqa
16
Occident musulman, en l’occurrence à Constantine, à Tlemcen et Bûna (hauts lieux de l’islam malékite), sûfi et calim se confondent souvent. L’un peut troquer son habit religieux avec l’autre ou le changer. Il arrive aussi qu’un seul personnage endosse la khir’qa (bure) de saint-sûfî et la ‘abâ’a (tunique) de faqîh. ‘Abdu-al-karîm al-Faggûn (-988 /1580 -1073/1662) shaykh al-islam (doyen de l’Is-lam) à Constantine, grammairien, khatîb (prédicateur), qâdî al-jamâ’a (doyen des juges), figure emblématique du fiqh était, en même temps, sûfî se réclamait d’un rigorisme ardent et s’affichait comme un détracteur de la mystique thaumaturge qu’il considé-rait comme laxiste à propos du halâl et du harâm 1.
En réalité, l’amour Divin 2 recherché par les uns ne portera pas ombrage à la justice terrestre et eschatologique tant espérée par les autres. Le fiqh et le tasawwuf étaient pratiqués avec la même passion. De ce fait les majâlis al-fuqahâ’ (cercles juristes) et les majâlis al–‘ulamâ’ (cercles des savants) se confondirent souvent avec les cercles des sûfî.
La voie des syncrétistes
Et c’est alors que les qâdî (juge appliquant la sharîca) et ‘âlim (docteurs en théologie), voire parfois toute une lignée d’une école juridique se constituaient autour d’une voie mystique ; la plus favorite qui attira les ulémas à cette époque fut la Zarruqiya 3. Cette tarîqa dérivée de la shadhûliya, était en vogue parmi l’élite savante maghrébine. Ah’mad al-Zarrûq (846h-899/ 1442-1398), dans son guide qu’il intitula « ‘uddat
1. « Manshûr al-hidâya tî kashf hâl man ada’a al wilây a » من�شور الهداية يف ك�شف .,حال من ادعى الولية، دار الغرب الإ�شالمي، بريوت، ط، 19872. Al-hubb pour certains al–‘ishq pour d’autre.3. Sheikh Zarrûq dit dans Qawâ`id Al-Tasawwuf : « Le soufisme a été défini, analysé et interprété de plus de deux mille manières, ayant toutes pour dénominateur commun le cheminement sincère vers Dieu, le reste étant des facettes de ce fondement. »
Kamel Filali
17
al-murîd al-Sadaq (le manuel du néophyte sincère) » 1, conçut comme garde-fou pour éviter au soufisme exhalé par sa tarîqa (confrérie) les déformations et les atteintes à la rigueur du sufisme pur. L’idée princi-pale de cet abrégé tourne autour de la Bid’a’ (innovation) qu’il consi-dère comme la cause principale “du mal” qui commence à infecter le tasawwuf depuis XVe siècle. Cette pureté recherchée motiva les émi-nents savants juridiques. Le ‘Âlim et sûfî, ‘Abdu-al-karîm al–Faggûn, le grand-père, fondateur de l’école constantinoise du fiqh malikite, ad-héra à la Zarrûqiya ; son petit fils, homonyme, ‘Abd-al-karîm al–Fag-gûn (-988 /1580 -1073/1662) (savant des savants) était, lui aussi, affilié à la Zarrûqiya. Initié par son père, Muhammad al-Faggûn, il adhère à cette silsila (chaîne initiatique) ainsi que tous ses condisciples, élè-ves de ‘Umar al-Wâzan (mort en 965h/1558), un faqîh grammairien qui fut beaucoup plus versé dans l’ésotérisme, « Un océan de science dont personne n’oserait s’aventurer » (Bahr lâ yujâra’ fî al-culûm بحر العلم .notait le « Manshûr al-hidâya » (le traité de la foi) 2 (ل يجارء يف C’est son ami Ahmed al-Awrâsî, dit-on, qui l’habilla de la khir’qa, étant lui-même initié par al-Tâhar b. Ziyân 3. Son élève grammai-rien et néophyte, l’algérois, ‘Îsâ al-Thacâlibî (1080/1680), « le maître des deux Orients et des deux Occidents » 4 évoquant sa double qualité de ‘Alim al-dâhir et ‘alim al-bâtin (soufi) disait de lui que : « Dieu L’a doté de science et de pratique et L’embellit par le zuh’d et l’austérité » 5.
A propos de ce phénomène d’adjonction entre l’ésotérisme et l’exo-térisme, Muhammad b. Hussayn al-Rifâ’î (mort en 1338h), note qu’« il est la perle pure de l’ésotérisme et de l’exotérisme. » 6.
1. عدة املريد ال�شادق، حتقيق ال�شادق عبد الرحمان الغرياين، دار ابن حزم ، بريوت، 361 �شفحة.
2. Manshûr, pp. 35/37.3. Al cAyâshî, al-Rihla, T. 2 p. 206.4. Kanzu al-ruwât, p. 300 ; Abû al-Qâsim Sacdallah, Shaykh.., p. 113.5. Kinzat al-ruwwât, m. s, p. 300.
Muhammad Ben husayn al-Rifâ’i, اخلال�ص », جوهره و الظاهر باطن 6. « الباطن Qalâ’d al zabrajad alâ hukm mûlâna al-ghût. (قالئد الزبرجد على حكم مولنا الغوث),
Le soufisme algerien au XVIIe siecle, entre la shari’a et la haqîqa
18
‘Abd-al-karîm al–Faggûn n’avait aucun contact avec la mystique orientale qu’il considérait moins rigoriste voire timorée dans les affaires du halâl et du harâm et lui endossa la responsabilité d’avoir rabaissé le soufisme au niveau de pratique folklorique de Samâ’ qu’il qualifiait d’innovatrice et charlatanesque. Il se blasa contre certaines pratiques soufies, telles la hadra et les protocoles de l’initiation par la délivrance de la ‘ijâzah dont il contesta la fia-bilité dans ce domaine aussi spiritualiste que le tasawwuf. Lorsque il initia le fameux voyageur de Sijilmasa, le marocain, al-‘Ayâshî et l’habilla de la khir’qa, il refusa de lui remettre une ijâza écrite et suffit de lui évoquer un célèbre hadith de l’imâm al-Shâdhulî : « Tu as ce que nous avons comme service, et la clémence et sur toi comme elle est sur nous. 1 » Al- ‘Ayâshî disait que : « ce mot me satisfait de crainte que je le gênasse surtout qu’il est un homme d’état mystique (rajul hâl) » 2. A cette ambivalence s’associa, aussi, le fameux histo-rien et voyageur le Tlemcenien Abû al-’Abbâs al-Maqarrî (mort en 1041h/1632) et ‘Alî al-Ajhûrî (mort en1066h/1656), une sommité du fiqh malikite à al-Azhar. Le Saharien Sîdî Abdu-al-Qâdar dit Abû Smâha, l’aïeul des Ûlâd al-Shaykh était zarrûqî à tendance mystique avant que son fils sîdî al-Shaykh ne créa, lui-même, la shaykhîya au XVIIe siècle.
Un syncrétisme qui se confond dans les lieux et les personnes,
L’ambivalence canonique se reconnaît aussi bien dans les person-nages que dans les lieux et les institutions religieuses. La mixité des lieux de culte Zaouïa, Masdjid (mosquée), Djami’ (Mosquée/ École) et Madrasa (Écoles juridiques) était une chose très courante dans l’Algérie du XVIIe siècle. Ghris, Mascara, Tlemcen, Miliana, Alger, Bejaia Constantine et Bûna étaient les plaques tournantes
.Dâr al-kutub al-igmiya, Beyrouth, 1971.Manshûr, p. 42 ; ( لك ما لنا من خدمة وعليك ما علينا من رحمة) .1
2. Al cAyâshî, al-Rihla, T. 2 p. 390
Kamel Filali
19
du fiq’h maghrébin où se tissaient réseaux de faqîh et s’empilaient les tabâqât (classification) des oulémas et les silsila (chaînes ini-tiatiques) de sûfî.
A l’Est, Constantine, lieu de transit entre l’Atlas et le Sahara, l’Orient et l’Occident, et Bône (Bûna, à la frontière tunisienne) lieu de halte de toute sorte de rihla (vers l’Orient), favorisaient se phénomène de concomitance et de cohabitation de la loi cano-nique et de la connaissance mystique.La plus ancienne mosquée fondée par Abd al-Malik b. Marwan b. Ali al-Kittânî al-Ishbîlî (mort en 1111) 1 symbolisait ce fait de jumelage. Elle fut institut de fiqh et un des cercles sûfî les plus exaltés dans la Régence d’Al-ger. Ahmad al-Bûnî (1653-1726) était le personnage qui marqua le plus cette École adjoignant sharî‘a et haqîqa depuis son aïeul, Abu al-‘Abbas Ahmad b. Ali al-Bûni, le fameux auteur de « shams al-ma’ârîf شم�ص املعارف� (le soleil des connaissances) », un ouvrage sur la ‘irâfa (la connaissance mystique) le plus édité dans l’histoire de l’Algérie 2 et le plus utilisé dans le shr et le tanjim (la sorcellerie et la voyance populaire). Dans sa : « Dûrra al-masûna fî ‘ulâma’ we awliya’ bûna بونة اأوليا و امل�شونة يف علماء la perle précieuse) الدرة dans la connaissance des savants et hommes pieux de Bûna », Ah-mad al-Bûnî 3 certifie que la plupart des ‘ulémas, à Bilâd al-‘Annâb (Annaba : Bûna), étaient des hommes pieux et étaient objets de vénération populaire tel le cas du patron de la ville le qotb sîdî Brahîm et Ibn fadhlîn auteur de « Histoire des Ulémas de Bûna بونة -il enseignait le fiqh malikî et organisait des cer ,« تاريخ علماء cles mystiques. Abd-al-Krim al-Faggûn détracteur de Sâsî al-Bûni pour ses pratiques thaumaturges, considère, son petit fils, Ahmad al-Bûni comme maître incontesté de ‘ilm al-dâhir et ‘ilm al-batin.
1. Babes Leila, l’intérieur de l’Algérie, édition al-Burâq, Beyrouth, 2000, p. 90.2. L’ouvrage en est à sa 12ème édition, nous disposons de la 4ème édition.3. احلفناوي، تعاريف ال�شلف برجال اخللف، موؤ�ش�شة الر�شالة، املكتبة العتيقة، الطبعة
الثانية، �ص 532.
Le soufisme algerien au XVIIe siecle, entre la shari’a et la haqîqa
20
C’est apparemment de son époque que date la renommée de Bûna (Annaba) dans le fiqh malikî.
La haqîqa et la sharî’a se confondaient comme se confond le ‘ilm (la science) et les karamât (prodiges). Quand certains détracteurs de ce panachage, considérant comme affaiblissant l’âme de fiqh, attaquent Ahmad al-Bûnî pour sa pratique du smâ’ et ses allures mystiques thaumaturges, il réplique « La conviction est saintetée et la critique est crime. » 1 Ahmad al-Bûnî voulant emboîter le pas à l’auteur de « Manshûr al-hidâya », ‘Abd-al-Krim al-Faggûn, clas-sait les saints/ savants en « orthodoxes et hétérodoxes » alors que lui-même était sujet de critique et taxé de mubtadî’ (hérétique) 2. Plus récemment abû al-Qasim Sa’dallah commentant une fatwa sur la hadâna (adoption), (Tarikh al-Taqâfî, T. I, p. 419) ne pouvant cacher son parti pris contre Ahmad al-Bûnî en l’accusant d’être imprégné du rite hanafite et de l’esprit hérétique ; il écrit que ceci : « est la preuve que l’esprit d’idjtihâd et de liberté rationnelle était encore pratique, même chez les semblables de al-Bûnî qui alliaient le fiqh au soufisme. » « Serait-ce alors son tasawwuf qui a entaché la réputation d’Ahmad al-Bûnî ? » S’exclama Leila Babès. 3
Hérétique aux yeux de certains, orthodoxe au regard des autres, Ahmad al-Bûnî défendra son statut de ‘âlim et de ‘ârif et celui de ses ailleux, notamment de son arrière grand père Ali al-Bûnî, de son grand père, Sâsî, et même de son propre fils et son condisciple qui l’initia après lui avoir octroyé la idjâza, qu’il transmit, à son tour à Husayn al-Wartilânî. 4 Ce faqîh kabyle croyait aux karamât
1. « جناية العتقاد ولية و النتقاد »2. Il eut plus de cent ouvrages entre shûrûh, mukhtasarât, tafâsîr et manaqib. Lors de la colonisation, en 1832, les Bûnî émigrent à Bizerte (Tunis) et emportent avec eux la bibliothèque de la famille. Beaucoup de ses ouvrages furent introuvables.3. Leila Babes, op-cit, p. 96.4. Muhammad al-Hafnâwî, Ta’rif al-khalaf bî rijâl al-salaf, Mu’assasat al-risâla, Damas, 1958, 1. p. 141.
Kamel Filali
21
et disait que lui-même était imbu de l’esprit saint. Ceci ne l’empê-cha pas de marquer son temps par un livre sur l’Histoire.
« L’école constantinoise des Al-Faggûn », haut lieu de jurispru-dence, qualifiée de Dâr al-Sharî’a (une Maison de loi canonique) spécialisée dans le fiqh malikite et le nah’w, était, comme nous l’avons dit, d’une manière catégorique impliquée dans le zuh’d, et ses membres pratiquaient la khul’wa (la retraite mystique), sans pour autant dénier à leurs nombreuses tâches : spirituelles, cano-niques et intellectuelles et parfois même politiques. A la mort de son père, Muhamed, (1045h/1635) auteur des « Nawâzal », ‘Abdû-al-Karîm al-Faggûn hérita officiellement de toutes les fonctions nobles de la ville de Constantine, que sa famille occupait déjà de-puis trois générations, à savoir le sacerdoce, les fonctions tribuni-tiennes de khatîb, la gestion des habûs de la Grande Mosquée en plus de sa qualité de maître de la Zarruqiya à Constantine et de Emir rakb al -Hajj (la caravane de la Mecque).
C’est plutôt la synthèse de la sharîca et la haqîqa qu’il consentit, au point que certains de ses disciples confondaient les temps où il fut ceci ou cela.
Le soufisme algerien au XVIIe siecle, entre la shari’a et la haqîqa
22
Comment donc expliquer une telle ambivalence et cet esprit de duplicité presque généralisé au point de devenir une tradition parmi les lettrés maghrébins, un esprit de syncrétisme de la ha-qîqa mystique et de la sharî’a canonique qui marqua la religiosité de cette époque ?
Contrairement à Tlemcen, Mazouna, Ghris et Mascara, Alger Constantine et Bûna étaient moins acquises au charifisme marqué par la baraka héritée de la généalogie prophétique, elles étaient plutôt imprégnées par le mouvement hilalien qui fut au départ un
Kamel Filali
23
phénomène bédouin 1. Mais ceci ne les empêcha pas de devenir des centres de fiqh au XVIIe et XVIIIe siècle, et du réformisme musulman au XIXe siècle.
A Ghris, l’autre bout de l’Algérie submergé par le mouvement ché-rifien depuis le XIVe siècle, où savoir, sainteté et prestige ances-tral vont de paire, on constate l’amalgame est presque de taille. Rammâsî, imbu de la théologie ghazalienne, résolument faqîh, adhère entre autres, à la synthèse 2. Il n’hésita pas à endosser aussi la khir’qa et organise des hadra. A la fin de son cycle, à Mazou-na, l’autre pays des chorfas, son maître, un certain sîdî Hannî, les autorisa, lui et ses condisciples, après leur avoir délivré les idjâza, de rentrer chez eux dans la province de Mostaganem. A Rammâsî, il conseilla al-madhhab (le rite) c’est-à-dire le fiqh malikite, au shaykh Omar b. Dhib, il prescrit la wilâya (la sainteté : le sou-fisme), à Shaykh al-‘Arbî le bendîr (le tambour) sous entendant le maraboutisme. Se félicitant de cette reconnaissance en sciences juridiques, dès son retour à son bourg, Rammâsa (Mostaghanem), al-Rammâsî institua son cercle mystique et s’initia à la Shadhûliya par un certain Sîdî Muhammad al-Sahrâwî.
Pourquoi donc cette ambivalence ? Rammâsî, ce juriste de renom, qui entre la sharî’a et la haqîqa opta pour leur synthèse, explique ce choix qu : « ’on ne peut avoir accès à la haqîqa sans avoir une solide connaissance de la ma’rîfa, car la sharî’a est la science la plus cohérente par son argumentation (al-hujja), la plus claire par sa méthode et la plus noble par ses conclusions. C’est elle qui facilite l’accès à la compréhension de Dieu et de Ses Attributions, Dhât al-Haqq wa Sifâtuhu » 3. C’est dans cet esprit de duplicité qu’il consi-
1. Sur ces deux mouvements voir notre ouvrage, « l’Algérie mystique », Publisud, Paris 2002.2. Houari Touati, Entre Dieu et les Hommes, éditions EHSS, 1994, p. 54. Mustafa al-Rammâsî, kifâyat al-murîd calâ shar’h caqîdat « ذات احلق و�شفته » .3al-tawhîd كفاية املريد على �شرح عقائد التوحيد, ms Rabat n° 2499, f. 1 ; voir Houari
Le soufisme algerien au XVIIe siecle, entre la shari’a et la haqîqa
24
dère que « Le fiqh pour lui est divin, parce qu’il consacre la haqîqa sur terre. C’est grâce à lui qu’on peut établir les règles de la sharî’a pour distinguer le bien du mal et le licite de l’illicite. Défendre la vérité al-haqq, pour lui, c’est manifester la duplicité. » (al-fiqh huqqun insânî yukarrisu al-haqîqa al-rabbâniya ‘alâ al-Ard الفقه الأر�ص على الربانية احلقيقة يكر�ص اإن�شاين -Se réclamant de l’éso « .حق térisme orthodoxe, Rammâsî comme beaucoup de ses paires vi-vait en parfaite harmonie son ambivalence religieuse. De ce fait, il se souleva contre les pratiques innovatrices de certains saints de Ghris telle l’initiation des femmes par des hommes, pratique très courante en Oranais à cette époque notamment chez les Béni Ze-roual. Comme la plupart des faqîh de son temps, Rammâsî restera un mystique sobre et discret. Quand certains néophytes le solli-citèrent pour intégrer sa chaîne initiatique, il répondit souvent qu’il n’est pas en mesure d’habiller la khir’qa 1 à quiconque. Dans les, Manâqib (biographies de saints) telles les « awliya’ de Ghris », nous pouvons constater que les grands lignages religieux concen-trent la synthèse de l’ésotérisme, de l’orthodoxie et du charifisme affairant à la noblesse religieuse, pour associer la Baraka, qui est innée chez les chur’fa (de la généalogie mohammadienne ص�) et la karama propre aux saints wâlîs. Ce genre de synthèse est fréquent surtout chez les fuqah’a’ de Ghris.
A Tlemcen, Sa’id b. Ahmad al-Tilamsânî (828-1011h/1520-1603), Doyen de la Mosquée cathédrale (al-djâmi’ al-A’dham), mono-polisa les fonctions juridiques et canoniques durant des lustres (plus de 45 ans). Il fut guide sacerdotal (imâm) et porta la bure mystique (la khirqa) de la main de hajjî Wahrânî (?) 2. Il fut l’en-nemi juré de la mystique populiste qu’il qualifie « de mystique de
Touati, entre Dieu et les hommes, p. 5.1. Muhammad al-Hafnâwî, Ta’rif al-khalaf bî rijâl al-salaf, op-cit, II, pp. 541.2. Abd al-Mun’im al Qâsimî, Biographie des soufis, p. 90.عبد املنعم القا�شمي، اأعالم الت�شوف، دار اخلليل القا�شمي، بو�شعادة 2007، �ص.90.
Kamel Filali
25
tambour ». L’autre Ahmad b. ‘Isâ al-Warnîdî (mort en 1610), de la tribu hilalienne de Beni Warnid, située au sud de Tlemcen, était réputé d’homme des deux sciences : ésotériques et exotériques. Il fut le maître de l’hagiographe Ibn Maryam le fameux auteur de « al-Bustân fî awliya’ tilamsân تلم�شلن اأوليا Biographie » « الب�شتان يف des saints de Tlemsen ».
Pas de soufisme sans la connaissance du fiqh
Le XVIIe siècle fut aussi caractérisé par les voyages d’initiation et de quêtes de voix mystiques notamment vers l’Orient, nous pou-vons le considérer comme l’époque de la préformation des ordres notamment algériens, à savoir : la Rahmânîya, la Tijânîya et la Hansâlîya. La fameuse voie mystique maghrébine pionnière, la Shadhuliya, et sa dérivée la zarrûqiya fut fondée par Sîdî al-Zar-rûq al-Fâsî. Sa devise est « pas de soufisme sans le respect du Droit ال�شريعة احرتام بدون ت�شوف en faisant en quelques sortes de la ,« ل shari’a les gardes fous de la haqîqa, cette tarîqa par excellence in-tellectualiste, aux allures de la « franc-maçonnerie » musulmane, draine tous les milieux de savants orthodoxes, et règne, alors, en chef sur les terres maghrébines en dépassant de loin la plus ancien-ne voie de l’islam 1, la Qadîrîya, de Sîdî cAbdu-al-Qâdir al-Jilânî.Déjà au départ, al-Hasan al Shadhûlî encourage ses adeptes pour la duplicité et une meilleure connaissance du fiqh. Sa’id Qaddura (mort en 1066/1656), le maître du fiqh malikite et muftî d’Alger, qualifié en son temps de shaykh al-mashayikh, s’affilie à la Zar-ruqiya en (1013h/1604), de même ses néophytes ‘Abd-al-krim al-Faggûn, ‘Isâ al-Tha‘âlibî, Ahmad al-Maqarrî (mort en 1080/1669) et Yahyia Shâwî et son élève Ahmad al-Bûni, comme nous l’avons vu.Tous formaient une classification (tabaqah) de ‘Alîm/Ârif, voi-re de réseau social de fiqh malikite qui eut ses pendants au-delà
1. Sur l’importance de la Zarruqiya dans le Maghreb, V. Abû Mahalla, al-salsabîl fî qasd al-sabîl, m.s, Rabat, K. 192, ff, 40/42.
Le soufisme algerien au XVIIe siecle, entre la shari’a et la haqîqa
26
de l’Orient et de l’Occident musulman pour imprégner le Hed-jaz. Évoquant son initiation à Médine par ‘Îsâ al-tha’âlibî, lors de son deuxième voyage (1069h/1659), Abû Sâlam al-‘Ayyâshî, note : « Notre shaykh Sîdî ‘Îsâ al-Tha’âlibî, c’est de lui que j’ai reçu le dhikr (le wird : l’invocation) ; il me serra la main, me donna un chapelet, trois dattes et de l’eau, m’habilla la khirqa et m’octroya la ijâza (le diplôme d’initiation). » 1
Le mouvement soufi, hiérarchisé en voies mystiques, les turûq, tendait à orienter, pour le moins qu’on puisse dire, le comporte-ment de ses adeptes dans des voies très différentes de fiqh. Ainsi, lors de la brûlante polémique qui opposa Sîdî Bûsmâha au ma-rocain Abû-Mahalla, Sa‘id Qaddura n’empêche pas à rejoindre le camp des traditionalistes « ahlu al-salaf (les salafistes = anciens) » malgré que les deux algériens étaient affiliés à la Zarruqîya.
Vulnérabilité des ‘ulamâ’ et adjonction de statuts religieux
La vulnérabilité des ‘ulamâ’ et des muftî vis-à-vis du pouvoir turco-ottoman (installé à Alger depuis 1519) et le besoin de protection sont apparemment la cause politique qui poussèrent certains à se renforcer par des titres canoniques et eschatologiques en s’endos-sant souvent les qualités de sûfi ou wâlî (ami de Dieu) 2 en plus de leurs statuts de faqîh et de muf ’tî.
Il est remarquable que tous les muftî, qu’ils appartiennent à un pouvoir ottoman, à Tunis, à Constantine, à Alger ou à Tlemcen, ou au règne des ‘Alâwites, à Fès, à Marrakech ou à Rabat associent à leur statut de faqîh, d’imâm ou de khatîb, à la mosquée, une ten-dance mystique récurrente et protectrice.
1. « و اأ�شافني بالتمر و املاء و األب�شني اخلرقة �شيخنا �شيدي عي�شى الثعالبي تلقيت منه الذكر، �شافحني و ناولنا ال�شبحة و �شابكني »
Abû Sâlam al-Ayyâshî, Iqtufâ’ al-Athar ba’da dhahâbi Ahl Al-Athar (اقتفاء الأثر بعد .Publié par Nafisa Dhahabiya, Université de Rabat, 1996, p. 150 ,(ذهاب اأهل الأثر2. Houari Touati, p. 121.
Kamel Filali
27
A la même époque, au Maroc, la mystique à tendance shadhûlît joua un rôle capital dans l’apaisement des tensions internes en-tre les faqîh de Fès 1. Comme l’a bien constaté J. Berque, 2 dans le deuxième tiers du XVIIe siècle, les Dilâites (de la Zâwiya Dilâ’iya) maîtrisaient, sous le générique de l’orthodoxie, cette polyvalence, puisque selon lui, la même famille associait les rôles religieux, économiques et administratifs. Al-Iyûsî, né en 1631 à Fezzaz, dans le moyen Atlas, après avoir fréquenté l’école de Fes, fît sa quête de la haqîqa du Sous à Tafilelt à Tamaggrut, avant de se fixer à Dilâ’. A Fès, al-Iyûsî fait l’objet d’égards flatteurs de la part de Moulay al-Rachid et affronte ‘Abd-al-Rahmân al-fâsî, un détracteur récu-rent du sultan.
Le fiqh, aussi mobilisateur qu’il paraisse, est loin de recouvrir, à lui seul, tous les champs de l’activité socio-humaine de la cité ma-ghrébine et encore moins, quand il s’agit des rapports de forces et des affaires spiritualistes transcendantes relevant des intercessions « entre les hommes et Dieu », titre de l’ouvrage de Houari Touati 3. C’est là que réside, apparemment, la cause, la vraie cause de cette tendance du syncrétisme canonico-mystique. A ceci s’ajoute la po-pularisation de la mystique et des grandes voies soufies, telle la Qadiriya, qui devient la confrérie des mendiants (qui de mandent l’aumône pour la figure de sidi Abdel-Kader) et la « maraboutisa-tion » du soufisme mêlé au charifisme 4.
Pr. Kamel FILALI
1. Jaques BERQUE, Ulamas fondateur insurgés, Edition Sindbad, p. 241.2. Ibid, p. 242.3. R. Brunshvnug, études d’islamologie, p. 10.4. Cf. Kamel Filali, l’Algérie mystique, des marabouts fondateurs aux khouans insurgés, Publisud, 2002.
29
Introduction 1Le voisinage géographique étroit entre le Maroc et l’Espagne est à l’origine des contacts multiples entre les deux pays. L’actualité est marquée par des conflits territoriaux, mais aussi par des mouve-ments de migration clandestine (cf. Khachani / Mghari 2006 : 6 ; López García / Lorenzo 2004). Le trajet préféré est toujours la tra-versée du détroit de Gibraltaren patera 2, de façon que les jeunes Marocains clandestins fassent constamment face à des tragédies humaines (cf. El País 22.09.2009 / 30.06.2009).
La metteuse en scène espagnole Chus Gutiérrez (cf. Cinemavau-lt, cf. The Filmmaking Team) et le scénariste Juan Carlos Rubio
1. Je remercie mon collègue Regis Machart pour la révision et l`amélioration du texte français.2. Traduction : en barque de pêche, les barques étant souvent en très mauvais état.
Retorno a Hansala : langue, interculturalité et cinéma 1
Dr. Isabel Knoerrich PartisaniIbn Khaldun Research InstituteResearcher Tunis
Retorno a Hansala : langue, interculturalité et cinéma
30
(idem.) ont abordé ce sujet d’une façon très humaine, mais tout à fait réaliste et surtout avec une grande sensibilité intercultu-relle.Leur long-métrage Retorno a Hansala 1 (Espagne, 2008, 95 min) a gagné plusieurs prix en 2008 et 2009 et était nominé à quelques autres (Internet Movie Database). Il est un chef-d’œu-vre qui trouve sa place parmi les productions cinématographiques espagnoles de l’an 2008 (Ministerio de Cultura 2008) et parmi les films qui mettent en relief la situation des immigrés marocains en Espagne. Une des productions les plus récentes du genre est de la même metteuse en scène : dans Poniente 2 (Chus Gutiérrez 2002, 96 min) elle montre la situation de travail des immigrés illégaux au sud d’Espagne. Saïd (Llorenç Soler 1998, 98 min) est la mise en scène du roman L’aventura de Saïd (1995) de l’auteur catalan Josep Lorman qui raconte la vie d’un jeune immigré venu en barque de pêche. Susanna (Antonio Chavarrías 1996, 93 min) est une des premières productions qui prennent la migration marocaine en considération (cf. Martín Corrales 2000 ; Castiello 2004 : 426). Le cinéma espagnol ne prend pas seulement la migration pour sujet, mais aussi d’autres aspects qui caractérisent les relations hispa-no-marocaines : Luna de agosto (Juan Miñón 1986, 96 min) et El sueño de Tanger (Ricardo Franco 1987, 88 min) se basent sur des histoires d’amour pour activer des clichés sur le Maroc, le trafic de hachis est au centre de Bajarse al Moro (Fernando Colomo 1989, 88min), l’ex-territoire espagnol du Sahara est sujet de El baúl de los recuerdos (María Miró 1994), et de Cuentos de la guerra sa-haraoui (Pedro Pérez Rosado 2003, 97 min), Natural de Melilla (Driss Delback 2002, 88 min) montre les difficultés des homo-sexuels entre deux cultures et le même metteur en scène s’appro-che de la participation marocaine à la guerre civile espagnole par Los perdedores (Driss Delback 2006, 80 min) 3.
1. Traduction du titre : Retour à Hansala.2. Traduction du titre : Vent d’Ouest.3. Traduction des titres : La Lune d’août (1986), Le rêve de Tanger (1987), Aller
Isabel Knoerrich Partisani
31
Retorno a Hansala donne une image réaliste et neutre du Maroc et des Marocains, ce qui est un fait récent dans le cinéma espagnol :
« El cine español ha tenido, tradicionalmente, una mirada prejuiciada respecto a Marruecos y sus gentes. Sin embargo, en el último decenio, se va produciendo un cambio sustan-cial parejo a una nueva realidad construida sobre las duras condiciones de la inmigración.El estereotipo del moro, sensual y violento, va siendo sustituido por un caleidoscopio de perso-najes y situaciones que distorsionan la figua estereotipada del marroquí dándole unos perfiles plurales y, en general, positi-vos. » (Castiello 2004 : 425)
Synopse de la narration
La première scène du film montre la surface de la mer vue par une personne qui est en train de se noyer. A l’arrière-plan se profile la silhouette d’Algeciras. La scène suivante montre les cadavres de jeunes Marocains qui ont été poussés sur la plage par la marée haute. Martín (José Luis Garcia Pérez), l’entrepreneur local de pom-pes funèbres, trouve un numéro de téléphone dans les vêtements d’un jeune garçon mort et il discute avec les autorités locales afin d’obtenir la permission de l’emmener. Tout au long de l’histoire, il s’avère que l’entreprise de Martin et de son associé Antonio (An-tonio de la Torre) connaît des difficultés financières qu’il essaie de surmonter en ramenant les morts de la plage à leur village et dans leur famille au Maroc. Il cherche des numéros de téléphone chez les morts pour trouver leur contact en Espagne et pour né-gocier avec celui-ci le transfert du mort au Maroc. C’est ainsi qu’il fait la connaissance de Leila (Farah Hamed), une jeune Marocaine qui travaille au marché aux poissons d’Algeciras, et dont le frère
chez le Maure (1989), La malle pleine de mémoires (1994), Récits de la guerre du Sahara (2003), Né à Melilla (2000), Les oubliés (2006).
Retorno a Hansala : langue, interculturalité et cinéma
32
Rashid est mort lors de sa tentative de traversée du détroit. Pour la somme d’environ 3000 €, Martín est prêt à ramener le corps de Rashid à son village natal de Hansala, situé au Moyen Atlas près de Beni Mellal, situé dans région berbère de langue Tamaghzit. La partie principale du film se déroule au Maroc. D’abord le voyage de Martín et Leila en corbillard est mise en scène. A Hansala, après les funérailles de Rashid, Martín et Leila essayent de trouver les familles d’autres victimes en exposant sur les marchés locaux les vêtements qui portaient les jeunes clandestins défunts. Entre-temps, le jeune Said (Adam Bounnouacha) qui est disposé à émi-grer à n’importe quel prix, se fait ami de Martín.
La majorité de l’action se déroule autour du village de Hansala. Cess-cènes exposent les motivations qui poussent les jeunes à émigrer et dans quelles circonstances cela se fait, alors qu’ils ont conscience du risque qu’entraîne le passage clandestin. Plusieurs scènes montrent les souffrances émotionnelles que les familles de jeunes morts subissent. Il est fait allusion au profit financier que quelques-uns tirent du mou-vement migratoire, Martin inclus, sans que cela soulève le moindre questionnement moral. De retour à Algeciras, l’amour qui s’est déve-loppé entre les deux protagonistes se concrétise dans un projet com-mun de transfert des défunts à un prix modéré que Martín propose à Leila. Sa réponse à elle « Se ve Africa 1 » est évasive et produit un open-end, mais elle souligne aussi la proximité géographique qui est à l’origine de toutes les tragédies vécues. Le générique final souligne que le mouvement migratoire du détroit est un fait accompli qui n’a pas de remède. Il présente des informations de la presse espagnole donnant les chiffres de personnes qui ont perdu la vie lors des tra-versées clandestines : « medio centenar […] », « […] en una noche » 2
Le cédérom du film est sorti en avril 2010. Les bandes-annonces étaient disponibles en anglais et en espagnol (Youtube, Trailer en
1. Traduction : « On voit l Afrique »,2. Traduction : « une demie-centaine […] », « […] dans une seule nuit »,
Isabel Knoerrich Partisani
33
castellano), dont les scènes choisies ne correspondent pas à la suite de la narration ni à la chronologie des scènes. Par ce changement se crée une montée de suspense qui évoque d’abord l’empathie du spectateur pour les personnes exposées et pour leurs conditions de vie. Les scènes d’action où les protagonistes sont mis en danger lors de leur voyage au Maroc apparaissent à la fin des bandes-an-nonces. A ce moment, l’identification empathique du spectateur est déjà assurée est une culmination de la suspense au sens du film d’action peut s’effectuer.
Naissance et intention du film
Retorno a Hansala a été présenté lors du festival du cinéma à Man-nheim en septembre 2009 où l’actrice Farah Hamed a participé à un débat après la projection en donnant des renseignements sur la naissance du film. Chus Gutiérrez avait l’intention de produire un film qui susciterait la compréhension du public espagnol de la situation des migrants, elle s’est d’ailleurs basée sur plusieurs faits réels. Le personnage de Martín a été créé à l’image d’une personne réelle de la région d’Algeciras. La metteuse en scèneavait été im-pressionnée par une information de la presse espagnole qui lui avait donné l’idée du film :
« Esta película surge de una noticia del periódico, realmente, yo leo esta nocticia, creo que es por el 2001, y la guardo. » 1 (Transcrit de Youtube, Retorno a Hansala Seminci, parte 2)
Le contenu de l information est précisé dans une autre source :
« RETURN TO HANSALA stems from a short article, pu-blished in a newspaper, telling the story of a worker at the Funeral Home of Los Barrios. After a small boat sinks and one of the corpses is identified through a phone number, he travels
1. Traduction : « Ce film est né d’une nouvelle de presse, en réalité, j’ai lu cette nouvelle, je crois c’était en 2001, et je l’ai gardée ».
Retorno a Hansala : langue, interculturalité et cinéma
34
to Morocco with the corpse and the clothes worn by the peo-ple who died in the wreck. The sister of one of the dead men believes many of the victims come from the same area and will easily be identified but (sic !) their relatives based on the clothes. » (Cinemavault, Director’s note)
Plusieurs familles de Hansala avaient perdu leurs fils lors d’une tentative de migration clandestine.En conséquence, ils étaient dis-posés à apparaître dans le film comme acteurs amateurs avec le désir que l’Espagne connaisse leur histoire, ce que Chus Gutiérrez commente de la manière suivante :
« Lo que deseaba era ir al lugar de origen y ver [...] » 1 (Trans-crit de Youtube, Retorno a Hansala Seminci, parte 2)
« Since the start of the project, we have been especially interes-ted in the authenticity and the realism of this story.This is why this film is actually an adventure in itself ; the search for the story’s real characters. While researching, we contacted many sources and were eventually able to reach those who are the real participants in this story. The first trip to the region of Beni Mellal, in Morocco, led us to a village called Hansala, where we found similarities with our own story. This commu-nity lost thirteen men sailing in one small boat. This village, located in the middle of the mountains and populated with Berbers living in extreme poverty, is completely neglected by the State andlocal authorities. Without electricity, water and doctors, the village survives thanks to the communities mutual support, solidarity and sharing of individual possessions. » (Cinemavault, Director’s note)
1. Traduction : « Je souhaitais aller au lieu d’origine pour voir… ».
Isabel Knoerrich Partisani
35
Classification du film
Au niveau de la narration, il s’agit d’un drame qui a ses moments d’humeur relatifs au sujet central de la mort. « Seguro es sólo una cosa y vivimos de ella » 1 dit Antonio à Martín en commentant l’en-treprise de pompes funèbres. En chemin au Maroc, Martín veut savoir de Leila à quoi elle se dédie. « Meto peces en cajas » dit-elle et Martín répond : « Tenemos el mismo trabajo » 2.
Au Canada, où le film avait sa première en septembre 2008 lors du 35ème Toronto International Film Festival sous le titre anglais Return to Hansala, il a été classé comme Road-Movie (Cinema-vault, cf. Toronto International Film Festival 2008), et en Euro-pe, on a adopté cette classification sans y réfléchir (Filmfestival Mannheim-Heidelberg 2009). Plusieurs descriptions renoncent à mentionner le genre (Variety 11.11.2008 ; 24. Filmtage des Mit-telmeers). Cette classification est inspirée par lesscènes qui mon-trent le voyage de Martín et Leila au Maroc en corbillard, mais elle ne correspond pas en fait au genre du film.Il se catégorise plutôt clairement comme Cinema de Inmigración. Le terme est généra-lisé en Europe (angl. Immigrant Cinema, allem. Migrantenkino), mais sa portée en espagnol est restreinte. Alors que les metteurs en scène qui produisent ce genre en Allemagne et en France font souvent partie des communautés des immigrées, ce n’est pas le cas en Espagne (cf. Migrant and Diasporic Cinema in Contemporary Europe) où le terme se réfère plutôt au sujet, au contenu et à la narration des films. Il paraît que Chus Gutierrez est consciente de ce blanc du cinéma espagnol. Le fait que sa protagoniste d’origine marocaine, Farah Hamed, a eu une place éminente lors des événe-ments publics (cf. Youtube, Rueda de prensa, parte 1 ; débat lors du Filmfestival Mannheim 2009) peut s’interpréter comme acte de
1. Traduction : « Il y a une seule chose qui est sûre est nous vivons d’elle ».2. Traduction : « Je mets les poissons dans les boites » - « Alors, nous avons le même travail ».
Retorno a Hansala : langue, interculturalité et cinéma
36
compensation. Les analyses scientifiques du genre sont encore ra-res et surtout récents (cf. Santaolalla 2007 ; Santaolalla in print).
Le film fait aussi partie d’une nouvelle vague de réalisme social qui caractérise le cinéma espagnol récent, mais qui n’est pas enco-re discuté comme tel (cf. Barroso / Gil 2002). Il se manifeste dans des productions comme Te doy mis ojos (Iciar Bollaín 2003, 106 min) qui discute les mauvais traitements conjugaux, et La Soledad (Jaime Rosales 2007, 130 min) qui montre les structures sociales à la campagne et en ville.
Il reste à discuter si le film se peut classifier comme film d’auteur ou, mieux dit, comme nouveau film d’auteur, étant donné que l’auteurisme était une phase historique du cinéma espagnol. Le rôle prononcé que Chus Gutiérrez avait dans le processus de pro-duction du film justifie cette réflexion.
La langue et le cinéma
Dans la théorie structuraliste du cinéma (Metz 2003), la notion de langage acquiert un sens amplifié qui correspond à celui-ci de la sé-miotique. D’après Metz, les scènes qui compostent la structure nar-rative se systématisent en syntagmes. Dans la structure narrative, ou bien le langage (au sens linguistique du terme) ou bien l’image fournissent le code principal. Par conséquent, la langue est seule-ment un élément entre autres qui composent la narrative. Les éco-les de production cinématographiques se basent sur le sens ampli-fié de langage cinématographique en l’appliquant à tous les éléments techniques de production (P. E. Pacific cinémathèque, Wohl 2008).
Comme cette approche ne sert pas à analyser le niveau linguisti-que du cinéma, il vaut revenir à la sémiotique doublée du visuel et de la langue parlée qui produisent la narration. Le niveau visuel se compose des images et de leurs séquences. La langue orale est la base pour les dialogues scéniques.
Isabel Knoerrich Partisani
37
D’après Metz (2003), un objet original de la réalité est transformé en objet narratif. Ceci veut dire que les films narratifs produi-sent une image de la vie quotidienne. En parallèle, les dialogues scéniques sont une reproduction de la langue quotidienne orale. D’après nous, cette superposition crée un niveau pragmatique ad-ditionnel. Le scénariste puise dans la langue quotidienne pour ex-poser les protagonistes et pour créer l’histoire. Le schéma suivant montre le niveau pragmatique additionnel :
L’élément linguistique est marqué par l’oralité. Il constitue d’abord un système sémiotique autonome qui, scène par scène, se lie aux images. La primordialité du niveau visuel sur tous les autres ni-veaux semble être une présupposition de la théorie cinématogra-phique, étant donné que c’est celui-ci qui fait distinguer le cinéma de la littérature. Dans la littérature, l’image est un produit secon-daire et individualisé qui se forme dans l’imaginaire du lecteur à base de la langue, alors que dans le cinéma, il est « préfabriqué » par le metteur en scène, un fait accompli. À la différence du théâ-tre, l’image est en mouvement, ses séquences sont flexibles et il sert à représenter un espace qui, au moins en théorie, est infini.
Retorno a Hansala : langue, interculturalité et cinéma
38
Cependant, la primordialité du niveau visuel sur le niveau linguis-tique est absolument discutable et a été déjà discuté. La progres-sion de l’action se réalise à travers les dialogues des protagonistes et, par conséquent, au niveau linguistique. Cet aspect paraît avoir une certaine importance pour la construction cinématographique de l’interculturalité.
Langue et interculturalité
Chus Gutiérrez et son équipe avaient l’intention de faire un film absolument réaliste, ce qui est important pour le niveau pragma-tique additionnel. La migration marocaine en Espagne se réalise dans une situation multilinguistique et, en même temps, elle crée et reproduit une situation plurilingue. Le paysage linguistique du Maroc est loin d’être uniforme et sur son marché linguistique, il y a certains choix. Selon le préambule de la constitution, l’arabe est la langue officielle du Royaume. Les langues vernaculaires de la vie quotidienne sont l’arabe marocain et les trois variétés berbères, Tashelhit, Tamaghzit et Tarifit. Le français est la langue secondaire la plus importante, mais le niveau de connaissance varie considé-rablement en fonction des groupes sociaux. L’espagnol castillan est assez répandu au Nord du Maroc du à la situation historique, aux relations avec les enclaves de Ceuta et Melilla, mais aussi à la proximité géographique de la Péninsule Ibérique. Mais aussi à l’intérieur du pays l’espagnol a une certaine importance, étant donné qu’il est la langue véhiculaire de la migration du Détroit de Gibraltar. Une grande partie des émigrés marocains sont origi-naires des régions berbérophones et disposent des connaissances rudimentaires d’espagnol au moment d’arriver à la Péninsule.
Pour garantir le réalisme de son film, Gutiérrez et le scénariste ont pris cette situation plurilingue en considération. Dans les fiches techniques du film, l’espagnol, l’arabe est le berbère sont indiqués sous la catégorie « Langue » (The Internet Movie Database). Au
Isabel Knoerrich Partisani
39
niveau pragmatique additionnel, Gutiérrez et son scénariste ont utilisé toutes les variétés qui sont en jeu pour construire les dia-logues scéniques. Le réalisme social du long-métrage se nourrit largement par ce jeu sur le « marché des langues » du contexte migratoire.
Les alternances de codes sont d`un intérêt particulier, parce qu’el-les sont un moyen au niveau non-visuel que Chus Gutierrez et le scénariste ont utilisé pour créer l’interculturalité. Pouranalyser les alternances, une liste des scènes et sous-scènes a été établie où fi-guraient les langues différentes utilisées dans chaque sous-partie. L`espagnol est la langue de base, la langue matrice du film.Elle domine dans les scènes du début qui exposent les protagonistes et c’est la langue dont se servent les deux protagonistes pour les dia-logues entre eux. Leila le parle couramment avec l`accent typique marocain et, pendant le voyage au Maroc, elle donne des traduc-tions réduites et des explications en espagnol à Martín. Dans une scène qui montre l’énorme solidarité qui existe entre Leila et sa collègue espagnole qui travaille avec elle au marché aux poissons, celle-ci parle le dialecte andalou, soulignant sa position sociale d’ouvrière. Comme Hansala se trouve dans une région berbéro-phone, le tamazight est la langue principale des scènes tournées au Maroc. La langue berbère produit un effet d`aliénation, de dis-tanciation. La dariža, l`arabe marocain, se présente comme lingua franca entre Marocains d`origines différentes, mais aussi comme langue officielle. Les émigrés qui vivent ensemble dans une maison à Algeciras le parlent entre eux et Leila l`utilise pour demander le chemin à Beni Mellal pendant le voyage. Mais aussi les doua-niers marocains qui règlent l`importation du cadavre de Rashid l`utilisent dans leur discussion avec Leila, alors qu`ils s’adressent en français à Martín. Lors des actes religieux, l`arabe classique se mélange à l`arabe marocain. Parmi les habitants de Hansala, certains ont des rudiments d`espagnol. Saïd, qui plus tard réussira à traverser le détroit clandestinement pour retrouver Martín à la
Retorno a Hansala : langue, interculturalité et cinéma
40
plage d’Algeciras, acquiert ses connaissances en écoutant la radio espagnole et en répétant les mots comme « impresionante ».
De même, l’interculturalité se doit en grandes lignes à l`alternance de codes laissant apparaître des conflits interculturels aux niveaux visuel et linguistique.Il s’agit d`abord du comportement pendant le Ramadan : « Sólo niños comen en Ramadán » 1 est l`explication de Leila qui termine toute discussion sur le sujet avec Martín qui avait dû éteindre sa cigarette à la douane pour respecter le jeûne des autres.La solidarité collective qui marque la société marocai-ne s`exprime au moment où les habitants du village ramassent l`argent pour payer Martín. « Aquí la gente se ayuda » 2 dit Leila de façon courte et sèche. Le conflit qui représente le payement des services rendus par Martín se fait évidemment quand la personne qui a organisé le transfert clandestin de Rashid vient demander son argent auprès de la famille alors que celui-ci est mort.« ¡Qué cabrón ! » 3 remarque-t-il. Leila répond froidement « Cada uno tie-ne su negocio » 4. Les clichés espagnols sur le Maroc ne manquent pas. Quand le corbillard est volé lors d`un accident simulé, Mar-tín s`en sert en écriant « ¡ Malditos moros, país de chorizos ! » 5. Le stéréotypé qui est activé vice-versa est moins agressif : il se réfère aux clubs de football espagnols. Saïd porte une chemise de Real Madrid et ainsi, Martín peut se convaincre que son ami marocain n`est pas parmi les jeunes morts que son collègue Antonio (Anto-nio de la Torre) a recueillis en son absence.
Quand même, le film se caractérise plutôt par ses images que par ses dialogues. La musique a une fonction dramaturgique relative-ment réduite. Tao Gutiérrez a produit la pièce musicale hispano-
1. Traduction : « Seulement les enfants mangent pendant le Ramadan ».2. Traduction : « Ici, les gens s`entraident ».3. Traduction : « Quel salopard ! ».4. Traduction : « Chacun a ses affaires à lui ».5. Traduction : « Maudits maures ! Pays des voleurs ! ».
Isabel Knoerrich Partisani
41
marocaine Manousal 1 (Youtube, Manousal) qui était nominée en 2009 au Goya de la meilleure chanson et qui est interprétée par Suhail Serghini et Selina del Rio. La pièce musicale s’intègre plei-nement à l’interculturalité du film. Il s’agit d’un rythme andalou avec les éléments du Rai. Ses paroles complètent la narration en se référant aux motivations des émigrés :
« ana ğīt min makān, ana ğīt min makān min comri mā būt
u rāya u raħ makān comri makqsān
comri ma būt qrīb, comri ma būt qrīb, u ğā bacida, ya bacida
comri ma mūt qrīb u ğā bacida
ana ğīt min makān, ana ğīt min makān… » 2
1. Traduction : « Je n’arrive pas ».2. Traduction : « je suis venu d’un lieu, je suis venu d’un lieu, de ma vie ne reste rien, et j’opine je vais quelque part, ma vie est endurcie, c’est proche qu’il ne reste rien de ma vie, c’est proche qu’il ne reste rien de ma vie, et l’arrivée est loin, oui loin, c’est proche qu’il ne reste rien de ma vie, et l’arrivée est loin, je suis venu d’un lieu, je suis venu d’un lieu … ».
Retorno a Hansala : langue, interculturalité et cinéma
42
Bibliographie
Sources impriméesBarroso, Miguel Ángel / Gil Delgado, Fernando (2002) :
Cine español en cien películas. Madrid : Ediciones Jaguar.
Castiello, Chema (2004) :“Inmigrantes en el cine español : el caso marroquí”. In : López García, Bernabé
/ Berriane, Mohamed (dirs.) : Atlas de la inmigración marroquí en España. Madrid : Observatorio de la inmigración marroquí en España / Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos. pp. 425 – 427.
López García, Bernabé / Lorenzo, Manuel (2004) :“Los focos de la inmigración irregular”. In : López García, Bernabé / Berriane,
Mohamed (dirs.) : Atlas de la inmigración marroquí en España. Madrid : Observatorio de la inmigración marroquí en España / Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos. pp. 89 – 93.
Metz, Christian (2003) :Essais sur la signification au cinéma. Retirage en un seul volume. Paris : Klincksieck
Santaolalla, Isabel (in print) :“Body Matters. Immigrants in Spanish, Greek and Italian Cinema”, in : Berghahn,
Claudia / Sternberg, Claudia (eds.), European Cinema in Motion. Migrant and Diasporic Cinema in Contemporary Europe. London : Palgrave.
Santaolalla, Isabel (2007) :“Inmigración y masculinidad en el cine español actual”. In : Herrera, Javier / Martínez-
Carazo, Cristina (eds.) Hispanismo y cine. Madrid / Frankfurt : Iberoamericana / Vervuert. Pp. 463 – 476.
Reprint of article in Mugak, 34, Jan-Mar 2006. pp. 9-16.
Sources digitalesCinemavault“Return to Hansala. A film of Chus Gutiérrez”http ://www.cinemavault.com/catalogue/pdf/returntohansala-mk.pdf
El País 22.09.2009“Más balsas de juguete en el Estrecho” por Cándido Romaguera. Edición impresa.http : / /w w w.elpais .com/ar t icu lo/anda lucia/ba lsas/ juguete/Estrecho/
elpepiespand/20090922elpand_5/Tes
Isabel Knoerrich Partisani
43
El País 30.06.2009“Mueren siete inmigrantes marroquíes al volcar su patera junto al faro de Trafalgar”
por Pedro Espinosa. Edición impresa.http ://www.elpais.com/articulo/espana/Mueren/inmigrantes/marroquies/volcar/
patera/junto/faro/Trafalgar/elpepiesp/20090630elpepinac_20/Tesp
Filmfestival Mannheim-Heidelberg 2009, “Retorno a Hansala”http ://www.iffmh.de/de/Ueber_das_Festival/Archive/Filmfestival_2009/
Programm_2009_1/Internationaler_Wettbewerb_1/Retorno_a_Hansala__-__Return_to_Hansala/
Khachani, Mohamed / Mghari, Mohamed (2006) :L’immigation marocaine en Espagne. Institut Universitaire Européen / Commission
Européenne / Euromed.http ://www.carim.org/Publications/CARIM-AS06_09-Khachani+Mghari.pdf
Martín Corrales, Eloy (2000) :“Arabes y musulmanes en el cine español de la democracia (1979 – 2000)”. In : Mugak 11.http ://revista.mugak.eu/articulos/show/55
Migrant and diasporic cinema in contemporary Europe“Cinema de Inmigración”http ://www.migrantcinema.net/glossary/term/cine_de_inmigracion_cine_de_
inmigrantes/
Ministerio de Cultura / Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (2008) :
Boletín informativo. Películas. Recaudaciones. Espectadores.http ://www.mcu.es/cine/docs/MC/BIC/2008/Boletin_2008.pdf
Pacific Cinémathèque“The Language of film”www.inpoint.org/LanguageofFilm.htm
The Internet Movie Database, “Retorno a Hansala”http ://www.imdb.com/title/tt1176942
Variety11.11.2008, “Return to Hansala”http ://www.variety.com/review/VE1117938320.html ?categoryid=2863&cs=1
Wohl, Michael (2008) :“The Language of Film”http ://www.kenstone.net/fcp_homepage/language_of_film.html
Retorno a Hansala : langue, interculturalité et cinéma
44
Youtube, “Manousal”http ://www.youtube.com/watch ?v=55v4ibAM5Fw
Youtube, “Retorno a Hansala – Trailer en castellano”http ://www.youtube.com/watch ?v=CZI0zLUdbX8&feature=related
Youtube, “Rodaje de Retorno a Hansala, de Chus Gutiérrez”http ://www.youtube.com/watch ?v=1KZrvfe1_iY
Youtube, “Rueda de prensa Retorno de Hansala, parte 1”http ://www.youtube.com/watch ?v=nELMYtu_MhY&feature=related
Youtube, “Retorno a Hansala Seminci, parte 2”http ://www.youtube.com/watch ?v=7f9pWl0HLu8&feature=related
24.Filmtage des Mittelmeers, “Retorno a Hansala – Return to Hansala”http ://www.karlstorkino.de/index.php ?RUBRIK=5&Document=21&ID=2070
45
Résumé : La sexualité évoquée dans la narration romanes-que définit un comportement sociétal. Elle révèle une société non épanouie car la frustration sexuelle signifie l’aliénation sociétale. Le mythe de l’amour impossible exprimé par les narrateurs acculturés, traduit tout le drame de l’intellectuel décolonisé, en partie désaliéné, condamné à vivre dans une société qui ne le serait pas et qui ne permettrai pas de lever les tabous. Ce mythe de l’incompatibilité entre le désir et la réalité est en rapport direct avec une problématique de l’identité. L’espoir exprimé est que la société maghrébine en pleine mutation participe à une tentative plus universelle de libération sexuelle connotée dans la définition de nouvelles valeurs sociétales. Quelle que soit la technique d’expression utilisée par nos auteurs, la littérature d’expression maghré-bine est entraînée dans un processus universel de libération totale de la femme contre les castrateurs. La véritable libé-ration de l’homme passe par la femme.
LA SEXUALITE A TRAVERS QUELQUES ŒUVRES MAGHREBINES
des années 1950 aux années 1980
Pr. Jamel ALI-KHODJAFaculté des Lettres Université de Constantine 1
La sexualité a travers quelques œuvres maghrébines...
46
1– La sexualité infantile
Les romans conservateurs les plus anciens, dont l’auteur n’était pas désireux de remettre en cause la société mais se contenter de sug-gérer les questions fondamentales, ont, bien sûr, omis par commo-dité et par souci de plaire à un public conservateur la sexualité en-fantine. Il en est ainsi de plusieurs romans dont La Colline oubliée de Mouloud Mammeri, Le Fils du pauvre de Mouloud Feraoun ou La Boîte à merveilles de Ahmed Séfrioui. D’autres romans tran-sitoires entre la phase de la révolte exacerbée et le conservatisme traditionnel, ont opté pour des allusions encore pudiques à l’évo-cation de la sexualité infantile. C’est le cas notamment de Salah Fellah ou des romans de Mohammed Dib où la sexualité n’est pas cachée mais est évoquée avec beaucoup de prudence, ainsi que du Village des Asphodèles de Ali Boumahdi, ou Rue des Tambourins de Taos Amrouche. Les auteurs de la nouvelle génération accu-sent la bipartition sexuelle arbitraire qui refuse de reconnaître à la femme les droits à la féminité en ne valorisant que le materna-lisme et qui est compensée par une survalorisation de l’élément masculin qui nuit à l’équilibre même de la société.
Pour l’adolescent, la misère sexuelle est extrême : il n’a le choix qu’entre le refoulement ou des substituts peu satisfaisants tels que la masturbation ou les prostituées.
En revendiquant la libération sexuelle de la femme, les auteurs souhaitent en même temps la propre libération masculine et même par un discours implicite, les romanciers ont su participer à une grande entreprise révolutionnaire en dévoilant l’hypocri-sie de la société traditionnelle. Naturellement la misère sexuelle des adolescents n’est pas une spécificité maghrébine et dans cette étude, nous voyons bien que tous les problèmes abordés tendent à l’universalité.
La sexualité infantile est abordée dans La Répudiation de Rachid Boudjedra et les obsessions de ce héros névrosé remontent à la pé-
Jamel ALI-KHODJA
47
riode pré-pubertaire où elles s’exprimaient alors sous une forme relativement naïve et puérile avant de devenir plus accaparantes pour aboutir à l’inceste avec la nouvelle épouse du père.
Chez Rachid Boudjedra particulièrement, la sexualité revêt une signification majeure. Ce thème obsessionnel dans la narration et cette érotisation forcenée révèlent à la fois certainement le désir de participer à cette mode révolutionnaire occidentale concernant la levée des tabous, en même temps d’ériger la sexualité maghré-bine en mythe qui garantirait sa spécificité. L’érotisation de la vie maghrébine est un moyen de formuler, nous précise Jean-François Revel :
« le mythe des pays du soleil, où la douceur du climat se prêterait de façon quasi permanente aux jeux amoureux. » 1
C’est pourquoi le narrateur est très explicite quant à la précocité de la révélation de la vie sexuelle et au dévoilement des perver-sions. Il tente d’expliquer ainsi son amour pour Zoubida, la jeune épouse du père :
« Je l’adorais, peut-être parce qu’elle était la première femme que je possédais véritablement... Avant elle, il y avait eu les cousines mais ce n’était que des attouchements perfides aux abords des zones érogènes. Enervant ! J’en avais mal aux tes-ticules. Parfois nous assistions à l’épilation communautaire des sexes malingres de nubiles qui exhibaient tristement des pubis à moitié tondus : nous les regardions faire juste au sortir de la prime enfance. » 2
Cet exemple pose déjà en condensé tous les problèmes de la sexua-lité pour l’enfant maghrébin, à savoir le caractère tribal (les cou-sines), les perversions (voyeurisme), la sexualité avec ses conno-tations culturelles (les pubis rasés des femmes) évoqué également
1. in L’Express du 29 septembre 1969.2. BOUDJEDRA Rachid, La Répudiation, Paris, Denöël. 1969, p. 24.
La sexualité a travers quelques œuvres maghrébines...
48
par Khatibi dans La Mémoire tatouée. Mais avant d’approfondir les différents niveaux de lecture, il est nécessaire de terminer l’in-ventaire des écrivains ayant affronté le sujet tabou de la sexualité infantile.
Voir un sexe est une des premières curiosités sexuelles et c’est encore cette même préoccupation qui habite le narrateur d’Har-rouda et ses camarades. Sa curiosité sexuelle justifie, au début du roman, la raison de l’existence de ce personnage mythifié par la suite, qu’est cette vieille prostituée déchue :
« Voir un sexe fut la préoccupation de notre enfance. Pas n’importe quel sexe. Pas un sexe innocent et imberbe... Le sexe qu’on nomme dans une rue déserte et qu’on dessine dans la paume de la main... Sur l’effigie de ce sexe, nous éjaculons des mots. » 1
L’auteur exprime ainsi le besoin d’exorcisme des enfants au sujet de la sexualité qui s’extériorise par des dessins obscènes, les des-sins traduisant, en fait, le trouble profond de l’enfant devant la découverte de sa propre sexualité. Il faut ajouter à cela une projec-tion certainement pertinente de l’inconscient de l’auteur trouvant un lien de contiguïté entre la sexualité et l’écriture par le biais du plaisir. Les dessins obscènes sont ainsi présents dans le récit de Ra-chid Boudjedra mais l’auteur y ajoute un fantasme supplémentaire propre à la tendance obsessionnelle de la sexualité du héros :
« …Nous dessinions des sexes bouffis et barbouillés de sang. » 2
Le sang, le lait, le sperme, tout élément liquide révèle chez le nar-rateur les difficultés à assumer la prise en charge de sa sexua-lité alors que le conflit violent avec le père a accentué la fixation à la mère et interdit l’épanouissement nécessaire à une sexualité équilibrée. En même temps, en formulant un sexualité névrotique,
1. BEN JELLOUN Tahar, Harrouda, Paris, Denöël. 1973, p. 13.2. BOUDJEDRA Rachid, La Répudiation, op. cit. p. 28.
Jamel ALI-KHODJA
49
l’auteur renvoie sans doute à sa propre psychose, caractéristique de son obsession de l’aliénation, le terme lui-même révélant la folie ou l’utopie de l’intellectuel acculturé de prétendre se libérer. La désaliénation n’est qu’un mythe et c’est pourquoi les fantasmes, chez Rachid Boudjedra, sont assez morbides.
Quant à Abdelkabir Khatibi, il affiche la découverte de la sexua-lité dès la prime enfance, remontant jusqu’à l’âge de quatre ans, suivant à la lettre l’exactitude des théories freudiennes 1. Pourtant le narrateur introduit une autre dimension à cette théorique re-connaissance de la sexualité, en prétendant avoir été initié par une jeune bonne, sorte de substitut à la mère, ce qui pouvait faire pen-ser à une transposition de l’inceste oedipien :
« Un simulacre d’adulte me sauva de l’ennui, cohabitation amoureuse avec une jeune bonne, même chambre et un même lit à l’occasion. Elle me viola, j’avais quatre ans... Je garde présente l’image de cette fille, réduite à mendier un orgasme impossible, l’oubli forcené dans un enfant. Alors ? » 2
Par le biais de la fiction littéraire, le narrateur semble réaliser un désir oedipien sans doute fortement vécu au niveau du fantasme, et présuppose l’aspect tribal de la sexualité maghrébine favorisée par la promiscuité. Écoutons Rabah Belamri :
« Malgré l’acuité de notre éveil sexuel, nos rapports directs avec le filles se résumaient à bien peu de choses : quelques attouchements nocturnes, sans suite, favorisés par l’exiguïté des maisons et la plé-thore des familles. Les meilleures occasions pour ces pratiques clan-destines, rarement éventées par les adultes, étaient fournies par les fêtes, les mariages, les circoncisions, des événements sans pareil
1. « On ne peut rien dire de certain sur la régularité et la périodicité des oscillations de ce développement, mais il semble bien que la vie sexuelle de l’enfant, vers la troisième ou quatrième année, se manifeste déjà sous la forme qui la rend accessible à l’observation. » (Sigmund Freüd, Ma vie et la psychanalyse, Paris, Payot, 1998, p. 69)2. KHATIBI Abdelkabir, La Mémoire Tatouée, Paris, Denöël. 1971, p. 25.
La sexualité a travers quelques œuvres maghrébines...
50
pour réunir, côte à côte, sur une natte commune, dans une confu-sion inextricable, un nombre considérable de fillettes et de garçon-nets. » 1.
Il ne faut pas omettre de relier sans cesse l’importance du conflit oedipien dans la littérature à un problématique de l’identité qui demanderait le retour symbolique à une société « maternelle » aimée après avoir liquidé la société castratrice des pères.
Albert Memmi relate également l’apparition d’une sexualité dès la prime enfance en parlant notamment des jeux sexuels avec sa petite soeur sous les couvertures, considérés comme des plaisirs secrets. Le narrateur assume le naturel de cette sexualité infantile en ajoutant, à cette époque, n’avoir pas connu la honte, sa mère ayant le tact de ne pas intervenir lors de ces états ambigus :
« Je ne crois pas qu’elle ait jamais soupçonné ce que nous faisions et je ne me souviens pas y avoir trouvé un fort sen-timent de honte. » 2
Liées à la prime enfance, les considérations de Memmi sont tou-jours positives, les conflits n’apparaissant qu’au contact avec l’exté-rieur, ce qui signifie que le mal dont souffre le Maghreb actuel ne provienne que de l’extériorité et du contact avec l’Autre qui fut fatal.
2- L’auto-satisfaction par la masturbation et l’homosexualité
Passées la prime enfance et la période de latence, la sexualité réap-paraît avec toute sa vigueur à la puberté où l’enfant découvre par la transformation de son corps de nouvelles dispositions à la sensua-lité, mais dans une société où la sexualité (féminine surtout) est réprimée, il ne reste plus à l’adolescent qu’à trouver des substituts.
1. Rabah Belamri, Le Soleil sous le tamis, Paris, Publisud, 1982, p. 432. MEMMI Albert, La Statue de sel, Paris, Buchet-Chastel, 1953, rééd. Dallimard, 1966, p. 23.
Jamel ALI-KHODJA
51
Au départ, la pulsion sexuelle reste encore auto-érotique et l’ado-lescent découvre d’abord l’auto-satisfaction par la masturbation. Encore une fois, pour le narrateur de La Répudiation, la pratique de l’onanisme prend vite un caractère obsessionnel :
« Treize ans. Irrité par l’odeur tenace, je m’évertuais à cher-cher, au fond des buanderies, cachées derrières les sacs de couscous - séché et rentré eu prévision des pluies automnales - les culottes des cousines, souillées à l’endroit du sexe d’une traînée jaune dont la seule évocation me faisait bander. Pre-mières masturbations dans la grande cour irradiée de soleil où j’allais chercher mes premières jouissances et une âcreté nécessaire à ma solitude. » 1
Chez Rachid Boudjedra les rapports entre l’écriture et la sexuali-té par l’intermédiaire du plaisir ne se situent plus seulement dans un rapport de contiguïté mais tendent à se confondre. Finalement toute la narration est axée sur le principe de plaisir, le discours sur l’enfance servant à se faire plaisir en se libérant des traumatis-mes et en revivant les moments agréables. L’auteur dénonce et se réjouit en même temps de la promiscuité favorable au développe-ment d’une surexcitation sensuelle. La précision et l’accumulation des détails dans l’énoncé lui permettent d’exposer des idées anticon-formistes, par un discours volontairement outrageant pour une lit-térature traditionnelle qui prendrait soin d’éviter ces sujets tabous.
Pour renforcer l’idée d’une sexualité névrotique (la névrose ré-pondant à la frustration trop grande imposée par la société), le narrateur réitère l’évocation de nouvelles envies masturbatoires qui, au fur et à mesure qu’il entre plus avant dans l’adolescence et qu’il est de plus en plus amoureux de la marâtre Zoubida avec la-quelle il est prêt à consommer l’inceste, envahissent son être tour-né définitivement maintenant vers la sexualité. Toute occasion de
1. BOUDJEDRA Rachid, La Répudiation, op. cit. p. 49.
La sexualité a travers quelques œuvres maghrébines...
52
rencontrer une femme devient symboliquement la rencontre de « La Femme » et le narrateur profite de ce que son père tient un magasin pour abuser de la situation, et se couvrir de l’innocence de l’enfance pour assouvir ses vices secrets :
« Derrière le bureau, je caresse mon sexe. La femme parle. Volupté. Demande un article. Erection. Je fais semblant de ne pas comprendre, je prolonge l’entrevue… Et l’envie de vio-ler, même les laides et les plus vieilles, n’est qu’un prétexte à la fureur qui pend aux lobes des yeux ratatinés par le désir fallacieux. Exorbitante déchéance ! La masturbation dure tout l’après-midi. » 1
L’allusion au fait que la masturbation soit une déchéance nous ré-vèle que le narrateur est conscient de sa culpabilité de devoir re-courir à des substituts pour assumer une sexualité envahissante et d’être un renégat de la société en accomplissant des actes tabous. Mais au niveau de l’inconscient de l’auteur, l’humour dans la nar-ration révèle encore le plaisir.
Pour Driss Chraïbi dans Le Passé simple, la masturbation est évo-quée uniquement parce qu’elle s’inscrit comme un acte de révolte contre la société et parce que proclamer une telle activité c’est dénoncer l’hypocrisie traditionnelle. C’est ainsi que durant son voyage à Fès, libéré du père pour la première fois, le jeune narra-teur espère pouvoir se livrer aux joies de la liberté :
« Donc, j’étais ici. J’avais huit ans. Je pouvais enfin vivre. Emplir mes poumons d’air. Rêver. Pleurer. Et chier à mon aise. Et jusqu’alors, rêve pur et simple, assouvissement fur-tif, me masturber pour faire acte de n’importe quoi qui ne fût pas un dogme. » 2
Vulgarité recherchée, langage cru sont des procédés signifiants
1. Idem p. 120.2. CHRAIBI Driss, Le Passé Simple, Paris, Denöël, p. 78.
Jamel ALI-KHODJA
53
employés pour exprimer la révolte contre l’oppressive société tra-ditionnelle.
Beaucoup plus objectivement est envisagée la découverte de la sexualité dans Harrouda où le narrateur ajoute à cette prise de conscience de la sensualité des critères sociologiques qui situent l’expérience masturbatoire comme une phase d’intégration néces-saire à la vie sociale et au monde adulte :
« Aller au café est l’étape parallèle à celle de la première ci-garette et des premières masturbations. » 1
Nommer le sexe devient important, nous précise Hédi André Bou-raoui :
« pour l’auteur du nouveau roman maghrébin, car c’est d’abord revendiquer la libération des tabous pesants de la société traditionnelle et réclamer en même temps une éman-cipation féminine qui permettrait d’élaborer des relations plus satisfaisantes avec l’autre sexe, les hommes acceptant de s’épanouir dans une relation égalitaire homme-femme. Mais nommer le sexe, c’est également affirmer à l’Autre et à la face du monde occidental que, même s’il a longtemps servi de modèle, il n’est pas le seul à proclamer une certaine révolution sexuelle et à tirer profit des découvertes de la psy-chanalyse. » 2
C’est, tout au moins, ce que sous-entend le discours de Nabile Fa-rès lorsque le camarade de lycée du jeune Yahia lui demande :
« Est-ce qu’à Alger on parle de la masturbation dans les ly-cées ? » 3
1. BEN JELLOUN Tahar, Harrouda, op. cit. p. 156.2. BOURAOUI Hédi André, dans la critique de ce roman, Le Monde du 2 avril 1990.3. FARES Nabile, Yahia, pas de chance, Paris, Le Seuil. 1970, p. 156.
La sexualité a travers quelques œuvres maghrébines...
54
La sexualité est alors directement rattachée à un discours sur l’identité qui explicite que la différence culturelle ne prive en rien de l’appartenance à l’humanité.
Abdelkabir Khatibi est le seul auteur qui ose relater l’onanisme chez les filles :
« Elles aussi, les fillettes de ma souvenance, sexe contre sexe sur la terrasse, alors que se frôlaient les chats. » 1
On peut noter ici une similarité des discours sur la sexualité chez Rachid Boudjedra et Abdelkabir Khatibi, qui existe notamment par une association symbolique du chat aux moments amoureux (cf le chat de la marâtre, chez Rachid Boudjedra).
La répression sexuelle et la bipartition rigoureuse annoncent aussi les tendances à l’homosexualité. Certains récits narrent les expé-riences des adolescents entre eux et Driss Chraïbi dans Le Passé simple fait remonter la découverte de cette perversion dès l’école coranique :
« Sans compter que les perversions des grands contaminent les petits et que presque toujours ces écoles servent de cours de pédérastie appliquée avec ou sans le concours de l’hono-rable maître d’école. » 2
Cette image est forcément symbolique : le métier d’instituteur, à l’époque des classes sexuellement séparées, a toujours été défini comme une tendance inconsciente de l’homosexualité. En liant ce personnage du maître d’école à la sexualité des enfants, Driss Chraïbi prépare l’intervention du narrateur de Rachid Boudjedra qui révèle également la perversion des adultes vis à vis des en-fants, en relatant une tentative de viol subie par lui de la part d’un vieillard :
1. KHATIBI Abdelkabir, La Mémoire Tatouée, op. cit. p. 49.2. CHRAIBI Driss, Le Passé simple, op. cit. p. 36.
Jamel ALI-KHODJA
55
« Je suis pris de panique. Là encore, l’enfance vient d’être saccagée, trahie, violée à brûle-pourpoint par la faute d’un adulte monstrueux. » 1
Non seulement les jeunes adolescents sont frustrés dans leur sexualité mais même les adultes sont terriblement pervertis et ne semblent pas avoir trouvé leur épanouissement dans une vie sexuelle équilibrée. Naturellement ce tableau résolument pessi-miste et le caractère névrotique de cette société envahie de per-versions sexuelles sont encore utilisés ici - affirme Guy Daninos - « pour dénoncer les erreurs d’une société sclérosée. » 2
Elle essaye par ailleurs de faire d’une pierre deux coups. Accusant les traditions socio-religieuses de favoriser les déviances sexuel-les, elle réduit aussi le mythe de la virilité du groupe à un compor-tement pathologique.
3- La sexualité dans le clan tribal
Les premières expériences amoureuses se déroulent, dans la plu-part des romans, à l’intérieur même de la grande maison arabe, la promiscuité favorisant les relations incestueuses. D’autre part, la prohibition de la femme maghrébine à l’extériorité est si ferme que la seule rencontre possible est finalement le lieu même de sa claustration.
Les premiers attouchements ont donc lieu dans l’enceinte de la maison arabe, particulièrement entre cousins et cousines. C’est l’exemple que nous donne le narrateur de La Répudiation, qui se hasarde à tenter une relation sexuelle avec sa cousine :
« J’osai lui toucher le sexe, mais ma main ne rencontra qu’un
1. BOUDJEDRA Rachid, La Répudiation, op. cit. p. 241.2. DANINOS Guy, Les nouvelles tendances du roman algérien de langue française, Ed. Naaman, Sherbrooke 1979, p. 66.
La sexualité a travers quelques œuvres maghrébines...
56
renflement de poils humides ; écoeuré, je la retira précipi-tamment… Elle ne comprenait pas mon attitude défaitiste devant son sexe vierge et qu’elle voulait bien me laisser ca-resser, voire prendre d’assaut. » 1
L’hésitation montre ici l’ambivalence de la sexualité pour l’adoles-cence : peur et envie, attrait et écoeurement.
Dans La Grande maison, Omar connaît ses premières émotions sensuelles avec une jeune voisine, beaucoup plus âgée que lui tou-tefois, et là encore la cohabitation de toutes ces familles entassées sous le toit de cette grande maison laisse tout de même un certain caractère tribal à la sexualité, bien qu’il s’agisse en fait d’une per-sonne n’ayant aucun lien de consanguinité avec le héros.
Cependant, plusieurs narrateurs vivent leurs expériences sexuel-les avec des personnages extérieurs à la maison arabe. C’est le cas notamment du héros des Barbelés de l’existence qui vit un amour platonique avec une cousine éloignée qui ne cohabite pas avec lui, étant interne dans un lycée :
« Elle était si belle ! Elle avait quatorze ans comme lui, ci-tadine, elle avait été élevée dans une institution chrétienne, pensionnaire à l’école privée de la Doctrine chrétienne. Ses manières délicates et ingénues la rendaient inaccessible. Saddek était séparé d’elle par l’étanche barrière des usages et de sa grande timidité. Il fermait les yeux et aspirait pour mieux voir son image et se raccrocher à elle. Elle était si belle dans son uniforme d’interne, sa jupe plissée, sa veste portant un écusson sur la petite poche ! » 2
En fait la jeune fille d’origine juive, mais élevée selon la tradition française, reste le symbole même de l’attrait pour cet adolescent.
1. BOUDJEDRA Rachid, La Répudiation, op. cit. p. 57.2. FELLAH Salah, Les barbelés de l’existence, Alger, SNED. 1979, p. 78.
Jamel ALI-KHODJA
57
Seule l’héroïne de Taos Amrouche semble vivre une sexualité tota-lement copiée sur le modèle occidental. Elle est la seule à connaître une relation sentimentale du type « flirt » que connaissent les ado-lescents des pays occidentaux. Toutefois l’héroïne reconnaît l’am-biguïté de la situation qui ne lui a pas permis de vivre sa sexualité en milieu maghrébin de la même façon qu’en milieu occidental puisque, dès la puberté, elle fut soumise aux principes restrictifs de liberté appliqués dans les familles musulmanes :
« Mais un jour d’hiver, j’appris brusquement que j’avais changé d’état, sans que rien dans mon apparence ne l’eut ré-vélé : je n’étais plus une fillette mais une femme... En consé-quence, plus de libres promenades, ni de jeux avec les cama-rades de mes frères, sur le boulevard. » 1
Albert Memmi va plus loin dans l’analyse des causes de la néces-sité d’une relation sexuelle extra-tribale, nécessité d’autant plus évidente que le narrateur est acculturé :
« Il m’aurait été impossible d’embrasser une fille de mon milieu. Mes voisines, mes parentes se fardaient mal, trop, avaient les cheveux roussis par des indéfrisables bon mar-ché, portaient des robes mal coupées, plus longues devant que derrière, aux couleurs voyantes, surchargées de pare-ments, plis et franfreluches, qui en faisaient des ballots mal ficelés... Femelles à destinée ménagère, leur ignorance, leur inculture me coupaient définitivement d’elles. Les autres, qui se rougissaient les lèvres avec discrétion, sentaient le parfum léger et la chair propre et caquetaient d’une façon que, dans le fond de mon coeur, je trouvais délicieux, étaient toutes des filles de bourgeois. » 2
1. AMROUCHE Marguerite-Taos, Rue des Tambourins, Paris, Ed. La Table ronde, p. 178.2. MEMMI Albert, La Statue de sel, Paris, Gallimard, 1966, p. 184.
La sexualité a travers quelques œuvres maghrébines...
58
Finalement c’est toujours le thème de l’amour impossible qui hante les narrations des romanciers acculturés. La séquence précédente tirée de La Statue de sel, signifie bien que l’identité au milieu ori-ginel n’est plus possible après l’acculturation.
L’autre recours possible pour l’enfant maghrébin qui tente d’échap-per à une sexualité tribale ne peut être que la prostitution. Une ex-périence est alors possible grâce à ce substitut et c’est le cas typique du récit de Tahar Ben Jelloun, où le baptême des sens est donné par la vieille Harrouda et, plongeant de nouveau, par ce récit, dans la nouvelle forme de la littérature maghrébine, nous retrouvons une façon bien audacieuse d’aborder l’initiation sexuelle :
« Tout en poussant des râles, Harrouda serre la tête des en-fants entre ses cuisses… Les enfants se relèvent un peu fou-droyés, mais heureux de ce nouveau baptême… Elle dit que nous sommes tous ses enfants et que nous pouvons dormir entre ses jambes. » 1
4- La prostitution : les quartiers réservés
Ceci nous amène à l’un des traits caractéristiques de la vie sexuel-le maghrébine dans le roman. Vu que la femme est un être cloî-tré, intouchable et valorisé par les maternités, elle devient un être respectable et surtout domaine privé inviolable de l’époux. Cette fonction ainsi sacralisée aboutit inévitablement à la bipolarisation de l’image féminine : d’un côté l’épouse fidèle avec ses devoirs ; mais aussi ses droits, de l’autre la femme pour le plaisir seule-ment : la prostituée.
Abdelwahab Bouhdiba rapporte d’ailleurs, dans une analyse dia-chronique de la sexualité en Islam, l’importance des concubines, femmes lettrées et cultivées, qui divertissaient seulement, par op-
1. BEN JELLOUN Tahar, Harrouda, op. cit. p. 15.
Jamel ALI-KHODJA
59
position à l’épouse, reléguée au rôle utilitaire de la maternité.Les jeunes narrateurs ne se cachent pas d’avoir recours, pour leurs satisfactions sexuelles, aux quartiers réservés que fréquente assi-dûment parfois le propre père du héros confronté au problème de la contradiction épouse = devoir ; prostitution = plaisir, instituée par la rigueur et les trop nombreux interdits que la société tradi-tionnelle a fait peser sur la femme. C’est à peu près à l’époque du lycée que le narrateur ose sa première tentative pour s’aventurer au quartier réservé. Dans La Répudiation, ce n’est pas le héros lui-même qui s’y hasarde, mais un de ses camarades :
« C’est un camarade de lycée bègue ; il manque les cours d’arabe pour aller au bordel. Il raconte. Il nous énerve à bégayer au moment le plus crucial. Nous exigeons des dé-tails. » 1
L’humour constant de Rachid Boudjedra dans le discours sexuel révèle peut-être le drame de la misère des adolescents mais, en tout cas, s’insère bien à une connaissance réaliste de cette classe d’âge particulière.
Albert Memmi consacre toute un chapitre à la description du quar-tier réservé, montrant ainsi que cet endroit fait partie intégrante de la structure de la ville maghrébine. Le narrateur s’y rend parce qu’au fur et à mesure qu’il devient capable d’assumer sa sexualité, il se retrouve confronté à un problème de solitude, les aventu-res avec les seules filles qui l’attirent, les bourgeoises françaises, n’aboutissent qu’à des échecs. Alors sa première expérience a lieu avec une prostituée, et le narrateur continue à retourner au quar-tier chaque fois qu’il n’en peut plus d’assumer sa solitude sexuelle, bien qu’il conclue de ses expériences malheureuses :
« O solitude des amours du bordel ! Voilà pourquoi mes camarades en parlaient tous entre eux : pour rompre cette
1. BOUDJEDRA Rachid, La Répudiation, op. cit. p. 121.
La sexualité a travers quelques œuvres maghrébines...
60
solitude face à la femme. Et pour peu que l’adolescent ait quelque pudeur, comme j’en avais, quelle vie de misères et de honte est sa vie sexuelle. » 1
Le drame de la solitude sexuelle est un drame de l’acculturation au même titre que tout déchirement socio-culturel. La significa-tion de la sexualité, envisagée comme détresse uniquement, est de révéler que la cassure d’avec le milieu originel est définitive et le mal irrémédiable.
Pour Abdelkabir Khatibi, il semble que le recours aux prostituées cause aussi certaines perturbations psychologiques, notamment celle d’associer immanquablement sexualité et dégoût. Quoi qu’il en soit, la prostitution est tout de même intégrée à une probléma-tique de l’identité :
« Je découvris le bordel plus tard, vers neuf ans. On y al-lait à plusieurs à la sortie de l’école, en file indienne. On se pointait chez une putain sans préjugés dont le nom étran-ge grince encore en moi… Dégoûtés aussi par son haleine puant le tabac… Même sensation quand je touche de ma main un quelconque hérisson : sexe rasé, expulsé par le sol et prêt à ensanglanter. Grand-mère, tombez ! Les putains de Casablanca fumaient des cigarettes avec le sexe, c’était du luxe, bien sûr ! » 2
Le sexe est ici une valeur culturelle (sexe rasé), valeur de référence à la tradition maghrébine contestée (Grand-mère, tombez !). En-fin la dernière phrase assez hermétique qui montre des prostituées fumant avec leur sexe, est peut-être, nous dit Arlette Roth :
« une transposition littéraire de la libération féminine sou-haitable dont les deux symboles sont le sexe et la cigarette : la libération sexuelle assurerait à la femme son autonomie
1. MEMMI Albert, La Statue de sel, op. cit. p. 270.2. KHATIBI Abdelkabir, La Mémoire Tatouée, op. cit. p. 58
Jamel ALI-KHODJA
61
et la reconnaissance de son existence en tant qu’être indé-pendant ; la cigarette serait un accaparement opéré par la femme d’un symbole viril. » 1
Les auteurs remettent donc en cause le statut traditionnel de la femme maghrébine frustrant et qui, par là même, frustre l’homme d’une vie épanouie, car la prostitution n’est qu’un substitut qui masque mal la misère des adolescents devant le peu d’attention qu’accorde à leur problèmes cette société ingrate.
5- La plongée dans les fantasmes sexuels
A cause de cette misère sexuelle vécue par l’adolescent maghrébin, celui-ci se réfugie dans le fantasme et, par le biais de l’imaginaire, opère le transfert nécessaire à la réalisation des désirs. Naturelle-ment, le narrateur envahi par les fantasmes sexuels est celui dont les problèmes sont les plus angoissants et dont les conflits sont les plus vécus avec intensité. C’est par exemple le narrateur de La Répudiation qui, au moyen de fantasmes obsessionnels, résout, ou tout au moins amoindrit, l’intensité de ses pulsions incestueu-ses. Ainsi le fantasme du lait, ayant pour connotation : lait mater-nel, interdit la relation incestueuse ou tout au moins en repousse l’échéance. C’est le fantasme qui hante le narrateur lors de ses pre-mières tentatives sexuelles avec les cousines :
« Je promenais sur le corps de la cousine des mains ascéti-ques... et à chaque instant, je m’attendais à ce que le lait tiède giclât du sein de la gamine… Je voulais partir, mais le sexe grotesque à l’entrebâillement rouge me fascinait de plus bel-le. Pendant quelques instants, l’envie me prit de gambader à travers l’énorme triangle velu, mais l’idée du lait, qui pouvait arriver jusque sous le lit de ma mère et dont l’odeur âcre la réveillerait, me gâchait ma sublime joie de gamin assis sur
1. ROTH Arlette, «La solitude sexuelle», Le Monde du 13 juin 1992.
La sexualité a travers quelques œuvres maghrébines...
62
le sommet d’un cul. Tout à coup je partis dans ma chambre, laissant ma cousine pantelante, bêtement femelle. » 1
Ce discours résolument provocant fait comprendre tout de suite que les auteurs qui ont osé pénétrer dans le domaine des fantas-mes sexuels sont ceux qui ont outrageusement parsemé leur récit d’audaces de la parole à propos du discours sexuel. Les fantasmes sont ignorés chez les auteurs de l’ancienne génération qui font en-core preuve d’une certaine pudibonderie ou tout au moins d’une certaine réserve et qui, de par là même, n’exploitent pas sur le plan littéraire les découvertes de la psychanalyse.
Pourtant certains de ces auteurs, à l’écart du roman-révolte conçu par l’avant-garde maghrébine, ont effleuré le domaine du fantas-me. L’héroïne de Taos Amrouche rêve d’une sexualité sécurisante qu’elle vivrait sur un plan foetal :
« Ma joue reposait innocemment sur sa poitrine nue. Oh ! si cette poitrine lisse pouvait s’entrouvrir comme la coque d’une amande et m’accueillir… car ce que je cherchais obscu-rément, c’était à retourner aux ténèbres initiales, au ventre de la mère. » 2
Naturellement, cette symbolique foetale signifie, pour les narra-teurs acculturés, la recherche d’une nouvelle patrie dans laquelle ils pourraient retrouver leur identité perdue.
Les romanciers qui ont pu apporter une représentation convenable d’une psychologie enfantine approfondie sont ceux qui, connais-sant les thèses freudiennes, n’ont pas refoulé leurs fantasmes et ont choisi l’écriture pour libérer leur inconscient. En tout cas, le fantasme est toujours utilisé pour expliciter, par rapport à une histoire personnelle, une situation historique :
1. BOUDJEDRA Rachid, La Répudiation, op. cit. p. 58.2. AMROUCHE Marguerite-Taos, Rue des Tambourins, op. cit. p. 280.
Jamel ALI-KHODJA
63
« Qu’aurait fait mon père si les soldats avaient forcé la porte de notre maison et violé ma mère ? Ce fantasme ne me quit-ta pas. » 1
C’est le décolonisé qui parle et qui reproche à la société des pères d’avoir facilité, par son impuissance à défendre une intégrité na-tionale, l’intrusion du colonialisme.
6- Les revendications audacieuses
En revendiquant l’orgasme et la jouissance excessive, le narrateur s’insère dans cette catégorie de révoltés outrageusement avides à l’égard de la sexualité mais dont l’ardeur de la révolte signifie plus encore. Un discours de libération sexuelle a forcément des inci-dences politiques et la provocation sexuelle chez Rachid Boudje-dra, par exemple, ne nuit en rien à la portée révolutionnaire du discours. D’ailleurs le narrateur associe à dessein éveil amoureux et conscience politique :
« Mon amour coïncidait avec mon éveil politique. J’endoc-trinais mes camarades et leur lisais des chants du poète Omar. » 2
Pour le narrateur de Abdelkabir Khatibi, de même, la frustration sexuelle révèle une société frustrante, répressive et opprimante.Tahar Ben Jelloun dénonce aussi la religion comme la source des maux de la société car, participant de la grande répression sexuel-le, morale, elle maintient l’homme aliéné et empêche l’apparition d’un homme nouveau, libéré, partant ainsi du principe que toute frustation nuit à l’équilibre sociétal :
« Nos parents ne pouvaient soupçonner qu’en nous jetant tous les matins dans un coin de la mosquée, ils nous inci-
1. KHATIBI Abdelkabir, La Mémoire Tatouée, op. cit. p. 13.2. BOUDJEDRA Rachid, La Répudiation, op. cit. p. 130.
La sexualité a travers quelques œuvres maghrébines...
64
taient à apprendre le délire collectif, à fendre le réel avec nos petit sexes nerveux, à découvrir le mensonge sacralisé et à apprendre la haine à travers une histoire semée de fil bar-belé pour la différence essentielle rapportée dans soixante chapitres d’une logique implacable. » 1
Ici l’interstrat éducatif et le superstrat religieux sont violemment critiqués et indiqués comme les principaux facteurs de répression du plaisir, sur lesquels fonctionne cette société perçue comme so-ciété de brimades perpétuelles, frustrante donc peu garante d’iden-tité pour un être lui-même affranchi. On retrouve une sexualité audacieuse et même une sensualité très forte dans le récit de Na-bile Farès mais il faut dire que l’expérience sexuelle est vécue avec une Française, la femme occidentale devenant symbole de figure féminine libérée, par opposition au sort réservé à la femme ma-ghrébine dont la sexualité, d’après les récits, semble uniquement faite de passivité et de soumission :
« Claudine, dans le noir des draps, avait descendu une main vers le sexe de Yahia, elle l’avait pris très chaudement, dans la paume de la main droite, l’avait caressé et avait demandé dans un chuchotement : « tu as eu mal ?… » et elle avait em-brassé Yahia dans le cou, la main toujours sur son sexe. » 2
Enfin Driss Chraïbi, quoique son roman soit l’un des plus anciens par rapport à ceux des jeunes auteurs, revendique également la libération sexuelle de la femme maghrébine comme condition essentielle à l’espérance d’un avenir meilleur pour le Maghrébin dont l’identité se trouverait ainsi définie sur des bases plus justes et plus équilibrantes. Le jeune narrateur qui fait évoluer sa propre mère vers cette libération, commence son entreprise par l’appren-tissage du corps, l’acceptation du corps étant la base principale
1. BEN JELLOUN Tahar, Harrouda, op. cit. p. 23.2. FARES Nabile, Yahia, pas de chance, op. cit. p. 22.
Jamel ALI-KHODJA
65
d’un équilibre mental qui refuse toute frustration, tout tabou et toute honte :
« Je lui appris son corps… Tabous, pudeurs, hontes, je les mettais bas, voile après voile, en lui parlant de Dieu en qui elle croyait dans toute sa sincérité : Dieu n’avait pas pu créer des corps et des organes dont on aurait honte, n’est-ce pas ?… A trente cinq ans, elle comprit pourquoi et comment elle avait des menstrues. Jusqu’alors elle était persuadée qu’elle avait une maladie « personnelle » dont il ne fallait parler à personne, pas même à son époux. » 1
Ainsi une éducation incomplète ou rigoriste, qui tient cachée la sexualité, prolonge le malaise du héros : malaise de la déchirure de l’être exclu d’une identité claire, et malaise devant son propre corps qui renforce encore le désarroi personnel.
Même dans L’Incendie de Dib, où le héros est alors un pré-adoles-cent, la pudeur n’aura pas disparu et devant la première tentative de contact sexuel avec la même héroïne Zhor, qui lui prodiguait déjà dans La Grande maison une affection inquiétante, le héros ne trouve son salut que dans la fuite.
Salah Fellah tente une justification de son silence sur la sexua-lité en la présentant comme une spécificité culturelle connotée par l’interdit. La surveillance stricte des jeunes filles maghrébines n’autorise aucun écart de conduite :
« Les Français parlaient des filles. Les Algériens se conten-taient d’écouter avec une secrète mais réelle envie. Le do-maine des filles leur était encore interdit. La tradition leur imposait le respect absolu de la jeune fille dans la rue. » 2
Enfin le récit de Ali Boumahdi, tout en abordant d’une façon rela-
1. CHRAIBI Driss, La Civilisation, ma mère !..., Paris, Denöël. 1972, p. 91.2. FELLAH Salah, Les barbelés de l’existence, op. cit. p. 35.
La sexualité a travers quelques œuvres maghrébines...
66
tivement approfondie la découverte de la sexualité du héros, reste très classique, selon les convenances d’un certain roman occidental bourgeois, et la sexualité n’est pas revendiquée comme révolution-naire et indispensable à l’acquisition d’une liberté fondamentale :
« La chaleur de son corps, ses cheveux qui me chatouillaient le cou, le silence qui se prolongeait sans cesse devinrent in-supportables pour moi. Le livre tomba de mes mains. Je me retournai et reçus son corps en plein visage comme une va-gue. Elle m’étreignit. J’enfonçai ma tête dans sa poitrine et serrai Alima de toutes mes forces. Son coeur battait très fort. Au fond de moi, je sentis comme des vannes qui s’ouvraient et se refermaient. Le sang, affluant de toutes parts, se pré-cipitait dans une course folle vers ma poitrine. Mes jambes faiblirent et je glissai le long de son corps rigide. » 1
Malgré une description détaillée et une tentative d’approche de la sensualité, la narration reste tout de même neutre. La misère sexuelle vécue par l’adolescent est passée sous silence alors que les narrateurs obsédés et racontant leur sensualité ont signifié, par ce manque obsessionnel, leur misère personnelle.
Il est évident, à travers ces oeuvres, que nier la sexualité ou la recon-naître témoignent d’une différence fondamentale dans la concep-tion de la société. En effet, nier purement et simplement toute sexualité à l’enfance, c’est afficher, nous précise Fadéla M’Rabet :
« sans ambiguïté sa soumission devant les principes rigides d’une société conservatrice (ce conservatisme afférent au respect de la tradition). Au contraire, admettre l’existence d’une sexualité chez l’enfant, c’est remettre en cause ces prin-cipes traditionnels et offrir les moyens de rechercher de nou-velles bases pour une société plus libérée. Les auteurs révol-tés ont simplement posé le problème mais, en tout cas, ils ont
1. BOUMAHDI Ali, Le Village des Asphodèles, Paris, Laffont. 1970, p. 391.
Jamel ALI-KHODJA
67
le mérite d’avoir reconnu la misère sexuelle de l’adolescent obligé de se tourner vers des substituts pour échapper à la sexualité tribale de la grande maison arabe et fuir ainsi les complexes oedipiens fortement ancrés chez l’enfant maghré-bin par la structure familiale elle-même qui privilégie trop longtemps les liens mère-fils. » 1
Ainsi la sexualité évoquée dans la narration romanesque définit un comportement sociétal. Elle révèle une société non épanouie car la frustration sexuelle signifie l’aliénation sociétale. Le mythe de l’amour impossible exprimé par les narrateurs acculturés, tra-duit tout le drame de l’intellectuel décolonisé, en partie désaliéné, condamné à vivre dans une société qui ne le serait pas et qui ne permettrait pas de lever les tabous.
Ce mythe de l’incompatibilité entre le désir et la réalité est en rap-port direct avec une problématique de l’identité. L’espoir exprimé est que la société maghrébine en pleine mutation participe à une tentative plus universelle de libération sexuelle connotée dans la définition de nouvelles valeurs sociétales. Les auteurs ont narré toutes les difficultés de l’adolescent à assumer sa propre sexualité et, en insistant sur ces difficultés, ils montrent que l’inégalité des sexes nuit fondamentalement à l’équilibre de la société maghrébine.
Quelle que soit la technique d’expression utilisée, la littérature d’expression maghrébine est entraînée dans un processus univer-sel de libération totale de la femme contre les castrateurs. La véri-table libération de l’homme passe par la femme. Au Maghreb, y a-t-il une réalité sociale plus brûlante que la situation de la femme ? N’entraîne-t-elle pas tout un déséquilibre de la société ? La situa-tion malheureuse de la femme ne se retourne-t-elle pas contre l’homme ? A vrai dire, il n’existe pas un problème de la femme. Le problème est celui de la femme et de l’homme. Ce qu’il faudra
1. M’RABET Fadéla, Les Algériennes, Ed. Maspéro, Paris 1967, 5° réédit. 1992, p. 67.
La sexualité a travers quelques œuvres maghrébines...
68
donc changer avant tout, c’est le regard de l’homme et une redéfi-nition de son rôle. Comme le dit si bien Abdelwahab Bouhdiba :
« L’homme arabe est aliéné par sa propre masculinité et l’émancipation féminine authentique passe par l’émancipa-tion masculine. » 1
C’est à ce prix qu’on peut espérer une enfance heureuse, une sexua-lité équilibrée et des matins heureux.
Pr. Jamel ALI-KHODJA
1. BOUHDIBA Abdelwahab, La Sexualité en Islam, Paris, PUF. 1975, p. 291.
69
Les Etudes orientales en Algérie restent presque un sujet inédit. Elles n’ont été abordées, que par l’ethnographie coloniale. C’est pourquoi notre présent article se propose de brosser un tableau sur les Etu-des arabes au service d’un orientalisme si utilitaire qu’il est même parfois difficile de le dissocier de l’idéologie coloniale. Suggéré par la fiévreuse curiosité de connaître « L’AUTRE », l’orientalisme fut exalté par l’éternel conflit de civilisations qui opposa l’Occident à l’Orient depuis les croisades. « Le spectre des conquêtes musulma-nes » poussa l’Europe chrétienne à se pencher sur l’étude du monde arabo-musulman. Une ambition échaudée par le zèle religieux nour-rissait l’obsession de vouloir décrypter « l’énigmatique et menaçant Orient » et imprégnait la société autochtone nouvellement conquise du fond en comble. Des centres d’exploration vecteurs fusent et à travers lesquels l’Occident chrétien voulait découvrir les contrastes l’Orient en Occident musulman.
CHAIRES ARABES ET ETUDES ORIENTALES EN ALGÉRIE À L’ÉPOQUE COLONIALE :
entre desseins coloniaux et orientalisme maghrébin
Pr. Kamel FilaliDirecteur de LERSHMM
Chaires arabes et études orientales en Algérie à l’époque coloniale : …
70
Dés le XIIIe siècle, l’action missionnaire de certaines congrégations chrétiennes d’Edmond Lulle aux chevaliers de Rhodes était essen-tiellement mue par cette obsession consistant à percer les secrets des mœurs et la maîtrise des idiomes des peuples musulmans à dominer voire même à convertir. Dans ce sens, au XIIIe siècle, les efforts sectaires des dominicains imbibés surtout d’exaltation reli-gieuse aboutirent à la création à Tunis de la première Ecole d’Etu-des de Langues Orientales appelée alors Studia Linguarium. 1 De la même manière et au service de l’extraordinaire zèle missionnaire et inquisitoire, les Etudes arabes étaient largement dispensées en Es-pagne à l’époque de la Reconquista et même après. 2 Toujours dans un cadre catéchiste et stratégique, l’orientalisme s’acclimata aux si-tuations et prit le pli des conjonctures marquées de conflictualités entre l’occident chrétien et l’orient arabo-musulman. A des épo-ques plus récentes et avec l’apparition du colonialisme, l’occident façonna l’orientalisme à des desseins purement impérialistes. Loin de l’orientalisme « humaniste » (œuvrant dans un but de rapproche-ment des cultures) cultivé surtout par les Hollandais 3, les Etudes orientales en Algérie, principalement françaises, étaient au service du colonialisme. Elles furent calquées sur un fond de toile idéologi-que animé par les perceptions patriotiques et théologocentriques.
La France bonapartienne et ses visées expansionnistes sur la rive sud de la Méditerranée voyait dans “les sciences orientales” une néces-
1. Capitale des Hafsides, Tunis était à cette époque le meilleur asile que l’Afrique pouvait offrir au Dominicains. Ab Zakariya qu’on considérait à juste titre comme le souverain le plus puissant de Berbèrie, rompu son allégeance au Khalife Almohade tout en prolongeant son pouvoir sur l’Algérie : Cf., André Berthier, Les Ecoles de Langues Orientales fondées au XIIIè siècle par les Dominicains en Espagne et en Afrique, in RA., n° 73, 1932, pp. 84-103.2. Sur ces missionnaires et les martyrs voir : Bartolomé Bénissar, Histoire des Espagnoles, Paris, A. Colin, 1985, pp. 381-391.3. Au premier rang figurait Thomas van Erpe (1584-1624) qui publie une initiation à la grammaire arabe et son élève Jacob Golius (1584-1667) et F. Ravlenghein (1539-1597) : Cf., Maxime Rodinson, La Fascination de l’islam, FM., p. 66 sq.
Kamel Filali
71
sité capitale qui pourrait faciliter sa tâche hégémonique. Quoique la première chaire arabe à Paris fut créée par le fameux Guillaume Postel au Collège de France, en 1539, 1 l’orientalisme à vocation ma-ghrébine commença réellement, pour ainsi dire, avec les campagnes napoléoniennes sur l’Egypte 1797 2 et prit forme avec l’expédition coloniale qui se concrétisa par la prise d’Alger le 5 juillet 1830.
Mais ce n’est que sept ans après la prise d’Alger, c’est à dire en 1837, que Louis Jacques Bresnier (ancien élève de l’Ecole Royale) institua la première Chaire d’Etudes arabes à Alger. 3 Dès sa naissance la Chaire d’Alger, comme d’ailleurs ses consœurs, était sous l’autorité immédiate des militaires ; et les premiers enseignants étaient des officiers qu’on avait formé à l’Ecole d’Etudes Orientales de Paris fondée par Napoléon lui-même. Le corps des interprètes expédi-tionnaires livra donc à l’administration les premiers maîtres initia-teurs de la langue arabe. 4
La Chaire d’Alger devint plus importante que l’Ecole des Langues Orientales à Paris, même l’auditoire était plus considérable. La conjoncture fut telle que les intérêts pour les études arabes étaient plus grands. Calquées sur le modèle traditionnel destinées à assurer les rapports entre colonisés et colonisateur, les Medersas « officiel-les » étaient considérées comme des laboratoires sur un terrain de pratique et d’opérations orchestré par les militaires.
1. Ibid, p. 65.2. Déjà à la fin du XVIIIè siècle l’interprète personnel de Napoléon Bonaparte, Venture de Paradis, l’un des plus grands orientalistes du XVIIIe siècle, fut envoyé à Alger dans un but d’exploration. Il collecta des notes que publia E. Fagnan vers 1845 et un ouvrage sur « l’Algérie et la Tunisie » qui n’est en fait qu’un recueil de textes qu’on peut consulter à la Bibliothèque Nationale de Paris sous la référence : N. A. 9134.3. Cf. Discours Brésnier, RA., 1869.4. L’un des pionniers fut Joanny pharaon, fils d’un Copte ancien interprète de l’armée française d’Egypte, et que Napoléon cita dans ces mémoires, ainsi que Agoub un autre copte, professeur d’arabe au Lycée Louis-le-Grand : Cf. L. Féraud, Les interprètes de l’armée d’Afrique, éd. du Gouvernement général.
Chaires arabes et études orientales en Algérie à l’époque coloniale : …
72
La mission de l’orientaliste à coloration coloniale et comme les des-seins le suggéraient, était, pour utiliser les mêmes termes de Bres-nier, « de dénuder le cœur de l’indigène ». De la création de la pre-mière chaire à Alger à la naissance des Bureaux arabes en 1844, les Etudes arabes étaient centrées sur une connaissance des formes de la pensée, des idiomes et des cultures populaires. Guidées par les impératifs de la pacification, les recherches des ethnologues se focalisaient surtout sur les mœurs et coutumes des différentes po-pulations conquises.
L’éclatement de la Révolution de février 1848 avait donné en quel-que sorte la prééminence à l’élément civil dans les affaires algérien-nes et l’ouverture des chaires à des éléments non militaires. Mais ce n’est qu’à partir de 1860 que l’orientalisme brillait en Algérie avec tous ses aspects artistiques et littéraires. Tout en levant le voile sur les réalités vivantes d’un Orient pittoresque et persécuté, les études arabes se démilitarisaient. L’Algérie poétique et profonde se faisait découvrir par l’intelligentsia européenne. Les écrits classiques et la vision antagonique d’un Orient “barbare” farouchement opposé à l’Occident « civilisé » ne pouvait plus se justifier. Les voyages de certains hommes de lettres en Algérie mirent fin au « Mythe barba-resque » longtemps activé par les nations chrétiennes. Daudet et Th. Gautier dépeint les merveilles orientales. C’est tout à fait un autre Orient que les français de la métropole découvriront avec Flaubert, Delacroix, Fromentin et autres. « La folie orientale » se transforma en un orientalisme doux et romanesque. C’est à peu près l’histoire « du conquérant conquis ». A. Daudet (1840-1897) exprimait cette situation par cette belle phrase : « Les parfums du vieil Orient s’y compliquent d’une forte odeur d’Absinthe et de casernes. » 1 Les produits « des Bureaux Arabes » qui étaient en quelque sorte des centres de collectes de données et d’informations ne servaient qu’à rallumer les rivalités administratives et les polémiques politiques.
1. Le voyage d’Alphonse Daudet, in RA., 65, p. 89.
Kamel Filali
73
La lutte entre romantiques et colonialistes ne diminua pas la « vo-gue de l’Orient » chez les artistes et les hommes de Lettres ; elle se poursuivit sous une forme politique libératrice mue par les mou-vements nationalistes qui commençaient à fleurir dans le monde arabo-musulman notamment après la première guerre mondiale.
Toutefois, de leur côté, les hommes politiques ne cessaient de prê-cher sur un registre officielle les intérêts stratégiques de l’orienta-lisme ; et crier fort sa mise en service en faveur de la politique de division. Dans son discours d’ouverture du premier cours, Brésnier rappelait à l’auditoire : « Votre but à tous, en venant ici nous prê-ter votre attention est de chercher à franchir la barrière formidable qu’une langue et des coutumes bien différentes des nôtres ont pla-cées entre vous et des peuples que la victoire a mis entre nos mains, et que notre intérêt comme notre devoir est d’amener à sentir les avantages de la vie active et industrieuse sur leur existence indo-lente et apathique ». 1
Etudes et recherches étaient au diapason de la politique expansion-niste. En 1846, dix ans après la naissance de la chaire d’Alger, une chaire dialectale fut créée au collège d’Alger. Peu après, une déci-sion du Ministre de la guerre institua un concours qui devait don-ner naissance à la chaire d’arabe de Constantine où brilleront les premiers arabisants par leurs différents travaux, tel Cherbonneau par exemple. 2
Pour mieux illustrer notre étude nous avons vu qu’il serait peut-être intéressant d’évoquer les plus célèbres maîtres qui ont marqué les Etudes arabes par leur services et par l’importance de leur re-cherches. A. de Calassanti-Motylinski (mort en 1906), l’un des plus anciens, devint titulaire de la chaire d’arabe en1886. Ethnologue de terrain, il fut d’abord interprète militaire à Ghardaïa où il enseigna
1. Discours de la première leçon de Brésnier Pub. in extenso dans le Moniteur algérien n° 315 du 14/11/ 1837.2. Henri Massé, Les Etudes arabes en Algérie (1830-1930), in RA., 74, 1933, p. 217.
Chaires arabes et études orientales en Algérie à l’époque coloniale : …
74
la doctrine ibadhite et l’histoire kharijite. Après une mission d’étu-des au Sahara, Motylinski fut emporté par le typhus en 1907. 1
William Marçais (1872-1956), Delphin et Destaing se relayèrent successivement à la Medersa d’Alger. Comme A. Joly qui, occu-pait de 1907 à 1913 la chaire publique de Constantine à sa mort, le premier s’intéressa aux idiomes de l’Ouest de l’Algérie et publia « un manuel sur les dialectes de Tlemcen et des Ouled Brahim de sa•da ». Spécialiste des dialectes de l’oranais, il fut appelé au collège de France. G. Delphin était lui aussi versé dans les études dialecta-les et publia de nombreux recueils notamment à la Revue Africaine. C’est Auguste Cour qui quitta la Medersa de Tlemcen vers 1905 pour venir par la suite diriger la Chaire d’arabe de Constantine.
René Basset (1855-1924) est « l’algérianiste » le plus célèbre par le poids de sa riche contribution et de ses recherches. Ses travaux sont variés et nombreux, il fut pendant longtemps le plus apprécié des arabisants et berbérisants. Il ne serait donc peut-être pas superflus de résumer sa vie en lui taillant un petit portrait : né à Lunéville, dès son jeune âge, il choisit l’orientalisme ; encore collégien, il com-mença à étudier la langue arabe. De 1873 à 1880, il travailla à l’Eco-le des Langues Orientales et à l’Ecole des Hautes -Etudes (Paris). Arrivé à Alger, le premier avril 1880, il est nommé chargé de cours à l’Ecole des Lettres. R. Basset commence d’abord par dispenser un cours sur la poésie antéislamique et enseigna aussi l’Histoire du Maghreb, ainsi que la géographie arabe. Il succède à Emile Masque-ray à la tête de la direction de l’Institut, en 1894, pour se faire élire doyen en 1909, date de la transformation de l’Ecole des Lettres en Faculté 2. Le profile de l’érudit l’emporte sur celui du professeur 3 : il fut le pionnier qui mit sur pied les Etudes berbères en Algérie. Non seulement il enseigna le Berbère à la Faculté, mais il publia
1. Ibid, p. 240.2. A. Bel, René Basset, in RA., n° 65, 1924, p. 13.3. Les Etudes Arabes en Algérie (1830-1930) in, RA., 74, p. 234.
Kamel Filali
75
également des Notes de lexicographie(1883 à1887), des Manuels, des Etude linguistiques, des textes, des contes et des légendes, etc. Enfin une trentaine d’études qui ouvrirent la voix aux Etudes ber-bères. Il forma les premiers spécialistes dont quelques uns sont de-venus, à leur tour, premiers linguistes spécialisés dans les idiomes de l’Afrique du Nord.
A l’Ecole des Lettres, Edmond Doutté regagna la Chaire d’Arabe et devint collègue de R. Basset et Fagnan. Homme de terrain sa tache concernera essentiellement l’ethnologie, l’anthropologie et la so-ciologie religieuse. Il se déplaça à travers toute l’Algérie pour faire ses enquêtes sur la magie et la religion folklorique. 1 Consacré à la question religieuse et l’islam maghrébin d’une manière générale, il enseigna le maraboutisme et les confréries. L’oeuvre d’Edmond Doutté vacille entre la berbérologie et l’anthropologie religieuse, elle tente de confirmer l’esprit folklorique des cultures locales.
La Chaire d’Etudes Orientales d’Oran connut Houdas, puis elle eut pour titulaire Machuel qui s’occupera plus de manuels scolai-res que d’études ethnologiques. Delphin enseigna d’abord à Alger pour enfin trouver une stabilité à Oran avant que cette dernière ne fut transférée à Tlemcen et confiée à A. Bel qui était pendant longtemps directeur de la Medersa. Le transfert de la chaire d’Oran à Tlemcen est du, vraisemblablement, à sa réputation de ses innom-brables cultes de saints et son importance historique notamment à l’époque musulmane : elle fut la capitale des ziyanides jusque à 1557. Arabisant remarquable par son enseignement, Alexandre Joly resta fidèle aux Medersas mais sans avoir suffisamment produit. En 1917, M. Godefroy, quitta la Medersa de Tlemcen en faveur de l’Ecole des Langues Orientales. Il publia en collaboration avec Abdelaziz Zenagui, un des premiers arabisants autochtones, « un Récit en dialecte tlemcénien ». Edmond Destaing quitta lui aussi la Medersa pour la chaire de berbère à l’Ecole des Langues Orien-
1. Ibid., p. 238.
Chaires arabes et études orientales en Algérie à l’époque coloniale : …
76
tales. Son travail à la chaire d’Alger était fructueux et accompagné de nombreuses publications ethnographiques et bibliographiques. Quant à Georges Marçais et Mohamed Benchneb (1869-1929) 1 ils occupèrent successivement, à la Médersa de Constantine et d’Alger, la chaire d’Arabe et devinrent professeurs à la faculté des Lettres d’Alger. 2 G. Marçais était surtout anthropologue spécialiste du cos-tume algérien, archéologue et historien de l’art musulman. Quant à M. Benchneb qui quitta l’Ecole des Lettres d’Alger, en 1898, pour Constantine, il toucha presque à tous les domaines. Il commença par publier dans la Revue Algérienne de droit une traduction sur le droit malékite, puis se tourne vers l’Education pour faire connaî-tre les Notions de pédagogie musulmane : en 1901, il rendit publi-que « Une Lettre sur l’éducation des Enfants dans la philosophie de Ghazali ». Après la publication de quelques textes d’hagiographie qu’il édita dans la Revue Africaine, il choisit la traduction et mit au service de l’orientalisme quelques sources locales telles : Bus-tan d’Ibn Maryam ; Al Warytilani, la Rihla, (1908) ; Ibn al Abbar (1920) Éetc 3
En ce début du XXe siècle, les Etudes arabes ne furent toujours pas neutres mais conditionnées pour le besoin du colonat. Elles étaient comme une revendication ardue de la francisation de l’Algérie. Quoique les professeurs des différentes écoles orientales d’Algérie restent intégrés au courant nationaliste-colonial qui commençait à s’épanouir aussi bien dans la Métropole qu’à l’intérieur de la colonie, ils ne pouvaient jouir totalement de leur liberté scientifique. Fai-sant œuvre officielle, ils suivaient toujours la politique colonialiste et travaillaient sous les ordres des chefs militaires. Tous les grands travaux sinon la majorité sont marqués par une note « œuvre faite
1. Muhammad Benchneb été attaché à la faculté de lettre en 1908, comme chargé de conférence. En 1922, il fit décoré chevalier de la légion d’honneur : Cf., George Marçais, M. Benchneb, in RA., n° 70, 1929, pp. 150-159.2. Chaire d’Arabes É, op. cit, p. 243.3. Cf., George Marçais, M. Benchneb, in RA., n° 70, 1929, pp. 155-157.
Kamel Filali
77
par ordre du Gouverneur général. » 1 Les chercheurs universitaires restaient toujours dévoués à la science impérialiste et expriment parfois un excès de patriotisme entaché de chauvinisme.
Ainsi, la connaissance orientaliste est orientée, comme la propre expression de Vatin et Lucas, vers « les structures rangées É » 2 La tendance globale des sociétés orientales savantes et des maîtres est eurocentrique voire impérialiste. « L’idéologisation » de la pensée scientifique était systématiquement déployée et concerne toutes les sciences ayant trait à l’Algérie. La vision des maîtres de chaires foca-lise sur la mystification des faits et la création des stéréotypes et des jugements entachés de préjugés parfois enfantins. 3 Il ne s’agissait pas seulement de connaître le passé pour maîtriser le présent, mais plutôt reformuler un passé et imposer définitivement à l’histoire l’emprunte impérialiste. 4 Les domaines de recherches ne semblent pas trop délimités ni appropriés aux chercheurs. Le maître de re-cherche peut toucher à plusieurs domaines à la fois. Edmond Dout-té, islamisant omniprésent dans les études coloniales, fit une sug-gestion au gouverneur général sur les modes de construction qui conviendraient le mieux pour l’habitat en Algérie et dont Augustin Bernard fut chargé par une seconde enquête officielle. 5
Les professeurs des chaires étaient en contact avec les administra-teurs de toutes les régions et pouvaient le cas échéant les interroger à leur guise. Des réseaux de sciences coloniales connectaient maî-tres de chaires, ethnologues et politiciens. Des renseignements re-
1. Voir P. Vatin et Lucas, op. cit, p. 53.2. L’Algérie des anthropologues, p. 58.3. Voir Kamel FILALI, Idéalisation du Kabyle dans l’oeuvre de E. DAUMAS in Annales de l’U.R.A.M.A, Constantine, 1997.4. Philippe Lucas et Jean Claude Vatin, l’Algérie des anthropologues, F. Maspéro, Paris, 1975 p. 58.5. Augustin Bernard, Enquête sur l’habitation rurale des indigènes de l’Algérie, faite par ordre de M. le gouverneur général, Fontana, Alger, 1921.
Chaires arabes et études orientales en Algérie à l’époque coloniale : …
78
cueillis, des notes accumulées pour essayer de dresser l’état complet d’une situation. Des techniciens ou des agents administratifs sont souvent dépêchés par leurs administrateurs ; et parfois l’ethnolo-gue se déplaçait lui-même pour connaître une secte, sa hiérarchie, ses adeptes, ses nombres, ses rites, ses ramifications et surtout son tempérament politique. Mais les chercheurs ne pouvaient en tirer des avantages pour avancer dans la connaissance des populations algériennes et de leur tendance qui était en mutation constante no-tamment entre les deux guerres. Au moment où Alfred Bel publiait son best seller : la « Religion musulmane en Berbèrie », un ouvrage centré sur les confréries musulmanes, la situation religieuse était toute autre et « le réformisme musulman « commençait à se faire valoir sur la scène politique avec force.
Profondément religieuse, la société arabo-berbère, dont les élans historiques étaient mus par le spiritualisme, adoptera essentielle-ment la Loi Coranique depuis la conquête musulmane (VIIIe siè-cle). Dans la mesure où il concerne la réorganisation administrative et politique, le juridique est la clé de vote du système colonial et des officiers de la colonisation devenus administrateurs. Comme toutes les autres disciplines les études juridiques étaient basées sur une ex-ploration canonique et visaient la francisation progressive du droit. Il concerne notamment les structures communautaires et l’organi-sation des biens. Comprendre les formes juridiques sur lesquelles repose la société locale pour pouvoir opérer des changements et créer de nouveaux mécanismes de transmission et de modification de la propriété. 1 Les traités de droit musulmans les plus importants sont commentés et traduits. C’est Edmond Fagnan (1846-1931) qui se chargera le plus de la question juridique. Après qu’il fut attaché entre 1873 et 1884 à la Bibliothèque Nationale et collabora à la pu-blication des Historiens orientaux dans le Recueil des Historiens des Croisades, il vint à la Faculté des lettres où il assura pour de
1. P. Lucas et Jean C. Vatin, op. cit, p. 14.
Kamel Filali
79
longues années à la chaire d’arabe la jurisprudence et l’exégèse. 1 Comme son maître, le Baron de Slane, et toujours dans l’obses-sionnel devoir de connaître l’islam et ses impacts idéologiques, M. Fagnan commenta le Coran et traduit bon nombre de chroniques arabes qui se rapportent à l’Afrique du Nord. En plus des nombreux travaux qu’il publia dans la Revue africaine, il concentra ses acti-vités de recherche dans la Société Historique Algérienne où il fut membre du comité de rédaction de 1892 à 1895. Ainsi, il édita pour la première fois en français : « l’Histoire des Almohades » de Lar-rakchi et la « chronique des Almohades et des Hafsides « attribuée à Zerkechi, ainsi que les Annales d’ibn al Athir et « l’histoire de l’Afri-que et de l’Espagne » d’ibn Adhari. Parmi ses grands travaux nous pouvons citer : « Concordances du Manuel de droit de Sidi Khal » l, Alger Fontana, 1889. », « Le Djihâd ou guerre sainte selon l’école malékite, Alger, Jourdan, 1908 » « Traduction et commentaire, Kha-lil Ibn Ishaq Ibn Yaqoub al Mâlik », Mariage et répudiation, Alger, Jourdan 1909 » 2
Les enjeux de la politique coloniale devenaient plus que jamais in-certains et les fantasmes de l’éthnicité devenaient de plus en plus apparents dans l’imaginaire des protagonistes. Les intérêts impé-riaux grandissaient et se compliquaient tellement sur le terrain qu’une chaire finit par être créée à Paris. Le protectorat marocain tira grand profit des berbérisants formés à la chaire d’Alger 3. Il em-prunta à l’Algérie des berbérisants - en majorité disciples de R. Bas-set - pour administrer et enseigner et, enfin, promouvoir le « mythe kabyle » qui ne trouva pas de terrain fertile en Algérie. Edmond Doutté fut envoyé au Maroc en 1912 pour servir la politique ber-bère que le protectorat confectionnait et commençait à mettre en pratique par de gros moyens de propagandes. Ainsi, en 1910, et
1. Les Etudes Arabes en Algérie (1830-1930), in RA., n° 74, 1933, p. 236.2. E. Gabriel, Edmond Fagnan, in RA., n° 72, 1931, p. 139-141.3. A. Bel, René Basset, in. RA., n° 65, 1924, p. 74.
Chaires arabes et études orientales en Algérie à l’époque coloniale : …
80
dans le but de renforcer la spécificité kabyle le gouverneur géné-ral recommandait à E. Doutté et à Emile Félix Gautier d’enquêter sur la disparité de la langue berbère en Algérie. L’enquête eut une conclusion pessimiste : elle observe un recul de la langue berbère 1. De 1915 à 1940, la deuxième génération des berbérisants et à sa tête André Basset essaye de pallier à cette dégradation des idiomes et de faire monter le berbère du statut de dialecte à celui de la langue. On multiplie les analyses, les notations et surtout les dictionnaires 2. Beaucoup de recherches sur les idiomes marocains, la religion, les mœurs, ont été livrées notamment par : Destaing, Henri et André Basset (fils de René), Henri Laoust, Biarmay. André Basset consa-cra exclusivement à la seule linguistique berbère deux moments de sa brillante carrière : Rabat (1922-1930), Alger (1930-1946). 3
En l’an 19OO, on était loin de l’air de l’exploration scientifique prô-née par les instances de l’Administration coloniale et déployée avec des moyens colossaux depuis les premières années de la colonisa-tion. L’assise du pouvoir colonial est acquise mais on est loin de s’assurer de sa pérennité et de sa consolidation à long terme faute de compréhension et de maîtrise des populations. L’observation scien-tifique reste toujours propriété de l’Etat mais les thèmes fouillés sont toujours les mêmes que ceux des temps des conquêtes et des pacifications (1830-1880).
L’islam, les idiomes, les Mœurs et coutumes font toujours l’objet d’études répétitives par rapport aux grandes études d’exploration. Les mots Islam, kabyles et arabes devinrent leitmotiv et font for-tunes dans les écrits orientalistes et coloniaux. Et c’est toujours le gouverneur général qui gère les études arabes considérées comme utilité stratégique de premier degré. Une stratégie que l’impulsion idéologique et l’instabilité socio-politique rendent indéfinissable.
1. L’Algérie des anthropologues, p. 46.2. L’Algérie des anthropologues, p. 52.3. M. Canard, André Basset, in RA., 1957, p. 171.
Kamel Filali
81
Quelques années avant la première guerre mondiale, en 1909 exac-tement, E. Doutté voyait dans le mouvement libéral et nationaliste qui se dessinait en Orient « un islam bien différent en dépit du dra-peau qu’arbore ses partisans, d’être de moins en moins un islam musulman et on ne doit pas s’en étonner. » 1 Le mouvement antico-lonialiste faisait ses premières apparences après la première guerre mondiale et encourageait timidement des études neutres. 2
Le début du XXè siècle fut aussi le temps des bilans. La longue ha-leine des travaux, l’opacité des mœurs et « la mysticité » de la société poussa les instances officielles à vouloir se situer par rapport à leurs réalisations dans le domaine des sciences coloniales. Il œuvrèrent à la tenue de deux congrès à Alger en 1905 : le congrès des Socié-tés savantes présidé par le Ministre de l’Instruction Publique, et le Congrès International des Orientalistes 3 sous le haut patronage du gouverneur général et auquel participa un grand nombre d’émi-nents savants tels Louis Massignon 4, Goldziher et Asin Palacios. 5
Les Promotions de diplômés arabisants et islamisants se succédaient, mais les concours de recrutement au sein des instituts orientaux étaient sévères et on n’acceptait que les plus doués parmi les pos-tulants. Les tâches scientifiques et les recherches se partagent mais les tendances idéologiques convergent. La vision théologocentrique et eurocentrique, qui affirme d’une façon agressive l’orientalisme colonial 6, ne semble pas quitter les études arabes de sa naissance
1. Magie et religions dans l’Afrique du Nord, Typographie, A. Jourdan, 1902, p. 2.2. Maxime Rodinson, op. cit, p. 131.3. Le dernier a eu lieu à Budapest en Juillet 1997. Nous y avons contribué avec une communication qui a porté sur : « Les Etudes arabes en Algérie entre les deux guerres ».4. Cf. Vincent Monteil, Le Linceul de feu - Louis Massignon, Paris, Vega press, p. 31.5. Exposé de la situation générale de l’Algérie. Présenté par M. C. Joumart 1905, p. 100.6. Maxime Rodinson, op. cit, p. 130.
Chaires arabes et études orientales en Algérie à l’époque coloniale : …
82
jusqu’à l’indépendance de l’Algérie (en 1962) même les plus objec-tives n’y échapperont pas. Comme d’ailleurs les mœurs, la religion musulmane est étudiée et enseignée par des savants en majorité de confession chrétienne.
Les Etudes islamiques officielles avec leur cadre idéologique ne trouveront pas de frein aux mouvements de résistances de la so-ciété algérienne et de ses pôles. Elles ne purent non plus contrôler les mutations d’un islam régénérateur en antagonisme et en formes d’oppositions. Après le temps des résistances (1854-1881) menées par des marabouts insurgés, l’Administration coloniale se retrou-vait face à un islam toujours combattant. Devant la complexité des mœurs et l’intériorité de la spiritualité musulmane, beaucoup d’orientalistes et de maîtres de chaires renoncèrent à leur tâche co-loniale et se vouèrent passionnément à l’ésotérisme. Ils cherchè-rent dans le mysticisme soufi les réalités suprasensibles de l’islam et « LES SECRETS DIVINS » que devaient comporter les légendes ancestrales colportées par les lignées de noblesses religieuses et les chaînes d’initiés (silsila). C’est d’ailleurs par les voies du soufisme que certains embrassèrent l’islam tels René Guenon (1886/1951), Vincent Mansour Monteil (plus récemment) ; d’autres tel Massi-gnon, A. Bel, se contentèrent d’expériences mystiques.
Les nouvelles données politiques et la conjoncture mondiale qui poussait vers la guerre influaient sur les tactiques et les stratégies. En 1905 E. Doutté traçant un bilan dans une Chronique, 1 estima que la vie intellectuelle d’Alger était particulièrement intense cet hiver là : La Société de Géographie d’Alger et d’Afrique du Nord faisait preuve d’une grande activité ; les membres dépassaient 1200, ce qui la classait au premier rang des sociétés françaises similaires. La société de Géographie d’Oran, malgré une courte crise, avait ra-pidement augmenté le nombre d’adhérents.
1. Bulletin d’Alger in RA., n° 49, 1905, pp. 5-18.
Kamel Filali
83
Malgré cette farouche résistance identitaire, l’idéologie coloniale en matière d’enseignement et de recherche ne désarme pas et les chaires arabes seront toujours corroborées par les Medersas. Le dé-cret du 5 juillet 1946 a complété la réorganisation des medersas algériennes par la création d’un Institut d’Etudes Supérieures Isla-miques qui sera rattaché à l’université d’Alger. 1 Le but de la prolifé-ration des Medersas rentre dans le cadre de la politique religieuse et culturelle. Sa tâche sublime était de se rapprocher le plus prés possible les populations autochtones et d’imprégner la société par la connaissance et le savoir occidentaux.
L’intérêt de la colonisation pour les mœurs et la religion du pays procède toujours d’une perception démagogique. Mais les popu-lations autochtones boycottaient les institutions françaises notam-ment les Medersas.
Entre les deux guerres mondiales, avec la naissance de l’islahism (le réformisme musulman) les Mosquées qui enseignaient la tradi-tion et les Sciences Coraniques tentaient de pallier à cette prolifé-ration des medersas qu’on appelait les Ecoles Franco-musulmanes. Pour l’année scolaire 1904-1905, 94 candidats s’étaient présentés au concours d’admission dans les trois Medersas (Alger, Constan-tine, Tlemcen) contre seulement 87 l’année scolaire précédente. Le nombre des élèves des 6 années de la Medersa d’Alger s’est élevé à 1O6 ; celui des 4 années de la Medersa de Constantine à 6O ; celui de la Medersa de Tlemcen à 51 : soit en tout 217 élèves réguliers dans tout le territoire algérien. 2 L’Administration coloniale jouait à la récupération par l’intégration des diplômés autochtones. Elle se préoccupait surtout de l’intégration des Algériens diplômés des medersas, qu’on appelait « Français musulmans », longtemps négli-gés, de leur trouver des débouchés. Un tableau complet des fonc-tions auxquelles pouvaient prétendre ces diplômés fut publié par
1. Situation générale, 1946, p. 215.2. Ibid, p. 215.
Chaires arabes et études orientales en Algérie à l’époque coloniale : …
84
le Ministère de l’Instruction Publique dans le Bulletin Officiel du Gouvernement. 1 Après la crise qui survient au début du XXe siècle, « l’impérialisme scientifique » trouva son ancrage notamment dans des objectifs politiques et économiques. En fait l’Algérie donna, au début du XIXe siècle, un regain d’actualité à l’orientalisme français, mais la « démilitarisation » des études arabes ne parviendra réelle-ment qu’au début des années quarante.
En 1930, la célébration du centenaire marque un nouvel élan dans l’histoire des études coloniales. Les réalisations en matière d’Etu-des arabes 2 sont grandioses mais ne paraissent pas suffisantes. Les Sciences orientales, comme support de la connaissance coloniale, atteignent leur comblent. Tous les domaines semble être fouillés sans pour autant régler les problèmes coloniaux ni apaiser les sou-cis des Bureaux de Paris en matière de domination et de contrôle des populations. Malgré les grands efforts déployés par « les arabi-sants », l’avenir de l’orientalisme reste incertain. Chaires Arabes et Etudes Orientales commençaient à être imprégnées par les mou-vements de libération et “les anticoloniaux” tels : Charles André Julien, André Berthier et Charles Robert Ageron qui œuvrèrent en faveur de la décolonisation et de la libre pensée.
Pr. Kamel FILALI
1. Situation générale, 1946, p. 215.2. On confie les fonctions de commissaire du centenaire à Gustave Mercier qui présenta deux communications : l’une sur le nom des plantes en dialecte Chaw et l’autre sur « la toponymie berbère de la région de l’Aurès », George Marçais, Gustave Mercier, in RA., n° 98, pp. 7.
85
Mit allem, was darin Raum hat, auch ohne Sprache.
Paul Celan, Atemwende
It is necessary that heteroglossia wash over a culture’s awareness of itself and its language, penetrate to its core, relativize the primary language system underlying its ide-ology and literature and deprive it of its naïve absence of conflict.
Bakhtin, The Dialogic Imagination.
Two novels on Algeria by the same author, Le blanc de l’Algérie, and Vaste est la prison, appear simultaneously in 1995. Propelling
WRITING OF THE ORIGIN :LANGUAGE AND HISTORICITY IN ASSIA DJEBAR’S
“EFFACEMENT SUR LA PIERRE ”
Ayşe Deniz TemizUniversity of New york
Writing of the origin : Language and historicity in assia djebar’s…
86
the writing on double planes and at a double pace is the crisis that has eclipsed the Algerian political scene beginning with 1988 and enduring throughout the 1990s. Blanc de l’Algérie offers a close up on this scene dominated by the systematic attempts on the part of the secularist government to impose cultural homogeneity as a response to the breakout of an Islamic fundamentalist movement, the FIS (Front islamique du salut). The repression directed at the Islamicists, however, serves as a screen which justifies the repres-sion in the eyes of the western states, as well as concealing the other targets of the repression : the Berber minority, the French-speaking intellectuals, and the women who claim a place in the public sphere. The massive destruction compels the author, Assia Djebar, to bear witness to the still too fresh memory of the writ-ers and intellectuals who have been the victims of violence, many of them Djebar’s own intimate friends. Struggling with a memory that is too present to recount, the narrative assumes an elegiac tone, breaking off every now and then into caesura and silences, until it invents a different strategy of remembrance : detaching itself from the present, Blanc de l’Algérie moves unto a more dis-tant layer of the past, which mirrors the present and therefore allows the author and the reader to contemplate, reflect upon and analyze the mechanisms that, historically, have been placed at the service of violence. Modeled on this movement of memory, the writing shuttles back and forth between the events of the 1990s and the years of the anti-colonial struggle (1950s), in search of the roots of the staunch will to impose homogeneity.
A similar narrative movement is at play in Vaste est la prison, com-pleted a year earlier than Blanc de l’Algérie and sharing a common problem with the latter text. This common problem pertaining to the origins of culture motivates an acceleration of the memory ap-paratus in the text, giving rise to a leap into a more primordial past. The origin thus becomes a point of convergence or conduit between the two novels. In the middle section of Vaste est la pris-
Ayşe Deniz Temiz
87
on, situated between an autobiographical account of the narrator’s painful repudiation of the marriage bond, and a genealogy of the “Algerian woman,” in the last part of the text, a sudden break oc-curs : autobiography yields to a third-person historical narrative that focuses on the most ancient layer of Algeria’s recorded his-tory. This brief interlude, titled “Effacement sur la pierre,” recounts an intriguing story set in a city of the Numidian Kingdom, with a tale-like quality that is reminiscent of the embedded allegory char-acteristic of eastern story-telling. But more than its mythical set-ting the story’s intrigue lies in the way in which it stages the fasci-nation with the origin, and the desire for deciphering a past whose trenchant incommunication constitutes its primary charm.
The need to define a solid foundation for self-identity no doubt plays a part in the appeal to the origin, especially given that the writing takes place within the context of political disintegration with nation-wide cultural crisis at its basis. The idea of the ori-gin holds the promise of a common ground that lies deeper than the rifts of the present, of an instance of undivided unity that can serve as the basis for collective identification. However, one is confronted by an immediate paradox here : can the desire to unearth and reinvigorate a forgotten image of unity avoid repeat-ing the problem that lies at the heart of the crisis of culture in the aftermath of colonialism : that of the distinction between what is proper to the Algerian self, and what constitutes the contamina-tion induced by the presence of the other ? Is there a way of evok-ing history that will be able to restore unity to the present without restating in the same move the question of propriety, which is the very factor that unleashes the fragmentation ?
Djebar foregrounds precisely this paradox in “Effacement sur la pierre.” The story encloses a political statement towards which the plot will draw : the primordial presence of the Berber culture on North African land, with a history that goes back centuries further
Writing of the origin : Language and historicity in assia djebar’s…
88
than the Islamic-Arab culture that the nation-state instates as the fixed and exclusive reference of cultural identity. This historical fact, however, is not offered in the text as constituting the histori-cal truth as such. One can challenge the narrow and elective scope of official historiography through a political agenda focused on the assertion of Berber identity, yet this challenge would remain in-complete, that is to say, limited to the debate on what constitutes the true content of the nation, without bringing into question the mode in which history becomes articulated into the political pro-cess of nation building. For Djebar, this latter question appears to be as crucial as the truth of history. The narrative insists on the so-lipsism of the historical truth, its political neutrality and inefficacy outside of the relays and translations through which it will have to pass in the course of its articulation into a historical narrative.
The materiality of the engagement with the “letter of history” then takes the center stage : the particular motives and ideas that set the pursuit of history in motion in a given era ; the partic-ular course that this pursuit will follow, which will involve the gathering, the translation and the putting together of disparate traces. Transcription and effacement play equal parts in that pro-cess. The presence of the ancient Numidian city poses somewhat of a paradox, in this respect, as the immutable setting of a nar-rative that will unfold over the span of centuries. The equivocal role of the ancient ruins as both referent—real and concrete—and signifier—with no determinable code—will be the source of mul-tiple, contending interpretations from one era to another. Dje-bar makes ingenious use of these series of erroneous assumptions and misjudgments on the part of the historian, and the failures of communication across decades, as an element of suspense in her narrative in a way that brings to mind the Nietzschean insight, recapitulated by Foucault, that “[g] enealogy does not pretend to go back in time to restore an unbroken continuity that operates beyond the dispersion of oblivion,” or
Ayşe Deniz Temiz
89
to demonstrate that the past actively exists in the present, that it continues to secretly animate the present, having imposed a predetermined form on all its vicissitudes… On the contrary, to follow the complex course of descent is to maintain passing events in their proper dispersion ; it is to identify accidents, the minute deviations—or conversely, the complete reversals—the errors, the false appraisals, and the faulty calculations that gave birth to those things which continue to exist and have value for us ; it is to dis-cover that truth or being lies not at the root of what we know and what we are but the exteriority of accidents. (Foucault 355 ; emphasis added)
The errors in the writing of history are as essential for Djebar, a historian herself, as they have been for Nietzsche and Foucault.The plot of “Effacement” relies on a staging of the paradox in-volved in assuming that the self can trace a continuous and un-mediated line of descent towards a primordial past that s/he can claim as the origin of her/his present identity. Just as Nietzsche differentiated between the different manners of a return to the origin ; between, that is, the dispersals and divisions involved in the Herkunft (descent, or genealogy), on the one hand, and an Ur-sprung (origin) imagined to be undivided and intact, on the other, so for Djebar the historical sense, the wirkliche Historie, cannot come about except through a traversal of the writing of history, without which the origin is bound to remain an imagined unity, a mute letter.
What one misses in presupposing an unobstructed access to the origin (and what will form the spine of the plot in “Effacement”) is that the origin, even the one that constitutes what is most proper to the self, does not speak in the same language as the subject. This may sound as another paradox, since what marks the origin of a people, a nation, or a culture is necessarily an unprecedented
Writing of the origin : Language and historicity in assia djebar’s…
90
event that marks a beginning in the history of the people, where-by the act of registering, which relies on a particular language, itself constitutes an event. The existence of the origin can only be confirmed thanks to that mark, and only on account of the language that marks it. This mark, moreover, often attests to the origin of that language, as well as of the people who speak it. And yet, at each turn of the narrative Djebar will leave us in a blind spot where we are confronted by the fact that the origin lacks a language, or, more precisely, the language it speaks is untranslat-able to the present of the subject.
Two things in the narrative, then, interrupt our imaginary rela-tion to the origin : first, that the content of history is inseparable from the writing that will grant it its consistency ; and secondly, that this writing can never take place in one’s own language, but will necessarily have to translate from the language of the other. I will look into the fictional development of these two insights, which constitute the essence of Djebar’s political response, articu-lated from the double perspectives of Blanc de l’Algérie and Vaste est la prison, to the state-fueled violence that stems from the will to a unitary and “authentic” Algerian identity. It is no coincidence that this will, doubtlessly overdetermined by the history of colo-nialism and its overthrow, manifests itself in the imposition of Arabic as the only legitimate language of the nation, a legitimacy conferred upon it by the religious reference, while simultaneously annexing religion as a defining trait of the people. 1 As it becomes a metonymy for the authenticity of the people, language turns into the site of a ritual purging that strives to erase from the national identity the traces of contamination of the French past. Violence
1. This logic of the origin operates via a metonymical shift which is best expressed in the slogan inherited from the anti-colonialist Ulema (inteligentsia) movement of the 1930s, and re-invigorated during the riots of the 90s as a motto of expulsion: “Arabic is my language. Algeria is my country. Islam is my religion.” See Benjamin Stora’s Histoire de l’Algérie coloniale (1830-1954). Paris: La Découverte, 1991.
Ayşe Deniz Temiz
91
thus escalates around the issue of language, which becomes in-strumental in the drawing of the boundary between those who are loyal to the people, and those who must be expelled for the sake of reassertion of authenticity. (Notwithstanding that the majority of those who are condemned to violence and death because they speak, write or teach in French, or claim Berber as their mother tongue, are the ones who deploy these languages in recounting the nation’s recent history.) Not only is violence, therefore, bound up with the question of origin—a connection that is more or less universal in the history of the nation-state—but the origin, more-over, is imagined to reside in a language that comes to stand as a metonymy of the people.
When Djebar invites us to return to the effaced origin it is a whole different journey that she has in store for us, one that runs in the tracks of a writing whose ability to illuminate the past is limited by the pace at which its own vision unfolds in time, and by the ne-cessity to cross over into the territory of a language that no people can claim as its property.
Language as the Threshold of History
Instead of placing the plot within ancient Numidia as a simulated setting made up of a synchronic image, such as one could hope to encounter in a museum, “Effacement sur la pierre” places us within a diachronic sequence of a picture that, contrary to the title, is coming into view in piecemeal fashion. 1 In the beginning, we watch a procession of aspiring researchers, amateur archeolo-gists, orientalist historians, philologists and casual travellers from Europe, scribbling and tracing somewhat blindly and with awk-
1. In conformity with this narrative logic, Djebar’s text itself somehow partakes in the diachronic process : only two years after the book’s publication, the ancient city of Dougga that forms the setting of the narrative becomes enlisted as a World Heritage site by the UNESCO.
Writing of the origin : Language and historicity in assia djebar’s…
92
ward gestures upon history’s vast writing pad, that calls to mind the real-size maps in Borges stories. All this is incorporated into the story of Dougga as the preliminaries of historiography.
“But how to translate this ?… We may imagine the question being silently repeated by the characters in Djebar’s story as they pace the streets of ancient Dougga, far from any contemporary major cities of the North African coast ; an ancient city located in inland Tunisa that owes its “complete and well-preserved” state to “its re-moteness from ancient and contemporary roads and its abandon-ment in late antiquity” (World Heritage Center 114). And within this silently intact cityscape, the one edifice that unmistakably strikes the sight of the visitor is “a majestic, harmonious, even strange, three-storey mausoleum,” “standing in the middle of an olive grove” (Djebar, So Vast 128 ; 137). This is the monument around which the story of Effacement will develop ; the structure of the narrative itself modeled on the architectonics of the edifice, moving from one façade to another in pace with those who trace and retrace the letters on the stone, observing, comparing, piec-ing together clues, always guided by the one question : “How to translate this ?” One is confronted by the problem of language soon as one takes the first step toward the trace of the past : The monument at Dougga consists of a collage between Greco-Roman and Egyptian features. Each of the three storeys is erected on stepped platforms. Above the burial chamber on the first level stands the middle section surrounded on all sides by embedded Roman columns, finished with a pyramidal top. Figures in relief, Roman chariots and winged figurines ornament the column heads and corners. As the observer moves from one façade to the next, a different cultural reference emerges with each shift of the per-spective. This architectonic movement lends its structure to the narrative, which unfolds in seven movements, each presenting the attempt made by a particular character from a particular era to decipher the monument’s history. Djebar’s cast of characters come
Ayşe Deniz Temiz
93
from unofficial historians, aspiring archeologists, or enthusiasts who, in one way or another, have left a record of the mausoleum. Redeeming these figures—a French captive to Tunisian pirates, a “renegade count” from Napoleonic empire, a British “archeologist lord” —from their respective inconspicuous places in history, the narrative gathers the partial vision they each offer as they move around the same monument, and yet, separated by history, are un-able to catch up with each other.
Despite each historian’s particular shortcomings, the blind spots in his vision due to misjudgments and confusions, all the accounts converge on a single question : that of the stele, or more precisely, the double steles on “two parallel but not similar faces” bearing seven-lines of inscription that holds the key to the monument’s history. The inscription, however, becomes a stumbling block for the historian rather than the key he hopes to find in it. When for instance the French exile Thomas d’Arcos, the first known chroni-cler of the ancient city, happens upon the site of the ruins in the seventeenth century, “drawn there by his curiosity about the Ro-man past” (128), the details he finds on the monument speak of another history :
Even though he is unable to read any of the signs, he sus-pects that one of the scripts on the two faces of the stele is Punic. For a moment he muses over the final moments of the Carthaginian presence : he tells himself with tears in his eyes that what he is copying down dates at least from the second century before Christ !… If one speech, one solemn declaration is inscribed there in the Phoenician language, before or after Carthage was abandoned to the flames, the other side would bear the same declaration, but in what lan-guage ? The language of the Vandals ? No. Or that of some other vanished population ? (129 ; emphasis added)
Writing of the origin : Language and historicity in assia djebar’s…
94
A century later, following inadvertently in the footsteps of Thom-as d’Arcos, Count Bourgia from Napoli is consciously searching for the remains of Carthage during his trip to Tunisia. But for all his preparation and learning, the mausoleum at Dougga will con-front him with an enigma :
While there he made numerous pencil sketches, some of which he later traces over with ink. He methodically repro-duces each of the monument’s façades as well as numer-ous plans of the inner chambers on all three levels. Finally, he copies down the bilingual inscription—in the notes he wrote in Italian to accompany the reproduction he men-tions two types of lettering, mistakenly referring to them as punico e punico-ispanico. (133)
Two decades after the count, Lord Sir Temple, “a fanatic about archeology,” arrives from Britain to Tunis, “dying to do just one thing” : “The next morning I was going to walk on the site of the great Carthage, he writes” (136). He is especially excited about visiting the ancient city of Dougga, which has been overlooked in the chronicles of the famous orientalist Shaw in the former cen-tury. During his tour of the city he too will unmistakably pause upon the monument with the double inscriptions, like his prede-cessors Thomas d’Arcos and Count Bourgia unbeknownst to him, and more ambitously than the former two quasi-historians he will see through his dream of publishing his observations in 1835 as part of his Excusions en Méditerranée :
On the east face a double inscription catches his eye and he is fascinated by it : One of the scripts is Punic—he quick-ly recognizes it. The other has unknown letters, probably “some form of old African,” he says to himself. He supposes therefore that this mausoleum dates from the last years of Punic Carthage—shortly before its disappearance, in 146 B.C.E.—or after ? (137 ; emphasis added)
Ayşe Deniz Temiz
95
The stele on the monument stands before the succesion of aspiring historians as the threshold to the origin. They each are suspended at this threshold, fascinated and disarmed by a writing that refuses to reveal its secret. The encounter with history has this immediate effect that it causes the historian to lose his language, though not his interest ; on the contrary, the language obstacle drives him to a zealous activity of tracing and retracing, copying and reciting a script that he cannot comprehend. The relation to the origin has its beginning in this strange reading without comprehension of the mute sign of an unknown language. Thanks to this blind urge for historicity, by the end of the first three movements of Effacement the secretive script of Dougga has already found its way to Rome, Paris, and London through letters, journals, and drafts sent by the quasi-historian, who is as yet unable to decipher its code. In other words, the writing of history is well on its way before the historian is able to cross the threshold of language. This threshold does not so much impede the work of historiography as facilitate it, cause it to proliferate, enable it to ask questions and disseminate them far enough to hit upon a chance for an answer.
In the first three movements of the story, where we follow the three quasi-historians, who themselves will gradually all but dis-appear from history’s record, in their erronous tracks towards what they imagine to be the “Carthaginian past,” we are thus al-ready placed within the essence of the historical, though still far from the truth of history being revealed. The moment when the self-made historian is stopped on his tracks in the course of his journey, namely, the moment that he is disarmed by the encoun-ter with an unknown language, is the very instance that histori-cal sense manifests itself. The subject is confronted by something that he will not be able to account for within the terms of his prevailing knowledge. The discovery that he makes is that of a past which he cannot place within the coordinates of his acquired history. Once the subjective illusion that sees in history a confir-
Writing of the origin : Language and historicity in assia djebar’s…
96
mation of the present (of the self ) is broken, what emerges instead is the inappropriable alterity of the origin, or what Nietzsche calls the wirkliche Historie.
Writing of the Event : Improper Language
Then, through the fourth and the fifth movement of the story something happens that will give more acuity to historical sense, through some narrative realignment between the temporal planes, between, that is, the primordial past to which the writing on the stele testifies, and the narrative present, which is that of the his-torian working on deciphering the original script. What happens will close up the distance that divides history from the present, and clear the cloud that occludes the vision into the past. This sudden change involves a switch of position between the pen and the sword, the sword of history getting the upper hand over the pen of the historian. More precisely, the narrative, which has been moving in a linear fashion up until this point is interrupted by the event whose disruptive force causes the ordering of time to break down, along with the most basic assumptions of the historian.
The event of “Destruction” declared in the title of the fourth movement refers in the first place to the French occupation of the city of Constantine in 1836. This historical moment, however, falls in step with the colonial pursuit of archeology, which contin-ues undeterred by the war till it culminates in another destruction whose symbolic import will echo the colonial devastation of the city. A heightened sense of the event now takes over the narra-tive which, in contrast to its preponderous pace in the earlier sec-tions, accelerates into a breathtaking rhytm, mapping the stages of the French invasion with a rich detail of dates, places and fig-ures that are intertwined with the passage of a full-fledged troop of archeologists and historians through the wreckage of war, as if their lack of historical sense, their incapacity to witness, had
Ayşe Deniz Temiz
97
immunized them to the present. Thus, during the long siege and final fall of Constantine that marks the beginning of French co-lonialism in Algeria, Djebar’s embedded historians—whom she calls “tourists”—will “resume their calculations, locating various sites… Although rage and death on the move spread out now… in these October days, the two foreigners, the Englishman and the Dane, have come only for the past” (141). As the two planes, the historical event and the writing (of history), follow on the heels of one another, the ruins on the archeological site lose distinction from the ruins of the cities ravished in the battle. Caught up in the paradoxical temporality of the event, 1 the present speeds up, only, as it it turns out, to catch up with the past.
As the story of the stele is taken over by that of the siege of Con-stantine we are introduced to two main characters : Ahmed Bey, who unifies Kabylian troops under his command and leads the resistance against the French army ; and Hamdane Khodja, a dig-nitary and intellectual of Turkish origins from Algiers, and an émigré in Paris at the time of the attack, acting as an intermediary between the Kabylian resistance and the moderate sections within French politics to negotiate for ending the occupation. When his efforts in Paris prove futile, he remains firm in his determination to support the struggle, and relocates to Constantinople, the seat of Ottoman power, to solicit the sultan’s assistance to the Kabylian forces under Ahmed Bey’s command. He presents the situation to the Ottoman authorities with an accurate prediction regarding the likely advance of colonialism over the entire Maghreb if the French cannot be stopped immediately. Khodja, whose title (Ara-bic for “teacher”) attests to his standing as an intellectual, and who, as we learn, speaks both French and British, Arabic and Turkish
1. Citing Nietzsche’s “On the Uses and Disadvantages of History for Life,” Deleuze and Guattari describe the event as the “vaporious region of the unhistorical.” What is Philosophy ? Trans. Hugh Tomlinson and Graham Burchell. New York : Columbia UP, 1994 ; p. 96.
Writing of the origin : Language and historicity in assia djebar’s…
98
fluently, represents a distinct position in the plot. The paralell between his efforts and those of the Kabylian military leader con-stitute a characteristic pairing, that of the pen and the sword, as two means of involvement in the event, with equal intensity and necessity. The act and its writing are manifested as complimenta-ry rather than contradictory. The comradeship of Ahmed Bey and Hamdane Khodja gives us an image of the mutual bond between the militant and the intellectual that Djebar will be exploring in numerous other texts as well, particularly in Blanc de l’Algérie, through such figures as Emir Abdelkader, the nineteenth century resistance leader and prominent poet ; or Ferhat Abbas, the mili-tary and political leader of the early years of independence, and an advocate of political over military solutions.Another reflection of this figure in the current text is the Greek-Roman historian Polybius from the 2nd century B.C., who will be the protagonist of the seventh section, titled “The Deported Writer.”
Polybius, the well-known chronicler of the Carthaginian War, is mirrorred by Hamdane Khodja, who provides the first account of the French occupation that will herald the colonial period in Algeria.In 1833, three years before the fall of Constantine, Khodja publishes a memoir in which he details the social and economic effects of the occupation, and argues for the right to sovereignty of the Algerian people.
In order to ground his diplomatic efforts in Paris with a testimo-ny, he has the book immediately translated into French, adding an appendage of his correspondances with the French army officials.The book, which appears in Paris with the title, Le Miroir, will not fail to create repercussions. The French mareschal Clauzel responds with a published “refutation,” while simultaneously an African Commision is set up to inquire into the situation. 1
1. Excerpt from the back cover of Le Miroir.
Ayşe Deniz Temiz
99
For Khodja writing is an immediate response to the event, a re-cord of and an intervention upon it. From amidst the occupation of Algiers, followed by that of Constantine, he reports the destruc-tion and translates it immediately into a demand, which implies translating it into the language of the aggressor. His double roles of the chronicler and the intermediary depends on his fluency in the dominant languages of the period, that of the occupier and the Empire, French and Turkish. He manages an intense traffic of letters with the French officials, as well as with the Ottoman authorities while still in Paris. His son Ali Effendi, who also lives in Paris at the time, will follow his example and respond to the occupation of Constantine by drafting a memoir about his trav-els into Kabylia accompanying his father to meet with the leader of the resistance, Ahmed Bey. Like Khodja, Ali Effendi will have his draft translated into French, in collaboration with the promi-nent orientalist scholar, de Saulcy. It should perhaps be noted that the French used by Khodja to intercede in the Paris circles is not yet the compulsory French spoken in a colonial Algeria. And yet Khodja certainly can be counted as a primary figure in the long line of Algerian authors who are caught up in the double bind to write about destruction in the language of the colonizer. In the last movement of the story this double bind acquires a clearer outline in the figure of Polybius, who finds himself compelled to chronicle the demise of his native Attica under Roman attacks from his assigned position of the Roman historian. The same im-perative no doubt obliges bilingual writers in contemporary Al-geria, with the difference that these authors face the additional imperative that they must now renounce the French language and return to their origins. The dynamics of this counter-imperative of the new nation state will become Djebar’s main focus in Blanc de l’Algérie along with the systematic violence that it legitimizes. Through the figure of Hamdane Khodja in this second, paral-lel text the problem of writing in the other’s language is placed
Writing of the origin : Language and historicity in assia djebar’s…
100
in perspective as an imperative born from the event, rather than a subjective choice on the part of the writer. The image of the friendship between Khodja and the Kabylian resistance leader, for whom Khodja will show life-long support, serves to defy any skep-ticism regarding the loyalty of the francophone intellectual, which continues to haunt bilingual writers in contemporary Algeria of the 90s.Hamdane Khodja’s unswerving allegiance to the Algerian cause is affirmed at the very source, by the figure in whom the cause originates. This also serves to show that the original cause relies upon the supplement of a writing to record its struggle and to communicate its goal, even when doing so will necessitate us-ing the language of the other.
In Monolingualism of the Other ; or, The Prosthesis of the Origin, Derrida talks about a “certain loving and desperate appropriation of language” that characterizes a writing in which one is obliged to use a language that is not one’s proper tongue, as is the case under the French colonial interdict on language :
this I of whom I speak is someone to whom, as I more or less recall, access to any non-French language of Algeria (literary or dialectical Arabic, Berber, etc.) was interdicted. But this same I is also someone to whom access to French was also interdicted, in a different, apparently roundabout, and perverted manner. (30-31)
Addressing the audience of a conference on bilingualism, Derrida however begins by altering the question from one of the coex-istence of two or more languages, into that of monolingualism, that is, being compelled to write in the other’s language without recourse to any outside. The predicament of having to renounce one’s mother tongue, as described by the Moroccan author Ab-delkebir Khatibi whom Derrida cites, does not constitute the ker-nel of the problem for him, since, as a Jewish Algerian, he has known no language prior to French, nor one used alongside it in
Ayşe Deniz Temiz
101
the familial sphere. 1 The question of the alienation in the oth-er’s language cannot be addressed, Derrida argues, in terms of a choice between languages, or a translation from an original to a target language, which would require a “count” of languages, bi-lingualism or multilingualism. (“No such thing as a language ex-ists… Nor does the language… That, moreover, is why one would never be able to count these things, and why if… we only ever had one language, this monolingualism is not at one with itself ” (65)).We must then ask : what are the grounds for narrowing down a conceptual argument on language to the historical specificity of the Jewish Algerian condition ? Moreover, Derrida goes on to make finer distinctions between various historical instances of de-propriation of language, distinguishing the case of the Jewish Algerian from that of the Jewish diaspora at large as described by Rosenzweig, where according to Derrida, “the Jewish person can still appropriate and love the language of the host like their own, in a country that is their own, and, above all, in a country that is not a ‘colony’” (82). What kind of a relation to language is Derrida driving at that precludes even a residual re-appropriation ? And if this relation is indeed so peculiar to the Jewish Algerian as to bear no comparison either to the case of the francophone Maghrebian
1. It may be contended that Derrida’s argument is rhetorical, that the interdict on French language in colonial Algeria goes alongside the colonialist strategy of making French into the single official language. But Derrida seems to refer more specifically to the literary use of French, and not merely to its use in daily communication. With regard to the interdict on French education for Muslims and Jews, Djebar’s own memoirs, as well as those of Hélène Cixous provide sufficient illustration. Cixous’ story of her three Muslim classmates in highschool is especially remarkable. The three girls, Zohra Drif, Leila Khaled and Samia Lakhdari, whom Cixous describes as reluctant, much like herself, to communicate with the rest of the French pupils, will indeed invent their own language in time : Zohra Drif becomes a leader in the maquis in the early stages of the independence war, while all the three women will become actively involved in the resistance, and later in the movement of women’s emancipation in independent Algeria. See “My Algeriance” in Stigmata : Escaping Texts. New York : Routledge, 1998.
Writing of the origin : Language and historicity in assia djebar’s…
102
or that of the Jew in the diaspora, then what relevance would his case have to the thinking of the colonial experience of bilingual-ism ?
Derrida points to a third necessity that compounds the predica-ment of the double de-propriation of language :
In what language does one write memoirs when there has been no authorized mother tongue ? How does one utter a worth-while “I recall” when it is necessary to invent both one’s language and one’s I, to invent them at the same time, beyond this surging wave of anamnesia that the double in-terdict has unleashed ? (31)
The ultimate effect of the “double interdict” is to expose the sub-ject to this necessity to recall, which can only take place through writing. The necessity itself stems from the event. Derrida is in fact giving a new definition of the impropriety of language, in which the need to respond to the event overrides the lack of a proper language. The important shift that is being suggested here is that the subject is not so much yielding to a language that is imposed on him, as “inventing” one which has been precluded for him. Derrida will call the invented language that is born of the “generative fury of this repression,” the “degree zero-minus-one of memory.” This invention, he argues, is manifested in a “jealous vengeance” that “mak [es] [the language] pay the price of the in-terdict,” or alternatively “acquit [s] itself… of the interdict” (33).The subject therefore cannot be said to inscribe him/herself sim-ply “within” the other’s language, but rather “in proximity to it,” like a “grievance” or a “complaint,” that bears within itself an “ap-pellant procedure”.
In Djebar’s story the writing in the other’s language appears as a fully necessary means of responding to the event. Hamdane Khodja is responding to the same necessity when he publishes his memoir in French, putting the French language to use for an
Ayşe Deniz Temiz
103
appellant procedure, as when he uses a “coded” language in his correspondence with the Kabylian commander. The use of an “improper” language in either case is called for by the historic-ity of the moment. Indeed, the language distance that separates the historian from the historical event, and the work of transla-tion that this rift necessitates, forms the pivot on which the narra-tive turns. Thus, when during his collaboration with de Saulcy in Paris, Hamdane Khodja’s son shares with the French scholar sev-eral of the letters sent by the Kabylian commander to his father, the distance separating the past from the present becomes un-expectedly bridged. De Saulcy notices a coded writing that runs in the margins of the letter written in Arabic. He guesses that it must be a strategy to avoid interception by the French authori-ties. The sheer coincidence of this observation with the debate in Paris about the bilingual stele of Dougga, leads him to imagine a parallel between the alphabet used in the letters and the one on the stele. An entire translation apparatus already in full gear in Paris at the time lays additional clues at his disposal : reports of unfamiliar alphabetic characters brought back by travelers from around the dessert of Fezzan that are dated to several centuries earlier document a match with the language currently used by Tuareg nomads ; in addition, a Berber-French dictionary has just been published in Paris.
Language of the Origin—Disincorporated Word
A comparison of the various recent reports on ancient Libyan scripts and contemporary Tuareg writings confirms de Saulcy’s intuition, which will soon be elaborated in the work of Célestin Judas. The enigma of the stele, which had eluded historians, ar-cheologists and interpreters for over two centuries, will thus be revealed thanks to a strategy of absolute secrecy. The distance of language that separated the ancient past from the present is
Writing of the origin : Language and historicity in assia djebar’s…
104
bridged all at once. As the past begins to flow on the same plane as the present, a whole set of assumptions and illusions that have sustained the colonialist perspective on history will give way : “What if this “old African,” which in North Africa the indigenous people themselves consider to be merely an oral dialect, what if this “barbarous” speech, before being accepted as “Berber,” used to be written ?” (147).
The historical truth is revealed, yet its effect is not so much reas-suring as disorienting for the dispositif of colonial historiography. The conclusion to a century-old inquiry proves the desire that ini-tiated it, the desire “to walk on the site of great Carthage,” to have been based on a false assumption all along. All the while the histo-rian imagined himself to be approaching the origins of a civiliza-tion which had rivaled the Roman Empire, and in defeating whom the Romans had laid down the precedents of European rule over North Africa, he was in fact being brought closer to a testimony of the long-rooted presence of the Berber people on the very land that is now being claimed from them by the French power. The strategy of colonial historiography, described by Edward Said in Orientalism as the will “to know the other better than they know themselves,” gives way to a situation in which the colonialist is confronted by his own ignorance regarding the historical circum-stances of his endeavor :
And yet the writing was alive. Its sonority, its music, its rhytm still reeled on around them, around the travellers and their followers, going back and forth between Doug-ga and Cirta. It travelled into conquered Constantine and onto the Kabylian mountains, still rebellious fifteen years after the fall of Constantine, and then beyond the dunes and sands of the Sahara, it went all the way to the heart of the desert itself. (148)
Ayşe Deniz Temiz
105
The story’s denoument restores historical sense as an event that undoes the ordering of temporality. The alterity of the primordial past, thus far measured in terms of a language distance, is now placed under a new light as the threshold of language is crossed.The past is not thereby rendered more familiar ; rather, the pres-ent is withdrawn from the “appropriable” position hitherto attrib-uted to it.
But the irony of the origin will not fall only upon the illusions of colonialist historiography. The view of the origin as an undi-vided unity will also be undermined by this irony, even when the referent of that unity is revealed to be the indigeneous people of North Africa. As its language is finally decoded at the end of a long pursuit, the writing on the stele acquires a novel inflection ; it now appears in the form of a crucial proposition concerning the way in which history is thought. Djebar’s fictional staging of the inaugural ceremony for the monument in Dougga in 146 B.C. reveals that, contrary to the most entrenched assumption of the historian, namely the assumption of the propriety of a language to its people, the Carthaginian script has not been put in place by Carthaginian power to begin with, nor even by any subservient people paying homage to Carthage. The monument testifies not to Carthaginian rule, but to its demise. It is the Numidians who con-tinue to write in Punic, and in a celebrant fashion, precisely at a time when the organic tie between that language and “its” people has been severed with the fall of Carthage. The revealing of the secret about the Numidian Berber, then, does not merely fill a gap in historiography, but rather causes an entire displacement in the way historical thought operates. The paradoxical statement of the stele, then, can be formulated thus : the origin speaks an “improp-er” language—the language, moreover, of the colonial other :
Carthage is no longer there, but its language is still current on the lips of both the educated and the uneducated in the
Writing of the origin : Language and historicity in assia djebar’s…
106
cities that fell but were not yet romanized. The language in fact, like a current, runs freely on, never becoming fixed.The Carthaginian language dances and quivers for five or six centuries to come. Freed of the soldiers of Carthage, of the priests of Carthage, of the sacrifice of children of Carthage, Carthaginian speech, free and unsettled, transmutes and transports with vivid poetry the spirits of the Numidians who yesterday made war on Carthage. (159-160)
The truth of the origin supplants the image of an undivided unity.In the place where historical imaginary anticipates an indisput-able suture between a people and its culture, an incarnate lan-guage that could serve as the touchstone for authenticity, histori-cal sense reveals a ghost language that has survived the demise of its original speakers. The once hegemonic Carthaginian Punic acquires a strange freedom in its afterlife through the “loving ap-propriation” of Numidians, who, as Derrida would say, can only inhabit this improper language by re-inscribing it as an inven-tion of their own. 1 Djebar’s narrative imparts a joyful tone to this originary impropriety, such as may be attained when an expres-sion compelled to the language of the other “acquits itself of the interdict” (Monolingualism, 33). The mark of the interdict has dissolved within the affirmation of the “polygamous” quality in-herent to language.
1. At this point the narrative opens the question of the origin unto a new and fruitful direction. A genealogy of ghost languages is laden with the potential to reshape the debate on language multiplicity in a diversity of historical contexts. The case of Turkish-speaking Armenian groups in Syria today, ninety years after their deportation from Anatolia, is a striking instance of this. The precise ways in which “grievance” speaks through this ghostly appropriation of Turkish calls for a thorough study, which could offer new ways for thinking not only the historical relation of Ottoman Empire with its Armenian subjects, but the status of the Kurdish language in the Turkish Republic today. I would like to thank Tuncay Birkan for sharing with me his impressions on encountering this “survivors’ Turkish,” which lives on alongside the major Turkish spoken by the citizens, and unheard by them.
Ayşe Deniz Temiz
107
That affirmation is conditioned upon a distinct sense of historic-ity that is capable of restoring the past in its relation to the event. Thus in the sixth movement of the narrative set in antiquity, the scene of the mausoleum’s inauguration is framed by the destruc-tion of Carthage in the background. Amidst the violent tumult, the Roman emperor Scipio intervenes for a brief unforeseeable mo-ment to give orders to spare the famous library of Carthage from the wholesale fire that holds sway over the entire city. Against all odds, and despite the emperor’s determination to leave no trace of the Carthaginian past behind, the books are saved and handed over to the Numidians, who have been the allies of Rome during the war. Behind this chance event Djebar offers us a glimpse of the figure of Polybius, who, as the mentor to the young emperor, is accompanying him on his military expedition, intervening oc-casionally to temper his pupil’s unbound will to conquer. By sheer contingency of history, or what could be regarded as the uncon-tainable excess of the event over history’s order of succession, the language along with its literature thus becomes disincorporated from the people in whom it originated, in a way that releases its potential for novel “polygamous” connections. The current Nu-midian king Micipsa, who commemorates his father—the former king Massinissa—by a monument adorned with Punic inscrip-tions, will likewise preserve the library of Carthage in the Nu-midian capital of Cirta, which will later become Constantine, the very Berber city where Ahmed Bey confronts the French army. The Numidian, or the ancient Berber culture, will thus serves as a relay for Punic language for centuries to come, during which the original referent of language will presumably have been com-pletely effaced and altered.
This image of the origin that consists in relays and contingent synthesis between a people and a (improper) language has its con-trast in the violence of the pure origin that is based on the logic of tabula raza. Thus, counterposed with the figure of the Berber
Writing of the origin : Language and historicity in assia djebar’s…
108
king, who commemorates freedom from its age-old enemy in the language of the latter, is the unflinching figure of the Roman ruler who registers his victory by ordering the sterilization of the entire stretch of the Carthaginian plain. The resulting blaze that “seems to burn and redden the four corners of the known Mediterra-nean,” as Polybius will later note in Histories (160), is the only image the narrative offers of the origin as the indivisible unity of self-identity. The necessary precondition of such purity is the disavowal of history.
Re-incorporating the Origin : Effacement of Historicity
Destruction, however, is not granted the last word on history in the narrative. In fact for Djebar the writing of history only ever occurs against the will to a pure past that effaces the trace of his-toricity. Thus, the narrative saves its sharpest irony for the co-lonial historian who is captive to a history without historicity, a realm of ruins in which the discourse about the past is reduced to a trade in tombs and stones. The case of Thomas Reade, the British Consul to Tunis during the French occupation, provides a singular example. At the time when the double languages on the stele has started to preoccupy an expanding network of French and British researchers, the British Consul all by himself devises a less cumbersome way to “attain” the ancient writing. Alerted to the growing interest in archeology in Europe he detects that the curious stele could make a good exhibit article at the British Museum, while also possibly rewarding him with a prize he esti-mates at “fifteen hundred pounds.” He sets to work to extract the stele from the monument where it has been impeccably preserved for twenty centuries, and orders “the entire façade bearing the engraved stele demolished, and the stele… sawn in two to make it easier to transport” (144). The travelers who visit the site after the consul’s intervention will be astonished by the heap of ruins
Ayşe Deniz Temiz
109
left behind where the monument used to stand. He will moreover be proved mistaken about the “purchase” of the antique piece, and will receive a mere “five pounds” for his audacious effort, in ad-dition to a condemning record in history to his name. At the turn of the century a French archeologist initiates the reconstruction of the monument from out of the heap of rubble, based on the forgotten sketch books of the earliest amateur chroniclers—those same partial and erroneous accounts used by Djebar in the begin-ning of the story.
But the stele will never be restored to its place on the mausoleum. Even when its secret is finally resolved and its pieces are reas-sembled, the mausoleum will never again be whole. The UNESCO World Heritage Center’s 1997 report on Dougga notes that “[t] he authenticity of the reconstruction of the Lybico-Punic mausoleum in 1908-10 has long been the subject of debate,” and adds in pa-renthesis, “although it might be argued that this has its own histo-ricity” (116). So close to the moment of its decipherment the long elusive truth of the origin will thus flee from sight for good. But the mark that is thereby left by colonial appropriation, a missing mark that reaffirms the impurity of the original writing, indeed becomes part of its historicity, including its very “resurrection… with an Anglo-French rivalry as [its] basis” (148). 1
1. The complete lack of a historical sense in the colonial pursuit of historiography is a theme that sounds familiar to us today from its re-enactment in the Middle East. We have witnessed the distance that separates ancient ruins from the ravishing of an ongoing war likewise fall away when the Buddha statues in Afghanistan’s Bamian region were destroyed in 2001 by the Taliban forces. The Taliban undertook the destruction by way of demonstrating that it rejected the fund offered by western NGOs for the protection of the statues, amidst the blunt reality of generalized UN sanctions on food and medicine flowing into the country, which had left civilians to starvation and death. The Western media seized upon the occasion to create another visual retournelle about the war in the Middle East, one more of those re-iterable explosions, which, like the Freudian fort-da game, stands for the Western spectator-citizen’s failure to come to terms with and symbolize its own death-insinct. “Buddha Collapsed Out of Shame,” a film directed by the Iranian
Writing of the origin : Language and historicity in assia djebar’s…
110
Does the origin thereby reassert its inappropriable truth, or alter-natively, does it finally reveal its truth, which amounts to its inap-propriable quality ? —inappropriable, for it confronts one with an improper language where one expected to find the incarnate speech of the people ; but also because it is tainted with a lack, with a part crucially missing such that it defies the imaginary of an intact and undivided origin. At this very instance the narrative enters into an exchange with a similar moment from another text written during the same time, Le blanc d’Algérie, which, as I have suggested in the beginning of the essay, deals with the violence that stems from the will to (appropriate) the origin in the context of the state-imposed “authentic” Algerian identity in the 1990s.In the epilogue of that text Djebar describes how, in an anxious effort to consolidate a unified Algerian identity, the official his-toriography of the newly founded nation-state engages in a trade of tombs and stones to build, in retrospect, its mythology of ori-
director Hanah Makhmalbaf, alludes to this event in a way that lends a vivid visual image to the flatening of history thematized by Djebar in the section of the story subtitled “Destruction”. Shot on the empty site where the massive Buddha statues used to stand, against the gaping hole carved in the mountain after the explosion and the rubbles on the ground, the peculiar treatment of space in the film flattens the present moment of the Afghan children playing around the rubbles, against the mythical layer of history now erased from the stone. This flattening of historical depth becomes most remarkable in a scene where a group of young boys, who are acting the role of Taliban, surround the little girl, Bakhti, and order her to a hands-up position. The shot nullifies the depth of field as we see the disarmed girl standing against the mountain, while the young boys acting as Taliban call her a heathen-woman, a Buddha-worshipper. In the next shot they start tearing at her notebook fervently, and make paper planes out of it : an entire fleet, which they hurl towards the depthless image of the mountain. “See how we destroyed the Buddha,” says the boy who plays the leader. The flatening of historical layers in the sequence re-enacts the explosion of the statues by the Taliban, which must have been a traumatic event for the children. The infantile repetition of violence, however, simultaneously undermines the vantage point of the Western spectator, since, more than being a parody of terrorism, it flattens the distance that separates the mythological layer—of the statues—that serves as the metonymy of Afghan history for the Western viewer, from the recent political economy of the ongoing war.
Ayşe Deniz Temiz
111
gins. A quintessential anchor point for that mythical narrative is the prominent figures of anti-colonial resistance, among whom Emir Abdelkader has the place of honor as the earliest and most transcient fighter, as well as the greatest poet of his time. In 1966, the president of the young nation comes up with a plan to have Abdelkader’s tomb transferred from Damascus, where the Emir had spent the last years of his life, back to his “native” soil. His-tory’s accident that has caused a displacement of the roots must be rectified in order that the origin found to be missing from its source can be reclaimed and be made to coincide once more with the ground of self-identity. The national narrative seeks to rein-force its coherence with monuments and ceremonies that ensure the re-incorporation of the ancestor to the native land.
The only thing left out of this scheme of re-appropriation, Dje-bar notes with irony, is any attention to the writings of the Emir, his poetry and political thought, which constitute the part of his legacy that would be the easiest to attain and circulate. But words have no place in the exchange of tombs and stones. In order to revoke the scheme of history’s effacement one has to speak in its terms—to demand a body in exchange for a body. Thus, when the envoys sent to Damascus meet with the heir of the Emir, a cabi-net member in the adopted country of his grandfather, he asserts only one condition for granting their request : that the authorities free his son who has been in prison in Algeria for more than a year. “‘Set my son free and you may return my grandfather to your country !’ It seems those were the terms he used : ‘You may return him to your country !’” (Algerian White 224-225).
Works CitedDjebar, Assia. So Vast the Prison. Trans. Betsy Wing. New York : Seven Stories Press,
1999.-. Vaste est la prison. Paris : Albin Michel, 1995.-. Le Blanc de l’Algérie. Paris : Albin Michel, 1995.
Writing of the origin : Language and historicity in assia djebar’s…
112
-. Algerian White. Trans. David Kelley and Marjolijn de Jager. New York : SevenStories Press, 2000.Foucault, Michel. Language, Counter-Memory, Practice. Ed. Donald Bouchard.Trans.Donald Bouchard and Sherry Simon. Ithaca : Cornell UP, 1977.Stora, Benjamin. Histoire de l’Algérie coloniale (1830-1954). Paris : La Découverte,1991.Nietzsche, Friedrich. Genealogy of Morals. Trans. Francis Golffling. New York :Doubleday, 1956.World Heritage Center, World Heritage List (794) 1997.Khodja, Hamdane. Le Miroir : Aperçu historique et statistique sur la Régence
d’Algér.Paris : Actes Sud, 2003.Derrida, Jacques. Monolingualism of the Other ; or, Prosthesis of the Origin. Trans.Patrick Mensah. Stanford : Stanford UP, 1998.Said, Edward. Orientalism. Vintage : NY, 1979.
113
Abstract
Educational technologies and language motivational instructions are actually the study and ethical practice of facilitating learn-ing and improving performance by creating, using and managing appropriate technological processes and resources. This is often associated with, development, use, management, and evaluation of processes and resources for learning. Educational technology includes, but is not limited to, software, hardware, as well as In-ternet applications, and activities. Media psychology is the field of study that applies theories in human behavior to educational tech-nology. Through this concept, our strategy when referring to edu-cational technologies and language instructions is to apply much of the human performance as a cottage to language learning suc-cess. This performance is an evidence-motivation-based ; as, ac-cording to us ; motivation is one of the key concepts to successful
EDUCATIONAL TECHNOLOGIES AND LANGUAGE MOTIVATIONAL INSTRUCTIONS
Salima MAOUCHE-KETFI,Maître de Recherche LERSHMM
Educational technologies and language motivational instructions
114
language learning especially for EFL learners. Maintaining a high level of motivation during a period of language learning is one of the most adequate ways to make the whole process more success-ful. As each individual is motivated in different ways, we have to find the right balance of incentives to succeed and disincentives to fail, encouragement, and the right environment in which to learn. In this respect, we focalized on some external factors as to intro-duce the use of movies and documentaries in classrooms to moti-vate our learners and to create a sound environment for learning, instruction, and recreation at the same time. As a matter of fact, this paper seeks to demonstrate how EFL learners are able to take a major stride toward learning English as a foreign language and foreign culture and civilization, and blending the English linguis-tic features as vocabulary. For this purpose, we organized a study day on “African Literature and Civilization” with our Master Two LLCE students to enable them understand the different messages the African writers convey through their novels which, most of the time seem difficult to reveal, depict the African society, its organization, its culture and beliefs and mostly the western chal-lenges it encounters. The article source of inspiration was based on a comparative study between the Nigerian, Kenyan and Alge-rian societies to draw differences and similarities throughout this study. The result was a real success since the students not only were fascinated by this new strategy but they were also able to present a piece of writing on this concern.
Index / Key Terms—Educational technologies, Motivational in-structions, Movies and documentaries, writing skill, foreign lan-guage learning, developing memorization abilities.
Résumé
Les technologies éducatives et la motivation instructionnelle lan-gagière sont en réalité l’étude et la pratique éthique de faciliter
Salima MAOUCHE-KETFI
115
l’étude et l’amélioration de la performance en créant, utilisant et gérant des processus technologiques et des ressources appropriés. Ceci est souvent associé au développement, l’utilisation, la gestion et l’évaluation du processus et des ressources pour l’apprentissage d’une langue. La technologie éducative inclut, mais n’est pas limi-tée au logiciel, en tant que matériel aussi bien qu’aux applications Internet et des activités. La psychologie médiatique est le domaine d’étude qui applique des théories dans le comportement humain à la technologie éducative. Par ce concept, notre stratégie en se référant aux technologies éducatives et des instructions de langue doit appliquer et impliquer beaucoup de performances humaines comme une source au succès d’apprentissage des langues. Cette performance est une motivation d’évidence basée » ; comme, selon nous, la motivation est un des concepts clés à l’apprentissage des langues fructueux particulièrement pour des apprenants du EFL. Le maintien d’un haut niveau de motivation pendant une période d’apprentissage des langues est une des façons les plus adéquates de faire le processus entier plus réussi. Comme chaque individu est motivé de différentes façons, nous devons trouver l’équilibre juste de motivations. À cet égard, nous nous sommes focalisés sur quelques facteurs externes pour présenter l’utilisation des films et des documentaires dans des salles de classe pour motiver nos apprenants et créer un environnement d’apprentissage et d’ins-truction sain, et par la même occasion un environnement de ré-création.
Introduction
Educational technologies and language motivational instructions are actually the study and ethical practice of facilitating learn-ing and improving performance by creating, using and managing appropriate technological processes and resources. This is often associated with, development, use, management, and evaluation
Educational technologies and language motivational instructions
116
of processes and resources for learning. Educational technology includes, but is not limited to, software, hardware, as well as In-ternet applications, and activities. Media psychology is the field of study that applies theories in human behavior to educational tech-nology. Through this concept, our strategy is when referring to educational technologies and language instructionsto apply much of the human performance as a cottage to language learning suc-cess. This performance is an evidence-motivation-based ; as, ac-cording to us ; motivation is one of the key concepts to successful language learning especially for EFL learners. Maintaining a high level of motivation during a period of language learning is one of the most adequate ways to make the whole process more success-ful. As each individual is motivated in different ways, we have to find the right balance of incentives to succeed and disincentives to fail, encouragement, and the right environment in which to learn. As a matter of fact, this paper seeks to demonstrate how EFL learners are able to take a major stride toward learning English as a foreign language and foreign culture and civilization, and blend-ing the English linguistic features as vocabulary. For this purpose, we organized a study day on “African Literature and Civilization” with our Master Two LLCE students to enable them understand the different messages the African writers convey through their novels which, most of the time seem difficult to reveal, depict the African society, its organization, its culture and beliefs and mostly the western challenges it encounters. The article source of inspi-ration was based on a comparative study between the Nigerian, Kenyan and Algerian societies to draw differences and similarities throughout this study. The result was a real success since the stu-dents not only were fascinated by this new strategy but they were also able to present a piece of writing on this concern.
• A General Overview in the fields of the current study
Educational technology includes other systems used in the proc-
Salima MAOUCHE-KETFI
117
ess of developing human capability such as software, hardware, as well as Internet applications. It is most simply and comfortably defined as a display of tools that might prove helpful in advancing student learning and may be measured in how and why individu-als behave. Educational Technology relies on a broad definition of the word as it can refer to material objects of use to humanity, such as machines or hardware, but it can also encompass broader themes, including systems, methods of organization, and tech-niques. Some modern tools include but are not limited to overhead projectors, laptop computers, and calculators. Newer tools such as « Smartphone » and games (both online and offline) are beginning to draw serious attention for their learning potential. On this ba-sis, educational technology is to transform basic educational and psychological research into an evidence-based applied science of learning or instruction. Furthermore, using and introducing films and documentaries in EFL learning and teaching classes not only encourage self-instructional programs and provide an accessible, interactive, and flexible way of presenting curriculum material-but assess the effectiveness of these technological and pedagogical tools and use textual materials, visuals, sound, and motion as well in higher education. A systematic review of the published literature comparing media –based instructional teaching and learning with other teaching methods was performed and the use of academi-cally homogeneous EFL students with objectives, predefined out-come criteria measuring performance, time spent, and attitudes. So much so, and according to the field this paper is describing we could say nothing but that the role and impact of audio-visual media have been a matter of considerable debate among higher education teachers since the emergence of the new pedagogical technologies as aids to communicating the curriculum, as forms of artistic and cultural identity, and as part of the critical cultur-al pedagogies of a liberal education. In the Algerian Universities the concept of using “the Media” was forged in the early 1980’s
Educational technologies and language motivational instructions
118
and later participated in preparing an integrated media educa-tion curriculum for graduated students mainly during these last decades with the new educational reforms. Although this initia-tive legitimated media education within classroom practice, it has not been fully exploited. However, integrating and incorporated the use of media tools as films and documentaries enable teach-ers determine the why, how and to what degree they succeed in teaching specific topics in literature and civilization and fully in-volve the students into a deep structural, thematic and linguistic understandings of the matters at hand. Furthermore, the value of media as a tool for both training and teaching/learning purposes plays a major role in assessing the preferences and aspirations of teachers and educators as well as the preferences of the students as to convey social attitudes or to enhance vocational skills and mo-tivate interest among them. Recognizing new media as emerging forms of artistic self expression, as audio-visual teaching aids is to recognize and find out the right technique to reach and engage diverse learners.
In addition to this, many teachers and students see media educa-tion as bringing electronic media and popular culture (other than books) into the classroom -to motivate and educate today’s stu-dents. The media they most often report using are news papers, magazines, film and video documentaries, websites and internet resources, as well as advertising, music and films.
We also wondered about the impediments that teachers experi-enced in promoting media literacy. Open ended responses fell into a number of categories which can be seen as largely support for the idea of teaching media literacy in the community, schools, among students. At the same time, they experienced frustrations of not having adequate technical resources (such as up-to-date computers and projectors) as well as limited access to films, vid-eos, newspapers, ads and curriculum packages that could be eas-
Salima MAOUCHE-KETFI
119
ily used in the classroom. Most teachers would like to have more teaching materials available to them, and access to better resourc-es to enhance their media production efforts in the classroom. They also note that preparation time and useful examples would be helpful though the technique of using this genre of media is used as an adjunct to traditional education and as a means of self- instruction.
2-1- Instrumental Motivation and ICT-based Approach Implementation
A number of pedagogical approaches have been developed in the computer age, including communicative and integrative ap-proaches. Others include constructivism, whole language theory, and socio-cultural theory although they are not exclusively theo-ries of language learning. With constructivism, students are ac-tive participants in a task in which they construct new knowledge based on experience to incorporate new ideas into their schema of knowledge. Whole language theory postulates that language learning moves from the whole to the part, rather than teaching the sub-skills like grammar toward higher abilities like writing. Whole language insists on the opposite. Socio-cultural theory states that learning is a process of becoming part of a desired com-munity and learning that community’s rules of behavior (Harmer, 2001).What most approaches have in common is taking the cen-tral focus from the teacher to students’ experience. The computer provides the opportunity for students to be less dependent on a teacher and have more freedom to experiment on their own with natural language.
In recent years, explosion of knowledge and technology access se-riously challenged the traditional language teaching and learning methodologies. Most teachers and experts recognize the need for a teaching method using Information and Communication Tech-nology (ICT) facilities as one of the most important techniques in
Educational technologies and language motivational instructions
120
teaching a foreign language in relation to educational objectives, learners and contents. Researches point out that language learners learn more and at a faster rate when they are stimulated enough. By means of improved teaching techniques, especially applying technology- based activities and applications, language teach-ers may have higher achievements in instructing English writing skills. Therefore, the widespread use of computers has created enormous opportunities for learners to enhance their language skills.
Moreover, technology-enhanced language learning was given a huge theoretical boost when Sydney Papert (1993) and others applied the principles of Piaget (1950) to the use of computers. “Constructivism” involves the use of problem-solving during tasks rather than direct instruction by the teacher. In Media-based Lan-guage Learning, the theory implies learning by using media tools to explore a foreign language.
Media-based Language Learning can be used to reinforce what has been learned in the classroom, or it can also be used as reme-dial to help learners with limited language proficiency and this has developed to link technology and pedagogy.
Warschauer (1996) divided the development of these technologi-cal tools into three phases : behaviorist, communicative, and inte-grative using multimedia and the internet. Behaviorist is defined by behaviorist theories of learning of Skinner. Because repeated exposure to materials was considered to be beneficial or even es-sential, computers were considered ideal for this aspect of learn-ing as the machines did not get bored or impatient with learn-ers. Communicative is based on the communicative approach in which the focus is on using a language rather than analyzing it. Integrative / explorative tries to integrate the teaching of language skills into tasks to provide directions.
Accordingly, one of the basic language skills the students are
Salima MAOUCHE-KETFI
121
learning is writing which consists of some sub-skills such as spell-ing, grammar, and punctuation. Peter Elbow (1992) expresses the conventional understanding of writing is as a two-step process. First, you figure out the meaning ; then you put it into language. He says process is not the end ; it is the means to the end. Brown (2001) says that trends in the teaching of writing in a foreign lan-guage classroom have not coincided with those of the teaching of other skills. He makes a distinction between writing as a process or product. To him, there is nothing inherently wrong with at-tention to any of these two aspects. He introduces different types of classroom writing performance : imitative or dictation, con-trolled or intensive, self-writing, real writing (that is, academic, technical, and personal). He then shows the six general categories that are often the basis for the evaluation and suggestion to the students’ writings. They include content, organization, discourse, syntax, vocabulary, and mechanics. According to Holmes and Kidd (1982) as all language skills and sub-skills benefit from the computer, so does the grammar and writing.
Turkle (1984) cites the case of Tanya, a pupil whose writing changed drastically when she got access to a technological tool. From never writing anything, she grew to like writing so much as to see herself as a writer. She had beautiful ideas but she didn’t know grammar well and too many spelling errors in her writing made it as an unacceptable one. This tool offered her a product that looked so neat and at the same time grammatically correct and free from spelling and punctuation errors that was unques-tionably right, a feeling she had never known before using the ma-terial. She was painfully aware of her deficits, ashamed of them, and above all, afraid of being discovered.
Based on what scholars state in the field, where technology is de-ployed to its best advantage, we should see teachers’ roles become that of guide and mentor, encouraging students to take charge of their own learning, helping them to learn at their own pace.
Educational technologies and language motivational instructions
122
Motivation is one of the key concepts to successful language learn-ing especially for EFL learners. Maintaining a high level of moti-vation during a period of language learning is one of the most adequate ways to make the whole process more successful. As each individual is motivated in different ways, we have to find the right balance of incentives to succeed and disincentives to fail, encouragement, and the right environment in which to learn. In this respect, we focalized on some external factors as to introduce the use of computers in classrooms to motivate our learners and to create a sound environment for learning and recreation at the same time as we profoundly believe that technology can have a re-ciprocal relationship with teaching. In addition to this, the emer-gence of new technologies pushes educators to understanding and leveraging these technologies for classroom use ; at the same time, the on-the-ground implementation of these technologies in the classroom can (and does) directly impact how these technologies continue to take shape As a matter of fact, this paper seeks to demonstrate how EFL learners are able to take a major stride to-ward learning English and blending the English linguistic features as vocabulary, spelling, punctuation, and grammar.
2-2- Role of motivation in language learning
What is good learning and what may enhance and motivate it ? These are actually two main questions with which we open a wide space for reflection and study as delving into a sensitive topic as this, is truly not an easy task since many factors and criteria should be engaged to reveal thick layers on the teaching and learning EFL processes, mainly this invaluable ingredient : motivation, which make of these processes a real success or a failure. These may be some subjective questions ; but immersing students in a learning experience that allows them to grapple with a problem, gaining higher-order thinking skills from pursuing the solution is likely to be a key component to answers that many educators would give.
Salima MAOUCHE-KETFI
123
In this sense, we would say that social psychologists were the first to initiate serious research on motivation in language learning be-cause of their awareness of the social and cultural effects on L2 learning (Dornyei, 2003)1.This interest was translated into the ap-pearance of a number of models that stressed the affective aspect of language learning including Krashen’s (1981) Monitor Model and Schumann’s (1986) Acculturation Model. However, the most influential model of LLM in the early sixties through the eighties of the previous century was that developed by Gardner, follow-ing studies carried out by him and associates. The model came to be known as the Socio educational Model (Gardner, 1985). Gard-ner defined motivation as a ‘combination of effort plus desire to achieve the goal of learning the language plus favorable attitudes towards learning the language’ (ibid : 10). In his model, Gardner talked about two kinds of motivation, the integrative and the in-strumental, with much emphasis on the former. The integrative motivation refers to learners’ desire to at least communicate or at most integrate (or even assimilate) with the members of the target language. The instrumental motivation refers to more functional reasons for learning the language such as getting a better job, a higher salary or passing an examination (Gardner, 1985). There are a number of components in the socio educational model which are measured using different attitudinal and motivational scales in what Gardner called the AMBT (Attitude / Motivation Test Bat-tery). Integrativeness is measured by three scales : attitudes to-wards the target language group, interest in foreign languages, and integrative orientation. Motivation is also a field of great im-portance as there were people who showed interest in LLM long before that but without systematic and focused research on LLM (see Horowitz, 2000) measured by three scales : motivational in-tensity (the amount of effort invested in learning the language), attitudes toward learning the target language and the desire to learn the target language. Attitudes toward the learning situation
Educational technologies and language motivational instructions
124
which refer to the individual’s reactions to anything associated with the immediate context in which learning takes place is meas-ured by two scales : attitudes toward the teacher and attitudes to-ward the course. However, it was the integrative motivation that was most stressed by Gardner and it was in fact the backbone of his model (figure 1). The role of attitudes towards the learned language, its speakers and the learning situation are all considered parts of the integrative motivation. In fact, the integrative aspect of the model appears in three different components : integrative orientation, Integrativeness, and integrative motivation. Gardner repeatedly stressed the differences among these components (e.g. Gardner 1985, 2001 ; Masgoret & Gardner, 2003) since confusion was often made between orientations and motivations. Accord-ing to Gardner orientations refer to the set of reasons for which an individual studies the language ; whereas, motivation refers to the driving force which involves expending effort, expressing de-sire and feeling enjoyment. The term orientation is problematic since it can also mean ‘attitude or inclination’. Still however, other understandings of the concept of orientation have been suggest-ed. For example, according to the understanding of Belmsihri & Hammel (1998), and others in the field, orientations are long–range goals (more will be said below about the role of goals in motivation), which, along with attitudes, sustain student’s moti-vation. However, as the focus should be pointed at only immedi-ate and at hand research field concepts of motivation, we will shed light on the following :
• Integrative Motivation : Crookes & Schmidt (1991) de-fined it as the learner’s orientation with regard to the goal of learning a second language. This definition in relation to the learner’s attitude allows for one’s evaluation of an at-titude object to vary from extremely negative to extremely positive, but also admits that the learner can also be con-flicted or ambivalent toward an object meaning which
Salima MAOUCHE-KETFI
125
he / she might at different times express both positive and negative attitude toward the same object. This has led to some discussion of whether individual can hold multiple attitudes toward the same object towards the target lan-guage group and the desire to integrate into the target lan-guage community.
• Instrumental Motivation : Hudson (2000) characterized the desire to obtain something practical or concrete from the study of a second language. Instrumental motivation underlies the goal to gain some social or economic reward through L2 achievement.
Instrumental motivation not only teaches students to be mind-ful of their actions / impact on others but make of these habits of mind, or conceptual knowledge become the greatest source of outcomes of the learning experience which in turn can transfer skills and morph into other domains, roles, and easy work. We will name this instrumental motivation : Information and Com-munication Technology-based teaching and learning approach because the emergence of new technologies has been paralleled by the evolution of theories on cognition and learning. Where learning and the mind were once viewed as “filling of the bucket,” the “social mind” is now a much more prevalent model. Of course, educators have long been aware that learning is a social activity, where learners construct their understanding not just through in-teraction with the material, but also through collaboratively con-structing new knowledge with their peers.
In order to see whether the multimedia tools in general and films and documentaries can help foreign language learners much bet-ter than the teachers in the improvement of their writings, here is the description of the investigative work.
Educational technologies and language motivational instructions
126
3- METHOD
Students’ level and stream
Teaching and learning credit
Subject-spe-cific search strategy
Students’ reac-tions
Master 2 language, literature and civilization (LLCE)
African Lit-erature and civilization
Hand outs, traditional teaching using blackboards, role play
• Weak par-ticipation,
• Partial un-derstanding of the content,
• boredom
A student-centered teaching methodology is an essential ingre-dient of a successful Pan-African literary course. Using such an approach, I combine reading assignments with journals, film presentations, and lectures in a productive learning environment in which I play the role of invisible facilitator of intellectual ex-change. My method incorporates a variety of Pan-African literary and historical works that help students understand the relations between Blacks of Africa and the Diaspora. The field needs to be-come more inclusive to reflect the multidimensional histories and cultures of that population while not losing sight of the history and specificity of Black experiences and struggles both locally and globally”. Using this balanced methodology, I employ a student-centered approach that enhances students’ understanding of Pan-African literature and contemporary issues through exploration of the connections among the literature, history, and folklore of Blacks of the Diaspora and Africa. Of course, the instructor can include the students’ voices by asking them the following ques-tions at the beginning of the semester :
• What topics should or should not be included in the syllabus in order to strengthen or contradict particular themes and issues ?
Salima MAOUCHE-KETFI
127
• What types of activities should be organized in or outside of class in the place of others ?
• What movies / documentaries should be watched in class in place of others ?
Students are more eager to learn and participate actively in a class when they know that the instructor takes their opinions and choices into consideration in the process and structures of the pedagogy. Giving students a voice in the syllabus will help them be accountable for what takes place in the classroom. When both their voice and responsibility are validated, students become ea-ger to discuss controversial themes such as slavery, war, globaliza-tion, sexism, feminism, homelessness, and sexual orientation, all of which require them to take positions and defend them firmly and responsibly. No morality, whether of sympathy for or devo-tion to a cause, race, sex, gender, or other identity should be used to tell students what they ought to do or how they should think. As Sartre points out, “It is I myself, in every case, who have to interpret the signs” (131-132). From this logic, students are the prime interpreters and facilitators of their own learning as they compare and critique texts in social, political, cultural, and eco-nomic contexts.
Since my primary goal is to help students become conscious of what is happening in a diversity of places and cultures that may differ from theirs, I place a strong emphasis on multiculturalism and issues related to marginalization, such as race relations, class conflicts, gender struggle, ethnic diversity, sexual orientation, and political institutions in both Pan-African communities and other societies. This inclusive methodology allows students to re-alize their capacity to think, write, and speak about the human condition. I strive to help students understand the humanities as a means for analyzing the social, political, and cultural forces that shape their lives and those of other members of a diverse world.
Educational technologies and language motivational instructions
128
My use of the humanities as a means for achieving social and po-litical consciousness comes from my belief that “if the political life is the way out of poverty, the humanities provide entrance to reflection and the political life”. Indeed, giving students the op-portunity to learn productively prepares them for future positions as leaders, critics, and enhancers of human conditions.
Therefore, I have modified my teaching style whenever I discover a strategy that can help me achieve better results with students. Alternatively, I realized that each student is expected to :
• Give a brief and concise summary of the assigned text highlight-ing the important themes and issues that the author discusses.
• Write a few sentences discussing the important questions and arguments that the text succeeded or failed to analyze.
• Say what makes him / her believe that the author did or did not explore such questions and arguments successfully.
• Explain what the author could have done to make the argu-ments and questions in his / her text more persuasive.
This type of exercise is productive in several ways. First, it gives students the opportunity to spend a good amount of their time doing a written assignment that will be graded and counted to-ward their final score. Second, the writing exercise allows me to know whether each student has been able to understand the as-signed film or documentary and is therefore ready to participate in class discussions. Third, as I correct each production, I can give each student feedback on the themes, diction, style, and level of analysis on which they should improve. Fourth, these types of ex-ercise, writing assignments, help me develop a closer relation with the students as I find out about their individual needs, ambitions, and goals. Finally, writing exercises help students give free range to their ideas at their discretion as they develop their sense of in-dividuality and independence in both thinking and writing.
Salima MAOUCHE-KETFI
129
C- Procedure
Setting film documentary Assigned activities
Media Room : the students have been shared into two sub-groups :15/SG
“SABA” a film displayed on “TV 5 Monde. A love story depicting the whole social, cultural, and economic as-pects in Niger.
“The mission-aries in Black Africa”, on “Fit toute l’histoire” channel
A documentary on The Black African beliefs, witchcraft, superstition, Christianity,…
• Summa-rizing
• Discussing
• Complet-ing informa-tion
• Writing final draft
D- Results : through the observational and note taking strategies, we all have been able to achieve the aim of using these revolution-ary and pedagogical instruments to give the credit a more tasteful sense of understanding and production. Therefore, the following production is a demonstrative proof to what we have actually been defending right now.
African Literature Issues through African Novels : A Mirror Re-flecting the Continental Unity.
Abstract : There will be a rehearsed question each time a point is covered : -
Now, isthere any difference ?
This paper aims to shed light on some aspects which are depicted in most African novels and which, thanks to the power given to the selected words, imageries, and the styles that constitute the African writers” identity, have enabled us to connect different Af-
Educational technologies and language motivational instructions
130
rican societies. Whether we are actually speaking about Nigeria, Kenya, Sudan, South Africa, or Algeria, we are convinced by the resemblance that characterizes the Continental Unity.
Aim of the article
This is a pure pedagogical aim. Most of our students do not give this literature its due care. It has not been met with the enthusi-asm it should be met with, a tasteful attention ; students are sim-ply scared, confused, and most importantly do not know how to deal with. This is why, in developing this article, we first of all meant to enable our students regain confidence, reinstate a kind of deep and joyful sense of analysis, and discover for the first time maybe the sweet and magic sides of this literature and all the busi-ness it is about.
Presentation
Our work is based on presenting this literature through its differ-ent angles :
1. African novels are history books through which students man-age to know about the different periods this old continent went through, highlighting the African societies during the pre-colonial (Amos Tutuola), the colonial period (Achebe, N‘gugi, …), and the post colonial period (Ezekiel M‘Phahlele, Peter Abraham, …) ;
2. African Novels are books on political and social organization : political because when reading and appreciating any African lit-erary work, the reader understands how tribes for instance are organized into a well-structured hierarchy : Elders, chiefs, subor-dinates, and so on. Social : only speaking about polygamy, lands, crops, cattle ; a man is well-ranked if he possesses these (children especially boys, palm trees, wives, yams,) ;
3. African novels are books about culture including art as music (drums, flutes,), folktales (the tortoise, the birds feast in the sky,),
Salima MAOUCHE-KETFI
131
superstition (-it is an abomination for a man to die during the Week of Peace ‖ : p : 24), celebrations : (the Week of Peace, season harvest,…), proverbs. All these aspects can be depicted through the many illustrations the African writers use in their literary works.As a general overview, we are able to notice that within the Algerian society, every bit of information given above is found. For instance, the Kabyle villages have always been organized the way the -Black African Tribes‖ have : -Amghar
N‘thadarth‖ (the oldest man of the village) standing for the main chief, the wise men, and so on. As far as the other aspects are concerned, olive trees, lands, cattle, wives and children, especially boys, have been given a great importance in these -Berber‖ vil-lages in order to give a certain social position for its member and community. According to culture, we have not only witnessed that -Berber Youngsters‖ are known for the musical genre, instru-ment -Guitar‖ used to sing their joy, sorrow, and celebrate local occasions, but if focusing on another image, shepherds do play on their flutes to feel that the days pass in a through harmony with nature, and to provide the cattle with a certain kind of presence. About history, we can not but say as the Black African novels and writers, the Algerian ones are known for being nationalists, revo-lutionary, fighting for the national identity and the national val-ues too.
Now, is there a difference ? Through this very short introduction, we want to reinforce that Achebe was right when he underlined in his novel entitled -Morning yet on Creation Day‖ (London : Heinemann, 1975 :56) :
Those who, in talking about African literature want to exclude North Africa because it belongs to a different tradition surely do not suggest that Black Africa is anything but homogeneous.Therefore, as Achebe -Things Fall Apart, A Man of the People‖, Camara Laye -l‘enfant noir‖, N‘gugi -A Grain of Wheat‖, Ah-
Educational technologies and language motivational instructions
132
madou Kourouma -Allah N‘est pas Obligé‖, Sheikh Hamidou Kane -L‘aventure Ambigue‖, Ezekiel M‘Phahlele
-Down Second Avenue‖, Alan Paton‖ Debbie Go Home‖, Wole Soyinka -The
Lion and the Jewel‖, and on, there are also Algerian writers who fought for the same reasons and objectives, using the same ardor, braving dangers and most of the time death.For instance ;
Jean El Mouhouv Amrouche Cendres (Mirages, Tunis, 1934 - L‘Harmattan, 1983) : poèmes (1928-1934) RomanÉtoile secrète (Cahiers de barbarie, Tunis, 1937 - L‘Harmattan, 1983) Roman-Chants berbères de Kabylie (Monomotapa, Tunis, 1939 - Édmond Charlot, 1947 - L‘Harmattan, 1986 - 1989) Roman Albert Camus -Misère de Kabylie‖ Mouloud Feraoun
Hachemi Chérif -Algérie : Modernité, Enjeux en jeu » Amar Ourdane « La Question Berbère », Azzedine Taguemount « Arezki Oulbachir ou l‘itinéraire d‘un juste », Kateb Yacine : « Les Sanda-les de Caoutchou »
Now, is there a difference ?
There is however, one characteristic that really attracted our at-tention : Proverbs. The presence of this special language feature is found in different novels mainly those of Achebe. This rhetorical register is shared by all the African societies.
As a matter of fact, the proverb is -the horse of words. If the word is lost, we use proverbs to search for it‖, it is simply wisdom. Here are some proverb features : Proverbs bear the sanctions of age showing that the expression has passed the test of time ;
Using proverbs in speech is to quote the linguistic community itself as they are performed in linguistic and cultural memory ; a proverb user validates his / her own observation with a received knowledge shared in advance by both the speaker and the audi-
Salima MAOUCHE-KETFI
133
ence ; Proverbs direct, urge, dictate actions. They proffer not to dispute but to command, not to persuade but to compel, they con-duct men immediately to the approbation and practice of integ-rity and virtue.
Now, is there a difference ?
As a result we conclude that the density of speaking refers to the quality of texture of a text. This density varies from one level of simplicity to the extreme level of complexity.
Aussi loin que l’on peut remonter dans le temps, le phénomène proverbial apparaît toujours comme une partie intégrante du lan-gage de la plupart des peuples connus.
L’Homme a su depuis très longtemps figer ses connaissances et ses expériences dans des formules combinant le choix des mots et la force des images, des formules simples, brèves et facilement mé-morisables. Relevant de la littérature orale, constituant une sorte de mémoire populaire et de « grammaire des valeurs », les prover-bes nous permettent d’appréhender la conscience collective d’un peuple. Si, par ailleurs, le conte, autre manifestation de la culture orale, est une « invitation au voyage » comme on l’a souvent dit, le proverbe, lui, est une « invitation à la sagesse » si ce n’est au voyage aussi.
Now, is there a difference ?
Some proverbs in French (taken from Kabyle contexts), and Eng-lish (taken from
Nigerian Igbo society contexts) :
-Blessed is he who forsakes his father and his mother for my sake‖ (Igbo) ;
-He who brings Kola brings Life‖ (Igbo) ;
Berber Proverbs :
Educational technologies and language motivational instructions
134
• -La langue n‘a pas d‘os »
• « Il ne connaît pas la marche de la poule et veut imiter celle de la perdrix »
• « Si dieu ne pardonnait pas, le ciel serait vide »
• « Pour les bons, un bienfait est un prêt, pour les méchants, c‘est une charité »
• « Celui qui t‘enseigne vaut mieux que celui qui te donne »
Now, is there really a difference ?
Conclusion
We used to hear Shakespeare‘s great quotation « To Be or Not to Be, », now we have to be used to hearing :
-To Do or Not to Do‖ (taken from Mabel Osakwe p : 90) ; a kind of advice embedded in a very attractive poetry molded as a prov-erb for each one :
Death is what you cannot undo,
Tears do not water lands, and
Fear builds a place of ruin.
In a nutshell, with that goal firmly in mind, we strive to provide a quality teaching related to African literature in order to motivate and challenge each student as we have committed ourselves to providing our students with a nurturing environment where they can not only learn but excel as well.
5- Recommendations
Having demonstrated the issue as to whether films and documen-taries can or cannot help in teaching real language skills from a communicative point of view, perhaps we should now put the
Salima MAOUCHE-KETFI
135
multimedia programs in their real perspective and recommend their implementation as part of the teaching / learning process aids because we truly believe that one of the most important per-ception of the growth of these technological tools is that software vendors (and language teachers) no longer feel bound to grammar practice as the main goal of computer use in the language class-room. More sophisticated error-checking can provide students real help in the feedback they receive, directing them to further practice or moving them to the next stage. Those who need extra help with those aspects of language that improve with practice can use small, focused programs to give them additional time and assistance outside the regular class time. There are many limita-tions of equipment and facilities, and many teachers may not be able to do with large, if not, overcrowded classes. Furthermore, no matter how simple these tools are, students need to learn a great deal to use them. Some students can never really adjust to getting familiarized with. They are never comfortable with them so these students often remain on their initial positions : either reading books and hand outs or simply ignoring the topic. One of the most important phenomenon teachers have to really con-sider is that incorporating films and documentaries in teaching and learning the aforementioned subject normally means that the learners work in isolation. This obviously does not help in devel-oping normal communication between the learners ; at least for one hour time which is a crucial aim in any language lesson. This situation obviously requires competence in the target subject area, pedagogical skills and multimedia experience.
6. CONCLUSION
Although the range of media education approachesisas’ diver-seasthe people teaching’ thereisa growing interestin news and ad-vertising because these help promo tecritical thinking, understand
Educational technologies and language motivational instructions
136
the different conveyed messages through teaching and learning a given subject. There is also a little evidence however, that teach-ing using multimedia tools as films and documentaries is basic as these materials have been considered for a very long time as real sources of visual aids in pedagogy.
REFERENCESBoswood, T. (1999). New ways of using computers in language teaching. Alexandria,
VA : TESOL Quarterly.Brown, D. H. (2001). Teaching by principles : an interactive approach to language
pedagogy. 2nd ed. London : Longman.Elbow, P.(1992).“Peer sharing and peer response”. In : The writer’s craft (teacher’s
edition). Evanston, IL : Mc Dougal, Little & CompanyFerris, D. (2002).“Teaching students to self-edit”. In : Methodology in language
teaching : an anthology of current practice. J. C. Richards & W. A. Renandya (eds).Cambridge : CUP.
Hansen-Smith, E. (2001). “Computer-assisted language learning”. In The Cambridge guide to teaching English to speakers of other languages. R. Carter and D. Nunan (eds). Cambridge : CUP.
Hardisty, D. and Windeatt, S. (1989). CALL : computer assisted language learning.Oxford : OUP.
Harmer, J. (2001). The practice of English language teaching. London : Longman.Holmes, M. and Kidd, K. (1982). Computers in use : using computers in language
classroom. Oxford : OUP.Jones, C. and Fortescan, J. (1987). Language, learners, and computers. TESOL
Quarterly, 24 (2), pp. 307-9.Kenning, T. (1990). Languages and machines. New York : Addison Westey pub.Leech, G. and Candlin, C. N. (1986). Computers in English language teaching and
research. Harlow : Longman.Papert, S. (1993). The children’s machine : rethinking school in the age of the computer.
New York : Basic Books.Reinders, H. (2007). Big brother is helping you : supporting self-access language
learning with a student monitoring system. System,35(1), pp. 93-111.Rivers, W. (1968). Teaching foreign language skills. 2nd ed. Chicago : University of
Chicago press.Sudkamp, A. T. (1988). Languages and machines. New York : Addison Wesley
publishing company.
Salima MAOUCHE-KETFI
137
Turkle, D. A. (1984). An example of the use of micro-computers in foreign language learning and teaching from high school for the academically talented. TESOL Quarterly, 22 (1), pp. 69-90.
Warschauer M. (1996). « Computer Assisted Language Learning : an Introduction ».In Photos S. (ed.) Multimedia language teaching, Tokyo : Logos International : pp. 3-20.
Andersen, N., Duncan, B. & Pungente, J. (n.d). Media Education in Canada-The Second
Spring. Retrieved November 13, 2012, fromhttp ://interact.uoregon.edu/MediaLit/JCP/articles/mediaedcanada.pdfAnderson, Neil. Duncan, Barry, & Pungente, John. The Canadian Experience :
LeadingThe Way. Retrieved November 13, 2012 from http ://www.media-awareness.caBuckingham, D. (2003). Media Education : Literacy, Learning and Contemporary
Culture. Cambridge : Polity Press.Duncan, B, Pungente, J, Shepherd, R. (2000). Media Education in Canada In T.
Goldstein & D. Shelby (Eds). Weaving Connections : Educating for Peace, Social and Environmental Justice. (pp. 323-341). Toronto : Sumach.
Hobbs, Renee (1997). Literacy for the information age. In James Flood, Shirley BriceHeath and Diane Lapp (Eds.) Handbook of research on teaching literacy throughThe communicative and visual arts. New York : International Reading Association
and Macmillan Library Reference.Masterman, L. (1985). Teaching the Media, London : Comedia.Jenkins, H. (2004). Media Literacy Goes to School, Technology Review, JanuaryKline, S., Stewart, K. & Murphy, D. (2006). Media Literacy in the Risk Society :AnEvaluation of a Risk Reduction Strategy. Canadian Journal of Education, 29(1), 131-153.Kline, S. & Stewart, K(2003). Media Saturated World : Helping Kids Reduce the Risk.http ://www.sfu.ca/media-lab/risk/



















































































































































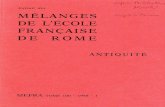



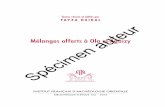


![Vbi ecclesia? Basiliques chrétiennes et violence religieuse dans l'Afrique romaine tardive (In: FREU, C.; JANIARD, S. [éds.], Libera Curiositas. Mélanges en l'honneur de Jean-Michel](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63178df62b00f6ff4406a021/vbi-ecclesia-basiliques-chretiennes-et-violence-religieuse-dans-lafrique-romaine.jpg)