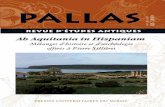Plan de Communication « Lutter contre les mariages précoces ...
« Rhétorique ou philosophie ? La structure du Contre les Sophistes et la polémique d'Isocrate...
-
Upload
paris-sorbonne -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of « Rhétorique ou philosophie ? La structure du Contre les Sophistes et la polémique d'Isocrate...
TEXTES ET TRADITIONS
C,'l I ct r ion d i ri gëe par
Marie-Odile GOULET-CAZÉ RichardcoulET Philippe HOFFMANN
RHETORICA PHILOSOPHANS
MÉLANGES OFFERTS À MICHBL PATILLON
Éditésp*
Luc BRISSON etPierre CHIRON
Ouvrage publié avec le concoursde I'Institut de Recherche et d'Histoire desTextes (C.N.R.S.)
et de l'Institut Universitaire de France
PARISLIBRAIRIE PHILOSOPHIQUE J. VRIN
6, Place de la Sorbonne, Ve
2010
=s-
MARIE-PIERRE NOEL
RHÉTORIQUE OU PHILOSOPHIE ?
LA STRUCTURE DU CONTRE LES SOPHISTESET
LA POLÉMIQUE D'ISOCRATE CONTRE GORGIAS
En général considéré comme un manifeste rédigé lors de l'ouverture de l'écoled'Isocrate (vers 390), soit peu de temps avant celle de I'Académie platonicienne
' 387) et la rédaction du Gorgias (385 ?), le discours Contre les sophistes constitue
probablement le plus ancien témoignage sur la polémique entre philosophie et
rhétorique qui se développera au cours du ry" siècle, puisque les textes du v" sièclejonnus sous le nom de technai logôn ne nous sont pas parvenus. Même si les
échos entre cette æuvre etle Gorgias suggèrent que la première serait I'une des
.-ibles du second, Platon visant alors derrière Gorgias son élève le plus célèbrel, et
si l'on ne peut exclure qu'elle porte la marque d'une rivalité plus ancienne entre
ies deux auteurs2, sa structure et ses enjeux demeurent sur bien des plans énigma-
riques.
Isocrate n'y mentionne en effet jamais ses adversaires. Contrairement à ce que
suggère le titre - si du moins ce titre est bien d'Isocrate3 -, il ne s'agit pas d'une
1. Sur les rapports entre les deux ceuvres, voir P. Der!{oNT (2008), << Isocrate et le Gorgias
;e Platon ,,. L'lnTormation Littéraire, N' 2/2008, p. 3-9. Sur les questions de datation dtr Contre
. t ; Sophistes , voir les réserves de Y. L. Too ( 1995), The Rhetoric of ldentity in Isocrates. Text,
Pt"",er. Pedagogy, Cambridge, p.152-156 (et bibliographie ad loc.); plus généralement, sur les
:::térentes interprétations du texte, p. 151-199.
l. \{ême sile Contre les Sophistes est probablement antérieur ar Gorgias,la date de paru-
::n des deux æuvres est trop proche pour que l'on puisse exclure une polémique déjà largement
:'.:-tse dans les années 390-380, et dont nous n'aurions conservé qu'une version écrite et donc
:a:iel1e.L Le titre semble avoir suscité un certain nombre de discussions dans I'Antiquité, dont on
:.:tlr'e des échos dans I'hupothesis qui accompagne le texte dans les manuscrits et chez Nicolas
ie \{1.:ra. Progymn.54,3 sqq. (textes cités par B. G. MaNoTLARAS [2003], edit.,Isocrates, Opera
,'":-:;. I-III. Mùnchen-Leipzig, Teubner, t. III, p.64). La présentation que fait Isocrate de cette
:;r:e Cans te Sur l'Échange,194 ne comporte aucune mention du titre, sauf si I'on considère les
,r:..ànons domées dans les manuscrits avant la citation qu'il propose aux $$ 193-195 comme
50 MARrE_prERRENoËL
polémique contre les <sophistes>, mais plutôt contre tous les maîtres et les pro_grammes éducatifs contemporains. Dès le début sont attaqués ceux qui..r'o""u_pent d'éducation> (g 1: o[ nq.rôeûetv énLxepoûweç). ie terme <sophistes>>,annoncé par le titre, apparaît seulement à partir du g 14, où il est question de ceuxqui n'ont fréquenté auatn sophisfe, c'est-à-dire aucun des maîùes de discourspolitiques attaqués dans ce passage, et qui sont devenus malgré cela d'habilesorateurs. c'est dans ce groupe que semble d'ailleurs se ranger Isocrate, en déplo_rant que de tels maîtres fassent que I'on critique < ceux qui ont la même activité >($ 11: toùç nepi tr)v aûtr)v ôrarpfjùv ôvtac). cette acrivité, il la nomme aux$$ 11 et 21, philosophiaa. ptis au g 19, à <<ceux des sophistes qui viennentd'éclore> (o[ pev oôv &prL rôv oogrotôv dvcrgudpevor;, encore susceptibles dese rallier à la doctrine isocratique, sont opposés ceux de la génération précédente,les auteurs de ce qu'on nomme Arrs (tùç xuÀouçrÉvcrç réXvaç), qui lont l,objetd'une nouvel le attaque.
L'ordre même dans requer ces adversaires sont énumérés et, plus généra-lement, la structure du texte, ne laissent pas d'étonner. Trois catégoriËs différentessont distinguées: les éristiques ($$ 1-g), les maîtres de discours-poritiques (gg 9-13), puis les auteurs d'Arts écrits (g$ 19-20), qui semblent
"onrùtu", une subdi_
vision à l'intérieur de la seconde catégorie et qui font I'objet d'une attaquespécifique, à I'issue de laquelle ils sont présentés comme inférieurs aux maîtresd'éristique mentionnés au début ($ 20). on peut s'interroger sur la fonction decette nouvelle subdivision, qui apparaît comme un ajout et un retour en arrière,puisque Isocrate vient d'exposer longuement sa propre conception de la paideiadans les paragraphes qui précèdent (g$ l4-lg). par ailleuis, I,epilogos, quiintervient tout de suite après cette attaque ($$ 21-22), s'achève de tanière trèsabrupte. La dernière phrase semble en effet annoncer un développement inexistantdans l'état actuel du texte:
....-.lro ôè pi ôoxô-rùç pev.rôv dÀÀov ûnooXéoetç ôroÀûaLv. aùrôç ôè çrei(o Àéyetv rôv
Êvovrov. e{ ôvnep crirôç ôneioO4 oihar roùr' ëxerv. poôi,ç oi1-rar xoi roii dÀLorç govepôvxatcot{oerv. (g 22)5
étant 1e fait d'Isocrate lui-même. Sur le problème difficile des citations d,auteur dans Ie ,Szrt'Échange, voir P. M. PNTO (2003), P)r h storia del testo di Isocrate. ltt testimonianzad' autor e, Bai' (Paradosis, 6).
4' L'usage qu'Isocrate fait de ce terme, dans le Contre les Sophistes comme dans le reste ducorpus' suggère qu'il ne récuse pas pour lui le titre de sophiste,mais qu'il se présente coûrme unsophiste différent des autres, dont 1'activité estla philosophla, c'està-dire lei politikoi logoi. Onreftouvera les mêmes idées dans le Sur l'Échange, où il se défend à plusieurs reprises des accu-sations qui pèsent sur les sophistes, notamment au g 155 l'accusatiàn d,avoir iagné beaucoupd'argent (comme Gorgias) et au g 195 les accusations de bavardage et d'abui;"pour rui, ressophistes modèles sont Solon ou les deux sophistes maîtres de Périclès, à savoir Ànaxagore etDamon.
5' Le texre suivi est celui de l'édition G. MATHTEU & É. BRÉMoND (1g2g),paris, cuF.Sauf précision contraire, les traductions sont de moi.
LA POLÉMIQUE D'ISOCRATE CONTRE GORGIAS 51
Ce que G. Mathieu, dans l'édition qu'il propose du texte dans la Collection des
Lniversités de France, traduit de la manière suivante:
pour empêcher de croire que je détruis les programmes des autres en dépassant moi-même
ie"s limiæs du possible, je feraivoir aux autres, facilement à mon avis, ce qui m'a persuadé qu'il
en est comme je le dis.
Si on le met en parallèle avec d'autres déclarations du même ordre, qui toutes
ou\Tent sur un développement, dans l'Éloge d'Hétène ou le Busiris6, le texte
:emble bien ici incomplet. D'où I'idée émise parfois d'un accident de trans-
mission. qui nous aurait laissé un texte fragmentaireT. On peut y voir aussi,
comme G.Mathieu8, un arrêt volontaire, le texte devant être complété par les
discours qu'Isocrate propose à I'imitation des jeunes gens dans son école. Une des
dernières interprétations en date, celle de Y. L. Too, va dans le même sens: l'as-
pect fragmentaire du texte serait délibéré; présenter un modèle incomplet pelmet-
trait de mahtenir la distance entre l'élève et le maître en évitant de reproduire le
modèle pédagogique figé qu'Isocrate reproche à ses adversairese.
Nous voudrions montrer ici que l'étude de la structure du discours suggère
qu'il est au contraire complet et que la forme choisie par Isocrate permet de mettre
en valeur I'originalité fondamentale de son enseignement et de ce qu'il nomme sa
- philosophie >>, en se démarquant de la définition de la < rhétorique >> proposée par
son maître Gorgias, tout comme Platon dans le Gorgias' mais selon des perspec-
dres différentes. Ainsi compris, le discours pelmet alors de préciser les rapports
entre Gorgias, Platon et Isocrate et I'originalité de ce dernier dans la polémique
sur l'art des discours publics et la définition de la philosophie au tout début du tve
siecle.
I
Dès le prooimion, c'est le thème de I'unité et de la cohérence de la démarche
éducative qui prédomine10. Isocrate définit son enseignement en le démarquant de
celui de tous ses rivaux ($ 1: oi ncrôeÛerv ôntxeLpoÛweç), dont il dénonce les
promesses supérieures aux résultats obtenus ($ 1: pei(ouç noteîoectr ràç ùno-
oyéoerç ôv ëpeÀÀov ônrreÀeiv),la <<vantardise irréfléchie> ($ I : ônepLoxénraç
dÀcr(owÛeo0ar), qui met en péril la philosophie en incitant à lui préférer la
6. Voir ÉIoge d'HéIène, 75 ; Busiris,9.
î. L'idée remonte à A. AUGER (1752),edit., Isocratis Opera Omnia Graece et Latine,voll.
I-Itr. Paris (trI, p. 1-2).
8. Notice, p.l4}-141: <<C'est une introduction au cours de rhétorique d'Isocrate, et laE6hode même de celui-ci lui interdisait d'en faire un exposé purement écrit; seul I'enseigne-
loe.nt viyant et le commentaire oral des ffavaux du maître ou des élèves pouvaient donner les
'turlrârs qu'il se flattait d'obtenir. >
9- Too (1995), p.194-199.
10. Pour les détails du texte, nous renvoyons au plan que nous donnons en annexe.
52 MARIE-PIERRE NOËL
<<paresse>> ($ 1: pcroupeîv). cette <<vantardise>, qui consiste en une contradictionprofonde entre paroles et actesll, caractérise les différentes catégories de maîtresattaquées tour à tour dans le discoursl2.
La première catégorie ($ 1 : npôrov pev) est celle des << maîtres en querelles >>
(les éristiques), qui feignent de rechercher de manière spéculative lavéljrté (g 2: otnpoonoroûvtat pEv d1v ôÀfOercrv (r1reïv), mais dont les propos démentent im-médiatement les programmes. Promettant en effet d'enseigner une science ($ 3:ènror{çr1ç) du comportement (g 3: &, nparcéov ôotdv) qui mène au bonheur(eÛôcripoveç), et prétendant transmettre le sens de la justice (g 5 : dv ôrxcrrooû-v4v), la vertu et la modération (96: tr)v &perilv xcri riv oogpooûv4v), ilss'inquiètent à I'idée de ne pas être payés par des élèves dont ils sont censés avoirfait des hommes parfaitement honnêtes et justes (g 6: xcrÀoi xôycr0oi xcriôixcrLor). Ils agissent donc au rebours de leurs proclamations ($ 5: tô.vavticrnp<itrovreç). une telle attitude correspond bien, on le voit, à I'accusation d'cla-zôneia,de <vantardise> portée par Isocrate contre tous ses adversaires13:
'La même contradiction entre actes et paroles apparaît dans les critiquesformulées contre les maîtres de discours politiques (g 9: roïç roùç noÀttrxoùçÀdyouç ùnroyvoulÉvorç), qui, eux, ne s'intéressent pas à la vérité (fiç pevôÀ4Oeicrç oùôèv gpovri(ouor) mais cherchent simplement à transmettre unetechnè fixe ($ 12: tercl.revrlv rÉxv4v)14. Leur enseignement consiste essentiel-lement à promettre, pour une somme modique, des résultats mirifiques, alorsmême que les discours qu'ils proposent par écrit (S 9: yprigoweç) sont pires queceux des profanes qui improvisent. Incapables de mettre en æuvre leur pro-grafirme, ils se trompent aussi sur la nature de leur activité, qui est une <activité>uéatrice ($ 12: nor4rruôv npdypcr) que I'on ne peut réduire à de simplespréceptes.
11. Voir Aristote, É,thique à Nicomaque,Il 7, 1108 a 2'!. sqq.: <En ce qui regarde le vrai, laposition moyenne peut être appelée véridique, et la médiété véracité, tandis que la feinte parexagération est vantardise (ôÀa(oveia) et celui qui la pratique un vantard (&Àcr(drv), et la feintepar atténuation, réticence, et celui qui la pratique, un réticent (eilpov).
" (trad. Tricot)12. C'est ainsi d'ailleurs que le texte est présenté dans le Sur l'Échange, 194: Àdyov
&éôoxcr yptirl.r<rç, Ëv t! gcvrioogo.r roiç re p.e.((ouç norouptévorç ràç ùno<rxéoeLç ênrrqlôv xairlv êgnutoû yvôpnv ônogorvdpevoç.
13. Il est difficile d'identifier les maîtres visés ici, d'autant que nous avons perdu une grandepartie des textes qui pourraient être incriminés. Il faut probablement inclure dans ce groupe lessocratiques (comme Platon ou Antisthène), dont Isocrate assimile I'usage qu'ils font du dialogueavec une pratique éristique, caractérisée par la dispute et la division.
14. On peut penser que sont ici visés des maîtres comme Alcidamas ou Polycrate, mais làaussi il est difficile de se prononcer. Les termes utilisés pour décrire I'activité de ces maîtres derhétorique sont assez proches de ceux de Socrate dans le Phèdre pow décrire les spécialistes deI'art des discours (n)v rôv À6yov téXvr1v), qui considèrent que la connaissance de la vérité estinutile à leur art (Phèdre,260 d).
L.\ POLÉMIQUE D'ISOCRATE CONTRE GORGIAS 53
i.;: ,;es prosramnes,Isocrate va définir une paideia reposant sur les logol,
:..:,: -:L'- n est ni une simple technè logôn ni une epistèmè, et qui prétend lier
=...r. :r: enseignement des discours (S 11-18)' Pour lui' I'enseignement ne peut
=:,,:-_.":: , la pertection que chez des étudiants déjà naturellement doués ($ 14: toÎc
..,*;"-.t:r.'.,. Car. si <la capacité de faire des discours et d'accomplir tous les autres
:ii;i : 1-l: crl frtu yàp ôuv<iperç xai tôv Àdyr'lv xsi tôv d'ÀÀtov épyov
.l-:r..:r.,.: 'lj Se troUve chez eux et <Chez CeuX qui Se SOnt exerCéS par I'eXpé-
:.::,:: rolç nepi tàç épnerpicrç TeYUFwcT'opevoLç)' c'est seulement dans le
-:.--,:: _ilr'rup€ ($ 15: roùç prèv totoÛtouç) que I'on formera des hommes <plus
,.,_..,...n,,,et <dotés de ressources plus grandes pour la recherche> (texvL-
,._'r.-,.-r-.f zui npàç tô (qteiv eÛnoptotépouç), de <bons jouteurs>> ou des
:::;::-:> de discours> (&ytovtotà.ç [...] ôycr0oÙC ô Àdyc-rv notntdÇ)' L'emploi
::: : ,:ltàratifs montre qu'il s'agit de remplacer progressivement ce qui est de
:::: :e \a tLtchè (oîç ôwuyy<ivouot) par des ressources <plus préparées" (ô(
:r, ---rir'rou. $ 15)16, qui relèvent donc davantage de la technè' et de former des
=:.:. qui associeront parole et action en devenant de bons <lutteurstlT ou de
', :.. ;réareurs de discours>, donc des hommes engagés dans I'action publique'
:.,-. t-t3c-lêû1ent soit par la production de discoursls. Pour la seconde catégorie
:._:,.es. dont la nature est inférieure (xcrtoôeeotépov tiv 9Ûotv ëxovtcrç), ils
-,.-.,in: simplernent prétendre à augmenter sur bien des points leur réflexion
-{-'-'.:*t.lrépt.lç), mais la perfection éthique leur est interdite'
L: maître dispense donc une science limitée ($ 16: êntott'rpLnv), qui est celle
_.. "la,:.r. terme large qui désigne probablement ici les formes générales ou
:.:-i:unes que l'on trouve dans tous les discourslg. I1 faut sans doute inclure dans
-.. ;-.ji.l. qui ,ont distinctes des < espèces de discours " ($ 17 : eiôq t6v À6yorv)20,
.:: :::fërents moyens de preuve (nioterç), comme les indices,les exemples ou les
.::-.rèmes ou les parties des discours, comme le prooimion, le récit, la
.: ,]ln peut comprendre aussi, comme Mathieu, <la faculté de faire des discours et, en
.:r:r:. J æirn.Dans tous les cas, noter la mise en rappofi systématique enffe paroles et actes,
, - =,, ,.. des leitmotive du discours. Sur cette question, voir aussi lnlc'.: .1: comprends ainsi le comparatif, dont Mathieu ne rend pas compte dans sa traduction'
'. : .,ssi D. Mnualy & Y.L. TOO (2000), edit., Isocrates I, Austin, university of Texas
:.:... , ft teaches those who now hit upon things by chance to achieve them from a readier
.- -:::. " rP.64)- Tel est le sens du terme ôyovLott'1ç, qui désigne aussi bien les joutes verbales que toutes
.:. :--::res de compétition.
-:. Comme chez Platon, le terme désigne à la fois la création en général et la poésie en
: ::::;ulier..Ç. pour ces ideai,voir aussi Busiris,33, ÉIoge d'Hétène,11 et 15. Dansl'Eloge d'Hélène'
:-:. :: 58. 1a beauté est présentée comme une idea, c'esT-à-dire 1à aussi comme une forme
:,:r:rune. Sur le sens du terme et sa fonction, voir aussi R. GAINES (1990), < Isocrates, Ep. 6.8 >,
;i';?':dj. 118, p. 165-170.
l,_,. surles<espècesdediscours>,voirRhétoriqueàAlexandre,ll,l42lb7-12.
54 MARIE-PIERRE NOËL
confirmation et I'epilogos2l. Mais, si les ideai s'apprennent, les choisir, lesmélanger, les disposer ($ 16), ne pas se tromper sur le moment opportun de leuremploi (rôv xcrrpôv), savoir orner le discours par les enthymèmes en respectantla convenance (npendvtclç) et s'exprimer avec des mots de façon rythmée etmusicale (eûpû0proç xai pouorxôç2z) demande beaucoup de soins (g 17: noÀÀfrçôn4:eÀeicrç ôeîo0aL) et un esprit viril et capable de conjecturer (xai Quxicôvôpuflç xai ôo{crotrxflç ëpyov23), c'est-à-dire de produire des opinions danslesquelles peut se reconnaître la communauté. Il ne s'agit plus ici d'une simpletransmission de données intangibles, mais d'une formation intellectuelle et moraleexigeante, au terme de laquelle émergeront de véritables hommes politiques.
Pour ce faire, il faut donc développer les dispositions naturelles des élèves (ou,à défaut, pallier en partie leur absence) par les logoi, ar moyen de connaissancestechniques, d'exercice et d'imitation du maître pour transformer cette phusis enethos, ce dernier garantissant alors la perfection des logoi et de I'action politiquedu disciple accompli. L'élève se doit ainsi d'apprendre les espèces de discours($ 17: tù. pev eiôrl rù. tôv Àdyalv çra0eîv), de s'entraîner à en faire usage (neplôè tàc xpfoerç crûrôv yu1-wco0flvar); le maître doit transmettre toutes ces con-naissances avec précision et pour le reste s'offrir coûrme exemple à l,imitation(roroûrov aùrôv noptiôetypc ncrpcroXeiv).
L'enseignement d'Isocrate repose en effet sur la figure du maître2a, qui incarnele ncrpdôerypra,, le modèle (g 17) que ses disciples vont s'efforcer d'imiter (g 1g:prpioao0ar). si I'on se souvient que le reproche principal fait par Isocrate à sesadversaires était I'incapacité de mettre en accord prograrnme et actes et donc des'offrir comme modèle à leurs élèves, on voit ici la parfaite cohérence du système
2 1. Sur tous ces termes, voir Sz r t' Échange, 280.22. Yoir Sur l'Échange,46-47.23. Yoir Éloge d'Hélène,5 et sur l'Échange, l83-184: <ceux qui s'occupent de philosophie
exposent à leurs disciples toutes les formes (iôécrr) qu'utilise le discours. Quand ils leur ontdonné une expérience précise de ces formes, ils les entraînent (ndÀrv yupvd(ouotv crûroirç) ànouveau, Ies habituent au travail et les obligent à relier chacun des éléments qu'ils ont appris,afin qu'ils 1es possèdent de façon plus sûre et que par leurs opinions ils soient au plus près de cequi constitue le moment oppoffun (rôv xcrLpôv). En effet, embrasser celui-ci par une connais-sance véritable est impossible, car, pour tous les événements la science nous échappe, tandis queceux qui sont les plus attentifs et qui sont capables d'examiner ce qui se produit la plupart dutemps le saisissent dans la plupart des cas.> La thèse développée par Socrate devant Polos dansle Gorgias 463 a, selon laquelle la rhétorique est <<une occupation qui ne repose pas slr unetechnè, mais qui est le fait d'une âme apte à conjecturer, courageuse et habile par nature às'entretenir avec les hommes>> (ônrt{ôeu1.rn relvrxôv prv oû, rluxflç ôè oroxcrorrxflç xaïôvôpeicrç xcri gûoer ôetvfrç npoooçuÀeîv roÏç ôv0pdrnoLç), est souvent considéràè comme uneparodie possible de ce passage (voir P. DEMONT [2008/2], <<Isocrate etle Gorgias de platon>,L' Information Littéraire, p. 5-6).
24. contrairement au socrate de Platon, qui refuse systématiquement ce terme, l'idéal duphilosophe platonicien étant non pas I'imitation d'un maître mais I'assimilation au dieu(ôpolooLç 0eÇ) par le mouvement dialectique vers les idées.
LA POLÉMIQUE D'ISOCRATE CONTRE GORGIAS 55
cxpo6é: c'est parce qu'Isocrate incarne I'idéal qu'il propose qu'il est fondé à
l-enseigaer.
Cette activité est définie comme un poiètikon pragma, une < activité >> créatricerpraique)- qui rivalise avec la création poétique. Il s'agit chaque fois, de produireum discours dont la beauté ($ 13: xaÀôç ëXeLv), contrairement à la fixité des
icf,res de l'alphabet, provient de I'adaptation aux circonstances (tôv xapôv), du
rs$Fect de la convenance et de la nouveauté (toÛ npendvtr,rç xcri toÛ xcrtvôçFprvr" L'imitation du maître et de ses discours n'a pas pour fin une reproductionrcrrrlle- mais la formation d'élèves doués à cette activité <<créaffice> qu'est lediisccnn. Fn devenant de <bons lutteurs>> ou des <créateurs de discours>>, ils
fwr(rut à leur tour se présenter comme des modèles à imiter. Il ne s'agit donc pas
Se trmsnettre des recettes pour fabriquer des discours, ni d'enseigner la vérité sur
æ S est. mais de former des élèves dontl'ethos est conforme au logos et qui, par
iær irylication dans la vie publique - qu'il s'agisse des joutes à l'assemblée ou
$e la production de discours ($ 15: ôy<,rvtoràc [...] ô.ycrOoùç fl Àdyr,rvuoo:Tdc) - seront capables d'être des modèles politiques dans lesquels se recon-
md la cité. Contrairement àl'alazôneia, qu'i caractérise ses adversaires et affecte
lews disciples, Isocrate propose donc un programme où I'unité entre les discours
û las artes du maître permet l'unité entre les discours et les actes des élèves.
il
[,e refus de la technè proposée par les maîtres de discours politique et I'affir-wflûm de la dimension éthique de la paideia isocratique peuvent se comprendre
ffrrrmË une démarcation par rapport à la définition gorgianique de la rhétoriqueelle qu'elle apparaît dans le Gorgias.
Si l'on n'a pas conservé les textes originaux de Gorgias, la présentation qui en
cfi feite dans le dialogue platonicien ne laisse aucun doute sur le sens qu'ilscturie'nt de donner au terme <rhétorique> et sur la relative nouveauté, sinon dusc" du moins de la définition qui en est proposée par le sophiste2s. On sait en
ctrer qr:e. dans le Gorgias , Gorgias présente son art comme celui du prittop - titre
5, Sur cette question, voir NoË,r (2006), <Édiu Gorgias aujourd'hui>, dans L. Calbolilrfi tusco, edit., Papers on Rhetoric, T, Roma, p. 165-180, dont nous reprenons une partie des
smhrsions. L'importance du terme prltoptxri dans le dialogue et la cohérence de la définition,.tr'en propose Gorgias nous paraît suggérer qu'il s'agit bien là d'une invention de Gorgias lui-mÈm et non, cofirme le pense E. ScHIAPPA (1990), <Did Plato coin Rhetorike?>>, AJPî 1ll,: .t5-{70. d'une invention de Platon. Voir aussi TH. CoLE (1991a), The Origins of Rhetoric in-{,lrcirnt Greece, Baltimore & London. Le fait que nous ayons dans le Gorgias la première
^wtion conservée du terme suggère seulement qu'il s'agit d'une innovation récente, ce quixriÊBride parfaitement avec l'activité de Gorgias, qui semble bien avoir vécu au moins jusqu'aui*r ù nÆ siecle.
56 MARIE-PIERRE NOËL
qu'il revendique d'emblée pour lui-même26 -, qui recourt essentiellement au
discours2T et qui a pour fin la persuasion, définie comme le <pouvoir de
persuader, par les discours, les juges au Tribunal, les membres du Conseil au
Conseil, et I'ensemble des citoyens à l'Assemblée, bref, (...) dans n'importequelle réunion publique (noÀrnxbç (ÛÀÀoyoç) >28, et qui < porte sur les questions
touchant au juste et à I'injuste (xai nepi toÛtov & ôott ôixcrLd te xcri &,ôLxcr) >>2e.
La téXvrl pntoptxll définie par Gorgias n'a donc pas pour objet la formationmorale de I'individu. Elle s'adresse à tout citoyen susceptible de payer et se
présente comme une forme de combat (456 c: dytov[a) auquel on s'entraîne, sans
que le maître soit responsable du mauvais usage que ferait l'élève de la technique
ainsi maîtrisée. Mais elle permet I'acquisition d'une ôÛvq.uç, d'une <capacité>
oratoire, susceptible de conférer une dunamis (ôÛvc4.uç), un pouvoir politique<< cause de liberté pour les hommes qui la possèdent et principe du commandement(&pXeLv) que chaque individu, dans sa propre cité, exerce sur autrui>>30. Dans une
cité démocratique comme Athènes, où I'essentiel de I'activité politique passe par
la parole, un tel art du discours public peut sans nul doute prétendre au rang d'artpolitique véritable (réXvn noÀrtrxll). Telle est d'ailleurs la position soutenue par
Calliclès - citoyen athénien, grand admirateur de Périclès et disciple de Gorgias -dans le dialogue de Platon: la rhétorique est I'art qui convient aux citoyens, laphilosophie n'étant qu'une propédeutique, réservée aux enfants.
Or, comme on I'a vu, même s'il se présente comme un maître de discours
politiques, Isocrate refuse de considérer son enseignement comme vne technè,wsavoir-faire transmis à n'importe quel candidat. La formation qu'il propose se doitde développer par les discours les potentialités existant dans la nature de l'élève.Elle est une formation de I'homme tout entier, une paideia logôn - selonI'expression que I'on trouve dans le Sur t'Échange,I80 - et non vne technè logôn.
Cette idée, qui constitue l'élément essentiel du programme isocratique et son
originalité majeure face à Gorgias, va se trouver exposée avec force à la fin du
discours. Elle explique I'attaque nouvelle contre les auteurs de technai,par rapport
auxquels Isocrate va préciser sa position en récapitulant les enjeux de la formationqu'il propose, attaque qui semble 1à aussi viser en priorité Gorgias.
Dans un second temps, en effet, la catégorie des <maîtres de discours
politiques> se trouve subdivisée, Isocrate distinguant d'une part les ..sophistes
récents, qui viennent d'éclore> ($ 19: oi gev o$v ôprt tôv oogtotôv &vagu-6pevot), dont il peut espérer encore le ralliement, et ceux de I'ancienne génération
(Àornoi ô' ripïv eioiv o[ npô ripôv yevdpevot). Là non plus, aucun nom n'est
26. Gorgias,449 a.
27. Gorgias,450b.28. Gorgias,452e.29. Gorgias,454b.30. Gorgias,452d.
LA POLÉMIQUE D'ISOCRATE CONTRE GORGIAS 57
,fué- \[ais cette troisième attaque vise; dans des termes assez proches de ceux
ryc l'on retrouvera dans le Phèdre3r quelques années plus tard, les auteurs de
Teûilrari de la génération précédente, qui ont concentré leur enseignement sur le
tr d'aprendre à plaider et sur les discours judiciaires ($ 19: ôrxd(eoecrt, etg S: roir ôua.vrxor)ç À6youç), sans tenir compte du fait qu'il y a là une activité.tut npxiypsroç) dont I'utilité ne se réduit pas à ce champ3z. Ces troisièmes
rdr,ersaircs sont donc des maîtres inférieurs encore aux premiers, à savoir les
æsnqm. qui ont promis du moins la vertu et la modération ($ 20: &,petfiv xcri
orrgpffiirunv), tandis que les auteurs de Technai, eux, ont négligé les autres biens
rffierem aux discours (tôv &'ÀÀov tôv npoodvtc,lv crùroîç ôycrOôv) pour n'être.pe ,ùci maîtres en intrigues et en cupidité.
LÀ aussi. les rapprochements avec l'art de Gorgias sont tentants33: dans le. c" c'est à ce dernier que semble remonter le plus ancien Art des discours{Trt\rt!ç--. À61ov), qui concerne essentiellement, selon Phèdre, les discourspduieircÀ et, de façon moindre, les démégories3a. L'idée que les premières
ûdnition donnée par Gorgias de la rhétorique dans le Gorgias.Il s'agit en effet,t*m mt qui rend apte à la détermination du juste et de I'injuste devant les assem-
[tùÉÊs-"s. de sorte qu'il ne constitue pas une formation à la justice au sens absolu dusæ- mais porte sur les questions de justice qui font I'objet de délibérations dans
lcr assemblées du peuple et se trouvent déterminées par le consensus du plus
crml nombre. Dans tous les cas, on formera donc non pas un orateur juste mais
rmtrement un orateur <habile à parlerrr36. Si I'on conçoit ainsi la justice, il est
l:, 5.rr la description de ces technai,vot Phèdre,26l a-c et266 d-267 d (et ci-dessus, p. 35*f[ . On piace en général la date de composition du Phèdre un peu avant ou un peu après lerùrm+tm rovage de Platon en Sicile, vers 370.
-î:' Dans la mesure où cette activité peut faire l'objet d'un enseignement ($ 20: xcrO'6oovùmr &dærr<iv), ce qu'Isocrate vient de nuancer en partie dans le passage qui précède.
ii. C'esc aussi l'idée du scholiaste, qui commente I'attâque contre les maîtres de I'ancienne
r ffilom de la manière suivante (MANDILARAS [2003], I, p.246): TLoicrv xai Kdpuxo Àéyer
rmrq f,up,cpcorrciouç, zai fopyfav xai opaoûpaxov, oi npôtoL pqtoptxàç ré1vaç ë1patl.rrv.
\t Phàdre,261 b'-c PnÈonr- (...) C'est plutôt en ce qui concerne les procès (nepi. tùçfi:mç qræ l'on parle et que I'on écrit avec art. Et I'on parle aussi avec art en ce qui concerne les
dfficmn publics (nepi ôapayopiaç). Mais je n'ai rien entendu dire de plus. SocRATE - Alors,r-.sr \pÈ ur n'as entendu parler que des Arts des discours (ré1voE... negi, Àôyov) de Nestor et
dAbsse. qu'ils ont composés pendant leurs moments de loisir à Troie, mais pas de ceux de
hùrmàde .) PnÈpna - Par Zeus, je ne connais même pas ceux de Nestor, à moins que ce ne soitGr1erô que tu imagines comme une sorte de Nestor ou Thrasymaque et Théodore comme une
icrre ,J'L11'sse.
i-" Gorgias,460 c. C'est pourquoi le Gorgias du dialogue admet sans difficulté qu'il:m*ergne a"ssi à ses disciples ces matières (460 a: taûta), à savoir lejuste (et I'injuste). Il n'est
aa* qmtion ici de < justice > au sens absolu (ôrxcrLooirvrl).
-16- \'oir Mérutn,95 c: < Ce que j'apprécie particulièrement chez Gorgias, Socrate, c'est que
umlrr;i on ne l'entendrait faire ce genre de promesse [être maître de vertu]. Au contraire, il se
58 MARIE-PIERRE NoEL
clair que les discours judiciaires, qui, plus que d'autres, posent la question du juste
et de l,injuste et demandent une compétence technique et une précision
supérieures à celles qu'exigent les démégories, constituent la meilleure formation
à la rhétorique. C'est pourquoi sans doute, de toutes les assemblées politiques, ce
sont les tribunaux que Gorgias mentionne en premier dans la définition de son art
dans le Gorgias et pourquoi aussi dans le Phèdre les premières technai logôn
s' inspirent essentiellement de l'éloquence judiciaire3T'
Gorgias semble donc bien constituer une des cibles principales du Contre les
Sophistis,ce qui concorde d'ailleurs avec les trois mentions explicites qui sont
faites de lui dans le corpus d'Isocrate, qui sont toutes trois négatives38' La vio-
lence de I'attaque - qui peut s'expliquer par le fait que, selon toute vraisemblance,
Gorgias était éncore vivant au moment de 1a rédaction du discours3e - n'est au
demeurant pas en contradiction avec I'existence de liens de maître à élève entre
les deux hommes, liens qui font I'objet d'un quasi-consensus de I'antiquité à nos
jours et dont la soufce la plus ancienne est pour nous Aristoteao. Mais elle oblige à
ielativiser la filiation Gorgias / Isocrate, conçue souvent dans les travaux consa-
crés à la rhétorique antique comme une évidence. Le rappel systématique du lien
entre Gorgias et Isocrate semble avoir constitué en effet un des éléments de la
polémiquJanti-isocratique, un moyen de nier I'originalité de ce derniell. On peut
moque des auffes, lorsqu',il les entend prendre cet engagement. selon lui, il faut seulement rendre
les Àommes habiles à parler (ÀéyeLv.. ' ôewoÛç)' >
37. Voir NOËL (2003b), <La place du judiciaire dans les premières technai logôn>>, dans
M. S. Celentano, edit., ARSITECHNE: iI manuale tecnico nelle civiltà greca e romana,
Alessandria, Ed. dell'Orso (Collana del Dipartimento di Scienze dell'Antichità-Università degli
Studi G. D'Annunzio, Chieti. Sezione filologica 2)'p' l-15'3g. À deux reprises dans l'ÉIoge d'HéIène et dans le Sur l'Échange, les critiques visent le
Traité du Non-êie (Étoge d'Hélène,2-3 et Sur l'Échange,168); dans le Sur I'Echange,155-
158, la carrière de Gorgias et sa fortune ne sont évoquées que pour les distinguer de celles
d,Isocrate. Par ailleurs, dans certains passages où l,on a pu Soupçonner l'influence du même
Gorgias, il semble qu'Isocrate ait 1à aussi iherché à se distinguer de lui. Ainsi, dans I'ÉIoge
d'nZrcne, 14, le prédécesseur anonyme d'Isocrate, qui aurait composé au sujet d'Hélène un
éloge qui serait en fait une défense - probablement Gorgias - est critiqué pour avoir mal écrit'
39.D'aprèsuneanecdoterapportéeparHermippe(apudAthénée'XI505d-e)'ilétaitencorevivant lors àe la composition du Gorgias de Platon, dans les années 390-380'
40. voir Quintilien, Io,Il 1,13'. clarissimus Gorgiae audilorum Isocrotes-(quamquam de
praceptore eius inter auctores non conuenit, nos autem Aristoteli credimus)' on ne peut donc
,uiur" y. L. Too (1995) lorsqu'elle cherche à démontrer (p'235-239) que les rapports enffe
Gorgias et lsocfate sont une rËconstruction tardive. Mais on se gardera de considérer que les
témJignages ântiques sur la question sont exempts de tout arrière-plan polémique.
41. C'est ainsi que I'on peut comprendre pourquoi la source principale sur la question est'
d,après Quintilien, Aristote, et pourquoi aussi la question semble avoir été débattue dans
t,,Lntiquiù. Sur la polémique arisiotélicienne contre Isocrate, voir NoËL (2002), << Aristote et les
.débuts'de la rhéioriquei recherches *tla Sunagôgè technôn et sur sa fonction>' dans L'
Calboli Montefusco, edit., Papers on Rhetoric,4, Roma, p.223-244. Sur la filiation stylistique
LA POLÉMIQUE D'ISOCRATE CONTRE GORGIAS 59
ùrryr€odre aussi les accusations de dikographla, c'est-à-dire d'<<écriture de dis-
"xwrs piiciaires or2. portées contre la paideia d'Isocrate au cours de sa carrière,
ûrûf,[E rm rnoven de confondre ce dernier avec son maître.
E[ tÀisant clairement de la perfection morale la fin de son enseignement -FspËtive qu'il reconnaît partager avec les éristiques ($ 20) -, et en refusant les
frnsipcs sru lesquels se fondent les premières technai,Isocrate s'affirme donc
{rrunË un maîne très différent de Gorgias et annonce les éléments essentiels de sa
ilddouoenta. développes dans les discours suivants. Pour lui, il s'agit de former,fu cfoÈfs gui seront autant de modèles dans lesquels s'incarnent les valeurs de la
,tr@âmé et dans lesquels donc cette dernière peut se reconnaître. Aux orateurs
,ùÊ ]& frû ,fo r' siècle, comme Cléon ou Hyperbolos, dont les querelles divisent la{mÉ" fr sbstitue la figure du conseiller (oÛçrf3ouÀoç), susceptible d'assurer le con-stg'p* ptr une perfection éthique qui fait de lui le paradigme de I'unité qu'ilFdorç". Pour cette activité, qui constitue l'essentiel des discours politiques selon
lmr:ræ. le modèle de discours n'est pas le plaidoyer judiciaire, dans lequel les
{mers s'opposent pour persuader les juges de leur bon droit, mais le discours
trlssembh:e tla démégorie), où I'on traite de I'avenir de la cité et des décisions àp$re-. Cependant, ces démégories ne sont plus de simples discours de
{lrcsostillc€. prononcés sur le moment et qui n'ont de valeur que pour l'occasioncn' ræ de laquelle elles sont composées, mais des discours écrits et destinés à la
ffisi'on- des discours politiques qui affirment et pérennisent les idéaux de lasnÉ'r" On songe ici au Panégyrique, discolurs composé pour une panégyrie
"!ryryque et répondant probablement aux Discours Olympiques de Gorgias et de
ræ iss deu-r hommes, utilisée là aussi dans le cadre des polémiques anti-isocratiques, voirlhtr- 1999r..Gorgiasetl'inventiondesGonctstA.ScHEMATA>>,RDG112,p.193-211.
4: 5w !'Échange,2. ll s'agit probablement d'une variante possible de Àoyolpcrgia, une
ûm æ{&çadon portée contre Isocrate.
4: l-cr \. LnT'IGSToNE (1998), < The Voice of Isocrates and the Dissemination of CulturalFrlrl:r r-.{qns Y. L. Too & N. L., edrt., Pedagogy and Power : Rhetorics of Classical Learning,CdrnigÈ- Cambridge Univ. Press, p.263-281 ; Io. (2007), < Writing Politics : Isocrates' Rhe-
. :r Fhilosophy ", Rhetorica,25,l, p. 15-34. Sur I'originalité de la conception isocratique du{ftffirurr- r'oir aussi R. NICOLAT (2004), Studi su Isocrate. Lo communicazione letteraria nel N-r*: s' C" e i nori geræri di prosa,Roma.
aa. Iso;rate donne ainsi le branle à la condamnation des lechnai logôn et à la minoration de
- :xrymce judrciaire que I'on ftouvera tout au long du siècle chez Platon et chez Aristote. Pourh de:enæs. voir NoËL (2003b).
!-i. Sur ce kaîros nouveau, différent de celui des orateurs, voir M. TvÉoÉ (1992), Kairos.L o-;rc'ps a I'occasion (le mot et la notion d'Homère à la fin du Ne siècle av. J.-C.),Paris,5&ryNare \- : le kairos des orateurs; sur Isocrate: p.260-282, etM.V ALLozzA (1985), < Karpdçæil-m rccria retorica di Alcidamante e di Isocrate, ovvero nell'oratoria orale e scritta >> , QUCC 50,p. : 1+l I. Sur kairos chez Gorgias, M.-P. NoËL (1998), << Kairos sophistique et mises en forme,dur ;oçor cbez Gorgias >>, RPh 72, p . 233-245 .
60 MARIE-PIERRE NOËL
Lysias, mais qui demandera à Isocrate un labeur de dix années et lui servira à
affirmer le rôle d'Athènes dans le monde grec et sa prétention à I'hégémoniea6.
Nous sommes loin désormais de I'exercice démocratique de la parole tel que
I'a connu Athènes au f siècle, dans lequel n'importe quel citoyen peut monter à
la tribune et devenir orateur, parce qu'il est à lui seul le représentant du démos tout
entier et qu'il n'y a donc pas de différence fondamentale entre un Périclès et leplus humble de ses concitoyens. Chez Isocrate, comme chez Platon, I'hommepolitique véritable n'est plus le rhètôr, mais le philosophe et il doit être recruté en
fonction de ses aptitudes et formé de façon spécifique par une paideia exrgeanteaT .
IU
L'epilogos du Contre les Sophistes, qui récapitule les points principaux du
programme isocratique et dans lequel I'originalité d'Isocrate se trouve clairement
définie, permet de conforter I'hypothèse d'une polémique anti-gorgianique.
L'attaque contre les auteurs deTechnai et I'opposition entre ces auteurs et les
éristiques, prépare en effet I'ajout d'une précision importante, qui distingueradicalement 1'enseignement d'Isocrate de celui de tous les maîtres qu'il a jusque-
là mentionnés : l'enseignement d'Isocrate est une philosophia (9 2I: tflç <prÀooo-
<p(crç taÛqç), qui est plus rapidement utile pour former à l'<honnêteté>> qu'àl'<éloquence> (noÀù ô.v 0dttov npôç ônteixetov fl npôç pqropeicrv... ôge-Àfoerev).
Là aussi I'utilisation du terme rhètoreia et non rhètorikè peut être comprise
comme une volonté affirmée de se démarquer de Gorgias: il n'existe pas d'art de
la parole publique (rhètorikè technè), mais une pratique liée à cette dernière
(rhètoreia); et cette pratique n'est pas la fin ultime d'un enseignement quipropose une compétence technique concernant les discours, mais une formation
éthique qui se fait par les discours et qui met en accord I'homme et ses proposa8.
46. Sur les rapports entre ces différents discours, voir M. A. FLowER (2000), <From
Simonides to Isocrates: the Fifth-Century Origins of Fourth-Century Panhellenism >>, CPh 19,p. 65-101.
47 . Sur la question, voir aussi NoËt (2003b).
48. Sur pnrdpeLa chez Isocrate, voir SCHIAPPA (199\, fhe Beginnings of rhetorical Theory
in classical Greece,New Haven & London, p. 158 et 169, qui considère que le terme a été formé
par Isocrate <<to contrast it with the objectives of his pedagogy>. Il est toutefois difficile de
souscrire à I'idée affirmée précédemment dans SCHLq,ppe (t19901, voir aussi COLE [1991a])selon laquelle l'utilisation de pqrdpeLcr par Isocrate permet d'identifier ce dernier dans le
Gorgias comme la cible visée par Platon derrière les attaques portées contre la prltoptxl téXvr1
de Gorgias. Il me semble plus simple d'inverser les perspectives et de supposer que le terme
permet à Isocrate de se distinguer de Gorgias. C'est Platon qui, en feignant d'ignorer les déné-
gations d.'Isocrate, assimilerait ainsi le maître et 1'é1ève. Par ailleurs, il n'est pas utile de
considérer Isocrate comme la cible majeure dtt Gorgias. On peut supposer en effet que Gorgias
était encore vivant à l'époque de composition du dialogue ou venait à peine de mourir, ce qui fait
L\ POLÉMIQUE D'ISOCRATE CONTRE GORGIAS 61
I"r ftrimdim drspensê par Isocrate est en effet d'abord une formation morale et,
rn SEXL lcs æcusations d'Isocrate contre son maître consonnent avec celle de
nm drl'{ le dialogue homonyme. Contrairement aux programmes des maîtres
& drsws politiques, qui cherchent à transmettre une technè ($ 9) portant sur les
rtû *. lsærate se propose de former non pas de simples rhetores ($ 2O'.
frgnnfrtlor- maiç des hommes caractérisés par leur epieikeia, leur <<honnêteté>,
c-cr-irriirr leur "perfection morale>. Aristote définira cette notion dans laftnrr#r f.13-13'14 a25 sqq.) et dans l'Éthique à Nicomaque (V 14, ll3"l a33
ry,l ormlnre *l'équité>, c'est-à-dire une forme spéciale de justice (ôtxarooÛvq)
W r'cm pos la justice léga7e, mais un correctif à la justice légale, qui permet de
rnnpdrler non la letûe, mais I'esprit de la loi, non I'action, mais l'intention.,lm- I'bmme equitable est < celui qui a tendance à choisir et à accomplir les
,rûlrnr @tables et ne s'en tient pas rigoureusement à ses droits, bien qu'il ait la
h ù sm côté " (trad. Tricot). Comme Aristote, Isocrate distingue ici I'epieikeia& tr ôftstosszà: il forme à la première, sans enseigner la seconde.
Ctæ disinction lui permet aussi de se démarquer des éristiques: contrai-G@rû à erm. il ûe pense pas que la << justice >> s'enseigne ni que l'on puisse provo-p riryr ctux dont le naturel ne dispose pas à la vertu la modération et la justice
ltn!ÇpmirurJv xcri ôLxarooÛvr1v), de sorte que sa philosophia ne peut que contri-M i mriær et à entraîner (oupncrpaxeÀeÛocroOat xcri ouvcroxfrocrt) à l'étude
fu diwcwrs politiques (rilv tôv Àdyo-rv tôv noÀttLxôv énrpéÀetav), mais non
p former tous les élèves quels qu'ils soient de la même manière. Il ne s'agitfuc ps d'une science de la justice (ôrxatooÛvr1), mais d'une formation moraleqfu:nuat qui garantit à l'élève la parfaite mise en adéquation entre discours etTF{ €f fait de lui à son tour - si sa nature le permet - un modèle de perfectionag.
l-^a cmception du discours sur laquelle repose ce programme explique la formeilrp db Contre les Sophistes et sa fin abrupte. Elle permet en effet d'interpréter
.ffiemment la phrase de conclusion du 5 22, que nous avons déjà citée au début
&ctr rdcle:'hm tÈ pq ôoxô ràç 1Èv rôv dÀÀov ùnooXéoerç ôrcrÀÛeLv, cruràc ôà pei(or Àéyetv tôv
lÊ!oll'n"ï .{ 6"rrrp aurôç êne(o0n oijto tcrût' ëXetv, pgôioç oTpat xcri toiç ciÀÀoLç gavepôv
@m:T6ErV-
G- \fathieu construit la proposition relative (è{ ôvnep crÛtôç èneioOn oÛtar
tuû,r- foerv) coûlme une complétive (<je ferai voir aux autres, facilement à monærs- ce qui m'a persuadé qu'il en est comme je le dis>), I'antécédent non expli-
,m -rm sr de son art des cibles tout indiquées pour Platon. Sur cette question, voir supra, note 40,e Jtog- ( )00kt). < L'art de Gorgias dans le Gorgia.s >>, dans L. Calboli Montefusco, edit., Papersm rtirrerorir- 6. Roma, p. 131-149.
.19 Dans le Sur l'Échange,218,ênlr;tx/1ç semble également pris comme équivalent de xcrÀôç
!ùT*t. l,e ærme désignant la perfection morale de l'orateur, qui garantit l'accord entre ses
rres er is paroles, donnant ainsi une force de persuasion plus grande au discours.
62 MARIE-PIERRE NOEL
cité du relatif Ë{ ôvnep étant alors un pronom démonstratif neutre pluriel à I'accu-
satif raûta, complément de xataorfoeLv et dont I'attribut serait gcvepdv. Mais
on peut aussi comprendre, comme le fait D. Mirhady dans sa traduction récente du
textesO, que le complément de xcrtcroujoetv est la proposition infinitive déjà
exprimée dans la relative : oÛro roûrct ëXetv, et considérer que la proposition
principale comme la relative ont la même construction, ô{ 6vnep devant être
compris comme un ôx toÛtcov è{ 6vnep. On lira alors :
Afin de ne pas paraître détruire les promesses des autres tout en tenant moi-même des propos
au-dessus ce que je suis en mesure de faire, c'est à partir des arguments qui m'ont moi-même
convaincu qu'il en est ainsi que, selon moi, je rendrai facilement cela clair pour les autres aussi.
L'idée que I'enseignement d'Isocrate sera en accord avec les prémisses sur
lesquelles il repose, contrairement à ses concurrents, dont les actes contredisent les
paroles, colrespond bien à I'argumentation du Contre les Sophistes: Isocrate n'est
pas un alazôn, ses paroles et ses actes forment une unité;les éléments qui l'ontconvaincu sont les réflexions ($ 14: ôr<ivotcr) exposées aux $$ 14-18, dont il va
faire le programme de son enseignement. Son discours est donc cohérent et, à ce
titre, Isocrate peut se présenter comme le paradigme de I'enseignement qu'ilpropose de dispensersl.
L'argument des $$ 2l-22 est construit selon une composition annulafue, qui
permet de récapituler I'ensemble des points, conformément à la fonction d'un
epilogos. Il est préparé par les $$ 19-20, la dernière accusation, contre les auteurs
detechnai($$ 19-20),seconcluantparunenouvellementiondeséristiques($20),qui renvoie à la première accusation ($ 1). Aux Sg2l-22, se dégage alors la posi-
tion particulière d'Isocrate par rapport à tous les maîtres qu'il a attaqués jusque-là.
C'est ainsi qu'àl'alazoneia des maîtres dénoncée dès la première phrase du
prooimion ($ 1) répond la cohérence affirmée d'Isocrate dans la dernière phrase
del'epilogos (ç22), ce qui suggère alors une clôture et non une ouverture ou un
arrêt détibéré, et semble bien indiquer que le texte est complet.
La forme du discours prouve aussi la cohérence du propos. Le Contre les
Sophistes obéit en effet ici aux principes énoncés aux $$ 14-18 : I'activité portant
Sur les discours ne relève pas d'un art fixe - dont on peut trouver les éléments
consignés dans les technai logôn-, mais d'un poiètikon pragma, une activité
poétique, dans laquelle le discours s'adapte aux cfuconstances qui I'ont suscité en
épousant le mouvement même des idées exposées, sans prétendle à I'exhaustivité.
Il n'a donc pas pour fonction d'être reproduit à I'identique, mais sa perfection
50. < So that I do not appeff to be destroying other's pretensions while myself claiming more
than is within my power, Ithink the reasons by which I was persuaded will easily make clear forothers also that these things are trre.> (MTRHADY & Too [2000]' p. 66)'
51. Voir aussi la Rhétorique à Alexandre,38,1445b29 sqq., où se trouve développée une
idée comparable , ainsi que le commentaire de CrilRoN (2002) ad loc ' ' p . 199-200 .
LA POLÉMIQUE D'ISOCRATE CONTRE GORGIAS 63
!d sËrrir de base à I'irnitation.
Ainsi compris-le contre les sophistes réussit donc à présenter, sans aucune
silar|liLrkln. un progranme de formation qui ne peut être entièrement explicité,
cc çi erplique sÀs doute I'aspect très inhabituel de son plan et de son épilogue.
l mnifese alors la perfection dela paideia isocratique en construisant'l'ethos du
tr pmadigmatique : Isocrate52.
f- cde lecffie vaut aussi pour l'ensemble du corpus, comme le montre le commentaire fait
çnhoæ- rtens ts grrl l'Échànge ($ 195), à propos du Contre les Sophistes, dont il vient de
lir- drft (S 14-18): <Ici, l;expression est plus élégante que dans ce qui a été ditpîécé-
ûro- miç elle veut dire la même chose, ce qui doit être pour vous le plus grand indice de
- re**e 1c4r4ptov ric êrric éntetxe[aç). En effet, on ne me voit pas, quand j'étais
lF.- æ tir:rer à des ianfaronnades (ôÀo(oveudpevoç) et exposer un proglamme d'envergure
l6c d:missant. abaisser ma philosophie (tcrne(vr1v noLô rr)v qrÀoooqicrv); mais on me voit
ro ûas mÊmes propos dans la force de l'âge et à la fin de ma vie, en pleine sécurité et au milieu
ù drgEr- der-alt les gens qui veulent être mes disciples et devant ceux qui vont voter à mon
fr Âlsri æ cmis-je pas que l'on puisse montrer quelqu'un qui ait été sur ce point plus sincère
cùFm que moi.', (trad' Mathieu mod')
-
64 MARIE.PIERRE NOËL
Annexe: plan du Contre les Sophistes
I Prooimion: attaque contre <<ceux qui s'occupent d'éducation>>, accusésde manquer de cohérence dans leurs actes et reurs parores (&Àc{o-veûeoOcrt).
1-8 Attaque contre les éristiques (tôv nepi tàç ëprôcrç ôrarptBdwov): ilspromettent d'enseigner ce qu'il faut faire et affirment que ce savoirpermet d'accéder au bonheur ($ 3: eûôcxfpoveç); alors qu'irs prétendentprovoquer vertu (g 6: dperav) et modération (oogpooûv4v) chez leursdisciples, ils se défient de ces derniers et prennent des garanties pour lepaiement de leurs honoraires ($ 5), eux qui guettent rÀ contradictions(g 7: êvavtrôoerç) dans les paroles ne voient pas ces dernières dansleurs propres actes; les accusations de bavardagË (g g: ôôoÀewdav) et t
de petitesse d'esprit (prxpoÀoyrcrv) contre eux sontjustifiées. ' I9-13 Attaque contre les maîtres de politikoi rogoi: ilsproposent des procédés Ifixes sans tenir compte de l'expérience et de la nat're de l'érève?g r0;;; I
montrent I'inadéq 'a1ien entre ce qu'ils promettent et ce qu'ils p"uu"rt Iréaliser (ôÀcr(oveûeo0cr) ; défense de I'activité d,Isociat", L t"t., Imaîtres font que |on critique aussi << ceux qui ont la même activité " I($ll); ils ont proposé des procédés fixes pour une activité créatrice I(g 12: norrlrrxôv npôygn); I
14-18 Programme d'Isocrate: 1) prendre en compte le fait que res capacités de Iparler et d'agir ne se trouvent que chez les jeunes g"ns aouË, et chez Iceux qui ont de l'expérience ($ ra); l'éducation ($ ts, ncdôeuorc) Ipermet à ceux-rà d'avoir une meilleure technique ('eyvrxartéporc) ;t Id'avoir une plus grande facilité à chercher, tandis que i"t uot
"r, -"é-; Is'ils ne peuvent devenir de bons débatteurs (ôy,vrotùç. ôvcrgoûcr àu Ides créateurs de discours (g 15: Àdyalv nor4'd,ç), peuvent'"gun-on, Iprogresser; 2) il n'est pas difficile d'acquérir la connaissance des formes I(iôécrr) à partir desquelles sont composés res discours ; mais c,est le;;i; Ide telle ou telle forme (g 16: npoeÀéo0cr), la manière de les mélanser I(prei(uoOcrr rpôc ôÀ^fÀcrç) er de les ordonner (t<i(aoO",), l,;r;;;; Id'erreur dans la détermination des moments opportuns (rôv xcrpôv) Ipour leur emplo.r, la capacité d'orner par les p"nre", (êv0upllpcor) nri Iconviennent et de trouver une expression harmonieuse et artistique iroic IôvdprnoLv eùpûOproç xai pouorxôç eineiv) qui demandent une'# Icourageuse et apte à penser (g i7: ôvôprxflç xaf ôo(aot,,flç); 3) l,élève Idoit apprendre les espèces (eiôa) de discours et s'entraîner à leur usase I($ 17); 4) le maître doit pouvoir exposer tout ce qui peut être enseiene Jt, Ipour le reste, s'offrir lui même comme
"^"-p1" (nap<iôerypni pou, I
j
LA POLÉMIQUE D'ISOCRATE CONTRE GORGIAS 65
façonner de son empreinte ($ 18: êxtun<10éwaç) des orateurs qui soient
capables de I'imiter (prpqoaooat); c'est ainsi que ceux qui s'adonnent à
la philosophie ($ 18: ol grÀooogoÛweç) peuvent accéder à la perfection.
1tr10 Attaque contre les auteurs de technai logôn appartenant à la génération
précédente; ils ont promis d'enseigner à plaider ($ 19: ôtx<i(eo0aÙ,
ievendication que les adversaires pourraient retourner comme une insulte,
cela pour une activité qui ne concerne pas que les discours judiciaires
($ 20); ils sont même inférieurs aux éristiques (tôv nepi tùç ëptôcrç
xcrÀtvôouçrev<ov) qui, au moins, promettent la vertu et la modération.
: -'l Epilogos: récapitulation ($ 21: intérêt de cette philosophia pour l'équité
davantage que pour I'activité oratoire; le sens de lajustice ne pegt être un
objet d'enseignement; il n'est pas de technè qui puisse faire naître la
modération et le sens de la justice chez ceux qui sont mal disposés par
nature; mais l'étude des politikoi togoi lrilv tôv Àdyclv tôv noÀtttxôv
èntpréÀercrvl peut y contribuer et y entraîner); Ç22 Isocrate, lui, est
capable de faire ce qu'il dit: contrairement à ses adversaires, il n'est donc
pas un ôÀcr(tirv.
TABLE DES MATIERES
Bibliographie des travaux de Michel Patillon "'
Entretien avec Michel Patillon """"""' 13
LUC BRISSON
QuelquesmanuelsderhétoriqueantérieursàPlatonetàAristote.....................35
MARIE-PIERRE NOËL
Rhétorique ou philosoph ie ? La structure da Contre les Sophistes
et la polémique d'lsocrate contre Gorgias"""""""""' """""""""' 49
HARVEY YUNIS
The rhetoric of law In Plato's Apotogy of socrates and Isocrates' Antidosi's "" 67
FRÉDÉRIQUE WOERTHER
Quelques remarques préliminaires pour une nouvelle édition
des fragments d'Hermagoras '..""""""' """"" """"" 15
CARLOS LÉVY
La rhétorique et son contexte :
quelquesremarquessurl,enseignementrhétoriquedePhilondeLarissa...........95
CHARLES GUÉRIN
Formes et fonctions du précepte rhétorique des manuels latins au De oratore " 10'7
JACQUES-HUBERT SAUTEL
Rhétorique militaire dans les Antiquités Romnines de Denys d'Halicamasse :
la harangue du dictateur Postumiu; avant la bataille du lac Régille (VI 6-9) ""' 133
404 TABLE DES MATIERES
MARIA SILVANA CELENTANO
Quintiliano e la duplice exercitalio nell'Institutio oratoria ........... 155
EUGENIO AMATO
Genre littéraire, contenu et structure des Mémorablesde Favorinos d'Arles .......165
BERNARD SCHOULER
Que cherchait Libanios en défendant Socrate ?................... ...........189 r
RICHARD GOULET i
Figures du rhéteur à Athènes au IVe siècle après J.-C. ...................205 i
LUCIA MONTEFUSCO
Do you know enough about rhetoric ?................ .......239
JEAN BOUFFARTIGUE
Le concept d'atticisme et son axiologie chez les Pères grecs............ ..................251
JOSEPH PARAMELLE
Esquive, ellipse, énigme, dans la poétiquede Cosmas de Maibuma (vtf-vnI" siècles) ...............275
MICHEL PATILLON
Adespoton anepigraphon ; Inurentianus Plut.51 ,33,f. 5l-53v........................287
TIZIANO DORANDI ;
Préliminaires de Georges Scholarios à L'Éthique à Nicomaque d'Aristote I
et aux Entretiens d'Épictète ..................297 i
PIERRE CHIRON
La figure d'hyperbate ......311
PIERRE-LOUIS MALOSSE
L'épiphonème : Histoire d'un supplément d'âme .....331
TABLES .....355
BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE .........315
CONTRIBUTEURS ........401




















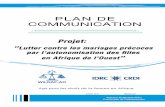



![Les sanctions contre l’Iran : Les multiples impacts néfastes [Sanctions on Iran: Multiple nefarious impacts]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/632035ea069357aa45061859/les-sanctions-contre-liran-les-multiples-impacts-nefastes-sanctions-on-iran.jpg)