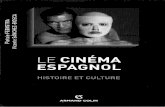Cicéron et la parole stoïcienne : polémique autour de la dialectique
-
Upload
univ-grenoble-alpes -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of Cicéron et la parole stoïcienne : polémique autour de la dialectique
1
Cicéron et la parole stoïcienne : polémique autour de la dialectique
Sophie Aubert (Université Paris XIII-Villetaneuse)
À l’époque républicaine, la parole stoïcienne fit l’objet, de la part de Cicéron, d’analyses aussi nombreuses que pointues, quoique le plus souvent biaisées dans la mesure où elles s’inscrivaient dans le cadre plus général de la polémique entre écoles philosophiques. Face à l’abondance oratoire que favorisait chez l’orateur un entraînement conforme aux préceptes de l’Académie ou du Lycée, la sécheresse stylistique propre à la plupart des Stoïciens romains ne pouvait qu’être raillée, voire fustigée, par l’Arpinate. De surcroît, ainsi que le notait C. Lévy dans un récent article, « Si par ‘histoire’ on entend ‘évolution’, il y a une certaine contradiction à dire qu’il existe chez Cicéron une histoire de la rhétorique stoïcienne. En effet, la particularité de cette rhétorique, du moins dans la représentation cicéronienne, est d’offrir des caractéristiques si rigides qu’elles semblent ne laisser pour ainsi dire aucune place à l’initiative individuelle
1 ». Dans la mesure où l’orateur du Portique ne conçoit aucune différence de fond entre les
deux sections de la logique que sont la rhétorique et la dialectique - ce que Zénon avait symbolisé par la célèbre métaphore du poing ouvert et de la main fermée
2 - ces deux disciplines peuvent toutes deux être
requises dans le même discours, sans à-coups dans le passage de l’une à l’autre, pour exposer des thèses philosophiques, s’adresser au sénat, plaider au tribunal ou au forum, par le biais tantôt de petits syllogismes acérés, tantôt de développements oratoires plus longs.
Ce fut précisément la coexistence des deux styles au sein d’un même discours, d’une même argumentation, qui conduisit Cicéron à discréditer la rhétorique des Stoïciens au point de ne plus reconnaître à ces philosophes qu’un seul mode d’expression - le mode dialectique
3, dont il conteste la
validité tant sous l’angle de la pratique philosophique (jugée inefficace) que d’un point de vue oratoire. Dans ce dernier domaine, l’échec de la rhétorique du Portique fut à ses yeux particulièrement flagrant : aussi souhaiterions-nous examiner ses analyses de plus près, en nous attachant à deux extraits du De Oratore au cours desquels il dresse un portrait accablant et circonstancié de l’éloquence stoïcienne, dont il déplore une homogénéité en réalité problématique. Il s’agit là d’un thème qui sera repris dans le Brutus, dans un contexte polémique, et qui concourt à stigmatiser la rigidité des orateurs du Portique, leur monolithisme, leur incapacité à moduler leur discours en fonction de l’auditoire du fait qu’ils ne possèdent qu’un seul mode d’expression, celui de la dialectique, traditionnellement associé à la philosophie et ne pouvant tenir lieu d’éloquence populaire.
1 C. Lévy, « Cicéron critique de l’éloquence stoïcienne », in L. Calboli Montefusco (éd.), Papers on Rhetoric, vol. III, Bologne,
2000, p. 127-144 (p. 127). 2 Cic., Or., 113-114 (cité en partie en SVF, I, 75) ; Fin., II, 17 (= SVF, I, 75) ; Quint., IO, II, 20, 7 (cité en partie en SVF, I,
75) ; SE, AM, II, 6-7 (reproduit en partie en SVF, I, 75 et II, 294 ainsi qu’en LS 31 E). 3 Cic., Br., 118. C. Atherton nous semble avoir occulté dans son article la part de la polémique dans le témoignage cicéronien,
estimant qu’il s’agit là d’une description objective du style des Stoïciens (« Hand over Fist : The Failure of Stoic Rhetoric », CQ, 38, 1988, p. 392-427 - ici, p. 401-404) alors que la situation est beaucoup plus nuancée, comme nous tâcherons de le mettre en lumière.
2
Au livre III du De Oratore, l’illustre orateur Crassus, auquel Cicéron confie souvent la tâche d’exposer ses thèses personnelles, entame un long excursus d’inspiration académicienne consacré aux rapports de l’éloquence et de la philosophie
4, et plus précisément, à la quête non de « la philosophie la
plus conforme à la vérité (quae sit philosophia uerissima) », mais de « celle qui entretient les rapports les plus étroits avec l’orateur (quae oratori coniuncta maxime)
5 ». Après avoir affirmé la nécessité de la culture
philosophique pour l’orateur (§ 56-61), et accusé vigoureusement Socrate d’être à l’origine du déplorable divorce entre sagesse et éloquence (§ 61), Crassus passe en revue les diverses écoles qui se réclament du philosophe athénien, en commençant par le Jardin (§ 63-64), puis en abordant le Portique (§ 65-66), avant de conclure sur les Péripatéticiens et les Académiciens (§ 67-68), censés former « deux groupes sous un même nom
6 ». D’emblée, le traitement de l’épicurisme révèle que nous nous trouvons en
contexte polémique : objet d’une présentation ironique et condescendante, cette école est congédiée non sur des critères stylistiques, mais en raison de son opposition au mos maiorum qui se traduit en l’espèce par un refus de toute participation à la vie de la cité. Une telle doctrine ne saurait évidemment convenir à l’orateur idéal que recherche Crassus.
Vient ensuite l’école du Portique, qui fait l’objet d’une réfutation bien plus sérieuse7 et détaillée
dans la mesure où nombre de ses doctrines sont accusées de contredire de façon flagrante les réalités et les exigences de la vie politique. Crassus brode alors sur le thème des paradoxes des Stoïciens
8, puis avant
de relever la singularité doctrinale propre à ces philosophes - une singularité qui signe selon Cicéron la faillite de leur pratique oratoire en introduisant un désaccord entre langage et action
9 -, il se livre à une
analyse serrée de leur mode d’expression et de son inadéquation à l’orateur : « En outre leur style même (orationis (…) genus) est peut-être fin, assurément pénétrant ; mais, pour l’orateur (ut in
oratore), il est décharné, contraire à l’usage, incompatible avec le goût populaire, obscur, creux, sec, tel par ailleurs
qu’il est absolument impossible de l’employer devant le peuple10
».
4 Cic., De Or., III, 57-72. Sur les sources d’un tel passage, nous renvoyons à C. Lévy, Cicero Academicus. Recherches sur les
Académiques et la philosophie cicéronienne, Rome, École Française de Rome, 1992, p. 109-113, ainsi qu’à J. Glucker, « Socrates in the Academic Books and the other Ciceronian Works », in B. Inwood - J. Mansfeld (éds.), Assent and Argument. Studies in Cicero’s « Academic books ». Proceedings of the 7th Symposium Hellenisticum, Leyde-New York-Cologne, Brill, 1997, p. 58-88 (p. 66-67). 5 Cic., De Or., III, 64 (traduction personnelle).
6 Ibid., III, 67 : nomen est unum, sententiae duae.
7 Signalons toutefois que la critique du Portique commence sur un ton badin, dans la continuité de la critique précédente ;
Crassus « congédie » les Épicuriens (dimittamus : ibid., III, 64) de la même façon que les Stoïciens (Stoicos autem (…) dimitto : § 65), et pas plus que les premiers ne sauraient s’en offenser, eux qui sont qualifiés « de braves gens » (boni uiri : § 64), les seconds ne sauraient éprouver de la colère, sentiment qui leur est parfaitement inconnu (nec eos iratos uereor, quoniam omnino irasci nesciunt : § 65). Ces ressemblances superficielles ne font toutefois ressortir qu’avec plus de relief les distinctions fondamentales qui suivent entre les deux écoles dans leur approche de l’éloquence. 8 Ibid., III, 65.
9 Ibid., III, 66. La référence faite à l’honneur (honor), à l’ignominie (ignominia), aux récompenses (praemium) et aux supplices
(supplicium) nous place sur le terrain de la parole publique, terrain privilégié pour l’exercice de la sagesse, sur lequel les Stoïciens connaissent un échec retentissant. 10
Ibid., III, 66 : Accedit quod orationis etiam genus habent fortasse subtile et certe acutum, sed, ut in oratore, exile, inusitatum, abhorrens ab auribus uulgi, obscurum, inane, ieiunum, ac tamen eius modi, quo uti ad uulgus nullo modo possit (traduction personnelle). La leçon ac tamen du manuscrit L, quoique confirmée par les éditeurs des Belles Lettres (qui ne la traduisent pas) et par K. Kumaniecki dans l’édition Teubner, fait difficulté, puisqu’il n’y a pas d’opposition entre eius modi… et ce qui précède. En réalité, celle-ci se situe au niveau méta-discursif : quoique le style des Stoïciens soit affublé de telle ou telle tare, on peut encore ajouter qu’il est impossible de l’employer devant le peuple, pour des raisons non plus strictement stylistiques, mais doctrinales cette fois, ainsi
3
Il convient tout d’abord de se pencher sur la conjonction ut, au sein de l’expression ut in oratore (« pour ce qui est de l’orateur »). Elle indique que Crassus décrit là non l’expression oratoire, mais le style philosophique des Stoïciens, dont il stigmatise l’inefficacité car même les philosophes ont besoin à ses yeux d’une certaine éloquence pour convaincre, et sont justiciables de jugements stylistiques au même titre que des orateurs
11. En effet, malgré le sens courant d’oratio comme « discours rhétorique », la mention de
l’orationis genus des Stoïciens ne signifie nullement que Crassus analyse ici le mode d’expression oratoire des philosophes du Portique, comme le suggère C. Atherton
12. Le groupe orationis genus revient fréquemment
pour évoquer le style des philosophes en général13
, voire des Stoïciens en particulier14
, des sophistes15
, ou encore des historiens
16, ces derniers n’ayant pas pour ambition de plaider au forum, quoique leur
mode d’expression soit examiné à la lueur des exigences de l’orateur idéal recherché tout au long du De Oratore. En d’autres termes, Crassus envisage ici la pratique stoïcienne sous un angle oratoire, sans entendre pour autant par l’expression orationis genus le « style oratoire », mais bien le « genre de style », ou le « style » tout court, qu’adoptent les membres du Portique. Cette interprétation est confirmée par l’analyse des Péripatéticiens et des Académiciens qui suit immédiatement : Crassus s’y intéresse à « l’abondance » et à la « variété » déployées par Aristote
17, au « charme exceptionnel de la parole » dont
faisait preuve Arcésilas dans son rejet des épistémologies dogmatiques18
, puis à « la vivacité intellectuelle et à l’abondance extraordinaires » de Carnéade dans son enseignement philosophique
19. Il est vrai en
revanche que non sans injustice, Crassus, usant d’une autre méthode vis-à-vis des Épicuriens et des Stoïciens, analyse l’éloquence philosophique des Académiciens et des Péripatéticiens sans chercher à examiner si elle conviendrait à un orateur, et nous aurons à nous interroger sur les motifs d’une telle différence d’approche. Celle-ci ne justifie pas pour autant la remarque de C. Atherton selon laquelle la
que l’indique la suite immédiate du passage citée plus haut, qui porte sur la singularité doctrinale des Stoïciens en matière d’éthique, ce qui entraîne d’importantes retombées sur leur pratique oratoire et politique. Sur l’interprétation du groupe at tamen, voir le commentaire du De Oratore d’A.D. Leeman, H. Pinkster, L.W. Nelson, E. Rabbie et J. Wisse, Heidelberg, 1981-2005, 5 volumes, vol. IV, p. 250-251. 11
Stoïcien exemplaire aux yeux de Cicéron, Caton est épargné par la critique de Crassus dans la mesure où il est le seul à s’exprimer à la fois en orateur et en philosophe jusque dans ses discours au sénat, en emportant la conviction de ses auditeurs. 12
C. Atherton, « Hand over Fist », art. cit., p. 392-427 (p. 401) nuance ensuite, il est vrai, son hypothèse. 13
Cic., De Or., I, 81 : Antoine évoque la « sorte de style » (quoddam orationis genus) que manient les philosophes. 14
Cic., Br., 114 (Cicéron évoque les Stoïciens devant Brutus) : « leur style (orationis genus) est, tu le sais, très pénétrant et débordant de technique, mais décharné et insuffisamment adapté au goût du peuple » (quorum peracutum et artis plenum orationis genus scis tamen esse exile nec satis populari assensioni accommodatum). La mention de la maigreur (exilis) et de l’inadéquation au goût du public évoque fortement le jugement porté par Crassus lui-même dans le De Oratore, III, 66. Voir encore Cic., Br., 119 (à propos des Stoïciens) : « tous leurs soins sont absorbés par la dialectique, tandis que ce beau style (orationis (…) genus) sans contrainte, ample, ondoyant, ne trouve pas chez eux d’application » (istorum in dialecticis omnis cura consumitur, uagum illud orationis et fusum et multiplex non adhibetur genus : traductions personnelles). 15
Cic., Or., 42 ; 96. 16
Cic., De Or., II, 64. 17
Ibid., III, 67 : copia fortasse et certe uarietate (…). 18
Ibid., III, 67 : eximio quodam (…) lepore dicendi. 19
Ibid., III, 68 : diuina quadam celeritate ingeni dicendique copia (traduction personnelle). La suvgkrisi" entre le Portique d’un côté et les autres écoles philosophiques - notamment le Lycée et l’Académie - de l’autre revient souvent chez Cicéron, et tourne systématiquement à l’avantage des secondes. On en trouve un exemple dans le De Finibus, IV, 2 où l’obscurité stylistique que justifie Caton par l’opacité inhérente aux choses-mêmes s’avère absente, selon Cicéron, des exposés des Péripatéticiens alors que ces derniers défendent, selon l’Arpinate, les mêmes thèses que les Stoïciens.
4
valeur de notre extrait du De Oratore résiderait dans une hypothèse implicite de Crassus : le style stoïcien critiqué serait celui qu’un orateur du Portique utiliserait forcément, étant donné l’absence de tout autre style, d’ordre rhétorique, à sa disposition, et même s’il existait en théorie un tel mode d’expression rhétorique stoïcien distinct du style philosophique, l’orateur nous avertirait de n’attendre aucune différence entre les deux dans la pratique
20.
En réalité, la théorie du Portique ne suggère nullement qu’il existerait un style rhétorique distinct du style philosophique, d’autant moins que la frontière ne passe pas entre rhétorique et philosophie dans le système stoïcien, mais entre rhétorique et dialectique, ce qui ne revient pas du tout au même. Entre les deux sections de la logique, la distinction porte sur la forme, non sur le fond
21 ; un exposé philosophique
est tout aussi justiciable d’une présentation sous forme de syllogismes ou bien de discours suivis, les deux étant souvent mêlés. Ainsi procèdent, en tout orthodoxie selon nous, les Stoïciens Caton et Balbus, au livre III du De Finibus et au livre II du De Natura Deorum respectivement. Tout en recélant une part d’exactitude, le constat de C. Atherton nous paraît donc procéder d’une confusion entre deux thèmes distincts, d’une part l’analyse d’un mode d’expression philosophique à la lueur des exigences d’un orateur, d’autre part l’homogénéité stylistique des Stoïciens qu’essaie de défendre Cicéron à la faveur d’amalgames polémiques et de coups de force. Si le premier trait, quoique problématique, est commun aux approches de toutes les écoles de pensée hellénistiques que mène l’Arpinate dans le De Oratore, le second est particulier aux Stoïciens - dans la représentation cicéronienne du moins - et mérite une étude plus précise. Si nous revenons sur l’analyse que propose Crassus de l’éloquence philosophique des Péripatéticiens et des Académiciens
22, nous constatons que l’orateur isole des individus - Aristote,
Arcésilas, Carnéade - censés être des représentants fidèles de leur école dans ce domaine, tandis qu’il n’envisage les Stoïciens (Stoicos autem (…) dimitto) que de façon compacte. Ce simple détail nous paraît participer d’une stratégie d’ensemble grâce à laquelle Cicéron reconstitue de force un « bloc » stoïcien prétendument homogène afin de concentrer ses attaques sur une seule cible en en livrant une vision délibérément caricaturale, au lieu de prendre en compte la souplesse des théories oratoires du Portique ainsi que les divergences des scolarques (mais aussi de leurs disciples) entre eux sur la question de la rhétorique. Il est vrai qu’il pouvait s’appuyer, dans cette entreprise polémique, sur la fluidité des rapports entre rhétorique et dialectique propre au stoïcisme, qui était de nature à gommer toute distinction non seulement entre philosophes et orateurs, mais surtout entre les deux sections de la logique, au point que seule semblât subsister la dialectique, même dans des discours destinés au forum dont l’inadéquation aux exigences populaires apparaissait alors de façon éclatante. C’est dans le Brutus que l’on trouve le témoignage le plus éclairant de la stratégie cicéronienne, lorsque le personnage éponyme insiste sur le caractère unitaire de l’éloquence stoïcienne, identique à Rome et à Athènes, dans des entretiens philosophiques ou des discours oratoires : 20
C. Atherton, « Hand over Fist », art. cit., p. 392-427 (p. 401). 21
Envisagés séparément, les deux pans de la logique sont définis comme des « sciences du bien parler », ce qui revient à dire le vrai : cf. Anonym., Proleg. in Hermog. Status, in RhG, VII, p. 8 Walz (cité partiellement en SVF, II, 293) ; Alex. Aphr., In Arist. Top., p. 1, 10-12 Wallies (= SVF, II, 124 = LS 31 D). Lorsque rhétorique et dialectique sont couplées en revanche, il convient d’insister sur la continuité du discours (peri; to;n ejn diexovdw/ lovgon) propre à l’une, l’échange de questions et réponses (peri; to;n ejn ejrwthvsei kai; ajpokrivsei lovgon) propre à l’autre, en vertu d’une opposition dans doute empruntée à l’Académicien Xénocrate (cf. DL, VII, 41-42 = SVF, II, 48 = LS 31 A). Même dans ce cas toutefois, on ne saurait oublier leur unité de nature, puisque toutes deux portent sur le lovgo", conçu à la fois comme discours et argumentation. 22
Cic., De Or., III, 67-68.
5
« Quelle ressemblance, je le vois, entre nos Stoïciens et ceux de la Grèce ! Ce sont presque tous (omnes fere Stoici) des
gens très avisés dans l’argumentation (in disserendo), qui la construisent conformément à des règles techniques et sont
des sortes d’architectes de paroles. Si on les fait passer en revanche de la discussion à l’exposé oratoire (idem traducti a
disputando ad dicendum), ils se retrouvent sans ressource23
».
Les Stoïciens se seraient donc contentés, au dire de Brutus, de transplanter leur langage dialectique dans le domaine de la parole publique. À cette présentation schématique, on ne peut qu’opposer les talents oratoires inégaux (et parfois non négligeables) de Fannius ou Rutilius Rufus, sans même mentionner Caton, qui justifie sans doute à lui seul la légère concession de Brutus en début de passage (omnes fere Stoici…). De façon fort intéressante, dans sa réplique, Cicéron admet qu’en réalité, Péripatéticiens et Académiciens ne satisfont pas plus que les Stoïciens aux exigences de l’art oratoire, mais pour des motifs inverses :
« Car si les Stoïciens ont un style (oratio) plus resserré (astrictior) et parfois plus ramassé (aliquandoque contractior) que ne
le réclame un auditoire populaire, en revanche les autres ont une allure plus libre et plus ample (liberior et latior) que
ne l’admet l’usage dans les procès et sur le forum24
».
Il ressort clairement de cet extrait que malgré la présence du terme oratio, c’est bien le langage philosophique des diverses écoles qui est en jeu, comme le soulignent les références à l’éloquence de Platon, d’Aristote ou de Théophraste au paragraphe suivant. En outre, nous trouvons ici la confirmation que le langage des orateurs du Portique est bien, selon Cicéron, celui de la dialectique, puisqu’il définit ailleurs celle-ci comme une « éloquence, pour ainsi dire, ramassée et resserrée » (quasi contracta et astricta eloquentia)
25. Rattaché aux adjectifs breuis ou minutus, et antonyme de latus (« large »), le mot contractus
désigne la brièveté d’une période, que ce soit chez Crassus ou chez l’orateur de style simple26
. Le terme astrictus, quasi synonyme du précédent, s’oppose quant à lui à l’adjectif liber, qui traduit l’affranchissement de la phrase à l’égard de tout nombre oratoire
27. La dialectique imprime donc à la phrase un rythme
saccadé, et la scande au fil de syllogismes en des membres concis et hachés. Par contraste, « les autres ont une allure plus libre et plus ample (liberior et latior) que ne l’admet l’usage dans les procès et sur le forum », un témoignage confirmé par un extrait de l’Orator : 23
Cic., Br., 118 : Quam hoc idem in nostris contingere intellego quod in Graecis, ut omnes fere Stoici prudentissimi in disserendo sint et id arte faciant sintque architecti paene uerborum, idem traducti a disputando ad dicendum inopes reperiantur (traduction de J. Martha, modifiée). 24
Ibid., 120 : Nam ut Stoicorum astrictior est oratio aliquandoque contractior quam aures populi requirunt, sic illorum liberior et latior quam patitur consuetudo iudiciorum et fori (traduction personnelle). Aussi est-il peu vraisemblable qu’une synthèse entre éloquence et philosophie ait eu lieu du fait des Péripatéticiens et des Académiciens, contrairement à ce qu’avance Cicéron au livre III du De Oratore, suite sans doute à une manœuvre dialectique pour discréditer Épicuriens et Stoïciens. Les disciples d’Aristote postérieurs à Théophraste ne semblent pas s’être engagés dans la voie de leur maître. Critolaos par exemple, le Péripatéticien du IIe siècle qui avait participé à l’ambassade de 155 à Rome avec Diogène de Babylonie et Carnéade, s’était lui-même opposé tant à la rhétorique qu’aux rhéteurs (cf. Cic., De Or., II, 160 ; SE, AM, II, 12 et 20), tandis que l’Académicien Charmadas était hostile à la rhétorique traditionnelle, qu’il jugeait inutile voire dangereuse pour les états (De Or., I, 46 et 84). 25
Cic., Br., 309 (traduction personnelle) ; cf. Cic., Or., 114 sur l’opposition entre éloquence, « plus large » (latior), et dialectique, « plus serrée » (contractior). 26
Cic., Br., 162 (sur l’éloquence de Crassus) ; Or., 78 (sur l’orateur simple). 27
Cic., De Or., I, 70 ; ibid., I, 254 ; ibid., III, 175 ; ibid., III, 184 ; Br., 274 ; Or., 67 ; ibid., 188.
6
« Pourtant leur style n’a ni le nerf ni le mordant de l’éloquence propre au forum (neque neruos neque aculeos oratorios ac
forensis habet) (…). En effet le style des philosophes est tendre et craint le soleil ; il ne s’arme pas de traits et de mots
faits pour le public ; il ne s’astreint pas à des rythmes, mais s’en affranchit assez librement (nec uincta numeris sed soluta
liberius)28
».
Si nous résumons ces témoignages sur l’éloquence des « philosophes », nous nous apercevons
que Cicéron n’englobe sous ce dernier vocable que les Académiciens et les Péripatéticiens, tout en évacuant les Stoïciens, qui forment décidément une classe à part : la citation de l’Orator intervient juste après l’éloge de Théophraste, Aristote, Xénophon et Platon pour leur éloquence riche et ornée (ornate)
29.
Dans des termes similaires, un texte du Brutus, en vantant le charme expressif (suauitas) du disciple de Théophraste Démétrios de Phalère, relève qu’il déploie surtout une éloquence d’école (palaestra), impropre à l’agressivité, aux luttes du forum, et dépourvue des « aiguillons » (aculeos) vigoureux -également mentionnés dans le texte de l’Orator - qui font violence à l’esprit des auditeurs en assurant le succès de l’orateur
30. Douceur, allure paisible et régulière
31, désir de plaire (delectare), absence de nombre
et de rythme mais aussi de mordant et d’énergie (neruis)32
: tels sont donc les principaux traits de l’éloquence des philosophi. On croirait lire un portrait en creux du mode d’expression stoïcien, qui se définit au contraire par l’agressivité d’un style pointu (acutum) et le caractère heurté, la scansion excessive d’un langage imprégné de dialectique.
Le constat de la faillite du langage des philosophes du Lycée et de l’Académie une fois transposé au forum pourrait paraître entrer en contradiction avec l’éloge que faisait Crassus de leur éloquence en opposition avec le mode d’expression des Stoïciens, dans le texte du De Oratore rapporté plus haut. Nous nous étions alors demandé pourquoi l’orateur, contrairement à la méthode dont il avait usé à l’égard des membres du Jardin
33 et surtout du Portique, avait analysé l’éloquence philosophique des Académiciens et
des Péripatéticiens sans chercher à examiner si elle conviendrait à un orateur. C’est qu’en réalité l’Académie et le Lycée fournissent, l’une par sa doctrine même, l’autre par les travaux techniques de son fondateur en matière de topique, des armes inestimables à l’orateur sans pour autant que les philosophes issus de ces écoles manient le même style que les orateurs qui auraient suivi auprès d’elles un enseignement philosophique plus ou moins approfondi, mais auraient surtout fréquenté
28
Cic., Or., 62 et 64 : Tamen horum oratio neque neruos neque aculeos oratorios ac forensis habet (…). Mollis est enim oratio philosophorum et umbratilis nec sententiis nec uerbis instructa popularibus nec uincta numeris sed soluta liberius (traduction d’A. Yon). Il est intéressant que soit décrite dans des termes similaires à l’éloquence philosophique l’éloquence que favorisent les écoles de rhétorique : cf. Cic., De Or., I, 157. Les différences qui séparent ces deux modes d’expression s’effacent devant le constat selon lequel tous deux sont confinés dans des écoles, et inadaptés de ce fait à la pratique réelle du forum. Voir encore sur ce point ibid., I, 81. 29
Cic., Or., 62. 30
Cic., Br., 37-38. 31
Cf. Cic., Off., I, 3. 32
Cf. Cic., Or., 127 et surtout De Or., III, 80. 33
Crassus note certes que les Épicuriens prônent le désengagement politique, quoique là encore, il s’agisse d’une présentation simplifiée de leur doctrine, qui admettait une participation aux affaires de la cité dans certaines circonstances, à condition de conserver à leur égard une salutaire distance (cf. Plut., Tranq. An., 465 f-466 a). Dans cette mesure, il relève les conséquences de leur doctrine (plus que de leur mode d’expression) philosophique sur la pratique de l’orateur. Néanmoins, ces penseurs bénéficient généralement d’une plus grande indulgence que les Stoïciens sous l’angle stylistique. Cicéron n’exige pas d’eux de réels talents oratoires, sans doute parce qu’ils ne contreviennent pas au principal mérite du discours philosophique, la clarté : cf. Cic., Fin., I, 15. Un philosophe du Portique pourrait s’insurger d’un tel traitement de faveur, si Cicéron ne jugeait pas primordiale pour un philosophe la clarté du propos : or le style du Portique se distingue avant tout par son obscurité.
7
les écoles de rhétorique34
. En d’autres termes, si Platon se distinguait de tous ses rivaux en philosophie « par le charme et la gravité » de sa parole (et suauitate et grauitate)
35, il aurait paru s’exprimer malgré tout
« de façon trop paisible » (pacatior), si son éloquence avait été transplantée telle quelle devant les tribunaux (huius oratio (…) translata (…) in iudicia)
36. En revanche, le refus du dogmatisme et l’attachement
au vraisemblable aux dépens d’une vérité jugée inaccessible favorisent chez les orateurs adeptes de la Nouvelle Académie une incontestable abondance, de même que la technique aristotélicienne de découverte des « lieux » argumentatifs permet de ne jamais manquer de matière dans un discours. Les philosophes du Portique, quant à eux, s’expriment bel et bien de la même manière que les orateurs issus de la même école (à de rares exceptions près), selon Cicéron, ce qui appuie sa défense d’une homogénéité radicale du style stoïcien et de son inadéquation foncière, quasi ontologique, à tous les auditoires possibles, qu’ils soient composés d’une foule sans culture au forum ou au tribunal, ou bien d’aspirants à la sagesse - voire d’adversaires - dans le contexte d’un échange philosophique. Il s’agit là d’un leitmotiv qui pourrait sembler banal, mais nous paraît plus profondément refléter, dans le regard cicéronien, une forme d’inappropriation foncière, d’ajnoijkeivwsi" de l’éloquence stoïcienne, s’il est permis de forger un tel néologisme. La mention de l’« inappropriation » du style stoïcien revient précisément à plusieurs reprises dans le texte du De Oratore qui constituait le point de notre départ de notre réflexion et sur lequel il convient à présent de nous pencher plus précisément. Pour plus de clarté, nous le citons à nouveau :
« En outre leur style même est peut-être fin, assurément pénétrant (fortasse subtile et certe acutum) ; mais, pour l’orateur,
il est décharné, contraire à l’usage, incompatible avec le goût populaire, obscur, creux, sec, tel par ailleurs qu’il est
absolument impossible de l’employer devant le peuple (exile, inusitatum, abhorrens ab auribus uulgi, obscurum, inane,
ieiunum, ac tamen eius modi, quo uti ad uulgus nullo modo possit)37
».
Les deux seules qualités concédées aux Stoïciens au début du passage, la finesse et l’acuité pénétrante (fortasse subtile et certe acutum), semblent dégénérer en maigreur excessive et en obscurité dès lors qu’elles sont transposées chez l’orateur. Plus exactement, les défauts relevés par Crassus, quoique tous intimement liés, se répartissent en quatre classes principales : la maigreur (exile, ieiunum, inane), le caractère insolite (inusitatum), l’inadéquation aux exigences d’une éloquence populaire (inusitatum, abhorrens ab auribus uulgi, eius modi quo uti ad uulgus nullo modo possit) et l’obscurité (obscurum).
La maigreur tout d’abord : l’étude du style exilis en contexte stoïcien met en lumière non seulement ses affinités avec la dialectique, mais aussi son manque d’ornements et sa restriction au seul
34
Citons à cet égard le cas exemplaire de Démosthène, dont Cicéron soutient à maintes reprises qu’il avait suivi des leçons auprès de Platon, auquel il devait peut-être son immense vigueur oratoire (summa[m] uim : Cic., De Or., I, 89) ainsi que le choix et la noblesse de ses expressions (ex genere et granditate uerborum : Cic., Br., 121) : nous renvoyons sur ce point à la section I.5. (« Démosthène imitateur de Platon ») du récent ouvrage de L. Pernot intitulé L’Ombre du Tigre. Recherches sur la réception de Démosthène, Naples, M. D’Auria, 2006. Voir encore Cic., Or., 15 ; Off., I, 4. Un tel jugement s’appuie sur les lettres (voire sur une seule lettre : cf. Br., 121) de Démosthène, qui sont toutefois considérées aujourd’hui comme apocryphes. 35
Cic., Or., 62. 36
Cic., Br., 121. 37
Cic., De Or., III, 66 : Accedit quod orationis etiam genus habent fortasse subtile et certe acutum, sed, ut in oratore, exile, inusitatum, abhorrens ab auribus uulgi, obscurum, inane, ieiunum, ac tamen eius modi, quo uti ad uulgus nullo modo possit (traduction personnelle).
8
genus tenue, propre aux raisonnements syllogistiques, ce qui contrevient à l’idée de variété oratoire38
. Quant au terme ieiunum, qui signifie à l’origine « à jeûn », il connaît deux acceptions principales : fréquemment associé au mode d’expression dialectique et plus particulièrement stoïcien pour en dénoncer la sécheresse
39, le manque d’abondance (l’adjectif auquel il s’oppose le plus fréquemment est
plenus)40
, il peut quitter son acception strictement stylistique pour se référer à la vacuité conceptuelle d’un discours, d’une parole en général
41. Il se rapproche en ce sens de l’adjectif inanis, « vide, vain », qui
désigne un style creux, détaché de tout contenu, une rhétorique tournant à vide42
, et s’applique au livre IV du De Finibus à la terminologie stoïcienne précisément, accusée d’envelopper de néologismes ou de mots pompeux des thèses déjà avancées par d’autres philosophes, et de n’être nullement adéquate à la réalité. Ainsi Cicéron tâche-t-il de miner de l’intérieur la cohérence doctrinale du Portique en mettant en exergue la figure de Panétius qui lui semble trancher sur l’ensemble des Stoïciens. Le scolarque recommandait en effet dans une lettre à Tubero la fermeté dans la douleur, sans jamais soutenir « nulle part » (nusquam) que la douleur n’était pas un mal. Pour autant, il ne défendit jamais non plus la thèse inverse, n’en déplaise à l’orateur qui adresse à Caton cette conclusion triomphale :
« puisqu’il fut Stoïcien, sa prise de position me semble avoir condamné l’inanité de vos jeux de mots (condemnata mihi
uidetur esse inanitas ista uerborum)43
».
Le parallèle entre notre texte du De Oratore et cet extrait du De Finibus contribue à mettre en
lumière les résonances philosophiques que comporte l’analyse de Crassus : de la maigreur formelle fustigée par l’adjectif ieunum, on glisse vers l’inanité conceptuelle (inane) ; de la bizarrerie terminologique (inusitatum), vers une incompatibilité plus générale du stoïcisme avec l’usage (usus) et les notions communes ; de l’inadaptation à l’auditoire (abhorrens ab auribus uulgi ; ac tamen eius modi, quo uti ad uulgus nullo modo possit), vers une inadéquation radicale de l’éloquence du Portique à toutes les tâches qui s’offrent à elle ; de l’obscurité d’un style concis et truffé de néologismes techniques (obscurum), vers son inaptitude à pénétrer le monde ou à communiquer les arguments et les émotions, du fait qu’il se perd constamment dans des contradictions qu’en grande partie il génère. Tout en constatant l’inutilité (voire le pouvoir nuisible) du mode d’expression philosophique du Portique pour l’orateur, Crassus nous semble condamner discrètement son absence d’efficacité pour les philosophes eux-mêmes.
Le portrait qu’il brosse du style stoïcien au livre III du De Oratore fait par ailleurs pendant à la description qu’en offre Antoine au livre II à propos du scolarque Diogène de Babylonie
44, et ce diptyque
38 Nous nous permettons de renvoyer sur ce point à notre thèse de doctorat, intitulée « Per dumeta. Recherches sur la
rhétorique des Stoïciens à Rome, de ses origines grecques jusqu’à la fin de la République », effectuée sous la direction de M. le Professeur Carlos Lévy, Université Paris IV-Sorbonne, novembre 2006, p. 741-745. Sur l’application de l’adjectif exilis au style stoïcien, voir Cic., De Or., I, 50 ; I, 83 ; II, 159 ; III, 66 ; Br., 114 ; Fin., IV, 12. 39
Sur l’application de l’adjectif ieiunus au style stoïcien, voir Cic., De Or., I, 50 ; Br., 114 ; Luc., 112 ; Fin., III, 19. Plus généralement, sur le lien entre l’adjectif ieiunus et le style des dialecticiens, voir De Or., II, 10 ; ibid., II, 68 ; Or., 118. 40
Cic., De Or., III, 16 ; ibid., III, 51. Cf. Or., 123 ; Opt. Gen., 9. 41
Cic., Pro Caec., 61 ; De Or., III, 106 ; Fin., V, 13 ; Fam., II, 17, 7. Voir encore Off., I, 157 ; Fam., XIV, 4, 14. 42
Cic., De Or., I, 17 ; I, 20 ; I, 37 ; I, 51 ; III, 141 ; Or., 170 ; PO, 81 ; ND, II, 1 ; Tusc., I, 21. 43
Cic., Fin., IV, 23 (= F 113 van Straaten = T 83 Alesse) : cuius quidem, quoniam Stoicus fuit, sententia condemnata mihi uidetur esse inanitas ista uerborum (traduction personnelle). 44
Cic., De Or., II, 159-160.
9
confirme non seulement l’homogénéité d’un tel mode d’expression dans la représentation cicéronienne - de nombreux traits étant communs aux deux passages - mais aussi sa réduction à la dialectique. En effet, le personnage sur lequel se penche Antoine est expressément présenté comme un dialecticien
45, alors
qu’il fut sans doute l’un des penseurs les plus novateurs de son école en matière de rhétorique et qu’on lui doit certainement la refonte théorique et terminologique des cinq vertus stoïciennes du discours
46.
Antoine l’ignorait-il ? Ou avait-il conscience, en attaquant ce philosophe sous l’angle oratoire, de toucher au cœur, en quelque sorte, la rhétorique du Portique ?
Un mot tout d’abord sur le contexte de son analyse. Au cours du livre II du De Oratore où il est chargé de développer les principes de l’inuentio, section de la rhétorique dans laquelle il excelle, Antoine rappelle que l’orateur dispose de trois ressorts persuasifs, prouver, plaire et émouvoir
47. S’attachant au
premier d’entre eux, le probare48
, il évoque l’art de la topique, qui consiste à trouver les « lieux » (loci, ou tovpoi) d’où seront tirés les arguments. Q. Catulus intervient alors pour rappeler le rôle fondamental d’Aristote dans ce domaine
49, ce qui donne lieu à un échange entre les deux interlocuteurs sur les
emprunts qu’un orateur romain est autorisé à faire à la philosophie grecque, en vertu d’un double affrontement entre Rome et la Grèce, l’éloquence et la philosophie - affrontement qui trouva une première issue dans l’ambassade de Diogène de Babylonie, Critolaos et Carnéade auprès du sénat romain en 155. C’est dans ce contexte et sur fond d’enquête sur la topique qu’intervient aux paragraphes 157-160 une longue analyse du mode d’expression du scolarque stoïcien, tandis qu’au Péripatéticien Critolaos et à l’Académicien Carnéade ne seront consacrées, juste après, que de brèves notices
50. Nous nous
attacherons plus loin aux nombreuses remarques d’ordre philosophique d’Antoine qui encadrent notre passage et portent sur le caractère autodestructeur de la dialectique stoïcienne. Notons pour l’heure que Diogène voit son style philosophique mis à l’épreuve en des termes oratoires et codifiés, manifestant une dégénérescence du genus tenue :
« De surcroît, il apporte un mode de conversation (genus sermonis) qui n’est ni limpide, ni ample et rapide, mais
décharné, aride, haché en menues phrases (non liquidum, non fusum ac profluens, sed exile, aridum, concisum ac minutum). Si
on l’approuve, on l’approuvera tout en admettant qu’il ne convient pas à l’orateur. Notre discours à nous, en effet,
45
Ibid., II, 157 (= LS 31 G). 46
DL, VII, 59 (= SVF, III Diog. 24) : « Les vertus du discours sont au nombre de cinq : la grécité, la clarté, la concision, la convenance, l’apprêt. La grécité est donc le mode d’expression qui consiste à s’exprimer sans faute, en respectant l’usage technique et non livré au hasard. La clarté est l’expression qui consiste à présenter la pensée de façon intelligible. La concision est l’expression qui consiste à n’employer que les mots nécessaires pour rendre manifeste l’objet du discours. La convenance est l’expression qui consiste à approprier son propos au sujet. L’apprêt est l’expression qui consiste à éviter la trivialité » ( jAretai; de; lovgou eijsi; pevnte: eJllhnismo;", safhvneia, suntomiva, prevpon, kataskeuhv. JEllhnismo;" me;n ou\n ejsti fravsi" ajdiavptwto" ejn th/` tecnikh`/ kai; mh; eijkaiva/ sunhqeiva/. Safhvneia dev ejsti levxi" gnwrivmw" parista`sa to; noouvmenon. Suntomiva dev ejsti levxi" aujta; ta; ajnagkai`a perievcousa pro;" dhvlwsin tou` pravgmato". Prevpon dev ejsti levxi" oijkeiva tw/` pravgmati. Kataskeuh; dev ejstin levxi" ejkpefeugui`a to;n ijdiwtismovn. Traduction personnelle). 47
Cic., De Or., II, 115. 48
Ibid., II, 116-177. 49
Ibid., II, 152. Malgré son admiration pour Aristote, Catulus est présenté dans le Lucullus comme Néoacadémicien (§ 18 et 148) ; sur sa situation exacte par rapport à la philosophie, voir J. Mansfeld, « Philo and Antiochus in the lost Catulus », Mnemosyne, 50, 1997, p. 45-74 (p. 58), ainsi que la réponse de C. Lévy, « Philon et Antiochus dans le Catulus, à propos d’un article récent », ArchPhilos, 62, 1999, p. 117-126 (p. 121-122). 50
Cic., De Or., II, 160-161.
10
doit être adapté aux oreilles de la foule, afin de charmer les esprits, de les entraîner, de faire admettre des idées qui se
pèsent non au trébuchet de l’orfèvre, mais en quelque sorte dans la balance du jugement populaire51
».
Contrairement aux commentaires de Crassus qui portaient sur l’orationis genus de l’ensemble des Stoïciens et avaient trait tant à la forme qu’au fond, la description d’Antoine s’attache au genus sermonis de Diogène : cette simple variation nous indique que nous nous trouvons sur un terrain plus décidément stylistique que dans le texte issu de l’excursus philosophique de Crassus. Le sermo en effet désigne fréquemment le mode d’expression du philosophe par opposition à l’éloquence de l’orateur, lorsque ce mot n’entre pas avec contentio dans un jeu d’antonymie, ce qui n’est manifestement pas le cas ici. Aussi l’indication liminaire fournie par Antoine annonce-t-elle que le style du Stoïcien ne saurait prétendre à la dignité du langage oratoire (oratio) : « si on l’approuve, on l’approuvera tout en admettant qu’il ne convient pas à l’orateur ». Non seulement il échoue à charmer (ad oblectandos animos, variation sur le mode du delectare) ou à entraîner les esprits (impellendos, ce verbe recoupant le domaine du mouere), mais il ne parvient pas même à remplir la principale tâche dévolue au style philosophique (le probare) en faisant approuver (ad probanda) les idées qu’il expose, décidément trop subtiles et inadéquates au goût populaire. Nous retrouvons là un thème présent dans l’analyse de Crassus, aux côtés de la maigreur, de la sécheresse et de l’obscurité de l’expression. Cela étant, Antoine porte plus que son ami l’accent sur le style paratactique et la scansion syllogistique qu’impriment la dialectique et la récurrence de « petites interrogations » au flux de la période oratoire (non fusum ac profluens)
52, la réduisant en miettes (concisum ac
minutum) et négligeant son abondance et ses clausules53
. La riche description du style de Diogène s’ouvre sur un adjectif problématique, liquidus, qui au
sens premier désigne la limpidité du ciel, et en un sens figuré, intellectuel ou littéraire, est fréquemment associé à purus (« pur »)
54. Un rapprochement avec un extrait du Brutus concernant Calidius, orateur
proche des Atticistes, souligne l’ambiguïté de ce terme, partagé entre les registres de la transparence et de la fluidité
55. Dans le cas de Diogène de Babylonie en revanche, l’allusion à l’absence de clarté n’est
qu’implicite, et la dimension qui ressort le plus fortement, en raison du voisinage des termes fusum ac profluens, est celle de la fluidité de la période, ou plutôt ici de ses cahots. Juste ensuite, l’occurrence du terme aridum qui fustige la sécheresse de l’expression dialectique nous semble appelée par une association d’idées, un jeu sur le réseau lexical de l’eau, du flux (liquidum, fusum ac profluens), et de son contraire. Cette interprétation nous semble confortée par la rareté du terme aridum, qui traduit sans doute le grec xhrovn et constitue un hapax chez Cicéron, tout en étant fort proche de l’adjectif exile auquel il est ici couplé :
51
Ibid., II, 159-160 : (…) genus sermonis adfert non liquidum, non fusum ac profluens, sed exile, aridum, concisum ac minutum, quod si quis probabit, ita probabit, ut oratori tamen aptum non esse fateatur. Haec enim nostra oratio multitudinis est auribus accomodanda, ad oblectandos animos, ad impellendos, ad ea probanda, quae non aurificis statera, sed populari quadam trutina examinantur. Sur un jugement fort similaire, voir Cic., Br., 119 (à propos des Stoïciens) : « tous leurs soins sont absorbés par la dialectique, tandis que ce beau style sans contrainte, ample, ondoyant, ne trouve pas chez eux d’application » (istorum in dialecticis omnis cura consumitur, uagum illud orationis et fusum et multiplex non adhibetur genus : traductions personnelles). 52
Notons que la terminologie critique employée ici par Antoine constitue le reflet inversé de celle qu’il utilise pour décrire le style de l’historien : cf. Cic., De Or., II, 64. Dans l’Orator toutefois, § 66, Cicéron précise que ce style n’est nullement approprié, lui non plus, au forum - pour d’autres raisons néanmoins que dans le cas du mode d’expression stoïcien. 53
L’association de l’adjectif concisus à la dialectique figure par exemple dans le Lucullus où le personnage éponyme, porte-parole d’Antiochus, expose les talents dialectiques des Académiciens (§ 42). À son tour, Quintilien insiste sur le lien entre la dialectique et un type d’expression laminé, pour ainsi dire : cf. IO, II, 20, 7. Ibid., XII, 2, 11. 54
Cf. Cic., Pro Caec., 78. 55
Cic., Br., 274.
11
tous deux manifestent la dégénérescence du style simple (ijscnovn)56
. Notons pour finir que les présentations multiples et concordantes qu’offre Cicéron du mode d’expression stoïcien recèlent un paradoxe si l’on songe que les membres du Portique visaient à un style neutre, qui fût un simple véhicule de la pensée et auquel l’auditeur ne devait pas s’arrêter, alors que leur étrange langage, heurté et concis, attire l’attention sur lui au risque de faire passer le contenu au second plan.
Dans le cas de Crassus comme d’Antoine, on relève malgré tout une discrète concession à l’égard du style stoïcien : le premier lui reconnaît une finesse et une subtilité pénétrante (fortasse subtile et certe acutum)
57 et semble ne contester que son transfert au forum, non sa légitimité de mode d’expression
philosophique en tant que tel ; le second conçoit que l’on puisse l’approuver en lui-même, mais non qu’on le juge approprié à l’orateur
58. Ne peut-on faire un pas de plus en se demandant si ce style ne se
révèlerait pas adéquat, après tout, à certaines sections précises des plaidoyers telles que les narrations ou les prologues, dont ces philosophes admettaient la légitimité
59 ? Cicéron lui-même est d’avis que les
périodes ne soient pas trop nombreuses dans les discours judiciaires et politiques, si l’on excepte le cas des péroraisons. Les phrases courtes, « incises » (kovmmata, incisa) et « membres » (kw`la, membra), doivent donc prédominer, tout en obéissant elles aussi aux lois du rythme
60. Certains orateurs renommés,
tel Crassus, préconisaient leur emploi : « Et il ne faut pas employer toujours ces longues suites de mots formant ce que j’appelle une période. Souvent il faut
couper la phrase en membres plus courts, mais eux aussi doivent être assujettis au nombre61
».
Définies comme de « petits coups de poignard » (pugiunculis) qui évoquent le réseau lexical de la
pointe si souvent appliqué à l’éloquence du Portique, les incises sont notamment recommandées dans la réfutation
62 - tâche dans laquelle excellaient les Stoïciens - et contribuent même au mouere
63. Ces
philosophes ont néanmoins poussé à l’extrême le rythme bref, haletant, inhérent au style simple. Si celui-ci exige des périodes formées de membres courts, le style sec va trop loin en accumulant des membres très concis dénués de toute structuration périodique
64, faisant ainsi écho à la prose archaïque « cousue »
56
Cf. Ad Her., IV, 16 ; Fortun., III, 9 ; Démétrios, PH, § 236-239 sur le danger d’un style aride, xhrov". Le mot ieiunitas, « sécheresse », désigne lui aussi la dégénérescence du style simple : cf. Cic., Br., 202 ; ibid., 285. De façon polémique, dans un contexte hostile aux Atticistes, Cicéron qualifie le style simple de ieiunitas (cf. Or., 20 ; Tusc., II, 3). 57
Cic., De Or., III, 66. 58
Ibid., II, 159. 59
DL, VII, 43 (= SVF, II, 295 = LS 31 A) : « Quant au discours rhétorique (to;n de; rJhtoriko;n lovgon), <il se divise> en prologue (prooivmion), narration (dihvghsin), réplique aux adversaires (ta; pro;" tou;" ajntidivkou") et épilogue (ejpivlogon) » (traduction de R. Goulet, retouchée). 60
Cic., Or., 211 et 221. 61
Cic., De Or., III, 190 : Neque semper utendum est perpetuitate et quasi conuersione uerborum, sed saepe carpenda membris minutioribus oratio est, quae tamen ipsa membra sunt numeris uincienda (traduction d’E. Courbaud et H. Bornecque) ; ibid., III, 186 ; Br., 186. 62
Cic., Or., 224-225. 63
Quint., IO, IX, 4, 126. 64
On note ici une coïncidence entre les Stoïciens et les premiers sophistes, dont le qualificatif platonicien de logodaidavlou" repris dans l’Orator (§ 39) n’est pas sans évoquer l’expression architecti paene uerborum appliquée, on l’a vu, aux orateurs du Portique. Or tous se voient reprocher par Cicéron leur style coupé en petits morceaux : celui des sophistes est en effet jugé trop fragmenté, « haché » (concisus), « trop brisé et, pour ainsi dire, insuffisamment arrondi » (praefractior nec satis, ut ita dicam, rotundus), « avec des rythmes morcelés » (minutis numeris) : ibid., 40 (traduction d’A. Yon).
12
(levxi" eijromevnh) qu’Aristote opposait déjà à la prose « tressée » (levxi" katestrammevnh)65
. Du coup la pugnacité oratoire qui aurait pu être envisagée comme une vertu du discours stoïcien se mue en une salve de « petites questions minuscules » (minutae interrogatiunculae)
66 semblables à autant de coups
d’épingle désordonnés, d’autant plus agressifs qu’ils ne s’inscrivent pas dans une structure oratoire harmonieuse et que la stimulation intellectuelle qu’ils sont censés provoquer est annulée par l’irritation de l’auditeur face à une prose aussi hachée et hérissée.
Aussi riche qu’homogène, le réseau lexical de la pointe mis en place par Cicéron décrit à la fois l’allure syllogistique du mode d’expression des Stoïciens et l’intellectualisme de leurs procédés rhétoriques, la densité et l’agressivité de leur style pénétrant, la subtilité intellectuelle de ces philosophes et leur rouerie au parfum sophistique
67. Il traduit en un mot l’imprégnation de ce langage par la
dialectique. À partir de Chrysippe notamment68, celle-ci acquit une importance prépondérante au sein du
Portique : non seulement cette école naquit au moment où l’Académie devint sceptique et se spécialisa dans l’affrontement contre elle, mais elle s’édifia pour l’essentiel en s’adossant au système péripatéticien afin de mieux s’en différencier. La nécessité d’une discipline capable non seulement de protéger les dogmes fondateurs du système contre tous les polémistes, mais aussi de pourfendre les adversaires philosophiques qui récusaient l’originalité (donc la légitimité) des thèses du Portique, s’imposa rapidement, tout en entraînant d’importantes retombées dans le domaine de la rhétorique. Carences en matière d’inuentio, enfermement dans un style obscur, inaptitude à persuader l’auditoire, méconnaissance de l’esthétique du langage : autant de traits que Cicéron mit en exergue en dépassant le simple stade de l’analyse stylistique pour ébranler jusque dans ses fondements la conception stoïcienne du langage.
Ainsi, lorsque nous avons examiné l’analyse du mode d’expression de Diogène de Babylonie par Antoine au livre II du De Oratore, nous avions précisé qu’elle était encadrée par des commentaires évoquant le caractère autodestructeur de la dialectique du Portique,
qui en formaient l’arrière-plan
philosophique. Or ceux-ci s’articulent selon une gradation insensible entre le point de vue logique - la découverte du vrai (quo modo uerum inueniatur) - et le point de vue proprement rhétorique - la découverte de ce que doit dire l’orateur (quem ad modum inueniam quid dicam), en d’autres termes l’inuentio :
« Mais pour en revenir au point à partir duquel notre discours a dévié, vois-tu que parmi ces trois illustres
philosophes qui, as-tu rappelé, sont venus à Rome, Diogène disait enseigner l’art de bien raisonner et de discerner
(diiudicandi) le vrai du faux, ce qu’il appelait d’un nom grec, la dialectique ? Cet art, si du moins c’en est un, ne
renferme aucun précepte pour découvrir (inueniatur) le vrai, mais seulement des règles pour le juger (iudicetur). (…)
65
Cf. Ar., Rhét., III, 1409 a 24-1409 b 18. 66
Sur le diminutif interrogatiuncula, voir Cic., Par. St., pr. 2 ; Fin., IV, 7 ; Sén., Ep., 82, 23. Les interrogations dialectiques sont comparées à des points (puncta) à cause de leur brièveté, mais aussi parce qu’elles ébranlent vivement l’adversaire. En outre, il n’est pas impossible que Cicéron opère avec le terme interrogatiuncula la traduction en latin du diminutif zetematium que l’un de ses auteurs favoris, Lucilius (Sat., XXVI, 7 Charpin = 650 Marx), s’était contenté de translittérer à partir du grec zhthmavtion pour stigmatiser « un petit débat », peut-être inspiré des controverses stériles d’Euripide à teneur psychologique ou morale (ibid., H 20 Charpin = 1169 Marx). Ce diminutif grec figure d’ailleurs chez le Stoïcien Épictète et désigne une question peu importante (Entr., II, 16, 20). 67
Nous renvoyons sur ce point à G. Moretti, Acutum dicendi genus. Brevità, oscurità, sottigliezze e paradossi nelle tradizioni retoriche degli Stoici, Bologne, 1995. 68
Rappelons que le catalogue des écrits de ce scolarque contient cent dix-neuf titres relevant de la rubrique « logique », soir en tout trois cent onze livres, sur un ensemble constitué de plus de sept cent cinq traités : cf. DL, VII, 198 (= SVF, II, 16) et VII, 180 (= SVF, II, 1). Cicéron nous confirme par ailleurs que Chrysippe avait bien plus œuvré dans ce domaine que ses prédécesseurs (Fin., IV, 9 = SVF, I, 47 = LS 31 I).
13
Au bout du compte, [les dialecticiens] se percent avec les pointes de leur propre finesse ; à force de chercher, ils
imaginent (reperiunt) des difficultés que non seulement eux-mêmes ne peuvent plus résoudre, mais qui sont telles que
la trame déjà ourdie, ou mieux presque achevée, est à nouveau complètement défaite. Ton Stoïcien ne nous est donc
d’aucune utilité, puisqu’il ne m’apprend pas à découvrir (inueniam) ce que je dois dire. Bien plus, il nous met des
entraves, en imaginant (reperit) une foule de questions, qu’il déclare ensuite insolubles. (…) Aussi, congédions cet art
tout entier, trop muet lorsqu’il s’agit de trouver (excogitandis) des arguments, trop bavard lorsqu’il est question de les
juger (iudicandis)69
».
L’un des aspects les plus frappants de ce texte est la récurrence du verbe « découvrir », inuenire (repris sous la variante excogitare dans la dernière phrase), qui traduit une thèse défendue avec insistance par Cicéron : celle de l’affrontement entre topique et dialectique, entre la découverte des arguments et leur analyse critique, celle-ci primant chronologiquement et ontologiquement sur celle-là
70. À l’absence
d’inuentio rhétorique répond une inuentio originale et pervertie, désignée par le biais du verbe reperire (« trouver », « imaginer ») pour qu’elle soit bien distincte de la précédente, et qui s’attache à dénicher des difficultés insolubles empêchant de bâtir le moindre raisonnement. Non seulement la dialectique stoïcienne ne peut en aucun cas aider l’orateur à construire son discours en lui fournissant sa matière argumentative, mais dans sa recherche de la vérité des propositions, elle détruit constamment la trame de son propos et connaît donc également un échec sur le plan philosophique.
Pour la clarté de l’exposé, il convient de distinguer l’invention et la topique, que nous venons de mentionner à quelques lignes d’intervalle. La topique est la théorie des « lieux » de l’argumentation (tovpoi, ou « lieux communs », koinoi; tovpoi), qui forment des listes de rubriques prédéfinies vers lesquelles l’orateur se tourne lorsqu’il veut aborder un sujet donné, et qui lui suggèrent des arguments - à charge pour lui d’adapter ces suggestions théoriques à la cause particulière qu’il défend
71. L’invention
(inuentio ou eu{resi") constitue quant à elle l’une des « rubriques » (tovpoi) de la rhétorique, pour
69
Cic., De Or., II, 157-160 (cité en partie en LS 31 G) : Sed, ut eo reuocetur unde huc declinauit oratio, ex tribus istis clarissimis philosophis, quos Romam uenisse dixisti, uidesne Diogenem eum fuisse, qui diceret artem se tradere bene disserendi et uera ac falsa diiudicandi, quam uerbo Graeco dialektikh;n appellaret ? In hac arte, si modo est haec ars, nullum est praeceptum quo modo uerum inueniatur, sed tantum est, quo modo iudicetur ; (…) et ad extremum ipsi se compungunt suis acuminibus et multa quaerendo reperiunt non modo ea, quae iam non possint ipsi dissoluere, sed etiam quibus ante exorsa et potius detexta prope retexantur. Hic nos igitur Stoicus iste nihil adiuuat, quoniam quem ad modum inueniam quid dicam non docet. Atque idem etiam impedit, quod et multa reperit, quae negat ullo modo posse dissolui. (…) Qua re istam artem totam dimittimus, quae in excogitandis argumentis muta nimium est, in iudicandis nimium loquax (traduction d’E. Courbaud, modifiée). 70
Cic., Top., 6 (absent des SVF = LS 31 F) : « Toute méthode approfondie de raisonnement (ratio diligens disserendi) comportant deux parties, l’une qui consiste à trouver (inueniendi) <les arguments> et l’autre à les juger (iudicandi), le pionnier dans l’une et dans l’autre, à mon avis du moins, fut Aristote. Les Stoïciens n’ont travaillé qu’à la seconde. Ils ont exploré à fond les méthodes de jugement, grâce à cette science qu’ils appellent la ‘dialectique’ ; quant à l’art de trouver (inueniendi artem), que l’on appelle ‘topique’ (topikh;) et qui était plus important pour la pratique et certainement le premier dans l’ordre naturel, ils l’ont totalement laissé de côté » (Cum omnis ratio diligens disserendi duas habeat partis, unam inueniendi alteram iudicandi, utriusque princeps, ut mihi quidem uidetur, Aristoteles fuit. Stoici autem in altera elaborauerunt ; iudicandi enim uias diligenter persecuti sunt ea scientia quam dialektikh;n appellant, inueniendi artem quae topikh; dicitur, quae et ad usum potior erat et ordine naturae certe prior, totam reliquerunt : traduction LS, retouchée). 71
On se reportera sur ce point à B. Riposati, Studi sui « Topica » di Cicerone, Milan, 1947, ainsi qu’aux articles plus récents de P.M. Huby, « Cicero’s Topics and its Peripatetic Sources », in W.W. Fortenbaugh - P. Steinmetz (éds.), Cicero’s knowledge of the Peripatos, Rutgers University Studies in Classical Humanities 4, New Brunswick-Londres, 1989, p. 61-76 ; J.M. van Ophuijsen, « Where have the Topics gone », in W.W. Fortenbaugh - D.C. Mirhady (éds.), Peripatetic Rhetoric after Aristotle, Rutgers University Studies in Classical Humanities 6, New Brunswick-Oxford, 1994, p. 131-174 ; R.N. Gaines, « Cicero’s Partitiones Oratoriae and Topica : Rhetorical Philosophy and Philosophical Rhetoric », in J.M. May (éd.), Brill’s Companion to Cicero. Oratory and Rhetoric, Leyde-Boston-Cologne, Brill, 2002, p. 445-480.
14
reprendre la terminologie stoïcienne rapportée par Diogène Laërce72 : ne se réduisant pas à la topique,
elle consiste en un ensemble de techniques ayant pour vocation de rechercher les différents thèmes à développer au fil d’un discours. Il s’agit là bien entendu d’une tâche essentielle, dont les Stoïciens admettaient tout à fait la légitimité et qu’ils abordaient fort classiquement en premier, avant le travail stylistique (fravsi") et la disposition des arguments (tavxi")
73. Pour autant, Cicéron s’appuie sur la
division des causes établie par le rhéteur Hermagoras de Temnos (IIe avant J.-C.) entre causes générales (causae, qevsei") et causes particulières (quaestiones, uJpoqevsei")
74 - les premières envisageant une question
dans l’abstrait indépendamment de toute considération de personne, de temps ou de lieu, les secondes traitant une situation concrète concernant des personnes déterminées et des faits localisés dans l’espace et le temps - pour récuser tout travail des Stoïciens dans le domaine de l’inuentio :
« C’est que [les anciens Péripatéticiens et Académiciens] avaient, en accord avec la réalité même, deux sortes
d’exercices oratoires. Tous les sujets qu’on peut avoir à traiter présentant, en effet, soit une question générale,
indépendante des particularités de personnes ou de temps, soit, avec ces particularités, une question de fait, de droit,
ou de qualification <à l’égard du fait>, toutes deux faisaient l’objet de leurs exercices et c’est à cette discipline qu’ils
durent la richesse de leur langue dans l’un et l’autre genre. Ce genre tout entier, Zénon et ses disciples, qu’ils ne
fussent pas capables ou désireux <de le préserver>, l’ont en tout cas délaissé. Cléanthe a pourtant écrit un traité de
rhétorique, de même que Chrysippe, mais ils sont tels que si l’on désire rester muet, il ne faut rien lire d’autre75
».
Il convient toutefois de replacer dans son contexte une telle critique, afin d’en mieux percevoir la
portée. Cicéron vilipende, au livre IV du De Finibus, le style étriqué et raboteux des Stoïciens, exaltant par contraste l’abondance oratoire (dicendi copiam) des anciens Péripatéticiens et Académiciens, que favorisent leurs exercices rhétoriques. Sa remarque porte donc essentiellement sur le refus d’un entraînement technique à l’art de la parole de la part des membres de l’Ancien Portique : seuls Zénon, Cléanthe et Chrysippe sont en effet mentionnés, ce qui ne signifie pas que les Stoïciens romains évoqués par Cicéron dans d’autres traités aient tous fait preuve de la même rigueur. Caton par exemple, octroyant une certaine autonomie de fait à l’art oratoire en s’exerçant à la déclamation, avait selon Cicéron puisé auprès de professeurs de rhétorique l’art de tourner des périodes liées et arrondies (apte ac rotunde)
76.
72
DL, VII, 43 (= SVF, II, 295 = LS 31 A) : les rubriques issues d’une diaivresi", comme dans le cas des quatre sections de la rhétorique stoïcienne, sont en effet appelées des « lieux ». Signalons en outre qu’une bonne partie des matériaux du propre traité de Cicéron Sur l’Invention repose sur le type d’arguments et de sophismes que Chrysippe se plaisait à analyser : ainsi l’auteur, en I, 86, propose-t-il le syllogisme conditionnel stoïcien « S’il y a de la lumière, il fait jour » comme un exemple de l’enthymème aristotélicien, tendant ainsi à inscrire l’enseignement dialectique du Portique dans le cadre de la rhétorique aristotélicienne. 73
DL, VII, 43 (= SVF, II, 295 = LS 31 A) : « Il existe aussi une division de la rhétorique en invention, élocution, disposition et action » (ei\nai d’ aujth`" th;n diaivresin ei[" te th;n eu{resin kai; eij" th;n fravsin kai; eij" th;n tavxin kai; eij" th;n uJpovkrisin : traduction de R. Goulet). 74
Cic., Inu., I, 8. 75
Cic., Fin., IV, 6-7 (cité en partie en SVF, I, 76 ainsi qu’en I, 492 et II, 288) : Erat enim apud eos, ut est rerum ipsarum natura, sic dicendi exercitatio duplex. Nam, quicquid quaeritur, id habet aut generis ipsius sine personis temporibusque aut iis adiunctis facti aut iuris aut nominis controuersiam. Ergo in utroque exercebantur, eaque disciplina effecit tantam illorum utroque in genere dicendi copiam. Totum genus hoc Zeno, et qui ab eo sunt, aut non potuerunt <tueri> aut noluerunt, certe reliquerunt. Quamquam scripsit artem rhetoricam Cleanthes, Chrysippus etiam, sed sic, ut, si quis obmutescere concupierit, nihil aliud legere debeat (traduction personnelle). C’est à la suite de H. von Arnim dans les SVF ainsi que de K.H. Hülser dans les FDS que nous avons inséré le verbe tueri, qui ne figure ni dans le texte des Belles Lettres ni dans les manuscrits. 76
Ibid., IV, 7 ; cf. Plut., Cat. Min., 4, 3-4.
15
Faut-il pour autant bannir entièrement la question de l’inuentio d’un tel témoignage ? Cela ne nous semble pas opportun, en raison d’une certaine ambiguïté du propos de Cicéron. Tout d’abord, la bipartition des causes qu’il mentionne ici relève bel et bien de cette première section de la rhétorique ; ensuite, l’allusion polémique et railleuse au mutisme (obmutescere) que suscite la lecture des traités oratoires stoïciens peut s’entendre soit comme une boutade à l’encontre du langage insolite, rachitique et truffé de néologismes auquel recourent ces philosophes, comme le suggère la suite immédiate du texte
77, soit
comme un écho de la conclusion lapidaire d’Antoine à l’encontre de la dialectique pratiquée par Diogène de Babylonie - une dialectique « trop muette lorsqu’il s’agit de trouver des arguments (in excogitandis argumentis muta nimium)
78 ». Dans le premier cas, il s’agirait d’une remarque purement stylistique, dans le
second, d’une allusion aux carences, en matière de topique (ou plus largement d’inuentio), de la dialectique dont est imprégnée la rhétorique stoïcienne. Il ne nous semble pas nécessaire de trancher entre ces deux interprétations, dans la mesure où Cicéron cherche délibérément, selon nous, à favoriser un certain amalgame entre le caractère décharné du langage des Stoïciens, leur absence de tout entraînement oratoire ressortissant à l’inuentio, et leur abandon du domaine de la topique au profit du seul exercice d’une dialectique hypertrophiée.
Pour polémique qu’elle soit, la critique cicéronienne n’en souligne pas moins une réelle difficulté de la théorie du Portique à propos de la fonction assignée à la dialectique. Il est vrai que Cicéron accentue à plaisir sa dimension « critique » au sens étymologique, sa vocation au « jugement » ((di)iudicare, (dia)krivnw)
79 - du moins dans la pratique qu’en offraient les Stoïciens, qui auraient donc négligé la
recherche de « lieux » où puiser pour développer un raisonnement. L’orateur paraît toutefois travailler sur la base d’une distinction non stoïcienne entre la dialectique et la topique, qu’il expose avec vigueur au livre IV du De Finibus, quelques paragraphes après avoir constaté l’abandon par les fondateurs du Portique du travail sur les questions « générales » ou « particulières » :
« Étant donné, en outre, que la plénitude parfaite de la pensée et du langage résulte de deux arts, celui de découvrir
<les idées> (una inueniendi) et celui de les exposer logiquement (altera disserendi), le second, nous le devons autant aux
Stoïciens qu’aux Péripatéticiens ; mais le premier, nous le devons aux Péripatéticiens seuls, les Stoïciens n’y ayant pas
touché du tout. Car les lieux, qui sont comme les dépôts d’où l’on peut extraire des arguments, vos philosophes n’en
ont pas eu le moindre soupçon, tandis que leurs prédécesseurs nous en ont donné la connaissance savante et
méthodique, c’est-à-dire un art qui a pour effet de ne pas nous astreindre perpétuellement à rabâcher en quelque
sorte sous la dictée <d’un maître>, sans jamais nous écarter de nos cahiers. Si l’on sait, en effet, en quel lieu se
trouve chaque argument et quelle voie y mène, on sera capable, si enfoui soit-il, de le déterrer et d’être <ainsi>
toujours son maître dans la discussion80
».
77
Ibid., IV, 7 : « Aussi, tu vois de quelle façon ils s’expriment ! Ils forgent des mots nouveaux, délaissent les usuels » (Itaque uides, quo modo loquantur. Noua uerba fingunt, deserunt usitata : traduction personnelle). 78
Cic., De Or., II, 160. 79
Ibid., II, 159 ; Luc., 91. Une image similaire de la logique, qui permet de « discerner et d’examiner tout le reste, et, pourrait-on dire, de le mesurer et de le peser » (diakritika; kai; ejpiskeptika; kai; wJ" a[n ti" ei[poi metrhtika; kai; statikav), est attribuée à Zénon, Cléanthe, Chrysippe et Antisthène par Épictète, Entr., I, 17, 10-11 (= SVF, I, 48 = I, 483 = II, 51 : traduction de J. Souilhé). 80
Cic., Fin., IV, 10 : Cumque duae sint artes, quibus perfecte ratio et oratio compleatur, una inueniendi, altera disserendi, hanc posteriorem et Stoici et Peripatetici, priorem autem illi egregie tradiderunt, hi omnino ne attigerunt quidem. Nam e quibus locis quasi thesauris argumenta depromerentur, uestri ne suspicati quidem sunt, superiores autem artificio et uia tradiderunt. Quae quidem ars efficit, ne necesse sit isdem de rebus
16
Ce passage incrimine en réalité le dogmatisme de la philosophie du Portique, qui réduit les
disciples à l’asservissement alors que le travail de la topique leur permettrait de s’émanciper de la tutelle d’un maître. Appliquant comme souvent à leurs adversaires les critiques platoniciennes dirigées contre les sophistes, les Néoacadémiciens affirment qu’au sein de leurs écoles, les dogmatiques ne discutent pas librement mais parlent entre élèves sous le regard jaloux du fondateur, qui ne tolère pas l’hétérodoxie
81 :
en soulignant le rôle central que joue l’autorité dans la vie intellectuelle du Portique, Cicéron met donc radicalement en cause le dévouement de cette école à la vérité
82.
Faut-il pour autant prendre l’orateur au mot et décréter, ainsi que l’a fait D. Babut dans un article récent, que la dialectique stoïcienne était dotée d’une fonction non pas heuristique, comme au sein de l’Académie ou du Lycée, mais défensive et agonistique, visant tant à protéger les dogmes stoïciens contre les attaques académiciennes (et surtout carnéadiennes)
83 qu’à polémiquer contre les autres écoles
84 ? Il
s’agit là d’une question fondamentale car si tel est bien le cas, le stoïcisme s’apparente beaucoup plus à une religion, chargée de sauvegarder une vérité déjà établie, qu’à une pensée philosophique
85.
Le stoïcisme n’a pas toujours défini la dialectique de la même manière86
, mais ses variations sont secondaires si l’on tient compte du fait qu’il l’a rétablie dans la dignité dont elle avait été déchue par Aristote
87. On sait en effet que le Stagirite, par opposition à Platon, sépara la dialectique de la philosophie
et réduisit ce que son maître concevait comme la science de l’être à « une simple technique d’argumentation par questions et réponses, qui permet de parler de tout, mais ne donne aucun enseignement, parce qu’elle se contente d’argumenter à partir des opinions admises et des notions communes, sans se soucier de la vérité
88 ». Le stoïcisme, lui, fit de la dialectique la science du jugement
semper quasi dictata decantare neque a commentariolis suis discedere. Nam qui sciet ubi quidque positum sit quaque eo ueniat, is, etiamsi quid obrutum erit, poterit eruere semperque esse in disputando suus (traduction de J. Martha). 81
Socrate oppose en effet le philosophe, qui a le loisir pour examiner tous les discours autant de fois que cela est nécessaire et qui est donc le seul homme véritablement « libre », et les orateurs politiques, qui sont soumis à la contrainte du temps et aux opinions du peuple : cf. Platon, Théét., 172 e. De même, les Académiciens prétendaient n’imposer aucun « dogme » aux membres de leur école afin de ne pas entraver la recherche de la vérité, qui exige que l’on puisse remettre en question toutes nos opinions, y compris celles que l’on a acquises lorsque l’on a appris la philosophie : cf. Cic., Luc., 8 et 60 ; Lib. Ac., I, 13 et fgt 15 ; Tusc., V, 83 ; C. Lévy, Cicero Academicus, op. cit., p. 156. 82
Voir D.N. Sedley, « Philosophical Allegiance in the Greco-Roman World », in M.T. Griffin - J. Barnes (éds.), Philosophia togata I : Essays on Philosophy and Roman Society, Oxford, Clarendon Press, 1989, p. 97-119, et surtout, T. Bénatouïl, « Le débat entre stoïcisme et platonisme sur la vie contemplative », article à paraître dans les actes du colloque de Gargnano (2006) intitulé Stoicismo e platonismo. 83
SE, AM, VII, 23 (= SVF, II, 44) ; Cic., Fin., III, 72 (= SVF, III, 281). Ces deux textes ne font nullement référence à la fonction heuristique de la dialectique, mais seulement à sa fonction défensive. 84
D. Babut, « Sur les polémiques des anciens Stoïciens », PhA, 5, 2005, p. 65-91. Il s’agit d’un point de vue qui recoupe sensiblement celui d’É. Bréhier, Chrysippe et l’ancien stoïcisme, Paris, Gordon & Breach, 1971 (1910), p. 63 : « les Stoïciens transforment la logique entière en dialectique (...). Mais le but du dialecticien n’est pas proprement l’invention, la découverte de principes nouveaux ; tout son effort porte sur la discussion des thèses qui se présentent naturellement à l’esprit humain et qui, passées à l’épreuve de la discussion, deviennent d’opinions incertaines et instables, des croyances fermes et systématiques ». 85
Cf. D. Babut, « Sur les polémiques », art. cit., p. 65-91 (p. 86 et n. 93). 86
Cf. J.-B. Gourinat, La dialectique des stoïciens, Paris, Vrin, 2000, p. 69-72. 87
Sur cette question, voir P. Hadot, « Les divisions des parties de la philosophie dans l’Antiquité », MH, 36, 1979, p. 202-223, repris in id., Études de philosophie ancienne, Paris, Belles Lettres, 1998, p. 125-158 ; id., « Philosophie, dialectique, rhétorique dans l’Antiquité », StudPhil, 39, 1980, p. 139-166, repris in id., Études de philosophie ancienne, op. cit., p. 159-193. 88
P. Hadot, « Les divisions des parties de la philosophie dans l’Antiquité », art. cit., p. 202-223 (p. 205).
17
vrai et la rangea parmi les vertus du sage. Cette restauration qui, si elle n’était pas un retour pur et simple à Platon, redonnait à la dialectique un domaine et une fonction qu’Aristote lui avait refusés, ne trouva pas grâce auprès des philosophes de la Nouvelle Académie qui estimaient en particulier que cette prétendue science était incapable de se définir un domaine qui lui fût extérieur et ne détenait aucune vertu heuristique.
Ce faisant, ils passaient sous silence un caractère important de la théorie stoïcienne de la dialectique. En effet, les philosophes de cette école n’ont cessé de répéter que le sage est le seul dialecticien ; autrement dit, nul autre que lui ne peut réaliser les possibilités, les promesses de la dialectique, nul autre que lui ne peut faire qu’elle soit une science de la vérité, et non plus seulement du vrai
89. Cette discipline connaît ainsi un changement qualitatif en fonction de l’état gnoséologique de celui
qui la pratique, sapiens ou stultus. Par ailleurs, si Chrysippe procède à une mise en garde méthodologique contre cette sorte de
dynamite intellectuelle que serait la discussion antilogique, qui pourrait avoir pour effet d’égarer des disciples aux représentations encore mal affermies, il n’assigne pas pour autant à la dialectique une tâche uniquement défensive, de l’aveu même d’un auteur académicien, Plutarque. Le Stoïcien lui accorde aussi le privilège de « découvrir le vrai » - ce qu’Antoine déniait précisément à l’art de Diogène de Babylonie :
« Mais dans son livre Sur l’usage de la raison, après avoir dit qu’il ne faut pas user de la puissance de la raison, pas plus
que lorsqu’il s’agit d’armes, à des fins indues, voici ce que [Chrysippe] a ajouté : ‘En vue de la découverte des choses
vraies (th;n tw`n ajlhqw`n eu{resin), il faut en faire usage, et de même en vue de leur commune mise en œuvre ; mais
à des fins contraires, il ne le faut pas, même si beaucoup le font’90
».
Il est vrai toutefois que le substantif eu{resi" n’apparaît que fort rarement dans les témoignages vétéro-stoïciens, et il convient de s’interroger sur une telle particularité. Les Stoïciens, on le sait, accordaient une place considérable dans leur pensée au concept de « représentation », y compris dans son acception la plus théâtrale ; c’est un signe que le texte qu’ils récitent, autrement dit la philosophie elle-même, est déjà écrit : ils n’en sont pas les auteurs, mais les interprètes. Leur invention porte entièrement et exclusivement sur le mode d’exécution, non sur le fond, et cette conception originale de l’invention nous semble ressortir tout particulièrement d’une déclaration de Balbus, au livre II du De Natura Deorum :
89
Sur la distinction entre vrai et vérité dans le système stoïcien, voir SE, PH, II, 81-83 (absent des SVF = FDS, 322 = LS 33 P). Nous renvoyons pour l’analyse précise de ce texte à l’article d’A.A. Long, « The Stoic Distinction between Truth and the True », in J. Brunschwig (éd.), Les Stoïciens et leur logique. Actes du Colloque de Chantilly, 18-22 septembre 1976, Paris, Vrin, 1978, p. 297-315. Voir encore SE, AM, VII, 38-45 (= SVF, II, 132). 90
Plut., St. Rep., X, 1037 b (= SVF, II, 129 = LS 31 P) : ejn de; tw'/ peri; th'" tou' Lovgou Crhvsew", eijpw;n wJ" ouj dei' th'/ tou' lovgou dunavmei pro;" ta; mh; ejpibavllonta crh'sqai kaqavper oujd’ o{ploi", tau't’ ejpeivrhke: « pro;" me;n ga;r th;n tw'n ajlhqw'n eu{resin dei' crh'sqai aujth'/ kai; pro;" th;n touvtwn suggumnasivan, eij" tajnantiva d’ ou[, pollw'n poiouvntwn tou'to » (traduction de D. Babut). Cf. Cic., De Or., II, 157 : « Cet art, si du moins c’en est un, ne renferme aucun précepte pour découvrir le vrai (nullum est praeceptum quo modo uerum inueniatur), mais seulement des règles pour le juger » (traduction d’E. Courbaud, retouchée). Le témoignage de Plutarque nous paraît donc s’opposer à l’interprétation que propose D. Babut de l’usage stoïcien (notamment chrysippéen) de l’antilogie : selon lui, à la différence de la pratique néoacadémicienne de la disputatio in utramque partem qui s’inscrit en principe dans une démarche d’investigation de la vérité, l’examen stoïcien de thèses contradictoires ne viserait qu’à protéger « une vérité déjà établie et non susceptible d’être remise en question » (D. Babut, « Sur les polémiques », art. cit., p. 65-91 - ici, p. 86). Sur le fait que Chrysippe aurait appris auprès de l’Académie la méthode « antilogique », voir ibid., p. 82-86 et DL, VII, 183-184 (= SVF, II, 1 = LS 31 O).
18
« Chrysippe, bien que doué d’un esprit très pénétrant, parle pourtant de telle sorte qu’il semble que la nature elle-
même lui ait appris ce qu’il dit et qu’il n’a pas l’air de l’avoir découvert tout seul (non ut ipse repperisse uideatur)91
».
À son tour, Épictète qualifiera le scolarque « d’interprète de la nature » (ejxhghth;" th`"
fuvsew")92
comme si, tout étant donné d’emblée par une fuvsi" providentielle et bienfaisante, l’enjeu de la découverte elle-même (eu{resi") perdait de son importance, au profit d’une interprétation, d’un déchiffrage des indices livrés par la nature pour nous permettre d’accéder à la vérité. Si la démarche intellectuelle des Stoïciens consiste bien dans une conquête, rien ne saurait être découvert ni conquis à leurs yeux, pour reprendre la célèbre formule de V. Goldschmidt, qui, en un sens, ne nous soit pas donné d’avance
93.
La critique cicéronienne ne se restreint pas néanmoins à incriminer l’absence de vocation heuristique de la dialectique stoïcienne, qui se manifeste tant dans le domaine rhétorique par une carence en matière d’inuentio, que sur le plan proprement philosophique par un dogmatisme sans faille et un dévouement contestable à la vérité. L’auteur du De Oratore, par la voix d’Antoine, soutient que loin de permettre un quelconque progrès, cette discipline (dont le statut d’ars est mis en cause) se détruit elle-même dans sa recherche de la vérité des propositions. Voici à nouveau, pour plus de clarté, le passage central de cette déclaration polémique :
« Au bout du compte, [les dialecticiens] se percent avec les pointes de leur propre finesse (se compungunt suis
acuminibus) ; à force de chercher, ils imaginent des difficultés que non seulement eux-mêmes ne peuvent plus
résoudre, mais qui sont telles que la trame déjà ourdie, ou mieux presque achevée, est à nouveau complètement
défaite. Ton Stoïcien ne nous est donc d’aucune utilité, puisqu’il ne m’apprend pas à découvrir ce que je dois dire.
Bien plus, il nous met des entraves, en imaginant une foule de questions, qu’il déclare ensuite insolubles (negat ullo
modo posse dissolui) (…)94
».
Non seulement la dialectique connaît un dévoiement par rapport à sa destination originelle, puisque Zénon en recommandait l’usage à ses disciples afin de « dénouer » (luvein) les sophismes
95 tandis
qu’ici elle contribue à créer des difficultés impossibles à « résoudre » (dissolui), mais même l’image de la pointe est ici subvertie. Normalement associé au talent propre à l’invention
96, l’acumen semble ne plus
servir chez les Stoïciens qu’à critiquer tous les arguments, au point que leur discours en est paralysé. Il convient de relever que malgré l’inculture philosophique qu’il affecte, Antoine se réfère ici aux 91
Cic., ND, II, 16 (= SVF, II, 1012) : Chrysippus quidem, quamquam est acerrimo ingenio, tamen ea dicit ut ab ipsa natura didicisse, non ut ipse repperisse uideatur (traduction de C. Auvray-Assayas). 92
Épict., Entr., I, 17, 16 (= SVF, II, 29). Sur l’idée d’un homme « interprète » de la nature, voir ibid., I, 6, 19. 93
V. Goldschmidt, Le système stoïcien et l’idée de temps, Paris, Vrin, 19984 (19531), p. 55. 94
Cic., De Or., II, 158-159 : et ad extremum ipsi se compungunt suis acuminibus et multa quaerendo reperiunt non modo ea, quae iam non possint ipsi dissoluere, sed etiam quibus ante exorsa et potius detexta prope retexantur. Hic nos igitur Stoicus iste nihil adiuuat, quoniam quem ad modum inueniam quid dicam non docet. Atque idem etiam impedit, quod et multa reperit, quae negat ullo modo posse dissolui (…) (traduction d’E. Courbaud, modifiée). Sur la critique cicéronienne de la dialectique stoïcienne au moyen des exemples du sorite et du paradoxe du « Menteur », nous renvoyons à C. Lévy, Cicero Academicus, op. cit., p. 313-316. 95
Plut., St. Rep., VIII, 1034 e (= SVF, I, 50 = LS 31 L). Les sophismes sont ainsi conçus comme des « sacs de nœuds », pour reprendre l’expression de J.-B. Gourinat, La dialectique des stoïciens, op. cit., p. 87, ce qui faisait dire aux Stoïciens que Chrysippe était le couteau qui tranchait les nœuds captieux des Académiciens (Plut., St. Rep., II, 1033 e = SVF, II, 3b). 96
Cic., De Or., II, 147 ; Br., 35 ; 202 ; 221 ; Or., 172 (à propos d’Aristote, où l’acumen sert indistinctement à la topique et à la dialectique, in rebus uel inueniendis uel iudicandis) ; ND, I, 49.
19
métaphores que la Nouvelle Académie utilisait contre la dialectique du Portique, la comparant tantôt au poulpe qui se dévore lui-même, tantôt à Pénélope qui défaisait la nuit la toile qu’elle tissait le jour
97. À
son tour, Plutarque exploite cette image frappante en un sens polémique : « On dit sans doute que le poulpe dévore ses propres tentacules quand vient la saison d’hiver, mais quant à la
dialectique de Chrysippe, qui détruit et met en pièces ses éléments les plus importants et ses propres principes, quelle
est celle, parmi les autres notions, qu’elle laisse à l’abri du soupçon ? Car ils n’imaginent assurément pas que les
parties supérieures de la construction puissent rester fermes et solides quand les fondations sont instables et
comportent tant de motifs de doute et de trouble98
».
La cohérence de la philosophie stoïcienne tant vantée par ses défenseurs est ici retournée contre
eux : en effet, si tout se tient dans ce système organique, il suffit de saper ses bases pour qu’il s’écroule tel un château de cartes. C’est pourquoi Cicéron dénonce, dans le De Finibus, la fausseté de la prémisse majeure du syllogisme de Caton sur le souverain bien pour réfuter en entier ce raisonnement indûment qualifié, selon lui, d’affûté et concluant (consectarium)
99 : il cache en effet la conclusion dans l’une des
prémisses, tombant ainsi dans la faute du cercle, et tient pour accordé ce qu’ensuite il n’y aurait plus besoin de prouver. En somme, il s’agit là d’une affirmation déguisée, non d’une démonstration. Aussi Cicéron y voit-il un coup de force dont il souligne l’aspect dérisoire par la métaphore du poignard de plomb - une métaphore d’autant plus remarquable qu’elle constitue chez lui un hapax, si l’on excepte sa modulation sous la forme d’un diminutif (pugiunculi) évoquant alors les questions dialectiques du Portique semblables à des coups d’épingle
100 :
« J’en viens maintenant à tes fameuses formules concises que tu disais si concluantes, et à celle-ci d’abord, qui est on
ne peut plus brève : ‘Tout ce qui est bon est digne d’éloge ; or tout ce qui est digne d’éloge est moral ; donc tout ce
qui est bon est moral’. Pauvre poignard de plomb (O plumbeum pugionem) ! En effet, qui pourra jamais t’accorder cette
majeure101
? »
De même, Plutarque souligne non seulement la fragilité des bases de la philosophie stoïcienne,
mais aussi l’acharnement des dialecticiens à éprouver (au lieu d’asséner) constamment la vérité de leurs 97
Sur l’image du poulpe, voir Stobée, Ecl., II, 2, 20 ; p. 23, 23-24 W. Sur l’image de Pénélope, voir Cic., Luc., 95 où Carnéade n’est pas explicitement nommé, mais qui relève d’une inspiration néoacadémicienne patente (cf. C. Lévy, « Cicéron critique », art. cit., p. 127-144 - ici, p. 135, n. 37). 98
Plut., Comm. not., II, 1059 e (absent des SVF) : To;n mevn ge poluvpodav fasi ta;" plektavna" auJtou` peribibrwvskein w{ra/ ceimw`no", hJ de; Crusivppou dialektikh; ta; kuriwvtata mevrh kai; ta;" ajrca;" auJth`" ajnairou`sa kai; perikovptousa tivna tw`n a[llwn ejnnoiw`n ajpolevloipen ajnuvpopton … Ouj ga;r oi[ontai dhvpou kai; ta; ejpoikodomouvmena dh; bevbaia kei`sqai kai; pavgia, tw`n prwvtwn mh; menovntwn ajporiva" de; kai; taraca;" ejcovntwn thlikauvta" (traduction de D. Babut). 99
Il arrive également à l’orateur d’adopter la démarche inverse à l’encontre du stoïcisme et de s’appuyer sur les conséquences absurdes auxquelles aboutit cette philosophie (tel le statut d’indifférents de tous les éléments irréductibles à des biens ou des maux) pour en déduire implacablement la fausseté des prémisses qu’elle adopte : Cic., Fin., IV, 53-55. Or récuser la conclusion d’un syllogisme correct revient, en fait, à ruiner la dialectique tout entière, ce dont Antiochus et les Stoïciens accusaient Épicure, d’après le Lucullus, 97. 100
Cf. Cic., Or., 224. 101
Cic., Fin., IV, 48 : Nunc uenio ad tua illa breuia, quae consectaria esse dicebas, et primum illud, quo nihil potest breuius : bonum omne laudabile, laudabile autem omne honestum, bonum igitur omne honestum. O plumbeum pugionem ! Quis enim tibi primum illud concesserit ? (traduction de J. Martha, modifiée).
20
propositions au risque de détruire leur propre édifice et de ne parvenir à aucune vérité stable102
. Aristote quant à lui fait preuve d’une tout aussi grande acuité intellectuelle que les Stoïciens, mais
ne dirige pas contre lui-même la pointe de son esprit : il s’en sert pour explorer la nature de toutes choses (rerum omnium uim naturamque uiderat) et percer les secrets de l’art de parler (haec quoque aspexit quae ad dicendi artem (…) pertinebant). Son seul tort, poursuit Antoine, est d’avoir méprisé ces derniers, de sorte qu’Aristote peut être d’un grand secours pour l’orateur, sans pour autant suffire à le former pleinement, dans la mesure où il dédaigne les fonctions de communication et de séduction du langage
103. En
conclusion, c’est parce que les Académiciens, contrairement aux dogmatiques, ne prétendent pas pénétrer la nature des choses grâce à leur acies mentis et ne retournent pas celle-ci contre eux-mêmes, mais contre le préjugé de certitude inhérent à la plupart des opinions humaines, que leur probabilisme est la philosophie qui favorise le plus l’abondance oratoire
104.
Les Stoïciens à l’inverse, pris au piège de leur propre dogmatisme dont ils ne sauraient satisfaire toutes les exigences, contraignent le philosophe au mensonge - lorsqu’il profère des syllogismes dont les prémisses sont sujettes à caution - ou bien à l’aphasie, quand celui-ci prend conscience que surgissent sans cesse de nouvelles objections contre ses démonstrations dialectiques et qu’il ne peut de facto accéder à des certitudes dans sa connaissance du monde, ce que reconnaît volontiers, pour sa part, le philosophe néoacadémicien. Sceptique qui s’ignore
105, le Stoïcien échoue à la fois à énoncer des vérités stables et à
faire usage de l’éloquence abondante que lui offrirait la conviction que rien n’est certain. Son langage ne parvient ni à pénétrer le monde ni à communiquer les arguments et les émotions, parce que constamment il se perd dans des contradictions qu’en grande partie il génère
106.
Le monde stoïcien, on le sait, est un monde de lumière (fw`") où la représentation (fantasiva) se donne à voir autant qu’elle révèle le monde et, lorsqu’elle est compréhensive, constitue la première étape de la connaissance. Il est d’autant plus surprenant que Cicéron reproche à maintes reprises aux philosophes du Portique l’obscurité de leur langage, comme en témoignent pêle-mêle une allusion de Varron, une occurrence de l’adjectif obscurum dans le portrait exhaustif et précis que dresse Crassus du style stoïcien
107, ou encore le sémantisme des adjectifs horridus ou squalidus, fréquemment accolés aux
102
L’auteur de la Rhétorique à Herennius, II, 16, reproche pour sa part aux dialectici d’être incapables de construire le moindre propos, paralysés qu’ils sont par la conviction que tout mot est fondamentalement ambigu. Aussi ne peuvent-ils avancer quoi que ce soit de certain, à la manière des Sceptiques. Cf. L. Calboli Montefusco, La dottrina degli « status » nella retorica greca e romana, Bologne, 1984 (= Hildesheim, Olms, 1986), p. 187 sq. et p. 182, n. 79. 103
Cic., De Or., II, 160. Sur ce passage, et plus particulièrement sur l’allusion qui y est faite à la sunagwgh; tevcnwn, voir l’article de M.-P. Noël, « La Sunagwgh; tevcnwn d’Aristote et la polémique sur les débuts de la rhétorique chez Cicéron », in C. Lévy, B. Besnier et A. Gigandet (éds.), Ars et ratio. Sciences, arts et métiers dans la philosophie hellénistique et romaine, Actes du colloque de Créteil, Fontenay et Paris, 1997, Bruxelles, Latomus, 2003, p. 113-125. Cf. C. Lévy, « Cicéron critique », art. cit., p. 127-144 (p. 136). 104
À la fin du Lucullus, § 122, Cicéron exprime ainsi le scepticisme académicien quant à la possibilité de connaître la nature du monde : « Tout cela est caché, Lucullus, et environné d’épaisses ténèbres ; nul regard humain n’a assez de subtilité pour pénétrer jusqu’au ciel et entrer dans la terre » (Latent ista omnia Luculle crassis occultata et circumfusa tenebris, ut nulla acies humani ingenii tanta sit, quae penetrare in caelum, terram intrare possit : traduction d’É. Bréhier). 105
D’« avocats de l’évidence » (provdikoi th`" ejnavrgeia"), selon les termes de Plutarque, voici les Stoïciens transformés en fossoyeurs de celle-ci, face à Cicéron qui prend plaisir à s’ériger contre ces surprenants et trop zélés défenseurs du doute. Cf. Plut., Comm. Not., XLIV, 1083 c (= SVF, II, 762 = LS 28 A), et Cic., Fin., IV, 67. 106
C. Lévy, « Cicéron critique », art. cit., p. 127-144 (p. 136). 107
Cic., De Or., III, 66. Voir encore Cic., Lib. Ac., I, 7.
21
orateurs du Portique108
et pourvus d’antonymes tels que nitidus ou illustris109
. Peut-être la critique cicéronienne peut-elle s’expliquer, entre autres, par le caractère insolite du mode d’expression stoïcien, évoqué juste avant à deux reprises dans la description qu’en donne Crassus (inusitatum, abhorrens ab auribus uulgi). Quant à la concision, quoique traditionnellement associée au manque de clarté, elle ne suffit pas à justifier celui-ci, étant donné que Varron reçoit les félicitations de Cicéron pour avoir abordé en un exposé à la fois ramassé et lumineux (breuiter sane minimeque obscure) la doctrine de l’Ancienne Académie et… celle des Stoïciens précisément
110.
De ce fait, Cicéron semble désamorcer à l’avance les allégations de Caton à propos de la difficulté et de l’opacité inhérentes à la doctrine même du Portique qu’il est chargé d’exposer au livre III du De Finibus (habet haec Stoicorum ratio difficilius quiddam et obscurius), difficulté renforcée par le fait que les néologismes techniques de cette école revêtent en latin un caractère étrange qu’ils ont perdu en grec au fil du temps
111. Au début du livre suivant, faisant fond cette fois sur la vertu stoïcienne du prevpon selon
laquelle le langage doit être approprié (oijkei`on) au thème abordé112
, Caton soutient que s’il existe des matières quelque peu obscures, il convient de ne pas en masquer l’opacité dans l’expression :
« Des obscurités, dit-il, oui, il y en a, je l’avoue. Mais, si leur langage est ainsi, ce n’est pas voulu. C’est dans le fond
même des choses que réside l’obscurité (inest in rebus ipsis obscuritas)113
».
L’intervention que Cicéron place dans la bouche du Stoïcien n’est pas exempte d’une certaine perversité, puisqu’il s’agit là d’un argument dont lui-même se sert pour défendre la Nouvelle Académie contre l’accusation de dogmatisme. Aussi Caton, en reconnaissant l’obscurité inhérente aux choses, devrait-il en toute cohérence aboutir au scepticisme académicien, incarnation du « bon sens critique », si l’on en croit Cicéron dans le Lucullus, écrit un mois avant le De Finibus :
« Il y a dans les choses mêmes tant d’obscurité (in ipsis rebus obscuritas) et dans nos jugements tant de faiblesse que des
penseurs très anciens et très savants ont désespéré, non sans raison, de pouvoir découvrir ce qu’ils désiraient ;
pourtant ils n’ont pas été découragés (…). Et il n’y a d’autre différence entre nous et ceux qui croient savoir, sinon
108
Horridus : Cic., Br., 117 ; Fin., IV, 78-79 (= F 55 van Straaten = T 79 Alesse). Squalidus : Cic., Or., 115 ; Fin., IV, 5. 109
Horridus / illustris : Cic., Or., 85-86. Horridus / nitidus : Cic., De Or., III, 51 ; Leg., I, 6 ; Br., 238 ; Or., 36 ; Par. St., pr. 3 ; Diu., II, 30. Il s’agissait là d’un reproche réversible, puisque les Stoïciens accusaient eux aussi les Académiciens de jeter de l’obscurité sur le monde (Cic., Luc., 61). 110
Cic., Lib. Ac., I, 43. De même, l’éloquence de Crassus dément la fatalité de la corrélation entre brièveté et absence de clarté ; cf. Cic., De Or., II, 326. 111
Cic., Fin., III, 15. La question de la terminologie revêt une importance décisive dans le débat sur l’éclat ou l’opacité d’un exposé doctrinal, dans la mesure où Cicéron tâchait d’acclimater la philosophie à Rome en créant une terminologie qui lui fût adaptée. Or au détour d’une brève remarque dans les Tusculanes, IV, 10, nous comprenons que l’enjeu est aussi pour le Romain de se confronter aux ouvrages grecs afin de l’emporter sur eux en clarté. Cette même clarté terminologique fait l’objet d’un éloge de la part de Cicéron lorsqu’un autre Romain, fût-il Stoïcien, l’applique, comme dans le cas de Caton (Fin., III, 40). L’éloge de Caton nous semble s’inscrire dans la poursuite de la stratégie dialectique qu’utilise Cicéron à l’encontre des philosophes du Portique, dont il mine la cohésion en prouvant que l’un d’entre eux au moins a su présenter la doctrine de son école, si obscure fût-elle, de façon lumineuse (ibid., IV, 1). Voilà qui prouve, une fois de plus, que l’absence de clarté du langage stoïcien n’est dictée par aucune nécessité ni aucune fatalité. 112
DL, VII, 59 (= SVF, III Diog. 24) : « La convenance est l’expression qui consiste à approprier son propos au sujet » (Prevpon dev ejsti levxi" oijkeiva tw/` pravgmati : traduction personnelle). 113
Cic., Fin., IV, 2 : Obscura, inquit, quaedam esse confiteor, nec tamen ab illis ita dicuntur de industria, sed inest in rebus ipsis obscuritas (traduction de J. Martha, retouchée).
22
qu’ils ne doutent pas de la vérité des thèses qu’ils soutiennent, tandis que nous tenons pour probables bien des
choses que nous admettons aisément mais sans pouvoir les affirmer114
».
La lecture du Lucullus révèle l’importance et la récurrence de la métaphore de la lumière dans la polémique entre Stoïciens et Académiciens
115 : à Lucullus, qui l’emploie pour dénoncer une philosophie
qu’il estime « ténébreuse » tant elle recouvre d’obscurité la réalité et minimise le pouvoir des sens116
, Cicéron oppose une réinterprétation de la métaphore de la lumière et des ténèbres, destinée à montrer que la vraie lumière est du côté de la Nouvelle Académie. Dès l’ouverture du traité, cette image sert de propédeutique à une critique de l’attitude des dogmatiques qui, tenant pour sûr ce que l’obscurité du monde permet tout au plus de considérer comme probable, font preuve d’une absence déplorable de sens critique et se cramponnent à une doctrine sans même savoir si elle est vraie, comme une huître s’attache à son rocher
117.
Par un retournement dialectique fort habile, Cicéron fait donc admettre dans un premier temps à un tenant du principe de la luminosité du monde et de la vérité, Caton, que la réalité est obscure, avant de contester aussitôt une telle position. Tout au long du livre IV du De Finibus, il s’attache en effet à démontrer que le Portique défend des thèses similaires à celles du Lycée (ou plutôt dérobées à cette école) ; mais tandis que les Péripatéticiens emploient une terminologie et plus généralement un style lumineux
118, les Stoïciens semblent parler un idiolecte incompréhensible aux profanes, de sorte que
l’obscurité réside moins dans le fond de leur discours que dans sa forme même, ou plus exactement dans un décalage constant entre les deux
119.
Dans un second temps, alors que l’Académie se sert du langage pour jeter de la lumière sur cette obscurité fondamentale qu’elle reconnaît, Cicéron souligne que les Stoïciens ne font du langage qu’un pouvoir d’expression de cette opacité, voire un moyen d’assombrir une réalité qu’ils estiment pourtant parfaitement claire et connaissable. Dès le De Inuentione, il avait pourtant soutenu énergiquement que le langage peut à la fois rendre lumineux ce qui est obscur et éclairer ce qui est sombre
120. Il est certes des
situations dans lesquelles l’orateur doit pouvoir susciter une certaine obscurité, notamment dans la narration de l’accusation où il enveloppera de brouillard les arguments que doit avancer l’accusé pour sa
114
Cic., Luc., 7-8 : Etsi enim omnis cognitio multis est obstructa difficultatibus, eaque est et in ipsis rebus obscuritas et in iudiciis nostris infirmitas, ut non sine causa antiquissimi et doctissimi inuenire se posse quod cuperent diffisi sint, tamen nec illi defecerunt (…). Nec inter nos et eos qui se scire arbitrantur quicquam interest nisi quod illi non dubitant quin ea uera sint quae defendunt, nos probabilia multa habemus, quae sequi facile, adfirmare uix possumus (traduction d’É. Bréhier). 115
Cette métaphore de la lumière revêtira surtout une importance extrême dans le moyen-platonisme. 116
Cic., Luc., 16 ; 30. 117
Ibid., 8-9. 118
Voir par exemple Cic., Fin., IV, 2 et 5. 119
C. Lévy, « Cicéron critique », art. cit., p. 127-144 (p. 138). Du coup disparaît le dernier argument qui aurait pu justifier l’obscurité du mode d’expression stoïcien. Au livre II du De Finibus en effet, Cicéron attaque l’Épicurien Torquatus pour l’opacité occasionnelle de son langage (§ 10 et 15), puis déclare qu’elle ne serait excusable que si elle était intentionnelle, comme dans le cas d’Héraclite, ou bien si elle découlait de la difficulté du sujet et non de l’obscurité de l’exposé (cum rerum obscuritas non uerborum facit), comme dans le Timée de Platon (ibid., II, 15). Or de l’aveu même de Caton, le manque de clarté de la présentation de l’éthique stoïcienne ne procédait pas d’un choix de la part des fondateurs du Portique (ibid., IV, 2 : nec tamen ab illis [obscura] ita dicuntur de industria). Quant à la complexité des idées avancées, elle n’excède pas celle des thèses du Lycée, dont la formulation par les Péripatéticiens est toujours lumineuse, souligne Cicéron (ibidem). Ni délibérée, ni inhérente au fond même, l’obscurité dont se rendent coupables les Stoïciens, en enfreignant la règle primordiale de tout discours philosophique qui se doit d’être clair, est donc dénuée de toute justification. 120
Cic., Inu., II, 156.
23
défense121
; mais en cas d’obscurité, il se doit d’apporter de la clarté. Crassus constitue à cet égard la parfaite antithèse de l’orateur stoïcien, puisqu’il nous est dit qu’il avait coutume, par son éloquence de conférer, « à une matière rébarbative, de l’éclat, à une matière pauvre, de l’abondance, à une matière rebattue, de la nouveauté
122 ». Les membres du Portique, en revanche, semblent ignorer la richesse des
virtualités du langage, ainsi que l’autonomie de celui-ci comme moyen de persuasion et de perfection esthétique
123.
121
Cic., PO, 121. Un tel procédé peut en revanche être appliqué bien involontairement par des avocats maladroits et brouillons, si l’on en croit les sarcasmes de Crassus : l’obscurité naît alors de la violation de l’ordre chronologique dans la narration de leur plaidoyer, de l’entassement des mots et du caractère inhabituel de ces derniers (tantaque insolentia ac turba uerborum : De Or., III, 50). 122
Cic., De Or., III, 51 : ita de horridis rebus nitida, de ieiunis plena, de peruulgatis noua quaedam est oratio tua (traduction d’E. Courbaud et H. Bornecque). 123
Cf. C. Lévy, « Cicéron critique », art. cit., p. 127-144 (p. 138-139).