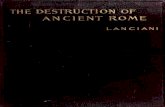Lutter contre la violence à Rome: attributions étatiques et tâches privées
Transcript of Lutter contre la violence à Rome: attributions étatiques et tâches privées
Lutter contre la violence a Rome: attributions etatiqueset taches privees
Cedric Brelaz *
" f
Le monopole de la force publique et la tache de lutter contre la violence et reprimer lacriminalite passent aujourd'hui, en Europe, pour des prerogatives inalienables de l'Etat. Lesinnovations structurelles qui ont conduit a cette situation - comme la creation de l'institution dela police, le desarmement de la societe civile, le developpement des instruments penaux,judiciaires et carceraux ou encore l'apparition de la criminologie - sont percues comme autantde caracteristiques de la formation de I'Etat modeme. L' accroissement des attributions despouvoirs publics en matiere de lutte contre la violence, qui s'echelonne du XVI" au XIXe s.,coincide en effet avec un mouvement de centralisation graduelle de l'Etat. Or cetteconcentration des modes d'expression de la violence dans les mains des autorites publiques, afind'en faire un usage raisonne pour la defense de la collectivite, est souvent envisagee comme un
, Iprogres. . "Par suite, l'exemple de l'Etat modeme conditionne presque inevitablement la perception
que l'on peut avoir du role de l'Etat romain dans le domaine du maintien de l'ordre. Cela peutdonner lieu a des prises de position tranchees sur la question et mener a des interpretations quis'inscrivent dans des courants historiographiques contradictoires sur Ie degre de modernite de
* Membre etranger de l'Ecole francaise d'Athenes, Odos Didotou 6, GR - 106 80 Athenes. Mes plus vifsremerciements vont a Jean-Jacques Aubert (Universite de Neuchiitel), Julien Fournier (Ecole francaise d' Athenes),Valerio Marotta (Universite de Pavie) et Janne Pdlonen (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales) pour leursobservations et conseils lors de l'elaboration de cette etude.Abreviations bibliographiques :LOVISI, Peine: C, LOVISI, Contribution a l'etude de fa peine de mort sous fa Republique romaine (509-149 av, J-C.),1999 (Paris).Roman Statutes: Roman Statutes, ed, par M. H. CRAWFORD et alii, 2 vol., HICS Suppl., 64, 1996 (Londres).1 Une telle perspective evolutionniste est frequemment adoptee dans les etudes de sociologie historique et juridique.Je pense d'abord a la theorie sur la formation de l'Etat de M. WEBER, Economie et societe, trad. de I'allemand parJ. Freund, 2 vol., 1995 (Paris). Le developpement du droit penal grec est egalement expose en ces termes parL. GERNET, « Le droit penal de la Grece ancienne », Du chdtiment dans fa cite, Supplices corporels et peine de mortdans fe monde antique, Coll. EFR, 79,1984 (Rome), p. 9-35.
C. BRELAZ
l'Etat romain. Ainsi, une these que l'on peut qualifier de modemiste suggere que l'Etat romain,a l'instar de l'Etat moderne, a l'exclusivite de la force publique et que le maintien de l'ordre estl'un de ses devoirs". A l'oppose, une these « primitiviste » considere, pour sa part, qu'encomparaison de l'Etat modeme, les moyens a la disposition de I'Etat romain pour lutter contrela violence sont necessairement rudimentaires et inefficaces '. A ces theories s'ajoute la tendancea laqueIIe nous a habitues la philo sophie politique depuis les Lumieres, sinon la Renaissance, etqui consiste a revendiquer la modernite des institutions politiques romaines. Le risque existedone egalement, dans nos etudes, de degager dans I'histoire du droit penal romain uneprogression continue et de decrire ceIIe-ci comme une extension positive des prerogatives deI'Etat aux depens des particuliers, evolution qui aurait ete brusquement interrompue au cours duMoyen Age par la fragmentation du pouvoir central en de multiples entites et par Ie systemesocial de la feodalite.
Mon but, dans les pages qui suivent, va etre de me distancier de ces interpretations et derevenir, de maniere moins ideologique peut-etre, sur le probleme des attributions de I,Etatromain dans le domaine du maintien de l'ordre", Pour ce faire, je compte soulever plusieursquestions: dans quelle mesure et jusqu'a quel point I'Etat romain s'engage-t-il dans la luttecontre la violence entre prives ? La repression crimineIIe est-elle une tache de I'Etat a Rome?QueIIes responsabilites reviennent aux particuliers ? Quels comportements sont considerescomme delictueux de la part de l'Etat ? Quels sont les moyens - juridiques, materiels ethumains - a la disposition des pouvoirs publics pour lutter contre la violence ? Enfin, Iemaintien de l'ordre public constitue-t-il une finalite pour l'Etat romain ? Pour traiter cetteproblematique, je me propose d'adopter une perspective diachronique et d'evaluer lesattributions des pouvoirs publics dans Ie domaine de la repression criminelle a travers I'histoireinstitutionneIIe de l'Etat romain, depuis la haute epoque republicaine jusqu'a la periodeimperiale.
Ma contribution s'articulera en trois points. Dans un premier temps, j'examinerai Iepoids des pouvoirs publics et Ia part devolue aux particuliers dans la repression criminelle aucours de la haute et moyenne epoque republicaine, J'evoquerai ensuite I'augmentation desattributions etatiques en matiere penale depuis Ie Il" s. avo J.-C. jusqu'au regime du Principat,
2 Cette these sous-tend, par exemple, I'ensemble de l'article de N. YANNAKOPULOS,« Preserving the Pax Romana:the peace functionaries in Roman East », MediterrAnt, 6, 2003, p. 825-905. La responsabilite de maintenir I'ordrepublic censee revenir a I'Etat romain y est presentee comme un postulat : «the need for organising an effective policeforce, which would maintain the sought stability, became an absolute necessity» (ibid., p. 825). La modernite del'Etat imperial romain dans ce domaine est egalement relevee par A. M. RIGGSBY, Crime and Community inCiceronian Rome, 1999 (Austin), p. 112-119.3 Cf. O. HIRSCHFELD,« Die Sicherheitspolizei im romischen Kaiserreich », Sitzungsberichte der Berliner Akademie1891, p. 845-877 (= id., Kleine Schriften, 1913 (Berlin), p. 576-612), en particulier p. 877 : «Auch auf diesem Gebiet[la securite publique] tritt in erschreckender K1arheit zutage, mit wie unzureichenden Mitte1n die rdmischen Landerregiert und verwaltet worden sind ... ». Cette these concluant a la faiblesse des structures de I'Etat romain s'appuieneanmoins sur un postulat d'inspiration modemiste et positiviste : pour pouvoir juger que I'Etat romain est inefficacedans Ie domaine de la securite publique, il faut estimer que I'Etat modeme represente 1a norme en la matiere etpretendre que Ie maintien de I'ordre devait aussi etre un des buts declares de I'Etat romain. Dans un tel sens, voir lesremarques de R. MACMuLLEN,Enemies of the Roman Order. Treason, Unrest, and Alienation in the Empire, 1966(Cambridge, reimpr. 1992, Londres / New-York), p. 163-167.4 Dne demarche similaire, visant a refuter 1es theories evolutionnistes tout en s'appuyant sur une enquete de typesociologique, a ete suivie par D. COHEN,Law, Violence, and Community in Classical Athens, 1995 (Cambridge) (enparticulier p. 3-24 sur les questions de methode), pour la repression de la violence dans la societe athenienne.
- 220-
LUTTER CONTRE LA VIOLENCE A ROME
Enfin, j'essaierai d'evaluer la portee de l'engagement de l'Etat imperial dans le maintien del'ordre public.
Par ces propos volontairement generaux, tendant a une vue d'ensemble, je souhaiteraisdeterminer la part que se reserve l'Etat romain dans l'affermissement de la securite collective(ainsi que re1ever les eventuels changements qui eurent lieu dans ce domaine en fonction desmutations constitutionnelles et politiques) et examiner le sens donne a la notion d'ordre public aRome", De maniere plus large, l'enjeu d'une telle enquete est d'etudier quelles etaient lesprerogatives de I'Etat romain et comment etaient reparties les taches d'interet collectif entre lespouvoirs publics et les particuliers.
1. Droits et devoirs de defense individuelle dans Ie droit archaique et durant Iahaute et moyenne epoque republicaine
L'aspect le plus frappant quand on etudie les moyens de repression de 1a violenceexistant a Rome sous la Republique, c' est - par rapport a la situation que nous connaissons dansnos societes europeennes contemporaines'' - l'importante marge de maneeuvre qui est laisseeaux particuliers. Cette latitude d'action s'explique, a Rome, par la nature et la structure memesdu droit penal: l'Etat romain ne detient pas l'exclusivite de l'exercice de lajustice penale". Celasignifie, d'une part, que les delits commis entre prives ne donneront pas necessairement lieu aun jugement officiel devant un tribunal public, d'autre part, que les particuliers ont les moyensde pratiquer une justice privee pour obtenir reparation des dommage subis. Quels sont cesmoyens et quel role l'Etat entend-iljouer en la matiere?
Dans le droit archai'que, mais cela vaut egalement pour toute la haute epoquerepublicaine, on attend des citoyens qu'ils reglent entre eux et par leurs propres ressources leursdifferends, meme si le contentieux porte sur un delit aussi grave qu'une agression physique,voire un meurtre. Conformement a une obligation sacree remontant - selon la tradition - aI' epoque royale, Ie chatiment d'un homicide volontaire revient ainsi aux parents de la victime :ces derniers sont tenus de venger le defunt et de laver I' offense faite a leur famille en versant aleur tour le sang du meurtrier. En procedant a l'assassinat compensatoire du meurtrier", 1es
5 Cette breve etude ne pretend toutefois pas foumir un panorama complet de l'histoire du droit penal et de laprocedure penale a Rome, ni rendre compte du systeme penal dans toute sa diversite et sa complexite, Pour une telleapproche, cf. O. F. ROBINSON,The Criminal Law of Ancient Rome, 1995 (Baltimore) ; B. SANTALUCIA,Diritto eprocesso penale nell'antica Roma, 19982 (Milan) (avec Ie compte-rendu que lui consacre T. SPAGNUOLOVIGORITA,Index, 29, 2001, p. 376-395). Je precise egalement que je m'interesserai ici aux actes de violence physique graves, eten particulier au meurtre, sans chercher a connaitre l'origine et les motivations de cette violence. Lorsque je parle deRome, iI faut entendre la res publica Romana definie comme entite politique. Je n'aborderai que marginalement laquestion du maintien de l'ordre dans les provinces, tout comme celIe de la politique suivie en la matiere par l'Etatromain vis-a-vis des communautes locales.6 Cette remarque vaut en effet surtout pour l'Europe. Car la notion d'autodefense est davantage prisee aiIIeurs,comme aux Etats-Unis. Dans d'autres regions du monde, en outre, les particuJiers sont autorises par la coutume ou lesregles religieuses a recourir a un droit de represailles pour se venger d'un meurtre ou a pro ceder a une executionprivee pour laver une offense.7 Cf. D. CLOUD,« The constitution and public criminal law», The Cambridge Ancient History, IX2, 1994, p. 498-505.8 FEST. p. 247 Lindsay, 23-24 : "Si qui hominem liberum dolo sciens morti duit, paricidas esto ", Pour I'interpretationde cette clause, et du terme paricidas en particulier (faut-il lui donner un sens passif [« qu'il soit rue parcompensation »] ou actif [« qu'il y ait un meurtrier par compensation »] ?), cf. LOVISI,Peine, p. 81-89, 131-137 ;
- 221 -
C. BRELAZ
parents de la victime jouissent de I'impunite. On peut rapprocher de cette pratique un autreusage relevant du droit archaique a Rome: l'individu qui est repute homo sacer pour avoiroffense les dieux par son comportement (comme Ie deplacement de bornes ou la violation d'unserment) peut etre tue sans que soit inquiete celui qui en a pris l'initiative, car son execution estconsideree comme un meurtre expiatoire public destine a apaiser la divinite". En cas d'homicideinvolontaire, en revanche, la mise a mort de la personne fautive n'est pas toleree : les parents dudefunt peuvent seulement exiger d'elle qu'elle sacrifie un belier par substitution d'elle-meme eta titre expiatoire'". Quant aux coups et blessures, ils sont punis soit par Ie talion, soit par desamendes, a la suite d'unjugement civil!'.
On en deduit qu'a Rome, la responsabilite de Ia repression repose a I'origine sur lesparticuliers. L'Etat se contente, pour sa part, de definir Ie cadre legal permettant l'exercice de lajustice privee. Les pouvoirs publics servent uniquement d'autorite de supervision et posent lesconditions du recours a ce type de justice 12. La limitation que l'Etat impose aux particuliers estdouble: premierement, il semble que, pour pouvoir pro ceder en toute impunite it l'execution dumeurtrier de leur parent, les particuliers aient dli obtenir l'accord formel des magistrats publics(Ie consul a l'origine, puis par la suite Ie preteur seconde de magistrats specialises connus sousIe nom de quaestores parricidii), a qui il revient de constater Ie crime qui a ete commis etd'enteriner la decision de la personne lesee de tirer vengeance du meurtrier " ; deuxiemement,en restreignant les possibilites de represailles en cas d'homicide involontaire ou de simplesblessures, l'Etat fixe la proportionnalite de la peine que peuvent infliger les particuliers. Parcette mesure, l'Etat - en meme temps qu'il suscite Ie recours a la vengeance familiale - bannitl'arbitraire dans la facon dont ce type de chatiment sera applique".
Durant les deux premiers siecles de la Republique, Ie recours a la justice privee pourvenger un meurtre semble avoir ete la norme de la part des citoyens, et l'ingerence des pouvoirspublics en la matiere parait s' etre bornee a canaliser et a reglementer Ie comportement desparticuliers et de leur famille. On note, en revanche, entre la fin du IVe et le debut du Ill" s., unengagement croissant de l'Etat dans Ie domaine de la repression criminelle. On observe, eneffet, durant cette peri ode, un developpement des institutions judiciaires publiques a mesure ques'etoffent les institutions politiques de la Republique, Deux innovations principales sont arelever: I'avenernent du tribunal populaire et la creation du college des triumviri capitales.
A. MAGDELAIN,« Paricidas », Du chdtiment dans la cite. Supplices corporels et peine de mort dans Ie mondeantique, Call. EFR, 79,1984 (Rome), p. 549-570.9 MACR.Sat. 3,7,5 : hominem sacrum iusfuerit occidi. Cf. LOVISI,Peine, p. 39-64.10 XII tab. 8,13 : si telum manu fugit magis quam iecit, <aries subiectus esto> (Roman Statutes, II, p. 693-694).Cf. Servo auct. Eel. 4,43 : in Numae legibus cautum est ut si quis imprudens occidisset hominem, pro capite occisiagnatis eius in contione ofJerret arietem.11 XII tab. 1,13 : si membrum rupit, ni cum eo pacit, talio esto ; 14 : si as fregit libero, CCC, <si> servo, CLpoena<e> su<n>to ; 15 : si iniuriam ? alteri ?faxsit, vigintiquinque poenae sunto (Roman Statutes, II, p. 604-608).12 Cf. J. ZLINSZKY,« La repression criminelle dans 1aRome archaique: aspects judiciaires », RJDA, 37, 1990, p. 463-475.13 Lovrsr, Peine, p. 65-95.14 La meme intention est perceptible dans 1a legislation criminelle archaique de Dracon a Athenes : cf. H. VANEFFENTERREet F. RUZE,Nomima. Recueil d'inscriptions politiques etjuridiques de l'archaisme grec, I, Call. EFR,188, 1994 (Rome), p. 16-23. Pour un expose synthetique sur les principes du droit penal en Grece ancienne,cf. J. MELEZEMODRZEJEWSKl,« La sanction de I'homicide en droit grec et hellenistique », Symposion 1990, ed. parM. GAGARIN,1991 (Cologne), p. 3-16.
- 222-
LUTTER CONTRE LA VIOLENCE A ROME
Dans leur fonction de tribunal populaire, les cornices centuriates 15 etaient Ie plussouvent saisis de crimes impliquant les interets de la collectivite, Ce n'est que plus tard, aucours du Ire s. avo J.-C., que l'assemblee du peuple commence a s'occuper de crimes de droitcommun, et encore s'agit-il de preference d'affaires mettant en cause des personnages derenommee publique.'". A l'origine, Ie tribunal populaire a done essentiellement comme tache dejuger les atteintes portees aux interets de I'Etat, et en premier lieu Ie crime de haute trahison(perduellio), sur la proposition d'un magistrat faisant office d'accusateur'", Quant aux triumviricapitales, formant un college de trois magistrats subalternes charges de veiller a l'ordre publicau jour Ie jour dans I'Urbs, ils etaient dotes de competences que I' on pourrait qualifier depolicieres (surveillance, operations de maintien de l'ordre, arrestation et detention de prevenus,instruction preliminaire d'affaires criminelles jugees devant les magistrats publics, supervisiondes executions capitales publiques), mais ils etaient depourvus de veritable juridiction penale.Tout au plus admet-on parfois qu'ils aient pu avoir la faculte de prononcer des peines capitales al'encontre des esclaves et des personnes d'humble condition, mais la question reste debattue ".Surtout, on ignore si, en dehors des mesures prises a I' encontre des individus perturbantouvertement I' ordre public dans les rues de Rome (lors de rixes par exemple) et, bien entendu, al'encontre des auteurs de forfaits ayant une incidence sur les interets de l'Etat, les triumviris' employaient egalement a pourchasser les criminels de droit commun.
A ces nouveaux organes etatiques devolus a la repression s'ajoute Ie pouvoir decontrainte (coercitio) des magistrats superieurs. Les magistrats pourvus de I' imperium (consuls,preteurs) etaient, en effet, habilites a user de violence contre les citoyens. lIs pouvaient fairearreter n'importe quel individu et - jusqu'a l'introduction de la procedure d'appel au peuple(provocatio ad populum) en 300 par une Lex Valeria, loi qui donnait la possibilite aux citoyensde s' opposer aux magistrats cum imperio en demandant un proces devant les cornices - ilspouvaient faire fouetter et meme faire mettre a mort un citoyen. Ce droit de recourir a desmesures de contrainte envers les citoyens ne s' exercait toutefois pas ordinairement contre lescriminels de droit commun. II visait avant tout a reprimer les actes de desobeissance a l'autoritedu magistrat cum imperio et a supprimer les complots politiques (coniurationesv",
En resume, on voit qu'au cours de l'epoque medio-republicaine, l'Etat abandonne sonrole passif d'intermediaire entre les particuliers pour se doter de nouvelles institutions enmatiere de repression. L'intervention de l'Etat dans ce domaine passe essentiellement parl'instauration d'une juridiction penale publique (Ie tribunal du peuple), capable de prononcer etdexecuter des peines a titre public. Pourtant, a l'exception des taches de police des triumviricapitales et des enquetes conduites par ceux-ci pour jugement devant Ie preteur, les efforts quedeploient les pouvoirs publics dans la repression se concentrent sur les crimes perpetres a
15 Lovrst, Peine, p. 231-235.16 Lovisr, Peine, p. 285-310.17 LaVIsI, Peine, p. 219-263. Lejugement des crimes politiques pouvait egalernent etre confie a des cours speciales(quaestiones extraordinariae) constituees par Ie Senat, comme lors de I'affaire des Bacchanales par exemple.18 B. SANTALUCIA,Studi di diritto penale romano, 1994 (Rome), p. 129-143 ; Lovrsr, Peine, p. 96-119. En faveurd'une juri diction criminelle sommaire des triumviri, cf. CLOUD, loco cit. (voir ci-dessus n. 7), p. 500-501. SurI'Inegalite sociale dans Ie regime des peines a Rome, cf. 1.-1. AUBERT,« A Double Standard in Roman CriminalLaw? The Death Penalty and Social Structure in Late Republican and Early Imperial Rome », Speculum Juris.Roman Law as a Reflection of Social and Economic Life in Antiquity, ed, par. J.-J. AUBERTet B. SIRKS,2002 (AnnArbor), p. 94-133.19 LaVISI, Peine, p. 170-178,184-218,263-267.
- 223-
C. BRELAZ
l'encontre des interets de l'Etat et qui acquierent, de ce fait, une portee publique. Par suite,I' essentiel des taches de repression de la violence entre prives devait continuer a reposer surl'initiative des particuliers eux-memes'" et nombre de crimes de droit commun rester a l'ecartde la juridiction publique ".
La grande part devolue aux particuliers dans l'exercice de la justice penale a Rome aucours de I'epoque republicaine est caracteristique des usages en vigueur dans les societestraditionnelles, ou les liens familiaux et c1aniques sont pre dominants et ou les comportementsindividuels et collectifs sont dictes par un code d'honneur rigoureux. Ce fait est, d'une facongenerale, une constante dans les communautes sociales et politiques pre-modernes ou I,Etat nese reserve pas la totalite des moyens d'expression et de pratique de la justice et ou lesparticuliers n' ont pas ete entierement dessaisis au profit de la collectivite de leurs privilegesdans ce domaine'", La possibilite consistant a resoudre des conflits entre prives en dehors desinstitutions etatiques, y compris en matiere criminelle, releve d'un phenomene bien connu deshistoriens du droit et des sociologues, qu'on appelle actuellement « l'infrajudiciaire » dansl'historiographie et qui a deja ete etudie de facon approfondie pour le cas des societesmedievales et d'Ancien Regime.".
A Rome, l'exemple le plus notable de la faculte qu'ont les citoyens de chatier un delitsans recourir a des tribunaux publics reside probablement dans la capacite judiciaire et penaledu pere de famille, lapatria potestas'". On compte en effet, parmi les attributs juridictionnels dupater familias, le droit de punir et de mettre a mort ses enfants, son epouse ou un membre de samaisonnee suite a une faute grave (honneur familial bafoue, manquement aux devoirs enversI'Etat) 25. Bien qu'il temoigne d'un temps - anterieur a la formation de l'Etat - ou la famillerepresentait I'entite sociale de base, ce droit n'est pas a interpreter, sous la Republique, commele residu obsolete de coutumes primitives. Le droit de vie au de mort (vitae necisque potestas)du pere de famille, qui fait partie de la juridiction domestique de ce dernier, est, a Rome, unepratique judiciaire qui coexiste avec les institutions penales publiques jusqu'a l'epoqueimperiale,
L'existence d'usages « infrajudiciaires » en matiere penale a Rome ne se verifie pasuniquement dans Ie cadre de l'exercice de la patria potestas. Comme je l'ai releve plus haut, laplupart des delits commis entre prives autorisent les particuliers a se faire justice eux-memes eta proceder a des represailles a titre de chatiment sans qu'il soit necessaire de porter l'affaire
20 C'est en effet aux prives qu'i1 incombe de porter une affaire criminelle a 1a connaissance du preteur, s'i1s entendentque 1a peine soit d'abord jugee, puis executee publiquement par 1es triumviri capitales. Car le preteur ne mene enprincipe pas d'enquete de sa propre initiative, sauf lorsque des quaestiones extraordinariae - d'importancepo1itique - lui sont confiees, En outre, 1es prives peuvent continuer a administrer eux-memes un chiitiment enrequerant au prealable l'accord du magistrat et sans que ce demier ne prononce formellement de jugement.Cf. LOVISI,Peine, p. 119-123.21 Cf. ROBINSON,op. cit. (voir ci-dessus n. 5), p. 41-42.22 Une situation simi1aire s'observe, par exemp1e, dans 1a cite d' Athenes a l'epoque classique : cf. V. J. HUNTER,Policing Athens. Social Control in the Attic Lawsuits, 420-320 B. c., 1994 (Princeton), en particulier p. 120-153.23 Voir L 'infrajudiciaire du Moyen Age d l'epoque contemporaine, ed. par B. GARNOT,1996 (Dijon).24 Cf. W. K. LACEY,«Patria Potestas », The Family in Ancient Rome. New Perspectives, ed. par B. RAWSON,1986(Ithaca), p. 121-144.25 W. V. HARRIS,« The Roman Father's Power of Life and Death », Studies in Roman Law in Memory of A. ArthurSchiller, ed. par R. S. BAGNALLet W. V. HARRIS,1986 (Leyde), p. 81-95.
- 224-
LUTTER CONTRE LA VIOLENCE A ROME
devant un tribunal public. Ainsi, on tolere habituellement une justice privee et expeditive dansles cas de crimes de sang et d'adulteres, et ce jusqu'a la fin de la periode republicaine ". Cereglement « infrajudiciaire », entre prives, de conflits causes par des actes de violence ne devraitpas etre percu comme une justice parallele, concurrente de la justice officielle et publique. Dansla Rome republicaine, la justice privee ne s'exerce pas aux depens des attributions de l'Etat.C'est une chose admise et reconnue que Ie pere de famille punisse lui-meme son fils ou qu'unprive reponde par la violence au meurtre d'un parent afin de laver l'affront fait a son clan. Enveillant eux-memes a punir la personne qui leur a cause un tort, les particuliers ne se soustraientpas a I' autorite publique.
Cette configuration du droit penal eclaire le poids qu'a l'initiative personnelle a Rome,non seulement dans l' exercice de la justice, mais aussi dans les moyens et les actions de defenseimmediate contre la violence. Certes, Ie droit de repousser la violence par la violence est, pourles Romains, un principe de droit naturel ". Mais il s'agit en realite bien davantage que delegitime defense dans le sens ou nous l'entendons actuellemenr", Car le droit d'user de laviolence ne se restreint pas, a Rome, au cas extreme ou la victime est contrainte, dans I'urgence,de defendre sa propre vie par la force, comme l'illustre un extrait des Sentences dites de Paul:« II convient de ne pas punir celui qui a tue un brigand qui avait l'intention de perpetrer unmeurtre ou, dans une autre circonstance, quiconque avait l'intention de commettre un viol. Car,dans un cas, on a defendu sa vie, dans l'autre sa pudeur d'un crime public. Si quelqu'un, de nuitou de jour, tue un voleur qui se defendait par une arme, il ne tombe evidemment pas sous lecoup de cette loi [la Lex Cornelia de sicariis et veneficis] ( ... ) »29. La Loi des XII Tablesprevoyait deja qu'un voleur pris en flagrant delit (furtum manifestum) puisse etre tue s'il avaitcommis son forfait de nuit ou bien s'il s'etait servi d'une arme lorsqu'on l'avait interpelle, cequi constitue en l'occurrence deux circonstances aggravantes", Le droit de tuer un voleur qu'ona deja attrape et qui, par consequent, est devenu inoffensif excede le champ d'application de lalegitime defense tel que nous le concevons. Dans le cas present, la loi autorise le particulier aexercer une justice privee et expeditive a l'encontre du voleur en le mettant a mort. La seuleprecaution que doit prendre Ie particulier pour pouvoir executer impunement Ie voleur estd'emettre un cri ou un appel (endoploratio) dans le but d'ameuter des voisins pouvant servir detemoins a la mise a mort, ce qui donne une dimension publique a I'evenemenr".
26 Y. THOMAS, « Se venger au Forum. Solidarite familia1e et proces crimine1 a Rome (premier siecle avo - deuxiemesiecle ap. J.C.) », La vengeance. Etudes d'ethnologie, d'histoire et de philosophie, III, Vengeance, pouvoirs etideologies dans quelques civilisations de l'Antiquite, ed. par R. VERDIERet J.-P. POLY, 1984 (Paris), p. 65-100.27 ULP. (69 ad ed.) Dig. 43,16,1,27 : Vim vi repellere licere Cassius scribit idque ius natura comparatur : apparetautem, inquit, ex eo arma armis repellere licere. Cf Gaius (7 ad ed. prov.) Dig. 9,2,4pr : adversus periculumnatura lis ratio permittit se defendere.28 A. D. MANFREDINI, « Vo1eurs, brigands et legitime defense en droit romain », RD, 74, 1996, p. 502-523.29 PAUL. Sent. 5,23,8-9 : Qui latronem caedem sibi inferentem vel alias quemlibet stupro occiderit, puniri nonplacuit : alius enim vitam, alius pudorem publico facinore defenderunt. Si quis furem nocturnum vel diurnum, cum setela defenderet, occiderit, hac quidem lege non tenetur ...30 XII tab. 1,17 : si nox furtum fa<x>it, <ast> im occisit, iure caesus esto ; 18 : si luci <furtum faxit, ast> se telodefendit, ... endoque plorato (Roman Statutes, II, p. 609-613). Cf. GELL. 11,18,6: Nam furem, qui manifesto furtoprensus esset, tum demum occidi permiserunt [les decemviri], si aut cum faceret furtum nox esset aut interdiu telo secum prenderetur defenderet.31 GAIUS (7 ad ed. prov.) Dig. 9,2,4,1 : Lex duodecim tabularum furem noctu deprehensum occidere permittit, uttam en id ipsum cum clamore testificetur : interdiu autem deprehensum ita permittit occidere, si is se telo defendat, utramen aeque cum clam ore testificetur ;Lovrsi, Peine, p. 38-39, 58-60.
- 225 -
C. BRELAZ
Le droit d'autodefense se double, a Rome, non seulement du droit de proceder a uneexecution sommaire dans certaines circonstances, comme lors de l'interception d'un voleur,dont il vient d' etre question, mais egalement de ce que I' on pourrait appeler un devoird'offensive individuelle, visant a la protection de la collectivite ". Comme Ie rappelle Tertullien,chaque personne prenant l'initiative de tuer un criminel representant un danger pour l'ensemblede la communaute doit se sentir investi de la force publique, dans la mesure OU son geste est unbienfait pour la sauvegarde de la societe.". En encourageant les particuliers a intervenirdirectement contre les ennemis communs de la collectivite et a leur administrer un chatirnentexpeditif qui aura valeur de mesure preventive, l'Etat pousse les citoyens a contribueractivement a la preservation de la securite publique.
2. Vers une extension des competences de l'Etat romain en matiere de repressioncriminelle (du Il" s, avo J.-C. au Principat)
Entre le Il" s. avo J.-C. et Ie I" S. ap. J.-C., on assiste, a Rome, a une extensionprogressive des competences de l'Etat en matiere penale ". Quelles furent les modalites de cetteevolution et quelles en ont ete les causes et les motivations?
L' augmentation des attributions de I'Etat dans le domaine du droit penal au cours de laperiode envisagee se traduit conjointement par le developpement des institutions judiciairespubliques (ainsi que l'extension de leurs prerogatives) et par Ie renforcement de l'appareillegislatif en matiere criminelle. Pour ce qui est des structures judiciaires, on remarque, des laseconde moitie du Il" s. avo J.-c., l'apparition de cours penales permanentes (quaestionesperpetuaey", Parmi ces cours specialisees, plusieurs sont chargees de juger des actes deviolence commis entre particuliers : on peut mentionner la cour de veneficis, qui se prononce surles affaires d'empoisonnement; la cour de sicariis, qui s'occupe des meurtres ; la cour de vi, quitraite des dommages causes par des bandes armees ; la cour de parricidiis, qui juge lesmeurtriers de parents proches ; enfin, la cour de iniuriis, qui se penche sur les actes de violencephysique en cas de violation de domicile et d'appropriation illicite de biens.
Parallelement a la constitution de ces cours penales, on note, durant le Il" et Ie I"S. avoJ.-C., une intense activite legislative visant a preciser les competences de ces tribunaux. Achacune des cours correspondait, en effet, une serie de lois fixant la nature du crime que celles-ci etaient habilitees a juger, ainsi que la peine prevue. En matiere criminelle, on mentionnera, enparticulier, la legislation de Sylla (voir notamment la Lex Cornelia de sicariis et veneficis), etcelle de Cesar et d' Auguste (voir les lois juliennes de vi).
32 Comparer Ie devoir d'assistance qui lie les domestiques (familia) it leur maitre (dominus) en cas d'agression de cedernier: MOD. (8 pan.) Dig. 29,5,19 ; ULP. (50 ad ed.) Dig. 29,5,1,35.33 TERT. Apol. 2,8 : in reos maiestatis et publicos hostes omnis homo miles est. Sont principalement vises ici lescriminels menacant I'integrite de l'Etat (crime de lese-majeste), ainsi que les ennemis publics. Par leurs agissementsqui font peser un danger sur I'ensemble de la societe, les brigands sont neanmoins souvent assimiles it ceux-ci dansles faits. Pour d'autres mesures favorisant le concours de particuliers a I'affermissement de la securite publique, voirci-dessous p. 235. Pour des exemples d'executions sommaires de brigands suite it des battues organisees dans lacampagne par les populations locales, cf. APP. B. Civ. 4,4,28 ; ApUL. Met. 7,13.34Cf. LOVISI, Peine, p. 304-322.35 CLOUD, loco cit. (voir ci-dessus n. 7), p. 505-530.
- 226-
LUTTER CONTRE LA VIOLENCE A ROME
La creation de cours penales permanentes a la fin de la Republique a pour effetd'introduire dans la categoric des crimes publics (crimina publica) des faits qui jusqu'alorsetaient consideres comme des delits prives". Par la creation de tribunaux specialises charges dese prononcer sur des types definis de forfaits, I,Btat reconnait que certains actes de violencecommis entre particuliers peuvent avoir des incidences sur la surete de la collectivite. De plus,en mettant a la disposition des citoyens des institutions judiciaires publiques que I' on peut saisiren tout temps, I'Btat entend se porter garant du reglement de litiges impliquant des prives, Defait, les pouvoirs publics assument, au travers des quaestiones perpetuae, une plus granderesponsabilite dans la defense des interets de chaque citoyen dans ses rapports avec sessemblables. Ces transformations profondes dans l' organisation judiciaire ont une consequencedirecte sur la procedure accusatoire. Alors qu'auparavant, seuls la victime ou les parents decelle-ci etaient habilites a chercher reparation du coupable, tout citoyen peut desormais saisir lesquaestiones. A partir du moment OU l'acte delictueux n'est plus envisage seulement comrne uneoffense perpetree a I' encontre d'un seul individu, mais comrne une offense faite au reste de lacollectivite, l'accusation peut etre portee par n'importe lequel de ses membres.
L'implication croissante de I'Btat en matiere de repression, deja sensible avec lacreation des quaestiones perpetuae, augmente encore au debut de I' epoque imperiale.L'avenement du regime du Principat a deux effets majeurs sur la procedure des proces criminelsa Rome. D'abord, la juridiction criminelle passe progressivement des cours penalespermanentes (quaestiones perpetuae) au prince et a ses representants (titulaires des prefecturesde Rome, gouvemeurs dans les provinces). Ensuite, on remplace peu a peu Ie systemeaccusatoire en vigueur dans les quaestiones perpetuae par un systeme inquisitoire, OU lescriminels sont automatiquement recherches par I'Btat.
Dans cette nouvelle procedure, dite « extra ordinem » (car ne suivant pas la procedureordinaire des proces publics devant les quaestiones), la part revenant a I'Etat estconsiderablement accrue." Car c'est aux autorites politiques, desormais, d'inculper le prevenuet de prendre l'initiative d'un proces criminel. Contrairement a la pratique voulue par lesquaestiones perpetuae, il n'est plus besoin d'une accusation formelle de la part d'un particulierpour que les tribunaux soient saisis. Auparavant, pour entreprendre une procedure judiciaire, lescours devaient etre expressement saisies par un citoyen, a qui revenait la tache de formuler uneaccusation et d'etablir les preuves. II suffit dorenavant d'une denonciation aux autorites pourque l'Etat ouvre une enquete et declenche une poursuite judiciaire. Avec la procedure extraordinem, le crime est recherche pour lui-meme et il est poursuivi d'office par les autorites : i1n'est pas besoin d'accusation pour que l'acte delictueux soit considere comme un crime digned' etre puni. Dans le systeme precedent, les institutions judiciaires publiques se bomaient a offriraux particuliers un cadre legal et penal leur permettant de resoudre leurs differends. Elles jouent
36 Dans la tenninologie juridique romaine, les delicta, n'impliquant que les interets de particuliers et faisant I'objetd'un reglernent entre les individus eux-memes, s'opposent aux crimina, qui ont des repercussions sur la sfirete de lacollectivite et necessitent un chatiment public: cf. M. Ducos, «Morale et definition du crime a Rome », Ordre moralet delinquance de l'Antiquite auXXe siecle, ed, par B. GARNOT, 1994 (Dijon), p. 25-32.37 Sur I'introduction de la procedure extra ordinem, cf. G. PUGLIESE, « Linee generali dell'evoluzione del dirittopenale pubb1ico durante il principato », ANRW, II 14, 1982, p. 722-789.
- 227-
C. BRELAZ
maintenant, au contraire, un role actif dans la definition et la reconnaissance des comportementsdelictueux, En theorie, l'Etat se trouve done, sous Ie Principat, it l'origine de la repression.",
L'accroissement des moyens dont se pare l'Etat imperial pour lutter contre la violencepasse egalement par l'attraction de delits supplementaires dans la sphere penale publique ".Ainsi, Ie champ couvert par la legislation criminelle augusteenne, laquelle remonte it des loisrepublicaines, s'etend au cours de l'epoque imperiale. Par ailleurs, la definition de ce qui peutapparaitre comme un crime et l'application de la peine sont laissees, dans la procedure extraordinem, au libre arbitre du juge". Ce demier peut decider, au besoin, de punir des agissementsque la loi ne prevoit pas de punir, mais qu'il considere neanmoins comme nuisibles it lacollectivite. Parmi ces mefaits appeles crimina extraordinaria, on note toute une serie de volsqualifies (dont Ie vol avec effraction et l'appropriation illicite de betail) , la sequestrationd'hommes libres ou encore Ie recel de brigands, entre autres".
Le corollaire de cet elargissement de la sphere penale publique est la limitationgraduelle du recours it la justice privee pour punir un crime commis entre particuliers. Lesexemples de contestation de la justice privee se multiplient en effet it I'epoque imperiale, Laremise en cause des pratiques « infrajudiciaires » s'appuie alors aut ant sur Ie developpementinterne du droit penal que sur des considerations d'ordre moral. Mentionnons, it titred'illustration, trois cas ou, it l'epoque imperiale, les particuliers sont dessaisis de leurs anciensdroits it se faire justice par eux-memes :
1° Ie droit it I' autodefense. Si, dans Ie droit archaique, la personne qui intercepte et tueun voleur beneficie de I'impunite - et c'est encore Ie cas it l'epoque tardo-republicaine -, cettepossibilite est soumise it condition it I'epoque imperiale. Desormais, la mise it mort du voleurn'est toleree que si celui-ci menace directement la vie de la personne qui l'intercepte et siaucune autre issue - comme une arrestation - n'est envisageable. Par consequent, si un voleurest mis it mort alors qu'il n'avait pas l'intention de tuer, la personne qui a pris l'initiative deI'executer risque d'etre inculpee pour homicide'f. Sous l'effet de cette restriction, Ie droit itI' autodefense se transforme en un principe de legitime defense tel que nous I' entendonsaujourd'hui dans notre droit contemporain, c'est-a-dire en un droit de recours it la violence enderniere extremite, exclusivement pour defendre sa propre vie.
2° Ie chatiment d'un adultere. Conformement au code d'honneur traditionnel en vigueurdans la societe romaine, c'est aux proches qu'il revient de charier une femme adultere et soncomplice, car leur comportement entache la dignite de I' ensemble de la famille. Pourtant, la
38 Dans la procedure extra ordinem, une accusation formelle de la part d'un citoyen reste cependant necessaire pourles crimes punis en vertu de la legislation republicaine et augusteenne et juges autrefois par I'une des quaestionesperpetuae. Les quaestiones perpetuae elles-memes se maintiennent, en outre, jusqu'au If s., mais ne sont habilitees itse prononcer que sur les crimes pour lesquels elles avaient ete instaurees. Cf. SANTALUCIA,op. cit. (voir ci-dessusn. 5), p. 213-215, 241-249, 256-268.39 PUGLIESE,op. cit. (voir ci-dessus n. 37), p. 773-784.40 Cf. W. RIESS, « Gnade vor Recht oder der Ermessensspielraum des Richters in der romischen Kaiserzeit. DieKontroverse zwischen De Robertis und Levy in sozialhistorischer und kulturvergleichender Perspektive »,Historische Anthropologie, 9, 2001, p. 462-470.41 Voir Dig. 47,11-20. .'42 ULP. (18 ad ed.) Dig. 9,2,5pr ; id. (37 ad. ed.) Dig. 48,8,9 ; Cod. lust. 9,16,3(4) (rescrit de l'empereur Gallien en265).
- 228-
LUTTER CONTRE LA VIOLENCE A ROME
legislation augusteenne inclut expressement I' adultere dans la categorie des crimes publics et leconsidere comme une atteinte a l'ordre moral proclame par Ie Principat'", Depuis ce moment, Iechatiment d'un adultere entre done dans la competence des tribunaux publics (exception etantfaite d'un droit de vengeance immediat concede, sous condition, au mari ou au pere de la femmeadultere), ce qui accroit la responsabilite de l'Etat en matiere criminelle.
3° l'exercice de la juridiction et de la puissance patemelles (patria potestas). Bien quemaintenu, Ie droit de vie ou de mort (vitae necisque potestas) dont dispose Ie pere sur son filsest, a l'epoque imperiale, sujet a une forte reprobation tant morale que sociale. L'execution deson fils par un pere passe desormais pour un abus de la puissance patemelle 44. Par consequent,ce droit tombe quasiment en desuetude dans la pratique a I'epoque imperiale'".
On peut done tracer, en resume, une tendance generale dans I'evolution du droit penal aRome entre Ie II" s. avo J.-C. et l'epoque imperiale qui est celIe du progressif transfert descompetences penales en matiere criminelle des particuliers au profit de l'Etat. Le fait que lespouvoirs publics accaparent peu a peu les taches de repression de la violence qui revenaienthabituellement aux prives s'inscrit dans un mouvement plus vaste d'accroissement desprerogatives de l'Etat romain durant la meme periode, Au cours du I" s. avoJ.-c., effectivement,la res publica ne se concoit plus seulement comme la reunion de particuliers, mais comme uneentite abstraite et autonome dont la finalite est de reguler la vie sociale. Quant a la mainmise dugouvemement imperial sur la juridiction criminelle, il faut y voir Ie resultat des transformationspolitiques provoquees dans les institutions republicaines par l'instauration d'un regimeautocratique et autoritaire.
De maniere generale, Ie champ d'action de l'Etat romain en matiere penale s'elargit ame sure que s'etoffe la notion d'ordre public. Le fait que l'on en vienne a admettre, a la fin de laRepublique, que des actes de violence perpetres entre prives puissent nuire a l'ensemble ducorps social denote une prise de conscience de la valeur de la surete collective. On reconnait, ace moment, a Rome, que la defense des interets de l'Etat ne se restreint pas uniquement aproteger les citoyens des attaques militaires etrangeres et a garantir l'integrite des institutionspolitiques, mais qu'elle passe aussi par la preservation de la surete civile. Desormais, uneoffense grave faite a un particulier acquiert une portee publique et el1e est percue comme uneattaque a la cohesion sociale, une menace dirigee contre la securite du corps social, autrement
43 Voir Ie titre 48,5 du Digeste (Ad legem Iuliam de adulteriis coercendis). Cf. Roman Statutes, II, p. 781-786, n° 60 ;Th. A. J. McGINN, Prostitution, Sexuality, and the Law in Ancient Rome, 1998 (New-York / Oxford), p. 140-147,202-207. II en va de meme du viol, qui n'est puni publiquement que depuis la legislation augusteenne de vi(MARCIAN. (14 inst.) Dig. 48,6,3,4).44 Cf. MARCIAN. (14 inst.) Dig. 48,9,5 :Divus Hadrianusfertur, cum in venationefilium suum quidam necaverat, quinovercam adulterabat, in insulam eum deportasse, quod latronis magis quam patris iure eum interfecit : nam patriapotestas in pietate debet, non atrocitate consistere (Ia facon dont Ie pere a ici execute son fils, au cours d'une partiede chasse, a dil paraitre particulierement sauvage); id. (sing. de delat.) Dig. 48,21,3,5 (cas du suicide d'un pere pouravoir mis 11mort son fils).45 Y. THOMAS,« Vitae necisque potestas. Le pere, la cite, la mort », Du chdtiment dans la cite. Supplices corporels etpeine de mort dans le monde antique, Col!. EFR, 79,1984 (Rome), p. 499-548, en particulier p. 511.
- 229-
C. BRELAZ
dit comme une atteinte it l'ordre public'", Dans cette optique, la securite publique devient unetache supplementaire de 1'Etat.
C'est Ie climat social et politique en vigueur it Rome tout au long du Ief s. avo I.-C. qui adicte de tels changements dans la conception qu'on avait du role de l'Etat en matiere derepression. L'insecurite continue due aux affrontements politiques et aux guerres civiles aucours de cette periode a pousse it legiferer sur les delits commis entre prives qui, par leur graviteet leur amp leur, menacaient la cohesion de la collectivite'". En outre, Ie regime du Principat a,par necessite politique autant que par ideologie, fait de la preservation de l'ordre public une deses priorites et un de ses leitmotive. Suite it des decennies d'instabilite politique et de desordrescivils, la securite publique a ete envisagee comme l'assise du nouveau regime, it tel point que,dans la propagande imperiale, la restauration de la paix civile (pax publica) et Ie maintien del'ordre public (disciplina publica) sont erigees en valeurs morales'", Aussi la participation del'Etat it la lutte contre la violence a-t-elle ete deliberement promue par Ie prince.
3. Etendue et limites des attributions de I'Etat imperial dans Ie domaine de la luttecontre la violence
L'accroissement des attributions penales de l'Etat romain en matiere criminelle, depuisla fin de la Republique et au cours de l' epoque imperiale, ne suit pas une evolution lineaire etabsolue. Malgre Ie renforcement des cornpetences publiques au detriment de l'exercice d'unejustice privee, l'Etat ne detient pas Ie monopole de la repression sous Ie Principato Surtout,l'evolution que l'on peut tracer n'implique pas, it l'evidence, que l'Etat imperial connaisse lesmemes principes et dispose des memes moyens que l'Etat modeme dans la lutte contre laviolence. Dans cette derniere section, je presenterai successivement quatre remarques quidevraient permettre de sonder I'etendue, mais aussi les limites de l'action de l'Etat imperialdans Ie domaine du mainti-n de l'ordre public et de la repression de la violence. Cesobservations auront egalement pour but de temperer les affirmations que j' ai enoncees dans lapartie precedente.
1) L'extension du champ d'application du droit penal public n'entraine pas l'abolitionde la justice privee, ni sa disparition dans les faits. Loin d'etre prohibe dans sa globalite,l'exercice de la justice privee est plutot canalise, Comme on l'a vu plus haut, la juridictionimperiale cherche it restreindre les cas ou Ie recours it la justice privee est tolere et it remplacercette derniere au profit de la juridiction publique ; mais les principes de la justice privee sontneanmoins conserves. Ainsi, Ie droit de vie ou de mort (vitae necisque potestas) dont est investiIe pere de famille n'est formellement aboli qu'au IVe S.49. Merrie si, depuis la fin de laRepublique, si ce n'est auparavant, la reprobation morale de ce type de chatiment rend sonusage exceptionnel, Ie pere de famille conserve theoriquement jusqu'a la fin de l' Antiquite Ie
46 De telles conceptions sont perceptibles dans l'ceuvre philosophique et politique de Ciceron : cf. N. WOOD, Cicero'sSocial and Political Thought, 1988 (Berkeley), notamment p. 185-193.47A. W. LINTOTT, Violence in Republican Rome, 19992 (Oxford), p. 107-131.48 Sur la notion de securitas dans l'ideologie imperiale, cf. A. KNEPPE, Metus temporum. Zur Bedeutung von Angst inPolitik und Gesellschaft der rdmischen Kaiserzeit des 1. und 2. Jhdts. n. Chr., 1994 (Stuttgart), p. 217-281.49 THOMAS, loco cit. (voir ci-dessus n. 45), p. 546-548.
- 230-
LUTTER CONTRE LA VIOLENCE A ROME
droit d'executer son fils sans risquer d'etre accuse de parricidium, pour autant que la peinecapitale soit decidee pour de justes motifs '". II en va de meme du droit a l'autodefense : bienque les juristes d'epoque imperiale insistent sur Ie fait qu'il serait preferable (melius jecerit) dedeferer a un magistrat un voleur qu'on surprend anne, on ne peut etre condamne pour avoirexecute Ie malfaiteur sur-Ie-champ et s'etre fait justice soi-meme ". Plus que des dispositionslegales, ce sont, en realite, des considerations morales et sociales qui poussent les particuliers aabandonner la pratique de la justice privee au profit des institutions judiciaires publiques. Endefinitive, ce qu'il importe de relever pour mon propos, c'est que l'accroissement desattributions etatiques en matiere penale ne s' est pas accompagne de mesures visant directementa la suppression de la justice privee. L'extension des competences de I'Etat dans ce domainen'est pas passee par la substitution radicale d'un systeme a un autre.
2) La legislation et la juridiction criminelles teIIes qu'eIIes se developpent a la fin de laRepublique et sous Ie Principat s'attachent avant tout a punir les actes delictueux qui ont desincidences directes sur la sauvegarde de I,Etat et a reprimer les crimes qui ont un retentissementpolitique. On peut verifier cette orientation de la juridiction penale romaine en examinant I' objetdes quaestiones perpetuae creees entre le Il" et le I"s. avo J.-C. La majorite des cours penalespermanentes a effectivement pour tache de se prononcer sur des forfaits touchant a la marchedes institutions et a la vie civique. Parmi les crimes sanctionnes par ces tribunaux publics, ontrouve : l'extorsion de fonds durant l'exercice d'une charge publique (quaestio de repetundis),la corruption et la fraude electorales (de ambitus, l'offense aux interets supremes de I'Etat et a ladignite de ses representants (de maiestate), le detournement d'argent public (de peculatu), enfinle faux monnayage et la falsification de testaments (dejalsis).
Meme la legislation criminelle sur les meurtres (de sicariis et veneficis) et les actes deviolence (de vi) porte, en realite, sur des faits commis aux depens de la stabilite politi que del'Etat. Malgre leur elargissement - des la fin de la Republique et au cours de l'epoqueimperiale - a des actes de violence ordinaires commis entre prives52, le but premier de ces loisn ' etait pas de reprimer en general les crimes de droit commun, mais de lutter specifiquementcontre les crimes qui avaient une portee politique. Ainsi, l'objet principal de la Lex Cornelia desicariis et veneficis, qui punissait le port d'armes avec intention frauduleuse ainsi que lesmeurtres et les incendies crapuleux, fut de circonscrire l'activisme de bandes armees et deneutraliser les agitateurs politiques", Promulguee dans le contexte trouble des affrontementscivils entre marianistes et partisans de SyIIa, cette loi visait d'abord a prevenir les assassinats
50 II semble, en outre, que la culpabilite du fils ait dfi etre prouvee par le pere devant le tribunal du magistrat ; cf. ULP.(1 de adult.) Dig. 48,8,2 : 1nauditum jilium pater occidere non potest, sed accusare eum apud praefectumpraesidemve provinciae debet.51 PAUL. Sent. 5,23,8-9 : Qui latronem caedem sibi inferentem vel alias quemlibet stupro occiderit, puniri nonplacuit : alius enim vitam, alius pudorem publico facinore defenderunt. Si quis furem nocturnum vel diurnum, cum setela defenderet, occiderit, hac quidem lege non tenetur : sed melius fecerit, si eum comprehensum transmittendum adpraesidem magistratibus obtulerit.52 Pour l'application de ces lois criminelles it partir de cas concrets connus par les plaidoyers ciceroniens,cf. RIGGSBY, op. cit. (voir ci-dessus n. 2), p. 50-119.53 J.-L. FERRARY, « Lex Cornelia de sicariis et veneficis », Athenaeum, 79, 1991, p. 417-434, en particulier p. 420-423. cr. Roman Statutes, II, p. 749-753, nO 50.
- 231 -
C. BRELAZ
politiques et a retablir la paix civile54. De meme, la legislation julienne de vi, en limitant Ie droitd'association, etait dirigee contre Ie risque d'emeutes et de complots politiquesf'.
Parmi toutes les lois s' attachant a preserver Ie cours regulier des institutions et Iederoulement de la vie politique, on note deux cas ou l'attention du legislateur s'est porteeexpressement sur des actes de violence perpetres entre particuliers, sans que ces faits aientvisiblement de consequences directes sur la sauvegarde de l'Etat. II s'agit de la legislation deparricidiis, qui prevoit des peines pour qui tue l'un de ses parents, et de la legislation de iniuriis,qui sanctionne I'usage de la violence dans les cas de violation de domicile. Pour ces deux typesde delits, I'intervention de l'Etat dans la fixation du chatiment est motivee par la gravite dudommage et la dimension symbolique de celui-ci. Dans Ie cas du parricide, Ie tabou social etmoral du meurtre d'un parent est si fort que la collectivite s'octroie la responsabilite de punir cecrime a travers des institutions judiciaires publiques ". Quant aux coups et blessures en cas deviolation de domicile, l'Etat se posait, en sanctionnant ce type de delits, en garant de la proprieteprivee ".
Le soin que porte l'Etat romain a la repression des crimes mettant en peril l'exercice dupouvoir se confirme sous Ie Principato En matiere de legislation criminelle, en effet, lajuridiction imperiale etend en priorite les dispositions relatives a la protection de la dignite et dela securite de l'Etat et du prince, ainsi qu'a la prevention des revoltes (Lex Julia maiestatis etLex Julia de Vi)58.De meme, la repression telle qu'elle est menee par les magistrats de l'empireen vertu de la procedure extra ordinem touche une categoric definie d' actes delictueux. II s' agitprincipalement de crimes qualifies, tels que I' assassinat en serie, Ie banditisme, Ie brigandage,l'incitation a la revolte, Ie sacrilege, Ie vol 59. Le gouvemement imperial ne legifere pas sur lasanction des meurtres isoles, les homicides de droit commun. On en deduit que, pour Ie regime,la lutte contre la violence a essentiellement pour but de contenir et d'eliminer les opposants al'ordre politique et moral prone par Ie Principat'", Autrement dit, les autorites imperiales se
541. D. CLOUD,«The primary purpose ofthe lex Cornelia de sicariis », ZRG, 86, 1969, p. 258-286.55 J. D. CLOUD,« Lex Iulia de vi : Part 1-2 », Athenaeum, 66, 1988, p. 579-595; Athenaeum, 67, 1989, p. 427-465.Cf. Roman Statutes, II, p. 789-792, n° 62. Comparer Ie titre 47,22 du Digeste (De collegiis et corporibus).56 Voir Ie titre 48,9 du Digeste (De lege Pompeia de parricidiis). Cf. E. M. LASSEN, « The Ultimate Crime.Parricidium and the Concept of Family in the Late Roman Republic and Early Empire », C&M, 43,1992, p. 147-161;R. A. BAUMAN,Crime and Punishment in Ancient Rome, 1996 (Londres /New-York), p. 30-32.57 SANTALUCIA,op. cit. (voir ci-dessus n. 5), p. 151-152. Sur la portee publique des actes de violence perpetres lars delitiges fanciers, cf. J. ANNEQUIN,« La civitas, la violence et la loi », Index, 20, 1992, p. 1-11. Sur l'engagement del'Etat dans la defense de la propriete privee, cf. L. LABRUNA,« Les racines de l'ideologie repressive de la violencedans l'histoire du droit romain », Index, 3, 1972, p. 525-538.58 R. A. BAUMAN,The Crimen Maiestatis in the Roman Republic and Augustan Principate, 1967 (Johannesburg), enparticulier p. 266-292 ; M. CORBlER, « Maiestas domus Augustae », Varia epigraphica. Atti del ColloquioInternazionale di Epigrajia, Bertinoro, 8-10 giugno 2000, ed, par G. ANGELIBERTINELLIet A. DONATI,Epigrajia eAntichita, 17,2001 (Faenza), p. 155-199.59 Cf. ULP. (7 de off proc.) Dig. 1,18,13pr: Congruit bono et gravi praesidi curare, ut pacata atque quieta provinciasit quam regit. Quod non difJicile obtinebit, si sollicite agat, ut malis hominibus provincia careat eosque conquirat :nam et sacrilegos, latrones, plagiarios, fures conquirere debet et prout quisque deliquerit in eum animadvertere,receptoresque eorum coercere, sine quibus latro diutius latere non potest.60 Cf. PAUL. (13 ad Sab.) Dig. 1,18,3 : nam et in mandatis principum est, ut curet is, qui provinciae praeest, malishominibus provinciam purgare ... Dans cette perspective, sur la place de la figure du latro dans I'ideologie imperiale,cf. C. WOLFF, Les brigands en Orient sous le Haut-Empire romain, Coil. EFR, 308, 2003 (Rome), p. 7-23Th. GRUNEWALD,Rauber, Rebellen, Rivalen, Rdcher. Studien zu latrones im Riimischen Reich, 1999 (Stuttgart).
- 232-
LUTTER CONTRE LA VIOLENCE A ROME
servent de la legislation criminelle pour affirmer et imposer I' ordre politique necessaire a lasurvie du regime.
3) Bien que, dans la procedure extra ordinem, la responsabilite d'engager une enqueteen matiere criminelle repose sur l'Etat, les moyens dont disposent les magistrats pour accomplircette tache demeurent limites. L'appareil judiciaire lui-meme est fort restreint et il se borne,pour l'essentiel, a la personne du magistrat, entoure de son personnel administratif et de sesappariteurs?'. On ne trouve pas, dans l'Etat imperial, d'equivalent de notre ministere public oude nos procureurs. De plus, les taches judiciaires du magistrat, quoique predominantes, ne sontpas les seules qui lui incombent. Car le magistrat, qui fait office de juge le cas echeant, n' est pasun professionnel et il ne peut consacrer la totalite de ses efforts a la juridiction. Dans lesprovinces, les gouverneurs, qui representent - a I'echelle provinciale -T'autorite juridictionnellesupreme, ne sont secondes que par quelques dizaines de soldats detaches dans leur ofjicium pouretre affectes a des taches judiciaires (cornicularii, commentarienses, beneficiarii, etc.)62. Pour lereste, les autorites provinciales s'appuient sur la collaboration des magistrats municipaux'", quisont tenus de deferer au tribunal du gouverneur les prevenus accuses d'un crime punissabled 'une peine depassant les attributions juridictionnelles des communautes locales (ce qui estevidemment Ie cas pour les meurtriers)".
En outre, il n'existe pas, dans l'Etat romain a I'epoque imperiale, d'organe autonome- comparable a la police dans l'Etat moderne - qui puisse servir d'auxiliaire a la justice en seconsacrant exclusivement a la surveillance de l'ordre public et aux enquetes criminelles. Certes,des taches de nature policiere sont confiees a certaines categories de soldats (comme lesstationarii'i' et certains ofjiciales), mais elles visent avant tout la protection des interetsstrategiques de l'Etat a l'interieur des provinces (reseau routier, postes de douanes, proprietesimperiales), non la repression du crime en general. Quant au service d'ordre dans l'Urbs, assurepar des troupes militaires (cohortes pretoriennes, cohortes urbaines, cohortes de vigiles), il apour mission principale d'empecher les emeutes et de garantir militairement la primaute duprince a la tete de l'Etat66. On comprend, dans ces conditions, l'importance prise par la figure dudenonciateur (delator) dans la societe romaine d'epoque imperiale'". En informant les autoritesdes crimes - surtout politiques - qui ont ete commis par des prives et qui sont punissables parl'"Etat, les delateurs suppleent a I'exiguite des infrastructures policieres etatiques. En depit du
61 Sur les taches policieres des appariteurs, souvent de condition servile, cf. A. WEISS, Sklave der Stadt.Untersuchungen zur offentlichen Sklaverei in den Stddten des Romischen Reiches, Historia Einzelschriften, 173,2003(Stuttgart), p. 102-116.62 Pour lcs fonctions policieres des soldats faisant partie de l'officium du gouverneur, cf. J. NELIS-CLEMENT,Lesbeneficiarii : militaires et administrateurs au service de I 'Empire (I" s. a.C. - Vf s. p.Ci), 2000 (Bordeaux), p. 211-268.63 Pour les competences policieres des magistrats municipaux (dans le cas des cites grecques d'Asie Mineure),cf. C. BRELAZ, La securite publique en Asie Mineure sous le Principat (I" - ur: s. ap. J.-C). Institutionsmunicipales et institutions imperiales dans I 'Orient romain (sous presse).64 Voir, dans ce sens, les prescriptions adressees par les autorites provinciales et imperiales aux magistratsmunicipaux de police (en l'occurrence les irenarques dans les cites d'Asie Mineure) : MARCIAN.(2 de iud. publ.)Dig. 48,3,6.65 M. F. PETRACCIALuCERNONI,Gli stationarii in eta imperiale, 2001 (Rome).66 H. MENARD,Maintenir l'ordre a Rome (If-IV siecles ap. J.-C), 2004 (Seyssel), p. 26-34.67 S. H. RUTLEDGE,Imperial Inquisitions. Prosecutors and Informants from Tiberius to Domitian, 2001 (Londres INew-York).
- 233 -
C. BRELAZ
caractere inquisitoire de la procedure extra ordinem, la denonciation de la part d'un tiers etaitsouvent necessaire au declenchement de la poursuite judiciaire'".
En resume, je dirai que, meme si cela avait ete dans ses intentions, l'Etat imperial n'etaitobjectivement pas dote d'infrastructures judiciaires et policieres suffisamment etoffees pourmener une politique concertee de lutte contre la violence. Je n'entends toutefois pas decelerdans ce fait une faiblesse structurelle de l'Etat romain, ni souligner, par cette remarque, uneeventuelle carence des pouvoirs publics a Rome. Je souhaiterais simplement suggerer que lenombre et la forme des moyens mis en ceuvre par les pouvoirs publics afin de lutter contre laviolence sont precisement revelateurs de I'idee que l'Etat romain se faisait de sa mission enmatiere de securite publique. II ne fait pas de doute que, lorsque les interets de l'Etat sont en jeuet qu'il s'agit de reprimer des crimes de nature politique, les autorites interviennent toujoursavec promptitude. La multiplication, au cours de I'epoque imperiale, des proces de maiestate'";l'augmentation du recours a la torture judiciaire parmi les moyens d'inquisition a la dispositiondes magistrats 70, Ie durcissement des peines et I' extension des conditions de leur application 71,
Ie developpement de l'institution carcerale comme outil repressif'" ou encore l'existenced' agents militaires charges de missions speciales de police (frumentarii) 73 en sont autantd'illustrations. En revanche, il n'est pas certain que les pouvoirs publics se soient montres aussiprompts a reagir lorsqu' on leur signalait un acte de violence ou un meurtre perpetre entreparticuliers. A ce propos, la documentation papyrologique egyptienne nous fait connaitre de tresnombreuses plaintes de particuliers revelant des actes de violence entre prives qui sont adresseesa des fonctionnaires de police locaux, ou a des officiers romains dans les regions ou stationnentdes militaires". Mais il nous est difficile d'estimer les suites qui etaient reellement donnees parles pouvoirs publics aces demandes d'intervention. Quoi qu'il en soit, les autorites centralesromaines ne se preoccupaient en principe pas de reprimer la delinquance et la criminaliteordinaires a linterieur des provinces. La responsabilite de veiller a la securite publique sur leplan local etait laissee a la discretion des autorites municipales 75.
68 Sur Ia place de Ia composante accusatoire, formelle ou non, dans Ia procedure extra ordinem, cf Y. RIVIERE,Lesdelateurs sous I 'Empire romain, BEFAR, 31 1,2002 (Rome), p. 263-305.69 L. SOLIDOROMARUOTTI,« La disciplina del crimen maiestatis tra tardo antico e medioevo », Diritto e giustizia nelprocesso. Prospettive storiche, costituzionali e comparatistiche, ed. par C. CASCIONEet C. MASI DORIA, 2002(Naples), p. 361-446.70 Y. THOMAS,« Les procedures de la majeste, La torture et l'enquete depuis les Julio-Claudiens », Melanges de droitromain et d'histoire ancienne. Hommage d la memoire d'Andre Magdelain, ed. par M. HUMBERTet Y. THOMAS,1998 (Paris), p. 477-499.71 W. RIEss, « Die historische Entwicklung der rornischen Folter- und Hinrichtungspraxis in KulturvergleichenderPerspektive », Historia, 51, 2002, p. 206-226.72 J.-V. KRAUSE,Geflingnisse im Riimischen Reich, HABES, 23,1996 (Stuttgart), p. 133-135.73 M. CLAUSS,Untersuchungen zu den principales des rdmischen Heeres von Augustus bis Diokletian. Cornicularii,speculatores,frumentarii, 1973 (Bochum), p. 82-113.74 R. ALSTON, Soldier and Society in Roman Egypt. A social history, 1995 (Londres / New-York), p. 74-101.Cf. B. ANAGNOSTOU-CANAS,« La documentation judiciaire penale dans l'Egypte romaine », MEFRA, 112, 2000,p.753-779.75 Dans les provinces ou regions ou des troupes sont stationnees et dans lesquelles les autorites romaines ne peuventasseoir leur domination sur des entites poiitiques de type civique (TTOAlS', civitas), Ie maintien de l'ordre semble avoirete pris en charge par des responsables militaires. C'est ce que revelent en particulier I'exemple egyptien, mais aussides papyrus recernment publies d' Arabie et de Syrie (P.Bostra I ; P.Euphrates 2, 5). Ces conditions specifiques - envigueur principalement dans des zones peripheriques, imparfaitement pacifiees ou abritant des possessions
- 234-
LUTTER CONTRE LA VIOLENCE A ROME
4) La repression criminelle et le maintien de l'ordre public ne sont pas consideres, sousIe Principat, comrne des prerogatives de l'Etat. L'emprise des pouvoirs publics sur ces activitesn'est pas, a I'epoque imperiale, un fait definitivement acquis et inconteste, II arrive, en effet, quedes particuliers prennent l'initiative de contribuer a titre prive au maintien de l'ordre public surIe plan local. Et je ne parle pas seulement ici des mesures d'autodefense, immediates (usage deIa legitime defense) ou permanentes (port d'arme, recrutement de gardes prives et d'homrnes demain "), que des particuliers peuvent prendre pour leur propre survie. On observe aussi,episodiquement, l' apparition de milices privees qui entendent faire regner l' ordre dans uneregion donnee, a proximite des proprietes des comrnanditaires de ces troupes. Seulement desabus sont souvent comrnis de la part de ces milices et ce qui devait etre a l'origine une me sured'autodefense se transforme en pratiques « mafieuses » confinant au banditisme. C'est, semble-t-iI, le cas en Italie du vivant meme d' Auguste, aux dires de Suetone, tandis que des voyageurssont enleves dans les campagnes pour alimenter la rnain-d'ceuvre servile des grandsproprietaires 77. Le plus souvent, les autorites imperiales cherchent a desagreger et a limiterl'influence de ces bandes armees, Une telle reaction de la part des autorites imperiales suggereque, meme si le monopole etatique de la force publique n'est pas un principe emis positivement,l'Etat tend du moins a ce monopole sous le Principat et veille a eliminer ce qu'il considerecomme des usurpations a sa souverainete.
Dans d'autres cas, en revanche, les pouvoirs publics encouragent, voire recherchent, laparticipation de prives a la defense de la securite collective. Je rappellerai ici l'extrait deTertullien mentionne plus haut, ou l'auteur affirme que « contre les personnes coupables delese-majeste et les ennemis d'Etat, chaque homrne est un soldat »78. Cet axiome evoque lateneur des serments de fide lite que les habitants de l'empire etaient tenus de preter a l'empereur,notamrnent celui que la population du koinon de Paphlagonie a dl1 jurer a Auguste et a sesdescendants, et dont on connait une copie sur pierre affichee dans la cite de Neapolis-Neoclaudiopolis : « s' ils [1'empereur et ses enfants] jugent quelqu'un leur ennemi, Ge jure) de Iepoursuivre et de le charier sur terre et sur mer par les armes et le fer» 79. Un edit des empereurs
irnperiales - ne sauraient passer pour une politique generale des autorites centrales valable pour I'ensemble del'empire.76 W. RIESS, Apuleius und dieRduber. Ein Beitrag zur historischen Kriminalitdtsforschung, BABES, 35, 2001(Stuttgart), p. 181-182. Voir Ie cas des fugitivarii, sorte de chasseurs de primes employes par les proprietaires pourretrouver leurs escIaves fugitifs : cf. Y. RIVIERE,« Recherche et identification des escIaves fugitifs dans l'Empireromain », L'information et la mer dans Ie monde antique, ed. par J. ANDREAUet C. VIRLOUVET,Coli. EFR, 297, 2002(Rome), p. 115-196, en particulier 183-192.77 SUET. Aug. 32,1 : Pleraque pessimi exempli in perniciem publicam aut ex consuetudine licentiaque bellorumcivilium duraverant aut per pacem etiam extiterant. Nam et grassatorum plurimi palam se ferebant succincti ferro,quasi tuendi sui causa, et rapti per agros viatores sine discrimine liberi servique ergastulis possessorumsupprimebantur, et plurimae factiones titulo collegi novi ad nullius non facinoris societatem coibant. Igiturgrassaturas dispositis per opportuna loca stationibus inhibuit, ergastula recognovit, collegia praeter antiqua etlegitima dissoluit. Pour les plagiarii, specialises dans Ie rapt d'esclaves et d'hommes libres, et les especes de prisonsprivees que sont les ergastula, cf. KRAusE, op. cit. (voir ci-dessus n. 72), notamment p. 28, 61, 134.78 TERT. Apol. 2,8 : in reos maiestatis et publicos hostes omnis homo miles est.79 OGIS 532 = ILS 8781, 1. 23-25 : ou,;- TE QV E:KX8pOV';-nurol Kplv[wcnv, TovJITov,;-KaTcl yijv Kal 8ciAaaaav(rTTAo[l';-TE] I Kal aloTjpwl 8lW~ElV Kat Uj..lVVEla[8m](texte et traduction de F. CUMONTin Studia Pontica, III,Recueil des inscriptions grecques et latines du Pont et de l'Armenie, 1910 (Brnxelles), p. 75-86, n° 66); cf. ClL 11172= ILS 190, 1. 5-10 : Ex mei animi sententia, ut ego iis inimicus / ero, quos C. Caesari Germanico inimicos esse /
- 235 -
C. BRELAZ
Valentinien II, Theodose et Arcadius, date de l'an 391 et adresse a l'ensemble des habitants desprovinces, va dans Ie meme sens en incitant les particuliers a se venger aussit6t d'un malfaiteurqui constituerait un danger pour la societe, y compris lorsque l'auteur des depredations est unsoldat'". La meme idee est repetee par les empereurs Arcadius, Honorius et Theodose II en 403dans une constitution au prefet du pretoire d'Occident : « Que chacun sache qu'a l'encontre desbrigands publics et des deserteurs de l'armee lui est concede le droit de proceder a unevengeance publique au nom de la securite commune »81. Hormis ces principes juridiquesgeneraux visant a associer les populations locales a la lutte contre l'insecurite, le concours departiculiers a la defense de l'Etat est parfois expressement sollicite de la part des autoritesromaines, en particulier lorsque les moyens font defaut aux pouvoirs publics et que la gravite dela menace a des repercussions sur la souverainete de l'Etat. Je citerai, a titre d'exemple, ledossier epigraphique d'Ovacik, site appartenant au territoire de la cite de Termessos en Pisidie(Asie Mineure), qui se refere a des evenements s'etant passes dans les annees 270-28082. Cesannees correspondent a une periode troublee pour la region meridionale de l' Anatolie suite auxattaques repetees et massives de la part de tribus isauriennes (considerees comme des brigands)contre de nombreuses cites. Or on apprend des inscriptions d'Ovacik que des officiers romainsont adresse des lettres a des notables locaux pour leur demander de lever une troupe dans leurcite afin de preter main-forte a des detachements militaires romains occupes a deloger unebande de brigands de la ville de Cremna.
L'implication de particuliers dans des operations de maintien de l'ordre est unphenomene qui va grandissant au cours de l' Antiquite tardive. Du fait des mutations qui, a cetteepoque, affectent la composition des elites locales et le fonctionnement des institutionsmunicipales, les grands proprietaires s' octroient de plus en plus de pouvoirs aux depens desautorites centrales et se positionnent en autorite politique de reference sur Ie plan local. Cetteevolution est symptomatique du passage a une societe de type feodal, ou emergent des potentats
cognovero, et si quis periculum ei salutiq(ue) eius / in[fJert in[fJer[etjque, armis bello internecivo / terra mariq(ue)persequi non desinam, quoad / poenas ei persolverit (serment a Caligula des habitants d' Aritium en Lusitanie). Pourla forme et la signification de ces serments de loyaute, cf. P. HERRMANN,Der romische Kaisereid. Untersuchungenzu seiner Herkunft und Entwicklung, 1968 (Gottingen).80 Cod. Theod. 9,14,2 (= Cod. lust. 3,27,1) : Liberam resistendi cunetis tribuimus facultatem, ut quicumque militumvel privatorum ad agros noeturnus populator intraverit aut itinera frequentata insidiis adgressionis obsederit,permissa cuicumque licentia dignus ilieo supplicio subiugetur ac mortem quam minabatur excipiat et id quodintendebat incurrat. Melius enim est occurrere in tempore, quam post exitum vindicare. Vestram igitur vobispermittimus ultionem et, quod serum est pun ire iudicio, subiugamus edicto : nullus parcat militi, cui obviare telaoporteat ut latroni.81 Cod. lust. 3,27,2 (cf. Cod. Theod. 7,18,14) : Cuncti etenim adversus latrones publieos desertoresque militiae iussibi sciant pro quiete communi exercendae publicae ultionis indultum. Pour le contexte politique, juridique et socialdans lequel ces constitutions ont ete promulguees, cf. P. JAILLETTE,« Brigands et voleurs de betail dans lescampagnes de I'Antiquite tardive. Le temoignage du Code Theodosien », Histoire & Societes Rurales, 14, 2000,p. 169-199 ; L. LOSCHIAVO,« Autodifesa, vendetta, repressione poliziesca. La lotta al brigantaggio nel passaggiodalle province tardo-imperiali ai regni romano-barbarici», II diritto giustinianeo fra tradizione classica e innovazione,ed, par F. BOTTA, 2003 (Turin), p. 105-133.82 M. BALLANCEet Ch. ROUECHE,«Appendix 2. Three Inscriptions from Ovacik », in M. HARRISON,Mountain andPlain. From the Lycian Coast to the Phrygian Plateau in the Late Roman and Early Byzantine Period, ed, parW. YOUNG,2001 (Ann Arbor), p. 87-112. Cf. S. MITCHELL,« Native rebellion in the Pisidian Taurus », OrganisedCrime in Antiquity, ed, par K. HOPWOOD,1999 (Londres), p. 155-175.
- 236-
LUTTER CONTRE LA VIOLENCE A ROME
locaux se substituant progressivement a l'Etat central 83. Diverses ordonnances imperiales (dontplusieurs des Novelles de Justinien) sont consacrees, au Ve et au Vl" s., a reduire la marge demanceuvre et l'influence de ces milices privees'", ainsi qu'a restreindre la sphere d'action dessortes de tueurs a gages employes par les gouvemeurs et divers officiels pour des operations demaintien de l'ordre a l'interieur des provinces'". Le nombre de ces reactions imperiales montrel'ampleur du probleme et indique que la juridiction criminelle publique est alors concurrenceelocalement par I'activite de justiciers prives'".
Conclusion: maintenir l'ordre public, une competence etatlque it Rome?
Que retenir de ce bref examen des attributions de l'Etat romain dans le domaine de lalutte contre la violence au fil de l'histoire constitutionnelle de Rome? Trois observationsresumeront mon propos.
Premierement, les competences des pouvoirs publics en matiere de lutte contre laviolence ont beaucoup varie en fonction des changements institutionnels et politiques. Laposition de l'Etat romain face a la criminalite n'a pas ete immuable, car elle ne repondait pas aun principe moral ou legal positivement etabli. Les differentes attitudes que l'Etat romain aadoptees envers la criminalite au cours du temps sont revelatrices des attentes que la collectivitea successivement manifestees a I' egard des pouvoirs publics. L' ampleur et les formes del' engagement de l'Etat dans la repression de la criminalite ont done dependu des ambitions despouvoirs publics et de l'image qu'on se faisait du role de ceux-ci a chacune des periodes deI"histoire institutionnelle de la res publica.
Deuxiemement, a aucun moment de son histoire, la lutte contre la violence civile n'arepresente un monopole pour l'Etat romain. Malgre la tendance generale qu'on est en mesure dereconnaitre et qui plaide pour un accroissement graduel des cornpetences etatiques en matiere
83 Cf. K. HOPWOOD,« Bandits between grandees and the state. The structure of order in Roman Rough Cilicia »,Organised Crime in Antiquity, M. par K. HOPWOOD,1999 (Londres), p. 177-206.84 Sur ces milices privees (bucellarii, 8oPV¢OPOL,etc.), cf. Ch. LECRIVAIN,«Etudes sur Ie Bas Empire. III. Les soldatsprives du Bas Empire », MEFR, 10, 1890, p. 267-283 (on se gardera toutefois des propos moralisants de I'auteur surl'intrusion « dans une societe civilisee [de] pratiques d'une epoque barbare » a propos du recours de plus en plusfrequent a des troupes armees de la part de prives) ; D. FEISSELet 1. KAYGUSUZ,«Un mandement imperial du VI" s.dans une inscription d'Hadrianoupolis d'Honoriade », T&MByz, 9, 1985, p. 397-419 (SEC 35 [1985] 1360 = AE1985, 816 : ordonnance imperiale, due probablement a Justinien, Iimitant Ie nombre et l'armement des hommes demain au service des proprietaires terriens de Paphlagonie) ; J.-J. AUBERT,« Policing the countryside: Soldiers andcivilians in Egyptian villages in the third and fourth centuries A.D. », La hierarchie (Rangordnung) de l'armeeromaine sous le Haut-Empire, ed, par Y. LE BOHEC,1995 (Paris), p. 257-265 (sur I'engagement croissant des privesdans le maintien de l'ordre en Egypte des Ie IVe s.) ; AE 2001, 1997 (riparii au service de grands proprietaires dansI'Egypte du Vie S.).85 Novell. lust. 8,12,1 ; 8,13 (535) ; 28,6 (535) ; 29,5 (535) ; 128,21 (545) ; 134,1 (556). Ces personnages, portant Ienom de Al]aTo8LlDKTaL(latronum insecutores) ou de ~LOKWADTaL(violentiarum inhibitores), sont accuses de secomporter arbitrairement envers les provinciaux.86 Cf. A. LEWIN,« Ius armorum. Polizie cittadine e grandi proprietari nell' Oriente tardoantico », Atti dell 'AccademiaRomanistica Costantiniana. IX Convegno internazionale, 1993 (Naples), p. 375-386.
- 237-
C. BRELAZ
criminelle depuis Ie debut de la Republique jusqu'au Principat, cette evolution n'a jamais aboutia une mainmise totale des pouvoirs publics sur la repression criminelle. Meme a I' epoqueimperiale, ou la securite publique est une preoccupation declaree du regime et ou lescompetences de l'£tat dans la repression criminelle sont les plus etendues grace a la procedureinquisitoire, l'£tat n'a pas l'exclusivite de l'expression de la justice et de la force. A l'inverse dela guerre et des moyens militaires deployes pour combattre l' ennemi exterieur, qui constituentun monopole d'£tat87, la responsabilite de proteger les citoyens contre leurs semblables n'estpas entierement deleguee aux pouvoirs publics a Rome. C'est pourquoi il faut compter, en lamatiere, avec les initiatives et les mesures prises par les particuliers.
Troisiemement, la repression criminelle n'est pas percue comme une prerogative d'Etata Rome et Ie maintien de l'ordre public n'est pas envisage comme l'une de ses finalites, L'£tatne se propose pas de lutter par tous les moyens contre les actes de violence perpetres entreprives et il ne pretend pas garantir la securite de chacun des citoyens. Le seul typed'agissements contre lesquels les pouvoirs publics se soient toujours engages avec fermete aRome, en prenant soin de developper des instruments penaux et judiciaires adequats, sont lesatteintes portees a l'encontre des interets de l'£tat. Aux yeux des autorites, l'ordre publicconsiste a prevenir les troubles graves ou repetes de la securite collective (emeutes, banditisme,actes de brigandage) et a eliminer les menaces pesant sur l'integrite de l'£tat (complots,opposition politique), c'est-a-dire sur la survie des institutions et de ses representants. Parconsequent, la repression des crimes de droit commun, qui demeurent des actes individuels etisoles et qui ne forment pas de danger pour les pouvoirs publics, n'entre pas dans les prioritesd'action de l'£tat.
Ces remarques m'amenent a reaffirmer ce qui apparait comme une evidence, mais qu'ilfaut garder a l'esprit lorsqu'on aborde Ie sujet du maintien de l'ordre a Rome: l'£tat romainantique n'a pas des competences aussi nombreuses et elargies que l'£tat modeme et laconception de l'ordre public ne recouvre pas les memes realites dans un cas et dans l'autre.Nous ne devons pas oublier que la police est une creation du Xvll" S., typique des orientationsabsolutistes de l'£tat modeme et symptomatique de la multiplication de ses prerogatives et durenforcement de ses pouvoirs'". Si l'£tat romain ne s'est pas dote d'instruments pluscontraignants pour lutter contre la violence civile'", c'est que I'idee meme d'un controleetatique total dans ce domaine etait etrangere aux mentalites romaines'". Ces considerationsdevraient nous rendre attentifs au fait que l'ordre public est une notion relative, une norme dont
87 Crc, Pis. 50; Marcian. (14 inst.) Dig. 48,4,3. Ce monopole etatique de la guerre n'est pas originel it Rome et desentreprises militaires conduites par des prives etaient encore tolerees durant la haute epoque republicaine :cf. D. TiMPE, « Das Kriegsmonopol des romischen Staates », Staat und Staatlichkeit in der friihen riimischenRepublik, ed, par W. EDER,1990 (Stuttgart), p. 368-387.88 P. NAPOLI,Naissance de la police moderne. Pouvoir, normes, societe, 2003 (Paris). Sur la centralisation desinstitutions de police dans le royaume de France au XVIIe s. par opposition aux traditions municipales en vigueur enCastille, cf. 1. HAUTEBERT,« Le maintien de l'ordre en France et en Castille sous la monarchie absolue. Prevote desmarechaux et "hermandades" », RD, 79, 2001, p. 31-55.89 Cf. K. HOPWOOD,«Aspects of Violent Crime in the Roman Empire », Thinking Like a Lawyer. Essays on LegalHistory and General History for John Crook on his Eightieth Birthday, ed. par P. McKECHNIE, Mnemosyne Suppl.,231,2002 (Leyde), p. 63-80.90 W. NIPPEL,Public Order in Ancient Rome, 1995 (Cambridge), en particulier p. 1-3,30-46, 113-119 (comparaisonavec d'autres societes pre-modemes).
- 238-
LUTTER CONTRE LA VIOLENCE A ROME
la definition et Ie contenu varient en fonction du lieu et de I'epoque'". Elles devraient surtoutnous dissuader de juger I'Etat romain a I'aune de l'Etat moderne.
91 Voir, it ce propos, les remarques methodologiques de L. SOLIDORO MARUOTTI, « La repressione della criminalitaorganizzata nel diritto romano. Criteri eli impostazione della ricerca », Juris vincula. Studi in onore di MarioTalamanca, VIII, 2001 (Naples), p. 33-77.
- 239-