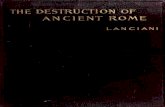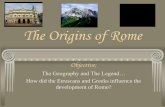Les antoniniens de Julia Domna au buste sans croissant émis dans l’atelier de Rome en 215
Tullus Hostilius fondateur de Rome
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Tullus Hostilius fondateur de Rome
VITA LATINAAnno MMXIV No 189-190
INDEXGiambattista Cairo Tullus Hostilius fondateur de Rome . . . . . . . . . . 5
Sophie Aubert-Baillot L’influence de la disputatio in utramque partemsur la correspondance de Cicéron. . . . . . . . . . . . . 21
Jacques-EmmanuelBernard
Lettres et discours : la persona de Cicéron aprèsl’exil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
VéroniqueLéovant-Cirefice
Les lettres de l’exil dans la correspondance deCicéron : une thérapie de la douleur ? . . . . . . . . . 54
Marie Ledentu Labor poétique et res gestae Caesaris : poésie etrefondation dans les Géorgiques . . . . . . . . . . . . . . 70
François Ripoll Une lecture de l’épisode du jardinier de Tarente(Virgile, Géorgiques IV, 116-148) . . . . . . . . . . . . . 89
EmmanuelleCimolino-Brébion
Scipion l’Africain chez Tite-Live : remarquessur le portrait d’un jeune général excep-tionnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Jérôme Lagouanère Les usages du stoïcisme dans le De spectaculiset le De pallio de Tertullien. . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Paul Mattei Christianisme et philosophie dans le De pallio.Notes cursives sur deux thèmes majeurs dutraité : la foi comme melior philosophia ;nature, coutume et changement . . . . . . . . . . . . . . 149
Agnès Molinier Arbo Le costume en Afrique à l’époque sévérienne :réalités et symboles dans le De Pallio de Ter-tullien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Tatiana Taous Autour de lat. micare / dımicare ¢ La théoriedes matrices métaphoriques au service del’anthropologie et de la reconstruction séman-tique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Pour la suite du sommaire, voir page intérieureRevue publiée avec le concours du C.N.L.et de l’Équipe d’Accueil CRISES (Univ. Montpellier III)
No 189-190 Anno MMXIV
Rev
uepu
blié
eav
ecle
conc
ours
duC.
N.L
.et
del’É
quip
ed’
Acc
ueil
CRIS
ES
(Uni
v.M
ontp
ellie
rII
I)
No
189-
190
Ann
oM
MX
IV
Tullus Hostiliusfondateur de Rome 1
Abstract
On the base of archaeological and literary sources it is possible to state that the originof Rome as urban centre is datable under the reign of Tullus Hostilius. The saga onHoraces and Curiaces is a foundation’s legend.
Quand et comment naquit Rome ? Qui en fut le fondateur et le premiersouverain ? À ces deux questions les Romains avaient une réponse précise. Selonles Romains du ier siècle avant Jésus-Christ, Rome avait été fondée le 21 avril 754av. J.C. par Romulus, qui avait délimité l’aire urbaine par un sillon tracé avec unecharrue. Il avait assuré en outre à la nouvelle ville une population masculine etféminine et avait créé ses principales institutions politiques. Donc Rome auraitété fondée là où rien n’existait, dans une brève période de temps, par undémiurge. Cette idée correspond à la conception que les Romains avaient de laville en tant qu’entité sacrée et juridique ¢ idée qu’ils appliquaient habituelle-ment à la fondation des colonies, qui étaient toujours conçues par les Romainscomme créées ex nihilo, même si cela avait lieu là où il y avait déjà desétablissements humains. En ce cas, ce qui compte n’est pas l’existence d’une villeplus ancienne, mais les rites qui accompagnaient la création des colonies, en leurdonnant une nouvelle signification sacrée et juridique. Pour cette raison, il esttoujours possible de rappeler la date exacte de leur fondation, qui est le jour oùle président de la commission chargée de la déduction accomplissait le rite avecla charrue, même s’il se déroulait sous une forme exclusivement symbolique 2.
1. Je remercie le professeur P.M. Martin pour ses précieux conseils et pour la traduction demon texte en français. Cet article est la suite de « Quelques considérations sur les sept rois deRome », Vita Latina, 187-188, 2013, p. 3-17.
2. G. Cairo 2012.
No 189-190, 2013, p. 5-20.
Cependant, à côté de ce niveau sacré et juridique, on doit considérer aussi uneconception différente de la ville, où ce n’est pas sa création ex nihilo qui importe,mais son existence en tant que résultat d’un processus historique de longuedurée. Les Romains eux-mêmes étaient bien conscients de ce point de vue,comme le montrent non seulement les légendes selon lesquelles d’autres établis-sements, sur le Palatin 3 et sur le Capitole 4, avaient précédé la ville fondée parRomulus, mais aussi l’affirmation de Caton, selon laquelle l’État romain n’avaitpas été constitué en un seul temps et par un homme seulement 5. Dans ce secondcas se pose donc le problème d’établir le moment à partir duquel on peut donnerà Rome le nom véritable de ville. Sur ce point nous ne trouverons pas de réponsedans les rites de fondation des villes, car ce qui intéressait les Romains, c’étaitjustement le seul niveau du sacré et du juridique. Il faut alors se tourner vers lesthéories modernes. Un point de départ utile peut être, par son ampleur et saprécision, la définition de la ville donnée par J. Martínez-Pinna Nieto, quiaffirme que, pour définir la ville, il faut
... la institución de una divinidad poliada ; la nueva definición de la figura del rey, quedeja de ser el jefe de una federación gentilicia para convertirse en el gobernante de unacomunidad política ; la institución de un ejército ciudadano, superación de las antiguasformaciones guerreras de naturaleza gentilicia ; la integración del campo en el seno dela organización ciudadana, con la preocupación por definir un territorio cívico sufi-ciente para las necesidades primarias ; la constancia de una mayor complejidad social,derivada de una más completa especialización en el trabajo, de la total independenciadel artesano, de la promoción de nuevas categorías sociales, etc., elementos todos ellostendentes a romper el estrecho marco de la organización gentilicia tradicional 6.
Selon le même chercheur, on peut y ajouter l’adaptation du forum à lastructure urbaine et une mentalité municipale à laquelle doit correspondre uncadre institutionnel précis 7.
Notre opinion est que la plupart de ces conditions ont mûri à l’époque dutroisième roi de Rome, Tullus Hostilius. Tout d’abord on doit considérer
3. Liv. I, 7, 3-15.4. Den. Hal. I, 44, 2.5. Caton ap. Cic. De rep. II, 37.6. J. Martínez-Pinna 1996 : 105 : « ... l’institution d’une divinité poliade, la nouvelle
définition de la figure du roi, qui cesse d’être le chef d’une fédération gentilice pour setransformer en gouvernant d’une communauté politique, la constitution d’une armée decitoyens, succédant aux formations militaires antérieures à caractère gentilice, l’intégration dela campagne au sein de l’organisation de la cité, avec la préoccupation de définir un territoire dela cité suffisant aux nécessités premières, la permanence d’une plus grande complexité sociale,dérivée d’une plus grande spécialisation du travail, de la totale indépendance de l’artisan, de lapromotion de nouvelles catégories sociales, etc. ¢ autant d’éléments tendant à briser le cadreétroit de l’organisation gentilice traditionnelle. »
7. J. Martínez-Pinna 2001 : 80-81.
6 giambattista cairo
l’armée, et sur ce point les auteurs anciens donnent très peu d’informations.Tite-Live se limite à constater que Tullus, après avoir déplacé à Rome la popu-lation d’Albe la Longue, la ville sur le Mont Albain qu’il avait détruite, avaitutilisé ses citoyens pour augmenter le nombre des légionnaires et recruter dixnouvelles turmae de cavaliers 8. L’aspect le plus intéressant de cette informationréside dans la référence aux turmae, unités composées de trois decuriae de dixcavaliers chacune. Pour en comprendre l’importance, il faut considérer briève-ment la structure la plus ancienne de l’armée romaine, qui était composée detrois mille fantassins et trois cents cavaliers, issus de trois tribus dans lesquellesétait répartie la population romaine à l’origine. Ces trois tribus formaient la plusancienne assemblée de Rome, les comitia curiata, dont l’unité était la curia,constituée de groupes nobiliaires, c’est-à-dire par le rassemblement de famillesdont l’origine remontait à un ancêtre commun. Chaque tribu comprenait dixcuriae ; par conséquent l’assemblée comptait au total trente curiae. Chacune deces curiae fonctionnait en outre comme centre de recrutement et fournissait àl’armée cent fantassins et dix cavaliers. La référence aux turmae de l’époque deTullus implique donc un système où désormais était brisé le lien nobiliaire entreles composants d’une même tribu. En effet, si auparavant toute tribu avaitses propres centuriae de cavaliers, où étaient représentées dix curiae à raisonde dix cavaliers par curia, pour l’époque de Tullus on doit supposer que dansles nouvelles unités de cavalerie les différentes tribus étaient représentées ennombre égal. Il est probable que chacune des trois decuriae dans laquelle uneturma était répartie était recrutée dans la curia d’une tribu différente, comme cesera le cas à l’époque suivante 9. Certes, on peut objecter qu’il s’agit d’unanachronisme. Mais cela ne change rien au fait que l’attribution, même d’unefaçon indirecte, de ce système à l’époque de Tullus veut souligner un trait deson règne : celui d’avoir commencé à faire diminuer d’importance les liensnobiliaires et tribaux, afin d’affirmer, évidemment, le pouvoir de l’État. Cetteinterprétation se nourrit, comme on verra, d’autres éléments.
Ce qui rend vraisemblable la tradition transmise par Tite-Live à propos desinstitutions militaires de Tullus, c’est aussi la constatation qu’elles réfléchissentbien peu les réformes de l’armée que les sources historiques attribuent auxautres souverains. Selon Tite-Live, Romulus aurait institué les trois premièrescenturiae de cavalerie 10 qui furent ensuite doublées par le cinquième roi deRome, L. Tarquin l’Ancien 11. Dans cette tradition ne sont pas mentionnés lestrois cents cavaliers, qui correspondent au nombre de trois centuriae, que TullusHostilius avait introduits. Que les centuriae de cavalerie furent au nombre de sixsous le règne de Tarquin l’Ancien est confirmé par le fait que, à l’époque
8. Liv. I, 30, 3.9. Fest. (Pauli Excerpta) p. 485 L.10. Liv. I, 13, 8.11. Liv. I, 36, 7-8.
vita latina 7
républicaine elle-même, alors que le nombre de centuriae avait été porté àdix-huit, on réservait aux six centuriae les plus anciennes un rôle spécial dans lescomitia centuriata, l’assemblée populaire qui s’était substituée en importanceaux comitia curiata.
On pourrait objecter à ce qu’on vient d’observer que Tite-Live, à propos duredoublement des centuriae accompli sous le règne de Tarquin l’Ancien, donneensuite une somme totale de mille huit cents cavaliers 12, qui ne correspondentpas à six centuriae, composées de six cents cavaliers. Mais il est probable quel’auteur padouan s’est trompé en attribuant à Tarquin l’Ancien le nombre descavaliers établi à l’époque de l’avant-dernier roi de Rome, Servius Tullius, quandles centuriae furent portées à dix-huit ; à moins qu’on ne veuille repérer danscette incohérence une tradition différente, dont on peut trouver la mémoireencore vive chez Cicéron et une trace plus faible chez Plutarque. Cicéron 13 eneffet reproduit la tradition livienne ; peut-être est-il justement la source utiliséepar Tite-Live. L’historien grec, en revanche, assigne à l’époque de Romulus lestrois premières centuriae de cavalerie, qui furent doublées quand il partagea letrône avec Titus Tatius 14. Si l’on ajoute aux six centuriae susmentionnées lestrois cents cavaliers que Tite-Live fait remonter à Tullus, on obtient par cedoublement le nombre de mille huit cents cavaliers qu’il assigne à Tarquinl’Ancien. Mais il s’agit de spéculations, et il est préférable de garder l’hypothèseque les mille huit cents cavaliers que Cicéron et Tite Live assignent à l’Anciensont le résultat d’une erreur 15.
On doit considérer maintenant le sénat. Dans ce cas aussi les informationsdonnées par les sources pour le règne de Tullus sont insuffisantes. Tite-Live seborne à rendre compte du fait que, après le déplacement des habitants d’Albe laLongue à Rome, Tullus avait fait entrer au sénat de nouvelles familles, dont ilnous donne la liste 16. Cette tradition n’a que peu à voir avec la source qui faitremonter les premiers cent sénateurs à l’époque de Romulus 17, doublés pendantla période où son règne était partagé avec Titus Tatius 18, et enfin augmentés decent autres membres par Tarquin l’Ancien 19. Cette dernière tradition est lerésultat d’un calcul artificiel. Les sénateurs, en fait, étaient choisis curiatim 20,c’est-à-dire en fonction des curiae, et l’on ne peut diviser la somme totale des
12. Liv. I, 36, 7.13. Cic. De rep. II, 35.14. Plut. Rom. XX, 1.15. Il faut souligner d’autre part que, selon Tite-Live, à l’époque de Numa les centuriae de
cavalerie auraient pu être portées à six, si l’on ajoute aux trois créées par Romulus les trois centsceleres dont le premier souverain se serait entouré vers la fin de son règne, Liv. I, 15, 8.
16. Liv. I, 30, 2.17. Liv. I, 8, 7 ; Den. Hal. II, 12, 1-4.18. Plut. Rom. XX, 1 ; Den. Hal. II, 47, 1 ; II, 57, 1.19. Liv. I, 35, 6 ; Den. Hal. III, 67, 1.20. Fest. p. 290 L. ; Den. Hal. II, 47, 1.
8 giambattista cairo
sénateurs (soit cent, soit deux cents) ni par trois (le nombre des tribus), ni partrente (le nombre des curiae) 21. En revanche, cela serait possible si l’on divisaitpar trois un nombre de cent cinquante sénateurs, qui est justement le nombre demembres du sénat que Cicéron considère comme valable pour l’époque précé-dant celle de Tarquin l’Ancien, quand il suppose que le cinquième roi de Romedoubla le nombre des sénateurs 22 jusqu’à trois cents 23. L’existence d’unetradition semblable est confirmée par Denys d’Halicarnasse à propos du règneconjoint de Romulus et de Titus Tatius 24 et par Plutarque à propos de l’inter-règne suivant la mort de Romulus 25. Cette tradition, indépendamment de soninterprétation, pourrait bien appartenir à Tullus Hostilius 26.
À cet égard, ce n’est pas une pure coïncidence si le siège le plus ancien dusénat, quel qu’en fût l’emplacement, portait le nom de Curia Hostilia et siCicéron en faisait remonter l’origine à Tullus Hostilius 27. En contradiction aveccette affirmation de Cicéron, mais seulement en apparence, comme on verrainfra, est la source livienne, où l’on constate que Tullus avait transformé entemplum, un lieu consacré, le siège où les sénateurs se rassemblaient 28. Cetteévolution s’explique seulement en relation avec l’affirmation de la classe sacer-dotale, pour qui il était important de lier la communauté aux divinités et, parconséquent, avec une organisation sociale pyramidale, où le pouvoir religieux ¢qui, à l’époque romaine archaïque, est étroitement lié au pouvoir politique ¢ seconcentrait désormais dans une seule personne. En d’autres termes, Tullusaurait transformé la curia de sa propre gens, les Hostilii, en curia de lacommunauté entière, où se concentrerait le pouvoir, qui avant cette époques’étendait aussi à d’autres familles. En ce sens l’affirmation de Tite-Live coïncideparfaitement avec celle de Cicéron.
C’est Cicéron toujours, dans le même passage où il assigne la création de laCuria Hostilia à Tullus, qui lui attribue aussi l’arrangement du Comitium,c’est-à-dire de l’aire où se rassemblaient les comitia curiata, le cœur de la viepolitique de Rome. Lié topographiquement et d’une façon fonctionnelle à cetemplacement se trouvait le forum. Les sources littéraires et archéologiques
21. Voir J. Martínez-Pinna 1996 : 207. Le système décrit par Denys (II, 12, 1-4) pourexpliquer le choix de cent sénateurs par les curiae n’est pas crédible, si l’on considère qu’unpareil système n’est en mesure d’expliquer ni le sénat de l’époque suivante, composé de deuxcents membres, ni un sénat de trois cents membres.
22. Cic. De rep. II, 35.23. Cf. Den. Hal. III, 67, 1.24. Den. Hal. II, 47, 2.25. Plut. Rom. II, 9.26. L’existence d’une tradition d’un sénat de cent cinquante membres est supposée aussi par
Den. Hal. (II, 47, 2) à l’époque du règne partagé entre Romulus et Titus Tatius, et par Plutarque(Rom. II, 9) pour l’interrègne suivant la mort de Romulus.
27. Cic. De rep. II, 31.28. Liv. I, 30, 2.
vita latina 9
s’accordent à situer le premier pavement du forum à l’époque de TullusHostilius, grâce à une collection de céramiques retrouvées dans un coffre del’édicule augustéen des Doliola 29. Ce matériel est daté environ entre 675 et650 av. J.-C., et on le considère comme un dépôt de fondation du premier ou dudeuxième pavage du forum. À propos de l’ensevelissement de ces récipients on adit en effet que :
potrebbe trattarsi di un atto connesso con la fondazione del Foro. Posto com’è, crono-logicamente, tra il primo e il secondo pavimento, il deposito potrebbe rappresentare ilmomento finale del primo allestimento coincidente con la conclusione dei lavori (ultimoatto della fondazione all’interno di un rituale che vedeva come primo atto la deposizionedi inumati), oppure potrebbe trattarsi di un rituale di fondazione per l’allestimentodella seconda pavimentazione 30.
Et encore :
si potrebbe anche pensare che il deposito sia relativo all’allestimento di uno dei primidue pavimenti della piazza forense ; in questo caso si tratterebbe di un deposito difondazione, confrontabile con quelli allestiti durante la costruzione delle mura delPalatino di VIII e VII a. C., o con quello deposto durante la costruzione della domusRegia nel Santuario di Vesta. La cronologia dei materiali del deposito dei Doliola(675-650 avant a. C.) corrisponde a quella dei reperti relativi all’allestimento dellaseconda pavimentazione (strati 23-22 a-b : 700-650 a. C.). Tuttavia, mentre nel caso deiDoliola si tratta di un deposito intenzionale, contemporaneo al rito, le pavimentazioniforensi e gli strati di livellamento ad esse sottostanti sono contesti di più ampia duratae con un’alta percentuale di materiali residuali. Se accettiamo una cronologia pruden-zialmente più bassa il primo pavimento (strato 24) sarebbe inquadrabile entro il primoventicinquennio del VII sec. a. C. In questo caso la cronologia del corredo dei Doliolarisulterebbe non troppo distante da quella del primo pavimento del Foro 31.
29. Pour l’identification du monument des Doliola, voir F. Coarelli 1983 : 282-302.30. D. Filippi 2005 : 114 : « Il pourrait s’agir d’un acte en relation avec la fondation du
Forum. Situé comme il l’est, chronologiquement, entre le premier et le second pavement, ledépôt pourrait représenter le moment final de la première réalisation, coïncidant avec laconclusion des travaux (acte ultime de la fondation à l’intérieur d’un rituel qui avait vu commeacte premier la déposition des corps inhumés), à moins qu’il ne s’agisse d’un rituel de fondationpour la réalisation du second pavement. »
31. E. Gusberti 2005 : 127 : « On pourrait penser aussi que le dépôt soit relatif à laréalisation de l’un des deux premiers pavements de la place du forum ; en ce cas, il s’agirait d’undépôt de fondation comparable à ceux réalisés durant la construction des murs du Palatin desviiie et viie s. av. J.C., ou avec celui déposé pendant la construction de la domus Regia dans leSanctuaire de Vesta. La chronologie des matériaux du dépôt des Doliola (675-650 av. J.C.)correspond à celle des découvertes relatives à la réalisation du second pavement (strates 23-22 a-b : 700-650 av. J.C.) Cependant, alors que dans le cas des Doliola il s’agit d’un dépôtintentionnel, contemporain du rite, les pavements du forum et les strates de niveaux sous-jacents à ceux-ci se situent dans une durée plus importante et avec un pourcentage élevé dematériaux résiduels. Si, par prudence, nous acceptons une chronologie plus basse, le premierpavement (strate 24) se situerait dans les vingt-cinq premières années du viie s. av. J.C. Dans ce
10 giambattista cairo
En faveur de cette hypothèse militent justement les sources littéraires, quiaffirment qu’après la mort de Numa Pompilius, sous le règne donc de TullusHostilius ¢ datable selon la tradition entre 672 et 640 av. J.-C. ¢ des petits vases,dits doliola, qui contenaient des objets sacrés appartenant au souverain mort,furent ensevelis là où l’on a retrouvé les coffres 32.
Les indices cités jusqu’à présent tendent à dater la formation de la ville del’époque de Tullus Hostilius. Cependant aucun de ces éléments ne peut en soirésoudre la question. Mais on a une donnée supplémentaire, qui justifie à notreavis sans équivoque notre affirmation antérieure. Il s’agit de la saga des Horaceset Curiaces, qui est située par la plupart des sources sous Tullus Hostilius. Cettesaga est donc, comme on va le montrer, une légende de fondation de la commu-nauté urbaine de Rome, exactement comme celle dont Romulus et Rémus sontles protagonistes.
Le récit est le suivant 33 : pour résoudre la guerre entre Rome et Albe laLongue sans verser d’autre sang, les chefs de deux villes décidèrent d’en confierle résultat à un duel entre deux groupes, chacun représenté par trois champions.Du côté romain furent choisis trois jumeaux, les Horaces, et pour Albe troisautres jumeaux, les Curiaces. Horaces et Curiaces étaient cousins entre eux,étant fils de deux sœurs, qui selon certaines sources 34 étaient elles-mêmesjumelles. Le duel se déroula avec des hauts et des bas. D’abord les trois Curiacestuèrent deux des Horaces. Ensuite le champion survivant des Horaces sépara sesadversaires par une ruse, et en les affrontant séparément, il les tua un par un. Àce point du récit, l’Horace vainqueur ramasse les dépouilles des ennemis etretourne à la ville, où une grande foule s’est rassemblée hors des remparts pourl’acclamer. Dans la foule se trouve une de ses sœurs, qui était fiancée avec un desCuriaces. Quand la sœur des Horaces voit parmi les dépouilles recueillies par sonfrère le manteau qu’elle avait tissé pour son fiancé, elle se met à pleurer. Sonfrère, indigné, la tue d’un coup d’épée. Pour ce crime il aurait subi, selon certainsauteurs 35, un procès pour parricide. Selon d’autres auteurs, différemment, ilaurait été jugé pour perduellio 36, c’est-à-dire pour haute trahison, par lesduouiri perduellionis, magistrats créés à cet effet. Selon ces sources, aprèssa condamnation il aurait dû subir la peine de l’arbor infelix : il aurait dû êtrelié à un arbre stérile pour être fouetté à mort, soit à l’intérieur soit à l’extérieurdes limites sacrées de la ville, donc soit dans le pomerium soit au-delà de ce sillon.S’il ne subit pas cette peine, ce fut grâce au roi, qui accorda à l’Horace vainqueur
cas, la chronologie du matériel des Doliola ne se retrouverait pas loin de celle du premierpavement du forum. »
32. Varron, LL, V, 157. Voir Fest. p. 60 L.33. Voir Liv. I, 22-26 ; Den. Hal. III,13-22.34. Den. Hal. III, 13, 4 ; Zon. 7, 6.35. Fest. p. 380 L. ; Den. Hal. III, 22, 3-10 ; Flor. I, 3, 6 ; Val. Max. VI, 3, 6.36. Liv. I, 26, 2-14.
vita latina 11
de prouocare, c’est-à-dire d’en appeler au peuple. Dans les deux versions de lalégende se serait donc déroulé devant le peuple un débat dramatique, au coursduquel le père de l’Horace prit la parole pour affirmer que, s’il avait considéréson fils coupable du crime dont on l’accusait, il l’aurait tué lui-même, en vertu dupouvoir qu’il avait en tant que paterfamilias, chef de famille. Enfin l’Horace futacquitté, à condition de passer sous le joug ¢ dont la mémoire était encore vive àl’époque républicaine grâce au monument du Tigillum Sororium ¢ et à condi-tion que son père offrît des piacula, des sacrifices expiatoires.
La saga peut se diviser cependant en deux grandes parties : le duel entre lesHoraces et les Curiaces, et le meurtre de la sœur des Horaces, avec tout ce qui suitcet événement.
Dans la première partie, un rôle significatif est joué par les liens parentauxentre les Horaces et les Curiaces, qui reflètent les liaisons entre Rome et Albe laLongue, parce que Rome selon la tradition était une colonie d’Albe. C’est dans cesens qu’on doit interpréter l’incertitude des sources mêmes, qui attribuentindifféremment les Horaces à Rome et les Curiaces à Albe ou les Curiaces àRome et les Horaces à Albe 37. Cette incertitude sur la patrie des combattantsreflète la commune origine des deux villes.
Donc, tant cette première partie de la légende que la deuxième, qui raconte lemeurtre de la jeune Horace de la main de son frère, rappellent une luttefratricide : dans le premier cas, entre deux communautés différentes ; dans lesecond, à l’intérieur de la même communauté. L’élément le plus évident dans lapremière partie est surtout le fait qu’aussi bien les Horaces que les Curiaces sontjumeaux ¢ élément qui, selon certains auteurs, comme on l’a vu, se retrouvemême à propos de leurs mères. À cet égard on a soutenu que
lo schema fondamentale del racconto corrisponde [...] a quello della lotta tra due fratelliantagonisti : e più precisamente [...] della contesa tra gemelli, visto che dei due gruppisi sottolineano i tratti specificatamente « gemellari » [...] una lotta bisogna aggiungere,connotata dal tratto dell’ordalia, il combattimento fra campioni scelti con cui sirisolvono le sorti di un conflitto tra due città o popoli 38.
On a observé en outre que
la determinazione di una nuova identità si costruisce [...] non solo in rapporto a quellaprecedente, come negazione di certi tratti e conseguente affermazione di nuovi, maanche come recupero di una continuità. Ora, quella tra gemelli antitetici sembra essereil tipo di relazione che più esplicitamente esprime questo intrecciarsi di contrasto e di
37. Liv. I, 24, 1.38. F. Mencacci 1987 : 139 : « Le schéma fondamental du récit correspond [...] à celui de la
lutte entre deux frères ennemis : et plus précisément [...] de la rivalité entre jumeaux, étantdonné que dans les deux groupes les traits ‘gémellaires’ spécifiques sont soulignés [...] Doit s’yajouter un affrontement, connoté par le trait de l’ordalie, le combat entre champions désignés,par lesquels se résout le sort d’un conflit entre deux cités ou deux peuples. »
12 giambattista cairo
dipendenza. I gemelli in lotta sono due individualità distinte e in concorrenza che peròambiguamente condividono una identica origine : essi esprimono perciò nel modo piùimmediato la problematica della « fondazione » che, come ogni altra forma di nuovaidentità, tanto necessita di « disgiunzioni » (lo scontro tra campioni), quanto di« congiunzioni » su cui appoggiarsi (la gemellarità dei combattenti) 39.
À partir de là on a soutenu que le duel entre les Horaces et les Curiacessymbolisait en réalité la création d’un nouvel ordre de civilisation. À unesuprématie sur le Latium d’Albe la Longue, fondée sur la pureté de la race et surla nette séparation entre les classes dirigeantes et les inférieurs, aurait succédé lasuprématie de Rome, issue de l’intégration des vaincus 40. Cependant, au delà decette interprétation, il est possible que la saga se réfère à la naissance d’unenouvelle ville, c’est-à-dire de Rome, comme semble le confirmer l’analyse quenous proposons de la deuxième partie de la légende.
À notre avis, il est inutile de chercher à dater la seconde partie de la narrationpar ses éléments intérieurs. On pourrait avoir en effet, tout au plus, un terminuspost quem pour son origine, mais cela ne nous indiquerait pas la raison pourlaquelle elle a été attribuée par les auteurs anciens au règne de Tullus Hostilius.Pour cerner cette raison, il faut analyser la signification sous-tendue par cettepartie de la saga. On a vu qu’aux temps anciens en circulaient deux versionsdifférentes. Selon certains auteurs, l’Horace vainqueur aurait subi un procèspour perduellio, selon d’autres pour parricide. Les deux versions ont étécomprises par un groupe de chercheurs selon la même interprétation. Ainsi ona dit que :
le paterfamilias commence par juger son fils, au titre du parricidium. Dans un secondtemps, on passe à une procédure de perduellio, devant des magistrats spécialisés.C’est-à-dire qu’il y a translation de pouvoirs, de la famille à la cité 41.
Et encore :
39. F. Mencacci 1987 : 144 : « La détermination d’une nouvelle identité se construit [...] nonseulement en rapport avec la précédente, comme négation de certains traits et, par suite, affir-mation de nouveaux, mais encore comme récupération de la continuité. Or celle entre jumeauxantithétiques semble être le type de relation qui exprime de manière plus explicite cet entrelacsde contraste et de dépendance. Les jumeaux en lutte sont deux individualités distincteset concurrentes, qui pourtant, de manière ambiguë, partagent une même origine : ceux-ciexpriment, de ce fait, de manière plus immédiate, la problématique de la ‘fondation’ qui,comme tout autre forme d’identité nouvelle, a besoin autant de ‘disjonctions’ (l’affrontemententre champions) que de ‘conjonctions’ sur quoi s’appuyer (la gémellité des combattants). »
40. F. Mencacci 1987 : 144-148. Cf. A. Pasqualini 1996 : 231-232.40. F. Mencacci 1987 : 144-148. Cf. A. Pasqualini 1996 : 231-232.41. Y. Thomas 1981 : 685.
vita latina 13
l’exemplum obéit à un rythme narratif qui est celui-là même qui sous-tend la repré-sentation classique des origines de la cité : la famille est un organisme antérieur,pré-politique, d’où la ciuitas est issue 42.
Dans ce cas, donc, la saga sous-tendrait le passage d’une société pré-urbaine àun contexte urbain. Cela apparaît d’une façon évidente dans le débat qui se seraitdéroulé devant le peuple. Là, en effet, le père d’Horace condamné prit la paroleen affirmant que, s’il avait considéré son fils comme coupable, il l’aurait punilui-même en vertu du pouvoir à lui assigné par le droit en tant que paterfami-lias 43. Il est bien connu que dans l’antiquité le père avait le pouvoir de punir sonfils, de le vendre et même de le condamner à mort. Même si au cours des sièclesce pouvoir fut adouci, il est probable qu’à l’origine il reflétait une suprématieabsolue de l’ascendance sur la descendance. Le discours du père d’Horacedevant le peuple se développe donc comme une revendication des prérogativesdu chef de famille devant l’affirmation du pouvoir concurrent du roi, contem-porain et « coessentiel » à la naissance de la communauté urbaine. De ce point devue, le meurtre même de la jeune Horace de la main de son frère acquiert unenouvelle signification. Il refléterait le conflit fratricide qui s’était révélé dans lacommunauté au moment de l’affirmation du pouvoir de l’État.
D’autres éléments de la saga concourent à appuyer notre affirmation. Toutd’abord la sanction de la suspensio à l’arbor infelix. Comme on l’a dit précédem-ment, l’arbor infelix est un arbre stérile, et comme tel il est consacré aux dieuxdes enfers. On lui oppose l’arbor felix, l’arbre cultivé et porteur de fruits. Ontrouve ici l’opposition entre le monde des morts et le monde des vivants. Lemonde des morts était identifié avec les forêts, c’est-à-dire avec le terrain exté-rieur aux remparts sacrés de la ville, hors de laquelle les défunts devaient êtreensevelis. Le monde des vivants, au contraire, était identifié avec l’aire de la ville,où résidait la communauté qui réglait ses relations sans le recours aux armes nià la violence, mais par le droit. C’était donc le terrain où s’exprimait l’ordrecéleste, qui était l’ordre de l’espace et du temps, des lieux consacrés de manièrefonctionnelle, dans un but déterminé, et d’une vie réglée par la série des joursouvrables et fériés selon le calendrier. Pour cette raison ce terrain était séparé del’extérieur par les remparts sacrés de la ville et par le pomerium, le sillon tracé àl’aide de la charrue par le fondateur, qu’on ne doit pas confondre avec lesremparts eux-mêmes.
Le condamné à la suspensio à l’arbor infelix était consacré, comme l’arbremême, aux dieux des enfers, au monde non urbain, tandis que sa fustigation àl’intérieur et à l’extérieur du pomerium soulignait que, par son crime, il s’étaitretranché de la communauté urbaine. La sanction entière renvoie donc à la
42. Y. Thomas 1981 : 687. D. Briquel, 1980 : 104-105, a souligné que l’oppositionparricide/perduellio reflète l’antinomie entre les domaines privé et public.
43. Den. Hal. III, 22, 4.
14 giambattista cairo
création de cette communauté, qui distingue la société où l’on respecte des règlesdéterminées et le monde extérieur, le monde du chaos, où règne la loi du plusfort. Une signification semblable doit être assignée aussi à l’autre sanctionmentionnée dans la saga, le passage sous le joug. À l’époque républicaine, le jougétait formé de deux lances enfoncées dans la terre et surmontées d’une troisièmeposée à l’horizontale, de façon à lui donner la forme d’une porte. On obligeait lesennemis défaits à passer sous elle, sans leur armes et vêtus seulement d’unetunique. Il est probable que par ce rite :
si mirasse soprattutto ad assicurare il passaggio forzato dell’esercito vinto dalla guerraalla pace, indebolendo il combattente e « spogliandolo » del furor guerriero, mentreperdurava ancora il conflitto bellico.
En revanche, le passage à travers le Tigillum Sororium, c’est-à-dire le jougsous lequel l’Horace condamné a dû passer, « registrava invece la medesimatrasformazione, ma in condizioni di normalità e cioè ad operazioni bellicheritualmente conclue » 44. « Il Tigillum Sororium quindi sarebbe una sorta diporta trionfale » 45 la porte à travers laquelle le général victorieux rentrait avecson armée dans la ville pour célébrer le triomphe :
grâce aux portes et spécialement à la Porta Triumphalis, les hostes, ennemis virtuels, setransforment en hospites, en hôtes ; les perduelles, guerriers dangereux, en Quirites,c’est-à-dire en citoyens membres des curies 46.
L’Horace vainqueur, en passant sous le joug, aurait donc été dépouillé du furorbellicus qui l’avait animé pendant le duel contre les Curiaces et en proie auquelil avait tué sa sœur. Cependant, le passage à travers le Tigillum mentionnéci-dessus ne constituait pas seulement « un rito di passaggio [...] avente pereffetto quello di estinguere la potenza ostile, che è nel colpevole o nel nemico » 47,mais il avait une fonction beaucoup plus importante et plus profonde. De chaquecôté du monument se trouvaient deux autels, consacrés respectivement à IanusCuriatius e à Iunus Sororia. Le premier était le dieu qui présidait à l’entréedes adolescents dans l’âge adulte, l’autre était la divinité qui présidait à la
44. M. Baistrocchi 1987 : 243 et 210-211 : « ...visait surtout à assurer le passage forcé del’armée vaincue de la guerre à la paix, en affaiblissant le combattant et en le ‘purgeant’ de safureur guerrière, pendant que durait encore le conflit armé. » « ...enregistrait à son tour la mêmetransformation, mais dans des conditions de normalité et donc pour des opérations guerrièresconclues selon le rite. »
45. F. Coarelli 1983 : 117 : « Le Tigillum Sororium serait donc une sorte de portetriomphale. »
46. B. Liou-Gille 1994 : 31-36, en particulier 36.47. P. De Francisci 1959 : 303 : « ...un rite de passage [...] ayant pour effet d’éteindre la
puissance d’hostilité qui se trouve dans le coupable ou dans l’ennemi. »
vita latina 15
transformation des filles en femmes. Les deux divinités veillaient donc surl’entrée des jeunes dans la vie civile. Le Tigillum symbolisait bien l’entrée dansla communauté urbaine sous toutes ses formes.
Le lieu du Tigillum a été identifié de manière hypothétique avec l’empla-cement où à l’époque du roi Servius Tullius se trouvait la Porte Capène. LeTigillum devait être une porte d’accès à l’ancienne ville de Rome, quand elleétait encore limitée au Palatin et à la Vélia. Pourtant on peut dire que
il Tigillum Sororium [...] è un accesso alla città palatino-veliense sul lato delle Carinae,che rivestiva funzioni rituali molto ampie, ma tutte riconducibili alla sua funzione di pas-saggio. Passaggio da uno spazio esterno, indifferenziato, a uno spazio interno, struttu-rato : lo spazio civico. Si può quindi comprendere che questa porta fosse utilizzata tantoper il « rito di passaggio » dell’iniziazione ¢maschile e femminile ¢ quanto per quello dipurificazione, che riammetteva nel corpo civico il guerriero di ritorno dalla guerra. Sitratta, a ben vedere, di riti la cui intima natura è la stessa 48.
Cette ville palatino-vélienne, dont le Tigillum était une porte d’accès, doitêtre identifiée avec la ville de Tullus Hostilius, dont la famille résidait justementsur la Vélia.
En revanche, nous semble moins convaincante, par rapport à celle qu’on vientde décrire, l’hypothèse d’antidater le Tigillum à une époque antérieure à TullusHostilius, en contradiction avec les auteurs anciens, qui situent à l’époque dutroisième roi de Rome la saga dont le monument est un élément originel. Si l’onvoulait cependant accepter cette hypothèse, qui a pour but de montrer qu’uneville pouvait déjà exister au milieu du viiie siècle av. J.-C., à l’époque où latradition situe le règne de Romulus, ce ne serait pas en contradiction avec nosconclusions. En fait, en ce cas, on devrait attribuer au Tigillum une significationpurement purificatrice, qui ne concernerait pas encore une communautéurbaine, mais un ensemble de villages unis dans une ligue, que les sourcesanciennes nous ont transmis sous le nom de Septimontium. D’autre part, lesauteurs mêmes qui ont proposé l’hypothèse susmentionnée admettent que cetteporte était comprise dans un établissement pré-urbain. En effet, après avoir misen rapport le Tigillum Sororium, porte sacrée à Ianus Curiatus et placée près dela Vélia, avec la porte sacrée à Janus Quirinus près du forum, là où « i montes siaprivano ai colles originariamente nemici » 49, et après avoir soutenu que c’est
48. F. Coarelli 1983 : 111-118, particulièrement 116-117 : « Le Tigillum Sororium [...] estun accès à la cité palatino-vélienne sur le côté des Carènes, qui revêtait des fonctions rituellestrès vastes, mais toutes réductibles à sa fonction de passage. Passage d’un espace extérieur,indifférencié, à un espace intérieur, structuré : l’espace civique. On peut donc comprendre quecette porte ait été utilisée tant pour le ‘rite de passage’ d’initiation ¢masculine et féminine ¢ quepour celui de purification, qui réintégrait dans le corps civique le guerrier de retour de la guerre.Il s’agit, à bien y voir, de rites dont la nature intime est la même. »
49. P. Carafa 2006 : 480 : « ... les montes s’ouvraient sur les colles originellement ennemies. »
16 giambattista cairo
par cette porte que sortait l’armée pour la guerre et qu’elle y rentrait ensuite,ils affirment que ces portes avaient une fonction :
integrativa e purificatrice, dal carattere quanto mai primordiale [...] Il fatto che le dueporte si trovino così vicine al cuore dell’abitato veliense-montano e nulla abbiano a chefare con le porte romulee poste ai piedi del Palatino, fa ritenere che siano entitàtopografiche più antiche di Roma e forse anche della ancora più risalente unificazionefra monti e colli 50.
Ce fut Tullus qui « probabilmente [...] attuò una rifondazione religiosa o unarifunzionalizzazione in senso urbano dell’antico luogo-rito » 51.
À ce point on peut conclure l’analyse de la seconde partie de la saga avec unedernière observation à propos de la prouocatio. Même sa présence dans la sagades Horaces et Curiaces peut se référer à la naissance de la ville. On est obligé deparvenir à cette conclusion si l’on considère d’une part que la prouocatio était undroit et qu’à l’époque républicaine elle représentait l’essence même du ciuis, lecitoyen, en le distinguant du miles, le soldat, et d’autre part qu’elle reflétait ladistinction entre le monde urbain délimité par le pomerium, à l’intérieur duqueln’était pas admis l’imperium militaire, et le monde des forêts, extérieur aupomerium, le seul où pouvait de manière licite se manifester le furor bellicus quianimait le soldat.
Achevons maintenant notre analyse. Ce que nous avons affirmé jusqu’àprésent porte à conclure que le processus qui a conduit à la naissance de la villede Rome s’est achevé sous Tullus Hostilius. Il n’est pas possible, sinon demanière extrêmement hypothétique, de reconstituer ce processus. On peutsupposer qu’une première tentative de donner vie à une communauté urbaineeut lieu au viiie siècle av. J.-C., comme sembleraient le confirmer les restes d’unmur et une porte urbaine retrouvés sur les pentes du Palatin 52. Cette tentativedevrait être attribuée à Hostus Hostilius, grand-père de Tullus Hostilius, dont lafamille résidait, comme on l’a dit, sur la Vélia. Hostus avait probablement assurésa suprématie sur une ligue de villages, le Septimontium, en cherchant à y fonder
50. P. Carafa 2006 : 482 : « ... d’intégration et de purification, à caractère au plus haut pointprimordial. [...] Le fait que les deux portes se trouvent ainsi voisines du cœur de l’habitatvéliano-montagneux et qu’elles n’aient rien à voir avec les portes romuléennes situées au pied duPalatin conduit à la conclusion qu’elles sont les entités topographiques les plus anciennes deRome et remontent peut-être même à l’unification entre montes et colles » ; A. Carandini2006 : 104-105, 227.
51. P. Carafa 2006 : 481 : « ...probablement [...] réalisa une refondation religieuse et une‘refonctionnalisation’ au sens urbain de l’antique lieu-rite. »
52. A. Carandini 2006 : 538 ; A. Carandini 2005 : 15 et 18 ; A. Carandini 1995a : 22-29 ;A. Carandini 1995 : 67 ; P. Brocato 2000 : 278-279 ; P. Brocato 2000 : 280.
vita latina 17
un pouvoir personnel de type institutionnel, mais on peut supposer qu’il avaitété empêché d’accomplir son projet à cause d’un événement imprévu, peut-êtrel’arrivée d’une invasion de Sabins. Son plan aurait été repris ensuite et réalisédeux générations plus tard par son petit-fils, Tullus Hostilius 53.
Giambattista CairoDottore di ricerca
Storia AnticaUniversità di Bologna
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Textes anciens
Cicéron, La République, tome II, texte établi et traduit par E. Bréguet, Paris, Les BellesLettres, CUF, 1980.
Dionysus of Halicarnassus, The Roman antiquities, Books I-II, 1960 (1937) ; BooksIII-IV, 1961 (1939), with an english translation by E. Cary on the basis of the versionof E. Spelman, Cambridge, The Loeb Classical Library.
Sexti Pompei Festi, De verborum significatu quae supersunt cum Pauli Epitome,thewrewkianis copiis usus edidit W. M. Lindsay, Leipzig, Bibliotheca scriptorumgraecorum et romanorum teubneriana, 1965 (1913).
Florus, Ouvres, tome I, texte établi et traduit par P. Jal, Paris, Les Belles Lettres, CUF,1967.
Livy, Books I-II, 1967 (1919), with an english translation by B. O. Foster, Cambridge, TheLoeb Classical Library.
Valère Maxime, Faits et dits mémorables, Tome II, Livres IV-VI, texte établi et traduit parR. Combès, Paris, Les Belles Lettres, CUF, 1997.
Varro, On the Latin Language, Books I-VII, with an english translation by R. G. Kent,Cambridge, The Loeb Classical Library, 1967 (1938).
Études critiques
André J. 1964, « Arbor felix, arbor infelix », dans Hommages à Jean Bayet, Bruxelles,p. 35-46.
Baistrocchi M. 1987, Arcana urbis. Considerazioni su alcuni rituali arcaici di Roma,Gênes.
Bauman R.A. 1969, « The Duumviri in the Roman Criminal Law and in the Horatiuslegend », Historia einzelschriften, 12, p. 1-21.
Briquel D. 1980, « Sur le mode d’exécution en cas de parricide et ‘‘perduellio’’ »,MEFRA, 92 (1), p. 87-107.
53. Pour cette hypothèse, voir G. Cairo 2013.
18 giambattista cairo
Brocato P. 2000, « Ricostruzione della porta Mugonia », dans A. Carandini &R. Cappelli (dir.), Roma. Romolo, Remo e la fondazione della città, catalogo dellamostra, Milan, p. 278-279.
— 2000 a, « Il deposito di fondazione », dans A. Carandini & R. Cappelli (dir.), Roma.Romolo, Remo e la fondazione della città, Catalogo della mostra, Milan, p. 280.
Cairo G. 2009, Roma, tra storia ed archeologia : religioni, istituzioni, territorionell’epoca delle origini, tesi di dottorato 2009, consultabile al sito :http://amsdottorato.cib.unibo.it/.
— 2010, Romolo figlio del fuoco, Bologne.— 2012, « Sulla procedura delle fondazioni coloniali in età repubblicana », RSA, 42,
p. 115-135.— 2013, « Quelques considérations sur les sept rois de Rome », Vita Latina, 187-188,
p. 4-17.Carafa P. 2005, « Il Volcanal e il Comizio », Workshop di Archeologia Classica, 2,
p. 135-149.
— 2006, « I Lupercali », dans A. Carandini (dir.), La leggenda di Roma, Milan,p. 477-493.
Carandini A. 1995, « Centro protourbano (Septimontium), città in formazione (prima etàregia) e città in sé compiuta (seconda età regia) », dans A. Carandini & P. Carafa(dir.), Palatium e Sacra Via, I, BCAR 31-33, p. 63-83.
— 1995 a (dir.), Palatium e Sacra Via, I. Tavole, BCAR 34.— 2005, « La nascita di Roma : Palatino, Santuario di Vesta e Foro », dans E. Greco (dir.),
Teseo e Romolo. Le origini di Atene e Roma a confronto, Athènes, p. 13-28.— 2006, Remo e Romolo, Turin.Castagnoli F. 1993, « Note sulla topografia del Palatino e del Foro Romano », dans
Topografia Antica. Un metodo di studio, I, Rome, p. 279-301.— 1993 a, « Per la cronologia dei monumenti del Comizio », dans Topografia Antica. Un
metodo di studio, I, Rome, p. 331-334.— 1993 b, « Il Lapis Niger nel Foro Romano e gli scavi del 1955 », dans Topografia
Antica. Un metodo di studio, I, Rome, p. 335-340.Citarella A.O. 1980, « Cursus Triumphalis and sulcus primigenius », PP, 35, p. 401-414.Coarelli F. 1977, « Il Comizio dalle origini alla fine della repubblica », PP, 32, p. 166-238.— 1983, Il foro romano. Periodo arcaico, I, Rome.De Francisci P. 1959, Primordia Civitatis, Rome.Deroy L. 1973, « Le combat légendaire des Horaces et des Curiaces », LEC, 41, 2,
p. 197-206.Dumezil G. 1942, Horace et les Curiaces, Paris.Filippi D. 2005, « Il Velabro e le origini del Foro », Workshop di archeologia classica, 2,
p. 93-115.Grandazzi A. 1986, « La localisation d’Albe », MEFRA, 98, 1, p. 47-90.Grosso G. 1960, « Provocatio per la perduellio. Provocatio sacramento e ordalia », BIDR,
p. 213-220.
vita latina 19
Guarino A. 1975, « La ‘perduellio’ e la plebe », Labeo 21, 1, p. 73-77.Gusberti E. 2005, « I reperti del saggio Boni-Gjerstad », Workshop di Archeologia
Classica, 2, p. 117-134.Jones A.H.M. 1972, Criminal Courts of the Roman Republic and Principate, Oxford.Liou-Gille B. 1993, « Le pomerium », MH, 50, p. 94-106.— 1994, « La perduellio : les procès d’Horace et de Rabirius », Latomus, 53, 1, p. 3-38.— 1998, Une lecture « religieuse » de Tite-Live I. Cultes, rites, croyances de la Rome
archaïque, Paris.Magdelain A. 1973, « Remarques sur la perduellio », Historia, 22, p. 405-422.— 1976, « Le pomerium archaïque et le mundus », REL, 54, p. 71-109.Martínez-Pinna J. 1996, Tarquinio priscus, Madrid.— 2001, « Reflexiones en torno a los orígenes de Roma : a propósito de recientes
interpretaciones », Orizzonti, p. 75-83.Mencacci F. 1987, « Orazi e Curiazi, uno scontro fra trigemini ‘gemelli’ », MD, 18,
p. 131-148.Montanari E. 1976, « Il mito degli Horatii e Curiatii », Roma. Momenti di una presa di
coscienza culturale, Rome, p. 19-89.Pasqualini A. 1996, « I miti albani e l’origine delle ‘Feriae Latinae’ », Alba Longa.
Mito Storia Archeologia. Atti dell’incontro di studio Roma-Albano Laziale 27-29 gennaio 1994, Rome, p. 217-253.
Phillips J.E. 1974, « The prosecution of C. Rabirius in 63 a. C. », Klio, 56, p. 87-101.Santini C. 1996, « Eroi culturali e annalistica : il caso di Tullus Hostilius », Eutopia, 5, 1-2,
p. 85-97.Thomas Y. 1981, « Parricidium », MEFRA, 93, 2, p. 643-715.Tyrrell W.B. 1973, « The trial of C. Rabirius in 63 a. C », Latomus, 32, p. 285-300.Watson A. 1979, « La mort d’Horatia et le droit pénal archaïque à Rome », RD, 57.
20 giambattista cairo
Suite du sommaire, vobis legimus
Laurence Gosserez (dir.), Le Phénix et son autre. Poétique d’un mythe desorigines au XVIe siècle : Rennes, Presses Universitaires de Rennes,collection « Interférences », 2013, 359 pages. (B. Bakhouche). . . . . . . . . . . . . . 233
Antonino Grillone, Gromatica militare : Bruxelles, coll. « Latomus »,no 339, 2012, 268 pages et plans hors page. (Chr. Nicolas). . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Philippe Guisard et Christelle Laizé (dir.), Expériences et représenta-tions de l’espace : Paris, éditions Ellipses, 2012, 630 pages. (Chr. Gouillart). 236
Rosario López Gregoris (dir.), Estudios sobre teatro romano. El mundode los sentimientos y su expresión : Saragosse, Libros Pórtico, 2012,575 pages. (S. Luciani) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Jean-Paul Morel et Agnès Rouveret (dir.), Le Temps dans l’Antiquité,Éditions du Comité des travaux historiques et scientifiques, collection« cths histoire », no 52, 2013, 246 pages. (B. Bakhouche). . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Pascale Paré-Rey, Flores et acumina. Les sententiae dans les tragédies deSénèque : Paris, collection « Études et Recherches sur l’Occident Romain ¢CEROR », 2012, 432 pages. (A. Casamento) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Rémi Poignault (dir.), Présence de la danse dans l’Antiquité. Présencede l’Antiquité dans la danse, Actes du colloque tenu à Clermont-Ferrand(11-13 décembre 2008) : Clermont-Ferrand, « Caesarodunum » XLII-XLIII bis, 2013, 436 pages. (E. Raymond) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
Mark Thomson, Studies in Historia Augusta : Bruxelles, collection « Lato-mus » no 337, 2012, 155 pages. (R. Loriol). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Sophie van der Meeren, Lectures de Boèce. La Consolation de Philosophie :Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2012, 240 pages. (B. Goldlust) . . . 249
Consignes aux auteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
BIBLIOGRAPHIES
Sophie Aubert-Baillot Bibliographie sur Cicéron, Correspondance,volume II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
SéverineClément-Tarantino
Bibliographie sur Virgile, Géorgiques III-IV . . . 214
Paul-Marius Martin Bibliographie sur Tite-Live, Livre I ¢ Adden-dum à la Bibliographie (Vita Latina 186-187) . . 218
VOBIS LEGIMUS
Jacques-Emmanuel Bernard, La sociabilité épistolaire chez Cicéron :Paris, Honoré Champion, 2013, 541 pages. (P.-M. Martin) . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Michel Briand (dir.), La trame et le tableau. Poétiques et rhétoriques durécit et de la description dans l’Antiquité grecque et latine : Rennes,Presses Universitaires de Rennes, Collection « La Licorne », no 101, 2012,518 pages. (R. Glinatsis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Nicole Charreyron, Éthique et Esthétique du récit de voyage à la fin duMoyen Âge : Paris, Honoré Champion, 2013, 539 pages. (L. Louison). . . . . . 224
Carl Deroux (dir.), Studies in Latin Literature and Roman History XVI :Bruxelles, Collection « Latomus », 2012, 670 pages. (M. Ledentu) . . . . . . . . . . 225
Fabrice Galtier, L’image tragique de l’Histoire chez Tacite. Étude desschèmes tragiques dans les Histoires et les Annales : Bruxelles, collection« Latomus », no 333, 2011, 344 pages. (A. Malissard). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Florence Garambois-Vasquez (dir.), Claudien : Mythe, histoire et science :Publications de l’Université de Saint-Étienne, Collection « Antiquité »,Mémoires du centre Jean Palerme, no 36, 2011, 171 pages. (J. Meyers) . . . . . 228
Alessandro Garcea, Caesar’s De analogia. Edition, Translation, andCommentary : Oxford, Oxford University Press, 2012, x + 304 pages.(P.-M. Martin) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Benjamin Goldlust, Maximien, Élégies, suivies de l’Appendix Maximianiet de l’Épithalame pour Maximus d’Ennode de Pavie : Paris, Les BellesLettres, Collection « La roue à livres », 2013, 220 pages. (B. Bureau). . . . . . . . 232
VITA LATINAAnno MMXIV No 189-190
INDEXGiambattista Cairo Tullus Hostilius fondateur de Rome . . . . . . . . . . 5
Sophie Aubert-Baillot L’influence de la disputatio in utramque partemsur la correspondance de Cicéron. . . . . . . . . . . . . 21
Jacques-EmmanuelBernard
Lettres et discours : la persona de Cicéron aprèsl’exil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
VéroniqueLéovant-Cirefice
Les lettres de l’exil dans la correspondance deCicéron : une thérapie de la douleur ? . . . . . . . . . 54
Marie Ledentu Labor poétique et res gestae Caesaris : poésie etrefondation dans les Géorgiques . . . . . . . . . . . . . . 70
François Ripoll Une lecture de l’épisode du jardinier de Tarente(Virgile, Géorgiques IV, 116-148) . . . . . . . . . . . . . 89
EmmanuelleCimolino-Brébion
Scipion l’Africain chez Tite-Live : remarquessur le portrait d’un jeune général excep-tionnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Jérôme Lagouanère Les usages du stoïcisme dans le De spectaculiset le De pallio de Tertullien. . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Paul Mattei Christianisme et philosophie dans le De pallio.Notes cursives sur deux thèmes majeurs dutraité : la foi comme melior philosophia ;nature, coutume et changement . . . . . . . . . . . . . . 149
Agnès Molinier Arbo Le costume en Afrique à l’époque sévérienne :réalités et symboles dans le De Pallio de Ter-tullien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Tatiana Taous Autour de lat. micare / dımicare ¢ La théoriedes matrices métaphoriques au service del’anthropologie et de la reconstruction séman-tique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Pour la suite du sommaire, voir page intérieure