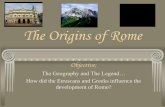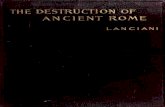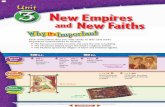Une nouveauté du xxe siècle ? Maquettes de Rome et perception « paysagère » de l’histoire
-
Upload
univ-tours -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of Une nouveauté du xxe siècle ? Maquettes de Rome et perception « paysagère » de l’histoire
HISTOIRE DE L’ART N°65 OCTOBRE 2009 7
PERSPECTIVE
« Rome » est un horizon culturel et historique, c’est aussi, pour les artistes, l’arrière plan sur lequel se déroulent nombre d’épisodes de l’histoire ancienne1. La forme que lui donne la peinture d’histoire varie souvent selon l’idée qu’en ont les artistes, une idée née des ruines qu’ils peuvent connaître comme de l’architecture dans laquelle ils sont habitués à vivre. Le souci « archéologique », malgré sa capacité à renforcer le caractère anecdotique des scènes, n’apparaît que tardivement et il faut attendre la pratique du panorama graphique pour voir la cité antique devenir l’objet unique des représentations2. Cette évolution se fait dans la seconde moitié du xixe siècle lorsque l’idée de paysage urbain se met en place, relayée par les problématiques que concrétise la naissance de l’urbanisme au début du xxe siècle. Le plan-relief historique, sorte de croisement entre maquettes de ruines et paysages panoramiques, représente l’aboutissement d’une conception graphique de l’Histoire.
Pour Marcello Fagiolo, les maquettes urbaines de Rome antique sont une caractéristique propre au xxe siècle. Elles synthétisent l’expérience des Antiquaires des siècles passés, en particulier « l’énorme patrimoine graphique accumulé entre les xviie et xviiie siècles ». Selon l’auteur, ce type de représentation en trois dimensions aurait même « été précédé et accompagné par la tradition des scénographies » du théâtre humaniste et de la peinture d’histoire3. Si l’accumulation d’un tel fonds cartographique offre effectivement la possibilité de réaliser des compositions beaucoup plus étendues qu’auparavant, elle n’explique ni le choix de ce changement d’échelle, ni le moment précis où il s’effectue. Qui plus est, l’extraordinaire essor des reconstitutions virtuelles, auquel l’évolution technique de l’informatique nous fait assister4, invite à s’interroger sur la spécificité de ces représentations « urbaines », ici limitées à Rome antique5. Comme le note en effet Diane Favro, ces reconstitutions nous renseignent autant sur le passé qu’elles illustrent que sur la perception que nous en avons et sur la culture qui la génère6.
Si l’on veut donc comprendre la rupture qu’introduisent les reconstitutions urbaines de Rome, un rapide « état de lieux » ne paraît pas inutile ni infondé.
Un état des lieux
En tant qu’objets de curiosité ou pièces de collection, les maquettes archéologiques se développent dès le XVIIIe siècle dans un milieu d’artistes, à l’origine napolitains et spécialisés dans la réalisation en liège des crèches de Noël7. « Le goût néoclassique de l’art antique, relayé par le goût romantique pour la ruine, suscite la fabrication de ces objets à la fois touristiques, artistiques, scientifiques et dont la gamme comprend surtout les monuments célèbres de Rome et de sa région, Albe et Tivoli8. » Aux premiers modélistes italiens, Altieri, Rosa, Chichi, succèdent les allemands Carl et Georg May, mais les sujets restent inchangés ainsi que les techniques, même si, de façon anecdotique, il a pu exister quelques pièces montées architecturales en confiserie ou des centres de table en pierres semi-précieuses et bronze doré représentant des architectures antiques9.
Manuel Royo
Une nouveauté du xxe siècle ? Maquettes de Rome et perception « paysagère » de l’histoire
UNE NOUVEAUTÉ DU XXe SIÈCLE ? MAQUETTES DE ROME ET PERCEPTION « PAYSAGÈRE » DE L’HISTOIRE8
Toutes ces maquettes ne sont pas l’œuvre d’architectes mais d’artisans et parfois même de dessinateurs, comme Louis François Sébastien Fauvel, un proche de l’entourage du comte de Choiseul-Gouffier qui réalise une maquette de l’acropole d’Athènes10. Ces modèles alimentent les collections d’antiquaires11, d’artistes12, d’architectes – comme le Britannique John Soane13 – et d’aristocrates. Citons par exemple Frédéric François Ier de Mecklembourg, Catherine II de Russie, Gustave III de Suède14.
Chez certains collectionneurs, comme Cassas, la galerie d’architecture représente « une étape intermédiaire dans ce vaste processus de « muséalisation » du début du xixe siècle, étape située à mi-chemin entre le cabinet d’amateur et le musée pédagogique, mais qui n’est pas sans annoncer la galerie du marchand d’art »15. Chez d’autres, l’exposition de ces œuvres est un « signe extérieur de culture », parfois l’expression concrète d’un rêve dans lequel le goût de la collection le dispute à l’érudition16. Pour John Soane, « the models themselves elide their referents and assume a power of their own17. »
Cependant aucune de ces maquettes, ou presque18, ne figure les constructions dans leur état « restauré », mais plutôt sous leur forme ruinée. De surcroît, toutes ont pour sujet des monuments isolés, celle de Pompéi mise à part. Cette dernière est un cas tout à fait particulier. Pour son concepteur, l’archéologue Giuseppe Fiorelli -responsable des fouilles de la cité vésuvienne-, la maquette n’est qu’un outil de documentation archéologique supplémentaire, qui permet à la fois de visualiser l’avancement des fouilles et de conserver une image des bâtiments au moment de leur découverte, avant la dégradation inévitable de leur état19.
Dans ce contexte, les maquettes de Rome font figure d’exception. Tout d’abord, elles ne sont que trois, même si elles ont parfois été dupliquées20. Deux de ces plans-reliefs ont ensuite pour auteurs des spécialistes : l’un est l’architecte français, grand prix de Rome en 1900 et passionné d’antiquité, Paul Bigot21 ; l’autre, l’italien Italo Gismondi, spécialisé dans l’architecture romaine, fait une grande partie de sa carrière à Ostie dont il dirige les fouilles22. Le troisième relief est dû à un autre Italien, modéliste et sculpteur, auteur d’un modèle réduit de Saint-Pierre et lui aussi amateur d’antiquité, Giuseppe Marcelliani23.
Fig. 1Vue partielle de la maquette de Giuseppe Marcelliani, vers 1900 (d’après Ciancio Rossetto 1992).
HISTOIRE DE L’ART N°65 OCTOBRE 2009 9
D’autre part, ces modèles réduits ne s’attachent pas à reproduire des monuments singuliers en ruines mais reconstituent un espace monumental complexe et étendu, à une période historique donnée : le centre monumental (Forum, Colisée, Palatin, Forums impériaux) « à l’époque des Césars » pour G. Marcelliani24 (fig. 1), les « trois cinquième de la ville du IVe siècle » ap. J.-C. chez Paul Bigot25, son étendue à l’intérieur de la muraille aurélienne à la même époque pour I. Gismondi26.
L’échelle27 ainsi que la taille des œuvres sont donc des éléments importants. Ces objets non seulement couvrent plusieurs dizaines de mètres carrés mais suivent aussi des principes de composition ou de présentation destinés à mettre l’accent sur le pittoresque des œuvres : peinture des monuments chez I. Gismondi28, jeux d’éclairage et écrasement du relief naturel chez P. Bigot29. Il en va de même dans les reproductions graphiques des reliefs30 : vues panoramiques ou à vol d’oiseau et dans un halo31 (fig. 2).
La visée didactique, voire pédagogique, de ces reliefs est un autre de leurs points communs. Le plan de G. Marcelliani est exposé à côté des ruines du Forum romain32, ceux de P. Bigot et d’I. Gismondi, conçus pour de grandes expositions archéologiques (1911 et 1938)33, entrent ensuite au musée et servent à l’enseignement34. Ces deux œuvres au moins ont en effet l’ambition de faire la synthèse des connaissances archéologiques de leur temps et de rendre sensible, tout en la corrigeant, la formidable entreprise cartographique d’enregistrement des découvertes archéologiques, réalisée par Rodolfo Lanciani, entre 1893 et 1901, sous le nom de Forma Urbis Romae35.
À ce titre, ces plans-reliefs sont des surfaces mouvantes que leur structure modulaire permet de modifier et d’étendre à volonté, ce dont aucun de leurs auteurs ne s’est privé, faisant ainsi durer leur réalisation sur des années, voire des décennies : de 1904 à 1910 s’agissant du modèle de G. Marcelliani, de 1904 à 1942 pour celui de P. Bigot et de 1937 à 1973 dans le cas du relief d’I. Gismondi36.
Plutôt que de s’attacher à l’inventaire des différences qui ne paraît guère d’un grand secours pour comprendre l’originalité de telles représentations, mieux vaut s’intéresser au contexte des événements où elles voient le jour.
« Décontextualisation » réelle, « re-contextualisation » symbolique
« Ce qui était partie intégrante du paysage des sept collines, lié à sa texture intime par le rapetassage, l’érosion, le pillage, le réemploi, le rhabillage séculaire de la ruine, traitée avec irrespect comme simple élément utilitaire de géologie urbaine, est devenu à Rome un ghetto sacralisé par le glacial enregistrement muséal.37 » La formule provocatrice de J. Gracq prend
Fig. 2Vue à vol d’oiseau retouchée de la maquette de P. Bigot (d’après Lacoste 1955).
UNE NOUVEAUTÉ DU XXe SIÈCLE ? MAQUETTES DE ROME ET PERCEPTION « PAYSAGÈRE » DE L’HISTOIRE10
acte des problèmes liés à la réorganisation des centres anciens38 et en particulier de la création de la Passegiata Archeologica (Forum, Colisée et Palatin, auxquels s’ajoutent l’Oppius et les thermes de Caracalla dans sa version primitive)39 . Décidée après bien des vicissitudes, cette « enclave archéologique » isole, à partir de 1914, le centre antique de la cité moderne sans rien régler -encore aujourd’hui40- des rapports entre l’une et l’autre.
Or, la « décontextualisation » des monuments antiques, si spectaculaire ici, est contemporaine de deux façons de voir l’espace urbain que résument les expressions de « paysage urbain » et de « paysage de ville ». C’est à la fin du xixe et au début du xxe siècle que naît une vision fragmentée de la ville, résultat de l’urbanisation rapide et sauvage de la société industrielle. « Le paysage urbain naît des décombres du « vieux Paris » ou de ces « vieilles villes qui s’en vont » et dont on commence à collectionner les antiquités ou à restaurer les monuments. Il correspond au passage insensible d’une forme aux contours définis et stables à l’informe de l’agglomération urbaine41 ». À l’opposé, « le paysage de ville » donne la ville saisie dans sa totalité et figée en quelque sorte pour l’éternité. Il est construit par un point de vue panoramique, globalisant et orthogonal. La ville est donc appréhendée de loin et de haut. Soit la distance à la fois géographique et temporelle de l’observateur de Paris à vol d’oiseau dans Notre-Dame de Paris, modèle littéraire de toutes ces “vues à vol d’oiseau”.42 » Ces deux procédés littéraires, mis en évidence par F. Chenet-Faugeras, correspondent aussi à l’esthétique des reconstitutions graphiques et des plans-reliefs qu’on a plutôt l’habitude de rapprocher des problématiques de l’urbanisme naissant43. Le premier répond au « paysage de rue » (« streetscape »44) et joue sur l’aspect pittoresque qu’on retrouve dans les cartes postales ou dans certains guides populaires45; le second, propre aux panoramas graphiques46 (fig. 3) et aux plans reliefs, associe à ce pittoresque une esthétique de la grandeur. Celle de Rome s’y trouve célébrée par l’abolition symbolique de la durée et l’affirmation d’une permanence intemporelle dans laquelle se résorbe, au profit du modèle, l’écart entre le réel et l’imaginaire.
Les maquettes de G. Marcelliani et de P. Bigot apparaissent ainsi au moment où le tissu urbain de la Rome historique se disloque à la suite des bouleversements urbanistiques suscités par son retour, dès 1870, au statut de capitale du nouveau royaume unifié. Avec la Forma Urbis de R. Lanciani, née aussi de l’observation de ces transformations47, l’idée d’une reconstitution cesse d’être utopique. Au contraire, faire revivre ce qui dans la pratique est voué à la disparition paraît enfin possible. Pareille résurrection réalise ce qui est, à cette époque, l’objet ultime de l’archéologie : « conserver le plus d’éléments architecturaux et décoratifs afin de ressusciter (ripristinare al vivo) sous toutes ses formes la ville morte48 ».
De même, la maquette d’I. Gismondi apparaît alors que l’essentiel du programme de destruction du tissu urbain, dicté par Mussolini dès 192549, est réalisé. Conçu pour la Mostra Augustea della Romanità, le plan relief « cadre parfaitement avec cette vision de la grandeur de Rome, qui justifiait la démolition de quartiers entiers le long de l’axe de la via dell’impero, la déportation à la périphérie de la ville des populations de certains ilots des quartiers du centre historique, conformément à l’idée selon laquelle isoler les monuments de leur contexte en soulignait la beauté et la grandeur50. »
Dans l’un et l’autre cas, le rôle des maquettes est bien de restaurer l’unité d’un tissu urbain mis à mal, voire de proposer- à travers des notions aussi floues et plastiques que celles de grandeur et de « romanité »- l’Antiquité comme un modèle d’organisation urbaine. Il n’y a, dès lors, rien d’étonnant à ce que ces maquettes soient créées à l’occasion des célébrations du jubilé de 191151 ou du bimillénaire de la naissance d’Auguste (1937), qu’elles entrent au Musée52 ou soient exposées, comme celle de G. Marcelliani, au sortir du Forum romain53. Il n’est pas non plus surprenant que concepteurs, commanditaires ou commentateurs y voient l’illustration d’une perfection rationnelle dont la réalité contemporaine masquerait les traces, produisant là un « contre-sens plus ou moins volontaire, nécessaire à l’émergence d’une nouvelle pratique urbaine dont Françoise Choay n’a pas manqué de souligner le caractère étrange et surprenant de l’urbanisme tel que constitué aux xixe et xxe siècles54. »
Paul Bigot discerne ainsi dans la répartition des voies et des espaces habités un schéma d’organisation que son ami, l’architecte belge H. Lacoste, systématisera en faisant des axes viaires le moteur du développement historique de Rome55. Mais « l’un des télescopages de notions le plus improbable est l’utilisation de l’expression de piano regolatore.56 » Ainsi, pour les architectes fascistes, la maquette de Gismondi -comme d’ailleurs les panoramas graphiques en vogue57- sert d’illustration à un idéal fantasmatique d’organisation, que la politique urbaine de Mussolini ne ferait que remettre au jour, refermant la boucle
HISTOIRE DE L’ART N°65 OCTOBRE 2009 11
entre passé et présent : « le plan régulateur impérial est un organisme si parfait que les exigences nouvelles n’ont pu le modifier ; bien au contraire, là où il a été altéré ou détruit, on a inconsciemment senti la nécessité de le restaurer. Le programme édilitaire dicté par le chef du gouvernement s’affirme avec l’évidence d’une maxime qui le résume : “après les problèmes de la nécessité, ceux de la grandeur”… Le simple rapprochement du plan régulateur antique avec la structure de la Rome actuelle (i.e. après les travaux de Mussolini) suffit à en démontrer la correspondance historique.58 »
Effets d’échelle, simulacres du réel
Le « paysage de ville » que produisent ces maquettes est donc avant tout une réponse symbolique à la réalité mise à mal du « paysage urbain ». Or, matérialité des œuvres et projection des représentations dans le passé donnent à cette réplique une véritable valeur substitutive.
La plupart du temps, la taille et la nature d’un tableau imposent au spectateur un point de vue et une distance « naturels ». Tel n’est pas le cas s’agissant des maquettes où deux raisons, pourtant opposées, combinent leurs effets. La première tient aux dimensions des reliefs qui excèdent notre
Fig. 3Reconstitution du temple de Jupiter au Capitole selon Bülhmann (Bülhmann 1892).
UNE NOUVEAUTÉ DU XXe SIÈCLE ? MAQUETTES DE ROME ET PERCEPTION « PAYSAGÈRE » DE L’HISTOIRE12
perception immédiate (fig. 4). Non seulement ces œuvres n’offrent pas de point de vue privilégié, mais elles obligent le spectateur à les observer à la fois de haut et de loin, au risque d’en perdre le détail. C’est d’ailleurs ainsi que les montrent les représentations photographiques où l’effet d’ensemble l’emporte. Il y a là une réduction de la perception aux deux dimensions de la vue cavalière. La seconde raison vient du niveau de détail atteint par ces objets et que renforcent encore les moyens destinés à mettre en valeur le pittoresque des constructions (peinture, jeux de lumière etc.). Ces détails ne sont perceptibles que de tout près. Ils renvoient à l’objet architectural singulier sur lequel focalise le regard et qui est le résultat d’un processus intellectuel de reconstruction et de manipulation59. Au total, l’un et l’autre procédé perturbent les codes habituels du modèle réduit où la connaissance du tout précède celle des parties60. Taille du relief et précision des détails agissent comme des opérateurs métaphoriques de la ville réelle où nous est interdite la coexistence d’une perception à la fois globale et particulière.
Tout comme dans les utopies urbaines, où la ville idéale paraît isolée du reste du monde61 (fig. 5), l’œil céleste de l’architecte s’applique à reconstruire logiquement un panorama archéologique. La nécessaire mise à distance qui accompagne l’entreprise « transforme le fait
Fig. 4Plan de la maquette de Gismondi au musée de la Civilisation romaine, Rome (d’après Liberati 2003).
Fig. 5Montage représentant la maquette de Giuseppe Marcelliani sur une double page du magazine Capitolium, 1937.
HISTOIRE DE L’ART N°65 OCTOBRE 2009 13
urbain en concept de ville62 », tandis que son inscription dans le passé historique fait de ce microcosme un substitut de la réalité. Comme l’écrit Paul Bigot63, « Exposé dans un milieu d’art, [le relief] intéressera les peintres et surtout les architectes. À la contemplation du lieu où l’on brûla le corps de César, leur émotion sera d’un autre ordre que celle des historiens ; ils verront en lui-même le décor commémoratif et jugeront de l’idée créatrice. Ils évalueront les proportions de tel arc de triomphe à côté du Colisée, de la vaste ordonnance des Thermes, la grandeur aérée du temple de Jupiter au milieu de son majestueux entourage ; ils recevront sans s’en douter tout un ordre d’émotions en se figurant assis sur les gradins du Cirque, et sans savoir le pourquoi de tous ces monuments qui jalonnent la Spina, ils jouiront de son implantation monumentale ; ils assisteront au passage des Triomphes et dans un Cirque rempli de centaines de milliers d’hommes, ils verront par leurs yeux et n’oublieront plus. »
L’art ultime du maquettiste consiste ainsi à exhumer un paysage fossile, destiné à se substituer à une collection monumentale ruinée, de façon à proposer un univers plus vrai que le réel et dont le passé historique garantit la véracité en même temps qu’il en célèbre la grandeur.
Fig. 6Maquette du quartier du Borgo avec la percée
de la via della conciliazione présentée lors de la Mostra sull’urbanisticà italiana,
dans Capitolium, 1937.
Fig. 7Maquette du projet pour le Palazzo del Littorio (via del Impero), 1933, par V. Fasolo, dans Capitolium, 1934
(d’après Insolera et Perego 1983).
UNE NOUVEAUTÉ DU XXe SIÈCLE ? MAQUETTES DE ROME ET PERCEPTION « PAYSAGÈRE » DE L’HISTOIRE14
« C’est l’analogue du fac-similé que produisent par une sorte de mise à distance, l’aménageur de l’espace, l’urbaniste ou le cartographe64. » On comprend dès lors que l’horizon temporel des représentations soit celui de l’apogée ou de la fin de l’Empire, c’est-à-dire de la période idéologiquement perçue comme la plus brillante et donc la plus propice à l’exaltation de cette grandeur. Cela peut expliquer aussi certaines entorses à la vérité archéologique. Mais de façon plus générale, on saisit mieux aussi pourquoi les maquettes, totales ou partielles, de la Rome antique ou de la ville moderne sont à ce point présentes lors des expositions fascistes consacrées aux programmes urbains, mêlant monuments antiques et projets monumentaux (fig. 6 et 7). « Planches, gravures, photographies et surtout magnifiques plans-reliefs envoyés par le Gouvernorat de Rome et par les principaux Organismes d’État, qui ont donné leur contribution à l’aménagement de Rome, illustrent avec une évidence absolue et une très grande efficacité, les œuvres déjà accomplies, celles actuellement en cours d’achèvement, et donnent d’intéressantes préfigurations sur celles à venir65. » Là encore, le but des maquettes n’est autre que de donner réalité à un espace virtuel tout en restaurant le continuum spatial et temporel d’une ville en proie aux bouleversements de la modernité. De fait, le plan-relief de Gismondi est perçu comme le couronnement de l’exposition archéologique de 1938, au terme d’un parcours qui, du Moyen Âge à l’époque moderne, conclut à la renaissance d’un empire identifié à une ville et à un régime66.
Or, comme le note Marcel Roncayolo, « les temps de la ville sont fortement marqués et rien n’évoque une croissance continue, régulière… L’image du palimpseste, le manuscrit où l’on retrouve sous l’écriture la plus récente, la marque des anciens textes, n’est pas suffisante. Ce sont les temps différents de la ville, qui sont mis au présent, s’articulent à travers le plan, la trame des voies, les réseaux successifs, la composition sociale… L’idée de faire une richesse de cette accumulation peu cohérente de strates historiques, au-delà du respect des « monuments », est somme toute une idée neuve dans le monde. C’est en cela, sans doute, que le « modernisme » a touché sa fin67. »
L’écart n’est que plus sensible entre une image reconstruite - même à travers des fragments associant projets urbains et monuments antiques -, telle qu’elle est transmise par les maquettes et la réalité multiple et segmentée d’une ville qui n’est « pas synchrone avec elle-même68 » comme ces reconstitutions prétendent pourtant le faire croire. Supports de mémoire, les maquettes de Rome auraient donc la force du monument, c’est-à-dire la capacité « d’apporter à la fiction du passé, que les machines à mémoire ont choisi de soutenir, la caution de sa matérialité et de sa visibilité. Un monument ne peut pas mentir puisqu’il échappe au langage dont une dimension constitutive est le mensong. Mais, corrélativement, n’ayant pas de sens univoque, il peut étayer différentes fictions du passé69. » Et l’on pourrait même ajouter « du présent », s’agissant des maquettes urbaines actuelles.
M. Manuel Royo est professeur d’histoire de l’art et d’archéologie à l’université François-Rabelais (Tours), et chercheur au Centre de Recherche sur les Mondes Anciens, l’Histoire des Villes et l’Alimentation (CeRMAHVA E.A. 4247).
NOTES
1. À la mémoire de François Hinard, « redécouvreur » de la maquette de Paul Bigot. Je remercie J.-B. Minnaert de sa relecture critique et de ses suggestions.J. Roudaut, Les villes imaginaires dans la littérature française, Paris, Hatier, 1990, p. 113 sq.
2. J. Garms, « Autour de l’idée de Rome, écrivains et touristes du XIXe siècle », Mélanges de l’École Française de Rome, Italie et Méditarranée (MEFRIM), 102, 1, p. 97 sq.
3. M. Fagiolo, Roma Antica, Coll. L’immagine delle grandi città italiane, 1991, chap. 7 (s.p.).
4. Ph. Fleury, « La réalité virtuelle et la restitution de la Rome Antique », Cahiers de la MRSH-Caen 14, 1998, p. 97-105 ; L. Haselberger, A. A. Dumser (éd.), Mapping Augustan Rome, supp. JRA 50, JRA, 2002 ; D. Favro, ‘‘In the Eyes of the Beholder: Virtual Reality Re-creations and Academia », JRA Supp. 61, 2006, p. 326 sq.
5. F. Lecocq, « Du modèle virtuel. Inventaire des maquettes et reconstitutions 3D sur le Web », Cahiers de la MRSH, 33, 2000, p. 233-242 (actes du Colloque Rome, Université de Caen) ; D. Favro, art. cit.
6. D. Favro, art. cit., p. 321 ; 324.
HISTOIRE DE L’ART N°65 OCTOBRE 2009 15
7. F. Lecocq, « Les premières maquettes de Rome. L’exemple des modèles réduits en liège de Carl et Georg May dans les collections européennes aux XVIIIe-XIXe siècles », dans O. Desbordes et Ph. Fleury (éd.), Roma Illustrata, Caen, PUC, 2008, p. 227 ; V. Kockel, Phelloplastica. Modelli in sughero dell’architettura antica nel XVIII secolo nella collezione di Gustavo III di Svezia, Stockholm, 1998, p. 13-20.
8. F. Lecocq, art. cit., p. 228.
9. Les premières seraient nées de l’influence du pâtissier Carême sur Carl May (F. Lecocq, art. cit., p. 234) ; sur les autres, voir V. Kockel, op. cit., p. 22-23 et A. Gonzales-Palacios, Il gusto dei principi, Milan, 1993, fig. LIII.
10. M. C. Hellmann, « À propos de quelques voyageurs partis à la découverte de la Grèce », Revue de la Bibliothèque nationale de France, 3, 1994, p. 58-60.
11. On citera ici Auguste Pelet, dont la collection, conservée aujourd’hui au musée archéologique de Nîmes, constituait un « cabinet archéologique », visité par Mérimée lors de son voyage dans le midi de la France : P. Mérimée, Notes d’un voyage dans le midi de la France, Paris, 1835 [1989] ; A. Pelet, Description des monuments grecs et romains exécutés en liège, Nîmes, 1876 ; W. Szambien, Le musée d’Architecture, Paris, 1988, p. 12-16.
12. Une des plus célèbres est celle de Louis François Cassas, la « galerie d’architecture », « figuration de l’histoire considérée comme un objet esthétique ou vice versa » : W. Szambien, « La galerie d’architecture », dans A. Gilet et U. Westfheling (éd.), Louis-François Cassas, Dessinateur, voyageur,., Catalogue de l’exposition de Tours et de Cologne, Mayence, 1994, p. 242-243.
13. J. Soane, Description of the House and Museum on the North Side Lincoln’s Inn Fields, Londres, 1835; J. Summerson, A New Description of Sir John Soane, Londres, 1991 [9e éd.]; J. Elsner, ‘‘A Collector’s Model of Desire: The House and Museum of Sir John Soane’’, dans R. Cardinal J. Elsner (éd.), The Cultures of Collecting, Londres, 1994, p. 157 sq.
14. V. Kockel, Phelloplastica, op. cit. ; I. Tatarinova, ‘‘Architectural modes at St Petersburg Academy of Fine Art’’, Journal of History of Collections 18-1, 2006, p. 27-39 ; F. Lecocq, « Les premières maquettes de Rome », art. cit.
15. W. Szambien, Le musée d’Architecture, op. cit., p. 246.
16. M. Olausson, « I modelli in Sughero di Gustavo III e il sogno Svedese dell’Antichità », dans V. Kockel (éd.), Phelloplastica, Stockholm, 1998, p. 45-46.
17. J. Elsner, ‘‘A Collector’s Model of Desire’’, art. cit., p. 170.
18. L’exception vient de la collection de John Soane dans laquelle coexistent monuments dans leur « état actuel » et « monuments restaurés », J. Elsner, ‘‘A Collector’s Model of Desire’’, art. cit., p. 165.
19. M. David, « Giuseppe Fiorelli et les modes de documentation en archéologie », dans S. De Caro (éd.), Maisons et monuments de Pompéi dans l’ouvrage de Fausto et Felice Niccolini, Paris, 1997, p. 54-55.
20. M. Royo, Rome et l’architecte. Conception et esthétique du plan-relief de Paul Bigot, Caen, PUC, 2006, p. 26-33 ; 34.
21. F. Chevallier, « Paul Bigot, architecte romantique », dans S. Texier (éd.), L’Institut d’art et d’archéologie, Paris 1932, Paris, Picard, 2005, p. 12-27 ; M. Royo, op. cit., p. 17-21.
22. A. M. Colini, « Italo Gismondi, cultore di Roma », Studi Romani XXII, 2, 1974, p. 149 sq. ; F. Filippi (éd.), Ricostruire l’antico prima del virtuale. Italo Gismondi, un architetto per l’archeologia (1887-1974), Archivio storico al Palzzo Altemps, Rome, Quasar, 2007.
23. P. Ciancio-Rossetto, « La Roma di coccio di Guiseppe Marcelliani », BullCom, ns 4,1990, p. 11 sq.
24. P. Ciancio-Rossetto, « La reconstitution de Rome Antique, du plan-relief de Bigot à celui de Gismondi », dans F. Hinard et M. Royo (éd.), Rome. L’espace urbain et ses représentations, Paris, Presses de la Sorbonne/ Msv Tours, 1992, p. 241.
25. P. Bigot, Notice sur le relief de Rome impériale, Rome, Editrice Romana via della Frezza, 1911, p. 1.
26. A. M. Liberati, « La rappresentazione di Roma antica nel plastico di Gismondi della civiltà romana a Roma », Cahiers de la MRSH, 33, 2003, p. 245 (actes du colloque Rome 2000, Université de Caen) ; C. Pavia, Roma Antica com’era; storia e tecnica costruttiva del grande plastico dell’urbe nel Museo della Civiltà Romana, Rome, Gangemi, 2006, p. 11.
27. 1 :100 - G. Marcelliani, 1 : 400 - P. Bigot et 1 : 250 - I. Gismondi.
28. C. Pavia, op. cit., p. 215 sq.
29. J.-Cl. Balty, « Henry Lacoste et la maquette de Bruxelles. L’enseignement de l’architecture et de l’urbanisme », dans F. Hinard et M. Royo (éd.), Rome. L’espace urbain et ses représentations, Paris, Presses de la Sorbonne/ Msv Tours, 1992, p. 236 ; P. Bigot, Reconstitution en relief de la Rome antique, Paris, 1913, p. 4.
30. B. Gruet, La rue à Rome, miroir de la ville. Entre l’émotion et la norme, Paris, PURS, 2006, p. 390.
31. M. Royo, Rome et l’architecte, op. cit., p. 174-175; C. Cecchelli, « Roma aeterna, passeggiata nella Roma del IV secolo », Capitolium XII, 1937, p. 326 sq. ; E. Guidoni, Roma in Cartolina, Rome, 1984, p. 57.
32. P. Ciancio-Rossetto, « La reconstitution de Rome Antique », art. cit., p. 242.
33. M. Royo, Rome et l’architecte, op. cit., p. 26 ; G. Pisani-Sartorio, « Le plan-relief d’Italo Gismondi », dans F. Hinard et M. Royo (éd.), Rome. L’espace urbain et ses représentations, Paris, Presses de la Sorbonne/ Msv Tours, 1992, p. 259.
34. J.-C. Balty, « Henry Lacoste et la maquette de Bruxelles », art. cit., p. 230 sq. ; G. Pisani-Sartorio, « Le plan-relief d’Italo Gismondi », art. cit., p. 266 ; M. Royo, « Paul Bigot et la maquette de Rome antique », dans S. Texier (éd.), L’Institut d’art et d’archéologie…, op. cit., p. 43 ; C. Pavia, Roma Antica com’era, op. cit., p. 217 sq.
35. G. Pisani-Sartorio, art. cit., p. 262 ; C. Pavia, op. cit., p. 213 sq ; M. Royo, op. cit., p. 121 sq.
36. A. M. Liberati, « La rappresentazione di Roma antica Liberati », art. cit., p. 246.
37. J. Gracq, Autour des sept collines, Paris, José Corti, 1988, p. 116-117.
38. G. Giovannoni, L’urbanisme face aux villes anciennes, Paris, Le seuil, 1998 (éd. française).
39. V. Fratichelli, Roma 1914-1929, La città e gli architetti tra la guerra e il fascismo, Rome, 1982, p. 101-134 ;
UNE NOUVEAUTÉ DU XXe SIÈCLE ? MAQUETTES DE ROME ET PERCEPTION « PAYSAGÈRE » DE L’HISTOIRE16
I. Insolera et P. Spada, « La promenade archéologique et l’Appia antica », dans M. Querrien et A. La Regina (éd.), Archéologie et projet urbain, Paris-Rome, 1985, p. 83-86.
40. I. Insolera, Roma moderna, Un secolo di storia urbanistica, Turin, 1976 (3e éd.) ; I. Insolera et F. Perego, Archeologia e città. Storia moderna dei Fori di Roma, Bari/Rome, Laterza, 1983, p. 3-30.
41. F. Chenet-Faugeras, « Du paysage urbain », dans P. Sanson (éd.), Le paysage urbain, représentations, significations, communication, Paris, L’Harmattan, 2007, p. 40.
42. F. Chenet-Faugeras, art. cit., p. 38.
43. P. Pinon, « De la cité antique à la ville industrielle. La naissance de l’urbanisme », dans F. Hinard et M. Royo (éd.), Rome. L’espace urbain et ses représentations, Paris, Presses de la Sorbonne/ Msv Tours, 1992, p. 189 sq. ; il n’est d’ailleurs pas étonnant qu’un grand nombre de maquettes archéologiques actuelles reproduisent des ensembles urbains : N. Richer, « Les maquettes de l’Ecole française d’Athènes », Monumental, 21, juin 1998, p. 19-21.
44. D. Favro, « In the eyes of the beholder », art. cit., p. 329.
45. E. Guidoni, Roma in cartolina, op. cit., p. 57-62 ; G. Gatteschi, Restauri della Roma Imperiale, con gli stati attuali e il testo spiegativo in quattro lingue, Rome, 1924.
46. Voir par ex. J. Bülhmann, Das Alte Rom mit dem Triumphzüge Kaiser Constantins im Jahre 312 N. Chr., Munich, F. Hanestaengl, 1892 ; G. Gatteschi, Restauro grafico del Monte Capitolino, Foro romano e monumenti circostanti nell’anno 300 dopo Cr., Rome, 1897; F. Guidobaldi, « L’edilizia abitativa unifamiliare nella Roma tardo antica », dans A. Giardina (éd.), Società romana e Impero Tardo-antico, Roma, Politica, Economia, Paesaggio urbano, Rome, Einaudi, t. II, 1986, p. 165-237 ; Patouillard, dans J.-M. Salamito, « L’îsola tiberina », dans M. Lenoir et G. Pisani-Sartorio (éd.), Roma antiqua, «Envois » degli architetti francesi (1786-1901), Grandi edifici pubblici, Rome, École Française de Rome, Commune di Roma, Ecole Nationale supérieure des Beaux-Arts, 1992, p. 132-161.
47. D. Palombi, Rodolfo Lanciani, l’archeologia a Roma tra Ottocento e Novecento, Rome, L’Erma di Breitschneider, 2006, p. 97 sq. ; 285 sq.
48. M. Barbanera, L’archeologia degli italiani, Rome, Editori Riuniti, 1998, qui cite l’archéologue italien Guido Calza, p. 152 (trad. personnelle).
49. Discours du 31 décembre 1925 : « Vous continuerez à libérer le tronc du grand chêne de tout ce qui l’étouffe encore : vous ouvrirez des percées autour du Théâtre de Marcellus, du Capitole, du Panthéon ; tout ce qui est venu s’y greffer durant les siècles de la décadence devra disparaître. D’ici cinq ans, une grande perspective doit rendre visible le Panthéon depuis la piazza Colonna. Vous libérerez aussi des constructions parasites et profanes les temples majestueux de la Rome chrétienne : les monuments millénaires de notre histoire doivent se dresser, tels des géants, dans un isolement nécessaire » (traduction de l’auteur), cité
par A. Cederna, Mussolini urbanista, lo sventramento di Roma negli anni del consenso, Bari, Laterza, 1979, p. 51.
50. G. Pisani-Sartorio, « Le plan-relief d’Italo Gismondi », art. cit., p. 261.
51. R. Lanciani (éd.), Catalogo della Mostra Archeologica nelle Terme di Diocleziano. Bergamo, 1911, p. 5-11 ; 181 ; A. Caracciolo, Roma capitale, dal Risorgimento alla crisi dello stato liberale, Rome (3e éd.), 1974, p. 287 sq.
52. A. M. Liberati, « La rappresentazione di Roma antica Liberati », art. cit., p. 246.
53. P. Ciancio-Rossetto, « La reconstitution de Rome Antique », art. cit., p. 242.
54. B. Gruet, La rue à Rome, op. cit., p. 391.
55. J.-C. Balty, « Henry Lacoste et la maquette de Bruxelles », art. cit., p. 227-230 ; M. Royo, Rome et l’architecte, op. cit., p. 47-53.
56. B. Gruet, op. cit., p. 392 sq.
57. Voir en particulier la page de titre de l’article de F. Clementi, « Il Piano Regolatore di Roma antica in relazione all’organismo della città attuale », dans Capitolium XIII, 1938, p. 443-456.
58. F. Clementi, « Il Piano Regolatore di Roma antica », art. cit., p. 445 sq. (trad. personnelle).
59. Voir dans le même ordre d’idées la distinction entre perspective et axonométrie chez P. Boudon, « La trame du monde », Sémiotiques, 4, 1993, p. 49 sq. ; 58.
60. Cl. Lévi-Strauss, La pensée sauvage, Paris, 1962, rééd. 1990, p. 38.
61. P. Gouhier, « Le plan de Rome des « Très Riches Heures du Duc de Berry », dans Rome antique, Pouvoir des images, images du pouvoir, actes du Colloque international, Caen, CERLA-Presses universitaires de Caen, 2000, p. 21 sq. ; I. Insolera, Roma. Imagini e realta dal X al XX secolo, Bari/Rome, Laterza 1980, p. 15 sq., fig. 21, 24, 25; P. Pinon, « De la cité antique à la ville industrielle », art. cit., p. 258.
62. M. Roncayolo, La ville et ses territoires, Paris, Gallimard, 1990, p. 161-163 ; M. de Certeau, L’invention du quotidien. I. Arts de faire, Paris, UGE, 1980, p. 175.
63. P. Bigot, Rome antique au IV e siècle après J.-C., Paris, Vincent et Fréal, 1942, p. 7.
64. M. de Certeau, L’invention du quotidien, op. cit., p. 173.
65. Anonyme, « Le grandiose realizzazioni della Roma Mussoliana alla Mostra dell’urbanistica italiana a Vienna », Capitolium XII, 1937, p. 616 (trad. de l’auteur).
66. F. Clementi, « Il Piano Regolatore di Roma antica », art. cit., p. 196.
67. M. Roncayolo, La ville et ses territoires, op. cit., p. 139 ; 143.
68. M. Roncayolo, op. cit., p. 143.
69. M. Guillaume, « Mémoires de villes », L’Archive, Traverses, 36, 1986, p. 138.