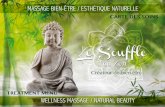document de travail - International Nuclear Information System ...
Manuti, A. Mininni, G., & Santarpia, A., (2011). Ancrer le bien-être au travail. Une étude sur la...
-
Upload
usherbrooke -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Manuti, A. Mininni, G., & Santarpia, A., (2011). Ancrer le bien-être au travail. Une étude sur la...
chaPitreAncrer le bien-être au travail
Une étude sur la construction discursive
du travail flexiblePascal Giuseppe Mininni – Amelia Manuti – Alfonso Santarpia 1
1. Université de Bari Département de Psychologie Palazzo Ateneo, Italie.
10Sommaire
Introduction 182
1. Apports théoriques 183
2. Méthodologie 187
3. Résultats 188
Conclusion 194
PsychoSociale.indd 181 17/05/11 11:46:25
1e épreuve 2011-05-17
1e épreuve 2011-05-17
182 Chapitre 10 – Ancrer le bien-être au travail
Résumé introductif
Récemment la vie professionnelle a été confrontée à des changements radicaux à cause des révolutions économiques, technologiques et sociales. La flexibilité du travail est devenue un mot clef pour les organisations, une condition nécessaire pour la survivance des marchés du travail national dans un monde de compétition globale, qui pousse les travailleurs modernes à s’adapter à des circonstances flexibles et à se préparer à des car-rières multiples (Atkinson, 1984 ; Reilly, 1998 ; Peiro et al., 2002). Dans ce cadre le concept de bien-être devient particulièrement pertinent en référence aux stratégies de planification de la carrière des jeunes générations qui doivent être prêtes à accepter une carrière flexible et sans confins. Le but de cette étude est d’analyser la relation entre bien-être subjectif et flexibilité du travail. On a conduit huit entrevues avec un groupe de tra-vailleurs stables et temporaires dans le but d’analyser l’attitude envers la restructuration rapide et radicale du marché du travail après l’adoption de politiques flexibles et pour capturer la construction discursive du sens de la flexibilité et du bien être. La recherche adopte une approche qualitative de l’analyse diatextuelle (Mininni, 1992, 2003, 2005) afin de mieux comprendre la relation entre parlants, sens et contexte d’énonciation. Plus en détail, une attention particulière a été donnée aux stratégies communicatives utilisée par les parlants qui ont été révélés grâce aux nombreuse traces pragmatiques et linguis-tiques (par exemple figures rhétoriques, présuppositions, choix stylistiques, etc.) et qui consentent à mettre en évidence la récurrence de répertoires interprétatifs spécifiques (Potter et Wetherell, 1987).
Introduction
Le langage et le travail sont les phénomènes qui donnent à l’expérience de la vie humaine son caractère unique. Il s’agit de deux conditions d’agence marquées par une homologie structurelle profonde (RossiLandi, 1968). En considérant la perspective « contractuelle » au sein de la communication humaine, Ghiglione (1986) a introduit plusieurs approches qui récemment ont de plus en plus mis en évidence sa nature dialogique (Weigand, 2000) et contextuelle (Mininni, 2003). Le contexte social et historique surdétermine n’importe quelle pratique communicative, parce que les gens ont besoin d’utiliser les ressources symboliques afin de partager ou de se dissocier d’une représentation du monde donnée (Mey, 2003).
On peut trouver les forces dynamiques qui lient les interactions aux connaissances, en faisant référence aux enjeux de l’organisation du travail (Barsalou, 2002). Aujourd’hui la littérature spécialisée a explicité la notion d’« action située » visant à éclaircir la complexe relation qui existe entre les processus cognitifs ; ces derniers, qui se déroulent aussi bien au niveau individuel que collectif, nous permettent d’interpréter les organisations en tant que « communautés de pratiques » (Lave et Wenger, 1991). Dans ce cadre général la communication est une dimension inévitable pour tous les processus d’organisation. S’il n’y a pas de communication, il n’y a aussi ni leadership ni motivation, ni négociation ni décision, parce que dans un tel cas les personnes n’ont aucune garantie sur le sens de ce qu’ils font et/ou de ce qu’ils devraient faire.
PsychoSociale.indd 182 17/05/11 11:46:25
1e épreuve 2011-05-17
1e épreuve 2011-05-17
183Apports théoriques
Souvent dans les organisations on distingue deux fonctions de la communication : instrumentale et intégrative. La première concerne la transmission des informations concernant les tâches et les rôles des personnes afin de contrôler et de coordonner les processus organisationnels ; la seconde met au relief les modalités de la construction identitaire au niveau individuel et collectif. Lorsque l’emphase est mise sur l’identité de l’organisation, les gens puisent dans les pratiques de la communication les ressources cognitives et émotionnelles nécessaires à l’activation d’une structure productive de décisions. En bref, la communication peut être conçue comme un indicateur de « conditions de santé » des organisations et du bienêtre de tous ceux qui y travaillent.
Notre recherche vise à montrer qu’on peut mieux comprendre la structure de la participation des personnes à une organisation donnée, en analysant la manière dont elles parlent de leur travail. La construction discursive de l’appartenance identitaire à certaines modalités de travail laisse transparaître l’élaboration de l’expérience du bienêtre personnel et organisationnel. L’identité professionnelle (en termes de motivation, engagement, etc.) se réalise à travers les processus d’intériorisation des contextes organisationnels qui sont définis par les enjeux de la communication.
1. Apports théoriques
1.1 Discours et bien-être au travail
Le « tournant linguistique » ou « discursif », qu’on a enregistré plusieurs fois dans les sciences humaines au cours du XXe siècle (Harré et Gillett, 1994), souligne que le langage fonctionne comme un « système de modelage primaire de la réalité » (Lotman, 1986). Ce sont les pratiques discursives qui nous permettent de percevoir les dynamiques de l’esprit en action (Potter, 2003). La possibilité de donner du sens (sense-making), qui soutient n’importe quelle activité de communication, devient le schéma explicatif des processus de la reproduction sociale et culturelle. Par conséquent, il est très intéressant d’examiner comment l’expérience du travail se reflète dans la construction discursive du bienêtre, en envisageant cette qualité de la vie aussi bien dans la perspective hédoniste qu’eudémoniste (Diener, 1994).
En effet, ce que les gens (et les communautés) interprètent comme « éprouver du bienêtre » est défini aussi par les multiples façons à travers lesquelles ils donnent du sens aux activités du travail. La sensation d’autoefficacitéou de frustration qui peut dériver des contextes organisationnels du travail pénètre dans la production discursive de l’identité de ceux qui ont du dédain. Même si avec des modes et des degrés différents, l’expérience du travail est pertinente par rapport aux principales théories du bienêtre, qui mettent au point son ton émotionnel (la perspective hédoniste) ou bien sa texture d’évaluation (perspective eudémoniste). En effet, quelquesuns perçoivent les contextes de travail comme un défi ou une menace pour l’expérience du bienêtre, parce qu’ils sont exposés aux risques d’éprouver des émotions négatives ; d’autres considèrent les contextes de travail comme des occasions de faire des expériences
PsychoSociale.indd 183 17/05/11 11:46:25
1e épreuve 2011-05-17
1e épreuve 2011-05-17
184 Chapitre 10 – Ancrer le bien-être au travail
profondes de bienêtre entendues en accord avec leur propre « démon » intérieur, ce sont ces contexteslà qui alimentent en effet le potentiel des aspirations personnelles.
Donc, les pratiques du travail constituent une condition métastable pour l’énonciation du bienêtre perçu, parce qu’elles peuvent soit produire une altération négative des attentes concernant le bienêtre subjectif, soit amorcer une confirmation positive des attentes concernant le bienêtre personnel. Quelquefois il peut être interprété comme une source de chagrin, plus ou moins lourd, quelquefois il soutient les vécus inspirés à la compétence et à l’autonomie.
En considérant l’importance décisive des contextes sociaux et organisationnels ainsi que l’entrelacement des composantes cognitives, affectives et motivationnelles de l’identité professionnelle, on peut soutenir que l’analyse des pratiques communicatives pourrait être une ressource très utile pour chercher à pénétrer le bienêtre subjectif dans les organisations, c’estàdire comment les gens se sentent lorsqu’ils travaillent.
Récemment le sujet du bienêtre subjectif est devenu de plus en plus important dans le domaine des sciences humaines, au fur et à mesure qu’on a pris conscience qu’ « aller bien », n’est pas simplement le contraire de « ne pas aller bien ». En effet, la conception dominante du bienêtre a plongé longtemps ses racines dans un modèle selon lequel la santé n’est définie que par l’absence de maladie et de désordre. L’ouvrage classique de Bradburn (1969) ayant pour objet la structure du bienêtre psychologique permet d’expliquer la première distinction entre affecte positif et négatif. À travers la tentative d’explorer le lien existant entre les changements sociaux au niveau « macro » (tels que les rythmes de l’urbanisation, les modifications des structures éducatives, les modèles d’emploi et les tensions sociales) et le vécu du bienêtre psychologique, Bradburn développe le sens commun selon lequel le bonheur est une variable dépendante qui peut être définie en termes d’équilibre entre affecte négatif et positif.
Cette conclusion a été âprement refusée par les programmes de recherche qui suggèrent de considérer le bonheur comme un sentiment de bienêtre à bref terme, incapable de faire face aux défis les plus durables de la vie tels qu’éprouver une impression de direction ou de finalité, nouer des rapports satisfaisants avec les autres, atteindre l’enjeu de l’autoréalisation (Ryff, 1989). C’est ainsi qu’on peut donner une confirmation nouvelle aux spéculations des anciens Grecs concernant la différence entre se sentir bien à ce momentlà (perspective hédoniste) et la tâche bien plus absorbante visant à réaliser son propre potentiel (perspective eudémoniste) (Waterman, 1984).
Bien sûr, le bonheur n’est pas le seul indicateur du fonctionnement psychique positif. Beaucoup de chercheurs ont essayé de vérifier empiriquement la définition du bienêtre en termes de satisfaction et de qualité de vie (Neugarten, Havighurst et Tobin, 1961). Mais, la satisfaction ou la qualité de vie, même si considérée comme une dimension à plus long terme n’est pas arrivée à contrôler certaines caractéristiques du bienêtre telles que l’autonomie, la croissance personnelle et les relations positives avec les autres. D’où la nécessité d’ancrer les études sur le bienêtre subjectif avec le postulat que cette notion ne se limite pas à mettre en évidence le manque de facteurs négatifs, mais elle incorpore aussi la valorisation des facteurs positifs (Diener et Diener, 1995). Bien sûr, le bonheur, la sérénité, la satisfaction de la vie peuvent exister en concomitance avec les sensations de défi et de stress (Diener, 1994 ; Veenhoven, 1996). Les
PsychoSociale.indd 184 17/05/11 11:46:25
1e épreuve 2011-05-17
1e épreuve 2011-05-17
185Apports théoriques
émotions positives et négatives peuvent coexister même au niveau de l’expérience subjective (George et al., 1995) ; en outre il ne faut pas croire que les individus vont aller bien simplement parce qu’ils ne font pas référence à leurs symptômes ou à des humeurs négatifs.
En bref, le bienêtre subjectif concerne les évaluations que chacun fait de sa propre qualité de vie en général, il s’agit donc d’une construction multidimensionnelle incluant des composantes aussi bien cognitives qu’affectives (Diener, 1994). Plus exactement, le bienêtre subjectif est le résultat de trois composantes : un niveau relativement haut d’affection positive, un niveau relativement bas d’affection négative et, enfin, un jugement global concernant la qualité de vie perçue comme bonne. Cette dernière évaluation cognitive est caractérisée le plus souvent par la satisfaction de vie. Au niveau théorique, le débat sur la notion du bienêtre, sur ses antécédents et ses conséquences, s’entremêle avec la discussion sur les procédures et les méthodes de mesure qui ont été développées pour définir sa structure de base. Beaucoup de chercheurs suivent le parcours traditionnel de la recherche quantitative (Gill et Fenstein, 1994), c’est pour cette raison qu’on essayera ici de valoriser le potentiel de quelques méthodes qualitatives.
1.2 La flexibilité du travail : risque ou ressource pour le bien-être ?
Dans ce cadre un rôle très important est joué par l’expérience du travail qui représente un aspect très significatif du bienêtre subjectif.
Récemment la vie professionnelle a été bouleversée par des changements radicaux causés par des révolutions économiques, technologiques et sociales qui ont eu lieu au niveau global. Par conséquent, la flexibilité du travail est devenue un mot clef pour les organisations, il s’agit d’une condition nécessaire pour permettre aux marchés nationaux du travail de survivre dans un monde de compétition globale, qui pousse les travailleurs. Aujourd’hui, les travailleurs sont en effet contraints à s’adapter aux circonstances d’une façon flexible et à se préparer à des carrières multiples (Atkinson, 1984 ; Reilly, 1998 ; Peiro et al., 2002).
Ces changements radicaux ont rapidement redessiné le sens du travail et les stratégies utilisées pour faire face aux exigences de la flexibilité (Hartley, Jacobson, Klandermans et Van Vuuren, 1991). En outre, bien que les organisations définissent la flexibilité comme une opportunité pour les travailleurs, qui peuvent utiliser cet escamotage pour mieux planifier la journée de travail et les activité du temps libre, la plupart des travailleurs subissent la flexibilité comme une demande de l’organisation, avec des implications considérables au niveau psychologique (Jacobson, 1991 ; Sverke et Hellgren, 2002).
En effet, pour ce qui concerne les nouvelles opportunités et modalités de travail, on observe un écart très important entre la perspective individuelle et la perspective des organisations ; ce dernier a produit une restructuration générale dans la traditionnelle représentation sociale du travail.
PsychoSociale.indd 185 17/05/11 11:46:25
1e épreuve 2011-05-17
1e épreuve 2011-05-17
186 Chapitre 10 – Ancrer le bien-être au travail
La notion de travail sûr et stable, qui dans le passé a été un mythe pour la plupart des sociétés occidentales, a été graduellement remplacée par celle du travail flexible et atypique. La carrière n’est plus un itinéraire linéaire, car elle est devenue un puzzle d’expériences, qui influencent la construction de l’identité professionnelle (Sennett, 1999).
Ces changements ont bouleversé la vie professionnelle de millions de travailleurs en causant beaucoup de sentiments d’incertitude sur l’existence de leur profession et sur la nature de leur identité professionnelle (Mow, 1987 ; Manuti, 2006). La littérature la plus récente dans la psychologie du travail a suggéré que l’incertitude à l’égard de notre propre vie professionnelle peut entraîner des conséquences très graves sur les conduites des travailleurs (Skerve et Hellgren, 2001), sur leur bienêtre subjectif (Barling et Kelloway, 1996 ; De Witte, 1999 ; Kinnunen, Mauno, Naetti et Happonen, 1999 ; Mohr, 2000) et sur les processus de l’organisation (Ketz De Vries et Balazs, 1997). Beaucoup de recherches ont montré que la flexibilité du travail est fortement corrélée avec l’incertitude du travail, les travailleurs ont un sentiment d’incertitude envers leur propre futur professionnel à cause de leur propre position occupationnelle (Klein Hesselink et Van Vuuren, 1999).
Un autre aspect très important qui met en relation le bienêtre psychologique avec la flexibilité du travail est le contrat psychologique et donc l’identification avec sa propre organisation (Rousseau, 1995, 1998). L’identification avec l’organisation peut être entendue comme un état psychologique qui permet aux individus de se percevoir comme une partie intégrante de l’organisation. Pendant une période de grands changements (Pfeffer, 1998), cet état psychologique exerce un rôle très important sur les performances professionnelles (Castanzias et Helfat, 1991), sur le bienêtre subjectif (Weiss, 1990) et sur l’élasticité aussi bien de l’organisation que du travail.
L’identification avec l’organisation peut être caractérisée par des degrés différents. Une identification minimale a lieu lorsque, pendant une période limitée dans le temps (par exemple, quelques travaux d’équipe), le sujet et l’organisation partagent des intérêts qui dominent leurs différences. Par conséquence, le sujet considère sa relation avec l’organisation comme si elle était entre deux parties du même ensemble qui forment un « nous ». Cet état est connu comme identification située. Une identification plus profonde a lieu lorsque la relation professionnelle altère les représentations mentales que le sujet a de soi en y incorporant l’organisation même. Ce mode d’identification, connue comme identification profonde, conduit à la congruence entre l’identité professionnelle et l’image qu’on a de soi (Turner, 1978). Quelques études empiriques montrent que les travailleurs temporaires ont plus tendance à établir une identification située que les travailleurs stables. De plus, les travailleurs stables ont plus accès à des ressources symboliques particulières, comme par exemple le pouvoir, que les travailleurs temporaires, qui n’ont accès qu’à des ressources économiques.
Cette évidence peut générer mécontentement et désengagement parmi les travailleurs temporaires (Kossek et al., 1997) jusqu’à se trouver impliqués dans des conflits personnels avec l’autre catégorie de travailleurs.
La position des travailleurs temporaires, c’estàdire la perception que sa propre relation avec l’organisation et avec les collègues est fortement influencée par la durée du
PsychoSociale.indd 186 17/05/11 11:46:25
1e épreuve 2011-05-17
1e épreuve 2011-05-17
187Méthode
contrat, conduit ce groupe de travailleurs à développer un contrat psychologique transactionnel plutôt qu’un contrat psychologique relationnel. Plus en détail, le contrat psychologique est un système de croyances et d’attitudes développés par les travailleurs à propos des droits et des devoirs mutuels qui joignent le travailleur et l’organisation. Ce système est modelé par les différents types de contrat d’emploi (à court terme plutôt qu’à durée indéterminée). La variation la plus importante concerne l’impact psychologique du contrat, car le premier est caractérisé par un degré faible de participation et d’identification, tandis que le second est caractérisé par une attribution de confiance et de fidélité.
C’est pour cette raison que le concept de « travail flexible » subit une transformation discursive profonde lorsqu’il est énoncé comme « travail précaire ». La notion de « bienêtre subjectif » peut être l’outil le plus raffiné pour capturer cette commutation de sens que le discours social enregistre dans l’alternative lexicale « flexible versus précaire ». L’étude présentée ici se focalise sur les formes et les modalités par lesquelles on peut énoncer cette différence.
2. Méthode
2.1 Objectifs
À partir de ce scénario, qui confronte la littérature sur le bienêtre psychologique avec les recherches sur l’incertitude du futur professionnel, le but principal de cette étude est l’analyse de la construction discursive du sens de la flexibilité.
2.2 Participants
Le contexte d’étude est le conseil municipal d’une petite ville du Sud de l’Italie (Alberobello). Les participants sont huit travailleurs : quatre temporaires (trois femmes et un homme) et quatre stables (trois femmes et un homme).
2.3 Méthode
Les méthodes d’analyse discursive adoptées dans cette étude sont compatibles avec une perspective qualitative et socioconstructiviste, suivant laquelle la langue n’est pas un miroir de structures cognitives qui préexistent, mais une matrice complexe qui produit des multiples « formes de vie » (Mininni, 2003). Plus en détail, les instruments qui ont été adoptés sont :
– l’interview narrative (Atkinson, 1998). Les participants ont été interviewés individuellement afin d’étudier la construction discursive du sens qu’ils donnent à l’expérience du travail, du bienêtre et du bienêtre au travail ;
PsychoSociale.indd 187 17/05/11 11:46:25
1e épreuve 2011-05-17
1e épreuve 2011-05-17
188 Chapitre 10 – Ancrer le bien-être au travail
– le récit de l’organisation. À partir de l’approche de la psychologie narrative, cet outil permet de révéler la nature réelle de l’organisation humaine. À ce propos, on a demandé aux participants de se référer à un récit de leur propre organisation qui puisse être représentatif de leur appartenance à l’organisation même.
Pour examiner les données et mieux comprendre la relation entre texte, contexte et énonciateurs on a adopté l’analyse diatextuelle (Mininni, 1992, 2003), qui peut être considérée comme une forme particulière de l’analyse du discours. Elle vise à organiser les traces de subjectivité, de consistance argumentative et de modalité expressive laissées par les locuteurs dans leurs textes, en essayant de produire un profil discursif cohérent. Par conséquent, une attention particulière est donnée aux stratégies de communication qu’on peut repérer par de nombreux indices pragmatiques et linguistiques (par exemple, les actes illocutoires ou les effets perlocutoires, les figures rhétoriques, les présuppositions, les options stylistiques ou les scénarios interlocutoires, etc.). La consistance de ces indices permet d’établir des répertoires interprétatifs spécifiques à une série de textes (Potter et Wetherell, 1987), en esquissant une hypothèse générale sur la production de leur sens qu’on peut présenter par le dispositif figuratif du « carré sémiotique » (Greimas et Courtés, 1979).
3. Discussion des résultats
3.1 Les positions discursives du bien-être au travail
Les textes des sujets interviewés ont été envisagés pour repérer la construction de l’identité professionnelle des travailleurs temporaires et stables. L’analyse diatextuelle vise à relever tous les aspects pragmatiques et rhétoriques qui sont impliqués dans les processus de production du sens, en mettant en évidence comment les locuteurs se placent réciproquement par leurs actes discursifs et par les stratégies de communication qui viennent d’être utilisées.
Généralement, le programme argumentatif qui supporte les positions identitaires est organisé selon des stratégies de généralisation (en disant, par exemple : « tous les types de travail… »), qui permettent aux locuteurs de se percevoir et de se faire percevoir le plus impliqué possible. Par contre, le premier programme argumentatif qu’on peut repérer dans les textes est marqué par la présence de stratégies de particularisation (par exemple : « je me souviens qu’un jour… »), qui conduit le locuteur à trahir la nature narrative de la pensée.
– « moi, j’aime ce travail, ce que je n’aime pas ce sont quelques collègues. Je me souviens qu’un jour une de ces personnes (un travailleur stable) m’a fait un reproche en public. Je ne méritais pas ce reproche-là, mais ce qui m’a déçu le plus fut le mode de faire le reproche, le fait que ce reproche eut lieu en public sans se soucier aucunement de ceux qui étaient là. Il avait fait ça pour se justifier et pour blâmer les autres » (travailleuse temporaire, 33 ans).
PsychoSociale.indd 188 17/05/11 11:46:25
1e épreuve 2011-05-17
1e épreuve 2011-05-17
189Discussion des résultats
Plus en détail, quand le texte est surdéterminé par les catégories de « satisfaction » et d’« obligation », il existe des significations qui attirent l’attention sur l’interprétation de l’expérience du travail comme une expérience statique. Donc le profil de l’identité qui émerge de cette texture discursive est celui du travailleur accoutumé. Ce profil se caractérise par une acceptation passive du travail comme une partie intégrante dans la vie de tout un chacun. Quoiqu’ils soient satisfaits de leur travail, ces sujets sont plutôt désenchantés par cette expérience : ils acceptent le travail avec résignation.
Lorsque le texte met l’accent sur les idées de satisfaction et d’engagement, on aperçoit le profil du travailleur heureux. Pour ce type de locuteurs le travail occupe une place très importante dans la vie. On repère un répertoire interprétatif « émotionnel » caractérisé par des mots et des locutions qui rappellent la participation personnelle et l’attachement au travail. Les indices affectifs (« intéressant » et « satisfaisant ») et les procédures d’embrayage (« mon travail ») dessinent une image d’énonciateur marqué par une grande identification au travail, qui est définie comme « une des composantes les plus stables de l’existence ». Cet exemple confirme l’importance jouée d’un travail stable dans les systèmes de croyances des personnes, car chacun a l’exigence d’organiser sa propre vie personnelle et professionnelle.
– « moi, je suis contente de ce travail, j’aime mes tâches. Maintenant j’aime vraiment ce que je fais, je travaille comme secrétaire général et c’est une activité très intéressante. Je pense que, si ont fait les choses avec passion, tout est satisfaisant. N’importe quel type de travail peut être gratifiant. Mon travail est très important pour moi, il est une des composantes les plus stables de mon existence et il m’apporte aussi du bonheur. Je me sens sûre avec mon travail stable, je sais que j’aurais toujours un travail et je peux donc organiser ma vie » (travailleuse stable, 32 ans).
Bien sûr, on trouve aussi le travailleur souffrant. Ce groupe de locuteurs considère le travail comme une expérience très négative, comme un fardeau qu’on doit supporter seulement pour des exigences d’ordre économique. Dans ce cas le répertoire interprétatif est caractérisé par des mots et des locutions qui soulignent la dimension d’obligation (« bien que je n’aime pas mon travail, je dois le faire ») et par la gêne amère qui dérive de cet effort négatif (« je dois le supporter avec le sourire »). Dans ces textes, le travail n’a pas seulement une dimension extrinsèque (accomplir ses tâches et gagner son salaire), il trahit plutôt une dimension intrinsèque et sociale qui est certainement plus importante que la première. L’emphase sur l’importance d’un climat positif et de relations personnelles agréables vise à dénoncer implicitement leur absence. L’extrait 3 met très simplement en évidence le fait que l’expérience du travail est très complexe : avoir une position permanente ne suffit pas à se sentir satisfait de son travail.
– « moi, je n’aime pas travailler ici. Je n’ai pas de relations avec les autres parce que je suis très spontanée et je n’aime pas les personnes qui cassent du sucre sur le dos des autres. Sincèrement je ne suis pas satisfaite de mon travail et si je pouvais me mettre à la retraite je l’aurais sans doute déjà fait, mais malheureusement je ne peux pas le faire, j’ai besoin de ce salaire et je ne suis pas assez vielle pour me retirer, donc je dois suppor-ter la situation avec le sourire » (travailleuse permanente, 45 ans).
Enfin, il y a des gens qui vivent entre le passé et le futur, en laissant transparaître le profil du travailleur confiant. Le passé est décrit en termes négatifs, mais ils ont en
PsychoSociale.indd 189 17/05/11 11:46:25
1e épreuve 2011-05-17
1e épreuve 2011-05-17
190 Chapitre 10 – Ancrer le bien-être au travail
même temps plein d’espoir pour le futur. En effet, ils ne sont pas satisfaits de leur travail actuel, mais ils s’engagent quand même parce qu’ils considèrent le travail comme une expérience très importante qui peut contribuer à évoluer et à s’améliorer. Le répertoire interprétatif de ce groupe de textes est caractérisé par l’ambivalence, car les mots qui reviennent souvent configurent une image d’énonciateurs tout à fait satisfaits de leur travail, mais en même temps très rattachés à l’espoir pour le futur et à la confiance en leurs propres forces et ressources.
– « si je peux être sincère, ce travail n’est pas comme j’avais pensé. Moi, je me sens contraint à faire des choses qui ne sont pas congruentes avec ma préparation. Mes connaissances m’ont aidé mais je sens que ça n’est pas le travail de ma vie. De toute façon, je suis content de mon travail et quelque fois je me sens mal parce que je pense que tôt ou tard je serai chômeur une nouvelle fois. Ce ne sera pas le dernier au revoir. J’attendrai une autre occasion et si elle n’arrive pas, je chercherai un autre travail » (travailleur temporaire, 28 ans).
La texture émotionnelle des profils discursifs se révèle par le « jeu des pronoms » (par exemple, la répétition de « ce travail » versus « mon travail »), par l’adoption de stratégies de modalisation et des indices métadiscursifs (« si je peux être sincère… »). Dans l’extrait suivant, catégorisé comme propre à un travailleur souffrant, l’énonciateur essaye de construire « discursivement » un terrain commun avec son allocuteur (par exemple : en faisant recours à une locution d’entente mutuelle telle que « comme on sait »). La position argumentative énoncée n’est supportée que par une vue stéréotypée de la femme au travail.
– « moi, je n’aime pas le cadre ici, je ne sais pas si c’est juste une caractéristique de ce cadre ou si c’est une caractéristique inhérente à toutes les administrations publiques… Certainement dans n’importe quel contexte public il y a une situation similaire parce que il y a beaucoup de personnes qui travaillent ensemble et comme on le sait malheu-reusement quand il y a beaucoup de femmes il y a de la rivalité et des malentendus » (travailleuse temporaire, 28 ans).
En ce qui concerne la distribution des profils par rapport à la position occupationnelle des sujets, l’analyse du discours a révélé qu’aucun des travailleurs temporaires ne montre un profil heureux et aucun des permanents n’a un profil confiant. La première évidence peut être expliquée en faisant référence au contexte particulier de la recherche, qui est caractérisé par une grande difficulté de relation entre les travailleurs temporaires et permanents. Par contre, le fait que les travailleurs permanents ne soient jamais catégorisés comme confiants peut être lié à leur condition professionnelle, qui les rend indolents et quelque fois passifs envers leur travail.
On peut synthétiser les résultats d’une première analyse diatextuelle à travers le dispositif du « carré sémiotique » (Greimas et Courtes, 1979), car il permet de capturer la dynamique de production du sens qui est activée dans les pratiques discursives en mettant en relief la contribution individuelle au plus général programme discursif. En effet, le processus de production de sens qui est propre à chaque position de l’identité s’affirme parce qu’il représente une des alternatives qui peuvent caractériser ce contexte d’énonciation. En étant la représentation figurative de l’articulation logique propre à chaque catégorie sémantique, le « carré sémiotique » organise des traces
PsychoSociale.indd 190 17/05/11 11:46:25
1e épreuve 2011-05-17
1e épreuve 2011-05-17
191Discussion des résultats
argumentatives qui modèlent quatre profils différents de l’identité. Chaque position discursive suit son plan interprétatif pour établir le sens du travail flexible.
Aristote avait déjà affirmé que le monde conceptuel postule une organisation du sens en termes de contraste ou de valorisation, car les signifiés ne peuvent exister qu’en repérant une différence entre les deux. À partir de là, le carré sémiotique est la représentation figurative du processus de la production du sens qui est impliquée dans chaque événement communicatif et pragmatique. Donc le carré sémiotique est fondé sur deux hypothèses :
– chaque demande de sens est validée grâce à son opposite (par exemple : blanc versus noir) ;
– chaque opposition de sens implique sa négation (par exemple : blanc et non blanc).
En bref, une chose est « blanche » parce qu’il est possible de la distinguer de quelque chose qui est « noire », « pas noire » et « pas blanche ». À vrai dire, n’importe quel trait distinctif qui contribue à la production du sens peut être situé sur l’axe de la contrariété (« blanc » versus « noir »), de la contradiction (« blanc » versus « nonblanc ») et de la subcontrariété (« nonblanc » versus « nonnoir »).
L’analyse diatextuelle des récits des travailleurs interviewés porte sur un carré sémiotique dessiné par deux axes sémantiques (figure 10.1) : d’une part la « satisfaction » opposée à la « nonsatisfaction », de l’autre l’opposition entre « obligation » et « engagement » dans le travail (cf. figure 10.1). Ces traits sémantiques sont en accord avec la littérature principale sur le sens du travail (Mow, 1987) et ils permettent de tracer quatre profils discursifs (accoutumé, heureux, souffrant et confiant), qui rendent compte d’autant de différentes positions à l’égard de l’expérience professionnelle.
Figure 10.1.Carré sémiotique des positions discursives sur le sens du travail
Ob
LIg
AT
ION
SATISFACTION ENg
Ag
EMEN
T
Stase versus ÉlanAccoutumé HeureuxSouffrant ConfiantNon élan versus Non-stase
NON-SATISFACTION
Donc la flexibilité du travail peut être interprétée différemment par rapport à la position des participants, c’estàdire des travailleurs temporaires ou stables. Les matrices d’opposition (satisfaction/nonsatisfaction et obligation/engagement) qui contribuent à la définition des profils discursifs du bienêtre ne sont pas en corrélation avec une des différences les plus évidentes qui marquent l’expérience du travail (c’estàdire la différence entre une carrière stable et une carrière précaire). Elles sont plutôt liées à une valeur plus intrinsèque du travail. En effet les travailleurs temporaires
PsychoSociale.indd 191 17/05/11 11:46:25
1e épreuve 2011-05-17
1e épreuve 2011-05-17
192 Chapitre 10 – Ancrer le bien-être au travail
considèrent le travail comme une occasion stimulante pour se mettre à l’épreuve et pour s’améliorer au niveau personnel et professionnel ; donc ils se décrivent comme confiant ou comme souffrant (condition discursive du non stase et du non élan). Différemment les travailleurs stables décrivent l’expérience du travail comme une sphère très satisfaisante de la vie, mais qui a déjà atteint son but. Par conséquent les profils discursifs qui marquent ces locuteurs sont l’accoutumé et l’heureux (condition discursive de la stase et de l’élan). Probablement la conscience d’une condition professionnelle qui est précaire et transitoire amène les travailleurs temporaires à s’engager d’avantage par rapport aux stables qui se considèrent à la ligne d’arrivée.
3.2 Fragments de bien être subjectif et de l’organisation au travail : le récit de l’organisation
Un autre outil qui peut nous aider à comprendre comment les personnes se sentent dans le contexte du travail est le récit de l’organisation. En partant d’une perspective symboliste (Alvesson et Berg, 1992) et narrative (CzarniawskaJoerges, 1997) aux organisations, le récit de l’organisation peut être un outil très précieux pour capturer l’identité réelle de l’organisation. En fait, selon la théorie de l’organisation non gérée (Gabriel, 1995), les organisations ont aussi bien une identité formelle qu’une identité informelle. Cette dernière est la plus vraie et on peut la retrouver dans les interactions informelles (par exemple : pendant le petit déjeuner) ou dans les objets de l’organisation (par exemple : l’organisation des espaces ou l’utilisation de différents jargons). Cette dimension profonde et parfois secrète ne donne pas seulement des informations sur la structure de l’organisation même, mais a le pouvoir de révéler aussi comment les personnes se sentent quand elles sont au travail.
L’étude présentée ici a confirmé l’importance du récit de l’organisation, parce que les contributions fournies sont convergentes avec les données recueillies dans les interviews. En effet les huit récits révèlent les difficultés de relations éprouvées par les travailleurs flexibles. Tous deux, les temporaires et les permanents, ont choisi de raconter un événement qui se rapporte à une situation de conflit entre eux et qui est différemment interprétée comme isolement et détachement plutôt que comme réticence et désengagement relationnelle.
PsychoSociale.indd 192 17/05/11 11:46:25
1e épreuve 2011-05-17
1e épreuve 2011-05-17
193Discussion des résultats
Tableau 10.1.Un récit de l’organisation raconté par une travailleuse permanente
OrganisationConseil municipal
AuteurTravailleuse temporaire, 51 ans
Rôle dans l’organisationMonitor pédagogique
ArgumentAmitié entre travailleur stable et temporaire
Corps du récitLes travailleurs permanents n’acceptent pas les travailleurs temporaires. Ils sont considérés comme précaires : actuellement ils sont ici, mais ils changent de travail rapidement. Donc les travailleurs permanents évitent de communiquer avec les travailleurs temporaires. Je sens qu’il y a une résistance à l’intégration. En effet, il y a deux groupes : les permanents et les temporaires. Les temporaires préfèrent s’entretenir entre eux, partager les pro-blèmes sans entrer en contact avec les permanents et ce fait est certainement également vrai pour les perma-nents.
Mots clésGroupes, intégration et réticence
Caractères principauxLes travailleurs permanents et temporaires
Morale du récitLes travailleurs temporaires forment un groupe séparé même dans les pauses.
Ces deux exemples, le premier raconté par un travailleur permanent (tableau 11.1) et le deuxième par un travailleur temporaire (tableau 12.1), témoignent et confirment le climat négatif qui caractérise les relations au sein du conseil municipal. En effet, les travailleurs permanents et temporaires forment deux groupes séparés qui rivalisent les uns entre avec les autres pour l’acquisition des ressources d’ordre aussi bien extrinsèques (salaires, équipement technique, information) qu’intrinsèques (relations et reconnaissances). Au niveau discursif, cette distinction marquée est évidente dans la construction d’un ingroup et d’un outgroup (nous et vous) et dans l’adoption de stratégies communicatives visant à provoquer un détachement visàvis de l’action de l’outgroup ainsi qu’une identification avec l’ingroup (par exemple : en faisant recours à des locutions telles que « ils se comportent de cette façon qui n’est pas celle correcte »). De plus, les mots clés les plus fréquents dans les récits sont reliés à des émotions négatives comme par exemple « rivalité », « peur », « nonacceptation ». Cette évidence témoigne une différence intrinsèque entre les deux types de travailleurs qui, quoiqu’ils partent de positions occupationnelles différentes, ont une considération très variée des personnes qui travaillent dans le conseil municipal.
PsychoSociale.indd 193 17/05/11 11:46:25
1e épreuve 2011-05-17
1e épreuve 2011-05-17
194 Chapitre 10 – Ancrer le bien-être au travail
Tableau 10.2.Un récit de l’organisation raconté par une travailleuse temporaire
OrganisationConseil municipal
AuteurTravailleuse temporaire, 28 ans
Rôle dans l’organisationOpérateur administrative
ArgumentRivalité entre les travailleurs permanents et temporaires
Corps du récitLes travailleurs permanents ont leurs espaces et nous ne pouvons pas l’envahir parce qu’ils ont leurs bureaux, leurs ordinateurs et on ne peut pas les utiliser. Il y a des personnes qui depuis le premier jour ont peur de nous, ils ne veulent pas qu’on fasse leur travail parce qu’ils ont peur qu’on puisse le faire mieux. Il y a de la rivalité. Ils cassent du sucre sur notre dos, ils nous provoquent en rapportant au manager chaque petite erreur. Ce compor-tement influence négativement l’opinion du manager en mettant à risque notre travail.
Mots clésRivalité et peur
Caractères principalesLes travailleurs temporaires et permanents
Morale du récitLes travailleurs permanents craignent les travailleurs temporaires, ils essayent de manipuler leurs relations avec le manager.
Conclusion
L’analyse des textes sur le sens du travail chez les travailleurs temporaires et permanents a fourni des résultats très intéressants qui contribuent à la discussion sur la relation entre bienêtre subjectif et flexibilité du travail.
En effet, on a essayé de faire dialoguer la littérature sur le sens du travail avec la littérature sur le bienêtre subjectif, car elles partagent toutes deux un intérêt pour la communication. L’analyse de la littérature aussi bien sur le bienêtre subjectif que sur le sens du travail et les résultants de l’étude présentés ici convergent vers une même conclusion : le travail est une expérience de vie très complexe qui est liée d’une façon ambivalente au bienêtre subjectif. Le sens que les personnes donnent au travail peut être lu comme une mesure de la correspondance positive entre les attentes développées et l’expérience concrète. En effet, les résultats de l’étude présentée confirment la haute importance imputée aussi bien aux dimensions intrinsèque et sociale de l’expérience du travail qu’à ses dimensions extrinsèques. Le bienêtre sur le lieu de travail et donc la satisfaction à l’égard du travail sont fortement liés à la qualité des relations plus qu’à la stabilité et à la sécurité économique. Les résultats convergent sur le fait que,
PsychoSociale.indd 194 17/05/11 11:46:25
1e épreuve 2011-05-17
1e épreuve 2011-05-17
195Questions pour mieux retenir
quoiqu’ils soient précaires, les travailleurs temporaires travaillent avec plus de passion lorsqu’ils peuvent jouir d’un climat stimulant et agréable.
Pour aller plus loin
Mininni, G. (1992). Diatesti. Per una Psicosemiotica del discorso sociale. Napoli : Liguori.
Mininni, G. (2003). Il discorso come forma di vita. Napoli : Guida Editore.
Ghiglione, R. (1986). L’homme communiquant. Paris : Colin.
Harré, R., & Gillett, G. (1994). The discursive mind. London : Sage.
Rousseau, D. (1995). Psychological contracts in organizations : understanding written and unwrit-ten agreements. Thousand Oaks : Sage.
Sverke, M., & Hellgren, J. (2002). The nature of job insecurity : understanding employment uncertainty on the Brink of the new millennium. Applied psychology : an International Review, 51(1), 2342.
Ryff, C. (1989). Happiness is everything or is it ? Explorations on the meaning of psychological wellbeing. Journal of Personality and Social Psychology, 57, 10691081.
Mots clefs
travail
bien être
flexibilité
analyse diatextuelle
construction sociale de l’identité
Questions pour mieux retenir
1. L’importance de la communication dans les organisations, de construire l’appartenance à l’organisation et de négocier une identité partagée.
2. L’influence de la flexibilité du travail sur la perception du bien-être.
3. Les difficultés dans la communication et la cohabitation entre travailleurs flexibles et permanents.
4. Les difficultés de gestion du personnel en face des changements radicaux du marché du travail.
PsychoSociale.indd 195 17/05/11 11:46:25
1e épreuve 2011-05-17
1e épreuve 2011-05-17