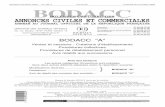“L’expérience et le savoir d’empire dans la province d’Hispania Ulterior sous la...
Transcript of “L’expérience et le savoir d’empire dans la province d’Hispania Ulterior sous la...
L’imperium Romanum en perspective
L’im
periu
m R
oman
um e
n pe
rspe
ctiv
eJu
lien
Dub
oulo
z, Sy
lvie
Pitt
ia, G
aeta
no S
abat
ini (
dir.)
Les savoirs d’empire dans la République romaine et leur héritage dans l’Europe médiévale et moderne
sous la direction de Julien Dubouloz, Sylvie Pittia, Gaetano Sabatini
P re s se s un i ve r s i t a i r e s de F r anche -Comté
Prix : 38 eurosISBN 978-2-84867-498-8
-:HSMIOI=[\Y^]]:
Ce volume étudie la culture d’empire, ensemble de savoirs et d’idées qui
fondent la domination d’une puissance sur les territoires et les populations
soumis – ici l’émergence d’une culture d’empire romaine durant l’époque
républicaine : comment s’élaborent des pratiques, des discours sur la
manière de gouverner un empire en constante expansion ?
Avec une approche sur le temps long, trois thématiques sont privilégiées : la
naissance de cette culture d’empire, les emprunts à une autre expérience
impériale – les royaumes hellénistiques –, enfin la conservation de cette
culture d’empire, de la République romaine aux périodes médiévale et
moderne, en termes pratiques mais surtout idéologiques.
Julien Dubouloz, MCF à Aix-Marseille Université, historien de l’Antiquité
Sylvie Pittia, PR à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, historienne de l’Antiquité
Gaetano Sabatini, PR à l’Université Roma Tre, historien des mondes modernes
Ouvrage publié avec le soutien de l’UMR 8210 ANHIMA, du Labex HASTEC, de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, du CNRS, du réseau Red Columnaria,
de la Faculty of Classics Oxford University, de l’Università Roma Tre, du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
et de la Ville de Paris.
Presses universitaires de Franche-Comtéhttp://presses-ufc.univ-fcomte.fr
L’imperium Romanum en perspective
Table des matières
introduction par Julien dubouLoz, Sylvie pittia et Gaetano sabatini ...............................................9
i. La cuLture d’ empire : de L’ expérience individueLLe à La constitution d’ une mémoire
Sylvie PittiaUniversité Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UMR 8210 ANHIMA
Naissance d’ une histoire de l’ administration provinciale républicaine :approche historiographique ......................................................................................................................21
Monique Dondin-PayreCNRS, Paris, UMR 8210 ANHIMA
L’ Afrique romaine vue par ses inventeurs : la République oubliée ......................................................43
Julien DuboulozUniversité d’ Aix-Marseille, UMR 8210 ANHIMA
La « correspondance provinciale » de Cicéron :culture aristocratique et technique de gouvernement ...........................................................................59
Gabrielle FrijaUniversité Paris-Est Marne-La-Vallée, EA 3350 ACP
Les Grecs et les autorités romaines au ier siècle av. J.-C. :réflexions sur l’ évolution du langage honorifique ..................................................................................81
Maria Teresa SchettinoUniversité de Haute-Alsace, UMR 7044 ARCHIMÈDE
Compétences et savoir comparés de l’ homme d’ État : le témoignage de Plutarque..........................95
Cyrielle LandreaUniversité Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UMR 8210 ANHIMA
Traditions, mémoire nobiliaire et savoirs d’ État à la fin de la République romaine ........................117
Sophie MétivierUniversité Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UMR 8167 Orient et Méditerranée
Culture familiale et savoirs d’ État dans l’ Empire byzantinà l’ époque mésobyzantine (viiie-xie siècles) .........................................................................................131
L’imperium Romanum en perspective
482 Table des matières
Raphaëlle LaignouxUniversité Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UMR 8210 ANHIMA
Frapper monnaie entre 49 et 31 av. J.-C. : les guerres civiles romainescomme laboratoire d’ unification monétaire .........................................................................................147
ii. La construction des savoirs d’ empire durant La répubLique :capitaLisation des expériences et transferts cuLtureLs
Clara BerrendonnerUniversité Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UMR 8210 ANHIMA
Pour administrer, faut-il savoir compter ? Les questeurs provinciauxet la tenue des comptabilités publiques (iie-ier siècles av. J.-C.) .........................................................173
Jonathan R. W. PragMerton College, University of Oxford
The quaestorship in the third and second centuries BC .....................................................................193
Simon DayBalliol College, Oxford
The use of the prouincia classis in the third and second centuries BCand the concept of the prouincia ............................................................................................................211
Edward BisphamBrasenose & St Anne’ s Colleges, Oxford
Roma iudex. Interstate arbitration and Rome’ s Mediterranean hegemony ......................................231
Georgy KantorSt John’ s College, Oxford
Roman legal administration in the province of Asia : Hellenistic heritage vs. innovation ............243
Bernard LegrasUniversité Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UMR 8210 ANHIMA
Expériences romaines dans le royaume lagide sous Ptolémée xii et Cléopâtre vii ........................269
Jonathan EdmondsonYork University, Toronto, Department of History
L’ expérience et le savoir d’ empire dans la province d’ Hispania Ulterior sous la République ........283
Emmanuelle ChevreauUniversité Paris 2 Panthéon-Assas, UMR 7184 Institut d’ histoire du droit
Le ius gentium : entre usages locaux et droit romain ...........................................................................305
L’imperium Romanum en perspective
483Table des matières
iii. perspectives comparatistes : penser et Légitimer L’ impériaLisme à partir de rome
et de L’ héritage répubLicain
Élisabeth MalamutUniversité d’ Aix-Marseille, UMR 7298 LA3M
Continuité et rupture : la fiscalité byzantine au début du xive siècleet la critique de l’ autorité impériale par les contemporains ...............................................................323
Matthias SchnettgerUniversité de Mayence
Nostrum, nostrum est Romanum Imperium. La présence de Rome dans l’ exercicedu pouvoir du Saint-Empire romain germanique ...............................................................................341
Hélène SirantoineUniversity of Sydney, Department of History
Un héritage romain tacite : imperium et imperatoresdans le royaume léonais des ixe-xiiie siècles ........................................................................................355
Saúl Martínez BermejoCentro de História de Além-Mar (CHAM), Universidade Nova de Lisboa, Universidade dos Açores
L’ image de Rome et la configuration du savoir militaire dans les monarchieshispano-ibériques à l’ époque moderne : approche et contradictions ..............................................371
Juan Francisco Pardo MoleroUniversitat de València, Departament d’ Història Moderna
Los usos de Roma. Ideas y recursos políticos en la Monarquía Hispánica.......................................389
Manfredi MerluzziUniversità di Roma Tre
Modello imperiale romano e Monarchia Universale : legittimazione e rappresentazione del potere nel discorso politico della Monarchia Spagnola ..............................411
concLusion par Jean-Louis Ferrary
Institut de France, EPHE IVe section, UMR 8210 ANHIMA .................................................................433
indices
Index des sources antiques ......................................................................................................................441Index des noms de personnes .................................................................................................................463Index géographique .................................................................................................................................473
tabLe des matières ...........................................................................................................................481
L’imperium Romanum en perspective
L’imperium Romanum en perspective, 283-303
L’ expérience et le savoir d’ empire dans la province d’ Hispania Ulteriorsous la République
Jonathan EdmondsonYork University, Toronto
Department of History
Au cours du processus d’ expansion de la domination romaine sur le bassin méditerranéen, les Romains furent assez vite impliqués dans l’ histoire de la péninsule Ibérique. Une trentaine d’ années après la création des premières provinciae transmarines de la Sicile et de la Sardaigne en 227 av. J.-C., donc dès 197 av. J.-C., le Sénat décida d’ envoyer, en principe annuellement, deux magistrats ou promagistrats de rang soit prétorien, soit consulaire pour assumer les provinciae de l’ Hispanie Citérieure et de l’ Hispanie Ultérieure ; ils avaient pour mission d’ assurer la sécurité de ces provinces et de gérer la guerre et la paix1. À l’ échelle du vaste territoire contrôlé par Rome, on peut affirmer que les deux Hispanies ont connu un nombre considérable d’ interventions romaines, par comparaison avec les autres régions de l’ empire émergeant : cela est dû à la forte résistance de bien des populi qui occupaient l’ intérieur et le nord de la Péninsule, surtout à la résistance des Lusitaniens et des Celtibères2. Même après une première voire une seconde soumission au pouvoir romain, ces peuples ont souvent essayé de se révolter au iie ou encore au ier siècle av. J.-C. En outre, les populations des régions les plus septentrionales de la Péninsule ne se sont soumises à la domination romaine qu’ à l’ époque augustéenne, à la suite des guerres contre les Astures et les Cantabres, qui se sont terminées en 19 av. J.-C.3.
Cette présence continue et de longue date des magistrats ou promagistrats romains avec leurs armées dans la péninsule Ibérique permit, du moins en principe, le développement de rapports de plus en plus réguliers entre les administrateurs romains et leurs sujets provinciaux et, au fil des années, d’ un savoir pratique de gouvernance parmi eux. Depuis la création des deux provinciae hispaniques en 197 jusqu’ à la fin des guerres civiles entre les
1 Synthèses utiles : Richardson 1986 ; Richardson 1996, p. 9-126 ; Le Roux 2010, p. 19-59 ; Pina Polo 2009. Sur la création des provinces sous la République en général : Ferrary 2008.2 Voir, par exemple, Richardson 1986, p. 126-155 ; Salinas de Frías 1995, p. 65-90 ; García Riaza 2002.3 Syme 1934 ; Syme 1970 (1979) ; Le Roux 1982, p. 52-69.
L’imperium Romanum en perspective
284 Jonathan Edmondson
pompéiens et les césariens en 45, il s’ est écoulé assez de temps pour la constitution d’ une vraie « culture d’ empire » dans la Péninsule.
Le but de cette contribution est donc d’ explorer, dans la mesure du possible, la nature des changements successifs dans l’ expérience de l’ impérialisme romain dans les provinces hispaniques, surtout au cours du ier siècle av. J.-C. En particulier, il faut se demander si un vrai système administratif s’ est développé dans la région avant la fin de la République. Dans quelle mesure fut-il possible de créer une structure de gouvernance plus ou moins systématique dans un endroit précis, à savoir la péninsule Ibérique, malgré la succession de soulèvements contre le pouvoir romain non seulement pendant le IIe, mais aussi ponctuellement pendant le ier siècle av. J.-C. ? Par ailleurs, durant deux périodes spécifiques – entre 83 et 71 et entre 49 et 45 – la Péninsule fut au centre et, en fait, le foyer principal de conflits civils romains de grande envergure : d’ abord, les luttes entre Q. Sertorius et les partisans de L. Cornelius Sulla, qui furent envoyés pour mettre fin au contrôle réputé illégal de Sertorius sur la Péninsule ; et plus tard, les conflits entre les partisans de Cn. Pompeius Magnus et les Césariens qui donnent lieu à quelques phases décisives sur le terrain hispanique. Il faut mesurer l’ impact de ces épisodes militaires sur la possibilité d’ établir des pratiques plus systématiques de gouvernance et d’ exploitation provinciale.
Dans le cadre de notre contribution, nous nous concentrerons sur la période qui va de 100 à 44 av. J.-C., en nous intéressant plus particulièrement à la province de l’ Hispanie Ultérieure, d’ une part, parce que nous avons à notre disposition plus d’ études détaillées sur l’ Hispanie Citérieure pour cette époque4 et, d’ autre part, parce que nos propres recherches portent principalement sur la partie occidentale de la Péninsule et surtout sur la Lusitanie5. Après avoir rappelé brièvement quelques problèmes et lacunes concernant les sources, je voudrais faire un bilan, nécessairement fragmentaire, de la formation et de l’ évolution d’ un système administratif dans la province d’ Hispanie Ultérieure, en mettant l’ accent sur deux principaux axes de l’ administration provinciale : à savoir la fiscalité et la justice. La principale explication à la mise en place d’ un système plus développé et plus standardisé dans la péninsule Ibérique me paraît être qu’ un nombre assez important d’ administrateurs romains ont conservé leur poste pendant plusieurs années ou sont revenus en Hispanie deux ou même trois fois pour assumer encore un autre mandat. Leurs expériences sur le terrain, encore plus approfondies, ont entraîné la constitution d’ un savoir d’ empire plus nuancé, ce qui devait affecter la nature de l’ administration romaine et la réception du pouvoir romain au milieu provincial.
4 Par exemple, Beltrán Lloris 2008 ; Barrandon 2011a ; Barrandon 2011b.5 Sur la Lusitanie sous la République : Edmondson 1996 ; Edmondson 2011 ; Salinas de Frías 2010.
L’imperium Romanum en perspective
285L’ expérience et le savoir d’ empire dans la province d’ Hispania Ulterior sous la République
Les problèmes liés à nos sources
Une des difficultés primordiales pour l’ étude de la création et de l’ évolution d’ un système d’ administration provinciale reste la quantité et la qualité assez médiocres de nos sources. Comme Cicéron l’ observa dans le discours qu’ il prononça pour défendre Cn. Plancius en 54 av. J.-C., « Il se passe à Rome tant de choses que l’ on n’ y entend guère parler de celles qui se passent dans les provinces »6. Dans l’ Antiquité, les historiens et les biographes s’ intéressaient aux milieux provinciaux seulement si des faits militaires ou des conflits politiques importants s’ y étaient déroulés. Ainsi pour les provinces hispaniques, d’ un côté les historiens – tels que Salluste (principalement dans ses Histoires, dont quelques fragments concernant notre thème subsistent), Tite-Live (dont le récit est perdu, sauf le fragment du livre 91 sur le conflit sertorien), Appien (dans les Iberika et les Guerres civiles) ou Dion Cassius –, et d’ un autre côté les biographes – tels que Plutarque ou Suétone – ne nous informent d’ une manière détaillée des événements significatifs que pour la période du conflit sertorien ou des guerres civiles entre les Pompéiens et les Césariens. Pour ces dernières, nous avons à notre disposition les récits assez circonstanciés des œuvres du corpus césarien, c’ est-à-dire le De bello ciuili, le De bello Alexandrino et le De bello Hispaniensi, mais il faut témoigner d’ une certaine prudence compte tenu du fait que ces récits présentent un bilan assez favorable de la cause césarienne. Par ailleurs, à l’ exception de quelques brèves observations de Plutarque dans ses vies de Pompée et de Jules César, il n’ existe presque aucun renseignement sur l’ administration des provinces hispaniques, où les conditions furent paisibles. Comme Tacite le dit avec beaucoup de tristesse (Tac. Ann. 4.32.1-2) en déplorant « la paix immuable ou médiocrement troublée » (immota quippe aut modice lacessita pax) du règne de Tibère, les historiens dans l’ Antiquité ne désiraient pas écrire l’ histoire d’ un monde en temps de paix. De temps en temps, les sources épigraphiques jettent quelque lumière sur certains éléments de l’ administration romaine, comme nous allons le voir, mais très peu de documents pertinents sont conservés qui puissent être rapportés à la période républicaine, même si l’ Hispanie fut l’ une des premières régions de l’ Occident romain à adopter la pratique épigraphique7.
Ainsi, la tâche de l’ historien reste difficile et frustrante. Il faut utiliser toutes les bribes d’ information que nous possédons à partir des sources littéraires et épigraphiques pour éclairer le développement de l’ administration en Hispanie, mais nous devons demeurer conscients qu’ il y a énormément d’ informations que nous ne possédons pas, et que nous ne pourrons jamais connaître. Néanmoins, malgré la maigreur de nos informations, il y
6 Cic. Planc. 63 : ita multa Romae geruntur, ut uix ea quae fiunt in prouinciis audiantur, trad. P. Grimal, CUF, Paris, 1966.7 Voir surtout le corpus récent des inscriptions républicaines de l’ Hispanie de Díaz Ariño 2008 ; cf. Stylow 2005 ; Díaz Ariño 2011. Sur le « epigraphic habit », Stylow 1998 ; Beltrán Lloris 1999.
L’imperium Romanum en perspective
286 Jonathan Edmondson
a suffisamment d’ indices pour suggérer que les pratiques administratives romaines se généralisent et se systématisent progressivement au cours du ier siècle av. J.-C., même si les révoltes et les conflits militaires n’ ont pas permis en permanence le bon fonctionnement de l’ administration romaine dans toutes les régions de la Péninsule. Dans certaines zones, notamment la côte nord-est de l’ Hispanie Citérieure et la vallée du Guadalquivir en Hispanie Ultérieure, il y a eu un progrès considérable, et même dans d’ autres zones, on peut argumenter contre une vision trop minimaliste des interventions romaines, en avançant que, dans les Hispaniae, une vraie « culture d’ empire » s’ est constituée sous la République et que dans un tel contexte, les Romains expérimentaient les techniques et les « savoirs » d’ un processus administratif.
Il ne faut certes pas exagérer les développements de l’ encadrement administratif qui ont eu lieu pendant l’ époque républicaine, ni réduire l’ importance des réformes d’ Auguste dans le cadre de l’ administration provinciale : ces réformes ont surtout concerné la régularisation du processus de recensement, l’ établissement de tous les populi de la Péninsule dans des limites fixes, par la définition des territoires de chaque communauté civique, et l’ imposition du tributum soli et du tributum capitis comme les deux principaux éléments de la fiscalité à laquelle était soumise la population provinciale8. Ces mesures, sans aucun doute, ont amélioré la capacité des Romains à acquérir une connaissance plus précise des ressources de chaque région des provinces hispaniques, en leur fournissant un cadre plus solide au sein duquel ils pouvaient, en théorie, exploiter les ressources d’ une manière plus efficace. Néanmoins, quelques jalons importants ont été déjà mis en place dans le dernier demi-siècle de la République.
La formation d’ une culture d’ empire : taxation, procès de rebus repetundis, administration de justice
Pendant le ier siècle av. J.-C., on peut apercevoir quelques indices dans nos sources, malgré leurs limites, de ce que les autorités romaines essayaient d’ établir un contrôle plus strict sur les communautés et les peuples de l’ Hispanie Ultérieure. On peut le détecter surtout dans deux domaines : la fiscalité et l’ administration de la justice, c’ est-à-dire, les deux principales tâches d’ un gouverneur provincial romain pendant son mandat, mais aussi dans la mise en place progressive d’ un mécanisme qui permit aux provinciaux de déposer une plainte en justice au sujet de la mauvaise administration et de la malhonnêteté de la part des gouverneurs romains.
8 Voir principalement Nicolet 1988 ; cf. Le Roux 1995, p. 59-78 ; Richardson 1996, p. 134-149. Sur les recensements dans les provinces républicaines, Le Teuff 2010.
L’imperium Romanum en perspective
287L’ expérience et le savoir d’ empire dans la province d’ Hispania Ulterior sous la République
Taxation
On n’ a pas besoin ici d’ entrer dans une discussion détaillée sur le passage, très bien connu mais d’ interprétation contestée, du discours De frumento de Cicéron contre Verrès (Cic. Ver. 3.12) où l’ orateur d’ Arpinum propose, en 70 av. J.-C., une comparaison entre le système de prélèvement de l’ impôt dû à Rome alors appliqué dans la province de Sicile et celui qui était imposé aux autres provinces de l’ empire émergeant9. Selon ce passage, il faut distinguer précisément entre la dîme (decuma) que les Romains ont prélevée sur la production agricole de la Sicile – ce qui fluctuait toutefois chaque année en fonction de la récolte – et le uectigal certum stipendiarium, une redevance fixe, qui porte le nom de « stipendiaire » et qui a été imposée aux communautés des deux Hispanies et à la plupart des Puniques (c’ est-à-dire, les peuples de l’ Afrique et probablement de la Sardaigne aussi)10 :
Inter Siciliam ceterasque prouincias, iudices, in agrorum uectigalium ratione hoc interest, quod ceteris aut impositum uectigal est certum, quod stipendiarium dicitur, ut Hispanis et plerisque Poenorum quasi uictoriae praemium ac poena belli, aut censoria locatio constituta est, ut Asia lege Sempronia.
Entre la Sicile et les autres provinces, juges, il y a une différence dans le système de l’ impôt territorial ; aux autres provinces, ou bien il est imposé un tribut fixe qu’ on appelle la redevance en argent ; c’ est le cas, par exemple, des Espagnols et de la plupart des cités puniques ; c’ est la récompense de notre victoire et leur punition pour nous avoir fait la guerre ; ou bien il a été établi une ferme adjugée par les censeurs ; c’ est, par exemple, le cas de l’ Asie, en vertu de la loi Sempronia11.
Malgré l’ interprétation minimaliste de T. Ñaco del Hoyo, on peut discerner de manière plus ou moins précise les traces du prélèvement de ce uectigal certum stipendiarium dans l’ Hispanie Ultérieure12.
Dès les premières années du ier siècle, les Romains ont commencé à envoyer encore plus régulièrement dans toutes leurs provinces un quaestor ou proquaestor pour aider le gouverneur provincial dans la gestion des affaires financières et fiscales13. La présence de ces fonctionnaires est attestée explicitement pour les provinces hispaniques en 81 (L. Fabius Hispaniensis ; C. Tarquitius), 79 (L. Hirtuleius), 78 (L. Hirtuleius), 76 (M. Marius), 75 (Cn. Calpurnius Piso
9 Pour une analyse détaillée, voir France 2007.10 Ainsi France 2007, p. 170, n. 5.11 Trad. H. de la Ville de Mirmont, CUF, Paris, 1960.12 Ñaco del Hoyo 2003 ; Ñaco del Hoyo 2005 ; Ñaco del Hoyo 2010 ; cf. France 2007 ; Cadiou 2008, p. 478-502. 13 Schulz 1997, p. 174-179. Voir aussi la contribution de Cl. Berrendonner dans ce volume (p. 173-191), ainsi que celle de J. Prag, n. 37, p. 202, qui identifie cette pratique en Espagne au début du iie siècle déjà.
L’imperium Romanum en perspective
288 Jonathan Edmondson
Frugi), 74 (C. Vrbinius), 71 (L. Valerius Flaccus ; peut-être C. Cornelius) 70 (L. Valerius Flaccus) et 69 (C. Iulius Caesar)14, et on peut imaginer qu’ ils étaient déjà envoyés antérieurement, c’ est-à-dire, entre la chute de Numance, en 133, et le conflit sertorien, une période toutefois très mal documentée dans nos sources15. Leur présence a dû bien aider les gouverneurs à imposer le uectigal et à obtenir les montants exigés.
Sans aucun doute, ce contrôle progressivement encore plus étroit entraîna dans certaines régions un accroissement de la rancœur à l’ égard des autorités romaines, surtout au cours des années 80. Selon Plutarque, Q. Sertorius a bénéficié de l’ appui de plusieurs communautés hispaniques précisément à cause de leur ressentiment à l’ encontre des administrateurs romains (Plut. Sert. 6.7-8) :
Παραλαβὼν δ’ ἔθνη, πλήθεσι μὲν καὶ ἡλικίαις ἀκμάζοντα, πλεονεξίᾳ δὲ καὶ ὕβρει τῶν πεμπομένων ἑκάστοτε στρατηγῶν πρὸς ὅλην κακῶς διακείμενα τὴν ἡγεμονίαν, ἀνελάμβανεν ὁμιλίᾳ τε τοὺς δυνατοὺς καὶ φόρων ἀνέσει τοὺς πολλούς. (…) μάλιστα δὲ τῶν ἐπισταθμιῶν ἀπαλλάξας ἠγαπήθη· τοὺς γὰρ στρατιώτας ἠνάγκαζεν ἐν τοῖς προαστίοις χειμάδια πήγνυσθαι, πρῶτος αὐτὸς οὕτω κατασκηνῶν.
Il y trouva (sc. en Hispanie) des populations nombreuses et riches en jeunes gens d’ âge militaire, mais révoltées contre toute autorité (sc. romaine) par la cupidité et la brutalité des préteurs qui s’ y succédaient. Il se concilia les notables par son affabilité et le peuple par la remise des tributs. (…) Mais c’ est surtout en les libérant de l’ obligation de loger les troupes qu’ il se fit aimer. Il força les soldats à fixer leurs quartiers d’ hiver dans les faubourgs, et il fut le premier à y dresser sa tente16.
Cette référence à la remise des impôts (φόροι), si elle est exacte, est importante puisqu’ elle me semble confirmer que le système fiscal, le uectigal certum dit stipendiarium, fonctionnait et exerçait déjà des pressions considérables sur les provinciaux17. En outre, il est bien évident qu’ il existait d’ autres formes d’ imposition qui pesaient assez lourdement. Car, en plus de la réduction des impôts, Plutarque dit dans le même passage que Sertorius leur promit que ses propres troupes ne prendraient pas les quartiers d’ hiver dans les villes de la province ; il obligea son armée à passer l’ hiver dans des campements à proximité des villes, et non pas à l’ intérieur des villes elles-mêmes. Ceci nous indique que le cantonnement des troupes avait été l’ une des charges les plus lourdes imposées aux communautés hispaniques. D’ ailleurs, dans les provinces républicaines, l’ exonération du logement de soldats était un vrai privilège que les autorités romaines n’ ont accordé qu’ aux communautés qui étaient
14 Pour les attestations, voir Broughton 1952, p. 77-132, sub annis.15 Sur cette période, García Moreno 1989.16 Trad. R. Flacelière et É. Chambry, CUF, Paris, 1973. 17 Sur le conflit sertorien en Hispanie, voir García Morá 1994 ; Scardigli 2002 ; Meister 2007.
L’imperium Romanum en perspective
289L’ expérience et le savoir d’ empire dans la province d’ Hispania Ulterior sous la République
demeurées très loyales à la cause romaine : par exemple, Termessus Maior en Pisidie, en 72 av. J.-C., ou Aphrodisias en Carie, qui reçut confirmation de ce privilège par un sénatus-consulte de 39 av. J.-C.18.
Mais, en même temps, la succession des conflits civils romains aggravait particulièrement les pressions sur les communautés de l’ Hispanie Ultérieure. Après le retour de Q. Sertorius dans la péninsule Ibérique en 80 av. J.-C., les Lusitaniens, par exemple, lui ont fourni des effectifs militaires, de l’ argent et des provisions. Et aussitôt que Q. Caecilius Metellus Pius eut pris contrôle de cette région en 78, ce dernier exigea probablement encore de ces mêmes communautés des soldats, de l’ argent et des denrées alimentaires. Par ailleurs, après la victoire finale de ce dernier et de Cn. Pompeius sur les adhérents de Sertorius en 72-71, Metellus Pius augmenta les impôts sur toutes les communautés de l’ Hispanie Ultérieure qui s’ étaient ralliées à la cause de Sertorius19. Ce n’ est qu’ avec l’ arrivée dans cette province en 61 av. J.-C. du préteur de l’ année 62, Jules César – probablement avec le titre de proconsul20 – que les Romains ont réduit le taux élevé et punitif de taxation imposé par Metellus, si l’ on peut croire le récit évidemment favorable à César élaboré dans le De bello Hispaniensi et, notamment, le contenu d’ un discours, que l’ auteur de cette œuvre fait prononcer à César lui-même en cours d’ une contio à Hispalis (Séville) en 45 av. J.-C. (B. Hisp. 42.2)21 :
Insequente praetura ampliato honore uectigalia quae Metellus imposuisset a senatu petisse et eius pecuniae prouinciam liberasse
Pendant la préture qui suivit (sc. sa questure en Hispanie Ultérieure) grâce à sa position plus élevée, il avait demandé au Sénat de supprimer les uectigalia que Metellus leur avait imposés et il avait libéré la province de cet impôt.
Même si les détails nous échappent et si nous ne pouvons pas suivre l’ histoire des fluctuations du taux de la fiscalité prélevée sur les provinciaux, il est bien évident que des prélèvements de caractère annuel sont clairement en place, et qu’ un système fondé sur les communautés locales s’ est développé pour assurer leur paiement. Il n’ existe aucune preuve d’ un recensement des sujets de Rome dans la région au cours de la République,
18 Termessus Maior : selon les dispositions de la lex Antonia de 72 av. J.-C. (CIL I2 589 = RS, n° 19, 1, p. 331-340). Aphrodisias : Reynolds 1982, no 8, l. 32-34.19 Liv. 91, fr. fournit un récit assez détaillé de quelques réquisitions effectuées dans la Hispanie Citérieure pendant la guerre sertorienne ; voir Ogilvie 1984. 20 Suet. Diu. Iul. 54.1 : proconsul ; cf. Cic. Balb. 43 : praetor ; voir Broughton 1952, p. 180 ; Brennan 2000, p. 517-518 ; Schulz 2002.21 Autres éloges sur son administration : Cic. Balb. 43 ; Vell. Pat. 2.43.4 ; Plut. Caes. 12.2-4 ; cf. Suet. Diu. Iul. 54.1 ; App. BC 2.8/27, moins laudatifs.
L’imperium Romanum en perspective
290 Jonathan Edmondson
mais l’ accroissement du nombre des communautés civiques vers 50 av. J.-C. a certainement facilité l’ administration romaine, en général, et la perception des impôts, en particulier.
Le corpus césarien fournit de nombreuses preuves non seulement des multiples réquisitions de fournitures et de contributions monétaires exigées par les Pompéiens et les Césariens dans l’ Hispanie Ultérieure pendant le déroulement de la guerre civile22, mais aussi de l’ existence de communautés civiques bien constituées vers la fin des années 50 av. J.-C. Ainsi Corduba, Hispalis et Gades occupent-elles une place d’ importance dans le récit23, mais d’ autres cités sont également mentionnées : par exemple, Carmo, décrite comme « de loin la communauté la plus forte de toute la province », Italica ou Carteia, colonie latine établie en 171 pour les enfants de soldats romains nés de mères hispaniques24. Par ailleurs, à Corduba il y avait un conuentus de citoyens romains qui était déjà installé en 49-48 av. J.-C.25 et, à partir d’ un passage du De bello Alexandrino, on peut déduire qu’ il y avait plusieurs autres conuentus dans la même province. Ce texte décrit un épisode en 47 av. J.-C. dans lequel Q. Cassius Longinus, legatus pro praetore de César en Hispanie Ultérieure, recrutait des troupes parmi les membres de l’ ordre équestre de la province, en les mobilisant « à partir de tous les conuentus de citoyens romains et colonies » (ex omnibus conuentibus coloniisque)26.
Les très rares inscriptions républicaines qui proviennent d’ Hispanie Ultérieure confirment l’ existence d’ institutions civiques : à Italica, par exemple, une mosaïque découverte à côté du forum atteste un préteur local finançant la construction d’ un bâtiment public, peut-être un temple d’ Apollon27. À La Rambla (province moderne de Córdoba), où l’ on peut localiser sans certitude la ville antique de Sabetum, un decemuir maxs(umus) et un aedilis de la communauté ont fait conjointement construire une porte urbaine à leurs
22 Par exemple, Caes. BC 1.38 ; 2.18 (réquisitions effectuées par les légats de Cn. Pompée en Ultérieure en 49 av. J.-C.) ; B. Alex. 50-51 ; 56 (par le légat césarien, Q. Cassius Longinus, en 48, dans la même province). 23 Corduba : Caes. BC 2.19-21 ; B. Alex. 49 ; 52 ; 57-59 ; 64 ; B. Hisp. 2-4 ; 6 ; 10-12 ; 32-33. Hispalis : Caes. BC 2.18 ; 20 ; B. Alex. 56 ; 57 ; B. Hisp. 35 ; 36 ; 39-40 ; 42 ; Gades : Caes. BC 2.18 ; 20-21 ; B. Hisp. 37 ; 39-40 ; 42. Vestiges archéologiques républicains, Cordoue : Vaquerizo Gil 2005 ; Márquez, Ventura 2005, cf. Panzram 2002, p. 129-145 (histoire de la ville républicaine) ; Hispalis : Campos Carrasco 1989 ; Gades : Bernal Casasola et Arévalo 2011. Sur l’ urbanisation dans la région en général, Keay 1998.24 Carmo : Caes. BC 2.19.4 : longe firmissima totius prouinciae ciuitas ; cf. B. Alex. 57 ; 64 ; Italica : Caes. BC 2.20, où les Italicenses ferment les portes de la ville contre l’ armée de Varron ; cf. B. Alex. 52 ; 57 ; Carteia : B. Hisp. 32 ; 37. 25 Caes. BC 2.19-20 ; cf. B. Alex. 57-59. Sur le conuentus ciuium Romanorum, Knapp 1983, p. 11-20.26 B. Alex. 56 : Equitum autem Romanorum dilectum instituit ; quos ex omnibus conuentibus coloniisque conscriptos transmarina militia perterritos ad sacramenti redemptionem uocabat.27 AE 1987.494 = 1988.707 = CILA 2.578 = HEp 3.350 = ELRH U23 : M(arcus) Trahius C. f. pr(aetor) Ap[ollini templum ?] / de stipe idemq(ue) caul[as d(e) s(ua) p(ecunia) f(acienda) c(urauit)].
L’imperium Romanum en perspective
291L’ expérience et le savoir d’ empire dans la province d’ Hispania Ulterior sous la République
propres frais28. On peut dater cette inscription précisément de 49 av. J.-C. par la référence aux consuls romains de cette année, L. Lentulus (Crus) et C. (Claudius) Marcellus, et aussi à Q. Cassius Longinus, tr(ibunus) pl(ebis), (legatus) pro pr(aetore), bien attesté dans le corpus césarien (voir infra p. 294-295).
D’ ailleurs, même dans les régions moins développées à l’ intérieur de la province, la soumission progressive des peuples (populi) aux armées romaines conduisit à une définition de plus en plus étroite de leurs territoires, ce qui facilita leur contrôle et leur administration par les autorités romaines. Ainsi, le texte de la deditio du populus Seano[corum ?], datée en 104 av. J.-C. et trouvée près d’ Alcántara (province moderne de Cáceres), fait-il référence à la rétrocession par le commandant romain, L. Caesius, des « agri, bâtiments et lois en leur possession à la veille de leur soumission »29. La cession et rétrocession de terres impliquent une définition et une reconnaissance de leurs limites. De tels actes de deditio, réitérés constamment pendant la conquête et encore après la fin des révoltes contre la domination romaine, ont entraîné une consolidation continue de la structuration de l’ espace provincial. Ils constituent une étape primordiale vers un contrôle administratif qui se montre d’ une redoutable efficacité de la part des Romains.
Les procès de rebus repetundis
Un autre indice, qui est cependant moins direct, de l’ exploitation plus intensive de la province et de l’ existence d’ une fiscalité assez répandue fut la création et la mise en route d’ un processus juridique contre l’ extorsion et les abus exercés par les administrateurs romains. Il s’ agit des procès de rebus repetundis. Les premières plaintes attestées des Hispani contre les magistrats romains remontent à 171 av. J.-C., lorsque quelques délégués des deux provinces hispaniques furent introduits au Sénat en Rome30. À cette occasion, ces délégués se plaignirent de la rapacité et de l’ arrogance de certains magistrats romains face à leurs alliés hispaniques. Selon Tite-Live (Liv. 42.2.1-12), les sénateurs demandèrent au préteur L. Canuleius de nommer cinq récupérateurs (recuperatores) pour instruire leurs plaintes. Finalement, deux des accusés – l’ un antérieurement préteur en Hispanie Citérieure (P. Furius Philus, praetor en 174), l’ autre préteur en Hispanie Ultérieure (M. Matienus, praetor en 173) – quittèrent l’ Vrbs avant la fin du procès, en préférant s’ exiler à Praeneste et Tibur respectivement, plutôt que d’ être condamnés.
28 CIL 22 /5.521 = ELRH U38 : L(ucio) Lentulo C(aio) Metello co(n)s(ulibus) / Q(uinto) Cassio C(ai) f(ilio) Long(ino) tr(ibuno) pl(ebis) pro pr(aetore) / Binsnes Vercellonis f(ilius) X uir maxs(umus) / M(arcus) Coranus Acrin(i) f(ilius) Alpis / aedilis portam faciund(am) / coer(auerunt) [d]e sua pecun(ia).29 AE 1984.495 = ELRH U2, l. 8-10 : … agros et aedificia leges cete[raque omnia] quae sua fuissent pridie quam se dedid[erunt quaeque] extarent eis redidit … ; cf. López Melero et al. 1984.30 Voir Richardson 1986, p. 113-115, avec la bibliographie.
L’imperium Romanum en perspective
292 Jonathan Edmondson
La création de la quaestio permanente de rebus repetundis, grâce à la lex Calpurnia de 149 av. J.-C., puis la définition plus précise du procès par la lex Sempronia de Gaius Gracchus et, encore plus tard, par les lois de Sylla puis de César pendant son consulat, fournissent aux alliés de Rome un moyen de défense contre les mauvais traitements qu’ ils endurent de la part des magistrats romains31. Néanmoins, les problèmes continuent pour les provinciaux. On le voit pour l’ année 43 av. J.-C., lorsque L. Cornelius Balbus, questeur (probablement proquaestor) césarien de l’ Hispanie Ultérieure, commet une série d’ injustices contre les habitants de la province, dont témoigne le rapport au ton exaspéré envoyé par son supérieur, le gouverneur C. Asinius Pollio, dans une lettre expédiée depuis Cordoue à Cicéron, qui était alors à Rome32. Par ailleurs, quelques gouverneurs romains pouvaient venir au secours des provinciaux en leur assurant qu’ ils aideraient leurs délégations à recevoir une audience au Sénat et/ou qu’ ils fourniraient une assistance dans le cas où serait intenté un procès de rebus repetundis. Dans le discours qu’ il a prononcé à Hispalis en 45 av. J.-C., et que nous avons évoqué auparavant, César souligne sa propre contribution comme patronus de plusieurs peuples de l’ Hispanie Ultérieure, du moins si l’ on en croit la version du discours élaborée dans le De bello Hispaniensi (B. Hisp. 42.2) :
Patrocinio suscepto multis legationibus ab se in senatum inductis simul publicis priuatisque causis multorum inimicitiis susceptis defendisse.
Après les avoir inclus dans son patronat (sc. quelques communautés de l’ Hispanie Ultérieure), il avait introduit beaucoup de leurs délégations au Sénat et en même temps, il avait lancé en leur nom quelques poursuites publiques et privées, au risque de se faire beaucoup des ennemis.
De tels beneficia offerts aux Hispani par leur patronus César, on peut déduire qu’ il existait déjà une conscience évidente des abus de la part des administrateurs romains de la province, qui nécessitaient l’ intervention d’ un patronus romain d’ un certain poids pour protéger les provinciaux : en leur offrant son soutien, ce patron permettrait, en théorie, le lancement d’ une action judiciaire pour obtenir une réparation bien justifiée.
En somme, les possibilités qui existaient pour les provinciaux de porter une accusation contre les représentants de l’ administration romaine et l’ intensification du nombre ainsi que de la signification des rapports « patron-client » en Hispanie Ultérieure suggèrent que des instruments – à la fois concrets et abstraits – et des modes de fonctionnement qui pouvaient assurer la gestion plus effective des provinces romaines ont été développés
31 Voir surtout Cic. Diu. Caec. 17-19. Sur ces leges de repetundis en général, Lintott 1981 ; plus sommairement, Richardson 1994, p. 577-578 ; dans la péninsule Ibérique, Richardson 1986, p. 137-140.32 Cic. Fam. 10.32.2 [= SB n° 415] : praeter furta et rapinas et uirgis caesos socios … (« outre les vols, les pillages et les flagellations de nos alliés battus de verges »).
L’imperium Romanum en perspective
293L’ expérience et le savoir d’ empire dans la province d’ Hispania Ulterior sous la République
bien avant la mort de César dans cette partie occidentale de la péninsule Ibérique33. Par ailleurs, la présence romaine sur une longue durée a transformé la Péninsule en une sorte de laboratoire d’ empire, où les expériences et les techniques de domination ont été en quelque sorte expérimentées, élaborées et modifiées selon les conditions et les événements qui s’ y déroulaient.
L’ administration de la justice
L’ autre domaine où l’ on peut voir les interventions des administrateurs romains de l’ Hispanie Ultérieure est l’ administration de la justice. Dans son discours sur le bon usage de l’ imperium dans le gouvernement provincial adressé à son frère Quintus, à la fin de l’ année 60 ou au début de 59 av. J.-C., Cicéron affirme que la justice représente la tâche la plus importante de l’ activité du gouverneur de la province d’ Asie34. La plaque de bronze – communément désignée sour le nom de Tabula Contrebiensis – découverte à Contrebia Belaisca (Cabezo de las Minas, Botorrita, province de Saragosse) démontre le rôle central joué par un gouverneur provincial dans la péninsule Ibérique au ier siècle av. J.-C. Le proconsul de l’ Hispanie Citérieure fut sollicité en 87 av. J.-C. par une communauté pour régler un différend entre elle et une autre communauté pérégrine concernant l’ accès à un canal d’ irrigation dans la vallée de l’ Èbre. Le proconsul, C. Valerius Flaccus – dont l’ autorité pour agir est soulignée par l’ inclusion de son titre d’ imperator dans le texte – confirmant le jugement, a utilisé son propre imperium pour nommer une troisième communauté pour réaliser l’ arbitrage, en cadrant lui-même à l’ avance le jugement selon la procédure juridique purement romaine per formulas35. Même s’ il n’ existe pas d’ autre document qui témoigne aussi précisément de telles actions judiciaires en Hispanie sous la République, il faut supposer que les gouverneurs se sont dès cette époque engagés assez fréquemment en matière de juridiction provinciale. On peut en déceler quelques faibles témoignages pour la province d’ Hispanie Ultérieure.
Selon une remarque fortuite dans le quatrième discours de la Seconde Action Contre Verrès, Cicéron nous informe qu’ il y avait, en 113 ou 112 av. J.-C., un « siège de justice » bien identifié déjà établi à Cordoue. Dans une anecdote où il veut opposer la probité du commandant de rang prétorien de l’ Hispanie Ultérieure, L. Calpurnius Piso Frugi, à la figure corrompue de Verrès, Cicéron raconte que Pison avait ordonné à un orfèvre de venir
33 Sur les relations « patron-client » en Hispanie en général : Badian 1958, p. 116-125, p. 252-284 ; Amela Valverde 2001, p. 109-113 ; Novillo López 2012 ; cf. Pina Polo 2011 (avec des remarques très pertinentes). Pour l’ Hispanie centrale et septentrionale, Barrandon 2011a, p. 221-226.34 Cic. Q. fr 1.1.7. En dernier lieu, Fournier 2009 ; Fournier 2010 ; et voir la contribution de J. Dubouloz dans ce volume.35 CIL 12.2951a = AE 1979.377 = ELRH C9, avec Richardson 1983.
L’imperium Romanum en perspective
294 Jonathan Edmondson
in forum ad sellam Cordubae : il faut comprendre qu’ il lui avait ordonné de venir sur le forum à Cordoue et de se présenter devant la sella curulis du promagistrat romain. Il utilise le mot sella ici par métonymie pour décrire l’ endroit où le gouverneur romain préside normalement les sessions judiciaires. Après avoir brisé son anneau d’ or officiel, Pison veut que l’ orfèvre en fabrique un autre pour le remplacer dans un lieu très clairement perçu comme public, qui était aux yeux de tous rempli de l’ autorité du pouvoir romain36.
Pendant le ier siècle, on peut observer l’ activité judiciaire de Jules César en Hispanie Ultérieure à deux reprises. Lorsqu’ il y fut questeur en 69-68, Suétone raconte un événement survenu à Gades (Cadix), où César s’ est rendu à l’ occasion de sa tournée judiciaire, selon les instructions du gouverneur provincial de rang prétorien (peut-être C. Antistius Vetus)37. Ici le proconsul avait délégué son autorité juridique à son questeur pour porter un jugement sur certaines affaires, ce que Cicéron a fait aussi quand il était l’ un des deux questeurs de Sicile, en 75 av. J.-C.38. Lorsqu’ il revient en Hispanie Ultérieure comme proconsul en 61, César s’ occupe, selon Plutarque, d’ un conflit assez sérieux entre les créanciers et les débiteurs dans la province. Désormais, il établit un règlement selon lequel tout créancier peut saisir deux-tiers des revenus du débiteur annuellement, tandis que le débiteur peut conserver l’ utilisation du tiers restant. Ce règlement demeure en vigueur jusqu’ à ce que la dette soit entièrement remboursée39.
Plus tard, pendant l’ hiver de 48-47, selon le De bello Alexandrino, Q. Cassius Longinus, legatus pro praetore de César, après avoir réparti ses légions dans leurs quartiers d’ hiver, gagna Cordoue ad ius dicendum (« pour y rendre justice »)40. Cette précision confirme non seulement que Cordoue était bien établie comme le centre juridique le plus important (le conuentus) de la province, mais aussi qu’ il y avait eu alors un développement dans la topographie de la justice : le forum de la ville était désormais doté d’ une basilica, où ce
36 Cic. Ver. 4.56 : Cum uellet sibi anulum facere, aurificem iussit uocari in forum ad sellam Cordubae et palam appendit aurum ; hominem in foro iubet sellam ponere et facere anulum omnibus praesentibus. Sur l’ épisode, voir Richardson 1986, p. 164 ; Brennan 2000, p. 498.37 Suet. Diu. Iul. 7.1 : Quaestori ulterior Hispania obuenit ; ubi cum mandatu pr(aetoris) iure dicundo conuentus circumiret Gadisque uenisset …, où on trouve l’ expression technique pour les assises provinciales, cf. Dig. 1.16.7.1 (Ulpien), avec Beltrán Lloris 2008, p. 134. Sur l’ identité du gouverneur, voir Brennan 2000, p. 514-515 et p. 710, Tableau A.5.38 Pour les sources antiques, voir Broughton 1952, p. 98. Sur la juridiction des questeurs en général sous la République : Richardson 1994, p. 590-591. 39 Plut. Caes. 12.2-4 : Θέμενος δὲ τὰ τοῦ πολέμου καλῶς, οὐ χεῖρον ἐβράβευε τὰ τῆς εἰρήνης, ὁμόνοιάν τε ταῖς πόλεσι καθιστὰς καὶ μάλιστα τὰς τῶν χρεωφειλετῶν καὶ δανειστῶν ἰώμενος διαφοράς. ἔταξε γὰρ τῶν προσιόντων τοῖς ὀφείλουσι καθ’ ἕκαστον ἐνιαυτὸν δύο μὲν μέρη τὸν δανειστὴν ἀναιρεῖσθαι, τῷ δὲ λοιπῷ χρῆσθαι τὸν δεσπότην, ἄχρι ἂν οὕτως ἐκλυθῇ τὸ δάνειον.40 B. Alex. 49.1 : Cassius legiones in hiberna dispositis ad ius dicendum Cordubam se recepit.
L’imperium Romanum en perspective
295L’ expérience et le savoir d’ empire dans la province d’ Hispania Ulterior sous la République
même Q. Cassius est victime d’ un attentat au printemps de 47 av. J.-C.41. À cette occasion, il entre dans la basilique, où on lui présente une demande sous la forme d’ un libelle (libellus). Lorsque quelques hommes se rassemblent « comme s’ ils s’ attendaient à entendre sa réponse », les conjurés commettent l’ attentat. Grâce à l’ intervention de ses nombreux gardes du corps, il réussit à survivre. À cette époque, le gouverneur provincial utilisait un bâtiment public, une basilica, construite sur le forum, et pas seulement une sella curulis placée sur un tribunal, pour rendre la justice. Ce bâtiment emblématique fut conceptuellement et symboliquement associé au pouvoir juridique du gouverneur romain par les provinciaux42.
De l’ expérience individuelle à la culture collective : vers une « culture d’ empire »
Pour cerner comment s’ est établi un système d’ administration plus perfectionné et plus standardisé dans les provinces hispaniques, il faut insister sur un facteur un peu négligé, qui y a contribué d’ une façon importante : c’ est le fait que, au cours du ier siècle av. J.-C., un pourcentage assez élevé des administrateurs romains ont séjourné plusieurs fois dans la Péninsule au cours de leur carrière officielle et/ou ont conservé leurs postes en Hispanie pendant plusieurs années avant de revenir en Italie, sans parler de leur service en Hispanie au début de leur carrière comme tribuni militum ou, plus tard, comme legati et/ou comme membres de la cohors amicorum, sélectionnés personnellement par le gouverneur provincial43. D’ autres magistrats romains sont revenus en Hispanie pour un deuxième, voire un troisième mandat (voir Tableau I).
41 B. Alex. 52-53 : … cum in basilicam iret, quidam Minucius Silo cliens L. Racili libellum, quasi aliquid ab eo postularet, ut miles ei tradit, deinde post Racilium — nam is latus Cassi tegebat —, quasi responsum peteret, celeriter dato loco cum se insinuasset, sinistra corripit auersum dextraque bis ferit pugione…42 Sur les fonctions symboliques de la basilica dans la topographie de l’ administration de justice, voir David 1983. À Ietas (Monte Iato) en Sicile, on a installé un tribunal dans une stoa de l’ agora au iie siècle av. J.-C., avec l’ inscription d’ un nom romain : Cn. Host[ilius] : voir Isler 2012. Dans une inscription sur bronze de la cité sicilienne d’ Halaesa, datée de la première moitié du ier s. av. J.-C., on trouve l’ expression ἐν τᾷ βασιλικᾷ, l’ attestation jusqu’ ici la plus précoce du mot en grec pour ce type de bâtiment (Scibona 2009), cf. BE 2010, 646. J’ adresse mes remerciements à J. Prag pour ces renseignements importants.43 Sur le personnel sélectionné par le gouverneur lui-même, voir Salinas de Frías 1995, p. 149-157. Par exemple, C. Memmius a servi comme tribunus militum sous Q. Metellus Pius en Ultérieure de 79 à 77 (Cic. Balb. 5, avec Broughton 1952, p. 84-91, sub annis) ; M. Terentius Varro a servi comme lieutenant de Cn. Pompeius dans la Péninsule pendant plusieurs années selon Var. RR 3.12.7 : probablement entre 76 et 71 et encore une fois de 55 à 49, cf. Broughton 1952, p. 625.
L’imperium Romanum en perspective
296 Jonathan Edmondson
i T. Didius (cos. 98), consul/proconsul, Hispania Citerior, 98-93
ii P. Licinius Crassus (cos. 97), consul/proconsul, Hispania Ulterior, 97-94
iii C. Valerius Flaccus (cos. 93), consul/proconsul, Hispania Citerior (et, peut-être, Ulterior), 93-81
iv Q. Caecilius Metellus Pius (cos. 80), proconsul, Hispania Ulterior, 79-71
v
Cn. Pompeius Magnus (cos. 70, 55, 52) : proconsul, Hispania Citerior, 77-71, proconsul, Hispaniae Citerior et Ulterior, 55-49, en utilisant ses legati pro praetore pour gouverner les deux provinces in absentia
vi
L. Afranius (cos. 60) : legatus, Hispania (? Citerior) sous Cn. Pompeius, 77-73/72 propraetor, Hispania Citerior, 71-69legatus pro praetore, Hispania Citerior sous Cn. Pompeius, 54-49
viiM. Terentius Varro (praetor ?) :legatus, Hispania Citerior sous Cn. Pompeius, c. 76-71legatus pro praetore, Hispania Ulterior sous Cn. Pompeius, c. 55-49
viii M. Petreius (praetor, 64 ou 63), legatus pro praetore sous Cn. Pompeius, Hispania Ulterior, 55-49
ix
C. Iulius Caesar (cos. 59, 48, 46, 45, 44) :quaestor/proquaestor, Hispania Ulterior, 69-68proconsul, Hispania Ulterior, 61-60dictator, présent dans la péninsule Ibérique pendant les guerres civiles en 49 et en 45
xQ. Cassius Longinus (tr. pl. 49) :quaestor, Hispania Ulterior sous Cn. Pompeius, 52legatus pro praetore, Hispania Ulterior sous César, 49-47
Ce tableau souligne que l’ administration romaine de la péninsule Ibérique fut concentrée entre les mains d’ un groupe relativement peu nombreux d’ individus, depuis 100 et jusque vers 45 av. J.-C. Par exemple, C. Valerius Flaccus, consul en 93, a passé presque douze ans dans la Péninsule de 93 jusqu’ en 81 av. J.-C., d’ abord pendant son consulat, puis comme proconsul44. En outre, sa prouincia fut anormalement étendue ; il fut responsable de l’ Hispania Citerior durant toute cette période, en assumant le gouvernement de la Gaule Transalpine, et à partir de 87, il fut sans doute aussi en charge de l’ Hispania Ulterior, pour une durée incertaine45. La durée de son mandat fut plus longue que celle d’ aucun autre gouverneur dans la péninsule Ibérique sous la République. Selon les Fasti Triumphales, il a
44 Cf. App. Hisp. 100 sur ses campagnes contre les Celtibères. Pour son administration de la justice dans la vallée de l’ Èbre, cf. supra, p. 293 et n. 35.45 Pour son rôle en Gaule transalpine, cf. Cic. Quinct. 24 ; 28 ; Caes. BC 1.47.4 ; en Hispanie Ultérieure, Brennan 2000, p. 502.
L’imperium Romanum en perspective
297L’ expérience et le savoir d’ empire dans la province d’ Hispania Ulterior sous la République
célébré un triomphe ex Celtiberia et Gallia en 8146. On peut imaginer que son mandat prolongé et son application à une grande échelle géographique ont dû entrainer une uniformisation des pratiques administratives, en facilitant le développement de processus et d’ usages administratifs qui ont eu un impact durable sur les rapports gouverneurs – gouvernés dans la zone correspondant à son mandat. D’ une manière semblable, Q. Caecilius Metellus Pius, consul en 80, resta dans la Péninsule comme proconsul plus de sept ans, officiellement en charge de la prouincia d’ Hispania Ulterior, quoique les exigences de la guerre contre Q. Sertorius nécessitassent d’ opérer aussi en Hispanie Citérieure47.
Quelques administrateurs ont aussi servi en Hispanie à divers stades de leur carrière politique. Q. Sertorius, par exemple, était arrivé dans la Citérieure comme tribunus militum sous le proconsul T. Didius en 95 av. J.-C., douze ans avant sa nomination à la tête de cette même province avec rang de gouverneur prétorien en 8348. L. Afranius est lui aussi venu en Hispanie pour la première fois comme legatus sous Cn. Pompeius pendant les campagnes contre Q. Sertorius de 77 jusqu’ en 73 ou 72, lorsqu’ il rentra à Rome pour obtenir la préture en 72 ou 71. Peu après, il est revenu pour gouverner la Citérieure pendant trois années, de 71 à 69. Avec sa connaissance et son expérience de la région, en 55, il était devenu un candidat idéal pour être legatus pro praetore d’ une des provinces hispaniques (probablement la Citérieure) aussitôt que Pompée fut investi d’ un imperium par lequel on lui permit de gouverner les deux Hispanies in absentia pour un mandat de cinq ans49. Afranius servait toujours dans la Péninsule six ans plus tard au moment du déclenchement des guerres civiles en 4950. Il resta là jusqu’ à la capitulation de son armée, qui fut obligée de se rendre à César en août de la même année51.
Par ailleurs, aussi bien Pompée que Jules César ont montré une bonne connaissance des provinces hispaniques, où ils se constituèrent d’ importants réseaux de clientèles à peu près à la même époque. Après sa propre présence dans la Péninsule pendant presque six ans, de 77 à 71, pendant ses campagnes contre Q. Sertorius, Cn. Pompeius Magnus gouverna les deux provinces hispaniques avec le titre de proconsul in absentia dès 5452, au titre de la lex Trebonia de 55 av. J.-C. De plus, il est très probable qu’ il y ait envoyé un légat pro praetore
46 Sur la durée de son mandat, Salinas de Frías 1995, p. 85.47 Plut. Sert. 12-13 ; 17-22 ; 27 ; Sall. Hist. 1.110-121 ; 2.59 ; 68-70 M ; Liv. Per. 91-93.48 Sur son tribunat militaire, Sall. Hist. 1.88 M ; Gell. 2.27.2 ; Plut. Sert. 3.3 ; sur sa nomination comme proconsul de rang prétorien en Hispanie Citérieure, Plut. Sert. 6.1-3 ; App. Hisp. 101 ; BC. 1.86. 49 Amela Valverde 2001.50 Caes. BC 1.37 ; 38 ; Liv. Per. 110 ; Vell. Pat. 2.50.4.51 Caes. BC 1.84-87. Sur la carrière de L. Afranius, Malavolta 1977 ; Konrad 1978.52 Liv. Per. 105 ; Plut. Pomp. 52 ; Amela Valverde 2001 ; Virvaet 2009.
L’imperium Romanum en perspective
298 Jonathan Edmondson
en 67, dans le cadre de son mandat pour éliminer les pirates de toute la Méditerranée53. Comme nous l’ avons vu, Jules César fut questeur en Hispania Ulterior en 69-68, puis proconsul de cette même province, pendant deux ans, immédiatement après sa préture en 6254. Il est revenu, bien sûr, pendant les guerres civiles pour confronter directement les forces de Pompée en 49 et de nouveau en 46-45, ce qui aboutit à sa victoire décisive sur les Pompéiens à la bataille de Munda55.
Tout cela a permis à ces acteurs politiques et militaires de développer une grande connaissance de la Péninsule et des principales tâches administratives qui devaient y être effectuées, pour autant que les conflits militaires n’ y faisaient pas obstacle. En restant sur place quelques années ou en revenant plusieurs fois au fil de leur carrière, ils ont appris quelles actions et décisions étaient nécessaires pour assurer l’ efficacité du pouvoir romain. En même temps, ils ont contribué au renforcement d’ un savoir-faire d’ empire au sein de la classe dirigeante romaine. Leur présence leur a également permis d’ établir des liens importants avec les élites locales, ce qui ensuite facilita encore les processus administratifs, notamment en assurant, dans la mesure du possible, que les communautés locales satisfaisaient aux exigences romaines, qu’ il s’ agisse des contributions fiscales imposées par l’ État romain, ou des effectifs militaires à fournir pendant les périodes d’ instabilité. Paradoxalement, ces périodes de guerre ont accru la nécessité d’ améliorer les techniques de prélèvements, soit en argent, soit en nature, auprès de la population provinciale. En outre, certains membres des élites provinciales ont obtenu la citoyenneté romaine, comme récompense pour leur soutien à la mission romaine, comme on le voit dans le cas célèbre de L. Cornelius Balbus de Gades et plusieurs autres, à qui fut accordée la citoyenneté romaine pour leurs services rendus à Pompée et Metellus Pius contre Q. Sertorius, octroi confirmé par la lex Cornelia Gellia de 72 av. J.-C56. L’ établissement de relations socio-politiques de cette nature a bien facilité les processus d’ administration romaine à la fin de la République.
En somme, la présence soit réitérée, soit continue pendant quelques années dans la péninsule Ibérique, d’ un groupe peu nombreux d’ administrateurs romains a contribué pendant le ier siècle av. J.-C. à un perfectionnement d’ une culture d’ empire grâce à un accroissement de l’ expérience sur le terrain et à la connaissance des problèmes inhérents au gouvernement d’ un empire. Au fil du temps, cette familiarité croissante avec les meilleures
53 Selon Salinas de Frías 1995, p. 102, peut-être A. Manlius Torquatus ou Ti. Claudius Nero ; voir aussi Girardet 1992. 54 Sur ses activités comme questeur et proquaestor en Hispanie Ultérieure, B. Hisp. 42 ; Vell. Pat. 2.43.4 ; Suet. Diu. Iul. 6-8 ; Plut. Caes. 5. Sur son proconsulat, Cic. Balb. 43 ; Suet. Diu. Iul. 54 ; Plut. Caes. 11-12 ; D.C. 37.52-53 ; 44.41.1. Cf. Roddaz 2000.55 Voir Melchor Gil et al. 2005. 56 Amela Valverde 2002 ; Rodríguez Neila 2006 ; cf. Pina Polo 2011.
L’imperium Romanum en perspective
299L’ expérience et le savoir d’ empire dans la province d’ Hispania Ulterior sous la République
pratiques administratives conduisit à des modifications importantes. Par exemple, en 49 (au plus tard), Cn. Pompée décida de diviser la province de l’ Hispania Ulterior en deux secteurs : un de ses legati pro praetore M. Terentius Varro, avec le soutien de deux légions, fut chargé de la région qui s’ étendait du col de Castulo (le saltus Castulonensis) au fleuve de l’ Anas (l’ actuel Guadiana), tandis qu’ un autre légat – M. Petreius – prit la responsabilité « du territoire des Vettones au nord de l’ Anas et de la Lusitania » – encore une fois avec deux légions57. Ce modèle est précisément celui adopté ensuite par Auguste, quand il divisa officiellement l’ Hispania Ulterior en deux nouvelles provinces – la Bétique et la Lusitanie – vraisemblablement en 16 av. J.-C. Les administrateurs romains, grâce à leur connaissance précise et de terrain du milieu hispanique, ont ainsi réussi une transformation par l’ introduction d’ un moyen plus efficace de gouverner cette région assez vaste et surtout très variée de l’ empire romain58.
Bibliographie
Abréviation
ELRH = Díaz Ariño B., Epigrafía latina republicana de Hispania, Instrumenta, 26, Barcelone, Universitat de Barcelona, 2008.
Amela Valverde L., « Pompeyo Magno y el gobierno de Hispania en los años 55–50 A.C. », HAnt, 25, 2001, p. 93-122.
Amela Valverde L., Las clientelas de Cn. Pompeyo en Hispania, Instrumenta, 13, Barcelone, Universitat de Barcelona, 2002.
Badian E., Foreign Clientelae (264‑70 B. C.), Oxford, Clarendon Press, 1958.
Barrandon N., De la pacification à l’ intégration des Hispaniques (133‑27 a. C.) : les mutations des sociétés indigènes d’ Hispanie centrale et septentrionale sous domination romaine, Bordeaux, Ausonius, 2011a.
57 Caes. BC. 1.38 : Afranius et Petreius et Varro, legati Pompei, quorum unus Hispaniam citeriorem tribus legionibus, alter ulteriorem a saltu Castulonensi ad Anam duabus legionibus, tertius ab Ana Vettonum agrum Lusitaniamque pari numero legionum obtinebat.58 Pour l’ invitation au très stimulant colloque parisien, je voudrais remercier les organisateurs, S. Pittia et J. Dubouloz ; pour les discussions, P. Le Roux et tous les autres participants du colloque ; et pour l’ amélioration de mon texte français, mon collègue du département d’ Histoire, M. Martel. Il me faut aussi exprimer ma gratitude encore une fois envers le CRSH / SSHRC du Canada pour son appui continu à mes recherches sur l’ histoire de la péninsule Ibérique dans l’ Antiquité.
L’imperium Romanum en perspective
300 Jonathan Edmondson
Barrandon N., « Le Sénat, les gouverneurs et les cités pérégrines d’ Hispanie citérieure aux deux derniers siècles de la République », dans Barrandon, Kirbihler 2011, p. 101-129.
Barrandon N., Kirbihler Fr. (dir.), Administrer les provinces de la République romaine, Rennes, PUR, 2010.
Barrandon N., Kirbihler Fr. (dir.), Les Gouverneurs et les provinciaux sous la République, Rennes, PUR, 2011.
Beltrán Lloris F., « Writing, language and society. Iberians, Celts and Romans in Northeastern Spain in the 2nd and 1st centuries B.C. », BICS, 43, 1999, p. 131-151.
Beltrán Lloris F., « Les débuts de l’ Hispania Citerior : précédents de la régionalisation de l’ administration provinciale », dans Piso, 2008, p. 123-143.
Bernal Casasola D., Arévalo A. (dir.), El Theatrum Balbi de Gades, Cadix, Universidad de Cádiz, 2011.
Brennan T. C., The Praetorship in the Roman Republic, 2 vol., Oxford, OUP, 2000.
Broughton T. R. S., The Magistrates of the Roman Republic, 2, 99 B.C. – 31 B.C., New York, American Philological Association, 1952 (réimpr., 1984).
Cadiou Fr., Hibera in terra miles. Les armées romaines et la conquête de l’ Hispanie sous la République (218 – 45 av. J.‑C.), Bibliothèque de la Casa de Velázquez, 38, Madrid, Casa de Velázquez, 2008.
Campos Carrasco J. M., « Estructura urbana de la Colonia Iulia Romula Hispalis en época republicana », Habis, 20, 1989, p. 245-262.
David J.-M., « Le tribunal dans le basilique : évolution fonctionnelle et symbolique de la République à l’ Empire », dans Architecture et société de l’ archaïsme grec à la fin de la république romaine, CEFR, 66, Rome, École Française de Rome, 1983, p. 219-241.
Díaz Ariño B., Epigrafía latina republicana de Hispania, Instrumenta, 26, Barcelone, Universitat de Barcelona, 2008.
Díaz Ariño B., « Epigrafía y gobernadores provinciales en Hispania durante la República romana », Chiron, 41, 2011, p. 149-179.
Edmondson J., « Roman power and the emergence of provincial administration in Lusitania during the Republic », dans E. Hermon (dir.), Pouvoir et ‘ imperium’ (iiie av. J.‑C. – ier ap. J.‑C.), Naples, Jovene Editore, 1996, p. 163-211.
Edmondson J., « La presencia romana en el sur de Lusitania en vísperas de la fundación de Augusta Emerita : aspectos sociales », dans J. M. Alvarez Martínez, P. Mateos Cruz & M. Alba (dir.), 1910‑2010 : El Yacimiento Emeritense, Mérida, Ayuntamiento de Mérida, Museo Nacional de Arte Romano – Mérida Consorcio, 2011, p. 93-110.
Ferrary J.-L., « Provinces, magistratures et lois : la création des provinces sous la République », dans Piso, 2008, p. 7-18.
Fournier J., « Rome et l’ administration de la justice provinciale », dans Fr. Hurlet (dir.), Rome et l’ Occident (iie siècle av. J.‑C. – iie siècle apr. J.‑C.). Gouverner l’ Empire, Rennes, PUR, 2009, p. 207-227.
L’imperium Romanum en perspective
301L’ expérience et le savoir d’ empire dans la province d’ Hispania Ulterior sous la République
Fournier J., « L’ apport de l’ œuvre de Cicéron à la connaissance du système judiciaire provincial au Ier siècle av. J.-C. », dans Barrandon & Kirbihler 2010, p. 181-194.
France J., « Deux questions sur la fiscalité provinciale d’ après Cicéron Ver. 3.12 », dans J. Dubouloz & S. Pittia (dir.), La Sicile de Cicéron : lectures des Verrines, Besançon, Presses Universitaires de Franche-Comté, 2007, p. 169-184.
García Morá F., « El conflicto sertoriano y la provincia Hispania Ulterior », dans II Congreso de Historia de Andalucía: Actas, Cordoue, Junta de Andalucía, 1994, p. 271-286.
García Moreno L. (dir.), Hispani tumultuantes : De Numancia a Sertorio, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá de Henarés, 1989.
García Riaza E., Celtiberos y lusitanos frente a Roma. Diplomacia y derecho de guerra, Veleia Anejo Minor 18, Victoria-Gasteiz, Universidad de País Vasco, 2002.
Girardet K. M., « Imperium und provinciae des Pompeius seit 67 v. Chr. », CCG, 3, 1992, p. 177-188.
Isler H. P., « L’ agora ellenistica di Iaitas », dans C. Ampolo (dir.), Agorà greca e agorai di Sicilia. Pisa, Edizioni della Normale, 2012, p. 105-115.
Keay S. J., « The developments of towns in Early Roman Baetica », dans S. J. Keay (dir.), The Archaeology of Early Roman Baetica, JRA suppl. 29, Portsmouth, Rhode Island, 1998, p. 55-86.
Knapp R. C., Roman Córdoba, Berkeley – Los Angeles, University of California Press, 1983.
Konrad C. F., « Afranius imperator », HAnt, 8, 1978, p. 67-76.
Le Roux P., L’ armée romaine et l’ organisation des provinces ibériques d’ Auguste à Dioclétien, Paris, De Boccard, 1982.
Le Roux P., Romains d’ Espagne. Cités et politique dans les provinces (iie s. av. J.‑C. – iiie s. apr. J.‑C.), Paris, A. Colin, 1995.
Le Roux P., La péninsule Ibérique aux époques romaines (fin du iiie s. av. n.è. – début du vie s. de n. è.), Paris, A. Colin, 2010.
Le Teuff B., « Les recensements dans les provinces de la République romaine : aux origines de la réforme augustéenne », dans Barrandon & Kirbihler 2010, p. 195-211.
Lintott A. W., « The leges de repetundis and associate measures under the Republic », ZRG, 98, 1981, p. 162-212.
López Melero A., Sánchez Abal J. L., García Jiménez S., « El bronce de Alcántara. Una deditio de 104 a.C. », Gerión, 2, 1984, p. 265-323.
Malavolta M., « La carriera di L. Afranio, cos. 60 a. C. », dans Quinta miscellanea greca e romana, Rome, Istituto italiano per la storia antica, 1977, p. 251-303.
Márquez C., Ventura A., « Corduba tras las guerras civiles », dans Melchor Gil et al. 2005, p. 429-466.
Meister F., Der Krieg des Sertorius und seine spanischen Wurzeln : Untersuchungen zu Krieg und Akkulturation auf der Iberischen Halbinsel im 2. und 1. Jh. v. Chr., Hambourg, Kovač, 2007.
Melchor Gil E., Mellado Rodríguez J. & Rodríguez Neila J. F. (dir.), Julio César y Corduba : tiempo y espacio en la campaña de Munda (49–45 A.C.), Cordoue, Universidad de Córdoba, 2005.
L’imperium Romanum en perspective
302 Jonathan Edmondson
Ñaco del Hoyo T., Vectigal incertum. Economía de guerra y fiscalidad republicana en el Occidente romano. Su impacto histórico en el territorio (228‑133 a. de C.), BAR i. s., 1158, Oxford, BAR, 2003.
Ñaco del Hoyo T., « Vectigal incertum. Guerra y fiscalidad republicana en el siglo ii a. de C. », Klio, 87, 2005, p. 366-375.
Ñaco del Hoyo T., « The Republican “war economy” strikes back : a “minimalist” approach », dans Barrandon & Kirbihler 2010, p. 171-180.
Nicolet Cl., L’ Inventaire du monde : géographie et politique aux origines de l’ Empire romain, Paris, Fayard, 1988.
Novillo López M. A., César y Pompeyo en Hispania : territorio de ensayo jurídico‑administrativo en la tardía república romana, Madrid, Sílex, 2012.
Ogilvie R. M., « Titi Livi Lib. xci », PCPhS, 210, 1984, p. 116-125.
Panzram S., Stadtbild und Elite : Tarraco, Corduba und Augusta Emerita zwischen Republik und Spätantike, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2002.
Pina Polo F., « Hispania y su conquista en los avatares de le República tardía », dans J. Andreu Pintado, J. Cabrero Piquero & I. Rodà (dir.), Hispaniae. Las provincias hispanas en el mundo romano, Documenta, 11, Tarragone, Institut Català d’ Arqueologia Clàssica, 2009, p. 223-236.
Pina Polo F., « Les Cornelii Balbi de Gadès : un exemple de clientélisme provincial ? », dans Barrandon & Kirbihler 2011, p. 189-203.
Piso I. (dir.), Die Römischen Provinzen. Begriff und Gründung, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2008.
Reynolds J. M., Aphrodisias and Rome, JRS Monograph, 1, Londres, Society for the Promotion of Roman Studies, 1982.
Richardson J. S., « The Tabula Contrebiensis : Roman law in Spain in the early first century B.C. », JRS, 73, 1983, p. 33-41.
Richardson J. S., Hispaniae and the Development of Roman Imperialism, 218‑82 BC, Cambridge, CUP, 1986.
Richardson J. S., « The administration of the empire », dans The Cambridge Ancient History2, 9, Cambridge, CUP, 1994, p. 564-598.
Richardson J. S., The Romans in Spain, Oxford, Blackwell Publishers, 1996.
Roddaz J.-M., « L’ empreinte de César sur la péninsule Ibérique », dans G. Urso (dir.), L’ ultimo Cesare : scritti, riforme, progetti, poteri, congiure, Rome, G. Bretschneider, 2000, p. 259-276.
Rodríguez Neila J. F., « Los Cornelios Balbos de Gades : las claves de su promoción social y política en Roma », dans J. F. Rodríguez Neila, E. Melchor Gil (dir.), Poder central y autonomía municipal : la proyección pública de las élites romanas de Occidente, Cordoue, Universidad de Córdoba, 2006, p. 131-184.
Salinas de Frías M., El gobierno de las provincias hispanas durante la República romana (218‑27 A.C.), Salamanca, Universidad de Salamanca, 1995.
L’imperium Romanum en perspective
303L’ expérience et le savoir d’ empire dans la province d’ Hispania Ulterior sous la République
Salinas de Frías M., « La provincia Ulterior entre Décimo Bruto y Augusto : los precedentes republicanos de la Lusitania imperial ; los gobiernos provinciales », dans J.-G. Gorges & T. Nogales Basarrate (dir.), Naissance de la Lusitanie romaine (ier av. ‑ ier ap. J.‑C.) : VIIe Table ronde internationale sur la Lusitanie romaine (Toulouse, 8‑9 novembre 2007), Toulouse, Université de Toulouse Le Mirail, et Mérida, Museo Nacional de Arte Romano, 2010, p. 39-68.
Scardigli B., « Trent’ anni di studi sertoriani », dans G. Urso (dir.), Hispania terris omnibus felicior. Premesse ed esiti di un processo di integrazione, Pisa, ETS, 2002, p. 143-161.
Schulz R., Herrschaft und Regierung. Roms Regiment in den Provinzen in der Zeit der Republik, Paderborn, Munich – Vienne – Zurich, F. Schöningh, 1997.
Schulz R., « Caesars Statthalterschaft in Spanien. Ein vergessenes Kapitel römischer Herrschaftspolitik in der späten Republik », dans J. Spielvogel (dir.), Res publica reperta. Zur Verfassung und Gesellschaft der römischen Republik und des frühen Prinzipats. Festschrift für Jochen Bleicken zum 75. Geburtstag, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2002, p. 263-278.
Scibona G., « Decreto sacerdotale per il conferimento della euerghesia a Nemenios in Halaesa », dans G. Scibona & G. Tigano (dir.), Alaisa‑Halaesa. Scavi e ricerche (1970‑2007). Messina, Regione Siciliana, 2009, p. 97-112.
Stylow A. U., « The beginnings of Latin epigraphy in Baetica : The case of funerary inscriptions », dans Keay 1998, p. 109-121.
Stylow A. U., « Fuentes epigráficas para la historia de la Hispania Ulterior en época republicana », dans Melchor Gil et al. 2005, p. 247-262.
Syme R., « The Spanish war of Augustus », AJPh, 34, 1934, p. 293-317.
Syme R., « The conquest of North-West Spain », dans Legio VII Gemina, León, Diputación Provincial de León, 1970, p. 79-107 (réimpr. dans R. Syme, Roman Papers, E. Badian (éd.), Oxford, Clarendon Press, 1979, 2, p. 825-854).
Vaquerizo Gil D., « Arqueología de la Corduba republicana », dans Melchor Gil et al. 2005, p. 165-205.
Virvaet F. J., « Pompeius’ career from 79 to 70 BCE : constitutional, political and historical considerations », Klio, 91, 2009, p. 419-422.