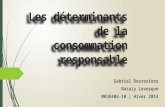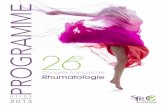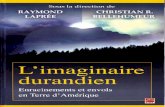Les Rhétoriques de la conspiration
Transcript of Les Rhétoriques de la conspiration
Sous la directiond’Emmanuelle Danblon et Loïc Nicolas
Les rhétoriques de la conspiration
CNRS ÉDITIONS15, rue Malebranche - 75005 PARIS
© CNRS éDITIONS, Paris 2010ISBN : 978-2-271-06999-3
Nous tenons à présenter nos plus sincères remerciements au Professeur Jean-Philippe Schreiber. Qu’il trouve ici le témoignage de notre chaleureuse gratitude pour son appui scientifique et sa précieuse collaboration dans la genèse conceptuelle de ce projet.
Les contributions rassemblées à l’occasion de cette publication sont issues du Séminaire interdisciplinaire en rhétorique et argumentation qui s’est tenu à l’Université Libre Bruxelles en 2008-2009 sous la direction conjointe d’Emmanuelle Danblon du Groupe de recherche en Rhétorique et en Argumentation Linguistique (GRAL) et de Jean-Philippe Schreiber du Centre Interdisciplinaire d’Étude des Religions et de la Laïcité (CIERL).
Sommaire
Introduction – Modernité et « théories du complot » : un défi épistémologique ................................................ 11Emmanuelle Danblon et Loïc Nicolas
i – Genèse, paradoxes et stratégies du conspirationnisme
La pensée conspiratoire. Une histoire dialectique et rhéto-rique ? ............................................................................ 27Marc angenot
Historiciser l’imaginaire du complot. Note sur un pro-blème d’interprétation .................................................. 45Paul Zawadzki
Les « théories du complot » ou la mauvaise conscience de la pensée moderne ........................................................ 59Emmanuelle Danblon
Rhétorique du complot : la persuasion à l’épreuve d’elle-même. Itinéraire d’une pensée fermée ......................... 75Loïc Nicolas
La notion de « théories du complot ». Plaidoyer pour une méthodologie empirique .............................................. 99Evgenia Paparouni
Les sources cognitives de la théorie du complot. La cau-salité et les « faits » .................................................... 121Marc Dominicy
Lorsque la cognition sociale devient paranoïde ou les aléas du scepticisme face aux théories du complot ... 135Olivier Klein et Nicolas Van der Linden
ii – La dénonciation de complot hier et aujourd’hui
Jean-Baptiste Louvet et l’obsession du complot aristocra-tique ............................................................................ 157Valérie André
Satan : l’esprit du complot ? Du théologique au politique dans l’encyclique Humanum Genus (1884). ............... 175Jean-Philippe Schreiber
Pensée du complot et imaginaire judéophobe chez Édouard Drumont ..................................................................... 199Cédric Passard
L’irrésistible rhétorique de la conspiration : le cas de l’imposture de la Lune ............................................... 221Thierry Herman
Face au complot, une guerre des saintes ? Analyse d’un ethos jihadiste ............................................................. 241Evelyne Guzy-Burgman
Les théories du complot en Chine de la fin de l’empire à la Révolution culturelle : ruptures et continuités ....... 257Françoise Lauwaert
iii – Une pensée globale de la conspiration : mythes et modernité
La pensée conspirationniste. Origines et nouveaux champs ......................................................................... 281Pierre-André Taguieff
Bibliographie ....................................................................324
Les auteurs ........................................................................350
Introduction
Modernité et « théories du complot » : un défi épistémologique
Emmanuelle Danblon et Loïc Nicolas
Pendant des millénaires, l’homme a été un chasseur. Au cours de ses innombrables chasses, il a appris à reconstituer les formes et les déplacements de proies invisibles à partir d’empreintes laissées dans la boue, de branches cassées, d’excréments, de touffes de poils, de plumes arrachées, d’odeurs confinées. Il a appris à sentir, à enregistrer, à interpréter et à classer des traces infinitésimales comme les filets de bave. Il a appris à effectuer des opérations mentales complexes avec une rapidité fulgurante dans l’épaisseur d’un fourré ou dans une clairière remplie d’embûches.
Carlo Ginzburg
Alors même que les fantasmes conspirationnistes ne sont pas nés de notre modernité historique, tant s’en faut, force est de constater que l’entrée dans la modernité a renouvelé de façon remarquable la pré-gnance des « théories du complot » sur notre appréhension du monde. Peut-être devrait-on d’ailleurs parler à leur sujet d’explications par le complot plus que de théories, afin de rendre compte de la fonction cognitive qu’elles revêtent dans la bouche de ceux qui les produisent et les diffusent, lesquels ne sauraient identifier comme théorique ce qu’ils perçoivent, le plus souvent, comme une stricte et objective description du monde. Il n’en demeure pas moins que la modernité a ouvert, malgré elle, un véritable âge d’or à ces constructions intellectuelles tout à la fois simples et complexes visant la mise en récit d’éléments éparpillés du
réel à des fins d’interprétation. La modernité leur a donné les moyens de renforcer leur puissance persuasive, ou du moins de l’adapter aux nouvelles exigences de l’esprit humain, en se présentant comme des modèles prodigieusement rigoureux de pensée critique.
Les « théories du complot » sont devenues un moyen d’exercer sa liberté de critiquer, tout en la détournant de sa fonction initiale et de son esprit. Elles manifestent donc un angle mort de la modernité, à savoir l’absolutisation de cette liberté même, en ce qu’elles cherchent à se soustraire au regard de la critique ou à en réviser les contraintes à leur profit. Le fait d’incriminer les thèses officielles dispenserait in fine de fournir des raisons et des justifications quant au sens produit rétrospec-tivement par l’explication conspirationniste. En se dérobant de la sorte à l’autorité de cette critique dont elles revendiquent l’usage exemplaire, les « théories du complot » en sont venues à faire reconnaître et plus encore à accréditer leur immunité face au doute. C’est à ce titre qu’on peut voir à l’œuvre dans le processus d’immunisation de leurs récits explicatifs, l’expression tyrannique d’une liberté de l’esprit présentée comme irrésistible et dont le seul exercice garantirait la légitimité autant que la valeur de ses productions. Cette tyrannie par laquelle la critique force l’adhésion à ses thèses en surexploitant l’effet d’évidence, carac-térise une habitude intellectuelle qui, dans la recherche de l’efficacité à tout prix, a fini par distendre son rapport à la réalité et entretenir une ambivalence à son égard. Une telle propension au déni où le monde se trouve dilué dans son explication, où la cohérence superficielle du sens annule la charge de la preuve, dispose à convertir la résistance à la doxa en illusion collective et le doute perpétuel en certitude conqué-rante. C’est pourquoi, loin de chercher à condamner la légitime et saine expression du doute, cet acquis des sociétés ouvertes, nécessaire au progrès social, politique et scientifique, nous proposons, au contraire, de réfléchir aux usages spécifiques de la critique mobilisés par les pen-seurs conspirationnistes ou ceux qui se font leurs relais.
En définitive, la modernité, en introduisant de nouveaux critères de production du savoir empirique et de légitimation des connaissances produites, s’est vue transmettre à la pensée conspirationniste des res-sources rhétoriques et procédurales qui ont garanti et qui garantissent encore son succès parmi les défenseurs de la contestation comme rapport privilégié à l’espace social et politique. L’esprit moderne n’est sans doute pas plus enclin que son prédécesseur à concevoir ou suspec-ter la présence de complots, d’ententes secrètes, de projets indicibles,
12 Les rhétoriques de la conspiration
de manigances abjectes, etc. derrière les portes de l’histoire en actes, au contraire, il devrait être théoriquement plus critique que lui face à des imputations farfelues ou étranges au regard des données factuelles. Mais en exaltant la digne posture du critique, posture de celui qui se dit éclairé par les lumières de la raison et conteste le « prêt-à-penser » qu’on lui donne, cet esprit moderne plus rationnel, plus méthodique, plus sceptique aussi, s’est paradoxalement trouvé impuissant face à ceux-là mêmes qui revendiquaient leur droit inaliénable à faire un usage radical de la critique au nom de la modernité.
Les dénonciateurs de complots – qui, sans cesse, entreprennent de dévoiler les raisons cachées, les plans et les mystères des (grands) événements historiques – ont donc trouvé dans la modernité un envi-ronnement favorable, voire inespéré, car le seul fait de prendre la parole pour afficher son scepticisme et témoigner de son « esprit critique », suffit souvent à légitimer socialement la parole qui s’énonce. En consé-quence de quoi, critiquer le critique, non pas forcément ce qu’il dit – ce point fera d’ailleurs l’objet d’un développement par la suite –, mais la légitimité extraordinaire qu’il tire de sa position de critique dans l’es-pace du discours, reviendrait finalement à lui refuser son droit d’être un moderne, c’est-à-dire un sceptique. Toute l’ambiguïté est là. La critique est-elle d’abord une place, que n’importe qui peut légitimement occuper pour renforcer sa position discursive, son ethos, ou un processus par lequel la parole se conforme aux exigences de la rationalité afin de repenser la signification de ce qui précisément fait question ?
Le présent ouvrage, par le biais d’une investigation relative aux modalités rhétorico-argumentatives de production et d’exposition des « théories du complot » ou explications conspirationnistes, se propose de mettre en lumière les mécanismes spécifiques par lesquels ces dernières parviennent à imposer leurs capacités de persuasion en affichant ostensiblement leur scrupuleux respect des contraintes de validation propres au savoir scientifique. En d’autres termes, il s’agit pour les contributeurs du volume d’analyser cette façon particulière qu’a la pensée conspirationniste de raisonner et de présenter ses « découvertes » en affichant un luxe de détails, une rigueur et une précision telles qu’elle réussit dans un même mouvement à attester la rationalité de son entreprise de dévoilement, tout en la préservant d’une quelconque mise à l’épreuve falsificatrice (Popper). Avant d’aller plus loin dans cette réflexion théorique, il nous paraît important de revenir sur l’originalité des « théories du complot » dans la modernité, afin de
Introduction 13
tracer le cadre général au sein duquel se manifeste le défi épistémolo-gique que nous souhaitons aborder.
Le complot moderne, l’homme et le ré-enchantement du monde
En tout état de cause, la pensée du complot dans les périodes pré-révolutionnaires présente un certain nombre de caractéristiques très spécifiques, et se déploie autour de deux pôles institutionnels : la reli-gion, plus particulièrement l’Église (ses dogmes, ses prélats, etc.), et la monarchie ; les deux étant finalement inséparables. Le supposé complot fait alors l’objet dans l’imaginaire général – celui des peuples comme celui des puissants – d’une attribution à une force supérieure, Satan ou l’Antéchrist, visant à renverser l’ordre établi, un ordre tout à la fois temporel et divin. Il s’agit donc d’un complot ourdi contre le détenteur du pouvoir et les institutions dans lesquelles il s’exerce, afin de changer le rapport de force, et pour tout dire de briser le sens de l’histoire autant que le contrat qui structure la réalité sociale et spirituelle. Les figures humaines désignées (tout spécialement les juifs, mais aussi les lépreux et les hérétiques, etc.) ne sont jamais que des instruments, certes malé-fiques, entre les mains d’une transcendance à l’envers, qui fait, d’une certaine manière, pendant à la transcendance révérée (incarnée par le monarque et le souverain pontife). L’humain, aussi malfaisant soit-il, n’incarne donc que le rouage d’un grand mécanisme, un moyen en vue d’une fin (tuer Dieu ou le roi) qui le dépasse et lui échappe, et dont il demeure forcément incapable d’apprécier la portée, celle d’une lutte létale entre deux espaces du sacré : le ciel et l’enfer. Sous l’Ancien régime, la peur est là, quotidienne, la réalité terrorise, mais les choses se passent, elles ont du sens, une raison d’être, une explication pérenne et invariable, à même d’être convoquée par n’importe qui lors d’expé-riences ou de situations critiques.
Comme le montrent avec précision plusieurs contributions au volume à la suite de travaux récents, tout cet appareil théorique, ou préthéorique, se trouve remis en cause avec la Révolution française, car la société, livrée à elle-même, dépossédée de ses vérités et de ses transcendances, doit désormais faire face au règne de l’incertitude, plus insoutenable encore que l’attente de n’importe quel châtiment
14 Les rhétoriques de la conspiration
divin. Les bouleversements dans l’ordre de la souveraineté politique, la proclamation de la « mort » de Dieu, ont eu pour conséquence la recom-position des théories du complot sur les vestiges de la pensée mythique, ainsi que leur adaptation aux nouvelles contraintes historiques et aux exigences de la raison moderne. La rationalisation et la sortie du reli-gieux, c’est-à-dire le fait d’éliminer la « magie » en tant que technique de salut, a eu pour effet l’abandon d’un monde stable où tous les événe-ments pouvaient s’expliquer et se comprendre par le retour, la réflexion sur une genèse fixée une fois pour toutes. Une genèse qui, jusqu’alors, donnait les clés indubitables pour déplier d’un bout à l’autre l’apparente complexité du réel. Les faits, et plus encore les accidents de l’existence (épidémies, famines, guerres, etc.) trouvaient leur solution en dehors de l’homme, lequel pouvait alors se décharger de ses interrogations et de ses doutes sur cette extériorité transcendante. À partir du moment où les processus de génération de l’histoire se « désenchantent » et que ce désenchantement ruine la compréhension qu’a l’homme de son environnement immédiat, les événements qui adviennent, importants ou infimes, perdent leurs liens internes et sont alors renvoyés à leur insupportable absurdité.
En d’autres termes, le renoncement à cette totalité explicative, primordialement sécurisante – parce que nécessaire et impossible à esquiver –, a laissé un vide, une place vacante, à savoir celle de la signification profonde des êtres et des choses qui désormais doivent construire, voire produire leur « sens » par eux-mêmes. C’est cette absence de réponse transcendante apportée sur le « pourquoi » des malheurs de l’humanité, qui s’est trouvée comblée par les phénomènes sectaires, les religions séculières (communisme et fascisme en parti-culier), et, bien sûr, par les « théories » du complot mondial, dont la fonction première est d’injecter du « sens », de la cohérence et de la causalité, là où, précisément, ceux-ci sont vacants, du moins à première vue. Libéré et en même temps orphelin de Dieu comme du diable, l’homme se voit donc amené à prendre la place de ces deux figures opposées, c’est-à-dire à remplir le rôle qu’elles occupaient jusqu’alors dans l’imaginaire collectif.
Les « théories du complot » qui convoquent de vieux démons, tout en les détournant de leur initiale fonction magique, participent donc intimement au ré-enchantement du monde à partir de la seule chose qui reste après la disparition des transcendances : l’homme comme
Introduction 15
principal moteur de l’histoire. En d’autres termes, il s’agit là d’une conversion des mythes aux exigences de l’esprit moderne, c’est-à-dire d’un dépouillement de leur dimension spécifiquement religieuse qui réduisait l’homme à un office purement instrumental devenu impossible à tenir. Du coup, la figure du mal, figure de l’ennemi (le juif, le jésuite, le franc-maçon, le dirigeant américain ou l’administrateur d’une multi-nationale, etc.) devient désormais identifiable en première personne (il porte un nom, il a certaines fonctions, il est motivé par des besoins et des aspirations personnels, il est doué de facultés d’action, d’intentions particulières, etc.). Cette figure se singularise donc pour donner prise à la dénonciation, c’est-à-dire pour l’insérer dans un monde composé de personnes réelles – incarnées – censées pouvoir répondre, à la fois pour elles-mêmes et pour le groupe qu’elles représentent ou symboli-sent, aux accusations formulées par les dénonciateurs. Ces personnes réelles, inspirées par des buts humains (domination, extermination, cap-tation des richesses, acquisition d’un pouvoir absolu, etc.) et engagées dans un pacte criminel, deviennent alors causes explicatives de tout ce qui dysfonctionne ; leur destruction, ou du moins leur évincement radical, libérerait de fait le monde des raisons de son malheur et de sa souffrance.
Dans le cas particulier et exemplaire des Protocoles des Sages de Sion, qui prête aux juifs un projet de domination planétaire, les faus-saires ont puisé dans un stock de stéréotypes et de clichés antisémites disponibles qu’ils ont réactivés, tout en les adaptant aux demandes d’une rationalisation proprement moderne, selon laquelle la clé de l’histoire se trouve dans l’action des hommes, c’est-à-dire dans leurs intentions proprement humaines. En conséquence, avec la modernité, l’enjeu des complots est toujours le même, à savoir l’ordre et le pouvoir établis, mais ceux qui se trouvent, à présent, du « mauvais côté de la barrière », c’est-à-dire du côté du complot, ne sont plus les peuples, nouveaux détenteurs du pouvoir (et primordialement dotés d’un pouvoir numérique), mais leurs représentants – au sens large : complices, amis, appuis, etc. –, ou plus exactement ceux qui prétendent assurer cette fonction, et cherchent à tirer les ficelles supposées à leur profit.
16 Les rhétoriques de la conspiration
L’indice comme preuve
La dénonciation d’un complot – aussi bien réel qu’imaginaire, minuscule ou colossal – s’appuie primordialement sur l’identification, ou la prétendue identification de sa présence matérielle (on peut le voir à l’œuvre, vivre ses effets, ressentir sa présence, etc.) au sein de la réalité factuelle. En d’autres termes, cette dénonciation se fonde sur des indices, des traces, des empreintes qui témoignent de son passage ou de son action. Si complot il y a, celui-ci doit nécessairement se manifester d’une manière particulière (par la production de documents, la tenue de réunions, la corruption de personnes, etc.), laisser des marques superfi-cielles qui attestent sa réalité et autorisent sa traque.
En conséquence, se lancer sur les traces d’un complot singulier – celui-là et pas un autre – implique soit de supposer que ce dernier pourrait éventuellement exister (par exemple après en avoir entendu parler), soit d’avoir l’assurance qu’il existe bel et bien (par exemple après avoir surpris une conversation entre des individus identifiés comme conspirateurs), et donc de concevoir avant d’entamer l’enquête des effets ou des manifestations possibles de son existence. Cette atti-tude consiste à suivre à la trace, c’est-à-dire à pister et à interpréter des résidus, déchets, débris apparemment anodins, à les faire parler pour qu’ils nous racontent leur histoire : une présence cachée, une cause, une raison. Une telle façon de faire constitue non seulement une disposition profondément ancrée dans l’esprit humain, mais surtout la base essen-tielle de sa fécondité, voire, n’ayons pas peur des mots, de sa rationalité. Dans ce travail ancestral de collecte et de reconstitution, dans cette res-tauration des relations (possibles) entre les faits à partir d’une enquête qui procède par comparaisons et suivant une démarche abductive, Carlo Ginzburg reconnaît la manifestation de ce qu’il nomme le « paradigme indiciaire ». En développant une connaissance pratique et intuitive fondée sur leur longue expérience du terrain (née de constats, succès, échecs ou méprises passés), le chasseur-cueilleur comme l’enquêteur moderne se sont progressivement dotés de cette aptitude essentielle, et depuis longtemps dévaluée, que les Grecs appelaient phronèsis. La « prudence » dans l’action est bien ce qui rend capable, en fonc-tion d’éléments ténus et pourtant signifiants, de tirer l’ordre du chaos, d’effectuer des rapprochements, de poser des conclusions, d’orienter ses recherches, c’est-à-dire de poursuivre son entreprise d’intellection du monde, non sur la base de certitudes ou de prin-
Introduction 17
cipes absolus, mais grâce à cette « faculté d’apercevoir » et d’opiner juste dont parle Aristote dans l’Éthique à Nicomaque, faculté que seuls l’expérience et le travail du temps nous enseignent. Cette façon de lire sinon de dire le monde, d’en déchiffrer le sens à partir d’une série d’événements sans lien apparent, mais qui justement prennent sens dans leur sérialité, fonctionne suivant un modèle cognitif conjectural.
Le diagnostic médical, depuis ses origines hippocratiques, ne procède pas autrement : à partir d’une observation de symptômes (un état fébrile, des douleurs abdominales, une éruption cutanée, etc.) couplée à un éventuel entretien clinique (sur les comportements et antécédents du sujet), le praticien élabore des hypothèses relatives aux causes des maux qu’il examine. Il s’efforce alors tout à la fois de reconstruire l’« his-toire » de la maladie, de comprendre les raisons de sa présence dans le corps du patient, et de prévoir les chances autant que les conditions du rétablissement. Rien n’est certain bien sûr, l’« histoire » élaborée est sans doute incomplète, mais le récit des faits produit par le médecin, assis sur l’expérience de cas similaires, possède une probabilité suf-fisamment forte pour autoriser une action thérapeutique spécifique. C’est pourquoi la médecine constitue avant tout un art, une technè, un empirisme, du moins pour ce qui concerne la phase de découverte et de diagnostic. Laquelle requiert le plus souvent le soutien d’un dispositif scientifique capable de valider, c’est-à-dire de confirmer ou d’infirmer, l’hypothèse initiale.
Cette précision importante ne remet nullement en cause la valeur éminente de la médecine – et tout particulièrement de la médecine moderne –, mais elle éclaire la distinction entre ce qui relève de la raison pratique, qui mobilise les qualités du phronimos, au premier chef desquelles la capacité de juger d’un cas nouveau à la lumière de l’expé-rience passée, et ce qui relève de la science au sens strict où le moment de l’expérimentation succède nécessairement à celui de la découverte.La médecine moderne s’appuie donc sur la science, mais elle ne saurait, en soi, revendiquer cette qualification pour désigner le processus mental par lequel le praticien identifie puis sélectionne une pathologie plutôt qu’une autre. Bien qu’il relève d’une forme de « sagesse pratique » ce processus n’est pas pour autant dénué de rationalité, au contraire, nous l’avons dit, il conditionne même, à partir de ce sens du probable qu’il convoque, l’action rationnelle et l’inscription du sujet comme acteur
18 Les rhétoriques de la conspiration
du monde. En conséquence, le raisonnement indiciaire qu’on rencontre en médecine, en philologie, en archéologie, dans l’expertise d’art… et bien sûr dans la pensée conspirationniste, ne peut faire l’objet d’un rejet de principe, au motif qu’il produirait des connaissances possibles, vraisemblables, parfois même très vraisemblables, mais aucune certi-tude absolue.
Quelle est, dans ces conditions, la particularité des « théories du complot » à l’égard du paradigme indiciaire ? L’un des constats que nous pouvons faire concerne le statut et la fonction que ces « théories » confèrent aux indices dans la construction intellectuelle qu’ils sont censés supporter, et plus précisément leur systématique conversion en preuves de l’authenticité de celle-ci. Concrètement, le besoin de donner du sens est si fort que la trace observée contient la réalité tout entière dans la mesure où cette trace rend manifeste et palpable, c’est-à-dire dévoile l’explication globale qui fait tenir le monde. En d’autres termes, l’indice collecté (la tenue d’une réunion à une date donnée, la relation entre deux personnes, l’origine d’un des protagonistes, etc.) devient le lieu de manifestation et de confirmation de la « théorie », et ceci au sens où le postulat initial, à savoir la nécessaire existence du complot, est vécu comme irréfutable parce qu’il ne saurait en être autrement. Sans cette irréfutabilité fonda-mentale de la « théorie », c’est toute la compréhension du monde, mais aussi sa cohérence qui risqueraient d’être radicalement menacés par le retour du doute. De cette manière, l’indice, repensé en preuve, est lu à la lumière de l’hypothèse première qu’il devrait normalement éclairer. Car lorsque l’effet est intégré à la cause, lorsque cette cause réduite à l’unité détermine et absorbe tous les effets possibles les rendant du même coup intelligibles, le monde se referme sur lui-même et parvient au ré-enchantement. Ainsi, le monde ne peut plus exister en dehors et indépendamment de la « théorie » à laquelle il se voit soumis ; l’autono-mie du réel est réduite à néant pour favoriser la pérennisation du sens qui sécurise la relation de l’homme à son environnement.
En conséquence, n’importe quel fait (ou absence de fait) peut subir une importation au sein de l’explication conspirationniste, et donc servir à en confirmer la validité. L’indice justifie l’explication autant que celle-ci est justifiée par lui. Les découvertes effectuées en vue (et au nom) de la dénonciation du complot échappent ainsi à toute mise à l’épreuve, puisque la dénonciation en tant qu’édifice théorique contrôle elle-même la production et la validation des découvertes qui servent à l’accréditer.
Introduction 19
Dès lors, la pensée du monde, soumise à une théorie unique et totali-sante, se fait en un seul geste suivant la méthode archaïque des mages et des chamanes : la représentation et la réalité se trouvent alors réunies, confondues afin de verrouiller la contestation et d’empêcher la survenue du doute. Dans ce cadre, propre aux « sociétés fermées », décrire le monde, le créer et lui donner du sens fonctionnent à l’identique.
Décrire ou condamner : vers une troisième voie
Ainsi se pose la question de l’attitude du chercheur à l’égard de ce mode de pensée tout à la fois « hypermoderne » et antimoderne voire profondément archaïque ; rationnel, du moins en apparence, et sans cesse défiant les principes de la rationalité. Est-ce le rôle du chercheur de dénoncer la bêtise, le piège ou même la dangerosité politique de telle ou telle théorie ? Est-ce son rôle de prendre parti et de s’opposer à elle au nom de la science en se positionnant dans l’espace public ? Doit-il se lamenter en déplorant l’importance prise par certaines idées suspectes et contestables ou, au contraire, mettre ses opinions à distance pour comprendre les raisons profondes de leur succès ? Certaines approches considèrent qu’il n’appartient pas au scientifique de juger ou de condam-ner une pensée plutôt qu’une autre et adoptent alors une attitude purement descriptive. C’est le cas notamment – mais il ne s’agit là que de tendances fortes – des travaux en psychologie sociale, en linguistique ou encore en histoire. Le chercheur présente ce qu’il observe, mais se défend, autant que possible, de porter un jugement positif ou négatif sur l’objet observé. De leur côté, la science politique ou la philosophie morale, plus normatives, ont souvent moins de réticence à formuler un tel jugement et parfois même s’en font un devoir. Enfin, la démarche qui caractérise les chercheurs en rhétorique et argumentation dont nous sommes se donne comme une troisième voie et peut-être comme une réponse au défi épis-témologique où s’opposent « décrire » et « condamner ».
En effet, il ne s’agit pas, pour nous, de partir des contenus, c’est-à-dire des idées, mais des modalités de formulation et de présentation de ces idées mêmes, et plus encore des mécanismes rhétoriques de production des preuves discursives. Nous estimons que la disposition et les types d’arguments utilisés, le choix des mots, l’usage des preuves subjectives (ethos et pathos), les raisonnements déployés (logos), constituent des renseignements essentiels pour décrire les discours
20 Les rhétoriques de la conspiration
eux-mêmes, leurs visées et leurs capacités de persuasion. En d’autres termes, nous décrivons des processus rhétoriques et argumentatifs que nous qualifions ensuite en termes logiques, éthiques ou politiques. Notre propos n’est pas de juger, en scientifiques, la valeur d’une idée, d’une thèse ou d’une théorie en tant que telle, même si nous pouvons par ail-leurs, comme citoyens, la trouver extrêmement douteuse ; les modèles dans lesquels s’inscrivent nos recherches (d’inspiration aristotélicienne et perelmanienne) se refusent à une telle attitude normative. Nous nous proposons, au contraire, de détailler les conditions d’élaboration et d’administration de ce qui est au cœur de la démarche rhétorique, c’est-à-dire la preuve, dans la mesure où c’est elle qui motive primor-dialement l’adhésion aux thèses qui sont exposées et défendues par le discours. La particularité de notre orientation scientifique consiste à prêter attention au fonctionnement du dispositif par lequel un auditeur accepte de se rallier aux vues de celui qui parle, notamment lorsque ce qui est dit paraît difficilement compatible avec la réalité objective. Il nous a semblé que les « théories du complot » pouvaient constituer un véritable laboratoire à une investigation de ce type, laquelle offrait alors un moyen de mieux comprendre les raisons de l’importance prise par ces théories dans nos sociétés contemporaines.
Notre analyse permet ainsi de faire ressortir et d’interroger les paradoxes, les ambivalences que renferme la pensée conspirationniste, afin d’apprécier sa position singulière entre archaïsme et modernité. Paradoxale, cette pensée l’est à plus d’un titre : d’une part au niveau du pathos, elle rassure et inquiète tout à la fois, car en dévoilant les causes cachées, les plans, les secrets, en dénonçant les coupables, elle fait voir l’ampleur extraordinaire de ce qu’elle dévoile ; d’autre part au niveau de l’ethos, elle élève le dénonciateur en expert suprême (technicien vir-tuose, scientifique de génie) et le place en même temps « à la marge » de la science, du pouvoir, de la société, etc., position marginale qui vient du même coup garantir la pureté de ses intentions et l’authenticité de son propos. Ces paradoxes nous semblent intimement liés aux rapports que chacun entretient à la modernité, aux institutions et à la rhétorique convoquée pour leur donner du sens.
En conséquence, si notre démarche scientifique trouve ses res-sources premières dans la description, cette dernière ne constitue pas la finalité de notre recherche. Du reste, nous n’avons pas vocation à condamner la pensée conspirationniste, tout spécialement parce que ce mode de compréhension du monde, causal et abductif, n’est ni régressif
Introduction 21
ni même irrationnel ou obscurantiste, comme voudraient le montrer cer-tains. Nous nous efforçons plutôt de tirer de la description les moyens de penser la modernité et ses limites, c’est-à-dire de questionner, à partir d’une analyse poussée des mécanismes rhétorico-argumentatifs qui trop souvent sont laissés dans l’ombre, certains aspects cruciaux de la raison humaine dans ses rapports paradoxaux à la liberté et à son difficile exercice en démocratie. Voilà où se situe la troisième voie, ni normative, ni purement descriptive, que nous proposons.
Nulle intention donc de nier la pluralité des contextes, de réfléchir le phénomène sans distinction ni discernement, de voir derrière chaque dénonciateur un conspirateur en acte ou en puissance, mais plutôt d’identifier des récurrences et des traits saillants capables de fournir les moyens de caractériser « génériquement » les situations concrètes où ce mode d’explication totalisant est mis en pratique. Le but du présent volume est d’abord de développer cette troisième voie, d’en montrer la valeur heuristique, d’en présenter les apports intellectuels, la pertinence, en invitant des chercheurs d’horizons divers à repenser, en fonction des outils d’analyse que fournissent les théories de la rhétori-que et de l’argumentation, les conditions dans lesquelles s’effectuent, aujourd’hui comme hier, les dénonciations de complots.
22 Les rhétoriques de la conspiration
La pensée conspiratoire. Une histoire dialectique
et rhétorique ?
Marc Angenot
Une histoire dialectique et rhétorique reste à concevoir ou du moins à développer. Je vais me borner à en esquisser d’abord la problématique telle que je la conçois. Elle serait l’étude de la variation historique et sociologique, de l’historicité et la socialité des types d’argumentations, des moyens de preuve, des méthodes de persuasion. Cette histoire du raisonnable et du persuasible est à peine ébauchée, il en existe toutefois des bribes ici et là, mais nulle synthèse. Je donne dans ce contexte à « raisonnable » un sens relatif et particulariste : le terme se rapporte à l’ensemble des schémas qui ont été acceptés quelque part et en un temps donné ou qui sont acceptés en tel ou tel lieu, dans telle ou telle sodalité idéologique1 comme sagaces et convaincants alors même qu’ils sont tenus pour « aberrants » en d’autres secteurs ou d’autres temps.
Toutes sortes de mots, flous et indécis, aucunement confrontés entre eux ni théorisés, visent à désigner certaines prégnances, certaines sin-gularités dans les manières de raisonner et d’argumenter qui composent dans tout état de société un arsenal de « démarches » disponibles ou, pour emprunter le sous-titre fameux de Descartes, de façons idiosyn-cratiques de « conduire sa raison et chercher la vérité ». On a pu parler d’un « esprit » (comme Augustin Cochin a caractérisé jadis l’« esprit du jacobinisme2 »), de « mécanismes » (comme le « manichéisme » peut être qualifié de « mécanisme mental » jugé propre à certaines « familles
1. Je me rapporte à la terminologie de M. Rodinson (De Pythagore à Lénine. Des activismes idéologiques, Paris, Fayard, 1993).
2. A. Cochin, fameux historien contre-révolutionnaire, avait pris pour objet d’étude les « Sociétés de pensée » d’avant 1789. Il y a décrit l’efflorescence d’une manière de penser et de persuader toute nouvelle – qu’il nomme « philosophique » simplement, ou par anticipation, « jacobine » – qui lui paraît singulière, foncièrement fausse, délétère et logiquement porteuse de futurs crimes, déduits et justifiés « abstrait-
d’esprit » et déplaisant et suspect pour d’autres), de « rhétorique » tout simplement mais guère plus clairement (le philosophe et historien de Harvard, Albert O. Hirschman a étudié la « rhétorique réactionnaire », The Rhetoric of Reaction, et en a reconstruit l’idéaltype invariable sur deux siècles3), de « pensée » (comme on parle fréquemment, en termes génériques, d’une « pensée utopique », censée opposée, cognitivement, au monisme positiviste4), de « systèmes » étiquetés en -isme comme de cadres cognitifs sous-jacents à des doctrines spécifiques (Karl Popper, éminent penseur libéral, a prétendu montrer que l’Historicism, cette pensée qui raisonne l’évolution sociale en termes de déterminisme historique et de « sens de l’histoire » délimitait à gauche une commu-nauté d’adhésion alors qu’il excède le connaissable et déraisonne sur du chimérique5), de « styles de pensée » enfin : les politologues américains font de ce qu’ils nomment le « style paranoïde » (qui n’est pas sans rapport étroit avec la « pensée conspiratoire » dont je vais traiter), « a mode of social thought » propre à certains secteurs « radicaux » U.S6.
ement » par les Robespierre et les hommes à doctrine de la Terreur. Cochin A., L’esprit du jacobinisme, Préface de J. Baechler, Paris, PUF, 1979 [1922], p. 39.
3. Hirschman A. O., Deux siècles de rhétorique réactionnaire, trad. P. Andler, Paris, Fayard, coll. « L’Espace du politique », 1991.
4. J’ai étudié dans plusieurs ouvrages cette sorte de « pensée » (L’Utopie collec-tiviste. Le Grand récit socialiste sous la Deuxième Internationale, Paris, PUF, 1993 ; D’où venons-nous ? Où allons-nous ? La décomposition de l’idée de progrès, Mon-tréal, Éd. Trait d’union, coll. « Spirale », 2001, etc.). On peut repérer à travers les deux siècles modernes une certaine manière constante d’argumenter la société comme étant ce qui « va mal » et ce qui « ne peut plus durer », argumentation qui débouche sur la promesse d’un Monde nouveau imminent que je désigne comme une logique de la modernité. Celle-ci a évolué en un conflit insurmontable avec les autres axiomatiques de la connaissance discursive – avec toutefois de subreptices contaminations. Une pensée « utopique », qu'est-ce à dire ? Aucunement une fiction imaginative comme on l’entend dire parfois, mais l’aboutissement d’un raisonnement, la Pars construens (comme disent les rhéteurs) d’une chose nouvelle née à la fin du xviiie siècle : la cri-tique sociale radicale, celle qui prétend aller à la racine du Mal.
5. Popper K. R., Misère de l’historicisme, trad. H. Rousseau révisée et augmentée par R. Bouveresse, Paris, Pocket, coll. « Agora », 1988 (version retraduite sur l'édition de Londres, 1976).
6. Marcus G., Paranoia within Reason: A Casebook on Conspiracy as Explana-tion, Chicago, University of Chicago Press, 1999, p. 1. Ce mot de paranoid est intégré au lexqiue politologique depuis l’ouvrage classique de R. Hofstadter : The Paranoid Style in American Politics and Other Essays (1965). Ce que le penseur décrivait dans ce livre fameux était ce qu’il nomme un « style de pensée » assez répandu, marqué par des raisonnements « exagérés », par l’esprit de suspicion et par des fantasmes con-
26 Marc Angenot
L’énumération de termes divers dans le paragraphe qui précède est là pour désigner ce qui me paraît un vaste problème largement en friche. De quoi veut-on parler avec de telles catégories intuitives et floues qui semblent néanmoins pointer toutes vers une problématique détermi-née ? Peut-on périodiser ces catégories, les confronter en historien des idées, les situer avec rigueur dans la « topographie » des cultures et des milieux sociaux ? Peut-on en expliquer pour chaque cas la genèse et la dynamique? Ne devrait-on pas inscrire ce déjà vaste ensemble de problèmes dans une question plus large encore : comment l’histoire et la société modernes ont été déchiffrées, anticipées, raisonnées, compri-ses ? Peut-on recenser enfin les diverses manières qu’il y a eu dans les deux siècles modernes de se positionner et de (sur)vivre dans l’histoire en cherchant à donner du sens au cours des choses ? On peut sans nul doute admettre l’universalité de la raison humaine, axiome général qui n’engage guère concrètement, et se poser ce genre de questions qui portent, non sur la pensée humaine dans son abstraction universelle, mais sur du social/historique. On ne parlera pas d’essences différentes, mais de choix marqués et de préférences sectorielles.
Je vais me borner dans le présent essai à faire suivre cette esquisse de problématique d’une étude de cas non moins rapide et sommaire. Je prendrai pour objet une chose abordée par bien des chercheurs avant moi : la pensée conspiratoire. Léon Poliakov, historien de l’an-tisémitisme européen, avait nommé jadis « causalité diabolique » la forme d’explication historique dans laquelle la société est minée par des forces occultes étrangères à elle, par une coalition scélérate qui agit dans les ténèbres et met en œuvre un plan néfaste de conquête du monde qui n’est pas loin de triompher, et qui explique tous les maux dont on souffre et dont on ignorait jusque là la cause, qui renvoie tous
spiratoires (« conspiratorial fantasies »). La sortie du livre d’Hofstadter était contemporaine de l’assassinat de Kennedy qui allait susciter un grand nombre de théories paranoïdes particulièrement persistantes. Le Paranoid Style avait, à ses yeux, une longue histoire nationale, de l’anticatholicisme U.S. du xixe siècle à l’anticommunisme (J. McCarthy venait juste d’être écarté). Le Complot sioniste marchait bien sur Internet, de pair avec le plus récent thème du grand Complot islamiste lorsque les événements du 11 septembre 2001 ont fait apparaître une vraie conspiration scélérate ayant pour but de détruire les États-Unis et leur démocratie : c’est dire que le raisonnement paranoïde a enregistré une relance confirmatrice qui lui garantit un bel avenir.
La pensée conspiratoire. Une histoire dialectique et rhétorique ? 27
ces maux à des Autres, purifiant notre monde de toute culpabilité et de toute faute7. Cette logique n’est pas sans rapport avec celle, séculaire, du « Bouc émissaire » dévoilée par René Girard8.
I. La pensée conspiratoire et son histoire
La Conspiration, ce n’est pas un « thème » dans la culture ni une « idée », ni une « idéologie » déterminée, mais précisément ce que j’ai choisi d’appeler une logique, un dispositif cognitif et herméneutique, une manière, exclusive d’autres, de déchiffrer le monde qui a, avant tout, une histoire qu’on peut suivre dans la modernité occidentale9. Sous leur forme la plus odieuse, les explications conspiratoires fleurissent, on ne l’ignore pas, chez les négationnistes d’aujourd’hui. Arthur Butz dans The Hoax of the 20th Century et Richard Harwood dans Did Six Millions Really Die? qui « démontrent » que l’Holocauste n’a jamais eu lieu, offrent en prime une explication conspiratoire : l’Holocauste est un mensonge ourdi par les sionistes pour asseoir la toute-puissance d’Israël, atteindre leur éternel plan de domination mondiale et pervertir les esprits des Gentils10. Cette logique conspiratoire qui, jusque dans les années 1970, était plutôt l’apanage de l’extrême droite fleurit désor-mais au reste dans la « gauche » altermondialiste. Dans ce contexte, l’affaire de l’historien des idées est, ce me semble, d’éclairer ces sortes de phénomènes résurgents en en retraçant l’histoire et en en dégageant la « logique ».
Or, ladite logique conspiratoire remonte à un ouvrage précis qui, « comme par hasard » (pour parler comme cette logique pense), est daté aux origines mêmes des grands affrontements idéologiques modernes : le gros livre hautement « contre-révolutionnaire » de l’Abbé Barruel,
7. Poliakov L., La causalité diabolique, t. 1 : Essai sur l’origine des persécu-tions (1980) et La causalité diabolique, t. 2 : Du joug mongol à la victoire de Lénine (1985) [Nouvelle édition en un volume, Préface de P.-A. Taguieff, Paris, Calmann-Lévy/Mémorial de la Shoah, 2006].
8. Girard R., Le bouc émissaire, Paris, Grasset, 1982. L’auteur montre l’étendue des raisonnements sur le « Bouc émissaire » partant de la Peste noire et des massacres de Juifs vers 1349-1350, et allant jusque dans notre banal quotidien moderne.
9. Voir Angenot M., Dialogues de sourds. Traité de rhétorique antilogique, Paris, Éd. des Mille et Une Nuits, 2008.
10. Billig M., Ideology & Opinions, Studies in Rhetorical Psychology, Newbury Park – CA, Sage, 1991, p. 109.
28 Marc Angenot
Mémoires pour servir à l’histoire du jacobinisme, paru en 179811. Dans son « Discours préliminaire », l’abbé présentait ainsi le malheur des temps et son explication :
« Sous le nom désastreux de Jacobins, une secte a paru dans les premiers jours de la Révolution Françoise, enseignant que les hommes sont tous égaux et libres. […] Qu’est-ce donc que ces hommes sortis, pour ainsi dire, tout à coup des entrailles de la Terre, avec leurs dogmes et leurs foudres, avec tous leurs projets, tous leurs moyens et toute la résolution de leur férocité ? » (I, 6)
Après avoir démontré que la Révolution avait été ourdie de bout en bout par les sociétés secrètes illuministes, il concluait : « Tout le mal qu’elle a fait, elle devait le faire ; tous ses forfaits et toutes ses atrocités ne sont qu’une suite nécessaire de ses principes et de ses systèmes. » (I, xii). L’avenir était encore plus sombre : « La révolution en France même n’est qu’un premier essai des Jacobins », révèle l’abbé émigré dans ces Mémoires (I, xx). L’absurdité démoniaque des principes révolutionnai-res se reflétait dans l’atrocité des moyens mis en œuvre. Pas d’« effet pervers » chez l’Abbé Barruel, la Révolution qui s’était déroulée suivant un plan criminel préparé de longue main avait été parfaitement cohérente avec elle-même, et l’Abbé prouve ou confirme alors par ses atrocités la monstruosité de ses idées.
Quatre-vingts ans plus tard nous retrouvons tous les traits de cette manière de raisonner dans une idéologie émergente propre au monde catholique sous la Troisième République anticléricale. Celle de la « Croisade » contre les francs-maçons. La dénonciation des Loges se centre sur le mythe du Complot scélérat et tout puissant. La maçonnerie forme, révèle à ses ouailles Mgr Fava, spécialiste de la question, « une société vaste comme l’Univers dont les membres nombreux à l’infini occupent tous les rangs de la société, […] une association dont la tête se cache comme celle du serpent tandis que ses longs anneaux se déroulent au loin à tous les yeux ; […] par la conscience du mal qu’elle fait et qu’elle veut faire encore et toujours, cette association est visiblement marquée du signe de la haine12. »
11. Barruel Abbé A., Mémoires pour servir à l’histoire du jacobinisme, Ham-bourg, Fauche, 1798-1799 (5 vol.).
12. La Franc-Maçonnerie démasquée, 1884, vol. I, p. 3. Voir aussi : Fava
La pensée conspiratoire. Une histoire dialectique et rhétorique ? 29
C’est apparemment qu’il fallait aux catholiques, pour expliquer le malheur des temps et les reculs de l’Église, une explication totale et la conspiration ourdie par une secte entourée de ténèbres (ou plutôt par un chef d’orchestre invisible) est cette explication – que valide Léon XIII dans une encyclique : « Son action peut seule expliquer la marche de la Révolution et les événements contemporains13. » « Est-ce une illusion de voir l’action des Loges dans tout le détail de nos révolutions et de nos bouleversements politiques ? Non certes ! Elles règnent en maîtresses sur la France14. » Mais il n’y a pas que la France. Le Vatican convoque en 1896 le Congrès de Trente qui répond abondamment et positivement à la question-clé : « Y a-t-il une organisation internationale des francs-maçons sous un chef suprême dont le pouvoir a une influence sur toute l’action politique sur le globe15 ? » Les progrès du socialisme en Europe en sont la preuve. L’idéologie antimaçonnique forme ainsi une historiosophie, une « explication » de l’histoire en cours qui répond point par point aux historiosophies progressistes et socialistes. Les maçons sont les descendants de ce groupe de criminels qui ont préparé et perpétré la Révolution française et qui, depuis 1789, poursuivent obstinément leur tâche de perdition.
La maçonnerie agit à travers tout le siècle, elle a renversé les trônes, elle veut renverser les autels, elle veut éradiquer la foi. Elle veut l’anéantissement complet du catholicisme, elle est depuis l’ori-gine et demeure « une conspiration […] pour démolir les mœurs », « un complot ourdi d’avance, [pour] pervertir, corrompre les peuples […] par l’imagerie pornographique, par la création de mauvais lieux, par la multiplication de débits d’alcool16. » Quant aux progrès du socialisme, la conspiration maçonnique les explique tout aussi claire-ment : « l’Internationale n’est qu’une branche détachée ou non de la
Mgr A.-J., Le secret de la Franc-Maçonnerie, apologétique, Lille, Desclée de Brouwer, 1885 [1881].
13. Humanum Genus, cité par E. Cartier, Lumière et ténèbres. Lettre à un franc-maçon, Paris, Letouzey et Ané, 1888, p. 34. Voir à ce sujet l’article de J.-Ph. Schreiber dans le présent volume.
14. Les Maçons juifs et l’avenir, ou la tolérance moderne, Louvain, Fonteyn, 1884, p. 3.
15. Actes du 1er congrès antimaçonnique international, 26 au 30 septembre 1896, Rome, Tournai, Desclée, 1897-1899, 2 vol in 4°.
16. La Franc-Maçonnerie démasquée, 1889, vol. II, p. 108.
30 Marc Angenot
franc-maçonnerie qui elle-même a été organisée par la juiverie pour bouleverser les nations chrétiennes17. »
En résumé, tous les crimes lui sont attribuables – d’où l’épaisseur des livres consacrés à les recenser :
« Les crimes que les Loges ont commis depuis quelques années pour tuer en France, pour y détruire l’Église catholique et l’Armée sont si nombreux qu’il nous faudrait écrire plusieurs volumes si nous voulions en donner seulement un aperçu18. »
II. La conspiration juive
Dans ce cadre et vers cette époque, on constate que les accusations antimaçonniques sont devenues parfaitement identiques aux accusa-tions antijuives qui se développent en un secteur idéologique contigu. Tout y est : l’action délétère et ubiquitaire, les textes secrets et criminels, les ambitions de domination universelle et même les « crimes rituels » perpétrés dans les « arrière-loges » pour grands initiés. Presque tous les prédicats qui s’appliquent aux juifs s’appliquent au Grand Orient. Un anonyme, qui signe Kimon, dans sa Politique israélite montre les Juifs derrière « l’empoisonnement alcoolique de la population19. » La Franc-Maçonnerie démasquée, abondante revue catholique mensuelle, démontre, elle, avec un grand luxe de preuves, que l’alcoolisme résulte d’un « complot maçonnique » qui travaille à la démoralisation des masses20. Il ne fallait qu’un coup de pouce pour que les deux hermé-neutiques, familières aux mêmes milieux, se confondent.
Si les sociétés secrètes expliquaient le malheur des temps, qu’est-ce qui expliquait les Sociétés secrètes ? Mgr Léon Meurin avait trouvé le premier la réponse après de longues déductions numérologiques et cabalistiques :
17. Debauge J.-F., La vermine : francs-maçons, révolutionnaires, libres-pen-seurs, juifs, politiciens, Paris, s.e., 1890, p. 9.
18. Baron A. [pseud. L. Dasté], Les sociétés secrètes, leurs crimes : depuis les initiés d’Isis jusqu’aux francs-maçons modernes, Paris, H. Daragon, 1906, p. 354.
19. Kimon D. [pseud.], La politique israélite : politiciens, journalistes, banqui-ers ; le judaïsme et la France : étude psychologique, Paris, A. Savine, 1889.
20. La Franc-Maçonnerie démasquée, 1889, vol. II, p. 108-113.
La pensée conspiratoire. Une histoire dialectique et rhétorique ? 31
« Ayant accaparé les trésors et le pouvoir civil de ce monde, le Juif fait une guerre acharnée à l’Église de Jésus-Christ et à tous ceux qui refusent de fléchir le genou devant lui et son Veau d’or21. »
Bon Dieu, mais c’était bien sûr. Si les Juifs étaient les chefs cachés des Loges, la grande explication devenait de plus en plus limpide et plus satisfaisante pour certains esprits obsédés. Or, beaucoup de publicistes catholiques s’acharnaient à le démontrer dans les années 1880-1890, « les Juifs sont presque tous francs-maçons22 » – mieux : « la juiverie [est] maîtresse de la Loge23 ». Aux innocents et aux naïfs, on révèle que les Juifs sont « les chefs absolus, quoique plus ou moins occultes » de la maçonnerie24 ; « L’espèce d’église dont Satan est le chef invisible fut édifiée sur la pierre maçonnique, par la haine des Juifs contre le Christ25. » « Les Juifs francs-maçons attaquent le Christ avec une rage qui ne sait point se contenir […]26. » Le Juif est la tête, le franc-maçon (le Grand Orient comprend quelques jobards, ignorants du rôle antipa-triotique qu’on leur fait jouer) n’est que le bras ! Édouard Drumont, de la science duquel on faisait grand cas, le confirme : « la franc-maçon-nerie est une institution d’origine juive. J’ajoute qu’elle est restée juive et qu’elle est aujourd’hui plus enjuivée que jamais27. » Si Léon XIII a condamné la maçonnerie dans Humanus Genus et si l’on peut montrer que maçon et juif, juif et maçon, c’est tout un, alors l’antisémitisme est approuvé et recommandé par le Saint-Père.
Ainsi, le cœur de l’argumentation antisémite – car l’antisémitisme est d’abord une affaire d’argumentation spéciale – est la thèse de la mal-faisance omniprésente, indice d’une conspiration générale – et ce, vingt ans et plus avant que l’Okhrana tsariste ne plagie et compile les fameux
21. Meurin Mgr L., La franc-maçonnerie, synagogue de Satan, Paris, V. Retaux, 1893, p. 11.
22. Le Tirailleur, 12 janvier 1889, p. 3.23. Article de Ch. Pontigny, dans L’Alliance anti-juive pour la défense sociale
et religieuse, vol. I, 1889, p. 5.24. Lamarque Abbé de, Préface à Le Juif talmudiste, Bruxelles, Vromant, s.d.25. Gandoux P., La république de la franc-maçonnerie, ou la franc-saloperie
devant la Raie-publique [sic], Bordeaux, 1885, p. 57.26. La Franc-Maçonnerie démasquée, 1885, vol. I, p. 24.27. Drumont E., Nos maîtres. La tyrannie maçonnique, Paris, Librairie anti-
sémite, 1899, p. 13.
32 Marc Angenot
Protocoles des Sages de Sion28. L’antisémitisme, montrent tous ses ana-lystes de Léon Poliakov à Zeev Sternhell et à Pierre-André Taguieff, n’est pas seulement une idéologie (pas seulement des contenus, une vision de la société, une doctrine de haine, des mots d’ordre), c’est une manière spéciale de diriger sa pensée et de (se) persuader. Anxiogène, « paranoïde », conspiratoire donc, cette manière de penser n’a pas été le propre des seuls antisémites ; elle est semblable dans son schéma général à d’autres idéologies « obsidionales » comme la peur et haine des Jésuites qui était plutôt « de gauche » sous la Monarchie de Juillet, ou comme la Croisade anti-maçonnique dont je viens de faire état.
III. En quoi la pensée conspiratoire est « rationnelle »
Tout au départ, le raisonnement conspiratoire part de quelque chose de logique au sens banal de ce mot : une série d’événements déplai-sants étant identifiés, cherchons-en les causes ou, ce serait mieux, plus simple et plus clair, la Cause. Et pour ce faire, écartons les « rideaux de fumée ». Le Complot découvert permet de « faire entrer dans le rationnel29 » et l’explicable ce qui, justement, apparaît d’abord comme désolant et inexplicable : il est à ce titre, cela ne se saurait nier, le produit d’un effort de rationalité, il a une « fonction cognitive30 » fût-elle dévoyée. Son caractère redoutable résulte du fait que cet effort rationnel débouche sur une haine légitimée. Débouchant sur la haine, il carbure au ressentiment : le manque d’estime de soi, le sentiment d’être lésé, rabaissé, opprimé, propres à l’homme du ressentiment, sont compensés par le plaisir intellectuel de découvrir le mécanisme du dol et sa cause secrète, et le plaisir moral de savoir sur qui désormais faire porter sa haine – qui voit ses peines, voit ses haines ! Découvrir la « vérité » au bout d’une longue « enquête » revient, les yeux dessillés, à voir toutes choses sous un jour nouveau et simplifié : là où je souffrais de consta-ter des maux divers, où je me sentais opprimé sans savoir pourquoi et
28. Taguieff P.-A., Les Protocoles des Sages de Sion, Paris, Berg International, 1992, 2 vol. [Rééd. rev. et corr. en 1 vol., Les Protocoles des Sages de Sion. Faux et usages d’un faux, Paris, Berg International – Fayard, 2004].
29. Taguieff P.-A., La Foire aux « Illuminés ». Ésotérisme, théorie du complot, extrémisme, Paris, Éd. des Mille et Une Nuits, 2005, p. 29.
30. Ibid., p. 80.
La pensée conspiratoire. Une histoire dialectique et rhétorique ? 33
par qui, je découvre qu’il y avait une cause ultime à mon malheur et aux malheurs du temps : « Tout a été prévu, médité, combiné, résolu, statué », avait écrit l’Abbé Barruel.
Les banales apparences, les petites explications partielles n’étaient que rideau de fumée, le plan de conquête du monde par le Suppôt du mal est la vérité longtemps cachée du cours désastreux des choses. Un sentiment de haute clairvoyance anime les adhérents d’idéologies conspiratoires, exaspérés par les résistances des incrédules qui s’obs-tinent à douter d’une thèse sidérante et limpide, corroborée par une immense accumulation de faits et de preuves. Les spécialistes de ces sortes de questions se livrent à des recherches ardues, ils déterrent des documents révélateurs, des témoignages obscurs et leurs efforts sont récompensés par de grandes certitudes, par le sentiment de progresser, d’aboutir à une révélation : « Ces chefs, cet aréopage mystérieusement rassemblé autour d’un chef unique, grand patriarche de la Maçonnerie universelle, où sont-ils, où se rassemblent-ils et quels sont-ils ? Que ce sanhédrin, que ce sénat existent, nul n’en doute […]31. » Les « appa-rences » cachaient une « vérité » à la fois sidérante, mystérieuse et embrouillée : un plan de conquête du monde (car c’est à ce but ultime prêté à l’Ennemi que l’on aboutit toujours) est la vérité cachée du cours désastreux qu’a pris la société.
Les théories conspiratoires de l’histoire sont des abductions (au sens de Peirce) qui ne prétendent pas à la vraisemblance a priori, mais à l’efficience englobante. En montrant que toute une série d’événe-ments sans lien apparent, mais tous plus ou moins fâcheux, ont une cause unique cachée, on ne choisit pas nécessairement l’explication la plus vraisemblable. Les antisémites, les anti-maçons de jadis ont tous souligné qu’au début de leur « réflexion », la Conspiration secrète et scélérate dont on leur parlait, leur paraissait inimaginable, invraisem-blable, mais c’est l’efficience factuelle qui a fini par les convaincre : les faits se sont accumulés qui, tous, cohéraient avec la théorie conspira-toire. Peu vraisemblable au départ, la Théorie était au moins totalement explicative au bout du compte, et elle donnait un mandat au convaincu. De l’abduction, il suffisait de déduire une Solution finale pour retrouver le bonheur. Il y a certes quelque chose d’affectif qui accompagne cette « logique » : tout ce qui déplaît au raisonneur, et ce sont des choses très
31. La Franc-Maçonnerie démasquée, 1884, vol. I, p. 302.
34 Marc Angenot
diverses, les progrès du socialisme, les magouilles et les crises finan-cières, les faillites, l’émancipation des femmes, la presse boulevardière, la littérature moderniste, tout ceci a une cause unique – les Juifs par exemple. Cette cohérence constamment renforcée confirme la justesse de mon flair axiologique, si je puis dire. À côté de la vraisemblance de l’abduction, critère courant de validité probable, et la compensant si elle est déficiente, il y a la force illuminante de la synthèse obtenue.
IV. En quoi elle est vue par d’autres comme « illogique »
La pensée conspiratoire est étrangère au principe de non-contra-diction : la société scélérate qui s’apprête à gouverner le monde et complote la destruction des Justes a plus d’un fer au feu. La Secte judéo-maçonnique contrôle à la fois les grandes banques et les partis du désordre, les « deux Internationales » des riches et des pauvres. « Au fond les deux Internationales se confondent, elles obéissent aux mêmes chefs occultes, elles exécutent les mêmes consignes mysté-rieuses », révèle le capitaine de Boisandré, l’un des professionnels de la question à la Belle Époque32. Ceci s’expliquait aisément puisque Karl Marx déjà recevait ses ordres de la « Juiverie bancaire cosmo-polite ». On relèvera sans surprise chez les antisémites que ce que les uns attribuent à la direction diabolique de la Haute banque, les autres l’imputent au socialisme « juif », et ce, avec le même degré de vraisemblance. « Le nihilisme veut par tous les moyens démolir le monde aryen pour s’y substituer et introniser à sa place la domina-tion Juive33. » Mais il ne suffit pas de désigner les Juifs, ce serait trop apparent encore, il faut découvrir derrière leur action maléfique, une organisation cachée : l’Alliance israélite universelle fondée en 1860 et « unissant secrètement les Juifs dispersés » fera l’affaire34. Et derrière elle encore, on peut et doit soupçonner « l’existence d’un gouverne-ment secret juif » qui « rêve d’assujettir le monde35. »
32. Boisandré A. de, Socialistes et Juifs : la nouvelle Internationale, Paris, Librairie antisémite, 1903, p. 24.
33. Auteroche J. d’, France antisémite, 14 juin 1890, p. 1.34. Tilloy J. A., Le Péril judéo-maçonnique : le mal, le remède, Paris, Librairie
antisémite, 1897, p. 44.35. Copin-Albancelli P., Le drame maçonnique – La conjuration juive contre
La pensée conspiratoire. Une histoire dialectique et rhétorique ? 35
Les raisonnements conspiratoires, « bizarres » du point de vue de la non-contradiction, sont aussi surprenants dans leurs modes de preuves : on note que la déviance des règles de déchiffrement du monde se complète d’une déviance complémentaire quant aux règles du débat. Exposant une thèse radicale, censée insoupçonnée et englobante, les tenants de la pensée conspiratoire se contentent de peu en fait de preuves, ils accumulent les indices ténus, les faits controuvés, ils les mettent bout à bout et triomphent bruyamment. Ils peuvent dire qu’ils ont de bonnes raisons pour ce faire : s’il y a conspiration, secrète, les preuves directes n’abonderont pas et les scélérats feront tout pour les supprimer. Si vous restez sceptique, ceci suggère fortement que vous êtes plus ou moins consciemment partie prenante de la Conspiration, et votre réticence est ainsi la preuve mise sur la somme. Il est loisible de répliquer aux hommes de peu de foi que, si une conspiration immense est tenue rigoureusement secrète, elle ne pourra être démontrée direc-tement, qu’il est donc raisonnable de se contenter d’une cumulation d’indices, de preuves circonstancielles, ténues prises une à une, hété-rogènes, mais qui valent par leur masse. Toute pensée conspiratoire produit alors de gros livres accumulant les preuves de ce tonneau. La France juive d’Édouard Drumont est ainsi, on oublie ce fait, très peu son œuvre, elle est composée à 80 % de coupures de journaux des années 1880, bien sélectionnées, alignées et regroupées… mais la dernière ligne du second volume de cette compilation obsessionnelle est un cri de délivrance et en latin s’il vous plaît : « Liberavi animam meam. »
Faible en « bonne logique », ce style de pensée a des avantages psychiques évidents : dans la mesure où même les objections ren-forcent la thèse, il permet d’aboutir à une conviction inexpugnable. C’est ce que constate un récent chercheur d’une vaine bonne volonté parlant des tentatives de discussion avec les négationnistes : « If the group takes the position that concentration camp deaths were all made up by Jews in a conspiracy including Joe Stalin, Winston Churchill, Franklin Roosevelt, Dwight Eisenhower […], then it may indeed be impossible to prove any murders to them.
le monde chrétien, Paris, La Renaissance française, 1909, p. 366 et 444.
36 Marc Angenot
They may claim that the news films were faked, the Nazis’own tons of records were faked and all the witnesses have been lying36. »
V. Comment elle fait coupure
C’est à la prédominance de certains schémas et de certains enchaînements que l’on peut distinguer des programmes et des ten-dances, regrouper des « familles d’esprits » et repérer des pentes argumentatives, des manières de soutenir une thèse qui, du dehors, pourront sembler impropres, abusives ou perverses. En dehors de ces « familles », ce qui était convaincant apparaît absurde : on parlera ici de coupure cognitive. Quelques mots sur cette notion. Dans mon récent Dialogues de sourds : traité de rhétorique antilogique, j’élabore une rhétorique des malentendus autour de l’hypothèse de telles coupures cognitives et argumentatives repérables dans les discours qui circulent dans la sphère publique37. Si l’incompréhension argumentative tenait banalement au malentendu – mal entendu – il suffirait de se déboucher les oreilles, d’être patient et bienveillant, de faire mieux attention. Mais dans certains cas, ces cas que J.-F. Lyotard classe comme les « différends », les humains ne comprennent pas leurs raisonnements réciproques parce que, parlant la même langue, ils n’usent pas du même code rhétorique. Cette notion de « code » suppose que, pour persuader, pour se faire comprendre argumentativement et pour comprendre son interlocuteur, il faut disposer, parmi les compétences mobilisées, de règles communes de l’argumentable, du connaissable, du débattable, du persuasible. Et qu’un problème naît si ces règles ne sont pas régulées par une universelle, transcendantale et anhistorique Raison, si ces règles ne sont pas les mêmes partout et pour tout le monde.
Ainsi, entre ceux qui séparent inflexiblement ce qui est et ce qui doit être, les jugements à l’indicatif et à l’impératif, et ceux qui font de la science de ce qui est, la prémisse d’un but qui est de prescrire ce qui doit être, passe une coupure que l’histoire moderne montre irréconciliable. Ceux qui pensent que l’avenir est fondamentalement inconnaissable et ceux qui pensent que raisonner, c’est avant tout pouvoir prédire ce qui
36. Regal Ph. J., The Anatomy of Judgment, Minneapolis, University of Mines-sota Press, 1990, p. 98.
37. Angenot, M., Dialogues de sourds…, op. cit.
La pensée conspiratoire. Une histoire dialectique et rhétorique ? 37
va advenir se superposent aux précédents. Ce qui importe du point de vue sociologique, socio-culturel, serait de chercher à établir précisé-ment en une conjoncture donnée en quel point de la topographie sociale certains raisonnements cessent de persuader. Les procès de Moscou et les crimes atroces de la « bande boukharino-trotskyste » agissant contre la Révolution depuis les premiers jours d’Octobre, ont tracé une ligne nette, dans le monde de gauche d’avant-guerre, entre ceux qui ont cru à ce « mythe » et ceux qui n’y ont pas coupé. Je n’ai toutefois pas le loisir ni l’espace pour traiter de ceci qui me semble un problème essentiel de l’histoire des idées. Je vais me borner à esquisser l’historique de la diffusion droite/gauche de raisonnements conspiratoires.
VI. Et de droite et de gauche
La vision conspiratoire du social a caractérisé d’abord des idéolo-gies de droite, elle forme un critère, le critère par excellence de leur classement. À droite, cette vision est précisément « logique » au sens psycho-social de ce mot : ceux qui pensent que les traditions sont sacro-saintes et qui les voient s’éroder sous les coups inexorables de la modernisation peuvent être amenés à supposer que cette érosion est voulue et orchestrée par des Méchants. Pour ces « pensées », la société marchait parfaitement bien jusqu’au jour où elle a subi l’action délétère d’ennemis congénitaux de la nation, de l’ordre et de la vérité. L’idée d’un mal structurel leur est étrangère comme leur échappe l’idée de méchants-par-position et non par nature.
Toutefois, on voit confusément apparaître cette herméneutique conspiratoire chez les socialismes romantiques. Ainsi chez l’oublié fondateur du « messianisme », J.-M. Hoéné-Wronski qui développe, en lieu et place d’une sociomachie du progrès, une sorte de gothic novel de la plus grande noirceur. Sa vision de la conjoncture prétendait « révéler aux hommes l’existence effective et non interrompue de sectes ou plutôt de bandes mystiques ayant, avec connaissance de cause, le but infernal d’empêcher l’humanité actuelle d’atteindre ses destinées afin de la jeter dans l’abîme où ces bandes mystérieuses puisent leur satanique inspi-ration. [...] C’est un fait, ajoutait Wronski, aussi réel qu’il est terrible et qui n’a échappé aux hommes que par son inconcevable anomalie [que]
38 Marc Angenot
l’existence effective au milieu de l’humanité de ces êtres infernaux, ligués contre la nouvelle espèce humaine38. »
On rencontre, inévitablement et abondamment, des raisonnements de type « conspiratoire » dans le discours socialiste sous la Deuxième Internationale : il ne suffit pas de dire que toutes les plaies sociales sont « inhérentes » au capitalisme et « disparaîtront » avec lui, il faut encore les dire « voulues » par la bourgeoisie, selon le lieu judiciaire Is fecit cui prodest. La société bourgeoise a intérêt à augmenter les misères ouvrières pour briser le ressort de la classe qu’elle domine ; tout en feignant une démocratique bienveillance, elle favorise en sous-main tout ce qui peut augmenter celles-ci. Un tel paradigme argumentatif s’applique, par exemple vers 1900, à l’alcoolisme, ce qui permet d’en rejeter la faute sur les dominants et d’en exonérer le peuple : « l’alcoolisme est, en effet, en même temps qu’un effet de l’organisation sociale actuelle, un soutien précieux pour la société qui l’engendre39. » Les falsifications alimen-taires, l’insalubrité des villes, la prostitution, la criminalité croissante sont immuablement expliquées comme causées par les bourgeois, organisées par eux dans le but vainement criminel de perpétuer leur règne.
VII. Bien d’autres points à aborder
Je me borne à rapidement signaler les liens de la logique conspi-ratoire avec plusieurs « mécanismes mentaux » connexes. Avec ce qu’on dénomme diabolisation par exemple, autre logique récurrente et métamorphique revenant à travers la modernité sous des oripeaux idéo-logique successifs. La « diabolisation » de l’adversaire et de ses idées, la création d’un adversaire diabolique faisant le mal pour le mal et qu’il importe d’anéantir, sont des phénomènes de longue durée qui sont en progrès de nos jours comme en témoigne l’étude récente d’O’Rourke, Demons by Definition: Social Idealism, Religious Nationalism and the Demonizing of Dissent40. Ce n’est en effet pas par hasard que les mots de diabolisation/démonisation sont passés dans le vocabulaire des médias récemment – et dans la bouche de tout le monde.
38. Wronski-Hoëné J. M., Messianisme, ou Réforme absolue du savoir humain, Paris, Firmin Didot, 1847, p. vii (3 vol.).
39. L’Action syndicale [Lens], 6 déc. 1908, p. 1.40. O’Rourke D. K., Demons by Definition: Social Idealism, Religious Nation-
alism, and the Demonizing of Dissent, New York, Peter Lang Publishing, 1998.
La pensée conspiratoire. Une histoire dialectique et rhétorique ? 39
Connexité encore de la pensée conspiratoire et du raisonnement de ressentiment. L’intrication est même si fréquente entre cette pensée et les raisonnements de ressentiment qu’elle impose à mon sens de les fusionner : on peut, avec d’abondants exempla historiques, montrer que tout ceci forme un de ces ensembles indissociables, bien attestés dans la modernité que je désigne comme une « logique ». Les idéologies du ressentiment, pour rapprocher donc le raisonnement diabolique de cette catégorie « généalogique » de Nietzsche et de Max Scheler41 sur laquelle j’ai publié naguère un essai42 sont, de fait, les grandes fabula-trices de raisonnements conspiratoires. Je qualifie de ressentiment un mode de production du sens, des valeurs, d’images identitaires, d’idées morales, politiques et civiques qui vise à un renversement des valeurs dominantes – Umwertung der Werte – et à l’absolutisation de valeurs « autres », inverses de celles qui prédominent, valeurs censées propres à un groupe dépossédé et revendicateur. La rhétorique du ressentiment sert deux fins concomitantes : démontrer la situation présente comme injustice totale, persuader de l’Inversion des valeurs qui se trouve à son principe et expliquer la condition inférieure des siens en renvoyant ad alteram partem tous les échecs essuyés. Les puissants adversaires que se donnent les idéologies du ressentiment passent leur temps à ourdir des trames, ils n’ont de cesse de tendre des rêts – et comme ces menées malveillantes ne sont guère confirmées par l’observation, il faut supposer une immense conspiration secrète – et se convaincre de son existence aussitôt l’hypothèse envisagée. La vision conspiratoire du monde va ainsi de pair avec elles : du fait que certains sont vus en position avantagée et sont objets d’envie impuissante, on leur prête un malfaisant projet de domination (il ferait beau voir que leur succès soit à quelque égard innocent), un but ultime d’hyperdomination, de dépouillement total de leurs victimes.
41. Nietzsche F., La Généalogie de la morale, Paris, Éd. du Mercure de France, 1964. Scheler M., L’Homme du ressentiment, Paris, Gallimard, coll. « Idées », 1970 [1912-1915]. Voir aussi Scheler M., Problèmes de sociologie de la connaissance, trad. S. Mesure, Paris, PUF, coll. « Sociologie », 1993 [1924].
42. Angenot M., Les Idéologies du ressentiment, Montréal, XYZ Éditeur, 1995 [Rééd. en format de poche, 1997].
40 Marc Angenot
On peut rapprocher encore la pensée conspiratoire-ressentimentiste et la pratique de l’amalgame. La principale simplification de la pensée du ressentiment est la « règle de l’ennemi unique43 » avec son grand moyen argumentatif, l’amalgame. Il faut que l’ennemi n’ait « qu’une seule tête » pour qu’on puisse espérer l’abattre d’un coup. Il faut que la diversité de ses opinions, de ses intérêts et de ses modes d’être ne soient qu’un « rideau de fumée » qui cache encore un coup une vaste entente scélérate.
Les sociomachies – qu’elles soient socialistes ou anticléricales, ultra-catholiques, antisémites – aboutissent toutes à représenter la société comme l’affrontement de deux camps en un manichéisme de combat. Pour les catholiques du xixe siècle, il y a d’une part « l’Armée de Dieu », « la Patrie chrétienne », de l’autre ceux qui veulent abattre la Croix, qui font la guerre à Dieu, le parti de « l’incrédulité, l’athéisme, et la juiverie révolutionnaire44. » Cette lutte dépasse les frontières du pays. « À l’heure qu’il est, la haine de Dieu s’organise en conspiration internationale45. » Ces deux camps, les « ennemis de la religion et ses amis », sont évidemment irréconciliables. La victoire reviendra totale-ment au camp du bien et La Croix s’occupe à promettre l’imminence de l’Armageddon :
« Les voleurs, les laïcisateurs, les persécuteurs, les francs-maçons, les Juifs et les Prussiens courbent maintenant la tête devant les honnêtes gens, les catholiques et les Français. »
Conclusion
« L’imaginaire complotiste46 » a encore de beaux jours devant lui. La « paranoïa » du persécuteur-persécuté et le manichéisme des mil-lénaristes ont toujours fait bon ménage : les idéologies radicales d’hier et d’aujourd’hui montrent un net penchant à intégrer à leurs moyens de persuasion la « causalité diabolique », penchant réprimé toutefois par la
43. Définie dans mon essai : La Parole pamphlétaire. Contribution à la typologie des discours modernes, Paris, Payot, 1982 [Rééd. en 2005].
44. La Croix, 3 juillet 1889, p. 1.45. Vaudon P. J., L’Évangile du Sacré-Cœur, les mystères d’amour du cœur de
Jésus, Paris, Retaux-Bray, 1889, p. 335.46. La formule est de P.-A. Taguieff.
La pensée conspiratoire. Une histoire dialectique et rhétorique ? 41
conscience (qui n’est pas intégralement effacée) de son affinité avec les visions fascistes et antisémites. La logique conspiratoire qui prospère dans l’altermondialisme et le gauchisme anti-sioniste n’est pas chose bien neuve : la résurgence permanente de thèmes antisémites dans le mouve-ment révolutionnaire entre la Commune et la Grande Guerre montre que cela a été de tout temps une tentation et une « pente » possibles.
L’avantage de l’approche historico-rhétorique est de dégager des schémas de raisonnement qui caractérisent une pensée historiquement situable – et non d’étiqueter les choses « croyance », « déraison », « paranoïa47 », de créer ainsi des boîtes noires sans valeur explicative. Non plus d’imputer à un moment déterminé ou à un secteur doxique et sociétal, une manière de penser qui prend son sens sur la longue durée et à travers la dynamique de ses avatars.
Il importerait aussi de faire apparaître dans leur ampleur et leur dif-fusion atténuée et diluée toutes les formes, y compris bénignes, de la pensée conspiratoire qu’on ne saurait utilement étiqueter en bloc d’un mot venu de la pathologie ou rapporter aux seules idéologies « extré-mistes » : tant de gens arrivent à des convictions irrévocables à partir de données vagues, douteuse et lacunaires, tant sautent aux conclusions devant un raisonnement probabiliste ardu et incertain, tant de gens ont aussi tendance à chercher et trouver des coupables extérieurs quand les choses ne vont pas bien, qu’il faut demander d’où vient le besoin de cette auto-intoxication et ce qui l’alimente. Entre le négateur de la Shoah et les bonnes gens qui entretiennent une suspicion à l’égard de toutes les « vérités officielles », il y a une marge. Ce qui doit toutefois retenir l’attention dans la « logique » que j’ai décrite c’est sa variété d’intensité et de condensation et son universalité comme tendance.
47. Un « paranoïaque », tel était E. Drumont, juge M. Winock dans une note en bas de page tout au début de son Édouard Drumont & Cie, Paris, Éd. du Seuil, 1982. « Paranoïaque ? Peu importe, il est lu, célébré, on le prend au sérieux. » Je me réfère ici à R. Boudon (L’idéologie, ou L’origine des idées reçues, Paris, Fayard, 1986).
42 Marc Angenot
Historiciser l’imaginaire du complot. Note sur un problème d’interprétation1
Paul Zawadzki
À première vue, l’imaginaire du complot n’est d’aucun temps ni d’aucun pays. Il arrive que l’imaginaire coïncide avec le réel2, mais dans les cas fantasmatiques où il tourne à vide, on l’associe naturellement à la superstition, à l’irrationalité ainsi qu’aux différentes formes de pensée mythique. « Et dire qu’il se trouve encore des naïfs pour prêter foi à ces croyances magiques », pensons nous volontiers. Ce faisant, on se heurte immanquablement au dur constat historique : depuis la fin du xviiie siècle jusqu’au milieu du xxe, ces représentations hallucinées ne dépérissent pas3 ; bien au contraire, elles se démultiplient. L’idée du complot accompagne l’idéologie et la pratique révolutionnaires4. Elle se déploie à mesure de la politisation des masses et de l’approfondis-sement de la conscience moderne de faire l’histoire5. Elle se loge au
1. Ce texte est issu de deux journées d’études : « Théories du complot : autour de Pierre-André Taguieff », organisée à l’Université Libre de Bruxelles par E. Danblon (GRAL) et J.-Ph. Schreiber (CIERL), le 19 mai 2009, et « François Furet, le travail de l’œuvre », 4e journée annuelle des doctorants en Études politiques de l’EHESS organi-sée par J.-V. Holeindre, le 8 juin 2007.
2. Est-il nécessaire de préciser que l’expérience historique est généreuse en com-plots réels et de rappeler que les sociétés secrètes se multiplient réellement au xixe siècle ?
3. Rogalla von Bieberstein J., Die Theise von der Verschwörung, 1776-1945. Philosophen, Freimaurer, Juden, Liberale und Sozialisten als Verschwörer gegen die Sozialordnung, Frankfurt am Main, Peter Lang, 1978 [1976].
4. Selon Fr. Furet : « c’est véritablement une notion centrale et polymorphe, par rapport à laquelle s’organise et se pense l’action : c’est elle qui dynamise l’ensemble de convictions et de croyances caractéristique des hommes de cette époque, et c’est elle qui permet à tout coup l’interprétation - justification de ce qui s’est passé », Penser la Révolution française, Paris, Gallimard, éd. revue et corrigée, coll. « Bibliothèque des histoires », 1983 [1978], p. 78.
5. Voir Gauchet M., « Le démon du soupçon », entretien donné à L’Histoire, n° 84, 1985, version modifiée dans Les Collections de l’Histoire, n° 33, 2006.
cœur de l’imaginaire et des pratiques totalitaires du xxe siècle. Loin de disparaître de l’horizon des sociétés rationalisées et intellectualisées, ces croyances délirantes produisent leurs effets les plus meurtriers au xxe siècle. Bref, l’imaginaire du complot entretient une relation para-doxale, ambiguë mais significative avec la modernité.
Dès lors, comment penser ensemble deux perspectives contraires qui semblent également pertinentes ? D’un côté, d’excellents auteurs considèrent que le complot – idée, idéologie, imaginaire – relève pour l’essentiel de la sécularisation d’anciens mythes et superstitions ; de l’autre qu’il puise aux ressources des représentations modernes du pouvoir, constituant une figure consubstantielle à l’univers démocra-tique.
À l’appui de la première interprétation, Karl Popper souligne que la théorie du complot fournit l’exemple « d’un type assez primitif de superstition ». Qu’elle est « plus ancienne que l’historicisme », et que, « dans sa version moderne, elle est un produit caractéristique du pro-cessus de laïcisation des superstitions religieuses ». Certes, « on ne croit plus aux machinations des divinités homériques, auxquelles on imputait les péripéties de la Guerre de Troie. Mais ce sont les Sages de Sion, les monopoles, les capitalistes ou les impérialistes qui ont pris la place des dieux de l’Olympe homérique6. » Dans le même sens, Norman Cohn rappelle que les mythes ne disparaissent pas nécessairement avec les circonstances qui les ont produits mais qu’ils possèdent leur autono-mie et leur vitalité propres7. Prolongeant certaines analyses de Joshua
6. Popper K. R., « Prédiction et prophétie dans les sciences sociales » [1948], dans K. R. Popper, Conjectures et réfutations. La croissance du savoir scientifique, trad. M.-I. et M. B. de Launay, Paris, Payot, 1985 [1963], p. 498. Le problème qui nous retient dans cet article porte moins sur les « théories » du complot stricto sensu (en admettant que le terme soit stabilisé, ce qui est loin d’être acquis) que sur ses mytho-logies (idée, imaginaire, idéologie, etc.). Nous avons par exemple laissé de côté les problèmes épistémologiques que posent les « théories » du complot. Sur ce point, voir : Pigden Ch., « Popper Revisited, or What Is Wrong With Conspiracy Theories? », Philosophy of the Social Sciences, vol. 25, n° 1, 1995, p. 3-34 ; Coady D. (ed.), Conspi-racy Theories: The Philosophical Debate, Aldershot, Ashgate, 2006 ; signalons enfin une synthèse moins accessible de Zdybel L., Idea spisku i teorie spiskowe w swietle analiz krytycznych i badan historycznych [Idées et théories du complot à la lumière des analyses critiques et des recherches historiques], Lublin, Uniwersytet MCS, 2002.
7. Cohn N., « The Myth of the Demonic Conspiracy of Jews in Medieval and
44 Paul Zawadzki
Trachtenberg8, il rattache les Protocoles des Sages de Sion à la tradition de l’antisémitisme démonologique (« l’idée que le judaïsme est une organisation conspirative, placée au service du mal »). Le mythe de la conspiration juive mondiale constituerait une « version modernisée et laïcisée des représentations populaires médiévales, d’après lesquelles les Juifs étaient une ligue de Sorciers au service de Satan, et poursuivant de concert avec lui la ruine spirituelle et corporelle de la Chrétienté57. »
La seconde perspective place le problème du complot moderne dans une matrice interprétative tout autre ; l’accent porte cette fois sur l’inédit anthropologique de la modernité politique ce qui n’interdit pas d’observer des recyclages de matériaux anciens. On songe ici aux pages que François Furet a consacré à ces questions dans Penser la révolution française9. Bien que le complot ne présente qu’une entrée restreinte pour la réflexion politique, il est un « délire sur le pouvoir10 » et, à ce titre, il nous renseigne sur le nouveau type de pratique et de conscience historiques ouvert par la Révolution. Le complot moderne suppose une série de transformations majeures dans la pensée du pouvoir et de l’action. Il procède notamment de la généralisation de l’idée selon laquelle le monde est tissé de volontés humaines. Ce « monde peuplé de volontés11 », c’est précisément ce qui caractérise « l’idéologie révo-lutionnaire qui fonde la politique moderne12. »
Modern Europe », dans A. de Reuck & J. Knight (eds.), Caste and Race: Compara-tive Approaches, London, J. & A. Churchill LTD, 1967, p. 242.
8. Trachtenberg J., The Devil and the Jews – The medieval Conception of the Jew and Its Relation to Modern Anti-Semitism, Philadelphia and Jerusalem, The Jewish Publication Society 1993 [1943].
9. Certaines de ses analyses du complot ont été discutées et élaborées dans le cadre du séminaire de P. Nora à l’EHESS. Comme le signale ce dernier, l’apport de M. Gauchet à ces analyses a été décisif : Nora P., « 1898. Le thème du complot et la défi-nition de l’identité juive », dans M. Olender (dir.), Pour Léon Poliakov. Le racisme mythes et sciences, Bruxelles, Complexe, 1981, p. 164.
10. Furet Fr., Penser la Révolution française, op. cit., p. 79 ; Birnbaum P., Le peuple et les gros. Histoire d’un mythe, Paris, Grasset, 1979 (éd. rev. et augmentée, Hachette/Pluriel, 1995).
11. Ibid., p. 44.12. Ibid., p. 77. Les pages qu’il consacre au terme même d’idéologie sont connues :
« idéologie désigne deux choses constitutives du tuf même de la conscience révolution-naire. D’abord que tous les problèmes individuels, toutes les questions morales ou intellectuelles sont devenues politiques, et qu’il n’y a pas de malheur humain qui ne soit justiciable d’une solution politique. Ensuite que, dans la mesure où tout est connais-
Historiciser l’imaginaire du complot 45
Le point de jonction et de divergence entre la thèse continuiste et celle de l’inédit anthropologique se cristallise autour du problème crucial des mythes politiques au sein de la modernité.
Selon les cas, la première les appréhende comme une persistance, voire un atavisme (version optimiste), comme de l’ancien reformulé ou réadapté, ou encore comme un invariant de l’esprit humain/social (version pessimiste). Pour rendre compte de l’histoire spécifique du fanatisme moderne, elle invoque la médiation de schémas explicatifs d’une grande généralité : mécanisme de la crise et du bouc émissaire ; idée assez vague que la perte des repères, des certitudes et le régime de changements accélérés suscitent des inquiétudes, des peurs, voire des angoisses qui a leur tour génèrent des croyances irrationnelles, des mythes13, etc. La seconde bute constamment sur ce que les Modernes n’ont généralement pas su prévoir, à savoir « l’apparition d’un nouveau pouvoir : celui de la pensée mythique14 » au beau milieu du xxe siècle. Au fond, la difficulté tient à l’énigme troublante du xxe siècle : l’ex-pansion proliférante de croyances hors religion et d’idéologies vers lesquelles semblent avoir été transférées des énergies et des schèmes de pensée métaphysiques15 dans les sociétés que l’on avait pourtant carac-térisées par la notion wébérienne de « désenchantement du monde ».
sable et tout est transformable, l’action est transparente au savoir et à la morale. » (p. 43)
13. On peut se demander si l’idée suivant laquelle le mythe ne serait que supersti-tion ou préjugé, produit de la peur et du malaise n’est pas, à son tour, une superstition ou un préjugé rationalistes.
14. Cassirer E., Le mythe de l’État, trad. B. Vergely, Paris Gallimard, 1993 [1946], p. 17.
15. Fr. Furet observe cette « logique formidable qui reconstitue sous une forme laïcisée, l’investissement psychologique des croyances religieuses », Penser la Révolu-tion française, op. cit., p. 43. Il prolonge la perspective dans Le passé d’une illusion. Essai sur l’idée communiste au xxe siècle, Paris, Robert Laffont/Calmann-Lévy, 1995 : « La révolution est une rupture dans l’ordre ordinaire des jours en même temps qu’une promesse de bonheur collectif dans et par l’histoire. […] Elle affirme en même temps que l’histoire est désormais le seul forum où se joue le sort de l’humanité, puisqu’elle est le lieu de ces surgissements ou de ces réveils collectifs qui manifestent sa liberté. Ce qui est une négation supplémentaire de la divinité, si longtemps maîtresse unique du théâtre humain, mais aussi une manière de réinvestir les ambitions de la religion dans la politique, puisque la révolution elle aussi est une quête du salut. » (p. 46).
46 Paul Zawadzki
I. Mythes et histoire
Passé qui s’énonce dans un éternel présent, le mythe brouille les pistes. Il se donne dans une temporalité suspendue, celle de l’immo-bilité d’une présence inaccessible à la raison historique16. À l’instar de leurs équivalents traditionnels, les mythes politiques sont « brico-leurs ». Ils recomposent sans cesse des cohérences nouvelles à partir de résidus et de débris17, bref, ils produisent du neuf avec de l’ancien tout en réincorporant l’inédit des événements singuliers dans la grille de leur récit. Ce rapport entre diachronie et synchronie est délicat à saisir pour une perspective qui s’attache à l’inédit anthropologique des sociétés modernes
En un sens, c’est un problème auquel se sont déjà heurtés les contem-porains des convulsions du xxe siècle qui furent souvent déroutés devant des phénomènes qui semblaient relever d’une forme de religiosité sans pour autant tenir de la religion stricto sensu. En héritiers rigides de l’anti-fanatisme du xviiie siècle, certains n’y voyaient que retour de la barbarie, persistance de l’archaïque ou régression historique. Mais comme le montre le vocabulaire tâtonnant de l’entre-deux-guerres, l’abondance des comparaisons religieuses (religions politiques, religions séculières, mysticisme politique18, etc.) atteste plutôt d’une vraie difficulté de nommer et de qualifier ces phénomènes hybrides auxquels les conflits de transition à la modernité démocratique ont donné naissance19.
16. Kolakowski L., « Symbole religijne i kultura humanistyczna » [Symboles religieux et culture humaniste] [1964], repris dans Kultura i fetysze [La culture et les fétiches], Warszawa, P.W.N., 2000 [1967], p 223.
17. Lévi-Strauss C., La pensée sauvage, Paris, Plon, 1962, p. 32-33.18. Burrin Ph., « Religion civile, religion politique, religion séculière », dans B.
Unfried & Ch. Schindler (dir.), Riten, Mythen und Symbole – Die Arbeiterbewe-gung zwischen « Zivilreligion » und Volkskultur, Vienne, Akademische Verlagsanstalt, 1999, p. 17-28 ; Gentile E., Les Religions de la politique. Entre démocraties et tota-litarismes, trad. A. Colao, Paris, Éd. du Seuil, coll. « La Couleur des idées », 2005.
19. Reste le penchant inévitable de la mémoire historique à réduire l’inédit pour ne chercher dans le passé que les ressemblances avec le présent. Dans les moments les plus tragiques, certains des accusés des procès staliniens se remémoraient l’épisode historique de la chasse aux sorcières. Ainsi dans une mise en abyme troublante, A. Weissberg, l’un des principaux témoins des purges soviétiques des années trente, raconte qu’en 1937, au moment où « libérés de toutes les entraves de la raison, de la morale et de l’intérêt national, les tchékistes inventaient des complots toujours plus fantastiques », un médecin arrêté décida de prendre exemple sur un jeune théologien
Historiciser l’imaginaire du complot 47
Le problème de l’historicité du mythe se pose avec une acuité particulière à propos de la figure du « complot juif mondial ». Pierre-André Taguieff y voit « un récit de facture mythique qui, doté d’une fonction cognitive (expliquer, justifier) et de différentes fonctions pratiques (mobiliser), est capable de se métamorphoser en s’adaptant à des contextes variables20. » Dans La Judéophobie des Modernes, il rappelle que « le mythe du complot juif se présente historiquement sous trois formes » : d’abord le complot juif contre la chrétienté médiévale, autour de l’accusation d’empoisonnement des puits, avant et pendant la grande peste de 1348 ; ensuite le complot international au xixe siècle, qui procède d’une « refonte du complot maçonnique dénoncé par les penseurs contre-révolutionnaires », enfin le « complot sioniste mondial21 ». Plus d’un siècle après leur fabrication, les Protocoles des Sages de Sion, constituent aujourd’hui un texte passe-partout et adaptable à tout contexte, fonctionnant aux quatre coins du monde comme un moyen privilégié de dénonciation du complot « américano-sioniste ». D’une remarquable adaptabilité, le complot juif acquiert les traits d’un mythe politique moderne, dont la parti-cularité est d’avoir été « fabriqué avec des matériaux symboliques empruntés à l’antijudaïsme et à l’antisatanisme médiévaux22. » En quel sens peut-on alors parler de la modernité du mythe, mise à part sa dimension mondialisée ?
L’anthropologie historique de la modernité que Taguieff déploie dans ses récents ouvrages s’efforce de tenir ensemble les deux perspectives tracées plus haut. De même que les stéréotypes négatifs ne disparaissent
allemand qui, accusé quelques siècles plus tôt, ne nia pas son commerce avec le diable mais, indiqua comme complices tous les membres de la haute Commission ecclésias-tique, Grand Inquisiteur de la ville y compris. Espérant gripper une machine judiciaire devenue folle, il décida de se reconnaître coupable et de donner les noms de tous les médecins de sa ville : Weissberg-Cybulski A, L’accusé, trad. P. Stéphano et E. Bestaux, Préface de A. Koestler, Paris, Fasquelle éd., 1953, p. 377 et 384.
20. Taguieff P.-A., L’imaginaire du complot mondial – Aspects d’un mythe moderne, Paris, Éd. des Mille et Une Nuits, coll. « Les Petits libres », n° 63, 2006, p. 6 ; du même auteur, voir Les Protocoles des Sages de Sion, Paris, Berg International, 1992, 2 vol. [Rééd. rev. et corr. en 1 vol., Les Protocoles des Sages de Sion. Faux et usages d’un faux, Paris, Berg International – Fayard, 2004].
21. Taguieff P.-A., La Judéophobie des Modernes. Des Lumières au Jihad mondial, Paris, Odile Jacob, 2008, p. 328.
22. Taguieff P.-A., L’Imaginaire du complot mondial…, op. cit., p. 8.
48 Paul Zawadzki
pas mais « s’accumulent et se métamorphosent23 », l’imaginaire du
complot juif procède de recyclages et de recompositions.Prenant la catégorie de la diabolisation au sérieux, tout comme
le faisait Léon Poliakov24, Taguieff replace certaines reformulations conspirationnistes contemporaines dans une historicité longue. À ce titre, l’obsession du complot sioniste mondial relève souvent de ce qu’il qualifie d’« antisionisme démonologique ». Mais il parcourt éga-lement le chemin inverse. Partant de la condition moderne, il insiste sur les modalités des recyclages du mythe (scientificité apparente de l’argumentation notamment) ainsi que sur ses nouvelles fonctions : fonction de mobilisation et de propagande qui suppose l’entrée dans l’ère de la politique de masse ; fonction cognitive visant à expliquer ou à justifier, d’autant plus sensible qu’elle s’exerce dans des sociétés caractérisées par une « crise continuée des fondements, dans l’ordre de la connaissance comme dans celui des valeurs et des normes25. » Permettant de « faire renaître des certitudes26 » par-delà le doute, le complot ré-enchante le monde. Encore faut-il remarquer qu’il le fait en présentant du monde une image particulièrement effrayante qui ne fait, en définitive, que renforcer sa propre « sociologie de l’angoisse27. »
Le mythe du complot juif mondial comporte ainsi des strates accu-mulées28, du syncrétisme et de l’inédit. Pour éviter le piège des pensées courtes, on ira dans le sens des thèses continuistes pour retrouver les dif-férentes significations, représentations, stéréotypes sédimentés qui sont – on ne s’en étonnera jamais assez – d’une extraordinaire persistance dans le temps. On s’en éloignera pour tenter de saisir ce que présup-pose la troublante prolifération des complots imaginaires au xxe siècle, à savoir qu’il y a, dans l’histoire de l’imaginaire du complot, quelque chose de fondamentalement nouveau à penser du côté de la modernité.
23. Ibid., p. 5.24. Poliakov L., La causalité diabolique. Essai sur l’origine des persécutions,
Paris, Calmann-Lévy, coll. « Liberté de l’esprit », 1980. Voir aussi, « Le diable et les juifs » (La « diabolisation des juifs en Occident »), dans M. Milner (dir.), Entretiens sur l’Homme et le Diable, Paris – La Haye, Éd. Mouton, 1965, p. 189-201.
25. Taguieff P.-A., L’Imaginaire du complot mondial…, op. cit., p. 44.26. Ibid., p. 48.27. Girardet R., Mythes et mythologie politiques, Paris, Éd. Seuil, coll. « L’Uni-
vers historique », 1986, p. 48.28. « Ce qui me paraît définir la mythologie moderne, c’est son caractère de stra-
tification », note R. Bastide dans « La mythologie moderne » [1969], repris dans Le sacré sauvage et autres essais, Préface de H. Desroche, Paris, Payot, 1975, p. 83.
Historiciser l’imaginaire du complot 49
S’ouvrent alors les pistes interprétatives portant sur les modes du croire. Depuis Max Weber jusqu’à des travaux plus récents (ceux de Daniel Bell ou de Danièle Hervieu Léger par exemple), on insiste sur le fait que la modernité n’abolit pas les croyances29 mais que celles-ci renaissent comme des réponses à l’éradication moderne de l’évidence du sens. C’est dans ce cadre que prolifèrent les bazars de l’ésotérisme dont il est question dans La Foire aux « Illuminés30 ».
II. L’imaginaire du complot et l’anthropologie politique de la modernité
En ses significations enchevêtrées, le complot révolutionnaire témoigne déjà d’une configuration paradoxale semblable. « Délire sur le pouvoir » d’une extraordinaire plasticité, il est « l’antiprincipe » tapi dans l’ombre du pouvoir révolutionnaire ; un envers qui peut tout. Son architecture a ceci de particulier qu’elle « recompose l’idée d’un pouvoir absolu31. » Dans le même sens, Pierre Nora relève que les grands complots imaginés dessinent le négatif du pouvoir démocratique dans les sociétés marquées par le fait libéral ; ainsi « le pouvoir prêté aux Juifs n’est pas un contre-pouvoir » mais « le fantasme d’un pouvoir entier enfin et à nouveau réuni sur lui-même32. » En ce sens, l’imaginaire moderne du complot est toujours hybride. Il incorpore la vue suivant laquelle le pouvoir n’est qu’humain ; néanmoins il va jusqu’à produire, selon Furet, « une perversion du schéma causal par laquelle tout fait historique est réductible à une intention et à une volonté subjective33. » Là, précisément se réintroduit la pensée mythique . Comme on l’a souvent relevé, au plus loin de l’idée qu’il puisse y avoir des effets non intentionnels de l’action résultant par exemple de l’effet d’agrégation
29. Selon le schéma évolutionniste d’un tube en U : plus il y a de science et de modernité, et moins il y a de croyances et de religions, voir : Hervieu-Léger D., La religion pour mémoire, Paris, Éd. du Cerf, coll. « Sciences humaines et religions », 1993.
30. Taguieff P.-A., La Foire aux « Illuminés ». Ésotérisme, théorie du complot, extrémisme, Paris, Éd. des Mille et Une Nuits, coll. « Essai », 2005.
31. Furet Fr., Penser la Révolution française, op. cit., p. 79.32. Nora P., « 1898. Le thème du complot et la définition de l’identité juive », art.
cit., p. 160.33. Furet Fr., Penser la Révolution française, op. cit., p. 78.
50 Paul Zawadzki
ou du mécanisme de la prophétie auto-créatrice34, les théories conspi-rationnistes posent que tout ce qui arrive a été voulu et profite à ceux qui l’ont voulu. Elles avancent ainsi des explications antihistoriques de l’histoire, et en fin de compte anti-sociologiques des phénomènes sociaux. En accentuant de manière unilatérale la dimension de l’inédit, on peut dire que ces dispositifs hybrides, surgis de l’intérieur de la conscience historique, se distinguent par bien des traits fondamentaux des complots classiques.
Les complots modernes sont humains. Avec la généralisation de l’idée que le monde est tissé de volontés humaines, la surnature, le Diable ou la Providence sont éliminés de la causalité quand il s’agit de penser les affaires terrestres. En lien direct avec ce qui précède, le basculement dans la conscience historique ouvre sur « un monde où tout changement social est imputable à des forces connues, répertoriées vivantes35. » Aussi imprégné soit-il des traits de la pensée mythique, l’imaginaire du complot – même quand il est envisagé dans une pers-pective contre Révolutionnaire (par exemple chez l’Abbé Barruel36) – puise à l’épistémè moderne ses principales orientations.
En outre, le complot moderne suppose que le pouvoir est à prendre (il ne l’était pas dans un régime monarchique de droit divin), qu’il est dans une certaine mesure désincorporé (devenu « une sorte de lieu vide », selon l’expression convenue de Claude Lefort). Le complot plonge alors ses racines dans « l’imaginaire démocratique du pouvoir », car c’est bel et bien dans les sociétés dans lesquelles les hommes se pensent comme faisant l’histoire, là où ils se donnent un pouvoir sur eux-mêmes, qu’il peut devenir une catégorie explicative spécifiquement politique. En lien avec la question de l’idéologie – entendue ici comme dispositif
34. Boudon R., Effets pervers et ordre social, Paris, PUF, coll. « Sociologies », 1989 [1977] ; Merton R. K., « The Self-Fulfilling Prophecy » [1948], repris dans Social Theory and Social Structure, Glencoe, The Free Press, 1957 [1949] (Éléments de théorie et de méthode sociologique, trad. H. Mendras, Paris, Armand Colin, 1997).
35. Furet Fr., Penser la Révolution française, op. cit., p. 43.36. Barruel Abbé A., Mémoires pour servir à l’histoire du jacobinisme, Ham-
bourg, Fauche, 1798-1799 (5 vol.) ; texte revu et corrigé en 1818 : « Dans cette Révolution française, tout jusqu’à ses forfaits les plus épouvantables, tout a été prévu, médité, combiné, résolu, statué : tout a été l’effet de la plus profonde scélératesse, puisque tout a été préparé, amené par des hommes qui avaient seuls le fil des conspi-rations longtemps ourdies dans des sociétés secrètes, et qui ont su choisir et hâter les moments propices aux complots. », t. 1, p. 42.
Historiciser l’imaginaire du complot 51
politique hors religion – il faut ajouter plus explicitement l’orientation futuriste du temps37 qui caractérise, selon Émile Poulat, « l’esprit du complot » au sens moderne. À le suivre, le premier de ses traits décisifs est « sa visée utopique, qui n’est pas seulement d’occuper le pouvoir en remplaçant celui qui le détient, mais de changer la société, de faire une société nouvelle, pour un homme nouveau (ou de s’y opposer38). »
De la modernité enfin, l’esprit du complot récupère l’implacable volonté de savoir, de percer les mystères et d’expliquer de manière exhaustive en éliminant toute trace de hasard. Les adeptes des concep-tions policières de l’histoire39 ne se contentent pas des apparences. Ils visent la profondeur, les causes ultimes, les ressorts cachés ; ils affichent volontiers une posture critique résolument anti-naïve. Ils savent que l’apparence n’est pas l’essence, qu’elle n’est qu’un voile qui dissimule la vraie nature des choses, au mieux un indice, une trace. La croyance au complot n’est donc pas nécessairement portée par une posture de cer-titude. Parfait exemple de la « bêtise de l’intelligence40 », elle procède souvent de la radicalisation du doute et du soupçon. Les hommes qui y adhèrent ne sont pas ces sots, simples d’esprit et autres crédules igno-rant tout des exigences du doute moderne. Inutile de s’étendre ici sur les nombreuses figures d’un tel dévoiement de l’esprit critique dans les familles politiques qui s’en réclament assidûment41.
Sur ce point, les mythologies complotistes entretiennent une affinité profonde avec le fanatisme moderne. En effet, dans leurs modalités spécifiques, les croyances fanatiques du xxe siècle ne correspondent pas exactement à celles que l’optimisme du xviiie siècle avait antici-pées. Loin d’être le fruit exclusif de certitudes absolues portées par des barbares immergés dans la foi du charbonnier, elles empruntent souvent
37. Pomian K., L’Ordre du temps, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des histoires », 1984, p. 291 et s.
38. Poulat E., « L’esprit du complot », Politica Hermetica, n° 6, 1992, p. 9.39. Sperber M., « La conception policière de l’histoire », Preuves, n° 36, Paris,
1954 [repris dans Sperber M., Le Talon d’Achille, Paris, Calmann-Lévy, coll. « Liberté de l’Esprit », 1957, p. 75-103].
40. Pachet P., Bêtise de l’intelligence : Jean-Louis Faure, Préface C. de Biéville, Nantes, Éd. Joca seria, 2006.
41. Pour ne mentionner qu’un témoignage relevant en quelque sorte de la critique interne, citons : Corcuff Ph., « Chomsky et le “complot médiatique”. Des simplifica-tions actuelles de la critique sociale », Bellaciao septembre 2006 (http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=33430).
52 Paul Zawadzki
un parcours inverse, allant du doute vers la foi, du nihilisme (ou dé-croyance) vers la certitude dogmatique42. Nul n’y fut plus sensible que Max Weber percevant clairement que l’éradication de l’évidence du sens (c’est-à-dire le désenchantement du monde), éloignait les intellectuels du xxe siècle de la tranquillité d’âme dont les créditait Voltaire lorsqu’il voyait dans l’esprit philosophique un rempart contre le fanatisme. Dans les années 1900 Weber observait déjà que les « tourments de l’homme moderne » suscitaient l’aspiration à de nouvelles totalisations du sens, de même qu’il sentait chez ses étudiants – qui auront une trentaine d’années au moment de la prise de pouvoir par Hitler – l’attente d’un chef charismatique43. Acceptant pour sa part, une situation intra-mondaine sans échappatoire, et cultivant l’amour d’une science ne conduisant pourtant à aucune plénitude44, il savait d’expé-rience la difficulté de vivre que pouvaient éprouver ses contemporains.
Sans cet arrière plan, marqué non plus par la puissance du religieux, mais par « la perte de son emprise structurante45 », il serait difficile de comprendre la production à grande échelle de ces croyances devenues folles – les religions séculières46 – avec lesquelles l’imaginaire du complot entretient plus d’une affinité. Elles ne relèvent plus du religieux stricto sensu, tout en véhiculant cependant des représentations holis-tiques d’un corps social unifié, voire fusionnel, menacé seulement de l’extérieur. Dans un monde en voie de sécularisation, elles permettent
42. Ne pouvant expliciter davantage cette perspective dans les limites de cet article, on se permettra de renvoyer à nos articles : « Une tache aveugle sur la rétine de Voltaire. Le fanatisme des intellectuels », dans Fr. Champion, S. Nizard et P. Zawa-dzki (dir.), Le sacré hors religions, Paris, L’Harmattan – Association française de sciences sociales des religions, 2007, p. 51-73 ; « Le fanatisme au miroir de la moder-nité », dans M. Chevrier, Y. Couture et S. Vibert (dir.), L’autre de la modernité, Montréal, Fides, 2011 [à paraître].
43. Weber M., Le Savant et le politique [1917], trad. J. Freund, Préface de R. Aron, Paris, Plon, 1963 [réed. 10/18, coll. « Bibliothèque », 2002, p. 108-121].
44. Voir les pages sur la « grandeur de Max Weber », dans E. Voegelin, Hitler et les Allemands, trad. M. Köller et D. Séglard, Paris, Éd. du Seuil, coll. « Traces écrites », 2003 [1951], p. 281-300.
45. Gauchet M., La condition historique, entretiens avec Fr. Azouvi et S. Piron, Paris, Stock, coll. « Les Essais », 2003, p. 292.
46. Au sens que R. Aron donnait à ce terme dans « L’avenir des religions séculiè-res », La France libre, n° 45, 15 juillet 1944, p. 210-217, et n° 46, 15 août 1944, p. 269-277 (L’article fut republié plusieurs fois, notamment dans Commentaire, n° 28-29, 1985, p. 369-383 et dans Chroniques de guerre, La France Libre 1940-1945, éd. revue et annotée par Ch. Bachelier, Paris, Gallimard, 1990, p. 925-948).
Historiciser l’imaginaire du complot 53
de rendre compte de l’énigme du mal, au travers d’une démonologie terrestre. « Le mysticisme laïque semble se passer facilement de Dieu mais non du Diable » écrit Manès Sperber47. Rien de tel qu’une théorie du complot pour s’immerger à nouveau, fut-ce pour un temps seule-ment, dans l’océan des certitudes. Ce n’est pas un personnage sorti d’un roman de Mikhaïl Boulgakov, mais bel et bien le procureur Vichinski qui s’adressait à l’un des accusés des procès de Moscou en ces termes : « Y eut-il des cas où les membres de votre organisation s’occupant d’une manière ou d’une autre du stockage du beurre, mettaient du verre pilé dans le beurre ? […] Y eut-il des cas où vos participants, vos complices dans le criminel complot contre le pouvoir et le peuple soviétique répandirent des clous dans le beurre ? » Une telle scène serait irrésistiblement comique si nous ignorions que dix-huit accusés furent exécutés sur-le-champ48.
C’est également ce qui permet de rendre intelligibles ces bascule-ments inattendus que Jean Grenier saisissait par une formule éloquente en 1936 : « c’est un trait frappant des dix dernières années que le brusque passage d’un doute absolu à une foi totale et parallèlement du désespoir sans limites à un espoir sans limites également49. » Grenier prenait acte du fait que dans la modernité la croyance renaît du doute et voyait une explication à ces modernes « sauts dans la foi » dont le xxe siècle regorge50.
Dans l’histoire de l’imaginaire du complot, on peut illustrer ce qui précède en rappelant la trajectoire de ce personnage extraordinaire – on ne s’étonnera pas que Danilo Kiš lui ait consacré une nouvelle51 – que fut Sergueï Nilus (1862-1929). Nilus tient une place de premier plan dans l’histoire de la fabrication des Protocoles des Sages de Sion qu’il fut
47. Sperber M., « Misère de la psychologie » [1954], repris dans Le Talon d’Achille, op. cit., p. 140.
48. Carrère d’Encausse H., Staline, l’ordre par la terreur, Paris, Flammarion, coll. « Champs », 1979, p. 58.
49. Grenier J., Essai sur l’esprit d’orthodoxie, Paris, Gallimard, 1961 [1937], p. 27.
50. « Le saut dans la foi » de Lukacs : Bell D., La fin de l’idéologie, Paris, PUF, coll. « Sociologies » 1997, p. 333-360 ; voir aussi, « The Returned of the Sacred? The Argument of the Future of religion », repris dans The Winding Passage. Essays and Sociological Journeys 1960-1980, Cambridge, Basic Books, 1980, p. 341-343 en par-ticulier.
51. Kiš D., « Le livre des rois et des sots », dans Encyclopédie des morts, trad. P. Delpech, Paris, Gallimard, 1985 [1983].
54 Paul Zawadzki
l’un des premiers à publier en appendice à la deuxième édition (1905) de son livre Le Grand dans le Petit, et l’Antéchrist en tant que possibilité politique imminente. Cet écrivain mystique qui hanta de longues années durant le monastère d’Optina Poustyne (gouvernement de Kalouga), et qui vivait avec sa femme et sa maîtresse, passait jusqu’au tournant du siècle pour « un libre penseur et un disciple de Nietzsche52. » Dans un témoignage célèbre, le comte Alexandre du Chayla53 le présente comme « un homme instruit. Il avait terminé avec succès le cours de la Faculté-de droit de l’université de Moscou. De plus il possédait à la perfection le français, l’allemand et l’anglais et connaissait à fond la littérature contemporaine étrangère. […] Il se passionna pour la philo-sophie de Nietzsche, l’anarchisme théorique et la négation radicale de la civilisation actuelle. Dans un tel état d’esprit Nilus ne pouvait vivre en Russie. Il partit pour l’Étranger avec une dame K. et vécut ainsi longtemps en France, en particulier à Biarritz, tant que son intendant ne lui eut appris que sa propriété d’Orel et lui-même étaient ruinés. C’est alors, aux environs de 1900, que sous l’influence de déboires matériels et de graves épreuves morales, il vécut une crise spirituelle qui l’amena au mysticisme. »
Le destin de ce dandy nietzschéen qui part en embardée pour finir comme sermonnaire apocalyptique peut être considéré comme idéal-typique des recompositions fanatiques de la première moitié du xxe siècle. Même les « graves crises psychiques54 » qu’il traverse sont à l’image du moment 1900, marqué par l’explosion des maladies de l’âme et le développement de la psychiatrie55. Sa trajectoire montre que la question de la persistance – « pourquoi y a-t-il encore du fanatisme au xxe siècle » – perd de sa pertinence. Ce n’est ni la continuité ni la permanence (psychique, culturelle, sociale, etc.) qui caractérisent la
52. Hagemeister M., « Qui était Serge Nilus ? », trad. M. Pique-Bressoux, Poli-tica Hermetica, n° 9, 1995, p. 143.
53. « Serge Alexandrovitch Nilus et les Protocols des Sages de Sion », La Tribune Juive, n° 72, 14 mai 1921, reprod. intégralement dans Taguieff P.-A., Les Protocoles des Sages de Sion. Faux et usages d’un faux, Paris, Berg International, coll. « Faits et Représentations », 1992, t. 1, p. 47-65.
54. Hagemeister M., « Qui était Serge Nilus ? », art. cit., p. 144. A. du Chayla se souvient de la « terreur mystique », voire même de l’effroi avec lequel Nilus tentait à lui montrer comment ce qui est dit dans les Protocoles s’accomplit infailliblement.
55. Swain, G., Le sujet de la folie, naissance de la psychiatrie, précédé de « De Pinel à Freud » par M. Gauchet, Paris, Calmann-Lévy, 1997 [1977] ; Ehrenberg A., La société du malaise, Paris, Odile Jacob, 2010.
Historiciser l’imaginaire du complot 55
vie de Nilus mais les ruptures, les crises et la discontinuité. Ce n’est pas tant l’assurance paisible d’une foi pleine et entière que la fébrilité d’échapper à la béance du sens. L’imaginaire du complot semble surgir d’un vide que sa « nouvelle foi56 » fanatique, on peut le supposer, ne remplira probablement jamais complètement.
Conclusion
Articulée à l’anthropologie des sociétés démocratiques, la pers-pective historicisante peut éventuellement approfondir le détail des logiques contextuelles dans lesquelles se déploient, à travers bien des particularités, les différentes formes de croyances complotistes. À titre de conjecture, elle permet également d’entrevoir certaines formes d’épuisement des théories idéologico-politiques du complot. En considérant que les sociétés occidentales ont accompli leur sortie du théologico-politique, on peut faire l’hypothèse de l’affaissement des grandes théories politiques du complot (celles qui étaient imbriquées dans des conceptions explicitement idéologiques du monde), tout comme on a pu observer l’implosion des grandes religions séculières que furent les idéologies totalisantes. Cela n’empêche nullement que prolifèrent les visions conspirationnistes infra-politiques, ni même que se poursuive l’engouement populaire pour les romans, films, séries éso-téro-complotistes. On conçoit sans peine les séductions romanesques du thème du complot.
Un point de vue plus sceptique ou plus désillusionné mettra davantage l’accent sur les permanences et les invariants des grandes constructions paranoïdes et des logiques de persécutions. Il doutera absolument d’une telle évolution et considérera comme naïve l’hypothèse d’une extinction progressive de l’imaginaire du complot politique.
56. Dans La pensée captive. Essai sur les logocraties populaires, trad. A. Pru-dommeaux et l’auteur, Préface de K. Jaspers, Paris, Gallimard, coll. « Les Essais », 1953, C. Milosz se demande : « Qui sait si l’absence d’un centre intérieur chez l’homme, n’explique pas le mystère du succès de la Nouvelle Foi, son grand attrait pour les intel-lectuels ? La nouvelle foi, en soumettant l’homme à une pression puissante, crée ce centre – ou du moins, elle fait naître le sentiment que ce centre existe. La peur devant la liberté n’est rien d’autre que la peur devant le vide » (p. 121).
56 Paul Zawadzki
Les « théories du complot » ou la mauvaise conscience
de la pensée moderne
Emmanuelle Danblon
De multiples approches sur les « théories du complot » se dévelop-pent aujourd’hui. Faut-il y voir le signe d’un phénomène d’actualité, signe des temps ? S’agit-il au contraire d’une manière de raisonner propre à l’homme ? Pourquoi, dans ce cas, fascine-t-il tant de nos jours ?
Cet article propose d’aborder la question sous l’angle de la rhétori-que, c’est-à-dire, en particulier, sous l’angle de la preuve, de sa validité mais aussi de son efficacité. À l’évidence, la propension de l’esprit humain à chercher des causes cachées n’est pas neuve. Elle semble au contraire être l’une des conditions essentielles à sa compréhension du monde, en somme, à sa rationalité. C’est le paradoxe qui s’impose d’emblée à la réflexion. Un mode de pensée réputé fallacieux, souvent condamné comme régressif sinon obscurantiste, témoignerait pourtant d’un trait inhérent à la raison humaine.
Pour mener cette enquête, nous emprunterons un chemin allant des origines de la pensée jusqu’aux confins de la modernité qui voit apparaître de nombreuses théories du complot. Pourtant, au cœur de la modernité, la recherche des causes cachées et la preuve par l’indice sont généralement relayées par des techniques de mise à l’épreuve des hypothèses : réfutations, expérimentations, comparaisons différentielles sont autant de démarches qui caractérisent l’épistémologie des sciences modernes réputées garantir aux hypothèses un statut scientifique. Mais il arrive aussi que des domaines entiers de la pensée s’immunisent contre la démarche critique pour renforcer la puissance explicative des représentations. Elles peuvent alors donner lieu à une inflation de sens, débouchant sur une conception déterministe du monde dont l’efficacité semble se construire au mépris de la validité des raisonnements.
Les théories du complot sont-elles un retour en arrière au cœur de la modernité ou, à l’inverse, un témoin privilégié de la raison moderne ?
I. Les théories du complot ou la pensée paradoxale
La question ainsi posée oblige à redéfinir les contours de la rationa-lité. Un raisonnement sera-t-il d’autant plus rationnel qu’il sera valide ou qu’il sera efficace ? En somme, qui est le plus rationnel ? Celui qui ne commet aucune erreur de raisonnement, quitte à demeurer dans le flou ? Ou bien celui qui fournit une explication du monde, fût-elle burlesque, mais qui lui permet de donner un sens à ce qu’il vit ?
À ce titre, chaque discipline peut se poser la question de savoir si et selon quels critères, elle a les moyens de distinguer ce qui serait non valide, fallacieux, incorrect, voir condamnable politiquement dans les théories du complot, tout en admettant que ces représentations du monde mettent en œuvre de nombreux traits communs aux raisonne-ments quotidiens. Voici donc formulé un paradoxe épistémologique. À partir de la question épistémologique se dégagera un second paradoxe, que je propose de qualifier de « topique ». En effet, il faut aussi noter que le goût pour les explications d’événements par le complot semble étroitement lié à des moments de bouleversement intense, qui favorisent ce besoin universel de donner un sens à la fois immédiat et exhaustif au bouleversement. Ce dernier, que les anciens nommaient peripeteia, exige ainsi que l’explication soit mise en récit, que l’on raconte précisé-ment ce qui s’est passé. Or, à l’évidence, la théorie du complot présente toutes les qualités psychologiques pour offrir un récit simple et efficace comme explication face au bouleversement.
On sait combien l’entrée dans la modernité à changé de fond en comble notre vision du monde. La laïcisation de la société et ses consé-quences ont rendu plus aigu encore ce besoin de donner du sens pour compenser un sentiment d’insécurité, au sein d’une société que l’on a qualifiée de désenchantée.
D’un côté, ces théories exacerbent de nombreux traits de la moder-nité ; elles affichent une pensée critique voire hypercritique, elles pratiquent le doute méthodique, elles ont le goût de l’argumentation par le détail et valorisent l’expertise scientifique, mais encore, elles souli-gnent la défense de la démocratie à travers l’exigence de transparence, la dénonciation de la corruption du pouvoir et des élites. D’un autre
58 Emmanuelle Danblon
côté, les théories du complot cultivent un goût pour l’occultisme, pour des approches ésotériques, hermétiques ou parascientifique d’explica-tion du monde. Cet aspect des choses s’explique, selon Pierre-André Taguieff, par le fait que les théories du complot sont aussi venues en réaction romantique contre la rationalisation du monde et donc, en un sens, contre l’esprit des Lumières. Comme vision du monde, elles semblent donc véhiculer une approche aussi moderne qu’antimoderne. Bref, les théories du complot se présentent paradoxalement comme respectant à la lettre les principes et les valeurs de la modernité tout en les défiant. Le respect exacerbé de la lettre des principes hérités des Lumières servirait-il en dernière analyse à en trahir l’esprit ?
Enfin, à partir des paradoxes épistémologique et topique se dégagera un troisième paradoxe, cette fois, rhétorique. Comme on le verra, la construction des preuves – ethos, pathos, logos – pourra être décrite, elle-même, comme paradoxale. La rhétorique conspirationniste s’affi-chera ainsi à la fois comme hypermoderne et antimoderne, jusque dans l’usage de ses preuves. Ce caractère triplement paradoxal des théories du complot semble, en définitive, être intimement lié à la question du rapport de chacun à la modernité et, derrière ce rapport, à l’idée que l’on se donne de la raison, des institutions qui font les sociétés, dont les productions rhétoriques sont le meilleur témoin.
Dans un monde ouvert où les hommes sont libres mais responsables de la construction de leur propre société, l’incertitude peut virer à l’an-goisse si la confiance de chacun dans ses propres capacités à raisonner et à agir n’est pas solide. Est-ce dans cet interstice que les théories du complot viennent se nicher ? Ou ne sont-elles finalement que l’expres-sion, au cœur de la modernité puis du désenchantement, d’un besoin universel et intemporel de donner du sens à ce qui nous échappe ? Cette question, en définitive, pourra se traduire en termes de genre. Existe-t-il un genre rhétorique de la théorie du complot qui serait propre aux insti-tutions de la modernité tardive ? Ou ne constitue-t-elle que l’expression organisée des habitudes de pensée que l’on trouvera partout ? Auquel cas, chaque dénonciation d’une théorie du complot ne serait qu’une tentative de masquer le complot auquel soi-même on participe. C’est la thèse que l’on trouve parfois chez certains critiques de l’attitude dénonciatrice. Finalement, le complot serait toujours par définition celui de l’autre, et l’on se retrouverait dans une régression à l’infini. La question rhétori-que se réduirait ainsi à une dénonciation politique.
Les théories du complot : mauvaise conscience de la pensée moderne 59
Pour tenter de rouvrir le débat dans toutes ses dimensions épistémo-logiques, topiques et rhétoriques, retournons tout d’abord aux sources du raisonnement par l’indice.
II. Un paradigme commun : le raisonnement indiciaire
Depuis Peirce, on assimile le raisonnement par l’indice à l’abduc-tion, ce mode d’inférence qui remonte d’un signe ou d’une trace observés à une cause présumée. De nombreux champs du savoir humain procèdent ainsi par la recherche d’indices en s’efforçant de recons-truire le récit d’une réalité dont on n’a plus que des traces. La part de pari ou de « devinette » contenue dans l’abduction, mais aussi sa grande puissance heuristique, a contribué à sa réputation d’irrationalité. L’abduction livrerait un passage immédiat à une conclusion sans devoir en passer par l’examen des prémisses. On ferait ainsi appel à des vertus bien peu logiques. Celles dont la source sont des qualités intellectuelles, certes, mais aussi émotionnelles et morales : l’intuition, la lucidité, la perspicacité. Dans sa Rhétorique, Aristote stipule d’ailleurs que tous les orateurs n’ont pas la même capacité à « découvrir » les indices. La qualité de l’homme prudent, la phronèsis, cette sagacité, est une forme d’intelligence intuitive qui semble bien peu relever du calcul inférentiel1. Mais s’oppose-t-elle, pour autant, à la raison logique ? En est-elle une alternative ? Aristote ne le pensait pas, même si la question est présente dans la Rhétorique2.
C’est sans doute à l’historien Carlo Ginzburg que l’on doit d’avoir repensé cette question à partir de ce qu’il nomme le « paradigme indiciaire ». Selon Ginzburg3, pour trouver la source de ce mode de
1. C’est aussi à cette qualité que fait allusion Fr. Goyet, en développant la façon dont elle fut repensée aux xvie et xviie siècles : Goyet Fr., Les Audaces de la pru-dence. Littérature et politique aux xvie et xviie siècles, Paris, Éd. Classiques Garnier, coll. « Études montaignistes », 2009.
2. Pour un examen spécifique de cette question, je me permets de renvoyer à : Danblon E., « Sur le paradoxe de la preuve en rhétorique », Communications, R. Mandressi (éd.), « Figures de la preuve », Paris, Éd. du Seuil, n° 84, 2009, p. 9-20.
3. Ginzburg C., Rapports de force : histoire, rhétorique, preuve, trad. J.-P. Bardos, Paris, Seuil/Gallimard, coll. « Hautes études », 2003 ; Ginzburg C., Mythes, emblèmes,
60 Emmanuelle Danblon
raisonnement, il faut remonter aux habitudes des chasseurs-cueilleurs qui avaient développé une aptitude à reconstruire les formes et les mou-vements des « proies invisibles » à partir d’une série de traces :
« Ce qui caractérise ce savoir, c’est la capacité de remonter, à partir de faits expérimentaux apparemment négligeables, à une réalité complexe qui n’est pas directement expérimentable. On peut ajouter que ces faits sont toujours disposés par l’observateur de manière à donner lieu à une séquence narrative, dont la formula-tion la plus simple pourrait être “quelqu’un est passé par là”4. »
Le savoir des chasseurs, et le lexique utilisé par eux se caractérisent par des métonymies (la partie pour le tout, l’effet pour la cause) qui témoi-gnent de cette activité intellectuelle comme l’aptitude à mettre en récit, à partir de traces parfois très ténues, une série cohérente d’événements. Ginzburg insiste en outre sur le fait que ce savoir conjectural est très présent dans la Grèce ancienne et pratiqué en particulier par certaines catégories de la population. Ce paradigme fut ensuite condamné dans son ensemble pour débarrasser la science et la logique grecques d’un passé ancestral, certes ancré dans les intuitions, mais, à ses yeux, témoin d’un monde irrationnel qu’il fallait désormais tenir à distance :
« Les médecins, les historiens, les chasseurs, les pêcheurs, les femmes ne représentent que quelques-unes des catégories qui opé-raient, pour les Grecs, dans le vaste territoire du savoir conjectural. Les frontières de ce territoire, gouverné, de manière significative, par une déesse comme Mètis, la première épouse de Jupiter, qui personnifiait la divination au moyen de l’eau, étaient délimitées par des termes comme “conjecture”, “conjecturer” (tekmor, tekmaires-thai). Mais ce paradigme resta, nous l’avons dit, implicite : il fut écrasé par le modèle de connaissance prestigieux (et socialement plus élevé) qu’élabora Platon5. »
L’identification de ce moment charnière me semble particulièrement importante pour aider à la compréhension de ce qui se joue dans les théories du complot, précisément parce qu’il témoigne d’un chan-
traces : morphologie et histoire, trad. M. Aymard, Ch. Paoloni, E. Bonan et M. Sancini-Vignet, Paris, Flammarion, coll. « Nouvelle bibliothèque scientifique », 1989.
4. Ginzburg C., Mythes, emblèmes, traces…, op. cit., p. 153.5. Ibid.
Les théories du complot : mauvaise conscience de la pensée moderne 61
gement de paradigme. Mais sans doute aussi, parce que c’est sur ce terreau ambivalent de la rencontre entre le monde archaïque et le monde moderne qu’est née la rhétorique. Et peut-être enfin parce que depuis ce moment, la pensée moderne n’a cessé de rejouer le combat entre raison et intuitions, entre rigueur logique et sagacité interprétative, sur le champ de bataille de la rationalité.
Quoi qu’il en soit, parmi les témoins de la puissance heuristique de cette raison archaïque, on trouve aussi bien des intuitions sur le futur que sur le passé. C’est d’ailleurs ce que nous enseigne la belle étude de Jean Bottéro6 sur les traités de divination en Mésopotamie. On y découvre en outre que les prophéties sont toujours exprimées en deux temps. S’exprime tout d’abord la protase, qui joue le rôle de prémisse. Elle est mise au conditionnel, constitue le premier membre de la phrase et fournit le présage. Vient ensuite l’apodose qui expose l’événement à venir et se déduit du présage. C’est le pronostic, la prédiction. Mais ce qui frappe d’emblée dans ces exemples, c’est le plus souvent l’absence de lien apparent entre la protase et l’apodose : ce qui compte, c’est la mise en correspondance. L’habitude de classer les événements, demeu-rée essentielle dans la science moderne, semble ainsi venir d’une raison archaïque. Ici comme là, on classe, on ordonne et, ce faisant, on donne du sens. La position de Bottéro sur cette question est sans équivoque :
« L’étude attentive de la divination montre l’extraordinaire mérite [des Mésopotamiens] sur ce point : au terme d’une évolution assez longue bien avant les Grecs, ils ont à leur manière inventé l’abs-traction, l’analyse, la déduction, la recherche des lois, bref l’essentiel de la méthode et de l’esprit scientifiques. Sur ce point comme sur les autres, le slogan vermoulu du “miracle grec”, encore bien trop accepté de nos jours, même par des historiens de métier, se révèle une niaiserie : les Grecs ne sont pas nés dans un univers de primates, une terre brûlée, une façon de néant culturel […]. Grâce à la divination, nous savons maintenant que ces “Barbares” [les Mésopotamiens] avaient poussé fort loin les choses et admira-blement préparé le terrain, en créant la méthode et l’esprit scientifiques et, en somme, la première science. C’est par là que,
6. Bottéro J., Mésopotamie. L’écriture, la raison et les dieux, Paris, Galli-mard, coll. « Bibliothèque des histoires », 1987 ; Bottéro J., « Symptômes, signes, écritures en Mésopotamie ancienne », dans J.-P. Vernant et al., Divina-tion et rationalité, Paris, Éd. du Seuil, coll. « Recherches anthropologiques », 1974, p. 70-195.
62 Emmanuelle Danblon
au-delà des Grecs, ils sont dans notre lignée paternelle directe et que leur rationalité a préparé la nôtre. Rien ne l’éclaire mieux peut-être que l’étude et l’histoire de leur divination7. »
Cette longue citation va à présent nous permettre d’aborder la deuxième étape de notre questionnement, en poursuivant notre enquête sur la nature de la raison qui se joue dans la pensée conspirationniste.
III. La pensée moderne coupée de ses racines indiciaires
Nous avons vu que la pensée moderne, née d’abord de l’avènement d’un logos rationnel qui cherchait à mettre à distance un mythos désor-mais réputé irrationnel, s’est en grande partie coupée de ses racines indiciaires et partant de la raison intuitive, comme le déplore Bottéro. Et c’est d’une réflexion similaire que partira Carlo Ginzburg en replaçant la notion de preuve rhétorique au centre du débat. Il cherche, ce faisant, à réhabiliter, dans sa vision de l’antique discipline oratoire, un mode de pensée qui utilisait, à côté des canons de la logique propositionnelle, les outils de la raison pratique à l’œuvre dans le paradigme indiciaire.
Pour comprendre le caractère paradoxal de la pensée conspiration-niste, nous pouvons à présent formuler une hypothèse que je tenterai d’étayer depuis les principes de la rhétorique. On note souvent que la pensée conspirationniste renoue simultanément avec les cadres déter-ministes de la raison archaïque, alors même qu’elle se donne comme un parangon de la modernité. Peut-être ce paradoxe serait-il le résultat de la mauvaise conscience d’une pensée moderne rendue en partie aveugle à ses racines archaïques désormais réputées « barbares ». Cette antique raison, ancêtre de notre « branche paternelle », se manifesterait comme un « ennemi de l’intérieur », comme un vieil oncle qui nous ferait honte avec ses traditions d’un autre âge, truffées de proverbes démodés, de superstitions et de remèdes de « bonne femme ». Dans la pensée conspirationniste, la raison archaïque se manifesterait comme la mauvaise conscience d’avoir voulu laisser le vieil oncle à la porte alors qu’il revendique le droit d’entrer.
7. Bottéro J., « Symptômes, signes, écritures en Mésopotamie ancienne », art. cit., p. 193.
Les théories du complot : mauvaise conscience de la pensée moderne 63
Cette première hypothèse a l’intérêt d’éclairer la logique paradoxale à l’œuvre dans les théories du complot. Alors même que celle-ci s’affi-che comme utilisant tous les canons de la raison moderne elle se fait, en même temps, l’écho lointain d’un mode de pensée réputé infréquentable et qui pourtant fournit à un besoin humain de donner du sens un plaisir cognitif auquel aucune déduction logique ne pourrait prétendre.
C’est ce que nous allons à présent développer en déclinant les trois paradoxes identifiés au sein des théories du complot.
IV. Un paradoxe épistémologique : la critique dans un monde clos
À reprendre l’opposition de Karl Popper8 entre sociétés ouvertes et fermées, on se rappellera que le critère a essentiellement une visée épis-témologique. Les sociétés fermées, à culture essentiellement orale, ne prévoient pas de moment critique dans la formulation des hypothèses sur le monde. Cela s’explique principalement par le fait que l’explication du monde s’y manifeste comme une partie du monde lui-même. L’institution prévoit le respect de la tradition et de la transmission rigoureuse des repré-sentations du monde qui sont autant de révélations sur lui. À l’inverse, les sociétés ouvertes ont besoin d’un moment critique qui leur permette de mettre les hypothèses à l’épreuve de contre-arguments, de tentatives de réfutation et de falsification, en vue d’une amélioration régulière d’une vision du monde toujours à parfaire.
Une telle distinction est d’autant plus utile qu’elle permet d’éclairer le lien entre l’activité critique et un critère politique pour la société. Ce lien a sans doute été découvert par les Sophistes qui ont compris l’importance de l’activité argumentative comme cheville ouvrière de l’exercice de la liberté. Il va sans dire que l’association des deux exercices – la critique et la liberté – n’était pas du goût de Platon, ni pour sa vision de la société, ni pour sa vision de la raison humaine. C’est en effet à ce moment que la référence à la tradition ne suffit plus pour convaincre. Les principes deviennent discutables. Il faut argumenter, comparer les opinions, évaluer la force des justifications. Ce que nous apprennent les Sophistes et que manifeste la sagacité du phronimos est la pratique délicate de la mise à
8. Popper K. R., The Open Universe: an argument for indeterminism, ed. by W. W. Bartley, Totowa – New Jersey, Rowman and Littlefield, 1982 [1956].
64 Emmanuelle Danblon
distance des opinions, y compris la sienne. Lorsqu’on entreprend de cri-tiquer, il s’agit, pour un temps, de suspendre tout jugement. Ce moment au cours duquel on considère les différentes hypothèses en concurrence, nous force à un mouvement d’ouverture de la pensée qui nous laisse momentanément sans explication. Sans doute à cause de la part d’incer-titude sur laquelle débouche toute relativisation du jugement, l’exercice de la critique dans un monde ouvert demande une pratique réelle, dont l’entraînement habitue le citoyen aux vertiges de la liberté. C’était là sans doute la proposition des Sophistes.
Mais si l’on replace ce mouvement de la critique dans un arrière-plan déterministe, en soi rassurant, il n’ouvre plus, il referme. Il n’ébranle plus, il rassure. Il ne questionne plus, il répond. C’est ce qui semble être le cas dans la pensée conspirationniste où la critique change de sens. Ou plutôt, elle y prend le sens non technique qu’on lui connaît dans la vie courante : il s’agit de disqualifier par la dénonciation. On voit se mettre en place une procédure qui n’avance qu’à charge, et non à décharge. Il n’y a plus de place pour le questionnement attentif entière-ment contenu dans l’activité de considérer. Il n’y a plus qu’une urgence d’atteindre une réponse déjà connue, une réponse tout entière contenue dans la question.
Ainsi, de cette épistémologie paradoxale qui se réclame de la critique, on voit se dessiner une étrange activité. Là où la critique moderne cherche à réfuter et à falsifier, la critique conspirationniste cherche à vérifier et à confirmer. Loin de renforcer ses hypothèses par la confrontation, elle les protège par immunisation.
En somme, l’hypothèse formulée ici propose de voir l’origine de cet état de fait bien avant l’entrée dans la modernité des Lumières, mais au moment de la naissance de la rhétorique, c’est-à-dire au moment de l’avè-nement de la première modernité, identifiée par ce « slogan vermoulu » dont parle Bottéro : celui du « miracle grec ». Ce qui s’est joué dans l’Europe des Lumières serait le deuxième acte de cette longue histoire de la raison humaine.
V. Un paradoxe topique : l’ennemi comme essentia-lisation du problème
Si l’on admet, dans une vision aristotélicienne, de nommer « topique » l’ensemble des principes et représentations qui forme une vision du
Les théories du complot : mauvaise conscience de la pensée moderne 65
monde dans laquelle les citoyens puiseront leur matière à débats, on verra par conséquent dans la topique une version courante, publique, non technique de l’épistémologie et de la culture d’une société donnée. Pour la modernité, cette topique consistera globalement dans les grands principes de la démocratie, des droits de l’Homme et de ce qui garantit la raison humaine, y compris les canons de la science moderne9. On s’attend donc bien à ce que la topique de la modernité considère la cri-tique comme la pierre angulaire de ces sociétés, et cela, tant pour des raisons politiques que scientifiques.
C’est ainsi, tout naturellement, dans la topique que viendra se configurer le deuxième paradoxe que nous allons décrire. Nous savons combien les théories du complot permettent de compenser un sentiment d’insécurité en fournissant une explication simple et souvent incarnée à un problème, à une crise ou à un événement traumatisant. Les spécia-listes du conspirationnisme ont assez traité de ces questions sans qu’il soit besoin d’y revenir encore une fois. Je me bornerai ici à tenter de décrire, depuis la notion de topique, les liens apparemment paradoxaux qui s’instaurent entre la valorisation typiquement moderne de la démar-che critique et l’essentialisation de l’ennemi, telle qu’on la trouve dans les civilisations archaïques.
On sait que les sociétés fermées ont une propension à s’immuni-ser contre la critique parce que le coût cognitif pour réviser la vision d’un monde stable et cohérent serait trop élevé. Ainsi, lorsqu’apparaît une brèche, une péripétie, on impute le problème à une intention mal-veillante et extérieure à la communauté : l’ennemi. Son identification a le double avantage qu’elle fournit une explication concrète à l’évé-nement problématique, tout en confirmant la vision du monde et en renforçant les liens sociaux autour d’un ennemi commun10. L’angoisse a un visage, ce qui explique le caractère simultanément rassurant et angoissant de la théorie du complot11. Dans une société ouverte, si l’on
9. Pour une description et une analyse rhétoriques de cette topique, on consultera : Danblon E. et Jonge E. de (éd.), « Les Droits de l’Homme en discours » – Revue Argumentation et Analyse du discours, 2010, http://aad.revues.org/index763.html.
10. Horton R. & Finnegan R. (eds.), Modes of Thought. Essays on Thinking in Western and Non-Western Societies, London, Faber & Faber, 1973.
11. On notera au passage, au plan rhétorique, la grande proximité cognitive que le processus mental révèle entre la critique moderne et les racines profondes d’un blâme archaïque qui a toujours une visée politique : celle de l’exclusion, du bannissement ou de la destruction.
66 Emmanuelle Danblon
opte pour une explication par la conspiration, la critique utilisera prin-cipalement la collecte d’indices en vue de confirmer une hypothèse a priori ou plutôt une thèse dont la puissance explicative la rend de fait irréfutable. On procédera alors à une enquête concentrée sur les inten-tions présumées d’un individu, d’un groupe ou d’une communauté, sur le mode abductif : on se demandera « à qui profite le crime ? ». D’où l’accusation des détracteurs de la puissante thèse : il s’agit d’un « procès d’intentions ». Et c’est là qu’une fois encore, le mouvement de la critique conspirationniste préférera la confirmation à la réfutation : « Si nous pouvons affirmer que l’individu, le groupe ou la communauté incriminés a de mauvaises intentions, c’est parce qu’il s’agit, chez eux, d’une disposition ». Ainsi, par la pratique toute moderne de la critique, on bascule dans un paradigme déterministe qui replace l’abduction dans un monde clos. Le pari d’une hypothèse risquée se transforme en prophétie sur le passé et le suspect devient alors l’ennemi à abattre. Le temps de l’explication, le monde se trouve réenchanté.
Pourtant, cette explication rassurante fondée sur l’idée selon laquelle telle catégorie de la population aurait des dispositions génétiques ou culturelles à avoir certains traits moraux (la fourberie, la lâcheté, la violence) est incompatible avec la topique moderne d’une politique des droits de l’Homme. Non seulement, elle présenterait une véritable atopie, surtout au regard des principes contenus dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, mais encore, elle serait souvent condamnée au plan juridique comme incitant à la haine. La topique conspirationniste consistera, ainsi, à repartir des canons de la modernité qui prévoient de mettre les préjugés à distance, mais en débouchant comme involontairement sur la révélation de l’ignominie du conspira-teur. L’effet de persuasion devrait être d’autant plus puissant qu’il n’est pas présenté comme recherché. Comme cela est d’ailleurs noté par de nombreux auteurs, le récit du dénonciateur de complot comprendra souvent une étape au cours de laquelle il montre comment il a perdu ses illusions. En bon citoyen de la pensée moderne, il place tous les préjugés archaïques à distance, et c’est alors même qu’engagé dans une enquête ouverte, il n’a trouvé sur son chemin que des arguments à charge. Le caractère essentiellement infâme de l’ennemi s’impose à lui, par la pratique du libre arbitre.
Cette brève description du paradoxe topique nous permet sans doute d’apprécier une autre source de la grande puissance persuasive de la raison conspirationniste : tout en appliquant les canons logiques et
Les théories du complot : mauvaise conscience de la pensée moderne 67
politiques de la modernité, elle débouche sur les certitudes de la raison archaïque, donnant par contrecoup à ses conclusions un caractère appa-remment aussi valide que persuasif. Au passage, elle aura secrètement réconcilié le citoyen avec ses racines indiciaires qui lui murmurent à l’oreille que ses intuitions ne le trompent pas et que, tout compte fait, il n’y a pas de fumée sans feu.
VI. Un paradoxe rhétorique ou la construction de preuves ambivalentes
Nous terminerons notre enquête par l’examen des conséquences, sur la rhétorique elle-même, de l’articulation paradoxale entre archaïsme et modernité. Gardant à l’esprit l’hypothèse générale de la mauvaise conscience de l’esprit des Lumières vis-à-vis de la pensée indiciaire, nous verrons, finalement, comment celle-ci se manifeste dans la construction des trois preuves de la rhétorique conspirationniste.
Il nous restera enfin à décider si nous avons bien affaire à un genre rhétorique propre à la modernité, ou à la manifestation, au cœur de la modernité, d’une propension universelle de l’esprit humain.
La construction des trois preuves rhétoriques dans la pensée conspirationniste, se fera à partir du paradoxe topique qui vient d’être décrit. Puisque la pensée moderne n’a pas su se relier à ses racines indiciaires, garantes de la raison intuitive, s’opérera systématiquement un basculement « ambivalent » ou « erratique » du cadre indétermi-niste propre à la pensée moderne au cadre déterministe propre à la pensée archaïque. De cette ambivalence naîtra une construction assez complexe des trois preuves rhétoriques dont nous allons à présent apprécier quelques spécificités.
Un logos polysémique
Le logos conspirationniste devrait nous permettre d’apprécier, comment se traduisent, au cœur du discours, les usages de la critique dans un cadre fermé. Ainsi, la démarche qui consiste à replacer l’ab-duction dans un monde clos, la fait passer d’un pari audacieux dont il faut encore valider la solidité, à une preuve irréfutable. L’un des usages concrets de ce basculement peut s’illustrer par l’emploi polysémique de l’auxiliaire modal « doit ».
68 Emmanuelle Danblon
Dans une réflexion sur l’abduction, Marion Carel12 commente ces deux énoncés :
(1) On a trouvé des fossiles marins loin de la mer, cela indique que la mer devait aller jusque-là à une certaine époque.(2) Jean est sorti, donc il doit faire beau.
En première remarque, on notera que chacun de ces énoncés peut s’ex-primer par la formule binaire utilisée dans les traités de Mésopotamie antique : la protase, puis l’apodose. L’emploi du modal « doit » exprime, dans l’apodose, la conclusion inférée à partir de l’indice formulé dans la protase. Marion Carel note ainsi que les deux énoncés peuvent avoir une lecture abductive classique. Mais elle affirme ensuite que l’énoncé (2) peut donner lieu à une lecture « un peu magique » selon laquelle la sortie de Jean provoquerait le beau temps. Au-delà du caractère apparemment anecdotique de cette réflexion, il me semble que Carel a repéré un témoin linguistique assez puissant de la force explicative de l’abduction, lorsqu’elle est replacée dans un cadre déterministe. L’auxiliaire « devoir », par sa polysémie, nous permet de retrouver le sens perdu d’un monde dans lequel l’explication se construit par l’essentialisation : Jean est si beau, si solaire, si puissant, que sa sortie provoque le beau temps. Jean est comme ça. Il y a donc une lecture de l’énoncé (2) qui résonne comme un éloge archaïque, construit à partir des mêmes critères que ceux du blâme archaïque : certains individus sont si essentiellement vertueux ou vicieux que leur empreinte sur le monde est d’une puissance quasi magique.
Or, que ce soit dans la lecture abductive moderne ou dans la lecture archaïque, l’énoncé (2) donne une explication du monde, exprimable par le couple que forment la protase et l’apodose. Dans un monde ouvert, elle a valeur d’hypothèse, et le couple inférentiel se retraduira en prémisse et conclusion. Dans un monde clos, elle fonctionne comme une explication éthico-déterministe et la formule binaire aura une fonc-tion de présage et de prédiction. Cet emploi archaïque exprimerait un état du monde tel qu’il est désiré pour qu’il soit juste. Si le monde est juste, le soleil doit briller lorsque Jean sort. L’ennemi doit être fourbe, lâche et nous vouloir du mal.
12. Carel M., « Note sur l’abduction », Travaux de linguistique, n° 49, 2004/2, p. 93-111.
Les théories du complot : mauvaise conscience de la pensée moderne 69
Mais ici, comme dans la topique, ce ré-enchantement du monde ne peut pas être assumé tel quel par la pensée moderne. Il sera ainsi solli-cité à travers les emplois ambivalents d’un logos qui, tel un interrupteur, nous montrerait tour à tour sa face moderne et sa face archaïque. Le plaisir cognitif éprouvé à la restauration d’un monde plein de sens, est rendu possible par le fait que la formule binaire, protase, apodose fonctionne aussi bien dans la logique moderne que dans la pensée archaïque et interprétative. Ainsi, le logos conspirationniste livrerait une explication du monde en renvoyant tour à tour à la raison moderne et à la raison archaïque. Ce dispositif serait d’autant plus puissant qu’il serait encore disponible tel quel dans un logos qui a conservé bien vivaces ses capacités de basculement vers un monde déterministe. Le logos conspirationniste se donne ainsi simultanément comme valide et plein de sens13.
L’ethos de l’expert au service du pathos du ressentiment
À ce logos clignotant de la rhétorique conspirationniste va corres-pondre de façon très cohérente une relation ethos – pathos. Comme bon nombre d’auteurs l’ont observé, l’ethos de celui qui s’apprête à dénoncer un complot est marqué par un certain paradoxe. Celui-ci se construit sur le modèle de l’expert, mais se trouve souvent hors du champ de l’exper-tise dominante. Il se présente comme hypercritique, rigoureux et précis, mais, en même temps, quelque chose semble lui donner un accès direct aux causes cachées. En somme, et pour poursuivre sur le thème du para-doxe, l’ethos conspirationniste se donne à la fois comme celui du libre penseur de la modernité et comme celui du prophète archaïque capable de déceler les raisons enfouies. Si sa rigueur prend parfois le visage de la rigidité, sa lucidité semble la conséquence directe de sa liberté. Aristote affirmait que l’ethos est la plus puissante des trois preuves et notre enquête ne le dément pas. Il semblerait, en effet, qu’ici plus que
13. Cette hypothèse sur le logos conspirationniste doit en outre être relayée par la description que je propose ailleurs du genre épidictique qui, lui, utilise cette capa-cité de la raison humaine à basculer vers un monde déterministe propice à donner du sens. Mais les éloges et les blâmes de la modernité opèrent ce basculement à partir d’un pacte fictionnel au cours duquel on fait « comme-si » le monde avait du sens. Voir E. Danblon, Rhétorique et rationnalité – Essai sur l’émergence de la critique et de la persuasion, Bruxelles, Éd. de l’Université de Bruxelles, coll. « Philosophie et société », 2002.
70 Emmanuelle Danblon
partout ailleurs dans la rhétorique conspirationniste, l’ethos réussit souvent à emporter l’adhésion des plus sceptiques, peut-être parce que, se nourrissant des plus grandes figures de la pensée moderne et de la pensée traditionnelle, il parvient, lorsqu’il est endossé par un orateur de talent, à gagner le pari d’être à la fois Galilée et Antigone, Zola et la Pythie. En somme, il réussit à ce tour de force rhétorique d’être à la fois celui qui va sauver la société de ses plus grands ennemis et celui qu’aucune institution, si puissante soit-elle, ne saurait corrompre. Il se présente comme incarnant le phronimos de la modernité14.
De façon très cohérente, cet ethos aura l’avantage de solliciter le pathos ambivalent des sociétés modernes : celui du ressentiment. Tel que le décrit finement Angenot15, le ressentiment est une émotion éminemment ambivalente. À ce titre, et replacée dans la suite des paradoxes auxquels cette enquête nous a confrontés, elle pourrait être l’émotion centrale suscitée par la pensée conspirationniste. Elle a ceci de commun avec l’indignation qu’elle dénonce volon-tiers les injustices et les inégalités. En cela, elle est éminemment moderne. En même temps, à l’image du protectionnisme des sociétés archaïques elle décline sa peur de la liberté en un rejet hostile de la différence. Elle est ainsi, comme les autres preuves de la rhétori-que conspirationniste, tour à tour moderne et archaïque. L’hostilité vis-à-vis de l’ennemi sera légitimée par l’expertise de l’orateur, le sentiment d’impuissance sera, quant à lui, justifié par la révélation de la toute-puissance de l’ennemi. Bref, l’homme du ressentiment, s’il ne peut être ni libre ni fier de ses réalisations, peut au moins trouver une compensation paradoxale dans le plaisir cognitif de trouver de bonnes raisons à cet état de fait. Ni archaïque, ni moderne, l’amateur de théories du complot représente l’une des figures paradoxales d’un homme moderne qui a honte de ne pas oser risquer la liberté16.
14. On retrouve d’ailleurs la construction d’un tel ethos dans le titre d’un des livres de l’avocat J. Vergès : « le salaud lumineux », paru en 1990. Chacun des deux termes peut d’ailleurs renvoyer sur ce mode ambivalent à la topique moderne ou archaïque. Le salaud lumineux semble ici célébrer le mariage de Zola et d’Antigone.
15. Angenot M., Les Idéologies du ressentiment, Montréal, XYZ Éditeur, 1995.16. Je songe ici aux réflexions de F. Midal : Risquer la liberté. Vivre dans un
monde sans repères, Paris, Éd. du Seuil, 2009. Si son constat sur notre époque pouvait rejoindre les incertitudes de la modernité évoquées ici, sa proposition se donne comme l’antidote au ressentiment.
Les théories du complot : mauvaise conscience de la pensée moderne 71
Conclusion
Finalement, cette enquête nous conduit à voir dans la théorie du complot un avatar de la modernité qui construit, sur une mode ambivalent, une rhétorique ni moderne ni archaïque et tout à la fois hypermoderne et hyperarchaïque.
Elle ne présente donc aucune spécificité cognitive puisqu’elle emprunte les outils de sa rhétorique à toutes les aptitudes de la raison. En cela, elle offre à l’analyse une construction spectaculairement com-plexe intellectuellement. De ce point de vue, on ne saurait dire qu’il s’agit là d’une pensée régressive. Mais la cohérence de son épistémo-logie, de sa topique et de sa rhétorique la rend facilement repérable. De ce point de vue, elle constitue un genre rhétorique à part entière qui ne saurait se réduire à la seule dénonciation politique.
Enfin, la théorie du complot et ses modes de pensée paradoxaux seraient l’un des meilleurs témoins de la mauvaise conscience d’une modernité qui n’a jusqu’ici pas trouvé les moyens d’articuler la raison moderne à ses racines indiciaires. Si elle trouvait pourtant une voie pour y parvenir, elle pourrait utiliser l’infinie richesse des intuitions de façon consciente, mais en les cantonnant aux registres de la raison où elle est la plus efficace. Si ce défi est levé, il ne saurait, sans doute, se réaliser sans l’aide de la rhétorique.
72 Emmanuelle Danblon
Rhétorique du complot : la persuasion à l’épreuve d’elle-même.
Itinéraire d’une pensée fermée
Loïc Nicolas1
Peut-être que mon corps et ce « moi » ont ourdi un complot dans le dos de mon propre esprit, qui affectionne particulièrement […] les ruelles sombres et les trappes secrètes.
Irvin Yalom, Et Nietzsche a pleuré.
Qu’en raison de contraintes économiques, stratégiques, politiques ou de sécurité, des sociétés, groupes, organisations, associations ou individus s’entendent pour agir en secret, cela ne fait aucun doute et demeure en un certain sens consubstantiel à l’exercice du pouvoir, y compris dans les sociétés démocratiques. Dès lors qu’un jury se réunit à huis clos pour délibérer, statuer sur une affaire ou sélectionner un can-didat, c’est-à-dire pour effectuer un choix parmi plusieurs possibles, les membres qui le composent sont, au moins le temps de leur mise à l’écart – condition d’effectuation de la tâche pour laquelle ils ont été désignés ou élus –, tenus à un certain secret, ce que d’aucuns appelleraient « dis-crétion ». Il demeure par ailleurs inévitable et compréhensible qu’en réponse à l’inconnu, donc au mystère, réel ou apparent, qui entoure l’événement inaugural, en d’autres termes l’acte de discrimination, naissent des spéculations sur ce qui a eu lieu, et que les conditions autant que les motivations profondes de la décision fassent l’objet d’une
1. L’auteur de l’article tient à exprimer ses plus sincères remerciements à E. Danblon pour ses remarques précieuses et les conseils qu’elle a formulés tant sur le fond que sur la forme de son texte.
interrogation critique ou soupçonneuse. En conséquence, le secret, ouvert sur l’imaginaire du profane – celui qui se tient hors de l’espace décisionnel –, constitue un lieu sur lequel s’expriment sans contrôle fan-tasmes et questions. Pourquoi mon dossier a-t-il été écarté au profit d’un autre ? Pourquoi ai-je été condamné ? Pourquoi m’interdit-on l’accès au contenu des débats ? Sur la base de ces protestations sans réponses officielles ou satisfaisantes s’échafaudent des « théories » (collusion interne, malveillance, stratégie d’évincement, etc.), qui permettent de fournir des raisons externes à ses propres angoisses ou échecs, c’est-à-dire non seulement de les expliquer, mais encore de les justifier par l’existence de contraintes invisibles mais supposées réelles à propos desquelles nous, ou plutôt nos actions, ne sauraient jamais avoir aucune prise ni effet.
En tout état de cause, il est assez courant de rechercher des « raisons cachées », ou, pour mieux dire, indicibles et mauvaises, ayant présidé à l’établissement du choix contesté – un choix qui nous dessert et qui blesse notre ego. La thèse du complot, ce « projet quelconque concerté secrètement entre plusieurs personnes2 », se mue alors en mode de dépassement et de négation de ses lacunes ou faiblesses intimes dont chacun préfère, par estime de soi et par amour propre, ignorer l’exis-tence. Finalement, cette reconstruction spéculative du monde qui, dans le transfert des responsabilités, permet de « sauver la face » et dont le ressentiment est un ferment puissant, couve derrière chaque porte fermée où l’incertitude règne telle une force obscure et maléfique. Historiquement, le mot « complot » sert à désigner, de façon plutôt anodine, une « foule compacte », un « accord commun3 », un « rassem-blement de personnes » et peut être rapproché, comme le souligne Léon Poliakov dans son « Avant-propos » au premier tome de la Causalité diabolique, du terme russe zagovor qui signifie étymologiquement « derrière-parler ». Or, « parler derrière le dos de quelqu’un [poursuit Poliakov] est déjà comploter, le complot est partout4 », et ce dans la mesure où sa convocation discursive permet avant tout de combler, par le façonnage de récits hybrides (mi-fictifs mi-réels), les blancs et les manques d’une connaissance du monde foncièrement parcellaire.
2. Trésor de la langue française (Entrée : « Complot »), vol. 5, Paris, CNRS – Gallimard, 1977, p. 1186.
3. Ibid.4. Poliakov L., La causalité diabolique – Essai sur l’origine des persécutions,
tome I, Paris, Calmann-Lévy, coll. « Liberté de l’esprit », 1980, p. 9.
74 Loïc Nicolas
L’argumentation par le « complot », c’est-à-dire par la cause dissi-mulée à dessein, demeure depuis la cour d’école jusqu’aux querelles conjugales ou professionnelles, une des ressources les plus facilement accessibles dans la discussion, un moyen de se rassurer, de se persuader que le désordre du sens (celui de sa propre existence) est forcément imputable à quelqu’un (l’autre, l’étranger, le nouveau venu, etc.) qui bénéficie en propre de ce dérèglement. Imputation qui tout à la fois initie et justifie la recherche ou le recoupement d’indices destinés à supporter une énonciation qui a déjà eu lieu. En d’autres termes, avant même l’identification des preuves, lesquelles finalement ne prouvent pas, mais confirment la nécessaire existence du complot, les raisons d’y croire et de tirer de cette croyance des prémisses d’actions fonctionnent – dans l’esprit de celui qui valide l’imputation – comme une matière déjà jugée, une doxa sur laquelle s’accordent (ou devraient s’accorder) tout ceux qui, de bonne foi, acceptent de voir la vérité en face.
L’objet de cette contribution, de même que celui du présent recueil sur Les rhétoriques de la conspiration, n’est aucunement de nier la réalité passée et présente de complots dont nous avons tous des exem-ples plus ou moins rocambolesques en mémoire : complot des Pazzi contre Laurent et Julien de Médicis, affaire des poisons, attentat manqué contre Hitler, assassinat de J.-F. Kennedy, Révolution des œillets, etc. Il ne s’agit pas non plus d’empêcher ou de condamner l’exercice légi-time de la critique à l’égard de ce qui peut sembler, à première vue, troublant et questionnable. L’idée est bien autre, elle vise à mettre en évidence la spécificité d’un mode de raisonnement et de reconstruction rhétorique des événements du monde. Ce qu’il s’agit d’éclairer, c’est bien cet appareil « théorique » ad hoc qui prétend expliquer de façon globale le réel et les développements de l’histoire présente, passée et à venir, c’est-à-dire de montrer comment fonctionne en discours ce que Manès Sperber appelle la « conception policière de l’histoire ». Suivant l’analyse qu’il formule, la spécificité de cette tournure de l’esprit est d’imaginer ou, plus exactement, de présumer l’existence d’une raison humaine, d’une intelligence, présidant aux destinées des hommes – destinées qui suivraient, en fin de compte, les plans secrets de groupes d’individus cherchant à satisfaire, au détriment de tous les autres (rendus aveugles quant à leur condition d’esclaves), des intérêts particuliers et clandestins par nécessité. Cette modalité de la cognition se développe autour d’une tendance excessive à surévaluer l’importance
Rhétorique du complot. Itinéraire d’une pensée fermée 75
du « secret » – et par suite de sa trahison, de sa transgression – dans la gestion des affaires humaines, et à supposer nécessairement concertées et manigancées, les raisons profondes à partir desquelles naissent les événements historiques. Relisons à ce propos ce qu’écrit Manès Sperber dans l’article qu’il consacre à la question :
« L’espionnage, vieux comme le monde, prend une place impor-tante dans la mythologie moderne. L’espion, héros aussi photogénique que le grand gangster ou le détective rusé, est sublime quand il sert votre patrie ou votre cause, et le plus ignoble des cri-minels s’il agit au profit de vos ennemis. Si les batailles se déroulaient selon les plans établis d’avance, l’espionnage serait efficace. Mais ce n’est pas le cas. On peut voler tout secret, sauf celui d’un avenir que nul ne connaît5. »
Aussi les « théories du complot6 » constituent un remède commode, sinon efficace – du moins pour leurs producteurs – face à la survenue d’événements incontrôlables et (apparemment) incompréhensibles pour tout un chacun. Leur évocation, à l’esprit et en discours, dévoile le sens caché des accidents, des incidents de l’existence qui échappent pri-mordialement à l’entreprise de notre entendement. Et bien qu’elles ne confèrent aucun pouvoir sur les choses, c’est-à-dire sur l’histoire, elles donnent au moins l’illusion, dans la mise en cohérence de faits qu’une trame narrative élève au statut d’indices, d’avoir mis à jour ses « raisons cachées », d’avoir approché un tant soit peu le dessous des cartes, c’est-à-dire d’être en quelque sorte soi-même partie prenante du secret honni (mais en même temps exalté) par l’effet de la révélation que l’on expose à la vue de tous, et peut-être primordialement à soi-même. L’explication par le complot permet donc de satisfaire un certain goût de l’intrigue, et offre l’occasion gratifiante – Marc Dominicy parlerait ici de « plaisir cognitif » – d’imaginer derrière les portes de l’histoire en train de se faire des mobiles humains subtils voire alambiqués, mais en fin de compte facilement intelligibles à travers l’exemplaire cohé-rence des ramifications qu’ils supportent, plutôt que de reconnaître la
5. Sperber M., « La conception policière de l’histoire », dans Preuves, n° 36, Paris, 1954, p. 6-7.
6. Si tant est qu’on puisse parler ici de « théories », car dans l’esprit des (préten-dus) démystificateurs, il s’agit d’abord de dénoncer une réalité objective et expérimentable quotidiennement.
76 Loïc Nicolas
présence de rapports causes-conséquences complexes et impossibles à embrasser dans leur totalité. Ce type d’explication de l’histoire – secret, complot, trahison, mensonge, double jeu, etc. – fait à l’évidence perdre la capacité d’identifier, même partiellement, les facteurs réels, souvent peu spectaculaires ou tout simplement improbables de prime abord, qui président aux changements que subissent les hommes et les sociétés. Attribuer une intelligence au monde des grandes choses historiques, c’est faire « comme-si » il était possible, dans un univers fictionnel et utopique, de modifier radicalement leur cours, en d’autres termes de se projeter, de s’imaginer en Prométhée moderne confiant à une humanité ignorante de ses fins, les plans (donc les clés) d’un avenir connu à l’avance et détenus par un ennemi unique dès lors identifié, démasqué, confondu. Un mécanisme de ce type revient donc à subtiliser la réalité au profit d’un mythe, artificiellement créé à partir d’une série d’indices apparemment plausibles, et sortis de leur isolement autant que de leur désordre initial à des fins persuasives ; un mythe – d’une plasticité éton-nante dans son adaptation aux sursauts de l’histoire – capable de faire le lien entre le monde et la fiction déterministe qui le met en lumière.
Le dispositif en « comme-si » qui s’élabore dans un tel contexte est donc très différent de celui qu’on rencontre dans le cadre des céré-monies épidictiques7 (lors d’un éloge funèbre par exemple) qui, elles aussi, libèrent une large place aux représentations mythiques, et ce dans la mesure où la référence au monde fictionnel dépasse le simple « espace du jeu », et tend à « abolir » progressivement et complètement « toute appréhension rationnelle du monde réel8 ». La fiction et la réalité s’amalgament ; elles perdent leur nécessaire autonomie rendant impossible la conservation du « comme-si » dans son intégrité. Dès lors, le mythe (du complot) ne forme plus un moyen rhétorique pour faciliter l’acceptation de la complexité du monde, un mythe reconnu et accepté comme mythe, comme support à l’expression d’un sens qui le dépasse, mais se transforme, au contraire, en fin même de la com-
7. Sur cette question on pourra se référer à : Nicolas L., « La fonction héroïque : parole épidictique et enjeux de qualification », dans Rhetorica – A journal of the History of Rhetoric, Berkeley, University of California Press, vol. XXVII, Issue 2, 2009, p. 115-141.
8. Voir Danblon E., Rhétorique et rationalité – Essai sur l’émergence de la critique et de la persuasion, Préface de M. Dominicy, Bruxelles, Éd. de l’Université de Bruxelles, coll. « Philosophie et société », 2002, p. 188 (on se reportera plus large-ment aux pages 186-190).
Rhétorique du complot. Itinéraire d’une pensée fermée 77
préhension du monde : le mythe fait le monde. Il le constitue autant qu’il le détermine. Aussi cette confusion amène-t-elle à identifier sur le même plan épistémologique construction fictionnelle et description du monde empirique. À ce titre, les analyses formulées par Emmanuelle Danblon concernant la perte des « repères indispensables à l’attitude fictionnelle » et l’impossibilité d’accepter les contraintes propres à la mise en fiction rhétorique (dissociation, distanciation, etc.) me parais-sent très éclairantes :
« Lorsque les enfants jouent au loup, ils éprouvent un certain plaisir à se faire peur. Ce plaisir est lié à la capacité d’être engagé dans une fiction ludique qui n’est pas confondue avec la réalité. Mais il peut toujours y avoir un moment où l’un des participants perd les repères indispensables à l’attitude fictionnelle. Il devient alors incapable de dissocier le jeu de la réalité. À ce moment, il peut éprouver une frayeur réelle, comme si le loup était réellement là. Mais il ne s’agit plus d’une peur en “comme-si”, celle de l’attitude fictionnelle, qui est génératrice de plaisir. Il s’agit d’une peur réelle. Et là, le jeu doit s’arrêter9. »
Il serait cependant déplacé de railler comme purement irrationnel un tel mode de pensée conspiratoire auquel chacun d’entre nous demeure plus ou moins enclin – et ce, malgré le rejet ou les moqueries qu’il peut nous inspirer par ailleurs –, notamment au regard des conséquences tragiques (persécutions, massacres, génocides, etc.) qu’il a eu et qu’il continue à avoir. Je me propose donc, à partir d’un corpus assez large de « théories du complot » (complot juif international, complot américain, complot de la rhétorique contre la raison), tirés d’ouvrages, forums et sites internet, de montrer en quoi celles-ci sont marquées, historique-ment, par des constantes fortes – qu’il serait pour autant impossible de relever ici dans leur totalité – et par un modèle de rationalisation propre, au-delà de leurs spécificités conjoncturelles. Ainsi je procéderai en deux temps : je m’efforcerai tout d’abord de préciser le rapport entre l’essentialisme (comme justification première) et la construction rhé-torique d’un système global en essayant de souligner la place centrale que prend la pensée causale dans celui-ci (I), puis je montrerai dans quelle mesure les théories du complot reposent sur le principe cardinal
9. Danblon E., La fonction persuasive : anthropologie du discours rhétorique, origines et actualité, Paris, Armand Colin, coll. « U – Philosophie », 2005, p. 160.
78 Loïc Nicolas
de requalification des faits – au nom duquel s’opère la confirmation du sens au niveau cognitif –, principe pour lequel j’avancerai une possible modélisation (II).
I. De l’essence au « système » causal : l’enjeu de la prédiction
Partons dès à présent de l’idée selon laquelle les « théories du complot » se développent à partir de deux axes qui ont trait à la notion de causalité, deux fondements qui expliquent, selon moi, leur fortune comme « modèles exégétiques » de l’histoire globale. Le premier concerne l’unicité de la cause, sa simplicité en quelque sorte, et le second une certaine forme de déterminisme historique. Prenons les choses dans l’ordre et examinons les modalités d’expression de la « mentalité primitive » décrite par Lévy-Bruhl, lesquelles modalités permettent d’éclairer l’idée selon laquelle il serait possible d’associer un événement et la cause non circonstancielle qui préside à son appari-tion. Soulignons tout de suite que la notion de « mentalité primitive », qui a fait l’objet de discussions et de critiques parfois très vives en philosophie comme en anthropologie10, n’implique pas, comme certains ont pu le laisser entendre, une scission entre deux humanités, entre deux modes de penser radicalement distincts, celui des « primitifs » d’une part, celui des « civilisés » de l’autre. Au contraire, et c’est en cela que la thèse de Lévy-Bruhl, malgré une terminologie sans doute malheu-reuse, prend tout son sens et éclaire l’objet de notre étude : « Il n’y a pas une mentalité primitive qui se distingue de l’autre par de[s] caractères qui lui sont propres, il y a une mentalité mystique plus marquée et plus facilement observable chez les “primitifs” que dans nos sociétés, mais présente dans tout l’esprit humain11 ». S’appuyant sur la dualité interne de cet esprit – laquelle dualité rejette alors l’opposition binaire et sim-pliste entre « eux et nous » –, il explique que la « mentalité primitive »
10. À ce sujet voir notamment : Sanchez P., La rationalité des croyances magi-ques, Préface de R. Boudon, Genève, Droz, coll. « Travaux de sciences sociales », 2007 (chap. 3.1.2, 10.2.1 et suiv.).
11. Lévy-Bruhl L., Les Carnets de Lucien Lévy-Bruhl (1949), Préface de M. Leenhardt, présentation de B. Karsenty, Paris, PUF, 1998, p. 131. Voir également l’ouvrage de Keck F., Lévy Bruhl – Entre philosophie et anthropologie. Contradiction et participation, Paris, CNRS Éditions, 2008.
Rhétorique du complot. Itinéraire d’une pensée fermée 79
(dont nul ne saurait se dépouiller complètement) a tendance à voir dans tout ce qui advient la manifestation, par-derrière, d’une puissance mystique explicative. Par exemple, si un individu tombe gravement malade en ayant pris froid, la cause de son mal ne sera pas rapportée à un mécanisme physico-chimique complexe, selon lequel l’exposition au froid, dans des circonstances particulières et à certaines conditions, peut avoir des conséquences sur l’état de santé des individus, mais sera au contraire associée à une force occulte, un charme ou un maléfice qui aurait pu s’exprimer, se manifester dans le monde empirique d’une tout autre manière (une chute, la rencontre avec un animal dangereux, une querelle de voisinage, etc.).
Cependant, n’en déduisons pas que la « mentalité primitive » récuse l’évidence sensible, c’est-à-dire qu’elle ne sait pas que lorsqu’une per-sonne reçoit un coup de lance ou ingère un poison, le coup de lance ou le poison peuvent avoir des conséquences funestes, et même qu’ils en auront sans doute – la réalité l’atteste pour tout un chacun et n’est pas contestée. Le processus à l’œuvre ici concerne plutôt le déplacement du rapport entre la cause et sa conséquence dans un espace fictionnel hors de l’espace et du temps. De fait, ce qui est cause du décès n’est précisément pas le coup de lance ou l’ingestion du poison, ni même la personne ayant porté le coup ou administré le poison, événements considérés comme secondaires, accessoires ou « anecdotiques », mais une cause invisible selon laquelle la personne concernée par le poison ou le coup de lance devait mourir d’une façon ou d’une autre, en raison d’une « condamnation » supérieure à laquelle répondent les événements qui sont advenus. S’il n’y avait pas eu cet acte premier et pour tout dire unique (du moins en tant que cause, tout le reste étant alors réduit à l’état de simple conséquence) qu’est la condamnation, il ne serait tout simplement rien arrivé. C’est pourquoi, dans un édifice mental de ce type, pour qui rien ne se produit jamais accidentellement, les choses, les êtres et les situations dans lesquelles ils se trouvent ne sauraient être le fruit du hasard. Tout demeure parfaitement ordonné, même ce qui est primordialement insolite ou inattendu, et ce dans la mesure où chaque élément du réel participe d’un tout, c’est-à-dire d’un réseau d’impli-cations mystiques, qui permet d’accepter et de révéler la signification profonde des choses. Ainsi Lévy-Bruhl souligne-t-il que « la mentalité primitive [est] indifférente à la recherche des causes secondes », en d’autres termes des mécanismes de production des faits, car elle « est habituée [dit-il] à un type de causalité qui lui cache, pour ainsi dire, le
80 Loïc Nicolas
réseau de ces causes, [lesquelles] se déploient dans le temps et l’es-pace12 ». Ces analyses de Lévy-Bruhl ont été largement attaquées au motif qu’elles ouvraient ou semblaient ouvrir sur un relativisme rendant impossible toute comparaison des sociétés (primitives et avancées) entre elles sur la base de critères anthropologiques communs. S’il faut parfois reconnaître une disposition de l’auteur à absolutiser certaines différences dans l’opposition logique/pré-logique qu’il consacre (alors même qu’il s’est efforcé, vers la fin de sa vie, de réduire ses désaccords avec Evans-Pritchard ou Lévi-Strauss), les thèses qu’il défend ne sau-raient être judicieusement approchées suivant la dichotomie rationalité/irrationalité, mais en fonction d’une hypothèse continuiste qui présup-pose d’abord la mise en conformité des opérations effectuées par les acteurs avec les exigences de l’organisation sociale au nom (et à partir) de laquelle le monde se trouve expliqué.
De fait, l’appel à la cause unique, que je me garderais cependant de qualifier, à la suite de Poliakov, de « diabolique », résurgence et manifes-tation, ou devrait-on dire persistance de la pensée mythique dans l’esprit moderne, est précisément ce qui caractérise les théories du complot : les causes secondes, les circonstances, les accidents, les imprévus, le pur hasard sont évacués pour faire place à une explication simple qui absorbe le réel dans sa totalité (même si cette explication peut sembler finalement assez « complexe », touffue dans les connexions multiples qu’elle prétend dévoiler). La saisie des événements s’établit alors sur un mode hautement fictionnel, au sens où il s’agit de reconstruire, derrière l’histoire en acte, la présence nécessaire de ce qui est à la fois soupçonné et invisible par définition. Mgr Léon Meurin dans La Franc-Maçonnerie, synagogue de Satan structure son discours de cette façon lorsqu’il écrit : « L’Histoire ne manquera pas de raconter un jour que toutes les révolutions des derniers siècles ont leur origine dans la secte maçonnique, sous la direction suprême des Juifs13 ». Invoquer cette « direction suprême » c’est, à proprement parler, suggérer, ou plutôt chez lui asserter, l’existence d’une cause unique, et finalement in-cau-sée (donc cause d’elle-même), sans laquelle rien de ce qui fait l’Histoire (« toutes les révolutions des derniers siècles ») ne serait jamais advenu.
12. Lévy-Bruhl L., La mentalité primitive, Préface de L.-V. Thomas, Paris, CEPL, coll. « Les classiques des sciences humaines », 1976, p. 97.
13. Meurin Mgr L., La Franc-Maçonnerie, synagogue de Satan, Paris, V. Retaux, 1893, p. 196.
Rhétorique du complot. Itinéraire d’une pensée fermée 81
Il s’agit là d’un abandon des phénomènes (synergies, liaisons causales, emballements, etc.) qui font la complexité du monde, au bénéfice d’une fiction explicative qui dispense de réfléchir sur la situation elle-même, ou pour mieux dire, sur les circonstances particulières d’un événement historique forcément singulier.
Le second axe d’analyse, à savoir celui du déterminisme, me semble être directement corrélé au premier. Cependant, il m’est apparu nécessaire d’établir une disjonction entre les deux, car la « mentalité primitive », ainsi que l’indique clairement Lévy-Bruhl, ne possède pas cette conception dans ses descriptions et interprétations phénoménales14. Les « théories du complot » fonctionnent sur l’idée selon laquelle tout est fixé à l’avance et se déroule selon des actions humaines elles-mêmes déterminées mécaniquement et « opérant par chocs et poussées15 », pour reprendre l’expression de Karl Popper. Elles se structurent donc – sorte de gage empoisonné donné à la pensée moderne – à partir d’un déterminisme anthropocentrique, qui considère que n’importe quel événement possède ultimement une origine ou une raison humaine, qu’il s’agirait seulement de dévoiler. Cette ancienne vision du monde qui évacue toute contingence, et à laquelle s’oppose Popper dans sa conférence intitulée « Un univers de propensions », présuppose que, dans le champ des affaires humaines, « nos actions sont déterminées par des motifs et ceux-ci à leur tour motivés ou causés par des motifs plus profonds, etc.16 », tout l’enjeu revenant alors à pouvoir identifier, en dernier lieu, le motif explicatif suprême de toute la chaîne causale. La thèse du complot qui, finalement, joue son réel unifié contre les causes apparentes et diverses, revient toujours à convoquer « les coups reçus par derrière17 » pour rendre compte du déroulement des choses auquel tout un chacun participe contraint ou, pour mieux dire, forcé. On voit ainsi comment la négation du libre-arbitre et de la possibilité du choix demeurent au fondement de ces théories anti-propensionnistes18, car le
14. Lévy-Bruhl L., La mentalité primitive, op. cit., p. 97.15. Popper K. R., Un univers de propensions : deux études sur la causalité et
l’évolution, trad. A. Boyer, Paris, Éd. de l’Éclat, coll. « Tiré à part », 1992, p. 43.16. Ibid., p. 39.17. Ibid., p. 43.18. Selon K. R. Popper, « le monde n’est [pas] une machine causale », mais suit
« un processus de déploiement de possibilités [objectives] en voie d’actualisation, et de nouvelles possibilités », ibid., p. 40-41.
82 Loïc Nicolas
complot, par définition, détermine et oriente à son profit toutes les situa-tions à venir, et les traite invariablement comme si elles préexistaient (dans l’esprit maléfique du groupe qui les aurait conçues par avance) à leur manifestation. De fait, une telle configuration de déterminisme généralisé autorise sans contradiction à concevoir la possibilité du renversement de n’importe quel événement en son exact contraire, c’est-à-dire la mutation d’un bien quelconque en un mal absolu. En d’autres termes, une action A peut toujours être interprétée comme suivant une fin cachée (non-B) derrière un but apparent (B), et ce en raison d’une intentionnalité externe, celle des comploteurs, qui vient contraindre la réalité suivant un calcul rationnel. Il existerait comme un « effet pervers » intentionnel, humainement conçu, c’est-à-dire une « main invisible » qui détournerait de la vérité des choses, en opérant une ré-organisation stratégique et perverse du monde19.
Regardons à ce propos ce qui se produit dans la dénonciation du supposé complot rhétorico-jésuite contre la raison tel qu’il est présenté dans une leçon prononcée au Collège de France par Edgar Quinet en juin 1843 : « Comment arrêter, suspendre, glacer la pensée humaine au milieu de cet élan [porté par l’esprit scientifique] ? Il n’y avait pour cela qu’un seul moyen ; c’est celui que tentèrent les chefs de l’ordre de Jésus : se faire les représentants de cette tendance, y obéir pour mieux l’arrêter, bâtir sur toute la terre, des maisons à la science pour emprisonner l’essor de la science, donner à l’esprit un mouvement apparent qui lui rende impossible tout mouvement réel, le consumer dans une gymnastique incessante et sous de faux semblant d’activité, caresser la curiosité, éteindre dans le principe le génie de la découverte, étouffer le savoir sous la poussière des livres […], voilà quel fut, dès son origine, ce grand plan d’éducation suivi avec tant de prudence et un art si consommé. Jamais on ne mit tant de raison à conspirer contre la raison20 ». Les jésuites, en vue d’une « domination universelle », se seraient donc appliqués, par le fait d’une doctrine et d’une pédagogie conspirationnistes, à tenir la jeunesse dans « l’erreur et l’ignorance absolue », c’est-à-dire dans un état de minorité – pour reprendre la formule kantienne –, lui faisant frauduleusement « admettre le faux
19. Voir par exemple : Taguieff P.-A., Les Protocoles des Sages de Sion : faux et usages d’un faux, Paris, Berg International – Fayard, 2004, p. 24.
20. Quinet E., « Des jésuites », dans J. Michelet et E. Quinet, Des Jésuites, Paris, Comptoir des Imprimeurs unis, Hachette – Paulin, 1843, p. 250.
Rhétorique du complot. Itinéraire d’une pensée fermée 83
pour le vrai21 » après avoir converti ce dernier en erreur. La rhétorique, cette « gymnastique » de l’esprit, devient alors l’instrument malfaisant par lequel les jésuites parviennent à monter la raison contre elle-même, c’est-à-dire à renverser, à intervertir la réalité et l’apparence, le monde réel et sa fiction. En conséquence, le fait de « bâtir […] des maisons pour la science » (A) n’aurait pas pour finalité de faire triompher l’esprit scientifique et la raison (B), mais, au contraire, d’« arrêter, sus-pendre, glacer la pensée humaine » (non-B).
En outre, si les choses se passent telles qu’elles doivent se passer, et demeurent toujours conformes au dessein initial, c’est d’abord parce que les individus, notamment les tenants du complot, agissent suivant l’essence, invariable dans le temps et l’espace, qui les caractérise. En d’autres termes, il ne saurait y avoir de telles constructions théoriques sans essentialisation, sans l’idée selon laquelle les comploteurs réalisent leurs actions en fonction de lois internes, des lois biologiques, qui ne sont pas celles de l’humanité réelle – une humanité qui les exclue dans sa définition –, mais caractéristiques de leur propre « race », laquelle se trouve de fait catégorisée comme infra- ou extra-humaine. Les évé-nements adviennent parce que la minorité agissante qui complote se structure conformément à une nature, un ordre interne et des propriétés intrinsèquement singulières définis de toute éternité, en opposition radicale avec l’être profond de la majorité qui compose le vrai monde. En ce sens, la pratique du mensonge et de la diversion – pratique qui permet d’étendre indéfiniment le champ du soupçon à tous ceux qui demeurent seulement sceptiques ou dubitatifs face aux accusations de complot – est-elle une modalité comportementale très couramment attribuée aux conspirateurs supposés. Ainsi, Thierry Meyssan – qui, dans L’effroyable imposture22, défend la thèse d’un complot interne, selon laquelle une « faction du complexe militaro-industriel » amé-ricain (notamment la CIA) aurait programmé l’assassinat de milliers de personnes lors des attentats du 11 septembre 2001 – récuse sur la base de ce principe essentialiste l’ensemble des discours officiels ou ceux tenus par des experts indépendants qui viennent contredire son
21. Moreau E. L., « Des causes de l’esprit d’obscurantisme », dans Publication des conférences interdites en 1865 – Les causeries de M. E. L. Moreau sur la science des causes, Paris, Librairie centrale, 1865, p. 19-20.
22. Meyssan Th., L’effroyable imposture – 11 septembre 2001, Chatou, Éd. Carnot, 2002.
84 Loïc Nicolas
édifice « théorique ». Tout ce qui n’abonde pas dans le sens de sa vision conspirationniste est systématiquement catalogué comme un signe indiscutable de l’appartenance du locuteur à la conspiration, et ce, dans la mesure où son imputation de complot, fondée sur un postulat d’évidence, devrait pouvoir être reconnue et acceptée par n’importe qui. En conséquence, il demeure selon lui une incompatibilité radicale, c’est-à-dire essentielle, entre d’une part le fait de dénoncer la vision du monde conspirationniste qu’il promeut, et d’autre part celui d’être un interlocuteur de bonne foi, digne de confiance. La démarche qu’il suit s’efforce donc tout à la fois de démasquer le sens véritable derrière le sens apparent, mensonger, et de prouver (mais aussi de confirmer) l’existence d’une autre disposition interne et déterministe – profondé-ment ancrée et attestée selon lui par des précédents historiques –, qui pousserait cette administration à sacrifier stratégiquement (et de façon récurrente) sa population en vue d’un bénéfice politico-financier (ici légitimer la « guerre contre le terrorisme », envahir l’Irak pour capter ses ressources pétrolières, etc.) plus ou moins immédiat.
Prenons à présent un autre exemple, celui du complot juif, qui fonc-tionne suivant une essentialisation relativement bien stabilisée. Les Juifs, en tant qu’unité raciale, biologique et culturelle supposée, seraient porteurs de propriétés invariables, et finalement topiques dans l’esprit de ceux qui prétendent dénoncer leurs plans secrets. Mgr Jouin, dans Le péril judéo-maçonnique, présente les actions menées par des juifs visant la négation des Protocoles des Sages de Sion (ce faux grossier qui leur prête un projet de domination du monde), comme la preuve incontestable de l’authenticité du document. Relisons ce qu’il écrit : « La suppression des Protocol[e]s n’ayant pas réussi, les Juifs ont nié leur authenticité. Une négation, fût-elle un mensonge, est toujours facile. La presse juive de tous les pays a crié au faussaire, sans apporter la moindre preuve de cette affirmation. […] Les Juifs usent aujourd’hui de cette arme favo-rite du mensonge contre la publication des Protocol[e]s, où ils peuvent en puiser la méthode et l’exemple. […] Négation, mensonge, diversion, fiction […] n’ont fait que divulguer et confirmer les Protocol[e]s23 ». Essayons de faire ressortir le « fondement » de ce discours grâce au modèle analytique proposé par Stephen Toulmin24 :
23. Jouin Mgr E., Le Péril judéo-maçonnique, vol. III, Paris, RISS & Librairie Émile-Paul, 1921, p. 80-86.
24. Toulmin S., Les usages de l’argumentation, trad. Ph. De Brabanter, Paris, PUF, 1993.
Rhétorique du complot. Itinéraire d’une pensée fermée 85
Tableau 1
L’assertion analysée n’accepte ici aucune restriction (au sens toulmi-nien du terme) dans la mesure où elle se présente comme vraie dans tous les cas possibles. En revanche, si l’on devait en insérer une (par exemple : à moins que les juifs ne soient pas naturellement menteurs), cela aurait pour effet l’inévitable inversion du fondement initial, son renversement, c’est-à-dire le refus de l’essentialisme. Or, ce nouveau fondement convoqué par la restriction ouvrirait sur un monde indéter-ministe que refusent, par définition, les théories du complot comme modèle d’explication du monde. Par ailleurs, ce qu’il est intéressant de noter dans l’extrait proposé, c’est le fonctionnement de la proposition en « circuit fermé » : les Protocoles attestent la réalité d’une essence des Juifs, ils la confirment, de même que l’essence des Juifs atteste l’authenticité des Protocoles, la boucle est bouclée, l’argumentation imparable. On voit clairement qu’aucune place n’est laissée à la contestation ou à la critique, le raisonnement est verrouillé, puisque le fondement (F) justifie la conclusion (C) du discours, autant que cette dernière (C) vient donner corps et garantir la validité du fondement ultime (F). En d’autres termes, C → F parce que F → C (en consé-quence, C → C : les Protocoles sont authentiques parce qu’il ne peut en être autrement) : le raisonnement, qui n’inclut aucun troisième terme, est clairement tautologique, mais apparaît comme indiscutable, dans la mesure où C (authenticité des Protocoles) et F (essence des Juifs) font l’objet d’un postulat d’évidence.
Donnée Les Juifs s’opposent à la publication des Protocoles et les dénoncent comme faux (A), donc Conclusion les Protocoles sont nécessairement authentiques (non-A) puisque Garantie les Juifs mentent et dissimulent la vérité ; ils se comportent à l’égard des Protocoles comme ils l’ont toujours fait, étant donné Fondement leur essence.
86 Loïc Nicolas
Finalement, à partir du triptyque (cause unique – déterminisme – essentialisation) que j’ai exposé ici, il me semble plus aisé de com-prendre en quel sens les théories du complot constituent des systèmes fixes qui revendiquent un pouvoir de prédiction absolue dans le champ des affaires humaines. L’idée de « système » que j’introduis ici fait signe, d’une part, vers le principe de conservation (rien de ce qui advient ne saurait être contraire à la survie du système), d’autre part, vers celui de perpétuation (tout ce qui advient lui est nécessairement favorable). Considérons à ce propos l’extrait d’un message signé du pseudonyme « riper » et publié sur Oulala.net, concernant l’élection d’Obama : « Je suis [dit-il] bien trop critique pour imaginer, espérer que quelque chose puisse changer. Comme si le système permettait à quelqu’un d’arriver à la première place sans avoir l’appui de ce système25 ». J’exploiterai plus précisément dans la deuxième partie l’exemple très éclairant de l’élection américaine, mais, pour ce qui m’intéresse à ce stade de l’analyse, le message est clair et déploie une argumentation reposant sur trois présupposés : 1) il y a un système, 2) il est fixe (sinon il ne serait pas conforme à sa définition), et 3) rien n’est possible sans son appui.
Tableau 2
25. Message de « riper » (Oulala.net) : http://www.oulala.net/Portail/article.php3?id_article=3713 (l’orthographe et la ponctuation ont été révisées). C’est moi qui souligne.
Donnée Obama a été élu, donc Conclusion il fait nécessairement partie du système, puisque Garantie personne ne peut arriver à la première place sans l’appui du système, étant donné Fondement la nature immuable, l’essence du système, et celle des hommes qui y participent.
Rhétorique du complot. Itinéraire d’une pensée fermée 87
On comprend donc que l’horizon d’un édifice mental de ce type est de permettre à l’égard de n’importe quelle situation l’annonce de ce qui doit se produire par nécessité, en fonction d’une essence des choses (institutions, organisations, etc.) et des êtres qui y participent. En consé-quence, tous les événements ne peuvent être autrement que signifiants au regard d’un « système » qui sature la totalité du réel, et ajuste tout ce qui doit advenir à sa propre nature intemporelle. Inutile de préciser que les prédictions contenues dans les théories du complot, à l’image de celles des astrologues, doivent demeurer suffisamment imprécises pour garantir leur caractère infalsifiable (Popper), et accéder à un haut niveau de généralité pour permettre à tout un chacun de les interpréter suivant sa culture et le sens de ses préoccupations.
II. Le principe de requalification ou l’infinie reconstruction des faits
À présent, et conformément aux acquis de la première partie, j’aimerais m’intéresser à un processus définitoire des théories du complot : celui de la « requalification ». Ce processus permet de garantir la pérennité du « système », c’est-à-dire de réguler la confrontation de ce dernier au monde réel. Le présent développement se propose de répondre à deux questions : (1) Que faire lorsque la prédiction ne se réalise pas et même se révèle fausse ? (2) Qu’est-ce qui fait tenir le « système » par-delà la manifestation de faits réputés impossibles (c’est-à-dire non conformes au sens voulu par l’édifice conspirationniste) ?
Le premier constat que l’on peut faire, consiste à dire que la récu-sation absolue des faits, de l’évidence sensible, demeure difficile voire impossible à tenir d’un point de vue argumentatif, et ce dans la mesure où le locuteur tendrait à se disqualifier en tant qu’instance de parole au regard des exigences impératives de la raison moderne. Nier l’existence catégorique d’une chose (ou d’un état du monde) pourtant perceptible ou acceptable par tout un chacun, revient donc à se mettre en porte-à-faux à l’égard d’un sens commun – la doxa26 – qui se trouve dès lors désavoué
26. Voir à ce propos, Nicolas L., La Force de la doxa – Rhétorique de la décision
88 Loïc Nicolas
dans sa définition27 : « “Une erreur de fait jette un homme sage dans le ridicule”, nous dit La Bruyère, à condition évidemment que cette erreur constitue un fait incontestable. Le prestige d’aucun homme ne pourra nous faire admettre que 2 + 2 = 5, ni croire le témoignage de quelqu’un, s’il nous semble contraire à l’expérience28 ». C’est pourquoi le proces-sus à l’œuvre dans l’« administration » de la réalité propre aux théories conspirationnistes consiste (le plus souvent) non pas à nier l’évidence factuelle, mais bien plutôt à tordre, à réinterpréter l’événement afin de le rendre conforme à la théorie en lui injectant des « qualités » (ou des propriétés) nouvelles. À titre d’exemple, on pourrait citer l’importance donnée, notamment chez les penseurs antisionistes européens, aux théo-ries révisionnistes contre celles négationnistes qui, dans leur énonciation même (à savoir dans la remise en cause globale de l’existence du géno-cide), ont tendance à rendre inopérante toute l’argumentation.
Un processus de ce type se retrouve tout particulièrement dans la pensée mythique, telle qu’elle s’exprime, par exemple, chez Talayesva29 dans Soleil hopi. Un épisode de sa vie – que l’on pourrait aisément rapprocher de certaines traditions bien connues chez nous (je pense ici aux cloches de Pâques ou au Père Noël) – est à ce titre très éclairant. Parmi les croyances hopi, l’une d’elles veut que les esprits des Anciens reviennent régulièrement dans le village sous la forme de Katcina, c’est-à-dire de dieux costumés et masqués, pour danser, chanter et offrir aux enfants des cadeaux (fruits, objets) ou autres bénédictions. C’est du moins ce que les adultes font croire à ceux-ci jusqu’à leur initiation (qui ne concerne que les garçons), laquelle leur révèle alors non seulement les fondements du rituel autant que les secrets de ce culte hopi, mais surtout la présence de membres initiés du clan (parents, frères plus âgés, oncles, etc.) derrière les masques animés des Katcina. Or, il se trouve qu’un jour le narrateur (non encore initié), malgré son
et de la délibération, Préface de D. Denis, Paris, L’Harmattan, coll. « Ouverture phi-losophique », 2007.
27. On pourrait à ce titre introduire la figure de l’atopos. Sur cette question on se reportera notamment aux analyses d’E. Danblon : La fonction persuasive : anthropo-logie du discours rhétorique, origines et actualité, op. cit., p. 53.
28. Perelman Ch. et Olbrechts-Tyteca L., « Acte et personne dans l’argumen-tation », dans Ch. Perelman, Rhétoriques, Bruxelles, Éd. de l’Université de Bruxelles, 1989, p. 281.
29. Les développements qu’on va lire dans cette troisième partie doivent beaucoup aux conversations de leur auteur avec L. Boltanski, ainsi qu’aux orientations et conseils bibliographiques de celui-ci.
Rhétorique du complot. Itinéraire d’une pensée fermée 89
amour des Katcina et le bonheur qu’il éprouve à recevoir des présents de leur part, s’aperçoit que les « hochets de calebasse » que les Katcina offrent à chaque cérémonie sont toujours les mêmes. Peu de temps après, il surprend sa mère en train de cuisiner du piki rouge – le piki étant une galette de maïs, base de l’alimentation hopi –, c’est-à-dire d’une couleur identique à celui qu’il reçoit traditionnellement lors des cérémonies avec les Katcina, et qu’il n’avait jamais vu préparer par personne auparavant. Dans les deux cas, le narrateur est profondément troublé et très malheureux, car il ne comprend pas dans quelle mesure de tels événements sont possibles au regard de la croyance qui structure son existence sociale et spirituelle, de même que la vie du clan. En d’autres termes, ces événements ne font pas sens dans son univers de représentations et d’attentes sociales. Le jeune hopi a donc deux solu-tions : soit (1) il conserve ces faits en l’état, et perd alors confiance (sur la base d’une tromperie avérée) en un système global de compréhension et d’explication du monde, soit (2) il attribue aux faits des « qualités » ad hoc et congruentes au système, il les réinterprète à la lumière de la doxa du groupe, laquelle gère un répertoire d’attentes et d’événements possibles. C’est bien ce dernier processus qui se produit dans le cas des « hochets » et amène le jeune hopi à la conclusion suivante : soit (1) les Katcina volent eux-mêmes les hochets après chaque fête, soit (2) ce sont les parents qui les volent pour les rendre aux Katcina afin que ceux-ci les redonnent indéfiniment. Deux solutions qui permettent de contourner la contradiction entre l’être et la croyance en un état du monde. En ce qui concerne le piki rouge sa mère lui explique que les Katcina avaient commencé à le cuisiner, puis l’avaient laissé en plan, et qu’elle-même ne faisait qu’en terminer la préparation : tout rentre alors dans l’ordre, d’autant que les Katcina ont l’heureuse idée d’offrir du piki jaune (plutôt que du rouge) lors de la cérémonie30. Le système est préservé, la confiance en lui est sauve.
Un mécanisme de réinterprétation à peu près identique à celui-ci se manifeste chez les adeptes des sectes apocalyptiques, notamment lorsque la fin du monde est annoncée à une date précise et que rien
30. Voir Talayesva Don C., Soleil hopi – L’autobiographie d’un Indien Hopi, textes rassemblés et présentés par L. W. Simmons, trad. G. Mayoux, Préface de Cl. Lévi-Strauss, Paris, Plon-Pocket, coll. « Terre Humaine/Poche », 2002, p. 94-95. Cet ouvrage écrit par un indien d’Amérique témoigne de son existence dans la tribu du Clan du Soleil.
90 Loïc Nicolas
ne se produit le jour dit. Comment dans ces conditions continuer à accepter l’édifice doctrinal, alors qu’il se trouve manifestement tenu en échec par la non-réalisation de la prédiction ? Les faits réels et le système entrent dans une contradiction apparemment indissoluble, du moins en l’état. C’est ainsi que la reconstruction mentale amène à considérer l’erreur comme indépendante du système, en d’autres termes à reconnaître la valeur intrinsèque de la prédiction malgré le démenti des faits, par exemple en assurant qu’une malencontreuse erreur de datation s’y est introduite. L’erreur serait liée (à l’image des problèmes de manipulation et d’expérimentation dans un laboratoire) aux circonstances de production de la prédiction, par exemple à la mauvaise appréciation des données, et non pas à la construction théo-rique, nécessairement valide, qui a présidé à son énonciation.
Accepter la valeur réelle de la contradiction en admettant sa dimen-sion falsificatrice, aurait pour conséquence l’effondrement imparable de tout cet univers de croyances et de représentations qui donne sens au monde et aux événements qui s’y produisent. Afin de saisir concrè-tement la puissance persuasive, parmi les partisans des « théories du complot », du processus de « requalification des faits », considérons la modélisation suivante :
Tableau 3 : Modèle général de requalification des faits dans les théories du complot
En d’autres termes, si au sein d’un Système (S) appartenant à un Monde particulier (M), la Prédiction (Pr) [ou Vérité (V)] relative au Postulat
les Katcina ont l’heureuse idée d’offrir du piki jaune (plutôt que du rouge) lors de la cérémonie152. Le système est préservé, la confiance en lui est sauve.
Un mécanisme de réinterprétation à peu près identique à celui-ci se manifeste chez les adeptes des sectes apocalyptiques, notamment lorsque la fin du monde est annoncée à une date précise et que rien ne se produit le jour dit. Comment dans ces conditions continuer à accepter l’édifice doctrinal, alors qu’il se trouve manifestement tenu en échec par la non-réalisation de la prédiction ? Les faits réels et le système entrent dans une contradiction apparemment indissoluble, du moins en l’état. C’est ainsi que la reconstruction mentale amène à considérer l’erreur comme indépendante du système, en d’autres termes à reconnaître la valeur intrinsèque de la prédiction malgré le démenti des faits, par exemple en assurant qu’une malencontreuse erreur de datation s’y est introduite. L’erreur serait liée (à l’image des problèmes de manipulation et d’expérimentation dans un laboratoire) aux circonstances de production de la prédiction, par exemple à la mauvaise appréciation des données, et non pas à la construction théorique, nécessairement valide, qui a présidé à son énonciation. Accepter la valeur réelle de la contradiction en admettant sa dimension falsificatrice, aurait pour conséquence l’effondrement imparable de tout cet univers de croyances et de représentations qui donne sens au monde et aux événements qui s’y produisent. Afin de saisir pleinement la puissance persuasive, parmi les partisans des « théories du complot », du processus de « requalification des faits », considérons la modélisation suivante :
Tableau 3 :
Modèle général de requalification des faits dans les théories du complot
Soit un Système (S) ∈ Monde (M)
Postulat (P) → Prédiction (Pr) [ou Vérité (V)]or
Événement (E) ≠ Pr [ou V]donc
S ∉ Mà moins que
E’ = Pr
En d’autres termes, si au sein d’un Système (S) appartenant à un Monde particulier (M), la Prédiction (Pr) [ou Vérité (V)] relative au Postulat initial soutenu par S, se trouve contredite par un Événement (E) quelconque, cela doit plaider pour l’inexistence de S dans M, à moins que E, requalifié dans les termes de S, c’est-à-dire E’, soit équivalent à Pr [ou V]. La requalification de l’Événement, ou pour le dire autrement l’insertion d’une « composante restrictive », au sens de Stephen Toulmin, dans l’édifice théorique, constitue la clause de sauvegarde de toutes les théories du complot – clause sans laquelle elles se trouveraient systématiquement disqualifiées aux yeux de tous, et, sans doute, primordialement à ceux de leurs partisans. Gérer la contradiction entre E et Pr, cela revient donc à injecter dans E les composantes de Pr. De fait, la Prédiction apparaît comme réalisée, mais sous une autre forme, inattendue, et finalement éminemment plus porteuse de sens que si Pr s’était accomplie elle-même, dans la mesure où les adeptes des théories du complot peuvent y lire la « preuve » irréfutable (ou plutôt infalsifiable) de l’existence du « système » et la manifestation attestée de son intrinsèque perversité. Examinons successivement deux exemples afin d’illustrer le présent modèle :
152 Voir TALAYESVA Don C., Soleil hopi – L’autobiographie d’un Indien Hopi, textes rassemblés et présentés par L. W. Simmons, trad. G. Mayoux, Préface de Cl. Lévi-Strauss, Paris, Plon-Pocket, coll. « Terre Humaine / Poche », 2002, p. 94-95. Cet ouvrage écrit par un indien d’Amérique témoigne de son existence dans la tribu du Clan du Soleil
les Katcina ont l’heureuse idée d’offrir du piki jaune (plutôt que du rouge) lors de la cérémonie152. Le système est préservé, la confiance en lui est sauve.
Un mécanisme de réinterprétation à peu près identique à celui-ci se manifeste chez les adeptes des sectes apocalyptiques, notamment lorsque la fin du monde est annoncée à une date précise et que rien ne se produit le jour dit. Comment dans ces conditions continuer à accepter l’édifice doctrinal, alors qu’il se trouve manifestement tenu en échec par la non-réalisation de la prédiction ? Les faits réels et le système entrent dans une contradiction apparemment indissoluble, du moins en l’état. C’est ainsi que la reconstruction mentale amène à considérer l’erreur comme indépendante du système, en d’autres termes à reconnaître la valeur intrinsèque de la prédiction malgré le démenti des faits, par exemple en assurant qu’une malencontreuse erreur de datation s’y est introduite. L’erreur serait liée (à l’image des problèmes de manipulation et d’expérimentation dans un laboratoire) aux circonstances de production de la prédiction, par exemple à la mauvaise appréciation des données, et non pas à la construction théorique, nécessairement valide, qui a présidé à son énonciation. Accepter la valeur réelle de la contradiction en admettant sa dimension falsificatrice, aurait pour conséquence l’effondrement imparable de tout cet univers de croyances et de représentations qui donne sens au monde et aux événements qui s’y produisent. Afin de saisir pleinement la puissance persuasive, parmi les partisans des « théories du complot », du processus de « requalification des faits », considérons la modélisation suivante :
Tableau 3 :
Modèle général de requalification des faits dans les théories du complot
Soit un Système (S) ∈ Monde (M)
Postulat (P) → Prédiction (Pr) [ou Vérité (V)]or
Événement (E) ≠ Pr [ou V]donc
S ∉ Mà moins que
E’ = Pr
En d’autres termes, si au sein d’un Système (S) appartenant à un Monde particulier (M), la Prédiction (Pr) [ou Vérité (V)] relative au Postulat initial soutenu par S, se trouve contredite par un Événement (E) quelconque, cela doit plaider pour l’inexistence de S dans M, à moins que E, requalifié dans les termes de S, c’est-à-dire E’, soit équivalent à Pr [ou V]. La requalification de l’Événement, ou pour le dire autrement l’insertion d’une « composante restrictive », au sens de Stephen Toulmin, dans l’édifice théorique, constitue la clause de sauvegarde de toutes les théories du complot – clause sans laquelle elles se trouveraient systématiquement disqualifiées aux yeux de tous, et, sans doute, primordialement à ceux de leurs partisans. Gérer la contradiction entre E et Pr, cela revient donc à injecter dans E les composantes de Pr. De fait, la Prédiction apparaît comme réalisée, mais sous une autre forme, inattendue, et finalement éminemment plus porteuse de sens que si Pr s’était accomplie elle-même, dans la mesure où les adeptes des théories du complot peuvent y lire la « preuve » irréfutable (ou plutôt infalsifiable) de l’existence du « système » et la manifestation attestée de son intrinsèque perversité. Examinons successivement deux exemples afin d’illustrer le présent modèle :
152 Voir TALAYESVA Don C., Soleil hopi – L’autobiographie d’un Indien Hopi, textes rassemblés et présentés par L. W. Simmons, trad. G. Mayoux, Préface de Cl. Lévi-Strauss, Paris, Plon-Pocket, coll. « Terre Humaine / Poche », 2002, p. 94-95. Cet ouvrage écrit par un indien d’Amérique témoigne de son existence dans la tribu du Clan du Soleil
les Katcina ont l’heureuse idée d’offrir du piki jaune (plutôt que du rouge) lors de la cérémonie152. Le système est préservé, la confiance en lui est sauve.
Un mécanisme de réinterprétation à peu près identique à celui-ci se manifeste chez les adeptes des sectes apocalyptiques, notamment lorsque la fin du monde est annoncée à une date précise et que rien ne se produit le jour dit. Comment dans ces conditions continuer à accepter l’édifice doctrinal, alors qu’il se trouve manifestement tenu en échec par la non-réalisation de la prédiction ? Les faits réels et le système entrent dans une contradiction apparemment indissoluble, du moins en l’état. C’est ainsi que la reconstruction mentale amène à considérer l’erreur comme indépendante du système, en d’autres termes à reconnaître la valeur intrinsèque de la prédiction malgré le démenti des faits, par exemple en assurant qu’une malencontreuse erreur de datation s’y est introduite. L’erreur serait liée (à l’image des problèmes de manipulation et d’expérimentation dans un laboratoire) aux circonstances de production de la prédiction, par exemple à la mauvaise appréciation des données, et non pas à la construction théorique, nécessairement valide, qui a présidé à son énonciation. Accepter la valeur réelle de la contradiction en admettant sa dimension falsificatrice, aurait pour conséquence l’effondrement imparable de tout cet univers de croyances et de représentations qui donne sens au monde et aux événements qui s’y produisent. Afin de saisir pleinement la puissance persuasive, parmi les partisans des « théories du complot », du processus de « requalification des faits », considérons la modélisation suivante :
Tableau 3 :
Modèle général de requalification des faits dans les théories du complot
Soit un Système (S) ∈ Monde (M)
Postulat (P) → Prédiction (Pr) [ou Vérité (V)]or
Événement (E) ≠ Pr [ou V]donc
S ∉ Mà moins que
E’ = Pr
En d’autres termes, si au sein d’un Système (S) appartenant à un Monde particulier (M), la Prédiction (Pr) [ou Vérité (V)] relative au Postulat initial soutenu par S, se trouve contredite par un Événement (E) quelconque, cela doit plaider pour l’inexistence de S dans M, à moins que E, requalifié dans les termes de S, c’est-à-dire E’, soit équivalent à Pr [ou V]. La requalification de l’Événement, ou pour le dire autrement l’insertion d’une « composante restrictive », au sens de Stephen Toulmin, dans l’édifice théorique, constitue la clause de sauvegarde de toutes les théories du complot – clause sans laquelle elles se trouveraient systématiquement disqualifiées aux yeux de tous, et, sans doute, primordialement à ceux de leurs partisans. Gérer la contradiction entre E et Pr, cela revient donc à injecter dans E les composantes de Pr. De fait, la Prédiction apparaît comme réalisée, mais sous une autre forme, inattendue, et finalement éminemment plus porteuse de sens que si Pr s’était accomplie elle-même, dans la mesure où les adeptes des théories du complot peuvent y lire la « preuve » irréfutable (ou plutôt infalsifiable) de l’existence du « système » et la manifestation attestée de son intrinsèque perversité. Examinons successivement deux exemples afin d’illustrer le présent modèle :
152 Voir TALAYESVA Don C., Soleil hopi – L’autobiographie d’un Indien Hopi, textes rassemblés et présentés par L. W. Simmons, trad. G. Mayoux, Préface de Cl. Lévi-Strauss, Paris, Plon-Pocket, coll. « Terre Humaine / Poche », 2002, p. 94-95. Cet ouvrage écrit par un indien d’Amérique témoigne de son existence dans la tribu du Clan du Soleil
Soit un Système (S) Monde (M)
Postulat (P) Prédiction (Pr) [ou Vérité (V)]or
Événement (E) ≠ Pr [ou V]doncS M
à moins queE’= Pr
Rhétorique du complot. Itinéraire d’une pensée fermée 91
initial soutenu par S, se trouve contredite par un Événement (E) quel-conque, cela doit plaider pour l’inexistence de S dans M, à moins que E, requalifié dans les termes de S, c’est-à-dire E’ soit équivalent à Pr [ou V]. La requalification de l’Événement, ou pour le dire autrement l’insertion d’une « composante restrictive », au sens de Stephen Toulmin, dans l’édi-fice théorique, constitue la clause de sauvegarde de toutes les théories du complot – clause sans laquelle elles se trouveraient systématiquement disqualifiées aux yeux de tous, et, sans doute, primordialement à ceux de leurs partisans.
Gérer la contradiction entre E et Pr, cela revient donc à injecter dans E les composantes de Pr. De fait, la Prédiction apparaît comme réalisée, mais sous une autre forme, inattendue, et finalement éminemment plus porteuse de sens que si Pr s’était accomplie elle-même, dans la mesure où les adeptes des théories du complot peuvent y lire la « preuve » irréfutable (ou plutôt infalsifiable) de l’existence du « système » et la manifestation attestée de son intrinsèque perversité. Examinons succes-sivement deux exemples afin d’illustrer le présent modèle :
L’élection d’Obama
Selon les partisans du complot américain, pour qui les États-Unis sont nécessairement détenteurs de tous les plus grands (ou vils) secrets du monde, lesquels secrets doivent être protégés et transmis entre des hommes « initiés » élevés dans le culte de la conspiration internationale, l’élection d’un Noir-Américain, jeune, ayant un père de confession musulmane, demeurait impossible, bien qu’ils l’appellent de leurs vœux. Or, il se trouve que, contre toute attente de leur part, c’est bien ce qui est advenu. En conséquence : comment un tel fait peut-il être intégré au système sans pour autant remettre en cause celui-ci dans son exis-tence même ? Ainsi que nous le verrons la gestion de la contradiction procède bien par requalification des faits, c’est-à-dire par attribution de « qualités » particulières à la personne d’Obama pour en faire une sorte de crypto-républicain, ou pour le dire autrement un autre (un nouveau) McCain. Analysons, suivant le modèle fourni précédemment, un extrait de l’article « Obama : l’héritage écrasant » signé du pseudonyme « Ashoka » : « [N]e nous faisons aucune illusion. Avant d’être Noir, Obama est Américain. Et il a été élu grâce à l’argent des riches. Sa femme est membre d’une société Illuminati. On sait aussi qu’Obama est cousin éloigné d’autres politiciens républicains comme Dick Cheney. Il y a eu
92 Loïc Nicolas
volonté évidente des cercles dirigeants américains de redorer le blason des États-Unis au niveau mondial, après le désastreux George W. Bush. L’image, fausse ou non, d’une Amérique plus fréquentable achètera quelques années de plus au pays31 ».
Tableau 4
Inutile de s’étendre beaucoup sur cet exemple, disons seulement que le passage de E à E’ s’effectue par ce qui ressemble à un amalgame de propriétés, d’indices et de pseudo-preuves éparses qui viennent témoi-gner de la vraie nature d’Obama, c’est-à-dire de son identité parfaite avec le candidat républicain (voter Obama, ce « politicien républicain » parmi « d’autres » comme le dit le texte, c’est, en quelque sorte, voter McCain, et même mieux ou pire, c’est voter pour un McCain qui ne dit pas son nom). De fait, assiste-t-on ici à un travail sur ce que l’on peut supposer être l’essence même de l’individu (son patrimoine historique, et dans une certaine mesure génétique), afin de le rendre disponible, par effet de requalification, à la dénonciation du postulat initial, la dénon-ciation du complot.
La démonstration de falsification des Protocoles des Sages de Sion
Un phénomène assez similaire s’est produit après la démonstration effectuée, dès août 1921 par le Times, de la supercherie concernant
31. Citation tirée du site Oulala.net : http://www.oulala.net/Portail/article.php3?id_article =3713 (orthographe et ponctuation révisées).
Il y a un complot américain (S) mondial (M)
Les cercles dirigeants doivent protéger leurs intérêts (P) McCain sera élu (Pr)or
Élection d’Obama (E) ≠ Pr [ou V]donc
Il n’y a pas de complot américain mondialà moins que
Obama (société illuminati + cousin de Dick Cheney, etc.) (E’) = McCain
les Katcina ont l’heureuse idée d’offrir du piki jaune (plutôt que du rouge) lors de la cérémonie152. Le système est préservé, la confiance en lui est sauve.
Un mécanisme de réinterprétation à peu près identique à celui-ci se manifeste chez les adeptes des sectes apocalyptiques, notamment lorsque la fin du monde est annoncée à une date précise et que rien ne se produit le jour dit. Comment dans ces conditions continuer à accepter l’édifice doctrinal, alors qu’il se trouve manifestement tenu en échec par la non-réalisation de la prédiction ? Les faits réels et le système entrent dans une contradiction apparemment indissoluble, du moins en l’état. C’est ainsi que la reconstruction mentale amène à considérer l’erreur comme indépendante du système, en d’autres termes à reconnaître la valeur intrinsèque de la prédiction malgré le démenti des faits, par exemple en assurant qu’une malencontreuse erreur de datation s’y est introduite. L’erreur serait liée (à l’image des problèmes de manipulation et d’expérimentation dans un laboratoire) aux circonstances de production de la prédiction, par exemple à la mauvaise appréciation des données, et non pas à la construction théorique, nécessairement valide, qui a présidé à son énonciation. Accepter la valeur réelle de la contradiction en admettant sa dimension falsificatrice, aurait pour conséquence l’effondrement imparable de tout cet univers de croyances et de représentations qui donne sens au monde et aux événements qui s’y produisent. Afin de saisir pleinement la puissance persuasive, parmi les partisans des « théories du complot », du processus de « requalification des faits », considérons la modélisation suivante :
Tableau 3 :
Modèle général de requalification des faits dans les théories du complot
Soit un Système (S) ∈ Monde (M)
Postulat (P) → Prédiction (Pr) [ou Vérité (V)]or
Événement (E) ≠ Pr [ou V]donc
S ∉ Mà moins que
E’ = Pr
En d’autres termes, si au sein d’un Système (S) appartenant à un Monde particulier (M), la Prédiction (Pr) [ou Vérité (V)] relative au Postulat initial soutenu par S, se trouve contredite par un Événement (E) quelconque, cela doit plaider pour l’inexistence de S dans M, à moins que E, requalifié dans les termes de S, c’est-à-dire E’, soit équivalent à Pr [ou V]. La requalification de l’Événement, ou pour le dire autrement l’insertion d’une « composante restrictive », au sens de Stephen Toulmin, dans l’édifice théorique, constitue la clause de sauvegarde de toutes les théories du complot – clause sans laquelle elles se trouveraient systématiquement disqualifiées aux yeux de tous, et, sans doute, primordialement à ceux de leurs partisans. Gérer la contradiction entre E et Pr, cela revient donc à injecter dans E les composantes de Pr. De fait, la Prédiction apparaît comme réalisée, mais sous une autre forme, inattendue, et finalement éminemment plus porteuse de sens que si Pr s’était accomplie elle-même, dans la mesure où les adeptes des théories du complot peuvent y lire la « preuve » irréfutable (ou plutôt infalsifiable) de l’existence du « système » et la manifestation attestée de son intrinsèque perversité. Examinons successivement deux exemples afin d’illustrer le présent modèle :
152 Voir TALAYESVA Don C., Soleil hopi – L’autobiographie d’un Indien Hopi, textes rassemblés et présentés par L. W. Simmons, trad. G. Mayoux, Préface de Cl. Lévi-Strauss, Paris, Plon-Pocket, coll. « Terre Humaine / Poche », 2002, p. 94-95. Cet ouvrage écrit par un indien d’Amérique témoigne de son existence dans la tribu du Clan du Soleil
Rhétorique du complot. Itinéraire d’une pensée fermée 93
les Protocoles. À partir de cette date, l’opinion publique occidentale est informée de l’imposture, au sens où la falsification a fait l’objet d’un exposé philologique incontestable et largement diffusé. Le ou les faussaires se sont attachés à récrire un pamphlet source, à savoir le Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu de Maurice Joly, en changeant les noms et en déplaçant les accusations portées contre Napoléon III vers les juifs, incarnés par leurs hiérarques, les « Sages de Sion », réunis en assemblée secrète. Malgré cette preuve imparable le texte a continué à être publié, lu et commenté comme s’il s’agissait d’une source d’informations primordiales et historiquement vérifiées. En tout état de cause, les Protocoles sont parvenus à gagner en « véra-cité » ce qu’ils avaient perdu en « authenticité32 », ainsi qu’Émile Poulat en fait la remarque dans l’article cité plus haut. Certes, mais pourquoi ? Pourquoi, leur mise en cause radicale a-t-elle fait progresser leur popularité ? Relisons l’introduction que Roger Lambelin donne aux Protocoles, et dans laquelle il répond aux accusions de plagiat :
« Ou bien l’auteur des “Protocol[e]s” a trouvé quelques unes de ses idées dans Maurice Joly, ou bien l’un et l’autre ont puisé à une source commune. Les Juifs, – et on le conçoit, – se sont accrochés désespérément à la première hypothèse. Alors une autre hypothèse vient à l’esprit. Pourquoi l’auteur mystérieux des “Protocol[e]s »” n’aurait-il pas été puiser à la même source que Maurice Joly ? […] Pourquoi Maurice Joly, franc-maçon de haut grade et qui plus est, enfant chéri d’Adolphe Crémieux, le fondateur de l’Alliance Israélite Universelle, qui à sa sortie des prisons impériales l’avait aidé à fonder une revue judiciaire Le Palais, n’aurait-il pas été au courant de cette littérature qui cuit, qui mitonne dans les loges et qui tout à coup, par échappées brusques, comme lors de la saisie des papiers des Illuminés de Bavière, en 1797, ou ceux de la Haute-Vente Italienne sous Grégoire XVI, jaillit au dehors ? Les Dialogues de Genève ne sont pas sortis tout ainsi du cerveau de Maurice Joly. On ne produit pas une œuvre aussi touffue sans texte, sans référence33. »
32. Poulat E., « L’esprit du complot », dans Politica Hermetica, n° 6, 1992, p. 10.33. Les Protocols des Sages de Sion, nouvelle édition, RISS – « Ligue Franc-
catholique », 1934, p. 31-33.
94 Loïc Nicolas
En tout état de cause, Roger Lambelin, reconnaît l’existence de ressem-blances frappantes entre les deux textes ; il ne peut nier l’évidence, ni la réalité de la démonstration philologique, il accepte les faits, mais afin de sauver l’édifice théorique sur lequel repose sa compréhension du monde – l’existence nécessaire d’un complot judéo-maçonnique – il se voit obligé, à partir d’une mise en série d’indices (Adolphe Crémieux, Alliance Israélite Universelle, loges maçonniques, etc.) et d’analogies (« comme lors de la saisie des papiers des Illuminés de Bavière… ») supposés concordants, de requalifier le rapport qui lie le Dialogue et les Protocoles en introduisant un mystérieux document « source » – sorte de secret des secrets ou de saint des saints –, dans lequel les juifs, ou les crypto-sémites comme Maurice Joly, seraient venus puiser. Les faits sont acceptés jusqu’à un certain point au-delà duquel il faudrait admettre l’échec total de cette vision du monde totalisante qui se structure et s’organise autour de la dénonciation du complot judéo-maçonnique. Que les Protocoles soient de première ou de deuxième main, cela n’a finale-ment que peu d’importance, ils sont « vrais » à défaut d’être absolument authentiques, et ce, dans la mesure où, il existe forcément une littérature secrète matricielle – introuvable, inaccessible, mais dont on doit néces-sairement postuler l’existence – qui a rendu les deux textes possibles.
Tableau 5
Il y a un complot juif de domination (S) du monde (M)
Les Juifs ont une essence (P implicite) Les Protocoles (qui prouvent le complot juif) sont authentiques (V)
or
Dialogue aux enfers + Preuve du plagiat (E) ≠ Vdonc
Il n’y a pas de complot juif de domination du mondeà moins que
Il existe un texte source (une matrice) et que Maurice Joly soit un « crypto-sémite » franc-maçon, ami d’Adolphe Crémieux
(E’) = Authenticité des Protocoles
les Katcina ont l’heureuse idée d’offrir du piki jaune (plutôt que du rouge) lors de la cérémonie152. Le système est préservé, la confiance en lui est sauve.
Un mécanisme de réinterprétation à peu près identique à celui-ci se manifeste chez les adeptes des sectes apocalyptiques, notamment lorsque la fin du monde est annoncée à une date précise et que rien ne se produit le jour dit. Comment dans ces conditions continuer à accepter l’édifice doctrinal, alors qu’il se trouve manifestement tenu en échec par la non-réalisation de la prédiction ? Les faits réels et le système entrent dans une contradiction apparemment indissoluble, du moins en l’état. C’est ainsi que la reconstruction mentale amène à considérer l’erreur comme indépendante du système, en d’autres termes à reconnaître la valeur intrinsèque de la prédiction malgré le démenti des faits, par exemple en assurant qu’une malencontreuse erreur de datation s’y est introduite. L’erreur serait liée (à l’image des problèmes de manipulation et d’expérimentation dans un laboratoire) aux circonstances de production de la prédiction, par exemple à la mauvaise appréciation des données, et non pas à la construction théorique, nécessairement valide, qui a présidé à son énonciation. Accepter la valeur réelle de la contradiction en admettant sa dimension falsificatrice, aurait pour conséquence l’effondrement imparable de tout cet univers de croyances et de représentations qui donne sens au monde et aux événements qui s’y produisent. Afin de saisir pleinement la puissance persuasive, parmi les partisans des « théories du complot », du processus de « requalification des faits », considérons la modélisation suivante :
Tableau 3 :
Modèle général de requalification des faits dans les théories du complot
Soit un Système (S) ∈ Monde (M)
Postulat (P) → Prédiction (Pr) [ou Vérité (V)]or
Événement (E) ≠ Pr [ou V]donc
S ∉ Mà moins que
E’ = Pr
En d’autres termes, si au sein d’un Système (S) appartenant à un Monde particulier (M), la Prédiction (Pr) [ou Vérité (V)] relative au Postulat initial soutenu par S, se trouve contredite par un Événement (E) quelconque, cela doit plaider pour l’inexistence de S dans M, à moins que E, requalifié dans les termes de S, c’est-à-dire E’, soit équivalent à Pr [ou V]. La requalification de l’Événement, ou pour le dire autrement l’insertion d’une « composante restrictive », au sens de Stephen Toulmin, dans l’édifice théorique, constitue la clause de sauvegarde de toutes les théories du complot – clause sans laquelle elles se trouveraient systématiquement disqualifiées aux yeux de tous, et, sans doute, primordialement à ceux de leurs partisans. Gérer la contradiction entre E et Pr, cela revient donc à injecter dans E les composantes de Pr. De fait, la Prédiction apparaît comme réalisée, mais sous une autre forme, inattendue, et finalement éminemment plus porteuse de sens que si Pr s’était accomplie elle-même, dans la mesure où les adeptes des théories du complot peuvent y lire la « preuve » irréfutable (ou plutôt infalsifiable) de l’existence du « système » et la manifestation attestée de son intrinsèque perversité. Examinons successivement deux exemples afin d’illustrer le présent modèle :
152 Voir TALAYESVA Don C., Soleil hopi – L’autobiographie d’un Indien Hopi, textes rassemblés et présentés par L. W. Simmons, trad. G. Mayoux, Préface de Cl. Lévi-Strauss, Paris, Plon-Pocket, coll. « Terre Humaine / Poche », 2002, p. 94-95. Cet ouvrage écrit par un indien d’Amérique témoigne de son existence dans la tribu du Clan du Soleil
Rhétorique du complot. Itinéraire d’une pensée fermée 95
Conclusion
Disons, pour refermer et en même temps ouvrir cette contribution au volume, que la différence fondamentale entre la démarche scienti-fique et les théories du complot – dont elles ne cessent pourtant de se prévaloir à des fins persuasives et dont elles revendiquent la solidité de la démonstration – relève de leur comportement à l’égard des faits, ou, pour le dire autrement, de leur façon d’administrer et plus encore de « dire » le réel, c’est-à-dire de régler les problèmes, les incohérences entre ce qui est cru et ce qui advient (ou est advenu). Elles se font face, comme s’opposent les sociétés ouvertes et les sociétés closes. Dans le cas des théories du complot, le rapport aux « événements du monde » est fondé sur la domination et la contrainte, ces derniers demeurent ré-interprétables à l’infini jusqu’à ce qu’ils soient intégrables sans dommage au sein d’un système causal explicatif sacralisé et a-his-torique. Partant, les rhétoriques conspirationnistes s’attachent-elles à faire dire aux faits – abolis dans leur intégrité – ce qu’elles projettent sur un monde saturé par la nécessité maléfique de ce qui est tou-jours censé s’y produire. À l’inverse, la démarche scientifique repose d’abord sur la considération qu’elle réserve au champ du factuel, la prise en compte de celui-ci dans ses qualités propres. Aussi, une théorie scientifique est-elle réputée vraie jusqu’à preuve du contraire, c’est-à-dire jusqu’à ce que les faits viennent la démentir et contredire sa validité. Si une théorie est opératoire pour expliquer et comprendre « ce qui est », qu’elle génère des prévisions réalisées, il est légitime de la conserver en l’état. Mais dès que le réel lui échappe, que les faits résistent et demeurent impossibles à interpréter par son intermédiaire, il est du devoir du scientifique de la réformer – afin de la rendre adé-quate aux faits, et non l’inverse –, voire, si cette opération se révèle au bout du compte insuffisante, c’est-à-dire après des « échecs répétés », de la remplacer par une théorie nouvelle mieux à même de répondre objectivement aux défis pressants du monde empirique.
96 Loïc Nicolas
La notion de « théorie du complot ».Plaidoyer pour une
méthodologie empirique
Evgenia Paparouni
L’objectif de cet article est double. Il s’agit d’abord de discuter le para-doxe selon lequel la dénonciation des théories du complot utilise souvent elle-même des schémas polarisés, manichéens et conspirationnistes.
Dans cette perspective, je voudrais passer en revue les objections de principe que l’on adresse aux théories du complot, et tout spécialement les objections fondées sur les critères de fausseté, d’improbabilité et de non-pertinence. En outre, compte tenu du fait qu’il est possible d’attribuer des intentions dans le cadre d’une psychologie populaire, le critère de littéralité de ce genre d’attributions revêt également une cer-taine importance. Enfin, telle qu’elle s’exerce sur la place publique, la dénonciation d’une théorie du complot dans la parole de l’autre procède par un jeu d’intertextualité qu’il convient d’examiner avec précision. Le réquisitoire argumentatif ainsi mis en scène est volontiers utilisé pour contester tout contenu qui relèverait rhétoriquement de la parole dénoncée, ce qui permet de se passer d’une argumentation portant « sur le fond ».
Mon deuxième objectif est de montrer comment les récits de complot s’associent à des croyances motivationnelles, nuancées par les désirs, les émotions et les valeurs du sujet1. L’assimilation de ces croyances nécessite une vision « large » de notre rationalité et devrait procéder d’analyses textuelles qui ne peuvent être menées qu’au cas par cas.
1. Clément F., Les mécanismes de la crédulité, Genève, Droz, coll. « Travaux de sciences sociales », 2006.
I. Définitions et problèmes de catégorisation : un attribut subjectif pour un référent fugace
Prenons comme définition de base du complot la « concertation secrète pour faire du mal2 », et comme définition de base de la théorie du complot « l’application indue ou incertaine à la réalité d’un schéma interprétatif qui invoque le complot ».
Au-delà des utilisations courantes du syntagme « théorie du complot », de nombreux théoriciens portent un regard analytique sur ce concept dont l’identité reste confuse3. Il faut en effet s’interroger sur l’existence d’une catégorie qui répondrait au syntagme « théorie du complot », qu’elle prenne la forme d’un genre, d’une figure, d’un paralogisme ou d’une mise en scène.
L’étude de l’argumentation et la linguistique textuelle sont des disciplines empiriques qui s’appuient sur des corpus. Si l’on essaie d’identifier des textes relevant de la « théorie du complot » ou se réfé-rant à celle-ci, on constate avec perplexité que la qualification de la parole d’un autre au moyen du syntagme « théorie du complot » est beaucoup plus fréquente que l’attribution du même qualificatif à ses propres dires ou écrits4. Ceci montre déjà que nous avons affaire à un fascinant jeu d’intertextualité et de polyphonie où l’étiquette « théorie du complot » n’est pas toujours attribuée de façon consensuelle par les membres d’une communauté linguistique, ni nécessairement assumée par son destinataire. Le syntagme « théorie du complot » possède un caractère argumentatif et péjoratif, en ce sens qu’il présuppose argu-mentativement – dans la langue, au sens de Ducrot – qu’il n’y a pas complot dans les faits ou que celui-ci n’est pas avéré5.
2. Nous excluons par ceci une fête d’anniversaire-surprise et le dogmatisme reli-gieux sur la bonté de la Providence Divine.
3. Taguieff P.-A., La Foire aux « Illuminés ». Ésotérisme, théorie du complot, extrémisme, Paris, Éd. des Mille et Une Nuits, coll. « Essai », 2005 ; L’Imaginaire du complot mondial – Aspects d’un mythe moderne, Paris, Éd. des Mille et Une Nuits, coll. « Les Petits libres », n° 63, 2006 ; Coady D. (ed.), Conspiracy Theories: The philosophical debate, Burlington (USA), Ashgate, 2006 ; Parish J. & Parker M. (eds.), The Age of Anxiety: Conspiracy Theory and the Human Sciences, Oxford, Blackwell, 2001; Pipes D., Conspiracy: How the Paranoid Style Flourishes and Where it Comes From, New York, Simon and Schuster, 1999.
4. À la différence du pamphlet qui est un genre reconnu et le plus souvent assumé en tant que tel par son auteur.
5. D’où la difficulté d’appliquer le qualificatif « théorie de complot » quand un
La notion de « théorie du complot » : vers une méthode empirique 99
À ce paradoxe lié à l’acceptation du qualificatif s’ajoutent les diffi-cultés qu’on éprouve à classifier les textes en cause.
En survolant la bibliographie sur les « théories du complot », nous constatons, non sans malaise, que tant les définitions initiales que les exemples donnés ou les domaines couverts sont très hétérogènes, allant de la politique à la fiction, aux pseudo-sciences et à l’ésotérisme, les auteurs mettant sur le même pied des genres qui ne présentent pas les mêmes exigences véridictionnelles et des situations où le degré d’abstraction, les preuves disponibles et le caractère impersonnel des agents impliqués diffèrent profondément. C’est ce que présente le tableau suivant :
Dans le cas des théories pseudo-scientifiques, et des négationnismes, la « croyance fausse » peut être infirmée par des preuves tangibles et incontestables qui constituent le dépôt de savoir d’une société. Si l’Holocauste n’avait pas eu lieu et si l’homme n’avait pas marché sur la lune, la contestation serait venue, dans nos sociétés ouvertes et poly-phoniques, de nombreuses autres sources d’autorité, scientifiques et médiatiques. Le cas complexe de la métaphysique et des ésotérismes de tout genre, des croyances qui ne peuvent être ni falsifiées, ni véri-
complot a été prouvé, par exemple dans le cas du Watergate.
Degré d’abstraction Exemples
Version de PopperLa lutte des classes,
« le conflit des civilisations »
Agents impersonnels : quelle intentionnalité ? La judéophobie, « l’axe du mal »
Agents personnels et complot prouvé Le Watergate
Empiriquement falsifiables et/ou falsifiés
L’Holocauste n’a pas eu lieu, le 11/9 est l’œuvre des services
secrets américains
100 Evgenia Paparouni
fiées, doit être étudié en termes psychologiques et dépasse la portée du présent article.
D’un autre coté, l’enquête policière et médiatique sur des complots comme le Watergate s’occupe d’agents personnels incriminables et propose des indices importants sans parvenir à des preuves exhaustives. Il faut rappeler, à ce propos, que le compte rendu d’un complot avéré ne peut (plus) être qualifié de « théorie de complot ».
À l’autre bout du spectre, Popper fait une utilisation métaphorique du terme « théorie du complot » pour se référer à la difficulté d’émettre des prévisions dans les sciences humaines et de programmer l’action poli-tique, étant donné les nombreux facteurs imprévus qui peuvent exercer leur influence6. Il reste ainsi conséquent avec sa conception politique éminemment individualiste, celle de quelqu’un qui a vu la paranoïa au pouvoir à une époque où, sous prétexte d’un projet de société, le nazisme et le stalinisme ont commis des crimes abominables7.
L’utilisation que fait Popper de la théorie du complot, comme une métaphore pour la pensée déterministe, est très différente de celle de Taguieff, qui semble qualifier de « théorie du complot » au sens littéral un ensemble de doxas qui diabolisent certains agents spécifiques : la franc-maçonnerie, les Juifs, les Américains et les entreprises multinatio-nales. Nous pourrions ajouter dans cette liste d’autres entités nationales ou ethniques qui ont eu la malchance de provoquer l’antipathie : l’Iran et la Corée du Nord, l’Irak de Saddam Hussein, les Noirs, les Musulmans, les Roms, les Tutsis et les Hutus les uns pour les autres, et de nom-breuses autres collectivités « différentes » ou « puissantes » qui ont été stigmatisées à un moment ou à un autre par ceux qui n’acceptaient
6. Popper K. R., Conjectures et réfutations. La croissance du savoir scientifique, trad. M.-I. et M. B. de Launay, Paris, Payot, 1985 [1963], p. 497-499.
7. K. R. Popper se réfère expressément au marxisme, mais il est fort douteux que les marxistes de l’époque aient accepté le qualificatif « théorie du complot ». De même, Fukuyama et Huntington n’auraient pas accepté que leur lecture de la fin de la guerre froide, respectivement comme « fin de l’histoire » et comme ouverture d’une nouvelle époque marquée par le « conflit entre les civilisations » relèvent de la théorie du complot, alors qu’il s’agit bien de récits qui attribuent des intentions et qui font des prévisions. Cf. Fukuyama F., La fin de l’histoire et le dernier homme, trad. D.-A. Canal, Paris, Flammarion, 1992; Huntington S. P., Le choc des civilisations, trad. J.-L. Fidel, G. Joublain, P. Jorland et al., Paris, Odile Jacob, coll. « Poches », 2000 [1996]. Ces deux ouvrages ont eu un succès éditorial considérable et ont été longue-ment discutés, malgré le fait qu’on aurait pu leur opposer les arguments de Popper sur l’impossibilité des prévisions absolues.
La notion de « théorie du complot » : vers une méthode empirique 101
pas leur différence ou qui se sentaient menacés par leur puissance. La particularité de P.-A.Taguieff est que, d’une remarquable érudition, il réunit un riche corpus sous l’étiquette de « théorie du complot », sans se préoccuper des divergences textuelles et génériques qui s’y manifestent, ni des conventions particulières à chaque sous-ensemble, lesquelles sont transparentes pour les auditoires8. Cette notion essentia-lisée de la théorie du complot me paraît avoir une portée argumentative intrinsèque, pour des raisons que je vais essayer de dégager par la suite.
Le panorama de tous ces sous-corpus me semble s’imposer si l’on veut faire preuve de prudence : en ne réduisant pas ces différents cas de figure les uns aux autres on s’aperçoit combien l’objet étudié est fugace et pluriel. Cette diversité est intuitivement perçue par les auditoires, qui ne mettent pas sur le même pied le discours de G. W. Bush sur les pays qui constituent l’« axe du mal » et la proposition amusante que les hommes politiques seraient des descendants des lézards.
La difficulté épistémologique et méthodologique que rencontre ici la théorie de l’argumentation tient à l’impossibilité de qualifier et de distinguer textuellement le mensonge, la fiction, la métaphore et le délire clinique sans l’apport d’une théorie de la vérité et sans recourir à des données externes liées à la fonction référentielle du langage, telle qu’elle se matérialise au cas par cas dans la parole. Même si nous renonçons à savoir « ce qui s’est réellement passé », nous ne pouvons pas nous passer des représentations sociales sur ce qui s’est passé et des conventions génériques transparentes aux utilisateurs des discours.
II. Le point de vue de la théorie de l’argumentation
Comment peut-on cerner la théorie du complot dans toutes ses dimen-sions et occurrences, si l’on adopte le point de vue de la linguistique textuelle, et tout particulièrement de la théorie de l’argumentation ? De prime abord, nous avons affaire à du récit, à un schéma narratif minimal, à une mise en scène qui peut, en effet, être appliquée, littéralement ou métaphoriquement, et d’une manière flexible et malléable, à une mul-titude de situations, régies par des genres socio-discursifs différents.
8. P.-A. Taguieff insiste même sur l’idée qu’il existe des « vases communicants » entre les axes thématiques particuliers.
102 Evgenia Paparouni
Peut-on qualifier ce micro-récit de paralogique ? Oui et non. Ni le secret, ni l’attribution d’une mauvaise action intentionnelle et causale ne sont, en soi, un trait qui permette de dire qu’une proposition est invalide. Nous ne pouvons pas non plus la qualifier de fausse par définition, sans la rapporter au monde. Or, un trait définitoire – le secret – empêche l’application exhaustive des dispositifs de vérification. Dans le meil-leur des cas, les preuves apportées par une « théorie du complot » sont des indices, ouverts à des qualifications multiples. Pour une « théorie du complot », l’absence de preuves confirme la réussite du secret, qui est lui-même retenu comme preuve d’une mauvaise intention. La mal-veillance axiomatique des protagonistes est suffisante pour extrapoler à perpétuité de nouveaux scénarios. Selon les détracteurs de la « théorie du complot », l’invocation du secret et de la malveillance axiomatique amènent à une pétition de principe. Pour qui utilise un micro-récit de complot, en revanche, les indices sont suffisants si le récit est cohérent, plausible et persuasif, dans l’attente de preuves plus solides, à tel point que la cohérence et la plausibilité du récit peuvent amener à la non-reconnaissance et à l’élimination sélective des éventuels contre-indices. Or le tri des indices est à effectuer au cas par cas. Ainsi, nous ne pouvons pas stipuler une règle générale de non-acceptabilité qui vaudrait pour toutes les théories du complot.
Nous avons donc déjà affaire à trois traits d’une théorie du complot : sa définition ne présente pas de faille logique interne, elle est poten-tiellement infalsifiable de par l’invocation du secret des preuves, et elle peut donc être appliquée à tout contenu possible, d’où son énorme puis-sance diffamatoire. C’est justement ce caractère diffamatoire sans répit et sans possibilité de défense qui explique la dénonciation véhémente du micro-récit par ses adversaires.
Du point de vue de la théorie de l’argumentation, la dimension argumentative d’un récit ne nous permet pas de rejeter celui-ci dans les dépotoirs de la mauvaise rhétorique en raison de sa narrativité. Le présent volume contient des exemples d’autres procédés rhétoriques uti-lisés par quelques théories du complot. La particularité de ces procédés, qui pourraient fournir « une règle de reconnaissance » de notre objet d’étude, est que nous ne pouvons pas préjuger de leur présence sur la base de la mise en scène narrative et de la définition de travail que nous nous sommes données, en nous passant de l’analyse textuelle et de la prise en compte d’éléments extralinguistiques.
La notion de « théorie du complot » : vers une méthode empirique 103
III. La dénonciation de la théorie du complot
Passons maintenant à un phénomène intriguant : les meilleurs recueils de théories de complot sont les ouvrages qui les dénoncent (Taguieff et Pipes). Le discours de dénonciation est à son tour polarisé, passionné, et applique des mises en scènes conspirationnistes. Nous trouvons un bel exemple de ce paradoxe dans la publication, à deux ans d’intervalle, des Nouveaux imposteurs et des Nouveaux désinfor-mateurs9. Les deux auteurs attribuent des intentions là où il pourrait n’y avoir que des effets, sans évidemment se convaincre l’un l’autre, étant donné l’absence d’un accord sur la qualification initiale des faits. Le lecteur reste perplexe et conclut à la thèse pessimiste que, suite à cette non-communication, chacun doit choisir son camp.
La dénonciation d’un schéma interprétatif comme théorie du complot se déploie sur trois plans différents : ontologique, cognitif, et rhétorique. Sur le plan ontologique, on infirme l’existence d’un complot dans un cas précis (Weill et Vitkine) ou bien l’on conteste la probabilité et la réussite des complots en général (Popper). Sur le plan des repré-sentations mentales et des mises en scènes rhétoriques, on s’attache à dénombrer les mécanismes et procédés d’une théorie du complot « pro-totypique » qui met en question ce que le corps social tient pour acquis, et déforme la réalité en présentant la spéculation comme une certitude10. Je voudrais, dans ce qui suit, discuter brièvement les trois critères qui sous-tendent les critiques ontologiques : la fausseté, l’improbabilité et la non-pertinence.
La dénonciation d’une théorie du complot s’opère, en premier lieu, au nom de son caractère sciemment trompeur, donc au nom de sa faus-seté : « complot fictif », « accusations délirantes », « mythe politique moderne », « invention narrative », « base fantasmatique11 ». Or, on l’a déjà souligné, l’évaluation en termes de vérité/fausseté n’est pas un critère interne, dérivable de la structure narrative d’une proposition, mais exige que la proposition soit confrontée au monde. Ce travail ne
9. Vitkine A., Les nouveaux imposteurs, Paris, Éd. de la Martinière, coll. « Doc en stock », 2005 ; Weill-Raynal, G., Les nouveaux désinformateurs, Paris, Armand Colin, 2007. Ces ouvrages portent, notamment, sur l’affaire Enderlin et sur L’effroya-ble imposture de Th. Meyssan, Paris, Broché, 2002.
10. Voir les contributions de L. Nicolas et de Th. Herman dans le présent volume.11. Taguieff P.-A., La Foire aux « Illuminés », op. cit., p. 15-23.
104 Evgenia Paparouni
se laisse mener qu’on abordant les théories du complot au cas par cas.Une théorie du complot n’est pas dénoncée seulement comme
trompeuse, mais aussi comme simpliste. Selon une conception non déterministe de l’histoire, nous ne pouvons pas maîtriser ou prévoir les effets de l’action humaine, ni en donner des explications cau-sales et déterministes, exhaustives et totales12. Une telle vision rend le complot peu probable, en préférant le hasard au dessein. Elle est thématisée, en épistémologie, comme théorie de la complexité13. Sans sous-estimer la place de l’émergence et de la complexité, ainsi que notre malaise psychique à leur égard – l’absence de causalité et d’explication suscitant un trouble qui crée le besoin d’une explication simple –, j’éprouve, pour ma part, quelque difficulté à considérer le hasard comme la configuration prototypique des événements, car cela reviendrait à adopter une lecture de la réalité proche de celle du bouddhisme. Une telle lecture est d’autant plus contre-intuitive que l’histoire politique de l’humanité est remplie de tentatives d’influence acharnées et de luttes intransigeantes pour le pouvoir, le contrôle et le plaisir. L’utilitarisme et l’approche réaliste des relations internationales thématisent ce phénomène en plaçant l’intérêt et la quête de pouvoir au centre des motivations humaines et, par extension, des mécanismes explicatifs des comportements des agents14. Les intentions avérées peuvent parfois être efficaces. D’où, d’ailleurs, le potentiel persuasif de la théorie du complot. Je me limiterai donc à l’observation qu’il ne faut pas trancher une fois pour toutes entre l’émergentisme et le déterminisme, étant donné les nombreuses manifestations concrètes et complémentaires des deux tendances en pratique.
Puisque l’émergentisme et le déterminisme ne constituent pas des clés de lecture exclusives et exhaustives, nous n’avons pas de critère théorique systématique définitoire, a priori, contre la recevabilité d’une théorie du complot – un critère qui nous épargnerait, s’il existait, la nécessité d’un abord au cas par cas, vérificationniste ou faillibiliste.
12. Je remercie M. Dominicy pour cette observation.13. Voir K. R. Popper, Conjectures et réfutations…, op. cit. ; Morin E. et Le
moigne J.-L (dir.), Intelligence de la complexité : épistémologie et pragmatique, Paris, L’Harmattan, 1999 ; Couloubaritsis L., « L’épistémologie de la complexité », dans Philosophie des Sciences [en grec], Salonique, ZITI, 2008.
14. Roche J.-J., Théories des relations internationales, Paris, Montchrestien, coll. « Clefs. Politique », 2008, p. 22-30.
La notion de « théorie du complot » : vers une méthode empirique 105
Un autre reproche adressé aux théories du complot est qu’elles attri-buent des intentions là où il n’existe que des effets, notamment à des entités qui ne peuvent pas avoir de volonté individuelle. On considère cette projection d’intentionnalité comme non pertinente. Ceci soulève le débat sur les conditions dans lesquelles nous pouvons postuler l’exis-tence d’une intentionnalité collective, capable de déclencher une action finalisée, motivée par des intérêts et des valeurs partagées, sans que l’action commune et concertée résulte nécessairement d’une décision expresse. La projection des causalités sur des agents impersonnels et des structures sociales requiert une attention particulière en philosophie de l’histoire. Rappelons que le droit pénal international ne prévoit pas l’inculpation des États15 ; or il est constamment développé pour inter-dire, imputer et sanctionner de nouveaux comportements16. À l’autre extrémité, les théories des relations internationales parlent volontiers de motivations comme la quête du pouvoir, inspirées par « la nature humaine », qui président à l’action des États17. Nous constatons donc une tension entre l’attitude formaliste du droit face à « l’intention » et l’attitude plus libre des théoriciens des relations internationales qui incluent des schémas narratifs dans leurs interprétations. Ceci nous permet d’introduire un critère rhétorique supplémentaire, à côté des critères ontologiques déjà cités, celui de la littéralité des acceptions.
En effet, très fréquemment, la projection d’intentions s’effectue dans le cadre de la psychologie populaire ou suite à l’application d’un trope18. Je peux dire « Mon chat se demande pourquoi je suis en retard » et « Ma femme se demande pourquoi je suis en retard » ; dans le premier cas, j’attribue une attitude propositionnelle par métaphore, sans qu’on puisse me taxer d’irrationalité puisque ma projection d’intentionnalité n’est pas littérale. L’affirmation que les hommes politiques sont des descendants des lézards ou celle que les entreprises multinationales sont les nouveaux maîtres du monde n’a pas la même prétention à la littéra-
15. On n’a pas inculpé l’Allemagne nazie pour crimes de guerre, l’Irak pour vio-lation des droits de l’homme, ou la Grèce pour fraude statistique. En même temps, la société demande la punition exemplaire des coupables en la personne des leaders.
16. Voir, par exemple, la revendication d’un Tribunal Pénal International ou les appels en faveur d’une supervision des marchés financiers, pour se prémunir contre des entités spéculatives dont l’identité se résume à une adresse dans un paradis fiscal.
17. Roche J.-J., Théories des relations internationales, op. cit., p. 18.18. Lyons W., Approaches to Intentionality, Oxford, Clarendon Press, 1995,
p. 233-234, 241-244.
106 Evgenia Paparouni
lité. Le deuxième énoncé utilise une image archétypique du maître pour décrire le pouvoir accru d’entités non élues qui échappent au contrôle des pouvoirs politiques. Le locuteur est, en l’occurrence, conscient du caractère non littéral de son énoncé.
Les récits explicatifs constituent des outils de lecture à dimension argumentative19. Ce sont « des images du possible dans un monde fon-damentalement imparfait »20 et le reflet des contraintes exercées par notre épistémologie. Ces récits permettent de donner sens au réel et de le domestiquer. L’attention doit donc se porter sur leur degré de produc-tion et de réception littérales, sur le respect des conventions génériques, sur leur violation créative21.
Cette parenthèse sur les critères de dénonciation du complot, et de la théorie du complot, me permet de discuter l’approche particulière de P.A. Taguieff22. Je pense que sa démarche est infiniment plus complexe que les précédentes, en ce sens qu’elle passe subtilement du plan onto-logique au plan métalinguistique – glissement très argumentatif en soi. Son point de départ est un recueil de textes dans lesquels on trouve des schémas narratifs, ainsi que des projections d’intentions manichéennes et polarisées, mais sans qu’une distinction soit faite entre les nuances et les critères exposés ci-dessus. Quelques-uns de ces récits véhiculent des théories du complot au sens « prototypique » du terme, qui entrent manifestement en conflit avec le monde empirique tel qu’on le connaît. Ils se rapportent donc à des situations où la différence d’opinions et de valeurs ne suffit pas à mettre en doute la réalité des événements : le 11-Septembre, l’alunissage d’Apollo, l’Holocauste, et toutes sortes d’autres matières dont traitent des théories pseudo-scientifiques. Contre ces récits, la dénonciation ontologique opère aisément. La dérision, bien méritée, est par la suite transposée et généralisée à tous les schémas narratifs qui incluent le même type de projection intentionnelle, sans
19. Pour la dimension argumentative des genres qui n’ont pas une visée argumen-tative explicite et assumée, voir : Amossy R., L’argumentation dans le discours : discours politique, littérature d’idées, fiction, Paris, Nathan, coll. « Fac – Linguisti-que », 2000, p. 24-25, 226.
20. Bruner J., Pourquoi nous racontons-nous des histoires ?, trad. Y. Bonin, Paris, Pocket, coll. « Agora » 2005, p. 124 : « Le refus de la tyrannie de l’histoire unique a sans doute poussé nos aïeux à garantir la liberté d’expression. »
21. Pour en revenir à l’exemple de Lyons, ce n’est que si je tue mon chat parce qu’il n’a pas été assez content de me voir qu’on peut commencer à s’inquiéter de ma santé mentale.
22. Une approche similaire est celle de Pipes D., Conspiracy…, op. cit., p. 160.
La notion de « théorie du complot » : vers une méthode empirique 107
tenir compte ni d’une éventuelle figure d’hyperbole ou de métaphore, ni de l’impossibilité de se prononcer sur la vérité d’une proposition à partir de son seul caractère narratif. La dénonciation opère désormais au niveau métalinguistique. La voie est ainsi ouverte à une manœuvre qui, en se rabattant au niveau ontologique, dénonce, sur base des procédés rhétoriques utilisés, toute démarche abductive qui prétendrait offrir une interprétation alternative de réalités inexplorables.
On voit mieux, dès lors, l’effet créé par le regroupement, sous l’éti-quette « théorie du complot », d’une masse de corpus hétérogènes : le brouillage des nuances et des frontières est argumentatif en soi : com-parer des schémas explicatifs politiques à des croyances ésotériques est infiniment réducteur, péjoratif et diffamatoire pour les premiers. Ce mouvement a la particularité de mettre entre parenthèses tant la dimen-sion argumentative du récit que le jeu de simulation en « comme-si » des croyances magiques23. Il s’agit, dans le débat public, d’un tour de force considérable qui transfère l’objet du débat à un niveau métalin-guistique, celui de la théorie du complot vue en tant que piège à naïfs et pure invention produite par des imaginations hyperactives. En tant que schéma argumentatif fallacieux, la dénonciation de la théorie du complot fait disparaître la nécessité d’une argumentation ad rem sur les sujets débattus ; or il y a débat sur bien des sujets de l’actualité politique24. Nous observons une symétrie paradoxale : aussi bien le tenant d’une théorie du complot que son détracteur renoncent à utiliser des preuves faillibles, mais sous des prétextes différents – le premier au nom du secret supposé, et le deuxième en vertu d’un reproche de simplisme. De ce fait, tant les théories du complot que leur dénonciation semblent avoir la prétention commune de clore le débat avant qu’il ne commence. Cette démarche s’expose à deux types de critiques : dans
23. Voir Danblon E., « Discours magique, discours rhétorique. Contribution à une réflexion sur les effets de persuasion », dans J.-M. Adam et U. Heidmann (éd.), Sciences du texte et analyse de discours. Enjeux d’une interdisciplinarité, Genève, Slatkine, 2005, p. 145-160.
24. Voici, à titre indicatif, quelques sujets inévitables : Pourquoi la réflexion sur une économie qui réduirait les émissions de carbone n’a-t-elle pas été menée dès la parution des premières publications scientifiques sur l’effet de serre et pourquoi a-t-on toujours du mal à avancer ? Pourquoi le bombardement de Gaza a-t-il eu lieu en janvier 2009 durant un vide de pouvoir formel aux États-Unis, et qui finance les parties belligérantes ? Quel est le rôle actuel de la franc-maçonnerie à un moment où les citoyens réclament un droit de regard presque voyeuriste sur les « forums » de leurs représentants élus ?
108 Evgenia Paparouni
la sphère publique, un contre-argumentateur pourrait facilement réfuter le virage métalinguistique en l’identifiant expressément comme tel, et souligner que la théorie du complot généralisée risque de devenir une énorme catégorie fourre-tout où nous serions tentés de mettre à la fois nos préjugés et nos sujets tabous25. Il redirigerait, par la suite, le débat vers la réalité des choses elles-mêmes. Après ce deuxième tour de force, le même contre-argumentateur pourrait maintenir que l’érudition de la dénonciation totale et sommaire apparaît plus comme une entreprise angoissée visant à se débarrasser une fois pour toutes du radicalisme et de l’antiaméricanisme, en faisant flèche de tout bois, de Popper jusqu’aux cérémonies satanistes. Or, le radicalisme et l’antiaméricanisme devraient être étudiés par d’autres disciplines que la théorie de l’argumentation, en tenant compte de dimensions histo-riques, politiques et psychologiques notamment, et entre autres d’un passé interventionniste prouvé, de la crise de confiance citoyenne vis-à-vis des institutions, des problèmes d’image d’une force planétaire qui revendique toujours l’hégémonie, ainsi que des préférences politiques et des valeurs propres aux auditoires.
Au-delà de ces débats sur les choses, une deuxième critique, énoncée d’un point de vue argumentatif, verrait dans la dénonciation une variante moderne du désir de policer la rhétorique pour se défendre de la démagogie – désir aussi ancien que la rhétorique elle-même. Somme toute, une protection du citoyen contre toute manipulation peut s’assurer par davantage de pratique rhétorique. L’injonction du « politiquement correct » se marie mal à une telle approche26, d’autant que ce dernier est souvent défini sur la base de critères identitaires et communautaristes. On peut très bien éviter un sujet par politesse, sans que ceci puisse vouloir dire que « l’impolitesse » consistant à y faire référence relèverait d’une rhétorique en soi fallacieuse.
25. D’autant que l’apparition de couples réciproquement dénoncés (G. Weill-Raynal vs A. Vitkine) renforce l’impression qu’une théorie du complot n’est pas la matérialisation concrète d’un débat philosophique entre le déterminisme et la com-plexité, mais une abstraction douteuse dans un débat politique miné.
26. Pourquoi une critique, même virulente et passionnée, de l’installation des colons par Israël serait-elle synonyme de judéophobie ? Le degré de « polémicité » d’un argument serait-il le critère de son caractère fallacieux ? Sur la question de la polémique on pourra se reporter à : Albert L. et Nicolas L. (dir.), Polémique et Rhé-torique de l’Antiquité à nos jours, Préface de D. Denis, Louvain-la-Neuve, Éd. de Boeck – Duculot, coll. « Champs linguistiques », 2010.
La notion de « théorie du complot » : vers une méthode empirique 109
IV. Une étude de cas : la théorie du complot sur le Groupe Bilderberg
Suite à l’expression de mon scepticisme face aux catégories géné-ralisantes, je voudrais proposer à présent l’étude d’un cas concret, qui illustre la nécessité de procéder par le biais d’analyses textuelles pru-dentes. Je soutiendrai en particulier que le traitement non-normatif de quelques théories du complot par la théorie de l’argumentation requiert une conception élargie de notre rationalité, de manière à inclure les émotions.
Examinons le texte suivant de Daniel Estulin, apparemment un sym-pathisant de l’extrême-droite souverainiste américaine, qui traque les réunions du Groupe Bilderberg27 :
« Imagine a private club where presidents, prime ministers, inter-national bankers and generals rub shoulders […] and where the people running the wars, the markets and Europe say what they never dare say in public.
Wars have usually been fought over expanding territory, but in this new era of globalisation, where business and politics co-depend for survival, economic control dominates. Regardless of the Bilderberg chairman’s claims, there is no doubt the Group wields economic control over world trade. The fact remains: the
27. Il est très difficile de présenter les théories du complot connexes, car pour le faire, il faudrait préalablement présenter le Groupe Bilderberg. Étant donné que quel-ques personnalités publiques ont admis leur participation aux séances du groupe, nous pouvons confirmer son existence. Le groupe lui-même se considère comme un club privé et n’informe pas le public de son activité. Les médias se comportent à son égard avec discrétion ou indifférence et les sources académiques manquent. Le Bilderberg est censé être un groupe de réflexion informel qui réunit chaque année des personna-lités du monde politique, économique et médiatique des pays de l’OCDE ; ses membres discutent en privé, donc librement, de l’actualité politique et économique mondiale. Le groupe n’a pas de statut institutionnel et/ou officiel et il n’est pas censé prendre de décisions. Sa création est réputée avoir eu lieu en 1954 aux Pays-Bas. Les listes de participants dont on dispose ne proviennent pas du groupe même, mais des rares jour-nalistes qui s’obstinent à découvrir et à guetter le lieu de la réunion annuelle. Selon la théorie du complot correspondante, le Groupe Bilderberg se comporterait comme un quasi-gouvernement du monde qui tirerait les ficelles de la politique, un club où l’ac-tualité serait débattue avant qu’elle devienne réalité et où l’on déciderait de la candidature de telle ou telle personne à la présidence d’un pays. Ces accusations pro-viennent à la fois de la droite conservatrice et isolationniste aux États-Unis, qui est réfractaire aux Nations Unies, et de la gauche altermondialiste en Europe.
110 Evgenia Paparouni
public is not privy to the proceedings of their annual meetings. They meet in secret to discuss global strategy and reach consensus on a wide range of issues. Such secrecy is suspect, and my goal is to uncloak the Bilderbergers’secrecy and show how this private club of world leaders and interlocking agencies keeps trying to subjugate all free nations to their rule through international laws, which they manipulate and have the UN administer.
Meetings […] are conducted behind closed doors. The only possible reason for this is that « they » don’t want you and me to know what they are discussing.
[F]rom the moment a Bilderberg meeting closes, what seems to happen, – “almost by accident” – is that the consensus reached in different areas of discussion are wholeheartedly promoted by these all powerful political and commercial interests through the mains-tream press, while simultaneously becoming common policies to governing international forces of seemingly different persuasions28. »
Une grande partie de l’argumentaire est fondé sur la preuve éthique. L’auteur s’adresse au lecteur en usant de la deuxième personne et l’appelle à imaginer, à considérer, une entité dont les traits ne sont pas tout à fait connus – sinon, il ne serait pas nécessaire de formuler des conjectures.
Le contraste entre le caractère privé du club et les fonctions publiques de ses membres, ainsi que le secret des délibérations, sont d’emblée utilisés pour induire une ambiance de soupçon et de méfiance et pour poser une distance entre les Bilderbergers (« they ») d’un côté, et l’auteur et le lecteur (« you and me ») de l’autre. La mention, entre guillemets et tirets, du consensus atteint au Bilderberg « presque par hasard » souligne ironiquement et polyphoniquement l’attribution d’un dessein. Les agents cités sont anonymes et impersonnels (« powerful interests », « international forces »). L’objectif de l’auteur est explicite : dévoiler le secret. Ailleurs, on apprend qu’une tentative contre la vie de l’auteur a échoué de peu. Ceci est un lieu rhétorique habituel : ceux qui traquent les rendez-vous annuels du Bilderberg dénoncent l’attitude de la police et affirment faire l’objet d’une surveillance29. Les menaces supposées contre la vie des auteurs ou des témoins tissent une ambiance
28. Estulin D., The True Story of the Bilderberg Group, Walterville, Trineday, 2005, p. 24-25.
29. Skelton C., « Bilderberg files », www.guardian.co.uk, éd. du 10 au 19 mai 2009.
La notion de « théorie du complot » : vers une méthode empirique 111
de méfiance et de peur. Le même effet est produit par le recours à des sources d’information anonymes ou lorsque l’auteur écrit lui-même sous un pseudonyme30.
Le militant revendique un ethos de responsabilité. Il se voit investi d’un rôle de héros moderne qui défie les idées reçues et les institutions corrompues, pour le bien de l’humanité ou d’une partie de celle-ci. Son attitude de « démasquage » est désintéressée : il s’agit d’un travail solitaire, d’un journalisme d’enquête qui élucide les mystères. Cet auto-portrait est flatteur comme image de soi, il satisfait l’amour-propre et donne du sens à la vie, ainsi qu’une possibilité de sortir de l’anonymat à travers un site Internet.
Ce type de mise en scène de l’ethos n’est pas loin de rappeler l’ethos du pamphlétaire qui, seul contre tous, et dans le souci de la vérité et de la liberté de conscience, lance un appel à être cru et entendu31 :
« It was a world utterly counterintuitive and unfamiliar to all but a select few who somehow had a brush or a connection with the underworld of spooks and counter-espionage. This parallel world remains unseen in the daily struggles of most humanity, but, believe me, it is there: a cesspool of duplicity and lies and double speak and innuendo and blackmail and bribery32. »
Un détour vers l’ensemble des représentations doxales d’un militant paraît utile sur le plan du logos. Le militant est tiraillé entre la vision d’un monde déchiré par les luttes de pouvoir et une croyance libérale dans la possibilité d’un changement et d’un progrès33. Les antagonismes
30. Respectivement, Estulin D., The True Story of the Bilderberg Group, op. cit., et Gama M., Rencontres au sommet. Quand les hommes de pouvoir se réunissent, Paris, L’Altiplano, 2007.
31. Angenot M. La parole pamphlétaire – Typologie des discours modernes, Paris, Payot, 1982. Voir également sur les aspects plus spécifiquement rhétoriques de cette question : Nicolas L. et Jonge E. de, « Limites et ambiguïtés rhétoriques du discours pamphlétaire : vers l’abandon d’une pratique sociale ? », dans Mots – Les langages du politique, « Que devient le pamphlet ? », n° 91, nov. 2009, p. 51-65.
32. Estulin D., The True Story of the Bilderberg Group, op. cit., p. 15.33. M. Dominicy rappelle à juste titre que tous les militants ne sont pas démocra-
tes. La militance en tant que telle n’équivaut pas à la vertu des causes défendues. Toutefois, la mise en scène de l’ethos peut être la même (un contre tous, polarisation, récit de complot), qu’il s’agisse de soutenir des causes louables ou répugnantes. Or nous avons à notre disposition suffisamment de critères politiques permettant de faire le tri parmi les causes, pour nous épargner des artefacts métalinguistiques. La tenta-
112 Evgenia Paparouni
de pouvoir lui paraissent irréductibles à des solutions consensuelles au profit de tous. Le monde est en guerre ; il est constitué d’amis et d’ennemis ; les ennemis sont dangereux ; il faut dénoncer l’élitisme et le manque de transparence.
Le militant a des a priori négatifs à l’encontre de toute proximité du monde politique avec le monde économique, considérant, par défini-tion, cette proximité comme une source ou plutôt un indice de collusion. Le privé ne peut être que secret et le secret est un aveu de culpabilité.
Les indices récoltés contre le Bilderberg sont autant de preuves dans la logique conspirationniste : le caractère secret des réunions et les mesures de sécurité, la représentation de personnalités de l’élite politique, économique et médiatique, des phénomènes de collusion entre les pouvoirs attestés dans nos sociétés démocratiques. Ceci dit, le dénonciateur du Bilderberg avance des propositions qui paraissent disproportionnées, sinon dérisoires, sur la base de notre savoir ency-clopédique (scission du Canada, disparition des identités nationales, surestimation des capacités de l’ONU34). Sans doute, un opposant dirait que si le contenu des débats menés par le Bilderberg est inconnu, toute conjecture à ce propos est infondée.
Au niveau du pathos, nous pouvons relever la peur face à l’inconnu et l’angoisse face à la perte de contrôle. À la longue, ces sentiments finissent par se cristalliser en une aversion et une animosité à l’égard des pouvoirs menaçants.
Le principal contre argument « disculpant » le Groupe Bilderberg réside dans le fait que ses réunions ne sont pas secrètes, mais privées – argument qui, apparemment, réussit à convaincre les médias interna-tionaux les plus importants, qui restent discrets à propos des réunions du groupe. Estulin, en revanche, prend ses distances par rapport à cette interprétation conventionnelle et dominante.
tion de chercher un critère de démarcation dans le langage caractérise la première époque de la philosophie analytique ; la métaphysique, cible d’antan, cède actuelle-ment sa place à d’autres spectres.
34. Mieux vaudrait dire « disproportionnelles aux yeux d’un auditoire européen » parce que, pour un auditoire nord-américain, les mêmes prises de position fonction-nent comme une « signature » politique, avec laquelle on peut ou non s’identifier.
La notion de « théorie du complot » : vers une méthode empirique 113
V. De l’illusion à l’insoumission
Cet exemple nous permet de discuter la théorie du complot en tant que phénomène de croyance tenace et minoritaire35. La personne qui adhère à une théorie du complot doit investir un effort cognitif énorme qui équivaut à une contestation de la vérité sociale, du savoir commun et des institutions qui le produisent et le garantissent. La thèse selon laquelle les attentats du 11-Septembre ont été perpétrés ou tolérés par les services secrets des États-Unis exige un effort cognitif de cet ordre. Ses tenants assument la tâche ingrate de la charge de la preuve, pour remettre en cause ce savoir par un mouvement anticonformiste, obsessionnellement fabulateur de conjectures fantaisistes, aux yeux de la majorité qui se demande « comment tout cela est possible ? ». Ce passage de catégorie, de l’illusion à l’insoumission, justifie que l’effort cognitif démesuré qu’exige la méfiance soit analysé en termes de croyances motivationnelles, c’est-à-dire des croyances qui s’associent à des désirs sous l’emprise des émotions.
Avant d’aller plus loin, je voudrais faire une incise théorique sur les trois notions de base de la philosophie de l’esprit et des neurosciences : croyance, désir et émotion. Les sciences cognitives contemporaines dépassent le contraste traditionnel entre émotions et cognition, et étu-dient souvent les deux soit comme des états interconnectés, soit comme des variations du même phénomène36. Sans prétendre être exhaustive, j’attire ici l’attention sur les approches d’Elster et de Livet qui se foca-lisent sur les interférences entre les croyances, les désirs et les émotions, nous proposant une conception de la rationalité humaine où l’illogique n’est pas le critère de l’irrationnel.
Elster répertorie une série de situations qui donnent lieu à des croyances tordues ou biaisées. Sous l’enseigne générale de « duperie de soi », il analyse le vœu pieu (prendre ses désirs pour des réalités) et la « self-deception » (ne pas vouloir croire), les croyances idéologiques, l’auto-suggestion, parfois thérapeutique, les croyances préférées, les croyances dévalorisées et culpabilisées (honte de l’envie), l’optimisme et le pessimisme excessifs37. L’interférence entre les croyances et
35. Coady D. (ed.), Conspiracy Theories…, op. cit.36. Damasio A. R., L’erreur de Descartes. La raison des émotions, trad. M. Blanc,
Paris, Odile Jacob, 1995 ; Cosnier J., Psychologie des émotions et des sentiments, Paris, Retz, coll. « La psychologie dynamique », 1994.
37. Elster J., Sour grapes: Studies in the subversion of rationality, Cambridge,
114 Evgenia Paparouni
les désirs est attribuée successivement aux pulsions, au mécanisme de diminution de la dissonance cognitive (au sens de Festinger38) et à l’orientation prioritaire de nos heuristiques vers des informations privilégiées, sous l’emprise des émotions. La contribution essentielle de cette approche consiste à démarquer les croyances biaisées des croyances irrationnelles39. La contamination des croyances par les préférences n’amène pas à des croyances contradictoires40, mais à des croyances biaisées qui ne dépasseraient pas un test de réalité et qui ne satisfont pas le critère de « rationalité externe », étant donné qu’elles ne se basent pas sur des preuves. Éventuellement fonctionnelles et édifiées en termes évolutionnistes, les croyances biaisées peuvent, selon Elster, amener l’agent à la prise de décisions non autonomes. Cette première approche reste significativement normative et dévalorisante face aux préférences et aux émotions, considérées, en accord avec une longue tradition philosophique, comme des intrus dans le raisonnement sobre – des intrus néanmoins parfois bienvenus, pour les impératifs d’une thérapie comportementaliste41.
L’approche de Livet, quant à elle, ne stigmatise pas, a priori, une résistance à la modification des croyances qui procéderait des préfé-rences et des émotions, notamment quand les croyances récalcitrantes portent sur des valeurs42. Livet se focalise sur la notion opératoire et transversale de « révision ». Il entend par cela la modification, parfois inconsciente et lente, de nos croyances, de nos intentions d’action et, en dernier lieu, de nos préférences, quand la réalité contredit nos attentes. Le démenti de nos attentes peut porter sur des croyances, sur les résul-tats escomptés de notre action ou sur des préférences. Selon ce modèle, les préférences ont une nette supériorité par rapport aux croyances, elles
Cambridge University Press, 1983, p. 125-152.38. Festinger L., A Theory of Cognitive Dissonance, Stanford, Stanford Univer-
sity Press, 1964, p. 198.39. Elster J., Sour grapes…, op. cit., p. 15-19.40. Elster souligne que « croire que P et ne pas croire que P » est différent de
« croire que P et croire que non-P. »41. La pensée de J. Elster sur le rôle des émotions évolue d’une manière impor-
tante tout au long de son œuvre, mais il reste, à mon sens, l’admirateur d’une raison idéalisée. Ibid., p. 160.
42. Livet P., Émotions et rationalité morale, Paris, PUF, coll. « Sociologies », 2002.
La notion de « théorie du complot » : vers une méthode empirique 115
définissent un ordre de priorité pour les autres révisions, elles sont révi-sées en dernier lieu pour être remplacées par d’autres préférences : nous sommes avant tout des êtres de désir. Les émotions sont multiplement liées aux révisions : elles signalent les conflits entre la réalité et nos attentes, et la nécessité de réviser. Elles motivent la révision elle-même. Lorsque surgit un conflit de cet ordre, il y a trois résultats possibles :
1. une révision progressive et souvent inconsciente, motivée par l’émotion ;
2. une résistance à la révision à travers le partage social de l’émo-tion, de la croyance et de la préférence. Ce partage transforme la préférence en valeur. Les valeurs résistent à la révision ;
3. une résistance à la révision à cause de l’émotion. Nous pouvons maintenir la croyance démentie si elle n’est plus une croyance, mais une situation désirée. Les multiples formes de duperie de soi, déjà citées, peuvent être apparentées à une telle révision manquée.
Revenons maintenant à notre exemple concernant la théorie du complot sur le Groupe Bilderberg. Au départ, on trouve une émotion : la peur d’une perte d’identité, la peur d’une perte de stabilité politique, la hantise des idéologies sécessionnistes ou impérialistes. Il suffit de tomber d’accord sur l’origine du Mal pour lui attribuer, en tant qu’effets causalement pro-duits par ses intentions, tous les maux individuels. La peur de l’inconnu et le renfort de l’amour-propre ressentis par le dénonciateur du complot sont également repérés par Pierre-André Taguieff43 ; celui-ci, toutefois, centre son propos sur une dénonciation fervente de la mise en scène rhétorique, restant peu loquace sur l’exigence de transparence dans nos sociétés et sur l’absence de théorie alternative sur le Groupe Bilderberg qu’il cite comme « association élitiste existante… prétendument secrète » en se distanciant polyphoniquement du qualificatif « secrète44 ».
Dans le texte d’Estulin, la peur accompagne les « croyances tenaces » suivantes : (1) les élites du monde ne peuvent pas se réunir en secret pour faire du bien (l’essentialisation est au cœur de toute stéréotypie) ; (2) le pouvoir international (ou national) est une menace pour la souve-raineté nationale (ou locale) ; (3) les pouvoirs non élus et non politiques
43. Taguieff P.-A., La Foire aux « Illuminés », op. cit., p. 17-21.44. Ibid., p. 31 note 31 ; p. 498 note 85.
116 Evgenia Paparouni
menacent, eux aussi, la souveraineté nationale ou locale et échappent au contrôle citoyen.
La réalité politique mondiale n’est pas privée d’incertitudes face à des mutations multiples. Quand un militant exalté se retrouve sans ancrages empiriques devant un trou noir communicatif comme le Bilderberg, il remplit le vide par la projection de peurs et de phobies pas nécessaire-ment connexes, accumulées au fil du temps. Le caractère secret ou privé du groupe attise l’imagination. Une phobie en quête d’objet Intentionnel rencontre un lieu d’opacité communicationnelle et remplit le vide. Si les croyances et les émotions sont partagées par les membres d’un groupe, leur répétition ne fait que souder les liens de celui-ci.
La présence de croyances motivationnelles est, elle aussi, un critère externe auquel on peut soumettre une théorie du complot précise, en la comparant à la réalité. Parler de peur ou de phobie témoigne d’une visée argumentative, trancher entre la « duperie de soi » à la façon d’Elster, et la résistance collective à la révision des croyances, due aux valeurs du groupe, selon Livet, constitue un choix accompagné d’une conjecture quant à ce qui est vrai et possible sur base de notre savoir encyclopédique – conjecture seulement productible au cas par cas, et non pas sur la base d’une définition préalable de la théorie du complot. L’appel au savoir encyclopédique qui veut que la scission du Canada ne soit pas un enjeu d’actualité et qu’il n’est pas tellement facile de faire sciemment disparaître des identités, se révèle nécessaire pour tracer la frontière entre le non-recevable et le plausible.
Si les publications sur le Bilderberg brillent par leur style de fabulation et leur pauvreté informative, le citoyen peut toutefois se poser maintes questions sur la légitimité de réunions, dites privées, entre des détenteurs de pouvoirs publics et portant sur des agendas éminemment politiques. D’où la nécessité d’envisager ici la théorie du complot connexe comme un récit explicatif, le pendant d’un discours absent sur ce qu’est le Groupe Bilderberg. Tant qu’il n’existe pas d’autre récit, officiel, docu-menté et non anonyme, la théorie du complot correspondante aura sa place, douteuse, pittoresque, amusante, provocante et dérangeante.
La notion de « théorie du complot » : vers une méthode empirique 117
Conclusion
J’ai voulu montrer ici que nous ne pouvions pas déduire la fausseté, l’improbabilité, la non-pertinence d’une théorie du complot sur la base de la nature des preuves rhétoriques utilisées. Les récits qui attribuent des intentions, même s’ils s’avèrent émotionnellement polarisés et manichéens, présentent les avantages persuasifs de la fiction et peuvent constituer des abstractions narratives, fertiles pour motiver le question-nement et le journalisme d’enquête, et cela d’autant plus lorsqu’il y a absence de récits explicatifs alternatifs. Les auditoires sont sensibles à la différence des genres et des conventions rhétoriques connexes : entre l’imposture et l’illusion, il existe un espace pour le trope, les croyances motivationnelles et les projections d’intentionnalité dans le cadre d’une psychologie populaire. C’est pourquoi, je demeure scep-tique face à la valeur argumentative revendiquée par une dénonciation des théories du complot puisque la dénonciation se concentre sur les preuves rhétoriques plutôt que sur un débat relatif au fond. À mon sens, bien plus qu’une quelconque perversité intellectuelle, l’existence de croyances motivationnelles explique en grande partie le caractère démesuré et anticonformiste de l’effort cognitif fourni par l’adhérent d’une théorie du complot.
118 Evgenia Paparouni
Les sources cognitives de la théorie du complot.
La causalité et les faits1
Marc Dominicy
Quelles que soient ses incarnations particulières et l’opinion que nous pouvons entretenir sur chacune d’elles, la théorie du complot exerce, a priori, un attrait cognitif dont les sources les plus profondes nous demeurent inconnues. Pourquoi les êtres humains apprécient-ils à ce point les récits de fiction qui rattachent toute une série d’événe-ments disparates à la volonté d’un seul individu ou d’un seul groupe ? Pourquoi éprouvons-nous tant de difficultés à envisager spontanément la pluralité des causes possibles, le rôle du seul hasard, l’émergence de l’ordre et de la complexité à partir du chaos ou de l’élémentaire ? Je voudrais soutenir ici que ces propensions de notre esprit trouvent leur origine dans les relations qui s’instaurent entre les événements, les faits et les assignations de causalité. Vue sous un tel angle, la théorie du complot nous apparaîtra comme le produit de deux démarches cognitives qui se confortent mutuellement. La première consiste à confondre l’absolutisme ou le relativisme épistémologique (quant aux faits et aux assignations de causalité) avec l’absolutisme ou le relati-visme ontologique (quant aux événements et à leur inscription dans une chaîne causale). La seconde exploite « l’inscrutabilité sémantique », telle qu’elle a été définie par Quine et Davidson2, en oubliant que les assignations de causalité que nous pratiquons dans des circonstances ordinaires, ou lors d’une enquête scientifique, ne prennent sens que par
1. Cette recherche a été menée dans le cadre du projet ARC 06/11-342 : « Les organismes culturellement modifiés : “Ce que cela veut dire d’être humain” à l’âge de la culture », financé par le Ministère de la Communauté française – DGENORS (Bel-gique).
2. Quine W. V. O., Relativité de l’ontologie et quelques autres essais, trad. J. Lar-geault, Paris, Aubier-Montaigne, 1977 ; Davidson D., Enquêtes sur la vérité et l’interprétation, trad. P. Engel, Nîmes, Chambon, 1993 [1984].
rapport à des hypothèses d’arrière-fond qui établissent des corrélations nomologiquement normées entre les faits et les événements.
La dimension rhétorique de ces deux démarches se laisse aisément apercevoir. En substituant l’un à l’autre les domaines où doivent res-pectivement s’appliquer l’absolutisme et le relativisme, on se donne un ethos à la fois « ouvert » et dogmatique qui sera interprété, selon les moments, comme une revendication anarchiste ou comme un appel à l’homonoia. L’alternance constante qui se crée ainsi entre deux « images » publiques vise évidemment à atteindre des buts complé-mentaires : susciter la curiosité, l’amusement ou le trouble, auprès d’un auditoire « exotérique » que l’on confronte à une vision du monde étran-gère à sa doxa préalable ; asseoir le sentiment d’unanimité de l’auditoire « ésotérique » par une réaffirmation sans réserves du scénario à privi-légier. La dualité de l’ethos induit, dès lors, un partage de l’auditoire effectif comme de son pathos, avec d’un côté les « sceptiques » à convertir et, de l’autre côté, les « convertis », eux-mêmes engagés dans une tâche de prosélytisme. Le débat s’organise, par conséquent, selon un modèle qui se réclame de Socrate au stade critique, mais s’enracine dans la tradition platonicienne ou religieuse de la révélation quand on en vient à expliquer le cours des choses.
Un balancement comparable s’observe sur le plan du logos. Lorsque prédomine l’ethos « ouvert » ou anarchiste, et donc l’orientation vers le pathos de l’auditoire « sceptique », le discours manipule une ontologie où les événements, et les liens de causalité, subissent une relativisation systématique : le monde est « multiple » ; il n’y a aucun motif pour ne pas admettre une pluralité des perspectives qui ne peut qu’enrichir l’expérience humaine. Lorsque l’ethos dogmatique de l’ho-monoia l’emporte en agissant sur le pathos de l’auditoire « converti », l’ontologie du discours absolutise systématiquement les faits et les assignations de causalité : le monde reçoit une seule explication, livrée par une doctrine globalisante qui éclaire tout ce qui paraissait, jusqu’alors, inintelligible ou obscur.
Les sources cognitives de la théorie du complot 121
I. La causalité
L’approche de la causalité que je vais adopter dans ce qui suit se fonde sur une distinction de principe entre le niveau des événements, et des liens de causalité qui les unissent, et le niveau des descriptions données de ces événements et de ces liens :
e1
cause e2
le fait que P cause le fait que Q
Le suicide d’Hitler, par exemple, se laisse décrire, en termes de cau-salité, au moyen d’une proposition comme : « Le fait qu’Hitler se soit suicidé a été causé par le fait que l’Allemagne avait perdu la guerre et qu’il savait qu’il allait finir prisonnier de l’Armée Rouge et… ». À l’intérieur d’une telle proposition, le prédicat « a été causé par » dénote le lien causal entre les événements e
1 et e
2 (ce qu’indique la
flèche simple), tandis que e1 et e
2 sont respectivement décrits (mais non
dénotés) par les syntagmes nominaux « le fait que l’Allemagne avait perdu la guerre et qu’Hitler savait qu’il allait finir prisonnier de l’Armée Rouge et… » et « le fait qu’Hitler se soit suicidé » (ce qu’indiquent les flèches doubles).
On admet, depuis Hume, que si un événement e1 cause un événe-
ment e2, alors e
1 (la cause) et e
2 (l’effet) doivent pouvoir être décrits
indépendamment l’un de l’autre. Prenons l’exemple d’une insolation3 : si une exposition excessive au soleil a causé une réaction cutanée, l’on doit pouvoir décrire cette exposition excessive au soleil et cette réaction cutanée indépendamment l’une de l’autre. De même, il doit être possible de décrire le suicide d’Hitler (par exemple, au moyen du syntagme nominal « le fait qu’Hitler se soit suicidé ») indépendamment de la description donnée de la cause de ce suicide. Ceci entraîne deux conséquences importantes. D’une part, il s’ensuit qu’en vertu d’une nécessité logique, l’effet (la réaction cutanée, le suicide d’Hitler) aurait pu être causé par autre chose que ce qui se trouve constituer sa cause (par exemple, par l’ingestion de certaines substances pour l’insolation, ou par une subite tumeur cérébrale dans le cas d’Hitler).
3. Davidson D., Subjective, Intersubjective, Objective, Oxford, Oxford Univer-sity Press, 2001, p. 31-33.
dogmatique de l’homonoia l’emporte en agissant sur le pathos de l’auditoire « converti », l’ontologie du discours absolutise systématiquement les faits et les assignations de causalité : le monde reçoit une seule explication, livrée par une doctrine globalisante qui éclaire tout ce qui paraissait, jusqu’alors, inintelligible ou obscur.
I- LA CAUSALITÉ
L’approche de la causalité que je vais adopter dans ce qui suit se fonde sur une distinction de principe entre le niveau des événements, et des liens de causalité qui les unissent, et le niveau des descriptions données de ces événements et de ces liens :
e1 cause e2
⇑ ↑ ⇑le fait que P cause le fait que Q
Le suicide d’Hitler, par exemple, se laisse décrire, en termes de causalité, au moyen d’une proposition comme : « Le fait qu’Hitler se soit suicidé a été causé par le fait que l’Allemagne avait perdu la guerre et qu’il savait qu’il allait finir prisonnier de l’Armée Rouge et… ». À l’intérieur d’une telle proposition, le prédicat « a été causé par » dénote le lien causal entre les événements e1 et e2 (ce qu’indique la flèche simple), tandis que e1 et e2 sont respectivement décrits (mais non dénotés) par les syntagmes nominaux « le fait que l’Allemagne avait perdu la guerre et qu’Hitler savait qu’il allait finir prisonnier de l’Armée Rouge et… » et « le fait qu’Hitler se soit suicidé » (ce qu’indiquent les flèches doubles).
On admet, depuis Hume, que si un événement e1 cause un événement e2, alors e1 (la cause) et e2 (l’effet) doivent pouvoir être décrits indépendamment l’un de l’autre. Prenons l’exemple d’une insolation177 : si une exposition excessive au soleil a causé une réaction cutanée, l’on doit pouvoir décrire cette exposition excessive au soleil et cette réaction cutanée indépendamment l’une de l’autre. De même, il doit être possible de décrire le suicide d’Hitler (par exemple, au moyen du syntagme nominal « le fait qu’Hitler se soit suicidé ») indépendamment de la description donnée de la cause de ce suicide. Ceci entraîne deux conséquences importantes. D’une part, il s’ensuit qu’en vertu d’une nécessité logique, l’effet (la réaction cutanée, le suicide d’Hitler) aurait pu être causé par autre chose que ce qui se trouve constituer sa cause (par exemple, par l’ingestion de certaines substances pour l’insolation, ou par une subite tumeur cérébrale dans le cas d’Hitler). D’autre part, la description donnée de e1 ou e2 ne suffit alors pas à identifier e1 ou e2. En effet, l’identification des événements requiert non seulement qu’ils soient individués en termes spatio-temporels, mais aussi que leur localisation spatio-temporelle s’avère épistémologiquement accessible. Or nous aurons bientôt l’occasion de voir que nous ne saurions disposer d’un pareil accès en l’absence d’une théorie d’arrière-fond qui détermine le rapport des faits aux événements par l’entremise de contraintes nomologiques pesant sur les assignations de causalité. En bref, si nous détachons l’événement de sa cause, nous perdons toute chance de pouvoir l’identifier.
Il existe, par ailleurs, des descriptions d’événements qui comportent une référence à une chaîne causale entière ; par exemple : « le fait que Pierre souffre d’une insolation », « le fait que j’aie entre les mains un (authentique) billet de 20 dollars », « le fait que j’aie entre les mains un (authentique) dessin de Rubens », « le fait que j’aie entre les mains la (vraie) montre de mon grand-père ». Nous essayons alors de décrire le monde en nous fondant à la fois sur les propriétés intrinsèques des objets et sur les propriétés extrinsèques liées à l’histoire causale de ces mêmes objets. Afin de constater que Pierre souffre d’une insolation, il ne suffit pas d’observer que Pierre
177 DAVIDSON D., Subjective, Intersubjective, Objective, Oxford, Oxford University Press, 2001, p. 31-33.
dogmatique de l’homonoia l’emporte en agissant sur le pathos de l’auditoire « converti », l’ontologie du discours absolutise systématiquement les faits et les assignations de causalité : le monde reçoit une seule explication, livrée par une doctrine globalisante qui éclaire tout ce qui paraissait, jusqu’alors, inintelligible ou obscur.
I- LA CAUSALITÉ
L’approche de la causalité que je vais adopter dans ce qui suit se fonde sur une distinction de principe entre le niveau des événements, et des liens de causalité qui les unissent, et le niveau des descriptions données de ces événements et de ces liens :
e1 cause e2
⇑ ↑ ⇑le fait que P cause le fait que Q
Le suicide d’Hitler, par exemple, se laisse décrire, en termes de causalité, au moyen d’une proposition comme : « Le fait qu’Hitler se soit suicidé a été causé par le fait que l’Allemagne avait perdu la guerre et qu’il savait qu’il allait finir prisonnier de l’Armée Rouge et… ». À l’intérieur d’une telle proposition, le prédicat « a été causé par » dénote le lien causal entre les événements e1 et e2 (ce qu’indique la flèche simple), tandis que e1 et e2 sont respectivement décrits (mais non dénotés) par les syntagmes nominaux « le fait que l’Allemagne avait perdu la guerre et qu’Hitler savait qu’il allait finir prisonnier de l’Armée Rouge et… » et « le fait qu’Hitler se soit suicidé » (ce qu’indiquent les flèches doubles).
On admet, depuis Hume, que si un événement e1 cause un événement e2, alors e1 (la cause) et e2 (l’effet) doivent pouvoir être décrits indépendamment l’un de l’autre. Prenons l’exemple d’une insolation177 : si une exposition excessive au soleil a causé une réaction cutanée, l’on doit pouvoir décrire cette exposition excessive au soleil et cette réaction cutanée indépendamment l’une de l’autre. De même, il doit être possible de décrire le suicide d’Hitler (par exemple, au moyen du syntagme nominal « le fait qu’Hitler se soit suicidé ») indépendamment de la description donnée de la cause de ce suicide. Ceci entraîne deux conséquences importantes. D’une part, il s’ensuit qu’en vertu d’une nécessité logique, l’effet (la réaction cutanée, le suicide d’Hitler) aurait pu être causé par autre chose que ce qui se trouve constituer sa cause (par exemple, par l’ingestion de certaines substances pour l’insolation, ou par une subite tumeur cérébrale dans le cas d’Hitler). D’autre part, la description donnée de e1 ou e2 ne suffit alors pas à identifier e1 ou e2. En effet, l’identification des événements requiert non seulement qu’ils soient individués en termes spatio-temporels, mais aussi que leur localisation spatio-temporelle s’avère épistémologiquement accessible. Or nous aurons bientôt l’occasion de voir que nous ne saurions disposer d’un pareil accès en l’absence d’une théorie d’arrière-fond qui détermine le rapport des faits aux événements par l’entremise de contraintes nomologiques pesant sur les assignations de causalité. En bref, si nous détachons l’événement de sa cause, nous perdons toute chance de pouvoir l’identifier.
Il existe, par ailleurs, des descriptions d’événements qui comportent une référence à une chaîne causale entière ; par exemple : « le fait que Pierre souffre d’une insolation », « le fait que j’aie entre les mains un (authentique) billet de 20 dollars », « le fait que j’aie entre les mains un (authentique) dessin de Rubens », « le fait que j’aie entre les mains la (vraie) montre de mon grand-père ». Nous essayons alors de décrire le monde en nous fondant à la fois sur les propriétés intrinsèques des objets et sur les propriétés extrinsèques liées à l’histoire causale de ces mêmes objets. Afin de constater que Pierre souffre d’une insolation, il ne suffit pas d’observer que Pierre
177 DAVIDSON D., Subjective, Intersubjective, Objective, Oxford, Oxford University Press, 2001, p. 31-33.
dogmatique de l’homonoia l’emporte en agissant sur le pathos de l’auditoire « converti », l’ontologie du discours absolutise systématiquement les faits et les assignations de causalité : le monde reçoit une seule explication, livrée par une doctrine globalisante qui éclaire tout ce qui paraissait, jusqu’alors, inintelligible ou obscur.
I- LA CAUSALITÉ
L’approche de la causalité que je vais adopter dans ce qui suit se fonde sur une distinction de principe entre le niveau des événements, et des liens de causalité qui les unissent, et le niveau des descriptions données de ces événements et de ces liens :
e1 cause e2
⇑ ↑ ⇑le fait que P cause le fait que Q
Le suicide d’Hitler, par exemple, se laisse décrire, en termes de causalité, au moyen d’une proposition comme : « Le fait qu’Hitler se soit suicidé a été causé par le fait que l’Allemagne avait perdu la guerre et qu’il savait qu’il allait finir prisonnier de l’Armée Rouge et… ». À l’intérieur d’une telle proposition, le prédicat « a été causé par » dénote le lien causal entre les événements e1 et e2 (ce qu’indique la flèche simple), tandis que e1 et e2 sont respectivement décrits (mais non dénotés) par les syntagmes nominaux « le fait que l’Allemagne avait perdu la guerre et qu’Hitler savait qu’il allait finir prisonnier de l’Armée Rouge et… » et « le fait qu’Hitler se soit suicidé » (ce qu’indiquent les flèches doubles).
On admet, depuis Hume, que si un événement e1 cause un événement e2, alors e1 (la cause) et e2 (l’effet) doivent pouvoir être décrits indépendamment l’un de l’autre. Prenons l’exemple d’une insolation177 : si une exposition excessive au soleil a causé une réaction cutanée, l’on doit pouvoir décrire cette exposition excessive au soleil et cette réaction cutanée indépendamment l’une de l’autre. De même, il doit être possible de décrire le suicide d’Hitler (par exemple, au moyen du syntagme nominal « le fait qu’Hitler se soit suicidé ») indépendamment de la description donnée de la cause de ce suicide. Ceci entraîne deux conséquences importantes. D’une part, il s’ensuit qu’en vertu d’une nécessité logique, l’effet (la réaction cutanée, le suicide d’Hitler) aurait pu être causé par autre chose que ce qui se trouve constituer sa cause (par exemple, par l’ingestion de certaines substances pour l’insolation, ou par une subite tumeur cérébrale dans le cas d’Hitler). D’autre part, la description donnée de e1 ou e2 ne suffit alors pas à identifier e1 ou e2. En effet, l’identification des événements requiert non seulement qu’ils soient individués en termes spatio-temporels, mais aussi que leur localisation spatio-temporelle s’avère épistémologiquement accessible. Or nous aurons bientôt l’occasion de voir que nous ne saurions disposer d’un pareil accès en l’absence d’une théorie d’arrière-fond qui détermine le rapport des faits aux événements par l’entremise de contraintes nomologiques pesant sur les assignations de causalité. En bref, si nous détachons l’événement de sa cause, nous perdons toute chance de pouvoir l’identifier.
Il existe, par ailleurs, des descriptions d’événements qui comportent une référence à une chaîne causale entière ; par exemple : « le fait que Pierre souffre d’une insolation », « le fait que j’aie entre les mains un (authentique) billet de 20 dollars », « le fait que j’aie entre les mains un (authentique) dessin de Rubens », « le fait que j’aie entre les mains la (vraie) montre de mon grand-père ». Nous essayons alors de décrire le monde en nous fondant à la fois sur les propriétés intrinsèques des objets et sur les propriétés extrinsèques liées à l’histoire causale de ces mêmes objets. Afin de constater que Pierre souffre d’une insolation, il ne suffit pas d’observer que Pierre
177 DAVIDSON D., Subjective, Intersubjective, Objective, Oxford, Oxford University Press, 2001, p. 31-33.
122 Marc Dominicy
D’autre part, la description donnée de e1 ou e
2 ne suffit alors pas à
identifier e1 ou e
2. En effet, l’identification des événements requiert non
seulement qu’ils soient individués en termes spatio-temporels, mais aussi que leur localisation spatio-temporelle s’avère épistémologique-ment accessible. Or nous aurons bientôt l’occasion de voir que nous ne saurions disposer d’un pareil accès en l’absence d’une théorie d’arrière-fond qui détermine le rapport des faits aux événements par l’entremise de contraintes nomologiques pesant sur les assignations de causalité. En bref, si nous détachons l’événement de sa cause, nous perdons toute chance de pouvoir l’identifier.
Il existe, par ailleurs, des descriptions d’événements qui comportent une référence à une chaîne causale entière ; par exemple : « le fait que Pierre souffre d’une insolation », « le fait que j’aie entre les mains un (authentique) billet de 20 dollars », « le fait que j’aie entre les mains un (authentique) dessin de Rubens », « le fait que j’aie entre les mains la (vraie) montre de mon grand-père ». Nous essayons alors de décrire le monde en nous fondant à la fois sur les propriétés intrinsèques des objets et sur les propriétés extrinsèques liées à l’histoire causale de ces mêmes objets. Afin de constater que Pierre souffre d’une insolation, il ne suffit pas d’observer que Pierre présente une certaine réaction cutanée ; encore faut-il s’assurer de ce que cet effet ait été causé par une exposition excessive au soleil, et non par l’ingestion de quelque produit chimique. Mais il peut arriver que l’histoire causale soit le seul paramè-tre décisif. Pour reprendre à Searle l’une de ses illustrations favorites, nul faussaire ne saurait se défendre en arguant du fait que personne ne parvient à distinguer les dollars qu’il a fabriqués de ceux émis par l’Hôtel des Monnaies américain4. Dans le domaine des arts plastiques, les historiens, les critiques et les « amateurs » ont longtemps cru, ou voulu croire, que l’authenticité de l’œuvre ne se laissait pas dissocier de sa matérialité synchronique ; mais ce « paradigme tracéologique » ne résiste guère face aux échecs répétés des expertises5. De même, si je conserve pieusement la montre de mon grand-père, dont le modèle a été reproduit en des millions d’exemplaires que je serais incapable de distinguer entre eux, l’« authenticité » de cette montre ne dépend que
4. Searle J. R., La construction de la réalité sociale, trad. C. Tiercelin, Paris, Gallimard, 1998 [1995].
5. Lenain Th., « Le “faux parfait”, image sans apparence », dans E. Clemens et al. (éd.) Le labyrinthe des apparences, Bruxelles, Éd. Complexe, coll. « Revue de l’Université de Bruxelles », 2000/1, p. 263-274.
Les sources cognitives de la théorie du complot 123
de sa présence à tous les stades d’une chaîne causale qui me relie à mon grand-père ; si j’apprends que quelqu’un a cassé cette montre, et lui a substitué un autre exemplaire sans me le dire, j’éprouverai un certain ressentiment alors même que je ne puis déceler aucune propriété intrin-sèque qui séparerait le nouvel exemplaire de l’objet « authentique6 ».
De tout cela découle un paradoxe apparent. D’un côté, le suicide d’Hitler, en tant qu’événement, possède une cause unique (même si celle-ci est très complexe) ; d’un autre côté, toute explication causale (huméenne) du suicide d’Hitler doit être formulée de telle sorte que plusieurs propositions de la forme « Le fait qu’Hitler se soit suicidé a été causé par le fait que P » s’avèrent logiquement possibles (la causa-lité doit rester contingente à ce niveau descriptif). Il y a là un premier élément à retenir quand on aborde la théorie du complot, dont la nature causale saute d’emblée aux yeux. En effet, un syntagme nominal comme « le fait que les attentats du 11-Septembre aient eu lieu » ne préjuge en rien de la cause assignée aux attentats du 11-Septembre en tant qu’événement ; mais il demeure vrai que les attentats du 11-Septembre, en tant qu’événement, procèdent d’une cause unique (quoique très complexe). Ce double résultat ouvre la voie à deux dérives. La pre-mière consiste à invoquer la pluralité des causes logiquement possibles, pour un effet décrit en termes huméens, afin d’en conclure à l’inanité d’assigner une cause unique à cet effet – ce qui revient à confondre un relativisme épistémologique avec un relativisme ontologique. La seconde, partant de l’unicité de la cause, proclame l’impossibilité de décrire l’effet indépendamment de sa cause – ce qui revient à confondre un absolutisme ontologique avec un absolutisme épistémologique. La théorie du complot met en œuvre, selon les moments, l’une et l’autre dérives. Face à un événement dont l’explication causale lui semble insatisfaisante, elle jette le soupçon sur toute explication causale dans
6. Voir Dominicy M. et Gullentops D., « Introduction », dans M. Dominicy et D. Gullentops (éd.), Genèse et constitution du texte – Degrés, n° 121-122, 2005, p. a1-a7. Ce dernier exemple montre, par parenthèse, les objections que l’on peut adres-ser à la notion d’aura, telle que la définit W. Benjamin. Pour ce dernier (Benjamin W., Écrits français, présentés et introduits par J.-M. Monnoyer, Paris, Gallimard, 1991, p. 142), « l’authenticité d’une chose intègre tout ce qu’elle comporte de transmissible de par son origine, sa durée matérielle comme son témoignage historique ». Mais sa phraséologie causaliste n’empêche pas W. Benjamin d’affirmer ensuite que « ce témoi-gnage, reposant sur la matérialité, se voit remis en question par la reproduction, d’où toute matérialité s’est retirée ».
124 Marc Dominicy
le principe – sa rhétorique consiste alors à demander une « ouverture d’esprit », une « pensée sans a priori » ; mais, dans un second mou-vement, elle ne reconnaît aucune validité à la description de l’effet si celle-ci n’inclut pas la cause à préférer – sa rhétorique consiste alors à prôner une « rigueur explicative », une capacité à « décoder le cours des choses ». À ce dernier stade, elle nous fournira des descriptions, en termes de faits, qui établiront un rapport nécessaire entre les propriétés intrinsèques des divers objets impliqués et les propriétés extrinsèques liées à leur histoire causale : par exemple, pour le 11-Septembre, on pourra privilégier le fait qu’à cette date, des attentats meurtriers aient frappé le pays du Watergate.
II. La notion de « fait »
De nombreux philosophes7 défendent l’idée selon laquelle la vérité objective d’une proposition P requiert l’existence d’un « fait » (ou « truth-maker ») qui « corresponde » à P. Or un tel recours à la notion de « fait » soulève de graves difficultés8, dont l’origine tient, pour l’es-
7. Parmi lesquels Wittgenstein L., Tractatus Logico-Philosophicus, trad. G.-G. Granger, Paris, Gallimard, 1993 [1922] ; Russell B., « The philosophy of logical atomism » [1918], dans B. Russell, Logic and Knowledge: New Philosophi-cal Essays, R. C. Marsh (ed.), London, Allen and Unwin, 1956, p. 175-281 ; Austin J. L., Philosophical Papers, J. O. Urmson & G. J. Warnock (eds.), Oxford, Oxford University Press, 1961 [1946] ; Barwise J. & Perry J., Situations and Attitudes, Cambridge – Mass., The MIT Press, 1983 ; Searle J. R., La construction de la réalité sociale, op. cit.
8. Voir, notamment Gochet P., Esquisse d’une théorie nominaliste de la propo-sition, Paris, Armand Colin, 1972; Neale S., Facing Facts, Oxford, Oxford University Press, 2001. L’une des questions les plus délicates concerne l’existence éventuelle de faits (ou de « truth-makers ») purement négatifs. Voir déjà le commentaire de Ogden C. K. & Richards I. A., The Meaning of Meaning: A Study of the Influence of Lan-guage upon Thought and of the Science of Symbolism, second edition revised, London – New York, Kegan Paul, Trench, Trubner & CO – Harcourt, Brace & Company, 1927, p. 291-295, sur Russell B., Logic and Knowledge: New Philosophical Essays, op. cit., et, plus récemment, Dominicy M., « Conscience et réalité physique. Sur une thèse de David Chalmers », dans F. Beets et M.-A. Gavray (éd.), Logique et ontologie : pers-pectives diachroniques et synchroniques. Liber amicorum in honorem Huberti Hubiani, Liège, Éd. de l’Université de Liège, 2005, p. 133-147 ; Molnar G., « Truth-makers for negative truths », Australasian Journal of Philosophy, 78, 2000, p. 72-86 ; Beall J. C., « On truthmakers for negative truths », Australasian Journal of Philoso-phy, 78, 2000, p. 264-268. De plus, l’argument dit du « lance-pierre » montre que,
Les sources cognitives de la théorie du complot 125
sentiel, à ce qu’on ne peut pas accepter un principe général qui semble pourtant indiscutable à première vue :
S’il est vrai, pour toute situation, que P est vraie si, et seulement si, Q est vraie, alors, dans toute situation où P et Q sont vraies, le fait que P est le fait que Q. Ainsi, pour toute situation, « 2+3 = 5 » est vraie si, et seulement si, « 3+2 = 5 » est vraie ; donc, pour toute situation (où, de toute manière, ces deux propositions sont vraies), le fait que 2+3 = 5 est le fait que 3+2 = 5.
On n’éprouve guère de peine à imaginer des contre-exemples. Pour toute situation où un spectateur contemple une scène donnée selon une certaine perspective, Chirac se trouve (assis) à gauche de Sarkozy si, et seulement si, Sarkozy se trouve (assis) à droite de Chirac. Mais le fait que Chirac se trouve à gauche de Sarkozy n’est pas le fait que Sarkozy se trouve à droite de Chirac. En effet, je puis juger surprenant le fait que Chirac se trouve à gauche de Sarkozy sans juger surprenant le fait que Sarkozy se trouve à droite de Chirac, et vice-versa. La mère de Sarkozy peut ressentir de la fierté face au fait que Sarkozy se trouve à droite de Chirac, sans ressentir aucune fierté face au fait que Chirac se trouve à gauche de Sarkozy ; elle peut même ne pas prendre conscience de ce fait. Ou encore, elle peut ressentir une fierté modeste (vis-à-vis de Chirac) face au fait que Sarkozy se trouve à droite de Chirac, ou une fierté méprisante (pour Chirac) face au fait que Chirac se trouve à gauche de Sarkozy.
Pour que le fait que P existe, il ne suffit donc pas que P soit vraie ; il faut, en outre, que P (et non une proposition Q qui serait équivalente à P de manière absolue ou dans le seul contexte pris en compte) soit utilisée pour décrire l’événement en question. Popper le souligne : « Les faits sont comme le produit conjoint du langage et de la réalité ; ils sont la réalité telle que la fixent nos énoncés descriptifs9 ».
L’individuation des faits mobilise ainsi deux types de vérité : la « vérité sémantique », qui ne dépend que de l’état du monde, et la « vérité représentationnelle », qui reflète le « point de vue » entretenu
moyennant des hypothèses qui semblent raisonnables, toutes les propositions vraies doivent se voir « correspondre » un et un seul fait (Davidson D., Enquêtes sur la vérité et l’interprétation, op. cit. ; Neale S., Facing Facts, op. cit.)
9. Popper K. R., Conjectures et réfutations. La croissance du savoir scientifique, trad. M. I. et M. B. de Launay, Paris, Payot, 1985 [1963], p. 318.
126 Marc Dominicy
par un esprit vis-à-vis de ce même monde10. Les propositions « Le 11-Septembre, des attentats meurtriers ont frappé les États-Unis » et « Le 11-Septembre, des attentats meurtriers ont frappé le pays du Watergate » sont toutes deux sémantiquement vraies, et équivalentes entre elles dans le contexte envisagé ; mais elles ne représentent pas l’événement en question de la même manière : on peut juger l’une ou l’autre sémantiquement vraie mais néanmoins « inadéquate », c’est-à-dire représentationnellement fausse. Les syntagmes nominaux « le fait que, le 11-Septembre, des attentats meurtriers aient frappé les États-Unis » et « le fait que, le 11-Septembre, des attentats meurtriers aient frappé le pays du Watergate » ne dénotent pas un événement – ils dénotent, chacun, un fait spécifique – mais ils décrivent un seul et même événement, quoiqu’ils ne suffisent pas à l’individuer, ni dès lors à l’identifier. Il en résulte que l’inventaire des faits excédera toujours l’inventaire des événements et celui des classes d’équivalence de pro-positions vraies.
La théorie du complot met pleinement à profit ce statut complexe des faits. Partant de l’observation (correcte) que les faits n’existent pas indépendamment d’un « point de vue » à portée descriptive, on conclut de la relativité des faits à la relativité des événements – ce qui revient, de nouveau, à confondre le relativisme épistémologique avec le relativisme ontologique. Une fois cette « dénonciation » acquise, la théorie du complot va utiliser à plein régime la capacité que possède le langage naturel de nous fournir en faits dont le nombre excède toujours celui des événements et celui des classes d’équivalence de proposi-tions vraies. Par exemple, on parlera systématiquement du fait que des attentats meurtriers aient frappé le pays du Watergate pour répondre à quelqu’un qui aurait évoqué le fait que des attentats meurtriers aient frappé les États-Unis.
Si la prolifération des faits s’allie si aisément au relativisme onto-logique (donc à une sorte de prolifération des événements), cela tient
10. Voir Dominicy M., « Langage, interprétation, théorie. Fondements d’une épistémologie moniste et faillibiliste », dans J.-M. Adam et U. Heidmann (éd.), Scien-ces du texte et analyse de discours. Enjeux d’une interdisciplinarité, Genève, Slatkine, 2005, p. 231-258 ; « L’évocation discursive. Fondements et procédés d’une stratégie “opportuniste” », dans « Linguistique et poésie : le poème et ses réseaux », M. Monte et J. Gardes-Tamine (éd.), Semen, n° 24, 2007, p. 145-165 ; « Les modèles de la phrase littéraire. Sur les pas de Michael Riffaterre », dans R. Bourkhis et M. Benjelloun (éd.), La phrase littéraire, Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant, 2008, p. 19-33.
Les sources cognitives de la théorie du complot 127
sans doute à la prégnance cognitive dont le langage mentaliste bénéficie aux yeux des êtres humains. Dans ce langage, la dimension descriptive que revêtent les syntagmes nominaux dénotant des faits exerce une influence décisive sur l’ontologie des événements décrits. Neale se demande comment la proposition (1) peut être vraie si un simple évé-nement a provoqué le trouble de Paul11 :
(1) Le fait que Marie se soit éclipsée de la réception n’a pas troublé Paul ; mais le fait qu’elle se soit éclipsée si vite l’a troublé.
En réalité, Paul a été troublé par un fait, qui ne saurait exister indépen-damment de la représentation qu’il s’est forgée du monde. Le processus causal à l’œuvre met alors en jeu un événement mental, interne à l’esprit de Paul : son évaluation de la rapidité avec laquelle Marie s’est éclipsée. Par conséquent, les syntagmes nominaux « le fait que Marie se soit éclipsée de la réception » et « le fait que Marie se soit éclipsée si vite de la réception » ne décrivent pas le même événement. Si la proposition (1) se révèle bien plus acceptable que la variante, formellement proche, qui suit :
(2) Le fait que Marie ait heurté la table de la tête ne l’a pas tuée ; mais le fait qu’elle l’ait heurtée si violemment l’a tuée.
cela tient à ce que la nature strictement physique du processus qui a conduit à la mort de Marie ne permet de faire aucune distinction onto-logique entre les événements décrits par les syntagmes nominaux qui dénotent les faits mentionnés.
On peut aussi exploiter les propriétés logiques des langages naturels pour construire de nouveaux faits. Par exemple, si les propositions « Les attentats du 11-Septembre ont eu lieu » et « Une réunion de FBI s’est tenue le 9 septembre 2001 » sont sémantiquement vraies, alors la proposition « Une réunion du FBI s’est tenue deux jours avant les attentats du 11-Septembre » est sémantiquement vraie, et vice-versa. Rien ne s’oppose, bien sûr, à ce qu’on déclare surprenant, suspect, questionnant, etc. le fait qu’une réunion du FBI se soit tenue deux jours avant les attentats du 11-Septembre, alors que le fait qu’une réunion du FBI se soit tenue le 9 septembre 2001 n’a, en soi, rien de surprenant, de
11. Neale S., Facing Facts, op. cit., p. 44 n. 29.
128 Marc Dominicy
suspect, de questionnant, etc. En d’autres termes, la stratégie à l’œuvre ne consiste pas à abolir les faits, mais en quelque sorte à les absolutiser après avoir relativisé les événements.
III. L’inscrutabilité sémantique
Dans un article qui remonte à 1969, Davidson recourait à la causalité afin d’individuer les événements :
« [D]es événements sont identiques si et seulement si ils ont exac-tement les mêmes causes et les mêmes effets. Les événements occupent une position unique dans le système des relations causa-les entre événements un peu de la même manière que les objets occupent une position unique au sein du système spatial des objets en général12. »
Après avoir montré la circularité de ce critère, Quine a proposé une individuation en termes spatio-temporels et Davidson s’est rallié à son approche13. Or les langages naturels n’autorisent une telle individuation que si nous les pourvoyons d’un métalangage sémantique ; en effet, le caractère continu de l’espace-temps nous impose de postuler l’infinité non dénombrable des réels, et celle-ci surpasse la cardinalité dénom-brable généralement reconnue à l’ensemble infini des propositions que l’on peut former grâce à la grammaire récursive d’un langage naturel14. De surcroît, l’individuation ne relève que de l’ontologie en ce qu’elle se borne à fixer les conditions d’identité entre événements, tandis que l’identification détermine notre rapport épistémologique à l’ontologie admise. Pour reprendre la comparaison initiale de Davidson, nous avons beau savoir que des objets sont identiques si et seulement s’ils occupent la même portion de l’espace, il ne s’ensuit pas, pour autant, que nous nous montrions capables d’identifier n’importe quel objet.
12. Davidson D., Actions et événements, trad. P. Engel, Paris, PUF, 1993 [1980], p. 240-242.
13. Quine W. V. O., « Events and reification » et Davidson D., « Reply to Quine on events », dans E. LePore & B. P. McLaughlin (eds.), Actions and Events: Per-spectives on the Philosophy of Donald Davidson, Oxford – Cambridge (USA), Blackwell, 1985, p. 162-171 et 172-176.
14. Dominicy M., « Effabilité », dans S. Auroux (éd.), Encyclopédie philosophi-que universelle – Les notions philosophiques, Paris, PUF, vol. I, 1990, p. 751-753.
Les sources cognitives de la théorie du complot 129
Considérons, à titre d’exemple, la proposition « Le fait qu’Hitler se soit suicidé a été causé par le fait que l’Allemagne avait perdu la guerre ». Nous lui donnerons, en nous inspirant de Davidson, la forme logique
(3) (Ǝe1) (Ǝe
2) [ L’Allemagne-avoir-perdu-la-guerre (e
1)
& Hitler-s’être-suicidé (e2) & cause (e
1, e
2) ].
La quantification que rétablit cette analyse suffit à montrer que ni e1, ni
e2 ne doivent être identifiés : seules se trouvent requises l’existence d’un
événement e1 décrit par le syntagme nominal « le fait que l’Allemagne
ait perdu la guerre », l’existence d’un événement e2 décrit par le syn-
tagme nominal « le fait qu’Hitler se soit suicidé », et la relation causale entre e
1 et e
2, que dénote le prédicat « a été causé par ».
Dans la mesure où la sémantique ne nous fournit aucun critère d’identification, nous avons besoin, pour surmonter le gouffre qui sépare les faits des événements, d’un cadre nomologique d’arrière-fond, constitué d’hypothèses causales. Cette exigence passe aisément inaperçue, surtout lorsqu’on se fonde sur un lien de causalité (réel ou illusoire) afin d’assigner une « signification naturelle » à l’un ou l’autre événement15. Considérons, pour illustrer ce problème, les deux propo-sitions qui suivent16 :
(4) Le fait que ces oiseaux volent bas signifieN (est causé par le
fait) qu’il va pleuvoir.(5) Le fait que ces oiseaux volent bas signifie
N (est causé par le
fait) que notre roi va mourir.
Pour que la proposition (4) ou la proposition (5) soit sémantiquement vraie, il faut, mais il ne suffit pas, que la proposition « Ces oiseaux volent bas » soit sémantiquement vraie, et que la proposition « Il va pleuvoir » ou « Notre roi va mourir » soit sémantiquement vraie. De surcroît, l’événement e
2 décrit par le syntagme nominal « le fait que
15. Grice H. P., Studies in the Way of Words, Cambridge – Mass., Harvard Uni-versity Press, 1989.
16. Voir Boyer P., Tradition as Truth and Communication: A Cognitive Descrip-tion of Traditional Discourse, Cambridge, Cambridge University Press, 1990 ; Dominicy M., « Discourse evocation: Its cognitive foundations and its role in speech and texts », dans P. De Brabanter & M. Kissine (eds.), Utterance Interpretation and Cognitive Models, Bingley, Emerald Group Publishing, 2009, p. 179-210.
130 Marc Dominicy
ces oiseaux volent bas » doit être causé par l’événement e1 que décrit le
syntagme nominal « le fait qu’il va pleuvoir » ou « le fait que notre roi va mourir ». Bien évidemment, e
1 ne saurait s’identifier à la pluie future
ou à la mort annoncée, car nous aurions alors affaire, dans chaque cas, à une causalité rétroactive.
Si nous voulons arriver à un véritable critère de vérité sémantique, nous devons nous demander comment établir, dans le métalangage, une relation entre le fait dénoté et l’événement décrit. Pour ce qui concerne l’exemple (4), la solution réside dans la co-causation : il existe un évé-nement e
1, décrit comme le fait qu’il va pleuvoir, qui cause à la fois un
événement e2, décrit comme le fait que les oiseaux volent bas, et un
événement e3 qui consiste en la chute de pluie à venir. Les syntagmes
nominaux « le fait que ces oiseaux volent bas » et « le fait qu’il va pleuvoir », en décrivant respectivement e
2 et e
1, nous offrent un accès
épistémologique à ces événements ; le syntagme nominal « le fait qu’il va pleuvoir », même s’il ne dénote ni ne décrit e
3, nous permet d’y
accéder épistémologiquement à partir de la description donnée de e1. En
revanche, le locuteur d’un énoncé divinatoire comme (5) se situe hors de tout cadre nomologique. Il s’ensuit que l’identification de e
1 n’obéit
à aucune contrainte : n’importe quel événement dont le début ne soit pas temporellement postérieur à celui de e
2 fera l’affaire.
La théorie du complot exploite abondamment cette « inscrutabilité sémantique ». Pour émettre une proposition (sémantiquement vraie) telle que (6), il suffit de s’appuyer sur la vérité (sémantique) des propositions (7) et (8), et sur l’existence d’un événement quelconque e
1, supposément décrit au moyen du syntagme nominal « le fait que
l’Administration Bush veut faire la guerre à l’Irak », tel que e1 cause
l’événement e2 décrit au moyen du syntagme nominal « le fait que les
attentats du 11-Septembre aient eu lieu » :
(6) Le fait que les attentats du 11-Septembre aient eu lieu signifie
N (est causé par le fait) que l’Administration Bush veut
faire la guerre à l’Irak.(7) Les attentats du 11-Septembre ont eu lieu.(8) L’Administration Bush veut faire la guerre à l’Irak.
Ce mode de raisonnement est à la fois relativiste et absolutiste. Relativiste, parce qu’en l’absence d’un cadre nomologique, l’ins-crutabilité sémantique permet de mentionner, lors de la description
Les sources cognitives de la théorie du complot 131
de l’événement causant, le fait qu’on désire privilégier. Absolutiste, parce qu’en utilisant constamment le même fait dans ce rôle, on peut faire comme si le même événement intervenait toujours dans la chaîne causale, alors que l’inscrutabilité sémantique nous enseigne, au contraire, que l’événement causant peut se modifier à chaque fois.
Les propositions divinatoires du type (5) ou (6) ne sont guère mises en péril par la découverte d’une chaîne causale empirique. Marie Delcourt17 cite, d’après Plutarque (Vie de Périclès, 6), le débat qui opposa Anaxagore au devin Lampon quand Périclès se vit apporter la tête d’un bélier qui n’avait qu’une corne. Pour Lampon, le fait que l’animal ait souffert d’une telle malformation signifiait (naturellement) que l’antagonisme entre le parti de Périclès et celui de Thucydide allait disparaître. Anaxagore, faisant fendre le crâne en deux, montra que celui-ci exhibait un rétrécissement progressif jusqu’au point même où la mystérieuse corne unique prenait racine. Mais, comme le souligne Delcourt, cette observation n’a guère impressionné Plutarque, dans la mesure où l’interprétation initiale de Lampon, telle que résumée en (9), cède aisément la place à une variante plus complexe :
(9) Le fait que ce bélier n’ait qu’une corne signifieN (est causé
par le fait) que l’antagonisme entre le parti de Périclès et celui de Thucydide va disparaître.(10) Le fait que [le fait que ce bélier n’ait qu’une corne] soit causé par [le fait que son crâne se rétrécit progressivement jusqu’à la racine de la corne] signifie
N (est causé par le fait) que
l’antagonisme entre le parti de Périclès et celui de Thucydide va disparaître.
La propension que manifeste la théorie du complot à « absorber » de cette manière les chaînes causales empiriques la rend, certes, infalsi-fiable – ce que nous savions déjà – mais aboutit, surtout, à une ontologie de plus en plus pauvre où un seul macro-événement, qu’il s’agisse de l’univers entier, de la volonté de Dieu, ou du cours inéluctable des choses, se verrait décrit par tous les syntagmes en « le fait que… » figurant à droite du prédicat « est causé par » lorsque l’assignation de causalité fonde un rapport de signification naturelle. C’est là, me
17. Delcourt M., La vie d’Euripide, Lecture de M. Grodent, Bruxelles, Éd. Labor, coll. « Espace Nord », 2004, p. 58-59.
132 Marc Dominicy
semble-t-il, que la théorie du complot acquiert la dimension « détermi-niste » qu’on lui attribue volontiers. Nous n’avons pas affaire, en réalité, à une doctrine déterministe, puisque l’absence de tout cadre nomolo-gique bloque la prédiction causale. Mais, dans la mesure où tous les événements qui ne se confondent pas avec la cause ultime se produisent pour la seule raison que l’univers entier, ou la volonté de Dieu, ou le cours inéluctable des choses, « sont ce qu’ils sont », il en résulte que la théorie du complot nous livre le monde « en bloc », et nous invite à choisir entre la résignation bouddhiste ou la révolte prométhéenne.
Les sources cognitives de la théorie du complot 133
Lorsque la cognition sociale devient paranoïde ou les aléas du scepticisme face
aux théories du complot
Olivier Klein et Nicolas Van der Linden
Qualifier de « théorie du complot » l’explication d’un fait social la rend immédiatement illégitime. Une telle désignation revient, en effet, à dénier à l’explication proposée toute prétention à l’authenticité. Elle provient d’un « dénonciateur » qui, par essence, est un scepti-que, s’insurgeant contre celui qui adhère à la théorie du complot : « le crédule » en proie à l’irrationalité. Le dénonciateur affirme d’emblée sa clairvoyance et dénonce l’obscurantisme de son opposant à grand renfort de faits empiriques qui remettent en cause la vraisemblance de la « théorie » initiale. Ce faisant, il se revendique cartésien (ses conclusions sont des déductions logiques) et positiviste (ses déductions sont basées sur l’observation de faits objectifs). En cela, la théorie du complot est toujours celle d’autrui.
Dans ce texte, nous souhaiterions précisément examiner comment une théorie du complot peut s’élaborer cognitivement. Ces théories reflètent-elles véritablement une dérive pathologique de la rationalité, comme semble le suggérer la forme de mépris que nous nourrissons à leur égard ? Nous tenterons de montrer qu’au contraire, des processus généraux d’explication causale sont susceptibles de rendre compte de leur formation et de leur résilience par rapport aux assauts dont elles font l’objet.
En second lieu, nous mettrons en exergue les limites de l’idéal sceptique qui anime le dénonciateur des théories du complot. Cet idéal se fonde sur l’idée selon laquelle le verdict adressé aux théories de ce type repose sur des faits objectifs. À travers un raisonnement conscient, le jugement serait ajusté aux faits. Plus radicalement, cette position, d’inspiration cartésienne, s’appuie sur le processus d’un jugement sus-pendu qui précède et détermine le partage entre le vrai et le faux. Ceci
134 Marc Dominicy
suppose que la connaissance d’une proposition à propos d’un état du monde et la croyance en l’existence de cet état constituent deux réalités psychologiques clairement distinctes. À l’inverse de cette position, nous nous proposons de repenser la séparation entre le fait de connaître une théorie du complot et le fait d’y croire, en montrant que la rupture entre « croire » et « connaître » est moins franche qu’il n’y paraît.
Pour conclure, nous nous intéresserons à certains facteurs contextuels susceptibles de faciliter la mise en œuvre de ce type de raisonnement à travers le concept de « cognition sociale paranoïde ».
I. Qu’est-ce qu’une théorie du complot ?
« Une théorie du complot est une explication d’un évènement his-torique (ou d’évènements historiques) fondée sur le rôle causal d’un petit groupe d’individus agissant en secret1. »
Remarquons tout d’abord que la définition ci-dessus ne pose aucun jugement quant à la vraisemblance de la théorie postulée. Par ailleurs, selon cette définition, la théorie du complot possède nécessairement les attributs suivants :
1. elle repose sur un raisonnement causal ;2. elle implique un processus de catégorisation sociale, c’est-à-dire
le placement d’individus dans un groupe ;3. elle suppose une intentionnalité de la part des membres de ce
groupe.
Le fait même que des individus en groupe puissent être caractérisés par une intentionnalité commune et une capacité à agir conjointement pré-suppose une perception du groupe non pas comme un simple ensemble de personnes distinctes, ce que Lorenzi-Cioldi2 qualifie de « groupe collection » (comme on pourrait catégoriser par exemple l’ensemble des utilisateurs de rasoirs électriques ou celui des amateurs de science-fiction), mais bien comme une entité dotée d’une organisation interne
1. Keeley B. L., « Of Conspiracy Theories », The Journal of Philosophy, n° 96, 1999, p. 116 (notre traduction).
2. Lorenzi-Cioldi F., Les représentations des groupes dominants et dominés. Collections et agrégats, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 2002.
ou « groupe agrégat ». Le groupe perçu comme capable de comploter n’est donc pas choisi arbitrairement. La représentation qui le caracté-rise, c’est-à-dire le stéréotype social auquel il renvoie, doit tolérer cette possibilité d’organisation et d’intentionnalité commune. Autrement dit, les membres qui composent un tel groupe doivent être perçus comme partageant des motivations qui justifient l’organisation d’un complot, mais aussi comme disposant de moyens spécifiques capables de soute-nir la mise en œuvre de celui-ci. Ces compétences et ces motivations s’insèrent nécessairement dans les stéréotypes sociaux auxquels se rapporte le groupe « comploteur ». C’est ainsi que l’existence de stéréo-types mixtes décrivant les Juifs comme des êtres ethnocentriques, voire xénophobes, mais également puissants et intelligents, a pu favoriser l’émergence de nombreuses théories du complot juif3. Il s’en suit que certains groupes, à propos desquels peuvent circuler des stéréotypes et des préjugés négatifs, mais qui ne sont perçus ni comme organisés, ni comme mal intentionnés, sont moins sujets aux théories du complot que d’autres. En un sens donc, il n’y a pas de théorie du complot sans (certains) stéréotypes.
II. Causalité, Explication et Théorie du complot
La théorie du complot est, par essence, un raisonnement causal. À cet égard, on peut distinguer deux visions antagonistes de la causalité. Selon une première perspective, que l’on peut faire remonter à Hume, les causes constituent des antécédents qui varient conjointement avec des effets : est cause, (1) ce qui se produit antérieurement à l’effet, (2) ce sans quoi l’effet ne se produit pas. Selon une seconde perspective, d’inspiration kantienne, la causalité ne dépend pas uniquement d’une telle « covariation » entre la cause et l’effet, mais repose sur le postulat d’un mécanisme, d’un processus générateur permettant de donner lieu à l’effet. La notion de « puissance causale » se réfère ainsi à l’idée qu’une « chose en cause une autre en vertu de la puissance ou de l’énergie qu’elle exerce sur cette autre chose4 ». Dans cette perspective,
3. Glick P., « Sacrificial lambs dressed in wolves’clothing: envious prejudice, ideology, and the scapegoating of Jews », dans L. S. Newman & R. Erber (eds.) Understanding genocide: The Social Psychology of the Holocaust, Oxford, Oxford University Press, 2002, p. 113-142.
4. Cheng, P. W., « From covariation to causation: A causal power theory », Psy-
136 Olivier Klein et Nicolas Van der Linden
l’effet n’est pas uniquement une conséquence nécessaire de la cause mais constitue la résultante d’un processus produit par la cause. Cette vision mécaniste de la causalité convient particulièrement à l’expli-cation d’évènements singuliers, ce qu’Hilton5 qualifie d’« attribution causale » (causal ascription), par opposition à l’« induction causale » qui concerne l’explication de phénomènes généraux (comme, par exemple, l’efficacité d’un médicament par rapport à une maladie) et qui fonctionne davantage selon une perspective humienne. L’attribution causale s’applique particulièrement aux théories du complot qui, géné-ralement, sont mobilisées pour expliquer des évènements singuliers (même si elles peuvent parfois être généralisées pour « éclairer » plusieurs événements ensemble). Dans le cas de l’attribution causale, on invoque un mécanisme qui aura souvent une forme narrative pour rendre compte de l’effet. Dans le contexte de ce récit, plusieurs facteurs déterminent la puissance d’une cause. Trois d’entre eux nous semblent particulièrement importants dans le cas des théories du complot et seront considérés plus avant ci-dessous.
Conjonction et théorie du complot
À l’origine de toute théorie du complot, on trouve un ensemble de « faits » réels ou supposés qui sont subséquemment organisés en un récit cohérent. Or, lorsque l’on dispose d’une théorie permettant d’ex-pliquer certains évènements distincts, on est souvent tenté de surestimer le caractère nécessaire de la conjonction de ces évènements. On a affaire ici à un phénomène bien connu, l’erreur de conjonction6, qui consiste précisément à estimer la probabilité de deux évènements conjoints comme supérieure à celle de l’un de ces deux évènements considérés isolément. Par exemple, imaginons que l’on adhère à la théorie du complot selon laquelle l’administration Bush aurait fomenté les atten-tats du 11-Septembre pour justifier l’invasion de l’Irak et que l’on doive se mettre dans la peau d’un observateur amené à juger la probabilité
chological review, n° 104, 1997, p. 367-405.5. Hilton D. J., McClure J. L. & Slugoski B. R., « The course of events: Coun-
terfactuals, causal sequences, and explanation », dans D. R. Mandel, D. J. Hilton & P. Catellani, The Psychology of Counterfactual Thinking, London, Routledge, 2005, p. 44-73.
6. Tversky A. & Kahneman D., « Probability, representativeness, and the con-junction fallacy », Psychological Review, n° 90, 1983, p. 293-315.
Lorsque la cognition sociale devient paranoïde 137
de certains faits en rapport avec cet événement. Dans cette situation, et contrevenant ainsi à la théorie des probabilités, on considérera la probabilité conjointe des deux faits suivants : « trouver de l’acier fondu dans les débris des tours jumelles » et « absence de réaction du gouver-nement Bush aux informations selon lesquelles des militants proches de Ben Laden s’entraînaient dans des écoles de pilotage », comme plus élevée que la probabilité de l’un de ces évènements considéré isolément. Cette tendance à surestimer la co-occurrence de plusieurs évènements ne serait présente que si, conformément à l’exemple précédent, une explication mécaniste permettant d’incorporer ces évènements dans un même récit7 est disponible8. Grâce à l’erreur de conjonction, des faits qui pourraient être purement fortuits ou contingents, apparaissent donc comme nécessaires. L’existence d’un mécanisme explicatif contribue également à produire un « biais de rétrospection9 », c’est-à-dire une tendance à surestimer le caractère prévisible de l’évènement critique (par exemple les attentats du 11-Septembre). Par l’entremise de ces biais cognitifs, la théorie du complot tend à conférer un caractère déter-ministe au passé.
Intentionnalité
Tout évènement est le produit d’un vaste ensemble de conditions dont certaines seront gratifiées du statut de « causes », alors que d’autres seront seulement perçues comme des mécanismes intermédiaires. Les théoriciens du droit Hart et Honoré10 avancent que, dans un contexte judiciaire, on tend préférentiellement à conférer le statut de cause à un antécédent si celui-ci implique un comportement intentionnel. Des
7. Les services secrets américains auraient laissé Ben Laden s’attaquer aux deux tours, mais la véritable cause de l’explosion est leur destruction à l’aide d’explosifs déjà implantés par ces mêmes services. Le mobile étant de justifier l’invasion de l’Irak et la prise de contrôle des ressources pétrolières du pays.
8. Ahn W. & Bailenson J., « Causal attribution as a search for underlying mech-anisms: An explanation of the conjunction fallacy and the discounting principle », Cognitive Psychology, n° 31, 1996, p. 82-123.
9. Fischoff B., « Hindsight ≠ foresight: The effect of outcome knowledge on judgment under certainty », Journal of Personality and Social Psychology, n° 18, 1975, p. 93-119.
10. Hart H. L. A. & Honoré T., Causation in the Law, Oxford, Oxford Univer-sity Press, 1985.
138 Olivier Klein et Nicolas Van der Linden
psychologues sociaux11 ont étayé cette hypothèse empiriquement en présentant à leurs sujets de longues chaînes menant à un évènement critique (par exemple le déraillement d’un train ou l’incendie d’une habitation). Ils ont fait varier expérimentalement certains antécédents impliqués dans la chaîne causale selon que ceux-ci sont intentionnels (par exemple un individu qui jette son mégot) ou non (par exemple le rayonnement du soleil). Ils ont ainsi pu constater que leurs sujets (des étudiants) considéraient préférentiellement comme causes, les compor-tements intentionnels. Si l’on se restreint à présent à l’explication de comportements, d’autres auteurs suggèrent même qu’une explication intentionnelle est choisie par défaut12. En d’autres termes, l’une des caractéristiques centrales des théories du complot, l’intentionnalité, semble procéder d’un mode d’explication quasiment automatique.
(Stéréo-)Typicité et Puissance Causale
D’autres éléments interviennent dans la puissance causale d’un antécédent. Parmi ceux-ci, le rôle de la typicité nous semble particu-lièrement pertinent dans l’appréhension des théories du complot. Le fait qu’un antécédent soit typique de l’agent le rend plus susceptible d’être considéré comme une cause importante même si, en pratique, il n’est pas davantage prédictif de l’issue qu’un antécédent non typique. Imaginez que, pour expliquer le massacre de soldats américains le 5 novembre 2009 à Fort Hood (Texas) par le psychiatre d’origine pales-tinienne, Nidal Malik Hassan, nous puissions invoquer deux causes potentielles : « Hassan était en colère contre ses collègues » vs « Hassan était déprimé ». Imaginez par ailleurs que ces deux causes ont autant de chance de produire l’effet observé (quand le psychiatre est en colère, il est tout autant susceptible de mettre en œuvre des comportements agressifs que lorsqu’il est déprimé). En d’autres termes, la probabi-lité conditionnelle d’une agression est identique selon qu’Hassan soit déprimé ou en colère. Il apparaît que, dans ce type de situation, la cause la plus typique ou la plus fréquente est préférentiellement sélection-
11. McClure D., Hilton D. J. & Sutton R. M., « Judgments of voluntary and physical causes in causal chains: Probabilistic and social functionalist criteria for attributions », European Journal of Social Psychology, n° 37, 2007, p. 879-901.
12. Rosset E., « It’s no accident: Our bias for intentional explanations », Cogni-tion, n° 108, 2008, p. 771-780.
Lorsque la cognition sociale devient paranoïde 139
née13. Par exemple, si l’on pense que Nidal Malik Hassan est souvent fâché contre ses collègues, on choisira davantage cette cause comme explication que si l’on pense qu’il l’est peu souvent. Ce type de résul-tat comporte des implications non négligeables quant à l’appréhension des théories du complot car il suggère que la catégorisation sociale des agents est susceptible d’influencer la puissance causale perçue de l’antécédent. En l’occurrence, sachant qu’Hassan est d’origine palesti-nienne, je pourrai invoquer cette origine pour estimer la fréquence de l’antécédent : « il doit souvent être irrité par des Américains de souche » et donc employer préférentiellement cette cause dans mon explication. Ce mécanisme explique peut-être pourquoi les comportements corres-pondant à des attentes stéréotypées s’insèrent aisément dans une théorie du complot.
Il apparaît donc que les comportements effectués par un ou plusieurs membres d’un groupe sont d’autant plus susceptibles d’être invoqués dans le cadre d’une explication causale que ceux-ci sont (stéréo-) typiquement associés à ce groupe. Ce faisant, ils seront généralement perçus comme les conséquences de dispositions internes partagées par les membres de ce groupe. Dans cette psychologie, l’intention peut opérer le lien entre la disposition (qui définit des traits généraux) et le comportement. Par exemple, l’impérialisme des Américains (disposition générale) peut expliquer l’attaque sur les tours jumelles (comportement) – laquelle attaque est dénoncée comme étant le fruit d’une explosion orchestrée et camouflée par le gouvernement améri-cain – en invoquant la volonté des autorités américaines de dominer le Moyen-Orient (intention).
Scepticisme et théorie du complot
Nous avons envisagé certains facteurs qui facilitent l’élaboration de théories du complot par rapport à d’autres formes d’explications. Intéressons-nous à présent à l’effet de la théorie du complot sur celui qui y est exposé en nous remémorant ces deux récepteurs potentiels : le « naïf », qui adhère à la théorie, et le « sceptique », qui la dénonce. La position de ce dernier se fonde sur le postulat cartésien selon lequel
13. Johnson J. T., Long D.L. & Robinson M. D., « Is a cause conceptualized as a generative force?: Evidence from a recognition memory paradigm », Journal of Experimental Social Psychology, n° 37, 2001, p. 398-412.
140 Olivier Klein et Nicolas Van der Linden
il est possible d’être exposé à une théorie du complot sans pour autant y adhérer. Dans sa quatrième méditation métaphysique, Descartes s’interroge sur la possibilité de se former une idée « vraie ». Comment savoir que l’on « ne se trompe pas », se demande-t-il ? Selon lui, il faut suspendre sa volonté avant de décider « d’assurer une idée ». Une fois que cette idée est suffisamment bien « entendue », on peut lui accorder le statut de vérité :
« La cause des faussetés et des erreurs : toutes les fois que je retiens tellement ma volonté dans les bornes de ma connaissance, qu’elle ne fait aucun jugement que des choses qui lui sont clairement et distinctement représentées par l’entendement, il ne se peut faire que je me trompe ; parce que toute conception claire et distincte est sans doute quelque chose de réel et de positif, et partant, ne peut tirer son origine du néant […]14. »
Dans la perspective cartésienne, on peut donc « envisager » une idée avant de la considérer comme vraie. Lorsque notre entendement en aura formulé une représentation satisfaisante, on pourra alors choisir d’y adhérer ou, au contraire, de la considérer comme fausse ou infondée. Descartes opère donc une distinction fondamentale entre la représenta-tion et la conviction. Il invite à se montrer sceptiques face à toute théorie et à examiner les différents éléments en faveur ou en défaveur de cette théorie avant de se prononcer.
Menaçant cette position sceptique, l’adhésion aux théories du complot semble, au contraire, guidée par des motivations – par exemple antisémites ou racistes – plutôt que par un jugement désincarné. Au lieu de lui être subordonnée, tout se passe comme si, dans l’adhésion aux théories du complot, la volonté précédait l’entendement. Ainsi, celui qui adhère aux théories du complot n’hésite pas à sélectionner, parmi les faits disponibles, ceux qui épousent le mieux sa théorie, et va même jusqu’à déployer des trésors d’imagination pour assimiler ceux qui paraissent la contredire en faisant un usage abondant d’explica-tions complexes et peu économes au regard du rasoir d’Ockham. Par exemple, l’idée selon laquelle l’explosion des tours jumelles ne consti-tuerait qu’un camouflage, suppose la collusion (explicite ou implicite) de deux agents (le gouvernement américain et les « terroristes ») et
14. Descartes R., Méditations Métaphysiques, Paris, 1641, p. 62. Extrait d’inter-net : http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/file/descartes_meditations.pdf.
Lorsque la cognition sociale devient paranoïde 141
implique de développer des explications périphériques par rapport à tous les éléments qui prima facie s’expliquent aisément et de façon plus économique, par l’action d’un seul agent (« Al Qaïda »). En raison de son caractère orienté, et peu économique, la théorie du complot a mau-vaise réputation. L’esprit cartésien apparaît comme un idéal qui décrit le fonctionnement de « mon » esprit de dénonciateur en opposition à celui du crédule, qui serait esclave de sa volonté et formulerait des explications moins élégantes.
Toutefois l’opposition entre l’intellect et la volonté proposée par Descartes n’est pas adoptée par tous. Spinoza, notamment, s’y oppose en envisageant les croyances comme des états cognitifs produits en réponse à des stimuli15. Dans cette vision de l’esprit, on tend à « croire tout ce que l’on sait », et c’est seulement par la force de la volonté que l’on peut rejeter certaines des représentations qui, initialement, forçaient notre conviction. S’il en est ainsi, la théorie du complot deviendrait alors plausible du simple fait d’exister. S’en distancer exige donc davantage d’efforts que d’y adhérer (contrairement à la vision cartésienne).
Peut-on trancher un tel débat ? Confronté à des affirmations non vérifiées sur des états du monde, se comporte-t-on en cartésien ou en spinozien ? Gilbert16 et ses collègues ont cherché à apporter une réponse empirique à cette question en mettant leurs sujets (des étudiants) dans la peau de jurés au sein d’un tribunal. Dans un premier temps, ils les invitaient à lire différentes affirmations concernant un prévenu. On précisait toutefois aux sujets que certaines informations concernant le prévenu étaient incorrectes. Les chercheurs avaient manipulé la nature de ces informations, qui étaient marquées en rouge et donc clairement identifiables : pour la moitié des sujets, ces informations « fausses » (disséminées parmi des informations prétendument authen-tiques) étaient clairement des circonstances atténuantes au regard du crime dont le prévenu était accusé, alors que pour l’autre moitié, elles constituaient des circonstances aggravantes (les informations soi-disant correctes étaient quant à elles identiques pour tous les participants). Ceci constituait la première manipulation expérimentale. La deuxième manipulation visait à scinder les sujets en deux groupes assumant des conditions différentes : dans la condition « occupée », les sujets devai-
15. Spinoza B., Éthique, trad. Ch. Appuhn, Paris, Garnier, 1929.16. Gilbert D. T., Tafarodi R. W. & Malone P. S., « You can’t not believe
everything you read », Journal of Personality and Social Psychology, n° 65, 1993, p. 221-233.
142 Olivier Klein et Nicolas Van der Linden
ent lire les informations portant sur le prévenu tout en effectuant une tâche concurrente (repérer un chiffre affiché sur un écran) alors que dans la condition « libre », les sujets pouvaient consacrer toute leur attention aux informations présentées. Dans un second temps, ils étaient invités à se comporter comme des jurés et, sur base des informations lues, à proposer une peine.
Le raisonnement de Gilbert est le suivant : si les sujets sont « car-tésiens », ils devraient être en mesure d’ignorer les informations marquées en rouge (qui sont annoncées comme étant fausses et qui donc ne devraient pas participer au jugement). En conséquence, il ne devrait pas y avoir de différence dans la peine proposée selon que ces informations constituent des circonstances atténuantes ou aggravantes et ceci que les sujets aient été ou non distraits dans leur lecture par la réalisation d’une tâche concurrente. En revanche, s’ils sont « spi-noziens », ils devraient intégrer les « fausses » informations à leur jugement avant, éventuellement, de s’en dédire et de « corriger » ce jugement initialement faussé. S’il en est ainsi, raisonne Gilbert, cette correction ultérieure du jugement devrait s’avérer particulièrement dif-ficile lorsqu’une tâche concurrente doit être menée. C’est bien ce que l’on observe : dans la condition occupée (et non dans la condition libre), les sujets ont tendance à attribuer une peine plus lourde au prévenu lorsque les informations « fausses » constituent des circonstances aggravantes que lorsqu’elles constituent des circonstances atténuantes. À l’évidence, ceci ne peut pas s’expliquer par une approche cartésienne. La leçon de cette expérience est simple : à défaut de disposer de suffi-samment de ressources cognitives (ou de motivation), toute affirmation apparaît donc comme vraie.
Appliquée aux théories du complot, cette expérience suggère qu’il est difficile de se comporter en véritable sceptique devant de telles constructions : faute de ressources cognitives suffisantes et de la motivation nécessaire, nous sommes susceptibles de les prendre pour argent comptant sans même nous apercevoir de la faillite de notre esprit critique.
Au vu de ces éléments, on peut s’attendre à ce que la simple expo-sition à une théorie du complot, fût-elle complètement fantaisiste, soit suffisante pour induire une adhésion, ne fût-ce que minimale, à celle-ci. C’est cette idée qu’ont testée Sutton et Douglas17. Leurs sujets pou-
17. Douglas K. M. & Sutton R. M., « The hidden impact of conspiracy theo-
Lorsque la cognition sociale devient paranoïde 143
vaient lire plusieurs informations étayant chacune différentes théories du complot concernant l’« assassinat » de Lady Diana. Par exemple, à l’appui de l’hypothèse selon laquelle des cellules « voyoues » des services secrets anglais avaient organisé l’assassinat, on présentait aux sujets un témoignage selon lequel des coups de feu auraient été entendus peu avant l’accident. On leur demandait ensuite d’indiquer leur degré d’adhésion à chacune des théories du complot ainsi que celui qui était le leur avant la présentation des informations (jugement rétrospectif).
De façon remarquable, les sujets sous-estimaient le degré auquel ils avaient été influencés par les informations présentées : ils pensaient ne pas avoir changé d’opinion suite à la présentation des informations alors qu’en réalité, ils croyaient davantage aux différentes théories du complot qu’un groupe contrôle (non exposé aux informations). Qui plus est, les sujets pensaient que les autres participants à l’étude (mais non eux-mêmes) avaient été influencés par ces informations, un résul-tat plus connu sous le nom d’« effet de la troisième personne » (Third Person Effect18), lequel effet désigne la tendance à croire qu’autrui est plus démuni, ou plus crédule que soi-même face aux tentatives de persuasion.
Cette expérience illustre la sensibilité de notre jugement à des données « empiriques » (en l’occurrence des faits qui étayent une théorie du complot). Toutefois, nous ne sommes apparemment pas conscients de cette influence sur notre jugement, ce qui s’oppose une fois encore à l’approche cartésienne. Nous sommes donc toujours sus-ceptibles de surestimer notre immunité face aux théories du complot, ce qui nous rend paradoxalement d’autant plus vulnérables à leur égard.
III. L’empirisme : un antidote ?
Nous avons vu que la théorie du complot se fondait sur un ensemble de « faits ». Elle a donc une vocation empirique. Pour démystifier une théorie du complot (ou toute autre théorie), une réponse logique consisterait à induire ce travail de « correction » nécessaire pour réviser la conviction première. Pour ce faire, on sera tenté de présenter des
ries: Perceived and actual influence of theories surrounding the death of Princess Diana », The Journal of Social Psychology, n° 148, 2008, p. 210-222.
18. Davison W. P., « The third-person effect in communication », Public Opinion Quarterly, n° 47, 1983, p. 1-15.
144 Olivier Klein et Nicolas Van der Linden
faits peu compatibles avec la théorie du complot, voire de remettre en cause les faits qui lui ont donné naissance. Ainsi, pendant sa cam-pagne présidentielle, Barack Obama a été confronté à des allégations selon lesquelles il n’était pas réellement de nationalité américaine mais kényane (ou indonésienne) et musulman. Pour y répondre, son équipe a élaboré un site web affichant les documents prouvant sa citoyenneté, sa foi chrétienne, etc. Ce type de stratégie se fonde sur la supposition que les adeptes d’une théorie du complot sont en mesure de corriger leurs théories (ou de les abandonner) lorsqu’ils sont confrontés à des faits qui s’y opposeraient.
Naturellement, cela suppose que l’interprétation d’un fait (par exemple la carte d’identité du jeune Obama) soit univoque. Or, les faits sont naturellement sujets à de multiples interprétations, quand bien même leur authenticité se voit reconnue19. Plus inquiétant, même lorsque l’interprétation des faits semble relativement univoque et contre-dit la théorie de l’observateur, l’adhésion à cette théorie peut demeurer intacte. On trouve un exemple particulièrement parlant de cette ten-dance dans les travaux20 de Rhedelmeier et Tversky sur la croyance (non fondée) en la relation entre pression atmosphérique et douleur rhumatismale. Ces auteurs ont présenté à leurs sujets (des étudiants) des séquences graphiques montrant l’évolution pendant 30 jours de ces deux variables chez des personnes imaginaires. Il est remarquable de constater que, même lorsque dans ces séquences, les douleurs rhuma-tismales et la pression atmosphérique n’étaient pas corrélées, les sujets percevaient une relation entre ces deux variables. De nouveaux faits, même quand ils ne se conforment pas à une théorie existante, peuvent donc être assimilés et ainsi contribuer à garder intacte, voire à renforcer, la popularité dont elle jouit. Il en va naturellement de même des théories du complot. Tout fait, même apparemment incohérent, peut s’y insérer, par exemple en invoquant une « tentative de camouflage » ou « une volonté de détourner l’attention », ce qui la rend souvent irréfutable.
En dépit de cette hyperphagie assimilatrice, une prétention à l’empi-risme subsiste parmi les adhérents à ces théories. Comme nous l’avons signalé, la théorie émerge parce qu’elle explique la contingence de
19. On a ainsi argué que le certificat, bien qu’authentique, n’était pas valide en raison de l’absence de cachet.
20. Redelmeier D. A. & Tversky A., « On the belief that arthritis pain is related to the weather », Proceedings of the National Academy of Sciences, n° 93, 1996, p. 2895-2896.
Lorsque la cognition sociale devient paranoïde 145
certains faits. Le sceptique peut alors nourrir l’espoir que si ces faits s’avèrent non fondés, la théorie sera remise en question. Par exemple, s’il apparaît, à la lumière de nouvelles archives, que la substance identi-fiée comme de l’acier fondu soit compatible avec l’idée que la chute des deux tours ait été provoquée par la collision des deux avions, la théorie selon laquelle les avions ne seraient qu’une diversion permettant de masquer une véritable explosion ordonnée par le Pentagone ne devrait plus susciter d’adhésion. Mais sommes-nous en mesure de corriger des inférences lorsque les données sur lesquelles elles se fondent s’avèrent a posteriori incorrectes ?
Les travaux sur la persistance des croyances (belief perserverance) vont à l’encontre de cet espoir. L’illustration la plus connue de ce phé-nomène est fournie par une expérience dans laquelle les sujets étaient invités à lire les profils de deux pompiers, dont l’un était présenté comme ayant réussi dans sa carrière (successful) et l’autre comme ayant échoué (unsuccesful21). Les deux profils étaient accompagnés des résultats d’un (faux) test psychologique mesurant un trait de per-sonnalité : la tendance générale à effectuer des choix risqués. Ce test, dont le résultat était manipulé expérimentalement, différenciait les deux pompiers : pour la moitié des sujets, le test révélait que le pompier « ayant réussi » effectuait des choix plus risqués que le pompier « ayant échoué ». L’inverse était vrai pour l’autre moitié des sujets. Les sujets devaient ensuite remplir deux tâches : d’une part, identifier la relation existant entre la tendance à effectuer des choix risqués et la compétence des pompiers et, d’autre part, essayer de proposer une explication à la relation qu’ils avaient mise en évidence. Or, chacune de ces manipula-tions pouvait induire une théorie différente : soit l’idée selon laquelle le succès professionnel d’un pompier dépend de sa tendance à prendre des risques ; soit l’idée selon laquelle ce succès dépend de sa prudence.
Suite à cette tâche, une nouvelle manipulation expérimentale, indé-pendante de la précédente, intervenait : on annonçait à une partie des sujets que les informations qu’on leur avait fournies à propos des deux pompiers étaient fictives et qu’ils avaient, en réalité, été répartis aléatoi-rement dans deux groupes chargés de trouver une relation soit positive, soit négative, entre prise de risque et succès professionnel chez les
21. Anderson C. A., Lepper R. W. & Ross R. W., « Perseverance of social theories: The role of explanation in the persistence of discredited information », Journal of Personality and Social Psychology, n° 39, p. 1037-1049.
146 Olivier Klein et Nicolas Van der Linden
pompiers. Ce « débriefing » n’était pas proposé aux autres sujets. Les chercheurs demandent ensuite à l’ensemble de l’échantillon d’estimer la probabilité de choix risqués (sur l’échelle présentée précédemment) chez des pompiers « ayant réussi » et chez ceux « ayant échoué » dans leur carrière, afin de mesurer la validité perçue du critère « prise de risque ». En tout état de cause, les sujets non « débriefés » devraient rester sensibles aux relations observées (dès lors qu’ils les croient valides). C’est effectivement ce que les chercheurs constatent.
En revanche, les sujets « débriefés » ayant été informés que les données sur lesquelles se fonde leur explication sont fausses, ne devraient pas être influencés par le type de relation (positive ou néga-tive) à laquelle ils ont été exposés. Et pourtant, ils le restent : par rapport à un groupe contrôle (qui n’a pas vu les profils), ils continuent à estimer que les pompiers téméraires ont plus de succès que les autres si la rela-tion présentée antérieurement allait dans ce sens (et inversement). Dans une expérience ultérieure, Anderson, Lepper et Ross22 montrent que cette configuration ne se produit que lorsque les sujets ont dû expliquer la relation observée.
Il apparaît, à la lumière de ces résultats, que le simple fait de devoir formuler une explication face à une relation induite empiriquement ren-force les observateurs dans le sentiment que cette relation est « vraie », et ce même si les données à la base de l’induction se révèlent fictives a posteriori. Ils agiraient de la sorte en bons spinoziens.
En somme, à la lumière de cet aperçu, l’espoir de lutter contre les théories du complot par l’empirisme semble bien ténu.
IV. Cognition sociale paranoïde
Dans ce texte, nous avons envisagé la théorie du complot comme une forme de raisonnement ordinaire en soulignant toutefois que certains facteurs peuvent faciliter l’élaboration de ce type de théorie, en particu-lier la préférence pour les explications intentionnelles et l’influence des stéréotypes sociaux sur l’explication causale. Ces facteurs concernent les données disponibles dans l’environnement immédiat du percevant ou du « théoricien du complot ». Il n’en reste pas moins que certains facteurs psychologiques facilitent l’adhésion aux théories du complot.
22. Ibid.
Lorsque la cognition sociale devient paranoïde 147
Le rôle de certains traits de personnalité a ainsi été souligné23, de même que celui d’une « mentalité complotiste24 ». Malheureusement, au-delà de ces approches purement psychologiques, la psychologie sociale n’a, à notre connaissance, proposé aucun modèle de l’émergence de théories du complot dans le cadre d’ensembles sociaux larges (comme des États, des sociétés, etc.). En revanche, un modèle de ce type a été développé par Kramer dans le cadre des organisations25.
Ce modèle cherche à comprendre comment des individus sont amenés à développer des croyances « paranoïdes » dans un tel contexte. Le modèle se fonde sur le postulat selon lequel ces croyances procè-dent de l’interaction entre des processus cognitifs ordinaires (et donc non pathologiques) et des situations sociales particulières, souvent anxiogènes, dans lesquelles sont placés ces individus. Il envisage prin-cipalement trois facteurs susceptibles d’entraîner le développement d’une cognition sociale « paranoïde » : la perception d’être « différent » des autres membres de l’organisation (par exemple, être « nouveau », appartenir à un groupe social minoritaire, etc.), l’incertitude quant à son statut au sein de cette organisation, et, enfin, le sentiment de faire l’objet d’évaluations au sein de ce système. Ces trois paramètres induisent une forme de défiance vis-à-vis de l’organisation et une « hypervigilance » qui se traduit par une propension à détecter et interpréter tout compor-tement effectué par ses collègues.
L’approche de Kramer s’avère particulièrement intéressante eu égard à la façon dont il mesure l’émergence de ce type de paranoïa dans des systèmes sociaux. Il identifie en particulier ce qu’il qualifie d’« erreur d’attribution sinistre » sur base d’un paradigme ingénieux : des sujets sont placés devant un écran d’ordinateur sur lequel apparaît un point lumineux. Chaque sujet est muni d’une manette supposée influencer la position du point sur l’écran. On signale aux sujets que la position du point sur l’écran est dépendante de l’effort conjoint de l’ensemble des sujets présents. Par ailleurs, on les informe que, si un seul sujet parvient
23. Wagner-Egger P. et Bangerter A., « La vérité est ailleurs : corrélats de l’adhésion aux théories du complot », Revue Internationale de Psychologie Sociale, n° 20, 2007, p. 31-61.
24. Taguieff P.-A., La Foire aux « Illuminés ». Ésotérisme, théorie du complot, extrémisme, Paris, Éd. des Mille et Une Nuits, 2005.
25. Kramer R. M., « Paranoid cognition in social systems: Thinking and acting in the shadow of doubt », Personality and Social Psychology Review, n° 2, 1998, p. 251-275.
148 Olivier Klein et Nicolas Van der Linden
à déplacer le point de façon sensible, il recevra individuellement une récompense. En revanche, si tous les sujets parviennent à maintenir collectivement ce point dans sa localisation, ils recevront chacun une récompense également, mais celle-ci sera moins substantielle. À l’issue de l’expérience, les sujets sont amenés à estimer le degré auquel le point lumineux a dévié de sa position initiale. En réalité, ils ne contrôlaient pas le mouvement de ce point.
En conséquence, la perception d’une déviation, que l’on peut qua-lifier d’erreur, ne pouvait être attribuée par les sujets qu’à l’égoïsme ou aux mauvaises intentions d’un ou plusieurs membres du groupe. Il s’agit donc d’un indice opérationnel de « cognition sociale para-noïde ». De façon remarquable, cette erreur, commune, était d’autant plus susceptible de se produire que les sujets avaient préalablement été invités à s’interroger sur les motivations de leurs partenaires durant la tâche. Cette instruction induit les sujets à s’engager dans un pro-cessus de « rumination sociale », qui encourage la défiance. Kramer attribue cet effet à une « heuristique de jugement » qui aurait la forme suivante : « si j’ai tant pensé à cela, ça doit être vrai26 ».
Cette heuristique n’est jamais que la traduction de l’approche spinozienne décrite précédemment : ce à quoi je pense m’apparaît comme vrai.
Conclusion
L’analyse cognitive de l’émergence de théories du complot révèle que celles-ci ne résultent pas d’une forme de rationalité pathologique. En effet, nous constatons qu’elles ne constituent jamais que l’appli-cation de processus de raisonnement relativement ordinaires à des données disponibles. Nous avons en particulier illustré la force des stéréotypes, de l’intentionnalité et de l’erreur de conjonction dans la for-mation des théories du complot. Plus généralement, nous avons cherché à montrer que leur persistance s’expliquait, en partie, par un mode de fonctionnement spinozien qui, contrairement au modèle cartésien, tend à prendre pour argent comptant toute affirmation. Nous avons tenté de démontrer que le degré d’adhésion aux théories du complot dépendait
26. Kramer R., Meyerson D. et Davis G., « How much is enough? Psychologi-cal components of “guns versus butter” decisions in a security dilemma », Journal of Personality and Social Psychology, n° 58, 1990, p. 984-993.
Lorsque la cognition sociale devient paranoïde 149
de notre niveau d’exposition à des données empiriques les étayant, alors même que nous sommes souvent inconscients de cette influence et donc peu à même de la corriger si ces données s’avèrent infondées. Enfin, nous avons considéré les déterminants sociaux de l’émergence de ces théories à travers le concept de « cognition sociale paranoïde ».
Dans le cadre de notre étude des facteurs d’adhésion aux théories du complot, nous n’avons pas considéré leur nécessaire complément, à savoir la défiance face à des théories, souvent plus parcimonieuses, qui iraient à leur encontre. Or, et c’est peut-être ce que négligent souvent les psychologues sociaux qui s’y intéressent, la théorie du complot ne s’articule pas dans un vide rhétorique. Elle coexiste et se transforme au contact d’autres formes de discours dans le cadre de ce que Byford27 appelle la « communication et l’échange inter-idéologique ». Au terme de son analyse de la littérature conspirationniste serbe, cet auteur suggère même que la théorie du complot procèderait typiquement de l’interpréta-tion littérale de métaphores empruntées à d’autres théories explicatives contemporaines (comme les analyses politiques des relations internatio-nales). Il en est ainsi de la métaphore biologique du néocortex qui fut utilisée dans la littérature militaire américaine pour faire référence à la structure décisionnelle de l’ennemi, et ceci, dans le seul but d’expliquer de façon claire et concrète ce qui est entendu par le concept de « guerre de l’information ». Cependant, une fois assimilée et commentée par la littérature militaire serbe, cette métaphore biologique s’est peu à peu transformée en une référence littérale à la manipulation des cerveaux. Ainsi transformée, elle permettait de formuler, de façon plausible et convaincante, l’idée que l’armée américaine complotait pour développer de nouvelles techniques de guerre et de manipulation des masses s’atta-quant aux fonctions intellectuelles de leurs ennemis. Selon Byford, une telle dynamique d’échange inter-idéologique aurait pour conséquence principale de rendre la théorie du complot plus acceptable.
La théorie du complot fait face à d’autres théories, et sans envisa-ger la dynamique communicationnelle qui s’établit entre elles, notre compréhension de sa popularité restera nécessairement lacunaire. En darwinien naïf, on pourrait s’attendre à ce qu’une théorie disparaisse dans un environnement où d’autres théories autant, voire plus vraisem-
27. Byford J., « Anchoring and objectifying “neocortical warfare”: re-presenta-tion of a biological metaphor in Serbian conspiracy literature », Papers on Social Representations, n° 11, 2002, p. 1-14.
150 Olivier Klein et Nicolas Van der Linden
blables, disposent d’une capacité de diffusion identique, ou plus élevée. Or, comme le suggère notre analyse des limites de l’empirisme face aux théories du complot, il n’en est pas souvent ainsi : la popularité de la théorie parvient en effet fréquemment à résister à toutes les attaques dont elle est l’objet. Au regard du fonctionnement spinozien que nous avons décrit, sa diffusion la rend consensuelle. À cet égard, la vivacité d’une théorie du complot, en particulier lorsque celle-ci semble peu parcimonieuse, doit trouver sa source dans une faillite de « dialogue » entre théories concurrentes. En particulier, pour que les théories offi-cielles ne soient pas crues, il faudrait qu’elles fassent l’objet d’une défiance suffisante pour être rejetées par leurs audiences spinoziennes (après avoir été initialement acceptées).
L’échec de ce dialogue résulte souvent d’une absence de confiance dans les institutions, accusées de produire les faits (qui deviennent sus-pects) et les théories qui les accompagnent. Si l’on transpose l’approche de Kramer à un niveau macro-social, il apparaît donc que comprendre l’émergence de théories du complot revient, en grande partie, à tracer la genèse de la défiance vis-à-vis des institutions au sein de certaines col-lectivités. Une tâche qui, pour la psychologie sociale, reste à accomplir.
Lorsque la cognition sociale devient paranoïde 151
Jean-Baptiste Louvet et l’obsession du complot aristocratique
Valérie André
Les articles réunis dans ce volume le prouvent, l’étude transdis-ciplinaire des théories du complot et de leur pouvoir rhétorique est d’une actualité sans cesse renouvelée. Les choses se répètent, selon un mécanisme immuable d’exaspération des angoisses collectives, lié à une certaine mythologie du secret.
La réflexion que j’aimerais développer s’inscrit dans la continuité des analyses présentées ici par Marc Angenot. Celui-ci rappelle l’im-portance de l’Abbé Augustin Barruel dans l’élaboration d’une théorie du complot judéo-maçonnique1 et nous replonge dans la période com-plexe des troubles révolutionnaires. Mil sept cent quatre-vingt-neuf symbolise la fin d’un monde. On ne rappellera pas ici les convulsions économiques, sociales, politiques et idéologiques qui ont agité la France pré-révolutionnaire et contribué à installer un climat fin de siècle propice à la multiplication de mouvements sectaro-mystiques, éloignés du « rationalisme des Lumières ». Le succès de l’illuminisme, revisité par Louis-Claude de Saint-Martin, le magnétisme de Mesmer, ou les mystifications de Joseph Balsamo traduisent le malaise d’une société en crise, à la recherche d’une nouvelle spiritualité2. Tous les ingrédients étaient présents à l’époque pour favoriser la fermentation d’une pensée paranoïaque capable d’expliquer, rationnellement, ou, du moins, de rationaliser, le bouleversement d’un empire que tous avaient cru immuable. L’obsession du complot, démultiplié, est omniprésente et touche tous les partis en présence : la réaction emboîte le pas à Barruel
1. Dans ses Mémoires pour servir à l’histoire du jacobinisme (Hambourg, P. Fauche, 1798-1799, 5 vol.), l’Abbé Barruel soutient l’idée selon laquelle la Révolution française serait née d’un complot fomenté par les juifs et les francs-maçons pour détruire l’Église et la royauté.
2. À ce propos, on consultera l’ouvrage déjà ancien d’A. Viatte , Les sources occultes du romantisme. Illuminisme. Théosophie (1770-1820), Paris, Honoré Cham-pion, 1928.
et crie au complot judéo-maçonnique ; les révolutionnaires accusent le roi et la noblesse de se coaliser dans un complot aristocratique destiné à affamer le peuple et détruire l’oeuvre de 893. Parmi ces derniers, Jean-Baptiste Louvet fait figure d’exemple.
I. Jean-Baptiste Louvet, écrivain, journaliste et politique
Le personnage reste peu connu, et pourtant, son œuvre littéraire l’inscrit au nombre des grands romanciers du xviiie siècle. Jean-Baptiste Louvet naît à Paris le 12 juin 17604. Il entame des études, probablement au collège, et acquiert une bonne connaissance des auteurs latins à qui il empruntera, quelques années plus tard, le ton et l’inspiration rhéto-riques. Il est très jeune encore lorsqu’il rencontre celle qui allait être l’amour de toute une vie : Marguerite Denuelle, qu’il surnommerait bientôt Lodoïska, du nom de l’héroïne polonaise de son roman Faublas. L’idylle est contrariée, cependant, par le mariage forcé de Marguerite, qui doit quitter la capitale.
En 1777, Louvet est engagé comme secrétaire du minéralogiste Philippe Frédéric de Dietrich, le futur maire de Strasbourg. Quelque temps après, il change d’orientation et devient commis du libraire-imprimeur Prault. C’est à peu près à cette époque qu’il songe à entreprendre des études de droit, sans jamais y parvenir. Privé du titre, Jean-Baptiste ne se sent pas pour autant délivré de la vocation et en 1778, il prend la défense d’une servante à qui il fait obtenir le prix de vertu crée par Montyon. Les années passent sans que rien de particu-lier ne vienne bousculer l’existence du jeune homme, jusqu’à ce qu’il retrouve en 1784, Marguerite Cholet-Denuelle, son amour de jeunesse.
3. Les historiens sont nombreux à s’être penchés sur la question. La monographie de G. Lefebvre, La grande peur de 1789, publiée à Paris chez Armand Colin en 1932 a longtemps fait autorité. Le propos en est aujourd’hui modéré par les travaux de cher-cheurs comme T. Tackett (voir notamment : « La grande peur et le complot aristocratique sous la révolution française », Annales historiques de la Révolution française, n° 335, 2004, p. 1-17. Article consultable en ligne : http://ahrf.revues.org/1298).
4. Nous renvoyons à notre ouvrage Les Mémoires de Jean-Baptiste Louvet ou la tentation du roman, Paris, Honoré Champion, coll. « Les Dix-huitièmes siècles », 2000. On y trouvera une biographie détaillée et une analyse de l’ensemble de ses œuvres. La question du complot y est abondamment traitée.
Jean-Baptiste Louvet et l’obsession du complot aristocratique 155
Tout était en train de changer pour lui. Sa vie affective prenait un tour nouveau et il avait en tête de devenir écrivain. Sa muse le dirigea sur le chemin du roman où il lança un Chérubin de quinze ans qui devait le rendre célèbre : le chevalier de Faublas dont, pendant plus de trois ans, il raconta les aventures.
La première partie, intitulée Une Année de la vie du chevalier de Faublas, paraît en 17875. Louvet signe alors Louvet de Couvray, sans doute moins par prétention nobiliaire que par concession au goût de l’époque pour la particule. Le succès est immédiat, les fredaines du jeune aristocrate volage enthousiasment le public. Entraîné par une telle réussite, le nouvel auteur consacre tout son temps libre à la rédaction de la suite du roman et, dès 1788, les Six semaines de la vie de Faublas s’étalent dans les devantures des librairies. Désormais célèbre, cou-ronné des lauriers de la gloire littéraire, Jean-Baptiste a tout pour être heureux. Marguerite s’est séparée de son mari, ils pourront dans peu de temps vivre ensemble. Plongé dans la rédaction de La Fin des Amours il goûte au bonheur rousseauiste de la vie simple et de l’amour partagé :
« Tout ce qui peut rendre heureux un homme sensible dont les goûts sont simples, je l’avais obtenu avant la révolution. Je vivais à la campagne que j’aimais avec passion. J’y composais des ouvra-ges dont le succès avait commencé ce que j’appelais ma petite fortune. Elle était petite, en effet, comme mon ambition. Vivement épris de l’indépendance, j’avais compris de bonne heure que le seul moyen de me l’assurer était de borner, autant que possible, mes besoins ; aussi le luxe, enfant de la coquetterie des premiers jours de mon adolescence, je l’avais chassé. J’avais appelé la sobriété, si nécessaire à la santé de chacun, plus nécessaire au travail d’un homme de lettres […]6. »
La prise de la Bastille est accueillie avec enthousiasme par le couple. Louvet, acquis aux idées de la Révolution, arbore fièrement une cocarde tricolore que lui a confectionnée sa Lodoïska. Romancier de talent, amant comblé, Louvet ne se sent guère poussé vers la carrière politi-que, l’action ne le tente pas. « Assez d’hommes alors défendaient les
5. Louvet J.-B., Les Amours du chevalier de Faublas, éd. de M. Delon, Paris, Gallimard, coll. « Folio classique », 1996.
6. Louvet J.-B., Quelques notices pour l’histoire et le récit de mes périls depuis le 31 mai 1793, Paris, Desjonquères, coll. « xviiie siècle », 1988, p. 15.
156 Valérie André
chers intérêts du Peuple. Celui de mon amour m’occupait tout entier7 », écrit-il dans ses mémoires. La Révolution, pourtant, n’allait pas tarder à trouver en lui l’un de ses plus vaillants défenseurs.
C’est cet aspect de la carrière de l’écrivain qui nous retiendra main-tenant ; l’entrée en politique de Louvet signifiant, en quelque sorte, son renoncement à la littérature8.
Octobre 1789. La crise des subsistances fait rage, les émeutes se multiplient dans la capitale. Le 5 et le 6, les événements dégénèrent, la foule massacre les gardes royaux Huttes et Varicourt ; le couple royal, contraint de revenir à Paris, s’installe aux Tuileries. Qui porte la respon-sabilité de ces débordements sanguinaires ? Jean-Joseph Mounier, alors président de l’Assemblée, accuse Paris dans un écrit violent. Celui qui avait été l’inspirateur du Serment du Jeu de Paume ne concevait pas le tour pris par la Révolution et témoignait son effroi devant la « fureur du peuple ». Indigné par la réaction de Mounier, Louvet saisit la plume et rédige le premier de ses textes politiquement engagés, Paris justifié contre M. Mounier, une brochure de cinquante-quatre pages qui préfi-gure les écrits à venir9. Véritable matrice en effet, Paris justifié pose les jalons rhétoriques des discours qu’il devait bientôt composer. L’auteur y déploie les traits stylistiques qui caractériseront désormais son écriture : l’invective et, surtout, la « fictionalisation » des hypothèses, un procédé récurrent qui appuiera sa théorie du complot aristocratique. Louvet se bat avec les armes de l’écrivain : actualisées dans le discours, les pro-jections catastrophistes se voient investies d’un poids de vraisemblance indéniable, la conjecture se fait réalité, la syntaxe et la langue viennent au secours de l’analyste politique. L’extrait suivant, dans lequel Louvet commente le projet de Mounier de poster six cents hommes au pont de Sèvres, nous en convainc sans peine :
« Que lui importait, pourvu que ses vengeances fussent satisfaites & ses destinées accomplies ? Les Milices Nationales Parisiennes,
7. Ibid., p. 17.8. En réalité, J.-B. Louvet ne parviendra jamais à se départir complètement de sa
casquette de romancier. Ainsi, ses mémoires, que nous avons déjà cités, sont largement « contaminés » par la vocation littéraire de l’auteur. Voir Les Mémoires de Jean-Bap-tiste Louvet ou la tentation du roman, op. cit.
9. Louvet J.-B., Paris Justifié, contre M. Mounier. Par M. Louvet de Couvrai, Paris, Chez M. Bailly, s.d. [1789], p. 42.
Jean-Baptiste Louvet et l’obsession du complot aristocratique 157
étant ainsi, pendant quelques instants, retardées dans leur marche, M. de la Fayette ne pouvait plus assez tôt parler au roi ; le Roi, sur l’heure, instruit des commencements du combat, dont on lui eût, dans un récit doublement perfide, diminué l’horreur & grossi le danger, le Roi eût supplié, même à genoux, d’abandonner Versailles ; la Milice de cette ville, trop inquiète ou trop occupée, n’aurait pu retenir huit voitures à la porte de l’Orangerie ! Louis XVI entraîné partait pour Metz ! Aussitôt rentrait en France un fameux Maréchal, bien payé pour l’être. Beaucoup de Nobles, colorant encore du beau prétexte de fidélité au régime qui les faisait oppresseurs, beaucoup de Nobles venaient se ranger du parti qu’on eût appelé Royaliste ; les mécontents d’un autre ordre se répan-daient dans les campagnes, pour y prêcher aux Peuples crédules le rétablissement des abus ; quelques Parlements ressuscités se hâtaient de nous déclarer, nous autres Soldats de la patrie : Rebelles ! Le glaive se tirait ; le carnage commençait entre dix millions de frères ; tous les fléaux réunis désolaient le plus beau des Empires, & peut-être, après cinquante ans de sanglants revers, ramenaient sous le joug de la servitude, cette Nation à qui, pour devenir la première du Monde, il n’a manqué jusqu’à présent que d’être libre10. »
On le voit, Louvet s’exprime en visionnaire – ses détracteurs diront perfidement en romancier – et parvient à évoquer de la façon la plus réaliste qui soit des événements qui ne se sont pas (encore) produits. Une étude linguistique de l’usage des temps du passé dans ses textes montrerait combien il tire parti des propriétés stylistiques de l’imparfait de l’indicatif. Passant insensiblement de la forme en -rait de l’irréel, ou du subjonctif plus-que-parfait de l’hypothèse, à celle de l’actualité passée, Louvet gomme les dernières marques grammaticales de la fiction qu’il met en place.
II. Une peur panique du complot
Il faudra attendre 1791 pour que se manifeste clairement la peur panique du complot. Le 25 décembre, Louvet, devenu un membre assidu de la société des jacobins, prend la parole à la barre de l’Assem-blée nationale pour demander que soit voté un décret d’accusation
10. Ibid., p. 42-43.
158 Valérie André
contre les princes émigrés11. Convaincu de l’existence d’un complot aristocratique, le représentant de la section des Lombards se dit « indigné des manœuvres de ces nobles qui, pour le rétablissement des plus intolérables abus, allaient armer l’Europe contre leur patrie12. »
La réaction de Louvet n’est pas isolée, elle participe d’un mouvement de suspicion généralisée qu’avaient encouragé le renvoi de Necker13, la fuite à Varennes14, et surtout, l’émigration du comte d’Artois et du prince de Condé15, désormais à la tête d’une redoutable armée contre-révolu-tionnaire. La menace était bien réelle, certes, mais l’idée du complot, elle, relevait du fantasme et se déclinait à l’infini. Chez Louvet, on la trouve essentiellement dans la Sentinelle, le journal-affiche d’obédience girondine dont il assura la direction d’avril à septembre 179216, et dans ses mémoires, Quelques notices pour l’histoire et le récit de mes périls depuis le 31 mai 1792. Dans les deux cas, on ne saurait mettre en doute la sincérité de l’écrivain, mais on observera toutefois que l’obsession paranoïaque était alors motivée par d’autres éléments. On y reviendra, mais il convient avant tout de considérer un texte de janvier 1792, à savoir le premier discours sur la guerre, qui met clairement en œuvre les procédés rhétoriques de la dénonciation du complot.
Premier discours sur la guerre
Le danger d’un conflit armé opposant la France aux autres états européens préoccupait la classe politique depuis de longs mois et, avant même que la Révolution n’éclate, la menace d’une offensive anglaise paraissait imminente17. En janvier 1792, c’est surtout vers l’Autriche
11. Pétition individuelle des citoyens de la section des Lombards, prononcée à la barre de l’Assemblée nationale, le 25 décembre 1791, par M. Jean-Baptiste Louvet […], suivie de la réponse de M. de Président, Paris, Imprimerie nationale, s.d.
12. Louvet J.-B., Quelques notices pour l’histoire et le récit de mes périls depuis le 31 mai 1793, op. cit., p. 20.
13. Le 11 juillet 1789. Le ministre sera rappelé le 16.14. Durant la nuit du 20 au 21 juin 1791.15. Ils furent parmi les premiers à émigrer, dès juillet 1789.16. Voir André V., Les Mémoires de Jean-Baptiste Louvet ou la tentation du
roman, op. cit., p. 72 sq.17. On consultera à ce propos le Mémoire sur la situation présente des affaires
composé par Ch.-G. de Lamoignon de Malesherbes et présenté au roi Louis XVI en juillet 1788 (texte établi, commenté et annoté par V. André, Paris, Tallandier, à paraître).
Jean-Baptiste Louvet et l’obsession du complot aristocratique 159
de Léopold II que se tournèrent les regards inquiets. En août 1791, la déclaration de Pillnitz avait scellé l’alliance entre l’Autriche et la Prusse, Léopold, entraîné par les émigrés, s’était assuré l’appui de l’empereur Frédéric-Guillaume pour rétablir Louis XVI dans ses droits et venger l’offense faite à la couronne. On le sait aujourd’hui, la manœuvre était destinée à intimider la France, bien plus qu’à lui promettre une véritable intervention armée. Il n’empêche. L’opinion s’en émut, la presse se déchaîna, et les partis en présence s’opposèrent pour décider de l’avenir de la nation. Fallait-il attendre l’attaque et se préparer à la riposte ou, au contraire, devancer l’ennemi et lui donner l’assaut en premier18 ? Cette question est au cœur même du discours que Louvet prononça à la société des jacobins le 9 janvier 179219 : « Est-il vrai que nous pouvons éviter la guerre ? », entamait-il avant d’aviver, en toute bonne foi, la peur de ses contemporains :
« Est-il vrai que nous pouvons éviter la guerre ? Oui, pendant six mois peut-être. Oui, si pendant six mois encore vous consentez à voir, dans les états voisins, nos compatriotes persécutés, emprison-nés, bannis sous de vains prétextes ; l’uniforme, la cocarde, les couleurs nationales, ces signes de la liberté conquise proscrits et foulés aux pieds ; nos envoyés dans les cours étrangères ne travailler qu’à nous y faire des ennemis déclarés ou des alliés perfides ; chez nous, la liste civile sans cesse corrompre, empoisonner, trahir ».
Et Louvet d’énumérer les manœuvres des ennemis de l’intérieur. La collusion semble généralisée, entre les « tigres émigrés », les magistrats corrompus, le gouvernement gagné par les bourreaux du peuple. Tous conspirent pour provoquer cette « Saint-Barthélemy des patriotes » que l’auteur croit imminente : « Oui, Messieurs, vous pouvez à ce prix, pendant six mois encore, éviter la guerre ; et sans doute alors on vous épargnerait la peine de la déclarer ; alors on vous assurerait, à vous, peuple épuisé, la paix du despotisme : nous, patriotes indomptables,
18. La déclaration de guerre à l’Autriche eut lieu le 20 avril 1792.19. Discours de Jean-Baptiste Louvet sur la guerre, prononcé à la société, le
9 janvier 1792, De l’imprimerie du Patriote Français, s.d. Les citations renvoient à cette édition. L’orateur y reviendra, quelques jours plus tard, dans un second dis-cours, réplique cinglante aux propos de Robespierre (Second discours de Jean-Baptiste Louvet sur la guerre, prononcé à la Société, le 18 janvier 1792; en réponse à celui de Maximilien Robespierre, prononcé le 11 du même mois, De l’imprimerie du Patriote Français, s.d.).
160 Valérie André
nous obtiendrions du moins la paix du tombeau. » L’argumentaire se construit pas à pas. Une deuxième question rhétorique se glisse aussitôt sous la plume du tribun : « Est-il vrai que la cour veut éviter la guerre ? ». La cour qui, aux yeux de Louvet, est l’instigatrice du complot, veut abuser le peuple ; elle prépare la guerre civile et organise, en silence, un nouveau massacre des innocents. Dans l’extrait qui suit, on observera l’utilisation habile de ressources linguistique pour étayer une thèse que les circonstances rendaient plausible. Le choix des termes mis en italiques est éloquent :
« Il y a plus : un fait récent vient à l’appui des faits que je cite, et commence à soulever un coin du voile dont s’enveloppe une poli-tique parricide. Quelqu’un de vous l’a-t-il lue sans inquiétude, cette proclamation par laquelle le ministère se hâte de déclarer d’avance que le procès sera fait, dans toute la rigueur des lois, à tout com-mandant français qui n’empêchera point que la moindre hostilité ne se commette sur le territoire autrichien, tout général qui ne pourra pas retenir l’ardeur de nos troupes ? Eh bien ! Messieurs, ne prouve-t-elle rien, cette proclamation ? Ne traduit-elle pas les secrets desseins de la cour ? N’est-il pas déjà trop avéré que, sous le prétexte des négociations entamées, et qu’on aura grand soin de traîner en longueur, on prétend forcer nos impatients défenseurs à demeurer, pendant plusieurs mois, spectateurs impassibles des menaçants préparatifs de l’ennemi ? Ne vous paraît-il pas certain qu’en même temps Léopold, affectant toujours la crainte d’une invasion qu’il sait pourtant qu’on se flatte de pouvoir empêcher, va, sans obstacle, couvrir de ses troupes le Brabant et les électorats ? Ne devient-il pas vraisemblable, qu’au moment où la ligue des traîtres du dedans aurait acquis des forces considérables, au prin-temps prochain, par exemple, ou vers juillet au plus tard, deux cents mille esclaves des différentes nations, tomberaient sur la France ainsi réduite, il faut le répéter, réduite à la seule guerre qu’on veuille lui donner, la guerre défensive, la guerre intérieure, la guerre civile20. »
La démonstration s’installe, la conjecture s’efface au profit de la cer-titude. L’écrivain joue avec les nuances et finit par mettre sur un pied d’égalité l’avéré, le certain et le vraisemblable ! La « fictionalisation » des hypothèses peut faire son apparition, Louvet se lance dans le récit
20. Ibid. (c’est moi qui souligne).
Jean-Baptiste Louvet et l’obsession du complot aristocratique 161
circonstancié des machinations de l’ennemi, les paroles de l’empereur autrichien sont « consignées » avec exactitude et précision :
« Moi qui n’entends pas mieux qu’un autre, j’entends d’ici Léopold murmurer, par un fondé de procuration, murmurer au fier à bras Gustave et à sa bien-aimée Catherine, ces mots : Vous me pressez de dépêcher ces gens-là, vous en parlez fort à votre aise ; à la rigueur, j’affronterais leurs vieilles baïonnettes ; mais leurs méchants nouveaux petits livres me font peur. Tomber trop tôt sur cette canaille, ce serait m’exposer à recevoir sa visite ; et si jamais une armée de ces sans culottes mettait le pied chez moi, il n’y aurait bientôt plus de barons dans mon empire. Mais laissez-moi faire, et sachez attendre : mes talpaches21 sont là qui les guettent ; chez eux on les travaille, on les fatigue, on les exténue ; et si pour leur malheur il faut qu’un moment d’assoupissement vienne les saisir, les trois quarts d’entre eux se réveillent esclaves ; l’autre quart ne se réveille plus. Messieurs, près d’ici, tout près d’ici, dans un beau vieux château, que nous connaissons tous, une autre bande de conspirateurs parle beaucoup plus bas ; mais n’importe, je l’en-tends aussi ; achetons, payons, promettons, divisons, trompons, corrompons : tôt ou tard viendra le beau jour de la Saint-Barthélemy religieuse et politique ; c’est cet heureux jour-là que nos amis du dehors choisiront pour agir. […] La proposition simplifiée se réduit à ceci : je suis seul, plusieurs assassins m’environnent, ils préparent leurs armes, d’autres scélérats se montrent dans le lointain près à les renforcer. Dira-t-on qu’il faut que j’attende que tous les poi-gnards soient affiliés et que tous les auxiliaires aient joint22 ? »
Il sonde les cerveaux ennemis et publie leurs secrètes manœuvres. Après avoir fait usage des formes verbales et des aspects, au sens guillaumien du terme, s’être servi au mieux des richesses sémantiques du lexique, l’auteur dévoile les intentions criminelles de son adversaire.
Les mécanismes sont désormais en place. Louvet y aura recours de façon systématique dans les affiches de La Sentinelle et dans ses mémoi-res. Dans le premier cas, la théorie du complot lui permet d’étayer la politique menée par le ministre Roland et les girondins, dans le second, il favorise l’identification de l’auteur à son modèle littéraire et humain, Jean-Jacques Rousseau, « l’immortel auteur de la Nouvelle Héloïse. »
21. Soldat de l’infanterie hongroise, aux xviie et xviiie siècles.22. Discours de Jean-Baptiste Louvet sur la guerre…, op. cit.
162 Valérie André
La Sentinelle, une affiche girondine
Avec la Sentinelle, nous plongeons au cœur des luttes intestines qui divisent les patriotes. Les Girondins, alors au pouvoir23 – Roland à l’intérieur, Clavière aux contributions publiques, Servan à la guerre et Dumouriez aux affaires étrangères – se montraient depuis longtemps partisans d’une guerre préventive24 et affichaient une opposition farou-che à la politique prônée par les Feuillants, qu’ils taxaient d’attentisme coupable et de collusion avec l’étranger.
Soutenu par plusieurs journaux parisiens et feuilles locales dans les provinces, le ministère girondin était conscient du rôle nouveau exercé par la presse dans la formation de l’opinion publique. Le décret sur la liberté de la presse avait en effet favorisé l’expansion considérable d’un mode d’expression qui devenait un pouvoir politique parallèle mais redoutable. La déclaration de guerre à l’Autriche, le 20 avril, attisait les tensions. Les journaux royalistes étaient en campagne et rivalisaient avec les journaux populaires comme L’Ami du Peuple de Marat ou le célèbre Père Duchesne d’Hébert. Les esprits, agités par la peur de l’invasion ennemie, cherchaient dans la lecture de tous ces périodiques de quoi calmer leurs inquiétudes. C’est dans ce contexte agité que Roland décida de s’adjoindre un organe de presse, outil de propagande de la politique girondine. À sa tête, il fallait un homme de confiance qui posséderait à la fois des qualités littéraires et l’éloquence du tribun. Le dévouement de Louvet à la cause de la Révolution, ses prises de position en totale adéquation avec la politique du ministère girondin, associés au talent de l’écrivain faisaient de lui le candidat idéal :
« On avait senti le besoin de balancer l’influence de la cour, de l’aristocratie, de la liste civile et de leurs papiers, par des instruc-tions populaires d’une grande publicité. Un journal placardé en affiches parut propre à cette fin ; il fallait trouver un homme sage et éclairé, capable de suivre les événements et de les présenter sous leur vrai jour, pour en être le rédacteur. Louvet déjà connu comme écrivain, homme de lettres et politique, fut indiqué, choisi, et accepta ce soin ; il fallait aussi des fonds, c’était une autre affaire.
23. Le ministère girondin est en place à partir de mars 1792.24. C’est évidemment dans cette optique qu’il faut relire le discours de Louvet
dont il est question plus haut.
Jean-Baptiste Louvet et l’obsession du complot aristocratique 163
Pétion lui-même n’en avait point pour la police ; et cependant, dans une ville comme Paris, et dans un tel état de choses où il importait d’avoir du monde pour être informé à temps de ce qui arrive ou de ce qui se prépare, c’était absolument nécessaire. Il eût été difficile de l’obtenir de l’Assemblée ; la demande n’eût pas manqué de donner l’éveil aux partisans de la cour et de rencontrer des obsta-cles. On imagina que Dumouriez, qui avait aux affaires étrangères des fonds pour dépenses secrètes, pourrait remettre une somme par mois au maire de Paris pour la police, et que sur cette somme seraient prélevés les frais du journal en affiches que surveillerait le ministre de l’Intérieur. L’expédient était simple, il fut arrêté. Telle a été l’origine de La Sentinelle25. »
On ne saurait être plus clair. Madame Roland avoue sans détour les intentions de son mari, l’orientation politique du futur journal ainsi que les moyens de son financement. Le titre choisi pour ce nouvel organe de presse est réfléchi et fait écho, d’emblée, à la théorie du complot. Le patriote français de Brissot26, porte-parole privilégié des Girondins, avait imposé sa devise, dès sa création le 28 juillet 1789 : « Une gazette libre est une sentinelle qui veille sans cesse sur le peuple ». Le journal-affiche de Louvet allait enfin remplir cet office et devenir le complément indispensable au célèbre périodique. Louvet s’en explique dans ses Mémoires :
« [Roland et sa femme] me pressèrent d’écrire pour une cause qui avait besoin de l’intime réunion de tous les hommes propres à la faire valoir. La guerre était déclarée. La Cour, visiblement d’accord avec l’Autriche, trahissait nos armées ; il fallait éclairer le Peuple sur tant de complots, j’écrivis la Sentinelle27. »
Éclairer le peuple et le mettre en garde, tels étaient donc les desseins de la Sentinelle. Soucieux d’être compris de tous, Louvet y insiste dans les post-scriptum qui terminent les premiers numéros :
25. Discours de Jean-Baptiste Louvet sur la guerre…, op. cit., p. 72-73.26. Le patriote français, Journal livre et national, par une société de citoyens et
dirigé par J.-P. Brissot, parut du 28 juillet 1789 au 2 juin 1793. Il comporte 1394 numéros et 82 suppléments (Voir Soboul A., Dictionnaire historique de la révolution française, Paris, PUF, 1989, p. 826).
27. Louvet J.-B., Quelques notices…, op. cit., p. 26 (c’est moi qui souligne).
164 Valérie André
« P.-S. Le moyen le plus facile, le plus prompt et le moins dispen-dieux, de répandre la vérité, dans un moment où de tous les points de l’empire on prête l’oreille, c’est un journal susceptible d’être affiché ; l’extrait des nouvelles de chaque jour et des réflexions qu’elles fournissent, peut être réduit à un espace extrêmement court, par celui qui voit les objets à une certaine hauteur et qui n’envisage que le bien public. »
Le lien entre le fond et la forme est essentiel, le choix du support est mûrement réfléchi et le but avoué : l’affiche est le medium idéal pour rallier la foule. Les ressorts psychologiques d’une telle démarche ne sauraient échapper au lecteur moderne. Le rédacteur entend jouer sur la peur du lecteur et, partant, l’engager à soutenir les chefs girondins et leur politique. Il peut également introduire un certain nombre de symboles fortement liés à la théorie du complot, insister sur l’oppo-sition manichéenne entre « le comité autrichien » et les « ministres patriotes ». À cet égard, le premier numéro du journal affiche mérite d’être relu, l’existence d’un complot aristocratique y transparaît à chaque ligne :
« FRANÇAIS,
Il est glorieux, mais il est critique le moment où tout un peuple régénéré prend les armes pour défendre sa constitution nouvelle. Quiconque alors a d’importantes vérités à proclamer, deviendrait criminel, s’il gardait le silence. Je vais donc parler : tant que le bruit du canon frappera mes oreilles, je parlerai. Je parlerai, Français, jusqu’à ce que vous ayez obtenu l’honorable paix, dont vous êtes dignes ; et j’espère, quoiqu’en [sic] puissent dire nos pol-trons, ou nos aristocrates, j’espère que je ne parlerai pas très longtemps. »
Bon pédagogue, le journaliste commence par un rappel des faits. Qui sont les ennemis déclarés du peuple ? Les questions rhétoriques se mul-tiplient, auxquelles succède une invariable réponse : la noblesse, cette noblesse responsable de tous les maux qui accablent la France, artisan du complot dont sera bientôt victime la nation tout entière si elle néglige les admonestations de la bienveillante Sentinelle :
Jean-Baptiste Louvet et l’obsession du complot aristocratique 165
« Eh bien, cette noblesse qui depuis quatre ans se montre si avide de notre sang, ne pourrions-nous donc pas, par quelque sacrifice, désarmer sa vengeance ? Très aisément, Français. »
Dans un même mouvement Louvet associe la cour, la noblesse et les adversaires de la Gironde. Le propos se radicalisera après la suspension du roi, le 10 août 1792: désormais, Louis XVI sera compris au sein de l’acte d’accusation et nommément désigné comme ennemi de la nation ! S’ensuit alors une juxtaposition d’antithèses, destinées à accentuer le fossé qui sépare le peuple français des ci-devant affameurs, jaloux de leurs privilèges :
« Ses privilèges, quels étaient-ils ? Vous le savez, Français ; vous en avez longtemps gémi. Elle nageait dans l’opulence ; vous mourriez de faim. Elle épuisait le trésor de l’État ; vous étiez seuls condam-nés à le remplir. Chaque genre de votre industrie lui devait une rétribution ; elle méprisait votre industrie. Vous arrosiez la terre de vos sueurs ; sa chasse dévorait vos récoltes. Si vous repoussiez son gibier, les galères vous recevaient ; si vous maltraitiez ses chiens, on vous plongeait dans les cachots. Tous les travaux pénibles et mal payés étaient pour vous ; toutes les places lucratives et honora-bles, pour elle. C’était pour leur ambition particulière qu’ils ensanglantaient le mo[n]de, vil troupeau, nous devions à leur gré mourir pour cinq sols.
Français, ou je vous connais mal, ou avant que, sous quelque prétexte que ce fût, un tel ordre de choses se rétablit dans votre patrie, vous péririez tous, les armes à la main. »
La technique est habile. Louvet met le lecteur en haleine, lui promet des révélations d’une importance capitale, puis s’interrompt brutalement… Le journaliste renoue avec les procédés de l’auteur de feuilletons et de romans à suite, un genre où, on le sait, il avait jadis fait ses preuves :
« Mais cette noblesse assez hardie pour espérer de forcer au parjure vingt millions d’hommes qui se sont engagés, devant l’Europe, à maintenir leur constitution, a-t-elle donc de si grands moyens ? Les ennemis qu’elle nous a suscités, sont-ils si terribles ? Ne nous reste-t-il pas au contraire d’immenses ressources à leur opposer ? C’est ce que j’examinerai dans un numéro prochain28. »
28. La Sentinelle, Paris, 1792-1793, version originale microfilmée, A.C.R.P.P.,
166 Valérie André
Chaque numéro de La Sentinelle est construit sur le même modèle : thématique, articulé autour d’un ou deux axes argumentatifs, toujours en relation avec la théorie du complot. Le tout est ponctué par de sem-piternels appels à la vigilance : « Français, veillez ; vous êtes de toute part environnés de pièges » (n° 8), « Veillez, veillez encore, le corps des conspirateurs est dissout ; mais les membres peuvent se rallier. Ils peuvent se joindre à la foule des conjurés que les murs de Paris ren-ferment » (n° 10), ou encore, emphatique « Veille sur toi, Généreux peuple, prends garde, ils ont soif de ton sang » (n° 22).
Nous l’avons déjà dit, Louvet est d’une sincérité indiscutable. Il croit vraiment à l’existence du comité autrichien, à l’établissement d’un réseau multiple d’agresseurs, les étrangers, ceux qu’il appelle les « ennemis du dehors » et les plus dangereux, les « ennemis du dedans », qui sans scrupules trahissent la mère patrie. À travers les articles de La Sentinelle, Louvet laisse s’exprimer ses peurs, ses angoisses, sa joie et son indignation. Ses états d’âme face aux événements s’affichent sur les murs de la capitale dans un souci de partage et de prosélytisme. Mais on analyserait à tort les appels de Louvet comme la simple traduction des angoisses paranoïaques du rédacteur de journal. Il s’agit également pour Louvet de servir les intérêts du ministère Roland, en justifiant la guerre, jugée indispensable par les chefs de la Gironde. L’évocation du conflit franco-autrichien l’amène rapidement à lancer des appels aux armes et à dévoiler au public les plans de l’ennemi de façon circonstanciée, c’est-à-dire tels qu’il se les imagine… Ses propos se teintent alors d’un nationalisme outré qui flirte très souvent avec la xénophobie.
Lorsqu’il s’en prend personnellement à ceux qu’il identifie comme les agents du complot, Louvet fait usage de l’invective directe, et renoue avec l’oralité, le ton passionné de ses prises de parole à la barre de l’assemblée nationale. Dans l’extrait qui suit, le tribun s’en prend à La Fayette, le héros de la guerre d’indépendance américaine. Le tutoiement théâtralise le propos et actualise le dialogue entre les deux hommes. La mise en accusation des origines sociales du militaire rappelle mutatis mutandis les revendications du Figaro de Beaumarchais… Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus, lit-on en filigrane de la dia-tribe, naître pour trahir le pays et entrer en collusion avec l’étranger :
n° 1. Dans chaque citation, nous respectons l’emploi des majuscules et des italiques.
Jean-Baptiste Louvet et l’obsession du complot aristocratique 167
« Lafayette, ce n’est pas une entreprise commune que celle d’un protectorat de ce nouveau genre ! Ton ambition peut en être flattée ; mais tes forces, tes moyens personnels, les as-tu bien consultés ? Sais-tu quel fut, sur une terre étrangère, cet autre protecteur qui étonna son siècle ? Sais-tu quel fut Cromwell ? – Cromwell naquit homme du peuple, tu es sorti d’une caste privilégiée ; il s’éleva par la seule force de son talent, tu dois beaucoup au hasard des circons-tances ; il fut grand orateur, tu ne fais pas les petits discours que tu prononces ; il se montra bon écrivain, on te compose ces longues lettres que tu signes ; il parut le premier capitaine de son âge, tes victoires ne sont encore qu’en espérances ; il eut un grand carac-tère, on assure qu’instrument mobile entre les mains de tes amis, tu ne développerais sans eux qu’un mince talent pour l’intrigue ; il porta sur l’avenir un regard presque toujours sûr, à peine sais-tu juger les événements de la veille ; il posséda l’art suprême de connaître les hommes, on te dit la dupe du moins adroit de ceux qui t’entourent ; l’ignorance de son temps le servit, chez nous la liberté de la presse que tes feuillants n’ont pas encore détruite, répand chaque jour de plus vives lumières ; le fanatisme lui fut utile, en France il existe une foule immense d’hommes libres bien résolus à ne plus adorer que la liberté et je ne pense pas que tu te flattes d’inspirer pour ton cheval blanc une longue idolâtrie ; enfin pour tout dire en deux mots, Cromwell eut du génie, et jusqu’à présent tout m’annonce que tu n’en as pas. Au reste, avant d’oppri-mer son pays, il l’avait beaucoup servi ; qu’as-tu fait pour le tien ? Je le dirai dans un prochain numéro [n° 20]. »
Une dernière cible est l’objet des dénonciations de Louvet : les autres journaux engagés, proches de partis opposés à la Gironde (en particulier les Feuillants), et considérés comme les armes des acteurs du complot. Et le rédacteur de jeter l’anathème sur une presse stipendiée, utilisée à des fins de pure propagande. La gazette universelle se voit ainsi traînée dans la boue, accusée de diffuser des « inepties, des bassesses, des calomnies sans nombres » (n° 14). Sans le moindre scrupule, Louvet, dont le journal est entièrement financé par le ministère, s’insurge contre la vénalité de ses confrères. Le pouvoir de la presse sur l’opinion publique était devenu une évidence, pour tous. Avant toute chose, il importait de se rallier le lectorat des adversaires.
168 Valérie André
Les Mémoires de Louvet : une cohérence argumentative
On ne saurait conclure cette réflexion sans évoquer rapidement les mémoires de l’écrivain. S’ils ne peuvent être comparés au journal-affiche, on y retrouve les mêmes procédés d’écriture dans l’évocation de ces moments difficiles qui ont précipité la chute de la Gironde. Louvet s’y montre d’une immodestie étonnante lorsqu’il évoque son importance politique et les prétendus complots fomentés contre lui pour l’empêcher d’agir :
« À peine je descendais dans la carrière, et déjà mes périls com-mençaient. Une chose digne de la remarque, c’est que je n’ai jamais pu savoir s’il est vrai que la popularité a quelques douceurs. Dès que j’ai servi le Peuple, on m’a calomnié près de lui, et plus je mettais d’ardeur à soutenir ses intérêts, plus il me poursuivait de sa haine29. »
En réalité, l’ouvrage est totalement dominé par l’identification à Rousseau, en particulier celui des Confessions et des Rêveries. Les textes politiques se trouvent mis en abyme dans le récit de l’errance du proscrit, recontextualisés et explicités a posteriori. Comme chez Rousseau, tout passe par le sentiment. Louvet est convaincu d’avoir été la victime expiatoire d’un complot destiné à le perdre. Le patriote se sacrifie pour le bien de sa patrie :
« Me voici donc seul sur la terre, n’ayant plus de frère, de pro-chain, d’ami, de société que moi-même. Le plus sociable et le plus aimant des humains en a été proscrit par un accord unanime. Ils ont cherché dans les raffinements de leur haine quel tourment pouvait être le plus cruel à mon âme sensible, et ils ont brisé violemment tous les liens qui m’attachaient à eux. J’aurais aimé les hommes en dépit d’eux-mêmes. Ils n’ont pu qu’en cessant de l’être se dérober à mon affection. »
La première partie des Quelques notices pour l’histoire et le récit de mes périls depuis le 31 mai 1792 est placée tout entière sous le signe de la conspiration, les moindres incidents sont analysés en termes de conju-ration et interprétés comme des indices signifiants, lamentablement
29. Louvet J.-B., Quelques notices…, op. cit., p. 23.
Jean-Baptiste Louvet et l’obsession du complot aristocratique 169
négligés. L’histoire se réécrit, sous la plume d’un Louvet-Cassandre, désabusé de ne pas avoir été écouté :
« […] Si j’avais été ministre de la justice, j’aurais assurément signé cette fameuse lettre de Roland à laquelle Duranthon, ambitieux et faible, refusa d’accéder. Coupable dans le sens des trois ministres, on me renvoyait avec eux. Partageant leur honorable disgrâce, j’ob-tenais aussi l’estime publique ; avec eux je rentrais le 10 août, j’étais ministre de la justice ; le royalisme déguisé ne commettait pas sur le berceau de la République les horreurs de septembre ; la faction des Cordeliers ne forçait point, par la terreur, l’élection de ces députés de Paris, dont quelques-uns ont été si funestes à la France. Le gouvernement anglais n’ayant pas de moyens d’exciter contre nous son peuple cherchait vainement un prétexte de guerre ; Robespierre, s’il ne changeait pas, succombait ; avec lui tombaient ou n’osaient se montrer Pache et son insolente Commune, Chaumette, Hébert, le grand exterminateur, et cette foule de vils coquins payés par les puissances. La République était fondée30 ! »
Conclusion
Jean-Baptiste n’avait pas l’éloquence d’un Mirabeau ou d’un Vergniaud, il possédait pourtant de réelles qualités de tribun. Alphonse Aulard le remarquait déjà dans son célèbre ouvrage sur L’éloquence parlementaire : « son rôle est d’exhaler les sentiments généreux qui s’agitent en lui : l’indi-gnation est la note dominante de son éloquence31 ». Indignation sincère, mais souvent alimentée de chimères… L’incidence de la théorie du complot sur l’écriture de Jean-Baptiste Louvet est manifeste. Sa tendance personnelle à la paranoïa offrait un terreau fertile à l’obsession persécu-trice qui s’exprime dans ses textes politiques comme dans ses mémoires.
Comme beaucoup de ses contemporains, le romancier devenu jour-naliste patriote cherchait une justification logique au cataclysme qui secouait le pays : la peur panique du complot aristocratique traduit les angoisses collectives d’une France en plein bouleversement, dépassée par l’emballement de la machine révolutionnaire.
30. Ibid., p. 26.31. Aulard F.-A., L’Éloquence parlementaire pendant la Révolution française.
Les Orateurs de la Législative et de la Convention, Paris, Librairie Hachette et Cie, 1885, livre VI, tome II, chap. iii, « Louvet », p. 19.
170 Valérie André
Satan, l’esprit du complot ? Du théologique au politique dans
l’encyclique Humanum Genus (1884)
Jean-Philippe Schreiber
Le fondement doctrinal de l’antimaçonnisme catholique repose sur la Constitution apostolique In Eminenti Apostolatus Specula du Pape Clément XII. Celle-ci proclamait, en 1738 : « Des hommes de toute religion et toute secte […] se lient l’un à l’autre par un pacte aussi étroit qu’impénétrable selon les lois et des statuts qu’ils ont créés eux-mêmes et s’obligent par un serment prêté sur la Bible et sous de graves peines à cacher dans un silence inviolable tout ce qu’ils font dans l’obscurité du secret1. » On y retrouve déjà les trois éléments qui seront au cœur du discours antimaçonnique catholique durant le siècle suivant, et jusqu’au code de droit canonique de 1917 : la suspicion d’hérésie, le motif caché et le secret entourant les travaux de la loge, scellé par un serment2. L’encyclique Humanum Genus du Pape Léon XIII, fulminée en 1884, dont nous allons traiter ici, s’inscrit à première vue dans la même logique. Toutefois, aucune condamnation papale de la franc-maçonnerie n’avait auparavant été aussi sévère. Le postulat que nous suivrons est qu’Huma-num Genus constitue un tournant fondamental dans l’antimaçonnisme : ce qui était ressassé sur la conspiration moderniste antichrétienne d’ins-piration satanique, et ce depuis l’abbé Barruel, est ici synthétisé dans la doctrine de l’Église, qui fait désormais de l’antimaçonnisme un combat au cœur de son action, lui offrant une formidable chambre d’écho.
Le discours explicatif d’Humanum Genus synthétise pratiquement tout ce qui sera dit et écrit par la suite en la matière. La théorie de la conspiration, dans ses ressorts rhétoriques comme dans l’argumentaire
1. Cité dans Boutin P., La Franc-maçonnerie, l’Église et la modernité : les enjeux institutionnels du conflit, Paris, Desclée de Brouwer, 1998, p. 125.
2. Rousse-Lacordaire J., Rome et les Francs-Maçons. Histoire d’un conflit, Paris, Berg International, 1996, p. 15, p. 45-46.
théologique déployé, y est en effet tout entière. Les conceptions qui seront développées ultérieurement, nourrissant le mythe politique du complot mondial, relèveront ainsi souvent d’une sécularisation de conceptions théologiques3. L’on passe donc, vers 1885, d’un antima-çonnisme de type documentaire, dont la fonction était relativement secondaire dans la stratégie politique et théologique de l’Église catho-lique, à un antimaçonnisme de type populaire, dont la mission devient centrale dans le discours ecclésial et déploie le fantasme d’une conspi-ration pour ainsi dire ontologique. L’objectif de la présente contribution sera d’en décliner les principaux arguments théologiques.
I. L’essence du mal
La substance du propos du Pape tient dans ces premières lignes : « Les fauteurs du mal paraissent s’être coalisés dans un immense effort, sous l’impulsion et avec l’aide d’une Société répandue en un grand nombre de lieux et fortement organisée, la Société des francs-maçons. Ceux-ci […] ne prennent plus la peine de dissimuler leurs intentions et ils rivalisent d’audace entre eux contre l’auguste majesté de Dieu. C’est publiquement […] qu’ils entreprennent de ruiner la sainte Église, afin d’arriver, si c’était possible, à dépouiller complètement les nations chrétiennes des bienfaits dont elles sont redevables au Sauveur Jésus Christ4. »
Le Pape commence sa dénonciation et son appel à la vigilance par le rappel de la constance de l’Église face à la franc-maçonnerie depuis 1738 : « Dans leur vigilante sollicitude pour le salut du peuple chré-tien, Nos prédécesseurs eurent bien vite reconnu cet ennemi capital au moment où, sortant des ténèbres d’une conspiration occulte, il s’élan-çait à l’assaut en plein jour. » Le complot qui s’affiche désormais en plein jour n’est donc pas né avec la franc-maçonnerie spéculative, il lui préexistait. Le Pape poursuit : Sachant ce qu’il était […] et lisant pour ainsi dire dans l’avenir, ils [ses prédécesseurs] donnèrent aux princes et
3. Taguieff P.-A., La Foire aux « Illuminés ». Ésotérisme, théorie du complot, extrémisme, Paris, Éd. des Mille et Une Nuits, coll. « Essais », 2005.
4. Voir : http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_18 840 420_humanum-genus_fr.html. Toutes les citations dans le texte proviennent de l’encyclique, dans la traduction citée ici.
Satan : l’esprit du complot ? 173
aux peuples le signal d’alarme et les mirent en garde. » Le Pape insiste sur la capacité de prédire l’avenir qu’aurait le détenteur du Saint-Siège : c’est le sens même d’une histoire providentielle. Le texte papal se veut en effet prophétique : la prédiction rejoint ici le discours apocalyptique de la théologie – rappelons que les tendances apocalyptiques travaillent alors en profondeur les milieux intransigeantistes – car ils ne « s’arrê-ter [ont] qu’après avoir ruiné de fond en comble toutes les institutions religieuses établies par les Papes. » La littérature pamphlétaire anti-maçonnique a été influencée il est vrai, outre Barruel, par la théologie visionnaire des révolutions inaugurée par Joseph de Maistre dans ses Considérations sur la France (1796).
L’égalitarisme religieux énoncé dans l’article 1er des Constitutions maçonniques d’Anderson est suspect, et condamné déjà par la Constitution apostolique In Eminenti en 1738, lorsqu’elle visait « des hommes de toute religion et toute secte [qui] se donnent une apparence d’honnêteté naturelle ». C’est, à travers la condamnation du relativisme religieux, le rejet d’une société fraternelle, fondée sur le principe philadelphique du temple de l’Humanité : « En ouvrant leurs rangs à des adeptes […] des religions les plus diverses, ils deviennent plus capables d’accréditer la grande erreur du temps présent, laquelle consiste […] à mettre sur le pied de l’égalité toutes les formes religieuses. Or, à lui seul, ce principe suffit à ruiner toutes les religions, et particulièrement la religion catholique, car, étant la seule véritable, elle ne peut […] tolérer que les autres reli-gions lui soient égalées. » La morale naturelle de la franc-maçonnerie et l’objectif qu’elle se donne de réunir des hommes de confession différente paraît éminemment subversif à l’Église. Il y a ainsi, pour les détracteurs catholiques de la franc-maçonnerie, un complot théologique. Le monde social idéal du christianisme est un monde d’équilibre, et toute tentative en vue de rompre cet équilibre ne peut résulter que d’une conspiration, pour substituer un ordre non naturel à cet ordre harmonieux5. Depuis la Révolution française, le monde de l’imposture se serait ainsi substi-tué à l’ordre naturel voulu par Dieu. Les Papes, seuls clairvoyants en la matière – et l’on sait que le caractère clairvoyant du récit explicatif, produisant un ethos prophétique, est un lieu commun de la rhétorique du complot –, ont prophétisé un nouveau Sodome et Gomorrhe, une
5. Goldschläger A. et Lemaire J.-Ch., Le complot judéo-maçonnique, Bruxelles, Éd. Labor et Espace de libertés, coll. « Liberté j’écris ton nom », 2005, p. 11.
174 Jean-Philippe Schreiber
conjuration universelle dressée contre la perfection sociale, l’harmonie voulue par Dieu.
Aux yeux du Pape, l’objectif des francs-maçons est de substituer le naturalisme à la discipline religieuse et sociale née des institutions chré-tiennes, à la société parfaite que le droit public ecclésiastique décline ou que le magistère catholique présente comme modèle de gouverne-ment – l’État doit en effet servir la vraie religion. La raison et la vérité suffisent aux yeux du Pape à prouver que la franc-maçonnerie est en opposition formelle avec la justice et la moralité naturelles – la concep-tion catholique romaine du droit naturel l’entend comme la science des principes indémontrables et stipule que la source du droit est dans la volonté du législateur suprême. Du fait de leur naturalisme, les francs-maçons sont responsables de la dégradation des mœurs et rendent les hommes esclaves de leurs passions : « Aussi voyons-nous multiplier et mettre à la portée de tous les hommes ce qui peut flatter leurs passions. Journaux et brochures d’où la réserve et la pudeur sont bannies ; repré-sentations théâtrales dont la licence passe les bornes ; œuvres artistiques où s’étalent avec un cynisme révoltant les principes de ce qu’on appelle aujourd’hui le réalisme ; inventions ingénieuses destinées à augmenter les délicatesses et les jouissances de la vie ; en un mot, tout est mis en œuvre pour satisfaire l’amour du plaisir avec lequel finit par se mettre d’accord la vertu endormie. » Et le Pape de citer le mariage civil, le divorce, l’éducation marquée par la morale indépendante, la neutralité de l’État en matière religieuse, la dissolution du lien social fondé sur l’autorité de Dieu, l’égalité des hommes en droit, la démocratie, etc. Ce faisant, les francs-maçons pavent la route pour la diffusion des idées subversives, socialistes et communistes : « Ils frayent ainsi le chemin à d’autres sectaires […] plus audacieux, qui se tiennent prêts à tirer de ces faux principes des conclusions encore plus détestables. »
Plus loin, le Pape ajoute que la franc-maçonnerie est une association criminelle, pernicieuse aux intérêts du christianisme comme à ceux de la société civile. Lutter contre la franc-maçonnerie, c’est travailler à res-taurer la souveraineté du détenteur supposé légitime du pouvoir contre ceux qui ou celui qui tente de le lui ravir, un « contre-Prince », un autre Roi – Rothschild, par exemple, roi de la finance. Les lois maçonniques
Satan : l’esprit du complot ? 175
s’opposent tant à la souveraineté des États qu’à celle de l’Église6 : sur le plan de l’argumentaire théologique, il y ici a un continuum d’In Eminenti à Humanum Genus : « Les malfaisantes erreurs que Nous venons de rappeler menacent les États des dangers les plus redoutables. En effet, supprimez la crainte de Dieu et le respect dû à ses lois ; laissez tomber en discrédit l’autorité des princes [celui entre les mains de qui le pouvoir réside ne peut être que le ministre de Dieu, détenteur du pouvoir de par l’autorité de Dieu et ne peut que gérer un ordre pro-videntiellement établi] ; donnez libre carrière et encouragement à la manie des révolutions, lâchez la bride aux passions populaires […] ; vous aboutissez par la force des choses à un bouleversement universel et à la ruine de toutes les institutions. »
Révolution : le terme prend ici comme ailleurs un sens quasi méta-physique : la thèse de plusieurs auteurs antimaçons, contemporains d’Humanum Genus, est que la Révolution n’est pas seulement un évé-nement, mais un travail lent et continu qui dissout la religion, la morale, le droit, la famille, la propriété, la hiérarchie sur lesquels la société a reposé de tout temps7. En outre, la Révolution française, attribuée aux francs-maçons, a été le théâtre d’un événement que les catholiques fran-çais intransigeants assimilent symboliquement au déicide : le régicide de 1793, le péché de la France. Mgr de Ségur interprétait ainsi le rituel d’un haut grade comme meurtre symbolique du roi de France8 ; et, dans une partie de la littérature anti-judéomaçonnique, le régicide a visé à substituer au souverain légitime un souverain imposé par la conspira-tion, régnant par le pouvoir de l’argent : « Rothschild Ier ».
L’encyclique ne cite pas les juifs. Toutefois, depuis la théorie éla-borée par Henri Gougenot des Mousseaux (Les Juifs, le judaïsme et la judaïsation des peuples chrétiens, 1869), la conjuration est présentée, de plus en plus, comme le fruit non d’une alliance d’intérêts entre judaïsme et franc-maçonnerie, mais comme « un assujettissement total et aveugle des loges aux menées subversives » des juifs – ce que le prédécesseur
6. Boutin P., La Franc-maçonnerie, l’Église et la modernité…, op. cit., p. 127-129.7. Fava Mgr A.-J., Le secret de la Franc-Maçonnerie, apologétique, Lille,
Desclée de Brouwer, 1885 [1881].8. Cité dans Poulat E. et Laurant J.-P., L’antimaçonnisme catholique, Paris,
Berg International, 1994, p. 53 (cet ouvrage comprend une réédition des Francs-Maçons de Mgr de Ségur).
176 Jean-Philippe Schreiber
de Léon XIII, Pie IX, accréditait déjà symboliquement dans une ency-clique de 1873, Etsi multa luctuosa, en assimilant la franc-maçonnerie à la « Synagogue de Satan9 ». Et Humanum Genus d’insister sur la perte de sa souveraineté temporelle du Pape, la responsabilité de l’issue de la Question romaine étant le plus souvent imputée aux menées des juifs et au rôle supposé de l’Alliance israélite universelle dans le démembre-ment des territoires pontificaux : « Après avoir […] dépouillé le pape de sa souveraineté temporelle […], les fauteurs de ces sectes en [sont] arrivés au point qui était depuis longtemps le but de leur secret dessein […] : proclamer que le moment est venu de supprimer la puissance sacrée des Pontifes romains et de détruire entièrement cette Papauté qui est d’institution divine. »
II. Le serment des francs-maçons
Selon le Pape, la franc-maçonnerie est une association criminelle aussi parce qu’elle exige de ses membres un serment dont la désobéis-sance entraîne la sentence de mort : « Ceux qui sont affiliés doivent promettre d’obéir aveuglément […] aux injonctions des chefs, de se tenir toujours prêts […] à exécuter les ordres donnés, se vouant d’avance, en cas contraire, aux traitements les plus rigoureux et même à la mort. » « De fait, il n’est pas rare que la peine du dernier supplice soit infligée à ceux d’entre eux qui sont convaincus, soit d’avoir livré la discipline secrète, soit d’avoir résisté aux ordres des chefs ; et cela se pratique avec une telle dextérité que, la plupart du temps, l’exécuteur de ces sentences de mort échappe à la justice établie […]. Or, vivre dans la dissimulation et vouloir être enveloppé de ténèbres ; enchaî-ner à soi par les liens les plus étroits et sans leur avoir préalablement fait connaître à quoi ils s’engagent, des hommes réduits ainsi à l’état d’esclaves […]. » « Enveloppé de ténèbres », dit l’encyclique : l’ombre
9. Gougenot des Mousseaux H., Les Juifs, le judaïsme et la judaïsation des peuples chrétiens, Paris, Henri Plon, 1869 [2e éd.], p. 163 ; voir aussi : Meurin Mgr L., La Franc-Maçonnerie, Synagogue de Satan, Paris, V. Retaux, 1893 ; Goldschläger A. et Lemaire J.-Ch., Le complot judéo-maçonnique, op. cit., p. 25 ; Schreiber J.-Ph, « L’image des juifs et du judaïsme dans le discours antimaçonnique au xixe siècle », dans M.-A. Matard-Bonucci (dir.), Antisémythes. L’image des juifs entre culture et politique (1848-1939), Paris, Éd. Nouveau monde, coll. « Culture-médias », 2005, p. 131-147.
Satan : l’esprit du complot ? 177
et la dissimulation agissent contre les lumières du bien. Les vrais fils de la lumière – filii lucis, une expression qui provient de Jean XII, 36 – sont les chrétiens. Les francs-maçons sont en revanche « des hommes réduits à l’état d’esclaves » : le croyant est libre, le franc-maçon est un esclave. Le Pape oppose ici un monde – catholique – de la liberté à un monde de souffrance et d’aliénation ; les canonistes romains consi-dèrent que l’engagement que contracte le franc-maçon et qui le lie à l’institution maçonnique le fait passer à l’état d’esclave, mobilisable pour réaliser l’objectif pernicieux de celle-ci10. En récusant la religion et en se soustrayant à l’obéissance qui vient de Dieu, l’homme tombe sous une nouvelle servitude, terrible, qui l’assujettit.
« Employer à toutes sortes d’attentats ces instruments passifs d’une volonté étrangère ; armer pour le meurtre des mains à l’aide desquelles on s’assure l’impunité du crime, ce sont là de monstrueuses pratiques condamnées par la nature elle-même » : la lecture magistérielle du droit naturel s’ajoute à la condamnation canonique de l’engagement qui lie les francs-maçons à une puissance occulte tentant de se substituer à l’autorité légitime, et qui conduit le maçon à commettre des crimes, à violer les lois humaines et divines, et ainsi à s’opposer au droit naturel tel que le conçoit l’Église. La punition du maçon légitime l’idée qu’il y a des crimes maçonniques : ce crime maçonnique est assimilé aux crimes attribués autrefois aux sorcières (empoisonnements, meurtres d’enfants, cannibalisme, etc.) ; par un phénomène de substitution, rendu possible par l’amalgame entre franc-maçonnerie et judaïsme, on assigne éga-lement à la franc-maçonnerie des crimes imputés aux juifs depuis des siècles (profanations d’hosties ou meurtres rituels).
Sur le plan de la discipline sacramentelle, il n’y a pas de réproba-tion catholique du secret maçonnique – d’un point de vue canonique, ce n’est pas le secret qui est en soi condamnable, puisque le secret et l’obligation inviolable de le garder ressortissent du droit naturel – mais bien du serment de le garder de manière absolue, ce qui le soustrait au contrôle ecclésiastique. Le serment maçonnique est ainsi contraire aux principes de l’Église : l’engagement maçonnique ne peut avoir de légitimité juridique, puisque la franc-maçonnerie abolit le lien qui unit l’homme à son Créateur, et conçoit l’individu comme librement déter-
10. Boutin P., La Franc-maçonnerie, l’Église et la modernité…, op. cit., p. 130.
178 Jean-Philippe Schreiber
miné – l’Église se complaît alors à dénoncer le panthéisme comme source philosophique de la franc-maçonnerie11. « Ceux qui sollicitent l’initiation doivent […] faire le serment solennel de ne jamais révéler […] les noms des associés, les notes caractéristiques et les doctrines de la Société » : une doctrine supposée secrète ne peut aux yeux de l’Église qu’être hérétique et anathème. Le secret maçonnique apparaît ainsi comme un savoir dissimulé ; c’est aussi une forme de pouvoir : sur ces deux plans, cette concurrence est insupportable à l’Église. Le danger, pour cette dernière, est en effet que le mode du secret sépare l’initié du monde profane : il intégrerait dans la maçonnerie une structure sociale alternative qui se proposerait de l’amener progressivement à des vérités qu’il ne pourrait atteindre ailleurs. Cela paraît donc être une remise en cause radicale de la suprématie de l’Église, par une sorte de dédouble-ment du monde, porteur d’une autre vérité, ce qui lui est insupportable. Ce n’est pas pour rien que les antimaçons visaient systématiquement dans leur dénonciation du complot les Illuminés de Weishaupt, même encore à la fin du xixe siècle, et les confondaient avec l’ensemble de la maçonnerie. Les Illuminés avaient fortement structuré un système d’enseignement alternatif pensé comme une Université secrète – l’ex-pression est de Pierre-André Lambert12. Secret contre vérité révélée : révéler ce secret sert à en montrer la perversité.
III. Le secret des francs-maçons
Le Pape vise certes le secret maçonnique comme enseignement alter-natif, mais aussi comme essence du complot ourdi dans la clandestinité et, mieux encore, comme principe d’existence de la franc-maçonnerie : « Il y a, en effet, chez elles [les sectes franc-maçonnes et assimilées], des […] mystères [le discours papal fait référence à des rites et sym-boles qui parlent une autre langue, qui transmettent le mal et protègent un secret ; des rites considérés comme blasphématoires – au sens de sacrilèges contre les mystères du christianisme, telle la Passion – et des rites initiatiques souvent stigmatisés dans la littérature antimaçonnique
11. Ibid., p. 132 sq ; Schreiber J.-Ph., « La question du secret dans le discours antimaçonnique au xixe siècle », dans Le pavé mosaïque. Revue d’études maçon-niques, 1-2003, p. 117-144.
12. Lambert P.-A., La charbonnerie française, 1821-1823. Du secret en politi-que, Lyon, PUL, 1995.
Satan : l’esprit du complot ? 179
mais rarement dans les condamnations pontificales, sauf ici] que leur constitution interdit […] de divulguer, non seulement aux personnes du dehors, mais même à bon nombre de leurs adeptes. À cette catégo-rie, appartiennent les conseils intimes et suprêmes, les noms des chefs principaux, certaines réunions plus occultes et intérieures ainsi que les décisions prises. » Il y aurait donc plusieurs niveaux dans le complot : c’est la société secrète dans la société secrète ; l’encyclique sanctionne ici, théologiquement, la thèse barruélienne des Supérieurs inconnus. Il s’agit dès lors de dévoiler le vrai pouvoir caché derrière le pouvoir apparent ou, comme l’écrivait Mgr de Ségur, de faire apparaître la maçonnerie secrète que cache la maçonnerie visible – d’où tout le jeu rhétorique entre l’ombre et la lumière, entre franc-maçonnerie visible et invisible. L’opération a aussi pour effet de distordre le sens du secret maçonnique : de condition nécessaire d’une quête, il est ramené à une réalité à cacher ou à déguiser. Le secret maçonnique, rempart à la vulnérabilité de la liberté d’expression, est visé par le discours papal comme espace de liberté politique, sociale et religieuse : c’est le mode de fonctionnement de l’Institution maçonnique elle-même que l’on se plaît à récuser, son contre-modèle social fondé sur une parole libérée et non contrôlée. Et l’on fait du secret le principe même d’existence de l’Institution, ce qui est historiquement faux : c’est-à-dire qu’on n’y voit rien d’autre que des prétendues visées conspiratrices et une trahison de l’ordre social et politique traditionnel.
L’obéissance au secret suppose le mensonge. Le secret est – sur le plan sacramentel – contraire à la confession. C’est un tabou pour l’Église, puisqu’il viole délibérément l’un de ses principes, et que le serment en fait une solidarité, voire une complicité. Serment et secret posent la question de la confession, mais aussi de la liberté de conscience face à l’autorité légitime : on se donne corps et âme à une autre société que l’Église13. Mais ceux qui se donnent ainsi corps et âme sont en grande majorité des chrétiens. L’Église ne peut totalement les rejeter, et doit donc considérer qu’une partie d’entre eux a été abusée. Ce sont des naïfs, ceux qui sont malgré eux les agents du complot, mais ignorent le plus souvent qu’ils sont manipulés et participent à un plan de domination universelle : « Parmi [les membres] […] il s’en peut trouver, et même en bon nombre, qui, bien que non exempts de faute pour s’être
13. Poulat E. et Laurant J.-P., L’antimaçonnisme catholique, op. cit., p. 37 et 97.
180 Jean-Philippe Schreiber
affiliés à de semblables sociétés, ne trempent cependant pas dans leurs actes criminels et ignorent le but final que ces sociétés s’efforcent d’atteindre ». Humanum Genus laisse ainsi une porte ouverte aux hon-nêtes gens abusés dans la franc-maçonnerie : ce sont des polichinelles, des naïfs qui se laissent mystifier ; « des agents inconscients qui ont porté partout nos mots d’ordre », diront les Protocoles des Sages de Sion14. Le coupable, dans la vision chrétienne de l’homme, n’est en effet pas un coupable absolu, il est libre de ne pas continuer à céder à la tentation et peut racheter ses fautes. L’aveu permettait depuis In Eminenti d’accéder à l’absolution : il n’en ira plus tout à fait de même après 1869, puisqu’à l’obligation de l’aveu s’ajoutera l’obligation de la dénonciation, répétée ici dans Humanum Genus, et reflétant l’idée d’un complot dans le complot. La peine est ainsi sévère pour ceux qui refusent de dénoncer les chefs : c’est l’excommunication latae sen-tentiae, réservée au Souverain Pontife ; cette dénonciation oblige le catholique en conscience, elle doit être juridique, c’est-à-dire pronon-cée devant l’autorité « légitime » en la matière, et répond à des règles précises déterminées dans l’encyclique.
Pie VII, dans la Constitution Ecclesiam a Iesu Christo (1821), a établi une nouveauté par rapport à la notion de secret telle qu’elle avait été caractérisée par ses prédécesseurs : le secret maçonnique, garanti par un serment immoral et meurtrier – il en récuse bien sûr la teneur symbolique –, ne servirait désormais pas seulement à couvrir l’action subversive mais aussi, à l’intérieur même de la franc-maçonnerie, à faire ignorer aux grades inférieurs les desseins des grades supérieurs. On peut supposer que la théorie des mystères, des hauts grades opaques et des supérieurs inconnus est mobilisée du fait même que les ouvrages de révélation ont permis de se rendre compte que la franc-maçonnerie, à travers ses rituels publiés et ses documents publics, n’avait rien de bien épouvantable. Il faut donc en quelque sorte créer une autre franc-maçonnerie, bien plus redoutable, bien plus occulte – pour reprendre les termes du pamphlétaire légitimiste Jacques Crétineau-Joly, la franc-maçonnerie n’est que l’antichambre de la véritable société secrète15.
14. Taguieff P.-A., Les Protocoles des Sages de Sion, Paris, Berg Interna-tional, 1992, 2 vol. [rééd. rev. et corr. en 1 vol., Les Protocoles des Sages de Sion. Faux et usages d’un faux, Paris, Berg International – Fayard, 2004].
15. Crétineau-Joly J., L’Église romaine en face de la Révolution, Paris,
Satan : l’esprit du complot ? 181
Pierre-André Taguieff a fait une analyse très fine de l’idéologie qui sous-tendra la production et la diffusion des Protocoles des Sages de Sion, et qui peut également s’appliquer à ses matrices idéologiques citées ici. La théorie du gouvernement secret implique qu’une vision provi-dentielle de l’histoire soit remplacée par celle d’un plan réalisé par une minorité secrète. Au pouvoir de l’Église se substitue progressivement celui d’une force sociale active, insaisissable, qui agit rationnellement sur le cours de l’histoire ; et Taguieff de parler dès lors de la « sécu-larisation d’une contre-Providence16 ». C’est un double mouvement complotiste : tout à la fois, il tente de subvertir le pouvoir, et il est déjà dans le pouvoir ; il est le vrai pouvoir désormais – le « gouvernement invisible » –, et il convient donc de l’en déloger : « Dans l’espace d’un siècle et demi, la secte des francs-maçons a fait d’incroyables progrès. Employant à la fois l’audace et la ruse [ce sont les attributs du Malin], elle a envahi tous les rangs de la hiérarchie sociale et commence à prendre, au sein des États modernes, une puissance qui équivaut presque à la souveraineté. »
L’ennemi est un ennemi rusé, diabolique : « Nous avons affaire à un ennemi rusé et fécond en artifices. Il excelle à chatouiller agréablement les oreilles des princes et des peuples ; il a su prendre les uns et les autres par la douceur de ses maximes et l’appât de ses flatteries. Les princes ? Les francs-maçons se sont insinués dans leurs faveurs sous le masque de l’amitié, pour faire d’eux des alliés et de puissants auxiliaires. » C’est là, exactement, le vocabulaire utilisé dès la Renaissance pour évoquer les ruses, les stratagèmes par lesquels le diable s’emploie à convaincre de sa puissance supérieure ceux dont il s’est acquis l’amitié et l’obéis-sance17. Depuis les textes apocryphes – rappelons-nous qu’apocrufos signifie « caché » –, l’Église a construit son imagerie du diable telle qu’elle dominera à partir de la fin du xive siècle, un diable qui devient, plus qu’un antagoniste de Dieu, le rival par excellence de celui-ci18.
H. Plon, 1861. Voir aussi : Turinaz Mgr Ch.-Fr., Le Grand péril de notre temps, ou la Franc-maçonnerie, Paris, Bray et Retaux, s.d. [1884].
16. Taguieff P.-A., Les Protocoles des Sages de Sion, vol. 1, op. cit., p. 26.17. Céard J., « Le Diable singe de Dieu selon les démonologues des xvie et
xviie siècles » dans Le Diable : vers une métaphysique, Colloque de Cerisy, Paris, Éd. Dervy, coll. « Cahiers de l’hermétisme », 1998, p. 43.
18. Aguerre J.-Cl., « De l’incertitude du Diable » dans Le Diable, op. cit., p. 26-27 et p. 31.
182 Jean-Philippe Schreiber
Ce que l’encyclique illustre : « C’est ainsi que, sous les apparences mensongères [le diable est défini comme menteur et père du mensonge dans l’Évangile de Jean, VIII-44] et en faisant de la dissimulation, une règle constante de conduite, comme autrefois les manichéens, les francs-maçons n’épargnent aucun effort pour se cacher et n’avoir d’autres témoins que leurs complices. » Ailleurs : « [Ils] cherchent à faire croire que la doctrine chrétienne est incompatible avec le bien de l’État, parce qu’ils veulent fonder l’État, non sur la solidité des vertus, mais sur l’impunité des vices. Si tout cela était mieux connu, princes et peuples feraient preuve de sagesse politique et agiraient conformément aux exigences du salut général, en s’unissant à l’Église pour résister aux attaques des francs-maçons, au lieu de s’unir aux francs-maçons pour combattre l’Église. » C’est bien entendu la France qui est visée ; ici, comme plus haut, et comme dans les bulles du xviiie siècle, le Pape donne une leçon de droit romain aux États, puisqu’il les pousse à sévir contre la menace que constituerait la franc-maçonnerie pour leur ordre public et leur souveraineté. C’est l’expression même d’une pensée réactionnaire, bien entendu, puisque tout changement est perçu comme nocif et que tout agent du changement est assimilé aux forces du mal.
IV. La coalisation des forces du Mal
La franc-maçonnerie est la coalisation des forces du Mal, le point central d’où tout procède et où tout se rejoint, où tout aboutit, synthèse du caractère polymorphe de l’ennemi : « Il existe dans le monde un certain nombre de sectes qui, bien qu’elles diffèrent les unes des autres par le nom, les rites, la forme, l’origine, se ressemblent et sont d’accord entre elles par l’analogie du but et des principes essentiels. En fait, elles sont identiques à la franc-maçonnerie, qui est pour toutes les autres comme le point central d’où elles procèdent et où elles aboutissent » : elle est la « mère de toutes les sociétés secrètes » écrira un évêque qué-bécois19. Le Pape produit là une historiosophie, une explication générale de l’histoire : le complot est la clé de l’histoire universelle, une histoire secrète mais paradoxalement transparente, celle de l’affrontement, au-delà de l’histoire contingente, entre Dieu et le Démon. La subver-sion est ainsi ramenée à son essence : il y a une « continuité de l’action
19. Savaète A., Vers l’abîme, Paris, 1908, vol. 11 (sur Mgr Laflèche, p. 201).
Satan : l’esprit du complot ? 183
subversive », écrit l’historien de l’ésotérisme Jean-Pierre Laurant20. La subversion moderne serait en effet, pour les antimaçons, l’héritière d’une longue lignée – hérésies antiques, gnoses, socinianisme, etc., jusqu’à la franc-maçonnerie –, le changement des formes masquant en réalité l’unité du but. Cette idée d’une « secte transhistorique » est en germe dès la Constitution Ecclesiam a Iesu Christo de 1821, laquelle fait de la franc-maçonnerie un ennemi majeur de l’Église, au centre d’un plan infernal orchestré en vue de lutter contre elle21. Toutes les condamnations qui suivront, jusqu’à celle de Léon XIII, reprendront et développeront ce postulat fondamental et la dénomination de secte, inaugurée en 1821. Humanum Genus sanctionnera définitivement l’idée d’une société secrète dans la société secrète, de mystères cachés même aux initiés et d’un point central d’où toutes les hérésies procèdent et aboutissent.
Le libéralisme, notamment, est né de la franc-maçonnerie et procède du complot, quoiqu’il apparaisse au grand jour : « Bien qu’à présent elles [ces sectes issues de la franc-maçonnerie] […] tiennent des réunions en plein jour et sous les yeux de tous, […] toutefois, si l’on va au fond des choses, on peut voir qu’elles appartiennent à la famille des sociétés clandestines. » Le mal paraît protéiforme, mais en réalité ramène à la même essence diabolique, cumule tous les maux du passé ; ce discours se refuse au complexe, à la nuance, il simplifie le réel, « déploie une logique de l’identification et de l’assimilation » : les ennemis sont assimilés les uns aux autres plutôt que différenciés22. Procéder par l’amalgame et l’analogie vise à laisser supposer le carac-tère d’universalité de la conspiration.
La Constitution Ecclesiam a Iesu Christo de 1821 élargit ainsi les griefs adressés à la franc-maçonnerie à toutes les sociétés clandestines. Marquée par Barruel et la théorie du complot, elle va alimenter les amalgames qui suivront et qui verront dans la franc-maçonnerie la synthèse de toutes les hérésies. Le discours de l’Église passera ainsi de la description d’une société à secrets à une société secrète, clandes-
20. Laurant J.-P., L’ésotérisme chrétien en France au xixe siècle, Lausanne, L’Âge d’homme, coll. « Politica hermetica », 1992, p. 32.
21. Rousse-Lacordaire J., Rome et les Francs-Maçons, op. cit., p. 88 sq.22. Rajotte P., Les mots du pouvoir ou le pouvoir des mots. Essai d’analyse des
stratégies discursives ultramontaines au xixe siècle, Montréal, L’Hexagone, 1991, p. 62.
184 Jean-Philippe Schreiber
tine, dont le secret est un élément nécessaire dans l’action subversive – l’Église devait alors, en effet, faire face à une nouveauté, qui s’incar-nait principalement dans le carbonarisme : celui d’une société secrète à vocation politique plus qu’initiatique23. Cet ennemi tient les rênes du pouvoir : « [Ils] se tiennent toujours prêts à ébranler les fondements des Empires, à poursuivre, à dénoncer et même à chasser les princes, toutes les fois que ceux-ci paraissent user du pouvoir autrement que la secte ne l’exige. » Cette coalition est une menace pour la sécurité des États, que l’Église a pour vocation de protéger – puisque l’Église se veut la garante de la souveraineté des États : « Il y a lieu de concevoir pour l’avenir les craintes les plus sérieuses ; non certes, en ce qui concerne l’Église, dont les solides fondements ne sauraient être ébranlés par les efforts des hommes, mais par rapport à la sécurité des États, au sein desquels sont devenues trop puissantes, ou cette secte de la franc-maçonnerie, ou d’autres associations similaires qui se font ses coopératrices et ses satellites. » Association criminelle, la franc-maçonnerie repose sur un projet occulte : « Fière de ses précédents succès, la secte des francs-maçons lève insolemment la tête et son audace semble ne plus connaître aucune borne. Rattachés les uns aux autres par le lien d’une fédération criminelle et de leurs projets occultes, ses adeptes se prêtent un mutuel appui et se provoquent entre eux à oser et à faire le mal. »
La franc-maçonnerie est systématiquement désignée dans l’encycli-que sous le vocable de « secte maçonnique » : elle est ainsi assimilée à une hérésie, à une doctrine contraire à la vraie foi ; la secte – terme non canonique – étant le véhicule de cette doctrine, ce qui fait de la franc-maçonnerie, aux yeux de l’Église, une religion à anathémiser – le péché d’hérésie est le péché le plus grave dans le catholicisme. Le code canonique de 1917 entérinera en droit cette assimilation de la franc-maçonnerie à l’hérésie ou au schisme24.
V. Royaume de Satan et Royaume de Dieu
L’association supposée de la franc-maçonnerie avec le diable est formulée dès le début du xixe siècle, mais c’est alors toujours en liaison avec son rôle politique supposé. Ce n’est qu’au milieu du siècle
23. Lambert P.-A., La charbonnerie française, op. cit.24. Canon 1240, Livre II, titre XII.
Satan : l’esprit du complot ? 185
qu’une conception de la franc-maçonnerie comme principe diabolique caché s’autonomise et s’élabore dans le cadre du discours théologique antimaçonnique. C’est à Henri Gougenot des Mousseaux que l’on peut attribuer la première synthèse d’une franc-maçonnerie satanique même si, à la même époque, Mgr de Ségur fait lui aussi un lien direct entre la franc-maçonnerie et le démon et si Alex de Saint-Albin, dans Du culte de Satan, affirme l’existence d’une Contre-Église luciférienne25. Pour Humanum Genus également, « depuis que, par la jalousie du démon [au sens théologique, un démon est un ange déchu, mais on l’entend ici au sens de Satan] le genre humain s’est misérablement séparé de Dieu […], il s’est partagé en deux camps ennemis, lesquels ne cessent pas de combattre, l’un pour la vérité et la vertu, l’autre pour tout ce qui est contraire à la vertu et à la vérité. Le premier est le royaume de Dieu sur la terre, à savoir la véritable Église de Jésus Christ […]. Le second est le royaume de Satan. Sous son empire et en sa puissance se trouvent tous ceux qui […] refusent d’obéir à la loi divine et multiplient leurs efforts, ici, pour se passer de Dieu, là pour agir directement contre Dieu. » Dès lors qu’il est l’œuvre du démon, le complot est universel, totalisant : il est un contre-projet de société. C’est une vision eschatologique : Dieu est exonéré de la responsabilité du mal qui frappe le monde ; ce mal est imputable à ceux qui s’acharnent à l’imposer, à savoir Satan et ses valets. Toutes les forces révolutionnaires coalisées depuis près d’un siècle ont composé le « corps sacerdotal de Satan26 » : « […] dans un plan si insensé et si criminel [vouloir détruire la religion et l’Église], il est bien permis de reconnaître la haine implacable dont Satan est animé à l’égard de Jésus Christ et sa passion de vengeance. »
Car Satan est l’ennemi le plus puissant de Dieu, l’antitheos, le Contre-Dieu par excellence, le principe du Mal qui répond antithétique-ment au principe du Bien, de sorte que la franc-maçonnerie devient par métonymie la Contre-Église, la contrefaçon de celle-ci. Tout le propos de l’encyclique Humanum Genus, dont le titre complet mentionne explicitement qu’elle entend combattre le relativisme philosophique et moral de la franc-maçonnerie, est de démontrer que le naturalisme de la franc-maçonnerie n’est qu’un simulacre de la Vérité, qui s’efforce de
25. Saint-Albin A. de, Du culte de Satan, Paris, J.-L. Paulmier, 1867.26. Cité par Lalouette J., « Le combat des Archanges », dans Le Diable : vers
une métaphysique, op. cit., p. 73.
186 Jean-Philippe Schreiber
se substituer à elle, en mêlant la vérité au mensonge. Satan, dans le dis-cours démonologique chrétien, possède, en effet, l’art consommé de la ruse, et a l’aptitude de singer le divin – c’est l’expression de Tertullien à propos de Satan : Simius Dei, Singe de Dieu27. Œuvre du Malin, la franc-maçonnerie, qui constitue le principe corrosif de la dégradation de la morale et des mœurs, est un venin qui s’insinue dans un corps sain, une souillure étrangère à celui-ci : « […] l’impure contagion du poison qui circule dans les veines de la société et l’infecte tout entière » – la méta-phore biologique est un topos du discours social de l’époque. C’est un mal, une contagion proclame Humanum Genus, à laquelle l’on répond par une prophylaxie, laquelle tient dans la parole de Dieu – une parole qui a une vertu performative, contre un ennemi vicié dans son essence. C’est un poison qui corrompt l’organisme social, un virus contre lequel il faut immuniser le peuple de Dieu : « Guérir [la maladie, l’impureté, la souillure appellent en contrepoint la résipiscence], par une science [reli-gieuse] de bon aloi, les maladies intellectuelles des hommes et de les prémunir tout à la fois contre les formes multiples de l’erreur et contre les nombreuses séductions du vice » : la démonologie traditionnelle attribuait aux démons la capacité de mobiliser sous couvert d’occulte les forces de la nature, la magie n’étant ainsi qu’une illusion ; ici, ce ne sont plus les forces cachées de la nature qui sont manipulées, mais les idées.
VI. l’église est en guerre : la croisade antimaçonnique
La Vierge était apparue – parmi d’autres apparitions dans une France alors fort mariolâtre – à Pellevoisin, en 1876, pour dire que la France serait délivrée de l’emprise maçonnique et satanique, et qu’elle retrouve-rait son rôle de sergent de Dieu et de chevalier de Marie28 : « Demandons à la Vierge Marie, Mère de Dieu [proclame Humanum Genus], de se faire notre auxiliaire et notre interprète. Victorieuse de Satan dès le premier instant de sa conception, qu’Elle déploie sa puissance contre les sectes réprouvées qui font si évidemment revivre parmi nous l’esprit de révolte,
27. Céard J., « Le Diable singe de Dieu selon les démonologues des xvie et xviie siècles », dans ibid.
28. Marx J., Le péché de la France – Surnaturel et politique au xixe siècle, Bruxelles, Espace de libertés – Éd. du Centre d’action laïque, coll. « Laïcité », 2005, p. 210.
Satan : l’esprit du complot ? 187
l’incorrigible perfidie et la ruse du démon. » La Mère de Dieu est ainsi invoquée pour combattre le vice et le matérialisme, incarnant l’efficacité de l’intercession divine et de la force de la prière dans le combat apo-calyptique du Bien contre les forces sataniques – et la dévotion mariale symbolisant le climat spirituel d’expiation et de réparation.
Face à cette menace ontologique, c’est une Église de combat qui s’affirme. L’appel est adressé aux guerriers du Christ rassemblés sous la bannière du chef des armées de Dieu, l’Archange Saint-Michel – Léon XIII avait, en 1880 déjà, chargé l’Archiconfrérie de Saint-Michel, bras politique de l’ultramontanisme, d’anéantir les sociétés secrètes et leurs projets infernaux –, Saint-Michel, l’Archange de Lumière en lutte contre le Prince des Ténèbres : « En un si pressant danger, en présence d’une attaque si cruelle et si opiniâtre du christianisme, c’est de Notre devoir de signaler le péril, de dénoncer les adversaires, d’opposer toute la résistance possible à leurs projets […], d’abord pour empêcher la perte éternelle des âmes dont le salut Nous a été confié. » Car c’est bien de cela qu’il s’agit : l’enjeu est sotériologique. Pour le catholique romain, son salut n’est pas entre ses mains, mais dépend d’une promesse d’achever jusqu’à la perfection l’œuvre de Création. Et l’Église, voyant dans la franc-maçonnerie un réel danger pour sa vocation d’administration du salut des âmes, ne peut admettre qu’une institution prétende permettre à ses adeptes d’accéder à la Vérité par leur propre pouvoir autocréateur, considérant qu’il y a là une véritable déification de l’être humain29. La crainte absolue que suscite le plan démoniaque ne peut qu’entraîner une réponse proportionnelle, et justifie donc le déchaînement de violence en retour – ce que reflétera notamment le langage de la Civilità Cattolica – contre la ruse déployée par les suppôts de Satan. Comme l’écrivent Jacques-Charles Lemaire et Alain Goldschläger : « La peur lubrifie les rouages du système : c’est pourquoi les complotistes se présentent souvent comme des guerriers, prêts à assumer tous les risques pour dévoiler la vérité au grand jour30. » Et l’encyclique de marteler : « Notre devoir est de Nous appliquer à trouver des remèdes proportionnés à un mal si intense et dont les ravages ne se sont que trop étendus. »
29. Pour les aspects ecclésiologiques de cette question, voir : Boutin P., La Franc-maçonnerie, l’Église et la modernité…, op. cit., p. 169.
30. Goldschläger A. et Lemaire J.-Ch., Le complot judéo-maçonnique, op. cit., p. 16.
188 Jean-Philippe Schreiber
Outre les vertus de la religion comme rempart solide, outre le rappel des sentences promulguées par ses prédécesseurs, Léon XIII appelle à divers moyens, dont la divulgation et la dénonciation : « En premier lieu, arrachez à la franc-maçonnerie le masque dont elle se couvre et faites la voir telle qu’elle est. » Il s’agit donc d’aller plus loin que les prédécesseurs de Léon XIII, et plus loin que la littérature de révélation ou l’antimaçonnisme dit « documentaire » l’ont fait – les ouvrages du premier antimaçonnisme étaient de véritables études sur la maçonnerie, malgré la perversité du propos31. Le secret de l’appartenance fera ainsi l’objet de divulgations systématiques avec l’antimaçonnisme populaire né de Humanum Genus, alors que les antimaçons d’avant Humanum Genus y apparaissaient souvent rétifs. L’un des procédés caractéristiques de l’antimaçonnisme d’après Humanum Genus sera de faire apparaître les maçons au grand jour, par le fait notamment des revues qui naquirent dans le sillage de l’encyclique : ce sera le cas, en Italie, de la Civiltà Cattolica des jésuites ou, en France, de la revue La Franc-Maçonnerie démasquée de Mgr Armand-Joseph Fava, parmi d’autres organes des ligues antimaçonniques créées avec l’assentiment du Pape. Divulguez et dénoncez, dit le Pape, car le secret entraîne la dénonciation. Et l’Église exige l’aveu pour accorder le pardon, rappelle Jean Delumeau32. Un décret du Saint-Office de 1886 stipulera les conditions posées par tout confesseur à celui qui voulait être absous et voir levée l’excommunication qui le frappait ; parmi ces conditions figurait l’obligation de la dénoncia-tion des chefs occultes33. Les instructions en la matière sont précisées par le Saint-Office : l’excommunication vise même ceux qui, sans être francs-maçons, auraient favorisé leurs desseins, en éditant leurs publications ou en abritant leurs réunions : ils tombent aussi sous le coup de la censure pontificale – et même le fils doit dénoncer le père34.
31. Sur la littérature de révélation, voir : Lemaire J., Les Origines françaises de l’antimaçonnisme : 1744-1797, Bruxelles, Éd. de l’Université de Bruxelles, coll. « Études sur le xviiie siècle – Hors-série », 1985.
32. Delumeau J., L’Aveu et le pardon. Les difficultés de la confession (xiiie-xviiie siècle), Paris, Fayard, coll. « Les Nouvelles études historiques », 1990.
33. Jarrige M., L’Église et la franc-maçonnerie dans la tourmente, la croisade de la revue « La Franc-Maçonnerie démasquée » (1884-1899), Préface d’E. Poulat, Paris, Éd. Arguments, 1999, p. 63 ; Nefontaine L., Église et franc-maçonnerie, Paris, Éd. du Chalet, 1990, p. 49-53.
34. Dictionnaire de théologie catholique, vol. VI, col. 727-728.
Satan : l’esprit du complot ? 189
« Le but fondamental et l’esprit de la secte maçonnique avaient été mis en pleine lumière par la manifestation évidente de ses agisse-ments, la connaissance de ses principes, l’exposition de ses règles, de ses rites et de leurs commentaires [il faut éclairer l’occulte et, selon ce principe, il n’est que l’Église à être capable de déchiffrer, décrypter, pénétrer ce qui est peu pénétrable] auxquels, plus d’une fois, s’étaient ajoutés les témoignages de ses propres adeptes. » Le Pape reprend ici un des poncifs de la littérature antimaçonnique de la seconde moitié du xixe siècle, qui était de faire parler les maçons contre les maçons, mobilisant des maçons retournés : les aveux des chefs de la secte étaient un mécanisme inauguré par l’abbé Barruel déjà. Le discours de l’Église, ici, renvoie aux convertis et à la notion de repentir que l’Inquisition avait si bien traduite : « Pour mettre hors de doute l’existence d’un tel plan, à défaut d’autres preuves, il suffirait d’invoquer le témoignage d’hommes qui ont appartenu à la secte et dont la plupart […] ont attesté comme cer-taine la volonté où sont les francs-maçons de poursuivre le catholicisme d’une inimitié exclusive et implacable, avec leur ferme résolution de ne s’arrêter qu’après avoir ruiné de fond en comble toutes les institutions religieuses établies par les Papes. »
Conclusion
Le cardinal Ratzinger, dans Congregatio Plenaria, recueil de textes d’un Conseil pontifical de 1981 où fut discutée la question de savoir si la franc-maçonnerie devait être maintenue parmi les associations condamnées par l’Église, déclara :
« Le relativisme est l’essence de la secte franc-maçonnique […] et cela dans un double sens : a) le relativisme entre le vrai et le faux […] b) le relativisme entre le bien et le mal […]. De mon point de vue, ce relativisme touche au noyau de toute notre crise. Dans cette affinité entre les principes maçonniques et ces éléments de la conscience moderne qui visent à détruire la foi, je vois ce danger extraordinaire de la secte maçonnique qui est incomparable à tous les autres35. »
35. Congregatio Plenaria, Rome, 1981 (cité dans Boutin P., La Franc-maçonnerie, l’Église et la modernité…, op. cit., p. 7).
190 Jean-Philippe Schreiber
Jacques Lemaire et Alain Goldschläger ont justement insisté, parlant du mythe du complot judéo-maçonnique, sur le fait que la pensée conspi-ratrice participe intimement d’un type de pensée religieuse, dont atteste notamment sa confiance absolue, témoignée par un acte de foi – au sens littéral du terme – dans le discours énoncé et la légitimité de celui qui tient ce discours36. J’entendais ici aller plus loin et montrer que cette idéologie est d’essence religieuse, justifiée théologiquement. L’Église se considère en effet, en 1884, comme une citadelle assiégée en per-manence par les forces du Mal. La franc-maçonnerie est identifiée par l’Église comme le lieu par excellence qui symbolise ce mal, à savoir le changement du monde moderne ; et c’est au nom de sa conception de la société parfaite qu’elle va condamner la franc-maçonnerie avec une violence qu’elle n’a appliquée, canoniquement, à aucune autre ins-titution. Il y a là à l’œuvre une véritable construction de l’adversaire, présenté comme redoutable et dangereux, afin de relancer l’esprit mis-sionnaire – l’appel à la Vierge Marie en témoigne – et de souder les rangs catholiques divisés notamment par la crise ultramontaine et la force d’attraction des libertés modernes37. Incarner les forces agissantes de la modernité dans le Malin, c’est affirmer clairement qu’en dehors de l’Église, aucune voie du Salut n’est légitime, et qu’aucun aspect de cette modernité ne peut constituer un horizon d’espérance pour l’homme. C’est le dernier avatar de l’histoire du Salut, du combat entre Dieu et l’adversaire le plus puissant qu’il se soit donné, qui s’efforce de se substituer à lui.
L’encyclique utilise ici des « couples archétypiques » – Bien/Mal, Vérité/Erreur, Lumière/Ténèbres, etc. – et une rhétorique démonolo-gique. L’Église, depuis le xiie siècle, a construit une sotériologie où la figure répulsive du Diable a occupé une place de plus en plus impor-tante38. La figure de Satan culmina au xviie siècle, avant de refluer avec la fin des guerres de religion39. Elle revient à la fin du xixe siècle – au
36. Goldschläger A. et Lemaire J.-Ch., Le complot judéo-maçonnique, op. cit., p. 15.
37. Voir à ce sujet : Marx J., Le péché de la France, op. cit.38. On consultera à ce propos : Boureau A., Satan hérétique : naissance de la
démonologie dans l’Occident médiéval (1280-1330), Paris, O. Jacob, 2004.39. Saur L., Le sabre, la machette et le goupillon. Des apparitions de Fatima au
génocide rwandais, Préface de J.-P. Chrétien, Bierges, Éd. Mols, coll. « Autres regards », 2004, p. 65 sq.
Satan : l’esprit du complot ? 191
moment où la culture catholique regorge à nouveau de surnaturel –, non pas sous une forme sécularisée, mais incarnée cette fois dans un mythe politico-religieux, l’hérésie maçonnique. Tout comme elle mobilise contre ce qu’elle considère comme une Contre-Église, l’Église entend réfuter ce qui lui paraît détourné dans son propre lexique : ses adver-saires auraient pris à l’Église les mots de liberté, de vérité, de vertu, de charité… pour les détourner de leur sens – le mensonge, c’est l’inver-sion du sens de la Vérité. Mais, en réalité, c’est le discours anti-libéral qui procède à une transposition de sens, et inverse le sens originel des termes : la liberté, paradoxalement, est ainsi transposée en servitude, remarque Pierre Rajotte, puisque la liberté, dans l’acception papale, est considérée comme la libre soumission à l’autorité légitime – Dieu, l’Église –, soumission ou obéissance qui libère l’homme – un homme à l’abri du doute, rassuré par l’éternelle Vérité40.
En outre, contre le secret maçonnique, l’Église a joué de deux registres en apparence paradoxaux, mais en réalité dialogiques. Le premier registre est celui du secret vu comme principe unificateur : la franc-maçonnerie est une société homogène, armée d’un projet conspi-rateur. Le second registre vise le secret comme principe séparateur : cette société est hiérarchisée ; les grades inférieurs n’ont pas accès aux mystères ; les grades supérieurs manigancent des plans occultes que les premiers ignorent. Ce qui accroît davantage le caractère anxiogène du discours papal. Et il y a là un paradoxe : la pédagogie de la peur entretenue sur les maçons contraste avec le fait que l’Église du xixe intensifie les efforts pour propager une nouvelle conception de Dieu, plus espérance que menace. La diffusion, à partir de la Restauration, de la théologie morale de saint Alphonse de Liguori en est une mani-festation, qui vise à la substituer à la pédagogie de la peur qui prévalait auparavant. Cela dit, l’Église est toujours marquée par les réponses qu’elle offre aux désastres du monde – épidémies, violences naturelles, mais aussi crises politiques. L’on peut peut-être considérer la franc-maçonnerie comme s’inscrivant dans ces calamités politiques, dans ce péril qu’on rapproche d’une menace naturelle, voire surnaturelle… et qui renvoie à la question du péché et du Dieu vengeur.
40. Rajotte P., Les mots du pouvoir ou le pouvoir des mots…, op. cit., p. 90.
192 Jean-Philippe Schreiber
Finalement, Humanum Genus traduit bien l’appréhension du temps, face à des changements sociaux de plus en plus accélérés qui désem-parent les tenants de l’ordre traditionnel, lesquels ne peuvent l’imputer qu’à des causes extérieures, incapables qu’ils sont d’en rationaliser les causes, leur conception de l’histoire et de la société étant manichéenne et providentielle. Cette conception suppose que le citoyen n’est jamais susceptible d’agir sur le cours des événements : ainsi, la Révolution, qui se serait accomplie sans aucune action de la société, mais ne pouvait être que le produit d’une conspiration. Cette lecture corrobore d’une certaine façon les principes très simples qui selon, Pierre-André Taguieff, struc-turent les croyances conspirationnistes : rien n’arrive par accident : tout ce qui arrive est le résultat d’intentions cachées ; rien n’est tel qu’il paraît être : les apparences sont donc toujours trompeuses ; tout est lié, mais de façon occulte41.
Certes, l’Église n’a plus été en tant que telle à l’avant-scène de la construction du mythe du complot après la fin du xixe siècle. Mais ce sont les événements qui lui ont dicté cette retenue nouvelle. La célèbre déclaration de Léo Taxil, avouant sa supercherie devant la Société de Géographie de Paris, en 1897, après douze années d’ardente activité antimaçonnique, marque assurément un coup d’arrêt brutal à cette croi-sade catholique42. Le premier Congrès antimaçonnique de Trente, qui a précédé et amené cet aveu, ne connaîtra dès lors pas le succès escompté et ne sera pas réédité. L’idée du complot, et même du complot juif, ne vient donc pas de l’extrême-droite : elle s’ancre dans la pensée contre-révolu-tionnaire, qui emprunte tant à l’intransigeantisme catholique qu’à une certaine gauche réactionnaire43. L’Église catholique a fortement contribué à créer et entretenir ce mythe politique d’une prétendue superpuissance cachée. Pierre-André Taguieff a montré que le principal véhicule textuel de ce mythe a été les Protocoles des Sages de Sion, dont il a décortiqué les formes du discours et les avatars. Toutefois, dans le monde latin, le
41. Taguieff P.-A., La Foire aux « Illuminés », op. cit.42. Weber E., Satan franc-maçon. La mystification de Léo Taxil, Paris, Julliard,
1964 ; Ferrer Benimeli J.A., « Antimaçonnisme et anticléricalisme. La mystification de L. Taxil (1890-1897) », dans J. Lemaire (éd.), Sous le masque de la franc-maçon-nerie, Bruxelles, Éd. de l’Université de Bruxelles, 1990, p. 103-117.
43. Crapez M., La gauche réactionnaire : mythes de la plèbe et de la race dans le sillage des Lumières, Préface de P.-A. Taguieff, Paris, Berg International, coll. « Pensée politique et sciences sociales », 1997.
Satan : l’esprit du complot ? 193
discours officiel de l’Église y a concouru, avant même la diffusion des Protocoles, freinée par l’affaire Taxil qui l’obligea à une courbe rentrante imprévue dans sa compulsive croisade antimaçonnique.
194 Jean-Philippe Schreiber
Pensée du complot et imaginaire judéophobe chez Édouard Drumont
Cédric Passard
En 1909, alors que sa carrière est sur le déclin, Édouard Drumont, âgé de soixante-cinq ans, se porte candidat à l’Académie française. Sur les trente-deux académiciens qui prennent part au vote, il remporte dix voix au premier tour, se plaçant ainsi, à deux voix près, derrière le romancier à succès Marcel Prévost, finalement élu au terme de quatre tours. Égal à lui-même, Drumont livre l’explication de sa défaite, guère étonnante sous sa plume puisqu’il l’applique ad nauseam à tous les événements et circonstances :
« En me présentant, j’ai démontré simplement que les élites litté-raires étaient sous la domination des Juifs comme les pouvoirs parlementaires, judicaires et financiers. À ce point de vue, ma can-didature est un document humain après tant d’autres, un apport de plus, une contribution à l’histoire de ce temps. Elle prouve que la Juiverie, l’esprit juif, le dreyfusisme ont pris possession des milieux intellectuels qui se sont longtemps préservés de la contagion1. »
Il en est toujours ainsi chez Drumont : il réitère à l’envi cette antienne d’une conspiration ourdie par les Juifs, comme un prêt-à-penser qui, pour autant, n’étouffe pas son imagination assurément fertile. C’est d’ailleurs avec cette thématique que le journaliste-écrivain, alors quasi inconnu du grand public, accède à la célébrité en publiant, en 1886, sa France juive dont 65 000 exemplaires sont vendus en un an – ouvrage qui connaîtra plus de deux cents éditions (dont la dernière en 1941). Par la suite, Drumont multiplie les titres et fonde, en 1892, un quotidien qui remporte également un grand succès, La Libre Parole. Il mène parallèlement une carrière politique qui lui ouvre les portes de l’enceinte parlementaire,
1. « Impressions académiques », La Libre Parole, 3 juin 1909, cité par Grégoire Kauffmann (Édouard Drumont, Paris, Perrin, 2008, p. 434).
et devient député « anti-juif » d’Alger en 1898. Ces très brefs rappels biographiques témoignent de l’incroyable réussite du publiciste. La renommée et l’influence de Drumont à l’époque contrastent d’ailleurs singulièrement avec l’oubli dans laquelle était tombé le personnage avant que les historiens ne le redécouvrent assez tardivement2. En cette fin du xixe siècle, la gloire de Drumont signe le développement d’un antisémi-tisme français vigoureux qui se fait système d’explication globale car, ainsi que l’a bien analysé Michel Winock3, l’antisémitisme de Drumont présente la particularité de synthétiser, de « conglutiner » les différentes traditions judéophobes qui soutiennent, chacune, un certain imaginaire du complot.
Il s’intègre d’abord dans la « haine religieuse du juif4 » portée par l’antijudaïsme médiéval des pères de l’Église contre le « peuple déicide », mais, plus encore, par la pensée contre-révolutionnaire, à l’instar de celle de Louis Bonald ou de Joseph de Maistre, qui rend responsables les Juifs de la chute de l’Ancien Régime. Drumont se situe ainsi dans la filiation directe de l’abbé Barruel qui interprète la Révolution de 1789 comme l’œuvre de sociétés secrètes et antichrétien-nes. C’est de cet antisémitisme « catholico-réactionnaire », comme le qualifie Pierre-André Taguieff5 qu’émerge le thème du complot judéo-maçonnique que Drumont reprend à son compte. Le Juif est considéré comme l’instigateur occulte de la franc-maçonnerie et l’ennemi de la civilisation chrétienne.
Mais l’antisémitisme de Drumont s’ancre, par ailleurs, dans une pensée économique de tradition socialiste, ou, en tout cas, anticapita-liste, assez caractéristique des auteurs comme Fourier, Proudhon voire Marx lui-même. De ce point de vue, la source principale de Drumont est un disciple de Fourier, à savoir Alphonse Toussenel, auteur, en 1845,
2. Winock M., Édouard Drumont et compagnie. Antisémitisme et fascisme en France, Paris, Éd. du Seuil, 1982 ; Busi F., The Pope of Antisemitism: the Career and Legacy of Edouard Drumont, Lanham, University Press of America, 1986 ; Kauff-mann G., Édouard Drumont, op. cit.
3. Winock M., Édouard Drumont et compagnie…, op. cit., p. 40-58.4. Arendt H., Sur l’antisémitisme : les origines du totalitarisme, Paris, Éd. du
Seuil, coll. « Points – Essais », 2005.5. Kauffmann G., Lenoire M., Taguieff P.-A., L’antisémitisme de plume
1940-1944 – La propagande antisémite en France sous l’Occupation, Paris, Berg International, coll. « Pensée politique et sciences sociales », 1999, p. 32-35.
Pensée du complot et imaginaire judéophobe chez E. Drumont 197
des Juifs, rois de l’époque6. Le Juif se confond ici avec les milieux financiers dominants dont la figure de Rothschild apparaît comme l’em-blème. Cet antisémitisme économique évoque également une vision complotiste de la société reposant sur l’opposition des « petits » et des « gros », dont Pierre Birnbaum a bien montré qu’elle envahissait le langage politique en cette fin du xixe siècle en représentant « le peuple innocent de tout pêché comme l’éternelle victime des gros, véritables démons, êtres cupides, parasites et dépravés dont la puissance est d’autant plus grande qu’elle demeure cachée, lointaine et impalpable7. » Cet antisémitisme économique exprime ainsi une version « ethnicisée » de la lutte des classes.
La pensée judéophobe de Drumont ressort, enfin, d’un antisémitisme « racialiste » qui se développe à l’époque, et qui fait du Juif un être bio-logiquement différent, inassimilable. Afin de légitimer ses imputations contre le Juif – à la fois tous les Juifs et chacun d’entre eux en particu-lier –, Drumont convoque tout un registre pseudo-médical, et reprend à son compte les théories naturalistes voire racialistes alors très en vogue, pour opposer, tant sur le plan biologique qu’historique, les « aryens » aux « sémites ».
En assemblant ces différentes formes d’antisémitisme, Drumont érige le complot juif en principe d’explication universelle, celui-ci faisant office de « mégacomplot » qui fusionne ou subsume tous les autres. Aussi, parmi les quatre types de théories du complot qu’a iden-tifiées Pierre-André Taguieff8, c’est à la dernière de celles-ci, la plus élaborée, que se rattache la vision du monde d’Édouard Drumont : celle d’une véritable mythologie conspirationniste qui voit dans le complot juif rien moins que le « moteur de l’Histoire ». En dépit de ses élucubrations et de ses contradictions logiques qui nous paraissent aujourd’hui si évidentes, au point de rendre incompréhensible son succès, il nous semble que si le discours de Drumont a pu néanmoins s’avérer persuasif, c’est qu’il est précisément parvenu à dessiner une trame narrative et à élaborer une mythologie antijuive qui possède sa propre logique interne. Cette « folie raisonnante » (selon la formule de
6. Totussenel A., Les Juifs, rois de l’époque. Histoire de la féodalité financière, Paris, Gabriel de Gonet éditeur, 1845.
7. Birnbaum P., Le peuple et les gros. Histoire d’un mythe, Paris, Grasset, 1979.8. Taguieff P.-A., La Foire aux « Illuminés ». Ésotérisme, théorie du complot,
extrémisme, Paris, Éd. des Mille et Une Nuits, coll. « Essai », 2005, p. 17-23.
198 Cédric Passard
Marc Angenot9) trouve ainsi, selon nous, sa cohérence dans une pensée de type mythique, un imaginaire judéophobe qui puise dans un stock de stéréotypes déjà disponibles, mais que Drumont est parvenu à adapter à l’esprit du temps.
I. Une histoire occulte
La pensée complotiste de Drumont tire d’abord une grande partie de son efficacité sociale du fait qu’elle habille son message judéophobe d’une rhétorique scientifique sans laquelle elle pourrait difficilement être audible à l’âge de la Science. Elle permet au pamphlétaire de ratio-naliser en apparence sa haine antijuive.
Une rhétorique de la scientificité
Drumont ne craint pas, en effet, de se présenter comme historien, psychologue ou sociologue ; il le fait d’autant plus facilement qu’à cette époque, les sciences sociales naissantes sont dans une situation encore précaire, prises dans des débats voire des querelles concernant leur statut et leurs méthodes, tiraillées entre le prestige dont jouissent les sciences de la nature et la prétention de la littérature à percer aussi à jour la société des hommes10. L’ambition scientifique de Drumont s’affirme et s’objective à travers l’ostentation de signes de scientifi-cité, en particulier dans le péritexte. Par exemple, les sous-titres de ses ouvrages portent la mention d’« étude psychologique et sociale » ou d’« essai d’histoire contemporaine ». Drumont s’appuie aussi sur une accumulation de documents divers et d’innombrables références scientifiques ou pseudo-scientifiques pour légitimer son propos ; l’intertextualité est, à ce titre, omniprésente. Dans La France Juive, il se revendique ainsi, dès les premières lignes, de l’autorité d’Hippolyte Taine : « Taine a écrit la Conquête jacobine. Je veux écrire la Conquête juive ». Plus précisément, l’objet de cette France juive, explique-t-il, est « de décrire les phases successives de cette Conquête juive, d’indiquer comment, peu à peu, sous l’action juive, la vieille France s’est dissoute,
9. Angenot M., Dialogues de sourds. Traité de rhétorique antilogique, Paris, Éd. des Mille et Une Nuits, coll. « Essai », 2008.
10. Lepenies W., Les trois cultures. Entre science et littérature, l’avènement de la sociologie, Paris, Éd. de la Maison des Sciences de l’Homme, 1990.
Pensée du complot et imaginaire judéophobe chez E. Drumont 199
décomposée, comment à ce peuple désintéressé, heureux, aimant, s’est substitué un peuple haineux, affamé d’or et bientôt mourant de faim11. » Cette idée de « Conquête juive » est inextricablement liée, dans l’esprit de Drumont, à celle d’un complot juif, car l’auteur prétend repérer derrière tous les éléments qui affectent la société ancienne assimilée à la vraie France, les faits et gestes occultes du Juif éternel. Toute la théorie du judéophobe repose, de ce point de vue, sur une loi historique simple selon laquelle « Quand le Juif monte, la France baisse ; quand le Juif baisse, la France monte12. » Mais Drumont renverse, en réalité, cet « axiome » formulé sous forme d’une induction en une abduction, puisque toute son entreprise consiste à affirmer que si la France baisse, c’est précisément parce que le Juif monte. Ce renversement de l’induc-tion en abduction n’est possible qu’en présence d’une proposition implicite qui postule que tout ce qui fait que la France baisse vient du Juif ou, pour le dire autrement, que tous les malheurs viennent du Juif. La théorie de Drumont fournit, de ce point de vue, un cas exemplaire d’une « mythologie scientifique13 » dont la cohérence apparente, de type scientifique, masque une cohérence cachée, de type mythique, qui attribue au Juif, en l’occurrence, la cause de tous les désastres.
Drumont offre ainsi une relecture de l’Histoire de France à travers les prétendus agissements occultes du Juif, celui-ci constituant, selon lui, le principe d’explication universelle des désordres de cette France dont il annonce la disparition. En particulier, le deuxième livre de la France Juive consacrée au Juif dans l’Histoire de France dessine une véritable contre-histoire fondée sur une interprétation, ou réinterpré-tation, conspirationniste de l’Histoire. Celle-ci est scandée par deux grands moments de rupture : le xive siècle et la Révolution française. Le premier de ces deux moments correspond à l’époque où Philippe Le Bel puis Charles VI expulsent les Juifs hors de France. Pour Drumont, pourtant, les juifs ne disparaissent pas de France, car selon lui, « la politique juive est toujours là14 », mais elle s’effectue dans l’ombre, elle avance désormais masquée.
11. Drumont E., La France juive, Paris, Marpon et Flammarion, t. 1, 1886, 43e éd., p. 7.
12. Ibid., p. 242.13. Bourdieu P., « La rhétorique de la scientificité : contribution à une analyse de
l’effet Montesquieu », dans P. Bourdieu, Ce que parler veut dire – L’économie des échanges linguistiques, Paris, Fayard, 1982, p. 227-239.
14. Drumont E., La France juive, t. 1, op. cit., p. 94.
200 Cédric Passard
Ainsi, Drumont explique-t-il que le Juif commence son entreprise de travestissement. Notamment en catholique :
« Les Juifs portugais […] se conformaient scrupuleusement à toutes les pratiques extérieures de la religion catholique ; leurs naissances, leurs mariages, leurs décès étaient inscrits sur les regis-tres de l’Église ; leurs contrats étaient précédés des mots : au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Après avoir vécu près de cent cinquante ans ainsi, les Juifs étaient restés aussi fidèles à leurs croyances que le jour de leur arrivée. Dès que l’occasion fut favo-rable, […], ils retournèrent ouvertement au Judaïsme15. »
Mais le Juif se déguise aussi en protestant selon Drumont. À la suite de Toussenel, Drumont conçoit, en effet, le protestantisme et la Réforme comme l’œuvre des Juifs et affirme ainsi que : « Tout protestant, […] est à moitié Juif16. » Finalement, Drumont répète sans cesse qu’« à cette époque, le Juif qu’on n’admettait nulle part était en réalité partout17. » Dissimulé, le Juif opère, dans l’ombre, et s’emploie à détruire tous les édifices de la société d’Ancien régime, et ce par l’intermédiaire de socié-tés secrètes présentées comme de véritables « machines de guerre » :
« Leur manière d’agir varie peu. Ils n’aiment guère à attaquer ouvertement, ils créent ou plutôt ils corrompent quand elle est créée, car là encore ils ne sont pas inventeurs, une association puis-sante qui leur sert comme de machine de guerre pour battre en brèche l’organisation sociale qui les gêne. Ordre des Templiers, Franc-maçonnerie, Internationale, Nihilisme, tout leur est bon. Dès qu’ils sont entrés, ils procèdent là comme dans une société finan-cière, où les efforts de tous sont uniquement employés à servir la cause ou les intérêts d’Israël, sans que les trois quarts du temps les gens aient la notion de ce qu’ils font18. »
Les multiples complots manigancés dans ses sociétés secrètes appa-raissent comme la force motrice des événements historiques, et c’est ainsi selon Drumont que le Juif a mené à bien son projet de renversement de la société d’Ancien régime, projet qui triomphe avec la Révolution
15. Ibid., p. 111.16. Ibid., p. 95.17. Ibid., p. 127.18. Ibid., p. 85.
Pensée du complot et imaginaire judéophobe chez E. Drumont 201
française. La démonstration de Drumont repose, à cet égard, sur un syl-logisme simple fondé sur le postulat que notait Karl Popper : « selon la théorie de la conspiration, tout ce qui arrive a été voulu par ceux à qui cela profite19. » Puisque la Révolution a émancipé les Juifs, cela prouve bien, aux yeux de Drumont, que ces derniers en sont les véritables instigateurs : en ses propres termes, « le seul auquel la Révolution ait profité est le Juif. Tout vient du Juif, tout revient au Juif20. » Mais, avec la Révolution, un changement décisif intervient selon Drumont : désor-mais, la société entière est phagocytée par les Juifs, elle est devenue elle-même un vaste complot. Ou, comme il l’explique :
« La force des Juifs est de ne plus procéder comme autrefois, par des méfaits isolés ; ils ont fondé un système où tout se tient, qui embrasse le pays tout entier, qui est muni de tous les organes néces-saires pour fonctionner, ils ont fortifié les points sur lesquels on pourrait les prendre, ils ont modifié sans bruit les lois qui pou-vaient les gêner ou obtenu des arrêts qui paralysent l’action de ces lois, ils ont soumis la presse au capital, de façon qu’elle soit dans l’impossibilité de parler21. »
De fait, le monde apparaît à Drumont comme dominé par la conspi-ration et le mensonge, tant et si bien que la science elle-même s’en trouve falsifiée : « tous les témoignages, […], tous les documents authentiques, en un mot, sur lesquels s’est basée jusqu’ici la certitude en histoire, n’ont plus aucune valeur aujourd’hui quand ils déplaisent aux Juifs22. » Pour Drumont, les manuels d’histoire ne contiennent donc que des « légendes », et les chiffres officiels ne sont pas crédibles. C’est pourquoi, il reconnaît d’emblée des « imperfections » à son travail qui tiennent précisément au fait que « l’œuvre latente du Juif est très difficile à analyser, [en ce qu’]il y a toute une action souterraine dont il est presque impossible de saisir le fil23. » On retrouve bien ici toute l’ambiguïté du rapport à l’argumentation de la parole pamphlétaire,
19. Popper K. R., La société ouverte et ses ennemis, trad. J. Bernard et Ph. Monod, Paris, Éd. du Seuil, 1979, t. 2, p. 68.
20. Drumont E., La France juive, t. 1, op. cit., p. 3.21. Drumont E., La fin d’un monde – Étude psychologique et sociale, Paris,
Albert Savine éditeur, 1889, p. 79.22. Drumont E., La France juive, t. 1, op. cit., p. 80.23. Ibid., p. 8.
202 Cédric Passard
brillamment analysée par Marc Angenot24 : « prophète d’une exigence bafouée de vérité », le pamphlétaire avoue ne pas être en mesure de tout démontrer rationnellement car l’imposture règne, le faux s’est substitué au vrai. L’authenticité et la pureté de sa parole ne peuvent être acquises qu’au prix d’une nécessaire mise en marge de la société, d’un exil intel-lectuel. Drumont endosse ainsi cet « anti-ethos » qui « tire sa légitimité du fait même qu’il est illégitime25 » et qui se nourrit du sentiment d’être soi-même victime du complot et bouc-émissaire. Tout savant qu’il se revendique, Drumont s’enorgueillit donc de s’écarter et se « mettre en désaccord avec la science officielle du moment26. »
Le secret et les limites de l’interprétation
Drumont prétend ainsi retrouver les fils cachés de l’Histoire en sondant ses arcanes, et en rendant l’invisible questionnable. L’imaginaire conspiratoire de l’auteur procède, de ce point de vue, d’une forme d’herméneutique du secret, au sens où il entend dévoiler les dimensions masquées et la face obscure des événements afin d’y décrypter le « mal juif ». En ce sens, Drumont, bien douteux Sherlock Holmes, emprunte souvent les codes de la fiction, du feuilleton populaire voire du roman policier qui se développent à l’époque, jouant avec les intrigues et les rebondissements. Si le propre du secret, à en suivre l’étymologie, est de séparer (les initiés des profanes), le discours de Drumont se fait donc volontiers initiatique, dénouant d’improbables énigmes ou divulguant des savoirs supposés mystérieux. À cet égard, il se pose lui-même comme un guide, un entrepreneur de dévoilement : il affirme tout dire en portant sur scène les prétendues coulisses de l’Histoire ou en pénétrant des espaces présumés interdits ou dissimulés, telles les loges maçonniques décrites en lieux de meurtres voire de crimes rituels. De ce point de vue, Drumont puise largement dans la vogue contemporaine du satanisme, du spiritisme et, plus généralement, des sciences occultes qu’illustrent notamment les romans de Péladan ou de Huysmans : en cette époque marquée par l’esprit du positivisme, on assiste à un réveil du mysticisme qui prend lui-même des allures pseudo-scientifiques.
24. Angenot M., La parole pamphlétaire – Typologie des discours modernes, Paris, Payot, coll. « Langages et sociétés », 1995.
25. Danblon E., La fonction persuasive : anthropologie du discours rhétorique, origines et actualité, Paris, Armand Colin, coll. « U – Philosophie », 2005, p. 53.
26. Drumont E., La France juive, t. 1, op. cit., p. 80.
Pensée du complot et imaginaire judéophobe chez E. Drumont 203
Les ouvrages de Drumont comportent, dans cette veine, de nombreuses formules de type incantatoire, généralement en latin, renforçant l’aspect ésotérique de son imaginaire conspiratoire :
« Ce qui est certain, ce qui est constaté par tous les témoignages, ce qui ressort à chaque ligne des pièces du procès publiées par Michelet, dans les Documents inédits de l’histoire de France, c’est qu’au moment de la suppression de l’ordre, l’outrage au crucifix faisait partie des cérémonies de l’initiation. Les chevaliers cra-chaient trois fois sur le crucifix en le reniant : ter abnegabant et horribili crudelitate ter in faciem spuebant ejus. Le frère Guillermy fut obligé pour son initiation de renier et de cracher trois fois sur la croix en signe de mépris pour Notre Seigneur Jésus-Christ qui a souffert sur cette croix : Despiciendo Dominum Jhesum Christum qui passus fuit in ea27. »
Dans le même esprit, Drumont fait de nombreuses références à la « kabale ». Il évoque, par exemple, « cette étrange figure de Nostradamus » qui « était, d’ailleurs, d’une tribu dans laquelle s’est longtemps perpétué le don de prophétie » : « au courant du travail mystérieux auquel se livrent les siens, il prédit, avec une précision qui étonne aujourd’hui, les terribles événements qui s’accompliront à la fin du xviiie siècle et qui feront sortir Israël de sa tombe28. » On voit bien ici que l’attitude de Drumont à l’égard de ce qu’il est censé révéler est assez ambigüe puisqu’il cultive lui-même ce goût du secret et du souterrain qu’il prétend dénoncer ; sa répulsion se mêle de fascination pour ces pratiques mystérieuses qu’il déclare mettre en lumière. Par leur mécanisme, les pamphlets de Drumont pourraient être ainsi rapprochés des romans de Sade : les uns comme les autres semblent, à leur manière, satisfaire un plaisir d’ordre sexuel, assouvir des pulsions libidinales. Ils jouent, en effet, des émotions contradictoires qu’ils suscitent : l’indigna-tion ou le dégoût d’un côté, la jouissance du voyeurisme de l’autre. Le public se retrouve, en effet, placé dans une position de « voyeur » qui entend et qui voit ce qu’il était censé ignorer… ou ce qu’il « sait » en réalité déjà trop bien. Car ce discours qui prétend dévoiler une réalité cachée s’alimente surtout de représentations stéréotypées et fantas-magoriques, de ragots, de « on-dit », comme le reconnaît Drumont
27. Ibid., p. 86.28. Ibid., p. 96.
204 Cédric Passard
lui-même. « S’il dit ce que personne ne veut entendre, il pense dire aussi ce que tout le monde sait29. » En somme, le secret, c’est qu’il n’y a pas de secret : la réalité est dans ce que l’on raconte tout bas et que Drumont ose dire tout haut. L’enjeu du secret ne réside donc pas dans l’information mais dans sa mise en scène et l’exploitation de ses formes30. Pour le dire autrement, le secret supposé importe moins par ce qu’il renferme que par le simple fait qu’il existe et ce que cela signifie, à savoir que l’on nous cache des choses, que le monde est un monde tronqué où le mensonge se dit vérité, où le faux a pris la place du vrai, où les apparences sont prises pour la réalité, le vice pour la vertu. Le schème du secret ne fonctionne donc que parce qu’il s’inscrit dans une trame fictionnelle et un dispositif de dramatisation. En somme, les agissements qu’évoque Drumont ne doivent leur attrait qu’au fait qu’ils sont présentés comme étant dissimulés, ce qu’avait bien remarqué Georg Simmel31 en notant qu’on accorde, psychologiquement, toujours plus d’intérêt à un fait secret, quelle que soit sa portée intrinsèque, qu’à la réalité. Cela explique sans doute que même les détails a priori les plus insignifiants puissent devenir signifiants, essentiels pour Drumont. Mieux, tout fait caché, ou considéré tel, devient finalement significatif aux yeux de l’auteur, rien de ce qui apparaît dissimulé n’est, en réalité, anodin selon lui : pour lui, le diable gît dans les détails. « J’estime que des faits minuscules sont aussi intéressants pour l’étude d’une époque que des faits importants32 » répète-t-il à loisir. Le logos de Drumont repose, comme l’a très justement noté Marc Angenot, sur une argu-mentation « en spirale » par laquelle il s’agit de « faire sentir qu’un diagnostic unique rend raison de tout et chacun des aspects de la vie sociale, que le grand est dans le petit, la totalité de l’imposture dans la plus banale anecdote, pour qui sait y voir33. » Drumont, tout historien qu’il prétend être, n’est donc pas gêné de reprendre à son compte des
29. Angenot M., Ce que l’on dit des juifs en 1889 – Antisémitisme et discours social, Saint-Denis, Presses Universitaires de Vincennes, coll. « Culture et Société », 1989, p. 25.
30. Voir, sur ce point, l’analyse d’Alain Brossat : « Prestige de la puissance occulte. Les protocoles des Sages de Sion comme exemple et modèle », dans T. Wuillème (dir.), Autour des Secrets, Paris, L’Harmattan, coll. « Le Forum-IRTS de Lorraine », 2005, p. 111-117.
31. Simmel G., Secret et sociétés secrètes, trad. S. Muller, Postface de P. Watier, Strasbourg, Circé, 1998.
32. Drumont E., La France juive, t. 1, op. cit., p. 196.33. Angenot M., Ce que l’on dit des Juifs, op. cit., p. 25.
Pensée du complot et imaginaire judéophobe chez E. Drumont 205
rumeurs, des anecdotes ou des témoignages invérifiables, car ils ont, pour lui, force d’argument :
« Tous les témoignages […], tous les documents authentiques, en un mot, sur lesquels s’est basée jusqu’ici la certitude en histoire, n’ont plus aucune valeur aujourd’hui quand ils déplaisent aux Juifs. Pour moi, j’ai infiniment plus de confiance dans le récit d’un ancêtre, qui me raconte ce qui s’est passé de son temps, que dans les dénégations d’un Darmesteter ou d’un Weil, fût-il membre de l’Académie des Inscriptions34. »
La vérité jouit chez Drumont de ce statut paradoxal que Marc Angenot a repéré dans La parole pamphlétaire : bien que dissimulée, elle s’impose par l’évidence, mais n’est pas démontrable rationnellement ; il faut la croire pour la voir. Le judéophobe, comme tout pamphlétaire, se présente ainsi comme un éveilleur des consciences, un révélateur, un guide, il se sent investi d’une mission, d’un devoir de parole et prend des allures messianiques :
« Ai-je rédigé notre testament ? Ai-je préparé notre renaissance ? Je l’ignore. J’ai accompli mon devoir, en tout cas, en répondant par des insultes aux insultes sans nombre que la presse juive prodigue aux Chrétiens. En proclamant la Vérité, j’ai obéi à l’appel impé-rieux de ma conscience, liberavi animam meam…35. »
En endossant ainsi la posture du prophète voire du Sauveur, Drumont n’en appelle pas aux facultés de raisonnement du lecteur, mais à son « bon sens », sa conviction intime, son for intérieur, et convoque cette évidence contre laquelle il est si difficile de lutter. Il s’adresse donc souvent directement à son auditoire sur le ton de la confidence et l’ex-horte à regarder la réalité en face :
« “Apprenez à lire les journaux, échappez par l’effort de la réflexion libre à la manipulation, à la trituration que le Juif opère sur vos cervelles !’’ Tel est le conseil que nous ne cesserons jamais d’adres-ser aux Français. […] l’effort que nous demandons est plus difficile qu’on ne le croit. On ne résiste pas à la parole constamment répétée
34. Drumont E., La France juive, t. 1, op. cit., p. 80.35. Ibid., t. 2, p. 302.
206 Cédric Passard
par le journal. […] Il en est de tout ainsi. Vous ne voyez que des apparences de choses et des caricatures d’hommes. Vous subissez sans comprendre36. »
Si Drumont avoue ne pas pouvoir donner des preuves tangibles du complot, puisque celles-ci sont, par définition, effacées par l’imposture triomphante, il prend fréquemment le lecteur à témoin, l’interpelle et sollicite son interprétation, et par là sa connivence. Ainsi explique-t-il : « il est bien entendu qu’un livre comme celui-ci est fait de moitié avec des lecteurs qui comprennent à demi-mot ; c’est une étude en commun. Chacun, dans le cercle spécial où il se meut, contrôle l’exactitude de ce que j’avance et constate combien j’ai raison37. » De fait, Drumont compense les défaillances de son logos, de son raisonnement abductif par une suraffirmation de son ethos et une exacerbation du pathos. Ou pour le dire autrement, le pathos vient masquer, chez lui, la contradic-tion entre logos et ethos. Il s’agit de mobiliser la complicité du lecteur en prétendant recourir à sa propre sagacité, tout en flattant, en réalité, ses plus bas instincts, son ressentiment et en composant un « Nous » qui s’oppose à « Eux » :
« Qu’en dites-vous, mes camarades, vous qui, après des examens difficiles, voyez votre jeunesse s’écouler avant d’arriver à un emploi qui vous permettre de vivre ; surnuméraire, expéditionnaire, commis rédacteur, voilà vos étapes ; tous les trois ans vous avez une petite augmentation, 1800, 2100, 2400, parfois une petite gra-tification de cent francs au 31 décembre quand les chefs n’ont pas jugé à propos de la confisquer pour augmenter leurs gros traite-ments. […] À vingt-cinq ans le descendant des Juifs allemands est sous-préfet […], il représente le gouvernement de la République. Vous croyez qu’on se permettra seulement de le blâmer quand il a causé par sa lâcheté, s’il ne l’a pas provoqué volontairement, un effroyable massacre ? On lui donne de l’avancement et on l’appelle à Paris où il pourra s’amuser tout à son aise ! Pensez-vous que je sois un énergumène comme l’affirment les beaux seigneurs du parti conservateur qui se sont faits les défenseurs de M. de Rothschild lorsque je dis que les Juifs sont nos maîtres ? […] Faut-il que les chrétiens soient veules, avachis, privés de tout
36. Drumont E., Le testament d’un antisémite, Paris, E. Dentu éditeur, 1891, p. 92.37. Drumont E., La fin d’un monde, op. cit., p. xxviii.
Pensée du complot et imaginaire judéophobe chez E. Drumont 207
ressort pour supporter un joug aussi ignominieux, pour admettre cette déchéance, cette mise hors la loi qui les frappe38 ? »
Bien qu’il se réclame de la science, le raisonnement de Drumont n’est donc pas fondé sur une démonstration empirique, mais sur une rhéto-rique de l’évidence. Celle-ci repose sur la base d’une doxa qui érige nécessairement tout Juif en coupable. À la façon des proverbes39 ou des « lieux du sublime » repérés par Francis Goyet40, le stéréotype antijuif se présente ici comme un contenu épistémique non soumis au principe d’argumentabilité et donc non discutable.
II. La preuve par l’imaginaire
La propension au complot est ainsi inscrite dans la nature profonde du Juif, dans sa « race » : « le Sémite est mercantile, cupide, intrigant, subtil, rusé41. » L’utilisation du singulier indique bien toute l’entreprise de substantialisation haineuse à laquelle procède Drumont et qu’il justifie de la sorte : « Tandis que la race aryenne comporte une variété infinie d’organisations et de tempéraments, le Juif, lui, ressemble tou-jours à un autre Juif42. » Comme le note Pierre-André Taguieff, à la suite des travaux fondateurs de Poliakov43, « la théorie du complot, qui postule que la manipulation mène l’Histoire, fonctionne de concert avec la diabolisation44. » La pensée conspiratoire de Drumont n’échappe pas à cette règle et repose sur un véritable travail de cristallisation
38. Drumont E., Le Secret de Fourmies, Paris, Albert Savine éditeur, 1892, p. 103-104.
39. Danblon E., Rhétorique et rationalité – Essai sur l’émergence de la critique et de la persuasion, Bruxelles, Éd. de l’Université de Bruxelles, coll. « Philosophie et société », 2002, p. 51-54.
40. Goyet Fr., Le sublime du « lieu commun ». L’invention de la rhétorique dans l’Antiquité et à la Renaissance, Paris, Honoré Champion, coll. « Bibliothèque litté-raire de la Renaissance », 2000.
41. Drumont E., La France juive, t. 1, op. cit., p 13.42. Ibid., p. 20.43. Poliakov L., La causalité diabolique, Préface de P.-A. Taguieff, Paris, Cal-
mann-Lévy et Mémorial de la Shoah, 2006 [édition en un seul volume des deux tomes : t. 1, Essai sur l’origine des persécutions, Paris, Calmann-Lévy, coll. « Liberté de l’esprit », 1980 et t. 2, Du joug mongol à la victoire de Lénine, Paris, Calmann-Lévy, coll. « Liberté de l’esprit », 1985].
44. Taguieff P.-A., La Foire aux « Illuminés », op. cit., p. 127-128.
208 Cédric Passard
démonologique de l’ennemi qui réactive toute une imagerie populaire judéophobe tenant lieu d’argumentation, suivant le mécanisme bien décrit par René Girard à propos du bouc-émissaire : « Les persécuteurs finissent toujours par se convaincre qu’un petit nombre d’individus ou même un seul peut se rendre extrêmement nuisibles à la société toute entière, en dépit de sa faiblesse relative. C’est l’accusation stéréotypée qui autorise et facilite cette croyance en jouant de toute évidence un rôle médiateur. Elle sert de pont entre la petitesse de l’individu et l’énormité du corps social45. »
Un imaginaire de l’Un et du Multiple
Comme toute théorie du complot, la pensée de Drumont suppose que le mal ne soit pas perçu comme un simple accident ou comme le fruit d’un individu isolé. Elle tend ainsi à présenter une lecture monocausale des événements et de l’Histoire en attribuant l’origine de tous les malheurs à un groupe unique, identifiable, ce qui implique d’opérer un passage entre le cas singulier (tel qu’on le trouve dans le fait divers, l’anecdote… dont Drumont est d’ailleurs très friand) et des significations plus larges. Cette opération de dé-singularisation revient à rattacher tout événement à un ordre ou, plus exactement, à un désordre d’ensemble. De ce point de vue, il faut souligner un nouveau paradoxe de la représentation de cette immense machination. D’un côté, les protagonistes de ces complots constituent un monde séparé, caché, invisible, d’autant plus menaçant qu’il semble à la fois partout et nulle part. Mais, d’un autre côté, on retrouve toujours, au cœur de cet onirique conspiratoire et, au delà des variantes narratives, une même figure qui tire toutes les ficelles : en l’occurrence, le Juif. La construction mytho-logique de l’Ennemi est ainsi traversée, chez Drumont, par une tension, une dialectique de l’Un et du Multiple qui confère à celui-ci un aspect plastique ou protéiforme, accentuant son omniprésence ou sa toute puissance : « sous des formes diverses et des déguisements différents, le Juif est en réalité partout46. »
En particulier, la technique de l’amalgame permet de subsumer, sous ce même visage, des figures diverses, renforçant, par là même, la vision
45. Girard R., Le Bouc émissaire, Paris, Grasset, 1982, p. 37.46. Drumont E., La France juive, t. 1, op. cit., p. 32.
Pensée du complot et imaginaire judéophobe chez E. Drumont 209
manichéenne qui sous-tend tout le discours de l’auteur47. Le complot « judéo-maçonnique » en est un exemple devenu presque trivial : « les Juifs […], reliés entre eux par la Maçonnerie, s’installent dans tous les comités, mènent le corps électoral et créent cette opinion artificielle que l’on prend pour l’opinion véritable » affirme ainsi Drumont48. Par ce procédé, le monde est réduit à la dichotomie ami-ennemi49. Cette règle de l’ennemi unique participe, en effet, d’une mise en ordre imaginaire du monde qui permet de signifier qui est qui et donc de stabiliser des identités, en renvoyant à du déjà haï, à du déjà ennemi. Drumont évoque ainsi les « judaïsants », ces « affiliés au système juif et plus âpres encore et moins scrupuleux, s’il est possible, que les Juifs50. » De fait, toute complexité est refusée : il n’y a pas de place à l’idée que les adver-saires puissent être divisés ou encore moins opposés. On saisit bien, dès lors, la centralité prise par la figure du traître dans cette construction : elle permet de confondre en un ennemi unique l’ennemi extérieur et l’ennemi intérieur qui incarnent deux modalités de l’Anti-France51 :
« Sous toutes les formes, le Juif ainsi servit Bismarck. […] « On nous fait remarquer, disait le journal le Nord, à la date du 19 août 1870, que la plupart des espions prussiens pris en Alsace sont Juifs. Cet ignoble métier ne saurait être mieux exercé que par les enfants de cette race dégradée qui a eu cette exécrable fortune de produire en Judas le type le plus achevé de la perfidie et de la trahison. » […] Quelquefois lorsqu’il est pris le Juif est fusillé, mais cela arrive bien rarement. D’abord, à cause de cette inexplica-ble passion qu’il nourrit pour sa triste personne, il prend toutes ses précautions et ne se hasarde qu’à bon escient. Ensuite, si malgré toutes ses ruses, il tombe dans un piège, il en est quitte pour opérer plus en grand. Il trahit les Allemands comme il espionne les
47. Ce que J.-M. Domenach a nommé « la règle de l’ennemi unique », et dont il fait la norme constitutive du discours polémique. Domenach J.-M., La propagande politique, Paris, PUF, 1950, p. 49-53. Voir aussi Angenot M., La parole pamphlé-taire, op. cit., p. 126 et suivantes.
48. Drumont E., La France juive, t. 1, op. cit., p. 55.49. Schmitt C., La notion de politique – Théorie du partisan, Paris, Flamma-
rion, coll. « Champs », 1999.50. Drumont E., La France juive devant l’opinion, Paris, Marpon et Flamma-
rion, 1886, p. 33.51. Girardet R., Mythes et mythologies politiques, Paris, Éd. du Seuil, coll.
« L’Univers historique », 1986, p. 43 ; Angenot M., La parole pamphlétaire, op. cit., p. 107-108.
210 Cédric Passard
Français ; à l’avenir il tiendra les renseignements en partie double et le métier n’en sera que plus lucratif52. »
La trahison hante l’imaginaire conspiratoire car le traître est, par défi-nition, dans le double jeu, la duplicité, il trompe la confiance. Plus encore, il constitue une menace d’éclatement pour la patrie et s’avère mortifère pour l’ordre social comme le remarquait Frédéric Bon : « la trahison atteint la société dans son principe même : la loyauté qui permet la coopération entre les hommes […]. Son effet est la dissolution du pacte social ; son horizon le retour à l’animalité53. » En ce sens, la trahison est, pour Frédéric Bon, « l’acte le plus méprisable qui puisse exister », « l’acte le plus subversif qui puisse être conçu » et ne peut donc être qu’une œuvre maléfique, le résultat de l’infiltration dans la société d’éléments extérieurs. Drumont émet toutefois une nuance. Il affirme que les Juifs n’ont pas conscience de trahir, « ils ne trahissent pas une patrie qu’ils n’ont pas54. » La figure du traître, incarnée par le Juif, tend paradoxalement à se confondre, chez Drumont, avec celle de l’apatride, ce qui est significatif dans la mesure où cela laisse penser que, dans l’esprit de Drumont, le traître en tant que tel ne peut vraiment exister. La menace n’en reste pas moins inquiétante : c’est « celle du voyageur sans nom qui porte avec lui la maladie ou l’épidémie, dont l’arrivée fait pourrir les moissons et périr le bétail. Celle de l’intrus qui s’introduit dans les foyers prospères pour y apporter le trouble et la ruine55. » Cette isotopie du Juif errant, qui véhicule l’image du virus prédateur, évoque les angoisses de cette France de la fin du xixe siècle obsédée par la question du vagabondage56.
Un imaginaire de l’angoisse
De fait, l’imaginaire conspiratoire de Drumont joue clairement le registre de la peur en puisant notamment dans un répertoire de stéréo-types déjà constitués qu’il parvient à synthétiser mais aussi à actualiser. Drumont évoque ainsi les vieilles fables de Juifs égorgeurs d’enfants
52. Drumont E., La France juive, t. 1, op. cit., p. 186.53. Bon F., « L’essence de la trahison », Silex, n° 26, 1984, p. 25.54. Drumont E., La France juive, t. 1, op. cit., p. 40.55. Girardet R., Mythes et mythologies politiques, op. cit., p. 43.56. Hacking I., Les fous voyageurs, Paris, Éd. du Seuil, coll. « Les Empêcheurs
de tourner en rond », 2002.
Pensée du complot et imaginaire judéophobe chez E. Drumont 211
ou persécuteurs des catholiques, convoque des créatures maléfiques et fascinantes héritées des démonolâtries médiévales57 :
« Nous pénétrons dans l’antre de l’alchimiste se livrant à d’étranges mixtures, demandant du sang pour ses opérations à ceux qui s’adres-sent à lui sous prétexte de découvrir la pierre philosophale, l’anima mundi et, en réalité, pour accomplir un rite monstrueux, écho des abominables mystères d’Astoret. Ce qu’on adore dans le ghetto, ce n’est pas le dieu de Moïse, c’est l’affreux Moloch phénicien auquel il faut, comme victimes humaines, des enfants et des vierges58. »
Drumont prête ainsi aux Juifs des pouvoirs surnaturels, maléfiques qui résonnent avec des représentations fantasmatiques anciennes, mais qui s’accordent aussi avec l’air du temps : en ces années 1880, l’hypnose est en vogue et Drumont fait référence au célèbre professeur Charcot qui connaît, à l’époque, une large réputation. On s’intéresse alors beaucoup au rôle des magnétiseurs, ces théories en venant même à contaminer les sciences sociales : un Tarde, par exemple, fait de la « magnétisation mutuelle » un élément central de sa théorie sociologi-que. Comme le note Marc Angenot, « ce thème de la suggestion permet de transfigurer l’argument de la Conspiration juive en un singulier processus neurologique59 » :
« Avec les Juifs, il faut s’attendre à tout. […] Ces gens-là, d’ailleurs, ont, quand ils le veulent, une puissance d’enveloppement, d’ensor-cellement particulier ; ce sont des sorciers, des magnétiseurs. Regardez-les opérer, ils fascinent peu à peu la victime qu’ils ont choisie comme le serpent fascine l’oiseau. J’ai vu des malheureux que les Juifs ont dépouillés, mis tout nus comme des petites saint Jean ; ils venaient me raconter leurs infortunes. Il y avait toujours dans l’influence qu’ils avaient subie quelque chose qui ne s’expli-quait pas – « Comment vous, un homme raisonnable, connaissant la vie, ayant gagné un petit pécule par votre intelligence et par votre travail, avez-vous pu vous laisser rouler comme cela ? – Je ne comprends pas, monsieur ; quand j’ai vu cet homme entrer chez
57. Cohn N., Démonolâtrie et sorcellerie au Moyen âge : fantasmes et réalités, trad. S. Laroche et M. Angeno, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque historique », 1982.
58. Drumont E., La France juive, t. 2, op. cit., p. 216.59. Angenot M., Ce que l’on dit des Juifs en 1889, op. cit., p. 39.
212 Cédric Passard
moi, j’ai deviné que le malheur entrait derrière lui, je me suis senti perdu… et j’ai fait tout ce qu’il a voulu60. »
On observe ainsi, dans la rhétorique de Drumont, un contraste saisissant entre l’ethos rationaliste ou scientiste dont se réclame le judéophobe, et la figure du Juif telle qu’il la dessine et qui est toujours rapportée à une forme d’irrationalité, de pensée magique, de sorcellerie. Le récit conspiratoire que Drumont compose s’insère ainsi dans une vérita-ble construction mythologique cohérente associant, dans une même constellation61, des images, des références ou des thèmes récurrents qui s’ordonnent autour d’une antithèse fondamentale opposant l’obscurité à la lumière. Il recourt, de la sorte, à un tout bestiaire inhérent à ce que Raoul Girardet nomme « l’empire des ténèbres ». Ce bestiaire du complot est composé de ce que Gilbert Durand appelle des symboles « thériomorphes » qui évoquent les bêtes sauvages voire les monstres et éveillent ainsi les grandes peurs ancestrales et enfantines de l’homme liées à la décomposition de son corps. Mais ce sont surtout les symboles « nyctomorphes » qui ont la faveur de Drumont, tels que les chauves-souris, les serpents ou les vipères. Ils rassemblent « tout ce qui rampe, s’infiltre, se tapit, […], tout ce qui est ondoyant et visqueux, tout ce qui peut porter la souillure et l’infection62. » Cette tératologie renvoie toujours, en effet, à des malpropretés, à de l’impur, comme en atteste la mobilisation du champ lexical de la souillure et de la puanteur qui résonne avec les inquiétudes hygiénistes de l’époque, les craintes de la contamination et le délire olfactif liés à la révolution pasteurienne63 :
« Le Juif [...] sent mauvais. Chez les plus huppés, il y a une odeur, fetor judaïca, un relent, dirait Zola, qui indique la race et qui les aide à se reconnaître entre eux. La femme la plus charmante, par les parfums mêmes dont elle se couvre, justifie le mot de Martial : qui ben olet mal olet. Le fait a été cent fois constaté. « Tout juif pue » a dit Victor Hugo qui s’est éteint entouré de Juifs64. »
60. Drumont E., Le secret de Fourmies, op. cit., p. 75-77.61. Selon l’expression de Gilbert Durand (Les structures anthropologiques de
l’imaginaire, Paris, Dunod, coll. « Psycho Sup », 1993).62. Girardet R., Mythes et mythologies politiques, op. cit., p 43.63. Corbin A., Le miasme et la jonquille, Paris, Aubier, 1981.64. Drumont E., La France juive, t. 1, op. cit., p. 57.
Pensée du complot et imaginaire judéophobe chez E. Drumont 213
Ce bestiaire s’associe donc au registre médical que mobilise également Drumont et qui participe de sa prétention scientifique. Les caractéristi-ques physionomiques, physiologiques et psychologiques prétendues du Juif sont ainsi utilisées pour témoigner de ses vices :
« Absolument différent du chrétien dans son évolution comme race et comme individu, le Juif est dans des conditions toutes différen-tes aussi sous le rapport sanitaire. Il est sujet à toutes les maladies qu’indique la corruption du sang : les scrofules, le scorbut, la gale, le flux. […] La névrose, telle est l’implacable maladie des Juifs. Chez ce peuple longtemps persécuté, vivant toujours au milieu de transes perpétuelles et d’incessants complots, secoué ensuite par la fièvre de la spéculation, n’exerçant guère, en outre, que des profes-sions où l’activité cérébrale est seule en jeu, le système nerveux a fini par s’altérer. Cette névrose, le Juif a fini, chose étrange, par la communiquer à toute notre génération65. »
Cette biologisation et cette animalisation du Juif l’installent dans une altérité irréductible et participent d’une entreprise d’essentialisation et de déshumanisation de l’Ennemi, typique des langages meurtriers66. Elle permet, en effet, de le présenter comme un être, par nature, inassi-milable et maléfique, repoussant tout compromis :
« Il y a intolérance dans le sens que la science prête à ce terme lorsqu’elle dit : « le sujet ne peut tolérer telle substance. » La France ne peut tolérer le Juif, elle […] en sera très malade si elle n’en meurt pas67. »
La décadence physique et morale de la société dont Drumont se fait le peintre signale ainsi, pour lui, l’action et le poids croissant du Juif dans celle-ci. La mythologie complotiste de Drumont emprunte des accents eschatologiques, exploitant l’angoisse de la « fin d’un monde » pour reprendre le titre d’un de ses pamphlets. Elle charrie donc toute une imagerie de la Chute et de la dégénération, qui manipule, encore une fois, des fantasmes séculaires, mais qui s’accorde aussi avec l’esprit du
65. Drumont E., La France juive, t. 1, op. cit., p. 56.66. Faye J.-P., Le langage meurtrier, Paris, Hermann, 1996 ; Klemperer V., LTI,
la langue du IIIe Reich, Paris, Albin Michel, 1996 [1947].67. Drumont E., La France juive, t. 1, op. cit., p. 93.
214 Cédric Passard
temps très fin de siècle marqué par une atmosphère générale de malaise et de pessimisme, un climat social et psychologique chargé d’angoisse et d’incertitude. Ce contemptus mundi s’associe, en effet, à la nostalgie d’un âge d’or : le présent est abject parce qu’il est vu comme la dégra-dation d’un paradis perdu sous l’effet de la modernité. Drumont alterne ainsi les descriptions bucoliques d’une France qui disparaît avec les descriptions sordides d’une société décadente. Cette pastorale de la peur recourt souvent, de ce point de vue, aux procédés du romanesque ou du naturalisme dans ses aspects les plus morbides68, comme l’illustre le portrait suivant d’une jeune ouvrière lors de la fusillade de Fourmies der-rière laquelle Drumont voit, comme à l’accoutumée, l’œuvre des Juifs :
« L’enfant du peuple avait commencé sa journée par le travail aux premiers rayons du soleil, et le soleil n’était pas encore couché qu’elle tombait sous les balles d’enfants du peuple comme elle… Elle fut littéralement scalpée ; elle eut tout le haut du crâne emporté, le curé Margerin ramassa sa cervelle éparse sur le pavé, mais on n’a jamais pu retrouver la magnifique chevelure blonde dont elle était si fière. La légende prétend que cette chevelure a été dérobée et vendue ; elle aura probablement été orner la tête chauve de quelque vieille baronne juive, et quelque gentilhomme décavé jouant la comédie de l’amour près de la femme pour se faire prêter de l’argent par le mari, a peut-être couvert de baisers, dans quelque boudoir du quartier Monceau, les blondes dépouilles de l’ouvrière assassinée69. »
Comme la citation précédente en témoigne, la narration joue un rôle crucial dans la démarche de Drumont, elle tient lieu d’argumentation. À cette époque où les sciences sociales sont encore balbutiantes et où une partie de la littérature affirme une ambition sociologique, Drumont utilise ainsi les ressorts du roman social et s’en revendique :
« Mon livre se rattache à tous les travaux tentés sous des formes différentes, par les psychologues et les romanciers, par les critiques et les chroniqueurs au jour le jour, par les Daudet, les Gongourt, les Zola, les Bourget, les Clarétie, les Platel, les Scholl, les Maupassant,
68. Rouault Th., Les mécanismes de la haine antisémite et antimaçonnique chez Drumont et ses héritiers, Thèse de doctorat en Lettres et Sciences humaines, Université de Paris VII, 2007, t. 1, p. 70-72.
69. Drumont E., Le Secret de Fourmies, op. cit., p. 33-34.
Pensée du complot et imaginaire judéophobe chez E. Drumont 215
les Uzanne, les Bonnières, les Fournel, pour peindre le monde qui change en quelque manière à vue d’œil. Chacun a le pressentiment d’un immense écroulement et s’efforce de fixer un trait de ce qui a été, se hâte de noter ce qui demain ne sera plus qu’un souvenir. Ce qu’on ne dit pas, c’est la part qu’a l’envahissement de l’élément juif, dans la douloureuse agonie d’une si généreuse nation, c’est le rôle qu’a joué, dans la destruction de la France, l’introduction d’un corps étranger dans un organisme resté sain jusque-là70. »
Conclusion
Crypto-sociologue ou pseudo-romancier, le judéophobe se veut l’observateur et le peintre d’une société en mutation, tout en se posant en gardien éructant d’un ordre moral et politique dont il souffre de voir les repères traditionnels se déliter. Cette rhétorique drumontienne de la conspiration est, en effet, à replacer dans un contexte de grande trans-formation que Karl Popper a qualifié de fin de la société close71. Au déterminisme de cette dernière, s’est substituée, avec l’avènement de nouvelles structures sociales liées à l’industrialisation et à la modernisa-tion, une indétermination du devenir historique et de l’avenir individuel. De ce point de vue, ce n’est pas un hasard si cette période apparaît comme l’Âge d’Or de la Conjuration, comme l’écrit Raoul Girardet, car l’imaginaire du complot a sans doute été un moyen de rendre intel-ligible les changements subis, de recréer une forme de déterminisme en personnifiant « le mal ». Le Juif, chez Drumont, synthétise, en somme, toutes les tares de la société ouverte72. Ainsi, bien qu’elle joue sur les peurs, cette pensée du complot remplit aussi, sans doute, une fonction de réassurance en constituant un moyen résilient de faire face au senti-ment de menace et d’incompréhension porté par ces bouleversements qu’elle rapporte tous à une cause unique, à la fois élémentaire et toute puissante : « elle en fait un tout qui a réponse à tout73 ».
70. Drumont E., La France juive, t. 1, op. cit., p. 8.71. Popper K. R., La société ouverte et ses ennemis, op. cit.72. Voir notamment sur ce point : Compagnon A., « Antisémitisme ou antimo-
dernisme, de Renan à Bloy », dans Les antimodernes de Joseph de Maistre à Roland Barthes, Paris, Gallimard, coll. « Nrf – Bibliothèque des idées », 2005.
73. Winock M., « Édouard Drumont et la France juive », dans Nationalisme, anti-sémitisme et fascisme en France, Éd. du Seuil, coll. « Points – Histoire », 2004, p. 129.
216 Cédric Passard
À travers le « mégacomplot » juif, Drumont explique pêle-mêle la crise économique, la corruption du régime, la misère ouvrière, le déclin des traditions et la dégénérescence de la France. Une même force mal-faisante permet de rendre compte de tous les phénomènes associés à la modernité, qu’il s’agisse des méfaits de l’argent, de la pornographie, de l’apparition de la publicité, de l’effondrement des anciennes solidarités ou du déclin de la foi religieuse. Cela éclaire peut-être la puissance de cette pensée primitive qui présente une capacité étonnante de résistance et de renouvellement, une aptitude surprenante à conjuguer des struc-tures anthropologiques de l’imaginaire avec un certain esprit du temps, à n’être donc ni jamais tout à fait la même ni tout à fait une autre.
Pensée du complot et imaginaire judéophobe chez E. Drumont 217
L’irrésistible rhétorique de la conspiration :
le cas de l’imposture de la Lune
Thierry Herman
Parmi les hypothèses conspirationnistes, certaines sont plus inoffensives que d’autres. L’idée selon laquelle l’homme n’a jamais posé le pied sur la Lune est de celles-là. L’hypothèse est saugrenue, mais, comme souvent lors des imputations de complots, elle se fonde tant sur des faits que sur des intentions crédibles. Dans le contexte de la guerre froide, l’avantage pris soudain par les Américains sur les Russes, jusqu’alors en avance dans la conquête spatiale, est presque trop incroyable pour être vrai. Du coup, la tentation exprimée, de manière marginale, « de percer les rideaux de fumée1 » sur la question de l’alunissage se fait jour auprès de quelques-uns, relayés par des médias parfois complaisants. Nous voudrions examiner un de ces « documentaires » médiatiques, gauchissant l’histoire au profit d’une forme de légende où se confondent enjeux idéologiques, fantasmes et questions. Le documentaire présenté en version française sous le titre Théorie de la Conspiration : avons-nous été sur la Lune ? diffusé une première fois aux États-Unis en 2001, a été versé au dossier de la conspiration lors de l’anniversaire de l’alunissage en 2009 avec des effets dévastateurs. Alors que la NASA avait, dans un premier temps, cherché à publier un livre démentant point par point toutes les allégations portées contre elle dans la vidéo, l’agence spatiale a finalement renoncé à cette idée y voyant le risque d’offrir une plus forte audience aux tenants de la thèse du complot2. L’analyse dudit documentaire vise à décrire l’efficacité rhétorique indéniable du film, mais aussi à souligner son caractère irrésistible. Nous défendrons l’idée selon laquelle toute démarche critique, toute pesée des arguments ou
1. Angenot M., Dialogues de sourds. Traité de rhétorique antilogique, Paris, Éd. des Mille et Une Nuits, 2008, p. 337.
2. Voir : « Moon landing conspiracy theories » sur la version anglaise de Wikipedia.
des intérêts, est rendue difficile par le flux du documentaire fondé, tout entier, sur une rhétorique de l’évidence.
Il y a peu de chances que l’affirmation selon laquelle « l’homme n’a jamais fait le grand bond pour l’humanité » puisse être convaincante de prime abord. L’ensemble du monde scientifique, les historiens et les médias considèrent le fait comme une évidence largement étayée par les images de la NASA ainsi que par de nombreux témoignages crédibles. Le « filtre cognitif3 » propre à chacun devrait donc, vraisemblablement, écarter l’hypothèse conspirationniste d’emblée. Pourtant, l’efficacité persuasive du documentaire télévisuel est telle – selon divers témoignages – qu’elle paraît déjouer le bénéfice du filtre cognitif ; l’hypothèse farfelue gagne en consistance au point de se faire peu à peu révélation. Notre angle rhétorique d’observation mettra en lumière les effets d’évidence du documentaire, effets qui invitent le téléspectateur à renoncer à son cadre préalable de représentation pour entrer dans une « logique » de l’indice et du soupçon.
L’hypothèse d’un canular de l’alunissage présuppose deux opérations mentales : d’une part, accepter de se projeter dans un monde possible (« et si c’était vrai ? »), d’autre part ne pas refuser l’application du principe de charité4 à l’égard de celui qui argumente en ce sens. Pour autant que l’énonciateur donne des preuves apparemment rationnelles, les croyances défendues, même apparemment absurdes, doivent bénéficier de ce principe. Comme le souligne Henri Broch : « Plus une allégation sort du cadre des lois connues ou entre en contradiction avec ces dernières, plus les preuves apportées pour soutenir cette allégation doivent être fortes5 ». On ne conçoit pas a priori l’orateur qui doit s’exprimer devant soi comme irrationnel ; au contraire, on applique à son encontre un postulat de rationalité auquel répond une
3. Par filtre cognitif, F. Clément entend un processus de tri rapide de l’information (et non de vérification systématique impossible) qui fonctionnerait en s’appuyant sur deux informations : le contexte dans lequel l’information est produite et le « scan-nage » de cette information par rapport à des représentations déjà tenues pour vraies. Voir sur cette question : Clément F., Les mécanismes de la crédulité, Genève, Droz, coll. « Travaux de sciences sociales », 2006.
4. F. Clément, en se fondant sur Davidson, définit ce principe comme une « maxi-misation de l’accord entre les croyances de l’interprète et celles de l’interprété », ibid., p. 33.
5. Broch H., Comment déjouer les pièges de l’information, s. l, book-e-book, 2008.
attente spécifique, celle d’un apport de preuves congruentes à la thèse qu’il entend défendre. Cela ouvre une brèche dans notre résistance. Cette brèche, nécessaire pour vivre et pour penser, cette garde qui s’abaisse, permet d’accueillir une argumentation qui se présente selon des oripeaux suffisamment vraisemblables pour être crédibles. Et même plus : l’absurdité apparente de l’hypothèse conspirationniste devra jouer « l’exercice solitaire de la raison contre la doxa6 ». Autrement dit, le raisonnement qui va contre la doxa convoque non seulement une habituelle vraisemblance rhétorique, mais aussi une « vérité » apparemment rationnelle, suffisamment évidente pour bousculer ce qu’on croyait acquis :
« Les croyances doxiques ont une tendance à l’inertie. Inertie sociale et individuelle : on ne tient pas à en changer tant qu’on n’y est pas contraint, on y est habitué, on multiplie les réticences devant les démentis et les objections tant qu’on n’est pas mis au pied du mur7. »
Si l’efficacité persuasive du documentaire que nous nous proposons d’analyser est bien celle qui est décrite par différents témoignages8, c’est que sa rhétorique nous met, en quelque sorte, au pied du mur. Nous verrons de quelle manière après la proposition théorique suivante.
I. Séparer le plan cognitif du raisonnement et le plan textuel de l’argumentation
Insistons d’abord sur la séparation conceptuelle entre le raisonnement, qui a ses caractéristiques propres, et la rhétorique. Certaines écoles – la logique informelle par exemple – pourraient avoir tendance à confondre ces deux niveaux. Le raisonnement, dont on trouve plusieurs types – déduction, induction, par analogie, etc. – me paraît, dès lors qu’il est identifiable et extractible du contexte d’argumentation persuasive, plutôt lié à l’éthique de la responsabilité, soumise à la critique et destinée à l’auditoire universel9. La rhétorique est l’usage de ce raisonnement
6. Angenot M., Dialogues de sourds…, op. cit., p. 338.7. Ibid.8. Voir par exemple : http://science.nasa.gov/headlines/y2001/ast23feb_2.htm.9. Nous sommes assez prudents sur ce point. Mais l’hypothèse que pose l’examen
220 Thierry Herman
dans le contexte d’un auditoire particulier et à des fins persuasives et praxéologiques. C’est la thèse d’Emmanuelle Danblon : « il s’agit de mettre en évidence le fait que toute mise en œuvre d’une discussion critique opère toujours à deux niveaux fondamentaux : d’abord au niveau argumentatif des raisonnements, ensuite au niveau rhétorique de la persuasion10 ». Ces deux niveaux ne sont pas dissociables : c’est à travers la rhétorique que je peux avoir accès, de manière critique, à l’étude du raisonnement mis en œuvre.
Cette distinction permet de voir comment les modes de raisonnement bien connus que sont la déduction, l’induction et l’abduction, trouvent leurs correspondances au niveau rhétorique. On le sait, sur le plan du raisonnement, on trouve essentiellement deux modèles logiques que sont la déduction et l’induction. Certaines écoles ajoutent à ce diptyque l’abduction, à la suite des propositions de Charles Sanders Pierce11. Par exemple, Walton considère qu’il existe trois types d’arguments : l’argument déductif, l’argument probable (induction), l’argument plausible (abduction)12.
En fait, cette typologie est problématique dans la mesure où l’on confond argument – que je place sur le plan rhétorique – et raisonne-ment. Or, une des premières caractéristiques des théories du complot – cet ouvrage l’expose à de nombreuses reprises – est de se fonder sur un raisonnement qui est naturellement uniquement plausible. Cela n’empêche pourtant pas de masquer sur le plan rhétorique cette fragi-lité du raisonnement par une certitude exprimée linguistiquement. Le conditionnel que devrait utiliser tout scientifique est facilement substi-tué par un présent de vérité générale.
Considérons dès lors le plan rhétorique en premier lieu. Dans la famille des relations causales au sens large ou relations de justification,
des schèmes argumentatifs nous semble ici féconde (voir notamment : Walton D., Reed C. & Macagno F., Argumentation schemes, Cambridge – New York, Cam-bridge University Press, 2008, p. 27). Plutôt que de parler d’arguments fallacieux a priori, le but est désormais d’analyser le raisonnement mis en œuvre via des schèmes argumentatifs, et de le soumettre à des questions critiques pour voir s’il résiste suffi-samment dans le contexte d’énonciation ou si l’argument se « défait ».
10. Danblon E., Argumenter en démocratie, Bruxelles, Éd. Labor, coll. « Quartier Libre », 2004.
11. Fann K., Peirce’s theory of abduction, La Haye, M. Nijhoff, 1970.12. Walton D., Fundamentals of critical argumentation, Cambridge – New
York, Cambridge University Press, 2006.
L’irrésistible rhétorique de la conspiration 221
je distinguerai quatre catégories qui se répartissent selon les modalités de présentation des prémisses et des conclusions (je reprends ces termes au vocabulaire du raisonnement et non à celui de la rhétorique). Pour être plus clair, on pourrait considérer qu’il existe des prémisses ou des conclusions qui se présentent comme des assertions certaines (C) et d’autres sous une forme probable (P). On ne veut assurément pas dire que les assertions certaines sont vraies, probables ou plausibles – ce qui serait de l’ordre du raisonnement – mais qu’elles se présentent linguis-tiquement comme telles. On peut avoir quatre cas de figure :
1. La cause se présente comme certaine, l’effet aussi : Des restes de plantes médicinales ont été découverts dans une tombe à Kebara (Israël) ; par conséquent, l’homme de Néandertal possédait des notions médicales et de pharmacopée13. Le prototype de cette relation est la déduction rhétorique14, dans laquelle la conclusion est posée comme certaine si les prémisses sont reconnues comme vraies. Il ne s’agit donc pas forcément d’une déduction au sens logique du terme, mais d’une apparence de certitude, et donc de vérité, avec tous les effets d’évidence que cela implique.
2. La cause est incertaine, mais l’effet est certain : on a quelques signes d’un changement climatique qui pourrait être un des facteurs expliquant la disparition de l’homme de Néandertal. Il s’agit ici d’une abduction rhétorique. L’abduction consiste à proposer la meilleure hypothèse explicative pour un événement. Ici, expressément, la cause (quelques signes d’un changement climatique) est posée comme une explication possible (on voit le conditionnel) parmi d’autres en faveur du fait certain : la dispari-tion de l’homme de Néandertal.
3. La cause est certaine, l’effet ne l’est pas : il n’existe pas de char-niers dans les sites archéologiques de l’époque de Néandertal, donc l’hypothèse du génocide par l’homme de Cro-Magnon semble peu probable. Cette manifestation linguistique entre en parenté avec l’induction ; on parlera donc d’induction rhétorique.
13. Ces exemples sont tirés d’un article de vulgarisation sur l’homme de Néander-tal, paru dans la revue Sciences humaines.
14. Nous classerons les différentes figures des relations de cause à effet selon quatre figures « classiques » de la littérature sur l’argumentation. En ajoutant l’adjectif rhétorique, je pointe à la fois une parenté voulue avec le raisonnement correspondant et les particularités linguistiques de l’argumentation telle qu’elle nous est proposée.
222 Thierry Herman
À partir de faits constatés (absence de charniers), on propose une conclusion qui n’exprime qu’une probabilité (semble) par généralisation.
4. Cause et effets sont incertains : L’homme de Néandertal n’aurait pas pu s’adapter au changement de l’écosystème. Et l’homme de Cro-Magnon serait arrivé au moment où la société néander-talienne était en crise, ce qui aurait accéléré la disparition de son cousin. Le prototype de cette relation pourrait être considéré comme étant une forme de spéculation, c’est-à-dire une forme de calcul par hypothèses successives. On projette une chaîne de causalité probable sur laquelle on ne manifeste linguistiquement aucune certitude.
En résumé :Ce modèle posé, on peut confronter la modalité du raisonnement proprement dit et les modalités de présentation de ce raisonnement, dans un souci de distinction formulé par Marc Dominicy dans le présent volume, entre les événements et ses liens de causalité par rapport à la description des événements et de ses liens de causalité. De cette confrontation, on verra qu’une des forces du documentaire est de brouiller les deux plans. La manipulation rhétorique la plus fondamentale étant de faire passer ce qui est, à l’évidence, une abduction pour une déduction avec toutes les modalités de la certitude. Inversement, le documentaire va aussi instiller du doute là où la certitude devrait s’imposer. L’objet d’analyse illustre parfaitement ce que Georges Vignaux appelle un « “glissement” […] entre signes linguistiques et objets de ces signes, entre mots et images du monde15 ».
De manière générale, les théories du complot utilisent volontiers ce glissement qui donne, faute de preuves, un espace plein à l’indice qui se substitue à la preuve, l’indice réinterprété de manière « simpliste », selon Taguieff16, dans une causalité unique, non complexe, luminescente. La fragilité de l’indice dans le monde est ainsi transfigurée en un élément de certitude dans le discours. L’anglais met particulièrement en relief le problème en qualifiant les preuves d’evidence. Si l’evidence était
15. Vignaux G., Le discours acteur du monde, Gap, Ophrys, coll. « L’Homme dans la langue », 1988, p. 473.
16. Taguieff P.-A., La Foire aux « Illuminés ». Ésotérisme, théorie du complot, extrémisme, Paris, Éd. des Mille et Une Nuits, coll. « Essai », 2005, p. 474.
L’irrésistible rhétorique de la conspiration 223
parfaitement évidente, il n’y aurait eu ni complot ni révélation. C’est un arrière-plan important, dans le sens où cela prépare l’auditoire à coordonner de manière cohérente une série de faits troublants : « Exposant une thèse radicale, censée insoupçonnée et englobante, les tenants de la pensée conspirationniste se contentent de peu en fait de preuves, ils accumulent les indices ténus, les faits controuvés, ils les mettent bout à bout et triomphent bruyamment17 » affirme Marc Angenot. À un niveau macroscopique de l’ordre du raisonnement, tout cela est juste. Si complot il y a, cela prépare l’auditoire à accepter les étranges coïncidences, les faits ténus, les raisonnements abductifs peu probables comme autant d’éléments qui finissent pas devenir probants. Soyons plus clair, tout l’enjeu est de faire passer ce qui est fondamentalement abductif (tels ou tels faits réels ou attestés trouvent leur explication par cette théorie du complot) pour une déduction évidente. L’abduction qui
a pour fonction d’apporter la meilleure explication possible devient apparence de déduction lorsque l’explication proposée semble la seule possible et incarne alors une certitude18. À un niveau microscopique, les indices ténus dont parle Marc Angenot sont parfois bel et bien exposés comme des preuves.
C’est en tout cas l’exemple de la révision de l’alunissage. Ainsi on peut voir des images de la NASA sur lesquelles le drapeau américain « flotte au vent ». Or, sur la Lune, il n’y a pas d’air ni a fortiori de vent. Donc, les images n’ont pas été tournées sur la Lune. On a ici un raisonnement syllogistique tout à fait classique, où les prémisses sont indubitables (je vois le drapeau flotter, je sais qu’il n’y a pas d’air sur la Lune) et la conclusion valide. L’indice irréaliste dans un ensemble plutôt réaliste suffit à ébranler l’édifice tout entier. On transforme sur le plan rhétorique ce qui est un raisonnement par l’indice (le drapeau
17. Angenot M., Dialogues de sourds, op. cit., p. 341.18. On peut noter que la figure clé de la « déduction » policière qu’est le person-
nage de Sherlock Holmes ne procède pas autrement. Raisonnant par abduction, il retourne le raisonnement pour l’énoncer sous une forme déductive qui souvent laisse pantois le docteur Watson.
Cause Certaine Probable Certaine ProbableEffet Certain Certain Probable ProbablePlan
rhétoriqueDéduction rhétorique
Abduction rhétorique
Induction rhétorique
Spéculation
224 Thierry Herman
qui ne se comporte pas comme il devrait) aboutissant, par abduction, à l’hypothèse qu’on n’est jamais allé sur la Lune en une déduction rhé-torique : si le drapeau flotte, c’est que les images ne proviennent pas de la Lune. De nombreuses théories du complot recourent à une démar-che argumentative visant à transformer une implausibilité intrinsèque en « vérité révélée », d’autant qu’elle est accompagnée par un ethos de certitude et souvent servie linguistiquement par des modalités de l’évidence. Pour qu’une théorie du complot fonctionne, il ne suffit pas de proposer de la vraisemblance, mais du « vrai ». Il s’agit bien d’un « vrai » rhétorique, d’une apparence de réalité, même s’il existe des complots qui s’avèrent.
Je poserai donc l’hypothèse générale selon laquelle les théories du complot font admettre l’abduction générale (niveau du raisonnement) en recourant à différents modes de présentation des preuves dont l’un des plus efficaces est la déduction rhétorique (niveau rhétorique). Une déduction, est un schéma toulminien dans lequel on occulte – souvent consciemment – la restriction possible. Ainsi dans l’exemple très parlant du drapeau – celui qui trouble quiconque a vu le documentaire ou entendu parler de cette théorie – la restriction occultée équivaut à peu près à ceci : à moins que le drapeau ne soit mobile que lorsqu’il est tenu par la main d’un astronaute qui tente de l’enfoncer dans le sol. Avec une force de gravité aussi faible sur la Lune, il faut peu de force pour que le drapeau s’agite comme s’il était traversé par du vent.
Négocier l’obstacle de l’implausibilité manifeste du complot que l’on veut dévoiler oblige les tenants de la pensée conspirationniste à un double mouvement, dont j’ai commenté le second – de l’abduction à une apparence de déduction. Mais avant cette démarche, il faut une première étape, à savoir l’instillation du doute. C’est-à-dire que l’on part d’une doxa, d’une vérité telle qu’on la connaît – les tours du 11-Septembre, l’alunissage, etc. – pour mettre en exergue certains faits qui cadrent mal dans le tableau, qui ne sont pas totalement en raccord avec l’explication officielle. Puis, on les réinterprète au profit d’une autre solution. Il y a donc deux mouvements, transformer la certitude en incertitude, puis remplacer la première certitude par une autre qui explique mieux les faits. En ce sens, je fais aussi un parallèle avec le mécanisme décrit par Marc Dominicy : commencer par relativiser puis absolutiser.
On étudiera quelques exemples assez éclairants – voire troublants – dans le documentaire. Mais ce qui m’intéresse est tout autant de décortiquer les « preuves » apportées que la manière avec laquelle
L’irrésistible rhétorique de la conspiration 225
le documentariste rend compte de ces « preuves ». Car le travail journalistique très complaisant permet, sous le couvert d’une apparente impartialité ou d’un équilibre entre les voix pour et les voix contre, de totalement biaiser le documentaire au profit de la théorie du complot. Du point de vue de l’éthique journalistique, ce reportage constitue une grave faute professionnelle. Le caractère alléchant du complot dévoilé a permis à cette émission américaine d’être à l’origine d’une magnifique caisse de résonance au complot, au mépris évident de la recherche de la vérité qui est la mission première du journaliste. Le documentaire de quarante minutes qu’on analysera a été initialement diffusé sur la chaîne de télévision américaine Fox en février 2001. Il a été réalisé par Craig Tipley et diffusé en France par une chaîne satellitaire 13e rue. La vidéo a longtemps été sur le web avant d’être retirée pour une raison inconnue à la fin de l’année 2009. On en trouve cependant encore des extraits. La version anglophone doit sans doute se nicher dans un des recoins de l’Internet19. Le présent texte devrait pouvoir se lire sans avoir recours à la vidéo.
II. Ébranler les certitudes
Ce texte se veut avant tout un exercice d’analyse d’une rhétorique conspiratoire. C’est pourquoi je propose ici une étude minutieuse de « l’exorde » du documentaire. Ce moment discursif m’intéresse tout particulièrement parce qu’il doit en quelques minutes – ici trois minutes trente – instiller le doute et donner des arguments forts pour déstabiliser les croyances les mieux établies. La mécanique de séduction se met donc rapidement en place.
Avant l’analyse proprement dite, il s’agit pour moi de rendre compte de l’existence d’un arrière-plan attestant que l’hypothèse d’un canular américain est certes incroyable mais plausible. La première et la plus crédible des données est bien sûr la course aux étoiles menée en pleine guerre froide. Les États-Unis accusent, dans les années 1960, un certain retard dans le domaine, puisque les Russes ont envoyé le premier satellite artificiel, le premier animal dans l’espace, le premier homme, ont transmis les premières photos de la face cachée de la Lune, créé le
19. Le document vidéo est disponible sur mon site à l’adresse : http://www.thierryherman.ch/alunissage-theorie-du-complot.
226 Thierry Herman
premier satellite autour de la Lune. Par bien des aspects, ils sont donc pionniers et Washington assez loin derrière. Un autre argument avancé est la promesse faite par Kennedy en 1961 et réitérée en 1962: « Nous irons sur la Lune avant la fin de la décennie ». Ne pas y aller serait faire injure au génie américain et déshonorer le président assassiné. Enfin, aller sur la Lune permettrait aussi d’orienter le regard sur d’autres contrées que le Vietnam. Tout cela donne des mobiles assez crédibles en soi. On peut imaginer la pression subie par la NASA à la suite de la promesse de Kennedy et la course entre les deux grandes puissances. En somme, l’arrivée sur le satellite de la Terre tombe si parfaitement bien que si cela n’était pas possible, certains pourraient dire qu’il faudrait l’inventer. Dans l’accusation d’un complot américain pour faire croire à l’alunissage résonne une topique assez classique : « trop beau pour être vrai ». Cet arrière-plan sera bien sûr rappelé dans le documentaire. L’instillation du doute dans les théories du complot me semble interve-nir souvent lors de la perception d’un événement qui paraît excéder sa propre réalité, parce que trop beau, trop parfait, trop bien exécuté, trop incroyable… pour être admis comme tel. Comme s’il devait y avoir autre chose. Le documentaire met parfaitement en scène l’intuition d’une « vérité cachée ».
Sur fond de musique grandiose, mais dans laquelle parmi les cymbales triomphales, on perçoit des éléments sonores plus inquiétants ou troublants, l’émission démarre par la narratio20 rhétorique. On y trouve un rappel des faits, des images d’époque, le nombre de jours de la mission Apollo 11 et la phrase symbolique de Neil Armstrong : toute la doxa est là. Mais, comme dans toute bonne narratio qui se respecte21, des éléments indiquent une autre vérité possible. Ainsi la voix off affirme très rapidement : « Et on prétend qu’ils sont allés là où jamais personne n’est jamais allé. » « Prétendre » propose une dualité
20. On pourrait s’étonner ici de la place de la narratio alors qu’elle fait partie de l’exorde général du documentaire. L’exorde général du documentaire qui se termine par une sorte de partitio – c’est-à-dire une promesse des explications que l’on aura dans la suite du programme – peut comporter des sous-parties de narratio et de réfu-tations. C’est même cela qui accroche le téléspectateur.
21. Herman Th., « Narratio et argumentation », dans E. Danblon, E. de Jonge, E. Kissina et L. Nicolas (éd.), Argumentation et Narration, Postface de J.-M. Ferry, Bruxelles, Éd. de l’Université de Bruxelles, coll. « Philosophie et société », 2008, p. 29-39.
L’irrésistible rhétorique de la conspiration 227
énonciative22 superposant à l’énonciateur premier un énonciateur qui refuse d’assumer le dire. Ce verbe assumé par l’énonciateur se glisse parmi une série de faits présentés comme certains : la modalisation par le conditionnel n’intervient pas.
Deuxième élément, magnifié par la bande sonore et alors qu’un montage très rythmé de différentes images authentiques se termine par un indice incontournable de la présence d’un homme sur la Lune, l’empreinte de pas, un « pourtant » qui est largement mis en relief par un silence qui le suit directement, introduit une rupture avec la narratio. La dramatisation est extrêmement habile : sur le plan de l’image, une série de preuves photographiques, y compris le signe par excellence que figure l’empreinte de pas ; mais sur le plan sonore, la voix off annonce une rupture par un connecteur mis en relief tandis que le bruitage, très « technologique », accentue le caractère d’évidence des images par un « bip » ressemblant à un code-barres passé dans un scanner. L’effet d’annonce est manifeste : malgré ce défilé de preuves plus solides les unes que les autres, il est possible d’avancer une autre hypothèse que l’alunissage. On assiste alors à l’instillation du doute, lequel est marqué ici par la seule forme de la question : « Pourtant [se sont-ils VRAIment [posés sur la Lune ? » (les points signalent les pauses, les majuscules l’intonation). L’adverbe de la question tend précisément à légitimer le doute. Le parti-pris pour une autre hypothèse est moins marqué que le verbe prétendre, mais il est bien là. À la vérité des images, l’adverbe « vraiment » semble indiquer la possibilité d’une autre vérité.
La voix off enchaîne la question par « La plupart d’entre nous y croient ». On notera l’habileté rhétorique qui consiste à inclure l’auditoire et l’énonciateur dans un « nous » collectif. En refusant le « vous », le documentariste ne s’installe pas comme ennemi de la doxa. Il crée une schématisation dans laquelle il demande à être convaincu par l’hypothèse du canular même s’il vient de donner linguistiquement les signes au nom desquels il faudrait mettre en cause la doxa. En outre, ce ne sont plus des faits que l’on énonce mais un énoncé de croyance ; non une proposition universelle, mais particulière – créant, par présupposition, l’hypothèse que certains, justement, n’y croient pas. Et laissant entendre qu’ils ont peut-être des raisons de ne pas y croire.
22. Vion R., « La dualité énonciative dans le discours », dans R. Jolivet et F. Epars Heussi (éd.), Mélanges offerts à M. Mahmoudian, Cahier de l’ISL, n° 11, tome II, 1998, p. 425-443.
228 Thierry Herman
III. Ethos : crédibiliser l’expert
« Mais jusqu’à aujourd’hui, certains prétendent que pour croire au petit pas de l’homme, il faut faire un grand bond dans la foi ». Le documentaire poursuit par une indication temporelle qui signale, par inférence, la résistance de la théorie du complot aux épreuves du temps. Il est encore possible de douter. L’énonciateur continue sa sché-matisation en feignant d’être dans le camp des sceptiques, utilisant le verbe « prétendre » pour se défaire, se distinguer des tenants radicaux de la conspiration. La formule de Neil Armstrong subit un défigement qui renverse le camp de la raison et des « illuminés : parler de « bond dans la foi » fait passer la plupart des téléspectateurs pour des croyants abusés incapables de raisonner comme le font ou le feront bientôt les (nouveaux) tenants de la théorie du complot. Cette menace sur notre face de convaincus par l’alunissage peut se rétablir, soit en ridiculisant le documentaire et ses preuves (ce qui, cependant, demeure très diffi-cile sans de précises connaissances astronomiques), soit en se laissant convaincre et en se présentant, dès lors, comme un converti, et non plus comme le naïf crédule pour lequel on passait jusqu’alors. Il y a là comme la promesse de cheminer sur un terrain nettement plus avanta-geux si l’on accepte de se désolidariser de la doxa, si l’on accepte de regarder la vérité en face.
L’homme qui va permettre ce mouvement est présenté directement après par un classique appel à l’autorité. Il s’agit de Bill Kaysing, « ingénieur et analyste à Rocketdyne, l’entreprise qui a conçu les fusées Apollo ». Ce que le documentaire ne dit pas, c’est que Bill Kaysing a quitté Rocketdyne en 1963, six ans avant l’alunissage. Le documentaire convoque ensuite des faits bruts de manière fallacieuse. Bill Kaysing est titulaire d’une licence ès lettres, il a travaillé à Rocketdyne comme rédacteur et bibliothécaire. Si sa fonction a été, un moment, « ingénieur de service », cela ne signifie pas qu’il ait des compétences en ingénierie23. Ces faits ont été trouvés par des analystes anti-conspirationnistes d’apparence fiable24, mais ils n’empêcheront pas un convaincu du complot de les traiter comme des faux destinés à décrédibiliser une hypothèse qui dérange… En revanche, on sait que
23. Voir http://www.clavius.org/kaysing.html, consulté le 31 janvier 2010.24. On peut regretter que le site Internet qui mentionne ces faits n’indique pas
ses sources.
L’irrésistible rhétorique de la conspiration 229
Rocketdyne n’a pas conçu les fusées d’Apollo 11, mais une partie des engins – ceux destinés à la propulsion. Ces faits-là sont vérifiables par le journaliste, mais ont été présentés selon un angle clairement avantageux. Ainsi Bill Kaysing est introduit en train de taper sur un clavier dans un décor étrange qui ressemble à l’intérieur d’un cockpit. Le sous-titrage le présente comme « enquêteur sur l’imposture de la Lune », ce qui est doublement intéressant. D’abord le déterminant défini « le » qui précède imposture postule que cette imposture est d’ores et déjà identifiable par le destinataire ; c’est un présupposé d’existence qui représente déjà un coup de force. Ensuite, Bill Kaysing n’est plus un ingénieur, mais un « enquêteur ». Il n’est pas seulement le dénonciateur d’un complot, mais se trouve re-catégorisé en personne agissante selon des normes scientifiques qui supposent la recherche de la vérité.
Avant une musique beaucoup plus inquiétante, digne d’un film policier, parcourue de bruits divers puis d’explosions et d’images de fusées d’essai qui s’écrasent, Bill Kaysing livre un premier argument : « beaucoup de problèmes se sont posés dans les années soixante qui ont conduit les gens à penser que nous n’allons jamais parvenir à la Lune ». Mais l’argument, une induction, est plutôt vague. Si l’on voulait être un peu normatif dans l’examen de cet argument, on signalerait l’usage d’un lexique très vague : on ne connaît pas le nombre et la nature des problèmes, on nous dit les années soixante, laissant entendre jusqu’en 1969 alors que les problèmes sont intervenus, logiquement, dans les premières phases d’expérimentation, on invoque aussi l’opinion des « gens » qui ne sont pas identifiés et qui sont présentés, avec l’article défini, comme un ensemble assez homogène comprenant de nombreuses personnes. L’adverbe quantifiant « beaucoup de » tente de renforcer la force de l’induction, mais se présente de manière infalsifiable. Le texte n’exprime pas grand-chose sur le plan référentiel, tant il est vague, mais il est rendu crédible par des images d’essais infructueux. L’argument reste intéressant car il pose l’expert comme membre du sérail : il a vu les problèmes, il a entendu « les gens » dire qu’ils ne pensaient pas que l’on y arriverait. Son expérience le place donc au-dessus de la mêlée.
Le documentaire continue en se focalisant sur la figure de Bill Kaysing. On le présente, comme tout le monde, en train de visionner l’alunissage. Pendant cette partie, la vidéo livre une image de soldat représentant Bill Kaysing, puis une photo de ce dernier en tenue de travail où il peut passer pour un ingénieur, ne serait-ce que par la conti-guïté d’une prise électrique et d’une rallonge proche de sa tête. Ces
230 Thierry Herman
photos assoient le statut social, en empêchant, par la photo de Kaysing soldat, de considérer que cet expert n’est pas un patriote. Elle bloque l’inférence reliant un possible contentieux avec son pays et le sacrilège de douter d’un exploit américain. La bande-son, au moment précis où l’on voit la photo de Bill Kaysing en tant qu’ingénieur, rappelle l’expertise : « mais ce qu’il a vu à la télévision, après son expérience à Rocketdyne, l’a laissé sceptique. » La mise en scène de la révélation suit un sentiment : « je sentais que tout cela était bidon », puis la modalité se renforce jusqu’à la certitude : « Je pense qu’intuitivement je savais que ce qu’on nous montrait n’était pas vrai ». La modalité épistémique « je savais » expurge le moindre doute que l’on pourrait avoir sur la vérité ou non des images, alors même qu’elle entre en conflit avec l’adverbe « intuitivement » et le verbe de la principale « je pense ». Cette révé-lation a un impact net sur l’ethos de l’expert qui cumule l’expérience personnelle (Rocketdyne), la rationalité scientifique (ingénieur et ana-lyste) et la connaissance de celui qui a accès à une vérité révélée.
IV. logos : trois preuves évidentes
Jusqu’ici, peu d’éléments montrent quoi que ce soit de probant sinon l’argument faible des problèmes qui sont survenus, mais dont on peut encore supposer qu’ils ont été résolus. Là où ce documentaire va ébran-ler fortement la thèse classique de l’alunissage, c’est en présentant trois « preuves » en rafale. En trente cruciales secondes, on va entrer dans un mode judiciaire avec convocation de pièces à conviction et d’arguments de type syllogistique.
La découverte des preuves ou des invraisemblances se fait selon ce que les narratologues appellent une focalisation interne. C’est par les yeux de Bill Kaysing que l’on découvre les invraisemblances : « En étudiant les images de plus près, il fut choqué de découvrir plusieurs invraisemblances ». Lorsque l’on évoque une étude de près, on n’est pas loin du mythe de Sherlock Holmes et de sa loupe. Bill Kaysing se voit renforcé dans son rôle d’enquêteur ; il ne se contente pas d’une intuition qui tend à la certitude. Le pathos intervient aussi : sa découverte d’in-vraisemblances le « choque ». Or, il ne devrait pas être choqué puisque c’est évidemment ce qu’il cherchait s’il avait l’intuition que « tout cela était bidon ». On l’imagine au contraire plutôt heureux de découvrir des arguments qui étaieraient sa thèse. Mais une telle version serait
L’irrésistible rhétorique de la conspiration 231
gênante et perdrait en persuasion rhétorique, car elle désignerait Bill Kaysing comme soucieux d’établir par tous les moyens la réalité de sa thèse. L’avantage de l’usage du passif et du pathos, « être choqué par les invraisemblances », permet d’inverser la démarche active et sans pathos, celle qui caractérise la recherche d’éléments capables d’étayer la théorie du complot. En outre, la tournure permet d’occulter le fait que la découverte d’invraisemblances est imputable à Bill Kaysing qui les a cherchées. Ces invraisemblances semblent exister, être déjà-là, partant elles ne sont que révélées par l’œil acéré de l’expert. Il y a donc ici un effet d’évidence qui se crée par la présupposition d’existence des invraisemblances et une démarche qui se donne comme une découverte miraculeuse – c’est-à-dire un dévoilement – qui n’est pas exactement pareille à la démarche active récompensée par une trouvaille au bout d’une enquête. La superposition d’éléments graphiques va confirmer cette rhétorique de la révélation. On voit différents cadres de couleur rouge, des sons qui tiennent du mélange entre les bruits d’appareils photos et de mécanique robotisée qui pointent, par divers procédés graphiques, les trois preuves : à savoir l’absence d’étoiles dans le ciel malgré la clarté de l’espace, le vision du drapeau qui flotte alors qu’il n’y a pas d’air sur la Lune, et l’absence de cratère sous les réacteurs de la capsule lunaire.
Sur l’absence d’étoiles, on peut évidemment se demander pourquoi, si les images sont fabriquées, la NASA n’a-t-elle pas planté des étoiles dans le ciel au lieu de laisser ce noir intégral ? Le problème s’explique assez simplement : plus il y a de lumière environnante, moins l’œil dis-tingue les faibles sources lumineuses que sont les étoiles. Les appareils photos et autres caméras fonctionnent de la même manière : on capture ce qui est le plus brillant, en l’occurrence ce qui est éclairé. L’argument peut sembler faible, mais il porte en raison d’une double expérience : celle des images de la NASA qui montrent à l’évidence une absence d’étoiles et celle que l’on peut faire lorsque, la nuit, on observe le ciel dégagé. De fait, on oublie, par l’absence d’atmosphère, que les condi-tions de vision ne sont pas du tout analogues à celles que l’on peut avoir sur terre. Cette différence de référentiel qu’il est difficile de saisir cognitivement par manque d’expérience des milliards d’individus qui ne sont pas allés sur la Lune, constitue une brèche dans laquelle il est facile de s’engouffrer. On le voit par le célèbre deuxième argument : celui du drapeau.
232 Thierry Herman
« Il a vu le drapeau américain flotter alors qu’il n’y a pas d’air sur la Lune. » L’exemple est déjà commenté. Il faut ajouter à cela que l’aspect « plissé » et drapé du drapeau est voulu. Le mât fait, lui-même, un angle de quatre-vingt-dix degrés. Il est habile que l’appel à prendre en compte un « autre » référentiel – « il n’y a pas d’air sur la Lune » – occulte une autre caractéristique lunaire, l’absence d’atmosphère qui amplifie les mouvements du drapeau lorsqu’il est tenu par la main d’un astronaute.
Vient ensuite la question du cratère, qui est présentée non selon un système graphique faisant apparaître des cadres et des croix, mais par des zooms successifs agrémentés de deux bruits définitifs qui ressemblent chacun à un coup de gong étouffé. Là aussi, une apparence d’illogisme pur : s’il y a de puissants réacteurs, le sol aurait dû être brûlé. En fait, le réacteur n’est pas assez puissant pour brûler le sol et la couche de poussière n’est pas suffisamment profonde pour qu’on voie un cratère… Est-ce à nouveau, cognitivement, l’analogie avec les fusées de propul-sion au départ qui laisse penser que l’arrivée est l’exact symétrique ?
Dans tous les cas, on a affaire à trois déductions rhétoriques, tou-jours présentées comme des découvertes successives de Bill Kaysing, qui vont permettre d’être requalifiées en preuves : « ces preuves ont convaincu Kaysing qu’aucun homme n’avait jamais mis les pieds sur la Lune ». Le lexique du genre judiciaire fait clairement basculer le documentaire vers la théorie du complot. Dans la démarche abductive, les trois éléments cités auraient dû être qualifiés d’indices, la transfor-mation rhétorique fait passer la démarche pour une déduction.
V. logos : une fausse contre-expertise
Les preuves ont convaincu Kaysing, « mais la NASA réfute ces accusations » : soulignons le registre judiciaire puisque les éléments découverts subissent cette double requalification en preuves et accu-sations. Ce passage vers le judiciaire durcit le ton dans le sens où de la simple hypothèse, on est passé à la mise en procès : les preuves apportées demandent réponse. Conformément à l’éthique journalis-tique, le documentaire tente de trouver des sources divergentes, ici un porte-parole de la NASA qui, en fait, ne réfute rien du tout. C’est-à-dire que non seulement il ne répond pas aux accusations (du moins pas dans l’extrait, sans doute savamment coupé), mais il affiche son mépris vis-à-vis de Kaysing et, désormais, des téléspectateurs en attente
L’irrésistible rhétorique de la conspiration 233
d’explications ou sonnés par les trois preuves précédentes : « il y aura toujours des gens pour croire aux théories les plus saugrenues et l’idée que, je ne sais comment, on aurait pu simuler une expédition lunaire est assez saugrenue ». Ces propos, qui, non seulement, ne réfutent aucune des trois preuves, n’invalident de plus en rien la théorie. Au contraire, cela valide l’idée selon laquelle on pourrait concevoir qu’Apollo est un canular, même si l’hypothèse est « assez saugrenue ». Le montage donne ainsi l’impression que le porte-parole évite le débat et passe par l’attaque ad hominem pour se défausser de ses responsabilités.
Le documentaire va se révéler assez pernicieux dans l’usage de la voix officielle de la NASA. Le porte-parole apparaît plusieurs fois, mais sans jamais pouvoir contrecarrer la théorie du complot. Il ne sera livré qu’une illusion de la mise en balance des arguments. À cinq reprises en tout cas, explicitement, la phrase qui suit directement l’avis de l’expert de la NASA commence par « mais » ou « et pourtant ». Quoique l’ex-pert dise, il se voit opposé un contre-argument par le documentariste en voix off. Le connecteur Mais étant toujours l’argument le plus fort en faveur d’une conclusion, les partisans du complot sont donc systé-matiquement avantagés.
Ensuite, alors que les théoriciens du complot ont le droit de livrer les arguments et les preuves sur le mode syllogistique, leurs adversai-res de la NASA ne répondent sur aucun point précis, se contentant de généraliser. C’est particulièrement patent lorsque l’expert affirme à un moment que répondre aux affirmations fantaisistes constitue une perte de temps.
Enfin, les propos très généraux de l’expert de la NASA vont parfois dans le sens des théoriciens du complot : il semble admirer leur ingé-niosité. Mais en parallèle, il utilise une série d’attaques ad hominem envers les théoriciens comme envers les spectateurs qui peuvent se sentir légitimement troublés par les arguments avancés. Au logos des partisans du complot répond, non des contre-arguments, mais un mépris disqualifiant l’adversaire. De toute manière, les partisans du complot ont un double beau rôle : celui de la reconnaissance de leur ingéniosité et celui de la victime du mépris de la source autorisée.
234 Thierry Herman
VI. Pathos : la pression du nombre
« Aussi saugrenu que cela puisse paraître, on estime que pas moins de 20 % des Américains pensent qu’on n’a jamais marché sur la Lune », enchaîne le documentaire après la première intervention du porte-parole. La reprise par la voix off du même adjectif « saugrenu » crée une dualité énonciative. Sa répétition semble tourner au sarcasme en donnant du coup de la crédibilité à l’hypothèse par la statistique avancée. En somme, la NASA vient de tourner en dérision l’hypothèse de l’imposture par l’adjectif « saugrenu » et le documentaire renvoie le même « projectile adjectival » à l’envoyeur par une statistique ahurissante.
Après l’ethos de Bill Kaysing, le logos des trois preuves par l’image, le documentaire joue sur le pathos du conformisme. Le pathos a déjà été mobilisé par le mépris affiché du porte-parole de la NASA, mais l’argument ad populum typique offre une porte de sortie au rejet subi : si 20 % des Américains croient qu’il y a anguille sous roche, c’est bien qu’il y a anguille sous roche. Les méprisés pourraient ne pas avoir tort ; s’ils sont rejetés au ban d’infamie, c’est peut-être qu’ils ont touché un point sensible. Même si 20 % n’est pas la majorité, le chiffre est suffisamment énorme pour soulever un doute. Il laisse entendre que soutenir une telle théorie n’est pas rejoindre des affabulateurs un peu marginaux, d’autant que le chiffre de 20 % est précédé d’un modificateur adverbial qui insiste sur le gigantisme du nombre : « pas moins de ». Reste qu’il est donné sans aucune source : le sujet est un « on » qui opacifie la référence et le chiffre provient bien d’une estimation explicite, et non d’un sondage. C’est ce que Robert Cialdini appelle la preuve sociale : « Suivant ce principe, l’un des moyens de déterminer ce qui est bien est de découvrir ce que d’autres personnes pensent être bien25. » Si quelque 20 % des gens doutent alors que vous êtes précisément en train de douter, le basculement dans le camp des sceptiques vis-à-vis de l’alunissage ne sera pas vécu comme une marginalisation par rapport au groupe. Une des conditions que donne Cialdini de la preuve sociale, l’incertitude, est intéressante à souligner ici : « Incontestablement, quand on ne sait pas à quoi s’en tenir, on se repose plus facilement sur les actions des autres pour déterminer la conduite qu’on doit tenir soi-
25. Cf. Cialdini R. B., Influence et manipulation, trad. M.-C. Guyon, Paris, First, 2004.
L’irrésistible rhétorique de la conspiration 235
même26. » Rien ne prouve donc que ce chiffre existe, ce qui n’empêche pas son efficacité. En fait un sondage Gallup de 1999 livre une autre estimation : 6 % des gens n’y croient pas27.
Le documentaire demande alors explicitement comment croire l’incroyable. « Mais comment croire que l’un des plus grands moments de l’histoire de l’humanité est une imposture ? ». La traduction française est extrêmement intéressante puisque l’indicatif suit une interrogation avec « croire que » au lieu du subjonctif. De fait, il ne s’agit plus alors de se demander comment croire ou ne pas croire à l’alunissage. L’imposture est désormais certaine. La question se déplace de l’objet vers les sujets : comment allez-vous croire que c’est bien une imposture28 ? À cette première question s’enchaîne une autre : « la NASA a-t-elle vraiment pu tromper le monde entier ? ». On retrouve le même adverbe « vraiment » qui avait débuté l’exorde du documentaire. L’exorde se boucle donc sur ces deux questions avec à nouveau un gros plan sur l’empreinte de pas de Neil Armstrong. La boucle est marquée aussi par le retour d’un expert, cette fois-ci un astronaute de la NASA. Puis un retour de Bill Kaysing qui va sortir de sa manche un nouveau chiffre : l’aller-retour sur le satellite terrestre est estimé à 0,017 % de chances de réussite. À nouveau, rien ne dit évidemment que ce chiffre ait une quelconque autorité scientifique.
Conclusion
Pour des raisons de place, nous ne poursuivrons pas cette analyse d’un « documentaire » de quarante-huit minutes. Ce qui nous intéresse sont bien les trois minutes et demi initiales, qui utilisent un certain nombre de stratégies de persuasion, tant sur le plan de l’ethos, du logos que du pathos, en profitant d’une complaisance journalistique évidente. Certaines sont faibles ou paraissent réfutables : le recours à l’expert douteux ou l’usage de statistiques sans origine contrôlée par exemple. Ils viennent néanmoins appuyer ce qui, d’après tous les témoignages, est le plus troublant : le comportement du drapeau, dont la découverte de l’anomalie se fait par les yeux de l’expert en question. Expert dont
26. Ibid.27. http://www.gallup.com/poll/3712/landing-man-moon-publics-view.aspx,
consulté le 31 janvier 2010.28. Je remercie M. Dominicy de m’avoir justement signalé ce point.
236 Thierry Herman
on met en scène fictivement l’émotion propre : « il fut choqué par les invraisemblances ». Ce même choc se répercute sur les téléspectateurs qui peuvent ensuite mettre en doute la théorie officielle.
Il me semble que les théories modernes du complot (11-Septembre, l’alunissage, etc.) fonctionnent essentiellement par le poids des évi-dences. Il ne s’agit plus de créer une hypothèse à partir de faits ténus ou controuvés, mais d’avancer des prémisses indubitables, entre autres par l’intermédiaire des images. Pour le 11-Septembre, la première image-choc qui a valu une soudaine popularité à Thierry Meyssan est sans doute celle de l’avion sur le Pentagone dont on ne trouve que peu de débris. Il s’agit d’une image analogue à celle du drapeau en mouvement sur la Lune, et ce dans la mesure où les deux images sont re-catégorisées en preuves indubitables. Dans les deux cas ces indices-preuves sont restitués sous la forme d’une déduction implacable, à la fois vraie (le drapeau bouge) et valide. Mais l’élément vrai extrait, qui permet la déduction formelle, est une schématisation à l’intention de l’auditoire dont certains éléments ont été occultés (on trouve bien des débris autour du Pentagone) ou dont certains demeurent inaccessibles à notre imagination par manque d’expérience : même si on sait que l’air est plus léger sur la Lune, on ne parvient pas à imaginer les conséquen-ces physiques et sensibles de cette réalité qui nous demeure étrangère. Cela donne raison à ce qu’écrivait Georges Vignaux à propos de notre champ commun d’investigations :
« [O]n ne peut […] traiter d’argumentation sans prendre en compte cette médiation essentielle du sujet énonciateur constituant à chaque discours son propre champ de vérité/erreur : un certain type de renvoi qu’il opère à des objets ou à des domaines, les énonçant comme “réels” voire vrais avec pour conséquence l’exclusion d’autres types de représentations du monde dès lors posées comme “erronées29”. »
29. Voir Vignaux G., Le Discours acteur du monde…, op. cit, p. 43-44.
L’irrésistible rhétorique de la conspiration 237
Face au complot, une guerre des saintes ? Analyse d’un ethos jihadiste
Evelyne Guzy-Burgman
Comment une personne individuelle décline-t-elle sur le plan personnel une pensée conspirationniste pour témoigner de sa condi-tion propre et, plus particulièrement, de son statut de femme ? Afin de répondre à cette question en termes rhétoriques, j’examinerai un cas dans lequel s’expriment les émotions et le vécu personnel d’une femme. Cette démarche permettra de dégager les dynamiques propres à la preuve éthique afin d’investir, plus largement, l’univers topique du texte analysé.
Ce qu’on appelle couramment une « théorie du complot » peut s’envisager comme la construction d’un engrenage mono-causal porteur d’une intentionnalité humaine. La « théorie du complot » tend à présenter tous les événements du monde comme inéluctables dans la mesure où ce qui advient est censé répondre aux intérêts secrets d’un groupe puissant et clandestin. Une telle habitude de pensée consiste à bâtir une vision déterministe, fondée sur la catégorisation, la causalité et aussi l’attribution d’intentions. Dès lors, comment distinguer une « théorie du complot » de ce qui relève de l’usage d’une disposition humaine ordinaire ? En tout état de cause, la pensée conspirationniste met en œuvre, de façon hypertrophiée, une logique générale du soupçon où les indices accumulés avec minutie font preuves et confirment le pressentiment initial selon lequel, forcément, « tout se tient ». Elle exprime la conviction que la vérité est dissimulée, soustraite à la vue du plus grand nombre, et qu’il revient aux clairvoyants – ceux qui se sont rendus à l’évidence – de lever le voile sur ce qui, jusque-là, demeurait caché. Pour Pierre-André Taguieff1, le niveau le plus élevé de la pensée conspirationniste prend corps dans un « mythe » explicatif du monde. Et, selon Marc Angenot, ce qui caractérise une théorie du complot qui
1. Taguieff P.-A., L’Imaginaire du complot mondial – Aspects d’un mythe moderne, Paris, Éd. des Mille et Une Nuits, coll. « Les Petits libres », n° 63, 2006.
se fait mythe2 se manifeste dans l’articulation des productions discur-sives qui la composent. Le « mythe du complot » crée un système et oriente une vision totale du monde qui détermine à la fois la place que chacun tient personnellement dans la société, et la façon dont celle-ci fonctionne. L’abduction conspirationniste a, toujours selon Angenot, « la force illuminante de la synthèse absolue3 ». Ce dernier voit en outre une « connexité de la pensée conspiratoire et de la logique du ressentiment4 ». Je m’attacherai ici à mettre en évidence la fécondité d’un tel lien, tout en soulignant les limites analytiques d’une relation de ce type. Le développement qui suit détaillera la construction d’un ethos au féminin sous l’angle du pathos du ressentiment. L’étude de ces deux preuves sera éclairée par une topique qui pourrait être spécifique de la pensée conspirationniste.
Le texte qu’on va lire est un « Appel5 » publié sur le site internet « La Voix des Opprimés ». Ce site s’adresse d’abord aux musulmans francophones et consacre une place importante à l’analyse de la situa-tion politique selon une vision du monde nettement conspirationniste. Il suffit pour s’en convaincre de noter que le site prévoit une rubrique « Conspiration » consacrée à la dénonciation de supposés complots contre lesquels le « jihad » et le « martyre6 » apportent une réponse armée.
2. Selon M. Angenot, « un mythe, c’est une fiction qui est donnée pour un fait, mis en preuve au service d’une doctrine » (Voir : Angenot M., Dialogues de sourds. Traité de rhétorique antilogique, Paris, Éd. des Mille et Une Nuits, 2008).
3. Ibid., p. 222.4. Ibid., p. 343-350.5. http://news.stcom.net/modules.php?name=News&file=article&sid=1377
(consulté le 9 mars 2009).6. « Jihad » signifie en arabe « effort dans un but déterminé ». À côté du grand
jihad – la lutte contre l’ego et les passions –, figure le petit jihad, valorisé par les isla-mistes radicaux. Il s’agit d’une guerre contre les mécréants, un combat « dans la voie de Dieu » afin de propager l’Islam. Voir par exemple : Sfeir A., L’Islam en 50 clés, Paris, Bayard, 2006, p. 99. D’après F. Kosrokhavar, le musulman qui meurt dans la voie de Dieu est un martyr ou « shahid » (témoin). La lutte contre les ennemis d’Allah est marquée par une violence légitime : Khosrokhavar F., Les nouveaux martyrs d’Allah, Paris, Flammarion, 2002, p. 15-20. Notons que la légitimité de ce combat n’ouvre pas le droit de se donner la mort volontairement tout en tuant de manière indis-criminée, comme le font les « hommes-bombes ». Dans sa vision traditionnelle, l’Islam considère l’attentat-suicide à la fois comme un suicide et un meurtre collectif, trans-gressant par deux fois les interdits liés au respect de la vie. Une lecture attentive des
Face au complot, une guerre des saintes ? 239
Paru le 17 avril 2005, l’« Appel » de Ghyslaine Roc est lancé au bénéfice de Malika El Aroud, une Belge d’origine marocaine. Née en 19597, cette dernière a épousé8 Abdessatar Dahmane, l’un des assassins du commandant afghan Massoud, chef de l’Alliance du Nord, qui luttait contre les Talibans en Afghanistan. Dahmane est mort le 9 septembre 2001 lors de cet attentat9. Fin février 2005, El Aroud est arrêtée en Suisse pour avoir aidé à mettre sur pied des sites islamistes gérés par son nouvel époux10. C’est de cette époque que date le texte que je soumets à l’analyse11.
i. Un ethos victimaire au service d’un Pathos du res-sentiment
Mon investigation rhétorique s’attachera à suivre pas à pas la construction de l’ethos de Ghyslaine Roc en abordant successivement quatre aspects du texte : la parole prophétique, la vision conspirationniste, la glorification de l’héroïne-victime et l’idéal de la sainte combattante.
Plusieurs pistes se dégagent dès le titre quant à l’élaboration de l’ethos de l’auteur :
« Méfiez-vous des lions blessés, lâchement poignardés ! APPEL URGENT POUR AIDER MALIKA EL AROUD DANS SON ÉPREUVE ! »
articles parus dans « La Voix des Opprimés » montre d’ailleurs que le site ne cautionne pas tous les types d’actions perpétrés au nom du jihad.
7. Le Herald Tribune la décrit comme l’un des plus importants jihadistes de l’in-ternet en Europe. Voir Sciolino E. & Mekhennet S., « Belgian women wages for Al Qaeda on the Web », Herald Tribune International, 27 mai 2008.
8. Il s’agit d’un mariage religieux non reconnu par les autorités belges. Sur l’his-toire du couple lire l’ouvrage de la journaliste Armesto M-R., Son mari a tué Massoud, Paris, Balland, 2002.
9. Voir l’Atlas de l’Islam radical, Paris, CNRS Éditions, 2007, p. 78.10. Voir Mansour F., « Deux accusés, dont la veuve de l’assassin du commandant
Massoud, seront jugés à partir de mercredi prochain pour avoir créé des sites de pro-pagande extrémiste et diffusé sur la Toile des images de mise à mort », Le Temps, 18 juin 2007.
11. Le 21 juin 2007, Malika El Aroud a été condamnée par un tribunal pénal fédéral suisse à six mois de prison (Le Soir, 22 juin 2007).
240 Evelyne Guzy-Burgman
La première phrase du titre de l’Appel, en minuscules, résonne comme une menace (« Méfiez-vous […] ! »). Elle évoque, elle-même, le titre d’un autre article12 qui reprenait une citation de Malika El Aroud. En cela, l’Appel fait écho au discours de cette dernière et lui confère ficti-vement la parole. Cette incarnation de l’héroïne victime au sein du texte permet immédiatement de construire un ethos victimaire qui s’appuie sur le ressentiment. Ghislaine Roc devient alors la porte-parole de Malika El Aroud et s’exprime ainsi à travers elle.
Mais ces deux voix qui cohabitent dans l’Appel s’adressent, en fait, à deux auditoires distincts : la menace est destinée aux bourreaux de Malika El Aroud, et l’appel qui lui fait suite, en capitales, est lancé à ceux qui sont susceptibles de lui porter secours13. La menace est d’autant plus angoissante qu’elle n’a pas de contenu véritable, si ce n’est l’allusion qu’elle fait à une vengeance ressentie comme juste et méritée, réponse à la violence injuste et déloyale (« lâchement ») subie par la victime, héroïne et égérie des valeurs à défendre. Comme dans la parole magique, censée créer, à peine énoncée, une nouvelle réalité, la vengeance humaine, choisie et intentionnelle, s’exprime ici comme une menace naturelle, inéluctable et d’autant plus puissante que sa réa-lisation semble inscrite dans sa propre profération. En écho à la culture archaïque14, orale, dans laquelle l’ordre du monde est nécessairement juste, la menace vient mécaniquement en réponse à l’hybris, à l’orgueil et la démesure des bourreaux. Elle se fait némésis, vengeance ou juste châtiment qui punit immanquablement l’impardonnable dépassement de la limite fixée par l’ordre des choses. Ainsi énoncée comme une généralité, une fatalité, la menace indirecte prend une dimension pro-verbiale et devient alors parole de sagesse15.
La citation de Malika El Aroud, à laquelle Ghyslaine Roc faisait allusion dans le titre, se retrouve au sein même du texte :
12. Article intitulé « “Les lions ont été blessés” » et paru dans journal suisse La Liberté daté du 6 avril 2005 (p. 11). C’est de cet article que sont tirées les différentes citations de M. El Aroud utilisées dans l’Appel.
13. À la lecture du forum qui suit l’Appel, on se rend compte que l’aide demandée est financière.
14. Sur cette question et sur l’opposition entre culture orale et modernité, je renvoie à l’article d’E. Danblon inclus dans ce recueil.
15. Cette dimension proverbiale est très présente dans le texte et contribue à façonner une rhétorique de l’allusion, pleine de sous-entendus, censée démasquer l’en-nemi caché, caractéristique de la parole conspirationniste.
Face au complot, une guerre des saintes ? 241
« Tous mes frères moudjahidin dans le monde entier sont au courant de ce qui s’est passé ici. Ils sont furieux, fous de rage. Les lions, comme je les appelle, sont blessés. Et un lion blessé, c’est très dangereux.“Les lions ont été blessés”. »
Ici, l’évidence archaïque se moule dans une justification qui, sur un mode indirect, évoque un véritable syllogisme. Selon cette justifica-tion, assumée par Malika et relayée par la voix de Ghyslaine Roc, il est normal, juste et sain qu’une victime cherche à se venger. S’il n’est pas toujours aisé de distinguer la menace, la vengeance et le chantage16, on voit ici se dessiner un double acte de langage : l’un, entièrement fondé sur une vision archaïque du monde (la némésis), l’autre dépassant l’évi-dence pour respecter les canons de la logique moderne. Mais l’auditoire à qui s’adresse cette némésis modernisée est impuissant face à la menace formulée, dans les deux cas, sur un mode allusif. En l’absence de toute exigence concrète, que peut-il faire, si ce n’est attendre, dans la peur, la juste vengeance annoncée ?
Cette menace prophétique vient ainsi naturellement s’insérer dans le cadre d’un logos conspirationniste. La suite du texte montre d’ailleurs ce logos à l’œuvre à travers la construction en miroir des figures archaï-ques des bourreaux et des victimes qui fait signe vers la postmodernité. Le premier paragraphe de l’Appel, en effet, met en scène les différents protagonistes de l’arrestation de Malika El Aroud, et les divise en deux camps antagonistes :
« Deux journalistes-sloganistes KESSAVA PACKIRY, SID AHMED HAMMOUCHE ont réussi à obtenir une interview de la citoyenne belge Malika El Aroud, vivant (exilée) depuis quelques temps [sic] en Suisse “neutre”, et de son époux, en profitant de sa naïveté. Cependant, ces deux amateurs de sensations ont quand même « informé » le grand public de la flagrante violation du droit à la dignité, à la pudeur, à la liberté d’expression et à la liberté de
16. Si la plupart des menaces se fixent un but, il semble que le but poursuivi par Ghyslaine Roc à travers la parole de Malika El Aroud soit seulement de susciter la peur, de terroriser. Il s’agit donc là d’un cas de menace exempt de chantage, qu’on pourrait dès lors situer dans le domaine de la prophétie magique. Sur la menace, voir Danblon E., « Argumenter par la menace : émotion et raisonnement », dans C. Plantin, M. Doury et V. traverso (éd.), Les émotions dans les interactions commu-nicatives, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, sur CD Rom, 2000.
242 Evelyne Guzy-Burgman
vivre en paix de la citoyenne musulmane Malika El Aroud, victime d’une lâche chasse aux sorcières depuis qu’elle a épousé la cause des opprimés de la terre. Louise Demahis-Michel, catholique déçue et victime de l’église, avait mené son combat sur les barricades armes à la main, sans peur et sans reproche. Malika El Aroud consacre sa vie et toute son énergie à la défense17 et au bien-être des prisonniers et de leurs proches familles de la tyrannie occiden-tale. En parlant de “l’interpellation” de la Mujaahida héroïne, victime permanente des médias racistes d’Europe et d’ailleurs, ces scribouilleurs de la petite semaine minimisent le comportement barbare et sadique de la “Police judiciaire fédérale” suisse (style Gestapo-Mossad !), qui n’est pas sans nous rappeler les exactions des soldats assassins, violeurs et sadiques anglo-saxons qui occu-pent illégalement et manipule [sic] l’Irak. »
Les journalistes y représentent une figure prototypique de la conspiration, ici assimilée aux puissances occidentales racistes, complices du complot américano-sioniste dénoncé par l’Appel18. L’ennemi « barbare » se voit alors identifié d’un seul bloc aux nazis et aux « sionistes » (« style Gestapo-Mossad ! »). Dans un geste postmoderne, les figures du Juif et du nazi se confondent, l’union des victimes et des bourreaux d’hier se trouve désormais consacrée dans une coalition contre les « opprimés ». On voit ainsi se dessiner clairement la figure, chère à l’auteur, de la « tyrannie occidentale » érigée en symbole de la lutte du mal face au bien, représenté par Malika El Aroud, égérie des musulmans.
Face à ces périls, cette figure ambivalente de la victime-héroïne tient une place cardinale dans la construction de l’ethos de Ghyslaine Roc. On la retrouve par exemple dans l’expression « la Mujaahida héroïne, victime permanente des médias racistes », où le mot « permanente » souligne la nature essentialisée de la victime. Pourquoi alors considérer Malika El Aroud comme une héroïne ? Parce qu’« elle a épousé la cause des opprimés de la terre ». Héroïne donc, parce que volontairement victime, c’est-à-dire martyr.
17. Il s’agit d’une allusion au site animé par M. El Aroud, le forum de discussion « Minbar-SOS », dédié à la défense des moudjahidines. Encore en ligne au moment de la réalisation de cette étude, en mai 2009, le site n’est plus disponible au moins depuis novembre 2009.
18. Plusieurs supposés conspirateurs seront désignés tout au long de l’Appel, lequel cite d’ailleurs, en référence, des auteurs conspirationnistes connus : Alex Jones et David Icke.
Face au complot, une guerre des saintes ? 243
L’argument victimaire du texte se fonde, dans sa grande part, sur la reprise du témoignage de Malika El Aroud, selon qui les policiers ont fait violemment irruption chez elle alors qu’elle était « presque nue » :
« L’œuvre de Satan et de ses suppôts suisses, sans nul doute, est néanmoins rapporté [sic] ici, venant de la bouche même de Malik [sic] El Aroud : “Oui. Les policiers ont fait irruption chez nous vers 5 h 30, en défonçant la porte. Quand j’entends des hurlements, un coup de feu, je me dis que je fais un cauchemar. Quelqu’un se jette sur moi. Une main m’attrape les cheveux, une autre me prend les mains et me tire en arrière, hors du lit. Je suis alors presque nue. Devant tous ces hommes, j’étais totalement humiliée. J’ai demandé à ce qu’on me couvre. Mais on m’a laissée ainsi pendant 40 minutes. J’avais aussi demandé à aller aux toilettes. Ils ont attendu le dernier moment pour me l’accorder. Là, ils ont laissé la porte ouverte et sont restés devant moi.”Malika El Aroud : “Je vais déposer une plainte contre le procureur, et contre tous ceux qui sont entrés chez moi, qui m’ont humiliée et m’ont laissée [sic] à moitié uriner sur moi-même. Je vais réclamer des dommages, des excuses, je veux qu’on me rende justice. Ils ont violé ma pudeur.”La pudeur est une notion que l’occident déchristianisé et islamo-phobe (trouille de l’Islam et de ses vertues [sic]) ne reconnaît plus ! »
Ici, tout en soulignant l’humiliation subie, laquelle renvoie au processus de la vengeance archaïque, Malika El Aroud exige réparation au nom du droit moderne ; elle en appelle à la « justice » des hommes, « réclame des dommages, des excuses ». On retrouve donc clairement le paradoxe propre à la pensée conspirationniste, telle que l’a analysée Emmanuelle Danblon dans ce volume. Alors même que la victime est essentialisée tant dans sa souffrance que dans son statut d’héroïne, l’appel aux prin-cipes et à la justice des Droits de l’Homme, au cœur de la modernité, constituent des éléments centraux dans l’argumentaire de l’auteur. En tout état de cause, le texte convoque un nouveau droit, sur lequel débou-che l’association ou plus exactement le dépassement des références topiques archaïques et modernes : le « droit à la pudeur ». Ni moderne, ni archaïque mais bien religieux, ce nouveau « droit » puise sa force de conviction dans l’ethos de l’héroïne, victime du complot occidental (« œuvre de Satan et de ses suppôts suisses ») contre l’Islam et ses
244 Evelyne Guzy-Burgman
principes. De façon plus générale, le statut victimaire de Malika El Aroud, « violé[e] » dans sa condition de croyante, charrie celui de tous les musulmans, dont l’Occident « déchristianisé », et donc mécréant, ne reconnaît pas les valeurs (ou les « vertus ») religieuses.
II. Construction de l’ethos et intertextualité
Malika El Aroud se trouve également porteuse de la cause des femmes. Pour construire cette figure symbolique, Ghyslaine Roc évoque celle de Louise Michel, une héroïne emblématique de la Commune (1871), dont on fêtait, en 2005, le centième anniversaire de la mort. Louise Michel a lutté, en son temps, contre le pouvoir des puissants ; Malika El Aroud combat, quant à elle, la tyrannie et la conspiration occidentales à notre époque. L’analogie avec Louise Michel revient à plusieurs reprises dans le texte. Son destin, associé à celui de Malika El Aroud, se lie, par contrecoup, à celui de Ghyslaine Roc. Cette dernière, habitée par l’ethos héroïque des deux femmes, nous parle en définitive de sa propre histoire :
« Cela fait plus d’un demi-siècle que je subis la barbarie euro-péenne, ces assoiffés du sang de l’innocent, des pervers et des obsédés sexuels. Oui, nous sommes blessés du plus profond de notre corps et de notre âme et Malika a raison de dire qu’un lion blessé est TRÈS DANGEREUX !!! C’est évident. Et, ce ne sont pas des paroles en l’air même si actuellement la Nation de l’Islam (Ummah) est toujours enchaînée et désarmée.KP-SAH19 : “Vous dites que vos amis moudjahidin ont été un peu touchés par ce qui vous est arrivée [sic] ?MeA : – Un peu touchés ? Regardez ce qu’ils ont fait en Afghanistan : ceux qui m’avaient arrêtée, ils les ont tous tués20. Et plus tard, ils m’ont libérée des mains de l’Alliance du Nord.” »
L’évocation de Louise Michel est reprise, sans transition ni rapport logique apparent, dès le paragraphe suivant :
19. Abréviation du nom des journalistes.20. Ce passage nous éclaire quant au contenu de la menace proférée dans le titre :
il s’agit d’une menace de mort.
Face au complot, une guerre des saintes ? 245
« Louise Demahis-Michel 29.5.1830 – 9.1.1905Ma petite “Vierge Rouge”, BRAVO ! Un peu touchés ? Cela fait plus de cinq décennies que je subis l’arrogance de cet occident meurtrier, mais avant mon départ de ce monde immonde, je ferai insha’allah mon devoir d’homme libre, de Musulman authentique, de Mujaahid, soumis à personne sauf à Dieu. Louise Demahis-Michel, la « Vierge Rouge », n’aura pas à rougir de certaines femmes croyantes, combattantes, sans peur et sans reproche de notre ère, que Malika El Aroud symbolise aujourd’hui. Le jour où elle tombera sur le champ de bataille, d’autres Malika et d’autres “Vierges Rouges” la remplacera [sic], insha’Allah. »
Le passage, voire l’identification, de Louise Michel à Malika El Aroud s’opère presque imperceptiblement : l’héroïne de la Commune était surnommée « la Vierge rouge », et c’est ainsi que Ghyslaine Roc qualifie affectueusement Malika El Aroud. Le texte prend des accents lyriques avec l’évocation des cinquante ans de souffrance de Ghyslaine Roc. Celle-ci rend alors publique une promesse faite à Dieu, témoin du plus haut degré d’engagement vis-à-vis de soi-même : « Je ferai insha’allah mon devoir d’homme libre, de Musulman authentique, de Mujaahid, soumis à personne sauf à Dieu ». Elle en vient ainsi à parler d’elle-même au masculin, afin de revendiquer, semble-t-il, la qualifi-cation pleine et entière de combattant du jihad (« Mujaahid21 »). Une définition particulière est donnée ici à l’expression « homme libre » (avec une minuscule, à l’inverse de « Musulman » et « Mujaahid »), et ce dans la mesure où elle se trouve dépossédée de son sens ordinaire, pour désigner avant tout celui qui est soumis à Dieu (traduction de « muslim », « musulman »)22. Ghyslaine Roc parle ainsi, de manière à peine voilée, de sa future mort en martyr, puisqu’elle (ou il, on ne peut être affirmatif sur ce point) fera son « devoir » avant son départ « de ce monde immonde ». C’est le destin qu’elle prédit également à Malika El Aroud « le jour où elle tombera sur le champ de bataille », la prédiction exprimée au futur ne laissant aucun doute sur son caractère fatal, nécessaire.
21. On peut se demander si en parlant d’elle-même au masculin G. Roc ne désire pas asseoir de façon plus ferme son statut de héros, ce statut étant, j’y reviendrai, net-tement plus ambivalent dans le cas d’une femme.
22. Sur le processus de « requalification » à l’œuvre, sinon caractéristique des théories conspirationnistes, voir l’article de L. Nicolas dans ce volume.
246 Evelyne Guzy-Burgman
Comme Louise Michel, elles font toutes les deux partie des femmes prêtes à se sacrifier pour la cause. Mais quelle cause ? Celle des femmes ou celle des musulmans ? Le texte entretient la confusion. La focalisation de l’auteur sur le viol, la plus grave atteinte que l’homme, en tant qu’homme, puisse porter à la femme, donne une piste de réponse. Le substantif « viol » et ses dérivés23 apparaissent treize fois dans le texte et sur le forum. Les adjectifs « croyantes » et « combattantes » mis côte à côte suscitent également l’intérêt. Il semble que Louise Michel, profondément religieuse dans la première partie de sa vie, ait mis cet aspect de côté durant sa période révolutionnaire24. Ghyslaine Roc l’imagine cependant fière des futurs exploits des femmes du jihad, que Malika El Aroud symbolise selon elle aujourd’hui, et pour laquelle elle choisit un vocabulaire issu du monde de la chevalerie et du combat d’honneur (« sans peur et sans reproche »). La mise en coïncidence de la figure du croyant et de celle du combattant paré de valeurs morales permet de récupérer la dimension éthique du combat, essentielle à la culture jihadiste.
On voit ainsi comment les valeurs du jihad, telles qu’elles sont déclinées ici, se construisent grâce à une topique conspirationniste tantôt archaïque, tantôt moderne, et usent d’une approche capable de toucher un public sensible à ces nouvelles figures ambivalentes du monde contemporain : des figures qui valorisent la violence exercée au nom d’une « morale » supérieure. Sur le forum de discussion Ghyslaine Roc va plus loin encore dans la construction d’une image exemplaire de « la femme », tout en renforçant la figure de Malika El Aroud dont elle continue à nourrir son propre ethos :
« Depuis que j’ai appris cette nouvelle épreuve de notre Sœur, il y a [sic] peine quelques jours, je dors bien, mais je suis mal dans ma peau, mal, mal, mal. J’en suis malade. Je vis et revis ce cauchemar chaque jour. Dans la rue, je ne puis m’empêcher de laisser échap-per des larmes venant droit du cœur. […] Mon corps tremble ; mon âme souffre ; mon cœur semble vouloir me lâcher […]. Ô Mère de Jésus, femme élevée au dessus [sic] de toutes les femmes de la
23. Viol, violeur, violer (et ses conjugaisons), violenter.24. La lecture de la correspondance le L. Michel montre bien son passage de la
foi à l’idéal communard. Voir : Michel L., « Je vous écris de ma nuit ». Correspon-dance générale 1850-1904, éd. de X. Gauthier, Paris, Éd. de Paris, coll. « Essais et documents », 1999.
Face au complot, une guerre des saintes ? 247
création25, que tu aies existé ou pas, tu es en notre cœur à jamais, dans notre foi chrétienne et islamique, dans nos espérances ! Mais, pourquoi donc te viole-t-on au su et au vu [sic] de toute l’huma-nité ? Pourquoi outrage-t-on ta pudeur ? Pourquoi dénuder ton corps de femme pour te traîner comme une bête malfaisante devant le Sanhédrin26 suisse ? […] Ces monstres ne savent pas respecter la femme de l’homme ! Ils les vendent au plus offrant, les violent, les humilient, les souillent, les torturent pour leur plaisir sadique ! La femme n’est pour eux qu’un paquet de viande ! »
À nouveau, imperceptiblement, on passe d’une figure à une autre, ici de celle de la Vierge Marie à celle de Malika El Aroud. Le texte donne à penser que c’est la Vierge elle-même qui a été violentée par la police suisse. Les mauvais traitements subis lors de son interrogatoire par Malika El Aroud prennent ainsi le statut d’une profanation suprême, d’un sacrilège. Le passage se présente d’ailleurs sous la forme d’une prière (« Ô Mère de Jésus »). Marie – Maryam – tient une place fon-damentale dans l’Islam : son nom est le seul nom de femme cité dans le Coran27. La figure musulmane de Maryam superpose la Miryam biblique et la Marie des Évangiles28. Selon Michel Dousse, la Miryam biblique, restée vierge et consacrée par sa mère à Dieu, « annonce une nouvelle récapitulation de l’humanité en Maryam nouvelle Ève29 ». Le Coran mêle les deux figures de Marie dans une synthèse archétypale symbolique qui débouche sur une figure si stylisée qu’elle en devient
25. Allusion au Coran, Sourate 3, 42 (trad. Masson, D., p. 66) : « O Marie ! Dieu t’a choisie, en vérité ; il t’a purifiée ; il t’a choisie en préférence à toutes les femmes de l’univers ».
26. Dans la tradition juive, à la fois tribunal suprême et assemblée législative. L’utilisation de ce terme reporte l’histoire de M. El Aroud à l’époque de Marie.
27. Le Coran, trad. et notes de D. Masson, Paris, Gallimard, 1967, p. LIII. À propos de la place fondamentale que tient Marie dans le Coran et de ses différen-ces avec Marie la chrétienne, voir : Dousse M., Marie la musulmane, Paris, Albin Michel, coll. « L’islam des Lumières », 2005, et Gallez E-M., « Le Coran identi-fie-t-il Marie, mère de Jésus, à Marie, sœur d’Aaron ? », dans A.-M. Delcambre, J. bossharD et al., Enquêtes sur l’Islam – En hommage à Antoine Moussali, Paris, Desclée de Brouwer, 2004, p. 139-151.
28. Dans le même ordre d’idées, G. Dye a souligné, lors du séminaire « Figures communes » du Centre d’Études des Religions et de la Laïcité (CIERL) de l’ULB du 16 novembre 2009, la quasi-identification par le Coran de Moïse (frère de Miryam) à Jésus (fils de Marie).
29. Dousse M., Marie la musulmane, op. cit., p. 44.
248 Evelyne Guzy-Burgman
abstraite et donc sacrée. C’est sur cet ethos multiple qu’ouvre la figure construite en discours par Ghyslaine Roc.
Comme on peut le voir dans le tableau proposé ici, les qualités que Ghyslaine Roc s’attribue personnellement se nourrissent de trois figures féminines. Chacune d’elles dispose d’un ethos spécifique qui se trouve directement relié à une topique particulière : moderne (Louise Michel), « conspirationniste » (Malika El Aroud), religieuse et sacrée (Marie) :
test3031
30. Sur le forum : « L’Islam et la Ummah ont grand besoin d’une révolution ! » 31. Notons avec M. Dousse que les « récits bibliques associent la figure de Miryam
aux thèmes conjoints d’une attente déçue et d’une contestation » (Marie la musulmane,
LOUISE MICHEL MALIKA EL AROUD
GHySLAInE ROC MARIE
Héroïne. Héroïne. Future héroïne.Héroïne suprême :
femme choisie entre toutes, selon le Coran.
Pour les opprimés et
contre la tyrannie
pendant la Commune.
Pour les opprimés et contre la « tyrannie
occidentale ».
Pour les opprimés et contre la « tyrannie
occidentale30 ».
Pour les opprimés et contre la tyrannie31 .
Victime de l’Église et du pouvoir32.
Pudeur : La Vierge-rouge
Victime de l’Occi-dent et de la police
suisse. Pudeur violée
Victime de l’Occi-dent et de la police
anglaise33. (Pudeur) violée
Victime du pouvoir34.Pudeur : La Sainte
Vierge.
Combattante armée, « sans peur et sans
reproches ».
Moudjahida héroïne, symbole de la femme
combattante35, « sans peur et sans
reproches ».
Future Moudjahida, femme combattante, « sans peur et sans
reproches ».
Par essence sans peur et sans reproches, car
sainte.
Vierge et combattante. Veuve d’un martyr combattant.
Mère d’un martyr combattant (allusions à un fils mort au com-bat en Afghanistan36).
Vierge et mère de Jésus37.
Croyante chrétienne déçue par l’Église.
Croyante musul-mane.Son livre célèbre le jihad
comme le Coran et la Bible38.
Croyante chrétienne et musulmane.
Croyante chrétienne et musulmane.
Face au complot, une guerre des saintes ? 249
Ce tableau nous laisse bien percevoir une certaine image de la femme qui, tout en assumant son rôle de mère ou d’épouse, se révèle à la fois héroïne, victime et croyante. Dans la défense de ceux qui souffrent, son courage s’allie à sa vertu, faite de pudeur et de religiosité. « Sans peur et sans reproche », elle n’hésite pas à lutter contre les tyrans. Ses qua-lités morales lui donnent accès à un statut de sainteté, proche de celui du martyr musulman dont la violence est assumée : c’est un guerrier32.
Grâce à la construction de cet ethos fondé sur une identification à des figures emblématiques, Ghyslaine Roc s’attribue un rôle prophétique et s’insinue ainsi dans l’univers mythique du complot. Sa démarche s’inscrit dans un substrat culturel où chaque croyant s’identifie au Prophète et l’imite en tous points, Marie se substituant ici à Mohamed. Ainsi Malika El Aroud se hisse-t-elle, aux côtés de Louise Michel et de la Vierge Marie, dans un nouveau panthéon des Dieux, que s’apprête peut-être à rejoindre Ghyslaine Roc.religiosité33343536373839.
op. cit., p. 52), ce qui nous ramène à la Marie déclinée par G. Roc. Miryam, avec ses frères Moïse et Aaron, a mené les « opprimés » juifs hors du désert, les soustrayant au joug des Égyptiens. Quant à la mère de Jésus, elle représente l’exemple même de la musulmane soumise à Dieu. Sa voie spirituelle, faite d’effacement et de dépossession de soi, la mène, dans un acte ultime de confiance envers le Créateur, à accepter de devenir mère, alors qu’elle se voyait seulement en vierge consacrée à Dieu (Ibid., p. 196).
32. Cette deuxième partie étant sous-entendue.33. Soulignons que les milieux jihadistes demeurent très divisés quant à la possi-
bilité pour les femmes de participer au jihad les armes à la main. Il s’agit là, seulement, d’une revendication de certaines d’entre elles.
34. Sur le forum : « Pas plus tard qu’avant-hier soir j’ai failli me faire arrêter par la Gestapo londonienne pour avoir oser [sic] les comparer à [sic] Mossad au téléphone. »
35. Pour Miryam, il s’agit du pouvoir des Égyptiens qui a provoqué l’exode des Juifs ; pour Marie, de celui des Romains et des Juifs qui ont persécuté le Christ.
36. Soulignons que M. El Aroud mène un combat idéologique et qu’elle n’a pas pris concrètement les armes.
37. Sur le forum : « Massoud aurait sauvé la vie de mon fils Olyeg, je lui devrais alors ma vie, mais cela ne s’est pas fait, car Dieu en avait décidé autrement. »
38. Le Coran envisage la figure de Jésus à travers sa mère. Selon Dousse, « Dans le Coran, c’est Marie qui entre dans la dénomination de son fils : “Jésus-fils-de-Marie” […] et non pas l’inverse (Marie mère de Jésus) » (Marie la musulmane, op. cit., p. 16). Notons que G. Roc a utilisé l’expression « Mère de Jésus », qui évoque la tradition chrétienne (les termes consacrés étant « Mère de Dieu », mais l’Islam ne reconnaît pas la divinité de Jésus). Pour les musulmans, Jésus, prophète et messager, n’a pas été crucifié mais sauvé par Dieu et élevé au ciel.
39. Dans le texte : « Le livre de Malika “Les Soldats de Lumière” n’est pas le seul
250 Evelyne Guzy-Burgman
III. La violence légitimée
Ghyslaine Roc se présente comme victime, et même doublement victime : en tant que femme et en tant que musulmane. À côté d’elle, une autre femme souffre, victime, elle aussi, de « la barbarie40 » occidentale et plus particulièrement de la cruauté de ses hommes. Malika El Aroud n’est pas seulement la sœur en Islam de Ghyslaine Roc, elle symbo-lise son propre destin. Sa vie se situe dans le sillage de celle d’autres femmes, pures et héroïques, la Vierge Marie et la Vierge Rouge. Ghyslaine Roc est allégoriquement Malika El Aroud, et à travers elle, toutes les femmes qui se sacrifient pour les « opprimés ». À l’image des hommes, elle défend la cause et aspire à devenir une héroïne autant qu’une femme libre. Mais, comme rattrapée par son identité, elle parle en femme, en mère, elle exprime ses émotions, sa compassion41. Ghyslaine Roc s’attendrit au sujet de Malika El Aroud, sa semblable, son autre elle-même. Elle se penche exclusivement sur la souffrance des musulmans, et plus encore sur celle des musulmanes. Dans le cadre de cette figure communautaire, « le malheureux est immédiatement quali-fié ; il n’est jamais par construction, n’importe qui42 ».
Ceci nous permet très concrètement de faire le lien entre l’ethos que nous venons de décrire, les différentes topiques utilisées pour y parvenir et l’émotion centrale dans cette construction : le ressentiment. Comme l’écrit Marc Angenot : « le ressentiment qui recrée une solidarité entre pairs rancuniers et victimisés et valorise le repli communautaire apparaît comme un moyen de réactiver à peu de frais la chaleur de la communion43 » dans un monde froid et sans frontières. Cette chaleur
livre à célébrer le “Djihad” ; la Sainte Bible et le Saint Qur’ân, les Livres de (attribués à) Dieu font de même. » G. Roc a recours à une interprétation de la Bible qui la dis-tancie de la lecture commune de ce texte. Voir : El Aroud M., Les soldats de lumière, Bruxelles, Les ailes de la miséricorde asbl, 2003, Téléchargeable sur http://ansar-alhaqq.net/PDF/LESSOLDATSDELUMIERE.pdf.
40. On relèvera ici un des nombreux intertextes avec le préambule de la Déclara-tion Universelle des Droits de l’Homme (2e paragraphe).
41. Danblon E., « Peut-on faire l’éloge d’une femme ? », dans E. Danblon (éd.), Degrés – « Les stéréotypes féminins. Une étude rhétorique et discursive », n° 117, 2004 (24 p.).
42. Boltanski L., La souffrance à distance : morale humanitaire, médias et politique ; suivi de La présence des absents, Paris, Gallimard, coll. « Folio – Essais », 2007 [1993], p. 35.
43. Angenot M., Dialogues de sourds. Traité de rhétorique antilogique,
Face au complot, une guerre des saintes ? 251
est nourrie d’une rumination partagée sur les humiliations subies par le passé. Ghyslaine Roc revient sans cesse, ressasse, ce qu’elle a subi, en cinquante ans de vie. Elle assimile son destin à celui de toutes les victimes et damné(e)s de la terre, que le ressentiment érige en héros (ou en héroïnes). Mais, loin de se plonger dans la passivité et le désespoir du monde désenchanté, comme le font les idéologies du ressentiment telles que décrites par Marc Angenot, Ghyslaine Roc se tourne, pleine d’espoir, vers des lendemains qui chantent. Sa voix, pense-t-elle, est celle des opprimés, qui, un jour, inévitablement, se lèveront pour écraser ensemble la domination et la conspiration occidentales. Sa voix est aussi celle des musulmans qui savent, parce que c’est écrit dans le Coran, que le règne d’Allah adviendra. Sa voix est enfin celle d’un avenir qu’elle fonde sur une vision de l’histoire, nourrie, de façon syncrétique, de deux utopies : l’une séculière – qui va de la Révolution française au tiers-mondisme –, l’autre religieuse – qui se nourrit du Coran et convoque des figures chrétiennes. Selon elle, le monde va changer parce que le peuple musulman, qui compte dans ses rangs des femmes valeureuses et justes, comme elle, comme Malika El Aroud, crie vengeance et s’arme contre les conspirateurs qui veulent sa perte.
Pour parvenir à ses fins Ghyslaine Roc construit son discours antioccidental en fonction des attentes supposées de l’auditoire auquel elle s’adresse : musulman, bien sûr, mais profondément imprégné des figures et des représentations occidentales, françaises notamment. Elle légitime sa parole par l’établissement paradoxal d’une topique conspi-rationniste tout à la fois moderne et antimoderne. En effet, s’il se teinte de l’espoir des Lumières – tout en prenant appui sur une lecture violente de l’Islam –, dans un même temps, l’Appel de Ghyslaine Roc fait écho au malaise d’une société qui n’ose plus croire ni aux valeurs qu’elle a proclamées, ni même en l’Humanité. Derrière cette construction discur-sive se dessine la complexité d’une topique contemporaine – dressée par Emmanuelle Danblon et Emmanuel de Jonge44 – expliquant les ambiva-lences d’une modernité orpheline de ses propres espoirs et de ses idéaux fondateurs. C’est bien là, au cœur d’une logique conspirationniste, que s’élabore le nouveau statut d’héroïne défendu dans l’Appel.
op. cit., p. 349.44. Voir le numéro spécial de la revue en ligne Argumentation et Analyse du
Discours consacré aux « Droits de l’Homme en discours », Danblon E. et Jonge E. de (éd.), http://aad.revues.org/index763.html.
252 Evelyne Guzy-Burgman
Conclusion
On a vu ici combien la construction d’une figure héroïque victimaire, à partir d’une cascade d’images féminines, pouvait trouver sa cohérence au sein même d’une vision conspirationniste de la société. Mais l’image de ces victimes-héroïnes, à la fois saintes et combattantes, ne saurait se décliner comme celle d’un héros masculin, fort et dominant. Elle implique forcément l’intégration de « valeurs féminines », telles que la douceur, la sensibilité, la sollicitude, dans un contexte où la femme est dominée, et donc bien moins crédible que l’homme dans un tel rôle.
Et pourtant, comment expliquer ce tour de force rhétorique qui consiste à subsumer, sous une seule figure, la violence et la douceur, les valeurs archaïques et les principes de la modernité ? Sans doute la capa-cité exemplaire de la rhétorique contemporaine d’articuler avec talent héroïsme et ressentiment, lendemains qui chantent et désenchantement, constitue-t-elle ici un élément de réponse.
Face au complot, une guerre des saintes ? 253
Les théories du complot en Chine de la fin de l’empire à la Révolution
culturelle : ruptures et continuités
Françoise Lauwaert
Les Chinois disposent depuis l’Antiquité de tous les mots néces-saires pour évoquer les activités des conspirateurs qui hantent leurs livres d’histoire. Les plus fréquents pour « complot » ou « comploter » sont yinmou ou mimou, deux composés où figurent l’ombre (yin) et le secret (mi). Leur élément commun mou devint usuel sous les Royaumes Combattants (453-221 av. J.-C.), une période riche en ruses et stratagè-mes que l’on considère généralement comme l’âge d’or de la philosophie chinoise. Le dictionnaire étymologique Shuowen jiezi (Propos sur les wen et analyse des zi), compilé au premier siècle de notre ère, en donne la lecture suivante : « c’est ce qui est ardu à penser » (lü nan yue mou). Écrit avec la « clé1 » de la parole, ce caractère ne décrit pas seulement un mouvement de la pensée, mais aussi un acte de langage consistant à mettre son projet en mots pour soi-même ou pour d’autres. Or, s’ils ne condamnent pas frontalement le discours et l’explicite, les Chinois ont souvent été tentés de voir dans le logos l’effet d’une pensée appliquée, voire calculatrice s’écartant des figures idéologiques du « naturel » et de la « sincérité ». Ceci peut expliquer pourquoi mou, qui peut être positif ou neutre (surtout dans les occurrences les plus anciennes), se charge de connotations négatives ou ambiguës dans bon nombre de ses composés. C’est le cas de mousi, « chercher son propre intérêt », qui prend un sens négatif lorsqu’il est lu à la lumière de l’opposition entre gong, le service de la collectivité, et si, la recherche égoïste d’un avan-tage personnel. De même, l’expression mouchen, « conseiller habile », aura un sens très différent selon qu’elle désignera le stratège de son propre camp ou celui de l’ennemi. Cette ambiguïté est renforcée par le
1. Élément sémantique permettant d’opérer un classement des caractères et faci-litant leur recherche dans les dictionnaires.
fait que sous sa forme verbale, mou peut prendre aussi bien un complé-ment direct qu’indirect. « Concevoir un projet » ou « comploter contre l’État » se construisent donc de la même façon, et le sens de l’acte dépendra en dernière instance de celui qui l’accomplira, comme dans l’expression : « l’homme de qualité a le bien en vue ; l’homme de peu complote contre l’État » (junzi mou shan ; xiaoren mou guo).
En dépit de cette richesse lexicale et de leur goût pour les intrigues à rebondissements, les Chinois ne semblent pourtant pas avoir produit de théorie générale du complot avant l’époque contemporaine. Dans la littérature sérieuse ou romanesque, les complots apparaissent comme des menées ponctuelles et toujours déjouées, tramées par des personnalités perverses et ambitieuses. Attribuer à un groupe particulier le pouvoir de contrôler en secret la vie politique du pays tout entier serait revenu en définitive à réfuter la théorie du mandat céleste (tianming), qui fut la principale légitimation des princes au cours des siècles. Cette construction ingénieuse, reposant sur une cosmologie complexe, un recours sys-tématique à l’analogie et une science de l’interprétation des signes, connut son plus haut niveau d’élaboration à la fin de l’Antiquité et sous la dynastie des Han (206 av. J.-C. – 220 apr. J.-C.). Elle attribuait au souverain, et à lui seul, la responsabilité de garantir la conformité de la société humaine à l’ordre céleste, et ceci en vertu du « mandat » que lui conférait le Ciel, son ancêtre le plus lointain. Seul le Ciel et son unique représentant légitime, le Fils du Ciel, avaient le pouvoir de régler et de dérégler la marche du monde.
Corrélativement, une dynastie se révélant incapable d’assumer sa tâche ordonnatrice perdait sa légitimité et s’exposait à être ren-versée sans délai. Le changement de mandat (geming, un terme qui fut repris à l’époque contemporaine pour dire « révolution ») était annoncé par des présages, auxquels faisait écho la demande du peuple que l’on transférât le pouvoir à celui que les puissances transcendantes désignaient pour l’exercer. Le fondateur d’une nou-velle dynastie ne pouvait donc être un rebelle ni un conspirateur ; il prenait place dans la lignée idéalement rectiligne des Fils du Ciel, tandis que les rédacteurs de l’histoire officielle de la dynastie précédente tentaient de faire oublier les aspects les plus rugueux de la conquête du trône. Rien n’interdit cependant aux spécialistes modernes de ces temps anciens de qualifier de « conspirations » certaines machinations des prétendants au mandat céleste, lesquel-
Les théories du complot 255
les machinations impliquaient la mobilisation d’un appareil de propagande considérable2, ainsi que l’élimination symbolique et très souvent physique des souverains disqualifiés, des prétendants malchanceux et de leurs partisans.
I. Comploteurs et Fils du Ciel
La théorie du mandat céleste a constitué une sorte de point d’arrêt aux dérives interprétatives portant sur les sommets du pouvoir, mais elle n’a pas préservé les Chinois du recours ponctuel aux catégories du complot et de la conspiration. Celles-ci trouvaient un terrain par-ticulièrement favorable dans deux milieux que tout semblait a priori séparer : les sociétés secrètes et les mouvements sectaires recrutant dans les milieux populaires, d’une part ; les hautes sphères du pouvoir, de l’autre. Entrer dans les ramifications des sociétés secrètes sans cesse renaissantes qui ont proliféré sur le sol chinois nous emmènerait trop loin. Nous pouvons cependant avancer, en simplifiant les propos de Barend ter Haar3, que pour ces tenants d’idéologies millénaristes, dont le modèle d’action était l’exorcisme, il s’agissait d’éliminer par la vio-lence les « démons » qui détenaient le pouvoir, plutôt que de mettre en place des stratégies subtiles de contrôle des leviers de commande. Une même violence directe leur était renvoyée par les autorités, qui crai-gnaient la rébellion et la subversion plus que les complots pour autant que l’on restât en milieu paysan. Dans les milieux proches de la cour, au contraire, tout l’art consistait à impliquer ses adversaires dans des procès et les compromettre dans des intrigues savamment ourdies, aussi l’accusation de complot était-elle d’usage courant.
Les membres de la famille impériale et plus particulièrement la paren-tèle féminine sont traditionnellement dépeints comme des comploteurs dans les histoires officielles, mais cela n’a rien de très spécifiquement
2. Voir à ce propos : Wechsler H. J., Offerings of Jade and Silk: Ritual and Symbol in the Legitimation of the T’ang Dynasty, New Haven, Yale University Press, 1985, et seiDel A., « Imperial Treasures and Taoist Sacraments – Taoist Roots in the Apocrypha », dans M. strickmann (ed.), Tantric and Taoist Studies in Honor of R. A. Stein, II, Bruxelles, Mélanges chinois et bouddhiques, XXI, 1983, p. 292-371.
3. ter Haar B. J., « China’s Inner Demons: The Political Impact of the Demono-logical Paradigm », China Information, XI (2-3), 1996, p. 54-85.
256 Françoise Lauwaert
chinois, et nous nous intéresserons davantage à cette autre composante de l’élite, autrement plus active et intéressante, qu’est la haute bureau-cratie, et ceci particulièrement à partir des Ming (1368-1644). La fin de cette dynastie avait vu l’émergence d’une sorte de « parti » se réclamant de l’Académie Donglin, un cénacle de lettrés et de hauts fonctionnaires réputé pour son orthodoxie et son intégrité, comme pour la qualité intel-lectuelle de ses membres. Ces confucianistes fervents s’étaient érigés en censeurs du comportement impérial et dénonçaient avec virulence le pouvoir des eunuques. Ces derniers, qui constituaient une sorte de bureaucratie parallèle, étaient parvenus à l’époque à concentrer entre leurs mains des pouvoirs de police et s’étaient transformés en outils commodes de l’absolutisme impérial. En 1620, l’empereur Wanli (r. 1573-1620) meurt à l’âge de 57 ans et son successeur, Taichang, ne lui survit que quelques mois. La crise est d’autant plus grave que le souverain avait longtemps hésité à désigner ce prince comme son héritier, lui préférant le fils de sa concubine favorite, et ceci à la plus grande indignation des confucéens orthodoxes. Wanli était un empereur négligent, et l’état d’abandon dans lequel il laissait les affaires de la cour avait contribué à dégrader la vie politique du pays.
Trois affaires successives qui encadrent la mort de Wanli sont dénoncées comme autant de complots visant directement la per-sonne impériale. Une seule nous suffira à rendre compte du climat de l’époque. Ardemment attendu par les partisans du Donglin, le nouvel empereur Taichang, réputé hostile au « parti » des eunuques, meurt dans des circonstances suspectes. Sentant ses forces minées depuis son intronisation, cet homme de trente-huit ans recourait régulièrement aux redoutables toniques dont la médecine chinoise se faisait une spécialité. Un médecin extérieur, appelé en toute hâte, lui propose une « pilule rouge » contenant, entre autres ingrédients, du plomb et du cinabre. Le Fils du Ciel meurt le jour même après avoir avalé deux doses du remède. S’agissait-il d’un empoisonnement volontaire, comme l’ont immédiatement clamé les membres du Donglin ? Comme bon nombre de ses prédécesseurs, l’empereur avait-il succombé aux remèdes mira-cles délivrés par quelque Diafoirus chinois ? Était-il déjà perdu avant d’avaler les pilules ? Il est impossible de trancher, mais les tenants de la thèse du complot n’ont aucun doute et font valoir leur opinion avec la plus extrême vigueur. Mus par un idéal de réforme politique et morale, ils agissent à visage découvert et cherchent l’affrontement, s’en prenant avec une témérité suicidaire à leurs adversaires haut placés. Ceux-ci
Les théories du complot 257
ripostent en accusant de corruption les porte-parole les plus véhéments du Donglin. Cette accusation n’a en soi rien d’extravagant, la corruption étant l’un des maux endémiques du système politique chinois, mais elle est calomnieuse dans ce cas précis. Soumis à des séances répétées de torture, détenus dans des conditions illégales et sommés de rendre gorge dans les plus brefs délais, les principaux accusés périssent l’un après l’autre dans les geôles secrètes du Palais. Leurs supposés com-plices sont poursuivis et l’Académie Donglin doit fermer ses portes. Cette affaire fit relativement peu de victimes, mais elle eut un impact symbolique considérable. Elle contribua à dégrader le climat politique et moral de la dynastie et fut même considérée comme l’une des causes indirectes des troubles qui allaient entraîner la chute des Ming vingt ans plus tard.
Si l’accusation de complot portée par les lettrés à l’encontre du parti des eunuques a échoué, ce n’était pas par l’effet d’un sursaut de la pensée critique, ni par la mise en œuvre de mécanismes de contrôle et de vérification, mais parce qu’il n’y avait personne à la tête de l’État pour la reprendre à son compte. Tianqi (r. 1621-1628), l’empereur adolescent qui avait succédé à Taichang, ne se distinguait pas par un rationalisme ardent et il avait accrédité une version des faits faisant la part belle au hasard essentiellement en raison de son hostilité au parti des lettrés. Tout au long de son règne, il couvrit les exactions de son eunuque favori Wei Zhongxian, alors sans doute l’homme le plus puissant de l’empire, et ne fit rien pour contrôler les eunuques. Le retournement de fortune n’en fut que plus rapide avec l’accession au trône de son successeur, qui renvoya aux ennemis du Donglin l’accusation de menées conspiration-nistes et poursuivit avec le même acharnement les principaux partisans du Grand Eunuque désormais proscrit.
C’était bien le Fils du Ciel qui possédait l’ultime pouvoir de donner ou non à une affaire la qualification de « complot » et d’embastiller ses adversaires, mais il ne pouvait aller jusqu’à heurter frontalement l’ensemble de sa bureaucratie et bafouer les valeurs incarnées par l’élite lettrée, sous peine de se discréditer aux yeux de ceux qui incarnaient la conscience morale de l’empire. Ce rôle crucial dévolu à l’empereur, tout comme la nécessité qui lui était faite de respecter certaines règles de procédure apparaissent dans une autre affaire, survenue sous le règne de Kangxi (1662-1722).
258 Françoise Lauwaert
En 1644, des cavaliers venus du Nord-Est s’emparent de Pékin à l’occasion d’une crise ouverte par de grandes rébellions populaires. L’empereur se suicide, les princes Ming s’enfuient et tentent maladroi-tement d’assurer la survie de la dynastie dans le Sud. Vingt ans plus tard, le pouvoir est aux mains de Kangxi, un Mandchou capable et énergique, dont le règne durera soixante ans. La jeune dynastie des Qing (1644-1911) veille à imposer sa propre version de l’histoire : toute référence à ses origines étrangères, aux massacres de la conquête comme aux derniers combats des légitimistes Ming est bannie des annales. Ceux qui résistent à cette récriture du passé sont traqués.
C’est sur cette toile de fond que doit se comprendre l’accusation lancée le 21 novembre 1711 par le président du tribunal des censeurs (l’organisme central chargé de contrôler l’administration) à l’encontre de l’académicien Dai Mingshi (1653-1713). Cet écrivain récemment promu fonctionnaire est accusé d’avoir donné dans ses écrits l’appel-lation de « dynastie des Ming du Sud » à la période d’une vingtaine d’années qui vit les derniers soubresauts de la dynastie vaincue4. Agir de la sorte, c’est reconnaître l’existence simultanée de deux Fils du Ciel sur le sol chinois et faire peser une accusation d’usurpation sur la nouvelle dynastie. Non seulement l’auteur de ce crime de haute trahison encourt la peine de mort sous sa forme la plus sévère, mais sa culpabilité rejaillit sur ses proches. La famille et les amis lettrés de Dai Mingshi sont aussitôt emprisonnés tandis que l’on traque l’éditeur, les préfaciers et les personnes nommément citées dans l’ouvrage incriminé. Pierre-Henri Durand5 retrace les méandres de cette affaire, connue sous le nom de « Procès de la Montagne du Sud », dans un livre passion-nant, qui est aussi une sociologie du mandarinat au xviiie siècle. Selon son analyse, les raisons de la susceptibilité particulière de l’empereur sont à trouver dans une grave crise de succession qui empoisonnait alors la vie de la cour, comme dans la méfiance qu’il éprouvait à l’en-contre des lettrés du Sud et particulièrement de la ville de Tongcheng, dont étaient issus la plupart des accusés. Ce procès, poursuit l’his-torien, ne constituait qu’une pièce dans une partie complexe que jouait Kangxi avec le sommet de l’appareil bureaucratique chinois,
4. Pour une traduction française : Dai Mingshi, Recueil de la Montagne du Sud, trad. du chinois, présenté et annoté par P.-H. Durand, Paris, Gallimard, coll. « Connaissance de l’Orient », 1998.
5. Durand P.-H, Lettrés et pouvoirs. Un procès littéraire dans la Chine impé-riale, Paris, Éd. de l’EHESS, 1992.
Les théories du complot 259
dont il suspectait la loyauté, et la haute noblesse mandchoue qu’il entendait contrôler.
Bien qu’il ne s’agisse pas d’un complot au sens strict du terme – l’on chercherait en vain l’existence d’un projet commun à la quarantaine d’accusés –, la logique inquisitoriale des enquêteurs parvint à transfor-mer un réseau de collègues et d’amis en un groupe de conspirateurs. Les verdicts avaient valeur d’avertissement : le passé appartient aux seuls historiens officiels enrôlés dans le projet impérial. Une fois cette leçon assénée avec tout le poids de l’appareil répressif, le souverain put, par un effet de sa mansuétude personnelle, tempérer la dureté des lois et commuer les peines les plus sévères.
Cette affaire n’a pas valu à ses protagonistes le même jugement de l’histoire que la persécution du Donglin. Le poids moral et institutionnel des accusés était différent, tout comme l’étaient les intentions prêtées à leurs persécuteurs. S’il s’agissait dans le dernier cas d’un abus de pouvoir caractérisé, enfreignant les normes juridiques communément admises et exposant au grand jour la cruauté d’officines gouvernemen-tales irrégulières, l’enjeu du procès de Dai Mingshi était plus abstrait et portait sur l’établissement d’une orthodoxie historique. Ordonner et contrôler la rédaction de l’histoire de la dynastie précédente étaient des prérogatives impériales, les Fils du Ciel étant, en effet, tout à la fois les créateurs et les garants des « dénominations correctes » (zhengming). Ceci n’impliquait pas, pour autant, la nécessité de falsifier la vérité historique, et l’on trouve une grande diversité d’attitudes selon les époques. La position de Kangxi et celle qu’adoptèrent ses successeurs dans des affaires comparables s’inscrivait à l’extrémité d’un continuum allant de la tolérance à l’autoritarisme, sans franchir pour autant les limites de la légitimité. Pour violente qu’elle fût, l’action qu’il diligenta à l’encontre de Dai Mingshi et de ses amis ne sortait pas du cadre des lois sur les atteintes à la personne impériale.
Ces deux exemples nous montrent que c’était en définitive l’État, en la personne du Fils du Ciel, qui était le principal créateur des théories du complot. Mais pour que ces dernières connaissent un complet triomphe, il fallait encore qu’elles surmontent les résistances opposées par l’appa-reil administratif, enclin souvent à plus de prudence ou de rationalité. Cet aspect apparaît en filigrane dans le livre remarquable que Philip Kuhn6 consacra à une affaire de sorcellerie survenue au milieu du règne
6. Kuhn P., Soulstealers. The Chinese Sorcery Scare of 1768, Cambridge –
260 Françoise Lauwaert
de l’empereur Qianlong (1735-1796). L’on peut y voir en effet le sou-verain dénoncer l’inertie, la passivité et l’incrédulité d’une partie de son administration dans une affaire qui se présente à ses yeux soupçonneux comme un complot dirigé contre son règne.
En 1768, éclate une panique dans la province du Zhejiang, située dans la riche région du bassin inférieur du fleuve Bleu. Des maçons ambulants et des moines errants sont violemment pris à parti ; ils sont accusés de couper la natte de passants pour en faire des charmes magi-ques. La police arrête les suspects et tente de leur extorquer des aveux7. De pareilles accusations constituent une épreuve bien embarrassante pour les autorités locales, qui redoutent les troubles de l’ordre public tout en professant le plus grand mépris pour la crédulité de ceux qu’ils appellent « le peuple stupide ». S’il existe bien dans le code quelques articles sur la magie noire, ils sont rarement appliqués et un fonction-naire avisé évitera de se lancer dans une chimérique chasse aux sorciers. Mais les procédures bureaucratiques imposent l’envoi de rapports aux échelons supérieurs ; les émeutes ayant fait des victimes, les dossiers remontent la pente administrative jusqu’à l’empereur. Celui-ci s’en-flamme aussitôt et dénonce la mollesse des autorités locales devant ce qui lui apparaît comme une menace pour son règne. La réprimande impériale, formulée dans les termes les plus vifs et assortie de menaces de sanctions, agit comme un électrochoc. Les magistrats vont désormais mettre le plus grand zèle à pourchasser les sorciers.
Comment en est-on arrivé là ? La cour est une fois de plus boule-versée par une crise de succession et par les difficiles arbitrages entre Chinois et Mandchous, et cette affaire vient rappeler l’un des épisodes cruciaux de la fondation de la dynastie. Dès les premiers jours de la conquête, ordre avait été donné aux nouveaux sujets de se raser le haut de la tête et de porter le reste des cheveux nattés, à la manière man-dchoue. L’adoption d’une autre coiffure était interprétée comme un acte de rébellion et punie de mort immédiate. Cette mesure, qui avait pour conséquence d’inscrire à même le corps de la population vaincue la trace de sa sujétion, était extrêmement impopulaire et suscita une
Mass., Harvard University Press, 1990.7. Contrairement à la persécution du Donglin et, dans une moindre mesure, au
procès de Dai Mingshi, mettant en scène des lettrés de haut rang, ce « complot » n’a pas laissé de traces dans la mémoire collective, et il a fallu toute l’habileté de l’histo-rien pour faire revivre ses humbles protagonistes à partir de documents conservés dans les archives de Pékin.
Les théories du complot 261
résistance immédiate. Il en résulta une sorte d’obsession de la coiffure : à l’obsession du contrôle de la part des autorités répondait la peur des Chinois, mêlée à l’envie sans cesse renaissante de braver l’interdit. Cela explique à la fois la terreur des coupeurs de nattes et le sérieux mis par l’empereur à traquer les supposés rebelles comme à réprimander les fonctionnaires sceptiques ou négligents.
Des malheureux sont arrêtés et soumis à la question. Petit à petit se dessine une piste traversant plusieurs provinces, au gré des errances des marginaux qui constituent la cible privilégiée des rumeurs. Ce qui se profile désormais, c’est une conspiration d’ampleur nationale visant directement le pouvoir impérial. Les suspects appartiennent aux couches les plus basses de la population et leur croyance aux vertus des charmes n’est pas partagée par les élites, il est donc impossible de leur trouver des complices haut placés. C’est sans doute ce qui va limiter, à terme, la portée de l’affaire.
Philip Kuhn dénoue l’un après l’autre les fils de cette histoire embrouillée. Il décrit en profondeur le substrat sociologique et religieux de cette peur des sorciers, dépeint la personnalité de Qianlong et les conflits dans lesquels se débat cet « hyper-empereur », tout en donnant un aperçu fascinant du fonctionnement de l’appareil judiciaire. Celui-ci n’est pas une simple chambre d’enregistrement, et certains fonction-naires ne partagent pas la crédulité impériale. C’est finalement par des arguments juridiques que le Grand Secrétaire Liu Tongxun (1698-1773) parvient à convaincre le souverain de la légèreté du dossier. Cet homme d’expérience, qui préside alors le ministère de la Justice, souligne le rôle néfaste joué par les fonctionnaires subalternes dans leur fabrication de coupables et les risques que cette attitude comporte pour la stabilité de l’empire. Transparaît aussi une critique voilée de la torture, dont les juges connaissent bien la cruauté et l’inefficacité, mais dont ils ne peuvent se passer pour obtenir les aveux indispensables à la clôture du dossier. Les arguments du Grand Secrétaire finissent par porter. Progressivement, les charges sont abandonnées à l’encontre des sup-posés sorciers. Pour bon nombre d’entre eux, morts de maladie ou des suites des tortures subies pour leur faire avouer des crimes imaginaires, la réhabilitation viendra trop tard.
Ces trois affaires constituent autant d’exemples de la manière dont l’exception parvient à se nicher dans l’appareil politique et judiciaire ordinaire dès lors que la personne impériale et les institutions fon-damentales paraissent en danger. La gravité de la menace requiert
262 Françoise Lauwaert
l’adoption de mesures exceptionnelles, qui sont désignées comme telles et doivent être limitées dans leur temps d’application comme dans leur portée. Toute la question réside dans la définition du crime et l’évalua-tion du danger : à quel moment peut-on sortir de la légalité ordinaire pour entrer dans ce qui s’apparente à un droit de guerre impliquant le recours à une violence étatique exceptionnelle ?
II. Quand l’exception devient la règle
Dans la période moderne, l’usage de la juridiction d’exception en vient progressivement à se généraliser. L’historien Xiaoqun Xu8 et l’anthropologue Zhang Ning9 soulignent tous deux la fréquence du néologisme fei pour désigner certaines catégories de brigands dans le contexte troublé du xixe siècle et du début du xxe siècle. Le recours à ce terme, qui porte en lui la notion de négativité, facilite le rejet hors de l’humanité d’êtres décrétés malfaisants et voués à une extermination rapide et radicale. Nous sommes revenus au paradigme démonologique décrit par Barend ter Haar10. C’est paradoxalement alors que se poursuit la réforme du système judicaire et des procédures pénales que se creuse l’écart entre la répression des crimes et délits ordinaires et la jurispru-dence d’exception qui s’abat sur ceux qui présentent un danger pour le nouvel État républicain11. En agissant de la sorte, les réformateurs ne font qu’étendre à de nouvelles catégories de criminels le traitement qui était réservé sous l’empire aux coupables des crimes les plus graves, au premier rang desquels figuraient la rébellion, la trahison et le complot contre le trône.
8. Xu Xiaoqun, « The Rule of Law Without Due Process: Punishing Robbers and Bandits in Early-Tenthieth-Century China », Modern China, 33, 2007, p. 230-257.
9. ZhanG Ning, « Catégories judiciaires et pratiques d’exception : “banditisme” et peine de mort en Chine », dans M. Delmas-marty et P.-E. Will (dir.), La Chine et la démocratie, Paris, Fayard, 2007, p. 195-213.
10. ter Haar B. J., « China’s Inner Demons: The Political Impact of the Demono-logical Paradigm », art. cit.
11. Xiaoqun Xu repère ainsi « a continuous tension between, on the one hand, the principle of rule of law, judicial independence, and due process that guided the legal-judicial reform and were insisted on by judicial officials and, on the other hand, the desire of provincial and county administrative officials to resort to “quick justice” to punish and deter violent crime. », art. cit., p. 231.
Les théories du complot 263
Cette banalisation des mesures d’exception s’accélère avec l’acces-sion des communistes au pouvoir. Les codes de l’époque républicaine sont supprimés et le rôle des institutions judiciaires s’estompe au profit de l’armée et de la Sûreté. Pendant la Révolution culturelle, les seuls organes de répression sont les « masses » elles-mêmes, qui se chargent d’arrêter les « contre-révolutionnaires » et de les enfermer dans des lieux de détention privés appelés « étables » (niupeng), qui rappellent les prisons irrégulières des eunuques.
Sitôt après la prise du pouvoir s’étaient succédé sans relâche des campagnes politiques visant certaines catégories de la population pré-sentées comme des suppôts de l’ordre ancien : propriétaires fonciers et paysans riches, élèves des écoles chrétiennes, « bourgeois », intellec-tuels traditionnels ou libéraux, militaires des armées nationalistes, etc. Rapidement éliminées par des mesures sanglantes, ces cibles classiques avaient laissé la place à diverses catégories d’ennemis intérieurs surgies du sein même du mouvement révolutionnaire. Accusées de « vouloir restaurer le capitalisme », de « faire tourner en arrière la roue de l’his-toire » ou encore, plus vicieusement, d’« agiter le drapeau rouge pour lutter contre le drapeau rouge », ces « mains noires » corruptrices et menaçantes étaient créditées d’un projet global, pervers et sans cesse renaissant, appelant en réaction la plus grande vigilance et une violence illimitée. Soumise à une mobilisation permanente, la population avait pour rôle de démasquer les « comploteurs contre-révolutionnaires » et de servir de claque dans les conflits opposant entre elles différentes factions de l’appareil. L’activité théorique se réduisait alors à dévoiler, stigmatiser et éliminer les ennemis, tout en entretenant la croyance en leur ubiquité et leur nocivité.
Cette littérature politique, dont l’ineptie et la férocité ne semblent pas avoir rebuté bon nombre d’intellectuels occidentaux de renom, ne visait pas à convaincre, mais à saturer le champ de la pensée. Il n’était pas nécessaire de faire des efforts particuliers de vraisemblance quand on disposait de l’ensemble de l’appareil coercitif et que les « ennemis » étaient a priori exclus de l’humanité. Aussi les théories du complot étaient-elles rudimentaires et répétitives. Dans un espace de discours où le débat était proscrit et où nulle bonne foi n’était prêtée à l’adversaire, l’opposition ne pouvait s’exprimer que par des explosions de violence physique et verbale (c’est sans doute l’une des explications de l’extrême brutalité des campagnes politiques de l’ère maoïste), par l’apathie, voire la folie ou le suicide, comme ce fut le cas pour de nombreux intellec-
264 Françoise Lauwaert
tuels, ou par la rumeur visant « ceux d’en haut ». C’est ainsi que les fils et les épouses des dirigeants abattus ont été systématiquement accusés des pires turpitudes sexuelles. Il est cependant à noter que l’invraisem-blance des dernières campagnes, dont l’exemple le plus marquant est le Pi Lin Pi Kong12 (la lutte contre Lin Biao et Confucius, au début des années 1970) finit par entraîner l’incrédulité et une certaine désaffection du peuple pour le régime et son Grand Timonier, préparant ainsi la voie au triomphe des idéologies dites « pragmatiques » des réformateurs des années 1980.
Ces mécanismes ne sont pas propres à la Chine ; ils avaient été mis en œuvre auparavant en Union soviétique puis dans les pays dits « de l’Est », et ils avaient produit les mêmes ravages. Cependant, la vigueur de la greffe totalitaire sur le tronc chinois doit nous inciter à réfléchir sur le substrat culturel qui l’a rendue possible. Partant d’une idée simple, selon laquelle une théorie du complot sert avant tout à imputer des crimes à des innocents, nous poursuivrons l’enquête par ce que peut nous révéler la pratique ordinaire des tribunaux de la fin de la période impériale sur la détermination des responsabilités individuelles et collectives dans des affaires portant atteinte à l’ordre social. L’analyse s’attachera à trois notions essentielles à la fabrication de théories du complot : l’intention, la complicité, et le hasard, ou plutôt ici l’absence de hasard.
III. Instigateurs et complices dans la jurisprudence des Qing et au-delà
Dans le vocabulaire juridique, mou, qui avait déjà le sens de « complot », prend le sens plus précis de « préméditation ». Mousha, le meurtre avec préméditation ou l’assassinat, est la forme la plus grave des six sortes d’homicide recensées dans les codes impériaux13. Plus lourdes encore
12. Il s’agissait, pour le dire vite, de faire croire à l’existence d’un complot pour restaurer le confucianisme et le féodalisme, dont l’artisan n’était autre que le dauphin désigné du président Mao, le maréchal Lin Biao, disparu dans des circonstances rocambolesques peu avant le début de cette campagne.
13. Les autres étant, par ordre de gravité décroissante : gusha, l’homicide volon-taire mais non prémédité (les commentateurs précisent que dans ce cas, l’intention criminelle vient au moment de frapper) ; ousha, l’homicide à force de coups, où il n’y avait pas d’intention meurtrière ; wusha, l’homicide par erreur (il y avait bien une
Les théories du complot 265
sont les inculpations d’atteinte à la sûreté de l’État (moupan), d’usurpa-tion (moucuan) et de conspiration (moufan). Ces derniers crimes sont sanctionnés par le châtiment d’exception que constitue la mise à mort par démembrement (lingchi14), assortie le plus souvent de peines collectives s’étendant aux proches parents et aux complices du coupable principal.
Si les peines varient selon les circonstances, c’est toujours l’instigateur du projet criminel qui est puni le plus sévèrement. En effet, comme le sou-ligne le grand juriste Xue Yunsheng (1820-1901), dans son commentaire de l’article iii de la loi sur l’assassinat : « C’est dans le projet criminel que réside la perversité15 ». L’article IV de la même loi va jusqu’à considérer l’instigateur comme le coupable principal, même s’il n’a pas pris part à l’exécution du crime.
Sous les Qing, les cinq articles statutaires de la loi sur l’assassinat reçoivent leur forme définitive en 172516. Ils isolent le coupable prin-cipal de l’ensemble de ses complices et, parmi ces derniers, établissent une distinction entre ceux qui ont participé activement au crime et ceux qui ont seulement pris part à l’élaboration du projet criminel. C’est lors de ce dernier partage que s’affirme le caractère plus ou moins sévère de la répression mise en œuvre, celle-ci variant en fonction de différences conjoncturelles, de la personnalité des victimes et de la relation qui les unit aux criminels.
intention criminelle, mais elle visait une autre personne que la victime – cette distinc-tion ne peut se comprendre qu’en sachant que le même acte criminel peut être puni de manière très différente selon la position sociale de la victime) ; xisha, « l’homicide commis en pratiquant un jeu », ce qui désigne les sports violents et les arts martiaux (l’on ne peut parler d’un accident à ce propos, parce que celui qui a infligé le coup était conscient du caractère potentiellement meurtrier de son arme), et enfin guoshisha, l’homicide par accident.
14. Sur ce châtiment d’exception, voir les travaux de J. Bourgon, et particulière-ment : Supplices chinois, Paris, Éd. Maison d’à côté, 2007, ainsi que l’ouvrage qu’il a réalisé en collaboration avec T. Brook et G. Blue : Death by a Thousand Cuts, Cam-brigde – Mass., Harvard University Press, 2008.
15. Duli cunyi (Revue des difficultés que présentent les articles du code, cité DLCY), compilé par Xue Yunsheng et édité par Huang Jingjia, [1905], rééd. Taipei, Research Aids Series VIII, 1970, art. 282, p. 776.
16. Sur le plan juridique, la dernière dynastie reprend le code des Ming et l’enrichit d’annotations dès 1646. À partir du xviiie siècle, se multiplient les « articles addition-nels » (li) venant compléter, mais aussi parfois contredire, les « lois statutaires » (lü) qui constituent l’ossature et la mémoire du droit depuis les grands travaux juridiques de la dynastie des Tang (618-910). Le code des Qing est cité ici dans son édition de 1872 : Da Qing lüli huiji bianlan (en abrégé DQLL), Hubei yanju.
266 Françoise Lauwaert
Les notes du compilateur du Code des Ming mettaient déjà en garde contre une trop grande extension de la notion de complicité, et Xue Yunsheng, à la fin des Qing, fait état de la fréquence des plaintes exprimées par les juges de terrain sur la trop grande sévérité de ces lois et les condamnations multiples qu’elles entraînent. Il rappelle ainsi que « pour que l’on puisse parler de complicité active, il faut que la victime ait réellement été frappée ou qu’elle ait été bousculée avec une violence particulière »17. En dépit de ces précisions, le passage d’une catégorie à l’autre était fréquent dans la jurisprudence, et la disparition de la distinction entre complices et comparses pouvait être l’un des effets de la législation d’exception visant les comploteurs ou les conspirateurs.
Jusqu’où pouvait aller l’intention criminelle et dans quelle mesure était-elle partagée ? Pour ceux qui visaient les fondements de l’État, de la morale et de la raison (lunli), le prix à payer était si lourd qu’il devait être partagé – tout se passait comme si la soif de châtiment ne pouvait être étanchée par la mise à mort d’une seule personne. C’est ainsi que la loi prévoyait dans certains cas de punir toute la parenté du coupable, et ceci jusqu’aux défunts, dont la tombe était désacralisée. C’est cet ultime supplice qui fut infligé à Fang Xiaobiao (1618-1649), accusé à titre posthume d’avoir été l’inspirateur des « propos rebelles » de Dai Mingshi, lors du procès de la Montagne du Sud18.
Ce qu’il fallait entendre par « intention criminelle » pouvait pré-senter de très grandes variations en fonction du contexte. Lorsque l’on quittait la jurisprudence d’exception pour traiter de la criminalité ordi-naire, cette notion pouvait se révéler extrêmement utile. C’était elle en effet, ou plutôt son absence, que les juristes impériaux avaient placée au fondement de la jurisprudence des homicides par imprudence ou par accident. Ce dernier crime était moins sévèrement puni, mais sa définition était très restrictive :
« Ce qu’on appelle un accident, c’est un événement que les yeux ni les oreilles n’ont pu percevoir et que la pensée n’a pu concevoir. Celui qui tue quelqu’un à coups de fusil ou de flèches lors d’une partie de chasse, ou qui jette des briques ou des tuiles pour l’une ou l’autre raison ; celui qui trébuche en escaladant une montagne et qui
17. DLCY, p. 776.18. Dai Mingshi, Recueil de la Montagne du Sud, op. cit., et Durand P.-H.,
« Mandchous et Chinois : l’empereur Kangxi et le procès du Nanshan ji », Études chinoises, VII, 1, 1988, p. 65.
Les théories du complot 267
entraîne son compagnon de voyage dans sa chute ; celui qui ne peut arrêter son bateau pris dans une tempête ou qui ne peut retenir ses chevaux emballés qui dévalent une pente ; celui qui laisse tomber une charge trop lourde sur son compagnon de travail […] aucun de ceux-là n’avait au départ l’intention de nuire19, c’est pourquoi ils pourront racheter leur peine. » (DQLL, chap. xxvi : 108b)
Lorsque la victime occupait une position d’autorité, l’évaluation de l’acte criminel subissait de très grandes modifications, que celui-ci ait été intentionnel ou non. Nous avons montré dans un précédent ouvrage20 que tout meurtre était considéré comme prémédité dès lors qu’il visait des parents ou des supérieurs hiérarchiques21. Cette « requalification » ne concernait pas seulement l’instigateur du crime, mais aussi l’en-semble de ses complices ou supposés tels. La distinction établie par la loi entre l’auteur du projet criminel et l’ensemble de ses complices visait à réduire l’ampleur de la répression en réservant le châtiment le plus lourd à une seule personne. Elle comportait cependant des effets pervers. Dans une justice reposant sur l’aveu, la tentation de faire appa-raître à toute force des intentions criminelles là où elles n’existaient peut-être pas était d’autant plus grande que les enjeux étaient élevés. Une confession extorquée par la torture permettait de boucler un dossier et d’apparaître sous les traits d’un fonctionnaire zélé et vigilant – c’est cette logique que nous avons vue à l’œuvre dans le procès des coupeurs de nattes. Si tout acte criminel accompli à l’encontre d’une autorité était d’emblée considéré comme intentionnel, l’aveu se révélait paradoxa-lement inutile à l’établissement du verdict. Et pourtant, la confession publique était le dernier acte indispensable au bon déroulement du rituel des procès. L’abaissement du coupable (renforcé par le dispositif spatial du tribunal) et la révélation de sa duplicité servaient de révélateurs à la clairvoyance du juge. L’aveu du « projet » ou « complot » criminel (selon le sens plus ou moins fort que l’on voudra donner à mou) consti-tuait le point culminant d’une pédagogie par l’exemple dont l’efficacité n’était pas mise en doute.
19. Nos italiques.20. Lauwaert F., Le meurtre en famille : parricide et infanticide en Chine, xviiie-
xixe siècle, Paris, Odile Jacob, 1999.21. Cette requalification du crime ne concernait pas seulement les actes crimi-
nels, mais aussi les actes langagiers, comme les injures ou l’impolitesse.
268 Françoise Lauwaert
Même lorsque la préméditation ne pouvait pas être établie, le recours aux catégories du hasard, de l’imprudence, de l’erreur ou de l’accident disparaissait lorsque le statut de la victime était supérieur à celui du criminel. Ce point est rappelé avec une éloquence frappante dans le commentaire officiel de l’article statutaire III de la loi sur les coups et blessures infligés aux parents :
« Bien que la faute soit inconsciente, lorsque le fils ou le petit-fils sert ses parents et grands-parents ; lorsque la femme sert les parents et grands-parents de son mari, ils doivent leur manifester respect et attention et ne peuvent causer leur mort “par erreur”. Aussi, même si [le criminel ordinaire] peut racheter sa peine, celui [que vise cet article] devra subir effectivement son châtiment. C’est que les rela-tions souverain-sujet et père-fils ne peuvent laisser place à l’erreur. » (DQLL, chap. xxviii : 2b)
Le même raisonnement valait lorsque la victime était un représentant légitime de l’autorité impériale. La porte était ainsi entrouverte aux accusations de violence intentionnelle, voire de complot reposant sur une interprétation des conduites et des pensées. Relativement prémuni contre les accusations délirantes par le droit ordinaire, le sujet de l’em-pire pouvait tomber sous le coup de procédures d’exception dès lors que les plus hauts détenteurs de l’autorité semblaient menacés. Le réseau de relations qui le protégeait d’ordinaire se transformait alors en piège mortel, tandis que s’abolissait le hasard. Paroles grossières ou désin-voltes, gestes imprudents ou maladroits, négligence ou distraction, tout trouvait désormais sa place dans un système d’interprétation aboutis-sant à transformer les accusés de ces procès exemplaires en comploteurs contre la hiérarchie et l’harmonie sociale.
Ces stratégies interprétatives ont trouvé un champ d’application particulièrement étendu dans les accusations d’incitation au suicide des parents22 et dans la jurisprudence de l’accident. S’il était déjà difficile de prouver le caractère purement accidentel d’un geste ayant entrainé la mort d’une victime ordinaire, l’évaluation du caractère accidentel ou non de décès survenus dans le cadre de la famille (dont la définition juridique comprend cinq degrés de parenté) faisait appel à de nombreux critères parmi lesquels figuraient la distance physique et sociale sépa-rant la victime de son meurtrier, l’arme ayant infligé la blessure mortelle
22. Voir Lauwaert F., Le meurtre en famille…, op. cit., p. 179-217.
Les théories du complot 269
(poison, arme blanche, simple bâton, pierre ou tout autre objet lancé à distance, ou encore coups de poings ou de pieds), l’emplacement des coups, et le temps mis par la victime à décéder.
Trois jugements rendus au xixe siècle dans des affaires présentant des points de ressemblance (il s’agit chaque fois d’une mort infligée par blessure à l’arme blanche) pourront nous faire évaluer ces différences d’appréciation de la gravité du crime23. Dans le premier cas, jugé en 1824, nous voyons s’appliquer la jurisprudence ordinaire. Le passage cité est un extrait légèrement condensé de la réponse du ministère de la Justice au rapport des autorités judiciaires provinciales :
« Li Wanyou et son ami Zhao Pei sont ivres tous les deux. Li s’ap-prête à couper un melon lorsque Zhao se lève pour partir. Li le raccompagne en ayant toujours le couteau à la main. Zhao s’incline pour saluer, mais comme il est ivre, il n’est plus très ferme sur ses pieds. Précipité vers l’avant, il tombe. Li essaie précipitamment de le retenir avec la main et dans sa hâte, il oublie de poser le couteau. Zhao s’embroche sur la pointe du couteau, qui l’atteint dans la région du cœur et il meurt. Le gouverneur avait condamné Li Wanyou à la peine de bastonnade la plus sévère prévue pour les actes répréhensibles24, mais sa décision a été cassée par le minis-tère, qui appliqua la loi sur l’homicide accidentel. » (XAHL, p. 2054)
S’il s’agit d’une affaire de pure routine, la ratification n’a cependant pas été automatique en raison de la nature même de la blessure (par arme blanche) et la peine a été alourdie d’un degré par rapport à la proposition initiale.
L’affaire suivante, survenue en 1800, met aux prises des parents par alliance. Sous l’emprise de l’alcool, un homme frappe sa femme et sa belle-mère. Cette dernière riposte, et l’homme s’empare alors d’un couteau. Dans la mêlée, il blesse sa femme et frappe mortellement la mère de cette dernière. Le débat judiciaire porte sur l’établissement
23. Ils sont tous les trois repris dans une célèbre collection de cas de jurisprudence du milieu du xviiie siècle et du début du xixe siècle le Xing’an huilan [Vue d’ensemble sur les jugements du ministère de la Justice ; cité XAHL], compilé par Zhu Qingqi et Bao Shuyun, Taipei, Chengwen chubanshe, 1969, 8 vol., d’après l’éd. de Shanghai, Tushu jicheng shuju (fangxiuzhen banyin), 1886.
24. Un article extrêmement commode qui permet de juger un certain nombre de délits légers non repris dans le code.
270 Françoise Lauwaert
de l’intention criminelle. La volonté de tuer existait-elle et était-elle dirigée vers la personne qui a effectivement été frappée, à savoir la belle-mère du coupable ? Cette question, qui paraît à première vue étrange, est au cœur du débat : viser délibérément une parente de la génération supérieure est un crime plus grave que l’atteindre par erreur à la place d’une personne de statut social inférieur (comme l’épouse du criminel). Répondre à ces questions implique de reconstituer la scène criminelle avec une précision chorégraphique : « He Yuanyao a blessé sa belle-mère dans l’obscurité, mais il avait saisi le couteau de cuisine avant que la lampe ne fût éteinte et alors que sa femme avait déjà pris la fuite. Bien qu’il n’y ait plus eu alors que sa belle-mère dans la pièce, il a donné des coups de couteau avec une fureur redoublée et a mortel-lement blessé cette dernière25. » Le crime est grave, mais il n’a pas été prémédité. De plus, dans le système de parenté patrilinéaire qui est alors celui de la Chine, la victime n’est pas considérée comme une proche parente, bien que son statut soit supérieur à celui du criminel. Pour ces deux raisons, le meurtrier a pu bénéficier malgré tout d’une remise de peine : la sentence de mort a été commuée en relégation à perpétuité dans les régions frontalières.
Le troisième cas, jugé en 1818, a aussi une rixe pour point de départ. Un homme est frappé à coups de pierres par son adversaire qui le maintient plaqué au sol. Le fils de la victime frappe l’agresseur de son père à coups de couteau. C’est à ce moment que survient l’accident : « incapable de retenir son mouvement, Guangwei frappe son père à la cuisse droite et au ventre et lui inflige des blessures mortelles26. » Les juges établissent dans ce cas aussi l’absence d’intention criminelle, mais l’élément déterminant à leurs yeux est le fait que les conséquences funestes de l’intervention du criminel n’étaient pas totalement imprévi-sibles compte tenu de la proximité des corps. Sachant que son père était proche et qu’il aurait pu être touché, un fils pieux aurait dû s’abstenir de jouer du couteau. Guangwei sera donc condamné à la décapitation immédiate, une peine inférieure d’un degré seulement au démembre-ment requis pour les auteurs de parricide.
La logique qui sous-tend ces trois jugements est celle d’un droit qui reconnaît, accepte et conforte les catégories sociales et idéologiques d’une société hiérarchique, où la valeur des individus dépend (au moins
25. DQLL, chap. IV, p. 121a-122a.26. XAHL, p. 2761.
Les théories du complot 271
en grande partie) de la place qu’ils occupent dans un système de parenté qui est aussi un dispositif de pouvoir. La notion d’intention joue ici un rôle différent de celui qui lui est imparti dans la loi ordinaire. Elle n’est plus indispensable à l’établissement de la vérité judiciaire, ni au dosage modéré des châtiments. Elle apparaît, au contraire, comme un signifiant aux contours flous appelé à renforcer la pédagogie de l’ordre établi. De tels signifiants trouvent aisément leur place dans la rhétorique des complots réels ou supposés.
Conclusion
Les différentes affaires évoquées plus haut se caractérisent toutes par le recours à des mesures d’exception prises à l’encontre d’indivi-dus crédités d’intentions criminelles à l’encontre de ce qui fonde une société ordonnée. Le terme d’exception (qui n’est pas à prendre dans le sens que lui donnèrent Carl Schmitt et ses épigones) ne figure pas comme tel dans le vocabulaire de la pensée chinoise antique ; il est pourtant indispensable à la compréhension de la conception du pouvoir qui prévalut sous l’empire. Dans les livres de droit, qui puisent leur légitimité dans des canons rituels plus anciens, l’ordre social est garanti par deux figures d’exception : le Fils du Ciel, qui opère à l’échelle du pays tout entier, et le père, qui constitue la pierre angulaire de l’édifice de la parenté. L’empereur, seul habilité à prononcer la peine de mort, dispose du pouvoir d’infléchir le cours normal de la justice pour pointer certaines catégories de suspects et leur apposer l’étiquette de rebelles ou de traîtres. Opérer le changement de dénomination qui transformera un groupe de lettrés de province en conspirateurs et une poignée de moines vagabonds en sorciers et comploteurs est une prérogative impé-riale découlant de son statut exceptionnel, tout comme l’est son pouvoir d’alléger la peine de certains criminels ou de prononcer des amnisties. Pour être légitimes, ces mesures doivent garder leur caractère d’excep-tion, ce qui implique de recourir à une rhétorique particulière. Même lorsque la procédure est routinière (comme c’est le cas pour certains allègements de peine), il faut souligner par une formule appropriée le caractère exceptionnel et par conséquent individuel de la mesure, et produire l’impression que les décisions sont prises au cas par cas. Par l’effet d’un paradoxe apparent, les criminels qui encourent les peines les plus lourdes pour les crimes considérés comme les plus sérieux – au
272 Françoise Lauwaert
rang desquels figurent la conspiration et la rébellion – sont jugés aux marges de l’institution judiciaire régulière et selon des procédures qui échappent grandement aux vérifications ordinaires.
L’importance extrême attachée aux dénominations correctes (zheng-ming), une préoccupation qui remonte à Confucius, est à l’origine du développement d’une impressionnante production normative rituelle et juridique, qui trouva son couronnement dans la rédaction des codes des deux dernières dynasties. À première vue, la précision des défini-tions et la minutie des débats rapportés dans la jurisprudence peuvent étonner. Derrière cette rigueur se cache cependant une certaine fluidité des concepts, et l’extrême formalisme des jugements – le texte de la loi devait être appliqué tel quel sans possibilité de doser la sévérité de la peine – pouvait être tempéré, voire même dans certains cas annulé par la possibilité de modifier la dénomination des crimes. Un acte pré-sentant les plus grandes similitudes formelles pouvait ainsi être qualifié d’accident, d’homicide ou d’assassinat selon le statut de la victime, et tomber de ce fait sous le coup de lois différentes. C’est dans cet espace de jeu que pouvait se déployer la rhétorique du complot. Du complot contre la personne privée au complot contre l’État, la distance était à la fois énorme et minuscule. Elle tenait à la présence ou à l’absence de mécanismes régulant le déploiement de la logique interprétative et limitant l’extension des mesures répressives.
Un tel système ne peut que perdre sa légitimité lorsque s’effondre l’ordre social sur lequel il est bâti. Les lois d’exceptions ont ainsi été présentées (non sans arrière-pensées) comme la marque d’un pouvoir cruel et arbitraire par les Occidentaux qui tentaient de forcer la Chine au début du xixe siècle. Ces critiques ont été reprises par les intellec-tuels et les révolutionnaires du début du xxe siècle. La dégradation de l’appareil judiciaire et le recours de plus en plus fréquent à des mesures répressives non formalisées ont accentué encore le discrédit qui frappait la pensée juridique chinoise. Le nouveau régime instauré en 1949 ne mit pas fin aux mesures d’exception, mais celles-ci se fondaient sur une autre logique répressive, dégagée de tout formalisme juridique. Le travail des juristes de la période républicaine était effacé d’un trait de plume ; pour lutter contre l’ordre ancien, il était plus commode de se focaliser sur les excès du régime impérial, lui-même présenté sous un jour caricatural.
Si le formalisme avait disparu, les théories de la causalité juridique poursuivaient leur chemin souterrain et continuaient à donner à l’espace
Les théories du complot 273
répressif sa physionomie particulière. L’instigateur du crime devenait une « main noire », tandis que l’autocritique se substituait à l’aveu arraché par la torture judiciaire (la torture extra-judiciaire, quant à elle, se poursuivait, parfois sur une très vaste échelle). En dehors des grandes périodes de bouleversement dynastique, les procès pour menées conspi-rationnistes faisaient sous l’empire relativement peu de victimes. Pour que flambent les accusations à l’encontre de catégories croissantes de la population, il a fallu que s’impose une vision de l’histoire reposant sur un antagonisme de classes structurel et perpétuellement renaissant. Il a aussi fallu que s’opère un changement d’échelle résultant de l’élévation du peuple au rang d’acteur principal de l’histoire.
Lorsque les comploteurs quittèrent les allées protégées de la Cité interdite pour se répandre jusqu’au plus profond des campagnes, il devint impossible de fixer une limite au nombre des complices d’un dessein criminel visant l’essence même de la société nouvelle. La logique inquisitoriale des procès, consistant à considérer tout accusé comme un coupable dont il fallait obtenir les aveux, était déjà bien ancrée dans la tradition ; elle connut un regain de vigueur pendant les trente années du pouvoir maoïste. Les victimes se comptèrent par millions, tandis que la population tout entière entrait dans l’ère de la vigilance et de la délation. L’affaiblissement de la société civile et la disparition de l’élite intellectuelle qui faisait obstacle, sous l’ancien régime, à l’arbitraire impérial, laissèrent la population sans recours face à la violence d’un pouvoir dont chacun était à la fois l’agent et la victime potentielle. L’entrée de la Chine dans l’ère des réformes s’ac-compagna d’une reconstruction de l’appareil judiciaire et du retour au formalisme juridique. L’imagination des accusateurs se fit plus sobre, tout comme se réduisait drastiquement le nombre des conspirateurs et la fréquence des complots. Et pourtant, à l’heure où Liu Xiaobo, le principal rédacteur de la Charte 200827 est condamné à onze ans de prison pour avoir demandé que soit enfin respectée la Constitution, l’on ne peut déclarer révolue l’époque où la rhétorique des complots menait sa tâche perverse de corruption du langage et de destruction des vies et des mémoires humaines.
27. Ce document, que l’on compare à la Charte 77 dont l’initiateur fut Vaclav Havel dans ce qui s’appelait encore la Tchécoslovaquie, circule encore de nos jours sur le web. Signé par plus de dix mille personnes, essentiellement des intellectuels, il constitue à ce jour le programme de réforme démocratique le plus complet et le plus ambitieux élaboré en République populaire de Chine.
274 Françoise Lauwaert
La pensée conspirationniste. Origines et nouveaux champs
Pierre-André Taguieff
Les faits ne pénètrent pas dans le monde où vivent nos croyances, ils n’ont pas fait naître celles-ci, ils ne les détruisent pas. Ils peuvent leur infliger les plus constants démentis sans les affaiblir.
Marcel Proust, Du côté de chez Swann.
Le style de pensée conspirationniste consiste à s’en prendre au temps qu’il fait sur le mode de l’accusation diabolisante ou de la dénonciation édifiante. Celle-ci se compose, d’une part, d’un dévoile-ment, qui implique l’attribution du phénomène considéré – naturel ou social – à des intentions cachées qui lui donnent son sens, et, d’autre part, d’une condamnation morale hyperbolique des « responsables » et/ou « coupables » ainsi désignés. Une révélation démystifiante, fondée sur la croyance fausse selon laquelle « tout événement mauvais est à imputer à la volonté mauvaise d’une puissance maléfique1 », et une condamnation hypermorale, qui prend ordinairement la forme de l’indi-gnation : telles sont les deux composantes fondamentales de la pensée conspirationniste. Mais la passion de décrypter à l’infini ne va pas sans s’accompagner de peurs, d’inquiétudes, voire d’angoisses, auxquelles fait écho une imagination diabolisante toujours en éveil. Les profession-nels du conspirationnisme, les « cognicrates » prétendant connaître ce qui se trame dans les coulisses de la scène mondiale2, savent jouer sur
1. Popper K. R., Conjectures et réfutations. La croissance du savoir scientifique [1963 ; 4e éd. revue, 1972], trad. M.-I. et M. B. de Launay, Paris, Payot, 1985, p. 24-25.
2. Sur la distinction entre « cognicrates » (les experts en matière de complots) et « cogniproles » (les naïfs et ignorants voués à être manipulés, car n’ayant pas accès au savoir complotologique), voir Mason F., « A Poor Person’s Cognitive Mapping », dans
tous ces tableaux. Ils alimentent une culture de la paranoïa qui, oscillant entre l’esthétique et le politique, entretient un état de panique permanent dans leur public, devenu mondial par l’effet du Web3. Interprétées par les récits conspirationnistes, les anxiétés provoquées par la globalisa-tion se traduisent chez nombre d’individus par le sentiment d’être les jouets et les victimes de forces invisibles, puissantes autant qu’hostiles4.
Le conspirationnisme ordinaire, quant à lui, relève de la politologie du café-comptoir : on bavarde sur l’actualité, qu’on décrypte avec jubi-lation sur la base de rumeurs prises au vol, en prenant des airs entendus. Ces rumeurs véhiculent des « révélations » sur des complots fictifs, jouant un rôle explicatif. Rien de grave ni d’inquiétant : le clin d’œil complotiste ne fait qu’ajouter du piment à la conversation sur ce dont on parle dans les médias. Tout commentaire sur l’actualité comporte un zeste d’esprit conspirationniste, sur le mode anodin : « Vous croyez que… Mais c’est faux (ou superficiel). Je vais vous dire, moi, la vérité sur… ». La vérité « vraie » est toujours à débusquer derrière la vérité apparente ou trompeuse, elle est forcément située ailleurs que dans les
Knight P. (ed.), Conspiracy Nation: The Politics of Paranoia in Postwar America, New York & London, New York University Press, 2002, p. 46-47.
3. Fenster M., Conspiracy Theories: Secrecy and Power in American Culture, Minneapolis – MN & London, University of Minnesota Press, 1999 ; Melley T., Empire of Conspiracy: The Culture of Paranoia in Postwar America, Ithaca – NY & London, Cornell University Press, 2000 ; Dean J., « Webs of Conspiracy », dans A. Herman & T. Swiss (eds.), The World Wide Web and Contemporary Cultural Theory: Magic, Metaphor, Power, New York & London, Routledge, 2000, p. 61-76 ; Knight P., Conspiracy Culture: From the Kennedy Assassination to The X-Files, London & New York, Routledge, 2000 ; Knight P. (ed.), Conspiracy Nation: The Politics of Paranoia in Postwar America, op. cit. ; Barkun M., A Culture of Conspiracy: Apocalyptic Visions in Contemporary America, Berkeley & Los Angeles, University of California Press, 2003 ; Bratich J. Z., Conspiracy Panics: Political Rationality and Popular Culture, Albany – NY, State University of New York Press, 2008.
4. Knight P., « Introduction: A Nation of Conspiracy Theorist », dans P. Knight (ed.), Conspiracy Nation, op. cit., p. 7 ; James N., « Militias, the Patriot Movement and the Internet: The Ideology of Conspiracism », dans J. Parish & M. Parker (eds.), The Age of Anxiety: Conspiracy Theory and the Human Sci-ences, Oxford – UK & Malden – MA, Blackwell Publishing, 2001, p. 62-92 ; Campion-Vincent V., « From Evol Others to Evil Elites: A Dominant Pattern in Conspiracy Theories Today », dans G. A. Fine, V. Campion-Vincent & C. Heath (ed.), Rumor Mills: The Social Impact of Rumor and Legend [2005], Piscataway – NJ, Aldine Transaction, 2009, p. 103-104.
La pensée conspirationniste. Origines et nouveaux champs 279
« vérités » officielles, dénoncées comme douteuses, mensongères, ou simplement superficielles. Le problème, c’est qu’il s’agit là, le plus souvent, d’une idée fausse.
Relisons à ce propos Tocqueville qui, dans De la démocratie en Amérique (vol. I, 1835), note avec perspicacité et un certain pessi-misme : « Une idée fausse, mais claire et précise, aura toujours plus de puissance dans le monde qu’une idée vraie, mais complexe5. » Et, ajoute judicieusement Raymond Boudon, surtout si ladite idée fausse est « utile », si, donc, elle « sert les intérêts d’une puissante corporation ou du “pouvoir social”6 ». Quoi qu’il en soit, étudier le conspirationnisme implique, au-delà du simple fait de prendre au sérieux le phénomène, de croire que les idées ont des conséquences dans l’Histoire7.
I. Variations sur le thème du grand complot
L’idée d’un grand complot subversif ou contre-subversif est apparue sous une forme élaborée à l’époque de la Révolution française8. Les récits mettant en scène tel ou tel mégacomplot postulent l’existence d’acteurs collectifs de dimension universelle (francs-maçons, Juifs, communistes, ploutocrates, etc.) auxquels sont attribués des projets de conquête, de domination ou de destruction de l’ordre social ou de la civilisation9. Au xixe siècle, la vision conspirationniste de l’histoire s’est développée aux deux pôles de l’espace politique : d’une part,
5. Tocqueville A. de, De la démocratie en Amérique, I, Paris, R. Laffont, coll. « Bouquins », 1986, p. 171.
6. Boudon R., Tocqueville aujourd’hui, Paris, Odile Jacob, 2005, p. 193.7. Pipes D., Conspiracy: How the Paranoid Style Flourishes and Where It Comes
From, New York, The Free Press, 1997, p. 51.8. Voir Furet Fr., Penser la Révolution française, Paris, Gallimard, 1978, p. 78
sq. ; Taguieff P.-A., Les Protocoles des Sages de Sion. Faux et usages d’un faux [1992], nouvelle éd., Paris, Berg International/Fayard, 2004, p. 18, 22-26.
9. Sur les figures du complot mondial, voir Rogalla von Bieberstein J., Die These von der Verschwörung 1776-1945. Philosophen, Freimaurer, Juden, Liberale und Sozialisten als Verschwörer gegen die Sozialordnung, Berne, Herbert Lang, et Francfort/M., Peter Lang, 1976 (2e éd., 1978) ; Gugenberger E., Petri F., Schwei-dlenka R., Weltverschwörungstheorien. Die neue Gefahr von rechts, Vienne et Munich, Franz Deuticke Verlagsgesellschaft, 1998 ; Taguieff P.-A., L’Imaginaire du complot mondial. Aspects d’un mythe moderne, Paris, Éd. Mille et Une Nuits, 2006.
280 Pierre-André Taguieff
dans la pensée contre-révolutionnaire ou réactionnaire qui, à la suite de l’Abbé Barruel10, a élaboré la thèse selon laquelle la Révolution française aurait été le résultat d’un complot maçonnique – le principal acteur en étant les « Illuminés » de Bavière, ou « Illuminati », dirigés par Adam Weishaupt11 –, réinterprété ensuite comme complot judéo-maçonnique dont l’objectif serait la conquête du monde à travers la destruction de la civilisation chrétienne12 ; et, d’autre part, dans la pensée révolutionnaire, socialiste ou anarchiste, qui a construit le mythe d’un complot capitaliste ou ploutocratique, judéo-capitaliste ou judéo-ploutocratique pour dominer et exploiter le genre humain13. Dans la première moitié du xxe siècle, la mentalité complotiste s’est fixée sur les deux pôles du totalitarisme : hitlériens et staliniens ont rivalisé dans l’exercice abusif et criminel de la pensée complotiste, d’une part pour éliminer leurs oppositions internes, et, d’autre part, pour diaboliser leurs ennemis extérieurs14.
10. Barruel Abbé A., Mémoires pour servir à l’histoire du jacobinisme, Londres, 1797-1798, 4 vol. ; texte revu et corrigé, 1818 ; nouvelle édition, Chiré-en-Montreuil, Diffusion de la Pensée française, 1973, 2 vol. Voir Le Forestier R., Les Illuminés de Bavière et la Franc-Maçonnerie allemande [1914], Milan, Archè, 2001, p. 681-690 ; Roberts J. M., La Mythologie des sociétés secrètes [1972], trad. C. Butel, Paris, Payot, 1979, p. 187-200.
11. Le Forestier R., Les Illuminés de Bavière, op. cit., passim ; Roberts J. M., La Mythologie des sociétés secrètes, op. cit., p. 123-148 ; Dülmen R. von, Der Geheimbund der Illuminaten, Stuttgart, Frommann-Holzboog, 1977 ; Pipes D., Conspiracy…, op. cit., p. 62-66 ; Reinalter H. (Hrsg.), Der Illuminatenorden (1776-1785-/87). Ein politischer Geheimbund der Auklärungszeit, Francfort/Main, Lang, 1997 ; Hippchen C., Zwischen Verschwörung und Verbot. Des Illuminatenorden im Spiegel deutscher Publizistik (1776-1800), Cologne, Böhlau, 1998.
12. Gougenot des Mousseaux H.-R., Le Juif, le judaïsme et la judaïsation des peuples chrétiens, Paris, Henri Plon, 1869 ; Deschamps N., Les Sociétés secrètes et la société ou Philosophie de l’histoire contemporaine, Avignon-Paris, Seguin, 1874-1876, 3 vol. ; Chabauty E. A., Les Juifs, nos maîtres ! Documents et développements nouveaux sur la question juive, Paris-Bruxelles-Genève, Société générale de Librairie catholique, Victor Palmé, 1882 ; Meurin L., La Franc-Maçonnerie, synagogue de Satan, Paris, Victor Retaux et fils, 1893.
13. Taguieff P.-A., La Judéophobie des Modernes. Des Lumières au Jihad mondial, Paris, Odile Jacob, 2008, p. 96 sq., 131 sq.
14. Arendt H., Les Origines du totalitarisme, trad. M. Pouteau et al., éd. établie sous la direction de P. Bouretz, Paris, Gallimard, coll. « Quarto », 2002, p. 669-686, 701-717.
La pensée conspirationniste. Origines et nouveaux champs 281
On suppose volontiers que la pensée conspirationniste représente l’envers des Lumières, qu’elle s’oppose absolument à la pensée du Progrès continu, nécessaire et sans fin. Mais l’envers se mêle inextri-cablement à l’endroit par des couplages idéologiques qui alimentent le sentiment d’une ambivalence irréductible de tout ce qui est moderne. C’est ainsi que, dans les écrits de l’Ordre des Illuminés de Bavière (fondé par Weishaupt le 1er mai 177615), un programme progressiste typiquement illuministe s’entrecroise avec un projet complotiste propre aux sociétés secrètes se donnant pour héritières de confréries traditionnelles ou de très anciens ordres de chevalerie. Comment des « Perfectibilistes » (car tel était le nom que les Illuminés s’étaient d’abord donné) pouvaient-ils être en même temps des conspirateurs et des idéologues conspirationnistes, au sens où ils croyaient que les com-plots, organisés par des sociétés secrètes, mènent l’Histoire ? Comment pouvaient-ils croire qu’une grande conspiration pouvait instaurer le règne du Progrès irréversible et sans fin en ce bas monde ?
Le modèle du complot des déviants, de la minorité rebelle, de la « société secrète », disons le complot subversif, a longtemps été dominant dans la culture complotiste, jusqu’à ce que, dans la période de l’après-Seconde Guerre mondiale, s’impose le modèle du complot d’en haut, celui des élites dirigeantes accusées de « mondialisme ». Le « complot gouvernemental », complot interne à l’État, fait l’objet d’une littérature de dénonciation foisonnante16. Mais des synthèses intégrant des complots respectivement élitaires et révolutionnaires ne cesseront d’être fabriquées par les professionnels du conspirationnisme, notam-ment par ceux qui lanceront des chasses aux sorcières en orchestrant des grandes peurs. Dans le maccarthysme, au début des années 1950, on rencontre ainsi un étrange mélange du complot des élites gouvernantes et du complot subversif (les conspirateurs « communistes » étant en même temps des « agents de l’étranger »), comme le montre ce fragment d’un discours prononcé par le sénateur Joseph McCarthy le 14 juin 1951:
15. Voir Taguieff P.-A., La Foire aux « Illuminés ». Ésotérisme, théorie du complot, extrémisme, Paris, Éd. des Mille et Une Nuits, 2005, p. 13 sq., 109 sq.
16. Melley T., Empire of Conspiracy: The Culture of Paranoia in Postwar America, op. cit. ; Knight P. (ed.), Conspiracy Nation: The Politics of Paranoia in Postwar America, op. cit.
282 Pierre-André Taguieff
« Comment pouvons-nous rendre compte de notre situation pré-sente à moins de croire que des hommes haut placés dans le gouvernement se concertent pour nous entraîner au désastre ? Cela doit être le résultat d’un grand complot, un complot sur une si grande échelle qu’il écrase toute entreprise analogue antérieure dans l’histoire de l’homme17. »
Après la vague maccarthyste a commencé le règne d’auteurs conspi-rationnistes se réclamant du christianisme et situés à l’extrême droite, tel William Guy Carr. Celui-ci a acquis sa célébrité dans les milieux conspirationnistes en publiant tardivement son ouvrage principal, Pawns in the Game (« Des Pions sur l’échiquier »), rédigé en 1955 et publié en 1958, dans lequel il désigne par le mot « Illuminati » les chefs secrets de la « subversion mondiale » visant à instaurer un « Gouvernement mondial » d’essence « totalitaire »18. Dans les dernières années du xxe siècle, c’est le modèle du « complot gouvernemental interne » qui, dans la littérature conspirationniste nord-américaine, prévaut. On le retrouve dans les écrits prétendant établir ce qui s’est « réellement » passé le 11-Septembre19.
À l’âge de la globalisation, on observe régulièrement des flambées d’interprétations conspirationnistes autour d’événements divers de dimension planétaire. Mais il convient d’entrée de jeu de souligner le phénomène le plus remarquable : c’est la globalisation comme telle, processus ambivalent, qui est au centre de la pensée conspiration-niste, laquelle la perçoit comme un phénomène négatif, incarnant une menace, voire le principe moteur de tous les malheurs des hommes. Les oppositions manichéennes constituent l’un des présupposés de la mentalité conspirationniste. Mon hypothèse est que les explications de style manichéen font partie du stock des croyances et des explications
17. J. R. McCarthy, 14 juin 1951. Voir : Hofstadter R., The Paranoid Style in American Politics and Other Essays [1965], Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1996, p. 7-8 ; Davis D. B. (ed. with commentary by), The Fear of Conspiracy: Images of Un-American Subversion from the Revolution to the Present, Ithaca – NY & London, Cornell University Press, 1971, p. 304-309 ; Aaronovitch D., Voodoo Histories: The Role of the Conspiracy Theory in Shaping Modern History, New York, Riverhead Books, 2010, p. 118-119.
18. Carr W. G., Pawns in the Game, Los Angeles, St. George Press, 1958 ; trad. P. C. : Des Pions sur l’échiquier, Cadillac, Éd. Saint-Rémi, 2002. Voir : Taguieff P.-A., La Foire aux « Illuminés », op. cit., p. 99-101, 431 sq.
19. Bratich J. Z., Conspiracy Panics, op. cit., p. 123-157.
La pensée conspirationniste. Origines et nouveaux champs 283
spontanées provenant d’un fonds mythique, que la rationalité moderne est impuissante à éliminer. Elles ne cessent de revenir sur le mode du retour du refoulé, dans le discours politique comme dans les œuvres de fiction. En ce sens, la mentalité conspirationniste constitue l’une des principales formes sous lesquelles le mythe continue de fonctionner dans les modernes sociétés qu’on suppose, trop hâtivement, désenchan-tées. L’extension de la pensée conspirationniste montre que, par des voies inattendues, le ré-enchantement s’opère.
Tout mythe politique moderne fonctionne au sein d’une opposition binaire : par exemple, dans le stalinisme comme dans l’hitlérisme, le mythe positif de la construction de l’homme nouveau et de la société nouvelle s’oppose au mythe répulsif des ennemis pervers qui, dans l’ombre, complotent contre le parti du Bien (complot juif ou judéo-bolchevique mondial pour les nazis, complot contre-révolutionnaire ou réactionnaire pour les communistes).
II. « Théorie du complot » ?
L’expression mal formée de « théorie du complot » (conspiracy theory, Verschwörungstheorie20), pour désigner tout récit explicatif et accusatoire fondé sur la croyance à un complot imaginaire, a été intro-duite par le philosophe Karl Popper vers le milieu des années 1940. Dans La Société ouverte et ses ennemis, en 1945, dans le cadre de sa critique de l’« historicisme », puis dans plusieurs essais parus ultérieu-rement, Popper a analysé d’une façon systématique ce qu’il a baptisé plus particulièrement « théorie sociologique du complot » (conspiracy theory of society21). L’intérêt pour la thématique conspirationniste, plus précisément pour les visions du monde centrées sur la dénonciation
20. L’expression est employée ordinairement, sans rigueur, soit au singulier (« la théorie du complot », « une théorie du complot »), soit au pluriel (« des » ou « les théories du complot »). Pour une analyse critique, voir Pfahl-Traughber A., « “Bausteine” zu einer Theorie über “Verschwörungstheorien” : Definitionen, Erscheinungsformen, Funktionen und Ursachen », dans Reinalter H. (Hrsg.), Verschwörungstheorien. Theorie – Geschichte – Wirkung, Innsbruck et Vienne, Studien Verlag, 2002, p. 30-44 ; Taguieff P.-A., La Foire aux « Illuminés », op. cit., p. 17-22; L’Imaginaire du complot mondial, op. cit., p. 60-63.
21. Popper K. R., La Société ouverte et ses ennemis [1945], trad. J. Bernard et P. Monod, Paris, Le Seuil, 1979, t. 2, p. 67-68 ; id., Conjectures et réfutations, op. cit., p. 23-25, 187-191, 497-501.
284 Pierre-André Taguieff
d’un grand complot (les visions conspirationnistes de la société et de l’Histoire), a été renforcé par la place que lui accorde Hannah Arendt dans Les Origines du totalitarisme (1951), puis par les analyses qu’en 1963-1964 l’historien américain Richard Hofstadter a développées sur le « style paranoïde » dans la politique américaine, en référence notam-ment à l’épisode maccarthyste22. Les travaux pionniers de Hofstadter sur les croisements entre populisme, conservatisme et antisémitisme, proches de ceux de Seymour Martin Lipset23, ont été poursuivis et déve-loppés par Daniel Pipes dans les années 1990 et 2000. L’essai de Pipes intitulé Conspiracy : How the Paranoid Style Flourishes and Where It Comes From (1997), a fortement stimulé les recherches sur le conspi-rationnisme en politique, aux États-Unis comme en Europe.
Directement liées à l’expérience du nazisme et du communisme, les analyses de Manès Sperber sur la « vision policière de l’histoire » (1953) dans les régimes totalitaires ont inspiré nombre de recherches d’historiens ou de sociologues, surtout en France. L’ouvrage de Norman Cohn sur les Protocoles des Sages de Sion, paru en 1967, où est pré-sentée une généalogie du mythe de la conspiration juive internationale, l’étude historique de John M. Roberts sur « la mythologie des sociétés secrètes » (1972), celle de Johannes Rogalla von Bieberstein sur les multiples figures prises par la « thèse du complot » depuis la fin du xviiie siècle (Die These von Verschwörung 1776-1945, 1976), ainsi que les travaux de Léon Poliakov sur la « causalité diabolique » (1980 et 1985) ont introduit l’étude des « théories du complot » dans le champ historiographique24. Dans son livre paru en 1986, Mythes et mythologies politiques, prenant pour objet l’imaginaire politique moderne, Raoul Girardet a proposé d’analyser les complots imaginaires (le juif, le jésuite et le maçonnique) comme autant d’expressions d’un mythe poli-
22. Hofstadter R., « The Paranoid Style in American Politics » (1963), dans The Paranoid Style in American Politics and Other Essays, op. cit., p. 3-40.
23. Lipset S. M. & Raab E., The Politics of Unreason: Right-Wing Extremism in America, 1790-1977 [1970], 2nd ed., Chicago & London, The University of Chicago Press, 1978.
24. Rogalla von Bieberstein J., Die These von der Verschwörung 1776-1945, op. cit. ; Poliakov L., La Causalité diabolique [t. I, 1980 et t. II, 1985], nouvelle édition en un volume, Préface de P.-A. Taguieff, Paris, Calmann-Lévy/Mémorial de la Shoah, 2006.
La pensée conspirationniste. Origines et nouveaux champs 285
tique bien défini, dont il construit un idéaltype : « la Conspiration »25. Depuis, les visions conspirationnistes sont apparues comme l’un des nouveaux objets que l’histoire politique s’est donné, à côté du « secret » (politique, ou en politique) ou du « poison » (dans ses usages poli-tiques). Parmi les objets connexes, on peut mentionner la « peur », les « rumeurs » et les « légendes urbaines », le « mensonge » et le « faux » (usages de faux, plagiats et contrefaçons, faussaires, etc.). Mais, paral-lèlement, de nouvelles analyses de la pensée conspirationniste ont été menées par certains spécialistes de psychologie sociale, tels Serge Moscovici et Carl Friedrich Graumann (co-directeurs d’un important ouvrage collectif : Changing Conceptions of Conspiracy, paru en 198726), ou un sociologue comme Raymond Boudon, en particulier dans son essai intitulé Pourquoi les intellectuels n’aiment pas le libéralisme (2004). Boudon explique pourquoi tant de théoriciens se contentent d’attribuer la misère du monde à un « complot des puissants » ou au « pouvoir invisible » des « dominants » – ou encore à un mystérieux « gouvernement mondial invisible » (Bourdieu27) –, idée fausse mais utile en ce qu’elle sert des intérêts ou répond à une demande sociale28. Le politologue américaine Michael Barkun a, de son côté, analysé divers types de visions conspirationnistes étatsuniennes en privilégiant leur dimension apocalyptique (A Culture of Conspiracy, 2003), et en s’intéressant aux usages médiatico-culturels des récits complotistes, comme l’avaient fait avant lui Mark Fenster (Conspiracy Theories, 1999) et Peter Knight (Conspiracy Culture, 2000), ou encore, en langue allemande, Eduard Gugenberger, Franko Petri et Roman Schweidlenka dans leur ouvrage paru en 1998, Weltverschwörungstheorien, où ils explorent, en particulier, les usages contemporains d’extrême droite de la culture conspirationniste. Je me suis moi-même engagé, au cours des années 2000, dans des recherches sur les mythes politiques modernes
25. Girardet R., Mythes et mythologies politiques, Paris, Le Seuil, coll. « L’Univers historique », 1986, p. 25-62.
26. Voir en particulier Moscovici S., « The Conspiracy Mentality » (trad. angl. K. Stuart), dans C. F. Graumann & S. Moscovici (eds.), Changing Concep-tions of Conspiracy, New York-Berlin-Heidelberg, Springer-Verlag, 1987, p. 151-169.
27. Voir Bourdieu P., Contre-feux 2. Pour un mouvement social européen, Paris, Éd. Raisons d’agir, 2001, p. 10, 69, 72, 88-89.
28. Boudon R., Pourquoi les intellectuels n’aiment pas le libéralisme, Paris, Odile Jacob, 2004, p. 161, 164.
286 Pierre-André Taguieff
organisés autour de l’idée de complot, et plus particulièrement celle de mégacomplot, ainsi que sur l’émergence, grâce à Internet, d’une nou-velle culture populaire mondiale à base de thèmes complotistes. Il m’est devenu clair que le succès de la thèse conspirationniste selon laquelle la marche du monde est déterminée par un « complot américano-sioniste » visant à instaurer un « Nouvel Ordre mondial » despotique29, thèse non seulement fausse mais délirante, tient à ce qu’elle satisfait une demande sociale suscitée par la globalisation30. Le message conspirationniste est parfaitement consonant avec l’opinion dominante, anti-américaine et « antisioniste » (c’est-à-dire à la foi s anti-israélienne et antijuive), telle qu’on la trouve radicalisée dans les cultures politiques d’extrême gauche et d’extrême droite – que j’ai explorées l’une et l’autre dans La Foire aux « Illuminés » (2005) et L’Imaginaire du complot mondial (2006). Des spécialistes de la sociologie des rumeurs ou des « légendes urbaines » contemporaines, comme Jean-Bruno Renard ou Véronique Campion-Vincent (La Société parano, 2005), en sont arrivés, dans les années 2000, à étudier les rapports entre rumeurs et représentations complotistes. Quant à la sociologue Nathalie Heinich, dans Le Bêtisier des sociologues (2009), elle a montré que de nombreuses approches
29. L’expression « New World Order » a été introduite en 1972 par l’idéologue conspirationniste étatsunien Robert Welch (fondateur, en décembre 1958, de la John Birch Society), puis reprise le 11 septembre 1990, dans un sens positif, par le présid ent George H. W. Bush lors d’un discours prononcé devant le Congrès. En 1991, le télé-vangéliste et leader populiste Pat Robertson publiait un essai polémique intitulé The New World Order (Dallas, Word Publishing). Voir Johnson G., Architects of Fear: Conspiracy Theories and Paranoia in American Politics, Los Angeles, Jeremy P. Tarcher, 1983, p. 125-137 ; Bennett D. H., The Party of Fear: From Nativist Move-ments to the New Right in American History, Chapel Hill, The University of North California Press, 1988 ; 2e éd. revue et mise à jour, New York, Vintage Books, 1995, p. 422-425. Sur le mythe apocalyptique du « New World Order » (NWO) et ses usages idéologico-politiques, voir : Durham M., The Christian Right, the Far Right and the Boundaries of American Conservatism, Manchester & New York, Manchester Uni-versity Press, 2000, p. 115 sq. ; Goldberg R. A., Enemies Within: The Culture of Conspiracy in Modern America, New Haven – CT & London, Yale University Press, 2001, p. 47-59, 65, 67, 84 sq. ; Barkun M., A Culture of Conspiracy, op. cit., p. 39-78 ; Bratich J. Z., Conspiracy Panics, op. cit., p. 124-128 ; Jamin J., L’Imaginaire du complot. Discours d’extrême droite en France et aux États-Unis, Amsterdam, Ams-terdam University Press, IMISCO-AUP Dissertations Series, 2009, p. 184-265.
30. Spark A., « Conjuring Order: The New World Order and Conspiracies Theo-ries of Globalization », dans J. Parish & M. Parker (ed.), The Age of Anxiety: Conspiracy Theory and the Human Sciences, op. cit., p. 46-62.
La pensée conspirationniste. Origines et nouveaux champs 287
en sciences sociales, fondées sur la pratique systématique du soupçon, n’étaient que des décalques jargonnants de telle ou telle variante de la vision conspirationniste du fonctionnement social et politique31.
Les grands récits conspirationnistes
Les récits conspirationnistes accusatoires sont structurés selon quatre principes :
1. Rien n’arrive par accident. Rien n’est accidentel ou insensé, ce qui implique une négation du hasard, de la contingence, des coïncidences fortuites.
2. Tout ce qui arrive est le résultat d’intentions ou de volontés cachées. D’intentions mauvaises ou de volontés malveillantes, les seules qui intéressent les esprits conspirationnistes, voués à privilégier les événements malheureux : crises, bouleversements, catastrophes. Postulant que tout événement a été pour ainsi dire programmé, leur baguette divinatoire est la question « à qui profite le crime ? ». Ce qui n’avait pas échappé à Karl Popper : « Selon la théorie de la conspiration, tout ce qui arrive a été voulu par ceux à qui cela profite32. »
3. Rien n’est tel qu’il paraît être. Tout se passe dans les coulisses ou les souterrains de l’histoire. Les apparences sont donc toujours trompeuses.
4. Tout est lié, mais de façon occulte. Derrière tout événement indé-sirable, il y a une « ténébreuse alliance33. »
Les complots, les conjurations et les conspirations sont des organisa-tions politiques secrètes qui, en tant qu’objets de récits fantasmatiques ou fantastiques, ne cessent de hanter les imaginaires sociaux depuis le xviiie siècle (naissance de l’anti-maçonnisme, suivie par son exploitation politique contre-révolutionnaire), tout en fournissant des matériaux sym-
31. Heinich N., Le Bêtisier du sociologue, Paris, Klincksieck, 2009, p. 31-36.32. Popper K. R., La Société ouverte et ses ennemis, op. cit., t. 2, p. 68.33. Sur ces principes constitutifs, voir Pipes D., Conspiracy, op. cit., p. 21-26,
38-48 ; Barkun M., A Culture of Conspiracy, op. cit., p. 3-4 ; Taguieff P.-A., La Foire aux « Illuminés », op. cit., p. 128-130 ; L’Imaginaire du complot mondial, op. cit., p. 57-60 ; Campion-Vincent V., La Société parano. Théories du complot, menaces et incertitudes, Paris, Payot, 2005, p. 11-12.
288 Pierre-André Taguieff
boliques aux mythes politiques modernes. C’est en effet la Révolution française qui apparaît comme la grande machine à produire, à diffuser et à consommer des complots (réels ou fictifs). Entre 1789 et 1799, on assiste à une flambée des accusations de complot, qu’accompagnent de multiples tentatives de théorisation. Loin de prendre toujours la figure d’une doctrine élaborée, le conspirationnisme commence avec la simple croyance par ouï-dire à l’existence d’un complot (n’existant pas réellement), ce qui relève du champ de la rumeur. Mais si les rumeurs sont révélatrices de croyances collectives, elles peuvent être aussi être formalisées et instrumentalisées par des discours de propagande. Plutôt que de « théorie du complot », pour être rigoureux, il faudrait utiliser judicieusement les expressions suivantes, en allant du moins élaboré au plus élaboré : rumeur de complot, hypothèse du complot, imaginaire du complot, idéologie du complot, mythe ou mythologie du complot. Selon la mentalité, l’esprit ou le style de pensée conspirationniste, il existe un « vaste complot » ou une « grande conspiration » constituant la force motrice de l’Histoire ou la principale cause productrice des évé-nements. Le « mégacomplot » est donc censé expliquer tel événement ou telle série d’événements. Ces récits explicatifs relèvent de la pensée mythique : en désignant les causes cachées du Mal, ils présentent l’avan-tage de rendre le monde intelligible ou de donner du sens à la marche de l’Histoire, tout en indiquant la voie à suivre pour lutter contre les « vrais responsables » des malheurs de l’humanité.
En 1948, dans un article intitulé « Prédiction et prophétie dans les sciences sociales », Popper a exposé et commenté son modèle de la « théorie sociologique du complot » qu’il suppose, à juste titre, fort répandue dans la modernité : « Celle-ci [la théorie sociologique du complot] est fondée sur l’idée que tous les phénomènes sociaux – et notamment ceux que l’on trouve en général malvenus, comme la guerre, le chômage, la pauvreté, la pénurie – sont l’effet direct d’un plan ourdi par certains individus ou groupements puissants34. » La vision conspirationniste peuple le monde d’ennemis absolus, absolument redoutables parce que puissants, pervers et dissimulés, qui semblent réinventer les dieux ou les démons : « On ne croit plus aux machina-tions des divinités homériques, auxquelles on imputait les péripéties de la Guerre de Troie. Mais ce sont les Sages de Sion, les monopoles,
34. Popper K. R., Conjectures et réfutations…, op. cit., p. 497-498.
La pensée conspirationniste. Origines et nouveaux champs 289
les capitalistes ou les impérialistes qui ont pris la place des dieux de l’Olympe homérique35. » Le principe de la vision conspirationniste est simple : on attribue la responsabilité de tous les malheurs du monde à des ennemis imaginaires du genre humain. Ces ennemis sont construits comme des puissances occultes et malfaisantes, pour qui les fins (dominer, exploiter, exterminer) justifient tous les moyens. Ils sont par là diabolisés : jésuites, francs-maçons, « ploutocrates », « judéo-maçons », « judéocapitalistes » ou « judéobolcheviks » dans le monde d’hier, « financiers internationaux », « nouveaux maîtres du monde » ou « américano-sionistes » dans le monde d’aujourd’hui. La théorie du complot, qui postule que la manipulation mène l’Histoire, fonctionne de concert avec la diabolisation. Dans la perspective définie par Popper, la « théorie du complot » consiste à poser que tous les maux observables dans les sociétés sont dus à un complot des puissants, qui dissimule-raient leurs desseins égoïstes sous de nobles intentions (« démocratie », « libéralisme », « humanisme », « progressisme », etc.). Un théoricien conspirationniste peut dès lors se présenter comme un démystificateur : il arrache les masques, il dévoile ce qui se cache dans les « coulisses » de l’Histoire. Les complots fictifs fonctionnent comme des récits expli-catifs permettant à ceux qui y croient de donner un sens à tout ce qui arrive, en particulier à ce qui semble n’avoir été ni voulu ni prévu, et qui inquiète ou scandalise. Dans la perspective complotiste, il n’y a pas réellement d’« effets pervers » au sens sociologique du terme (effets ni voulus ni prévus), car tout ce qui arrive est perçu comme l’effet néces-saire d’intentions ou d’actions intentionnelles. C’est en ce sens que la théorie du complot constitue un simulacre de science sociale. Pour comprendre cette prétention recouvrant une imposture, il faut rappeler comment Popper définissait la « tâche principale des sciences sociales théoriques », à savoir « déterminer les répercussions sociales non intentionnelles des actions humaines intentionnelles36 ». Les sciences sociales sont ainsi vouées à étudier les effets pervers. Le théoricien complotiste, quant à lui, commence par nier l’existence même des effets pervers, ou bien s’efforce de les éliminer du champ historique ou social en les réduisant à des modes de réalisation de plans ou de projets, donc à des effets attendus.
35. Ibid., p. 498.36. Ibid., p. 498 (trad. modifiée).
290 Pierre-André Taguieff
Dans la nouvelle vulgate « anticapitaliste », répandue à l’extrême gauche comme à l’extrême droite, la causalité diabolique s’incarne d’abord dans la globalisation, assimilée au capitalisme mondial et à ses méfaits supposés. Comme la « religion du progrès » qui pense posi-tivement la globalisation, la vision conspirationniste du monde peut être décrite comme une religion politique, ou plus exactement comme une gnose, c’est-à-dire comme un savoir qui sauve. Conspirationnisme et progressisme répondent en effet d’une façon différente à quelques questions fondamentales concernant le sens du devenir. La pensée progressiste, en tant que gnose moderne, se présente d’une part comme explication de l’Histoire, voire de l’évolution tout entière ainsi dotée d’un sens, et, d’autre part, comme méthode de salut, à travers une action collective visant à suivre le Progrès dans sa marche inévitable, ou bien, à l’accélérer de diverses manières. La gnose progressiste définit à la fois ce qu’est le réel dans son essence (tout est en progrès), ce qu’est l’Histoire (un long processus de perfectionnement ou d’amélioration de l’espèce humaine), ce qu’est l’homme (un être perfectible), ce qu’il doit faire (vouloir le progrès et contribuer à sa réalisation historique) et ce qu’il lui est permis d’espérer (dans et par le progrès, l’Humanité se sauve : promesse formulée à l’endroit des générations futures).
La gnose conspirationniste, quant à elle, définit le réel comme ce qui est caché derrière les apparences trompeuses, et imagine l’His-toire comme un domaine contrôlé par des forces occultes cherchant à dominer, exploiter ou détruire les groupes humains. Elle postule que les hommes sont soit faibles et crédules, soit puissants et cyniques (et, en tant que tels, non transformables), partant exclut l’idée que la morale puisse être autre chose qu’illusion et instrument au service d’un despo-tisme, et ne laisse espérer qu’une chose : que les puissances obscures, une fois dévoilées, perdent leur puissance.
Cette conviction est un invariant de la pensée conspirationniste, dont le mode d’action symbolique privilégié est le dévoilement des secrets supposés de l’ennemi caché, soit la révélation de son programme de domination, d’exploitation ou de destruction. C’est ainsi que le milliar-daire engagé Henry Ford, en dévoilant les secrets des ennemis cachés du genre humain par la publication des Protocoles des Sages de Sion ou de pamphlets antijuifs dérivés – dont The International Jew (1920-1922, 4 vol.), recueil d’articles de ses collaborateurs qu’il s’est laissé attribuer –, était convaincu de fournir à ses compatriotes les moyens
La pensée conspirationniste. Origines et nouveaux champs 291
de lutter victorieusement contre le « péril juif37 ». En 1922, dans son autobiographie (My Life and Work), désireux de justifier la publication du Juif international, Henry Ford s’adressait à eux en ces termes :
« Notre livre ne prétend pas avoir dit le dernier mot sur les Juifs en Amérique. Il ne fait que relater leur impact présent dans ce pays. […] Il suffit que les gens apprennent à identifier l’origine et la nature des influences qui s’exercent autour d’eux. Que le peuple américain comprenne une fois pour toutes qu’il n’y a pas de dégénérescence naturelle, mais une subversion préméditée qui nous meurtrit : dès lors, il sera sauf. En signalant le danger, on l’écarte 38. »
En 1920, Hitler prend connaissance des Protocoles qui viennent d’être traduits en allemand et, à son tour, croit y découvrir le plan secret des Juifs pour la domination du monde. Dans le premier tome (1925) de Mein Kampf, le Führer affirme que les Protocoles des Sages de Sion « exposent clairement et en connaissance de cause ce que beaucoup de Juifs peuvent exécuter inconsciemment. » Et d’ajouter : « C’est là l’important. Il est indifférent de savoir quel cerveau juif a conçu ces révélations ; ce qui est décisif, c’est qu’elles mettent au jour, avec une précision qui fait frissonner, le caractère et l’activité du peuple juif et, avec toutes leurs ramifications, les buts derniers auxquels il tend. » Comme Ford, qu’il admirait, Hitler voit dans le document supposé révélateur une arme idéologique décisive contre les Juifs : « Le jour où il sera devenu le livre de chevet d’un peuple, le péril juif pourra être considéré comme conjuré39. »
37. Voir Lee A., Henry Ford and the Jews, New York, Stein and Day, 1980 ; Singerman R., « The American Career of the Protocols of the Elders of Zion », American Jewish History, 71 (1), sept. 1981, p. 48-78 ; Ribuffo L. P., « Henry Ford and The International Jew », American Jewish History, 69 (4), june 1980, p. 437-477 ; repris dans Ribuffo L. P., Right Center Left: Essays in American History, New Bruns-wick, NJ, Rutgers University Press, 1992, p. 70-105 ; Baldwin N., Henry Ford and the Jews: The Mass Production of Hate, New York, Public Affairs, 2001.
38. Ford H. (in collaboration with Crowther S.), My Life and Work, Garden City, NY, Garden City Publishing Co. William Heinemann Ltd., 1922, p. 250-251 ; trad. anonyme : Ma vie et mon œuvre, Paris, Payot, 1926, p. 283-284 (trad. légèrement modifiée). Voir aussi Lee A., Henry Ford and the Jews, op. cit., p. 33.
39. Hitler A., Mein Kampf [1925 et 1927], Munich, Zentralverlag der NSDAP, Verlag Franz Eher, 1942, p. 337 ; trad. J. Gaudefroy-Demombynes et A. Calmettes : Mon Combat (Mein Kampf), Paris, Nouvelles Éditions latines, 1934, p. 307.
292 Pierre-André Taguieff
Le « Nouvel Ordre mondial », entité ambiguë installée depuis le début des années 1990 dans l’imaginaire de la globalisation, est perçu soit comme le nouveau Dieu sauveur dans la gnose néo-progressiste ou « mondialiste », soit comme la nouvelle figure du diable dans la gnose conspirationniste – qui se présente sous les couleurs de l’anti-mondialisme à droite et de l’altermondialisme à gauche. Nous sommes ainsi en présence de deux conceptions de l’Histoire opposées, l’une et l’autre fondées sur des emprunts sélectifs à des spéculations théologico-religieuses ou philosophiques, emprunts devenus méconnaissables par les traitements polémiques auxquels ils ont été soumis. Religiosités de substitution pour non-croyants en quête de sens, ou philosophies de l’Histoire fabriquées par des amateurs se donnant pour des contre-experts. Dans la gnose conspirationniste contemporaine, fabriquée avec des matériaux symboliques issus de diverses traditions (antimaçon-nisme, antisémitisme et « antisionisme » radical, antiaméricanisme, anticapitalisme), la globalisation est pensée et dénoncée comme un processus démoniaque, intrinsèquement destructeur, mais en dernière analyse maîtrisable en ce qu’il est imputé à des comploteurs qu’il suffit de démasquer. Il est toujours possible d’agir sur les causes, en particu-lier lorsqu’elles se confondent avec des sujets humains.
Dans les années 2000, ces mythologies du temps présent, centrées sur la dénonciation d’un mégacomplot imaginaire attribué à des puissances occultes démonisées, ont mis en scène deux grands accusés, érigés en ennemis absolus : les États-Unis et Israël, le plus souvent associés dans une ténébreuse alliance qui, dans le discours khomeyniste, était celle du « Grand Satan » et du « Petit Satan40 ». Jumelées dans le discours stéréotypé de l’islamisme radical, notamment dans celui des leaders d’Al-Qaida, ces deux figures prennent place dans la représentation jiha-diste du « complot américano-sioniste », qui définit l’ennemi absolu à éliminer par tous les moyens41. Il s’agit là de deux sujets universels,
40. Voir Taheri A., Khomeiny [1985], trad. J. Carnaud et J. Lahana, Paris, Balland, 1985, p. 282-307 ; The Persian Night : Iran under the Khomeinist Revolution, New York & London, Encounter Books, 2009, p. 3-5, 7-9, 152, 160, 132-145 (Israël), 161-170 (le « Grand Satan » ou les États-Unis) ; Taguieff P.-A., La Judéophobie des Modernes, op. cit., p. 401-403.
41. Taguieff P.-A., Prêcheurs de haine. Traversée de la judéophobie planétaire, Paris, Éd. des Mille et Une Nuit, coll. « Essai », 2004, p. 25 sq., 108 sq., 466 sq. ; La Judéophobie des Modernes, op. cit., p. 17-80 ; La Nouvelle propagande antijuive. Du symbole al-Dura aux rumeurs de Gaza, Paris, PUF, 2010, chap. VII.
La pensée conspirationniste. Origines et nouveaux champs 293
stigmatisés en tant qu’occidentaux (donc liés à la sécularisation, à la démocratie pluraliste, au capitalisme, etc.), auxquels sont imputables des complots internationaux de type criminel. C’est en vertu de leur statut commun de nouveaux « ennemis du genre humain » que s’opère la diffusion planétaire des récits démonologiques dont ils sont les héros intrinsèquement négatifs.
Imaginaires complots « d’en haut »
D’une façon générale, on observe que les vagues conspirationnistes surgissent dans des contextes de crise globale ou de bouleversements profonds de l’ordre social, ébranlant le fondement des valeurs et des normes. Révolution française, Révolution d’Octobre, crise de 1929 : autant d’événements destructeurs de certitudes et de repères, aussitôt suivis d’interprétations plus ou moins délirantes fondées sur l’idée de complot, ces dernières permettant de redonner du sens à la marche de l’Histoire. Prenons l’exemple de la Révolution bolchevique, qui a été interprétée comme le résultat d’un grand complot juif ou judéomaçon-nique. Il est significatif qu’elle ait favorisé, à partir de 1920, la diffusion mondiale des Protocoles des Sages de Sion, qui fournissaient un modèle d’interprétation de ces événements incompréhensibles : cette révolution n’était qu’une étape dans la conquête du monde par les Juifs. La pro-pagation du mythe de « l’Internationale judéobolchevique », véhiculée par les commentaires des Protocoles, commence avec la traduction du célèbre faux en Allemagne dès janvier 1920, puis en anglais le mois suivant. Ces commentaires réactivent la « légende illuministe » et la généalogie fictive qui est censée conduire des « Illuminati » d’Adam Weishaupt (dit « Spartacus ») aux bolcheviks de Lénine et Trotski. En février 1920, alors que les Protocoles venaient d’être traduits en anglais, Winston Churchill, alors ministre de la Guerre, reprenait à son compte la vision conspirationniste de la Révolution bolchevique diffusée par les émigrés russes antisémites, anti-maçons et anti-bolcheviks :
« Ce mouvement parmi les Juifs n’est pas nouveau. Depuis l’épo-que de Spartacus-Weishaupt, en passant par celle de Karl Marx, pour en arriver maintenant à celle de Trotski (Russie), Bela Kuhn (Hongrie), Rosa Luxembourg (Allemagne) et Emma Goldman (États-Unis), cette conspiration mondiale pour anéantir la civilisa-tion et pour reconstruire la société sur la base de l’arrêt du
294 Pierre-André Taguieff
développement, d’une méchanceté envieuse et d’une impossible égalité n’a fait que s’étendre régulièrement. […] Elle a joué un rôle parfaitement identifiable dans la tragédie de la Révolution fran-çaise. Elle a été le ressort principal de tous les mouvements subversifs au cours du xixe siècle, et, pour finir, aujourd’hui, ce gang d’individus extraordinaires sortis des bas-fonds des grandes métropoles d’Europe et d’Amérique du Nord tient désormais le peuple de Russie par les cheveux, et ils sont devenus les maîtres pratiquement indisputés de cet énorme empire42. »
Conspirationnisme et esprit totalitaire
Les idéologues conspirationnistes peuvent se définir par leur champ de vision : ils ne voient dans la modernité que le triomphe des forces occultes (des « sociétés secrètes » à certaines organisations internatio-nales), dictant la marche de l’Histoire par le moyen d’une manipulation généralisée. Dans la perspective des Lumières, les idées mènent le monde vers le mieux et les bonnes intentions se réalisent dans l’Histoire sous la figure du Progrès. La vision conspirationniste de l’Histoire est, au contraire, fondée sur le postulat que les idées mènent le monde vers le pire, et que l’Histoire avance sous la dictature des mauvaises inten-tions. En ce sens, la vision conspirationniste révèle l’envers des idéaux illuministes, c’est-à-dire la face gênante, désespérante, de la marche de l’Histoire. Un pas de plus, et l’on peut reconnaître au conspirationnisme un mérite, celui de dissiper certaines illusions propres à l’optimisme progressiste moderne : derrière la libre discussion dans l’espace public, idéalisée par la théorie démocratique moderne, il fait entrevoir la fabri-cation et la manipulation cyniques des opinions par des puissances ayant intérêt à agir d’une façon secrète et à utiliser systématiquement le mensonge comme arme politique. Les écrits conspirationnistes se présentent en effet comme des analyses hypercritiques du monde moderne, comme des investigations démystifiantes sur ce qui est dit des événements. Jusque dans leurs excès, ils dévoilent parfois des vérités
42. W. Churchill, Illustrated Sunday Herald, 8 février 1920. Voir : Lebzelter G. C., Political Anti-Semitism in England 1918-1939, London, The Macmillan Press & Oxford, St Anthony’s College, 1978, p. 96-100 ; Segel B., A Lie and a Libel: The History of the Protocols of the Elders of Zion [1926], trad. et éd. critique par R. S. Levy, Lincoln & London, University of Nebraska Press, 1995, p. 41; Bronner S. E., A Rumor About the Jews: Reflections on Antisemitism and the Protocols of the Learned Elders of Zion, New York, St. Martin’s Press, 2000, p. 107.
La pensée conspirationniste. Origines et nouveaux champs 295
inaperçues, ou gênantes. C’est là précisément ce qui les rend, aux yeux de certains, particulièrement pervers.
Étudier l’imaginaire du complot mondial, c’est, au-delà de l’intérêt propre d’un tel objet, contribuer à l’étude, nécessairement pluridis-ciplinaire, des mythes politiques modernes43, dont on peut esquisser sommairement une typologie : (1) Le complot ; (2) L’âge d’or (et/ou le déclin, la décadence) ; (3) Le sauveur ; (4) L’unité ; (5) L’avenir (et/ou le progrès) ; (6) L’homme nouveau (amélioré ou fabriqué) ; (7) La société parfaite ; (8) La santé parfaite. Tels sont les grands récits, où le mythe se marie avec l’utopie et les « religions séculières » (Raymond Aron) ou les nouvelles gnoses (Eric Voegelin), qui peuplent l’espace de l’imaginaire social et politique des Modernes.
Il reste à considérer de plus près les relations entre les fantasmes conspirationnistes et le fonctionnement réel des mouvements et des régimes totalitaires, grands consommateurs de complots fictifs contre lesquels ils organisaient des complots terriblement réels. L’esprit totali-taire se fonde en effet sur deux postulats, qui apparaissent chez certains idéologues comme les deux aspects d’une conviction absolue : (1) l’His-toire est l’histoire des conspirations qui réussissent ou échouent ; (2) pour lutter contre les puissances occultes qui nous menacent à travers l’organisation de complots, il faut organiser des contre-complots. D’où l’engagement dans une sorte de machiavélisme magique, dont on peut résumer le motif fondamental comme suit : si c’est Satan qui est le moteur caché de l’Histoire, alors il convient de recourir aux méthodes de Satan contre ses suppôts. C’est dans l’antisémitisme hitlérien qu’on trouve la théorisation la plus aboutie, et la plus radicale, de cette vision de l’Histoire et de l’action dans l’Histoire, qui suppose l’existence intrinsèquement menaçante du « Juif » comme figure pseudo-humaine prise par le diable. Dans cette perspective, la démonisation du « Juif », traité comme une entité mythique, est centrale. Cette forme radicale de
43. Voir ellul J., « Mythes modernes », Diogène, n° 23, juillet-septembre 1958, p. 29-49 ; reszler A., Mythes politiques modernes, Paris, PUF, 1981; Girar-Det R., Mythes et mythologies politiques, op. cit. ; cassirer E., « Le judaïsme et les mythes politiques modernes », Revue de métaphysique et de morale, n° 96 (3), 1991, p. 291-303 ; Le Mythe de l’État [1946], trad. B. Vergely, Paris, Gallimard, 1993 ; FlooD Ch. G., Political Myth: A Theoretical Introduction, New York & London, Routledge, 2002 ; blumenberG H., La Raison du mythe [2001], trad. S. Dirschauer, Paris, Gallimard, 2005.
296 Pierre-André Taguieff
judéophobie repose sur deux dogmes : (1) les Juifs sont responsables de tous les maux qui frappent le genre humain ; (2) l’élimination totale des Juifs représente la voie du salut. Dans le fantasme de la vaste conspi-ration criminelle contre le genre humain imputée aux Juifs, impliquant la vision d’un combat final contre le principe du Mal, s’articulent donc le mécanisme d’attribution causale baptisé « causalité diabolique » par Léon Poliakov et le schéma d’une attente de rédemption emprunté à la littérature apocalyptique et eschatologique.
L’antisémitisme radical de Hitler et de certains hauts dirigeants du Troisième Reich ne peut se comprendre qu’en tant que forme prise, au xxe siècle, par la vision démonologique du « Juif » (dit « éternel », « international », etc.), et plus précisément comme un avatar moderne de la démonologie antijuive fabriquée avec certains matériaux théolo-gico-religieux de la culture chrétienne. On doit à Norman Cohn et à Léon Poliakov l’élaboration d’un modèle d’intelligibilité, incluant une généalogie, de cet « antisémitisme exterminateur » aux implications totalitaires. Dans la préface à l’édition française de sa grande étude sur les Protocoles des Sages de Sion, Norman Cohn pose que « la forme première de l’antisémitisme fut l’antisémitisme démonologique, c’est-à-dire l’idée que le judaïsme est une organisation conspirative, placée au service du mal, cherchant à déjouer le plan divin, complotant sans trêve la ruine du genre humain44 », et que cet antisémitisme démonolo-gique, qui s’est constitué surtout à partir du xiie siècle, « fut ranimé et modernisé aux xixe et xxe siècles45 », avant de se transformer, à l’âge de la sécularisation et dans un espace idéologique orienté par un antichris-tianisme plus ou moins assumé, en noyau dur de la vision hitlérienne du « Juif » comme ennemi absolu à combattre inconditionnellement.
III. L’imaginaire conspirationniste dans la période post-nazie
La légende des Illuminati a aujourd’hui pris place dans la culture populaire globalisée. Mais cette figure paradigmatique du groupe conspiratif présente désormais deux visages. Il faut distinguer les Illuminati de type satanique – à la fois inhumains et surhumains –,
44. Cohn N., Histoire d’un mythe. La « Conspiration » juive et les Protocoles des Sages de Sion [1966], trad. L. Poliakov, Paris, Gallimard, 1967, p. 13-14.
45. Ibid., p. 14.
La pensée conspirationniste. Origines et nouveaux champs 297
fantasmés par exemple comme des figures de l’Antéchrist ou des représentants de Satan en personne, des « Illuminati de proximité », qui restent des humains en dépit de leur inquiétante étrangeté. Les pre-miers fascinent les extrémistes « mystiques » de toutes obédiences, en quête d’un ennemi unique, absolu, invisible et surpuissant, incarnant la perversité, supposé traverser les époques historiques en sachant se tra-vestir. Les seconds sont représentés comme des « tireurs de ficelles » et autres manipulateurs invisibles des événements visibles. Contrairement aux figures sataniques, ils ressemblent aux « Grands » visibles de ce monde : hauts dirigeants politiques, financiers internationaux, etc. Dans le discours politique, cette propension au soupçon se rencontre dans les attitudes populistes, dont le moteur affectivo-imaginaire est le ressenti-ment contre « ceux d’en haut », les élites perçues comme illégitimes et prédatrices46. On retrouve ici les rumeurs complotistes ordinaires, struc-turées par des croyances très répandues : « On nous ment », « On nous mène en bateau », etc. Ce qui est ici postulé, c’est que les « lobbies » mènent le monde. Des « lobbies » qui, loin de n’être que des groupes de pression, sont des minorités agissantes imaginées comme superpuis-santes et dominatrices, cyniques et cupides.
Depuis la fin du communisme soviétique, la recomposition du camp révolutionnaire suit la voie d’une nouvelle critique radicale, refusant tout compromis (celui qui fonde la perspective social-démocrate), du capitalisme ou de l’économie libérale. Le « turbocapitalisme », appelé aussi « capitalisme mondialisé » ou « néo-libéralisme », est dénoncé comme une vaste machination intrinsèquement perverse mise en place par les puissances financières pour maximiser leurs profits. Le résumé le plus simple de la nouvelle vision démystificatrice et révolutionnaire du monde est le suivant : les riches complotent contre les pauvres, pour devenir encore plus riches et rendre les pauvres toujours plus pauvres – jusqu’à recourir à diverses méthodes criminelles pour les éliminer (épidémies et pandémies planifiées dans des laboratoires secrets, contrôle des naissances visant les seules populations indésirables, etc.). L’objet de la démonisation révolutionnaire n’est autre qu’une chimérique « Internationale des riches ». Le programme de la justice révolutionnaire tient en un double impératif : les riches doivent payer, et ils doivent payer pour être ce qu’ils sont – d’abominables « riches ».
46. Taguieff P.-A., L’Illusion populiste. Essai sur les démagogies de l’âge démo-cratique [2002], nouv. édition, Paris, Flammarion, 2007.
298 Pierre-André Taguieff
Contrairement aux complots chimériques traditionnels (le jésuite, le maçonnique, le contre-révolutionnaire ou réactionnaire, le révolution-naire ou subversif), attribués à des minorités actives rebelles ou à des « sociétés secrètes » subversives, les complots fictifs ainsi dénoncés sont des complots « d’en haut », supposés fomentés par les élites en place, les détenteurs du pouvoir et des richesses, censés vouloir plus de pouvoir et plus de richesses – tels les « banquiers de Wall Street », qui personnifient la mystérieuse et redoutable « ploutocratie cosmopolite ». Ces « nouveaux maîtres du monde », par leur inhumanité, leur avidité et leur parasitisme, se seraient donc exclus du genre humain : leur statut de « maîtres secrets » du monde symbolise cette mise à part. Avec eux sont réinventés les « disciples de Satan » ou les figures annonciatrices de l’Antéchrist. Ils sont par ailleurs identifiés comme les chefs invisi-bles, les représentants ou les véhicules anonymes de deux « ismes » mythiques répulsifs : l’« impérialisme » et le « capitalisme » (« mondia-lisation libérale », « néo-libéralisme », dit-on encore). Leurs victimes sont censées être « les peuples », supposés exploités, discriminés, dominés. Les grands récits anticapitalistes, postulant une vision mani-chéenne du monde (dominants/dominés, riches/pauvres, etc.), oscillent entre la divinisation populiste des « peuples » et leur victimisation misérabiliste. Dans la littérature conspirationniste contemporaine, la plupart des mégacomplots imaginaires sont attribués aux « puissants » ou aux « dominants ». La mythologie des complots subversifs ou révo-lutionnaires a fait place à celle des complots contre-révolutionnaires, réactionnaires, « néo-réactionnaires » ou « néo-conservateurs ».
Lorsqu’ils sont exploités par une propagande politique, ces méta-récits sont portés par une triple visée : (1) désigner, pour les mettre en accusation, les responsables cachés des malheurs du genre humain, (2) réduire tous les ennemis des « peuples » à la figure d’un ennemi unique et démonisé (d’où la dénonciation de complots qui s’emboîtent), et (3) provoquer une mobilisation totale contre l’ennemi absolu, dont l’élimi-nation est pensée comme l’acte par lequel l’humanité se libère enfin de ses « chaînes ». Le mythe répulsif du mégacomplot criminel s’accom-pagne d’un mythe positif centré sur la promesse d’une libération, d’une délivrance, d’une rédemption. La dénonciation du grand complot des méchants par les membres du parti universel du Bien dessine la voie du salut. La dénonciation du mégacomplot a une dimension gnostique : la pensée conspirationniste fournit un savoir qui sauve.
La pensée conspirationniste. Origines et nouveaux champs 299
Dans les années d’après-guerre, au sein du monde occidental, la mythologie conspirationniste s’est développée autour de sept figures de complots fictifs :
1. la « rumeur » de Roswell (Nouveau-Mexique) lancée le 8 juillet 1947, lorsque fut publiée l’annonce de la découverte des débris d’une « soucoupe volante », à partir de laquelle va se développer une proliférante littérature ufologique de facture conspiration-niste qui passe à l’extrême droite au cours des années 1970 et 1980, réactivant la vieille doctrine théosophique des envahis-seurs extraterrestres et mettant en cause le gouvernement fédéral américain (en tout ou en partie), l’armée, certains cercles du FBI et la CIA (en tout ou en partie47) ;
2. la menace communiste, centrée sur la double vision paranoïaque d’une infiltration (privilégiée par la chasse aux sorcières de type maccarthyste) et d’un encerclement des démocraties libérales occidentales par des forces relevant d’une Internationale révolu-tionnaire aux multiples visages ;
3. les activités inquiétantes des organisations « mondialistes » avec leurs projets secrets ou leurs manipulations occultes, visant à instaurer un « gouvernement mondial » au profit de la super-élite du pouvoir et de l’argent ;
4. la menace fasciste, néofasciste ou néonazie : la thèse selon laquelle une internationale d’extrême droite occulte est en passe de réaliser son programme totalitaire, thèse largement diffusée par la propagande soviétique que présupposent toutes les variétés d’« antifascisme » dans la période post-nazie, qui postulent donc l’existence d’un grand complot fasciste ou néo-fasciste d’exten-sion planétaire dont les idéologues « antifascistes » cherchent indéfiniment des indices ou des preuves ;
5. la manipulation, l’orchestration ou l’organisation du terrorisme par les services secrets des États, s’efforçant de réaliser certains objectifs cachés et inavouables à travers des attentats spectacu-laires qu’ils dénoncent cyniquement, les attribuant à des groupes
47. Voir Stoczkowski W., Des hommes, des dieux et des extraterrestres. Ethnolo-gie d’une croyance moderne, Paris, Flammarion, 1990 ; Lagrange P., La Rumeur de Roswell, Paris, La Découverte, 1996 ; Dean J., Aliens in America: Conspiracy Cultures from Outerspace to Cyberspace, Ithaca, NY, Cornell University Press, 1998.
300 Pierre-André Taguieff
armés fictifs ou totalement infiltrés. En France, Guy Debord a théorisé dans les années 1970 ce modèle « démystificateur » du terrorisme. En 1988, dans ses Commentaires sur la société du spectacle (ix), Debord réduisait le terrorisme à un instrument créé par l’État pour forcer le consentement des citoyens-spectateurs à ce qui est : « Cette démocratie si parfaite fabrique elle-même son inconcevable ennemi, le terrorisme. Elle veut, en effet, être jugée sur ses ennemis plutôt que sur ses résultats. L’histoire du terrorisme est écrite par l’État ; elle est donc éducative. Les populations spectatrices ne peuvent certes pas tout savoir du terrorisme, mais elles peuvent toujours en savoir assez pour être persuadées que, par rapport à ce terrorisme, tout le reste devra leur sembler plutôt acceptable, en tout cas plus rationnel et plus démocratique48. » Ce modèle conspirationniste du terrorisme a été ensuite appliqué par l’extrême gauche, au cours des années 1990, pour nier la réalité du terrorisme islamiste en Algérie, puis par les antiaméricains radicaux pour nier l’existence d’Al-Qaida, réduite à un épouvantail créé par les services secrets étatsuniens, et, pour finir, par les dénonciateurs de la « conspiration interne » dont aurait résulté le 11-Septembre (tel Webster G. Tarpley, théo-ricien du « terrorisme fabriqué ») ;
6. les origines artificielles (fabrication en laboratoire) et la propa-gation volontaire du sida par de puissants réseaux occultes, avec leurs objectifs inavouables, d’ordre démographique ou d’inspi-ration raciste : le génocide des peuples du Tiers-monde (ou des « pays pauvres »), des homosexuels, des Noirs, etc. ;
7. les vols et les trafics d’organes humains accompagnés ou non d’assassinats, mondialement planifiés sur le mode d’un méga-marché criminel, les pays riches étant accusés de piller le capital somatique des pays pauvres (variante du thème de propagande tiers-mondiste par excellence : le « pillage du Tiers-monde »). Les pays visés en priorité sont ici les États-Unis et Israël49.
48. Debord G., Commentaires sur la société du spectacle [1988], suivi de Préface à la quatrième édition italienne de La Société du Spectacle [1979], Paris, Gallimard, 1992, p. 40 & Œuvres, éd. établie et annotée par J.-L. Rançon en collaboration avec A. Debord, Préface et introduction de V. Kaufmann, Paris, Gallimard, coll. « Quarto », 2006, p. 1607.
49. Sur ce thème d’accusation visant Israël, voir : Reichstadt R., « Vol d’organes : le web conspirationniste “antisioniste” se lâche », 25 septembre 2009, http://www.
La pensée conspirationniste. Origines et nouveaux champs 301
Du fait qu’il est de notoriété publique que la CIA conduit des opérations secrètes et organise des complots pour réaliser des objectifs politiques ou militaires, elle représente une cible privilégiée pour tous les dénon-ciateurs de complots imaginaires. Ces derniers voient la main invisible de la CIA dans tous les bouleversements mondiaux. L’existence d’une base empirique pour les inférences les plus délirantes confère à ces der-nières une vraisemblance que les professionnels du conspirationnisme savent exploiter. Depuis 1947 (année de création de la célèbre agence) et l’entrée dans la période de la guerre froide, la CIA est régulièrement inscrite dans les figures mythiques du « Gouvernement invisible » ou du « Gouvernement secret ». Mais, coïncidence hautement significative relevée par tout esprit complotiste, c’est également en 1947 qu’a eu lieu l’événement fondateur de l’affaire ou de la rumeur de Roswell, à savoir la prétendue découverte, le 7 juillet 1947, par l’Armée de l’Air américaine, d’un ovni accidenté, contenant des visiteurs extraterrestres morts ou blessés (supposés autopsiés ou soignés en secret), le tout ayant été aussitôt placé en lieu sûr. Le communiqué du 8 juillet 1947, émanant de la base aérienne de Roswell, a été suivi par la rumeur que d’ina-vouables « secrets » entouraient l’affaire, nourrie par la multiplication des « témoins » affirmant avoir vu des ovnis ou des extraterrestres, ainsi que par la diffusion des accusations visant l’armée américaine censée « cacher la vérité » sur l’affaire.
Cette conjonction de rumeurs et de légendes en voie de formation a provoqué une intense activité interprétative dans divers milieux, qui a rapidement pris la forme de la dénonciation d’un complot étatique interne. Voilà qui suffit à confirmer, pour certains esprits, la thèse du complot du « gouvernement secret » américain (comprenant la CIA et une partie de l’Armée) pour dissimuler de prétendus accords secrets passés avec des extraterrestres prédateurs mais plus « avancés » que les humains en matière de technologie. Un examen des sondages réalisés aux États-Unis au cours de la décennie 1995-2005 montre qu’entre 50 % et 80 % des Américains interrogés croient que le gouvernement fédéral (en tout ou en partie) est entré en contact avec des extra-ter-restres et qu’il cache la vérité aux citoyens sur ces contacts50.
conspiracywatch.info/Vol-d-organes-le-web-conspirationniste-antisioniste-se-lache_a413.html ; Taguieff P.-A., La Nouvelle propagande antijuive, op. cit., p. 492 sq.
50. Taguieff P.-A., La Foire aux « Illuminés », op. cit., p. 31.
302 Pierre-André Taguieff
La vague de conspirationnisme ufologique a également favorisé la dénonciation de complots purement fictifs, totalement dénués de base empirique, aussi invérifiables qu’irréfutables (ou infalsifiables, pour parler comme Popper). Ces derniers ont pris un nouvel essor avec l’ap-parition des extraterrestres dans l’espace des croyances contemporaines. Dans l’après-Roswell, se sont multipliés, d’une part, les récits terrifiants d’abductions ou d’enlèvements extraterrestres (plus exactement : d’hu-mains par des extraterrestres) et, d’autre part, les dénonciations du « complot extraterrestre », indissociable du « complot gouvernemen-tal » à l’américaine, auquel se trouvent souvent mêlés les sinistres MIB, les Men in Black, imaginaires gardiens des secrets ufologiques, ainsi que les inquiétants Illuminati, assimilés par certains auteurs aux mys-térieux et inquiétants « Sages de Sion » tels qu’ils sont présentés dans le plus célèbre des faux conspirationnistes : les Protocoles des Sages de Sion. Tous ces récits de complots ont bénéficié, depuis les années 1990, des puissants moyens de diffusion offerts par Internet.
Le fantastique comme « genre » ou catégorie s’est ainsi enrichi des ténèbres pseudo-scientifiques de la science-fiction d’épouvante. À la suite de la vague de légendes provoquée par la « rumeur de Roswell », et s’en inspirant, des romans et des films de science-fiction ont exploité les représentations complotistes des envahisseurs extraterrestres en les mêlant aux hantises d’un complot communiste, largement répandues à l’époque de la guerre froide. Au cours des années 1950, en particulier aux États-Unis, on rencontre l’assimilation du péril rouge à la menace extraterrestre dans de nombreuses œuvres de fiction. L’énigme persis-tante qu’est l’assassinat de John Fitzgerald Kennedy a été elle-même réinterprétée par les ufologues conspirationnistes : le président améri-cain aurait été tué sur ordre du « gouvernement mondial » occulte qu’il s’apprêtait à démasquer51. Dans les trente dernières années du xxe siècle, l’ufologie conspirationniste, qu’illustre notamment la série télévisée The X-Files (« Aux frontières du réel », lancée en 1993), mêlant le complot extraterrestre et le « complot gouvernemental » à l’américaine, a pris le relais52. Le héros du film tiré de la série, l’agent Fox Mulder,
51. Knight P., Conspiracy Culture…, op. cit., p. 76-116 ; Goldberg R. A., Enemies Within, op. cit., p. 105-149.
52. Fenster M., Conspiracy Theories: Secrecy and Power in American Culture, op. cit., p. 132 sq. ; Knight P., Conspiracy Culture…, op. cit., p. 27-31, 45-55, 216-223 ; Kellner D., « The X-Files and Conspiracy: A Diagnostic Cri-tique », dans Knight P. (ed.), Conspiracy Nation, op. cit., p. 205-232.
La pensée conspirationniste. Origines et nouveaux champs 303
définit parfaitement la vision conspirationniste dans laquelle il joue son rôle : « Je suis le personnage clef d’une machination gouvernementale, un complot destiné à cacher la vérité au sujet de l’existence des extra-terrestres. Une conspiration mondiale, dont les acteurs se trouvent au plus haut niveau du pouvoir et qui a des conséquences dans la vie de chaque homme, femme et enfants de cette planète. »
La force de séduction de la série X-Files, dont le message principal est que « la vérité est ailleurs », tient à la conjonction habilement mise en scène du paranormal, de thèmes ufologiques inquiétants et de repré-sentations conspirationnistes, faisant entrer le spectateur dans le monde du complot des puissants (élites cyniques, sans scrupules) et des extra-terrestres conquérants et prédateurs, dont l’invisible présence hante de nombreux épisodes de la série. Ce monde inquiétant est régi par la mani-pulation. D’où la conclusion que la démocratie est une « cryptocratie », thèse « démystificatrice » reprise par les milieux d’extrême droite et certaines mouvances d’extrême gauche. C’est là l’un des indices d’une transformation du modèle conspirationniste dans les sociétés occidenta-les de l’après-1945 : sans cesser d’être particulièrement virulentes dans les extrémismes de gauche et de droite, les hantises conspirationnistes, longtemps fixées sur des figures étrangères diabolisées (en témoigne la forte dimension xénophobe du conspirationnisme classique), visent de plus en plus souvent l’État ou les grandes organisations internatio-nales, soupçonnés ou accusés de cacher leurs véritables objectifs, leurs plans secrets, leurs connivences souterraines. Le style populiste devient dominant. La méfiance et le soupçon des citoyens vis-à-vis du gouver-nement ou de l’establishment viennent relayer, au moins en partie, les représentations conspirationnistes de l’étranger ou de l’« apatride ». Les puissances occultes malfaisantes sont pour ainsi dire rapatriées ou internalisées : la mythologie américaine très élaborée depuis les années 1950 du « gouvernement secret » dans le gouvernement officiel en fournit la meilleure illustration. L’esprit conspirationniste est au cœur du néo-populisme étatsunien.
Les nouvelles cibles de la mythologie conspirationniste sont peu nombreuses : les États occidentaux riches et puissants (avec leurs services secrets), le gouvernement américain en particulier, la finance internationale ou le capitalisme financier (avec ses agents partout infil-trés), les forces ou les organisations « mondialistes » plus ou moins occultes liées aux « nouveaux maîtres du monde », voire la « race blanche », l’Amérique blanche ou les hétérosexuels (blancs), ces trois
304 Pierre-André Taguieff
dernières catégories démonisées étant accusées d’être responsables de la fabrication et de la propagation du sida pour atteindre leurs objectifs criminels spécifiques. Un grand récit d’accusation circule planétai-rement depuis le début de l’épidémie de sida, faisant jouer un mode d’« explication » relevant typiquement de la « causalité diabolique » : tout s’éclairerait par un complot américain dont les initiateurs, inévita-blement liés à la CIA, auraient organisé la fabrication du virus du sida en laboratoire, au moyen de manipulations génétiques, pour décimer les pays pauvres et ainsi apporter une réponse efficace à la question préoccupante de la surpopulation dans le monde. D’autres auteurs dénoncent le sida comme une « arme génétique ou ethnique », desti-née à tuer sélectivement et en masse des catégories d’humains. Il y a ainsi une version « gay » et « anti-homophobe » du complot sidéen : le virus diabolique aurait été fabriqué pour éliminer les homosexuels. On en trouve aussi une version « antiraciste » : le leader du mouvement « nationaliste » afro-américain « The Nation of Islam » (La Nation de l’Islam), Louis Farrakhan, a repris l’accusation de manipulation à son compte, dénonçant un complot de l’Amérique blanche contre les Noirs, voire la volonté de réaliser un « Holocauste des Noirs53 ».
Dans le monde musulman, l’imaginaire conspirationniste est très répandu : dans la culture populaire, il revient à imputer tous les mal-heurs des musulmans aux « infidèles » qui complotent contre l’Islam depuis toujours. Les idéologues islamistes ont élaboré une doctrine du complot antimusulman doté de deux fonctions principales : expliquer l’état du monde musulman supposé « humilié » ou « opprimé » par les puissances impérialistes, et légitimer l’organisation d’un contre-com-plot musulman inspiré par le jihad et porté par la force du ressentiment. Le postulat de la vision islamiste radicale, telle qu’elle s’est formée au cours des deux derniers tiers du xxe siècle, est qu’il existe un grand complot contre l’Islam et les musulmans, lequel explique le « déclin » de la civilisation islamique. Une fois ce postulat accepté et érigé en dogme fondateur, l’appel au jihad va de soi : les musulmans ont le devoir de combattre ceux qui combattent leur foi, leur existence même en tant que croyants. C’est Hassan al-Banna qui, le premier, a donné une éla-
53. Sur ces différentes versions, voir : Cantwell A. (Jr.), Queer Blood: The Secret AIDS Genocide Plot, Los Angeles, CA, Aries Rising Press, 1993 ; Pipes D., Conspiracy…, op. cit., p. 3-6 ; Knight P., Conspiracy Culture…, op. cit., p. 192 sq. ; Taguieff P.-A., L’Imaginaire du complot mondial, op. cit., p. 21-30 ; Bratich J. Z., Conspiracy Panics, op. cit., p. 97-121, 172-173.
La pensée conspirationniste. Origines et nouveaux champs 305
boration doctrinale à cette vision d’un déclin historique expliqué par un complot permanent, vision décliniste et conspirationniste assortie d’une utopie de la « renaissance » ou de la « régénération » du monde musul-man par le jihad purificateur. Dans son sillage, Sayyid Qutb a défini les deux principales cibles du jihad rédempteur : l’Occident et les Juifs. Oussama Ben Laden, vers le milieu des années 1990, a fait de ce pos-tulat conspirationniste et de sa conclusion jihadiste le thème majeur de sa propagande, qu’on peut ainsi résumer : « L’Islam est partout assiégé, agressé et spolié, l’offensive “judéo-croisée” est planétaire et appelle une mobilisation de l’ensemble des musulmans54. » C’est sur la base de ces prémisses conspirationnistes que Ben Laden peut présenter son combat comme défensif, et théoriser le jihad global comme une réaction légitime à une guerre mondiale engagée contre l’Islam par ses ennemis diaboliques, au premier rang desquels se trouvent les Américains et les Juifs (les leaders d’Al-Qaida ne recourent pas à l’euphémisation chère aux antijuifs européens : plutôt que de se référer aux « sionistes », ils désignent « les Juifs » comme tels).
La principale différence entre l’islamisme radical première version (Hassan al-Banna et les Frères musulmans) et deuxième version (Ben Laden et Al-Qaida), tient à ce que le projet des Frères musulmans était d’ordre politique (instaurer un État islamique), alors que les jihadistes apocalyptiques, ceux qui ne croient plus à la restauration du califat comme ceux qui rêvent, en utopistes, d’un califat universel, ne cherchent plus qu’à mettre le monde à feu et à sang pour en extir-per le mal, sous la supposition que l’Apocalypse précède la venue du Royaume55. Comme l’a noté Jean-Pierre Filiu, l’émergence d’Al-Qaida s’est accompagnée d’une « relecture millénariste du terrorisme jiha-diste56 ». Pour les idéologues du jihadisme apocalyptique, le monde tel qu’il est, supposé intrinsèquement mauvais, doit être bouleversé de fond en comble, voire même détruit pour accélérer la marche vers le salut. Dans le cadre de cette vision eschatologique, toute nouvelle catastrophe nous rapproche de la fin des temps. Face au complot antimusulman, un contre-complot islamique est légitime, et prend la forme d’un complot terroriste permanent. Les islamistes jihadistes choisissent donc l’Apo-calypse, horizon rêvé de tout attentat terroriste, pour faire advenir le
54. Filiu J.-P., Les Neuf Vies d’Al-Qaida, Paris, Éd. Fayard, 2009, p. 238.55. Voir Filiu J.-P., L’Apocalypse dans l’Islam, Paris, Éd. Fayard, 2008, notam-
ment p. 155 sq.56. Ibid., p. 12.
306 Pierre-André Taguieff
Royaume57. Les accélérateurs de l’Apocalypse aux yeux des jihadistes révolutionnaires peuvent être identifiés : le 11-Septembre et la bombe iranienne contre Israël.
IV. Premières années du xxie siècle : le 11-Septembre et après
Les années 2001-2009 ont été scandées par quatre moments conspi-rationnistes, tous liés à des événements de portée planétaire, que je caractériserai successivement.
Le 11-Septembre
Les attaques antiaméricaines du 11-Septembre 2001 ont provoqué une première grande vague conspirationniste dont les thèmes variés, allant du doute partiel (sur les commanditaires de l’action terroriste, l’avion tombé sur le Pentagone ou certains aspects techniques de l’effon-drement des tours du World Trade Center) à la négation globale des faits moyennant une réinterprétation d’ensemble fondée sur le dogme du « terrorisme fabriqué », se sont diffusés planétairement par le canal d’Internet. Dénonciateur du complot oligarchique qui serait à l’origine du 11-Septembre, Webster G. Tarpley réduit corrélativement Al-Qaida à un instrument de la CIA : « Il faut rappeler vigoureusement à l’Arabe qui sympathise avec Al-Qaida que cette organisation a été créée par la CIA et qu’elle continue d’être pilotée par elle au moyen de divers truchements et fusibles, c’est-à-dire des intermédiaires sans liens apparents avec elle58. » Partant, les nouveaux idéologues conspirationnistes postulent que les terroristes sont aveugles, à différents degrés. Cette déréalisation totale du terrorisme international va de pair avec l’imputation à telle instance de pouvoir de la création et du pilotage des groupes terroristes, poussés à commettre des attentats spectaculaires sans en connaître le véritable sens ou les objectifs finaux :
57. Étienne B., Les Combattants suicidaires. Essai sur la thanatocratie moderne, suivi de Les Amants de l’Apocalypse. Clés pour comprendre le 11 septembre, La Tour d’Aigues, Éd. de l’Aube, 2005, p. 90, 94-95, 97.
58. Tarpley W. G., La Terreur fabriquée, Made in USA. 11 septembre : le mythe du xxie siècle [2005], trad. T. Pruzan et B. Kremer, Paris, Éd. Demi-lune, 2007, p. 96.
La pensée conspirationniste. Origines et nouveaux champs 307
« L’essentiel du terrorisme international, mené sur une échelle spectaculaire, est en réalité soutenu par l’État. Cela ne signifie pas qu’il est sponsorisé par l’ensemble du gouvernement […], mais qu’une partie du réseau gouvernemental utilise son accès aux leviers du pouvoir pour soutenir le fait terroriste de diverses maniè-res. […] Le terrorisme moderne est le moyen par lequel les oligarchies mènent contre les peuples une guerre clandestine qu’il serait politiquement impossible de mener ouvertement. […] L’oligarchie poursuit toujours le même et unique programme, inchangé depuis l’époque de Thucydide […] : le but et le pro-gramme de l’oligarchie sont de perpétuer l’oligarchie. […] Le terrorisme est intrinsèquement une activité contrôlée par une faction du gouvernement, agissant probablement sous l’influence de groupuscules financiers qui sont généralement l’ultime source d’autorité sur notre planète mondialisée depuis 199159. »
À la thèse classique, à l’américaine, du complot gouvernemental interne, avec l’implication de la CIA en tout ou en partie, s’est ajoutée la thèse « antisioniste » consistant à voir partout la main criminelle invi-sible des services secrets israéliens. Tout s’expliquerait par une vaste manipulation organisée de concert par la CIA et le Mossad (auxquels certains ajoutent les services secrets britanniques), avec l’aval d’une partie du gouvernement américain (l’administration Bush), supposé désireux d’en finir avec le régime de Saddam Hussein et de « remode-ler » le Proche-Orient. Le discours conspirationniste le plus idéologisé a fait renaître un vieux thème d’accusation antijuif, longtemps resté dans les seules mains des extrêmes droites européennes et étatsuniennes, et repris à la fin du xxe siècle par la plupart des leaders de l’islamisme radical : « Les Juifs dirigent l’Amérique », ou, en version actualisée : « Les sionistes dirigent la politique extérieure des États-Unis ». Mais, sous cette forme explicite, la thèse conspirationniste radicale n’appa-raît que dans les milieux extrémistes (des islamistes aux néo-nazis, en passant par certaines mouvances de la gauche radicale), et a pour effet de renforcer leur marginalisation.
L’avocat et homme politique allemand Andreas von Bülow, auteur de l’un des premiers essais conspirationnistes sur le 11-Septembre60, a
59. Ibid., p. 96, 98.60. Bülow A. von, Die CIA und der 11. September. Internationaler Terror und
308 Pierre-André Taguieff
résumé sa vision du monde dans une intervention à la conférence inter-nationale « Axis for Peace », conférence « anti-impérialiste » et « pour la paix dans le monde » organisée à Bruxelles les 17 et 18 novembre 2005 par le Réseau Voltaire, animé par Thierry Meyssan61. Comme tous les idéologues conspirationnistes, il fait jouer la question magique, celle qui ouvre toutes les portes des complots : la question « À qui profite le crime ? ». Dans son intervention centrée sur l’analyse des « mécanismes de la politique impérialiste », l’ancien ministre allemand a dénoncé « l’Internationale du mensonge » dont « le premier outil est aujourd’hui la manipulation des médias » :
« Faire éclater les opérations psychologiques menées dans nos médias par le Pentagone, la CIA, mais également le Mossad, et leurs satellites, est la tâche la plus importante qui nous attend. Cela peut paraître étrange, mais poser obstinément la question “à qui profite le crime ?’’ face aux références médiatiques quotidiennes à Al-Qaida, Ben Laden ou Zarkaoui, mènera très souvent à voir les choses de façon opposée à la désinformation officielle62. »
Poser la question magico-policière « À qui profite le crime ? » constitue pour les conspirationnistes une véritable méthode de divination63. Les réponses complotistes, par le fait même qu’elles paraissent contesta-taires et marginales (elles se donnent souvent comme marginalisées) ont un pouvoir de séduction spécifique, surtout quand elles jouent sur du mystérieux ou de l’énigmatique. Le 11-Septembre, le suicide de Marylin Monroe, l’assassinat du président Kennedy, l’accident de
die Rolle der Geheimdienste, Munich, Piper, 2003. Pour une étude critique, voir Jaecker T., Antisemitische Verschwörungstheorien nach dem 11. September. Neue Varianten eines alten Deutungsmusters, Münster, Lit Verlag, 2005.
61. Meyssan Th., 11 septembre 2001. L’Effroyable imposture. Aucun avion ne s’est écrasé sur le pentagone ! Chatou, Éd. Carnot, 2002.
62. Bülow A. von, « Nous devons d’abord lutter contre la manipulation » (novembre 2005), 6 janvier 2006, http://www.voltairenet.org/article132462.html#article132462. Voir aussi Meyssan Th., L’Effroyable imposture II. Manipula-tions et désinformations, Monaco, Éd. Alphée, Jean-Paul Bertrand, 2007, p. 28-30.
63. Voir Chossudovsky M., Guerre et mondialisation. À qui profite le 11 septembre ? trad. L. Roy-Castonguay, Paris, Le Serpent à Plumes, 2002. Cet universitaire d’extrême gauche est un proche de N. Chomsky. Voir Chomsky N., 11 septembre. Autopsie des terrorismes. Entretiens [2001], trad. H. Morita et I. Genet, Paris, Le Serpent à Plumes, 2001.
La pensée conspirationniste. Origines et nouveaux champs 309
voiture de Lady Diana, etc., sont des faits complexes, qui, en raison d’enquêtes plutôt mal conduites, demeurent au moins en partie mysté-rieux. Or, le mystère est le berceau de l’imaginaire conspirationniste. Le détective qui est en nous se pose la question : « À qui profite le crime ? », et croit naïvement pouvoir identifier les responsables d’un acte supposé criminel en répondant simplement à cette question. La « clé du mystère » est toujours une activité complotiste, qui satisfait une large demande sociale. D’autant qu’aujourd’hui, des théoriciens du complot intelligents existent : David Ray Griffin, par exemple, s’est fondé sur les incertitudes laissées par les enquêtes sur le 11-Septembre pour développer une contestation radicale et séduisante de l’explication officielle (un attentat organisé et perpétré par Al-Qaida), et conclure à un « complot gouvernemental » interne64. Mais tout ce qui est séduisant n’est pas pour autant vrai. Il faut insister ici sur l’engouement pour la démarche « anti-expert » qui séduit tant le grand public « interne-tisé », qui trouve sur la Toile toutes les interprétations possibles et imaginables, lesquelles sont, dans leur grande majorité, des réponses complotistes. Là encore, il s’agit du prix à payer pour la démocratisation d’Internet, qui diffuse ce mélange de vrai et de faux qui, comme le disait Paul Valéry, est pire que le faux. Les théoriciens du complot s’installent dans cette zone d’ambiguïté ou d’équivoque, dans ce monde virtuel où tout est possible, tout est croyable. Dans le cyberespace, ce qui est simplement imaginable, une fois mis en circulation, devient rapidement une évidence, puis une idée reçue65.
Les interprétations conspirationnistes du 11-Septembre ont montré l’émergence d’une forme nouvelle de pensée du complot, acceptable par des publics non-extrémistes, fondée à la fois sur le rejet des « thèses officielles » comme mensongères, et l’instrumentalisation du doute
64. Griffin D. R., Le Nouveau Pearl Harbor. 11 septembre : questions gênantes à l’administration Bush [2004], trad. P.-H. Bunel, Paris, Éd. Demi-lune, 2006 ; Omissions et manipulations de la Commission d’enquête sur le 11 septem-bre [2004], trad. P.-H. Bunel, G. Beduneau et E. Dablin, Paris, Éd. Demi-lune, 2006 ; 11 septembre. La Faillite des médias. Une conspiration du silence [2007], trad. P.-H. Bunel, Paris, Éd. Demi-lune, 2007.
65. Pour une analyse critique, voir Dasquié G. & Guisnel J., L’Effroyable mensonge. Thèse et foutaises sur les attentats du 11 septembre, Paris, La Décou-verte, 2002 ; Venner F., L’Effroyable imposteur. Quelques vérités sur Th. Meyssan, Paris, Grasset, 2005 ; Vitkine A., Les Nouveaux imposteurs, Paris, Éd. de La Martinière, coll. « Doc en stock », 2005 ; Taïeb E., « La “rumeur” des jour-nalistes », Diogène, n° 213, janv.-mars 2006, p. 133-152.
310 Pierre-André Taguieff
sceptique ou méthodique en tant que mode de légitimation de la thèse, laquelle peut ainsi rester sous-entendue. Dans cette vision conspiration-niste, le dogme central est rarement explicité sous la forme de la thèse suivante, qui fonctionne comme un postulat caché, et qu’on retrouve dans la conclusion qui reste allusive : « Les attentats du 11-Septembre sont les résultats d’un complot organisé par les services secrets améri-cains et israéliens, avec l’aval de l’administration Bush ». L’énonciation des prémisses du raisonnement se fait sans que la conclusion soit lit-téralement énoncée – du moins dans la plupart des cas. On peut ainsi laisser entendre que le 11-Septembre est le fruit d’un « complot amé-ricano-sioniste », sans jamais énoncer la thèse comme telle, qui reste présupposée ou sous-entendue. Ce qui ménage à l’énonciateur une porte de sortie, car l’on peut toujours nier un présupposé ou un sous-entendu : « Je n’ai jamais dit cela », « Je ne voulais pas dire cela », « Vous sur-interprétez mes propos », « C’est vous qui le dites », etc. Ou alors la thèse est énoncée sur le mode de la mention d’une thèse « alternative » soutenable, mais non soutenue personnellement par l’énonciateur, qui souligne sa distance par une dénégation (« Je n’affirme pas que… », « Je ne tire pas de conclusions… »).
Une récente illustration de cette stratégie argumentative est fournie par ce fragment d’une interview d’Aymeric Chauprade, spécialiste de géopolitique, qui donne naïvement dans la dénégation (laquelle revient finalement à affirmer ce qu’on déclare ne pas affirmer) : « Je ne suis pas convaincu par la version officielle. […] J’ai des doutes importants, mais cela ne veut pas dire que je crois que les responsables sont des éléments des services américains ou israéliens. Je ne tire pas de conclusions, je m’interroge. » La conclusion n’est posée, le plus souvent, que sous une forme négative, à travers diverses variantes de « rumeurs négatrices66 » du type « Aucun avion ne s’est écrasé sur le Pentagone » (Thierry Meyssan), ou « Les deux avions qui se sont écrasés soi-disant dans la forêt et au Pentagone n’existent pas » (Jean-Marie Bigard), ou encore « Ni Al-Qaida, ni aucun Ben Laden n’a été responsable des attentats du 11-Septembre » (Jean-Marie Bigard).
66. Renard J.-B., « Negatory Rumors: From the Denial of Reality to Conspiracy Theory », dans G. A. Fine, V. Campion-Vincent & C. Heath (eds.), Rumor Mills: The Social Impact of Rumor and Legend, op. cit., p. 223-239 ; « Les rumeurs néga-trices », Diogène, n° 213, janv.-mars 2006, p. 54-73.
La pensée conspirationniste. Origines et nouveaux champs 311
La deuxième guerre d’Irak
Avant et après le déclenchement de la deuxième guerre d’Irak, en 2002-2003, à l’occasion des mobilisations « antiguerre », des accusations de facture conspirationniste se sont largement répandues, prétendant dévoiler les véritables et nécessairement « inavouables » raisons de l’intervention américaine. Au sein des mouvances extrémistes (de droite comme de gauche) de l’opposition militante à la guerre d’Irak, la dénon-ciation du « complot américano-sioniste » était dominante, comme elle l’avait été dans la réception conspirationniste du 11-Septembre, affirmée d’une façon explicite ou, le plus souvent, sur le mode de la suggestion. La guerre d’Irak est alors dénoncée comme le résultat des pressions exercées par le « lobby juif » ou « sioniste » sur la Maison Blanche67. Le Cheikh Yusuf Al-Qaradawi68, dans son sermon du 4 avril 2003 inti-tulé « N’oublions pas la Palestine ! », a ainsi résumé son interprétation « conspira-sioniste » de l’intervention militaire en Irak, recourant comme il se doit à la question magique « À qui profite le crime ? » :
« Ce qui se passe en Irak ne sert en réalité que le sionisme et Israël. Le premier à profiter de tous ces événements est Israël. L’affaiblissement de l’Irak est un renforcement d’Israël, la destruc-tion des armes de l’Irak sert les intérêts d’Israël. Tout ce qui se passe sert les intérêts d’Israël. Cherchez Israël, cherchez le sio-nisme derrière tous les événements et vous verrez que leur main invisible intervient dans un grand nombre d’affaires. »
La crise mondiale et ses coupables prévisibles
La crise économique et financière mondiale de 2008-2009, dénoncée sur la base d’une vision paranoïaque du capitalisme comme puissance satanique vouée à toujours faire le mal, est devenue le prétexte d’une troisième vague planétaire de récits conspirationnistes, marqués par une forte imprégnation judéophobe.
67. Taguieff P.-A., Prêcheurs de haine, op. cit., p. 439-612.68. Yusuf Al-Qaradawi préside le « Conseil Européen de la Fatwa et de la
Recherche », installé en Angleterre, et siège parallèlement au « Conseil scientifi-que » du principal centre de formation d’imams en Europe, installé à Saint-Léger-de-Fougeret, dans la Nièvre. Ce centre de formation, intitulé « Institut européen des Sciences humaines », a été créé à l’initiative de l’UOIE (Union des Organisations Islamiques d’Europe).
312 Pierre-André Taguieff
1. L’anti-héros Madoff et les figures de la « haute banque juive »
Un héros négatif a aussitôt été sélectionné par le système commu-nicationnel : le financier et escroc Bernard Madoff, dont la judéité a été largement médiatisée, comme celle de son entourage. La démonologie anticapitaliste tenait son ennemi absolu à visage d’homme. L’ennemi modernisé du genre humain, jusque-là ennemi abstrait faisant l’objet de la haine abstraite des milieux anticapitalistes radicaux, perdait son abstraction pour prendre la figure d’un financier juif. Plus précisément, celle d’un « financier juif international » paraissant incarner le stéréo-type négatif traditionnel. C’était l’occasion d’assurer la résurrection du personnage de Shylock, le financier rapace, retouché pour figurer un nomade mondialiste, ou la renaissance actualisée du mythe Rothschild, cette invention des pionniers de l’anticapitalisme socialiste radical69.
Le troisième moment conspirationniste des années 2000 tourne donc autour de l’imputation conspirationniste de la crise économique et finan-cière aux « financiers juifs internationaux » typisés par l’escroc Bernard Madoff ou par la banque d’affaires Goldman Sachs, fondée aux États-Unis en 1869 par un immigré juif allemand, Marcus Goldman. L’un des articles les plus reproduits, cités ou démarqués à ce propos est celui du journaliste politique Matt Taibbi, paru en juillet 2009 dans le magazine Rolling Stone, qui commence ainsi : « La première chose qu’il faut que vous sachiez sur Goldman Sachs, c’est qu’elle est partout. La banque d’investissement la plus puissante du monde est une formidable pieuvre vampire enroulée autour de l’humanité, enfonçant implacablement son suçoir partout où il y a de l’argent. En fait, l’histoire de la récente crise financière, qui est aussi l’histoire du déclin et de la chute rapide de l’Empire américain ruiné par des escrocs, se lit comme le Who’s Who des diplômés de Goldman Sachs. » Un traitement du même type a été réservé, après sa faillite en septembre 2008, à la banque d’investissement multinationale Lehman Brothers, créée en 1850 en Alabama par les frères Emanuel et Mayer Lehman, immigrés juifs allemands.
La crise économico-financière a fourni l’occasion de réactiver la dénonciation des méfaits du tout-puissant « lobby juif » ou « lobby sioniste » aux États-Unis, lieu commun de l’antisionisme radical dans toutes ses versions. Dans un communiqué diffusé le 7 octobre 2008, le porte-parole du Hamas, Fawzi Barhoum, a ainsi accusé le « lobby
69. Taguieff P.-A., La Judéophobie des Modernes, op. cit., p. 309-328.
La pensée conspirationniste. Origines et nouveaux champs 313
juif » étatsunien d’être responsable de la crise financière qui secoue le pays, affirmant que les problèmes du système financier américain s’expliquaient par « la mauvaise gestion administrative et financière et un mauvais système bancaire mis en place et contrôlé par le lobby juif ». Selon Barhoum, ce lobby « contrôle aussi les élections améri-caines et définit la politique étrangère de toute nouvelle administration d’une façon lui permettant de garder la haute main sur l’argent améri-cain, le gouvernement et l’économie, afin que l’Amérique devienne le gros bâton de ce lobby et l’instrument de sa domination sur le monde entier ». Et le porte-parole du mouvement islamiste de se demander « si le président Bush va mener une enquête et dire franchement à son peuple que le lobby juif est directement responsable de ce désastre ». Début octobre 2008, nombre d’observateurs spécialisés ont constaté que la crise financière paraissait provoquer une forte augmentation du nombre de messages à caractère antisémite diffusés sur Internet. Les jeux de mots classiques de l’antisémitisme américain (« New York » – « Jew York ») ont refait surface, adaptés à l’esprit du temps : le « New World Order » dénoncé comme un « Jew World Order », cachant ou annonçant un « Jewish World Government ».
Diffusée massivement sur Internet, et bénéficiant du puissant vecteur politico-culturel qu’est l’anticapitalisme gnostique, l’accu-sation conspirationniste dans toutes ses variantes a fait le tour de la planète, montrant que l’acceptabilité, voire la respectabilité de la vision antijuive du monde était loin d’avoir disparu. Sa réception sans fron-tière marque en même temps l’apparition d’une zone idéologiquement indéterminée, oscillant entre extrême droite et extrême gauche, occupée sur le Web par les blogs et les sites du type « alterinfo », « altermedia » ou « contreinfo ».
2. Bilderberg et Cie
Outre le personnage Madoff, la Goldman Sachs et la banque Lehman Brothers, incarnations de la finance cosmopolite et prédatrice, un autre acteur répulsif, collectif quant à lui, est intervenu dans les récits dia-bolisateurs suscités par la crise économico-financière : les « sociétés secrètes » censées rassembler les puissants de ce monde, sur le modèle du groupe de Bilderberg, « groupe de discussion » censé être l’un des principaux lieux de rencontre, de coordination et de décision de l’oli-garchie mondiale ou de « l’élite financière internationale ». Dans la
314 Pierre-André Taguieff
littérature conspirationniste d’extrême droite « classique70 », le groupe de Bilderberg est inclus dans une série noire d’organisations « mon-dialistes » supposées omnipotentes et maléfiques : la Commission Trilatérale, le Council on Foreign Relations (CFR), le B’nai B’rith, les Skull and Bones71, etc. La mythologie conspirationniste des « sociétés secrètes » est en train de passer des milieux d’extrême droite à cer-taines mouvances d’extrême gauche, où elle bénéficie d’une structure d’accueil : la croyance que tous les malheurs du monde s’expliquent par les actions criminelles des « nouveaux maîtres du monde » ou des membres du cercle sans frontières des élites dirigeantes, dont le noyau dur constituerait une sorte de gouvernement secret d’extension planétaire (« Nouvel Ordre mondial », « Gouvernement mondial72 »). En témoigne par exemple la réception positive d’un article non signé intitulé : « Bilderberg, Trilatérale et transversalité “de gauche” », partant du « mutisme » des « grands médias français » sur les réunions de la Trilatérale (Paris, novembre 2008) et du groupe de Bilderberg (Athènes, mai 2009), un silence général qui ne serait « pas le fruit du hasard ». C’est le prétexte avancé pour dénoncer le « rôle dirigeant des oligarchies financières et industrielles » ou la « stratégie de l’oligarchie européenne et planétaire », en déplorant le « silence général » sur ce fait qu’on s’efforcerait par tous les moyens de « masquer ». Diffusé en mai 2009 sur le blog international du collectif « Indépendance des chercheurs » (sic), « La Science au xxie siècle », cet article de facture conspirationniste a été repris par un grand nombre de sites et de blogs d’extrême gauche comme d’extrême droite.
Les activités occultes de ces organisations « mondialistes », sup-posées fondées sur le pouvoir de l’argent et accusées de vouloir gouverner le monde par la manipulation cynique, sont perçues, par leurs dénonciateurs « révolutionnaires », « antimondialistes » ou « altermon-
70. Allen G. (with Abraham L.), None Dare Call It Conspiracy, Rossmoor, CA & Seal Beach, CA, Concord Press, 1971.
71. Concernant ces organisations, abusivement présentées comme des « sociétés secrètes », un certain journalisme d’investigation donne dans la mise en scène conspi-rationniste. Voir par exemple Robbins A., Skull & Bones. La vérité sur l’élite secrète qui dirige les États-Unis…, trad. B. Drweski et G. Vallifuoco, Paris, Max Millo, 2005. Pour une analyse critique, voir Taguieff P.-A., La Foire aux « Illuminés », op. cit., passim ; L’Imaginaire du complot mondial, op. cit., p. 15-16.
72. Voir Estulin D., La Véritable histoire des Bilberbergers [2005], trad. P. Mazé, Lopérec, Éd. Nouvelle Terre, 2008. Un best-seller de la littérature conspirationniste contemporaine, traduit en 42 langues.
La pensée conspirationniste. Origines et nouveaux champs 315
dialistes73 », comme la principale cause des maux frappant l’humanité. Les accusations convergent toutes en direction d’un même ennemi incarnant la « causalité diabolique » : « le capitalisme » ou « le capi-talisme mondialisé », réalité sociohistorique traitée par ses ennemis comme une entité mythique maléfique dont la destruction totale, au terme de la « lutte finale », est attendue comme un acte de délivrance ou de libération, voire de rédemption. On reconnaît le schéma emprunté à un messianisme teinté de gnosticisme : purifier l’humanité par la destruction de ses éléments nuisibles, afin de garantir la naissance de « l’homme nouveau ».
La grippe H1N1
Il est une quatrième vague observable de croyances conspirationnis-tes, autour de la grippe A (H1N1) dont le virus est réapparu sous une nouvelle forme en 2009, provoquant une grande peur internationale suscitée autant que relayée par les médias. Des rumeurs contradictoires ont provoqué et entretenu les doutes sur la campagne de vaccination lancée par la plupart des États, une campagne perçue a priori comme suspecte par ceux qui jugent que le pouvoir politique est intrinsè-quement manipulateur en même temps que soumis à des puissances économico-financières occultes (les « véritables maîtres du monde »). Les réticences de nombre de médecins, publiquement exprimées, se sont constituées en indice immédiatement privilégié et converti en preuve par la pensée conspirationniste. Si les explications fondées sur le schème du complot mondial se sont multipliées, c’est sur la base des effets pervers d’une application politique imprudente ou brouillonne du principe de précaution à grande échelle. Outre la diffusion d’informa-tions contradictoires sur l’origine du virus et ses éventuelles mutations, le décalage entre la menace annoncée (une grippe mortelle) et la réalité de la situation à l’automne 2009 (faible mortalité, contamination limitée) a nourri l’imaginaire conspirationniste du public international. Ce qui a radicalisé l’inquiétude, c’est le caractère massif des mesures d’urgence prises pour prévenir le surgissement d’une pandémie potentielle. Les explications conspirationnistes sont apparues comme des formations de compromis permettant de sortir de la situation de « dissonance
73. Voir Tweeten L., Terrorism, Radicalism, and Populism in Agriculture, Ames, Iowa State Press, 2003, p. 10, 27-49, 182.
316 Pierre-André Taguieff
cognitive » produite par la co-présence de représentations et de croyan-ces contradictoires : d’une part, la croyance à l’extrême gravité de la situation sanitaire annoncée par les pouvoirs publics, et, d’autre part, le constat de la rareté des cas graves, laissant penser que la grippe H1N1 était comparable, en ses effets, à la banale grippe saisonnière. La réduc-tion de la dissonance cognitive s’est opérée en postulant l’existence d’un diabolique complot international organisé par les firmes pharma-ceutiques et leurs complices parmi les dirigeants politiques en place : le virus aurait été fabriqué et sciemment diffusé, sa virulence aurait été volontairement exagérée, sa diffusion aurait été accompagnée d’une campagne d’opinion destinée à provoquer peurs et paniques de masse, les vaccins contribueraient eux-mêmes à l’extension de la pandémie. Les explications conspirationnistes, répondant à la demande sociale en s’adaptant aux croyances du public (notamment la conviction que « ceux d’en haut » nous mentent et nous trompent), ont ainsi fonctionné comme des modes de rationalisation. Car s’il est vrai que l’affaire de la grippe H1N1 se réduit à une escroquerie de grande envergure organisée par un groupe de puissants comploteurs, tout semble s’éclairer. Ce qui caractérise, ici comme ailleurs, les explications conspirationnistes, ce n’est pas leur irrationalité, c’est au contraire la démesure dans la quête d’une vision rationnelle, c’est un abus de la faculté de chercher des causes, un excès du désir de rationaliser le paysage événementiel. Loin d’illustrer une simple fuite dans « l’irrationnel » (ce qui la rendrait com-parable à la démarche des occultistes modernes, qui se réfèrent plutôt à un ordre « supra-rationnel »), la pensée conspirationniste se présente comme hyper-rationnelle, elle pêche précisément par son rationalisme hyperbolique, arrogant, extrémiste, jusqu’auboutiste. À ce titre, elle exprime l’hybris de la pensée moderne.
Pour ceux qui postulent qu’« on nous cache tout » et cherchent, sans grands moyens d’investigation, « à qui profite le crime », la réponse est donc simple : les responsables de la pandémie sont les grandes firmes pharmaceutiques désireuses d’écouler leurs stocks ou de répondre à la demande mondiale d’urgence de vaccins qu’elles auraient provoquée. Bref, les actuels « maîtres du monde », supposés intrinsèquement cupides et cyniques, auraient sciemment organisé la pandémie pour s’enrichir, en sélectionnant ou fabriquant le virus et en le propageant sciemment. Cette première interprétation conspirationniste, dont l’évidence vient de ce qu’elle exprime les convictions anticapita-listes ordinaires, fait elle-même l’objet d’une réinterprétation selon le
La pensée conspirationniste. Origines et nouveaux champs 317
code culturel de la « nouvelle judéophobie », structurée par la hantise du « complot américano-sioniste ». Sur les sites conspirationnistes « alter », on trouve en effet des affirmations du type : « Il devient de plus en plus évident que les américanosionistes ont quelque chose à voir avec la fabrication de ce nouveau virus ».
Mais la mythologie du « complot américano-sioniste » n’est nulle-ment confinée au cyberespace. Elle s’exprime aussi au plus haut niveau des instances internationales. Le président-dictateur libyen Mouammar Kadhafi, dans le discours qu’il a prononcé lors de la 64e Assemblée Générale de l’ONU, le 23 septembre 2009 (la Libye étant le pays qui préside l’Assemblée Générale pour un an), n’a pas hésité à dénon-cer le complot criminel occidental/capitaliste à l’origine selon lui de l’épidémie : « Parmi les défis auxquels nous sommes confrontés, il y a aussi le virus H1N1 qui a été fabriqué dans des laboratoires à des fins militaires comme arme de destruction. […] Un jour nous aurons aussi la grippe des poissons. Ils fabriquent les virus pour que les industries pharmaceutiques fabriquent les vaccins. […] Les industries capitalistes fabriquent les virus pour ensuite fabriquer les vaccins et faire des profits. » Une nouvelle fois, c’est le complot mondial des « puissants » ou des « dominants », des « riches » et des capitalistes prédateurs, qui est censé expliquer les malheurs des « peuples » ou des « dominés », des « pauvres » ou des « exploités ».
En ce début du xxie siècle, l’imaginaire du complot continue de fournir les représentations et les croyances par lesquelles, dans la nou-velle culture populaire globalisée, sont pensées les crises, les guerres, les révolutions et les catastrophes. Bien que l’utopie communiste ait été disqualifiée, sa démonologie anticapitaliste lui a survécu : les capita-listes, les « puissants » et les « maîtres de la finance » forment toujours la redoutable bande de démons que les hommes dénoncent comme les responsables cachés des malheurs qui les frappent, afin de donner du sens au monde chaotique qui les inquiète et, par là, de se donner des raisons d’espérer.
Conclusion
Intellectuels et journalistes déplorent rituellement ce qu’ils pensent être un scepticisme croissant vis-à-vis de l’histoire « officielle » ou des médias « sérieux », et se posent une question d’apparence naïve
318 Pierre-André Taguieff
du type : « Sommes-nous tous devenus paranoïaques ? ». Manière de poser la question de la haute acceptabilité culturelle de la thématique du complot dans le décryptage de « l’actualité », c’est-à-dire des événements tels qu’ils sont présentés ou représentés. Car la perte de confiance et le soupçon croissant touchent moins l’histoire faite par les historiens que le traitement médiatique de l’actualité. Ils s’expriment à travers la banalisation de ces formules sloganisées : « On nous ment », « On nous trompe », « On nous cache tout ». Trois aspects doivent être distingués. Tout d’abord, la diffusion croissante de la norme pluraliste dans l’espace public, qui implique le respect des positions minoritaires et la discussion critique, donc la prise au sérieux, des opinions et des croyances les plus marginales, à l’exception des incitations à la haine et à la violence. On reste ici dans les limites de la démocratie libérale/pluraliste. On peut même y voir un « progrès » de l’esprit ou des mœurs démocratiques : respecter la liberté d’expression de nos adversaires mêmes, en répondant à leurs arguments, aussi sophistiques soient-ils, par des contre-arguments.
Ensuite, la tentation du relativisme radical : dans un contexte culturel défini par l’effondrement des grandes visions du monde et l’accroisse-ment de l’incertitude, on observe une forte tendance à la mise sur le même plan de toutes les thèses sur les événements historiques. Il n’y a plus de faits, seulement des interprétations, qui se valent toutes. Toutes les « théories » paraissent également acceptables, et donc discutables. La nouvelle culture populaire mondialisée qu’a créée Internet favorise ce mouvement de relativisation, qui a pour effet d’effacer la distinction entre le vrai et le faux, donc d’interdire tout jugement de valeur. Dès lors, « tout se vaut », ou, plus précisément, tout le monde a droit à la parole, et toutes les paroles se valent, c’est-à-dire possèdent une même valeur de « vérité », ou, pour le moins, de discutabilité. Ce qui revient à poser, comme un fait en même temps qu’une norme : « à chacun sa vérité ». L’égalitarisme qui règne au sein de la communauté des inter-nautes est à l’image de l’hyper-égalitarisme du démocratisme vulgaire. Comment n’y pas déceler une forme douce de nihilisme ?
Il faut enfin pointer l’extension du soupçon visant les médias, accusés – souvent à juste titre – soit de connivence avec les pouvoirs dont ils ne seraient que les courroies de transmission, soit de conformisme frileux les conduisant à s’aligner sur les communiqués « officiels ». Cette atti-tude de défiance favorise la croyance que les investigations sans tabous et les débats libres ne se rencontrent que sur Internet. C’est la thèse
La pensée conspirationniste. Origines et nouveaux champs 319
publiquement défendue par la plupart des tenants de la pensée conspira-tionniste, qui se transfigurent eux-mêmes en « résistants » luttant contre la « désinformation officielle ». Ils s’imaginent en héros d’une grande aventure intellectuelle, qui s’élève à leurs yeux à la hauteur d’un combat pour la vérité. Illusion bien sûr, mais qui donne sens à leur vie. C’est pourquoi aucun argument ne peut ébranler leurs dogmes, ces gardiens du sens de leur existence.
Tant que la marche de l’Histoire paraîtra obscure aux humains, ces derniers demanderont aux récits conspirationnistes de les éclairer. Or, il paraît improbable qu’on puisse un jour accéder à une transparence historique totale. Il est hautement probable que l’invisible ne cessera jamais de hanter le visible, en dépit du progrès des connaissances. Les interprétations conspirationnistes ont donc de beaux jours devant elles.
320 Pierre-André Taguieff
Bibliographie
A- Sources primaires
- Allen G. (with Abraham L.), None Dare Call It Conspiracy, Rossmoor, CA & Seal Beach, CA, Concord Press, 1971.
- Baron A. [pseud. L. Dasté], Les sociétés secrètes, leurs crimes : depuis les initiés d’Isis jusqu’aux francs-maçons modernes, Paris, H. Daragon, 1906.
- Barruel Abbé A., Mémoires pour servir à l’histoire du jacobinisme, Hambourg, Fauche, 1798-1799 (5 vol.).
- Boisandré A. de, Socialistes et Juifs : la nouvelle Internationale, Paris, Librairie antisémite, 1903.
- Bourdieu P., Contre-feux. Propos pour servir à la résistance contre l’invasion néo-libérale, Paris, Éd. Liber-Raisons d’agir, 1998.
- Bourdieu P., Contre-feux 2. Pour un mouvement social européen, Paris, Éd. Raisons d’agir, 2001.
- Bülow A. von, « Autant de traces qu’un troupeau d’éléphants », trad. J. D., interview réalisée par S. Lebert & N. Thomma, Der Tagespiegel, 13 janvier 2002, http://membres.lycos.fr/wotraceafg/buelow.htm.
- Bülow A. von, Die CIA und der 11. September. Internationaler Terror und die Rolle der Geheimdienste, Munich, Piper, 2003.
- Bülow A. von, « Nous devons d’abord lutter contre la manipula-tion » (novembre 2005), 6 janvier 2006, http://www.voltairenet.org/article132462.html#article132462.
- Cantwell A. (Jr.), Queer Blood: The Secret AIDS Genocide Plot, Los Angeles, CA, Aries Rising Press, 1993.
- Carr W. G., Pawns in the Game, Los Angeles, St. George Press, 1958 [trad. P. C. : Des Pions sur l’échiquier, Cadillac, Éd. Saint-Rémi, 2002].
- Cartier E., Lumière et ténèbres. Lettre à un franc-maçon, Paris, Letouzey et Ané, 1888.
- Chabauty E. A., Les Juifs, nos maîtres ! Documents et développements nouveaux sur la question juive, Paris-Bruxelles-Genève, Société géné-rale de Librairie catholique, Victor Palmé, 1882.
- Chomsky N., Chomsky, les médias et les illusions nécessaires, un film de M. Achbar et P. Wintonick, dossier réuni par S. Vernet et Kl.-J. Gerke, Paris, K-films Éditions, 1993.
- Chomsky N., « Les exploits de la propagande », dans N. Chomsky, R. W. McChesney, Propagande, médias et démocratie, trad. L. Arcal, Préface de C. Beauchamp, Montréal, Les Éditions Écosociété, 2000 [1997], p. 15-78.
- Chomsky N., Deux heures de lucidité. Entretiens avec Denis Robert et Weronika Zarachowicz [1999], trad. J. Carnaud, Paris, Éd. des Arènes, 2001.
- Chomsky N., 11 septembre. Autopsie des terrorismes. Entretiens, trad. H. Morita et I. Genet, Paris, Le Serpent à Plumes, 2001.
- Chomsky N., Clark R. et Saïd Ed. W, La Loi du plus fort. Mise au pas des États voyous, trad. G. Ducornet, Paris, Le Serpent à Plumes, 2002 [1999].
- Chossudovsky M., Guerre et mondialisation. La vérité derrière le 11 septembre, trad. L. Roy-Castonguay, Montréal, Les Éditions Écosociété, 2002.
- Chossudovsky M., Guerre et mondialisation. À qui profite le 11 sep-tembre ? trad. L. Roy-Castonguay, Paris, Le Serpent à Plumes, 2002.
- Copin-Albancelli P., Le drame maçonnique – La conjuration juive contre le monde chrétien, Paris, La Renaissance française, 1909.
- Crétineau-Joly J., L’Église romaine en face de la Révolution, Paris, H. Plon, 1861.
- Dai Mingshi, Recueil de la Montagne du Sud, trad. du chinois, présenté et annoté par P.-H. Durand, Paris, Gallimard, coll. « Connaissance de l’Orient », 1998.
- Da Qing lüli huiji bianlan [Code des Qing ; cité DQLL], Hubei yanju, 1872.
- Debauge J.-F., La vermine : francs-maçons, révolutionnaires, libres-penseurs, juifs, politiciens, Paris, s.e., 1890.
- Debord G., Commentaires sur la société du spectacle [1988], suivi de Préface à la quatrième édition italienne de La Société du Spectacle [1979], Paris, Gallimard, 1992.
- Debord G., Œuvres, édition établie et annotée par J.-L. Rançon en collaboration avec A. Debord, Préface et introduction de V. Kaufmann, Paris, Gallimard, coll. « Quarto », 2006.
- Deschamps N., Les Sociétés secrètes et la société ou Philosophie de l’histoire contemporaine, Avignon-Paris, Seguin, 1874-1876 (3 vol.).
Bibliographie 323
- Drumont E., Le testament d’un antisémite, Paris, E. Dentu éditeur, 1891.
- Drumont E., Le Secret de Fourmies, Paris, Albert Savine éditeur, 1892 [43e éd.].
- Drumont E., La France juive, Paris, Marpon et Flammarion, 2 tomes, 1886.
- Drumont E., La France juive devant l’opinion, Paris, Marpon et Flammarion, 1886.
- Drumont E., Nos maîtres. La tyrannie maçonnique, Paris, Librairie anti-sémite, 1899.
- Duli cunyi [Revue des difficultés que présentent les articles du code], compilé par Xue Yunsheng et édité par Huang Jingjia, [1905], rééd. Taipei, Research Aids Series VIII, 1970.
- El Aroud M., Les soldats de lumière, Bruxelles, Les ailes de la miséricorde asbl, 2003. Téléchargeable sur : http://ansar-alhaqq.net/PDF/LESSOLDATSDELUMIERE.pdf.
- Estulin D., The True Story of the Bilderberg Group, Walterville, Trineday, 2005.
- Estulin D., La Véritable histoire des Bilberbergers [2005], trad. P. Mazé, Lopérec, Éd. Nouvelle Terre, 2008.
- Fava Mgr A.-J., Le secret de la Franc-Maçonnerie, apologétique, Lille, Desclée de Brouwer, 1885 [1881].
- Ford H. (in collaboration with Crowther S.), My Life and Work, Garden City, NY, Garden City Publishing Co. William Heinemann Ltd., 1922.
- Ford H., Ma vie et mon œuvre, trad. anonyme, Paris, Payot, 1926.- Gama M. [pseud.], Rencontres au sommet. Quand les hommes de pouvoir
se réunissent, Paris, L’Altiplano, 2007.- Gandoux P., La république de la franc-maçonnerie, ou la franc-saloperie
devant la Raie-publique, Bordeaux, 1885.- Gougenot des Mousseaux H., Les Juifs, le judaïsme et la judaïsation des
peuples chrétiens, Paris, Henri Plon, 1869 [2e éd.].- Grand dictionnaire Ricci de la langue chinoise, 7 vol., Paris, Taipei,
Instituts Ricci-Desclée de Brouwer, 2001.- Griffin D. R., Le Nouveau Pearl Harbor. 11 septembre : questions
gênantes à l’administration Bush, trad. P.-H. Bunel, Paris, Éd. Demi-lune, 2006 [2004].
- Griffin D. R., Omissions et manipulations de la Commission d’enquête sur le 11 septembre, trad. P.-H. Bunel, G. Beduneau & E. Dablin, Paris, Éd. Demi-lune, 2006 [2004].
324 Les rhétoriques de la conspiration
- Griffin D. R., 11 septembre. La Faillite des médias. Une conspiration du silence, trad. P.-H. Bunel, Paris, Éd. Demi-lune, 2007.
- Hitler A., Mein Kampf [1925 et 1927], Munich, Zentralverlag der NSDAP, Verlag Franz Eher, 1942
- Hitler A., Mon Combat (Mein Kampf), trad. J. Gaudefroy-Demombynes et A. Calmettes, Paris, Nouvelles Éditions latines, 1934.
- Jouin Mgr E., Le Péril judéo-maçonnique, vol. III, Paris, RISS & Librairie Émile-Paul, 1921.
- Kimon D. [pseud.], La politique israélite : politiciens, journalistes, banqui-ers ; le judaïsme et la France : étude psychologique, Paris, A. Savine, 1889.
- Maçons juifs et l’avenir, ou la tolérance moderne (Les), Louvain, Fonteyn, 1884.
- Meurin Mgr L., La Franc-Maçonnerie, synagogue de Satan, Paris, V. Retaux, 1893.
- Meyssan Th., 11 septembre 2001. L’Effroyable imposture. Aucun avion ne s’est écrasé sur le pentagone ! Chatou, Éd. Carnot, 2002.
- Meyssan Th., Le Pentagate, Chatou, Éd. Carnot, 2002.- Meyssan Th., « Qui a commandité les attentats du 11 septembre ? »,
conférence de Th. Meyssan sous les auspices de la Ligue arabe, Abu Dhabi (Émirats arabes unis), 8 avril 2002, http://membres.lycos.fr/wotraceafg/meyssan.htm.
- Meyssan Th., L’Effroyable imposture II. Manipulations et désinforma-tions, Monaco, Éd. Alphée – Jean-Paul Bertrand, 2007.
- Meyssan Th., « Opération Sarkozy : comment la CIA a placé un de ses agents à la présidence de la République française », 19 juillet 2008, http://www.voltairenet.org/article157210.html.
- Michelet J. et Quinet E., Des Jésuites, Paris, Comptoir des Imprimeurs unis, Hachette – Paulin, 1843.
- Moreau E. L., « Des causes de l’esprit d’obscurantisme », dans Publication des conférences interdites en 1865 – Les causeries de M. E. L. Moreau sur la science des causes, Paris, Librairie centrale, 1865.
- Protocoles des Sages de Sion (Les), nouvelle édition, RISS – « Ligue Franc-catholique », 1934.
- Raynaud E., 11 septembre. Les Vérités cachées, Monaco, Éd. Alphée, Jean-Paul Bertrand, 2009.
- Robbins A., Skull & Bones. La vérité sur l’élite secrète qui dirige les États-Unis…, trad. B. Drweski et G. Vallifuoco, Paris, Max Millo, 2005.
- Saint-Albin A. de, Du culte de Satan, Paris, J.-L. Paulmier, 1867.
Bibliographie 325
- Talayesva Don C., Soleil hopi – L’autobiographie d’un Indien Hopi, textes rassemblés et présentés par L. W. Simmons, trad. G. Mayoux, Préface de Cl. Lévi-Strauss, Paris, Plon-Pocket, coll. « Terre Humaine/Poche », 2002.
- Tarpley W. G., La Terreur fabriquée, Made in USA. 11 septembre : le mythe du xxie siècle, trad. T. Pruzan et B. Kremer, Paris, Éd. Demi-lune, 2007 [2005].
- Tilloy J. A., Le Péril judéo-maçonnique : le mal, le remède, Paris, Librairie antisémite, 1897.
- Toussenel A., Les Juifs, rois de l’époque. Histoire de la féodalité financière, Paris, Gabriel de Gonet éditeur, 1845.
- Turinaz Mgr Ch.-Fr., Le Grand péril de notre temps, ou la Franc-maçonnerie, Paris, Bray et Retaux, s.d. [1884].
- Vaudon P. J., L’Évangile du Sacré-Cœur, les mystères d’amour du cœur de Jésus, Paris, Retaux-Bray, 1889.
- Vergès J., Le salaud lumineux – Conversations avec J.-L. Remilleux, Paris, Éd. Michel Lafon/Éd. n° 1, 1990.
- Wronski-Hoëné J. M., Messianisme, ou Réforme absolue du savoir humain, Paris, Firmin Didot, 1847.
- Xing’an huilan [Vue d’ensemble sur les jugements du ministère de la Justice ; cité XAHL], compilé par Zhu Qingqi et Bao Shuyun, Taipei, Chengwen chubanshe, 1969, 8 vol., d’après l’édition de Shanghai, Tushu jicheng shuju (fangxiuzhen banyin), 1886.
- Xu Shen, Shuowen jiezi [Propos sur les wen et analyse des zi], Beijing, Zhonghua shuju, 1963.
- Ziegler J., Les Nouveaux Maîtres du monde et ceux qui leur résistent, Paris, Fayard, 2002.
- Ziegler J., La Haine de l’Occident, Paris, Albin Michel, 2008.
B- Sources secondaires
- Aaronovitch D., Voodoo Histories: The Role of the Conspiracy Theory in Shaping Modern History, New York, Riverhead Books, 2010.
- Ahn W. & Bailenson J., « Causal attribution as a search for underlying mechanisms: An explanation of the conjunction fallacy and the discount-ing principle », Cognitive Psychology, n° 31, 1996, p. 82-123.
- Albert L. et Nicolas L. (dir.), Polémique et Rhétorique de l’Antiquité à nos jours, Préface de D. Denis, Louvain-la-Neuve, Éd. de Boeck – Duculot, coll. « Champs linguistiques », 2010.
326 Les rhétoriques de la conspiration
- Amossy R., Les idées reçues – Sémiologie du stéréotype, Paris, Nathan, coll. « Le Texte à l’œuvre », 1991.
- Amossy R., L’argumentation dans le discours : discours politique, litté-rature d’idées, fiction, Paris, Nathan, coll. « Fac – Linguistique », 2000.
- Anderson C. A., Lepper R. W. & Ross R. W., « Perseverance of social theories: The role of explanation in the persistence of discredited information », Journal of Personality and Social Psychology, n° 39, p. 1037-1049.
- Angenot M., Ce que l’on dit des juifs en 1889 – Antisémitisme et discours social, Saint-Denis, Presses Universitaires de Vincennes, coll. « Culture et Société », 1989.
- Angenot M., L’Utopie collectiviste. Le Grand récit socialiste sous la Deuxième Internationale, Paris, PUF, 1993.
- Angenot M., La parole pamphlétaire – Typologie des discours modernes, Paris, Payot, coll. « Langages et sociétés », 1995.
- Angenot M., Les Idéologies du ressentiment, Montréal, XYZ Éditeur, 1995.
- Angenot M. D’où venons-nous ? Où allons-nous ? La décomposition de l’idée de progrès, Montréal, Éd. Trait d’union, coll. « Spirale », 2001.
- Angenot M., « Un Juif trahira » : l’espionnage militaire dans la propagande antisémitique 1886-1894, Montréal, CIADEST, coll. « Cahiers de recherche », XVIII, 1994 [Réédition de ce cahier épuisé, avec quelques corrections mineures, sous le titre : « Un Juif trahira ». Le thème de l’espionnage militaire dans la propagande antisémi-tique, 1886-1894, Montréal, coll. « Discours social/Social discourse », Nouvelle série, XVII, 2003].
- Angenot M., Dialogues de sourds. Traité de rhétorique antilogique, Paris, Éd. des Mille et Une Nuits, 2008.
- Arendt H., Les Origines du totalitarisme, trad. M. Pouteau et al., éd. établie sous la direction de P. Bouretz, Paris, Gallimard, coll. « Quarto », 2002 [1951].
- Arendt H., Sur l’antisémitisme : les origines du totalitarisme, Paris, Éd. du Seuil, coll. « Points – Essais », 2005 [1973].
- Aron R., « L’avenir des religions séculières », La France libre, n° 45, 15 juillet 1944, p. 210-217 & n° 46, 15 août 1944, p. 269-277.
- Aulard F.-A., L’Éloquence parlementaire pendant la Révolution française. Les Orateurs de la Législative et de la Convention, Paris, Librairie Hachette et Cie, 1885.
- Austin J. L., Philosophical Papers, J. O. Urmson & G. J. Warnock
Bibliographie 327
(eds.), Oxford, Oxford University Press, 1961 [1946].- Baldwin N., Henry Ford and the Jews: The Mass Production of Hate,
New York, Public Affairs, 2001.- Barkun M., A Culture of Conspiracy: Apocalyptic Visions in
Contemporary America, Berkeley & Los Angeles, University of California Press, 2003.
- Barkun M., « L’interversion des faits et de la fiction : les Illuminati, le Nouvel Ordre mondial et autres complots » (entretien avec M. Barkun), dans D. Burstein et A. de Keijzer (dir.), Les Secrets révélés de Anges & Démons, trad. G. Rivest, Monaco, Éd. Alphée, 2005 [2004], p. 184-196.
- Barwise J. & Perry J., Situations and Attitudes, Cambridge – Mass., The MIT Press, 1983.
- Bastide R., Le sacré sauvage et autres essais, Préface de H. Desroche, Paris, Payot, 1975.
- Beall J. C., « On truthmakers for negative truths », Australasian Journal of Philosophy, 78, 2000, p. 264-268.
- Bell D., The Winding Passage. Essays and Sociological Journeys 1960-1980, Cambridge, Basic Books, 1980.
- Bell D., La fin de l’idéologie, Paris, PUF, coll. « Sociologies » 1997.- Benjamin W., Écrits français, présentés et introduits par J.-M.
Monnoyer, Paris, Gallimard, 1991.- Bennett D. H., The Party of Fear:From Nativist Movements to the
New Right in American History, Chapel Hill, The University of North California Press, 1988.
- Bercé Y.-M. et Fasano Guarini E. (dir.), Complots et conjurations dans l’Europe moderne, École française de Rome – Palais Farnèse, 1996.
- Billig M., Ideology & Opinions, Studies in Rhetorical Psychology, Newbury Park – CA, Sage, 1991.
- Birnbaum P., Le peuple et les gros. Histoire d’un mythe, Paris, Grasset, 1979.
- Blumenberg H., La Raison du mythe, trad. S. Dirschauer, Paris, Gallimard, 2005 [2001].
- Boltanski L., La souffrance à distance : morale humanitaire, médias et politique ; suivi de La présence des absents, Paris, Gallimard, coll. « Folio – Essais », 2007 [1993].
- Bottéro J., « Symptômes, signes, écritures en Mésopotamie ancienne », dans J.-P. Vernant, et al., Divination et rationalité, Paris, Éd. du Seuil, coll. « Recherches anthropologiques », 1974, p. 70-195.
328 Les rhétoriques de la conspiration
- Bottéro J., Mésopotamie. L’écriture, la raison et les dieux, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des histoires », 1987.
- Boudon R., Effets pervers et ordre social, Paris, PUF, coll. « Sociologies », 1989 [1977].
- Boudon R., Pourquoi les intellectuels n’aiment pas le libéralisme, Paris, Odile Jacob, 2004.
- Boudon R., Tocqueville aujourd’hui, Paris, Odile Jacob, 2005.- Bourdieu P., « La rhétorique de la scientificité : contribution à une
analyse de l’effet Montesquieu », dans P. Bourdieu, Ce que parler veut dire – L’économie des échanges linguistiques, Paris, Fayard, 1982, p. 227-239.
- Boureau A., Satan hérétique : naissance de la démonologie dans l’Occident médiéval (1280-1330), Paris, O. Jacob, 2004.
- Bourgon J., Supplices chinois, Paris, Éd. Maison d’à côté, 2007.- Boutin P., La Franc-maçonnerie, l’Église et la modernité : les enjeux
institutionnels du conflit, Paris, Desclée de Brouwer, 1998.- Boyer P., Tradition as Truth and Communication: A Cognitive
Description of Traditional Discourse, Cambridge, Cambridge University Press, 1990.
- Broch H., Comment déjouer les pièges de l’information ou les règles d’or de la zététique, s.l., book-e-book, 2008.
- Bronner S. E., A Rumor About the Jews: Reflections on Antisemitism and the Protocols of the Learned Elders of Zion, New York, St. Martin’s Press, 2000.
- Brook T., Bourgon J. & Blue G. (eds.), Death by a Thousand Cuts, Cambrigde – Mass., Harvard University Press, 2008.
- Bruner J., Pourquoi nous racontons-nous des histoires ?, trad. Y. Bonin, Paris, Pocket, coll. « Agora » 2005.
- Burrin Ph., « Religion civile, religion politique, religion séculière », dans B. Unfried & Ch. Schindler (dir.), Riten, Mythen und Symbole – Die Arbeiterbewegung zwischen « Zivilreligion » und Volkskultur, Vienne, Akademische Verlagsanstalt, 1999, p. 17-28.
- Busi F., The Pope of Antisemitism: the Career and Legacy of Edouard Drumont, Lanham, University Press of America, 1986.
- Byford J., « Anchoring and objectifying “neocortical warfare”: re-presentation of a biological metaphor in Serbian conspiracy literature », Papers on Social Representations, n° 11, 2002, p. 1-14.
- Campion-Vincent V. et Renard J.-B., Légendes urbaines : rumeurs d’aujourd’hui, Paris, Payot, coll. « Documents », 1993.
Bibliographie 329
- Campion-Vincent V., La société parano : théories du complot, menaces et incertitudes, Paris, Payot, 2005.
- Campion-Vincent V., « Les rumeurs négatrices », Diogène, n° 213, janvier-mars 2006, p. 54-73.
- Carel M., « Note sur l’abduction », Travaux de linguistique, n° 49, 2004/2, p. 93-111.
- Carrère d’Encausse H., Staline, l’ordre par la terreur, Paris, Flammarion, coll. « Champs », 1979.
- Carrière J.-C., Delumeau J., Eco U., Gould S. J., Entretiens sur la fin des temps, Paris, Fayard, 1998 [rééd., Paris, Pocket, 1999].
- Cassirer E., « Le judaïsme et les mythes politiques modernes », Revue de métaphysique et de morale, n° 96 (3), 1991, p. 291-303.
- Cassirer E., Le mythe de l’État, trad. B. Vergely, Paris Gallimard, 1993 [1946].
- Cheng P. W., « From covariation to causation:A causal power theory », Psychological review, n° 104, 1997, p. 367-405.
- Cialdini R. B., Influence et manipulation, trad. M.-C. Guyon, Paris, First, 2004.
- Clément F., Les mécanismes de la crédulité, Genève, Droz, coll. « Travaux de sciences sociales », 2006.
- Coady D. (ed.), Conspiracy Theories: The Philosophical Debate, Aldershot, Ashgate, 2006.
- Cochin A., L’esprit du jacobinisme, Préface de J. Baechler, Paris, PUF, 1979 [1922].
- Cohn N., « The Myth of the Demonic Conspiracy of Jews in Medieval and Modern Europe », dans A. de Reuck & J. Knight (eds.), Caste and Race: Comparative Approaches, London, J. & A. Churchill LTD, 1967, p. 240-354.
- Cohn N., Histoire d’un mythe. La « Conspiration » juive et les Protocoles des Sages de Sion, trad. L. Poliakov, Paris, Gallimard, 1967.
- Cohn N., Démonolâtrie et sorcellerie au Moyen âge : fantasmes et réalités, trad. S. Laroche et M. Angeno, Paris, Payot, 1982 [1975].
- Compagnon A., Les antimodernes de Joseph de Maistre à Roland Barthes, Paris, Gallimard, coll. « Nrf – Bibliothèque des idées », 2005.
- Corbin A., Le miasme et la jonquille, Paris, Aubier, 1981.- Corcuff Ph., « Chomsky et le “complot médiatique”. Des simplifica-
tions actuelles de la critique sociale », Bellaciao, 2006, http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=33430.
330 Les rhétoriques de la conspiration
- Cosnier J., Psychologie des émotions et des sentiments, Paris, Retz, coll. « La Psychologie dynamique », 1994.
- Coward B. & Swann J. (eds.), Conspiracies and conspiracy theory in early modern Europe: from the Waldensians to the French Revolution, Aldershot, Ashgate, 2004.
- Crapez M., La gauche réactionnaire : mythes de la plèbe et de la race dans le sillage des Lumières, Préface de P.-A. Taguieff, Paris, Berg International, coll. « Pensée politique et sciences sociales », 1997.
- Damasio A. R., L’erreur de Descartes. La raison des émotions, trad. M. Blanc, Paris, Odile Jacob, 1995.
- Danblon E., « Argumenter par la menace : émotion et raisonnement », dans Ch. Plantin, M. Doury et V. Traverso (éd.), Les émotions dans les interactions communicatives, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, sur CD Rom, 2000.
- Danblon E., Rhétorique et rationalité – Essai sur l’émergence de la critique et de la persuasion, Préface de M. Dominicy, Bruxelles, Éd. de l’Université de Bruxelles, coll. « Philosophie et société », 2002.
- Danblon E., « Peut-on faire l’éloge d’une femme ? », dans E. Danblon (éd.), Degrés – « Les stéréotypes féminins. Une étude rhéto-rique et discursive », n° 117, 2004 (24 p.).
- Danblon E., Argumenter en démocratie, Bruxelles, Éd. Labor, coll. « Quartier Libre », 2004.
- Danblon E., La fonction persuasive : anthropologie du discours rhétorique, origines et actualité, Paris, Armand Colin, coll. « U – Philosophie », 2005.
- Danblon E., « Discours magique, discours rhétorique. Contribution à une réflexion sur les effets de persuasion », dans J.-M. Adam et U. Heidmann (éd.), Sciences du texte et analyse de discours. Enjeux d’une interdisciplinarité, Genève, Slatkine, 2005, p. 145-160.
- Danblon E., Jonge E. de, Kissina E. et Nicolas L. (éd.), Argumentation et Narration, Postface de J.-M. Ferry, Bruxelles, Éd. de l’Université de Bruxelles, coll. « Philosophie et société », 2008.
- Danblon E., « Sur le paradoxe de la preuve en rhétorique », Communications, R. Mandressi (éd.), « Figures de la preuve », Paris, Éd. du Seuil, n° 84, 2009, p. 9-20.
- Danblon E. et Jonge E. de (éd.), « Les Droits de l’Homme en dis-cours » – Revue Argumentation et Analyse du discours, 2010, http://aad.revues.org/index763.html.
Bibliographie 331
- Dardess J. W., Blood and History in China: the Donglin Faction and its Repression 1620-1627, Honolulu, University of Hawai’i Press, 2002.
- Dasquié G. et Guisnel J., L’Effroyable mensonge. Thèse et foutaises sur les attentats du 11 septembre, Paris, La Découverte, 2002.
- Davidson D., « Reply to Quine on events », dans E. LePore & B. P. McLaughlin (eds.), Actions and Events: Perspectives on the Philosophy of Donald Davidson, Oxford – Cambridge (USA), Blackwell, 1985, p. 172-176.
- Davidson D., Actions et événements, trad. P. Engel, Paris, PUF, 1993 [1980].
- Davidson D., Enquêtes sur la vérité et l’interprétation, trad. P. Engel, Nîmes, Chambon, 1993 [1984].
- Davidson D., Subjective, Intersubjective, Objective, Oxford, Oxford University Press, 2001.
- Davis D. B. (ed.), The Fear of Conspiracy: Images of Un-American Subversion from the Revolution to the Present, Ithaca – NY & London, Cornell University Press, 1971.
- Davison W. P., « The third-person effect in communication », Public Opinion Quarterly, n° 47, 1983, p. 1-15.
- Dean J., Aliens in America: Conspiracy Cultures from Outerspace to Cyberspace, Ithaca, NY, Cornell University Press, 1998.
- Dean J., « Webs of Conspiracy », dans A. Herman & T. Swiss (eds.), The World Wide Web and Contemporary Cultural Theory: Magic, Metaphor, Power, New York & London, Routledge, 2000, p. 61-76.
- Delcourt M., La vie d’Euripide, Lecture de M. Grodent, Bruxelles, Éd. Labor, coll. « Espace Nord », 2004, p. 58-59.
- Delumeau J., L’Aveu et le pardon. Les difficultés de la confession (xiiie-xviiie siècle), Paris, Fayard, coll. « Les Nouvelles études historiques », 1990.
- Diable (Le), Colloque de Cerisy, Paris, Éd. Dervy, coll. « Cahiers de l’hermétisme », 1998.
- Dierkens A. (éd.), Les courants antimaçonniques hier et aujourd’hui – Problèmes d’histoire des religions, Bruxelles, Éd. de l’Université de Bruxelles, 1993.
- Domenach J.-M., La propagande politique, Paris, PUF, 1950.- Dominicy M., « Effabilité », dans S. Auroux (éd.), Encyclopédie phi-
losophique universelle – Les notions philosophiques, Paris, PUF, vol. I, 1990, p. 751-753.
332 Les rhétoriques de la conspiration
- Dominicy M., « Langage, interprétation, théorie. Fondements d’une épistémologie moniste et faillibiliste », dans J.-M. Adam et U. Heidmann (éd.), Sciences du texte et analyse de discours. Enjeux d’une interdisciplinarité, Genève, Slatkine, 2005, p. 231-258.
- Dominicy M., « Conscience et réalité physique. Sur une thèse de David Chalmers », dans F. Beets et M.-A. Gavray (éd.), Logique et ontolo-gie : perspectives diachroniques et synchroniques. Liber amicorum in honorem Huberti Hubiani, Liège, Éd. de l’Université de Liège, 2005, p. 133-147.
- Dominicy M. et Gullentops D., « Introduction », dans M. Dominicy et D. Gullentops (éd.), Genèse et constitution du texte – Degrés, n° 121-122, 2005, p. a1-a7.
- Dominicy M., « L’évocation discursive. Fondements et procédés d’une stratégie “opportuniste” », dans « Linguistique et poésie : le poème et ses réseaux », M. Monte et J. Gardes-Tamine (éd.), Semen, n° 24, 2007, p. 145-165 [En ligne].
- Dominicy M., « Les modèles de la phrase littéraire. Sur les pas de Michael Riffaterre », dans R. Bourkhis et M. Benjelloun (éd.), La phrase littéraire, Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant, 2008, p. 19-33.
- Dominicy M., « Discourse evocation: Its cognitive foundations and its role in speech and texts », dans P. De Brabanter & M. Kissine (eds.), Utterance Interpretation and Cognitive Models, Bingley, Emerald Group Publishing, 2009, p. 179-210.
- Douglas K. M. & Sutton R. M., « The hidden impact of conspiracy theories: Perceived and actual impact of theories surrounding the death of Princess Diana », The Journal of Social Psychology, 148-2, 2008, p. 210-221.
- Dousse M., Marie la musulmane, Paris, Albin Michel, coll. « L’islam des Lumières », 2005.
- Ducrot O., Le Dire et le dit, Paris, Éd. de Minuit, coll. « Propositions », 1984.
- Durand G., Les structures anthropologiques de l’imaginaire, Paris, Dunod, coll. « Psycho Sup », 1993.
- Durand P.-H., « Mandchous et Chinois : l’empereur Kangxi et le procès du Nanshan ji », Études chinoises, VII, 1, 1988, p. 65-108.
- Durand P.-H., Lettrés et pouvoirs. Un procès littéraire dans la Chine impériale, Paris, Éd. de l’EHESS, 1992.
Bibliographie 333
- Durham M., The Christian Right, the Far Right and the Boundaries of American Conservatism, Manchester & New York, Manchester University Press, 2000.
- Ehrenberg A., La société du malaise, Paris, Odile Jacob, 2010.- Ellul J., « Mythes modernes », Diogène, n° 23, juillet-septembre
1958, p. 29-49.- Elster J., Sour grapes: Studies in the subversion of rationality,
Cambridge, Cambridge University Press, 1983.- Étienne B., Les Combattants suicidaires. Essai sur la thanatocratie
moderne, suivi de Les Amants de l’Apocalypse. Clés pour comprendre le 11 septembre, La Tour d’Aigues, Éd. de l’Aube, 2005.
- Fann K., Peirce’s theory of abduction, La Haye, M. Nijhoff, 1970.- Faye J.-P., Le langage meurtrier, Paris, Hermann, 1996.- Fenster M., Conspiracy Theories: Secrecy and Power in American
Culture, Minneapolis – MN & London, University of Minnesota Press, 1999.
- Ferrer Benimeli J.A., « Antimaçonnisme et anticléricalisme. La mystification de Léo Taxil (1890-1897) », dans J. Lemaire (éd.), Sous le masque de la franc-maçonnerie, Bruxelles, Éd. de l’Université de Bruxelles, 1990, p. 103-117.
- Festinger L., A Theory of Cognitive Dissonance, Stanford, Stanford University Press, 1964.
- Filiu J.-P., L’Apocalypse dans l’Islam, Paris, Éd. Fayard, 2008.- Filiu J.-P., Les Neuf Vies d’Al-Qaida, Paris, Éd. Fayard, 2009.- Fine G. A., Campion-Vincent V. & Heath C. (ed.), Rumor Mills:
The Social Impact of Rumor and Legend, Piscataway – NJ, Aldine Transaction, 2009 [2005].
- Fischoff B., « Hindsight ≠ foresight: The effect of outcome knowl-edge on judgment under certainty », Journal of Personality and Social Psychology, n° 18, 1975, p. 93-119.
- Flood Ch. G., Political Myth: A Theoretical Introduction, New York & London, Routledge, 2002.
- Fukuyama F., La fin de l’histoire et le dernier homme, trad. D.-A. Canal, Paris, Flammarion, 1992.
- Furet Fr., Penser la Révolution française, Paris, Gallimard, éd. revue et corrigée, coll. « Bibliothèque des histoires », 1983 [1978].
- Furet Fr., Le passé d’une illusion. Essai sur l’idée communiste au xxe siècle, Paris, Robert Laffont/Calmann-Lévy, 1995.
334 Les rhétoriques de la conspiration
- Gallez E-M., « Le Coran identifie-t-il Marie, mère de Jésus, à Marie, sœur d’Aaron ? », dans A.-M. Delcambre., J. Bosshard et al., Enquêtes sur l’Islam – En hommage à Antoine Moussali, Paris, Desclée de Brouwer, 2004, p. 139-151.
- Gauchet M., Le désenchantement du monde – Une histoire politique de la religion, deuxième partie, Paris, Gallimard, 1985.
- Gauchet M., « Le démon du soupçon » [entretien], L’Histoire, n° 84, décembre 1985, p. 49-56 [Repris dans Les Collections de l’Histoire (Complots, secrets, et rumeurs), n° 33, 2006, p. 60-69].
- Gauchet M., La condition historique, entretiens avec Fr. Azouvi et S. Piron, Paris, Stock, coll. « Les Essais », 2003.
- Gentile E., Les Religions de la politique. Entre démocraties et tota-litarismes, trad. A. Colao, Paris, Éd. du Seuil, coll. « La Couleur des idées », 2005.
- Gilbert D. T., Tafarodi R. W. & Malone P. S., « You can’t not believe everything you read », Journal of Personality and Social Psychology, n° 65, 1993, p. 221-233.
- Ginzburg C., « Signes, traces, pistes. Racines d’un paradigme de l’in-dice », dans Le Débat, n° 6, nov. 1980, p. 3-44 [republié dans Mythes, emblèmes, traces, Paris, Flammarion, 1989, sous le titre « Traces. Racines d’un paradigme indiciaire », p. 139-180].
- Ginzburg C., Mythes, emblèmes, traces : morphologie et histoire, trad. M. Aymard, Ch. Paoloni, E. Bonan et M. Sancini-Vignet, Paris, Flammarion, coll. « Nouvelle bibliothèque scientifique », 1989 [1986].
- Ginzburg C., Le sabbat des sorcières, trad. M. Aymard, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des histoires », 1992 [1989].
- Ginzburg C., Le fromage et les vers : l’univers d’un meunier du xvie siècle, trad. M. Aymard, Paris, Aubier, coll. « Histoires », 1993 [1976].
- Ginzburg C., Rapports de force : histoire, rhétorique, preuve, trad. J.-P. Bardos, Paris, Seuil/Gallimard, coll. « Hautes études », 2003 [1999].
- Girard R., Le bouc émissaire, Paris, Grasset, 1982.- Girardet R., Mythes et mythologies politiques, Paris, Éd. du Seuil,
coll. « L’Univers historique », 1986.- Glick P., « Sacrificial lambs dressed in wolves’clothing: envious preju-
dice, ideology, and the scapegoating of Jews », dans L. S. Newman & R. Erber (eds.), Understanding genocide: The Social Psychology of the Holocaust, Oxford, Oxford University Press, 2002, p. 113-142.
Bibliographie 335
- Gochet P., Esquisse d’une théorie nominaliste de la proposition, Paris, Armand Colin, 1972.
- Goldberg R. A., Enemies Within: The Culture of Conspiracy in Modern America, New Haven – CT & London, Yale University Press, 2001.
- Goldschläger A. et Lemaire J.-Ch., Le complot judéo-maçonnique, Bruxelles, Éd. Labor & Espace de libertés, coll. « Liberté j’écris ton nom », 2005.
- Gorgias, Éloge d’Hélène, trad. J.-L. Poirier, dans Les Présocratiques, Paris, Gallimard, coll. « La Pléiade », 1988.
- Goyet Fr., Le sublime du « lieu commun ». L’invention de la rhétorique dans l’Antiquité et à la Renaissance, Paris, Honoré Champion, coll. « Bibliothèque littéraire de la Renaissance », 2000.
- Goyet Fr., Les Audaces de la prudence. Littérature et politique aux xvie et xviie siècles, Paris, Éd. Classiques Garnier, coll. « Études montai-gnistes », 2009.
- Graumann C. F. & Moscivici S., Changing conceptions of conspiracy, New York, Springer, coll. « Springer series in social psychology », 1987.
- Grenier J., Essai sur l’esprit d’orthodoxie, Paris, Gallimard, 1961 [1937].
- Grice H. P., Studies in the Way of Words, Cambridge – Mass., Harvard University Press, 1989.
- Gugenberger E., Petri F., Schweidlenka R., Weltverschwörung-stheorien. Die neue Gefahr von rechts, Vienne et Munich, Franz Deuticke Verlagsgesellschaft, 1998.
- ter Haar B. J., « China’s Inner Demons: The Political Impact of the Demonological Paradigm », China Information, XI (2-3), 1996, p. 54-85.
- Hacking I., Les fous voyageurs, Paris, Éd. du Seuil, coll. « Les Empêcheurs de tourner en rond », 2002.
- Hagemeister M., « Qui était Serge Nilus ? », trad. M. Pique-Bressoux, Politica Hermetica, n° 9, 1995, p. 141-158.
- Hart H. L. A. & Honoré T., Causation in the Law, Oxford, Oxford University Press, 1985.
- Heinich N., Le Bêtiser du sociologue, Paris, Klincksieck, 2009.- Herman Th., « Narratio et argumentation », dans E. Danblon, E. de
Jonge, E. Kissina et L. Nicolas (éd.), Argumentation et Narration, Postface de J.-M. Ferry, Bruxelles, Éd. de l’Université de Bruxelles, coll. « Philosophie et société », 2008, p. 29-39.
336 Les rhétoriques de la conspiration
- Hervieu-Léger D., La religion pour mémoire, Paris, Éd. du Cerf, coll. « Sciences humaines et religions », 1993.
- Hilton D. J., McClure J. L. & Slugoski B. R., « The course of events:Counterfactuals, causal sequences, and explanation », dans D. R. Mandel, D. J. Hilton & P. Catellani, The Psychology of Counterfactual Thinking, London, Routledge, 2005, p. 44-73.
- Hirschman A. O., Deux siècles de rhétorique réactionnaire, trad. P. Andler, Paris, Fayard, coll. « L’Espace du politique », 1991.
- Hofstadter R., The Paranoid Style in American Politics and Other Essays, New-York, Alfred A. Knopf, 1965.
- Horton R. & Finnegan R. (eds.), Modes of Thought. Essays on Thinking in Western and Non-Western Societies, London, Faber & Faber, 1973.
- Huang R., 1587 : le déclin de la dynastie des Ming, Paris, PUF, coll. « Histoire », 1985.
- Huntington S. P., Le choc des civilisations, trad. J.-L. Fidel, G. Joublain, P. Jorland et al., Paris, Odile Jacob, coll. « Poches », 2000 [1996].
- Jaecker T., Antisemitische Verschwörungstheorien nach dem 11. September. Neue Varianten eines alten Deutungsmusters, Münster, Lit Verlag, 2005.
- James N., « Militias, the Patriot Movement and the Internet: The Ideology of Conspiracism », dans J. Parish & M. Parker (eds.), The Age of Anxiety: Conspiracy Theory and the Human Sciences, Oxford – UK & Malden – MA, Blackwell Publishing, 2001, p. 62-92.
- Jamin J., L’Imaginaire du complot. Discours d’extrême droite en France et aux États-Unis, Amsterdam, Amsterdam University Press, IMISCO-AUP Dissertations Series, 2009.
- Jarrige M., L’Église et la franc-maçonnerie dans la tourmente, la croi-sade de la revue « La Franc-Maçonnerie démasquée » (1884-1899), Préface d’É. Poulat, Paris, Éd. Arguments, 1999.
- Johnson G., Architects of Fear: Conspiracy Theories and Paranoia in American Politics, Los Angeles, Jeremy P. Tarcher, 1983.
- Johnson J. T., Long D.L. & Robinson M. D., « Is a cause concep-tualized as a generative force?: Evidence from a recognition memory paradigm », Journal of Experimental Social Psychology, n° 37, 2001, p. 398-412.
- Jonge E. de, « Le préambule des déclarations des droits de l’homme : entre narration et argumentation », dans E. Danblon, E. de Jonge, E. Kissina et L. Nicolas (éd.), Argumentation et Narration, Postface de J.-M. Ferry, Bruxelles, Éd. de l’Université de Bruxelles, coll. « Philosophie et société », 2008, p. 99-111.
Bibliographie 337
- Kauffmann G., Édouard Drumont, Paris, Perrin, 2008.- Kauffmann G., Lenoire M. et Taguieff P.-A., L’antisémitisme de
plume 1940-1944 – La propagande antisémite en France sous l’Occu-pation, Paris, Berg International, coll. « Pensée politique et sciences sociales », 1999.
- Keck F., Lévy Bruhl – Entre philosophie et anthropologie. Contradiction et participation, Paris, CNRS Éditions, 2008.
- Keeley B. L., « Of Conspiracy Theories », The Journal of Philosophy, n° 96, 1999, p. 109-126.
- Khosrokhavar F., Les nouveaux martyrs d’Allah, Paris, Flammarion, 2002.
- Klein O. et Pohl S. (dir.), Psychologies des stéréotypes et des préju-gés, Bruxelles, Éd. Labor, coll. « Quartier Libre », 2007.
- Klemperer V., LTI, la langue du IIIe Reich, Paris, Albin Michel, 1996 [1947].
- Knight P., Conspiracy Culture: From the Kennedy Assassination to The X-Files, London & New York, Routledge, 2000.
- Kolakowski L., Kultura i fetysze [La culture et les fétiches], Warszawa, P.W.N., 2000 [1967].
- Kramer R. M., « Paranoid cognition in social systems: Thinking and acting in the shadow of doubt », Personality and Social Psychology Review, n° 2, 1998, p. 251-275.
- Kramer R., Meyerson D. & Davis G., « How much is enough? Psychological components of “guns versus butter” decisions in a secu-rity dilemma », Journal of Personality and Social Psychology, n° 58, 1990, p. 984-993.
- Kuhn P., Soulstealers. The Chinese Sorcery Scare of 1768, Cambridge – Mass., Harvard University Press, 1990.
- Lagrange P., La Rumeur de Roswell, Paris, La Découverte, 1996.- Lambert P.-A., La charbonnerie française, 1821-1823. Du secret en
politique, Lyon, PUL, 1995.- Laurant J.-P., L’ésotérisme chrétien en France au xixe siècle, Lausanne,
L’Âge d’homme, coll. « Politica hermetica », 1992.- Lauwaert F., Le meurtre en famille : parricide et infanticide en Chine,
xviiie-xixe siècle, Paris, Odile Jacob, 1999.- Lebzelter G. C., Political Anti-Semitism in England 1918-1939,
London, The Macmillan Press & Oxford, St Anthony’s College, 1978.- Lee A., Henry Ford and the Jews, New York, Stein and Day, 1980.
338 Les rhétoriques de la conspiration
- Le Forestier R., Les Illuminés de Bavière et la Franc-Maçonnerie allemande [1914], Milan, Archè, 2001.
- Lemaire J., Les Origines françaises de l’antimaçonnisme : 1744-1797, Bruxelles, Éd. de l’Université de Bruxelles, coll. « Études sur le xviiie siècle – Hors-série », 1985.
- Lemaire J. et Goldschlager A., Le complot judéo-maçonnique, Bruxelles, Éd. Labor & Éd. Espace de libertés, coll. « J’écris ton nom », 2005.
- Lenain Th., « Le “faux parfait”, image sans apparence », dans E. Clemens et al. (éd.) Le labyrinthe des apparences, Bruxelles, Éd. Complexe, coll. « Revue de l’Université de Bruxelles », 2000/1, p. 263-274.
- Lepenies W., Les trois cultures. Entre science et littérature, l’avè-nement de la sociologie, Paris, Éd. de la Maison des Sciences de l’Homme, 1990.
- Lévi-Strauss C., La pensée sauvage, Paris, Plon, 1962.- Lévy-Bruhl L., La mentalité primitive, Préface de L.-V. Thomas,
Paris, CEPL, coll. « Les classiques des sciences humaines », 1976 [1922].
- Lévy-Bruhl L., Les Carnets de Lucien Lévy-Bruhl (1949), Préface de M. Leenhardt, présentation de B. Karsenty, Paris, PUF, 1998.
- Lipset S. M. & Raab E., The Politics of Unreason: Right-Wing Extremism in America, 1790-1977, 2nd ed., Chicago & London, The University of Chicago Press, 1978 [1970].
- Livet P., Émotions et rationalité morale, Paris, PUF, coll. « Sociologies », 2002.
- Lorenzi-Cioldi F., Les représentations des groupes dominants et dominés. Collections et agrégats, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 2002.
- Lyons W., Approaches to Intentionality, Oxford, Clarendon Press, 1995.
- Marcus G., Paranoia within Reason: A Casebook on Conspiracy as Explanation, Chicago, University of Chicago Press, 1999.
- Marx J., Le péché de la France – Surnaturel et politique au xixe siècle, Bruxelles, Espace de libertés – Éd. du Centre d’action laïque, coll. « Laïcité », 2005.
- Mason F., « A Poor Person’s Cognitive Mapping », dans P. Knight (ed.), Conspiracy Nation: The Politics of Paranoia in Postwar America, New York & London, New York University Press, 2002, p. 40-56.
Bibliographie 339
- McClure D., Hilton D. J. & Sutton R. M., « Judgments of vol-untary and physical causes in causal chains: Probabilistic and social functionalist criteria for attributions », European Journal of Social Psychology, n° 37, 2007, p. 879-901.
- Melley T., Empire of Conspiracy: The Culture of Paranoia in Postwar America, Ithaca – NY & London, Cornell University Press, 2000.
- Merton R. K., Social Theory and Social Structure, Glencoe, The Free Press, 1957 [1949].
- Midal F., Risquer la liberté. Vivre dans un monde sans repères, Paris, Éd. du Seuil, 2009.
- Milner M. (dir.), Entretiens sur l’Homme et le Diable, Paris La Haye, Éd. Mouton, 1965.
- Milosz C., La pensée captive. Essai sur les logocraties populaires, trad. A. Prudommeaux et l’auteur, Préface de K. Jaspers, Paris, Gallimard, coll. « Les Essais », 1953.
- Molnar G., « Truthmakers for negative truths », Australasian Journal of Philosophy, 78, 2000, p. 72-86.
- Morin E. et Le moigne, J.-L (dir.), Intelligence de la complexité : épistémologie et pragmatique, Paris, L’Harmattan, 1999.
- Moscovici S., « The Conspiracy Mentality » (trad. angl. K. Stuart), dans C. F. Graumann & S. Moscovici (eds.), Changing Conceptions of Conspiracy, New York-Berlin-Heidelberg, Springer-Verlag, 1987, p. 151-169.
- Neale S., Facing Facts, Oxford, Oxford University Press, 2001.- Nefontaine L., Église et franc-maçonnerie, Paris, Éd. du Chalet, 1990.- Nicolas L., La Force de la doxa : Rhétorique de la décision et de la
délibération, Préface de D. Denis, Paris, L’Harmattan, coll. « Ouverture philosophique », 2007.
- Nicolas L., « La fonction héroïque : parole épidictique et enjeux de qualification », Rhetorica – A journal of the History of Rhetoric, Berkeley, University of California Press, vol. XXVII, Issue 2, 2009, p. 115-141.
- Nicolas L. et Jonge E. de, « Limites et ambiguïtés rhétoriques du discours pamphlétaire : vers l’abandon d’une pratique sociale ? », dans Mots – Les langages du politique, « Que devient le pamphlet ? », n° 91, novembre 2009, p. 51-65.
- Nietzsche F., La Généalogie de la morale, trad. H. Albert, Paris, Éd. du Mercure de France, 1964 [1887].
340 Les rhétoriques de la conspiration
- Nora P., « 1898. Le thème du complot et la définition de l’identité juive », dans M. Olender (dir.), Pour Léon Poliakov. Le racisme mythes et sciences, Bruxelles, Complexe, 1981, p. 157-163.
- Ogden C. K. & Richards I. A., The Meaning of Meaning: A Study of the Influence of Language upon Thought and of the Science of Symbolism, second edition revised, London – New York, Kegan Paul, Trench, Trubner & CO – Harcourt, Brace & Company, 1927.
- O’Rourke D. K., Demons by Definition: Social Idealism, Religious Nationalism, and the Demonizing of Dissent, New York, Peter Lang Publishing, 1998.
- Pachet P., Bêtise de l’intelligence : Jean-Louis Faure, Préface C. de Biéville, Nantes, éd. Joca seria, 2006.
- Parish J. & Parker M. (eds.), The Age of Anxiety: Conspiracy Theory and the Human Sciences, Oxford, Blackwell, 2001.
- Perelman Ch. & Olbrechts-Tyteca L., La Nouvelle rhétorique – Traité de l’argumentation, Paris, PUF, 1958 (2 vol.).
- Perelman Ch. et Olbrechts-Tyteca L., « Acte et personne dans l’argumentation », dans Ch. Perelman, Rhétoriques, Bruxelles, Éd. de l’Université de Bruxelles, 1989, p. 257-293.
- Pfahl-Traughber A., « “Bausteine” zu einer Theorie über “Verschwörungstheorien” : Definitionen, Erscheinungsformen, Funktionen und Ursachen », dans H. Reinalter (Hrsg.), Verschwörungstheorien. Theorie – Geschichte – Wirkung, Innsbruck et Vienne, Studien Verlag, 2002, p. 30-44.
- Pigden Ch., « Popper Revisited, or What Is Wrong With Conspiracy Theories? », Philosophy of the Social Sciences, vol. 25, n° 1, 1995, p. 3-34.
- Pipes D., The Hidden Hand: Middle East Fears of Conspiracy, New York, St. Martin’s Press, 1996 [puis London, Macmillan, 1997].
- Pipes D., Conspiracy: How the Paranoid Style Flourishes and Where It Comes From, New York, The Free Press, 1997.
- Poliakov L., « Causalité, démonologie et racisme. Retour à Lévy-Bruhl ? » [1980], article revu et corrigé, dans P.-A. Taguieff (dir.), Les Protocoles des Sages de Sion. Faux et usages d’un faux, Paris, Berg International, 1992, t. II, p. 419-456.
- Poliakov L., « Causalité démonologie et racisme. Retour à Lévy-Bruhl », dans L. Poliakov, Sur les traces du crime, textes rassemblés et introduits par P. Zawadzki, Préface de Ch. Delacampagne, Paris, Berg International, 2003, p. 201-228.
Bibliographie 341
- Poliakov L., La causalité diabolique, t. 1: Essai sur l’origine des per-sécutions, [1980] & La causalité diabolique, t. 2 : Du joug mongol à la victoire de Lénine [1985] [nouvelle éd. en un volume, Préface de P.-A. Taguieff, Paris, Calmann-Lévy/Mémorial de la Shoah, 2006].
- Pomian K., L’Ordre du temps, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des histoires », 1984.
- Popper K. R., La société ouverte et ses ennemis, trad. J. Bernard et Ph. Monod, Paris, Éd. du Seuil, 2 vol., 1979 [1945].
- Popper K. R., The Open Universe: an argument for indeterminism, ed. by W. W. Bartley, Totowa – New Jersey, Rowman and Littlefield, 1982 [1956-1957].
- Popper K. R., Conjectures et réfutations. La croissance du savoir scientifique, trad. M.-I. et M. B. de Launay, Paris, Payot, 1985 [1963].
- Popper K. R., Misère de l’historicisme, trad. H. Rousseau révisée et augmentée par R. Bouveresse, Paris, Pocket, coll. « Agora », 1988 [vers. retrad. sur l’éd. de London, 1976].
- Popper K. R., Un univers de propensions : deux études sur la causalité et l’évolution, trad. A. Boyer, Paris, Éd. de l’Éclat, coll. « Tiré à part », 1992 [1989-1990].
- Poulat E., « L’esprit du complot », Politica Hermetica, n° 6, 1992, p. 6-12.
- Poulat E. et Laurant J.-P., L’antimaçonnisme catholique, Paris, Berg International, 1994.
- Quine W. V. O., Relativité de l’ontologie et quelques autres essais, trad. J. Largeault, Paris, Aubier-Montaigne, 1977 [1969].
- Quine W. V. O., « Events and reification », dans E. LePore & B. P. McLaughlin (eds.), Actions and Events: Perspectives on the Philosophy of Donald Davidson, Oxford – Cambridge (USA), Blackwell, 1985, p. 162-171.
- Rajotte P., Les mots du pouvoir ou le pouvoir des mots. Essai d’ana-lyse des stratégies discursives ultramontaines au xixe siècle, Montréal, L’Hexagone, 1991.
- Redelmeier D. A. & Tversky A., « On the belief that arthritis pain is related to the weather », Proceedings of the National Academy of Sciences, n° 93, 1996, p. 2895-2896.
- Regal Ph. J., The Anatomy of Judgment, Minneapolis, University of Minessota Press, 1990.
- Renard J.-B., « Les rumeurs négatrices », Diogène, n° 213, janvier-mars 2006, p. 54-73.
342 Les rhétoriques de la conspiration
- Reszler A., Mythes politiques modernes, Paris, PUF, 1981.- Ribuffo L. P., « Henry Ford and The International Jew », American
Jewish History, n° 69 (4), june 1980, p. 437-477 [repris dans Ribuffo L. P., Right Center Left: Essays in American History, New Brunswick, NJ, Rutgers University Press, 1992, p. 70-105].
- Roberts J. M., La Mythologie des sociétés secrètes [1972], trad. C. Butel, Paris, Payot, 1979.
- Robinson D., Bandits, Eunuchs and the Son of Heaven. Rebellion and the Economy of Violence in Mid-Ming China, Hawai’i, Honolulu University Press, 2001.
- Roche J.-J., Théories des relations internationales, Paris, Montchrestien, coll. « Clefs. Politique », 2008.
- Rogalla von Bieberstein J., Die These von der Verschwörung, 1776-1945. Philosophen, Freimaurer, Juden, Liberale und Sozialisten als Verschwörer gegen die Sozialordnung, Frankfurt am Main, Peter Lang, 1978 [1976].
- Roisman J., The rhetoric of conspiracy in ancient Athens, Berkeley – CA, University of California Press, coll. « The Joan Palevsky imprint in classical literature », 2006.
- Rosset E., « It’s no accident: Our bias for intentional explanations », Cognition, n° 108, 2008, p. 771-780.
- Rouault Th., Les mécanismes de la haine antisémite et antimaçon-nique chez Drumont et ses héritiers, Thèse de doctorat en Lettres et Sciences humaines, Université de Paris VII, 2007.
- Rousse-Lacordaire J., Rome et les Francs-Maçons. Histoire d’un conflit, Paris, Berg International, 1996.
- Russell B., « The philosophy of logical atomism » [1918], dans B. Russell, Logic and Knowledge: New Philosophical Essays, R. C. Marsh (ed.), London, Allen and Unwin, 1956, p. 175-281.
- Sanchez P., La rationalité des croyances magiques, Préface de R. Boudon, Genève, Droz, coll. « Travaux de sciences sociales », 2007.
- Saur L., Le sabre, la machette et le goupillon. Des apparitions de Fatima au génocide rwandais, Préface de J.-P. Chrétien, Bierges, Éd. Mols, coll. « Autres regards », 2004.
- Scheler M., L’Homme du ressentiment, Paris, Gallimard, coll. « Idées », 1970 [1912-1915].
- Scheler M., Problèmes de sociologie de la connaissance, trad. S. Mesure, Paris, PUF, coll. « Sociologie », 1993 [1924].
Bibliographie 343
- Schmitt C., La notion de politique [1933] – Théorie du partisan [1963], Paris, Flammarion, coll. « Champs », 1999.
- Schreiber J.-Ph., « La question du secret dans le discours antima-çonnique au xixe siècle », dans Le pavé Mosaïque. Revue d’études maçonniques, 1-2003, p. 117-144.
- Schreiber J.-Ph, « L’image des juifs et du judaïsme dans le discours antimaçonnique au xixe siècle », dans M.-A. Matard-Bonucci (dir.), Antisémythes. L’image des juifs entre culture et politique (1848-1939), Paris, Éd. Nouveau monde, coll. « Culture-médias », 2005, p. 131-147.
- Searle J. R., La construction de la réalité sociale, trad. C. Tiercelin, Paris, Gallimard, 1998 [1995].
- Segel B., A Lie and a Libel: The History of the Protocols of the Elders of Zion [1926], trad. and ed. R. S. Levy, Lincoln & London, University of Nebraska Press, 1995.
- Seidel A., « Imperial Treasures and Taoist Sacraments – Taoist Roots in the Apocrypha », dans M. Strickmann (ed.)., Tantric and Taoist Studies in Honor of R. A. Stein, II, Bruxelles, Mélanges chinois et bouddhiques, XXI, 1983, p. 292-371.
- Simmel G., Secret et sociétés secrètes, trad. S. Muller, Postface de P. Watier, Strasbourg, Circé, 1998.
- Singerman R., « The American Career of the Protocols of the Elders of Zion », American Jewish History, n° 71 (1), sept. 1981, p. 48-78.
- Spence J. D., Treason by the Book, New York, Viking, 2001.- Sperber M., « La conception policière de l’histoire », Preuves, n° 36,
Paris, 1954 [repris dans M. Sperber, Le Talon d’Achille, Paris, Éd. Calmann-Lévy, coll. « Liberté de l’esprit », 1957, p. 75-103].
- Spinoza B., Éthique, trad. Ch. Appuhn, Paris, Garnier, 1929 [1677].- Stoczkowski W., Des hommes, des dieux et des extraterrestres.
Ethnologie d’une croyance moderne, Paris, Flammarion, 1990.- Swain, G., Le sujet de la folie, naissance de la psychiatrie, précédé
de « De Pinel à Freud » par M. Gauchet, Paris, Calmann-Lévy, 1997 [1977].
- Taguieff P.-A., Les Protocoles des Sages de Sion, Paris, Berg International, coll. « Faits et Représentations », 1992, 2 vol. [Rééd. rev. et corr. en 1 vol., Les Protocoles des Sages de Sion. Faux et usages d’un faux, Paris, Berg International – Fayard, 2004].
- Taguieff P.-A., Prêcheurs de haine. Traversée de la judéophobie pla-nétaire, Paris, Éd. des Mille et Une Nuit, coll. « Essai », 2004.
344 Les rhétoriques de la conspiration
- Taguieff P.-A., La Foire aux « Illuminés ». Ésotérisme, théorie du complot, extrémisme, Paris, Éd. des Mille et Une Nuits, coll. « Essai », 2005.
- Taguieff P.-A., L’Imaginaire du complot mondial – Aspects d’un mythe moderne, Paris, Éd. des Mille et Une Nuits, coll. « Les Petits libres », n° 63, 2006.
- Taguieff P.-A., L’Illusion populiste. Essai sur les démagogies de l’âge démocratique, nouv. édition, Paris, Flammarion, 2007 [2002].
- Taguieff P.-A., La Judéophobie des Modernes. Des Lumières au Jihad mondial, Paris, Odile Jacob, 2008.
- Taguieff P.-A., La Nouvelle propagande antijuive. Du symbole al-Dura aux rumeurs de Gaza, Paris, PUF, 2010.
- Taheri A., Khomeiny, trad. J. Carnaud et J. Lahana, Paris, Balland, 1985.
- Taheri A., The Persian Night:Iran under the Khomeinist Revolution, New York & London, Encounter Books, 2009.
- Taïeb E., « La “rumeur” des journalistes », Diogène, n° 213, janv.-mars 2006, p. 133-152.
- Tocqueville A. de, De la démocratie en Amérique, Paris, R. Laffont, coll. « Bouquins », 1986.
- Toulmin S., Les usages de l’argumentation, trad. Ph. De Brabanter, Paris, PUF, 1993 [1958].
- Trachtenberg J., The Devil and the Jews – The medieval Conception of the Jew and Its Relation to Modern Anti-Semitism, New Haven, Yale University Press, 1944 [1943], Philadelphia and Jerusalem, The Jewish Publication Society 1993.
- Tversky A. & Kahneman D., « Probability, representativeness, and the conjunction fallacy », Psychological Review, n° 90, 1983, p. 293-315.
- Tweeten L., Terrorism, Radicalism, and Populism in Agriculture, Ames, Iowa, Iowa State Press, 2003.
- Venner F., L’Effroyable imposteur. Quelques vérités sur Thierry Meyssan, Paris, Grasset, 2005.
- Vignaux G., Le Discours acteur du monde : énonciation, argumentation et cognition, Gap, Ophrys, coll. « L’Homme dans la langue », 1988.
- Vion R., « La dualité énonciative dans le discours », dans R. Jolivet et F. Epars Heussi (éd.), Mélanges offerts à M. Mahmoudian, Cahier de l’ISL, n° 11, tome II, 1998, p. 425-443.
- Vitkine A., Les nouveaux imposteurs, Paris, Éd. de la Martinière, coll. « Doc en stock », 2005.
Bibliographie 345
- Voegelin E., Hitler et les Allemands, trad. M. Köller et D. Séglard, Paris, Éd. du Seuil, coll. « Traces écrites », 2003 [1951].
- Wagner-Egger P. & Bangerter A., « La vérité est ailleurs : corré-lats de l’adhésion aux théories du complot », Revue Internationale de Psychologie Sociale, n° 20, 2007, p. 31-61.
- Walton D., Fundamentals of critical argumentation, Cambridge – New York, Cambridge University Press, 2006.
- Walton D., Reed C. & Macagno F., Argumentation schemes, Cambridge – New York, Cambridge University Press, 2008.
- Weber E., Satan franc-maçon. La mystification de Léo Taxil, Paris, Julliard, 1964.
- Weber M., Économie et Société, tome premier, trad. J. Freund et al., Paris, Plon-Pocket, coll. « Recherches en Sciences humaines », n° 27, 1971 [1909].
- Weber M., Le Savant et le politique [1917], trad. J. Freund, Introd. R. Aron, Paris, Union Générale d’Éditions, coll. « Le Monde en 10/18 », 1963.
- Wechsler, H. J., Offerings of Jade and Silk: Ritual and Symbol in the Legitimation of the T’ang Dynasty, New Haven, Yale University Press, 1985.
- Weill-Raynal G., Les nouveaux désinformateurs, Paris, Armand Colin, 2005.
- Weissberg-Cybulski A, L’accusé, trad. P. Stéphano et E. Bestaux, Préface de A. Koestler, Paris, Fasquelle éd., 1953.
- Will P.-E., « Le contrôle de l’excès de pouvoir sous la dynastie des Ming », dans M. Delmas-Marty et P.-E Will (dir.), La Chine et la démocratie, Paris, Fayard, 2007, p. 111-156.
- Winock M., Édouard Drumont et compagnie. Antisémitisme et fas-cisme en France, Paris, Éd. du Seuil, 1982.
- Winock M., Nationalisme, antisémitisme et fascisme en France, Éd. du Seuil, coll. « Points – Histoire », 2004 [1990].
- Wittgenstein L., Tractatus Logico-Philosophicus, trad. G.-G. Granger, Paris, Gallimard, 1993 [1922].
- Wuillème T. (dir.), Autour des Secrets, Paris, L’Harmattan, coll. « Le Forum-IRTS de Lorraine », 2005.
- Xu Xiaoqun, « The Rule of Law without Due Process: Punishing Robbers and Bandits in Early-Tenthieth-Century China », Modern China, 33, 2007, p. 230-257.
- Zawadzki P., « Le fanatisme au miroir de la modernité », dans M.
346 Les rhétoriques de la conspiration
Chevrier, Y. Couture et S. Vibert (dir.), L’autre de la modernité, Montréal, Fides, 2011 [à paraître].
- Zawadzki P., « Une tache aveugle sur la rétine de Voltaire. Le fanatisme des intellectuels », dans Fr. Champion, S. Nizard et P. Zawadzki (dir.), Le sacré hors religions, Paris, L’Harmattan – Association fran-çaise de sciences sociales des religions, 2007, p. 51-73.
- Zdybel L., Idea spisku i teorie spiskowe w swietle analiz krytycznych i badan historycznych [Idées et théories du complot à la lumière des analyses critiques et des recherches historiques], Lublin, Uniwersytet MCS, 2002.
- Zhang Ning, « Catégories judiciaires et pratiques d’exception : “ban-ditisme” et peine de mort en Chine », dans M. Delmas-Marty et P.-E. Will (dir.), La Chine et la démocratie, Paris, Fayard, 2007, p. 195-213.
- Zhang Ning, « Corps et la peine capitale dans la Chine impériale. Les dimensions judicaires et rituelles sous les Ming », T’oung pao, 94 (4-5), 2008, p. 246-305.
Bibliographie 347
Les auteurs
Valérie André est Maître de recherches du FRS-FNRS et Professeur d’histoire de la littérature et des idées à l’Université Libre de Bruxelles.
Marc Angenot est titulaire de la Chaire James McGill d’Étude du discours social et Professeur de langue et littérature françaises à l’Uni-versité McGill de Montréal.
Emmanuelle Danblon est Professeur de rhétorique et d’argumen-tation à l’Université Libre de Bruxelles.
Marc Dominicy est Professeur de linguistique générale et de poé-tique à l’Université Libre de Bruxelles.
Evelyne Guzy-Burgman est doctorante en rhétorique et argu-mentation à l’Université Libre de Bruxelles ainsi que consultante en communication.
Thierry Herman est Maître d’enseignement et de recherche en communication et argumentation à l’Université de Neuchâtel et Chargé de cours en rhétorique à l’Université de Lausanne (Suisse).
Olivier Klein est Professeur de psychologie sociale à l’Université Libre de Bruxelles.
Françoise Lauwaert est Professeur d’anthropologie et d’histoire des sociétés asiatiques à l’Université Libre de Bruxelles.
Loïc Nicolas, Aspirant du FRS-FNRS, est doctorant en rhétorique et argumentation à l’Université Libre de Bruxelles et à l’EHESS de Paris.
Evgénia Paparouni est doctorante en rhétorique et argumentation à l’Université Libre de Bruxelles et interprète à la Commission euro-péenne.
Cédric Passard est Professeur agrégé (PRAG) de sciences sociales et doctorant en sciences politiques à l’IEP de Lille.
Jean-Philippe Schreiber est Maître de recherches du FRS-FNRS et Professeur d’histoire des religions et des institutions à l’Université Libre de Bruxelles.
Pierre-André Taguieff, philosophe, politologue et historien des idées est Directeur de recherche au CNRS, attaché à l’IEP de Paris.
Nicolas Van der Linden est Assistant de recherches et doctorant en psychologie sociale à l’Université Libre de Bruxelles.
Paul Zawadzki est Maître de conférences en sciences politiques à l’Université Panthéon-Sorbonne – Paris I.
Auteurs 349
Mise en page : LEN
Achevé d’imprimer en aout 2010 par LEN S.A.S. - 92800 Puteaux
Dépôt légal :aout 2010
Imprimé en France