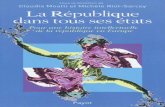Iran – Asie centrale – Inde, XVe-XVIIIe siècles - OpenEdition ...
Les pensionnaires russes en Italie et en France au XVIIIe siècle
Transcript of Les pensionnaires russes en Italie et en France au XVIIIe siècle
Basile Baudez Université Paris-Sorbonne, Paris IV
Les pensionnaires russes en Italie et en France au XVIIIe
siècle
L’Académie des beaux arts de Russie fut fondée par ÉlisabethIère avec l’aide de son favori Ivan Chouvalov. D’aborddépartement de l’université de Moscou de 1755, elle ne devintautonome dans la ville de Saint-Pétersbourg que deux ans plustard. Elle se fondait sur le modèle académique français maispossédait l’originalité à partir de 1764 lors de sa réformepar Catherine II et Ivan Betskoï d’associer un collège sur lemodèle des écoles militaires de cadets allemands avecl’académie proprement dite. Les élèves y entraient dès l’âgede six ans et en ressortaient onze à douze années plus tard enayant suivi pour les meilleurs d’entre eux une formation depeintre, de sculpteur, de graveur ou d’architecte ; les autresavaient la possibilité d’être formés à des métiers del’artisanat d’art, comme la menuiserie, l’horlogerie ou lasculpture décorative.
Contrairement à ce que l’on peut penser au premier abord, cen’est pas l’exemple des pensionnaires de l’Académie de Franceà Rome qui influença Ivan Chouvalov lorsqu’il décida d’envoyerdes Russes en Europe. Quand Chouvalov ordonna une enquête surles conditions de transport, les itinéraires, le logemententre autres, il demanda des conseils à Iouri Kologriov quiaccompagna les premiers pensionnaires de Pierre le Grand. Ils’agissait du portraitiste Ivan Nikitine qui fut envoyé àVenise et Florence de 1716 à 1719, de son camarade AndreïMatveev qui étudia en Hollande, à Amsterdam et La Haye etsuivit des cours à l’Académie des beaux-arts d’Anvers en 1723,et de l’architecte Mikhaïl Zemtsov à Venise. Paris et Rome nefaisaient pas encore partie des destinations les pluscourantes et Pierre le Grand préférait envoyer les étudiantsapprendre la navigation à Brest ou à Toulon1. 1 Cet envoi n’apporta pas, semble-t-il, les résultats escomptés. Le rapportde leur instructeur à Toulon daté du 9 septembre 1717 indique qu’ils nefaisaient que se battre entre eux et agissaient comme des sauvages. Ilécrit : « Une partie de ces jeunes messieurs n’a que la figure de l’hommeet il n’y a chez eux que l’animal qui agit. » Archives de la Marine, B3, d.
1
Cette tradition fut reprise par l’Académie des sciences quienvoyait en Allemagne ou au Royaume Uni ses meilleurs étudiantspour qu’ils se perfectionnassent en sciences ou même enéconomie, comme ce Desnitski qui alla écouter Adam Smith àGlasgow2. Mais l’Académie des sciences envoya aussi despensionnaires artistes à l’étranger. C’est le cas du sculpteurMikhaïl Pavlov qui fut envoyé à Paris en 1759 travailler chezAllegrain et Pigalle3. Il rencontra dans la capitale françaiseles premiers pensionnaires de l’Académie des beaux-arts,Vassili Bajenov et Anton Losenko.
Principes
Être choisi par l’Académie des beaux-arts pour partir à Paris,Rome ou Venise représentait une chance peu imaginable pour desjeunes gens issus de milieux modestes. Il s’agissait d’unvoyage que seuls les grands aristocrates pouvaient s’offrir àcause du coût qu’occasionnaient les distances. Mais il faut serappeler que les étudiants qui n’avaient pas été choisisn’auraient jamais pu faire ce que Vallin de La Mothe oud’autres artistes qui n’avaient pas la pension romaine du roide France firent : aller de leur propre chef en Italie. LesRusses du XVIIIe siècle, contrairement aux Français ou auxAnglais, ne pouvaient pas voyager sans autorisation écrite dusouverain, ne fût-ce que d’une ville à l’autre. Autant direque les étudiants qui obtenaient le privilège de pouvoirvoyager à l’étranger faisaient partie des seuls Russes nonnobles et fortunés qui franchirent jamais les frontières deleur empire au cours du siècle. On mesure mieux l’importanceque revêtait ce choix et le dépit qui pouvait s’emparer desautorités académiques lorsqu’elles s’apercevaient que lespensionnaires avaient gâché l’extraordinaire chance qui leurétait accordée.
De quelle manière étaient choisis les étudiants que l’onenvoyait à l’étranger ? Il ne pouvait s’agir que d’étudiantsdes classes d’arts libéraux. Dans les premières années de245, fol. 307. 2 TDCBYF- Y= F=- Fhrbntrnehyfz ntjhbz d Hjccbb XVIII dtrf- [La théorie architecturale enRussie au XVIIIe siècle], Moscou, 1975, p. 122.3 Voir la monographie de E. Souklova sur Mikhaïl Petrovitch Pavlov publiée àMoscou en 1967.
2
l’Académie, devenaient pensionnaires non pas des étudiants quiavaient fait leurs classes à l’Académie et que l’on souhaitaitvoir se perfectionner, mais des jeunes gens qui avaientintégré l’Académie avec un bon niveau en art, et qui étaienttout simplement envoyés faire leurs études à l’étranger. Cefut le cas en 1761 des étudiants Alexandre Karamichov etMatfeï Afonine qui étaient entretenus à Stockholm pour 300roubles par an chacun ; de même, quatre étudiants furentenvoyés à Königsberg de septembre 1758 à mars 1762, et deuxétudiants de l’Université de Moscou suivirent des cours enAngleterre où ils recevaient chacun 400 roubles par an de lapart de l’Académie4. Cette pratique fut vite abandonnée lorsquele Conseil réussit à engager des professeurs qui pouvaientformer sur place les élèves en art.
Selon le Règlement, le Conseil devait envoyer à l’étranger douzeétudiants tous les trois ans, choisis parmi la promotionsortante du dernier âge5. Ce chiffre ne fut pas respecté. Lesmembres de l’assemblée académique durent juger plus d’une foisqu’il n’y avait pas douze jeunes gens qui méritaient cethonneur. Plus prosaïquement, les difficultés financièresrestreignirent souvent le nombre des étudiants pensionnés.Ainsi en juillet 1767, on ne choisit que sept pensionnaires,onze en 1770, dix en juin 1773, de nouveau sept en 1782 ; ilne sont plus que cinq en 1785. Lors des premiers troubles enFrance, le nombre diminua considérablement. En mai 1789,l’Académie envoya trois étudiants à Rome puis en avril 1792,un seul, Gavrila Rodtchev6.
Le choix des pensionnaires se faisait normalement parscrutin lors d’une assemblée publique de l’Académie. Avec letemps, cette procédure fut abandonnée pour un simple vote desmembres du Conseil, qui ne fut même pas ratifié par l’Académiecertaines années. On ne décèle aucune intervention soit duprésident, soit du pouvoir souverain. C’est au nom de
4 Liste du personnel. 1761. PETROV P. N., [Recueil de matériaux pourl’histoire de l’Académie impériale des Beaux-arts de Saint-Pétersbourg surun siècle d’existence], Saint-Pétersbourg, 1864-1866, I, p. 16.5 Règlement, II, IX, 2.6 Réunion publique du 30 mai 1792. Saint-Pétersbourg, HUBF (HjccbqcrbqUjcelfhcndtyysq Bcnjhbxtcrbq Fh[bd) [Archives historiques de l’État russe],fonds 789 : Académie des beaux-arts de Saint-Pétersbourg 1757-1917, 1, 1,1050. Envoi du pensionnaire G. Rodtchev. Avril 1792. HUBF, 789, 1, 1, 1022.
3
l’Académie que les étudiants étaient envoyés à l’étranger etnon au nom du souverain, contrairement à ce qui se passait enFrance pour les pensionnaires envoyés à Rome. Lespensionnaires étaient choisis le plus souvent parmi lesétudiants qui avaient reçu une médaille d’or. Ainsi en juillet1767, tous les pensionnaires sont des médaillés. On trouve unpeintre, Piotr Grinov médaillé en 1766 ; deux sculpteurs,Fedot Choubine, médaille d’or de 1766 et Fedor Gordeev,médaille d’or de 1767 ; deux architectes, les frères Ivan etAlexeï Ivanov qui reçurent une grande médaille d’or l’un aprèsl’autre en 1766 et 1767 ; un graveur, Ivan Merstalov, petitemédaille d’or en 1766 puis grande médaille l’année suivante ;un peintre de paysage, Semion Chtchedrine médaille d’or en1767. Tous sortaient du cinquième âge avec un diplôme dupremier degré.
Si tous les pensionnaires sont médaillés, pourquoi tous lesmédaillés ne sont-ils pas pensionnaires ? Ce fut le cas d’IvanErmeniev qui obtint la grande médaille d’or en peinturehistorique en 1767. La solution se trouve dans le classementdes diplômes de sortie. Ivan Ermeniev reçoit un diplôme dequatrième degré réservé aux étudiants qui ont obtenusd’excellents résultats mais qui n’ont pas fait preuve d’unebonne conduite. Nous voyons que la conduite passée desétudiants décidait de leur envoi à l’étranger. D’après leslistes que nous avons pu consulter et qui ne sont pascomplètes pour toute la période, il semble que le Conseilchoisissait toujours au moins un élève de chaque département.Dans les années 1780, on trouvait toujours un portraitiste enplus des peintres médaillés en peinture d’histoire ; parcontre, depuis Semion Chtchedrine, très peu de peintres depaysage, encore moins de peintres de fruits et de fleurs ou depeintres animaliers.
D’après ce que nous avons vu, les destinations choisies parl’Académie pour ses étudiants étaient principalement Paris etRome. Certes, on relève quelques exceptions. Ainsi en août1773, l’Académie envoya à Londres deux étudiants du quatrièmeâge se perfectionner dans les sciences7, et en 1773 MikhaïlBelskoï partit pour Londres avant de se rendre à Paris en1776. Nous ne connaissons malheureusement pas les raisons pour
7 Séance du Conseil du 1er août 1773. HUBF, 789, 1, 1, 535.
4
lesquelles on décida d’envoyer cet étudiant en peinturehistorique en Angleterre. Londres était d’ailleurs unedestination qui convenait mieux aux graveurs. Ivan Merstalov yfut envoyé en 1767 avant de se rendre à Paris et GavrilaSkorodoumov apprit la manière noire chez Bartolozzi de 1773 à1782. Quelques étudiants séjournèrent à Venise comme lepaysagiste Fedor Alexeev qui travaillait dans les ateliers deD. Moretti et P. Gaspari8, ou bien à Gênes où travaillait Isaeven 17769. On peut hésiter à qualifier de pensionnaires, commele fit le Conseil, les étudiants Ivan Alexandrov et TimophéeVassiliev qui furent envoyés par l’Académie en Chine afin depeindre des vues de jardins en 180510.
À l’origine la seule destination prévue pour les étudiants enart était Paris. Mais très vite, les premiers pensionnairesBajenov, Losenko et Starov demandèrent la permission d’aller àRome. Dans une lettre au Conseil, Ivan Starov explique que levoyage à Rome est indispensable et que c’est là que vonttravailler les étudiants français de l’Académie royaled’architecture11. Bajenov obtint l’autorisation de se rendre àRome à l’automne 1762 et Starov en 1766. Il semble que parfoisl’Académie ait éprouvé des difficultés à laisser partir lespensionnaires en Italie. En 1770, Fedot Choubine rêve de serendre à Rome alors que le Conseil aimerait qu’il restât unpeu plus longtemps à Paris. Diderot le soutient et dans unelettre à Catherine II datée du 4 août 1782, Melchior Grimmexplique la position des pensionnaires, notamment du sculpteurFeodosi Chtchedrine :
« Cet artiste prétend qu’il faudrait commencer par envoyer tousles jeunes élèves à Paris, parce qu’ils y trouvent une grandeémulation qui excite au travail au milieu de tant d’élèves detoute espèce, et finir par Rome parce qu’on n’y trouve niconcours, ni émulation (tout y est mort), mais on y trouve lesgrands modèles éternels qui inspirent un autre genre
8 Rapport de Fedor Alexeev de Venise daté du 24 octobre 1776. HUBF, 789, 1,1, 720.9 Lettre de Vallin de La Mothe au Conseil du 25 février 1776. HUBF, 789, 1,1, 711.10 Envoi d’étudiants en Chine. 1805. HUBF, 789, 1, 1, 1856.11 Lettre du pensionnaire Ivan Starov au Conseil. Décembre 1764. HUBF, 789,1, 1, 474, fol. 8.
5
d’émulation quand on a commencé à se sentir et à pénétrer tousles secrets de l’art12. »
À Paris, les étudiants se mesuraient à leurs camarades françaiset perfectionnaient leurs techniques et leur style auprès desplus grands artistes de l’Europe, mais à Rome ils apprenaient àvoir la beauté de l’antique, à rencontrer la fleur du mondeartistique européen et à établir de fructueux contacts. Ainsi,dans les années 1760 et 1770, le parcours habituel comprenaitun séjour à Paris puis à Rome. Il y eut quelques exceptions.Mikhaïl Kozlovski, par exemple, fut envoyé directement à Romeen 1773 et ne s’arrêta que peu de temps à Paris sur le chemindu retour. À la fin des années 1780, les troubles en Franceincitèrent les autorités académiques à choisir Rome comme seuledestination pour leurs étudiants. Ainsi, Grigori Ougrioumov nese rendit pas à Paris mais séjourna dans la cité pontificale de1787 à 1790. En réalité, cela ne faisait que renforcer unetendance perceptible dès le milieu des années 1770. PiotrSokolov par exemple fut envoyé uniquement à Rome de 1773 à1778.
Avant de partir, les étudiants recevaient un certain nombre derecommandations. Ils devaient tenir un journal dans lequel ilsnotaient tout ce qu’ils voyaient d’intéressant, leursoccupations et les personnes, sans oublier les lieux qu’ilsétaient amenés à côtoyer. À partir des notes prises dans cejournal, les pensionnaires avaient l’obligation d’envoyer àl’Académie un rapport tous les quatre mois indiquant leur lieude résidence et leurs occupations. Ces exercices avaient unedouble utilité aux yeux des responsables académiques. Lesétudiants servaient d’agents de renseignements pour l’Académiesur l’actualité, les monuments, les œuvres qui se créaient, lespersonnes qui disparaissaient ou se distinguaient. En bref, lespensionnaires représentaient une mine d’informationincomparable pour l’Académie. La seconde utilité des rapportsétait d’ordre pédagogique. Les étudiants devaient apprendre àexercer leur sens de l’observation et leur goût. Dans laperspective de l’enseignement, ces travaux d’écriture leurpermettaient d’exprimer leur pensée avec correction et clarté.
12 Lettre du baron Grimm à Catherine II datée du 4 août 1782. RÉAU L., « Lesartistes russes à Paris au XVIIIe siècle », Revue des études slaves, III [1923],p. 293.
6
Le premier journal de pensionnaire fut celui d’Anton Losenkoqui est daté des années 1764 et 1765. Très fourni, on sent queson auteur s’est appuyé sur des guides de l’époque pour lesdescriptions qu’il faisait des monuments de la capitalefrançaise et de ses environs. Il indiquait à chaque foisl’auteur et les caractéristiques de l’ouvrage, en termes deproportions, de symétrie, de couleur. Ce journal servira demodèle pour les futurs pensionnaires13. D’ailleurs les rapportsles plus intéressants étaient lus lors des séances du Conseilet on les communiquait parfois aux futurs pensionnaires pourqu’ils se renseignent sur leur lieu de destination14. LeConseil fournissait aux étudiants qui partaient desinstructions écrites. En 1779 les étudiants égarèrent leursinstructions lors de leur voyage vers Paris ; ils écrivirentaussitôt au Conseil pour qu’on leur en envoie un autreexemplaire, car ils se savaient pas comment rédiger lesrapports ni tenir leur journal15. On leur indiquait aussi lecours du change, comment économiser leur argent, où et commentil fallait expédier leurs œuvres, comment les emballer, rédigerles étiquettes, les enveloppes. Certaines instructions étaientextrêmement précises, comme celle de 180616. Le Conseil tenaitparticulièrement à ce que les étudiants notassent leursimpressions de voyage. Ainsi l’instruction de 1806 produit unjournal type sur lequel devaient s’appuyer les pensionnaires.Il était rédigé en ces termes :
« Journal du pensionnaire de l’Académie des beaux-arts Untel,résidant à X sur les choses intéressantes vues dans les paysétrangers. Arrivé dans tel endroit, j’ai vu un tableau ou une statueintéressante représentant tel ou tel sujet de tel ou tel maître ; oubien j’ai vu un bâtiment construit par tel architecte, ou de beauxjardins, une perspective. Dans telle ville, j’ai vu ceci ou cela…Indiquer dans quelles villes vivent les plus grands artistes dutemps17. »
13 Le journal d’Anton Losenko a été publié par A. Fedorov et M. Davydov en1938 dans Vfcnthf bcreccndf j, bcreccndt, t. IV, p. 31-38.14 Séance du Conseil du 19 novembre 1767. HUBF, 789, 1, 1, 586, fol. 17.15 Rapport des pensionnaires au Conseil, 1779. HUBF, 789, 1, 1, 847a, fol. 3.16 Nous conservons un exemple d’instructions, un peu postérieur à notrepériode puisqu’il date de 1806, mais il fut copié sur des instructionsantérieures. HUBF, 789, 1, 1, 2010.17 Instructions aux pensionnaires. 1806. HUBF, 789, 1, 1, 2010, fol. 10.
7
Ils semble que ces instructions ne fussent pas inutiles étantdonné les plaintes régulières du Conseil sur le fait que lespensionnaires ne voient rien sur leur chemin, ne remarquentrien d’intéressant avant d’arriver à Paris ou à Rome18. Pourjuger d’un bâtiment, la régularité et l’utilité étaient lesmaîtres mots. Leur jugement reflète le goût dominant enarchitecture. Ainsi en 1779, Iakov Farafontiev en route pourParis et passant par la Prusse et la Courlande ne remarque quele nouveau Berlin qui lui plut par sa régularité etl’ordonnance de ses rues19. Les pensionnaires voyageaient parpetits groupes. Ils avaient le choix entre la route maritime,la plus simple et la plus rapide, et la route terrestre. Parmer, ils embarquaient à Cronstadt20 et débarquaient àAmsterdam, de là ils se rendaient à Bruxelles puis à Paris, ouils pouvaient débarquer à Dantzig et se rendre à Berlin parLübeck pour rejoindre Bruxelles. La route de terre passait parRiga, Mitau, Berlin puis Paris ou Rome. Pour aller deSaint-Pétersbourg à Paris, les pensionnaires mettaient entre unmois et six semaines.
Vie quotidienne
Arrivés à Paris, les pensionnaires devaient être pris en chargepar le ministre de Russie à Paris. Si le comteBestoujev-Rioumine ne semble pas avoir fait montre de beaucoupd’enthousiasme dans sa tâche, son successeur, le prince DmitriGalitzyne s’occupa avec beaucoup de ferveur des pensionnaires.Il accueillit Anton Losenko dans son hôtel21 et servitd’intermédiaire entre les jeunes Russes et son ami DenisDiderot à qui il demanda officiellement en 1770 d’être leurprotecteur22. Diderot n’eut sans doute pas de contacts avec les18 Lettre du prince Dmitri Galitzyne au Conseil de janvier 1767. Séance duConseil du 10 octobre 1767. HUBF, 789, 1, 1, 298, fol. 15v-16.19 Rapport des pensionnaires au Conseil. 1779. HUBF, 789, 1, 1, 847a, fol.19v.20 Le secrétaire de conférence accompagna les pensionnaires qui embarquaientpour la France à Crondstadt. Séance du Conseil du 24 septembre 1782. PETROVN. P., op. cit., I, p. 254.21 Registre des élèves de l’Académie de peinture et de sculpture, I, fol. 22 : « Losinkof.Russien. Protégé par M. Restout et par l’embassadeur de Russy à la courd’Espagne, il demeure à l’othel dudit embassadeur. Rue des PetitsAugustins, octobre 1761. »22 HUBF, 789, 1, 1, 411.
8
pensionnaires avant 1767 puisque dans une lettre à Falconetdatée de décembre 1773 il dit ne jamais avoir rencontré AntonLosenko23. Mais en mai 1768 il demanda à Falconet de dire àAlexandre Saltykov que l’Académie recevrait un rapport de samain tous les trois mois sur les mœurs et la conduite desélèves russes24. Galitzyne aida les premiers pensionnaires àentrer dans les académies parisiennes, à se trouver desmaîtres. Ainsi, il plaça Vassili Bajenov chez Charles De Waillyet Anton Losenko chez Jean Restout. De Wailly accueillit Staroven 1762, Volkov en 1776 et Ivan Komisarov en 178125.
A Paris, les étudiants ne bénéficiaient pas de lieud’accueil comparable à l’Académie de France à Rome. Certainshabitaient chez leur maître, comme Ivan Bersenev qui résidaitchez le graveur Charles Clément Bervic en 1785. Si tel n’étaitpas le cas, ils tentaient de trouver, avec plus ou moins dedifficulté, un endroit où se loger. Ainsi Fedot Choubine, élèvede Pigalle, habita successivement chez un certain M. Dominique,rue Saint-Honoré, puis en octobre 1767 chez une fruitière rued’Argenteuil et enfin chez un perruquier, M. Lesprit, rueFromenteau26. Lesprit déménagea ensuite rueSaint-Thomas-du-Louvre ce qui était bien pratique pour lesélèves des académiciens disposant d’un logement au Louvre.Cette adresse fut souvent fréquentée par les pensionnairesrusses. On y retrouve Anton Losenko en 1765 lorsqu’il passadans l’atelier de Vien et Piotr Gordeev en 1768. Dans lesannées 1780, on trouvait à l’hôtel d’Espagne, rue Guénégaud,Ivan Pekorski, Mikhaïl Ouvajnoï, Ivan Piskounov et IvanToupylev ; à l’hôtel de Champagne, rue des Poulies, IvanSemenov et Élisée Kochkine.
Les pensionnaires recevaient 100 roubles chacun pour leursfrais de voyage, puis 400 roubles par an. L’argent leur était23 « Et ce pauvre Lossinkow qui a dessiné votre monument, et qui disaitqu’il fallait l’avoir copié pour en sentir tout le mérite, il n’est doncplus ? Quoique je n’ai pas eu le temps de le connaître, j’en suis fâché. »,Correspondance de Diderot, éd. Laurent Versini, Paris, Robert Laffont, 1997,p. 1 202.24 Lettre de Diderot à Falconet de mai 1768, Correspondance de Diderot, op. cit.,p. 824. Diderot dans sa lettre donne à « M. de Soltikoff » le titre dedirecteur de l’Académie. Alexandre Saltikov était secrétaire de conférence.25 Rapports d’Ivan Starov, Fedor Volkov et Ivan Komisarov. HUBF, 789, 1, 1,474, fol. 5 ; 776, fol. 2 ; 866, fol. 8.26 Registre des élèves de l’Académie de peinture et sculpture, I, fol. 98.
9
versé par des marchands qui commerçaient entreSaint-Pétersbourg et Paris. En 1762, le salaire de Losenko etBajenov est livré par un certain Thomson. Dans une lettre auxpensionnaires datée du 10 septembre, Alexandre Kokorinov leurprécisait que si jamais ce qu’ils avaient reçu n’était passuffisant, ils pourraient bénéficier d’une lettre de créance de1 000 roubles que le marchand Jean Michel apportait à Paris27.Le ministre de Russie était chargé de conserver les fonds et deles distribuer aux pensionnaires28. A partir des années 1770,le Conseil faisait appel à des banquiers, dont les célèbresThélusson, Necker et Cie, qui géraient l’ensemble des dépensesde l’Académie en France, que ce soit les salaires versés auxétudiants ou les pensions des anciens professeurs comme Vallinde La Mothe29.
Il est difficile de bien cerner la manière dont les élèveschoisissaient leurs maîtres. Il semble que l’Académie les leurimposait, sur les recommandations du prince Galitzyne puis deDiderot ou de Grimm, mais les pensionnaires acquirent de plusen plus de liberté dans leur choix. Ainsi par une lettre du 23décembre 1777, Vallin de La Mothe, qui s’acquittait encore desa tâche de surveillance et de conseil auprès despensionnaires, fit part au Conseil d’un problème. Il concernaitle sculpteur Feodosi Chtchedrine :
Mr Chedrine sculpteur paraît embarrassé d’aller ou chez Mr
Pigalle ou chez Mr Mouchy suivant les ordres qu’il a reçu del’Académie s’il veut rester un an de plus. Comme les deux messieurssont parents de Mr Allegrin [sic] il croit faire affront à Mr
Allegrin dont il est le plus satisfait. M’ayant fait savoir cettedélicatesse, je lui ai fait dire qu’il devait se conformer auxordres de l’Académie et de lui écrire les raisons30.
27 Lettre d’A. Kokorinov à V. Bajenov et A. Losenko, 10 septembre 1762.PETROV N. P., op. cit., I, p. 54-55.28 Lettre du prince Dmitri Galitsyne au Conseil du 5 mai 1765. HUBF, 789, 1,1, 187.29 Paiement des pensions aux étudiants de Paris, 2 janvier 1771. HUBF, 789,1, 1, 487, fol. 3. Transfert de 2 000 roubles aux banquiers Masse et filspour les pensions en France. Séance du Conseil du 13 janvier 1780. PETROV N.P., op. cit., I, p. 234.30 Lettre de J.-B. Vallin de La Mothe au Conseil du 23 décembre 1777. HUBF,789, 1, 1, 777, fol. 1.
10
Nous n’avons pas pu retrouver la trace de tous lespensionnaires qui vinrent travailler à Paris, mais nous avonsun aperçu des artistes chez qui allaient travailler les élèvesrusses31. En sculpture, les pensionnaires arrivés à Paris en1767, Fedor Gordeev et Fedot Choubine, allèrent le premierchez Jean-Baptiste Lemoyne, le second chez Jean-BaptistePigalle. Il ne semble pas que ces artistes aient accueillisd’autres sculpteurs russes. Les Russes ne furent-ils passatisfaits de l’enseignement ou, plus probablement les Françaisne souhaitèrent pas renouveler l’expérience. En 1770, SemionVassiliev et Arkhipe Ivanov se rendirent chez Pajou, ami deNicolas Gillet et de Vallin de La Mothe. En 1776, c’est chezGabriel Allegrain que travailla Feodosi Chtchedrine. Ce futsans doute Diderot qui recommanda Allegrain aux Russes. Ilavait particulièrement apprécié sa Vénus au bain du Salon de1767, mais nous avons vu que l’Académie souhaita ensuite placerson pensionnaire chez Pigalle ou Louis-Philippe Mouchy.
C’est chez Mouchy d’ailleurs que Gavrila Zamaraev entra en1780. Son camarade Mikhaïl Ouvajnoï préféra aller chezJean-Antoine Houdon et Ivan Prokofiev chez Pierre Julien. Cedernier semble avoir donné satisfaction aux autoritésacadémiques, ou avoir apprécié les pensionnaires russes, car ilaccueillit trois ans plus tard Iakov Maskvine et GavrilaRodtchev en 1790. En 1785 par contre, Pavel Sokolov entra chezCharles Bridan. Si l’absence de Clodion dans cette listes’explique par le fait qu’il n’était pas académicien, on nesaurait trouver les raisons pour lesquelles aucun Russe n’allatravailler dans l’atelier de Jean-Jacques Caffieri. Peut-êtrela rivalité qui l’opposait à Pajou, grand ami de Diderot et desprofesseurs de l’Académie de Saint-Pétersbourg, fut-elle unobstacle ?
31 Cette liste a été composée d’après les registres des élèves de l’Académiede peinture et sculpture en partie éditée par Denis Roche en 1909 dans CnfhstUjls, des lettres de J.-B. Vallin de La Mothe ou de N. Gillet adressées auconseil académique, de l’étude, assez fautive, de Louis Réau publiée dansla Revue des études slaves en 1923 et des recherches personnelles menées sur lacarrière des artistes russes issus de l’Académie. Faute de temps, il nenous a pas été possible d’effectuer un relevé systématique des archivespersonnelles des différents maîtres qui accueillirent des étudiants del’Académie. Ce travail serait sans doute fructueux et mériterait d’yconsacrer du temps et de l’énergie.
11
Le choix de Jean Restout pour le jeune Anton Losenko en 1762s’imposa sans doute pour des raisons de prestige : le peintrevenait d’être nommé directeur de l’Académie royale de peintureet de sculpture l’année précédente. Losenko réalisa dans cetteannée une copie de la Pêche miraculeuse de Jean Jouvenet, grand-père maternel de son maître qu’il partit présenter à CatherineII à l’occasion du couronnement de l’impératrice à Moscou en1763. À son retour, Losenko entra chez Joseph-Marie Vien32.L’atelier de ce dernier était particulièrement réputé ; sagloire augmentait depuis le succès de sa Marchande d’amoursprésentée au Salon de 176333. Vien accueillit d’ailleurs PiotrGrinov en 1767 après le court séjour du Russe chez Greuze. Lepeintre de genre était en train de changer sa manière pour selancer dans la peinture d’histoire avec un manque de succèsqu’il est inutile de rappeler34… Mais d’après ce que noussavons du caractère de Greuze, il n’est pas étonnant que lepauvre pensionnaire russe ait préféré ne pas prolonger sonséjour dans l’atelier de celui qui n’était pas encoreacadémicien en 1767. Greuze reçut pourtant de nouveau unpensionnaire russe en 1786 ; il s’agissait de Mikhaïl Belskoï.En 1770, les pensionnaires allèrent chez Alexandre Roslin et LePrince. Le premier comptait parmi sa clientèle de nombreuxRusses. Il forma Ivan Iakimov puis le portraitiste StepanChtchoukine en 178535. Jean-Baptiste Le Prince s’étaitspécialisé dans les scènes russes depuis le voyage qu’il
32 KAGANOVITCH A., op. cit., p. 54. 33 GAETHGENS T., LUGAND J., Joseph-Marie Vien, peintre du roi : 1716-1809, Paris, Arthena,1988, à voir. 34 A revoir avec cat expo de Tournus. Ce fut un échec retentissant pourl’artiste lorsque l’Académie lui refusa son Septime Sévère en peintured’histoire l’année 1769. Voici ce qu’en dit Diderot dans une lettre àSophie Volland datée du 1er octobre 1769 : « Vous ais-je dit que Greuzevenait de recevoir le remboursement du mépris qu’il avait eu jusqu’àprésent pour ses confrères ? Son but était d’être peintre d’histoire ; il aprésenté pour sa réception un tableau d’histoire. Ce tableau étaitmauvais ; ils ont accepté son mauvais tableau, et reçu comme peintre degenre. Sa femme s’en ronge les poings de fureur. », Correspondance de Diderot,éd. de L. Versini, Paris, Robert Laffont, 1997, p. 980. Deux ansauparavant, Diderot faisait les louanges de ce même tableau dans une lettreà Falconet du 15 août 1767 : « Le Greuze vient de faire un tour de force.Il s’est tout à coup lancé de la bambochade dans la grande peinture ; etavec succès, autant que je m’y connais. », Ibid., p. 750. Les deux amiss’étaient brouillés au début de l’année 1769.35 Alexandre Roslin, un portraitiste pour l’Europe, Paris, RMN, Château de Versailles, 2008, 208 p. à voir
12
effectua en Russie de 1758 à 1763. Il admit dans son atelierMikhaïl Ivanov de 1770 à 1774. En 1775, Ivan Ermeniev rejoignitMikhaïl Belskoï dans l’atelier du portraitiste Joseph SiffredDuplessis. En 1780, ce fut chez Louis-Jean-François Lagrenéel’Aîné que fut envoyé Ivan Toupylev. Mais l’année suivante,l’ancien professeur de Saint-Pétersbourg fut nommé directeur del’Académie de France à Rome. Toupylev alla donc avec soncamarade Ivan Pikounov chez le frère cadet de leur maître,Jean-Jacques Lagrenée, dit le Jeune. David n’accueillit dansson atelier qu’un seul Russe — un sculpteur, GavrilaRodtchev —, ses rivaux François-André Vincent et Joseph-BenoîtSuvée se partagèrent des élèves des années 1780 comme IvanSemenov, Kiprian Melnikov et Stepan Chtchoukine qui avaitquitté Le Prince. Si Carle Van Loo meurt en 1765, on remarquel’absence à la fin du siècle de Jean-Baptiste Regnault malgréla notoriété et l’importance de son atelier.
Les étudiants de peinture de bataille ou de paysage allaientsurtout chez Francesco Casanova, comme Semion Chtchedrine en1767 ou Gavrila Serebriakov en 1772 qui avait passé quelquesmois dans l’atelier de Loutherbourg36. Les étudiants enpeinture de perspective, comme on les appelait en Russie, serendaient tous dans l’atelier de Pierre Antoine De Machy. Cefut le cas de Iakov Farafontiev de 1779 à 1783 ou de IakovGerasimov en 1780. Quant au graveur Ivan Merstalov, c’est dansl’atelier de Jacques-Philippe Le Bas qu’il étudia aprèsLondres. Le Bas avait exposé au Salon en 1778 une gravured’après Le Prince dédiée à Catherine II et tentait dès 1767 devendre ses productions à la souveraine russe parl’intermédiaire de Diderot37. Dans les années 1780, tous lespensionnaires en gravure travaillaient dans l’atelier deCharles-Clément Bervic. On y retrouve Élisée Kochkine en 1783,Ivan Bersenev en 1785 et Nikolaï Outkine à l’an XII.
L’exemple de Piotr Grinov est caractéristique de la vie despensionnaires à Paris. Il écrivait dans ses rapports qu’ildessinait d’après nature ; Greuze lui avait interdit de copierdes tableaux, et le poussait à inventer ses proprescompositions. Grinov, pour être plus près de son maître qui
36 Voir la thèse sur Loutherbourg dirigée par Jobert. 37 La France et la Russie au Siècle des Lumières, expos., Paris, Grand Palais, 1986-1987, Paris, Ministère des affaires étrangères, AFAA, 1986, p. 298.
13
habitait au Louvre, rejoint Anton Losenko chez le perruquierLesprit. Dans son rapport de mars 1768, Piotr Grinov disaitêtre passé dans l’atelier de Vien. Les lundi, mardi etmercredi, il peignait ses propres compositions ; les jeudi,vendredi et samedi, il dessinait d’après nature, du matin ausoir. Il continuait d’ailleurs à travailler dans la soirée àl’école du modèle de l’Académie royale. Piotr Grinov réglait 3roubles 60 à son maître par mois, soit dix-huit livres. C’estla seule indication du coût des cours que nous ayons. PiotrGrinov eut une fin tragique puisqu’il développa une tuberculoselors de son séjour parisien qui l’emporta à l’âge devingt-quatre ans en 176838.
Si tous les maîtres français des pensionnaires russes devaientêtre académiciens, c’était pour permettre à ces derniers departiciper aux concours des académies parisiennes. Dans unpremier temps, Dmitri Galitzyne aida les pensionnaires à entrerà l’Académie de peinture et sculpture et à l’Académied’architecture. Cependant, si certains pensionnaires pouvaientparticiper aux prix de quartier grâce à la protection du maîtrechez qui ils travaillaient, le fait qu’ils ne soient pascatholiques les empêchait de participer au Grand prix. C’est cequ’expliqua Ivan Starov dans un rapport au Conseil daté demai-juin 176439. Certains arrivaient à exposer leurs projetslors des réunions annuelles de l’Académie pour la Saint Louis.Une lettre du comte Ivan Tchernychev à Ivan Chouvalov, datée de1762, indique que Vassili Bajenov présenta un projet d’hôpitalpour invalides40. Exceptionnellement, les élèves eurent ledroit de participer au Grand prix mais sans pouvoir obtenir demédaille. En 1764, Ivan Starov obtint la permission deJacques-François Blondel d’exposer son projet de collège lorsde la réunion générale du 27 août41.
Dans une lettre de Fedor Volkov au Conseil on apprend que lespensionnaires russes eurent finalement le droit de participeraux Grands prix de l’Académie royale d’architecture42. FedorVolkov était pensionnaire chez Charles De Wailly de 1776 à1782. Il fut agréé à son retour en Russie en 1782 sur un projet38 PETROV N. P., op. cit., I, p. 756.39 Rapport d’Ivan Starov. 21 mai-1er juin 1764. HUBF, 789, 1, 1, 474, fol. 6.40 Lettre citée par MIKHAÏLOV A., [Bajenov], Moscou, 1951, p. 353.41 Rapport d’Ivan Starov. Août-septembre 1764. HUBF, 789, 1, 1, 474, fol. 7.42 Rapport de Fedor Volkov. 1777. HUBF, 789, 1, 1, 1749, fol. 3
14
de lazaret et de pont triomphal. Ce projet de pont triomphallaisse supposer qu’il a participé au prix d’émulation organiséen décembre 1779 par l’Académie royale d’architecture43. FedorVolkov est d’ailleurs signalé comme élève de Julien-David LeRoy en 177744 et en février 1778 lorsqu’il remporte le premierprix du concours d’émulation pour la décoration d’une grandeporte d’écurie45. D’ailleurs le prix d’émulation du moissuivant, mars 1778, était… un lazaret. Certains pensionnairesprésentèrent leurs projets devant les membres de l’Académieroyale d’architecture qui leur délivrait ensuite un certificat.Le 12 juillet 1762, Vassili Bajenov présenta certains de sesprojets que la compagnie apprécia46. Il reçut un certificat dela part du marquis de Marigny le 30 juillet47. Ivan Starovmarcha sur les pas de son aîné puisqu’il obtint la même faveuren septembre 1766. Le procès-verbal de la séance du 1er
septembre 1766 est ainsi rédigé :
« La Compagnie qui a vu avec le plus grand plaisir les ouvragesque M. Starov, pensionnaire de l’Académie impériale de Russie,lui a présenté et montré en différens tems, et principalementle projet d’un dôme pour une cathédrale qu’elle a trouvé aussibien pensé que bien rendu […] a jugé à propos de donner à M.Starov le présent certificat pour donner à tous ceux qui leverront une preuve authentique de l’estime qu’elle a de sestalens48. »
43 Le dessin n’a pas été retrouvé à notre connaissance. 44 SCHÖLLER W., Die « Académie Royale d’Architecture » (1671-1793) : Anatomie einer Institution,Cologne, Bölhau, 1993, p. 394.45 PÉROUSE DE MONTCLOS J.-M., “Les Prix de Rome”, concours de l’Académie royale d’architectureau XVIIIe siècle, Paris, Berger-Levrault, ENSBA, 1984, p. 157.46 Procès-verbal du 12 juillet 1762 : « M. Basil Bajenow a présenté àl’Académie différents desseins de sa composition, l’Académie les a vus avecplaisir et les a considérés comme le fruit d’un travail assidu et d’étudessuivies avec zèle et intelligence. », Procès-verbaux de l’Académie royaled’architecture, éd. Henri Lemonnier, Paris, Armand Colin, 1924, t. VIII,p. 113.47 « Certifions à qui il appartiendra qu’il nous a été rendu les meilleurstémoignages par différents architectes du roy et notamment par le sieurGabriel, premier architecte, des talents et capacités du sieur BasiliBasenow en art d’architecture. En foy de quoi nous avons ordonné que leprésent certificat lui fût délivré. » Arch. Nat. O1 1094. Cité par RÉAU L.,« Les artistes russes à Paris au XVIIIe siècle », op. cit., p. 290.48 Procès-verbal de la séance du 1er septembre 1766. Archives de l’Institutde France, B21, d. 3.
15
Les peintres et les sculpteurs participaient aux prix dequartier à l’Académie royale. Anton Losenko obtint unetroisième médaille en mars 1762, une seconde médaille enjanvier 1764 et la première médaille en février 1765. En mars1779, Feodosi Chtchedrine remporta une seconde médaille et IvanProkofiev la même distinction au prix de janvier 1783. Neconnaissant pas le nombre des pensionnaires admis à l’école dumodèle, il est difficile de juger de ces résultats. Obtenir unemédaille assurait une place de choix dans la salle du modèleainsi qu’une certaine considération. C’est ce qu’expliqueMelchior Grimm à Catherine II dans sa lettre du 4 août 1782 àpropos de Feodosi Chtchedrine : «[cette médaille] lui assureune place fixe dans la salle où l’on dessine le modèle, etcette place, il ne la vendrait pour rien au monde49 ». Lesmédaillés français entraient tout de même avant les étrangers.
Les pensionnaires profitaient de leur séjour pour aller voir etcopier les plus beaux monuments de Paris et de ses environs.Ainsi, Fedot Choubine raconte dans son rapport de 1767 qu’il avisité avec ses camarades Fedor Gordeev, Semion Chtchedrine etles frères Ivanov les Tuileries, le Palais Royal, le Luxembourget longuement l’hôpital et la chapelle des Invalides, qu’ilappréciait particulièrement. La jeune troupe va à Marly et àVersailles, mais ne semble pas dépasser un périmètre restreintautour de la capitale, sans doute faute de temps et d’argent50.Il est quasiment impossible d’évaluer l’importance desrenseignements que les pensionnaires livraient à l’Académie. Ilétait vital pour Saint-Pétersbourg de se tenir au courant desnouveautés parisiennes. Les pensionnaires servirent aussi àplusieurs reprises de commissionnaires. Ainsi, en septembre1761, Alexandre Kokorinov chargea Anton Losenko d’acheter dupapier et du matériel à dessin pour les classes académiques51.En 1781, Ivan Komisarov demandait de l’argent au Conseil pourpouvoir acheter des estampes et des livres pour la bibliothèquede son institution52.
Après Paris, les pensionnaires se rendaient à Rome. Parfoismême, ils s’y rendaient directement. Le premier à faire le49 Lettre du baron Grimm à Catherine II. Citée par RÉAU L., [1923],p. 292-293. 50 TROUBNYKOV A., Cnfhst Ujls, 1916, p. 88.51 Journal des dépenses. 21 septembre 1761. PETROV N. P., op. cit., I, p. 658.52 Rapport d’Ivan Komisarov au Conseil. 1781. HUBF, 789, 1, 1, 866, fol. 6.
16
voyage fut Vassili Bajenov, recommandé par le marquis deMarigny au directeur de l’Académie de France, CharlesNatoire53. En Italie, les jeunes Russes arrivaient à rencontrernombre d’étrangers. Ainsi dans une lettre de 1764, l’AllemandI. Mannlich disait avoir croisé à Rome Anton Losenko, IvanStarov, les frères Hackert de Prusse et le Danois Rosenberg54.L’itinéraire de Paris à Rome qu’empruntèrent les pensionnairesrusses en 1769 est décrit dans le rapport que Fedot Choubineenvoya au Conseil55. Les pensionnaires traversèrent Dijon,Lyon, Avignon pour embarquer à Marseille. Le bateau les déposaà Livourne. Ils marchèrent ensuite jusqu’à Pise en laissantleurs effets sur le bateau. Fedot Choubine raconte combien ilsfurent marqués par la tour de Pise. Ils se rendirent ensuite àFlorence où ils passèrent quatre jours sous la protectiond’Ivan Chouvalov qu’ils voyaient quotidiennement. L’ancienprésident de l’Académie des beaux-arts de Russie leur fournitdes recommandations pour le cardinal Albani, pour CharlesNatoire et pour l’antiquaire Johann Friedrich Reiffenstein. Ilspartirent à pied pour Rome, dormant à Sienne le surlendemain deleur départ de Florence ; ils mirent ensuite trois jours pouratteindre Viterbe. Là, épuisés, ils se décidèrent à louer deschevaux et atteignirent enfin la cité pontificale au bout dedeux jours. Ils arrivèrent à temps pour assister àl’intronisation de Clément XIV et s’empressèrent de visiterSaint-Pierre, le Latran et tous les monuments romains.L’Académie leur accorda ensuite l’autorisation de voyager dansle pays pour voir les monuments avant de commencer à réaliserleurs œuvres. Les pensionnaires romains voyageaient en effetplus à l’intérieur de l’Italie que dans les provincesfrançaises. Ainsi, Vassili Bajenov habita Rome dans lespremiers temps et visita les environs, Frascati et Tivoli. Ilse rendit à Florence, à Venise et à Milan. Il copia sans cesseet certains de ses dessins furent rassemblés en albums par
53 Dans une lettre au marquis de Marigny, Charles Natoire écrit à la fin de1762 : « J’ay veu aussy le jeune Russe nommé Barjanoff que vous me faitesl’honneur de me recommander et pour lequel M. le prince de Galitzins’intéresse. Je feray tout ce qui dépendra de moy pour que ce jeune artistereconnaisse mon zelle à remplir vos ordre pour tout ce qui pourraconcourrir à son avancement. » Citée par RÉAU L., « Les artistes russes àParis au XVIIIe siècle », op. cit., p. 290. 54 KAGANOVITCH A., [Anton Losenko et l’art russe de la fin du XVIIIe siècle], Moscou, 1963,p. 41.55 TROUBNYKOV A. op. cit., p. 77.
17
Fedor Karjavine56. Le musée de l’Académie des beaux-artsconserve une importante collection de dessins de VassiliBajenov qui datent de son séjour en Italie. Sa curiosité allaitdes thermes antiques aux palais Renaissance, en passant par lesintérieurs d’églises gothiques et les œuvres de Palladio. Lecas de l’architecte Fedor Volkov, envoyé à Venise, présente uncas particulier. Il entra dans l’atelier de Tomaso Temanza,mais ne se plut pas dans la cité des doges, comme le rapportedepuis Lyon, Vallin de La Mothe, chargé depuis 1775 decontrôler les pensionnaires : « Il me vient une réflexion quej’ay l’honneur de présenter à l’Académie au sujet de laconversation que j’ay eu avec Mr. Volkow sur le peu d’artistesqu’il y a à Venise. C’est que dans les deux derniers genres,sculpture et architecture, il seroit inutile d’y envoier desartistes, attendu que ces jeunes gens ne trouvant personne àpouvoir les diriger, ils ne peuvent que perdre leur tems,surtout dans un pays qui leur est inconnu57 ». Il semble bienque les pensionnaires ne trouvaient qu’à Rome de quoi lessatisfaire. Ainsi, le sculpteur Chédrine arriva à Florencedepuis Saint-Péterbsourg en 1773. Il y passa cinq mois etécrivit dans son rapport : « J’ai l’honneur de rapporter quedans cette ville, il n’y a pas d’artistes, ni d’académie […]Pour cette raison, j’ose importuner l’Académie impériale desbeaux-arts et lui demander qu’elle me permette de quitter cetteville et de me rendre à Paris pour que j’y exerce mescapacités. Et s’il m’est impossible d’aller à Paris, permettez-moi au moins d’aller à Rome58. » Il se rendit ensuite à Romealors que l’Académie souhaitait l’envoyer à Paris. Cette fois-ci, le sculpteur ne souhaitait plus quitter l’Italie : « Enarrivant à Rome, j’ai compris mon erreur irréparable que jeregrette sensiblement. J’importunais en vain l’honorablecompagnie en demandant qu’on m’envoie à Paris, car je n’espèrepas trouver un autre lieu plus convenable aux études queRome59. » L’Académie demeura inflexible et Chédrine partit pourParis, où il demeura onze années, bien au-delà du terme
56 Ces albums sont conservés à la Bibliothèque d’État de Russie, située àMoscou.57 Rapport de Vallin de La Mothe au Conseil académique, 12 décembre 1776. HUBF, 1, 1, 711, fol. 15. 58 KAGANOVITCH A., [Feodosi Feodorovitch Chédrine], Moscou, 1953, p. 23. Cité par MEDVEDKOVA Olga, L’architecture française en Russie au XVIIIe siècle, doctorat s. dir. J. Revel, EHESS, 2000, t. II, p. 435. 59 Ibid.
18
prescrit. Rome demeurait donc le centre de l’Italie et lesalternatives étaient mal vécues par les pensionnaires russes.
Les pensionnaires russes à Rome avaient besoin de protection.Ils bénéficiaient du soutien d’Ivan Chouvalov. Ainsi, IvanNeelov écrivait au Conseil en 1771 que grâce à l’appui d’IvanChouvalov, ses camarades et lui étaient admis partout à Rome60.Très vite s’est posé la nécessité d’avoir une personne deconfiance qui s’occuperait de tout ce qui concernait lespensionnaires à Rome. Cette même année 1771, Ivan Chouvalovproposa à l’Académie d’engager Johann Friedrich Reiffenstein àce poste. Ce dernier faisait partie du groupe d’archéologuesantiquaires qui s’était formé autour de Piranèse, du cardinalAlbani, des frères Bartolomeo et Paolo Cavaceppi61. Le 9janvier 1771, l’assemblée académique élut membre d’honneur etcommissionnaire de l’Académie à Rome le conseiller à la Cour deHesse Kassel, Johann Friedrich Reiffenstein. On lui attribua untraitement annuel de 200 roubles par an62. A Venise, le chargédes affaires de l’Académie était un marchand d’origine grecque,le marquis Panno Maruzzi, qui se trouvait à Saint-Pétersbourgen 1766 selon le témoignage de Casanova63. En septembre 1773,il écrivait à Vallin de La Mothe en Russie qu’il avait reçuFedor Volkov à Venise64.
Nous ne savons pas où ils logeaient. Dans une lettre dedécembre 1779, Johann Reiffenstein dit qu’ils étaient logés etnourris chez des amis à lui, sans autre précision65.Trèssouvent les pensionnaires russes travaillaient avec leurs60 Rapport des pensionnaires à Rome, I. Neelov, G. Serdioukov et M.Vetochnikov. 1771. HUBF, 789, 1, 1, 434, fol. 7.61 LEGRAND J. G., Notice sur la vie de Piranèse, BNF, ms, n.a.f. 5968, fol. 138v.62 Réunion publique extraordinaire du 9 janvier 1771. PETROV N. P., op. cit., I,p. 128.63 CASANOVA G., Histoire de ma vie, Francis Lacassin éd., Paris, Robert Laffont,1993, t. III, p. 1 163.64 Lettre du marquis Panno Maruzzi à J.-B. Vallin de La Mothe. Venise le 14septembre 1773 : « J’ai reçu l’honneur de votre lettre du 29 may dernier,qui m’a été remise par le Sr Wolkow, élève de notre Académie impériale desbeaux-arts qui vient d’arriver ici, auquel j’ay fait tout l’accueil que jedois à la recommandation de l’Académie. Il seroit à souhaiter que saconduite et bonnes mœurs ne se changent point avec le climat, afin qu’ilpuisse mettre à profit les talens qu’il a déployé pour l’Architecture. »HUBF, 789, 1, 1, 559, fol. 10.65 Lettre de Johann Reiffenstein au Conseil datée du 29 décembre 1779. HUBF,789, 1, 1, 847a, fol. 1.
19
camarades de l’Académie de France. Ainsi, en 1766 Ivan Starovécrit qu’il est occupé à mesurer le Colisée avec lespensionnaires français66. Dans une lettre du 1er décembre 1775,Vallin de La Mothe disait avoir recommandé les pensionnairesrusses au nouveau directeur de l’Académie de France à Rome,Joseph-Marie Vien qui passait par Lyon67 et dans une autrelettre, il rapporte que les pensionnaires ne sont chez aucunmaître, mais fréquentent régulièrement l’institutionfrançaise68. À Rome, les pensionnaires russes pouvaientdessiner et modeler d’après nature à l’Académie de France, àl’Accademia de San Luca et au Capitole69. En Italie, lespensionnaires avaient la possibilité de participer pluslibrement qu’à Paris aux nombreux concours des académies dedessin. A. Mikhaïlov, dans sa biographie sur Bajénov de 1951affirme que le pensionnaire remporta en 1763 le premier prix duconcorso Clementino de l’Accademia de San Luca70. Or, il n’y eut aucunconcours cette année-là, et on ne trouve pas de trace departicipation du Russe aux concours de 1762 et de 176671. Parcontre, il présenta en 1764 des dessins qui le firent admettrecomme académicien de l’institution romaine72. Nous n’avons paspu vérifier s’il fut bien élu membre des académies de Florenceet de Bologne. Fedor Volkov raconte dans son rapport de 1777qu’il remporta le premier prix à l’Accademia de San Luca, mais onne trouve nulle part la trace de sa participation au concoursBalestra de la même année. Il reçut cependant à Paris une
66 Rapport de Rome, 1766 par Ivan Starov au Conseil. HUBF, 789, 1, 1, 434,fol. 15.67 Séance du Conseil du 11 janvier 1776. PETROV N. P., op. cit., I, p. 206 etlettre de Vallin de La Mothe au Conseil du 1er janvier 1775, HUBF, 789, 1, 1,711, fol. 4. 68 Lettre au Conseil du 22 mai 1776. HUBF, 789, 1, 1, 711, fol. 10-11. 69 Lettre d’Ivan Chouvalov de Rome au Conseil. 1771. HUBF, 789, 1, 1, 440.70 MIKHAÏLOV A., op. cit., 1951, p. 29-30.71 MARCONI P., CIPRIANI A., VALERIANI E., I disegni di architettura dell’Archivio storico dell’Accademia di San Luca, Rome, De Luca, 1974, 2 vol. 72 Assemblée du 3 juin 1764 : « Avendo fatta istanza il sig. Basilio Bajenoiarchitecto di nazione moscovita pensionario ed agiunto di S.M. russa d’esser escrito nella nostra academia academico di merito al qual effeto hafatti esibire uavy disegni di sua invenzione che esposti nella solita stanzaalla vista de sign. Congregati e da coro esaminati lo giudicarono degno d’esser proposito a che trovandosi in Moscovia, e non in Roma non fasse necessaria la solita dilazione ordinata dello statuto y a formale ammissione essendo tutti permesi dalle relazioni gia conseguite. » Accademia di San Luca, archives 52, p. 64-64v.
20
médaille de l’Académie de Venise pour un projet de temple73. Àvérifier
Un bilan positif ?
Les étudiants envoyés à l’étranger devaient non seulement seformer l’œil mais surtout se perfectionner dans leur art.L’Académie exigeait qu’ils travaillassent et qu’ils fournissentles preuves de ce travail. Le Règlement spécifie bien que lespensionnaires ne pouvaient recevoir l’argent de leur retour enRussie qu’après avoir envoyé à l’Académie « un morceau de leurouvrage, ou au moins une copie des plus beaux tableaux,statues, desseins, etc74. » Les envois des pensionnairesparisiens partaient par voie de mer depuis Rouen jusqu’àSaint-Pétersbourg75. Les envois se perdaient souvent en route,mais dans le cas des projets primés dans des concours, lespensionnaires étaient obligés de laisser les originaux dans lesacadémies locales. C’est pourquoi il serait sans doutefructueux d’effectuer des recherches dans les fonds desacadémies génoise ou vénitienne pour qui travaille sur lesartistes russes qui furent pensionnaires en Italie. En 1774,par exemple, Fedor Volkov envoya à Saint-Pétersbourg une copiede son projet de pont triomphal pour l’Académie de Venise, eten 1776, le projet d’un hôpital fut exposé dans la galerie del’académie russe76.
Les étudiants pouvaient réaliser des copies d’après desœuvres célèbres de leur maître qu’ils envoyaient ensuite àl’Académie. C’est le cas de Semion Vassiliev qui réalisa unecopie du Pluton de Pajou ou de Fedot Choubine d’après le Mercurede Pigalle. Il pouvait s’agir de copies d’œuvres plus ou moinsrécentes comme cette Pêche miraculeuse d’après Jean Jouvenet queLosenko apporta en décembre 1762 avec lui à l’Académie77. Ils73 Rapport de Fedor Volkov au Conseil. 1777. HUBF, 789, 1, 1, 847a, fol. 19vet 24v.74 Règlement, II, IX, 3.75 Transport des travaux des pensionnaires depuis Rouen. Séance du Conseildu 26 octobre 1773. HUBF, 789, 1, 1, 553.76 Envois de Fedor Volkov. 1774 et 1776. HUBF, 789, 1, 1, 883, fol. 4.77 Annonce qu’Anton Losenko apportera avec lui son tableau fait à Paris.Séance du Conseil du 27 août 1762. Petrov, I, p. 54. Le tableau fut placé àl’Ermitage à la fin du XVIIIe siècle sur ordre de Catherine II. Il futtransféré en 1897 au Musée russe, n° inv. ;-4970.
21
pouvaient aussi exécuter des œuvres originale comme le Sacrificed’Abraham que Losenko peignit dans l’atelier de Vien et quel’Académie exposa en juin 176678. Plus tard, Fedor Volkov, quitravailla dans l’agence de De Wailly, fut cité en exemple auxpensionnaires pour être devenu célèbre en participant à laconstruction du théâtre de Choisy79. Nicolas Gillet témoignedans une lettre au Conseil de septembre 1778 que Fedor Volkovétait allé présenter au roi un modèle de salle de spectaclepour Choisy 80. La plupart des pensionnaires présentaient commemorceau d’agrément le travail qu’ils avaient envoyé del’étranger. C’est le cas d’Arkhipe Ivanov avec son Plutond’après Pajou81 ou de Piotr Sokolov pour son Mercure et Argusenvoyé de Rome en 177682.
Mais il semble que l’Académie ne fut pas toujours aussicontente de ses pensionnaires. Le problème constant del’Académie était de faire surveiller ses pensionnaires. Cesouci est légitime. Comment ne pas s’inquiéter de laisser seulsdans des villes comme Paris, Rome ou Venise, des jeunes gensqui avaient entre dix-huit et vingt-trois ans et qui, pour laplupart, avaient vécu les trois quarts de leur existence dansune institution fermée, sous un régime strict et quasimilitaire ? Qu’ils ne soient pas tentés de profiter despremiers moments de liberté qu’ils aient eu dans leur vieserait extraordinaire. À Paris, la surveillance étaitinexistante, les pensionnaires ne disposaient pas de lieu derésidence qui leur fût propre et l’Académie dépendait du bonvouloir de Diderot, de son ambassadeur ou de membres desacadémies royales pour la tenir au courant des débordements deses protégés. Vallin de La Mothe qui se proposa de remplir lerôle de surveillant des pensionnaires habitait Lyon, jusqu’à cequ’il eut une attaque qui l’empêcha de réaliser son offre.
Dès 1773, Diderot mettait en garde Catherine II contre laconduite des pensionnaires parisiens. Il écrivait que « les
78 Exposition publique du 5 juin 1766. HUBF, 789, 19, 7, 1565, fol. 64v.79 Instruction de 1806. HUBF, 789, 1, 1, 1789, fol. 8.80 Lettre de Nicolas Gillet au Conseil datée du 29 septembre 1778. HUBF, 789,1, 1, 777, fol. 4. Des recherches mériteraient d’être menées pour saisir lerôle de Fedor Volkov dans ce chantier. 81 Séance du Conseil du 17 octobre 1776. PETROV N. P., op. cit., I, p. 214.82 Réunion publique du 13 septembre 1778. PETROV N. P., op. cit., I, p. 138. Letableau se trouve depuis 1923 au Musée russe, n° inv. ;-4976.
22
élèves livrés à eux-mêmes ont été leur train ; ils ont peutravaillé. Les uns ont été paresseux, les autres libertins, etpresque tous sont partis pour Rome, incapables d’achever enItalie, avec quelque succès, les cours qu’ils avaient commencésà Paris. Paris est un lieu de perdition pour tout jeune hommenon inspecté83 ». La nouvelle du mauvais comportement despensionnaires de Paris et de Rome déclencha de grandes réformesen 1783. Ivan Betskoï demanda au Conseil de ne plus remettre lapension académique sans certificat de bonne conduite délivrépar un surveillant84. Le Conseil proposa de charger de lasurveillance des pensionnaires russes ou le secrétaireperpétuel de l’Académie d’architecture, Michel-Jean Sedaine, ouJean-Baptiste Pierre, le directeur de l’Académie royale depeinture et sculpture. Ils auraient reçu un salaire annuel de800 roubles. À Rome, si Reiffenstein s’acquitta avec beaucoupde zèle de son emploi dans les premières années, il semblequ’il ait peu à peu abandonné les pensionnaires à leur sort. Àpartir de 1779, l’Académie ne reçut plus de nouvelle de soncommissionnaire qui touchait tout de même 220 roubles par an85.Malgré une lettre de relance en mai 1782 suivie d’une réponsepeu précise, les pensionnaires de 1782 demeurèrent livrés àeux-mêmes.
En 1788, l’Académie décida de confier à Mikhaïl Kozlovskiqui partait pour Paris une mission de surveillance etd’encadrement des pensionnaires. Cette initiative arrivait aubon moment puisque les pensionnaires n’arrivaient pas à trouverdes maîtres, que le directeur Pierre disait n’avoir jamais reçude nouvelles d’eux et que certains pensionnaires comme PavelSokolov ou Kyprian Melnikov n’envoyaient même plus de rapport
83 DIDEROT D., « Sur les jeunes artistes que Sa Majesté envoie en paysétrangers », Mélanges pour Catherine II, 84 Séance du Conseil du 2 mai 1783, propositions de Betski, point 10 : « Ilfaut absolument faire des efforts pour vaincre les défauts des élèves desdeux derniers âges, qui en ont beaucoup à cause de la mauvaise éducationqu’ils ont reçue. Les désordres des pensionnaires doivent cesser ; ilsportent atteinte au prestige de l’État et de l’Académie des beaux-arts. Onfera savoir aux commissionnaires étrangers que les pensions ne serontversées qu’après approbation écrite des surveillants. On écrira auxpensionnaires pour leur signifier qu’ils ne recevront plus de pension etdevront rentrer en Russie, s’ils ne s’améliorent pas. » PETROV N. P., op. cit.,I, p. 257 sq.85 Liste du personnel, 1772. HUBF, 789, 1, 1, 94, fol. 384.
23
au Conseil86. C’est pendant son séjour que le graveur IvanBersenev mourut de la tuberculose87. Louis Réau attribue sondécès aux débauches répétées du jeune pensionnaire au« Venusberg » du Palais Royal selon les propres termes del’historien88. Mikhaïl Kozlovski fit part de ses inquiétudes ausujet du sculpteur Pavel Sokolov qui avait accumulé beaucoup dedettes et qui devait même 220 livres à feu Ivan Barsenev89. Sescraintes étaient fondées puisque le ministre russe à Paris,Ivan Simoline parle ainsi de la fin pitoyable du séjour deSokolov à Paris :
« Socoloff, abandonné par l’Académie des arts était tombé dansla misère ; un professeur l’avait recueilli et lui donnait del’ouvrage. La passion pour le jeu l’a porté à s’oublier et às’emparer des effets qui ne lui appartenaient pas pour lesconvertir en argent. Il n’a pas laissé d’être bientôt découvertet d’être détenu dans une prison du district. Pour arrêter uneprocédure criminelle contre lui, j’ai dû prendre le parti del’envoyer à Rouen pour y être embarqué sur un vaisseau quipartait pour Hambourg ; ayant vendu ses habits, chemises,souliers, chapeaux et tout ce qu’il avait pour couvrir soncorps, j’ai dû lui faire acheter le vêtement le plusindispensable90. »
Les autorités russes songeaient sans doute fortement à lafin du siècle à créer à Paris un équivalent de l’Académie deFrance à Rome, mais les troubles de la Révolution et un certainmanque de suivi politique firent que cette fondation n’eutjamais lieu. Cela aurait sans doute résolu des problèmesprévisibles et qui ne doivent pas faire oublierl’extraordinaire apport qu’eurent ces séjours, non seulementpour les pensionnaires eux-mêmes, mais aussi pour l’Académietoute entière. Les pensionnaires représentaient une ouverture86 Séance du Conseil du 11 novembre 1788. PETROV N. P., op. cit., I, p. 297-298.87 Rapport de Koslovski lu lors de la séance du Conseil du 10 février 1789.PETROV N. P., op. cit., I, p. 298-299. M. Kozlovski demande à l’Académie de luirembourser les frais d’enterrement qui s’élevaient à 626 livres et 11 sous.88 RÉAU L. Histoire de l’expansion de l’art français moderne. Le monde slave et l’Orient, Paris,H. Laurens, 1924, p. 266. Nous n’avons pas trouvé la source d’où Louis Réauaurait pu tirer pareille information. 89 Rapport Kozlovski. Séance du Conseil du 10 février 1789. PETROV N. P., op.cit., I, p. 299.90 MOHRENSCHILDT D. S. von, Russia in the Intellectual Life of Eighteenth-century France,[1936], New York, Octagon Books, 1972, p. 55.
24






































![[1996] Le Sabbat des sorciers en Europe (XVe-XVIIIe s.).](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631cb889a906b217b907179a/1996-le-sabbat-des-sorciers-en-europe-xve-xviiie-s.jpg)