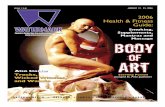MI CASA, MI CALLE, MI CIUDAD: EXPERIENCIAS SOBRE EL ESPACIO INFANTIL EN EL MADRID HISTÓRICO
Les perles de nacre du sultanat. Les princesses ottomanes (mi-XVe – mi-XVIIIe siècle)
Transcript of Les perles de nacre du sultanat. Les princesses ottomanes (mi-XVe – mi-XVIIIe siècle)
ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES
ÉCOLE DOCTORALE D’HISTOIRE ET CIVILISATIONS
Doctorat en histoire moderne
Juliette Dumas
Les perles de nacre du sultanat
Les princesses ottomanes (mi-XVe
– mi-XVIIIe
siècle)
Thèse dirigée par Gilles Veinstein
Professeur au Collège de France, Directeur d’Études à l’EHESS
Soutenue le 19 juin 2013
Jury :
Romain Bertrand, Directeur de recherches au CNRS (CERI Sciences-po).
Nathalie Clayer, Directrice d’études à l’EHESS, directrice de recherches au CNRS.
Jocelyne Dakhlia, Directrice d’études à l’EHESS.
Leslie Peirce, Professeur à l’Université de New York.
Michel Nassiet, Professeur à l’Université d’Angers, membre honoraire de l’IUF. Rapporteur
Nicolas Vatin, Directeur d’études à l’EPHE, directeur de recherches au CNRS. Rapporteur
Page | 3
REMERCIEMENTS
Les pages de remerciements sont une étrange section que la plupart des lecteurs
s’empresse de sauter. À mes yeux, elles constituent un exercice difficile : dresser une liste de
noms ne saurait suffire, il faut encore, surtout, mettre des mots sur des sentiments, des
expériences, du vécu – un long vécu qui s’étend sur près de sept ans. Une thèse n’est peut-être
pas le travail d’une vie, mais n’y voir qu’un travail serait réducteur. C’est une expérience
particulière, personnelle, intime même, un travail sur soi autant que, dans mon cas, sur des
inconnues décédées quelque cinq cents ans plus tôt. C’est un voyage de découverte dans
l’univers étrange du savoir et des connaissances. Comme tout voyage, on part pensant savoir
ce qu’on va y trouver, pour se rendre compte, finalement, que ce qu’on y découvre n’a que
peu à voir avec les attentes initiales. C’est probablement ce qui fait la beauté de cette
expérience, unique en son genre.
Tout ce que je sais, ou du moins la plus grande part, je le dois à ceux qui m’ont
entourée, encadrée, conseillée durant ces longues années. L’arrogance de la jeunesse tient en
partie, me semble-t-il, à la difficulté à exprimer sa gratitude envers les aînés qui ont contribué
à sa formation. C’est, je crois, une humilité qu’on apprend avec le temps. Comment pourrais-
je jamais remercier comme il se doit tous ceux qui m’ont soutenue durant toutes ces années ?
Il est des choses qui, à mon sens, ne s’énoncent pas par des mots, car ceux-ci sont des outils
imparfaits, réducteurs ; ils tombent comme des couperets, trop tranchants pour définir la
justesse, la complexité des émotions. Les remerciements qui vont suivre ne sauraient, à mes
yeux, dépeindre dans toute leur dimension la force des sentiments qu’ils prétendent exprimer.
Ceux qui me connaissent savent, j’en suis sûre, à quel point ces mots n’en sont qu’un pâle
reflet.
Il est d’usage de commencer ses remerciements par son directeur de thèse. Dans mon
cas, ce fut Gilles Veinstein. Si son nom figure en premier, c’est autant dans un souci de
respect des usages que parce que je lui dois énormément. Je lui serai toujours grâce d’avoir
pris sous son aile la jeune étudiante inexpérimentée et maladroite que j’étais, de l’avoir
acceptée, accueillie, encadrée, conseillée, soutenue, sans faillir, avec cette attention et cette
gentillesse toute particulière qu’il a su me témoigner tout au long de ces années. Il n’a cessé
de m’accorder sa confiance, d’abord dans le choix d’un sujet qui présentait certains risques,
mais aussi dans ma capacité à mener ce projet jusqu’à son terme, enfin, dans les résultats
escomptés. Il n’est rien de plus précieux, pour un doctorant, que de bénéficier de la confiance
et du soutien de son directeur de thèse. Il m’a enseigné tant de choses que je serais bien
incapable d’en faire la liste. Il a compté parmi ces rares professeurs capables de former leurs
doctorants à la rigueur scientifique avec une infinie douceur, par la force de leur propre
exemple. Je ne saurais compter le nombre de fois où, en quelques mots heureux, il a su
m’inviter à pousser mes analyses toujours plus loin et ne tolérer aucune paresse intellectuelle.
Le temps, l’attention, l’énergie, le soutien, le réconfort qu’il a manifesté à mon égard ont été
Page | 4
précieux et je lui en demeure infiniment reconnaissante. S’il m’est donné, un jour, de devenir
une historienne, ce sera grâce à lui. Mon grand regret est de n’avoir pu lui dire tout cela avant
qu’il ne nous quitte.
Comme doctorante, j’ai bénéficié d’une chance incroyable car, en plus de mon
directeur de thèse, j’ai joui d’un encadrement complémentaire, en la personne de Nicolas
Vatin. Il me faudrait répéter ici l’essentiel des choses que j’ai dites ci-dessus. Je ne saurais
oublier les heures passées à travailler avec lui sur des textes ottomans qui résistaient à mes
tentatives de déchiffrement ou de traduction et qui, en sa présence, prenaient soudain sens. Et
que dire de ces après-midi passés à discuter de ma thèse, d’un article, d’un problème
historique que je ne parvenais pas à résoudre ? Combien de fois n’ai-je pas fait appel à lui,
quand une difficulté survenait ou que j’hésitais dans mes analyses ? Combien de fois encore
n’a-t-il pas du rassuré la doctorante angoissée que j’étais, qui doutait de tout et qui ne
parvenait pas à déchiffrer l’univers, souvent brumeux, de la recherche scientifique ? Il m’a
témoigné une patience, accordé une attention et un temps infinis qui, je l’espère, n’ont pas été
vains. La rigueur scientifique, le souci de la précision et de la justesse historique, je les ai
également acquis avec lui.
Ma chance ne s’est pas arrêtée là, car j’ai encore bénéficié des conseils avisés de
Leslie Peirce et d’Ethem Eldem. Ma première rencontre avec Leslie remonte à 2005, quand je
n’étais encore qu’en première année de master. Dans un anglais hésitant, j’ai pu lui faire part
de mes aspirations scientifiques, qui ont trouvé ce jour-là les encouragements dont elles
avaient besoin pour prendre vie et forme dans un projet de recherche. Il me semble parfois
qu’elle m’a transmis alors la volonté infaillible qui la caractérise et qu’elle allie si bien à une
gentillesse et une douceur qui m’ont toujours émerveillée. Je me rappelle les lectures avides et
subjuguées de ses travaux, qui m’ont initiée à l’histoire des femmes et du genre dans le
domaine ottoman, et qui continuent à être, pour moi, une source d’inspiration profonde. Sans
elle, cette thèse n’aurait pas eu lieu. Le rôle d’Ethem Eldem fut tout aussi essentiel. J’avais eu
l’occasion de faire sa connaissance à Paris, en 2007, et je me rappelle de l’intérêt et des
encouragements qu’il me témoignât aussitôt. Il a toujours répondu présent à chacun de mes
appels à l’aide, m’accordant un temps qu’il n’avait pas et un soutien qui n’a jamais failli. Je
lui dois la relecture et la vérification de mes translittérations d’un registre de compte du
palais, travail ô combien ingrat, grâce auquel j’ai pu étayer mes analyses. Tous deux ont suivi
de loin, mais sans interruption, les évolutions de mon travail. Ils ont relu des articles, discuté
avec moi, de longues heures durant, divers points de ma thèse et leurs recommandations et
suggestions m’ont toujours été d’une grande utilité. La pertinence de leur analyse et de leurs
conseils m’a permis d’affiner nombre de mes intuitions ou développements.
Il est d’autres personnes que je tiens également particulièrement à remercier pour le
temps qu’ils ont consacré à relire ma thèse, me fournir des conseils et me nourrir de leurs
critiques et avis. Alexandre Toumarkine mérite sans nul doute de figurer au premier rang de
cette énumération. Il a été l’un des amis les plus dévoués et n’a jamais rechigné à toutes les
relectures que je lui ai demandé. Bien plus qu’un relecteur critique, il a aussi été un conseiller,
une oreille attentive, un soutien, en un mot, un ami. Je lui dois plus que je ne saurais le dire en
quelques phrases. Olivier Bouquet compte aussi parmi ces personnes qui m’ont encadrée et
Page | 5
m’ont consacrée du temps et de l’intérêt. La finesse et la rigueur de ses analyses m’ont permis
d’affiner mon travail. Je le remercie beaucoup du temps qu’il a consacré à la relecture d’un
long chapitre, qui s’est étoffé depuis en deux parties. Lui aussi a toujours répondu présent à
mes appels. Mon travail doit également beaucoup aux conseils et suggestions de Benoît
Fliche, qui n’a pas rechigné à relire mes analyses sur le mariage des princesses et grâce à qui
je suis allée puiser chez les anthropologues certaines réponses à mes questions. Les
discussions que j’ai pu avoir avec Tülay Artan ont orienté mon travail sur la philanthropie et
m’ont permis de tester la pertinence de certaines réflexions. Son soutien et son aide ne m’ont
jamais fait défaut. J’en dirais de même de Frédéric Hitzel, dont les conseils avisés et le
soutien, la gentillesse et l’amitié m’ont été très précieux tout au long de ces années. J’aimerais
encore mentionner Işık Tamdoğan, avec laquelle j’ai eu la chance de travailler et qui m’a
beaucoup appris.
Le hasard des trajectoires a permis que je rencontre Romain Bertrand, Dejanirah Couto
et Christian Ingrao. La rencontre avec le premier a été salvatrice : grâce à lui, j’ai pu mettre un
point final à ma démonstration. Il a fourni la pierre d’achoppement à mon ouvrage, libérant
d’un coup les énergies bloquées jusque-là. Avec Dejanirah Couto, il m’a encore initiée à un
univers intellectuel dans lequel j’ai trouvé l’énergie de rebondir et le plaisir de la découverte.
Cette dernière fut, pendant près de trois ans, mon horloge professionnelle : chacun de ses
passages sonnait la résolution d’un mois, rappelant à mon bon souvenir la dure réalité de
l’écoulement du temps. Un anniversaire, un Nouvel An sont souvent l’occasion de faire le
point sur ce qui a été accompli et ce qui reste à faire : Dejanirah fut mon réveillon mensuel :
telle une nouvelle année qui augure d’un futur à découvrir, elle fut, et est, pour moi, cette
promesse d’un voyage intellectuel qui ne cesse de m’impressionner. Quant à Christian, il eut
la tâche ingrate de supporter, soutenir, conseiller une doctorante en fin de thèse, enfouie dans
l’écriture et les corrections, assaillie de doutes sur l’avenir, de questionnements sur elle-même
et le monde professionnel qui l’entoure. La fin de thèse est un passage éprouvant : il a été là
pendant toute cette étape. Les remerciements le mettent mal à l’aise, aussi je n’en dirai pas
plus.
Pour clore cette longue énumération des personnes qui m’ont entourée, choyée, aidée,
soutenue, je voudrais ajouter encore quelques noms : Loubna Lamrhari, Nicolas Elias,
Benjamin Gourisse d’abord, qui, au nom de l’amitié, ont enduré l’épreuve des relectures
multiples, avec un dévouement et une application remarquables ; mais aussi Brian Chauvel,
Yoann Morvan, Julie Zeisser, Dilek Sarmış et Anaïs Lamessa. La thèse m’a donné la chance
de les rencontrer. Ils sont devenus des amis proches, avec lesquels j’ai échangé et partagé tant
d’expériences et d’événements qu’un livre ne suffirait à en venir à bout. Du troisième étage à
la salle de conférence de l’IFEA, puis au Yedinci Kat ou au Sanat, j’ai passé avec eux de
beaux moments, qui ont ponctué ces dernières années. Sans eux, je n’aurais pu surmonter
cette longue épreuve. Sans eux, ce voyage n’aurait pas eu la même saveur. Et que dire de tous
les autres ? La thèse m’a permis de faire la rencontre de bien des personnes qui, chacune à
leur manière, ont compté durant ces années : Yavuz Aykan, Cumhur Bekar, Cédric Bodet,
Ségolène Debarre, Pınar Dost, Güneş Işıksel, Cilia Martin, Elise Massicard, Lisa
Montmayeur, Ilias Petalas, Annie Pralong, Emmanuel Szurek, Aude Aylin de Tapia, Aksel
Page | 6
Tibet, Ümit Sevgi Topuz, mais aussi Öner Ateş, Sıla Çetindağ, Demet Kaya, Dilek Kepez,
Şükrü Özbey, Aynur Topalak…
J’ai encore reçu le soutien de plusieurs institutions, auxquelles vont mes
remerciements : l’EHESS et le CETOBAC – un grand merci à Nathalie Clayer, directrice de
ce centre de recherche, pour avoir bien gentiment accepté, au pied levé, de se charger de
m’accompagner au terme de cette expérience. Merci à l’IFEA et à ses directeurs successifs,
Nora Şeni et Jean-François Pérouse. J’y ai travaillé pendant plus de quatre ans, d’abord
comme chercheuses associée, puis comme boursière. À ce titre, il me faut témoigner de ma
reconnaissance au Ministère des Affaires étrangères, qui m’a accordé un financement d’aide à
la mobilité, ainsi que le TÜBİTAK, qui m’a octroyé une bourse de recherche. La stabilité
offerte par l’IFEA a beaucoup contribué à m’offrir un cadre de travail privilégié, grâce auquel
j’ai pu venir à bout de cette recherche. Plus récemment, l’Orient Institut à Istanbul m’a ouvert
ses portes avec sollicitude et j’en suis fortement reconnaissante à Richard Wittmann. Je
n’oublie pas non plus mes premières années à l’université de Toulouse – Le Mirail et la
sollicitude de mes professeurs, tout particulièrement Benoît Joudiou et Bernard Doumerc.
Dans cette aventure, mon arme secrète fut ma famille. Il n’est rien de plus précieux
que de pouvoir bénéficier du soutien, de la confiance, du réconfort d’un père, d’une mère,
d’un frère et d’un compagnon. Ma thèse a investi l’univers familial, s’imposant comme sujet
de discussion inévitable, au point que les princesses ottomanes sont devenues des convives
régulières des repas de famille. De tous mes remerciements, les plus chaleureux leurs sont
destinés. Ils me connaissent trop bien pour ne pas savoir à quel point leur présence à mes
côtés fut la plus belle et la plus heureuse expérience de ces dernières années.
Mes derniers mots vont aux absents, ceux qui nous ont quittés trop tôt et dont le
souvenir hante les chemins parcourus le long de ce voyage. Et à Misket…
Page | 7
NOTE SUR LA PRONONCIATION DU TURC
e se prononce « è », comme dans « thèse »
ı est une voyelle intermédiaire entre « i » et « é »
ö se prononce « eu », comme dans « peu »
u se prononce « ou », comme dans « loup »
ü se prononce « u » comme dans « tu »
c se prononce « dj » comme dans « djellaba »
ç se prononce « tch » comme dans « tchèque »
g est toujours dur, comme dans « gramme »
ğ ne se prononce pas, se rapproche du « h » français
et prolonge la voyelle qui le précède
h est expiré
s est toujours dur, comme dans « dessus »
ş se prononce « ch » comme dans « château »
y est une consonne, il se prononce comme dans « yoga »
Page | 9
INTRODUCTION
« À quoi doit s’attendre la fille d’un grand prince ? Son sort est
sans contredit le plus malheureux. Esclave en naissant des
préjugés du peuple, elle ne naît que pour se voir assujettie à ce
fatras d’honneurs, à ces étiquettes sans nombre attachées à la
grandeur. […] À la fin, on cherche à l’établir. La voilà
condamnée à abandonner tout, sa famille, son pays, et pour qui ?
Pour un inconnu, pour une personne dont elle ignore le caractère,
la façon de penser, pour une famille qui peut-être ne la verra
qu’avec jalousie, ou du moins prévention. Sacrifice d’un prétendu
bien public, mais plus encore de la politique malheureuse d’un
ministre qui ne sait trouver d’autres voies pour lier deux maisons,
pour former une alliance qu’il annonce indissoluble, et que la
première apparence d’avantage rompt aussi facilement qu’un
engagement pris sans réflexion. Elle part, abandonne ce qui lui est
de plus cher, dans l’incertitude même de plaire à celui auquel on
la destine. Peut-on rien trouver de [plus] dur, si l’on réfléchit
bien, à cette situation ? »1
« Il était une fois, dans un pays lointain, une princesse … » : nous connaissons tous
cette formule annonciatrice de contes ou légendes qui nous ont été racontés ou lus dans notre
enfance. Les princesses dont nous allons parler ici vivent bien « dans un pays lointain », mais
leur histoire n’a rien à voir avec celle d’une Blanche-Neige ou d’une Belle-au-bois-dormant.
Esclaves des étiquettes et des honneurs, elles sont assujetties aux intrigues et machinations
politiques des hommes d’État qui veillent jalousement sur leur honneur, mais n’hésitent pas à
les sacrifier sur l’autel du mariage : tel est le tableau de la condition des princesses brossé par
l’une d’entre elles, Isabelle de Bourbon-Parme ; si elle parle d’expérience personnelle, son
analyse dépeint pourtant très bien la situation de ses consœurs ottomanes. Alors pourquoi
cette entrée en matière ? Parce que le sujet renvoie instinctivement à tout un univers romancé
dont il est bien difficile de se défaire, quand bien même il serait historique. Marie-Antoinette
ou Catherine de Médicis seraient-elles aussi connues sans les intrigues qu’on leur attribue, à
tort ou à raison ? Continueraient-elles à susciter autant de passions sans le brillant et le faste
des cours qu’elles régentèrent ? Femmes et pouvoir sont deux termes qui se vendent bien
parce qu’ils font appel à tout un imaginaire romanesque dont notre culture est imprégnée
depuis la plus tendre enfance et dont l’école, puis les médias, se font le relai.
À ces deux thèmes déjà fort alléchants, nous en ajoutons un autre : celui du harem
impérial. L’orientalisme rejoint ici l’univers romanesque pour créer toutes les conditions d’un
monde mystérieux de femmes toutes plus belles les unes que les autres, asservies aux désirs
concupiscents et libidineux d’un seul homme. Jalousies, intrigues et histoires d’amour cachées
dans un univers clos, dissimulé aux regards extérieurs n’ont cessé de fasciner des lecteurs en
1 Isabelle de Bourbon-Parme, « Je meurs d’amour pour toi… » Lettres à l’archiduchesse Marie-Christine, 1760-
1763, E. Badinter (éd.), Paris, Tallandier, 2008 : 101-102.
Page | 10
mal d’exotisme. Quelques grands noms de la littérature s’y sont même essayés, depuis Racine
avec son Bajazet jusqu’à Théophile Gautier dans La mille et deuxième nuit et même Prévost
avec son Histoire d’une Grecque moderne2. Notre propos est cependant tout autre : laissons la
romance aux écrivains au profit d’une histoire des princesses ottomanes, c’est-à-dire une
histoire de ce qu’être princesse ottomane signifiait, à l’époque moderne.
1. La genèse d’une catégorie sociale atypique
Les princesses ottomanes de l’époque moderne représentent un groupe de plus de 300
filles descendantes des sultans. Ce nombre est à la fois considérable pour l’historien (il est
difficile d'examiner avec la même rigueur autant d'individus), mais faible, si l’on tient compte
du fait que l’étude s’étend sur une période de plus de trois siècles. Les princesses ottomanes,
en tant que catégorie sociale, constituent en effet une minorité d’individus, la crème de l’élite
féminine ottomane, définie par deux critères : l’appartenance (selon des degrés bien définis) à
la dynastie ottomane et le sexe féminin. Quiconque répond à ces critères détient alors un titre
qui reflète les spécificités de ce rang et souligne l’affiliation à la dynastie ottomane.
S’il y a toujours eu des princesses ottomanes, la catégorie sociale n’a pas toujours
existé. Le concept de princesse ottomane est le fruit d’une construction sociopolitique propre
à l’Empire ottoman, qui se profile à partir de la seconde moitié du XVe siècle, période
charnière pour la dynastie ottomane qui, solidement installée à la tête d’un empire, repense
alors ses modes d’affirmation souveraine et procède à une redéfinition de la place et des rôles
de ses membres. Les Ottomans eux-mêmes donnent un nom à cette catégorie, les sultânân,
terme générique qui englobe tout à la fois les filles et les petites-filles de sultan, et jusqu’à
certaines arrière-petites-filles. Une fois établie, cette catégorie sociale a la vie longue : elle
résiste aux effets du temps et aux évènements qui secouent l’Empire ottoman tout au long des
siècles, sans subir d’altérations profondes. Son existence est liée au destin de la dynastie
ottomane : les princesses (en tant que catégorie sociale) disparaissent avec l’abolition du
sultanat en 1923.
Notre étude ne va cependant pas aussi loin : elle s’arrête dans le milieu du XVIIIe
siècle, avec les filles d’Ahmed III (1703-30). Deux raisons ont motivé le choix de cette césure
chronologique. Le souci de conserver une certaine unité dans l’étude de l’organisation
sociopolitique ottomane ; or, la seconde moitié du XVIIIe siècle se caractérise par
l’émergence d’un mouvement d’occidentalisation et de modernisation de l’État, prémisses des
réformes qui seront engagées au siècle suivant, dont l’étude nous aurait entraînée sur un
terrain fort différent de celui poursuivi jusque-là. Le fait est que la période allant du mi-XVe
au mi-XVIIIe siècle dispose d’une cohérence propre, qui voit l’organisation palatiale féminine
s’organiser progressivement. La dynamique d’institutionnalisation de la hiérarchie palatiale et
2 Olga Augustinos, « Eastern Concubines, Western Mistresses: Prévost’s Histoire d’une Grecque moderne »,
dans Women in the Ottoman Balkans. Gender, Culture and History, A. Buturovic et I. C. Schick (éds.), Londres / New York, I.B. Tauris, 2007 : 11-44.
Page | 11
dynastique féminine ne se stabilise qu’à partir de la fin du XVIIe et au début du XVIII
e siècle.
Le choix de l’intervalle chronologique est donc motivé par la volonté de comprendre cette
construction dans son ensemble.
Les princesses ottomanes constituent une catégorie sociale fort atypique sous divers
aspects, qui dérivent principalement de cette spécificité de genre : pour être sultânân, il faut
être femme. C’est, à notre connaissance, l’un des rares cas de catégorie sociale réservée à un
sexe et, qui plus est, au beau sexe. Or le fait d’être constituée exclusivement de femmes
suscite auprès de ses membres un problème de définition identitaire. Les princesses ottomanes
disposent à la fois d’une identité de naissance, indélébile, et d’une identité d’acquisition, dans
laquelle elles se meuvent et ancrent leur postérité. Il en résulte un conflit identitaire qui ne
trouvera jamais à se résoudre et qui imposa ses marques aux pratiques politiques et sociales de
ces femmes.
2. La place des princesses dans la construction dynastique ottomane
Ce travail sur les princesses ottomanes s’inscrit dans la continuité d’une recherche sur
la dynastie ottomane qui n’a cessé de susciter de nouvelles considérations. Cette recherche a
suivi des directions différentes selon les générations et les écoles. La question des origines et
fondements idéologiques de la dynastie a longtemps entretenu un âpre débat entre tenants
d’une origine centre-asiatique et défenseurs des influences des modèles impériaux byzantines
ou arabo-musulmans. Les derniers travaux semblent conclure en faveur d’un héritage mixte
reposant sur la construction d’un discours adapté aux publics et au contexte événementiel3. La
transformation de l’État ottoman en empire suscita également de nombreux travaux, tant dans
le domaine de l’élaboration de la nouvelle idéologie impériale et universaliste que dans les
procédés politiques, militaires, judiciaires et bureaucratiques qui ont vu le jour4. Enfin, les
questions de définition et de transmission de la souveraineté ottomane ont également occupé
3 Voir notamment Herbert A. Gibbons, The Foundation of the Ottoman Empire, Oxford, Oxford University Press,
1916 ; Colin Imber, « Paul Wittek’s ‘De la défaite d’Ankara à la prise de Constantinople’ », Osmanlı Araştırmaları 5 (1986) : 65-81 et The Ottoman Empire 1300-1481, Istanbul, Isis, 1990 ; Cemal Kafadar, Between Two Worlds. The Construction of the Ottoman State, Berkeley / Los Angeles / Londres, University of California Press, 1995 ; Mehmet F. Köprülü, Les Origines de l’Empire ottoman, Paris, Éditions de Boccard, 1935 ; Heath W. Lowry, The Nature of the Early Ottoman State, Albany, State University of New York Press, 2003 ; Paul Wittek, « De la défaite d’Ankara à la prise de Constantinople », Revue des Études Islamiques 12 (1938) : 1-34 et The Rise of the Ottoman Empire, Londres, The Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, 1938 ; Elizabeth A. Zachariadou, The Ottoman Emirate, 1300-1389, Rethymnon, Crète University Press, 1993 ; Halil İnalcık, « The Ottoman Concept of State and the Class System », dans The Ottoman Empire. The Classical Age, 1300-1600, Londres, Phoenix, 1974 : 65-69 et « The Question of the Emergence of the Ottoman State », International Journal of Turkish Studies II (1980) : 71-79. 4 La littérature existante sur le sujet est bien trop vaste pour être citée dans une note de bas de page ; on
trouvera en bibliographie les travaux qui ont servi dans le cadre de cette étude.
Page | 12
les esprits : l’instauration de la fameuse loi du fratricide puis son abandon au cours du XVIIe
siècle, remplacée par la pratique du kafes, fut l’un des terrains de cette recherche5.
S’il est une critique que l’on peut formuler à l’encontre de ces travaux, c’est leur
désintérêt pour une partie des personnages de cette histoire dynastique : les femmes. Il est vrai
que, très tôt, il a été établi que les femmes n’avaient pas droit à l’exercice de la souveraineté
ottomane et que les agents actifs de la dynastie étaient les hommes – tant les souverains que
les princes de sang ottomans. En cela, ils reproduisent une conception de la répartition des
rôles des femmes prônée par les Ottomans eux-mêmes dans leurs écrits, sans tenir compte de
leur valeur discursive et politisée. Or, depuis plusieurs décennies, les travaux sur les femmes
et le pouvoir en Europe ont souligné l’intérêt de reconsidérer les opinions des penseurs
modernes à l’aune de la méthodologie critique historique. Les proclamations affirmant
l’exclusion des femmes de l’exercice politique, et notamment de l’exercice souverain, doivent
être traitées pour ce qu’elles sont : des discours qui reflètent la position de certains et non une
vérité historique. En France, l’exclusion des femmes de la souveraineté, prônée par la loi
salique, est le fruit d’une construction politique et législative qui suscita de nombreuses
réactions – et qui ne concerne que la France, les autres dynasties européennes s’étant
abstenues de faire appliquer une telle loi. Elle n’empêcha pas certaines femmes d’exercer une
forme de souveraineté contrôlée, en la personne des reines et tout particulièrement des
régentes de France6.
Dans ce domaine, les études ottomanes sont moins avancées que celles sur les cours
européennes. Le travail de Leslie Peirce s’inscrit néanmoins dans la continuité de ces
réflexions. Dans The Imperial Harem, elle scrute la place des femmes, et notamment des
concubines et reines mères des sultans, dans la construction dynastique ottomane de l’époque
moderne7. Nous avons fait grand cas de ce travail et de ses résultats, qui fut le point de départ
5 Sur ces questions, voir notamment Mehmet Akman, Osmanlı Devletinde Kardeş Katli, Istanbul, Eren, 1998 ; A.
D. Alderson, The Structure of the Ottoman Dynasty, Oxford, Clarendon Press, 1956 ; Mouradja d’Ohsson, Tableau général de l’empire othoman, Istanbul, Isis, 2001 ; Feridun M. Emecen, Osmanlı Klasik Çağında Hanedan, Devlet ve Toplum, Istanbul, Timaş, 2011 ; Haldun Eroğlu, Osmanlı Devletinde Şehzadelik Kurumu, Ankara, Akçağ Yayınları, 2004 ; Zeynep T. Ertuğ, XVI. Yüzyıl Osmanlı Devletinde Cülûs ve Cenâze Törenleri, Ankara, T.C. Kültür Bakanlığı, 1999 ; Halil İnalcık, « The Manner of Accession to the Throne », dans The Ottoman Empire. The Classical Age, 1300-1600, Londres, Phoenix, 1974 : 59-64 et « The Ottoman Succession and Its Relation to the Turkish Concept of Sovereignty », dans The Middle East and the Balkans under the Ottoman Empire. Essays on Economy and Society, Bloomington, Indiana University, 1993 : 37-69 ; Dimitri J. Kastritsis, The Sons of Bayezid. Empire Building and Representation in the Ottoman Civil War of 1402-1413, Leiden / Boston, Brill, 2009 ; Nikos Sigalas, « Devlet et Etat : du glissement sémantique d’un ancien concept du pouvoir au début du XVIIIe siècle », dans Byzantina et Moderna. Mélanges en l’honneur d’Hellène Antoniadès-Bibicou, G. Grivaud et S. Petmezas (éds.), Athènes, Editions Alexandria, 2007 : 385-415 ; Şerafettin Turan, Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Taht Kavgaları, Istanbul, Kapı Yayınları, 2011 ; Nicolas Vatin et Gilles Veinstein, Le sérail ébranlé. Essai sur les morts, dépositions et avènements des sultans ottomans, XIVe – XIXe siècle, Paris, Fayard, 2003 et Nicolas Vatin, « Loi ou fatalité ? À propos du fratricide dans la dynastie ottomane », dans Mélanges en l’honneur du Professeur Halil Inalcık, en cours de publication. 6 Sur ce sujet, voir tout particulièrement Fanny Cosandey, La reine de France, Paris, Gallimard, 2000 ainsi que
« Puissance maternelle et pouvoir politique : la régence des reines mères », Clio 21 (2005) : 63-83 et « De la loi salique à la régence, le parcours singulier du pouvoir des reines », dans In assenza del re. le reggenti dal XIV al XVII secolo (piemonte ed. europa), F. Varallo (éd.), Florence, Olschki, 2008 : 183-197. 7 Leslie P. Peirce, The Imperial Harem, Women and Sovereignty in the Ottoman Empire, New York, Oxford
University Press, 1993.
Page | 13
de notre propre réflexion : la présente étude sur les princesses ottomanes s’offre comme une
poursuite des investigations menées par cette historienne sur les femmes du harem : cette
dernière s’étant concentrée sur le personnage des concubines, elle n’accorde qu’une attention
limitée aux descendantes des sultans.
Il n’est pas question de prétendre que le travail de Peirce fut le premier à discuter des
femmes royales ottomanes : il existe des travaux antérieurs dont elle fait grand usage – et
nous de même. Citons tout particulièrement les études de Çağatay Uluçay, auteur de plusieurs
livres sur le sujet, d’Alderson, auteur d’un ouvrage sur la structure de la dynastie ottomane, ou
encore d’Ahmet Refik Altınay, à qui nous devons l’invention du terme de « sultanat des
femmes », titre de son livre8. Alderson accorde une place importante aux femmes, et
notamment au système matrimonial de la dynastie ottomane, mais outre qu’il est fort
parcimonieux concernant ses sources, il demeure très incomplet et très généraliste. Altınay
propose de son côté une lecture orientée de la place des femmes dans la dynastie et de leur
“ingérence” dans les affaires gouvernementales, mais il n’est ni systématique, ni objectif.
Uluçay contribua à renouveler la manière d’aborder la question, tant par sa volonté d’étudier
le système du harem que par son travail de collecte systématique, mais non exhaustif,
d’informations. Il a posé des bases incontournables pour des travaux ultérieurs. Il manque
néanmoins à ses travaux une réflexion d’ensemble et ses conclusions, rarement erronées,
demeurent très factuelles.
D’autres travaux discutent occasionnellement des femmes du harem impérial, tel celui
de Mouradgea d’Ohsson ou d’İsmail Hakkı Uzunçarşılı : avec plus d’un siècle d’écart, tous
deux étudièrent, de façon plus ou moins poussée, la structure de la dynastie et du Palais
impérial, mais la place et l’intérêt qu’ils accordent aux princesses sont fort restreints –
quelques pages, tout au plus, dans chacun de ces ouvrages9. Par ailleurs, tous deux présentent
le même défaut de généralisation à partir d’exemples particuliers datant généralement du
XVIIIe siècle, ce qui laisse croire en un système parfaitement stable quand, au contraire, il se
construisit progressivement. Nous ne citerons pas ici des ouvrages plus récents, produits par
l’historiographie turque contemporaine, qui se contentent de reprendre, quitte à les copier mot
à mot, les travaux en question. Distinguons néanmoins le travail de Necdet Sakaoğlu qui, tout
en reprenant la forme d’un des livres d’Uluçay, propose une synthèse récente et bien
documentée des biographies des femmes royales10
. Le parti-pris biographique de l’auteur
interdit néanmoins toute réflexion structurelle ou approche sociologisante. Enfin, le travail sur
les femmes et le genre dans la société ottomane est en plein essor et a produit de fort belles
études, mais rarement sur les femmes royales : le rôle des femmes dans la philanthropie, les
8 Ahmet R. Altınay, Kadınlar Saltanatı, Istanbul, Tarih Vakfı, 2005 ; Alderson, The Structure of the Ottoman
Dynasty. Pour Uluçay, voir notamment Çağatay M. Uluçay, Padişahların kadınları ve kızları, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1992 et Harem II, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 2001. 9 d’Ohsson, Tableau général de l’empire othoman ; İsmail H. Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin Saray Teşkilâtı,
Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1988. 10
Necdet Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları. Vâlide Sultanlar, Hâtunlar, Hasekiler, Kadınefendiler, Sultanefendiler, Istanbul, Oğlak Yayıncılık, 2009.
Page | 14
structures familiales et les cadres matrimoniaux sont les principaux axes de recherche de ces
travaux11
.
L’étude sur les princesses ottomanes s’inscrit donc dans une historiographie
déséquilibrée entre une multiplicité de travaux et de réflexions très poussées concernant la
construction dynastique ottomane dans sa composante masculine, mais limitée à quelques
études – fort utiles, il est vrai – pour la partie féminine. Ce déséquilibre, qu’il n’était pas en
notre pouvoir de réduire, se retrouve dans le présent travail. En l’état, il offre une réflexion
complémentaire à celles proposées par Peirce et s’inscrit en faveur d’une plus grande
considération des femmes royales dans la compréhension de la longue et complexe
élaboration de la dynastie ottomane. Il s’attache notamment à montrer de quelle manière la
dynastie utilisa à son profit des femmes qui, tout en lui étant attachées, s’intégraient à
l’univers cosmopolite et complexe de l’élite gouvernante ottomane. La dualité des liens des
princesses ottomanes, à cheval entre l’univers palatial et celui de l’élite, permit leur
instrumentalisation selon des logiques dynastiques souterraines que l’étude sur le long terme
permet de faire ressortir.
3. Des modèles pour interroger les procédés politiques des sociétés de cour à
l’époque moderne
Dans les études ottomanes, les femmes ont longtemps été disqualifiées comme actrices
politiques en raison de leur incapacité à détenir un office étatique et de la séparation des
sphères masculines et féminines, qui prône la réclusion des femmes au sein de l’espace (et des
activités) domestique(s) : l’univers public et politique serait ainsi réservé aux hommes. C’est
là une vision caricaturale de la société ottomane qui pêche par la croyance dans le fait que le
pouvoir ou l’action politique ne se définiraient que par la détention d’un office. Dans une
société monarchique de type absolutiste où le souverain est, in fine, l’ultime décideur dans
tous les domaines du pouvoir et de l’action politique et le grand dispensateur de tous les
offices et privilèges (un état symbolisé par l’octroi de brevets de nominations officialisés par
le sceau impérial), la proximité avec la personne royale est, en soi, un pouvoir : pouvoir
d’influence sur les décisions gouvernementales, sur les nominations et jusque sur les
attributions financières. Ce système se répercute aux échelons inférieurs : le contact avec les
principaux officiers de l’État, auxquels est délégué l’exercice du pouvoir au quotidien,
indique également un pouvoir politique. Il faut donc penser le pouvoir et l’action politique en
termes de réseaux d’influence et non seulement de détention d’offices. Pour se maintenir à un
poste élevé, un grand dignitaire devait non seulement faire montre de ses compétences
professionnelles, mais aussi disposer de contacts suffisamment puissants pour lui assurer
sinon une promotion, du moins le maintien au rang auquel il est parvenu : la compétence ne
11
Nous proposons, en bibliographie, une liste non exhaustive des principaux travaux réalisés dans ce domaine au cours de ces dernières décennies.
Page | 15
suffisait pas ou, plus précisément, la compétence se distinguait également par la capacité d’un
individu à construire et s’entourer d’un réseau d’alliés ou de clients.
Ce système n’est pas propre à la société ottomane ; c’est une réalité politique très
largement répandue à l’époque moderne qui se retrouve, entre autres, dans les cours
européennes. Or, pour créer du réseau et s’assurer l’accès aux personnes les plus puissantes,
notamment la personne impériale, tous les moyens sont bons, à commencer par les femmes et
les parents. Magdalena Sanchez a ainsi fourni une belle étude de cette situation à la cour de
Philippe III d’Espagne. Elle montre notamment les oppositions et conflits, mais également les
passerelles qui existaient entre les femmes de l’entourage du souverain, à la tête d’un propre
réseau d’influence, et le favori impérial, le duc de Lerma, qui cherchait à contrôler au
maximum les individus ayant accès au souverain afin de conserver intact son monopole
d’influence et d’action politique12
. Dans le contexte troublé et sanglant de la France des
guerres de religion, Denis Crouzet a également montré de quelle manière la régente Catherine
de Médicis tenta d’user de ses propres réseaux, mais aussi des oppositions et rivalités entre les
factions à la cour des Valois, pour promouvoir une politique religieuse conciliatrice (qui fut
un échec) et imposer le principe d’une royauté au-dessus des factions13
. Quelle que soit la
cour étudiée, les femmes jouaient un rôle aussi important que les hommes dans la constitution
de structures politiques fondées sur le principe du clientélisme.
La société ottomane serait-elle différente en raison de la séparation des sphères
masculines et féminines ? Une telle distinction spatiale fondée sur des critères de genre n’est
pas propre à la société ottomane (et, plus largement, musulmane) : les femmes à la cour
d’Espagne étaient confrontées à des obligations de réclusion fort similaires – ce qui ne les
empêcha pas d’exercer du pouvoir14
. Car au fond, le problème qui se pose est celui des
contacts entre les mondes : non seulement entre les mondes masculins et féminins, par l’usage
d’intermédiaires, mais aussi les mondes privés et publics des souverains. Ici, le parallèle entre
la cour d’Espagne et celle d’Istanbul vient fort à propos : contrairement à un Louis XIV qui
usa de sa vie privée comme d’un instrument pour enchaîner la noblesse et les courtisans, les
empereurs espagnols et ottomans, chacun de leur côté de la Méditerranée, s’inscrivirent dans
une pratique de réclusion progressive de la personne royale. Dès la seconde moitié du XVIe
siècle, les farouches guerriers très largement nomades qu’étaient les premiers souverains
ottomans laissèrent leur place à des sultans sédentaires, de plus en plus dissimulés derrière les
portes de leur Palais et, au sein même de ce palais, dans des espaces d’accès restreint, réservés
à la personne impériale15
. Or, plus l’accès au souverain était restreint, plus l’usage
d’intermédiaires était nécessaire.
12
Magdalena Sanchez, The Empress, The Queen, and The Nun. Women and Power at the Court of Philipp III of Spain, Londres / Baltimore, The John Hopkins University Press, 1998. 13
Denis Crouzet, Le haut cœur de Catherine de Médicis. Une raison politique aux temps de la Saint-Barthélemy, Paris, Albin Michel, 2005. 14
Sanchez, The Empress, The Queen, and The Nun : 11-35. 15
Gülrü Necipoğlu, Architecture, Ceremonial and Power: the Topkapı Palace in the Fifteenth and Sixteenth Centuries, New York, The Architectural History Foundation Books, 1991. Il faut néanmoins tempérer cette idée de réclusion intempestive des sultans qui n’est que partiellement ou périodiquement exacte : cf. Rhoads
Page | 16
Les princesses ottomanes interviennent ici pour montrer toute l’importance de leur
position : elles comptent parmi les seules personnes capables d’accéder librement, sous
couvert des relations de parenté, à la personne du souverain ; elles comptent encore parmi les
seuls individus aptes à faire le lien entre le monde fermé, mais puissant du harem impérial et
l’univers complexe et empreint de rivalités de l’élite dirigeante masculine de cet Empire. La
grande force politique des princesses ottomanes réside dans leurs liens familiaux, qui les
mettent en contact avec la majorité des acteurs du pouvoir ottoman. L’étude du rôle politique
des princesses ottomanes apparaît dès lors comme un cas exemplaire pour comprendre et
dénouer les fils du fonctionnement des réseaux d’influence à la cour ottomane à l’époque
classique. Leur cas nous apprend non seulement les rouages du système, mais aussi les
spécificités et les limites du pouvoir politique féminin qui ne peut s’absoudre des limites
fixées par le cadre familial.
4. Des modèles pour étudier les procédés de production et de reproduction des
élites ottomanes à l’époque classique
La puissance des princesses résidait dans leurs liens familiaux, mais ces liens
familiaux étaient aussi le principal cadre d’intervention de ces femmes : la famille est à la fois
le moyen et la fin des actions politiques de ces femmes. Car on attendait bien de ces femmes
une certaine forme d’action, mais qui devait se restreindre à la promotion des intérêts
familiaux. Le principal souci des princesses ottomanes réside dans la conservation du
patrimoine politique familial. Nous sommes en présence de femmes installées au sommet de
la hiérarchie sociale ottomane féminine et mariées à des hommes de même stature. Le rôle des
princesses est d’assurer à leur conjoint une position confortable (c’est-à-dire favoriser leur
promotion professionnelle si et quand c’est nécessaire) et de protéger leurs arrières, car, tout
puissants qu’ils étaient, aucun d’entre eux n’était à l’abri d’un renversement des pouvoirs.
Le deuxième volet d’action des princesses dans le champ politique est du même ordre,
mais concerne cette fois leur descendance. Dans un système qui ne reconnaît pas l’hérédité
des charges, l’enjeu était de taille. Il leur revenait (pour partie) d’assurer le maintien social de
leur descendance sur plusieurs générations, ce qui nécessitait d’élaborer des stratégies de
reproduction du groupe fort complexes. La formation était un champ de bataille fondamental :
il fallait assurer à leurs descendants l’accès aux principales filières d’éducation et de
formation. Hormis certaines familles, la réussite des princesses dans le domaine de la
reproduction familiale n’est pas évidente : elles surent donner à leur descendance les moyens
d’un maintien dans les rangs de l’élite, mais l’insertion dans les milieux politiques les plus
puissants demeure occasionnelle.
Les princesses ottomanes s’intéressent encore à la promotion des membres de leur
entourage, qui se répartissent en deux catégories : les serviteurs et les clients. Les procédés
Murphey, Exploring Ottoman Sovereignty. Tradition, Image and Practice in the Ottoman Imperial Household 1400-1800, Londres, Continuum, 2008.
Page | 17
sont relativement similaires dans les deux cas : fort de leurs connexions avec une princesse,
certains bénéficient d’un réel patronage royal ; d’autres se voient gratifiés d’aides financières
ou d’offices rétribués de moindre importance. L’affiliation au réseau d’une princesse n’est
d’ailleurs pas nécessairement incompatible avec des connexions du même genre auprès
d’autres individus. Les réseaux d’influence et les factions sont rarement délimités de façon
aussi stricte que la reconstruction historique le laisse entendre et les individus, au sein même
d’un réseau ou d’une faction, sont bien souvent beaucoup plus indépendants et autonomes
qu’il n’y paraît : leur “allégeance” à un individu ou un groupe est rarement exclusive16
. Tous
ces individus affiliés plus ou moins solidement au réseau des princesses contribuent à
renforcer leur propre position politique et affirmer leur position sociale.
L’étude de la reproduction des élites ne se limite pas à l’éducation et à l’accaparement
des offices : elle implique également de s’interroger sur la capacité d’une transmission
mémorielle du sentiment d’appartenance à l’élite. La commémoration lignagère en est l’un
des instruments17
. Dans ce domaine, les princesses surent exploiter les moyens à leur
disposition et notamment faire un usage extensif de l’institution du vakf. La création de
fondations pieuses favorisa l’élaboration d’un discours sur soi et sur la qualité du lignage issu
des princesses, tout en renforçant la cohésion familiale grâce à la création d’espaces lignagers
à l’usage et à la gloire des familles princières. Les vakf favorisèrent l’élaboration d’une
conception lignagère des familles princières qui s’épanouirent de façon distincte les unes des
autres : le patrimoine symbolique s’imbriquait ainsi dans les interstices du patrimoine
immobilier de ces lignages.
5. Les balbutiements d’une recherche
Dans son Apologie pour l’histoire, Marc Bloch préconisait aux historiens d’inclure
dans leurs travaux un chapitre portant ce titre : « Comment puis-je savoir ce que je vais vous
dire ? »18
L’introspection qu’il appelait ainsi de ses vœux se présente comme une nécessité
scientifique : en retraçant le chemin tortueux qui aboutit à l’élaboration finale du travail, elle
permet d’en percevoir toute la portée, y compris et surtout ses limites. Loin de produire une
image authentique du passé sur lequel il travaille, l’historien appréhende son objet selon une
tournure influencée par ses propres interrogations. Il ne traite pas d’un sujet au hasard et sa
16
Dans son étude sur la cour de Philippe III d’Espagne et le rôle politique des femmes royales, Madgalena Sanchez rappelle et illustre la complexité et la liberté des individus qui gravitent autour des chefs de réseau : Sanchez, The Empress, The Queen and the Nun : 36-60. 17
Les études sur les familles nobles d’Europe accordent une place importante à cette commémoration du lignage. Voir notamment Christiane Klapisch-Zuber, La maison et le nom. Stratégies et rituels dans l’Italie de la Renaissance, Paris, Editions de l’EHESS, 1990 ; Jean-Louis Flandrin, Familles. Parenté, maison, sexualité dans l’ancienne société, Paris, Éditions du Seuil, 1984 ; Michel Nassiet, Parenté, noblesse et États dynastiques, XVe – XVIe siècle, Paris, Éditions de l’EHESS, 2000 ; 18
Il insiste encore sur le fait qu’une telle suite de paragraphes, loin d’ennuyer un lecteur même extérieur au métier, lui procurerait au contraire un certain plaisir intellectuel car « [l]e spectacle de la recherche, avec ses succès et ses travers, est rarement ennuyeux. C’est le tout fait qui répand la glace et l’ennui. » : Marc Bloch, Apologie pour l’histoire ou Métier d’historien, Paris, Armand Colin, 2011 : 82.
Page | 18
manière d'interroger la documentation est elle-même dépendante du cadre de l’objet retenu.
Cette réalité est peut-être encore plus prégnante dans le cadre d’une thèse : ne nous martèle-t-
on pas, tout au long de cet éprouvant exercice, qu’il ne s’agit que d’une recherche concise et
restreinte et non de l’œuvre d’une vie ? Les illusions de la jeunesse tombent vite sous le coup
des années et on se retrouve rapidement contraint à abandonner nombre de pistes
intéressantes, mais qui nous écarteraient du sujet initial, nombre d’aspects passionnants, mais
impossibles à traiter dans le cadre imparti. À cela s’ajoute encore la spécialisation accrue de la
recherche en sciences sociales qui interdit à l’individu isolé de réunir l’ensemble des
connaissances en sa seule personne, dût-il y consacrer l’intégralité de sa vie – a fortiori,
lorsqu’il s’agit d’un apprenti. Des choix doivent donc encore être faits dans l’emploi des
concepts, dans le choix des travaux de références. Une thèse est une succession d’abandons
qu’il convient de mettre en lumière.
Ce travail prend naissance il y a plusieurs années de cela, dans le cadre de mémoires
de Master. Le système prévoyait encore la rédaction d’un mémoire à la fin de chacune des
deux années nécessaires pour l’obtention du diplôme. Le premier devait permettre une
approche générale d’un sujet ; ce fut l’influence politique des femmes à la cour ottomane aux
XVe-XVII
e siècles (sous la direction de Benoît Joudiou). À l’issue de cette année, il
apparaissait que le travail exemplaire mené par Leslie Peirce interdisait la poursuite d’une
recherche sur l’ensemble des femmes royales ottomanes de l’époque classique, sauf à orienter
la question sur des aspects très précis ou sur un personnage en particulier. Malgré l’attrait de
l’exercice biographique, l’étude d’un type de personnage retint plus notre attention. Or, les
recherches antérieures n’accordaient qu’une place minime aux descendantes des sultans
(filles, petites-filles, arrières petites-filles), les princesses. Le second mémoire de Master (sous
la direction de Gilles Veinstein) devait permettre d’élaborer une première réflexion sur le
sujet choisi et d’esquisser un corpus. À travers deux thématiques concises, les mariages et les
décès des princesses ottomanes (mi-XVe – mi-XVIII
e siècle), il s’agissait de fournir une
première définition du terme de princesse ottomane.
Ces deux années préparatoires avaient fait apparaître la complexité et l’ambivalence de
la position des princesses ottomanes, personnes royales associées de façon épisodique à la
dynastie selon un lien précaire qui leur interdisait toute participation à la souveraineté, et
jusqu’à sa transmission même. Or, la position des descendantes indirectes révélait des
incohérences par rapport au système patrilinéaire proclamé par la dynastie. À ce stade, nous
n’étions pas parvenue à descendre plus loin que la seconde génération – et la thèse n’a fourni
que de bien maigres résultats pour les générations suivantes. De même, si l’historiographie
traditionnelle niait très largement le rôle des princesses dans la politique, des attestations
égrenées au fil des sources consultées suggéraient une situation beaucoup plus complexe.
Leur rôle était-il officiel ou officieux, leur action directe ou de l’ordre de l’influence, et selon
quels réseaux ? À la sortir du Master, les questions étaient plus nombreuses que les réponses
et invitaient à de plus amples recherches.
Parvenue au seuil de la thèse, un vaste programme de recherche s’ouvrait à l’horizon,
mais laissait irrésolu le problème des sources. L’existence d’un corpus bien précis traitant de
ces femmes et de leur rôle n’était pas certaine et paraissait même douteuse – la suite a prouvé
Page | 19
la véracité des doutes sur le sujet. La recherche s’orientait donc moins vers une étude de la
manière dont ces femmes étaient considérées, mais plutôt d’une reconstitution par un récit
historique de ce que les informations contenues dans la documentation permettaient de
déduire de leur position et de leur rôle. Par ailleurs, l’intervalle chronologique fut étendu
jusqu’à la première moitié du XVIIIe siècle, afin de pouvoir suivre les évolutions du début du
XVIIe siècle jusqu’à leur stabilisation. De même, un regard poussé sur les périodes antérieures
du XIVe et début du XV
e siècle fut intégré. De cette manière, l’étude permettait de brosser un
tableau complet des princesses ottomanes durant toute la période moderne. Enfin, quatre
grandes thématiques furent retenues : les statuts, les stratégies matrimoniales, les rôles
politique et philanthropique. Bien des choses ont évolué au cours des recherches et de la
rédaction, mais le cadre chronologique et les thématiques générales n’ont pas bougé. Le choix
des quatre problématiques susdites a infléchi la réflexion vers une étude sociopolitique qui se
résume à la question suivante : quels étaient la place et le rôle des princesses, en tant que
catégorie sociale spécifique, au sein de la société ottomane ?
6. Dépouillement des sources et construction de l’objet
« Dans notre véritable subordination envers le passé, nous nous sommes donc
affranchis du moins en ceci que, condamnés toujours à le connaître exclusivement par ses
traces, nous parvenons toutefois à en savoir sur lui beaucoup plus long qu’il n’avait lui-même
cru bon de nous faire connaître. C’est, à bien le prendre, une grande revanche de l’intelligence
sur le donné »19
: cette revanche revendiquée par Marc Bloch est néanmoins tempérée par la
nécessité de disposer d’un matériel historique adéquat à sa réalisation ; or, ce dernier rappelait
que « l’illusion serait grande d’imaginer qu’à chaque problème historique réponde un type
unique de documents, spécialisé dans cet emploi. Plus la recherche, au contraire, s’efforce
d’atteindre les faits profonds, moins il lui est permis d’espérer la lumière autrement que des
rayons convergents de témoignages très divers dans leur nature »20
. Son avertissement nous
semble destiné, car tel est bien la situation à laquelle nous fûmes confrontée : après d’intenses
recherches, il apparût que la lumière qui devait éclairer notre sujet n’était pas discernable dans
un corpus : il ne nous restait plus qu’à faire appel à des attestations convergentes pour espérer
obtenir cet éclairage.
Les Ottomans n’ont pas eu la bonté de laisser derrière eux quelques traités bien
tournés concernant la place et le rôle des princesses ottomanes dans leur société. Pourtant, ces
femmes ne sont pas tout à fait inexistantes dans la documentation consultée : à nous d’en
reconstituer les images éparses de manière à permettre une lecture compréhensive. Le défi
n’était pas sans difficultés car les sources disponibles ne présentaient aucune harmonie de
forme ou de fonds, ni même de valeur historique. Nous avions recensé, au départ, huit types
de sources potentiellement utiles : les chroniques, les actes de fondation pieuse (vakfiyye), les
registres de compte (muhasebe defterleri), les stèles funéraires, les ouvrages biographiques,
19
Bloch, Apologie pour l’histoire : 76-77. 20
Bloch, Apologie pour l’histoire : 79.
Page | 20
les récits de voyageurs, les lettres et les firmans de donations foncières. Nous ne pûmes
exploiter les deux derniers en raison de la fermeture des archives du Palais de Topkapı (où
était entreposé l’essentiel des lettres et firmans) pour cause d’inventaire, peu après notre
inscription en thèse21
.
Les chroniques furent les premières sources vers lesquelles nous tournâmes nos
regards et leur consultation s’étendit sur plusieurs années tant elles sont nombreuses. Et
encore sommes-nous loin d’avoir tout consulté. Un vaste mouvement d’édition des
principales chroniques en version originale et/ou en caractères latins a vu le jour depuis
plusieurs années, ce qui a considérablement simplifié le travail des historiens amenés à
exploiter cette documentation – mais a rendu obligatoire, par là même, la confrontation des
récits entre eux. De sorte que nous avons privilégié les chroniques publiées, postulant que le
nombre compenserait la faiblesse des annotations. Cette spéculation s’avéra partiellement
fondée, dans le sens où effectivement, au fur et à mesure des consultations systématiques de
ces histoires, les attestations augmentaient, mais cette accumulation n’était pas
nécessairement fructueuse. Les chroniques se complètent et se répètent entre elles,
reproduisant les mêmes données, de sorte que la multiplication des observations relatives aux
princesses n’était pas forcément synonyme d’apport nouveau.
Certaines chroniques se sont rapidement révélées plus précieuses que d’autres dont
nous avons privilégié l’usage. Ainsi notamment celle de Selânikî, qui fournit des
renseignements introuvables ailleurs et d’une précision indéniable22
, ou encore celle de
Na'îmâ, qui se veut une compilation raisonnée des histoires antérieures : tant par la durée que
par le souci d’exactitude qu’il apporte à son travail, son récit s’est révélé extrêmement utile23
.
Il faudrait encore en dire de même de l’histoire compilée par Raşid24
. Mais de façon générale,
le principal inconvénient de cette documentation réside dans un désintérêt assez marqué pour
les princesses ottomanes. Ces chroniques sont des récits de règne destinés à proposer une
histoire édifiante des événements survenus sous les règnes des sultans ottomans. Elles ne
prétendent pas à l’exhaustivité, encore moins à l’objectivité de leurs propos, de sorte que c’est
avec de multiples précautions et armé d’un solide esprit critique qu’il faut aborder leur
contenu25
. Quand elles mentionnent les princesses ottomanes, c’est presque par accident, pour
illustrer un événement survenu par ailleurs, ou dans un esprit critique.
21
À quelques mois de terminer ce travail, nous avons appris la réouverture de ces archives, versées au fond déjà existant des Archives du Conseil de la présidence (Başbakanlık Arşivleri). Ne voulant pas opter pour une prolongation de la thèse, il nous fallut faire le deuil de cette documentation, que le personnel des archives suscitées est en train de cataloguer et scanner avant d’en permettre l’accès. Certains fichiers sont néanmoins déjà accessibles. 22
Selânikî Mustafa Efendi, Târih-i Selânikî, 2 tomes, M. İpşirli (éd.), Istanbul, Edebiyat Fakültesi Basımevi, 1989. 23
Mehmet İpşirli (éd.), Târîh-i Na’îmâ, 4 tomes, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 2007. 24
Râşid, Râşid Târîhi, 6 volumes répartis en 3 tomes, Istanbul, 1865. 25
Pour des réflexions sur ces sources, voir notamment les travaux qui suivent : Virginie Aksan, « Ottoman
Political Writing, 1768-1808 », International Journal of Middle East Studies 25/1 (février 1993) : 53-69 ; Esin Atil,
« The Story of an Eighteenth-Century Ottoman Festival », Muqarnas 10 (1993) : 181-200 et Levni and the
Surnâme: The Story of an Eighteenth-Century Ottoman Festival, Istanbul, Koçbank, 1999 ; Cornell H. Fleischer,
Bureaucrat and Intellectual in the Ottoman Empire. The Historian Mustafa Âli (1541-1600), Princeton, Princeton
University Press, 1986 ; Douglas A. Howard, « Ottoman Historiography and the Literature of ‘Decline’ of the
Page | 21
Ce phénomène est tout particulièrement visible dans les narrations les plus anciennes,
qui relatent les événements survenus sous les règnes des premiers sultans : la place des
princesses y est à ce point minime que c’est à peine si le dépouillement d’une chronique
entière apporte une dizaine de mentions, d’une utilité parfois très limitée, au final. Le nom des
princesses n’est même pas indiqué – rendant inutile l’usage des index auxquels il n’est
d’ailleurs pas toujours recommandé de se fier. Plus on progresse dans le temps, plus les
annotations se multiplient : les chroniqueurs accordent une place croissante aux événements
survenus au sein de la cour. Mais les affaires rapportées concernent presque exclusivement les
unions des princesses. La prépondérance des informations relatives à cette thématique se
retrouve d’ailleurs dans notre travail, qui consacre deux chapitres aux mariages des princesses
ottomanes. Les chroniques présentent néanmoins l’avantage d’être des discours d’hommes du
passé sur leur propre temps ou celui de leurs ancêtres : ces discours se révèlent souvent aussi
intéressants dans leurs commentaires que dans leurs silences, qui en apprennent parfois plus
long qu’une belle sentence.
Les actes de fondation d’un legs pieux (vakfiyye) constituent un deuxième fonds
d’archives considérable. La consultation intégrale de la liste des vakfiyye conservées au
Vakıflar Genel Müdürlüğü à Ankara (VGMA) a révélé un nombre impressionnant de
documents relatifs aux fondations pieuses des princesses ottomanes – le chiffre s’élevait à
plus d’une centaine d’actes. Dans ces conditions, il n’était pas question de les traduire
systématiquement : l’exercice n’aurait pas été dénué d’intérêt ; néanmoins, dans l’optique qui
nous occupait, l’intérêt de ces témoignages résidait dans les données brutes qu’ils renferment,
relevées de façon systématique et recensées dans des tables dont on trouvera la synthèse en
annexe. Ce travail fastidieux a permis de dresser un inventaire des fondations pieuses des
princesses, puis de réfléchir à leur usage pour les fondatrices et leur famille. Ces actes
contiennent bien une partie de discours des princesses sur elles-mêmes, sur la manière dont
elles entendent se présenter et être commémorées, mais il s’agit là de formules extrêmement
codifiées : sans nier qu’une étude pourrait être menée sur cet aspect, nous doutons qu’elle
apporte des résultats originaux – c’est la raison pour laquelle nous avons renoncé à nous y
atteler26
.
Sixteenth and Seventeenth Centuries », Journal of Asian History 22 / 1 (1988) : 52-77 ; Halil İnalcık, « The Rise of
Ottoman Historiography », dans Historians of the Middle East, B. Lewis et P. Holt (éds.), Londres, Oxford
University Press, 1962 : 152-167 et « Tursun Beg, Historian of Mehmed the Conqueror’s Time », Wiener
Zeitschrift für die Kunde des Morgenslandes 69 (1977) : 55-71 ; Bernard Lewis, « Ottoman Observers of
Ottoman Decline », Islamic Studies 1 (1962) : 71-87 ; Victor L. Ménage, « The Beginnings of Ottoman
Historiography », dans Historians of the Middle East, B. Lewis et P. Holt (éds.), Londres, Oxford University Press,
1962 : 168-170 et Neshri’s History of the Ottomans: The Sources and Development of the Text, Londres, Oxford
University Press, 1964 ; Nikos Sigalas, « Des histoires des Sultans à l’histoire de l’État. Une enquête sur le temps
du pouvoir ottoman (XVIe-XVIIIe siècles) », dans Les Ottomans et le temps, F. Georgeon et F. Hitzel (éds.), Paris,
Éditions du CNRS, 2012 : 99-128 ; Kemal Silay, « Ahmedî’s History of the Ottoman Dynasty », Journal of Turkish
Studies 16 (1992) : 129-200 ; Lewis Thomas, A Study of Naima, New York, New York University Press, 1972. 26
Sur ce sujet, voir notamment Ali H. Berki, Vakıflar, Istanbul, Cihan Kitaphanesi, 1941 et Vakfa dair yazılan
vakfiye ve benzerî vesikalarda geçen ıstılah ve tâbirler, Ankara, 1966 ; William J. Griswold, « A Sixteenth Century
Ottoman Pious Foundation », Journal of the Economic and Social History of the Orient 27 (1984) : 175-198 ;
Page | 22
Les registres de compte sont des documents fort éprouvants à traduire et d’une
sècheresse affligeante. Rédigés par les scribes à usage bureaucratique interne, ils se présentent
comme une suite de chiffres introduits par des annotations lapidaires destinées à en indiquer
la nature. Deux types de registres de compte pouvaient satisfaire notre intérêt : les registres
palatiaux généraux, qui concernent l’ensemble des dépenses du Palais impérial (en fait, pour
être plus exacte, de l’ensemble des palais impériaux) et les registres spécifiques par palais
princier. Ces derniers sont néanmoins assez tardifs – les registres conservés et connus datent
du début du XVIIIe siècle : leur usage présentait le risque de déséquilibrer la structure
générale du texte en fournissant un surplus d’informations sur une très courte période à la
marge de notre champ chronologique. Par ailleurs, le risque était grand que les informations
qu’ils contiennent ne s’inscrivent pas dans la trame générale de la dissertation. En outre, ils
faisaient déjà l’objet d’un travail fort avancé et de vaste ampleur par Tülay Artan. Nous nous
sommes dès lors rabattue sur la première catégorie, prenant notre mal en patience et tâchant
de trouver, dans les pages qui se suivent et se ressemblent, celles relatives aux princesses. Une
note positive à ce tableau : certains registres, parmi les plus intéressants, avaient été publiés
par Ömer Lütfi Barkan dans un numéro de Belleten, ce qui facilita grandement leur
exploitation27
. Ces peines ne furent pas sans récompense, ces registres de compte se sont
révélés fort intéressants et c’est grâce à eux qu’une réflexion sur l’existence d’une catégorie
sociale propre aux princesses a pu être menée. Ils nous ont encore permis de découvrir toutes
les subtilités de la hiérarchie interne aux princesses, introuvables par ailleurs.
Les stèles funéraires sont un domaine d’étude qui a été partiellement abandonné – ou,
pour être plus juste, mis de côté jusqu’à nouvel ordre. Des raisons viennent motiver cette
décision. Tout d’abord, il existe une littérature conséquente et très précieuse sur le sujet : une
partie du travail avait déjà été fait. On rétorquera que ces ouvrages ne fournissent pas toujours
la copie du texte des stèles funéraires des princesses ottomanes. Mais pour l’usage que nous
en faisions, ces textes présentent une utilité minime : ils indiquent généralement la date du
décès, le nom du père et, parfois, du mari – des renseignements connus par ailleurs, bien
souvent grâce à la lecture de ces stèles justement. Or, ce qui nous intéressait renvoyait surtout
à la localisation des tombes des princesses, non à l’inventaire des modes d’énoncé de leur
présentation post-mortem. L’aurait-on voulu que le travail n’aurait pu être fait qu’à moitié :
les stèles funéraires des défunts inhumés dans les mausolées des sultans à Sainte-Sophie,
Sultanahmet et sous la coupole du türbe de Turhan Valide Sultane ne sont pas accessibles au
public ni au chercheur28
. En fin de compte, seules les stèles érigées dans les jardins utilisés
comme nécropole permettent un travail du genre, or les princesses inhumées dans ces espaces
Mehmet F. Köprülü, « L’institution de vakf et l’importance historique de documents de vakf », Vakiflar Dergisi 1
(1938) : 3-9 (partie française) ; Véra Moutaftchieva, Le vakıf, un aspect de la structure socio-économique de
l’Empire ottoman (XVe – XVIIe s.), Sofia, Jusautor, 1981 ; Amy Singer, Constructing Ottoman Beneficence. An
Imperial Soup Kitchen in Jerusalem, Albany, State University of New York Press, 2002 ; Bahaeddin Yediyıldız,
Institution du vakf au XVIIIe siècle en Turquie. Étude socio-historique, Ankara, Édition du Ministère de la Culture,
1990. 27
Ömer L. Barkan (éd.), « İstanbul Saraylarına Ait Muhasebe Defterleri », Belgeler 9 / 13 (1979) : 1-380. 28
En ce qui concerne les mausolées de Sainte-Sophie, il semble que les stèles funéraires aient été enterrées sur-place, sous les sarcophages, et que leur état de conservation n’était pas brillant, aux dires d’un gardien ; nous n’avons pu vérifier la véracité de ces allégations.
Page | 23
constituent des exceptions29
. Mis à part des vérifications de visu, nous nous sommes donc
contentée d’utiliser la littérature déjà existante sur le sujet30
.
Pour un travail tel que nous l’envisagions, l’apport des ouvrages biographiques se
révélait inestimable. Malheureusement, la tradition ottomane dans le domaine n’est point si
développée que dans d’autres sociétés, en tout cas pour les individus qui nous concernent. Il
existe des ouvrages de ce type pour les oulémas, pour les grands vizirs, pour les eunuques,
mais les collections de notices biographiques accordant une place aux princesses ottomanes
ne sont pas légion. En fin de compte, c’est celui de Mehmed Süreyya qui s’est révélé le plus
utile31
. Toutefois, le fait qu’il fut compilé à la fin de l’Empire ottoman rend son usage
malaisé, car son auteur a pour coutume de calquer les pratiques de son époque sur les périodes
plus anciennes, présupposant leur permanence dans le passé. Il se révèle également très mal
renseigné pour les périodes les plus reculées. En revanche, au fur et à mesure qu’on se
rapproche dans le temps, ses informations se font à la fois plus complètes, plus précises et
plus sûres. Il demeure qu’il a été d’une réelle utilité pour reconstituer les connexions entre
individus, ébauche pour une restitution, même incomplète, des réseaux d’influence des
princesses – ou de leurs époux.
Nous avons encore ponctué notre travail d’informations glanées dans les récits des
voyageurs occidentaux de passage dans l’Empire ottoman. Les spécificités littéraires et
historiques de ces ouvrages ont été largement discutées ailleurs, aussi paraît-il presque
superflu d’y revenir32
. Nous nous contenterons de rappeler que les explications qu’ils
rapportent sont à prendre avec beaucoup de précautions, dans la mesure où leurs auteurs
montrent un degré de compréhension de la société ottomane parfois peu convaincant. Par
ailleurs, il faut tenir compte du fait qu’ils écrivent en respectant le principe, en cours à cette
époque, du plagiat : les topoï littéraires sont légion et une même description, une même erreur
se retrouve souvent presque telle quelle d’un livre à l’autre. Gardons encore en tête qu’à la
période qui nous intéresse, tous les auteurs de ces récits sont des hommes – à l’exception
29
Cela ne nous a pas empêchée de procéder à des vérifications sur-place et de procéder à des relevés poussés des stèles en question. Nous avons eu ainsi la chance d’accéder au cimetière, fermé en raison de travaux, de la Şehzade Camii qui contient les tombes d’un certain nombre de descendants indirects des princesses. Il s’agit néanmoins de descendants très indirects qui dépassent le cadre de notre étude. Nous comptons bien faire usage ultérieurement des informations que nous avons pu y récolter. 30
Nous avons fait usage tout particulièrement des ouvrages suivants : Jean-Louis Bacqué-Grammont, Hans P. Laqueur, Nicolas Vatin, « Stelae Turcicae II. Cimetières de la mosquée de Sokollu Mehmed Pasa à Kadırga Limanı , de Bostancı Ali et du türbe de Sokollu Mehmed Pasa à Eyüp », Istanbuler Mitteilungen 36 (1990) : 1-260 ; Hakkı Önkal, Osmanlı Hanedan Türbeleri, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1992 ; Nicolas Vatin et Stéphane Yerasimos, Les cimetières dans la ville. Statut, choix et organisation des lieux d’inhumation dans Istanbul intra-muros, Istanbul / Paris, IFEA / Maisonneuve, 2001. 31
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî. Osmanlı Ünlüleri, S. A. Kahraman (trad.), 6 tomes, Istanbul, Tarih Vakf Yurt Yayınları, 1996. 32
Voir en particulier Lucette Valensi, Venise et la Sublime Porte. La naissance du despote, Paris, Hachette, 1987. Stéphane Yerasimos et Elisabetta Borroméo se sont attelés à la tâche difficile de recenser et étudier ces voyageurs, leurs biographies, leurs itinéraires et les spécificités de leurs récits : Stéphane Yérasimos, Les voyageurs dans l’Empire ottoman (XIVe-XVIe siècles). Bibliographie, itinéraires et inventaires des lieux habités, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1991 ; Elisabetta Borroméo, Voyageurs occidentaux dans l’Empire ottoman (1600-1644). Inventaire des récits et étude sur les itinéraires, les monuments remarqués et les populations rencontrées (Roumélie, Cyclades, Crimée) , Paris, Maisonneuve & Larose / IFEA, 2007.
Page | 24
notable de Lady Montagu, dans la première moitié du XVIIIe siècle – ce qui signifie qu’ils
n’avaient pas accès à l’univers fermé du harem, qu’ils comprenaient d’ailleurs souvent mal et
voyaient à l’aune de leurs conceptions et croyances. La qualité de leurs informations dépend
donc beaucoup de la qualité de leurs informateurs. Néanmoins, parce qu’ils sont étrangers à
ce monde qu’ils lisent avec leurs yeux d’Européens de l’époque moderne, ils fournissent, par
moment, des informations introuvables dans la documentation ottomane.
Au terme de trois années de travail au plus près des sources ottomanes, nous étions
parvenues à nous faire une idée de ce qu’elles contenaient. Il restait le travail le plus
laborieux, qui nous prit deux années supplémentaires : leur donner un sens. Outre les travaux
en histoire ottomane qui ponctuent notre travail, nous avons fait appel à des cadres théoriques
déjà existants qui avaient le mérite de mettre en lumière les données patiemment récoltées
dans les archives. Dans le domaine historique, nous avons privilégié les recherches et
ouvrages relatifs à l’histoire médiévale et moderne européenne. Il est certainement regrettable
que nous n’ayons pas aussi orienté nos lectures en direction d’aires culturelles
extraeuropéennes, asiatiques notamment. L’historiographie chinoise ou japonaise aurait pu se
révéler intéressante. Mais les passerelles entre l’histoire européenne, française ou espagnole
notamment, et celle de l’Empire ottoman paraissaient plus évidentes. Quelques thématiques
ont été privilégiées, pour des raisons évidentes. Ce sont les études sur les femmes
(appartenant à l’élite principalement)33
et les systèmes de cour, sur l’organisation politique de
type monarchique et la construction de l’État34
.
33
L’historiographie existante est conséquente et en pleine expansion ; nous ne citons ici que quelques références parmi tant d’autres : Bartolomé Bennassar, Le lit, le pouvoir et la mort. Reines et princesses d’Europe de la Renaissance aux Lumières, Paris, Éditions de Fallois, 2006 ; Philippe et Geneviève Contamine (éds.), Autour de Marguerite d’Écosse. Reines, princesses et dames du XVe siècle, Paris, H. Champion, 1999 ; Georges Duby et Michelle Perrot (éds.), Histoire des femmes en Occident, 4 volumes, Paris, Perrin, 2002 ; Jean Dufournet, André Joris, Pierre Toubert (éds.), Femmes, mariages, lignages, XIIe-XIVe siècles. Mélanges offerts à Georges Duby, Bruxelles, De Boeck Université, 1992 ; Robert Muchembled, Passions de femmes au temps de la reine Margot (1553-1615), Paris, Seuil, 2003 ; Isabelle Poutrin et Marie-Karine Schaub (éds.), Femmes et pouvoir politique. Les princesses d’Europe, XV
e-XVIII
e siècle, Rosny-sous-Bois, Bréal, 2007 ; Elianne Viennot,
Marguerite de Valois, « la reine Margot », Paris, Perrin, 2005 ainsi que La France, les femmes et le pouvoir. L’invention de la loi salique (Ve – XVIe siècle), Paris, Perrin, 2006 et La France, les femmes et le pouvoir. Les résistances de la société (XVIIe – XVIIIe siècle), Paris, Perrin, 2008 ; Anne Vergus et Denise Davidson, Le roman conjugal. Chroniques de la vie familiale à l’époque de la Révolution et de l’Empire, Seyssel, Champ Vallon, 2011 ; Cosandey, La reine de France ; Sanchez, The Empress, The Queen and the Nun ; Crouzet, Le haut cœur de Catherine de Médicis. 34
L’historiographie sur cette thématique est particulièrement vaste. En voici quelques exemples : Jean-Marie Apostolides, Le roi-machine : politique et spectacle au temps de Louis XIV, Paris, Minuit, 1981 ; Lucien Bély, La société des princes, XVIe-XVIIIe siècles, Paris, Fayard, 1999 ; Romain Bertrand, Etat colonial, noblesse et nationalisme à Java. La Tradition parfaite, Paris, Karthala, 2005 ; Monique Chatenet, La cour de France au XVIe siècle. Vie sociale et architecture, Paris, Picard, 2002 ; Crouzet, Le haut cœur de Catherine de Médicis ; Norbert Elias, La société de cour, Paris, Flammarion, 1985 ; Ralph E. Giesey, Le roi ne meurt jamais. Les obsèques royales dans la France de la Renaissance, Paris, Flammarion, 1987 et Cérémonial et puissance souveraine. France, XVe – XVIIe siècles, Paris, Armand Colin, 1987 ; Alain-Charles Gruber, Les grandes fêtes et leur décor à l’époque de Louis XIV, Paris / Genève, Droz, 1972 ; Bernard Hours, Louis XV et sa Cour. Le roi, l’étiquette et le courtisan, Paris, Presses Universitaires de France, 2002 ; Ernst Kantorowicz, Les deux corps du roi, Paris, Gallimard, 1989 ; Frédérique Leferme-Falguières, Les courtisans. Une société de spectacle sous l’Ancien Régime, Paris, Presses Universitaires de France et Le Monde, 2007 ; Michel Nassiet, Parenté, noblesse et États dynastiques, XVe – XVIe siècle, Paris, Éditions de l’EHESS, 2000 ; Karl F. Werner, Naissance de la noblesse, Paris, Fayard / Pluriel, 2010 ;
Page | 25
Quelques travaux de sociologie se sont révélés particulièrement utiles pour un travail
qui s’orientait de plus en plus vers une inscription dans les études de sociologie historique. La
société de cour de Norbert Elias nous a ainsi appris à penser en termes de « formations »
sociales dans lesquelles « les individus sont liés les uns aux autres par un mode spécifique de
dépendances réciproques et dont la reproduction suppose un équilibre mobile de tensions. »35
Chaque individu agit de façon libre, mais dans les limites permises par la chaîne
d’interdépendances qui le lie aux autres. Malgré les critiques qui ont pu être formulées à
l’encontre de son travail, fondées notamment sur son choix discutable de sources, nous avons
retenu avec attention sa manière de comprendre l’usage, par le monarque, des tensions et
rivalités existantes entre les aristocrates et les bourgeois d’une part, au sein même des
aristocrates eux-mêmes d’autre part. La lecture qu’il donne de l’instrumentalisation par Louis
XIV de l’étiquette de cour dans le but d’enchaîner les nobles, individuellement et en tant que
classe, dans une soumission totale et quotidienne à sa personne n’a pas manqué de nous
intéresser. Mais le principal apport d’Elias à notre réflexion est peut-être sa manière de
comprendre le rôle et la place d’un individu quelconque au sein de sa formation : toujours
libre, son action est néanmoins déterminée par l’évolution des interdépendances qui
structurent à la fois sa propre formation en interne et les liens que celle-ci entretient avec les
autres formations. Car l’un des problèmes de notre étude consistait à comprendre la place et le
rôle des princesses ottomanes dans leur société en tant que groupe et en tant qu’agrégat
d’individus aux intérêts et capacités variables. Si notre travail accorde probablement plus de
place aux dispositions structurelles qu’aux individus, c’est en raison des sources dont nous
disposons sur le sujet, qui favorisent une telle approche et rendent difficile la compréhension
des apports individuels.
Comme Elias, Bourdieu prétend dépasser le paradigme individualiste et son
contrepoint, le holisme. Il élabore pour cela toute une méthodologie fort complexe dont
l’objectif est de permettre d’envisager l’action individuelle en fonction des différents capitaux
à leur disposition. La solution du problème résiderait selon lui dans la notion d’habitus, qu’il
définit comme un système de dispositions réglées qui fournit à l’individu considéré les cadres
de lecture du monde qui l’entoure et qu’il partage avec les autres membres de la catégorie
sociale à laquelle il appartient. Néanmoins, pour le travail qui nous occupe, c’est moins la
notion d’habitus que sa réflexion sur l’intériorisation des normes et la reproduction des élites
que nous avons retenue. Bourdieu a en effet été capable de montrer les ressorts d’une
intériorisation de normes imposées par les dominants sur les dominés, de sorte que la
supériorité des premiers sur les seconds soit perçue comme naturelle et s’impose par l’effet
d’une violence symbolique subjectivée. La hiérarchisation des groupes sociaux favorise
l’intériorisation des rapports de domination par l’élaboration d’un discours de la distinction et
l’imposition de pratiques quotidiennes différenciatrices. La reproduction de la domination
passe alors par la reproduction des élites et des modes de pensée, grâce à un appareil éducatif
Andrew W. Lewis, Le sang royal. La famille capétienne et l’État, France, Xe-XIVe siècle, préface de G. Duby, J. Carlier (trad.), Paris, Gallimard, 1986 ; Robert Descimon et Élie Haddad (éds.), Epreuves de noblesse. Les expériences nobiliaires de la haute robe parisienne (XVIe-XVIIIe siècle), Paris, Les belles lettres, 2010. 35
Préface de Roger Chartier dans Elias, La société de cour : p. X.
Page | 26
qui enseigne et favorise la répétition de la différence parce qu’elle est subjectivée à la fois par
les enseignants et par les élèves36
.
Ces travaux ont inspiré et orienté certaines de nos réflexions, mais nous n’avons
aucunement la prétention de les avoir appliqués dans un contexte ottoman qui aurait
difficilement permis l’exercice. En revanche, nous les avons fortement mis à contribution
pour élaborer le cadre théorique qui a permis de comprendre le rôle et la place des princesses
ottomanes dans leur société. À bien des égards, les princesses ont été instrumentalisées par les
sultans comme des agents au service de la dynastie. Elles ne formulèrent jamais la moindre
revendication contraire aux intérêts dynastiques : on peut y voir une déformation occasionnée
par le temps et les sources ou l’interpréter, ce qui a été notre parti-pris, comme l’expression
d’une intériorisation des normes. Les princesses connaissaient leurs marges d’action, savaient
leur position de supériorité, maîtrisaient les fonctionnements du clientélisme ottoman : elles
n’eurent jamais la volonté consciente d’y apporter la moindre modification, mais surent
l’exploiter à leur profit et à celui de leur entourage. Enfin, la capacité des lignages princiers à
se maintenir dans les rangs de l’élite, malgré une dépréciation sociale rarement évitée, est le
reflet d’une volonté – réussie – de reproduction de cette élite, qui se concrétise par l’insertion
des descendants dans les espaces de formation les plus prometteurs, telle l’école du Palais
impérial.
À côté de la sociologie, l’anthropologie nous a également intéressée. C’est chez elle
que nous sommes allée chercher les concepts nécessaires à une lecture anthropologisante des
pratiques matrimoniales des princesses ottomanes. Les travaux sur la parenté et sur le don ont
tout particulièrement retenu notre attention, car ils permettaient de donner un sens symbolique
et des cadres de compréhension au système d’alliance et aux structures lignagères des
princesses ottomanes37
. La lecture politique des mariages des princesses ne présentait pas de
grandes difficultés, mais ne permettait pas un déchiffrage de leur signification symbolique.
Car malgré tout, pour un monarque, marier sa fille ou sa sœur à un de ses esclaves n’est pas
banal, fut-il grand dignitaire ! Encore moins quand on sait que cette pratique s’imposa au
détriment de gendres d’origine princière. Par ailleurs, le mariage, en tant que système d’union,
d’alliance ou d’échange d’une part, composant indispensable et fondateur des structures
familiales d’autre part, est par essence un fait anthropologique. Restait à savoir l’interpréter en
termes de système et de symbole.
Il est un dernier domaine qui a nourri notre réflexion et qui n’appartient ni tout à fait à
l’histoire, ni à la sociologie, ni à aucune discipline spécifique des sciences sociales : les études
sur les femmes et le genre. Distinguons d’abord ces deux termes qui, n’en déplaisent à
certain(e)s qui en font des synonymes, n’impliquent pas les mêmes choses. Les études sur les
36
Parmi les nombreux ouvrages et travaux de ce sociologue, nous avons utilisé ici surtout Pierre Bourdieu, La domination masculine, Paris, Seuil, 1998 ; Raisons pratiques. Sur la théorie de l’action, Paris, Éditions du Seuil, 1994 ; La noblesse d’État, Paris, Les Éditions de Minuit, 1989. 37
Au sein d’une littérature fort abondante sur ces sujets, nous avons exploité les travaux de Alain Caillé, Anthropologie du don. Le tiers paradigme, Paris, La Découverte, 2007 ; Maurice Godelier, L’énigme du don Paris, Fayard, 1996 ainsi que Métamorphoses de la parenté, Paris, Fayard, 2004 ; Claude Lévi-Strauss, Les structures élémentaires de la parenté, Berlin / New York, Mouton de Gruy, 2002 ; Marcel Mauss, Essai sur le don, Paris, Presses Universitaires de France, 2007.
Page | 27
femmes sont des travaux qui prennent pour objet une ou des femmes, dans une société
donnée : la réflexion peut privilégier une approche historique, politique, sociologique,
anthropologique, mais elle ne suppose pas nécessairement une réflexion sur le genre. On
pourrait ainsi imaginer une biographie sur une femme quelconque qui n’accorderait aucune
place à l’analyse en termes de genre – bien qu’une telle absence ne manquerait pas d’être
reprochée, à juste titre. Il est aussi possible de parler de genre sans parler de femme(s) dans la
mesure où il s’agit d’une analyse des relations entre des sexes sociaux et non biologiques :
prenons l’exemple des eunuques, hommes émasculés qui sont, d’un point de vue biologique,
des hommes, mais d’un point de vue social, à mi-chemin entre les hommes et les femmes.
Définir le genre en tant que concept et méthodologie d’analyse n’est pas aussi aisé
qu’on pourrait s’y attendre. Prenons pour point de départ la formule de Simone de Beauvoir :
« on ne naît pas femme, on le devient ». Elle n’entend certes pas qu’une femme ne naîtrait pas
avec les attributs biologiques propres aux femmes, mais qu’« être femme » est une notion
sociale et, comme telle, mouvante ; elle renvoie à tout un univers intellectuel et normatif qui
définit le champ des possibles et des interdits. Ainsi une femme apprend à se tenir : à croiser
les jambes par exemple38
. Elle apprend, comme les hommes d’ailleurs, la pensée de la
différence qui, aux yeux de Françoise Héritier, serait une donnée universelle à ajouter à la
prohibition de l’inceste, la répartition sexuelle des tâches et une forme reconnue d’union
sexuelle. La « valence différentielle des sexes » serait « la corde qui lie entre eux les trois
piliers du tripode social » susdit39
et qui trouverait ses origines dans une observation sans
cesse reproduite des fonctionnements physiologiques40
. Nombreux sont les penseurs, depuis
l’Antiquité jusqu’à nos jours, qui ont voulu expliquer les origines et les conséquences de cette
différence des sexes et les travaux sur le genre se sont attachés à dénouer les écheveaux de ces
conceptions intellectuelles41
.
Ce n’est pourtant pas cet apport de la recherche sur le genre qui a retenu notre
attention, mais plutôt la deuxième facette du problème : les applications de cette pensée de la
différence, notamment en histoire. Si l’on admet que la pensée de la différence est le fruit
d’une construction sociale, il faut alors concéder que chaque société produit ses propres
conceptions des rôles attribués à chaque “genre” et des normes qui régularisent les relations
entre eux. Les antiquisants et les médiévistes ont produits des travaux forts intéressants dans
le domaine, qui s’attachent non seulement à décrire les discours – très largement masculins –
sur les relations de genre, mais aussi à montrer les réponses et stratégies d’évitement ou de
protestation à leur endroit : une société peut prôner la domination masculine ou affirmer
38
Bourdieu, La domination masculine : 30-32. 39
Françoise Héritier, Masculin / Féminin. La pensée de la différence, Paris, Odile Jacob, 1996 : 27. 40
Héritier, Masculin / Féminin : 15-29. 41
Danielle Chabaud-Rychter, Virginie Descoutures, Anne-Marie Devreux, Eleni Varikas (dir.), Sous les sciences
sociales, le genre. Relectures critiques de Max Weber à Bruno Latour, Paris, La Découverte, 2010 ; Élisabeth
Badinter, L’amour en plus. Histoire de l’amour maternel, XVIIe-XXe siècle, Paris, Flammarion, 1980 ; Geneviève
Fraisse, La différence des sexes, Paris, Presses Universitaires de France, 1996 ; Michelle Perrot, Mon histoire des
femmes, Paris, Éditions du Seuil, 2006 et Histoire de chambres, Paris, Seuil, 2009 ; Françoise Thébaud, Écrire
l’histoire des femmes et du genre, Paris, ENS Éditions, 2007 ;
Page | 28
l’infériorité féminine, cela ne signifie pas qu’elles étaient appliquées de facto42
. Cette
recherche s’est déployée principalement autour de trois domaines d’étude : l’exercice du
pouvoir, les rapports familiaux et la pratique religieuse. La plupart des travaux historiques ont
une démarche similaire qui consiste à prendre une (catégorie de) femme(s) comme objet
d’étude et voir de quelle manière leur condition féminine déterminait leur marge d’action dans
les domaines suscités.
Notre propre étude sur les princesses ottomanes s’inscrit pleinement dans cette trame
méthodologique – la lecture de ces travaux a probablement orienté nos interrogations et la
manière de penser l’action des femmes qui nous intéressaient. Seul l’aspect religieux a été mis
de côté, dans la mesure où les sources sont silencieuses concernant les pratiques et la
religiosité des princesses ottomanes43
, à l’exception de leur investissement dans le domaine de
la philanthropie44
. En somme, il n’est pas erroné de dire que cette étude sur les princesses
ottomanes est une étude d’histoire politique et sociale qui, prenant pour objet des femmes afin
d’examiner leurs procédés d’insertion dans un monde politique défini comme masculin, inclut
des grilles d’analyse de genre pour retracer leur position et leurs pratiques sociopolitiques.
7. De toutes ces choses qui n’ont pas pu être faites
Le travail final s’est écarté sur bien des points du projet initial ; tel qu’il se présente, il
pèche sur bien des aspects du fait de l’orientation privilégiée et des conditions de son
élaboration. Il faut donc faire la liste de ses défauts – en tout cas, ceux que nous avons été
capables d’identifier. On pourra reprocher, pour commencer, l’absence d’une véritable
prosopographie. Mais qu’est-ce qu’une prosopographie ? C’est un travail qui, prenant pour
point de départ une catégorie (construite par l’historien ou formulée par la société étudiée)
prédéterminée d’individus (par exemple les pachas ou les membres du parlement de Paris) et
42
Voir notamment Claudia Opitz, « Contraintes et libertés (1250-1500) », dans Histoire des femmes en Occident. T. II : Le Moyen Âge. G. Duby et M. Perrot (éds.), volume sous la direction de Ch. Klapisch-Zuber, Paris, Perrin, 2002 : 343-418 ; Carla Casagrande, « La femme gardée », dans Histoire des femmes en Occident. T. II : Le Moyen Âge. G. Duby et M. Perrot (éds.), (volume sous la direction de Ch. Klapisch-Zuber), Paris, Perrin, 2002 : 99-142 ; Marie-Françoise Bosquet, Chantale Meure, Le Féminin en Orient et en Occident, du Moyen Âge à nos jours : mythes et réalités, Saint-Étienne, Publications de l’Université de Saint-Étienne, 2011 ; Frédéric Chauvaud, Gilles Malandain (dir.), Impossibles victimes, impossibles coupables. Les femmes devant la justice (XIXe-XXe siècles), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2009 ; Michèle Riot-Sarcey (éd.), De la différence des sexes. Le genre en histoire, Paris, Larousse, 2010. 43
De façon générale, c’est l’aspect le moins abordé des études féminines dans le domaine ottoman à l’heure actuelle, en raison d’un problème de documentation. Il faut espérer que l’avenir verra naître plus de travaux sur le sujet. 44
La philanthropie musulmane, telle que pratiquée dans la société ottomane, est effectivement une forme de religiosité, mais elle dépasse très largement le cadre spirituel, de sorte qu’il serait réducteur de prendre l’exercice de la philanthropie comme une marque de religiosité en soi. Ce qui ne signifie pas que les princesses ottomanes n’étaient pas inspirées par une pensée religieuse ou qu’elles n’avaient pas des pratiques de la religion, qui restent à définir, ni même que leurs fondations pieuses n’en soient une certaine expression : nous entendons seulement par là que l’étude des fondations pieuses, telle que nous l’avons menée, n’est pas un vecteur suffisant pour comprendre la nature de la religiosité de ces femmes.
Page | 29
s’appuie sur la reconstitution de leurs biographies pour déduire les logiques constitutives du
groupe. Un excellent exemple d’étude prosopographique a été réalisé par Olivier Bouquet sur
les pachas ottomans durant la seconde moitié du XIXe siècle
45. Il disposait néanmoins d’un
corpus abondant, qui accordait une large part aux individus qu’il souhaitait étudier et les
informations fournies par ce corpus étaient suffisamment denses et répétitives pour permettre
d’établir des points de comparaison.
Notre documentation n’offre malheureusement pas de telles perspectives de travail.
Les sources consultées ne s’intéressent jamais, ou presque, aux princesses pour elles-mêmes :
quand elles apparaissent dans la documentation, c’est toujours du fait d’une conjoncture
particulière. Même au niveau du mariage, l’un des aspects les mieux documentés, les
informations sont trop aléatoires pour permettre de se lancer dans une réelle prosopographie.
Veut-on établir le profil de leurs maris ? Dans l’approche générale, il est trop évident : ce sont
tous, à quelques exceptions près et à partir du XVIe siècle, des pachas. Oui, mais quels
pachas ? À une queue, à deux queues, à trois queues ? Étaient-ils pachas avant ou après avoir
épousé la princesse ? Quel fut l’impact du mariage sur leur carrière ? Pour répondre à ces
questions, il faudrait connaître avec certitude la date de leurs mariages. Or, ce travail n’est
possible que par intermittence : les chroniqueurs se contentent trop souvent de signifier, au
détour d’une phrase, que tel pacha était l’époux d’une fille, d’une sœur du sultan, sans plus de
précisions (il faut attendre le début du XVIIIe siècle pour que les informations se fassent plus
récurrentes et soient datées).
L’étendue de l’intervalle chronologique a bien des avantages, mais n’est pas sans
entrainer quelques inconvénients. L’un d’eux est le caractère disparate des informations au fil
du temps. La date de naissance et de mariage des princesses de l’extrême fin du XVIIe et de la
première moitié du XVIIIe siècle sont connues, mais ce n’est pas le cas pour la période
antérieure. Quelle valeur aurait ces résultats dans l’optique d’un travail sur le temps long ? De
façon générale, les informations sur les princesses sont plus nombreuses au fur et à mesure
que l’on avance dans le temps ; elles ne sont pas pour autant plus précieuses. Reste le souci
d’harmonisation. Un travail plus resserré dans le temps, concentré par exemple sur le XVIIe et
XVIIIe siècle, aurait été plus facile peut-être, mais bien moins intéressant, car il serait resté
aveugle devant les évolutions cruciales survenues dans la période antérieure. Il n’aurait pas
été possible de se rendre compte que l’importance accrue que les princesses semblent avoir
acquise à partir du XVIIe siècle est en fait une illusion : le piédestal sur lequel elles sont
installées est bien doré, mais on l’a vidé de toute substance.
Ce choix du temps long est une chance, mais aussi une orientation qui induit un certain
cadre. Si ses implications n’ont pas été pleinement conçues dès le départ, il n’en a pas moins
beaucoup déterminé la forme finale. Fernand Braudel préconisait trois temps historiques : un
rythme lent, celui de la longue durée (dans ce contexte, il s’agirait de l’étendue chronologique
du travail), un rythme moyen de la conjoncture (par exemple, le temps d’un règne ou le
tournant du XVIe siècle, si crucial pour notre sujet), enfin un rythme rapide, qui correspond au
temps court de l’événement (comme une cérémonie de mariage). Braudel qualifie chacun de 45
Olivier Bouquet, Les pachas du sultan. Essai sur les agents supérieurs de l’État ottoman (1839-1909), Paris / Louvain, Peeters, 2007.
Page | 30
ces temps d’un adjectif spécifique : il y a le « temps géographique », mais qui a aussi été
appelé temps structurel, le « temps social » et le « temps individuel »46
. Que ces temps ne
représentent qu’une décomposition intellectuelle, donc virtuelle, d’un ensemble destiné à
favoriser une meilleure compréhension de leur enchaînement, il ne semble presque plus
nécessaire de le rappeler.
Tout le problème réside dans la manière de les faire concorder dans un discours
reconstruit après coup. Braudel, dans son ouvrage sur la Méditerranée, avait opté pour un
découpage qui respectait chacun de ces temps : trois parties, chacune consacrée à un temps,
du plus long au plus court, du plus global au plus individuel47
. Pour notre sujet, il a semblé
plus pertinent de préférer une organisation thématique qui tienne compte, en son sein, de ces
différents rythmes. Nous avons ainsi procédé, au sein d’un espace-temps long prédéfini48
, à
un découpage en tranches de temps social qui se succèdent les unes aux autres, s’enclenchent
mutuellement à la suite d’évolutions progressives. Le temps de l’individu s’inscrit
logiquement à l’intérieur de ces tranches et sert notamment à en expliquer les caractéristiques.
Ce sont les hommes qui font les évènements qui vont augurer de changements plus ou moins
profonds de la structure sociopolitique ottomane. Ce choix d’organisation ne va pas sans
certains désavantages : une certaine lourdeur du propos, par moments, le souci de mise en
contexte obligeant à des répétitions.
Ce choix de travailler sur le temps long tend à privilégier les phénomènes structurels
par rapport aux aspects individuels. L’approche sociale, les considérations holistes prennent le
pas, dans le récit, sur la dimension individuelle. Si l’approche de départ y est pour beaucoup,
la documentation a joué son rôle dans cette inflexion implicite. Outre la manière spécifique
que les sources ottomanes ont de parler des princesses, les conceptions narratives de l’époque
sont aussi à prendre en compte, car elles excluent tout rapport à l’intime ou au privé. Les
sentiments, le caractère, le physique même, n’ont pas leur place – ou à la marge. Et encore
moins lorsqu’il s’agit de femmes : quel chroniqueur s’oserait à la description physique ou
psychologique d’une princesse qu’il n’a, fort vraisemblablement, jamais vu de ses propres
yeux et que la culture de l’époque interdit de représenter (et même de voir, à moins d’être soi-
même une femme, or les femmes de cette époque n’ont pas de voix, ne livrent pas leurs
pensées ou expériences). La dimension individuelle des princesses ottomanes est donc restée
relativement en retrait, malgré nos efforts dans ce sens.
Enfin, une mise en perspective comparatiste aurait certainement été un plus et nous
l’avions envisagée, ce qui explique le choix de certaines lectures. Mais il a vite fallu convenir
de l’impossibilité d’un tel ajout, eu égard au temps et aux difficultés qu’un tel exercice
comportait. D’autant que se posait aussitôt la question des bases d’un éventuel comparatisme :
avec qui, avec quoi établir la comparaison ? Selon quelles méthodes ? Nous nous sommes
46
Jean Leduc, Les historiens et le temps. Conceptions, problématiques, écritures, Paris, Éditions du Seuil, 1999 : 21-33. 47
Fernand Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II, Paris, Armand Colin, 1966. 48
On pourra, à juste titre, nous reprocher de ne pas avoir inséré ce temps long dans un contexte plus large. C’est une limite de départ, que nous espérons pouvoir combler avec l’expérience et le temps.
Page | 31
donc contentée, dans les conclusions, de mettre en relief les résultats de nos travaux avec les
connaissances acquises sur le sujet pour d’autres sociétés.
8. Une histoire des princesses ottomanes en cinq chapitres
Ce travail s’organise en cinq parties : la première pose le décor, les quatre autres
étudient les princesses selon un prisme différent. L’agencement suit donc une logique
thématique, au sein de laquelle nous avons néanmoins privilégié une double cohérence à la
fois de statut et de chronologie. L’étude a pour objet une catégorie d’individus. L’exercice
commencera donc naturellement par une réflexion sur le moment de son apparition : les
dernières décennies du XVe siècle ; la nature et la composition de la catégorie « princesses
ottomanes » : les descendantes rapprochées des souverains ottomans, organisées de façon
hiérarchique selon le degré de proximité biologique avec un sultan ; les ingrédients qui en font
l’unité : un titre, une condition ; son positionnement par rapport aux autres catégories sociales
qui l’entourent : à cheval entre dynastie et élite, intermédiaires entre le monde politisé des
hommes et celui, domestique, des femmes ; enfin ses spécificités et attributs distinctifs (au
double sens de différenciatifs et d’honorifiques) : des prérogatives, conjugales notamment, qui
les élèvent au-dessus de la condition humaine partagée par le reste de la société et que les
femmes immédiatement en-dessous d’elles tentent d’imiter.
Le principal motif occasionnant l’insertion de mentions relatives aux princesses dans
les chroniques ottomanes est leur mariage : il est le seul événement de la vie de ces femmes à
être cité de façon récurrente, à défaut d’être systématique. Nous suivrons donc la logique
ottomane, qui n’est pas dénuée de bon sens, en commençant l’étude de leur place dans la
société ottomane par ce thème. Il s’agira de comprendre les bases du système des alliances
matrimoniales nouées autour des princesses ottomanes. Elles respectent une règle implicite, à
défaut d’avoir été explicitée, élaborée à partir de la seconde moitié du XVe siècle et qui
préconise le mariage de ces femmes avec les seuls représentants les plus élevés des
dignitaires-esclaves des sultans, hauts serviteurs de l’État, qu’on pourrait regrouper sous
l’appellation de grands kul. Si des considérations de politique intérieure et extérieure sont à
l’origine de cette pratique, elle triompha si bien qu’elle devint une obligation pour chacun des
acteurs : les sultans, les princesses, les grands kul, et tous ceux qui, à un titre quelconque,
avaient leur mot à dire dans ces affaires matrimoniales. Cette pratique devient alors un
élément de stabilité de la structure politique ottomane, mais représente aussi une entrave à
l’émergence d’autres équilibres des pouvoirs.
Le deuxième volet de la thématique du mariage est celui des cérémonies élaborées à
l’occasion de ces unions. Les cérémonies qui entourent les princesses ne se limitent certes pas
à celles que leurs mariages suscitaient. Il en est certainement de très quotidiennes, sur
lesquelles nous ne savons presque rien (réceptions féminines et fêtes religieuses, politiques ou
familiales données au sein du Palais notamment, dont parlent les récits postérieurs et dont tout
laisse à penser qu’elles préexistaient au XIXe siècle), cérémonies funéraires, passées sous
Page | 32
silence à quelques rares attestations près (les chroniqueurs ne parlent pas plus de celles
données à l’occasion du décès des grands officiers de l’État : seules les morts des sultans ou
des princes, exceptionnellement des reines mères, sont l’objet d’indications dans les sources),
festivités à l’occasion des naissances, dont les mentions émergent, pour les princes comme
pour les princesses, à la fin du XVIIe et surtout au début du XVIII
e siècle, soit à la toute fin de
la période retenue dans le cadre de ce travail, ce qui explique que nous n’en parlerons pas. Les
mariages des princesses sont donc l’opportunité principale dont nous disposons pour étudier
l’insertion de ces femmes dans le dispositif d’autoreprésentation de la dynastie. Il accorde une
place croissante à ces représentantes du sang ottoman, transformant progressivement toutes
les occurrences en matière à rappeler et enchaîner tantôt l’élite politique, tantôt l’ensemble de
la société (par l’intermédiaire de la population stambouliote, voire d’Edirne, lorsque la cour y
résidait, utilisée comme substitut de l’ensemble de la population de l’Empire) à une
soumission, même et surtout symbolique, à la dynastie.
La condition des princesses, membres et représentantes de la dynastie, et leur insertion
à la tête de l’élite, résultat de leurs mariages avec les grands kul, leur assure une position
d’intermédiaires privilégiées entre le monde du Palais impérial et l’univers des maisons des
pachas. Elles s’inscrivent ainsi au centre des positions et des relations de pouvoir politique. Le
quatrième chapitre soulève donc la question de leur rôle dans ce champ. Pour cela, il est
impératif de commencer par définir l’espace des possibles – et donc, l’étendue des
interdictions et restrictions. La palette des actions politiques étant connue, il faudra ensuite se
concentrer plus particulièrement sur l’intervention en faveur des membres de la famille,
notamment les descendants et les serviteurs, ainsi que les clients. Le plus souvent, les
princesses se contentent d’entretenir le flot des personnes à leur charge selon un statut
convenable à leur propre état. Certains individus sont cependant l’objet d’attentions plus
soutenues : leurs fils notamment, ou leurs serviteurs les plus prometteurs. Ceux-là vont retenir
particulièrement notre attention.
En guise de dernier chapitre, il nous restera à étudier le rôle philanthropique des
princesses ottomanes, qui seul permet une interaction, un dialogue (codifié, certes) entre elles
et le reste de la société. Elles comptent parmi les rares femmes à s’investir dans la fondation
en dur, dans l’œuvre sinon grandiose (seules quelques rares princesses établirent des
fondations somptueuses) du moins d’utilité publique, noblesse oblige : leur appartenance à la
dynastie et aux plus hauts rangs de l’élite ottomane, leur position d’extrême supériorité qui
dénote des qualités morales et des valeurs humaines remarquables (à en croire la conception
ottomane), enfin un sens du devoir acquis par l’exemple impérial surtout (les sultans et les
reines mères sont les principaux mécènes de l’Empire), des agents de l’État également (le
groupe le plus investi dans le mécénat public, en nombre de réalisations et de participants),
réclamaient leur investissement dans ce domaine. Il fut néanmoins irrégulier tout au long du
temps. Mais surtout, par-delà l’aspect religieux et la contribution au développement public,
l’une des préoccupations principales des princesses à l’origine de fondations pieuses (vakf),
semble bien avoir été égoïste d’abord (souci d’autopromotion, recherche d’une
commémoration dans le futur), familial ensuite (volonté de créer une cohésion lignagère au
Page | 33
sein d’espaces dédiés à la mémoire de l’ancêtre royal féminin). Statuts, pouvoir, famille,
mariages : tels sont donc les mots-clés de l’étude qui suit.
Page | 35
1
L’ÉLABORATION D’UNE IDENTITÉ
SOCIALE COMPLEXE
« Aussitôt que la princesse eut appris que son mariage avec
l’héritier du trône d’Espagne était signé, elle exigea qu’on lui
rendît tous les honneurs dus à son nouveau titre. Marie Louise
Thérèse n’avait alors que douze ans. Le prince de Parme, son
frère, la plaisantant un jour sur ce qu’il appelait ses ridicules
prétentions, elle lui dit avec colère : “Je vous apprendrai à avoir
les égards que vous me devez ; car enfin, je serai reine d’Espagne,
et vous ne serez jamais que le petit duc de Parme. – En ce cas,
répondit l’infant, le petit duc de Parme aura l’honneur de donner
un soufflet à la reine d’Espagne.” »1
Qui sont les princesses ottomanes ? La réponse paraît tellement évidente que personne
ne semble avoir pris la peine d’y répondre. Les historiens de l’Empire ottoman qui ont
travaillé sur le monde du harem impérial fournissent tous une description organisée autour de
la logique des titres et occupations de ses résidentes, sans se préoccuper de comprendre
l’enjeu sémantique qui se dissimule derrière. Ainsi, ils accordent une section aux Valide
Sultanes (les reines mères), aux Kadın Efendi et İkbal (les concubines), aux Kalfa (les chefs
de métiers) et cariye (les novices), aux Sultanes et aux Hanım Sultanes comme si tous ces
titres avaient toujours existé et embrassé les mêmes significations2. Or, la plupart
n’apparaissent qu’au cours du XVIe siècle, d’autres plus tardivement encore. On se contente
généralement de préciser que les Sultanes sont les filles de sultan, les Hanım Sultanes leurs
propres filles. Personne ne semble s’émouvoir de la répétition d’un titre (Sultane) porté par
des femmes aux positions fort diverses (les reines mères, les filles et les petites-filles en lignée
masculine des sultans), ni même du fait qu’il fasse écho à celui porté par les souverains eux-
mêmes et leurs fils.
L’existence même du titre de Sultane, décliné tardivement en Hanım Sultane pour les
petites-filles, annonce l’existence d’un ensemble d’individus répondant à des caractéristiques
similaires. La question qui émerge alors est de savoir si ce phénomène correspond à une
subdivision sociale conceptualisée (sous une forme ou une autre) par les Ottomans ou si elle
1 Anecdote rapportée par Pezzana dans ses mémoires, publiées par Elisabeth Badinter, L’Infant de Parme, Paris,
Fayard, 2008 : 24. 2 Voir notamment Uzunçarşılı, Saray Teşkilâtı ; Uluçay, Harem II.
Page | 36
est le fruit du hasard de l’histoire, sans valeur conceptuelle. « Pour qu’un groupe apparaisse
sur le tissu des relations sociales, il faut que soit forgé son concept et que soit institué son nom
(travail qui engage une restructuration de l’ensemble du champ sémantique des noms de
groupes et de classes) », rappelait Luc Boltanski3. Néanmoins, une catégorie relativement
homogène d’individus peut exister dans le tissu social sans nécessairement constituer une
classe sociale en soi ; pour cela, encore faut-il que ces individus s’enveloppent d’un manteau
de pratiques et de rapports à soi et aux autres à la fois communs au groupe, mais distincts des
autres. Toute catégorie sociale n’est pas apte à donner naissance à une classe morale, au sens
de groupe social qui « se définit autant par les dimensions imaginaires de son rapport à
d’autres groupes sociaux que par sa place au sein du procès de production. Une classe morale
peut être dite « constituée » lorsque se stabilisent les énoncés prescriptifs concernant ses
manières de vivre, c’est-à-dire lorsqu’elle se dote d’une esthétique de vie codifiée sous forme
d’obligations et d’interdits de comportement »4.
L’objet de ce chapitre consiste à réfléchir sur l’existence d’un concept de « princesse
ottomane ». L’étude de leurs titres servira à dégager les éléments du positionnement social des
princesses ottomanes, seules, entre elles et par rapport aux autres, afin de dresser les frontières
de cette catégorie : quels en sont les membres et qui en sont exclus ? Une fois établie la réalité
d’une catégorie sociale des « princesses ottomanes », il restera à s’interroger sur les
caractéristiques identitaires de ces femmes. L’étude de leurs lieux d’inhumations présente
l’avantage de révéler la complexité et les contradictions inhérentes à la position doublement
marginale des descendantes des sultans, enchaînées entre des pratiques exaltant leur
appartenance dynastique et d’autres synonymes d’une intégration au rang de l’élite. En
dernier lieu, les rapports conjugaux qu’entretiennent les princesses ottomanes avec leurs
époux permettront de percevoir la mise en scène de la singularité dynastique jusque dans
l’intimité des vies conjugales.
3 Luc Boltanski, Les cadres. La formation d’un groupe social, Paris, Les Éditions de Minuit, 1982 : 57.
4 Bertrand, La Tradition Parfaite : 104-105.
Page | 37
I. Être princesse : un titre, un statut
Dans ses Méditations pascaliennes, Pierre Bourdieu s’interroge : « quel jeu plus vital,
plus total, que la lutte symbolique de tous contre tous qui a pour enjeu le pouvoir de
nomination ou, si l’on préfère, de catégorisation, où chacun met en jeu son être, sa valeur,
l’idée qu’il a de lui-même ? »5. Le problème est complexe, car il est à la fois individuel et
social, symbolique, normatif et pratique. Romain Bertrand notait ainsi que les priyayi de Java
s’étaient constitués en classe morale à la suite d’un processus de distinction à la fois vis-à-vis
de la noblesse aristocratique et de la classe marchande. Les priyayi avaient ainsi élaboré un
discours sur eux-mêmes et sur les autres qui exaltait l’excellence de leurs mœurs, érigées en
symbole de leur condition6. Les princesses n’échappent pas à cet exercice de dénomination
sociale. Avant toute considération sur leur rôle au sein de la société ottomane, il faut
commencer par définir ce qu’était une princesse.
Les princesses sont appelées tantôt Hatun, tantôt Sultanes, tantôt Hanım Sultanes ; de
plus, elles partagent certaines de ces dénominations avec d’autres. La multiplicité des
appellations nous a poussée à utiliser le terme générique de « princesse(s) », qui lui-même
n’est pas entièrement neutre puisque ce terme occidental prend une résonnance plus large en
Europe que dans l’Empire ottoman de l’époque classique7. Nous avons pris le parti d’user de
ce terme dans un sens strict, pour désigner uniquement les descendantes féminines des princes
et sultans ottomans. Ce choix n’est pas illégitime : malgré des nuances nominatives dues à
un affinement progressif des modes de désignation, nous sommes bien en présence d’une
seule et unique catégorie d’individus. La spécificité des princesses ottomanes réside dans leur
5 Pierre Bourdieu, Méditations pascaliennes, Paris, Éditions du Seuil, 2003 : 341.
6 Bertrand, La Tradition Parfaite : 29-102.
7 Dans l’Europe de l’époque moderne, une princesse est avant tout une fille de roi ou de prince, mais elle peut
aussi, par le jeu des alliances matrimoniales, devenir reine ou duchesse, voire archiduchesse. Si le cas de figure occidental a pu se présenter de façon similaire dans la société ottomane des premiers siècles, il disparaît très vite avec l’abandon des alliances matrimoniales interdynastiques. Les dictionnaires turc-français / français-turc datant de la fin du XIX
e siècle reflètent assez bien la non-équivalence des termes de chaque langue. Les
dictionnaires de Sami Bey en sont l’exemple parfait. Dans le dictionnaire français – turc, à l’entrée « princesse », on trouve la définition suivante : « bir hükümdâr veya hükümdâr-zâdeniñ zevce veya kerîmesi ; bir memleketiñ hâkimesi » [« épouse ou fille d’un souverain ou d’un prince de sang ; souveraine d’un royaume »]. La définition correspond dès lors parfaitement à l’acception française ou occidentale du terme. Or, il existe également une entrée spéciale pour le terme « sultane » : « ‘Osmânlilar pâdişâhınıñ k âdın ve k ızlarından beheri ; sultân ; k âdın » [pour chaque personne parmi les filles et les concubines en titre des souverains ottomans ; sultanes ; concubines en titre ». L’explication n’est pas tout à fait correcte, en tout cas pour la période qui nous intéresse : les filles sont bien des sultanes, comme nous allons le voir, mais il n’était pas employé pour les concubines ; il ne le fut que pour les reines mères puis pour les favorites (haseki sultan). L’explication semble répondre, en fait, à une volonté de rendre le terme intelligible pour des mentalités occidentales. Sami Bey, Dictionnaire Français-Turc, Constantinople, Ed. Mihran, 1885 : 1475, 1758. Le phénomène paraît plus clair quand on compare avec les explications données dans l’autre dictionnaire de Sami Bey turc – français , à l’entrée sult ân » : « soultân, sm. Souverain, m. ; monarque, m. ; empereur, m. ; Sultan, m. Sultane, f. ; sœur ou fille du Sultan. On dit k âdın aux femmes du Sultan. vâlide sult ân : la reine mère ; la mère du Sultan. Quand il s’agit d’un Sultan, ce mot précède le nom propre, et quand il s’agit d’une sultane, il le suit ». Samy-Bey Fraschery, Dictionnaire Turc-Français, Constantinople, Ed. Mihran, 1885. Cette explication est, par contre, tout à fait conforme au système dynastique ottoman.
Page | 38
identité de “personnes royales de sexe féminin”, un état dont elles sont les seules bénéficiaires
à vie et qui se concrétise dans le port d’un titre associé à un statut. L’étude de ce titre royal va
ainsi nous permettre de délimiter les bornes de la catégorie des princesses, d’évaluer la place
sociale de ses membres au sein de l’élite dominante ottomane, de percevoir les modalités et la
chronologie de la constitution de ce concept de “princesse ottomane”, enfin d’en connaître les
stratifications internes.
1) La création du titre : les hésitations de la dynastie
Pour qualifier une femme de princesse, il faut avant tout qu’elle appartienne à la
descendance d’un souverain (prince, roi ou empereur). Mais cette qualité ne suffit pas pour
donner une valeur statutaire : on peut être une princesse sans que ce terme recouvre une
réalité concrète pour les Ottomans eux-mêmes. Les descendantes des sultans ottomans
détenaient-elles un statut distinctif, associé à des privilèges et des honneurs spécifiques ? La
société ottomane est une société fortement hiérarchisée dont la structure se distingue au vu de
la palette de titres associés à des statuts. La détention d’un titre est la marque d’une position
bien précise au sein de l’édifice social ottoman. Il est vrai, cependant, que la gamme des titres
accordés aux femmes est bien loin d’être aussi étendue et diversifiée que pour les hommes,
car les titres sont à la fois le signe d’une position sociale, mais aussi et surtout d’une position
professionnelle, ce dont les femmes étaient exclues pour la plus grande part. La majorité des
femmes sont seulement appelées Hatun, terme qui évolue vers celui de Hanım au cours du
XVIIIe siècle
8.
Les princesses ottomanes ne s’inscrivent pas dans cette indistinction titulaire propre
aux femmes : elles disposent d’un titre spécifique, qui les distingue et les élève au rang de
catégorie exclusive à laquelle seule la naissance donne accès. Mais les titres sont rarement
fixes et immuables : ils évoluent avec la conception que la société se fait du rang des
individus qui les portent. Le cas des princesses est particulièrement révélateur de ces
évolutions : le titre auquel elles répondent ne recouvre pas une réalité indéfectible ; il n’est
même pas intemporel : il apparaît soudainement au cours de la fin du XVe siècle – preuve de
la volonté de distinguer ces femmes des autres –, s’affine au cours du siècle suivant par la
création d’un “sous” titre, puis exclut de son port certaines descendantes qui réagissent en
mettant en place des stratégies de transmission commémorative d’un titre qui leur est refusé.
Faire l’histoire de ce titre, c’est faire l’histoire de la naissance et de l’élaboration d’une
catégorie de femmes ottomanes : les princesses.
8 John A. Boyle, « Khatun », EI (2) : t. 4 p. 1164 ; Abdülkadir Özcan, « Hatun », TDVİA : t. 16 p. 499-500 ; Voir
aussi Hedda Reindl-Kiel, « damet ismetûha–immer währe ihre Sittsamkeit: Frau und Gesellschaft im Osmanischen Reich », Orientierungen 1 (1989) : 37-81.
Page | 39
1) Apparition d’un titre catégoriel (fin XVe siècle)
Le choix d’une titulature est une affaire de politique et de revendication. Deux cas de
figure sont possibles. Soit le détenteur du titre se l’est accordé de son propre chef : dans ce
cas, il est le reflet de la manière dont il conçoit sa propre position au sein de l’édifice
hiérarchique dans lequel il s’inscrit et de la manière dont il veut être perçu – la concordance
des deux n’est pas évidente. Soit le détenteur du titre le reçoit d’un autre qui lui est supérieur
et c’est alors l’indication de la manière dont cette hiérarchie conçoit la position de ce
subalterne (par rapport aux autres membres, inférieurs et supérieurs)9. L’étude des titres peut
ainsi permettre à l’historien de percevoir les évolutions et les compétitions qui agitent une
structure hiérarchique.
On connaît les rivalités souterraines qui animent l’attribution des titres des princes
anatoliens au cours des XIVe et XV
e siècles – la lutte pour l’octroi du titre de Sultan plutôt
que Bey en est un exemple. C’est que les titres possibles sont nombreux : hân, bey, sultân,
hüdavendigâr, pâdişâh, etc.10
Quand Murad Ier se fait appeler Hüdavendigâr au lieu de Bey,
c’est le signe d’une volonté de se distinguer des autres princes voisins ; son changement de
titre indique aussi la puissance croissante de cette dynastie au sein de l’échiquier politique
international. Il ne suffit pas de s’autoproclamer sultan pour être sultan : encore faut-il que les
puissances voisines le reconnaissent11
. La reconnaissance internationale est une donnée qui
9 Pour que l’acquisition d’une position soit rigoureuse, il faudrait que celle-ci ne soit accordée qu’à condition de remplir certaines conditions exprimées de façon officielle et sans qu’aucun autre élément n’entre en ligne de compte, ce qui supposerait la possibilité qu’en certains temps, une telle position ne trouve pas de postulant adapté ou qu’à d’autres, elle soit accordée de façon équivalente à plusieurs individus qui répondraient tous aux exigences requises. Tel n’est pas le cas dans le système ottoman et nous doutons qu’un tel cas de figure ait jamais existé . La détention d’un office associé à un titre dépend d’un système complexe tenant compte de l’offre et de la demande. Prenons l’hypothèse d’un règne où il n’y aurait que trois offices de beylerbey avec rang de pacha disponibles. Soit il n’y aura que trois individus nommés à ces postes, ce qui ne signifie pas qu’ils soient les seuls, ni même les plus compétents, pour le travail attendu d’eux et les autres candidats, moins chanceux ou moins soutenus, devront attendre une politique de réaffectation pour espérer monter en grade. Soit le sultan décidera de créer de nouveaux offices de beylerbey avec rang de pacha, procédant alors à une politique de redistribution des responsabilités et des domaines de gouvernance, afin de répondre à la pression des solliciteurs. Mais cette politique de création de nouveaux offices peut aussi être due à une expansion territoriale brusque, qui oblige à répartir les tâches entre un plus grand nombre de dirigeants, sans que cela signifie nécessairement que les individus qui vont être sélectionnés pour cette promotion soient nécessairement compétents ou remplissent tout le cahier des charges requis en temps normal. L’organisation de la structure hiérarchique répond donc à un savant équilibre des besoins et des demandes qui tient compte des exigences administratives et symboliques, des nécessités ou envies de récompense des agents sociaux, et des pressions des membres présents aux divers échelons de la hiérarchie. 10
Osman G. Özgüdenli, « Sultan » : TDVİA t. 37 p. 496-497 ; Johannes H. Kramers, « Sultan », İA : t. 11 p. 27, « Sultan », EI (2) : t. 9 p. 849-851 et Sult n », EI t. 4 p. 568-571 ; Halil İnalcık, « Padişah », TDVİA : t. 34 p. 140-143. 11
Outre les références ci-dessus, voir Paul Wittek, « Notes sur la Tughra ottomane », Byzantine 18 (1948) : 311-334 ; Gilles Veinstein, « La tuğra ottomane », dans L’écriture du nom propre, A.-M. Christin (éd.), Paris, L’Harmattan, 1998 : 149-162 et « Charles Quint et Soliman le Magnifique : le grand défi », dans Carlos V. Europeismo y Universalidad. Volume III : Los escenerarios del Imperio, J.-L. Castalleno et F. G. Sanchez-Montez (éds.), Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoracion de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2001 : 519-529 ou encore « Chronologie différentielle des titres impériaux selon les supports utilisés. Quelques exemples empruntés à la documentation ottomane », dans Événement, Récit, Histoire officielle. L’écriture de l’histoire
Page | 40
joue profondément jusqu’au début du XVIe siècle, tant que l’Empire ottoman est encore
confronté à des rivaux aussi puissants que lui sinon plus (les Mameloukes notamment). La
question des titres accordés aux princesses ottomanes au cours de cette période allant de
l’apparition de la dynastie jusqu’à la fin du XVe siècle s’inscrit dans cette problématique
revendicative.
Jusqu’à la seconde moitié du XVe siècle, aucune qualification distinctive n’est
employée pour définir les princesses ottomanes : les princesses ottomanes ne se voient
gratifiées que du titre de Hatun, employé communément pour désigner les femmes
appartenant à l’élite ottomane, que ce soit les épouses ou les concubines des sultans, mais
également les mères, sœurs et filles des commandants sous les ordres des Ottomans. Ainsi
toutes les princesses ottomanes, depuis Nefise Melek, fille de Murad Ier, jusqu’à Selçuk, fille
de Mehmed Ier, ont-elles le titre de Hatun accolé à leur nom. Mais les filles de Bayezid II, à la
fin du XVe siècle, sont appelées tantôt Sultanes, tantôt Hatun : une rupture surgit ainsi autour
de la période du règne de Bayezid II, dont les subtilités nous échappent encore.
Pour tenter de la comprendre, il faut regarder de plus près la manière dont les
princesses issues des premiers sultans sont appelées dans les sources dont nous disposons
pour cette époque. L’exercice est ardu, car la plupart des chroniques ne prennent pas le temps
de mentionner nominalement les princesses : elles sont seulement qualifiées de « fille[s] du
sultan ». Ainsi Neşrî12
, précisant la descendance de Mehmed Ier, écrit-il :
« Sultan Mehmed [Ier] avait cinq fils : Murad, Mustafa, Ahmed, Yusuf et
Mahmud. Ahmed mourut sous le règne de son grand-père [Bayezid Ier]. À la mort
de Mehmed, il laissa quatre fils et sept filles. »13
On chercherait en vain le nom de ces sept filles : il ne le précise nulle part, pas même quand il
indique les mariages qu’on contracta pour elles :
« Il [Mehmed Ier] donna trois de ses filles à des fils [du bey] de Karaman, l’une à
Ibrahim, une autre à Alaeddin et la dernière à Isa. Il en donna deux autres à des
fils de Isfendiyar, l’une à Ibrahim, l’autre à Kasim. Il donna encore une [de ses
filles] à Karaca Bey, gouverneur d’Anatolie, qui mourut en martyr lors de la guerre
sainte à Varna, et la dernière au fils d’Ibrahim Pacha Mahmud Çelebi. Cette fille
mourut à La Mecque, la gloire de Dieu, où elle fut inhumée. »14
L’anonymat de ces femmes est, chez lui, poussé à l’extrême puisqu’il va jusqu’à omettre le
nom, connu par ailleurs, de la fille de Murad Ier, Nefise Melek Hatun, alors même qu’il lui
dans les monarchies antiques. Actes du colloque du Collège de France des 24-25 juin 2002, N. Grimal et M. Baud (éds.), Paris, Cybèle, 2004 : 259-269 ; Murphey, Exploring Ottoman Sovereignty : 77-98. 12
Neşrî est une source importante dans la mesure où il s’agit d’un historien contemporain d’une partie des évènements qu’il rapporte, puisqu’il vécut sous le règne de Bayezid II et Selim Ier (il serait décédé en 1520). Originaire de Germiyan, il fut formé à Bursa où il exerça ensuite l’office de müderris de la Sultan Medresesi : il est donc un des cadres religieux ottomans de la fin du XV
e siècle. cf. Cemal Toksoy, « Neşrî », OA : t. 2 p. 363-
364 ; Şeh beddin M. C. Tekindağ, « Neşri », İA : t. IX p. 214-216 ; Colin Woodhead, « Neshri », EI (2) : t. VIII p. 7-8 ; Ménage, Neshri’s History of the Ottomans. 13
Mevlânâ Mehmed Neşrî, Cihânnümâ. Osmanlı tarihi (1288-1485), N. Öztürk (éd.), Istanbul, Çamlıca, 2008 : 257. 14
Neşrî, Cihânnümâ : 267. Les éléments soulignés sont des ajouts dans un manuscrit de la chronique qui n’apparaissent pas dans le texte utilisé comme référence par l’éditeur mais qui sont indiqués en note .
Page | 41
accorde quelques lignes pour indiquer son rôle dans la résolution du conflit entre son père et
son époux : par trois fois, il l’appelle Sultan Hatun15
. La seule princesse dont le nom est
consigné est Selçuk, une autre fille de Mehmed Ier, dont il précise le rôle lors du conflit de
succession entre Bayezid II et son frère Cem. Le passage ne laisse d’ailleurs aucun doute sur
son identité : elle est « Selçuk Hatun, la sœur de Sultan Murad [II] et la tante de Sultan
Mehmed [II] »16
.
Finalement, c’est chez Aşıkpaşazade Derviş Ahmed, qui écrit sous le nom de plume
Âşıkî, que nous trouvons les renseignements les plus complets. Comme Neşri, il est
contemporain des événements qu’il raconte, ayant vécu sous le règne de Murad II et
jusqu’aux premières années de celui de Bayezid II17
. S’il ne fournit pas beaucoup plus
d’informations nominales que ses confrères, elles ont le mérite d’être unanimes quant au titre
accordé aux princesses : Hatun. Ainsi la fille de Bayezid Ier envoyée à Byzance comme otage
est « Fatma Hatun, la sœur d’Emir Süleyman »18
et la fille de Mehmed Ier qui servit
d’intermédiaire entre les deux fils de Mehmed II en compétition pour le trône est bien
« Selçuk Hatun »19. D’une manière ou d’une autre, tous les chroniqueurs semblent s’accorder
pour attribuer le titre de Hatun aux princesses ottomanes issues des premiers sultans, jusqu’au
milieu du XVe siècle.
Pourtant, dans le récit de Hoca Sadeddin Efendi, cette même Selçuk porte le titre de
Sultane : « Selçuk Sultane, qui se trouve être la fille de Sultan Çelebi [Mehmed Ier] »20
. Il est
vrai que ce chroniqueur est postérieur aux événements qu’il raconte (il écrit au XVIe siècle),
mais cela ne le discrédite nullement21
. Au contraire, cette divergence est révélatrice des
enjeux de l’attribution des titulatures des princesses à cette période. À partir du règne de
Bayezid II, les filles des souverains commencent à être appelées Sultanes. Cette pratique
s’impose durablement : c’est ce titre qui sert à les identifier par la suite. L’évolution peut donc
être datée de la fin du XVe siècle. Le décalage chronologique entre la réalité des titres portés
par les princesses du XIVe et XV
e siècle et ceux que des chroniqueurs postérieurs, tel
Sadeddin, leur attribuent pourrait relever tout simplement d’une erreur de la part de ces
derniers : écrivant après les événements en question, ils calqueraient les titres en usage à leur
époque sur des périodes plus anciennes. Ce n’est pourtant pas notre opinion. Il nous semble
qu’il faille y voir plutôt l’expression d’une volonté politique qui s’exprime au cours de ce
tournant du XVIe siècle et qui, de ce fait, ne peut se lire chez les chroniqueurs antérieurs.
Cette volonté politique consisterait alors à rehausser le prestige de ces filles de sultan à une
époque où, justement, les souverains ottomans acquièrent eux-mêmes le titre de Sultan.
15
Neşrî, Cihânnümâ : 107-108. 16
Neşrî, Cihânnümâ : 373. 17
Abdülkadir Özcan, « Âşıkpaşazade » : 261-262 ; du même auteur, « Âşıkpaşaz de », TDVİA 4 : 6-7 ; Mehmet F.
Köprülü, « Âşık Paşaz de », İA : t. 1 p. 706-709 ; Franz Taeschner, « Ashik-Pasha-zade », EI (2) : t. 1 p. 720. 18
Derviş Ahmed Âşıkî, Âşıkpaşazâde Tarihi, C. Çiftçi (éd.), Istanbul, Mostar, 2008 : 145. 19
Âşıkî, Âşıkpaşazâde Tarihi : 303. 20
Son nom et titre sont encore rappelés quelques lignes plus bas. Hoca Sadettin Efendi, Tacüt-tevarih, İ. Parmaksızoğlu (éd.), Ankara, Kültür Bakanlığı, 1999 : t. 3 p. 195. 21
« Sadeddin Efendi (Hoca) », OA : t. 2 p. 477-479 ; Şerafettin Turan, « Sa’deddin », İA 10 : 27-32 ; du même
auteur, « Hoca Sâdeddin Efendi », DİA 18 : 196-198 ; Barbara Flemming, « Khodja Efendi », EI (2) : t. 5 p. 27-28.
Page | 42
Qu’il y ait un certain décalage entre le moment où les souverains s’approprient ce titre
et celui où il est accordé à leurs filles n’a rien de surprenant. Le fait que cette révision des
titulatures touche l’ensemble des membres de la dynastie est toutefois révélateur : il ne s’agit
pas seulement d’affirmer le statut des souverains, mais de l’ensemble de la dynastie, qui
devient la principale famille de la région, la famille souveraine par excellence. C’est donc la
dynastie tout entière qui affirme sa supériorité sur les autres et se proclame l’égale des anciens
Seldjoukides et des actuels Mameloukes (autres porteurs du titre sultanien). Et ce n’est peut-
être pas un hasard si Sadeddin accorde ce titre pour la première fois à Selçuk. Elle est la seule
princesse dont la figure émerge de façon flagrante dans son récit, ce qui s’explique par le rôle
d’intercesseur qu’elle joua entre les princes Bayezid et Cem, lors de la querelle de succession
à la mort de Mehmed II22
. Elle peut ainsi être considérée comme une des premières grandes
princesses ottomanes à s’être distinguée dans l’histoire de cette dynastie23
. Selçuk Hatun /
Sultane est donc un personnage central qui semble avoir servi, après coup, de catalyseur pour
la mise en œuvre de ce changement de titulature des princesses.
La dimension spatiale doit également être invoquée pour comprendre l’apparition de
ce titre à ce moment donné. Ce qui distingue Selçuk Hatun / Sultane des princesses
antérieures ou de ses sœurs, c’est son action au sein de la dynastie ottomane. Or, celle-ci eut
lieu à une époque où elle avait réintégré les territoires ottomans, à la mort de son époux ; elle
n’était plus porteuse que d’une seule identité : princesse ottomane. Après elle, les filles de
Bayezid II bénéficient également de l’attribution de ce titre. Certes, cela coïncide avec la
période où l’État ottoman conforte sa prétention au rang d’Empire et où les souverains se sont
octroyés de façon définitive le titre de Sultan et de Padichah. Mais c’est aussi et surtout peut-
être le moment où la dynastie abandonne définitivement les mariages interdynastiques24
, qui
scelle l’immobilité des princesses : elles ne sont plus envoyées auprès des cours voisines jouer
leur rôle d’épouse d’un prince étranger, elles ne deviennent plus les mères de princes
anatoliens et ne troquent plus leur identité ottomane au profit d’une identité étrangère. Elles
sont désormais des princesses ottomanes de naissance à trépas. Leur acquisition du titre de
Sultane coïncide donc avec le moment où elles s’enracinent dans l’espace ottoman et
deviennent des relais indéfectibles de la dynastie ottomane, quand tout risque de confusion
identitaire “patriotique” a disparu.
Le concept de princesse ottomane naît donc à la fin du XVe siècle, à partir du règne de
Bayezid II. Il s’ancre dans un titre, expression indissoluble de leur attachement à la dynastie.
Elles deviennent, à proprement parler, des créatures de la dynastie. Ce titre, il faut encore
préciser qu’il est doublement distinctif. À cette époque reculée, il n’est porté que par les
membres “titulaires” de la dynastie, ceux qui sont récipiendaires de la souveraineté ottomane
– qu’ils aient ou non la capacité d’en faire usage : les sultans, les princes et les princesses.
Aucune autre femme, même associée à la dynastie, ne porte alors un tel titre ; cela viendra
22
Nous étudierons plus en détail son intervention dans un chapitre suivant (4. I. 3. 2.). 23
D’autres princesses ottomanes jouèrent également un rôle de premier plan, mais parce que mariées à des princes étrangers, leur action est assimilée à l’histoire de ces principautés voisines et non à celle de l’histoire ottomane. Elles sont perçues comme des semi-étrangères par les chroniqueurs. Nous étudierons également ces questions dans un chapitre ultérieur (4. I. 3. 1.). 24
Cf. 2. I. 1. et 2. I. 2.
Page | 43
plus tard. Mais tout en les intégrant à la dynastie, en en faisant des membres “titulaires”, ce
titre distingue néanmoins les princesses des autres détenteurs de sexe masculin. En effet, pour
les hommes de la dynastie, ce titre précède le prénom (Sultan Ahmed, Sultan Mehmed, etc.)
tandis que pour les princesses, il succède à leur prénom : Selçuk Sultane, Ayşe Sultane, Hüma
Sultane…25
De sorte qu’une distinction entre les membres de la dynastie, qui recoupe, nous le
verrons, une logique liée à la capacité d’exercer ou non la souveraineté, est ainsi exprimée. Ce
titre a néanmoins la caractéristique d’être détenu ad vitam aeternam : dès sa naissance, une
princesse est gratifiée du titre de Sultane, qu’elle conserve jusqu’à sa mort. C’est la marque du
sang ottoman.
2) Élargissement des catégories d’ayants droit au titre (fin XVe –
XVIe siècle)
Cette marque du sang ottoman est-elle transmissible et qui concerne-t-elle ? Pour
parfaire la compréhension du concept ottoman de princesse, il ne suffit pas de regarder du
côté des filles de sultan : il faut encore s’intéresser aux descendantes indirectes. Ces femmes
ne sont pas faciles à débusquer dans la documentation ottomane : quasi inexistantes, à
quelques très rares mentions près, dans les chroniques, guère plus présentes dans les récits des
voyageurs occidentaux, il faut aller les chercher au gré d’annotations archivistiques éparses.
Encore celles-ci ne sont-elles que des bribes d’information insuffisantes pour se faire une
idée, même partielle, de la personne : au mieux, les données proviennent d’actes de fondation
d’un legs pieux (vakfiyye) et l’on peut alors espérer connaître l’action de la fondatrice dans ce
domaine – quand encore elle en est la fondatrice et non une bénéficiaire citée au détour d’une
phrase ; au pire, la mention du nom n’est suivie d’aucune explication familiale (interdisant
toute possibilité de reconstituer le lignage auquel appartient la princesse, à moins de disposer
d’informations extérieures) et n’est là que pour justifier une annotation quelconque
(attributions financières, dons, etc.).
Difficilement exploitables dans d’autres contextes, ces précisions se révèlent pourtant
inestimables pour le sujet qui nous intéresse, car s’il est une chose que les scribes ottomans
n’omettent quasiment jamais, c’est la mention du titre accolé au nom. De là, le tableau qui
suit.
25
Le turc ne connaît pas l’usage du masculin ou du féminin. L’ottoman non plus, sauf dans certains apports de mots arabes. De sorte que le titre est toujours « Sultan ». Cependant, le français procédant à une distinction de sexe et le mot étant déclinable dans les deux formes, masculine (Sultan) et féminine (Sultane), pour rendre la compréhension plus aisée et pour respecter les usages de la langue française, nous avons choisi d’utiliser ces deux formes.
Page | 44
Tableau 1.1 Évolution de la titulature des descendantes indirectes des sultans
Nom et ascendance royale Titre
Ayşe, petite-fille de Bayezid Ier (mère : Oruz Hatun) Ayşe Hatun26
Seyyide Hadice, petite-fille de Mehmed Ier (mère : Selçuk
Hatun / Sultane)
« Seyyide Hâdîce Hâtûn »27
Hânî, petite-fille de Mehmed II (père : Şehzâde Mustafa) « Hânî Hâtûn »28
Gevhermüluk, petite-fille de Mehmed II (père : Şehzâde
Cem)
« Gevhermülûk Sultân »29
“Sofu” Fatma, petite-fille de Bayezid II (père : Şehzâde
Ahmed)
« Sultân Fâtima Hâtûn »30
« Sûfî Sultân »31
Hadice, petite-fille de Bayezid II (mère : Selçuk Sultane) « Sultân Hâdice Hâtûn »32
« Hâdice Sultân »33
“Hançerli” Fatma, petite-fille de Bayezid II (père : Şehzâde
Mehmed ou Mahmud)
« Hânzâde Fâtima Sultân »34
Aynişah, petite-fille de Bayezid II (père : Şehzâde Abdullah) « ‘Aynîşâh Hâtûn »35
Aynişah, autre petite-fille de Bayezid II (mère : İlaldi
Sultane)
« Şehzâde ‘Aynîşâh Hâtûn »36
Neslişah, petite-fille de Bayezid II (mère : Gevherimülûk
Sultane)
« Neslişâh Sultân »37
Hümaşah, petite-fille de Süleyman Ier (père : Şehzâde
Mehmed)
« Hümâşâh Sultân »38
Ayşe, petite-fille de Süleyman Ier (mère : Mihrimah Sultane) « ‘Âyşe Sultân »39
Fatma, arrière-petite-fille de Süleyman Ier (mère : Hümaşah,
grand-père : Şehzâde Mehmed)
« Fâtıma Sultân »40
26
Tayyip M. Gökbilgin, Asırlarda Edirne ve Paşa livâsı. Vakıflar – mülkler – mukataalar, Istanbul, Üçler basımevi, 1952 : 321 (en note). 27
VGMA D 608-2 s. 341 sıra 286 : 888 (1483), D 608-2 s. 384 sıra 333 : 888 (1483), D 581-2 s. 376 sıra 374 : 906 (1500), D 581-2 s. 382 sıra 381 : 899 (1493), D 581-2 s. 383 sıra 382 : 908 (1502). 28
Gökbilgin, Edirne ve Paşa livâsı : 379-380. 29
Gökbilgin, Edirne ve Paşa livâsı : 380-381. 30
Ömer L. Barkan et Ekrem H. Ayverdi (éds.), İstanbul vakıfları tahrîr defteri 953 (1546) târîhli, Istanbul, Baha Matbaası, 1970 : 273-275. 31
Mehmet Canatar (éd.), İstanbul Vakıfları Tahrîr Defteri 1009 (1600) Târîhli, Istanbul, İstanbul Fetih Cemiyeti,
2004 : 475. 32
Barkan et Ayverdi (éds.), İstanbul vakıfları tahrîr defteri 953 (1546) târîhli : 402-403 et Canatar (éd.), İstanbul Vakıfları Tahrîr Defteri 1009 (1600) Târîhli : 664. 33
Barkan et Ayverdi (éds.), İstanbul vakıfları tahrîr defteri 953 (1546) târîhli : 402. Dans le même document, le quartier qui porte le nom de la princesse parce qu’elle y a fait construire un mescid) est défini d’une manière différente. C’est que l’entête de la partie Mahalle-i mescid-i Hadîce Sultan aleyh rahmet’ür-rahmân ») correspond à l’appellation commune du quartier, au moment de la rédaction du registre, soit en 1546, plusieurs décennies après la mort de la fondatrice dont la description du legs pieux suit aussitôt et à une période où les pratiques titulaires ont évolué durablement. Idem dans Canatar (éd.), İstanbul Vakıfları Tahrîr Defteri 1009 (1600) Târîhli : 664 et 665. 34
Barkan et Ayverdi (éds.), İstanbul vakıfları tahrîr defteri 953 (1546) târîhli : 436-437 et Gökbilgin, Edirne ve Paşa livâsı : 381-382. L’auteur précise qu’elle est connue sous le nom de “Hançerli”. 35
Gökbilgin, Edirne ve Paşa livâsı : 380-381. 36
Gökbilgin, Edirne ve Paşa livâsı : 381 note 595. 37
VGMA D 574 s. 71 sıra 35 : 949 1542 , D 574 s. 73 sıra 36 : 949 1544 , D 574 s. 74 sıra 37 : 949 (1553). 38
VGMA D 747 s. 368 sıra 252 : 978 (1570). 39
VGMA D 635-2 s. 33 sıra 2 : 1003 (1594), D 635-2 s. 49 sıra 3 : 1003 (1594), D 635-2 s. 58 sıra 4 : 1022 (1613), D 635-2 s. 59 sıra 5 : 1022 (1613), D 635-2 s. 60 sıra 6 : 1034 (1624), D 635-2 s. 61 sıra 7 non daté , D 635-2 s. 167 sıra 18 : 1021 (1612). 40
Necdet Ertuğ éd. , Istanbul tarihî çeşmeler külliyatı, Istanbul, Forart Basımevi, 2006 : 111.
Page | 45
Lire ce tableau nécessite d’être attentif à l’écart générationnel entre le sultan dont est
issue la princesse indirecte considérée et le règne de celui sous lequel elle vit. Ainsi Seyyide
Hadice Hatun, petite-fille de Mehmed Ier (1412-1420), vivait encore sous le règne de Bayezid
II (1481-1512) ; quant aux petites-filles de ce sultan, elles connurent le règne de Süleyman Ier
(1520-1566). Le titre porté n’est donc pas le reflet d’une situation sous le règne de leur grand-
père, mais sous ses successeurs. Notons encore la spécificité de ces sources par rapport aux
chroniques : il n’est plus question ici de récits de règnes, nécessairement politisés, mais de
documents officiels. Traduiraient-ils mieux la réalité titulaire que les chroniques ? Pas
nécessairement : les actes de fondation de legs pieux sont produits sous l’égide des
fondatrices. Deux cas de figure se présentent : soit il s’agit des vakfiyye (originales ou
copiées) des fondatrices, soit de registres administratifs élaborés en partie à partir de ces
documents, mais sans qu’on puisse être certain que la copie fut sans retouche.
Un exemple illustre ce problème : l’appellation accordée à Sofu Fatma, petite-fille de
Bayezid II. Le registre édité par Barkan et Ayverdi, datant de 1546, lui attribue deux titres : la
notice décrivant son legs pieux, qui semble être une copie de sa vakfiyye originale aujourd’hui
disparue (ou pas encore retrouvée) l’appelle Hatun ; mais dans le titre de la rubrique qui réunit
l’ensemble des legs pieux du quartier, elle est appelée Sultane. Cette rubrique est le fait des
scribes ottomans de l’époque, qui avaient le souci d’organiser selon une répartition spatiale
(par quartiers) l’ensemble des legs pieux d’Istanbul : ils ont naturellement inscrit le nom du
quartier tel qu’il était connu à leur époque et qui accordait alors à la princesse le titre de
Sultane. Un phénomène de renomination des princesses selon les canons de l’époque émerge
ici. Une princesse indirecte qui, à son époque, ne portait que le titre de Hatun, se voit décerner
celui de Sultane, c’est-à-dire le titre qu’elle aurait porté si elle avait vécu quelques décennies
plus tard. Gardons-nous d’y voir une volonté politique de rehausser le statut de ces femmes :
l’appellation de ces quartiers ne fait pas partie des champs d’interaction du pouvoir royal. Il
est le fait de la mémoire locale, de la connaissance populaire, dont on voit qu’elle n’était pas
au fait des finesses de l’évolution de l’attribution des titres.
Trois phases se dégagent de ce tableau. Le premier temps, le plus ancien, celui des
petites-filles de Bayezid Ier et de Mehmed Ier qui vécurent sous le règne de Bayezid II, ne
laisse planer aucun doute quant au titre qui leur était dévolu : ce sont des Hatun, à l’instar de
leurs mères. Le deuxième temps est plus complexe, plus incertain ; le doute flotte : les petites-
filles de Mehmed II et de Bayezid II sont appelées tantôt Hatun, tantôt Sultane. Mais il est
vrai que les sources qui leur accordent le titre sultanien sont systématiquement postérieures à
leur époque : on retrouve ici la confusion susmentionnée entre le titre qu’elles portèrent et
celui que les générations ultérieures leurs concédèrent. Le changement de titulature se situe
donc entre la fin du XVe et le début du XVI
e siècle, entre le règne de Bayezid II et le début de
celui de Süleyman Ier. Puis s’amorce le temps de la certitude (qui ne durera pas),
probablement sous le règne de Süleyman Ier : les princesses indirectes sont alors appelées
Sultanes. Elles rejoignent donc le groupe des princesses ottomanes, identifiées et perçues
comme telles, aux côtés des filles de sang, les filles des sultans. Les troisièmes générations
sont également concernées. Ainsi Fatma Sultane, la dernière princesse de notre tableau, est en
effet une arrière-petite-fille de Süleyman Ier (petite-fille de l’aîné de ses fils nés de sa favorite
Page | 46
Hürrem, le prince Mehmed). Est-ce à dire que les petites-filles de prince pouvaient, comme
les petites-filles de sultan, prétendre au titre sultanien ? La logique serait alors d’accorder ce
titre jusqu’à la seconde génération descendante d’un homme de la dynastie, créant de la sorte
un décalage entre lignages féminins et lignages masculins. Nous aurons l’occasion de revenir
sur cette question de la place des arrières petites-filles dans la suite du chapitre.
Revenons un instant sur la période intermédiaire, dont la confusion va plus loin que
l’hésitation entre un titre de Hatun et de Sultane. On note en effet l’usage d’un lâkâb de nature
royale précédant le nom des princesses de cette période. Deux d’entre elles portent le terme
Sultane avant leur nom : Sultane Fatima Hatun, Sultane Hadice Hatun ; une autre, celui de
Hanzade qui signifie, littéralement, « descendant(e) ou issu(e) du Han », Han étant un terme
de royauté régulièrement porté par les sultans après leur nom (Sultan Murad Han) ; une
dernière, celui de Şehzâde, « descendant(e) ou issu(e) du Şah », Şah étant un autre terme de
royauté également employé par les sultans (on notera que le terme de Şehzade est également
usité pour les princes). Ces inclusions de termes de renvoi à la royauté, juxtaposés devant le
couple nom-titre officiel, laissent percevoir le désir de se / les distinguer des autres femmes,
de souligner l’appartenance dynastique par le recours aux lâkâb41
. Or, un phénomène
similaire semble s’être produit dans le cas des filles des sultans, à une époque plus reculée
cependant. On se rappelle en effet que Neşrî, à défaut de fournir le nom des filles de Murad
Ier et de Mehmed Ier mariées à des princes étrangers, les appelait d’un terme apparemment
générique : Sultan Hatun42. L’octroi du titre de Sultane serait donc ultérieur à une
revendication latente, exprimée par ces tentatives semi-officielles de commémoration
d’appartenance au lignage dynastique ottoman. Quant à savoir si ces revendications étaient le
fruit des princesses elles-mêmes, en mal de distinction, ou des cercles du pouvoir, qui y
voyaient l’occasion de favoriser les revendications politiques de la dynastie, il est impossible
de le dire.
3) Affinement et stabilisation du concept (fin XVIe- XVIII
e siècle)
Le processus d’affinement du concept de princesse ottomane, engagé dès le règne de
Bayezid II, ne s’arrête pas une fois les descendantes indirectes inscrites parmi les membres de
cette catégorie. De fait, il prend part à un mouvement plus général de redéfinition de la
hiérarchie dynastique ottomane sur lequel nous reviendrons par la suite. Or, dans le système
dynastique ottoman, les rangs et statuts des membres de la ‘Âl-i ‘Ôsmân sont tous définis par
rapport au degré de proximité généalogique avec la personne royale. La structure hiérarchique
ne pouvait se satisfaire d’un ordonnancement qui mettait sur un pied d’égalité les filles de
sang avec les descendantes indirectes. En poursuivant son travail de définition de la hiérarchie
41
Sur la question des lâkâb et autres formes de nomination dans l’Empire ottoman, cf. Olivier Bouquet,
« Onomasticon Ottomanicum : identification administrative et désignation sociale dans l’État ottoman du
XIXe siècle », Revue des Mondes Musulmans et de la Méditerranée 127 (2010) : 213-235.
42 Neşrî, Cihânnümâ : 107-108.
Page | 47
de ses membres, la dynastie en est venue à affiner et clarifier les positions respectives de
chacun, créant des distinctions au sein de la catégorie des princesses et excluant sans appel
certains individus.
Exceptionnellement, partons de l’état ultérieur et remontons la courbe du temps pour
tenter de saisir les étapes, les points de transition, qui ont produit ce résultat. Les ouvrages
biographiques datant de la fin de l’Empire, tel le Sicill-i ‘Osmanî de Mehmed Süreyya, qui
s’ouvre sur les membres de la dynastie, proposent une vision claire des distinctions titulaires
de ces individus43
. Chez cet auteur, à partir du XVIe siècle, les filles de sultan portent toutes le
titre de Sultane ; les petites-filles, qu’elles soient nées d’un prince ou d’une princesse, sont
qualifiées de Hanım Sultane. Les fils des sultanes ne sont gratifiés, pour leur part, d’aucun
titre les associant à la dynastie : ceux qui sont inscrits dans la catégorie des membres de la
famille régnante ne portent que le titre de Bey. Certains jouirent néanmoins d’une carrière
plus heureuse et parvinrent à des offices importants, obtenant le titre de Pacha, d’autres celui
d’Aga : ceux-là sont exclus de la section des membres de la dynastie et rejoignent les rangs
des personnalités importantes de l’Empire. Tous les descendants indirects des princesses en
deçà de la deuxième génération mentionnés dans cet ouvrage sont confrontés à cette même
situation : exclus des membres de la dynastie, ils se fondent dans la masse consacrée aux
personnages notoires de l’Empire. Une césure apparaît donc ici, qui respecte un double
principe de degré de descendance et de genre et que l’on peut visualiser sous cette forme :
Schéma 1.2. Répartition des titres parmi les descendants des sultans
Selon cette logique, la dynastie procède à une distinction de genre parmi les
descendants des sultanes : seules leurs filles portent un titre royal qui, tout en les associant à la
dynastie et en les intégrant à la catégorie des princesses, les distingue néanmoins des filles des
sultans. Grâce à quoi, par le titre, est-il possible de connaître précisément le rang officiel de
chaque princesse dans la hiérarchie dynastique. Les fils des sultanes en sont toutefois exclus.
Contrairement à leurs sœurs, parce qu’ils sont des hommes, ils peuvent exercer un office. Le
principe successoral ottoman exclut théoriquement ces hommes de la succession parce qu’ils
sont issus en lignée féminine, mais cela semble n’avoir pas été suffisant pour rassurer les
souverains quant à la capacité de ces descendants à se poser en candidats éventuels. Leur
43
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1.
Page | 48
puissance potentielle était perçue comme un risque éventuel, de sorte que pour faire usage de
leur potentiel d’action, on ne leur offrait d’autre choix que d’abandonner toute identité royale
et d’investir les carrières étatiques. Ils s’inséraient ainsi dans les rangs des kul des sultans dont
l’état leur permettait alors de prétendre à l’octroi d’offices, eux-mêmes donnant droit à des
titres associés à des rangs dans la hiérarchie socioprofessionnelle ottomane44
.
La dynastie ne suit pas sa logique de transmission du sang de façon scrupuleuse : les
filles de princes devraient être détentrices d’un statut équivalent à celui d’une sultane et en
recevoir le titre. C’est le cas au XVIe siècle, mais ça ne l’est plus aux siècles ultérieurs : elles
sont désormais appelées Hanım Sultane, ce qui les relègue au niveau des filles de sultanes. La
logique générationnelle a pris le pas sur celle de la transmission du sang. Les sultanes y
gagnent à être installées sur un piédestal incomparable : elles sont désormais les seules à
détenir un titre qui glorifie de la façon la plus éclatante possible leur appartenance à la
dynastie – même les princes, leurs frères, qui héritent de la souveraineté et sont susceptibles
de monter sur le trône, ne sont gratifiés que du titre de Şehzâde (ce titre les associe à la
dynastie et proclame leur ascendance royale, mais tout en les distinguant des détenteurs d’un
titre sultanien). Les craintes des sultans envers toute personne susceptible de se poser en rivale
à leur autorité, tout candidat potentiel au trône, s’expriment ici de façon cristalline. On
comprend alors leur choix de mettre en avant les membres “inoffensifs” de la dynastie,
comme les sultanes.
Reste à déterminer à quel moment cette ligne de partage entre descendantes directes et
indirectes s’est mise en place, puisque nous utilisons là des matériaux qui ne nous montrent
que l’état final. Les premières vakfiyye à faire état d’une descendante indirecte datent de la
seconde moitié du XVIIe siècle, en la personne de Fatma, fille de Kaya Ismihan Sultane (fille
de Murad IV) et de Melek Ahmed Pacha : elle y est nommée sous la forme « Fatima Hanım
Sultane »45
. À cette période, la pratique de distinguer par la titulature les filles des petites-
filles de sultan serait donc déjà en application – mais ce type de documentation ne nous
permet pas d’être précise46
. Les chroniques ne sont pas plus utiles, car elles ne font pas état du
titre de ces femmes, d’ailleurs rarement mentionnées dans ces sources ; seul l’usage d’un
patronyme apparaît : « Sultân-zâde »47
. Il nous faut conclure de façon imprécise : la transition
prit place, selon toute vraisemblance, quelque part entre la fin du XVIe et la deuxième moitié
du XVIIe siècle – période qui correspond par ailleurs à d’autres évolutions internes de la
hiérarchie dynastique.
44
Cf. 4. I. 1. 3. 45
VGMA D 2138 n°3 : 1066 (1656), également conservé au Kasa 47 ; D 573 s. 75 sıra 9 : 1128 (1715) ; D 623 s. 289 sıra 299 : 1138 (1725) ; D 623 s. 276 sıra 298 : 1138 (1726) ; D 573 s. 80 sıra 10 : 1138 (1726) ; D 623 s. 290 sıra 300 : 1138 (1726) 46
Les autres vakfiyye de princesses datant de la période antérieure, entre le milieu du XVIe et le milieu du XVII
e
siècle, ne font état d’aucune princesse indirecte. 47
Ainsi les deux descendantes indirectes nées des filles de Selim II, à savoir la fille de Gevherhan Sultane et de Piyale Pacha et celle d’İsmihan Sultane et d’Ali Pacha, son second époux, sont nommées de la sorte, Sultanzade remplaçant alors toute autre mention nominative leur prénom n’est pas mentionné . Cf. Selânikî, Tarih-i Selânikî : t. 1 p. 156 ; t. 2 p. 775. En revanche, on ne s’explique pas l’usage de la formule Safiye Hanım » dans le cas de la fille de Gevherhan Sultane fille d’Ahmed Ier et de Receb Pacha, dans le récit de Naima – s’agirait-il d’une erreur ? Cf. İpşirli éd. , Tarîh-i Na’îmâ : t. 3 p. 990. Ce sont là les seules mentions de princesses indirectes dans les chroniques consultées dans le cadre de ce travail.
Page | 49
4) Stratégies commémoratives des exclus
Les fils des sultanes puis les générations descendantes à partir du troisième degré sont
les grands perdants de ce système de dénomination des membres officiellement affiliés à la
dynastie. Mais leur exclusion de la structure titulaire dynastique, telle que pensée et prônée
par la dynastie, ne présuppose en rien une acceptation sans résistance de leur part. On voit
naître des stratégies de perpétuation de la mémoire de leur lignage dynastique – mémoire
d’une noblesse et d’un rang perdu par le fait de la succession des générations48
. La question
du rapport entre discours officiel et discours officieux, entre stratégies dynastiques et
stratégies lignagères, surgit ici : les intérêts divergent nécessairement et l’antagonisme
apparaît au niveau de la question des titres et titulatures.
Exclu(e)s de tout port de titre les rattachant officiellement à la dynastie, ces
descendant(e)s usèrent d’autres procédés destinés à commémorer leur appartenance au
lignage royal. L’usage du titre postérieur au nom leur était interdit ? Qu’à cela ne tienne, ils en
usèrent comme d’un patronyme ou, plus exactement, d’un matronyme. S’il est difficile de
dater le moment où cet usage s’affirma – les premières attestations datent de la seconde moitié
du XVIe siècle, mais ce n’est que plus tard qu’il devint systématique –, la forme qu’il prend
est par contre plus aisée à déchiffrer. Plusieurs versions existent : 1/ la plus courte, le terme de
Sultanzade est accolé au nom de façon antérieure ; 2/ une forme plus précise indique de quelle
princesse est issu l’individu en question (par exemple, « Mihrimah Sultanzade »49
ou « Fatima
Sultanzade Süleyman Beğ »50
) ; 3/ enfin une dernière forme est encore possible, qui utilise
cette fois Hanım Sultane comme référentiel (par exemple, Hanım Sultanzade Yahya Tevfik
Efendi51
ou Hanım Sultanzade Yakup Bey52
) : on comprend alors que le nom des princesses
(aussi bien le nom de la sultane que celui de la Hanım Sultane) n’est pas connu de l’auteur,
qui est seulement informé de sa qualité de descendant d’un lignage royal.
Ces modes de nomination à partir d’un ancêtre puissant sont évidemment à mettre en
parallèle avec les pratiques des lignages d’hommes d’État comme les descendants de pacha
(paşazade) ou de bey (beyzade), mais aussi d’hommes de religion, tels les Dürrizadeler ou les
Ebussuudzadeler (pour ne prendre que ces exemples). Il s’agit là de stratégies tout à la fois
nominatives (ces patronymes jouent le rôle de nos noms de famille), distinctives (le
patronyme rappelle le rang de la famille, par l’usage du titre de l’ancêtre commun de
référence) et commémoratives (les descendants conservent et perpétuent par ce biais la
48
Un système similaire avait lieu également à Java, chez les familles issues de la noblesse d’Etat : les titres accordés aux hommes de la famille allaient décroissant au fur et à mesure des générations, pour disparaître dès le troisième degré. Cf. Bertrand, La Tradition parfaite : 29-102. 49
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani : t. 5 p. 1403. 50
Robert Dankoff, Seyyit A. Kahraman, Yücel Dağlı éds. , Evliya Çelebi Seyahatnamesi, 1. Kitap: Istanbul, Topkapı Sarayı Kütuphanesi Bağdat 304, Istanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2006 : 19. 51
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 5 p. 1676. 52
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 5 p. 1678.
Page | 50
mémoire lignagère)53
. Les descendants qui nous intéressent ont cependant une
particularité exceptionnelle : leur ancêtre de référence est une femme. Selon nos constatations,
ce cas de figure est extrêmement rare, même s’il existe d’autres exemples du genre. Ce qui
vaut à ces femmes de servir de référent lignager, c’est bien leur appartenance à la famille
royale, c’est-à-dire au sang le plus noble qui soit dans l’espace ottoman. Nous y voyons, pour
notre part, une volonté de la part des descendants de conserver la mémoire de cette noblesse
étiolée sous l’effet de la succession des générations, dans un système social qui ne reconnaît
pas l’existence de noblesses héréditaires en dehors des seyyid54
.
Ces lignages issus des sultanes et hanım sultanes ne se contentent pas d’invoquer
l’ancêtre maternel. Ils font montre, au contraire, d’une diversité des usages nominaux tout à
fait intéressante. Prenons l’exemple du lignage issu du couple Mihrimah Sultane (fille de
Süleyman Ier) et Rüstem Pacha. Les descendants issus de ce couple disposent d’au moins
deux dispositifs nominaux : ils peuvent invoquer le nom de l’ancêtre maternel, se rattachant
ainsi à la dynastie, ou celui de l’ancêtre paternel, s’inscrivant ainsi dans la continuité des
pratiques des agents de l’État et s’affirmant comme descendants d’un serviteur du sultan (en
l’occurrence, un grand vizir). À cela s’ajoute encore, pour une partie du lignage, l’invocation
du nom du gendre de la fille du couple, Cigalazade Sinan Pacha, dont la descendance est
également connue sous le nom des Cigalazade. De sorte que Mehmed Süreyya note avec
justesse :
« Rüstem Paşazade
Il s’agit du lignage [hânedân] du gendre de Süleyman Ier (Kanunî), Rüstem Pacha.
Les enfants de sa fille, Ayşe Hanım Sultane, sont également appelés “Mihrimah
Sultanzadeler”. On compte encore de nos jours certains descendants de cette
famille. Ce lignage s’est assimilé à celui de Cağaloğlu Sinan Pacha, dont est issu
Semin Mehmed Pacha. Bien que l’on appelle également ainsi les fils de Leskovikli
Rüstem Pacha, leur lignée est issue d’une famille de Bulgares, dont est issu le
beylerbey Kani Pacha. »55
Nul doute que les membres de ce lignage savaient faire un usage approprié des divers
procédés d’autodénomination dont ils disposaient, en fonction des circonstances et selon
l’aspect sur lequel ils voulaient mettre l’accent.
Le mouvement d’autodéfinition engagé par la dynastie entre le milieu du XVe et le
milieu du XVIe siècle affecte ainsi l’ensemble des membres de cette famille. Dès le règne de
Mehmed II, les souverains ottomans s’inscrivent dans une stratégie discursive ayant pour
objectif d’être reconnus comme les successeurs des basileus byzantins et des empereurs
romains et s’approprient définitivement le titre de Sultan. Mais ces derniers n’entendent pas
se contenter de proclamer leur grandeur individuelle : ils veulent affirmer la supériorité de
53
Cf. notamment Bouquet : « Onomasticon Ottomanicum ». La question est également traitée par Margaret L. Meriwether, The Kin Who count: Family and Society in Ottoman Aleppo, 1770-1840, Austin, University of Texas Press, 1999 : 30-68. 54
Hülya Canbakal, « On the ‘Nobility’ of Provincial Notables », dans Provincial Elites in the Ottoman Empire. Halcyon Days in Crete V. A Symposium Held in Rethymno, 10-12 January 2003, A. Anastasopoulos (éd.), Rethymno, Crete University Press, 2005 : 39-50. 55
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani : t. 5 p. 1403.
Page | 51
leur sang, d’une famille choisie par Dieu pour régner sur le monde. Le mode de dénomination
des descendantes des sultans évolue alors dans ce sens, avec néanmoins un décalage de
quelques décennies. Elles accaparent une version féminisée (par le choix de l’emplacement
par rapport au nom) du titre impérial : Sultane. Une certaine confusion règne alors entre filles
de sang et descendantes indirectes. Comme toutes acquièrent le même titre, la hiérarchie
générationnelle ne se donne plus à voir. Il faut alors procéder à une redéfinition des titres
attribués à ces descendantes et procéder à une clarification des ayants droit. Les descendantes
de la première génération (les filles), conservent leur titre de Sultane ; les descendantes de la
deuxième génération (les petites-filles), sont distinguées par le titre de Hanım Sultane. Les
générations suivantes flottent dans une indistinction officielle contre laquelle ils réagissent en
s’appropriant la palette des titres et dénomination de leurs ancêtres, sous forme de
matronymes : Sultanzade, Hanım Sultanzade.
2) L’élaboration d’une hiérarchie complexe
La société ottomane renvoie l’image d’une société structurée selon un principe
hiérarchique qui se veut stable et indéfectible. Cette stabilité est très largement fictive, car la
dynastie et l’État ne sont pas les seuls acteurs à participer à son élaboration – quand bien
même tout est mis en place pour préserver l’idéal d’un État unique dispensateur des rangs et
privilèges56
. Deux discours se font face : celui, formel, produit par l’État et par la dynastie, et
celui, officieux, produit par des acteurs en mal de reconnaissance, qui tentent d’imposer leurs
revendications statutaires ou qui entendent se distinguer les uns des autres. Dans le cas des
descendants des sultans, les revendications statutaires sont trop intimement liées à la dynastie
pour permettre de véritables protestations. Les dynamiques qui entraînent des révisions de la
structure hiérarchique sont fortement contrôlées par l’organe étatico-dynastique et, de ce fait,
ne nous sont connues qu’une fois accomplies, c’est-à-dire quand elles sont sanctionnées par
des organes officiels ou officialisant : impossible, dès lors, d’évaluer le rôle des différents
acteurs dans les démarches. Aucune requête ni protestation quelconque touchant à ces
questions n’apparait dans les récits officiels, qui ne laissent même pas transparaître l’existence
des subtils niveaux hiérarchiques existant entre princesses. Et pourtant, n’en doutons pas, une
Mihrimah Sultane avait la préséance sur ses nièces et, bien plus encore, sur toutes les
princesses vivant au début du règne de Murad III, son neveu. Le silence est volontaire : les
auteurs de chroniques font partie des agents de production du discours officiel. Les
informations doivent donc être cherchées ailleurs ; elles se trouvent dans d’autres documents,
produits par l’État et ses scribes, mais qui n’existent que pour des nécessités de gestion
internes : exclus de tout usage public, ils révèlent les subtilités de la structure hiérarchique
ottomane dont les princesses constituent un maillon.
56
Les puissances locales qui s’approprient certains statuts, offices et privilèges finissent souvent par être reconnues, a posteriori, par l’État qui les institue dans les positions qu’elles ont acquises hors de sa puissance car il en va du maintien de l’ensemble de la structure ottomane de procéder à une régularisation de ces situations pour les ramener dans le giron de l’État.
Page | 52
1) Les princesses dans la hiérarchie sociale ottomane
Les mémoires de Leïla, fille du médecin du Palais et conseiller du Sultan, qui relate
ses expériences personnelles au Harem impérial du XIXe siècle, fourmillent d’indications
concernant le protocole palatial masculin et féminin. Ainsi, lors des célébrations du bayram
qui clôt le ramadan, la réception donnée à l’occasion de la visite du sultan au harem donne
lieu à la description suivante :
« Sa Majesté s’arrête devant la porte et la Sultane-Validé vient se mettre à côté
d’Elle ; la musique joue alors la marche impériale.
Les sultanes, les Hanoums-sultanes (filles des sultanes) viennent, par ordre d’âge,
elles avancent lentement, d’une allure à la fois majestueuse et respectueuse, en
laissant traîner leurs jupes sur le parquet ; elles s’approchent de Sa Majesté, font
un grand salut jusqu’à terre et se rangent à sa droite, en croisant les mains sur la
poitrine, dans une attitude respectueuse. Puis, viennent les épouses reconnues du
Sultan, Kadines et Ikbals, qui se placent à sa gauche, avec le même cérémonial.
Les anciennes calfas ou haznédars que les sultanes ont amenées avec elles,
s’approchent à leur tour, baisent le sol et vont se ranger au loin, dans un coin. La
musique ne cesse de jouer pendant toute cette cérémonie.
Dès qu’elle a pris fin, deux jeunes filles apportent une serviette de soie tissée d’or,
contenant de petites pièces de monnaie toutes neuves, que la haznédar ousta
prend à pleines mains et lance dans le vestibule. Les calfas d’un rang moyen, qui
assistent de loin à la cérémonie, ramassent seulement les pièces qui tombent tout
près d’elles, mais les petites se répandent de tous les côtés, comme les pigeons de
mosquées qui se précipitent pour picorer les graines qu’on leur jette […].
Le Sultan cause quelques instants avec les princesses, qui se retirent ensuite dans
leurs appartements pour s’y reposer et prendre leur repas.
Dans l’après-midi, une haznédar arrive annoncer la visite du Sultan, qui va les
féliciter, chacune chez elle, séparément. Lorsque Sa Majesté s’est retirée, les
membres de la famille impériale se visitent mutuellement, se félicitent et passent
quelque temps les unes chez les autres, à causer, à jouer du piano. »57
Cinq niveaux hiérarchiques élémentaires apparaissent dans cette description : la reine mère (la
valide sultan) est au sommet, suivie des princesses (sultanes et hanım sultanes) puis, en
troisième position, les épouses et concubines en titre. Les deux derniers niveaux hiérarchiques
sont détenus par les employées du harem, selon une distinction qui répond au niveau de
compétence et d’expérience professionnelles ; celles-là ne sont pas autorisées à être
introduites auprès du sultan58
.
57
Leïla Hanoum, Le harem impérial au XIXe siècle. Un témoignage essentiel sur un univers fascinant, Bruxelles, André Versaille, 2011 : 159-160. 58
La hiérarchie professionnelle du Harem est en fait bien plus complexe, ainsi que le montrent les travaux sur le sujet. Voir notamment Uzunçarşılı, Saray Teşkilâtı ; Uluçay, Harem II. Consulter également les récits de femmes ayant fréquenté le harem : Leyla Açba, Bir Çerkes prensesinin harem hatıraları, H. Açba (éd.), Istanbul,
Page | 53
Ce protocole compte des absents et notamment les hommes : les princes s’en tiennent
à l’écart, car ils participent à d’autres festivités, répondent à un autre protocole, masculin,
public. Quant aux femmes de l’élite, les épouses et filles des ministres et grands dignitaires de
l’État, elles n’ont tout simplement pas été invitées à cet événement intime, familial, réservé au
monde du harem. Pourtant, elles participent à d’autres festivités, qui sont l’occasion du
déploiement d’un nouveau protocole. Ainsi, lors du mariage de Refia Sultane, la même Leïla
rapporte qu’à l’occasion de la visite du sultan à la jeune mariée, en plein cœur des festivités,
« les sultanes d’abord présentèrent leurs hommages à Sa Majesté et se tinrent sur un côté ;
puis les femmes des ministres s’avancèrent en saluant, baisèrent le sol et se rangèrent à
distance respectueuse »59. Ici, en l’absence de la reine mère et des servantes du Harem (qui
n’ont pas leur place dans ces réceptions publiques), une autre logique est respectée. Dans les
deux cas néanmoins, le protocole respecte un principe de séparation physique entre les
femmes affiliées à la dynastie et les autres : les premières ont la préséance et prennent place à
la droite ou à proximité directe du souverain, tandis que les autres se rangent de l’autre côté
ou à distance respectueuse.
On objectera qu’il s’agit là de mémoires postérieurs de plusieurs siècles à l’époque que
nous étudions ici ; il n’y a pourtant pas de raison de penser qu’à partir du moment où la
structure hiérarchique féminine du harem impérial se stabilisa, au cours du XVIIe siècle, les
logiques protocolaires aient varié par rapport à celles indiquées ci-dessus – dans le détail, on
peut supposer l’existence de subtiles modulations sur lesquelles nous sommes
malheureusement bien incapables de discourir. Les récits décrivant les évènements intérieurs
au Harem ne débutent qu’au XIXe siècle et la place accordée aux femmes dans les ouvrages
narratifs ottomans est trop minime (et passe sous silence ce genre d’informations) ; même
dans les rares narrations occidentales rédigées par des femmes, comme les lettres de Lady
Montaigu60
, rien de précis ne transparaît.
La position des reines mères, les Valide Sultan, mérite une brève digression. Les
mémoires de Leïla Hanoum et des autres femmes ayant connu le monde du harem impérial61
imposent l’image de reines mères au sommet de la hiérarchie palatiale et dynastique féminine
ottomane. Il n’en fut pas toujours ainsi ; le harem lui-même n’eut pas toujours l’importance
qu’on lui connaît à partir du XVIe siècle. Rappelons qu’il était installé dans un Palais différent
de celui de Topkapı jusqu’au jour où Hürrem s’y installa. Par ailleurs, jusqu’au XVIe siècle,
les sultans étaient des nomades, plus souvent en campagne ou à la chasse que dans leurs
L&M Yayınları, 2005 ; Cavidan Hanim (prenses), Harem Hayatı. Prenses Cavidan hanım’ın kaleminden Harem’in gizemli dünyası, S. Hauser (trad.), Istanbul, İnkil p, 2009 ; Melek Hanım, Thirty Years in the Harem: or, the Autobiography of Melek Hanum, wife of H. Kıbrızlı Mehemet Pasha, Londres, Chapman and Hall, 1872 ; Albertus Bobovius, Topkapı. Relation du sérail du Grand Seigneur, Paris, Sindbad / Actes Sud, 1999 ; Leïla Hanoum, Le harem impérial au XIX
e siècle. Voir également les indications fournies par le baile vénitien Ottoviano Bon, The
Sultan’s Seraglio. An intimate portrait of life at the Ottoman Court, Londres, Saqi Books, 1996. 59
Leïla Hanoum, Le harem impérial au XIXe siècle : 204.
60 Lady Mary Montagu, L’islam au péril des femmes. Une Anglaise en Turquie au XVIII
e siècle, Paris, François
Maspéro, 1981. 61
Notamment Açba, Bir Çerkes prensesinin harem hatıraları ; Cavidan, Harem Hayatı ; Ayşe Osmanoğlu, Babam
Sultan Abdühamid. Hatıralarım, İstanbul, Selis Kitaplar, 2008 ; Fatmagül Demirel, Dolmabahçe ve Yıldız
Saraylarında Son Ziyaretler Son Ziyafetler, L. Tınç éd. , Istanbul, Doğan Kitap, 2007.
Page | 54
palais : ce n’est qu’à partir du milieu du XVIe siècle que les monarques ottomans
commencèrent à résider durablement à l’intérieur de l’enceinte de leur sérail, ce qui n’est pas
sans expliquer la montée en puissance des femmes du harem – la proximité avec la personne
royale étant l’une des sources ultimes du pouvoir62. Or, ce n’est que dans la seconde moitié du
XVIe siècle que les reines mères acquièrent un titre faisant état de leur lien filial avec la
dynastie – soit près d’un siècle et demi après les princesses : elles sont alors appelées Valide
Sultane (titre qui succède à leur prénom). Contrairement aux princesses, ce titre ne leur est
conféré qu’au moment où leur fils monte sur le trône : avant cela, les seuls titres dévolus aux
concubines sont Haseki (qu’il faut traduire par « favorite »), İkbal, Hatun, Kadın ou encore,
plus tard, Kadınefendi63
. Le titre des reines mères est donc une acquisition qui reconnaît, à
terme, leur rôle dans la dynastie, mais leur affiliation au lignage ottoman se fait de façon
rétroactive, suite à la montée sur le trône de leur fils : il ne s’agit donc pas d’une qualité innée,
mais attachée à la fortune d’un autre. Il nous semble dès lors possible de dire que les
princesses eurent le pas sur les reines mères, au moins d’un point de vue protocolaire,
jusqu’au milieu du XVIe siècle, quand une redistribution des positions au sein du harem
décerna la première place à ces dernières.
À l’exception de la Valide Sultane, élevée par l’ascension de son fils au trône, les
princesses ottomanes disposent d’un statut supérieur à toutes les femmes de la société
ottomane, y compris leurs propres mères ou belles-mères. La politique d’élévation de la
famille ottomane installe les princesses ottomanes sur un confortable piédestal, au seul motif
de leur appartenance à la ‘Âl-i ‘Ôsmân. Elles prennent ainsi le pas non seulement sur les
autres membres de l’élite féminine ottomane, mais également de l’élite masculine, qu’ils
soient kul du sultan, membres de l’‘ilmiyye ou encore descendants de familles respectables :
aucun d’eux ne partage le sang ottoman, signe évident d’une noblesse royale. Les seuls
individus auxquels les princesses doivent accorder la préséance sont d’abord le sultan, chef
absolu de l’ensemble de la société ottomane et de toutes les structures hiérarchiques
existantes, la reine mère (à partir de la seconde moitié du XVIe siècle), enfin les princes,
souverains potentiels.
2) Des grandes princesses et des moins grandes
Certains indicateurs de la vie quotidienne laissent entendre que la hiérarchie interne
aux princesses ne se limitait pas à une répartition fondée sur le seul degré de parenté avec le
sultan : toute sultane n’était pas l’égale d’une autre. La hiérarchie vécue au quotidien se révèle
beaucoup plus complexe. Une princesse l’affirme elle-même, en la personne de Fatma
Sultane, fille d’Ahmed Ier, au cours de sa nuit de noces avec Melek Ahmed Pacha : comparée
62
Peirce, The Imperial Harem : 10-12, 119-125. 63
Uluçay, Harem II : 39-43, 61 ; Uzunçarşılı, Saray Teşkilâtı : 146-158 ; Ali Akyıldız, Kadınefendi », TDVİA : t. 24
p. 94-96 ; Akif M. Aydın, Kadın – İsl m’da Kadın », TDVİA : t. 24 p. 86-94 ; Boyle, « Khatun » ; Bekir Kütükoğlu,
« Vâlide Sultan », İA : t. 13 p. 181 ; Özcan, « Hatun » ; Jean Denis, « Wâlide Sultân », EI : t. 4 p. 1172-1178.
Page | 55
à la précédente épouse de son mari, une princesse (Kaya Ismihan Sultane) issue d’un autre
sultan (Murad IV), elle s’exclame : « Regardez cet esclave de mon père qui me confonds avec
Kaya la jeune ! » La réponse du mari ainsi rabroué ne se fait pas attendre :
« Que Dieu me pardonne, ma sultane, il m’est impossible de te confondre avec elle.
Tu es la fille de mon seigneur Sultan Ahmed Han, tu es une vieille femme de
soixante-dix-sept ans, qui a vécu trop longtemps et a vu trop de visage
[d’hommes] ; tu as connu douze maris. Tandis que j’ai pris Kaya Sultane quand
elle était une fille chaste de treize ans, c’était alors encore une vierge qui n’avait vu
d’autres visages ni entendu d’autres voix que son père. Elle a vécu comme Rabia la
mystique et elle est décédée en étant toujours ma femme. Elle était Kaya Ismihan,
une femme sans égale, une lune étincelante. Toi, tu es une vieille femme usée et
décrépite, avec des rides au visage. Comment pourrais-je jamais te confondre avec
ma sultane ?»64
Mais comment procéder pour parvenir à connaître, au moins partiellement, les subtilités
internes de la hiérarchie des princesses ? Car si le texte ci-dessus pointe du doigt l’existence
de certains critères permettant d’évaluer la “valeur” personnelle d’une princesse, il est loin
d’être assez précis et constant pour permettre d’en dresser une liste cohérente. D’autre part, il
faut également garder à l’esprit le fait qu’Evliya Çelebi n’est pas un chroniqueur officiel, mais
un conteur : son récit est destiné à amuser son public (n’oublions pas que ces histoires étaient
principalement construites pour être lues ou contées)65
et la tournure qu’il donne à l’affaire
s’en trouve influencée66
.
Il faut prendre un chemin détourné et utiliser les registres de compte du Palais pour
tenter de préciser, à partir des sommes octroyées à chacune des princesses spécifiées, les
principes hiérarchiques internes à la catégorie des princesses. À ce stade, un point explicatif
concernant les registres de compte du Palais ne paraît pas superflu. Il s’agit de documents
comptables, destinés à un usage administratif interne au Palais. Ils reflètent ainsi une réalité
quotidienne différente, plus complexe, que celle prônée officiellement par la dynastie.
Evanouie, la belle écriture colorée, enluminée, et les phrases bien tournées des manuscrits ;
elles font place à la graphie complexe du siyâkât. La rédaction de ces documents est le fruit
du travail de scribes, qui annotent plus qu’ils ne rédigent et qui dressent des listes de comptes,
introduites de façon lapidaire où seules figurent les informations concernant la nature des
dépenses effectuées. Ces scribes n’écrivaient pas pour être lus par un public lettré, mais pour
64
Evliyâ Çelebi b. Derviş Mehemmed Zıllî, Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, Istanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2011 : vol. 1 livre 6 p. 75 ; Robert Dankoff (éd.), The Intimate Life of an Ottoman Statesman. Melek Ahmed Pasha (1588-1662) as Portrayed in Evliya Çelebi’s Book of Travels, New York, State University of New York, 1991 : 160. Cf. annexes C.31. 65
La double valeur orale et écrite des récits ottomans, tout particulièrement pendant les premiers siècles de l’histoire de cette dynastie, se retrouve dans certaines formulations qui rappellent le langage oral. La question de l’oralité dans les sources écrites ottomanes a fait l’objet de travaux regroupés et édités par Nicolas Vatin (dir.), L’oral et l’écrit dans le monde turco-ottoman, numéro thématique de la Revue du Monde Musulman et de la Méditerranée 75-76, Aix-en-Provence, 1996. Cf. tout particulièrement les articles de Gilles Veinstein, « L’oralité dans les documents d’archives ottomans : paroles rapportées ou imaginées ? » : 133-142 et Nicolas Vatin, « Remarques sur l’oral et l’écrit dans l’administration ottomane au XVIe siècle » : 143-154. 66
Voir l’introduction par Rhoads Murphey dans Dankoff (éd.), The Intimate Life of an Ottoman Statesman : 3-41.
Page | 56
l’usage éventuel d’autres scribes : l’emploi de diminutifs connus et partagés, semble-t-il, par
les autres scribes est monnaie courante ; le système comptable employé est celui de
l’administration, d’après un calendrier tantôt lunaire, tantôt solaire, et un usage des chiffres
persans au lieu des chiffres arabes67. Ne mentionnons même pas l’absence des points qui,
dans une langue comme l’ottoman, rend évidemment le déchiffrage extrêmement malaisé, car
de nombreuses lettres ne se distinguent les unes des autres que par la présence ou non d’un ou
plusieurs points au-dessus ou en dessous du signe…
Ces registres, conservés pour l’essentiel aux Archives du Conseil de la Présidence à
Istanbul, sont de tailles diverses. Les informations comptables qu’ils contiennent varient
également d’un registre à l’autre, bien que dans la teneur générale, il s’agisse
systématiquement des dépenses du Palais en faveur de ses résidents et ayants droit. Ce qui
nous amène à nous interroger sur ces derniers. Nous y trouvons bien évidemment la
population masculine et féminine des Palais impériaux, soit à la fois le Palais de Topkapı
(Saray-i ‘Âmire) et le Vieux Palais (Eski Saray), mais aussi, selon les registres, d’autres palais
affiliés comme celui de Galatasaray ou d’Ibrahim Pacha. Cependant, certaines personnes
comprises dans la liste des récipiendaires des dons (en nature ou en argent sonnant et
trébuchant) n’appartiennent pas aux résidents de ces palais : ainsi certaines princesses, tantôt
mariées et vivant chez leur époux, tantôt veuves et disposant de leur(s) propre(s) résidence(s) ;
ainsi aussi d’autres individus, dont les motifs de leur présence dans la liste des ayants droit
paraissent moins évidents, comme le cheikh-ul-islam ou certaines filles de pachas dont on ne
sait trop la nature de leur lien avec la dynastie68
.
La nature des dépenses varie également d’un registre à l’autre, depuis le versement
d’émoluments jusqu’aux frais de bouche (sucre, miel, viandes rouges et/ou blanches, pois
chiches, etc.) et d’habillement (distributions réglementaires de tissus pour servir aux toilettes
des bénéficiaires, en nombre et qualité variables selon le statut), et autres dispositions annexes
et épisodiques, semble-t-il, comme l’envoi de bois de chauffage. Certains registres établissent
la liste de l’ensemble de ces dépenses par poste, d’autres tiennent compte seulement de
certaines d’entre elles. Ces annotations sont inscrites selon une organisation qui répond à des
principes multiples : répartition spatiale (ou ce qui équivaut à une répartition spatiale), avec la
liste des dépenses des gens de chaque palais, l’un après l’autre, avec une subdivision, pour
Topkapı, entre ceux de l’« intérieur » (« Enderûnî ») et ceux de l’« extérieur » (« Birûnî ») ;
par catégorie (les femmes royales, les eunuques, etc.) ; par durée (mensuelles, voire
annuelles)69
.
67
Said Öztürk, Osmanlı Arşiv Belgelerinde Siyakat Yazısı ve Tarihî Gelişimi, Istanbul, Ismanlı Araştırmaları Vakfı, 1996 ; Dündar Günday, Arşiv Belgelerinde Siyakat Yazısı Özellikleri ve Divan Rakamları, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1989 ; Yılmaz Kurt, Muhammed Ceyhan, Osmanlı Paleografyası ve Osmanlı Diplomatikası, Ankara, Akçağ, 2012 ; Lajos von Fekete, Die Siyaqat-Schrift in der Türkischen Finanzverwaltung, Beitrag zur Türkischen Palaographie I-II, Budapest, Akademiai Kiado, 1955 ; Mübahat S. Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatika), Istanbul, Kubbealtı Neşriyatı, 1994. 68
Ceci apparaît notamment dans le registre inédit sur lequel nous avons travaillé et dont on trouvera la translittération et la traduction en annexes : KK 7104 (1038-1039), conservé aux BOA. Cf. annexes A. 69
En raison des difficultés de l’exercice de déchiffrage de ces documents et de leur caractère extrêmement répétitif, nous nous sommes contentée d’utiliser certains de ces registres, sans chercher à les exploiter tous, estimant qu’un aperçu périodique suffisait à rendre compte des évolutions de cette hiérarchie interne aux
Page | 57
L’étude de ces registres fournit des renseignements nouveaux, en confirme d’anciens.
Si l’on doutait encore de l’existence d’une catégorie sociale de « princesses » dans la structure
sociale ottomane, ces registres viennent corroborer nos analyses précédentes. De fait, qu’elles
résident au Vieux Palais ou à Topkapı, ces princesses sont définies sous un terme catégoriel
qui, néanmoins, évolue au cours du temps, preuve que le concept se perfectionne. Dans le
registre de 1555-56, elles sont inscrites dans la rubrique des şehzâdegân ; en 1603-04, il est
question à la fois de sultânân et de şehzâdegân70
. Cette double terminologie ne semble pas
avoir satisfait les scribes du Palais qui lui préférèrent, à terme, celui de sultânân, plus précis,
moins équivoque et plus proche du titre des princesses de l’époque. On notera que l’un
comme l’autre ne sont employés que pour qualifier des princesses, à l’exclusion des princes,
absents de ces registres. C’est donc bien de la catégorie sociale des princesses qu’il est
question lorsqu’ils apparaissent sous la plume des scribes impériaux.
Les concepts de « princesses de l’Enderûn » et de « princesses du Bîrûn » trouvent
également certains éclaircissements. Ainsi, celles dépendant de l’« Intérieur » sont
systématiquement des filles ou des petites-filles qui résidaient au sein du Palais en question
(qu’il s’agisse de Topkapı ou du Vieux Palais) ; le terme de « Bîrûnî » est employé, semble-t-
il, pour désigner des princesses de la troisième génération qui, nous en sommes convaincue,
ne résidaient pas dans l’enceinte d’un des Palais (ceci expliquerait le fait que les comptes
mentionnent le versement de certaines allocations couvrant tout ou en partie, les dépenses de
logement de certaines d’entre elles)71
. Il apparaît dès lors que les princesses ottomanes font
partie des ayants droit du Trésor impérial jusqu’à la troisième génération descendante, quand
bien même elles n’appartiendraient plus au monde des Palais impériaux.
Une certaine disparité règne dans les avantages financiers accordés respectivement aux
unes et aux autres. Le versement des émoluments est la donnée la plus stable, certes pas dans
ses montants, mais dans sa régularité et sa logique d’attribution, qui semblent purement liées
au degré de relation avec l’ancêtre royal. Les frais de bouche viennent ensuite, de façon assez
récurrente, mais avec des absences qui n’ont de cesse de nous intriguer : soit que certaines
princesses n’y aient pas droit, soit que la liste de ces dépenses figure, pour des raisons
quelconques, dans d’autres registres. Dans le registre de 1555-56, elles ne semblent pas liées à
des considérations de statut (au vu des différences de montant entre les différentes
princesses), mais adaptées aux besoins respectifs de chacune ; en revanche, dans celui de
1603-04, la logique hiérarchique interne aux princesses est claire et nivelle les montants
octroyés en fonction de leur position dans cette hiérarchie. Les autres dépenses
princesses. Nous avons eu néanmoins la chance de pouvoir utiliser les registres publiés par Barkan, ce qui a grandement facilité l’exploitation des données. Ils offrent l’intérêt de dater des périodes transitoires mises en avant par ailleurs. Pour compléter cette documentation, nous avons cependant exploité un registre inédit datant de la seconde moitié du XVII
e siècle, afin de vérifier les tendances apparaissant par ailleurs (dans la
mesure où le registre le plus tardif parmi ceux publiés par Barkan date du début du XVIIe siècle). Cf. Barkan
(éd.), « Muhasebe Defterleri » et BOA, KK 7104 (1038-1039), annexes A. 70
Barkan (éd.), « Muhasebe Defterleri » : 4, 8, 155, 164-165. Nous ne savons pas trop, ici, à qui fait référence ce terme, utilisé à propos de six personnes non identifiées : s’agirait-il de princes ou de princesses en bas âge ? 71
Lewis donne une définition extrêmement brève du Bîrûn : Bernad Lewis, « Bîrûn », EI 2 : t. I p. 1273. Les explications de Parry à propos de l’Enderûn ne sont pas beaucoup plus longues : Vernon J. Parry, « Enderûn », EI 2 : t. II p. 715. Cf. également Murphey, Exploring Ottoman Sovereignty : 154-157.
Page | 58
(vestimentaires, aides au logement, bois de chauffage, etc.) sont aléatoires et semblent
attribuées au cas par cas. Nous allons nous concentrer sur les deux postes de dépenses les
mieux documentés : les émoluments versés aux princesses et les sommes allouées au titre de
frais de bouche.
Tableau 1.3. Sommes allouées au titre des émoluments et frais de bouche en faveur des şehzâdegân et de leurs
mères résidant au Vieux Palais (novembre 1555 – novembre 1556)
Type de dépense
Şehzâde Sultane
Hürrem72
Şah Sultane Mère de Şah Sultane
Ismihan Sultane
73
Ayşe Sultane, fille de Şehzâde Sultane
74
Émoluments (en aspres)
200 /j. 2000 /j. 200 /j. 75 /j. 100 /j. 100 /j.
Frais de bouche (en aspres)
24 696 /an 211 676 /an 22 119 /an 26 232 /an - -
La hiérarchie des princesses est assujettie à leur degré de parenté avec l’ancêtre royal.
En 1555-56, les filles de sultan perçoivent chacune exactement le même montant (200 aspres
par jour), soit le double de la somme attribuée aux petites-filles (100 aspres par jour). On
notera l’absence de distinction entre une fille née de prince (Ismihan) et une autre, issue d’une
princesse (Ayşe), alors même qu’elles ne descendent pas du même sultan : la première est une
petite-fille de Süleyman Ier, sultan régnant au moment de la rédaction du registre, la seconde
une petite-fille de Selim Ier, père du précédent.
Une différence de statut émerge entre princesses « de l’Enderûn » et princesses « du
Bîrûn », quand bien même elles sont situées au même degré de descendance. Ainsi les petites-
filles de sultan appartenant au Bîrûn, perçoivent une somme limitée à 70 aspres par jour, au
lieu des 100 aspres de leurs consœurs de l’Enderûn (cf. tableau infra). La qualité du lignage
doit ici être prise en considération : la seule arrière-petite-fille issue en lignée masculine
(Asitanşah), bénéficie d’une rétribution légèrement supérieure aux autres arrières petites-
filles, issues de princesses (la fille de Dukakinzade, Neslihan et Mihrî). Il est vrai que la
différence n’est pas énorme : la première perçoit 40 aspres par jour (ce qui la place en position
d’infériorité par rapport aux descendantes au degré précédent) contre 30 pour les secondes.
72
« valide-i şehz deg n » : Barkan (éd.), « Muhasebe Defterleri » : 4. 73
« şehz de-i kûçek, duhter-i merhum Sultan Mehmed » : Barkan (éd.), « Muhasebe Defterleri » : 4. 74
« hanım-ı kûçek, duhter-i hazret-i Şehz de Sultan» : Barkan (éd.), « Muhasebe Defterleri » : 4. Son nom est cité quelques pages plus loin : « Ayşe Sultan, duhter-i şehz de Sultan» : Barkan (éd.), « Muhasebe Defterleri » : 8.
Page | 59
Tableau 1.4. Dépenses en faveur des şehzâdegân et de leurs mères résidant à Topkapı et dépendant de la
section du Bîrûn (novembre 1555 et novembre 1556)75
Type de dépense
(en aspres)
Ayşe Sultane, fille de Sultan Mahmud
76
Hanım Sultane, sa sœur
77
Y Sultane, fille de Sultan Ahmed
78
‘Aynî Sultane
79
Y, fille de Dukakin-zâde
80
Âsitânşah Sultane, fille de Sultan Murad, fils de Sultan Ahmed
81
Neslihan Sultan, fille d’Aynî Sultane
82
Mihrî Hatun, fille de Hanzâde Sultan, fille d’Ayşe Sultan, fille de Bayezid II
83
Émoluments
70 /j. 70 /j. 70 /j. 70 /j. 30 /j. 40 /j. 30 /j. 30 /j.
Frais de bouche
13 037 /an 12 677 /an 13 103 /an - 6 816 /an 6 776 /an 6 816/an84
6 816 /an
La hiérarchie interne aux princesses au milieu du XVIe siècle peut donc se résumer
selon l’ordre suivant :
A. Enderûn
1/ les filles de sultan
2/ les petites-filles de sultan
B. Bîrûn
3/ les arrière-petites-filles de sultan en lignée masculine
4/ les arrière-petites-filles de sultan en lignée féminine
75
Nous n’indiquons ici que les princesses mais une concubine est également mentionnée, la mère de Sultan Osman (selon toute vraisemblance, un des petits-fils de Bayezid II en lignée masculine). 76
« Ayşe Sultan, duhter-i Sultan Mahmud » : Barkan (éd.), « Muhasebe Defterleri » : 14. Le prince Mahmud en question est, selon toute vraisemblance, un des fils de Bayezid II. 77
« Hanım Sultan, hemşire-i mezbûre » : Barkan (éd.), « Muhasebe Defterleri » : 14. 78
Son nom n’est pas indiqué, mais on précise cependant qu’elle est l’épouse d’un certain Ahmed Beg : « duhter-i Sultan Ahmed, zevce-i Ahmed Beğ » : Barkan (éd.), « Muhasebe Defterleri » : 14. 79
Nous ne disposons d’aucune information permettant d’identifier cette princesse ; l’indication du nom de l’époux ne nous est, malheureusement, d’aucun secours : « ‘Aynî Sultan, zevce-i Abdussel m Beğ » : Barkan (éd.), « Muhasebe Defterleri » : 14. Il s’agit sans doute d’une petite-fille de Bayezid II, eu égard aux sommes qu’elle reçoit. 80
« duhter-i Dukakin-zâde, zevce-i Ca’fer Beğ » : Barkan (éd.), « Muhasebe Defterleri » : 14. L’identification de cette princesse se révèle également mal aisée, dans la mesure où il existe plusieurs individus répondant au patronyme de Dukakinzade, dont deux auraient épousé des princesses ottomanes. Cependant, tout porte à croire qu’il s’agit ici de la fille de Dukakinzade Mehmed Pacha fils d’Ahmed Pacha du même patronyme) et de la princesse Gevherhan Sultane. Il s’agirait donc d’une arrière petite-fille de Bayezid II. 81
Il s’agit là d’une autre arrière petite-fille de Bayezid II, issue cette fois en lignée masculine. Barkan indique cependant qu’il n’est pas sûr de la lecture de son nom : « Âsit nşah ?) Sultan, duhter-i Sultan Murad bin Sultan Ahmed » : Barkan (éd.), « Muhasebe Defterleri » : 14. 82
« Neslihan Sultan, duhter-i ‘Aynî sultan, zevce-i Memişah Beğ, mîr-i s bık-ı liv -i Çingâne » : Barkan (éd.), « Muhasebe Defterleri » : 14. 83
« Mihrî Hatun, duhter-i Hanzâde Sultan bint-i Ayşe Sultan, duhter-i Sultan Bayezid Han » : Barkan (éd.), « Muhasebe Defterleri » : 14. 84
Elle est ici appelée Neslişah, au lieu de Neslihan, preuve que la fin de son nom correspond à une particule interchangeables entre diverses appellations royales : Barkan (éd.), « Muhasebe Defterleri » : 18.
Page | 60
Toutes sont toutefois porteuses du même et unique titre : Sultane ; toutes sont identifiées
comme appartenant à la catégorie des şehzâdegân.
Tableau 1.5. Dépenses en faveur des sultânân, des şehzâdegân dépendant de la section de l’Enderûn, à
Topkapı, et de leurs mères (mai 1603 – mai 1604)
Type de dépense
Valide Sultane
85
Valide Sultane, mère de Mehmed III
86
Gevherhan Sultane, veuve de Cerrah Mehmed Pacha
87
Ayşe Sultane, veuve de Yemişçi Hasan Pacha
88
Fatma Sultane, veuve de Halil Pacha
89
Ayşe Sultane, veuve d’Ahmed Pacha
90
6 şehzâdegân
Hadice Sultane, fille de Gevherhan Sultane
Émoluments (en aspres)
1000 /jr 3000 /jr 350 /jr 400 /jr 400 /jr 150 /jr 600 /jr en tout, soit 100 /jr et /personne
50 /jr
Frais de bouche (en aspres)
66 140 50 380 /an 50 380 /an
50 380 /an
27 740 /an
Le registre de 1603-04 indique une complexification de la hiérarchie interne aux
princesses. Deux princesses sortent du lot : Ayşe Sultane et Fatma Sultane perçoivent 400
aspres par jour quand leur (probable) demi-sœur, Gevherhan Sultane, n’en recueille que 350.
La différence de traitement ne s’explique que par la différence de statut de leurs mères : les
deux premières sont les filles de Safiyye, haseki de Murad III et valide sultan de Mehmed III,
quand tout laisse à penser que la dernière est née d’une concubine moins chanceuse. La
qualité du statut de l’ancienne Reine Mère semble donc rejaillir sur la propre condition de ses
filles, installées dans une position légèrement supérieure à leurs demi-sœurs. Ces différences
statutaires se lissent néanmoins partiellement dès lors que l’on avise les sommes qui leurs sont
allouées au titre des frais de bouche : toutes les filles de sultan, sans distinction ni préférence,
perçoivent le même montant (50 380 aspres par an).
Le montant des émoluments des deux autres princesses inscrites parmi les sultânân de
l’Enderûn, toutes deux petites-filles de sultan, annonce l’irruption de nouvelles
considérations. Ainsi Ayşe Sultane, qui ne peut être que la fille de Mihrimah Sultane et de
85
Il s’agit de la mère d’Ahmed Ier, qui vient de monter sur le trône. 86
Il s’agit de Safiyye Valide Sultane, concubine favorite de Murad III puis reine mère de Mehmed III. La différence de revenus entre l’ancienne et la nouvelle reine mère a été discutée par Leslie Peirce dans Peirce, The Imperial Harem : 126-127. 87
« Hazret-i Gevherhan Sultan, zevce-i merhum cerrah vezir Mehmed Paşa » : Barkan (éd.), « Muhasebe Defterleri » : 155. Il doit donc s’agir d’une des filles de Murad III. C’est cependant le seul endroit où nous avons trouvé une telle indication. Il est vrai néanmoins que le grand nombre de princesses à marier à la mort de ce sultan fit que les chroniqueurs s’en épargnèrent la liste scrupuleuse, mentionnant seulement que certains d’entre elles furent contraintes d’épouser des bey, par manque de pachas disponibles. Cf. chapitre suivant : 2.I.2.2. 88
« Hazret-i Ayşe Sultan, zevce-i merhum vezir Hasan Paşa, eş-şehir be-Yemişçi » : Barkan (éd.), « Muhasebe Defterleri » : 155. Il s’agit de la fille aînée de Murad III, née de son union avec sa favorite Safiyye. 89
« Hazret-i Fatma Sultan, zevce-i merhum Halil Paşa » : Barkan (éd.), « Muhasebe Defterleri » : 155. Il s’agit de la seconde fille de Murad III et Safiyye Sultane. 90
« Hazret-i Ayşe Sultan, zevce-i merhum Ahmed Paşa » : Barkan (éd.), « Muhasebe Defterleri » : 155. Nous pensons qu’il s’agit là de la fille de Mihrimah Sultane et Rüstem Pacha, qui épousa Ahmed Pacha (qui s’éleva au rang de grand vizir peu de temps avant sa mort).
Page | 61
Rüstem Pacha, perçoit une somme considérable pour sa position (150 aspres par jour), quant
Hadice Sultane, fille de Gevherhan Sultane, n’a droit qu’à une modeste somme de 50 aspres
par jour. Il faut croire que l’aura de la mère rejaillit, ici aussi, sur celui de la fille : en
l’occurrence, celle de Mihrimah Sultane était des plus éclatantes, ce qui explique le statut très
atypique de sa fille. Par ailleurs, l’évolution des sommes entre le milieu du XVIe et le début
du XVIIe siècle suit des courbes divergentes selon les statuts : elles sont doublées (ou
presque) pour les filles de sultan, mais la situation est plus confuse pour les petites-filles (les
sommes allouées à Ayşe montrent une augmentation, mais Hadice perçoit des sommes
inférieures aux montants accordés aux princesses indirectes précédentes).
Tableau 1.6. Dépenses en faveur des sultânân dépendant du Bîrûnî (mai 1603 – mai 1604)
Type de dépense Gevherhan Sultane
91
Ayşe Sultane, veuve de Cafer Pacha
92
Esmâhan Sultane, fille de Yusufşah Beg
93
Esmâhan Sultane, fille d’Isaşah
94
La Dâye Hatun
Émoluments 30 /jr 30 /jr 30 /jr 30 /jr 30 /jr
Frais de bouche 21 047 /an 21 047 /an 21 047 /an 21 047 /an 21 047 /an
La complexité de la hiérarchie des princesses de l’Enderûn ne se retrouve pas parmi
celles qui dépendent du Bîrûn : les différences sont aplanies pour mettre tout le monde sur un
pied d’égalité. Toutes, en effet, perçoivent les mêmes émoluments, à hauteur de 30 aspres par
jour. L’une des explications consisterait à considérer toutes ces princesses comme des arrière-
petites-filles de sultan en lignée féminine – ce qu’il nous est impossible d’affirmer ou de
démentir. Nous pencherions plutôt en faveur d’une explication d’ordre structurel : passé la
seconde génération, il n’est plus question de s’embarrasser de différences de rang entre
princesses indirectes, mais au contraire de les noyer dans une estime uniforme. Ce processus
entraînerait alors une certaine dévalorisation de leur statut. Cette explication justifierait par la
même occasion la stabilisation des montants qui leurs sont attribués, inchangés depuis le
milieu du XVIe siècle, ainsi que l’égalité parfaite des sommes de frais de bouche accordées à
chacune. Toute considération autre que le degré de parenté est niée, de sorte que ces
privilèges sont assujettis à une position statutaire dépersonnalisée.
La hiérarchie interne aux princesses à l’orée du XVIIe siècle suit donc un ordre plus
complexe :
91
Le registre ne fournit aucune explication permettant de la situer au sein de la généalogie dynastique ottoman : Barkan (éd.), « Muhasebe Defterleri » : 164. 92
Barkan (éd.), « Muhasebe Defterleri » : 164. 93
Nous ne savons pas qui elle est mais nous pouvons déduire des indications fournies qu’il s’agit d’une descendante de la troisième génération, au moins, voire peut-être de la quatrième génération : Barkan (éd.), « Muhasebe Defterleri » : 164-165. 94
Le registre fournit des informations contradictoires : elle est nommée une première fois « Esmâhan Sultan binti İsaşah Sultan » et une seconde fois « Esm han Sultan binti İsaşah Han ». Nous pensons que le scribe s’est trompé lors de la première indication, car il nous semble plus logique de penser qu’il s’agit du nom de son père et non de sa mère ce que l’appellation İsaşah Han laisserait entendre . Elle serait, elle aussi, une descendante de la troisième génération : Barkan (éd.), « Muhasebe Defterleri » : 164-165.
Page | 62
A. Enderûn
1/ les filles de sultan nées de la favorite devenue reine mère
2/ les autres filles de sultan
3/ les petites-filles détentrices d’une considération particulière, dérivant de l’aura
maternelle
4/ les autres petites-filles de sultan
B. Bîrûn
5/ les arrières petites-filles de sultan ou toutes princesses inscrites dans cette catégorie
Contrairement au principe ottoman de transmission du sang, qui ne tient compte
(officiellement) que du lignage paternel, l’importance des mères prédispose leurs filles à une
certaine prépondérance sur leurs demi-sœurs. La hiérarchie tend également à produire une
distinction plus forte entre filles et petites-filles (entre sultanes ou hanım sultanes) et les
troisièmes générations, mises un peu pêle-mêle dans une sous-catégorie annihilant toute
spécificité individuelle.
Tableau 1.7. Dépenses en faveur des sultânân dépendantes du Bîrûn (février 1649 – 1650)95
Avec le temps, il devient plus difficile d’identifier les évolutions de la hiérarchie, qui
semble s’être cristallisée, en raison de la complexification des généalogies96
. Ainsi, dans le
95
KK 7104 (1048-1049), conservé aux BAO. Voir la copie des originaux et les transcriptions en annexes A. 96
Pendant toute la première moitié du XVIIe siècle, plusieurs décès de sultans à un âge encore jeune et la
destitution des autres a entraîné une multiplication de successions en un cours espace de temps, rendant les distinctions entre lignes descendantes et collatérales plus illisibles que par le passé.
NOM Par jour Par mois
Total annuel
Hanzade S. ¤ Bayram P.
430 12 900
154 800
Ayşe S. ¤ Ahmed P. 430 12 900
154 800
Hümaşah S. ¤ Hüseyin P.
430 12 900
154 800
Ümmigülsüm S. ¤ Halil P.
430 12 900
154 800
Fatima S. ¤ Yusuf P. 430 12 900
154 800
Fahri S. ¤ Bayram P. 430 12 900
154 800
Beyhan S. ¤ Mustafa P.
415 12 450
149 400
Safiyye S. ¤ Mehmed P.
350 10 500
126 000
Hadice S. ¤ Mehmed P.
330 9 900
118 800
Atike S. ¤ Kenan P. 330 9 900
118 800
Page | 63
tableau qui précède, nous sommes bien incapable d’identifier l’ensemble des princesses. Nous
n’avons aucun doute sur l’identité de certaines, filles d’Ahmed Ier ; d’autres nous sont
inconnues : s’agit-il de filles de Murad III ou de Mehmed III ? Le fait qu’elles appartiennent
au Bîrûn interdit de penser qu’il s’agisse de filles du sultan régnant, mais la méconnaissance
des noms et même des unions des filles de ces sultans ne permet pas d’aller plus loin dans
l’analyse. Certaines pourraient même être des petites-filles de sultan, mais, là encore, le
manque d’informations ne permet pas de trancher.
Ce registre n’établit pas de distinction entre les sommes versées en tant
qu’émoluments et celles qui sont accordées au titre de frais de bouche : elles sont réunies en
une unique allocation. Or, quand on fait la comparaison entre les sommes annuelles totales
attribuées aux princesses du Bîrûn pour l’année 1604-1605 et celles pour l’année 1629-1630,
on note une augmentation considérable : 31 847 pour les premières (30x30x12 = 10 800 +
21 047) contre 118 800, 126 000, 149 400 ou encore 154 800 pour les secondes, soit entre le
triple et le quintuple. Il est vrai que la dynastie devait faire face à une situation relativement
nouvelle : la présence majoritaire de filles de sultan parmi les princesses du Bîrûn. Une
réévaluation des attributions financières était donc nécessaire : on comprend néanmoins que
certains s’insurgèrent contre l’octroi de sommes faramineuses en période de crise (politique et
économique).
3) L’attribution des pensions comme marque dynastique
Les princesses recevaient donc des dotations financières variées, dont le montant est
soumis à leur rang dans la hiérarchie dynastique et palatiale ottomane. Ces attributions
financières ne doivent pas être étudiées uniquement pour ce qu’elles indiquent (une position
sociale) ; elles méritent également d’être vues pour ce qu’elles symbolisent. Une question va
guider notre réflexion : à quel titre se voyaient-elles accorder ces avantages financiers ?
Commençons par voir ce qu’elles recevaient et sous quelle forme. Les deux types de
dotations régulières sont des versements sous forme d’argent liquide d’une part (appelées
‘ulûfât) et sous forme de provisions (les me’kûlât). Dans le même ordre, bien que leur
présence ne soit pas constante, viennent également des dotations de nature vestimentaire ou,
pour le moins, de tissus destinés à la confection de vêtements (les melbûsât). Les registres
stipulent bien qu’il s’agit de dotations régulières : elles sont attribuées sur l’ensemble de
l’année, avec des versements tantôt mensuels, tantôt journaliers (ou du moins, évalués selon
une somme journalière). En dehors de ces dotations régulières viennent encore des versements
qui ne concernent que certaines princesses et qui sont de nature très diverse : bois de
chauffage, la location d’une résidence, etc. L’inconstance de ces dernières laisse penser qu’il
s’agissait d’attributions individualisées, décernées au compte-goutte, en réponse
probablement à un besoin (donc à une demande, même indirecte) des concernés (car les
princesses ne sont pas les seules bénéficiaires). En ce sens, elles se rapprochent plus des
distributions de cadeaux, qui sont un phénomène régulier et qui étaient également enregistrées
Page | 64
dans des registres spécifiques dont nous avons gardé des exemples97
. Ces deux dernières
formes de dotations financières s’apparentent à des aides exprimant la largesse impériale,
attribuées soit sur sollicitation, soit en signe de la faveur impériale, soit probablement en
récompense de services rendus – les motifs ne sont pas précisés dans les registres.
Chacune de ces dotations était financée directement par le Trésor impérial : elles sont
donc un effet du souverain en tant que personne morale, non de l’État. C’est bien le souverain
qui octroie, sur ses finances propres, ces dotations aux princesses. Mais à quel motif ? La
consultation de l’ensemble de ces registres révèle que hormis les membres de la famille
royale, chaque personne bénéficiant de telles allocations exerçait une fonction au Palais. C’est
donc en tant que serviteurs particuliers du souverain qu’ils sont rétribués de leurs services.
C’est la raison pour laquelle toute une école d’historiens de l’Empire ottoman a vu dans la
population du palais ni plus ni moins que la household personnelle du souverain. En ce sens,
pour ces individus, ces allocations sont tantôt des rétributions (quand elles sont régulières),
tantôt des primes ou des dons (quand elles sont périodiques). Le sens symbolique dont elles
sont alors dotées est clair : elles sont la manifestation de la dépendance et de la soumission au
monarque, leur maître.
Deux cas de figure sont possibles, selon que les dotations sont régulières ou non.
Celles qui sont régulières sont attribuées systématiquement soit à des membres du Palais, soit
à des serviteurs-esclaves du sultan. Il ne faut dès lors pas les confondre avec des salaires : ce
n’est pas en tant qu’employés qu’ils perçoivent ces dotations, mais comme rétributions
décidées de façon unilatérale. Leur attribution est le fait du souverain, non d’une estimation
par rapport au travail effectué. La preuve en est qu’il n’est pas adapté à la tâche accomplie,
mais au rang dans la hiérarchie palatiale – quand bien même, du fait de leur position, ils sont
appelés à exercer diverses tâches au service du souverain. La gratification accordée par le
souverain à ses serviteurs (de façon individuelle) est un gage de reconnaissance du lien qui les
unit. Et parce qu’elle est tributaire de l’importance acquise par l’individu en question dans la
hiérarchie, elle se lit comme une marque d’honneur : elle donne à voir le degré de proximité
entre le bénéficiaire et la personne impériale. Plus on est proche, par son rôle, de la personne
royale, meilleure est la rétribution : le système fonctionne selon une succession de cercles
concentriques dont la taille se réduit au fur et à mesure que l’on approche du centre, le sultan.
Le nombre d’individus et le montant des rétributions, plus que la nature variable des tâches,
évoluent de façon proportionnellement inversée d’un cercle à l’autre.
Les dotations attribuées au coup par coup sont également des marques de la largesse
impériale, mais elles ne sont plus cette fois la marque du lien maître-serviteur : les
bénéficiaires sont principalement des individus (hommes ou femmes) extérieurs au
Palais. Quand des membres du Palais bénéficiaient de tels dons, ce n’était pas en raison de
leur position de serviteur, mais en qualité de sujet du monarque. Murphey verrait sans doute
dans ces dons l’expression de la bienfaisance des souverains ottomans, voire de leur esprit
97
L’un d’entre eux, datant de la fin du règne de Bayezid II et intitulé Defter-i müsevvedât-ı in’ m ve tasaddukaat ve teşrif t ve irs liy t ve ‘ det ve nukeriye ve gayruhu v cib-i sene tis’a ve tis’a mie » a été publié par Barkan : Barkan (éd.), « Muhasebe Defterleri » : 296-380.
Page | 65
charitable, selon des pratiques héritées des coutumes turco-mongoles98
. Mais un rapide coup
d’œil à la liste des bénéficiaires invalide une telle analyse : les récipiendaires de ces dons sont
majoritairement des individus appartenant aux catégories sociales privilégiées de l’Empire, à
l’exclusion du peuple (les re’âyâ). Il faut y voir, nous semble-t-il, une forme d’évergétisme
particulier, dont les diverses expressions dans la société gréco-romaine ont été étudiées avec
brio par Paul Veyne99
. Plus précisément, ces dons seraient à rapprocher des largesses et
évergésies ob honorem pratiquées par la société gréco-romaine. L’évergétisme ob honorem a
la particularité d’être une affaire de pouvoir et de politique, il est l’expression « des rapports
compliqués que les hommes ont avec le métier politique »100
. Il consiste en des dons et
largesses faits par des agents politiques dans le cadre et comme obligation associée à leurs
activités dans ce domaine, plutôt que d’être un choix libre ou présenté comme tel (à la
différence du mécénat, autre forme d’évergétisme)101
. Tout évergétisme ou don illustre une
volonté d’expression de puissance, de magnificence, de libéralité102
. Mais ce qui différencie le
don du troc ou de l’échange commercial, c’est l’intention qui l’anime, car l’acte de donner
« suppose l’existence d’une relation entre deux individus, qu’il découle de cette relation, qu’il
la crée ou qu’il la symbolise » : « tout cadeau implique une relation personnelle, quelle qu’elle
soit. Je donne parce que l’intérêt que je porte à cette relation l’emporte pour moi en intérêt sur
le bien que je donne »103
. Les dons sont alors à la fois un moyen d’instaurer une telle relation
personnelle, le signe et le rappel de son existence, enfin le symbole tout entier de la réalité de
cette relation. Les dons que les sultans accordent régulièrement à leurs sujets, de même que
ceux qu’ils font à des représentants de monarques voisins, sont la marque de l’existence de la
relation interpersonnelle qui les unit. Ils rappellent que si le sultan est souverain de droit divin
et qu’il détient une autorité subjective, il n’en oublie pas pour autant qu’il a des devoirs envers
ses sujets ; un lien particulier les unit, qu’il lui faut régulièrement raffermir, entretenir, pour
les rassurer et prolonger le sentiment d’affection qui les lie mutuellement, « car gouverner
n’est pas seulement obtenir d’autrui les résultats que l’on veut : peu d’hommes sont assez
positifs pour se contenter de cette satisfaction substantielle : on veut encore gouverner les
sentiments dont l’obéissance extérieure n’est que l’expression, régner sur les cœurs. [...] Ou,
si l’on préfère, le pouvoir n’est pas seulement exercice, il est aussi relation avec autrui et
prestige »104
.
Les dotations accordées aux princesses n’appartiennent à aucune des deux catégories
susdites. Elles sont d’un troisième ordre qui, nous semble-t-il, est spécifique à cette catégorie
98
Murphey, Exploring Ottoman Sovereignty : passim. 99
Paul Veyne, Le pain et le cirque. Sociologie historique d’un pluralisme politique, Paris, Editions du Seuil, 1976. 100
Veyne, Le pain et le cirque : 44. 101
Veyne, Le pain et le cirque : 44-45. 102
Marcel Mauss a largement décrit le phénomène ; Maurice Godelier insiste également sur ce point. Cf. Mauss, Essai sur le don ; Godelier, L’énigme du don. Paul Veyne accorde à cette question un développement particulier : Veyne, Le pain et le cirque : 104-113. 103
Veyne, Le pain et le cirque : 81, 84. 104
Veyne, Le pain et le cirque : 380. L’idée d’affection est mentionnée plus loin, p. 382 : « Les petits cadeaux
entretenaient la clientèle, qui consistait souvent en un échange de services très étalés dans le temps : pour
maintenir l’obligation de rendre le service reçu, il fallait que s’institu t un lien d’affection entre le protecteur et
le protégé, et cette affection se symbolisait par de petits cadeaux qui semblaient la créer, mais qui ne faisaient
qu’entretenir l’amitié et le souvenir du service qui attend encore sa récompense. »
Page | 66
d’individus. Avant d’en expliquer l’essence, il faut commencer par montrer en quoi elles
diffèrent de celles qui sont attribuées aux autres membres de la famille royale. Les membres
de la dynastie se répartissent en trois groupes différents. Commençons par les descendants
mâles des sultans : soit ils résident au Palais (parce qu’ils sont trop jeunes pour avoir été
envoyés en province en qualité de gouverneur ou du fait de l’arrêt de cette pratique, qui
entraîna la réclusion à vie des princes dans le palais), soit ils l’ont quitté pour prendre la tête
d’une cour, véritable reproduction en miniature du complexe palatial paternel et impérial.
Dans le second cas, l’autonomie financière acquise est aléatoire : le sultan a droit de regard
sur les comptes de ses fils et petits-fils et c’est lui qui détermine le montant des revenus
alloués à leur charge de gouverneur, qui tient naturellement compte de leur statut de princes
du sang. Néanmoins, le budget dont ils sont crédités ne dépend pas du Trésor impérial et il est
directement lié à la fonction attribuée. Cette charge, en fait, est double : ces princes sont à la
fois gouverneurs de province et héritiers (potentiels) du trône. Ils sont des personnages
politiques à ces deux titres et sont défrayés en conséquence105
. Dans le cas où ils n’ont pas
encore quitté le Palais, on peut également considérer que les sommes qui leurs sont allouées
répondent à cette qualité intrinsèque de personnages politiques (en potentialité, au minimum) :
à tout moment, l’un d’entre eux est susceptible de réaliser cette potentialité en montant sur le
trône ou en quittant le Palais. Les allocations qu’ils reçoivent sont donc autant la marque du
sang ottoman que le signe d’une puissance politique, d’une fonction (potentielle) au sein de
l’État.
Il en va de même des reines mères, de façon probablement plus flagrante encore ; les
allocations qui leurs sont octroyées se font au titre d’une fonction précise : chef du harem. Par
ailleurs, des responsabilités politiques leurs sont reconnues, dont Leslie Peirce a largement
discuté et sur lesquelles nous ne reviendrons pas ici106
. La situation des concubines, favorites
ou non, ne diffère pas beaucoup de celle des valide sultan. Elles aussi remplissent des tâches
au nom desquelles elles reçoivent des dotations : elles tiennent d’une part le rôle de
concubines, qui impose un devoir sexuel envers le monarque (qui seul choisit d’en faire usage
ou non : la concubine n’est pas libre d’avoir des relations sexuelles avec le sultan ou de se
refuser à lui) ; celles qui sont mères ajoutent à cela une tâche éducative envers leur(s)
enfant(s), qui explique l’augmentation des allocations auxquelles elles ont droit. D’une
certaine manière, en forçant un peu le trait, on pourrait aller jusqu’à expliquer la différence de
statut et, partant, de rétribution, existant entre les mères de prince et de princesses par une
responsabilité accrue dans le premier cas : une mère de prince devait éduquer un futur
souverain, tandis que la responsabilité d’une mère de princesse n’était pas aussi lourde, les
filles n’étant pas amenées à exercer une position politique institutionnelle.
Les seuls individus du Palais à recevoir des allocations sans aucune contrepartie de
charge ou de fonction ni aucun rôle politique (institutionnalisé) sont les princesses. Et ce
d’autant plus qu’elles n’ont même pas la perspective de mettre au monde de futurs princes,
105
Voir par exemple le registre de compte du prince Süleyman, fils de Selim Ier, durant son gouvernorat à Amasya, publié par Çağatay M. Uluçay, « Kanuni Sultan Süleyman ve ailesi ile ilgili bazı notlar ve vesikalar », dans Kanuni Armağanı, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1970 : 227-258 [p. 239-252]. 106
Peirce, The Imperial Harem : passim.
Page | 67
leurs descendants mâles étant exclus de la succession et du lignage dynastique107
. Elles ne
remplissent et ne rempliront jamais aucune fonction de service envers le souverain, quel qu’il
soit. Bref, la seule raison des financements qui leurs sont attribués réside dans leur qualité de
princesses. C’est bien en tant que personnes royales, détentrices du sang ottoman,
représentantes de la dynastie qu’elles bénéficient des allocations vues précédemment.
On rétorquera que dans la mesure où elles résident au Palais, elles font partie des
personnes dépendantes du monarque : les princesses ne seraient-elles que des pupilles qui
bénéficieraient des largesses impériales ? Si tel était le cas, elles cesseraient alors de recevoir
des allocations une fois hors du Palais et tout particulièrement une fois mariées : il revient
alors au mari de les entretenir. Or, mêmes mariées, même après avoir quitté le Palais, et
même, pour certaines, n’y ayant jamais mis les pieds, les princesses bénéficient de dotations
financières régulières. Par ailleurs, la logique hiérarchique des sommes attribuées, telles que
nous l’avons décrite plus haut, selon laquelle toute princesse de même condition bénéficiait
des mêmes allocations montre bien que nous ne sommes pas en présence d’aides
individuelles, mais bien de nature statutaire. Car à la fin, seul le motif de l’exaltation du lien
dynastique peut expliquer la pérennité, la régularité et la répétition de ces allocations, qu’il
faut dès lors appeler pensions. Tout semble indiquer que les princesses ont droit à ces
pensions à vie, même si le montant peut varier au cours de leur existence en fonction de
l’évolution de leur position au sein de la structure dynastique.
L’attribution de ces pensions révèle deux intentions. En premier, on découvre le souci
de la dynastie d’assurer une certaine indépendance financière à ses descendantes, même
mariées. Ces pensions ne font d’ailleurs pas l’objet d’un contrôle quelconque concernant leur
usage. Il ne peut en être autrement, dans la mesure où elles ne sont pas octroyées au titre
d’une tâche ou d’une fonction, mais uniquement d’une dignité qui est elle-même à vie. On
constate encore la volonté de la dynastie de perpétuer le lien entre elle et ses descendantes :
quoi qu’il arrive, mariées ou veuves, résidentes ou non du Palais, les princesses ottomanes
sont et demeurent des membres de la dynastie. Il n’en allait pas de même, par exemple, des
concubines qui étaient abandonnées à leur propre sort à la mort du sultan ou, pour celles qui
avaient donné naissance à un fils, au décès de celui-ci108
. La dynastie ressentait donc le besoin
d’affirmer la qualité royale des princesses et de les honorer par l’octroi de ces pensions. C’est
le reflet d’une profonde instrumentalisation de ces femmes au service de la famille régnante,
que nous allons voir en œuvre tout au long des chapitres suivants. On voit également émerger
l’une des difficultés identitaires des princesses ottomanes : leur attachement à la dynastie n’est
pas un choix ; elles ne peuvent quitter cette identité en quittant le Palais ; elles ne peuvent dès
lors jamais s’intégrer pleinement à l’élite ottomane, car elles en sont toujours distinctes par
cette marque d’appartenance dynastique.
107
Cf. chapitre suivant : 4.I.1.3. 108
On sait, par exemple, que Mahidevran, la mère du prince Mustafa, fils de Süleyman Ier exécuté pour rébellion, vécut pendant de longues années sans aide quelconque du Palais (alors même que Süleyman Ier était encore en vie) ; ce n’est que sous le règne de Selim II que le nouveau sultan, fils de sa rivale, lui vint en aide financièrement. Cf. Peirce, The Imperial Harem : 56.
Page | 68
*
Loin d’être une création théorique, la catégorie des princesses ottomanes recouvre une
réalité historique conçue par les Ottomans eux-mêmes. Ils ne firent pas de traités sur le sujet,
ne s’étendirent pas sur son sens et ses raisons d’être, mais ils l’employèrent, au quotidien.
« L’objet de l’analyse tend à désigner par avance le cadre théorique qui lui sera appliqué »,
rappelait Bertrand dans une mise en garde contre les enjeux de l’écriture de l’histoire,
précisant que seule l’existence d’une « littérature priyayi témoignant de l’emprise de ce
groupe sur les formes pérennes d’énonciations des principes de (di)vision du monde social »
justifiait l’élévation du groupe priyayi en classe morale autonome. Le récit de la constitution
de ce groupe pouvait alors s’écrire comme « une success-story : l’histoire d’une réussite d’une
entreprise collective de fabrication et d’imposition d’un registre de valeurs »109
. L’existence
d’une dénomination catégorielle des princesses, survenue dans le dernier quart du XVe et qui
se perfectionne tout au long du XVIe siècle, nous autorise à affirmer la réalité historique du
concept de princesse, qui répondait à une hiérarchie interne complexe. Mais est-ce suffisant
pour parler d’une classe morale des princesses ottomanes ? Les sultânân sont-elles à
rapprocher du cas des priyayi de Java étudiés par Romain Bertrand ou bien de cette « classe
avortée » des affranchis indépendants de la Rome impériale du premier siècle de notre ère,
dont parle Paul Veyne110
?
109
Bertrand, La Tradition Parfaite : 651. 110
Bertrand, La Tradition Parfaite ; Veyne, La société romaine, Paris, Seuil, 1991 : 35-36.
Page | 69
II. Une position aux confins de la dynastie et de l’élite
Les princesses ottomanes appartiennent à deux mondes : par la naissance, elles sont
membres à vie de la dynastie, mais par leur mariage, elles quittent le monde protecteur et
distinctif du Harem impérial pour intégrer celui de l’élite ottomane ; elles prennent la tête
d’une maison, investissent une ou plusieurs demeures palatiales, donnent naissance à leur
propre lignage. Au jour de leur mariage ou, plus précisément, au jour de leur entrée au
domicile conjugal, les princesses acquièrent une seconde identité de femme d’élite :
désormais, les deux identités cohabitent en leur personne, qu’elles peuvent invoquer selon les
besoins. Les travaux sur les caractéristiques des pratiques normatives de l’élite ottomane et
tout particulièrement sa moitié féminine sont rares, surtout pour la période moderne. Un
élément peut néanmoins servir d’indicateur dans le domaine : le lieu d’inhumation, qui
montre, avec une grande pertinence, l’ambiguïté de la position des princesses à la frontière
entre la dynastie et l’élite. Il permet cette réflexion parce qu’il est le reflet ultime des
intentionnalités individuelles en matière de conception de soi. Le choix de la dernière
demeure n’est pas anodin, pour quiconque a les moyens de le rendre expressif. Choix du
défunt, choix des survivants qui s’occupent de sa dépouille, dans tous les cas, il révèle une
intentionnalité : l’ordonnancement du monde social se lit dans l’organisation des dépouilles
des défunts.
Dans la société ottomane, le lieu d’inhumation est public : la visite et les récitations de
prières aux morts font partie des pratiques sociales et religieuses recommandées aux
musulmans. C’est la raison pour laquelle les stèles funéraires étaient tournées en direction des
passants et que les espaces les plus visibles ou les plus directement accessibles étaient les plus
recherchés. Le lieu d’inhumation s’inscrit encore dans la durée : l’élévation d’un mausolée
(türbe) ou, plus modestement, d’une stèle, en est l’expression la plus parfaite111
. Ce sont là
des traces laissées par les défunts aux vivants. Le choix du lieu d’inhumation est donc la
résultante d’enjeux individuels, familiaux et sociaux complexes, qu’il s’agit d’analyser dans le
cas particulier des princesses. Pour comprendre la spécificité des princesses dans ce domaine,
il faut disposer d’éléments de comparaison : les stratégies d’inhumation des autres membres
de la dynastie et de l’élite doivent être résumées brièvement dans un premier temps, avant
d’aborder la palette des choix des princesses et de leurs descendants dans l’élection de leur
demeure posthume.
111
Il a largement été démontré que l’imposition d’une stèle funéraire, en particulier de bonne qualité (en
marbre par exemple était un phénomène plus ou moins réservé à une certaine élite, désireuse d’une
conservation pérenne du souvenir de leurs morts. Cf. Ethem Eldem, « L’écrit funéraire ottoman : création,
reproduction, transmission », Revue du monde musulman et de la Méditerranée : Oral et écrit dans le monde
turco-ottoman, 75-76 (1995) : 65-78 ; du même auteur, Death in Istanbul. Death and Its Rituals in Ottoman-
Islamic Culture, Istanbul, Ottoman Bank Archives, 2005 ; Ethem Eldem et Nicolas Vatin, L’épitaphe ottomane.
L’épitaphe ottomane musulmane XVIe-Xxe siècles. Contributions à une histoire de la culture ottomane, Paris /
Louvain / Dudey MA, Peeters, 2007 ; Nicolas Vatin, « Sur le rôle de la stèle funéraire et l'aménagement des
cimetières musulmans d'Istanbul », dans Mélanges Professeur Robert Mantran, Temimi (éd.). Zaghouan, 1988 :
293-297.
Page | 70
1) Le choix du lieu d’inhumation : une question de prestige
Les demeures éternelles des rois et reines ne sont jamais comparables à celles des
paysans : la position sociale du vivant se retrouve dans la mort. Ainsi en Égypte ancienne, le
pharaon Khéops se fit-il bâtir une pyramide destinée à recevoir sa dépouille, tandis que les
membres de sa famille et certains dignitaires reçurent l’honneur de pouvoir se faire enterrer à
proximité ; les paysans, les marchands, tous ceux qui n’appartenaient pas à cette classe
privilégiée étaient exclus de cette nécropole – ils en constituèrent d’autres. L’organisation des
morts appartenait aux vivants et répondait à des considérations très diverses : selon que l’on
se place d’un point de vue social, familial ou individuel, le rapport à la mort et au choix du
lieu d’inhumation de la dépouille des défunts ne suit pas les mêmes logiques. L’État avait à
charge notamment de définir les règles générales : l’État ottoman réglementa les inhumations
en interdisant les enterrements intra muros sauf dérogation impériale. Bayezid II délimita
ainsi un vaste espace hors des murailles de la ville destiné à servir de cimetière pour les gens
du commun, pendant que les personnes favorisées étaient autorisées, sous réserve d’obtention
d’une autorisation impériale, à se faire bâtir des mausolées familiaux ou de simples tombes à
l’intérieur de la ville112
. Au sein de l’élite ottomane, le choix du lieu d’inhumation était une
bataille pour le prestige, une dernière affirmation par-delà la mort du statut du défunt, dont il
faut reconstituer les expressions principales pour chaque segment de l’élite.
1) Les règles de localisation funéraire pour les membres de la
dynastie
La mort d’un sultan était un événement politique majeur : elle inaugurait une crise
politique, étatique, successorale plus ou moins longue selon les situations et qui ne prenait fin
qu’au moment de l’intronisation d’un nouveau sultan et la mise en terre, dans la foulée, du
précédent. On ne saurait enterrer un prince, encore moins un sultan, comme le premier
quidam venu : ces inhumations cristallisaient toutes les composantes de l’idéologie étatique et
dynastique. Le choix du lieu de la sépulture des sultans et des princes devait prôner
l’exceptionnalité de la dynastie, se faire le relai de la domination symbolique de la Maison
d’Osman. Les considérations symboliques primaient sur les volontés personnelles. Ainsi, bien
112
Nicolas Vatin, « Les cimetières musulmans ottomans : source d'histoire sociale», dans Les villes dans l'Empire
ottoman : activités et sociétés, t. I, Panzac (éd.), Marseille, CNRS, 1991 : 149-163 ; du même auteur, «
L'inhumation intra-muros à Istanbul à l'époque ottomane », dans Les Ottomans et la mort. Permanences et
mutations, G. Veinstein (éd.), Leyde, Brill, 1996 : 157-174 ; Nicolas Vatin et Stéphane Yérasimos, « Documents
sur les cimetières ottomans, I. Autorisations d'inhumation et d'ouverture de cimetières à Istanbul intra-muros
et à Eyüp (1565-1601) », Turcica XXV (1993) : 165-187 et « Documents sur les cimetières ottomans, II. Statut,
police et pratiques quotidiennes (1565-1585) », Turcica XXVI (1994) : 169-210. Voir également Vatin, « Sur le
rôle de la stèle funéraire ».
Page | 71
que Bayezid II ait exprimé par testament sa volonté d’être enterré à Eyüp dans une tombe
anonyme, son fils et successeur, Selim Ier, lui fit bâtir un türbe (un mausolée) dans le jardin
de la mosquée éponyme du défunt113
. Le choix du lieu d’inhumation et l’organisation des
préparatifs échappaient au royal défunt (qu’il fût sultan ou prince) : la décision revenait à
celui qui tenait alors les rênes de l’Empire114
.
Deux villes seulement reçurent les dépouilles royales : Bursa et Istanbul. Jusqu’à la
conquête d’Istanbul, les sultans et princes ottomans (à quelques rares exceptions près)115
furent inhumés à Bursa. La pratique fut élaborée par le fondateur de la dynastie, Osman Ier :
sentant sa fin prochaine, il aurait ordonné par testament d’être inhumé dans la ville devant
laquelle il avait mis le siège. Sitôt la ville tombée entre ses mains, son fils Orhan s’empressa
de respecter les souhaits de son prédécesseur116
. Bursa devint la capitale, le siège du pouvoir
ottoman et le foyer de la dynastie ; la ville vit alors fleurir les ouvrages d’art destinés à
recevoir les dépouilles des membres de cette famille régnante117
. La conquête d’Istanbul mit
un terme à ces pratiques. Mehmed II fut le premier sultan à y être enterré ; après lui, tous ses
successeurs y furent également inhumés. Le parallèle entre les deux sultans est éloquent : tous
deux furent à l’origine de la conquête d’une nouvelle capitale dans laquelle ils se firent
inhumer. Les motivations sont d’ordre idéologique : la présence d’une dépouille musulmane
(en l’occurrence, d’un grand chef de guerre) transformait irrévocablement la terre qui la
recevait en “domaine musulman”, appartenant au vaste dar ul-islam. Le lieu d’inhumation de
ces deux dépouilles royales se chargeait donc d’une proclamation politique destinée à affirmer
la détention pleine et entière du territoire conquis.
Le caractère idéologique du lieu d’inhumation s’imposait comme une obligation à
l’ensemble des membres masculins de la dynastie. Lors du décès d’un prince ou d’un sultan
hors de la capitale, on préférait recourir à des techniques de conservation pour permettre le
rapatriement de la dépouille plutôt que de l’inhumer sur-place118
. Confronté au décès en
pleine campagne militaire de Süleyman Ier, Sokollu Mehmed Pacha, son grand vizir, décida
de garder secret cet événement, à grand renfort de subterfuges, afin d’assurer la retraite
paisible de l’armée et le rapatriement de la dépouille royale119
. Et même quand la cour
s’installa à Edirne, au détriment de la capitale stambouliote, on eut recours à ces pratiques de
préparation des dépouilles des princes décédés pour assurer leur retour à Istanbul, pour
inhumation120
. Les princes rebelles, quant à eux, se voyaient refuser l’inhumation dans la
113
Vatin et Veinstein, Le Sérail ébranlé : 426, 431. 114
Vatin et Veinstein, Le Sérail ébranlé : 394-442. 115
Citons notamment le cas du prince Süleyman, fils aîné d’Orhan, décédé de façon soudaine à la suite d’une chute de cheval, dans les environs de Gelibolu. Ses compagnons choisirent de l’inhumer sur place, pour des motifs pratiques, mais également idéologiques. Cf. Vatin et Veinstein, Le Sérail ébranlé : 36-39. 116
Vatin et Veinstein, Le Sérail ébranlé : 36-39, 41-42. 117
Önkal, Osmanlı Hanedan Türbeleri. 118
Vatin et Veinstein, Le Sérail ébranlé : 385-394 ; Nicolas Vatin, « Macabre trafic : la destinée post-mortem du prince Djem », dans J.-L. Bacqué-Grammont et R. Dor (éds.), Mélanges offerts à Louis Bazin par ses disciples, collègues et amis, Paris, L’Harmattan, 1992 : 231-239. 119
Vatin et Veinstein, Le Sérail ébranlé : 388-389. 120
Nicolas Vatin, « Relevés de dépenses à l’occasion des funérailles de membres de la famille ottomane dans la seconde moitié du XVIIIe siècle », Turcica 30 (1998) : 347-370.
Page | 72
capitale, ainsi que l’illustre le cas des deux fils de Süleyman Ier. La dépouille de Mustafa,
exécuté sur ordre du sultan en 1553, fut envoyée à Bursa ; celle de Bayezid, à Sivas.
Au sein même des deux capitales, Bursa puis Istanbul, le choix du lieu d’inhumation
n’était pas le fruit du hasard. Mettons de côté le cas de Bursa, antérieur à notre période, pour
nous concentrer sur Istanbul. De Mehmed II à Selim II, tous les sultans disposaient d’une
mosquée éponyme (qu’ils en soient ou non les constructeurs) qui servit comme lieu
d’inhumation de leur dépouille mortelle, mise en terre dans le jardin de la mosquée, protégée
et exaltée par la construction d’un türbe individuel. Le décès de Selim II suscita un problème,
car sa mosquée se trouve à Edirne et non à Istanbul. On décida alors de lui construire un
mausolée dans le jardin de Sainte-Sophie. Le phénomène se reproduisit avec Murad III, puis
de nouveau avec Mehmed III, qui reposent tous deux dans leur propre türbe, dans le jardin de
Sainte-Sophie. Le règne d’Ahmed Ier fut l’occasion d’un retour à la pratique antérieure, car il
fit ériger la monumentale mosquée qui fait face à Sainte-Sophie, le long de l’Hippodrome :
son mausolée y fut logiquement érigé. Puis le système s’enraille de nouveau avec ses
successeurs : pendant toute la fin du XVIIe et la première moitié du XVIII
e siècle, aucune
mosquée impériale ne fut entreprise par les sultans. Au lieu de leur construire un mausolée
individuel, comme ce fut le cas pour Selim II, Murad III et Mehmed III, on préféra réutiliser
les türbe déjà existants : Mustafa Ier, Osman II, Murad IV et Ibrahim reposent aux côtés de
leurs ancêtres, tantôt à Sainte-Sophie, tantôt à Sultanahmet. La mort de Mehmed IV scelle une
dernière évolution. Pas plus que ses ancêtres, Mehmed IV ne fit construire de mosquée
éponyme ; sa mère s’en chargea pour lui, commanditant la splendide Yeni Valide Camii à
Eminönü, où elle se fit d’ailleurs inhumer dans un vaste türbe à sa gloire. On opta alors pour
une réunion posthume de la mère et du fils. La pratique fut de nouveau appliquée avec ses
successeurs, Ahmed II, Mustafa II et Ahmed III, tous trois inhumés aux côtés de Mehmed IV,
dans le mausolée de Turhan Hadice Valide Sultane. À quelques rares exceptions près, les
princes suivirent l’exemple des sultans et furent inhumés à leurs côtés, tantôt au sein même du
türbe du père, tantôt dans un autre sis à proximité121
.
Quatre phases se distinguent ainsi : 1/ de Mehmed II à Süleyman Ier, les sultans élisent
leur dernier domicile au sein d’un mausolée bâti dans le jardin de leur mosquée éponyme, où
leurs fils sont également inhumés (mais généralement à distance du père)122
; 2/ de Selim II à
Mehmed III, les sultans et leurs fils disposent toujours de mausolées distincts, mais ceux-ci ne
sont plus attenants à une mosquée construite par le sultan lui-même ; le regroupement familial
se fait plus intense, les fils prenant place aux côtés de leur père, à l’intérieur même du türbe ;
3/ les sultans ne disposent plus de leur propre mausolée : leur dépouille est ajoutée à celles
déjà présentes dans les türbe de leurs prédécesseurs ; 4/ les sultans et princes continuent d’être
121
Önkal, Osmanlı Hanedan Türbeleri : 110-114, 122-126, 149-158, 164-170, 178-183, 187-210 ; Lucienne Thys-Şenocak, Ottoman Women Builders. The Architectural Patronage of Hadice Turhan Sultan, Aldershot, Ashgate, 2006 : 237-244 ; Vatin et Veinstein, Le Sérail ébranlé : 430-435 ; Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 67-70. 122
On notera toutefois qu’une certaine souplesse existait dans le choix des lieux d’inhumation des princes, dont la dépouille pouvait être disposée à une distance plus ou moins importante du père, voire même dans un autre cimetière, comme ce fut le cas pour les deux fils de Süleyman Ier décédés de mort naturelle en qualité de prince, Mehmed et Cihangir, enterrés dans un mausolée bâti dans le jardin de la mosquée du Prince et non à la Süleymaniyye.
Page | 73
inhumés dans des mausolées déjà existants et occupés, mais la tombe est cette fois celle d’une
femme, d’une reine mère. Le regroupement familial, constante des pratiques funéraires
ottomanes, entraîne donc l’élaboration de cimetières impériaux, véritables petites nécropoles
réservées aux membres de la dynastie123
.
Le choix du lieu d’inhumation des reines mères est également régi par le principe
d’appartenance dynastique. Il suit les évolutions de la hiérarchie sociale palatiale qui
reconnaît progressivement les reines mères comme membres de la dynastie à titre rétroactif,
lors de la montée sur le trône de leur fils. Mais les pratiques funéraires semblent avoir anticipé
sur l’obtention des titres, car dès la seconde moitié du XVe siècle, les reines mères se
rapprochent, dans la mort, de leur conjoint, trouvant place désormais dans des türbe distincts,
mais à proximité directe de celui du sultan. Ainsi Gülbahar, mère de Bayezid II, et Hafsa,
concubine de Selim Ier et mère de Süleyman Ier, bénéficient d’un türbe attenant à celui de
leur conjoint124
. Il faut y voir le signe d’une reconnaissance de leur appartenance dynastique.
Le phénomène se reproduit avec Hürrem Sultane, favorite puis épouse légale de Süleyman
Ier : à sa mort en 1558, son époux lui fait construire un mausolée dans le jardin de sa propre
mosquée, la Süleymaniyye, où il la rejoindra à sa mort. Hürrem ne fut jamais valide sultan et
n’aurait probablement pas dû être inhumée aux côtés de son conjoint ; mais au crépuscule de
sa vie, elle était assurée de voir un de ses fils prendre la succession de leur père, ce qui
l’instituait de facto en position de valide sultan en puissance125
. La pratique d’inhumer les
reines mères à proximité de leur royal concubin fut perpétuée intacte pendant plus d’un
siècle126
.
Une exception à la règle se présente néanmoins dans la seconde moitié du XVIIe
siècle : Turhan Hadice Sultane. À sa mort, elle fut inhumée dans un türbe éponyme, situé à
l’arrière de sa mosquée, à Eminönü. Quelle que soit la raison de cette exception, elle donna
naissance à une véritable nécropole matriarcale : la dépouille de son fils (Murad IV) vint
s’ajouter à la sienne, donnant à cette nécropole sa légitimité en tant que cimetière impérial,
bientôt suivie des corps de ses successeurs. La logique est ainsi renversée : ce ne sont plus les
femmes qui viennent tirer parti de l’ombre impériale, mais les hommes qui viennent se placer
sous la tutelle de leur mère ou ancêtre maternel. L’accent est alors mis sur le rapport mère –
fils, au détriment du lien conjugal.
123
Vatin et Veinstein, Le Sérail ébranlé : 430-435 ; Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 67-70. 124
Peirce, The Imperial Harem : 52 ; Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 67-70. 125
Au moment de sa mort, les princes encore vivants sont Cihangir, dont l’état physique l’excluait comme héritier potentiel, et Bayezid et Selim. Leur opposition armée aura lieu plusieurs années plus tard, en 1561. En somme, que ce soit Bayezid ou Selim qui monte sur le trône plus tard, au moment de sa mort, Hürrem incarnait déjà la mère du futur souverain, dès 1553, c’est-à-dire à la mort de Mustafa. 126
Ainsi Nurbanu et Safiyye, les mères de Murad III et de Mehmed III, se trouvent-elles réunies dans la mort respectivement à Selim II et à Murad III, à Sainte-Sophie, tandis que Kösem Sultane voit sa dépouille rejoindre celle d’Ahmed Ier, dans le türbe de ce dernier. Peirce, The Imperial Harem : 187-191 ; Önkal, Osmanlı Hanedan Türbeleri : 164-170, 178-183, 187-202 ; Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 67-70.
Page | 74
2) Les membres de l’élite ottomane
Contrairement aux membres de la dynastie et du Palais impérial, l’inhumation des
membres de l’élite, hommes comme femmes, n’est pas décidée directement par le sultan ni
commandée par les impératifs dynastiques. Ce sont les familles des défunts, voire les défunts
eux-mêmes qui, de leur vivant, prennent les dispositions nécessaires. Pour être inhumé dans
Istanbul intra muros, il fallait obtenir une autorisation impériale. L’inhumation intra muros
était en effet interdite, sauf octroi d’une dérogation reçue comme une marque d’honneur
décernée par le souverain127
.
Les membres de l’élite ottomane étaient les principaux bénéficiaires de cet honneur
posthume, que des membres moins élevés de la société pouvaient néanmoins requérir. Les
rapprochements familial ou socioprofessionnel étaient les principaux critères retenus pour
obtenir une telle dérogation. Une famille ayant déjà bénéficié d’une autorisation impériale
pour un de ses membres augmentait ses chances d’en obtenir une seconde, en arguant du désir
de se rapprocher du défunt parent (le plus souvent le père ou l’époux), sous réserve de la
disponibilité en place dans le cimetière en question128
. Le rapprochement familial va même
plus loin puisque, à l’intérieur d’un même cimetière, on constate la proximité des stèles
funéraires des membres d’une même famille entre eux. Comment s’assurer d’avoir une place
à côté de son époux ou de son père, quand celui-ci est décédé plusieurs années, voire plusieurs
décennies auparavant ? La famille pouvait anticiper par l’achat de concessions funéraires
suffisamment grandes pour permettre l’inhumation de plusieurs membres de la famille. Le
rapprochement familial n’est donc pas seulement une stratégie pour obtenir l’autorisation : il
correspond à une volonté de perpétuer une certaine cohésion familiale dans la mort129
.
Le regroupement familial est surtout mis en application pour les membres de l’élite.
Pour les individus moins hauts placés dans la hiérarchie sociale ottomane, un autre critère
pouvait déterminer leur lieu d’inhumation : leur position socioprofessionnelle. Les divers
cimetières de la ville sont occupés selon des regroupements d’individus de même milieu
social et/ou professionnel. Des cartes des lieux d’inhumation ont ainsi pu être dressées, qui
127
Vatin et Yerasimos, « Documents sur les cimetières ottomans I » et Les cimetières dans la ville : 1-24. 128
Vatin et Yerasimos, « Documents sur les cimetières ottomans I » et Les cimetières dans la ville : 1-24, 73-78. 129
Le phénomène est particulièrement visible dans les travaux de relevés de stèles funéraires dans les
cimetières ottomans : Jean-Louis Bacqué-Grammont, Hans P. Laqueur, Nicolas Vatin, « Stelae Turcicae I. Le
cimetière de Küçük Aya Sofiya », Istanbuler Mitteilungen 34 (1984) : 393-403 et « Stelae Turcicae II » ; Jean-
Louis Bacqué-Grammont et Nicolas Vatin, « Stelae Turcicae III. Le cimetière de plein air de Şile », dans Türkische
Miszellen. Robert Anhegger Festschrift, Bacqué-Grammont et alii (éds.), Varia Turcica IX (1987) : 45-61 et
« Stelae Turcicae IV. Le cimetière de la bourgade thrace de Karacaköy », Anatolia Moderna – Yeni Anadolu 2
(1991) : 7-27 et « Stelae Turcicae VI. Stèles funéraires de Sinop », Anatolia Moderna – Yeni Anadolu 3 (1992) :
105-207 ; Jean-Louis Bacqué-Grammont, Paul Dumont, Ethem Edhem, Hans P. Laqueur, Béatrice Saint-Laurent,
Nicolas Vatin et Thierry Zarcone, « Stelae Turcicae V. Le tekke bektachi de Merdivenköy », Anatolia Moderna –
Yeni Anadolu 2 (1991) : 29-135. Voir également l’article d’Olivier Bouquet, « Le vieil homme et les tombes.
Références ancestrales et mémoire lignagère dans un cimetière de famille ottoman », Oriens 39 (2011) : 331-
365.
Page | 75
reflètent les préférences par quartiers des oulémas, des serviteurs de la dynastie, des individus
appartenant au monde des confréries mystiques ou encore au monde des commerçants et
artisans. Prenons l’exemple d’un récitant de prière d’une mosquée d’Istanbul : à sa mort,
celui-ci avait toutes les chances de se voir octroyer le droit d’être inhumé dans le cimetière de
la mosquée dans laquelle il officiait130
.
L’érection d’une fondation pieuse était également un argument considérable pour
justifier l’inhumation du fondateur à proximité de son œuvre. Lorsqu’un pacha ordonnait la
construction d’une mosquée dans Istanbul, ni lui ni les membres de sa famille n’avaient de
peine à obtenir l’autorisation de s’y faire inhumer – dans la limite de l’espace disponible. Les
mosquées sont bien évidemment des lieux privilégiés, car elles disposent d’un jardin pouvant
faire office de cimetière ; mais d’autres fondations, telles que les écoles ou les couvents,
pouvaient également faire l’affaire. Toutes les fondations pieuses ne furent néanmoins pas
utilisées à une telle fin : ni hammam, ni marché (de quelque forme qu’il soit), ni pont ne
servirent de lieu d’inhumation. La mort renvoie à tout un univers de croyances culturelles et
religieuses qui incite l’individu à faire appel de préférence aux codes religieux. Le désir de
s’associer à l’aura religieuse dispensée par une mosquée, par exemple, était fort naturel et il
est logique que ceux qui étaient à l’origine de telles fondations aient voulu associer leur
dépouille à leurs œuvres.
2) Les demeures d’éternité des sultanes, hanım sultanes et sultanzade
Le lieu d’inhumation fonctionne très largement comme marqueur du statut social du
défunt voire, dans le cas des membres de la dynastie, comme prérogative associée à la
condition royale. Une étude des lieux d’inhumation des princesses ottomanes peut donc servir
comme indicateur de leur position sociale. Il s’agit de déterminer si leur statut proclamé à
travers la titulature se reflète dans les autres marqueurs sociaux. L’analyse des titres mettait en
avant une position officielle définie de façon presque exclusive par le rapport avec la dynastie,
mettant en sourdine l’appartenance mixte à l’élite : les stratégies suivies en matière
d’inhumation révèlent une identité plus complexe, à cheval entre l’identité purement royale et
celle de membre de l’élite, progressivement négociée en faveur d’une association toujours
plus marquée avec la dynastie.
1) Le XIVe – mi-XV
e siècle ou les difficultés du rapprochement
dynastique
Durant les deux premiers siècles de l’histoire ottomane, l’affiliation des princesses
ottomanes à la dynastie est encore incertaine. Des hésitations apparaissent, qui se résolvent 130
Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 39-80.
Page | 76
progressivement en faveur d’un rapprochement dynastique. Jusqu’à la fin du XVe siècle, la
prédominance de Bursa comme lieu d’inhumation montre l’importance de cette première
capitale des Ottomans comme espace dynastique privilégié.
Tableau 1.8. Les lieux d’inhumations hors Istanbul des princesses ottomanes aux XIVe et XVe siècles
Rapprochement dynastique
Rapprochement familial (hors père et mari)
Rapprochement conjugal
Mausolée et/ou fondation propre
Autre
Nefise Melek, f. Murad Ier
Konya131
Hundi, f. Bayezid Ier
Bursa, mosquée fondée par la princesse pour son mari : türbe familial
132
Oruz, f. Bayezid Ier Samarcande133
Fatma, f. Bayezid Ier
Bursa, türbe d’Orhan
134
Selçuk, f. Mehmed Ier
Bursa, türbe de Mehmed Ier
135
Ayşe, f. Mehmed Ier
Bursa, türbe de Mehmed Ier
136
Sitti, f. Mehmed Ier Bursa, türbe de Mehmed Ier
137
Hafsa, f. Mehmed Ier
La Mecque138
Fatma, f. Murad II Bursa, türbe à proximité de celui de Murad II
139
Şehzade, f. Murad II
Bursa, türbe du prince Alaeddin, à proximité de celui de Murad II
140
Hafsa, f. Murad II Edirne, türbe des Sultans, dans le jardin de la mosquée de Bayezid Ier
141
131
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 31 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 58 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 6. 132
Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 73-74 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 9 ; Albert Gabriel, Une capital turque : Brousse, Bursa, Paris, E. de Boccard, 1958 : 131-134. 133
Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 75 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 9. 134
Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 10, 74. 135
Mehmed Süreyya ne fournit aucune information concernant le lieu de son inhumation : Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 38 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 85-87 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 11-12 ; Önkal, Osmanlı Hanedan Türbeleri : 64-69. 136
Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 88 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 12 ; Önkal, Osmanlı Hanedan Türbeleri : 64-69. 137
Önkal, Osmanlı Hanedan Türbeleri : 64-69. 138
Cette princesse décéda à la Mecque durant son pèlerinage. Cf. Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 87-88 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 12 ; Neşrî, Cihânnümâ : p. 267. Önkal prétend que cette fille serait l’une des occupantes du türbe de Mehmed Ier : Önkal, Osmanlı Hanedan Türbeleri : 64-69. 139
Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 105 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 17. 140
Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 106 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 17-18 ; Önkal, Osmanlı Hanedan Türbeleri : 79-83. 141
Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 106 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 18.
Page | 77
Hadice, f. Bayezid II Bursa, türbe perso
142
Şah, f. Bayezid II Bursa, türbe de sa soeur (Hadice)
143
Bursa, türbe perso
144
Hundi, f. Bayezid II Bursa, türbe de Bülbül Hatun dans le complexe de la Muradiye ou à proximité
145
Kamerşah, f. Bayezid II
Bursa, türbe de son frère Alemşah ou de sa mère (Gülruh)
146
Fatma, p.-f. Bayezid II
Bursa, türbe de Mükrime Hatun
147
Aynişah, p.-f. Bayezid II
Bursa, türbe de Şirin Hatun
148
Hundi, p.-f. Bayezid II
Bursa, türbe de Mustafa le Vieux
149
Ce tableau ne reflète qu’une réalité imparfaite des lieux d’inhumations des dépouilles
des princesses ottomanes. Seules les plus “ottomanes” d’entre elles y sont présentes, à
l’exclusion presque complète des autres. La profondeur de la dichotomie identitaire qu’elles
vivaient surgit ici. À l’instar des princesses occidentales de la même période, les filles des
souverains ottomans sont élevées dans l’idée, partagée par tous, de leur départ futur probable.
Les pratiques d’alliances interdynastiques alors en cours impliquent en effet leur mariage avec
un prince ou chef politico-religieux hors du domaine ottoman. Une telle situation signifie
l’adjonction d’une nouvelle identité à celle dont elles héritent à la naissance : elles ne seront
plus seulement des princesses ottomanes, mais également des épouses étrangères150
.
142
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 16 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 145 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 27. 143
Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 144 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 29. 144
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 16 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 145 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 27. 145
Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 143-144 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 27. 146
Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 145 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 28. 147
Önkal, Osmanlı Hanedan Türbeleri : 94-98. Mükrime Hatun était une concubine du prince Şehinşah fils de Bayezid II) dont elle eut un fils, le prince Mehmed, mais elle n’a aucun lien de parenté avec la princesse, fille du prince Alemşah. 148
Gabriel, Une capitale turque : 119-120 ; Önkal, Osmanlı Hanedan Türbeleri : 108-109. Pour comprendre l’importance de ce choix, il convient de dresser un aperçu des voisines d’Aynişah : Şirin Hatun, la résidente principale de ce mausolée érigé en son nom, est une concubine de Bayezid II, dont elle eut un fils, le prince Abdullah. A ses côtés se trouve également une femme du prince susdit, la mère d’Aynişah. Le türbe présente donc une volonté de rassemblement familial féminin sur trois générations : la mère, la femme et la fille du prince y reposent côte à côte, mais le prince lui-même est absent. Selon une autre tradition, la princesse aurait été inhumée dans son türbe, dans le jardin de son mekteb, à Istanbul. Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 143 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 24 ; Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 96 notice 47 ; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 6. 149
Gabriel, Une capitale turque : 119-120. 150
Les princesses européennes étaient elles aussi confrontées à cette double identité, ainsi que le rappelle Lucien Bély dans son ouvrage sur La société des princes : 18-22. A deux occasions, Louis XIV exprime d’ailleurs cette problématique identitaire. Ainsi, lors du mariage de sa nièce Marie-Louise d’Orléans avec Charles II d’Espagne, en 1679, il aurait déclaré : « Ma nièce, je vous ai traitée comme ma fille, je vous donne comme mari
Page | 78
Cette “perte” de l’identité de naissance explique qu’elles ne furent pas inhumées dans
les cimetières impériaux ottomans. Comment aurait-il pu en être autrement d’ailleurs ? À leur
mariage, ces princesses quittaient de façon définitive (ou pensée comme telle) les territoires
paternels pour s’installer à la cour de leur époux ; elles y devenaient des mères de princes ;
elles y vivaient jusqu’à leur mort et, alors, elles y étaient inhumées. L’exemple le plus
révélateur est certainement celui de Nefise Melek Hatun, fille de Murad Ier, mariée au
souverain de la principauté du Karaman. Devenue karamanide par son mariage, elle proclama
son attachement à ce royaume en commanditant la construction d’un complexe qui porte
encore son souvenir à Konya, l’une des principales villes de la principauté : rien de plus
logique, dès lors, qu’elle y ait été inhumée. Il en va de même de la fille de Bayezid Ier mariée,
de force peut-être, à un descendant de Tamerlan, qu’elle suivit lorsqu’il s’en retourna vers
Samarkand, capitale timouride. Deux exemples paraissent bien maigres, par rapport à toutes
les princesses inhumées au sein de l’espace ottoman. Mais il faut tenir compte du fait que les
sources ne permettent pas, ici, de prendre la mesure d’une réalité bien plus récurrente : la
plupart des princesses ottomanes mariées à des souverains étrangers furent certainement
inhumées sur les territoires de leur époux, dans leur principauté d’adoption. La
méconnaissance de ces lieux n’est due qu’au désintérêt des chroniqueurs ottomans (et à
l’absence de sources complémentaires) à leur propos : dès lors qu’elles quittaient la cour
ottomane, sauf rares cas d’interactions, elles sortaient du domaine de l’histoire ottomane et
leurs écrivains n’avaient plus de raison de s’y intéresser.
Mais l’identité qui se perd peut aussi se reconquérir, comme le montre l’exemple de
Selçuk Hatun, fille de Mehmed Ier, femme d’Isfendiyaroğlu Ibrahim Bey. À la mort de son
époux, elle réintègre la cour ottomane. Certes, ce n’est plus son père qui y règne, mais son
frère, auquel succède ensuite son neveu, puis son petit-neveu. La longévité de vie de cette
princesse a contribué à renforcer son identité ottomane : à sa mort, elle avait réintégré le
domaine ottoman depuis déjà plusieurs décennies ; de sorte qu’elle ne fut inhumée ni sur les
territoires de son époux, comme ses fils151
, ni même dans un lieu fortement identifié à sa
personne, comme sa mosquée à Edirne, mais aux côtés de son père, dans le mausolée de celui-
ci à Bursa. Elle ne fut pas la seule : à ses côtés, entourant le sarcophage de leur père, se
trouvent également les dépouilles de certaines de ses sœurs. Certaines, mais pas toutes : les
seules filles qui rejoignirent Mehmed Ier dans la mort sont celles qui furent mariées au sein de
l’espace ottoman ou qui réintégrèrent la cour ottomane à la mort de leur époux152
. Il manque
les dépouilles de trois de ses filles, qui n’eurent pas l’occasion de revoir la cour ottomane :
un grand roi ; je désire que, quoique Française, vous soyez une aussi bonne reine espagnole que la reine ma femme, quoique Espagnole, est bonne reine française ; si des guerres éclatent entre nous et votre mari, nous sommes assez grands seigneurs pour ne pas pouvoir nous ruiner ». Puis, lorsqu’il annonce à la cour qu’il a décidé d’accepter le testament du susdit Charles II, qui désignait le duc d’Anjou, Petit-Fils de France, comme roi d’Espagne, il sermonne celui-ci en ces termes : « Soyez bon Espagnol, c’est présentement votre premier devoir ; mais souvenez-vous que vous êtes né Français pour entretenir l’union entre les deux nations ; c’est le moyen de les rendre heureuses et de conserver la paix de l’Europe ». Cité par Bély, La société des princes : 18, 19. 151
Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 78-87. 152
Outre Selçuk, les deux autres filles de Mehmed Ier qui gisent à ses côtés sont Sitti et Ayşe. Le lieu d’inhumation d’Hafsa, décédée pendant qu’elle accomplissait son pèlerinage à La Mecque, constitue une exception.
Page | 79
elles comptent parmi ces princesses oubliées de l’histoire ottomane parce qu’envoyées vivre
dans une cour voisine.
Dès le début du XVe siècle néanmoins, la volonté de rapprochement dynastique des
princesses ottomanes (qui n’ont jamais perdu cette identité par suite de leur mariage ou qui
ont reconquis cette identité à la mort de leur époux) s’impose : la majorité de ces filles sont
alors inhumées aux côtés de leur père, à Bursa – jusqu’au jour où Istanbul s’impose comme
nouvelle capitale et que les sultans commencent à s’y faire inhumer. Ce phénomène ne touche
néanmoins que les filles des sultans, à l’exclusion des petites-filles. Celles qui deviendront les
hanım sultanes ne bénéficient pas, à ce stade, du privilège de l’inhumation dynastique. La
volonté de rapprochement familial dans la mort existe pourtant aussi chez ces descendantes
indirectes, mais il concerne les autres membres de la dynastie. Pour s’en rendre compte, il
suffit de regarder les exemples d’Aynişah, fille du prince Abdullah (fils de Bayezid II),
inhumée aux côtés de sa mère et de sa grand-mère ; de Hundi, fille du prince Alemşah (autre
fils de Bayezid II), qui repose aux côtés de son père et d’un autre prince (répondant au nom
d’Abdullah)153
; et même celui de Fatma, autre fille du prince Alemşah, qui trouva pour
dernière demeure le türbe d’une concubine de sultan Bayezid II à laquelle elle n’était pourtant
pas affiliée154
.
2) Les stratégies dynastiques de l’inhumation des princesses dans
la capitale stambouliote (fin XVe – XVIII
e siècle)
L’arrêt des mariages interdynastiques coïncide avec l’accaparement du titre royal par
les princesses ottomanes. L’officialisation de leur appartenance à la dynastie ottomane scelle
la fin d’une crise identitaire “patriotique” : les princesses ne sont plus tiraillées entre une
identité ottomane de naissance et une identité étrangère acquise par mariage ; elles ne se
définissent plus que comme ottomanes, au sens de membre de la Âl-i ‘Ôsmân. Le règlement
de cette crise identitaire met un terme aux hésitations concernant leur lieu d’inhumation : elles
ont désormais une place réservée au sein des cimetières dynastiques, accédant ainsi aux
marques d’honneur liées au statut.
153
Gabriel, Une capitale turque : 119-120. 154
Nous possédons très peu d’informations concernant les descendant e s indirect e s des sultans des premiers siècles de l’histoire ottomane ; il et probable qu’elles rencontraient les mêmes difficultés identitaires que les filles de sultan : les enfants nés d’une princesse ottomane mariée à un prince étranger n’étaient pas considérés comme ottomans et n’avaient aucune raison, n’ayant connu que la cour de leur père, d’être inhumés sur les territoires ottomans. Un grand nombre de ces descendants furent donc probablement inhumés sur les territoires de la principauté dans laquelle ils avaient grandi.
Page | 80
Tableau 1.9. Les inhumations dans Istanbul des Sultanes et Hanım Sultanes : stratégies dynastiques (de
Mehmed II à Selim Ier)
Fatih Sultan Camii
Bayezid Sultan Camii
Yavuz Sultan Selim Camii
Süley-maniyye
Sainte-Sophie
Sultan-ahmet
Yeni Camii Şehzade
Gevherhan S., f. Mehmed II
Türbe de Gülbahar155
Selçuk S., f. Bayezid II
Türbe perso
156
Hadice S., f. Selim Ier
Türbe perso
157
Hafise S., f. Selim Ier
Türbe des princes
158
Şah S., f. Selim Ier
Türbe perso
159
Les deux premières attestations d’inhumation de princesses au sein d’un cimetière
impérial d’Istanbul datent de la fin du XVe siècle : il s’agit de Gevherhan, la fille de Mehmed
II, et d’une fille de Bayezid II, Selçuk (probablement décédée dans les premières décennies du
XVIe siècle). Toutes deux furent inhumées à proximité de leur père respectif, la première dans
un türbe bâti dans le jardin de la mosquée de Mehmed II et dédié à une de ses concubines,
Gülbahar Hatun (la mère de Bayezid II) ; la seconde dans un türbe personnel localisé derrière
celui du sultan, dans la mosquée éponyme qu’il avait fait construire à Istanbul. La pratique fut
répétée presque à l’identique avec les dépouilles des filles des sultans ultérieurs : trois filles de
Selim Ier (Hadice, Hafsa et Şah, bien que le lieu de son inhumation soit discuté) furent
inhumées dans le jardin de la mosquée de leur père, dans un türbe commun au trois. La
pratique ne s’impose pourtant pas de façon systématique : une autre fille de ce sultan (Fatma
155
Gülbahar, sa mère, est une des concubines du sultan : Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 113 notice 154 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 132-133 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 21 ; Sakaoğlu ne précise pas le lieu d’inhumation de Gevherhan : Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 132-133. 156
Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 97 notice 55 ; Önkal, Osmanlı Hanedan Türbeleri : 115-116 ; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 38 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 144 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 28. 157
Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 161 notice 411 ; Önkal, Osmanlı Hanedan Türbeleri : 127-128 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 150-153 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 32. Mehmed Süreyya fournit également le cimetière de la mosquée de Selim Ier comme lieu de son inhumation, mais propose un autre türbe : Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 16. 158
Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 161 notice 411 ; Önkal, Osmanlı Hanedan Türbeleri : 127-128 ; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 16 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 155 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 32. 159
Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 161 notice 411 ; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 42 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 153-154 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 32-33. Pour Ayvansarâyî, elle aurait néanmoins été inhumée ailleurs, dans un türbe à Eyüp (près de sa fondation) : Howard Crane (éd.), The Garden of the Mosques. Hafiz Hüseyin Al-Ayvansarayî’s guide to the Muslim monuments of Ottoman Istanbul, Leiden, Brill, 2000 : 145 et Ahmed N. Galitekin (éd.), Hadîkatü’l-Cevâmi’. İstanbul Câmileri ve Diğer Dînî-Sivil Mi’mârî Yapılar. Ayvansarâyî Hüseyîn Efendi, Alî Sâtı’ Efendi, Süleymân Besîm Efendi, Istanbul, İşaret, 2001 : 185.
Page | 81
Sultane) préféra être inhumée à proximité de son (second) mari, comme nous le verrons plus
loin.
Tableau 1.10. Les inhumations dans Istanbul des Sultanes et Hanım Sultanes : stratégies dynastiques (de
Süleyman Ier à Mehmed III)
Fatih Sultan Camii
Bayezid Sultan Camii
Yavuz Sultan Selim Camii
Süley-maniyye
Sainte-Sophie
Sultan-ahmet
Yeni Camii Şehzade
Mihrimah S., f. Süleyman Ier
Türbe du sultan
160
Hümaşah H.S., p.-f. Süleyman Ier
Türbe du prince Mehmed161
Fatma H.S., a. p.-f. Süleyman Ier
Türbe perso
162
? H.S. (?) Tombe163
Ismihan S., f. Selim II
Türbe de Selim II
164
Fatma S., f. Selim II
Türbe de Selim II
165
Gevher(han) S., f. Selim II
Türbe de Selim II
166
13 filles de Murad III
Türbe de Murad III
167
160
Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 162-163 notice 415 ; Önkal, Osmanlı Hanedan Türbeleri : 149-158 ; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 25-26 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 187-191 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 38-39. 161
Elle repose donc aux côtés de son père. Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 164-166 notice 422. On notera également la présence de sa fille, Fatma, et l’époux de celle-ci. Cf. Önkal, Osmanlı Hanedan Türbeleri : 138-143. 162
Le rapprochement est ici autant familial que dynastique puisque sa mère et son grand-père reposent tous deux dans le même cimetière et que son propre époux se tient à ses côtés dans son türbe : Önkal, Osmanlı Hanedan Türbeleri : 171-174 ; Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 164-166 notice 422 (les informations indiquent tantôt que sa dépouille aurait été déposée dans le türbe du prince Mahmud, tantôt dans une tombe quelconque. Nous avons pu vérifier par nous-mêmes sur-place : elle repose bien dans un türbe éponyme. 163
Nous n’avons pas été capable d’identifier cette princesse. Les informations sont contradictoires : elle serait la fille d’une certaine Kaya Sultane, présentée comme une fille de Mehmed IV. Or, Mehmed IV n’eut pas, à notre connaissance, de fille de ce nom : il aurait pu s’agir d’une erreur pour Murad IV mais les dates de décès indiquées (1562-64) rendent cette filiation impossible. Cf. Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 164-166 notice 422. 164
Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 94-95 notice 44 ; Önkal, Osmanlı Hanedan Türbeleri : 164-170 ; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 19 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 198-200 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 40-41. 165
Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 94-95 notice 44 ; Önkal, Osmanlı Hanedan Türbeleri : 164-170 ; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 13 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 201-202 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 42. 166
Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 94-95 notice 44 ; Önkal, Osmanlı Hanedan Türbeleri : 164-170 ; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 15 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 201 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 41-42. 167
Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 94-95 notice 44 ; Önkal, Osmanlı Hanedan Türbeleri : 164-170.
Page | 82
Ayşe S., f. Murad III
Türbe de Murad III ou de Mehmed III
168
Fahri S., f. Murad III
Türbe de Murad III
169
Fatma S., f. Murad III
Türbe de Murad III
170
Mihriban S., f. Murad III
Türbe de Murad III
171
Hadice S., f. Murad III
Türbe perso
172
3 p.-enfants de Murad III
Türbe de la mère
173
2 p.-f. Murad III Türbe du prince Mahmud174
Ayşe S., f. Mehmed III
Türbe de Destârî Mustafa Pacha, son époux
175
3 p.-enfants de Mehmed III
Türbe du même, leur père
176
2 filles de Mehmed III
Türbe de Murad III
177
168
Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 94-95 notice 44 ; Önkal, Osmanlı Hanedan Türbeleri : 178-183, 187-193 ; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 7 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 217 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 45. 169
Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 94-95 notice 44 ; Önkal, Osmanlı Hanedan Türbeleri : 178-183 ; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 7 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 201 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 46. 170
Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 94-95 notice 44 ; Önkal, Osmanlı Hanedan Türbeleri : 178-183 ; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 13 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 216-217 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 46. 171
Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 94-95 notice 44 ; Önkal, Osmanlı Hanedan Türbeleri : 178-183 ; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 26 il l’appelle Mihrimah ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 218 il l’appelle également Mihrimah ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 46. 172
Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 164-166 notice 422. 173
Le rapprochement est donc à la fois dynastique et familial : Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 164-166 notice 422. 174
Il s’agit de deux filles de la princesse Hadice Sultane, fille de Murad III : Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 164-166 notice 422. Önkal ne mentionne aucune princesse : Önkal, Osmanlı Hanedan Türbeleri : 1784-186. 175
Le rapprochement est donc à la fois conjugal, familial (les enfants du couple y sont également inhumés) et dynastique : Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 164-166 notice 422. 176
Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 164-166 notice 422. 177
Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 94-95 notice 44 ; Önkal, Osmanlı Hanedan Türbeleri : 178-183.
Page | 83
Les princesses font donc leur entrée dans les cimetières impériaux, mais elles
demeurent à distance respectueuse de la dépouille impériale, dans un türbe à part. Cet
éloignement disparaît néanmoins avec le précédent créé par Mihrimah Sultane, fille unique de
Süleyman Ier. À sa mort au début du règne de son neveu (Murad III), elle fut inhumée dans
un sarcophage placé aux côtés de celui de son père ; ils y resteront seuls pendant plus d’un
siècle, avant que d’autres dépouilles royales ne viennent les rejoindre. Les motifs de ce
rapprochement ne sont formulés nulle part ; il faut peut-être y voir la reconnaissance de son
statut incomparable au sein de la dynastie (outre la puissance politique qu’elle exerça tout au
long de sa vie, favorisée par une richesse considérable, elle décéda également à un âge très
avancé, devenant ainsi une aïeule profondément respectée), à moins qu’il s’agisse d’une
reconnaissance du lien intime qui unissait le père à la fille. Les princesses
suivantes bénéficièrent de ce précédent établi : les filles de Selim II, de Murad III puis un
grand nombre de celles d’Ahmed Ier furent inhumées dans le mausolée de leur père respectif.
Tableau 1.11. Les inhumations dans Istanbul des Sultanes et Hanım Sultanes : stratégies dynastiques (d’Ahmed
Ier à Ibrahim)
Fatih Sultan Camii
Bayezid Sultan Camii
Yavuz Sultan Selim Camii
Süley-maniyye
Sainte-Sophie
Sultan-ahmet
Yeni Camii Şehzade
Atike S., f. Ahmed Ier
Türbe de Mustafa Ier et Ibrahim
178
Fatma S., f. Ahmed Ier
Türbe du sultan
179
Hanzade S., f. Ahmed Ier
Türbe de Mustafa Ier et Ibrahim
180
Ayşe S., f. Ahmed Ier
Türbe du sultan
181
Übeyde S., f. Ahmed Ier
Türbe du sultan
182
Zeyneb S., f. Ahmed Ier
Türbe du sultan
183
Zeyneb S., f. Osman II
Türbe du sultan
184
178
Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 94-95 notice 44 ; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 6 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 235 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 52. 179
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 13-14 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 233-234 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 51-52. Pour Vatin et Yerasimos, elle reposerait néanmoins dans le türbe d’Ibrahim : Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 94-95 notice 44. 180
Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 94-95 notice 44 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 235; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 51-52. Mehmed Süreyya se trompe quand il donne le türbe de son père pour son lieu d’inhumation : Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 17. 181
Önkal ne précise pas le nom des princesses inhumées, se contentant de mentionner la présence des filles de ce sultan : Önkal, Osmanlı Hanedan Türbeleri : 194-202 ; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 7 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 232-233 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 50-51. 182
Önkal, Osmanlı Hanedan Türbeleri : 194-202 ; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 44 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 235. 183
Önkal, Osmanlı Hanedan Türbeleri : 194-202; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 46 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 236.
Page | 84
Safiyye S., f. Murad IV
Türbe du sultan
185
Kaya Ismihan S., f. Murad IV
Türbe de Mustafa Ier et Ibrahim
186
Rukiyye S., f. Murad IV
Tombe187
Rukiyye H.S., p.-f. Murad IV
Türbe du sultan
188
Ayşe H.S., p.-f. Murad IV
Tombe189
Fatma H.S., p.-f. Murad IV
Tombe190
Ayşe S., f. Ibrahim
Türbe de Mustafa Ier et Ibrahim
191
Beyhan S., f. Ibrahim
Türbe du sultan
192
1 fille d’Ibrahim Türbe de Hürrem
193
2 filles d’Ibrahim
Türbe de Murad III
194
Une fois la pratique d’inhumer les princesses dans les mausolées impériaux établie,
elle ne change plus pendant toute la période étudiée. Mais par-delà sa régularité, quelques
subtiles évolutions se font jour, qui révèlent une accentuation du lien dynastique au détriment
de la relation père-fille. Deux nécropoles réunissent la grande majorité des dépouilles des
princesses du XVIIe-XVIII
e siècle : le mausolée d’Ahmed Ier, à Sultanahmet, et celui de
Turhan Hadice Sultane, à Eminönü. Moins apprécié, le cimetière de la Süleymaniyye, où se
184
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 46 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 239. 185
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî : t. 1 p. 37 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 242 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 56. 186
Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 94-95 notice 44 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 241-242 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 54-55. 187
Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 242. Mehmed Süreyya prétend que sa dépouille reposerait dans le türbe d’Ahmed Ier ; il est repris par Uluçay : Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî : t. 1 p. 36 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 56. 188
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî : t. 1 p. 36 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 56. 189
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî : t. 1 p. 6. Elle est inhumée aux côtés de sa mère, Rukiyye Sultane (fille de Murad IV). 190
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî : t. 1 p. 13. Elle est inhumée aux côtés de sa mère, Rukiyye Sultane (fille de Murad IV). 191
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî : t. 1 p. 7 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 262. 192
Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 162-163 notice 415 ; Önkal, Osmanlı Hanedan Türbeleri : 149-158 ; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî : t. 1 p. 9 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 261-262 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 65. 193
Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 162-163 notice 415. Önkal indique deux autres théories contradictoires concernant l’identité de cette princesse : certains avancent qu’il s’agirait de Hanım, petite-fille de Selim Ier, à laquelle on attribue déjà deux lieux d’inhumation différents, tandis qu’Ayvansarayî prétend qu’il s’agirait d’une fille d’Ahmed II : Önkal, Osmanlı Hanedan Türbeleri : 144-148. 194
Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 94-95 notice 44 ; Önkal, Osmanlı Hanedan Türbeleri : 178-183.
Page | 85
trouve le tombeau de Süleyman Ier, n’en héberge pas moins quelques sarcophages de filles de
sultan de cette période.
Les filles d’Ahmed Ier furent principalement inhumées aux côtés de leur père,
conformément aux pratiques du XVIe siècle. Il en fut de même d’un certain nombre de filles
des sultans successifs, Osman II, Murad IV et Ibrahim, qui ne disposaient pas d’un türbe
individuel et furent inhumés aux côtés d’Ahmed Ier. Le lien filial n’est donc pas abandonné,
tout au long de cette période, mais l’inclusion des dépouilles des trois derniers sultans
susmentionnés au sein du türbe de leur père conduit à mettre en exergue le principe
dynastique, avec la création de super-nécropoles impériales. Une logique absolument
similaire commande à l’organisation du mausolée de Turhan Hadice Sultane, qui reçut les
dépouilles de plusieurs sultans (Mehmed IV, Ahmed II, Mustafa II et Ahmed III, pour la
période qui nous intéresse), lui donnant son caractère impérial. Or, dans l’enceinte de cette
nécropole furent inhumées les dépouilles des filles de Mehmed IV, celles d’Ahmed II, puis de
Mustafa II (à l’exception d’Emine, de Safiyye et d’Ümmügülsüm), et encore celles d’Ahmed
III (24 des 28 filles de ce sultan).
De tels regroupements dynastiques soulèvent nécessairement un problème de place,
qui ne tarde pas à se faire sentir, au détriment de certaines princesses. Des solutions peu
satisfaisantes semblent avoir vu le jour, qui consistaient à répartir les princesses laissées pour
compte dans les cimetières ou les türbe de sultans antérieurs. C’est ainsi que le cimetière de la
Süleymaniyye fut soudainement investi par plusieurs princesses décédées durant la seconde
moitié du XVIIe et le début du XVIII
e siècle. Leur répartition fut aléatoire : certaines prirent
place aux côtés du sultan et de sa fille, dans le mausolée impérial, d’autres dans le türbe
voisin de la favorite du sultan, Hürrem, d’autres encore durent se contenter d’une tombe dans
le jardin.
Tableau 1.12. Les inhumations dans Istanbul des Sultanes et Hanım Sultanes : stratégies dynastiques (de
Mehmed IV à Ahmed III)
Fatih Sultan Camii
Bayezid Sultan Camii
Yavuz Sultan Selim Camii
Süley-maniyye
Sainte-Sophie
Sultan-ahmet
Yeni Camii Şehzade
Fatma S., f. Mehmed IV
Türbe de la Valide Sultane
195
Hadice S., f. Mehmed IV
Türbe de la Valide Sultane
196
Ümmî S., f. Mehmed IV
Türbe de la Valide Sultane
197
195
Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 174-176 notice 478 ; Önkal, Osmanlı Hanedan Türbeleri : 203-210 ; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî : t. 1 p. 14 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 278-279 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 69. 196
Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 174-176 notice 478 ; Önkal, Osmanlı Hanedan Türbeleri : 203-210 ; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî : t. 1 p. 16 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 276-278 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 68-69.
Page | 86
Ümmügülsüm S., f. Mehmed IV
Türbe de la Valide Sultane
198
Fatma H.S., p.-f. Mehmed IV
Türbe de la Valide Sultane
199
Safiyye H.S., p.-f. Mehmed IV
Türbe de la Valide Sultane
200
Ayşe H.S., p.-f. Mehmed IV (?)
Tombe201
Asiyye S., f. Ahmed II
Türbe du sultan
202
Atike S., f. Ahmed II
Türbe de la Valide Sultane
203
Safiyye S., f. Mustafa II
Tombe204
Ayşe S., f. Mustafa II
Türbe de la Valide Sultane
205
Emetullah S., f. Mustafa II
Türbe de la Valide Sultane
206
Fatma S., f. Mustafa II
Türbe de la Valide Sultane
207
Rukiyye S., f. Mustafa II
tombe208
197
Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 174-176 notice 478 ; Önkal, Osmanlı Hanedan Türbeleri : 203-210 ; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî : t. 1 p. 44. 198
Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 174-176 notice 478 ; Önkal, Osmanlı Hanedan Türbeleri : 203-210 ; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî : t. 1 p. 44 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 279 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 69-70 il l’appelle Ümmî . 199
Fille de la précédente : Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 174-176 notice 478 ; Önkal, Osmanlı Hanedan Türbeleri : 203-210 ; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 13. 200
Fille de la précédente : Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 174-176 notice 478 ; Önkal, Osmanlı Hanedan Türbeleri : 203-210 ; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 37. 201
On sait juste qu’elle est la fille d’une Rukiyye Sultane et qu’elle mourut en 1716. Il est fort probable qu’il s’agisse d’une petite-fille de Mehmed IV. Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 164-166 notice 422. 202
Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 162-163 notice 415 ; Önkal, Osmanlı Hanedan Türbeleri : 149-158 ; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî : t. 1 p. 6 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 284 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 72. 203
Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 284 ; Uluçay ne précise pas le lieu de son inhumation et se contente de mentionner son décès à Edirne : Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 72. Mehmed Süreyya la confond, semble-t-il, avec une de ses soeurs inhumée à la Süleymaniyye : Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî : t. 1 p. 6. 204
Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 162-163 notice 415 ; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî : t. 1 p. 37 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 295-297 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 77-78. 205
Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 174-176 notice 478 ; Önkal, Osmanlı Hanedan Türbeleri : 203-210 ; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî : t. 1 p. 7 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 292-293 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 75-76. 206
Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 174-176 notice 478 ; Önkal, Osmanlı Hanedan Türbeleri : 203-210 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 297-298 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 78. 207
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 14 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 299 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 79. 208
Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 298-299 ; Uluçay n’indique pas le lieu de son inhumation : Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 79. Mehmed Süreyya indique qu’elle reposerait dans le türbe lui-même : Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 36.
Page | 87
Zeyneb S., f. Mustafa II
Türbe de la Valide Sultane
209
Zahide H.S., p.-f. Mustafa II
Tombe210
Ayşe S., f. Ahmed III
Tombe211
Atike S., f. Ahmed III
Tombe212
Beyhan S., f. Ahmed III
Tombe213
Emine S., f. Ahmed III
Tombe214
Emine S., f. Ahmed III
Tombe215
Fatma S., f. Ahmed III
Tombe216
Ferdane S., f. Ahmed III
Tombe217
Hadice S., f. Ahmed III
Tombe218
N ’ile S., f. Ahmed III
Tombe219
Nazîfe S., f. Ahmed III
Tombe220
Rabia S., f. Tombe221
209
Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 174-176 notice 478 ; Önkal, Osmanlı Hanedan Türbeleri : 203-210 ; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 46 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 299 ; Uluçay n’indique pas le lieu de son inhumation : Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 79. 210
Le regroupement est à la fois dynastique et familial puisqu’elle est inhumée aux côtés de sa mère, Safiyye Sultane, et de son époux (Ebubekir Pachazade Süleyman Beyefendi) : Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 162-163 notice 415. 211
Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 174-176 notice 478 ; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 6 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 317-318 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 88. 212
Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 174-176 notice 478 ; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 6 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 314-315 ; Uluçay n’indique pas le lieu de son inhumation : Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 91. 213
Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 174-176 notice 478 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 323 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 95. 214
Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 174-176 notice 478 ; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 11 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 323 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 92. 215
Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 174-176 notice 478 ; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 11 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 92. 216
Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 174-176 notice 478 ; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 14 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 306-311 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 83-85. 217
Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 174-176 notice 478 ; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 14 ; Sakaoğlu ne dit pas le lieu de son inhumation : Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 323. 218
Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 174-176 notice 478 ; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 16 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 322 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 91-92. Mehmed Süreyya cite deux autres filles du même nom, également inhumées dans ce jardin : Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 16. 219
Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 174-176 notice 478 ; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 31 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 324 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 93. 220
Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 174-176 notice 478 ; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 14 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 323-324 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 93. 221
Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 174-176 notice 478 ; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 36 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 324 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 93 (Mehmed
Page | 88
Ahmed III
Rabia S., f. Ahmed III
Tombe222
Reyhan S., f. Ahmed III
Tombe223
Rukiyye S., f. Ahmed III
Tombe224
Rukiyye S., f. Ahmed III
Tombe225
Rukiyye S., f. Ahmed III
Tombe226
Sabiha S., f. Ahmed III
Tombe227
Ümmügülsüm S., f. Ahmed III
Tombe228
Ümmügülsüm S., f. Ahmed III
Tombe229
Ümmügülsüm S., f. Ahmed III
Tombe230
Ümmüseleme S., f. Ahmed III
Tombe231
Zeyneb S., f. Ahmed III
Tombe232
Zeyneb S., f. Ahmed III
Tombe233
Zübeyde S., f. Ahmed III
Tombe234
L’inhumation dans le jardin ceinturant un türbe impérial relève, selon toute
vraisemblance, d’un manque de place dans les mausolées dynastiques : la répartition des
Süreyya et Uluçay affirment l’existence d’une seconde princesse de ce nom, autre fille d’Ahmed III, également inhumée dans ce jardin). 222
Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 174-176 notice 478 ; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 36 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 325 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 93. 223
Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 174-176 notice 478 ; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 36 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 323 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 94. 224
Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 174-176 notice 478 ; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 36 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 322 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 94. 225
Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 174-176 notice 478 ; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 36 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 322 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 94. 226
Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 323 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 94. 227
Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 174-176 notice 478 ; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 37 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 325 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 94. 228
Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 174-176 notice 478 ; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 45 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 311-313 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 85-86. 229
Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 174-176 notice 478 ; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 45 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 325 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 86. 230
Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 174-176 notice 478 ; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 45 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 325 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 86. 231
Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 174-176 notice 478 ; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 45 il indique l’existence de deux sœurs de celle-ci, répondant au même nom et inhumées au même endroit) ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 323 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 94. 232
Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 174-176 notice 478 ; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 46 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 322 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 87. 233
Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 174-176 notice 478 ; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 46 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 322-323 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 87. 234
Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 174-176 notice 478 ; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 46 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 321-322 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 92.
Page | 89
dépouilles royales au sein de l’espace du mausolée de la reine mère Turhan Hadice en est un
exemple. Toutes les dépouilles ne furent pas reçues sous la coupole : certaines prirent place à
l’ombre des arbres du jardin, le tout séparé de la turbulence du monde extérieur par un mur
d’enceinte percé de fenêtres, pour permettre aux passants la lecture des stèles funéraires.
L’ensemble de cet espace (mausolée + jardin) est clairement une nécropole dynastique : la
grande majorité des tombes appartiennent à des membres de la famille ottomane, les quelques
autres individus admis dans ce cercle fermé étant eux-mêmes des serviteurs du Palais. Nous
ne nous lancerons pas dans une tentative éperdue de compréhension des logiques
d’inhumation au sein de ce cimetière : pourquoi certains prirent-ils place sous la coupole au
détriment des autres ? Faut-il y voir une logique chronologique, une logique statutaire ? Faut-
il y voir une logique tout court ? La confusion la plus complète semble régner puisque les
dépouilles reléguées au jardin appartiennent aussi bien à des filles que des petites-filles de
sultan, des princes ou encore des concubines. Même diversité des statuts des individus
inhumés sous la coupole, qui réunit également des concubines, des princes, des reines mères,
des sultans et des princesses. Quelle que soit la règle, si tant est qu’il y en ait eu une, elle ne
tenait pas compte de la hiérarchie dynastique, mais peut-être tout simplement d’une logique
chronologique. En effet, ce sont principalement les filles d’Ahmed III, décédées en majorité
postérieurement aux filles de Mehmed IV (sans le moindre doute), mais aussi de Mustafa II,
qui trouvèrent refuge dans le jardin : elles arrivaient trop tard, dans la suite des décès, pour
trouver des places sous la coupole235
.
Un cimetière semi-impérial se constitua en sus des cimetières impériaux
susmentionnés : celui de la Mosquée du Prince (Şehzade Camii). Quelques princesses y furent
inhumées, dont la fille du prince Mehmed (fils de Süleyman Ier), Hümaşah Sultane, ainsi que
sa propre fille, Fatma Sultane, et deux princesses décédées à Edirne, dont le corps fut rapatrié
à Istanbul236
. L’absence de dépouilles de sultan dans cette nécropole interdit de la considérer
comme cimetière impérial. Néanmoins, elle fut fondée à la mémoire d’un prince, Mehmed, le
fils aîné de Süleyman Ier et d’Hürrem, décédé de mort naturelle à la fleur de l’âge et qui y fut
inhumé237
. Le choix de Süleyman Ier d’y faire enterrer également son autre fils, Cihangir, au
nom duquel il avait pourtant fait bâtir une mosquée, sur les collines de Galata, montre la
volonté de faire de cet endroit un espace dynastique princier. Il est bien naturel que la fille de
Mehmed y ait trouvé sa demeure posthume : son sarcophage fut déposé aux côtés de celui de
son père, sous la coupole du türbe. Ce cimetière se situe donc à un rang intermédiaire entre les
nécropoles impériales et celles de l’élite. Sa forte identification dynastique favorise son usage
pour divers membres de la dynastie, fils ou filles de sultans, mais aussi pour des membres
plus éloignés, comme nous le verrons plus loin.
235
Cette logique ne tient néanmoins pas compte des filles de ce sultan décédées encore enfant : la chronologie ne tient pas à leur propos. On peut supputer que la place disponible s’étant fortement restreinte au cours du temps, on préféra inhumer les dépouilles de ces bébés dans le jardin, eu égard à leur jeunesse, afin d’éviter d’encombrer trop rapidement l’intérieur de la coupole. 236
Sur les conditions du rapatriement des corps des princes et princesses décédés à Edirne, voir Vatin, « Relevés de dépenses », Turcica 30 (1998) : 347-370. 237
Stéphane Yerasimos, Constantinople. De Byzance à Istanbul, Paris, Editions Place des Victoires, 2000 : 253-257.
Page | 90
3) Des inhumations en dehors des cadres dynastiques : le poids des
pratiques élitaires
Toutes les princesses ne furent pas systématiquement inhumées dans les nécropoles
impériales. Tout au long du XVIe jusqu’au XVIII
e siècle, des cas exceptionnels surgissent, qui
montrent l’intrusion de pratiques typiques des membres de l’élite. L’inhumation peut avoir eu
lieu à proximité d’une fondation pieuse de nature religieuse, comme une mosquée ou une
medrese : il faut distinguer alors les fondations qui sont le fait de la défunte et celles qui
appartiennent à un tiers. Le choix du lieu d’inhumation peut aussi avoir pour motif la volonté
d’un rapprochement familial : nous distinguerons alors entre rapprochement conjugal et
familial au sens large.
Tableau 1.13. Les inhumations dans Istanbul des Sultanes et Hanım Sultanes : stratégies non dynastiques
Inhumation liée à une fondation personnelle
Inhumation liée à la fondation d’un tiers
Rapprochement conjugal
Rapprochement familial (non dynastique)
Sofiyye Fatma S., f. Bayezid II
Mosquée d’Aşık Pacha (tombe)
238
Aynişah S., f. Bayezid II
Mekteb à son nom (türbe perso)
239
Gevherhan S., f. Bayezid II
Mekteb à Eyüp (tombe)240
Ayşe S., f. Bayezid II Türbe perso à Vefa241
Hümaşah S., f. Bayezid II
Mosquée érigée initialement par son mari, dont elle acheva les travaux et ajouta un minbar (türbe du couple)
242
Ferruhşad H.S., p.-f. Bayezid II
Mosquée Kızıltaş fondée par son époux Bali Mehmed Efendi, également inhumé là (türbe perso)
243
Neslişah H.S., p.-f. Bayezid II
Mosquée éponyme (türbe perso)
244
238
Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 93 notice 36. Uluçay avance néanmoins l’hypothèse d’une inhumation à Bursa, dans le türbe du prince Ahmed : Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 26. Sakaoğlu préfère, pour sa part, ne pas prendre position en gardant le silence sur ce sujet : Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 144-145. 239
Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 96 notice 47 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 143 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 24 ; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 6. Mais d’autres travaux avancent l’hypothèse d’une inhumation à Bursa, dans le türbe de Şirin Hatun : Gabriel, Une capitale turque : 119-120 ; Önkal, Osmanlı Hanedan Türbeleri : 108-109. 240
A côté du mekteb fut construit, plus tard, la mosquée dite de Zal Mahmud Pacha ; seul Uluçay précise que le mekteb est une œuvre de la princesse. Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 146 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 26. 241
Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 142-143 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 25. 242
Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 97 notice 53 (ils la présentent néanmoins comme une petite-fille de Bayezid II . Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 146 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 27 ; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 15. 243
Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 135 notice 282. 244
Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 148 notice 347 ; Crane (éd.), The Garden of the Mosques : 26-27 et Galitekin (éd.), Hadîkatü’l-Cevâmi’ : 281-282. On notera d’ailleurs que le principe de rapprochement conjugal a fonctionné dans ce cas, bien qu’à l’inverse : son époux y fut également inhumé.
Page | 91
Fatma “Hançerli” H.S., p.-f. Bayezid II
Eyüp245
Fatma H.S., p.-f. Bayezid II
Eyüp246
Fatma S., f. Selim Ier
Mosquée de son époux247
Hanım H.S., p.-f. Selim Ier
Complexe éponyme (türbe perso)
248
Ayşe H.S., p.-f. Süleyman Ier
Complexe dédié au cheikh Mahmud Hüdayî à Üsküdar (türbe perso)
249
Şah S., f. Selim II Complexe fondé en commun par le couple (türbe du couple)250
Emine S., f. Mustafa II
Mosquée de Mimar Acem Ali (türbe perso)
251
Esma S., f. Ahmed III
Eyüp252
Saliha S., f. Ahmed III
Porte du tombeau d’Eyüp
253
Zeyneb S., f. Ahmed III
Mosquée éponyme (türbe perso)
254
Ayşe H.S., p.-f. Ahmed III
Eyüp255
Emine H.S., p.-f. Ahmed III
Eyüp (türbe maternel)
256
245
Fille du prince Mahmud. Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 13 ; Crane (éd.), The Garden of the Mosques : 106, 272, 279. 246
Fille du prince Mehmed. Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 13. On pourrait croire à une confusion entre les noms de leur père (facilement imaginable, l’écriture du nom Mahmud étant très proche de celle du Mehmed , ce qui laisserait entendre que les deux princesses pourraient n’en faire qu’une. Mais les dates de décès fournies pour chacune ne correspondant pas, il faut convenir qu’il s’agit de deux princesses différentes. L’emploi de mêmes prénoms pour différentes descendantes indirectes de Bayezid II est d’ailleurs un phénomène récurrent, Ayşe et Fatma étant les plus courants et portés par plusieurs petites-filles de ce sultan. 247
Certains indiquent qu’elle aurait été inhumée dans le türbe de son époux, d’autres dans une tombe à l’extérieur. Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 90 notice 18 ; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 13 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 156 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 31. 248
Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 120 notice 188. Plus loin, il est indiqué qu’elle aurait été inhumée aux côtés de sa mère, dans le türbe de celle-ci, dans le jardin de Selim Ier : idem, 161 notice 411 ; Önkal, Osmanlı Hanedan Türbeleri : 127-128 ; les sources sont confuses quant au personnage même de cette Hanım Sultane, présentée tantôt comme une fille, tantôt comme une petite-fille de Selim Ier. 249
Gülrü Necipoğlu, The Age of Sinan. Architectural culture in the Ottoman Empire, Londres, Reaktion Books, 2005 : 302 ; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 6 ; Galitekin (éd.), Hadîkatü’l-Cevâmi’ : 76-77. 250
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 43 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 200-201 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 41 ; Necipoğlu, The Age of Sinan : 368-376. 251
Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 143 notice 316 ; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî : t. 1 p. 11 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 293-295 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 76-77. 252
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî : t. 1 p. 12 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 320-321 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 90-91. 253
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî : t. 1 p. 37-38 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 315-316 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 89-90. 254
Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 177 notice 484. Son époux y fut également inhumé, dans le türbe de la princesse, ainsi que plusieurs de ses descendants il n’est pas certain qu’ils soient issus de la princesse). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî : t. 1 p. 46 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 318-319 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 86-87. 255
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 6. 256
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî : t. 1 p. 12 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 320-321 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 90-91.
Page | 92
Le cas de figure le plus courant est l’inhumation d’une princesse au sein d’un espace
religieux dont elle est la fondatrice. Ce fut le cas d’Aynişah et de Neslişah, respectivement
une fille et une petite-fille de Bayezid II, de la petite-fille de Selim Ier, bien que le lieu de son
inhumation soit contesté, ou encore de la fille de Mihrimah Sultane (fille de Süleyman Ier) et
du grand vizir Rüstem Pacha, Ayşe Sultane257
. Nous n’avons aucune indication allant dans ce
sens pour le XVIIe siècle, mais un exemple réapparaît au XVIII
e, avec Zeyneb, fille d’Ahmed
III. La chronologie est intéressante, car elle permet d’expliquer les motifs de ces choix. À
l’extrême fin du XVe et au XVI
e siècle, ce sont principalement des petites-filles de sultan qui
ont recours à ce choix de lieu d’inhumation. Or, à cette époque, ces princesses indirectes n’ont
pas accès aux cimetières dynastiques : le meilleur moyen d’afficher leur haute condition était
encore de se faire inhumer à proximité d’une fondation construite par leurs soins (comme
nous le verrons plus tard, l’acte de fondation constituait une proclamation d’un statut
élevé258
). Si de nouveaux cas réapparaissent au XVIIIe siècle, c’est peut-être bien en raison
des problèmes de place dans les nécropoles dynastiques de cette période que nous avons
soulignée plus haut. C’est donc à la fois par défaut, mais aussi parce qu’elle en a la possibilité,
qu’une princesse se fait inhumer à proximité de son œuvre religieuse, car pour se faire
inhumer dans le jardin de sa propre fondation, encore faut-il avoir réalisé une telle
construction – et les femmes d’élite à s’être distinguées dans de telles entreprises sont plutôt
rares.
Les princesses qui ne disposaient pas d’un espace religieux en leur honneur étaient
contraintes de chercher ailleurs une affiliation digne de leur statut. Quelques cas demeurent
inexpliqués : les motifs qui poussèrent Sofiyye Fatma à se faire inhumer dans la mosquée
d’Aşık Pacha ou Emine dans celle de Mimar Acem Ali ne sont pas connus. D’autres montrent
des préférences communes aux membres de l’élite, comme l’inhumation à Eyüp. La vaste
nécropole d’Eyüp fut très vite un lieu abritant les dépouilles de nombre de membres de l’élite
ottomane. L’association avec le grand personnage, la présence répétée de membres de l’élite
qui s’y firent construire des mausolées familiaux, tout contribuait à faire de cette nécropole un
endroit propice à l’enterrement de princesses indirectes. Ainsi, deux petites-filles de Bayezid
II choisirent de s’y faire inhumer : Fatma « Hançerli », fille du prince Mahmud, et Fatma, fille
du prince Mehmed. Toutes deux sont des filles de prince : n’ayant pas de place auprès de leur
père, le lieu d’Eyüp était conforme à leur statut. Au XVIIIe siècle, la princesse Ayşe, fille de
Safiyye (fille d’Ahmed III), Emine et sa mère, Saliha (autre fille d’Ahmed III), ou encore sa
sœur, Esma Sultane, s’y firent aussi inhumer.
Les pratiques décrites ci-dessus correspondent pleinement aux mœurs funéraires
cultivées par les membres de l’élite, tant hommes que femmes. La principale différence entre
les sexes, dans ce domaine, réside dans la plus grande rareté des fondations pieuses édifiées
257
Cette princesse, protectrice d’un cheikh de renom qui bénéficiait déjà du soutien de ses parents, Mahmud Hüdayı, participa fortement à la construction d’un complexe qui lui fut dédié, à Üsküdar
257, situé non loin du
complexe de la mère de cette princesse la mosquée de Mihrimah Sultane, au niveau de l’embarcadère d’Üsküdar . L’association de ce cheikh avec la famille et la fondatrice, la présence de legs pieux associés à son nom, favorisèrent le choix du lieu d’inhumation d’Ayşe, qui se fit inhumer dans un türbe situé dans l’enceinte du complexe d’Hüdayî ; Necipoğlu, The Age of Sinan : 302 ; Mehmed Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 6. 258
Chapitre suivant 5.III.1.3.
Page | 93
sous l’égide des femmes259
. On pourrait ainsi souligner une certaine spécificité des princesses
ottomanes en matière d’inhumation : celles qui ne purent ou choisirent de ne pas être
inhumées dans les cimetières dynastiques bénéficiaient généralement d’un espace religieux de
commémoration propre. Ce choix de lieu d’inhumation les rapprochait certes des pratiques
élitaires, mais l’existence même de ces fondations à leur gloire rappelait la hauteur de leur
statut. Un dernier élément permet encore de distinguer ces femmes de celles de l’élite. Les
pratiques funéraires féminines les plus courantes consistaient, pour les membres des classes
privilégiées, à se faire inhumer à proximité d’un membre masculin de la famille. Les femmes
de l’élite se faisaient donc enterrer aux côtés de leur mari ou de leur père, voire dans certains
cas plus rares, de leur fils ou frère.
La différence des pratiques des femmes de l’élite et des princesses surgit ici : hors des
nécropoles dynastiques, le regroupement familial est inexistant ; aucune des princesses en
question ne fit le choix d’être inhumée à proximité d’autres membres de la famille. Et pour
cause, les autres membres féminins hauts placés de leur famille trouvaient place
principalement dans les nécropoles dynastiques. Seuls les hommes non membres de la
dynastie offraient la possibilité d’un rapprochement familial : les époux, les pères (dans le cas
des Hanım Sultanes) – le cas des Sultanzade sera discuté plus bas. Seules quelques-unes de
ces femmes optèrent pour un rapprochement conjugal : Hüma, Ferruhşad, Fatma et Şah. Faut-
il y voir l’expression d’un amour clamé par-delà la mort ? Certains, comme Peçevi,
n’hésitèrent pas à le penser, comme dans le cas de Şah Sultane, épouse de Zal Mahmud
Pacha, décédée très peu de temps après lui :
« On raconte qu’il tomba malade le même jour que son épouse, la sultane, et qu’ils
rendirent l’âme ensemble, après avoir échangé des vœux mutuels de pardon en
signe d’un amour porté à un tel degré de perfection qu’il ne se trouve pas entre
mari et femme. »260
L’attachement sentimental est une cause possible, car, après tout, ces femmes avaient la
possibilité d’une ultime glorification post mortem, qu’elles refusèrent au profit d’une
association à leur époux : il est douteux qu’une princesse malheureuse en couple ait fait ce
choix. Mais l’attachement sentimental n’est pas la seule explication à ces choix d’inhumation
hors des nécropoles impériales. Fatma Sultane, fille de Selim Ier, se fit inhumer auprès de son
mari, mais dans la mosquée qu’elle avait contribué à terminer, de même qu’Hüma Sultane,
fille de Bayezid II, qui avait fait ajouter un minbar à ses frais. Ainsi Şah Sultane est certes
inhumée aux côtés de son époux, dans un türbe conjugal ; mais c’est aussi au sein de leur
fondation pieuse commune, dont elle fut l'investisseur principal261
. Il faut donc rapprocher ces
quelques cas de ceux vus précédemment : l’inhumation dans un espace religieux érigé par la
défunte.
Ces situations sont particulièrement intéressantes parce qu’elles reflètent un
phénomène de déclassement social volontaire, qui fait surgir la question de la liberté du choix
259
Cf. Chapitre suivant 5.I.2.3. 260
İbrahim Efendi Peçevî, Tarîh-i Peçevî, F. Ç. Derin et V. Çabuk (éds.), Istanbul, Enderun Kitabevi, 1980 : t. I p. 441-442. 261
Nous reviendrons sur ces deux cas dans le dernier chapitre, dédié aux fondations pieuses des princesses. Cf. Chapitre suivant 5.III.1.1.
Page | 94
du lieu d’inhumation laissée aux intéressées. L’existence de cas dérogatoires montre qu’il
était possible de prendre des dispositions allant à l’encontre des pratiques dynastiques ; mais
la rareté des exceptions laisse entendre qu’en l’absence de précisions spécifiques, la dépouille
recevait automatiquement une place quelque part dans un cimetière impérial. Le meilleur
moyen, pour une princesse, d’affirmer ses désirs concernant le devenir de sa dépouille était de
les coucher par écrit sur un testament. De fait, ce fut la solution prise par la fille du prince
Mehmed (fils de Süleyman Ier et d’Hürrem), Hümaşah Sultane, dont le testament a été
heureusement conservé262
, ou encore par Esma Sultane, fille d’Ahmed III, inhumée à Eyüp,
auprès de son époux, « d’après son testament »263
.
4) Les Sultanzade, entre rapprochement familial et rapprochement
dynastique
Le cas des descendants indirects non affiliés à la dynastie – soit tous ceux qui ne sont
pas détenteurs d’un titre royal, tel qu’ils ont été identifiés plus haut et que, par commodité,
nous appelons de façon générique les Sultanzade – mérite également de figurer dans ce
chapitre, car il s’agit, d’une part, de vérifier la spécificité des pratiques funéraires des
princesses ottomanes par rapport au reste de l’élite (à laquelle les Sultanzade appartiennent),
et d’autre part, de voir si ces individus mirent en place des stratégies spécifiques pour
commémorer leur ascendance royale, comme ils le firent dans l’usage des matronymes.
Tableau 1.14. Les inhumations dans Istanbul des Sultanzade
Rapprochement dynastique
Rapprochement familial (non dynastique)
Rapprochement conjugal
Inhumation liée à la fondation d’un tiers
Dukakinzade Osman Bey
Mosquée de Atik Ali Pacha (tombe)
264
Cigalazade Mustafa Bey Mosquée Ebu’l-Vefa (tombe)
265
Cigalazade Mahmud Pacha
Medrese de Kuyucu Murad Pacha (tombe)
266
Cigalazade Mahmud Bey
Mosquée de Mihrimah Sultane à Edirnekapı tombe
267
Cigalazade Süleyman Bey
Mosquée du Şehz de tombe 268
262
VGMA D 747 s. 373 (986) : 1578. 263
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 12. 264
Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 93-94 notice 39. 265
Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 110 notice 138. 266
Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 139 notice 294. 267
Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 143 notice 315. 268
Il est le fils de Sultanzade Simîn ou Semin Mehmed Pacha : Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 164-166 notice 422.
Page | 95
Cigalazade Mehmed Bey
Mosquée du Şehz de tombe 269
Cigalazade Ahmed Bey Mosquée du Şehz de tombe 270
Cigalazade Mustafa Bey Mosquée du Şehz de tombe 271
Cigalazade el-Hacc Ibrahim Bey
Mosquée du Şehz de tombe 272
Abdülkerim Bey Mosquée du Şehz de tombe 273
Cigalazade N ’ile Kadın Mosquée du Şehz de tombe 274
Süleyman Rif’at Efendi Mosquée du Şehz de (tombe)275
Cigalazade Süleyman Salim Efendi
Mosquée du Şehz de tombe 276
Cigalazade Mesude Hanım
Mosquée du Şehz de tombe 277
Cigalazade Saliha Hanım
Mosquée du Şehz de tombe 278
Cigalazade Tahrir Bey Mosquée du Şehz de tombe 279
Cigalazade Mahmud Bey
Mosquée du Şehz de tombe 280
Les autres membres de la famille des Cigalazade
Mosquée de Mihrimah Sultane à Üsküdar
281
Hadice Kadın Mosquée du Şehz de tombe 282
Sultanzade X Türbe du prince Mahmud, à la mosquée Şehzade, aux côtés de ses sœurs
283
Hanım Sultanzade Rifat Bey
Türbe de Turhan Hadice Valide Sultane (tombe)284
Hanım Sultanzade Süleyman Bey
Türbe de Turhan Hadice Valide Sultane (tombe)285
Le tableau ci-dessus présente un déséquilibre contraire à celui observé précédemment.
Le rapprochement conjugal est inexistant, l’inhumation dans des espaces religieux fondés par
le(a) défunt(e) introuvable. Même les inhumations dans des fondations pieuses appartenant à
269
Fils du précédent : Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 164-166 notice 422. 270
Fils du susdit Cigalazade Mehmed Bey : Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 164-166 notice 422. 271
Idem. : Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 164-166 notice 422. 272
Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 164-166 notice 422. 273
Allié à la famille par son mariage avec une Cigalazade : Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 164-166 notice 422. 274
Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 164-166 notice 422. 275
Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 164-166 notice 422. 276
Il appartient à la lignée de Cigalazade Süleyman Pacha : Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 164-166 notice 422. 277
Fille du précédent : Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 164-166 notice 422. 278
Idem. : Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 164-166 notice 422. 279
Frère de la précédente : Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 164-166 notice 422. 280
Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 164-166 notice 422. 281
İbrahim H. Konyalı, Âbideleri ve Kitâbeleriyle Üsküdar Tarihi, Istanbul, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Yayınları, 1976-1977. 282
Epouse du précédent : Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 164-166 notice 422. 283
Il s’agit d’un fils de la princesse Hadice Sultane, fille de Murad III : Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 164-166 notice 422. 284
Il est inhumé à proximité de sa grand-mère, Ayşe Sultane, mère de Rukiyye Hanım Sultane qui avait épousé Lalazade Nûrî Bey : Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 174-176 notice 478. 285
Frère ou demi-frère du précédent : Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 174-176 notice 478.
Page | 96
un tiers sont rares : les cas recensés datent tous de la première moitié du XVIe siècle, mais
nous ne savons pas s’il faut y voir une évolution des pratiques funéraires au cours du temps.
Une caractéristique prédomine dans les choix des lieux d’inhumation : le
rassemblement familial. La branche des Cigalazade au sein de la descendance de Mihrimah
Sultane et Rüstem Pacha en est l’exemple le plus accompli : la grande majorité d’entre eux
furent inhumés soit dans le cimetière de la mosquée de Mihrimah Sultane à Üsküdar, soit dans
celui attenant à la mosquée du Şehzade. Or, ce rapprochement suit bien une logique
lignagère : les époux, les lignées collatérales, les descendants sur plusieurs générations s’y
trouvent réunis dans la mort. L’emplacement même de leurs tombes en est le reflet : dans le
cimetière de la Mosquée du Prince, nous avons pu constater de visu la proximité des tombes,
disposées les unes aux côtés des autres, comme c’est souvent le cas. Cette logique lignagère
est encore renforcée par le choix même des cimetières : le premier est attenant à la mosquée
de la fondatrice du lignage, Mihrimah Sultane, le second recueille le mausolée du fondateur
du lignage, Rüstem Pacha. Le choix de ces cimetières est donc une manière de se placer sous
la protection des ancêtres. Mais le cimetière de la Şehzade Camii est aussi un cimetière semi-
impérial, ainsi que nous avons eu l’occasion de le dire plus haut. Et à ce titre, il rappelle
également l’idée d’une ascendance dynastique. Les Cigalazade qui s’y firent inhumer
vécurent néanmoins aux XVIIIe et XIX
e siècles : il semble donc que la commémoration du
lien dynastique, si tant est qu’elle fût à l’origine de ce choix, soit une préoccupation tardive de
descendants fort éloignés d’une princesse, qui désiraient peut-être renouer avec leur lustre
ancestral.
Une différence considérable distingue les pratiques des princesses ottomanes et des
sultanzade en matière d’inhumation : les sultanes et hanım sultanes ne répondent pas à des
stratégies funéraires lignagères, au contraire des sultanzade. C’est bien le lignage qui est mis à
l’honneur dans le cas des Cigalazade : non pas seulement la famille nucléaire, comme dans le
cas traditionnel des membres de l’élite, mais bien l’ensemble du lignage sur plusieurs
générations. Le choix des lieux d’inhumation de ces descendants indirects reflète donc la
volonté de perpétuer une certaine cohésion familiale lignagère par-delà la mort. Il est
intéressant de noter que ces pratiques s’amplifièrent et se diffusèrent progressivement auprès
des familles de kul organisées en véritables lignages, ainsi que l’ont montré les travaux
d’Olivier Bouquet pour le XIXe siècle
286.
286
Cf. Olivier Bouquet, Les pachas du sultan. Essai sur les agents supérieurs de l’Etat ottoman 1839-1909), Paris / Louvain, Peeters, 2007 : 202-230 et « Le vieil homme et les tombes ». Sur la question des grandes familles ottomanes et l’importance du lignage, voir également, du même auteur, « Comment les grandes familles ottomanes ont découvert la généalogie », Cahiers de la Méditerranée 82 (juin 2011) : 297-324 et « Famille, familles, grandes familles : une introduction », Cahiers de la Méditerranée 82 (juin 2011) : 189-211.
Page | 97
*
Les choix des lieux d’inhumation des princesses ottomanes illustrent parfaitement le
conflit d’identité qu’elles connaissent. Exclues dans les premiers temps des cimetières
impériaux en raison d’une identité ottomane mal assise, les princesses ottomanes font leur
entrée dans ces lieux à la gloire de la dynastie dès l’abandon des pratiques d’alliances
matrimoniales interdynastiques, quand leur identité ottomane n’est plus mélangée à celle
acquise par le mariage. Le tournant du XVIe siècle correspond donc au moment où ces
femmes acquièrent une place officielle et participative dans la dynastie, symbolisée par
l’octroi de titres royaux et jusque dans les honneurs funéraires. Désormais, nées princesses
ottomanes, c’est cette condition qu’elles emportent dans la mort. Cette évolution des
pratiques, qui rejoint une transformation plus profonde de la conception des membres affiliés
à la dynastie, est néanmoins progressive : le rapprochement des dépouilles des sultanes de
celles des sultans se fait par étape. Les hanım sultanes, dont le lien avec la dynastie est plus
complexe, ne parviennent à faire leur entrée dans les cimetières dynastiques que plusieurs
générations après les filles de sang, preuve d’une ouverture progressive de la dynastie en
faveur de la descendance féminine des sultans.
Si le problème de définition identitaire des princesses ottomanes est très largement
résolu dans le courant du XVIe siècle en faveur d’une identification dynastique, ces femmes et
familles à cheval entre la dynastie et l’élite ottomane continuent de souffrir de cette dualité de
positionnement social. Ce phénomène se lit dans le choix de certaines princesses de refuser
l’association dynastique posthume au profit de pratiques funéraires plus typiques des
membres de l’élite – sans omettre néanmoins de souligner la spécificité de leur rang : le choix
de se faire inhumer au sein d’espaces religieux associés à leur nom est une manière de
rappeler leur prestige et leur qualité morale, en se mettant en scène en femmes philanthropes,
patronnes d’architecture. Les stratégies funéraires des sultanzade révèlent cette crise
identitaire que l’amenuisement du lien dynastique au fil des générations ne parvient pas à
faire disparaître : leur incapacité à investir les espaces funéraires dynastiques ne les empêche
pas de développer des stratégies commémoratives de leur appartenance ancestrale commune à
la famille royale. Elles permettent le renforcement d’une cohésion familiale lignagère peu
commune, dans ces proportions, au sein des familles de l’élite à cette période, qui se
contentent souvent d’un rapprochement familial sur une base nucléaire. On sent naître ainsi,
au cours du temps, une conception de la famille dans la haute société ottomane qui tente de
surmonter l’effilochage du statut social imposé à ces familles par l’absence d’un système
aristocratique en promouvant le concept lignager. Les familles des princesses ottomanes
pourraient bien avoir joué un rôle précurseur auprès des familles des serviteurs de l’État287
.
287
Nous ne sommes pas convaincue par l’idée que les familles d’oulémas souffrent des mêmes difficultés en matière de succession et de reproduction sociale. Des études plus poussées sont à mener, dans un esprit de comparaison avec les familles de kul.
Page | 98
III. Conjugalité et rapports hiérarchiques
Le domaine de la conjugalité appartient à ce monde de l’intime que l’historien peine à
découvrir, car il est rarement l’objet d’une mise par écrit des sujets eux-mêmes. Les
modernistes travaillant sur l’Europe ont plus de chance que leurs collègues ottomanistes dans
ce domaine, grâce à l’existence de lettres et journaux intimes qui fournissent des
renseignements souvent introuvables ailleurs288
. De telles considérations ne sont pas
envisageables, en l’état de la documentation, pour la période antérieure à la seconde moitié du
XIXe siècle de l’Empire ottoman, c’est-à-dire avant l’édition de revues et magasines pour
femmes qui abordent ces questions des rapports conjugaux. Les Ottomans de l’époque
classique gardent un silence pesant sur tout ce qui a trait à l’intimité, que ce soit l’intimité des
relations familiales ou conjugales, ou même l’intimité du harem. L’espace domestique avec
tout ce qui s’y passe est, par nature, perçu comme privé : il n’a pas sa place dans les écrits
narratifs. Ce n’est donc pas chez les Ottomans qu’il faut chercher des indices des réalités de la
vie conjugale des princesses, mais chez les voyageurs occidentaux289
. Leur savoir ne pouvait
être que partiel, tant il dépendait de la qualité des connaissances de leurs informateurs. Leurs
écrits permettent néanmoins de se faire une opinion non pas des détails de la vie privée de ces
couples princiers, mais des règles qui les ordonnançaient. Leurs propos se font l’écho d’une
surprise partagée : ces couples n’ont rien à voir avec ce qu’ils pensaient trouver dans une
société qui prône la soumission de la femme à son époux, tant chez eux, en Occident, que
chez ceux qu’ils viennent visiter, les Ottomans. Avec une certaine pitié à l’égard des époux
des princesses ottomanes, ils se font les rapporteurs des rapports conjugaux de ces couples
exceptionnels.
Pour percevoir la spécificité des avantages maritaux accordés aux princesses
ottomanes, il faut procéder à un décalage de perspective et se concentrer sur leurs époux, les
gendres impériaux, les dâmâd-ı sehriyârî. L’apparition de ce terme repose sur une volonté
impériale de mettre en valeur les kul alliés à la famille régnante. Il faut alors commencer par
s’interroger sur ceux qui avaient le privilège de détenir ce titre (et ceux qui en étaient exclus)
et sur la portée idéologique de cette dénomination. Après quoi, il restera à regarder quelles
étaient les obligations maritales qui s’imposaient, de façon surérogatoire, aux gendres
impériaux et qui avaient pour fondement la volonté d’exaltation de la supériorité dynastique.
Il s’agit donc d’étudier, ici, la manière dont la dynastie ottomane proclama, jusque dans
l’intimité des couples princiers, l’idéal d’exceptionnalité du sang ottoman.
288
Cette documentation a permis des travaux sur les rapports intimes au sein du couple. Voir notamment les travaux de Philippe Aries et Georges Duby (dir.), Histoire de la vie privée, Paris, Le Seuil, 1985 ; Anne Vergus et Denise Davidson, Le roman conjugal. Chroniques de la vie familiale à l’époque de la Révolution et de l’Empire, Seyssel, Champ Vallon, 2011 ; François Lebrun, La vie conjugale sous l’ancien régime, Paris, Colin, 1975 ; Michelle Perrot, Histoire de chambres, Paris, Editions du Seuil, 2009 ; Adeline Rucquoi, Aimer dans l’Espagne médiévale. Plaisirs licites et illicites, Paris, Les Belles Lettres, 2008. 289
Un récit narratif ottoman fait néanmoins exception, celui d’Evliya Çelebi, proche parent de Melek Ahmed Pacha dont il était un confident et dont il rapporte certaines de ses expériences conjugales. Voir notamment la publication d’extraits par Dankoff éd. , The Intimate Life of an Ottoman Statesman.
Page | 99
1) Magnifier les époux : la création du titre de « dâmâd-ı şehriyârî »
N’était pas dâmâd-ı şehriyârî qui voulait : tous les époux des princesses ottomanes ne
furent pas gratifiés de cette appellation, qui n’apparaît qu’à la fin du XVe siècle. Pour
comprendre la signification de cette dénomination, il faut se pencher sur le profil des
détenteurs de ce titre et de ceux qui en furent exclus, puis sur les avantages associés au port de
ce titre.
1) Qui sont les « gendres impériaux » ?
Dâmâd-ı şehriyârî signifie, littéralement, gendre impérial : en cela, ce terme appartient
au lexique de la parenté. De fait, il induit une relation familiale bien particulière, qui est à la
fois alliance, exclusion et distinction. L’alliance est fortement soulignée par l’emploi du mot
dâmâd : un gendre est un homme qui entre dans une famille par la voie d’une alliance
matrimoniale290
. Mais ce terme d’alliance est tout de suite spécifié par un adjectif, şehriyârî :
ce gendre est impérial. Le type d’alliance est ainsi précisé sans confusion possible : ce gendre
n’est pas n’importe quel gendre, mais il est l’époux d’une princesse ottomane. Il s’agit là
d’une précision honorifique qui souligne l’existence d’une distinction parce qu’elle indique
précisément la famille avec laquelle l’alliance est faite (au contraire du terme générique de
dâmâd), et rappelle la qualité de cette union (on ne se glorifie pas d’une alliance
désavantageuse). Mais le terme a également une valeur d’exclusion : le gendre demeure un
allié extérieur, un associé qui n’est pas pleinement intégré à la famille. Il n’est pas appelé
« fils » par son beau-père, ni « frère » par ses beaux-frères ; on ne lui accorde aucun titre
dynastique (il ne devient pas « sultan » ni « şehzâde »). Cette alliance matrimoniale n’induit
en aucun cas l’intégration du gendre au sein de la dynastie – pas plus que le mariage avec un
prince n’induisait l’intégration de son épouse dans le lignage dynastique291
. Le lien institué
demeure de l’ordre de la connexion familiale, en cohérence avec le système familial ottoman
patriarcal, dans lequel la transmission du sang est uniquement masculine : quand bien même
ces gendres l’auraient voulu, ils n’auraient pu être intégrés au lignage ottoman puisque leur
lien avec la dynastie n’était assuré que par la voie féminine.
Ceci étant posé, une première remarque s’impose : le terme de dâmâd-ı
şehriyârî n’apparaît que tardivement dans les chroniques ottomanes. Ainsi, dans le récit
d’Aşık Paşazade, la formule n’est jamais utilisée, pas plus que dans celui de Neşri292
. Dans les
histoires officielles, le terme n’apparaît pas avant le XVIe siècle. Pourtant, à consulter
290
Johannes H. Mordtmann, « Dâmâd », EI (2) : t. 2 p. 105-106. 291
Ainsi, pendant toute la période allant du XIVe au XV
e siècle, au cours de laquelle les sultans et princes
ottomans prirent pour épouse des princesses étrangères, tantôt chrétiennes, tantôt musulmanes, aucune d’entre elles ne fut gratifiée d’un titre distinctif soulignant son appartenance à la dynastie. 292
Derviş Ahmed Aşıkpaşaz de, Tevârîh-i Âl-i ‘Osmân, Âşıkpaşazâde Tarihi, Istanbul, Imprimerie Impériale, 1332 ; Neşrî, Cihânnümâ.
Page | 100
l’ouvrage (tardif, il est vrai) de Mehmed Süreyya, on pourrait croire que son usage serait plus
précoce ; mais il est vrai que celui-ci l’utilise de façon assez confuse, tout aussi bien à propos
de kul, tel Güveyi Sinan Pacha293
que de princes étrangers, tel le souverain karamanide
Ibrahim Bey294
. Or, ce terme de gendre impérial, qu’il accorde au souverain karamanide, il le
refuse au prince isfendiyaride, l’époux de Selçuk Hatun, fille de Mehmed Ier, qu’il nomme
Kasım Pacha295
. Mehmed Süreyya confond allégrement les individus entre eux : Selçuk Hatun
épousa Isfendiyar Bey et non son fils, Kasım Pacha (qui n’est d’ailleurs pas noté parmi ses
enfants dans la notice lui correspondant)296
. De même, ni Isa Bey, fils du souverain
karamanide Mehmed Bey et gendre de Murad II, ni aucun autre gendre de sultan avant
Bayezid II ne fut gratifié du terme de dâmâd-ı şehriyârî. La confusion de Mehmed Süreyya
semble provenir d’une application trop stricte, parce que calquée sur les pratiques de son
époque, du terme de dâmâd-ı şehriyârî à l’ensemble des gendres des sultans, sans s’interroger
sur la possibilité qu’il n’en ait pas toujours été ainsi.
Il est en fait bien difficile de dater avec précision le moment où les gendres impériaux
commencent à être distingués comme des dâmâd-ı şehriyârî. Les premières attestations allant
dans ce sens sont fournies par Sadüddin Efendi, qui rédige au XVIe siècle, à propos de
gendres de Bayezid II (soit une période antérieure à son temps). Pourtant, les tournures
empruntées ne sont pas encore figées et le couple de mots dâmâd-ı şehriyârî n’apparaît pas
dans son récit ; à la place, il lui préfère des tournures qui insiste sur la notion de parent par
alliance : « k arâbet-i mus âheret » ou « k arîn-i mus âheret ». Ainsi, à propos d’Hersekzade
Ahmed Pacha, dont il retrace l’entrée au Palais et la brillante carrière qui s’ensuivit, il note
qu’il « fut distingué et considéré d’un œil bienveillant [par le monarque], de sorte qu’il acquit
une place de grande valeur parmi les Piliers de l’État en s’élevant au rang de vizir et en
293
« Sinan Paşa (Damad-ı şehriyârî) (Güveyi). Saraydan 897’de (1492) çıkarak Gelibolu sancağıyla kapdan-ı deryâ oldu. 300 parça gemiyle gidip Avlonya sahillerini vurdu. 898’de (1493) azledildi. Sonra vilâyete çıkıp 907’de (1501/02) Anadolu beylerbeyi olup 909’da (1503/04) vefat etmiştir. » : Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 5 p. 1511. 294
« İbrahim Bey (Damad-ı şehriyârî). Karaman beyi II. Mehmed Bey’in oğludur. 837’de (1433/34) babasının katlinde Konya’da vali ve hâkim oldu. Sonra II. Murad’a damad oldu. Lakin rahat durmayıp beyliği müddet ince birçok defa isyan ve harb etti. Cezalandırılacağı sırada zevcesi sultanı şefaata gönderip affa mazhar oluyordu. Velhasıl bağlılık noktasında azca bulunup 869’da (1464/65) vefat eyledi. Mezarında da rahat olmadı. Çünkü oğulları anlaşmazlığa düşüp Karamanoğulları bu yüzden perişan oldu. Evladından ve sultanzâdelerden Alâeddin Bey, Karaman Bey, Nure Sofî Bey 982’de (1467) Konya muharebesinde vefat ettiler. Diğeri Kasım Bey ana-baba bir kardeşi Pîr Ahmed Bey’le baba bir kardeşi İshak Bey’in aralarını bozup 885 (1480) yılında sonra yok olmuştur. » : Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 3 p. 743. 295
« Kasim Paşa. İsfendiyar Bey’in oğludur. I. Mehmed’in (Çelebi kızıyla evlendi. Babasının vefatında Kastamonu ve Kengiri valisi olup 848’de (1444) sultanın vefatında II. Murad’ın kızıyla evlendi. II. Murad devri (1421-1451) sonlarında vefat eylemiştir. Sâdık ve doğru idi. Oğlu Mustafa Bey savaşlarda bulunarak serdârlık etmiş bir yiğitti. » : Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 3 p. 874. La grande confusion de Mehmed Süreyya apparaît évidente lorsqu’il indique, à propos d’Isfendiyar Bey : « İsfendiyar Bey. Köturüm Bayezid’in oğludur. Babsının vefatında sade Sinop’a vali oldu. Timur hadisesinde ona gidip Kastamon’yu da aldı. Sonra II. Murad’a, kızıyla evlenerek bağlılığını yenilemiştir. II. Murad devrinde (1421-1451) vefat eyledi. Oğulları İbrahim Bey ve Murad Bey’dir. Murad Bey’i, hayatında hediyelerle Osmanlı padişahına göndermiştir. Kendisinden evvel vefat eyledi. » : Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 3 p. 802. 296
Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 11-12 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 78-87.
Page | 101
devenant également un parent par alliance »297
. La formulation est la même à propos de
Güveyi Sinan Pacha, autre gendre de Bayezid II298
et encore à propos d’Ahmed Mirza, petit-
fils d’Uzun Hasan299
.
La chronique de Sadüddin révèle ainsi les prémisses d’une mise en valeur verbale des
gendres impériaux qui n’existait pas jusque là : les chroniqueurs antérieurs se contentent
d’indiquer que la fille (souvent non nommée) de tel sultan fut « donnée » ou « mariée » à telle
personnalité politique. Aucun terme de parenté spécifique n’est employé. Ce serait donc dans
le courant du XVIe siècle que la formulation officielle cherche à créer une tournure lexicale
spécifique pour caractériser les gendres impériaux. Cependant, un problème de datation
survient ; Sadüddin use de ces formules, introuvables dans les auteurs plus anciens, à propos
d’individus antérieurs à son temps : faut-il comprendre que le changement se fit sous le règne
de Bayezid II ou bien qu’il date de la première moitié du XVIe siècle et que Sadüddin
applique des formules de son temps à des personnes appartenant au passé ? Il n’est pas
possible de répondre de façon précise, mais il est certain qu’une évolution se fit entre la fin du
XVe et la première moitié du XVI
e siècle, ce qui coïncide avec la transformation profonde du
modèle des alliances matrimoniales nouées autour des princesses ottomanes. Auparavant,
celles-ci étaient mariées tantôt à des souverains voisins, tels les İsfendiyaroğlu ou les
Karamanoğlu, tantôt à des représentants des grandes familles d’oulémas, tels notamment les
Candarlızade. Or, cette pratique disparaît progressivement tout au long de la seconde moitié
du XVe siècle, d’abord sous le règne de Mehmed II, puis de façon plus définitive, sous celui
de son fils et successeur, Bayezid II300
. À leur place, ce sont des kul des sultans qui sont
désormais choisis pour devenir les époux des princesses ottomanes : ce sont eux qui sont
définis comme dâmâd-ı şehriyârî.
Un premier élément de définition se distingue ici, un élément d’exclusion : ne sont
dâmâd-ı şehriyârî que les gendres kul. Tout d’abord, parce que le terme souligne un lien
particulier avec le sultan et la dynastie : on est gendre impérial, gendre du sultan. Or,
appliquer une telle étiquette à des souverains tels que les Karamanoğlu ou les Isfendiyaroğlu
présentait un risque d’amalgame entre les dynasties. Les conséquences politiques d’une telle
confusion identificatoire étaient de taille : si le lien matrimonial proclamé par ce terme est
sans danger pour la dynastie ottomane lorsqu’il est mis en avant pour un kul (en tant
qu’“esclave”, il ne peut se prévaloir de ce lien familial pour revendiquer le trône), en
revanche, un prince souverain étranger pouvait arguer de cette affiliation à la dynastie dans un
but politique. L’exclusion des femmes de la souveraineté ne semble pas avoir suffi à rassurer
297
« Hersek oġli der devletde şeref-i İsl m ila ser- raz u man ûr-ı na ar i’z z olub ‘ k ibet-i mansıb-ı vez ret ve k ar bet-i mus heret cem’î ile erk n-i devletden mümt z oldı » : Sadüddin, Tac’üt-tevârîh, Istanbul, 1862 : t. 1 p. 397. 298
Sadüddin, Tac’üt-tevârîh : t. 2 p. 6. 299
Ah med Mîrz n m oġli derg h-i ‘osmânî u serîr-i sult nî’ye mesh -i cebîn édüb k arîn-i ‘in yet-i p dişahî ve sult n-ı sa’îd Sult n B yezîd mus here şere ile [...] » : Sadüddin, Tac’üt-tevârîh : t. 2 p. 116. 300
Peirce, The Imperial Harem : 28-56 ; Turan, « The Marriage of Ibrahim Pasha » ; Alderson, The Structure of the Ottoman Dynasty ; Juliette Dumas, « Des esclaves pour époux… Réflexion sur les stratégies matrimoniales de la dynastie ottomane », Clio. Histoire, femmes et sociétés 34 (2011) : 255-275 et « La princesse et l’esclave… Pragmatisme politique et stratégies matrimoniales à la cour ottomane (XIVe – mi-XVIe siècle) », en cours de publication. Cette question est l’objet d’un chapitre ultérieur : 2.I.1.
Page | 102
les Ottomans sur ce point. Et ils n’avaient pas totalement tort : cette exclusion reposait sur un
principe coutumier spécifique à l’Empire ottoman et qui n’engageait qu’eux : leurs voisins
n’avaient aucune raison d’en tenir compte.
On ne saurait comprendre l’octroi de ce terme, refusé à certains du fait de leur
puissance potentielle (les souverains étrangers, les grandes familles turques), accordé à
d’autres, du fait de leur soumission (les esclaves des sultans), sans accepter l’idée qu’il
constitue une marque d’honneur particulière. Cette marque d’honneur n’est pas due à la
réalisation d’un travail particulier ou à l’obtention d’un office, mais au lien matrimonial qui
attache désormais le kul à son souverain. Il s’agit donc d’une marque distinctive, qui donne à
son détenteur un élément de supériorité par rapport aux autres kul : celui d’être allié au sultan
par les femmes. L’application du terme est d’ailleurs cohérente avec sa signification : ne sont
dâmâd-ı şehriyârî que les époux des filles de sultan, à l’exclusion des princesses indirectes,
petites-filles de sultan notamment, et ce, dès l’apparition du terme.
La question des honneurs accordés aux époux des princesses selon le degré de parenté
de celles-ci avec le sultan amène à s’interroger sur l’existence ou non d’une distinction plus
poussée, notamment entre les gendres du sultan régnant et des sultans précédents. Une telle
distinction ne parut pas nécessaire aux yeux des Ottomans : quel que soit le sultan régnant,
seul compte le lien matrimonial avec la dynastie pour être proclamé « gendre impérial ».
Ainsi Halil Pacha, époux de Fatma Sultane, fille de Murad III et de Safiyye Sultane, était
toujours considéré comme un dâmâd-ı şehriyârî sous le règne de Mehmed III, quand bien
même il n’était pas le gendre du souverain régnant301
. Cette indistinction entre les gendres du
sultan sur le trône et ceux des prédécesseurs est d’ailleurs la raison principale de nombre
d’erreurs historiographiques dans la constitution des arbres généalogiques de la famille
ottomane – Hammer, par exemple, semble être passé complètement à côté de ce phénomène
lorsqu’il parle des gendres impériaux302
. Ce flou est lié à la hiérarchie entre les princesses à
propos de laquelle nous avons vu qu’elle ne tenait compte, officiellement, que du lien de
parenté avec un sultan. Cette absence de distinction entre les gendres impériaux, qu’ils soient
gendres du sultan régnant ou non, n’est pas sans donner quelques nouvelles indications sur la
signification du terme : ce n’est pas le lien avec le sultan régnant qui est mis en valeur, mais le
lien avec la dynastie – un lien qui est respecté et honoré du vivant du beau-père aussi bien
qu’après sa disparition. Le lien matrimonial n’est pas individuel, mais dynastique.
301
Il en garda d’ailleurs le surnom, Damad Halil Pacha. Pourtant, le mariage de ce vizir avec la fille de Murad III n’eut lieu qu’à l’extrême fin du règne de ce sultan (pour le nikâh). Il continua pourtant par la suite d’être appelé dâmâd. 302
Joseph von Hammer-Purgstall, Histoire de l’Empire ottoman depuis son origine jusqu’à nos jours, 16 volumes, J.-J. Hellert (trad.), Istanbul, Isis, 1993-2000.
Page | 103
2) Un titre purement honorifique
Tous ces éléments amènent à réfléchir sur ce que représente l’octroi de ce terme de
dâmâd-ı şehriyârî. S’agit-il d’un titre, d’une dignité ou d’un honneur ? On peut tout de suite
supprimer le titre de l’équation, dans la mesure où aucun de ces gendres ne fut appelé Dâmâd
ou même Dâmâd-ı Şehriyârî après son prénom (c’est-à-dire à l’emplacement du titre)303
: ce
sont des pachas, voire des beys, un titre qui correspond à un office, à une fonction. L’octroi
d’un titre en rapport à une fonction est d’ailleurs réglementé, notamment dans les kânûnnâme,
qui précisent que le détenteur de tel poste prendra tel titre et recevra tels émoluments304
.
L’absence d’émoluments associés au terme de dâmâd-ı şehriyârî est d’ailleurs un second
argument permettant d’éliminer définitivement l’idée qu’il correspondrait à un titre. Pour les
mêmes raisons, il faut éliminer la notion de dignité, au sens de dignitas, dans la mesure où
elle suppose la détention d’un office ou d’une charge (même non rétribuée et purement
honorifique)305
. Or, l’une des particularités des dâmâd-ı şehriyârî est la grande diversité de
leurs profils socioprofessionnels. Si l’on admet l’idée d’une relation entre une charge et une
dignitas, il faut alors éliminer cette acception pour les gendres impériaux. Toutefois, dans
l’idée de dignitas réside également une notion de distinction honorifique, que l’on ne peut
complètement omettre.
De fait, c’est l’idée d’honneur qui semble le mieux caractériser ce terme. Le fait d’être
gendre impérial n’est ni un titre, ni une dignité, mais un honneur que le sultan n’accorde qu’à
certains de ses kul. Cette honorabilité comporte plusieurs dimensions : de façon immédiate,
elle implique le mariage avec une fille de sultan ; la mémoire de l’union est conservée dans
les récits de règne et dans les notices biographiques, lui accordant un caractère pérenne ; elle
prend encore une portée symbolique, puisqu’elle consacre la proclamation d’une alliance avec
la dynastie. La dimension symbolique associée au damadlık impérial n’est pas sans donner
des indications précises quant à l’intérêt que la dynastie y trouve. Nous verrons plus loin les
303
Il s’agit ici de ne pas confondre l’emplacement du D m d par rapport au prénom : certains de ces gendres furent surnommés Dâmâd, mais en tant que lakab et non au niveau du titre. Ainsi l’époux de Fatma Sultane, fille d’Ahmed III, est-il appelé Damad Nevşehirli Ibrahim Pacha, mais jamais Ibrahim Damad. Sur la question des lakab et des patronymes ottomans, voir Bouquet, « Onomasticon Ottomanicum ». 304
Voir les Kânûnnâme publiés par Akgündüz, tout particulièrement celui de Mehmed II : Ahmed Akgündüz (éd.), Osmanlı Kanunnâmeleri ve Hukukî Tahlilleri. Tome 1 : Osmanlı Hukukuna Giriş ve Fatih Devri Kanunnâmeleri, Istanbul, Fey Vakfı, 1990. 305
Voir la définition de la dignitas dans l’Empire romain puis dans les dynasties chrétiennes d’Occident, notamment dans le royaume de France, par Werner, Naissance de la noblesse : 321-242. Paul Veyne en donne également une définition, pour la société gréco-romaine : « Plus généralement, le point d’honneur de chaque oligarque était sa dignitas, c’est-à-dire son rang, son prestige dans le domaine politique ; la dignitas n’est pas la « dignité », vertu bourgeoise, mais la gloire (decus), idéal aristocratique. Un oligarque romain se passionne pour sa dignitas politique autant que le Cid pour l’honneur de sa maison. Seulement l’honneur médiéval consiste à n’avoir par failli à certaines exigences minimales avant tout, celle d’être courageux auxquelles tout noble est présumé satisfaire jusqu’à la preuve du contraire : on a son honneur ou on le perd ; la dignitas romaine, elle, s’acquiert, se conserve et s’augmente à mesure que l’importance politique d’un sénateur s’accroît. Ainsi Cicéron : toute sa vie, il a pensé à sa dignitas comme un seigneur à son honneur ; au cours d’une carrière jusqu’alors prodigieusement habile et triomphale, il est exilé : il se désespère, sa dignitas n’est plus ; il est rappelé d’exil : on lui a rendu sa dignitas. » : Veyne, Le pain et le cirque : 353.
Page | 104
enjeux politiques de ces alliances matrimoniales306
. Il reste que l’octroi de cet honneur permet
à la dynastie de promouvoir ses intérêts politiques en accordant une distinction particulière à
un de ses kul.
Sur un plan symbolique, l’une des conséquences de ces mariages est de favoriser
l’idée de suprématie de la dynastie ottomane sur toute autre famille, d’en rehausser le prestige
en faisant de ses membres des individus placés virtuellement au-dessus de tout autre, au-
dessus même des plus puissants dignitaires de l’Empire. En ce sens, les sultans ont opéré un
profond glissement de sens de ces mariages. Ce n’est plus un chef d’État qui cherche une
alliance ou impose un mariage pour s’assurer de la passivité de la dynastie voisine ou d’une
famille puissante ; c’est un souverain absolu qui offre sa fille à un de ses “esclaves”, en signe
de reconnaissance et d’honneur. Le mariage vient ainsi le distinguer parmi les autres kul du
sultan : il est désormais signalé, à vie, par l’honneur que lui a fait son sultan.
2) Les obligations maritales surérogatoires
Il convient maintenant d’examiner les implications du terme de dâmâd-ı şehriyârî. Au
titre de leurs relations conjugales avec les princesses, les gendres impériaux se voyaient
soumis à des obligations surérogatoires, qui s’imposaient par-delà les pratiques islamiques
traditionnelles en cours dans l’espace ottoman. L’importance de ces obligations va de pair
avec leur spécificité : seuls les gendres impériaux y sont astreints.
1) Une inversion des rapports de soumission
Une première obligation domine toutes les autres : celle de la soumission imposée au
mari envers son épouse, c’est-à-dire du kul à la princesse, du bey ou pacha à la dynastie. Tout
réside dans cette idée de soumission à la dynastie, dont la princesse est la représentante au
sein du couple307
. Parmi les obligations imposées aux gendres impériaux, cette soumission est
probablement la plus connue de toutes, parce qu’elle choqua les voyageurs occidentaux, qui
prirent soin de l’évoquer dans leurs relations. Ainsi Stéphan Gerlach, prédicateur luthérien
allemand qui accompagna l’ambassadeur autrichien à la cour ottomane où il résida de 1573 à
1578, note-t-il :
« Les beys qui épousent des sultanes sont condamnés à être les esclaves de leurs
femmes, qui ne se gênent pas pour leur dire : “Tu es l’esclave de mon père !”, de sorte
qu’ils sont contraints de répondre à tous les désirs de leur femme. » 308
306
Chapitres 2.II.1 et 2.II.2. 307
Mordtmann, « Dâmâd » ; d’Ohsson, Tableau général de l’empire othoman : t. VII livre 1 p. 196. 308
Stéphan Gerlach, Türkiye günlüğü, K. Beydilli (éd.), T. Noyan (trad.), Istanbul, Kitap yayinevi, 2006 : t. 2 p.
585.
Page | 105
Son propos trouve un écho auprès d’un autre témoin occidental du XVIe siècle, un Italien
cette fois, le baile vénitien Ottoviano Bon, qui explique :
« Ces sultanes, femmes de pachas, sont pour l’essentiel les maîtresses de leur mari,
libres de les insulter et de les commander comme il leur plaît. Elles portent toujours à
leur ceinture un Hanjar [une dague], enrichi de pierres précieuses, en signe de
privilège et de domination, et elles considèrent leur mari comme des esclaves, les
traitant bien ou de façon diabolique, ou selon la faveur et le pouvoir que le Souverain
leur témoigne. »309
Est-il nécessaire de rappeler que cette soumission du mari envers sa femme est en rupture
avec les pratiques conjugales islamiques en cours dans l’Empire ottoman ? Le principe de
puissance maritale s’applique en effet dans l’ensemble de la société ottomane, en accord avec
les préceptes islamiques, qui font de la soumission de la femme à son époux une règle
essentielle des rapports conjugaux. D’ailleurs, c’est bien parce que l’inversion des rapports de
soumission était exceptionnelle – aussi bien pour la société ottomane que pour ses voisines
occidentales de l’époque moderne – que les témoins susmentionnés ont pris soin de noter ce
phénomène.
Mais cette idée même de soumission du mari à son épouse doit être partiellement
déconstruite. Si elle s’impose aussi facilement dans le cas du couple dont parle Gerlach
(Ismihan Sultane – Sokollu Mehmed Pacha), et de façon plus générale au XVIe siècle, c’est
parce que ces couples sont relativement équilibrés : la princesse en question est une jeune
femme mature, en pleine capacité intellectuelle. Ismihan Sultane épouse en effet Sokollu
Mehmed Pacha à l’âge de 17 ans310
; de même, la plupart des princesses du XVIe siècle sont
mariées à l’âge adulte, rarement avant 15 ans311
. Certes, une différence d’âge importante
prévaut dans ces unions, puisque ce sont des hommes à la carrière déjà bien avancée qui sont
choisis pour devenir des gendres impériaux. Mais, dès le début du XVIIe siècle, la différence
d’âge se fait plus sensible : les princesses sont mariées de plus en plus jeunes, encore enfants ;
les gendres sont des pachas de plus en plus accomplis, c’est-à-dire de plus en plus âgés312
.
Ainsi les filles d’Ahmed Ier sont-elles mariées avant même d’être sorties de l’enfance : Ayşe
Sultane, dont on pense qu’elle naquit en 1605, aurait épousé Nasuh Pacha en 1612, à l’âge de
sept ans313
; Gevherhan Sultane n’avait que trois ans lorsqu’elle fut mariée à Öküz Mehmed
Pacha314
. Par la suite, la règle est systématiquement appliquée : les princesses sont mariées
pour la première fois à un âge tendre, à des époux d’âge avancé – pour être ensuite remariées
à plusieurs reprises au cours de leur vie. Ainsi au XVIIIe siècle, quand, au début de son règne,
309
Bon, The Sultan’s Seraglio : 53. 310
Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 198-200 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 40-41. 311
Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 150-222 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 31-46. 312
Nous y reviendrons ultérieurement : Chapitre 2.I.3. 313
Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 232-233 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 50-51. 314
« Cependant l’escadre égyptienne, qui tous les ans était le point de mire des flottes maltaise et florentine, était arrivée heureusement à Constantinople avec douze cent mille ducats formant le tribu de deux années de l’Égypte, sous la conduite d’OEgüz Mohammed Mohammed le Bœuf , fils d’un maréchal-ferrant de la capitale, élevé dans le harem ; pour le récompenser, il fut nommé à la dignité de kapitan-pasha en remplacement de Khalil, et fiancé à la fille du sultan Ahmed, âgée de trois ans [été 1610]. » : Hammer, Histoire générale de l’Empire ottoman : t. 8 p. 87. Cf. Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 234-235. Uluçay ne fait pas mention d’elle.
Page | 106
Ahmed III décide de donner ses nièces en mariage, celles-ci n’ont, de l’aveu des
chroniqueurs, que cinq et six ans, la dernière, la plus jeune, ne devant pas avoir plus de trois
ans315
.
Dans ces conditions, peut-on vraiment accréditer l’idée d’une soumission effective de
l’époux à sa femme, une enfant ? Il semble plus raisonnable de penser que la soumission était
plus officielle que factuelle, en tout cas à partir du XVIIe siècle. Car, au bout du compte, ce
qui était demandé aux gendres impériaux, ce n’était pas tant une soumission complète et totale
à leur épouse, que la démonstration de toute la déférence due à un membre de la dynastie,
c’est-à-dire à une personne statutairement supérieure à eux. Ainsi, le caractère hypogamique
de ces mariages princiers influe sur les relations conjugales et sur l’équilibre hiérarchique, qui
penche désormais en faveur de l’épouse. Or, l’existence de telles unions hypogamiques dans
la haute société ottomane est loin d’être une spécificité de la famille royale ; on la retrouve
pratiquée ailleurs, en Égypte notamment, ou encore à Alep – bien que pour des périodes
ultérieures316
. Nulle part n’est spécifiée cette idée de soumission, même si on peut penser
qu’une certaine déférence s’imposait naturellement, en raison de l’omniprésence du rapport
hiérarchique dans la société ottomane. Quand bien même elle ne serait que pure
démonstration extérieure, il faut y voir la marque d’une spécificité royale : la déférence n’est
pas tant envers la femme que par respect pour ce qu’elle incarne, la dynastie.
2) L’obligation de monogamie
La soumission symbolique n’est cependant que le premier volet des obligations
conjugales imposées aux dâmâd-ı şehriyârî. À cela s’ajoute aussi une autre obligation, plus
exceptionnelle encore : celle de la monogamie. Gerlach note à ce propos :
« Quand un pacha est marié à une sultane, il est contraint de divorcer de ses épouses
précédentes, quand bien même elles auraient eu des enfants de lui. D’ailleurs lorsque
Mehmed Pacha épousa la sultane qui est sa femme actuelle, il divorça de sa
précédente épouse qui lui avait donné plusieurs fils. L’un d’eux [Hasan Pacha] a été
récemment nommé au poste de beylerbey d’Alep. Quant à l’ancienne épouse du pacha,
elle s’est remariée avec un autre homme. Piyale Pacha a lui aussi vécu les mêmes
choses. »317
Cette règle de monogamie – puisque c’est bien de cela qu’il s’agit – s’imposait au moment du
mariage, mais aussi par la suite : il ne suffisait pas que le futur gendre divorce de ses épouses
315
Abdülkadir Özcan (éd.), Anonim Osmanlı tarihi (1099-1116 / 1688-1704), Ankara, Türk Tarih Kurumu, 2000 : 148. Voir la traduction du passage en annexes C.42. 316
Voir les travaux sur la famille pour ces régions, notamment Meriwether, The Kin Who count ; Mary A. Fay, « Women and Waqf : Toward a Women Reconsideration of Women Place in the Mamluk Household » International Journal of Middle East Studies 29/1 (February 1997) : 33-51 ; id., « Women and Waqf : Property, Power and the Domain of Gender in Eighteenth-Century Egypt », dans Women in the Ottoman Empire, Middle Eastern Women in the Early Modern Era, M. C. Zilfi (éd.), Leiden, Brill, 1997 : 28-47. Sur la question des grandes familles du centre, voir aussi Bouquet, « Famille, familles, grandes familles ». 317
Gerlach, Türkiye günlüğü : t. 2 p. 584-585.
Page | 107
précédentes ; il s’engageait également, de façon tacite, à ne pas en prendre d’autres, c’est-à-
dire à renoncer à son droit à la polygamie, pourtant garanti par la législation islamique.
C’est là un phénomène qui mérite qu’on s’y arrête quelques instants. La polygamie est
non seulement un droit reconnu par l’islam, mais aussi un modèle familial prôné par le sultan
lui-même, dès les premiers temps de la dynastie – bien qu’après, il ne soit plus question que
de concubines et non d’épouses légales. Les travaux de Cem Behar et Alan Duben à la fin de
l’Empire ont largement démontré que l’usage de la polygamie était attesté presque
exclusivement au sein des familles de l’élite ottomane, en particulier parmi les pachas318
.
Autrement dit, cet interdit vient s’imposer justement auprès de ceux pour qui l’usage en était
le plus courant : les pachas. Il faut donc convenir qu’il s’agit là d’une règle de différenciation
dynastique, qui permet à la famille régnante d’affirmer sa supériorité, en la plaçant au-dessus
des lois du commun319
.
La règle irait-elle plus loin, jusqu’à prendre en compte le concubinage lui-même ? À
en croire certains, on pourrait le penser. Ainsi Gerlach, encore lui, raconte :
« Lorsqu’un pacha rend visite à son épouse sultane, il est mal vu qu’il regarde autour
de lui. Il n’est autorisé qu’à regarder devant lui. S’il laisse percevoir dans son regard
un intérêt pour l’une des cariye, la cariye en question ne survit pas à la nuit. Les
femmes turques sont à ce point jalouses que lorsqu’elles constatent que leur époux
montre un intérêt pour une de leurs cariye, celle-ci est étranglée dans la nuit. La
femme du defterdar de Roumélie ferait même brûler, en les jetant dans la cheminée,
celles de ses cariye qui ont l’heur de plaire à son époux. »320
Et Hammer de fournir une autre illustration, tout aussi macabre :
« La veuve de Pialé [Gevherhan Sultane, fille de Selim II] avait poignardé un jour de
sa propre main une de ses esclaves parce qu’elle avait vu son mari effleurer son cou
en passant. »321
Ces exemples ne sont pas aussi probants qu’ils paraissent. Ce qu’ils donnent à voir, ce n’est
pas tant un interdit du concubinage : de toute évidence, au vu des exemples suscités, les
gendres impériaux en question se permirent de le pratiquer, sans réaction de la part du sultan.
D’ailleurs, Gerlach ne parle nulle part d’interdit ; ses mots indiquent bien la teneur du
problème, lorsqu’il dit que c’est « mal vu », sous-entendu par l’épouse, qui pouvait alors
prendre sur elle de régler le problème de façon radicale.
Cependant, dans les exemples précédents, il est systématiquement question d’esclaves
(cariye) des épouses, et non du mari. Les règles de propriété des esclaves donnent
effectivement le droit de vie ou de mort au maître ou à la maîtresse sur ceux-ci. Aussi bien, la
jalousie dont il est question n’en est peut-être pas une. Pour une maîtresse de maison, une
relation entre son époux et une de ses esclaves était génératrice de deux conséquences
318
Behar et Duben, Istanbul Households. 319
Les femmes d’élite imitèrent néanmoins ce modèle, rendant l’usage de la polygamie relativement rare, en dehors du concubinage. 320
Gerlach, Türkiye günlüğü : t. 2 pp. 584-585. On notera que Gerlach procède à une généralisation à
l’ensemble des femmes d’élites. 321
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 7 p. 73
Page | 108
indésirables. La première répond à une logique purement économique : la valeur d’une cariye
dépendait principalement de sa beauté et, par-dessus tout, de sa virginité. Si celle-ci “cédait”
ses faveurs à l’époux de sa maîtresse, cette dernière perdait alors l’essentiel de
l’investissement placé en cette fille, à savoir l’éducation, la formation en vue de l’offrir à un
officier plus ou moins haut placé, dans l’espoir de s’en faire un allié322
. Une autre
conséquence était encore à craindre : la naissance d’un enfant qui aurait bénéficié du même
statut que celui des enfants nés de l’épouse officielle323
. Autrement dit, ce que la princesse
redoutait peut-être, c’était la naissance d’un enfant qui se poserait en concurrent de ses
propres fils et filles – ce qui n’était probablement pas pour plaire à ces femmes éduquées dans
l’idée de leur supériorité sur tous et toutes (les membres de la dynastie mis à part). Enfin, il
faut peut-être invoquer ici un sentiment peu noble, mais dont la force n’est pas à négliger : la
fierté. Pour une princesse, comment ne pas prendre ombrage de la préférence d’un époux
supposé soumis pour une de ses esclaves ? Une réaction violente était une manière de
répondre à cet affront, non pas tant vis-à-vis de l’époux, qui n’est pas inquiété, mais de
l’esclave qui, par son acceptation tacite (ou involontaire), a bravé l’autorité de sa maîtresse.
3) Le divorce, épée de Damoclès… pour les maris !
Le troisième volet des règles conjugales imposées aux dâmâd-ı şehriyârî renforce
encore l’idée d’un statut d’exception conféré aux membres de la dynastie. Après la
soumission et l’obligation de monogamie, c’est maintenant l’impossibilité du divorce qui
s’impose aux gendres impériaux. Le rapport de chacun des époux au divorce est intéressant,
parce qu’il reflète encore cette toute-puissance dynastique. En effet, au cours des trois siècles
d’histoire ottomane étudiés dans le cadre de ce travail, on ne repère aucun cas de divorce à
l’initiative du mari ; l’idée ne les effleure même pas, parce qu’elle n’est pas envisageable. Si
l’on admet que l’accès au damadlık impérial est un honneur distinctif pour le kul, il faut alors
concevoir que ce dernier n’a pas la capacité de le renier après coup. L’engagement est
définitif pour lui. Ainsi, quand bien même son épouse se montrerait-elle insupportable
(« diabolique » dit même Ottoviano Bon)324
, le gendre impérial n’a d’autre choix que de se
plier à ses exigences et faire acte de déférence.
Il doit d’autant plus montrer sa soumission que, si lui ne peut divorcer, sa femme, elle,
en a la capacité, ainsi que le rappelle Ottoviano Bon :
« Et parfois, elles se débarrassent de leurs maris et en prennent un autre ; mais jamais
sans le consentement du Grand Seigneur : un tel divorce entraîne généralement la
mort et la ruine des pauvres maris rejetés, le Souverain ayant le pouvoir de se laisser
322
Voir notamment Ehud R. Toledano, Slavery and Abolition in the Ottoman Middle East, Seattle / London, University of Washington Press, 1998 : 24-30 ; Metin Kunt, Kulların Kulları », Boğaziçi Üniversitesi Dergisi, Hümaniter Bilimler 3 (1975) : 27-42 ; voir aussi l’exemple de Hüsrev Pacha, développé par Halil İnalcık, Hüsrev Paşa », İA : t. 5 p. 613. 323
Robert Brunschvig, « Abd », EI (2) : t. 1 p. 26-31. 324
Bon, The Sultan’s Seraglio : 53.
Page | 109
convaincre et de réaliser la volonté des Sultanes : de sorte qu’il leur incombe de se
montrer particulièrement obséquieux, dans toutes les situations, envers leurs
femmes. » 325
Les princesses n’hésitèrent pas à faire usage de cette capacité à divorcer qui s’offrait à elles.
L’un des premiers exemples les plus connus est celui de la séparation de Şah Sultane d’avec
Lutfi Pacha. Şah Sultane, fille de Selim Ier, fut mariée probablement au début du règne de son
frère à Lutfi Pacha, d’abord gouverneur de Yanya, finalement rappelé à la capitale et devenu
grand vizir, de 1539 à 1541. Sa puissance semblait assurée, lorsque survint un désaccord avec
son épouse, au cours d’une absence du sultan (Süleyman Ier) de la capitale. D’Ohsson fournit
un récit édifiant de l’histoire :
« Un jour, il alla jusqu’à ordonner qu’une mahométane surprise au milieu de ses
débauches fût mutilée à coups de rasoir dans une partie du corps que la pudeur ne
permet pas de nommer. L’indécence et la barbarie de cette punition révoltèrent tous
les esprits. Lutfi Pacha était marié à une Sultane, sœur de son maître. Cette princesse
indignée lui fit les reproches les plus vifs et les plus amers. Ne devais-tu pas, lui dit-
elle, respecter la pudeur ? Comment as-tu pu inventer un supplice aussi cruel et aussi
flétrissant ? Il est fait pour le crime, répondit le vizir, et désormais il sera la peine que
l’on infligera à toutes celles qui se déshonoreront au mépris de la religion et des lois.
À ces mots la Sultane l’accabla d’injures, et le traita d’impudent, de barbare, de
tyran. Transporté de colère, le ministre met la main sur une masse d’armes et se
précipite sur elle ; aux cris de la Sultane, les filles esclaves et les eunuques préposés à
la garde volent à son secours et chassent à coups de poing le vizir de l’appartement de
leur maîtresse. Un événement si extraordinaire entraîna la perte de Lutfi Pacha.
Süleyman blâma hautement sa conduite, ordonna sa séparation de la Sultane, le
dépouilla de sa dignité, et l’envoya en exil à Demitoca, où il termina ses jours »326
.
Il nous a malheureusement été impossible de vérifier la teneur de ses dires : d’Ohsson cite
bien sa source, Hasanbeyzade, mais nous n’avons pas été capable de retrouver le passage dans
lequel cet événement serait mentionné327
. Néanmoins, Peçevî y fait allusion de façon fort
délicate mais très évasive : « il fut marié à la sœur du vénérable souverain mais, par la suite, il
en fut séparé pour divers motifs », rapporte-t-il. Pour ajouter ensuite quelques explications
confuses : se croyant versé dans les sciences religieuses ( kend ye ‘allâme-i ‘asr s anub »), il
se serait permis de prendre, dans le domaine, des décisions extravagantes (« bu vechle hâs ve
‘âmmetan sefâhatan i hâr éd b »), ce qui aurait été la conséquence de son renvoi avec
disgrâce ( ba’de ‘azl olunub tak â’ d vérilmiş édi »)328
. Les indications de Peçevî donnent
quelque crédit au récit rapporté par d’Ohsson : les décisions extravagantes qu’il aurait prises
semblent bien être une allusion aux punitions affligées aux prostituées contre lesquelles
s’insurgea la princesse. Mais la période n’est pas encore venue où un chroniqueur peut se
permettre de mettre par écrit les frasques intimes d’une princesse, encore moins d’établir un
lien explicite entre l’incident survenu entre les deux époux et la destitution du ministre qui
325
Bon, The Sultan’s Seraglio : 53. 326
D’Ohsson, Tableau général de l’empire othoman, Istanbul, Isis, 2001 : t. 4 p. 351. 327
Ahmed Paşa Hasan Beyz de, Hasan Bey-zade tarihi, 3 volumes, Ş. N. Aykut éd. , Ankara, Türk Tarih Kurumu, 2004. 328
Peçevî, Tarîh-i Peçevî : t. 1 p. 21, l. 4-12.
Page | 110
s’ensuivit. Ne doutons pas que les contemporains comprenaient parfaitement les allusions du
chroniqueur : l’affaire n’avait probablement pas manqué de faire du bruit et les ragots
devaient aller bon train.
Les récits des chroniqueurs nous fournissent d’autres exemples intéressants, qui
laissent entendre la facilité avec laquelle une princesse pouvait obtenir le divorce et détruire
par là même la carrière de leur époux. Ces récits montrent que ces femmes avaient une
connaissance parfaite de cette disposition et qu’elles n’hésitaient pas à en faire usage, à titre
de chantage. Les deux exemples qui suivent concernent le même gendre, mais deux épouses
successives : Melek Ahmed Pacha, d’abord marié à Kaya Ismihan Sultane, fille de Murad IV,
puis remarié à Fatma Sultane, fille d’Ahmed Ier, à la mort de la précédente. Une première
fois, le divorce plane au-dessus de la tête du gendre impérial, lorsque sa femme, la jeune Kaya
Ismihan Sultane, tente d’éviter son envoi en province par un chantage à peine voilé :
« Quelques jours auparavant, le vizir susdit [Ibşir Pacha] ayant constaté sa propre
faiblesse et décadence dans le domaine de ses affaires, il se débarrassa
intentionnellement de ceux qui lorgnaient sur le grand vizirat ; c’est à ce moment-là
que le glorieux mari de Kaya Sultane, Melek Ahmed Pacha, passa avec
empressement à Üsküdar, [suite à sa récente promotion à la tête de] la province de
Bagdad, dont l’office était vacant avec la mort du [précédent gouverneur], un
certain Arslan Pacha. Mais la sultane s’en plaignit au souverain : “Il vient juste de
rentrer ! S’il y a une raison à son départ immédiat, qu’on m’accorde alors le
divorce !” Suite à cette déclaration, le départ de Melek Ahmed Pacha fut invalidé par
consentement impérial.
De sorte que le troisième jour qui suivit, on lui apporta le sceau de l’État, qui lui fut
remis. Tandis qu’il revenait de son envoi erroné à Bagdad, le souverain convoqua
Melek Ahmed Pacha à ce sujet et lui remit le sceau de l’État, faisant de lui son
grand vizir. »329
De toute évidence, la menace de Kaya Ismihan Sultane de réclamer le divorce fit son effet : au
lieu d’être envoyé à Bagdad, il reçut le sceau de l’État et devint grand vizir – place qu’il
conserva pendant un peu plus d’un an330
.
Le chantage est d’une nature toute autre lorsqu’il implique cette fois la seconde épouse
royale de ce pacha, Fatma Sultane – dépeinte en des termes peu amènes par Evliya Çelebi.
Quand le pacha s’aventure dans la chambre nuptiale le jour de leurs noces, sa nouvelle
épouse, qui en était à son sixième mari, fait preuve envers lui d’une attitude extrêmement
désinvolte et un tant soit peu méprisante – du moins aux dires d’Evliya Çelebi, qui rapporte
les propos que lui tint le pacha le lendemain :
« Mon Evliya, que cela reste un secret. Les tortures que j’ai enduré de cette femme
qui est la mienne pendant la nuit de noces jusqu’au matin ne se trouvent pas même
chez les captifs de Malte. Que Dieu me pardonne, mais quelle femme immodeste,
329
İpşirli éd. , Tarîh-i Na’îmâ : t. 3 p. 1266. Annexes D.11. 330
Ömer M. Alper, « Ahmed Paşa Melek », OA : t. 1 p. 150-151 ; Necdet Sakaoğlu, Ahmed Paşa Melek », Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi : t. 1 p. 128-129.
Page | 111
effrontée et extravagante ! Sitôt après être entré dans le harem en récitant un
bismillah, je l’ai vue installée à sa place. Maintenant que je suis son mari et que
c’est notre toute première nuit, elle doit se comporter envers le malheureux que je
suis avec un minimum de respect et d’honneur. A aucun moment elle ne bougea
d’un pouce ; elle resta bien droite [à sa place]. Le pauvre que je suis s’approcha d’elle
et, une fois que j’eu embrassé sa main, elle déclara : “Bienvenu pacha”. “Avec plaisir.
Dieu soit remercié de m’avoir permis de voir la beauté du sourire de ma sultane” et,
de la sorte, je proférais de multiples prières gracieuses de toutes sortes, selon la
manière coutumière des paroles des derviches. Pas une fois, elle ne m’invita à
m’asseoir. Malgré le fait qu’elle est une veuve totalement décrépie qui a connu
douze maris, elle prenait des postures et agissait comme une fille chaste non
déflorée. La première perle qui sortit de sa bouche fut la suivante : “Mon cher
pacha, si tu veux t’entendre avec moi, que tu sois présent ou absent, en route vers
tes offices, mes dépenses sont de 15 bourses par mois et chaque mois. […]” »331
Et la princesse de se lancer dans une longue énumération des obligations financières dont son
nouvel époux va devoir s’acquitter, ce qui vaut une tentative de protestation de la part de
Melek Ahmed Pacha, qui commence par mettre en avant sa pauvreté, puis sa dignité de
combattant de la foi, enfin le fait que sa précédente épouse, Kaya Ismihan Sultane, ne lui
coûtait pas aussi cher :
« Ces dépenses sont trop [élevées]. Je vous en prie, réduisez-les un peu. J’ai la
capacité de couvrir des dépenses équivalentes à celles de la défunte Kaya Sultane,
mais je n’ai pas les ressources pour couvrir des dépenses cinq fois plus
importantes ! »332
Les choses s’enveniment, mais le dernier mot revient à la princesse, qui conclut la dispute par
une menace ouverte :
« Mon pacha, si tu ne peux pas t’entendre avec moi, je divorcerai de toi, vivant ou
mort ! Prépare-toi tout de suite à me verser mon douaire d’un Trésor
égyptien ! »333
La phrase est forte : « je divorcerai de toi, vivant ou mort ». Autrement dit, Fatma Sultane est
convaincue de pouvoir obtenir soit le divorce, soit l’exécution de son mari, qui lui permettra
d’être libérée et, en fin de compte, de recevoir l’argent qu’elle estime être son dû. Melek
Ahmed Pacha saisit d’ailleurs la menace dans toute sa portée et finit par s’incliner, soulignant
ainsi le fait que lui-même est convaincu de la facilité avec laquelle son épouse obtiendrait
gain de cause et de son incapacité à défendre son cas.
331
Evliyâ Çelebi b. Derviş Mehemmed Zıllî, Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, Istanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2011 :
vol. 1 livre 6 p. 74-75. Voir le texte complet en annexes C.31. Voir également la traduction en anglais qu’en
fournit Dankoff (éd.), The Intimate Life : 259. 332
Evliyâ, Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi : vol. 1 livre 6 p. 75. Voir le texte complet en annexes C.31. Dankoff (éd.),
The Intimate Life : 260. 333
Evliyâ, Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi : vol. 1 livre 6 p. 75. Voir le texte complet en annexes C.31. Dankoff (éd.), The Intimate Life : 261.
Page | 112
Facilité, certes, mais qui n’avait rien d’automatique et qui ne constitue peut-être pas
une constance historique. La capacité à divorcer dépend de la bonne volonté du sultan, qui
décide de façon unilatérale de la séparation. Dans cette affaire, il agit comme juge et partie,
mais sans s’embarrasser des justifications légales traditionnellement invoquées dans les
affaires de divorce ; surtout, c’est lui qui décide et impose aux maris rejetés le montant des
compensations financières qu’ils devront acquitter et qui est sans commune mesure avec les
pratiques constatées pour le reste du peuple en la matière. Ainsi, quand Şah Sultane est
séparée de son époux, Lutfi Pacha, sur décision de son frère, Süleyman Ier, celui-ci est sommé
de lui verser des compensations financières considérables qui empiétèrent sur l’héritage de ses
enfants nés hors couple334
. Mais toutes les princesses malheureuses en couple n’eurent pas la
possibilité de se séparer de l’époux encombrant : ainsi Fatma Sultane, autre sœur de Süleyman
Ier, supporta-t-elle un époux qui la dédaignait et s’en allait ouvertement trouver plaisir
ailleurs : ce n’est qu’une fois le scandale devenu public qu’elle se décida à s’en ouvrir à son
père, n’osant même pas solliciter ou suggérer le divorce – elle espérait probablement que le
sultan en viendrait à cette conclusion de lui-même335
.
Dans d’autres cas, le divorce est décidé sans même que la princesse ne soit concernée.
Quelques cas du genre sont attestés aux XVIIe et XVIII
e siècles. Citons l’affaire de 1702,
quand Emine Sultane fut divorcée de son époux, Hasan Pacha, avant même qu’il n’ait pu
accéder à la chambre nuptiale :
« Mariage de la vénérable fille du souverain.
Le souhait de donner [la main de] Son Altesse Emine Sultane à celui qui était
alors emir’ül-hac et gouverneur de la province de Şam, Hasan Pacha, se
concrétisa et l’organisation du mariage contractuel fut entreprise par le vizir
susdit, avec l’accord [impérial], selon les coutumes ancestrales. Or,
l’organisation détestable que celui-ci instaura sur la route du pélerinage
provoqua une grande honte qui causa la chute de la faveur que le souverain
lui témoignait. On revint sur la décision de donner la Sultane susdite au
pacha en question et, présentement, elle dépend du Silahdar impérial,
Çorlulu Ali Aga, qui enviait cet honneur. »336
Entre le début du XVIe siècle, où une princesse n’ose pas demander à son père de bien vouloir
la séparer d’un mari qui la délaisse, et le début du XVIIIe siècle, qui voit une princesse
divorcée sans même avoir connu intimement son mari, parce qu’on estima que ses actions
n’étaient pas assez honorables, deux siècles se sont écoulés au cours desquels les princesses
furent de plus en plus étroitement associées à l’expression de la supériorité dynastique. Il
semble que l’usage du divorce se soit répandu ; à moins qu’il ne s’agisse d’une impression
334
Fonds Âli, Ms. 3409, folios 121 r-v. de la bibliothèque de la Nuruosmaniye ; TSMA E 7924 (cité par Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : n° 4 p. 33) ; TSMA E 7924/2 daté du 23 mai 1564 (cité par Thys-Şenocak, Ottoman Women Builders : n°137 p. 98 ; l’affaire est traitée et le document présenté dans Anadolu Kadının 9000 Yılı (9000 Years of Anatolian Women), Istanbul, Turkish Republic, Ministery of Culture, General Directorate of Monuments and Museum, 1994 : 208-209, 228. 335
Çağatay M. Uluçay, Haremden Mektuplar, Istanbul, Ötüken, 2011 : 43-46. 336
R şid, Râşid Târîhi, Istanbul, 1865 : vol. 2 p. 529 ; cf. annexes C.41.
Page | 113
reflétée par les sources, qui accordent plus de place aux princesses au cours du temps ?337
Par
ailleurs, Mustafa II n’était pas Selim Ier ; leur rapport à l’exercice du pouvoir n’était pas non
plus le même. Les princesses avaient donc la possibilité de se séparer d’un époux pour des
motifs divers, mais sous réserve que les conditions (politiques, familiales) le permettent.
4) D’un palais à l’autre : les résidences des princesses
La question de la localisation résidentielle du couple est incontournable ici : le sens
symbolique de l’union et la structure familiale qui en découle ne sont pas les mêmes si
l’installation a lieu chez les parents de la femme (matrilocalité) ou de l’homme (patrilocalité),
ou encore si la résidence est celle du mari (virilocalité) ou de l’épouse (résidence uxorilocale).
La pratique la plus répandue auprès des membres de l’élite ottomane semble favoriser la
virilocalité. Le mari dispose d’une résidence qui lui est propre (distincte de celle de ses
parents), dans laquelle il entretient une ou des épouses et/ou des concubines. Claude Duben et
Cem Bahar mentionnaient cependant, à la fin de l’Empire, l’existence de pratiques
résidentielles patrilocales pour des familles aisées extérieures à l’élite dirigeante338
. Dans un
cas comme dans l’autre, la partie masculine (le père ou l’époux) prime lors de l’établissement
du couple. L’épouse, quand bien même disposerait-elle de ses propres possessions
immobilières, prend résidence chez son mari ou son beau-père lors de son mariage. Cette
patri- ou virilocalité résidentielle est cohérente avec l’idée islamique de supériorité de
l’homme dans le couple. Les couples des princesses ottomanes dérogeraient-elles aux
convenances ? Convenances et non règles : aucune loi ne statue sur cette question, pas plus
pour les musulmans en général que pour les princesses en particulier. Nous entrons ici dans le
domaine des pratiques culturelles. Or, dans le cas des princesses, une pratique singulière
semble s’être progressivement imposée, qui favorise l’usage de résidences uxorilocales.
Mais avant d’en venir au lieu de résidence conjugal, il faut commencer par s’interroger
sur l’endroit où elles vivaient avant leur mariage. Ce petit détour nous permettra de mieux
prendre la mesure de l’évolution survenue dans l’élection du domicile conjugal des
princesses. La période antérieure au mariage est la tranche de vie la moins renseignée de ces
femmes, à tout le moins pour l’intervalle chronologique qui nous intéresse. Il faut attendre
l’extrême fin du XVIIe et surtout le XVIII
e siècle pour connaître avec une relative récurrence
leurs dates de naissance et, pour certaines, jusqu’à leur existence ; leur éducation demeure un
mystère et il est difficile d’établir précisément le(s) lieu(x) où elles vivaient. Néanmoins,
quelques indications grappillées au fil des sources laissent deviner ce qu’il pouvait en être.
337
Dans une conférence donnée à l’IFEA dans le cadre du séminaire Les femmes dans l’Empire ottoman (organisé par Juliette Dumas), intitulée « Les damad du sultan : comment en écrire l’histoire ? » (1
er février
2010), Olivier Bouquet montrait une situation similaire pour la période postérieure à celle que couvre cette étude : certaines princesses divorcent sans problème, quand d’autres sont contraintes de supporter un mari peu aimé. Voir la vidéoconférence sur le site de l’IFEA : www.-ifea-istanbul.net La même impression se dégage de la lecture des mémoires de femmes ayant fréquenté le harem, au XIX
e siècle.
338 Behar et Duben, Istanbul Households : 48-86.
Page | 114
Deux logiques s’imposent. La première est celle d’une domiciliation avec le père, jusqu’au
jour du mariage, date à partir de laquelle elles quittent la protection paternelle pour passer
sous la responsabilité du mari. Nous disons bien du père et non du sultan : jusqu’au XVIIe
siècle, soit jusqu’au moment où les pratiques successorales évoluent en faveur du séniorat, les
princes avaient des enfants, parmi lesquels des filles.
Murad III eut plusieurs enfants de sa favorite Safiyye durant son exercice de prince-
gouverneur en province, dont deux fils et deux filles : sa concubine vivant alors à ses côtés,
dans son harem provincial, il faut supposer que ses filles y résidaient aussi, à l’instar de leurs
frères. Elles ne vinrent à la capitale qu’une fois leur père monté sur le trône de ses ancêtres339
.
Ce faisant, Murad III ne faisait que répéter l’exemple de ses parents, Selim II et Nurbanu340
.
Le phénomène est encore plus flagrant avec les enfants de Süleyman Ier : tous ses fils, à
l’exception de Bayezid, dont les infirmités physiques interdisaient toute prétention au trône,
prirent la tête d’un gouvernement provincial. Ils y établirent une cour, avec un harem, eurent
des enfants, garçons et filles, qui y vécurent à leur côté. Ainsi, lorsque le prince Bayezid
échoua dans sa tentative de s’imposer comme unique héritier contre son frère Selim, il
s’échappa et alla trouver refuge auprès du chah d’Iran : sur le chemin de sa fuite, il eut le
temps de repasser par sa cour et d’emmener avec lui ses fils, laissant derrière lui ses filles341
.
Il savait qu’elles ne courraient aucun risque, contrairement à leurs frères, car elles ne
pouvaient prétendre à la succession. Cette pratique prévalait déjà au XVe siècle ; l’exemple de
la fille du prince Cem le montre : après sa défaite face à son frère, Bayezid II, Cem s’enfuit
des territoires ottomans et, dans son exil forcé, trouva fuite notamment en Égypte342
. Il y fut
accompagné de sa mère et de sa fille, probablement en bas âge à ce moment-là. Si sa fille
avait résidé n’importe où ailleurs qu’aux côtés de son père, elle n’aurait pu l’accompagner
dans cette fuite précipitée : il faut donc qu’elle se soit trouvée avec le reste de sa cour et son
harem, attendant avec angoisse le résultat de la confrontation armée des deux princes.
Jusqu’au milieu du XVIe siècle, le devenir de ces filles de prince après la succession
suivait les mêmes règles que les filles de sultan. Soit le père a échoué et la pratique du
fratricide a été appliquée à son endroit : privée de père, elle devient alors une pupille du sultan
régnant (il en va de même des filles de princes décédés de mort naturelle) ; soit il est sorti
victorieux de la crise de succession et s’est installé sur le trône ottoman, prenant alors la tête
du Palais impérial : de fille de prince, elle devient alors fille de sultan. C’est ce cas de figure
que nous allons maintenant discuter. Or, le problème se complique, car il devient plus difficile
de connaître les lieux de résidence des princesses. Dès le règne de Mehmed II, deux palais
impériaux coexistent à Istanbul : le Vieux Palais et celui de Topkapı. Jusqu’au milieu du
règne de Süleyman Ier, la séparation était relativement stricte : après l’érection du palais de
Topkapı, dans lequel le sultan élit domicile, fonda son école de page et installa les principaux
offices d’État, le Vieux Palais servit de résidence familiale, pour les femmes et les enfants de
la Maison d’Osman.
339
Peirce, The Imperial Harem : 94, 95. 340
Peirce, The Imperial Harem : 92-93. 341
Sur la rébellion du prince Bayezid, cf. Turan, Taht Kavgaları. 342
Sadüddin relate son retour d’Egypte et son rapatriement à Istanbul. Cf. Sadüddin, Tac’üt-tevârîh : t. 2 p. 127-128.
Page | 115
Du moment où un harem fit son entrée dans l’enceinte de Topkapı, suite au précédent
établi par Hürrem, en 1534, la situation se compliqua343
. La séparation palais d’État / demeure
familiale ne tenait plus et des membres de la dynastie séjournaient à Topkapı pendant que
d’autres étaient mis à l’écart au Vieux Palais. Nous connaissons plus ou moins bien les
pratiques concernant les femmes des sultans : la mère du monarque et ses concubines
résidaient avec lui à Topkapı, tandis que les femmes associées au(x) prédécesseur(s) étaient
envoyées au Vieux Palais. Un nouveau règne signifiait ainsi une rotation profonde des lieux
de résidence de ces femmes344
. Mais qu’en était-il des princesses – et, par la même occasion,
des princes ? Si nous avons bien compris le fonctionnement de cette famille, il semblerait que
le lieu de domicile des sultanes dépendait alors tout à la fois du sultan régnant et de l’état de
leur mère – les deux étant indissociables : les filles d’un sultan régnant résideraient
logiquement avec leur mère et leur père à Topkapı, ses sœurs, tantes ou nièces étant reléguées
au Vieux Palais, en compagnie de leur mère. Mais ce sont là des remarques déductives et non
des conclusions argumentées. Les registres de compte palatiaux consultés ne permettent pas
de trancher : il faudrait mener une étude plus poussée sur la population du Vieux Palais, avec
une attention toute particulière aux dates de règne, pour en avoir le cœur net345
.
Quant aux descendantes indirectes issues de princesses, les hanım sultanes et autres
descendantes plus éloignées, le problème ne se pose pas dans les mêmes termes et soulève de
nouvelles interrogations. Les quelques cas à propos desquels nous disposons de maigres
informations laissent entendre qu’elles résidaient avec leur mère – au moins jusqu’au mariage.
Plusieurs raisons à cela. Outre le poids de traditions qui instituent la mère comme responsable
des enfants – jusqu’à un certain âge –, dans le cas des princesses, il faut également compter
sur la différence d’âge qui sépare les époux, qui renforce l’association des enfants à la mère,
pour la simple raison que le père est amené à disparaître rapidement de leur quotidien, que ce
soit du fait des nominations en poste hors de la capitale ou, de façon plus radicale, du fait de
son décès. Ainsi, la documentation relative aux actes de fondations de certaines princesses du
XVIIIe siècle indique des cohabitations mère-fille, comme ce fut le cas de Safiyye Sultane et
Zahide Hanım Sultane346
.
Pourtant, gardons-nous d’y voir une pratique absolument systématique. Que se passait-
il dans le cas d’une hanım sultane dont la mère était décédée avant qu’elle n’ait atteint l’âge
du mariage ? La logique voudrait qu’elle vive alors avec son père : mais cela signifiait-il
qu’elle le suivait lors de ses affectations en province ? Nous n’avons aucune attestation allant
dans ce sens, ce qui ne prouve ni n’invalide rien. On peut tout aussi bien envisager qu’elle soit
restée vivre dans un des palais familiaux, sous la surveillance de tuteurs. Et dans le cas d’une
343
Peirce, The Imperial Harem : 62-63. 344
Peirce, The Imperial Harem : 119-125. 345
Le travail serait sans nul doute fort enrichissant et complèterait les connaissances historiques déjà acquises par les diverses recherches sur le monde du harem impérial ; mais il s’agit également d’une recherche à part entière, qui nous aurait entraînée bien loin de notre propos. Aussi l’avons-nous laissée de côté pour l’instant. 346
C’est particulièrement visible lorsque l’on consulte les vakfiyye de Zahide Hanım Sultane : VGMA D 738 n° 26 : 1163 (mars 1750) ; D 738 n° 24 : 1166 (avril 1753) ; D 46 n° 46 : 1166 (avril 1753) ; D 46 n° 50 : 1170 (décembre 1756) ; D 46 n° 48 : 1170 (juillet 1757) ; D 46 n° 52 : 1175 (février 1762) ; D 46 n° 53 : 1176 (août 1762) ; D 46 n° 54 : 1176 (août 1762) ; D 46 n° 56 : 1176 (octobre 1762) ; D 46 n° 55 : 1176 (janvier 1763) ; D 46 n° 47 : 1177 (novembre 1763) ; D 46 n° 58 : 1189 (mars 1775) ; D 46 n° 59 : 1196 (mai 1782).
Page | 116
hanım sultane orpheline de père et de mère ? Faut-il imaginer de nouveau l’usage de tuteurs
ou songer à un retour au Palais impérial, sous la protection du chef de la dynastie ? La vérité
est qu’à ce jour, nous n’en savons absolument rien347
. Concluons ; les cas particuliers mis à
part, jusqu’à leur mariage, les sultanes résidaient tantôt dans des palais princiers, tantôt dans
des palais impériaux ; les hanım sultanes, pour leur part, restaient attachées à leur mère. À
partir de la seconde moitié du XVIe siècle, quand l’usage d’envoyer les princes se former en
province fut abandonnée, seuls les palais impériaux servaient de résidence aux sultanes. Ce
phénomène n’est pas sans expliquer et renforcer l’attachement particulier des princesses à la
dynastie et à ses membres : jusqu’à leur mariage, c’était le seul univers qu’elles côtoyaient.
Que se passait-il après les noces ? Dans un premier temps, il semble que les princesses
suivaient leurs époux, qu’il s’agisse d’un souverain anatolien ou d’un dignitaire ottoman.
Nous avons déjà largement discuté de la question des princesses ottomanes mariées à
l’étranger pour ne pas avoir à y revenir. Toutefois, il faut s’intéresser de plus près aux sultanes
mariées au sein de l’Empire. Il est difficile de statuer sur la question pour la période du XIVe –
XVe siècle, car la documentation n’apporte pas d’évidences indiscutables. Néanmoins, l’étude
menée plus loin sur les fondations pieuses réalisées par ces princesses montre une diversité
territoriale qui ne s’explique, en partie, que si l’on admet l’idée qu’elles quittaient la cour pour
suivre leur époux en province348
. Les lettres échangées par les princesses avec les sultans
permettent d’être plus catégorique concernant leur lieu de résidence au tournant du XVIe
siècle. Ainsi, la fille de Bayezid II, Ayşe Sultane, résidait à Kütahya, aux côtés de son époux,
le gouverneur d’Anatolie Güveyi Sinan Pacha, lorsque le conflit entre Bayezid et Cem éclata.
Le gouverneur s’empressa de voler au secours de son beau-père, laissant sur-place sa femme,
mais oubliant de lui laisser les moyens de subvenir à ses besoins : elle s’ouvre alors à son
père, dans une lettre, de sa situation financière, lui demandant de l’aide349
. De même, c’est par
le moyen d’une lettre de Fatma Sultane, fille de Selim Ier et épouse du gouverneur du sancak
d’Antalya, dans laquelle elle fait état de ses problèmes conjugaux, qu’on apprend qu’elle y
vit, aux côtés d’un mari qui la dédaigne en raison de ses penchants homosexuels350
.
Par la suite, les princesses cessent de suivre leur mari en province. Le changement
semble être historique : la fille unique de Süleyman Ier, Mihrimah, est mariée à Rüstem Pacha
qui exerça comme grand vizir après son rappel à la cour, pendant toute la durée de leur
mariage – à l’exception des deux années de retraite, suite à l’exécution du prince Mustafa,
qu’il passa sans affectation et probablement dans un de ses palais stambouliotes. Il en fut de
même des filles de Selim II, mariées à des vizirs de la coupole, qui exerçaient donc à la cour.
Seule exception : Piyale Pacha, pendant un temps amiral de la flotte : la princesse n’allait
certainement pas l’accompagner dans ses déplacements en mer ! La pratique de voir les
sultanes demeurer à la capitale, que leur époux y exerce ou non, s’instaura ainsi
progressivement, naturellement, sans même qu’on s’aperçoive du changement.
347
Les registres de compte des palais personnels des princesses, tels ceux étudiés actuellement par Tülay Artan, pourraient peut-être fournir des réponses à ces questions. 348
Voir le dernier chapitre : 5.II.2.1. et 5.II.3.2. 349
Uluçay, Haremden Mektuplar : 40-41. 350
Uluçay, Haremden Mektuplar : 43-46.
Page | 117
Cette période correspond également à une ère d’enrichissement, dont les princesses
profitèrent : le montant de leurs pensions augmente, elles sont désormais à la tête de grandes
fortunes. La coïncidence chronologique n’est peut-être pas un hasard : une princesse résidant
dans une capitale provinciale pouvait ne pas être extrêmement riche, ses besoins n’étaient
d’ailleurs probablement pas les mêmes ; mais dès lors qu’elle demeure à Istanbul, théâtre
d’expression du pouvoir impérial, il devient indispensable que sa personne et chaque
composante de sa vie expriment son appartenance à la dynastie – noblesse exige. Elles sont
désormais propriétaires de palais, définis dans les sources comme tels (le mot usité est
« saray » et non konak ou n’importe quel autre terme résidentiel). Elles ne sont pas les seules :
les gendres impériaux sont eux aussi propriétaires de vastes demeures dans la capitale, dont ils
font un usage privé en même temps que professionnel. Le couple établira-t-il sa résidence
chez le mari ou chez la femme ? Au XVIe siècle, il semble que l’installation se fasse chez
l’époux. Pourtant, il n’est pas toujours aisé d’en avoir la certitude. Prenons l’exemple du
couple Ismihan Sultane (fille de Selim II) et Sokollu Mehmed Pacha. La jeune mariée
s’installa d’abord chez son époux, où elle vécut quelques années. Mais les décès successifs de
leurs six premiers enfants, avant même qu’ils n’atteignent l’enfance, amena la princesse à
croire le lieu maudit et elle décida la construction d’un nouveau palais. Dans un geste de
largesse et d’attention, le grand vizir son époux alla au-devant de ses désirs et proposa de
prendre en charge cette affaire – c’est-à-dire de s’acquitter des travaux et de leur coût351
. Don
du mari, mais réalisé sous sa supervision et avec son argent, le nouveau palais dans lequel
s’installa le couple était-il celui du pacha ou de la princesse ? Un peu des deux, peut-être, à
moins que la réponse varie en fonction de la perspective privilégiée.
À partir du début du XVIIe siècle, la situation évolue progressivement. Les
descriptions des cortèges nuptiaux des princesses, qui scellent la sortie de la fiancée du
domicile parental et son établissement dans la demeure conjugale, fournissent des
informations précieuses qui permettent parfois de répondre à la question de leur lieu de
résidence. Or, leur consultation révèle que le palais conjugal n’était pas toujours synonyme de
palais du mari : il pouvait également s’agir de celui de la princesse352
. Un paragraphe de la
chronique de Topçular Katibi soulève une partie du problème :
« Comme l’office de kapudan avec rang de vizir avait été offert par le Siège
[litt. par la capitale] à Mehmed Pacha, alors gouverneur de la province
d’Egypte, on offrit ensuit la province d’Egypte à Sufi Mehmed Pacha, silahdar
dans le harem impérial. Le susdit Sufi Mehmed Pacha résidait, à la date de
Cemaziyelahır 1020 [août 1611], dans le palais de l’ancien vizir [Sokollu ?]
Mehmed Pacha, à proximité du [palais de] Kadirgalimanı du vizir et
kaymakam, Gürcü Hadım Mehmed Pacha. A cette période, le susdit Sufi
Mehmed Pacha sortit du palais. Après quoi, eu égard à sa position, le même
mois, on décida de l’honorer [de la province susdite]. Et le vizir-kapudan
351
Tülay Artan, « The Kadırga Palace: An Architectural Reconstruction », Muqarnas 10 (1993) : 201-211 et The Kadırga Palace Shrouded by the Mists of Time », Turcica XXI (1994) : 55-124. Voir également Doğan Kuban, Kaybolan Kent Hayalleri Ahşap Saraylar, Istanbul, Yem Yayın, 2001 : 35. 352
Uzunçarşılı comme d’Ohsson semblent être passés à côté de ce phénomène. Cf. Uzunçarşılı, Saray Teşkilâtı : 163 ; d’Ohsson, Tableau général : 194-197.
Page | 118
venant d’Egypte, Mehmed Pacha, ayant reçu l’ordre l’invitant à venir à la
Capitale avec le Trésor [d’Egypte], et on lui donna le Palais d’Ibrahim Pacha
sis sur l’Hippodrome. Cependant, à l’intérieur y résidait le vizir Davud Pacha.
L’ordre de vider les lieux lui ayant été transmis, le susdit Davud Pacha acheta
le palais de Ferhad Pacha, situé devant le lieu-dit Eski-odalar. Puis, ayant
quitté le palais de l’Hippodrome, Kara Hace, kethuda du vizir-kapudan Pacha,
venu précédemment d’Egypte, s’y installa [dans l’attente de la venue de
Mehmed Pacha]. Il fit faire des réparations au palais susdit et on vit arriver les
provisions. Puis l’on maria Sa Majesté la Sultane issue de notre fortuné
padichah au kapudan-vizir Mehmed Pacha. »353
La succession des événements est intéressante, car elle indique une logique de promotions et
d’honneurs en cascade : Mehmed Pacha est rappelé à la capitale après son administration
(fructueuse, semble-t-il) de la province d’Égypte ; il est fort probable qu’à ce moment-là déjà,
l’idée du mariage avec une princesse avait été fixée, mais à ce stade, rien d’officiel n’ayant
encore eu lieu, nous ne disposons pas de documentation permettant de l’affirmer ; le sultan
octroie au pacha, nommé à l’office de kapudan, un palais (expulsant l’ancien locataire, un
vizir) : il faut donc admettre que les projets de promotion de ce pacha étaient déjà établis, on
conçoit mal sinon qu’un vizir fût débouté de son palais au profit d’un autre vizir. Et quelle
promotion, quel honneur pouvait-il avoir qui surpassa celui d’un autre vizir sinon celui de
devenir gendre impérial (la place de grand vizir étant déjà prise par un autre, également en
voie de devenir gendre impérial) ? Le mariage public put alors avoir lieu, qui amena la
princesse à s’installer dans le palais offert précédemment par son père à son mari354
. En ce
début du XVIIe siècle, on offre donc au pacha un palais, destiné à devenir le lieu de résidence
du couple. Le statut de ce palais est dès lors problématique : certes, il devient la résidence du
pacha et de son épouse, mais sa possession demeure, semble-t-il, de l’ordre des biens du
sultan. C’est en tout cas ce que laisse entendre l’épisode relatif à Davud Pacha, qui s’en voit
expulsé sans préavis, pour faire place au futur résident.
Le phénomène se répète par la suite, avec des variantes possibles. Ainsi, lorsqu’il est
question du mariage de la fille de Mehmed IV, Fatma Sultane, avec Tırnakçı Ibrahim
Pacha, Sarı Mehmed Pacha raconte :
« Fatima Sultane – que Dieu la protège –, une des filles étoiles de pureté de Sa
Majesté le défunt Sultan Mehmed Han – que le pardon et la bénédiction divine soit
353
Ziya Yılmazer (éd.), Topçular Kâtibi ‘Abdülkâdir (Kadri) Efendi Tarihi. Metin ve Tahlîl, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 2003 : t. 1 p. 595. Annexes C.15. 354
On notera que les sources mentionnent seulement le mariage officiel et public, le düğün, qui se faisait de façon distincte, dans le temps et dans l’espace, de la réalisation du mariage contractuel, forcément antérieur à l’envoi de l’épouse à son nouveau domicile : or, c’est sous le règne d’Ahmed Ier que la pratique de marier contractuellement les princesses à des âges très jeunes se met en place : elles ne sont envoyées vivre auprès de leur époux que plusieurs années plus tard. Les dates précises n’étant pas fournies, il est difficile d’établir une chronologie exacte. Les indications avancées par Hammer ne reposent sur aucune information solide et se contredisent entre elles : la princesse aurait eu tantôt trois, tantôt sept ans au moment des célébrations. Il faut certainement comprendre qu’elle fut fiancée à un ge très tendre, mais que son union officielle n’eut pas lieu avant le retour du pacha d’Égypte. Cf. Yılmazer éd. , Topçular Kâtibi : 595-598, dont la traduction est donnée en Annexes C.15.
Page | 119
sur lui – a été mariée de façon contractuelle au gouverneur de Silistre, Tırnakçı
Ibrahim Pacha. Le palais connu sous le nom de Palais de Koca Yusuf Pacha, sis à
proximité du Vieux Palais, avait été tapissé aux frais du [Trésor] impérial pour la
Sultane susmentionnée. Dans l’ordonnancement du cortège, le grand vizir et les
autres vizirs, les notables et les grands personnages vinrent tous en tête de la
Sultane susdite, tandis qu’ils marchaient du Nouveau Palais Impérial en direction
du quartier susdit. »355
C’est encore dans le palais de la princesse qu’a lieu le mariage de la fille de Mustafa II, Ayşe
Sultane, avec Ebubekir Pacha :
« Les fêtes et réjouissances pour la réunion du contrat de mariage et l’entrée dans
le lit [nuptial] eurent lieu dans le palais de la sultane susdite, sis à Zeyrek. »356
Entre le début du XVIIe et la seconde moitié du XVIII
e siècle, une évolution
s’instaure : les couples princiers se distinguent désormais des autres par leur résidence
uxorilocale. Si les sources ne permettent pas d’affirmer que toutes les princesses furent
immédiatement concernées, il ressort cependant qu’au cours du XVIIe siècle, la pratique de
doter les filles de sultan d’un palais, au moment de leur mariage, s’imposa comme une règle
coutumière357
. C’est ainsi qu’Asiyye Sultane, fille d’Ahmed II, reçut un palais doté d’un
jardin planté d’arbres358
; Ayşe Sultane, fille d’Ahmed III, reçut pour sa part le Palais de
l’intendant de la reine mère, Mehmed Pacha, situé à proximité de la Süleymaniyye359
; sa
sœur, Esma Sultane, fut dotée d’un palais sis dans le quartier de Kadırgalimanı, qui échut par
la suite à une autre princesse, à sa mort360
; les exemples pourraient ainsi être étendus à
l’ensemble des princesses ottomanes du XVIIIe siècle. Hammer interprète d’ailleurs cette
pratique, dispendieuse, comme l’une des raisons du mécontentement populaire sous le règne
de Mustafa II361
. Cela n’empêcha pas la pratique de s’instaurer durablement et d’être
renouvelée par les souverains ultérieurs.
La princesse, hiérarchiquement supérieure à son époux, kul du sultan, détient entre ses
mains toutes les cartes de la puissance conjugale. Son époux lui doit soumission (même
355
Sarı Mehmed Paşa, Zübde-i vekayiât. Tahlil ve metin (1066-116 / 1656-1704), A. Özcan (éd.), Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1995 : 576. Annexes C.37. 356
Subhî Mehmed Efendi Vak’anüvis , Subhî Tarihi, Samî ve Şâkir ile birlikte, M. Aydıner éd. , Istanbul, Kitabevi, 2007 : p. 155 note 85 (ajout du manuscrit Sâmî). Annexes C.42. 357
Uzunçarşılı y fait mention dans les quelques pages dédiées aux filles de sultan dans son ouvrage sur le Palais ottoman : Uzunçarşılı, Saray Teşkilâtı : 159-166. 358
Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 72. 359
Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 317. 360
Artan, « The Kadırga Palace: An Architectural Reconstruction » : 201, 203-204 ; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 12. 361
« Les dépenses occasionnées par l’ameublement des palais de ses trois filles fiancées, l’une avec le vizir Nououman Koeprüli, frère d’Abdoullah Koeprülü, la seconde avec le vizir Ali, fils du grand vizir Kara Moustafa, et la troisième avec le silahdar Ali de Tschorli, le favori du sultan, ne laissèrent pas d’augmenter toutes ces dispositions hostiles. Moustafa II fit construire pour elles de somptueux palais en ville et des maisons de campagne sur les rives de la Toundja ; le plus grand luxe présida à l’ameublement de ces harems, et, pour les remplir, il invita les pachas de Bosnie, d’Erzeroum et d’Akhiska à envoyer des esclaves. Dans sa lettre circulaire aux pachas, le grand vizir leur dit : “Qu’autrefois on avait coutume de fournir des hommes, mais que le sultan n’avait besoin que d’esclaves ”. » : Hammer, Histoire générale de l’Empire ottoman : t. 13 p. 62.
Page | 120
symbolique) ; il doit renoncer à cette démonstration de puissance conjugale masculine qui
consiste à recevoir chez lui sa femme ; il est contraint d’entretenir une relation monogamique
avec elle ; enfin, il est toujours sous la menace d’un divorce, qui n’est pas sans renforcer le
rapport de soumission envers son épouse. Il semble qu’un mot de la princesse suffirait à délier
l’union ainsi nouée et mettre le malheureux gendre dans une position particulièrement
difficile – voire à décider de son exécution pure et simple. Tous ces privilèges maritaux
accordés aux princesses sont intimement liés les uns aux autres, car tous participent de la
même idée de supériorité des membres de la dynastie par rapport au commun des mortels. Ils
contribuent à renforcer le phénomène de distanciation des membres de la dynastie du reste de
la société : ils n’obéissent plus aux règles du commun, ils sont au-dessus de ces règles, ils
répondent à des prescriptions qui leurs sont propres parce qu’ils représentent des individus
exceptionnels en tant qu’élus de Dieu – qui a choisi cette dynastie pour régner et dont la
pérennité du pouvoir est signe de sa protection.
*
Lorsqu’il s’agit d’affirmer sa suprématie sur les autres, les dynasties régnantes ont
toujours su faire preuve d’imagination et d’improvisation, voire d’originalité. Norbert Elias
rappelait, dans la Société de cour, que le roi de France se réservait le droit de construire les
plus belles résidences, instaurant de la sorte une hiérarchie de l’habitat selon laquelle chacun
était astreint, selon son statut respectif, au respect des règles en matière de décorum : seuls le
souverain et les membres de sa famille pouvaient réaliser les palais les plus somptueux362
. Il
rappelait encore que l’organisation de la société de cour avait un objectif : permettre au roi
d’affirmer sa supériorité en forçant les membres de l’aristocratie à entrer en compétition
individuellement les uns avec les autres et, en tant que classe, avec les bourgeois, grâce à un
subtil jeu de concurrence dans l’attribution d’honneurs qu’il était le seul à pouvoir
dispenser363
. De même, le principe des échanges matrimoniaux préconisé par les dynasties
royales d’Europe reposait sur l’idée d’un échange de femmes entre familles souveraines, qui
permettait de souligner la supériorité des lignages royaux.
Les dynasties d’Europe occidentale ne furent pas les seules à appliquer des mesures
destinées à souligner la supériorité de leur lignage : les Ottomans firent de même, bien que les
moyens fussent différents. Il faut dire que la culture étatique ottomane ne reposait pas sur les
mêmes bases : les Ottomans étaient en effet les représentants d’un triple héritage impérial
362
Elias, La société de cour : 17-45. 363
« Cette situation impose au roi en tant que souverain une tâche bien déterminée : il doit veiller à ce que les tendances divergentes et opposées des hommes de cour s’exercent conformément à ses intérêts : « Le roi, dit Saint-Simon, utilisait les nombreuses fêtes, promenades, excursions comme moyen de récompense ou de punition, en y invitant telle personne et en n’y invitant pas telle autre. Comme il avait reconnu qu’il n’avait pas assez de faveurs à dispenser pour faire impression, il remplaçait les récompenses réelles par des récompenses imaginaires, par des jalousies qu’il suscitait, par de petites faveurs, par sa bienveillance. Personne n’était plus inventif à cet égard que lui. » Ainsi, le roi « divisait et régnait ». Mais il ne faisait pas que diviser. On constate qu’il savait évaluer le rapport des forces à la cour, équilibrer les tensions, répartir judicieusement pressions et contre-pressions. » : Elias, La société de cour : 119.
Page | 121
byzantin, moyen-oriental islamique (notamment des dynasties régnantes en Égypte) et turco-
asiatique364
. S’ils se devaient de respecter les pratiques musulmanes, ils avaient également
conscience de la nécessité d’affirmer la suprématie de leur lignage. Parmi les diverses
expressions que prit cette affirmation de supériorité, l’une des plus surprenantes fut la mise en
place d’un système matrimonial exceptionnel reposant sur l’alliance conjugale des membres
de la dynastie à des esclaves. Il s’ensuivit la création d’un statut à part de dâmâd-ı şehriyârî.
La spécificité de ce terme réside dans sa nature même : il s’agit en effet non d’un titre, mais
d’un honneur décerné à certains dignitaires de l’Empire qui marque le lien particulier unissant
ce dignitaire à la dynastie ; il le distingue donc de ses compagnons de même statut, mais sans
lui reconnaître une réelle place dans les rangs de la famille royale. Le dâmâd-ı şehriyârî est un
membre associé, qui a pour toute reconnaissance de son association une distinction
honorifique. Cette distinction implique en revanche une soumission (formelle) quasi totale
envers la dynastie. C’est ainsi que le dâmâd-ı şehriyârî se voit privé de nombre de ses droits
conjugaux, pourtant garantis par la législation islamique ; de même, il se voit également privé
de diverses expressions de sa supériorité conjugale, elle aussi intrinsèquement liée à la culture
islamique. Que, dans la pratique, les choses n’aient pas été aussi évidentes, c’est plus que
probable ; néanmoins, sur un plan symbolique, tout était mis en œuvre pour signifier la
suprématie de la représentante de la dynastie sur son époux. N’allons pas croire que les
gendres impériaux n’en tirèrent aucun avantage : en termes de carrière notamment, l’alliance
impériale assurait de nombreuses garanties et la protection princière en sauva certains de
situations périlleuses365
.
Ainsi les pratiques conjugales imposées aux filles de sang et à leurs époux procurèrent
à la dynastie les moyens d’une proclamation de supériorité exceptionnelle. Grâce à son
système, grâce aux obligations surérogatoires imposées aux dâmâd-ı şehriyârî, les plus
puissants personnages de l’État et, parmi eux, les plus honorables de tous, parce qu’ils avaient
été considérés comme dignes de l’honneur de devenir gendre impérial, devaient faire montre
de soumission envers leurs femmes, représentantes de la dynastie. Bien plus, par-delà
l’exaltation de sa supériorité sur tout autre lignage, la dynastie parvint aussi à affirmer son
exceptionnalité. C’est à ce seul titre que la dynastie pouvait réclamer des règles conjugales en
opposition avec les principes islamiques. En tant qu’élue divine, et parce que Dieu continuait
régulièrement de lui témoigner sa protection en permettant sa continuité, la dynastie
s’autorisait à proclamer des règles de conduite exceptionnelles à son endroit. En se plaçant au-
dessus des lois du commun, la dynastie ottomane affichait son caractère suprahumain : elle
s’autosacralisait. Le caractère sacré de la personne royale fut peut-être ébranlé à diverses
reprises366
, mais l’exceptionnalité de la dynastie, proclamée à travers maints biais, dont les
obligations conjugales imposées aux dâmâd-ı şehriyârî, demeura jusqu’à la fin de l’Empire.
364
Kafadar, Between Two Worlds : passim ; İnalcık, « The Ottoman Concept of State and the Class System ». 365
Il en sera question dans un chapitre ultérieur : 4.I.2.2. 366
Notamment lors de l’exécution sommaire du sultan Osman II. Cf. Vatin et Veinstein, Le Sérail ébranlé : 183-258.
Page | 122
CONCLUSION : Une crise identitaire irrésolue
Le tournant du XVIe siècle n’est pas seulement une période d’organisation de l’État et
de l’Empire ottoman, il est aussi une période de redéfinition des structures dynastiques elles-
mêmes. Engagé dès la seconde moitié du XVe siècle, ce travail se poursuit sur plus d’un
siècle, avant de trouver une certaine stabilisation qui n’exclut pas, néanmoins, des évolutions
mineures. C’est au cours de cette période que s’institue une catégorie sociale spécifique,
constituée uniquement de femmes descendantes de la dynastie, appelée d’abord şehzâdegân
puis sultânân. Les membres de cette catégorie se distinguent par le port d’un titre
immédiatement assimilable aux membres de la dynastie détenteurs de la souveraineté (les
hommes), mais qui diffère néanmoins de celui qui est attribué à ces derniers par son
emplacement après le nom. Les attributs de cette catégorie sont des signes distinctifs
d’appartenance dynastique, que ce soit dans le titre, dans les privilèges ou encore dans les
marques de statut. Il s’agit néanmoins d’une catégorie extrêmement sélective, à laquelle on
n’accède que par les liens du sang et qui se conserve à vie (et même par-delà la mort). C’est
donc l’une des rares catégories sociales de type héréditaire qui n’ait jamais procédé à aucune
ouverture de ses rangs367
. Elle doit sa constance à son lien avec la dynastie : seuls l’abolition
du sultanat et l’exil forcé de la famille royale mirent un terme à son existence368
.
Les princesses ottomanes appartiennent toutefois à une catégorie atypique qui souffre
de l’ambiguïté de son identité, à cheval entre la dynastie et l’élite. Cette ambiguïté est
renforcée par leur place dans la société : membres de la dynastie ottomane, elles n’ont pas les
mêmes droits que les hommes de cette famille (notamment en terme d’exercice de la
souveraineté, comme nous le verrons par la suite). À partir de la seconde moitié du XVIe
siècle, lorsque la coutume d’envoyer les princes comme gouverneur de province est
abandonnée, elles sont les seules membres de la famille régnante à quitter l’univers du Palais
impérial. L’ambiguïté de leur position sociale se lit ainsi dans la succession de leurs espaces
résidentiels : nées au Palais impérial, elles le quittent au jour de leur mariage, mais pour
éventuellement y revenir une fois veuves. Leurs pratiques quotidiennes en sont encore
l’expression, que ce soit au niveau des lieux d’inhumation, ou de leurs modes d’actions
politiques et sociales, comme nous allons le voir par la suite.
367
Au contraire des noblesses aristocratiques occidentales, qui bénéficièrent toutes de phases d’ouverture à des membres étrangers pour assurer la reproduction du groupe, soumis à des périodes de décroissance démographique. Cf. notamment Philippe Contamine, « Noblesse française, nobility et gentry anglaises à la fin du Moyen Âge : une comparaison », dans La noblesse en question (XIIIe-XVe s.), numéro thématique de Cahiers de recherches médiévales et humanistes 13 (2006) : 105-131 ; Adeline Rucquoi, « Être noble en Espagne aux XVIe-XVIe siècles », dans Nobilitas. Funktion und Repräsentation des Adels in Alteuropa, herausgegeben von Otto Gerhard Oexle & Werner Paravicini, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1997 : 273-298 ; Julien Demade, « Parenté, noblesse et échec de la genèse de l’Etat. Le cas allemand », Annales. Histoire, sciences sociales 61 / 3 (2006) : 609-631. Voir aussi Philippe Contamine, La noblesse au royaume de France, de Philippe le Bel à Louis XII, Paris, Presses Universitaires de France, 1997. 368
Leyla Açba raconte cet épisode douloureux de la famille ottomane et des femmes du harem dans ses mémoires : Açba, Bir Çerkes Prensesinin Harem Hatıraları. Istanbul, L&M Yayınları, 2005 : 135-192.
Page | 123
L’une des spécificités de cette catégorie sociale élitaire tient dans les forces à l’origine
de sa constitution. Sans prétendre que les princesses n’eurent aucun rôle dans ce processus, ce
sont surtout les sultans, en tant que chefs de la dynastie, qui semblent en avoir été les
principaux initiateurs. Il est vrai que l’ambivalence de leur identité ne favorise pas la
participation des princesses à ce processus de formation de leur définition sociale et interdit
leur constitution en classe morale, puisque l’élément essentiel pour établir l’existence d’une
classe morale réside dans l’existence d’un code de conduite propre aux membres de cette
classe369
. Il est important, néanmoins, de prendre en considération l’aspect inconscient de ce
processus : quand nous affirmons que les sultans furent les principaux responsables de la
constitution de la catégorie des princesses ottomanes, nous n’entendons pas qu’ils le firent
d’une façon entièrement consciente et planifiée, mais que l’étude que nous faisons de ce
processus permet l’établissement d’un récit compréhensif qui en retrace les étapes, dont les
acteurs eux-mêmes n’avaient probablement pas conscience.
La confusion identitaire vécue par les princesses ottomanes n’est pas exceptionnelle :
on la retrouve également, sous des formes différentes, chez les princesses occidentales qui
subissent une situation fort similaire370
. La différence entre les Ottomanes et les Européennes
se lit au niveau de l’ancrage spatial au sein duquel cette crise s’inscrit. Les princesses
européennes connaissent une crise identitaire que l’on pourrait dire nationale : nées et
éduquées dans une cour, un État, une famille, elles les quittent définitivement lors du mariage
(parfois lors des fiançailles) pour prendre désormais l’identité de la cour et du pays d’accueil,
avec tous les problèmes et tensions que cela a pu susciter. Les princesses ottomanes subirent,
pour certaines d’entre elles, une situation similaire pendant la période des mariages
interdynastiques, soit jusqu’au XVe siècle. Mais l’abandon de cette pratique fit que, pendant la
période qui nous intéresse, elles ne quittaient plus l’espace ottoman. Le conflit identitaire
qu’elles vivaient n’était donc pas “national” mais social, du fait de la pratique d’unions
hypogamiques à leur endroit.
Nous avons beaucoup dépeint cette situation en termes négatifs (« crise »,
« ambiguïté », « conflit » identitaire), mais il faut aussi y voir une ressource. La nature de
cette ressource varie entre les princesses ottomanes et européennes du fait même de cette
différence géographique suscitée : parce qu’elles demeuraient au sein d’un espace dont elles
maîtrisaient les pratiques, les premières purent tirer avantage de leur double identité dans le
cadre de leurs actions politiques ou sociales, ainsi que nous allons le voir par la suite. Les
princesses européennes n’avaient pas cette chance : leur insertion dans une nouvelle cour était
souvent difficile et sonnait généralement le glas de leurs relations et clientèles antérieures. Il
leur fallait reconstituer intégralement ou presque leurs réseaux, comprendre et apprendre à
manipuler de nouveaux mœurs et modes d’actions, sans grande chance de jamais perdre leur
qualificatif d’étrangère, empreint d’une forte suspicion371
. Dans un tel cadre, l’un des
369
Bertrand, La Tradition parfaite : 11-14, 59-80 et « L’ascèse pour la gloire. Trajectoires notabiliaires de la noblesse de robe à Java (XVIIe – XIXe siècles) », Politix 17/65 (2004) : 17-44. 370
Bély, La société des princes : 18-22. 371
Bély, La société des princes : 18-22 ; Annie Duprat, « Les princesses dans la propagande : Marie-Antoinette au miroir des reines de France », dans Femmes et pouvoir politique. Les princesses d’Europe, XV
e-XVIII
e siècle, I.
Poutrin et M.-K. Schaub (éds.), Rosny-sous-Bois, Bréal, 2007 : 294-309.
Page | 124
principaux domaines dans lesquels elles pouvaient jouer de leur double identité, sans trop
encourir le soupçon de traîtrise, était le domaine des arts et de la culture. Les princesses
occidentales jouèrent en effet un rôle considérable dans la diffusion transnationale des arts
occidentaux, par leur rôle de mécènes et patronnes d’architecture372
.
372
Sur le sujet, voir notamment Sabine Frommel et Juliette Dumas (éds.), Hommes et femmes bâtisseurs, traditions et stratégies dans le monde oriental et occidental, Paris / Rome / Istanbul, Picard / Campisano / IFEA, sous presse.
Page | 125
2
LE JEU MATRIMONIAL
« Quelques jours après il se parla du mariage du prince de
Navarre, qui maintenant est notre brave et magnanime Roi, et de
moi. La Reine ma mère, étant un jour à table, en parla fort
longtemps avec monsieur de Meru, parce que la maison de
Montmorency était ceux qui en avaient porté les premières
paroles. Sortant de table, il me dit qu’elle lui avait dit de m’en
parler. Je lui dis que c’était chose superflue, n’ayant de volonté
que la sienne ; qu’à la vérité, je la supplierais d’avoir égard
combien j’étais catholique, et qu’il me fâcherait fort d’épouser
personne qui ne fut de ma religion. Après, la Reine, allant à son
cabinet, m’appela, et me dit que messieurs de Montmorency lui
avaient proposé ce mariage, et qu’elle en voulait bien savoir ma
volonté. Je lui répondis n’avoir ni volonté ni élection que la
sienne, et que je la suppliais se souvenir que j’étais fort
catholique. Au bout de quelque temps, les propos s’en continuant
toujours, la reine de Navarre sa mère vint à la cour, où le mariage
fut du tout accordé avant sa mort […]. »1
Pour les princesses, le mariage n’était pas un choix, mais une obligation : fruit de
politiques conduites par d’autres, en vue de la création d’alliances entre deux familles, deux
maisons, voulues durables, mais bien souvent fragiles, il s’imposait sans qu’elles aient voix au
chapitre. Et il faut être une Marguerite de Valois ou une Marguerite-Louise d’Orléans pour
pouvoir s’extraire, non sans en payer le prix, de relations conjugales fâcheuses2. Les malheurs
ne s’arrêtent pas au mariage, car sitôt celui-ci conclu, il faut faire preuve de ses capacités à
engendrer une descendance nombreuse, sans quoi plane la menace de la répudiation.
L’anxiété de la grossesse est tellement présente qu’elle tient en haleine non seulement le
couple, mais les deux familles alliées, et jusque l’ensemble des deux cours respectives. Les
lettres échangées entre Marie-Thérèse, impératrice d’Autriche, et sa fille, Marie-Antoinette,
reine de France, en témoignent : Marie-Thérèse abandonne le ton impérial pour un « je » plus 1 Marguerite de Valois, Mémoires et autres écrits de Marguerite de Valois, la reine Margot, Y. Cazaux (éd.),
Paris, Mercure de France, 1986 : 57. Nous avons modernisé l’orthographe sans toucher à la grammaire. 2 Sur Marguerite de Valois, voir notamment Viennot, Marguerite de Valois et Muchembled, Passions de
femmes : 23-50 ; voir également son autobiographie : de Valois, Mémoires et autres écrits. Sur Marguerite-Louise d’Orléans et son mariage avec Côme de Médicis, voir Jean-Claude Waquet, « L’échec d’un mariage : Marguerite-Louise d’Orléans et Côme de Médicis », dans Femmes et pouvoir politique. Les princesses d’Europe, XVe-XVIIIe siècle, I. Poutrin et M.-K. Schaub (éds.), Rosny-sous-Bois, Bréal, 2007 : 120-132. La première dut cependant abandonner son trône, la seconde accepter une relégation peu glorieuse. Une autre princesse, Renée de France, n’eut pas une telle chance et malgré ses divergences religieuses profondes avec son époux, elle ne put s’en séparer : Caroline Zum Kolk, « Les difficultés des mariages internationaux : Renée de France et Hercule d’Este », dans Femmes et pouvoir politique. Les princesses d’Europe, XV
e-XVIII
e siècle, I. Poutrin et M.-K.
Schaub (éds.), Rosny-sous-Bois, Bréal, 2007 : 102-119.
Page | 126
intime qui lui permet d’exprimer ses inquiétudes et ses espoirs : « l’idée seulement qu’un
courrier puisse me porter la nouvelle d’une grossesse me met hors de moi, de consolation et
d’impatience […] » ; mais elle revient rapidement aux recommandations dont elle inonde sa
fille : « cette année, où nous avons de si grandes espérances que d’un jour à l’autre vous
pourriez être enceinte, il serait impardonnable de vous exposer […]. Votre santé doit en
souffrir ; elle ne vous appartient à vous seule, il faut la ménager pour vous et pour l’État. »3
Cette omniprésence du mariage se lit dans le nombre de travaux et d’approches que
cette thématique a pu susciter dans les sciences sociales. Anthropologues, sociologues et
historiens se sont attachés à en expliquer les portées, les structures et les pratiques. Tantôt
perçues en terme d’alliance, tantôt associées à un don, toujours soumises à des stratégies qui
sont le fruit d’intérêts à la fois individuels, familiaux et sociaux, voire étatiques, les approches
de la question sont multiples4. Dans cette littérature, les études ottomanes font pâle figure.
Certes, les travaux sur les femmes et le genre menés ces dernières années ont permis une
révision de nombreux préjugés ; la question du divorce a fait ainsi l’objet de nombreux
travaux, de même que celle des règles et pratiques judiciaires concernant les unions
matrimoniales (avec un accent sur les pratiques locales ou les minorités non musulmanes)5.
3 Georges Girard (éd.), Correspondance entre Marie-Thérèse et Marie-Antoinette, Paris, Éditions Bernard
Grasset, 1933 : 230. 4 Pour ne citer que quelques-uns des travaux qui ont enrichi la réflexion de ce chapitre, cf. Bély, La société des
princes ; Bennassar, Le lit, le pouvoir et la mort ; Pierre Bourdieu, Le bal des célibataires. Crise de la société paysanne en Béarn, Paris, Éditions du Seuil, 2002 ; Dufournet, Joris, Toubert (éds.), Femmes, mariages, lignages, XIIe-XIVe siècles ; Godelier, L’énigme du don ; Levi-Strauss, Les structures élémentaires de la parenté ; Mauss, Essai sur le don ; Nassiet, Parenté, noblesse et États dynastiques. 5 Colin Imber, « Guillaume Postel on Temporary Marriage », dans Festschrift Hans Georg Majer. Arts, Women
and Scholars, S. Prätor et Ch. K. Neumann (éds.), Istanbul, Simurg, 2002 : 179-184 ; idem, « Involuntary’ Annulment of Marriage and Its Solutions in Ottoman Law », Turcica 25 (1993) : 39-73 ; idem, « Zinâ in Ottoman Law », dans Contributions à l’histoire économique et sociale de l’Empire ottoman, J.-L. Bacqué-Grammont et P. Dumont (éds.), Louvain, Peeters, 1983 : 59-92 ; idem, « Women, Marriage and Property: Mahr in the Behcetü’l-Fetâvâ of Yenişehirli Abdullah », dans Women in the Ottoman Empire. Middle Eastern Women in the Early Modern Era, M.C. Zilfi (éd.), Leiden / New York / Köln, Brill, 1997 : 81-104 ; Ronald C. Jennings, « Women in Early 17
th Century Ottoman Judicial Records – the Sharia Court of Anatolian Kayseri », Journal of the Economic
and Social History of the Orient 18 (1975) : 53-113 ; idem, « The Legal Position of Women in Kayseri, a Large Ottoman City, 1590-1630 », International Journal of Women’s Studies 3 (1980) : 559-582 ; idem, « Divorce in the Ottoman Sharia Court of Cyprus, 1580-1640 », Studia Islamica 78 (1993) : 155-167 ; idem, Studies on Ottoman Social History in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. Womens, Zimmis and Sharia Courts in Kayseri, Cyprus and Trabzon, Istanbul, Isis Press, 1999 ; Georgios Salakides, « Women in the Kadı Sicilleri of Yenişehir (Larissa) in the Middle of the Seventeenth Century », dans Festschrift Hans Georg Majer. Arts, Women and Scholars, S. Prätor et Ch. K. Neumann (éds.), Istanbul, Simurg, 2002 : 209-228 ; Amira el-Azhary Sonbol, « Rape and Law in Ottoman and Modern Egypt », dans Women in the Ottoman Empire. Middle Eastern Women in the Early Modern Era, M. C. Zilfi (éd), Leiden / New York / Köln, Brill, 1997 : 214-131 ; Amira el-Azhary Sonbol (éd.), Women, the Family and Divorce Laws in Islamic History, Syracuse N.Y., Syracuse University Press, 1996 ; Judith E. Tucker, « Marriage and Family in Nablus, 1720-1856: Toward a History of Arab Marriage », Journal of Family History 13 (1988) : 165-179 ; idem, « Ties that Bound: Women and Family in Eighteenth- and Nineteenth-Century Nablus », dans Women in Middle Eastern History: Shifting Boundaries of Sex and Gender, N. Keddie et B. Baron (éds.), New Haven (Connecticut) / Londres, Yale University Press, 1991 : 233-253 ; Gilles Veinstein, « Femmes d’Avlonya (Vlöre) vers le milieu du XVIe siècle d’après les actes des cadis », dans Festschrift Hans Georg Majer. Arts, Women and Scholars, S. Prätor et Ch. K. Neumann (éds.), Istanbul, Simurg, 2002 : 195-208 ; Fariba Zarinebaf-Shahr, « Ottoman Women and the Tradition of Seeking Justice in the Eighteenth Century », dans Women in the Ottoman Empire. Middle Eastern Women in the Early Modern Era, M. C. Zilfi (éd.), Leiden / New York / Köln, Brill, 1997 : 253-263 ; Madeline C. Zilfi, « ’We Don’t Get
Page | 127
Mais force est de constater qu’en dehors de la dynastie ottomane, la question des stratégies ou
des règles d’alliances matrimoniales a très peu suscité l’intérêt des ottomanistes.
La littérature disponible sur les unions matrimoniales de la famille ottomane est
pourtant loin d’être dense et se caractérise par une répétition assez tacite des connaissances
déjà existantes, d’un ouvrage à l’autre. Ainsi, après Alderson, auteur d’un travail
incontournable sur la famille ottomane et ses alliances6, la plupart des travaux qui suivirent se
contentèrent de reprendre ses conclusions sans plus les questionner. Tout le monde s’accorde
sur l’existence d’une transition des pratiques matrimoniales au cours de la seconde moitié du
XVe siècle, qui vit disparaître les unions interdynastiques au profit d’unions internes à
l’Empire avec des esclaves : les cariye pour les hommes, les kul pour les femmes de la
dynastie. Depuis, de nombreux ouvrages biographiques ont vu le jour, qui mettent en valeur
les différentes unions des membres de la dynastie7. Il revient néanmoins à Peirce d’avoir
proposé une nouvelle réflexion concernant les pratiques matrimoniales dynastiques. Elle a
notamment mis en valeur l’existence d’une pratique de régulation de la descendance
masculine, limitée à un fils par concubine, tandis que les épouses légales des sultans ottomans
(princesses issues de dynasties voisines) se voyaient exclues de ce rôle de reproduction8.
Cependant, les travaux de cette dernière, concentrés sur les concubines et reines mères des
sultans ottomans, n’accordent qu’une attention limitée aux unions des filles de sultan. De
manière générale, les descendantes indirectes, pour lesquelles les sources sont peu
nombreuses, n’ont fait l’objet d’aucune attention particulière9.
Le mariage tient un rôle tout à fait central dans la vie des princesses ottomanes,
qu’elles soient filles de sultan ou descendantes indirectes de la dynastie. L’histoire de cette
dynastie s’est également construite partiellement autour de ces unions, qui éclairent en partie
les relations avec les voisins ou avec l’élite (militaire puis administrative) interne à l’Empire.
Le sujet est trop central pour ne pas mériter qu’on lui consacre un développement spécial. Il
Along’: Women and Hul Divorce in the Eighteenth Century », dans dans Women in the Ottoman Empire. Middle Eastern Women in the Early Modern Era, M. C. Zilfi (éd.), Leiden / New York / Köln, Brill, 1997 : 264-296. 6 Alderson, The Structure of the Ottoman Dynasty.
7 Parmi les principaux ouvrages du genre, citons Ulucay, Padişahların kadınları ve kızları ; Sakaoğlu, Bu Mülkün
Kadın Sultanları. Voir aussi Necdet Sakaoğlu, Bu Mülkün Sultanları. 36 Osmanlı Padişahı, Istanbul, Oğlak Yayıncılık, 2000 ; Yılmaz Öztuna, Devletler ve Hânedanlar. Türkiye (1074-1990), Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1969. 8 Leslie P. Peirce, « The family as faction: dynamics politics in the reign of Süleyman », dans Soliman the
magnifique et son temps. Actes des IXe rencontres de l’École du Louvre, Paris, 7-10 mars 1990, G. Veinstein (éd.), Paris, La Documentation Française, 1992 : 105-116 et, du même auteur, The Imperial Harem. 9 Au sujet des unions matrimoniales de la dynastie ottomane, voir aussi Altınay, Kadınlar Saltanatı ; Anthony
Bryer, « Greek Historians on the Turks: the Case of the First Byzantine-Ottoman Marriage », dans The Writing of History in the Middle Ages: Essays Presented to Richard William Southern, R. H. C. Davis et J. M. Wallace-Hadrill (éds.), Oxford, Clarendon Press, 1981 : 471-493 ; Hans G. Majer, « The Harem of Mustafa II (1695-1703) », Osmanlı Araştırmaları / Journal of Ottoman Studies 12 (1992) : 431-444 ; Ebru Turan, « The Marriage of Ibrahim Pasha (ca. 1495-1536). The Rise of the Sultan Süleyman’s Favorite to the Grand Vizierate and the Politics of the Elites in the Early Sixteenth-Century Ottoman Empire », Turcica 41 (2009) : 3-36 ; Uluçay, « II. Bayezid’in ailesi », Tarih Dergisi 10 (1959) : 105-124 ; du même auteur, « Kanuni Sultan Süleyman ve ailesi » ; Juliette Dumas, « Des esclaves pour époux… » ; idem, « La princesse et l’esclave… » ; idem, « Bir Prenses bir Kulla Evlenirse : 14. Yüzyıldan 15. Yüzyılın İlk Yarısına, Osmanlılarda İlkel Evlilik Sistemi », Toplumsal Tarih 209 (Mayis 2011) : 86-91 ; idem, « Bir Prenses bir Kulla Evlenirse II : Osmanlıların Sıradışı Evlilik Sistemi (15. Yüzyıl Ortalarından 16. Yüzyıl Ortalarına) », Toplumsal Tarih 210 (Haziran 2011) : 36-42.
Page | 128
s’agit en effet de déterminer le(s) type(s) d’unions matrimoniales élaborées pour les
princesses ottomanes, comme révélateurs de la structure politicosociale de la haute société
ottomane. Pour cela, il est indispensable de coupler la méthodologie historique traditionnelle
avec les apports d’autres disciplines des sciences sociales, notamment l’anthropologie et la
sociologie. Nous avons emprunté à l’anthropologie son approche structuraliste et son
questionnement sur la parenté en tant que construction sociale dans laquelle le mariage joue
un rôle central. Nous nous sommes donc interrogée sur l’existence de règles d’alliances
matrimoniales dans le cas des princesses ottomanes. C’est encore dans les travaux
anthropologiques que nous sommes allée puiser les outils d’une réflexion sur la symbolique
des mariages, en nous inspirant des études sur le don. Nous avons encore emprunté à la
sociologie (bourdieusienne notamment) le questionnement sur le rôle des acteurs (les agents
sociaux), producteurs à la fois conscients et inconscients des pratiques socioculturelles de leur
groupe. Néanmoins, notre démarche générale demeure historisante et, à ce titre, se veut aussi
attentive aux grands mouvements inscrits sur plusieurs siècles qu’aux nuances
évènementielles, fruits d’intérêts individuels ou de groupes qui déterminèrent l’élaboration
des pratiques matrimoniales des princesses ottomanes.
Le premier chapitre est ainsi consacré à l’étude des mariages des princesses d’un point
de vue structuraliste : la collecte des données factuelles permet ainsi de faire ressortir les
dynamiques principales qui commandent à l’élaboration de ces unions. Cependant, ces
dynamiques ne peuvent être pleinement comprises sans être mises en perspective avec les
composantes politiques auxquelles la dynastie est confrontée. Événements politiques, les
mariages sont les reflets de stratégies en relation directe avec les évolutions des conditions
politiques du pouvoir ottoman. La deuxième partie s’attache dès lors à montrer
l’instrumentalisation politique des mariages des princesses ottomanes. Ce champ est lui-même
soumis aux pressions tantôt concordantes, tantôt divergentes, des agents concernés
(directement ou non) par l’élaboration d’une union dynastique. Les époux sont loin de tenir
les rôles principaux dans cette partie d’échecs qui ne cesse de se rejouer. L’objectif de la
troisième partie est donc de révéler le rôle et la marge d’action de chacun dans ce vaste
marché matrimonial. L’élaboration du mariage d’une princesse se donne à voir comme un jeu
au champ si vaste que ses acteurs n’en perçoivent jamais l’horizon.
Page | 129
I. DES PRÉFÉRENCES MATRIMONIALES MARQUÉES
Dans le chapitre de son Osmanlı Devletinin Saray Teşkilâtı consacré aux filles de
sultan, Uzunçarşılı note : « les filles des souverains ottomans sont appelées sultanes ;
lorsqu’elles grandissent, elles sont mariées à des personnes de haut rang ; les filles ou sœurs
des premiers souverains ottomans étaient données en mariage, tantôt à d’autres souverains
anatoliens ou à leurs fils, tantôt à des beys de leur suite ; par exemple la fille de Murad Bey
Ier, Nefise Sultane, fut donnée à Karamanoğlu Alaüddin Bey en 1381. […] À partir du début
du XVIe siècle, il fut décidé de ne donner les sultanes qu’à des vizirs ou beys ottomans »
10. Il
affirme ici l’existence d’une modification des pratiques au début du XVIe siècle pour laquelle
il ne propose malheureusement aucune explication. La différence de statut entre les gendres
des premiers (princes souverains ou pour le moins héritiers) et ceux qui bénéficient de
l’appellation honorifique de dâmâd-ı şehriyârî est surprenante. Les premiers sont des
individus extérieurs au territoire ottoman, tandis que les seconds en sont partie prenante.
Autant d’éléments qui amènent à s’interroger sur les motifs et intérêts qui ont guidé les
sultans vers le choix de gendres si radicalement différents d’une période sur l’autre. À en
croire Uzunçarşılı, la dynastie serait passée d’un type d’époux à un autre sans coup férir,
phénomène douteux qui invite à de plus amples recherches. La transition fut-elle brutale ou
s’affirma-t-elle par étapes, par avancées progressives ? Peut-on procéder à une généralisation
qui suggérerait l’existence d’une règle ? Dans la mesure où nous avons choisi, dès le départ,
d’ancrer ce travail dans la durée, il est nécessaire de poser la question de la pérennité de ces
règles. Cette pérennité renvoie d’ailleurs à deux réalités : la pérennité chronologique, dans le
sens de la répétition (ou non) de la pratique chez les mêmes acteurs d’un siècle sur l’autre ; la
pérennité lignagère, dans le sens de la répétition de la pratique parmi les descendant(e)s des
filles des sultans.
1. Des alliances préférentielles exogamiques et isogamiques (XIVe – mi-XV
e
siècle)
De d’Ohsson à Peirce en passant par Alderson ou Uzunçarşılı11
, tous ont souligné
qu’entre la fin du XVe et le début du XVI
e siècle, la dynastie avait abandonné l’ancestral
système d’alliances interdynastiques pour lui préférer des unions avec des esclaves :
concubines pour les membres masculins de la dynastie, kul pour les princesses12
. Bien que la
période des premiers siècles dépasse notre cadre chronologique, il paraît essentiel de revenir
sur le type d’échange matrimonial pratiqué dans le cas des mariages des princesses au cours
10
Uzunçarşılı, Saray Teşkilâtı : 159. La traduction du texte est personnelle. 11
Peirce, The Imperial Harem : 28-56 ; Uluçay, Harem II : 87-91 ; Alderson, The Structure of the Ottoman Dynasty : 85-100 ; d’Ohsson, Tableau général de l’Empire ottoman : 195. 12
Outre les auteurs cités, voir aussi Bryer, « Greek Historians on the Turks » et Dumas, « Des esclaves pour époux… ».
Page | 130
de cette période allant du XIVe à la mi-XV
e siècle, afin de mieux comprendre la portée du
changement appliqué par la suite.
Entre le règne de Murad Ier (1362-1389)13
et celui de Mehmed II (1451-81), la
majorité des mariages furent réalisés avec des membres de dynasties voisines. Deux familles
furent particulièrement privilégiées : les Karamanoğlu et les İsfendiyaroğlu. Des mariages
répétés furent contractés avec les Karamanoğlu : le plus ancien (connu) est celui d’une fille de
Murad Ier, Nefise Melek Hatun14
; puis trois des sept filles de Mehmed Ier (1412-20) – Ilaldi,
et deux sœurs dont les noms ne sont pas certains)15
. Sur l’ensemble de la période mentionnée,
cette dynastie reçut ainsi quatre princesses ottomanes. Les İsfendiyaroğlu ne furent pas non
plus en reste. L’alliance créée entre les deux dynasties se reproduit d’ailleurs sur trois
générations au sein de la même famille. Ce furent d’abord deux filles de Mehmed Ier (Selçuk
Hatun et Sultan Hatun) qui épousèrent deux descendants de la famille İsfendiyaroğlu (Ibrahim
Bey et Kasim Bey)16
. Le fils de Selçuk, qui prit la succession de son père Ibrahim, épousa à
son tour une fille de Murad II (dont le nom ne nous est pas parvenu)17
. De cette union naquit
un fils, Hasan Bey, qui lui-même reproduisit le modèle en épousant de nouveau une princesse
ottomane, une fille de Mehmed II18
. Ainsi les İsfendiyaroğlu reçurent eux aussi quatre
princesses ottomanes. De façon plus épisodique, d’autres dynasties voisines des Ottomans
devinrent également des alliés par mariage. Ainsi une fille de Bayezid Ier (1389-1402) épousa
un petit-fils de Tamerlan (soit un membre de la dynastie timouride)19
; tandis qu’une autre
aurait été donnée en mariage à un des émirs mongols, Şemseddin Mehmed fils de Celaleddin
İslam20
. Une troisième fille de Bayezid Ier (Erhondu Hatun) aurait encore épousé Yakup Bey,
fils du bey de Pars21
. Enfin, la dynastie des Akkoyunlu fut également l’objet de deux
13
Nous ne disposons d’aucune information antérieure relative aux mariages des princesses ottomanes – à peine avons-nous connaissance de leur existence. 14
Neşrî, Cihânnümâ : 107-108 ; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 31 ; Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 1 p. 148-150 ; Johannes Schiltberger, Captif des Tatars, J. Rollet (trad.), Toulouse, Anacharsis, 2008 : 41-44 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 6-7 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 52-58. 15
Neşrî, Cihânnümâ : 267 ; Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 2 p. 126, 141 ; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 3 p. 373, p. 800 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 12-13 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 88. D’après ce dernier, les deux sœurs d’Ilaldi seraient Ayşe et İncu ; cependant, les chroniques consultées ne précisent jamais le nom de ces deux filles, aussi préférons-nous garder une certaine réserve concernant l’attribution de ces noms. 16
Neşrî, Cihânnümâ : 267 ; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 38 ; Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 2 p. 122 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 11-13 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 78-88. 17
Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 106. 18
Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 106. 19
Il s’agit de Oruz ou Uruz Hatun, qui aurait épousé Ebubekir Mirza, fils de Miranşah, fils de Tamerlan. « Mohammed Sultan [mirza de l’armée tatare de Timur, après la bataille d’Ankara] fut rejoint par Mikhalidj par l’avant-garde sous les ordres d’Eboubekr-Mirza et l’émir Sewindjik qui avait saccagé tous les villages situés sur le bord de la mer. Peu de temps après son retour à Broussa, le prince célébra, dans la plaine de Yenischehr, son mariage avec la fille aînée de Bayezid. » Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 2 p. 53 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 75. Uluçay ne donne aucune information concernant son mariage : Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 9. 20
Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 74-75. 21
Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 10 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 75.
Page | 131
alliances : une fille de Mehmed II épousa Uğurlu Mehmed, fils d’Uzun Hasan22
, puis leur
propre fils, Göde Ahmed Mirza, répéta l’exemple paternel en prenant pour femme une fille de
Bayezid II23
.
Ces mariages se caractérisent à la fois par leur isogamie et leur exogamie. Les
Ottomans eurent soin de sélectionner des gendres de préférence parmi des membres
appartenant à des groupes extérieurs (exogamie), mais de même statut (isogamie). C’est donc
un rapport d’équivalence et non de hiérarchie qui se met en place au travers de ces unions. On
notera d’ailleurs que l’équivalence était renforcée par le fait que les sultans ne se contentaient
pas de donner des filles, ils en prenaient aussi parmi ces mêmes dynasties voisines24
: nous
sommes ainsi en présence d’un cas relativement habituel d’échange de femmes entre groupes
de même statut qui entraine un système de dépendance mutuelle entre les familles25
.
Néanmoins, il n’est question, en tout et pour tout, que de treize princesses sur une période
s’étendant sur un siècle et demi. Peut-on dès lors parler de préférence ? La faiblesse des
informations fournies par les sources autorise difficilement à répondre à la question et les
chroniques et travaux historiographiques consultés ne permettent pas de se faire une idée
précise du nombre total de princesses sur la période. Ainsi Necdet Sakaoğlu (qui reprend les
données fournies par Alderson et Uluçay) mentionne 27 filles sur l’ensemble de la période.
Cependant, il faut soustraire à ce chiffre un certain nombre de filles non mariées
(probablement parce qu’elles moururent en bas âge) et compter sur les confusions : il n’est
pas rare que les mêmes indications de mariage soient données pour différentes filles. Par
ailleurs, l’historiographie mentionne régulièrement des unions sans prendre le temps de
préciser les sources qui, de toute évidence, diffèrent des nôtres dans la mesure où celles-ci
n’en font pas mention – ce qui nous amène à douter de leur véracité26
. Treize unions
interdynastiques pour peut-être une vingtaine de princesses mariées, cela représente tout de
même plus de la moitié des alliances : le chiffre est donc suffisamment significatif pour être
pris en considération.
Le cas des filles de Mehmed Ier est exemplaire : sur ses sept filles, cinq épousèrent des
princes issus des dynasties anatoliennes voisines. Neşri souligne d’ailleurs la chose sans une
hésitation :
« [Mehmed Ier] donna trois de ses filles à des fils [du bey] de Karaman, l’une à
Ibrahim, une autre à Alaeddin et la dernière à Isa. Il en donna deux autres à des
fils de Isfendiyar, l’une à Ibrahim, l’autre à Kasim. Il donna encore une [de ses
22
Il s’agit de Gevherimüluk ou Gevherhan Hatun. Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 15, t. 4 p. 1076 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 21 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 132-133. 23
Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 143 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 24-25. 24
On notera cependant qu’il ne s’agissait pas forcément des mêmes dynasties, ainsi les sultans ottomans contractèrent plusieurs alliances matrimoniales avec la dynastie byzantine, mais ne donnèrent jamais de femme en retour. Cf. Bryer, « Greek Historians on the Turks » ; Alderson, The Structure of the Ottoman Dynasty : 85-100 ; Dumas, « Des esclaves pour époux… » ; Uluçay, Harem II : 87-90. 25
Godelier a particulièrement bien expliqué ce cas de figure dans son étude des mariages chez les Baruya. Cf. Godelier, L’énigme du don : 59-62. Voir également, du même auteur, Métamorphoses de la parenté. 26
Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları.
Page | 132
filles] à Karaca Bey, gouverneur d’Anatolie, qui mourut en martyr lors de la guerre
sainte à Varna, et la dernière au fils d’Ibrahim Pacha Mahmud Çelebi. »27
On ne peut douter, dans ce cas précis, de la préférence marquée par ce sultan pour les
alliances avec ses voisins régnants – d’obédience musulmane exclusivement, puisque les
préceptes islamiques interdisent l’union d’une musulmane avec un non-musulman28
. Il en
avait déjà été de même avec les filles de son père, Bayezid Ier : trois de ses cinq filles furent
mariées avec des princes étrangers29
. Nous sommes donc bien en présence d’une règle
préférentielle (mais non pas unique) en faveur d’alliances isogamiques et exogamiques30
.
2. La recherche d’un nouveau modèle marital (mi-XVe siècle – mi-XVI
e siècle)
À partir du milieu du XVe siècle, on constate un changement des pratiques
matrimoniales des princesses ottomanes qui correspond au passage d’une règle à une autre –
dont nous verrons les motifs par la suite. Désormais, les princes anatoliens sont délaissés au
bénéfice d’unions contractées uniquement avec des kul des sultans. Cette transition procède
par étapes dont la temporalité et les modalités varient selon que l’on regarde les mariages des
filles de sultan ou de leurs descendantes. De fait, le changement ne fut ni radical, ni
immédiat : au contraire, il se construit progressivement, sous le règne de trois sultans
successifs, qui apportèrent chacun leur touche à cet édifice.
1. Une transition en trois phases : le cas des filles de Bayezid II
Peut-on dater avec précision le moment où la transition fut engagée ? Dès le début du
XVe siècle, on repère des cas isolés d’unions entre princesses ottomanes et kul. Le mariage
d’une des filles de Mehmed Ier avec Karaca Pacha31
est probablement l’exemple qui se
27
Neşrî, Cihânnümâ : 267. 28
On notera que la réciproque n’est pas vraie : un musulman pouvait épouser une non musulmane, sans que celle-ci ne soit contrainte d’abjurer sa foi, du moment que les enfants étaient élevés en tant que musulmans. 29
Paşa Melek Hatun, mariée à Şemseddin Mehmed ; Erhundu Hatun, mariée à Yakup Bey ; Oruz Hatun, mariée à Ebubekir Mirza. Seules Hundi Hatun et Fatima Hatun furent données à des personnalités politiques internes à l’espace ottoman (nous y reviendrons plus loin). Nous excluons la fille mentionnée par Alderson, dont il ne fournit d’ailleurs pas le nom et qu’il indique mariée à Ladislas Napolili, dans la mesure où ce mariage nous semble erroné. Il était impossible, au regard de la législation musulmane, pour une princesse ottomane d’épouser un non-musulman. D’ailleurs, le texte faisant allusion à une telle union, qu’il nous a été donné de consulter, parle de façon assez vague d’un « Frank » sans préciser son nom et montre de nombreuses incohérences. Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 69-75. 30
Les exceptions seront traitées plus loin, lorsqu’il sera question des stratégies politiques sous-tendant ces alliances matrimoniales. 31
L’identité de l’épouse de ce pacha n’est absolument pas claire, si ce n’est qu’il s’agit d’une fille de Mehmed Ier, ainsi que l’indique Neşri (qui l’appelle Karaca Bey) : Neşrî, Cihânnümâ : 267. De nombreux historiens pensèrent qu’il s’agissait de Selçuk Hatun, qui épousa de façon certaine İsfendiyaroğlu Ibrahim Bey mais quand on examine de plus près les dates, une telle union avec Karaca Bey ou Pacha devient impossible. Il faut donc
Page | 133
rapproche le plus des pratiques que nous allons voir par la suite. Fatma Sultane, sœur de la
précédente, fut également mariée à un bey ottoman32
. Mais à ce stade, il ne s’agit pas encore
d’une réelle orientation préférentielle, mais de solutions épisodiques – ou du moins est-ce
l’impression qui s’en dégage. Ce n’est que sous Mehmed II (1451-81) qu’il est possible d’y
voir une préférence politique marquée : Mehmed II fut en effet l’initiateur du changement des
pratiques matrimoniales dynastiques, pour la partie masculine principalement. Son fils et
successeur, Bayezid II (1481-1512) fut celui qui consolida et généralisa la pratique à
l’ensemble de la dynastie, presque sans exception. La transition amorcée sous les règnes de
Mehmed II et Bayezid II ne naît donc pas de nulle part, mais plonge ses racines dans des
expériences plus anciennes – sur lesquelles nous reviendrons par la suite. L’étude détaillée
des mariages des filles de Bayezid II, dont certains furent contractés sous le règne de son
prédécesseur, est donc essentielle pour comprendre comment elle se réalisa : dans l’arbre
généalogique de ce sultan33
, on peut distinguer trois phases successives et, peut-être,
partiellement concomitantes.
Arbre généalogique 2.15. Les mariages des filles de Bayezid II
La première phase de transition n’est pas évidente à établir et il n’est pas impossible
qu’il y ait eu chevauchement avec la suivante. Les premiers mariages des filles de Bayezid II
semblent avoir été réalisés avec des “semi” kul : des kul descendants de familles chrétiennes
nobles voire princières. Deux filles de Bayezid II furent mariées avec de tels personnages :
envisager qu’il s’agit d’une de ses sœurs. Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 38 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 11-12 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 78-87. 32
« Désormais le sultan [Mehmed Ier] pouvait régner en maître absolu, car Moustafa était prisonnier de l’empereur de Constantinople, et il n’avait rien à redouter de Kasim. Ce dernier, frère de Mohammed, n’avait pas été exécuté conformément au principe établi par Bayezid pour assurer la tranquillité de l’empire. On s’était contenté de lui faire crever les yeux, et Mohammed lui avait assigné pour séjour et donné en apanage la ville d’Akhissar, voisine de Kiwa. Sa sœur Fatimé, que Souleïman avait laissée, ainsi que Kasim, en qualité d’otage entre les mains de l’empereur grec, et que ce dernier s’était empressé de livrer à Mohammed, pour preuve de son amitié et de sa confiance, fut donnée en mariage à un sandjakbeg. Malgré la cruelle opération que Mohammed avait fait subir à son frère, il n’avait cependant pas étouffé dans son cœur tout sentiment de pitié ; toutes les fois qu’il allait à Brousa, il faisait venir Kasim et sa sœur dans son palais et s’entretenait avec eux avec une bonté toute fraternelle. » : Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 2 p. 96. 33
L’arbre complet de la descendance de ce sultan est disponible en annexes B.7.
Page | 134
Hundi Hatun, qui épousa le puissant Hersekzade Ahmed Pacha, descendant de la famille
princière d’Herzégovine34
et Gevherimülûk Sultane, qui épousa un descendant d’une autre
puissante famille ducale d’Europe de l’Est, Dukakinzade Mehmed Pacha35
. La noble origine
de ces individus était largement connue, proclamée même à travers leur nom de famille :
Dukakinzade comme Hersekzade signifient « le fils (ou le descendant) du duc »36
. Leur
prestigieuse ascendance n’était un secret pour personne et pourrait avoir facilité l’évolution du
système matrimonial.
Cette transition entre des gendres d’origine noble ou bénéficiant d’une aura
particulière vers des gendres d’origine servile relève d’un pragmatisme évident que le recul
historique permet de percevoir ; il n’est pourtant pas évident que cette pratique fut pensée
comme telle, ni acceptée avec bienveillance par ses contemporains. Le choix de ces époux
peut ainsi se lire, avec le recul, comme une solution intermédiaire qui permettait de jouer sur
plusieurs tableaux, puisqu’ils étaient à la fois esclaves du sultan, grands dignitaires détenteurs
d’une aura particulière, et d’ascendance noble. Les gendres impériaux ne sont pourtant pas les
seuls concernés par ce choix d’élévation socioprofessionnelle des kul d’origine noble : le
phénomène est plus général et l’on sait bien que Mehmed II intégra dans son équipe
dirigeante un certain nombre de représentants des grandes familles ou de l’élite des pays
récemment conquis par ses troupes. La politique de promotion des kul au sein de la haute
administration ottomane engagée par Mehmed II privilégie donc la voie des kul de noble
origine : l’application de cette logique aux gendres impériaux en découle et n’en est qu’un
élément.
Une deuxième phase se distingue à travers les mariages de Selçuk et Kamerşah avec
des fils de dignitaires : soit des kul beyzade ou pachazade. Cette pratique pourrait avoir été
influencée par l’exemple du mariage de Gevherimülûk Sultane et Dukakinzade Mehmed
Pacha, ce dernier étant non seulement le descendant d’une famille noble, mais également le
fils d’un puissant dignitaire ottoman, Dukakinzade Ahmed Pacha37
. Les deux autres gendres
de cette catégorie ne bénéficient toutefois pas du prestige de l’ascendance noble, leurs pères
respectifs étant de “purs” esclaves de la Porte. Selçuk Sultane épousa ainsi Mehmed Bey, le
fils de Koca Mustafa Pacha38
, et Kamerşah Sultane celui de Davud Pacha39
. La transition
matrimoniale s’accentue de la sorte en faveur de gendres non princiers, non nobles,
appartenant pleinement à la catégorie des esclaves du sultan. Il est probable que cette phase
34
Fils cadet du souverain de cette principauté vassale des Ottomans, il fut envoyé comme otage alors qu’il était encore enfant. Cf. Şerafettin Turan, « Hersekzâde Ahmed Paşa », TDVİA 17 : 235-237 ; Hedda Reindl, Männer um Bâyezid. Eine prosopographische Studie über die Epoche Sultan Bâyezîds II (1481-1512), Berlin, Klaus Schwarz, 1983 : 129-146 35
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 15, t. 4 p. 1049 ; voir aussi la bibliographie consacrée à son père par Abdülkadir Özcan, « Dukakinzâde Ahmed Paşa » ; Nejat Sefercioglu, « Dukakinzâde Ahmed Bey », TDVİA 9 : 549-550. 36
Duka pour duc, kin pour Jean, zade pour fils ou descendant, littéralement, le fils, le descendant du duc Jean. De même pour Hersekzade : Hersek vient du mot herzog, qui signifiait duc. 37
Özcan, « Dukakinzade Ahmed Paşa », TDVİA 9 : 550-551 ; Reindl, Männer um Bâyezid : 333-335. 38
Mehmed Süreyya ne mentionne aucun mariage : Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 38 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 28 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 144. 39
Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 28 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 145.
Page | 135
ait été concomitante (au moins partiellement) avec la précédente, mais seule la connaissance
des dates de ces mariages nous permettrait d’en avoir la certitude.
La dernière phase de cette transition pouvait alors être amorcée sans difficulté, à savoir
marier les filles de sultan aux dignitaires kul eux-mêmes. Cette pratique matrimoniale fut en
fait la plus employée : à huit reprises, avec sept autres filles de Bayezid II. Fatma Sultane,
surnommée « Sofu » ou « Sofi » fut ainsi mariée à deux reprises : la première fois avec un bey
(Güzelce Hasan Bey), la seconde avec un pacha (Ahmed Pacha) 40
. Une autre princesse,
Şehzade Şah, fut également mariée à un bey : Nasuh Bey41
. Toutes les autres, Ayşe,
Hümaşah, Ilaldi, Hatice et Aynişah, furent mariées à des pachas (respectivement, Sinan
Pacha, Bali Pacha, Ahmed Pacha, Faik Pacha et Yahya Pacha)42
. Il est difficile de comprendre
pourquoi deux de ces gendres furent choisis parmi des beys et non parmi des pachas.
Toutefois, il faut tenir compte du nombre important de filles nées de ce sultan : le sultan
pourrait n’avoir eu d’autres solutions que de choisir des gendres auprès des beys43
. À moins
que les beys n’aient constitué une autre étape intermédiaire, avant les kul pachas ? Le fait est
que les trois gendres fils de pachas étaient eux aussi des beys, du moins au moment de leur
mariage. Le peu de renseignements fournis à ce sujet ne permet pas d’apporter de réponse
conclusive à cette question.
2. La consolidation du modèle (première moitié du XVIe siècle)
Au crépuscule du XVe siècle, à la fin du règne de Bayezid II, la nouvelle pratique
matrimoniale consistant à marier les princesses à des kul s’est imposée : elle devient une des
coutumes dynastiques fondamentales de l’Empire ottoman. Néanmoins, les tâtonnements
suivis dans son élaboration lui offraient encore une certaine souplesse qui disparaît avec les
règnes suivants. Selim Ier (1512-1520) et Süleyman Ier (1520-1566) instituèrent une formule
plus rigide, qui servit de référence par la suite.
À sa montée sur le trône, Selim Ier hérite des dignitaires de son père ; il en maintint
certains bien volontiers, mais aurait sans doute préféré se passer des services de certains
autres44
. Selim Ier disposait d’une capacité d’alliance moins étendue que son père : sa
descendance féminine (à notre connaissance) se limitait à six filles – quand Bayezid II avait
donné naissance à plus d’une vingtaine d’enfants. La montée sur le trône de Selim Ier amène
donc une réduction du nombre des alliances, rendues plus précieuses du fait de leur rareté. Or,
40
Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 26 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 144-145. 41
Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 29 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 144. 42
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 6, 15, 16 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 24-29 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 142-146. 43
On remarquera qu’un même phénomène se reproduit par trois fois durant notre période d’étude : avec les filles Bayezid II, de Murad III puis d’Ahmed III. Il ne s’agit pas là d’une coïncidence, mais des trois sultans qui eurent une descendance beaucoup plus nombreuse que celle des autres sultans (près d’une vingtaine de filles pour chacun). Il y a donc un lien de cause à effet direct entre le nombre de filles et le statut de leurs époux. 44
Turan, « The Marriage of Ibrahim Pasha » : 21.
Page | 136
si l’on regarde de plus près la position de ce sultan vis-à-vis de ses gendres, on constate
l’existence de deux tendances opposées : l’une consiste à les tenir éloignés, l’autre au
contraire à s’appuyer sur eux pour renforcer son ascendant sur le gouvernement. Ainsi Lütfi
Pacha était gouverneur à Yahnya45
; Ferhad Pacha était en charge de la province de
Dulkadir46
; Mustafa Pacha était à Antalya47
; Iskender Pacha, l’époux d’Hafsa Sultane, avait
à charge le domaine maritime (en tant que kaptan-ı derya)48
. Cette volonté d’éloignement des
gendres ne dura qu’un temps, auquel succéda au contraire la promotion de certains d’entre
eux au sein du gouvernement49
. Le faible nombre de gendres impériaux rendait leur entrée au
gouvernement plus aisée que sous le précédent règne ; elle n’était pourtant pas tout à fait
nouvelle. On en trouve des tentatives isolées déjà sous le règne de Bayezid II. Quelles que
soient les raisons de ses hésitations, il semble que la proximité des gendres lui parut
finalement l’option la plus préférable.
Le début du règne de Süleyman est marqué par la poursuite de ces pratiques
matrimoniales : les gendres impériaux sont systématiquement choisis parmi les kul du sultan
et, au sein même de cette catégorie, parmi les plus hauts placés dans la hiérarchie
administrative impériale. Süleyman Ier n’a pas les hésitations de son père : il montre très vite
son désir de proximité avec les gendres impériaux, nommés à des postes dans la capitale –
quitte à les rappeler de province50
. L’exemple le plus ancien de cette pratique serait tout
naturellement le mariage de sa sœur, Hadice Sultane, avec Ibrahim Pacha, son ami intime et le
premier des deux principaux grands vizirs de son règne, si une thèse récente n’avait achevé de
45
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 42, t. 3 p. 903 ; Azmi Özcan, « Lutfî Paşa », OA : t. 2 p. 49-50 ; Colin Imber, « Lutfi Pasha », EI (2) : t. 5 p. 837-838 ; Tayyip M. Gökbilgin, « Lûtfi Paşa », İA : t. 7 p. 96-101 ; Mehmet F. Köprülü, « Lutfî Paşa », Türkiyat Mecmuası I (1925) : 119-150 ; Necipoğlu, The Age of Sinan : 293 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 32-33 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 153-154. 46
Nous connaissons surtout la fin de ce gendre, grâce au récit qu’en fait Hammer : « Ferhad Pacha qui, lors de l’expédition de Rhodes, avait cherché à assouvir, dans la principauté de Soulkadr, sa rapacité et son instinct sanguinaire par l’extermination de la famille Schehzouwar, avait continué à se montrer plutôt le bourreau que le gouverneur de la province confiée à ses soins. Ses exactions et l’exécution de plus de six cents personnes injustement mises à mort criaient vengeance. Süleyman, sur les plaintes multipliées qui lui arrivèrent d’Asie, rappela Ferhad Pacha ; mais vaincu par les instances de la sultane mère et de sa sœur épouse du coupable, il lui assigna le gouvernement de Semendra avec sept cent mille aspres de traitement, dans l’espoir sans doute qu’un pareil revenu mettrait des bornes à ses concussions, et que le voisinage du siège du gouvernement lui imposerait une administration plus équitable. Mais rien ne pouvait corriger la nature originellement mauvaise du Dalmate ; il opprima les ressortissants de son nouveau gouvernement comme ceux de l’ancien, et appela sur lui la colère du sultan, qui, dans cette circonstance, donna une nouvelle preuve de ses sentiments d’inflexible justice, en le faisant exécuter, bien qu’il fût son beau-frère (4 moharrem 931 – 1er novembre 1524). » Hammer cite encore le rapport de l’ambassadeur vénitien Piero Bragadino, datant de 1526 : « Ferhad bassa fu cugnado del Sgr., mediante la moie e la madre sostenuo, ha perso il Ghazali, Alaeddule [Schehzouwar] sua moglie sorella del Signor belissima donna vestita di negro » : Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 5 p. 31, voir également p. 67-68 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 31 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 156. 47
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 16 ; Havva Koç, « Mustafa Paşa (Çoban) », OA : t. 2 p. 309 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 33-34 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 155-156. 48
Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 32 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 155. 49
Turan, « The Marriage of Ibrahim Pasha » : 24-25. 50
Pour le profil des gendres de Süleyman Ier, voir les articles de Peirce et Turan : Peirce, « The family as faction » ; Turan, « The Marriage of Ibrahim Pasha » : 24-25.
Page | 137
démontrer que ce mariage – très controversé – n’avait pas eu lieu51
. D’autres exemples
viennent cependant soutenir cet argument. Après l’exécution d’Ibrahim Pacha, Süleyman
chercha un nouveau grand vizir sur lequel se reposer. Cette recherche prit quelques années, au
cours desquelles les individus se succédèrent à ce poste. Parmi eux, on trouve l’époux d’une
de ses sœurs : Lütfi Pacha, mari de Şah Sultane, rappelé à la capitale et nommé vizir de la
coupole, peu de temps avant sa promotion au grand vizirat ; il ne dut la perte de son poste et
sa défaveur qu’à sa conduite irrespectueuse envers son épouse52
. Quelques années après, le
poste de grand vizir fut de nouveau accordé à un gendre impérial : l’époux de la fille de
Süleyman, Rüstem Pacha53
. Celui-ci fut d’ailleurs le second grand vizir à avoir tenu cette
place pendant plus d’une décennie sous le règne de ce sultan, après Ibrahim Pacha. Puis,
pendant les deux ans de sa retraite forcée à la suite de l’exécution du prince Mustafa, il fut
remplacé par un autre gendre impérial : Kara Ahmed Pacha, second époux de la sœur du
sultan, Hafsa Sultane54
.
3. Un autre modèle de transition : le cas des descendantes indirectes
(mi-XVe – mi-XVI
e siècle)
L’étude des alliances matrimoniales des descendantes indirectes des sultans du XVe
siècle se révèle un exercice ardu : au silence très généralisé des sources s’ajoute les
contradictions de l’historiographie, qui fournit des renseignements le plus souvent
invérifiables. À une exception près, les cas connus correspondent tous à des mariages noués
autour des descendantes indirectes du sultan Bayezid II55
, soit entre la fin du XVe et le début
du XVIe siècle. Le phénomène s’explique : avant cette période, les filles de sultan étaient
mariées généralement à des princes étrangers ; de ce fait, elles étaient amenées à quitter les
51
Turan, « The Marriage of Ibrahim Pasha ». Voir aussi, Nigâr Anafarta, « Makbul İbrahim Paşa Kanuni’nin Damadı mıydı ? », Hayat Tarih Mecmuası 8 (Eylül 1966) : 75-76 ; Adnan Giz, « Makbul İbrahim Paşa’nın Damatlığı Meselesi », Resimli Tarih Mecmuası IV/48 (décembre 1943) : 2793-2794 ; İsmail H. Uzunçarşılı, « Kanunî Sultan Süleyman’ın Veziriâzamı Makbul ve Maktul İbrahim Paşa Padişah Damadı Degıldi », Belleten XXIX/114 (Nisan 1965) : 355-361. 52
Özcan, « Lutfi Paşa » ; Imber, « Lutfi Paşa »; Gökbilgin, « Lûtfi Paşa » ; Köprülü, « Lutfî Paşa »; Necipoğlu, The Age of Sinan : 293 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 32-33 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 153-154. 53
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 25-26, t. 5 p. 1402 ; Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 5 p. 151-152 ; Franz Babinger, « Mihr-i Mâh Sultan », EI (2) : t. 7 p. 6-7 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 38-39 ; Necdet Sakaoğlu, « Mihrimah Sultan », OA : t. 2 p. 213-214 ; idem, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 187-191 ; Murat Belge, « Rüstem ve Mihrimah », Tarih ve Toplum VII/37 (Ocak 1987) : 29-37 ; Baysin, « Mihrümah Sultan », İA : t. 8 p. 307-308. 54
Müjdat Uluçam, « Ahmed Paşa (Kara) », OA : t. 2 p. 149 ; Cavid M. Baysun, « Ahmad Pasha », EI (2) : t. 1 p. 291 et « Ahmet Paşa », İA : t. 1 p. 193. 55
L’arbre généalogique de la descendance indirecte de Bayezid II se révèle particulièrement complexe : celui-ci avait en effet donné naissance à un nombre impressionnant de filles (et de fils) qui, mariées, eurent leur propre descendance. Dans certains cas, il nous a été possible de reconstituer leurs généalogies jusqu’à la troisième génération, c’est-à-dire jusqu’aux arrières petits-enfants du sultan. Nous disposons ainsi d’un vaste tableau généalogique pour cette période cruciale qui engendre une transformation des pratiques dynastiques. Cf. Annexes B.7.
Page | 138
territoires paternels et à construire une vie et une famille dans leur principauté d’accueil. Les
enfants issus de ces mariages sortaient donc du cadre ottoman pour faire partie de la parenté
de l’époux de la princesse. Dès lors, ce n’est qu’à partir du moment où la pratique de marier
les filles de sultan à l’étranger disparaît que les unions de leurs propres descendantes
commencent à être connues56
. Si le résultat et la chronologie générale suivent le modèle
maternel, dans le détail, les phases et les pratiques ne coïncident pas totalement. L’évolution
semble avoir suivi un schéma simplifié en deux temps.
Arbre généalogique 2.16. Les mariages des descendantes indirectes de Bayezid II
Le premier temps montre l’application d’une pratique de mariages endogamiques au
sein de la parenté ottomane. La descendance de Fatma Sofu Sultane (probablement avec
Hasan Bey) en constitue une bonne illustration. Elle eut au moins un fils et une fille, qui tous
deux épousèrent des descendants de lignées princières : Mehmed fut en effet marié à une fille
du prince Alemşah57
, tandis que sa sœur, dont le nom ne nous est pas parvenu, épousa un
certain Ahmed Bey, appartenant au lignage de la princesse Ayşe Sultane (épouse de Güveyi
Sinan Pacha)58
. De même, les deux princes Şehinşah et Abdullah contractèrent-ils une
56
Quand bien même aurions-nous trouvé des renseignements concernant les alliances des descendantes des filles de sultan mariées à des princes étrangers, que nous n’en aurions pas fait usage dans ce chapitre : aussi intéressants qu’elles puissent être, ces unions n’appartiennent pas à notre cadre d’étude (limité à la compréhension du fonctionnement du groupe des princesses au sein de la société ottomane). 57
Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 26 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 145. 58
Uluçay, qui fournit ces renseignements, ne semble pas avoir fait le lien familial : il mentionne en effet que la fille de Sofu Fatma Sultane épousa Ahmed Bey, fils de Ali Bey, fils de Mesih Pacha. Or, ailleurs, il avait également indiqué qu’Ali Bey fils de Mesih Pacha avait lui-même épousé une princesse : une fille de Ayşe Sultane et Güveyi Sinan Pacha répondant au nom de Kamerşah. Tout semble pourtant indiquer qu’il s’agit du même Ali Bey : Ahmed Bey, époux de la fille de Sofu Fatma Sultane, serait donc issu du lignage de la princesse Ayşe Sultane par sa mère. Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 25-26.
Page | 139
alliance entre leurs deux familles, le fils du premier, Mehmed, épousant la fille du second
(Aynişah, à moins qu’il ne s’agisse de sa sœur, Şahinşah)59
. Il en va encore de même du fils
du prince Ahmed, Alaeddin, qui prit pour femme une fille de la princesse Aynişah60
.
Cette pratique d’alliances entre les lignages princiers ottomans semble correspondre à
une adaptation du système matrimonial antérieur, à savoir des alliances entre les dynasties. On
se rappelle en effet que la descendance masculine du couple Selçuk Hatun (fille de Mehmed
Ier) – İsfendiyaroğlu Ibrahim Bey avait contracté des mariages, sur plusieurs générations,
avec la dynastie ottomane (en l’occurrence, des filles de sultan). Ce cas montre bien
l’existence du principe de patrilinéarité selon lequel les enfants issus du couple sont des
İsfendiyaroğlu, donc des princes étrangers, malgré leur parenté biologique avec la famille
ottomane. En ce sens, il est normal que les stratégies matrimoniales reproduisent le modèle
paternel d’unions interdynastiques (malgré l’existence d’une consanguinité des époux). Cet
exemple, un des rares cas documentés du genre, montre l’absence d’interdit de mariage entre
parents biologiques appartenant à des lignées différentes. Si l’hypothèse d’une antériorité de
ces pratiques d’endogamie au sein d’un ensemble de familles princières par rapport aux
pratiques d’endogamie au sein même de la parenté ottomane se confirmait, il faudrait y voir
un renfermement fort intéressant de la parenté ottomane sur elle-même.
Toutefois, les lignées princières ne mirent pas longtemps à s’ajuster aux pratiques
matrimoniales des sultans et sultanes : la grande majorité des alliances contractées pour les
petites-filles de Bayezid II fut réalisée avec les nouveaux personnages centraux de l’État, les
kul. Les alliances matrimoniales nouées autour des filles de la princesse Ayşe Sultane et du
beylerbey Sinan Pacha attestent largement de cette volonté : sur cinq filles connues, trois
furent mariées à des fils de pacha, eux-mêmes membres de l’administration provinciale –
ainsi que l’atteste leur titre de bey – et une à un pacha. Ayşe épousa Dukakinzade Ahmed
Pacha ; Gevherşah, Ibrahim Bey, fils d’un certain Ömer Bey ; enfin Kamerşah et une autre,
dont le nom ne nous est pas parvenu, furent toutes deux données à des fils du puissant Mesih
Pacha, Ali Bey et Ahmed Bey61
. La fille de Gevherimülûk, Neslişah, fut elle aussi mariée à un
bey (Iskender)62
, de même que deux filles de Selçuk Sultane : Neslişah avec Yunus Pacha
(puis avec un certain Mehmed Çelebi) et sa sœur, avec un fils d’Halil Pacha63
. Les exemples
continuent avec la fille d’Aynişah, mariée à Bali Bey64
; les deux filles du prince Ahmed
mariées, la première (Fatma) au fils de Davud Pacha, Mehmed Bey65
, la seconde (Kamer) à
un Mustafa Bey, fils de Mehmed Çelebi66
; ou encore les filles du prince Kasım et du prince
Mahmud, Fatma Hanzade et Ayşe, mariées respectivement à Mehmed Bey67
et Ferruh Bey68
.
59
Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : note 5 p. 25. 60
Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 24-25. 61
Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 25-26 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 142-143. 62
Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 26-27 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 146. Ce dernier précise d’ailleurs que cet İskender Bey appartiendrait à la famille des Dukakinzade. 63
Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 28 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 144. 64
Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 24-25 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 143. 65
Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : note 2 p. 26. 66
Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : note 2 p. 28. 67
Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : note 2 p. 26. 68
Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : note 2 p. 25.
Page | 140
Bien qu’antérieur, il faut encore rapprocher de ces exemples le cas du mariage de la fille de
Selçuk Hatun (fille de Mehmed Ier) et d’İsfendiyaroğlu Ibrahim Bey, Hatice, qui épousa un
gouverneur ottoman, un certain Mahmud Bey ou Çelebi, fils de Koca Mehmed Pacha69
. Soit,
au total, treize alliances contractées entre les descendantes indirectes des sultans et les
membres de l’administration impériale, au tournant du XVIe siècle, contre quatre avec des
membres de la parentèle ottomane.
La majorité de ces époux appartiennent néanmoins au rang de bey et sont, pour un
grand nombre d’entre eux, des fils de pacha. Ces gendres bénéficient d’un statut triplement
particulier : dignitaires de l’État par eux-mêmes, ils sont également gendres princiers – ce qui
présentait certainement des avantages pour leur carrière – et fils de dignitaires (pachazade),
dont on se demande s’ils étaient considérés comme des kul du sultan ou non. Malgré leur
alliance avec la dynastie, peu d’entre eux parvinrent aux postes les plus élevés dans
l’administration impériale : faut-il y voir le signe d’une politique impériale visant à leur
interdire de trop grandes promotions ou simplement la cause d’un surnombre de parents par
alliance qui ne permettait pas de placer tout le monde à des hauts postes de commandement ?
On notera l’institution d’un ordre symbolique entre les filles de sultan, mariées aux pachas, et
les petites-filles, mariées aux beys, qui va de pair avec une hiérarchie organisée selon le degré
d’appartenance à la dynastie, dont il a été question précédemment70
.
3. La reproduction du système (mi-XVIe siècle – mi-XVIII
e siècle)
Si les destinées maritales des filles de sang et des descendantes indirectes des
princesses suivirent une chronologie différente au cours de la période de transition (mi-XVe –
mi-XVIe siècle), le phénomène ne fut que temporaire : le “retard” des secondes fut rapidement
rattrapé et, dès la moitié du XVIe siècle, on ne repère plus qu’une seule règle d’alliance
matrimoniale, valable pour toutes les princesses : l’alliance avec les kul. Cette stabilité
n’empêche pas de s’interroger sur l’existence éventuelle de tendances ou préférences
particulières. En effet, des données telles que la démographie et l’apparition du système du
séniorat, la montée en puissance de nouveaux acteurs politiques, ou encore la recherche
d’intimité viennent peser sur le système des alliances matrimoniales, lui apportant quelques
modifications significatives.
La fin du XVIe siècle se place sous le signe de la continuité directe avec le système
matrimonial établi sous le règne de Süleyman Ier. Ses successeurs suivent très
scrupuleusement le modèle des alliances privilégiées entre le sultan et ses principaux officiers
du gouvernement : les « piliers de l’État » sont les principaux candidats à l’honneur du
damadlık impérial, avec une préférence toute particulière pour le détenteur de l’office de
69
Les dates fournies par la documentation (qui ne sont pas les dates de mariage) laissent entendre que sa fille vécut sous le règne de Bayezid II. Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 11-12 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 78-88. 70
Cf. Chapitre 1.I.1. et 1.I.2.
Page | 141
grand vizir, de l’amirauté, de l’aga des janissaires et, plus généralement, des vizirs de la
coupole71
. Le grand vizir, quel qu’il soit, est un partenaire matrimonial particulièrement
recherché par la dynastie et quiconque souhaitait s’élever à cette place augmentait ses chances
d’y parvenir en épousant une princesse. Le tableau suivant permet de s’en rendre compte.
Tableau 2.17. Nombre des gendres impériaux au sein du groupe des vizirs (de Süleyman Ier à Ahmed Ier)72
Gendres impériaux (+ époux
de descendantes indirectes) non dâmâd-ı şehriyârî
Grands vizirs
15
(dont 3 mariés à des
descendantes indirectes)
14
Vizirs
10
(dont 2 mariés à des
petites-filles de sultan)
35
Pourtant, une modeste spécificité surgit au cours de la seconde moitié du XVIe siècle. Les
sultanes mariées aux grands vizirs furent systématiquement les aînées des princesses, filles
d’haseki : Ismihan Sultane sous Selim II, Ayşe Sultane sous Murad III. Les mariages
successifs de cette dernière sont le signe de cette préférence en faveur de l’aînée des filles :
elle fut mariée, tour à tour, à trois grands vizirs successifs – Ibrahim Pacha, Yemişçi Hasan
Pacha puis encore Güzelce Mahmud Pacha73
. Le récit qu’en fait Naima montre d’ailleurs la
corrélation étroite entre l’obtention du grand vizirat et de la main de la princesse :
« La nouvelle de la mort d’Ibrahim Pacha arriva au Seuil de la Porte le 21 juillet
1601. Le sceau de l’Etat fut confié au kaymakam Yemişci Hasan Pacha et l’on émit
un firman illustre lui enjoignant de gagner Belgrade au plus vite. Le ministre
susdit mit vingt jours à prendre la tête du gouvernement ; la tente et le pavillon du
précédent serdar, toutes ses affaires, ses bagages et ses armes, ses chameaux et
ses mules lui furent remis en présent. Il fut même marié à sa veuve, Ayşe
Sultane. »74
De façon générale, cette période inaugure un phénomène de mise en avant des filles nées des
haseki, qui se lit dans le fait que ce sont elles qui sont mariées aux plus hauts officiers de
l’Empire (de préférence), ceux qui détiennent les principales charges. Et c’est bien Süleyman
Ier qui initia ce phénomène, à l’occasion de la triple cérémonie organisée lors du mariage de
ses trois petites filles Ismihan, Gevherhan et Şah : la première fut mariée au futur grand vizir,
Sokollu Mehmed Pacha ; la seconde, à l’amiral de la flotte, Piyale Pacha ; enfin la troisième à
l’aga des janissaires, Hasan Pacha75
.
71
Voir les arbres généalogiques présentés en annexes B.9 à B.17. 72
Pour réaliser ce tableau, nous avons fait usage des listes de vizirs fournies par Hasanbeyzade dans sa chronique, à la fin de chaque règne, et nous les avons comparées avec les indications dont nous disposions concernant les gendres impériaux. Cf. Hasanbeyzade, Hasan Bey-zade tarihi : t. 2 p. 166-169, 402-406 ; t. 3 p. 768-774, 900-904. 73
Voir l’arbre généalogique de Murad III : Annexes B.11. 74
İpşirli (éd.), Tarîh-i Na’îmâ : t. 1 p. 179. Annexes C.12. 75
Peirce, The Imperial Harem : 68 et « The family as faction » : 106-107.
Page | 142
Enfin, les réalités démographiques font que les sultanes de cette période sont
régulièrement mariées par un autre que leur père. Le mariage simultané des trois filles aînées
de Selim II eut lieu sous le règne de leur grand-père ; après quoi, elles contractèrent de
nouvelles unions, sous le règne de leur frère, Murad III76
. Quant aux filles de Murad III, elles
furent mariées et remariées sous le règne de leur frère, Mehmed III, certaines même durant le
gouvernement de son successeur, Ahmed Ier (leur neveu)77
. Le long règne de Süleyman Ier
semble avoir déstabilisé la courbe démographique dynastique : jusque-là, les sultans
montaient sur le trône relativement jeunes et laissaient, à leur mort, des enfants encore
adolescents. Mais Süleyman régna sur une très longue période et, à sa mort, son héritier, d’âge
mûr, avait déjà un fils capable de lui succéder et des filles établies chez leur mari. Dès lors, au
cours des règnes suivants, les sultanes sont très majoritairement mariées par leur frère. Si un
tel cas de figure n’était pas inconnu de l’histoire ottomane, sa récurrence à partir de la seconde
moitié du XVIe siècle renforce l’idée d’un sultan chef de famille, décidant des alliances de
l’ensemble des filles de sang, qu’il s’agisse de ses sœurs aussi bien que de ses nièces, voire de
ses petites-filles.
La première moitié du XVIIe siècle renforce encore la prépondérance des filles
d’haseki. Celles-ci sont non seulement mieux mariées, mais aussi un plus grand nombre de
fois : Ayşe Sultane eut six époux successifs, sa sœur Fatma, sept. Toutes deux étaient les filles
de la favorite puis reine mère régente, Kösem Valide Sultane78
. Toutefois, les réalités
démographiques mirent fin à cette pratique. Turhan Hadice Sultane, belle-fille de Kösem
Sultane, ne mit au monde qu’un fils, Mehmed IV. Par la suite, ce dernier eut bien une
favorite, Gülnüş Emetullah Sultane, qui donna naissance à deux jumeaux (appelés tous deux à
monter sur le trône, Mustafa II et Ahmed III), mais pas de filles79
. L’usage extensif des filles
d’haseki dans la conclusion des alliances matrimoniales disparut ainsi de lui-même et les
pratiques se lissèrent naturellement.
Au cours de cette première moitié du XVIIe siècle, une autre modification, plus
durable, apparaît : la multiplication des mariages des princesses. Au début du XVIIe siècle, la
mort de Mehmed III porte sur le trône un adolescent, Ahmed Ier. La dynastie connaît
rapidement un déficit en sultanes à marier, que la naissance de filles du nouveau souverain
promet de compenser. Mais celles-ci ne sont encore que des enfants ; or, confrontée à de
graves crises politiques avec la rébellion des celali et l’affaiblissement du pouvoir dû à la
76
Ismihan épousa Kalaylikoz Ali Pacha en 1584 ; Şah, Zal Mahmud Pacha en 1575 ; Gevherhan, Boyalı Mehmed Pacha en 1578 ou 1579. Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 40-42 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 198-202. 77
Les deux aînées, filles de la favorite, semblent avoir été les seules à être mariées sous le règne de leur père : Ayşe épousa Ibrahim Pacha, son premier mari, en 1586 ; Fatma, Halil Pacha en 1593. Elles furent cependant remariées sous celui de leur frère, de même que leurs demi-sœurs. Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 45-46 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 214-218. 78
Voir l’arbre généalogique d’Ahmed Ier : Annexes B.12. Nous avons également noté ce phénomène au niveau des rétributions financières auxquelles elles avaient droit, légèrement supérieures à celles de leurs demi-sœurs : cf. 1.I.2.2. 79
Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 65-66 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 266-274. Ce dernier laisse cependant entendre que l’aînée des filles de Mehmed IV, Hadice Sultane, pourrait bien avoir été la fille de sa haseki (bien que rien ne vient le confirmer) : id., p. 276.
Page | 143
jeunesse du souverain80
, la dynastie a besoin de renouveler ses liens avec sa classe dirigeante :
elle ne peut se permettre d’attendre des années que les filles du sultan aient atteint la puberté.
C’est dans ce contexte que les premières fiançailles de princesses-enfants apparaissent. Les
mêmes tensions se répètent tout au long de la première moitié du XVIIe siècle, de sorte qu’on
prend l’habitude de faire appel aux princesses déjà présentes sur le marché matrimonial – les
filles d’Ahmed Ier (qui connaissent ainsi des mariages à répétition), tout en continuant, en sus,
de marier les filles des sultans régnants dès leur plus jeune âge81
. La pratique du kafes, qui nie
aux princes le droit d’engendrer, jusqu’au jour de leur propre montée sur le trône, vient encore
accroître le déficit en princesses à marier82
. La situation est paradoxale, avec des sultans
intronisés à des âges mûrs, mais sans enfant. Ils n’ont d’autre choix, dans un premier temps,
que de faire appel à leurs sœurs et/ou nièces pour créer des alliances matrimoniales, jusqu’à
ce que leurs filles (l’âge infantile passé) puissent être utilisées à cette fin. L’empressement que
les sultans montrent à marier leurs filles, quand ils pourraient se satisfaire des alliances créées
autour de leurs parentes83
, indique bien la valeur particulière accordée à l’alliance directe avec
le sultan régnant : du vivant de leur père, les filles d’un sultan bénéficient d’un surcroît de
valeur sur le marché matrimonial.
La conséquence de ces crises dynastiques fut donc de marier des filles tout juste
sorties de la période infantile à des dignitaires de l’État d’un âge déjà bien avancé.
L’abaissement de l’âge au premier mariage des princesses permit, à la suite, la multiplication
de leurs unions. Au XVIe siècle, les sultanes semblent avoir été mariées aux alentours des
quinze – dix-sept ans ; aux XVIIe et XVIII
e siècles, ce sont des enfants de trois à cinq ans que
l’on fiance ! Certes, il ne s’agit que de fiançailles, le mariage effectif devant attendre que la
princesse ait atteint la puberté – quand encore l’époux n’était pas exécuté entre temps. Les
chroniques ottomanes nous livrent alors des récits d’un ridicule avoué, qui mettent en scène
de vénérables vizirs à la barbe déjà bien blanchie présentant leurs respects et offrant à leur
fiancée en cadeaux… des habits pour enfant !84
Entre le mi-XVIIe et le mi-XVIII
e siècle, peu de nouvelles modifications apparaissent.
Contrairement à la période précédente, la dynastie rétrécit le champ des candidats susceptibles
de devenir gendres impériaux. Les proches et intimes sont favorisés et sollicités pour jouir de
cet honneur. Plusieurs musahib sont ainsi appelés à devenir gendres impériaux. L’exemple le
plus significatif de cette politique est celui fourni sous le règne d’Ahmed III. Après quelques
essais infructueux, le sultan trouva son champion en la personne de Nevşehirli Ibrahim Pacha,
son favori de longue date, qu’il promut au poste de grand vizir après l’avoir marié à sa fille
aînée, Fatma Sultane. Par la suite, loin de vouloir équilibrer la puissance de ce grand
80
Halil Inalcık, The Ottoman Empire. The Classical Age, 1300-1600, Londres, Phoenix, 1974 : 41-52. Sur les celali, voir notamment l’étude de William J. Griswold, The Great Anatolian Rebellion, 1000-1020 / 1591-1611, Berlin, K. Schwarz, 1983. 81
Uluçay, Harem II : 92-93. Cf. Annexes B.12 à B.14. 82
Inalcık, The Ottoman Empire : 60. 83
Ainsi Ahmed III, qui a pourtant déjà élaboré plusieurs alliances entre la dynastie et son élite militaro-administrative grâce aux mariages de ses nièces, montre néanmoins un empressement certain à marier sa fille aînée, Fatma Sultane, avec son grand vizir. 84
Voir notamment la liste des cadeaux offerts par Kara Mustafa Pacha à son épouse-enfant : Antoine Galland, Voyage à Constantinople (1672 – 1673), Paris, Maisonneuve et Larose, 2002 : 188-189.
Page | 144
personnage, il choisit au contraire de renforcer son pouvoir en multipliant les alliances entre la
famille impériale et celle du grand vizir. Ainsi, des « sept vizirs de la coupole, […] cinq
étaient gendres du sultan, entre autres le fils et les deux neveux du grand vizir, et les deux
autres gendres de ce dernier »85
. On remarquera qu’il s’agit là d’un retour aux pratiques mises
en place par Süleyman Ier, au XVIe siècle, qui avait lui aussi cherché à s’entourer d’intimes.
Aucune de ces subtiles modulations d’une même pratique ne se retrouvent dans les
mariages des descendantes indirectes des sultans. Le modèle d’époux recherché pour les
petites-filles ou arrières petites-filles de sultan est celui des pachas (généralement de moindre
importance) ou, à défaut, des beys. Il faut y voir une part de reproduction du système
parental : les filles sont mariées selon le même modèle que leurs mères. Toutefois, l’absence
de distinction de statut entre les époux des filles et les époux des petites-filles de sultan n’est
pas sans surprendre. Si toutes étaient mariées à des pachas, comment établir la différence de
statut entre la mère et la fille ? La chose n’était pas évidente ; néanmoins, on constate que les
pachas / époux des descendantes indirectes appartiennent rarement au plus haut cercle des
dignitaires (vizirs et grands vizirs). Il s’agit, en quelque sorte, de pachas de second rang. Par
ailleurs, ceux-ci ne sont jamais mentionnés comme damad-ı şehriyârî. À ce propos,
soulignons que ces mariages sont rarement notés dans les chroniques, preuve qu’ils ne sont
pas considérés comme des événements politiques majeurs et il faut aller les chercher, le plus
souvent, dans les sources non officielles.
*
L’étude des mariages des princesses ottomanes laisse apparaître une rupture profonde
qui survient dans la seconde moitié du XVe siècle. Cette rupture indique un changement de
règle : au lieu d’alliances préférentielles exogames et isogames, on opte pour des unions de
type hypogamiques. Désormais, les époux des princesses sont placés dans une subordination
formelle à l’égard de leurs épouses. La pérennité et la portée dynastique de cette
transformation sont exemplaires. Pérennité historique, car une fois établie, la nouvelle
pratique ne connaît plus que des évolutions mineures. Il s’agit de modulations plus que de
modifications de la règle : abaissement de l’âge des princesses au premier mariage,
multiplication des unions, renforcement du caractère intime de ces alliances, tous ces aspects
ne sont jamais que de sensibles inflexions d’un même modèle. La même étude effectuée sur
les siècles ultérieurs ferait probablement ressortir d’autres évolutions tout aussi mineures86
. Le
modèle établi entre la fin du XVe et le début du XVI
e siècle se maintint jusqu’à la fin de
l’Empire.
85
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 14 p. 108. 86
Olivier Bouquet avait également remarqué la présence, par intermittence, d’une recherche d’intimité dans les alliances matrimoniales des princesses ottomanes du XIX
e siècle. Conférence réalisée à l’IFEA dans le cadre
du séminaire « Les femmes dans l’Empire ottoman », le 1er
février 2010, intitulée « Les damad impériaux : comment en écrire l’histoire ? » . Vidéoconférence disponible en ligne à l’adresse suivante sur le site de l’IFEA : http://www.ifea-istanbul.net dans la rubrique des conférences en ligne.
Page | 145
La portée dynastique de ce modèle est également remarquable, car il s’applique très
rapidement à l’ensemble des princesses, aussi bien filles de sultan que descendantes
indirectes87
. Par ailleurs, le parallèle entre les pratiques matrimoniales mises en œuvre dans le
cas des mariages des membres féminins de la dynastie (les princesses) et les unions des
membres masculins (sultans et princes) est flagrant et suit une chronologie similaire. Pendant
toute la période allant de la naissance de la dynastie à la moitié du XVe siècle, les sultans et
princes ottomans contractèrent des unions avec des princesses étrangères issues des dynasties
voisines ; après quoi, ils s’en remirent à l’usage unique du concubinage, c’est-à-dire à des
unions avec des esclaves88
. Il existe cependant une différence notable entre les pratiques
matrimoniales des membres masculins de la dynastie et celles des princesses : dans le cas des
premiers, elles n’impliquaient pas l’institutionnalisation de l’union par le mariage. Qu’un
sultan entretienne des relations de concubinage avec une esclave n’est, en soi, pas bien
surprenant89
; qu’il marie sa fille, une princesse dont la supériorité du statut social est
exacerbée par tous les moyens dont la dynastie dispose, avec un de ses kul est déjà plus
exceptionnel. La pérennité de cette règle suppose néanmoins l’incapacité de la famille
régnante à s’y soustraire et si la pratique eut ses avantages (sur lesquels nous allons bientôt
revenir), elle condamna néanmoins ses utilisateurs à sa répétition sans fin. Osman II montra
bien des velléités de résistance en prenant pour épouse la fille du cheikh-ul-islam : bien mal
lui en prit ! Le fait est en effet cité parmi les causes de la colère des janissaires qui entraîna
une révolte, dont les conséquences furent des plus funestes (destitution puis assassinat du
jeune sultan)90
.
87
On peut cependant s’interroger sur la pérennité de ce modèle au cours des générations descendantes : certes, il apparaît dans notre étude qu’il se répète sur plusieurs générations ; mais jusqu’à quel point ? Les informations collectées n’ont pas permis de répondre à cette question de façon plus détaillée. Des recherches ultérieures pourraient permettre de statuer sur le sujet. 88
Le concubinage était déjà largement pratiqué par les membres masculins de la dynastie, en parallèle des unions officielles. Cependant, ce n’est qu’à partir du milieu du XV
e siècle qu’il s’imposa comme l’unique
système matrimonial. Sur ce sujet, voir notamment Alderson, The Structure of the Ottoman Dynasty : 85-100 ; Uzunçarşılı, Saray Teşkilâtı : 283-284 ; Peirce, The Imperial Harem : 28-56 ; Dumas, « Des esclaves pour époux ». 89
Il existe cependant quelques exceptions : certains sultans épousèrent leur concubine esclave. Ce fut le cas notamment de Süleyman Ier avec sa favorite Hürrem, puis de Selim II avec Nurbanu, ou encore d’Ibrahim avec Telli Haseki. Safiyye Sultane, concubine de Murad III, aurait également tenté de se faire épouser du sultan, mais sans succès. Peirce, The Imperial Harem : 61-63 ; Pedani, « Safiye’s Household » : 17-19. 90
Vatin et Veinstein, Le sérail ébranlé : 221-240. Sur le règne d’Osman II, voir notamment Baki Tezcan, The Second Empire, Political and Social Transformation in the Early Modern World, Cambridge, Cambridge University Press, 2010 : 115-152.
Page | 146
II. DES STRATÉGIES MATRIMONIALES À ÉCHELLES
MULTIPLES
Dans une de ses nombreuses contributions, Bourdieu montrait que si le mariage arabe
traditionnel est considéré comme la règle chez les Kabyles, celle-ci n’est cependant appliquée
que dans un faible nombre de cas. Non que ces familles la rejettent, mais elle apparaît comme
une pratique idéale qu’il n’est cependant pas toujours possible ni souhaité d’appliquer. Il
rappelait ainsi la nécessité de compléter les approches structuralistes par l’étude des stratégies
des agents du marché matrimonial91
. La remarque s’applique pleinement dans le cas d’étude
présent, car comment expliquer la transition des pratiques matrimoniales mise en valeur dans
la partie précédente, si ce n’est en posant la question des stratégies mises en place par les
acteurs du marché matrimonial ? Poser la question des enjeux des stratégies matrimoniales
revient à historiciser ces mariages, à les contextualiser. Cela implique également de dépasser
le cadre de l’événementiel pour voir comment l’événement s’inscrit de façon plus profonde
dans tout un réseau de dépendances et d’alliances, mais aussi d’oppositions et de conflits. Or,
ce réseau peut et doit être étudié selon plusieurs niveaux d’analyse. Le sultan qui marie sa fille
à son grand vizir procède à une action qui peut se lire comme l’expression d’une relation
(dont la nature doit être définie) entre deux individus, mais également comme la
démonstration d’une autre relation, cette fois entre plusieurs groupes (alliance entre la
dynastie et les kul, qui créée nécessairement des exclus – les oulémas notamment). Et que dire
lorsqu’il s’agit non plus de la fille d’un sultan, mais d’une descendante indirecte ?
Le contexte des unions des princesses ottomanes doit se comprendre à l’aune d’une
double analyse : une première lecture consiste à observer la manière dont ces mariages
s’insèrent dans une structure politique complexe et mouvante. La dynastie ottomane construit
son pouvoir et redéfinit régulièrement ses alliés et soutiens : l’usage des mariages des
princesses s’insère dans cette ronde des pouvoirs. Il faut donc procéder à une étude de nature
politique de ces unions, en tenant compte aussi bien du contexte international qu’interne à
l’État. La seconde lecture se détache des motifs supérieurs (la politique dynastique) pour
étudier les retombées attendues du mariage d’une princesse avec un kul. Une telle union
favorisait la constitution de réseaux de clientèle à base familiale. Mais ces réseaux pouvaient
être de nature et d’efficacité variable. Il faut alors procéder à une réinscription des mariages
des princesses ottomanes dans le champ politique interne à l’État ottoman.
91
Pierre Bourdieu, « La parenté comme représentation et comme volonté », dans Esquisse d’une théorie de la pratique, précédé de trois études d’ethnologie kabyle, Paris, Éditions du Seuil, 2000 : 83-215.
Page | 147
1. Le long processus d’affirmation de la supériorité ottomane (XIVe-XV
e
siècles)
Un souverain quel qu’il soit est à la fois le chef (virtuel ou réel) de sa société, le
premier parmi les siens, et un prince au milieu d’autres princes voisins. Sa position, ses actes,
ses décisions se trouvent nécessairement déterminés par cette ambivalence. Les souverains
ottomans n’y firent pas exception. Quelle que soit l’époque à laquelle nous nous plaçons,
leurs décisions (à portée personnelle, familiale ou politique) s’insèrent toujours dans un réseau
complexe d’enjeux internes et externes qui ne sont pas toujours cohérents entre eux. L’étude
des alliances matrimoniales des princesses ottomanes est un cas parmi tant d’autres qui
expriment cette dualité d’intérêts et d’enjeux. Pendant plus d’un siècle et demi, entre le XIVe
et la moitié du XVe siècle, ces mariages obéirent à une real politik qui répondait autant aux
nécessités extérieures qu’aux exigences intérieures, ainsi que nous allons le voir en détail.
L’une des spécificités de la dynastie ottomane réside dans le fait d’avoir trouvé une pratique
originale qui permettait de répondre à tous ces enjeux en même temps.
1. S’imposer sur la scène internationale par le jeu des alliances
« Le mieux, cependant, est toujours de s’attacher les royaumes par les liens de ses
propres enfants », conseillait Charles Quint à son fils Philippe II dans son « testament
politique »92
. On ne saurait mieux mettre en évidence l’inscription de ces unions dans une
« économie d’échanges réciproques entre monarques européens, qui permettaient le maintien
de relations diplomatiques et de rapports pacifiques »93
. Lucien Bély a par ailleurs montré le
rôle et la portée des unions matrimoniales interdynastiques dans la création d’un vaste réseau
politico-diplomatique à l’échelle européenne94
. Dans les premiers temps, les Ottomans firent
un usage assez similaire des alliances matrimoniales nouées autour des membres de la
dynastie, notamment grâce aux unions des princesses. Nous savons que jusqu’au milieu du
XVe siècle, les sultans montrèrent une préférence en faveur des unions contractées avec des
représentants des dynasties régnantes voisines. Il s’agit maintenant d’en comprendre l’usage
politique et symbolique.
Cette préférence reflète la volonté des souverains ottomans de s’inscrire dans un jeu
d’alliance de niveau international (interdynastique). L’enjeu est de taille : il s’agit, par la
présence même dans ce système d’échange, d’afficher sa valeur, son rang, le prestige de la
dynastie. Pour cela, il fallait l’acceptation des autres acteurs de ce système (les autres
dynasties environnantes), c’est-à-dire que ceux-ci consentent à prendre femme chez les
92
Cité par Bennassar, Le lit, le pouvoir et la mort : 39. 93
Isabelle Poutrin et Marie-Karine Schaub (éds.), Femmes et pouvoir politique. Les princesses d’Europe, XVe-
XVIIIe siècle, Rosny-sous-Bois, Bréal, 2007 : 30.
94 Bély, La société des princes.
Page | 148
Ottomans ou à en donner95
. Dans un premier temps, il semble que les Ottomans n’aient été en
mesure de remplir qu’une partie de ce cahier des charges. Les premiers mariages
interdynastiques furent conclus pour le souverain ottoman lui-même, puis très vite en faveur
de ses fils, les princes, mais sans don de femme dans l’autre sens : la dynastie ottomane se
retrouvait en position unique de donataire, ce qui le plaçait en situation d’endettement vis-à-
vis des dynasties donneuses de femmes. Le fait est que, sur l’ensemble de la période des
mariages interdynastiques, les sultans reçurent plus souvent des épouses qu’ils n’en donnèrent
à leurs voisins96
.
Coïncidence ou reflet d’une réalité politique ? Il est bien difficile de le savoir :
contrairement aux Européens, qui écrivirent des lettres ou des mémoires, produisirent des
traités politiques, en un mot livrèrent leurs pensées et préoccupations en la matière, tels
Charles Quint ou Louis XVI dans ses Mémoires97
, les Ottomans gardèrent le silence le plus
total à ce sujet. Y eut-il des projets de mariage ayant échoué ? Quelles furent les raisons qui
les motivèrent à marier leurs filles à tels princes plutôt que tels autres ? Les chroniqueurs ne
fournissent pas la moindre indication. Seule mention est faite du mariage – et encore, dans ce
cas, peut-on s’estimer heureux lorsque le nom de l’épouse est précisé. En l’absence
d’éclaircissements de la part des Ottomans eux-mêmes, il ne nous reste que la connaissance
des mariages effectivement conclus – en tout cas ceux dont le souvenir a été gardé dans les
chroniques. Autrement dit, bien peu de choses. Si cela ne nous permet pas d’éclairer l’état
d’esprit ni les motifs conscients des acteurs au moment de leur conclusion, c’est tout de même
suffisant pour fournir quelques éléments de réflexion.
Le système d’échange de femmes repose sur un double principe d’alliance et de
rivalité98
. Rivalité entre les divers partenaires potentiels du réseau d’échange, mais aussi
rivalité entre les alliés par mariage. Lorsque Marie de Médicis choisit de marier son fils, Louis
XIII, à Anne d’Autriche, c’est par souci de décorum : ce mariage permettait à la France de se
déclarer de nouveau l’égale de l’Espagne, de réaffirmer sa position dans le réseau des
alliances internationales européennes99
. Le choix des époux dans telle dynastie plutôt que telle
autre avait des impacts multiples : il invitait les deux dynasties à mener une entente amicale ;
il signifiait aussi à l’ensemble du réseau la puissance (momentanée ou plus durable) de la
dynastie alliée ; mais il pouvait aussi entraîner des rancœurs, voire signifier un changement
d’orientation politique d’un des partenaires, forçant l’ensemble du réseau à réévaluer sa
politique générale au vu de cette nouvelle donne. L’entrée de la dynastie ottomane sur le
95
Mauss, Essai sur le don : 66, 131, 147-151. 96
Alderson, The Structure of the Ottoman Dynasty : tables XX à XXVIII. Le phénomène est particulièrement visible dans les alliances des premiers souverains, notamment Orhan, Murad Ier et, plus qu’aucun autre, Bayezid Ier. 97
Il accorde un long développement pour expliquer les manigances auxquelles il se livra pour assurer le mariage de Charles II d’Angleterre avec l’infante du Portugal : Louis XIV, Mémoires suivis de Manière de montrer les jardins de Versailles, Cornette (éd.), Paris, Éditions Tallandier, 2007 : 86-90. 98
Mauss, Essai sur le don : 121, 139-143, 147-157. 99
Elle remettait ainsi en cause les projets de son défunt époux, Henri IV, lequel avait annoncé qu’il considérait « plus utile à un grand roi de prendre des alliances avec les princes ses inférieurs, capables de s’attacher à ses intérêts, qu’avec d’autres qui fussent en prétention d’égalité ». Cité par Bennassar, Le Lit, le Pouvoir et la Mort : 54.
Page | 149
marché matrimonial international, dès le règne d’Orhan, peut ainsi se lire comme une forme
de reconnaissance de l’importance qu’elle était parvenue à acquérir100
. Cependant, les
difficultés des souverains ottomans à marier leurs filles en retour laissent entendre que leur
position était encore fragile, car le don d’une femme constitue une démonstration de
pouvoir101
.
Il fallut un certain temps à la dynastie ottomane pour parvenir à placer ses femmes sur
le marché matrimonial interdynastique. À notre connaissance, la première fut Nefise Melek
Hatun, fille de Murad Ier : son père et son grand-père avaient déjà conclu de nombreuses
alliances interdynastiques pour eux-mêmes ou leurs fils à ce moment102
. Plusieurs décennies
s’écoulent encore avant que d’autres alliances soient de nouveau nouées autour des filles des
souverains ottomans. C’est surtout au début du XVe siècle que la pratique de marier les
princesses ottomanes aux princes étrangers s’applique de façon régulière103
. Plus d’un siècle
sépare ainsi l’entrée sur le marché matrimonial international des hommes de la dynastie et des
princesses ottomanes. Entre-temps, la Maison d’Osman s’est imposée comme un acteur
puissant et stable dans la région. Elle n’est plus une famille relativement obscure, fraîchement
apparue sur la scène internationale, mais le socle d’un État solide et redouté104
.
Les mariages des princesses ottomanes furent contractés pour l’essentiel avec deux
dynasties : les İsfendiyaroğlu (eux-mêmes issus des Candaroğlu) et les Karamanoğlu –
auxquelles s’ajoutent de façon épisodique les Timourides et les Akkoyunlu105
. Il s’agit là de
quatre grandes dynasties, particulièrement importantes sur l’échiquier politique anatolien. Les
Karamanoğlu se présentent comme les principaux adversaires des Ottomans pour la
suprématie en Anatolie pendant la période allant du mi-XIVe au mi-XV
e siècle. Dans les
100
Orhan aurait ainsi épousé une fille d’Andronic III, empereur byzantin (qui prit le nom d’Asporça Hatun), et une autre princesse byzantine du nom de Théodora ou Maria, fille de l’empereur Jean VI Cantacuzène et de l’impératrice Irène. Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 4-5 ; Alderson, The Structure of the Ottoman Dynasty : table XXII ; Bryer, « Greek Historians on the Turks ». Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si ces alliances ont été conclues avec la dynastie byzantine, mais cela reflète au contraire les intérêts réciproques (bien que divergents) des deux parties. Les Byzantins avaient en effet besoin de l’aide militaire des Ottomans, lesquels trouvaient dans ces alliances une marque de prestige. 101
Mauss, Essai sur le don : 147-153 ; Godelier, L’énigme du don : 59-62, 69, 80-82. 102
Hormis les alliances d’Ohran, discutées plus haut, citons également le mariage de Murad Ier avec la sœur du souverain bulgare, Tamara ou Mara, en 1376. Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 4-5 ; Alderson, The Structure of the Ottoman Dynasty : table XXII et XXIII. 103
Les unions des filles de Mehmed Ier avec les dynasties des İsfendiyaroğlu et des Karamanoğlu ont fait l’objet d’un long développement. Rappelons simplement que seule une fille de Bayezid Ier, Oruz semble-t-il, fut mariée à un prince étranger, un timouride ; cependant, cette union est postérieure au règne de son père. Il en a déjà été question plus haut. 104
Fort des avancées réalisées sous le règne de son père, Murad Ier, le règne de Bayezid Ier représente, en effet, la première tentative de transformation de l’État ottoman en Empire. La défaite de celui-ci en 1402 face à Tamerlan et les guerres fratricides qui s’ensuivirent ne fragilisèrent que temporairement le pouvoir ottoman, qui se releva rapidement dans la région. De fait, les Ottomans étaient réellement une puissance considérable dès cette époque. Cf. Inalcık, The Ottoman Empire : 9-22. 105
Sur ces dynasties, cf. John E. Woods, The Aqquyunlus. Clan, Confederation, Empire, Minneapolis / Chicago, Bibliotheca Islamica, 1976 ; Sapancalı Hüsnü, Karamanoğulları. Hayât ve Vakâyi’ Tarihiyyeleri, N. Topal (éd.), Konya, Kömen Yayınları, 2010 ; İsmail H. Konyalı, Abideleri ve Kitabeleriyle Karaman Tarihi, Istanbul, Baha matbaasi, 1967 ; İsmail H. Konyalı et al., Karaman Tarihi ve Kültürü, Konya, Karaman Valılığı, 2005 ; Beatrice F. Manz, The Rise and Rule of Tamerlan, Cambridge, Cambridge University Press, 1999 ; Jean-Paul Roux, Tamerlan, Paris, Fayard, 1991.
Page | 150
premiers temps, les deux dynasties rivales ne furent pas en voisinage immédiat, mais leur
expansion territoriale et prétentions réciproques sur l’Anatolie en firent des opposants
naturels, ainsi que le montrent les nombreux conflits qui les opposèrent106
. Le contexte dans
lequel ces mariages furent élaborés en traduit clairement les objectifs : ils apparaissent lors de
conclusion de paix, à l’issue d’un conflit armé entre les deux puissances – que les chroniques
ottomanes présentes comme autant de victoires de leurs armées. Le “don” de la princesse
ottomane au “vaincu” prend alors un double sens : d’un côté, il s’agit d’une démonstration
publique de la puissance ottomane, la princesse étant “imposée” à l’époux vaincu – elle joue
tout à la fois le rôle d’épouse, d’espion placé au cœur de la cour ennemie, et de garante du
maintien de la paix107
; d’un autre côté, elle tient également une place de modérateur.
L’existence même du mariage montre une certaine volonté de créer des liens sinon pacifiques,
du moins apaisés entre les deux familles108
, via la médiation de la nouvelle épouse. La
réouverture régulière des hostilités montre que cette solution ne fut pas couronnée de succès.
Les alliances avec les autres familles princières révèlent des stratégies politiques
différentes. Le mariage d’une fille de Bayezid Ier (1389-1402) avec un petit-fils de
Tamerlan109
implique une reconnaissance de la puissance timouride sur les Ottomans, ou du
moins de leur place importante sur l’échiquier politique anatolien du début du XVe siècle. Ce
mariage fut conclu, imposé peut-être, après la défaite de Bayezid Ier contre Tamerlan,
pendant la période d’interrègne qui s’ensuivit entre ses fils110
. Mehmed Ier inaugure une autre
stratégie politique d’alliance matrimoniale, en mariant sa fille, Selçuk Hatun, à l’un des
descendants de la famille İsfendiyaroğlu. Cette union paraît relativement inhabituelle dans la
mesure où la dynastie İsfendiyaroğlu, voisine directe des Ottomans, ne constituait pas un réel
danger pour ces derniers : elle était une vassale relativement fidèle111
. Mais il faut tenir
compte du fait que les İsfendiyaroğlu étaient les descendants de la Maison Candaroğlu,
longtemps considérée comme la plus puissante et florissante d’Anatolie : la dynastie était
couverte d’un lustre ancien qui n’était peut-être pas pour déplaire aux Ottomans.
106
Inalcık, The Ottoman Empire : 14-15, 19-21. 107
C’est, à peu de choses près, la situation qui s’imposa à François Ier, prisonnier de Charles Quint qui le contraignit à épouser sa sœur, Eléonore, veuve du roi du Portugal. Cf. Bély, La société des princes : 218-220. 108
Alain Caillé rappelle l’importance de cet aspect du don et de l’alliance : « rien n’est plus précieux que l’alliance scellée par le don puisque c’est elle qui permet le passage, toujours révocable, de la guerre à la paix et de la défiance à la confiance. » : Caillé, Anthropologie du don : 10. 109
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 2 p. 53 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 75. Uluçay ne donne aucune information concernant son mariage : Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 9 ; Alderson, The Stucture of the Ottoman Dynasty : table XXIV. 110
Bayezid Ier, défait, fut fait prisonnier : Tamerlan décida de l’emmener avec lui à Samarkand (mais le souverain ottoman décéda sur le chemin). Il s’ensuit plusieurs années de querelles et guerres entre les fils de Bayezid Ier et pour récupérer les territoires paternels. Sur ce sujet, voir notamment l’étude de Kastritsis, The Sons of Bayezid. 111
On rappellera cependant que Mehmed Ier était l’un des prétendants au trône ottoman après la défaite de Bayezid Ier à Ankara ; or, pendant cette période de crise, l’ensemble des beylicats turcomans d’Anatolie avait regagné leur indépendance : Mehmed Ier avait ainsi dû composer avec les revendications de ses voisins, dont les İsfendiyaroğlu. La vassalité de cette dynastie ne lui paraissait dès lors peut-être pas si bien acquise.
Page | 151
Autre cas de figure, le mariage de la fille de Mehmed II, Gevherhan Sultane, avec un
prince Akkoyunlu, Uğurlu Mehmed112
. Plus de trente ans séparent le règne de Mehmed Ier et
celui de Mehmed II et la puissance ottomane s’est depuis largement imposée sur la majeure
partie de l’Anatolie : les İsfendiyaroğlu ont été assimilés, les Karamanides ont disparu ; le
seul ennemi qui se dresse encore dans la région face au conquérant de Constantinople est
Uzun Hasan, de la famille des Akkoyunlu, qui ont succédé à la branche timouride établie dans
cette région113
. Plusieurs batailles eurent lieu entre les deux puissances, sans réel dénouement,
si ce n’est la reconnaissance implicite de leurs frontières respectives114
. C’est dans ce contexte
qu’Uğurlu Mehmed, fils d’Uzun Hasan, se présenta à la cour ottomane, à la suite de l’échec
de sa révolte contre son père115
. Uğurlu avait toutes les chances d’y trouver le soutien et l’aide
dont il avait besoin pour reprendre le combat, tandis que Mehmed II pouvait espérer, grâce à
lui, affaiblir ou du moins inquiéter son ennemi. Pour raffermir cette alliance naturelle, le
sultan ottoman décida de marier son “invité” à l’une de ses filles, mais Uğurlu Mehmed
décéda peu de temps après son mariage116
.
Les sources garderaient-elles intentionnellement le silence sur d’autres alliances,
antérieures, moins glorieuses ? Il n’est évidemment pas possible de répondre à cette question,
mais l’hypothèse est envisageable. On se rappelle que le nombre de princesses mentionnées
dans les chroniques, pour les périodes les plus reculées, était étonnamment faible. Certes, il
est toujours possible d’envisager une descendance moins importante chez les premiers
souverains ottomans, mais le phénomène ne paraît pas de façon flagrante pour la descendance
masculine, ce qui amène à douter d’une telle explication. En revanche, il n’est pas
inconcevable de penser que les chroniques aient passé sous silence l’existence d’un certain
nombre de princesses dont le mariage n’était pas assez glorieux, ou la princesse trop effacée,
pour mériter de figurer dans les annales ottomanes117
. Après tout, les chroniques ne sont
jamais que des compilations des événements principaux et marquants du règne des sultans
ottomans – dont la sélection est laissée à la discrétion des auteurs118
. On notera encore
l’absence quasi généralisée de mariages croisés, si souvent pratiqués dans les cours
européennes. Seule la dynastie İsfendiyaroğlu fut l’objet d’un tel type d’alliance : Murad II
épousa la fille de son voisin tandis qu’il lui envoyait sa propre sœur119
. L’inexistence d’une
réciprocité des échanges de femmes est surprenante et amène à s’interroger sur le sens et la
112
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 15, t. 4 p. 1076 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 21 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 132-133. 113
Woods, The Aqquyunlus. 114
Inalcık, The Ottoman Empire : 28 ; Woods, The Aqquyunlus : 99-137. 115
Woods, The Aqquyunlus : 135-137. 116
Woods, The Aqquyunlus : 136. 117
Ainsi, les documents d’archives ont révélé l’existence d’une fille d’Osman, totalement inconnue des récits narratifs, mais dont le nom apparaît dans une vakfiyye. Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 3 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 34. 118
Il existe une littérature fortement utile pour apprendre à décoder le langage des chroniques ottomanes. Voir notamment Sılay, « Ahmedî’s History of the Ottoman Dynasty » ; Ménage, Neshri’s History of the Ottomans et « The Beginnings of Ottoman Historiography » ; Lewis, « Ottoman Observers of Ottoman Decline » ; Howard, « Ottoman Historiography and the Literature of ‘Decline’ » ; Fleischer, Bureaucrat and Intellectual ; İnalcık, « The Rise of Ottoman Historiography » et « Tursun Beg ». 119
Neşrî, Cihânnümâ : 265-266.
Page | 152
valeur amicale placée dans ces mariages. Les sultans cherchaient-ils vraiment à créer des
amitiés et alliances durables avec leurs voisins ?120
2. Une distribution triangulaire du pouvoir
L’historiographie accorde une place très minime aux mariages des princesses
ottomanes avec des représentants de familles soumises à l’autorité du sultan. Ces alliances
sont citées de façon anecdotique, sans plus de réflexion quant à leur raison d’être. Le fait est
que ces cas sont problématiques à bien des égards. Comment expliquer qu’une fille de
Mehmed Ier, Fatma Hatun, épousa un membre d’une grande famille d’ouléma (Mahmud
Çelebi issus des Çandarlızade)121
, pendant que sa sœur était mariée à Karaca Pacha122
– un kul
semble-t-il ? Pour comprendre ces alliances méconnues, à une période antérieure à
l’application de la règle préférentielle envers les kul, il faut en fait renverser la question :
plutôt que de s’interroger sur le « qui épouse-t-on ? », il faut partir du « qui n’épouse-t-on
pas ? ».
Si l’on regarde de près l’appartenance sociale des gendres impériaux “internes” à
l’Empire, un phénomène d’exclusion apparaît. Parmi les diverses catégories de personnages
puissants de cet Empire, il en est une avec laquelle la dynastie ne conclut pas d’alliances : ce
sont les familles de l’élite militaire héréditaire (tels les Evrenosoğulları ou les Mihailoğulları).
Il s’agit là, pourtant, de familles particulièrement puissantes et qui ont contribué à l’expansion
ottomane – bien qu’on puisse s’interroger sur la réalité de leur lien de dépendance envers la
dynastie régnante. De fait, c’est bien là que semble résider le nœud du problème. Puissantes,
très autonomes, fortement marquées par le principe d’hérédité, ces familles ont su constituer
de véritables domaines sur lesquels ils exercent leur pouvoir de façon très indépendante –
quand bien même les histoires de règne ultérieures voudraient nous faire croire en leur
soumission totale envers le sultan ottoman123
.
Feridun Emecen rappelle la prudence avec laquelle aborder les déclarations des
chroniqueurs ottomans sur des sujets aussi sensibles :
« L’organisation de la famille ottomane dans la seconde moitié du XVe siècle,
rapportée par des histoires rédigées, pour la plupart de leurs écrivains, près de 100-
150 ans après les événements, donne une image d’une dynastie sans alternatives ; 120
Peirce avait conclu pour sa part que la dynastie ottomane conservait une méfiance forte envers ceux-ci, qui expliquait, selon elle, la politique de reproduction des sultans avec des concubines plutôt qu’avec leurs épouses officielles. Les sultans auraient choisi de n’avoir de descendance que de leurs concubines esclaves, afin de se protéger contre d’éventuelles ingérences politiques extérieures qui n’auraient pas manqué de se produire si des princes ottomans, fort de leur ascendance, avaient pu aller réclamer de l’aide auprès des dynasties voisines. Peirce, The Imperial Harem : 39-42. 121
Neşrî, Cihânnümâ : 267. 122
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 38. Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 11-12 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 78-87. Des explications sur l’identité de la princesse épouse de Karaca Pacha sont fournies en note 28 p. 10. 123
Murphey, Exploring Ottoman Sovereignty : 45-56.
Page | 153
malgré le zèle [de ces écrivains], les informations qu’ils fournissent insistent sur
une présentation qui met l’accent sur l’immutabilité de sa légitimité ; or, il faut
accorder une place à l’existence, dans les premiers temps, de grandes familles bien
enracinées qui pouvaient être des concurrentes de la famille ottomane. Ces rivales
sont [les descendants] des compagnons d’Osman Bey, qui agissaient comme
arbitres dans les affaires gouvernementales, assumaient des offices variés, et
étaient parvenus à stabiliser leur pouvoir sur le long terme. Les premiers signes de
conflit entre la Maison ottomane et les familles de cette sorte apparaissent sous le
règne de Bayezid Ier. Il fallut attendre le règne de Mehmed II pour que la famille
ottomane puisse en faire totalement abstraction. »124
Jusqu’à la seconde moitié du XVe
siècle, les Ottomans se trouvent en effet en
compétition avec de nombreuses familles, certaines qui se sont imposées comme rivales
extérieures (les İsfendiyaroğlu, les Karamanoğlu, les Akkoyunlu, les Timourides, etc.) et
d’autres, plus ou moins soumises au souverain ottoman. De fait, il n’est pas inutile de rappeler
qu’à l’origine, Evrenos ou Mihail sont des compagnons, et non des vassaux, des souverains
ottomans. C’est à ce titre qu’ils ont acquis une part du butin de guerre – des terres notamment.
La volonté des souverains ultérieurs de faire reconnaître à ces familles une allégeance à la
dynastie ottomane était certes une étape essentielle pour renforcer la mainmise et le contrôle
de son territoire ; elle n’en était pas moins problématique : il s’agit là d’un véritable bras de
fer entre la dynastie ottomane et les héritiers de ses premiers compagnons de guerre. De fait,
la dynastie ottomane ne pouvait assurer son pouvoir et sa supériorité autrement qu’en
rabaissant le prestige de ces familles, qui elles-mêmes ne pouvaient accepter la chose de façon
aussi évidente que les chroniques voudraient nous le faire croire.
Les enjeux relatifs aux mariages des princesses ottomanes s’en trouvent mieux
éclairés. Dans la compétition entre grandes familles anatoliennes, les Ottomans devaient faire
front tout à la fois contre des prétentions externes et internes. L’alliance matrimoniale entraîne
nécessairement des liens de dépendance réciproque, mais sonne également comme une
démonstration de pouvoir et, en même temps, d’amitié. En choisissant de s’allier par les
femmes avec les familles régnantes voisines, les Ottomans et leurs alliés s’auto-
reconnaissaient implicitement comme des égales. Selon la même logique, s’allier avec les
familles militaires internes à l’État aurait entraîné automatiquement une forme de
reconnaissance de leur puissance, situation qui se serait révélée dangereuse pour la dynastie et
qui allait à l’encontre de sa propre stratégie de distanciation. On ne peut se prétendre
supérieure aux autres (au niveau interne) et accepter en même temps de s’allier avec des
familles dont la puissance menace sa propre autorité ! Ceci explique l’absence de mariages
avec des représentants des familles militaires issues des compagnons des premiers Ottomans.
Mais comment expliquer alors la présence d’alliances avec des familles internes
appartenant à l’élite religieuse ? Pourquoi ces familles, qui bénéficiaient de l’ancienneté du
lignage et d’une aura particulière, du fait de leur rôle spirituel et religieux, ne furent-elles pas
perçues comme des rivales potentielles au même titre que les familles militaires ? Leur rôle au
124
Emecen, Hanedan, Devlet ve Toplum : 39.
Page | 154
sein de l’État ottoman naissant ne fut pas des moindres, puisque c’est chez elles que les
souverains ottomans allèrent chercher les cadres de leur administration125
. L’explication
pourrait résider dans le type de relation qui les unissait avec le pouvoir dirigeant. Les oulémas
s’inscrivaient, en effet, dans un lien de dépendance relativement fort envers la dynastie : ils
étaient à son service, sous son autorité directe. Ainsi la famille si puissante des Çandarlı, qui
donnèrent plusieurs grands vizirs à l’État : parce qu’ils étaient au service de l’État, dont le
chef suprême était le souverain, ils demeuraient sous l’autorité directe de la dynastie qui,
théoriquement, pouvait choisir de s’en débarrasser si besoin était126
. Enfin, ces familles
d’oulémas ne disposaient pas de force militaire propre. Elles ne présentaient dès lors pas le
danger de s’autonomiser par la force, voire de se rebeller manu militari contre l’autorité
souveraine.
La dichotomie entre alliances internes et externes, pertinente à certains égards, a le
désavantage de cacher le principe général qui sous-tend, à notre avis, l’ensemble des unions
réalisées par le moyen des princesses. Le découpage chronologique élaboré a les mêmes effets
négatifs : il tend à opposer une pratique marquée dans le temps à une autre, qui lui succède.
Vu dans son ensemble, le principe général élaboré par la dynastie est celui d’une longue
politique de distanciation de la famille ottomane des autres. Il nous faut repenser les stratégies
matrimoniales nouées autour des princesses ottomanes selon une approche sociohistorique. Si
l’on admet l’hypothèse que le système complexe des alliances matrimoniales des princesses
ottomanes des XIVe – XV
e siècles relève d’une manœuvre (planifiée ou non par les acteurs)
d’affirmation de la supériorité de la Âl-i ‘Osman, il faut alors admettre le corollaire à cette
tactique, à savoir une politique de redéfinition profonde du réseau des interdépendances entre
les groupes dominants dans et hors le domaine ottoman. Nous nous rapprochons, par une telle
hypothèse, des propos de Norbert Elias dans La société de cour, qui voyait dans l’organisation
de la société française de l’Ancien Régime l’existence d’un rapport de force structuré entre les
différents groupes dominants, dont l’antagonisme devait et était entretenu par le roi, grâce à la
curialisation127
. Entendons-nous bien : il ne s’agit pas de reproduire tels quels les propos
125
Irène Beldiceanu-Steinherr, « Les débuts : Osmân et Orkhân », dans Histoire de l’Empire ottoman, R. Mantran (dir.), Paris, Fayard, 1989 : 15-36 ; Nicolas Vatin, « L’ascension des Ottomans (1362-1451) », dans Histoire de l’Empire ottoman, R. Mantran (dir.), Paris, Fayard, 1989 : 37-80 ; Halil İnalcık, « Learning, the Medrese and the Ulema », dans The Ottoman Empire. The Classical Age, 1300-1600, Londres, Phoenix, 1974 : 165-172. 126
C’est d’ailleurs ce qui arriva, sous le règne de Mehmed II. Sitôt Constantinople conquise, il s’empressa de se débarrasser du grand vizir hériter de son père, Candarlızade Halil Pacha, qui avait eu l’heur de provoquer le rappel de son père au trône, mettant fin ainsi à sa première expérience à la tête de l’Empire. Cf. Franz Babinger, Mahomet II, le Conquérant et son temps, 1432-1481. La grande peur du monde au tournant de l’histoire, Paris, Payot, 1954. 127
« L’antagonisme existant entre les groupes sociaux dominants est donc, en premier lieu, le résultat de la différenciation des fonctions sociales qui a renforcé le pouvoir d’une bourgeoisie d’offices et d’administration à côté de celui, traditionnel, de l’aristocratie foncière et militaire. Mais cette rivalité, condition même du pouvoir absolu, peut et doit être perpétuée par le souverain qui, en jouant successivement un groupe contre l’autre, reproduit « l’équilibre des tensions » nécessaire à la forme personnelle du monopole de domination. D’où, dans un premier temps, l’affermissement parallèle de l’État monarchique et de la bourgeoisie robine, à qui sont réservées les charges de justice et de finance pour faire pièce aux prétentions nobiliaires. D’où, ensuite, la volonté royale de protéger et de contrôler tout à la fois l’aristocratie, contrepoids indispensable à la puissance officière. Pour ce faire, la cour devint l’institution essentielle : d’une part, elle garantit la surveillance par la proximité, et donc, assure le contrôle du roi sur ses plus dangereux concurrents potentiels ; d’autre part, elle
Page | 155
d’Elias ; cependant, la démarche générale ne semble pas dénuée d’intérêt et permet d’éclairer
certains aspects des stratégies matrimoniales des princesses ottomanes. Pour ce faire, il faut
considérer les époux des princesses ottomanes non pas de façon individuelle, mais comme
membres et représentants de groupes dominants. Plusieurs groupes émergent alors, les uns
définis comme alliés, d’autres comme « non épousables ».
Dans un premier temps, soit du XIVe à la moitié du XV
e siècle, trois groupes
dominants peuvent être identifiés : l’élite interne militaire, l’élite interne administrative (les
oulémas, mais également les kul, qui font progressivement leur apparition au cours de la
période) et l’élite externe princière. Or, nous avons noté que si les sultans mariaient
éventuellement leurs filles à des membres de leur administration, ils n’avaient cependant
conclu aucune alliance avec des représentants de l’élite militaire. Aussi bien pour des raisons
de politique interne que d’idéologie dynastique, il était indispensable pour les sultans de
s’imposer au-dessus de cette élite turbulente et potentiellement dangereuse, parce qu’armée.
Pour cela, la dynastie renforça ses alliances avec un autre groupe interne qui pouvait ainsi
faire concurrence à cette élite militaire : l’élite administrative. Mais l’affirmation de la
suprématie du lignage ottoman au sein de ses territoires n’était pas la seule préoccupation des
Ottomans ; au niveau externe, la dynastie devait également s’imposer sur la scène
internationale comme l’égale des grandes familles régnantes de la région. Pour cela, il lui
fallait conclure des alliances matrimoniales avec les dynasties voisines. C’est ce qu’elle fit, en
nombre plus important que les alliances conclues en interne, d’abord en tant que receveurs,
puis en tant que donneurs de femmes. Le déséquilibre entre le nombre des alliances conclues
en interne et en externe est révélateur de l’intérêt et de l’importance que la dynastie avait à
s’imposer comme partenaire politique et allié sur la scène politique internationale. De fait,
c’est ce qui lui permettait, en interne, d’affirmer sa suprématie sur les autres lignages128
.
Ce n’est là, cependant, que la première étape dans la politique ottomane
d’autopromotion dynastique. Le prestige des oulémas pouvait, à terme, devenir un problème
pour la dynastie ; quant aux familles régnantes voisines, elles étaient de dangereuses
concurrentes. L’un comme l’autre de ces groupes se présentaient dès lors comme des rivaux
potentiels de la famille ottomane, à court ou moyen terme129
. Les pratiques matrimoniales des
princesses ottomanes vinrent de nouveau soutenir les intérêts dynastiques. Revenons en effet à
cette transition du milieu du XVe siècle, lorsque la dynastie choisit de s’allier de préférence
avec des kul. Cette nouvelle politique continue de s’inscrire dans le cadre d’une
permet par le jeu des faveurs monarchiques de consolider les fortunes nobiliaires, mises en péril non seulement par la dépréciation monétaire, mais par une éthique économique qui règle les dépenses, non sur les revenus, mais sur les exigences de la condition – ce qu’Elias désigne comme « status-consumption ethos ». La cour est donc une pièce fondamentale dans la stratégie monarchique de reproduction des tensions […] ». Préface par Roger Chartier de Elias, La société de cour : XVII-XVIII. 128
À notre connaissance, il n’existe pas d’unions entre les familles de l’élite militaire ou administrative ottomane et les familles régnantes voisines. On peut ainsi interpréter l’existence de telles alliances pour la dynastie ottomane comme une démonstration de sa puissance et de sa supériorité sur les autres lignages existants sur son territoire. 129
Rappelons ici les conséquences de la défaite de Bayezid Ier face à Tamerlan en 1402 : les dynasties anatoliennes voisines, un temps soumises, s’empressèrent de reprendre leur autonomie et de se proclamer en concurrentes des Ottomans, ainsi qu’il a déjà été mentionné à plusieurs reprises.
Page | 156
démonstration de la supériorité du lignage ottoman. Elle a cependant la conséquence
(anticipée ?) de produire un nouveau rapport de force. Les groupes dominants sont à nouveau
au nombre de trois, mais présentent cependant une variation intéressante par rapport au
schéma antérieur. L’élite princière voisine demeure, mais l’élite administrative ottomane est
cette fois divisée en deux groupes distincts : les grandes familles d’oulémas d’un côté et les
kul de l’autre130
. Mehmed II est d’ailleurs connu pour avoir favorisé cette distinction : c’est
sous son règne en effet que commence à s’opérer une redéfinition des rôles entre ces deux
catégories sociales. Les membres de l’élite religieuse sont écartés des offices administratifs au
profit des kul131
. Cette pratique devint ensuite une règle de conduite sous les sultans suivants.
Or, la politique matrimoniale initiée par ce sultan, puis perpétuée par ses successeurs, repose
sur un unique choix d’alliance avec un de ces trois groupes : les kul. Ceux-ci apparaissent
donc comme l’unique contre-pouvoir aux deux autres.
Le choix des alliances internes avec des kul plutôt qu’avec des princes voisins a fait
l’objet d’explications dans le sens desquelles nous abondons. Peirce interprète cette
préférence comme le reflet d’un choix idéologique : en refusant désormais de s’allier avec les
dynasties voisines, les Ottomans entendraient de la sorte proclamer leur nouvelle supériorité.
De fait, cette politique coïncide avec la proclamation de l’État en tant qu’Empire et la
disparition ou la soumission de la majeure partie des dynasties voisines132
. Au niveau interne,
cependant, le choix matrimonial en faveur des kul ne semble pas avoir fait l’objet de
commentaires : dans les chroniques de règne, tout se passe comme s’il allait de soi et s’était
décidé sans coup férir. Néanmoins, ce choix s’inscrit dans une longue politique de promotion
des esclaves, entreprise de longue date par la dynastie, d’abord pour se constituer une armée
indépendante et soumise (la création des janissaires)133
, puis pour se libérer de la puissance
politique de l’élite religieuse. La politique d’alliances matrimoniales semble en avoir
constitué une étape. Cette étape venait à un moment où les conditions politiques le
130
On note en effet que l’ancienne élite militaire héréditaire des premiers siècles de l’histoire a relativement disparu des acteurs dominants de la politique ottomane, au cours de la seconde moitié du XV
e siècle. C’est là le
résultat de deux phénomènes : la politique menée par Mehmed II d’une part (poursuivie par son fils et successeur Bayezid II) et l’accroissement de la puissance des kul, qui investissent également les positions militaires traditionnelles de ces familles, avec leur insertion à l’intérieur du système du timar. Cf. İnalcık, « The Ottoman Concept of State and the Class System » ; Mehmet İpşirli, « Ottoman State Organization », dans History of the Ottoman State, Society and Civilisation, Ekmeleddin (éd.), Istanbul, IRCICA, 2001 : vol. 1 p. 133-186 ; Gilles Veinstein, « Asker et re’aya : aperçu sur les ordres dans la société ottomane », dans Le concept de classe dans l’analyse des sociétés méditerranéennes, XVIe-XIXe siècles, Actes des journées d’étude, Bendor, 5-7 mai 1977, Nouschi (éd.), Cahiers de la Méditerranée, Nice, 1978 : 15-19. 131
C’est ainsi que, sous le règne de ce sultan, tous les grands vizirs à l’exception de celui hérité du règne de son père furent des kul. Mehmed II avait en effet eu à souffrir de la trop grande puissance de son grand vizir, Çandarlızade Halil Pacha, qui avait ourdi sa destitution lors de sa première montée sur le trône et était le meneur d’une faction opposée à ses intérêts lors des premières années de son second règne. İnalcık, « The Question of the Emergence of the Ottoman State » ; du même auteur, « Mehmed the Conqueror (1432-1481) and His Time », Speculum 35 (1960) : 408-427 ; Babinger, Mahomet II. 132
Peirce, The Imperial Harem : 29-30. 133
« There were, however, powerful factors working in favor of Ottoman unity and the centralized administration. The most potent factor was the Ottoman kul – slave – system. In particular the Janissary corps, whose numbers had risen to six or seven thousand, gave the Ottoman sultan an undisputed superiority over his rivals. In the province the Ottomans created a corps of military administrators of slave origin and an army of sipâhîs, who greatly strengthened the central authority which they represented and which guaranteed their own status. » : Inalcık, The Ottoman Empire : 18.
Page | 157
permettaient : il fallait d’abord qu’il existât des kul au sein de l’administration impériale (et à
un niveau élevé) pour cela. Passe encore de marier une princesse de sang à un kul de haut
rang, mais la mésalliance ne peut aller au point de les unir à des individus subalternes. Les
critiques à peine masquées formulées à la fin du XVIe siècle – soit à une période où le système
était bien établi – contre le mariage des filles de Murad III à des kul de “second rang” (des
beys au lieu de pachas) révèlent bien qu’une trop grande hypogamie était mal acceptée134
. La
seconde moitié du XVe siècle était propice pour cela : l’administration était désormais très
largement entre les mains des kul du sultan et ceux-ci bénéficiaient d’un prestige suffisant, en
tant que principaux dignitaires de l’État, pour paraître dignes de devenir des gendres
impériaux.
L’alliance entre la dynastie et ses kul, exprimée à bien d’autres niveaux, s’est ainsi
renforcée par la création de liens intimes, par l’intermédiaire des mariages des princesses. Les
pratiques matrimoniales en faveur des kul peuvent donc se lire comme une étape dans la
continuité de la politique dynastique générale de renforcement du pouvoir de ce groupe. Les
sultans instituèrent ainsi une distribution tripartite et pyramidale du pouvoir avec la dynastie
et son chef, le sultan, placé au-dessus des deux autres groupes dominants, l’élite d’origine
servile et celle des grandes familles religieuses, engagées dans une compétition relativement
équilibrée. L’élite religieuse, forte de son prestige associé à son rôle spirituel et à
l’enracinement de son pouvoir, voyait sa puissance contrebalancée par l’élite kul qui, à défaut
de pouvoir faire valoir une quelconque ancienneté de ses racines, pouvait s’enorgueillir de son
service au sein de l’État et d’une certaine forme d’anoblissement par l’alliance impériale.
2. « La famille comme faction »135
: alliance, pouvoir et clientélisme
À partir du XVIe siècle, la pratique de marier les princesses ottomanes à des kul s’est
imposée avec une telle force qu’il n’est plus possible, pour les sultans, de ne pas s’y plier. Elle
eut des effets durables, dont l’un des plus connus est l’instauration du factionnalisme136
. Dire
134
D’Ohsson note également la critique : d’Ohsson, Tableau général de l’empire othoman : 195. 135
L’idée de considérer la famille comme une faction n’est pas nouvelle : elle fut déjà développée par Peirce dans un article consacrés aux gendres du sultan Süleyman : Peirce, « The Family as Faction ». Suivant ses traces, Ebru Turan a mené une étude du règne de Selim Ier et de l’usage qu’il fit de ses gendres dans une politique visant nettement à se détacher du poids des anciens grands dignitaires hérités du règne de son père, pour les remplacer par ses propres créatures, favorisant la promotion de ses gendres au gouvernement : Turan, « The Marriage of Ibrahim Pasha». La plupart des historiens s’accordent d’ailleurs pour interpréter l’usage des mariages des princesses ottomanes avec des dignitaires de l’Empire comme un moyen, pour les sultans, de s’imposer au-dessus des factions politiques, représentées par les divers grands officiers de l’État, pachas et vizirs. 136
La question du poids politique des factions a été largement associée à celle de la caractérisation du poids politique des maisons (household), elle-même étroitement liée à la question de la famille, notamment des familles de l’élite. Sur ces sujets, voir notamment les travaux suivants : Metin İ. Kunt, The Sultan’s Servants: The Transformation of Ottoman Provincial Government, 1550-1650, New York, Columbia University Press, 1983 ; Jane Hathaway, « Eunuch Households in Istanbul, Medina and Cairo during the Ottoman Era », Turcica 41 (2009) : 291-304 ; du même auteur, The Politics of Households in Ottoman Egypt: The Rise of the Qazdaglis, Cambridge, Cambridge University Press, 1996 ; Alan Duben, « Household Formation in Late Ottoman Istanbul »,
Page | 158
que le factionnalisme constitue la base du fonctionnement politique ottoman n’a rien de
nouveau : c’est même un fait largement reconnu dans l’historiographie et y compris par les
contemporains eux-mêmes. Le point sur lequel nous aimerions mettre l’accent est la
participation des princesses et des familles princières à la reproduction de ce système. Notre
sentiment va même plus loin : à notre sens, les mariages des princesses au sein de l’Empire et
parmi l’élite kul a favorisé, entre autres causes, l’éclosion de ce système. Quelques exemples
très connus nous invitent d’ailleurs à suivre cette voie : ainsi le frère de Rüstem Pacha (époux
de Mihrimah Sultane, la fille de Süleyman Ier) n’était autre que Sinan Pacha, gouverneur
d’Herzégovine puis amiral de la flotte ottomane137
; un autre de ses parents, son oncle Idris
Ali Efendi, exerça la fonction de cheikh pendant 60 ans138
. De même, au XVIIe siècle, l’époux
d’Hadice Sultane (fille de Mehmed IV), Kara Mustafa Pacha, pouvait-il compter sur le
soutien politique de son propre fils, Mehmed Pacha, qui accéda au poste de gouverneur de la
province de Şehrizor139
; le fils de Sirke Osman Pacha (époux d’Emetullah Sultane, fille de
Mustafa II)140
, Mustafa Bey, suivit lui aussi une carrière prometteuse et qui aurait pu être
brillante, s’il n’avait montré des réticences à quitter la capitale : il fut d’abord kapıcıbaşı, puis
commandant des sipahi, puis mîrimîran, puis mutasarrıf de la province de Maraş avant d’être
démis pour les raisons évoquées, puis finalement nommé kethüda des kapıcıbaşı141
.
Avant d’aller plus loin, un mot sur la méthode employée dans le cadre de ce chapitre
ne semble pas inutile. Tout historien désireux de travailler sur les familles, les maisons ou les
factions des grands personnages de l’Empire ottoman est confronté à un problème de sources.
Les informations, quand elles existent, doivent être cherchées une par une, mises bout à bout,
puis étudiées avec une vision d’ensemble toute relative. Les difficultés d’un tel exercice ont
International Journal of Middle East Studies 22/4 (Novembre 1990) : 419-435 ; Behar et Duben, Istanbul Households ; Meriwether, The Kin Who count ; Ortaylı, Osmanlı Toplumunda Aile ; Vahid Çubuk, Köprülüler, Istanbul, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınevi, 1988 ; Yusuf Küçükdağ, II. Bayezid, Yavuz ve Kanûnî Devirlerinde Cemâlî Ailesi, Istanbul, Aksarayî vakfı yayınları, 1995 ; Necdet Sakaoğlu, Anadolu Derebeyi Ocaklarından Köse Paşa Hanedanı, Ankara, Yurt Yayınları, 1984 ; Franz Taeschner et Paul Wittek, « Die Vezir Familie des Gandarlyzade », Der İslam 21 (1929) : 60-115 ; İsmail H. Uzunçarşılı, Çandarlı Vezir Ailesi, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1974 ; Antonis Anastasopoulos (éd.), Provincial Elites in the Ottoman Empire. Halcyon Days in Crete V. A Symposium Held in Rethymno, 10-12 January 2003, Rethymno, Crete University Press, 2005 ; Colette Establet et Jean-Paul Pascual Familles et fortunes à Damas : 450 foyers damascains en 1700, Damas, Institut Français de Damas, 1994 ; Bouquet, « Famille, familles, grandes familles » et « Comment les grandes familles ottomanes ont découvert la généalogie ». 137
« Sinaneddin Yusuf Paşa. Sadrazam Rüstem Paşa’nın kardeşidir. Enderûn’da yetişerek Hersek sancağıyla çıktı. 955’de (1548) kaptan-ı deryâ olup 961’de (1554) vefat etti. Üsküdar’da, Mihrimah Sultan Camii’nde medfundur. Beşiktaş’ta bir cami ve medrese inşasına başladıysa da 963’de (1556) tamamlandı. Lütfüpaşa’da da bir mescidi vardır. Trablusgard bunun zamanında fetholundu. Vefatına, “Daldı rahmet denizine kapdan” tarihdir. » : Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 5 p. 1515. 138
« İdris Ali Efendi. Tırhalalıdır. İstanbul’a felip Bayramî tarikatine girdi. Amcası Rüstem Paşa’nın terzibaşısı olmakla bu suretle “İdris” adını aldı. 60 sene şeyhlik edip 1024’de (1615) vefat etti. Okmeydanı’nda medfundur. Cezbe sâhibiydi. Sultanselim Çarşısı semtinde evi olup “Hacı Ali Bey” derlerdi. Birkaç defa haccederek Yemen’e gitmişti. Öncelerdi ticaretle Bosna, Rumeli ve Tuna’ya sefer eyledi. Halk, hakkında iki fırka olup kimi sapık ve kimi kerâmet sâhibi derdi. Hatta bazı kürsü şeyhleri küsülerde dinsizliğinden bahsederlerdi. Lâkin bu zat geçerkten ermişlerden ve keşif sahiplerindendir. » : Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 3 p. 791. 139
« Mehmed Paşa. Kara Mustafa Paşa’nın oğlu olup 1079’da (1668/69) Şehrizor beylerbeyi olarak sonra vefat etti. » : Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 4 p. 1031. 140
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 11 ; Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 14 p. 24 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 297-298 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 78. 141
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 4 p. 1144.
Page | 159
été recensées par Metin Kunt : recours aux ouvrages biographiques rarement exempts
d’erreurs ou de confusions ; limites dans les informations fournies par ces sources
(notamment sur la formation ou l’éducation des individus avant leur réussite professionnelle) ;
absence d’une véritable tradition ottomane de rédaction d’ouvrages autobiographiques142
. Et
le nombre des individus concernés n’est pas pour simplifier les choses. La première étape fut
le dépouillement des cinq tomes de notices biographiques rédigées par Mehmed Süreyya143
.
Ce dépouillement devait remplir trois objectifs :
1°) renseigner sur les individus gravitant autour des princesses (descendants, officiers à
leur service ou simples clients) : les informations relatives à ces individus étaient
scrupuleusement notées, fichées, catégorisées.
2°) établir une liste complète des gendres impériaux, en prenant note de façon tout aussi
scrupuleuse de leurs biographies.
3°) dresser un premier inventaire des individus gravitant autour de ces époux, selon un
tableau distinguant les membres de la famille, ceux de la maison, les clients et les
opposants.
Le travail de dépouillement susdit effectué, les tentatives d’exploitation systématique se
révélèrent vite infructueuses. Si un travail prosopographique est possible, nous ne sommes pas
parvenue à trouver la manière de le réaliser. De fait, nous doutons qu’il soit réalisable à
grande échelle. Les informations récoltées sont trop aléatoires pour permettre de connaître de
façon précise le type de lien qui unissait deux individus entre eux (quand ils ne sont pas de la
même famille ou de la même maison). Les renseignements sur les carrières sont incomplets et
ne permettent pas d’en reconstituer le cursus. En fin de compte, la seule chose qu’il nous a été
donné de voir, c’est une arborescence des principaux membres de quelques grandes maisons.
Certaines familles, certaines factions se détachent en effet du lot, sur lesquels nous avons
alors choisi de nous concentrer.
142
Kunt, The Sultan’s Servants : xvi-xxi. On appréciera d’autant plus la valeur de la documentation mise en lumière par Olivier Bouquet, les Sicill-i ahvâl defterleri, qui lui a permis de réaliser un des meilleurs exercices de prosopographie menée dans le cadre des études ottomanes. Cf. Bouquet, Les pachas des sultans : voir notamment les pages 47-106 pour le commentaire détaillé de cette source. Il convient également de citer le très beau travail réalisé sur les oulémas par Madeline C. Zilfi, The Politics of Piety: The Ottomans Ulema in the Postclassical Age (1600-1800). Minneapolis, Bibliotheca Islamica, 1988. 143
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî. L’étendue du travail explique et justifie le recours à Mehmed Süreyya, malgré toutes les critiques, parfaitement justifiées, qui ont pu être effectuées de son travail. Le fait est qu’il arrive que ses notices soient incorrectes (qu’il se trompe, par exemple, en prétendant que tel individu épousa telle princesse) ; il se montre également trop souvent parcimonieux dans les informations qu’il livre ; et sa méconnaissance des périodes les plus anciennes laisse pantois (les XIV
e et XV
e siècles sont très mal
représentés ; seuls les individus les plus puissants sont réellement pris en compte pour le XVIe et même une
partie du XVIIe siècle ; en bref, nous ne sommes bien renseignés que pour les deux derniers siècles de l’histoire
ottomane). Malgré tout, l’ouvrage n’est pas sans avantages : d’abord celui d’être publié en alphabet latin (ce qui facilite grandement le dépouillement des informations en faisant gagner un temps précieux), ensuite d’englober des individus au profil très divers, contrairement à d’autres ouvrages biographiques concentrés uniquement sur les eunuques, sur les grands vizirs ou sur les cheikh-ul-islam. En somme, il se prêtait très bien à un exercice de reconnaissance qui pouvait être complété, pour les individus les plus importants tels les gendres impériaux, par des prospections complémentaires dans d’autres ouvrages.
Page | 160
1. Une faction dominée par le gendre impérial
Le premier cas de figure n’est pas nouveau : dans sa notice biographique consacrée à
Sokollu Mehmed Pacha, Gilles Veinstein notait déjà que « Sokollu n’est pas un homme seul,
comptant sur ses seuls ascendants et habiletés personnels pour asseoir son pouvoir. Très tôt
dans sa carrière, on le voit tisser autour de lui un réseau d’affidés, à base familiale ou du
moins ethnique et régionale »144
. Le grand vizir assura la carrière de pas moins de neuf
membres de sa famille, parmi lesquels ses cousins, ses fils, son gendre et quelques parents
plus éloignés145
. Sokollu Mehmed Pacha instaura ainsi une véritable politique de népotisme
144
Gilles Veinstein, « Sokollu Muhammed (Mehmed) Pasha », EI (2) : t. IX pp. 735-742. 145
1) Mustafa Pacha, son neveu, « à l’éducation duquel il avait personnellement veillé ». Éduqué dans l’Enderûn, il en sort en tant que küçük mirahûr, puis est nommé çakırcıbaşı en 1555, avant d’obtenir la distinction de mîr’ül-ümera. À la fin du règne de Süleyman, au cours de la campagne de Szigetvar – soit dans les premières années du grand vizirat de Sokollu Mehmed Pacha – il reçoit encore le poste de gouverneur de la province de Buda, qu’il conserve jusqu’à sa mort, en 1578, soit durant près de 12 ans. 2) Pendant que Mustafa Pacha était nommé gouverneur de Bosnie, son jeune frère, Mehmed, recevait le sancakbey du même nom. Lui aussi avait profité d’une éducation au sein de l’Enderûn avant d’en sortir comme mîrahûr. Mehmed Süreyya, qui fait pourtant le lien familial avec Sokollu Mehmed Pacha, semble ne pas avoir fait le rapprochement avec le sancakbey de Bosnie et omet toute la période comprise entre sa sortie du Palais et sa nomination au poste de yeniçeri ağası, en 1592. Il ignore ainsi le fait qu’il conserva son poste de sancakbey de Bosnie jusqu’en 1573 (malgré quelques interruptions), date à laquelle il fut nommé précepteur d’un des princes – affectation qui se reflète dans son surnom : il est désormais appelé Lala Mehmed Pacha
145.
Sa promotion sur le devant de la scène politique ne s’arrêta pas en si bon chemin : nommé grand vizir en août 1604, il prit la tête de l’armée envoyée en campagne contre les Safavides peu après. Il mourut au cours de cette campagne, en mai 1606, et fut inhumé à proximité du türbe de son cousin, Sokollu Mehmed Pacha. 3) Un troisième cousin de Sokollu profite encore de son soutien pour accéder à des hautes fonctions : Ferhad Bey, nommé sancakbey de Kilis en 1570, obtint finalement le poste du précédent cousin (Mehmed Bey, devenu Lala Mehmed Pacha), et exerça ainsi la fonction de sancakbey de Bosnie. 4) Le beau-frère du grand vizir ne fut pas non plus oublié. Kara Sinan Bey, qui avait épousé Şemsa, la sœur de Sokollu Mehmed Pacha, est le troisième membre de la famille à briguer le poste de sancakbey de Bosnie, qu’il obtient en 1562. Il se voit ensuite octroyer celui d’Herzégovine à trois reprises (de 1563 à 1567 ; puis de juin à décembre 1569 ; puis de 1574 à 1580). 5) Le jeune frère de Kara Sinan Bey ne fut pas non plus laissé pour compte. Il accède au poste de gouverneur d’Égypte de 1573 à 1575. 6) Cafer Pacha est un cas plus particulier. Éduqué dans l’Enderûn d’où il sort avec le poste de silahdar-ı şehriyârî, il devient l’un des hommes de confiance du grand vizir, partageant avec lui le secret de la mort du sultan Süleyman et participant aux divers stratagèmes mis en place pour retarder le moment de l’annonce de son décès. Peu après, il reçoit la récompense de sa fidélité : il est nommé baş kapıcıbaşı et, très rapidement, yeniçeri ağası. Le grand vizir décida alors de consolider ce lien d’amitié en faisant de lui son gendre. Il accède ensuite au poste de gouverneur de Roumélie, avant de devenir un des vizirs siégeant au Conseil impérial. 7) Kurt Bey, un des fils de Sokollu Mehmed Pacha nés avant son union avec la princesse Ismihan Sultane (fille de Selim II), bénéficie lui aussi du soutien de son père. 8) La situation se répète avec son frère, Hasan Pacha. Il accède au rang de beylerbey sous le grand vizirat de son père et reçoit tour à tour la province de Diyarbekir (1570-71), de Şam (quatre fois), de Bosnie (deux fois) et encore d’Erzurum, d’Anatolie, de Roumélie, de Temeşvar et de Budin. Il accéda finalement au rang de cinquième vizir en 1596-97, puis fut nommé à Belgrade et encore à la tête de la province de Bagdad. 9) Ibrahim Han, fils du couple princier et qui légua son nom à sa descendance (les Ibrahim Hanzade), s’occupa principalement de la gestion des vakf familiaux. Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 3 p. 765, t. 4 p. 1063, t. 2 p. 381 et p. 644 ; Tayyib M. Gökbilgin, « İbrahim Han », İA : t. 5 p. 894-895 ; Veinstein, « Sokollu Muhammed (Mehmed) Pasha ».
Page | 161
grâce à laquelle il pouvait compter sur l’appui de ses alliés pour toutes les affaires touchant la
Bosnie et l’Herzégovine146
, mais aussi au sein même du gouvernement.
La question qui demeure est celle de la place de la princesse, son épouse, dans tout ce
jeu. Celle-ci n’est pas bien grande : Ismihan Sultane ne joue aucun rôle connu dans la
nomination des divers parents de son époux à des postes importants. Il est probable également
qu’elle n’en tire aucun profit politique direct. La faction politique qui se dégage place le
gendre impérial dans le rôle du chef, la princesse n’est elle-même qu’un “pion”
supplémentaire qui vient renforcer les liens avec la dynastie et la propre gloire de celui-ci.
Peut-être, incidemment, la position de la princesse permettait-elle d’appuyer certaines des
décisions de son puissant époux. Toujours est-il que, dans ce cas de figure, la puissance
politique ne réside pas entre les mains de la sultane, mais du pacha. Ceci n’exclut pas le fait
qu’elle sut en faire usage. Le tissu familial tressé par son époux n’était pas sans impact sur sa
capacité d’influence politique personnelle. Prenons un exemple : lorsqu’éclate l’affaire des
dames de compagnie de Catherine de Médicis, Ismihan Sultane fait partie des princesses qui
soutiennent la cause de la mère éplorée. L’intervention réussie de la princesse s’explique en
bonne partie par la puissance de son époux – les plaintes des ambassadeurs français ne font
aucun doute à ce sujet147
. Ainsi, plus la faction politicofamiliale d’un gendre impérial était
étendue et puissante, plus la propre puissance politique de la princesse augmentait –
potentiellement à tout le moins. De sorte que l’alliance nouée à l’occasion du mariage d’une
princesse ne visait pas seulement l’union d’un membre de la dynastie avec un haut
personnage de l’État ; elle visait aussi à s’attacher l’ensemble de la famille de l’époux, de sa
faction politique (et inversement). Quand Ismihan Sultane épouse Sokollu Mehmed Pacha,
elle acquiert l’accès à l’ensemble de ses connexions familiales, une des bases de son pouvoir.
Le choix d’en faire usage est, ensuite, affaire de circonstances et de personnalité.
2. Multiplier les alliances entre deux familles
Un autre exemple de népotisme, encore plus poussé, se dessine sous le grand vizirat de
Nevşehirli Ibrahim Pacha, de 1718 à 1730 – date à laquelle il fut exécuté suite à la rébellion
de Patrona Halil148
. Or, plus encore que son lointain prédécesseur au grand vizirat, Nevşehirli
Ibrahim Pacha se distingua par une tendance très marquée au népotisme, notée par divers
historiens, depuis Hammer jusqu’à Münir Aktepe, auteur de la notice biographique qui lui est
146
Le poste de gouverneur de Bosnie fut conservé entre les mains de son cousin pendant 12 ans ; le poste de sancakbey de Bosnie fut attribué tantôt à l’un, tantôt à l’autre de ses deux autres cousins, tantôt encore à son beau-frère, mais semble être resté majoritairement sous le contrôle d’un membre de sa famille ; quant au poste de sancakbey d’Herzégovine, entre 1563 et 1580, il fut entre les mains de son beau-frère pendant plus de 10 ans. 147
Susan Skilliter, « Catherine de’ Médici’s Turkish Ladies-in-waiting: A Dilemna in Franco-Ottoman Diplomatic Relations », Turcica 7 (1975) : 188-204 ; il en sera question plus en détail dans le chapitre suivant : 4.I.3.3. 148
Cf. notamment Münir M. Aktepe, Patrona İsyânı 1730, Istanbul, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1958.
Page | 162
consacrée dans la Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi149
. Un commentaire de Hammer
permet d’ailleurs de se faire une première idée de la chose :
« De même qu’Ahmed Köprülü, [Ibrahim Pacha] confia aux membres de sa famille
les premières charges de l’empire ; le kapitan pacha et le kiaya beg épousèrent les
filles qu’il avait eues de sa première femme ; son fils et deux de ses neveux, honorés
de la main des filles du sultan, prirent place sous la coupole du divan avec le titre
de vizir. »150
De sorte que, des sept vizirs de la coupole en 1728, cinq étaient liés entre eux par des liens
familiaux. Hormis les membres de cette famille siégeant au Conseil impérial, Ibrahim Pacha
contribua encore à la poursuite de la carrière de plusieurs autres membres de sa famille151
.
La grande différence entre cet exemple et le précédent, c’est la multiplication des
alliances entre le groupe familial placé sous l’égide du pacha et le groupe dynastique : quatre
filles d’Ahmed III furent ainsi mariées à des membres de cette famille. La multiplication des
représentantes de la famille royale a nécessairement été pensée dans le but de renforcer les
liens privés entre ces deux groupes. On pourrait y voir une volonté d’enfermement du sultan
dans ces liens à la fois privés, familiaux et politiques – un enfermement volontaire, peut-on
supposer, qui était en partie compensé par les nombreux autres liens matrimoniaux construits
grâce au mariage de ses autres filles152
. Cette multiplication des liens allait en faveur de la
puissance du pacha ou du sultan – probablement des deux à la fois –, mais pas des princesses :
ce n’était plus une, mais plusieurs sultanes qui incarnaient l’alliance avec la dynastie et
assuraient le contact direct avec le sultan. La multiplication des agents de contact a pour
conséquence de dénaturer la puissance d’intervention de la princesse, qui réside justement
dans sa capacité à assurer le lien entre le sultan et son époux, entre le détenteur de l’autorité
suprême et un de ses agents. De fait, aucune de ces épouses ne brilla par sa présence sur la
scène politique ; Fatma Sultane elle-même, pourtant une figure relativement présente dans les
chroniques et même dans l’historiographie, n’apparaît nulle part comme un personnage
politique autonome153
.
149
Münir M. Aktepe, « Damad İbrâhim Paşa, Nevşehirli », TDVİA 8 : 441-443 ; voir aussi la notice préparée par l’équipe de Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi : « İbrahim Paşa (Nevşehirli Damat) », OA : t. 1 p. 638-640. 150
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 14 p. 119 151
Citons notamment Genç Ali Pacha, son frère ; Hacı Mustafa Bey, fils du précédent et Hafız Mehmed Bey, autre fils de Genç Ali Pacha (on ne connaît malheureusement presque rien de cet individu, sinon son titre qui indique qu’il devait détenir une place non négligeable dans l’administration provinciale de l’Empire ; il mourut en 1763-64 et fut inhumé au tekke de Hüdâî). Voir l’arbre généalogique en annexes B.21. 152
Ahmed III eut en effet plus d’une vingtaine de filles qui furent toutes mariées à de hauts personnages. Même si une préférence nette fut donnée à ce groupe familial, les autres alliances contrebalançaient partiellement la toute-puissance placée dans cette faction. 153
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 14 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 83-85 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 306-311.
Page | 163
3. Des Mihrimah Sultanzadeler aux Cigalazadeler
Les exemples précédents montrent ce qui était probablement la tendance principale de
ces unions. Pourtant, pour faire la part des choses, il faut également tenir compte des cas
irréguliers. L’exemple de la famille de Mihrimah Sultane et Rüstem Pacha révèle une
situation tout à fait contraire à ce que nous venons de décrire.
Rüstem Pacha est loin d’être dénué de pouvoir : il sut se maintenir au grand vizirat
pendant plus de quinze années, au cours desquelles il prit des décisions difficiles, qui eurent
un impact important sur le fonctionnement administratif de l’État ottoman. Mais ce grand
vizir souffre, encore aujourd’hui, d’une image particulièrement négative, relayée par les
chroniqueurs et par l’historiographie : pour tous, il est l’une des trois têtes du triumvirat qui
aurait réussi à circonvenir la puissance de Süleyman Ier, et dont les deux autres membres
n’étaient autres qu’Hürrem Sultane (la favorite du sultan) et Mihrimah Sultane (leur fille et
son épouse)154
. Ce qui nous intéresse ici, c’est l’idée largement acceptée selon laquelle la
puissance de ce grand vizir résidait entièrement, ou presque, entre les mains de ces deux
femmes et notamment de son épouse. Nombreux sont les contemporains, ottomans comme
étrangers, à l’affirmer : le médecin de la princesse alla jusqu’à avancer que le grand vizir et
son frère, le kapudan Sinan Pacha, verraient leur puissance totalement anéantie si celle-ci
venait à mourir155
. L’affirmation est certainement exagérée : le grand vizir s’était distingué
bien avant son mariage avec la princesse ; ses qualités personnelles lui avaient alors valu de
recevoir la main de la fille unique du sultan156
. Cependant, le baile vénitien rapporte
également que, malgré les efforts conjugués de sa femme et de sa belle-mère, il ne parvint
jamais au degré de proximité et de complicité qu’Ibrahim Pacha, un de ces prédécesseurs,
avait entretenu avec le sultan : les quartiers privés de Topkapı lui restaient interdits et c’est la
princesse qui s’y rendait fréquemment, en lieu et place de son époux157
.
La puissance de Mihrimah Sultane s’affiche surtout après la mort de son époux, en
1561. Certains prétendirent qu’elle épousa ensuite son successeur au grand vizirat, Semiz Ali
Pacha ; d’autres que ce fut leur fille, Ayşe ; depuis, il semble établi que le grand vizir,
démarché en ce sens par la sultane, refusa la proposition. De toute évidence, c’est la recherche
de puissance ou, plus exactement, le maintien de sa puissance, qui motiva la princesse à
rechercher une telle union – alors même que le grand vizir en question était « tellement gros
qu’il ne pouvait monter à cheval »158
. De fait, le décès de son mari et l’âge avancé de son père
n’étaient certainement pas pour rassurer Mihrimah, en conflit avec son frère et héritier du
trône, Selim (II). Il fallait renforcer la faction familiale par le jeu des alliances matrimoniales,
en mariant sa fille, Ayşe Sultane. Sa décision s’arrêta sur un personnage prometteur, l’aga des
154
Şinasi Altundağ et Şerafettin Turan, « Rüstem Paşa », İA : t. 9 p. 800-802 ; Tayyıb M. Gökbilgin, « Rüstem Paşa ve Hakkındaki İthamlar », Tarih Dergisi 18 / 11-12 (1968) : 11-50 ; Aydın Topaloğlu, « Rüstem Paşa », OA : t. 2 p. 470-472 ; Colin Woodhead, « Rüstem Pasha », EI (2) : t. VIII p. 640-641. 155
Necipoğlu, The Age of Sinan : 297. 156
Necipoğlu, The Age of Sinan : 297. 157
Rapport du baile Bernardo Navagero en 1553, cité par Necipoğlu, The Age of Sinan : 297. 158
Necipoğlu, The Age of Sinan : 297.
Page | 164
janissaires, Güzelce Ahmed. Celui-ci s’était distingué à ses yeux en intervenant pour éviter le
siège du palais de son époux, à la mort de celui-ci. Le mariage eut lieu très rapidement, dans
la même année (1561)159
: la rapidité d’exécution montre l’urgence dans laquelle se trouvait la
princesse.
Elle ne fut pas longue d’ailleurs à assurer la promotion de son nouveau gendre : il fut
très rapidement élevé au rang de vizir de la Coupole. L’appui que Mihrimah Sultane témoigne
envers son gendre s’étend au-delà du règne de son père : lors de la montée sur le trône de
Selim II, Ahmed Pacha est l’objet des ressentiments du frère envers la sœur ; mais c’est sans
compter sur la puissance de la princesse qui parvint, en un temps record, à le faire réinstaller
parmi les vizirs de la coupole – il conservera la place de second vizir pendant tout le grand
vizirat de Sokollu Mehmed Pacha, pour lui succéder brièvement à sa mort. Malgré l’animosité
du nouveau sultan envers sa sœur, qui entraîna la destitution de son gendre, celle-ci parvint
dans un laps de temps très court à le faire revenir sur sa décision. Il faut convenir dès lors de
la réelle puissance de la princesse qui ne résidait pas dans son seul lien avec son père, ni avec
son époux. Il semble bien que Mihrimah Sultane ait pour le moins partagé la direction de la
faction incarnée par Rüstem Pacha de son vivant, avant d’en reprendre la tête à sa mort.
4. Les alliances des lignages princiers après les secondes générations
Quels étaient les fondements des stratégies matrimoniales appliquées par les
descendants des princesses, passée la seconde génération ? Il est bien difficile de discuter de
la chose, dans la mesure où la constitution d’arbres généalogiques s’est révélée
particulièrement difficile. Quelques familles se distinguent malgré tout, à partir desquelles
nous allons entreprendre cet exercice.
La famille de Mihrimah Sultane est exemplaire, car, exceptionnellement, la
documentation permet de se faire une idée des stratégies matrimoniales au-delà de la
deuxième génération descendante160
. Plusieurs enfants naquirent de l’union entre Ayşe
Sultane et Ahmed Pacha, dont trois filles. Deux d’entre elles furent mariées successivement à
Ciğalazade Sinan (alors Aga, il ne deviendra Pacha que plus tard), qui s’imposa comme l’un
des principaux dignitaires de la période de la fin du XVIe au début du XVII
e siècle : la
première étant morte jeune, sa sœur, Safiyye, la remplaça161
. La persistance de la famille des
Mihrimah Sultanzadeler et de Cigalazade Sinan Pacha à renouer une alliance compromise par
ce décès montre l’importance et le profit que chaque partie entendait tirer de l’autre. Hormis
cette union, une autre fille fut encore mariée à un certain Mahmud, alors kapıcıbaşı. Ne nous
laissons pas abuser par son statut au moment de son mariage : ce Mahmud est décrit par les
159
Necipoğlu, The Age of Sinan : 296-297 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 38-39 ; Babinger, « Mihr-i Mâh Sultan » ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 187-191 ; Cavid M. Baysun, « Mihrümah Sultan » ; Necdet Sakaoğlu, « Mihrimah Sultan », OA : t. 2 p. 213-214. 160
Voir l’arbre généalogique de la famille, annexes B.19. 161
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 7 p. 73 ; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 5 p. 1403 ; les bailes vénitiens rapportent les mêmes informations. Cf. Pedani, « Safiye’s Household ».
Page | 165
sources vénitiennes comme le protégé de la reine mère162
. Pour le couple Ayşe Sultane –
Ahmed Pacha, cette union sonnait comme une seconde victoire : elle consacrait les liens avec
un autre individu appelé à devenir important, fort du soutien de la reine mère163
.
Cet exemple est à l’opposé des stratégies matrimoniales élaborées par la descendance
du couple Ismihan Sultane et Sokollu Mehmed Pacha, qu’un travail comparatif entre la
généalogie conservée par les descendants de la famille elle-même et les documents
historiques avait mises en valeur164
. Au vu de ces travaux, il semblerait que la lignée ait choisi
d’entretenir une double ligne matrimoniale : les fils conclurent des alliances avec des familles
d’oulémas165
, tandis que les filles épousaient des individus d’un rang inférieur au leur, mais
également proches des ‘alim166
. On notera d’ailleurs qu’un certain nombre de ces gendres
étaient des officiers au service de la famille, ce qui représente une pratique courante au sein
des familles d’élite. Néanmoins, ces alliances doivent être considérées avec circonspection
dans la mesure où elles datent d’une période postérieure à la nôtre (XVIIIe-XIX
e siècles). Il
semblerait que ces pratiques matrimoniales étaient courantes chez les descendants des
sultanes des derniers siècles de l’Empire167
.
Un troisième type d’alliance se dessine également : celui des mariages avec des
individus appartenant à des grandes familles de dignitaires (des paşazade), tantôt pachas eux-
mêmes, tantôt simples beys, tantôt extérieurs à l’administration impériale. Un des plus anciens
exemples de ce type est celui du mariage de Mehmed Pacha (fils de Sinan Pacha, qui se hissa
jusqu’au poste de grand vizir) avec la fille de Gevherhan Sultane (fille de Selim II) et Piyale
Pacha168
. C’est encore le cas avec la petite-fille de Mustafa II, Hibetullah Hanım Sultane
(issue du couple formé par Emmetullah et Sirke Osman Pacha), mariée avec Gül Ahmed
Paşazade Ali Pacha169
, et une autre petite-fille de Mustafa II, née de l’union de Safiyye
Sultane avec Mirza Mehmed Pacha, Zahide Hanım Sultane, qui épousa le fils du vizir
Ebubekir Pacha, Süleyman Beyefendi170
.
162
Pedani, « Safiye’s Household » : 18. 163
Nous n’avons malheureusement pas réussi à identifier ce personnage. 164
Bacqué-Grammont, Laqueur et Vatin, Stelae Turcicae II : 48-53. 165
Ainsi trouve-t-on une Zeliha Hanım de la famille des Muhsinzade, une Mihrişah Kadın issue du Palais et une Hafiza, fille d’un ancien kurşuncubaşı. Bacqué-Grammont, Laqueur et Vatin, Stelae Turcicae II : 51. 166
Parmi les époux, on trouve un kethüda de la famille, un müderris, un mütevelli du vakf familial, un secrétaire du divan, un douanier d’Istanbul, etc. Bacqué-Grammont, Laqueur et Vatin, Stelae Turcicae II : 51-52. 167
De fait, Ibrahim Han était le seul fils survivant du couple : il n’eut lui-même que deux fils (d’après les informations collectées), qui eux-mêmes n’eurent que des fils. Il faut attendre la 4
e génération pour trouver
une fille, dont on ne connaît pas les époux éventuels, et descendre encore plus pour trouver des mariages de descendantes d’Ibrahim Hanzade. Nous sommes alors déjà au XVIII
e siècle. Bacqué-Grammont, Laqueur et
Vatin, Stelae Turcicae II : 51-52 et l’arbre généalogique en fin d’ouvrage. 168
İpşirli (éd.), Tarih-i Selânikî : t. 2 p. 775. Cf. Annexes C.11. 169
Subhî, Subhî Tarihi : 653-654. 170
Le lien matrimonial apparaît notamment dans ses vakfiyye : VGMA D 738 n° 26 : 1163 (mars 1750) ; D 738 n° 24 : 1166 (avril 1753) ; D 46 n° 46 : 1166 (avril 1753) ; D 46 n° 50 : 1170 (décembre 1756) ; D 46 n° 48 : 1170 (juillet 1757) ; D 46 n° 52 : 1175 (février 1762) ; D 46 n° 53 : 1176 (août 1762) ; D 46 n° 54 : 1176 (août 1762) ; D 46 n° 56 : 1176 (octobre 1762) ; D 46 n° 55 : 1176 (janvier 1763) ; D 46 n° 47 : 1177 (novembre 1763) ; D 46 n° 58 : 1189 (mars 1775) ; D 46 n° 59 : 1196 (mai 1782).
Page | 166
*
Le passage à une politique matrimoniale préférentielle en faveur des kul n’est pas le
fruit d’une invention soudaine : il s’appuie sur des bases préexistantes et des enjeux explicites.
Il existait des alliances internes avec des membres appartenant à l’administration étatique
ottomane avant que cette pratique ne s’impose définitivement. Le passage aux gendres kul
scelle une passation de pouvoir entre anciens et nouveaux cadres de l’État qui dépasse le
cadre matrimonial : elle coïncide avec la période au cours de laquelle l’administration
impériale se peuple de kul au détriment de membres appartenant à l’élite religieuse. Le choix
des kul comme gendres impériaux s’enchâsse ainsi dans une politique plus vaste de promotion
de ces individus au sein de l’État, qui s’inscrit dans le cadre d’une volonté impériale de
redistribution des pouvoirs et honneurs entre les divers groupes dominants au sein de l’espace
ottoman.
Les grands perdants de cette politique matrimoniale sont d’abord les grandes familles
militaires héréditaires, exclues dès le début, puis toutes les familles disposant d’une aura
politico-religieuse et d’une ascendance glorieuse susceptible de faire ombrage à la dynastie
ottomane. Les familles régnantes (y compris celles passées sous tutelle ottomane) sont ainsi
rapidement évincées. Les familles d’oulémas, qui surent conserver un rôle essentiel au sein de
l’État et de la société ottomane, rejoignirent bientôt elles aussi le rang des membres exclus des
alliances matrimoniales dynastiques. Le pouvoir ottoman se trouve ainsi réparti en deux
classes, avec l’élite militaro-administrative d’un côté, constituée des kul, dans laquelle on
puise pour trouver des époux aux princesses, et l’élite juridico-religieuse de l’autre,
représentée par les oulémas, bannis du système matrimonial dynastique. À la tête de ces deux
groupes se trouve la dynastie, qui proclame ainsi sa supériorité sur tous et toutes.
La dynastie s’allie ainsi avec le groupe le moins susceptible de lui faire ombrage parce
qu’il est le plus éloigné d’elle en termes de statut. Elle s’allie avec ses propres serviteurs,
renforçant ainsi le lien de dépendance et d’association qui l’unit à ses kul. Ce faisant, elle
accorde à cette élite une aura particulière, qui dérive uniquement de son service et de ses liens
(matrimoniaux) avec la dynastie, ce qui renforce sa position tout en l’enchaînant à la dynastie.
Le message proclamé est clair : ce n’est qu’à travers le service et l’alliance avec la dynastie
que les membres de cette élite peuvent trouver honneur et distinction. Leur sort est donc lié
intimement à celui de la dynastie. Mais cette médaille possède également son revers : elle
implique la constitution sans cesse renouvelée de factions au sein même du pouvoir ottoman,
dont les princesses se font l’agent autant que le relai. Si le souverain y gagne à s’imposer au-
dessus des groupes en s’affirmant comme arbitre et dispensateur des honneurs et offices, cela
entraîne également une division des énergies et un accroissement des conflits et compétitions
pour les honneurs qui tend à scléroser la politique ottomane dès lors que la clef de voûte du
système – le sultan – perd de sa puissance et de son autorité.
Originellement au service de la dynastie, le système tend à se développer au bénéfice
des factions elles-mêmes, qui trouvent leurs avantages dans l’alliance impériale (sur le plan
honorifique) et dans le soutien des princesses (sur le plan politique). De fait, pas plus les
Page | 167
princesses que les gendres pachas ne restent spectateurs de ce système : ils y participent et en
tirent des profits qui ne coïncident pas nécessairement avec les intérêts dynastiques. Ainsi, si
l’alliance impériale permet d’attacher le gendre à la dynastie, elle contribue également, en
retour, à attacher la dynastie à son gendre – et plus généralement à l’ensemble de son réseau.
Selon l’optique à partir de laquelle on se place, l’instauration de ce système peut se lire
comme une victoire de la dynastie (au moins dans les premiers temps), mais une victoire si
bien réussie qu’elle l’enferme rapidement dans un système d’alliances dont elle ne put se
détacher par la suite et qui assura la pérennité du pouvoir des kul.
Page | 168
III. INTERACTION DES ACTEURS DU MARCHÉ MATRIMONIAL
Une des critiques fondamentales formulées à l’encontre des approches structuralistes
et, de façon générale, de toute approche holiste, est la tendance à enfermer les individus dans
des actions prédéfinies qui les dépasseraient et qu’ils se contenteraient de reproduire,
consciemment ou non, sans avoir la maîtrise ou la capacité d’influer dessus. Les acteurs du
système matrimonial ne sont pourtant pas des automates, et Alain Caillé de regretter que « le
sujet de l’action mis en scène par le holisme est incapable de donner. Trop régi depuis
l’extérieur de lui-même pour accéder à la liberté et au sens, il ne peut au mieux qu’accomplir
plus ou moins bien le rite, la règle ou la fonction et se soumettre à son destin. Il est trop
contraint, trop obligé pour agir »171
. Sans tomber dans un excès d’individualisme, il est
important de prendre en considération le rôle des acteurs au sein même d’un système qui les
dépasse, mais dans lequel ils se meuvent malgré tout avec plus ou moins de brio.
Notre corpus de princesses est constitué de près de 300 femmes : si l’on partait de la
base d’un unique mari par princesse, ce qui serait très en dessous de la moyenne, nous aurions
un total de plus de 600 acteurs. Il faudrait encore y ajouter les parents de chaque princesse,
soit 600 personnes de plus. On aura compris qu’une étude approfondie de chaque acteur de ce
vaste marché matrimonial est inenvisageable. Nous avons dès lors concentré nos efforts sur
les acteurs principaux de ces unions afin d’évaluer, dans leurs grandes lignes, les marges de
manœuvre dont ils disposaient. Qui participait, directement ou non, aux négociations et aux
choix ? Qui prenait les décisions ? Par quels intermédiaires ces négociations se faisaient-
elles (question cruciale dans un monde qui prône la séparation spatiale des sexes) ? Enfin,
quel était le rôle respectif des acteurs principaux, les époux ? Ce sont ces questions qui ont
animé notre réflexion. Nous avons ainsi privilégié une mise en perspective des réseaux
d’interdépendance dans lesquels s’inscrit chacun de ces acteurs172
.
Il ne s’agit pas de montrer que le père, en tant que chef de famille, avait à charge de
marier ses filles : c’est un fait très largement connu et sans surprise ; mais de voir comment
son rôle décisionnaire est orienté par la position respective des autres acteurs. Ce père qui
marie sa fille parce que c’est sa responsabilité n’agit pas de façon totalement autonome : sa
décision est circonscrite par des normes socioculturelles (dans le cas des sultans, l’obligation,
à partir du XVIe siècle, de marier ses filles à des kul) et des nécessités politiques (puissance du
sultan par rapport au reste de l’élite dominante, besoin plus ou moins urgent de nouer des
alliances) que nous avons vu précédemment, mais aussi par une autre forme de dépendance
qui est celle du réseau des individus qui circonvient le père au moment donné du mariage et
qui est toujours en mouvement, toujours susceptible de se redéfinir d’un jour à l’autre. Ainsi,
certaines alliances furent imposées au sultan, qui n’avait d’autre possibilité que de légitimer
après coup cette union non désirée pour sauvegarder les apparences, préserver l’image d’un
171
Caillé, Anthropologie du don : 52. 172
Les travaux d’Elias ont en effet montré l’importance de considérer les personnes comme faisant partie d’un ensemble, d’un réseau d’individus interdépendants. Voir notamment son article « Sociologie et histoire », présenté en introduction de La société de cour : tout particulièrement p. LIV, LXXI.
Page | 169
souverain tout-puissant. Pour d’autres décidées librement, le cours du temps et la redéfinition
du réseau d’interaction amena le sultan à revenir sur sa décision première et à la désavouer, en
rompant l’alliance nouée par ses soins (ou par ceux d’un autre) quelque temps auparavant.
Étant donné le nombre des individus concernés et l’état de la documentation, une
étude de chacune des alliances nouées n’est pas parue souhaitable ; nous lui avons préféré une
approche mettant en valeur les continuités dans ce domaine. On pourra reprocher à cette mise
en forme un manque d’historicité, une tendance à laisser croire en une immuabilité des
situations : le rôle du sultan aurait toujours été celui du décideur ultime, assertion véridique,
mais également contestable dans la mesure où, comme nous allons le voir, il arrive que ce rôle
n’ait eu qu’une portée symbolique. Hélas, il faut accepter les limites du possible à partir des
sources disponibles : nous sommes bien consciente de ce défaut, mais nous avons malgré tout
choisi d’inclure ce chapitre parce qu’il nous semble essentiel pour finir de cerner l’envers du
décor de ce vaste jeu matrimonial.
1. Par la grâce du sultan : le choix souverain du chef de famille
Le sultan est premièrement un père et, à ce titre, il est responsable du choix de ses
futurs gendres. Toutefois, il est aussi un chef de famille (au sens large), le chef de la Maison
d’Osman, parce qu’il en est le membre le plus élevé, celui autour duquel cette Maison se
définit et s’organise. Dans ce cadre, la responsabilité d’assurer la prospérité et la continuité de
son lignage repose sur ses épaules. L’établissement de l’ensemble des membres féminins (et
masculins) affiliés à la Âl-i ‘Osmân lui revient comme une charge, mais également comme un
atout : il mariera et placera ces individus non pas tant selon les meilleurs intérêts de chacun
d’entre eux, mais en accord avec les siens propres, qui ne coïncident avec les intérêts de la
dynastie que dans la mesure où le sultan régnant incarne la dynastie. Il décide donc des époux
qui seront donnés à ses sœurs, ses nièces ou autres173
. Ce principe ne pose aucune difficulté
pour toutes les princesses, directes ou indirectes, privées de père, telle Hümaşah Sultane, fille
du prince Mehmed, dont le père décéda avant qu’elle n’ait atteint l’âge d’être mariée174
.
Mais l’absence de père est loin de constituer une tendance générale. La situation se
complexifie dans le cas des descendantes indirectes en lignées féminines. Nous avons vu
qu’en dépit de la règle de transmission dynastique patrilinéaire, ces femmes avaient été
intégrées parmi les membres affiliés à la dynastie. Dès lors, qui, du père-pacha ou du parent-
sultan, portait la responsabilité de leur mariage ? Plusieurs cas de figure sont possibles. Dans
les premiers temps de l’histoire ottomane, quand les princesses étaient mariées à des 173
Le même principe s’applique en Europe, à l’époque moderne. Cf. Bély, La société des princes : 197-198. 174
Mehmed, fils de Süleyman Ier et de sa favorite Hürrem, serait né en 1521. Sa circoncision eut lieu en 1530. Il décéda de mort naturelle en 1543. Il n’avait donc que 22 ans. Nous ne connaissons pas la date de naissance de sa fille, Hümaşah, mais quand bien même elle serait née lorsque son père avait 15 ans, à la mort de celui-ci, son âge ne dépasserait pas les sept ans. Par ailleurs, d’après Peirce, elle aurait épousé Ferhad Pacha au cours de la dernière année du règne de son grand-père, en 1566 : son âge aurait donc avoisiné la trentaine au moment de son mariage. Cf. Peirce, The Imperial Harem : 67.
Page | 170
souverains anatoliens, les enfants nés de ces unions appartenaient à la maison de leur père : en
sa qualité de chef de famille, il lui revenait alors de prendre en charge leurs mariages, selon
son propre agenda politique. Le cas des princesses indirectes nées d’un père kul est plus
insidieux. La position de celui-ci, “esclave” du sultan, le plaçait en situation de soumission
face au sultan, mais aussi face à sa femme, comme nous l’avons vu. Dès lors, son autorité
paternelle était contrebalancée par la puissance de son épouse et de son beau-père, ou du
parent par alliance en position de chef de la dynastie, qui se trouvait dès lors libre d’imposer
ses choix, au détriment des volontés paternelles175
. Mais la situation pouvait être plus facile :
la différence d’âge entre les époux fait que nombre des enfants des sultanes grandirent sans
père – reste à savoir alors qui, de la mère ou du grand-père, choisissait le mari.
Le sultan, maître des alliances de l’ensemble des membres de la dynastie ? Certes,
mais parfois plus dans la forme que dans le fond. Pour qu’il soit le maître que les formulations
et pratiques laissent entendre, encore faudrait-il qu’il soit en position de force, capable
d’assumer et d’imposer pleinement ses décisions. Ce ne fut pas toujours le cas, soit que le
sultan ait été un enfant et la réalité du pouvoir lui échappait alors, soit que son pouvoir ait été
chancelant, et il était bien contraint de faire avec les récriminations et réclamations de son
élite. Deux exemples viennent illustrer ces situations – les cas similaires sont bien plus
nombreux, et il faut supposer que ce que la documentation nous laisse percevoir n’est
probablement qu’un petit bout de la lorgnette. Un sultan enfant ne décidait pas lui-même des
alliances des membres de sa famille ; il ne décidait d’ailleurs pas grand-chose de lui-même.
Pourtant, de sa montée sur le trône au jour de sa prise de pouvoir effective, des mariages
étaient conclus pour ses sœurs, tantes, et autres parentes disponibles. Il faut donc que la
décision ait été prise par quelqu’un d’autre. Nous verrons plus bas la question du rôle des
régentes, insistons ici sur l’influence du grand vizir. Mehmed IV enfant maria officiellement
plusieurs de ses tantes et parentes à certains de ses kul. Pourtant, il semble bien que son rôle
se soit limité à donner son auguste autorisation pour des décisions déjà engagées sans qu’il ait
été consulté. Ainsi Fatma Sultane, fille d’Ahmed Ier, aurait été mariée à Melek Ahmed Pacha
par le grand vizir, Köprülü Mehmed Pacha176
.
Inversement, sa sœur Hanzade Sultane avait été mariée à Bayram Aga, élevé au rang
de pacha dans la foulée, d’une manière fort étrange. Le récit de Naima montre les hésitations
de ce chroniqueur, soit qu’il savait de quoi il en retournait, soit qu’il ait senti qu’il y avait
dans cette affaire quelque chose de louche ; dans tous les cas, il était confronté à la difficile
décision de trancher sur la manière de le rapporter : fallait-il révéler ouvertement l’événement
ou au contraire le dissimuler, pour préserver l’image dynastique ? Car ce qu’il laisse entendre
à demi-mot, c’est bien un aga des janissaires qui s’imposa de force à la dynastie et la força à
lui octroyer la main d’une des filles du sultan, dans un contexte assez trouble de protestation
des janissaires177
. Mieux valait sacrifier une princesse que prendre le risque de voir l’armée se
175
Par ailleurs, l’écart d’âge au mariage devient tel, à partir du XVIIe siècle, qu’il n’est pas rare que le père soit
déjà décédé au moment du mariage de ses enfants (issus de son union avec la princesse) : un phénomène qui n’est pas sans accentuer le décalage des rapports de force au sein de ces familles, comme nous l’avons déjà souligné. 176
Evliya, Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi : vol. 1 livre 6 p. 74-76. Cf. annexes C.31. 177
Dankoff, Karaman, Dağlı (éds.), Evliya Çelebi Seyahatnamesi : p. 106. Cf. annexes C.18.
Page | 171
retourner contre le sultan et exiger sa destitution, ce qui aurait entraîné la chute d’un certain
nombre de ses ministres. De telles attestations n’apparaissent qu’à partir de la seconde moitié
du XVIIe siècle et se font légèrement plus régulières, ou du moins plus évidentes, au siècle
suivant, c’es-à-dire quand le sultan a perdu de son panache et délégué une grande part de ses
responsabilités gouvernementales à ses vizirs. Naima parle par sous-entendu : comprendra qui
voudra bien comprendre ses allusions ; il évite bien soigneusement de fournir un récit trop
précis ou trop clair178
. En somme, peu importe la manière par laquelle un mariage a été
élaboré, du moment qu’il peut s’inscrire dans le récit à la gloire de la dynastie.
2. Sous l’œil de l’entremetteuse : le rôle indispensable des femmes
La séparation des mondes masculins et féminins et l’idéal de domination masculine
dans le couple invitent à s’interroger sur la place des mères et, plus généralement, des femmes
dans les tractations en vue d’un mariage. Des attestations postérieures à notre période
affirment leur rôle dans ce domaine, au point d’en faire des acteurs essentiels. Fanny Davis
indique ainsi la présence centrale d’un personnage féminin : la görücü, également appelée
kılavuz. L’appellation donnée à cette femme est révélatrice de son rôle : elle est « celle qui
voit » ou « celle qui guide », c’est-à-dire celle qui va rencontrer les jeunes filles pour juger
celle qui répondra le mieux aux attentes du jeune homme destiné à être marié, celle qui va
guider celui-ci et sa famille tout au long de cette phase de préliminaires179
. D’autres femmes
pouvaient être sollicitées, si l’on en croit les propos de Melek Hanım qui raconte comment
elle fut sollicitée par le supérieur de son époux, désireux de se marier :
« Après les salutations d’usage, il [Gözüklü Reşid Pacha] fit part à Mehmed Bey
[l’époux de Melek] de son intention de se marier. Il supplia mon mari de me faire
venir près de la porte de sorte que, sans être vue, je puisse entendre ce qu’il avait à
dire à ce propos. Comme il n’avait pas de parents sur-place, car il était natif de
Géorgie, il désirait que je me charge de cette affaire en son intérêt, car la recherche
d’une épouse est généralement confiée à une parente.
Ayant vécu en Europe, il m’expliqua souhaiter une femme grande et mince, telles
que les Européennes sont généralement, et de belle contenance. »180
178
Quant à Evliya Çelebi, écrivain subversif à bien des égards, il ne faisait pas parti des auteurs de cour. Il était ainsi plus libre de raconter des événements qui n’étaient pas pour magnifier la dynastie, d’autant plus qu’il lui fallait intéresser son auditoire par le récit d’événements fabuleux ou de lieux inconnus, ou encore en usant des ressorts comiques. 179
Fanny Davis, The Ottoman Lady. A Social History from 1718 to 1918, New York / Wesport Connecticut / Londres, Greenwood Press, 1986 : 61-65. 180
Melek Hanum, Thirty Years in the Harem : 37-38. On notera, dans ce cas, que c’est l’absence de parente sur place qui motive cet officier à faire appel à la femme d’un de ses subalternes. S’il s’est décidé à confier cette tâche importante à Melek, c’est peut-être bien en raison de ses goûts personnels. Reşid Pacha explique en effet à notre auteure qu’il recherche une jeune femme répondant aux caractéristiques européennes. Or, Melek Hanum correspond elle-même à ces critères : Grecque orthodoxe, elle voyagea en Europe, où elle rencontra son futur mari. Elle était la mieux placée pour trouver la perle rare recherchée par le supérieur de son époux – comme ce fut le cas. Le surlignage est de notre fait.
Page | 172
Melek Hanoum se lance alors à la recherche d’une jeune fille répondant aux critères du pacha,
se présentant aux portes des maisons où elle savait y résider des jeunes filles à marier. Quand
on lui demandait l’objet de sa visite, elle répondait : « Je souhaite voir votre jeune fille »,
phrase qui annonçait ses motifs. S’ensuivaient alors les visites, l’examen rapide de la jeune
fille à l’occasion du service du café, puis les discussions pour connaître et négocier les
dispositions financières et autres conditions conjugales souhaitées par les deux parties181
. Du
côté de la jeune fille, la tâche de négocier les conditions du mariage revenait
traditionnellement aux mères et les offres et propositions étaient discutées lors de conseils de
famille182
. Tout ceci nous montre à quel point les négociations pré-maritales fonctionnaient
grâce à la participation des femmes, du fait même de la séparation des sexes : les hommes ne
pouvant interférer avec le monde féminin (en tout cas pour le monde de l’élite), l’intercession
des femmes était nécessaire et c’était sur les rapports qu’elles faisaient de leurs entrevues que
les décisions étaient prises.
L’existence de ces exemples postérieurs à l’époque qui nous intéresse suffit-elle à
attester de la présence de ces pratiques à l’époque moderne ? Peut-on admettre la supposition
selon laquelle ce qui se pratiquait pour des femmes de l’élite était également valable pour les
princesses ? Quelques attestations de mariages royaux et princiers fort anciens, datant du XVe
siècle, poussent à conclure dans ce sens. Ainsi Neşri nous livre une description tout à fait
précieuse des tractations en vue du mariage du prince Mehmed, fils de Murad II appelé à
devenir le conquérant de Constantinople, avec une fille issue de la dynastie des Zulkadıroğlu :
« Au cours du retour du sultan Murad de la plaine de Kös-ova, il déclara à Halil
Pacha : “Je souhaite marier mon fils Mehemmed. Ce Zulkadıroğlu Süleyman Bey
est un turkmène plaisant. Il se comporte de façon fort loyale et amicale avec nous.
Je souhaite prendre une de ses filles [pour lui].” Halil Pacha répondit : “Qu’il en
soit ainsi, mon sultan, c’est approprié.” Ils envoyèrent alors aussitôt la femme
d’Hızır Aga d’Amasya en Elbustan, auprès de Süleyman Bey. À cette époque,
Süleyman Bey avait cinq filles. Elles furent toutes amenées auprès de la dame, qui
en apprécia une en particulier : elle lui joignit les mains et l’embrassa sur chaque
œil. Après quoi, elle s’en retourna auprès du sultan pour lui donner des nouvelles
des bienfaits et de la déférence de Süleyman Bey ainsi que de la beauté et de la
morale de sa fille. Sultan Murad ayant donné son accord, la femme de Hızır Ağa
s’empressa d’y retourner avec les femmes des grandes familles Rûm et les beys des
grandes familles. Süleyman Bey les reçut, leur témoigna un grand respect, fit
montre d’une grande considération à l’égard des entremetteuses et les entretint
gracieusement de nombreuses réceptions. Puis il remit sa fille à la femme d’Hızır
Bey et l’envoya [à la cour ottomane]. »183
181
Melek, Thirty Years in the Harem : 38-42. 182
Davis, The Ottoman Lady : 64. 183
« Hikâyet-i tezvîc-i ibnuhu Mehemmed Han bi-binti Süleymân bin Zulkâdır. Çün kim, Sultân Murâd Kös-ova ugraşından devletile Edirne’ye gelicek, Halîl Paşa’ya eyitdi : “Dilerin ki, oglum Mehemmed’i everem. Şol Zulkâdır-oglı Süleymân Beg bir hoş Türkman’dur. Bizümle hayli sadâkat ve dostluk ider, anuñ kızın almak isterin.” Halîl Paşa eyitdi : “N’ola sultânum, lâyıkdur.” Derhâl Amâsiyye’den Hızır Aga’nuñ hatunın gönderdiler ; Elbustan’a Süleymân Beg’e vardı. Süleymân Beg’üñ ol vakt biş kızı vardı. Cümlesin
Page | 173
Ce texte montre clairement l’intercession féminine effectuée ici par des épouses des
dignitaires de l’entourage du sultan, c’est-à-dire par des personnes habilitées à pénétrer dans
le monde des femmes et qui pouvaient ensuite faire leur rapport au sultan. Il s’agit aussi de
personnes de confiance, ou du moins estimées comme telles par le sultan : l’enjeu est de taille,
puisqu’il s’agit pour eux de choisir la meilleure épouse pour l’héritier présomptif du sultan.
On peut imaginer les discussions auxquelles cette revue des princesses donnait lieu ; on peut
aussi imaginer l’exaspération qu’elle pouvait susciter : ces princesses étaient rabaissées au
rang de femme d’élite quelconque, obligée de plaire à des étrangères venues les juger. Peu
importe, pour notre propos : ce texte a l’avantage d’attester de l’existence de l’intercession
féminine dans les mariages princiers dès les premiers siècles de l’histoire ottomane.
S’appliquait-elle aussi aux princesses ottomanes elles-mêmes ? C’est moins évident.
Les négociations semblent avoir suivi un autre procédé, attesté par les sources : l’échange
épistolaire. La séparation des sphères masculines et féminines dans la société ottomano-
musulmane ne signifie certainement pas qu’aucune liaison n’était possible entre les deux ; elle
suppose cependant la mise en place de moyens de communication spécifiques, permettant de
contourner les communications orales qui nécessitent un contact direct. L’un de ces moyens
fut l’échange de billets184
. Nous en avons gardé un exemple, lorsque Kösem Sultane, régente
pendant près de trente ans, décida de contracter une nouvelle alliance avec l’un des principaux
grands dignitaires de la fin du XVIe et de la première moitié du XVII
e siècle, Hafiz Ahmed
Pacha185
. Le billet qu’elle envoya au pacha à cette occasion ayant été conservé, nous avons
ainsi une connaissance précise de la manière dont elle initia les négociations :
« Dès que vous serez prêt, faites-le-moi savoir, j’agirai en conséquence. Nous nous
occuperons de vous aussitôt, une princesse est prête. Je ferai de même que lorsque
j’ai envoyé ma Fatma Sultane. » 186
Hatun’uñ ileyine getürdiler. Hatun birin begenüp, eline yapışup, iki gözlerinden öpdi. Andan hünkâra gelüp, Süleymân Beg’üñ keremin ve itâʻatin ve kızınuñ hüsnini ve hulkını haber virüp, Sultân Murâd kabûl idüp, tekrâr Hızır Aga’nuñ hatunıyıla Rûm aʻyânlarınuñ hatunlarını aʻyân beglerle koşup varup, Süleymân Beg karşu gelüp, azîm hürmetler idüp, düñürleri iʻzâzla kondurup, lutfıla törelerince agırlayup, kızı, Hızır Beg’üñ hatunına teslîm idüp gönderdi. » : Neşrî, Cihânnümâ : 304. L’épisode est également rapporté par Aşıkpaşazade, presque mot à mot : Âşıkpaşazâde, Tevârîh-i Âl-i ‘Osmân : 137-138. 184
On notera au passage que l’échange épistolaire ne pouvait se réaliser qu’avec le concours des eunuques noirs, les intermédiaires entre le monde féminin du harem et celui masculin. Il n’était pas rare que ceux-ci soient chargés de transmettre un message oral en plus de celui écrit au destinataire auprès de qui ils étaient envoyés. L’oral et l’écrit pouvaient donc se compléter, ce qui nous amène à penser que la pratique d’envoyer des intermédiaires chargés des négociations matrimoniales existait déjà probablement à l’époque classique étudiée ici, en la personne des eunuques. 185
Ainsi que nous le verrons par la suite, une grande partie de l’activité politique de cette régente fut de se jouer des conflits entre les factions (conflits qui font rage tout au long de la première moitié du XVII
e siècle). Or,
pour cela, elle mit à profit la possibilité de créer des alliances privilégiées entre la dynastie (dont elle était provisoirement en charge, en tant que régente, d’abord en raison du jeune âge de son fils Murad IV, puis de la faiblesse mentale de son autre fils Ibrahim) et les chefs de file des factions en présence. Pour y parvenir, elle instrumentalisa les princesses ottomanes et tout particulièrement ses filles, Ayşe et Fatma. 186
« Kendünüz her ne zaman hazır olursanız [girü] bana bildiresiz, o minval üzre ederim. Heman size bakaruz hanım hazırdır. Benüm Fatma Sultanı nice gönderdimse öyle ederim » : TSMA E 2457/2. Une partie du texte est cité dans Peirce, The Imperial Harem : 148. Nous remercions profondément cette dernière d’avoir eu la gentillesse de bien vouloir nous faire parvenir ses notes et notamment la translittération du texte en ottoman : le document n’est actuellement pas disponible à la consultation du fait du transfert et du catalogage des archives du Palais de Topkapı.
Page | 174
Dans ce court texte, Kösem se présente comme l’unique personne en charge : elle présente
son offre au pacha, invité à y répondre. À aucun moment son fils, le sultan, n’est
mentionné187
. C’est qu’à cette période, Kösem est encore en position de régente de son fils,
qui n’est pas en âge de s’occuper des affaires du trône. C’est donc en double qualité de mère
et de suppléante du sultan qu’elle agit, ce qui donne d’autant plus de poids à sa proposition,
qui sera d’ailleurs acceptée par le pacha.
Arrêtons-nous un instant sur ce billet qui, à ce jour, est la seule attestation connue d’un
document de nature privée à aborder les négociations en vue du mariage d’une princesse. Il
faut, dès lors, être attentif à la formulation employée, en rapport à celle des chroniqueurs.
Dans les récits de règne est mise en exergue, à plusieurs reprises, la nature unilatérale de
l’élaboration d’un mariage princier, décidé par le sultan (ou son substitut) et qui s’impose dès
lors aux deux époux, sans consultation préalable de leur avis. Ces derniers se voient informés
de la décision par courrier officiel, une fois celle-ci rendue. Ainsi Subhî rappelle que les
princesses Safiyye, Saliha et Ayşe reçurent un « ordre impérial émanant du sultan […] les
informant de se réjouir de [la venue de] la perle très précieuse du mariage », juste avant que
leur contrat respectif ne fût signé. Il précise d’ailleurs les modalités : les « bonnes nouvelles »
ont été communiquées par le grand vizir aux princesses « par l’envoi de lettres, remises à
chacune par un envoyé spécial, accompagnées de l’annonce de joyeuses festivités
nocturnes »188
. On trouve des échos similaires dans diverses chroniques, mais aussi chez
Evliya Çelebi, qui raconte que Melek Ahmed Pacha avait été marié sans son avis, pendant
qu’il était en poste en province (en train de se battre pour l’honneur de l’Islam, nous rappelle-
t-on), par le grand vizir Köprülü Mehmed Pacha, ainsi qu’il s’en défend à sa femme durant
leur nuit de noce :
« Que Dieu me pardonne. Je n’avais certainement aucune idée que j’allais t’épouser.
Alors que j’étais sans nouvelles en [pleine] campagne de Transylvanie, toi à Islambol,
tu m’as pris [pour époux]. La nouvelle du mariage m’est parvenue en Transylvanie.
Juste quand je remerciais Dieu en disant : “me voilà sauvé des dépenses de Kaya
Sultane”, le défunt Köprülü t’a donnée à moi. “J’ai donné un éléphant à Melek, qu’il
le nourrisse !” a-t-il déclaré [à cette occasion] ; puis il est décédé. Voilà, je suis
maintenant venu à toi. C’est la volonté de Dieu. »189
Le billet de la régente dirait-il autre chose ? À première vue, il semblerait qu’une
certaine marge de liberté soit laissée au pacha. Mais cette impression ne résiste pas à
l’examen de la formulation du texte. Kösem Valide Sultane ne laisse, en vérité, aucun choix à
Hafız Ahmed Pacha ; elle ne lui offre qu’un délai pour se préparer : « dès que vous serez prêt
» dit-elle, avant de passer à un mode autoritaire. La princesse en question n’est pas mieux
lotie ; elle n’est pas même mentionnée. Kösem parle en effet d’une jeune fille (une princesse),
qui se tient prête, peu importe au fond laquelle : voilà toutes les sultanes déshumanisées,
187
D’autres exemples de billets rédigés par des reines mères régentes, notamment Turhan Hadice Sultane, donnent à voir la différence d’attitude entre cette dernière et Kösem : au contraire de sa belle-mère, Hadice a soin, dans ses lettres, de rappeler systématiquement que ses ordres sont l’expression et la voix de son fils, le sultan. Voir les exemples présentés par Thys-Şenoçak, Ottoman Women Builders : 39-54, 127-175, 181-185. 188
Subhî, Subhî Tarihi : 625. On trouvera la translittération du texte complet en ottoman en annexes C.50. 189
Evliyâ, Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, vol. 1 livre 6 p. 75 ; cf. Annexes C.31.
Page | 175
désindividualisées, rabaissées au rang d’objets interchangeables. Mais pourquoi accorder un
délai au pacha ? Tout simplement parce que l’union avec une sultane impose, comme on le
verra plus tard, un certain nombre de préparations et surtout, de grands investissements
financiers. En somme, le temps que la régente octroie au pacha pressenti pour devenir un
dâmâd-ı şehriyârî est celui dont il a besoin pour mettre de l’ordre dans ses affaires et dans ses
finances en vue d’être apte à répondre aux exigences d’une union avec un membre de la
dynastie. Le pacha est d’ailleurs averti des charges qui l’attendent : elles seront les mêmes que
dans le cas du précédent mariage de Fatma Sultane, fille de la régente (« je ferai de même que
lorsque j’ai envoyé ma Fatma Sultane »).
La formulation laisse la part grande à l’action autonome de la régente, qui annonce les
mesures qu’elle prendra une fois le pacha prêt. On notera la répétition du je, qui s’inscrit
autant dans un futur anticipé : « je ferai de même», « j’agirai en conséquence», que dans un
passé proche, mais déjà révolu : « lorsque j’ai envoyé ma Fatma Sultane ». Pourtant, Kösem
se rappelle aussi des exigences de sa position et a soin de rappeler insidieusement le fait que
ses ordres sont l’émanation de ceux du sultan, dans une formule qui associe la mère et le fils
dans un ensemble commun : « nous nous occuperons de vous », qui renvoie à l’idée d’un
paternalisme protecteur en cohérence avec l’idée de famille et l’idéologie impériale.
Néanmoins, une phrase relativise la toute-puissance impériale inscrite dans les mots du
discours et rappelle le besoin en alliances dans laquelle la dynastie se trouve alors. L’urgence
se fait même sentir par ce « aussitôt », qui souligne que la régente n’a pas l’intention de
repousser plus que le strict nécessaire cette union inéluctable. Un pacha averti en vaut deux,
Ahmed Pacha sait à quoi s’attendre : il deviendra dâmâd-ı şehriyârî, qu’il l’ait voulu ou non.
La seule marge de manœuvre dont il dispose, le seul argument sur lequel il peut jouer, est
celui du délai qui lui est accordé pour se mettre en condition de recevoir dignement la main
d’une princesse. Il pourra, s’il le souhaite, invoquer des problèmes dans ses finances ou un
état indigne de l’honneur qu’on lui fait pour repousser, jusqu’aux limites de la décence et du
respect envers la dynastie, l’inéluctable arrangement conclu pour lui. Qui sait, d’ailleurs, ce
qui peut se passer entre-temps ? Changement de règne, renversement des alliances, tout est
envisageable, si d’aventure on peut se ménager du temps.
Le texte susdit met en scène une régente ayant à disposition, pour les alliances qu’elle
souhaite nouer entre la dynastie et l’élite kul, l’ensemble des princesses disponibles, car elle
agit en tant que substitut du sultan. Mais qu’en était-il des mères des princesses ? Les
stratégies élaborées par ces dernières variaient très certainement en fonction de nombreux
critères (leur personnalité y jouant une part non négligeable), mais, dans l’ensemble, on peut
supposer que les enjeux de pouvoir tenaient une place prépondérante. Dans ce contexte, leur
statut personnel influait beaucoup sur les attentes qu’elles pouvaient nourrir à l’égard de
l’union de leurs filles. Si la mère se trouvait déjà au sommet de la hiérarchie féminine
palatiale, si elle était valide sultan notamment, son intérêt se mêlait à celui de l’État. Les
intérêts de l’État n’étaient certainement pas leur seule préoccupation, car ces mariages étaient
aussi un moyen de se ménager des soutiens, des alliés personnels, au sein de ce vaste et
complexe échiquier politique qu’était la cour ottomane. L’autorité dévolue à la reine mère
n’était pas sans poser de nombreuses difficultés aux concubines mères de princesses. Celles
Page | 176
qui entendaient instrumentaliser le mariage de leurs filles afin de renforcer leur position
personnelle au sein de la cour couraient le risque de voir leurs ambitions mécontenter les
autres concubines mères du harem impérial. La marge d’action de chacune s’en trouvait
d’autant diminuée et les moins puissantes subissaient probablement les oppositions et rapports
de force des plus influentes.
Au XVIe et XVII
e siècle, les conflits les plus violents se déroulent entre la haseki et la
valide sultan, toutes deux cherchant à se servir du mariage de leurs filles, voire de celles des
autres, pour renforcer leur propre position politique. Nous sommes malheureusement mal
renseignée dans le détail de ces rivalités, tout particulièrement sur le point qui nous intéresse
ici. Les rapports des Vénitiens fournissent néanmoins un exemple qui permet de se faire une
idée des enjeux et des modalités de ces rivalités qui se répercutaient sur les princesses, lorsque
venait le jour de les installer. Nurbanu Sultane, mère du sultan régnant Murad III, et Safiyye
Sultane, sa favorite, menèrent entre elles un véritable combat politique, la reine mère tentant
de maintenir son pouvoir, la favorite, dont la position de future reine mère était quasi assurée,
travaillant à développer la sienne. Pour cela, chacune entendait profiter des possibilités
d’alliance offertes par le mariage de la fille aînée de la haseki, Ayşe Sultane : Nurbanu voulait
la marier à son fils adoptif, Mahmud, alors kapıcıbaşı de la Porte, tandis que Safiyye
souhaitait qu’elle épouse le très influent Ibrahim, favori du sultan qui allait bientôt devenir
pacha et même grand vizir190
. La stratégie de ces deux femmes est transparente : la reine mère
entendait renforcer sa faction et diminuer celle de sa rivale par le mariage d’un de ses
protégés avec la fille de celle-ci. De son côté, la haseki entendait marier sa fille au personnage
pressenti pour devenir un des futurs hommes forts de l’État, au vu de l’amitié que lui
témoignait le sultan. Ce fut la concubine qui remporta la victoire : Ayşe Sultane fut mariée à
Ibrahim Pacha, nommé peu de temps après au poste de grand vizir, tandis que le protégé de
Nurbanu, Mahmud, concluait une autre alliance, tout aussi profitable, avec une descendante
d’une des plus puissantes familles du XVIe siècle, la lignée issue de Mihrimah Sultane
191.
Ce combat entre femmes montre bien à quel point le choix des époux des princesses
relevait d’une longue suite de tractations politiques, dans lesquelles les mères n’étaient pas en
reste. Mais leur capacité d’influencer le sultan variait en fonction de leur statut respectif. La
valide sultan, la plus haut placée dans la hiérarchie du harem, possédait un réel droit de regard
non seulement sur les mariages de ses filles, mais aussi sur l’ensemble des alliances des
princesses. La haseki, en seconde position, pouvait également participer aux décisions, voire
s’opposer à la reine mère ou à toute autre concubine lorsque ses propres intérêts étaient en jeu.
Pour les autres concubines, leur participation dans les négociations est moins connue, ce qui
laisse à penser qu’elle était aussi moins importante : elles étaient contraintes de tenir compte
des intérêts des deux premières, quitte à jouer de leurs rivalités à leurs propres fins.
Le Harem impérial n’avait pas le monopole des transactions matrimoniales et d’autres
mères méritent qu’on s’intéresse à elles, à savoir les sultanes elles-mêmes, mères de
princesses indirectes. Dans ce cas, les négociations n’ont plus lieu au sein du harem impérial,
mais au sein des palais princiers. La distance ainsi établie accordait une plus grande marge de 190
Pedani, « Safiye’s Household » : 17-19. 191
Pedani, « Safiye’s Household » : 17-19.
Page | 177
manœuvre à ces mères. De même, les enjeux étatiques et dynastiques s’amenuisaient et
cédaient le pas aux considérations lignagères. Pour la mère, l’enjeu consistait tout autant à
maintenir sa propre puissance qu’à renforcer celle de sa famille et de sa descendance. Ainsi,
les mariages contractés pour les descendantes de Mihrimah Sultane (fille de Süleyman Ier)
soulignent la volonté de cette famille de demeurer au cœur du pouvoir, en créant des alliances
avec les personnages les plus puissants de l’État192
. Elle est loin d’être un cas spécial, même si
elle constitue l’un des exemples les plus accomplis dans le domaine : le modèle était repris,
avec plus ou moins de brio, par les autres lignages princiers, comme nous l’avons déjà dit plus
haut.
Terminons sur une pointe de nuance : certes, les mères intervenaient (à plus ou moins
grande échelle, avec plus ou moins de brio) dans les négociations matrimoniales concernant
leurs filles. Mais leurs intrigues ou préférences n’obtenaient pas nécessairement l’aval du
sultan. Certaines femmes royales, y compris les plus puissantes, connurent des échecs dans ce
domaine. Hürrem Sultane, dont l’influence sur le sultan Süleyman est devenue le fruit d’une
légende noire193
, tenta en vain de le faire changer d’avis concernant l’époux qu’il avait choisi
pour leur fille, Mihrimah Sultane. Le sultan voulait en effet la marier à Rüstem Pacha,
nouvellement promu au poste de gouverneur de la province de Diyarbakır, tandis qu’Hürrem
Sultane lui préférait le plus séduisant gouverneur d’Egypte194
. Elle serait allée jusqu’à lancer
la rumeur que le pacha avait la lèpre : le sultan prit, semble-t-il, l’accusation au sérieux et
délégua auprès du pacha son médecin personnel qui, ayant trouvé la présence de poux sur le
corps du pacha, annonça qu’il n’en était rien195
. L’hygiène corporelle douteuse du gendre
pressenti n’empêcha pas la conclusion de cette union et Hürrem dut se résoudre à voir sa fille
l’épouser196
. Mihrimah Sultane elle-même, qui jouit de la puissance et de l’autorité que sa
mère avait acquises auprès du sultan, aurait elle aussi échoué dans un projet de remariage
avec le nouveau grand vizir, Semiz Ali Pacha. Celui-ci ayant exprimé le souhait de ne jamais
se marier, elle abandonna le projet et choisit le veuvage, plutôt qu’un mari de second rang197
.
3. Tantôt soumis, tantôt indépendants : la puissance variable des candidats
192
Ahmed Pacha, qui accéda sur la fin de sa vie au poste de grand vizir, après être demeuré au poste de second vizir pendant toute la période du grand vizirat de Sokollu Mehmed Pacha ; Ciğalazade Yusuf Pacha, qui jongla tour à tour entre les postes de kapudan pacha, de grand vizir et de serdar ; le protégé de Nurbanu Sultane ; et encore un très riche personnage du nom de Hasan, dont on ne sait malheureusement que peu de choses. Voir la généalogie de cette princesse : Annexes B.19. 193
Peirce, The Imperial Harem: 30, 63, 88-90. 194
Necipoğlu, The Age of Sinan: 297. 195
Necipoğlu, The Age of Sinan: 297. 196
Peirce, The Imperial Harem: 76-77, 84, 147, 220-221. 197
Necipoğlu, The Age of Sinan : 297, d’après des rapports vénitiens.
Page | 178
Le mariage d’une princesse à un kul serait-il le seul fait du sultan et/ou de ses
suppléants ? Les textes respectent cette idée d’un honneur octroyé par la seule action du
monarque, mais on peut se demander dans quelle mesure cette formulation n’est pas un
simple mode d’énonciation officiel qui (ré)écrit l’événement en respectant les formes
protocolaires en usage, passant sous silence tout ce qui n’y avait pas sa place. Les kul
pressentis ou candidats au damadlık impérial n’auraient-il eu aucune prise sur leur propre
élévation à cette condition honorifique, aux conséquences cependant assez lourdes pour
eux (et leurs finances) ? Les kul dont il est question furent pourtant loin d’être des
marionnettes dans les mains du monarque, et plus on avance dans le temps, plus grande fut
leur autonomie ou leur puissance face au sultan : le doute est largement permis.
Tout le problème est de parvenir à déterminer les modalités de leur intervention dans
un domaine aussi sensible. Dans sa chronique, Raşid a cette précision fort brève à propos de
l’union de Çorlulu Ali Aga avec Emine Sultane selon laquelle ce dernier « enviait cet
honneur »198
. Autrement dit, le choix en faveur de cet Ali, appelé à jouer un rôle important au
sein de l’État ottoman au XVIIIe siècle, ne sortit pas de nulle part : il avait témoigné de son
désir d’obtenir cet honneur. Un premier élément surgit donc ici, qui ne concernait peut-être
pas tous les gendres, mais qui semble avoir joué en faveur de Çorlulu Ali Aga / Pacha : il
convient de faire entendre son désir de s’allier à la dynastie, il faut se porter candidat sur la
liste (fictive) des prétendants au damadlık impérial. Comment ? Les textes ne le disent pas,
mais il ne nous semble pas difficile d’extrapoler en la matière. Il suffisait certainement de
glisser quelques mots allant dans ce sens dans les bonnes oreilles, de façon anodine, badine
même, lors de conversations appropriées. Le commérage a toujours trouvé un terrain
favorable dans les sociétés de cour, car ils constituent un mode de communication et de
diffusion des informations tout à fait valable199
. Evliya Çelebi fournit d’ailleurs un exemple
de la puissance destructrice de la circulation des potins, qui parviennent à l’oreille du sultan et
l’informent de la mésentente survenue avec son épouse lors de leur nuit de noces200
.
Une fois qu’un kul s’est déclaré prétendant à la main d’une princesse, il lui reste
encore à convaincre en sa faveur et, peut-être, à négocier au mieux les conditions de son
alliance – comme nous le verrons après, certaines unions étaient plus avantageuses que
d’autres. On entre ici, malheureusement, dans un domaine de tractations discrètes, non écrites,
sur lesquelles nous ne disposons d’aucune attestation. Mais ce que les sources ne veulent pas
livrer d’elles-mêmes, il est parfois possible de le mettre en lumière malgré elles. Prenons
l’exemple d’un jeune chercheur désireux de se présenter au concours du CNRS : les textes
officiels lui permettront de savoir les consignes de mise en forme de son dossier, pas de
connaître les qualités requises pour avoir une chance d’être retenu parmi les finalistes. Il peut
alors s’en remettre à la chance ou se tourner vers sa boule de cristal, mais il serait plus avisé
de se pencher sur le profil des candidats qui ont été reçus par le passé : il y trouvera
198
« bu ‘izzet-i mah sûde ile » : Raşid, Târîh-i Râşid : vol. 2 p. 529. Cf. Annexes C.41. 199
La lecture des mémoires des courtisans à la cour de France suffit à s’en rendre compte. Elias s’est d’ailleurs penché sur cette nature comportementale des nobles : Elias, La société de cour : 98-114. 200
Evliyâ, Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, vol. 1 livre 6 p. 76 ; cf. Annexes C.31.
Page | 179
certainement des informations utiles sur les atouts officieux, le reste étant affaire de
circonstances. De façon similaire, le profil des gendres, c’est-à-dire des candidats kul qui ont
effectivement été jugés dignes de cet honneur, peut permettre de fournir quelques éléments de
réponse concernant les arguments en faveur d’un candidat potentiel.
Dès lors que les sultans ottomans suivirent la pratique de marier leurs filles à leurs kul,
ils leurs imposèrent de divorcer de leurs femmes précédentes avant d’être honorés de la main
d’une sultane201
. L’application de cette règle dynastique avait une conséquence : le gendre
devait être en capacité de se séparer de sa (ses) femme(s). L’affaire n’était pas évidente : par-
delà les règles juridiques, la capacité d’un homme à répudier sa femme dépend de la
puissance de sa belle-famille. Plus la famille était puissante, plus la séparation était
difficile202
: un kul qui aurait déjà conclu une alliance matrimoniale avec une famille puissante
n’avait peut-être pas avantage à rompre celle-ci en répudiant son épouse, ce qui constituait un
affront à la famille. Dans la mesure où nous n’avons pas connaissance de conflits du genre, il
faut supposer que les candidats retenus étaient sélectionnés parmi les kul susceptibles de se
soumettre à cette obligation203
.
D’autres pachas pouvaient encore être exclus par souci de favoriser une certaine
symbiose du couple. Leslie Peirce a en effet noté que, sous les règnes de Selim Ier et de
Süleyman Ier, seuls les kul susceptibles de remplir pleinement leur rôle conjugal avaient été
mariés à des princesses. Ainsi, Hadım Süleyman Pacha, eunuque, en avait été exclu ;
Mustafa Pacha avait été séparé de son épouse, Fatma Sultane, lorsque ses préférences
homosexuelles avaient été révélées par la princesse, qui s’en était plainte au sultan, son père.
Peirce avance encore l’idée qu’Ayas Pacha aurait été écarté en raison de ses penchants
violents204
. Les eunuques, les homosexuels, les violents… Les exclus sont tous ceux qui, pour
une raison ou une autre, auraient été incapables de tenir leur rôle et d’exalter, par leur
exemple même, le caractère inégalable de la dynastie ottomane. Les candidats se devaient
d’être irréprochables, car ces mariages exaltaient la soumission de l’époux à la princesse, du
pacha à la dynastie. Cette règle ne vaut pourtant que dans les cas de pouvoir fort : qu’un
201
Cf. Chapitre 1.III.2.2. 202
L’étude des registres de cadi et des textes juridiques a permis de nombreux travaux sur la question des séparations conjugales, dont : Fatma M. Göçek et David M. Baer, « Social Boundaries of Ottoman Women’s Experience in Eighteenth-Century Galata Court Records », dans Women in the Ottoman Empire. Middle Eastern Women in the Early Modern Era, M. C. Zilfi (éd), Leiden / New York / Köln, Brill, 1997 : 48-65 ; Imber, « Involuntary’ Annulment of Marriage » ; Jennings, « Women in Early 17
th Century Ottoman Judicial Records » ;
du même auteur, « Divorce in the Ottoman Sharia Court of Cyprus » ; Haim C. Gerber, « Social and Economic Position of Women in an Ottoman City, Bursa (1600-1700) », International Journal of Middle East Studies 12 (1980) : 231-244 ; Sonbol, Women, the Family and Divorce Laws ; Tucker, « Ties that Bound » ; Zarinebaf-Shahr, « Ottoman Women and the Tradition of Seeking Justice » ; Zilfi, « ‘We Don’t Get Along’ ». 203
Le fait qu’il n’existe, dans la littérature, aucune attestation de divorce de pacha marié avec une fille de grande famille, en vue d’une union avec une princesse, confirme l’idée qu’aucun cas de la sorte ne s’est présenté. On peut penser que si une telle chose s’était produite, la littérature en aurait parlé, car cela n’aurait pas manqué de soulever quelques protestations de la part de la famille rejetée. Inversement, il faut alors penser que lorsqu’un pacha prenait la décision de se marier avec une fille d’ouléma ou d’un autre pacha, il savait s’interdire de la sorte toute possibilité d’union royale – sauf à ce que sa femme ne vienne à mourir entre-temps. De tels mariages pouvaient constituer une stratégie avisée pour un pacha préférant éviter la dépendance et les obligations d’une union avec une princesse. 204
Peirce, « The family as faction » : 107.
Page | 180
sultan se retrouve en position de faiblesse politique, qu’il soit mineur ou mentalement dérangé
ou que la dynastie ait un besoin pressant d’alliances pour soutenir son autorité, et ces
restrictions s’envolaient : la raison d’État primait alors.
Un véritable travail de prosopographie dédié à la carrière des gendres impériaux n’a
pas été possible, pour des raisons déjà invoquées. Néanmoins, dans les grandes lignes, les kul
retenus pour devenir gendres impériaux semblent répondre à deux profils : on note ceux qui
ont été mariés relativement tôt dans leur carrière et ceux pour qui, au contraire, le mariage en
est une sorte de consécration. Dans tous les cas, pour devenir gendre, il fallait déjà être engagé
sur la voie d’une carrière prometteuse. Les damad recensés sur l’ensemble de la période
n’accèdent à l’honneur du damadlık qu’après avoir fourni la preuve de leurs compétences.
Entre la seconde moitié du XVe et la fin du XVI
e siècle, la majorité des gendres sont des
pachas qui n’ont pas encore atteint les plus hautes marches de l’État : c’est en partie l’alliance
impériale qui leur en assure l’accès. Les sultans montrent alors une préférence envers les kul
qui leurs sont proches et sont susceptibles de leur apporter soutien et fidélité, comme nous
l’avons déjà noté, tout particulièrement en début de règne, lorsqu’un sultan cherche à
personnaliser son équipe gouvernementale. Ebru Turan a relevé ce phénomène sous les règnes
de Bayezid II et de Selim Ier205
; il en va de même à propos des gendres de Süleyman Ier et
Selim II206
. La carrière des futurs gendres fait alors l’objet d’une attention particulière et leur
élévation au damadlık impérial se fait quand les preuves se sont accumulées. Citons
notamment l’exemple de Rüstem Pacha, gendre de Süleyman Ier, qui s’était distingué bien
avant son mariage : il semble que le sultan ait eu très tôt le souhait d’en faire un gendre
impérial, probablement dès son envoi à Diyarbakır comme beylerbey ; ce n’est pourtant qu’à
son retour qu’il fut appelé à devenir tout à la fois son gendre et son grand vizir207
. On pourrait
en dire de même de la carrière de Sokollu Mehmed Pacha, qui avait déjà fait les preuves de
ses capacités professionnelles ainsi que de sa fidélité lorsqu’il fut nommé troisième vizir de la
coupole et, dans la foulée, gendre du futur sultan, Selim II208
. Le cas d’Ibrahim Pacha, gendre
de Murad III, relève de la même dynamique209
. À cette époque, le repérage se fait tôt, mais
l’accès aux plus hauts postes paraît (partiellement) conditionné à l’obtention du damadlık
impérial, qui précède et favorise la nomination au grand vizirat, pour les deux exemples
donnés, ou aux postes-clés de l’administration, pour les autres.
Durant la première moitié du XVIIe siècle, le profil des gendres impériaux se modifie
légèrement. De fait, la dynastie est confrontée à deux problèmes : la faiblesse de son pouvoir,
avec des régences à répétition et des révoltes difficilement contrôlées, et un déficit du nombre
de princesses disponibles pour la création d’alliances matrimoniales. La dynastie ne peut plus
se permettre de suivre la carrière d’un pacha sur plusieurs années jusqu’au moment opportun
pour le marier à une princesse. D’ailleurs, l’aspect général des carrières professionnelles se 205
Turan, « The Marriage of Ibrahim Pasha » : 16-35. 206
Peirce, « The Family as Faction » : 106-108. 207
Altundağ et Şerafettin, « Rüstem Paşa » ; Gökbilgin, « Rüstem Paşa ve Hakkındaki İthamlar » ; Topaloğlu, « Rüstem Paşa » ; Woodhead, « Rüstem Pasha ». 208
Afyoncu, « Sokollu Mehmed Paşa », TDVİA 37 : 354-357 ; Tahsin Özcan, « Mehmet Paşa (Sokollu, Damat) », OA : t. 2 p. 168-172 ; Veinstein, « Sokollu Muhammed (Mehmed) Pasha ». 209
Nezihi Aykut, « Damad İbrâhim Paşa », TDVİA : t. 8 p. 440-441 ; İsmet Parmaksızoğlu, « İbrahim Paşa », İA : t. 5/2 p. 915-919 ; Vernont J. Parry, « İbrâhîm Pasha, Dâmâd », EI 2 : t. III p. 65-66
Page | 181
modifie à la même époque, avec une rotation des postes beaucoup plus rapide210
. Mutation
des conditions politiques, évolution des carrières professionnelles : le modèle du gendre idéal
du XVIe siècle n’est plus de mise. Le type du gendre émérite vient le supplanter.
L’association entre l’accès au grand vizirat et l’alliance avec la dynastie se maintient, mais
selon une logique inverse. Le mariage avec une fille de sultan ne constitue plus une étape
préparatoire qui ouvre la voie au grand vizirat, mais un honneur venant concrétiser la
puissance reconnue d’un pacha. On comprend dès lors la précarité de ces alliances et la
disparition rapide des gendres impériaux : mariés en fin de carrière, à un âge bien avancé, ils
ne restent unis que peu de temps avec la princesse – qu’ils viennent à décéder de mort
naturelle ou qu’ils soient exécutés sur ordre du sultan.
Par la suite, les deux types de profil semblent s’être maintenus et avoir coexistés, à
certains moments. Les filles de Mehmed IV, d’Ahmed II et de Mustafa II sont mariées de
préférence à des dignitaires accomplis. Mais le règne d’Ahmed III, qui se distingue par sa
stabilité, montre les deux tendances. Ainsi, durant les trois siècles d’histoire ottomane étudiés,
deux types principaux de gendres impériaux se distinguent : celui du gendre honoré en plein
milieu de sa carrière, qui doit sa promotion aux plus hauts postes à son alliance avec la famille
impériale, et le gendre en fin de carrière, dont l’union avec la famille régnante vient consacrer
une carrière réussie et qui apporte son soutien et sa puissance politique au sultan. Le type de
profil de gendre dépend donc de la puissance même du sultan, c’est-à-dire du contexte
politique dans lequel l’union s’inscrit. Le sultan n’est à même de choisir des gendres dont il a
personnellement suivi la carrière que lorsque son pouvoir est stable et s’enracine dans la
durée211
.
Des dignitaires très puissants, qui imposent leurs choix matrimoniaux ; d’autres, forts
de la faveur du sultan, qui se permettent de refuser ses offres ; tandis que d’autres encore y
sont contraints : le tableau qui émerge est donc plutôt mitigé. La personnalité et les
circonstances semblent compter presque autant que la position ou les intérêts de ces candidats.
Mais le fait que certains se permettent de refuser les propositions qui leurs sont faites, quand
d’autres les espèrent, montre que l’alliance avec la dynastie était ambivalente : en épousant
une fille de sultan, le pacha s’assurait une voie d’accès informelle à la personne du sultan,
mais, inversement, procurait à celui-ci les moyens d’une surveillance plus étroite de ses
activités. L’alliance entre la dynastie et le dignitaire (et son réseau) sous-entend l’acceptation
implicite d’un pacte de réciprocité qui, une fois conclu, ne peut être rompu que par la
dynastie. On comprend que certains aient préféré repousser une proposition à double
tranchant.
210
D’après Metin Kunt, un pacha ne resterait pas plus d’un an et demi au même poste. Il note également qu’il peut s’écouler un temps presque aussi long avant que celui-ci ne retrouve un autre poste. Toutes les conséquences de ce système sont largement développées dans son ouvrage : Kunt, The Sultan’s Servants : 75-93. 211
L’essentiel de ces critères se retrouve aux périodes ultérieures. Olivier Bouquet a présenté les résultats de ses travaux sur la question des gendres impériaux du XIX
e siècle lors d’une conférence réalisée à l’Institut
Français d’Études Anatoliennes, le 1er
février 2010, intitulée « Les damad du sultan : comment en écrire l’histoire ? ». Cette conférence eut lieu dans le cade d’un séminaire mensuel que nous avions organisé sous l’intitulé : « Les femmes dans l’Empire ottoman ». La vidéoconférence est disponible en ligne sur le site de l’IFEA : www.ifea-istanbul.net.
Page | 182
4. Attendre l’annonce de son mariage et s’en réjouir : la participation limitée
des princesses
Le tableau des acteurs des négociations matrimoniales ne saurait être complet sans
qu’il soit question de la principale intéressée : la princesse. Si elle est l’enjeu de ces
négociations, elle en demeure largement absente. Il est vrai que la culture ottomane place la
fille sous la puissance paternelle : le choix de l’époux repose sur le père ou son substitut (en
cas d’absence), de sorte qu’une jeune fille qui n’a encore jamais été mariée ne peut choisir de
façon autonome son époux212
. L’âge des fiancés est un premier critère à prendre en
considération. Si l’état des sources ne permet pas de fournir des résultats concrets quant à
l’âge au mariage des princesses pour les périodes les plus reculées (XIVe et XV
e siècles), le
recoupement des informations à partir du XVIe siècle et les mentions parfois directes des
chroniqueurs des XVIIe et XVIII
e siècles permettent de dresser quelques constatations. Au
XVIe siècle, les princesses sont généralement mariées à la puberté ou quelques années après,
lorsqu’elles ont entre douze et dix-sept ans. Ce sont encore des jeunes filles qui n’ont jamais
quitté le Palais. À partir du XVIIe siècle, l’âge du premier mariage s’abaisse de façon
radicale : on fiance ou marie les princesses avant même qu’elles ne sortent de l’enfance. Leur
jeune âge est un facteur déterminant pour comprendre leur absence au cours des
négociations : elles ne sont tout simplement pas en mesure d’y participer.
Tableau 2.18. Nombre et durée des mariages des sultanes du XVIIe et XVIIIe siècle
Nom et lien filial de
la princesse
Date de
naissance-décès
Âge à la
1re
union
1re
union
(durée)
2e union
(durée)
3e union
(durée)
4e
union
(durée)
5e
union
(durée)
6e
union
(durée)
7e
union
(duré
e)
Ayşe (f. Ahmed I) 1605 ou 1608 –
56 (?)
= 4 ou 7
ans
1612>14
(2 ans)
1620>21
(1 an)
1626>32
(6 ans)
1635>
36
(1 an)
1639>
44
(5
ans)
1645>
49
(4 ans)
1654
>
55
(1 an)
Fatima (f. Ahmed I) 1606-après
1667
= 18 ans 1624>25
(1 an)
1626>28
(2 ans)
1631>36
(5 ans)
1660>
62
(2 ans)
1663>
66
(3
1667>?
212
Leslie Peirce a fourni un exemple contradictoire qui montre toutes les difficultés, pour une jeune fille mature, d’avoir voix au chapitre de son propre mariage. La fille en question vint en effet clamer ouvertement devant le tribunal son désir de choisir par elle-même son époux et refuser celui que son père voulait lui donner. Néanmoins, l’unique ressort de sa stratégie consiste à trouver un homme de sa famille capable d’être sa représentante au lieu de son père : le poids de la famille et le rôle décisif des hommes dans la conclusion du mariage ne sauraient être remis en cause. Cette affaire a été présentée lors d’une conférence donnée par la susdite à l’Institut Français d’Études Anatoliennes, le 1
er décembre 2009, intitulée « ‘I am my own agent !’
Women and the rocky road to marriage in early modern Anatolia ». Cette conférence eut lieu dans le cadre d’un séminaire mensuel « Les femmes dans l’Empire ottoman » que nous avions organisé. La vidéoconférence est disponible en ligne sur le site de l’IFEA : www.ifea-istanbul.net.
Page | 183
ans)
Gevherhan (f.
Ahmed I)
1605 (?) – après
1656
= 7 ans (?) 1612>20
(8 ans)
1623>32
(9 ans)
? 1643>
56
(13
ans)
Hanzade (f. Ahmed
I)
1607 (?) – 1650 = 16 ans 1623>38
(15 ans)
1643>50
(7 ans)
Atike (f. Ahmed I) ? – après 1670 = au - 16
ans
1633>47
(14 ans)
1647>52
(5 ans)
1652>70
(18 ans)
Übeyde (f. Ahmed
I)
? – après 1647 ? 1641>47
(6 ans)
Kaya İsmihan (f.
Murad IV)
1633-52 = 11 ans 1644>52
(8 ans)
Rukiyye (f. Murad
IV)
? – 1696 1663>85
(22 ans)
1693>96
(3 ans)
Gevherhan (f.
İbrahim)
1642 – 1694 = 4 ans 1646>47
(1 an)
1647>81
(34 ans)
1692>94
(2 ans)
Fatima (f. İbrahim) 1642 –1682 (?) = 3 ans 1645>46
(1 an)
1646>57
(11 ans)
1667>78
(11 ans)
Beyhan (f. İbrahim) 1645 – 1700 = 1 an 1646>47
(1 an)
1647>48
(1 an)
? > 1683
1689>
99
(10
ans)
Atike (f. İbrahim) 1648>59
(11 ans)
1659>66
(7 ans)
Hadice (f. Mehmed
IV)
1660 (?) – 1743 = 15 ans
(?)
1675>86
(11 ans)
1691>1713
(22 ans)
Fatima (f. Mehmed
IV)
? – 1700 1695>97
(2 ans)
1698>1700
(2 ans)
Ümmü-gülsüm (f.
Mehmed IV)
Avant 1680 –
1720
1693>
1720
(27 ans)
Ayşe (f. Mustafa II) 1696 – 1752 = 7 ans 1703>19
(16 ans)
1720>24
(4 ans)
1725>28
(3 ans)
Emine (f. Mustafa
II)
1696 – 1739 = 5 ans 1701>01
(1 an)
1708>11
(3 ans)
1712>26
(14 ans)
1728>
36
(8 ans)
Safiye (f. Mustafa
II)
1696 – 1778 = 7 ans 1703>23
(20 ans)
1726-28
(3 ans)
1740>
59 (19
ans)
Emetullah (f.
Mustafa II)
1701 – 1727 = 19 ans 1720>24
(4 ans)
Fatima (f. Ahmed
III)
1704 – 1733 = 4 ans 1708>16
(8 ans)
1717>33
(16 ans)
Ümmü-gülsüm (f.
Ahmed III)
1708 – 1732 = 1 an 1709>15
(6 ans)
1724>30
(6 ans)
Hadice (f. Ahmed
III)
1710 – 1738 = 14 ans 1724>35
(11 ans)
Atike (f. Ahmed III) 1712 – 1737 = 12 ans 1724>37
(13 ans)
Saliha (f. Ahmed III) 1715 – 1778 = 13 ans 1728>31
(3 ans)
1736>44
(8 ans)
1758>63
(5 ans)
1764>
70
(6 ans)
Ayşe (f. Ahmed III) 1715 – 1775 = 13 ans 1728>37 1740>48 1758>75
Page | 184
(9 ans) (8 ans) (17 ans)
Zeyneb (f. Ahmed
III)
1720 – 1774 = 8 ans 1728>64
(36 ans)
1765>74
(9 ans)
Esma (f. Ahmed III) 1726 – 1788 = 17 ans 1743>44
(1 an)
1758>74
(16 ans)
Zübeyde (f. Ahmed
III)
1728 – 1756 = 20 ans 1748>48
(6 mois)
1749>56
(7 ans)
Une princesse d’âge mûr avait-elle la possibilité de choisir son époux ou de participer
aux négociations en vue de son mariage ? À partir de la seconde moitié du XVIe siècle, le cas
de figure est relativement fréquent : la différence d’âge entre les époux conduit souvent ces
princesses, filles ou descendantes indirectes des sultans, à se retrouver veuves et susceptibles
de se remarier. Or, plusieurs exemples nous montrent que, dans ce cas de figure, la veuve
pouvait décider de son destin, ou pour le moins y contribuer. Ainsi Şah Sultane, divorcée de
Lütfi Pacha, aurait-elle choisi de ne pas se remarier213
. Elle ne fut pas la seule : d’autres
suivirent son exemple, telle Mihrimah Sultane après la mort de Rüstem Pacha et l’échec de
son projet de remariage avec Semiz Ali Pacha214
. Le remariage n’était donc pas
nécessairement une obligation, mais on peut se demander dans quelle mesure le veuvage était
un choix : les impératifs de la politique passaient avant les désirs personnels de ces femmes et
le sultan pouvait, en dernier ressort, imposer sa décision.
On constate en effet une très forte propension au remariage, qui s’accentue au cours du
temps. La maturité et la puissance acquise au cours de la première expérience maritale
offraient probablement à ces veuves une certaine autonomie décisionnelle. Et quelques-unes
d’entre elles seraient alors parties à “la chasse à l’époux”, à en croire les commentaires
d’Hammer. Outre l’exemple de la tentative avortée de Mihrimah Sultane auprès de Semiz Ali
Pacha, dont elle semble avoir été l’initiatrice, il faut encore mentionner ses nièces, à propos
desquelles Hammer à ces mots peu amènes :
« Rongées d’ambition malgré leur âge, les veuves de Sokolli et de Pialé n’eurent pas
de repos qu’elles n’eussent convolé en de secondes noces. […] Esma, veuve de
Sokolli, femme petite et laide, mais d’un esprit actif, après avoir vainement espéré
s’unir à Osman Pacha, donna sa main à Kalaïlikof Ali Pacha, successeur d’Oweïs
Pacha dans le gouvernement d’Ofen […]. »215
Que les commentaires soient le fait de l’auteur, c’est certain. Toutefois, il faut bien
reconnaître que son analyse n’est pas tout à fait erronée : les trois sultanes avaient alors un âge
suffisamment respectable pour ne pas avoir à subir de pressions quelconques de la part du
sultan régnant. Il est d’ailleurs possible qu’il n’ait pas vu ces alliances d’un très bon œil :
fortes de leurs expériences politiques et de leurs réseaux (qui avaient bénéficié de l’appui et
de la puissance de leurs précédents époux), ces sultanes étaient devenues de puissants agents
213
Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 32-33 ; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 42 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 153-154. 214
Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 38-39 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 187-191 ; Necipoğlu, The Age of Sinan : 296-299. 215
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : 73.
Page | 185
politiques au sein de la cour ottomane216
. Dans ces conditions, il n’est pas étonnant que leur
main ait été recherchée par d’autres dignitaires, sitôt devenue libre : l’union laissait présager
un accroissement du pouvoir du prétendant, tout en raffermissant la position de ces veuves,
affaiblie par la disparition de leurs époux respectifs.
De même que pour les pachas précédemment, il convient de s’interroger sur le profil
de ces futures épouses et sur les critères qui faisaient pencher la balance en faveur de l’une
plutôt que de l’autre, au moment du choix de la fiancée. Les sultanes étaient-elles vraiment
interchangeables entre elles, comme le laissait entendre le billet de Kösem Valide Sultane ?
Ou bien faut-il croire Evliya Çelebi, quand il laisse entendre que certains critères comme l’âge
ou la virginité avaient quelque valeur ? Et dans ce cas, quelles étaient les qualités recherchées
de préférence chez ces femmes ? Contraintes et restrictions n’étaient pas qu’une affaire
d’hommes : elles atteignaient également la partie féminine. La première de ces contraintes
était l’âge des princesses, point sur lequel il nous faut revenir ici. Nous avons vu que jusqu’à
la fin du XVIe siècle, on mariait ces jeunes femmes après leur puberté
217. Ainsi, les trois filles
de Selim II mariées lors de la triple cérémonie de 1562 (Ismihan, Gevherhan et Şah) avaient
entre 17 et 19 ans218
. Hümaşah Sultane, autre petite-fille de Süleyman Ier, fut mariée aux
alentours de la trentaine, comme nous l’avons déjà noté. Un délai s’imposait donc aux sultans,
qui devaient attendre que les années de l’enfance se soient écoulées avant de pouvoir marier
une princesse. La contrainte pouvait se révéler de taille dans le cas de règnes difficiles,
lorsque le besoin en alliances se faisait pressant, ou pour des sultans montés sur le trône à un
jeune âge, avant d’avoir eu des enfants (ou alors que ceux-ci sont encore tout petits). Ainsi
Süleyman Ier : monté sur le trône en 1520, à l’âge de 20 ans, ses premiers enfants avaient vu
le jour peu avant son ascension au trône. Son unique fille serait née dans l’année 1522 ; elle
fut mariée en 1539 : elle avait environ 17 ans219
. Süleyman Ier avait donc dû attendre près de
20 ans avant de pouvoir construire son unique alliance matrimoniale directe220
.
Le cas de Süleyman Ier soulève un autre aspect du problème : le nombre de princesses
disponibles. Or, si un sultan disposant d’une descendance féminine nombreuse, ou profitant
de celle de son prédécesseur, pouvait aisément nouer des alliances, trop de princesses à
marier, comme ce fut le cas pour Mehmed III et ses nombreuses sœurs, posait un vrai
problème à la dynastie et leur faisaient perdre de la valeur sur le marché matrimonial. La
valeur d’une sultane dépend donc de la pression ou de la dilatation du marché matrimonial
dynastique au moment où elle s’y présente : Mihrimah Sultane, fille unique de Süleyman Ier,
vit sa valeur s’envoler du simple fait de l’absence de sœurs ; de même, en présence de filles
disponibles pour le mariage, les sœurs étaient moins recherchées, car l’alliance directe avec le
sultan est préférable à celle avec une parente. Ainsi, la qualité d’une alliance est toujours
216
Cf. chapitre suivant 4.I.3.3. 217
Le silence des chroniqueurs sur l’âge des princesses mariées, pendant toute la période allant du XIVe siècle
jusqu’au XVIe siècle, laisse à penser qu’il n’avait rien de surprenant pour les pratiques traditionnelles – ce n’est
pas le cas par la suite. 218
D’après Necipoğlu, Ismihan serait née en 1544, Şah en 1545. Necipoğlu, The Age of Sinan : 331 ; 368. D’après Uluçay, Gevherhan serait également née en 1544. Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 41. 219
Necipoğlu, The Age of Sinan : 296. Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 38. 220
Pendant ce temps, il eut recours à ses sœurs pour construire des alliances, qui n’offraient toutefois pas un lien de proximité avec le sultan aussi privilégié.
Page | 186
affaire de circonstances et dépend d’un marché matrimonial extrêmement fluctuant, qui peut
se renverser à tout moment.
Le contexte politique complexe du début du XVIIe siècle ne permet plus aux sultans
d’attendre pour se ménager des alliances avec leur élite turbulente. Aussi la dynastie n’hésite-
t-elle pas à innover et à marier les princesses à un très jeune âge : certaines sultanes furent
fiancées à partir de trois ans !221
Sitôt appliquée, la pratique s’installe durablement et s’impose
comme une tradition. Elle avait ses avantages : elle permettait de réduire le délai entre la
naissance et le mariage d’une sultane. Par ricochet, elle accroissait également le nombre de
princesses disponibles au mariage. La baisse de l’âge au premier mariage allongeait la durée
pendant laquelle une princesse pouvait être mariée. Cette modification des pratiques
matrimoniales permet de marier les princesses du XVIIe et XVIII
e siècle un plus grand
nombre de fois (entre trois et quatre fois en moyenne).
Tout cela ne concerne cependant que les filles de sultan, qui étaient sujettes, comme
nous avons eu l’occasion de le rappeler à de nombreuses reprises, à la raison d’État. La
conclusion ne semble pas s’appliquer aux princesses indirectes. Non que nous disposions de
données d’ordre démographique à leur sujet, loin de là : ni leurs dates de naissance, ni celles
de leur(s) mariage(s) ne sont connues – en tout cas dans les sources consultées dans le cadre
de cette recherche. Cependant, l’absence de notification particulière à ce sujet chez les
chroniqueurs – qui laissaient sous-entendre leur désapprobation concernant l’âge au premier
mariage des filles de sultan – est un premier indice. Une autre indication est le nombre de
leurs époux : réserve faite du manque criant d’informations à ce sujet, tout laisse à penser que
les princesses indirectes n’étaient mariées qu’une fois ; les quelques cas de remariage connus
présentent un caractère d’exceptionnalité. De sorte qu’on peut penser que les remariages
successifs et un âge très bas au premier mariage étaient des données propres aux filles de
sultan, au gré des enjeux politiques sous-entendus par leurs unions.
Une dernière contrainte résidait dans le délai légal avant remariage, imposé par les
préceptes musulmans. D’après la législation musulmane, le remariage d’une veuve ou d’une
femme divorcée ne pouvait avoir lieu qu’après un délai de quelques mois au cours duquel on
s’assurait que la femme en question n’était pas enceinte. Cette disposition souligne les
précautions prises concernant la définition des lignages : il n’était pas question de se tromper
dans l’attribution de la paternité d’un enfant ou qu’un doute puisse flotter sur ce point. La
précaution était d’autant plus prise au sérieux que les familles étaient puissantes et accordaient
une attention spécifique aux questions lignagères. Ces prescriptions répondaient encore à des
considérations financières : le père devait subvenir aux besoins de ses enfants, que ce soit
après divorce (par l’octroi d’une allocation) ou post-mortem (par les droits sur l’héritage dont
l’enfant était gratifié)222
. Le décès d’un mari ne remettait donc pas immédiatement sa veuve
sur le marché matrimonial, qu’elle soit une femme du peuple ou une princesse.
221
Cf. Çağatay M. Uluçay, « Beş yaşında iken nikâhlanan ve beşikte nişanlanan sultanlar », dans Sancaktan Saraya, Seçme Yazılar, M. S. Koz et H. Şahin (éds.), Istanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2012 : 285-291. 222
Yvon Linant de Bellefonds, Traité de droit musulman comparé. T. 3 : filiation, incapacités, libéralités entre vifs, Paris / La Haye, Mouton & Co, 1973.
Page | 187
*
Le mariage d’une princesse était donc la conclusion d’un long processus de
négociation entre de nombreux protagonistes, plus ou moins actifs et autonomes. Le rapport
de force entre eux variait selon le contexte politique, la position sociale, les intérêts
personnels et étatiques, enfin la personnalité des individus impliqués. Le sultan, ultime
décideur, fut souvent obligé, dans la pratique, de composer avec les factions en place, quitte à
en promouvoir de nouvelles pour contrebalancer celles déjà existantes. Les limites de la
puissance impériale sont particulièrement visibles lors de périodes de régence ou de faiblesse
du pouvoir : le choix n’est plus alors celui du sultan, mais l’expression des intérêts de la reine
mère ou du grand vizir, voire des factions en place. Les principaux interlocuteurs sont les
candidats, eux-mêmes en situation variable : tantôt à même d’imposer ou de faire entendre
leurs intérêts, ils demeurent contraints par la puissance impériale et par les modalités de
négociation imposées par la dynastie.
Les femmes ne sont pas en reste dans ce jeu d’alliances matrimoniales. Les mères des
princesses instrumentalisent leurs filles pour défendre ou renforcer leur position, tout en étant
forcées de composer avec les principales figures féminines de la cour, la valide sultan et la
haseki qui, fortes de leur position hiérarchique et de leur proximité avec le sultan, tenaient le
haut du pavé. Les intérêts personnels de ces grandes figures féminines du Harem Impérial les
placent dans une situation d’opposition quasi systématique : la valide sultan se sent menacée
par la montée en puissance de la haseki, sa remplaçante probable, laquelle voit elle-même son
influence politique limitée par le poids de la reine mère. La grande absente est la principale
intéressée : la princesse. Hormis des rares cas où sa position lui permet de faire valoir une
certaine autonomie (en situation de veuvage ou de divorce, à un âge mûr), elle est soumise
aux décisions prises par d’autres concernant son avenir conjugal. Ainsi, les mariages des
princesses relèvent d’une dynamique presque exclusivement politique, sur laquelle les
princesses ont peu d’influence – sauf à pouvoir s’en servir elles-mêmes à des fins
personnelles.
Page | 188
CONCLUSION : Des unions placées sous le signe de la
dépendance
L’une des grandes spécificités de la dynastie ottomane réside dans ses pratiques
matrimoniales atypiques qui surprenaient tant les voyageurs occidentaux, habitués à un
système d’alliances matrimoniales entre membres d’une même classe, voire au sein d’une
même famille. De fait, en Occident « les mariages entre les souverains, ou leurs fils, et des
femmes qui n’auraient pas été issues du même groupe social étaient très rares : les rois
n’épousaient pas leurs sujettes, instituant ainsi une barrière biologique entre les souverains et
les autres »223
. Ce principe repose sur la conception d’une pureté du sang, partagé par
l’ensemble de la société aristocratique, la famille royale n’en étant qu’un exemple parmi tant
d’autres224
. L’endogamie et la peur de la mésalliance deviennent les deux facteurs principaux
réglant le choix des conjoints. Ainsi, « une des règles non écrites de la monarchie française,
élaborée par les jurisconsultes du XVIe siècle, exige que les enfants de roi choisissent leur
conjoint hors du royaume au sein des familles souveraines »225
, donnant naissance à une
« société de princes » à l’échelle européenne226
. La conception de l’alliance matrimoniale
prônée par les dynasties européennes repose donc sur plusieurs principes codépendants :
l’exaltation de la pureté du sang, l’endogamie sociale, et finalement, la supériorité des
lignages souverains qui ne trouvent d’égal que chez leurs parents.
Les Ottomans recherchaient également l’exaltation de leur supériorité dynastique,
mais ils instituèrent pour cela un système radicalement différent. La signification symbolique
et les conséquences politiques et sociales de l’élaboration du système matrimonial ottoman
ont suscité moins de réactions que le constat, somme toute banal, d’un renforcement des liens
entre la dynastie et son élite dirigeante. En 1976, Paula Sutter Fichtner regrettait que les
mariages royaux (européens), en tant qu’objet historique, étaient considérés comme
anecdotiques ; la même remarque pourrait être formulée à l’égard de l’histoire ottomane. Un
regain d’intérêt pour l’étude des mariages princiers apparut avec leur insertion dans l’histoire
des relations internationales. C’est peut-être pour cette raison que les historiens de l’Empire
ottoman montrèrent un tel désintérêt pour ces événements. Dès le milieu du XVe siècle, les
Ottomans abandonnèrent la pratique des mariages interdynastiques ; dès lors qu’il n’y avait
plus de mariages entre les dynasties régnantes, c’et-à-dire plus d’échanges politiques ou
diplomatiques fondés sur ces unions, les mariages princiers ottomans perdaient leur raison de
figurer dans le vaste domaine d’étude des relations internationales.
C’est pourtant là que résident tout le cœur et l’intérêt de ces stratégies matrimoniales,
dans ce refus volontaire d’utiliser les mariages princiers comme vecteur d’échanges
internationaux. Cette volonté politique contraignit les Ottomans à instaurer une autre
conception politique et dynastique. Le nouveau système des alliances matrimoniales 223
Poutrin et Schaub (éd.), Femmes et pouvoir politique : 30. 224
Leferme-Falguières, Les courtisans : 106-107. 225
Leferme-Falguières, Les courtisans : 106. 226
Bély, La société des princes : passim.
Page | 189
ottomanes est le fruit d’une construction politique de longue haleine, dont nous avons
décortiqué les étapes principales. Initiée au milieu du XVe siècle, sous le règne de Mehmed II,
son élaboration se poursuit sur plus d’un demi-siècle, avant de prendre une forme définitive et
pérenne. Cette chronologie coïncide avec les différentes phases du vaste courant politique de
promotion des esclaves dans le système palatial et administratif ottoman. Elle s’insère
également dans le mouvement de distanciation de la dynastie ottomane, qui tente de s’élever
au-dessus de toutes les autres familles, souveraines ou non, qui l’entourent. Les princesses se
retrouvent immergées dans le fouillis de cette construction étatico-dynastique tâtonnante, non
comme actrices, mais instruments de ce nouvel agencement.
Le parallèle avec la famille royale française est frappant : la célèbre loi salique n’est-
elle pas, elle aussi, le fruit d’une construction répondant à des enjeux politiques et dynastiques
précis ? N’a-t-elle pas entraîné une redéfinition de la place des princesses, de leurs rôles et
devoirs, des limites de leur action au sein de la dynastie française ? Son but premier n’était-il
pas leur exclusion de la souveraineté, tant de son exercice personnel que de sa transmission –
les princesses ottomanes subiront le même sort, comme nous le verrons ultérieurement ?
Enfin, dernier parallèle, les stratégies matrimoniales de la dynastie française n’avaient-elles
pas pour idéal la proclamation de la souveraineté dynastique sur les autres lignages, internes
comme externes ?227
Ces deux dynasties que tout sépare, tant au niveau de la culture que de la
religion, donnèrent toutes deux naissance à deux conceptions dynastiques qui furent le fruit
d’un véritable travail de construction théorique : l’une donna naissance à toute une littérature
protestataire ou de défense qui prit le nom de « querelle des femmes »228
, tandis que l’autre
s’appliqua silencieusement par la répétition d’une coutume valant force de loi229
.
Et pourtant, la similitude de finalité des deux conceptions produisit des pratiques
divergentes, dont l’une des expressions réside notamment dans leur système respectif
d’alliances matrimoniales. Le système français offrait aux Filles de France la possibilité de
devenir reines, dans un pays étranger. Les princesses ottomanes des premiers siècles le
pouvaient aussi, tant qu’elles furent mariées à des princes souverains étrangers. Dès lors que
les sultans mirent fin aux alliances interdynastiques, ces dernières perdirent cette faculté de
devenir des reines étrangères230
. Le système matrimonial ottoman a donc cette particularité
227
La loi salique fut magnifiée par les théoriciens de la monarchie française pour signifier la supériorité des rois de France sur tous les autres monarques : « Venant les successeurs de mâle en mâle, l’héritier est toujours certain et si est du même sang de ceux qui ont été auparavant » souligne Claude de Seyssel dans La grande monarchie de France, publié en 1519. Grâce à cette loi, les rivalités successorales étaient évitées et la France pouvait donner des rois à toute la terre, sans jamais courir le risque de voir un étranger occuper le trône de France. Cité dans Poutrin et Schaub (éd.), Femmes et pouvoir politique : 24. 228
Une formidable étude sur les origines et conséquences politiques, sociales et théoriques de la loi salique a été réalisée par Éliane Viennot. Elle insiste notamment sur les résistances auxquelles elle donna lieu. Cf. Viennot, La France, les femmes et le pouvoir. L’invention de la loi salique. 229
Il en sera question plus en détail dans le chapitre suivant : 4.I.1.2. et 4.I.1.3. 230
Nous avons été amenée à proposer une comparaison des situations respectives des princesses ottomanes et françaises au XVI
e siècle lors d’une conférence organisée dans le cadre des rencontres annuelles de la Sixteenth
Century Society, qui se tinrent à Genève du 28 au 30 mai 2009, intitulée « Les princesses dans les monarchies françaises et ottomanes au XVIe siècle. Eléments de comparaison ». Une version écrite de cette communication fut publiée dans la revue Toplumsal Tarih : Dumas, « Osmanlı Hareminden Fransız Sarayına : 16. Yüzyılda Osmanlı ve Fransız Prensesleri. 1: Evlilik Manzaralı », Toplumsal Tarih 202 (Ekim 2010) : 77-83 et « Osmanlı
Page | 190
exceptionnelle de produire des princesses à vie : nées princesses, installées sur un piédestal à
ce titre, elles vivent toute leur vie dans cet état, sans risque de rabaissement, mais aussi sans la
moindre chance d’élévation.
La grande spécificité de la dynastie ottomane est d’avoir créé un système matrimonial
reposant uniquement sur des partenaires esclaves. Leslie Peirce avait très largement montré ce
phénomène pour la partie des alliances des sultans et princes de la dynastie qui, après une
période mixte de partenaires tantôt princesses, tantôt esclaves, choisirent finalement de ne
plus contracter de mariages officiels avec des étrangères de rang royal ou princier, pour leur
préférer exclusivement des concubines esclaves231
. Un phénomène similaire se produit dans le
cas des mariages des princesses ottomanes, pour lesquelles on abandonne le système des
alliances interdynastiques au profit d’époux choisis parmi les esclaves du sultan, les kul.
Certes, ces kul ne sont pas des esclaves comme les autres. Le terme même d’esclave est à
prendre avec précaution : ces kul sont plus des serviteurs du sultan que ses esclaves à
proprement parler, bien que le souverain conserve sur eux un droit unilatéral de vie et de
mort. Finalement, l’ambiguïté du terme kul a été parfaitement résumée par Metin Kunt
lorsqu’il rappelle que le terme peut prendre trois acceptions : celui d’esclave, celui de
serviteur et, au pluriel (kullarım), dans le sens de « mes gens »232
.
L’abandon des mariages interdynastiques ne répond pas à une considération sexuée,
mais bien dynastique : membres masculins et féminins affiliés à la dynastie se retrouvent
presque aussitôt confrontés aux mêmes nouvelles exigences matrimoniales. Nous sommes
donc en présence d’une volonté politique précise qui consiste à privilégier la proximité des
esclaves, tant hommes que femmes, avec la dynastie régnante, dans son ensemble. Cette
proximité répond à des enjeux cohérents. La promotion des kul dans l’entourage du sultan
permit d’évincer tout à la fois les descendants des conquérants-compagnons des chefs
ottomans des premiers temps, les oulémas et les représentants des familles souveraines
anatoliennes voisines –selon des temporalités distinctes néanmoins. Elle favorisa ainsi la
création d’une élite militaro-administrative loyale parce que directement dépendante du sultan
par sa servilité233
, tout en écartant les individus trop indépendants et susceptibles de donner
Hareminden Fransız Sarayına : 16. Yüzyılda Osmanlı ve Fransız Prensesleri. 2: Prenseslerin Değeri », Toplumsal Tarih 203 (Kasım 2010) : 76-81. 231
Peirce, The Imperial Harem : 28-56. 232
Kunt, The Sultan’s Servants : 41-42. Metin Kunt reprend les réflexions d’autres scientifiques avant lui, dont Ménage, « Some Notes on the Devshirme » ; des travaux plus récents peuvent aussi être cités et tout particulièrement celui de Vatin et Veinstein, Le Sérail ébranlé : passim. Sur la question, il convient encore de consulter Toledano, Slavery and Abolition in the Ottoman Middle East, notamment les deux premiers chapitres, ou encore M’hamed Oualdi, Esclaves et maîtres. Les Mamelouks des Beys de Tunis du XVIIe siècle aux années 1880, Paris, Publictions de la Sorbonne, 2011. Ce dernier a également proposé une approche historiographique du traitement de la question de l’esclavage des chrétiens dans les sociétés musulmanes qui mérite d’être consultée : M’hamed Oualdi, « D’Europe et d’Orient. Les approches de l’esclavage des chrétiens en terre d’Islam », Annales. Histoire, Sciences sociales 63/4 (2008) : 829-843. 233
Notons qu’il s’agit là d’un système et d’une conception politique qui est loin d’être propre aux Ottomans. Elle n’est pas même nouvelle : les Ottomans ne font, en réalité, que suivre des pratiques utilisées dans de nombreux autres États islamiques, notamment en Égypte, dont les dynasties régnantes firent un usage très similaire de leurs mamelouks, ainsi que le rappelle Metin Kunt dans l’introduction de son troisième chapitre consacré au statut des ümerâ : Kunt, The Sultan’s Servants : 31-33. Sur bien des aspects, les Ottomans se placent d’ailleurs dans la continuité des théories politiques moyen-orientales. Voir notamment les travaux
Page | 191
naissance à des factions qui pourraient entrer en compétition avec la suprématie du pouvoir
impérial.
Les sultans ne se contentèrent pas de favoriser le recours aux esclaves ; ils leurs
fournirent les plus hautes places, en leur réservant l’accès à l’école du Palais. Or, le Palais est,
avant tout, la résidence du souverain et de sa maison, dont les esclaves et domestiques
constituent la part majoritaire. En sa qualité de chef de maison, il est normal qu’il privilégie
l’éducation de ces derniers au gré des besoins auxquels il est confronté : la formation militaire
et administrative des esclaves personnels du sultan tombe dès lors sous le sens. Le phénomène
n’était d’ailleurs pas propre au sultan, les représentants des grandes familles s’entouraient eux
aussi d’une vaste domesticité, symbole de leur puissance, qu’ils éduquaient de la même
manière, dans l’espoir d’en faire de futurs officiers. La particularité de la maison du sultan est
que son espace domestique coïncide spatialement avec l’espace politique : le Palais est la
résidence du sultan, mais c’est aussi le lieu du pouvoir. L’entrée au Palais devenait la voie
privilégiée pour réaliser une belle carrière234
. Le parallèle homme / femme prend ici une
expression particulièrement vive : les femmes qui étaient formées au sein du harem impérial
pouvaient, elles aussi, espérer s’élever socialement jusqu’à s’inscrire dans les rangs des plus
grandes dames de l’Empire235
.
En réservant l’entrée aux écoles (masculines, les pages, ou féminines, les cariye) du
Palais aux esclaves, le sultan proclamait sa supériorité au sein de sa maison (espace
domestique) et de l’État (espace politique). Il y apparaissait comme le seul homme : seul
homme libre (les autres sont des esclaves ou des eunuques), seul homme mature (jusqu’à la
fin du XVIe siècle, ses fils quittent le palais sitôt atteint l’âge adulte ; par la suite, avec
l’apparition du kafes, on leur interdit tous les attributs masculins tels que le port de la barbe ou
le droit d’avoir des enfants). Il est pleinement l’homme de sa maison et de son État. Le
mariage des princesses à des kul est l’un des éléments qui contribuèrent le plus à développer
l’idée de supériorité de la dynastie sur tous et toutes : ses dignitaires les plus puissants, les
plus honorables, les damad-ı şehriyârî, disposaient d’un statut inférieur à leurs épouses,
femmes nobles par excellence puisque de sang royal, du fait de leur condition d’esclaves du
sultan. Ainsi, tout en rehaussant le statut des filles de sang, c’est en fait la dynastie tout
entière, et à sa tête le sultan, qui était installée sur un piédestal. Par leurs filles, les sultans
trouvèrent le moyen ultime d’imposer et d’affirmer universellement la suprématie de la
Maison d’Osman et le caractère inégalable de ses membres. Le choix de sélectionner les
d’Inalcık sur le sujet, dont « The Ottoman Concept of State and the Class System » et « State and Ideology under the Sultan Süleyman I », dans The Middle East and the Balkans under the Ottoman Empire. Essays on Economy and Society, Indiana University, Bloomington, 1993 : 70-94. 234
Halil Inalcık et Metin Kunt, qui étudièrent tous deux les carrières des officiers de l’État, ont noté l’importance presque exclusive du Palais dans l’obtention des offices les plus importants de l’État, à la période classique : Kunt, The Sultan’s Servants : 31-44 ; Halil Inalcık, « The Palace », dans The Ottoman Empire. The Classical Age, 1300-1600, Londres, Phoenix, 1974 : 76-88 ; voir aussi, du même auteur, « Mehmed the Conqueror (1432-1481) and His Time ». 235
La cour ottomane n’est pas le seul exemple du genre ; il existait une véritable tradition de gouvernement au moyen d’esclaves, qui correspond généralement au système mamelouk et que l’on retrouve en Égypte et dans un grand nombre de pays arabo-musulmans de l’époque moderne. Une belle étude a été faite sur ce sujet pour la Tunisie : Oualdi, Esclaves et maîtres.
Page | 192
gendres impériaux exclusivement parmi les grands dignitaires kul est ainsi l’une des multiples
facettes de la longue et complexe élaboration du système politique ottoman « classique »,
résolument tourné autour de la personne impériale. Idéologiquement, toutes les énergies, tous
les regards, les sources de pouvoir dérivent de la personne du sultan, centre névralgique de
l’Empire. Le Palais, qui symbolise sa personne, son pouvoir, son État, devient, par sa
présence même, le cœur de l’État. Bref, l’État que les sultans ottomans construisent et dirigent
se centralise, parce que l’ensemble du dispositif gravite autour de leur personne.
En abandonnant les mariages interdynastiques avec les princes voisins, l’État entrait
dans une phase de renfermement sur lui-même, car les échanges diplomatiques, les relations
internationales n’étaient plus renforcés par un échange de femmes. Le phénomène peut
paraître anodin, pourtant la comparaison avec l’Europe permet d’en éclairer les conséquences,
tant sur le point culturel que politique. Les royautés d’Europe occidentale se pliaient aux
pratiques d’échanges de femmes entre elles, élevées en principe idéologique d’exaltation de la
suprématie du sang royal. Ce système matrimonial donna naissance à une vaste « société des
princes » internationale qui favorisa, entre autres choses, l’élaboration d’une véritable
diplomatie à l’échelle européenne236
. Ce phénomène va d’ailleurs plus loin que la seule
constitution d’alliances politiques renforcées par un échange de femmes. Les anthropologues
insistent sur l’idée selon laquelle de tels mariages étaient perçus comme le moyen d’élaborer
des alliances privilégiées grâce aux liens du sang, qui devaient dédoubler et affermir à plus ou
moins long terme les liens politiques tissés ente les deux familles, limiter les confits et
renforcer les loyautés réciproques. Et bien que les faits historiques démontrent l’inanité de ces
intentions, cela ne remit en rien en cause la perception qu’on se faisait de l’utilité de ces
unions : les souverains occidentaux continuèrent de conclure des mariages interdynastiques au
nom de l’amitié entre les princes237
. De fait, ces mariages eurent une conséquence imprévue
en favorisant la rédaction de traités politiques destinés à résoudre d’avance les affaires
successorales. Les contrats de mariage royaux devinrent ainsi de véritables traités politiques,
ainsi que le montre l’exemple des deux mariages d’Anne de Bretagne avec Charles VIII en
1491 et Louis XII en 1499 ou encore celui de François II et Marie Stuart, en 1558238
.
Les mariages interdynastiques favorisent ainsi le développement d’échanges
(politiques, culturels) entre deux pays dont ils deviennent un trait d’union. On pourrait croire
ces données contredites par les événements circonstanciels : les mariages entre les dynasties
françaises et espagnoles n’empêchèrent pas de nombreuses guerres entre elles ; de même que
le mariage de Nefise Melek Hatun avec le prince du Karaman n’empêcha pas ces deux
familles de se trouver régulièrement face à face sur le champ de bataille. Pourtant, sur la
longue durée, ces événements apparaissent plus comme des incidents au regard de relations
durables. Ainsi, en mettant fin à ce système d’alliances interdynastiques, les Ottomans se 236
Bély, La société des princes : 36-40. 237
Bertrand Haan a fort justement posé la question de l’importance de cette idée d’amitié entre les princes occidentaux. Cf. Bertrand Haan, L’amitié entre princes : une alliance franco-espagnole au temps des guerres de religion, 1560-1570, Paris, Presses Universitaires de France, 2011 238
Michel Nassiet, « Les reines héritières : d’Anne de Bretagne à Marie Stuart », dans Femmes et pouvoir politique. Les princesses d’Europe, XV
e-XVIII
e siècle, I. Poutrin et M.-K. Schaub (éds.), Rosny-sous-Bois, Bréal,
2007 : 134-144 [spécialement 135-138 ; 140-142]. Consulter également, du même auteur, Parenté, noblesse et États dynastiques.
Page | 193
privèrent de l’un des moyens les plus pérennes d’établir des relations privilégiées avec les
puissances voisines. Ils se refermèrent ainsi sur eux-mêmes, sur leur propre puissance, sur
leur propre culture. Les contacts diplomatiques, les alliances politiques n’étaient plus
renforcées par des échanges de femmes qui, avec elles, entraînaient nécessairement une
ouverture réciproque.
Même mise en échec par l’événementiel, la notion de création de liens privilégiés,
d’une amitié interdynastique est donc intimement liée à l’essence même de ces mariages
internationaux. Dès lors, leur abandon par la dynastie ottomane amène à s’interroger sur le
sens symbolique prôné par le système privilégié à la place. Or, l’échange de femme constitue,
d’après les anthropologues, l’une des nombreuses variantes du système du don. L’échange de
don se décortique en trois temps :
1°) le don lui-même indique la volonté d’une personne ou d’un ensemble de personnes
(famille, clan, groupe social, etc.) de s’ouvrir et de se lier à une autre ;
2°) la personne ou autre sollicitée est libre de recevoir ou de refuser le don qui lui est
proposé (l’acceptation n’est pas automatique) : la réception du don place le donataire en
position d’obligé, d’endetté vis-à-vis du donneur ;
3°) cette dette enclenche la production d’un nouveau don, qui peut être plus ou moins décalé
dans le temps, pour compenser, voir dépasser, le don initial.
Autrement dit, le fait d’offrir une femme motiverait la famille qui la reçoit à offrir en retour
une femme à son alliée239
. Mais ce double échange ne ferme pas la boucle : en offrant un don
en contre-échange d’un premier don, on n’était pas quitte, mais au contraire, on produisait une
situation de double débiteur. Le don, parce qu’il oblige celui qui le reçoit envers celui qui
l’offre, produit une situation de dépendance du premier envers le second. Le contre-don, parce
qu’il est lui aussi un don, transforme l’obligé en donateur, inversant la courbe des rôles, sans
effacer pour autant l’ardoise précédente240
.
Encore faut-il être capable de faire un contre-don qui égale, a minima, le premier,
voire qui le dépasse. Dans le cas des mariages des princesses ottomanes avec des officiers de
l’État, un tel contre-don était inenvisageable. Comment aurait-il pu l’être, quand l’idée même
de ce système était de démontrer la supériorité de la dynastie ? Ainsi, quand les sultans
arrêtèrent d’épouser des princesses étrangères, ils cessèrent de se placer en situation d’obligé
envers la famille de celle-ci. Tant que les sultans donnèrent en mariage leurs filles à des
princes voisins, ils forçaient ceux-ci à se placer comme leurs débiteurs. Mais des souverains
étrangers pouvaient toujours offrir, voire imposer, le mariage d’une de leur fille avec un
sultan ou un prince ottoman. La dynastie dans son ensemble n’était donc pas à l’abri de se
retrouver, un jour ou l’autre, dans la situation d’obligé envers une autre famille.
Le mariage avec des officiers de l’État, esclaves du sultan, réglait ce problème. En
donnant leurs filles à des kul, les sultans honoraient certains de leurs officiers ; cet honneur
plaçait ces gendres impériaux en situation d’obligés du sultan – renforçant ainsi leur
dépendance naturelle, en tant qu’esclaves, envers leur souverain. Or, parce qu’ils étaient des
esclaves, des serviteurs du sultan à qui ils devaient tout, y compris leur carrière et leur 239
Mauss, Essai sur le don : 147-157. 240
Godelier, L’énigme du don : 59-62.
Page | 194
prestige personnel, il n’existait aucun contre-don possible. Le don d’une princesse à un
officier de l’État devenait un don inégalable, plaçant ce dernier dans une situation d’éternel
redevable. Le gendre impérial était redevable à vie, non pas au sultan personnellement, mais à
la dynastie tout entière. Par le mariage de leurs filles avec leurs officiers, les sultans
trouvèrent le moyen de se constituer des obligés à vie, enfermés dans une dépendance plus
forte encore que le lien maître – serviteur parce que, contrairement à ce lien, il n’était pas
entre deux individus, mais avec une dynastie tout entière. Le kul, que la disparition de son
maître libérait de son lien de dépendance envers lui (jusqu’à l’intronisation d’un nouveau
sultan)241
, était attaché à vie à la dynastie, qui lui avait fait l’honneur suprême de lui offrir une
femme.
Mais parce qu’il est inégalable, ce don de femme remet en cause l’idée même
d’alliance : le système matrimonial que les sultans instaurèrent n’était pas basé sur l’idée
d’alliance symbolique, mais sur le principe de dépendance et de soumission. Quand les
sultans abandonnèrent le système des alliances interdynastiques, ils abandonnèrent en fait
l’idée même d’alliance matrimoniale : la famille ottomane n’avait plus d’alliés extérieurs ;
elle n’avait plus que des obligés qui, en retour de l’honneur qui leur était fait, se devaient de
lui témoigner une soumission totale. Le système matrimonial mis en place autour des
mariages des princesses ottomanes est ainsi un moyen pour sublimer la supériorité du sang
ottoman242
. Car, en fin de compte, l’idéologie proclamée est que la puissance et la dignité de
la Maison d’Osman sont telles qu’elle peut (et même n’a d’autre choix que celui de) se passer
de toute alliance, l’un des principes de parenté les plus pérennes de l’histoire des sociétés.
241
Vatin et Veinstein, Le Sérail ébranlé : 87. 242
Mauss insiste sur la notion de rivalité et la recherche de prestige inhérente au système d’échanges de dons. Le texte mérite d’être cité : « Non moins grand est le rôle que dans ces transactions des Indiens joue la notion d’honneur. Nulle part le prestige individuel d’un chef et le prestige de son clan ne sont plus liés à la dépense, et à l’exactitude à rendre usurairement les dons acceptés, de façon à transformer en obligés ceux qui vous ont obligés. La consommation et la destruction y sont réellement sans bornes. Dans certains potlatch on doit dépenser tout ce que l’on a et ne rien garder. C’est à qui sera le plus riche et aussi le plus follement dépensier. Le principe de l’antagonisme et de la rivalité fonde tout. Le statut politique des individus, dans les confréries et les clans, les rangs de toutes sortes s’obtiennent par la « guerre de propriété » comme par la guerre, ou par la chance, ou par l’héritage, par l’alliance et le mariage. Mais tout est conçu comme si c’était une « lutte de richesse ». Le mariage des enfants, les sièges dans les confréries ne s’obtiennent qu’au cours de potlatch échangés et rendus. On les perd au potlatch comme on les perd à la guerre, au jeu, à la course, à la lutte. Dans un certain nombre de cas, il ne s’agit même pas de donner et de rendre, mais de détruire, afin de ne pas vouloir même avoir l’air de désirer qu’on vous rende.[…] Non seulement on se fait ainsi progresser soi-même, mais encore on fait progresser sa famille sur l’échelle sociale. […] ce commerce est noble, plein d’étiquette et de générosité ; et, en tout cas, quand il est fait dans un autre esprit, en vue de gain immédiat, il est l’objet d’un mépris bien accentué. » : Mauss, Essai sur le don : 139-143, voir aussi p. 72-74 et p. 121.
Page | 195
CHAPITRE 3
LE DISCOURS CÉRÉMONIEL
« Quelques mois après le dit prince de Navarre, qui lors
s’appelait roi de Navarre, portant le deuil de la Reine sa mère, y
vint accompagné de huit cents gentils hommes tous en deuil, qui
fut reçu du Roi et de toute la cour avec beaucoup d’honneur ; et
nos noces se firent peu de jours après avec autant de triomphe et
de magnificence que de nul autre de ma qualité ; le roi de Navarre
et sa troupe y ayant laissé et changé le duel en habits très riches et
beaux, et toute la cour parée comme vous savez, et le saurez trop
mieux représenter ; moi habillée à la royale avec la couronne et
couet d’hermine mouchetée, qui se met au-devant du corps, toute
brillante des pierreries de la couronne, et le grand manteau bleu à
quatre aulnes de queue portée par trois princesses ; les échafauds
dressés à la coutume des noces des filles de France depuis
l’évêché jusqu’à Notre-Dame, tendus et parés de drap d’or ; le
peuple s’étouffant en bas à regarder passer sur cet échafaud les
noces et toute la cour, nous vînmes à la porte de l’église, où
monsieur le cardinal de Bourbon, qui faisait l’office ce jour-là,
nous ayant reçus pour dire les paroles accoutumées en tel cas,
nous passâmes sous le même échafaud jusqu’à la tribune qui
sépare la nef d’avec le cœur, où il se trouva deux degrés, l’un
pour descendre au-dit cœur, et l’autre pour sortir de la nef hors
de l’église. »1
Un mariage princier n’est pas seulement un flot de stratégies politiques, familiales ou
individuelles, c’est aussi un évènement qui réunit la participation d’un nombre multiple
d’acteurs et manipule une diversité de symboles. Dans la conception musulmane, le mariage
n’est pas un sacrement ; il n’en répond pas moins à toute une série de règles et prescriptions
légales complexes qui s’imposent, théoriquement, à toute personne d’obédience musulmane2.
Néanmoins, il n’est pas rare que les personnes royales bénéficient ou s’arrogent des passe-
droits dans ce domaine. Ainsi les souverains européens se mariaient régulièrement avec des
parents prohibés, d’après les canons ecclésiastiques, forts de licences délivrées par les papes
eux-mêmes. Ces mêmes souverains n’hésitaient pas plus à se séparer, sous des prétextes
souvent fallacieux, d’épouses encombrantes ou stériles, avec l’approbation papale, bafouant
allégrement le principe d’indissolubilité d’une union sacrée devant Dieu. Les monarchies
européennes ne sont d’ailleurs qu’une illustration d’un principe, semble-t-il, transculturel et
atemporel selon lequel les personnes royales ne seraient pas astreintes aux mêmes droits et
1 De Valois, Mémoires de Marguerite de Valois : 58-59. L’orthographe a été modernisé, laissant la grammaire
telle quelle. 2 Sur ce sujet, voir notamment Y. Linant de Bellefonds, Traité de droit musulman comparé. T. 2 : le mariage, la
dissolution du mariage, Paris / La Haye, Mouton & Co, 1965.
Page | 196
devoirs que le commun des mortels3. Et pourtant, leurs mariages s’inscrivent toujours dans le
cadre des pratiques de leur temps. Ils en sont des expressions tellement sublimées qu’elles
débordent, par moment, les cadres tolérés, sans que ces démesures entraînent de réelles
transgressions : les dérogations ont toujours soin d’être légitimées selon des discours et des
apparats justificatifs qui permettent leur réinscription dans un schéma admissible.
Les mariages des princesses ottomanes sont de même nature : ils s’inscrivent dans une
tradition juridique et cérémonielle solidement établie, et bien étudiée, mais sont aussi
exceptionnels en raison du statut de la mariée4. Les évènements auxquels ils donnent
naissance présentent des enjeux très différents des cas européens ; pourtant, la trame générale
ne change pourtant pas : ils sont tout à la fois des contrats juridiques unissant entre eux deux
individus et des cérémonies qui favorisent une mise en scène théâtralisée du pouvoir. Mais
contrairement aux unions royales européennes, les mariages des princesses ottomanes ne sont
pas des affaires internationales5 ; leurs contrats ne donnent pas lieu à rédaction de traités
politiques destinés à prévoir une redéfinition des cartes géographiques de chaque État ; ils
sont des contrats de type commercial (c’est bien dans cette catégorie de droit qu’ils sont
inscrits) entre deux individus, qui engagent certes les familles, mais non l’État (l’exclusion
des femmes de la souveraineté conforte cette donnée). Les cérémonies occasionnées ne
suivent dès lors pas les mêmes logiques symboliques. Les thèmes principaux sont pourtant
3 L’anthropologie a fourni des réflexions et travaux indispensables sur cette question. Voir, entre autres, Alfred
Adler, La mort est le masque du roi. La royauté sacrée des Moundang du Tchad, Paris, Payot, 1982 et Le pouvoir et l'interdit : Royauté et religion en Afrique noire : Essais d'ethnologie comparative, Paris, Albin Michel, 2000 ; Marc Abeles, « Formation de l’État et « Royautés sacrées ». L’État sans classe », Anthropologie et sociétés 3 / 1 (1979) : 29-40 ; Lévi L. Makarius, Le sacré et la violation des interdits, Paris, Payot, 1974 ; Luc de Heusch, « Nouveaux regards sur la royauté sacrée », Anthropologie et Sociétés 5 / 3 (1981) : 65-84 ; Jean-Claude Muller, « La Royauté divine chez les Rukuba (Benue-Plateau State, Nigeria) », L'Homme 15 / 1 (1975) : 5-27. Du côté des historiens, voir aussi Marc Bloch, Les rois thaumaturges : étude sur le caractère surnaturel attribué à la puissance royale particulièrement en France et en Angleterre, Paris, Gallimard, 1983 ; Ralph E. Giesey, Le roi ne meurt jamais. Les obsèques royales dans la France de la Renaissance, Paris, Flammarion, 1987 et Cérémonial et puissance souveraine. France, XVe – XVIIe siècles, Paris, Armand Colin, 1987 ; Ernst Kantorowicz, Les deux corps du roi, Paris, Gallimard, 1989. 4 Sur le sujet, voir notamment Metin And, Kırk Gün Kırk Gece, Eski Donanma ve Şenliklerde Seyirlik Oyunları,
Istanbul, Taç Yayınları, 1959 et « Osmanlı Düğünlerinde Nahıllar », Hayat Tarih Mecmuası 2 / 12 (Janvier 1969) : 16-19 ; Nurhan Atasoy, 1582 Surname-i Hümayun, Düğün Kitabı, Istanbul, Koçbank, 1997 ; Esin Atil, « The Story of an Eighteenth-Century Ottoman Festival », Muqarnas 10 (1993) : 181-200 et Levni and the Surnâme: The Story of an Eighteenth-Century Ottoman Festival, Istanbul, Koçbank, 1999 ; Özdemir Nutku, « The Nahıl: A Symbol of Fertility in Ottoman Festivities », Annales de l’université d’Ankara XII (1966) : 63-71 ; du même auteur, IV. Mehmed’in Edirne Şenliği, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1972 ou encore « Düğün (Türkler’de Düğün) », TDVİA : t. 10 p. 16-18 ; İrem Özgören-Kınlı, Analyse figurationnelle des fêtes impériales et des divertissements des élites ottomanes (XVIe-XIXe siècles), Thèse de doctorat, Paris, Université de Paris 1 – Panthéon Sorbonne, 2011 ; Derin Terzioğlu, « The Imperial Circumcision Festival of 1582: an Interpretation », Muqarnas 12 (1995) : 84-100 ; Muammer Yılmaz, Osmanlı’da Töre, Tören ve Alaylar, Istanbul, Elit Kültür, 2010 ; Mehmed Efendi Hâfız, 1720 Şehâdelerin Sünnet Düğünü. Sûr-ı Hümâyûn, S. A. Kahraman (éd.), Istanbul, Kitap yayınevi, 2008 ; Hatice Aynur, Saliha Sultan’ın Düğününü Anlatan Surnameler, 1834, Harvard, Harvard University Press, 1995 ; Çağatay M. Uluçay, « Fatma ve Safiye Sultanların düğünlerine ait bir araştırma », İstanbul Mecmuası 4 (1958) : 148-152 ; Tülay Artan, « Royal weddings and the Grand Vezirate: institutional and symbolic change in the early 18
th
century », dans Royal Courts and Capitals, Artan T. et Kunt M. (éds.), Leiden, Brill, 2011 : 339-399. 5 Notons néanmoins qu’à partir du XVIIIe siècle, les düğün des princesses ottomanes étaient l’occasion de
vastes cérémonies publiques auxquelles les ambassadeurs étrangers étaient conviés, donnant à ces événements une touche d’internationalisme.
Page | 197
bien les mêmes : alliance, fertilité, pouvoir, puissance, richesse ; mais ils ne sont pas articulés
selon les mêmes desseins.
Le mariage d’une princesse ottomane est un évènement important, célébré dans le
présent par les fêtes et commémoré dans la mémoire par son inscription dans les chroniques
de règne. Pourtant, ces récits leur accordent un traitement très variable selon les époques, les
individus, les faits concernés. Un lecteur désintéressé n’y verra que répétition presque à
l’identique alors qu’un œil avisé notera tout de suite des différences profondes qui retiendront
son attention. Cet évènement se divise en effet en deux étapes parfois réunies dans le temps,
le plus souvent distantes de plusieurs mois voire années : la signature du contrat de mariage,
qui donne lieu à une réunion intime de plus en plus publicisée au cours du temps, et la
célébration officielle, à l’occasion de l’envoi de la mariée au domicile de son époux. Chacune
se distingue par le nombre et le rôle de ses participants, les lieux où elles se déroulent, les
formes qu’elles prennent. Il s’agit donc de deux cérémonies foncièrement distinctes l’une de
l’autre qui, réunies, forment le mariage-évènement d’une princesse.
Page | 198
I. LE NİKÂH : UN ÉVÉNEMENT PRIVÉ TRANSFORMÉ EN
CÉRÉMONIE SEMI-PUBLIQUE
Les stratégies et les négociations décrites précédemment trouvent leur couronnement
lors de la signature du contrat qui conclut le mariage : il s’agit du nikâh, un terme hérité du
langage juridique musulman6. Dès cet instant, l’union est considérée comme valable et ne
peut se défaire qu’au regard des prescriptions légales islamiques7. Cependant, le mariage est
6 La documentation utilise également la formule plus précise de akd-ı nikâh, qui peut se traduire par « le
contrat de mariage » ou « la conclusion du contrat de mariage ». 7 Il existe une historiographie assez vaste sur le domaine des règles matrimoniales dans le système ottomano-
musulman, dont nous ne citons ici que quelques exemples : Nuri Adıyeke, « Osmanlı İmparatorluğu’nda Tanzimat Dönemi Evlilikleri », dans Pax Ottoman Nejat Göyünç Armağanı, Ankara, Yeni Türkiye yayını, 2001 : 121-150 ; Akif M. Aydın, « Osmanlı Hukukunda Nikah Akitleri », Osmanlı Araştırmaları III (1982) : 1-12 ; Behar et Duben, Istanbul Households ; Cem Behar, « Neighborhood Nuptials: Islamic Personal Law and Local Customs: Marriage Records in a Mahalle of Traditional Istanbul (1864-1907) », International Journal of Middle East Studies, 36/4 (November 2004) : 537-559 ; Peter Benedict, « Türk Hukuk Reformu Açısından Başlık ve Mehr », dans Türk Hukuk ve Toplumu Üzerine İncemeler, P. Benedict et A. Güriz (éds.), Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1974 : 1-40 ; Georges-Henri Bousquet, L’éthique sexuelle de l’Islam, Paris, Maisonneuve et Larose, 1966 ; Halil Cin, İslâm ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1974 et Eski Hukukumuzda Boşanma, Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1976 ; Robert Dankoff, « Marrying a Sultana: The Case of Melek Ahmed Paşa », dans Decision Making and Change in the Ottoman Empire, C. E. Farah (éd.), Kirksville (Missouri), Thomas Jefferson University Press, 1993 : 169-182 ; Davis, The Ottoman Lady ; Robert Devereux, « XIth Century Muslim Views on Women, Marriage, Love and Sex », Central Asiatic Journal 11 (1966) : 134-140 ; Juliette Dumas, « Evlilikle Gelen Ek Yükümlükler: Erken Modern Dönemde Dâmâd-ı Şehriyârî II », Toplumsal Tarih 227 (Kasım 2012) : 72-79 ; İmber, « Zinâ in Ottoman Law » ; idem, « Involuntary’ Annulment of Marriage » ; idem, « Women, Marriage and Property: Mahr in the Behcetü’l-Fetâvâ of Yenişehirli Abdullah » ; idem, « Guillaume Postel on Temporary Marriage » ; Dawoud el-Alami et D. Hinchcliffe, Islamic marriage and divorce laws of the Arab world, London, Kluwer Law International, 1996 ; Ghassan Asha, « Polygamie in der moderne Arabische Rechtsliteratuur », Recht van de Islam 11 (1994) : 25-54 ; Svetlana Ivanova, « The Divorce Between Zubaida Hatun and Esseid Osman Ağa: Women in the Eighteenth-Century Shari’a Court of Rumeli », dans Women, the Family, and Divorce Laws in Islamic History. Women, the Family and Divorce Laws in Islamic History, A. Sonbol (éd.), Syracuse, Syracuse University Press, 1996 : 112-125 ; idem, « Muslim and Christian Women Before the Kadı Court in Eighteenth Century Rumeli: Marriage Problems », Oriente Moderno 18 / 79 (1999) : 161-176 ; idem, « Judicial Treatment of the Matrimonial Problems of Christian Women in Rumeli during the Seventeenth and Eighteenth Centuries », dans Women in the Ottoman Balkans. Gender, Culture and History, A. Buturovic et I. C. Schick (éd.), Londres / New York, I.B. Tauris, 2007 : 153-200 ; Jennings, « Women in Early 17
th Century Ottoman Judicial Records » ; idem, « Divorce
in the Ottoman Sharia Court of Cyprus » ; Hayreddin Karaman, İslâm’da Kadın ve Aile, Istanbul, Ensar Neşriyat, 1995 ; Aglaia E. Kasdagli, « Dowry and inheritance in 17th-Century Naxos », Mélanges de l'École française de Rome, Italie et Méditerranée 110 /1 (1998) : 211-216 ; Ya’akov Meron, L’obligation alimentaire entre époux en droit musulman hanéfite, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1971 ; İlber Ortaylı, « Anadolu’da XVI. Yüzyılda Evlilik İlişkileri Üzerine Bazı Gözlemler », Osmanlı Araştırmaları 1 (1980) : 33-40 ; Bilgehan Pamuk, « Conditional Divorce in Ottoman Society: A Case from Seventeenth-Century Erzurum », Bilig 44 (2008) : 111-122 ; Leslie P. Peirce, « Le dilemme de Fatma : Crime sexuel et culture juridique dans une cour ottomane au début des Temps modernes », Annales. Histoire, Sciences Sociales 53/2 (Mars-Avril 1998) : 291-319 ; idem, « ’She is trouble… And I Will Divorce Her’: Orality, Honor and Representation in the Ottoman Court of ‘Aintab », dans Women in the Medieval Islamic World, Hambly Gavin R.G. (éd.), New York, St Martin’s Press, 1998 : 269-300 ; idem, Morality Tales. Law and Gender in the Ottoman Court of Aintab, Berkeley C. A., University of California Press, 2003 ; Carl F. Petry, « Conjugal Rights versus Class Prerogatives: A Divorce Case in Mamluk Cairo », Women in the Medieval Islamic World, Hambly Gavin R.G. (éd.), New York, St Martin’s Press, 1998 : 227-240 ; Salakides, « Women in the Kadı Sicilleri of Yenişehir » ; Schacht, « Nikâh. I-Dans l’Islam
Page | 199
aussi un événement social, qui intéresse l’ensemble de la communauté dans laquelle les époux
évoluent ; pour cela, une cérémonie à caractère public venait également officialiser l’union
conclue auparavant par contrat : il s’agit du düğün. L’alliance est donc arrêtée au cours de
deux étapes, deux cérémonies que nous allons étudier tour à tour. Les enjeux ponctuels ou
pérennes de la politique (dynastique et gouvernementale) qui pesaient sur les négociations et
les choix des conjoints ne s’arrêtaient pas à la phase prélémimaire des négociations : ils
dominaient également lors de ces cérémonies. Reste à savoir de quelle manière et selon quels
principes ?
Affaire juridique, la signature du contrat ne présente pas les mêmes enjeux que la
cérémonie publique : elle se charge d’un caractère privé qui explique le silence d’une majorité
des récits à leur propos. Seuls les chroniqueurs particulièrement au fait des événements
internes au palais nous renseignent sur le sujet. Les premières mentions remontent à la
seconde moitié du XVIe siècle ; par la suite, elles se font plus régulières : les récits de règnes
montrent un intérêt croissant pour le quotidien de l’univers palatial. Naima est l’un des plus
loquaces à ce sujet, de même que Sarı Mehmed Pacha ou Raşid. Quelques autres se
distinguent également8. L’émergence progressive et continue des annotations relatives aux
nikâh des princesses dans les récits officiels est le reflet d’une mutation profonde du sens
donné à ces affaires : de fait, ils deviennent des événements. Leur nature change, et avec elle
évolue tout à la fois les caractéristiques de leur déroulement (lieux, participants, etc.), leur
mode de perception et jusqu’à la symbolique qui y est attachée. L’objet de cette partie
consistera à montrer comment et pourquoi un fait de nature privée est devenu progressivement
un événement public, doté d’une valeur cérémonielle.
La difficulté de l’exercice ne réside pas tant dans la faiblesse de la documentation, à
laquelle nous sommes maintenant accoutumée, mais à la disparité des cas de figure recensés.
Outre les évolutions temporelles, il faut distinguer les situations selon que le nikâh conclu
concerne une sultane lors de son premier mariage, une sultane veuve ou divorcée, à l’occasion
de secondes noces, ou encore une princesse indirecte, dont les prérogatives varient par rapport
aux filles de sang. Par ailleurs, pour avoir quelques chances de s’y retrouver dans ce méli-
mélo de cas de figure et cet afflux d’informations disparates et déséquilibrées, il a fallu
ajouter à ces premières distinctions relatives au déroulement protocolaire des nikâh selon la
situation respective des princesses, des approches thématiques. Un développement sera ainsi
consacré aux lieux de ces cérémonies, un autre aux obligations financières liées à la signature
de ces contrats de mariage.
classique » ; Sonbol (éd.), Women, the Family and Divorce Laws ; Susan A. Spectorsky, Chapters on Marriage and Divorce: Responses of Ibn Hanbal and Ibn Rahwayh, Austin, University of Texas Press, 1993 ; O. Spies, « Mahr », EI (2) : t. 6 p. 76-78 ; Judith E. Tucker, In The House of The Law. Gender and Islamic Law in Ottoman Syria and Palestine, Berkeley / Los Angeles / Londres, University of California Press, 1998 ; idem, Women, Family, and Gender in Islamic Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2008 ; idem, « Marriage and Family in Nablus » ; idem, « Ties that Bound » ; Veinstein, « Femmes d’Avlonya » ; Selma Zecevic, « Missing Husbands, Waiting Wives, Bosnians Muftis: Fatwa Texts and the Interpretation of Gendered Presences and Absences in Late Ottoman Bosnia », dans Women in the Ottoman Balkans. Gender, Culture and History, A. Buturovic et I. C. Schick (éds.), Londres / New York, I.B. Tauris, 2007 : 335-360 ; Zilfi, « ‘We Don’t Get Along’ ». 8 İpşirli (éd.), Tarîh-i Na’îmâ ; Sarı Mehmed, Zübde-i vekayiât ; Râşid, Râşid Târîhi ; Yılmazer (éd.), Topçular
Kâtibi ; Özcan (éd.), Anonim Osmanlı tarihi.
Page | 200
1. Le nikâh d’une sultane mariée pour la première fois
Pour comprendre la nature et l’enjeu de la cérémonie de nikâh réalisée lors d’un
premier mariage d’une sultane, nous suivrons le fil conducteur des individus amenés à y
participer. Le rôle assigné à ces participants, en nombre variable, diffère de l’un à l’autre.
Deux considérations priment : le respect, au moins partiel, des obligations juridiques
musulmanes, et les dispositions prises dans le cadre du cérémonial. Les représentants des
époux et de l’autorité religieuse s’inscrivent dans la première catégorie ; dans la deuxième
viennent le sağdıç et le public, présent en qualité de témoin de l’événement.
1. Les représentants des époux
Pour qu’un mariage soit légal, la législation musulmane qui prévaut dans la société
ottomane imposait un certain nombre de règles. La manifestation orale du consentement par
les époux, en présence de témoins, compte parmi les obligations imposées par le droit
islamique et sur laquelle les juristes insistent fortement, car elle est conçue comme un moyen
de s’assurer de la volonté individuelle des individus concernés par le contrat de mariage.
Néanmoins, les futurs époux n’avaient pas besoin d’être présents personnellement : ils
pouvaient, voire devaient se faire représenter pas un mandataire (vekîl ou vali), qui parlait en
leur nom9. Pouvaient, pour la partie masculine ; devaient pour les femmes : la présence en
personne d’une femme dans une réunion majoritairement masculine était considérée comme
inconvenante, surtout pour les femmes de l’élite et, à fortiori, les princesses. Ces dernières
sont systématiquement absentes lors de la signature du nikâh, où elles sont représentées par un
tiers10
.
Si l’on suit les prescriptions imposées en la matière, le vali (tuteur) doit, en tout état de
cause, faire partie des parents de sexe masculin de la mariée ; en cas d’absence de parents
mâles, le cadi ou son substitut endosse généralement cette responsabilité. Éventuellement, les
époux peuvent se mettre d’accord pour désigner un vali11
. Lors des nikâh des princesses, la
9 de Bellefonds, Le mariage, la dissolution du mariage : 74-96.
10 On notera que Fanny Davis indique une pratique différente, dans le cas des mariages des femmes d’élite au
XIXe siècle : d’après elle, les femmes participaient à la cérémonie du nikâh derrière une porte, à travers laquelle
l’imam leur demandait leur consentement à l’union. Davis, The Ottoman Lady : 66. 11
« Le contrat de mariage est conclu entre le fiancé et le walî (tuteur) de la fiancée, qui doit être un musulman majeur, libre et de bonne renommée. Le walî est tenu de participer à l’établissement du contrat réclamé par la femme, si le fiancé satisfait à des prescriptions légales déterminées. Sont qualifiés pour le rôle de walî dans l’ordre suivant : - 1. Le plus proche ascendant mâle en ligne masculine ; - 2. Le plus proche parent mâle en ligne masculine parmi les descendants du père ; - 3. Le même parmi les descendants du grand-père, etc… ; - 4. S’il s’agit d’une affranchie, le mawlâ (celui qui l’a affranchie) et, suivant les cas, ses parents mâles dans l’ordre des héritiers ab intestat ; - 5. Le représentant de l’autorité désigné à cet effet (hâkim) ; dans beaucoup de pays, c’est le kâdî ou son remplaçant. Au lieu du hâkîm, les fiancés peuvent s’entendre pour désigner un walî ; ils doivent même le faire quand il n’y a pas de hâkim qualifié dans la localité. » : Joseph Schacht, « nikhâh », EI (2) : t. VIII p. 26-29 [p. 27].
Page | 201
logique voudrait donc qu’on trouve à cette place le père (voire le grand-père) de l’épouse,
c’est-à-dire le sultan : il est pourtant systématiquement absent de ces cérémonies. Sa position
de sultan en est probablement la cause : sa présence pour un événement si mineur aurait été
inconvenante. Or, il n’est remplacé par aucun autre membre de la famille. L’absence du père
ou de tout membre masculin de la famille de l’épouse lors de son mariage est l’une des
premières spécificités de ces nikâh.
Une telle absence imposait de choisir un représentant suffisamment proche de la
princesse pour parler en son nom, et suffisamment important pour refléter le statut et
l’importance de la cérémonie. Le choix se fit en faveur du chef des eunuques noirs : le
Darü’s-sa’ade ağası ou kızlar ağası12
. Aux dires de certains chroniqueurs, ce rôle serait une
de leurs fonctions traditionnelles. Ainsi en témoigne Abdî lors de la cérémonie du nikâh entre
Fatma Sultane (fille d’Ahmed Ier) et Yusuf Pacha, en 1667 :
« Le lundi 16 [5 septembre 1667], un firman impérial vint annoncer que Sa Majesté
Fatima Sultane, une des honorables filles du défunt qui réside au Paradis, Sultan
Ahmed Han, serait mariée au Beylerbey de Silistre, Vizir Yusuf Pacha et [dans ce
but], le Kaymakam Pacha, Monsieur le cheikh-ul-islam, Hazinedar Musahib
Yusuf Aga et le mandataire du Pacha susdit se sont réunis au Jardin Havuzlu
[pour la conclusion] du contrat de mariage, qui fut établi avec un mihr-i müeccel
équivalent au montant d’un Trésor d’Egypte complet [= le revenu annuel du tribut
égyptien à la Porte]. A cette occasion spéciale, le représentant de la Sultane –
responsabilité qui incombe [traditionnellement] au Chef des Eunuques Noirs en
personne – ayant été forcé de garder le lit, l’eunuque susdit avait été incapable de
participer à cette réunion : il délégua cette responsabilité de mandataire au
Hazinedar Aga. Devenu gendre vénérable, le Pacha fit revêtir de somptueux
manteaux de fourrures le cheik-ul-islam, le Kaymakam Pacha et Hazinedar Yusuf
Aga. »13
Ce texte nous indique non seulement la règle, mais aussi ses exceptions : l’absence du chef
des eunuques noirs, quelle qu’en soit la raison (ici, sa maladie), entraîne la nomination d’un
remplaçant, le suivant dans la hiérarchie des eunuques noirs, le Hazinedar. La présence du
chef des eunuques noirs en tant que représentant de la princesse, qui semble attestée
systématiquement – bien que tous les récits n’en fassent pas mention14
– est une expression
parmi d’autres de la montée en puissance de ce personnage, mise en valeur par les travaux de
Jane Hataway15
. Il s’agissait également d’une marque d’honneur pour les époux. C’est
d’ailleurs la raison des explications fournies par Abdi Pacha dans sa chronique : qu’on n’aille
12
Uzunçarşılı, Saray Teşkilâtı : 160. 13
Fahri C. Derin (éd.), Abdurrahman Abdi Paşa vekâyi’-nâmesi. Osmanlı tarihi (1648-1682), Istanbul, Çamlıca,
2008 : p. 266. Cf. Annexes C.33. Le surlignage est de notre fait. 14
L’absence assez régulière de mention concernant la présence du chef des eunuques noirs lors de la cérémonie ne doit pas nous surprendre. La règle étant sa présence, il n’était pas nécessaire pour les chroniqueurs de la mentionner systématiquement. Sa présence était probablement considérée comme évidente pour les lecteurs contemporains. 15
Jane Hathaway, Beshir Agha: Chief Eunuch of the Ottoman Imperial Harem, Oxford, Oneworld Publications, 2006 ; du même auteur, « Eunuch Households ».
Page | 202
pas interpréter l’absence du chef des eunuques noirs comme la marque d’une défaveur envers
le gendre !
Ce choix de vekîl est cependant problématique, car il marque un déplacement, illégal
d’un strict point de vue juridique, du choix du vali, sélectionné hors des membres masculins
de la famille de l’épouse, alors même qu’aucune justification juridique ne peut être invoquée
(des membres sont en vie et présents là où se déroule l’événement). Le rôle du chef des
eunuques noirs, en lieu et place d’un membre masculin de la famille ou d’un quelconque
représentant de l’autorité judiciaire, constitue donc une entorse à la règle. Son choix
s’explique d’abord par sa proximité (spatiale, professionnelle, affective peut-être) avec la
princesse, mais surtout du fait de sa tâche de délégué de l’autorité impériale (sa proximité
avec le sultan lui-même, sa haute autorité au sein du harem et de la société ottomane sont
alors des arguments recevables). Autrement dit, un raisonnement à la fois hiérarchique et
intimiste a prévalu à l’encontre des préceptes juridicoreligieux prônés par l’islam, dont les
sultans s’affirment comme dépositaires et protecteurs. L’absence de critiques souligne
l’acceptation, par tous16
, d’une règle d’exception dans le cas de la famille impériale17
. Il s’agit
là d’un exemple supplémentaire des nombreuses applications exclusives du droit que la
dynastie s’est arrogée et qui contribuent à renforcer son mouvement de distanciation sociale
en vue d’une autosacralisation18
.
Du côté de l’époux, le système de représentation est également de mise, d’autant plus
inévitable que le gendre pressenti était souvent absent physiquement, en raison de la
distribution des offices, dont la majorité imposait une résidence hors de la capitale19
. Ainsi
lors du remariage de la fille de Murad III, Ayşe Sultane, avec Yemişçi Hasan Pacha, le fiancé
se trouve à Belgrade20
. Il en va de même lors de l’union de Fatma Sultane avec Melek Ahmed
Pacha, en 166221
, ou de Rukiyye Sultane (fille de Murad IV) avec Gürcü Mehmed Pacha, en
1693. Cependant, à d’autres occasions, c’est-à-dire quand la situation le permettait, quand le
mariage ne constituait pas une urgence, on pouvait également choisir de rappeler le gendre et
d’attendre son arrivée pour réaliser, dans un même mouvement, le contrat et les noces : c’est
le cas des mariages de Hadice Sultane (fille de Mehmed IV) avec Silahdar Hasan Pacha, en
16
On notera à ce propos que les historiens sont silencieux sur cet aspect, soit qu’ils n’y aient pas été attentifs, soit qu’ils aient eux-mêmes perçu l’exceptionnalité dynastique comme une évidence. Uzunçarşılı notamment ne dit mot à ce propos. Uzunçarşılı, Saray Teşkilâtı : 160. 17
Nous en avons vu d’autres exemples précédemment. Cf. chapitre 1.III.2. Nous avons développé ailleurs cette question du régime de droit dérogatoire auquel la famille ottomane répondait, lors d’une conférence présentée à l’IFEA le 7 janvier 2012, intitulée « Des femmes au-dessus des lois ? Le cas des sultanes », dans le cadre du workshop international « Justice in Ottoman Society: Institutions, Actors and Practices », 6-7 janvier 2012 à l’IFEA. La publication des actes est en cours. 18
C’est d’ailleurs un phénomène assez commun aux royautés qui prônent une essence divine, ainsi que l’ont montré les nombreux travaux d’anthropologues et africanistes que nous avons déjà eu l’occasion de citer. 19
L’absence des gendres, en poste en province, est une donnée stable dans le temps ; elle se retrouve tout au long du XVIII
e et du XIX
e siècle, comme l’a fort bien montré Olivier Bouquet dans sa conférence du 1
er février
2010, « Les damad impériaux : comment en écrire l’histoire ? », réalisée à l’IFEA dans le cadre du séminaire « Les femmes dans l’Empire ottoman ». Vidéoconférence disponible en ligne à l’adresse suivante sur le site de l’IFEA : http://www.ifea-istanbul.net dans la rubrique des conférences en ligne. 20
Yılmazer (éd.), Topçular Kâtibi Tarihi : t. 1 p. 344. Cf. Annexes C.12. 21
Dankoff (éd.), The Intimate Life : 261.
Page | 203
1700-0122
; d’Ayşe Sultane (fille de Mustafa II) avec Ebubekir Pacha, en 173223
; ou encore
d’Ayşe Sultane (fille d’Ahmed III) avec Ahmed Pacha, en 174424
. Ce qui n’empêchait pas ces
gendres d’envoyer un mandataire signer le contrat à leur place, quand bien même ils étaient
présents ou en poste à la cour, statut oblige.
La réalité du consentement des futurs époux à leur mariage, dont l’importance est
soulignée par la récitation obligatoire de certaines formules lors du nikâh, devient alors
contestable25
. Plusieurs textes donnent à penser que les princesses, de même que certains
pachas, ne furent informés de leur mariage qu’une fois celui-ci conclu, ce qui réduit à néant
leur consentement. Nous y avons déjà fait allusion précédemment, dans un autre contexte. On
se rappelle ainsi la mention, chez Subhî, d’un « ordre impérial » transmit aux princesses
Safiyye, Ayşe et Saliha, en 1740, les informant « de se réjouir de la venue de la perle très
précieuse du mariage », le tout communiqué par lettres remises « par un envoyé spécial » 26
.
On se rappelle encore des protestations de Melek Ahmed Pacha, qui se défendait de n’avoir
jamais eu l’intention d’épouser Fatma Sultane et qui n’avait appris la nouvelle qu’une fois
l’affaire conclue27
. Versons au dossier un texte supplémentaire, extrait de la chronique de
Râşid :
« Parmi les filles marquées du signe de la chasteté de Son Altesse le précédent
souverain Sultan Mustafa Han, Son Altesse Emine Sultane avait été choisie pour
épouser Son Excellence Çorlulu Ali Pacha, actuellement grand vizir, et Son Altesse
Ayşe Sultane, pour épouser Son Excellence le vénérable vizir Köprülüzade Numan
Pacha. De ce fait, présentement, un firman a été émis [stipulant] leur mariage et
une autorisation impériale leur octroya la faveur d’organiser les festivités pleines
d’allégresse. »28
La précision des explications fournies par Râşid permet de prendre la mesure d’un phénomène
que nous avions déjà soupçonné : certes, les chroniques font état de l’envoi d’un faire part
officiel du mariage, mais il s’agit là d’un effet rhétorique. La conclusion du mariage est
présentée comme une décision politique relevant de la seule décision et autorité du sultan.
C’est une manière de dissimuler le caractère négocié de l’union ainsi que sa part légale,
soumis à l’omnipotence impériale. Au niveau symbolique, cela permettait d’inscrire l’union
22
Sarı Mehmed, Zübde-i vekayiât : 386. 23
Aydiner (éd.), Subhî Tarihi : 159 n° 88. 24
Aydiner (éd.), Subhî Tarihi : 842-843. 25
Linant de Bellefonds, Le mariage, la dissolution du mariage : 74-96. Le consentement était d’autant plus important que son absence pouvait être cause de rupture du contrat : une femme pouvait en effet dénoncer une union conclue contre son gré ou sans qu’elle ait en mesure de donner son consentement. Ainsi, une fille mariée avant sa puberté pouvait, durant la période très courte suivant l’arrivée de ses menstruations, dénoncer le mariage et le voir ainsi annuler. 26
Aydiner (éd.), Subhî Tarihi : 625. Cf. Annexes C.50. 27
L’idée est répétée à plusieurs occasions. Outre les textes que nous avons cités précédemment, Evliya Çelebi rappelle encore : « Notre Seigneur Melek Ahmed Pacha reçut l’hivernage de la ville de Belgrade et tandis qu’il vivait dans la paix et le plaisir, il fut fiancé à Fatima Sultane, fille d’Ahmed Han. Un firman impérial arriva auprès de Melek Ahmed Pacha à ce sujet ; [à la suite de quoi] celui-ci se rendit au Seuil de la Félicité au gré de chacune des étapes [du voyage] et, après le mariage, Melek Ahmed Pacha demeura trois mois sous la coupole [= vizir siégeant au Divan] et mourut le ------. » : Dankoff, Karaman, Dağlı (éd.), Evliya Çelebi Seyahatnamesi : p. 141. Cf. Annexes C.31. 28
Râşid, Râşid Târîhi : vol. 3 p. 243. Voir le texte intégral, en ottoman, suivi de sa traduction, en annexes C.42
Page | 204
ainsi conclue dans le domaine des effets de la grandeur et de la générosité impériale,
dispensée au bénéfice commun des deux époux.
Pourtant, derrière son manteau symbolique, l’ordre a pour motif principal d’officialiser
les préparatifs du mariage : Râşid précise bien que l’intention avait déjà été prise et que son
existence était connue de tous à la cour. Mais entre l’arrêt du choix d’un gendre et la
concrétisation de l’union projetée subsistait un laps de temps plus ou moins long, sur lequel la
dynastie pouvait jouer. Seul le sultan (ou son substitut) était apte à mettre un terme à l’attente
et permettre aux concernés, soit l’ensemble des participants dont nous étudions actuellement
le rôle, de se préparer en vue de l’événement et de prendre les mesures nécessaires.
Contrairement à ce que laisse entendre Evliya Çelebi, il n’y avait pas d’espace pour une
quelconque surprise ; quand Subhî évoque l’invitation qui est faite aux princesses de se
réjouir de leur mariage à venir, il n’entend nullement qu’elles n’avaient pas été tenues
informées de l’affaire, mais qu’elles étaient désormais autorisées à procéder aux réjouissances
publiques, protocolaires – quels que soient leurs sentiments intimes sur le sujet.
2. Le représentant de l’autorité religieuse
Dans les mariages ordinaires, le nikâh était souvent réalisé en présence d’un juge ou
d’un de ses représentants, ce qui permettait de garantir la validité juridique du contrat ainsi
que la bonne réalisation des formules appropriées29
. Eu égard au statut des personnes
impliquées, la présence d’un haut personnage religieux était requise. À partir du XVIIe siècle,
cette responsabilité fut dévolue au détenteur de la plus haute autorité religieuse de l’Empire :
le cheikh-ul-islam. C’est d’ailleurs ce que nous disent à ce propos d’Ohson et Uzunçarşılı30
.
Mais en a-t-il toujours été ainsi ? La montée en puissance de l’office de cheikh-ul-islam dans
le courant du XVIe siècle
31 amène à douter de la permanence de son rôle lors des nikâh des
sultanes.
Nous ne disposons d’aucune information antérieure au XVIe siècle. Au cours de la
seconde moitié du XVIe siècle et par deux fois, cette responsabilité est confiée au hoca-ı
hümâyûn – le professeur impérial. La présence de ce personnage au cours de cet événement
pourrait s’expliquer par sa position au sein du Palais et sa proximité avec la famille impériale.
Néanmoins, tantôt il s’agit du mariage d’une fille de sultan32
, tantôt du mariage d’une petite-
fille de sultan33
: dans le premier cas, le représentant de l’autorité religieuse n’est que
29
On notera qu’au XIXe siècle, il semble que ce soit un imam qui soit systématiquement en charge des mariages
de membres de l’élite ottomane. Cf. Davis, The Ottoman Lady : 66. 30
Uzunçarşılı, Saray Teşkilâtı : 160 ; d’Ohsson, Tableau général de l’empire othoman : 195. 31
Sur ce personnage et son office, voir notamment l’ouvrage de Richard C. Repp, The Müfti of Istanbul : A Study in the Development of the Ottoman Learned Hierarchy, Londres, Ithaca Press, 1986. 32
Il s’agit du mariage de la fille de Murad III, Ayşe Sultane, avec Ibrahim Pacha. Cf. Selânikî, Tarih-i Selânikî : t. 1 p. 168-171. Voir en annexes C.8. 33
Il s’agit cette fois du mariage de la fille de Gevherhan Sultane (fille de Selim II) et Piyale Pacha avec Sinanpaşazade Mehmed Pacha. Selânikî, Tarih-i Selânikî : t. 2 p. 775. Voir en annexes C.11.
Page | 205
professeur impérial (il s’agit de Sadi Efendi), tandis que dans le second cas, ce hoca-ı
hümâyûn cumulait également la fonction de cheikh-ul-islam (il s’agit de Sadeddin Efendi)34
.
Ce qui signifie que le mariage de la petite-fille de sultan eut lieu en présence d’un personnage
de rang supérieur à celui présent lors du mariage de la fille de sultan.
Les dates respectives de ces mariages permettent d’élucider cette surprenante situation.
Le mariage de la fille du sultan, Ayşe Sultane (fille de Murad III), précède de plusieurs années
celui de la petite-fille (seulement surnommée « Sultanzade » par Selaniki) : 1586 pour le
premier, 1598 pour le second. On peut dès lors supposer que la pratique la plus ancienne
consistait à déléguer cette responsabilité au professeur impérial ; puis elle aurait été
progressivement dévolue au cheikh-ul-islam. Il est même envisageable que le cumul des deux
charges par Sadeddin Efendi soit à l’origine de cette dévolution en faveur des cheikhs-ul-
islam, qui purent par la suite se prévaloir de ce précédent35
. De fait, dès le début du XVIIe
siècle, tous les nikâh des sultanes furent réalisés sous l’œil attentif de ce représentant suprême
de l’autorité religieuse. Sa présence systématique à partir de cette date suit un développement
politique similaire à ce qui a été dit plus haut à propos du chef des eunuques noirs : elle
illustre la montée en puissance de cette fonction ; mais elle reflète également l’importance
croissante accordée à ces cérémonies.
3. Le sağdıç
Il est encore un autre personnage sur lequel nous n’avons que peu d’informations : le
sağdıç36
. Et, de fait, sa présence n’est pas exigée par la législation musulmane ; il s’agit plutôt
d’une pratique socioculturelle. Qu’est-ce que le sağdıç ? Quel est son rôle ? D’après le
Redhouse, le sağdıç serait le témoin de l’époux37
. On remarquera qu’une telle disposition
n’existe que pour l’époux. Cette particularité s’explique quand on prend connaissance des
responsabilités qui lui reviennent, décrites par Selânikî à l’occasion du mariage d’Ayşe
Sultane, fille de Murad III, avec Ibrahim Pacha ; le sağdıç était alors Kılıç Ali Pacha :
« Pour s’acquitter de sa tâche de façon méritante, il réalisa des dépenses
abondantes et fit des dons infinis. Quand on envoya la marque de l’état de félicité
[l’annonce du mariage ?] au Vieux Palais, il fit preuve d’un très grand zèle pour [la
manifestation de] la majesté du sultanat de haute gloire. Quand il distribuait des
dons sur la route de son maître, il faisait preuve d’une générosité sublime. Son
Excellence le grand vizir –que Dieu, qu’Il soit exalté, perpétue sa gloire–, de son
34
Sur ce personnage, voir sa notice : « Sadeddin Efendi (Hoca) » ; Şerafettin, « Hoca Sâdeddin Efendi » et « Sa’deddin ». 35
Nous reviendrons plus loin sur les nikâh des princesses indirectes : il ne sera question, ici, que des sağdıç des époux des sultanes. 36
Il n’en est question nulle part dans la partie relative au mariage, dans l’ouvrage de Davis, The Ottoman Lady : 61-86. De façon générale, ce personnage ne semble pas avoir retenu l’attention des historiens jusqu’à présent. 37
« Sağdıç : 1. Bridegroom’s best man. 2. Intimate friend of the bride or the bridegroom ; intimate friend. » : Redhouse, Redhouse Sözlüğü. Türkçe / Osmanlıca– İngilizce, Istanbul, SEV, 1998 : 972.
Page | 206
côté, avait préparé et envoya successivement des bijoux et des perles, des
couronnes embellies, des diamants, des rubis, des grenats, des émeraudes ainsi
que des plaques et bracelets sertis de pierreries. Le voile de la mariée et les bottes
que Son Excellence le Kapudan Pacha a fourni ont été estimés à 50 000 pièces d’or.
Il s’est également acquitté de la dépense de toutes les autres affaires et ouvrages
en sucre et toutes les choses importantes nécessaires. Tout cela fut réalisé dans le
respect des démonstrations de la souveraineté, dont la majesté et la grandeur
impériale [sont] parfaites, la réputation, la courtoisie et la déférence
indiscutables. »38
La responsabilité du sağdıç semble avoir été de s’occuper principalement des préparatifs du
mariage public, en s’acquittant d’une grande partie des dépenses. On notera qu’il contribue
notamment à l’approvisionnement d’une partie des cadeaux offerts par le fiancé à sa promise :
le voile et les bottes dont il est question évoquent en effet le « nikâb orné de rubis » ou de
diamants, la « paire de chaussons [meşt] ornée de perles » (à moins qu’il ne s’agisse de ces
sortes de sabots destinés à l’usage unique du bain, les nalîn, qui, dans le cas des princesses,
était souvent « en or incrusté de perles ») dont on trouve mention chez Râşid, dans la liste des
cadeaux offerts de façon rituelle, semble-t-il, par les dâmâd impériaux à leur fiancée39
.
Sa présence est également attestée lors du nikâh : son rôle correspondrait alors au sens
du terme donné par le Redhouse. Toutefois, il n’est pas un témoin au sens moderne et
occidental du terme, dans la mesure où il n’est pas choisi par le gendre, mais par le sultan lui-
même. Les chroniques sont d’ailleurs indiscutables sur ce point :
« Son Excellence le vizir Ibrahim Pacha est devenu le gendre du Padişah refuge du
monde ; Son Excellence le Kapudan Kılıç Pacha a été nommé pour être son témoin ;
la nouvelle a été transmise au Vieux Palais et le contrat de mariage a été conclu.
Le premier jour du mois de Cemaziü’l-evvel de l’année 994 [20 avril 1586], on
accorda une promotion à Son Excellence le Vizir qui orne le gouvernement, Ibrahim
Pacha –que Dieu, qu’Il soit exalté, perpétue sa gloire. Il s’est vu nommé de façon
auspicieuse à la dignité de gendre [impérial], en récompense de sa longue fidélité, de
son service en tant que confident secret, qui mérite le respect. Et un firman a été
émis à destination de Son Excellence le Mirmiran et Kapudan Kılıç Ali Pacha, le lion
des batailles, le requin de mer des combats –fasse que sa félicité se perpétue !– le
désignant pour endosser la responsabilité de témoin.»40
La responsabilité de sağdıç est ainsi accordée officiellement, par octroi d’un firman, par le
sultan lui-même, sans consultation préalable avec le futur gendre. Elle est décidée de façon
unilatérale par la partie impériale41
. Devenir sağdıç apparaît dès lors comme un honneur à
double tranchant : un personnage de haut rang trouvait ainsi l’occasion de se distinguer lors
38
Selânikî, Târîh-i Selânikî : t. 1 p. 168-171 ; Annexes C.8. 39
Râşid, Râşid Târîhi : t. 3 p. 244 (mariages des filles de Mustafa II, Emine Sultane avec Çorlulu Ali Pacha et Ayşe Sultane avec Köprülüzade Numan Pacha) – annexes C.42 – ou encore t. 5 p. 221 (mariage d’Emetullah Sultane, fille d’Ahmed III, avec Sirke Osman Pacha. 40
Selânikî, Tarih-i Selânikî : t. 1 p. 168-171 ; Annexes C.8. 41
Ce témoin vient s’ajouter aux propres représentants de l’époux dont nous avons eu l’occasion de parler plus haut.
Page | 207
du mariage d’une princesse, mais c’est là un honneur particulièrement coûteux, car ses
dépenses doivent exalter la magnificence impériale. Si ce dernier fait preuve d’une prodigalité
inouïe, il sera récompensé de ses efforts – de ses dépenses – par la faveur impériale et
princière, mais aussi par celle du gendre ; qu’il fasse preuve de retenue, et il court le risque de
vexer ces trois parties…
Eu égard aux sommes impliquées par l’exercice de cet honneur, on peut supposer que
le sağdıç était choisi de façon consciencieuse. Il nous est presque possible de deviner les
discussions auxquelles ce choix donnait lieu : qui avait les moyens d’une telle démonstration
de magnificence parmi les grands de l’Empire ? Cette question semble bien avoir orienté le
profil typique des sağdıç : pendant tout le XVIe siècle et la première moitié du XVII
e siècle,
les sağdıç dont nous avons connaissance sont presque toujours les détenteurs de l’office de
kapudan, dont on estimait alors que les ressources financières étaient immenses, grâce aux
profits qu’ils tiraient de la course. Avec la montée en puissance de cet office, le sağdıç
commença à cumuler les offices de kapudan et second vizir42
. Mais cette responsabilité fut
aussi parfois dévolue au defterdar, qui cumulait lui aussi régulièrement cet office avec celui
de vizir de la coupole43
.
4. Le public spectateur
Le cadre intimiste du nikâh n’empêchait pas la participation d’un nombre variable
d’individus. On remarque une ouverture progressive de la cérémonie à un public plus
nombreux. Pendant tout le XVIe siècle, seules les personnes nommées ci-dessus sont
mentionnées44
, mais dès le début du XVIIe siècle, le nombre des participants augmente. Lors
du mariage d’Ayşe Sultane, fille d’Ahmed Ier, avec Nasuh Pacha, en 1612, l’ensemble du
gouvernement, les Piliers de l’État, y participe, jusqu’aux kadi‘asker45
! En somme, les plus
hauts personnages de l’Empire, qu’ils appartiennent à l’élite administrative ou religieuse, se
réunissent à l’occasion de la conclusion d’un mariage princier.
La raison d’être de cette évolution du protocole ne serait-elle pas, dès lors, de raffermir
l’importance de cette cérémonie en fortifiant son caractère politique ? La présence d’une si
grande assemblée à l’occasion d’une cérémonie largement privée ne transforme-t-elle pas
fondamentalement son sens, pour en faire un événement public ? Au début du XVIIe siècle, la
dynastie connaît une crise profonde, qui entraîne des modifications importantes de son 42
C’est le cas lors des deux mariages d’Ayşe Sultane, fille d’Ahmed Ier, avec Nasuh Pacha puis avec Ibşir Pacha : le sağdıç fut respectivement Mehmed Pacha puis Murad Pacha. Cf. Annexes C.16 et C.29. 43
C’est le cas lors du mariage de Gevherhan Sultane, fille d’Ahmed Ier, avec Öküz Mehmed Pacha. Annexes C.15. et encore par la suite, à l’occasion des mariages de Hadice Sultane, fille de Mehmed IV, avec Mustafa Pacha, annexes C.35. C’est encore le cas lorsque l’union entre Safiyye Sultane, fille de Mustafa II, et Maktulzade Ali Pacha fut scellée. Cf. Annexes C.44. 44
Voir les mariages d’Ayşe Sultane, fille de Murad III, avec Ibrahim Pacha puis Yemişçi Hasan Pacha, de sa sœur Fatma Sultane avec Halil Pacha, ainsi que le mariage de la Sultanzade, Annexes C.8. et C.12. 45
Mis à part le cheik-ul-islam et le sağdıç, Mehmed Pacha (kapudan et 2e vizir), sont encore présents Gürcü
Mehmed Pacha, Davud Pacha, Hasan Pacha, Yusuf Pacha, Halil Pacha, Ahmed Pacha (defterdar). Annexes C.16.
Page | 208
système successoral et cérémoniel46
. Or, cette période se caractérise également par un creux
survenu dans l’élaboration de cérémonies impériales. Dès le règne de Murad III, la pratique
d’envoyer les princes en province avait été abandonnée et, avec elle, les cérémonies
occasionnées. Les seules cérémonies masculines survenues durant la fin du XVIe et le début
du XVIIe siècle avaient été la circoncision du prince Mehmed, puis les deux cülûs de Mehmed
III et d’Ahmed Ier. L’utilisation des femmes dans le cadre de la démonstration de la puissance
impériale n’avait pas suffi à équilibrer le déficit en cérémonies impériales créé par cette
situation47
. Les décennies qui s’étendent entre la fin du XVIe et le début du XVII
e siècle, soit
le règne de Mehmed III et les premières années du règne d’Ahmed Ier, correspondent à une
période de vide cérémoniel presque complet – à l’exception des cülûs des sultans48
.
Les mariages contractuels des filles d’Ahmed Ier se prêtaient aux besoins dans ce
domaine : si ces cérémonies n’étaient pas publiques, dans le sens où elles ne s’affichaient pas
à l’extérieur, rien n’empêchait de les ouvrir à un public plus grand que celui qui y était
traditionnellement convié. Inviter les représentants de la classe dirigeante à ces évènements
était un moyen efficace de leur rappeler l’autorité impériale ainsi que la supériorité de la
dynastie. En outre, cela permettait d’ancrer l’alliance au sein même du pouvoir : le nouveau
gendre était de la sorte immédiatement reconnu et honoré comme grand personnage politique
par la présence de cette assemblée, qui attestait et reconnaissait sa nouvelle position d’allié
impérial. Ainsi la faiblesse d’une union incertaine avec une enfant, qui ne prendrait
consistance que plusieurs années plus tard, lorsque celle-ci serait en âge d’être envoyée à son
époux, était compensée par le renforcement de la symbolique liée à la signature du contrat.
La transformation du sens de cette cérémonie, dont le caractère juridique et privé est
dévié en faveur d’un caractère semi-public et politique, se retrouve à l’occasion de toutes les
cérémonies de nikâh des filles d’Ahmed Ier : lors du mariage d’Ayşe Sultane avec Nasuh
Pacha49
, de Gevherhan Sultane avec Öküz Mehmed Pacha50
, de Hanzade Sultane avec
Bayram Pacha51
– et on peut supposer qu’il en alla de même avec ses autres filles, à propos
desquelles les chroniqueurs se montrent discrets. C’est encore le même protocole que l’on
retrouve par la suite, à l’occasion du mariage d’Hadice Sultane, fille de Mehmed IV, avec
Mustafa Pacha, et ainsi de suite52
. Le système mis en place par Ahmed Ier et reproduit par ses
successeurs s’inscrivit ainsi progressivement parmi les pratiques coutumières de l’Empire et
46
Cf. Vatin et Veinstein, Le Serail ébranlé : passim. 47
Mehmed III n’eut pas de filles ayant survécu à l’enfance : les dernières cérémonies de ce type avaient été réalisées à l’occasion des mariages des filles de Murad III. Ahmed Ier, monté sur le trône encore enfant, dut attendre plusieurs années avant que ses filles aient atteint l’âge requis pour leur envoi au domicile conjugal, qui était l’occasion de vastes cérémonies publiques. 48
Une situation similaire s’était déjà présentée sous le règne de Süleyman Ier : entre le mariage de sa fille et la circoncision de ses fils, réalisée de façon commune, et la triple cérémonie de mariage de ses petites-filles en 1562, plus de deux décennies s’étaient écoulés sans cérémonies impériales. Il est vrai que ce déficit avait été compensé par les cérémonies militaires, à l’occasion des campagnes. Néanmoins, nous suivons l’hypothèse de Peirce, selon laquelle l’une des raisons de la triple cérémonie de 1562 serait le besoin en cérémonie impériale ressenti par la dynastie. Peirce, The Imperial Harem : 68. 49
Yılmazer (éd.), Topçular Kâtibi : t. 1 p. 601, 609. Voir en annexes C.16. 50
Yılmazer (éd.), Topçular Kâtibi : t. 1 p. 595-596. Voir en annexes C.15. 51
Yılmazer (éd.), Topçular Kâtibi : t. 2 p. 761. Voir en annexes C.18. 52
Derin (éd.), Abdi Paşa vekâyı’-nâmesi : p. 443-444. Voir en annexes C.35.
Page | 209
de la dynastie. L’honneur retombait autant sur le gendre que sur la princesse elle-même : son
mariage devenait l’occasion d’une cérémonie politique impliquant la participation des Piliers
de l’État, ce qui contribuait à renforcer sa position privilégiée au sein de cette élite. Avant
même d’en faire partie, c’est-à-dire avant même sa sortie du Palais, les grands dignitaires
étaient contraints de venir témoigner de la future élévation de son mari et de sa propre
supériorité : elle n’était pas encore sortie de l’enfance qu’ils lui prêtaient déjà hommage.
2. Les nikâh lors des remariages des sultanes
La distinction entre premières unions et remariages, dans le cas des filles de sultan,
acquiert une importance particulière au vu des cérémonies. Dans la société ottomane, comme
dans bien d’autres à la même période53
, la jeune fille vierge est dotée d’une valeur supérieure
à celle d’une femme veuve ou divorcée – d’où l’accent mis sur la première union. Cet état de
l’épousée modifie profondément le déroulement de la cérémonie de mariage : une première
union consacre l’entrée de la jeune fille dans le monde des adultes et l’installe dans son
nouveau statut d’épouse et future mère de famille ; un remariage ne consacre aucune
évolution sociale – la jeune fille, devenue femme, ne peut que progresser vers l’état de veuve
(un état perçu comme ultime et symbolisé par l’arrêt des relations sexuelles54
). Ces deux
éléments expliquent la discrétion des sources à leur propos et se traduisent par l’absence de
düğün : la cérémonie de mariage dans son ensemble est ainsi tronquée, pour ne garder que
l’indispensable.
Jusqu’à la fin du XVIe siècle, les princesses ottomanes connaissent rarement plus d’un
mari. Il existe bien quelques rares cas de secondes unions, mais celles-ci sont rares. Le déficit
en princesses disponibles et le besoin croissant en alliances survenu au cours de la fin du XVIe
et de la première moitié du XVIIe siècle ont pour conséquence d’instaurer de façon courante
la pratique des remariages55
. Le cérémonial s’en trouve modifié : il tend à se publiciser, à se
transformer en cérémonie semi-ouverte, célébrée officiellement, à l’instar des premières
unions, à ceci près que les remariages ne prévoient pas de düğün. Il faut donc attendre le
XVIIe siècle pour que la cérémonie trouve sa place dans les récits ottomans
56. Le cérémonial
53
Le même phénomène s’observe en France et, plus généralement, en Europe à l’époque de l’Ancien Régime. Cf. Casagrande, « La femme gardée » ; Opitz, « Contraintes et libertés » ; Olwen Hufton, « Le travail et la famille », dans Histoire des femmes en Occident. T. III : XVIe-XVIIIe siècle, G. Duby et M. Perrot (éds.), volume sous la direction de N. Z. Davis et A. Farge, Paris, Perrin, 2002 : 25-63 ; Beauvalet-Bontouyrie, Être veuve sous l’Ancien Régime ; Benassar, Le lit, le pouvoir et la mort : 67-70, 132-140 ; Klapisch-Zuber, La maison et le nom : 136-248. 54
Pour une discussion sur la conception et les impacts de l’état post-sexuel sur le statut des femmes ottomanes, voir notamment Peirce, The Imperial Harem : 22-27 et, du même auteur, « Seniority, Sexuality and Social Order: The Vocabulary of Gender in Early Modern Ottoman Society », dans Women in the Ottoman Empire. Middle Eastern Women in the Early Modern Era, M. C. Zilfi (éd.), Leiden / New York / Köln, Brill, 1997 : 169-196. 55
Cf. Chapitre précédent 2.III.4. 56
Le silence des chroniques sur le sujet, avant cette date, souligne le manque d’importance politique dont ces événements étaient dotés ; il ne faudrait cependant pas croire en une absence totale : notre avis est que de
Page | 210
s’y trouve réduit à son minimum, à savoir les deux éléments obligatoires pour assurer la
validité de l’union : le nikâh et l’entrée de l’époux dans la chambre nuptiale – qui compte
comme réalisation de l’acte sexuel, que celui-ci ait eu lieu ou non. Ainsi Melek Ahmed Pacha
est-il pleinement considéré comme l’époux de Fatma Sultane, fille d’Ahmed Ier, quand bien
même il avoue à Evliya Çelebi être resté « en état de pureté » pendant toute la nuit de noces,
passée dans la chambre de son épouse à négocier le montant de ses dépenses57
. De fait,
personne n’est là pour attester si l’acte a effectivement eu lieu ou non et l’état des
connaissances médicales n’est pas suffisant pour permettre une quelconque vérification58
.
Dans le cas des premières unions, le nikâh et la nuit de noces étaient distincts dans le
temps et dans l’espace ; les remariages procèdent au contraire à leur réunion complète. Les
deux étapes tendent désormais à se succéder59
, sauf en cas d’absence de l’époux hors de la
capitale, notamment lorsqu’il est en poste en province au moment de la signature du contrat.
Dans ce cas, des réjouissances peuvent avoir lieu hors d’Istanbul et ne concernent que la
partie masculine, ainsi qu’il apparaît dans l’exemple suivant :
« Parti d’Istanbul, le kethüda des kapıcı, Nasuh Ağa, entra dans Belgrade revêtu de
son costume et de sa robe d’honneur, sur ordre impérial. [Par ailleurs], la bonne
nouvelle du mariage de Sa Majesté l’illustre Sultane avec le grand vizir Hasan
Pacha fut confirmée par le kethüda des baltacı. Tandis que ces trois niveaux de
joie et de bonheur prenaient place, des festivités eurent lieu. L’ensemble des
notables de Belgrade participèrent aux félicitations. [juin 1602- mai 1603] »60
On perçoit aisément l’enjeu de ces cérémonies : l’époux trouve l’occasion d’afficher son
nouveau statut (celui de gendre impérial) et de recevoir les félicitations de son entourage. Il
s’agit aussi de montrer qu’on se réjouit d’une telle nouvelle : il ne saurait en être autrement.
Pour que la cérémonie principale (stambouliote) ait tout son poids, il fallait la présence
de grands personnages, témoins autant que cautions de l’événement. Les chroniqueurs
insistent particulièrement sur cet aspect. Ainsi, à l’occasion du (re)mariage d’Ayşe Sultane,
fille d’Ahmed Ier, avec Ibşir Pacha :
telles cérémonies eurent bien lieu dans les quelques rares cas de remariages connus du XV
e et XVI
e siècle. Leur
caractère était cependant bien trop privé pour mériter d’être mentionné dans les récits de règne officiels. 57
Dankoff (éd.), The Intimate Life : 259-260. 58
Le phénomène est particulièrement visible dans les cas d’adultère ou de viol, aussi bien dans le domaine ottoman qu’en France. Cf. Imber, « Zina in Ottoman Law » ; Peirce, « Le dilemme de Fatma » ; Sonbol, « Rapt and Law » pour le premier, Vigarello, Histoire du viol pour le second. 59
Ce phénomène est particulièrement visible dans le texte suivant : « Par le passé, Sa Majesté la fortunée Sultane avait été mariée [à Hafız Ahmed Pacha] selon les ordres relatifs à la législation maritale du Prophète de Dieu – le salut soit sur lui – et de Sa Majesté Divine. Après une grande période sans qu’aucune réunion n’ait eu lieu, les festivités [nuptiales] impériales eurent [finalement] lieu. La visite des représentants de l’Etat et des vénérables oulémas eut [d’abord] lieu puis, dans la nuit de la cérémonie nuptiale, Vizir Hafiz Ahmed Pacha pénétra [dans la chambre nuptiale], conformément à un ordre [impérial]. Par ailleurs, Husrev Ağa, démis de son office de Chef des Janissaires, subit nombre de tourments de la part du Trésor public. Puis, pour des raisons d’Etat, il reçut le rang de vizir. Parvenu jeune à la position de vizir, il fut choisi au poste d’honneur [au grand vizirat] et fut marié à Son Excellence la Sultane. Dans la même période [que le mariage d’Hafiz Pacha], Husrev Pacha invita également les représentants de l’Etat et les vénérables oulémas. Une réunion publique eut lieu et il reçut également l’ordre [de pénétrer la chambre nuptiale]. » : Yılmazer (éd.), Topçular Kâtibi : t. 2 p. 830. Cf. Annexes C.20. 60
Yılmazer (éd.), Topçular Kâtibi : t. 1 p. 344. Cf. Annexes C.12.
Page | 211
« La vénérable tante (paternelle) de notre majestueux Padişah Ayşe Sultane avait
été donnée en mariage au grand vizir Ibşir Paşa avant qu’il n’obtienne cet office.
Comme il n’avait pas encore pénétré la chambre nuptiale, le dimanche 21
[Rebiyulahir 1065 = 28 février 1655] après la prière de l’après-midi, le şeyhülislam et
les vizirs de la coupole qui l’accompagnaient se rendirent au palais de la Sultane
susmentionnée. La nuit venue, ils installèrent le grand vizir avec honneur et
respect dans la chambre nuptiale. Son témoin fut le vizir kapudan Murad
Pacha. »61
La présence du cheikh-ul-islam et du sağdıç (le témoin) s’explique du fait de leur rôle dans la
cérémonie ; celle de l’ensemble des vizirs de la coupole, par contre, n’a d’autre motif que de
lui faire endosser le rôle de public témoin de l’événement, à l’instar de ce qui a été vu pour les
premières unions.
L’évolution en faveur d’une ouverture et d’une publicisation des cérémonies de nikâh
dépasse donc le seul cadre des sultanes jeunes mariées. Le sens varie pourtant : dans le cas
des premiers mariages, l’ouverture de la cérémonie à une plus grande audience profitait
principalement à la dynastie : elle lui permettait de réaffirmer les liens qui unissent le sultan à
son élite dirigeante, kul notamment, par un rappel de sa puissance et de son autorité
souveraine. Dans le cas des remariages, la dynastie n’a rien à y gagner ; elle est même
totalement absente de l’événement – phénomène qui se constate particulièrement dans le
choix de son lieu de réalisation, sur lequel nous allons revenir. On peut donc supposer que le
choix d’une audience importante lors de tels nikâh n’était pas du fait de la dynastie ; partant,
qu’elle n’était pas obligatoire, mais voulue par le marié, qui est en le principal bénéficiaire :
c’est son statut de gendre impérial qui se voit en effet reconnu par cette assemblée.
Tout le monde n’a cependant pas droit aux mêmes privilèges, ou tout le monde ne
ressentait pas le besoin de publicité : lors de son union avec la fille d’Ahmed III, Ayşe
Sultane, le vizir Ahmed Pacha, fraîchement revenu de province et pour lequel le contrat avait
déjà été signé, fut accompagné chez son épouse par Şerif Halil Ağa, kethüda du grand vizir62
– un personnage certes important, mais qui fait pâle figure comparé à l’assemblée réunie
précédemment pour İbşir Pacha. Cette différence de traitement pourrait être le fait du
décalage temporel entre le moment de la signature du contrat et l’entrée de l’époux dans la
chambre nuptiale. Le délai explique peut-être également la non-publicité de l’événement –
peut-être Ahmed Pacha eut-il droit, à l’instar de Yemişçi Hasan Pacha au tout début du XVIIe
siècle, à des célébrations par son entourage, là où il officiait ?
L’absence de düğün dans les cas de remariages restreint l’événement à ses deux
extrêmes : la signature du contrat et l’entrée de l’époux dans la chambre nuptiale. La
déconsidération dont ils sont empreints explique leur omission dans les sources officielles
jusqu’au XVIIe siècle. La place et l’intérêt grandissants accordés aux cérémonies de nikâh lors
de premières unions (aux motifs invoqués plus haut) se répercutent sur les cas de remariages :
les deux mouvements semblent se nourrir mutuellement. Moins honorables, ces remariages
61
Derin (éd.), Abdi Paşa vekâyı’-nâmesi : p. 75. Cf. Annexes C.29. 62
Aydıner (éd.), Subhî Tarihi : p. 842-843. Cf. Annexes C.50.
Page | 212
souffrent d’un désengagement significatif de la dynastie, ce qui permet de laisser plus de
place aux autres acteurs de ces unions, notamment les gendres, dont certains savent saisir
l’occasion pour se mettre en valeur auprès de leurs pairs.
3. Les nikâh des princesses indirectes
Contrairement aux sultanes et eu égard à la dilatation de leurs liens avec la dynastie, la
présence des plus hauts officiers de l’État n’était pas requise à l’occasion des nikâh des
princesses indirectes. D’après Uzunçarşılı, ces contrats ne seraient plus conclus par le cheikh-
ul-islam mais par le cadi‘asker de Roumélie63
. Cependant, plusieurs éléments invitent à douter
de la pérennité historique de cette affirmation peu étayée par ailleurs. Uzunçarşılı se fonde en
effet sur les indications d’une chronique tardive. Or, rien ne dit qu’une pratique attestée une
fois durant la seconde moitié du XVIIIe siècle corresponde à un phénomène récurrent,
applicable au passé. Nous avons eu la chance de trouver quelques rares indications, mais
particulièrement instructives, qui viennent contredire les déclarations d’Uzunçarşılı. Ainsi,
lors du mariage de la fille de Gevherhan Sultane (fille de Selim II) et Piyale Pacha avec
Mehmed Pacha, fils du grand vizir Sinan Pacha, c’est bien le cheikh-ul-islam qui conclut le
contrat :
« Son Excellence, le chef des muftis et cheikh-ul-islam et professeur du souverain
du monde, Sadeddin Efendi avait [en effet] conclu le contrat de mariage pour
50 000 pièces d’or. »64
Nous avons déjà évoqué ce cas auparavant. Il s’agit ici de s’interroger sur la présence de ce
haut personnage dans le cas d’un mariage de hanım sultane. Le statut des mariés peut être
évoqué : la « sultanzade » n’est pas n’importe qui (elle est issue d’un couple particulièrement
puissant), tout comme son époux (pacha, fils de pacha ex-grand vizir, amené à devenir grand
vizir lui-même). Mais comment expliquer que, par la suite, les cheikh-ul-islam cessèrent
d’être convoqués à ces événements ? L’explication résiderait, à notre sens, dans la redéfinition
hiérarchique interne aux princesses maintes fois invoquée65
: c’est au cours du XVIIe siècle
que le cérémonial dynastique institue une formule mieux adaptée au rapport entre statut et
privilèges. Le mariage de cette Sultanzade serait antérieur, ce qui lui aurait valu des faveurs
dignes d’une sultane.
S’il en est ainsi pour les hanım sultanes qui bénéficient tout de même d’une affiliation
dynastique reconnue, que penser des nikâh des princesses indirectes de la troisième génération
(et au-delà) ? Aucun texte ottoman ne fournit d’information sur le sujet, ce qui constitue en
soi une indication du désintérêt profond envers ces événements jugés indignes de figurer dans
63
Uzunçarşılı, Saray Teşkilâtı : 166. D’Ohsson en dit de même : d’Ohsson, Tableau général de l’empire othoman : 195. 64
Selânikî, Tarih-i Selânikî : t. 2 p. 775. Voir en annexes C.11. 65
À la même période, une autre princesse indirecte – Ayşe, fille de Mihrimah Sultane et de Rüstem Pacha – se voyait encore octroyer le titre de sultane ; et la princesse en question n’est pas citée par Selânikî par son titre de hanim sultane mais par une appellation détournée (sultanzade).
Page | 213
le recueil des faits marquants survenus sous les règnes des sultans. Cependant, nous avons la
chance de disposer du récit d’un voyageur occidental, Gerlach, témoin du mariage d’une
princesse ottomane de la troisième génération, et pas des moindres : il s’agit de la petite-fille
de Mihrimah Sultane et Rüstem Pacha, qui épousa Cigalazade Sinan, alors aga des janissaires,
en 157666
. Il fournit le récit suivant :
« D’après les coutumes turques, lorsque la fiancée est amenée au domicile du
gendre, les femmes qui l’accompagnent se rendent, avant l’arrivée des époux,
auprès du sağdıç du gendre et lui demandent ce qu’il compte donner à sa femme
en cadeaux de mariage [mihr-i muaccel] ou s’il meurt [mihr-i müeccel] et combien
il lui laissera s’il se sépare d’elle. À ces questions, le beylerbey répondit qu’il lui
serait donné 20 000 ducats, mais les femmes en réclamaient 60 000. Le sağdıç
répondit que toute sa fortune ne suffirait pas à couvrir une telle somme, mais il
admit pouvoir donner au maximum jusqu’à 30 000. Cette fois-ci, les femmes
réclamèrent 50 000, le menaçant, s’il n’y consentait, de reprendre la fiancée et de
la ramener chez son père. Mais le beylerbey ne montra aucune surprise et
rétorqua qu’elles pouvaient bien ramener la fiancée ou la laisser, il ne donnerait
pas plus de 30 000 ducats. Finalement, les femmes décidèrent que cette somme
était suffisante et ils s’entendirent sur le montant. De sorte qu’en retour du
marchandage que le beylerbey avait fait en son nom et du montant intéressant
qu’il avait négocié, l’aga des janissaires promit de lui offrir le tissu pour deux
vêtements, mais il ne tint pas sa parole. »67
Laissons de côté, pour l’instant, la question financière – nous y reviendrons plus tard. Seul un
dignitaire est présent, du fait de son rôle actif dans la cérémonie : le sağdıç (ici : Siyavuş
Pacha, beylerbey de Roumélie).
Voilà qui permet d’éclairer le rôle de ce personnage sous un autre angle. La
responsabilité du sağdıç ne se limiterait pas à sa contribution financière, mais il semble bien
avoir à charge toutes les négociations en vue de l’élaboration du contrat de mariage. Ces
unions sont probablement les plus représentatives d’un mariage d’élite ordinaire. Une
différence se dessine alors entre mariages d’élite (à l’époque moderne) et mariages princiers :
dans ces derniers, le rôle du sağdıç est privé de l’essentiel de ses tâches, réparties par pôles de
compétences entre des intervenants plus « spécialisés » et surtout plus hauts placés dans la
hiérarchie de leur domaine respectif. Dans un mariage d’élite ordinaire, le sağdıç semble être
tout à la fois négociateur au nom du (futur) gendre, garant du respect des normes juridiques
matrimoniales et responsable du déroulement de la cérémonie. C’est là un élément de plus qui
66
Gerlach mentionne deux mariages, à deux dates différentes (1573 puis 1576). On pourrait envisager une erreur de terme, avec des fiançailles en 1573 qui débouchèrent sur l’union effective en 1576, mais l’erreur serait d’autant plus surprenante que ce voyageur semble avoir été parfaitement au fait du fonctionnement du système matrimonial ottoman. Or, la mention de ces deux cérémonies fait écho aux déclarations des bailes vénitiens présents dans la capitale au même moment, qui mentionnent dans leurs lettres deux unions successives dudit Cigalazade, avec deux sœurs – la première ayant rendu l’âme, la main de sa sœur fut accordée à son veuf, en remplacement. Gerlach, Türkiye Günlüğü : t. 1 p. 88, 456-458, 462-463 ; Pedani, « Safiye’s Household » : 18, 28. 67
Gerlach, Türkiye Günlüğü : t. 1 p. 462. Texte complet, en turc, en annexes C.9.
Page | 214
souligne l’intrusion du politique et des “intérêts supérieurs dynastiques” dans
l’ordonnancement de ces cérémonies.
Il révèle également une ligne de fracture entre les membres féminins officiellement
associés à la dynastie (sultanes et hanım sultanes) et les descendantes indirectes qui ne
bénéficient plus de la reconnaissance officielle de cette affiliation dynastique : les nikâh des
unes, parce qu’ils constituent des événements dynastiques, sont sous contrôle direct de la
dynastie, tandis que les autres sont plus libres, mais de ce fait également moins glorieux. Ils
n’imposent aucune participation des hauts dignitaires de l’État. Seul demeure le sağdıç, qui
n’est plus choisi par le sultan. Dans le cas cité, on notera toutefois l’importance de son statut,
qui rappelle la qualité des familles impliquées : il s’agit tout de même du beylerbey de
Roumélie – un office particulièrement élevé dans la hiérarchie ottomane – qui se trouve être
un damad impérial. Coïncidence ou choix volontaire, reflétant l’existence de connexions entre
les lignages princiers ?
4. Les lieux de la cérémonie
Dans les cas de premier mariage d’une sultane, la cérémonie se déroule
systématiquement au Palais impérial. Uzunçarşılı indique que le nikâh d’une sultane avait lieu
tantôt au Nouveau Palais, tantôt à la « porte du pacha », sans donner plus d’explications68
.
Jusqu’à la fin du XVIIe siècle, le nikâh semble avoir pris place au Vieux Palais ; après quoi,
ces cérémonies prennent place plutôt à Topkapı – si tant est que la mention de palais impérial
se comprenne dans ce sens. La logique voudrait que ce changement de localisation soit lié au
changement du lieu de résidence des princesses elles-mêmes qui, vivant dans un premier
temps au Vieux Palais, le « palais des femmes », furent par la suite intégrées aux résidentes de
Topkapı. Cela pose cependant un problème de chronologie : l’établissement des princesses à
Topkapı n’est pas immédiatement suivi par un déplacement du lieu de réalisation de leur
nikâh ; un retard de près d’un siècle sépare les deux69
. Il ne semble pas avoir fait le rapport
entre le lieu choisi et le type d’union (premier mariage ou remariage). De fait, une distinction
très nette apparaît entre les deux, car pour ces derniers, la cérémonie n’a jamais lieu dans un
palais impérial (quel qu’il soit). Et de fait : du fait de leur précédent mariage, elles ont quitté
le palais impérial et disposent de leurs propres résidences dans la capitale. Mais cette
différence est aussi représentative de la dépréciation de ces secondes unions à laquelle nous
avons déjà fait allusion. La signature du contrat se déroule dès lors dans le palais des épouses,
comme l’indique l’exemple suivant :
68
Uzunçarşılı, Saray Teşkilâtı : 160. 69
On rappellera qu’originellement, seuls les hommes résidaient à Topkapı, les femmes étant reléguées au Vieux Palais : ce n’est qu’à partir du milieu du XVI
e siècle que des femmes pénétrèrent l’enceinte de Topkapı. La
première à transformer le système fut Hürrem Sultane, la favorite puis épouse de Süleyman ; l’exception devint la règle presque aussitôt, puisque les favorites des successeurs de ce sultan, ainsi que leurs mères, s’y installèrent sans difficulté. Elles furent très vite suivies des autres concubines des sultans : Topkapı avait cessé d’être un palais uniquement peuplé d’hommes.
Page | 215
« La vénérable tante (paternelle) de notre majestueux Padişah Ayşe Sultane avait
été donnée en mariage au grand vizir Ibşir Paşa avant qu’il n’obtienne cet office.
Comme il n’avait pas encore pénétré la chambre nuptiale, le dimanche 21 après la
prière de l’après-midi, le şeyhülislam et les vizirs de la coupole qui
l’accompagnaient se rendirent au palais de la Sultane susmentionnée. La nuit
venue, ils installèrent le grand vizir avec honneur et respect dans la chambre
nuptiale. Son témoin fut le vizir kapudan Murad Pacha. »70
Il en est toujours de même au siècle suivant :
« Mariage contractuel d’Ayşe Sultane avec Ebubekir Pacha, ancien Silahdar. Le 25e
jour du mois susdit [21 avril 1732], la veuve du défunt Köprülüzade Numan Pacha,
Sa Majesté la fortunée Ayşe Sultane – que Dieu la protège – a été mariée à Son
Excellence Ebubekir Pacha, ancien Silahdar impérial et qui est actuellement
gouverneur d’Anatolie. Les fêtes et réjouissances pour la réunion du contrat de
mariage et l’entrée dans le lit [nuptial] eurent lieu dans le palais de la sultane
susdite, sis à Zeyrek. »71
C’est donc la localisation uxorilocale qui est privilégiée (pour la signature du contrat comme
pour le lieu de résidence du couple), au détriment d’une localisation virilocale.
La signification même de la cérémonie de mariage s’en trouve modifiée : ce n’est plus
la femme qui entre dans la maison de son époux, mais l’époux qui pénètre dans celle de sa
femme72
– et nous savons que le phénomène dépasse le temps de la conclusion du temps et de
la réalisation des noces : la résidence conjugale et familiale est de type uxorilocal, à partir du
milieu du XVIIe siècle
73. Diverses indications avaient révélé que certains gendres de hanım
sultane (ou même des générations ultérieures) venaient s’installer dans le palais de la famille
de son épouse. En conclusion, à cette période, le statut royal de ces femmes conduit à un
renversement du sens de la cérémonie de mariage, symbolisant par là même le statut
exceptionnel accordé à ces femmes, mais aussi leur place particulière au sein du noyau
conjugal.
5. Les douaires des princesses
Dans la conception musulmane, le mariage repose sur le principe d’une transaction qui
ne saurait être valable sans le versement d’un mehr (ou mehir) du mari à sa femme : un
douaire. Toutefois, la langue ottomane établit une distinction entre mehr-i muaccel et mehr-i
70
Derin (éd.), Abdi Paşa vekâyı’-nâmesi : p. 75. Cf. Annexes C.29. 71
Aydıner (éd.), Subhî Tarihi : p. 155 note 85 (ajout dans le manuscrit Sâmî). Cf. Annexes C.48. 72
On remarquera d’ailleurs qu’un phénomène relativement similaire se constate dans les cas des premières unions, ainsi que nous le verrons un peu plus tard, lorsqu’il sera question du düğün. 73
Cf. Chapitre 1.III.2.4.
Page | 216
müeccel. Le mehr-i muaccel correspondrait à un douaire immédiat74
, tandis que le mehr-i
müeccel serait au contraire un douaire reporté. Si le premier est facultatif, le second est, lui,
obligatoire. D’après Colin Imber, par ce paiement, l’époux acquérait le droit de libre
disposition du sexe de sa femme, c’est-à-dire le droit exclusif d’avoir des relations sexuelles
avec elle75
. Le mehr-i müeccel revient (théoriquement) en main propre à l’épouse76
. Établi au
moment de la signature du contrat, il peut être versé à n’importe quel moment pendant le
mariage, ou être reporté au moment de sa dissolution (que ce soit par la mort d’un des époux
ou par répudiation) – la pratique la plus courante77
.
Pour les femmes du commun, les montants attribués au titre de mehr-i müeccel
s’échelonnent selon des écarts très variables. Zilfi indique des sommes comprises entre 1000
et 100 000 aspres pour les femmes d’Istanbul au XVIIIe siècle (les sommes au-dessus de
50 000 aspres étant néanmoins rares et le signe de familles privilégiées)78
, quand Salakides
fournit, pour sa part, des montants compris entre 2000 et 40 000 aspres pour la région de
Yenişehir au XVIIe siècle
79. De fait, Salakides a bien raison de rappeler que le montant du
mehr-i müeccel variait en fonction des régions80
. Il aurait pu également ajouter l’aspect
temporel : les sommes évoluèrent probablement au cours du temps81
. On retiendra que pour
les mehr des femmes du commun, le douaire s’élève dans une fourchette entre 1 000 et 50 000
aspres82
, soit entre (environ) 15 et 750 pièces d’or en 1584, mais la moitié deux ans plus tard,
7 et 360 pièces d’or en 1625 et encore en 1641 (avec des changements de taux néanmoins
74
Le mehr-i muaccel, qui est versé au moment des fiançailles ou de la signature du contrat, ne revient pas forcément à l’épouse. Il prend souvent la forme de cadeaux, offerts selon un principe d’échange, qui symbolisent et officialisent le lien établi entre les deux époux. Ainsi, si l’union venait à être dissoute avant sa consommation, la règle veut que les époux rendent les cadeaux qu’ils ont reçus – ou une somme équivalant au montant de ces cadeaux. Cf. Imber, « Women, Marriage and Property » : 81-104 ; Colette Establet et Jean-Paul Pascual, « A propos du sadaq ou mahr dans une région arabe de l’Empire ottoman à l’aube du XVIIIe siècle », Droit et cultures 42 (2001) : 211-230 ; Spies, « Mahr ». Voir aussi la conférence du 7 décembre 2009 par Leslie Peirce, dans le cadre du séminaire « Les femmes dans l’Empire ottoman » organisé à l’IFEA en 2009-2010, intitulée « ‘I am my own agent!’ Women and the rocky road to marriage in early Modern Anatolia » (disponible en ligne sur le site de l’IFEA : www.ifea-istanbul.net). 75
Imber, « Women, Marriage and Property » : 81-104. 76
Il s’agit d’une « compensation » prévue pour les cas de disparition de l’époux (décès, répudiation ou autres). Si la femme demande le divorce, la pratique veut cependant qu’elle renonce à cette somme qui lui a été promise. La littérature sur le sujet est consistante, nous l’avons déjà citée. Pour le détail, voir la bibliographie en fin d’ouvrage. 77
Spies, « Mahr », EI (2) : t. 6 p. 76-78. 78
Les mehr qu’elle a elle-même étudié s’accordent sur des sommes comprises en majorité entre 1 000 et 5 000 aspres. Par ailleurs, Said Öztürk a trouvé une série de 554 mehr datant de la fin du XVII
e siècle, dont la moitié
ne dépassent pas les 5 000 aspres, les autres se répartissant entre 5 000 et 50 000 aspres, un petit nombre seulement s’étalant entre 50 000 et 100 000 aspres. Said Öztürk, Askeri Kassama ait Onyedinci Asır İstanbul Tereke Defterleri, Istanbul, OSAV Yayınları, 1995 : 220-229. Zilfi, « We don’t gel along » : 280. 79
Salakides, « Women in the Kadı Sicilleri of Yenişehir (Larissa) » : 216. 80
Salakides, « Women in the Kadı Sicilleri of Yenişehir (Larissa) » : 216. 81
Il manque des études générales qui permettraient de prendre la mesure des variations au cours du temps et dans l’espace, soit la constitution d’une sorte de barème des prix des fiancées dans l’Empire. 82
Salakides fournit ainsi un exemple n’entrant pas dans la fourchette traditionnelle, en la personne de Rukiye Hanım, fille du Miralem Mustafa Ağa, qui reçut un mehr de 100 000 aspres. Il précise qu’il s’agit d’un cas à part, non représentatif de la société de Yenişehir au milieu du XVII
e siècle, cette femme appartenant à la haute
société stambouliote. Salakides, « Women in the Kadı Sicilleri of Yenişehir (Larissa) » : 216.
Page | 217
entre temps), et une fourchette allant d’un peu moins de 4 pièces d’or à 185 de 1669 à 168983
.
Le montant du mehr est, pour l’essentiel, lié au statut de l’épouse. Aussi faut-il s’attendre,
dans le cas des princesses, à trouver des montants particulièrement élevés, reflet de la
supériorité dynastique.
Tableau 3.19. Évolution des montants des douaires des princesses ottomanes (XVIe – XVIII
e siècles)
84
Union (date) Somme fixée pour le douaire (en
pièces d’or)
Filles de Süleyman Ier et de Selim II 100 00085
Ayşe Sultane et Ibrahim Pacha (1586) 300 00086
Ayşe Sultane et Yemişçi Hasan Pacha (1602) 4 00087
Ayşe Sultane et Güzelce Mahmud Pacha (1604) 3 20088
Kaya Ismihan Sultane et Melek Ahmed Pacha (1648) 200 00089
Fatma Sultane et Melek Ahmed Pacha (1661) Environ 600 00090
Fatma Sultane et Yusuf Pacha (1667) Environ 600 00091
Hadice Sultane et Kara Mustafa Pacha (1675) Environ 600 00092
83
Le taux d’échange entre les pièces d’or sultani et les aspres était de 1 pour 65-70 en 1584, 1 pour 120 en 1586, 1 pour 140 en 1625 et en 1641, de 1 pour 270 en 1669, 1672 et 1689. Cf. Şevket Pamuk, A Monetary History of the Ottoman Empire, Cambridge, Cambridge University Press, 2000 : 136. 84
Les sommes étant fournies tantôt en aspres, tantôt en pièces d’or, nous avons utilisé les tables de conversion proposées par Şevket Pamuk. La plupart des chiffres étaient néanmoins exprimés en pièces d’or (ou en ducats, ce qui revient au même), que nous avons dès lors choisies comme monnaie de référence. Pamuk, A Monetary History of the Ottoman Empire : 136. 85
Selânikî, Târîh-i Selânikî : t. 1 p. 168-171. 86
Selânikî, Târîh-i Selânikî : t. 1 p. 168-171. 87
İpşirli (éd.), Târih-i Na’îmâ : t. 1 p. 207. 88
Naima précise une somme de 400 000 aspres. İpşirli (éd.), Târih-i Na’îmâ : t. 1 p. 285. 89
« Chacune des princesses [Emine et Ayşe, filles de Mustafa II] reçut une dot de vingt mille ducats, c’est-à-dire le cinquième seulement de la somme qu’on allouait autrefois aux sultanes, et le dixième de celle que Mohammed IV donna à la fille de Mourad IV, lors de son mariage avec le grand vizir Melek Ahmed. » : Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 13 p. 105 90
L’expression exacte est « un trésor égyptien » : Evliyâ, Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, vol. 1 livre 6 p. 76. Dankoff (éd.), The Intimate Life : 261. 91
Râşid n’est pas très précis sur la somme, mais insiste sur la notion de répétition, lorsqu’il indique à propos de ce mariage que « Monseigneur le Cheikhulislam a conclu le contrat de mariage en désignant un douaire équivalent à ceux établis dans des cas similaires » : Râşid, Târîh-i Râşid : vol. 1 p. 138-139. Heureusement, Abdî Pacha est plus explicite : le contrat fut signé « avec un mihr-i müeccel équivalent au montant total d’un Trésor d’Égypte complet » : Derin (éd.), Abdi Paşa vekâyı’-nâmesi : p. 266. La même expression est utilisée par Hammer : Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 11 p. 137. 92
John Covel indique de son côté une somme similaire à celle accordée aux princesses antérieures, à savoir « un an de trésor d’Égypte », soit « 600 000 zekin » : John Covel, Bir Papazın Osmanlı Günlügü. Saray, Merasimler, Gündelik Hayat, Istanbul, Dergâh Yayınları, 2009 : 150. Hammer, qui se réfère aux propos de Rycaut, qui lui-même se réfère à des rumeurs dont il n’est pas sûr, mentionne cependant la somme de « deux ans de revenus d’Égypte ».
Page | 218
Ayşe Sultane et Köprülüzade Numan Pacha (1708) 20 00093
Emine Sultane et Çorlulu Ali Pacha (1708) 20 00094
Fatma Sultane et Silahdar Ali Pacha (1709) 40 00095
Safiyye Sultane et Maktulzade Ali Pacha (1710) 10 00096
Atike Sultane et Mehmed Bey (1723-24) 10 00097
Hadice Sultane et Ali Bey (1723-24) 10 00098
Ümmügülsüm Sultane et Çerkez Osman Pachazade Ahmed
Bey (1723-24)
10 00099
Mettons de côté, pour l’instant, la somme du mehr du mariage d’Ayşe Sultane avec
Güzelce Yemişçi Hasan Pacha, problématique à bien des égards. Au XVIe siècle, le montant
traditionnel des mehr des sultanes s’élève à quelques 100 000 pièces d’or, une somme environ
quinze fois supérieure aux montants maximums compris dans la fourchette des douaires
attribués aux autres femmes. Même le mehr atypique mentionné par Salakides pour une fille
appartenant à la haute société stambouliote demeure très inférieur. Or, dès 1586, ces sommes
énormes sont encore réévaluées à la hausse : le mehr octroyé à Ayşe Sultane est triplé ; il
s’élève à 300 000 pièces d’or. L’écart des sommes accordées aux princesses par rapport au
reste de la société se creuse, afin de souligner avec encore plus d’éclat leur valeur inégalable.
Il en découle plusieurs constatations. La logique d’attribution n’était pas dominée par
les motifs traditionnels ; la somme ne consistait pas en une évaluation ni de la valeur de la
possession du mari sur le sexe de sa femme (si l’on suit les conclusions de Colin Imber), ni
des besoins minimums pour permettre à l’épouse de maintenir son train de vie. La logique
consistait à fixer un montant stable, défini d’après un principe unique : une princesse est une
épouse hors de prix. D’où la stabilité des montants d’une princesse à une autre, que de
nombreuses formules soulignent. Ils ne varièrent qu’à la suite de réévaluation, à la hausse ou à
la baisse, selon les époques, qui s’appliquaient alors à l’ensemble des princesses. C’est dire
qu’il n’est pas négocié, ni négociable : le gendre n’a pas son mot à dire à ce sujet, c’est la
dynastie qui décide et ordonne. Une sultane n’a pas de prix ; pourtant, il faut bien en fixer un,
qui dès lors sera nécessairement idéal : il consistera en un chiffre rond, fruit d’un équilibre
entre une somme exorbitante, pour souligner le statut royal, et les moyens du mari, car il
faudra bien un jour qu’il s’acquitte de cette somme, même à titre posthume. Le montant est
encore pensé pour interdire toute répudiation, de sorte qu’il n’est que dans la mort que les
dâmâd impériaux pouvaient s’acquitter du douaire de leur femme, ce qui contribue
grandement à leur conférer une position de force au sein du couple, ainsi que nous l’avons
vu100
.
93
Râşid, Târîh-i Râşid : vol. 3 p. 243-245. 94
Râşid, Târîh-i Râşid : vol. 3 p. 243-245. 95
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 13 p. 106. 96
Râşid, Târîh-i Râşid : vol. 3 p. 319-320. 97
« Chacune d’elles, au lieu de recevoir, comme leurs sœurs aînées, une dot de vingt mille ducats, ne reçut que la moitié de cette somme » : Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 14 p. 39-40. 98
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 14 p. 39-40. 99
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 14 p. 39-40. 100
Chapitre 1.III.2.1.
Page | 219
Au cours des XVIIe et XVIII
e siècles, les montants indiqués pour les mehr des
princesses évoluent : d’abord à la hausse, jusqu’à la fin du XVIIe siècle, après quoi ils
subissent une diminution très forte qui les ramène à un niveau inférieur à celui du XVIe siècle.
De toute évidence, les difficultés financières que connaît l’Empire au XVIIe siècle, si souvent
invoquées par ailleurs, n’ont pas immédiatement entraîné de révision des sommes allouées
aux princesses à l’occasion de leur mariage. Ou plutôt, de façon assez surprenante, dans un
premier temps, la révision s’est faite à la hausse101
. La première moitié du XVIIIe siècle
montre un abaissement drastique des sommes allouées au mehr des princesses, qui repassent
en dessous de la barre des 50 000 pièces d’or. Pourquoi et comment interpréter cette
diminution ? Faut-il y voir un rabaissement du statut des princesses ? C’est en tout cas
l’explication suggérée par Hammer, lorsqu’il souligne le rapport avec les mariages
précédents : « chacune d’elles, au lieu de recevoir, comme leurs sœurs aînées, une dot de
vingt mille ducats, ne reçut que la moitié de cette somme »102
. Mais dans la mesure où un tel
phénomène ne se repère nulle part ailleurs, cela est douteux. La multiplication des mariages
des princesses, caractéristique de cette époque, paraît une explication plus sûre, à laquelle
s’ajoute le nombre particulièrement élevé de princesses au XVIIIe siècle
103. Si les filles de
sultan conservent leur statut, leur valeur sur le marché matrimonial semble avoir baissé en
raison de ces deux facteurs : si la rareté de ces unions en augmente la valeur, inversement leur
profusion provoque le contraire.
Les sommes citées dans le tableau reflètent encore l’existence de la hiérarchie interne
aux princesses, mise en valeur dans le premier chapitre104
. Ainsi Kaya Ismihan Sultane ne
touche-t-elle que le tiers de la somme allouée à sa tante, Fatma Sultane. C’est que Fatma
bénéficie d’un statut supérieur à celui de Kaya Ismihan, du fait de la puissance de sa mère (la
régente Kösem Valide Sultane). La différence de valeur, liée au statut de chaque princesse, est
ici chiffrée (même de façon symbolique). Mais les montants prennent en compte d’autres
aspects. Ainsi, au XVIIIe siècle, la fille aînée du sultan régnant vient en tête (Fatma Sultane :
40 000 pièces d’or) ; les filles de Mustafa II (le prédécesseur du sultan régnant), viennent en
seconde position, parce qu’elles sont les premières princesses mariées sous le règne d’Ahmed
III, à un moment où ce dernier ne dispose pas encore de filles prêtes à être mariées (20 000
pièces d’or chacune). Par la suite, les mariages se multiplient : la valeur des princesses baissa,
de même que le statut de leurs époux, et les sommes attribuées suivirent le mouvement
(10 000 pièces d’or).
Un échelonnement des sommes de mehr s’effectue encore entre premiers mariages et
remariages. Le cas le plus représentatif de ce phénomène est sans nul doute les trois mariages
successifs d’Ayşe Sultane, fille de Murad III, entre la fin du XVIe et le début du XVII
e siècle :
après avoir bénéficié d’un mehr exorbitant d’un montant de 300 000 pièces d’or lors de son
101
Il paraît presque impossible qu’ils aient eu les moyens de payer l’intégralité de la somme au moment même du mariage. Il est plus probable que cette dette était repoussée au moment du décès et l’argent prélevé sur l’héritage – dont on peut penser qu’il suffisait à en payer le montant. 102
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 13 p. 105 103
Au début du XVIIIe siècle, certaines filles de Mehmed IV étaient en effet toujours en vie, qui côtoyaient les
filles d’Ahmed II et celles de Mustafa II, auxquelles vint s’ajouter la vingtaine de filles d’Ahmed III… 104
Chapitre 1.I.1. et 1.I.2.2.
Page | 220
premier mariage, son douaire n’est fixé qu’à 4 000 puis 3 200 pièces d’or lors de ses deux
autres mariages successifs. Erreurs du chroniqueur ou marque de la moindre valeur des
secondes noces ? À moins qu’on ait pensé en termes de besoin : au décès d’Ibrahim Pacha,
son premier mari, Ayşe avait pu empocher son mehr, auquel s’était encore ajouté sa part
d’héritage (considérable, si l’on en juge par les quelques éléments transformés en vakf au
bénéfice de sa fondation pieuse)105
. Ayşe n’avait certainement pas le souci du train de vie.
Mais l’a-t-elle jamais eu ? De telles considérations intéressées (au sens de l’intérêt financier)
s’adaptent mal à la mentalité qui prime pour l’attribution de ces mehr. D’où il ressort qu’à la
fin du XVIe siècle, une sultane qui avait déjà connu les joies conjugales ne pouvait plus
prétendre à un douaire volontairement excessif et chaque nouvelle union entraînait une baisse
supplémentaire (bien que proportionnellement moins important qu’entre le premier et le
second mariage). La virginité d’une sultane était donc un aspect pris en grande considération.
Pourtant, quelques décennies plus tard, cette vérité est mise à mal. Fatma Sultane, fille
d’Ahmed Ier, bénéficie en effet d’un douaire exactement identique, à chacun de ses mariages.
La virginité d’une sultane n’est plus un critère majeur, dans l’évaluation de son mehr-i
müeccel. C’est qu’entre-temps, non seulement la pratique des remariages des princesses s’est
intensifiée et banalisée, mais surtout, il a fallu en venir à marier des enfants encore nubiles.
Plusieurs filles d’Ahmed Ier, dont Fatma Sultane, furent mariées à plusieurs reprises avant
même d’avoir atteint la puberté, de sorte que certains dâmâd impériaux reçurent la main d’une
veuve encore vierge. Dès lors, il devenait logique qu’il s’acquitte du même douaire que son
prédécesseur, la valeur de son épouse n’ayant pas été modifiée. La pratique s’imposa de ne
plus différencier les premières unions des secondes noces, faisant voler en éclat ce culte de la
virginité au jour du mariage, au seul bénéfice des sultanes.
Concernant les douaires des princesses indirectes, nous ne disposons que de très peu
d’informations. Deux mentions, en tout et pour tout : la « sultanzade » déjà mentionnée, fille
de Gevherhan Sultane et de Piyale Pacha, mariée en 1598, et Safiyye, petite-fille de Mihrimah
Sultane et de Rüstem Pacha, en 1576. La première est une hanım sultane : son mehr est fixé à
50 000 pièces d’or106
. La seconde est une princesse de la troisième génération : après
négociations, il est convenu que son mehr s’élève à 30 000 pièces d’or107
. On est loin des
sommes extraordinaires des sultanes de la même époque : les montants demeurent cependant
très largement supérieurs à ceux convenus lors des mariages des femmes non royales. La
différence de statut entre les deux princesses est néanmoins respectée : la petite-fille se voit
mieux dotée que l’arrière petite-fille. On aurait pu s’attendre pourtant à un écart plus grand,
n’était-ce en faveur d’une petite-fille de Mihrimah Sultane. Enfin, on notera l’existence,
indéniable dans le récit qu’en rapporte Gerlach, de négociations entre les familles pour
décider du montant du mehr à accorder à l’épouse – négociations qui se firent par
l’intermédiaire du sağdıç, ainsi que nous l’avons dit plus haut. Leur existence même est un
fait intéressant, car elles semblaient interdites dans le cas des mariages des sultanes. On ne
sait ce qu’il en était lors des mariages des hanım sultanes, dont les pratiques matrimoniales
105
VGMA D 2138 n° 20 : 1011 (14 janv. 1603), n° 21 : 1011 (14 janv. 1603), n° 22 : 1011 (14 janv. 1603), n° 23 : 1013 (1605). Voir en annexes E.10. 106
Selânikî, Tarih-i Selânikî : t. 2 p. 775. Voir en annexes C.11. 107
Gerlach, Türkiye Günlüğu : t. 1 p. 462-463.
Page | 221
reprennent le modèle maternel. En revanche, les princesses indirectes à partir de la troisième
génération n’y étaient plus astreintes, preuve que leurs unions n’entraient pas dans le cadre
des affaires impériales ; elles étaient gérées par les familles en direct et de façon autonome.
*
La signature du contrat de mariage est un évènement privé qui réunit un nombre plus
ou moins défini d’individus amenés à y jouer un rôle : les représentants des époux (eux-
mêmes absents) et de l’autorité religieuse sont les seuls participants indispensables à sa
réalisation. Mais les mariages des princesses ne sont pas des événements comme les autres : le
statut des époux et surtout la qualité royale de la fiancée imposent des pratiques spécifiques.
Elles ont toutes pour point commun de souligner le caractère exceptionnel des membres de la
dynastie. Élues de Dieu, au même titre que l’ensemble de la Al-i Osman, elles n’ont pas à
obéir aux obligations légales qui s’imposent au reste de la société musulmane. Nous avons vu
certaines dérogations dans le domaine de la vie conjugale, d’autres aspects apparaissent ici
dans les modes d’élaboration du contrat de mariage. Le “prix de la mariée”, imposé par la
dynastie aux maris, selon toute vraisemblance, au moins dans le cas des sultanes (et peut-être
de hanım sultanes), le rappelle avec force. Les sommes réclamées sont tellement élevées qu’il
paraît douteux que les maris aient eu les moyens de s’en acquitter de leur vivant, à moins de
risquer la ruine totale, ce qui permettait d’enchaîner encore plus les damad impériaux dans
une soumission à leur épouse – une soumission financière bien concrête cette fois.
La dynastie gardait une main-mise très forte sur ces évènements, de sorte qu’elle n’eut
aucune peine à en changer le sens dès lors que le besoin s’en fit sentir. Ces nikâh qui avaient
tout d’une réunion intime, et à ce titre très largement passée sous silence jusqu’à la seconde
moitié du XVIe siècle, se chargent bientôt d’un caractère cérémoniel accru qui se traduit par
une publicisation de l’évènement. Les participants se multiplient et la présence d’un public
composé des membres les plus haut placés de l’État est bientôt requise. La réunion d’un tel
auditoire indique le sens symbolique dévolu à cette cérémonie : pour la dynastie, il s’agissait
de multiplier les occasions de renouer les liens avec son élite dirigeante tout en lui rappelant,
au passage, sa suprématie. Cette attente coïncide ainsi fort à propos avec une période de
faiblesse du pouvoir dynastique et de chute des cérémonies mettant en scène les hommes de la
famille régnante. Mais la dynastie n’est pas la seule intéressée, ni la seule à pouvoir infléchir
le déroulement de ces cérémonies, et d’autres acteurs s’emparent rapidement de ces nouvelles
pratiques pour souligner leur propre valeur. Certaines célébrations s’y prêtent plus que
d’autres, du fait d’un relâchement du contrôle dynastique à leur endroit, tels les nikâh lors de
remariages des sultanes ou des unions des princesses indirectes. Le regain d’intérêts
convergents en faveur de ces évènements contribue ainsi à les inscrire progressivement dans
le cadre des cérémonies dynastiques semi-publiques et leur mémoire est conservée par leur
inscription, toujours lapidaire il est vrai, mais de plus en plus régulière, dans les récits de
règne ottomans.
Page | 222
II. FÊTES ET CORTÈGES NUPTIAUX : ENJEUX ET CONFLITS
D’UNE CÉRÉMONIE IMPÉRIALE PUBLIQUE
L’entrée de la femme dans le domicile conjugal, de l’époux dans la chambre nuptiale,
étaient l’aboutissement d’une longue cérémonie publique : le düğün108
. Manifestation
publique, cette fête est le signe d’un changement de position sociale des mariés. La jeune fille
sort de l’enfance pour devenir une femme (une épouse puis une mère), de même que son
époux, amené à devenir homme, futur père de famille, chef de maison. Le couple ainsi formé
doit encore être reçu et accepté par le groupe auquel il prétend s’adjoindre, selon une logique
de cooptation qui force l’ensemble des membres du groupe à se sentir juge et parti dans
l’événement qui se réalise. La famille est l’une des premières concernées par cette affaire,
c’est l’occasion pour elle d’une mise en scène à niveaux variés. Le mariage est supposé être
une alliance entre deux familles et la cérémonie qui la consacre prône l’entente : à travers elle,
on entend raffermir les liens de cordialité et d’amitié qui uniront désormais les deux
familles109
. Entente cordiale certes, mais qui dissimule à peine les rivalités individuelles,
familiales, ou de groupe. Dans une société aussi sophistiquée que l’était la haute élite
dirigeante ottomane, ces rivalités ne s’exprimaient pas à coups de poings ou de mauvais mots,
mais sous une forme sublimée. Les cérémonies publiques notamment leur offraient un terrain
d’exercice idéal, sous des formes ritualisées.
Les acteurs, multiples, tirent tous parti des diverses possibilités offertes par l’existence
d’une cérémonie pour tirer leur propre épingle du jeu, selon leurs intérêts et la manière dont
108
Cette cérémonie était loin d’être propre aux princesses : elle est attestée de façon très générale à diverses époques, lieux et pour divers groupes sociaux – bien que des particularités puissent apparaître selon les situations. Néanmoins, pour l’époque moderne, les düğün des princesses sont les mieux connus, car la littérature existante pour les autres femmes de la société est extrêmement rare. Il faut également mettre ces festivités en perspective avec celles qui étaient données à d’autres occasions, comme la circoncision des princes ou les naissances de princes et princesses. Sur ces questions, voir notamment Mehmed Arslan (éd.), Osmanlı Saray Düğünleri ve Şenlikleri, Tome 1 : Manzûm Sûrnâmeler, Istanbul, Sarayburnu Kitaplığı, 2008 ; idem, Osmanlı Saray Düğünleri ve Şenlikleri, Tome 2 : İntizâmi Sûrnâmesi, Istanbul, Sarayburnu Kitaplığı, 2009 ; idem, Osmanlı Saray Düğünleri ve Şenlikleri, Tome 3 : Vehbi Sûrnâmesi, Istanbul, Sarayburnu Kitaplığı, 2009 ; idem, Osmanlı Saray Düğünleri ve Şenlikleri, Tome 4-5 : Lebib Sûrnâmesi, Hâfız Mehmed Efendi (Hazin) Sûrnâmesi, Abdi Sûrnâmesi, Telhîsü’l-beyân’ın Sûrnâme kısmı, Istanbul, Sarayburnu Kitaplığı, 2011 ; Hafız, 1720 Şehâdelerin Sünnet Düğünü ; Artan, « Royal weddings and the Grand Vezirate » ; Aynur, Saliha Sultan’ın Düğününü ; Juliette Dumas, « Bir duhtercığımız dünyaya geldi. III. Ahmed’in ilk kız çocuğu Fatma Sultan doğumu şerefine düzenlenen şenlikler », Toplumsal Tarih 198 (Hazıran 2010) : 22-28 ; Uluçay, « Fatma ve Safiye Sultanların düğünlerine » ; idem, « XVIII. Asırda Yapılan Sultan Süğünlerine Umumî Bir Bakış », Yeni Tarih Dergisi 3 (Mars 1952) : 80-82, 90 ; idem, « İstanbul’da XVIII. ve XIX. Asırlarda Sultanların Doğumlarında Yapılan Törenler ve Şenliklere Dair », İstanbul Enstitüsü Dergisi IV (1958) : 148-152 ; And, Kırk Gün Kırk Gece ; idem, « Osmanlı Düğünlerinde Nahıllar » ; Atasoy, Düğün Kitabı ; Atil, « an Eighteenth-Century Ottoman Festival » ; Levni and the Surnâme ; Murphey, Exploring Ottoman Sovereignty : 175-252 ; Nutku, « The Nahıl » ; idem, IV. Mehmed’in Edirne Şenliği ; idem, « Düğün » ; Özgören-Kınlı, Analyse figurationnelle des fêtes impériales ; Terzioğlu, « The Imperial Circumcision Festival of 1582 » ; Yılmaz, Töre, Tören ve Alaylar. 109
Altieri, un Romain écrivant peu après 1500 un mémoire concernant les rituels matrimoniaux de son époque, rappelait que la négligence de ces rites revenait à « déprécier la parenté et les rapports d’amitié entre parents », « renier l’union, la cohésion, la solidarité de la ville tout entière, soudée de façon assurée et perpétuelle par l’amour » : cité par Christiane Klapisch-Zuber dans La maison et le nom : 146.
Page | 223
ils s’inscrivent dans le champ politique et symbolique ottoman. Il y a d’abord la dynastie,
avec ses intérêts propres ; puis l’époux, à la tête d’une maison, d’une clientèle, et dont le rôle
ne peut s’assimiler à celui d’un simple spectateur de son mariage ; et encore les autres
membres contraints d’assister à l’événement et qui peuvent y voir une occasion de se
distinguer. Au niveau des princesses indirectes, apparaissent alors les familles respectives des
époux. Les enjeux et intérêts de chacun ne sont pas les mêmes, ils peuvent toutefois être
regroupés sous un même qualificatif : l’ostentation de la puissance. Ces diverses volontés,
tantôt s’harmonisaient, tantôt entraient en concurrence les unes avec les autres, produisant une
suite de petits riens inscrits dans les rares espaces libres non définis par le protocole. Ils
contribuent à introduire de la diversité dans des programmes festifs rigides : à trop regarder la
forêt, on en oublie parfois d’observer les arbres qui la composent.
Les düğün des princesses sont comparables à des ballets. On y retrouve cette
impression d’ensemble parfait dans lequel chacun a sa place, son jeu, sa danse, et contribue au
tout. Les rythmes changent, pour exalter une ambiance à force de mouvements, de musique,
de décors et de symboles. Comme les ballets, les düğün sont tout dans le geste, rien dans les
mots. Là réside tout le paradoxe : la mémoire de ces festivités a été transmise par des auteurs
de cour contraints d’enfermer un spectacle visuel dans des mots et expressions selon un
lexique prédéfini. L’historien parviendra peut-être à rendre compte des mouvements de
chacun, de la succession des rythmes ; il peut témoigner du chatoiement des costumes, du
scintillement des pierreries, du foisonnement des spectateurs, qui rompt avec
l’ordonnancement parfait de la troupe ; il ne peut restituer l’impression qu’un tel spectacle
pouvait susciter auprès de la foule spectatrice, les sentiments qu’elle ressentait alors, et qui ne
sauraient être sous-estimés.
L’étude de ces cérémonies doit être attentive à l’aspect chronologique : selon
l’évolution du champ politique, le champ symbolique s’adaptait aux exigences individuelles
et de groupe. La dynastie utilise des mises en scène adaptées à son auditoire, qu’il s’agisse de
son élite dirigeante ou du peuple, et à son époque. Le discours cérémoniel est modelé selon le
public visé et les participants impliqués ; la diversité des spatialités cérémonielles y contribue.
Une organisation thématique a été privilégiée pour mettre en valeur les diverses composantes
du düğün des sultanes, avant de terminer sur les spécificités inhérentes aux cas des princesses
indirectes. Les quatre ingrédients du dügün des filles de sultan s’articulent d’abord autour des
phases successives de la cérémonie (les fêtes publiques, offertes à la population, les réceptions
officielles, destinées à l’élite politique, enfin le cortège nuptial qui accompagne la princesse et
mobilise l’ensemble du corps social ottoman, représenté par la population stambouliote), sans
oublier, en dernier lieu, la question des dépenses somptuaires engagées à cette occasion.
Page | 224
1. Les fêtes publiques
La cérémonie du düğün, appelée tantôt sûr ou sûr-ı hümâyûn, tantôt gelin alayı110
, se
divise en trois composantes distinctes par leurs enjeux, acteurs et spatialités. La première qui
va nous intéresser ici consiste en des fêtes publiques données à l’occasion d’un mariage
princier ; nous verrons ensuite les célébrations réservées à l’élite, puis le jour de la parade.
Certains aspects de ces fêtes publiques ont déjà fait l’objet de travaux antérieurs, aussi nous
contenterons-nous de les survoler pour mettre l’accent sur d’autres aspects, moins connus111
.
La durée totale des festivités était fixée par édit impérial112
. De fait, si une telle
précision était nécessaire, c’est parce qu’il n’existe aucune règle spécifique en la matière.
Uzunçarşılı avait raison de noter que la durée des düğün n’avait rien de systématique. Certains
duraient quinze, voire vingt jours, comme ce fut le cas en 1675, à l’occasion du mariage de la
fille de Mehmed IV, Hadice Sultane, avec Kara Mustafa Pacha113
. Mais d’autres düğün de
princesses ne furent pas prolongés au-delà de quelques jours, une semaine tout au plus114
.
Pourquoi cette différence de durée qui, par ailleurs, n’est pas propre aux düğün des princesses
et se retrouve dans nombre de cérémonies dynastiques, comme les circoncisions115
? Pour en
comprendre la raison, il faut établir un lien entre l’importance politique de l’événement (au
moment où il se produit) et sa durée. Une logique apparaît alors, selon laquelle la durée est
proportionnelle à l’importance que revêt la cérémonie pour la dynastie, qui en est le
commanditaire. Ainsi, la durée moyenne des fêtes données à l’occasion de la circoncision
110
Le terme « gelin alayı » signifie littéralement « le cortège de la fiancée » et ne désigne ainsi, dans son acception la plus restreinte que le jour du cortège qui accompagne l’épouse à son domicile conjugal. Cependant, on trouve également le terme employé pour faire référence à l’ensemble des festivités qui accompagnent cet événement. 111
Uzunçarşılı, Saray Teşkilâtı : 159-166 ; Yılmaz, Töre, Tören ve Alaylar : 150-154 se contente de reprendre presque mot à mot les propos du précédent ; Özgören-Kınlı entend reprendre la méthodologie éliasienne pour étudier les fêtes ottomanes : Özgören-Kınlı, Analyse figurationnelle des fêtes impériales. 112
Cet aspect est souvent passé sous silence dans les chroniques, qui ne montrent aucun intérêt à rappeler ce qui, pour un contemporain, était probablement une évidence. Pourtant, la chronique anonyme éditée par Özcan souligne bien cet aspect : les préférences narratives de l’auteur, qui a soin, chaque fois qu’il peut, d’asseoir ses dires, en insérant des copies (partielles) d’ordres impériaux, y sont pour beaucoup. Özcan (éd.), Anonim Osmanlı Tarihi : 289-290. Nous avons étudié notamment, dans un article spécial, le passage de la chronique relatif à la naissance de la princesse Fatma Sultane, fille d’Ahmed III, où il fait usage de l’ordonnance de festivités et leur durée : Dumas, «Bir duhtercığımız dünyaya geldi! ». 113
Uzunçarşılı, Saray Teşkilâtı : 161. 114
Le mariage d’Ayşe Sultane avec Ibrahim Pacha, en 1586, ne dura que trois jours ; celui de sa sœur, Fatma Sultane, avec Halil Pacha, une semaine ; celui de Gevherhan Sultane avec Öküz Mehmed Pacha, en 1611, dura en revanche un mois entier. Au XVI
e et début du XVII
e siècle, il est rare de pouvoir déduire des textes la durée
des festivités : l’absence d’information, la concision des descriptions, laissent entendre qu’ils ne duraient en général pas plus de quelques jours. Selânikî, Târîh-i Selânikî : t. 1 p. 168-171 ; t. 1 p. 340-343. Yılmazer (éd.), Topçular Kâtibi : t. 1 p. 595-598; t. 1 p. 600-601. Voir en annexes C.8, C.10, C.15. 115
Celles-ci durèrent un mois lors de la circoncision des princes Bayezid et Mustafa, fils de Mehmed II, en 1457 ; trois semaines pour celle des premiers fils de Süleyman Ier, en 1530 ; mais seulement 15 jours pour ses autres fils, Bayezid et Cihangir ; 15 jours également pour la circoncision des fils d’Ahmed III, Süleyman, Mustafa, Mehmed et Bayezid en 1720 ; puis 12 jours en 1856, lors de la circoncision des princes Mehmed Reşad, Kemalettin, Nureddin et Burhaneddin… La plus longue cérémonie fut celle donnée, en 1582, à l’occasion de la circoncision du prince Mehmed, fils de Murad III : elle dura 55 jours. Arslan, Manzûm Sûrnâmeler : 164-165.
Page | 225
d’un prince est supérieure à celle pour le mariage d’une princesse, parce que la première est
l’occasion, pour la dynastie de façon générale et pour le sultan en particulier, d’affirmer la
continuité de son lignage et d’assurer l’entrée d’un prince (un successeur potentiel) sur la
scène politique116
.
Mais là n’est pas le seul élément à prendre en compte : il faut aussi considérer le
besoin que la dynastie éprouve en matière de cérémonies impériales. De tels événements
étaient l’occasion de rappeler sa présence, sa puissance et sa suprématie sur l’ensemble de son
Empire – et principalement dans sa capitale117
. Ces cérémonies jouaient un rôle essentiel de
liant social entre une dynastie de plus en plus inaccessible, et sa société. Plus la dynastie avait
eu l’occasion de s’exprimer publiquement dans les temps précédents la cérémonie, moins elle
éprouvait le besoin de la faire durer – et inversement. Ainsi, selon Peirce, l’importance
accordée à la triple cérémonie de mariage des petites-filles de Süleyman Ier en 1562
s’expliquerait par le fait que, depuis plusieurs années, l’Empire n’avait pas connu de vastes
cérémonies dynastiques : ces mariages étaient l’occasion de combler ce vide. L’importance
accrue des düğün des princesses au cours des XVIe et XVII
e siècles serait la conséquence de
la baisse du nombre des cérémonies dynastiques masculines, engendrée notamment par la
disparition des festivités données à l’occasion de l’envoi des princes en province (cette
pratique ayant été abandonnée durant le dernier quart du XVIe siècle)
118.
Si nous suivons Peirce sur ce point, deux remarques viennent cependant s’y ajouter.
La première moitié du XVIIIe siècle, non traitée par cette dernière, est particulière. Ce siècle
connaît un nombre impressionnant de fêtes dynastiques, masculines comme féminines, dont le
nombre est à mettre en lien avec la politique personnelle du sultan Ahmed III119
. Il semblerait
que l’importance croissante accordée aux düğün des princesses au cours des siècles antérieurs
créa un précédent coutumier. La pratique de réaliser de vastes cérémonies à l’occasion des
düğün des princesses s’était solidement établie : ne pas l’appliquer aurait été perçu comme un
manquement aux impératifs dynastiques. En outre, le nombre de princes et princesses dans
cette période produisit un trop-plein de festivités particulièrement coûteuses et, de ce fait, pas
toujours bien vues. Pour y faire face, on multiplia les cérémonies communes. L’un des
exemples les plus représentatifs est certainement la cérémonie de 1720, sous le règne
116
Les düğün donnés à l’occasion de la circoncision d’un prince ont fait l’objet d’un chapitre du livre de Murphey sur les rituels dynastiques ottomans. Cf. Murphey, Exploring Ottoman Sovereignty : 175-206. 117
Si de nombreuses cérémonies dynastiques avaient déjà eu lieu à l’occasion d’un règne, les dernières avaient tendance à perdre de leur importance et à se réduire dans le temps ; inversement, en cas d’absence de cérémonies impériales régulières, le vide était comblé par l’augmentation en temps et magnificence des rares cérémonies qui avaient lieu. 118
Peirce, The Imperial Harem : 68. 119
On notera ainsi que la pratique d’ordonner des festivités à l’occasion des naissances de princesses, en plus de celles des princes, s’était renforcée. Mais Ahmed III est également connu pour avoir multiplié les fêtes en tous genres, quitte à inventer de nouveaux prétextes à célébration (fête de la tulipe, de l’arrivée du printemps, etc.). De sorte qu’il est généralement admis avoir pratiqué une politique volontairement pacifique et tournée vers le divertissement.
Page | 226
d’Ahmed III, qui vit tout à la fois la circoncision de plusieurs princes et le düğün de plusieurs
princesses120
.
Dans son analyse, Peirce ne tenait compte que des mariages les plus connus. Or, à y
regarder de plus près, la hiérarchie interne aux princesses semble, ici encore, avoir été une
donnée importante dans le choix de la durée des festivités. Ce sont principalement les aînées
(généralement filles de haseki) qui bénéficièrent de célébrations s’étendant sur plusieurs
semaines. Cette préférence ne relèverait pas tant, à notre avis, de la position de la mère que de
l’ordre des naissances. Nous avons déjà largement souligné l’importance accordée au mariage
des filles du sultan régnant par rapport aux sœurs, parce que l’alliance ainsi élaborée avec le
sultan était directe. De même, les cérémonies de mariage des aînées semblent avoir été
privilégiées, parce qu’elles en étaient les premières manifestations publiques. S’il était
important pour le sultan de souligner l’importance de l’ensemble de la dynastie, il n’en
oubliait pas pour autant ses intérêts personnels : le mariage de ses filles était l’occasion de sa
propre glorification, bien plus que le mariage de ses sœurs ou tantes. Ce dernier élément est
cependant à tempérer : qui connaissait vraiment le nom et le degré de parenté des princesses
mariées à l’occasion de ces cérémonies ? Si l’on en croit les informations nominales souvent
flottantes des chroniqueurs, pourtant eux-mêmes relativement bien informés, on peut douter
de ce fait. Ce n’est pas un hasard si ceux-ci indiquent, avec force détail, le déroulement des
cérémonies, mais oublient de mentionner le nom de la princesse : c’est bien le reflet d’une
prédominance du statut de l’épouse sur son individualité. C’est une sultane, un membre de la
dynastie ; c’est donc une cérémonie dynastique qui a lieu – peu importe, au fond, celle qui en
était la raison d’être. La puissance de l’époux doit aussi être prise en considération. De fait, le
rang de la princesse dans la hiérarchie dynastique, la puissance de son époux et l’importance
accordée à leur union et aux célébrations occasionnées coïncident de façon systématique.
Autrement dit, parmi les éléments qui justifiaient de la durée de ces festivités publiques, il
fallait tenir compte tout à la fois du statut des deux époux, ainsi que du besoin de la dynastie
en cérémonies publiques.
Le contenu de ces cérémonies est probablement l’un des aspects les mieux connus,
grâce aux nombreuses descriptions des contemporains (ottomans ou non) et représentations
picturales dont elles ont été l’objet. Ces descriptions font montre d’un effet de répétition
évident, car le type de festivités données varait, peu ou prou : jeux de cirque ou sportifs,
saltimbanques, illuminations, reconstitutions historiques et pièces de théâtre…121
Il convient
de souligner la ressemblance entre les festivités données à l’occasion des düğün des
princesses et toute la panoplie possible des cérémonies dynastiques : circoncisions, naissance
de princes, de princesses, etc. Toutes ces cérémonies, dont la signification et les acteurs
changeaient pourtant, donnaient lieu à des festivités publiques très similaires les unes des
autres. Ce qui amène à penser que celles-ci représentaient une sorte de modèle invariable,
porteur de réjouissances officielles. Les chroniqueurs eux-mêmes soulignent ce caractère
120
Cette cérémonie cumula en effet la circoncision des princes Süleyman, Mehmed, Mustafa et Bayezid ainsi que le mariage des princesses Safiyye, Ayşe et Emetullah. Cf. notamment Hâfız, 1720 Şehzâdelerin Sünnet Düğünü : 26-27, 28. 121
Ils sont longuement décrits par Arslan, Manzûm Sûrnâmeler : 237-323. Voir également les exemples fournis en annexe.
Page | 227
itératif en se contentant, bien souvent, d’une énumération sans plus de détail, qui suffisait
probablement aux contemporains pour imaginer les spectacles dispensés122
. Des indications
plus précises sont généralement le signe d’un événement particulier : dans le récit de Selânikî
par exemple, la conclusion funeste de jeux de corde justifie leur inclusion dans le texte123
.
Mais le particularisme pouvait aussi être plus joyeux. Ici et là, apparaissent des annotations
particulières, comme à l’occasion du mariage de la fille aînée d’Ahmed III, Fatma Sultane,
avec Silahdar Ali Pacha, qui fut l’occasion de festivités particulièrement riches et de
qualité124
.
Pour certains, ces festivités étaient l’occasion de se distinguer en offrant des spectacles
sensationnels. L’exemple le plus marquant est très certainement celui du lancer de
montgolfière qui eut lieu à l’occasion du mariage d’Adile Sultane (fille de Mahmud II) avec
Mehmed Ali Pacha en avril 1845 – bien qu’il dépasse notre période d’étude chronologique125
.
Pourquoi cette recherche d’exceptionnalité ? Pour se distinguer des autres ; pour se faire
remarquer : par le public d’une part, qui transmettra le nom de celui qui lui a offert un
spectacle inhabituel ; mais surtout du sultan et de la famille royale, qui lui sauront gré d’avoir
embelli, d’avoir contribué à immortaliser la fête par un événement mémorable. Derrière le
côté distrayant de ces fêtes publiques s’opérait donc une “guerre de représentation” parmi les
grands officiers, qui cherchaient à se distinguer des autres par leur prodigalité et leur
originalité126
.
Ces festivités avaient un coût – et pas des moindres. Au vu des informations fournies
par les chroniqueurs et dans l’historiographie, les dépenses étaient réparties principalement
entre trois acteurs : le Palais, le dâmâd et le sağdıç. Ainsi, à l’occasion de la triple cérémonie
de mariage des filles de Selim II en 1562, les dâmâd et leurs sağdıç respectifs reçurent des
fonds spéciaux octroyés par le Palais pour couvrir (partiellement) les frais d’une si grande
cérémonie : Sokollu Mehmed Pacha (époux d’Ismihan) et Hasan Aga (époux de Şah) reçurent
tous deux 15 000 florins, tandis que Piyale Pacha (époux de Gevherhan) se vit doter d’une
somme de 10 000 florins – une différence qui s’explique peut-être par le fait qu’il était alors
détenteur de l’office de kapudan, considéré comme particulièrement lucratif. Quant à leurs
témoins, ils reçurent respectivement une somme de 15 000, 13 000 et 12 000 florins. En outre,
122
La différence entre les cérémonies dynastiques et les autres, ou entre les différentes cérémonies dynastiques entre elles, résidait probablement dans l’importance en nombre et, peut-être, en qualité, des représentations ainsi données, mais surtout dans la durée qui leur était accordée – ainsi que nous venons de le voir. 123
Un accident survint au funambule, qui alla s’écraser sur le sol. Selânikî, Târîh-i Selânikî : t. 1 p. 340-343. 124
Uluçay, Harem II : 107-108. 125
Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 407-412. 126
Un autre exemple du genre est le spectacle offert par Ismihan Sultane lors de la circoncision du prince Mehmed (III), longuement décrit par les chroniques et reprit par Hammer : « Les esclaves chrétiens de la veuve de Sokolli, au nombre de neuf cents, simulèrent au milieu de danses pyrrhiques la lutte de saint Georges avec le dragon […]. Les musiciens de la chapelle de la sultane, veuve de Sokolli, jouèrent une espèce de pantomime mythologique ; au milieu de l’harmonie des cymbales, des luths et des violons, un bravo italien s’approcha d’un jeune enfant déguisé en Cupidon, et voulut s’emparer de lui, en employant d’abord la flatterie, puis la force ; mais une jeune fille, armée d’un javelot comme une nymphe de Diane ou une Amazone, intervint en ce moment, repoussa l’audacieux agresseur, et délivra le jeune enfant. » : Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 7 p. 87.
Page | 228
le Palais lui-même contribua aux dépenses pour une somme s’élevant à 25 000 florins. Des
montants, on le voit, particulièrement élevés, d’autant plus qu’il ne s’agissait probablement
que de compléments : dâmâd et sağdıç y furent certainement de leur poche127
. Ainsi
Uzunçarşılı avait bien raison d’affirmer que le dâmâd était obligé d’entreprendre de grandes
dépenses lors de son mariage avec une princesse ; il se trompait cependant lorsqu’il soutenait
qu’il était le seul à couvrir l’ensemble des frais128
. Lors de la triple cérémonie susdite, le
Palais octroya encore de l’argent aux princesses : 2 000 florins chacune129
, mais on ne sait à
quoi cet argent fut dépensé : pour les fêtes ou comme argent propre pour couvrir des achats
divers, en vue de leur future installation hors du Palais ? D’autres personnes pouvaient
également entreprendre des dépenses particulières. Ainsi, à l’occasion de cette fête, la
princesse Mihrimah Sultane prit en charge de nombreux frais et la supervision de divers
spectacles – afin, dit-on, de se réconcilier avec son frère130
. Mais les informations sont
fragmentaires ou trop peu détaillées pour permettre une réflexion plus poussée.
Pour une fête, il faut du public et des acteurs131
. Les düğün des princesses sont des
cérémonies polysémiques : selon les étapes et les besoins, le discours et la raison d’être des
festivités changent, parce que les acteurs et spectateurs changent eux-mêmes. Ainsi, dans le
cas des fêtes publiques, les spectateurs sont aisément identifiables : ce sont les gens du peuple,
les Stambouliotes (l’essentiel des festivités a lieu dans la capitale). Au cours de ces fêtes,
l’élite politique n’est jamais mentionnée comme participante : elle n’y est même pas présente.
Si ce sont les grands officiers de l’État qui pourvoient au financement de ces divertissements,
eux-mêmes n’y prennent aucune part. Des « gens du spectacle », comme on pourrait les
appeler avec un certain anachronisme, sont spécialement payés pour divertir le peuple.
Pendant ce temps, d’autres fêtes ont lieu, qui occupent, cette fois, les officiers de l’Empire.
On comprend mieux, ainsi, la finalité de ces fêtes publiques : il s’agit d’amuser le peuple, tout
en lui rappelant la présence impériale, de le distraire – pour éviter qu’il n’aille, à ses temps
perdus, s’intéresser à d’autres choses.
127
Peirce, The Imperial Harem : 68 (d’après un document conservé dans les archives de Topkapı : TSMA D 7859). 128
Uzunçarşılı, Saray Teşkilâtı : 161. Pourtant, si le Palais participe au financement, c’est de façon indirecte : il octroie de l’argent aux gendres et à leurs témoins plutôt que de couvrir directement aux dépenses. Les dépenses étaient ainsi réalisées en leur nom, plutôt que par le Palais directement. Ce fonctionnement met en lumière une discordance entre respect des pratiques – le gendre et son témoin doivent financer une grande part des festivités – et la démonstration du caractère inégalable des membres de la dynastie, qui passe nécessairement par la réalisation de célébrations somptueuses. 129
Peirce, The Imperial Harem : 68 (d’après un document conservé dans les archives de Topkapı : TSMA D 7859). 130
Ceci fut utilisé comme excuse pour refuser à l’ambassadeur Busbecq sa réception de départ : la princesse Mihrimah interdisait à quiconque de la famille impériale de s’éloigner, en prévision des cérémonies qu’elle organisait. Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 6 p. 82. 131
Tout le travail de Frédérique Leferme-Falguières, sur les courtisans sous les règnes de Louis XIV, Louis XV et Louis XVI, tourne autour de cette question des rites et fêtes données par la cour versaillaise. Pour elle, la cour toute entière est à la fois actrice et spectatrice principale, sinon parfois unique, de ces spectacles. Cf. Leferme-Falguières, Les courtisans. Voir également Apostolides, Le roi-machine ; Giesey, Cérémonial et puissance souveraine ; Gruber, Les grandes fêtes et leur décor ; Hours, Louis XV et sa Cour ; Marie-Christine Moine, Les fêtes à la cour du Roi Soleil, Paris, Sorlot et Lanore, 1984 ;
Page | 229
2. Les réceptions officielles
Pendant que le peuple était occupé par des spectacles divers, avaient lieu les réceptions
officielles des grands officiers de l’État, les ziyâfet. Les ziyâfet consistent en visites organisées
et protocolaires des personnalités de l’Empire aux époux, avec les visites masculines, faites au
gendre, d’un côté, les visites féminines, faites à l’épouse, de l’autre. Les premières sont bien
plus accessibles à l’historien que les secondes. Les rédacteurs des chroniques étaient des
hommes et, de ce fait, ils n’avaient pas accès aux espaces féminins : ils n’auraient pu décrire
ces réunions qu’avec beaucoup d’imprécision et sur la foi de paroles rapportées. Par ailleurs,
il est probable que ces réceptions ne suscitaient pas, à leurs yeux, un grand intérêt, car si les
récits de règne accordent une place aux descriptions des réceptions masculines, c’est bien en
raison de leur caractère intimement politique – et vice versa.
1. Les visites masculines
La visite de ces messieurs signait l’adoubement social de l’époux comme dâmâd-ı
şehriyârî, entériné par son groupe d’appartenance sociale. L’absence du sultan ou des
membres masculins de la dynastie au cours de ces réceptions en confirme la nature : la fête est
destinée à l’élite, qui s’en approprie les rôles de public et d’acteur unique132
. La cérémonie
donne à voir et consacre la redistribution des places et statuts de chacun au sein du groupe.
Le lieu de rassemblement de ces visites a occasionné des confusions malheureuses.
L’erreur vient, apparemment, du parallèle qui est fait entre les réceptions données à l’occasion
des circoncisions des princes et celles réalisées au cours des düğün des princesses. Si bien des
aspects de ces deux cérémonies sont semblables, elles divergent néanmoins en ce qui
concerne leur spatialité : tout au long de la période moderne, les premières sont réalisées de
façon publique, sur la place de l’Atmeydanı (l’hippodrome)133
, tandis que les secondes ont
lieu dans des lieux privés : chez le gendre. Lors du mariage d’Ibrahim Pacha avec la fille de
Murad III, Ayşe, les oulémas furent reçus « dans la chambre de Son Excellence le Pacha »134
;
la « ziyâfet-i cem’iyyet-i küberâ » lors du mariage de Halil Pacha avec Fatma Sultane, sœur de
la précédente, eut lieu dans le palais du gendre (« Halil Paşa – edâme’llâhu te’âlâ iclâlehû –
hazretleri sarâyında »)135
; il en fut de même lors du mariage du grand vizir Nasuh Pacha
avec la fille d’Ahmed Ier136
ou celui d’Hadice Sultane, fille de Murad IV, avec Musahib
Mustafa Pacha137
. La constance du lieu souligne la pérennité de la signification de
132
On remarquera la présence systématique du sultan lors des fêtes de circoncision. 133
Arslan, Manzûm Sûrnâmeler : 208-226 ; voir également à ce sujet la thèse de Özgören-Kınlı, Analyse figurationnelle des fêtes impériales. 134
Selânikî, Târîh-i Selânikî : t. 1 p. 170. Voir en annexes C.8. 135
Selânikî, Târîh-i Selânikî : t. 1 p. 342. Voir en annexes C.10. 136
Yılmazer (éd.), Topçular Kâtibi : t. 1 p. 622. Voir en annexes C.16. 137
Derin (éd.), Abdi Paşa vekâyı’-nâmesi : 443 et Sarı Mehmed , Zübde-i vekayiât : 66. Voir en annexes C.35.
Page | 230
l’évènement : c’est bien l’époux qui est à l’honneur, en tant que sujet de la réception, et non la
dynastie. D’où l’absence de toute présence dynastique : une telle visite aurait accordé trop
d’importance au gendre (déjà honoré par son alliance avec la dynastie). Qui plus est, le
prestige impérial ne saurait s’y prêter : un sultan ne se déplace pas chez des inférieurs ; ce
sont eux qui viennent à lui138
.
Le protocole impérial semble avoir connu une inflexion considérable sur ce point à la
fin du XVIIe siècle, puis ensuite durant le siècle suivant. Si l’on en croit le récit qui nous est
fourni par John Covel, la première entorse à la règle se serait produite à l’occasion du mariage
d’Hadice Sultane, fille de Mehmed IV, avec Mustafa Pacha, en 1675 : la Valide Sultane, mère
de la jeune mariée, l’aurait accompagnée durant son transfert vers son nouveau domicile139
.
Pourtant, les chroniques ottomanes n’y font pas mention et il reste difficile de savoir si cette
présence était atypique ou non, dans la mesure où nous connaissons mal le versant féminin
des festivités maritales données à l’occasion des mariages des princesses140
. Le mariage
d’Ümmügülsüm Sultane avec Çerkes Osman Pacha, en 1694, fournit un exemple plus concret,
dont on trouve mention chez plusieurs chroniqueurs, dont Râşid :
« Conclusion du mariage d’Ümmügülsüm Sultan avec le kaymakam Rikab Osman
Pacha. La fille estimée du précédent souverain défunt, Son Altesse Mehmed Han IV
Gazi – que la compassion exaltée de Dieu soit sur lui –, Son Altesse Ümmügülsüm
Sultane – que sa chasteté soit éternelle –, a été mariée contractuellement, sur ordre
impérial, à Son Excellence le vénérable vizir Osman Pacha, kaymakam des Ecuyers
Impériaux. Par la suite, le 15e jour du mois estimé de Şaban [de l’année 1105 =
dimanche 11 avril 1694], Leurs Altesse l’auguste souverain du monde et la Haseki
Sultane vinrent honorer de leur présence le Palais du défunt Sinan Pacha, sis à
proximité du Bain du Gouverneur à Edirne, qui avait été vidé et le sol recouvert de
tapis [pour l’occasion]. Après quoi, les estimables vizirs et les représentants de
l’Etat qui étaient présents aux côtés du souverain se rendirent au Palais impérial et
ils amenèrent Son Altesse l’épouse fortunée en cortège au susdit Palais de Sinan
Pacha. »141
Les motifs d’une telle exception ne sont pas connus et aucun chroniqueur n’en fournit
d’explications. On notera toutefois que cette fête eut lieu à Edirne, où résidait alors la cour, et
non à Istanbul, ce qui permettait peut-être une plus grande souplesse protocolaire. L’honneur
spécial que le sultan et la haseki accordèrent par ce geste au dâmâd explique la place
particulière accordée à cette union dans les diverses chroniques. Par la suite, le phénomène se
138
Il lui arrive cependant de faire des visites à ses serviteurs, en se rendant chez eux – marque d’honneur souvent coûteuse pour eux. Une seule exception connue : le mariage d’Ibrahim Pacha, grand vizir de Süleyman Ier, auquel le sultan participa en rendant visite à son ami d’enfance. Le bruit que cela suscita – et qui explique partiellement la pérennité de la croyance en un mariage impérial avec la sœur du sultan – montre assez à quel point la chose était exceptionnelle. Sur le mariage du grand vizir Ibrahim Pacha, voir notamment l’article de Turan, « The Marriage of Ibrahim Pasha ». 139
John Covel, Bir Papazın Osmanlı Günlügü. Saray, Merasimler, Gündelik Hayat, Istanbul, Dergâh Yayınları, 2009 : p. 155. Voir le texte en annexes C.35. 140
Voir infra. 141
Râşid, Râşid Târîhi : vol. 2 p. 249-250. Sarı Mehmed Pacha rapporte également l’affaire dans sa chronique : Sarı Mehmed , Zübde-i Vekayiât : p. 478. Voir en annexes C.38.
Page | 231
répète par intermittence, sans s’imposer comme règle générale – au moins pour la période qui
nous intéresse142
.
Ces réceptions répondent à un protocole strict, fondé sur la hiérarchie étatique143
. De
fait, pour les réceptions les mieux documentées, telles celles de la fin du XVIIe et du XVIII
e
siècle, le phénomène est indéniable, avec la répartition stricte des visites par corps, à des jours
fixés à l’avance. Cependant, lorsqu’on regarde de plus près les textes pour les périodes
antérieures, le protocole ne paraît pas si bien établi, ni si bien agencé. La documentation met
en valeur une structuration progressive du protocole, en adéquation avec la rigidification de la
hiérarchie. Comparons les récits des visites lors du mariage de deux sœurs, Ayşe Sultane et
Fatma Sultane, toutes deux filles de Murad III, respectivement avec Ibrahim Pacha (en
1586)144
et Halil Pacha (en 1594)145
. Lors du premier mariage, les réceptions se firent en trois
temps : le premier jour fut consacré uniquement au nakib’ül-eşraf, le second à l’ensemble des
oulémas, le troisième aux Piliers de l’État. La préséance exceptionnelle accordée au
représentant des descendants du Prophète demeure inexplicable ; mais elle disparaît lors du
second mariage, qui procède à une distribution plus stricte, mais aussi mieux répartie, des
jours de réception : un jour est accordé à l’élite religieuse, le lendemain à l’élite militaro-
administrative. Autrement dit, l’organisation protocolaire des visites lors des düğün des
princesses, qui semble éclore au cours de la fin du XVIe siècle, tend à se caler sur la structure
même de l’État ottoman. Mais elle ne prévoit pas encore de distinction au sein même de ces
deux catégories : l’ensemble des oulémas, sans distinction apparente de rang ou statut, est
invité à se présenter un jour, l’ensemble des kul procédant de même le lendemain.
La préséance est ainsi donnée à l’élite religieuse, la première à venir présenter ses
respects. Ceci pourrait répondre à des soucis d’organisation : si le premier texte n’est pas très
clair sur le sujet, le second indique que la visite des Piliers de l’État a lieu le jour même de la
parade de la princesse. Autrement dit, ces grands dignitaires se réunissent d’abord chez le
gendre, avant de se rendre, tous ensembles, au Palais, en fin d’après-midi, pour chercher la
princesse et l’escorter chez son époux : le choix de recevoir les Piliers de l’État ce jour-là
répond dès lors à une double logique protocolaire et pratique. Contrairement à ce que la
formulation laisse entendre, ce n’est pas l’ensemble de la communauté des oulémas ou de
l’élite militaro-administrative qui est invitée, mais seulement certains d’entre eux – les plus
haut placés de chacune de ces cem’iyyet. Effet dû à la formulation du texte, qui aurait mis
l’accent sur les principaux dignitaires par souci de décorum, ou bien reflet de la réalité d’une
sélection par le haut ? Au vu des développements ultérieurs du protocole, nous aurions plutôt
tendance à pencher en faveur de la seconde hypothèse.
142
La même configuration (visite du sultan et de la reine mère au palais du gendre) se reproduit en 1708 lors du mariage d’Emine Sultane, fille de Mustafa II, avec le grand vizir Çorlulu Ali Pacha : cf. Râşid, Târîh-i Râşid : vol. 3 p. 243-245. Lors du mariage de Safiyye Sultane, fille de Mustafa II, avec Maktulzade Ali Pacha, en 1710, le sultan vint également rendre visite au nouveau damad le lendemain de la nuit de noce : cf. Râşid, Târîh-i Râşid : vol. 3 p. 319-320. 143
Arslan, Manzûm Sûrnâmeler : 208-226. 144
Selânikî, Târîh-i Selânikî : t. 1 p. 169-170. Voir en annexes C.8. 145
Selânikî, Târîh-i Selânikî : t. 1 p. 341-342. Voir en annexes C.10.
Page | 232
Dès le début du XVIIe siècle, ces réceptions connaissent une ouverture de leurs rangs,
de sorte que c’est bientôt l’ensemble de l’élite ottomane, grands et petits officiers, qui
participe à ces événements. Ainsi, lors de la cérémonie de mariage de la fille d’Ahmed Ier,
Ayşe Sultane, avec le grand vizir Nasuh Pacha en 1612 (soit un peu moins de deux décennies
après celui de Fatma Sultane), le nombre de visiteurs a déjà augmenté de façon
considérable146
; il en va de même lors des cérémonies ultérieures, telle celle de la fille de
Mehmed IV, Hatice Sultane, avec Musahib Mustafa Pacha147
; d’Emine Sultane et Ayşe
Sultane, filles de Mustafa II, avec respectivement Çorlılı Ali Pacha et Köprülüzade Numan
Pacha148
; de Safiyye Sultane avec Maktulzade Ali Pacha149
ou encore d’Asime Sultane, fille
de Mustafa II, avec Yakup Pacha150
. On peut d’ailleurs constater que l’allongement de la
durée totale des festivités va de pair avec l’augmentation du nombre des visites : il fallait
étendre la durée de l’évènement pour que des visites supplémentaires soient possibles,
nécessaires même, pour ne pas courir le risque de voir des journées sans manifestations pour
les membres de l’élite151
. Plus on avance dans le temps, plus l’auditoire convoqué à l’occasion
de ces visites s’ouvre vers le bas de l’échelle sociale : c’est l’ensemble d’un corps de métier
qui se déplace ou est convié – bien qu’on ne sache trop, dans le détail, qui se présentait
vraiment à la porte du nouveau gendre – et non plus seulement leurs représentants les plus
hauts placés.
Pourquoi cette ouverture ? La chronologie permet de répondre à cette question. La
première attestation connue de cette multiplication des invités a lieu à l’occasion du mariage
de la fille aînée d’Ahmed Ier avec son grand vizir, Nasuh Pacha. La cause serait de nature
politique152
: on se rappelle avoir relevé, à la même période, un phénomène identique dans le
cas des cérémonies données à l’occasion de la conclusion des nikâh des princesses. Le
caractère intimiste des nikâh n’offrait pas les mêmes possibilités que les düğün en terme
d’ouverture et de publicisation des festivités, car ces derniers sont, par nature, des événements
publics, officiels. La publicisation des conclusions de nikâh des princesses aurait constitué
une sorte de pis-aller plus ou moins convaincant, mais qui ne pouvait remplacer une vraie
cérémonie publique telle qu’un düğün. Ainsi, l’ouverture vers le bas qui se repère dès le début
du XVIIe siècle et qui s’intensifie par la suite serait voulue.
146
Yılmazer (éd.), Topçular Kâtibi : t. 1 pp 621-622. Voir en annexes C.16. 147
Derin (éd.), Abdi Paşa vekâyı’-nâmesi : 443-447. Voir en annexes C.35. 148
Râşid, Târîh-i Râşid : vol. 3 p. 243-245. Voir en annexes C.42. 149
Râşid, Târîh-i Râşid : vol. 3 p. 319-320. Voir en annexes C.44. 150
Subhî, Subhî Tarihi : p. 765-766. Voir en annexes C.49. 151
Ceci n’est pas sans poser quelques soucis d’organisation : dans les cérémonies du XVIe siècle, les visites
précédaient la parade nuptiale ; au XVIIe siècle, l’ordre des événements est plus confus. Les visites sont
intercalées entre l’annonce du düğün, la réalisation du nihâh – qui jusqu’alors en était distinct – et l’exécution de la parade ; certaines visites s’étendent même encore après cet événement qui, traditionnellement, sonnait la conclusion des festivités ! 152
Pour une fois, le rang du gendre ne semble pas jouer – même s’il peut avoir influencé l’apparition de cette évolution.
Page | 233
Ne peut-on lire, dans cette ouverture progressive à l’ensemble des classes
“privilégiées”153
la volonté de la dynastie d’utiliser ces cérémonies dans un programme de
restauration de l’unité de son corps politique, à une période où cette unité était justement
malmenée par les révoltes des celali ? Ne s’agissait-il pas de ressouder, de raffermir les liens
de ce corps politique au cours d’une célébration toute à la gloire de la dynastie ? Car, en fin de
compte, même de façon fictive, c’est cet idéal d’unité qui était proclamé au travers de cet
événement. Les échanges de cadeaux et de nourriture occasionnés, qui ont fait l’objet de
quelques (trop rares) études154
, peuvent alors se lire comme un moyen de renforcer cette
cohésion interne au corps politique ottoman. Si l’échange de dons (c’est-à-dire des cadeaux
offerts de façon volontaire autant que contrainte)155
repose sur un principe de rivalité entre les
acteurs156
, il reflète aussi l’intention de favoriser la création de liens d’amitié et d’alliance, qui
reposent sur des liens de dépendance réciproque entre les acteurs157
. Il va de soi, cependant,
qu’une telle hypothèse mériterait d’être étayée par de plus amples recherches, qui ne
pourraient se limiter au seul domaine des cérémonies des düğün des princesses, mais
devraient englober l’intégralité des cérémonies dynastiques – dépassant ainsi largement le
cadre de cette étude158
.
2. Les visites à la princesse
La princesse avait également droit à des visites de félicitation. Cependant, il faut bien
reconnaître que cet aspect du düğün est peu connu et peu décrit – surtout pour la période
moderne, pour laquelle nous ne disposons pas de récits de femmes ayant gravité dans les
153
Nous entendons par là les classes d’individus qui ne paient pas de taxe. Cf. Inalcık, The Ottoman Empire : 65-69 ; Bahaeddin Yediyıldız, « Ottoman Society », dans History of the Ottoman State, Society and Civilisation, vol. 1., E. İhsanoğlu (éd.), Istanbul, IRCICA, 2001 : 491-558 [p. 492-519]. 154
Arslan, Düğünleri ve Şenlikleri : t. 1 p. 177-193 et p. 227-237 ; Hedda Reindl-Kiel, « Power and Submission. Gifting at Royal Circumcision Festivals in the Ottoman Empire (16
th-18
th Centuries) », Turcica 41 (2009) : 37-88 ;
Uluçay, Harem II : 100-103 ; du même auteur, « East is East and West is West, and Sometimes the Twain Did Meet Diplomatic Gift Exchange in the Ottoman Empire », dans Frontiers of Ottoman Studies, vol. 2, C. Imber, K. Kiyotaki, R. Murphey (éds.), Londres, I. B. Tauris, 2005 : 113-123 et « Luxury, Power Strategies, and the Question of Corruption. Gifting in the Ottoman Elite (16
th-18
th Centuries) », dans Şehryârîn. Die Welt der
Osmanen, die Osmanen in der Welt. Wahrnehmungen, Begegnungen und Abgrenzungen. Illuminating the Ottoman World. Perceptions, Encounters and Boundaries, Festschrift Hans Georg Majer, Y. Köse et T. Wölker (éds.), Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2012 : 107-120. 155
Mauss souligne, dès son introduction, l’aspect contradictoire des échanges de dons qui présentent un « caractère volontaire, pour ainsi dire, apparemment libre et gratuit, et cependant contraint et intéressé » : Mauss, Essai sur le don : 66. 156
Mauss souligne à de nombreuses reprises la compétition et la rivalité inhérente au système d’échange des
dons, liée à la notion d’honneur associée au fait de donner : Mauss, Essai sur le don : 78, 108-109, 121, 139-
143. 157
Mauss, Essai sur le don : 101-102. 158
Une étude plus poussée des teşrîfat defterleri pourraient rendre possible une telle étude ; Hedda Reidl-Kiel a d’ailleurs initié le travail, qui devrait donner suite à de nouvelles publications de sa part. Nous même avons dû nous résigner, à grand regret, à mettre de côté l’étude des registres de teşrîfat defterleri concernant les mariages des princesses.
Page | 234
sphères du harem. Au vu des informations éparses collectées au gré des sources, nous nous
contenterons de brèves indications. Les visites faites à la princesse se font à deux occasions :
les premières précèdent la parade nuptiale et ont lieu au Vieux Palais (ou à Topkapı, suivant
l’endroit où réside la princesse) ; les secondes se déroulent au palais des nouveaux mariés, le
jour de la parade.
La première catégorie de visite est la mieux documentée. Les informations fournies
par les chroniqueurs permettent d’en distinguer les étapes et les évolutions. Et cette fois
encore, on repère une ouverture progressive du public convié, qui touche tous les aspects des
cérémonies de mariage des sultanes. Ainsi, en 1586, lors du mariage d’Ayşe Sultane et
Ibrahim Pacha, ne sont mentionnés que le gouverneur de Roumélie (nous ne nous expliquons
pas trop la raison de sa présence) et le kapudan paşa, en sa qualité de sağdıç du gendre (celui-
ci est néanmoins accompagné de toute sa suite159
). Une décennie plus tard, à l’occasion du
mariage de Fatma Sultane avec Halil Pacha, c’est l’ensemble des piliers de l’État qui
accomplissent leurs visites au Vieux Palais. De façon fort inhabituelle, on notera que le sultan,
à cette occasion, accorde également une visite à sa fille : c’est la seule attestation du genre160
.
Une quinzaine d’années plus tard, à l’occasion du mariage d’Ayşe Sultane avec Nasuh Pacha,
les janissaires sont cette fois de la partie, et pour la première fois, on prend soin d’indiquer la
durée de ces visites au Vieux Palais : dix jours et dix nuits161
. Lors du mariage de sa sœur,
Gevherhan Sultane, avec Öküz Mehmed Pacha, les janissaires sont à nouveau présents, mais
la spécificité est au niveau du temps prévu pour ces visites, qui durent cette fois trente jours.
Pour la première fois, la venue d’autres princesses, qui viennent présenter leurs félicitations à
la jeune mariée, est mentionnée162
. Ces visites sont l’occasion de distributions de cadeaux (de
robes d’honneur notamment, mais aussi d’autres tissus), sans qu’on sache précisément qui
s’acquittait de ces dépenses. D’autre part, il est difficile de décrire ces visites comme
purement féminines : il nous semble bien que si une partie d’entre elles se faisaient entre
femmes, d’autres concernaient plutôt les eunuques du Palais – il est en effet peu probable que
la princesse ait reçu personnellement toute une troupe de janissaires fraîchement sortis de leur
école !
La deuxième catégorie de visites avait lieu tout de suite après la parade, une fois la
princesse installée dans son nouveau harem. Malheureusement, à part quelques indications
allant dans ce sens163
et une remarque d’Uzunçarşılı à ce propos164
, nous ne disposons
d’aucune information précise à ce sujet. Exceptionnellement, nous nous permettrons de citer
l’extrait d’un récit postérieur, qui nous semble résumer assez bien l’idée de ces visites et
respecter la hiérarchie féminine. Il s’agit du mariage de Münire Sultane avec Ilhami Pacha, en
1858 :
159
İpşirli (éd.), Tarih-i Selânikî : t. 1 p. 168-169. Voir en annexes C.8. 160
İpşirli (éd.), Tarih-i Selânikî : t. 1 p. 340-341. Voir en annexes C.10. 161
Yılmazer (éd.), Topçular Kâtibi : t. 1p. 621. Voir en annexes C.16. 162
Yılmazer (éd.), Topçular Kâtibi : t. 1 p. 597. Voir en annexes C.15. 163
Lors du mariage d’Hadice Sultane avec Mustafa Pacha, la cérémonie du henné eut lieu dans le palais du gendre, peu après l’ entrée de l’épouse au domicile conjugal. Or, cette cérémonie étant réservée aux femmes, il faut supposer qu’il y eut, à cette occasion, des visites féminines sur lesquelles rien n’est dit. Derin (éd.), Abdi Paşa vekâyı’-nâmesi : 443-447. Voir en annexes C.35. 164
Uzunçarşılı, Saray Teşkilâtı : 163.
Page | 235
« Après s’être reposée pendant quelques instants, la Sultane [qui vient d’entrer à son
domicile conjugal] fit prier sa belle-mère de venir auprès d’elle, à titre privé. Elles
s’embrassèrent et la dame se retira ensuite.
Alors la princesse reçut officiellement les félicitations des autres sultanes. D’abord sa
tante Adilé sultane, fille du sultan Mahmoud, vint, accompagnée de sa fille Haïré
Hanoum sultane, puis arrivèrent ses sœurs Fatma sultane et Réfia sultane. […] Les
filles des sultanes, cousines de la mariée, vinrent à leur tour. Toutes ces princesses
restèrent quelque temps auprès de la mariée, puis quittèrent le salon.
Après les princesses, la Sultane reçut les femmes et les filles des ministres et des vizirs,
qui baisèrent le sol et se tinrent debout devant elle. La femme du Grand Vizir prit la
parole, au nom de toutes ces dames, et présenta leurs respectueuses félicitations ; la
Sultane lui témoigna sa satisfaction en quelques mots aimables, puis tout le monde se
retira. »165
C'est là malheureusement tout ce que nous savons à propos de ces visites à la partie féminine
– et rien n’indique, à ce jour, qu’il soit possible de trouver de plus amples informations dans
les sources.
3. Le cortège nuptial
La parade nuptiale, qui consiste en un cortège qui accompagne la jeune mariée à son
nouveau domicile et dont l’importance est proportionnelle au statut des époux et de leurs
familles, se présente comme l'apothéose finale d’un düğün. Cette parade est, à vrai dire, la
raison d’être de l’ensemble des activités et spectacles qui la précèdent. Rien n’y est laissé au
hasard ; tout est travaillé, depuis le choix des participants, leur placement dans le cortège, et
jusqu’aux décorations préparées spécialement pour cet instant. Le hasard n’a pas sa place
dans cet événement chargé de toute la pompe impériale et qui cristallise en un jour tous les
enjeux de cette cérémonie. Étant donné sa complexité, il est préférable de procéder par étapes
– plus précisément, par thématiques, afin d’éviter de se perdre dans les flots de descriptions de
ces parades qui, il faut bien le reconnaître, ont la fâcheuse tendance à en dissimuler les aspects
importants : les détails font rapidement perdre de vue les enjeux, les conflits, les évolutions
subreptices apportées à cette cérémonie, tout au long de la période moderne.
1. Espaces et temps de la parade
Commençons par situer l’événement dans l’espace et le temps, afin d’en comprendre
l’articulation générale. La parade nuptiale s’organise en plusieurs composantes réparties sur
une journée entière. Les historiens qui se sont penchés sur la question ont concentré leurs
165
Leïla, Le Harem impérial : 226-227.
Page | 236
regards sur le cortège qui accompagnait la princesse et, de ce fait, ont négligé de tenir compte
du déroulement complet. Pourtant, la journée commence bien avant la parade. Le récit que
nous fait Selânikî à l’occasion du mariage d’Ayşe Sultane, fille de Murad III, avec Ibrahim
Pacha est unique en son genre : pour la première fois, un chroniqueur prenait le temps de
décrire dans le détail l’intégralité des événements qui constituent la cérémonie166
. Lui fait
écho, dans le souci de la précision, les descriptions de Râşid, notamment ceux d’Emine
Sultane et d’Ayşe Sultane (filles de Mustafa II) avec Çorlulu Ali Pacha et Köprülüzade
Numan Pacha, d’Emetullah Sultane ou encore de Safiyye Sultane (filles d’Ahmed III)167
.
Les étapes successives décrites par Selânikî se distinguent dans le temps et l’espace.
Les Piliers de l’État et, de façon plus générale, les principaux représentants du corps militaro-
administratif de l’État, se retrouvent chez le gendre, au petit matin168
. Tout, dans la
description qui en est faite, laisse entendre que cette étape s’apparente aux précédentes visites
réalisées par les oulémas. La première étape de cette journée commence donc au petit matin,
chez le gendre, dont le palais est situé sur l’Hippodrome, et se poursuit plusieurs heures
durant en divertissements divers, dans un respect très strict des positions hiérarchiques de
chacun. La journée s’écoule de la sorte, jusqu’au moment où il convient d’aller chercher
l’épouse pour la ramener à son mari :
« Et avant la prière du début de soirée, les piliers de la félicité se levèrent et se
rendirent au Vieux Palais en grande pompe »169
Ce sont donc les invités qui ont la responsabilité d’aller chercher l’épouse. Le mari ne fait pas
partie du groupe : il attend sa femme chez lui. Partie du palais du gendre, la petite troupe
(nous reviendrons sur sa composition) se rend au domicile de la princesse – ou du moins, ce
qui symbolise son domicile : le Vieux Palais. Ceci se situe avant la prière du soir, dont l’heure
varie en fonction de l’époque de l’année. Il ne reste plus alors à la troupe (gonflée par la
présence des propres serviteurs de la princesse) qu’à revenir à son point de départ : ce retour
correspond à la parade nuptiale, sur laquelle nous reviendrons plus en détail après. Les
célébrations qui suivent se déroulent intégralement au domicile conjugal. L’événement
complet monopolise ainsi la participation d’un vaste ensemble d’individus sur une journée
entière. L’ensemble fonctionne sur un cercle fermé : parti d’un lieu, on y revient. Tout
commence et se termine au domicile conjugal, qui est le cœur spatial de cette journée, le lieu
de toutes les attentions. D’où l’importance de la visite des Piliers de l’État, dès le matin, à
l’époux : ce sont les membres de son groupe d’appartenance qui vont chercher et lui ramènent
son épouse. C’est là une manière de mettre l’accent sur le caractère social de cette cérémonie
– au détriment, peut-être de l’aspect familial170
.
Ces informations ne sont pas sans soulever quelques remarques et interrogations. Nous
commencerons par le jour choisi pour l’envoi de la princesse. D’après Selânikî, il s’agirait du
166
Selânikî, Târîh-i Selânikî : t. 1 p. 168-171. Voir en annexes C.8. 167
Râşid, Râşid Târîhi : vol. 3 p. 243-245, vol. 5 p. 220-226 ; voir en annexes C.42 et C.44. 168
Selânikî, Târîh-i Selânikî : t. 1 p. 169. Voir en annexes C.8. 169
Selânikî, Târîh-i Selânikî : t. 1 p. 169. Voir en annexes C.8. 170
Les chroniques ne précisent jamais la présence de membres de la famille des époux respectifs. Il peut certes s’agir d’un effet de style propre à ces récits – qui mettent l’accent sur les détails porteurs d’une valeur politique. On peut aussi y voir une prédominance du politique sur le familial.
Page | 237
jeudi. Cela coïnciderait avec les informations fournies par Fanny Davis, pour les mariages de
l’élite au XIXe siècle
171. Notre documentation semble confirmer ce fait : outre le mariage
d’Ayşe Sultane avec Ibrahim Pacha, la parade a lieu également un jeudi pour celui de Fatma
Sultane (fille de Murad III) avec Halil Pacha172
; de celui d’Ayşe Sultane (fille d’Ahmed Ier)
avec Nasuh Pacha173
; ou encore de celui de Safiyye Sultane (fille de Mustafa II) avec
Maktulzade Ali Pacha174
. Pourtant, lors de l’exubérante cérémonie donnée à l’occasion du
mariage d’Hatice Sultane, fille de Mehmed IV, avec Musahib Kara Mustafa Pacha, la parade
eut lieu non pas le jeudi, comme de coutume, mais le mercredi175
. Ce décalage est en fait
motivé par le souci d’éviter un chevauchement de cérémonies dynastiques, car le jeudi eut
lieu une cérémonie donnée à l’occasion du premier cours d’un des princes, qui nécessitait la
présence des Piliers de l’État176
. Le mariage d’Hatice Sultane n’est qu’une exception qui
confirme la règle du jeudi comme jour privilégié pour la parade nuptiale. De même, la double
cérémonie de mariage organisée en l’honneur des filles de Mustafa II en 1702 obligea à
quelques compromis : si Râşid n’indique pas le jour de la semaine, il précise par contre que le
cortège en l’honneur d’Ayşe Sultane succéda de deux jours celui de sa sœur, Emine Sultane177
– il est donc impossible que les deux cortèges aient eu lieu un jeudi, puisque l’intervalle entre
les deux n’est pas assez long. Ces exemples montrent que des adaptations étaient possibles,
qu’une certaine souplesse existait quand l’impératif dynastique l’exigeait. Il met surtout en
exergue l’impossibilité de cumuler plusieurs cérémonies dynastiques le même jour.
2. Acteurs et figurants : les protagonistes
La journée de la parade met en scène, dans un ensemble programmé et hiérarchisé, les
protagonistes nécessaires à son déroulement. Chacun y a sa place, définie à l’avance et dont il
ne peut changer par humeur. La portée de cette journée, de cette parade, devient le reflet des
considérations dynastiques. Parmi les premiers protagonistes présents viennent les membres et
représentants de l’élite politique : les Piliers de l’État, qui viennent chercher et ramener la
princesse à son époux, mais aussi les oulémas. La présence de ces derniers pourrait bien
constituer un ajout datant de la fin du XVIe siècle. En effet, dans la description qu’il fait du
mariage d’Ayşe Sultane, fille de Murad III, avec Ibrahim Pacha, Selânikî ne mentionne que
les Piliers de l’État178
. Pourtant, une décennie plus tard, il fait état de la participation des
171
Le jour de l’entrée de l’épouse au domicile conjugal tombait toujours, d’après elle, le jeudi. Cf. Davis, The Ottoman Lady : 74-75. 172
« Yevmü’l-hamîs fî 15 rebî’ulevvel » : Selânikî, Târîh-i Selânikî : t. 1 p. 342. 173
« mâh-ı cumâdelâhıre[de] pençşenbih günü » : Yılmazer (éd.), Topçular Kâtibi : t. 1 p. 622. 174
Râşid, Târîh-i Râşid : vol. 3 p. 319-320. Voir en annexes C.44. 175
« Onıncı Çihâr-şenbih güninde » : Derin (éd.), Abdi Paşa vekâyı’-nâmesi : 444 ; « Ununcu, yevmü’l-erbi’âda » : Sarı Mehmed , Zübde-i vekayiât : 67. 176
« Le jeudi 11 [4 juillet], après la prière de l’après-midi, eut lieu la réunion publique à l’occasion du [1er
] cours en présence impériale. Sur ordre impérial, tous les vizirs et oulémas furent présents à cette assemblée royale […] » : Derin (éd.), Abdi Paşa vekâyı’-nâmesi : 444. 177
Râşid, Târîh-i Râşid : vol. 3 p. 243-245. Voir en Annexes C.42. 178
Selânikî, Târîh-i Selânikî : t. 1 p. 169. Voir en Annexes C.8.
Page | 238
oulémas également, à l’occasion du düğün de la sœur de la précédente, Fatma Sultane, avec
Halil Pacha179
. Le récit suit la même trame que le précédent, mais précise cette fois, sans
doute possible, la participation de membres de l’élite religieuse, notamment les deux
cadiasker de Roumélie et d’Anatolie, Sunullah Efendi et Ali Çelebi Efendi, ainsi que le cadi
d’Istanbul, Ebussuudzade Mustafa Çelebi Efendi, ou encore le “hoca des Efendizade”
Mehmed Efendi, dès le matin. Mais ce sont surtout des formules englobantes qui sont le plus
communément utilisées : « erkân-ı sa’âdet », « a’yân-ı devlet », « erkân-ı devlet ».
Plus on avance dans le temps, plus ces descriptions se font précises et révèlent la
présence d’une assemblée croissante. La parade organisée en l’honneur du mariage de la
princesse Gevherhan Sultane avec Öküz Mehmed Pacha, sous le règne d’Ahmed Ier, fut
somptueuse :
« Les kul de la Porte, les agas des écuyers impériaux, l’ensemble des descendants
du Prophète, des nobles oulémas et des cadiaskers, ainsi que les honorables vizirs,
venus de l’hippodrome à cheval, attendirent un certain temps à l’intérieur de la
cour du Vieux Palais, après quoi ils se mirent en route selon les coutumes.
Précédant les grandes palmes venait un défilé de musiciens jouant de divers
instruments et un défilé de çeşteci, puis venaient, marchant à pied, le vizir-
defterdar Ahmed Pacha, en tête de tous les agas. Le palmier de pierres précieuses
qui suivait était porté par les responsables du palmier, accompagnés des portiers,
des baltacı, des portiers du Seuil Sublime et de l’Aga du Vieux Palais. Après quoi
venaient les gardiens du palais, les agas avec [en tête] le Chef des eunuques noirs,
qui portaient le lit nuptial à piliers ainsi que de l’or, de l’argent et de la nourriture.
Puis venaient les eunuques-agas [du Bîrûn] et ceux de l’Enderun, marchant à pied
et en groupe, entourant avec gloire et honneur Sa Majesté la fortunée Sultane,
[protégée] derrière une moustiquaire dont ils tenaient les piliers d’or et incrustés
de pierres précieuses. Un défilé de jeunes filles voilées, escortées par des eunuques-
agas à cheval, suivait. »180
Un siècle plus tard, la parade organisée en l’honneur de la fille de Mustafa II, Asime Sultane,
mariée à Yakup Pacha, présente toujours cette accumulation de hauts personnages présents :
« Le 3e jour du mois de Muharrem [27 février 1743], l’ordre et le commandement
d’envoyer en grande procession Sa Majesté susmentionnée au Palais Sublime sis
[dans le quartier] de Kadirgalimanı ayant été donné, ce jour-là, en conformité avec
les traditions anciennes ottomanes, Son Excellence le grand vizir, Leurs
Excellences l’amiral et le chef des janissaires ainsi que les piliers du conseil, les
représentants des oulémas, le noble chef de la chancellerie, les kapıcıbaşı de la
Porte impériale, le peuple des cuisines, les agas et tous les autres grands et petits
officiers se présentèrent au petit matin au Palais Impérial de Sa Majesté royale.
Après avoir fait préparer la voiture et les autres affaires nécessaires aux dernières
touches d’équipement et de préparation [de la cérémonie], la procession se mit en
179
Selânikî, Târîh-i Selânikî : t. 1 p. 342-343. Voir en Annexes C.10. 180
Yılmazer (éd.), Topçular Kâtibi : t. 1 p. 597-598. Voir en Annexes C.15.
Page | 239
place, sous le contrôle auguste et avec le consentement de Son Excellence le chef
des eunuques noirs, Elhac Beşir Ağa. Les capitaines de la garde venaient d’abord,
marchant de façon élégante, puis les hallebardiers du divan portant leur turban
mücevveze181, puis les müteferrika de la Porte impériale portant le manteau de
fourrure des officiers, puis le chef de la chancellerie du conseil, directement suivi
du chef des cuirassiers, de l’intendant du corps susdit, et les autres officiers [des
cuirassiers], après quoi venaient les colonels suivis du chef des voituriers, de
l’intendant et des officiers du corps des agas, puis à leur suite d’autres officiers du
corps des janissaires ainsi que l’intendant des kul, après quoi les chefs de la
cavalerie et des porteurs de sabres, puis les kapıcıbaşı de la Porte impériale, puis le
Ministre des finances et le Directeur des registres de propriétés foncières, puis à
leur suite ces Messieurs les oulémas actuellement sans affectation et qui se
trouvent à Istanbul, Leurs Excellences Messieurs les deux cadiaskers, puis Leurs
Excellences l’amiral de la flotte et l’aga des janissaires tous deux côte à côte, puis
le premier secrétaire du Grand Vizir, le second, le chef de la garde impériale et le
Ministre des Affaires étrangères, après quoi il y eut le passage d’une magnificence
et d’un succès impeccable du grand vizir, suivi des personnes de l’arsenal et, en
plus grand nombre que par le passé, de six petits palmiers, dont trois grands et un
fabriqué tout en argent. Son Excellence susmentionné le Chef des eunuques noirs
venait ensuite à la tête de centaines de kapıcı vêtus de feutres de grande valeur, de
quelques centaines de hallebardiers du Vieux Palais, des eunuques de la suite
impériale et du Vieux Palais ainsi que des chefs du Harem Impérial, marchant
devant et derrière le carrosse de la sultane susdite. Partis de la Porte de la Félicité
sous la forme d’un cortège de joie parfaitement arrangé, ils passèrent par la place
de l’hippodrome, donnant de la joie et du bonheur à l’humanité qui les
contemplait, installée tout le long de la route dans les boutiques, maisons et
échoppes se trouvant des deux côtés du chemin, et arrivèrent au palais de la
sultane, sis dans le quartier appelé Kadırga Limanı ; à ce moment-là, après les
cérémonies traditionnelles, chacun de son côté retourna à ses propres affaires. »182
L’ouverture de ces cérémonies de mariage à un public sans cesse plus diversifié, que nous
avons déjà noté à plusieurs occasions pour d’autres étapes, se confirme de nouveau.
Le peuple, qui se presse sur le passage du cortège pour apercevoir le défilé, constitue
une deuxième catégorie de protagonistes. Ainsi, lors du mariage de Gevherhan Sultane,
mentionné plus haut, « vieux et jeunes, riches et pauvres, toutes les personnes dans les
maisons et les boutiques, les femmes et les enfants dans [toute] la ville d’Istanbul se
pressèrent en ordre. Il ne demeura pas un homme en ville. Les çavuş étaient à bout de nerfs :
tout le monde se pressait là comme au jour du jugement dernier. »183
Sa présence est
181
Un turban fait de plusieurs plis tressés, porté lors des occasions formelles comme faisant partie de l’ensemble de l’uniforme des fonctionnaires turcs 182
Subhî, Subhî Tarihi : p. 765-766. Voir en Annexes C.49. 183
Yılmazer (éd.), Topçular Kâtibi : t. 1 p. 597. Voir en Annexes C.15.
Page | 240
indispensable, nous le verrons, pourtant c’est à peine s’il est mentionné par les chroniqueurs :
concentrés sur les faits et gestes des membres de l’élite, ceux-ci ne voient aucun intérêt à
s’étendre sur la présence, évidente à leurs yeux, de la population lors de la parade. Les
attestations se résument à un mot et quelques adjectifs, qui insistent par contre, tel un let
motiv, sur le caractère œcuménique du regroupement populaire : Selânikî parle de « la
population du monde »184
et Subhî de « l’humanité » qui contemplait le passage du cortège,
« installée tout le long de la route dans les boutiques, maisons et échoppes se trouvant des
deux côtés du chemin »185
. Certains viennent y chercher le moyen d’arrondire les fins de
mois, aux dires de Selânikî, qui précise que le cortège nuptial fut l’occasion d’une distribution
abondante d’aspres et qu’à cette occasion, « les faiseurs de butin ramassèrent une foultitude
d’aspres », n’hésitant pas à menacer ceux qui se plaignaient qu’ils prenaient plus que leur
part186
.
Vient alors la dernière catégorie de protagonistes : la dynastie. Dans les étapes
antérieures, la dynastie est restée très à l’écart : elle ne participe pas aux festivités (même si
elle en finance une partie) et aucun de ses membres ne vient attester de sa présence. Elle se
place volontairement à l’arrière-plan, attendant le jour de la parade pour apparaître dans tout
son éclat. Car cette parade est entièrement prévue pour lui permettre de se sublimer. La
dynastie est non seulement la principale protagoniste de la parade, mais c’est encore elle qui
donne son sens à cet événement. Précisons qu’à quelques très rares exceptions près, la
dynastie n’est jamais représentée que par un seul de ses membres, la princesse nouvellement
mariée. Aucune autre princesse n’est présente à part elle, aucun prince, et surtout pas le
sultan. La place unique et centrale donnée à la princesse est volontaire et participe à créer
l’ambiance recherchée : elle devient l’incarnation même de la dynastie. Elle personnifie, à elle
seule, toute la Âl-i ‘Osmân. Pour qu’elle puisse endosser une telle charge symbolique, il était
indispensable qu’elle soit le seul membre de la dynastie présent à cette occasion : si le sultan
avait participé, il aurait éclipsé l’aura de la princesse et tous les regards, toutes les attentions,
toute la disposition même du défilé auraient alors été orientés en sa direction187
.
Occupés jusque-là par des manifestations distinctes, l’élite dirigeante et le peuple se
retrouvent soudainement réunis en un même lieu et temps, à l’occasion de la parade. Ce n’est
pas un hasard : tous deux apportent leur propre contribution au défilé. Le peuple sert de
témoin : par sa présence, il souligne l’importance de l’événement, son caractère exceptionnel
et sa valeur totale. Le rôle de l’élite est plus actif, plus invasif ; il est le reflet de sa propre
place au sein de la société ; elle participe au cortège qui va chercher puis ramène la fiancée à
son mari. Elle n’est donc pas seulement figurante, comme le peuple, mais actrice de
l’événement. Une barrière invisible mais palpable sépare le peuple de l’élite : les premiers
184
Selânikî, Târîh-i Selânikî : t. 1 p. 171. Voir en annexes C.8. 185
Subhî, Subhî Tarihi : p. 766. Voir en Annexes C.49. 186
Selânikî, Târîh-i Selânikî : t. 1 p. 171. Voir en annexes C.8. Une formulation extrêmement proche est reprise par le même chroniqueur lors de la description du mariage de Fatma Sultane, fille de Murad III, avec Halil Pacha. Voir en annexes C.10. 187
Un raisonnement similaire s’appliquait lors des mariages des souverains espagnols, ainsi que l’a mis en valeur José Maria Perceval dans son article « Épouser une princesse étrangère : les mariages espagnols », dans Femmes et pouvoir politique. Les princesses d’Europe, XV
e-XVIII
e siècle, I. Poutrin et M.-K. Schaub (éds.), Rosny-
sous-Bois, Bréal, 2007 : 66-77.
Page | 241
sont statiques, ils regardent mais ne participent pas directement ; les seconds sont en
mouvement, ils portent tous leur costume de cérémonie, ils se tiennent bien droit et défilent
gravement et avec fierté. Ils sont sur la scène, quand les autres sont sur les gradins. Ils servent
certes de faire-valoir, mais leur présence en devient justement indispensable.
L’élite est donc actrice, mais soumise à la dynastie. La manifestation qui a lieu au
moment où le cortège vient chercher la princesse pour l’amener chez son mari peut se lire
comme un acte de soumission de l’ensemble de la classe politique à la dynastie. Ses plus
hauts représentants viennent en effet prier la princesse, au pas de chez elle (un Palais
impérial), de bien vouloir quitter cet espace supérieur (parce qu’incarnation du pouvoir
suprême) pour venir habiter, vivre parmi eux, aux côtés d’un des leurs. Et la princesse ne se
presse pas de venir : elle se fait attendre, longuement, afin de bien montrer que la parade se
fera selon son bon vouloir, quand elle se décidera à venir. L’escorte des grands dignitaires
organisée à l’occasion de la parade qui vient chercher Safiyye Sultane, fille de Mustafa II,
pour l’emmener auprès de son époux, Sirke Osman Pacha, arrive au Vieux Palais aux
environs de quatre heure ; ils furent invités à se reposer dans la Salle de réception (Misafır
odası) du chef des eunuques noirs : ils attendirent là jusqu’à cinq heures trente, une heure et
demie donc, que la princesse soit prête !188
Une certaine hiérarchie sociale s’opère dès lors
tout au long du défilé : au cœur de la parade se trouve la princesse, mise en avant par toutes
sortes de procédés, escortée par des représentants de l’élite (placés ainsi en seconde position) :
sa proximité avec la princesse dans le cortège rappelle son rôle envers l’État. De son côté, le
peuple, présent mais inactif, se presse au passage de la procession, mais il est relégué sur les
bas côtés, en troisième et dernière position. Il n’a pas prise sur l’événement ; il le constate et
en témoigne seulement – sa participation n’en est pas moins essentielle.
Quant à la princesse, son rôle est ambivalent : sujet de la fête, elle y demeure
cependant très largement passive. On vient la chercher et on l’amène chez son époux ; elle,
docile, se laisse emmener sans mot dire, sans geste particulier, sans protestation quelconque.
Tout le monde se réunit devant elle, mais elle-même s’interdit la moindre participation
active au risque, sinon, d’y perdre de son lustre ; le mystère, le silence qui entoure la princesse
permettent ainsi de souligner sa supériorité, son inaccessibilité189
. Mais en même temps,
l’absence de participation de la princesse souligne sa propre soumission à la dynastie : elle
incarne certes la ‘Âl-i ‘Osmân et, à ce titre, est mise sur un piédestal ; mais elle demeure une
représentante somme toute insignifiante, passive, sans responsabilité, dans un événement qui
la touche personnellement, mais dont la principale raison d’être est à chercher dans les intérêts
supérieurs de la dynastie.
Cette passivité symbolise encore son état d’innocence : la timidité et la docilité sont
des attitudes attendues de la part d’une jeune vierge, car elles sont la promesse de son
obéissance : envers le mari, envers les codes sociaux. L’attitude de retrait endossée
188
Râşid, Râşid Târîhi : t. 5 p. 222. 189
On peut y voir un parallèle avec la pratique du silence impérial lors des réceptions des ambassadeurs : les représentants des souverains voisins entament un long discours et présentent leurs compliments au sultan, qui répond par le silence, ce qui est une manière d’affirmer la différence de condition entre le sultan ottoman et les souverains voisins.
Page | 242
publiquement par une jeune mariée le jour de son mariage est la garantie exigée par la société
qu’elle n’ira pas remettre en cause l’ordre établi. Cette soumission ainsi mise en scène n’est
pas sans surprendre, quand on sait qu’elle était largement remise en cause au sein des couples
princiers, ainsi que nous l’avons déjà vu190
. Une contradiction surgit ici : publiquement, la
princesse doit respecter les codes comportementaux imposés à son sexe, mais par la suite, il
revient au gendre de respecter la hiérarchie et d’affirmer sa soumission à la dynastie. Dans les
deux cas, la soumission est surtout symbolique : peu importe, au fond, ce qui se passait dans
l’intimité du harem. Mais il apparait que même une princesse doit payer son tribut à l’ordre
social. L’autosacralisation de la dynastie entraîne certes des dérogations dans l’application du
droit, mais elle ne saurait remettre en cause un fonctionnement social qui arrange tout le
monde et qui est l’un des fondements de la société islamique : la soumission de la femme.
La soumission de l’ensemble de la classe politique et populaire stambouliote est non
seulement lisible au travers de la cérémonie ; elle était surtout perçue comme telle par les
participants eux-mêmes, en tout cas par certains d’entre eux, et sujette à une remise en cause.
Uzunçarşılı le souligne191
, en rapportant les propos de Selânikî, auquel nous laissons la
parole :
« Par le passé, à l’époque de Sultan Süleyman Han –que le pardon et la grâce
divine soit sur lui–, à l’occasion de la sortie de Mihrimah Sultane –qu’elle repose
en paix– du Vieux Palais vers le palais du défunt Rüstem Pacha, le défunt grand
vizir Hadım Süleyman Pacha était descendu de son cheval et avait marché devant
la timide Sultane, mettant en évidence l’honneur impérial, sa magnificence et sa
gloire. De même, lors de la sortie du Vieux Palais de la fille de feu le prince Sultan
Mehmed, Hüma Sultane –qu’elle repose en paix– pour se rendre au palais du
défunt Ferhad Pacha, le défunt Rüstem Pacha s’était conformé à cet usage : en
arrivant au coin du Vieux Palais, nous l’avons vu en train de marcher le bâton à la
main. Mais lors de la sortie du Vieux Palais des filles du prince Sultan Selim Han,
les princesses dignes de vénération, pour se rendre aux palais du vizir Mehmed
Pacha, de l’amiral Piyale Pacha et du chef des janissaires Hasan Ağa, le grand
vizir était le défunt Semiz Ali Pacha. Comme il souffrait d’un problème de
résistance du à son obésité excessive, il avait présenté des excuses et avait reçu
une permission du Padişah refuge du monde [pour demeurer sur son cheval].
Cette fois-ci encore, à l’occasion de la venue traditionnelle du défunt grand vizir
susdit Siyavuş Pacha, nous avons vu celui-ci sortir de la porte du palais et monter
sur son cheval. »192
Il n’est question ici que de la place et du rôle joués par le grand vizir dans cette parade,
mais elle est révélatrice des conflits qui se déroulaient en arrière-plan. Ainsi, plusieurs
évolutions successives virent le jour au cours du XVIe siècle. La tradition voulait, apprend-on,
que le grand vizir (le chef de l’ensemble de l’élite politique ottomane) précède la princesse,
190
Chapitre 1.III.2.1. 191
Uzunçarşılı, Saray Teşkilâtı : 162. 192
Selânikî, Târîh-i Selânikî : t. 1 p. 170-171. Voir en annexes C.8.
Page | 243
qu’il escortait à pied, tandis qu’elle-même se tenait à cheval. Cette disposition avait
l’avantage, pour la dynastie, de rappeler la différence de statut entre le grand vizir, un kul du
sultan, et la princesse, membre et représentante de la dynastie. Il n’existait donc pas
d’équivalence de statut possible entre les deux et la disposition respective permettait de le
souligner, symbolisant par là même la soumission et l’infériorité de l’ensemble de l’élite
politique par rapport à la dynastie. Une dérogation exceptionnelle fut accordée à Semiz Ali
Pacha lors du mariage des filles de Selim II. La justification n’était pas politique, tant s’en
faut : seule la corpulence de celui-ci est invoquée. De fait, il est décrit unanimement dans les
sources comme étant tellement obèse qu’il en était incapable de marcher. L’éventualité d’un
grand vizir incapable d’accomplir jusqu’au bout et avec panache la tâche qui lui était assignée
n’avait rien pour plaire à la dynastie et la solution fut de lui permettre, exceptionnellement, de
faire le chemin à cheval. C’était là cependant ouvrir la brèche à des réclamations ultérieures,
ce qui ne manqua pas d’arriver. Arguant du précédent établi, le nouveau grand vizir Siyavuş
Pacha réclama le même privilège que son prédécesseur, lorsque vint son tour d’accompagner
la princesse Ayşe Sultane, fille de Murad III193
. L’existence d’un précédent renforçait la
prétention de celui-ci et, de fait, il eut gain de cause ; de sorte que la pratique voulut
désormais que les grands vizirs accompagnassent à cheval les princesses.
Ce texte révèle comment un protocole peut être contourné et modifié. À aucun
moment, la question du symbole de soumission n’est invoquée, alors même que c’est bien
cela qui est en cause. Des considérations personnelles entraînèrent la première exception ;
mais la réclamation de Siyavuş Pacha est, elle, bel et bien d’ordre politique. Il entend avoir
droit aux mêmes avantages que son prédécesseur, étant dans la même position. Il fait donc
valoir un argument reposant sur une prérogative associée au statut de grand vizir, qui
n’existait pas jusqu’alors. Il n’était pas question qu’il n’ait pas droit aux mêmes faveurs qu’un
autre par le passé ! La réclamation, si elle touche au domaine du politique et de la
représentation, se limite cependant à la place de grand vizir. Cependant, la portée de cette
évolution prend un sens plus général, puisque c’est le symbole même de la soumission de
l’ensemble de l’élite politique, mise en valeur par celle du grand vizir, qui est remise en cause,
au moins partiellement. Le fait que le grand vizir se tienne désormais à cheval devant la
princesse tend, en effet, à réduire la différence de statut existant entre les deux, à rapprocher le
grand vizir de la dynastie et, inversement, à rapprocher la princesse du grand vizir – donc de
l’élite ottomane. On peut y voir la marque du renforcement de la puissance du grand vizir par
rapport à la dynastie. Mais Siyavuş Pacha était-il conscient de la portée de sa réclamation ?
Les parades nuptiales des princesses sont ainsi dotées d’un caractère total. De
nombreux historiens de l’Empire ottoman ont mis l’accent sur la répartition de la société
ottomane en deux catégories, les privilégiés et les autres, placés sous la puissance et l’autorité
supérieure de la dynastie194
. Or, ce sont bien ces trois grandes catégories sociales qui sont
présentes lors des parades nuptiales, chacune à sa place, chacune dans son rôle. Il nous
193
On remarquera, au passage, que Selânikî ne nous dit rien du cortège ni même de l’existence éventuelle de telles cérémonies à l’occasion des mariages des autres filles de Selim II, notamment Fatma Sultane, mariée au dit Siyavuş Pacha, qui eut lieu entre ces deux cérémonies mentionnées. 194
Veinstein, « Asker et re’aya » ; İnalcık, « The Ottoman Concept of State » ; İpşirli, « Ottoman State Organization ».
Page | 244
semble, dès lors, que la cérémonie favorise l’union sociale. Certes, l’ensemble de l’Empire
n’est pas représenté ; malgré les résonances possibles de ces fêtes dans les autres villes et
provinces de l’Empire, Istanbul (éventuellement Edirne, pour les quelques occasions où de
telles fêtes y eurent lieu) est la seule à vivre les festivités avec une telle intensité. Elle devient,
de la sorte, la représentante de l’ensemble du peuple de l’Empire, une sorte de laboratoire
d’expérimentation où se développe et se réaffirme, au travers de ces parades, la cohésion
sociale ottomane. Mais derrière la cohésion, c’est également une réaffirmation de la hiérarchie
sociale qui se met en place, avec le rappel de la suprématie de la dynastie sur l’ensemble de la
société ottomane.
4. Dépenses somptuaires et étalage de richesses
Parce qu’elles figent les hiérarchies dans le temps, dans l’espace et dans la mémoire
collective, les cérémonies sont l’occasion de multiples rivalités, dont certaines sont déjà
apparues précédemment. Il est une autre forme de rivalité sur laquelle il convient maintenant
de s’arrêter : la consommation somptuaire. Ce type de rivalité est loin d’être propre à la
société ottomane, encore moins aux seules cérémonies de düğün des princesses. Sans entrer
dans le détail de cette historiographie, citons notamment les travaux sur le don, tel celui de
Mauss195
, ou encore sur les systèmes curiaux, tel celui d’Elias196
. Les cérémonies publiques
sont toujours, dans ce contexte, des occasions privilégiées pour exprimer ces rivalités, dont les
chroniqueurs se font l’écho.
Le thème de la prodigalité est en effet récurrent dans les textes relatifs aux cérémonies
de mariage des princesses. Tous les acteurs contribuent, à leur niveau, à créer l’impression de
profusion et d’abondance de richesses : le gendre vient à sa fête « avec des cadeaux et des
195
Lorsqu’il décrit les caractéristiques des prestations totales de type agonistiques (le potlatch), Mauss souligne que l’un de ses principes premiers est la rivalité et la lutte : « le but poursuivi au cours de cette lutte de générosité est d’établir la hiérarchie entre différents groupes et leurs représentants : le plus fort sera celui qui aura offert, y compris en les détruisant, le plus de richesses. Le potlatch n’existerait donc, suggère Mauss, que dans les sociétés où la hiérarchie est instable, là où elle est susceptible d’être remise en cause à chaque cérémonie », car « loin de chercher le gain matériel, les protagonistes d’un potlatch se doivent de manifester tout le mépris qu’ils éprouvent envers la richesse pour elle-même, et tout le prix qu’ils attachent à leur honneur, à leur prestige, en se montrant chacun le plus généreux et le plus dépensier de tous. Ce qui est engagé dans ces luttes de générosité, c’est en effet l’honneur des protagonistes ». Mauss, Essai sur le don : 18, 72-74. 196
Elias ne se contente pas de rappeler l’existence d’une rivalité des membres de la cour par l’étalage des richesses ; il montre en quoi ce trait de caractère était inhérent à ce type de société. L’étalage de richesse est et doit être en accord avec le statut hiérarchique de chacun ; un duc ne peut vivre comme un comte, il doit montrer dans chacun de ses actes, chacune de ses dépenses, son statut de duc, qui ne peut être supérieur à ce qu’il est ; il ne peut construire une résidence plus riche et plus belle que celle d’un prince, au risque d’outrepasser sa position hiérarchique. Le critère somptuaire est donc critère hiérarchique ; il s’impose à l’individu s’il veut tenir son rang. De sorte que les membres composant la société de cour ne sont pas seulement engagés de façon extérieure dans cette compétition somptuaire, cette compétition somptuaire est inhérente à leur habitus de classe ; en fin de compte, elle fonctionne comme un instrument au service de la monarchie absolue. Elias, La société de cour : 46-62.
Page | 245
présents »197
; le sağdıç réalise « des dépenses abondantes et [fait] des dons infinis » pour
s’acquitter de sa tâche « de façon méritante », distribue « des dons » et fait preuve « d’une
générosité sublime »198
; lors des visites au Vieux Palais, « il [pleut] des aspres nouveaux sur
des plateaux d’argent » et « chacun des sipahis présents » reçurent trois kuruş, « distribués à
la porte des agas »199
; et lors du cortège, qui se déroule « dans le plus grand respect et
honneur, avec force d’élégance et d’ornementations les plus exaltées »200
, tout le monde est
paré de ses habits de cérémonie, certains portant le üst, d’autres le mücevezze201
. L’abondance
s’exprime jusque dans la nourriture prévue à cette occasion : « toutes sortes de nourritures
diverses » sont présentées, en un « sublime banquet » honoré par « des récitants du Coran
sacré à la voix agréable »202
ou dans la décoration des palais, « tapissé[s] aux frais du [Trésor]
impérial » en l’honneur des sultanes203
. Il arrive encore que pour faire état de sa bonté,
l’incarnation de la dynastie, le sultan, ordonne une série de promotion de ses serviteurs formés
au sein du Palais : on fait par exemple sortir « le silahdar impérial, les laquais, les eunuques
de l’Enderûn impérial, les écuyers, l’officier de la garde-robe et quelques détenteurs de
positions [au sein du Palais], en les nommant ici et là avec la rétribution tantôt de kapıcıbaşı,
tantôt de kapıcı de niveau intermédiaire »204
. Et gare à ceux qui ne voudraient pas jouer le jeu
et feraient, par leur retenue, honte à la dynastie : ils en perdraient aussitôt la faveur du
souverain, avec toutes les conséquences que cela implique205
.
Volontairement, cette prodigalité n’est évoquée qu’à l’occasion des düğün : aucune
attestation similaire n’est faite à l’occasion des remariages ou des simples conclusions de
nikâh des sultanes, ni même durant les düğün des hanım sultanes et autres descendantes
indirectes. Cette surabondance de biens et de richesses n’est là que pour exprimer la splendeur
dynastique. Ou plus exactement, les chroniques n’usent de ce thème que lorsqu’il s’agit de se
faire le relai du lustre de la dynastie, car il est probable que les autres types de cérémonies de
mariage étaient également l’occasion de démonstrations de richesse, bien que sous d’autres
formes. La dynastie se garde jalousement le monopole de l’expression suprême de la
prodigalité : les autres acteurs peuvent bien en faire usage, selon leurs capacités, du moment
qu’ils ne transgressent pas les règles de l’art littéraire et ne prétendent pas en transmettre la
mémoire à titre individuel. Si l’extrême profusion de richesse offerte par certains à l’occasion
de ces cérémonies est citée dans les chroniques, ce n’est que pour illustrer à quel point ces
serviteurs de la dynastie ont soin de l’honorer et de participer à sa gloire éternelle.
197
Selânikî, Târîh-i Selânikî : t. 1 p. 170. Cf. Annexes C.8. 198
Selânikî, Târîh-i Selânikî : t. 1 p. 169. Cf. Annexes C.8. 199
Yılmazer (éd.), Topçular Kâtibi : t. 1 p. 596. Cf. Annexes C.15. 200
Derin (éd.), Abdi Paşa vekâyı’-nâmesi : p. 445. Cf. Annexes C.35. 201
Derin (éd.), Abdi Paşa vekâyı’-nâmesi : p. 445. Cf. Annexes C.35. 202
Selânikî, Târîh-i Selânikî : t. 1 p. 171. Cf. Annexes C.8. 203
Sarı Mehmed , Zübde-i Vekayiât : p. 576. Cf. Annexes C.37. 204
Özcan (éd.), Anonim Osmanlı Tarihi : p. 25. Cf. Annexes C.38. 205
Ainsi Hasan Pacha, auquel le souverain avait l’intention de donner la main d’Emine Sultane, fille de Mustafa II, se vit retirer l’honneur de devenir gendre impérial et la main de la princesse fut donnée à un autre. Cf. Annexes C.41.
Page | 246
1. Une économie rituelle des cadeaux
L’étalage de richesse n’est cependant pas abandonné au libre arbitre des participants :
il doit suivre et respecter certaines formes, temps et cadres bien définis. Les échanges de
cadeau à l’occasion des mariages des princesses en sont l’illustration. Le tableau qui suit
récapitule ainsi les informations fournies par les chroniqueurs concernant les cadeaux offerts
durant ces événements.
Tableau 3.20. Récapitulatif des cadeaux échangés à l’occasion des mariages des sultanes
Occasion Donneur(s) Dons Donataire(s)
Düğün d’Ayşe (f. Murad III) avec Ibrahim Pacha
Gendre Bijoux et pierres précieuses
Epouse
Sağdıç Voile et bottes (estimées à 50 000 pièces d’or)
Epouse
? (épouse ou sultan ?)
Robes d’honneur (1000 au total)
- Gouverneur de Roumélie - Sağdıç - Mustafa Çavuş, responsable des dépenses du sağdıç - intendant de l’arsenal du sağdıç - les agas du sağdıç
Les époux Tissus et couvertures Eunuques (Vieux Palais)
Düğün de Fatma (f. Murad III) avec Halil Pacha
Gendre Bijoux et pierres précieuses
Epouse
Epouse Robes d’honneur - sağdıç - kethüda du gendre - les agas du gendre
Epouse (?) Tissus et couvertures Eunuques (Vieux Palais)
Lendemain du nikâh de Fatma (f. Ahmed Ier) avec Melek Ahmed Pacha
Sultan Veste en zibeline Gendre
Nikâh de Fatma (f. Ahmed Ier) avec Yusuf Pacha
Sultan Robe d’honneur en fourrure (chacun)
- cheikh-ul-islam - sağdıç (le kaymakam) - le remplaçant du chef des eunuques noirs
Nikâh de Hadice (f. Mehmed IV) avec Mustafa Pacha
Sultan Fourrures de zibeline (chacun) Présentées par le chef des eunuques noirs
- cheikh-ul-islam - public : les vizirs et les kadi’asker
Gendre Fourrure de zibeline Présentée par le chef des eunuques noirs
- sağdıç
Sultan Fourrure
Gendre
Düğün de Hadice (f. Mehmed IV) avec Mustafa Pacha
Gendre Fourrures (chacun) - membres du cortège : vizirs, oulémas, chef des eunuques noirs
Nikâh d’Emine (f. Mustafa II) avec Çorlulu Ali Pacha
Gendre Bijoux et pierres précieuses ; voile ; chaussons ; pièces d’or ; 40 plateaux de sucreries
Mariée, Emine Sultane
Nikâh d’Ayşe (f. Mustafa II) avec Köprülüzade Numan Pacha
Gendre Bijoux et pierres précieuses ; voile ; chaussons ; pièces d’or ; 40 plateaux de sucreries
Mariée, Ayşe Sultane
Nikâh d’Emine et Ayşe (f. Mustafa II) avec Çorlulu Ali Pacha et Köprülüzade Numan
Chacune des épouses
Robes d’honneur - cheikh-ul-islam - sağdıç respectifs
Page | 247
Pacha
Emine Sultane Robe d’honneur - intendant du grand vizir
? Robe d’honneur - le cheikh de Sainte-Sophie, qui a récité les prières - l’ensemble des participants
Chaque gendre Robes d’honneur - chef des eunuques noirs - intendants des baltacı - chefs de régiment
Lendemain du düğün de Safiyye (f. Mustafa II) avec Maktulzade Ali Pacha
Sultan Robe d’honneur en fourrure
Gendre
Nikâh d’Ayşe (f. Ahmed III) avec Ahmed Pacha
Gendre ? Robe(s ?) d’honneur Kethüda du grand vizir, qui l’a amené chez son épouse
Nous savons que les cérémonies dynastiques étaient l’occasion de nombreux échanges
ritualisés de cadeaux. Tout n’était pas bon à offrir, il fallait respecter des codes ; mais à
l’intérieur de grandes prescriptions, il était toujours possible de faire montre d’originalité.
Lors des cérémonies données à l’occasion de la circoncision de princes notamment, les pachas
cherchaient à s’attirer les bonnes grâces impériales en offrant des cadeaux susceptibles de
distinguer le donneur aux yeux du souverain. Il en va de même des échanges de cadeaux
diplomatiques. Trois tendances existaient : soit le donneur cherchait à se faire remarquer par
l’extrême richesse et/ou la grande qualité de l’ouvrage d’art offert, soit il cherchait à
impressionner par la multiplication du nombre des cadeaux, soit il privilégiait l’originalité, la
rareté du don (animaux exotiques, objets inhabituels venus de loin)206
. Nous savons tout cela,
notamment grâce à des études réalisées sur des registres de dons, qui dressent une liste
complète et descriptive de tout ce qui fut offert à une occasion donnée, ou pendant la durée du
règne d’un sultan. Or, les chroniques ottomanes ne sont pas des registres de dons :
contrairement aux teşrifât defterleri, elles n’ont pas fonction à être exhaustives sur ce point. Il
est très rare qu’elles livrent une liste scrupuleuse et détaillée des dons échangés aux
différentes étapes d’un mariage. Sans se perdre dans le détail, elles offrent à voir les grandes
lignes des échanges de don maritaux et permettent d’en percevoir la nature symbolique.
Les dons mentionnés par les chroniqueurs peuvent être regroupés dans trois catégories
réparties selon le donataire qui en bénéficie. On peut établir une distinction entre les dons faits
à la fiancée, ceux qui reviennent aux participants de la cérémonie, enfin ceux destinés au
gendre. Chacun émane d’une personne différente, mais au final, tout le monde est satisfait, car
chacun reçoit une gratification. La fiancée est la première à recevoir des cadeaux, qui lui sont
offerts par celui qui lui est promis, ce qui peut se comprendre comme une preuve de
soumission immédiate, instantanée, du gendre à sa future épouse, représentante de la dynastie,
selon un principe que nous avons déjà largement expliqué. Par ce geste, le gendre indique
qu’il est conscient de l’honneur qu’on lui fait de recevoir la main d’une princesse et donne les
marques de son estime envers sa future femme.
206
Reindl-Kiel, « Power and submission » ; voir aussi, du même auteur, « East is East and West is West » et « Luxury, Power Strategies, and the Question of Corruption ».
Page | 248
Le premier et seul chroniqueur à donner des détails avant le XVIIIe siècle est Selânikî,
à l’occasion du mariage d’Ayşe Sultane avec Ibrahim Pacha207
et de celui de sa sœur, Fatma
Sultane, avec Halil Pacha, à propos duquel il rapporte :
« Le lendemain dimanche, les dignitaires fortunés se présentèrent au palais de Son
Excellence Halil Pacha. On apporta au Vieux Palais une succession innombrable
et incalculable de tiares de la plus belle manufacture, embellies et décorées de
pierres précieuses de grande valeur, de superbes levh, bracelets et bagues [offerts]
par l’illustre vizir porteur de la marque de la félicité [Halil Pacha], [lors d’un
cortège] d’une perfection pleine de gloire et d’éminence, selon les coutumes et
manières dynastiques. »208
Raşid, au XVIIIe siècle, se fait plus précis et permet de mieux comprendre à quoi
correspondait la liste évoquée par Selânikî. Ainsi, à l’occasion du double mariage d’Emine et
d’Ayşe, filles de Mustafa II, leurs époux respectifs font parvenir aux princesses les dons
d’usage. Le grand vizir, de son côté, offre à sa promise, Emine Sultane :
« Une couronne de diamant ; une tresse de boutonnière en diamant ; un bracelet
en diamant ; une paire de boucles d’oreille en rubis en forme de grappe; un miroir
décoré de pierres précieuses ; un voile (nikâb) orné de rubis ; une paire de
chaussons (meşt) ornés de perles ; une paire de nalîn en or plaqué et incrustés de
perles ; 2 000 pièces d’or ; 40 plateaux de sucreries. »209
Tandis que Köprülüzade Numan Pacha, désigné pour recevoir la main d’Ayşe Sultane, lui
offre :
« Une couronne de diamant ; un bracelet en diamant ; une paire de boucles
d’oreille en émeraudes ; une tresse de boutonnière en diamant ; une paire de nalîn
en or plaqué et incrustés de perles ; une paire de chaussons (meşt) incrustés de
diamants ; 2 000 pièces d’or ; 40 plateaux de sucrerie, recouverts d’un tissu
peint. »210
Ces descriptions font encore écho aux cadeaux offerts par Sirke Osman Pacha à son épouse
Safiyye Sultane, fille de Mustafa II :
« Un cheval de race harnaché ; 2 000 pièces d’or ; un sceau en diamants ; une
ceinture en diamants ; une paire de bracelets en diamants ; une couronne en
diamants ; une paire de boucles d’oreille en émeraudes formant un grand corps
solide auquel était accroché un élément pendant ; un voile orné de pierres
précieuses ; un miroir enrichi de pierres précieuses ; une paire de nalîn inscrustés
d’or et de perles ; une paire de chaussons (filâr) en perles. »211
Comment ne pas être supris par le caractère répétitif de cadeaux qui semblent être quasi la
réplique d’une cérémonie à l’autre ? Chacun offre une couronne de diamants ; chacun offre
une paire de boucles d’oreilles, dont seule la composition change (émeraudes ici, rubis là) ; un
nikâb est systématiquement offert, de même que les 2 000 pièces d’or ; la paire de nalîn
207
Selânikî, Târîh-i Selânikî : t. 1 p. 168-169. Cf. Annexes C.8. 208
Selânikî, Târîh-i Selânikî : t. 1 p. 168-169. Cf. Annexes C.10. 209
Râşid, Târîh-i Râşid : vol. 3 p. 244. Cf. Annexes C.42. 210
Râşid, Târîh-i Râşid : vol. 3 p. 244. Cf. Annexes C.42. 211
Râşid, Târîh-i Râşid : vol. 5 p. 221.
Page | 249
revient aussi, ainsi que des chaussures à usage des bains (meşt ou filâr). Les variantes sont
minimes : Selânikî indique que le sağdıç d’Ibrahim Pacha avait financé une partie des
cadeaux ainsi offerts, ce qui ne semble plus être le cas par la suite ; Sirke Osman Pacha se
montre un peu plus prodigue que ses prédécesseurs, en ajoutant un cheval et un sceau à la liste
habituelle.
Nul doute qu’il s’agit là de cadeaux rituels, qui ne sont pas l’expression volontaire des
fiancés à leurs promises, mais jouent un rôle symbolique spécifique. Le caractère rituel de cet
échange de cadeau est d’ailleurs mis en avant par Raşîd lui-même, qui en fait l’annonce en
parlant de cadeaux « traditionnels ». Ceci explique leur absence dans la majorité des
chroniques : nul besoin d’en faire étalage dans les récits, car tout Ottoman digne de ce nom en
savait la présence et la teneur approximative. Dans ce cas, pourquoi ces quelques mentions
indiquées plus hauts ? Dans le cas de Selânikî, il semblerait que ce soit le coût prodigieux de
la participation du sağdıç qui en soit la cause. La mention s’inscrit dans la continuité de la
description d’un mariage exceptionnel, eu égard aux richesses incroyables qui y furent
étalées, depuis la somme (triplée) du douaire attribué à la princesse, jusqu’à la contribution du
sağdıç, qui fit preuve de largesses inouïes, ou encore dans l’incroyable parade qui fut
organisée pour la sortie d’Ayşe Sultane. Quant à Raşîd, les motifs qui le poussèrent à fournir
ces informations sont d’une nature différente : autre temps, autres pratiques, entre la fin du
XVIIe et le début du XVIII
e siècle se met en place une nouvelle tradition littéraire, avec la
création de l’office de vakanüvis. Les auteurs de chroniques se veulent de plus en plus précis,
de plus en plus méticuleux ; ils dressent un inventaire détaillé des événements qui se déroulent
sous un règne en particulier, ou sur un intervalle de temps relativement court. Ils mettent
l’accent sur le caractère authentique des informations livrées, que ce soit par la caution que
l’auteur apporte en tant que témoin, ou par l’inclusion de copies d’ordres212
.
La symbolique de ces dons se dévoile au vu du type de cadeaux offerts ; il s’agit
d’affaires dont l’épouse fera usage dans sa vie de femme : un voile pour les sorties, des bijoux
pour la parure, des chaussons pour le bain, une petite caissette de monnaie pour faire des
emplettes… Par ces cadeaux, premiers échanges (officiels) entre les époux, le dâmâd-ı
şehriyârî donne les marques de sa position de mari assurant la prise en charge de sa femme : il
est de son devoir de pourvoir à son entretien et il s’y engage symboliquement par ces cadeaux
qu’il lui fait parvenir. Inversement, en recevant ces cadeaux de son mari, la princesse
s’engage à être sa femme, c’est-à-dire à tenir son rôle d’épouse. Cet échange de cadeaux est le
signe de l’engagement mutuel des époux à respecter leurs devoirs conjugaux l’un envers
l’autre ; il est aussi le signe d’une soumission de chacun aux codes sociaux et aux rôles
respectifs imposés aux conjoints par la société ottomane. Leur qualité de sultane n’absout pas
les princesses au respect de l’ordre moral et conjugal : voilà ce que ces cadeaux symbolisent.
On voit apparaître ici une nouvelle illustration de la contradiction entre les privilèges maritaux
accordés aux princesses et les obligations liées à leur sexe.
212
Rhoad Murphey, « Ottoman historical writing in the seventeenth century: a survey of the general development of the genre after the reign of Sultan Ahmed I (1603-1617) », dans Essays on Ottoman Historians and Historiography, Istanbul, Eren, 2009 : 89-119.
Page | 250
La deuxième catégorie de dons mentionnés par les chroniques ont en commun de
gratifier les multiples participants de la cérémonie de mariage. Ils sont offerts tantôt par le
mari, tantôt par la femme ou par le sultan. La distribution des rôles entre la princesse et le
sultan n’est pas bien claire : dans certains cas, il semble que ce soit le donneur soit la
princesse elle-même, dans d’autre, que cette charge incombe au sultan. Dans tous les cas, la
répartition serait la suivante : la princesse (ou le sultan) gratifie de dons (robes d’honneur tout
particulièrement) ceux qui ont joué un rôle actif dans la conclusion du contrat de mariage (le
cheikh-ul-islam, le sagdıç et d’autres participants éventuels). Le gendre, de son côté, gratifie
les participants passifs – le public, les visiteurs – ainsi que quelques personnes actives durant
les diverses cérémonies : à l’occasion du nikâh, c’est lui qui récompense le représentant de
son épouse, le chef des eunuques noirs ; c’est lui, encore, qui fournit les cadeaux aux
membres du cortège qui lui amènent son épouse. Il contribue ainsi à l’essentiel des cadeaux
offerts durant la cérémonie – du moins est-ce l’impression que les sources laissent entendre.
De fait, cette documentation donne à voir, partiellement, les dons qui étaient offerts aux
participants masculins de la cérémonie, mais on ignore l’essentiel des contributions offertes
aux femmes : il est pourtant plus que probable que des échanges de dons avaient également
lieu à ce niveau, sur lesquels les chroniques ne s’attardent pas – nous verrons pourquoi.
Quelques variantes apparaissent néanmoins : lors du nikâh d’Ayşe Sultane, fille de
Murad III, avec Ibrahim Pacha, ce sont non seulement les participants actifs du mariage, mais
encore l’ensemble des serviteurs de son nouvel époux qui sont gratifiés de cadeaux – au total,
nous dit Selânikî, un millier de robes d’honneur furent distribuées213
. Lors du nikâh de la fille
d’Ahmed Ier, Fatma Sultane, avec Yusuf Pacha, le remplaçant du chef des eunuques noirs,
souffrant ce jour-là, qui endossa la responsabilité d’être son représentant à l’occasion de la
signature du contrat de mariage, fut remercié de ses efforts par le don d’une robe d’honneur
offert par le sultan – au nom de la princesse peut-être ?214
Dans tous les cas, ces dons
fonctionnent comme signe de remerciement envers ceux qui ont contribué, par leur
participation, à l’éclat de la cérémonie – quand bien même ils n’avaient guère le choix.
Il est fort intéressant de noter qu’à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle, les
chroniqueurs soulignent, comme une marque d’honneur supplémentaire, le fait que les dons
offerts par la princesse soient remis des mains même du chef des eunuques noirs. On pourrait
croire être en présence d’une innovation du protocole : il nous semble qu’il n’en est rien. À
aucun moment, la princesse ne rentre en interaction directe avec les participants de la
cérémonie de son mariage : tout se fait par l’intermédiaire de son représentant, le chef des
eunuques noirs. Il est donc très vraisemblable que les dons offerts par la princesse furent
toujours distribués par cet intermédiaire. L’affectation des sources tardives sur cet aspect
reflète la montée en puissance de cet office, qui se fait jour au cours de la seconde moitié du
XVIe siècle pour culminer au XVIII
e siècle
215. Le fait que l’office de chef des eunuques noirs
soit devenu prestigieux et que son détenteur se soit imposé comme un homme
particulièrement puissant au sein de l’élite ottomane rend son rôle dans cette affaire
213
Selânikî, Târîh-i Selânikî : t. 1 p. 169. Cf. Annexes C.8. 214
Râşid, Târîh-i Râşid : vol. 1 p. 138-139 ; Derin (éd.), Abdi Paşa vekâyı’-nâmesi : p. 266. Cf. Annexes C.33. 215
Sur le sujet, voir Hathaway, Beshir Agha.
Page | 251
particulièrement honorifique, pour ceux qui sont gratifiés de cette marque d’honneur
supplémentaire ; cela ne change pourtant rien aux pratiques coutumières.
La dernière catégorie de dons offerts durant ces cérémonies concerne uniquement le
gendre, gratifié, de la part du sultan lui-même, d’une robe d’honneur de grande valeur. Les
mentions ne sont pas systématiques, mais elles sont identiques : le lendemain de la nuit de
noces, le damad impérial est convoqué en présence du souverain, qui le fait revêtir d’un
caftan (en fourrure). L’honneur fait au gendre réside, dès lors, autant dans le don lui-même,
que dans le fait qu’il soit offert par le sultan. La symbolique s’en trouve éclairée : Abdi Pacha
l’indique d’ailleurs sans détour, à propos du nouveau gendre de Mehmed IV, Musahib
Mustafa Pacha :
« Le matin, [Mustafa Pacha] lui-même fut revêtu entièrement de fourrure par Son
Altesse impériale, le padichah refuge du monde, et il vit sa dignité s’élever par son
alliance royale. »216
Par ce don symbolique, le sultan reconnaît son gendre comme tel et lui donne des marques de
sa nouvelle dignité. Il est officiellement honoré dans sa nouvelle position d’allié de la
dynastie.
Qu’il s’agisse des dons aux participants offerts par la princesse ou le mari, ou de ceux
du sultan à son gendre, tous sont de nature purement symbolique et, à ce titre, prennent des
formes protocolaires : il s’agit de robes d’honneur pour les plus hauts dignitaires, de tissus
divers pour les autres, voire de menue monnaie. Ici, l’objectif n’est pas de surprendre par la
qualité, la préciosité ou la rareté des cadeaux distribués, mais tout simplement de souligner le
rôle joué par chacun dans l’organisation de la cérémonie. Par cet échange généralisé de dons,
l’ensemble des participants se trouve enchaîné dans une économie rituelle de service. Tout le
monde engage son nom et son honneur par sa participation à l’événement, et se voit octroyer
en retour des dons rituels. On comprend mieux, dès lors, pourquoi toutes les chroniques ne se
font pas l’écho de cet échange de dons, qui coulait de source, et pourquoi celles qui prennent
le temps de décrire les cérémonies de mariage insistent sur certains éléments.
Quand des distributions exceptionnelles eurent lieu, les chroniqueurs relatent
l’événement, pour souligner la prodigalité des donneurs. Les échanges de dons entre femmes
ne les intéressent pas : d’une part, parce qu’ils n’ont pas une bonne connaissance de leur
nature ; d’autre part, parce qu’ils créent des réseaux de dépendance qui ne les concernent pas.
Seuls les dons aux membres de l’élite sont inscrits systématiquement dans les chroniques,
parce qu’ils indiquent la création d’un lien entre les participants et les protagonistes de
l’événement, symbolisé par la transmission de cadeaux entre donneurs et donataires. D’abord
restreintes à un petit groupe, l’accroissement du public participant aux cérémonies fait que les
dépendances créées par ces événements enchaînent un ensemble très large d’individus au sein
d’un réseau de solidarité qui, à terme, renforce la cohésion des divers membres de l’élite et de
la dynastie.
216
Derin (éd.), Abdi Paşa vekâyı’-nâmesi : p. 446-447. Cf. Annexes C.35.
Page | 252
2. Une relation agonistique à l’expression de la splendeur
Le premier et principal protagoniste de cet étalage de magnificence est la dynastie, qui
bénéficie d’une position privilégiée à bien des égards. Elle dispose notamment du monopole
protocolaire : c’est elle qui décide de l’arrangement de la cérémonie. Certaines collaborations
sont ainsi décidées, de façon unilatérale, par le sultan : le choix du sağdıç déjà évoqué plus
haut, dont les contributions financières ne sont pas des moindres, émane du sultan –
contraignant la personne “honorée” par cette “charge” à s’engager dans des dépenses
somptuaires considérables. De même, sa position au sommet de la hiérarchie offre à la
dynastie la liberté de fixer le niveau des dépenses qui seront engagées. Or, dans la mesure où
l’étalage de richesses doit être en adéquation avec la hiérarchie des individus, ce niveau
détermine l’échelle de grandeur (échelle des dépenses) à partir de laquelle les autres
participants évaluent leur propre contribution.
Dans la mesure où la contribution de la dynastie est la première et sert de référence
auxautres, il convient de commencer par en évaluer le montant et les formes au cours de la
parade. Mettons de côté les contributions indirectes, telles les aides au financement accordées
à certains participants, dont les exemples sont apparus lors de la triple cérémonie de 1562217
.
Un aspect particulier de la parade permet cependant d’évaluer le montant et l’importance de la
contribution dynastique : le trousseau de la mariée ou cihaz (qui peut aussi prendre le nom de
çeyiz). L’existence même d’un trousseau est, en soi, une indication de la volonté de la famille
de la mariée, en l’occurrence de la dynastie, d’afficher sa richesse, et par là sa puissance. De
fait, il convient de rappeler que, dans le système marital musulman, seule la contribution
financière de l’époux (le mehr) est requise légalement. Cependant, la société ottomane connaît
également la pratique (que nous pourrions définir comme sociale) du cihaz, c’est-à-dire une
dotation à la mariée, par sa famille, en vue de son installation : la mariée vient s’installer chez
son époux avec meubles, bijoux, vêtements, serviteurs et servantes, et autres commodités du
genre. Faut-il préciser que cette pratique sociale est particulièrement observée au sein des
familles de l’élite, soucieuses de souligner le statut de la fille donnée (reflet de la position
sociale de sa famille) ? L’existence d’un cihaz est alors d’autant plus importante, dans le cas
des princesses, que toute l’idéologie dynastique repose sur l’idée d’une supériorité inégalable
de ses membres. Cette supériorité s’exprime, entre autres, par un étalage de richesses qui en
souligne l’opulence – exprimée à un tel niveau que toute rivalité serait rendue impossible, en
plus d’être prescrite.
De fait, c’est bien ce que fait la dynastie. Les descriptions des cihaz des princesses
sont toujours volontairement incomplètes, pour souligner l’impossibilité des chroniqueurs
d’en faire un décompte précis : la somptuosité est telle qu’elle dépasse toute velléité
d’évaluation. Ainsi, lors du mariage de Fatma Sultane (fille de Murad III) avec Halil Pacha, le
217
Celles-ci sortent du prisme d’étude présent dans la mesure où elles ne sont pas destinées à mettre en valeur de façon directe la puissance dynastique par l’étalage en son nom de richesses.
Page | 253
transport du trousseau aurait duré trois jours entiers218
; lors du mariage de Gevherhan Sultane
(fille d’Ahmed Ier) avec Öküz Mehmed Pacha, défile « une incroyable succession de tapis et
de tissus de soie, de brocards, de velours et de satins […] montés sur des files de centaines de
chevaux et par les jeunes apprentis cavaliers et par les silahşor à pieds »219
; Abdi Pacha n’a
pas de mots assez forts pour décrire la splendeur du cihaz de la princesse Hadice Sultane (fille
de Mehmed IV) lors de son mariage avec Kara Mustafa Pacha : « A la vérité, leurs yeux
furent éblouis par sa splendeur, tant c’était sans précédent. Il y avait là les plus beaux des
vêtements, tous d’un montant sans égal, décorés de pierreries translucides et aussi étincelantes
que la lumière du soleil en pleine canicule »220
. Les descriptions se font plus complètes au
XVIIIe siècle, grâce à la chronique de Râşid, qui dépeint en ces mots le cihâz de Safiyye
Sultane, fille de Mustafa II, à l’occasion de son mariage avec Sirke Osman Pacha :
« De cette manière, une fois que tout le monde fut prêt, 5h30 étant passée, le
trousseau qui met en lumière la beauté de la sultane susdite fut sorti par les
teberdâr par la porte du harem qui jouxte la Salle du Conseil et [tout le monde] se
tint prêt [pour le transport]. Pour cette occasion, les mehterân chargèrent une file
de dix mulets de coffres et disposèrent d’autres affaires dans trois voitures
fermées ; les teberdâr du Vieux Palais transportèrent à bout de bras les coffres et
plateaux remplis de vaisselle en argent et en perles. Quand tout cela fut prêt et
bien disposé, après avoir témoigné une pause de pure vénération au Kiosque des
Cérémonies qui se trouve à proximité de la Fontaine Froide de notre vénérable
souverain, le firman impérial donnant l’ordre de commencer le défilé arriva.
Marchaient en tête les capitaines et les subaşı avec, à leur suite, les corps des
sipahis et des silahdar, puis le cebecibaşı, le kul kehtüdası, le yeniçeri efendisi, le
sekbanbaşı, l’aga respectif des sipahis et des silahdar, l’aga des kapıcıbaşı puis des
başbaki kuli, le mâliye tezkereci, le defterdar efendi, l’aga des janissaires, puis
encore le sağdıç, Son Excellence le vizir Nişancı Mustafa Pacha, suivi de
l’intendant de la chaste sultane susdite, accompagné du teşrîfât efendi, puis les
bevâbân de la Porte Sublime répartis en deux ailes à droite et à gauche. Venaient
alors, toujours à pieds, les eunuques du harem impérial, flanqués à gauche et à
droite des teberdâr du Vieux Palais, les responsables des tentes [neferât-ı hayme]
avec à leur tête, selon les usages coutumiers, le agababası, portant les ustensiles
de vaisselle en argent et en perles ; puis la file des animaux de bât [portant les
coffres décrits plus haut] ; puis les voitures fermées ; puis les musiciens. »221
La constitution du cihaz entraîne ainsi une accumulation de richesses provenant de la
dynastie, destinées à être transférées au domicile conjugal de la future épouse. Pourtant, ce
transfert n’a pas lieu lors de la parade, comme on pourrait s’y attendre, mais en amont, dans
218
« Pendant trois jours, trois cents rangs de bêtes de somme furent occupés à transporter la dot [en fait, le cihaz] dans le palais du fiancé, sous l’inspection de quarante eunuques. » : Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 7 p. 147. 219
Yılmazer (éd.), Topçular Kâtibi : t. 1 p. 597. Voir en Annexes C.15. 220
Derin (éd.), Abdi Paşa vekâyı’-nâmesi : 444. Voir en Annexes C.35. 221
Râşid, Râşid Târîhi : vol. 5 p. 222-223.
Page | 254
les jours qui précèdent. Dans certains cas, la conclusion du contrat de mariage (nikâh) et la
remise du trousseau coïncident le même jour : c’est le cas lors du mariage d’Ayşe Sultane
avec Ibrahim Pacha en 1586222
et de celui d’Hatice Sultane avec Kara Mustafa Pacha en
1675223
. Cela n’est évidemment possible que lorsque le nikâh est conclu pendant la période
des festivités en vue du düğün, qu’il ne précède alors que de quelques jours ; dans la majorité
des cas cependant, un temps plus ou moins long sépare les deux événements. Quant au jour de
la remise du cihaz, il ne semble pas exister de préférence ou règle : deux ou trois jours avant
la parade dans le cas du mariage suscité d’Ayşe Sultane224
; quatre jours avant celle-ci lors de
celui de sa sœur Fatma Sultane (fille de Murad III) avec Halil Pacha225
; mais la veille au soir
pour le mariage de Gevherhan Sultane (fille d’Ahmed Ier) avec Öküz Mehmed Pacha226
;
quatre jours avant la parade d’Hatice Sultane lors de son mariage avec Kara Mustafa
Pacha227
; trois, enfin, dans le cas du düğün d’Emine Sultane avec Çorlili Ali Pacha228
.
Le transfert du trousseau est un défilé somptuaire : la puissance dynastique s’exprime
ainsi par la précellence de sa richesse. La parade est, pour sa part, un défilé où la puissance
dynastique s’exprime sur des individus – bien que l’aspect somptuaire n’en soit pas
totalement exclu, notamment au vu du soin dans les tenues portées par les participants. Cette
manière de distinguer richesse et puissance politicosociale permet d’éviter toute confusion
entre les deux éléments : la supériorité de la dynastie ne réside pas uniquement dans sa
richesse, mais aussi dans sa capacité à s’imposer au-dessus des autres, et inversement. La
distinction des deux événements présente néanmoins l’inconvénient d’accorder moins de
popularité à l’envoi du trousseau, d’autant que le jour change souvent. Ce qui amène à se
poser la question : auprès de qui la dynastie cherchait-elle à afficher sa richesse ?
Ce sont les sources qui permettent de répondre à cette question, tout en révélant, au
passage, une évolution dans le déroulement des festivités, avec la création, semble-t-il, d’un
nouvel événement : l’exposition du trousseau de la mariée. Celle-ci n’est effectivement
attestée qu’à partir du mariage d’Hatice Sultane avec Kara Mustafa Pacha, en 1675. Il s’agit
donc d’une évolution tardive du cérémonial. Voici quelles en sont les modalités, décrites par
Abdi Pacha :
« Le jeudi 4 [27 juin], il y eut la visite des chefs des rikab impériaux. Le même jour,
les vizirs, les oulémas, le chef des janissaires et les chefs des différentes
compagnies militaires reçurent l’autorisation impériale de se présenter à la
Chambre privée pour jouir du spectacle du trousseau royal. A la vérité, leurs yeux
furent éblouis par sa splendeur, tant elle était sans précédent. Il y avait là les plus
222
« Et le jour de remise du trousseau de la mariée […] a eu lieu le même jour que la signature du contrat de mariage » : İpşirli (éd.), Tarih-i Selânikî : t. 1 p. 169. Voir en Annexes C.48. 223
Derin (éd.), Abdi Paşa vekâyı’-nâmesi : 443-444. Voir en Annexes C.35. 224
Selânikî, Târîh-i Selânikî : t. 1 p. 169. Voir en Annexes C.8. 225
Selânikî, Târîh-i Selânikî : t. 1 p. 342-343. Voir en Annexes C.10. 226
Yılmazer (éd.), Topçular Kâtibi : t. 1 p. 597. Voir en Annexes C.15. 227
Derin (éd.), Abdi Paşa vekâyı’-nâmesi : 443-444. Voir en Annexes C.35. 228
Râşid, Târîh-i Râşid : vol. 3 p. 243-245. Voir en Annexes C.42.
Page | 255
beaux des vêtements décorés de pierreries translucides et aussi étincellantes que
la lumière du soleil en pleine canicule, tous d’un montant sans égal. »229
L’honneur est rare : il faut appartenir aux hauts échelons de la hiérarchie ottomane pour s’y
voir convier. Il est d’autant plus rare qu’il se produit au cœur du Palais : non seulement à
Topkapı, mais dans l’espace privé du sultan, dans sa Chambre privée (la Hassoda). L’accès à
cet espace est particulièrement restreint et constitue en soi un privilège, ce qui renforce le
caractère honorifique de cette réception qui n’a pour seul but que d’éblouir ces “Grands parmi
les Grands” par la richesse offerte à la princesse.
Cette rivalité somptuaire ne se définit pas seulement dans l’espace-temps de la
cérémonie, mais également par rapport aux expériences passées. L’extrait suivant permet de
s’en rendre compte :
« Lorsque la cérémonie impériale [pour le mariage d’Ayşe Sultane, fille d’Ahmed
Ier, avec Nasuh Pacha] débuta, le rassemblement [eut lieu] au Vieux Palais.
Auparavant, Mustafa Ağa, Chef des eunuques noirs, avait fait réaliser un palmier
tout en perles et pierres précieuses. Par le passé, lorsque Sa Majesté le défunt qui
bénéficie du pardon divin, Sultan Murad Han, dont la vie fut fortunée et la mort
celle d’un şehîd, avait marié Sa Majesté la fortunée Sultane au vizir Ibrahim
Pacha, en 994-995, au moment de la cérémonie impériale, le garçon d’honneur
était le célèbre kapudan, l’ancien vizir Ali Pacha : il avait multiplié les personnes à
son service pour cette réunion. Il avait également fait faire un palmier en perles
précieuses, [dont la préparation avait duré] deux ans. A cette époque, les
personnes en charge des palmiers étaient trois sœurs versées dans les arts. Sitôt
que les joaillers eurent fourni les provisions d’or et d’argent, elles se mirent au
travail et réalisèrent [le travail de décoration des palmiers]. Parmi ces femmes en
charge des palmiers, certaines vinrent à mourir. Mais elles avaient des filles en
bonne santé, qui furent appelées [à leur place]. Les femmes susdites réalisèrent un
palmier à quatre rangées de perles. Le Kozbekçi auprès d’elle était Hüseyin Ağa.
On lui remit tout à la fois l’argent, l’or et les pierres précieuses, ainsi que les
comptes et les mesures. Des fleurs et des arbres, des graines et des fruits furent
ainsi réalisées. Chaque niveau faisait sept coudées. A ce jour, la famille et la belle-
mère des malheureuses femmes démunies responsables des palmiers sont
décédées. Deux grands palmiers étant en cours de réalisation, l’un à Aksaray
ressemblant à une bougie, l’autre à la Porte du Bois, lorsque ceux-ci furent
terminés, les ru’es et les ‘azab du peuple de l’Arsenal envoyèrent chacun 100
d’entre eux : des charpentiers venaient devant les œuvres d’art, détruisirent les
boutiques et les auvents des maisons qui posaient problème [à leur passage]. »230
L’objet de la rivalité est d’ordre symbolique : il s’agit des palmes de noce, œuvres d’art
finement décorées, qui précédaient la princesse et qui symbolisaient la fertilité espérée de
l’union. De telles palmes sont toujours présentes lors des parades nuptiales des princesses
229
Derin (éd.), Abdi Paşa vekâyı’-nâmesi : 443. Voir en Annexes C.35. 230
Yılmazer (éd.), Topçular Kâtibi : t. 1 p. 596-597. Voir en Annexes C.15.
Page | 256
(mais également lors des circoncisions des princes, bien que la symbolique ne porte pas, dans
ce cas, le même sens)231
. Leur présence systématique lors de ces cérémonies en fait un objet-
témoin idéal. De la sorte, il devient également objet d’expression de rivalités à plusieurs
échelles.
L’échelle sur laquelle nous voulons mettre l’accent ici est celle du temps : elle permet
aux protagonistes de ces cérémonies de rivaliser non pas seulement entre eux, mais aussi avec
leurs prédécesseurs. Dans le texte ci-dessus, l’idée d’une compétition entre cérémonies est
soulignée par la seule mise en comparaison avec la cérémonie antérieure du mariage d’Ayşe
Sultane, fille de Murad III, avec Ibrahim Pacha, soit deux règnes plus tôt. Le choix de cette
cérémonie comme exemple à dépasser est révélateur des enjeux de cet antagonisme. La
similitude des statuts des principaux protagonistes est essentielle : dans les deux cas, l’union
implique la fille aînée du sultan régnant et son grand vizir ; dans les deux cas, il s’agit de la
première union directe entre le sultan régnant et un membre de son élite, conclue durant son
règne. Les enjeux politiques et cérémoniaux atteignent donc leur paroxysme. Mais un dernier
élément doit encore être mentionné, qui explique la raison d’être de cette rivalité : il s’agit,
pour la dynastie et l’élite politique ottomane du début du XVIIe siècle, de montrer qu’elle
n’est pas moins puissante, pas moins riche, qu’elle ne l’était quelques décennies plus tôt. La
concurrence n’est alors ni entre individus, ni même entre les groupes ; il s’agit d’une
compétition entre une société toute entière et l’image qu’elle a de son passé. Les éléments de
comparaison, telles les palmes de noce, se doivent dès lors d’être plus nombreux, plus grands,
plus riches, plus spectaculaires que par le passé232
.
Cette rivalité entre cérémonies, entre règnes, est un des éléments les plus constants :
elle s’exprime par la multiplication du nombre des palmes de noce et des acteurs présents, par
l’augmentation de la durée des festivités, et dans bien d’autres aspects encore. L’enjeu n’est
plus l’organisation hiérarchique, la puissance individuelle ou d’un groupe ; il est mémoriel.
C’est la mémoire de l’ensemble de la société qui est impliquée, le souvenir qu’on entend
laisser de son temps, de son règne – qui nécessite l’implication de tous et toutes, chacun à son
niveau. En ce sens, la multiplication des écrits relatifs à ces cérémonies au cours du temps en
serait un vecteur de diffusion et de connaissance. On ne met par écrit que ce qui est jugé digne
d’intérêt : l’attention croissante pour ces cérémonies (et pour l’ensemble des cérémonies
impériales) est une indication, en elle-même, du fort enjeu de mémoire dont elles étaient
dotées. De fait, ces commémorations de fêtes somptueuses mettent en relief une société riche
et puissante, loin de l’image du déclin souvent invoquée.
231
And, « Osmanlı Düğünlerinde Nahıllar » ; Nutku, « The Nahıl ». 232
Ce faisant, le chroniqueur, soit par erreur, soit volontairement, déforme le souvenir du passé en ne faisant mention que d’une unique palme de noces, lors de la cérémonie sous le règne de Murad III, quand le récit de son prédécesseur Selânikî fait explicitement mention de deux palmes : « Elle fut emmenée devant les palmiers-dattiers de joyaux et de pierres précieuses et on lui présenta deux palmiers-dattiers ornant les cœurs pareils à des minarets de 12 coudées de hauteur, qui donnaient à voir des couleurs de mille feux et qui manifestaient l’art et le talent des artistes du monde dans les ateliers de ce monde. » : Selânikî, Târîh-i Selânikî : t. 1 p. 169.
Page | 257
5. Les düğün des princesses indirectes
Nous avons déjà eu maintes fois l’occasion de souligner l’incidence du degré de
proximité biologique avec le sultan dans l’attribution des marques d’honneurs et de statut à
l’intérieur même de la catégorie des descendantes de la famille régnante. Il faut donc respecter
la logique, y compris sur l’aspect cérémoniel et se demander si les düğün des princesses
indirectes différaient de ceux des filles de sultan – et sur quels aspects. Dans quelle mesure les
mariages des princesses indirectes étaient-ils des événements dynastiques ; qu’est-ce qui
distinguait les cérémonies nuptiales des membres de la dynastie, de celles réalisées pour
n’importe quelle femme de l’élite ottomane ?
Les informations se font particulièrement rares. En tout et pour tout, il est question de
quatre mariages : celui de la petite-fille de Süleyman Ier, Hümaşah Sultane (fille du prince
Mehmed)233
et de son arrière-petite-fille, descendante de Mihrimah Sultane234
; d’une petite-
fille de Selim II, issue du mariage de Gevherhan Sultane et Piyale Pacha235
; enfin d’une
petite-fille d’Ahmed Ier, issue de l’union de Gevherhan Sultane et Receb Pacha236
. S’il est
impossible, à partir de ces récits, de dresser un aperçu, même minime, des éventuelles
évolutions de ces cérémonies au cours du temps, ceux-ci fournissent cependant un autre
spectre d’étude, tout aussi enrichissant. La spécificité de ces récits réside dans le fait de
donner un aperçu non plus linéaire, à statut égal, mais en suivant les degrés descendants de
princesses, sur plusieurs générations : de la petite-fille en lignée masculine à la petite-fille en
lignée féminine, jusqu’à l’arrière-petite-fille – soit les trois échelons hiérarchiques entre
princesses indirectes.
Le récit concernant le mariage d’Hümaşah Sultane avec Ferhad Pacha est loin de
fournir tous les renseignements que l’on pourrait espérer. Selânikî se contente de préciser que
le protocole suivi à l’occasion de la parade nuptiale avait été le même que lors du mariage de
Mihrimah Sultane : le grand vizir l’avait escortée à pied237
. Ce faisant, il fournit une
information de première importance : le cortège nuptial était organisé de façon similaire à
celui d’une princesse de sang. La fille et la petite-fille de Süleyman Ier sont toutes deux
menées chez leur époux par le grand vizir en personne. Pourquoi y aurait-il une différence
d’ailleurs ? D’un point de vue purement lignager, la petite-fille, étant issue de lignée
masculine, a droit aux mêmes prérogatives que la fille du sultan. Ceci correspond aux
informations que nous avons pu récolter par ailleurs : si différence hiérarchique il y avait entre
ces deux niveaux de princesse, celle-ci était relativement faible238
.
233
Selânikî, Târîh-i Selânikî : t. 1 p. 170-171. Voir en annexes C.8. 234
Gerlach, Türkiye Günlüğü : t. 1 p. 456-458 et 462-463 ; Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 7 p. 24-25. Voir en annexes C.9. 235
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 7 p. 190 ; Selânikî, Târîh-i Selânikî : t. 2 p. 775. Voir en annexes C.11. 236
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 10 p. 26 ; İpşirli (éd.), Târih-i Na’îmâ : t. 3 p. 990. Voir en annexes C.23. 237
Selânikî, Târîh-i Selânikî : t. 1 p. 170-171. Voir en annexes C.8. 238
Cf. Chapitre 1.I.2.2.
Page | 258
La même question se pose concernant les princesses indirectes en lignée féminine, de
façon d’autant plus prégnante qu’entre les filles de sultan et leurs propres filles, il existait une
différence hiérarchique plus marquée, symbolisée par le port d’un titre différent : hanım
sultane, qui entre en application quelque part durant la seconde moitié du XVIe siècle
239. Or,
c’est justement de cette période que date le récit que fait Selânikî du mariage de la fille de
Gevherhan Sultane et de Piyale Pacha avec le fils du grand vizir Sinan Pacha, Mehmed Pacha
– qui lui-même deviendra grand vizir :
« Le mariage de Mehmed Pacha, fils du défunt grand vizir Sinan Pacha, avec la
Sultanzade. Dans la deuxième décade du mois de Rebi-ül-ahir [10-20 novembre
1598], Son Excellence le vizir Mehmed Pacha, fils du défunt grand vizir Sinan
Pacha, a été marié à l’auguste fille du défunt Piyale Pacha et de la Sultane, [fille]
du défunt Sultan Selim Han – que la paix soit sur lui. Les nobles fiançailles furent
organisées selon les lois de l’Empire et coutumes ancestrales de l’Etat : les
eunuques des piliers de l’Etat, accompagnés d’un cheval dont les chaînes étaient
en or et le harnais, splendide, tout en pierres précieuses, destinés à Son Excellence
le grand vizir Mehmed Pacha – que Dieu, qu’Il soit exalté, perpétue sa gloire –, et
d’un [autre] cheval de grande valeur, recouvert du manteau des sultanzade et de
diverses affaires entièrement cérémonielles, se sont présentés à la porte de Sa
Majesté la Sultane fortunée. »240
On notera la précision des « lois d’Empire et des coutumes ancestrales de l’État » définissant
le protocole en matière de mariages de hanım sultane. Cela signifie que les düğün de ces
princesses étaient régis par les pratiques et prescriptions dynastiques, à l’instar de toute
cérémonie impériale : ces düğün étaient donc considérés comme des cérémonies officielles.
Malgré les différences prévisibles en raison des différences de statut des épouses,
jusqu’à quel point ces düğün copiaient-ils ceux de leurs aïeules ? Les protagonistes, d’abord,
ne sont pas en aussi grand nombre, ni d’aussi haut statut. Le grand vizir notamment est
absent : ce n’est pas lui qui accompagne la princesse chez son époux ; ce sont des
représentants des plus hauts personnages qui en sont chargés. La hiérarchie est ainsi rappelée
de façon intéressante : la princesse elle-même n’est qu’une représentante (indirecte) de la
dynastie et à ce titre, elle n’est accompagnée que par des représentants des Grands de
l’Empire. On notera encore l’existence d’objets cérémoniaux spécifiques à cette catégorie
d’individus, qui permettent de les situer sans le moindre doute : ainsi notamment « le manteau
des sultanzade » qui fait référence au dais de satin rouge qui dissimule les sultanes des
regards extérieurs. Le motif de ces objets241
et attentions particulières est facile à percer : il
s’agit d’établir une distinction claire, non seulement entre les cérémonies et prérogatives des
filles de sang (filles de sultan et petites-filles en lignée masculine) et des princesses indirectes,
mais également entre ces dernières et les filles issues des autres familles de l’élite.
239
Cf. Chapitre 1.I.1.3. 240
Selânikî, Târîh-i Selânikî : t. 2 p. 775. Voir en annexes C.11. 241
Uzunçarşılı mentionne encore quelques prescriptions particulières concernant les palmes de noce, qui devaient respecter certaines dimensions précises, moins importantes que dans le cas des palmes de noce des filles de sang. Uzunçarşılı, Saray Teşkilâtı : 166.
Page | 259
Mais jusqu’où s’étendent ces prérogatives ? La troisième génération descendante y a-t-
elle également droit ? Gerlach, qui raconte le mariage de la petite-fille de Mihrimah Sultane
avec Cigalazade Sinan Pacha, nous offre un récit minutieux de l’événement :
« Le 5 novembre [1576], les cadeaux envoyés par l’aga des janissaires, Cigala, à sa
fiancée, la fille d’Ahmed Pacha, sont passés devant la porte de notre résidence. En
tête du convoi défilèrent à cheval les serviteurs les plus hauts gradés du palais,
suivis du beylerbey de Roumélie avec son serviteur personnel. Ils étaient suivis par
les musiciens avec leurs tambours, cymbales et clarinettes, à pied. À leur suite
venaient les affaires offertes en guise de cadeau, transportées par des ânes, portées
dans des paniers et corbeilles recouvertes de tissus de soie brodés. Ils étaient suivis
par les çeşnigir du beylerbey et du gendre, accompagnés d’un grand nombre de
janissaires vêtus de leurs habits de cérémonie, qui portaient les sucreries en forme
de cheval, d’éléphant, de chameau, de lion, de sirène et de toute sorte d’oiseaux de
toutes les couleurs. Ceux qui étaient en tête du cortège marchaient en rang par
quatre, ceux à l’arrière suivant deux par deux. [...] Le beylerbey de Roumélie
[Siyavuş Pacha], qui servait de sağdıç, avait dû dépenser des centaines de florins
pour la cérémonie de mariage de la fiancée. À son époque, lorsque l’amiral de la
flotte Uluç Ali avait servi comme sağdıç du gouverneur de Roumélie, il avait
dépensé 80 000 florins.
Le 6 novembre, ils apportèrent les fusées volantes. Décorées en forme de tours,
elles étaient faites en papier vert et rouge et s’élevaient jusqu’à hauteur de maison.
Le 7 novembre, les affaires d’intérieur de la fiancée furent transportées de la
maison de son père, Ahmed Pacha, au konak du gendre. Ces affaires consistaient
en : 1. des perles et une grande variété de pierres précieuses de valeur dans une
grande boîte en or, transparente sur un côté, laissant voir ce qu’elle contenait ; 2.
six grands candélabres d’argent ; 3. deux grands couvre-lits surbrodés de fils d’or
ou d’argent ; 4. des tapis tressés d’Iran ou d’ailleurs, des habits, un lit et d’autres
affaires de maison qui représentaient la charge de 106 ânes ; 5. les cadeaux offerts
par le père à sa fille en guise de dot, qui consistait en 40 jeunes femmes esclaves
vêtues la plupart de robes de soie et de brocart, accompagnées de 5-6 eunuques
(noirs) pour les diriger et les surveiller.
Le 8 novembre, une heure avant la nuit, la fiancée fut amenée de la maison de son
père à celle du gendre. En tête du cortège escortant la fiancée venaient deux
palmes de noce peintes en rouge, vert, bleu, jaune et d’autres couleurs encore, qui
s’élevaient jusqu’à hauteur de notre résidence. En outre, brûlait une bougie
disposée au sommet d’un plateau rempli de roses, pommes, poires, grenades,
raisins et bien d’autres sortes de fruits réalisés avec un tel art qu’en les voyant, ils
passaient pour vrais. Pour permettre le passage de cette palme, ils coupèrent une
treille qui s’élevait en face de notre résidence et qui couvrait toute la rue, ainsi que
la plupart des branches d’un arbre en face d’une maison à proximité, et ils
renversèrent plusieurs autres arbres. Après quoi venait un ornement fait en pierre,
Page | 260
entouré à l’avant et à l’arrière de roses et autres choses du genre en cire qui
ressemblaient à des jeux d’enfants.
Le cheval qui avançait devant la fiancée avait la queue et la crinière peignées et
arrangées en mèches tressées de fils d’or. La fiancée passa devant nous après
toutes ces choses, sous une tente faite de très beaux tissus de soie surbrodés de fils
d’or, portée par plusieurs personnes. La fiancée montait un superbe cheval blanc
dont on ne voyait que le cou et la tête décorés de fils d’or. Le cheval de la fiancée
était suivi de près de 40 femmes esclaves. On nous a rapporté que la robe de noce
de la fiancée, qui était décorée d’or et de pierres précieuses de grande valeur, avait
coûté 100 000 ducats. 20 000 ducats furent dépensés pour les sucreries et plus de
1000 ducats pour les palmes de noces précédant la fiancée ; en tout, les dépenses
de la seule cérémonie de mariage atteignirent 70 000 ducats.
L’ensemble des dépenses a été prise en charge par la Sultane Hanım [Mihrimah
Sultane], fille du sultan Süleyman, veuve de Rüstem Pacha et belle-mère d’Ahmed
Pacha. C’est elle qui supervise [la carrière de] tous ses petits-enfants nés de sa fille
[Ayşe Sultane] et qui les marie. La rumeur raconte qu’elle aurait 2 000 ducats de
revenus journaliers. »242
Le récit de cet événement est dû à un témoin européen ; les chroniques ottomanes n’y
font aucune mention. On aurait tort d’y voir un de ces hasards de la conservation des sources
historiques ; le silence des Ottomans est volontaire et indique qu’il n’était pas considéré
comme un événement dynastique et, de ce fait, n’avait pas sa place dans les chroniques. Les
particularités du cortège permettent d’ailleurs de vérifier cette appréciation. On notera tout
particulièrement l’absence du manteau des sultanzade : il semblerait que celui-ci soit réservé
aux hanım sultanes. De même, aucun personnage d’État n’est présent dans l’escorte qui
entoure la princesse. Les prérogatives impériales accordées aux filles et petites-filles de sultan
ne s’étendaient pas aux générations ultérieures. La description que nous avons est l’une des
rares fresques existantes de düğün de membres de l’élite ottomane à la période moderne.
Cependant, il ne faudrait pas croire que le statut particulier de cette princesse, c’est-à-dire non
seulement son ascendance dynastique, mais aussi la place particulière de son ascendante
maternelle, Mihrimah Sultane, n’eut aucun rôle dans l’élaboration de la cérémonie. Si aucun
protocole dynastique particulier ne s’appliquait dans le cas de ces cérémonies, cela ne signifie
pas pour autant que les familles ne mettaient pas tout en oeuvre de leur côté pour souligner
leur haut lignage, leur importance. Ainsi, ce n’est pas par hasard si Gerlach met l’accent sur la
richesse de la cérémonie et du cortège : l’étalage des richesses est un instrument d’expression
des prétentions familiales.
*
242
Gerlach, Türkiye Günlüğü : t. 1 p. 456-458. Voir en annexes C.9.
Page | 261
Le cérémonial matrimonial ottoman est loin d’être statique. Il fait état de nombreuses
évolutions, certaines majeures, d’autres plus subtiles. Le moteur de ces évolutions est souvent
marqué du sceau de la Raison d’État ou, plus précisément, se montre en adéquation avec les
besoins dynastiques. Mais il n’en va pas toujours de la sorte et les motifs personnels, voire
égoïstes, ont également leur place dans ce jeu de réinvention récurrente de la tradition. Les
causes sont toujours épisodiques, mais, en raison de la forme même des pratiques dynastiques
ottomanes, les nouveautés protocolaires tendent à se pérenniser et à s’imposer comme
coutumes. Elles-mêmes entraînent de nouvelles adaptations, lorsque de nouveaux besoins se
profilent. L’une des spécificités de la dynastie ottomane tient justement dans cette capacité à
innover, facilitée par l’absence de codification stricte de ses pratiques.
La polysémie de ces cérémonies est à prendre en considération. La reconnaissance,
l’acceptation d’un membre dans son groupe d’appartenance, constitue un thème inévitable des
cérémonies de mariage, dans la mesure où l’union représente un changement de statut social
des époux respectifs : il se retrouve naturellement dans le cas des unions des princesses
ottomanes, modulé selon un strict respect des positions respectives de chacun au sein du
champ politique et social. Traditionnellement comprises comme une alliance entre familles,
les fêtes données à l’occasion des mariages développent généralement le thème de l’amitié et
de l’entente. La dynastie ottomane diffère sur ce point : l’amitié interfamiliale s’évanouit au
profit d’une mise en scène destinée à cristalliser symboliquement la hiérarchie sociale
ottomane. Le thème central mis en avant tout au long de ces festivités n’est autre que celui de
la supériorité dynastique. Supériorité qui appelle, prône même un idéal de syncrétisme social
derrière la dynastie, par la participation de l’ensemble de la population de la capitale, qui joue
ici le rôle de représentante de l’ensemble de la communauté de l’Empire. Cette supériorité
dynastique a cependant ses limites : elle s’arrête avec les filles de sang, respectant en cela la
hiérarchie interne aux princesses, telle qu’elle fut élaborée au cours de la première moitié du
XVIe siècle.
Ce syncrétisme social n’empêche pas la rivalité – elle paraît même encouragée par la
prégnance du politique dans le domaine du symbolique. Une rivalité qui se décline sous
plusieurs formes : rivalité entre personnes, qui cherchent à se distinguer au-dessus des autres
au cours de cet événement ; rivalité entre familles, qui souhaitent souligner leur prestige ;
rivalité entre cérémonies (de mariage entre elles ou par rapport aux circoncisions) ; enfin,
rivalité entre les règnes. Toutes ces rivalités, qui s’expriment tantôt par la durée des festivités,
tantôt par la recherche d’exceptionnalité, tantôt par l’étalage de richesse, sans qu’aucun de ces
éléments soit exclusif, suggèrent de s’interroger sur la dimension commémorative de ces
événements. Le champ mémoriel des cérémonies de mariage et, plus largement, des
cérémonies dynastiques, peu envisagé, nous semble pourtant un pan indissociable de toute
étude sur le sujet. Il implique de s’interroger sur le rôle de la production écrite dans le travail
de mémoire : la multiplication des récits de fêtes impériales, qui accordent progressivement
une place croissante aux cérémonies de mariage des princesses, nous semble y avoir joué un
rôle important.
Page | 262
CONCLUSION : UN DISCOURS CÉRÉMONIEL DE LA
DYNASTIE SUR ELLE-MÊME
Les cérémonies dynastiques sont l’occasion d’une mise en scène du pouvoir répondant
à un haut degré d’élaboration des discours et de manipulation des symboles. Jusqu’au XVIe
siècle, le discours cérémoniel dynastique était principalement modulé autour des membres
masculins de la dynastie. Les symboles convoqués mettaient en exergue la puissance
militaire, la force physique, la virilité. À partir de la seconde moitié du XVIe siècle, la
sédentarisation des sultans, l’arrêt des conquêtes militaires et l’évolution des pratiques
successorales appellent une redéfinition du langage cérémonial. Les membres féminins de la
dynastie acquièrent une place plus importante dans l’élaboration de l’image dynastique
officielle, que la diminution du nombre des cérémonies masculines facilite. Les cérémonies de
mariage en sont l’occasion et permettent de moduler le discours au public visé.
À l’occasion de ces cérémonies, la dynastie s’inscrit dans un mouvement de
compétition aux dimensions multiples. La rivalité est d’abord intérieure, face à une élite
dirigeante dont la puissance et les exigences se renforcent au cours du temps. Elle est aussi
extérieure, face aux puissances voisines, alliées ou rivales, aux yeux desquelles il est essentiel
de rappeler la puissance de la Maison d’Osman par des fêtes grandioses dont l’écho sera porté
– on l’espère – jusque dans ces cours. Enfin, cette rivalité est encore historique. Il s’agit de ne
jamais déparer face au prestige des ancêtres, de les dépasser même par des fêtes éblouissantes
dont le souvenir sera relayé dans le futur grâce aux récits de l’évènement spécialement
commandés à ces occasions ou inscrits dans les chroniques de règne.
Le traitement accordé à ces cérémonies dans les récits officiels évolue au cours du
temps. À peine mentionnées au XVe-XVI
e siècle, les descriptions se font progressivement
plus nombreuses et plus précises tout au long du XVIIe et XVIII
e siècle. Songeons que nous
ne possédons aucune description du mariage de Mihrimah Sultane avec Rüstem Pacha, alors
que des princesses du XVIIIe siècle, très retirées de la vie politique, ont droit à une
présentation détaillée de leur nikâh et de leur düğün ; on connaît avec détail chacun des
mariages des filles de Mustafa II et Ahmed III, alors que seules quelques princesses des
siècles précédents sont l’objet de telles attentions. La création d’un office de vakanüvis
(chroniqueur officiel) chargé de relater tous les événements importants du règne a
certainement contribué à favoriser la connaissance et la commémoration de ces cérémonies
dynastiques. Mais l’émergence de cet office est la conséquence, non la cause, de ce
changement de conception du rôle et de l’usage des chroniques officielles.
Au XVIe siècle, les mariages des princesses ne sont pas considérés comme des
événements par eux-mêmes ; les unions princières ne sont mentionnées que dans deux cas de
figure. La mention surgit dans le cadre d’un récit dont le gendre impérial est le sujet : la
mention du mariage arrive alors de manière insidieuse, pour indiquer la détention de cet
honneur recherché par le dignitaire en question. Ou alors, il en est question pour mettre en
évidence une innovation dans les pratiques dynastiques : le grand vizir qui se tient désormais
Page | 263
à cheval, un nikâh conclu pour une princesse encore enfant, la présence d’une audience plus
importante que d’habitude, etc. Au XVIIIe siècle, les chroniques accordent des paragraphes
spéciaux à ces mariages : nikâh et düğün deviennent des événements à part entière, dont
l’existence suffit à justifier leur présence dans les histoires de règne officielles.
Le phénomène se répète au niveau des naissances et des décès des princesses, mais
aussi des princes. Ce n’est qu’à l’extrême fin du XVIIe siècle que les naissances de princes et
princesses apparaissent comme événements dans les chroniques. Très vite, ces
renseignements deviennent systématiques, de même que les décès. La vision d’ensemble du
phénomène indique un changement du mode discursif des chroniques, qui accordent une place
croissante au quotidien familial de la dynastie. La chronique de Raşid est exemplaire à cet
égard. Son auteur accorde systématiquement un paragraphe à chacun de ces événements
familiaux : tantôt il est question de la naissance d’un prince ou d’une princesse, tantôt d’un
mariage, ici de la visite du sultan à sa mère, là des déplacements de la reine mère de tel à tel
autre palais, ou encore d’un décès survenu dans la famille. Le quotidien familial de la dynastie
devient objet de mémoire, à côté des récits des affaires gouvernementales, des conflits armés,
des relations diplomatiques. Les chroniques ne sont plus des histoires des sultans, mais de la
famille ottomane dans son ensemble.
Page | 265
4
LA POLITIQUE DU RÉSEAU
« Très haute, très excellente princesse et très puissante dame et
sœur : Felipe d’Atienza, huissier de votre chambre, fils de Lucas
d’Atienza, secrétaire de ma Chambre et de mon Trésor, m’a
supplié de vous écrire et de vous demander de lui accorder l’office
de Maréchal de votre Palais, compte-tenu de ses services et en
considération du service qu’a accompli son frère en tant que votre
chapelain. Et comme j’ai pris soin de ce qui concerne Lucas
d’Atienza son père, tant à cause de ses services que parce qu’il a
été pendant si longtemps le serviteur de la reine ma mère et le
mien, je désire fortement lui donner mon appui et lui faire la
grâce qu’il demande. Je vous serai très reconnaissante, pour ces
motifs, d’accepter ma demande de lui accorder l’office de
Maréchal de votre Palais, car j’en serai fort contente. […]
Très haute, très excellente princesse et très puissante dame et
sœur, que Notre Seigneur conserve toujours votre personne et
votre état royal en sa sainte garde.
À Palmella, le 27 février 1531
Sœur de Votre Altesse, qui fera ce qu’elle demandera,
La reine. »1
Des femmes détentrices de la dignité royale, des épouses de souverains anatoliens ou
de grands dignitaires de l’État ottoman : autant d’éléments qui nous amènent à poser la
question du rôle politique des princesses ottomanes. “Les femmes n’ont pas leur place en
politique” ont pu prétendre certains à leur propos. Et pourtant, ne parle-t-on pas de « sultanat
des femmes »2 pour la période allant du mi-XVI
e au mi-XVII
e siècle ? Certes, l’expression
visait à mieux fustiger une action jugée anormale. Et les chroniqueurs ottomans eux-mêmes
ne se privèrent pas de critiquer le pouvoir des femmes dans la politique et dans les décisions
gouvernementales, dès lors qu’il dépassait à leurs yeux les limites de l’acceptable3. En creux,
il faut comprendre que ces femmes furent bien présentes en politique, au moins sur une
période donnée, et le travail de Peirce a très bien démontré de quelle manière cette action
s’installa et les formes qu’elle prit4. Néanmoins, ce livre se concentrait sur le personnage des
favorites (haseki) et des reines mères (valide sultan). La question du rôle politique des filles
des sultans et de leur descendance n’y était pas évoquée.
1 Aude Viaux (éd.), Lettres des souverains portugais à Charles Quint et à l’impératrice (1528-1532) conservées
aux archives de Simancas. Suivies en annexe de lettres de D. Maria de Velasco et du Duc de Bragance, Lisbonne / Paris, Centre Culturel Calouste Gulbekian, 1994 : 167. 2 D’après l’expression de l’historien Ahmed Refik Altınay ; Altınay, Kadınlar Sultanatı.
3 Peirce, The Imperial Harem : 173-174 ; 177-185.
4 Peirce, The Imperial Harem : passim.
Page | 266
L’une des difficultés de l’exercice réside dans la documentation. Pour analyser l’action
de ces femmes, il fallait être capable de trouver et délimiter un corpus qui fournirait des
informations utiles et suffisantes sur le sujet. Un tel corpus en soi n’existant pas, il a fallu
coupler les informations de sources diverses. Les récits des chroniqueurs ou des voyageurs
occidentaux se révélèrent très utiles, mais parcellaires. Les lettres des sultanes, dont certaines
ont été publiées par Uluçay5, auraient pu s’avérer utiles et donner une voix à ces femmes :
nous n’y eûmes pas accès6. Les registres de compte des Maisons des princesses, étudiés par
Tülay Artan7, furent une piste rapidement abandonnée, en raison de l’impossibilité d’établir
des recoupements de carrière à partir de ces informations (les Mahmud Ağa et Mehmed Bey
font légion dans tout l’Empire). Une dernière piste fut finalement suivie : celle des ouvrages
biographiques, en particulier celui de Mehmed Süreyya qui, malgré ses erreurs régulières,
fournit néanmoins un vaste éventail de personnages « importants » parmi lesquels il a été
possible d’identifier les membres de l’entourage des princesses8. Au total, il faut bien
convenir que le corpus réuni, pour une période qui s’étend sur trois siècles, s’avère limité.
Faut-il y voir une volonté des chroniqueurs et auteurs d’ouvrages biographiques de
dénigrer toute trace d’une action politique des princesses ottomanes ? Pas directement,
semble-t-il. Le problème est autre : l’action politique des princesses, limitée, choqua rarement
les esprits des contemporains au point de mériter des annotations dans les récits de règne. Il
faut alors retourner la question : si des femmes placées au cœur du pouvoir ne jouèrent qu’un
rôle limité en politique, ne faut-il pas dès lors envisager l’existence de restrictions à leur
égard ? Dès lors, il est possible de dégager des éléments structurels délimitant le cadre dans
lequel une princesse pouvait entreprendre une action politique. Un cadre limité, qui ne leur
laissait que peu de marge d’action, mais qui explique parfaitement leur absence dans la
documentation traditionnelle : l’action d’une princesse ne pouvait être directe, sauf cas
exceptionnels ; elle passait par un travail de réseau, de faction ; leur rôle n’était pas
institutionnalisé, il consistait à soutenir, défendre, placer les membres de leur entourage (leur
famille, dynastique ou lignagère, leur Maison).
5 Uluçay, Haremden Mektuplar ; voir aussi, du même auteur, Aşk Mektupları.
6 Malgré des demandes répétées auprès des autorités, nous n’avons pas réussi à obtenir l’autorisation de
travailler dans les archives de Topkapı à ce jour, fermées pour cause d’inventaire. D’ailleurs, rien ne dit que ces lettres auraient fourni des renseignements profitables à la forme de cette étude : les exemples connus montrent toute la limite des informations apportées par cette documentation. Le travail aurait été intéressant à faire, mais dans le cadre d’une étude épistolaire, ce qui aurait requis une méthodologie et une direction de travail qui n’ont pas leur place ici. Cette documentation pourrait néanmoins contribuer à percevoir comment ces femmes parlaient d’elles-mêmes, entretenaient des relations avec d’autres, percevaient les événements politiques. Certains historiens ont étudié quelques exemples de ces missives. Citons notamment les deux ouvrages d’Uluçay, Haremden Mektuplar et Aşk Mektupları ; Leslie Peirce et Lucienne Thys-Şenocak ont également exploité certaines lettres en particulier : Peirce, The Imperial Harem ; Thys-Şenocak, Ottoman Women Builders (notamment les deux premiers chapitres). 7 Nous remercions Tülay Artan de nous avoir fait part de ses travaux dans le domaine et attendons avec
impatience leur publication. 8 Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî.
Page | 267
I. Champ du pouvoir et intériorisation des contraintes de
l’action politique
« La société de cour n’est pas un phénomène existant en dehors des individus qui la
constituent ; et les individus qui la constituent, depuis le roi jusqu’au valet de chambre,
n’existent pas en dehors de la société qu’ils constituent ensemble », indiquait Elias à propos
de la cour versaillaise de Louis XIV. Cette codépendance existentielle entre les individus et le
système social dans lequel ils gravitent est définie dans son travail sous l’appellation de
« formation » sociale9. En ce sens, le rôle des princesses ottomanes au sein de leur
« formation » sociale ne peut se comprendre qu’à la condition d’avoir appréhendé au
préalable l’ensemble des interdépendances qui les entourent et dont elles constituent un
maillon. Or, ajoute Bourdieu, le « champ du pouvoir » est « un champ de luttes pour le
pouvoir entre détenteurs de pouvoirs différents » qui disposent chacun d’un capital propre,
« économique ou culturel, notamment » précise-t-il, et qui s’affrontent ainsi « dans des
stratégies destinées à conserver ou à transformer » le rapport de force qui les ordonnance dans
un tout relativement cohérent10
. Il ne suffit alors pas de définir le champ politique dans lequel
les princesses gravitent ni même de déterminer les individus et les groupes avec lesquels elles
luttent, et nous ajouterons, ceux avec lesquels elles s’allient : il faut encore et surtout parvenir
à déterminer le type de capital dont elles disposaient dans cet affrontement pour la promotion
ou la conservation de leur position dominante.
Or, la marginalité de leur position au sein de la structure de l’élite dominante ottomane
laisse supposer quelques spécificités. Leurs droits, les rôles politiques et les modes d’action
qui s’offrent à elles répondent aux exigences de leur sexe et de leur condition sociale. Liées à
la dynastie d’un côté, à l’élite dirigeante de l’autre, les princesses sont des personnes mobiles ;
elles sont amenées à jouer le rôle d’intermédiaires indispensables entre individus dominants
dans cette « formation » qu’est le champ de l’élite politique ottomane. Étudier le rôle
politique des princesses ottomanes suppose de se détacher de l’analyse des formes
traditionnelles d’action politique, pour s’intéresser aux pratiques “marginales” de ceux qui ne
s’inscrivent pas dans les cadres institutionnalisés du champ politique. Pour autant, cette
marginalité n’est qu’apparente, car le rôle et les formes d’action de tels individus ne
constituent en rien des anomalies du système : par leur position même au sein du réseau
d’interdépendance du champ politique ottoman, ces marginaux (les princesses ottomanes n’en
sont qu’un exemple) sont dotés d’une fonction qui s’inscrit dans la diversité des rôles
attribués à l’ensemble des acteurs politiques.
Le propre des marginaux tient dans le fait de n’avoir pas accès aux formes d’action
dominantes : leurs pratiques prennent des chemins de traverse et, de ce fait, n’apparaissent au
grand jour que quand le résultat s’inscrit dans le jeu traditionnel. Ainsi les chroniqueurs diront
que la nomination de tel individu à tel poste est due à l’intervention de sa femme ou de sa
9 Elias, Sociologie et histoire en avant-propos de la Société de Cour : LIV.
10 Bourdieu, La noblesse d’État : 375.
Page | 268
mère, mais ils tairont les moyens ou arguments utilisés à cette fin. L’étude du rôle politique
des princesses ottomanes peut dès lors servir de cas d’exemple. Les princesses ne sont pas les
seules personnes marginales de ce système (qui ne comprend d’ailleurs pas que des femmes),
mais leur position est suffisamment élevée et les conséquences de leurs actions suffisamment
importantes pour surgir, par intermittence, dans la documentation et donner ainsi les moyens
d’une étude dans le domaine.
Nous commencerons par étudier les conditions d’une action politique des princesses,
dans le cadre du champ politique ottoman, c’est-à-dire en déterminant les acteurs principaux
de ce champ et les stratégies d’action élaborées par chacun, au regard des propres conditions
d’une action politique des princesses, inscrites dans un périmètre volontairement restreint –
pour des raisons qu’il conviendra d’expliciter. Cette base établie, il sera dès lors possible de
nous concentrer sur les modalités d’action politique des princesses, condensées à l’intérieur
du cadre familial : c’est par et pour les membres de leur famille (au sens large du terme) que
les princesses trouvent les moyens et les motifs de leurs actions. Restera alors à en voir les
applications concrètes, en regardant les domaines politiques dans lesquels ces femmes
s’investirent, depuis l’action souveraine, mais nécessairement hors du domaine ottoman, la
diplomatie, et jusqu’aux affaires d’État.
1. Les conditions d’une action politique des princesses
Le champ politique ottoman est un champ complexe dans lequel interfèrent des
individus aux profils et intérêts très divers. Il n’est pas stable, si tant est qu’une telle situation
ait jamais existé : sur les quelque trois siècles d’histoire que couvre cette étude, les mutations
sont profondes et nombreuses. Il ne revient pas à ce travail de reprendre et discuter l’ensemble
des travaux qui ont été faits sur le sujet : les grandes lignes suffiront. Le champ politique
ottoman se répartit selon plusieurs principes : une répartition spatiale (centre – provinces)
avec ses agents respectifs et ses tensions et rivalités inévitables, un ordonnancement
professionnel (militaires, administrateurs, religieux). Les passerelles et collusions d’un
domaine à un autre furent récurrentes : un militaire pouvait devenir administrateur et vice
versa, un officier provincial investir les offices de l’administration centrale. La beauté et la
complexité des institutions politiques ottomanes ne présentent malheureusement que peu
d’intérêt pour notre propos, car les princesses n’étaient en interaction qu’avec un nombre très
restreint des individus qui en constituaient l’ensemble.
Ces individus, ce sont d’abord ceux de la capitale puisque, dès le début du XVIe siècle,
les princesses ne sont plus mariées qu’aux plus grands dignitaires de l’État, ceux qui gravitent
autour de la personne impériale et du gouvernement central – quand bien même ils peuvent
être amenés à occuper des postes de gouverneur de province (beylerbey) qui les obligent à
s’éloigner de la capitale le temps de l’office : ils y vont alors seuls, laissant l’épouse princière
dans ses palais le long du Bosphore. L’univers politique des princesses se concentre au centre
du pouvoir et de l’État : les personnalités qui gravitent autour de la personne royale et qui
Page | 269
constituent le gouvernement central. De ce fait, malgré des liens, plus ou moins affichés, avec
l’élite religieuse, l’essentiel de leurs interactions politiques se fait avec les kul du sultan, qu’ils
soient militaires ou administrateurs. C’est donc le fonctionnement de ce groupe très restreint
d’individus, les kul du sultan appartenant au sommet de la hiérarchie socioprofessionnelle de
la capitale, qu’il convient de définir pour comprendre le type de rapport et de relations que les
princesses ottomanes entretenaient avec eux.
Mais les princesses sont aussi des membres de la dynastie et, à ce titre, il faut
s’interroger sur leur potentiel d’exercice d’une autorité souveraine. Or, les souverains
ottomans eurent tôt fait de réduire les potentialités d’une action princière par l’affirmation
d’un double interdit : l’exclusion de l’exercice de la souveraineté et l’incapacité à transmettre
cette souveraineté à leurs descendant(e)s. On chercherait en vain les justifications et les
affirmations de ces exclusions : elles ne sont formulées explicitement nulle part, ce qui
n’empêchât pas leur application tacite. L’absence de toute tentative de remise en cause de ces
principes excluants révèle un phénomène de subjectivation, par les princesses, de leur régime
de gouvernementalité, intériorisé comme norme. Ce qui ne signifie pas que la norme n’ait pas
subi quelques altérations au cours du temps.
1. Le champ politique et les conditions du pouvoir dans l’espace
ottoman
Aborder la question des cadres d’une action politique au sein de l’espace ottoman est
un exercice ardu qui a mobilisé un nombre conséquent de chercheurs pendant des années et
des travaux complémentaires ne cessent de voir le jour. Nous ne prétendons pas proposer ici
de nouvelles théories ou approches, ni même un état général de la question : un tel travail
couvrirait un plein ouvrage et nous entraînerait bien loin de notre propos. Nous nous
contenterons donc, avec toute la modestie requise, d’éclairer certains aspects du problème
directement liés à notre questionnement. Trois points vont ainsi faire l’objet d’un
développement ici : la question de la détention naturelle et héréditaire du pouvoir à l’intérieur
de la dynastie ; la mise en place d’un État superpuissant qui contrôle et octroie la grande
majorité des offices et dignités qui induisent la détention d’un pouvoir ; enfin, l’évolution
d’une méritocratie idéalisée vers un système de clientélisme.
Héritiers des traditions turcomanes et centre-asiatiques, les Ottomans ont développé
une théorie politique fondée sur la détention naturelle de chacun de leur membre du devlet,
notion politique qui, pour la période qui nous intéresse, prend un sens très différent de celui
d’État et qui rend compte de la détention d’un charisme transmis au sein du lignage ottoman
et que Nikos Sigalas s’est attaché à définir. Le devlet est ainsi « tout d’abord fortune (baht),
celle que Dieu accorde. […] Il ne s’agit donc pas simplement d’une bonne fortune, mais d’une
fortune assimilée à un choix préférentiel de Dieu, à une élection. Le devlet est aussi synonyme
de pouvoir sur les hommes. Et à ce titre, il est tout d’abord un lieu : un lieu intermédiaire entre
Dieu et les hommes, une station (menzil) sur le chemin qui mène à Dieu, où sont placés
Page | 270
‘Osmân et sa lignée, un locus, entre le monde terrestre et le monde surnaturel ». Le devlet est
donc « une réification du pouvoir du prince », une sorte de charisme wébérien, qui « se
transmet de génération en génération, de façon à assurer la perpétuation des rites et des
pratiques, des savoirs et des croyances, des gestes et des coutumes, éléments d’un ensemble
dont la cohésion est garantie par la continuité de la succession »11
. Le sultan et sa lignée sont
de la sorte non seulement à la tête de leur communauté, mais ils en assurent encore la
pérennité.
Le devlet s’écarte cependant de la notion de charisme dans son caractère non
personnel : contrairement au charisme, il est un attribut héréditaire, partagé par tous les
membres de la lignée12
. De cette conception, qui plonge ses racines très loin dans les théories
turcomanes du pouvoir et dont l’historien Halil İnalcık s’est attaché à montrer les origines et
différences dans le cadre ottoman13
, dérive toutes les pratiques successorales ottomanes et
l’incapacité de cette dynastie à produire une règle en la matière. Par décret divin, tout prince
de la lignée est digne de monter sur le trône et d’exercer son autorité : il n’est donc pas du
pouvoir d’un homme, fut-il lui-même élu de Dieu, de légiférer dans le domaine. Il ne leur est
possible que de limiter les prétendants et les problèmes engendrés lors d’une succession par
l’application du fratricide ou d’une pratique – jamais inscrite dans le code des lois d’Empire –
d’une succession, que ce soit pas l’application du fratricide ou d’un système successoral par
voie de séniorat, ou par le dénigrement d’un concurrent en lui reniant, à tort ou à raison, sa
qualité de membre de la dynastie – le prétendant est alors appelé Düzme (qui prend le sens de
faux, contrefait, factice).
Le sultan ottoman est l’incarnation même de l’État, organe quasi incontournable pour
l’acquisition d’un pouvoir politique, d’une auctoritas, autorité certes subordonnée à celle du
princeps, ici le sultan, mais qui autorise la détention et l’exercice d’une potestas, d’une
puissance, qui est puissance d’action, de décision, sur d’autres. Nous ne reviendrons pas sur
l’organisation générale de la société ottomane entre dominés (le peuple, les re’âyâ) et
dominants, exempts de taxes parce qu’ils sont au service de l’État, et qui bénéficient d’une
autorité sur les premiers au nom d’un service rendu à la société : service militaire,
administratif, religieux, judiciaire14
. Qu’ils soient kul ou oulémas, l’État interfère toujours, de
façon plus ou moins directe, avec l’autorité qui leur est confiée ; il ne peut y avoir d’autorité
(reconnue officiellement) en dehors des structures étatiques ottomanes15
.
11
Sigalas, « Devlet et État » : 389-390. 12
Sigalas, « Devlet et État » : 390-391. 13
İnalcık, « The Ottoman succession » et « The Ottoman Concept of State and the Class System ». 14
Cette répartition ne tient cependant pas compte des individus qui, au service des privilégiés, ne détiennent encore aucune potestas en propre, mais dont la position les prédispose à atteindre un tel poste : nous les mettons volontairement de côté ainsi que les membres des re’âyâ qui ne nous intéressent pas directement ici. İnalcık, « The Ottoman Concept of State and the Class System » ; Veinstein, « L’empire dans sa grandeur (XVI
e
siècle) » ; Yediyıldız, « Ottoman Society » : 492-519. 15
C’est d’ailleurs cette assomption qui a permis à Karen Barkey d’interpréter le banditisme comme une forme de protestation de la part d’individus ou groupes d’individus qui se sentaient lésés par le renforcement de l’autoritarisme impérial centralisateur, et qui s’apaisait par l’intégration des rebelles au sein de la structure étatique. Cf. Karen Barkey, Bandits and Bureaucrats. The Ottoman Route to State Centralization, Ithaca / Londres, Cornell University Press, 1994.
Page | 271
Or, à y regarder de plus près, et sans nier l’importance des oulémas et de l’ensemble
des membres de l’‘ilmiyye, à la période classique qui nous occupe ici, l’essentiel du pouvoir
politique en tant qu’auctoritas et potestas réside entre les mains des agents de l’administration
(provinciale et centrale). L’importance des pouvoirs qui leurs sont confiés suppose un
contrôle strict de la part de l’État, qui explique que ces individus, dans leur grande majorité,
soient des kul (des serviteurs esclaves du sultan, qui détient le droit unilatéral de nomination
et de destitution, de récompense ou de punition sur eux). L’autorité et la puissance de ces
individus ne s’acquièrent que par la voie du service au sultan, incarnation de l’État, qui la
confère ou l’ôte selon son bon vouloir. L’auctoritas confiée aux kul ne leur appartient pas en
propre ; elle n’est qu’une délégation temporaire. Un officier quelconque ne peut
théoriquement l’accaparer pour lui-même ni la transmettre à un autre ; elle ne dure que le
temps de l’office. Voilà interdite toute possibilité de transmission héréditaire de cette
auctoritas et de la potestas qui lui est associée : hormis la dynastie régnante, la noblesse de
sang n’existe pas au sein de l’État ottoman16
. Quelle que soit l’effectivité du pouvoir que ces
agents de l’État peuvent exercer, elle s’inscrit dans le cadre d’un office d’État, soumis à des
règles précises, dont la variabilité ne change pas le caractère limité et soumis à ce même État,
c’est-à-dire, dans le contexte de l’époque classique, au sultan. Autrement dit, il n’est de
puissance politique en dehors d’un office, délégation d’une parcelle restreinte et limitée dans
le temps (de l’office en question) de l’autorité du sultan.
Décontenancés devant un système où la noblesse de sang n’existait pas en tant que
classe politique, les voyageurs occidentaux utilisèrent le terme de “méritocratie” pour définir
le système politique ottoman17
. De fait, dans l’Empire ottoman classique, la naissance ou la
position au sein de l’organisation sociale ne garantissent en rien l’acquisition d’offices. Seule
la formation puis la promotion au sein même de la structure étatique, selon des cursus
honorum encore mal connus pour la période qui nous intéresse18
, semblent assurer l’élévation
socioprofessionnelle et, à terme, l’octroi répété de postes de pouvoir. Encore les agents ne
sont-ils pas alors à l’abri d’une démission soudaine ou d’une punition en cas de
mécontentement de la hiérarchie supérieure. Les modalités de cette formation, réalisée pour sa
plus grande part au sein du Palais (approvisionné en majorité en esclaves-kul), au moins au
XVIe et encore au XVII
e siècle, confirment cette impression que les compétences
16
Nous mettons ici de côté le cas de la noblesse héréditaire des seyyid (les descendants du Prophète), car elle ne peut être assimilée à une noblesse “de pouvoir” dans la mesure où la détention de ce titre n’entraîne pas la détention d’un office quelconque : c’est une noblesse “spirituelle”. Cf. notamment Canbakal, « On the ‘Nobility’ of Provincial Notables » et Kılıç, Seyyidler ve Şerifler. 17
Cette vision « positive » de l’État ottoman ne dura qu’un temps, avant l’implantation de l’image du despote oriental : Valensi, Venise et la Sublime Porte. 18
Certaines carrières ont fait l’objet d’études particulières, notamment sur les cheikhs-ul-islams : Repp, The Mufti of Istanbul ; les eunuques noirs : Hathaway, Beshir Agha ; les chefs de la chancellerie : Inalcık, « Reis ül-küttâb » ; les naib : Veinstein, « Sur les na’ib ottomans » ; les oulémas : Madeline C. Zilfi, « Elite Circulation in the Ottoman Empire: Great Mollas of the Eighteenth Century », Journal of the Economic and Social History of the Orient 26 (1983) : 318-364 et The Politics of Piety, pour ne prendre que ces quelques exemples. Citons également les travaux de Bouquet, Les Pachas du sultan et de Caroline V. Findley, Bureaucratic Reform in the Ottoman Empire, The Sublime Porte, 1789-1922, Princeton, Princeton University Press, 1980, qui s’intéressent à la période postérieure à la notre.
Page | 272
individuelles et l’accomplissement strict du service étatique étaient le seul gage d’une
ascension professionnelle qui, elle-même, se traduisait en termes sociaux19
.
Cette méritocratie est pourtant plus un idéal qu’une réalité profonde, car d’autres
principes avaient également cours, comme le clientélisme, qui remet partiellement en cause
l’idéal méritocratique. Le clientélisme a-t-il toujours existé au sein de la société et de l’État
ottoman ou s’agit-il d’un développement concomitant à la stabilisation de l’État à partir du
XVIe
siècle ? Certaines formes de clientélisme ont cours antérieurement au règne de
Süleyman Ier, mais c’est surtout à partir de la seconde moitié du XVIe siècle qu’il se
manifeste de façon évidente – nous en verrons quelques exemples par la suite. Ce clientélisme
repose sur la volonté des grands dignitaires de copier le modèle impérial : à l’instar des
sultans, les pachas (pour ne prendre qu’eux comme exemple, parce qu’il est le plus révélateur)
entretiennent une maison, une household, au sein de laquelle gravitent des individus aux rangs
et activités très divers, au service du(des) maître(s)20
. Le rôle de ces maisons comme foyer de
formation de futurs officiers de l’État n’est plus à démontrer : à partir du XVIIe siècle, elles
font concurrence, jusqu’à un certain point, à l’école du Palais21
. Mais une erreur, souvent
répétée, serait de faire coïncider maison et clientèle : la maison et les membres qui y
prospèrent ne constituent qu’une petite partie de la clientèle d’un grand dignitaire ; il faut
encore y ajouter tous les membres extérieurs parmi lesquels se trouvent notamment les parents
dudit dignitaire, qui peuvent eux-mêmes être à la tête de leur propre maison (et les cas de
népotisme sont monnaie courante au sein de l’État ottoman à partir du XVIe siècle), mais
aussi les alliés politiques, les clients au sens propre du terme, tous ceux qui viennent se placer
ou se trouvent, d’une manière ou d’une autre, sous sa protection sans nécessairement résider
sous son toit. Parmi cette dernière catégorie se trouvent notamment de nombreux individus
appartenant à un degré quelconque à l’‘ilmiyye. C’est là une dimension trop souvent oubliée
de la puissance d’un dignitaire : elle ne réside pas uniquement dans sa maison ou sa capacité à
établir des liens avec d’autres membres de son groupe, mais également en dehors.
L’une des conséquences naturelles du clientélisme, institué comme mode
d’organisation politique, est l’apparition d’un système de factionnalisme. La hiérarchie étant
ce quelle est, la survie politique des dignitaires les moins puissants (c’est-à-dire l’assurance
de conserver son poste ou d’en obtenir un autre dans un délai le plus court possible22
),
nécessite qu’ils se placent sous la protection des plus puissants. Eux-mêmes sont dans la
nécessité de favoriser la position respective de chaque membre de leur clientèle, afin de
19
Kunt, The Sultan’s Servants : 31-56 ; İnalcık, « The Palace ». 20
De fait, le chef de la maison est rarement seul à gouverner : il est épaulé soit de sa mère, soit de son épouse, laquelle règne sur une partie du personnel, selon le principe de division des espaces au sein de la maison. Ainsi le pacha régnant sur une Maison est secondé dans sa tâche par son intendant, son kethüda ; mais il en va de même de son épouse, qui dispose de son propre kethüda. Monsieur commande à l’ensemble de son personnel, en recrute de nouveaux, s’acquitte de ses responsabilités et paie son personnel sur ses propres revenus, pendant que de son côté, Madame en fait de même, de façon indépendante de son époux. On notera cependant qu’il peut revenir au mari de payer les salaires des serviteurs et servantes de sa femme, et vice versa. 21
İnalcık, « Hüsrev Paşa » et « The Palace » ; Kunt, The Sultan’s Servants : 31-44. 22
Metin Kunt a montré qu’à partir du XVIIe siècle, le souci de se voir attribuer rapidement un nouvel office était
particulièrement prégnant, tant le roulement des postes était rapide et comportait des phases d’attente récurrentes, y compris pour les dignitaires les plus puissants : Kunt, The Sultan’s Servants : 67-93.
Page | 273
conforter leur propre puissance : en servant les intérêts des autres, les chefs de faction ne font,
en fait, que défendre les leurs. Des super-clientèles se dessinent ainsi progressivement autour
des plus hauts dignitaires de l’État, qui augurent de leur propre puissance personnelle. On se
trouve bien là en présence d’un système de factions qui, du fait de la structure même du
pouvoir, sont soumises à un double principe d’entraide et de rivalités. Entraide pour conserver
le pouvoir, face à la montée de nouvelles factions, mais rivalité pour acquérir le maximum de
pouvoir par rapport aux concurrentes directes. L’harmonisation de l’ensemble repose sur un
principe d’équilibre des factions garanti, idéalement et virtuellement, par l’autorité suprême
du sultan.
2. L’exclusion de l’exercice de la souveraineté
La première interrogation à formuler concernant les moyens d’une action politique des
princesses ottomanes est celle du caractère institutionnel (ou non) de leur rôle. Et pour cela, il
y a lieu d’observer leur participation à la dynastie. Eu égard à la place qu’elles occupaient au
sein de la dynastie, quelles pouvaient être leurs pratiques politiques et de quelle légitimité
disposaient-elles ? Les princesses ottomanes avaient-elles un droit d’exercice politique
institutionnel ? En d’autres termes, le fait d’être liées, directement ou non, au souverain leur
donnait-il droit à un exercice particulier du pouvoir ?
Pour répondre à cette question, il nous faut faire appel à plusieurs principes du
fonctionnement et de la distribution du pouvoir au sein de la dynastie. L’historiographie
contemporaine a largement insisté sur le caractère patriarcal de la famille ottomane, que
l’usage du concubinage vient encore renforcer23
. Mais en mettant l’accent sur cet aspect,
l’apport profond et durable des traditions turco-mongoles, qui considèrent la souveraineté
comme un bien commun et partagé par l’ensemble de la dynastie a été négligé. À juste titre,
Peirce rappelle que « les femmes jouaient également des rôles politiques vitaux et attendus.
Dans le cas ottoman, princes et princesses de sang partageaient un pouvoir royal par le simple
fait de la naissance. Mais les membres de la famille dynastique dont le sang ne portait aucun
droit au pouvoir – les concubines mères, des femmes esclaves venant des territoires chrétiens
et converties à l’Islam – étaient aussi capables de prétendre à une part dans l’exercice de
l’autorité souveraine à travers leurs rôles au sein de la famille. C’est dans ce cadre des
relations à l’intérieur de la famille régnante, parmi ses membres, que ces femmes exerçaient
une autorité, et leurs fils étaient perçus comme des héritiers politiques potentiels »24
. La
remarque prête pourtant le flanc à la critique, car le fait d’exercer une autorité à l’intérieur et
par l’intermédiaire de la famille ne signifie pas et ne peut être compris comme le signe d’un
droit, même partiel, à l’exercice de la souveraineté.
L’exclusion des femmes royales de l’exercice de la souveraineté est un point que
l’historiographie traditionnelle martèle sans admettre la moindre discussion. Ils fondent leur
23
Peirce, The Imperial Harem : 16-17 ; Alderson, The Structure of the Ottoman Dynasty : 77-100. 24
Peirce, The Imperial Harem : 17. Les termes en italique sont le fait de l’auteur.
Page | 274
appréciation sur les propos des chroniqueurs des XVIe et XVII
e siècles qui, au nom de ce
principe, critiquent le rôle politique acquis par certaines. Pourtant, en creux, la présence du
débat, chez les Ottomans eux-mêmes, sur le rôle politique des femmes (royales) indique la
possibilité d’un exercice du pouvoir par ces femmes : on ne critique pas l’inconcevable. De
fait, dès le XVe siècle, les reines mères endossèrent le rôle de conseillères privées de leur fils,
lorsque celui-ci était envoyé en province apprendre son métier de souverain. Certes, elles
devaient partager cette responsabilité avec toute une équipe masculine et leur rôle était
principalement cantonné à l’enceinte du harem princier ; il n’en était pas moins
institutionnalisé25
. La montée en puissance des favorites et reines mères durant toute la
période du XVIe siècle, malgré les critiques auxquelles elle donna naissance, ne remit pas en
cause la légitimité du rôle de ces femmes en tant que conseillères de leur fils26
.
Cependant, même au faîte de leur puissance et la régence en main, ces femmes royales
ne purent jamais exercer un rôle souverain en leur nom propre. Les lettres de Turhan Hadice
Sultane aux membres du gouvernement martèlent le fait que ses réclamations sont des
émanations des ordres du sultan son fils (un enfant qui n’a pas encore atteint les 10 ans)27
. De
même, les reines mères ne possèdent pas de tuğra en propre, ni ne font frapper monnaie à leur
nom. Elles disposent certes d’un exercice du pouvoir institutionnalisé, mais celui-ci n’est pas
l’exercice de la pleine souveraineté. D’autre part, celui-ci dérive directement de leur lien avec
le sultan / le prince : que celui-ci vienne à disparaître, et toute leur puissance tombe aussitôt
comme un château de cartes28
. La puissance politique de ces femmes ne réside donc pas en
leur personne, mais dans leur relation avec leur fils ou avec le sultan : à l’intérieur de la
famille, comme disait Peirce, dont on rappellera qu’elle parlait de femmes esclaves dont
l’élévation était due à leur intimité avec le sultan et à l’enfantement29
.
La situation des princesses ne saurait être comparée à ces dernières, ne serait-ce que
pour des raisons de statut : leur honneur est assuré à la naissance. Certes, il dérive du lien avec
le sultan, mais il est individuel et à vie : il ne peut ni se perdre, ni diminuer. Cependant, la
question est de savoir à quoi ouvre droit cette détention de la dignité royale, en terme
d’exercice politique. Un consensus existe sur le sujet, qui veut que les princesses aient été
théoriquement exclues de l’exercice de la souveraineté. Pourtant, aucun texte ne vient
affirmer ou infirmer ce propos. Il faut alors convenir qu’il s’agit d’une exclusion de l’exercice
de la souveraineté ni théorique, ni codifiée, mais coutumière. Et le fait est que le cas de figure
ne s’est jamais présenté : la dynastie ne fut jamais confrontée à une revendication souveraine
féminine, indice de l’intériorisation de cette coutume par les princesses elles-mêmes30
.
25
Peirce, The Imperial Harem : 28-56. 26
Peirce, The Imperial Harem : 57-90. 27
Thys-Şenocak, Ottoman Women Builders : 39-54, 127-175, 181-185. 28
Exception faite de Kösem, qui parvint à se faire nommer « grande valide sultane » et à rester à sa place de régente pendant les premières années du règne de son petit-fils, Mehmed IV – au détriment de sa belle-fille, jugée trop jeune et inexpérimentée, Turhan Hadice Sultane. Cf. Thys-Şenocak, Ottoman Women Builders : 17-55 ; Peirce, The Imperial Harem : 249-252 ; Sakaoğlu, « Kösem Sultan » et Bu Mülkün Kadın Sultanlar : 224-232. 29
Peirce, The Imperial Harem : 15-27. 30
La France présente un exemple contraire : l’invention de la loi salique naît dans un cas de figure où la couronne de France allait revenir entre des mains d’une femme. C’est donc l’apparition d’une situation concrète, la peur de perdre le contrôle sur la succession (et de voir échapper le trône en faveur d’autres lignées
Page | 275
L’application de la loi du fratricide, qui a fait couler l’encre de nombreux
scientifiques, doit ici être invoquée. Nous ne reviendrons pas sur les conditions dans
lesquelles cette pratique apparut, ni comment elle fut utilisée, et les hésitations qu’elle connut
dans son application. Les souverains régnants ressentent le besoin de se prémunir contre la
concurrence de leurs lignées collatérales masculines par leur exécution brutale, selon un
principe directeur très clairement formulé dans l’article de loi inscrit dans le code de Mehmed
II : il s’agit d’éviter les querelles et guerres internes de succession, ainsi que l’affaiblissement
de l’autorité souveraine, par l’exécution des candidats potentiels (les princes des lignées
collatérales) 31
. Seuls les fils du sultan et leurs propres enfants demeurent saufs – jusqu’à la
prochaine succession. Or, cet article ne concerne que les princes, à l’exclusion de leurs sœurs.
Ce phénomène ne s’explique que si l’on part du principe que les princesses ne représentaient
aucun danger : elles n’étaient pas perçues comme des forces subversives susceptibles
d’affaiblir le trône. L’application sexuée de la loi du fratricide suppose l’existence d’une règle
dynastique excluant les filles du trône et de l’exercice de la souveraineté.
Cette exclusion est pourtant loin de couler de source. La légitimité dynastique
ottomane s’est construite sur un triple héritage turco-mongol, islamique et byzantin32
. Or,
dans chacune de ces civilisations, les exemples de femmes souveraines (ou ayant partagé
l’exercice de la souveraineté) sont nombreux : Seyyide Hatun en Perse, Dayfa Safiyye Hatun,
à Alep, Gasye Hatun à Hama, Inanç Sultane Raziyye à Delhi, Şecerüddür en Égypte, Türkan
Hatun à Kirman, et ainsi de suite33
. Pourquoi cette spécificité ottomane ? La présence
concomitante de deux phénomènes pourrait y avoir contribué. En premier, il faut invoquer la
pratique originelle des mariages interdynastiques. Les princesses concernées étaient alors
amenées à quitter l’espace ottoman pour intégrer une cour étrangère. Ce faisant, elles
ou maisons souveraines) qui pousse à édicter une loi écrite. Cf. Viennot, La France, les femmes et le pouvoir. L’invention de la loi salique : 295-345. 31
Vatin et Veinstein, Le Sérail ébranlé : 149-170 ; Akman, Kardeş Katli ; Abdülkadir Özcan, « Fatih’in teşkilât kanunnâmesi ve nizam-ı alem için kardeş katli meselesi », İÜEF Tarih Dergisi 33 (1980-81) : 7-56 ; Vatin, « Loi ou fatalité ? ». 32
Pour un bon résumé discuté des différentes thèses, lire notamment Kafadar, Between Two World ; voir également, sur le sujet, Lowry, the Early Ottoman State ; Gibbons, The Foundation of the Ottoman Empire ; Imber, « Paul Wittek’s ‘De la défaite d’Ankara » et The Ottoman Empire 1300-1481 ; İnalcık, « the Emergence of the Ottoman State » ; Ronald C. Jennings, « Some Thoughts on the Gazi Thesis », Wiener Zeitschrift für die Kunde Des Morgenlandes 76 (1986) : 151-161 ; Köprülü, Les Origines de l’Empire ottoman ; Wittek, « De la défaite d’Ankara à la prise de Constantinople » et The Rise of the Ottoman Empire ; Elizabeth A. Zachariadou (éd.), The Ottoman Emirate (1300-1389), Rethymnon, Crete University Press, 1993. 33
Il existe une littérature étendue sur le sujet parmi laquelle Bahriye Üçok, İslâm Devletlerinde Türk Nâibeler ve Kadın Hükümdarlar, Istanbul, Bilge Kültür Sanat, 2011 ; Peter Jackson, « Sultan Radiyya bint Iltutmish », dans Women in the Medieval Islamic World, R. G. Hambly Gavin (éd.), New York, St Martin’s Press, 1998 : 181-198; Rekha Misra, Women in Moghul India, 1526-1748 AD, Delhi, Munshiram Manoharlal, 1967 ; Ruth Roded, Women in Islamic Biographical Collections: From Ibn Sa’d to Who’s Who, Boulder, co. / Londres, Lynne Rienner Publishers, 1994 ; Priscilla P. Soucek, « Timurid Women : À Cultural Perspective », dans Women in the Medieval Islamic World, Hambly Gavin R. G. (éd.), New York, St Martin’s Press, 1998 : 199-226 ; Maria Szuppe, « La participation des femmes de la famille royale à l’exercice du pouvoir en Iran safavide au XVIe siècle. I : L’importance politique et sociale de la parenté matrilinéaire », Studia Iranica I/23 (1994) : 211-258 ; du même auteur, « La participation des femmes de la famille royale à l’exercice du pouvoir en Iran safavide au XVIe siècle. II : L’entourage des princesses et leurs activités politiques », Studia Iranica II/24 (1995) : 1-58 ; et encore, « The ‘Jewels of Wonder’: Learned Ladies and Princess Politicians in the Provinces of Early Safavid Iran », dans Women in the Medieval Islamic World, Hambly Gavin R. G. (éd.), New York, St Martin’s Press, 1998 : 325-348.
Page | 276
pouvaient, dans certains cas, exercer un rôle politique et même la souveraineté, mais en tant
que souveraines d’une principauté étrangère, jamais en tant qu’ottomanes34
. Or, au même
moment, le développement de l’usage du concubinage et la pratique des sultans de n’avoir de
descendance qu’avec leurs concubines esclaves35
favorisait l’exclusion des femmes de la
souveraineté : des princesses étrangères, notamment des musulmanes36
, auraient peut-être pu
prétendre à un exercice quelconque de la souveraineté, mais des esclaves qui ne devaient leur
élévation qu’à leur intimité avec le souverain en étaient exclues. Ces deux données permirent
à la dynastie de se prémunir contre toute prétention de ses femmes à l’exercice de la
souveraineté. La reproduction d’une coutume valant force de loi, chez les Ottomans comme
dans bien d’autres sociétés37
, il n’est pas surprenant que lorsque les princesses cessèrent d’être
mariées à l’étranger et que le rôle des concubines et reines mères prit une ampleur sans
précédent, la coutume était déjà solidement installée : les princesses avaient perdu la bataille
du droit à l’exercice de la souveraineté.
3. L’exclusion de la transmission de la souveraineté
L’application de la loi du fratricide est un moyen assez sûr de juger des détenteurs de
la souveraineté au sein de la dynastie. Continuons donc d’en voir l’application non plus au
niveau des descendants directs (fils et filles de sultans), mais de leurs propres enfants, afin
d’évaluer la capacité des premiers à transmettre la souveraineté aux seconds. L’inaptitude des
sultanes à exercer la souveraineté ne présuppose en rien une incapacité à la transmettre à leurs
propres descendants, mâles notamment38
.
Distinguons la descendance indirecte en lignée masculine de celle par les femmes.
Lorsque Selim Ier se résolut à appliquer le fratricide, il ne se contenta pas de faire exécuter
ses frères, mais aussi leurs fils. De même, lorsque le prince Bayezid s’enfuît en Iran, il laissa
derrière lui ses filles, mais ses fils l’accompagnèrent : ceux-ci n’échappèrent pas plus que lui à
34
Sur ce point, il est possible d’établir un parallèle avec la situation française, si particulière du fait de la mise en place de la célèbre loi salique, qui ordonnait l’exclusion des femmes de la souveraineté française, mais qui leur laissait tout loisir de devenir souveraines étrangères, en Espagne, en Italie, ou n’importe où en Europe, tant que c’était hors des territoires de la couronne française. Sur la question de la naissance de la loi salique et du débat qu’elle fit naître, voir notamment Viennot, La France, les femmes et le pouvoir. L’invention de la loi salique : 295-391. 35
Peirce, The Imperial Harem : 32-39. 36
Rappelons que jusqu’à la moitié du XVe siècle, les sultans et princes ottomans épousaient des princesses
musulmanes issues des dynasties anatoliennes voisines. Peirce a proposé l’hypothèse selon laquelle ces épouses se seraient vues imposer un contrôle des naissances leur interdisant toute progéniture afin d’éviter toute ingérence politique de leur part ou de la part de leur famille d’origine. Cf. Peirce, The Imperial Harem : 39-42. 37
Sur cette question, consulter notamment l’ouvrage d’Éric J. Hosbawm et Terence O. Ranger, L’invention de la tradition, Paris, Éditions Amsterdam, 2012. 38
C’est en tout cas la situation des princesses en Europe et notamment en France qui, même incapables de réclamer la souveraineté pour elles-mêmes, n’en transmettaient pas moins les droits à leurs descendants, mâles notamment.
Page | 277
la peine capitale réclamée par Süleyman Ier au chah d’Iran39
. Les filles, quant à elles, ne
subirent aucune atteinte – et c’est bien la raison pour laquelle Bayezid les laissa derrière lui :
l’une d’elles épousa même un des vizirs du sultan40
. Elle répétait ainsi l’exemple d’une de ses
aïeules, la fille de Cem, rival vaincu de Bayezid II qui avait dû fuir les territoires ottomans
pour préserver sa vie : elle ne connut aucune des pressions faites à l’encontre des hommes de
sa famille, mena une vie normale et fut mariée à un dignitaire ottoman, à l’égal des autres
princesses41
. Et si l’on descendait d’un degré de plus dans la descendance, au niveau cette fois
des arrières petits-enfants, on constaterait la reproduction de cette logique : les filles des
princes que nous venons d’évoquer furent mariées et eurent des enfants des deux sexes, sans
que cela ne pose le moindre souci aux souverains régnants, à l’inverse des fils de prince, qui
savaient la vie de leurs fils (mais uniquement de leurs fils) menacée en cas d’échec du père à
s’emparer du trône.
Du côté de la descendance indirecte en lignée féminine, la situation est bien plus
claire : la menace n’existe tout simplement pas. Les enfants, petits-enfants et ainsi de suite,
hommes comme femmes, n’ont aucune menace mortelle à redouter. Quel que soit le sultan
installé sur le trône, tous conserveront leur état (et leur vie). C’est que celui-ci n’est ni
négociable ni altérable : une sultane est sultane de sa naissance à sa mort. Sa position peut
certes évoluer (par exemple de fille à sœur, puis à tante, ou de petite-fille à fille), mais il ne
s’agit jamais que d’une redistribution de position au sein de la famille qui n’entache point leur
essence royale. En stricte application du principe patrilinéaire, les descendant(e)s des filles de
sultan ne sont pas détentrices de la souveraineté et, à ce titre, ne bénéficient d’aucun droit sur
le trône. Les filles de sultan ne sont pas seulement incapables d’exercer la souveraineté en
propre, elles sont aussi dans l’impossibilité de la transmettre. Elles sont des réceptacles fermés
d’une souveraineté dont elles ne peuvent faire usage, hormis s’en prévaloir comme d’une
gloire dénuée de contenu.
Une contradiction se fait jour néanmoins. Nous avons montré auparavant que les
descendants des sultans, leurs filles notamment, conservaient une place officielle au sein de la
dynastie. Or, cela est incompatible avec le principe susdit d’une incapacité, en théorie totale,
des filles de sultan à transmettre la souveraineté : il y a là un problème à résoudre. De fait, dès
l’époque de Mehmed II, on note l’existence d’une suspicion à l’égard des descendants mâles
issus des princesses de sang, que révèle sans ambages l’article suivant de son code de loi :
39
Sur la pratique du fratricide, voir Vatin et Veinstein, Le Sérail ébranlé : 149-182 ; Vatin, « Loi ou fatalité ? » ; Özcan, « kardeş katli meselesi » ; İnalcık, « The Ottoman Succession » ; Eroğlu, Şehzadelik Kurumu : 193-218 ; sur le cas particulier des fils de Süleyman Ier, voir Turan, Taht Kavgaları : 23-54 et 159-210. 40
Sur le conflit entre les deux fils de Süleyman Ier, Bayezid et Selim (futur Selim II), lire notamment Turan, Taht Kavgaları. 41
Sur Cem Sultan et les suites de sa fuite hors des territoires ottomans, voir notamment Nicolas Vatin, Sultan Djem. Un prince ottoman dans l'Europe du XVe siècle d'après deux sources contemporaines : Vâkı'ât-ı Sultân Cem, Œuvres de Guillaume Caoursin, Ankara, Société Turque d'Histoire, 1997; Münevver O. Meriç, Sultan Cem. Hayatı, Esareti, Edebî Kişiliği, Eserleri, Şiirleri, Ankara, PYS Vakıf Sistem Matbaa, 2006 (notamment p. 297-310 à propos de sa fille, Gevherimülûk Sultane).
Page | 278
« On ne donnera pas de charge de gouverneur de province [beğlerbeğilik] à mes
descendants nés de mes filles ; mais qu’on leur confie des sancak importants. »42
Il n’est pas besoin d’être devin pour comprendre que le souci de préservation de la stabilité du
trône a commandé à l’édiction de cet article, destiné à exclure les descendants (indirects) en
lignée féminine de toute fonction trop importante au sein de la structure étatique ottomane.
Le principe de non-détention de la souveraineté à beau s’appliquer à leur endroit, un
doute demeure quant à leur capacité subversive. Ce doute est d’ailleurs clairement exprimé
par d’autres. Ainsi Ottoviano Bon indique :
« Un pacha ayant épousé une sœur ou une fille du Roi et ayant eu des fils d’elle,
ces fils ne peuvent s’élever au-delà du rang de sancakbey ou de kapıcıbaşı, ils
seront maintenus en deçà jusqu’à la fin, en tant qu’alliés de la couronne ; de sorte
que, gardés en telles médiocres places, il ne puissent pas se rebeller. Mais leurs
frères, que leur père aurait eu d’esclaves, peuvent devenir des pachas ; car ils sont
hors de tout soupçon, dans la mesure où ils ne sont pas de sang royal. Ainsi en
est-il, que ces enfants, qui ont des Sultanes pour mère, se retrouvent si souvent à
des positions inférieures aux autres. En effet, pour les raisons susdites, celui-ci,
qui est né d’une esclave, est supérieur à celui-là, qui est né d’une Sultane : mais il
en va autrement des enfants des autres sujets ; car ils sont tous égaux. »43
D’autres alléguèrent, pour des motifs similaires, que les fils des sultanes étaient tués à leur
naissance :
« Cette précaution n’est pas la seule qu’ait dictée la politique ombrageuse du
sérail. Une règle barbare condamne à la mort, dès leur naissance, les enfants
mâles des princesses : on ne leur noue pas le cordon ombilical. Cette mesure
établie depuis le règne d’Ahmed I, concourt, avec celle qui ordonne la réclusion des
fils des Sultans, à préserver l’Empire des troubles civils que les entreprises de
l’ambition et de la rivalité des princes du sang ont constamment fait naître dans
les États d’Asie, et l’on peut dire que c’est à ces dispositions rigoureuses et cruelles
que la maison ottomane doit sa stabilité. »44
De toute évidence, ces sultanzade n’étaient pas tués à leur naissance, mais leur lien avec la
dynastie, bien qu’indirect et exclu de toute prétention à l’exercice de la souveraineté, les
rendait suspects aux yeux des souverains ottomans.
La loi du code de loi de Mehmed II est claire sur les possibilités de carrière des
sultanzade dans l’administration impériale et le propos d’Ottoviano Bon lui donne une réalité
jusque vers la fin du XVIe siècle, mais cet écho est alors déjà partiellement erroné. En effet,
contrairement à ce qui fut prescrit, dès la seconde moitié du XVIe siècle
45, les sultanzade
42
« Ve kızlarım evlâdından olanlara beğlerbeğilik verilmeyüb, ağır sancaklar verilsün » : Akgündüz, Osmanlı hukukuna giriş : 329. 43
Bon, The Sultan’s Seraglio : 118. 44
D’Ohsson, Tableau général de l’empire othoman : 196. 45
Nous ne savons pas jusqu’à quel point cette prescription était vraiment respectée au XVe siècle. Les premiers
exemples connus du genre remontent à cette période, mais rien ne dit qu’il n’y ait pas eu d’autres cas auparavant, que nos sources n’indiquent pas.
Page | 279
infiltrèrent l’administration impériale à des degrés plus élevés que les limites prescrites par
l’article suscité, en tout cas pour certains d’entre eux – nous reviendrons sur ce point plus loin
dans le chapitre. Deux phénomènes semblent donc s’opérer au cours de la période étudiée.
D’une part, le doute à l’égard de la fidélité des sultanzade semble s’être amenuisé au cours du
temps, de sorte que ceux-ci purent entreprendre de brillantes carrières : l’interdiction, si elle
ne fut peut-être pas abolie, semble être tombée en désuétude46
. D’autre part, on repère
également, quand bien même ce serait à petite échelle, des stratégies de pénétration de l’État
par des membres issus de familles de la plus haute élite ottomane, l’élite princière – nous
reviendrons également sur cette question par la suite.
La structure du champ politique ottoman qui s’offre à la connaissance des princesses
dès leur naissance est ainsi organisée selon un idéal de promotion par le mérite, tempéré et
complété dans la pratique par l’existence du clientélisme, dans un système où l’État, en la
personne du souverain, se pose en dispensateur des principaux moyens d’accès et d’exercice
d’un pouvoir. Deux voies sont praticables à qui entend exercer une autorité politique :
l’obtention d’un office, soit l’insertion au sein de l’organe étatique, d’où dérivent les
principaux honneurs et les positions les plus puissantes, et l’influence indirecte par le jeu du
réseau de clientèle. La coutume exclut les princesses ottomanes, en tant que femmes, de
l’exercice de toute forme de souveraineté qui s’inscrirait dans le cadre d’une place
institutionnalisée (en tout cas, au sein de l’espace ottoman) et va même jusqu’à leur dénier la
capacité à transmettre la moindre parcelle de cette souveraineté à leurs descendants. La seule
voie possible pour la pratique d’un pouvoir par ces femmes passe par l’exercice d’une
influence indirecte par le biais des factions. La restriction est de taille, mais il faut se garder
d’y voir la marque d’un rôle inférieur ou même inconséquent. L’obtention et le maintien aux
postes les plus en vue du gouvernement central se font et se défont au gré des rivalités entre
les factions. Et au jeu des réseaux de clientèle, les princesses disposent d’atouts très concrets à
faire valoir, en leurs connexions familiales et domestiques. Il nous reste à déterminer l’usage
qu’elles en firent.
2. Les ressorts familiaux d’une action politique des princesses
Contrairement aux agents du pouvoir qui structurent le champ politique ottoman, les
princesses ottomanes ne bénéficient d’aucune auctoritas, d'aucune potestas inscrites dans un
cadre institutionnalisé : elles ne sont pas détentrices d’un office qui définirait un domaine
d’activité, des privilèges, des devoirs ; elles ne disposent d’aucune parcelle de souveraineté au
nom de laquelle agir ou légitimer une intervention d’ordre politique ; elles ne participent
même pas à la transmission de la souveraineté. Autant de restrictions qui semblent anéantir
toute possibilité d’action politique de leur part – à moins d’envisager un accaparement sinon
illégal, du moins illégitime, du pouvoir. Or, les chroniques mentionnent, sans s’en émouvoir,
46
Les cas demeurent cependant rares pour la période étudiée ici, ce qui souligne un phénomène d’exceptionnalité plus qu’un cas régulier.
Page | 280
des cas d’actions politiques de la part de certaines princesses. Il faut alors convenir de
l’existence en parallèle d’autres rapports de pouvoir. Ces rapports sont d’une tout autre nature,
car ils ne dérivent pas d’un cadre institutionnalisé : ce sont des rapports de l’ordre de la
proximité, de l’intime. Et c’est bien grâce à ces rapports de proximité (avec la personne du
souverain, avec les agents de l’État) que les princesses disposent d’une capacité d’action que
d’aucuns définiront comme une influence politique. Elle s’inscrit néanmoins dans un cadre
précis : le cadre familial. La famille est, pour les princesses, à la fois source et enjeu de
pouvoir. Il nous faut donc voir de quelle manière et en faveur de qui les princesses faisaient
usage de leurs connexions familiales. Trois cas de figure se présentent : le soutien aux
membres de l’entourage (proche), la défense des intérêts de l’époux et le conseil au souverain.
1. Protéger ses proches : une besogne ordinaire
On imaginerait volontiers les princesses ottomanes occupées, dans leur quotidien, à
des tâches subalternes et oisives comme l’achat de bijoux, la commande de robes et autres
dépenses diverses et multiples en biens de consommation ou encore comme l’organisation de
fêtes, de réceptions féminines, de divertissements musicaux ou dansants. Outre le fait que les
enjeux de telles activités étaient loin d’être tout à fait anodins47
, ce serait une erreur de
concevoir leur ordinaire uniquement occupé à cela. Une tâche récurrente leur incombait : celle
d’assurer la protection de leurs proches. Là réside cependant le problème : il s’agissait d’une
activité ordinaire, banale en quelque sorte, attendue en tous les cas, et à ce titre, qui ne
justifiait pas d’être mentionnée dans les chroniques de règne. De sorte que ces événements et
leur modalité de réalisation n’apparaissent que rarement : on en trouve trace chez Selânikî,
parce que ce chroniqueur a la particularité de bien connaître le milieu de la cour ottomane – il
fut l’un des rares, en tout cas l’un des premiers, à mentionner certains événements du
quotidien de la cour que d’autres estimaient, selon toute vraisemblance, indignes de figurer
dans les récits de règne ; on en trouve également des marques chez tous ceux qui ne font pas,
justement, de telles histoires : les voyageurs occidentaux ou les ambassadeurs, que ces
informations intéressent au plus haut point, parce qu’elles leur permettent de comprendre les
rouages du système, la cuisine interne du pouvoir, et de connaître les personnalités puissantes
(et leurs appuis), enfin chez Evliya Çelebi, dont le récit atypique inclut des informations
précieuses sur des personnalités qu’il connaissait, des événements qu’il vécut.
De telles sources sont datées : elles ne commencent qu’à partir du XVIe siècle (et c’est
en vain, probablement, qu’on chercherait à trouver des attestations antérieures) ; encore
celles-ci sont-elles généralement fragmentaires ou elliptiques. Ainsi l’annotation de Selânikî,
qui raconte de quelle manière le gendre de Mihrimah Sultane fut rétabli dans son rang de
vizir, est-elle brève :
47
Outre le travail de Norbert Elias sur le rôle de l’étiquette à la cour versaillaise de Louis XIV (Elias, La société de cour), citons également Leferme-Falguières, Les courtisans ; Apostolides, Le roi-machine ; Gruber, Les grandes fêtes et leur décor ; Hours, Louis XV et sa Cour ; Marie-Christine Moine, Les fêtes à la cour du Roi Soleil, Paris, Sorlot et Lanore, 1984.
Page | 281
« Plus tard, sous le règne de Sultan Selim Han, Son Excellence Ahmed Pacha fut
démis de sa fonction de vizir pour une période de 25 jours. Bien qu’on lui eût
attribué une pension [de retraite] de 3 000 aspres, Sa Majesté Mihrimah Sultane
intercéda [en sa faveur] : réinstallé au rang de vizir, Ahmed Pacha reçut l’ordre de
se présenter à Son Excellence Piyale Pacha et de s’asseoir en contrebas de ce
dernier. Ceci eut lieu en 997 [novembre 1588-octobre 1589]. »48
Le baile vénitien Paolo Contarini n’est pas beaucoup plus loquace lorsqu’il rapporte, en 1583,
l’influence des princesses sur le choix des nominations aux postes les plus importants.
L’Empire, prétend-il, « est largement gouverné par les sultanes », les vizirs n’étant rien
d’autre que « des exécuteurs » des « ordres émanant du harem plutôt que de conseillers
indépendants » ; il ajoute encore que « les postes les plus importants sont attribués à ceux qui
sont en bonnes grâces auprès de ces femmes », de sorte que, pour conserver leur place, ils
n’ont d’autre solution que « chercher à plaire aux sultanes sans jamais s’opposer à aucune de
leurs requêtes » et « leur présenter des cadeaux pour obtenir leurs faveurs »49
.
Les moyens dont disposent les princesses pour agir en faveur de leurs proches sont
cependant explicités de telle manière qu’on perçoit toute la mesure de leur évidence :
Mihrimah Sultane se rend auprès du sultan, son frère – avec lequel elle entretient des rapports
tendus – pour obtenir la réinstallation de son gendre au sein du Conseil. On ignore la
conversation qui s’ensuivit, mais malgré l’animosité dont le sultan gratifiait sa sœur, celle-ci
n’eut pas grande peine à obtenir gain de cause50
. Pour le moins, on chercherait en vain une
quelconque surprise exprimée sous la plume de Selânikî : elle ne fait qu’agir dans un cadre
traditionnel, attendu, et il faut croire que cela suffit à convaincre le monarque. Contarini paraît
plus surpris de l’influence des sultanes ; mais les moyens qu’il indique pour les dignitaires
désireux d’obtenir ou de conserver une place n’a, en revanche, rien de surprenant – et il ne
s’attarde d’ailleurs pas dessus : ils consistent à contenter ces dames en leur offrant de
somptueux cadeaux et en accédant à leurs demandes. En d’autres termes, il s’agit de se les
acheter, tant de façon pécuniaire qu’en les enchaînant dans une complexe combinaison de
dépendances : devenues redevables, elles seraient plus enclines à agir avec bienveillance. Et
les exemples abondent, que nous ne citerons pas tous, certains étant traités ailleurs. Ainsi
Gerlach mentionne-t-il la libération d’un prisonnier grâce à l’intervention de Mihrimah
Sultane, dont la bienveillance avait été acquise moyennant l’achat d’une horloge évaluée à
200 ducats51
; c’est encore auprès des princesses Mihrimah et Ismihan que les Juifs se
48
Selânikî, Târîh-i Selânikî : t. 1 p. 186. 49
Cité par Necipoğlu, The Age of Sinan : 281. Hammer ne dit pas différemment lorsqu’il écrit : « Les princesses du sang, qui, par leur influence, élevèrent leurs maris et leurs favoris aux plus hautes fonctions de l’empire, et surent, ou les y maintenir, ou, en cas de déposition, sauver leur vie et leurs biens, étaient alors, […] les trois filles de Selim, sœurs de Mourad, savoir la veuve de Sokolli, la veuve de Pialé et la femme du grand vizir Siawousch ; ensuite la vieille sultane Mihrimah, fille de Süleyman le Grand, veuve de Rüstem Pacha et belle-mère du grand vizir Ahmed Pacha, qui lui avait donné deux petites-filles. » Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 7 p. 73. 50
On notera néanmoins que Selânikî a soin de préciser que ce dernier reçut, en même temps que la restitution de sa place, l’ordre de s’asseoir en contrebas de Piyale Pacha. C’est donc bien d’une querelle de préséance dont il est question ici, entre un gendre princier et un gendre royal (Piyale Pacha est l’époux d’une fille de Selim II) qui tous deux font appel au soutien du royal parent. N’en déplaise à Mihrimah Sultane, il fallut bien accepter que son gendre cède le pas devant celui de son frère, le sultan. 51
Gerlach, Türkiye Günlüğü : t. 2 p. 592.
Page | 282
tournent lorsqu’ils sentent leur position menacée, offrant, pour se ménager leur bienveillance,
plusieurs milliers de ducats52
. Et lorsque l’envoyé du vice-roi de Naples arrive à Istanbul pour
traiter de la paix avec l’Espagne, en 1625, il s’efforce de s’accommoder, à coup de présents et
de promesses, la faveur des sœurs du sultan, espérant par là s’assurer leur soutien et celui de
leurs époux respectifs53
.
N’insistons pas dans l’énumération de fragments attestant, de façon aussi lapidaire les
uns que les autres, des pratiques similaires aux périodes ultérieures. Un autre texte mérite
qu’on s’y arrête, en raison de l’exceptionnalité des informations qu’il recèle, et que nous
devons à Evliya Çelebi. Il met aux prises Melek Ahmed Pacha, confronté aux attaques
menées à son encontre par le grand vizir de l’époque, Siyavuş Pacha, en 1651. Melek Ahmed
Pacha est alors en poste en province et n’a pas la capacité de venir au secours de ses serviteurs
visés par l’attaque : il s’en remet à son épouse, Kaya Ismihan Sultane, fille de Murad IV – une
bonne indication de la bipolarité de la faction et de la collusion des maisons et des serviteurs
attachés respectivement à chacun.
« Pendant que nous profitions des plaisirs de Rusçuk, un valet en chef du nom de
Bayram Aga, accompagné de quarante chambellans, apporta au pacha un noble
rescrit émanant du Siège de la Félicité et qui réclamait l’envoi, sous chaînes, de
Kudde Kethüda à la Porte. Se conformant au commandement impérial, Melek
Ahmed Pacha confina Kudde dans la citadelle de Rusçuk et rédigea immédiatement
des lettres qu’il me confia en disant : « Prépare-toi, mon Evliya, tu vas te rendre
auprès de ma Kaya Sultane ». M’étant pourvu de cent pièces d’or pour les frais de
voyage, je pris aussitôt les lettres et, sans nouvelle des autres mondes, à proximité
de la ville, j’enfourchais mes chevaux. De Rusçuk, je partis en direction du sud et
parvins à la citadelle de Piravadi en une nuit, puis en un jour à la ville de Kırkkenîse,
puis je rejoignis Kaya Sultane [qui se trouvait] à Topçular. Elle me fit aussitôt venir
au harem et me questionna, dissimulée derrière le grillage. Je lui fis le récit en détail
de la traversée de la Valachie du pacha, des cadeaux qu’il avait reçu, de la justice
qu’il y avait restaurée, enfin de la manière dont Kudde Kethüda avait été placé
enchaîné dans la citadelle de Rusçuk par l’intervention du valet en chef et barbier en
chef, Bayram Aga. Après avoir écouté mon récit, plutôt que de se mettre à pleurer,
Kaya Sultane libéra ses cheveux, s’engouffra dans une rage royale et se transforma
presque en sorcière. « Je jure devant Dieu, Evliya Çelebi, que même si je dois
dépenser 2 000 bourses au profit de l’intendant du pacha, ce qui est fort possible, je
ne l’abandonnerai pas aux griffes de Siyavuş ! » Elle monta dans son carrosse et s’en
alla directement chez l’épouse de Siyavuş, la Hanım Sultane, fille de Receb Pacha.
« Dépêche-toi ! Appelle ton époux ! », dit-elle. Siyavuş Pacha entra dans le harem et
lui souhaita la bienvenue. « Toi, Siyavuş , le tyran ! » cria-t-elle, « Tu as assassiné
ma grand-mère [Kösem Sultane], la mère de ton Seigneur Murad ! Tu as volé toutes
les positions élevées que mon époux avait acquises ! Tu es finalement parvenu à
52
Gerlach, Türkiye Günlüğü : t. 2 p. 623. 53
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 9 p. 63.
Page | 283
prendre le sceau [du grand vizirat] et maintenant, tu veux emprisonner son
intendant et le tuer ! N’êtes-vous pas, toi et mon mari, des parents ? N’étais-tu pas
le valet de mon père, le Sultan Murad – que Dieu accorde le repos à son âme ! –
quand il était porteur du sabre ? Ne vous êtes-vous pas mutuellement souhaité
d’attendre les quarante et cinquante ans ? Libère l’intendant de mon pacha ou, sur
l’âme de mon grand-père [Ahmed Ier], je te maudirai et tu ne tireras aucun plaisir
de ce sceau ! » Devant cette explosion de rage, Siyavuş répondit : « Ma Sultane, ton
pacha doit au souverain 1000 bourses. Elles furent prises par la main de Kudde
Kethüda. Qu’il vienne s’en acquitter et il pourra retourner auprès de son pacha ».
« Mon pacha a déposé 3000 bourses au Trésor de la porte du milieu en cadeaux de
service. Il a payé la dette et s’est même acquitté d’un montant supplémentaire de
1000 bourses. Contrôle le registre impérial ! Si mon pacha doit quoi que ce soit au
Trésor impérial, je m’en acquitterai. Qu’as-tu à faire avec l’intendant de mon
pacha ? » Toujours en colère, elle sortit et se rendit auprès de la Reine mère puis de
l’auguste souverain lui-même, puis du chef des eunuques noirs, Div Süleyman Aga,
qui avait assassiné l’ancienne Reine mère. Elle poursuivit encore sa tournée en se
rendant dans quelques autres places avant de s’en retourner dans son palais. Trois
jours plus tard, Kudde Kethüda fut apporté par voiture, les fers aux pieds, au chef
du corps des silahdar, qui l’emprisonna et lui réclama les 1000 bourses. Cependant
que, le même jour, à l’instigation de Kaya Sultane, le monde se mit à s’effondrer sur
la tête de Siyavuş Pacha. À son arrivée au Conseil impérial, le chef des eunuques
noirs, Div Süleyman Aga, lui arracha de force son sceau, lui criant : « Donne-moi le
sceau, stupide garçon ! » et il le donna à Gürcü Mehmed Pacha, qui devint grand
vizir. On envoya en exil en Méditerranée, sur le caïque du bostancıbaşı, Siyâvuş
Pacha, dont on saisit les richesses et les biens qui se trouvaient dans son palais, de
sorte qu’il se retrouvât sans rien. A la suite de ça, on l’honora de la province de
Roumélie et Gürcü Mehmed Pacha libéra de prison Kudde Kethüda, qui retourna
auprès du pacha sans avoir déboursé un centime. »54
Malgré sa subjectivité très probable, Evliya Çelebi nous offre ici un tableau unique du
rôle de la princesse et de ses moyens d’action. La réaction de la sultane est particulièrement
intéressante : elle a, nous explique Evliya, une colère tout aussi royale que masculine – elle ne
verse aucune larme, ne s’apitoie pas sur son sort, celui de son époux ou de ses serviteurs – et
ne met pas longtemps à décider de la marche à suivre (elle était peut-être évidente ?). Kaya
Sultane commence par se précipiter chez le responsable, le grand vizir, qu’elle attaque
directement, verbalement, et de façon peu amène ; cependant, la menace ne semble pas avoir
grand effet. Les visites suivantes de la princesse sont particulièrement révélatrices : elle se
rend d’abord chez la reine mère, qui tient les rênes du pouvoir en tant que régente, puis chez
le sultan (encore dans un âge tendre), puis auprès du chef des eunuques noirs et d’autres
personnes qu’Evliya ne prend pas la peine de mentionner. On peut supposer qu’il s’agissait de
54
Evliyâ, Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, vol. 1 livre 3 p. 187-188 ; Dankoff (éd.), The Intimate Life of an Ottoman Statesman : 91-92. Voir en annexes D.11.
Page | 284
quelques grands dignitaires qui pouvaient être intéressés par l’affaiblissement de la puissance
du grand vizir. Autrement dit, elle se rend vers ceux qui détiennent l’exercice du pouvoir.
Ce récit nous apprend d’abord que la princesse n’a aucune difficulté pour se faire
recevoir, au pied levé, par la reine mère, par le sultan, puis par le chef des eunuques noirs.
Détail en apparence, mais qui montre tout l’intérêt d’une médiation portée par la sultane : son
accès particulièrement aisé au Palais impérial est un avantage évident, notamment en cas
d’urgence. Elle n’a pas plus de difficulté à discuter de vive voix et en direct avec les hommes
d’État : voilà qui n’est pas sans remettre en cause certaines croyances concernant la séparation
stricte des sphères masculines et féminines au sein de l’Empire. Certes, la rencontre se fait
dans l’espace clos du harem et en présence d’autrui ; il n’en demeure pas moins que le
dialogue et la rencontre frontale pouvaient bien avoir lieu. De fait, la stratégie de la princesse
se révèle bénéfique : en peu de temps, le kethüda de son époux est libéré, sans autres
considérations. Et qui se soucie que pour faire libérer un intendant et affirmer l’autorité de son
époux, le grand vizir lui-même en ait perdu sa place ? Il ne tenait qu’à lui de ne pas encourir
la colère d’une sultane – quand bien même celle-ci profita probablement de rivalités latentes
et des intérêts de certains dans le remplacement du grand vizir.
2. Épauler son mari : un impératif chronique
Plus encore que dans le cas des proches, une princesse se doit d’apporter son soutien à
son époux – quand bien même les conjoints seraient-ils en mauvais termes. Tout l’y invite :
non seulement l’usage politique, la conception du pouvoir et du réseau, mais aussi, et ce n’est
pas là un aspect des plus négligeables, son intérêt personnel. Celui-ci passe par la puissance
de l’époux – on se rappelle l’exemple des filles de Selim II qui, à peine devenues veuves,
s’étaient empressées de se choisir de nouveaux époux pour raffermir leur position affaiblie par
la disparition de leur mari, principal appui à leurs démarches politiques. On peut également
invoquer un souci de décorum : pour des femmes éduquées dans l’esprit de la supériorité de
leur statut et la certitude de leur dignité, toute atteinte au prestige familial (comme la
destitution ou l’éloignement de la capitale de l’époux, ou encore l’incapacité à lui assurer un
retour rapide à une position de qualité) était probablement perçues comme un échec
personnel, une atteinte à leur dignité. Et les princesses n’hésitèrent pas, devant l’imminence
d’un tel aveu d’impuissance, à s’investir personnellement pour contrecarrer ces situations.
Des exemples d’action princière en faveur de l’époux sont cités dès le XVe siècle,
preuve que la pratique est ancienne et profondément ancrée dans les mœurs politiques. Ainsi
une des sœurs de Murad II intervint en faveur de son époux, Mahmud Çelebi, tombé aux
mains de Jean Hünyadi, voyvode de Transylvanie, en 1443, durant ce qui fut appelé la
« longue campagne »55
:
55
Vatin, « L’ascension des Ottomans (1362-1451) » : 74-75.
Page | 285
« Les Turcs furent encore battus, et parmi les prisonniers qui tombèrent entre les
mains des croisés, on cite Kasim, le beglerbeg de Roumélie, et Mahmoud
Tschelebi, le sandjak beg de Boli, frère du grand vizir et gendre de Mourad.
Hunyade en fit massacrer cent soixante-dix, et ramena les deux begs à Ofen où il
entra en triomphe. »56
La malheureuse épouse sollicite alors l’aide de son frère pour obtenir la libération de son
époux :
« Tandis que Sultan Murad était en route pour Edirne, sa soeur, qui était la femme
de Mahmud Çelebi, vint [le voir], le visage déformé par le chagrin. Elle embrassa la
main du souverain, le supplia humblement, l’implora au sujet de l’absence de
Mahmud Çelebi. Pris de compassion, le souverain racheta Mahmud Çelebi : il
rendit Semendire aux infidèles. »57
La concession du sultan à sa sœur est de taille – et c’est la raison pour laquelle Neşrî
mentionne son intervention : pour assurer son retour, il n’hésite pas à s’acquitter d’une rançon
importante et hautement symbolique (la restitution d’une cité nouvellement conquise).
Le sultan fait certes preuve de « compassion » envers sa sœur et le chagrin qu’elle dit
éprouver – nous reviendrons sur cette thématique de l’expression du chagrin –, mais le cas est
des plus défendables : Mahmud Çelebi est non seulement le frère du grand vizir et le
descendant d’une famille très puissante et qui a fourni de nombreux serviteurs à l’État
ottoman depuis le XIVe siècle, mais aussi un combattant de la guerre sainte, tombé entre les
mains des adversaires tandis qu’il se battait vaillamment pour sa foi et son souverain.
Intercéder en sa faveur ne fut probablement pas bien difficile à justifier. Il en fut tout
autrement lors de l’affaire Ferhad Pacha. L’événement se situe durant les premières années du
règne de Süleyman Ier et son omission dans la majorité des chroniques ottomanes de l’époque
souligne le malaise de ces auteurs fasse à ce cas. Nommé gouverneur de la province du
Dulkadır, Ferhad Pacha fut incriminé d’actes d’exaction à l’égard de la population. Il fallut
l’intervention de son épouse, la sœur du sultan, Beyhan Sultane, et l’appui de celle de la reine
mère, pour obtenir du monarque le pardon de sa faute. Réinstallé dans ses fonctions, Ferhad
Pacha ne mit pas longtemps à récidiver : il fut alors exécuté, sans que les supplications de son
56
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 2 p. 147. 57
Neşrî, Cihannümâ : 293-294. Voir en annexes D.3. On notera que la version fournie par Hammer diverge par endroits de celle de Neşrî, notamment concernant la rançon acquittée pour la libération du gendre impérial : « Fatigué de faire la guerre et obsédé par les supplications de sa seconde sœur, mariée à Mahmoud Tschelebi, prisonnier des chrétiens, il résolut de terminer la querelle qui désolait le nord-ouest de son empire ; à cet effet, il restitua la Valachie au voïévode Drakul ; il rendit au despote Brankovic ses deux fils, et les forteresses de Schehrkoeï, de Krussovaz et de Semendra ; il envoya en même temps son chancelier, Grec renégat, auprès de Jean Hunyade, qu’il croyait vice-roi de Hongrie, et auquel les historiens ottomans ont donné ce titre. Le général hongrois détrompa l’ambassadeur qui s’adressait à lui pour négocier la paix, et le renvoya à la diète du royaume, assemblée à Szegedin. Vladislas attendit jusqu’à l’entrée du printemps des troupes auxiliaires, que ses alliés s’étaient engagés à lui fournir pour continuer la croisade ; mais ne les voyant pas arriver, il céda enfin aux conseils d’Hunyade et de Brankovich, qui, malgré les insinuations du pape et de l’empereur de Constantinople, le pressaient d’accepter les propositions de Mourad. La paix fut conclue et ratifiée à Szegedin, le 12 juillet 1444, pour dix ans et aux conditions suivantes : la Servie et la Herzegovine seraient restituées à leur ancien maître, George Brankovich. La Valachie serait réunie à la Hongrie ; le sultan paierait une somme de soixante-dix mille ducats pour la rançon de Mahmoud Tschelebi, son gendre. », Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 2 p. 147 (le soulignage est de notre fait).
Page | 286
épouse parviennent à émouvoir de nouveau son royal frère. La protection de la princesse ne
saurait être éternelle : elle ne marche qu’une fois ; elle offrit au gouverneur une seconde
chance, qu’il eut tort de penser immuable. Mais le conflit alla plus loin, car il est dit que la
princesse prit grief de la décision impériale et de l’exécution de son époux, au point de choisir
l’exil loin de la cour58
. On comprend le silence pudique de la majorité des chroniqueurs : il
n’y avait rien à glorifier dans cet incident qui inaugurait déjà de la sévérité du sultan
Süleyman, chaque fois que son autorité était remise en question, et dont les épisodes les plus
funestes furent les exécutions de son grand vizir, Ibrahim Pacha, puis de ses fils, Mustafa et
Bayezid.
Le soutien que Mihrimah Sultane apporte à son mari, Rüstem Pacha, a des
conséquences tout aussi funestes pour celui qui, par la force des choses, devint « l’homme à
abattre ». La mémoire collective a gardé un triste souvenir du triumvirat Hürrem Sultane
(l’épouse) – Mihrimah Sultane (la fille) – Rüstem Pacha (le gendre, grand vizir de Süleyman
Ier), qui serait, selon les récits qui en ont été faits, à l’origine de l’exécution du prince
Mustafa, très apprécié des janissaires. Mais là n’est pas l’objet de notre chapitre : seules nous
intéressent les suites de cet événement. Très vivement ressentie par l’armée, l’exécution du
prince obligea le sultan à destituer son gendre et grand vizir, Rüstem Pacha. Les opposants à
cette faction virent alors renaître leurs espoirs et crurent déceler la fin de l’ère du triumvirat
avec la nomination d’un autre genre, Kara Ahmed Pacha, époux de la sœur du sultan. Mais
deux ans étaient à peine écoulés que, à l’instigation couplée de sa femme et de sa fille, le
sultan ordonna la destitution et l’exécution brutale de son beau-frère et grand vizir. La
disparition de Kara Ahmed Pacha laissa la place libre à Rüstem Pacha, réintégré dans ses
fonctions de grand vizir – poste qu’il garde ensuite jusqu’à sa mort (naturelle)59
. Mettons de
côté le jugement des contemporains et de la postérité sur le rôle des deux femmes royales
dans cette histoire. Mihrimah Sultane et sa mère ne font qu’agir selon les cadres de l’époque :
leur rôle est de défendre les intérêts de leur faction, dont Rüstem Pacha est la tête masculine.
Mais leur réussite dans le domaine scelle aussi l’échec d’une autre princesse, Fatma Sultane,
la sœur du souverain, qui faillit à protéger son époux, Kara Ahmed Pacha, contre sa nièce et
sa belle-sœur.
Un dernier cas de figure mérite encore de figurer ici, car il illustre une situation banale,
somme toute, par ses modalités et ses finalités. Banalité qui nous intéresse au plus haut point,
car elle nous permet de cerner un cadre d’intervention médian ; mais banalité à relativiser, car
la conclusion de l’intervention princière est des plus heureuses, et il est douteux qu’il en ait
toujours été ainsi. Situons le cadre : Melek Ahmed Pacha, qui compte parmi les grands
dignitaires de l’État ottoman de la moitié du XVIIe siècle, subit l’hostilité du nouveau grand
vizir, qui fait en sorte de se débarrasser de lui en l’écartant de la capitale. Mais c’était sans
compter sur l’intervention de son épouse, la princesse Kaya Ismihan Sultane :
« Quelques jours auparavant, le vizir susdit [Ibşir Pacha] ayant constaté sa propre
faiblesse et décadence dans le domaine de ses affaires, il se débarrassa
58
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 5 p. 31, 67-68 ; Peirce, The Imperial Harem : 57, 67, 79 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 31 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 156. 59
Gerlach, Türkiye Günlüğü : t. 2 p. 729.
Page | 287
intentionnellement de ceux qui lorgnaient sur le grand vizirat ; c’est à ce moment-là
que le glorieux mari de Kaya Sultane, Melek Ahmed Pacha, passa avec
empressement à Üsküdar, [suite à sa récente promotion à la tête de] la province de
Bagdad, dont l’office était vacant avec la mort du [précédent gouverneur], un
certain Arslan Pacha. Mais la sultane s’en plaignit au souverain : “Il vient juste de
rentrer ! S’il y a une raison à son départ immédiat, qu’on m’accorde alors le
divorce !” Suite à cette déclaration, le départ de Melek Ahmed Pacha fut invalidé par
consentement impérial. De sorte que le troisième jour qui suivit, on lui apporta le
sceau de l’État, qui lui fut remis. Tandis qu’il revenait de son envoi erroné à Bagdad,
le souverain convoqua Melek Ahmed Pacha à ce sujet et lui remit le sceau de l’État,
faisant de lui son grand vizir. »60
Ainsi, grâce à l’intervention de son épouse, Melek Ahmed Pacha passe de persona non grata
à la cour, à chef du gouvernement : difficile d’en nier l’efficacité !61
L’alliance avec la famille impériale était donc une garantie considérable pour les
gendres impériaux. C’est d’autant plus flagrant que Kaya Ismihan Sultane n’est pas
l’archétype de la princesse toute-puissante, loin de là : elle illustre bien plutôt le modèle
ordinaire de la princesse ottomane, ayant peu de goût pour la politique, mais connaissant sa
qualité et ses devoirs. Cet exemple n’en est que plus précieux : si une princesse somme toute
anodine pouvait aussi aisément changer le cours des nominations au gouvernement, par
simple protestation auprès du sultan et de la reine mère, qu’attendre d’une princesse plus
investie dans la politique ! Ne doutons pas qu’une telle réussite fut facilitée, dans le cas
présent, par des appuis extérieurs qui ne nous sont pas connus : la nomination de Melek
Ahmed Pacha et/ou la destitution du précédent grand vizir servaient probablement les intérêts
de certains ; l’intervention de la princesse ne fut peut-être que le déclencheur, l’excuse bien
trouvée pour justifier ce changement de gouvernement. Il n’en demeure pas moins qu’une
princesse ottomane telle que Kaya Ismihan Sultane, qui ne montra aucune inclination
particulière pour le pouvoir, pouvait sans grande peine faire entendre sa voix et obtenir gain
de cause. La banalité d’une telle intervention souligne à quel point elle était normale, c’est-à-
dire qu’elle entrait dans les attributions et devoirs d’une princesse épouse de dignitaire, et
qu’elle était considérée comme légitime.
Nous pourrions multiplier les exemples de protection d’une princesse à l’égard de son
époux. Ils abondent, allant de l’appui pour trouver un poste à la protection tout au long de la
carrière, le pardon d’un échec jusqu’à la situation extrême : la survie. Ainsi lorsque le nouvel
époux d’Ayşe Sultane (fille de Murad III), le grand vizir Hasan Pacha, sentit sa vie menacée,
son premier réflexe fut d’aller chercher refuge et protection auprès de son épouse62
; Fatma
60
İpşirli (éd.), Tarîh-i Na’îmâ : t. 3 p. 1266. Voir en annexes D.11. 61
La protection que Kaya Ismihan Sultane dispense à son mari est encore redoutée d’un autre grand vizir, Ibşir Pacha, lorsqu’il décide d’écarter de la cour Melek Ahmed Pacha en l’envoyant prendre la tête de la province de Van : il prend soin de l’obliger à un départ immédiat, sans surtout lui laisser le temps de rentrer chez lui, de peur que sa femme ne trouve le moyen de le faire rester. Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 10 p. 182. 62
« Le grand vizir ne se dissimulant pas le danger qui le menaçait, barricada son palais, et s’enferma dans un cabinet attenant à celui de sa fiancée, la sultane veuve d’Ibrahim ; il ne pouvait aller chez elle, parce que les noces n’avaient pas encore été terminées. » : Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 8 p. 17.
Page | 288
Sultane, quant à elle, n’aurait eu de cesse de protéger la position de son époux, Halil Pacha,
tout au long de sa carrière63
; c’est encore grâce à son lien conjugal avec Ayşe Sultane, fille
d’Ahmed Ier, que l’amiral Voynuk Ahmed Pacha se fit pardonner la perte d’une de ses
galères à l’entrée du Bosphore, juste devant Dolmabahçe64
ou que Damad Hasan Pacha,
époux de la fille de Mehmed IV, Hadice Sultane, fit oublier la perte de l’île de Chios, puis
obtint le poste de gouverneur d’Azof65
, poursuivit une belle carrière jusqu’à l’obtention de la
place de grand vizir66
ou, plus sobrement, se fit dispenser du service au camp67
.
Les princesses ottomanes connaissent pourtant des revers, car elles ne sont pas les
seules à utiliser leur réseau de clientèle au bénéfice de leurs alliés et proches. La protection
qu’elles dispensent à leur mari n’est pas infaillible ni systématique, et il leur arrive d’échouer.
Ainsi, on se rappelle que la protection de Beyhan Sultane à l’égard de son époux, Ferhad
Pacha, ne fut couronnée de succès qu’une fois : à la seconde, il ne put échapper à l’exécution.
Il en fut de même de Hasan Pacha, époux d’Ayşe Sultane, qui était allé chercher refuge auprès
de sa royale femme : il n’évita pas la perte de son poste de grand vizir et les protestations des
janissaires ne firent qu’empirer les choses : des eunuques se présentèrent chez la princesse,
s’emparèrent de lui et l’étranglèrent peu après68
. Son mariage avec Ümmügülsüm Sultane,
63
« Khalil, d’abord kapitan-pascha, puis kaïmakam, ne conserva ses fonctions que grâce à sa femme, sœur du sultan. Comme amiral de la flotte, Khalil fit construire une baschtarde, ou galère impériale, à seize rangs de rame, composés chacun de huit rameurs, et, d’après le Kanoun institué par Souleïman et observé par Selim II et Mourad III, il la fit lancer à l’eau en présence du sultan. » : Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 7 p. 190. 64
« Le kapitain pascha Woïnak Ahmed, étant entré dans le port de Constantinople, par un temps orageux, perdit, devant Dolmabagdjé, une de ses galères, dont on réussit cependant à sauver l’équipage. La perte d’une galère en vue de la capitale et sous les yeux du sultan et de la sultane Walidé, était plus dangereuse pour les ministres, que celle de nombreux vaisseaux dans des mers éloignées, parce qu’il était facile, dans ce cas, de la dissimuler et de l’excuser ; d’un autre côté, le kapitan pascha, époux de la sultane Aïsché, avait moins à redouter la colère du harem que le grand vizir {Sofi Mohammed Pascha}, qui ne se tenait par aucun lien de parenté à la famille impériale. » : Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 10 p. 109. 65
« Damad Hasan Pacha, Grec né en Morée, était ce commandant de Khios qui, sous le règne de Mohammed avait été retenu prisonnier pendant quelque temps dans l’appartement du bourreau du sérail, en attendant que son sang coulât en expiation de la reddition de l’île et de la forteresse de Khios aux Vénitiens. Il n’avait dû son salut dans cette circonstance et sa nomination au gouvernement d’Azof, qu’à l’intercession de la princesse, son épouse. » : Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 13 p. 80. 66
« La place de kaïmakam était occupée par un autre Hasan, surnommé le gendre, époux de la sultane Khadidja, ancienne fiancée du grand vizir Kara Moustafa ; sa parenté avec le Sultan lui ouvrit par la suite le chemin du grand vizirat. » ; « Damad Hasan Pacha, Grec né en Morée, était ce commandant de Khios qui, sous le règne de Mohammed avait été retenu prisonnier pendant quelque temps dans l’appartement du bourreau du sérail, en attendant que son sang coulât en expiation de la reddition l’île et de la forteresse de Khios aux Vénitiens. Il n’avait dû son salut dans cette circonstance et sa nomination au gouvernement d’Azof, qu’à l’intercession de la princesse, son épouse. » : Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 13 p. 15. 67
« Le prédécesseur de Firari, le vizir Silihdar Hasan Pacha, fut fiancé vers cette époque à la fille du sultan Mohammed, veuve du favori Moustafa Pacha. Dans le but de plaire à cette dernière, Hasan Pacha fut dispensé du service au camp, mais il fut obligé de payer au trésor une somme de cent cinquante bourses. [1691] » : Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 12 p. 162. Encore que l’acquittement d’une compensation financière pourrait suffire à expliquer son exemption. 68
« Dans l’après-midi du même jour [4 octobre 1603], Hasan était occupé à écrire à la sultane Validé, lorsque le chambellan Türk Ahmed lui apporta une lettre du sultan qui lui annonçait sa destitution ; il se rendit immédiatement aux jardins de Südlidjé appartenant à la sultane son épouse. À la nouvelle de la déposition du grand vizir, les janissaires se constituèrent en révolte ouverte ; ils enfermèrent leur aga dans sa maison, et signifièrent au moufti et aux kadiaskers d’obtenir la réinstallation de Hasan dans sa dignité, les menaçant, en cas contraire, de piller et d’incendier leurs maisons. […] La révolte des janissaires fut apaisée par l’intervention
Page | 289
fille de Mehmed IV, augmenta certes l’influence d’Osman Pacha, mais elle joua aussi en sa
défaveur : un nouveau grand vizir était à peine nommé qu’il s’empressa, pour sa propre
protection, d’éloigner le gendre impérial en question à Diyarbakır69
. Même Damad Hasan
Pacha, l’époux de Hadice Sultane qui l’avait si bien protégé tout au long de sa carrière, ne put
éviter de perdre son poste de grand vizir, sur l’instigation du nouveau chef des eunuques
noirs, qui n’était autre que l’ancien premier eunuque de la reine mère !70
3. Conseiller le sultan : la marque des plus puissantes
Les devoirs politiques courants d’une princesse alternaient entre le soutien aux proches
et la défense des intérêts de son époux. Certaines princesses, plus puissantes, plus investies
dans la politique, ou plus attachées à leur royal parent, exercèrent un rôle qui excédait ces
cadres réguliers, comme conseillères du sultan. Nous savons, grâce aux travaux de Peirce,
qu’il s’agissait là d’une activité incombant traditionnellement aux mères : valide sultan dans
le cas d’un sultan, concubines ou favorites dans le cas d’un prince, car on croyait au
dévouement naturel d’une mère pour son fils. Le système une mère – un fils renforçait encore
ce principe, mais il ne laissait cependant aucune place aux princesses71
. Pourtant, les quelques
de leur nouvel aga et de leurs officiers. Dix jours après, dix eunuques se rendirent au palais de Südlidjé, arrachèrent Hasan de l’appartement de la sultane, et l’étranglèrent dans le jardin de Khanedan Aga. » : Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 8 p. 20. 69
« Quelques jours plus tard {du 7 avril 1694}, on célébra les noces de la princesse Oumm Koulsoum ou Oummi, fille de Mohammed IV, qui, trois ans auparavant, avait été fiancée au vizir Osman Pacha. […] Le premier acte que Sourmeli Ali Pacha {nommé grand vizir le 25 avril} jugea nécessaire pour se maintenir au premier poste de l’empire fut l’éloignement du kaïmakam Osman Pacha, dont le mariage avec la princesse Oummi venait d’augmenter l’influence. Un ordre du grand vizir, contresigné par le Sultan, lui enjoignit de partir en toute hâte pour Diarbekr et de prendre possession de ce gouvernement ; mais à peine était-il parti, que cette place lucrative lui fut retirée, et qu’on lui donna en échange le commandement de la Canée, poste infiniment inférieur. » : Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 12 p. 180. 70
« Il ne lui fut pas aussi facile de donner la place de kizlaraga au trésorier Mohammed ; il craignait, non sans raison, que, si elle revenait à Souleïman, le premier eunuque de la Walidé, il ne pût se maintenir longtemps dans la dignité de grand vizir. Il communiqua son projet au trésorier par l’entremise du nain Hamzaaga : mais Mohammedaga, moins ambitieux que pusillanime, en fit part à l’eunuque, celui-ci à la Walidé, et cette dernière au sultan. Ce que Hasan Pacha avait redouté arriva : le sultan éleva Souleïman à la dignité de kizlaraga. À peine ce dernier fut-il en possession de sa place, qu’il fit jouer tous les ressorts de son influence sur la Walidé pour hâter en secret la chute du grand vizir. […] Dès que le grand vizir se fut éloigné pour se rendre au palais de son épouse, la sultane Khadidjé, le grand chambellan alla le chercher pour lui redemander le sceau de l’empire. En attendant son retour, le sultan se rendit au koeuschk de Bagdad, où il voulut investir Kalaïli Ahmed du pouvoir suprême. Personne dans le sérail ni dans la ville ne soupçonnait le changement projeté. Lorsque le sultan fut entré dans le koeuschk et que l’on annonça l’approche du grand vizir, tout le monde crut voir arriver Damad Hasan Pacha, le gendre d’Ahmed, mais tous furent saisis d’étonnement, en voyant sortir de la chambre du kozbegdji et s’avancer vers le koeuschk, Kalaïli Ahmed Pacha. Le grand vizir, que sa parenté avec le sultan n’avait pu maintenir à son poste, ni protéger contre l’influence d’un eunuque, fut relégué avec son épouse la sultane Khadidjé, à Nicomédie ; toutefois le sultan lui laissa, outre les biens de la couronne que possédait sa femme, un revenu annuel de trente bourses. » : Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 13 p. 86. 71
On notera toutefois que la tâche n’est jamais totalement abandonnée aux mères : à leurs côtés se trouvent toujours des hommes. C’est le cas tout particulièrement des princes envoyés en province : Peirce, The Imperial Harem : 47-50. Il en va de même pour les sultans qui, outre le rôle évident des vizirs, disposent également des
Page | 290
exemples qui suivent – et nous ne prétendons pas à l’exhaustivité – montrent que certaines
sultanes accaparèrent ce rôle de conseillères du sultan : reste à comprendre dans quel
contexte.
Les princesses du XIVe et XV
e siècle disposaient certainement de la prestance
nécessaire à un tel exercice : les chroniques n’en font néanmoins aucune mention. Non qu’il
faille, de là, conclure qu’elles n’en firent rien – les chroniques ne disent que ce qu’elles
veulent, et l’on sait depuis longtemps que les marques d’une influence féminine sur le pouvoir
sont rarement perçues de façon positive. D’ailleurs, pour cette époque reculée, elles ne
fournissent pas beaucoup plus d’informations sur les conseillers masculins des sultans – alors
même que le jeune âge de certains d’entre eux, lors de leur montée sur le trône, laisse
entendre l’existence de conseillers et tuteurs. De façon générale, les chroniques de cette
époque n’accordent que peu d’intérêt à la structure du pouvoir et aux conflits au sein de la
cour, tant elles sont concentrées sur les actes de bravoure, actes victorieux : les guerres, les
conquêtes, les « trahisons » de voisins qui rechignent à se plier à la domination ottomane…
Le fait est que certaines princesses étaient exclues, pour des raisons géographiques, d’une
telle responsabilité : toutes celles qui furent mariées à des princes étrangers et, de ce fait,
contraintes à quitter le territoire ottoman.
Il faut attendre le XVIe siècle pour trouver la première attestation incontestable d’un
tel rôle accordé à une princesse ottomane. Il s’agit bien évidemment de la fille de Süleyman
Ier et d’Hürrem, Mihrimah Sultane. À la mort de sa mère, tout le monde s’accorde à dire
qu’elle reprit le rôle de conseillère du sultan, que cette dernière avait acquis au cours de ses
nombreuses années aux côtés de Süleyman. Or, les deux cas qui sont systématiquement cités
comme illustration de son influence sur son royal père sont de taille. Elle serait en effet
derrière la guerre contre Malte, en 1565 :
« En outre, sa fille, la pieuse Mihrimah, ne cessait, ainsi que nous l’avons déjà dit,
de lui représenter la conquête de Malte comme l’une des plus belles et des plus
saintes entreprises contre les Infidèles. »72
Pour convaincre le sultan hésitant, elle aurait même proposé d’armer, à ses frais, plus de 400
navires73
. Et lors de la dernière campagne du souverain, dite de Szigetvar, c’est encore sur ses
recommandations que Süleyman, au crépuscule de sa vie, prend la tête de l’armée :
« D’un autre côté, les représentations de sa fille Mihrimah et du cheikh Noureddin
vinrent le confirmer dans cette résolution : celui-ci lui reprochait d’avoir trop
longtemps négligé les devoirs d’un bon musulman, en s’abstenant de conduire en
personne les guerres saintes contre les Infidèles. »74
Eu égard à l’importance du rôle joué par Mihrimah Sultane dans des domaines aussi
importants que la guerre, il n’est pas surprenant que les chroniques en fassent mention. Or,
conseils tantôt d’un ancien lala, tantôt du hoca impérial, ou tout autre conseiller jugé opportun qui peuvent, parfois, prendre une place centrale dans le dispositif politique et indisposer les autres agents. Ce serait l’origine de la révolte qui entraîna la destitution de Mustafa II : Rifa’at A. Abou-el-Haj, The 1703 Rebellion and the Structure of the Ottoman Politics, Istanbul, Nederlands Historisch-Archaeologisch Instituut te Istanbul, 1984. 72
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 6 p. 103 73
Uluçay, Aşk Mektupları : 46-47. 74
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 6 p. 111.
Page | 291
dans le flot des critiques que Mihrimah Sultane encourut, ces actions n’y figurent pas.
Probablement parce que l’avis de la princesse allait dans le sens d’autres (c’est évident dans le
cas de la campagne de Szigetvar), mais aussi parce qu’elle occupe alors une fonction féminine
traditionnelle, normalement occupée par la mère, mais rendue vacante par le décès de la
valide sultan puis de la favorite (qui avaient toutes deux exercé cette fonction auparavant)75
.
Mihrimah ne fut pas la seule exception : d’autres princesses après elle eurent
également l’écoute des sultans. À commencer par ses nièces, dont l’influence politique était
considérable, et tout particulièrement celle d’Ismihan Sultane, épouse du grand vizir Sokollu
Mehmed Pacha – et il faut peut-être voir un lien de causalité entre la grande influence dont
l’aînée de Selim II bénéficia auprès de son frère, le sultan Murad III, et la position de son
époux, l’un des grands vizirs les plus puissants de l’histoire ottomane classique. Mais c’est sur
un autre exemple que nous aimerions nous arrêter, celui de la princesse Hadice Sultane, fille
de Mehmed IV. En 1703, l’État et la dynastie sont secoués par une révolte combinée des
janissaires et des oulémas ; alors que le trône et même la vie du sultan Mustafa II sont
menacés, sa sœur vint le conseiller :
« L’assemblée décida que le souverain se rendrait immédiatement à
Constantinople, précédé de l’étendard sacré, et suivi des princes et de toute sa
cour. Avant de s’embarquer, le Sultan voulut prendre encore une fois l’avis de sa
sœur, la sultane Khadidjé, qui lui conseilla de retenir auprès de lui tous ses
ministres, afin de pouvoir racheter sa vie en sacrifiant la leur, au cas où les
rebelles demanderaient une satisfaction de ce genre. »76
Conseil avisé, mais qui ne préserva pas le sultan de la destitution77
. Il faut dire que cette
princesse bénéficiait d’une forte expérience dans le domaine, ayant déjà vécu la révolte qui
entraîna la destitution de son père ; en outre, elle comptait également parmi les femmes mûres
de la dynastie, une aînée que les années avaient rendue avisée (on se rappelle le rôle essentiel
qu’elle joua dans la carrière de son époux, Damad Ibrahim Pacha). Mais son conseil reflète
aussi un réflexe : celui de sacrifier les kul pour préserver la personne royale. Cet avis, partagé
par le sultan (et qui ne surprend absolument pas les chroniqueurs), indique l’esprit qui habitait
les membres de cette dynastie ottomane : un sentiment de supériorité évident, mais qui
indique aussi une exclusion. Hadice Sultane comme Mustafa II n’étaient pas sans savoir que
ces « ministres » qu’on n’hésitait pas à sacrifier pour préserver la vie d’un membre de la
dynastie étaient, pour nombre d’entre eux, des parents par alliance : ils demeuraient
néanmoins avant tout des kul. La césure entre les membres de la famille royale et les kul alliés
apparaît ici de façon dramatique.
Un élément commun semble lier toutes ces princesses conseillères royales : si elles
n’agissent pas en commun accord avec leur mère, c’est alors après la disparition et en
remplacement de celle-ci. Il semble bien que l’absence de la reine mère, dont le rôle de
conseillère auprès du sultan était institutionnalisé depuis le XVe siècle
78, ait favorisé un report
75
Peirce, The Imperial Harem : 63-65. 76
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 14 p. 115 77
Sur cette révolte et ses causes, voir Abou-el-Haj, The 1703 Rebellion. 78
Peirce, The Imperial Harem : 42-50.
Page | 292
d’attention sur une sultane, tantôt la fille, tantôt la sœur, mais toujours l’une des plus proches
et des plus âgées des princesses. Le cercle des princesses capables d’acquérir une telle aura
est ainsi restreint aux seules filles de sultan, à l’exclusion des descendantes indirectes. La
conséquence est que seules quelques-unes parvinrent à s’affirmer et à se distinguer sur la
grande scène politique : les plus puissantes d’entre elles, c’est-à-dire généralement celles qui
bénéficièrent d’une aura particulière, du fait de leur âge, de leur renom et en raison de
l’importance de leur(s) mari(s).
Un premier profil des moyens d’une action politique des princesses est ainsi esquissé.
Elle se module dans un cadre précis, celui de la famille, à la fois objet et moyen d’intervention
des princesses. C’est en faveur de membres de leur famille, et tout particulièrement des
époux, que les princesses agissent, par l’intervention d’autres membres de leur famille. La
famille est donc à la fois objet d’attention et ressource d’action. On comprend mieux dès lors
pourquoi certaines, fortement investies dans la politique, s’empressèrent de se remarier sitôt
devenues libres : le mari était une personne-ressource de premier ordre pour les princesses.
On comprend mieux également pourquoi les pachas voyaient d’un si bon œil le fait d’épouser
une princesse, en dépit de toutes les contraintes que cela représentait : l’épouse était aussi une
personne-ressource importante pour les gendres impériaux. Voilà qui force à repenser notre
perception des factions politiques dans l’espace ottoman, en prenant en plus grande
considération le rôle des épouses. Au moins dans le cas des princesses ottomanes, c’est bien le
noyau conjugal, composé du mari (pacha) et de l’épouse (sultane), qui constitue le directorat
de la faction. La puissance de l’un dépend en bonne partie de celle de l’autre.
Le schéma d’intervention politique défini pour les sultanes dépasse en réalité le cas de
ces seules femmes. Il est reproduit selon les mêmes principes par le reste de l’élite féminine
ottomane, depuis les princesses indirectes jusqu’aux épouses et filles de pachas, de beys ou
d’oulémas. La différence se situe au niveau de la portée de ces interventions : l’action d’une
princesse a un impact sur les affaires gouvernementales de première importance, sur la
nomination des plus hauts dignitaires ; une femme d’élite n’avait pas tant de poids. Le silence
des sources à leur propos ne doit dès lors pas être compris comme le signe de leur non-
implication politique ; il répond tout simplement au régime historiographique de cette
documentation, qui ne mentionne que les événements les plus importants et les plus
choquants. L’action politique des princesses ottomanes ne constitue pas une exception, mais
un modèle exemplaire.
3. Ces femmes qui osent intervenir dans les affaires de l’État
Le cadre esquissé jusque-là se contente de poser les bornes d’une action des princesses
dans le champ politique ottoman. Exclues de toute forme de participation directe à la
souveraineté, nous avons vu que l’essentiel de leur pouvoir s’inscrit dans le contexte familial.
Leur réseau d’influence est cependant une ressource qui leur offre les moyens d’une action
dont les finalités dépassent cette fois le simple cadre familial, pour s’inscrire dans le champ
Page | 293
des affaires gouvernementales. La capacité est là, elle est connue et accessible, tolérée même
– jusqu’à un certain point. Pourtant, toutes n’en firent pas usage : c’est là une affaire tout à la
fois de conjoncture et d’individus. Voyons donc qui sont ces princesses sorties du rang qui
osèrent s’immiscer dans les affaires de l’État.
1. Des souveraines “étrangères” suspectes
Les Ottomans s’étaient peut-être prémunis contre l’éventualité d’un exercice de la
souveraineté par les femmes, mais l’exclusion prônée à leur encontre ne valait que dans un
contexte ottoman : qu’une princesse ottomane exerce la souveraineté ou une forme de
souveraineté chez leurs voisins n’était pas de leur ressort et ne les dérangeait probablement
pas. Ils avaient même fort à gagner, pour peu que la princesse usât de son influence pour
promouvoir les intérêts ottomans. Mais nous ne sommes pas sans savoir qu’une princesse
mariée dans une dynastie voisine est toujours doublement suspecte : aux yeux de sa famille et
de sa patrie d’accueil, qui voit en elle le relai des intérêts de la dynastie à laquelle elle
appartient par naissance, mais aussi aux yeux de sa famille et de sa patrie d’origine qui
considèrent qu’une fois partie, le risque qu’elle se soit acclimatée à son nouvel environnement
et “trahisse” ses origines, en somme quelle soit devenue pleinement une étrangère, était
toujours possible79
.
C’est bien dans cette situation que les princesses ottomanes mariées à l’étranger se
retrouvaient. Ceci ne les empêcha nullement d’y exercer une réelle action politique et même,
dans certains cas, la souveraineté. Car cette double suspicion ne doit pas dissimuler
l’importance du réseau détenu par la princesse en question : épouse d’un prince étranger et
généralement mère de princes de cette dynastie, elle dispose à loisir des deux identités, c’est-
à-dire la capacité de faire appel à celle dont elle aurait besoin (ou dont on aurait besoin) à un
moment donné. Il nous faut donc, exceptionnellement, quitter le domaine ottoman pour
regarder ce qui se passe chez leurs voisins, dans le cas d’une princesse mariée à un prince
anatolien. Expatriation géographique qui ne dura qu’un temps : le temps au cours duquel un
tel contexte était possible, soit du XIVe au milieu du XV
e siècle, qui sonne le glas de ces
mariages interdynastiques.
Le récit de Schiltberger, un jeune soldat allemand fait prisonnier lors de la bataille de
Nicopolis en 1396, intégré au rang des soldats de Bayezid Ier, permet se faire une idée du rôle
politique qu’une princesse ottomane mariée à l’étranger pouvait exercer80
; dans ses
79
Les princesses européennes subissaient les mêmes doutes, que les nombreuses cérémonies destinées à intégrer ces épouses dans leur nouvelle société ne parvenaient pas à éteindre. Fanny Cosandey, « Puissance maternelle et pouvoir politique : la régence des reines mères », CLIO 21 (2005) : 63-83 et, du même auteur, La reine de France ; José M. Perceval, « Epouser une princesse étrangère : les mariages espagnols », dans Femmes et pouvoir politique. Les princesses d’Europe, XV
e-XVIII
e siècle, I. Poutrin et M-K. Schaub (éds.), Rosny-sous-Bois,
Bréal, 2007 : 66-77 ; Contamine et Contamine, Reines, princesses et dames ; Benassar, Le lit, le pouvoir et la mort ; Bély, La société des princes ; Duprat, « Les princesses dans la propagande ». 80
Schiltberger, Captif des Tatars : 5-11.
Page | 294
mémoires, il relate en effet la guerre du sultan ottoman contre son beau-frère, Alaeddin
Karamanoğlu : les deux armées se rencontrèrent et le prince karamanide, défait, tomba en fin
de compte entre les mains de son adversaire, qui le fit finalement exécuter.
« Ensuite le roi [Bayezid Ier] ordonna de mettre la tête de Karaman au bout d’une
pique et de la montrer alentour pour que ceux qui étaient restés dans la ville, en
apprenant que leur chef avait été tué, se rendent d’autant plus vite. Enfin il occupa
la ville de Konya avec quelques-uns de ses hommes et se dirigea vers la capitale
Laranda. Il fit savoir aux habitants qu’il arrivait avec son armée et qu’ils devaient
se rendre à lui. Au cas où ils n’obtempéreraient point, ils y seraient contraints par
l’épée. Les habitants envoyèrent les quatre plus importants notables de la ville
pour le prier d’épargner les personnes et les biens. Ils lui firent également la
proposition suivante : même si leur maître était effectivement mort, il y avait
encore dans la ville ses deux fils et Bayezid devrait nommer l’un d’entre eux
comme gouverneur. S’il était d’accord, ils lui remettraient la ville. Bayezid promit
de les épargner, eux et leurs biens et, s’il s’emparait de la ville, de placer comme
gouverneur un des fils de Karaman ou l’un des siens. Ils se séparèrent là-dessus.
Mais quand les citadins prirent connaissance de la réponse du roi, ils ne voulurent
pas lui livrer la ville, mais dirent que même si leur chef était mort, il restait
pourtant deux fils sous lesquels ils voulaient vivre ou mourir. Ils se défendirent
cinq jours contre le roi et quand il vit leur résistance, il renforça encore le
contingent de soldats, fit apporter des arquebuses et exécuter des travaux de
retranchement.
Quand les fils de Karaman et leur mère [Nefise Melek Hatun] furent avertis de ces
préparatifs, ils firent venir auprès d’eux les meilleurs habitants de la ville et leur
dirent : « Vous voyez bien que nous ne pouvons résister à Bayezid, qui est le plus
fort. Nous serions affligés si vous deviez mourir à cause de nous, ce que nous ne
voulons pas. Aussi sommes-nous tombés d’accord avec notre mère pour nous
rendre à sa merci. » Ce langage plut beaucoup aux habitants. Aussi les fils de
Karaman réunirent-ils autour d’eux leur mère et les notables de la ville, ouvrirent
les portes et sortirent. En s’approchant de l’armée, la mère prit chacun de ses fils
par la main et s’avança vers Bayezid. Quand celui-ci vit sa sœur avec ses fils, il
sortit de sa tente et s’avança vers eux. Ils s’agenouillèrent devant lui, lui baisèrent
les pieds, lui demandèrent grâce et lui remirent les clefs de la ville. Alors le roi
ordonna aux notables de se relever. Puis il entra dans la ville et nomme un de ses
seigneurs comme gouverneur. Mais il envoya sa sœur et ses deux fils à Brousse, sa
capitale. »81
Ce texte permet de reconstituer le rôle en trois temps de la princesse ottomane, Nefise Melek
Hatun82
, fille de Murad Ier et sœur de l’actuel souverain ottoman, Bayezid Ier.
81
Schiltberger, Captif des Tatars : 41-44. 82
Atınay, Kadinlar Saltanatı : 12 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 6-7 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 52-58 ; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 31.
Page | 295
1°) Une phase d’inertie politique. Son époux est défait, il se réfugie dans Konya, mais,
de nouveau battu, il est fait prisonnier et finalement exécuté. La passivité de la princesse
pendant toute cette période tient d’abord à son éloignement spatial. Nefise n’est pas à Konya,
aux côté de son époux, mais à Larende, avec ses enfants, les princes nés de son union avec
Alaeddin Bey. L’absence de ces princes sur le champ de bataille (quand les pratiques en cours
voudraient au contraire qu’ils soient aux côtés de leur père, à la tête d’une des ailes de
l’armée)83
laisse penser qu’ils étaient trop jeunes pour participer aux combats. Or, si l’on en
croit la formulation du texte, ces princes seraient les seuls successeurs et héritiers du
souverain karamanide. L’inertie de Nefise prend alors un sens nouveau : son rôle n’est plus de
veiller sur son époux (qu’elle a déjà sauvé une première fois, ainsi qu’on le verra ensuite),
mais de tout faire pour assurer la succession de ses fils.
2°) Dans la seconde phase, la princesse reste dans l’ombre. Pourtant, on peut présumer
qu’elle fut l’instigatrice de la proposition formulée à Bayezid Ier par les notables de la ville, à
savoir une soumission de la principauté favorable à ses fils. Elle ne pouvait que se réjouir de
cette proposition qui suggérait de nommer comme gouverneur de la ville un de ses fils –
difficile d’imaginer qu’une telle proposition fut faite sans sa consultation et son accord
préalables. Soit que le sultan ottoman n’ait pas agréé cette proposition, soit que celle qu’il leur
fit ne parvint pas à satisfaire les citadins, l’échec des négociations provoqua une tentative de
résistance armée de la ville. L’attachement que la population, par la voix de ses représentants,
témoigne ici à ses princes révèle que la position de la princesse ottomane et de ses fils était
solidement établie.
3°) L’échec de l’intervention des notables et le durcissement du siège devant la ville
obligent Nefise à déployer une nouvelle stratégie. Contrainte de sortir de son silence, elle
s’implique désormais personnellement dans les négociations. C’est ainsi qu’elle convoque les
notables et pousse ses fils à déclarer qu’en bons souverains, ils se refusent à voir leurs sujets
payer pour eux et qu’ils préfèrent se rendre84
. S’ensuit alors une véritable démonstration
d’autorité royale : elle sort, escortée de tous les notables de la ville, tenant ses fils par la main.
Une attitude d’un grand courage (l’exécution d’Alaeddin en encore toute fraîche : elle a donc
toutes les raisons de craindre pour la vie de ses enfants) et d’une grande noblesse, qui force le
souverain ottoman à sortir de sa tente et à se rendre à sa rencontre. L’accueil est cependant
plus que mitigé, puisqu’il se contente de recevoir leur soumission, sans montrer d’égard
particulier envers sa sœur ni ses neveux, qu’il s’empresse d’envoyer à Bursa, sous étroite
surveillance dans son propre palais, coupés de leurs soutiens potentiels. Sa participation au
conflit est donc graduée et ce n’est qu’en dernier recours qu’elle tente un coup de force en se
mettant elle-même en scène. Pourquoi n’est-elle pas intervenue personnellement avant ? On
peut penser que cela aurait entraîné un certain discrédit : une souveraine, régente par le décès
d’Alaeddin et la jeunesse de ses fils héritiers, ne s’abaisse qu’en dernier lieu à supplier son
ennemi – quand bien même ce serait son frère. Ses tentatives pour aboutir à un compromis
83
Inalcık, « The Ottoman Succession » : 54-55. 84
Si l’on admet, comme le récit le laisse entendre, que les enfants sont en bas âge et que Nefise agit en position de régente, il faut alors envisager très fortement l’hypothèse que c’est elle qui se trouve à l’origine des déclarations des princes devant leurs notables.
Page | 296
honorable ayant échouées, il devenait urgent de s’inquiéter de la survie, tout court, de ses fils.
Sa sortie majestueuse permit d’épargner leur vie, sans plus de succès.
Cet exemple, un des rares cas documentés, montre qu’une princesse ottomane pouvait
exercer des prérogatives souveraines au sein du royaume de son époux, en tant que mère de
princes, d’héritiers potentiels. Ceci suppose une perte d’identité ottomane au profit de celle de
la nouvelle dynastie dans laquelle elle était reçue. Le récit de Schiltberger s’en fait l’écho de
façon bien involontaire : ce n’est qu’à la fin, presque par hasard, qu’il précise que la mère des
princes karamanides n’était autre que la sœur de Bayezid Ier. Quant à ses enfants, ils sont
systématiquement définis comme des princes karamanides : leur parenté biologique avec la
dynastie ottomane est totalement passée sous silence. Et c’est d’ailleurs bien la défense des
intérêts karamanides, et non ottomans, que la princesse recherche, sans réel succès.
Néanmoins, l’action de cette princesse ne s’écarte finalement pas du cadre traditionnel : c’est
en tant que mère qu’elle agit, c’est la défense des intérêts de ses enfants à la succession de
leur père qui l’occupe. C’est donc bien grâce et en faveur du cadre familial qu’elle exerce une
action souveraine. Régentes ou mère protectrices : l’activité politique des princesses
ottomanes hors de l’État paternel ne transgresse pas les pratiques politiques féminines
courantes.
2. Des grandes diplomates évincées
Aux XIVe et XV
e siècles, les princesses ottomanes endossaient régulièrement le rôle
de grande diplomate, mais celui-ci disparaît de leur répertoire d’activités politiques dans le
courant du XVIe siècle. Cette évolution soulève quelques questions : pourquoi, dans les
périodes les plus reculées, purent-elles jouer un tel rôle ? Qu’est-ce qui amena à les en exclure
– et alors, en faveur de qui se fit la passation ? Pour répondre à ces interrogations, il faut se
concentrer sur cette période qui s’étend du début du XIVe jusqu’à la moitié du XVI
e siècle.
Les chroniques fournissent quatre exemples de princesses diplomates. Le plus ancien date du
début du XVe siècle, en la personne de Nefise Melek Hatun, fille de Murad Ier et épouse du
souverain karamanide Alaeddin (dont nous venons de voir le rôle de régente de ses fils). Elle
est suivie par une des filles de Mehmed Ier, autre épouse d’un souverain karamanide, Ibrahim
Bey. Sa propre sœur, Selçuk Hatun, se distingue également dans ce domaine, bien qu’à la fin
du XVe siècle. Enfin, au milieu du XVI
e siècle, nous retrouvons la dernière figure de
princesse diplomate : la fille de Süleyman Ier, Mihrimah Sultane. Or, si les chroniqueurs se
montrent parfois hostiles quant aux moyens de persuasion employés par les princesses, leur
rôle d’intermédiaire diplomatique n’est cependant pas remis en cause, car cette activité n’est
jamais qu’une suite logique du principe d’intervention en faveur de la famille85
.
85
Les premiers temps de l’histoire ottomane constituent une période relativement obscure, sur laquelle nous manquons d’informations. Notre connaissance repose presque exclusivement sur les récits de chroniqueurs ottomans postérieurs aux événements, qu’ils rapportent avec une fiabilité douteuse. Le temps écoulé entre les événements et leur mise par écrit mis à part, les chroniqueurs brossent un tableau des règnes précédents revu
Page | 297
Intercéder entre les familles : les cas de Nefise Melek Hatun et de sa petite-
nièce
Les deux premiers exemples que nous allons voir, les plus anciens, mettent en scène
Nefise Melek Hatun puis sa petite-nièce et reflètent un premier type d’intervention
diplomatique des princesses. Point similaire aux deux femmes : elles ont toutes deux été
mariées à des souverains karamanides, qui s’opposèrent militairement au souverain ottoman,
lequel remporta finalement la victoire, obligeant le prince karamanide à proposer une
ouverture diplomatique en vue d’une résolution pacifique. Une mise en parallèle des deux
récits permettra de souligner la similitude des discours.
L’intervention diplomatique de Nefise Melek Hatun pour négocier l’arrêt des hostilités
entre son époux, Alaeddin Bey, et son père, Murad Ier est l’objet de deux paragraphes de
l’histoire de Neşrî86
:
« Histoire du siège de Konya.
Karamanoğlu ayant été mis en déroute, il s’enfuit et se réfugia dans Konya. Murad
Han arriva et fit le siège de Konya. Mais il interdit à ses troupes de faire des
dommages quelconques aux récoltes [litt. aux grains, céréales ou baies] de qui que
ce soit. Pourtant, quelques infidèles parmi les soldats de Laz s’en prirent à des
musulmans. Gazi Murad Han ordonna qu’ils soient exécutés. Au total, Murad Han
demeura 12 jours devant Konya, pendant lesquels il n’y eut aucun combat.
Karamanoğlu était sans force : il sollicita sa reddition et envoya des ambassadeurs,
qu’on daigna accepter. [Leurs propositions] ne furent pas acceptées : on congédia
les ambassadeurs.
Supplique de pardon de la part de Sultane Hatun, issue du sultan.
Cette fille de Murad Han était la femme de Karamanoğlu Alaeddin Beg. Alaeddin
Beg comprit que Sultan Murad était en grande colère, qu’il ne lui accorderait pas de
reddition, mais voulait s’emparer de sa personne. Il envoya la nouvelle à sa femme
en lui déclarant : “Si tu ne supplies pas ton père pour moi, il s’emparera de Konya et
me tuera. Prie-le, fais preuve de bonté envers moi ; rends-toi auprès du souverain,
embrasse-le, prie-le pour moi, fais en sorte qu’il me pardonne ma faute”. Sultan
Hatun se rendit auprès de Murad Han et tomba à ses pieds ; elle l’implora, le
et corrigé selon l’idéal bien-pensant ottoman. Ils produisent des histoires comprises avec les cadres de réflexion de leur époque et destinées à proclamer l’image d’un Empire ottoman idéal. Ceci n’est pas sans conséquence sur la place et le traitement appliqué au rôle politique des femmes à cette période. Enfin, la manière de traiter l’histoire et les relations avec les beylicats voisins est des plus partiales : on chercherait en vain une objectivité du récit qui n’existe pas alors dans l’écriture de l’histoire. Quand ces beylicats sont mentionnés, c’est toujours en lien avec l’histoire de l’État ottoman, c’est-à-dire en cas de conflit ou d’alliance, avec une vision ottomano-centrée qui met en valeur les sultans ottomans en prise avec leurs rivaux. 86
Cette négociation se situe donc quelques années avant le récit précédent que nous avait fait Schiltberger, à l’occasion de la lutte entre son époux et son frère, Bayezid Ier, qui avait entraîné la mort du premier et le siège de la ville où elle-même résidait avec ses fils.
Page | 298
suppliant de la sorte: “passe lui encore cette faute, ne fais pas cela”. A force de
mensonge et de dissimulation, elle obtint le pardon de sa faute. Le souverain
déclara: “qu’il vienne et se présente à moi ; qu’il embrasse ma main et s’incline
devant moi et je lui rendrai de nouveau son territoire”.
Sultan Hatun envoya un homme à Alaeddin Beg avec la nouvelle “viens demain
matin, baise la main du souverain”. Karamanoğlu écouta et s’en réjouit ; mais le
matin venant, il lui restait peu d’énergie. Le matin suivant, il sortit de Konya ; il
vint, baisa la main du souverain, se prosterna à ses pieds et lui présenta mille sortes
d’excuses. Sultan Murad Han ne resta pas sur [le souvenir] des mauvaises manières
perpétrées par ce dernier ; le souverain lui offrit de nouveau ses territoires. » 87
Presque un demi-siècle plus tard, la situation se reproduit : cette fois, c’est la fille de Mehmed
Ier, épouse d’Ibrahim Bey, qui vient intercéder auprès de son frère, Murad II :
« Sultan Murad se mit aussitôt à l’ouvrage ; il amena avec lui l’ensemble de sa
troupe de soldats infidèles engagés à son service et avança jusqu’à Konya.
Karamanoğlu s’enfuit et entra dans Taş. Alaeddin Çelebi, fils de Murad Han,
marcha sur lui avec son père, mit le feu aux pays de Karaman et attaqua Larende. Il
porta la destruction sur Konya et Larende et sur toute la principauté. Telle fut
l’oppression qu’ils subirent que jusque là nul n’en avait subi de pareille de la part
des Ottomans. Mais c’était bien Karamanoğlu Ibrahim Bey qui était responsable de
ces atrocités.
Karamanoğlu convoqua sa femme, qui était la soeur de Sultan Murad, ainsi que le
vizir Kara Server et leur déclara : “Demandez [mon pardon] à mon illustre sultan.
Par Dieu, à l’avenir, je ne ferai plus jamais rien de pareil !” Ils vinrent se présenter
devant le souverain et tombèrent à ses pieds dans une prière humble. Sa soeur lui
déclara : “Ainsi, vous venez chez moi [sur mon territoire] pour y semer une telle
destruction ; vous l’avez semée ; quel est votre problème [qui justifie] ce que vous
me faites subir ?” supplia-t-elle humblement et pleura-t-elle. [Le souverain] déclara
à Kara Server : “Te portes-tu garant qu’aucune malice ne soit faite à quiconque ?”
Kara Server répondit : “Mon fortuné sultan ! Au début, je n’étais même pas partie
prenante de cette faute, et je n’étais pas d’accord. Tout est venu des incitations des
Turkutoğlu. Quand [Karamanoğlu] lui-même a confessé sa faute, il a dit à ton kul
que je suis : “Rends-toi auprès du souverain et convaincs-le de me pardonner ma
faute”. Le souverain ne garda pas rancune de la mauvaise conduite de Karamanoğlu
; il lui pardonna sa faute et se retira [dans ses terres]. Ceci eut lieu en 846 de
l’Hégire [1451]. »88
Ces deux exemples permettent de dégager un schéma directeur. Pour commencer, la
princesse ottomane n’est sollicitée qu’en dernier recours, après l’échec des émissaires
accrédités, lorsque la situation semble désespérée. C’est donc la crainte de conséquences
dramatiques qui justifie une solution extrême : l’intervention de la princesse. Mais c’est aussi 87
Neşrî, Cihânnümâ : p. 107-108. Voir en annexes D.1. 88
Neşrî, Cihânnümâ : p. 292-293. Voir en annexes D.2.
Page | 299
la connaissance du lien familial avec le souverain ottoman qui justifie cette intervention : là
où les hommes les plus doués ont échoué, on espère que la supplique venue d’une parente
aura plus de succès. Et c’est bien parce que c’est une femme qu’on pense que la princesse
saura se faire entendre : on attend d’elle qu’elle invoque les sentiments qui l’unissent à son
mari, plutôt que des arguments politiques de diplomates patentés. Tout cela indique une
reconnaissance de la pérennité des liens de sang, par-delà même le mariage interdynastique et
l’abandon par la princesse de sa patrie d’origine. La logique causale suit donc le
développement suivant : action de dernier recours / appel aux liens du sang / exhortation à la
pitié et à la douceur encouragés par l’intervention féminine.
Si le rôle diplomatique de ces femmes n’est pas remis en cause par les chroniqueurs,
c’est parce qu’il s’inscrit toujours dans le schéma traditionnel : une femme qui intervient
auprès d’un membre de sa famille pour le supplier de pardonner la faute de son époux.
Pourtant, ce n’est pas sans une certaine perfidie qu’ils jugent les moyens de persuasion de ces
femmes. La part de critique et même de mépris que Neşri témoigne aux instruments de
persuasion employés par Nefise Melek Hatun auprès de son père est palpable : il est question
de l’usage de larmes et de pleurs89
, de suppliques et d’implorations, le tout accompagné de
mensonges. De même, la conclusion abrupte du récit qu’il fait de l’intervention de la fille de
Mehmed Ier auprès de son frère Murad II laisse imaginer qu’il n’en pensait pas moins : plutôt
que de tirer profit de sa victoire, le sultan se retire90
.
Une doyenne pour gérer des conflits internes à la dynastie : le cas de
Selçuk Hatun
L’exemple de Selçuk Hatun présente une variante par rapport aux cas précédents, car
si son action s’insère toujours dans le cadre d’un conflit entre membres de sa famille, ce n’est
plus entre un père (ou un frère) et un mari, mais entre ses deux petits-neveux, Bayezid II et
Cem Sultan. Le conflit ne dresse plus deux dynasties alliées l’une contre l’autre, mais deux
frères, deux prétendants au trône.
À la mort de Mehmed II en 1481, ses deux fils se disputèrent la succession : Bayezid
II était soutenu par les janissaires et par de nombreux hauts dignitaires, Cem par le grand
vizir, Karamani Mehmed Pacha. Le premier parvenu à la capitale, Bayezid se fit aussitôt
introniser, mais Cem, arrivé entre-temps à Bursa, se fit proclamer sultan à son tour,
s’empressant de battre monnaie et de faire réciter la hutbe en son nom : l’Empire connaissait
89
De telles pratiques existaient également dans les cours européennes médiévales : cf. Manuel Guay, « Les émotions dans les cours princières au XV
e siècle : entre manifestations publiques et secrets », Questes 16
(2009) : 39-50. 90
Et Hammer d’y voir la preuve de la grande clémence de ce souverain : « Le respect religieux de Mourad pour la vie de ses frères, sa condescendance aux prières de ses sœurs qui obtinrent de lui, l’une le pardon du prince de Kermian et la paix en Asie, l’autre le rachat de Mahmoud Tschelebi et la paix en Europe ; […] témoignent de la bonté de son cœur et d’un esprit mûri par l’expérience et la réflexion. » : Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 2 p. 148-149
Page | 300
deux souverains, situation intenable qui laissait présager l’affrontement entre les deux frères,
qui eut lieu le 14 juin 1481 à Yenişehir. La défaite de Cem l’obligea à prendre la fuite dans
l’espoir de préserver sa vie (et celle de ses fils)91
. C’est dans ce contexte de guerre civile que
Selçuk Hatun, fille de Mehmed Ier et la femme la plus âgée de la dynastie, fut sollicitée pour
intervenir. Le récit de Neşri demeure très discret sur l’intervention de cette princesse :
« En bref : On transmit la nouvelle de cet événement [Cem s’empare de Bursa et se
proclame sultan] à Sultan Bayezid. Aussitôt, il passa à Üsküdar avec les piliers de
l’Etat et marcha sur Cem. Selçuk Hatun, qui était une des sœurs de Sultan Murad
et la tante de Sultan Mehmed, sortit de Bursa avec Şükrullahoğlu Ahmed Çelebi
[Mevlana Ayaz, dans un autre manuscrit] et alla à la rencontre de Sultan Bayezid.
Quelle que soit la conversation qu’ils eurent, lorsqu’ils rentrèrent, ils firent sortir
Cem de Bursa et s’en allèrent à Yenişehir. On raconte que le défunt Fenarioğlu
Hasan Çelebi fut la raison principale à la venue de Cem à Yenişehir. »92
Le détail des discussions nous est fourni ailleurs : d’après Hoca Sadeddin Efendi,
Selçuk Hatun, accompagnée par deux éminents représentants de la communauté religieuse
(Mevlana Ayas et Şükrullahoğlu Ahmed Çelebi)93
aurait proposé un partage de l’Empire entre
les deux souverains en compétition :
« La vénérable tante paternelle du père du grand-père [de Bayezid II], qui est une
des filles légitimes de Son Altesse Sultan Çelebi, Selcuk Sultane, s’est rendue au
Seuil de la Félicité en compagnie de Mevlana Ayas et de Şükrüllahoğlu Ahmed
Çelebi, qui jouissent d’un savoir [acquis au long] d’une longue vie et de l’estime des
gens de sciences, afin de réaliser leur légation.
Après avoir présenté les louanges et prières coutumières d’une façon distinguée lors
de la cérémonie du baise-main sacré, Selçuk Hatun déclara : “Ô Mon souverain,
n’est-il pas possible que vous ne vous disposiez pas à verser le sang d’un frère dont
vous partagez l’âme et que vous n’allumiez pas la flamme de la guerre au sein de la
communauté musulmane ? Contente-toi de diriger les territoires de Roumélie et
accorde-lui la province du gouvernorat d’Anatolie. [Ainsi] personne ne pliera son
cou sous le joug de la soumission et dorénavant, personne n’ira sur la voie de
l’opposition. Le sens du proverbe “si l’on ne cultive pas bien l’arbre, on ne récoltera
que des embêtements” est évident pour la conscience intérieure resplendissante du
souverain et si deux souverains qui occupent un trône élevé partent en guerre [l’un
contre l’autre], le peuple subira un grand nombre de sacrifices. Particulièrement,
cette jeune pousse d’arbre s’est nourrie dans le jardin de la prospérité ottoman et a
acquis la renommée d’un beau jardin planté d’arbres de bonne réputation. Il n’est
pas conforme à la magnanimité ni convenable à l’esprit de générosité
d’entreprendre la destruction d’un corps comme celui-ci en raison d’une querelle
91
Vatin et Veinstein, Le Sérail ébranlé : 97-99. Sur Cem, voir Cavit M. Baysun, Cem Sultan Hayatı ve Eseri, Güven Basımevi, Ankara, 1963 ; Meriç, Sultan Cem ; Vatin, Sultan Djem. 92
Neşrî, Cihânnümâ : 372-373. Voir en annexes D.4. 93
On remarque que, dans les deux versions du récit de Neşrî, c’est tantôt l’un, tantôt l’autre de ces deux personnages qui est cité en accompagnateur de la princesse.
Page | 301
pour sa possession.” On ne prêta pas l’oreille au message de l’envoyée et comme ils
étaient dans l’obligation d’accomplir leur tâche de messagers, on renvoya les
émissaires auprès de leur mandataire [= Cem] en leur donnant congé de façon
courtoise. »94
Cette mission survient à un moment critique : Bayezid II s’est installé sur le trône de
ses ancêtres et fait proclamé sultan ; il a donc reçu le serment d’obéissance de ses serviteurs
lors de la cérémonie d’investiture (la be’yât). A cet égard, il est perçu comme le souverain
légitime, ce qui explique l’adresse de Selçuk à son égard : elle l’interpelle « mon souverain »
(mais cette adresse peut aussi être lue comme la reconnaissance postérieure de l’auteur du
texte, Hoca Sadüddin Efendi, de la légitimité pleine et entière de Bayezid II, qui place dès lors
le prince Cem en situation de rébellion). Pourtant, la légitimité des droits de Cem n’est à
aucun moment démentie ni discréditée : il vient d’ailleurs de se faire proclamer sultan en
faisant réciter la hutbe et frapper monnaie à son nom – deux gestes souverains : l’Empire
connaît deux souverains. Par ailleurs, dans sa course au trône, Cem s’est approché jusqu’à
Bursa, où il s’est installé en apprenant l’intronisation de son frère. La confrontation armée est
imminente et paraît inévitable ; elle est également dramatique, puisqu’elle entraînera la mort
d’un des deux rivaux sans laquelle la paix ne pourra rentrer tout à fait dans l’ordre – d’après
les conceptions ottomanes de la souveraineté. Or, c’est dans cet intervalle qu’intervient la
mission diplomatique de la princesse Selçuk, flanquée de ses deux compagnons. On retrouve
ici un schéma désormais traditionnel : les femmes sont appelées à la rescousse devant
l’imminence d’une catastrophe, quand la mort plane au-dessus de la tête d’un des
protagonistes de l’affrontement.
Le fait est que la situation a un arrière-goût de déjà-vu, dont le souvenir n’est pas bien
vieux. Les divers protagonistes en scène ont en mémoire la succession de Bayezid Ier, :
pendant une décennie, les quatre fils de ce sultan défait par Tamerlan s’affrontèrent avant que
Mehmed Ier, le « Sultan Çelebi » de Sadüddin, ne parviennent à s’imposer sur ses frères et
régner finalement en souverain unique. Dix ans de guerres fratricides qui ont laissé un
souvenir amer dans la mémoire ottomane, comme une blessure profonde d’où a jailli le sang,
la mort, la discorde et la destruction. Ainsi, l’évocation des sacrifices que le peuple subira si
deux souverains se font la guerre est loin d’être fortuite : elle est une allusion directe à ce
passé proche, souligné en trame de fond par l’intrusion du nom de Sultan Çelebi et par la
présence même de Selçuk, fille de ce souverain, qui intervient comme la mémoire vivante de
ce traumatisme. Son intervention est donc motivée par de nombreuses considérations qui en
font une médiatrice parfaite. Elle est la mémoire de la dynastie, en tant qu’aînée des membres
de la Maison d’Osman ; elle est encore la fille de ce sultan qui dut se battre contre ses frères,
futur immédiat qui attend les deux princes Bayezid et Cem – elle plus que quiconque est donc
en droit de parler au nom d’une paix, de mettre en garde contre les troubles et les dommages
qu’une telle guerre fratricide va entraîner. Mais c’est aussi une femme et cette qualité est ici
essentielle. Dans la répartition traditionnelle des attributs de genre, les hommes sont dotés des
qualités martiales, parce qu’ils sont les détenteurs de la force physique. C’est à eux que
revient la responsabilité de faire couler le sang et de faire usage des objets tranchants ; au
94
Sadüddin, Tâcü-t-tevârîh : t. 2 p. 10. Cf. Annexes D.4.
Page | 302
contraire, les femmes incarnent la douceur, l’esprit de paix, la non violence : déjà entachées
par le sang des menstruations, elles ne peuvent ni ne doivent faire couler le sang95
. Face à cet
appel du sang que le risque de guerre rend imminent, seule une femme pouvait se faire la
porte-parole de la paix.
Pourtant, elle n’est pas seule : elle est accompagnée de deux oulémas, qui bénéficient
du respect de leur communauté et d’une grande expérience – soulignée par l’idée de longue
vie au service de la science (« ‘ulemânıñ muʻammer »). Ce détail est important et n’est pas
sans rappeler la présence du vizir Kara Server aux côtés de l’épouse du prince karamanide,
lorsqu’elle va implorer le pardon de son mari auprès de son frère, Murad Ier, dans l’exemple
précédent. Nefise Melek Hatun, pourtant, avait intercédé seule auprès de ses parents pour
sauver son époux, Karamanoğlu Alaeddin Bey, puis protéger ses fils face à Bayezid Ier. Nous
nous garderons d’interpréter cette différence, mais il faut néanmoins souligner le choix opiné
des partenaires de négociations des princesses ottomanes : dans le cas de l’épouse du
karamanide, c’est un homme d’Etat qui lui est accolé, parce que le conflit est d’ordre
politique. Dans la situation présente, la nature politique de la dispute est également prégnante,
mais elle est reléguée à un second plan, en raison des arguments invoqués par les médiateurs,
qui consiste en une remise en cause des pratiques successorales ottomanes. La présence
d’oulémas de grande réputation n’est donc pas un hasard : ils servent de caution aux
propositions de la princesse, qui sont dès lors considérées comme valables. D’ailleurs, à
aucun moment elles ne sont réfutées : Sadüddin se contente de conclure que ses propos « ne
furent pas entendus ni écoutés ». On plonge ici dans les méandres du problème de
l’application du fratricide, sans cesse remis en cause par les Ottomans96
. Pourtant, Mevlana
Ayas comme Ahmed Çelebi restent passifs dans le récit que nous livre Sadüddin, qui pourtant
accorde rarement de la place aux femmes dans son histoire : c’est bien la princesse qui
s’adresse à son arrière petit-neveu – preuve qu’on pensait bien qu’elle était la mieux placée
pour réussir dans une entreprise aussi ardue.
De fait, Cem Sultan avait raison de vouloir mettre toutes les chances de son côté en
envoyant une femme porteuse de tant de symboles, encadrée par les plus éminents savants de
son époque : la proposition qui est formulée à Bayezid II ne pouvait que lui déplaire. Selçuk
entame son discours par une évocation des liens de sang qui unissent les deux protagonistes :
ils sont frères et leur seul crime est de vivre tous les deux au même moment. Faut-il pour
autant que la situation se résolve par la mort de l’un des deux ? Deux frères ne peuvent-ils
vivre en paix ? Plus important encore que la survie des frères, ce sont les conséquences que
leur conflit : la communauté musulmane doit-elle souffrir de l’opposition des deux frères ? On
notera l’insistance sur la notion de préservation du peuple musulman (ehl-i islâm) : il s’agit
bien d’une querelle intestine, qui n’est donc pas légale. La guerre doit être portée contre les 95
A cet égard, on rappellera les réflexions de Nassiet sur les rapports différenciés à la violence des hommes et des femmes françaises sous l’Ancien Régime : Michel Nassiet, La violence, une histoire sociale. France, XVIe-XVIIIe siècles, Seyssel, Champ Vallon, 2011 : 41-46. Il se fonde sur les théories de Testart quant à la division sexuelle du travail, qui découlerait d’une conception relative à l’écoulement du sang, que nous reprenons ici à notre profit : Alain Testart, Essai sur les fondements de la division sexuelle du travail chez les chasseurs-cueilleurs, Paris, Editions de l’EHESS, 1986. relatives au rapport au sang proposées par 96
Vatin et Veinstein, Le sérail ébranlé : 81-182 ; Vatin, « Loi ou fatalité ? ».
Page | 303
ennemis de l’islam, contre les infidèles : c’est la guerre sainte, la gaza. Le conflit entre deux
princes musulmans ne peut être que négatif, car il porte la guerre au sein des territoires de
l’islam, les affaiblissant donc – pire, les mettant en situation de faiblesse par rapport aux
voisins infidèles qui s’empressent à sa porte et n’attendent qu’un relâchement pour attaquer.
On se rappelle, à ce titre, comment les Ottomans justifiaient les conflits avec leurs voisins
musulmans : en se rebellant ou en se soulevant contre eux, ils empêchaient les Ottomans de
poursuivre leur tâche, la guerre sainte – l’un des thèmes principaux invoqués pour justifier
leur autorité : Dieu a élu la Maison d’Osman pour porter la guerre sainte contre les infidèles.
Et la princesse Selçuk fait appel à « la conscience intérieure resplendissante du souverain »
pour choisir la voix de la raison, la voix de « la magnanimité » et de « l’esprit de générosité ».
La solution au problème ? Une partition de l’Empire : les territoires occidentaux à
Bayezid, qui trône déjà à Istanbul ; l’Anatolie à Cem, qui s’est installé à Bursa. Selçuk
enfonce le clou en prévoyant d’avance les réserves de nature politique de Bayezid II : les
arguments disséminés dans le texte sont là justement pour y répondre. Cette solution
permettra la paix : non seulement parce que la guerre imminente, avec toutes ses
conséquences désastreuses sur le peuple, n’aura pas lieu, mais aussi et surtout parce qu’il n’y
aura pas, à l’avenir, de motifs de dispute. Car la discorde naît « du joug de la soumission » :
sous-entendu, chaque prince règnera en maître dans ses territoires, sans soumission envers un
autre. Or, cette soumission n’est pas tolérable car chacun a des droits identiques au trône. Plus
de joug, plus de conflit : la paix règnera en maître sur les territoires ottomans. C’est là rien
moins que la négation de l’argument invoqué dans la loi qui justifie le fratricide, à savoir
prévenir les risques inévitables d’un conflit entre prétendants disposant de droits égaux au
trône. La solution proposée est donc celle de la tradition turcomane, qui considère les
territoires d’un souverain comme un patrimoine privé, cessible entre héritiers. On note ici que
même chez les Ottomans, qui se sont détachés de ces pratiques successorales pour créer la
leur propre, les contestations existent encore à la fin du XVe siècle.
Le deuxième argument politique invoqué par Selçuk concerne la grandeur ottomane :
elle compare cet Etat en formation à une « jeune pousse d’arbre » qui a progressivement
acquis « la renommée d’un beau jardin planté d’arbres ». La pousse originelle a grandi,
comme le prévoyait le rêve prémonitoire d’Osman Ier : elle s’est multipliée pour donner tout
un jardin peuplé d’arbres « de bonne réputation ». Mais le danger est là, que « la flamme de la
guerre » vienne brûler le bel agencement du jardin et « la prospérité » ottomane. Pis, il
pourrait y perdre sa réputation : ne craignant plus sa puissance, les voisins ne mettraient pas
longtemps, alors, à venir empiéter sur son territoire. Il revient au sultan, au nom de « la
magnanimité » et de « l’esprit de générosité », de prévenir « la destruction » annoncée de ce
« corps » : « une querelle pour sa possession » ne justifie pas l’avenir qui l’attend si une
solution pacifique n’est pas trouvée ; elle serait même absurde, car qui voudrait de la
possession d’un jardin brûlé par la guerre ?
L’argument s’oppose à la conception ottomane de la souveraineté, développée chez un
autre chroniqueur, Kemalpaşazade, lorsqu’il mentionne l’exécution des neveux de Selim Ier
sur ordre de ce dernier :
Page | 304
« Un pays ne peut avoir deux chefs et souverains ; une armée ne peut avoir deux
capitaines et commandants en chef. Deux lions ne se tiennent pas dans une seule
antre, ni deux épées dans un seul fourreau. »97
Ici, deux principes s’opposent : l’idée ottomane, sur laquelle s’appuie Bayezid, d’indivisibilité
du territoire, et celle proposée par Selçuk au nom de Cem, du droit de chaque fils à hériter
d’une parcelle du territoire paternel, qui repose sur une conception de la royauté comme
patrimoine privé ordinaire98
.
Les propos tenus par Selçuk à son petit-neveu nous donnent l’image d’une princesse
parfaitement au fait des enjeux politiques et des règles dynastiques en cours dans et hors de
l’Empire. C’est une femme particulièrement avisée qui engage une négociation avec une
stratégie bien établie, dont le manque de réussite à l’arrivée ne diminue en rien la pertinence.
Si Selçuk se distingue, par son activité diplomatique, de ses aïeules, c’est que contrairement à
elles, son intervention n’est pas fondée sur des pratiques de persuasion “féminines”
(suppliques, pleurs, mensonges), mais sur un véritable discours politique. Son action n’a pas
pour finalité de pardonner la révolte (ou ce que les chroniqueurs ottomans présentent comme
tel) d’un prince étranger rebelle et militairement vaincu (toujours aux dires de ces derniers),
mais pour éviter un conflit armé et qui s’annonce destructeur entre deux princes ottomans
légitimes. Cette action exceptionnelle valut à cette princesse d’être considérée parmi les
grands diplomates de son époque, ce qui n’est pas sans expliquer son surnom honorifique de
“Sultane” Selçuk Hatun.
Mihrimah Sultane, la dernière des princesses diplomates
Le dernier exemple de princesse ayant joué un rôle diplomatique de premier plan est
celui de Mihrimah Sultane, la fille de Süleyman Ier et de Hürrem Sultane, au XVIe siècle. Son
action prend place dans un cadre géographique beaucoup plus vaste, car, contrairement à ses
aïeules, elle n’est pas restreinte à l’intérieur du cadre familial : ses interlocuteurs sont des
étrangers avec lesquels elle n’est liée d’aucune manière. C’est donc une nouvelle forme
d’activité diplomatique, atypique, exceptionnelle même pour une princesse, qui apparaît ici.
L’exemple le plus connu des activités diplomatiques de Mihrimah Sultane est sans nul
doute ses relations épistolaires avec les souverains polonais. Des premiers contacts existaient
déjà entre la royauté polonaise et la dynastie ottomane sous le règne de Sigismond Ier ; mais
c’est à l’accession au trône de son fils, Sigismond II, que Mihrimah Sultane apparaît : elle lui
envoie personnellement une lettre de félicitations, accompagnée de cadeaux99
. Cependant, la
97
Nous n’en citons ici qu’une partie : l’énumération continue de la sorte en de multiples métaphores destinées à démontrer l’impossibilité d’une cohabitation de deux souverains dans un même pays. Cité par Vatin et Veinstein, Le sérail ébranlé : 169. 98
İnalçik, « The Ottoman Succession » : 37-69. 99
La lettre est conservée aux Archives d’État polonaises. Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 189 ; Peirce, The Imperial Harem : 221 ; Çağatay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 38-39 ; Nejat R. Uçtum, « Hürrem ve Mihrümah Sultanların Polonya Kıralı II. Zigsmund’a Yazdıkları Mektuplar », Belleten 44 (1980) : 697-715.
Page | 305
lettre de la princesse fait écho à celle de sa mère, la favorite Hürrem, de son père, le sultan, et
de son mari, le grand vizir. Nous sommes donc en présence d’une diplomatie élaborée sur une
base familiale où la place que tient la princesse n’est qu’une petite composante du phénomène
global100
. Le sultan entendait-il favoriser la création d’un tissu de liens familiaux entre les
membres de sa famille et celle du roi polonais ? Dans ce cas, l’échange de cadeaux et de
lettres de la part des femmes les plus proches de lui était pertinent : leur existence même
engageait Sigismond II à faire répondre les femmes de son entourage aux compliments et
cadeaux qu’il avait pu recevoir des femmes royales ottomanes101
. Quoi qu’il en soit, force est
de constater que dans ce jeu diplomatique, la princesse ottomane n’a pas le premier rôle : elle
n’est qu’une exécutante de la politique de son père.
Pour être pleinement comprise, la spécificité de l’action diplomatique de Mihrimah
Sultane doit, être mise en perspective avec la propre activité de sa mère dans ce domaine.
Hürrem avait en effet établi des contacts épistolaires non seulement avec le souverain
polonais, mais également avec la sœur du chah d’Iran102
. Le modèle d’échanges
diplomatiques épistolaires avec les pouvoirs voisins, tel qu’il est pratiqué par Hürrem et, à
moindre niveau, par Mihrimah, est repris et sublimé aux règnes suivants, par les reines
mères : Nurbanu Sultane est en contact régulier avec le Sénat vénitien, Safiyye avec Élisabeth
Ière
d’Angleterre, etc.103
En d’autres termes, la pratique diplomatique de Mihrimah Sultane est
atypique pour une princesse (et ne sera pas reproduite après elle, en tout cas pour la période
en question), mais pas pour une femme royale : elle fut rapidement accaparée par les valide
sultan. Ce sont elles qui, désormais, deviennent les grandes figures féminines de la diplomatie
ottomane, celles que les ambassadeurs vont visiter et courtiser de préférence104
.
Permettons-nous une brève digression pour souligner l’usage des cadeaux, qui
réapparaît ici dans notre documentation. L’échange de cadeaux est un élément central des
relations diplomatiques internationales, mieux connu pour les périodes ultérieures. On sait,
par exemple, que l’élite ottomane était friande des horloges à mécanique, des miroirs et autres
produits de fabrication locale que chaque royaume envoyait dans l’espoir de plaire aux
100
On notera d’ailleurs que l’ensemble de ces quatre lettres fut envoyé comme un tout, par courrier unique. Peirce, The Imperial Harem : 221. 101
On pourrait même envisager l’hypothèse – manquée semble-t-il – de créer une nouvelle forme de diplomatie entre la dynastie ottomane et ses voisins reposant sur l’usage et la complicité des femmes. Le fait que cette expérience prenne place à une période où les mariages interdynastiques avaient définitivement pris fin, coupant la dynastie ottomane de ses contacts privilégiés avec les cours voisines, pourrait renforcer cette hypothèse. 102
Hürrem Sultane fut d’ailleurs bien plus active sur le plan des échanges épistolaires diplomatiques que sa fille, puisqu’elle entretint également des échanges avec la sœur du souverain safavide, Sultanim. Peirce, The Imperial Harem : 221. 103
Peirce, The Imperial Harem : 222-228 ; Necipoğlu, The Age of Sinan : 280-281 ; Pedani, « Safiye’s Household » ; Susan A. Skilliter, « The Letters of the Venetian ‘Sultan’ Nûr Bânû and Her Kira to Venice », dans Studia Turcologica Memoriae Alexii Bombaci Dicata, A. Gallotta et U. Marazzi (éds.), Naples, Herder, 1982 : 515-536 et « Three Letters from the Ottoman ‘Sultana’ Safiye to Queen Elizabeth I », dans Documents from Islamic Chanceries, S. M. Stern (éd.), Columbia S. C., S. M. Stern, 1965 : 119-157. 104
Peirce, The Imperial Harem : 222-228 ; Skilliter, « The Letters of the Venetian ‘Sultan’ Nûr Bânû » et « Three Letters from the Ottoman ‘Sultana’ Safiye » ; voir encore, du même auteur, « Catherine de’ Médici’s Turkish Ladies-in-waiting ».
Page | 306
dirigeants ottomans105
. Le choix des cadeaux était crucial : ils devaient contenter les goûts de
ceux à qui on voulait plaire, mais aussi répondre à des exigences de prestige. C’est ainsi que
la reine d’Angleterre Élizabeth Ière
eut l’idée d’offrir un orgue au sultan Mehmed III – cadeau
qui eut beaucoup de succès, mais entraîna quelques difficultés dans son montage106
; de son
côté, Safiyye Sultane fut ravie de recevoir un carrosse, mais une tiare promise par elle en
retour, disparue pendant un temps sans explications, ne fut pas loin de créer un incident
diplomatique107
. Bien évidemment, les femmes royales n’étaient pas les seules à être ainsi
sollicitées par les puissances étrangères : c’est un commerce qui touchait l’ensemble de l’élite
dirigeante.
Quelques jolis cadeaux suffisaient-ils pour obtenir la sollicitude de ces individus ?
Divers exemples laissent à penser que cela pouvait être le cas. Hammer rapporte cet
événement survenu lors des négociations entre la Porte et la Hongrie, entre la régente Isabelle
et le sultan Süleyman, qui suivirent la défaite de Louis II de Hongrie en 1526, mort sur le
champ de bataille :
« Süleyman retint pendant une semaine les conseillers d’Isabelle [reine régente de
Hongrie] dans son camp, et débattit avec eux la question de savoir s’il ne
conviendrait pas d’emmener la reine à Constantinople. De son côté, Isabelle
négocia la liberté de ses conseillers par l’ancien ambassadeur de son père
Sigismond auprès de la Porte ; elle fut appuyée dans ses démarches par Rüstem
Pacha, dont elle avait gagné la femme, la sultane Mihrimah (lune des soleils), par
de riches présents. »108
Sur bien des points, cet événement paraît hautement improbable109
. Cependant, la pratique des
échanges de cadeaux, à la frontière entre le don et la corruption, est largement attestée par
ailleurs110
. C’est ainsi que le baile Bernardo Navagero informe le Sénat, en 1553, de
105
Reindl-Kiel, « Power and Submission » ; Frédéric Hitzel, « Diplomatik Armağanlar: Osmanlı İmparatorluğu ile Batı Avrupa Ülkeleri Arasında Modern Çağda Yapılan Kültürel Değiş-Tokuş », dans Harp ve Sulh. Avrupa ve Osmanlılar, D. Couto (éd.),Ş. Tekeli (trad.), Istanbul, Kitap Yayınevi / IFEA / Fondation Calouste Gulbekian, 2010 : 243-258. 106
Skilliter, « Three Letters from the Ottoman ‘Sultana’ Safiye ». 107
Peirce, The Imperial Harem : 227-228. 108
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 5 p. 167. 109
La spatialité est déjà problématique : Isabelle se trouvait dans le camp ottoman, en Hongrie, en présence du sultan et de Rüstem Pacha, tandis que Mihrimah était probablement à Istanbul pendant ce temps. N’aurait-il pas été plus facile de gagner directement le vizir qui se trouvait sur place par des cadeaux, plutôt que de passer par la femme, spatialement éloignée ? Le texte n’aurait de sens que si l’on imagine que les contacts entre la reine de Hongrie et la princesse ottomane étaient antérieurs à ces événements. Mais un autre problème bien plus grave apparaît, chronologique cette fois. Hammer mentionne la chose peu après la circoncision des fils et du mariage de la fille de Süleyman Ier, qui eurent lieu en 1539, soit treize ans après la défaite de Louis II de Hongrie qui conduisit à la réception par le sultan, dans sa tente, de sa veuve, la régente Isabelle et son fils, encore bébé. Or, en 1526, Mihrimah Sultane n’était encore qu’une enfant elle-même : elle n’était certainement pas en âge de jouer le rôle qu’on veut lui donner. Nous ne savons trop à quoi Hammer fait référence. Ce qui est sûr, c’est que l’information n’est reprise par aucun contemporain ni historien que nous avons pu consulter. 110
À titre d’exemple, quelques décennies plus tard, en 1583, l’ambassadeur français à la Porte se plaint de l’influence des vénitiens sur Nurbanu Sultane, qui leur témoignait une amitié particulière en raison de ses origines vénitiennes. Mais il ne manque pas de souligner qu’ils avaient entretenu cette amitié avec diligence, à force de cadeaux. Cité par Necipoğlu, The Age of Sinan : 281. De même, l’ambassadeur Contarini rapporte que le grand vizir Siyavuş Pacha appréciait fortement les cadeaux qu’on pouvait lui faire, avec encore plus de
Page | 307
l’importance, selon lui, d’envoyer des cadeaux non seulement au grand vizir en poste, Rüstem
Pacha, mais aussi à sa femme, Mihrimah Sultane, dont il estime le pouvoir plus étendu et à
laquelle il attribue un caractère bien « plus prudent »111
.
Dans le cours du XVIe siècle, les princesses perdent le rôle de grandes diplomates,
bien établi aux siècles antérieurs, au profit des reines mères. Tant que les princesses étaient
mariées à l’étranger et devenaient des souveraines étrangères, l’ambivalence de leur identité
les élevait au rang d’intermédiaires diplomatiques privilégiées lors des conflits
interdynastiques, voire internes à l’État ottoman. Mais dès lors qu’elles cessèrent d’être
mariées à l’extérieur, elles perdirent cette qualité d’intermédiaires indispensables. Or, cette
perte survient durant la période au cours de laquelle la dynastie procède à une redéfinition de
sa hiérarchie palatiale féminine, au bénéfice des mères des sultans. Le rôle de Hürrem Sultane
est crucial dans ce développement (elle contribua beaucoup à la création de ce personnage de
la mère conseillère intime du sultan). Si elle ne devint jamais reine mère elle-même, c’est bien
son exemple qui fut repris et perfectionné par la suite112
. Dès lors, les princesses n’ont plus de
raison de briller sur la scène diplomatique : la perte de leur qualité de hautes représentantes de
la dynastie fait qu’elles ne sont plus indispensables. Désormais, c’est aux reines mères que
vont les principaux honneurs et responsabilités, dont la diplomatie internationale fait partie.
3. Le temps des princesses de l’ombre
L’interruption définitive des mariages interdynastiques et la montée en puissance des
reines mères scellèrent la fin des ingérences directes des princesses dans les affaires d’État.
Non que celles-ci aient totalement disparu, ni même qu’elles aient modifié leur mode
d’action, mais désormais, à partir du milieu du XVIe siècle, ces interventions se firent plus
discrètes, plus indirectes, et surtout, de moindre importance.
Interventions discrètes certes, mais dont les résultats n’en étaient pas moins probants,
comme le démontre l’affaire des dames de chambre de Catherine de Médicis, étudiée par
Suzan Skilitter. Voici de quoi il retourne : deux jeunes filles turques furent faites prisonnières
lors d’un déplacement en mer. Elles se retrouvent, après diverses péripéties, au service de la
reine mère, régente de France, Catherine de Médicis. La présence de ces deux Turques à la
cour de France ne dérangeait personne, jusqu’au jour où la mère des jeunes filles se décida à
réclamer leur retour, ouvrant la voie à un conflit diplomatique qui allait se poursuivre pendant
des années. Pour soutenir sa demande, la mère éplorée alla faire appel à la justice impériale,
réclamant l’appui du sultan et du grand vizir dans ses démarches face à l’ambassadeur
français. Son cas n’aurait pas fait grand bruit si elle n’avait eu la présence d’esprit de s’assurer
également du soutien des princesses, notamment la vieille et puissante Mihrimah Sultane et sa
plaisirs qu’ils étaient importants, en raison des coûts considérables que représentait l’entretien de sa femme, Fatma Sultane, la fille de Selim II. Cité par Peirce, The Imperial Harem : 224. 111
Alberi, cité par Necipoğlu, The Age of Sinan : 296. 112
Peirce, The Imperial Harem : 57-90.
Page | 308
nièce, non moins puissante elle aussi, Ismihan Sultane, épouse du grand vizir en fonction. Les
ambassadeurs français à la Porte ne cessent de se plaindre, dans leurs missives, de l’embarras
que cette femme leur cause, les ministres ottomans prenant prétexte de cette affaire pour
refuser ou compliquer toutes leurs démarches et sollicitations. Dans leurs lettres, ils ne
manquent pas de souligner de façon fort explicite le rôle des princesses dans cette histoire :
sans elles et l’appui qu’elles accordent à la mère, qui se concrétise par des exhortations
récurrentes au sultan et au grand vizir, le conflit aurait été résolu depuis longtemps. Il fallut
des années et l’acquittement d’une compensation financière à la mère pour que l’affaire des
dames de chambre de la reine cessa d’empoisonner les ambassadeurs français dans leurs
démarches auprès de la Porte113
.
On perçoit mal, a priori, la raison pour laquelle ces princesses choisirent de soutenir,
de façon aussi durable, le cas de cette mère. Pourtant, ce choix s’éclaire à la lumière d’autres
exemples d’interventions discrètes des princesses, qui toutes soulignent un investissement en
faveur de prisonniers de guerre. La première attestation du genre, la plus ancienne (à ce jour)
met de nouveau en scène Mihrimah Sultane. À l’occasion de négociations en vue de la
conclusion d’une paix entre l’Empire ottoman et l’Autriche, en 1566, un mémoire fut remis
par la partie ottomane, indiquant leurs attentes, parmi lesquelles « 20 000 ducats comme
représentant l’arriéré de trois années de tribut », mais aussi « la restitution de quelques
prisonniers turcs, désignés par la veuve de Rüstem [Mihrimah], en échange de l’Espagnol don
Alvaro, qu’on avait mis en liberté à Constantinople »114
:
« Hossuti arriva avec des présents pour les vizirs et vingt prisonniers affranchis ;
de ce nombre était le vieux tschaousch Kasim, fait prisonnier quelques années
auparavant par les soldats du palatin Thomas Nadasdy, et dont la veuve de
Rüstem avait expressément demandé la mise en liberté. »115
L’intérêt personnel que montre Mihrimah Sultane en faveur de la libération de prisonniers de
guerre qui ne comptent même pas parmi les membres des échelons supérieurs de la société est
révélateur : l’intervention en faveur de prisonniers de guerre pour hâter leur libération semble
tomber dans un de leurs domaines d’ingérence traditionnels. Ce qui ne signifie pas qu’elles ne
puissent trouver dans l’affaire quelques intérêts en nature : sollicitée une autre fois pour la
libération d’un certain Auersberg, Mihrimah Sultane reçut, en guise de remerciement pour son
aide, une horloge mécanique d’une valeur de 200 ducats116
.
Les exemples du genre se poursuivent tout au long de la période. Ainsi, à la fin du
XVIe siècle, une des filles de Murad III fit inscrire, parmi les clauses de sa fondation pieuse,
des prescriptions spécifiques en faveur de la libération des captifs de guerre (musulmans),
femmes en priorité : les sommes ont beau être modestes, le geste n’est pas anodin117
. Et au
XVIIIe siècle, la fille aînée d’Ahmed III est encore partie prenante lors de la libération de
prisonniers :
113
Skilliter, « Catherine de’ Médici’s Turkish Ladies-in-waiting ». 114
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 6 p. 81. 115
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 6 p. 110. 116
Gerlach, Türkiye Günlüğü : t. 2 p. 592. 117
TSMA D 6932. Cité dans Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 45 et Peirce, The Imperial Harem : 202.
Page | 309
« L’ambassadeur français, le marquis de Bonnac, fidèle à sa promesse qu’il avait
faite au nom de sa cour de rendre la liberté à quatre-vingts prisonniers, en
reconnaissance de la permission de réparer l’église de Jérusalem accordée par la
Porte, les emmena à Constantinople, où la sultane Fatima et son époux, le grand
vizir, firent don à chacun d’eux, la première de douze, le second de huit
piastres. »118
Il est intéressant de voir que c’est la princesse qui se montre la plus généreuse à leur égard,
quand son époux est pourtant largement plus riche qu’elle. La raison de cet intérêt répété en
faveur des esclaves est à rapprocher de celle qui motive les princesses à entreprendre des
fondations pieuses : il s’agit d’aider les plus pauvres et les plus démunis.
Toutes les interventions discrètes, mais bien concrètes, des princesses à partir de la
seconde moitié du XVIe siècle ne se résument néanmoins pas à secourir les prisonniers de
guerre. Malheureusement, comme elles ne s’inscrivent pas dans les actions relatives à l’État,
il est impossible de les trouver dans les chroniques de règne. C’est du côté des voyageurs
occidentaux qu’il faudrait se tourner, pour en connaître la nature. Nous ne citerons qu’un
épisode du genre, assez représentatif du comment et du pourquoi de telles interventions
princières, que nous devons au récit de Gerlach, qui implique des chrétiens embarqués dans
une protestation violente contre un juif, au point de réclamer sa mort :
« Le 18 août [1577], un groupe nombreux de chrétiens vint de nouveau se présenter
au Divan [impérial] et furent mis en présence du pacha [grand vizir]. Ils
insistèrent pour obtenir l’exécution du juif. Le pacha leur fit cette réponse : “Au vu
de votre demande, je m’engage à donner une punition plus sévère à ce juif et je vais
ordonner de le faire fouetter chaque jour de 80 coups de bâton. Ainsi, chaque jour,
il sentira la mort”. De leur côté, les juifs se rendirent à la résidence du pacha et
versèrent des centaines de ducats au pacha et au cadiasker pour obtenir le pardon
de leur compatriote. En outre, pour renforcer encore les chances de pardon du juif,
ils versèrent encore de fortes sommes à la vieille Sultane Hanım, veuve de Rüstem
Pacha [Mihrimah], et à la Sultane Hanım, épouse de Mehmed Pacha [Ismihan]. Le
pacha étant revenu à l’ordre de le faire fouetter 70 fois, l’homme s’évanouit à
plusieurs reprises. [...] »119
Les princesses n’étaient pas toujours sollicitées pour intervenir dans des affaires d’État ; à
l’instar des pachas, elles recevaient des placets à propos d’affaires courantes, privées. Le
moyen de les intéresser au cas était le même que pour les pachas : le versement de sommes
considérables pour convaincre du bien-fondé de la demande. L’intérêt de cet exemple réside
surtout dans le fait qu’il montre que la société stambouliote savait pouvoir faire appel aux
princesses : elle savait pouvoir avoir accès à elles, se faire entendre d’elles (sous réserve d’en
avoir les moyens, ce qui n’était probablement pas donné à tout le monde), et compter sur la
réussite de leur intercession. Avancer l’argument d’un rôle politique et d’une influence des
princesses n’est donc pas une conclusion orientée par les désirs de l’historien : ce sont ces
118
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 14 p. 19 119
Gerlach, Türkiye Günlüğü : t. 2 p. 623. Voir en annexes D. 7.
Page | 310
juifs de la capitale et cette mère musulmane venue réclamer le retour de ses filles qui nous le
disent.
*
La plupart des recherches sur les acteurs politiques ottomans se sont concentrées, fort
logiquement, sur les individus détenteurs d’une position institutionnalisée au sein de l’édifice
étatique ottoman, car c’est là que réside le pouvoir officiel, celui qui accorde richesses,
honneurs et prestige, et qui délègue une autorité et une capacité d’action, une puissance
d’intervention sur d’autres. Mais cette préférence marquée pour l’étude de ces agents ne
repose pas uniquement sur ces causes ; plus simplement, il est plus aisé de travailler sur ce
type d’actions institutionnalisées parce qu’elles apparaissent largement dans la
documentation. Les sources dévoilent plus difficilement les actions, les agents non
institutionnalisés du pouvoir. Nous savons depuis longtemps que le clientélisme battait son
plein dans l’Empire ottoman de l’époque classique, mais nous ne sommes que rarement
capables d’en montrer les rouages et les conséquences, car, par définition, il est un principe de
fonctionnement qui ne dit pas son nom : savoir que tel officier a bénéficié du soutien de telle
personne pour accéder à son office est une chose, l’inscrire dans des récits de règne ou sur des
notes de chancellerie en est une autre. Le clientélisme ottoman peine donc à se faire voir.
L’étude des princesses ottomanes peut ici apporter sa contribution : en tant que
femmes, elles sont exclues de toute position institutionnalisée ; la seule forme d’intervention
qui leur est ouverte est celle qui passe par le réseau de clientèle. Il faut ici critiquer les
positions qui, trop facilement, considèrent l’action par le réseau (ce que d’aucuns appellent
l’influence indirecte) comme une marque de non-pouvoir ou comme une action politique de
second plan. L’influence indirecte, quand elle entraîne la nomination d’une personne au poste
de grand vizir, convainc le sultan de partir en campagne contre Malte, ou assure la conclusion
d’une paix entre deux États en guerre, n’a rien d’une action de second plan. Elle n’a rien non
plus d’une action proprement féminine, sous prétexte que seules les femmes s’y investiraient
– présupposé fondé sur des arguments peu recevables. L’ensemble de la classe dominante
ottomane, quel que soit le niveau de l’échelle concernée, pratiquait le clientélisme : le rôle
qu’y jouent les femmes n’est qu’un indicateur de l’existence de réseaux féminins au sein de ce
système. Plus exactement, il ne s’agit pas de mettre en opposition des réseaux masculins avec
ceux des femmes, mais d’accepter la mixité et la complémentarité de ces réseaux. Or, c’est
bien l’exceptionnalité de leur réseau qui permit aux princesses ottomanes de jouer, avec un
succès relatif, le rôle qu’on leur réservait. Elles sont les seules, aussi bien chez les hommes
que chez les femmes, à bénéficier d’un accès immédiat et privé à l’ensemble des personnalités
dirigeantes ottomanes : le sultan, la reine mère, le chef des eunuques noirs, les pachas
membres du Conseil, et même un très grand nombre de pachas auxquels elles sont liées, de
près ou de loin, par des liens familiaux. La pratique de marier les princesses au sein de
l’Empire aux kul du sultan contribue à introduire ces femmes au cœur même du champ
politique ottoman, d’en faire des agents politiques d’excellence, par le seul jeu du réseau.
Page | 311
On pourra alors se demander comment il se fait que des femmes en possession d’un tel
pouvoir ne se soient pas emparées de cette capacité d’action pour s’imposer non plus dans
l’ombre, mais au plein jour. Il faut probablement voir là une illustration du principe
bourdieusien d’intériorisation des normes. L’exclusion des femmes de la souveraineté ne
reposait sur rien d’autre qu’un principe coutumier : les princesses ne firent rien, pourtant, pour
le remettre en cause. L’inscription de leurs actions dans un cadre familial repose sur une
logique similaire dont elles se contentèrent. Éduquées dans la connaissance de ces rouages du
système, elles en connaissaient parfaitement les fonctionnements, les capacités, mais aussi les
limites, perçues par elles comme normales. Deux phénomènes en découlent. D’une part, leur
position était exceptionnelle parce qu’elle les maintenait sur un piédestal accepté et intériorisé
par tous et toutes. La contrepartie à ce piédestal était, en quelque sorte, l’acceptation d’une
position non institutionnalisée. C’est parce qu’elles se tiennent en dehors du jeu des rivalités
institutionnelles, en arbitres subjectifs (parce qu’intéressées à la réussite de certains au
détriment d’autres), mais extérieurs, que cette position était garantie. Personne ne songea
jamais à la remettre en cause parce qu’il en allait de l’intérêt de tous qu’elle demeurât telle
quelle : les sultans, les reines mères, les eunuques noirs y voyaient le moyen de contrôler les
factions en les obligeant à se définir dans un système de rivalité ; les pachas, une garantie de
protection (même ceux qui n’étaient pas mariés avec une princesse ne voulaient pas remettre
en cause l’ensemble du système, au cas où ils pourraient un jour en bénéficier). De sorte que
les princesses comptent parmi les rares agents politiques à n’avoir jamais connu d’attaques à
l’encontre de leur position : leur marginalité, ici encore, s’est transformée en atout.
Le second phénomène qui découle de l’ensemble du système et qui contribua
beaucoup à interdire à ces femmes de revendiquer une autre position est l’absence d’une
action catégorielle. Les princesses appartiennent certes à une catégorie spécifique d’individus,
mais elles ne sont pas une classe morale120
. Elles n’agissent jamais dans l’intérêt de leur
catégorie. Elles ne le peuvent tout simplement pas : mariées à des grands dignitaires à la tête
de faction, elles n’ont d’autres intérêts que la protection de leur faction, et tout
particulièrement des membres de leur famille et de leur maison. Ce système suppose la
constitution de lignages princiers en rivalité avec les autres lignages de pachas et d’oulémas,
mais aussi et surtout en compétition avec les autres lignages princiers. La défense des intérêts
du lignage d’une princesse implique l’opposition avec celui des autres princesses. Ainsi,
quand Mihrimah Sultane intrigue pour que son mari récupère son office de grand vizir, elle
sait que sa réussite suppose la défaite de sa tante, Fatma Sultane, qui elle-même, pour protéger
son propre époux, doit rabattre les prétentions de sa nièce. Quand une princesse gagne, c’est
qu’une autre perd. Le système matrimonial est non seulement un moyen de forcer les factions
à rivaliser entre elles, mais aussi d’interdire aux princesses d’agir en tant que classe cohérente.
Cela revient à réduire à néant toute prétention éventuelle des lignages princiers, en les
contraignant à se mettre au niveau des lignages non princiers et de jouer leur jeu.
120
Romain Bertrand donne un bel exemple de classe morale dans son travail sur les priyayi de Java, qui se sont constitués comme tel par un long processus d’élaboration de leurs mœurs et en se définissant en opposition tout à la fois à la noblesse de sang et aux marchands. Cf. Bertrand, La Tradition Parfaite : 103-176.
Page | 312
Il nous faut encore éclairer un dernier point : la notion d’intérêt de l’autre. Une
certaine emphase a été mise sur la finalité altruiste des actions des princesses, investies dans
la défense des intérêts des autres – proches, membres de la famille, clients. Or, non seulement
ces actions ne sont jamais totalement désintéressées, mais encore la notion même d’acte
désintéressé est à prendre avec circonspection. Les princesses ont quelque chose à défendre de
personnel quand elles interviennent en faveur de ces individus : leur propre prestige d’une
part (en tant qu’agentes de pouvoir à la tête de faction, elles ont pour obligation de protéger et
défendre tous ceux qui en font partie ; ne pas le faire ou, pire, échouer, serait une
reconnaissance de faiblesse, avec toutes les conséquences que cela suppose) ; leurs propres
intérêts d’autre part. Nous avons largement montré que le pouvoir d’influence de ces femmes
dérivait de leur réseau : pour conserver ce pouvoir, les princesses doivent donc
nécessairement protéger ceux qui le constituent, grands comme petits. L’entraide que se
témoignent respectivement les princesses et leur époux en est la preuve : peu importe que les
conjoints s’apprécient mutuellement, leur puissance respective est fortement conditionnée à
celle de l’autre. L’entraide n’est pas une alternative mais une obligation de survie.
L’acte désintéressé ne doit pas être perçu comme une négation de soi, négation des
princesses de leurs propres intérêts au profit de ceux des autres, mais bien comme
l’expression d’une norme, d’une conception de soi qui, au lieu d’être individuelle, est
collective. Il revient à Bourdieu d’avoir montré le phénomène, lorsqu’il pose la question :
« Un acte désintéressé est-il possible ? »121
S’appuyant sur les travaux d’Elias sur la société de
cour, il note que les comportements économiques de l’aristocrate français de l’époque
moderne sont incohérents avec tout principe de profit économique, pour la raison que leur
habitus est antiéconomique, qu’il les prédispose à refouler les intérêts, au sens de la poursuite
des profits économiques, au bénéfice d’une conduite fondée sur l’honneur, sur la dépense
somptuaire, quitte à faire banqueroute122
. La dépense somptuaire est une conduite
aristocratique, la recherche du profit, une conduite bourgeoise : pour être noble, c’est-à-dire
s’identifier et être identifié comme tel, il convient de se comporter comme tel. Mieux,
l’intériorisation des normes fait qu’il n’est pas pensable, pour un noble, de ne pas dépenser
même au-delà de ses moyens, du moment que c’est en harmonie avec son statut123
. Or, ce qui
rend possible, sociologiquement, le désintéressement, c’est « la rencontre entre des habitus
prédisposés au désintéressement et des univers dans lesquels le désintéressement est
récompensé », parmi lesquels Bourdieu cite, en première place, la famille124
. Cette
omniprésence de la famille (au sens large de maison), au niveau des actions politiques des
princesses, invite à s’intéresser de plus près aux stratégies de promotion et de reproduction du
groupe.
121
Bourdieu, Sur les théories de l’action : 149-167. 122
Bourdieu, Sur les théories de l’action : 162-163. 123
Elias, La société de cour : 46-62. 124
Bourdieu, Sur les théories de l’action : 164. Le caractère désintéressé d’un certain nombre des actions politiques des princesses reflète donc l’existence d’une conception morale du désintérêt intériorisé par ces femmes. Il est du devoir des princesses d’utiliser leur pouvoir au bénéfice de certaines personnes avec lesquelles elles n’ont aucun lien et/ou qui ne servent pas leurs intérêts directs. Elles le font parce qu’elles savent, inconsciemment, que cette action sera perçue comme vertueuse. Mais pour autant, ce n’est pas la recherche de cette perception qui guide leur choix.
Page | 313
II. Parents, serviteurs et clients : les stratégies de
promotion et de reproduction du groupe familial
L’action politique des princesses se fait, nous l’avons vu, par et pour les membres de
leur famille. Fort bien, il reste toutefois à comprendre en quoi consistait ces familles-factions
que nous avons jusque-là laissées sans définition, faisant usage tantôt du terme de famille,
tantôt de lignage, ou encore de maison, de clientèle et de faction. C’est que l’ensemble de la
clientèle constitue, selon notre optique, la faction, sous réserve de considérer la clientèle selon
une base conjugale. Les princesses ont accès à la clientèle de leur époux et vice versa, de sorte
que ce qui pourrait être perçu comme deux clientèles distinctes est en fait mis en commun
pour le plus grand bénéfice de la faction. En ce sens, nous posons comme base que la faction
n’est pas portée uniquement par le mari de la princesse, mais par le couple – nous avons assez
insisté sur la complémentarité des époux pour ne pas revenir dessus. Précisons encore que
nous employons le terme de faction dans un sens assez lâche, qui n’implique pas
nécessairement un agenda politique bien défini. Par ailleurs, la mise en commun des clientèles
ne fait pas disparaître le lien de clientélisme personnel qui unit un patron à son client : la perte
d’un conjoint signifie la disparition de sa clientèle, à moins de renouveler personnellement les
liens avec le conjoint restant.
La clientèle regroupe tout à la fois les parents lignagers ou par alliance (à l’exclusion
des lignées collatérales, qui constituent leur propre faction, ainsi que nous l’avons souligné
plus haut), les serviteurs et les clients qui se sont placés sous la protection d’une princesse
(puisque c’est de ce type de clientèle qu’il est question). La maison, au sens anglais de
household, comprend en son sein à la fois parents (enfants notamment), alliés (l’époux, qui
peut avoir à ses côtés des membres de sa propre famille, parents par alliance de la princesse),
et serviteurs. Cependant, tous les serviteurs et surtout tous les employés des princesses, encore
moins tous leurs clients, ne résident pas dans l’espace domestique. En ce sens, nous utilisons
le terme de client pour parler d’individus qui ne sont ni des employés, ni des parents, directs
ou par alliance, et qui ne résident pas sous le toit de la princesse, c’est-à-dire des personnes
autonomes, qui choisissent volontairement de se placer sous la protection princière.
Tous ces termes renvoient ainsi à des membres du réseau de clientèle des princesses,
mais dont le lien d’attachement à la “patronne” répond à des réalités distinctes. Tous
contribuent, à leur niveau, à conforter la puissance de la princesse et bénéficient de sa
protection tutélaire. Mais tous ou la plupart conservent une certaine autonomie, en tout cas
recherchent une réalisation personnelle qui échappe, partiellement, au contrôle voire aux
intérêts de la princesse. Bref, tous, la princesse et ses clients, agissent tout à la fois dans
l’intérêt commun et général de la faction, et dans celui de leur propre intérêt individuel et
privé125
. Dans la pratique, comment fonctionnait ce système de clientélisme ? C’est ce que
125
Le même phénomène a été étudié dans le cas de la cour espagnole de Philippe III ; cf. Sanchez, The Empress, The Queen and the Nun : 36-60.
Page | 314
nous allons tenter de percevoir à travers l’étude des stratégies de promotion familiale puis du
soutien à l’entourage en dehors de la famille.
1. Autopromotion lignagère
L’accent a largement été mis, jusqu’à présent, sur les alliés des princesses (leurs époux
et parents par alliance). D’autres personnes méritent autant notre intérêt, notamment les
descendants des princesses, et tout particulièrement leur descendance masculine. Une
question centrale va guider notre réflexion : que devenaient les descendants des princesses
ottomanes, exclus de toute forme d’héritage souverain, comme nous l’avons noté
précédemment ? Étudier le devenir, en termes politiques, de ces individus revient à les
considérer tout à la fois comme objets de l’attention des princesses, qui entendent assurer à
leurs descendants les moyens de maintenir leur position au sein de la hiérarchie sociale
ottomane, mais aussi comme des ressources du propre maintien de la puissance de la faction
des princesses.
Les descendants des sultanes appartenaient, par naissance, au groupe des privilégiés, à
l’élite, et s’inscrivaient même parmi les rangs les plus élevés de l’élite. Il s’agit là cependant
d’un statut difficile à conserver, en l’absence de tout système aristocratique. Le système
ottoman produit en effet cette surprenante contradiction que la naissance donne accès au
groupe de l’élite, mais ne permet pas l’acquisition d’offices par transmission lignagère. Ainsi,
quand une famille de l’élite voulait assurer à ses descendants la conservation de sa position
sociale, il lui fallait développer des stratégies destinées à donner à leurs enfants les moyens de
cette conservation, dans un mouvement sans cesse renouvelé. Reste à déterminer quels étaient
ces moyens et stratégies. Il existe sur ce sujet une littérature qui permet de replacer le cas des
familles princières dans une réflexion plus générale sur le fonctionnement des élites et des
household126
.
Les travaux de Halil İnalcık et de Metin Kunt, pour ne citer qu’eux, fournissent des
renseignements particulièrement utiles sur les carrières des officiers de l’État à l’époque
moderne127
. Si le Palais demeure l’une des voies principales, et la plus prometteuse de toutes,
126
Voir notamment Anastasopoulos (éd.), Provincial Elites ; Gabriel Piterberg, « The Formation of an Ottoman Egyptian Elite in the 18th Century », International Journal of Middle East Studies 22/ 3 (août 1990) : 275-289 ; Fatma M. Göçek, Rise of the Bourgeoisie, Demise of Empire. Ottoman Westernisation and Social Change, New York / Oxford, Oxford University Press, 1995 ; Rif’at A. Abou-el-Haj, « The Ottoman Vizier and Pasha Households, 1683-1703: a preliminary report », Journal of the Americain Oriental Society 94/4 (1972) : 438-447 ; Metin İ. Kunt, « Ethnic-Regional (Cins) Solidarity in the Seventeenth-Century Ottoman Establishment », International Journal of Middle East Studies 5 (1974) : 233-239 ; Hathaway, « Eunuch Households » et The Politics of Households ; Paul G. Forand, « The Relation of the Slave and the Client to the Master or Patron », International Journal of Middle East Studies 2 (1971) : 59-66 ; Ehud R. Toledano, « The Emergence of Ottoman-local elites (1700-1900): a framework for research », dans Middle Eastern Politics and Ideas: a History from Within, I. Pappé et M. Ma’oz (éds.), Londres / New York, I. D. Tauris, 1997 : 145-162. 127
İnalcık, « The Palace » : 76-88 et « Hüsrev Paşa » ; Kunt, The Sultan’s Servants et « Ethnic-Regional (Cins) Solidarity » et « Kulların Kulları ».
Page | 315
pour quiconque souhaite s’élever dans la hiérarchie étatique ottomane, dès le XVIe siècle, les
household des grands dignitaires présentent une alternative tout à fait valable et de plus en
plus pratiquée. Outre que l’intégration à l’école du Palais n’était pas exclue pour les fils de
dignitaires (fils de pachas notamment, mais aussi les fils des princesses), notamment dans le
rang des müteferrika128
, ils pouvaient également se servir de la formation dispensée au sein
même de la maison paternelle ou entrer dans celle d’un autre pacha, souvent un proche ou un
parent129
. Les travaux de Margaret Meriwether et Mary Fay apportent un éclairage
indispensable pour une reconsidération de la place des vakf dans la consolidation et la
transmission des richesses familiales130
.
L’absence de système aristocratique dans la société ottomane scelle l’incapacité des
familles à transmettre par voie d’héritage direct les positions et offices acquis par un parent. Il
faut pourtant se garder d’en conclure tout de suite que les familles de notables ottomans
étaient incapables d’assurer à leurs descendants les moyens de se maintenir, voire de s’élever
encore plus haut. Travailler sur la notabilité ottomane suppose de s’interroger sur les
stratégies élaborées par les familles en vue de la conservation du statut social. Il faut dès lors
commencer par s’interroger sur les critères d’élaboration du statut de notable, de membre de
l’élite. Abraham Marcus, qui a travaillé sur les élites d’Alep au XVIIIe siècle, affirme que
l’appartenance à l’élite est conditionnée par la détention de trois critères : le lignage, la haute
position sociale et la richesse131
. Dans le cas des familles qui nous intéressent, la question du
lignage ne se pose plus : nous avons largement insisté sur les stratégies de commémoration du
lignage dynastique chez les descendants des princesses pour savoir que le haut lignage était
un élément connu autant des descendants que du reste de l’élite. Il nous reste à voir comment
les familles princières raffermissaient leur richesse et assuraient leur maintien à de hautes
positions sociales. Deux directions de travail émergent ici, que nous allons étudier tour à tour.
1. Maintenir son rang : le vakf comme instrument d’affirmation de
la notabilité
La détention de richesses est l’un des critères essentiels, mais non unique, pour
pouvoir prétendre au statut de membre de l’élite, qui suppose un comportement de
128
Sur les müteferrika, voir notamment la notice de Tayyıb M. Gökbilgin, « Müteferrika », İA : t. 8 p. 853-856 et Murphey, Exploring Ottoman Sovereignty : 155-158. 129
Olivier Bouquet a fourni une étude très fouillée de l’éducation des fils de pachas ; bien que son étude corresponde à une période ultérieure à la nôtre, il nous semble que, dans son ensemble, le système n’a pas changé au cours du temps (même si les connaissances exigées ont pu évoluer) : Bouquet, Les pachas du sultan : 107-148. 130
Meriwether, The Kin Who count ; Fay, « Women Place in the Mamluk Household » ; Fay, « Property, Power and the Domain of Gender in Eighteenth-Century Egypt » ; dans le même genre, voir aussi les travaux de Filiz Yenişehirlioğlu, « Architectural Patronage of Ayan Families in Anatolia », dans Provincial Elites in the Ottoman Empire, Halcyon Days in Crete V. A Symposium Held in Rethymno, 10-12 January 2003, A. Anastasopoulos (éd.), Rethymno, Crete University Press, 2005 : 321-342. 131
Abraham Marcus, The Middle East on the Eve of Modernity: Aleppo in the Eighteenth Century, New York, Columbia University Press, 1989 : 38.
Page | 316
démonstration ostentatoire de cette richesse. Néanmoins, Margaret Meriwether rappelle que si
la richesse est un critère indispensable d’appartenance à l’élite, elle ne suffit pas à elle seule
pour permettre à un individu d’accéder au statut d’élite : elle est principalement un vecteur
favorisant l’obtention d’offices et de dignités132
. La richesse devient alors non seulement un
critère d’identification, mais aussi un ingrédient de base pour lier les composants entre eux :
aucune famille ne peut prétendre au rang d’élite sans détenir les richesses indispensables à son
maintien à cette position. Voilà qui pose la question non seulement de la richesse des
princesses, mais surtout des moyens de sa transmission aux descendants.
L’un des moyens privilégiés pour assurer aux descendants la détention de revenus
fixes propres à assurer leur maintien au rang d’élite était le vakf (legs pieux), car le fondateur
était libre de stipuler dans les clauses de sa fondation l’attribution d’offices, de biens et/ou de
revenus à quiconque lui plaisait, qu’il s’agisse d’un descendant, d’un domestique ou
d’inconnus. L’institution du vakf permettait ainsi aux familles de transmettre un héritage, sous
la forme d’offices rémunérés, de rentes ou encore d’avantages financiers divers, sans que le
fisc n’y trouve rien à redire. Par ailleurs, le caractère éternel des vakf favorisait la perpétuation
de ces avantages sur le long terme. Or, les princesses se trouvent être, au même titre que leurs
époux et qu’une grande majorité de la classe dominante, des fondatrices de legs pieux133
. Ceci
nous permet d’étudier les stratégies de transmission de la richesse familiale élaborées par les
princesses ottomanes.
Transmission de la charge de gestionnaire du vakf maternel aux hommes
Parmi toutes les dispositions qu’un fondateur ou une fondatrice pouvait établir par
l’intermédiaire de son legs pieux, la capacité de créer des offices rémunérés n’est pas des
moins avantageuses. L’office le plus important était celui de gestionnaire de la fondation
(tevliyet pour l’office ; mütevelli pour la fonction) : la pratique la plus répandue voulait que la
charge de tevliyet revienne d’abord au fondateur lui-même, de son vivant, puis à ses
descendants, puis à ses affranchis, puis à leurs propres descendants, jusqu’à extinction des
lignées134
. La formulation par laquelle ces prescriptions étaient imposées demeurait
néanmoins, dans la grande majorité des cas, suffisamment générale pour laisser ouvert le
choix du futur mütevelli parmi les divers candidats potentiels : il revenait alors au cadi de
nommer celui qu’il estimait le plus apte à protéger les intérêts du vakf135
. Certaines vakfiyye
132
Meriwether, The Kin Who Count : 36-50. 133
Le chapitre 5 est dédié à cette question du patronage des princesses ottomanes. On y trouvera également des informations quant au fonctionnement général de cette institution dans la société ottomane. 134
Hasan Yüksel, Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Hayatında Vakıfların Rolü (1585-1683), Sivas, Dilek Matbaası, 1998 : 57-61. 135
Des travaux ont mis en évidence les stratégies et conflits que rencontrent les individus dans l’obtention de cet office. Voir notamment Yüksel, Vakıfların Rolü : 57-61 ; Gabriel Baer, « Women and Waqf : An Analysis of the Istanbul Tahrir of 1545 », Asian and African Studies 17 (1983) : 9-27 ; Margareth L. Meriwether, « Women and Waqf Revisited: The Case of Aleppo, 1770-1840 », dans Women in the Ottoman Empire. Middle Eastern
Page | 317
(actes de fondation) se faisaient plus précises, stipulant que soit choisi le plus compétent ou le
plus âgé des candidats, ou tout autre critère jugé significatif par le fondateur ou la fondatrice ;
mais il revenait toujours au cadi d’estimer lequel des prétendants remplissait le mieux ces
critères supplémentaires.
Toutes les vakfiyye ne sont pas aussi générales : certains actes de fondation des
princesses organisent concrètement la transmission de l’office de mütevelli. Dans ces cas,
relativement nombreux, une répartition sexuée se dessine au bénéfice des hommes. Ainsi, dès
le XVe siècle, Selçuk Hatun (fille de Mehmed Ier) exclut ses filles – pourtant citées dans sa
vakfiyye – de la transmission de l’office de gestionnaire au profit des lignées masculines
(affranchis compris) :
« La fondatrice susmentionnée [Selçuk Hatun] a placé, de son vivant, l’office
d’administrateur de sa fondation pieuse susdite entre ses propres mains, puis l’a
confié, à sa mort, à Hamid Ağa fils d’Abdullah, estimable fierté des grands, puis
ses fils et les fils de ses fils, après quoi les meilleurs de ses esclaves affranchis
hommes »136.
Sa propre fille, Hatice Sultane (née Isfendiyaroğlu), en fait de même et tranche en faveur de la
lignée de son fils :
« [Hatice Sultane] a établi la clause selon laquelle l’office de gestionnaire et de
superviseur de ce legs pieux, ainsi que tous les biens tasarruf [qui en font partie]
lui reviendront de son vivant, puis [ils seront transmis] à son fils Süleyman Bey,
fils de Mahmud Bey, fils de Mehmed Pacha ; puis au meilleur de ses enfants ; puis
au meilleur des enfants de ses enfants jusqu’à extinction de la lignée ; après le
meilleur des enfants des enfants de ses enfants, [que la charge soit accordée] au
meilleur de ses affranchis »137
Les princesses fondatrices ultérieures ne s’écartent pas de cette ligne de conduite, qu’il
s’agisse d’Ismihan Sultane138
ou de Fatma Sultane139
(toutes deux filles de Selim II), au XVIe
siècle, ou encore, au XVIIe siècle, de Fatma Hanım Sultane, petite-fille de Murad IV, qui
Women in the Early Modern Era, M. C. Zilfi (éd), Leiden / New York / Köln, Brill, 1997: 128-152 et, du même auteur, The Kin Who Count : 178-206. 136
« mezkûre vakıfa evkafı mezburenin tevliyetini sağ oldukça nefsine, vefatından sonra havassın mabihil iftiharı olan Hamid Ağa bin Abdullah, sonra üredikçe oğullarına ve oğulları oğullarına, bunlardan sonra erkeklerden azdalılarının aslahına aid kıldı » VGMA D 608-2 n°333 : 888 (1483). 137
« bu evkafın tevliyet ve nezaretini ve umumunda tasarrufu kaydı hayat ile kendi nefsine ve badehu oğlu Süleyman Bey ibn’il-merhum Mahmut Bey ibn’il-merhum Mehmet Paşa’ya ve badehu Süleyman Bey’in evlâdının aslahına sonra evlâdı evlâdının aslahına sonra neslen bade ve batnen bade batnin evlâdı evlâdı evlâdının aslahına sonra utekasının aslâhına şart […] eyledi. » VGMA D 581-2 n°374 : 906 (1500). 138
Elle utilise ainsi la formule « ebna-i ebnalarına ve ebna-i ebna-i ebnalarına neslen da’de neslin ». Le terme ebna est le pluriel de bin, fils en arabe : le choix de ce terme qui fait appel à une descendance proprement et exclusivement masculine est volontaire, dans la mesure où la formule plus traditionnelle utilise le terme evlad – les enfants, sans distinction de sexe. VGMA D 572 n°53 : 980 (1572). On sait par ailleurs que les fondations pieuses familiales, aussi bien de la princesse que de son époux, le grand vizir Sokollu Mehmed Pacha, passèrent entre les mains de la famille de leur fils, les Ibrahim Hanzade. 139
VGMA D 732 n°253 : 998 (1589).
Page | 318
remet entre les mains de ses fils la succession à la gestion des vakf familiaux hérités de sa
mère140
.
Certains cas semblent déroger à cette pratique mais, à y regarder de plus près, ils ne
remettent pas en cause ce système. Ils sont en petit nombre, parmi lesquels la fondation de
Mihrimah Sultane (fille de Süleyman Ier), qui institue nominalement sa fille, Ayşe Sultane,
comme mütevelli après sa mort141
: unique héritière du couple, il n’y avait pas de fils à qui
confier cette charge142
. D’ailleurs, les stipulations suivantes reviennent rapidement à la
pratique susdite : Mihrimah Sultane précise en effet, dans une vakfiyye plus tardive, qu’à la
mort de sa fille, les fils de celle-ci (Mehmed Bey, Mahmud Bey et Mustafa Bey) prendront sa
succession à l’office de gestionnaire de son vakf143
. Que l’on n’aille pas croire que le choix
était forcé : Ayşe Sultane avait plusieurs filles, mariées à de grands dignitaires, qui pouvaient
tout à fait être désignées144
. La fille de Süleyman choisit volontairement de favoriser les
lignées descendantes masculines, dès que la possibilité lui fut offerte.
L’association des hommes aux fondations vakf des princesses peut aller parfois au-
delà du cadre des consanguins. Fatma Sultane, la fille de Selim II, choisit d’intercaler son
mari entre elle et ses descendants dans la succession au poste de gestionnaire de sa fondation
pieuse145
, tandis qu’au XVIIe siècle, Atike Sultane prit les dispositions nécessaires pour
instituer une transmission en faveur des descendants de son époux, Kenan Pacha :
« Que la charge de gestionnaire [du legs pieux] soit gratifiée d’une somme
journalière de 10 aspres par jour ; qu’elle revienne en premier à la fondatrice elle-
même [Atike Sultane] puis, à sa mort, aux enfants du défunt pacha susmentionné
[Kenan Pacha] et aux enfants de ses enfants jusqu’à extinction de la lignée »146.
Au XVIIIe siècle encore, la princesse Fatma Sultane (fille d’Ahmed III) stipulait qu’à sa mort,
la charge de tevliyet reviendrait au gendre de son époux, Mehmed Pacha, puis aux
descendants d’Ibrahim Pacha, avant d’être transférée entre les mains de ses affranchis et de
leurs descendants147
. Ce choix en faveur des fils du conjoint, dont la formulation laisse
entendre qu’il s’agit d’enfants issus d’un autre lit, ne s’explique qu’en l’absence d’enfants nés
140
VGMA D 573 n°9 : 1128 (1715). 141
« Kendülerinden sonra nezaret ve tevliyet seyyideti’l-muhadderât, taci’l-mesturat kerime-i mükerremeleri Hanım Ayişe Sultan Hazretleri’ne anlardan sonra evlad-ı zukura ve evlad-ı evladın muide evlad-ı zukur evladına ve evlad-ı evlad-ı evladına meşruta olub » VGMA D 635-2 n°965 (1557) 142
Le couple Mihrimah Sultane – Rüstem Pacha eu d’autres enfants que leur fille, Ayşe, mais ceux-ci décédèrent relativement jeunes. Cf. Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 5 p. 1402 ; Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları : 38-39 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 187-191. 143
« mezbure Ayşe Sultan, ammerehalahu medde’l-ezman hazretlerinin sulbi oğulları, Mehmed Bey ve Mahmud Bey ve Mustafa Bey’e bi inayeti’l-haliki’l-insi ve’l-can evlad-ı emcad-ı kesire ve ensab-ı encab-ı ğafire mukadder ve müyesser olurise evlad-ı zükura bi-emrillahi Te’âla sulbi oğulları munkariz oldukda evlad-ı zükurun evlad-ı evlad-ı evladına ba’dehu inasın evlad-ı zükuruna ve evlad-ı evlad-ı evladına meşruta olub mütevelli olanı nazırola » VGMA D 635-2 n°11 : 978 (1570) 144
Voir l’arbre généalogique de la famille Mihrimah Sultane, Annexes B.19. 145
VGMA D 732 n°253 : 998 (1589). 146
« ve yevmî on akçe vazîfe-i tevliyet olub evvelâ kendilere ba’de vefâtiha merhum Paşa-i müşarun ileyhin evladına ve evlad-ı evladına ile’l-inkiraz meşrut olub ». VGMA D 623 n°20 : 1062 (1652). 147
VGMA D 38 n°3 : 1141 (1729).
Page | 319
de l’union avec la sultane148
. Une princesse sans descendance disposait de plusieurs options :
nommer directement ses affranchis ; confier la responsabilité immédiatement au cadi (ou à
une autre instance décisionnelle, comme le vali) ; ou encore favoriser d’autres lignées
masculines. Quand un tel choix se présentait à une princesse patronne, la tendance allait à
préférer les esclaves affranchis et/ou une instance étatique, plutôt que les descendants de
l’époux : les exemples d’Ayşe Sultane, fille de Murad III149
, ou encore de Zeyneb Sultane,
fille d’Ahmed III150
sont là pour en attester. Les directives de Fatma Sultane sont donc
hautement exceptionnelles, pour une princesse.
Ce tableau comporte des absents : les frères et sœurs des fondatrices et leurs lignées.
D’après Hasan Yüksel, si les lignées collatérales étaient rarement nommées à cette charge, la
pratique n’était pour autant pas totalement inexistante et coïncidait généralement avec des cas
de fondateurs sans descendance151
. Pourtant, aucune princesse ottomane ne préconisa de telles
directives : les sultanes préférèrent déléguer cette responsabilité à leurs affranchis, voire aux
descendants de l’époux (par une autre femme) plutôt que de la transférer à leurs frères ou
sœurs. Le sort réservé à leurs frères justifie leur absence : princes de sang, ils étaient appelés à
devenir sultan, dans le meilleur des cas, à être exécutés ou gardés sous étroite surveillance
pour les autres. Ils ne présentaient pas une option cohérente dans un système destiné à
favoriser la constitution et la préservation d’un patrimoine familial, puisque leur accorder la
responsabilité de la gestion des vakf princiers aurait entraîné l’intégration (et la dissolution) de
la fondation princière dans l’ensemble des vakf relevant du patrimoine impérial. À terme,
cette intégration était certainement inévitable, mais il est intéressant de remarquer que les
princesses choisirent d’en repousser l’échéance, tant qu’il leur était donné d’avoir une
descendance.
Le problème ne se pose pas sur les mêmes bases avec les lignées collatérales des
sœurs. Une princesse telle que Fatma Sultane (fille d’Ahmed III) avait une dizaine de sœurs
vivantes auxquelles elle aurait très bien pu transférer la compétence et la surveillance de ses
fondations : elle ne le fit pas, ni aucune autre princesse de la période classique152
. Il faut y voir
l’expression d’une volonté de démarcation très nette entre les lignées princières, destinée à
maintenir distincts les héritages respectifs des lignages princiers – phénomène qui coïncide
parfaitement avec tout ce que nous avons pu noter par ailleurs dans cette étude. C’était donc à
148
Dans les deux cas présentés ici, l’explication correspond en effet à la situation conjugale des princesses respectives, pour lesquelles on ne connaît aucun enfant (ayant atteint l’âge adulte, pour le moins) issu de leur union avec leur pacha respectif. 149
Cette princesse se montre très précise dans ses choix concernant les futurs gestionnaires de son vakf : après elle-même viendront son propre mütevelli (choix particulièrement pertinent puisqu’il s’occupait déjà de la fondation au nom de la princesse du vivant de celle-ci : il s’agit d’un certain Sefer Ağa bin Abdülmennan, un affranchi donc, très probablement eunuque) et les descendants de celui-ci. Après quoi, elle réclame de transmettre ce poste entre les mains de quelqu’un extérieur à sa maisonnée, stipulant d’exclure ses affranchis (notation et charte tout à fait inhabituelle). VGMA D 2138 n°20 : 1011 (1603), original disponible sous la référence Kasa 86. 150
Après elle-même, elle choisit de remettre la gestion de sa fondation pieuse entre les mains de ses kethüda avant de laisser le choix au nazır (le chef des eunuques noirs).VGMA D 736-3 n°7’ : 1153 (1740). 151
Yüksel, vakıfların rolü : 57-65. 152
Ainsi que nous l’avons vu un peu plus haut, elle préféra remettra la charge de tevliyet entre les mains de la famille de son époux, Ibrahim Pacha. VGMA D 38 n°3 : 1141 (1729).
Page | 320
leur descendance masculine que les princesses choisissaient, de façon préférentielle, de
confier la surveillance de leur héritage, soit non seulement la charge d’en maintenir voire
améliorer les revenus et le prestige, mais encore le droit d’accéder aux richesses qu’un tel
office offrait, comme nous le verrons un peu plus loin. Exclues, les filles se virent néanmoins
dotées de compensations.
Attribution de rentes compensatoires aux filles
L’office (rétribué) de gestionnaire de vakf n’est pas la seule manière pour un fondateur
de legs pieux de permettre la transmission d’une partie de ses richesses à ses descendants ; il
pouvait également prescrire l’attribution de rentes, sans limite de montant ni restriction
concernant le bénéficiaire. Or, dans le cas des fondations des princesses ottomanes, ces rentes
furent accordées, de façon quasi unanime, aux filles des fondatrices, en particulier lorsque
celles-ci étaient exclues du poste de mütevelli.
Les cas de figure sont néanmoins variables et montrent l’absence d’une règle de
conduite stricte. Ainsi Selçuk Hatun, qui avait confié le tevliyet de son vakf aux lignées
masculines, instaura en contrepartie des rentes attribuées à sa descendance féminine :
« La fondatrice susdite [Selçuk Hatun] a stipulé que la somme de 15 dirhems par
jour, prélevés sur les revenus susmentionnés, sera remise à vie à sa fille [litt. celle
née de son sang], Seyyide Hatice Hatun, née d’Ibrahim Bey fils d’İsfendiyar ; on
remettra également, sur les revenus susmentionnés, la somme de 2 dirhems par
jour à la fille de celle-ci, nommée Ayşe Hanım ; puis, à sa mort, cette somme sera
transmise de génération en génération à ses fils et aux fils de ses fils »153.
Dans ce cas présent, le système de balancement est très net : ce ne sont pas seulement les
filles, mais aussi les petites-filles, qui bénéficient de l’attribution de rentes préconisées par la
fondatrice. Mais la préférence féminine s’arrête à ce niveau et retourne ensuite en faveur des
lignées masculines, qui en hériteront (« oğullarına ve oğulları oğullarına »).
Le cas de Mihrimah Sultane est plus confus : n’ayant pour toute héritière qu’une fille,
ce fut elle qui reçut la charge de surveiller la gestion des vakf maternels. Les choses se
compliquent à la deuxième génération. Dans l’une de ses vakfiyye, Mihrimah Sultane impose
une transmission masculine de son tevliyet, comme nous venons de le voir ; dans une autre,
elle accorde des rentes, d’un montant de 50 aspres par jour, à l’ensemble de ses petits-enfants,
sans distinction de sexe : leurs propres enfants hériteront eux-mêmes de cette somme154
. Les
modalités n’en sont cependant pas précises : faut-il comprendre que chaque arrière petit-
enfant recevra 50 aspres par jour ou que l’ensemble des enfants de chaque fils et fille d’Ayşe
153
« Mezbure vakıfa kendisinden doğan kadri yüce Seyyide Hatice Hatun binti İbrahim Bey ibni İsfendiyar Beye kaydi hayatla mezkûr galleden her gün onbeş dirhem verilmesini ve mezkûr galleden Ayşe Hanım namındaki kızına her gün iki dirhem vefatından sonra bu paranın tenaül edüp üredikçe neslen bade ve batnin oğullarına ve oğulları oğullarına verilmesini […] şart kıldı ». VGMA D 608-2 n°333 : 888 (1483). 154
VGMA D 635-2 n°12 : 965 (1558).
Page | 321
se partageront, à proportion égale, les 50 aspres attribués à leur parent ?155
Les rentes laissent
entendre ainsi une logique d’équité entre les descendants, qui ne saurait néanmoins dissimuler
la préférence en faveur des hommes, qui bénéficient non seulement des rentes, mais encore du
tevliyet.
La fille de Selim II, Gevherhan Sultane, ordonne quant à elle la distribution de rentes à
ses deux enfants, un garçon (Salih Bey) et une fille (Hatice Hanım Sultane), à prélever sur le
surplus de son vakf. La somme prévue pour chacun d’eux (réévaluée à la hausse au cours du
temps) est d’abord de 20 puis 70 aspres par jour pour le fils, contre 40 puis 100 aspres par
jour pour la fille !156
Dans ce cas, la compensation se lit dans le montant accordé à la fille :
l’écart des sommes entre le frère et la sœur tient compte des revenus que Salih Bey recevra au
titre de l’exercice du tevliyet, de sorte que tous deux se voient dotés, par l’intermédiaire du
vakf, de revenus quotidiens relativement équitables.
Les princesses fondatrices semblent donc avoir suivi une logique de répartition des
rôles attribués à leurs descendants, qui respecte néanmoins une certaine volonté d’équilibre
des richesses héritées par la voix des vakf. Ce sont certes les hommes qui héritent des
responsabilités principales, non seulement les revenus alloués à l’office de tevliyet mais
encore le prestige que cela confère ; mais cette préférence masculine ne porte pas de réels
dommages financiers aux filles, qui recevaient une compensation pécuniaire relativement
équivalente, sous forme de rentes. Or, seul un des descendants pouvait espérer devenir
mütevelli du vakf maternel, sans engagement de durée157
, quand au contraire les rentes, parce
qu’individuelles et à vie, étaient garanties aux filles : les filles n’étaient donc pas plus mal
loties que leurs frères.
Le motif d’une telle répartition sexuée soulève quelques interrogations. La
documentation ne fournit aucune forme d’explication, mais des indications d’ordre social
peuvent être invoquées. Les hommes, par leurs facilités sociales – mobilité,
autoreprésentation, indépendance –, présentent un profil avantageux pour représenter les
intérêts de la fondation. Les femmes, en revanche, subissaient des pressions sociales destinées
155
Des réponses à ces questions peuvent être apportées, sous réserve de mener une étude approfondie des registres de compte du vakf de Mihrimah Sultane, disponibles aux archives du Başbakanlık, à Istanbul. C’est un travail que nous nous sommes finalement résolues à ne pas entreprendre, pour deux motifs : d’une part, l’exercice (qui serait fort instructif) nous aurait amenée à nous écarter de notre problématique actuelle ; d’autre part, le nombre et la difficulté des documents considérés auraient requis un travail de plusieurs années de déchiffrage, qu’il aurait fallu encore reproduire pour chaque vakf de princesse (pas souci d’équilibre). C’est donc une tout autre thèse qu’il aurait fallu mener, que nous préférons laisser à d’autres temps ou personnes. 156
VGMA D 742 n°67 : 1018 (1609) ; D 742 n°68 : 1032 (1623). 157
L’office étant, par nature, indivisible, il s’ensuivait des conflits familiaux réguliers entre les divers prétendants réclamant pour eux l’exercice du tevliyet (avec les revenus et honneurs qui lui étaient associés). Les filles n’hésitaient pas à faire appel au tribunal pour réclamer l’obtention de l’office en leur faveur : non seulement leur position était reçue par le juge (preuve qu’elle était légale), mais encore certaines, dans des familles moins élevées sur l’échelle sociale, parvinrent-elles à convaincre les cadis. Meriwether, « Women and Waqf Revisited » : 128-152 et The Kin Who Count : 178-206. Les cas de conflits ne concernent néanmoins pas des familles princières et nous n’avons trouvé trace d’aucun conflit de ce genre dans le cas des familles des princesses ottomanes, ce qui nous amène à penser que le recours au tribunal de justice ne faisait probablement pas partie des pratiques en cours dans ces familles, qui préféraient sans doute éviter une action publique et favoriser des solutions plus discrètes.
Page | 322
à restreindre leur ingérence dans les affaires publiques : les discours religieux militaient en
faveur d’une réclusion plus stricte des femmes “nobles” (« muhaderre ») au sein de l’espace
domestique. Celles qui s’y refusaient ou étaient contraintes, par leur situation sociale, d’en
sortir pour travailler, mettaient en danger leur réputation – mais aussi, dans une certaine
mesure, leur statut, par le simple fait de pénétrer dans la sphère publique masculine158
. Le
moins qu’on puisse dire, c’est qu’à l’époque moderne, les femmes n’étaient pas encouragées à
détenir des offices, dans la mesure où cette situation les amenait nécessairement à investir un
espace voulu comme masculin. Arguons que la nomination d’une femme à un office de
tevliyet ne signifiait pas qu’elle allait être amenée à déambuler sans fin dans les rues mais,
selon les pratiques en cours, qu’elle allait déléguer l’exécution de ses tâches et démarches à
son kethüda (ou quiconque d’autre, au sein de sa maison, digne de la représenter), elle-même
se contentant de faire entendre ses ordres depuis l’espace clos et protecteur de son harem
(n’enfreignant ainsi aucune loi de la bienséance féminine) : un homme présentera malgré tout
l’avantage de l’absence totale de restrictions sociales à son égard et une capacité et liberté
d’action incomparables à celles d’une femme. Par ailleurs, les hommes avaient accès à une
formation plus complète, leur éducation prévoyant de telles responsabilités futures, quand il
est douteux que les meilleures éducations féminines s’y soient employées159
.
La nomination d’hommes au poste de tevliyet n’est cependant pas sans comporter
quelques inconvénients majeurs. Si les hommes étaient mieux formés aux tâches
administratives et aux responsabilités publiques, c’est parce que la société prévoyait pour eux
un rôle professionnel, quand celui des femmes était domestique. Les descendants de
princesses étaient amenés à investir les carrières militaro-administratives ou juridico-
religieuses de l’État. Or, il n’existait aucune règle à l’encontre du cumul des postes : rien
n’interdisait d’être gestionnaire d’un vakf en sus de la détention d’un office quelconque.
Prenons l’exemple d’un bey, mütevelli du vakf familial. Les responsabilités associées à sa
dignité de bey accaparaient déjà une grande partie de son temps, le rendant moins disponible
pour s’occuper au mieux de la fondation. Le jeu des affectations était tel qu’il avait de fortes
chances d’être envoyé en poste loin de la capitale et du vakf dont il avait la charge. Le cumul
des postes impliquait ainsi forcément une déficience (d’intérêt, de temps, de conditions
pratiques) dont le vakf ne pouvait que souffrir dans sa gestion quotidienne160
. Il ne restait plus
158
Leslie P. Peirce, « Domesticating Sexuality : Harem Culture in Ottoman Imperial Law », dans Harem Histories: Lived Spaces and Envisioned Places, M. Booth (éd.), Durham / Londres, Duke University Press, 2010 : 104-135 ; idem, « Le dilemme de Fatma » ; idem, « ‘The Law Shall not Languish’ : Social Class and Public Conduct in Sixteenth-century Ottoman Discource », dans Hermeneutics and Honor. Negotiating Female ‘Public’ Space in Islamic/ate Societies, A. Asfaruddin (éd.), Cambridge (Center for Middle Eastern Studies), Harvard University, 1999 : 140-158. 159
Sur la question de l’éducation féminine, voir notamment l’article de Nadia Maria El Cheikh, « Observations on Women's Education in Medieval Islamic Societies », dans F. Georgeon et K. Kreiser (éds.), Enfance et jeunesse dans le monde musulman, Paris, Maisonneuve et Larose, 2007 : 57-72.ainsi que Davis, The Ottoman Lady : 45-60. Un autre inconvénient s’élevait encore contre la nomination de femmes au tevliyet : leur dépendance, soumission même à l’autorité masculine. Une femme était amenée à se marier, c’est-à-dire à passer sous l’autorité – même relative – d’un époux extérieur à la famille : les princesses préférèrent peut-être s’épargner les conséquences éventuelles d’un tel choix, sauf à y être contrainte par l’absence d’héritier mâle. 160
D’autant plus que le cumul des charges pouvait être au niveau des offices de tevliyet eux-mêmes : il n’est pas rare que les deux parents aient établi, chacun de leur côté, un vakf dont la gestion pouvait, par le jeu des circonstances, retomber entre les mains d’une seule et même personne.
Page | 323
à ce bey qu’à charger son kethüdâ de la gestion quotidienne des activités du vakf en son
nom161
: qu’est-ce qui le distinguait, dès lors, du mode de gestion qu’aurait proposé sa sœur
ou sa tante ?
Exemple imaginaire, situation improbable ? Tant s’en faut. Sans empiéter sur les
explications du chapitre suivant, avançons que la majorité des descendants des princesses
exerçaient une activité professionnelle au sein de l’organe étatique. Certes, il n’est pas
toujours possible d’établir une corrélation entre les individus mentionnés dans les vakfiyye et
ceux dont il est question dans les chroniques et dictionnaires biographiques : nous ne sommes
donc pas en capacité d’affirmer de façon systématique que les descendants des princesses
fondatrices de vakf cumulèrent la charge de tevliyet à d’autres offices. Tout semble même
indiquer que certaines familles, pour le moins certains de ces individus, se contentèrent de
profiter des revenus tirés du vakf familial pour mener une vie de rentiers, sans s’inquiéter le
moins du monde de réaliser des carrières étatiques : les Ibrahim Hanzade en sont d’ailleurs un
exemple particulièrement révélateur162
. Cependant, si l’on considère la récurrence avec
laquelle des descendants de princesses exercèrent un office quelconque dans l’organisation
militaro-administrative ou palatiale ottomane, force est de constater qu’il dut bien y avoir des
cumuls de charges relativement réguliers163
.
En conclusion, la répartition choisie par les princesses fondatrices concernant l’octroi
des offices rémunérés et des rentes semble procéder d’une logique raisonnée, reflet autant de
l’intériorisation du discours sur la répartition sexuée des rôles sociaux que d’un souci de
répondre aux besoins de chacun. De fait, parce que les filles étaient amenées à se marier (à
des hommes hauts placés, selon les pratiques matrimoniales que nous avons vues
précédemment), il revenait à l’époux de subvenir à leurs besoins quotidiens : elles ne
souffraient pas des mêmes besoins financiers que leurs frères, dont les richesses étaient une
nécessité pour soutenir d’éventuelles prétentions professionnelles ou tout simplement
conserver leur rang. Le besoin pourrait ainsi expliquer la logique motrice de cette répartition :
tout laisse à penser que les princesses avaient à cœur, au travers de leurs fondations pieuses,
d’accorder à leurs descendants les moyens d’un maintien dans les rangs des membres de
l’élite. Si les dispositions variaient, c’est que les besoins n’étaient pas les mêmes, selon qu’on
était homme ou femme.
161
Il s’agit là d’une pratique récurrente des hauts fonctionnaires de l’État, que les princesses et leurs descendants ne font que répéter. Le phénomène a été étudié par Yüksel, Vakıfların Rolü : 55-80. 162
À l’exclusion néanmoins d’Ibrahim Han lui-même, qui s’éleva jusqu’au poste de vizir. Sur les Ibrahim Hanzade, cf. Bacqué-Grammont, Laqueur, Vatin, « Stelae Turcicae II » : 48-51 ainsi que Gökbilgin, « İbrahim Han ». 163
Ainsi, parmi les petits-fils de Mihrimah Sultane qui bénéficièrent de l’attribution de rentes et qui héritèrent de l’office de tevliyet à la mort de leur mère, apparaissent un certain Abdurrahman Bey et un certain Mehmed Ağa. Or, dans les renseignements fournis par ailleurs dans les autres sources, on retrouve un Abdurrahman et un Mehmed, tous deux devenus Pacha. Quant à leurs frères, dont il n’est pas question dans la vakfiyye, tous eurent des carrières dans l’administration impériale. Quel que soit celui d’entre eux qui devint mütevelli de l’énorme vakf familial du couple Mihrimah Sultane et Rüstem Pacha, il cumulait nécessairement cet office avec un autre. Pour le détail de la famille, voir l’arbre généalogique de la descendance de Mihrimah Sultane, Annexe B.19. ; il sera question plus loin de l’importance de ce vakf familial.
Page | 324
Des revenus en adéquation avec le rang de la famille
Il ne suffit pas de démontrer l’existence de ces dispositions et leur logique sexuée, il
faut encore comprendre en quoi elles différaient de celles pratiquées par le reste de la société
et en quoi elles permettaient d’assurer aux descendants le maintien du statut d’élite. Pour ce
faire, il nous faut comparer les sommes allouées aux descendants par le biais des vakf des
princesses à ceux que les autres membres de l’élite attribuaient à leurs propres descendants164
.
Au XVe siècle, la rétribution du mütevelli s’élève, d’après nos sources, à un montant
de quelques dirhems par jour (Fatma Hatun prévoit une rétribution s’élevant à 1,5 dirhem par
jour pour le mütevelli)165
; au XVIe siècle, il avoisine les 50 aspres par jour (40 puis 50 aspres
par jour pour la fondation de Mihrimah Sultane166
, 50 pour les fondations d’Ismihan
Sultane167
, de Fatma Sultane168
et d’Ayşe Sultane169
). L’augmentation est considérable : elle
s’explique au vu du contenu des fondations pieuses respectives de ces princesses, dont
l’importance (tant en terme de services et de bâtiments financés que de revenus alloués aux
fondations) accroît de façon exceptionnelle entre le XVe et le XVI
e siècle
170. Ces montants
diminuent néanmoins dès le siècle suivant, mais couvrent alors une fourchette plus ouverte.
Pour la période des XVIIe
et XVIIIe
siècles, ils s’échelonnent entre quelques aspres à une
centaine par jour : le mütevelli de la fondation de Safiyye Sultane, fille de Mustafa II, se voit
doté d’un revenu de deux aspres par jour ; quatre pour celui d’Esma Sultane, fille d’Ahmed
III, six pour celui de sa sœur, Emine Sultane, mais 15 pour celui de Fatma Hanım Sultane,
petite-fille de Murad IV, et 120 pour celui de Fatma Sultane, autre fille d’Ahmed III171
. La
fondation de Fatma Sultane fait ici figure d’exception : elle est la seule à prévoir des sommes
en augmentation par rapport au XVIe siècle, quand toutes les autres princesses revoient les
rétributions du mütevelli à la baisse. Cette diminution générale est néanmoins en accord avec
la taille et l’importance des fondations créées par les princesses au cours de ces deux
siècles172
. Tout indique que le revenu du mütevelli d’un vakf était plus ou moins proportionnel
à la somme investie dans la fondation et à l’importance de ses réalisations.
164
L’estimation de leurs revenus est loin d’être une affaire aisée, dans la mesure où les sources doivent souvent être mises en parallèle pour permettre de reconstituer le montant total. La période des XV
e – XVI
e
siècle offre, sur ce point, certaines facilités, dans la mesure où les vakfiyye sont plus complètes, moins démultipliées dans le temps. 165
VGMA D 608-2 n°333 : 888 (1483). 166
VGMA D 635-2 n°12 : 965 (1558) ; D 635-2 n°11 : 978 (1570). 167
VGMA D 572 n°53 : 980 (1572). 168
VGMA D 732 n°253 : 998 (1589). 169
VGMA D 2138 n°20 : 1011 (1603), original conservé sous la référence Kasa 86. 170
Voir le Chapitre 5.II.3.1. 171
VGMA D 734 n°164 : 1138 (1725) ; D 740 n°50 : 1177 (1763) ; D 736-3 n°44 : 1152 (1739) ; D 623 n°299 : 1138 (1725) ; D 38 n°3 : 1141 (1729). Une question cruciale se pose, concernant les fondations de cette période : en présence de plusieurs vakfiyye complémentaires, faut-il additionner les revenus accordés au mütevelli ? Cela ne nous semble pas être le cas, mais il convient de souligner que si tel était, les montants des revenus des mütevelli seraient alors plus importants, mais quasi impossibles à évaluer, sinon à être certain d’avoir regroupé et retrouvé l’ensemble des documents de fondation d’un personnage. 172
Voir le Chapitre 5.II.2.3. et 5.II.2.4.
Page | 325
Les rentes “compensatoires” suivent les mêmes courbes et, partant, les mêmes
logiques. Ainsi, elles s’élèvent à quelques dirhems par jour au XVe siècle
173, pour passer
ensuite à une échelle plus importante, selon une fourchette qui s’étend de plusieurs dizaines à
plusieurs centaines d’aspres par jour, au XVIe
siècle174
. Néanmoins, il faut également noter
l’absence de rentes accordées aux descendant(e)s des princesses ottomanes pour la période
des XVIIe-XVIII
e siècles – un phénomène qu’il faut peut-être mettre en parallèle avec le fait
que bon nombre des princesses fondatrices de cette période eurent pour seule héritière leur
fille.
Une liste de chiffres sans comparaison se révèle rarement de grande utilité ; il convient
de la mettre en parallèle avec les montants attribués aux descendants des autres membres de
l’élite dans l’espoir de pouvoir répondre à cette question : les princesses dotaient-elles mieux
leurs descendants que la normale ? Mais trouver des éléments de comparaison n’est pas une
mince affaire175
. En l’absence de données immédiatement disponibles pour la comparaison, il
a fallu réfléchir aux moyens d’établir nous-mêmes cette base comparative. Fort heureusement,
l’historien dispose des Vakıflar Tahrîr Defterleri publiés, dont celui datant de l’an 1009 de
l’Hégire, soit l’année 1600, pour la ville d’Istanbul176
. Les données fournies dans ce registre
ont été réparties selon le tableau qui suit177
.
173
Les rentes que Selçuk Hatun, fille de Mehmed Ier, accorde à sa fille et à sa petite-fille s’élèvent à respectivement 15 et 2 aspres par jour. VGMA D 608-2 n°333 : 888 (1483). 174
Şah Sultane, fille de Selim Ier, accorda 50 aspres par jour de rente à sa fille, Ismihan Sultane – rente transmissible à ses descendants jusqu’à extinction de la lignée : VGMA D 1993 n°7 : 977 (1569) ; Gevherhan Sultane prévoit ainsi des rentes de 40 et 50 aspres par jour pour son fils et sa fille : VGMA D 742 n°67 : 1018 (1609) réévalués quelques années plus tard à 70 et 100 aspres par jour : D 742 n°68 : 1032 (1623). Fatma Sultane, cas relativement rare lorsqu’il s’agit des princesses, prévoit une rente pour sa mère, qu’elle évalue à 60 aspres par jour : VGMA D 732 n°254 : sans date ; enfin Mihrimah Sultane se présente en grande bienfaitrice de sa fille : elle lui accorde une rente journalière de 200 aspres par jour, qui viennent s’ajouter à son revenu en tant que mütevelli (d’abord 40 puis 50 aspres par jour) ainsi que 50 aspres par jour à chacun des enfants de sa fille, aussi bien garçons que filles – revenus dont leurs propres enfants hériteront, jusqu’à extinction de la lignée : VGMA D 635-2 n°12 : 965 (1558). 175
Hasan Yüksel a procédé à une étude dans ce sens (un de ses tableaux montre la répartition des dotations financières des fondateurs pour l’office de tevliyet), mais qui s’est vite révélée peu exploitable, dans la mesure où son travail ne couvre que le XVII
e siècle, soit une période au cours de laquelle nous avons très peu de
fondations établies par des princesses. Par ailleurs, il n’établit aucune distinction selon le rang social des fondateurs ; or, comparer la fondation d’un esclave affranchi établissant sa maison en vakf pour sa descendance à celle d’une princesse ayant construit un vaste complexe se révélerait peu instructif : la différence de moyens des fondateurs respectifs suffirait à expliquer en soi la différence des dotations aux mütevelli. Cf. Yüksel, Vakıfların Rolü : 229. 176
Canatar (éd.), İstanbul Vakıfları Tahrîr Defteri : 1009 / 1600 tarihli. Un autre exemple du genre avait déjà été publié par Barkan et Ayverdi, İstanbul vakıfları tahrîr defteri: 953 (1546) târîhli, qui date pour sa part de l’année 1546. Celui publié par Canatar nous a semblé plus utile parce qu’il tenait compte de toute la période jusqu’à la fin du XVI
e siècle, période au cours de laquelle les princesses ottomanes entreprirent de nombreuses
fondations dans Istanbul. À ce sujet, voir le chapitre suivant (5.II.2.). Par ailleurs, cela permettait de faire le lien avec les données fournies par Yüksel, qui couvre le siècle suivant. 177
Le montant accordé par les fondateurs à leur mütevelli a été réparti en six fourchettes de revenus (entre 0 et 5 aspres, 6 et 10, etc.). Cependant, seuls certains personnages ont été retenus dans cette étude, à savoir ceux au service de l’État : les pachas, les beys, les ağa, les personnages religieux, les personnages tels que kethüda, çelebi, subaşi, çavuş etc., enfin les femmes appartenant à ces catégories par lien du sang (les filles de pacha, de bey, de cheikh et autres). Contrairement à Yüksel, nous avons préféré situé la fourchette la plus basse entre 0 et 5, car dans le registre consulté, il apparaît à de très nombreuses reprises que les dotations
Page | 326
Tableau 4.21. Les dotations des mütevelli des fondations d’Istanbul selon le registre de l’année 1600
0 – 5 6 – 10 11 – 20 21 – 30 31 – 60 61 – 150
Pachas 4 4 1 4 2 0 15
Beys 89 21 2 1 0 0 113
Ağa 26 2 3 0 0 0 31
Personnages
religieux
(cheikhs,
imams, etc.)
29 2 2 0 0 0 33
Divers
(Kethüda,
Çelebi,
Çavuş,
Subaşı, etc.)
65 7 2 0 0 0 74
Femmes
(filles de
personnages
répondant
aux
catégories
précédentes)
23 5 0 1 0 0 29
236 41 10 6 2 0 295
Si l’on en croit les résultats fournis par ce tableau, la grande majorité des dotations se
situaient dans la fourchette la plus basse, entre 0 et 5 aspres par jour178
. Seuls les pachas et
une femme, la Valide Sultane, assurèrent des revenus plus élevés à leurs mütevelli : entre 21 et
30 aspres pour la plupart, deux fondations seulement prévoyant des revenus situés entre 31 à
60 aspres. La fourchette la plus élevée (de 61 à 150 aspres) ne comprend aucune occurrence :
seuls les sultans, dont les fondations n’ont pas été prises en compte dans ce tableau, prévoient
des dotations aussi importantes pour leur mütevelli. Le tableau fourni par Hasan Yüksel pour
la période suivante du XVIIe siècle montre des résultats similaires : plus la fourchette est
élevée, moins le nombre de dotations est important179
. En conclusion, la majorité des
fondateurs, pourtant des individus de condition sociale aisée, membres de l’élite (bien qu’à
des degrés variables), n’accordent que des revenus relativement faibles aux mütevelli de leurs
fondations. Seuls les pachas, soit le sommet de l’élite ottomane masculine, et les reines mères
(sommet de l’élite palatiale féminine), prennent des dispositions financières plus favorables à
leur mütevelli, mais qui excèdent rarement les 30 aspres par jour.
Voilà maintenant le tableau des dotations journalières des mütevelli des princesses aux
XVe, XVI
e et XVII
e siècles.
journalières étaient inférieures à 1 aspre : 0,5 dans certains cas, encore moins dans un grand nombre d’autres cas. 178
Il faut même penser que dans la majorité des cas, le montant de la dotation journalière était inférieur à un aspre par jour ; pour ces fondateurs, attribuer un revenu journalier de deux ou trois aspres était déjà fort honorable ; cinq aspres par jour est relativement rare et dénote déjà une volonté de doter son mütevelli au-dessus de la moyenne. 179
Yüksel, Vakıfların Rolü : 229.
Page | 327
Tableau 4.22. Les dotations des mütevelli des fondations des princesses à Istanbul
0 – 5 6 – 10 11 – 20 21 – 30 31 – 60 61 – 150
XVe s. - Fatma
(f. Bayezid II)180
- Hadice (pte-f. Mehmed Ier)
181
- Neslişah (pte-f. Bayezid II)
182
= 3
- Fatma (pte-f. Bayezid II)
183
- Hanzade (pte-f. Bayezid II)
184
= 2
XVIe s. - Ayni ( ?? )
185
= 1
- Hadice (pte-f. Bayezid II)
186
= 1
- Ayşe (f. Murad III)
187
- Fatma (f. Selim Ier)
188
- Ismihan (f. Selim II)
189
- Mihrimah (f. Süleyman Ier)
190
= 4
- Ayşe (pte-f. Süleyman Ier)
191
- Gevherhan (f. Selim II)
192
= 2
XVIIe
s.
- Atike (f. Ahmed Ier)
193
= 1
- Fatma (pte-f. Murad IV)
194
= 1
- Kaya Ismihan (f. Murad IV)
195
= 1
Les dotations sont mieux réparties sur l’ensemble des fourchettes, sans que cela ne
dissimule pourtant la tendance à l’augmentation des sommes attribuées aux mütevelli des
fondations pieuses des princesses, jusqu’à la fin du XVIIe siècle. Ce tableau ne tient
volontairement pas compte du XVIIIe siècle parce qu’il n’existe pas d’éléments de
comparaison avec le reste de la société. Cependant, on constate à cette époque une diminution
générale des revenus accordés par les princesses à leur mütevelli. Le modèle de dotations
journalières des mütevelli des princesses s’approche de celui des pachas, avec cependant des
revenus généralement plus élevés : seuls deux pachas accordaient des rétributions s’élevant
entre 31 et 60 et aucun au-delà des 60 aspres, tandis qu’on trouve, dans ces mêmes
fourchettes, respectivement quatre et deux dotations pour les fondations des princesses. Ce
180
VGMA D 581-2 n° 428 : 915 (1509) 181
VGMA 581-2 n° 374 : 888 (1483) 182
VGMA D574 n° 35 : 949 (1542) 183
VGMA D 584 n° 71 : 939 (1532) 184
Canatar (éd.), İstanbul Vakıfları Tahrîr Defteri : 1009 / 1600 tarihli : n° 3244 p. 716. 185
Canatar (éd.), İstanbul Vakıfları Tahrîr Defteri : 1009 / 1600 tarihli : n° 3242 p. 715. 186
Canatar (éd.), İstanbul Vakıfları Tahrîr Defteri : 1009 / 1600 tarihli : n° 3044 et 3045 p. 664-665. 187
VGMA Kasa 86 et 2138 n°20 : 1011 (1603) 188
VGMA D 732 n° 253 : 998 (1589). 189
VGMA D 572 n° 53 : 980 (1572) 190
VGMA D 635-2 n° 8 : 965 (1558). Notons cependant que le mütevelli cumule également la charge de nezaret. 191
VGMA D 635-2 n°6 : 1034 (1624). La somme de 100 aspres par jour tient cependant compte du cumul du poste de tevliyet et nezaret dans les mains de la même personne. 192
VGMA D 742 n° 67 : 1018 (1609) 193
VGMA 623 n° 20 : 1062 (1652) 194
VGMA D 623 n°299 : 1138 (1726) 195
VGMA D 623 n° 298 : 1138 (1726)
Page | 328
phénomène est d’autant plus surprenant que les œuvres des princesses sont rarement de même
importance que celles des pachas : à l’exception du XVIe siècle, les pachas entreprirent des
vakf bien plus grands et dispendieux que les sultanes196
. Les fortes dotations journalières
accordées aux mütevelli des fondations princières ne s’expliquent que si l’on considère qu’ils
sont l’expression de la volonté des princesses d’assurer des revenus importants à leurs
descendants – au moins jusqu’à la fin du XVIIe siècle.
Les dotations journalières sous forme de salaire (pour l’office de tevliyet) ou de rentes
n’étaient cependant pas le seul héritage que les princesses transféraient à leur descendance par
l’intermédiaire des vakf. Les mütevelli percevaient également le montant des surplus produits
par le vakf – après acquittement de toutes les dispositions établies par la fondatrice. Or, divers
éléments laissent à penser que ceux-ci pouvaient représenter une somme annuelle
considérable : c’est ce qui expliquerait que de nombreuses dispositions soient prises
concernant ces surplus (actions de charité, réparations et restaurations diverses). Le montant
de ces surplus pouvait donc représenter des sommes non négligeables, qui n’étaient pas
systématiquement utilisées ni affectées par la fondatrice. Ces surplus reviennent pourtant
systématiquement au mütevelli, c’est-à-dire en général à l’un des descendants de la fondatrice,
ainsi que nous l’avons montré plus haut. Cette somme vient ainsi augmenter ses revenus, telle
une “prime de fin d’année”.
D’autres avantages s’ajoutent encore à cette liste, tels les biens tasarruf, qui sont des
biens (domaines agricoles, fermes ou biens immobiliers) dont l’usufruit est laissé au
détenteur, qui peut le transmettre à ses héritiers. Les exemples les plus représentatifs, mais
aussi les plus récurrents, sont les palais et yalı des fondatrices. Il ne s’agit pas là d’une
spécificité propre aux princesses : outre qu’on retrouve des exemples de cette pratique
remontant à l’époque des compagnons du Prophète, l’action de transformer en vakf sa propre
habitation, pour la réserver à l’usage personnel du fondateur et de ses descendants, est une
pratique traditionnelle de l’institution du vakf dans l’Empire ottoman197
. Les princesses
ottomanes firent cependant grand usage de cette licence. Très tôt, dès le XVe siècle, elles
transformèrent leur résidence en vakf, permettant à leur famille d’en garder l’usage et le
contrôle. Cette pratique s’intensifia à partir du XVIe siècle, puis aux siècles suivants.
Si le principe est simple, dans la pratique, les choses sont plus compliquées : à qui
revenait le palais quand la princesse avait plusieurs enfants ? Les renseignements fournis par
les actes de fondation ne sont pas assez explicites pour permettre de dresser des conclusions
générales, bien qu’une préférence semble se dessiner en faveur des filles. Dans la majorité des
cas, ce sont elles qui héritent du palais maternel (parfois également de celui du père en
sus)198
: Ismihan Sultane hérite du palais de sa mère, Şah Sultane, fille de Selim Ier ; Ayşe
Sultane de ceux de Mihrimah Sultane, fille de Süleyman Ier ; Safiyye Hanım Sultane de celui
de Kaya Ismihan Sultane, fille de Murad IV ; Zahide Hanım Sultane de celui de Safiyye
196
Cf. Chapitre 55.I.2. et 5.II.2. 197
Nous y reviendrons au prochain chapitre 5.III.2.1. 198
C’est le cas notamment de Ayşe Sultane, fille de Mihrimah Sultane et de Rüstem Pacha, qui hérite de l’ensemble des palais de ses parents, cinq en tout : sa position d’unique héritière explique la concentration entre ses mains de tous les biens de ses parents, faisant d’elle une des plus riches héritières de la période.
Page | 329
Sultane, fille de Mustafa II199
. Néanmoins, ces exemples correspondent également à des cas
d’héritière unique. Notons encore que la dotation de palais concerne essentiellement les filles
de sultan, les descendantes indirectes étant absentes de cette pratique. Dans la mesure où elles
héritaient des palais de leurs parents, on peut penser qu’elles n’avaient pas de motif à chercher
à faire de nouvelles acquisitions et ne disposaient donc pas de palais personnels à transformer
en vakf.
Ces données doivent être mises en perspective avec les réflexions plus générales
menées sur la question de la richesse. Et pour cela, il convient de se rapporter aux discussions
menées par les historiens sur le sujet, tels Uriel Heyd200
, Halil Inalcık201
, Haim Gerber202
et
Metin Kunt203
. D’après ces auteurs, l’appartenance à la classe moyenne était déterminée par la
détention d’une richesse comprise entre 10 000 (pour Inalcık) ou 20 000 (pour Gerber) et
100 000 aspres de revenu annuel : l’élite supérieure était détentrice d’une richesse dépassant
les 100 000 aspres. Un salaire ou une rente de 50 aspres par jour correspondait à un total de
18 000 aspres par an204
; un salaire de 100 aspres par jour (perçu par exemple par la petite-
fille de Süleyman Ier, Ayşe, et par la fille de Selim II, Gevherhan) représentait un revenu
annuel de 36 000 aspres.
Ces montants seuls ne suffisent donc pas à faire des descendants des princesses des
membres de l’élite supérieure, mais ils les placent déjà dans la classe moyenne. Or, si l’on
tient compte du fait qu’il ne s’agit là que d’une partie de leur richesse acquise par héritage, à
laquelle venait s’ajouter l’héritage paternel ainsi que leurs propres revenus, il faut convenir
que les princesses eurent soin de doter leurs descendants des moyens nécessaires à leur
maintien à un rang élevé dans la société ottomane. Ainsi Ayşe Sultane, fille de Mihrimah
Sultane et de Rüstem Pacha, jouissait à elle seule d’un revenu de 550 aspres par jours, grâce
aux revenus cumulés des fondations de ses parents ; soit un revenu annuel de 218 000 aspres –
plus du double de la somme minimum pour appartenir à l’élite supérieure ! Elle n’était pas la
seule : Ibrahim Han, fils d’Ismihan Sultane et Sokollu Mehmed Pacha, pouvait aussi se
contenter de ses revenus dérivés des fondations parentales pour vivre selon son rang205
.
Les exemples donnés ci-dessus ne constituent cependant qu’une part infime des cas ;
la plupart des princesses n’étaient pas capables d’assurer des revenus ou rentes de 50 aspres
ou plus par jour à leurs descendants. Le vakf fut donc bel et bien, pour les sultanes, un moyen
d’assurer l’avenir de leurs descendants mais, à quelques exceptions près, l’héritage transmis
par le vakf ne suffisait pas pour leur maintien au même rang que celui des princesses elles-
mêmes : ces revenus leurs permettaient seulement de se prévaloir de leur appartenance à une
élite stambouliote intermédiaire.
199
Voir les fiches récapitulatives des vakf de ces princesses (annexes E.1 à E.24.). 200
Heyd, Studies in Old Ottoman Criminal Law, Oxford, Clarendon Press, 1973. 201
İnalcık, The Ottoman Empire : 162. 202
Gerber, « Social and Economic Position of Women ». 203
Kunt, The Sultan’s Servants : 51-56. 204
Le calcul est fait sur une base de 12 mois de 30 jours, c’est-à-dire la base de calcul prise par les scribes du palais, ainsi qu’il apparaît dans les registres de compte que nous avons étudiés précédemment. Cf. Chapitre 1.I.2. 205
Bacqué-Grammont, Laqueur, Vatin, « Stelae Turcicae II » : 48-51 ainsi que Gökbilgin, « İbrahim Han ».
Page | 330
2. Infiltrer les carrières militaro-administratives
La richesse était certes un critère déterminant, mais ne suffisait pas pour prétendre
appartenir à l’élite. Encore fallait-il s’assurer de leur insertion dans les rangs
socioprofessionnels de cette élite. Pour cela, deux types de carrières étaient envisageables :
entrer dans les rangs de la hiérarchie militaro-administrative ou dans les branches juridico-
religieuses. À travers l’étude des carrières des descendants des princesses, c’est la question de
la capacité politique des princesses qui est en jeu : il s’agit de déterminer l’habileté des
lignages princiers à assurer leur propre reproduction à l’apex de l’élite ottomane. Dans la
mesure où les femmes étaient exclues de la détention des offices étatiques, seuls les hommes
issus des familles princières vont nous intéresser ici. Un premier problème se pose : celui de
la représentativité des informations collectées. Le nombre de descendants de princesses
(toutes générations confondues) pour lesquels nous disposons de quelques informations
n’excède pas la cinquantaine d’individus, un bien faible chiffre au regard de celui des
descendantes indirectes qui s’élève à près du triple. Les résultats qui suivent ne sont valables
qu’en l’état des connaissances, sans prétention à une quelconque généralisation au-delà du cas
des individus présentement concernés. À cela s’ajoute le fait que les informations glanées au
gré des sources permettent rarement de reconstituer l’ensemble des carrières de ces individus.
Il n’est dès lors pas envisageable de traiter la question comme elle le mériterait, mais
seulement d’apporter quelques premiers éléments de réflexion sur le sujet.
Si les sources ne permettent pas de reconstituer l’ensemble de la carrière des
sultanzade, elles fournissent néanmoins des informations sur le titre qu’ils parvinrent, en
dernier lieu, à acquérir. Nous avons choisi d’utiliser ces titres comme reflet d’une position
sociale, dans la mesure où, à la période moderne (ce n’est plus le cas par la suite), de façon
générale, les titres étaient associés à des offices – les cas d’usurpation mis à part,
probablement moins rares qu’il n’y paraît. Il est vrai qu’un même titre peut être associé à
plusieurs fonctions, mais leur rang dans l’édifice étatique est alors similaire. Seuls quatre
titres apparaissent dans la documentation : Aga206
, Bey207
, Pacha208
et Efendi209
. Leur
répartition selon les générations est la suivante :
206
« En tant que titre, jusqu’à la période des réformes, et même, dans certains cas, après, il était donné à de nombreux personnages, d’importance variable, qui étaient au service du gouvernement, et occupaient pour la plupart des postes à caractère militaire, ou tout au moins des fonctions autres que celles de secrétaire ; ce titre s’opposait ainsi particulièrement à celui d’« efendi ». Les aghas les plus remarquables de ce genre furent les Yeničeri Aghası ainsi que le plus grand nombre des principaux officiers de carrière en tant que se distinguant de l’armée féodale, et les Üzengi ou Rikâb Aghaları et la plupart des officiers de la Maison du Sultan. Mais le kâhya (ked-khudâ) du Grand Vizir portait aussi le titre d’agha bien que ses fonctions fussent exclusivement d’administration et de secrétariat, d’où, dans son cas, l’addition du mot efendi à son titre, ce qui le faisait appeler Agha Efendimiz ; de même, les eunuques du Palais commandés par le Bab ül’Se`âdet Aghası ou Kapı Aghası (blanc) et le Dâr ül’Se`âdet Aghası ou Kızlar Aghası (noir) et les eunuques au service de la Wâlide Sultân et des princesses d sang impérial. De là, les eunuques employés par les fonctionnaires et les gens riches en général en vinrent à être appelés normalement harem ou khadım aghaları, et le mot agha seul signifia parfois « eunuque ». » : Harold Bowen, « Agha », EI (2) : t. 1 p. 253-254 [p. 253]. 207
Chez les Ottomans, ce titre était utilisé pour honorer les chefs de tribu, les hauts fonctionnaires civils et militaires, et les fils des grands, notamment des pachas. Mais l’usage dans ce dernier cas, sans lien avec la
Page | 331
Tableau 4.23. Position sociale des descendants des princesses au cours des générations
Ağa Bey Pacha Efendi
1re
génération
(fils de
sultane)
3 10 2 0 15
2e génération
(petits-fils de
sultane ; fils
de hanım
sultane)
1 3 1 1 6
Générations
suivantes
0 10 6 1 17
4 23 9 2
Les descendants des princesses choisirent de façon préférentielle les carrières militaro-
administratives, au détriment de celles qui permettaient d’accéder aux responsabilités
juridico-religieuses. Les motifs d’une telle préférence ne sautent pas aux yeux, d’autant que
les travaux de Meriwether sur les grandes familles d’Alep, à une période néanmoins
postérieure, ont fourni des résultats opposés : la stratégie principale de ces grandes familles
provinciales était justement de s’appuyer sur les carrières juridico-religieuses, pour ensuite
chercher à acquérir des postes dans l’administration provinciale210
.
Plusieurs éléments peuvent éclairer cette préférence. Tout d’abord, l’une des
différences entre les familles étudiées par Meriwether et les familles princières réside dans la
localisation géographique : les premières appartiennent à l’élite provinciale, tandis que les
secondes sont situées au cœur même de l’Empire, dans la capitale. Par ailleurs, les familles
d’Alep développent des stratégies d’ascension (puis de maintien) tandis que pour les familles
princières, l’objectif est d’enrayer une délitation inévitable du rang familial. Or, les carrières
les plus prometteuses et avantageuses, tant en terme de revenus que de dignités et d’honneurs,
sont celles de l’organisation militaro-administrative. Outre que ces carrières étaient la garantie
détention d’un quelconque poste, semble n’apparaître qu’à partir du XVIIIe siècle. Harold Bowen, « Beg », EI (2) : t. 1 p. 1194-1195. 208
« le plus haut des titres honorifiques (‘unwân ou lakab) officiels en usage, jusqu’à l’avènement de la république de Turquie et encore survivant dans certains pays musulmans, comme le Maroc. Il accompagnait obligatoirement le nom propre, comme les titres nobiliaires de l’Occident européen, mais, à la différence de ceux-ci, il se plaçait après le nom (de même que les titres moins importants, de bey et d’efendi). En outre, n’étant ni héréditaire, ni transmissible aux épouses, ni attaché à une possession terrienne, il avait un caractère plutôt militaire que féodal. Il n’était cependant pas réservé uniquement aux gens d’épée, car on le donnait à certains hauts dignitaires civils (non religieux) », « le titre de pasha devint en tout cas rapidement l’apanage de deux sortes de dignitaires : – 1. Les beylerbeyis de province et – 2. Les wazîrs de la capitale. Il s’étendit ensuite aux fonctionnaires qu’on leur assimila. » : Jean Deny, « Pasha », EI (2) : t. VIII p. 287-290 [p. 287, 288]. Pour une définition complète et précise du titre au XIX
e siècle, cf. Bouquet, Les pachas des sultans : 108-113.
209 Titre ottoman d’origine grecque, qui signifierait « seigneur », « maître ». Le mot devint communément
utilisé pour désigner des membres des classes religieuses et bureaucratiques, par opposition aux classes militaires. Il était également employé pour certains hauts fonctionnaires, comme le re’is’ül-küttâb ou Reis Efendi et le cadi d’Istanbul, aussi appelé Istanbul Efendisi, ou encore à propos du secrétaire principal des janissaires, Yeniçeri Efendisi. Les secrétaires principaux du divan d’Istanbul ou des gouverneurs généraux de province portaient également ce titre. Cf. Bernard Lewis, « Efendi », EI (2) : t. II p. 44-45. 210
Meriwether, The Kin Who count : 30-68.
Page | 332
du maintien au sommet de l’édifice social ottoman, elles suivaient également l’exemple des
carrières paternelles. Pour conserver leur statut, les descendants des princesses se trouvaient
ainsi contraints de reproduire le modèle professionnel de leur père, c’est-à-dire de se
reconnaître comme serviteurs du sultan par l’entrée dans les rangs des kul, signe de
soumission et de reniement (même relatif) de leur héritage royal. Cela n’empêchât pas ces
hommes d’user de leur ascendance royale pour se distinguer des autres kul, mais la réussite de
cette stratégie n’est que partielle : leur situation se noie très largement dans le vaste maillage
des fils de pacha, et il est bien difficile de distinguer l’apport concret de ces commémorations
d’ascendance royale en terme de réussite professionnelle.
Nous ne sommes pas sans savoir qu’à l’époque classique, le recrutement des
sancakbey et des beylerbey (qui donnaient droit aux titres de bey et de pacha) se faisait de
préférence dans les rangs des officiers du gouvernement central plutôt que parmi les officiers
provinciaux subalternes211
. Deux écoles s’ouvraient aux descendants des princesses : l’école
du Palais et la formation au sein des household des pachas. Nous savons que la seconde
solution fut largement usitée, tout particulièrement à partir du XVIIe siècle. L’instruction au
sein du Palais impérial était également une voie retenue pour ces descendants de princesses :
les cas de sultanzade porteurs du titre de Ağa le montrent. Parmi les fils de sultane ayant
acquis ce rang se trouvent deux des fils d’Hümaşah Sultane (fille du prince Mehmed, lui-
même fils de Süleyman) et de Ferhad Pacha, Mahmud et Mustafa. Le premier s’éleva jusqu’à
obtenir l’office de silahdarbaşı en 1595212
, le second alterna les postes de baş kapıcıbaşı, mîr-
alem, çaşnigirbaşı et şahincibaşı au cours des années 1595 et 1596213
. Quant au troisième de
cette catégorie, il s’agit d’Ibrahim Ağa, fils d’une sultane (non identifiée) et de Mehmed
Pacha qui, sous le règne de Mehmed III, détint l’office de kapıcıbaşı de mai 1596 à juin
1597214
. Il est possible de rapprocher l’unique cas de sultanzade appartenant à la deuxième
génération devenu ağa des trois autres : il s’agit d’Abdurrahman Ağa, petit-fils de Mihrimah
Sultane (fille de Süleyman Ier) et de Rüstem Pacha, qui reçut lui aussi le poste de
kapıcıbaşı215
. Sa mère souhaitant accomplir le pèlerinage en sa compagnie, il fut élevé au
poste de sancakbey – mais décéda peu de temps après216
.
Arrêtons-nous un instant sur ces postes qui ne manquent pas d’importance et éclairent,
mieux que tout développement, la volonté d’élévation aux plus hauts rangs de l’administration
impériale. Tous les postes mentionnés (kapıcıbaşı et baş kapıcıbaşı217
, çaşnigîrbaşı218
et mîr
211
Kunt, The Sultan’s Servants : 57-67. 212
Selânikî, Târîh-i Selânikî : 656. 213
Selânikî, Târîh-i Selânikî : 458, 460, 575-576, 616. 214
Selânikî, Târîh-i Selânikî : 608, 696. 215
Selânikî, Târîh-i Selânikî : 669. 216
Selânikî, Târîh-i Selânikî : 669. L’histoire est reprise par Mehmed Süreyya, qui semble cependant le mentionner à deux reprises, une fois en tant que fils de Semiz Ali Pacha, l’autre fois comme fils d’Ahmed Pacha : Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 85, 86. 217
Le baş kapıcıbaşı était le commandant de l’ensemble des “portiers”, gardiens des entrées extérieures du Palais. Les kapıcı étaient organisés en unités militaires avec un kapıcıbaşı à la tête de chaque unité. Ces officiers étaient suffisamment importants pour être utilisés par le gouvernement lors d’ambassades, pour apporter les ordres aux gouverneurs de province, pour servir d’inspecteurs ou encore pour administrer les punitions. İnalcık, The Ottoman Empire : 81.
Page | 333
alem219
) appartiennent aux offices supérieurs du Bîrûn, le service extérieur du Palais impérial,
à l’exception d’un seul, silahdar başı220
, qui dépend du service intérieur, l’Enderûn. Ces
postes permettaient de sortir du Palais et d’être directement nommé sancakbey (ou subaşı,
pour les moins chanceux). Quant au silahdar başı, un des officiers les plus importants du
Palais, il n’était pas rare qu’il soit directement affecté à un poste de gouverneur de province, à
sa sortie du Palais (un office donnant droit au port du titre de pacha). À tout le moins recevait-
il un poste de sancakbey221
. Autrement dit, ces sultanzade formés au sein du Palais étaient
assurés d’être sur les voies professionnelles les plus prometteuses, celles qui permettaient le
plus sûrement d’accéder aux postes de sancakbey puis de beylerbey, avec ensuite la possibilité
de compter parmi les pachas les plus puissants de l’Empire, de devenir vizir et peut-être
même un jour grand vizir !222
Comment ces sultanzade parvinrent-ils à pénétrer le système palatial impérial,
largement réservé aux esclaves et jeunes recrues du devşirme ? L’une des voies privilégiées
fut l’entrée dans le corps des müteferrika. Les müteferrika forment un groupe particulier au
sein du Palais. À l’origine, il était réservé aux fils de pacha, ainsi que l’indique le kanunname
de Mehmed II :
« Que les fils de grand vizir deviennent des müteferrika avec [un revenu journalier
de] 60 aspres ; et que les fils des autres vizirs deviennent également des
müteferrika avec [un revenu journalier de] 50 aspres. Et pour les fils du nişancı,
qu’ils soient müteferrika avec 45 aspres [de revenu] ; et les fils de beylerbey aussi,
avec 40 aspres [de revenu]. »223
Les fils des princes étrangers vassaux de l’Empire y furent également admis. Puis, par la suite,
d’autres individus purent y entrer, à titre d’honneur, en signe de gratification impériale
spéciale. Or, d’après Metin Kunt, les müteferrika étaient traditionnellement promus, à leur
218
Le çaşnigîr başı, ou chef des goûteurs du Palais, et ses hommes s’occupaient de servir les repas aux membres du Conseil impérial ou lors des banquets donnés au divan lors des réceptions des ambassadeurs étrangers. Inalcık, The Ottoman Empire : 81. 219
Le mîr alem était le gardien des attributs de la royauté du sultan : l’étendard, les queues de cheval, la tente et la musique militaire. Parmi ses responsabilités, il était notamment en charge de présenter l’étendard et les queues de cheval aux gouverneurs nouvellement nommés. İnalcık, The Ottoman Empire : 81. 220
Les silahdar étaient les porteurs du sabre impérial lors des déplacements du souverain. İnalcık, The Ottoman Empire : 80. 221
İnalcık, « The Palace » (et tout spécialement p. 82) ; Kunt, The Sultan’s Servants : 57-76. 222
Tous les descendants des princesses ne choisirent pas les carrières militaro-administratives. L’exemple de choix alternatif le plus représentatif date de la première moitié du XVI
e siècle : il s’agit de la famille des
Dukakinzade, dont les deux ancêtres éponymes furent chacun mariés à des princesses ottomanes (Ahmed Pacha aurait épousé une petite-fille de Bayezid II après (?) que son fils, Mehmed Pacha, eut épousé une fille de ce sultan, Gevherhan). Des quatre enfants de ce dernier couple, le premier (Ahmed Bey) fut poète, le second (Osman Bey) cadi. On notera cependant qu’Ahmed Bey, avant d’embrasser une carrière littéraire, intégra d’abord les rangs des müteferrika et reçut la détention d’un zaim en province. Quant à son frère Osman, c’est probablement à tors qu’il est appelé du titre de Bey : Mehmed Süreyya répète semble-t-il l’erreur d’Evliya Çelebi, quand Selaniki a bien soin de l’appeler Efendi. Cf. Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 159 et t. 4 p. 1287 ; Sefercioğlu, « Dukakinzade Ahmed Bey » ; Dankoff, Karaman, Dağlı (éds.), Evliya Çelebi Seyyahatnamesi : t. 1 p. 178 ; Selânikî, Târîh-i Selânikî : t. 1 p. 237, 240-41, 277-78, 381. 223
Akgündüz (éd.), Osmanlı Hukukuna Giriş : 325.
Page | 334
sortie du Palais, au rang de sancakbey, nomination qui les mettait sur les rails des carrières les
plus prometteuses224
.
Deux problèmes surgissent néanmoins. Tout d’abord, les codes de lois sont formels :
c’est le lien paternel qui permettait de devenir müteferrika. La princesse n’aurait donc aucun
rôle dans la promotion professionnelle de ses enfants. Et pourtant, une remarque de
Mavrocordato, rapportée par Hammer, précise que « le titre de mouteferrika impliquait une
position éminente, puisque la plupart de ces dignitaires étaient petits-fils de sultanes ».225 De
façon non officielle, il existerait donc un lien entre l’entrée dans le corps des müteferrika et le
fait d’être le descendant d’une sultane. Soulignons la précision de Mavrocordato : selon ses
dires, ce sont les petits-fils des sultanes qui sont les seuls concernés, à l’exclusion des fils –
nous reviendrons sur ce point. On notera l’intervalle de temps qui sépare le texte du code de
loi de Mehmed II, datant du milieu du XVe siècle, et la déclaration de Mavrocordato, qui lui
est postérieur d’un siècle. Il n’est pas impossible, et même très probable, que les pratiques et
interdictions se soient assouplies pour permettre l’entrée des sultanzade dans ce corps
prestigieux.
Le second problème est plus difficile à évacuer. Le corps des müteferrika, parce qu’il
est composé de fils de grandes familles, détient une position tout à fait spéciale au sein du
Palais, qui le met à l’écart des voies de formation et d’ascension traditionnelles. L’entrée dans
le groupe favorise la nomination à des postes hauts placés en province, mais ne permet pas de
gravir les échelles supérieures au sein du Palais, seul chemin d’accès direct aux offices les
plus hauts placés. Comment expliquer, alors, la présence de certains sultanzade à des postes
théoriquement inaccessibles aux müteferrika ? Selon nous, c’est la marque d’un privilège
spécial qui ne s’explique que par l’influence des princesses. Ce rôle des princesses paraît
évident si l’on considère les cas en question : tous sont des descendants soit d’Hümaşah
Sultane, soit de Mihrimah Sultane. La première était, en raison de la mort de son père, le
prince Mehmed, la pupille des sultans – et le soin que montra Süleyman Ier à la marier à un
pacha qu’il nomma aussitôt quatrième vizir témoigne de la considération qu’il lui portait et
que ses successeurs perpétuèrent. Quant à la seconde, il paraît presque superflu de rappeler la
puissance dont elle disposa sous le règne de son père, mais également par la suite, sous le
règne de son frère Selim II (malgré leurs désaccords et inimitiés respectifs) et jusque sous
celui de son neveu Murad III.
Le degré de parenté avec le sultan doit également être pris en considération : les
sultanzade entrés dans les rangs des müteferrika sont tous des arrières petits-fils de Süleyman
Ier. S’ils appartiennent à des familles très puissantes, leur éloignement générationnel n’est pas
un élément à négliger. On se rappelle, à ce propos, la phrase de Mavrocordato concernant les
petits-fils de sultanes. Or, dans le tableau précédent, la majorité des sultanzade qui parvinrent
au rang de pacha sont des descendants de la troisième génération ou plus. Ce phénomène n’est
pas le fruit du hasard : il fait écho à une loi édictée dans le kanunname de Mehmed II :
224
Kunt, The Sultan’s Servants : 39 ; voir aussi Gökbilgin, « Müteferrika » ; Inalcık, « The Palace » : 83. 225
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 12 p. 236.
Page | 335
« Qu’on ne donne pas d’offices de gouverneur aux fils de mes filles, mais qu’on leur
attribue des sancak importants. »226
Nous avons choisi de traduire le terme ottoman evlâd par fils et non par descendants, car il
nous semble évident, au vu des résultats obtenus dans le tableau ci-dessus, mais aussi en
tenant compte de la logique de cet interdit, que les personnes visées sont bien les fils, non les
descendants plus éloignés. La logique est claire : il s’agit d’éviter d’accorder trop d’influence
et de pouvoir aux descendants des sultans par les femmes. Ainsi que nous l’avons indiqué
plus haut, même exclus de la souveraineté, ils continuaient d’être perçus comme un danger
contre lequel les sultans prirent diverses mesures. Il était plus facile pour un sultanzade
appartenant à la troisième ou quatrième génération de devenir pacha que pour le fils d’une
princesse. Et si l’on s’en tenait strictement à la règle, il ne devrait y avoir aucun cas de fils de
princesse pacha : de toute évidence, la règle ne fut pas appliquée de façon systématique.
Quelques exemples permettront de s’en convaincre. Nous avons choisi de privilégier
l’étude de trois cas de familles : celle de Hümaşah Sultane, petite-fille de Süleyman Ier227
,
celle de Mihrimah Sultane, fille du précédent228
, et celle de Safiyye Sultane, fille de Murad
IV229
. Le choix de ces familles a été guidé par leur longévité, particulièrement exceptionnelle
dans le cas des Mihrimah Sultanzadeler, dont on retrouve des membres jusqu’au XIXe siècle.
Dans l’arbre généalogique de la famille de la petite-fille de Süleyman Ier, Hümaşah, la
première génération descendante comprend cinq beys et deux pachas. De ces deux pachas,
nous savons que l’un (Hacı Pacha) a eu une descendance qui prit son patronyme230
; l’autre
(Ibrahim) eut un fils qui devint bey. Hacı entra au Palais comme müteferrika, puis s’éleva au
rang de mirimiran et de mutassarıf de Saruhan231
; Ibrahim parvint au rang de beylerbey232
.
Quant aux autres frères, on les retrouve également au Palais, dans les offices supérieurs du
Bîrûn233
. Autrement dit, tous les fils de cette princesse investirent l’école du Palais, tantôt
comme müteferrika, tantôt dans les offices supérieurs du Bîrûn, avant de poursuivre, pour
certains, une carrière parmi les membres de l’ümera. La deuxième génération des descendants
d’Hümaşah ne produisit pas de grands personnages : les fils des deux pachas ne s’élevèrent
pas plus haut que le rang de bey ; quant au fils de Mustafa Bey, Süleyman, il devint
müderris234
. En revanche, les descendants de ce müderris produisirent trois générations de
pacha : son fils, Ahmed ; son petit-fils, Mustafa ; son arrière petit-fils, Ismail. Il s’agit de la
troisième, quatrième et cinquième génération issue de la princesse, soit, si l’on suit le
décompte à partir du sultan, les cinquième, sixième et septième générations. Dans le cas de
cette famille, il paraît évident que la dilution dans le temps n’entraîna pas une perte
d’importance de la famille, bien au contraire : celle-ci sut demeurer au sommet de l’élite
militaro-administrative ottomane. 226
Akgündüz (éd.), Osmanlı Hukukuna Giriş : 329. 227
Cf. Annexes B.18 228
Cf. Annexes B.19. 229
Cf. Annexes B.20. 230
Malheureusement, nous ne sommes pas parvenus à trouver d’informations concernant ces membres. 231
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 2 p. 553. 232
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 3 p. 786. 233
Mustafa Bey fut kapıcıbaşı puis mir-i alem ; Hasan Bey, çaşnigirbaşı et şahincibaşı; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 2 p. 615 ; t. 4 p. 1143. 234
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 2 p. 518.
Page | 336
La descendance de Mihrimah Sultane, fille de Süleyman Ier, propose une variation de
ce schéma. De sa fille Ayşe, sa seule héritière (après la mort précoce de ses fils)235
, naquirent
au moins quatre fils et deux filles : trois des fils devinrent bey (Osman, Mehmed et
Abdurrahman), le quatrième s’éleva jusqu’au rang de pacha. Mehmed et Osman reçurent tous
deux des sancak importants : Niğbolu puis Kilis pour le premier236
, Karahisar pour le
second237
; quant à Abdurrahman, après avoir servi au Palais comme kapıcıbaşı avec rang
d’ağa, il fut nommé sancakbey à sa sortie238
. Le pacha, enfin, exerça tour à tour comme
beylerbey de Semendire, Belgrade et Kilis, avant de mourir au cours de la guerre contre
l’Autriche239
: il compte ainsi parmi les pachas particulièrement puissants de l’État, bien qu’il
ne parvint pas à entrer au Conseil. Les deux filles furent toutes deux mariées à Ciğalazade
Sinan Pacha (la cadette, Safiyye, remplaçant sa sœur, décédée très tôt, dans le lit de son
époux)240
. Leur descendance prit le patronyme de Ciğalazade (parfois aussi Cigalazade,
Cağalzade, Cağaloğlu), mais sans jamais abandonner la mémoire lignagère des Mihrimah
Sultanzadeler ; c’est ainsi que Mehmed Süreyya peut déclarer :
« Rüstem Pachazade. Famille du gendre de Süleyman Ier Rüstem Pacha. Les
enfants de sa fille, Ayşe Hanım Sultan, furent appelés “Mihrimâh Sultanzadeler”.
De nos jours, on trouve encore des descendants de ce lignage. Cette lignée s’est
mélangée au lignage de Cağaloğlu Sinan Pacha, dont est issu Semin Mehmed
Pacha. »241
Parmi les descendants de ce couple, à la deuxième génération, on trouve deux pachas et un
bey : Semin Mehmed Pacha242
, Mahmud Pacha243
et Mehmed Bey. Les deux pachas devinrent
vizirs de la coupole, c’est-à-dire des membres du Conseil impérial, Mehmed Pacha réussissant
même à se hisser au plus haut rang : en 1644, il est nommé grand vizir – poste qu’il conserva
un an et demi. Quant au dernier, s’il n’accéda pas au rang de pacha (à notre connaissance), il
eut néanmoins l’office de turnacıbaşı et fut jugé digne d’épouser une sultane (une fille de
Murad III)244
. Cependant, les générations suivantes ne parvinrent pas à renouveler la réussite
professionnelle de leurs aînés : on ne trouve plus alors que des beys ou des ağa, jusqu’à la fin
du XIXe siècle
245. Contrairement aux descendants d’Hümaşah Sultane, les Mihrimah
Sultanzade / Cigalazadeler montrèrent plus de réussite dans les premières générations, mais
furent incapables de perpétuer le phénomène.
235
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 25-26. 236
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 3 p. 959 et 963 (il s’agit des mêmes personnes ; Mehmed Süreyya se trompe lorsqu’il écrit qu’Ayşe aurait épousé Semiz Ali Pacha) ; Selânikî, Târîh-i Selânikî : 162, 164, 214, 321. 237
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 4 p. 1286 ; Selânikî, Târîh-i Selânikî : 241. 238
Selânikî, Târîh-i Selânikî : 669 ; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 85, 86. 239
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 4 p. 1196. 240
L’affaire est rapportée dans les rapports du baile vénitien : Pedani, « Safiye’s Household » : 18 ; Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 7 p. 73. 241
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 5 p. 1403. 242
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 4 p. 1045-46 ; Ömer M. Alper, « Mehmed Paşa (Sultanzade, Civankapıcıbaşı) », OA : t. 2 p. 172. 243
Dankoff, Karahman, Dağli (éd.), Evliya Çelebi Seyyahatnamesi : t. 1 p. 99. 244
Yılmazer (éd.), Topçular Kâtibi : t. 1 p. 624, 633. 245
Ibrahim Ağa dit Kara Koca, Süleyman Salim Bey, Tahir Mehmed Bey, Tevfik Bey, Mahmud Bey, Mustafa Ağa, Ragib Mustafa Bey, Rifat Bey. Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 3 p. 739, 910 ; t. 4 p. 1135, 1341-42 ; t. 5 p. 1394, 1552, 1612, 1629.
Page | 337
À partir du milieu du XVIe siècle, l’exemple de la descendance de Mihrimah Sultane
constitue le modèle-type de réussite professionnelle des membres des familles princières. On
le retrouve, avec moins de succès, dans la famille des Safiyye Sultanzade, apparue au milieu
du XVIIe siècle
246. Le couple Safiyye Sultane – Hasan Pacha eut deux enfants, un garçon et
une fille. Le garçon devint pacha sous le nom de Remzi Mehmed Pacha. Il eut cinq fils, tous
bey, qui eurent des fils et des petits-fils, eux aussi tous bey247
. La déperdition générationnelle
fut donc plus rapide dans cette famille que chez les Mihrimah Sultanzadeler, mais il faut
reconnaître que les capacités et la puissance des chefs de file de ce lignage étaient
incomparables.
Quelques conclusions peuvent être tirées de ces résultats. Tout d’abord, l’interdit de
promotion aux postes principaux de l’Empire frappant les fils de sultanes ne fut pas respecté :
il semble qu’il soit tombé en désuétude dès le XVIe siècle. Et pourtant, peu de descendants
des sultanes parvinrent à s’élever aux plus hauts offices. Or, quand on sait l’importance
accrue que jouèrent les grandes household dans la production d’officiers à partir du XVIIe
siècle248
, la constatation paraît surprenante. Elle l’est encore plus si l’on tient compte de
l’importance statutaire de leurs parents et de leurs avantages financiers. On pourrait penser
que ces sultanzade n’estimèrent pas nécessaire de pousser plus loin une carrière dans le
système militaro-administratif ottoman ; mais dans ce cas, le fait même d’y entrer, en premier
lieu, n’aurait aucun sens. Et pourtant, dans les premières générations de descendants, des cas
assez réguliers de sultanzade pachas apparaissent, même s’ils ne sont pas majoritaires.
Est-ce à dire que les princesses étaient incapables d’assurer la promotion de leurs
descendants ? Ce n’est pas certain. Il faut d’abord se garder d’attribuer toutes les réussites
précédentes comme le simple fait des princesses – il ne faudrait pas oublier le rôle des maris
et des gendres. Ensuite, à comparer ces résultats avec ceux des familles de pachas, on
remarque que le mouvement d’effilochement de la puissance familiale au cours des
générations s’opère de façon très fortement similaire249
. La spécificité des grandes familles de
l’élite ottomane réside justement dans leur incapacité à se maintenir à un haut niveau sur le
long temps. Tout bien considéré, non seulement les sultanes furent capable d’assurer de belles
carrières à leurs fils ou petits-fils, au point qu’un certain nombre parvinrent au rang de pacha,
voire de vizir et même de grand vizir, mais encore leurs lignages ont été capables de se
maintenir à un rang élevé sur plusieurs siècles. L’exemple des Safiyye Sultanzadeler est
particulièrement révélateur sur ce point : contrairement aux deux autres familles étudiées, il
ne s’agit pas d’une princesse particulièrement puissante (comme Mihrimah Sultane) ou
protégée (comme Hümaşah Sultane). Elle ne se distingue en rien et n’est citée qu’à l’occasion
246
Il s’agit des descendants de Safiyye Sultane (fille de Murad IV) et de Sarı Hasan Pacha. 247
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 3 p. 816 ; t. 5 p. 1386-87, 1418, 1432. Dans leur cas, on peut s’interroger sur l’association du titre de bey avec un office : nous sommes en effet déjà au XVIIIe siècle, soit à une période où le titre est parfois attribué sans réalité socioprofessionnelle, seulement pour marquer le statut social de son détenteur. C’est ainsi qu’on trouve, dans les cimetières, des tombes d’enfants porteurs du titre de bey avant même d’avoir atteint l’âge d’exercer une profession accordant ce titre. Cf. Eldem et Vatin, L’épitaphe ottomane musulmane. 248
Kunt, The Sultan’s Servants : 57-67. 249
Le phénomène se constate encore à la période ultérieure. Pour une étude des familles des pachas, cf. Bouquet, Les pachas du sultan : 202-230.
Page | 338
de ses mariages250
. Elle est une princesse parmi tant d’autres, qui parvint malgré tout à assurer
la carrière de son fils et le mariage de sa fille avec un puissant pacha. Les princesses
ottomanes n’étaient donc peut-être pas aussi puissantes que les pachas, leur household ne
pouvait probablement pas rivaliser en puissance et en capacité politique avec celles des plus
grands dignitaires de l’État, mais elles n’en étaient pas moins non négligeables et produisaient
régulièrement des officiers hauts placés de l’État.
Soulignons encore la capacité des princesses à faire entrer leurs descendants au sein du
Palais. C’est-à-dire que ce n’était pas leur household qui assurait la formation de leurs
descendants, mais celle du sultan. C’est là un point essentiel qui les distingue des pachas. La
capacité des sultanzade à entrer dans le groupe des müteferrika était assurée par leur noblesse
de naissance ; ce n’était donc pas une preuve de la puissance des princesses, mais un privilège
accordé à leurs descendants en reconnaissance de leur lien avec la dynastie. Il existe une
confusion très forte entre les household des princesses et la household impériale, le Palais.
Les maisons des sultanes apparaissent comme des extensions du Palais. Sans être entièrement
des bâtiments impériaux, des liens extrêmement forts existent entre le Palais impérial et les
palais princiers, lesquels sont à la fois autonomes et dépendants du premier251
.
Terminons sur un point économique. Certes, les princesses ne furent pas capables
d’assurer, sur le long terme, le maintien de leurs descendants parmi les rangs les plus élevés
des officiers. Cependant, il ne faudrait pas négliger l’importance du statut de bey. La plupart
d’entre eux, nous l’avons vu, étaient des sancakbey, ce qui signifie qu’ils bénéficiaient de
revenus importants produits par leur hâs (sans même mentionner les revenus dérivés associés
à la fonction). Ces revenus s’échelonnaient entre 200 000 et 600 000 aspres par an, selon
l’ancienneté et l’importance du sancakbey252
. Ce qui, d’après les données mentionnées plus
haut, plaçait ces sultanzade dans la classe la plus riche de l’Empire. Les princesses ottomanes
ne donnèrent peut-être pas naissance à de longues lignées de grands dignitaires, mais elles
furent capables de créer des lignées de membres de l’élite qui surent conserver leur rang sur
plusieurs siècles grâce aux avantages cumulés des revenus issus de leur héritage et des profits
économiques de leurs offices.
250
Voir Annexes B.18 et B.19. 251
De nombreuses interrogations demeurent : toutes les générations de sultanzade avaient-elles droit d’entrer dans le groupe des müteferrika ? Tous les sultanzade ne furent pas des müteferrika au sein du Palais, en tout cas tous n’apparaissent pas à ce rang : faut-il imaginer l’existence de passerelles entre le groupe des müteferrika et les autres offices du Bîrûn ? Ou bien les princesses parvinrent-elles effectivement à promouvoir leurs descendants en dehors des schémas de carrière prévus pour eux ? Il est impossible, en l’état de la recherche, de répondre à ces questions, mais il faut espérer que des études futures sur les familles de l’élite ottomane, notamment celles princières, ainsi que sur les müteferrika, permettront d’y voir plus clair à ce sujet. 252
Kunt, The Sultan’s Servants : 16-26.
Page | 339
2. Assurer la prospérité de son entourage
Pas plus la clientèle que la faction ne sont réductibles à la famille et aux descendants.
Il est évident que les princesses étaient bien plus intéressées à la réussite sociale de leurs
descendants qu’à celle de leurs serviteurs ou clients. Outre l’attachement filial dont il ne faut
pas trop préjuger, le sentiment d’appartenance à un même lignage, les liens du sang
fonctionnaient selon les mêmes ressorts que chez les familles des noblesses occidentales. Ne
nous laissons néanmoins pas obnubiler par la parenté : les maisons des membres de l’élite
comprenaient bien plus de serviteurs que de parents et des liens d’attachement sentimental
existaient avec autant de prégnance, si ce n’est plus, qu’entre parents. Les récits des femmes
de harem du XIXe siècle sont truffés d’attestations allant dans ce sens, souvent empreintes de
rapports hiérarchiques fondés sur la certitude de la supériorité des unes sur les autres. Un
exemple suffira amplement. C’est presque en s’excusant que Leila Hanım inclut « ces
quelques lignes […] pour parler d’une négresse qui [lui] a appartenu, de [s]a petite Yacémine
(jasmin), qu’[elle] aimait beaucoup »253
:
« Bien d’autres faits encore dénotaient la vive intelligence de la petite négresse, qui
grandissait chaque jour dans mon estime. Je commençais à lui apprendre à lire et
à écrire, par la méthode que j’avais déjà employée avec Yetkâ ; mes efforts furent
rapidement couronnés de succès. Je réussis de même à lui apprendre le français,
qu’elle arriva à parler, avec un accent assez drôle, mais d’une façon
compréhensible. Elle apprit de même la couture, les travaux d’aiguille et elle
accomplissait ponctuellement son service. Le matin, elle ne montait jamais avant
d’avoir soigneusement achevé sa toilette, d’avoir mis un nœud dans ses cheveux,
sa collerette et son tablier blanc, qu’elle repassait et empesait elle-même. Elle ne
manquait jamais de nous interroger pour apprendre les choses qu’elle
ignorait. »254
Il y aurait fort à dire sur ce passage ; contentons-nous de souligner la proximité qui lie la
maîtresse à son esclave, l’attention qu’elle lui porte, au point de noter ses petites habitudes
quotidiennes, enfin le temps et l’intérêt qu’elle montre à sa formation, d’autant plus
surprenants que, quelques lignes plus tôt, on apprend que Leïla n’en fait pas autant envers son
fils, Yusuf, qui est éduqué par les soins d’une gouvernante étrangère, chargée de lui enseigner
le français255
.
Les liens qui unissent les maîtresses de maison à leurs serviteurs et servantes étaient
particulièrement forts et perduraient par-delà le temps de service au sein de la maisonnée,
ainsi que le montre le cas de Mail Yenge, une cariye circassienne ayant appartenu à la famille
de Seniha Hanım, dont elle rapporte l’histoire suivante :
« Elle fut vendue dans la maison de Suphi Pacha, qui la maria à son fils aîné,
Ayetullah. Ayetullah se vit offrir une épouse circassienne plus jolie, mais il préféra
253
Leïla Haoum, Le harem impérial : 104. 254
Leïla Haoum, Le harem impérial : 108. 255
Leïla Haoum, Le harem impérial : 107.
Page | 340
Mail. Leur seul fils, un garçon, mourut enfant. Ayetullah était un essayiste et un
poète. Il […] mourut en 1878, à l’âge de 30 ans. Mail Hanım se remaria et fut veuve
pour la seconde fois. N’ayant pas d’autres moyens de subsistance qu’une pension
d’État, elle retourna au konak de son défunt beau-père, Suphi Pacha. Un grand
nombre des enfants et petits-enfants de ce dernier y vivaient et tous l’aimaient
beaucoup. Elle y passa le reste de sa vie. […] Nous l’aimions tous sincèrement et
chacun de nous la pleura quand elle décéda à un âge avancé. »256
Ils s’inscrivaient dans le cadre des relations d’intisâb, que même l’affranchissement
n’éteignait pas. Ainsi, à la mort d’un esclave affranchi, ses biens étaient hérités non par ses
enfants, mais par son ancien maître.
Les relations d’intisâb fonctionnent dans les deux sens et illustrent parfaitement notre
propos : la maîtresse a des obligations (d’ordre moral) envers ses serviteurs et clients qui, en
retour, sont eux-mêmes tenus par les mêmes conventions morales. Il ne nous est pas possible,
à partir des sources disponibles, d’illustrer de quelle manière les serviteurs et clients des
princesses payaient en retour les bienfaits de leur protectrice, mais il n’est pas besoin d’être
très avisé pour en comprendre la nature. Il est cependant possible de se faire une opinion de la
manière dont les princesses fournissaient leur aide à tous ces hommes et femmes placés sous
leur protection. Il convient néanmoins de procéder à une distinction entre les serviteurs,
employés personnels des princesses résidant sous leur toit et placés sous une tutelle directe, et
les clients, extérieurs aux maisons princières, dont les liens avec les sultanes et hanım sultanes
étaient plus lâches.
1. Les serviteurs personnels des princesses
Les princesses ottomanes vivaient dans des palais, entourées de serviteurs esclaves,
affranchis ou libres, qui constituaient le personnel de leur maison. L’ensemble des tâches
quotidiennes leur revenait. Le privilège de résider sous le toit de leur maîtresse, de la côtoyer
chaque jour, garantissait l’établissement de liens directs et intimes. La grandeur et
l’importance du personnel d’une maison sont le reflet du statut du maître ou de la maîtresse.
Un premier problème réside dès lors dans le fait de savoir si les princesses disposaient de leur
propre maison avec leur propre personnel (reflet de leur statut) ou si elles intégraient la
maison de leur époux (leurs serviteurs se diluant dans la masse des domestiques de la maison
de l’époux). Une fois ceci établi, il sera possible alors de s’interroger sur la capacité des
princesses à s’entourer d’individus puissants. Ne restera plus qu’à déterminer dans quelle
mesure les sultanes s’inquiétaient du devenir de leurs serviteurs.
256
Davis, The Ottoman Lady : 102.
Page | 341
Diriger des maisons royales
« Quand un duc se propose de faire construire une maison, celle-ci doit bien être la
maison d’un duc et non celle d’un comte. Cette remarque s’applique à tous les éléments de
son train de vie. Il ne peut tolérer qu’un autre s’entoure d’allures plus “ducales” que lui ! »257
.
Cette remarque de Norbert Elias dans La société de cour rappelle la nécessaire adéquation
entre le statut et l’importance de la maison d’un haut personnage. Elias utilisait le terme de
maison dans le sens d’habitat, nous l’utilisons ici dans une acception plus générale qui
englobe l’ensemble des individus qui y résident.
Les princesses ottomanes, en tant que personnes royales, se devaient d’imposer leur
statut dans chaque aspect de leur vie. L’habitat, c’est-à-dire à la fois la structure résidentielle
et la population qu’elle héberge, était l’un des vecteurs de cette démonstration de supériorité
du sang royal. Le cas des princesses ottomanes présente néanmoins une spécificité : la
différence de statut entre les époux. Dans la société que décrit Elias, l’épouse acquiert, à son
mariage, le statut de son mari, quelle qu’ait été sa position de naissance. Tel n’était pas le cas
des princesses ottomanes : leur mariage n’induisait pas la perte de leur statut royal. Épouses
de pacha ou de bey, elles demeuraient des princesses, des personnes royales. La distinction
des statuts des époux pose le problème de la structure des maisons, perçues comme des biens
à la fois individuels et communs au couple.
Chaque princesse semble avoir été détentrice d’un palais personnel dans lequel elle
entretenait tout un personnel qui lui était propre. Une déclaration de Fatma Sultane, rapportée
par Evliya Çelebi, illustre ce fait. Lors de la nuit de noces avec son nouvel époux, Melek
Ahmed Pacha, elle lui déclare sans ambages qu’il lui faudra désormais s’acquitter des
dépenses de sa suite, qui compte en tout trois cents femmes qui partagent son quotidien, mais
le chiffre s’élève à sept cents, une fois les affranchies et leurs enfants compris, et encore cinq
cents employés masculins258
. Ismihan Sultane, fille aînée de Selim II, avait pour sa part, pour
la seule partie du harem, au moins 300 cariye à son service, qu’elle mariait régulièrement au
fur et à mesure qu’elles vieillissaient, ainsi qu’une centaine d’autres qui accomplissaient le
service extérieur au harem, auxquelles s’ajoutaient encore les eunuques chargés de leur
surveillance259
. La taille de la domesticité de Fatma Sultane, qui fait écho à celle d’Ismihan
Sultane, est le reflet de son statut ; les protestations de Melek Ahmed Pacha, qui rétorque plus
loin ne pas avoir les moyens de telles dépenses somptuaires, en sont également un indice.
Qu’un pacha appartenant à la crème de l’élite, qui servit comme grand vizir, reconnaisse son
incapacité à entretenir une telle domesticité, souligne la supériorité de la maison princière sur
son époux.
L’existence de palais appartenant aux princesses ne signifie pas pour autant que les
époux faisaient nécessairement chambre à part. On sait par exemple que Sokollu Mehmed
257
Elias, La société de cour : 43. 258
Dankoff (éd.), The Intimate Life : 259-260. 259
Gerlach, Türkiye Günlüğü : t. 2 p. 584.
Page | 342
Pacha résidait sous le même toit que sa femme, Ismihan Sultane260
; il en allait de même pour
le couple Melek Ahmed Pacha et Kaya Ismihan Sultane261
, même si celle-ci se rendait parfois
dans ses propres possessions, à Üsküdar (où son mari venait également la rejoindre)262
. La
division des habitats n’était donc pas stricte, pas plus que la division du personnel respectif
des époux. La cohabitation (même dans des espaces séparés au sein du même palais)
favorisait d’ailleurs une certaine mixité du personnel. Ainsi, lorsque Mihrimah Sultane se
lance dans son projet de construction d’un second complexe à Edirnekapı, elle a recours, dans
ses démarches, à Mehmed Bey, ancien kethüda de son défunt mari qu’elle reprend à son
service et nomme superviseur du projet263
. De même, Melek Ahmed Pacha n’hésite pas à
plusieurs reprises à utiliser l’argent de son épouse, Kaya Ismihan Sultane, pour procéder à des
distributions de récompenses à l’intention de l’ensemble du personnel des deux maisons264
.
Les princesses disposent donc de leur propre maison (habitat + personnel), mais n’en
dédaignent pas pour autant celle de leur époux – et inversement – au point que Kaya Sultane,
apprenant l’arrestation et l’emprisonnement du kethüda de son époux, prit aussitôt l’affront
comme une affaire personnelle et se hâta d’œuvrer en faveur de sa libération265
. La ligne de
démarcation entre les maisons respectives des époux est d’une étonnante porosité.
Fatma Sultane s’était entourée d’une très vaste domesticité. Cependant, dans son
discours, seuls quelques-uns sont mentionnés nominalement : elle établit verbalement une
hiérarchie des domestiques. Son intendant (kethüda) et ses serviteurs (Keremetçi Mustafa
Ağa, Selman Bey, Ömer Bey et Mukbil Ağa) viennent en tête, suivis de quelques autres beys
et eunuques266
. Parmi les quelque mille domestiques à son service, seule une petite dizaine se
distingue du lot comme personnages d’un certain rang. Le discours de Fatma Sultane est une
invitation à nous concentrer sur ces quelques serviteurs particulièrement proches des
princesses et tout particulièrement les intendants, hommes à tout faire de ces femmes. Il est
malaisé de dresser des conclusions générales à partir du peu de renseignements disponibles.
Les remarques que nous avions soulevées à propos des carrières des descendants des
princesses sont également valables pour les membres de leur maison. Le choix de la période
moderne n’aide pas : plus on avance dans le temps, plus la documentation laisse transparaître
d’informations relatives à ces individus et tout particulièrement aux kethüdâ des princesses.
On pourrait y voir le signe d’une montée en puissance de ces personnages ; nous n’y croyons
pas et penchons pour une explication liée aux caractéristiques propres aux sources. Les
dictionnaires biographiques consultés, parmi lesquels l’ouvrage de Mehmed Süreyya267
s’est
révélé le plus utile, datent largement de périodes postérieures à l’époque moderne : les
informations contenues sont bien plus précises et complètes dès lors qu’on approche du
XVIIIe et surtout du XIX
e siècle.
260
Gerlach, Türkiye Günlüğü : 546. 261
Dankoff (éd.), The Intimate Life : 221. 262
Dankoff (éd.), The Intimate Life : 52, 152, 158. 263
Necipoğlu, The Age of Sinan : 307-308. 264
Dankoff (éd.), The Intimate Life : 152, 231. 265
Dankoff (éd.), The Intimate Life : 91-92. 266
Dankoff, The Intimate Life of an Ottoman Statesman : 259-260. 267
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî.
Page | 343
Tableau 4.24. Aperçu des carrières des kethüdâ des princesses ottomanes
Nom / princesse Formation Groupe d’appartenance
Poste(s) avant de devenir kethuda de la princesse
Poste(s) après être devenu kethuda de la princesse
Mevkufâtçı Mehmed Efendi (Kaya Ismihan, fille de Murad IV)
268
Household de pacha (fils d’Haci Pacha)
? ? - divan efendi d’Eyyûb Pacha au Caire - mevkufatî - reisülküttab - disgrâce - nişancı
Piyale Çavuşoğlu Mustafa Efendi (Kaya Ismihan, fille de Murad IV)
269
? ? ? - defter emîni
Hüseyin Efendi (Hadice, fille de Mehmed IV)
270
Household impériale Hacegân Mîrimîran Hacegân
- kapıcıbaşı - şehremini - Bozok mutasarrıfı - defter emini vekili
Veli Ağa (Hadice, fille de Mehmed IV)
271
? ? ? - kapıcılar kethüdâsı
Mehmed Efendi (Hadice, fille de Mehmed IV)
272
? ? ? - Hân kapu kethüdası - Tersâne emîni - muhâsebe-i cizye mansıbı
Abdullah Bey (Safiyye, fille de Mustafa II)
273
? ? ? - darbhane emini - cize muhasebeci - şehremini - yeniçeri kâtibi - başmuhasebeci
Ismail Efendi (Fatma, fille d’Ahmed III)
274
? Hacegân (après être entré au service de la princesse)
? - Nuruosmaniye evkaf kâtibi
Emin Mehmed Efendi (Ayşe, fille d’Ahmed III)
275
Kalem Hâcegân - Binâ emini - ruznâme-i evvel - rikâb çavuşbaşısı - rikâb-ı hümâyûn kethudası
Hasan Ağa (Ayşe, fille d’Ahmed III)
276
Household de pacha Ağa - kapı kethudası (du pacha)
- kapıcıbaşı et matbah emini - surre emini
Ibrahim Efendi (Esma, fille d’Ahmed III puis Şah Sultane)
277
Haseki - dârüssaâde yazıcı - mevkufatçı
- arpa emini - başmuhasebeci - ordu defterdarı
268
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 3 p. 1010 ; İpşirli (éd.), Tarîh-i Na’îmâ : t. 3 p. 997, 1376 ; Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 10 p. 16, 20, 149. 269
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 4 p. 1162 ; İpşirli (éd.), Tarîh-i Na’îmâ : t. 3 p. 1376. 270
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 3 p. 704. 271
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 5 p. 1657. 272
Subhî, Subhî Tarihi : 163. 273
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 58. 274
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 3 p. 821. 275
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 1 p. 474-475. 276
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 2 p. 611. 277
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 3 p. 751.
Page | 344
Melme Efendi (Esma, fille d’Ahmed III)
278
Household d’efendi Hacegân (après être entré au service de la princesse)
? - piyade mukabelecisi - çavuşbaşı vekili - rikâb-ı hümâyûn kethudası - ruznâme-i evvel - başmuhasebeci - disgrâce suite au décès de la princesse - surre emini - rikâb-ı hümâyûn kethudası
Mustafa Efendi (Saliha, fille d’Ahmed III)
279
Kalem Hacegân (après être entré au service de la princesse)
- serdârlar kitâbi - matbah eini - tersane emini - sadrazam kethüdâsı
Mustafa Efendi (Saliha, fille d’Ahmed III)
280
Household de pacha Hacegân (après être entré au service de la princesse)
- kapıcılar kethüdâsı (du pacha)
- mevkufatî
Trois éléments se dégagent de ce tableau. Dans la majorité des cas, les individus
appelés à devenir kethüda d’une princesse sont des individus à la carrière déjà avancée. Leur
entrée au service de la princesse apparaît comme une promotion au sein d’un parcours en
construction. Or, tout laisse à penser que les offices détenus après l’entrée au service de la
princesse se font en sus de cette activité. À tout le moins, un kethüda serait-il contraint de
démissionner de son service auprès de la princesse que cela ne sonnait pas nécessairement le
glas de leurs relations de clientèle. Ainsi Mehmed Efendi, éloigné en Égypte suite à ses
projets de mariage en faveur de sa patronne, fut contraint de se démettre de son service auprès
de Kaya Ismihan Sultane ; on le retrouve pourtant quelques années plus tard en train de
manigancer, par l’intermédiaire de son fils, en faveur d’un retour en grâce de l’époux de la
princesse, Melek Ahmed Pacha281
.
La double carrière suivie par ces kethüda est révélatrice tout à la fois de l’appui
princier, sans lequel il est douteux que ces individus aient pu obtenir toutes les promotions
mentionnées ci-dessus, et de celui qu’eux-mêmes apportaient à la princesse en retour, grâce à
la puissance politique que leurs offices, ainsi acquis, assuraient. Une fois parvenus aux postes
supérieurs grâce à l’appui de leur protectrice, il est exceptionnel que ces individus cherchent
d’autres protecteurs. À la mort de la princesse ou après démission de leur service à ses côtés,
ces anciens kethüda font alors généralement cavalier seul : ils comptent désormais parmi les
officiers supérieurs de l’État et ne sentent plus le besoin de se placer sous la tutelle directe
d’un nouveau patron. Si Ibrahim Efendi, kethüda d’Esma Sultane, fille d’Ahmed III, reprit du
service auprès d’une autre sultane (Şah Sultane), c’est parce qu’il n’était pas encore parvenu à
une situation assez confortable pour se permettre de se passer du soutien d’un grand
protecteur282
.
Le service impérial domine très largement la carrière de ces individus. Quelques rares
cas mis à part, la plupart se présentent au service des princesses après avoir suivi des
278
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 3 p. 990. 279
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 4 p. 1176. 280
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 4 p. 1290. 281
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 10 p. 16, 20, 149 ; İpşirli (éd.), Tarîh-i Na’îmâ : t. 3 p. 997, 1376 ; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 3 p. 1010. 282
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 3 p. 751.
Page | 345
formations au sein du Palais. La prédominance de la kalemiye est d’ailleurs remarquable, soit
qu’elle apparaisse spécifiquement, soit qu’elle transparaisse dans les offices détenus avant
leur entrée dans la maison princière. Le recrutement des kethüda des princesses au sein de la
household impériale se révèle particulièrement instructif. Il souligne les liens serrés entre la
maison impériale et les maisons princières que nous avons déjà repérés à diverses occasions.
Il est également la marque d’une préférence en faveur des officiers sortis des rangs du Palais,
au détriment de ceux formés au sein des maisons de pachas. Mais c’est la marque d’un échec :
celui des princesses à former leurs propres officiers – on ne va chercher ailleurs que ce dont
on ne dispose pas chez soi. Le phénomène se répète d’ailleurs en dehors des carrières des
kethüda : rares sont les individus formés au sein des maisons des princesses qui parvinrent à
suivre de hautes carrières – leurs parents mis à part.
Mehmed Efendi compte parmi ces exceptions : entré dans sa jeunesse au service de
Beyhan Sultane (fille d’Ibrahim) comme baltacı, il parvint à se faire nommer au poste de
secrétaire du chef des eunuques noirs, position qui lui ouvrit la porte d’une carrière aux postes
les plus élevés283
. Un second exemple nous est fourni avec Velî Efendi, entré au service
d’Hadice Sultane, fille de Mehmed IV, qui le fit entrer dans l’Enderûn (du palais impérial) ; il
s’éleva d’abord au rang d’intendant du trésorier impérial, puis de başmuhasebeci, Haremeyn
muhasebeci, de nouveau başmuhasebeci, defter emini, puis cizye muhasebeci, enfin defter
emini de l’armée284
. Le phénomène est néanmoins rare : les princesses reçoivent bien plus
qu’elles ne donnent d’officiers issus de leurs rangs ; elles propulsent des individus déjà
formés et prometteurs, mais se chargent rarement de leur instruction initiale. Seule exception :
les cariye, qu’elles entretiennent et éduquent en nombre important, et marient dans les autres
maisons une fois celles-ci en âge de l’être. Les récits des femmes du harem du XIXe siècle
recèlent de multiples informations qui permettent de distinguer tout un réseau de clientélisme
et d’interpénétration des maisons entre elles, par l’intermédiaire des cariye. Notre période ne
permet pas une si bonne connaissance de ces réseaux, mais on sait néanmoins que les
princesses comptaient parmi les personnalités de l’Empire qui offraient de belles cariye au
sultan. L’esclave qu’Ismihan Sultane offrit à son frère, Murad III, mit fin à sa relation
monogame avec sa favorite, Safiyye Sultane285
; la reine mère Turhan Hadice Sultane avait
été formée par Atike Sultane avant d’être offerte au sultan. La collusion entre la maison
impériale et les maisons princières se repère jusque dans les échanges de femmes esclaves286
.
Doter ses serviteurs
Si les princesses ottomanes surent dispenser leur protection à certains de leurs
serviteurs et leur assurer une double carrière, la grande majorité d’entre eux ne bénéficièrent
283
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 3 p. 1024. 284
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî : t. 5 p. 1658. On notera qu’il s’agit d’une princesse particulièrement active en politique, qui a beaucoup contribué à assurer la carrière de son époux, Damad Hasan Pacha. 285
Thys-Şenocak, Ottoman Women Builders : 18 ; Peirce, The Imperial Harem : 236. 286
Pedani, « Safiye’s Household » : 13.
Page | 346
pas d’un tel traitement. Pour ceux-là, les princesses se contentèrent d’accorder des offices ou
des rentes, via leurs fondations pieuses – du moins pour les plus chanceux d’entre eux. De
fait, les fondations pieuses ont une utilité familiale qui ne se limite pas au cadre des relations
consanguines, mais englobe la maison tout entière et même, dans certains cas, les clients ou
protégés d’une princesse.
Tous les membres de la maison d’une princesse n’étaient pas gratifiés d’un office au
sein de sa fondation pieuse : seuls quelques membres sont récompensés de la sorte. Ces
privilégiés peuvent être répartis en trois catégories, qui reflètent des degrés divers de
proximité avec la fondatrice. Le degré de plus grande proximité est détenu par les kethüda
(intendants), quasi systématiquement nommés au poste de mütevelli en lieu et place de la
princesse287
. Ainsi Hüsrev Kethüda ibn Abdurrahman, intendant d’Ismihan Sultane (fille de
Selim II), se voit-il également confier l’office de mütevelli de sa fondation288
; Süleyman
Beyefendi ou Osman Beyefendi cumule également ces deux charges auprès de Safiyye
Sultane (fille de Mustafa II)289
, de même que Elhac Hüseyin Ağa ibn Mahmud auprès
d’Emine Sultane (fille d’Ahmed III)290
. Le cumul des charges, récurrent dans la société
ottomane, a ici un côté pratique évident : au courant des affaires privées de la sultane, en
contact direct et régulier avec elle, l’intendant est le mieux placé pour gérer les intérêts de sa
fondation. Le vakf permet en retour à la fondatrice de rétribuer un de ses employés les plus
proches, gratification qui est autant une marque de confiance et de proximité, qu’un
instrument supplémentaire pour s’attacher la personne qui en profite.
Les scribes et collecteurs de taxes du vakf sont régulièrement choisis parmi les
membres de la maison de la princesse fondatrice. Moins proches que les kethüda, leur
nomination renforce cependant la forte relation entre le vakf et la maison de la fondatrice. Le
nombre de personnes concernées est cependant variable : une ou deux personnes pour les plus
petites fondations, jusqu’à une dizaine dans les plus grandes. Certaines vakfiyye expriment de
façon très claire ce lien avec la household : ainsi, Selçuk Hatun, au XVe siècle, confie-t-elle
les divers postes de collecteurs de taxe et de superviseur de sa fondation à trois de ses esclaves
affranchis, Haci Ilyas bin Abdullah, Eşigüldü bin Adullah et Mahmud bin Abdullah, précisant
qu’à leur mort, leurs offices devront être transmis aux lignées masculines de ses affranchis291
;
de même Mihrimah Sultane, au XVIe siècle, remet l’office de scribe entre les mains de ses
287
Il convient d’expliquer plus précisément ce système, dans la mesure où le mütevelli est l’office du gestionnaire du vakf, et que nous avons expliqué plus haut qu’il était détenu et hérité par les fondatrices et leurs descendants. Le fait est que le vocabulaire même des sources porte à confusion, puisqu’il est question tantôt du mütevelli, tantôt de l’office de tevliyet : deux termes dérivés de la même racine arabe, qui renvoient à la même responsabilité : le premier est l’officiant, le second l’office. Il semble qu’une répartition ait été effectuée entre les deux, au moins lors de l’établissement du vakf, du vivant de la fondatrice – la situation est moins claire par la suite. La fondatrice se réservait la détention de l’office, laissant un autre faire le travail. 288
VGMA D 572 n°53 : 980 (1572). 289
Süleyman était un personnage central de la maisonnée, cumulant les charges de kethüda de la princesse et de mütevelli, ses liens matrimoniaux (il était en effet le gendre de la princesse), et ses liens paternels (son père, Ebubekir Paşa, était un des vizirs de la coupole). Il fut ensuite remplacé semble-t-il par un autre kethüda de la princesse, également kapıcıbaşı, Osman Beyefendi. Voir la fiche récapitulative de la Safiyye Sultane, Annexe E.18 (ainsi que celle de sa fille, E.19.). 290
VGMA D 736-3 n°44 : 1152 (1739). 291
VGMA D 608-2 n°333 : 888 (1483).
Page | 347
affranchis et de leurs descendants292
; Atike Sultane, fille d’Ahmed Ier, place son propre
kethüda, Isa Ağa, au poste de superviseur de son vakf293
; Safiyye Sultane, fille de Mustafa II,
désigne un certain Türbedar Musa Çelebi, membre de sa maison, aux postes de scribe et de
collecteur de taxes294
. Les principaux postes de gestion du vakf étaient détenus par des
individus dépendants de la princesse envers lesquels elle se sentait liée : la création de vakf se
présente ainsi comme un moyen d’assurer et de promouvoir sa propre maison, en accordant à
certains de ses membres des postes rémunérés – en sus de ceux qu’ils exerçaient au service
domestique de la princesse.
L’attribution de rentes financées par le vakf fut une autre manière de récompenser
certains membres de leur entourage. Parmi les privilégiés se trouvent d’anciennes esclaves
affranchies, ainsi remerciées de leurs services par une rente à vie, les nourrices des enfants de
la fondatrice, et encore certaines personnes à propos desquelles les informations sont trop
confuses pour permettre de déterminer le type de relation qu’elles entretenaient avec la
princesse. Dans ces divers cas, la rente va de pair avec une connaissance intime de la
fondatrice : elle apparaît comme une gratification personnelle, une reconnaissance du degré
d’intimité d’une employée avec sa patronne. Par-delà l’argent proprement dit, qui représente
souvent des sommes limitées, c’est surtout la marque du lien maîtresse / esclave qui primait
dans l’acte de donation295
. On constate, par ailleurs, que ces rentes touchent très
majoritairement des femmes. Les fondatrices semblent avoir suivi la même répartition sexuée
des aides accordées aux membres de la maison que dans le cas de leurs descendants. Le même
système de compensation surgit : traditionnellement absentes des activités professionnelles
institutionnalisées, ces femmes en étaient exclues au profit des hommes ; elles étaient
cependant les principales bénéficiaires des rentes ad vitam eternam.
Les princesses ottomanes sont à la tête de maisons individuelles dont la taille et
l’importance sont en adéquation avec leur propre statut de personnes royales. Elles
accomplissent leur rôle de chef de maison en usant de tous les moyens mis à leur disposition :
elles favorisent l’insertion de certains dans les carrières étatiques, assurent à d’autres des
revenus et/ou des offices par l’intermédiaire de leurs vakf. Des liens très forts unissent les
maisons des princesses au Palais, qui représente non seulement l’une des sources
d’approvisionnement en officiers à leur service, mais encore l’une des voies principales de
promotion sociale de leurs serviteurs et servantes. Néanmoins, rares sont ceux qui bénéficient
d’une aide réelle de la part de la princesse : sur les quelques centaines d’individus à leur
service, une dizaine à peine se voit récompensée de leurs efforts par des gratifications
supplémentaires. Les sultanes agissent de même que les sultans : l’intimité, la proximité, le
292
VGMA D 635-2 n°8 : 965 (1558). 293
VGMA D 623 n°20 : 1062 (1652). 294
VGMA D 46 n°12 : 1152 (1739). Ce Musa Çelebi apparaît de façon récurrente dans les vakfiyye de la princesse, soit parmi les témoins, soit à diverses fonctions en relation avec son vakf ; les renseignements le concernant permettent de l’identifier de façon incontestable comme un des membres de sa maisonnée. 295
Contrairement aux rentes des descendantes de sexe féminin des sultanes, qui se voyaient souvent octroyées des rentes dont leurs propres enfants pouvaient, dans certains cas, hériter, celles accordées aux esclaves membres de la maisonnée sont destinées uniquement à un bénéficiaire, nominalement précisé, avec mention que cet avantage prend fin au trépas du bénéficiaire.
Page | 348
contact direct et régulier avec le/la chef de maison sont les voix principales pour se distinguer
à ses yeux et profiter alors de ses bienfaits.
2. La clientèle extérieure et les relations avec l’ʻilmiyye
Le vakf était certes un instrument de promotion familiale (au sens large de parents et
serviteurs), mais il ne saurait se réduire à ces seuls individus. La fondation d’un vakf assurait
la création d’un nombre important et diversifié d’offices rétribués, dont seuls quelques-uns
revenaient aux membres de la maison des princesses. Une majorité de ces offices étaient de
nature religieuse et requérait des personnes spécialement versées dans ces connaissances. Or,
la formation des hommes de l’`ilmiyye, les « gens de science » (dans le sens de science
religieuse), se faisait en dehors des household, en dehors même du Palais : elle avait lieu dans
les écoles religieuses, sous la surveillance de professeurs patentés, seuls capables de délivrer
des diplômes reconnus par l’État. Ces écoles, depuis les mekteb aux medrese, étaient
construites et entretenues par l’institution du vakf296
. Les fondations pieuses des princesses
étaient ainsi à la fois des viviers de production de « gens de science », parmi tant d’autres, et
des employeurs pour ces mêmes personnes. La connexion entre les princesses et l’`ilmiyye
peut ainsi s’étudier à travers le personnel de leurs vakf.
Deux exemples particulièrement connus viennent justifier cette approche. Şah Sultane
(fille de Selim Ier), disciple de l’ordre Halveti-Sünbüli, fit bâtir successivement trois petits
complexes dédiés à cet ordre et tout particulièrement à un de ses représentants, le cheikh
Merkez Efendi. Les tekke ainsi fondés permirent à nombre de derviches de cet ordre d’y être
formés et d’y exercer. Le lien avec le cheikh Merkez Efendi transparaît dans ses vakfiyye :
outre la construction d’un mescid en son nom, où elle le nomma comme officiant, elle accorda
encore des rentes à divers membres de sa famille297
. De même Ayşe Sultane, fille de
Mihrimah Sultane et de Rüstem Pacha, fit ajouter des bâtiments au complexe de sa mère à
Üsküdar, par désir d’honorer le cheikh dont elle était une fervente disciple : Mahmud Hüdayî.
Elle ordonna notamment la construction de son türbe, près duquel elle se fit d’ailleurs
inhumer298
. L’élément moteur de ces fondations est le désir de plaire et de soutenir une
organisation religieuse appréciée, selon les formes traditionnelles du patronage. L’érection
296
Gilles Veinstein, « Les Ottomans : fonctionnarisation des clercs, cléricalisation de l’État ? », dans Histoire des hommes de Dieu dans l’Islam et le Christianisme, D. Iogna-Prat et G. Veinstein (éds.), Paris, Flammarion, 2003 : 178-202 et « Le modèle ottoman », dans Madrasa. La transmission du savoir dans le monde musulman, N. Grandin et M. Gaborieau (éds.), Paris, Éditions Arguments, 1997 : 73-83 ; İnalcık, « Learning, the Medrese and the Ulema ». Voir aussi Zilfi, The Politics of Piety ; İsmail H. Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinde İlmiye Teşkilâtı, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1965 ; Câhid Baltacı, XV-XVI asırlar Osmanlı Medreseleri, Istanbul, İrfan Matbaası, 1976 ; Fleischer, Bureaucrat and Intellectual. 297
Sur cette question, consulter Necipoğlu, The Age of Sinan : 293-296 ainsi que Alberto F. Ambrosio, « L’origine féminine des espaces soufis à Istanbul », dans Hommes et femmes bâtisseurs, traditions et stratégies dans le monde oriental et occidental, S. Frommel et J. Dumas (éds.), Paris / Rome / Istanbul, Picard / Campisano / IFEA, 2013 : 229-237. 298
Necipoğlu, The Age of Sinan : 302.
Page | 349
d’édifices vakf offrait à ces individus un endroit où officier, favorisant ainsi l’accroissement
de sa gloire et de sa réputation, tout en lui assurant un office rétribué.
Le personnel officiant des vakf des princesses suivait une hiérarchie professionnelle et
sociale mise en évidence par les écarts de revenus, qui place les emplois religieux dans la
partie supérieure de la pyramide des métiers. On peut la schématiser de la sorte :
Schéma 4.25. Pyramide socio-professionnelle des offices rétribués au sein des vakf des princesses
Au sommet viennent les chefs d’établissements et employés hautement formés, tels les
professeurs, les imams ou les müezzin. Les professeurs de medrese tiennent le haut du pavé,
avec des salaires s’échelonnant de 8 à 100 aspres par jour. La majorité d’entre eux perçoivent
néanmoins un salaire de 50 aspres par jour299
. Leur position à la tête des offices religieux des
vakf des princesses respecte scrupuleusement les hiérarchies sociales de l’`ilmiyye ayant cours
dans l’Empire, qui place les professeurs des « universités » (les medrese) au sommet de
l’édifice. Le système ottoman des medrese était organisé selon un système de classification
défini par le salaire des professeurs y enseignant. Le premier niveau d’instruction était fourni
par les « medrese de l’extérieur » (hariç medrese), subdivisé en trois niveaux : les « medrese à
20 aspres », à 30 aspres et à 40 ou 50 aspres, ces dernières étant localisées dans les villes-
capitales de l’Empire, Bursa, Edirne et Istanbul. Quand un étudiant était diplômé d’une de ces
299
Le müderris de la medrese de Mihrimah Sultane (fille de Süleyman Ier) à Üsküdar reçoit 50 aspres par jour, de même que celui de son complexe à Edirnekapı : VGMA D 635-2 n°1 : 957 (1549) et D 635-2 n°11 : 978 (1570). Celui de l’autre medrese de cette princesse à Üsküdar, non intégrée à son complexe, reçoit 40 aspres par jour : VGMA D 635-2 n°8 : 965 (1568). Le müderris de la medrese d’Ismihan Sultane (fille de Selim II) reçoit également 50 aspres par jour : VGMA D 572 n°53 : 980 (1572), de même que celui officiant dans la medrese construite par Gevherhan Sultane (fille de Selim II) : VGMA D 742 n°67 : 1018 (1609) et que celui de la medrese d’Ayşe Sultane (fille d’Ahmed Ier) : VGMA D 2138 n°21 : 1011 (1603). Par contre, le mu’allim de la medrese de Fatma Sultane(fille de Selim II) se voit rétribué d’une somme ne s’élevant qu’à 8 aspres par jour : VGMA D 732 n°254 : sans date. Ce bas salaire peut s’expliquer par le fait qu’il s’agit d’un mu’allim, non d’un müderris : les premiers exercent généralement au sein des mekteb, les seconds dans les medrese, même s’il arrive qu’il y ait des exceptions à la règle, comme dans le cas présent. Fatma Hanzade Sultane (petite fille de Bayezid II) accordait pour sa part un salaire de 40 aspres par jour au müderris de sa medrese, à Bursa : VGMA D 584 n°71 : 939 (1532). Enfin, au XVIII
e siècle, on trouve encore un müderris nommé pour la medrese fondée par Fatma
Sultane, fille d’Ahmed III, qui reçoit la somme de 100 aspres par jour : VGMA D 38 n°3 : 1141 (1729).
Page | 350
écoles, il pouvait alors se présenter à l’entrée des « medrese de l’intérieur » (dâhil medrese),
elles aussi subdivisées en diverses catégories. Ces dernières sont principalement localisées
dans les villes susdites. À la classification des medrese correspond ainsi une hiérarchie des
postes de müderris (les professeurs enseignant dans ces écoles), qui se distinguent à la fois par
les salaires afférents et par les matières enseignées300
. Au vu des salaires perçus par leurs
müderris, les medrese des princesses se plaçaient parmi les écoles les plus prestigieuses de
l’Empire, bien qu’à un niveau en dessous des fondations impériales (notamment celles de
Mehmed II et de Süleyman Ier). Ces müderris n’étaient donc pas seulement au sommet des
officiants des vakf des princesses ; ils appartenaient également à l’élite supérieure de la
hiérarchie religieuse de l’ʻilmiyye.
Les professeurs de mektep, les mu’allim, viennent en deçà, avec un salaire
s’échelonnant de 3 à 25 aspres par jour301
. Les imams et müezzin se situent à un niveau
similaire, bien que l’échelle de leurs revenus soit plus ample pour les imams (entre 1 et 30
aspres par jour)302
, de 1 à 10 aspres par jour pour les müezzin303
. Dans les fondations les plus
300
Veinstein, « Les Ottomans : fonctionnarisation des clercs, cléricalisation de l’État ? » : 181-184 ; Fleischer, Bureaucrat and Intellectual : 25-28 ; Uzunçarşılı : İlmiye Teşkilâtı : 11-48 ; İnalcık, « Learning, the Medrese and the Ulema » : 168-172. 301
Les mu’allim des deux mekteb fondées par Mihrimah Sultane (une à Üsküdar, une à Istanbul) reçurent tous deux la somme de 3 aspres par jour : VGMA D 635-2 n°8 : 965 (1558). Celui de la mekteb créée par Kaya Ismihan Sultane, fille de Murad IV, fut doté, pour sa part, d’un revenu de 25 aspres par jour : VGMA 573 n°9 : 1128 (1715). Celui de la mekteb fondée par Fatma Sultane, fille d’Ahmed III, recevait quant à lui 10 aspres par jour : VGMA D 38 n°3 : 1141 (1729). Enfin, le hoca enseignant dans la mekteb de Zeyneb Sultane, autre fille d’Ahmed III, fut doté d’un salaire de 20 aspres par jour : VGMA D 743-1 n°80 : 1183 (1769). Il faudrait également mentionner, dans cette catégorie, leurs halife, qui reçoivent un salaire inférieur à celui du maître, mais qui demeure tout de même respectable. 302
Les imams constituent une catégorie professionnelle très nombreuse, qui bénéficia largement de la création de nouveaux établissements par les princesses ottomanes. Nous nous contentons, ici, de donner quelques exemples au cours du temps. Ainsi Selçuk Hatun, fille de Mehmed Ier, prévoit le financement du salaire de plusieurs imams, qui recevaient respectivement 4, 2 et 1 dirhem par jour : VGMA 608-2 n° 333 : 888 (1483). La fille de Selim Ier, Şah Sultane, avait la responsabilité de la nomination de trois imams (un pour son vakf à Eyüp, un pour celui de Yenikapı, un autre pour celui de Davud Paşa) : ceux-ci touchaient respectivement un salaire de 25, 5 et 5 aspres par jour : VGMA D 1993 n° 7 : 977 (1569). Les imams des deux mosquées fondées par Mihrimah Sultane, fille de Süleyman Ier (Üsküdar et Edirnekapı) percevaient respectivement 8 et 10 aspres par jour : VGMA D 635-2 n°1 : 957 (1549) et VGMA D 635-2 n°11 : 978 (1570). La mosquée d’Ismihan Sultane, fille de Selim II, était dotée de deux imams, qui recevaient tous deux un salaire de 10 aspres par jour : VGMA D 572 n° 53 : 980 (1572). Celui de la mosquée de sa sœur, Gevherhan Sultane, était moins bien payé, puisqu’il ne touchait que 7 aspres par jour, mais la mosquée était située dans un village en Roumélie, non dans la capitale : VGMA D 742 n°67 : 1018 (1609). Plus tard, au XVIII
e siècle, on trouve encore la mosquée fondée par la fille
d’Ahmed III, Fatma Sultane, qui accordait un salaire de 30 aspres par jour à son imam : VGMA D 38 n°3 : 1141 (1729), mais l’augmentation du salaire s’explique par la dévaluation monétaire survenue tout au long du XVII
e
siècle. La moyenne se situe ainsi aux alentours de 10 aspres par jour, dès lors que l’on exclut les cas particuliers des mescid du XV
e siècle de Selcuk Hatun et que l’on tient compte de l’augmentation de salaire au XVIII
e siècle,
destinée à compenser la dévaluation monétaire survenue tout au long du siècle précédent. 303
Les müezzin constituent une seconde catégorie professionnelle bien pourvue en créations de postes, grâce aux nouvelles fondations des princesses. De même que pour les imams, nous nous contentons ici de donner quelques exemples de salaires, au cours du temps. Selçuk Hatun, fille de Mehmed Ier, prévoyait la somme de 2 dirhem par jour pour son muezzin : VGMA 608-2 n° 333 : 888 (1483). Les trois complexes fondés par la fille de Selim Ier, Şah Sultane, nécessitaient la nomination d’autant de müezzin, qui touchaient un salaire de 5 aspres par jour chacun, pour le müezzin régulier : VGMA D 1993 n° 7 : 977 (1569). Les müezzin en chef des deux mosquées fondées par Mihrimah Sultane à Üsküdar et à Edirnekapı percevaient respectivement 4 et 6 aspres par jour : VGMA D 635-2 n°1 : 957 (1549) et D 635-2 n°11 : 978 (1570). La mosquée d’Ismihan Sultane, fille de
Page | 351
prestigieuses, il existait encore une hiérarchie interne à ces métiers avec, par exemple, un
müezzin en chef, assisté de deux ou trois autres. C’est le cas de la mosquée fondée par
Ismihan Sultane à Istanbul : quatre müezzin reconnus pour leur belle voix y officient, dont
« l’un d’entre eux [est] le chef et commandant et reçoit six aspres par jour pour cette charge
de responsabilité, les autres étant rétribués cinq aspres par jour chacun ; une autre personne
dotée d’une belle voix et à la diction aérienne officiera en tant que müezzin de l’appel à la
prière du vendredi et des grandes occasions : qu’il reçoive deux aspres par jour au titre de
cette charge »304
. Şah Sultane305
, Mihrimah Sultane306
et Gevherhan Sultane307
, pour ne citer
que ces exemples, en font de même. Ces mosquées, qui comptent parmi les plus prestigieuses
de l’Empire, prévoyaient encore la présence d’un prêcheur pour la prière du vendredi, qui
touchait un salaire avoisinant celui de l’imam308
.
Les professeurs dispensant des cours dans des mosquées au lieu d’écoles, phénomène
qui apparaît au XVIIIe siècle pour les vakf des princesses, forment le bas de ce groupe
supérieur : leurs enseignements jouissent d’une moindre considération que ceux dispensés
dans des structures éducatives reconnues. Le niveau de leur salaire s’en ressent : il oscille
entre deux et 60 aspres par jour, mais la majorité n’excède pas les 10-15 aspres309
. Ceux qui
Selim II, était dotée de plusieurs müezzin, dont le chef percevait un salaire de 6 aspres par jour : VGMA D 572 n° 53 : 980 (1572). Quant à la mosquée fondée hors d’Istanbul par sa sœur, Gevherhan Sultane, les deux müezzin y travaillant ne recevaient qu’une rétribution d’un aspre par jour chacun : VGMA D 742 n°67 : 1018 (1609). De nouveau, au XVIII
e siècle, on trouve un müezzin officiant dans la mosquée de la fille d’Ahmed III,
Fatma Sultane, qui se voit doté d’un revenu de 10 aspres par jour (une augmentation justifiée par la dévaluation de la monnaie) : VGMA D 38 n°3 : 1141 (1729). La moyenne se situe donc autour des 5 aspres par jour pour un müezzin en chef employé dans une mosquée sise de la capitale. 304
« Dört nefer bülbül-i bağ-ı cinân gibi nağamat-ı dil-ferib ile her biri kuvvetcan ve kuvvestcism nâtuvan olub elhan-ı bî-bedelleri merhem-i dil ve nale-i müselsilleri zencir ömr-i müsta’cel olan kimesneler müezzinler olub, içlerinden bir avazı nefsi anlara serdar ve reis olub hizmetlerin eda etdiklerinde reislerine yevmî altı akçe verilüb sairlerinin her birine yevmî beşer akçe verile ve bir hoş avaz ve nâme pervaz kimesne dahi salâ müezzini olub hizmeti malumesi eda etdikde yevmî akçe verile ». VGMA D 572 n°53 : 980 (1572). 305
Ses trois müezzin réguliers, officiant dans ses trois fondations (à Eyüp, à Yenikapı et à Davud Paşa) sont chacun assistés d’un müezzin chargé de faire les appels à la prière du vendredi et des jours saints. VGMA D 1993 n° 7 : 977 (1569). 306
Elle prévoit en tout quatre müezzin qui se répartissent le travail, le chef recevant un salaire de 6 aspres par jour, les trois autres le même revenu journalier de 5 aspres. VGMA D 635-2 n°11 : 978 (1570). 307
Elle prévoit deux müezzin pour sa mosquée à Fethü’l-islam, qui se répartissent le travail sans distinction de salaire ni de statut. VGMA D 742 n° 67 : 1018 (1609). 308
C’est le cas notamment dans la seconde mosquée fondée à Edirnekapı par Mihrimah Sultane, dont le prêcheur recevait 10 aspres par jour : VGMA D 635-2 n°11 : 978 (1570). C’est également le cas dans la mosquée fondée par la fille de Selim Ier, Şah Sultane, à Eyüp, bien que le salaire du prêcheur soit ici largement inférieur à celui de l’imam, puisqu’il ne reçoit que 4 aspres par jour (l’imam était doté d’un revenu de 25 aspres par jour). VGMA D 1993 n° 7 : 977 (1569). 309
Ce type d’emploi est une figure typique du 18e siècle : nos exemples datent tous de cette période. Safiyye
Sultane, fille de Mustafa II, est l’une des premières à avoir pratiqué cela, avec le financement de deux cours dans des mosquées déjà existantes, respectivement celle de Mehmed II, de Bayezid II et de Sainte-Sophie : les professeurs recevaient de la princesse un salaire respectif de 15, 15 et 8 aspres par jour : VGMA D 736-3 n°71 : 1154 (1741) et D 736-3 n°72 : 1155 (1742). Mais celui pratiquant dans la mosquée de Sainte-Sophie vit rapidement son salaire rehaussé au niveau de celui de ses confrères : VGMA D 46 n°33 et D 1161 (1748). Quelque temps plus tard, elle créée de nouveaux cours, dispensés dans les mosquées de Molla Şeref et Öksüzce (toutes deux à Istanbul), pour lesquels les professeurs touchent respectivement 2 et 10 aspres par jour : VGMA D 46 n°45 : 1163 (1750) ; puis de nouveau dans la mosquée de Murad Paşa, à Aksaray (Istanbul) : son professeur se voit doté d’un revenu de 15 aspres par jour : VGMA D 46 n° 42 : 1166 (1753). De même sa
Page | 352
exercent dans les mosquées prestigieuses, impériales notamment, sont les mieux payés de
cette catégorie. Les cas des deux professeurs nommés par Saliha Sultane, fille d’Ahmed III,
est à mettre à part, car ils professent non pas dans des mosquées, mais des türbe : ils sont les
seuls à toucher respectivement 30 et 60 aspres, signe d’un enseignement religieux de qualité
(apprentissage du Coran pour de futurs récitants)310
. Enfin, les cheikhs nommés à la tête des
couvents (tekke / zaviyye) s’inscrivent également dans cette tranche de la pyramide, avec des
salaires qui s’échelonnent entre cinq dirhems (au XVe siècle) et 15 aspres par jour
311, une
somme respectable qui souligne leurs responsabilités de chefs d’une communauté religieuse
(les derviches du couvent).
La moitié inférieure de cette pyramide est tenue pour partie par les étudiants et
récitants de prière. Ceux-ci ne reçoivent que quelques aspres par jour, en guise de rétribution
pour leurs services religieux, ou comme « bourse d’études »312
. Ces étudiants financés sont
des privilégiés : les jeunes éduqués dans les mekteb ne reçoivent aucun émolument, au plus
quelques gratifications en nature s’apparentant à de la charité. Il est vrai, toutefois, qu’il s’agit
de jeunes garçons auxquels on dispense une instruction très sommaire et qui ne prétendent
nullement, à ce stade, devenir les futurs cadres religieux de l’Empire – contrairement aux
élèves des medrese. Ils forment le bas de l’échelle de la profession religieuse.
Les princesses ne prenaient bien évidemment pas le temps de choisir personnellement
chaque employé. Néanmoins, les officiants appartenant au sommet de cette pyramide, comme
les professeurs et les responsables divers, étaient nommés directement par les fondatrices. Le
nièce, Esma Sultane, prévoit l’organisation de cours dans diverses mosquées d’Istanbul, soit à Sainte-Sophie et à la Bezzazi Cedid : les professeurs chargés de ces cours se virent accordés un salaire de 10 aspres chacun : VGMA D 740 n°50 : 1177 (1763). Sa sœur, Zeyneb Sultane, en fit de même à Sainte-Sophie et dans la mosquée de la Valide Sultane à Bağçekapısı : les professeurs furent rétribués d’un salaire respectif de 10 et 9 aspres par jour : TSMA D 736-3 n°74 : 1153 (1740). Enfin Saliha Sultane, autre fille d’Ahmed III, proposa également ce type de cours, dan les mosquées de Mehmed II et celle de Piri Paşa, à Istanbul, ainsi que dans deux türbe, celui d’Eyüp et celui de son père : les professeurs chargés de ces cours furent, pour leur part, rétribués selon un salaire s’élevant à 20 aspres pour les trois premiers, et 60 pour le dernier : VGMA D 736 n°27-1 : 1151 (1738) et D 741 n°143 : 1190 (1176). 310
Voir note précédente. 311
Au XVe siècle, la princesse Neslişah Sultane, petite-fille de Bayezid II, fonde un petit complexe à Istanbul, qui
compte entre autres une zaviyye et un mescid (transformé par la suite en mosquée) : le cheikh de la zaviyye, également chargé de l’office de l’imam, se voit doté d’un salaire de 5 dirhems d’argent par jour : VGMA D 574 n°35 : 949 (1542). Les cheikhs des tekke fondés à Eyüp et à Yenikapı par Şah Sultane, fille de Selim Ier, percevaient un salaire de 15 aspres par jour chacun : VGMA D 1993 n°7 : 977 (1569). Deux siècles plus tard, Fatma Sultane, fille d’Ahmed III, prévoit un revenu de 10 aspres par jour pour le cheikh pratiquant dans la zaviyye de Koca Mustafa Paşa, à Istanbul ; il est toutefois possible que cette somme consiste à un ajout de revenu, non à son unique salaire, puisque la fondation, déjà existante, ne peut avoir oublié de prévoir le salaire de son cheikh ; il est probable que cette clause ait été destinée à compenser, par un ajout de revenu, un salaire devenu trop faible pour les conditions de vie dans la capitale, suite aux dévaluations monétaires : VGMA D 38 n°3 : 1141 (1729). 312
Les récitants perçoivent un ou deux aspres par jour, sans distinction selon les récitations (zikr, prières, lectures du Coran) ; les étudiants des medrese sont financés, hors récitations supplémentaires, à hauteur de deux aspres par jour et par personne en moyenne. Ainsi les étudiants des medrese de Mihrimah Sultane perçoivent chacun deux aspres par jour. VGMA D 635-2 n°8 : 965 (1558) et D 635-2 n°11 : 978 (1570). Le même salaire est prévu pour les étudiants de la medrese d’Ayşe Sultane, fille de Murad III : TSMA D 2138 n°21 : 1011 (1603). Les étudiants de la medrese de Gevherhan Sultane, fille de Selim II, semblent avoir été mieux payés, puisqu’ils reçoivent des émoluments s’élevant à six aspres par jour : VGMA D 742 n°67 : 1018 (1609).
Page | 353
phénomène peut d’ailleurs se vérifier dans nombre de cas : dans leurs vakfiyye, il n’est pas
rare que les princesses stipulent nominalement le müderris, l’imam ou le mu’allim appelé à
exercer dans sa fondation, indication qui suppose un choix spécifique en faveur d’une
personne connue. Le phénomène est particulièrement visible concernant les professeurs qui
officiaient hors du système scolaire : ils sont choisis nominalement. Ainsi, Safiyye Sultane
finance-t-elle un cours dans la mosquée de Molla Şeref, qu’elle confie aux bons soins
d’Ibrahim Efendi ibn Mehmed ; deux autres sont dispensés dans les deux mosquées
impériales de Mehmed II et de Bayezid II par Hasan Efendi ; enfin celui qui se tient dans la
mosquée de Murad Pacha à Aksaray est placé sous la responsabilité de Hafız Mustafa Efendi
ibn Namlı313
. Les princesses entretenaient donc des liens assez lâches de patronage envers des
individus appartenant à l’`ilmiyye, ce qui leur permettait d’étendre leur réseau d’influence en
direction d’autres sphères du pouvoir et de la société.
*
Les princesses ottomanes investissent l’essentiel de leur capacité d’action en faveur de
leurs proches et clients. Les individus qu’elles ont ainsi sous leur responsabilité sont en
nombre important (plusieurs centaines d’hommes et de femmes), mais tous ne bénéficient pas
de façon identique de la protection princière : elle décroît en fonction du degré de proximité et
d’intimité avec la princesse. Une division très nette apparaît entre les descendants, qui sont
l’objet d’une véritable attention destinée à contrecarrer les effets de déperdition sociale que le
délitement générationnel impose dans un système qui ne reconnaît pas l’hérédité des charges
ni des positions, et les serviteurs et clients, en faveur desquels l’empressement se fait
beaucoup plus lâche.
Toutes proportions gardées, le résultat de l’action des princesses envers leurs
descendants est plutôt réussi, grâce à une combinaison subtile des usages du vakf et des
politiques d’insertion au sein des carrières militaro-administratives. Les fondations pieuses
permettent, en effet, aux princesses d’assurer à leurs descendants tout à la fois une certaine
richesse, le prestige (même limité) d’être à la tête de vastes vakf, enfin une position garantie
par la pérennité de l’institution. Mais cela ne suffisait pas pour assurer à ces descendants le
maintien, impossible en vérité, dans une position sociale équivalente à celle des ancêtres
fondateurs de la lignée. Pour cela, il fallait procurer aux sultanzade les moyens de reproduire
le modèle paternel de progression de carrière au sein de l’État. Le moyen que les princesses
semblent avoir trouvé pour cela fut de faire accepter leurs descendants au sein de l’école du
Palais, souvent dans le groupe très sélectif des müteferrika, parfois dans les filières plus
courantes. Tous ceux qui y furent placés connurent des évolutions de carrière normales et
purent ainsi s’élever dans la hiérarchie étatique. Cette stratégie permettait à ces sultanzade, du
fait de leurs offices, d’obtenir richesse, prestige et position sociale, mais encore des honneurs 313
VGMA D 736-3 n°121 : 1152 (1739) ; D 736-3 n°72 : 1155 (1742) ; D 46 n°42 : 1166 (1753). Une partie d’entre eux seront par la suite remplacés par d’autres professeurs et cheikh, ainsi qu’il apparaît dans la vakfiyye VGMA D 736-3 n°73 : 1161 (1748).
Page | 354
et, surtout, le pouvoir qui était associé à ces fonctions. Néanmoins, un sultanzade n’est pas
l’égal d’un autre dans ces affaires : les descendants issus des princesses les plus puissantes
sont généralement mieux lotis et ont des chances de conserver, bon gré mal gré, leur position
sociale et de la transmettre à leurs propres enfants. Les autres montrent parfois une réussite
personnelle fort louable, mais qui se retrouve rarement chez leurs descendants. Ainsi, la
grande majorité des sultanzade durent se satisfaire d’une situation certes honorable, mais
moins brillante que celle de leurs ancêtres.
Les membres de la maison ou de la clientèle sont l’objet d’une considération moindre.
Les enjeux ne sont plus les mêmes, les résultats non plus. On note cependant un véritable va-
et-vient d’individus, de promotions et d’entraide entre le Palais impérial, les maisons des
princesses et leurs vakf. Certains officiers sortis des rangs de la kalemiyye (ou d’une autre
branche) entrent au service d’une princesse : ils peuvent alors être nommés gestionnaires de
sa fondation pieuse ; d’autres ne font qu’un passage auprès de la sultane, avant de retourner à
leur carrière administrative (sans rompre nécessairement tout lien avec l’ancienne maîtresse) ;
d’autres encore peuvent espérer être nommés à un office quelconque de sa fondation pieuse
ou être promus dans les rangs de l’administration impériale. Les maisons des princesses
hébergent un nombre considérable d’individus, mais rares sont ceux qui sont puissants ou
seront amenés à le devenir. En ce sens, il faut convenir que les maisons des princesses sont
surtout des lieux où l’on place, pour un temps, des officiers intermédiaires ; des milieux
relativement à l’abri du vacarme ambiant de la politique et où il est possible probablement de
demeurer ainsi protégé pendant de longues années. Mais elles ne sont pas des viviers de
production d’officiers ; elles ne sont pas des milieux de formation en vue de grandes carrières.
Les maisons qui copient et concurrencent le modèle impérial, ce sont les household de
pachas : les princesses demeurent relativement à l’écart de ces synergies.
Pourquoi les princesses ne firent-elles pas comme leurs époux ? Pourquoi ne
formèrent-elles pas des officiers destinés aux plus hautes charges ? Il faut peut-être y voir
l’effet des conditions imposées à leur sexe. La force des household de pacha résidait dans la
personne même du pacha : c’est sous son égide, par l’exemplarité de ses pratiques, que ses
employés étaient formés selon des procédés décrits par Bouquet314
. C’est parce que le pacha
gravitait lui-même dans le monde du pouvoir institutionnalisé que ses serviteurs pouvaient
apprendre les rouages du système et s’y insérer à leur tour. Les princesses ottomanes, en tant
que femmes, étaient exclues de cet espace public du pouvoir. Les hommes à leur service ne
pouvaient espérer parvenir à de hautes fonctions, parce qu’ils ne pouvaient espérer recevoir la
formation ou les contacts indispensables à cette réussite. Les princesses avaient certes des
contacts avec le monde de l’élite dirigeante masculine, mais ceux-ci n’étaient pas des contacts
professionnels. La seule opportunité de carrière qu’une princesse pouvait offrir à un de ses
serviteurs consistait à le placer soit auprès d’un pacha, soit au sein de la structure étatico-
palatiale. Ces limites de l’ordre du genre fonctionnent néanmoins dans les deux sens : les
pachas et autres dirigeants de sexe masculin étaient, de leur côté, bien incapables d’obtenir
des résultats aussi brillants que les femmes dans la formation de jeunes cariye destinées au
mariage avec d’autres officiers. Pour ces affaires, ils devaient s’en remettre aux femmes. Si
314
Bouquet, Les pachas du sultan : 231-263.
Page | 355
les attestations sur le sujet sont lapidaires, en raison du silence pudique des sources dès qu’il
s’agit de l’univers féminin des harems, tout porte à croire que les princesses disposaient là
d’une véritable compétence souvent couronnée de réussite. Les critères de genre influaient
donc sur les responsabilités de chacun dans la reproduction de l’élite.
Page | 356
CONCLUSION : Des instruments de consolidation du
champ politique ottoman en factions
Les princesses ottomanes sont enfermées dans un modèle de conduite politique précis,
élaboré dès les premiers siècles de l’histoire ottomane. Ce modèle se définit par le déni de
toute action ou initiative à but personnel : les sultanes ne sont pas supposées agir pour leurs
propres intérêts, mais au bénéfice des autres. Les autres, ce sont les membres de leur famille :
la famille dont elles sont issues (la dynastie) et celle qu’elles construisent (la famille
conjugale et l’ensemble de la domesticité et des employés). L’implication féminine dans des
affaires politiques n’était pas nécessairement jugée inacceptable par les Ottomans ; elle devait
cependant respecter le cadre des rapports de sexe. Comme le rappelait Peirce, c’est dans le
cadre de la famille qu’une femme, même royale, trouvait un terrain d’exercice politique. Cela
s’explique par la division des espaces et des rôles entre les hommes et les femmes dans la
société ottomane : aux hommes, les affaires publiques ; aux femmes, les affaires domestiques.
La défense des intérêts familiaux, parce qu’ils entrent dans le cadre des activités dévolues aux
femmes (cadre domestique), ne suscitait aucune protestation ; elle était même encouragée.
C’est la raison pour laquelle les mères de prince étaient estimées les plus aptes à défendre les
intérêts de leur fils : on présupposait qu’une mère était naturellement dévouée corps et âme à
son fils. Dans cette conception du pouvoir, les femmes n’avaient pas, ne devaient pas avoir
d’intérêts propres, mais devaient se concentrer uniquement, naturellement, sur les intérêts des
membres de leur famille : leur père ou frère, leur mari, leurs enfants.
Une conception particulière de la famille ottomane en découle. Les princesses ne
soutiennent pas l’ensemble des membres de leur famille généalogique : les relations
horizontales sont écartées au profit quasi exclusif des parents en ligne verticale – le père,
parfois le frère en tant que chef de famille, substitut du père, les descendants, mais jamais les
sœurs et leurs lignées. L’époux est l’objet d’une attention particulière, tant par devoir que par
intérêt : une épouse se doit d’embrasser les intérêts de son mari (jusqu’à un certain point) ; les
princesses y sont d’autant plus invitées que leur propre puissance dérive, pour beaucoup, de
celle de leur conjoint. Mais l’époux n’est jamais considéré que comme un allié, une pièce
rapportée : il n’est jamais pleinement intégré au lignage princier. Les enfants et petits-enfants,
mais aussi les proches, les intimes, sont également l’objet d’une attention soutenue. Ils
profitent du soutien politique et financier des princesses, via la création d’offices, la
promotion au sein de l’organisation étatique, ou l’octroi de rentes. Les lignées collatérales,
leurs sœurs et les enfants de leurs sœurs, les membres de leurs maisons en sont
systématiquement absents. Le principe vertical favorise ainsi l’établissement de lignées
distinctes et évite toute confusion des divers lignages entre eux.
Cette conception lignagère des familles princières explique l’absence d’action de
groupe. La somme totale de capital d’action politique détenue par chaque princesse, qui
constituerait un réel poids politique s’il parvenait à s’unir dans des revendications communes,
est fragmentée par la création de factions reposant principalement sur la famille au sens large
Page | 357
(la household). Structurellement parlant, les princesses ont été éduquées à préférer la défense
des intérêts de leur faction à celle de leurs alter ego, car soutenir les membres de la maison
d’une autre princesse reviendrait à renforcer la puissance de sa faction et à réduire la sienne.
Le système politicodynastique ottoman a ainsi permis l’existence d’un système de faction en
lieu et place d’un système de classe. L’existence d’un tel système explique à la fois la forme
d’action politique des princesses et leur incapacité à agir en tant que groupe.
Les sultans eux-mêmes semblent avoir privilégié, de façon indirecte et peut-être
involontaire, une telle inertie. Tout au long de la période étudiée, ils favorisèrent le
renforcement de la position statutaire des princesses au sein de la société. Tout fut mis en
place pour promouvoir une distanciation sociale entre les princesses ottomanes, représentantes
de la dynastie, et l’ensemble des membres de la société. L’objectif était de signifier la
supériorité de la dynastie au sein et en dehors de l’Empire et les princesses en furent l’un des
moyens privilégiés. L’une des conséquences fut cependant l’éviction des princesses de la
grande scène politique. Cette singularité consolida leur position au sommet de la hiérarchie
sociale, tout en prohibant toute velléité de constitution d’un groupe de pouvoir réel et
autonome. Dans son entreprise d’autosacralisation, la dynastie instrumentalisa les princesses,
qui profitèrent de ses retombées statutaires : elles raffermissaient leur position sociale, mais la
laissaient vide de toute réalité politique institutionnelle. Les princesses ne disposaient d’aucun
pouvoir politique indépendant : leur autorité continuait à dépendre du lien avec le sultan, et le
capital de puissance de l’ensemble du groupe était fragmenté par l’existence du principe
politique du factionnalisme, dont les princesses étaient l’un des moteurs. Engagées dans le
combat entre les factions qui les poussaient à s’opposer les unes aux autres (en tout cas à
défendre des intérêts divergents), les princesses ne pouvaient s’unir dans une action groupée.
Elles sont un groupe qui ne fait pas groupe, mais se délite en de multiples entités politiques,
dont le contrôle par le souverain s’en trouve facilité. En ce sens, les princesses furent des
instruments de consolidation de la structure du champ politique ottoman en factions.
Page | 359
5
L’ILLUSION PHILANTHROPIQUE
« Le mois de Zulkadir de cette année (616 [1220]), Sitt al-Sham,
fille de Ayyub b. Shadhi et sœur des rois Salah al-Din et al-‘Adil,
trépassa à Damas. Le hâfız Azki al-Din mentionne qu’elle est
décédée le 16 du mois de Zulkadir ; une autre autorité ajoute que
[son décès] eut lieu en fin de journée, le vendredi. Les deux
medrese de Damas sont nommées d’après elle : l’une se situe au
sud de l’hôpital de Nur al-Din, l’autre se trouve à l’extérieur de
Damas, dans le quartier dit ‘Awniyya. Cette dernière est
également connue sous le nom de Husamiyya, d’après le nom du
fils [de Sitt al-Sham], Husam al-Din ibn Lajin. Il y fut inhumé et
elle-même se fit enterrée dans la tombe dans laquelle son corps
avait été placé. Parmi les trois tombes, il s’agit de la troisième du
côté de la porte d’entrée. La tombe la plus au sud de celle-ci
appartient à son frère [al-Mu’azzam Sayf al-Islam] Turanshah.
Celle du milieu appartient à son cousin paternel, Nasir al-Din
Muhammad b. Shirkuh b. Shadhi, dont elle devint la femme après
le décès de [son premier mari] Lajin. Abu al-Muzaffar Sibt b. al-
Jawzi dit : Elle fut la première des princesses dévouées à la
prière, aux œuvres pieuses et aux dons. Chaque année, on
dépensait des centaines de dinars dans sa résidence afin de
préparer potions, narcotiques et plantes médicinales qu’elle
faisait distribuer au peuple. Sa porte était un refuge pour ceux qui
cherchaient un asile et un sanctuaire pour ceux qui pleuraient un
mort. Elle accorda une dotation généreuse pour ses deux medrese
et reçut des funérailles imposantes. »1
L’architecture est souvent perçue comme un domaine d’activité masculin, parce
qu’elle est une marque de pouvoir, de puissance, voire de prestige. La présence majoritaire
des hommes dans ce domaine est un fait commun à bon nombre de sociétés, depuis les
sociétés européennes jusqu’aux civilisations musulmanes médiévales et modernes. Souvent
plus modeste, la participation des femmes, de certaines femmes, dans ce domaine est un fait
pourtant avéré : ainsi l’exemple de la princesse Sitt al-Sham, une des vingt-six patronnes
1 Cité par Stéphane R. Humphreys, « Women as Patrons of Religious Architecture in Ayyubid Damascus »,
Muqarnas 11 (1994) : 35-54 [p. 47].
Page | 360
d’architecture à Damas à l’époque ayyoubide2 ; ainsi Donna Olimpia Maldachini dans la
Rome du XVIe siècle
3 ou Madeleine de Savoie dans la France du même siècle
4. L’importance
de l’architecture, qui s’explique par son caractère visuel, ne doit pas faire oublier que, dans les
systèmes musulmans, la pratique architecturale n’est que l’une des expressions de la
philanthropie qui se développe grâce à l’institution du vakf. Le vakf est un système complexe
qui touche à tous les aspects de la société ottomane, depuis l’économie, l’urbanisme, la
religion, l’éducation, jusqu’à la politique étatique et la famille.
Eu égard à l’extrême diversité des sphères d’action de cette institution, le vakf a suscité
de nombreuses études, qui ont privilégié certaines approches. La question économique et ses
dérivés, l’aspect juridique et foncier, ont ainsi inspiré de nombreux travaux5. L’omniprésence
de cette approche fait écho aux théories wébériennes d’une part, qui voient dans l’institution
du vakf l’une des causes de l’absence de développement économique et, partant, de
l’incapacité des sociétés musulmanes à passer à un système capitaliste, et l’impact de l’École
des Annales d’autre part, qui se lit dans l’intérêt marqué pour les travaux sur les questions
économiques et démographiques dans le domaine ottoman6. La considération accordée à
l’architecture, en tant que création ou rénovation de bâti, est à l’origine d’une production
féconde. Outre l’approche artistique et technique, qui a retenu l’attention des historiens de
l’art, la réflexion s’est concentrée sur la question de l’impact des bâtiments vakf dans la
société ottomane. Les études urbanistiques y ont trouvé un terrain fertile, selon des aires
d’étude variables (du quartier à la ville et à la région)7. De là sont nées également de très
2 Humphreys, « Women as Patrons of Religious Architecture in Ayyubid Damascus ».
3 Thierry Verdier, « Donna Olimpia Maldachini (Maildachini) Pamphilj, femme mécène au temps d’Innocent X »,
dans Hommes et femmes bâtisseurs, traditions et stratégies dans le monde oriental et occidental, S. Frommel et J. Dumas (éds.), Picard / Campisano / IFEA, 2013 : 239-249. 4 Kathleen Wilson-Chevalier, « Madeleine de Savoie et Anne de Montmorency : des bâtisseurs conjugaux »,
dans Hommes et femmes bâtisseurs, traditions et stratégies dans le monde oriental et occidental, S. Frommel et J. Dumas (éds.), Picard / Campisano / IFEA, 2013 : 123-134. 5 Parmi les travaux dans le domaine, cf. Ahmet Akgündüz, İslam Hukukunda ve Osmanlı Tatbikatinda Vakıf
Müessesi, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1988 ; Faruk Bilici, « Les waqf-s monétaires à l'époque ottomane : droit hanéfite et pratique », Revue du monde musulman et de la Méditerranée 79-80 (1996) : 73-88 ; Tevfik Güran, Ekonomik ve Malî Yönleriyle Vakıflar. Süleymaniye ve Şehzade Süleyman Paşa Vakıfları, Istanbul, Kitabevi, 2006 ; Ronald C. Jennings, « Pious Foundations in the Society and Economy of the Ottoman Trabzon, 1565-1640 », Journal of the Economic and Social History of the Orient XXXIII (1990) : 271-336 ; Moutaftchieva, Le vakıf ; Stéphane Yérasimos, « Le waqf du defterdar Ebu’l Fazl Efendi et ses bénéficiaires », Turcica 33 (2001) : 7-33. 6 Cf. Halil İnalcık, « Impact of the Annales School on Ottoman Studies and New Findings », Journal of the
Fernand Braudel Center I (1978) : 69-96. 7 Nous ne citerons ici que quelques références : Evangelia Balta, Les vakifs de Serrès et de sa région (XVe et XVIe
siècles), Athènes, Centre de recherches néo-helléniques de la fondation nationale de la recherche scientifique, 1995 ; Ömer L. Barkan, « Osmanlı Imparatorluğunda bir iskân ve kolonization metodu olarak vakıflar ve temlikler. I. Istilâ devrinin kolonizatör türk dervişleri ve zaviyeler », Vakıflar Dergisi 2 (1942) : 279-386 [ voir aussi, du même auteur : « Les déportations comme méthode de peuplement et de colonisation dans l’Empire ottoman », İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuâsı IX (1949-50) : 67-131 et « Osmanlı İmparatorluğunda bir iskân ve kolonyzasyon metodu olarak sürgünler », İstanbul Üniversitesi Iktisat Fakültesi Mecmuası XV (1953-54) : 209-237] ; Vasilyadis Demetriades, « Vakifs along the Via Egnatia », dans The Via Egnatia under ottoman Rule 1380-1699, Halcyon Days in Crete II; A Symposium Held in Rethymnon 9-11 January 1994, E. Zachariadou (éd.), Crete, Crete university press, 1996 : 85-95; Hakkı İI. Konyalı, « Kanunî Sultan Süleyman’ın Annesi Hafsa Sultanın Vakfiyesi ve Manisa’daki Hayır Eserleri », Vakıflar Dergisi 8 (1969) : 47-56 ; Richard van Leeuwen, Waqfs and Urban Structures. The Case of Ottoman Damascus, Leiden, Brill, 1999 ; Hilmi
Page | 361
nombreuses monographies dédiées tantôt aux œuvres d’un personnage, tantôt à un bâtiment
au cours du temps, ou encore à l’ensemble des vakf fondés à un moment et à un endroit
donnés (ce qui a favorisé la publication de sources d’archives)8. La réunion de cette
documentation a ainsi permis d’explorer de nouvelles pistes, telle que la réflexion sur la
notion même de philanthropie ou encore la place et le rôle des femmes dans le développement
des vakf dans la société ottomane9.
Malgré la grande profusion de travaux sur le sujet des vakf, peu d’entre eux
s’intéressent à la relation inévitable entre le profil socioprofessionnel du fondateur et le type
d’action entreprise. Il va pourtant de soi qu’un sultan n’avait pas la même approche qu’un
vendeur de poisson ou qu’un notable de Sofia ou de Damas. Cette évidence due au décalage
des positions sociales et/ou géographiques est tout aussi valable dans des cas moins
contrastés : un pacha a-t-il la même conception du vakf qu’un ouléma ? Le vacuum assez
généralisé dans ce domaine n’a pas été sans soulever de nombreux problèmes pour notre
propre travail, dont le vecteur principal repose justement sur l’homogénéité des profils
sociologiques des individus étudiés. L’objet fondamental de ce chapitre réside, en effet, dans
un questionnement sur l’existence ou non d’une spécificité du patronage des princesses
ottomanes à l’époque moderne. À l’intérieur du groupe des princesses, il faut s’interroger sur
Z. Ülken, « Vakıf Sistemi ve Türk Şehirciliği », Vakiflar Dergisi IX (1971) : 13-37 ; Ömer Demirel, Osmanlı Vakıf-Şehir İlişkisine Bir Örnek: Sivas Hayatında Vakıfların Rolü, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 2000. 8 Ahmet Tevhid, « Menteşeoğullarından Ahmed Gazi Bey’in Hayratı Kitabeleri », Tarihî Osmânî Ecümeni
Mecmuası III/18 (1912) : 1146-1152 ; Halim B. Kunter, « Emir Sultan Vakıfları ve Fatih’in Emir Sultan Vakfiyesi », Vakıflar Dergisi IV (1958) : 39-74 ; Aptullah Kuran, « Üsküdar’da Mihrimah Sultan Külliyesi », Boğaziçi üniversiti dergisi: Hümaniter Bilimler 3 (1975) : 43-72 ; Robert D. Mc Chesney, « Wakf and Public Policy: The Waqfs of Shah Abbas, 1011-1023 / 1602-1614 », Asian and African Studies XV (1981) : 165-190 ; Lucienne Thys-Şenocak, « The Yeni Valide Mosque Complex of Eminönü, Istanbul (1597-1665): Gender and Vision in Ottoman Architecture », dans Women, Patronage and Self-Representation in Islamic Societies, F. Ruggles (éd.), Albany, State University of New York, 2000 : 69-90 ; du même auteur, Ottoman Women Builders ; Metin İI. Kunt, « The Waqf as an Instrument of Public Policy: Notes on the KÖPRÜLÜ Endowment », dans Studies in Ottoman History in Honor of Professor Victor Ménage, C. Heywood et C. Imber (éds.), Istanbul, Isis, 1994 : 189-198 ; Ekrem H. Ayverdi, Avrupa’da Osmanli mimari eserleri: Bulgaristan, Yunanistan, Arnavudluk IV, Istanbul, İstanbul Fetih Cemiyeti yayını, 1982 ; Ahmet Yiğit, XVI. Yüzyıl Menteşe Livası Vakıflar (338 Numaralı Mufassal Evkâf Defteri H. 970 / M. 1562), Ankara, Barıs Platin Kitabevi, 2009 ; Gökbilgin, Edirne ve Paşalivâsı ; Galitekin (éd.), Hadîkatü’l-Cevâmi’ ; Canatar (éd.), İstanbul Vakıfları Tahrîr Defteri : 1009 / 1600 Tarihli ; Barkan et Ayverdi (éd.), İstanbul vakıfları tahrîr defteri: 953 (1546) târîhli ; Hakkı İI. Konyalı, « Bir hüccet iki vakfiyye », Vakıflar Dergisi 7 (1995) : 97-110. 9 Sur les femmes et les fondations pieuses, cf. Tülay Artan, « Periods and problems of ottoman (women’s)
patronage on the Via Egnatia », dans The Via Egnatia under ottoman Rule 1380-1699. Halcyon Days in Crete II; A Symposium Held in Rethymnon 9-11 January 1994, E. Zachariadou (éd.), Crete, Crete University Press, 1996 : 19-43 ; du même auteur, « Noble Women Who Changed the Face of the Bosphorus and the Palaces of the Sultanas », İstanbul (Biannual) 1 (1993) : 87-97 ; Esin Atil, « Islamic Women as Rulers and Patrons », Asian Art 6 (1993) : 3-12 ; Baer, « Women and Waqf » ; Ülkü Ü. Bates, « Women as Patrons of Architecture in Turkey », dans Women in the Muslim World, L. Beck and K. Nikki (éds.), Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1978 : 245-260 ; du même auteur, « The Architectural Patronage of Ottoman Women », Asian Art 6 (1993) : 50-65 ; Fay, « Toward a Women Reconsideration of Women Place in the Mamluk Household » ; du même auteur, « Property, Power and the Domain of Gender » ; Meriwether, « Women and Waqf Revisited » et The Kin Who Count : 178-206 ; Fairchild Ruggles (éd.), Women, Patronage and Self-Representation in Islamic Societies, Albany, State University of New York, 2000 ; Thys-Şenocak, Ottoman Women Builders. Sur la philanthropie en particulier, cf. Nina Ergin, Christoph Neumann, Amy Singer (éds.), Feeding People, Feeding Power : Imarets in the Ottoman Empire, Istanbul, Eren, 2007 ; Osman Ergin, Türk Şehirlerinde İmaret Sistemi, Istanbul, Cumhuriyet Matbaası, 1939 ; Amy Singer, Constructing Ottoman Beneficence.
Page | 362
l’existence de particularismes (individuels ou temporels). Pour cela, il convient de dresser un
inventaire complet (dans la mesure des données collectées) des vakf des princesses. Au niveau
extérieur, il importe de pouvoir mettre en perspective l’activité de ces femmes avec le reste de
la société.
Cette double nécessité nous a imposé de faire un détour imparfait, mais que nous
espérons suffisant, sur les caractéristiques du vakf et de l’activité philanthropique dans la
société ottomane en général. Une fois les spécificités de l’action des princesses dans ce
domaine mises en évidence, il restera encore à réfléchir quant à leur raison d’être. La
progression du travail s’est donc imposée d’elle-même. Dans un premier temps, nous
reviendrons sur l’institution du vakf dans l’Empire ottoman : après un rapide aperçu des
origines et du lexique propre à l’institution, nous verrons les divers impacts du vakf sur la
société ottomane avant d’examiner les pratiques philanthropiques des diverses catégories
socioprofessionnelles. Il sera alors possible de procéder, dans une seconde partie, à un
inventaire raisonné des fondations des princesses, organisé d’après quatre grandes phases
chronologiques, et à un recensement des revenus dotés en vakf par les fondatrices. Enfin, en
dernier lieu, nous examinerons la question des finalités recherchées par les princesses par
l’intermédiaire de la philanthropie, tant au niveau individuel que familial.
Page | 363
I. NATURE ET USAGES DE L’INSTITUTION DU VAKF
Un voyageur qui se rendrait en Turquie non pour ses plages et attraits d’un tourisme
consumériste pourrait se lancer dans une découverte culturelle de ce pays : il irait voir les
vestiges de la bibliothèque de Celsus à Éphèse, le cirque pouvant accueillir 75 000 spectateurs
d’Aphrodisias, l’amphithéâtre disposé sur les contreforts de la falaise de Pergame, le temple
d’Athéna à Assos et, à Istanbul, Sainte-Sophie, l’hippodrome, la Mosquée bleue, la
Süleymaniyye, les palais, khans et bains ottomans, et bien d’autres choses encore. Toutes ces
traces construites du passé qu’il verrait ont été le fait d’hommes et de femmes que le jargon
scientifique appelle tantôt philanthropes, tantôt mécènes, ou encore évergètes. Ce touriste
s’émerveillerait sans nul doute devant la diversité des ouvrages et, peut-être, de leurs
techniques ; mais serait-il aussi fasciné par la diversité des pratiques philanthropiques ? Si
d’aventure ce voyageur est un lecteur de Paul Veyne10
, il saura que le mécène qui a offert un
sanctuaire dédié à Apollon à Didymes n’a rien de commun avec un Trajan, empereur romain
de son état, qui fit élever un temple à sa propre gloire dans la ville de Pergame ; que ce dernier
n’a lui-même rien à voir avec le basileus Justinien qui se délecta à l’idée d’avoir surpassé
l’œuvre de Salomon en offrant Sainte-Sophie à la communauté chrétienne, ni avec Süleyman
Ier ou Ahmed Ier dont les mosquées respectives rivalisent avec cette dernière et entre elles.
Au-delà de la variété des fondations, la multiplicité des conceptions de la philanthropie, ou de
l’évergétisme, est un phénomène des plus intrigants. Paul Veyne l’avait d’ailleurs remarqué :
certaines caractéristiques semblent immuables (recherche de gloire, volonté commémorative,
expression de pouvoir et son corollaire, étalage de richesse, etc.) et pourtant, les fondements
culturels qui soutiennent l’action divergent radicalement11
.
À première vue, l’une des spécificités de la conception philanthropique ottomane
repose sur son accessibilité la plus totale : tous et toutes, au sein de la communauté
musulmane, peuvent fonder son propre legs pieux, selon ses moyens, ses désirs, ses
préférences, ses choix géographiques (au sein des terres de l’Islam). Mais l’historien ne
saurait s’arrêter aux apparences : si l’acte de fondation d’un vakf se veut accessible à tous, du
moins à la plus grande majorité, il était loin d’être pratiqué de la même manière ou d’exprimer
la même conscience de soi et du devoir socioreligieux de chacun. Notre intention n’est
pourtant pas de réfléchir à la conception philanthropique musulmane telle que la prônait la
société ottomane, ni même d’évaluer la diversité de ses pratiques par les Ottomans : il faudrait
y consacrer un ouvrage au moins aussi long que celui de l’historien de l’Empire gréco-romain.
Notre propos est bien plus modeste et se contente de chercher à comprendre la spécificité des
usages de la philanthropie d’une catégorie spécifique d’individus : les princesses ottomanes.
Or, pour ce faire, il faut d’abord s’interroger sur les usages de l’institution, qui sert de cadre à
toute action dans le domaine : le vakf. Puis il est indispensable de s’intéresser à la manière
dont les membres de l’élite ottomane en faisaient usage, afin de dégager les lignes principales
10
Veyne, Le pain et le cirque : passim. 11
Veyne, Le pain et le cirque : passim.
Page | 364
de la conception philanthropique de l’élite (masculine et féminine) de l’Empire ottoman de
l’époque moderne.
1. Une institution pluriséculaire
Les Ottomans n’ont pas inventé le vakf : les premières pratiques de cette institution
musulmane remontent à l’époque du Prophète. Cette ancienneté implique que toute nouvelle
fondation s’inscrit dans un cadre préétabli qui l’enchaîne dans un réseau de pratiques et dans
un système législatif extrêmement élaboré. Mais ce cadre n’est pas rigide : il dispose d’une
certaine souplesse qui a permis une lente élaboration et adaptation aux diverses sociétés
musulmanes. La société ottomane a hérité d’une institution qu’elle a modulée pour répondre à
ses propres besoins : ce sont ceux-là qui nous intéressent.
1) Définition et fonctionnement d’un vakf
Le terme ottoman de vakf ou vakıf vient de l’arabe waqf, qui signifie stopper, prévenir,
restreindre. L’origine grammaticale de ce mot permet d’en percevoir le sens : il s’agit
d’empêcher la cession ou l’acquisition d’un bien dont la substance est déclarée appartenir à
Dieu, l’homme n’en ayant que le bénéfice et l’usage. La chose fondée et ses revenus sortent
du système de la détention privée et sont rendus inaliénables, à des fins de bienfaisance. Au
cours du temps, le terme de vakf, utilisé pour définir la nature juridique des revenus, en vint
également à être employé pour définir l’objet. Ainsi, en ottoman, vakf peut signifier autant les
revenus d’une mosquée que la mosquée elle-même, tandis que le terme d’evkâf (pluriel arabe
de vakf) fut employé pour désigner l’œuvre complète d’une personne12
: pour un Ottoman, il
sera d’usage de parler des evkâf de la princesse Mihrimah Sultane, pour qualifier l’ensemble
de ses fondations – tandis que l’usage français aura tendance à se contenter du singulier.
Il existe toute une terminologie lexicale propre aux vakf, définissant tantôt les revenus,
tantôt les œuvres réalisées. Une première distinction peut être opérée selon le type d’œuvres
réalisées. On parlera de hayrî vakıflar (ou vakf-ı hayrî) dans le cas de fondations religieuses
telles que mosquées, écoles, soupes populaires, fontaines, marchés couverts ou encore aides
financières à destination des pauvres. En revanche, si le vakf est constitué au profit du
fondateur lui-même ou de sa famille, on parlera alors de zürri vakıflar ou vakf-ı ehlî13
: c’est
le cas notamment des dotations sous forme d’habitat aux descendants ou des rentes attribuées
à des particuliers. Une troisième catégorie regroupe encore les avârız vakıflar, c’est-à-dire des
12
Bahaeddin Yediyıldız, « Vakıf », İA : t. XII p. 171-190 ; Willi Heffening, « Waqf », EI : vol. 4 p. 1096-1103. 13
Mustafa Güler, Osmanlı Devlet’inde Haremeyn Vakıfları (XVI. – XVII. Yüzyıllar), Istanbul, Tarih ve Tabiat Vakfı, 2002 : 12-13.
Page | 365
legs pieux fondés dans le but de procurer des revenus à des propriétaires dans le besoin. Quant
aux revenus des legs pieux, ils relèvent d’une terminologie particulière : les revenus
commerciaux, tels que des maisons, des boutiques, des terrains ou des jardins, prennent
l’appellation d’akârın vakfı ; les dotations en argent liquide ou biens, tels que des habits, des
bijoux ou encore des animaux, sont définies par le terme de menkulün vakfı ; enfin, iktâ vakfı
sert à désigner les revenus produits de domaines agricoles, de villages ou de timar14
.
Pour qu’un vakf soit valide, il était indispensable que le fondateur en précise les
différentes clauses. Si une mise par écrit n’était pas obligatoire à l’origine (une déclaration
orale devant témoin pouvant suffire), la pratique de rédiger les diverses conditions de
fonctionnement de la fondation stipulées par le fondateur s’imposa progressivement sous la
forme d’un acte de fondation : une vakfiyye15
. Ces documents, dont la longueur est
proportionnelle au nombre des prescriptions de la fondation, obéissent à des formes très
codifiées. Dans une première partie introductive étaient explicités les motifs du fondateur.
Mais ces explications étaient fortement stéréotypées : tout n’était pas bon à dire et seules les
motivations religieuses du commanditaire et le caractère pieux de l’œuvre étaient mis en
valeur16
. Suivait ensuite une présentation du fondateur par lui-même (présentation codifiée
qui respectait les normes protocolaires et statutaires en vigueur). Venaient alors deux très
longues parties qui forment le cœur du document : la liste des biens dotés et des dépenses
prévues dans le cadre de la fondation. Le tout se concluait sur un paragraphe attestant du
caractère légal de la fondation, au vu des opinions juridiques des principaux penseurs dans le
domaine : la fondation nouvelle était ainsi inscrite dans la continuité d’une tradition
pluriséculaire.
Si la signification littérale du terme de vakf met l’accent sur la notion de perpétuité,
qui a pu donner l’impression d’une institution statique (les biens sont « stoppés », ils
deviennent des biens « de mainmorte »), il ne faudrait pas croire pourtant en une immobilité
irrévocable des fondations. Les conditions juridiques prévoient la possibilité de transactions
(échange ou achat), sous réserve du respect de certaines conditions. Les procédures légales
mises à part, un principe général commande, connu sous le nom de maslaha : l’intérêt public
ou la prospérité de la communauté musulmane. Des modifications peuvent ainsi être
apportées au vakf initial, à condition que la fondation y trouve avantage (un échange de
propriété ne peut être fait au détriment des revenus du vakf, par exemple)17
et que cet avantage
se révèle également profitable à la société (une augmentation des revenus d’un vakf, qui par
essence est estimé profitable à la société, ne peut donc qu’être profitable aux deux)18
.
14
Güler, Haremeyn Vakıfları : 12-13. 15
Singer, Constructing Ottoman Beneficence : 21. 16
Singer, Constructing Ottoman Beneficence : 25-27. Mais ces introductions ne sont cependant pas toutes des copies conformes les unes des autres : une argumentation plus personnelle (religieuse ou politique) était possible, ainsi que l’ont montré les travaux de Yediyılız, Institution du vakf ; Pınar « The Atik Valide’s Endowment Deed: A Textual Analysis » dans Feeding People, Feeding Power. Imarets in the Ottoman Empire, N. Ergin, Ch. K. Neumann et A. Singer (éds.), Istanbul, Eren, 2007 : 261-274. 17
Cf. Vatin et Yerasimos, « Documents sur les cimetières ottomans, II. ». 18
Singer, Constructing Ottoman Beneficence : 21-22.
Page | 366
L’importance des clauses de certaines fondations et cette nature potentiellement
évolutive d’un vakf imposent une surveillance régulière de son fonctionnement, qui constitue
une condition indispensable à toute fondation. Cette surveillance se répartit entre deux
postes : un office d’intendant et un autre de surveillant du legs pieux doivent être établis dès le
départ. L’intendant (le mütevelli) endosse la responsabilité de faire appliquer les prescriptions
de la fondation et de s’assurer de son bon fonctionnement19
. De son côté, le surveillant (le
nazır) est chargé de contrôler le travail du mütevelli et de l’ensemble du personnel de la
fondation, d’après les mêmes références20
. La pratique la plus commune veut que le fondateur
se nomme lui-même, à vie, comme mütevelli, préconisant à sa mort que la charge (tevliyet)
revienne à ses descendants21
. Quant au nazır, dès le XVIe siècle, le poste est attribué
traditionnellement à des officiers de l’État22
: dans le cas des membres de la famille impériale,
il s’agit alors du chef des eunuques noirs, mais des cadis peuvent également nommés à cette
place et, dans certains cas peu courants, des gouverneurs (vali) de la région.
2) Un instrument de (re)production des structures sociales
Le vakf, en tant que fondation nouvelle ou rénovation d’un bâti déjà existant, constitue
un formidable moyen de développement des structures sociales. Deux domaines illustrent
particulièrement ce phénomène : le secteur urbain et le cadre familial. Dans l’espace ottoman,
la concentration voire l’accroissement de la population sont favorisés par l’institution du vakf,
qui permet la multiplication des structures socio-économiques diverses, répondant aux
attentes de la communauté dans les domaines du culturel et de l’infrastructure. L’existence de
marchés, de routes, de ponts, de commerces, qui permettent un développement économique,
est rendue possible par l’établissement de vakf qui en assurent la création puis l’entretien. Il
en va de même au niveau religieux : les espaces spirituels, sous quelques formes qu’ils soient
(mosquées, oratoires, couvents, écoles), sont le fait encore de vakf, sans aucune exception. Les
structures d’entraide sociale reposent également sur le système du vakf : cuisines populaires,
hôpitaux, distributions d’aumônes aux pauvres, aux orphelins, fonctionnent grâce à lui. Le
développement de la culture est enfin très largement assuré par l’institution du vakf : les
écoles sont des legs pieux et les divers professeurs sont financés par des vakf. Bref, la base du
19
Singer, Constructing Ottoman Beneficence : 20-21 ; Moutaftchieva, Le vakıf : 114-118 ; Yüksel, Vakıfların Rolü : 55-79 ; Yediyıldız, « Vakıf » ; Heffening, « Waqf ». 20
Certaines vakfiyye du XVe siècle instituent un seul et même individu à ces deux places, mais il s’agit
probablement d’une pratique archaïque qui disparaît totalement dès le XVIe siècle.
21 Les descendants, hommes ou femmes, du fondateur sont majoritairement nommés à cette place ; dans
certains cas cependant, notamment lorsque le fondateur est sans descendance, il arrive que des membres collatéraux de la famille soient nommés. Afin d’inscrire encore plus la fondation (et son contrôle par la famille) dans le long temps, les actes de fondations préconisent très largement que l’office revienne, après les enfants directs, à leur propre descendance jusqu’à extinction de la lignée ; après quoi, il sera accordé aux affranchis du fondateur puis à leurs descendants, selon les mêmes prescriptions. Ce n’est qu’une fois toutes ces lignées éteintes, que la fondation entre alors dans le giron de l’État : l’office de mütevelli revient alors au cadi ou, parfois, au gouverneur de la région (ou autre officiel associé à l’État). Cf. Yüksel, Vakıfların Rolü : 57-61. 22
Yüksel, Vakıfların Rolü : 61-65.
Page | 367
système social ottoman est très largement dépendante de cette institution. Les villes, grands
centres urbains, cumulent l’essentiel de ce capital (financé principalement par des revenus
agricoles produits par l’arrière-pays).
L’une des formes les plus visibles de ce phénomène est la külliye : un vaste ensemble
de bâtiments à usages divers, réunis autour d’une mosquée. Ces complexes « acquièrent
graduellement le caractère de larges projets urbains établis selon des schémas planifiés, qui
unifient plusieurs types de constructions au sein d’un conglomérat. Ces complexes
contiennent les éléments essentiels d’une structure urbaine, comme les centres de pèlerinage,
les centres d’apprentissage et la préservation de la culture, et sont des points de concentration
pour les activités économiques »23
. Les Ottomans se sont d’ailleurs rendus maîtres dans ce
domaine, au point de faire de la külliye un symbole de la culture ottomane classique. Istanbul
en est certainement le fleuron : il suffit, pour s’en rendre compte, de penser au complexe de
Mehmed II à Eyüp, de Bayezid II, de Süleyman Ier (autour de la Süleymaniyye), ou encore
d’Ahmed Ier (autour de la Mosquée bleue)24
. La diffusion du modèle est assurée par sa
reproduction par l’élite ottomane, dans et hors de la capitale : vizirs, pachas, reines mères,
princesses s’y investissent, à l’instar des sultans.
De tels complexes favorisent très largement le développement du quartier alentour.
Dans certains cas, leur implantation est à l’origine même de la création d’un nouveau quartier
– comme dans celui du complexe fondé par la mère de Süleyman Ier, Hafsa Hatun, à
Manisa25
. Mais ils sont également responsables d’un compartimentage de la ville par
quartiers, marqués du sceau du fondateur du complexe, favorisant l’implantation sur-place de
son entourage ou sa clientèle26
. Le complexe de Nurbanu Sultane à Üsküdar illustre ce
phénomène : construit sur les hauteurs de la ville, il s’organise autour de la mosquée, flanquée
d’une medrese, d’un tekke, d’un mekteb, d’une école de récitation du Coran et des hadiths,
d’un double caravansérail avec étables, d’un hôpital, d’un double bain et d’un ‘imaret27
. Tout
autour, l’ensemble du quartier porte la marque de la reine mère, qui y avait fait construire son
palais d’été : Mehmed Aga, chef des eunuques noirs et un des principaux membres de sa
faction, y possédait un jardin ; d’autres membres de son entourage détenaient des résidences
dans les environs, parmi lesquels son intendant, qui a laissé son nom à une des rues (Valide
Kahyası Sokağı)28
.
En dehors de ces structures que nous pourrions qualifier d’utilité publique, le système
du vakf permettait également des usages familiaux, sous deux formes principales : la
transmission de biens et/ou de revenus et la transmission d’offices (dotés eux aussi de
revenus), au sein d’une famille. Le vakf représente ainsi un moyen de constitution et de
préservation d’un patrimoine au sein d’une famille, qui échappe aux perceptions fiscales
imposées par l’État. Le prestige d’une fondation pieuse associée à une famille en particulier et
23
Leeuwen, Waqfs and Urban Structures : 182. 24
Yérasimos, Constantinople : 250-325. 25
Konyalı, « Kanunî Sultan Süleyman’ın Annesi Hafsa Sultanın Vakfiyesi » : 47. 26
Leeuwen, Waqfs and Urban Structures : 188-189. 27
Necipoğlu, The Age of Sinan : 282 (plan du complexe), 283 ; Yérasimos, Constantinople : 285. 28
Necipoğlu, The Age of Sinan : 288.
Page | 368
la production (relativement pérenne) de richesses font du vakf un élément indispensable pour
affirmer publiquement son appartenance à l’élite29
. Mais les familles de la haute société
stambouliote ou provinciale ne furent pas les seuls à tirer parti des facilités proposées par le
vakf. L’uniformisation de l’usage familial du legs pieux à tous les niveaux de la société fait du
vakf un véritable instrument de reproduction des structures familiales.
Cet usage ne fut pas sans entraîner son lot de critiques, qui permettent de souligner le
lien entre le système du vakf et l’évolution des conditions économiques de la société
ottomane. Mustafa Ali Gelibolulu, auteur particulièrement contestataire de la seconde moitié
du XVIe siècle, explique ainsi dans son Nushat üs-Selâtin :
« Tant que les glorieux sultans […] ne se sont pas enrichis personnellement par le
butin de la Guerre Sainte et ne sont pas devenus propriétaires de territoires par le
gain de campagnes pour la Foi, il n’est pas approprié qu’ils entreprennent la
construction de cuisines populaires pour les pauvres ou d’hôpitaux ou la
réparation de bibliothèques ou de medrese de haut niveau ou, en général, toute
construction d’établissement de charité ; et il n’est vraiment pas juste de dépenser
et consommer les ressources du Trésor public en des projets superflus. Comme les
lois divines ne permettent pas la construction d’établissements charitables sur les
ressources du Trésor public, elles n’autorisent pas plus la fondation de mosquées
et de medrese qui ne sont pas indispensables. Sauf si un sultan, après avoir
commandé une campagne victorieuse, décide de dépenser le butin qu’il a acquis en
actes pieux plutôt qu’en plaisirs personnels et s’engage à le prouver par
l’édification de bâtiments [publics]. »30
Mustafa Ali soulève ici le problème de l’usage des domaines impériaux, sources de revenus
pour les caisses de l’État, pour la constitution de vakf – quand bien même ceux-ci auraient-ils
une utilité publique. Il stipule clairement qu’il n’est pas de la responsabilité de l’État d’assurer
le développement des structures socio-économiques de l’Empire : c’est là une affaire privée,
le fait d’individus, motivés par des soucis religieux.
En prônant que seul l’argent prélevé sur le butin de guerre peut être utilisé pour
financer de vastes projets de construction d’utilité publique (c’est-à-dire de type hayrî),
Mustafa Ali sous-entend que les femmes royales, mais aussi les favoris qui ne doivent leur
puissance qu’à la faveur impériale, sans avoir fait preuve de qualités militaires, ne peuvent
prétendre entreprendre de telles constructions prestigieuses, puisqu’ils sont exclus ou absents
des champs de bataille. Certes, le propos n’est pas formulé directement : il demeure possible,
théoriquement, pour un individu quelconque d’entreprendre de vastes fondations financées sur
ses richesses personnelles (comprenons : qui ne dériveraient pas de revenus octroyés par
l’État) ; cependant, il existe une corrélation assez nette entre la détention de biens fonciers
(tels que des villages notamment), transformés en mülk, et la constitution de vastes vakf. La
construction d’un complexe pieux nécessite l’investissement de revenus considérables ; les
29
Meriwether, The Kin Who Count : 178-206. 30
Cité par Kayaalp-Aktan, « The Atik Valide’s Endowment Deed » : 267 et par Singer, Constructing Ottoman Beneficence : 29.
Page | 369
dépenses régulières d’un tel complexe ne peuvent être couvertes que par la transformation en
vakf de biens fonciers mülk, qui sont les seuls revenus capables de produire un bénéfice de
cette importance. Or, le butin de guerre dont parle Mustafa Ali, seule catégorie financière apte
à servir au financement de telles œuvres selon lui, ne consiste en aucun cas en terres
mülk puisque, par essence, la terre appartient à l’État et qu’elle ne fait pas l’objet d’un partage
entre les conquérants. L’application stricte des prescriptions de cet auteur reviendrait à
interdire toutes les grandes fondations, de type külliye notamment, qui ne peuvent se passer de
telles ressources – avec toutes les conséquences en terme de développement des structures
sociales que cela impliquerait.
Quelques décennies plus tard, un autre penseur ottoman reprend le flambeau des
critiques contre les « mauvais usages » du vakf, avec cette fois un discours beaucoup plus fin
et argumenté : il s’agit de Koçi Bey, auteur d’un Risâle-i Koçi Bey. Son traité politique permet
de comprendre les conséquences économiques de l’accroissement de l’usage du vakf pour
l’État :
« Dans le passé, les gazi, les beys et les beylerbey menaient des campagnes de
gaza pour l’amour de Dieu […] et le prospère et sublime État a ainsi conquis un
grand nombre de territoires. Comme un grand nombre de combattants étaient au
service de l’État et de la religion, les sultans exaltés leur donnèrent, en échange de
ces services, la possession privée (temlik) de villages et domaines sur les pays
qu’ils avaient conquis. Avec la permission des sultans, ils réalisèrent des
institutions religieuses et charitables qui étaient bénéfiques à la communauté
musulmane ; ils construisirent des mosquées, des imaret, des zaviye et créèrent
des vakf pour cela. »31
Dans les premiers temps d’expansion territoriale, l’État s’est délesté de la possession de
domaines en faveur de certains conquérants, sous la forme de dotations de terres mülk, en
guise de rétribution pour leurs efforts de guerre. La détention de tels mülk leur permit ainsi de
transformer tout ou partie de ces domaines en vakf. Contrairement à Mustafa Ali, Koçi Bey
n’y voit aucun problème, car ces vakf servaient les intérêts de la religion et de la communauté,
en favorisant l’islamisation et la prospérité socio-économique du territoire, nonobstant l’usage
politique qui en fut fait, en terme de contrôle de la région nouvellement conquise.
Le problème que Koçi Bey met en évidence se situe au niveau de l’usage postérieur
qui fut fait du vakf. Dans la suite du texte, il explique qu’avec le temps, la détention de tels
domaines mülk cessa d’être accordée en récompense militaire, pour n’être plus que l’effet de
la bonté impériale, suscitée par la proximité avec le sultan. Ainsi, en vertu de leur influence
ou de leur intimité avec le souverain, et non de leur labeur militaire ou administratif, certains
personnages se virent délivrer des temlik leur donnant pleine possession de terres conquises de
longue date. Non seulement l’État perdait les revenus des impôts prélevés sur ces domaines,
mais en sus, il se démunissait de la capacité d’en faire usage comme moyen de rétribution. Le
31
Cité par Barnes, An introduction to the religious foundations : 62.
Page | 370
phénomène mettait en péril l’ensemble du système de rétribution des officiers, notamment des
spahis, par le timar32
.
Là n’était pas le seul motif d’exaspération de Koçi Bey à l’égard des mauvais usages
des vakf. Il se plaignait encore du fait que ces terres, données à des gens qui ne les méritaient
pas, leur permettaient de fonder des vakf familiaux, dits ehlî, qui profitent au fondateur et à
ses descendants, non à la communauté musulmane dans son ensemble. Plus précisément, il
estime illégal et contraire à la loi islamique d’établir un vakf ehlî financé par les revenus d’un
domaine “usurpé” au Trésor public33
. Ce faisant, c’est mettre de côté le fait que l’usage
familial des vakf est non seulement permis, mais même encouragé dans le Coran, qui engage
les musulmans à assurer la prospérité de leur famille34
.
Si les propos de penseurs tels que Mustafa Ali et Koçi Bey sont révélateurs de
l’existence d’un débat intellectuel concernant l’usage du vakf, il ne faudrait pourtant pas se
laisser entraîner par leurs interprétations subjectivées de la situation : la portée de leur discour
ne dépassait probablement pas la petite frange lettrée de la population ottomane, et était loin
de faire pleinement l’unanimité35
. Ils tendent à orienter l’appréciation d’un vakf selon une
dichotomie basée sur l’opposition : vakf hayrî contre ehlî, usage public contre usages privés,
bien et mal. C’est là restreindre la compréhension et l’appréhension du système du vakf par
les Ottomans à un antagonisme qui n’existait probablement pas pour eux. Les motifs sous-
tendant la constitution d’un vakf étaient aussi multiples que complexes : l’inquiétude
individualiste n’était pas nécessairement dissociable et incompatible avec un souci public.
L’histoire d’al-Munajjim, au Xe siècle, le rappelle :
« al-Munajjim [un collecteur de taxes] fut longtemps remercié pour avoir établi
des fondations pieuses dans son quartier, pour avoir fait réparer le système
d’irrigation local et pour avoir fait des dons aux personnes appropriées. En privé,
al-Munajjim disait qu’il avait fait ces choses pour Dieu, mais, ajoutait-il, s’il les
avaient faites pour les apparences, ça aurait été tout aussi bien, car pourquoi la
population locale ne voudrait-elle pas sauvegarder les apparences en prétendant
32
Ces domaines transformés en vakf étaient d’autant moins de terres disponibles à confier à ces officiers en retour de leur service pour l’État : abandonnés sans terre ni office, donc sans revenus, ceux-ci se laissaient alors aller aux exactions, au pillage et à l’exploitation illégale de la population afin de maintenir leur rang et leur richesse. Ces mauvais usages du vakf seraient ainsi à l’origine des révoltes celalî qui déstabilisèrent l’État ottoman pendant plusieurs décennies – du moins est-ce là l’explication fournie par cet auteur. Sur le système du timar dans les premiers siècles de l’histoire ottomane, voir notamment l’étude de Nicoara Beldiceanu, Le timar dans l’État ottoman (début XIVe – début XVIe siècle), Wiesbaden, Harrassowitz, 1980. Sur l’évolution des structures économiques et militaires, voir tout particulièrement Halil İnalcık, « Military and Fiscal Transformation in the Ottoman Empire, 1600-1700 », Archivum Ottomanicum VI (1980) : 283-337. Sur la révolte des celali, voir Griswold, The Great Anatolian Rebellion et Barkey, Bandits and Bureaucrats. 33
Barnes, An introduction to the religious foundations : 62 ; Singer, Constructing Ottoman Beneficence : 30-31. 34
Singer, Constructing Ottoman Beneficence : 19, 31. 35
Mustafa Safi, qui écrit au tout début du XVIe siècle, sous le règne d’Ahmed Ier, défend en effet une position
tout à fait adverse à celle de Mustafa Ali : il met l’accent sur les aspects bénéfiques de la construction par les sultans de vastes complexes religieux, quand bien même ils ne seraient pas financés par l’argent du butin de guerre. Cf. Roads Murphey, « The Historian Mustafa Safi’s version of the kingly virtues as presented in his extended preface to volume one of the Zübdet’ûl-Tevarih, or Annals of sultan Ahmed, 1012-1023 A.H. / 1603-1614 A.D. », dans Essays on Ottoman Historians and Historiography, Istanbul, Eren, 2009 : 69-86 [p. 79-80].
Page | 371
d’une manière hypocrite qu’elle croit en les motifs élevés du bienfaiteur ?
Aujourd’hui, se plaignait-il, si un homme fait preuve de munificence, on dit de lui
qu’il « fait commerce de sa munificence » et on le prend pour un avare. »36
3) Les implications religieuses
C’est grâce à l’institution du vakf que furent bâties toutes les œuvres de nature
religieuse telles que les mosquées, les oratoires (mescid), les couvents (tekke, zaviyye), les
écoles (medrese, mekteb, dârülhadis, etc.) – elles-mêmes religieuses –, les récitations de
prières, et ainsi de suite. Par essence, un vakf est religieux : il se doit de favoriser le
développement de l’Islam, de quelque manière que ce soit. Un accent particulier mérite
cependant d’être mis sur deux aspects essentiels des caractéristiques religieuses des vakf :
leurs rôles institutionnel et éducatif.
Dans l’Empire ottoman, les individus dont l’exercice professionnel est de nature
religieuse peuvent être répartis en deux catégories : ceux qui sont au service de l’État et ceux
qui officient dans les structures vakf. Les premiers regroupent tout le personnel judiciaire
(kâdî’asker, cadi, na’ib, etc.) ou encore les fonctionnaires chargés de faire appliquer le respect
de la loi et des règlements, sur les marchés par exemple (muhtesib). La seconde catégorie, qui
n’est pas directement contrôlée par l’État, rassemble tous les « hommes de religion »
(oulémas) dont l’office est inscrit dans le cadre d’un vakf, qui assure leur rétribution. Ce sont
les imams (guides de la prière), les vâ’iz (sermonnaires), les hatîb (prédicateurs), les hâfız
(récitateurs du Coran), les müderris (enseignants dans les medrese), ou encore les maîtres
spirituels exerçant dans les couvents (pîr, cheikh, mûrşid), etc. Le système du vakf pourvoit
donc au financement de très nombreux hommes de religion qui reçoivent, par cet
intermédiaire, des offices reconnus et honorables.
Ces offices étaient le fruit de la volonté d’un particulier – le fondateur du legs pieux –
qui en définissait non seulement le nombre et les revenus qui y étaient associés, mais aussi
l’exercice à accomplir. Nous sommes donc en présence d’une forme assez typique de
patronage. Ce patronage permit peut-être le maintien d’une certaine indépendance, au moins
économique, des oulémas par rapport à l’État ; mais l’indépendance était loin d’être laissée
hors de tout contrôle. L’essentiel de la structuration du corps des oulémas dans la société
ottomane repose sur un système de classification des écoles, medrese notamment, auquel nous
avons déjà fait allusion, et qui est loin d’avoir été statique37
. L’État ottoman a ainsi institué
36
Cité par Singer, Constructing Ottoman Beneficence : 32. 37
Deux étapes sont particulièrement importantes. Dans les années 1463-1470, Mehmed II imposa au sommet de la classification hiérarchique des medrese, les huit qu’il avait lui-même fait construire en liaison avec sa propre mosquée dans la capitale. Ces medrese prirent le nom de sahn-i semân ou semâniyye : « cour des huit » ou « les huit ». Quelques décennies plus tard, après que le complexe de la Süleymaniyye fut construit, ce furent les six medrese de ce sultan, Süleyman Ier, qui prirent la tête de la hiérarchie, supplantant les précédentes. Quatre de ces medrese dispensaient un enseignement général, une autre était consacrée aux hadiths (les traditions du Prophète) et une autre aux études médicales. Cf. Veinstein, « Les Ottomans : fonctionnarisation
Page | 372
une hiérarchie des structures religieuses privées, qui inscrit toute fondation, ancienne ou
nouvelle, dans un réseau relativement cohérent, contrôlé et dominé par l’État, dans la mesure
où le sommet de cette hiérarchie est détenu par des structures impériales, produisant ainsi un
amalgame entre structures privées et structures étatiques.
Le rôle éducatif du système du vakf est probablement l’une de ses caractéristiques les
plus prégnantes. Dans la société ottomane de l’époque classique, il n’existe pas d’autre
système d’éducation que celui des établissements religieux : que les jeunes gens suivent les
cours d’un mekteb ou qu’ils reçoivent l’instruction à domicile d’un précepteur, voire qu’ils
aillent suivre les enseignements professés par des maîtres dans des couvents (il s’agit alors de
maîtres spirituels) ou tout simplement dans des mosquées (comme cela se fait dans les
grandes villes, notamment à Istanbul), les sources de son éducation seront toujours
religieuses. La base de l’instruction est l’apprentissage du Coran (mémorisation totale ou
partielle, lecture ou écriture, selon les niveaux) puis des hadiths ; même les cours du niveau
supérieur dispensés dans les medrese sont à base religieuse. Par ailleurs, l’ensemble du corps
enseignant est constitué par les hommes de religion, les « hommes de science », les oulémas.
Ce système éducatif échappe, pour une bonne partie, au contrôle étatique, car
l’essentiel des structures éducatives (si l’on met de côté les cas d’enseignements dispensés
chez les particuliers par des précepteurs) est supporté par le système du vakf : c’est en tant que
vakf que les diverses écoles sont fondées et bénéficient d’un lieu d’exercice ; c’est comme
personnel d’un vakf que les professeurs sont nommés ; et c’est par les revenus d’un vakf
qu’eux et leurs étudiants reçoivent leurs émoluments. L’institution du vakf structure et
organise ce vaste système d’éducation au sein de l’Empire ottoman. Mais cette éducation est
loin d’échapper totalement au contrôle et à la surveillance de l’État, dans la mesure où le
« personnel enseignant » est dépendant des vakf, dont les structures religio-éducatives sont
hiérarchisées par l’État. Ce dernier peut ainsi imposer une certaine forme de contrôle sur ces
enseignants – et, par ce biais, sur le système éducatif dans son ensemble. La surveillance est
encore renforcée par la mise en place de pratiques de contrôle des offices qui demeurent entre
les mains d’un personnel de formation religieuse, mais sont néanmoins placées de façon plus
directe sous la houlette de l’État. Ce contrôle est en effet effectué par les cadis et, au-dessus
d’eux, les juges d’armée et le cheikh-ul-islam : des officiers qui obéissaient, directement ou
indirectement, à l’autorité impériale38
.
4) Les utilisations politiques
Que ce soit au niveau de la (re-)production des structures sociales, en passant par les
problèmes économiques, jusqu’aux usages religieux des vakf, tout nous amène à nous
des clercs, cléricalisation de l’État ? » : 182. Voir aussi Veinstein, « Le modèle ottoman » et les études sur le système de l’ilmiye d’Uzunçarşılı, İlmiye Teşkilâtı et de Baltacı, Osmanlı Medreseleri. 38
İpşirli, « Ottoman State Organization » : 264-268.
Page | 373
interroger sur les rapports qu’entretient cette institution avec le pouvoir. La fondation d’un
vakf, surtout lorsqu’il comporte la création ou la restauration de structures socioreligieuses de
grande ampleur comme les külliye, les medrese, les mekteb, les couvents, et autres fondations
de type hayrî, constitue en effet un moyen d’affirmation de la puissance du fondateur. La
création d’une structure nouvelle, destinée à l’usage collectif et pourvu d’une nature pieuse,
est par essence un signe de puissance39
. Le fondateur ne peut s’acquitter des dépenses
engagées pour de telles œuvres que dans la mesure où il a accès à des ressources
considérables (autrement dit, que le fondateur détient des revenus importants, ce qui est
presque à coup sûr la marque d’un personnage au service de l’État, ou qu’il détient des terres
en bien propres, ce qui suppose la proximité avec la personne impériale, seule dispensatrice
de tels biens). En somme, il faut être riche pour être fondateur d’un vakf, et pour être riche, il
faut graviter dans les sphères du pouvoir.
Mais l’acte de fondation d’un vakf n’est pas seulement un acte démonstratif ; il peut
également être doté d’une portée plus politique. Le vakf a en effet été utilisé, par les Ottomans
et leurs prédécesseurs musulmans comme un moyen pour l’État ou, à plus petite échelle, pour
un commandant, d’imposer son contrôle sur ses domaines40
. Un exemple représentatif de ce
phénomène est le rôle joué par les « derviches colonisateurs », d’après l’expression de
l’historien Barkan, dans la mainmise « pacifique » de territoires frontaliers ou nouvellement
conquis, sur lesquels la présence ottomane (ou portant un tel label) était encore mal assurée.
Dans les territoires d’Europe orientale notamment, la création de fondations religieuses, telles
que les tekke de derviches ou les complexes associant mosquée et écoles, suivait de près la
conquête militaire d’un territoire. Elle favorisait l’installation d’une population venue des
terres intérieures, tantôt par émigration volontaire, tantôt sous l’effet de déplacements de
population recherchés par l’État. L’installation de cette population favorisait la colonisation
du territoire41
.
Cette colonisation est ainsi le fait de hauts dirigeants : tantôt par l’État lui-même
(politique sultanienne), tantôt par les commandants militaires en charge des frontières. Ces
derniers, qui s’étaient vus octroyés la détention en main propre (mülk) de vastes territoires, en
rétribution de leurs efforts dans la propagation de la gaza, transformèrent en vakf leurs biens.
Véritables commandants quasi autonomes sur les régions dont ils avaient le contrôle, il leur
était indispensable d’assurer le développement et la prospérité de leurs domaines, base de leur
richesse et de leur pouvoir : la constitution de vakf s’y prêtait parfaitement. La famille
Evrenosoğlu ou encore les Candarlı, pour ne citer qu’eux, pratiquèrent intensément cette
politique de constitution de legs pieux sur l’ensemble de leurs domaines, leur donnant ainsi un
dynamisme économique et social remarquable42
. Au demeurant, les sultans ne furent pas en
reste, et les nombreuses fondations entreprises sous leur patronage en témoignent largement43
.
39
Singer, Constructing Ottoman Beneficence : 27-29 ; Leeuwen, Waqfs and Urban Structures : 184-196. 40
Leeuwen, Waqfs and Urban Structures : 188-192. 41
Barkan, « I. İstilâ devrinin kolonizatör Türk dervişleri ve zaviyeler » ; idem, « Les déportations comme méthode de peuplement » ; idem, « Osmanlı İparatorluğunda bir iskân ve kolonyzasyon metodu ». 42
Pour l’œuvre familiale de la famille Candarlı, voir notamment Balta, Les vakifs de Serrès ainsi que Uzunçarşılı, Çandarlı Vezir Ailesi. Sur Evrenos Bey et sa famille, voir İsmail H. Uzunçarşılı, « Evrenos », İA : t. 4 p. 413-418 ;
Page | 374
Toutefois, au vu des réalisations entreprises, le patronage des sultans (auquel peut être
associé, dans une certaine mesure, celui des autres membres de la dynastie) semble avoir
concentré l’essentiel de ses efforts non sur les frontières, mais plutôt en vue du
développement interne de l’Empire, en priorité de ses grandes villes. Il est vrai que celles-ci
furent soit des capitales de l’Empire (Bursa, Edirne, Istanbul), soit des capitales provinciales,
sièges de cours princières. Ici, le but n’était plus d’assurer le contrôle de territoires
nouvellement conquis, ou frontaliers, mais de favoriser la prospérité économique des centres
urbains majeurs de l’État. Sans oublier le besoin d’afficher la puissance ottomane, qui
explique en partie l’intérêt particulier porté aux deux premières capitales de l’Empire, Bursa
et Edirne, puis ensuite leur abandon relatif au profit d’Istanbul44
.
Avec le temps, l’État ottoman renforça sa politique autoritaire par une centralisation
accrue des pouvoirs et des richesses entre les mains du souverain. La politique centralisatrice
ottomane, initiée relativement tôt, constitue une caractéristique majeure de cet État ; elle
prend toute sa puissance à partir du XVIe siècle, grâce au développement de la bureaucratie et
de l’administration impériale. Or, les vakf sont l’un des domaines qui échappent quasi
entièrement au contrôle étatique. Fondés par des individus, ils sont également contrôlés de
façon privée – par opposition à un contrôle étatique. La pratique de confier à des membres de
la famille l’office de gestionnaire (tevliyet) du vakf permet effectivement aux individus, aux
familles, de conserver la direction de leurs œuvres pieuses et la mainmise sur les revenus qui
vont avec. L’une des explications du succès de cette institution réside peut-être là. Mais au vu
de l’importance que prit le vakf dans la société ottomane et des énormes revenus et parcelles
du territoire que ces œuvres réunissaient, c’est tout un pan de l’activité économique, urbaine
et sociale qui échappait ainsi au contrôle et à la surveillance de l’État.
L’État n’était pourtant pas sans exercer aucun contrôle sur l’ensemble du système : le
fait que les cadis (des fonctionnaires de l’État) soient chargés de vérifier la légalité des
fondations et des activités économiques réalisées par leurs mütevelli montre bien qu’il
disposait déjà d’une certaine tutelle sur ce système. Mais celle-ci était loin d’être suffisante et
ne permettait aucune ingérence directe dans le système du vakf. D’autant plus que l’institution
elle-même repose sur des règles élaborées dans le cadre de la législation islamique, dont l’État
(en la personne du sultan) est le garant suprême. Toute la difficulté de l’exercice consistait
donc à trouver un moyen d’imposer un contrôle plus direct de l’État sur les énormes
ressources (financières, humaines, symboliques, etc.) détenues par les fondations pieuses, tout
en respectant le cadre juridicoreligieux de l’institution. L’activité législative du cheikh-ul-
Heath W. Lowry et İsmail E. Erünsal, Yenice-i Vardar’lı Evrenos Hanedanı: Notlar ve Belgeler, Istanbul, Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları, 2010. 43
À ce propos, consulter notamment les ouvrages de Ekrem H. Ayverdi, Osmanlı Mimârîsinde Çelebi ve II. Sultan Murad devri. 806-855 (1403-1451), İstanbul, Baha matbaasi, 1972 ; idem, Osmanli mimarisinde Fatih devri. 804-886 (1451-81), Istanbul, Baha matbaasi, 1974 ; id., Avrupa’da Osmanli mimari eserleri ; id., İstanbul Mimarî Çağının Menşe’i, Osmanlı Mimarîsinin İlk Devri Ertuğrul, Osman, Orhan Gaziler, Hüdâvendigâr ve Yıldırım Bayezid. 630-805 (1230-1402), Istanbul, İIstanbul Fetih Cemiyeti, 1989 ; et avec Aydın İ. Yüksel, Osmanlı Mimarisinde II. Bâyezid Yavuz Selim Devri. 886-926 (1481-1520), Istanbul, İIstanbul Fetih Cemiyeti yayını, 1983. 44
Aptullah Kuran, « A Spatial Study of Three Ottoman Capitals: Bursa, Edirne, and Istanbul », Muqarnas 13 (1996) : 114-131.
Page | 375
islam Ebussuud45
, sous le règne de Süleyman Ier, apporta quelques pierres à cet édifice. Ce
grand législateur mit tout l’art de sa rhétorique à justifier la réappropriation par l’État de
certaines terres constituées en vakf46
. Le système de la double location fut ainsi instauré pour
l’ensemble des revenus des legs pieux47
.
Dans un autre domaine, l’État chercha également à imposer son contrôle par une
politique de centralisation progressive des offices de superviseurs (nezâret) des vakf. Dès le
XVIe siècle, bon nombre de fondations pieuses souffraient d’un manque d’entretien, au point
parfois de tomber en désuétude. Le constat dressé incriminait la corruption des gestionnaires
des vakf – les mütevelli. Ceux-ci, afin d’augmenter leurs revenus, puisaient dans les finances
des fondations dont ils étaient chargés d’assurer le bon entretien, les laissant tomber en ruines.
La dispersion des mütevelli et leur connivence avec les nazır (les contrôleurs) favorisaient un
tel laisser-aller. L’État ottoman tenta donc de centraliser, dans les mains d’un seul individu, le
contrôle de l’ensemble des vakf impériaux, à savoir non seulement ceux fondés par les sultans
et les membres de leur famille, mais aussi tous ceux passés sous le contrôle de l’État, après
disparition des héritiers. Engagée au XVIe siècle, cette politique passait par la nomination
d’un individu chargé d’organiser la surveillance – un individu qui appartiendrait à l’appareil
de l’État ou qui serait sous l’autorité directe de la personne impériale : le choix se posa sur le
chef des eunuques noirs – soit un personnage qui, à cette époque, ne disposait alors que d’un
pouvoir limité.
Cette politique avait pour but d’empêcher les corruptions : elle en créa de nouvelles,
plus puissantes encore que les premières : forts de cette charge, les chefs des eunuques noirs
(Kızlar Ağası ou Darüs-sa’ade ağası) acquirent un pouvoir impressionnant, qui alla de pair
avec la montée en puissance de leur propre charge au sein du Palais et de l’État. De fait, la
supervision de ces vakf leur assurait une source de revenus considérable et les rendait
responsables de la nomination d’un personnel important : la pratique des pots-de-vin battait
son plein ; obligés de payer une commission pour obtenir un office, mütevelli et nazir
n’hésitaient pas alors à prélever à leurs fins personnelles des sommes sur les revenus du vakf.
Ressources financières et humaines assurèrent aux chefs des eunuques noirs, dépositaires
d’une place qui leur donnait accès aux personnalités les plus puissantes de l’État, la capacité
de se constituer une faction politique importante, qui alla croissante entre le XVIe et le XVIII
e
siècle48
.
Le temps des Tanzimat, bien qu’il dépasse notre période chronologique, mérite d’être
mentionné, car il permet de comprendre la portée des évolutions susmentionnées :
l’accaparement de la supervision des vakf par le chef des eunuques noirs et la volonté de
contrôle étatique de l’ensemble des fondations pieuses. Malgré quelques tentatives antérieures
infructueuses, il faut attendre le règne de Mahmud II (1808-39) pour que le Kızlar Ağası soit
45
Ce grand législateur est loin de s’être intéressé uniquement à la question du vakf : on le voit au contraire mener une véritable politique législative dans quasiment tous les domaines du droit. Cf. notamment les études, sur ce personnage et son œuvre, de Imber, Ebu’s-Su’ud ; Repp, The Müfti of Istanbul. 46
Barnes, An Introduction to Religious Foundations : 41-42, 47-48. 47
Barnes, An Introduction to Religious Foundations : 50-56. 48
Sur le sujet, voir notamment les travaux d’Hathaway, « Eunuch Households » et Beshir Agha.
Page | 376
progressivement écarté du contrôle des vakf impériaux, par la création d’un office
indépendant49
. Dès lors qu’il eut les mains libres par rapport à l’influence de son chef des
eunuques noirs, le sultan intégra les vakf des femmes de la famille royale et du harem, ainsi
que ceux de quelques grands dignitaires, dans les fondations gérées par ce nouvel office. Une
fois le système solidement implanté, il l’étendit et lui annexa de nouvelles fonctions,
notamment le contrôle des réseaux d’eau. Quant à la prise de contrôle étatique des vakf privés,
l’une des démonstrations les plus probantes est, sans conteste, la réquisition de l’ensemble des
legs pieux appartenant aux Bektâchî puis, peu après, de tous ceux appartenant aux divers
groupes derviches50
. Le début du XIXe siècle vit donc culminer la politique étatique de
centralisation du contrôle de l’ensemble des legs pieux par un organe de l’État.
2. Les fondateurs de vakf dans la société ottomane
Qui fonde des vakf dans la société ottomane et que fondent-ils ? Ces deux questions
sont essentielles pour permettre une mise en perspective de l’action philanthropique des
princesses ottomanes. Sans cette capacité à renvoyer à un référentiel, un inventaire des vakf
des princesses ne présenterait qu’une utilité limitée. En quoi consisterait ce référentiel et
comment l’établir, en l’absence de travaux de compilation sur la question51
? Il ne s’agit pas
d’étudier le problème sur l’ensemble de la société ottomane : quelques points nous intéressent
tout spécialement. Au niveau géographique, seule Istanbul retiendra notre attention ici, dans la
mesure où la capitale de l’Empire héberge la grande majorité des fondations des princesses
ottomanes. Au niveau sociologique, nous nous contenterons de comparer leur patronage à
celui entrepris par la dynastie, dont elles sont issues, à celui de l’élite ottomane, dans laquelle
elles s’insèrent par mariage, et à celui mené par les femmes de façon générale.
49
Mustafa II (1695-1703) tenta de faire passer la collecte des revenus des evkâf impériaux des mains du chef des eunuques noirs à celles du defterdar. Plus tard, Abdülhamid Ier créa le Evkâfı Hümâyûn Nezareti, office qui consistait à supervision et centraliser de façon indépendante l’ensemble de ses propres fondations pieuses. Le processus finaliser par Mahmud II était donc déjà engagé de longue date, sans succès. Barnes, An Introduction to Religious Foundations : 67-86. 50
Barnes, An Introduction to Religious Foundations : 87-101. 51
Nous voulons dire par là qu’il n’existe pas, à notre connaissance, d’études sociologiques de l’activité philanthropique dans le domaine ottoman. La littérature sur le vakf est particulièrement importante : il existe des compilations des fondations dans les lieux précis, ou à des époques précises, ou encore de nombreuses monographies d’œuvres, mais il est bien difficile d’établir un tableau général sur le sujet. Il faut pour cela recouper des informations éparses et qui ne coïncident pas toujours entre elles.
Page | 377
1) Le patronage dynastique
Le patronage de la dynastie ottomane est de loin l’un des mieux documentés. Les
études faites sur le sujet permettent d’en dresser les principales caractéristiques. Par facilité,
mais aussi pour suivre au plus proche la logique dynastique, il convient de distinguer, au sein
de ce groupe, l’activité des sultans de celle des princes, des reines mères et des concubines
(les princesses feront l’objet du chapitre suivant, aussi il n’en sera pas question ici).
Le patronage des sultans, un acte de pouvoir et de puissance
Le patronage des souverains ottomans se présente comme un acte de pouvoir, une
démonstration de puissance : puissance de la dynastie incarnée par le souverain bâtisseur,
pouvoir du souverain sur l’espace qu’il domine. La nature de ce patronage prend ainsi
plusieurs formes, parfois concomitantes, sans que ce soit là une règle absolue : il souligne
tantôt une prise de pouvoir sur un espace, rappelle tantôt le caractère sacré du pouvoir
impérial ; il peut encore être démonstratif et proclamer la supériorité dynastique.
La première forme de patronage des sultans ottomans est intimement liée à la période
des conquêtes et à l’expansion territoriale. L’exemple le plus représentatif de ce type de
patronage est celui effectué directement après la conquête d’un espace : le sultan, chef
conquérant, affirme alors son autorité sur le lieu récemment conquis et intégré à ses territoires
en ordonnant la construction (ou la restauration, avec éventuellement des modifications)
d’œuvres personnelles (de dimensions variables), qui soulignent et rappellent à tous les
habitants la mainmise du souverain sur cet espace : le patronage exhibe ainsi sa volonté
d’imposer et d’affirmer sa domination sur la zone considérée. À ce titre, on rappellera que
l’un des premiers actes des sultans à la suite d’une conquête consistait à accomplir la prière et
faire réciter la hutbe en son nom, soit dans une mosquée déjà existante (dans le cas des
conquêtes dans les territoires déjà musulmans), soit dans une église transformée
automatiquement en mosquée par cet acte (dans les territoires chrétiens).
Si cette récitation est déjà une marque de la nouvelle domination, celle-ci prend encore
plus de valeur lorsqu’elle a lieu, non dans un espace rituel préexistant aux vainqueurs qui se
l’accaparent (cette marque de violence constitue une démonstration de force), mais lorsqu’elle
s’opère dans un lieu nouveau, qui vient s’ajouter aux anciens, et porte, de ce fait, la marque
intégrale de la nouvelle domination : de prédateur, l’acte s’inscrit dès lors dans une
dynamique de continuité (avec le passé) et de pérennité (inscription dans le futur). La
domination se veut plus pacifique. Rappel de cette domination, un tel patronage exalte aussi la
victoire ottomane : l’œuvre, visible et inscrite en dur (il s’agit de bâti), est dotée d’une valeur
commémorative immuable (un vakf est, par nature, éternel). La création de vakf s’associe
alors avec la notion de la permanence de la conquête par la gaza : un espace conquis par les
Page | 378
soldats de la guerre sainte (les gazi) est intégré au domaine musulman (dâr’ül-islam) et ne
peut, en théorie, être rendu ou perdu52
.
Le patronage impérial se situe également dans le domaine du symbolique. Le symbole
proclamé est de l’ordre du spirituel : la dynastie ottomane est élue de Dieu, qui a choisi d’en
faire un instrument de son pouvoir (le sultan n’est-il pas « l’ombre de Dieu sur terre » ?). En
tant que tel, l’une de ses tâches est d’assurer la perpétuation de la religion et le développement
de la communauté musulmane. Le sultan n’est pas simplement un gestionnaire de l’État, il est
aussi le chef spirituel de son peuple. La fondation de mosquées s’inscrit dans ce sens,
puisqu’elle favorise l’exercice des pratiques musulmanes (la prière, un des cinq piliers de
l’Islam). Mais plus que les mosquées, ce sont les fondations de medrese, les tekke ou encore
les türbe, qui rappellent ce rôle spirituel du souverain : c’est là que sont formés les savants et
penseurs musulmans (les ‘alim), mais aussi les saints et autres individus qui se consacrent
uniquement à l’exercice religieux (pîr, cheikh, derviches, etc.). En fondant de tels espaces, le
sultan contribue à accroître le potentiel spirituel de ses domaines, ce qui lui permet de
s’affirmer comme protecteur de la religion et instrument de la Divinité. En amplifiant la
capacité de production spirituelle de son Empire, le souverain acquière ainsi une aura qui
dépasse le cadre temporel pour s’inscrire dans le domaine du symbolique, du sacré, dans
lequel Dieu l’avait déjà placé, en le choisissant pour être son représentant sur terre.
Enfin, le patronage des sultans est démonstratif de leur puissance, évidemment, mais
surtout de leur supériorité. En ce sens, leurs efforts sont principalement concentrés dans les
capitales successives de l’Empire : Bursa d’abord, Edirne ensuite (à moindre niveau
cependant), enfin et surtout Istanbul. Le paysage urbanistique de Bursa est ainsi profondément
modifié et restructuré autour des complexes des souverains ottomans : celui de Mehmed Ier,
autour de la Yeşil Camii, ou de Murad II, la Muradiyye, en sont des illustrations53
. C’est dans
ces capitales que sont bâties les œuvres les plus magnifiques de leur règne (et généralement de
leur époque) et que s’exprime la splendeur ottomane, symbolisée par la magnificence des
œuvres de ces souverains. C’est là également que les sultans instituent cette forme
architecturale particulière, qui devient une marque de fabrique ottomane : les külliye, vastes
complexes pluri-bénéfiques organisés autour d’un centre (la mosquée) offrant diverses
commodités (économiques : les marchés, les hammams ; religio-éducatifs : les écoles ;
sociaux : les cuisines populaires, les hôpitaux), qui favorisent l’émergence et la propagation
d’un art ottoman classique. Les plus beaux exemples, les plus belles réalisations de ce genre
sont à Istanbul, capitale de l’Empire : la succession quasi ininterrompue sur plusieurs
générations d’œuvres impériales dans la capitale reflète l’importance de cet acte54
. Tout est
52
Qu’on se rappelle l’importance du choix d’Osman Ier de se faire enterrer dans Bursa, en état de siège mais pas encore conquise par l’armée ottomane. C’est une proclamation envers ses successeurs et son peuple : cette ville doit être conquise ; une fois le mausolée construit, il n’est plus possible de revenir en arrière : la ville ne peut plus être perdue. Il en va de même lors de l’inhumation du prince Süleyman, fils aîné de Orhan, en Thrace : ce territoire, conquis par le fruit de ses efforts et de ses victoires ne saurait être abandonné aux Infidèles. Son intégration durable parmi les domaines ottomans devient incontournable. 53
Kuran, « A Spatial Study of Three Ottoman Capitals » ; Yerasimos, Constantinople : 156-181. 54
On trouve ainsi le complexe de Mehmed II, puis celui de Bayezid II, puis celui à la mémoire de Selim Ier (fondé cependant par son fils et successeur), celui de Süleyman Ier ; Selim II rompt cette succession, en faisant construire son complexe à Edirne ; puis ce sont les reines mères qui remplacent l’activité des sultans dans la
Page | 379
d’ailleurs fait pour assurer à ces œuvres un caractère inégalable : les dimensions de l’œuvre,
la taille des coupoles, la présence de multiples minarets, la position en hauteur ou au cœur des
zones vitales, l’interdiction de bâtir des maisons à une hauteur égale aux mosquées (qui
dissimuleraient le bâtiment aux regards), etc.55
Ces œuvres participent d’une remodélisation
du paysage urbain de la capitale, tout en servant de support à l’appropriation de l’espace par la
dynastie, consacrée lors des grandes cérémonies dynastiques organisées autour de ces
œuvres56
.
Le patronage des princes, un phénomène limité dans le temps et
l’espace
Le patronage des princes de sang se distingue de celui des sultans sur bien des aspects,
du fait des restrictions qui s’imposent à lui. L’exercice philanthropique d’un prince ne peut en
effet se situer que pendant une période de temps restreinte à son activité de prince, quand il
sort du Palais pour être envoyé se former en province en tant que gouverneur. Cette activité
prend fin avec l’expiration de sa position de prince-gouverneur : soit qu’il monte sur le trône
– son activité relève dès lors du patronage impérial ; soit qu’il disparaisse des suites de
l’application de la pratique du fratricide. De ce fait, cette activité se limite à la zone où son
autorité trouvait à s’appliquer – l’espace de la province dont il est nommé gouverneur. Certes,
cette province pouvait changer en cours de vie : l’activité philanthropique suivait alors la
relocalisation du prince en question. Un prince en poste à Manisa n’entreprenait des œuvres
qu’à Manisa et n’allait pas empiéter sur le territoire d’un autre prince, en poste à Konya, par
exemple. Cette restriction spatiale suit cependant la logique de la formation reçue par le
prince pendant toute sa période de şehzadelik, à savoir qu’il s’exerçait à son métier de futur
souverain. De même que l’aire d’action philanthropique d’un sultan s’étendait à l’ensemble de
ses domaines, mais ne les excédait pas, celle d’un prince couvrait l’ensemble de sa province,
mais pas au-delà.
La restriction est aussi datée dans le temps : il faut qu’il y ait des princes en poste en
province pour que ceux-ci puissent exercer, dans le cadre de cette fonction, une activité
philanthropique. Quand la pratique d’envoyer les princes en province prit fin (dans la seconde
moitié du XVIe siècle), de même disparut tout patronage princier (masculin). La logique est
d’ailleurs concomitante avec celle qui motiva l’arrêt de la formation des princes : la peur des
capitale pendant quelques décennies, avec l’œuvre de Nurbanu, mère de Murad III et celle, inachevée et abandonnée, de Safiyye Sultane ; Ahmed Ier renoue avec la pratique antérieure, mais ce sont ensuite de nouveau les reines mères qui reprennent l’activité philanthropique impériale dans la capitale, avec Kösem Sultan, Turhan Hadice Sultane et Gülnûş Emetullah Sultane. Nous reviendrons sur le rôle de « suppléantes des sultans » des reines mères dans ce domaine. 55
Necipoğlu, The Age of Sinan : 115-126. 56
Necipoğlu, The Age of Sinan : 27-76 et Architecture, Ceremonial and Power ; Maurice Cerasi, Divanyolu, Istanbul, Kitap Yayınevi, 2006 : 54-65 ; Nicolas Vatin, « Aux origines du pèlerinage à Eyüp des sultans ottomans », Turcica XXVII (1995) : 91-99 ; Vatin et Veinstein, Le sérail ébranlé : 305-319.
Page | 380
sultans – peur d’une éventuelle rébellion des princes, peur qu’ils n’acquièrent un trop grand
pouvoir, une trop grande puissance susceptible de fragiliser la leur. Or, le patronage, surtout
architectural, est en soi un acte de pouvoir, une démonstration de puissance, nous l’avons dit.
Il n’y aurait aucun sens à retirer aux princes l’exercice d’un pouvoir, tout en leur laissant la
possibilité d’exprimer une puissance. Maintenir les princes au Palais et leur interdire toute
activité philanthropique procédait donc d’une même logique : les conserver, pendant toute la
période du sultanat paternel, dans une enfance fictive.
Une dernière restriction s’applique au niveau du degré d’ostentation toléré pour les
œuvres d’un prince. Dans la mesure où la philanthropie est acte de pouvoir, elle est
nécessairement assujettie à certaines règles hiérarchiques qui suivent l’organisation sociale
ottomane. Au niveau architectural ou philanthropique dans son sens large, un prince ne peut
en aucune manière dépasser son rang pour s’approcher de celui d’un sultan et en prendre les
attributs. Et par impossibilité, il faut entendre à la fois une interdiction (tacite), mais
également une incapacité : les revenus d’un prince, même considérables, ne lui permettaient
pas d’entreprendre des œuvres monumentales du niveau de celles des sultans57
.
Le patronage des concubines, à l’écart de la scène impériale
L’activité philanthropique des concubines des sultans suit de près celle des reines
mères, à la seule différence, fondamentale cependant, qu’elle ne connaît pas l’évolution notée,
pour ces dernières, à partir du XVIe siècle : de faible importance, constitué principalement de
bâtiments solitaires, il ne porte aucune marque impériale. Les complexes sont quasi
inexistants, les mosquées rares, et encore ne sont-elles pas gratifiées de doubles minarets. La
présence de réalisations architecturales est déjà, en soi, exceptionnelle : une grande part des
activités philanthropiques des concubines consiste en actes de bienfaisance comme la
distribution de dons charitables pour les pauvres et les orphelins. La seule différence entre les
XIVe-XV
e siècles et la période suivante est d’ordre géographique : durant les deux premiers
siècles, les fondations des concubines sont éparpillées dans diverses zones du territoire
ottoman ; les premières capitales de l’État, Bursa et Edirne, étaient cependant privilégiées.
Bursa demeura le lieu principal du patronage des concubines royales jusqu’à la fin du XVe
siècle, quand les élites masculines montraient déjà une préférence pour Istanbul, après
Edirne : on peut donc dire que les concubines continuèrent à pratiquer un patronage
traditionnel en retard par rapport aux tendances générales de l’élite masculine et impériale. À
partir du XVIe siècle cependant, ce retard dans le choix de la localisation fut comblé :
désormais, l’essentiel de leur patronage se situe soit dans Istanbul, soit en faveur des lieux
saints. Cependant, le bâti a alors presque totalement disparu – les raisons financières y sont
probablement pour beaucoup.
57
Eroğlu, Şehzadelik Kurumu : 184-187.
Page | 381
Deux figures méritent une attention particulière cependant : les mères de princes
envoyés en province durant la seconde moitié du XVe siècle d’une part, et la première favorite
(haseki), Hürrem Sultane, d’autre part. Les premières bénéficièrent, en effet, d’un surcroît de
prestige grâce à la construction d’œuvres architecturales en leur nom, par leurs fils. Ces
constructions sont généralement localisées dans la capitale provinciale ou dans une des
grandes villes de la région sous contrôle du fils. Ainsi Gülbahar Hatun a-t-elle une mosquée à
son nom à Tokat, œuvre de son fils, le prince Bayezid (futur Bayezid II). Ce prestige octroyé
par le fils pour sa mère s’explique à la fois par la qualité du lien filial, renforcé par le principe
de formation des princes sous l’égide maternelle, et par la nature même de ce lien : c’est parce
qu’elles sont mères d’un candidat au trône, futur souverain potentiel, qu’elles sont ainsi mises
en valeur. On voit ainsi émerger le principe de l’insertion rétroactive de ces femmes dans le
lignage ottoman (et dans la hiérarchie palatiale impériale) qui s’établira définitivement
quelques générations plus tard, au début du XVIe siècle.
La figure de la première favorite de l’histoire ottomane, Hürrem, est doublement
atypique. Elle bénéficia de la pratique suscitée d’un patronage royal au nom d’un autre, à la
différence qu’ici, il ne s’agit pas du fils, un prince, mais du concubin/époux, sultan régnant.
Atypique aussi parce qu’à bien des égards, ce patronage s’inscrit dans la continuité des
œuvres dynastiques – sans en avoir néanmoins tous les attributs. Ainsi, Hürrem dispose
d’œuvres à son nom dans la capitale même58
. Mais la capitale de l’Empire n’est pas le seul
lieu qui rappelle la position exceptionnelle de cette femme, ni sa participation à la
construction d’une image impériale dynastique relayée par le bâti : les complexes construits
pour elle par Süleyman Ier à Médine et La Mecque seraient une manière d’associer la favorite
aux responsabilités impériales à l’égard de ces lieux saints, tout en établissant une continuité
virtuelle entre son activité philanthropique et celle d’autres femmes musulmanes, hautement
révérées : Khadidja, première épouse du Prophète, et Zubeida, seconde épouse du calife
abbasside Haroun al-Rashid. Quant au complexe à Jérusalem, également construit par le
sultan au nom de sa favorite, il pourrait être un clin d’œil à une autre grande dame du monde
méditerranéen oriental : Hélène, mère de Constantin, l’empereur byzantin fondateur de
Constantinople59
. Le précédent d’Hürrem fut suivi par les autres haseki, une fois parvenues à
la position de valide sultan. Les autres concubines furent très largement exclues de ces
activités. Le patronage de ces femmes perdit de sa valeur, pour devenir presque invisible, sauf
au travers de quelques réalisations disséminées ici ou là. L’engouement pour les fontaines que
connaît l’élite ottomane, féminine notamment, au XVIIIe siècle, permit à ces femmes un
regain d’activité : elles y gagnèrent en visibilité, mais pas en importance.
58
Peirce, The Imperial Harem : 61. 59
Peirce, The Imperial Harem : 203-204.
Page | 382
Le patronage des reines mères, substitut de celui de leur fils
Le patronage des mères de sultan change radicalement selon la période
chronologique : deux phases apparaissent, réparties avant et après le tournant du XVe siècle.
Au cours de la première phase, soit aux XIVe et XV
e siècles, ce patronage conserve des
proportions restreintes : il s’agit le plus souvent de bâtiments solitaires, sans commune mesure
avec les caractéristiques des œuvres impériales. On notera notamment la diversité des lieux de
ces fondations, répartis au gré des provinces où étaient nommés leur fils, avec toutefois une
préférence assez marquée pour l’ancienne capitale de l’État, Bursa60
. Si cette philanthropie
participe du développement socio-religio-économique patronné par l’élite, elle n’est
cependant pas associable à l’image de puissance prônée par les œuvres impériales. Au XVIe
siècle, cette activité connaît un tournant majeur, qui lui fait prendre toutes les caractéristiques
d’un patronage impérial. Peirce écrit que, sous le règne de Süleyman Ier, fut instauré « un
nouveau paradigme pour les constructions publiques féminines » : « la mère de Süleyman,
Hafsa, sa fille Mihrimah, ses sœurs et ses petites-filles, et tout particulièrement sa haseki
Hürrem entreprirent des constructions de plus grandes dimensions que leurs prédécesseurs et,
pour la première fois, érigèrent des monuments majeurs dans la capitale de l’Empire » ;
l’exemple prôné par ces femmes devint « le standard pour les valide sultan des générations
futures »61
. Ce « nouveau paradigme » est directement lié à la redéfinition de la hiérarchie
dynastique féminine, qui conduit progressivement à rehausser la position et le statut de la
reine mère.
Le premier précédent fut établi par l’exemple d’Hafsa Sultane, mère du sultan
Süleyman, qui fit construire, peu de temps après la montée sur le trône de son fils (soit peu de
temps après sa propre accession à la position de reine mère), un vaste complexe comprenant,
outre la mosquée, une medrese, un tekke, un mekteb et un imaret62
. Divers éléments
permettent d’intégrer ce complexe parmi les œuvres impériales, dont le plus visible de tous :
la présence de deux minarets (un honneur jusque-là réservé uniquement aux sultans). Seule la
localisation de cette œuvre, non dans la capitale de l’Empire mais à Manisa, en limite
l’importance. Le choix de cette ville s’explique aisément : c’était là que le jeune prince
Süleyman fut envoyé en formation, sous la surveillance de sa mère, sous le règne de son père.
Une attention particulière pour les dates d’élaboration du projet permet de comprendre qu’il
avait certainement été envisagé quelques années avant l’accession au trône de Süleyman,
quand mère et fils résidaient dans cette capitale provinciale63
. Le changement de statut et de
lieu de résidence (désormais dans la capitale) de la fondatrice n’entraîna pas l’abandon du
60
Sur le sujet, voir notamment la dissertation de master d’Ayşe Çıkla, Architectural patronage of women in the early Ottoman era, Mémoire de Master, Istanbul, Boğaziçi Üniversitesi, 2004. 61
Peirce, The Imperial Harem : 199. 62
Le sultan fera ensuite ajouter à ce complexe un hôpital et un bain, au nom de sa mère. Peirce, The Imperial Harem : 199. 63
Ainsi, on note, dès 1528, l’achat collectif de quelques centaines de boutiques ordonné par Hafsa Sultane dans les environs, qui seront transformés en vakf et intégrés aux revenus de sa fondation. Peirce, The Imperial Harem : 199-200.
Page | 383
projet, mais il eut probablement un impact sur l’importance de la réalisation finalement
entreprise : en devenant reine mère, Hafsa Sultane accédait à des revenus dont le montant
excédait de beaucoup ce que son précédent statut de concubine lui offrait. Le précédent fut
suivi ensuite par toutes les valide sultan de l’époque classique64
. Nurbanu Sultane entreprit la
fondation d’un vaste complexe sur les hauteurs d’Üsküdar65
; sa belle-fille, Safiyye Sultane,
engagea un projet architectural au cœur même de la ville, à Eminönü – qu’elle dut cependant
abandonner avant qu’il n’ait abouti66
; Kösem Sultane, mère de Murad IV et d’Ibrahim,
réalisa également un complexe à Üsküdar ; finalement, c’est sous le règne de Mehmed IV que
les reines mères virent culminer leur prestige en tant que fondatrices, sous la forme du
majestueux complexe d’Eminönü, réalisé par Turhan Hadice Sultane67
. Sa propre belle-fille,
Gülnuş Emetullah Sultane, se contenta, pour sa part, d’un superbe complexe à Üsküdar.
Ce n’est pas tant par leur localisation (hors de la capitale intra-muros, à l’exception de
celui de Turhan Hadice Sultane) que par le port d’insignes architecturaux de la royauté que
ces fondations participent à l’élaboration d’une image philanthropique de la dynastie. Ces
indices montrent leur pleine intégration dans le rang des fondateurs impériaux, aux côtés des
sultans. On s’explique mieux alors la chronologie mise en valeur plus haut : les reines mères
ne furent pleinement associées au lignage ottoman, dont la marque est l’octroi d’un titre
impérial (valide sultan), qu’à partir du XVIe siècle. Une reine mère ne pouvait prétendre à
l’utilisation des prérogatives architecturales dévolues aux œuvres impériales qu’une fois
parvenue à la position de valide sultan. La fondation de Nurbanu Sultane, commencée quand
elle n’était que haseki de Selim II, mais terminée sous son office de valide sultan de Murad
III, en est un bon exemple : son changement de statut entraîna une réévaluation des plans
initialement prévus par l’architecte impérial, Sinan, afin de donner à l’œuvre la qualité et le
prestige auxquels elle avait désormais droit68
.
Cette prééminence architecturale acquise par les reines mères fut facilitée, encouragée
peut-être, par un désintérêt des sultans dans le domaine. Les œuvres des reines mères
suscitées (à l’exception de Hafsa Sultane) coïncident toutes avec des sultans non bâtisseurs,
peu ou prou. Dans sa vakfiyye, Nurbanu Sultane laisse d’ailleurs entendre que le fait que son
fils se soit abstenu de réaliser un complexe de type impérial serait l’une des raisons pour
laquelle elle se serait lancée personnellement dans ce projet69
. Un glissement de sens de ces
fondations s’opère : elles cessent d’être perçues comme des œuvres personnelles, pour être
associées à des œuvres impériales. L’action philanthropique des reines mères est assimilée de
façon quasi symbiotique à l’activité impériale. Dans le domaine architectural, l’activité de la
64
Seules exceptions : la mère d’Ahmed Ier, dont la puissance fut presque nulle et qui ne tint cette position que quelques années, avant de décéder, de Mustafa Ier et d’Osman II, moins retirées de la vie politique que celle d’Ahmed Ier, mais qui ne surent s’imposer durablement ou solidement. 65
Necipoğlu, The Age of Sinan : 280-292. 66
Thys-Şenocak, Ottoman Women Builders : 193-195. 67
Thys-Şenocak, « The Yeni Valide Mosque Complex of Eminönü » et Ottoman Women Builders. La vakfiyye de Turhan Hadice Valide sultane a été publiée par Tülay Duran (éd.), Tarihimizde Vakıf Kuran Kadınlar: Hanım Sultan Vakfiyeleri, Istanbul, Tarihî Araştırmalar ve Dokümantasyon Merkezleri Kurma ve Geliştirme Vakfı Yayını, 1990 : 61-91. 68
Necipoğlu, The Age of Sinan : 284-289. 69
Kayaalp-Aktan, « The Atik Valide’s Endowment Deed ».
Page | 384
reine mère devient synonyme d’activité sultanienne – et on peut se demander dans quelle
mesure celle-ci ne fut pas elle-même assimilée, par un glissement de conception du pouvoir
impérial qui s’opère à la même période70
, à une activité étatique.
2) L’activité philanthropique de l’élite masculine ottomane
Un problème immédiat se présente à nous, lorsqu’il s’agit de dresser un aperçu
relativement représentatif de l’activité philanthropique de l’élite masculine ottomane : en
l’absence de travaux de synthèse sur cette tranche de la société, comment établir un référentiel
comparatif sans s’écarter trop de notre sujet ?
Il est essentiel de commencer par évaluer le degré de participation des élites
masculines dans la fondation de legs pieux. Un dépouillement du Vakıflar Tahrîr Defteri
d’Istanbul daté de l’année 160071
offrait la possibilité de se faire une première opinion sur ce
point, pour la période s’étendant de la prise de Constantinople à l’aube du XVIIe siècle. De
tels registres fournissent peu de renseignements biographiques sur les fondateurs : nous avons
opté pour la seule répartition qui nous semblait possible, en tenant compte des titres (ou,
inversement, d’absence d’un titre) : ce furent 1°) les Pachas, 2°) les Beys, 3°) les Ağa, 4°) les
Çelebi, 5°) toutes les personnes détenant une affiliation religieuse quelconque, 6°) enfin, une
dernière catégorie réunissant tous ceux qui ne rentraient pas dans ces six autres.
Tableau 5.26. Nombre de legs pieux fondés à Istanbul, par catégorie sociale (de la prise de la ville à 1600)
Pachas 36
Beys 287
Ağa 71
Çelebi 123
Personnages religieux 507
Autres 866
Soit un total de 1890 fondations masculines pour lesquelles il a été possible de déterminer,
dans les grandes lignes une appartenance sociale72
.
70
Sur le sujet, cf. Sigalas, « Devlet et État » et « Des histoires des Sultans à l’histoire de l’État ». 71
Canatar (éd.), İstanbul Vakıfları Tahrîr Defteri : 1009 / 1600 Tarihli. 72
Le registre dénombre au total 1933 fondations masculines, auxquelles il faudrait rajouter ou tenir compte des vakf à multiples fondateurs, qui sont souvent le fait d’un couple ou de frères et soeurs.
Page | 385
Graphique 5.27. Répartition des fondations pieuses à Istanbul, par catégorie sociale
(de la prise de la ville à 1600)
Ce graphique laisse entendre que plus on s’élève dans la hiérarchie sociale, moins les
fondations dans la capitale sont nombreuses. Cependant, il faut se méfier des chiffres. En
effet, cette répartition du nombre de fondations établies à Istanbul jusqu’à l’année 1600 est en
chiffres absolus : elle ne permet pas de refléter le pourcentage réel de chaque catégorie. De
fait, la hiérarchie sociale ottomane étant pyramidale, plus on s’élève dans cette hiérarchie,
plus le nombre d’individus concernés diminue. Le chiffre de 36 fondations attribuées à des
pachas fait faible figure, surtout si l’on pense au nombre total de pachas sur l’ensemble de la
période. Il faut dire qu’il ne s’agit là que des fondations dans la capitale. Or, les pachas
entreprenaient de nombreuses fondations hors d’Istanbul. Cette activité provinciale représente
même une part essentielle de leurs œuvres. Qu’on pense aux exemples de Rüstem Pacha ou
Sokollu Pacha, pour le XVIe siècle, de Köprülü Mehmed Pacha au XVII
e siècle !
73 Il faut
également tenir compte du fait que l’intervalle chronologique du recensement n’est pas bien
long (un siècle et demi). Mais surtout, toute fondation n’équivaut pas à une autre. En chiffre
réel, les pachas furent peut-être moins nombreux que les membres d’autres catégories à établir
des vakf, mais leurs fondations sont les plus considérables, avec celles des sultans, ainsi que
nous allons le voir. D’ailleurs, si l’on compare ces résultats avec ceux proposés par Yüksel,
dans son étude sur le rôle du vakf dans la société ottomane du XVIIe siècle
74, qui couvre
l’ensemble du territoire ottoman, des différences apparaissent. Le nombre de fondations pour
l’ensemble des pachas, sur une période plus courte qui n’excède pas un siècle, est largement
supérieur au précédent, circonscrit à la seule capitale (155 contre 36).
73
Necipoğlu, The Age of Sinan : voir notamment les cartes p. 578 et 579, pour les deux premiers ; Kunt, « The Waqf as an Instrument of Public Policy » pour le troisième. 74
Yüksel, Vakıfların Rolü. Voir notamment les graphiques en fin d’ouvrage.
Pachas; 36
Beys; 287
Aga; 71
Çelebi; 123
Religieux ; 507
Autres; 866
Page | 386
Tableau 5. 28. Les fondations des membres de l’élite ottomane au XVIIe siècle sur l’ensemble de l’Empire
(d’après l’étude d’Hasan Yüksel)75
Sultans Pachas Beys Agas
21 155 128 335
Les différences chronologiques et géographiques ne permettent aucune conclusion
précise, mais ces résultats laissent entendre l’existence d’une spécificité de la capitale au
niveau de l’action philanthropique des membres de l’élite ottomane. L’activité d’un même
individu différerait selon qu’il prévoyait de fonder dans ou hors de la capitale. Sous réserve
que ces résultats ne soient pas faussés par les différences suscitées, on peut avancer
l’hypothèse que les pachas constitueraient la principale catégorie sociale responsable de la
fondation d’œuvres hayrî en province. Comme nous l’avons noté pour les sultans, l’œuvre
réalisée dans la capitale est dotée d’un surcroît de valeur (symbolique) qui conduit à
augmenter les exigences en terme de qualité et de finesse du travail – avec les conséquences
financières que cela implique, qui supposent une réduction du nombre des réalisations et un
rétrécissement des profils des fondateurs. Ainsi, Rüstem Pacha entreprit plusieurs dizaines
d’œuvres pieuses partout dans l’Empire, de taille, d’importance et de degré de raffinement
variables, mais seulement un complexe dans la capitale : ce dernier présente toutefois une
qualité architecturale et décorative d’une grande richesse76
. On pourrait en dire de même du
patronage de Sokollu Mehmed Pacha, de Köprülü Mehmed Pacha et de la majorité des grands
officiers de l’État77
.
L’étude de la participation des élites masculines à l’embellissement architectural de la
capitale a, dès lors, été privilégiée, au détriment de la situation en province. Ce resserrement
spatial paraît d’autant plus indispensable que l’essentiel des fondations des princesses se
trouve à Istanbul. Se concentrer sur la capitale paraît à la fois plus facile, du fait de la
multiplication des travaux disponibles sur le sujet, mais également, et pour les mêmes raisons,
plus complexe. Passer en revue, une fois encore, les quelques centaines de pages du Vakıflar
Tahrir Defteri ne parut pas opportun : non seulement le travail aurait été gigantesque, mais en
plus limité chronologiquement. Un autre ouvrage s’avéra répondre à nos objectifs : la
description des monuments d’Istanbul par Ayvansarâyî78
. Les écrits de cet auteur offrent, en
effet, une vision relativement complète des monuments érigés en vakf dans la capitale sur
75
Yüksel, Vakıfların Rolü : graphiques en fin d’ouvrage. 76
Necipoğlu, The Age of Sinan : 314-318 (pour le complexe à Istanbul), 318-331 (pour ceux construits par Mimar Sinan hors d’Istanbul). 77
Necipoğlu, The Age of Sinan : 331-345 (pour la fondation (du couple) à Istanbul), 345-368 (pour celles du pacha hors d’Istanbul). Kunt, « The Waqf as an Instrument of Public Policy » pour Köprülü Mehmed Pacha. Ces vakf provinciaux, fondés en province par les pachas, étaient cependant dotés d’un rôle essentiel d’identification du fondateur et de sa famille au sein de sa communauté : il lui permettait d’y ancrer et d’y affirmer son pouvoir et son statut. Meriwether, The Kin Who count ; Fay, « Women Place in the Mamluk Household » et « Property, Power and the Domain of Gender » ; Randi Deguilhem (éd.), Le Waqf dans l’espace islamique. Outil de pouvoir socio-politique, Damas, Institut Français de Damas, 1995 ; Leeuwen, Waqfs and Urban Structures. 78
Galitekin (éd.), Hadîkatü’l-Cevâmi’.
Page | 387
l’ensemble de la période (et même au-delà). Il met de côté tous les legs pieux ehlî, de loin les
plus nombreux, mais qui ne présentent aucune utilité pour notre propos, pour se concentrer
uniquement sur les fondations hayrî.
Tableau 5.29. Typologie des œuvres architecturales réalisées par les membres de l’élite ottomane masculine
dans Istanbul intra-muros
Sultans Pachas Oulémas Beys Agas
Complexes külliye 8 12 1 1 2 24
Mini-complexes79
0 10 6 0 5 21
Bâtiments solitaires80
20 51 56 11 73 211
- dont mosquées 4 20 6 1 7 38
- dont mescid 15 30 45 10 63 163
28 73 63 12 80 256
Tableau 5.30. Typologie des œuvres architecturales réalisées par les membres de l’élite ottomane masculine
dans Istanbul extra-muros
Sultans Pachas Oulémas Beys Agas
Complexes külliye 7 11 0 0 2 20
Mini-complexes 2 10 9 0 6 27
Bâtiments solitaires 40 37 49 10 76 212
- dont mosquées 19 16 10 1 14 60
- dont mescid 21 17 35 9 61 143
49 58 58 10 84 259
Les résultats fournis par ces tableaux permettent de proposer quelques conclusions qui
mériteraient néanmoins d’être affermies par un travail plus en profondeur, qui n’est pas
l’objet de cette étude. On commencera par noter que le nombre total des fondations dans
79
Il s’agit de complexes ne comprenant que deux bâtiments et se présentant sous la forme d’un lieu de prière (mosquée ou, plus généralement, mescid) et d’une école quelconque (medrese, mekteb, ou autres), voire, très rarement, d’un couvent. 80
On notera l’absence totale de mekteb solitaires fondés par les diverses catégories des membres masculins de l’élite ottomane : le mekteb n’est construit que dans le cadre d’un complexe, voire en association avec un autre bâtiment (mescid notamment, ou mosquée).
Page | 388
Istanbul intra-muros est assez similaire à celui pour la zone extra-muros : les divergences
apparaissent au niveau de la répartition selon le type de fondation. La comparaison entre le
bâti intra-muros et celui hors des murs révèle que les œuvres les plus luxueuses, les plus
prestigieuses (külliye et minicomplexes, auxquels nous ajoutons exceptionnellement les
mosquées solitaires) sont plus nombreuses hors des murs. Dans la mesure où la rareté fait
souvent la valeur d’un bien, il ressort qu’il est plus difficile de fonder de telles œuvres dans
Istanbul qu’en dehors, partant, que l’action en devient plus prestigieuse. Le faible nombre de
külliye hors des murailles, par rapport à la situation intra-muros, peut s’expliquer par les
mêmes raisons. Pour une fondation, le summum du prestige est atteint lorsqu’il s’agit d’une
külliye fondée dans Istanbul intra-muros : il n’y a donc aucun intérêt, pour un fondateur, à
entreprendre une telle action hors les murs, quand il est possible de la faire dedans. À ce titre,
une étude chronologique de ces fondations montrerait, sans nul doute, que la majorité des
külliye fondées dans la zone extra-muros d’Istanbul sont postérieures à l’époque classique : ils
datent d’une période où le réseau du bâti dans la ville intérieure est extrêmement dense et rend
difficile de telles constructions, d’où le choix (presque obligatoire) des fondateurs de se
rabattre sur les quartiers hors des murailles, qui connaissent alors une forte expansion.
Concernant les fondations solitaires, les mosquées sont préférées aux mescid dans la
zone extra-muros, mais le rapport s’inverse dans la zone intra-muros. Cette différenciation
peut s’expliquer par une disparité des besoins en terme de bâti religieux, dans et hors les
murailles : Istanbul intra-muros est une ville aux structures religieuses très denses ; les zones
à l’extérieur des murs constituent des espaces d’expansion urbaine progressive : des villages,
autrefois peu peuplés et à l’écart de la capitale, sont progressivement assaillis par une
population croissante et tendent à s’intégrer au maillage urbain. Cette urbanisation
progressive de l’espace a cependant un impact sur le type de réalisations socioreligieuses qui
y sont nécessaires : le mescid qui, en milieu urbain, est une forme assez typique des espaces
au bâti très dense, cède la place aux mosquées, plus coûteuses, mais qui deviennent d’une
réalisation plus aisée, dès lors que le maillage urbain se fait plus lâche et que les coûts d’achat
des terrains diminuent. La réalisation d’une œuvre architecturale dans Istanbul intra-muros
était plus coûteuse, mais aussi plus complexe à réaliser qu’à l’extérieur des murailles81
.
L’activité des sultans hors des murailles de la ville paraît plus nombreuse, en nombre
d’édifices construits, mais le type de réalisation varie considérablement selon la localisation.
La différence se repère principalement au regard des œuvres d’importance moyenne et
81
Il fallait, en effet, prévoir une longue période de négociations et de tractations immobilières pour acquérir l’espace nécessaire pour réaliser le projet architectural souhaité, puis détruire le bâti déjà existant (quand c’était le cas). Pour les sultans ou les reines mères, il était toujours possible d’opter, dans certains cas, pour une politique d’expropriation, qui était loin d’être aisée et soulevait des protestations. On connaît notamment le problème et ses conséquences dans le cas du projet de construction d’un complexe à Eminönü, entrepris d’abord par Safiyye Valide Sultane, qui dut l’abandonner, puis par Turhan Hadice Valide Sultane. Les deux reines mères durent mettre en place une politique d’expropriation longue, coûteuse (il fallait tout de même indemniser les personnes expropriées de leurs biens) et qui souleva quelques ressentiments. Sur le sujet, cf. Lucienne Thys-Şenoçak, « Location, Expropriation and the Yeni Valide Complex in Eminönü », dans Art turc, Turkish art, 10 th International Congress of Turkish Art, 10e Congrès international d'art turc, Genève-Geneva, 17-23 September 1995, Actes-Proceedings, Genève, Fondation Max Van Berchem, 1999 : 675-680 et Ottoman Women Builders : 193-202.
Page | 389
mineure : les mini-complexes et, surtout, les bâtiments solitaires, sont nettement plus
nombreux hors des murs que dans la ville historique (2 > 0 pour les mini-complexes ; 40 > 20
pour les bâtiments solitaires). On voit ici à quel point l’acte de fonder dans Istanbul intra-
muros est perçu comme une action empreinte de majesté. Hors des murailles, la lecture des
œuvres n’est plus la même : les bâtiments qui y sont construits répondent à une utilité, un
besoin, non au désir d’expression de la domination impériale82
.
Les pachas montrent un investissement plus poussé (en quantité) dans la ville intra-
muros qu’à l’extérieur des murs. La variation du bâti présente néanmoins une image inverse à
celle des sultans : la différence se remarque au niveau des fondations de moindre importance,
dont le chiffre est largement supérieur dans les murs qu’à l’extérieur (51 > 37), tandis que les
fondations plus prestigieuses, comme les külliye et les mini-complexes, affichent des chiffres
quasi équivalents (12 > 11 pour les premières, 10 = 10 pour les seconds). L’explication relève
cependant du même raisonnement : la fondation dans Istanbul intra-muros est prestigieuse,
elle représente un acte noble. Quitte à opter pour une fondation de moindre importance, il est
préférable de s’investir dans une œuvre architecturale au sein des murailles de la ville qu’à
l’extérieur. On note d’ailleurs qu’un nombre important des réalisations hors des murailles sont
souvent localisées dans la proximité directe d’un lieu de résidence du fondateur (palais ou
yalı), relation qui indique que le motif de la fondation n’est plus la recherche du prestige, mais
l’utilité pratique, dans un cadre familial, ou encore une volonté de renforcer l’identification du
quartier au fondateur.
Le patronage des oulémas présente des caractéristiques très similaires selon qu’il se
situe dans ou hors les murs de la ville ; il suit les mêmes logiques que précédemment. La
grande différence entre les oulémas et les pachas réside dans le manque quasi total
d’investissement des premiers dans la réalisation de grandes œuvres architecturales (külliyye),
contrairement aux seconds : on ne compte, en tout en pour tout, qu’une seule külliyye réalisée
par un ouléma, dans Istanbul, aucune hors des murs. La typologie de leurs œuvres se borne à
quelques mini-complexes et, surtout, des bâtiments solitaires. Même dans ce domaine, on
remarque une préférence très marquée pour les mescid au détriment des mosquées (45 mescid
pour six mosquées dans Istanbul intra-muros, 35 pour 10 hors des murs). Le peu d’intérêt des
oulémas, c’est-à-dire des membres de la classe religieuse, pour la fondation de medrese, de
mektep, de tekke ou autres bâtiments du genre est intéressant : ce phénomène montre que s’ils
sont les bénéficiaires de ces structures, qui leur offrent offices et revenus, ils ne se conçoivent
pas comme des patrons potentiels – c’est là une responsabilité qui incombe aux membres
dynastiques et aux grands agents de l’État. Les conditions financières de ces individus sont
probablement l’une des raisons de cette typologie. Si les oulémas constituent une élite
dominante dans l’Empire, leur aura se fonde principalement sur leur savoir et leurs
compétences religieuses : ils ne peuvent rivaliser, en terme de richesse et de revenus, avec les
hauts agents de l’État (les pachas). Partant, ils ne bénéficient pas des moyens financiers (ni
82
À ce titre, notons que la majorité des complexes (külliye) fondés dans la partie hors des murs de la ville sont postérieurs à l’époque classique, soit à un moment où la densité démographique et urbanistique de la ville ne peut plus fournir d’espaces pour de nouvelles créations d’une telle ampleur.
Page | 390
probablement de l’appui logistique) pour entreprendre de vastes fondations dans Istanbul intra
et extra muros : ils en sont donc réduits à des réalisations de moindre mesure.
Le désengagement très marqué des beys dans les réalisations architecturales dans la
capitale est intéressant : dans ou hors les murs, leurs actions sont très peu nombreuses. En
termes quantitatifs, leur investissement est faible, qui plus est, il consiste uniquement en
œuvres de faible importance : une seule külliye en tout et pour tout, aucun mini-complexe, et
essentiellement des mescid en bâtiments solitaires. Si les beys ont pu être des patrons
d’architecture, ce n’est pas dans la capitale qu’ils trouvèrent l’espace pour s’exprimer. Les
raisons financières peuvent ici aussi être invoquées, mais il faut probablement y ajouter une
question de lieu d’exercice : les beys exerçaient principalement leurs offices en province ; ils
n’avaient donc pas de motifs à vouloir s’investir dans un lieu qu’ils connaissaient
probablement mal et qui faisait moins sens, en terme d’identification d’un patron à un espace
modelé par sa présence et son autorité sur-place. C’est donc probablement dans les provinces
qu’il faut chercher les formes et modalités d’expression architecturale et du patronage des
beys.
Le patronage des agas présente aussi des surprises. S’il est constitué majoritairement
d’œuvres de faible importance (bâtiments solitaires principalement), ce patronage représente
néanmoins une part importante des réalisations architecturales de la capitale intra et extra
muros : c’est d’ailleurs le chiffre le plus important de toutes les catégories sociales prises en
considération ici (au total, 80 réalisations dans Istanbul et 84 hors des murs, soit près d’un
tiers des œuvres, dans les deux cas)83
. Leur intérêt très marqué pour la capitale dans son
ensemble peut se justifier par leur lieu d’implantation. Il s’agit principalement de membres du
Palais (on compte de nombreux eunuques impériaux), dont l’essentiel des activités se
concentre dans la capitale. Hommes de la capitale, il est normal qu’une grande part de leur
patronage y soit localisé84
.
La différence entre le patronage impérial et celui des pachas se situe donc au niveau de
la fondation de bâtiments de faible importance : les pachas en réalisent plus dans la ville
intra-muros qu’à l’extérieur, tandis que les sultans procèdent à l’inverse. Pour ces derniers, il
semble que le degré de raffinement des œuvres réalisées dans Istanbul soit un critère
d’importance, qui perd de sa gravité dès lors qu’on s’éloigne des murs de la ville, alors que les
pachas privilégieraient l’action architecturale intra-muros en elle-même, quelle qu’en soit la
forme. L’importance de l’implantation d’une fondation dans Istanbul est soulignée, dans les
deux cas, par le fait que ce sont ces deux catégories d’individus qui sont responsables de la
très grande majorité des œuvres remarquables qui s’y trouvent. Ce sont les pachas et les
sultans qui financent l’essentiel des constructions de külliye et de mini-complexes. Plus le
statut du fondateur est élevé, plus il est important pour lui d’entreprendre une œuvre en
83
Le faible niveau d’investissement de leur patronage s’explique par les mêmes raisons financières invoquées à plusieurs reprises jusqu’à maintenant. 84
Les eunuques, qui représentent un certain nombre des agas, semblent avoir également eu une activité philanthropique importante en faveur des lieux saints et de l’Égypte, qui s’explique par les liens qu’ils entretenaient avec ces lieux (par leurs fonctions ou par attachement sentimental). Cf. Hathaway, « Eunuch Households » et Beshir Agha.
Page | 391
adéquation de son statut : ainsi, si l’on tient compte du fait que les sultans sont moins
nombreux (en quantité d’individus) que les pachas, la similitude des chiffres en nombre de
külliye fondées par les uns et les autres n’est en fait que le reflet de la primauté impériale dans
ce domaine85
.
De même, les oulémas, les agas et les beys, à leur niveau respectif, ne peuvent rivaliser
avec les pachas, encore moins avec les sultans (ce serait d’ailleurs interdit), quant à la qualité
et l’importance des œuvres entreprises. Il faut en conclure que les grandes entreprises
architecturales dans Istanbul sont le fait soit des sultans, soit des pachas, qui sont les seuls à
disposer à la fois des moyens financiers et logistiques, mais aussi d’une culture du patronage
allant dans ce sens ; l’entreprise architecturale somptuaire est donc un acte noble, associé à
une notion de service d’État. Le système marche dès lors en boucle fermée : il faut être un
serviteur de l’État pour disposer des moyens d’une telle entreprise, qui elle-même est le reflet
du statut du fondateur, dont l’élévation, soulignée par la noblesse de son geste, inscrite en dur
dans le bâti de la capitale, est le signe de son service à l’État.
3) Les femmes et la création de vakf dans l’Empire ottoman
Les travaux sur les femmes dans l’Empire ottoman se sont penchés sur la question de
la participation féminine dans le domaine des fondations pieuses. Ils ont révélé que leur
participation dans ce secteur était un trait constant de la société ottomane, bien qu’elle fût
moins importante (en quantité) et moins grandiose que celle des hommes. Les diverses études
entreprises proposent un pourcentage de fondations féminines avoisinant les 25 %, avec un
écart allant de 15 à 30, parfois même 35 %, selon les lieux et les époques86
. Néanmoins, fort
de son étude menée à partir du tahrîr defteri de 1546, Baer avançait la conclusion que la
fondation de vakf ne permettait pas aux femmes, comme il était souvent énoncé, d’acquérir
une réelle indépendance économique, car les pratiques de gestion entraînaient, à terme, leur
exclusion du système par l’accaparement des postes et revenus par les hommes87
. Prenant à
contre-pied ces résultats, d’autres chercheurs ont remis en cause cette conclusion, dans la
mesure où les principes juridiques et culturels décisifs en matière de gestion des vakf
permettaient autant aux hommes qu’aux femmes de devenir mütevelli (gestionnaire) des
fondations de leurs ancêtres, voire, dans certains cas, leur en donnaient la primauté. Dans les
cas, majoritaires, où la fondatrice du legs pieux n’imposait aucune préférence entre les
85
Moins nombreux que les pachas, les sultans sont à l’origine d’une quantité similaire d’œuvres, ce qui signifie en fait une plus grande participation de leur part (par individu). 86
25 % pour l’Égypte au XVIIIe siècle selon les travaux de Mary Ann Fay, 20 % pour Edirne au XV
e-XVI
e siècle
selon ceux de Haim Gerber, 36,8 % pour Istanbul d’après le tahrîr defteri daté de 1546 étudié par Baer, qui trouve encore 36,3 % pour Alep au XVIII
e siècle, enfin 24 % pour Jérusalem entre 1805 et 1820 et 23,4 % pour
Jaffa pendant la période ottomane. Fay, « Women Place in the Mamluk Household » : 33-51 ; Fay, « Property, Power and the Domain of Gender » : 28-47 ; Baer, « Women and Waqf » : 9-27 ; Meriwether, « Women and Waqf Revisited » : 128-152 et The Kin Who Count : 178-206. 87
Baer, « Women and Waqf » : 9-27.
Page | 392
descendants dans sa vakfiyye, il revenait au cadi local de choisir parmi les descendants celui à
qui la charge incombait. Deux règles prévalaient : l’aînesse et le non-cumul des offices. Or,
exclues de la sphère active et professionnelle, les femmes étaient libres de toute charge et plus
aptes à s’occuper pleinement de la supervision d’un vakf. Par ailleurs, les aléas de la
démographie faisaient qu’elles étaient régulièrement amenées à se trouver en position
d’aînesse. Elles répondaient donc parfaitement au profil, de sorte que des cadis optèrent
régulièrement en leur faveur, au détriment des hommes de la famille88
.
La question de l’usage que les femmes faisaient des vakf a également intéressé certains
chercheurs. Les travaux menés sur l’Égypte ottomane, notamment, ont mis en valeur le lien
entre la création de legs pieux par des femmes, ou l’acquisition du droit de gestion de legs
établis par des hommes de leur famille, et leur poids économique au sein de la famille. À une
époque où les luttes entre factions entraînaient souvent la confiscation de terres après la
défaite d’un parti contre un autre, la constitution de vakf était essentielle pour la préservation
de la richesse familiale. Les femmes, les épouses en particulier, devenaient bien souvent les
gardiennes de cette richesse, tandis que leur mariage ou remariage au sein de la même faction
permettait de maintenir la cohésion du groupe : la veuve d’un officier était amenée à épouser
un de ses esclaves, qui acquérait ainsi, par mariage, la richesse de son ancien patron,
concluant ainsi son alliance avec le groupe89
.
Nous avons vu que l’appartenance sociale des individus avait un impact important sur
le type de patronage architectural de la capitale. Il n’y a pas de raison de croire qu’il n’en
allait pas de même pour les femmes, mais les logiques étaient-elles similaires ? Il convient de
reprendre les informations fournies par Ayvansarâyî pour voir quelles étaient les catégories
sociales féminines impliquées dans la réalisation d’œuvres architecturales (dans la capitale).
Or, les femmes ne disposaient pas d’un panel de titres aussi étendu que les hommes90
. La
répartition des femmes fondatrices ne peut donc suivre les mêmes critères que précédemment.
Nous avons opté pour une division sociale beaucoup plus simple, qui prend en considération
trois catégories : les femmes du Harem (les concubines royales qui ne parvinrent jamais à la
position de Valide Sultane, les saraylı et les cariye du Palais) ; les autres femmes de l’élite
88
Meriwether, « Women and Waqf Revisited » : 128-152 et The Kin Who Count : 178-206. 89
Fay, « Women Place in the Mamluk Household » : 33-51 ; Fay, « Property, Power and the Domain of Gender » : 28-47. Il est fort regrettable que nous ne disposions pas d’études similaires pour les autres régions de l’Empire (notamment l’Anatolie et la Roumélie), qui n’étaient pas soumises aux mêmes configurations politiques que l’Égypte. Concernant les luttes de faction en Egypte, voir Hathaway, The Politics of Household. Voir également, du même auteur, « Bilateral Factionalism in the Ottoman Provinces », in Provincial Elites in the Ottoman Empire, Halcyon Days in Crete V. A Symposium Held in Rethymno, 10-12 January 2003, A. Anastasopoulos (éd.), Rethymno, Crete University Press, 2005 : 31-38 et, avec Davis Morgan (éds.), The Politics of Households in Ottoman Egypt, Cambridge, Cambridge University Press, 2002. 90
Les femmes sont appelées tantôt Hatun, tantôt Hanım, ou encore Kadın. Si on peut comprendre le titre de Kadın (avec des variantes comme Kadınefendi ou Başkadın) comme la marque d’une relation de concubinage avec le sultan, les deux autres ne permettent pas d’en déduire la moindre indication de statut : Hatun est le terme d’adresse le plus ancien pour désigner une femme – il était probablement utilisé dans un sens honorifique, qu’on pourrait traduire par Dame, sans qu’il soit possible d’en faire une règle générale – et fut progressivement remplacé par l’emploi du terme Hanım. Par ailleurs, les sources ottomanes (et tout particulièrement les vakfiyye) utilisent souvent des formules “une femme (hatun) appelée” : il est difficile alors de juger si le terme hatun est employé comme un marqueur social ou comme un signe de sa condition féminine. Boyle, « Khatun » ; Özcan, « Hatun » ; Akyıldız, « Kadınefendi ».
Page | 393
(les mères, épouses et filles de dignitaires de l’État ottoman, pachas, beys, oulémas, etc.) ;
enfin toutes les autres, c’est-à-dire à la fois celles pour lesquelles on pouvait supposer une
condition sociale peu élevée ou pour lesquelles les renseignements fournis étaient trop partiels
pour percevoir leur position dans la hiérarchie sociale91
. Les réalisations entreprises par ces
femmes fondatrices dans Istanbul ne recouvrent pas non plus les mêmes spectres d’action : il
a donc fallu adapter le tableau à leurs activités. Aucune de ces femmes n’entreprit de vastes
complexes – l’activité est réservée aux femmes royales affiliées à la dynastie, les reines
mères, comme nous l’avons vu, et les princesses, comme nous allons le voir. De manière
générale, leurs actions prennent des dimensions plus restreintes, moins grandioses que pour
les membres masculins de l’élite : le tableau met ainsi l’accent sur la diversité de ces activités
de moins grande envergure.
Tableau 5.31. Typologie des œuvres architecturales réalisées par les membres de l’élite ottomane féminine dans
Istanbul intra et extra muros
Construction
de mini-
complexe
Construction
de mosquées
Construction
de medrese
Constructions
de bâtiments
solitaires de
faible coût –
mekteb,
mescid,
fontaines
Ajouts ou
restauration
d’un bâti
déjà existant
Construction
par un autre,
au nom
d’une
femme
Femmes du
Harem
(cariye,
concubines,
saraylı)
1 8 0 14 5 1
Filles ou
femmes de
l’élite
(pachas,
beys, etc.)
1 1 1 13 12 1
Autres 0 0 0 12 6 0
Le tableau reflète une modulation des pratiques en fonction du statut social des
fondatrices. En tout, on dénombre 82 fondations attribuées à des femmes pour la capitale –
soit un nombre très largement inférieur par rapport aux hommes : 56 d’entre elles sont le fait
de femmes appartenant à l’élite (femmes du Harem impérial ou parentes des dignitaires de
l’État) ; les deux fondations faites au nom d’une femme sont exclues de ce décompte, bien
qu’elles soient également le fait de femmes de l’élite, pour d’autres femmes appartenant
également à cette catégorie sociale. Le constat est sans équivoque : ce sont surtout les femmes
91
Pour ces femmes, deux hypothèses sont envisageables : soit l’auteur ne connaissait rien de la fondatrice, soit sa condition sociale était peu élevée et expliquerait l’absence de renseignements concernant ses relations familiales ou sa position professionnelle. Nous sommes partie de l’hypothèse que, dans la majorité des cas, l’absence de renseignements sur la condition de la fondatrice était le signe d’une position sociale peu élevée, dans la mesure où les pratiques commémoratives supposaient au contraire d’indiquer sa qualité.
Page | 394
d’élite qui entreprennent des actions de patronage architectural, parce qu’elles détiennent les
moyens financiers nécessaires pour de telles entreprises.
Le type d’actions entreprises révèle néanmoins leur manque de moyens (financiers,
pratiques), y compris pour les femmes de l’élite. Leurs activités se répartissent principalement
entre la fondation de petites structures solitaires de faible coût (mescid, mekteb et fontaines :
on notera l’absence de fondation de tekke), l’ajout d’éléments architecturaux (adjonction d’un
minber ou d’un minaret notamment) ou encore la rénovation de structures déjà existantes. Les
grands complexes sont introuvables dans cette liste et les minis-complexes sont exceptionnels,
de même que les medrese, c’est-à-dire les formes de bâti d’un coût relativement élevé. Toutes,
sans distinction sociale, montrent un intérêt presque similaire envers les fondations solitaires
de petite taille ; les ajouts ou restaurations semblent avoir suscité un plus grand engouement
(toutes proportions gardées) auprès des parentes des dignitaires de l’État92
.
Les deux catégories de femmes d’élite se distinguent encore des autres au niveau des
fondations de mosquées. Toutefois, les femmes du Harem montrent un investissement plus
considérable que les épouses ou filles d’agents de l’État dans ce domaine. Les raisons
financières et pratiques sont peut-être évocables, bien qu’elles ne nous semblent pas
nécessairement pertinentes (il faudrait vérifier les capacités économiques de chacune) ; faut-il
y voir l’influence de l’exemple royal ? Il n’est pas exclu que ces femmes du Harem impérial
aient tenté, avec leurs propres moyens, de reproduire les pratiques architecturales en cours
auprès des femmes royales affiliées à la dynastie, chez qui la fondation de mosquée est plus
importante. Le patronage architectural est donc principalement l’affaire des femmes de l’élite.
L’existence d’une fondation commémorative à leur nom atteste ainsi de leur qualité sociale.
Mais la rareté des œuvres architecturales entreprises par ces femmes, en dehors des membres
affiliées à la dynastie (84 sur plus de trois siècles est un chiffre bien faible), laisse entendre
qu’il s’agissait-là d’une action féminine peu commune.
*
L’institution du vakf a déjà une longue histoire lorsqu’émerge l’État ottoman. Elle
plonge ses racines au cœur même de l’Islam, reposant sur des principes fondamentaux tels
que la sadaka (un des cinq piliers de l’Islam), l’aide aux plus démunis ou aux membres de la
famille et, bien entendu, le développement de la communauté musulmane. L’étendue du
système est telle qu’elle touche presque tous les domaines de la société : le pouvoir, l’État, la
famille, l’éducation, l’économie, l’urbanisme. Les Ottomans apportèrent néanmoins leur
propre touche à cet ancien édifice, sous l’impact notamment du centralisme étatique :
92
Nous n’avons aucune explication, à ce jour, pour expliquer ce phénomène qu’il faudrait confirmer par de plus amples recherches : l’explication la plus évidente, à savoir la volonté de soutenir une œuvre familiale (fondation du père ou de l’époux notamment) n’est que partiellement confirmée par les sources. D’autres principes sont donc en jeu, qui nous échappent encore.
Page | 395
l’absolutisme centralisateur et bureaucratique de l’État eut, en effet, pour conséquence
d’élaborer une dynamique de contrôle des vakf, tant au niveau des services fournis par cette
institution (éducatifs, religieux, sociaux) que des revenus et offices placés dans son escarcelle.
Les Ottomans inaugurèrent également une forme architecturale spécifique : la mosquée-
complexe (külliye), qui réunit divers bâtiments religieux, économiques, sociaux et/ou
charitables autour d’une mosquée. Cette structure architecturale, sponsorisée par les sultans,
fut reproduite par les grands agents de l’État (pachas notamment), tant dans la capitale que
dans les provinces, faisant de l’architecture et du vakf un relai d’expression de la domination
ottomane. Istanbul devint naturellement le fleuron de l’architecture ottomane : c’est là que se
concentre l’essentiel des œuvres les plus magnifiques, les plus sophistiquées.
Les données économiques et politiques font que le vakf est un système qui reproduit et
affiche les hiérarchies sociales existantes dans l’Empire. Ce sont les détenteurs de la
puissance politique, membres de la dynastie et haut agents de l’État, hommes comme femmes,
qui investissent dans les grandes œuvres architecturales, parce que ce sont eux qui détiennent
les conditions financières nécessaires, mais également mentales : être un haut officier de
l’État assure les ressources matérielles indispensables, octroyées sous réserve d’un retour
obligatoire, parce qu’imposé par la morale, en faveur de la communauté. L’acte de fondation
architecturale de type hayrî est un acte à la fois noble et anoblissant : il faut appartenir aux
hautes sphères du pouvoir pour s’en rendre capable, ce qui signifie que fonder un vaste
complexe est un signe aisément perceptible d’une position sociale privilégiée.
Inversement, ceux qui ne gravitent pas dans ces hautes sphères sont quasi exclus de
cette activité : ils n’en ont pas les moyens, mais la nécessité ne s’impose pas non plus à eux.
Ils se contentent d’une philanthropie plus modeste. Les mieux lotis copient, à leur niveau, les
actions des grands, en faisant construire des œuvres mineures, mais qui entrent dans la
catégorie du bâti (bâtiments solitaires comme une mosquée ou un mescid, ou encore, à
moindre niveau, une fontaine), voire en associant leur nom à une construction déjà existante
par le jeu de la rénovation ou de l’ajout (d’un minaret par exemple). Si l’aura acquise n’est
pas la même que lors de la fondation d’un complexe, l’action procède cependant d’une
volonté de glorification individuelle qui rappelle, à son échelle, la position privilégiée du
fondateur au sein de la société. Les moins privilégiés, exclus de telles actions, se contentent
d’interventions qui répondent à des soucis plus personnels, plus privés, tels que la
transmission d’un patrimoine ou de revenus au sein de la famille, par la voie du vakf.
Il ne faudrait cependant pas croire en l’existence d’une dichotomie totale entre vakf
hayrî et vakf ehlî : le souci privatif et familial est également présent dans les fondations des
grands personnages, qui trouvent dans le vakf le moyen d’une glorification personnelle en
même temps que l’assurance de pouvoir garantir, sur le long terme, la transmission d’une part
de l’héritage familial. La différence se situe au niveau de la capacité et de la volonté de
transmettre une image de soi glorifiée par l’action socioreligieuse, par l’existence d’un bâti
servant de relais d’identification et de transmission du nom du fondateur. S’il faut être en
position de le faire, la position ne saurait suffire : la volonté, c’est-à-dire un désir de mémoire,
est indispensable à l’entreprise hayrî.
Page | 396
II. CARACTÉRISTIQUES DES VAKF DES PRINCESSES OTTOMANES
Dans la vie antique gréco-romaine, « tout notable municipal est tenu, par une sorte de
morale de classe, de faire au peuple des libéralités, et le peuple attend cela de lui ; les
sénateurs romains, de leur côté, maîtres du monde, donnent des jeux à la plèbe de la ville de
Rome, distribuent des cadeaux symboliques à leurs partisans et à leurs soldats, pratiquent
ouvertement une sorte de corruption électorale ; l’empereur lui-même assure à la ville de
Rome du pain à bon marché et des combats de gladiateurs, et ses sujets affirment volontiers
qu’il est le premier évergète de son Empire. Ces dons d’un individu à la collectivité sont ce
qu’on appelle l’évergétisme. [I]maginons qu’en France la plupart des mairies, des écoles,
voire des barrages hydro-électriques, soient dus à la munificence du capitalisme régional, qui,
en outre, offrirait aux travailleurs l’apéritif ou le cinéma »93
. Nous pourrions reprendre cette
entrée en matière de Paul Veyne et, en changeant les quelques mots qui permettent de situer
historiquement son propos, l’appliquer presque telle quelle à la philanthropie ottomane : le
vakf assure, en effet, les services publics, éducatifs, économiques, sociaux, religieux. Il
structure profondément l’ensemble de la société ottomane. Mais le vakf tel qu’il est pratiqué
dans la société ottomane n’a rien de commun avec l’évergétisme gréco-romain, qui en faisait
l’affaire des notables exclusivement, sans l’associer directement à une pratique religieuse.
Fonder un vakf, pour un Ottoman, est un acte de foi, un acte envers Dieu, auquel il offre sa
fondation, réputée pieuse, quand bien même ses usages n’auraient rien de religieux. Le vakf se
distingue encore du mécénat antique par son universalisme : il est ouvert à tous et tous
peuvent réaliser un vakf, même les femmes (si absentes du propos de l’historien de l’antiquité
gréco-romaine).
Pourtant, par-delà l’universalisme du vakf, il existe tout de même des différences de
classe. Ce sont les officiers de l’État, les notables, les gens d’élite, hommes et femmes, qui
réalisent les « dons à la collectivité » ; ce sont eux qui sont évergètes. Les autres pratiquent
une autre forme de fondation pieuse, tournée vers l’entraide au sein de la famille, des parents,
des descendants, des domestiques. La césure avouée par la société antique retrouve ses droits
à l’époque moderne : l’évergétisme est l’affaire de quelques-uns, ceux que Dieu a honoré
particulièrement en leur permettant leur réussite sociale, et qui doivent Lui montrer leur
reconnaissance en agissant en faveur des moins bien lotis, de ceux qui sont moins aimés de
Lui. Et tout comme le peuple grec et romain attendait de leurs notables, des sénateurs et de
l’Empereur romain qu’ils lui fassent des cadeaux, le peuple de l’Empire ottoman attend de ses
dirigeants, de ses notables, de ses souverains qu’ils usent de leur grandeur en agissant envers
eux. Les actions attendues ne sont pas les mêmes ; la conception diverge profondément ; mais
l’évergétisme comme morale des plus puissants demeure une constance. Cependant, dans la
société ottomane, cet évergétisme peut prendre diverses formes, qui ne passent pas toutes par
93
Veyne, Le pain et le cirque : 9.
Page | 397
le vakf. Les princesses venaient en aide aux prisonniers de guerre, parfois par des
prescriptions inscrites dans leur fondation pieuse, parfois en dehors94
.
On attendait des sultans et des agents de l’État qu’ils entreprennent de vastes
fondations polymorphes, qu’ils construisent des mosquées, des écoles, des marchés, des
ponts ; mais les oulémas, qui y trouvaient à exercer, n’avaient pas une telle responsabilité. Les
femmes, mêmes quand elles appartenaient à l’élite, n’avaient pas non plus à se charger d’un
tel poids (à moins qu’elles n’appartiennent à la dynastie), pourtant certaines le firent : par
souci religieux, peur de l’au-delà ? Par désir d’immortalité ou recherche de gloire ?
Probablement un peu de tout cela ; il est bien difficile de le savoir. Les textes des actes de
fondation mettent en avant les sentiments pieux et charitables des fondateurs et des
fondatrices ; mais ils répondent à des cadres discursifs préétablis et ne peuvent être pris pour
argent comptant. Ils ne disent pas ce qu’il en fut des motifs réels des fondateurs, mais la
manière dont ceux-ci devaient être mis en forme pour respecter les codes moraux de l’époque.
Les contemporains eux-mêmes n’y croyaient pas toujours, et un Mustafa Ali Gelibolulu
reprochait – à tort ou à raison – aux plus grands leur désir de gloire, d’autant plus abjecte à ses
yeux que celle-ci était parfois usurpée, parce qu’elle ne provenait pas de la guerre sainte et
pesait sur les ressources de l’État au point de le déstabiliser. Et que dire de cette charité
prônée par les vakfiyye, qui ne s’exerçait qu’au bénéfice de certains, ni les plus pauvres, ni les
plus démunis !95
Pour comprendre ce qu’il en était réellement de la philanthropie ottomane, il convient
de se pencher de plus près sur les usages qui en étaient faits, sans présupposer aucune osmose
des comportements entre catégories sociales et entre individus. Nous allons dès lors nous
concentrer sur l’étude du cas des princesses ottomanes. L’objet de ce chapitre est de
déterminer les contours de la philanthropie pratiquée par les princesses ottomanes. La
première question sera de savoir s’il s’agissait d’une action commune à l’ensemble des
membres de cette catégorie, ou seulement de certaines. Après quoi, il restera à étudier la
nature de leur patronage : quels en étaient les aspects typologiques et économiques ?
1. Les princesses fondatrices et les autres
Toutes les princesses ottomanes étaient-elles des fondatrices ou bien cette activité ne
concerne-t-elle que certaines d’entre elles ? Et dans ce cas, existe-t-il des raisons qui
expliquent l’intérêt des unes et pas des autres ?
94
Voir au chapitre 4.I.3. 95
Des travaux sur le fonctionnement des imaret ont mis en évidence le fait que ces « soupes populaires » étaient en fait plus des « cantines professionnelles » qui ne fournissaient qu’en dernier lieu de la nourriture aux pauvres. Cf. Ergin, Neumann, Singer (éds.), Imarets in the Ottoman Empire. Voir également Singer, Constructing Ottoman Beneficence.
Page | 398
Les aléas de la conservation des sources font qu’il est fort probable qu’une partie des
actes de fondation des princesses ne soit pas parvenue jusqu’à nous. De fait, certaines sources
narratives ou administratives mentionnent des legs pieux de princesses pour lesquels la
vakfiyye est introuvable. Le dépouillage des actes de fondation des princesses ottomanes, dont
le nombre s’élève à plus d’une centaine de documents, a ainsi été complété par un croisement
des sources (administratives ou littéraires). Au total, le panel des princesses fondatrices
s’élève à trente-huit filles de sultan et sept descendantes indirectes. Le rapport est de plus de
cinq pour une. S’il faut toujours se méfier des chiffres, la différence est cependant trop
marquée pour ne pas refléter une réalité évidente : ce sont principalement les sultanes qui se
préoccupèrent de la fondation de vakf, au détriment des princesses indirectes.
Tableau 5.32. Nombre de princesses fondatrices par siècle
XVe siècle XVI
e siècle XVII
e siècle XVIII
e
siècle96
Total
Filles de sultan 17 9 5 7 38
Descendantes
indirectes
4 1 1 1 7
Pour le XVe siècle, notre panel comprend dix-sept femmes ; c’est le nombre le plus
important de princesses fondatrices, toutes périodes confondues. Le XVIe siècle est également
une période d’intense activité, avec neuf fondatrices : trois filles de Selim Ier (Şah Sultane,
Fatma Sultane et Hanım Sultane), la fille unique de Süleyman Ier, Mihrimah Sultane, quatre
filles de Selim II (Ismihan Sultane, Gevherhan Sultane, Şah Sultane et Fatma Sultane), enfin
une seule fille de Murad III, Ayşe Sultane97
. Cette période s’arrête donc sur le patronage de la
fille de Murad III, dont les fondations vont jusqu’au tout début du règne d’Ahmed Ier. Le
XVIIe siècle constitue une période creuse, avec seulement cinq fondatrices : Atike, Ayşe et
Fatma, filles d’Ahmed Ier ; Kaya Ismihan, fille de Murad IV et Hatice, fille de Mehmed IV 98
.
Quant au XVIIIe siècle, il montre de nouveau une période de grande activité, avec sept
fondatrices recensées pour les seules filles de Mustafa II (Safiyye et Emine) et Ahmed III
(Fatma, Saliha, Esma, Ayşe et Zeyneb) 99
.
Le XVe siècle est également le siècle des princesses indirectes : la majorité des
fondatrices de cette catégorie vécurent en effet dans cette période – quatre sur sept, à avoir
Seyyide Hatice Hatun, Neslişah Sultane, Aynişah Sultane et Fatma Hanzade Sultane100
. Ce
chiffre est loin de pouvoir rivaliser avec celui des filles de sultan au même moment, mais il
reflète cependant une réalité : c’est surtout à la période la plus reculée que les descendantes
indirectes s’investirent dans les actions de patronage. Aux siècles suivants, seule une
princesse indirecte par siècle apparaît (Ayşe Sultane au XVIe ; Fatma Hanım Sultane au XVII
e
96
Dans notre étude, nous n’avons tenu compte que des filles de Mustafa II et d’Ahmed III, et leurs propres descendantes, dont l’activité couvre néanmoins presque intégralement le XVIII
e siècle.
97 Pour chacune de ces princesses, voir leurs Fiches récapitulatives, Annexes D.7 à D.14.
98 Pour chacune de ces princesses, voir leurs Fiches récapitulatives, Annexes D.15. et D.16.
99 Pour chacune de ces princesses, voir leurs Fiches récapitulatives, Annexes D.17. à D.24.
100 Pour chacune de ces princesses, voir leurs Fiches récapitulatives, Annexes D.1 à D.6. ;
Page | 399
et Zahide Hanım Sultane au XVIIIe siècle)
101, comme un exemple confirmant les préceptes
désormais imposés : ce sont les sultanes qui se posent comme fondatrices. On notera encore
l’absence quasi totale de descendantes indirectes au-delà de la deuxième génération, à
l’exception de Neslişah Sultane : les rares princesses indirectes à s’investir dans le domaine
des fondations pieuses sont des hanım sultanes, des petites-filles de sultan.
Par rapport à l’ensemble du panel de princesses sur lequel nous travaillons, ces chiffres
sont éloquents. Le nombre de filles de sultan, depuis les filles de Murad Ier jusqu’à celles
d’Ahmed III, s’élève à ce jour à 141 femmes, dont seulement 38 réalisèrent des activités de
patronage (dont nous ayons conservé la trace). Le rapport est de près d’un pour quatre : de
toute évidence, l’activité philanthropique par l’institution du vakf est loin de constituer une
pratique commune à l’ensemble du groupe. La même constatation pourrait être dressée avec
les princesses indirectes, mais la disparité des informations collectées à leur propos nous
interdit de fournir des chiffres plus précis. Si l’on rapporte maintenant ces chiffres par siècle,
on constate un phénomène de décroissance. Ainsi, sur les 36 sultanes dont l’existence est
attestée pour la période du XVe siècle, 17 furent engagées dans des activités de patronage, soit
un rapport d’environ un pour deux ; au XVIe siècle, le nombre de princesses est moins
nombreux, elles ne sont plus que 28, dont neuf fondatrices, soit un rapport d’un pour trois ; au
XVIIe siècle, le nombre total d’individus est un peu plus important, 31 princesses, dont
seulement cinq fondatrices, le rapport est alors d’un pour six ; au XVIIIe siècle, pour les
seules filles de Mustafa II et Ahmed III, le nombre est en très nette hausse, 46 princesses pour
seulement sept fondatrices, le rapport passe alors à un pour 6,5. Il faut toutefois tenir compte
d’une distorsion due aux sources : nous avons une meilleure connaissance de l’ensemble des
princesses au XVIIIe siècle qu’aux siècles précédents, car la documentation mentionne toutes
les sultanes, y compris celles qui décédèrent dans leur petite enfance. Pourtant, il ne semble
pas que ce phénomène change fondamentalement la dynamique générale : l’activité des
princesses dans le domaine considéré connaît une baisse croissante au cours du temps. En
chiffres réels (le nombre de fondatrices par siècle), cette baisse ne semble pas si évidente et se
concentre surtout sur le XVIIe siècle. Mais rapportée au nombre de princesses pour chacune
des époques, la décroissance paraît à la fois évidente et progressive.
2. Un siècle de gloire, trois de modestie
À bien des égards, les princesses constituent une catégorie particulière dans le vaste
ensemble des fondateurs et fondatrices de vakf dans l’Empire ottoman. Leur ascendance
royale et leur mariage avec les plus grands dignitaires de l’État leur offraient des facilités
exceptionnelles pour entreprendre des fondations pieuses : des revenus considérables, un
statut favorable pour entreprendre des actions de grande taille, l’accès aux personnes-
ressources et le soutien des plus hauts organes de l’État. Elles restent cependant soumises aux
101
Pour chacune de ces princesses, voir les fiches récapitulatives de leurs vakf, Annexes D.10, D.16. et D.19.
Page | 400
conditions politiques, économiques, sociales et religieuses de leur époque. Or, sur les quatre
siècles que couvre cette étude, ces données évoluèrent profondément : reste à savoir de
quelle(s) manière(s) ces évolutions modifièrent l’activité philanthropique des princesses.
Pour répondre à cette question, une approche typologique, organisée de façon
chronologique, a été privilégiée. Le découpage chronologique étant connu, il convient ici de
présenter la répartition typologique qui a été retenue. Cinq catégories ont été établies, selon la
nature du service proposé par le patronage. La première regroupe les actions de construction
d’un bâti à usage socioreligieux (mosquées ou mescid, écoles, imaret, couvents ou, plus
simplement, fontaines). Le bâti proposant un service économique (tels les hamam, les han ou
caravansérails, les boutiques ou menzil) n’a pas été pris en compte dans cette partie102
. La
deuxième catégorie englobe toutes les fondations socioreligieuses sans construction, comme
le financement de cours ou de conseils religieux dans des espaces déjà existants, ou encore le
fait de participer à la prise en charge et à l’entretien de fondations déjà en activité. La
récitation de prières, action religieuse par excellence, qui nécessitait de payer des officiants
spécialisés, constitue la troisième catégorie. Suit celle des œuvres charitables : nous n’avons
tenu compte alors que des actions spécifiques au legs pieux (à l’exclusion des dispositions
obligatoires) ou des services proposés par le vakf par ailleurs103
. Enfin, la dernière catégorie
dénombre les attributions de rentes individuelles, stipulées dans les clauses des fondatrices.
Un inventaire des services fournis par les vakf des princesses ottomanes au cours du temps
devient dès lors possible.
102
On pourrait, certes, discuter de l’apport social d’un hammam ou d’un caravansérail, qui tout en fournissant un service économique au vakf, proposaient également au quartier environnant une offre sociale. Dans la mesure où leur intérêt par rapport à la fondation était principalement économique, nous les avons exclus du tableau. De même, les fontaines y ont été intégrées, quand bien même elles ne proposent pas toujours un service religieux à la population (il faut distinguer les fontaines pour les ablutions, généralement à l’entrée, dans la cour, d’une mosquée, de celles qui étaient destinées à fournir de l’eau à la population du quartier, les plus nombreuses). Toutefois, le service social qu’elles fournissaient, essentiel pour une société où il n’existait pas encore de système d’approvisionnement en eau potable individuel, nous a incité à les intégrer dans le tableau. 103
Certaines obligations religieuses, inscrites dans le cadre légal, sont communes à l’ensemble des vakf et renvoient à un futur non daté l’utilité charitable du legs pieux ; ces dispositions ne sont pas, à nos yeux, la marque d’un réel investissement du fondateur en faveur d’une action charitable.
Page | 401
Graphique 5.33. Typologie des actions philanthropiques des filles de sultan par siècle
Graphique 5.34. Typologie des actions philanthropiques des descendantes indirectes des sultans par siècle
1) Du bâti dispersé et modeste : le XVe siècle
La construction de bâti par les princesses du XVe siècle représente des chiffres
suffisamment importants pour révéler leur intérêt dans ce domaine. Il est à noter cependant
que les fondations entreprises sont principalement de dimensions limitées et solitaires, comme
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Constructions Fondations sans
construction
Récitation de prières
Œuvres charitables
Rentes
15e s.
16e s.
17e s.
18e s.
0
5
10
15
20
25
30
Constructions Fondations sans
construction
Récitation de prières
Œuvres charitables
Rentes
15e s.
16e s.
17e s.
18e s.
Page | 402
la création d’écoles ou de lieux de prières. Il s’agit donc d’œuvres de faible importance et de
faible coût. Sur ce point, filles de sultan et descendantes indirectes se retrouvent dans l’intérêt
porté pour ce type de fondation, bien qu’en proportions différentes (qu’il faut mettre en
parallèle avec le nombre restreint de princesses indirectes fondatrices par rapport à celui des
sultanes).
Pour compenser la petitesse de leurs constructions, la tendance fut de réaliser ces
fondations dans des lieux particuliers, notamment des espaces religieux déjà en activité, qui
bénéficiaient d’un capital d’attraction préexistant. Un couvent, par exemple, pouvait être
fondé à proximité d’un lieu de culte populaire, comme les tombes de saints reconnus ; une
école, dans les environs d’une mosquée. Ce phénomène est particulièrement visible dans le
cas des fondations entreprises sous le règne de Bayezid II par Seyyide Hatice Hatun, petite-
fille de Mehmed Ier : outre la construction d’un mausolée au nom de Seyyid Mehmed Buhari,
à Bursa, elle ordonne encore la réalisation d’une école, à proximité directe de la mosquée
Emir Sultan, également sise à Bursa, dont la réputation dépasse les frontières de l’Empire,
grâce à la célébrité du cheikh pour lequel elle fut bâtie104
.
Un autre moyen consistait à entreprendre ces réalisations dans des villes bénéficiant
d’un prestige particulier : Bursa, la première capitale de l’État ottoman naissant, ou Edirne,
seconde capitale de l’Empire au XVe siècle, puis Istanbul, dès la fin de ce siècle. Une seconde
particularité de l’action bienfaisante des filles de sultan de cette période surgit ici : la
dispersion géographique. Le lieu de résidence des fondatrices peut être invoqué pour
expliquer cette dispersion géographique. Au XVe siècle, les filles de sultan étaient amenées à
quitter la capitale, ou du moins le palais impérial, pour suivre leur époux : hors des frontières
ottomanes du moment, lorsqu’il s’agit d’un prince anatolien, ou dans une des villes de
province de l’Empire, lorsqu’il s’agit d’un dignitaire ottoman. Les constructions de Nefise
Melek Hatun, fille de Murad I, sont un exemple flagrant : mariée au bey du Karaman
Alaeddin, elle entreprit la construction d’un vaste complexe, encore partiellement visible,
dans la capitale de la principauté, Larende105
. Sur ce point, le patronage des filles de sultan du
XVe siècle s’apparente très fortement à celui des femmes royales de la même période. À
regarder les réalisations entreprises par les concubines ou reines mères des sultans de ce
siècle, on constate les deux mêmes particularités (œuvres de faibles dimensions / faibles coûts
et une certaine dispersion géographique).
Les descendantes indirectes ne suivent cependant pas tout à fait les mêmes
dynamiques que leurs aïeules en matière de choix du lieu de localisation de leurs
constructions : la prédominance d’Istanbul y est flagrante. Le décalage générationnel fait que
ces fondatrices appartiennent déjà à l’ère d’embellissement d’Istanbul. Néanmoins, les cas
hors d’Istanbul rappellent la préférence pour Edirne et Bursa susmentionnée. La présence de
Bursa est surprenante, car les fondations royales commençaient à s’y raréfier du fait de
préférences pour Edirne d’abord, Istanbul ensuite. Bursa apparaît alors comme une
104
On remarquera que les deux bâtiments honorent une seule et même famille, issue du cheikh Buhari, connu sous le nom d’Emir Sultan, époux de la fille de Bayezid Ier, Hundi Hatun, qui lui a fait construire la mosquée dite Emir Sultan, à Bursa. 105
Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 52-58.
Page | 403
localisation ancienne et démodée. Les quelques cas de fondations dans cette ville par des
descendantes indirectes de sultan se présentent donc à contre-courant des pratiques en cours,
révélant que la première capitale ottomane n’avait pas encore perdu tout son prestige et son
attraction auprès des grands fondateurs ottomans. Elle gardait beaucoup de son prestige du
fait de servir de nécropole impériale (des premiers sultans).
En dehors de la construction de bâti, les princesses ottomanes du XVe siècle
s’investirent encore dans d’autres formes de patronage. Mais quelle qu’en soit la forme, à une
exception près sur laquelle nous allons revenir, l’intérêt de ces femmes n’est que très limité.
Les fondations sans construction semblent avoir retenu l’attention des filles de sultan comme
des descendantes indirectes. Néanmoins, si l’on tient compte de la différence du nombre de
fondatrices, il faut alors convenir du fait que les descendantes indirectes montrèrent un intérêt
plus poussé envers cette forme de patronage que les filles de sultan. Au contraire, les œuvres
charitables ne semblent pas avoir intéressé les princesses : filles et petites-filles de sultan sont
quasi inexistantes dans ce domaine d’activité. Nous ne reviendrons pas sur la question du
rapport entre nombre de fondatrices par catégorie de princesses et l’impact sur la lecture du
graphique : nous considérons ce point désormais comme acquis. Il n’en demeure pas moins
que les actions charitables ne sont pas le domaine de prédilection des princesses du XVe
siècle, toutes catégories confondues. Les stipulations obligatoires semblent avoir suffi à les
satisfaire.
C’est au niveau des deux autres types d’action qu’une réelle différence de
comportement se repère entre filles de sultan et princesses indirectes. Ces dernières montrent
une forte préoccupation envers le financement de récitations de prières et de rentes, qui ne
trouve pas le même écho chez les filles de sultan106
. Une telle différence de comportement
mérite quelques explications. On peut penser que les sultanes, plus investies dans les
fondations de bâti, ne jugèrent pas nécessaire de financer en sus des récitations de prières,
dans la mesure où les structures construites le prévoyaient déjà. Moins investies dans la
réalisation de bâti, les princesses indirectes pourraient bien y avoir vu un moyen de
compensation. Par ailleurs, l’existence de structures bâties offrait aux sultanes de nombreuses
opportunités pour doter les membres de leur entourage, sans avoir recours aux rentes.
L’intérêt accru des descendantes indirectes pour l’attribution de rentes paraît procéder d’une
inquiétude particulière en faveur de leur entourage et de leur descendance, que les seuls
offices instaurés par la fondation ne suffisaient pas à couvrir.
106
Néanmoins, la majorité des informations relatives aux vakf des princesses du XVe siècle dérivant de sources
indirectes, non de leurs vakfiyye (disparues), il est possible qu’elles aient été plus actives en ce domaine, sans que nous ayons la capacité de le savoir : les récits littéraires d’Ayvansarayî ou Evliya Çelebi, ou documents économiques étudiés par Balta et Tayyıp ne livrent pas ce type de renseignements.
Page | 404
2) L’effacement des descendantes indirectes, l’éclat architectural
des sultanes : le XVIe siècle
Le XVIe siècle constitue la grande période du patronage des filles de sultan, avec
l’existence d’œuvres nombreuses, de grande taille et d’un raffinement recherché. Outre un
patronage qui se concentre presque exclusivement (ou pour le moins de façon la plus
brillante) à Istanbul, les fondatrices ne se contentent plus de constructions solitaires : elles
entreprennent désormais de vastes complexes, qui deviennent le lieu de convergence et de
développement de l’espace environnant.
Les premiers complexes, réalisés par les filles de Selim Ier, conservent encore une
forme de modestie héritée du XVe siècle – et probablement expliquée par des revenus toujours
limités. La pratique est révolutionnée par l’œuvre de la fille unique de Süleyman Ier,
Mihrimah Sultane. Son nom et son action méritent d’être cités de façon séparée, dans la
mesure où elle inaugure une nouvelle dynamique de bienfaisance des filles de sultans. En
effet, elle fit construire un premier vaste complexe à Üsküdar, au niveau de l’embarcadère,
qui par ses dimensions, l’importance de ses installations et la richesse du décor, montre de
façon éclatante la volonté d’une action publique imposante, du niveau des œuvres des
principaux hommes d’État, vizirs, grands vizirs et sultans eux-mêmes. Elle continua avec la
réalisation d’un second complexe, à Edirnekapı, moins développé que le premier, mais plus
imposant par ses dimensions, sa visibilité et la beauté de ses décorations107
. Au moment où
Mihrimah Sultane entreprit la réalisation de ces deux complexes, aucune femme royale
ottomane n’avait encore fait construire des œuvres aussi importantes et majestueuses. Ni le
complexe d’Hafsa Sultane, mère de Süleyman Ier, à Manisa (construit dans les années
1530)108
, ni les réalisations de la favorite-épouse de ce sultan, Hürrem Sultane, à Istanbul
(1538/39 - 1540 et 1550/51) et Jérusalem (1550-57)109
, ne peuvent être comparées à celles de
Mihrimah Sultane, en raison soit de leur localisation hors de la capitale, soit de leur taille
limitée.
Mihrimah Sultane a donc insufflé une dynamique nouvelle au patronage traditionnel
des princesses ottomanes, rendue possible grâce à une augmentation considérable de leurs
revenus. Sitôt le mouvement lancé, il fut suivi, dans des proportions légèrement plus modestes
par les filles de Selim II. Ismihan Sultan fit construire une medrese à Eyüp et participa au
complexe de Kadirgalimanı, à Istanbul ; elle est encore à l’origine d’une mosquée en
province110
. Gevherhan Sultane fit construire une medrese à proximité du quartier dit
Avratpazarı (« le marché aux femmes »), où se trouvaient également quelques fondations de
son mari, ainsi qu’une fontaine, à proximité de son palais. En outre, elle est encore à l’origine
107
Les historiens de l’art s’accordent pour dire que la structure novatrice de sa mosquée fut réutilisée par son architecte, toujours Mimar Sinan, lors de la construction de sa grande œuvre à Edirne, la Selimiyye. 108
Peirce, The Imperial Harem : 199-200 ; Konyalı, « Kanunî Sultan Süleyman’ın Annesi Hafsa Sultanın Vakfiyesi ». 109
Peirce, The Imperial Harem : 200-205 et Necipoğlu, The Age of Sinan : 268-280. 110
Voir sa fiche récapitulative, Annexes D.11.
Page | 405
de nombreuses fondations hors d’Istanbul, dans le village de Fethü’l-islam111
. Şah Sultane,
dernière des trois filles de Nurbanu Sultane, fit construire, en commun avec son mari, le
complexe à Eyüp, connu maintenant sous le nom de Zal Mahmud Pacha112
. Quant à Fatma
Sultane, probablement née d’une autre concubine113
, elle est également à l’origine de
fondations dans Istanbul : une mosquée, une medrese, un mekteb, un imaret, un caravansérail
et plusieurs fontaines114
.
Au XVIe siècle, le nombre de récitations de prière et de rentes établies augmente de
façon remarquable quand, au contraire, l’intérêt pour les actions charitables reste en retrait. La
création d’espaces religieux favorise la réalisation de prières sur-place par le personnel
attenant, dont une partie répond à des demandes spécifiques, inscrites dans les actes de
fondation. Quant aux rentes, importantes en quantité, elles demeurent inférieures au nombre
des constructions et des récitations entreprises par les fondatrices. Reste la charité : les grands
revenus accordés aux princesses ont permis ou encouragé un accroissement considérable de
leurs actions charitables. Non seulement ces actions sont plus nombreuses pendant ce siècle
qu’à tous les autres, mais en plus elles sont plus importantes. La construction d’imaret,
structures particulièrement coûteuses et, de ce fait, assez rares – partant, plus prestigieuses –
est spécifique à ce siècle. Avec ces fondations, elles acquièrent le prestige de femmes
charitables entre toutes, magnifique démonstration de la richesse et du prestige associés à leur
statut. En d’autres termes, la première préoccupation des filles de sultan au XVIe siècle est
d’établir de vastes complexes socioreligieux, qui comprennent logiquement des récitations de
prières et, à un moindre degré, mais de façon proportionnelle à l’importance des revenus
dotés, permettent d’assurer des ressources financières aux membres de leur entourage. La
préoccupation familiale est donc loin de prendre le pas sur les œuvres publiques : au contraire,
c’est l’augmentation de leurs revenus et la création de vastes vakf au bénéfice de la
communauté qui les autorise à établir un plus grand nombre de rentes.
Il est difficile de proposer de réelles conclusions concernant le patronage des
descendantes indirectes de cette période, dans la mesure où l’activité ne concerne qu’une
seule fondatrice : la fille de Mihrimah Sultane, Ayşe Sultane, très riche héritière ayant pour
modèle parental un véritable couple de constructeurs. Si le XVIe siècle voit les sultanes
entreprendre de grandes réalisations, il tend à exclure de cette dynamique leurs descendantes.
L’exemple connu montre une préférence pour les entreprises privées, intimes : construction en
faveur d’un client proche de la famille (le cheikh Hüdayî), récitations de prières, constitution
de rentes familiales. Ainsi, si le XVe siècle tendait à mettre les princesses sur un pied
d’égalité, quel que soit leur degré de parenté avec les sultans, l’accroissement des revenus des
filles de sultan ne semble pas avoir bénéficié à leurs propres filles.
111
Voir sa fiche récapitulative, Annexes D.11 112
Voir sa fiche récapitulative, Annexes D.12. 113
Sur cette question, Peirce, The Imperial Harem : 92 et 311 n° 52. 114
Voir sa fiche récapitulative, Annexes D.13.
Page | 406
3) Le recul des activités philanthropiques des princesses au XVIIe
siècle
Le XVIIe siècle montre un essoufflement de la dynamique créatrice du siècle
précédent. Un nombre de fondatrices très restreint, des constructions presque inexistantes et
très modestes, un intérêt renouvelé pour les œuvres à faible coût : le XVIIe siècle est celui des
fondations de fontaines ou de mekteb disséminées dans le tissu serré des quartiers d’Istanbul,
de récitations de prières pour des maris défunts ou pour l’âme des fondatrices elles-mêmes,
etc. S’il n’y avait la domination exclusive d’Istanbul, on se croirait revenu aux pratiques du
XVe siècle, à un niveau encore plus restreint ! Il est vrai que le mouvement de décroissance
architecturale ne touche pas que les princesses, mais l’ensemble de l’élite ottomane de la
capitale, jusqu’aux sultans eux-mêmes (Ahmed Ier fut le seul souverain à entreprendre une
vaste fondation). Ce siècle renoue ainsi avec les entreprises socioreligieuses sans construction.
Dans une ville au tissu urbain très dense et à une époque de tensions politiques et
économiques, les sultanes se tournent vers des œuvres qui offrent un service socioreligieux
sans requérir l’investissement dans une construction dispendieuse : le soutien à des
institutions existantes en difficulté fut l’une des formes privilégiées. De même, les
financements de récitations de prières sont en augmentation. Ces préférences se retrouvent
également chez la seule descendante indirecte à avoir fondé un vakf durant cette période (dont
nous ayons trace).
Les documents traités révèlent encore une disparition totale des attributions de rentes,
compensée par des prescriptions en faveur des transmissions de patrimoine (notamment les
palais et autres résidences), qui prennent une place croissante dans les fondations du XVIIe
siècle. Les rentes sont inexistantes à la fois dans les fondations des sultanes, mais aussi des
descendantes indirectes : il semble qu’il existe une corrélation assez forte entre le fait
d’entreprendre des œuvres hayrî, même de taille modeste, et la constitution de rentes en
faveur des membres de la famille de la fondatrice. Quant à la charité, qui au XVIe siècle
connaît un pic d’activité chez les sultanes, elle perd toute attractivité auprès des princesses
(toute catégorie confondue) au siècle suivant et retombe à un niveau similaire à celui du XVe
siècle. La corrélation entre fondation hayrî et dispositions de nature charitable semble aussi
vraie qu’avec les rentes.
4) Une stabilité dans la médiocrité architecturale : le XVIIIe siècle
Le XVIIIe siècle ramène avec lui un nouveau dynamisme dans les activités
bienfaisantes des princesses. La participation des sultanes est forte, mais elle suit les pratiques
instaurées au siècle précédent : les œuvres sont majoritairement de faible coût et d’un
rayonnement limité. Les récitations de prières sont nombreuses, mais pas nécessairement
Page | 407
nominatives : les parents, les époux et la fondatrice en sont souvent les bénéficiaires, mais très
peu les enfants ; on trouve, en revanche, une forte proportion de récitations en faveur du
Prophète ou d’ordre général, sans mentions ni destinataires particuliers. Les œuvres
charitables sont nombreuses, mais elles représentent en réalité des sommes modestes,
principalement destinées aux pauvres des Villes Saintes. Les rentes ou transmissions
d’héritage, en revanche, constituent une part non négligeable des actions stipulées par les
fondatrices.
La grande particularité de ce siècle réside dans son intérêt flagrant pour toutes les
œuvres sans construction. Trois domaines furent privilégiés : le soutien financier à des
institutions ou espaces religieux déjà existants, le financement de conseils et de cours
religieux dans ces mêmes lieux. La réhabilitation ou réutilisation des espaces bâtis, qui prend
naissance au siècle précédent, est l’un des traits caractéristiques du XVIIIe siècle. Il s’explique
par l’absence de revenus suffisants pour réaliser de grandes constructions, l’intensité du
réseau urbain au sein d’Istanbul, l’existence d’espaces religieux antérieurs favorables à une
réutilisation, enfin l’état de détérioration des vakf dans la capitale et, de façon plus générale,
dans tout l’Empire. Autant de raisons qui expliquent la typologie particulière des œuvres de
bienfaisance des filles de sultan au XVIIIe siècle. Citons enfin le patronage de Zahide Hanım
Sultane, petite-fille du sultan Mustafa II, née du mariage de Safiyye Sultane et de Mirza
Mehmed Pacha, unique fondatrice parmi les descendantes indirectes de cette période. Ses
actions sont multiples et couvrent des domaines divers : récitation de prières, financement de
cours et de conseils religieux, dons d’argent pour les pauvres des Villes saintes, attribution de
rentes et soutien financier à un établissement déjà existant115
; son patronage ne se distingue
en rien de l’action des sultanes à la même période116
.
Le patronage des filles de sultan présente de la sorte une évolution en dents de scie. La
typologie de leurs fondations va de pair avec les données politiques et financières de chaque
époque. Ainsi le XVe siècle, qui accorde aux princesses un statut relativement important, mais
des revenus limités, les amène à entreprendre des actions visibles, mais de petites tailles et
dispersées sur l’ensemble du territoire. L’accroissement de leur statut et de leurs revenus au
XVIe siècle permet aux sultanes d’atteindre l’âge d’or de leur action architecturale, avec la
construction de vastes complexes monumentaux, concentrés dans la capitale, Istanbul. Les
difficultés économiques et politiques du XVIIe siècle entraînent une baisse très forte des
activités de bienfaisance des princesses et une nouvelle forme de patronage se met en place,
qui perdure au XVIIIe siècle, malgré une reprise des activités : les constructions nouvelles se
raréfient, favorisant des œuvres dans des lieux déjà bâtis, des réalisations de petite taille,
comme les fontaines, et une action dans l’ensemble plus discrète. Leurs descendantes furent
plus touchées par les évolutions. Le XVe siècle fait figure d’exception avec une activité assez
importante sur la scène architecturale. Par la suite, plutôt que d’entreprendre des fondations
pieuses de leur propre chef, il semblerait qu’elles aient préféré se limiter à un rôle de
gestionnaire des vakf de leurs parents (quand il leur revenait et non à leurs frères), à quelques
115
Voir sa fiche récapitulative, Annexes D.19. 116
Son patronage s’apparente d’ailleurs très fortement à celui de la fille de Kaya Ismihan Sultane et Melek Ahmed Pacha, Fatima Hanım Sultane, dont il a été question plus haut.
Page | 408
rares exceptions près. Au XVIIe-XVIII
e siècle, leurs vakf sont intimement liés à ceux de leurs
mères : ils donnent l’image d’annexes à des fondations déjà existantes, plutôt que de créations
nouvelles117
.
3. Des bourses de moins en moins renflouées
Pour fonder un legs pieux, il faut de l’argent ; la question économique est donc un
aspect indissociable de toute œuvre de bienfaisance. D’un point de vue historique, l’aspect
économique présente l’intérêt de nous renseigner sur le type et le montant de revenus
nécessaires à la constitution de vakf, mais aussi sur les capacités financières de leurs
fondateurs118
. Sur ce point, les vakfiyye constituent des sources exceptionnellement riches – la
partie concernant les revenus et les dépenses prévus pour la fondation est l’une des plus
détaillées. Présentement, les vakfiyye des princesses ottomanes ont été utilisées pour tenter
une approche typologique des biens détenus et transformés en vakf par ces fondatrices. La
localisation de ces biens mérite également notre attention, car elle révèle l’existence de flux
monétaires variables au cours du temps.
1) Capacités financières et domaines d’investissement des
princesses
Il existe un rapport évident entre la richesse d’un fondateur et le type de fondation
réalisée. De fait, la typologie des œuvres des princesses au cours du temps se calque sur
l’évolution de leurs propres moyens financiers. Nous allons ici tenter de dresser un aperçu des
biens dont les princesses dotaient leurs vakf et repérer leurs évolutions au cours de la période.
Pour cela, quatre catégories de biens ont été établies : les possessions domaniales consistant
en villages ou domaines agricoles ; les biens immobiliers, urbains, tels les boutiques, les
menzil ou, plus simplement, des logements de plus ou moins grande dimension (ev, oda,
hücre) ; les apports financiers, à savoir des versements en argent liquide ou en produits de
consommation (bijoux, vêtements, animaux, etc.) ; enfin une dernière catégorie, regroupant
117
Le cas de Fatma Hanım Sultane, fille de Kaya Ismihan Sultane (fille de Murad IV) et de Melek Ahmed Pacha, est particulièrement révélateur : sur les cinq vakfiyye rédigées à son nom, seules deux révèlent les nouveautés qu’elle apporta au vakf maternel et qui se limitent à l’ajout de nouveaux revenus permettant de financer des œuvres mineures, telles que la récitation de prières. Tout le reste, pourtant scrupuleusement noté, correspond à l’œuvre établie par sa mère, ainsi que les vakfiyye l’indiquent elles-mêmes
117.
118 Les renseignements fournis sur ce point sont cependant nécessairement partiels : l’ensemble de la richesse
d’un fondateur n’était pas transformé en vakf et il n’est pas possible, en l’état des connaissances, d’évaluer quelle fut la part des biens transformés en vakf. D’autre part, il faut également tenir compte du fait qu’il était courant, surtout dans le cas des princesses, que le sultan octroie un temlik affecté au financement d’un vakf hayrî. Ces revenus exceptionnels ne sont donc pas représentatifs de la richesse propre du fondateur.
Page | 409
tout ce qui ne rentrait pas dans les groupes précédents, dans laquelle les palais et autres
résidences des fondatrices et leurs jardins ont été inscrits119
.
Graphique 5.35. Les domaines d’investissements économiques des filles de sultan
119
Nous avons choisi de séparer ces types de revenus des autres en raison de leur finalité, plus familiale et privée que publique : les palais étaient transformés en vakf en vue de leur transmission aux descendants, tandis que les jardins représentent une forme complexe de revenus. Annexes aux palais, ils servaient tout à la fois de lieux de plaisance et d’espaces productifs (en fruits et légumes) destinés en priorité à être consommés sur place, le surplus étant vendu sur les marchés environnants. Leur utilisation est ainsi à la fois privée et publique ; leur localisation est urbaine, contrairement aux espaces agricoles appartenant à la première catégorie, situés en zones rurales.
0
100
200
300
400
500
600
700
15e siècle 16e siècle 17e siècle 18e siècle
divers
biens financiers
biens immobiliers
biens domaniaux
Page | 410
Graphique 5.36. Les domaines d’investissements économiques des descendantes indirectes
Le XVe siècle se caractérise par une diversité des biens détenus par les princesses : les
quatre catégories s’y trouvent représentées, avec une préférence pour les possessions
domaniales et immobilières, mais les sommes impliquées demeurent restreintes. La capacité
d’investissement est donc limitée, ce qui explique la multiplication de petites fondations
solitaires. On notera encore l’absence de différence notoire entre filles de sultan et
descendantes indirectes. Les revenus domaniaux notamment, qui ne peuvent être acquis que
par donation impériale, sont présents aussi bien chez les filles de sultan que chez leurs
descendantes. Il semble donc qu’au XVe siècle, la politique impériale soutenait l’activité
bienfaisante de l’ensemble des princesses, toutes (jusqu’à la deuxième génération au moins)
se voyant accorder des temlik (qu’elles transformaient ensuite en legs pieux)120
. La
consultation des travaux de Tayyıp Gökbilgin sur la région d’Edirne et d’Evangelia Balta pour
Serrès mettent en valeur ce phénomène121
. Il existe, cependant, un lien de causalité entre la
faible importance du nombre de biens domaniaux accordés à ces princesses et la multiplicité
des fondatrices : on verra de façon récurrente, au cours de ce chapitre, que le nombre de
princesses impliquées dans l’activité fondatrice est inversement proportionnel à l’importance
des dotations en temlik accordées par les sultans à chacune d’entre elles.
Le XVIe siècle présente une tout autre image. La redéfinition hiérarchique au sein de
la famille impériale, qui distingue progressivement le statut de chaque princesse en fonction
120
Ce phénomène reflète l’absence relative de distinction hiérarchique entre filles de sultan et descendantes indirectes au XV
e siècle, que nous avons déjà repéré à divers niveaux.
121 Gökbilgin, Edirne ve Paşalivâsı ; Balta, Les vakifs de Serrès.
0
20
40
60
80
100
120
140
15e siècle 16e siècle 17e siècle 18e siècle
divers
biens financiers
biens immobiliers
biens domaniaux
Page | 411
de son degré de parenté avec le sultan, semble avoir engendré une réévaluation de la
répartition des revenus accordés aux princesses, donnant la préférence aux filles de sultan.
Cette distinction se repère de façon très claire dans la typologie des biens détenus par chacune
d’entre elles : le financement des fondations pieuses par des revenus tirés des taxes prélevées
sur des villages détenus en biens de mainmorte est très majoritairement un phénomène qui
touche les sultanes, à l’exclusion de leurs descendantes, et représente des sommes
considérables. La vakfiyye de Fatma Sultane, fille de Selim II, précise ainsi le montant des
revenus perçus par sa fondation émanant de six villages dans le sancak de Yanya, qui s’élève
à 58 000 aspres par an !122
Or, Mihrimah Sultane dota ses vakf des revenus de 97 villages123
;
les filles de Selim II en firent de même, bien que dans des proportions plus restreintes124
. Les
dépenses de construction puis d’entretien quotidien de vastes complexes n’étaient possibles
que grâce à la détention de biens domaniaux. L’augmentation du nombre de domaines
accordés sous forme de mülk aux filles de sultan, au XVIe siècle, explique leur très forte
participation au développement architectural de la capitale. Privées de tels revenus, les
petites-filles de sultan furent exclues, de facto, de telles réalisations. Or, ces revenus sont
accordés par les sultans : la politique impériale favoriserait donc ouvertement l’activité
architecturale, à grande échelle, des membres directs de la dynastie, au détriment des
membres indirects, dont le statut inférieur se lisait, dès lors, dans la modestie de leurs
fondations pieuses.
Dans ce cadre, il convient de souligner la place exceptionnelle d’Ayşe Sultane, fille de
Mihrimah Sultane et de Rüstem Pacha, et d’Ibrahim Han, fils d’Ismihan Sultane et de Sokollu
Mehmed Pacha. Tous deux entreprirent des constructions publiques relativement importantes.
Ils constituent de la sorte des cas particuliers, dans le tableau du XVIe siècle que nous venons
de dresser, qui s’explique par le statut remarquable de leurs parents et leur richesse
respective : Ayşe Sultane et Ibrahim Han virent tous deux échoir entre leurs mains, par
héritage, la gestion d’immenses richesses qu’ils purent mettre à profit pour entreprendre, en
leur nom propre, des réalisations architecturales dont l’existence même était la marque de leur
position exceptionnelle. Ayşe Sultane percevait un revenu s’élevant à 500 aspres par jour (soit
pratiquement le montant des salaires accordés par les sultans à leurs filles à la même période),
pour la seule charge de tevliyet des vakf de sa mère et de son père – auquel venait s’ajouter les
150 aspres par jour d’émoluments attribués par le Palais impérial125
. Ibrahim Han fut
également un fondateur important, aux dires d’Ayvansarayî, qui lui attribue des œuvres en
Roumélie, en Anatolie, à La Mecque et à Eyüp – son patronage est cependant intimement lié à
celui de son père126
.
Le XVIIe et le XVIII
e siècle peuvent être étudiés ensemble, dans la mesure où ils
affichent une situation économique similaire qui consacre la baisse généralisée des revenus
122
VGMA D 732 n° 253 : 998 (1589). 123
Voir sa fiche récapitulative, Annexes D.9. 124
Et Necipoğlu de conclure, très logiquement, que la multiplication du nombre de princesses sous Selim II, comparée à la place de fille unique de Süleyman Ier, entraîna une baisse de leurs revenus. Cf. Necipoğlu, The Age of Sinan : 306. 125
VGMA D 635-2 n° 17 : 968 (1560). 126
Galitekin (éd.), Hadîkatü’l-Cevâmi’ : 432.
Page | 412
des princesses ottomanes : les revenus domaniaux, si présents au XVIe siècle et qui ont permis
aux filles de sultan d’entreprendre de vastes constructions, sont quasi absents au XVIIe siècle,
pour ne remonter que faiblement au siècle suivant. En revanche, les revenus immobiliers
connaissent une augmentation considérable, au point de prendre le pas sur tous les autres
types de ressources. Les vakf des princesses (sultanes et hanım sultanes) de cette période sont
financés essentiellement grâce aux gains acquis par la location de menzil et autres types
d’habitations, ou de boutiques. Ces conditions économiques expliquent, pour une large part, le
type de fondation des princesses ottomanes du XVIIe et XVIII
e siècles.
Cette situation souligne une mutation importante des revenus des princesses qui
deviennent progressivement urbains – au détriment des sources rurales de revenu. Plusieurs
explications peuvent être avancées pour interpréter ce phénomène : une régression du nombre
des domaines agricoles cessibles a pu amener les sultans à réduire le nombre de domaines
accordés en temlik aux princesses, alors même qu’une profonde critique secouait les
intellectuels ottomans contre l’octroi “abusif” de mülk aux femmes du harem et favoris des
sultans – et l’on peut se demander s’il ne faut pas y voir l’intériorisation du discours critique
de ces penseurs127
. De fait, l’accord du sultan était nécessaire pour transformer un domaine en
mülk et ne constituait pas une simple formalité. Parmi les documents publiés par Fodor, dans
son étude sur les tehlis des grands vizirs entre le mi-XVIe et le mi-XVII
e siècle, l’un d’eux
met en évidence les réticences du sultan (en l’occurrence, il s’agit de Murad III) face à ces
immobilisations de terres appartenant au domaine impérial : la priorité économique tendait
vers une limitation des mülk128
. Confrontées à cette baisse de leurs revenus transformables en
vakf, les sultanes auraient ainsi investi dans d’autres sources de production de richesse :
l’immobilier urbain.
2) Localisation des revenus et flux monétaires
Ce tableau économique ne saurait être complet sans aborder la question de la
localisation de ces revenus et des courants monétaires qui s’opèrent entre le lieu d’où ils sont
prélevés et celui où ils sont dépensés. L’exercice de localisation des revenus est loin d’être
aisé : bien que les vakfiyye soient relativement précises sur la question, il est très difficile pour
l’historien de placer ces données sur des cartes : les nombreuses transformations survenues
dans la toponymie et les modifications régulières du tracé des unités administratives rend le
travail presque impossible. À défaut de pouvoir faire un travail précis, nous nous sommes
limitée à un rapide travail schématique visant à mettre en valeur les régions dans lesquelles les
princesses possédaient des temlik. La carte ci-dessous montre ainsi les évolutions survenues
127
Ce sujet a fait l’objet d’une présentation personnelle lors du Congrès des Arts Turcs qui s’est tenu à Paris les 19-21 septembre 2012, intitulée « Building against the grain… The architectural patronage of Ottoman princesses confronted with the political critics of the 16
th-18
th century ». La publication des actes est en cours.
128 Pal Fodor, « A grand vizieral tehlis : a study in the Ottoman central administration 1566-1656 », Archivum
Ottomanicum 15 (1997) : 137-188.
Page | 413
au cours du temps dans la localisation des revenus dotés sous forme de villages-temlik par les
princesses.
Carte 5.37. Localisation des temlik transformés en vakf par les princesses ottomanes129
La vive préférence pour la province de Roumélie, où sont situés la grande majorité des
temlik, saute immédiatement aux yeux. La plupart des villages accordés sous forme de temlik
par les sultans à leurs filles et descendantes indirectes se situent dans cette province, toutes
époques confondues. On peut en déduire que les biens domaniaux qui étaient accordés aux
princesses – appelés plus tard başmaklık – étaient majoritairement localisés dans cette même
région, qui présente l’avantage non seulement d’être riche et ancienne, mais aussi d’être située
à proximité relative des capitales successives de l’État ottoman (Bursa, Edirne puis Istanbul) :
il s’agit d’une région fortement structurée et dont les axes de circulation étaient développés et
bien entretenus.
Revenons néanmoins sur une étude chronologique. La localisation des temlik des
princesses au XVe siècle offre une diversité propre à ce siècle. La province de Roumélie est
certes favorisée, néanmoins, la part des possessions situées en Anatolie est loin d’être
négligeable. La présence de Bursa n’y est pas étrangère – la région environnante représente le
berceau de l’État ottoman. On remarque ainsi que tous les villages dotés par les princesses du
129
D’après un fond de carte tiré de Donald E. Pitcher, Osmanlı İmparatorluğu Tarihsel Coğrafyası, Istanbul, Yapı Kredi Yayınları, 1999 : carte XXIV.
Page | 414
XVe siècle en Anatolie se situent dans le sancak de Hüdavendigâr (qui englobe Bursa et sa
région). La carte révèle encore la présence de temlik situés dans la province de Sivas,
appartenant à la petite-fille de Mehmed Ier, Seyyide Hatice Hatun, à proximité d’Amasya et
de Merzifon. Il est probable qu’elle ait acquis ces biens par héritage, soit de son mari, soit par
ses parents (son père était Ibrahim Bey Isfendiyaroğlu). Il faudrait encore mentionner le cas
de Nefise Melek Hatun, fille de Murad Ier, mariée au bey du Karaman, qui fit construire un
complexe à Konya, grâce à des revenus prélevés sur des possessions domaniales situées dans
cette même principauté – qui ne sera intégrée que plus tard au domaine ottoman. Leur
localisation est ainsi à mettre directement en relation avec son mariage avec ce prince, qui lui
fit quitter le domaine paternel pour s’installer à la cour karamanide. La diversité géographique
des possessions domaniales des princesses ottomanes au XVe siècle s’explique donc en partie
par des considérations politico-familiales : ce siècle se distingue, en effet, par la migration des
princesses ottomanes, suite à leur mariage.
Dès le XVIe siècle, le déplacement des princesses prend fin : elles résident désormais
de façon constante à Istanbul. La dispersion géographique de leurs revenus est alors limitée et
l’on constate une suprématie écrasante de la province de Roumélie, dont la carte qui suit
montre le détail. On remarque ainsi une certaine tendance au regroupement des villages-temlik
détenus par les princesses au cours de ce siècle : ils se situent le long d’une ligne incurvée, du
Nord au Sud, dans un périmètre proche d’Istanbul. Seules deux exceptions ont été
recensées au XVIe siècle : un village constitué en temlik situé en Anatolie, mais qui se trouve
en fait à proximité d’Üsküdar130
, et un ensemble de trois villages situés en Égypte. Ils
proviennent de l’héritage de la princesse fondatrice, Ayşe Sultane (fille de Murad III), suite au
décès de son époux, Ibrahim Pacha. La localisation de ces villages est donc à mettre sur le
compte du défunt mari. Hormis ce cas spécial, on repère un cloisonnement assez poussé des
revenus entre maris et femmes.
130
Il s’agit d’un village mülk détenu par Mihrimah Sultane. Voir sa fiche récapitulative, Annexes D.9.
Page | 415
Carte 5.38. Localisation des temlik transformés en vakf par les princesses ottomanes dans la province de
Roumélie131
La même constatation peut être dressée concernant les revenus immobiliers :
investissements personnels des princesses, ils se concentrent presque exclusivement dans les
capitales ottomanes – Bursa et Edirne pour la période du XVe siècle, Istanbul (dans sa
dimension d’agglomération, c’est-à-dire Eyüp et rive asiatique comprise) pour les siècles
131
D’après un fond de carte tiré de Pitcher, Osmanlı İmparatorluğu Tarihsel Coğrafyası : carte XXVI.
Page | 416
suivants132
. La seule exception est la fondation de la princesse Ayşe Sultane, qui avait déjà
hérité de plusieurs villages en Égypte de son mari : elle ajoute à sa fondation pieuse les
revenus d’un kahvehane et de 60 boutiques situés dans la ville de Hama, qui proviennent
également de sa part d’héritage, prélevée sur les possessions de son premier époux. Sa
vakfiyye est d’ailleurs explicite :
« et soixante boutiques ainsi qu’un café, avec l’ensemble de leurs annexes et
dépendances, sis dans la petite ville de Hama, et qui sont également connus pour
provenir et être en relation avec l’[héritage] du défunt susmentionné Ibrahim
Pacha, ont été fait [vakf]. »133.
Il convient maintenant d’établir une relation entre la localisation des revenus et celle
des fondations, afin de déterminer la direction des flux monétaires engendrés. Au XVe siècle,
ces flux se concentrent dans un espace relativement restreint : les fondations sont financées
sur des revenus prélevés dans la même région. Ainsi les diverses fondations érigées par Nefise
Melek Hatun (fille de Murad Ier) à Konya sont dotées de revenus localisés dans la province
du Karaman134
. De même, Selçuk Hatun, fille de Mehmed Ier, ordonne la réalisation de
plusieurs œuvres dans la ville de Bursa, qui sont financées par des revenus levés sur des biens
établis dans le kaza d’Hüdavendigâr, de façon générale, certains se trouvaient dans la ville en
question135
. On pourrait encore citer l’exemple d’Hundi Hatun, fille de Mehmed Ier, qui
entreprit des fondations en faveur de la ville d’Üsküp et d’Hayrebolu, dont les revenus
provenaient de leur arrière-pays respectifs. Ainsi, le XVe siècle est une période pendant
laquelle les flux monétaires sont relativement statiques : l’arrière-pays produit les revenus
utilisés pour des fondations sises sur-place. La fin du XVe siècle annonce le début d’une
mutation de ce système, avec des premiers transferts d’argent d’une région à une autre :
Selçuk Hatun, que nous venons de mentionner et dont les revenus étaient situés dans les
environs de Bursa, fit construire – tardivement semble-t-il – une mosquée à Edirne. Cet
exemple, qui date de la fin du XVe siècle, à une époque de relative stabilité, montre que les
flux monétaires sont devenus possibles. Les fondations des filles de Bayezid II montrent la
même tendance en faveur d’un transfert des revenus en direction des capitales : Edirne, puis
Istanbul.
Le XVIe
et le XVIIe siècle se distinguent par deux phénomènes. Tout d’abord, on
constate un fort flux d’argent en provenance de Roumélie (de façon presque exclusive, ainsi
que nous l’avons vu précédemment) vers la capitale, Istanbul. Le nombre total de villages
concernés (plus d’une centaine) montre que ce flux de la province vers la capitale est loin
132
Une localisation de ces acquisitions immobilières au sein d’Istanbul aurait été intéressante à mener : malheureusement, les changements notables et réguliers survenus dans la toponymie des quartiers n’ont pas permis un tel exercice – que nous avions envisagé, de prime abord. 133
« ve nefs-i kasaba-i Hama […] vaki’ olup kezalik merhum-i merkum İbrahim Paşa’ya intimayile leda külle karibin ve baid maruf ve meşhur olmağın mustağni ani’t-tahdit olan altmış bab mülk dükkânı ve bir kahvehaneyi cemi’i tevabi ve levahikı ile sair mal-ı helâllarından ifraz ve imtiyaz-ı temam ile mümtaz kılup ». VGMA Kasa 86, transcription disponible sous la côte D 2138 n° 22 : 1 Şaban 1011 (14 janvier 1603). Cette vakfiyye fait également référence aux villages-temlik hérités de son mari, ainsi que de 250 boutiques sises dans le marché de Bolu, dont l’acquisition est probablement à mettre sur le compte de son époux. 134
Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 52-58. Voir aussi Konyalı, « Bir hüccet iki vakfiyye ». 135
Voir sa fiche récapitulative, Annexes D.1.
Page | 417
d’être négligeable. Les princesses ottomanes ont contribué à créer un afflux d’argent, de la
province vers la capitale, de la périphérie vers le centre, à seule fin de son enrichissement et
de son embellissement.
Toutefois, quelques princesses entreprirent des vakf hors de la capitale136
. De même,
au XVIe siècle, un autre phénomène s’instaure, avant de prendre de l’ampleur au cours des
siècles suivants : un certain nombre de ces flux monétaires ne s’arrêtent pas dans la capitale et
continuent leur chemin : vers les fondations provinciales des princesses notamment. Or,
l’intégration des Villes Saintes à l’Empire au début du XVIe siècle a favorisé le
développement d’un type particulier de charité en faveur de La Mecque et Médine. Les
vakfiyye des princesses indiquent des sommes annuelles à distribuer aux pauvres de ces villes,
qui doivent être envoyées à l’occasion de la caravane du pèlerinage. Les sommes varient,
mais sont récurrentes ; elles font apparaître une nouvelle redistribution de l’argent des
provinces qui, après être récolté et dépensé dans sa majeure partie en faveur du
développement (architectural, économique et social) de la capitale, est renvoyé vers ces deux
villes d’Arabie, contribuant également à leur développement. Ce phénomène connaît un
certain accroissement au cours du XVIIIe siècle, les princesses montrant un intérêt de plus en
plus poussé envers ce type d’œuvres charitables.
Les flux monétaires liés à la réalisation d’un vakf favorisent le développement de
certaines villes, au détriment d’autres. En ce qui concerne les princesses, après une certaine
stagnation de l’argent sur-place, au XVe siècle, ces flux montrent un investissement
préférentiel en direction de la capitale. Ce phénomène est néanmoins compensé, dans une
certaine mesure, par une redistribution longue-distance en faveur des Villes Saintes d’Arabie,
Médine et surtout La Mecque ou, de façon plus épisodique, de quelques villages disséminés
ici et là. Le caractère statique de la vie des princesses à partir du XVIe siècle a contribué à
cloisonner et réduire leur monde : ne connaissant qu’Istanbul, elles ne pensent à construire
que dans cette ville et il faut l’influence d’un époux ou le poids de la religion pour que
certaines d’entre elles entreprennent des réalisations en dehors. Il en va de même de leurs
investissements : dès lors que les sultans cessent de les pourvoir en villages mülk et qu’il leur
revient de se constituer un patrimoine, leur horizon se limite aussitôt à Istanbul et son arrière-
pays direct.
*
136
Ismihan Sultane, fille de Selim II, fit construire une mosquée dans le village de Mangalia, sur le rivage de la mer Noire, dans un kaza (Tekfur Golü) où son mari, Sokollu Mehmed Pacha, possédait des terres ; Gevherhan Sultane, sa sœur, fit bâtir une mosquée et un hammam dans le village dit Fethü’l-islam (en Roumélie) ainsi qu’une autre mosquée dans celui dit Bostanböğü (en Anatolie) ; Ayşe Sultane, fille de Murad III, ordonna la construction d’un pont et apporta son soutien financier au complexe de son époux dans la ville de Tatarpazarı, en Roumélie ; Atike Sultane, fille d’Ahmed Ier, prit également des dispositions pour soutenir la fondation de son époux, Kenan Pacha.
Page | 418
Les Ottomans ont repris les institutions développées par les civilisations musulmanes
qui les précédèrent, dont le vakf. L’incroyable flexibilité de cette institution, les nombreux
avantages qu’elle offre, aussi bien aux fondateurs qu’aux bénéficiaires, lui ont valu la faveur
des membres de la société ottomane. De fait, l’établissement d’un vakf reconnaissait aux
fondateurs le droit de transformer en bien de mainmorte ses revenus, immortalisés au bénéfice
de Dieu, mais dont l’usufruit était laissé aux hommes, dans la mesure où la fondation
prévoyait un usage religieux et charitable. Ces facilités étaient compensées par l’existence
d’une pression culturelle et sociale : une personne bénéficiant d’un certain statut et d’une
certaine richesse se devait de faire acte de bienfaisance, en fondant un ou des vakf au bénéfice
de la communauté. Le fondateur acquérait, de son côté, prestige et reconnaissance sociale,
donnant ainsi à son personnage une aura de respectabilité. Les grands personnages de la
société ottomane, tout spécialement les agents de l’État, se distinguèrent, à plus ou moins
grande échelle, par l’exercice de la bienfaisance, sous la forme de créations de vakf. Un pacte
tacite semble avoir motivé leur intervention : lorsque le sultan accordait à un dignitaire ou un
membre de sa famille d’énormes revenus, via la détention de domaines, il était attendu, en
retour, qu’il participe à l’effort public en construisant des mosquées, écoles, ponts, marchés et
autres137
.
Les femmes ne furent pas en reste et les études menées à leur propos révèlent leur fort
intérêt pour ce système, qui leur permettait de s’affirmer publiquement, visuellement même
pour certaines, dans l’espace public. Les femmes royales ottomanes, en particulier, furent
d’importantes créatrices de fondations pieuses : mosquées ou mescid, écoles (medrese ou
mektep), couvents (tekke ou zaviyye), marchés, bains, cuisines populaires (imaret), fontaines
(çeşme ou sebil) ; elles participèrent au foisonnement architectural ottoman et tout
particulièrement au rayonnement des capitales, d’abord Bursa, puis Edirne, enfin Istanbul.
Toutefois, ce sont surtout les reines mères qui furent à l’origine des plus grandes fondations,
des complexes socioreligieux appelés communément külliye : leurs œuvres prirent une telle
importance qu’elles éclipsèrent et reléguèrent au second plan le patronage architectural des
princesses ottomanes. Seules quelques grandes princesses, principalement au XVIe siècle,
s’imposèrent comme de grandes patronnes d’architecture.
L’importance et la monumentalité des réalisations architecturales des femmes royales
du XVIe siècle ne furent pas sans conséquence : par leur caractère grandiose, elles attirèrent
sur elles le regard de leurs contemporains, qui louèrent leur esprit de bienfaisance, mais
critiquèrent très sévèrement les coûts impliqués. Avec le tarissement des conquêtes et l’arrêt
de l’expansion territoriale, ce patronage royal féminin fut très vivement contesté : il ne
convenait pas que des femmes s’illustrent au premier plan ; elles n’avaient pas à entreprendre
de coûteuses réalisations architecturales en utilisant l’argent du Trésor public – et on les
accusa vite de détourner cet argent à leur propre usage et au bénéfice de leurs familles. Les
reines mères, appelées à la même période à prendre la place de régente auprès de sultans
enfants ou déficients mentaux, furent relativement épargnées : leur activité architecturale et
bienfaisante se confondait avec celle de leur fils. Les princesses ottomanes ne pouvaient
137
Kunt, « The Waqf as an Instrument of Public Policy » : 189-198.
Page | 419
s’abriter derrière le rempart d’un exercice impérial : elles furent les plus exposées à ces
critiques.
Le patronage des princesses ottomanes prend donc, au cours du temps, des formes
variées allant des grandes réalisations architecturales aux simples récitations de prière. Les
conditions économiques et politiques influencent considérablement le type de patronage
qu’elles purent entreprendre, le statut auquel leurs fondations pouvaient prétendre. Toutefois,
leur capacité d’adaptation et la pérennité de leur action bienfaisante méritent d’être
soulignées. Elles ne sont pas les seules à souffrir d’un affaiblissement de l’activité
philanthropique à partir du XVIIe siècle. La baisse est même encore plus flagrante au niveau
impérial, avec la disparition complète des princes de la scène architecturale et le désintérêt
assez général des sultans dans ce domaine – qui n’est compensé que par l’action de leurs
mères, véritables substituts des souverains jusque dans l’architecture. Dans ces conditions, les
princesses ne sont pas les seules à opter pour la réalisation d’œuvres mineures.
Les difficultés économiques que connaissent les princesses font ainsi écho à la
situation générale de l’Empire. Elles paraissent plus évidentes parce que ces dernières étaient
beaucoup plus dépendantes que les agents de l’État, par exemple, des dotations impériales en
biens mülk. La persistance qu’elles affichèrent, malgré tout, à se distinguer dans le domaine
du patronage architectural et la fondation de vakf hayrî souligne une volonté de s’afficher
comme « bienfaitrice ». Là s’exprimait la qualité de leur statut, la noblesse de leurs origines,
la différence entre ces femmes d’ascendance royale et les autres femmes de l’élite, enfin, leur
proximité avec les agents de l’État. Quantitativement, les princesses ottomanes représentent
une part considérable des actions philanthropiques des femmes de l’élite : c’est la catégorie
sociale féminine la plus investie dans ce domaine. Toutes n’y participèrent cependant pas, ce
qui laisse entendre l’existence de stratégies, personnelles et familiales, spécifiques.
Page | 420
III. UN INSTRUMENT DE PRODUCTION MÉMORIELLE
Dans l’étymologie du mot vakf est contenue l’idée d’une valeur éternelle : le bien
transformé en legs pieux est offert à Dieu de façon irrévocable. Que des adaptations aient pu
être apportées à l’institution ne change pas son caractère pérenne ; la permanence d’une
fondation est assurée par les générations des descendants ou d’affranchis en charge de la
gestion et de l’entretient du vakf puis, après eux, par la stabilité de l’organe étatique qui prend
le relai. Sous cet angle, étudier l’institution du vakf revient à s’interroger sur le champ de la
transmission intergénérationnelle. La place accordée à ces considérations dans les actes de
fondation souligne d’ailleurs l’importance de cette transmission. Mais qu’entend-on par
transmission : qu’est-ce qui est transmis, à qui et pourquoi ?
Nous avons vu l’intérêt particulier des princesses ottomanes à l’égard de la création de
bâti, qui les distingue profondément des autres femmes de l’élite et les rapproche de l’activité
philanthropique impériale et de l’élite masculine. Or, le bâti est porteur de nom : il proclame
de façon durable le nom de son fondateur, par le relai de la mémoire collective autant que par
des attestations “gravées dans le marbre”. Les princesses bâtisseuses chercheraient-elles à
transmettre le souvenir de leur nom aux générations futures ? Le vakf était-il pour elles un
moyen d’y parvenir ? Et dans ce cas, ce moyen se révéla-t-il efficace ? Le bâti, parce qu’il est
une forme de legs pieux réservée à une petite élite privilégiée et puissante dont il favorise la
transmission du nom, associe nécessairement le fondateur à son statut. Ce n’est donc pas
seulement un nom que les princesses chercheraient à transmettre, mais également le souvenir
du statut allant avec. Or, ce statut est tout à la fois personnel, dynastique et familial : elles le
détiennent de façon individuelle, mais il dérive de leur lien avec la dynastie ; enfin, même s’il
ne peut s’hériter, il se transmet néanmoins, sous une forme appauvrie, aux générations
suivantes.
Plus généralement, le vakf permet également de transmettre des offices et des richesses
aux héritiers désignés, ainsi que nous l’avons vu dans le précédent chapitre138
. Plus le legs
pieux est conséquent, plus les offices sont nombreux et les richesses dérivées importantes. Or,
richesse et détention d’offices (rémunérés) sont des gages d’un statut social de la famille qui
favorise son insertion ou son maintien dans les rangs de l’élite. La création d’un vakf de
grande taille, pris comme marqueur social, est donc fortement associée à l’idée
d’appartenance et de reproduction de l’élite. Le vakf devient alors l’objet d’un discours d’une
famille sur elle-même. Il permet encore d’associer un individu et, plus généralement, la
famille d’un individu, à un ou des lieux : ainsi les mosquées servent souvent de lieu
d’inhumation familiale139
; les palais sont transformés en vakf et transmis aux descendants de
génération en génération. Le vakf favorise de la sorte l’émergence de lieux d’ancrage de la
famille, qui deviennent des espaces de la mémoire familiale.
138
Chapitre 4.II.1.1. 139
Bouquet, « Le vieil homme et les tombes » ; Vatin et Yerasimos, Les cimetières dans la ville : 73-79.
Page | 421
Toutes les pistes de réflexion pointent vers une même direction, vers une même
interrogation : la place de la mémoire familiale dans le vakf. Les fondations pieuses sont, à
notre avis, des instruments au service de la production et de l’entretien durable d’une mémoire
lignagère associée à un statut social, lui-même associé à un individu fondateur – dans le
double sens de créateur des lieux de mémoire familiale par le vakf, et de fondateur de la
famille. Reste à savoir dans quelle mesure les vakf des princesses contribuaient à la création
d’une mémoire familiale – et avec quel succès ?
1. « À qui profite le crime ? » ou les enjeux de la philanthropie
Tout legs pieux n’avait pas matière à être doté d’une valeur mémorielle ; ou, pour le
moins, toute forme de vakf ne permettait pas le même degré de commémoration de son
fondateur. Les grands personnages entreprenaient la réalisation d’œuvres monumentales,
inscrites dans le paysage architectural (urbain ou rural). Par leur importance et eu égard aux
services qu’ils rendent à la société, ces réalisations favorisaient la commémoration de leur
fondateur par l’association de son nom à celui de l’ouvrage. Autre marque de ce souci
commémoratif : les ouvrages descriptifs recensant ces bâtiments, tels les récits d’Evliya
Çelebi ou d’Ayvansarayî140
. Pourtant, ces vakf hayrî sont loin d’être les plus nombreux : la
plupart des legs pieux consistent en la dotation d’une maison aux descendants du fondateur
(ou à d’autres membres de sa famille). Dans ces types de vakf, le souci n’est pas plus
« d’utilité publique » que d’ordre commémoratif. Si commémoration il y a, elle n’excède pas
la très petite sphère familiale – et encore sommes-nous bien incapable d’affirmer qu’elle
existait bien. Tout vakf n’était donc pas digne de servir de support à une célébration
individuelle et familiale publique ; tous n’en avaient pas la prétention. Dans ce contexte, une
précision est nécessaire quant à l’objet du travail qui va suivre. Dans le cadre de ce chapitre,
nous ne discuterons que des œuvres de nature publique, sujettes à une commémoration
officielle. Toutefois, la majorité des princesses fondatrices qui se distinguent par leur activité
philanthropique, à quelques rares exceptions près, établirent des vakf mixtes, c’est-à-dire à la
fois hayrî et ehli, à la fois d’utilité publique et de portée familiale. La valeur commémorative
des vakf des princesses ne portait dès lors que sur une partie de leurs fondations : le bâti
d’utilité publique.
140
Evliya, Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi ; Galitekin (éd.), Hadîkatü’l-Cevâmi’ et Crane (éd.), The Garden of the Mosques pour la traduction anglaise.
Page | 422
1. Une commémoration individuelle disputée
De la fontaine de quartier à la mosquée, du plus petit ouvrage au plus majestueux, que
son utilité concerne un très petit nombre d’individus ou le plus grand, un vakf se fait toujours
le relai d’une célébration individuelle. De fait, il s’agit d’un acte religieux, pieux, dont on
attend un retour lors du jour du jugement ; pour s’assurer la meilleure “rentabilité religieuse”,
des prières de remerciement sont sollicitées auprès des utilisateurs de l’œuvre pieuse ; et pour
éviter tout risque de confusion dans les prières, le fondateur a généralement soin de faire
inscrire son nom dans un endroit bien visible. Par-delà l’aspect religieux lié à une inquiétude
post mortem, ces précautions soulignent l’importance mémorielle de ces réalisations offertes à
l’usage de la communauté : une célébration du fondateur est attendue en retour de son action
philanthropique. Cette commémoration n’est donc pas seulement tournée vers l’au-delà, mais
aussi vers la société dans laquelle l’évergète gravite : il s’agit d’inscrire son nom dans la
postérité.
Cependant, pour qu’il y ait commémoration nominative, il faut qu’il y ait transmission
du nom, c’est-à-dire qu’il existe une adéquation entre la connaissance collective d’un vakf et
le nom de son fondateur. Or, les deux mosquées de Mihrimah Sultane sont généralement
appelées İskele Camii (la mosquée de l’embarcadère) et Edirnekapı Camii (la mosquée de la
Porte d’Edirne) ; le complexe fondé conjointement par Şah Sultane (fille de Selim II) et Zal
Mahmud Pacha est connu sous le nom de Zal Mahmud Pacha külliyesi et la mosquée, Zal
Mahmud Pacha Cami’. L’adéquation ne semble pas être au rendez-vous, ce qui, dans une
certaine mesure, est un phénomène relativement atypique. S’il arrive que des mosquées ou des
bâtiments d’utilité publique prennent le nom du lieu plutôt que celui du fondateur, il est rare
qu’il tombe totalement dans l’oubli (d’autant plus quand la fondation prend des proportions
aussi importantes que les exemples suscités ou ceux qui vont suivre) : la mémoire collective
en transmet généralement la connaissance. La disparition du nom de ces fondatrices
relèverait-elle d’une volonté de négation de leur présence publique et ne conduit-elle pas à
réduire à néant toute volonté d’auto-commémoration ?
Comment est-il possible d’effacer de sa propre œuvre le nom d’une fondatrice d’aussi
haut rang qu’une princesse ottomane ? Et au profit de qui se faisait cet effacement ? Deux cas
de figure se dessinent, qui permettent de comprendre les difficultés, pour une princesse,
d’affirmer et d’assurer son auto-commémoration de façon pérenne. Le premier cas de figure
apparaît à diverses occasions, lors de fondations communes avec l’époux. La présence de
doubles fondateurs compliquait probablement la grille de lecture des contemporains. De fait,
ce type de fondation “d’utilité publique” ont un point commun entre toutes : si elles peuvent
avoir plusieurs appellations, celles-ci ne font jamais référence à plusieurs fondateurs. Une
identification spatiale peut être associée à une appellation nominale. Mais si deux fondateurs
sont à l’origine de l’œuvre, que ce soit de façon simultanée ou distincte dans le temps (une
rénovation), seul un des deux sera retenu comme fondateur – l’autre tombant dans un oubli
partiel, voire total.
Page | 423
Le cas le plus probant est celui du complexe de Şah Sultane et Zal Mahmud Pacha à
Eyüp, largement étudié par Necipoğlu141
. Elle reprend ainsi l’historique de leur fondation
commune : une mosquée, deux medrese (une pour chaque fondateur), un mausolée (où ils
furent tous deux inhumés) et des structures commerciales. Ce complexe fut entièrement
réalisé de façon posthume, les deux fondateurs étant décédés à quelques semaines
d’intervalle, en 1577, avant le début des travaux : la réalisation se fit sous la supervision de
leur kethüda et sous la surveillance de Nurbanu Valide Sultane (mère de la princesse, elle-
même grande patronne d’architecture) et du grand-vizir, Sokollu Mehmed Pacha (autre grand
fondateur). La construction fut longue, plus que de coutume, car des événements politiques
vinrent compliquer la tâche des responsables142
. Le superviseur des travaux fut contraint
d’apporter des changements : mise en commun des revenus des deux fondateurs et
compilation d’une vakfiyye commune, résumant les deux actes de fondations143
. Celle-ci nous
permet, de façon assez exceptionnelle, de connaître le montant investi par chacun : la
princesse en était l’investisseur principal – 3 018 008 aspres à son actif, contre 2 857 655
aspres par son époux144
.
La prépondérance de la princesse ne se limite pas à la seule donnée financière : elle se
remarque aussi dans les structures. La construction des deux medrese (l’une au nom de la
princesse, l’autre de son époux) souligne la différence de statut entre le vizir et sa femme : les
dimensions respectives (plus importantes pour le bâtiment princier), les matériaux employés
(également plus riches), et jusque la localisation (la medrese du vizir se situe en contrebas de
celle de son épouse) en sont le reflet. En résumé, le complexe tout entier respire la présence
princière, quand celle de l’époux paraît plus diffuse. Et pourtant, le complexe est connu sous
le nom du mari145
. Autre cas similaire : le complexe de Kadirgalimanı, à Istanbul, réalisé en
commun par Ismihan Sultane (fille aînée de Selim II et Nurbanu Sultane) et son mari, le grand
vizir Sokollu Mehmed Pacha. Tous deux s’en réclament dans leurs vakfiyye respectives :
Ismihan Sultane se présente comme la fondatrice de la mosquée et de la medrese ; Sokollu
Mehmed Pacha, de l’ensemble du complexe. Mais la double identité du bâtiment fut oubliée
au seul profit de l’association avec le pacha . Ayvansarayî est le seul à ranger la medrese
parmi les réalisations de la princesse : les autres écrivains gratifient l’ensemble du complexe
141
Necipoğlu, The Age of Sinan : 368-376. 142
Hüseyin Ağa, premier kethüda chargé de la supervision des constructions, commença par entreprendre la construction du mausolée du couple. Puis, afin d’assurer des revenus conséquents pour financer la suite des travaux, il fit construire un caravansérail. À ces délais dans la réalisation du complexe, s’ajouta le fait qu’il fut envoyé en campagne militaire contre les Safavides : pour éviter que les travaux ne prennent un plus grand retard, il fut remplacé par un autre kethüda, Mustafa (Kehtüda) bin Aburrahman. Cf. Necipoğlu, The Age of Sinan : 369. 143
BAO, Evkaf 20/25, date de la fin du mois de Muharrem 1002 (octobre 1593). 144
La somme totale mise à la disposition du kethüda, Hüseyin Agha, était au départ de 5 875 663 aspres : 2 857 655 aspres provenant de l’héritage de Zal Mahmud Paşa (son tiers héritable), et 3 018 008 aspres provenant de la princesse, dans lesquels sont compris les parts de ses héritiers, ayant accepté de remettre leur héritage au profit de cette construction. L’investissement fournit par Şah Sultane comprend ainsi ses propres revenus, sa dot, et la part d’héritage acquise au décès de son mari. Elle dota ainsi la structure du revenu de 14 villages situés près de Plovdiv, que son père lui avait accordé en tant que temlik. Necipoğlu, The Age of Sinan : 359. 145
Galitekin (éd.), Hadîkatü’l-Cevâmi’ : 339-341. Evliya Çelebi lui donne également le nom du mari : Evliyâ, Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi : vol. 1 t. 1 p. 195. Voir également Necipoğlu, The Age of Sinan : 337 ; 376.
Page | 424
au grand vizir146
. La grande Mihrimah Sultane elle-même ne fut pas épargnée : la construction
de son premier complexe à Üsküdar fut attribuée tantôt à son époux, Rüstem Pacha, tantôt à
son père, Süleyman Ier (qui l’aurait fait construire au nom de sa fille)147
. Mentionnons encore
le cas, antérieur, du complexe fondé par Hundi Hatun, fille de Bayezid Ier, pour son époux, le
cheikh Bukari : le nom de la princesse, longtemps mis de côté, tomba dans l’oubli – jusqu’à
ce que des historiens le ramènent à la lumière, au début du XXe siècle. Dans la connaissance
populaire, ce complexe fut et demeure commémoré sous le nom de son mari, Emir Sultan148
.
D’aucuns ont voulu voir dans ce phénomène l’expression d’une volonté misogyne.
Sans nier la misogynie latente qui prévaut dans la société ottomane, il convient de replacer ces
éléments dans leur contexte. Il paraît plus juste de penser que les princesses souffrirent du fait
de ne pas être traditionnellement identifiées comme de grandes patronnes d’architecture,
contrairement à leurs pères ou maris. Pour un contemporain, l’action architecturale
d’envergure d’un pacha ou d’un sultan était d’une banalité contre laquelle les princesses
ottomanes ne pouvaient rivaliser, et il semble que ce soit la raison pour laquelle ces cas
particuliers – presque tous datés du XVIe siècle – furent plus volontiers attribués à leurs époux
ou pères. De fait, Şah Sultane était quasi inconnue de la scène politique et publique
ottomane149
. Ismihan Sultane était certes puissante, mais moins que son époux, un très grand
patron d’architecture par ailleurs : il s’était même distingué auparavant en offrant
généreusement de construire à ses frais un nouveau palais pour sa femme, lorsque celle-ci
avait exprimé son souhait de changer de résidence150
. Mihrimah Sultane elle-même,
lorsqu’elle entreprit sa première fondation à Üsküdar, était encore une inconnue sur la scène
architecturale, contrairement à son époux ou son père. D’ailleurs, le problème ne se présenta
pas lors de sa seconde fondation à Edirnekapı : son mari et son père étaient décédés avant la
fin de la construction, celle-ci ne pouvait être confondue avec celle d’un autre. Quant à Hundi
Hatun, il faut bien dire qu’aucune princesse du XVe siècle n’entreprit de constructions aussi
vastes à cette période151
.
146
Necipoğlu, The Age of Sinan : 331-345 ; Galitekin (éd.), Hadîkatü’l-Cevâmi’ : 258-260. 147
Necipoğlu, The Age of Sinan : 296-314. 148
Gabriel, Une capitale turque : 131-134, 172 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 69-74. 149
On ne sait presque rien d’elle, si ce n’est ses deux mariages et sa fondation. Cf. Uluçay, Padişahların kadınları ve kızları : 41 ; Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 200-201. 150
Il s’agit du palais de Kadirgalimanı, où le couple s’installa ; le quartier était donc marqué de l’empreinte du grand vizir, qui y tenait ses audiences publiques, avant même la construction du complexe. Cf. Artan, « The Kadırga Palace: An Architectural Reconstruction » et « The Kadırga Palace Shrouded by the Mists of Time ». 151
Du moins sur le territoire ottoman : dans la même période, une autre princesse ottomane s’affirma sur la scène architecturale, mais sur les territoires de son époux, Ali Karamanoğlu : Nefise Melek Hatun, fille de Murad I. Une bonne notice bibliographique de cette princesse est disponible chez Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları : 52-58. Sur sa fondation, voir İ Konyalı, « Bir hüccet iki vakfiyye ».
Page | 425
2. Affirmation publique de soi
La commémoration recherchée par la fondation d’un vakf hayrî ne se situait pas
uniquement à l’échelle du nom : elle se faisait également au niveau du rang du fondateur, qui
s’exprimait au travers de divers éléments architecturaux. Le prestige de la fondation allait de
pair avec le statut social de son commanditaire. Ces éléments étaient relativement connus, de
sorte qu’ils constituaient probablement une grille de lecture aisément reconnaissable par la
plupart des Ottomans. Outre les complexes, construire une mosquée ou une medrese
permettait d’être identifié parmi les grands bienfaiteurs, eu égard aux usages publics et
religieux ainsi qu’au coût de telles fondations, qui comptaient ainsi parmi les plus
prestigieuses. À un moindre niveau, très respectable, venaient les couvents, les mekteb, les
marchés fermés (caravansérails, hân, etc), ainsi que les mescid, avec des variations selon
l’époque et le lieu. Or, au vu des résultats présentés ci-dessus, il apparaît que toutes les
princesses n’eurent pas la prétention ou les moyens de doter leurs fondations des
caractéristiques permettant d’affirmer un haut rang social : c’est surtout au XVIe siècle que
certaines d’entre elles purent rivaliser avec les plus grands fondateurs et fondatrices
contemporains (pachas, sultans, reines mères). Chez les princesses, la fondation d’un vakf
n’est donc pas nécessairement motivée par une recherche de prestige personnel.
Concentrons-nous alors sur ces exemples de fondations prestigieuses entreprises par
les princesses. La localisation spatiale constituait un premier signe distinctif de la qualité du
fondateur. Certains emplacements étaient réservés à la dynastie : c’est ainsi que les collines de
la Corne d’Or sont surmontées de mosquées construites par des membres de la famille
impériale – les divers artistes occidentaux de passage dans l’Empire ont largement mis en
scène ce panorama, que l’on peut encore admirer de nos jours sur la ligne d’horizon
d’Istanbul152
. De manière générale, tout lieu en hauteur et bénéficiant d’une visibilité
particulière revenait de droit aux constructions impériales. C’est ainsi que Mihrimah Sultane
fit construire sa seconde mosquée sur une des hauteurs de la ville, au niveau de la porte
d’entrée de la route allant à Edirne : Edirnekapı153
. Les hauteurs de la ville ne sont pas les
seuls endroits prestigieux de la capitale : les portes d’entrée de la ville et les lieux de grande
fréquentation sont aussi très recherchés, pour leur visibilité154
. Ainsi la première mosquée de
Mihrimah Sultane se situe au niveau de l’entrée orientale de la capitale, près de l’embarcadère
152
Voir Necipoğlu, The Age of Sinan : 71-126. 153
Cette position est doublement exceptionnelle : non seulement la mosquée est située sur une hauteur de la ville, mais en plus au niveau de l’une des extrémités de la route impériale, la divan yolu. Ceci justifie peut-être que le sultan ait soutenu le projet de cette princesse, lors du conflit l’opposant à sa tante, Fatma Sultane, représentante de son défunt époux Kara Ahmed Paşa. Sur ce site prestigieux, il est aisé de penser que le souverain, consulté en dernier ressort, ait préféré y voir ériger une œuvre de sa fille, un membre direct de la dynastie, plutôt que d’honorer son grand vizir défunt – un esclave, qui plus est exécuté sur décision impériale – quand bien même fut-il représenté par sa sœur. Avec Mihrimah Sultane, c’était la dynastie tout entière qui se mettait en scène : le choix en faveur de Mihrimah Sultane servait les intérêts dynastiques. Sur ce conflit entre les deux princesses, cf. Necipoğlu, The Age of Sinan : 296-313. 154
Ainsi la reine mère Turhan Hatice Sultane fit réaliser son complexe au niveau de l’embarcadère d’Eminönü, place hautement fréquentée pour son port d’accès et sa zone commerciale alentour. Cf. Thys-Şenoçak, Ottoman Women Builders.
Page | 426
d’Üsküdar, lieu de passage hautement fréquenté, parce qu’il assurait une des liaisons
principales entre les deux rives. C’était à cet endroit, notamment, qu’était fêtée l’arrivée dans
la capitale de certains grands dignitaires rappelés de leurs gouvernements dans les provinces
orientales de l’Empire ; c’était encore à cet endroit qu’avait lieu le départ de la caravane
annuelle du pèlerinage155
. À moindre niveau, la proximité avec une fondation prestigieuse
plus ancienne pouvait aussi être une solution, pour des constructions de type bâtiment solitaire
ou complexe de petite taille. La nouvelle fondation pouvait ainsi s’appuyer sur le prestige et la
visibilité de celle déjà existante laquelle, en retour, bénéficiait de ce supplément
d’institutions qui favorisait le rayonnement de l’ensemble de la zone156
.
Passons sur des critères distinctifs tels que la taille et les dimensions des monuments,
qui sont évidemment un signe de prestige extérieur, mais qui ne permettaient pas
nécessairement de différencier la fondation d’une princesse de celle d’un pacha. D’autres
critères, d’ordre architectural, permettaient d’établir cette distinction, à commencer par les
inscriptions intérieures et extérieures des monuments. En écriture calligraphiée, ces
inscriptions assuraient l’identification de la fondatrice : nom – bien que celui-ci ne soit pas
toujours inscrit sur le fronton – titre et ascendance, parfois également la date, en
chronogramme. Ces inscriptions pouvaient être répétées à divers endroits, mais elles étaient
particulièrement visibles sur les frontons portaux. Mihrimah Sultane se présentait ainsi, sur
l’entrée de sa mosquée d’Üsküdar, comme « la fondatrice d’œuvres pieuses, la protectrice de
l’État, du monde et de la foi musulmane, la sultane – que Dieu le Tout-Puissant lui accorde
une abondance de générosité – fille du roi des rois d’Orient et d’Occident, le sultan des
sultans des territoires où le soleil se lève et se couche […], le sultan fils de sultan, Sultan
Süleyman Han »157
. Néanmoins, dans une société peu lettrée, il est douteux que la population
ait été capable de déchiffrer ces inscriptions, qui répondaient à un haut degré de calligraphie.
L’architecture du bâtiment permettait également de souligner le rang des fondatrices.
Dans le cas des mosquées, la taille du dôme et le nombre de minarets y contribuaient. Les
dimensions du dôme central contribuaient, en effet, à distinguer les fondateurs entre eux : plus
le diamètre était grand, plus le rang du fondateur était élevé – prouesse technique oblige !
155
Sur le sujet de la caravane annuelle de pèlerinage et des conflits politico-religieux qu’elle occasionna entre Mamelouks et Ottomans, cf. Gilles Veinstein, « Le serviteur des deux saints sanctuaires et ses mahmal. Des Mamelouks aux Ottomans », Turcica 41 (2009) : 229-246. 156
Nous avons déjà noté ce phénomène plus haut, aussi n’est-il pas nécessaire de rentrer dans les détails. Citons cependant, en guise de rappel, l’exemple du complexe d’Emir Sultan, à Bursa, qui attira le patronage des princesses et dignitaires ottomans : lui-même œuvre d’une princesse, Hundi Hatun, fille de Bayezid Ier et épouse du cheikh Bukari “Emir Sultan”, qui donna son nom au complexe, il reçut de nombreuses extensions alentours (hammam, écoles, etc.), réalisées par des princesses du XV
e siècle. Ce site bénéficiait alors d’un grand
prestige et d’une belle renommée, qui dépassait les limites de la ville, et même celle de l’État ottoman. Au XVIe
siècle, c’est le site d’Eyüp et la proximité de sa grande mosquée qui furent particulièrement prisés : medrese, türbe, et autres bâtiments y furent érigés par les princesses ottomanes (ainsi que de nombreux dignitaires de l’État). On y trouve, notamment, la medrese d’Ismihan Sultane, construite près du mausolée familial où ses six premiers enfants, décédés en bas âge, furent inhumés. Enfin, citons l’exemple de Fatma Sultane, qui fit ériger divers bâtiments sur le site de la Şehzade Camii : le site était prestigieux en lui-même, par sa qualité impériale (et de ce fait, il était situé sur une zone relativement élevée et visible), mais en plus l’époux de la princesse avait lui-même entrepris des constructions alentour, avant d’y être finalement inhumé. 157
Cite dans Peirce, The Imperial Harem : 201.
Page | 427
Mais le fondateur n’était pas libre de réclamer de son architecte n’importe quelle dimension
pour son dôme : celles-ci répondaient à une classification architecturale statutaire. Necipoğlu
a ainsi constaté que le dôme de la mosquée de Mihrimah Sultane à Üsküdar, construite à la
même période que la Şehzade Camii (dédiée à la mémoire de son frère, le prince Mehmed),
soulignait parfaitement son statut du moment : avec ses 11,4 mètres de large et 24,2 mètres de
haut, il était plus large que la majorité des dômes construits jusque-là, en tout cas plus que
ceux des vizirs ; toutefois, il demeurait légèrement moins large que celui de son frère qui, en
tant que prince, détenait un statut supérieur (19 m. x 37 m.)158
. Ces deux dômes n’excédaient
pourtant pas les dimensions de celui de la Süleymaniyye, œuvre de leur père et sultan,
Süleyman Ier. Or, lorsque quelques années plus tard, Mihrimah Sultane entreprit la
construction de sa seconde mosquée, à Edirnekapı, son statut avait évolué : elle était devenue
la principale figure féminine de la dynastie, la fille chérie du sultan déclinant et une actrice
politique de premier rang. Son dôme prit alors les dimensions en rapport avec son nouveau
statut : 20,25 m x 37 m, toujours inférieur à celui de la Süleymaniyye, mais très faiblement
plus large que celui de la mosquée de son frère159
.
Le nombre de minarets était lui aussi une marque de statut : la présence de plus d’un
minaret signifiait sans erreur possible qu’il s’agissait d’une mosquée impériale. Celles des
sultans et des reines mères en possédaient au moins deux, souvent quatre, parfois six. Reste à
savoir si les princesses, en tant que membres de la famille impériale, avaient droit à ce
privilège, ce qui revient à s’interroger sur la reconnaissance d’une capacité (ou non) à agir en
tant que représentantes de la famille régnante. Sur ce plan, les princesses ne surent pas
s’imposer… à une exception près : Mihrimah Sultane. Elle eut en effet le privilège
exceptionnel de doter sa mosquée d’Üsküdar de deux minarets. Jamais octroyé auparavant, ce
privilège souligne le statut et la puissance de la fille unique de Süleyman Ier et de sa favorite,
Hürrem Sultane, épouse du grand vizir, Rüstem Pacha. Mais il fut de courte durée : sa
deuxième mosquée, à Edirnekapı, ne possède qu’un seul minaret. Cette construction, dont on
pense qu’elle fut prévue avec deux minarets, fut certes engagée sous le règne de son père,
mais ne se termina que sous celui de son frère : outre la mésentente connue entre le frère et la
sœur, il faut probablement aussi y voir, à la suite de Necipoğlu, l’expression d’une volonté
politique consistant à lui refuser un privilège impérial160
.
Cette grille de lecture architecturale, dont nous avons défini les principaux points,
n’est pas sans rappeler la réflexion d’Elias sur la structure de l’habitat dans la société
française d’Ancien Régime : réglementée (implicitement ou directement, selon les aspects),
158
Necipoğlu, The Age of Sinan : 305 ; Yerasimos, Constantinople : 252-256. 159
Necipoğlu, The Age of Sinan : 313. 160
Pour être exhaustif, il faudrait encore mentionner l’architecte en charge des travaux (l’implication de l’architecte impérial était probablement plus prestigieuse qu’un autre) ainsi que la qualité du travail décoratif intérieur et extérieur : peintures, céramiques, inscriptions, vitraux, ces éléments coûteux, qui apportent un charme supplémentaire aux bâtiments, sont loin d’être présents dans toutes les mosquées ; ils contribuaient ainsi à indiquer sinon la puissance, du moins la richesse du fondateur. Le détail de ces aspects conduirait cependant à nous écarter de notre propos : laissons aux historiens de l’art le soin d’en révéler toute la complexité.
Page | 428
elle permet d’identifier le rang social du fondateur au rang architectural de sa fondation161
.
Une ligne de démarcation stricte, codifiée, se distingue entre fondations impériales et
fondations de membres de l’élite. Dans la mesure où les princesses se situent à cheval entre
ces deux mondes, il faut s’interroger sur l’octroi ou non de marques impériales à leurs
fondations. Or, au vu des données suscitées, seules les œuvres de Mihrimah Sultane acquirent
un rang impérial. Un faisceau de facteurs convergents explique l’exception dont elle fut
gratifiée. Son statut, tout d’abord, est sans pareil : elle est la fille unique d’un des plus grands
sultans ottomans. La période elle-même était propice : c’est le début des grandes
constructions architecturales réalisées par Mimar Sinan, le moment où Istanbul se couvre
d’œuvres monumentales, grâce à l’enrichissement et la stabilité politique qui caractérisent le
règne de Süleyman Ier. Sa richesse, ensuite, est sans égale : elle fut la plus riche des
princesses ottomanes, toutes époques confondues : elle put, par ses propres moyens, financer
la construction et l’entretien de deux vastes complexes, chose qu’aucune autre ne put se
permettre.
Que la princesse ait eu des ambitions particulièrement élevées pour ses fondations ne
fait aucun doute ; il se dégage de la personne de Mihrimah Sultane l’image d’une princesse
consciente de sa place privilégiée et dotée d’une très haute estime d’elle-même. Initiée à la
politique par sa mère, Hürrem Sultane, mariée au grand vizir Rüstem Pacha, elle était très au
fait du fonctionnement du système et savait en tirer parti. La réussite de ses projets ne fut
cependant possible que dans la mesure où ils ne contredisaient pas la propre politique
impériale de son père, sa principale source de pouvoir. L’acceptation paternelle s’exprime
d’ailleurs indirectement dans la décision de Süleyman Ier d’accorder à sa fille les moyens
financiers à la mesure de ses ambitions, puis de lui reconnaître le droit de faire usage des
prérogatives architecturales impériales. Rappelons encore que la politique impériale de ce
sultan se caractérise notamment par la place importante qu’il accorde aux femmes royales
dans le vaste programme de représentation publique de la dynastie qu’il promulgua. Utiliser
les membres (féminins ou masculins) de la dynastie dans un but représentatif n’est pas propre
à Süleyman Ier – d’autres en firent autant ; cependant, ce sultan fut l’un des premiers à utiliser
à un tel degré le personnage des femmes royales dans ce domaine. Les fondations (à Istanbul
et à Jérusalem) de sa concubine/favorite/épouse Hürrem en sont la preuve162
.
161
Elias, La société de cour : 17-45. Elias discute cependant de l’habitat, non des autres types de bâtis. Sa démonstration nous semble acceptable dans son idée générale, nous ne prétendons cependant pas qu’elle puisse s’appliquer telle qu’elle à la société ottomane et, plus particulièrement, aux vakf hayrî ottomans. Une certaine hiérarchie du bâti se distingue, qui répond à des critères assez bien définis, ainsi qu’il a été dit ; elle est néanmoins loin d’être aussi stricte que celle dont parle Elias. L’aspect géographique, mis de côté par celui-ci (il traite surtout des Hôtels parisiens) serait à prendre en considération pour l’Empire ottoman : les enjeux varient selon que le vakf est situé dans la capitale ou en province. L’aspect chronologique est également non négligeable. Enfin, il ne semble pas interdit à un bey d’entreprendre une fondation d’aussi grande qualité qu’un pacha, du moment qu’il en a les moyens. 162
Peirce, The Imperial Harem : 199-205. Outre Hürrem et sa fille, sa mère et deux de ses fils (Mehmed et Cihangir) participèrent également à ce maillage architectural de la capitale par la présence dynastique. On notera cependant les absents : Mustafa, sa mère, et Bayezid, c’est-à-dire ceux qui se trouvèrent en conflit avec le sultan et dont il n’était dès lors pas souhaitable d’encourager la mémoire.
Page | 429
La conjugaison des volontés du père et de la fille permit à Mihrimah Sultane de voir
ses constructions acquérir un rang impérial ; a contrario, l’absence du soutien impérial
empêcha les autres princesses de continuer dans cette voie. Que ce soit sur le plan financier ou
architectural, aucune autre sultane ne se vit accorder des avantages similaires, ce qui revient à
dire qu’elles furent exclues de toute prétention au même rang : à la mort de Süleyman, Selim
II s’empressa de refuser le deuxième minaret initialement prévu pour la mosquée de sa sœur à
Edirnekapı, perpétuant ensuite cet interdit à l’encontre de ses filles. Aucune autre princesse
non plus ne fut gratifiée de tels revenus : il est vrai que l’augmentation, par la suite, du
nombre de princesses réduisait leurs revenus respectifs163
. Que ce soit avant ou après, les
conditions politiques et économiques ne furent donc jamais favorables à l’intégration des
princesses dans le patronage architectural impérial : Mihrimah Sultane demeure un cas
unique.
3. Un acte de noblesse
Incapables d’assurer à leurs fondations un rang impérial en adéquation avec leur
propre statut (à l’exception de Mihrimah Sultane), les princesses ottomanes peinent à
s’affirmer de façon autonome sur la scène architecturale, ce qui facilite l’assimilation de leurs
œuvres à celles de leur époux. L’affirmation de soi des princesses dans le domaine
architectural fut dès lors fortement éprouvé. Pour autant, ces revers n’empêchèrent pas les
princesses de continuer à investir dans ce domaine, bien que de façon irrégulière. Ce n’est
donc peut-être pas tant, ou pas seulement, leur propre personne qui était en jeu dans cette
quête de commémoration. Voilà qui nous ramène à la question : pourquoi fonder un vakf
hayrî quand on est une princesse ? L’aspect religieux vient immédiatement en tête : instituer
un vakf est, de fait, un acte pieux. Mais ne confondons pas la nature du vakf, établie par
essence et qui se rapproche de l’acte du don, de la sadakat musulmane (dont elle serait une
forme perfectionnée), et le motif personnel : un fondateur n’a pas besoin d’être pieux par
conviction pour que son vakf soit considéré comme tel. Or, sans nier d’éventuelles aspirations
religieuses propres aux fondatrices, sur lesquelles nous n’avons cependant aucune
connaissance particulière, certains éléments suggèrent l’existence de facteurs autres que la
religiosité comme motif de fondation d’un vakf. Car ni la recherche de prestige, ni
l’importance de certaines de ces fondations ne sont explicables par l’aspect religieux.
Deux éléments peuvent permettre de percevoir un autre enjeu du vakf, qui ne nous
semble pas avoir été mis suffisamment en lumière dans les travaux sur le sujet : 1/ le faible
nombre de princesses impliquées dans de telles activités, et 2/ la rareté de ces œuvres dans le
163
La période antérieure n’était pas plus favorable aux princesses : au XVe siècle, non seulement l’Empire
n’était pas assez riche pour leur accorder de grands revenus, mais en plus la tradition n’était pas en leur faveur. À cette époque, les femmes royales ne construisaient pas d’œuvres individuelles monumentales ; au contraire, leurs réalisations gardaient des dimensions limitées, qui venaient compléter et bénéficier du prestige d’une œuvre déjà existante.
Page | 430
cas des femmes d’élite. Des remarques similaires du côté masculin sont possibles : à regarder
de près les sources, on constate que les principaux fondateurs sont, outre les sultans et princes,
les pachas et ağa du Palais. Les beys et oulémas sont en retrait, dès lors qu’il s’agit de fonder
des vakf hayrî. Que ces constatations soient associables à des considérations financières ne
fait pas de doute. Ce n’est cependant pas le point que nous aimerions souligner ici, mais le
caractère sélectif de ce type d’activité, tout particulièrement dans le cas des femmes. Les
principales fondatrices de vakf hayrî sont en premier lieu les valide sultan, en second lieu les
princesses – ou plus exactement, certaines d’entre elles. Concubines royales ou princières et
femmes d’élite n’y prennent qu’une part très faible. De même, parmi les princesses, ce sont
surtout les sultanes, les filles de sultan, qui s’y investissent : les hanım sultanes et autres
descendantes indirectes sont particulièrement rares.
En ce sens, construire et entretenir un vakf hayrî représente un acte de distinction qui
peut être reliée au statut de ces femmes : plus que toutes autres, les princesses sont des
muhaddere, des “femmes nobles, vertueuses”. Or, ainsi que Peirce l’a expliqué dans un récent
article, ce terme renvoie à l’idée d’une certaine élection divine : on ne devient pas muhaddere
par choix ou par volonté, mais parce que Dieu en a décidé ainsi. Cette distinction sociale va
de pair avec tout un attirail comportemental : réclusion, sorties accompagnées, ainsi que la
croyance en un comportement naturellement plus vertueux que celui des autres femmes164
.
Certes, la fondation d’un vakf n’est pas obligatoire – encore moins d’un vakf hayrî
d’importance. Pourtant, pour les pachas, Kunt notait l’existence d’un lien entre la haute
position au sein de l’appareil étatique, associée elle-même à de hauts revenus, et la
constitution de vastes fondations d’utilité publique : selon lui, la création de tels vakf
constituait un retour attendu, à défaut d’être imposé, en échange d’une telle situation. Un
pacha aurait donc été plus enclin à entreprendre de telles œuvres du fait même de sa position
et des attentes sociales qu’elle recouvrait165
.
Le cas des princesses fondatrices de vakf hayrî s’en trouve éclairé : acte non
obligatoire, mais signe de distinction sociale, il est associé à une reconnaissance de puissance
et de statut, d’autant plus que contrairement aux pachas, les princesses ne disposaient d’aucun
office associé à la détention de vastes revenus. En créant un vakf hayrî, une princesse
ottomane affirmait ainsi sa volonté de clamer sa position privilégiée, effet de la bonté divine,
et d’en assumer les contreparties. En procédant de la sorte, elle se haussait au-dessus de la
condition traditionnelle d’une femme (même d’élite) pour se rapprocher d’une essence royale,
telle que les reines mères, ou de la condition d’un agent de l’État, comme les pachas. La
constitution de tels vakf représente donc une sortie d’anonymat : pas tant d’un anonymat
nominatif (nous avons vu les difficultés auxquelles elles étaient confrontées dans ce domaine),
mais d’un anonymat sur la scène publique. Par là, elles s’affirment comme agent de l’État – à
défaut d’être agents de la dynastie, statut qui leur fut refusé dans le domaine architectural.
L’acte de fondation d’un vakf, hayrî ou non, est aussi, par essence, acte de
transmission : transmission de revenus, de charges, de biens. Mais la transmission qui nous
164
Peirce, « Domesticating Sexuality ». 165
Kunt, «The Waqf as an Instrument of Public Policy ».
Page | 431
intéresse ici n’est pas de ce genre ; c’est la transmission de la distinction elle-même, c’est la
transmission de la transgression. En faisant hériter la charge de mütevelli à leurs descendants,
le cas de figure le plus habituel, les princesses fondatrices leur transfèrent également la
mémoire de cette distinction originelle. Ils en deviennent les dépositaires de cette distinction,
à charge pour eux de la céder intacte à leurs propres descendants. Nous sommes donc en
présence d’une distinction héréditaire. À travers le vakf s’opère la commémoration d’un statut
acquis et proclamé par la princesse fondatrice, qui se transmet de génération en génération. En
ce sens, il nous semble pleinement possible de parler d’un acte de noblesse.
2. Renforcer la cohésion familiale par la constitution d’espaces de
mémoire
L’essentiel du potentiel commémoratif contenu dans l’acte de fondation d’un vakf
(hayrî) se concentre ainsi sur la capacité à transmettre la mémoire de l’entreprise distinctive
originelle, en faveur d’une célébration familiale. Encore faut-il s’interroger sur la manière
dont cette descendance faisait usage de ce capital commémoratif – c’est-à-dire poser la
question de la réussite de ce projet commémoratif multigénérationnel instauré par ces
princesses fondatrices. Or, la réussite de cette entreprise est due, à notre avis, à la création
d’espaces porteurs de cette valeur.
1. Les palais : un espace lignager dans le monde terrestre
Parmi les nombreux biens établis en vakf par les princesses, les diverses habitations de
luxe des fondatrices (palais et yalı) sont mentionnées de façon récurrente. Les princesses sont
en effet connues pour avoir détenu de nombreuses résidences de ce genre, en sus de celles de
leurs époux. Rarement construites sous leur égide, elles furent bien souvent acquises soit par
don, soit par achat. Le don paraît avoir été une pratique courante : au XVIe
siècle, Ismihan
Sultane (fille de Selim II) ayant fait savoir son désir d’un nouveau palais, son époux eut la
bonté de lui offrir ce plaisir – prenant en charge tout à la fois les coûts financiers et les
travaux166
. À partir du XVIIe siècle, ainsi que nous l’avons déjà mentionné, les sultans prirent
l’habitude d’offrir un palais à leurs filles ou sœurs lors de leur premier mariage. Outre ces
palais, les princesses détenaient également des résidences de bord de mer (d’abord appelées
sahilsaray puis yalı167
) dans lesquelles elles venaient profiter de l’air frais marin. Or, bon
166
Après la mort en bas âge de ses six premiers enfants, la princesse s’était mise à considérer celui qu’elle occupait alors comme porteur de malheur et pensait qu’un nouveau palais se révèlerait plus auspicieux ; ce fut le cas : elle y mit au monde son fils, Ibrahim Han. Necipoğlu, The Age of Sinan : 331-332. 167
À propos de ces différentes appellations, cf. Juliette Dumas, « Hücreden saraya: 15-18. yüzyıllarda Osmanlı konutları », Toplumsal Tarih 193 (Ocak 2010) : 18-25
Page | 432
nombre de ces habitations (si ce n’est toutes) furent inscrites dans la liste des biens établis en
vakf.
Transformer son lieu de résidence en vakf est loin d’être un fait propre aux princesses :
c’est un acte très largement partagé par l’ensemble de la société ottomane, à tous les niveaux
sociaux. Ce type de fondation constitue d’ailleurs la grosse majorité des vakf – du moins dans
la capitale au début du XVIIe siècle
168. Le motif en est toujours le même : transmettre ce bien
à ses descendants (ou à des bénéficiaires appartenant à l’entourage du fondateur, tel(le)s
d’ancien(ne)s esclaves affranchi(e)s. Et dans ce domaine, il ne semble pas exister de
différences selon les sexes : hommes et femmes semblent y accorder la même importance.
Mais existe-t-il une différence de classe ? La question est trop vaste pour y répondre dans son
ensemble, mais le cas des princesses ottomanes peut nourrir une réflexion sur ce point.
Pour comprendre s’il existe une différence entre l’acte d’établir sa maison en vakf pour
un membre quelconque de la société ottomane et celui d’instituer comme tel son palais pour
une princesse, il faut s’interroger sur les éventuelles spécificités de ces palais. Or, une
première particularité réside dans leur statut juridique. La maison dont il est question est
transformée en vakf pour seul usage familial : elle a donc le statut d’un legs pieux de type ehlî.
C’est en partie le cas des palais des princesses transformés en vakf : ils ont également pour
premier usage de servir la famille. Cependant, ce n’est pas là leur unique utilité : bien souvent,
les princesses fondatrices ont soin de stipuler des mesures de type hayrî : par exemple,
Mihrimah Sultane demande qu’une fois les bénéficiaires prescrits disparus, son palais soit
démoli et les pierres utilisées pour le pavement des routes impériales169
; Şah Sultane, fille de
Selim Ier, prescrit un usage similaire : les matériaux de son palais devront servir à construire
des maisons pour les pauvres170
.
Mais il semble que toutes les princesses fondatrices n’eurent pas le même souci de
prévoir un usage hayrî ultérieur à leurs palais. La chronologie peut fournir quelques
explications sur ce point : ce sont principalement les princesses du XVIe siècle qui
envisagèrent un tel usage hayrî de leurs palais – et tout particulièrement celles qui
s’inscrivirent parmi les grandes patronnes d’architecture. Le lien entre les deux n’est
probablement pas un hasard, mais ce n’est peut-être pas là le seul aspect à prendre en compte :
si l’on compare le registre de recensement des vakf d’Istanbul en 1546 à celui pour l’année
1600, on constate une augmentation très sensible du nombre des résidences privées
transformées en legs pieux171
. Le phénomène est à mettre en parallèle avec l’augmentation
générale des vakf ehlî, dont se plaignaient les chroniqueurs ottomans, comparée au nombre de
fondations hayrî. Dans le courant de la seconde moitié du XVIe siècle et par la suite, l’action
d’établir sa résidence en legs pieux pour usage privatif (familial) se banalisa, de sorte qu’il ne
paraissait plus nécessaire de prévoir un usage charitable quelconque, même ultérieur.
168
La consultation du registre İIstanbul Vakıfları Tahrîr Defterleri daté de l’an 1600 permet aisément de s’en rendre compte. Canatar (éd.), İstanbul Vakıfları Tahrîr Defteri : 1009 / 1600 Tarihli. 169
VGMA D 635 n°8 : 965 (sept. 1558). 170
VGMA D 1993 n° 7 : 977 (1569). 171
Barkan et Ayverdi (éds.), İstanbul vakıfları tahrîr defteri: 953 (1546) târîhli ; Canatar (éd.), İstanbul Vakıfları Tahrîr Defteri : 1009 / 1600 Tarihli.
Page | 433
Dans les vakfiyye comme dans les sources narratives ottomanes, les palais sont
presque toujours identifiés par le nom de leur propriétaire. C’est d’ailleurs là une des
difficultés du travail d’identification et de localisation des palais dans la capitale : un
changement de propriétaire entraîne un changement de nom et il est rarement possible de
suivre leur chaîne de succession172
. Cependant, par l’acte de transformation en vakf, le palais
devient un bien de mainmorte173
. L’immortalisation du bien entraîne celle du nom : ce n’est
donc pas seulement le palais que la princesse transmet à sa descendance, mais de nouveau son
nom, associé intrinsèquement au bien. C’est là une différence fondamentale avec la
transformation d’une maison quelconque en vakf, à laquelle aucun nom particulier n’est
associé. Ainsi, la sphère de commémoration recherchée par l’établissement du palais en vakf
est double : publique, puisque le nom est connu du reste de la société (les chroniqueurs s’en
font l’écho) ; familiale, puisque le souvenir de la fondatrice se transmet au sein même du
lignage (descendant).
Par ailleurs, les palais ont la particularité d’être naturellement associés à un sentiment
de puissance et de solidité. Le fait est que toute résidence importante n’est pas qualifiée de
palais174
. Un palais est donc un gage tout à la fois de pouvoir, de prestige et de durabilité. La
différence entre un palais et une autre construction, repose sur la volonté du fondateur d’être
propriétaire d’une œuvre de qualité, qui résistera aux assauts du temps, impressionnante par sa
taille et sa richesse. Les quelques descriptions ou images de palais ottomans, bien que souvent
plus tardifs, en sont l’expression175
. Cette solidité n’est pas qu’architecturale : elle symbolise
également la robustesse de la famille, du lignage qui y réside176
. Ainsi, le fait d’établir en vakf
leur palais serait, pour les princesses, le moyen d’une auto-commémoration publique
supplémentaire, qui prend ici une portée familiale très forte : c’est au sein de leur propre
lignage, de leur propre descendance, que les princesses entendent imposer leur souvenir. Tout
se passe comme si elles voulaient assurer la survivance non seulement de leur existence, et de
leur statut (il faut être puissant et associé à l’État ou à la dynastie pour avoir un palais) auprès
de leurs descendants. Elles semblent vouloir donner les moyens d’une élaboration d’une
172
Pour quelques exemples d’exercice du genre, cf. Artan, « The Kadırga Palace : An Architectural Reconstruction » ; du même auteur, « The Palaces of the Sultanas » ; idem, « The Kadırga Palace Shrouded by the Mists of Time » ; Kuban, Ahsap Saraylar. 173
Il ne peut plus être vendu ni cédé. Il peut, en revanche, être échangé contre un autre bien (à condition qu’il n’y ait pas déperdition de valeur), ainsi que le prescrivent les règles en matière de gestion des vakf. Cependant, à notre connaissance, aucun palais ne fut ainsi échangé : et pour cause, cela irait à l’encontre de l’usage familial qui en est fait, ainsi que nous allons le voir. 174
Dans ce sens, une réflexion sur l’usage du terme de palais en contexte ottoman serait nécessaire : quelles habitations avaient droit à porter ce terme ? À première vue, il semblerait que seules les habitations des membres de la dynastie et de l’État bénéficiaient de ce privilège. Mais il nous semble évident que des évolutions chronologiques eurent lieu sur ce point. 175
Sur le sujet, voir notamment Kuban, Ahsap Saraylar ; Nurhan Atasoy, İbrahim Paşa Sarayı, Istanbul, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1972 ; Selman Can, Belgelerle Çırağan Sarayı, Ankara, T.C. Kültür Bakanlığı yayınları, 1999 ; Seton Lloyd, « Old Waterside Houses on the Bosphorus : Saffet Paşa Yalısı at Kanlıca », Anatolian Studies VII (1957) : 163-suite ; Wolfgang Müller-Wiener, « Das Kavak Sarayı Ein Verlorene Baudenkmal Istanbuls », Istanbuler Mitteilungen 38 (1988) : 363-376 ; K. Tuchelt, « Das Yalı der Kıbrıslı Mustafa Paşa in Küçüksu », Istanbuler Mitteilungen 12 (1962) : 129-158. 176
Le même phénomène se retrouve dans l’Italie de la Renaissance, avec les casa des grandes familles. Cf. Klapisch-Zuber, La maison et le nom : 26-28.
Page | 434
mémoire familiale autour d’un espace bâti, porteur du nom et du souvenir de l’ancêtre de la
famille : la princesse.
2. Les fondations religieuses : un espace familial dans le domaine
du sacré
Les fondations religieuses de type hayrî, tels les mosquées, les couvents, les écoles et
autres bâtiments de cette catégorie, n’avaient pas pour seule utilité une auto-commémoration
de la fondatrice. À bien des égards, ces bâtiments d’utilité publique répondaient également à
des enjeux de commémoration familiale. Nous ne développerons que deux exemples de ce
phénomène : la création de cimetières familiaux et le réinvestissement des descendants dans
les fondations de leur ancêtre.
Le premier cas de figure a déjà été développé dans notre première partie, aussi serons-
nous brève sur cet aspect. Les individus qui nous intéressent précisément ici sont tous les
descendants des princesses exclus du lignage dynastique (et des privilèges que cela implique).
Pour ces descendants, la conduite, en terme de pratiques d’inhumation, se définit par une règle
générale : le regroupement familial. Ce regroupement familial se fait très généralement autour
d’un membre particulièrement prestigieux de la famille. Cette pratique n’est pas propre aux
descendants des familles princières : elle s’applique de façon générale à l’ensemble de l’élite
ottomane, notamment aux descendants des pachas, ainsi que nous l’avons déjà vu177
. La
particularité des lignages issus des princesses – pour être plus précis, de certains de ces
lignages – réside dans la possibilité d’être inhumé non pas seulement autour d’un ancêtre
prestigieux, mais au sein d’un espace familial prestigieux, comme la mosquée de la princesse.
L’exemple du lignage issu de Mihrimah Sultane, notamment de la branche des Cigalazade,
illustre bien ce phénomène178
. Que ce vaste regroupement familial se fasse dans un cimetière
attaché à une œuvre monumentale associée à l’ancêtre féminin de la famille est à prendre en
grande considération : il indique bien l’importance, pour les descendants et même pour les
alliés, de s’associer dans la mort à cet ancêtre prestigieux que fut la princesse.
Le deuxième cas est plus participatif : il ne s’agit plus d’une utilisation d’une zone
prédéfinie, pour un usage préconçu, au sein d’une fondation religieuse princière (un acte
volontaire, de peu d’impact sur la fondation en question), mais bien d’un réel réinvestissement
(architectural, artistique ou rénovateur) d’une fondation originelle déjà existante, par un
descendant de la fondatrice. La configuration la plus connue de ce type d’investissement
serait le cas d’une fille faisant construire un bâtiment annexe quelconque venant s’ajouter à
l’ensemble de la fondation de la mère : il ne s’agit pas d’une fondation nouvelle, mais d’une
adjonction, d’une amélioration à une fondation déjà existante. Nous avons déjà souligné
l’existence de ce phénomène lors de l’inventaire des fondations des princesses, aussi ne
177
Voir le chapitre 1.II.1. 178 Voir le chapitre 1.II. 2.4.
Page | 435
rentrerons-nous pas dans le détail. Ces activités de réinvestissement d’espaces déjà construits
par des parents permettent d’illustrer un nouveau phénomène. Si les descendantes indirectes
se distinguèrent rarement par l’exceptionnalité de leurs activités fondatrices, ce n’est peut-être
pas uniquement pour des motifs financiers (invoqués précédemment). Il faut envisager
l’hypothèse d’une inutilité de la chose : quoi qu’elles eussent entrepris, leurs œuvres
n’auraient pu prétendre dépasser en monumentalité, en magnificence, en qualité, en
“noblesse” enfin, celles des sultanes. En terme de commémoration familiale, l’apport eut été
faible et aurait peut-être même nuit à la qualité du lignage prônée par les fondations des
sultanes : faire moins bien que l’ancêtre, c’est donner à voir l’incapacité à faire mieux, et
admettre ainsi une certaine dépréciation qualitative. Au contraire, réinvestir les fondations
déjà existantes, c’est s’inscrire dans la continuité, renforcer une qualité déjà existante, la
raffermir.
Il faut donc relier ces pratiques à l’apparition, quelque part dans le courant de la
seconde moitié du XVIe siècle, d’un esprit lignager bien départagé entre les diverses lignées
issues des princesses. Au XVe siècle, les pratiques de réinvestissement de fondations
antérieures existent, mais à la différence des siècles suivants, elles ne se font pas forcément
sur une conception descendante de la famille. Rappelons-nous le cas du complexe d’Emir
Sultan à Bursa, évoqué à plusieurs reprises. Fondé sous l’égide d’une princesse, Hundi Hatun
(fille de Bayezid Ier et épouse du cheikh à qui est dédié la fondation), il connaît de
nombreuses annexions dont un certain nombre sont l’œuvre de princesses ultérieures. Si le
réinvestissement est sur une base familiale, cette base comprend les branches collatérales : les
princesses en questions ne sont pas nécessairement liées de façon verticale entre elles. Il faut
rapprocher de ce type de comportement les fondations qu’une princesse pourrait faire dans la
proximité d’une œuvre impériale. Ces pratiques tendent à disparaître aux siècles suivants,
quand la hiérarchie dynastique se clarifie et que les lignages princiers se définissent tous au
sein de l’Empire. Une nouvelle conception de la famille ottomane se donne à voir au travers
de ces actes : désormais, des familles princières voient le jour, établies en lignages distincts
les uns des autres et auxquels les descendants se rattachent.
Ces fondations religieuses, contrairement aux palais, sont certes ancrées dans l’espace
social et urbain contemporain des fondateurs, mais leur valeur réside dans le sacré. Inscrits
dans le temps présent, dans le monde terrestre, elles constituent une voie d’accès vers le
domaine du sacré, du spirituel, du divin. Et c’est bien dans cet espace du divin que l’enjeu de
la commémoration familiale se dessine ici. Espace divin certes, mais dont l’existence est
l’effet d’une personne, d’un ancêtre, d’une famille : les descendants de cet ancêtre rappellent,
par leur réutilisation (selon des formes diversifiées) de l’espace, leur appartenance à cette
famille. La famille, dans son ensemble, démontre ainsi sa mainmise exclusive sur cet espace
sacré, qui lui permet de souligner sa valeur, parce qu’elle s’ancre justement au-delà du
terrestre, dans un sacré éternel. Pour les descendants, c’est une manière de tirer avantage du
bienfait dont la fondatrice originelle est forcément gratifiée par son acte fondateur, en se
mettant sous son ombre protectrice et dans son sillage filial.
Page | 436
CONCLUSION : UNE ÉCONOMIE SYMBOLIQUE FAMILIALE
Promue par l’Islam, qui en fait un acte pieux, renforcée par les usages des sociétés
voisines, encouragée par l’exemple des souverains, l’activité philanthropique compte parmi
les pratiques incontournables de l’Empire ottoman et il ne semble pas exagéré de dire que tous
ses sujets entraient forcément, à un moment ou à un autre de leur vie, en contact avec cette
institution. En ville, ils la côtoyaient aux bains, à la mosquée, au marché ; en voyage, ils
traversaient des ponts, s’arrêtaient dans des ‘imaret ou des caravansérails financés par elle ;
des boutiques, maisons et champs versaient leurs impôts aux vakf ; pour les musulmans, leur
éducation et leur encadrement moral et religieux étaient le fruit du travail de ses employés. En
bref, le vakf était omniprésent dans la société ottomane.
Cette ubiquité ne signifie pas que tout le monde entretenait le même rapport avec
l’institution. Certains n’avaient du vakf qu’une expérience forgée par l’usage, beaucoup
cependant contribuaient à la prospérité de l’institution par des créations nouvelles.
Néanmoins, les fondateurs de legs pieux conçus comme des « dons à la communauté », qui
fournissent un intérêt public, sont peu nombreux. Si les questions financières y sont pour
beaucoup (il faut de grands moyens pour construire et entretenir ce type de fondations),
l’aspect culturel n’est pas non plus à négliger. En fin de compte, les fondations hayrî étaient
principalement le fait d’individus incarnant l’État : les sultans bien sûr qui, en tant que chefs
de la communauté musulmane et de l’État, montraient l’exemple ; les reines mères et les
princes également, qui participent à cette expression dynastique royale relayée par
l’architecture ; les agents de l’État enfin, grands administrateurs ou intimes du Palais, qui
copiaient le modèle impérial. Dans ce programme de développement public, les femmes
étaient très largement exclues (à quelques exceptions près, comme les reines mères), en raison
de la faiblesse de leurs moyens, bien entendu, mais aussi du fait de leur marginalisation
extrême par rapport à l’État.
Dans ce tableau général, les princesses tiennent une place particulière. Plus investies
dans la fondation de vakf hayrî que les autres femmes, mais moins que les reines mères, qui
agissent comme substituts du sultan, les princesses montrent une activité pérenne dans le
domaine de l’évergétisme. Pérenne, mais non constante : leur investissement se réduit
progressivement au cours du temps. Les motifs économiques sont à évoquer pour justifier ce
phénomène : les princesses souffrent, plus que d’autres, de la raréfaction des dotations
terriennes dès la fin du XVIe siècle, qui seules permettent à de vastes entreprises de voir le
jour. Mais le motif psychologique ne doit-il pas être également avancé, ne faut-il pas voir,
dans cette baisse de participation des princesses le reflet d’un désintérêt croissant en faveur
des fondations hayrî ? Et ne faudrait-il pas, alors, l’interpréter comme l’acceptation d’une
autoconception de groupe extérieure à l’organe étatique ? Exclues de l’expression impériale
architecturale, en compétition pendant un temps avec les pratiques philanthropiques des
agents de l’État, plus légitimes du fait de leur position et des revenus afférents et parce qu’ils
sont l’incarnation pleine et entière de l’État (contrairement aux princesses), les princesses
Page | 437
auraient finalement rendu les armes, rapprochant leur patronage des pratiques des femmes de
l’élite – un élément de plus à verser au dossier du positionnement social de ces femmes, à
cheval entre la dynastie, les agents de l’État et l’élite féminine de la capitale.
Le cas des princesses est néanmoins particulièrement instructif concernant l’usage
familial qu’elles font du vakf. Le débat qui anima les Ottomans, quant à l’usage permissif de
l’institution du vakf au profit des intérêts familiaux, se révèle mal adapté à l’activité des
princesses, bien qu’elles comptent parmi les principales incriminées. Néanmoins, la portée
lignagère prend progressivement le dessus sur les autres considérations. L’aspect financier et
institutionnel du vakf dans le cadre familial n’est plus à démontrer ; ce n’est pourtant pas cet
aspect qui a retenu notre attention, mais le rôle joué par le vakf dans la constitution des
lignages princiers, comme instrument de création et de cohésion d’une conscience lignagère
noble : 1/ par ses pratiques mêmes, pratiques de fondation de bâti, acte noble et anoblissant
parce que réservé à une petite élite qui s’institue en dispensatrice des bienfaits sociaux et
religieux ; 2/ par sa création d’espaces d’affirmation lignagère inscrits en dur dans le paysage
de la capitale (dans l’arène temporelle comme dans l’espace du sacré) ; 3/ par la
commémoration d’un statut royal qui se transmet à l’œuvre et, par elle, au lignage ; 4/ et par
le caractère héréditaire à la fois du prestige, des honneurs, des avantages et du bâti.
Si le vakf permet ainsi le renforcement de la cohésion lignagère, ancrée dans la
commémoration de l’ancêtre fondateur, la spécificité de ces lignages réside dans le sexe de cet
ancêtre : c’est bien la princesse qui joue ce rôle – qu’elle peut néanmoins partager avec son
époux, dans certains couples, voire sur sur certains aspects. Plusieurs motifs à cela : la
princesse transmet en effet le « nom de famille » (en tout cas l’un des noms de famille usités)
et l’ascendance royale (donc noble), commémorée au travers de ce nom de famille ; mais
surtout, phénomène très atypique, elle constitue le socle familial, le référentiel lignager. Or, ce
phénomène semble s’amplifier au cours du temps : la multiplication des mariages, donc des
époux, favorise le recentrage de la famille autour du personnage qui incarne à la fois sa
noblesse et sa stabilité : la princesse. Dans ces familles de sultanzade, la femme tient la place
du personnage central, de sorte que le vakf devient l’instrument d’une économie familiale
orientée autour de l’axe princier.
Page | 439
CONCLUSION
« La perle de nacre du sultanat, l’éminence de l’excellence
accordée par la gloire et la grandeur, la Fatma de chasteté et la
Hadice d’honnêteté, la Ayşe d’intelligence naturelle et la Belkıs de
nature parfaite, la souveraine des souveraines qui est pure de
caractère et se montre à l’écoute des qualités morales, le joyau
des femmes pures, la gloire des femmes pures, celle qui décide de
la direction des événements de la vie, celle qui est à l’origine de la
fondation de bonnes œuvres, celle qui détient l’essence de la
gloire et la quintessence des qualités admirables, la lumière
protectrice des enfants royaux, la fille des filles de sultan »1
Si les femmes du Harem impérial composaient la couronne de l’élite féminine
ottomane, les princesses en seraient les joyaux les plus précieux. Dans la seconde moitié du
XVe siècle se dessine une catégorie de femmes promues au sommet de l’élite et auxquelles on
accorde des privilèges exceptionnels. Leur position unique sur la toile sociale les autorise à
exercer un rôle politique et social exemplaire.
L’abandon des mariages inter-dynastiques dans la seconde moitié du XVe siècle
produit une situation atypique aux conséquences multiples. La dynastie ottomane se retrouve
avec une profusion de princesses qu’il faut marier, entretenir, écouter, recevoir, en un mot,
dont il faut désormais s’occuper. Pragmatiques, les sultans ottomans perçoivent leurs
descendantes comme une ressource dont ils peuvent faire et font usage. Les princesses
ottomanes deviennent les relais des desideratas de la dynastie. Il faut dire que leur position
sociale invite à les considérer ainsi : dans leurs veines coule le sang impérial, mais parce
qu’elles sont femmes, une règle coutumière leur dénie toute participation effective à la
souveraineté. Quelle que soit la manière de les instrumentaliser, quel que soit le pouvoir
qu’on leur donne, à quelle hauteur qu’elles puissent s’élever dans la hiérarchie sociale, les
sultans n’ont pas à redouter de leur part une volonté de s’emparer du trône pour elles-mêmes
ou pour leurs fils, exclus des héritiers potentiels en application du principe de patrilinéarité.
Voudrait-on décrire de façon métaphorique ce système qu’on ne trouverait pas mieux
que l’image du serpent qui mange sa queue : les sultans instrumentalisent les princesses au
bénéfice de la dynastie, tandis que le pouvoir et la puissance dont ces femmes disposent
dérivent de leur lien avec la dynastie. Il n’est pas surprenant, dès lors, que cette relation
1 Extrait de la titulature décernée à Mihrimah Sultane dans une de ses vakfiyye, qui se présente comme suit :
« Dürdane-i sadef-i saltanat, ferzane-i şeref bahş-i izzet ve azamet, Fatıma-i ismet ve Hatice-i iffet, Ayişe-i fıtnet ve Belkıs-ı fıtret, meliketu’l-melikât, melikitü’l-melikât, safiyyetu’s-sıfat, semiyyetu’s-simat, ikliletü’l-muhsinât, celiletü’l-muhsinât, mufizat-i mecari’l-hayrat, münşiye-i mebanii’l-meberrât, sâhibü’z-zati’l-celile, zati’s-sıfati’l-cemile, tac-ı ruus-i esnafi’l-havatin, nur-i uyuni’l-evladi’l-havakîn, mahdume-i benati’s-selatin, zinde-i havalisi’l-mai ve’t-tîn, rabi’atu’z-zaman, Zubeytü’l-evan hiyelleti lâ tuzahi, Mihrimah Sultan Hanım ebbedallahu te’âla bi-evtadi’l-huludi fî-arasati’l-vucud seradık-ı ismetiha ve izzetiha ve şüyyide bi-etnabi’l-ebud ilâ-yevmi’l-mev’ud, setayir-i iffetiha ve azametiha binti’s-sultani’l-a’zami’l-adeli [……] Süleyman Şah Han… » : VGMA D 635-2 n°1 : 957 (1549).
Page | 440
dynastique ait été exaltée à outrance. Ce lien de dépendance mutuelle des princesses à la
dynastie constitue l’un des éléments les plus stables du système politique ottoman : sans cesse
affiné et sublimé, il ne fut jamais remis en cause par aucun des acteurs du champ politique
ottoman, car tous avaient intérêt à sa perpétuité.
L’élément déclencheur naît de la volonté des sultans d’affirmer la supériorité de leur
lignage. L’excellence du sang ottoman est proclamée au point d’estimer impropre toute
alliance avec les dynasties voisines : les kul du sultan sont jugés préférables aux princes
musulmans, car leur dignité dérive de celle de leur maître. Un déséquilibre conjugal naît de
cette situation : ils ont beau symboliser la réussite socioprofessionnelle, les kul n’en
demeurent pas moins des esclaves du sultan et, de ce fait, sont inférieurs aux princesses. Voilà
les princesses ottomanes installées sur un piédestal confortable : en tant que membres de la
dynastie, elles n’ont pas d’égales dans la société ottomane. Voilà la dynastie investie d’une
qualité incomparable : ses femmes ne trouvent plus d’époux de leur condition.
L’abandon des mariages inter-dynastiques impose encore la contrainte de donner une
place à ces femmes au sein de la société ottomane. Cette place doit refléter l’idéologie
dynastique en construction : il faut que leur statut incarne parfaitement leur position au sein de
la société et de la dynastie. Une catégorie est alors construite : les sultânân ; un titre leur est
dévolu : Sultane. Le concept de princesse ottomane est né, il faut maintenant l’affiner. Une
ligne de démarcation s’installe progressivement, autour de la troisième génération
descendante ; une hiérarchie se dessine, fonction du degré de parenté avec l’ancêtre royal ;
des privilèges sont accordés, de façon décroissante ; la titulature se précise entre filles et
petites-filles de sultan, entre les Sultanes et les Hanım Sultanes. Le concept de princesse
ottomane n’est pas statique : il est systématiquement réinvesti, repensé, perfectionné.
Le système matrimonial élaboré en remplacement des alliances inter-dynastiques
contribue à inscrire ces princesses dans le champ politique : elles en sont des éléments
stabilisateurs. Leur mariage au sein de la classe des kul retisse sans cesse le lien de
dépendance réciproque entre ces individus et la dynastie. Mais la lecture de ces unions ne peut
se limiter à une approche fondée sur les rapports entre classes sociales, car le champ politique
ottoman n’est pas construit sur une rivalité entre ces classes, mais entre des factions qui
transgressent les frontières entre ces groupes. Le système matrimonial ottoman permet ainsi à
la dynastie d’introduire ses membres à l’intérieur même de ces factions, ce qui lui permet d’en
garder le contrôle. Les gendres impériaux reçoivent la main de la princesse comme une
distinction honorifique qui renforce leur lien de dépendance et d’asservissement, mais qui
sonne également comme une promesse de soutien politique pour eux-mêmes, leurs parents,
leurs serviteurs les plus proches, leurs enfants : la faction du gendre impérial s’en trouve
renforcée. Dans une société où les honneurs, les dignités et les offices sont distribués comme
des bienfaits du souverain, les princesses deviennent un instrument dans les mains de la
dynastie pour contraindre les factions à chercher auprès de la personne impériale les moyens
de leur survie politique et du renforcement de leur puissance.
Page | 441
1. Les princesses face aux paradigmes holiste et individualiste
Alain Caillé estimait que « le propre des sciences humaines et sociales, par rapport à la
philosophie, est, sans renoncer à la théorisation, de faire toute sa place à l’inépuisable
diversité de la réalité empirique et de refuser d’admettre qu’elle puisse se plier et se réduire à
la seule logique du concept »2. Historiens, sociologues, ethnologues, tous seraient pris en
tenaille par la tentation d’expliquer des faits, des comportements selon une démarche tantôt
holiste, tantôt individualiste. La tentation holiste consiste à « expliquer toutes les actions,
individuelles ou collectives en les analysant comme autant de manifestations de l’emprise
exercée par la totalité sociale sur les individus et de la nécessité de la reproduire. Loin que les
faits sociaux apparaissent comme le produit de l’entrecroisement des desseins individuels
rationnels, c’est l’ensemble des actions des individus qui semble être commandé par une
totalité sociale toujours préexistante aux individus, infiniment plus importante qu’eux et
incommensurable à leurs actes ou à leurs pensées qu’elle prédétermine de part en part »3,
quand la tentation individualiste prône la démarche inverse, mettant au premier plan les
notions d’intérêt, de calcul, de coûts, manœuvres et stratégies, ne laissant aucune place aux
actes désintéressés. Or, le phénomène d’intériorisation de la domination, largement décrit par
Bourdieu4, fonctionne tout autant pour les « dominants » que les « dominés » : un symbole ne
peut s’implanter dans une société qu’à partir du moment où ceux qui le promulgue y croient
eux-mêmes5.
Les princesses ottomanes sont des femmes douées d’une condition supérieure parce
qu’elles sont perçues et se perçoivent elles-mêmes comme telles. L’ensemble des agents du
champ politique et social ottoman adhèrent à cette opinion qu’aucun ne remet en cause, parce
que tous y croient profondément. La raison de cette croyance est la conviction en la
supériorité de la dynastie ottomane, élaborée et martelée sans cesse depuis le XIVe siècle. La
victoire des princesses, c’est avant tout la victoire de la dynastie, dont elles sont des relais.
Les gendres impériaux reçoivent la main de la princesse qui leur est donnée comme un
honneur suprême parce qu’eux-mêmes, les autres kul, la dynastie et jusqu’aux princesses
adhèrent tous à cette opinion. Ils croient en la capacité d’influence politique de leur épouse
parce que tous y croient et tous consentent à la réalité de ce pouvoir d’intervention. Le
pouvoir des princesses ottomanes réside dans le fait que l’ensemble des acteurs du champ
politique et social ottoman a intérêt à son existence ; mais cet intérêt n’existe que parce que
tous ont admis les règles du jeu du clientélisme par intériorisation de cette norme politique.
Ne laissons pas pour autant les sirènes du holisme nous emporter dans les tréfonds du
structuralisme : les princesses nourrissent le système, qui les nourrit en retour. Tenter de
2 Caillé, Anthropologie du don : 30.
3 Caillé, Anthropologie du don : 17.
4 Notamment Bourdieu, La noblesse d’Etat et La domination masculine.
5 « Le paradoxe est que l’instrumentalisation [de symboles] ne peut produire de résultats que pour autant que
ceux qui l’impulsent adhèrent à leur propre discours et cessent donc d’être simplement instrumentaux et manipulateurs » : Alain Caillé, Critique de la raison utilitaire. Manifeste du MAUSS, Paris, La Découverte, 2003 : 115.
Page | 442
chercher l’origine première de la poule ou de l’œuf n’a pas de sens ici. Les princesses sont à
l’origine de ce système autant que le système est la cause de leur existence même. Notre étude
peut avoir donné l’impression de privilégier l’approche structuraliste, fonctionnaliste. La
raison réside dans les sources elles-mêmes. La documentation utilisée pour construire ce
travail ne comprend pas de récits de soi, au sens de discours de cette catégorie sur elle-même
et sur les autres : nous n’avons que le récit des autres sur elle. Pis, ce récit n’est pas un récit
sur les princesses, mais sur d’autres : nos sources sont des récits des autres (les chroniqueurs,
les bureaucrates, les scribes) sur d’autres (les sultans, les agents de l’Etat), qui permettent de
reconstruire partiellement, par voix interposée, le récit de soi. L’avenir permettra peut-être de
recomposer la partie manquante de ce travail, la voix des princesses sur elles-mêmes. Nous en
doutons fortement et avons pris notre parti d’admettre l’inexistence du « je » ou du « nous » à
cette période donnée. Nous abondons donc dans le sens de Romain Bertrand quand il conclut
qu’il « n’y a pas de raison pour qu’un priyayi se soit dit, ait « fait (le) récit de lui-même »
dans des formes propres à la trajectoire européenne d’invention de la figure d’un sujet ayant
quelque chose à dire de lui-même et devant le dire »6. Les sultânân de l’époque moderne ne
ressentaient pas le besoin de se « dire elles-mêmes » : « c’est une manifestation
d’ethnocentrisme que de vouloir retrouver à tout prix, partout et toujours, des pratiques
d’énonciation de soi immédiatement intelligibles »7.
Les princesses ottomanes avaient conscience d’elles-mêmes, de leur qualité, de leur
rôle sur l’échiquier politico-social ottoman, suffisamment pour qu’une Fatma Sultane se
pique, durant sa nuit de noce, de menacer son mari de divorce ou de mort s’il lui prenait l’idée
de ne pas se plier à ses désirs. Elles ne se pensaient pas comme ego, comme sujet qui a besoin
de parler de lui et de ses expériences. Si les récits de femmes ayant connu la vie du Harem
n’existent qu’à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, ce n’est pas parce que nous n’avons
pas trouvé trace de documents similaires pour la période antérieure, mais parce qu’il n’en
existe pas : ce n’est qu’au crépuscule de l’Empire que le récit de soi et surtout le récit de
l’intimité, puisque le harem appartient à ce monde du privé et de l’intime, naît et se
développe. Nous ne pouvons faire l’histoire du récit de soi des princesses, mais cela
n’implique pas que cette histoire n’ait pas existé.
2. Une classe avortée
Les princesses ottomanes constituent une catégorie d’individus spécifiques, définie au
travers d’un titre et de prérogatives distinctives. L’une des spécificités de cette catégorie est
qu’elle est constituée uniquement de femmes. Mais constituent-elles pour autant une classe
morale ? Pour qu’un « groupe de statut » se transforme en classe morale, il faut qu’il se dote
de « stratégies, collectives ou plus ou moins conscientes, visant à le doter d’un discours sur sa
spécificité de style de vie, sur sa façon propre d’exister socialement, et qui est aussi
6 Bertrand, La Tradition Parfaite : 654.
7 Bertrand, La Tradition Parfaite : 654.
Page | 443
indissociablement un discours sur les façons d’exister des autres ordres sociaux. Tout groupe
de ce type dispose de « frontières culturelles » qu’il s’ingénie à instituer et à maintenir au
moyen d’une série de rites de « clôture », et qui s’offrent à l’analyse comme une série de
particularités de conduite de vie, dans des domaines aussi divers que les habitudes
alimentaires, les goûts esthétiques, les façons d’occuper le temps libre. »8 L’absence de
documentation directement relative aux princesses interdit toute approche de ce type : faut-il
pour autant conclure en l’incapacité de l’historien à statuer sur ce point ? Il n’est pas rare,
dans un travail d’histoire, de devoir reconnaître les limites d’une analyse. Mais avant d’en
venir à une telle conclusion, il est nécessaire de s’assurer d’avoir retourner le problème sous
tous ses aspects, d’avoir explorer l’inexplorable par des chemins détournés et inattendus.
Il n’est pas besoin de connaître les habitudes alimentaires ni les goûts esthétiques des
princesses ottomanes pour affirmer l’incapacité de ces femmes à se constituer en classe
morale : l’étude de leurs pratiques politiques et sociales le montre. Les princesses ne font pas
groupe parce qu’elles ne peuvent faire groupe. La structure du champ politique et social est
telle qu’elles s’inscrivent dans une répartition factionnelle de l’élite. En tant qu’individus,
elles appartiennent à l’origine à un groupe (la dynastie), qu’elles quittent chacune au profit
d’autres groupes différents les uns des autres, les factions. Elles ne jouent aucun rôle dans la
constitution de cette organisation en groupes factionnels qui transgressent les frontières des
classes socioprofessionnelles (les militaires, les bureaucrates, les oulémas, etc.) : elles ne
créent pas de factions mais s’insèrent dans un groupe déjà existant. Elles ont néanmoins un
rôle essentiel dans la perpétuation de ce système, car elles favorisent le maintien de factions
distinctes les unes des autres en privilégiant, par leur action, leur groupe au détriment des
autres – fussent-ils soutenus par d’autres princesses.
Le système politique des factions tel qu’il fonctionne dans la société ottomane interdit
l’idée même d’une classe morale des princesses. Les princesses ne peuvent pas à la fois
s’investir contre leurs sœurs ou nièces au profit de leur maison et s’entendre avec elles dans
l’élaboration d’un discours sur soi commun et distinctif. Les princesses n’ont donc peut-être
pas conscience d’elles-mêmes en tant que classe morale princière, mais elles ont certainement
une conscience accrue de leur groupe au sens de leur faction. Les stratégies de soutien et de
promotion, voire de défense des intérêts des membres de leur faction montre le sentiment
aigüe qu’elles en avaient. L’absence de protestations ou de manœuvres contradictoires avec le
système souligne l’extrême intériorisation des normes de leurs actions : les princesses
ottomanes ont inculqué la notion d’acte désintéressé comme une tâche qui leur incombe et qui
se révèle, en soi, intéressée, car la promotion des intérêts de leur groupe implique une
promotion individuelle, dans la mesure où leur propre puissance réside dans ce groupe.
Les princesses ont d’autant moins l’envie de se constituer en classe morale qu’elles
n’en ressentent pas le besoin. Si les priyayi de Java l’ont fait, c’est qu’ils étaient en pleine
crise de rivalité avec les tenants de la noblesse de sang, qui les renvoyaient à leurs origines
roturières, tout en subissant les assauts des marchands qui, forts de leur argent, prétendaient
8 Bertrand, La Tradition Parfaite : 11.
Page | 444
copier les mœurs nobiliaires9. Norbert Elias n’en disait pas moins de la société de cour
versaillaise, fractionnée entre une aristocratie héréditaire et une noblesse de robe, sous le coup
des attaques d’une bourgeoisie montante10
. Pierre Bourdieu, de son côté, élabora un système
théorique destiné à décortiquer les modes de domination sur le principe d’une rivalité
inhérente entre agents détenteurs de pouvoirs différents11
. La présente étude sur les princesses
ottomanes illustre un cas exceptionnel d’agents d’une catégorie connue et reconnue, qui ne
sont pas confrontés à ce problème de rivalité, car l’ensemble des acteurs du champ politique
et social ont tous intérêt à la préservation et même à l’augmentation de la position des
membres de cette catégorie, incapable de se constituer en groupe. L’incapacité des princesses
à se penser comme un tout cohérent ôte tout danger de voir se constituer un nouvel acteur
social qui entrerait en rivalité avec ceux déjà existants ; leur insertion diffuse au sein de la
haute société ottomane, un pied dans la dynastie, un pied dans l’élite, au service des uns
comme des autres, en fait des agents pluripartites rêvés.
La dynastie s’engage, dès la fin du XVe siècle, dans une dynamique de promotion des
princesses contre laquelle les divers secteurs de l’élite ne protestent nullement, y trouvant
leurs propres intérêts : plus les princesses sont placées sur un piédestal, plus l’honneur de
devenir gendre impérial est élevé ; plus ces femmes sont puissantes, plus elles sont
susceptibles d’aider les membres de la faction dans laquelle elles entrent. Les princesses elles-
mêmes n’ont nul besoin de se mobiliser pour la défense de leurs intérêts statutaires : on le fait
pour elles. C’est un système où tout le monde est gagnant, mais qui repose sur l’acceptation
tacite de la non-constitution en une classe morale susceptible de rivaliser avec les autres
segments du champ politique et social. Nous sommes donc face à un exemple de « classe
avortée », pour reprendre l’expression de Paul Veyne12
.
3. Les sultans n’ont pas de famille
Le rapport à la famille est omniprésent dans cette étude : la position sociale de ces
femmes dépend de la dynastie, leur rôle politique s’inscrit dans un cadre familial, et même
leurs actions sociales montrent une prégnance très forte des liens familiaux. Dans un système
patrilinéaire comme celui pratiqué dans la société ottomane, les femmes sont toujours à
cheval entre deux familles, avec un pied chez la famille conjugale et un autre chez la famille
de naissance. Les princesses ottomanes n’échappent pas à cette situation instable mais leur
exemple permet de dresser les contours du concept de famille tel qu’il était vécu par les
membres de la dynastie.
Une phrase mise dans la bouche de Bayezid II en réponse à son arrière grande tante,
Selçuk Hatun, résume le cœur du problème : les sultans n’ont pas de famille. Ou, plus
9 Bertrand, La Tradition Parfaite : 29-296.
10 Elias, La société de cour : passim.
11 Notamment Pierre Bourdieu, Choses dites, Paris, Editions de Minuit, 1987 et La noblesse d’Etat : 373-427.
12 Veyne, La société romaine : 35-36.
Page | 445
précisément, les sultans ont bel et bien une famille, mais ils ne sont pas astreints par les liens
familiaux qui s’imposent au commun des mortels. C’est d’ailleurs précisément l’enjeu du
dialogue : Selçuk Hatun l’admoneste en faveur de Cem, frère du sultan, le rappelant à ses
sentiments familiaux ; Bayezid répond qu’un souverain n’est pas astreint aux liens familiaux :
il n’a donc que faire des sentiments auxquels elle l’exhorte. L’idéologie qu’on perçoit derrière
ce propos est puissante mais inexacte. L’essentiel des mesures dynastiques prises par les
sultans sont des réponses à leur problème familial : l’application du fratricide ou le passage à
une succession par voie de séniorat en constituent des démonstrations flagrantes. Et tout ce
que nous avons vu sur l’instrumentalisation des princesses en faveur des intérêts dynastiques
renforce encore le phénomène
Le problème des Ottomans n’est pas qu’ils n’aient pas de famille, mais qu’ils
aimeraient pouvoir la soumettre pleinement aux intérêts du sultan régnant. Et c’est bien un tel
système familial qu’ils construisirent : tout au long des siècles, jusqu’à l’instauration
définitive du séniorat et du kafes, les sultans cherchèrent une solution à leur problème
familial. Le paradoxe de cette recherche est qu’ils ne pouvaient trouver de solution
convenable sans toucher, dans le même temps, à leurs statuts et prérogatives, sans porter
atteinte à leurs propres intérêts, de sorte que la solution ne vint pas de la dynastie elle-même,
mais des Piliers de l’Etat, qui imposèrent progressivement l’abandon du fratricide et
l’instauration d’une succession réglée d’avance. Dans l’affaire, la dynastie perdit non
seulement de son éclat, mais aussi une partie de sa supériorité qui avait permis à un prince du
XVe siècle, Musa, de s’emporter contre des « gens du peuple » qui s’étaient crus capables de
se mêler des affaires de la dynastie13
.
L’échec ne fut néanmoins pas total : les sultans réussirent au-delà de toute espérance
avec leurs femmes : avec les reines mères notamment, mais surtout avec les princesses, qui
devinrent de véritables éléments de stabilisation de l’idéologie de supériorité proclamée par la
dynastie. Le système matrimonial élaboré à leur endroit en est l’expression, il permit
d’enchaîner l’ensemble des segments du champ politique dans une soumission totale à la
dynastie, d’obliger ces gendres impériaux à une dépendance à vie envers la dynastie qui leur a
fait don d’une femme.
Un tel système matrimonial, associé aux règles d’exclusion de la souveraineté que l’on
connaît, a également pour conséquence de restreindre les capacités de reproduction de la
dynastie à la seule descendance masculine dans un premier temps, puis à la seule descendance
des sultans dans un second temps. A chaque génération, la famille régnante ottomane se
déleste de ses obligations familiales envers la descendance féminine en excluant
graduellement leurs descendants. Les princesses ottomanes se révèlent incapables, à terme, de
transmettre leur essence royale à leurs descendants. Elles sont confrontées à leur incapacité à
s’inscrire dans une ligne de transmission verticale continue : elles appartiennent à une
verticalité montante qui prend fin avec elles et donnent naissance à une seconde verticalité
descendante qui commence à partir d’elles. Ces deux verticalités se retrouvent au niveau de
leur personne mais demeurent dissociées. Quant aux liens de famille horizontaux, nous avons
13
Vatin et Veinstein, Le sérail ébranlé : 92.
Page | 446
suffisamment insisté sur la distinction des lignages princiers les uns des autres pour ne pas
avoir à rappeler leur inexistence.
Le phénomène est encore amplifié par leurs époux qui, en tant que kul, se voient eux
aussi coupés de leur ascendance : ils sont, théoriquement, des hommes sans famille d’origine.
Le couple princier est donc un couple d’individus amputés de leur ascendance respective, qui
ne peuvent s’inscrire dans un cadre familial qu’en en créant un nouveau, c’est-à-dire dans la
descendance. Et l’on pourrait encore ajouter à cela le fait que leurs mères elles-mêmes, des
concubines esclaves, sont également des femmes sans famille : elles ne sont maîtresses ni de
leur ascendance, qui se voit reniée, ni de leur descendance, qui leur échappe pour entrer dans
le lignage ottoman. Les lignages des princesses s’élaborent ainsi de façon distincte les uns des
autres. L’emphase que ces femmes montrent en faveur de la création d’une mémoire familiale
collective doit peut-être se lire comme une réponse à ce rapport imparfait à la famille auquel
elles sont confrontées. Ce sont des femmes aux liens familiaux défectueux qui s’évertuent à
créer de la famille.
4. La question identitaire
Au cœur de ce travail est la question de l’élaboration d’une identité propre aux
princesses. Ce n’est pas parce que ces princesses échouèrent, en tant que catégorie, à se
constituer en classe morale que la question de leur identité ne se posa pas de façon aigüe. La
spécificité de ce cas d’étude réside dans la passiveté de ces princesses dans le processus
d’élaboration de leur identité. Contrairement aux priyayi de Java, aux aristocrates ou aux
bourgeois de la cour versaillaise qui avaient été les agents principaux de l’élaboration d’une
identité morale de classe, l’exercice de dénomination et de désignation des princesses
ottomanes fut principalement réalisé en dehors de leur intervention. Les principaux auteurs de
cette manœuvre furent les sultans : ce sont eux les seuls capables d’accorder in fine l’usage
durable et officiel d’un titre statutaire ; ce sont eux encore qui sont les seuls habilités à
autoriser l’inhumation des princesses dans les cimetières impériaux ; et encore eux qui
pouvaient accorder à leurs filles des droits maritaux exceptionnels.
Les prétentions des sultans, justifiées au nom des intérêts dynastiques, furent encore
relayés par les chroniqueurs : en inscrivant au détour des phrases les avantages et prérogatives
de ces femmes et en s’abstenant de les critiquer, ils se faisaient les relais de la politique
d’exaltation de la supériorité dynastique. Mieux, ils en assuraient la diffusion et la réussite
dans le temps, car l’écriture de ces récits de règne est destinée à servir d’exemple pour les
générations futures : ces histoires sont promises à figer dans le temps une image retouchée
d’un Empire tel qu’on entend l’immortaliser. Elles sont des discours asservis aux intérêts de
ceux qui les écrivent et de ceux qui les commanditent. Dans ce type de documentation, le
silence, en soi, n’est jamais neutre : il est une prise de position qu’il faut savoir retranscrire.
L’absence de critiques concernant la place accordée aux princesses, l’absence même de
Page | 447
discussion sur le sujet, indique mieux que tout autre discours l’acceptation tacite des
chroniqueurs à ce propos.
Tout au long de leur histoire, les princesses ottomanes furent confrontées à une crise
identitaire. Jusqu’à la seconde moitié du XVe siècle, elles oscillaient entre une identité de
naissance ottomane et une identité d’acquisition, par mariage, étrangère (karamanide ou
isfendiyaride, pour l’essentiel). L’existence de ce conflit d’identité est probablement l’une des
causes de leur éviction des membres reconnus de la dynastie ottomane. Mettre en avant des
femmes amenées, selon les pratiques matrimoniales en usage à cette époque, à endosser une
identité hors du territoire ottoman ne présentait aucun intérêt ; pire, les risques étaient
flagrants : le danger de voir un prince étranger allié à la dynastie revendiquer des droits sur le
trône ottoman, au nom de leur alliance matrimoniale, n’était jamais exclu, dans la mesure où
c’était la pratique la plus diffusée dans l’espace anatolien. L’exclusion des femmes de la
souveraineté est une spécificité ottomane qui ne s’appliquait qu’aux Ottomans. C’est la raison
pour laquelle seuls les gendres impériaux d’origine kul se virent octroyer le titre honorifique
de dâmâd-ı şehriyârî : il n’était pas question d’associer nominalement à la dynastie des
individus susceptibles de s’élever en candidats au trône.
Quand ce problème d’identité “nationale” (pour prendre un terme tout à fait
anachronique) fut réglé par l’abandon des mariages inter-dynastiques, s’éleva un problème
d’identité “morale”. Au sein de l’espace ottoman, les princesses oscillaient entre une
appartenance dynastique et une appartenance à l’élite. Leur statut en faisait des membres de la
dynastie, de même que leurs prérogatives, mais leurs pratiques politiques et sociales les
apparentaient au reste de l’élite, dans laquelle s’inscrivait leur futur, leur avenir, leur postérité.
Les pratiques d’inhumation en sont l’illustration : elles reflètent les hésitations des membres
d’une catégorie prise en tenaille entre deux éthiques de vie et incapables de réduire la dualité
de leur identité.
Cette bipolarité identitaire n’a pourtant pas que des aspects négatifs. Elle est même
l’une des principales ressources de ces femmes. C’est parce qu’elles appartiennent à deux
dynasties que les princesses ottomanes du XIVe-XV
e siècle purent s’imposer comme des
diplomates internationales ; c’est parce qu’elles appartenaient à la fois au monde du Palais
impérial et de l’élite qu’elles disposèrent des moyens d’une action politique efficace ; et c’est
parce qu’elles étaient des instruments indispensables dans la politique de la dynastie comme
dans celle des factions que personne ne trouva rien à redire à leur position exceptionnelle.
L’incapacité des princesses à résoudre leur problème identitaire a donc des raisons pratiques
évidentes : pour y parvenir, il aurait fallu admettre de sacrifier l’une des deux, ce qui revenait
à amputer considérablement leurs moyens d’action.
Page | 448
5. Des femmes de pouvoir au pouvoir dénigré
L’historiographie traditionnelle accorde peu de place au rôle politique des femmes
dans l’Empire ottoman. Deux raisons expliquent ce dénigrement. La séparation des sphères
masculines et féminines prônée par la société ottomane, qui accorde aux hommes l’espace
public et aux femmes l’espace domestique, est une première excuse invoquée. La
conséquence de cette conception des rôles sociaux justifie en effet l’exclusion des femmes des
offices et activités de nature institutionnelle. La seconde cause réside dans la lecture trop
proche des textes ottomans : les auteurs de chroniques de règne se font en effet l’écho de cette
conception, refusant aux femmes tout rôle en dehors de l’espace domestique. Le discours sur
les femmes, tel qu’il est formulé par les législateurs ottomans, va d’ailleurs dans le même
sens. Le tort de ces travaux réside dans le fait d’avoir pris pour vérité ce qui n’est qu’un
discours parmi tant d’autres. Plutôt que de répéter les opinions des Ottomans, il aurait fallu
s’interroger sur la nécessité qui commandait l’insertion d’un tel discours dans des récits à
teneur politique. Car si ces derniers introduisirent de tels jugements dans leurs histoires, c’est
bien parce qu’ils répondaient à une situation opposée à ce qu’ils estimaient normal : il faut
donc convenir, de leur propre aveu, que les femmes jouaient un ou des rôles politiques dans la
société ottomane.
La problématique n’est pas de savoir si les princesses ottomanes disposaient d’un
pouvoir, mais plutôt de savoir comment celui-ci se formulait. Par-delà l’étude de cas, les
princesses ottomanes sont un exemple, un des mieux documentés peut-être (après les reines
mères et concubines), des modes de participation des femmes d’élite à la structuration du
champ politique ottoman. Elles permettent de sortir du cadre institutionnalisé du pouvoir pour
s’interroger sur les mécanismes souterrains, ceux justement qui ne figurent pas de façon
directe dans les chroniques. Le rôle de ces femme n’était certes pas d’être à la tête des armées
ou de présider à la signature de traités internationaux, elles ne dirigeaient pas des provinces ni
ne décidaient de la marche à suivre du gouvernement, au jour le jour ; elles n’en avaient pas
moins un rôle concret, inscrit dans les limites d’une intervention dans le cadre familial. Elles
interviennent par et pour la famille, conçue dans un sens large, englobant à la fois les parents,
les alliés, les serviteurs et les clients. En tant qu’épouses, il leur revient d’assurer, voire
conforter la position du mari ; en tant que filles ou sœurs, de conseiller le sultan ; en tant que
mères, de garantir la réussite sociale et professionnelle de leurs enfants ; enfin, en tant que
chefs de réseau, de favoriser la carrière de leurs serviteurs et clients. Elles y parvinrent, avec
un degré de réussite tributaire de la puissance des membres de leur réseau, mais aussi de leurs
propre capacités personnelles, avec suffisamment de régularité pour y voir une activité
normalisée.
Les conclusions de ce travail ouvrent des pistes de recherche sur le fonctionnement et
la reproduction des élites ottomanes. Les études ottomanes montrent un intérêt récent pour les
travaux sur les réseaux d’influence et leur poids dans la structuration du champ élitaire, dans
lesquels il faudrait insérer le rôle des femmes et des familles. Nous sommes encore trop peu
renseignés sur les clientèles des grands personnages ou sur les alliances entre grandes
Page | 449
familles, qui contribuent pourtant à faire de l’élite une classe qui s’auto-reproduit et n’accepte
en son sein que des individus issus de leurs propres rangs : l’expression kulların kulları (les
kul des kul)14
reflète bien cette situation. Les familles d’élite élaborent des stratégies destinées
à favoriser leur maintien, voire leur élévation sociale, remettant ainsi en cause le principe
méritocratique prôné par l’Etat ottoman.
14
Kunt, ,« Kulların Kulları », Boğaziçi Üniversitesi Dergisi: Beşeri Bilimler 3 (1975) : 27-42.
Page | 451
ANNEXES A
LES PENSIONS DES PRINCESSES
1. Le registre BAO KK 7104 : extraits de l’original
2. Registre BAO KK 7104 : translittération partielle
3. Tableau récapitulatif des dotations accordées aux
princesses, d’après le registre BAO KK 7104
Page | 461
REGISTRE BAO KK 7104 : TRANSLITTERATION
PARTIELLE
Les informations de ce registre sont répétitives, d’un mois sur l’autre, ainsi que nous
avons pu le vérifier par nous même avec les princesses. De ce fait, il ne nous a pas semblé utile
de montrer dans le détail la traduction pour chaque mois. Les pages qui suivent consistent donc
en une sélection volontaire : seules les dépenses du Palais pour le mois de Şevval de l’année
1048 [février 1639] relatives aux femmes porteuses du titre de sultane ont été retenues dans ce
qui suit.
Fol. 1 a
1) İcmâl-i
) mu se e-i v rid t ve i r c t ve ane-t-ta vil t ve a re u der am n- İsma’ l el- a r em n-i
azîne-i s s a-i ma r se-i İstânbûl berâ-
) mev ci -i e deg n ve sult ânân ve cevârî-i s s a der sarây-i cedîd-i mire ve sar -i at -i
ma‛m re ve mev ci t ü mekûlât-i sultânân
4) birûnî maʻ mevâcibât ü mekûlât-i lmânân-i Enderûn-i Sarây-i Ġalat a ve Sarây-i İ ra im Pa a
maʻ mevâcib-i mevâliyân ü mevâlî-zâdegân
) ve müte ‛id n ve mev ci -i mesâcid ve zâviye-d r n ma‛ ebniye-i hümâyûn-i müteferri ve-l-
am n çe-i s s a ve bâ çehâ-i s ’ire
) el-v iʻ f 9 e r-i Şevv l-ül-mü errem sene 1048 il e-i 9 e r Mu arrem-ül- arâm sene
1050.
Page | 462
As l- m l
Be-cihet : 403 073 061
&&&1re ligne&&&
Fî 3 C.e sene minh (note chancellerie)
Be-cihet
f 9 Şevvâl sene 1048
be-cihet-i mevâcib-i nım b nt
R c b P ş . Fî yevm 120
Berâ- v c - e r-i Şevvâl
sene 1048
Cihet 3 600
Fî 3 C.e sene minh (note chancellerie)
Be-cihet
Fî 29 Şevvâl sene 1048
Be-ci et-i mev ci -i a ret-i Hânzâde
t ân B râm P ş . Fî yevm
430. Maʻ bahâ-i g t
Berâ- v c - e r-i Şevv l sene 1048
Cihet 12 900
Page | 463
&&&2e ligne&&&
Fî 3 C.e sene minh (note chancellerie)
Be-cihet
Fî 29 Şevvâl sene 1048
Be-ci et-i mev ci -i a ret-i ş t ân
 m d P ş . F evm 4 0. Maʻ
bahâ-i g t er - v ci -i e r-i
Şevvâl sene 1048
Cihet 12 900
Fî 3 C.e sene minh (note chancellerie)
Be-cihet
Fî 29 Şevvâl sene 1048
Be-ci et-i mev ci -i a ret-i ümâşâ
t ân m r m ş s n P ş
Fî yevm 430. Mâʻ bahâ-i g t
Berâ- v ci -i e r-i Şevvâl
sene 1048
Cihet 12 900
Fî 3 C.e sene minh (note chancellerie)
Be-cihet
Fî 29 Şevvâl sene 1048
Be-cihet-i mev ci -i a ret-i Ümmü Gülsüm
t ân
î P ş . Fî yevm 430. Maʻ
bahâ-i g t er - v c - e r-i
Şevvâl sene 1048
Cihet 12 900
Page | 464
Fî 3 C.e sene minh (note chancellerie)
Be-cihet
Fî 29 Şevvâl sene 1048
Be-ci et-i mev ci -i a ret-i ât m t ân
Y s P ş . Fî yevm 4 0. Maʻ
bahâ-i g t er - v c -
e r-i Şevv l sene 1048
Cihet 12 900
&&&3e ligne&&&
Fî 10 C.e sene minh (note chancellerie)
Be-cihet
Fî 29 Şevvâl sene 1048
Be-cihet-i mevâcib-i a ret-i Kamerî t ân
m r ûm Sofî B râm P ş . Fî yevm
430. Maʻ bahâ-i g t
Berâ- v c - e r-i Şevvâl
sene 1048
Cihet 12 900
Fî 3 C.e sene minh (note chancellerie)
Be-cihet
Fî 29 Şevvâl sene 1048
Be-cihet-i mevâcib B ân t ân m r ûm
M st P ş . Fî yevm 415.
Maʻ bahâ-i g t er - v c
e r-i Şevvâl sene 1048
Cihet : 12 450
Page | 465
Fî 3 C.e sene minh (note chancellerie)
Be-cihet
Fî 29 Şevvâl sene 1048
Be-cihet-i mevâcib-i a ret-i âfiyye t ân
m r ûm M m d P ş . Fî yevm 350
Maʻ bahâ-i g t er - v c -
e r-i Şevv l sene 1048
Cihet 5 500
Fî 3 C.e sene minh (note chancellerie)
Be-cihet
Fî 29 Şevv l sene 1048
Be-cihet-i mevâcib-i a ret-i adîce t ân
m r ûm M m d P ş -i Kefe. Fî yevm 330.
Maʻ bahâ-i g t er - v c -i
e r-i Şevv l sene 1048
Cihet : 9 900
&&&4e ligne&&&
Fî 10 C.e sene minh (note chancellerie)
Be-cihet
Fî 29 Şevv l sene 1048
Be-cihet-i mevâcib-i a ret-i ‘ t t ân
K nʻân P ş . Fî yevm 330. Maʻ
bahâ-i g t er - v c - e r-i
Şevv l sene 1048
Cihet : 9 900
Page | 466
&&&6e ligne&&&
Fî minh (note chancellerie)
Be-cihet
Fî 3 Zilkade sene 1048
Be-cihet-i mevâcib-i a ret-i lide ult ân
dâmet ismetühâ berâ- v c -
e r-i Zilkade sene 1048
Cihet 90 000
&&&7e ligne&&&
Fî minh (note chancellerie)
Be-cihet
Fî 3 Zilkade sene 1048
Be-ci et-i mev ci -i s ekî ult ân
dâmet ismetühâ berâ- v c -
e r-i Zilkade sene 1048
Cihet 60 000
&&&10e ligne&&&
Fî 8 minh (note chancellerie)
Be-cihet
Fî 7 Zilkade sene 1048
Ber a -i me’ l t-i ult ânân- Enderûn-
ar - At -i Âmire er - v c -
e r-i Şevvâl sene 1048 be-dest-i
Al Ağa ser-bâzârî-i Sarây-i
mezbûre
Cihet 269 752
TABLEAU RECAPITULARIF DES DOTATIONS ACCORDEES AUX PRINCESSES,
D’APRES LE REGISTRE BAO KK 7104
NOM Şevval
Zilkade Zilhicce Muha-
rem
Safer
Rebiül-
evvel
Rebiül-
ahır
Cemazi
ül-evvel
Cemazi
ül-ahır
Receb
Şaban Rama-
zan
Hanzade S. ¤
Bayram P.
430
12 900
430
12 900
430
12 900
430
12 900
430
12 900
430
12 900
430
12 900
430
12 900
430
12 900
430
12 900
430
12 900
430
12 900
Ayşe S. ¤
Ahmed P.
430
12 900
430
12 900
430
12 900
430
12 900
430
12 900
430
12 900
430
12 900
430
12 900
430
12 900
430
12 900
430
12 900
430
12 900
Hümaşah S. ¤
Hüseyin P.
430
12 900
430
12 900
430
12 900
430
12 900
430
12 900
430
12 900
430
12 900
430
12 900
430
12 900
430
12 900
430
12 900
430
12 900
Ümmigülsüm
S. ¤ Halil P.
430
12 900
430
12 900
430
12 900
430
12 900
430
12 900
430
12 900
430
12 900
430
12 900
430
12 900
430
12 900
430
12 900
430
12 900
Fatima S. ¤
Yusuf P.
430
12 900
430
12 900
430
12 900
430
12 900
430
12 900
430
12 900
430
12 900
430
12 900
430
12 900
430
12 900
430
12 900
430
12 900
Fahri S. ¤
Bayram P.
430
12 900
430
12 900
430
12 900
430
12 900
430
12 900
430
12 900
430
12 900
430
12 900
430
12 900
430
12 900
430
12 900
430
12 900
Beyhan S. ¤
Mustafa P.
415
12 450
415
12 450
415
12 450
415
12 450
415
12 450
415
12 450
415
12 450
415
12 450
415
12 450
415
12 450
415
12 450
415
12 450
Safiyye S. ¤
Mehmed P.
350
10 500
350
10 500
350
10 500
350
10 500
350
10 500
350
10 500
350
10 500
350
10 500
350
10 500
350
10 500
350
10 500
350
10 500
Hadice S. ¤
Mehmed P.
330
9 900
330
9 900
330
9 900
330
9 900
330
9 900
330
9 900
330
9 900
330
9 900
330
9 900
330
9 900
330
9 900
330
9 900
Atike S. ¤
Kenan P.
330
9 900
330
9 900
330
9 900
330
9 900
330
9 900
330
9 900
330
9 900
330
9 900
330
9 900
330
9 900
330
9 900
330
9 900
Page | 469
ANNEXES B
LES ARBRES GÉNÉALOGIQUES
1. La succession des sultans
2. La descendance féminine de Murad Ier
3. La descendance féminine de Bayezid Ier
4. La descendance féminine de Mehmed Ier
5. La descendance féminine de Murad II
6. La descendance féminine de Mehmed II
7. La descendance féminine de Bayezid II
8. La descendance féminine de Selim Ier
9. La descendance féminine de Süleyman Ier
10. La descendance féminine de Selim II
11. La descendance féminine de Murad III
12. La descendance féminine d’Ahmed Ier
13. La descendance féminine de Murad IV
14. La descendance féminine d’Ibrahim
15. La descendance féminine de Mehmed IV
16. La descendance féminine de Mustafa II
17. La descendance féminine d’Ahmed III
18. La famille d’Hümaşah Sultane, petite-fille de Süleyman Ier
19. La famille de Mihrimah Sultane, fille de Süleyman Ier
20. La famille de Sokollu Mehmed Pacha
21. La famille de Safiyye Sultane, fille de Murad IV
22. La famille de Nevşehirli Ibrahim Pacha
OSMAN IERv. 1280 - v. 1324
1
ORHANv. 1324 - v. 1362
1.1
MURAD IERv. 1362 - 1389
1.1.1BAYEZID IER
1389 - 1402
1.1.1.1
MEHMED IER1413 - 1421
1.1.1.1.1
MURAD II1421 - 1444 ; 1446 - 1451
1.1.1.1.1.1MEHMED II
1444 - 1446 ; 1451 - 1481
1.1.1.1.1.1.1
BAYEZID II1481 - 1512
1.1.1.1.1.1.1.1
SELIM IER1512 - 1520
1.1.1.1.1.1.1.1.1SÜLEYMAN IER
1520 - 1566
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
SELIM II1566 - 1574
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
MURAD III1574 - 1595
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1MEHMED III
1595 - 1603
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
AHMED IER1603 - 1617
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
MUSTAFA IER1617 - 1618 ; 1622 - 1623
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2
OSMAN II1618 - 1622
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.3
MURAD IV1623 - 1640
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4
IBRAHIM1640 - 1648
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.1MEHMED IV
1648 - 1687
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.2SÜLEYMAN II
1687 - 1691
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.3AHMED II
1691 - 1695
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.1.1
MUSTAFA II1695 - 1703
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.1.2
AHMED III1703 - 1730
BAYEZID IER
1
ERHUNDI (ERHONDU)
YAKUB BEY
2
FATMA
? BEY
3
HUNDI
SEYYID SEMSEDDIN MEHMEDEmir Buhari "Sultan"
4
ORUZ (URUZ)
EBUBEKIR MIRZA (?)
5
MELEK "PASA"
SEMSEDDIN MEHMED
1.1
UMUR BEY1.2
MEHMED ÇELEBI3.1
?3.2
?3.3
EMIR ALI4.1
AYSE
4.1.1
MEHMED BEY
MEHMED IER
1?
KASIM BEYIsfendiyaroglu
2HAFSA
MAHMUD ÇELEBIÇandarlizade
3ILALDI
IBRAHIM BEYKaramanoglu
4AYSE
ISA BEYKaramanoglu
5INCU
ALAEDDIN (ALI) BEYKaramanoglu
6SELÇUK
IBRAHIM BEYIsfendiyaroglu
7HADICE (?)
KARACA PACHA
2.1ISFAHAN SAH
2.2ALI ÇELEBI
2.3HASAN ÇELEBI
2.4HÜSEYIN ÇELEBI
2.5MUSTAFA ÇELEBI
3.1
PIR AHMED3.2
ALAEDDIN BEY3.3
KARAMAN BEY (?)3.4
KASIM BEY3.5
SÜLEYMAN BEY3.6
NURI SOFI
6.1
SEYYIDE HADICE
MAHMUD ÇELEBIKoca Mustafa Pasaoglu
6.2
HAFSA6.3
EMIR YUSUF ÇELEBI6.4
ISHAK BALI6.5
ISMAIL BEY
6.1.1
AYSE6.1.2
ZEYNEB6.1.3
HUNDI6.1.4
SEHZADE6.1.5
FATMA6.1.6
SÜLEYMAN BEY
MURAD II
1
SEHZADE
SINAN PACHA
2
HAFSA
KAYA BEYIsfendiyaroglu
3
FATMA
ZAGANOS PACHA
4
?
ISMAIL BEYIsfendiyaroglu
5
(ER)HUNDI
MIRAHUR ILYAS BEY YAKUB BEY
3.1
AHMED ÇELEBISultanzade
4.1
HASAN BEY
?Osmanli
4.2
YAHYA BEY
MEHMED II
GÜLBAHAR
1
GEVHERHAN
UGURLU MEHMED MIRZAAkkoyunlu
2
BAYEZID II
1.1
AHMED MIRZA "GÖDE"
2.1
AYNISAH
1.2
HÜSEYIN1.3
MEHMED1.4
MAHMUD
2.1
AYNISAH
1.1
AHMED MIRZA "GÖDE"
BAYEZID II
1
AHMED BEY
2.1?
2AYNISAH
AHMED MIRZA YAHYA PACHA
3ALEMSAH
4FATMA "SOFU" (SOFI)
HASAN BEY "GÜZELCE" MUSTAFA PACHA
5GEVHERHAN
MEHMED PACHADükakinzade
6
HADICE
FAIK PACHA KARA MUSTAFA PACHA (?)
7ILALDI
AHMED PACHA
8SAH MELEK (SEHZADE)
NASUH BEY
9KAMER(SAH)
MUSTAFA BEY
10SELÇUK
MEHMED BEY
11
HÜMA
BALI PACHAAntalyali
12
HUNDI
AHMED PACHAHersekzade
13
AYSE
SINAN PACHA "GÜVEYI"
2.1
?
1AHMED BEY
2.2
?
BALI BEY
3.1
?
4.1MEHMED ÇELEBI
4.1
MEHMED ÇELEBI
3.1?
4.2
?
AHMED BEY
5.1
NESLISAH
ISKENDER BEY
6.1AHMED ÇELEBI
7.1AYNISAH
7.2MEHMED BEY (?)
10.1?
YUNUS PACHA MEHMED ÇELEBI
10.2NESLISAH
10.3HADICE
12.1KAMERSAH
12.2HÜMASAH (OU AYNYSAH ?)
12.3MUSTAFA BEY
12.4ALI BEY
12.5MAHDUMZADE (?)
13.1AYSE
AHMED PACHADükakinzade
13.2GEVHERSAH
IBRAHIM BEY
13.3?
ALI BEY
13.4KAMERSAH
AHMED BEY
13.5MIHRIHAN
13.65 FILS
10.3.1HANZADE
SELIM IER
1BEYHAN
FERHAD PACHA† 1524
2FATMA
MAHMUD PACHA KARA AHMED PACHA
3HANIM (HADICE)
ISKENDER PACHABostancibasi
MUSTAFA PACHA "ÇOBAN"
4HAFSA
MUSTAFA PACHA "BOSNAK" (?) ISKENDER BEY (?)
5SAH
LUTFI
1.1
ISMIHAN3.1
OSMANSAH BEY "KARA"3.2
SÜLEYMAN BEY3.3
NEFISE3.4
MEHMETSAH BEY3.5
ALI ÇELEBI
5.1
ISMIHAN
HÜSEYIN PACHA
3.2.1
MUSTAFA BEY5.1.1
NESLIHAN5.1.2
VASFIHAN
SÜLEYMAN IER
MAHIDEVRANHÜRREM
1a
MUSTAFA° 1518† 1553
2bMIHRIMAH
° 1521† 1578
RÜSTEM PACHA† 1561
3b
MEHMED° 1521† 1543
1a.1?
1a.2?
MUSTAFA PACHA
1a.3?
MEHMED OU SINAN PACHA ?
2b.1
AYSE
AHMED PACHA FERIDUN BEY
3b.1HÜMASAH
FERHAD PACHA
2b.1.1
OSMAN BEY† 1591
2b.1.2
MEHMED PACHA† 1593
2b.1.3
ABDURRAHMAN PACHA† 1595
2b.1.4
MUSTAFA PACHA† 1593
2b.1.5
?† 1580
x 1580
SINAN PACHACigalazade
2b.1.6
SAFIYYE
x 1581
SINAN PACHACigalazade
2b.1.7
?
3b.1.1
FATMA† 1592
MEHMED BEY† 1586
3b.1.2
MEHMED BEY3b.1.3
HASAN BEY† 1604
3b.1.4
HÜSNI BEY3b.1.5
IBRAHIM PACHA† 1602
3b.1.6
HACI PACHA† 1627
3b.1.7
OSMAN BEY† 1592
3b.1.8
MUSTAFA BEY† 1597
3b.1.9
MAHMUD AGA
SELIM II
1
ISMIHAN† 1585
x 1562
SOKOLLU MEHMED PACHA† 1579
x 1584
KALAYLIKOZ ALI PACHA† 1587
2
SAH† 1577
x 1562
ÇAKIRCIBASI HASAN PACHA† 1574
ZAL MAHMUD PACHA† 1577
3
GEVHERHAN
x 1562
PIYALE PACHA† 1578
x 1579
BOYALI MEHMED PACHA
4
FATMA† 1580
x 1575
KANIJELI SIYAVUS PACHA† 1590
5
?
CERRAH MEHMED PACHA
6
?
2.1
KÖSE HÜSREV PACHA (?)
1.2aIBRAHIM HAN
1.3a?
CAFER PACHA
1.4a?
(6 Autres Enfants Morts En Bas Âge)
1.1b
MAHMUD° 1585† 1585
2.1
KÖSE HÜSREV PACHA (?)
6
?
2.2
?3.1
AYSE
3.2FATMA
3.3
MEHMED BEY (?)
4.1SINAN BEY
4.2? BEY
4.3? BEY
4.4?
MURAD III
1
AYSE† 1605
x 1586
BOSNALI IBRAHIM PACHA† 1601
x 1602
YEMISÇI HASAN PACHA† 1603
x 1604
GÜZELCE MAHMUD PACHA
2
FATMA
x 1593
HALIL PACHA† 1603
x 1605
MURAD PACHA
3FETHIYE
ÇUHADAR AHMED PACHA† 1618
4FAHRI(YE)
SOFU BAYRAM PACHA
5MIHRIMAH
MIRAHUR AHMED PACHA
6
?
x 1603
MAHMUD PACHACigalazade
7
?
x 1613
MEHMED BEYCigalazade
2.1
MAHMUD† 1598
MEHMED III
1
?
x 1604
KARA DAVUD PACHA† 1623
2
?
x 1604
MIRAHUR MUSTAFA PACHA† 1610
3
?
TIRYAKI HASAN PACHA° 1611
4
?
ALI PACHA (?)
AHMED IER
1FATMA
x 1624
ÇATALCA HASAN PACHA† 1631
x 1631
CANPULADZADE MUSTAFA PACHA† 1636
x 1637(À Partir De)
AHMED PACHA† 1644
x 1660
MELEK AHMED PACHA† 1662
x 1663
KUNDAKÇIZADE MUSTAFA PACHA† 1666
x 1667
KOZBEKÇI YUSUF PACHA† 1678
2
AYSE† 1656
x 1612
NASUH PACHA† 1614
x 1620
KARAKAS MEHMED PACHA† 1621
x 1626
HASAN PACHA (?)† 1632
x 1626
HAFIZ AHMED PACHA (?)† 1632
x 1632
MURTEZA PACHA† 1636
x 1639
SILAHDAR AHMED PACHA† 1644
x 1645
VOYNUK AHMED PACHA† 1649
x 1655
IBSIR MUSTAFA PACHA† 1655
3
ATIKE "BURNAZ"
x 1633
MUSAHIB CAFER PACHA† 1647
x 1647
KOCA KENAN PACHA† 1652
x 1652
DOGANCI YUSUF PACHA† 1670
4
GEVHERHAN
x 1612
ÖKÜZ MEHMED PACHA† 1620
x 1623
TOPAL RECEB PACHA† 1632
5
HANZADE
x 1623
BAYRAM PACHA† 1638
x 1649
NAKKAS MUSTAFA PACHA† 1653
6ÜBEYDE (ABIDE)
x 1641
KÜÇÜK MUSA PACHA† 1647
7
KÖSEM (?)
x 1612
NASUH PACHA† 1614
8
?
x 1626
KARA MUSTAFA PACHA† 1628
1.1
HASAN PACHA
2.1
MUSTAFA BEY
4.1SAFIYYE
x 1643
SIYAVUS PACHA
MURAD IV
1
KAYA ISMIHAN° 1633† 1652
x 1644
MELEK AHMED PACHA† 1662
2
SAFIYYE
SARI HASAN PACHA° 1688
3
RUKIYYE† 1703
x 1663
MELEK IBRAHIM PACHA† 1685
x 1693
GÜRCÜ MEHMED PACHA (?)
x 1701
MAKTULZADE ALI PACHA
1.1
FATMA° 1652
1.2
AFIFE
2.1
MEHMED REZMÎ PACHA† 1719
2.2
RUKIYYE† 1696
3.1
AYSE† 1717
3.2
FATMA† 1727
x 1699
BIYIKLI MEHMED PACHA† 1701
IBRAHIM
1
GEVHERHAN° 1642† 1694
x 1647(Ou 1653)
ÇAVUSZADE MEHMED PACHA† 1681
x 1692
HELVACI YUSUF PACHA† 1714
2
FATMA° 1642† 1661
x 1645
MUSAHIB YUSUF PACHA† 1646
x 1646
MUSAHIB FAZLI PACHA† 1657
3
BEYHAN° 1645† 1700
x 1647
HEZARPARE AHMED PACHA† 1648
x 1650(À Partir De)
UZUN IBRAHIM PACHA† 1683
x 1689
BIYIKLI MUSTAFA PACHA† 1699
4
ATIKE
x 1646
CAFER PACHA
x 1648
SARI KENAN PACHA† 1659
x 1659
MÜFETTIS ISMAIL PACHA† 1666
x 1666
CERRAH KASIM PACHA
5
AYSE
HASEKI MEHMED PACHA DEFTERDAR IBRAHIM PACHA
6
KAYA
x 1649
HAYDARAGAZADE MEHMED PACHA† 1661
7
ÜMMÜGÜLSÜM
x 1653
ABAZA AHMED PACHA† 1656
MEHMED IV
1HADICE
° 1660† 1743
x 1675
MUSAHIB MUSTAFA PACHA† 1686
x 1701
SILAHDAR MORALI HASAN PACHA† 1713
2ÜMMÜGÜLSÜM (ÜMMÎ) "KÜÇÜK"
† 1720
x 1675
MERZIFONLU KARA MUSTAFA PACHA† 1683
x 1693
ÇERKES OSMAN PACHA† 1727
3FATMA (EMETULLAH)
† 1700
x 1695
TIRNAKÇI ÇERKES IBRAHIM PACHA† 1696
x 1697
TOPAL YUSUF PACHA† 1716
1.1MEHMED BEY
1.2HASAN BEY
1.3VASIF (ASAF ?) BEY
1.4ALI BEY
1.5ABDULLAH BEY
2.1FATIMA
° 1699† 1730
2.2HADICE
° 1701† (Bas Âge)
3.1SAFIYYE
3.2RUKIYYE
† 1720
x 1708
SIRKE OSMAN PACHA† 1724
MUSTAFA II
1
SAFIYYE° 1696† 1778
x 1703
MAKTULZADE ALI PACHA† 1723
x 1726
MIRZA MEHMED PACHA† 1728
x 1730
KARA MUSTAFA PACHA† 1736
2
EMINE° 1696† 1739
x 1701
HASAN PACHA
x 1703
ÇORLULU ALI PACHA† 1711
x 1712
RECEB PACHA† 1726
x 1728
ABDULLAH PACHA† 1736
3AYSE° 1696† 1752
x 1703
KÖPRÜLÜZADE NUMAN PACHA† 1719
x 1720
TEZKIRECI SILAHDAR IBRAHIM PACHA† 1722
(Ou 1724 ?)
x 1725
KOCA MUSTAFA PACHA† 1728
x 1732
EBUBEKIR PACHA† 1759
4EMETULLAH
° 1701† 1727
x 1720
SIRKE OSMAN PACHA† 1724
5ASIME
x 1733
YAKUB PACHA
1.1BAYEZID BEY
1.2ZAHIDE
x 1740
SÜLEYMAN BEYEFENDI
2.1?
IBRAHIM PACHAKiz Hüseyin Pasaoglu
† 1736
4.1
HIBETULLAH° 1723† 1744
HACI ALI PACHA
AHMED III
1
FATMA° 1704† 1733
x 1709
SILAHDAR ALI PACHA† 1716
x 1717
NEVSEHIRLI IBRAHIM PACHA† 1730
2
ÜMMÜGÜLSÜM° 1706† 1732
NEVSEHIRLI ALI PACHA
3
HADICE "KÜÇÜK"° 1710† 1738
x 1724
AHMED PACHAÇerkes Osman Pasaoglu
† 1735
HALIL AGA (?)
4
ATIKE° 1712† 1737
x 1724
GENÇ MEHMED PACHA† 1768
5
SALIHA° 1715† 1778
x 1728
SARI MUSTAFA PACHADeli Hüseyin Pasazade
† 1731
x 1736
GÜLEÇ SARHOS ALI PACHA† 1744
x 1758
KOCA RAGIB PACHA† 1763
x 1764
TURSU MEHMED PACHA† 1770
6
AYSE° 1715† 1775
x 1728
ISTANBULI MEHMED PACHA† 1737
x 1740
GÜL RATIB AHMED PACHATopal Osman Pasaoglu
† 1748
x 1758
SILAHDAR MEHMED PACHA† 1788
7
ZEYNEB° 1720† 1774
x 1728
SINEK KÜÇÜK MUSTAFA PACHADeli Hüseyin Pasazade
† 1764
x 1765
MELEK MEHMED PACHA
8
ESMA "BÜYÜK"° 1726
x 1743
YAKUB PACHA† 1744
x 1745
YUSUF PACHA (?)
x 1758
MUHSINZADE MEHMED PACHA† 1774
9
ZÜBEYDE° 1728† 1756
x 1748
SÜLEYMAN PACHAKaraalizade
† 1748
x 1749
NUMAN PACHA
10
SAFIYYE
MUSTAFA PACHA
2.1
MUSTAFA BEY† 1725
3.1
SÜLEYMAN IZZÎ EFENDI
5.4
AYSE5.5
EMINE
ZUHDI ISMAIL PACHA
5.1a
AHMED BEY† 1736
5.2a
HADICE5.3a
FATMA
x 1748
IBRAHIM BEYYahya Pacha Biraderi
6.1
RUKIYYE ? ZEKIYYE ?
NURI EFENDILalazade
10.1
AHMED BEY† 1733
6.1.1
SÜLEYMAN BEY6.1.2
AHMED RIFAT BEY
SÜLEYMAN IER HÜRREM
MEHMED° 1521† 1543
FERHAD PACHA HÜMASAH
1
FATMA† 1592
MEHMED BEY† 1586
2
MEHMED BEY3
HASAN BEY† 1604
4
HÜSNI BEY5
IBRAHIM PACHA† 1602
6
HACI PACHA† 1627
7
OSMAN BEY† 1592
8
MUSTAFA BEY† 1597
9
MAHMUD AGA10
?11
?
5.1MUSTAFA BEY
6.1HACIPASAZADELER
(Descendance)
8.1SÜLEYMAN BEY
† 1655
8.1.1
AHMED PACHA
8.1.1.1MUSTAFA PACHA
8.1.1.1.1
ISMAIL PACHA
MIHRIMAH° 1521† 1578
RÜSTEM PACHA† 1561
1
AYSE
AHMED PACHAFERIDUN BEY
1.1
OSMAN BEY† 1591
1.2
MEHMED PACHA† 1593
1.3
ABDURRAHMAN PACHA† 1595
1.4
MUSTAFA PACHA† 1593
1.5
?† 1580
x 1580
SINAN PACHACigalazade
1.6
SAFIYYE
x 1581
SINAN PACHACigalazade
1.7
?
1.6.1
MAHMUD PACHACigalazade
° 1643
x 1603
?(Fille Murad III)
1.6.2
MEHMED BEY
x 1613
?(Fille Murad III)
1.6.3
?
ABDURRAHMAN BEY
1.6.3.1
SEMIN MEHMED PACHA
1.6.3.1.1
MEHMED BEY† 1672
1.6.3.1.1.1
AHMED BEY† 1715
1.6.3.1.1.2
MUSTAFA BEY
?
1
CEMALEDDIN SINAN BEYDimitriye
2
?3
?
1.1SOKOLLU MEHMED PACHA
Bayo° 1505† 1579
x 1562
ISMIHAN SULTANE?
1.2
SEMSA
KARA SINAN BEY
2.1
MUSTAFA PACHA2.2
LALA MEHMED PACHA3.1
FERHAD BEY
1.1.1a
IBRAHIM HAN1.1.4a
?
CAFER PACHA
1.1.2bHASAN PACHA
1.1.3bKURT BEY
1.1.1a.1
IBRAHIM HANZADELER1.1.4a.1
MEHMED1.1.4a.2
CAFER
MURAD IV
1
SAFIYYE
x 1659
SARI HASAN PACHA† 1688
1.1
RUKIYYE† 1696
1.2
REZMI MEHMED PACHA† 1719
1.2.1
ISMAIL BEY† 1787
1.2.2
AHMED BEY† 1802
1.2.3
EBUBEKIR BEY† 1751
1.2.4
ABDULLAH BEY† 1743
1.2.5
MEHMED BEY† 1740
1.2.1.1
DANIS MEHMED BEY1.2.4.1
ABDI BEY† 1775
1.2.4.2
SADIK MEHMED BEY† 1780
1.2.4.2.1
MUSTAFA BEY
FATMA HANIM
SIPAHI ALI AGA?
1a
NEVSEHIRLI IBRAHIM PACHA° 1662† 1730
x 1717
FATMA SULTANE† 1733
?
2a
?
3b
GENÇ ALI PACHA
x 1724
ÜMMÜGÜLSÜM SULTANE
1a.4a
MEHMED BEY ?† 1738
1a.1bGENÇ MEHMED PACHA
† 1768
x 1724
ATIKE SULTANE
1a.2bHIBETULLAH
† 1774
KETHÜDA MEHMED PACHA
1a.3bFATMA
† 1766
? PACHA
2a.1
MEHMED EFENDI3b.1
HAFIZ MEHMED BEY† 1764
3b.2
HACI MUSTAFA BEY† 1780
3b.3
HULUSI BEY3b.4
YEGEN MUSTAFA PACHA† 1760
1a.1b.1MEHMED BEY
† 1783
1a.1b.2IBRAHIM BEY
1a.2b.1
?
DIVITDAR EMIN MEHMED PACHA
3b.1.1
HALIL BEY3b.3.1
ALI BEY† 1806
1a.1b.2.1
ALI RIZA BEY† 1793
1a.2b.1.1HACI ABDI BEY
1a.2b.1.2FATMA
1a.2b.1.2.1
EMIN MEHMED BEY
Page | 517
ANNEXES C
MARIAGES ET RELATIONS CONJUGALES
1. Hundi Hatun, fille de Bayezid Ier, mariée à Emir Bukhari
2. Oruz Hatun, fille de Bayezid Ier, et un prince timouride
3. Les alliances nouées autour des filles de Mehmed Ier
4. Fatma Hatun, fille de Murad II, et Zaganos Pacha
5. Şah Sultane, fille de Selim Ier, et Lutfi Pacha
6. Mihrimah Sultane, fille de Süleyman Ier, et Rüstem Pacha
7. Gevherhan Sultane, fille de Selim II, et Piyale Pacha
8. Ayşe Sultane, fille de Murad III, et Ibrahim Pacha (1586), suivi d’une description
des processions nuptiales données à l’occasion des mariages antérieurs
9. Les mariages des descendantes indirectes de Süleyman Ier
10. Fatma Sultane, fille de Murad III, et Halil Pacha (1594)
11. La fille de Gevherhan Sultane, fille de Selim II, et Sinan Paşazade Mehmed Pacha
(1598)
12. Ayşe Sultane, fille de Murad III, et Yemişçi Hasan Pacha (1601)
13. Ayşe Sultane, fille de Murad III, et Güzelce Mahmud Pacha (1604)
14. Fatma Sultane, fille de Murad III, et Murad Pacha (1605)
15. Gevherhan Sultane, fille d’Ahmed Ier, et Öküz Mehmed Pacha (1608-09)
16. Ayşe Sultane, fille d’Ahmed Ier, et Nasuh Pacha (1612)
17. Ayşe Sultane, fille d’Ahmed Ier, et Hasan Pacha (1626)
18. Hanzade Sultane, fille d’Ahmed Ier, et Bayram Pacha (1630 ?)
19. Gevherhan Sultane, fille d’Ahmed Ier, et Receb Pacha (1631)
20. Ayşe Sultane, fille d’Ahmed Ier, et Hafız Ahmed Pacha (1631)
21. Fatma Sultane, fille d’Ahmed Ier, et Canpuladzade Mustafa Pacha (1631 ?)
22. Hanzade Sultane, fille d’Ahmed Ier, et Nakkaş Mustafa Pacha (1649)
23. Safiyye Hanım Sultane, petite-fille d’Ahmed Ier, et Siyavuş Pacha (1643)
24. Fatma Sultane et Musahib Fazlı Pacha (1646)
25. Atike Sultane, fille d’Ibrahim, et Cafer Pacha, puis Kenan Pacha (1648)
26. Kaya Sultane, fille d’Ibrahim, et Haydaragazade Mehmed Pacha (1649)
27. Fatma Sultane et Ahmed Pacha (années 1635-40 ?)
28. Ümmügülsüm Sultane, fille d’Ibrahim, et Ahmed Pacha (1653)
29. Ayşe Sultane, fille d’Ahmed Ier, et Ibşir Pacha (1655)
30. Atike Sultane, fille d’Ahmed Ier, et Müfettiş Ismail Pacha (années 1650) puis
Kasım Pacha
31. Fatma Sultane, fille d’Ahmed Ier, et Melek Ahmed Pacha (1660)
32. Atike Sultane, fille d’Ahmed Ier, et Cerrah Kasım Pacha (1666)
33. Fatma Sultane, fille d’Ahmed Ier, et Yusuf Pacha (1667)
Page | 518
34. Beyhan Sultane, fille d’Ibrahim, et Uzun Ibrahim Pacha
35. Hadice Sultane, fille de Mehmed IV, et Musahib Mustafa Pacha (1675)
36. Rukiyye Sultane, fille de Murad IV, et Gürcü Mehmed Pacha (1693)
37. Fatma Sultane, fille de Mehmed IV, et Tırnakçi Ibrahim Pacha (1695-96)
38. Ümmügülsüm Sultane, fille de Mehmed IV, et Çerkes Osman Pacha (1694)
39. Hadice Sultane, fille de Mehmed IV, et Silahdar Hasan Pacha (1700-01)
40. Rukiyye Sultane, fille de Murad IV, et Maktulzade Ali Bey (Pacha) (1702)
41. Emine Sultane, fille de Mustafa II, et Hasan Pacha (1702)
42. Ayşe Sultane, Emine Sultane et Safiyye Sultane, filles de Mustafa II, avec
Köprülüzade Numan Pacha, Hasan Pacha et Kara Mustafapachazade Ali Pacha
(1702)
43. Fatma Sultane, fille d’Ahmed III, et Silahdar Ali Pacha (1709)
44. Safiyye Sultane, fille de Mustafa II, et Maktulzade Ali Pacha (1710)
45. Fatma Sultane, fille d’Ahmed III, et Nevşehirli Ibrahim Pacha
46. Atike Sultane, Hadice Sultane et Ümmügülsüm Sultane, filles d’Ahmed III, avec
Mehmed Bey (puis Pacha), Ali Beg et Çerkes Osmanpachazade Ahmed Bey
(1728)
47. Saliha Sultane, Ayşe Sultane et Zeyneb Sultane, filles d’Ahmed III, avec Mustafa
Pacha, Silahdar Ali Pacha et Mustafa Pacha (1728)
48. Ayşe Sultane, fille de Mustafa II, et Ebubekir Pacha (1732)
49. Asime Sultane, fille de Mustafa II, et Yakub Pacha (1733)
50. Safiyye Sultane, fille de Mustafa II, Saliha Sultane et Ayşe Sultane, filles
d’Ahmed III, avec Ebubekir Pacha, Ali Pacha et Ahmed Pacha (1740)
Page | 519
1) Hundi Hatun, fille de Bayezid Ier, mariée à Emir Bukhari
« Non content d’avoir par la terreur mis un terme à la vénalité des juges, Bayezid
s’efforça de neutraliser, par une meilleure conduite, les effets du mauvais exemple qu’il
avait donné à ses sujets. Guidé dans la voie du repentir par le grand scheïkh Boukara
(ainsi appelé du nom de sa ville natale, mais plus connu sous le nom d’Emir Sultan), il
fit, en expiation de ses fautes, construire à Broussa deux mosquées. L’une s’élève hors
des murs sur les bords du torrent Aktschaghlan (à l’écume blanche), dans un site
solitaire et pittoresque ; l’autre, bâtie dans le quartier de Broussa qui porte encore le
nom d’Emir Sultan, fut donnée au pieux Boukhara, qui avait su, malgré la sévérité de
ses princes, gagner non seulement l’amitié de Bayezid, mais encore l’amour d’une de
ses filles, dont il devint l’époux. »1
*
« Nous avons déjà fait mention du moufti Fenari, ainsi que du Scheïkh Bokhari, qui
avait su se faire aimer de la sœur [erreur : fille] de Bayezid et l’avait épousée. »2
*
« Seïd Natta (le Nattier), né à Bagdad, avait été élevé par le grand cheikh Emir Sultan,
qu’il accompagna à la cour de Bayezid. Lors du mariage d’Emir Sultan avec la sœur
[erreur : la fille] de ce souverain, son disciple épousa la fille d’Ishak Pacha. A
l’exemple de Bayezid, qui avait fait construire à Broussa une mosquée et un couvent
pour son beau-frère, Ishak Pacha fonda également pour son gendre une mosquée et un
couvent, dont les derwichs reçurent dans la suite le nom d’Abou Ishak. A l’époque où
les Tatares, sous Timour, dévastèrent l’Asie, Seïd Nataa avait été fait prisonnier ainsi
que son maître et le savant Fenari, avec lesquels il fut ensuite rendu à la
liberté. Yildirim Bayezid, en l’honneur de ses hautes vertus, l’avait nommé chef des
seïds ou émirs, c’est-à-dire des parents du Prophète. A la fête que donna Mourad II, à
l’occasion de la circoncision de son fils Mohammed, Seïd Nataa étendit des nattes
fabriquées de sa main sur la table, luxe inconnu jusqu’alors chez les Ottomans. »3
1 Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 1 p. 76. Hammer précise en note qu’il se réfère aux propos
de Sadeddin, d’après un manuscrit de Taşköprüzade. 2 Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 2 p. 52.
3 Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 2 p. 177.
Page | 520
2) Oruz Hatun, fille de Bayezid Ier, et un prince timouride
« Mohammed Sultan [mirza de l’armée tatare de Timur, après la bataille d’Ankara] fut
rejoint par Mikhalidj par l’avant-garde sous les ordres d’Eboubekr-Mirza et l’émir
Sewindjik qui avait saccagé tous les villages situés sur le bord de la mer. Peu de temps
après son retour à Broussa, le prince célébra, dans la plaine de Yenischehr, son
mariage avec la fille aînée de Bayezid. »4
4 Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 2 p. 53.
Page | 521
3) Les alliances nouées autour des filles de Mehmed Ier
« [I. Mehmed] Kızlarınuñ üçini üç Karaman-oglanlarına, birin
Ibrâhîm’e ve birin Alâeddîn’e ve birin Îsâ’ya ; ikisin dahı Isfendiyâr-
oglanlarına, birin Ibrâhîm’e ve birin Kâsım’a ; birin Anatolı
beglerbegisi Karaca Beg’e, kim Varna gazâsında şehîd oldı, birin
dahı İbrâhîm Paşa-oglı Mahmûd Çelebi’ye virdi. Ol kız, Mekke’de
şerrefehâ’llâhu vefât itdi anda yatur. »5
« Il [Mehmed Ier] donna trois de ses filles à des fils [du bey] de Karaman,
l’une à Ibrahim, une autre à Alaeddin et la dernière à Isa. Il en donna deux
autres à des fils de Isfendiyar, l’une à Ibrahim, l’autre à Kasim. Il donna
encore une [de ses filles] à Karaca Bey, gouverneur d’Anatolie, qui mourut
en martyr lors de la guerre sainte à Varna, et la dernière au fils d’Ibrahim
Pacha Mahmud Çelebi. Cette fille mourut à La Mecque, la gloire de Dieu,
où elle fut inhumée. »
*
« Ces arrangements terminés, Mourad II repassa l’Hellespont et revint à Andrinople
pour s’occuper des préparatifs de ses noces avec la fille du prince de Sinope. Il envoya
à la cour d’Isfendiar Elwanbeg, son premier écuyer-tranchant, et la veuve de Khalil
Pacha, qui sous le règne de Mohammed avait été élevée dans le harem, tous deux
chargés de ramener sa fiancée, avec les honneurs dus au rang qu’elle allait occuper. Le
prince de Sinope les reçut avec magnificence, et remit sa fille à la garde de la veuve de
Khalil Pacha et de la femme du prince de Kermian. (828-1424)
Partout des fêtes brillantes signalèrent le passage de la future épouse ; elle fit son
entrée dans Andrinople au milieu d’une pompe dont l’empire ottoman n’avait pas
encore eu d’exemple. Mourad célébra le mariage de ses trois sœurs en même temps que
le sien : il donnait l’une d’elles à Kasimbeg, fils d’Isfendiar ; l’autre à Karadja
Tschelebi, qui gouvernait l’Asie Mineure, et qui périt quelque temps après la bataille de
Warna ; la troisième au fils d’Ibrahim Pacha, Mahmoud Tschelebi, qui mourut à la
Mecque. »6
*
« De toutes les mutilations de noms propres qu’on remarque à chaque page dans les
historiens européens, celle qu’a subie successivement le nom de Mahmoud Tschelebi est
5 Neşrî, Cihânnümâ, p. 267. Les passages soulignés correspondent à des ajouts fournis par les autres
manuscrits conservés de cette histoire. 6 Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 2 p. 122.
Page | 522
encore la plus inexplicable. Ce Mahmoud Tschelebi, gendre du sultan, est appelé par
Callimachus et Bonfinius, Calepin et Carambus. Engel (Histoire de Hongrie, III, p 63),
qui en outre ne reconnaît pour gendre de Mourad, que le beglerbeg d’Anatolie, fait de
Carambus, Caram. Voyez du reste Neschri, Idris, Solakzadé et Ali. »7
7 Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 2 p. 255 (notes et éclaircissements LII). Il se répète ailleurs
dans le texte : « Mahmoudbeg, gendre du sultan, fait prisonnier à l’affaire de Konoviza, est désigné sous
le nom de Carambus » : p. 176.
Page | 523
4) Fatma Hatun, fille de Murad II, et Zaganos Pacha
« Khalil Pacha crut l’occasion favorable pour plaider en faveur de Constantinople, et
s’efforça de déterminer le sultan à faire la paix avec l’empereur ; vainement il lui
représenta que d’autres secours plus considérables pouvaient être envoyés à l’ennemi,
et qu’il lui serait impossible de les intercepter. Il avait contre lui le vizir Saganos
Pacha, beau-frère et favori du sultan, le molla Mohammed Kourani, qui avait élevé le
sultan, et le scheik Akschemseddin, dont les prédications entretenaient l’enthousiasme
des troupes. »8
*
« Le faubourg de Galata fit sa soumission particulière après la prise de Constantinople.
Galata était alors protégée par une forte muraille et habitée par les Génois dont les
flottes couvraient la mer ; ce fut là que les Turcs amenèrent ceux des Grecs qui
n’avaient pas encore été réduits en esclavage. Les députés envoyés à Saganos Pacha,
vizir et gendre du sultan, demandèrent et obtinrent que la ville ne fût pas livrée aux
horreurs du pillage. »9
8 Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 2 p. 198.
9 Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 2 p. 211-212.
Page | 524
5) Şah Sultane, fille de Selim Ier, et Lutfi Pacha
« Bien différent d’Ayas Pacha, Lutfi, loin d’aimer les femmes, faisait profession de les
mépriser, et les mauvais traitements qu’il fit subir à la sœur du Sultan qu’il avait
épousée lui attirèrent deux ans plus tard la disgrâce de son beau-frère. Déposé de sa
charge, il fut séparé de la sultane sa femme et exilé à Dimetoka. »10
*
« Un jour il alla jusqu’à ordonner qu’une Mahométane surprise au milieu de ses
débauches fut mutilée à coups de rasoir dans une partie du corps que la pudeur ne
permet pas de nommer. L’indécence et la barbarie de cette punition révoltèrent tous les
esprits. Lutfi Pacha était marié à une Sultane, sœur de son maître. Cette princesse
indignée lui fit les reproches les plus vifs et les plus amers. Ne devais-tu pas, lui dit-elle,
respecter la pudeur ? Comment as-tu pu inventer un supplice aussi cruel et aussi
flétrissant ? Il est fait pour le crime, répondit le vizir, et désormais il sera la peine que
l’on infligera à toutes celles qui se déshonoreront au mépris de la religion et des lois. A
ces mots la Sultane l’accabla d’injures, et le traita d’impudent, de barbare, de tyran.
Transporté de colère, le ministre met la main sur une masse d’armes et se précipite sur
elle ; aux cris de la Sultane, les filles esclaves et les eunuques préposés à la garde
volent à son secours et chassent à coup de poings le vizir de l’appartement de leur
maîtresse. Un événement si extraordinaire entraîna la perte de Lutfi Pacha. Süleyman
blâma hautement sa conduite, ordonna sa séparation de la Sultane, le dépouilla de sa
dignité, et l’envoya en exil à Demitoca, où il termina ses jours »11
.
10
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 5 p. 151. 11
D’Ohsson, Tableau général : t. 4 p. 351.
Page | 525
6) Mihrimah Sultane, fille de Süleyman Ier, et Rüstem Pacha
« A l’occasion de la circoncision des deux princes Bayezid et Cihangir, furent données
des fêtes qui durèrent quinze jours, du 11 au 26 novembre. Le premier jour, Süleyman
se rendit à l’Hippodrome ; les vizirs, les beglerbegs et les begs vinrent le recevoir et lui
présenter leurs félicitations. Un magnifique festin fut offert aux janissaires et aux
gardes-du-corps. Des lions, des tigres, des léopards, des panthères, des lynx, des loups
et des girafes furent donnés en spectacle à la multitude. Le lendemain, le sultan, assis
entre les kadiaskers et les defterdars, reçut l’hommage et les présents des vizirs ; Lutfi
Pacha, l’eunuque octogénaire et conquérant de l’Arabie, Süleyman Pacha, Sofi
Mohammed Pacha, Rüstem Pacha, Süleyman Pacha, gouverneur d’Anatolie, et Ferhad
Pacha, gouverneur de Caramanie, furent admis à la cérémonie du baise-main ; les
ambassadeurs de France, de Venise, ceux de Ferdinand roi de Hongrie et du roi Jean
Zapolya, partagèrent cet honneur. Les lutteurs, les saltimbanques, les bateleurs, les
ombres chinoises, les jongleurs et les bouffons furent chargés d’amuser le peuple. Puis
ce fut le tour des chanteurs, des danseurs, des musiciens et même des Juifs qui
apportèrent sur la place centrale un dragon à sept têtes. Les vizirs et les émirs, les
oulémas et les cheikhs obtinrent tous de riches présents de la magnificence du
souverain, et se retirèrent revêtus de caftans d’honneur. Simultanément avec la
circoncision de ses fils, Süleyman célébra le mariage de Rüstem Pacha avec sa fille
Mihrimah. »12
12
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 5 p. 151-152.
Page | 526
7) Gevherhan Sultane, fille de Selim II, et Piyale Pacha
« Büyük paşaların eşleri, özellikler de padişahın ailesine mensup kadınlar, tıpkı erkek
hizmetkârlarda olduğu gibi, cariyeler arasında da bir görev bölüştürmesi
yapmaktadırlar. Cariyelerin her birine, yaptıkları işe göre günde dört-beş akçe ödenir.
Sultan hanımlar da tıpkı sipahiler gibi kuşaklarında bir hançer bulundururlar. Piyale
Paşa’nın eşi, kocasının cariyelerden birinin boyuna dokunduğunu aynadan
gördüğünde, hemen arkasını dönüp onu hançeriyle öldürmüş. »13
13
Gerlach, Türkiye Günlüğü : t. 2 p. 677.
Page | 527
8) Ayşe Sultane, fille de Murad III, et Ibrahim Pacha (1586), suivi d’une
description des processions nuptiales données à l’occasion des mariages
antérieurs
« Vezîr İbrahim Paşa hazretleri dâmâd-ı Pâdişâh-ı âlem-penâh
olup, Kapudan Kılıç Paşa hazretleri sağdıç buyurılup ve Eski-
sarây’a nişân gidüp ve akd-ı nikâh olduğıdur.
Ve sene 994 cumâdelâhiresinün gurresinde Vezîr-i saltanat-ârâ
İbrahim Paşa –edâme’llâhu taʻâlâ iclâlehû– hazretleri hidmetinde
terbiyesiyle hâsıl olup, makbûl emekdâr, mahrem-i râz hidmetkârı,
vâcibü’r-riʻâyesi olmağın damadlık izzetiyle müstesʻid buyurılup ve
sağdıçlık hidmeti dahi şîr-i ner-i heycâ ve neheng-i deryâ-yı vegâ
Mîrimîrân ve Kapudan Kılıç Ali Paşa –dâme ikbâlühû– hazretlerine
fermân olunup, lâyık u sezâvâr olduğı üzre harc-ı ferâvân ve bezl-i
mâl-i bî-pâyân idüp hazret-i saltanat-ı âlî-şân içün Sarây-ı Atîka
nişân-ı saʻâdet-şân göndermekde âlî-himmetlik eyleyüp efendisi
yoluna varın nisâr eylemekde yed-i ulyâ gösterdi. Vezîriaʻzam –
edâllâhu taʻâlâ iclâlehüm– hazretleri taraflarından dahi ale’t-tertîb
zî-kıymet cevâhirle murassa` ve müzeyyen istefanlar ve elmas ve
yakut ve laʻl ve zümmürrüd ile mücevherlü levhler ve bileziker tertîb
eyleyüp irsâl eylediler. Ve Kapudan Paşa hazretlerinün tedârük
eyledüği duvak ve çizme elli bin altun tahmîn olunup ve sâ’ir esbâb
ve âlât-ı şeker ve mühimmât-ı lâzime küllî harc ile görilüp şevket ü
haşmet-i tâm ve şöhret ve ikrâm u ihtirâm-ı mâlâ-kelâm ile debdebe-
i saltanat üzre çekilüp Sarây-ı Atîka vusûl bulduklarında Rûmili
Beğlerbeğisi Mehmed Paşa ve Kapudan Paşa hazretleri ikişer hilʻat-
ı fâhire ile teşrîf buyuruldı. Ve Tersâne-i Âmire Emîni Mustafa
Çavuş, ki cümlenün muhtârı mu’temedün-aleyhdür ve Tersâne
Kethüdâsına ve ağasına Kapudan Paşa’nun cemîʻan ağalarına bi-
esrihim ağır hilʻatlar geydirildi. Ve sâ’ir hüddâm-ı zeviʻ-
lihtirâmlarına inʻâm u ihsân olunan donluk kumaşdan gayrı ol gün
tamâm bin hilʻat sarf olundı. Ve cihâz alunduğı gün, ki akd-i nikâh
dahi ol gün vâkî` olmışdı, dâmâd ve arus cânibinden virile serâser
ve akmişe-i mütenevviʻa ve hilʻat defteriyle tamâm üç bin kıtʻa
virilmişdi. Ve Hoca-i Şâh-ı cihân, a’lemü’l-ulemâ ve efdâlü’l-fudulâ
mevle’l-mevâlî Saʻdî Efendi –dâmet fezâ’ilühû– hazretleri izn-i
hümâyûn ile üç yüz bin sikke altun akd-i nikâh eylediler. Ve şimdiye
değin vâkiʻ olan selâtîn-i selek nikâhları yüz bin altundan ziyâde
vukûʻ bulmaduğın yine müşârun-iley hazretleri nakl ü hikâyet
buyurdılar.
Sâdât-ı enâm Nakîb ile ziyâfet olduğıdur.
Page | 528
Ve düğün ziyâfetlerine şurûʻ olundukda be-tahsîs dâdât u eşrâf –
zâdehâ’llâhu taʻâlâ şerefen ve taʻzîmen– ile İstanbul Efendisi olan
Nakîbüleşrâf Mevlânâ Mîr Mahdûm hazretleri ziyâfet olundı.
Ulemâ-i kirâm ziyâfet olduğıdur.
Ve bir gün dahi ulemâ-i izâm –kesserehümü’llâhi taʻâlâ ilâ yevmi’l-
kıyâm– ile Müftilenâm ve Şeyhülislâm Çivizâde Efendi ve Hoca
Efendi –dâmet fezâ’ilühümâ– hazretleri daʻvet-i ziyâfet olunup,
ikrâm u ihtirâm olundılar. Ve âmme-i ulemâ ile sımât-ı niʻmete
çıkmayup, Paşa hazretleri odasında tenha oturup musâhabet
eylediler. Ve Paşa hazretleri icâzetle ulemâya sımât cıkup şeneldiler.
Ve erkân-ı saʻâdet ziyâfet olunup, âyîn-ı saltanat üzre Sultân
hazretleri Eski Sarây’dan geldüğidür.
Ve şehr-i mezbûrenün üçünci penç-şenbih gün aʻyân-ı devlet ü
saʻâdet vüzerâ-i izâm –edâme’llâhu taʻâlâ iclâlehüm ve ebkâhüm–
hazretleri şevket ü haşmet ile At-meydânı Sarâyı’nda ale’s-seher
hâzırûn olup cemʻiyyet-i azîm oldı. Kâʻide-i kadîme ve Kânûn-ı
saltanat üzre Sadrıaʻzam Siyâvûs Paşa –dame zılluhû– hazretleri
geldükde İbrahim Paşa hazretleri atdan nuzûl ideceği kademe-i
nerdübâna varup koltuğına girdi. İʻzâz u ikrâm ile gelüp sadr-ı izzete
oturdı. Yemîn u yesâr erkân-ı saʻâdet yerlü yerinde kâʻim Dîvân-ı âlî
olup, çavuşlar karşu turup alkışladı. Şerbet içildükde çavuşların
sitâyiş duʻâları âfâka çıkdı. Meclis-ârâ sâzendeler ve hoş-edâ
gûyendeler usûl üzre dem-sâz olup, ışk u şevk ehlini söz ü sâz teşrîf
eyleyüp, hâlet-bahş oldılar. Baʻdehû erbâb-ı lehv u luʻb geldi.
Matrakcı-başı kırk nefer hasmâne yoldaşlarıyle âzmâyiş-i ceng
eyleyüp darb u harblerin seyr u temâşâ itdürdiler. Ve rikâb-ı
hümâyûn ağaları ale’t-tertîb vüzerâ-i izâm hazretlerine makrama-i
dest ve leğen ve ibrik getürüp Beğlerbeğiler ve Kapudan ve Yeniçeri
Ağasına çaşnigîrler makrama ve ibrik virdiler. Ve envâʻ-ı niʻam-ı
İlâhî çekilüp, ziyâfet-i âlî olup, hoş-elhân hâfızlar Kur’ân-ı azîm ile
müşerref eylediler. Şükr ü Sipâs-ı minnet-i zü’l-minen olundı. Ve
kable salâti’l-asr yine aʻyân-ı saʻâdet kalkup ferr ü şevketle Sarây-ı
Atîk’a varılup Sultân-ı âlî-şân –dâmet izzetühâ– hazretleri kadîmden
selâtîn-i izâma mahsûsa olan duhte kırmızı atlas cibinlik ile çıkup ve
kemâl-i izz ü ikbâl ve azamet ü rif`at ü iclâl, ki andan ziyâde tutuk
mutasavver olmaya, âdâb-ı saltanat üzre erkân-ı saʻâdet önüne
düşüp ve nahl-i murassaʻ ve mücevher önince götürülüp ve minaret
misâm on iki zirâʻ kadd ile iki nahl-i dil-ârâ, ki üstâdân-ı cihân kâr-
gâh-ı âlemde nice bin dürlü sanʻat u mahâret ızhâr eyleyüp reng-i
bukalemun göstermişlerdi. Bâ-izz ü nâz merdân-ı dilâverân
önlerince götürüp hırâmân olup, gelmişlerdi. Halk-ı âlem
temâşâsında hayrân u nigerân kalup, herkesün mübârek-bâd
duʻâları vird-i zebânları olmışdı. Vâfir ve müstevfâ çili akçalar îsâr
u nisâr olunup, yağmacılar etek etek akçalar aldılar. Ve bi’l-cümle
Page | 529
hissedâr olmayanlara “Nasîblü yer köteği” diyü cevâb-ı bâ-savâb
virdiler. Ve’l-hamdü li’llâhi vahdehû.
Kadîmden vüzerâ-i izâm ve selâtîn-i kirâm cemʻiyyetlerinde ide-
geldükleridür.
Ve mukaddemâ Sultân Süleyman Han –aleyhi’r-rahmetü ve’r-
rıdvân– zamânında Mihrumâh Sultân –tâbet serâhâ– merhûm
Rüstem Paşa’ya Sarây-ı Atîk’den çıkdukda Sadrıaʻzam merhûm
Hadım Süleyman Paşa rahtdan inüp tutuk-ı Sultân önünce
yürümişler, nâmûs-ı saltanat ve kadr ü izzet gözetmişler. Ve merhûm
ve mağfûrûnleh Şehzâde Sultân Mehmed duhteri Hümâ Sultân –tâbet
serâhâ– merhûm Ferhad Paşa’ya Sarây-ı Atîk’den kezâlik çıkdukda
merhûm Rüstem Paşa ol kânûna riʻâyet idüp Sarây-ı Atîk gûşesine
gelince yayan elinde asâ ile yürümişdi gördük. Ve Şehzâde Sultân
Selim Han duhterleri selâtîn-i zevi’l-ihtirâm Vezîr Mehmed Paşa’ya
ve Kapudan Piyâle Paşa’ya ve Yeniçeri Ağası Hasan Ağa’ya Sarây-ı
Atîk’den çıkduklarında Sadrıaʻzam merhûm Semiz Ali Paşa idi.
Sıklet-i semen ile derd-i pâya mübtelâ olmağın özr beyân idüp
Pâdişâh-ı âlem-penâhdan icâzet-i hümâyûn almışdı. Ve bu defʻa
dahi müşârun-ileyh Sadrıaʻzam Siyâvuş Paşa hazretleri ola-geldüği
üzre sarây kapusundan taşra çıkup, ata binmişler idi, gördük. Ve’s-
selâmü alâ men semiʻa’l-kelâm. »14
« Son Excellence le vizir Ibrahim Pacha est devenu le gendre du Padişah
refuge du monde ; Son Excellence le Kapudan Kılıç Pacha a été nommé
pour être son témoin ; la nouvelle a été transmise au Vieux Palais et le
contrat de mariage a été conclu.
Le premier jour du mois de Cemaziü’l-evvel de l’année 994 [20 avril 1586],
on accorda une promotion à Son Excellence le Vizir qui orne le
gouvernement, Ibrahim Pacha –que Dieu, qu’Il soit exalté, perpétue sa
gloire. Il s’est vu nommé de façon auspicieuse à la dignité de gendre
[impérial], en récompense de sa longue fidélité, de son service en tant que
confident secret, qui mérite le respect. Et un firman a été émis à destination
de Son Excellence le Mirmiran et Kapudan Kılıç Ali Pacha, le lion des
batailles, le requin de mer des combats –fasse que sa félicité se perpétue !–
le désignant pour endosser la responsabilité de témoin. Pour s’acquitter de
sa tâche de façon méritante, il réalisa des dépenses abondantes et fit des
dons infinis. Quand on envoya la marque de l’état de félicité [l’annonce du
mariage ?] au Vieux Palais, il fit preuve d’un très grand zèle pour [la
manifestation de] la majesté du sultanat de haute gloire. Quand il distribuait
des dons sur la route de son maître, il faisait preuve d’une générosité
sublime. Son Excellence le grand vizir –que Dieu, qu’Il soit exalté, perpétue
14
Selânikî, Târîh-i Selânikî : t. 1 p. 168-171.
Page | 530
sa gloire–, de son côté, avait préparé et envoya successivement des bijoux et
des perles, des couronnes embellies, des diamants, des rubis, des grenats,
des émeraudes ainsi que des plaques et bracelets sertis de pierreries. Le
voile de la mariée et les bottes que Son Excellence le Kapudan Pacha a
fourni ont été estimés à 50 000 pièces d’or. Il s’est également acquitté de la
dépense de toutes les autres affaires et ouvrages en sucre et toutes les choses
importantes nécessaires. Tout cela fut réalisé dans le respect des
démonstrations de la souveraineté, dont la majesté et la grandeur impériale
[sont] parfaites, la réputation, la courtoisie et la déférence indiscutables. A
leur arrivée au Vieux Palais, Leurs Excellences le gouverneur de Roumélie
et le Kapudan Pacha ont tous deux été honorés de leur visite avec de
précieuses robes d’honneur. Et le superviseur de l’arsenal impérial, Mustafa
Çavuş, qui avait été choisi comme responsable de ses dépenses, son
Intendant de l’arsenal, son aga et l’ensemble des agas du Kapudan Pacha
ont également été revêtus de lourdes robes d’honneur, tous sans
distinction. Ce jour-là, 1000 robes d’honneur furent dépensées au total, sans
compter les morceaux de tissus ayant été offerts et donnés aux autres
eunuques de grand honneur. Et le jour de remise du trousseau de la mariée,
qui eut lieu le jour même de la signature du contrat de mariage, trois mille
mesures [de tissus] au total avaient été remises par le gendre et la fiancée,
du début jusqu’à la fin, y compris en couvertures diverses et en robes
d’honneur, [ainsi qu’il a été inscrit] dans le registre [des dons]. Et Son
Excellence le professeur du Souverain de l’univers, le savant des savants, le
vertueux des vertueux, le maître des maîtres Sadi Efendi –que sa vertu
perdure– a conclu, le contrat de mariage [établissant] la somme de 300 000
pièces d’or [de douaire], avec le consentement impérial. Et bien que, jusqu’à
présent, les mariages réalisés sous les sultans précédents ne dépassaient pas
les 100 000 pièces d’or, Son Excellence susdite s’est acquittée du transfert
[d’argent] et de la diffusion de l’information.
La visite du Chef des descendants du Prophète
A l’occasion des visites au marié, le nakibüleşraf, Monsieur le chef des
descendants du Prophète et cadi d’Istanbul, est venu rendre visite à Son
Excellence au nom des enfants et descendants du Prophète –que Dieu, qu’Il
soit exalté, perpétue l’honneur et le respect de ses descendants.
La visite des honorables oulémas
Un autre jour, Leurs Excellences le Moufti de l’humanité et Cheikh-ul-islam
Çivizade Efendi, accompagné des glorieux oulémas – qu’ils bénéficient des
bienfaits de Dieu – qu’il soit exalté ! – le jour du jugement dernier –, et le
Hoca Efendi –que sa vertu perdure– ont également été invités à venir faire
leur visite. Ils apportèrent des présents et cadeaux. Aucune marque de
faveur [particulière] ne fut témoignée envers le public des oulémas ; ils
s’assirent à l’écart dans la chambre de Son Excellence le Pacha et
conversèrent [entre eux]. Quant à Son Excellence le Pacha, après avoir
Page | 531
présenté ses marques [de respect] aux oulémas, avec leur permission, il se
divertit.
La visite des hauts officiers de l’Etat, puis la venue de Sa Majesté la
Sultane du Vieux Palais, au cours d’une cérémonie impériale.
Et le jeudi du même mois [22 avril 1586], Leurs Excellences les piliers de
l’Etat et de la félicité les vizirs –que Dieu, qu’Il soit exalté, perpétue leur
gloire et leur grandeur– se rendirent au petit matin au palais de
l’Hippodrome en grande pompe ; les fêtes de mariage furent magnifiques.
D’après les anciennes coutumes et les lois dynastiques, à l’arrivée de Son
Excellence le grand vizir Siyavuş Pacha –que sa gloire perdure–, Son
Excellence Ibrahim Pacha lui a présenté des marches d’escaliers pour sa
descente de cheval et il s’est installé dans un fauteuil. Il est venu avec des
cadeaux et des présents, et s’est assis à la place d’honneur. Les piliers de
l’Etat se sont installés à leur place respective au Conseil impérial, à sa droite
et à sa gauche ; les çavuş se tenaient en face et l’acclamèrent. Pendant que
l’on buvait les sorbets, les prières d’éloge des çavuş se sont élevées jusqu’à
l’horizon. Des musiciens de bonne compagnie et des chanteurs à la voix
agréable se sont accordés sur leur composition, ils ont honorés de leurs
paroles et leurs sons l’assemblée d’amour et de joie, diffusant ainsi la bonne
ambiance. Les spécialistes des amusements et des jeux vinrent alors. Le chef
des lutteurs et quarante de ses camarades peu amènes firent un combat
expérimenté, ils présentèrent un spectacle et une représentation d’une
grande violence et d’une grande combativité. Et les agas de l’étrier royal
apportèrent des mouchoirs, des bassines et des aiguières à Leurs Excellences
les vizirs, selon leur rang. Les gouverneurs de province, l’amiral de la flotte,
le chef des janissaires et les goûteurs du palais donnèrent des mouchoirs et
des aiguières. On présenta toutes sortes de divines nourritures et il y eut un
sublime banquet qui fut honoré par les récitants à la voix agréable du Coran
sacré. On présenta d’infinis remerciements et gratitudes suprêmes. Avant la
prière du début de soirée, les piliers de la félicité se levèrent et se rendirent
au Vieux Palais en grande pompe ; Sa Majesté la Sultane de grande dignité
–que la protection divine soit sur elle– sortit [dissimulée derrière] un voile
de satin rouge ouvragé, réservé selon la tradition aux envois des sultanes. La
perfection du mérite et de l’honneur, la grandeur de la sublimité et de la
gloire, qui après [son mariage] fut considérée comme encore plus [digne],
fut déposée devant les piliers de la félicité, selon les pratiques dynastiques,
sans que sa personne n’ait été aperçue. Elle fut emmenée devant les
palmiers-dattiers de joyaux et de pierres précieuses et on lui présenta deux
palmiers-dattiers ornant les cœurs pareils à des minarets de 12 coudées de
hauteur, qui donnaient à voir des couleurs de mille feux et qui manifestaient
l’art et le talent des artistes du monde dans les ateliers de ce monde. On fit
venir devant elle avec honneur et coquetterie les hommes courageux, qui
marchaient avec élégance. On resta admiratif et attentif devant le spectacle
de la population du monde ; tout le monde répéta sans cesse les prières de
Page | 532
louange envers son abondance. Une très grande quantité d’aspres neufs fut
distribuée et donnée avec largesse et les faiseurs de butin ramassèrent [à
cette occasion] une foultitude d’aspres. Et ils répondirent même avec
justesse à ceux qui n’avaient pas eu leur part : “celui dont c’est la part
recevra des coups”. Louanges à Dieu l’Unique.
Ceux qui participent traditionnellement aux cérémonies de mariage des
grands vizirs et des honorables princesses.
Par le passé, à l’époque de Sultan Süleyman Han –que le pardon et la grâce
divine soit sur lui–, à l’occasion de la sortie de Mihrimah Sultane –qu’elle
repose en paix– du Vieux Palais vers le palais du défunt Rüstem Pacha, le
défunt grand vizir Hadım Süleyman Pacha était descendu de son cheval et
avait marché devant la timide Sultane, mettant en évidence l’honneur
impérial, sa magnificence et sa gloire. De même, lors de la sortie du Vieux
Palais de la fille de feu le prince Sultan Mehmed, Hüma Sultane –qu’elle
repose en paix– pour se rendre au palais du défunt Ferhad Pacha, le défunt
Rüstem Pacha s’était conformé à cet usage : en arrivant au coin du Vieux
Palais, nous l’avons vu en train de marcher le bâton à la main. Mais lors de
la sortie du Vieux Palais des filles du prince Sultan Selim Han, les
princesses dignes de vénération, pour se rendre aux palais du vizir Mehmed
Pacha, de l’amiral Piyale Pacha et du chef des janissaires Hasan Ağa, le
grand vizir était le défunt Semiz Ali Pacha. Comme il souffrait d’un
problème de résistance du à son obésité excessive, il avait présenté des
excuses et avait reçu une permission du Padişah refuge du monde [pour
demeurer sur son cheval]. Cette fois-ci encore, à l’occasion de la venue
traditionnelle du défunt grand vizir susdit Siyavuş Pacha, nous avons vu
celui-ci sortir de la porte du palais et monter sur son cheval. »
*
« Lorsque Süleyman avait marié sa fille Mihrimah à Rüstem, et sa petite-fille Huma à
Ferhad Pacha, les deux grands vizirs, l’eunuque Süleyman et Rüstem Pacha avaient
marché à pied, un bâton à la main, devant les fiancées, depuis le vieux séraï jusqu’à
leurs nouvelles résidences ; mais lorsque Süleyman avait célébré les noces de ses trois
petites filles avec Sokolli, Pialé, et l’aga des janissaires Hasan, le grand vizir Ali reçut
la permission de remplir cette cérémonie à cheval, en considération de son excessif
embonpoint et de ses accès de goutte. »15
*
« Murad, depuis longtemps déterminé à donner sa fille la sultane Aïsché en mariage à
Ibrahim, fixa la célébration des noces au 20 mai de l’année suivante (1586). Par une
faveur toute particulière, la dot de la princesse, qui d’après le kanoun était fixée à cent
mille ducats, fut portée au triple ; les noces furent cependant retardées jusqu’au 9 juin.
15
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 7 p. 95-96.
Page | 533
Le kapitan-pascha Kilidj-Ali, nommé paranymphe, offrit en cette qualité à la fiancée un
présent d’une valeur de cinquante mille ducats, et se chargea de faire les frais des
sucreries et des palmes de noces. Le jour des fiançailles, Kilidj-Ali se rendit au vieux
séraï, où il fut revêtu, ainsi que Mohammed, beglerbeg de Roumélie, d’habillements
d’honneur ; on distribua en outre aux grands de l’empire jusqu’à trois mille kaftans,
ainsi que le prouvent les registres. L’historien Sadeddin, précepteur du sultan,
contribua à la dot de la princesse pour une somme de trois mille ducats. Les quatre
jours suivants, les émirs et tout le corps des oulémas, à la tête desquels le nouveau
moufti Tschiwizadé, furent invités à un somptueux festin. Le 29 mai, le fiancé traita,
dans son palais de l’hippodrome (l’ancienne résidence d’Ibrahim, favori de Süleyman),
le grand vizir, les autres vizirs ses collègues, les beglerbegs et le kapitan-pascha,
auxquels il fit distribuer des pièces de drap et des vases précieux ; quarante chanteurs
et lutteurs avaient été appelés pour égayer la fête. Dans l’après-midi du même jour, les
vizirs, ayant le grand vizir en tête, allèrent chercher la fiancée au vieux séraï ; ils la
conduisirent au palais d’Ibrahim, sous un baldaquin de satin rouge, tel que celui qui
était destiné d’ordinaire aux princesses. En tête du cortège étaient douze palmes de
noces, hautes de douze aunes, et une autre plus petite, toute garnie de pierrerie ; le
grand vizir, monté sur un beau cheval, précédait immédiatement la princesse. Lorsque
Süleyman avait marié sa fille Mihrimah à Rüstem, et sa petite-fille Huma à Ferhad
Pacha, les deux grands vizirs, l’eunuque Süleyman et Rüstem Pacha avaient marché à
pied, un bâton à la main, devant les fiancées, depuis le vieux séraï jusqu’à leurs
nouvelles résidences ; mais lorsque Süleyman avait célébré les noces de ses trois petites
filles avec Sokolli, Pialé, et l’aga des janissaires Hasan, le grand vizir Ali reçut la
permission de remplir cette cérémonie à cheval, en considération de son excessif
embonpoint et de ses accès de goutte. Siawousch Pacha utilisa cet antécédent dans son
intérêt et celui de ses successeurs. »16
16
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 7 p. 95.
Page | 534
9) Les mariages des descendantes indirectes de Süleyman Ier
« Trois autres, tels que Ferhad Pacha, le quatrième vizir Mahmoud, et le troisième vizir
Ahmed, avaient épousé, le premier la fille du prince Mohammed, le second la fille du
prince Moustafa, et le troisième une princesse du sang, toutes les trois petites-filles de
Süleyman Ier. Ahmed Pacha maria, dans le cours de l’année 1576, sa fille à l’agha des
janissaires Djighalizadé (Cicala), avec un déploiement de magnificence
extraordinaire ; le présent du paranymphe Siawousch valait soixante mille ducats ; les
palmes de noce coûtèrent seules mille ducats, l’habit de la fiancée cent mille, et les
sucreries distribuées au peuple le double. Ces dépenses furent faites par la sultane
Mihrimah, femme de l’ancien grand vizir Rüstem Pacha, dont les revenus étaient
estimés à deux mille ducats par jour. »17
*
« Les princesses du sang, qui, par leur influence, élevèrent leurs maris et leurs favoris
aux plus hautes fonctions de l’empire, et surent, ou les y maintenir, ou, en cas de
déposition, sauver leur vie et leurs biens, étaient alors [en 1585], […] les trois filles de
Selim, sœurs de Mourad [III], savoir la veuve de Sokolli, la veuve de Pialé et la femme
du grand vizir Siawousch ; ensuite la vieille sultane Mihrimah, fille de Süleyman le
Grand, veuve de Rüstem Pacha et belle-mère du grand vizir Ahmed Pacha, qui lui avait
donné deux petites-filles. Ces deux arrières-petites-filles de Süleyman entrèrent toutes
deux dans le lit du capitan pacha, le renégat génois Cicala, l’aînée d’abord, et, après la
mort de celle-ci, la plus jeune. »18
*
« Ahmed Pacha, successeur de Mohammed Sokolli, qui devait sa dignité de grand vizir
non seulement à l’ancienneté de ses services, mais encore à l’influence de sa femme, la
princesse Mihrimah [erreur : Ayşe, fille de Mihrimah], outre les deux filles qui
épousèrent successivement Cicala, en avait une troisième qui entra dans le lit du riche
Hasan Pacha, et une belle sœur, fille de Rüstem Pacha et de la sultane Aïsché [erreur :
Mihrimah] ; la main de cette dernière fut donnée au secrétaire d’Etat disgracié
Feridoun, qu’on avait envoyé en qualité de sancakbey à Semerdra, puis à Güstendil, et
à qui cette alliance rendit sa faveur et sa place. »19
*
« 5 Kasım’da [1576] yeniçeri ağası Cigala’nın [Cigalazade Sinan Ağa], nişanlısı olan
Ahmed Paşa’nın kızına gönderdiği hediyeleri konutumuzun kapısı önünden geçirdiler.
17
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 7 p. 24-25. 18
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 7 p. 73. Les propos d’Hammer sont confirmés par les lettres du baile vénitien alors en poste dans la capitale, ainsi que nous l’avons vu dans le chapitre consacré aux mariages des princesses ottomanes. 19
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 7 p. 73.
Page | 535
Kafilenin en önünde sarayın üst düzey hizmetkârları at üstünde geçtiler, onları uşağıyla
birlikte Rumeli beylerbeyi izliyordu ve arkasından davul, zil ve zurnalarıyla çalgıcılar
yürüyorlardı. Bunları takiben eşeklere yüklenmiş üstü ipek örtülerle kapatılmış
sepetlerin, sandıkların içinde hediye eşyalar taşındı. Arkasından beylerbeyinin ve
damadın çeşnigirleri, özel giysileri içinde çok sayıda yeniçeri ile birlikte şekerlemeleri
taşıdılar. Bunlara at, fil, deve, arslan, denizkızı ve renk renk boyanmış kuş şekilleri
verilmişti. Alayın başındakiler dörder kişilik sıra halinde yürüyorlardı, daha sonra
ikişer ikişer sıralandılar. Aralarında Bakenenli Hans Ferber’in de bulunduğu
çeşnigirlerin belinde bir karış genişliğinde sırma ve sim işlemeli kuşaklar vardı.
Şekerler, daha sonra içecekleri şerbetler için kullanılıyor. Gelinin sağdıcı olan Rumeli
beylerbeyi [Siyavuş Paşa] bu düğün için binlerce florin harcamış olmalı. Vaktiyle
Rumeli beylerbeyinin sağdıcı olan kaptan-ı derya Uluç Ali de zamanında 80 000 florin
harcamış.
6 Kasım’da havai fişekleri (ateş eğlencelerini) getirdiler. Bunlar bi rev yüksekliğinde,
yeşil, kırmızı kâğıtlardan yapılma süslü kulelerdi.
7 Kasım’da gelinin ev eşyası, babası Ahmed Paşa’nın evinden damadın konağına
taşındı. Eşyalar şunlardı: 1. Bir tarafı saydam billurdan olan oldukça büyük altın bir
kutu içinde inciler ve çeşit çeşit değerli mücevherler. 2. Altı adet büyük gümüş şamdan.
3. Iki sırma işlemeli büyük yatak örtüsü. 4. Yüz on altı eşek yükü Iran’da ve başka
yörelerde dokunmuş halı, giysi, yatak ve başka ev eşyası. 5. Babanın kızına çeyiz olarak
armağan ettiği, çoğu sırmalı ve ipekli elbiseler giymiş 40 kadın köle ve bunların
arasında onları kollayacak ve yönetecek olan beş-altı atlı hadım ağası.
8 Kasım’da geceye bir saat kala gelin, babasının evinden damadın evine götürüldü.
Gelin alayının önünde taşınan kırmızı, yeşil, mavi, sarı ve diğer renklere boyanmış iki
nahıl konutumuzun boyuna erişiyordu. Ayrıca gerçek oldukları izlenimi verecek kadar
sanatkârane yapılmış güller, elmalar, armutlar, narlar, üzümler ve daha çeşit çeşit
meyvelerle dolu tablanın tepesinde de bir mum yanmaktaydı. Bu nahılı geçirebilmek
için konutumuzun önünde yetişmekte olan ve bütün sokağın üstünü örten bir asmayı ve
yakınımızdaki bir caminin önündeki bir ağacın birçok dalını kestiler, bazı ağaçları da
yıktılar. Bundan sonra altın ve değerli, taşlardan yapılmış süs eşyası, onun önünden ve
arkasından da çocuk oyuncaklarına benzer mumdan yapılma güller vb. şeyler taşındı.
Gelinin önü sıra yürütülen atın yelesi ve kuyruğu taranıp tutam tutam ayrılmış ve içine
sırma iplikler örülmüştü. Bütün bunların arkasından birkaç kişinin taşımakta olduğu
çok güzel, sırma işli ipekli kumaşlardan ; yapılma bir tentinin altında gelin önümüzden
geçti. Gelin çok gösterişli beyaz bor ata binmişti, atın sadece altın tellerle süslü başı ve
boyunu gözüküyordu. Gelini ata binmiş 40 kadar köle kadın takip etti. Söylediklerine
gore, altın ve değerli taşlarla süslenmiş olan gelinlik 100 000 dukaya mal olmuş.
Şekerlemeler için 20 000 duka, gelin alayının önünde taşınan nahıllar için 1 000
dukadan fazla para harcanmış ve düğün masrafları 70 000 dukayı bulmuş.
Bütün masrafları Sultan Süleyman’ın kızı, Rüstem Paşa’nın dul eşi ve Ahmed Paşa’nın
kayınvalidesi olan Kadın Sultan [Mihrimah Sultan] üstenlenmiş. Kızından [Ayşe
Sultan] olan bütün torunlarını o idare ediyor ve evlendiriyormuş. Rivayete göre günlük
geliri 2000 duka imiş.
Page | 536
Kadın sultanların ve hatta tüm diğer Türk kadınlarının zenginliklerine ve gösterişlerine
karşılık Türk erkeği zavallının bir durumda, çünkü evlilik dolayısıyla kadına ailesi
tarafından verilen ve kocasının da vermek zorunda olduğu malların üzerinde erkeğin
hiçbir hakkı olmadığı gibi, erkek, padışahın soyundan gelen karısına kötü bir söz
söyleyemiyor. Kadın, herhangi bir aileden olsa bile, kocasına gücenirse, hemen
boşanıyor ve servetini de beraberinde götürüyor. »20
20
Gerlach, Türkiye Günlüğü : t. 1 p. 456-458.
Page | 537
10) Fatma Sultane, fille de Murad III, et Halil Pacha (1594)
« Vezîr-i müşîr Halil Paşa hazretlerinün Sultân-ı ismet-penâh
hazretlerine ittisâlleri ve düğün cem’iyyetidür.
Ve sene isneteyn ve elf şehr-i rebîülevvelinde Vezîr-i saʻâdet-karîn ü
izzet-rehîn celîlü’l-kadr Halil Paşa ‘edâme’llâhu ta’âlâ iclâlehû–
hazretleri ki saʻâdetlü Pâdişâh Cem-câh u sitâre-sipah –
hallede’llâhu hilâfetehû– hazretlerinün harem-i saʻâdet-
muhteremlerinden ve huddâm-ı zevi’l-ihtirâmlarından âdâb-ı devlet
ü saltanat hidmetinde mü’eddeb emekdâr olmağın muhaddara-i
ismet ü saltanatdan hazret-i sultân –dâmet ismetühâ– hidmet-i
saʻâdetiyle mütesʻid olmak buyurulduğında Vezîr-i izzet temkîn ü
saʻâdet-âyîn Mehmed Paşa –edâme’llâhu taʻâlâ iclâlehû– hazretleri
dahi sağdıçlık hidmetiyle me’mur buyuruldı. Ve evâ’il-i şehr-i
mezbûrda bir hafta ehl-i Dîvân hidmet-i dîvâniyeden muʻâf
buyurulup, tedârük-i mühimmât-ı sûr-ı saʻâdete iştiğâl olundı. Ve
Sarây-ı Âmire’den hademe-i harem-i muhterem eskâl ü ahmâl ile
Sarây-ı Atîka göçdiler. Ve bir hafta tamâm selâtîn-ı izâm ve ulemâ-i
kirâm haremleri ikrâm ve ihtirâm olunup cemʻiyyet-i ziyâfet olundı.
Ve sebt güni erkân-ı devlet ve aʻyân-ı saʻâdet [ve] vüzerâ-i izâm
Sarây-ı Atîk’da şâhâne ziyâfet olundılar. Ve ol gün Yeniçeri ve
Acemi-oğlanı tâ’ifesi işlenen üç yüz kıtʻa nahl-i dilârâları hezâr zîb
ü zînet ile yerlerinden kaldırup Sarây-ı Atîk’a nakl eylediker,
temâşâ-yı âlem oldı. Ve yine ol gün vüzerâ-i izâm ve erkân-ı devlet
ziyâfetinden sonra izzetlü ve saʻâdetlü Pâdişâh-ı gerdûn bestat
hazretleri şevket ü haşmet ile Sarây-ı Atîk’a gelüp eğlenmeyüp izz ü
ikbâl ile yine Sarây-ı Âmire’ye gitdiler. Ve irtesi yevmü’l-ahadde
Halil Paşa hazretleri sarâyında aʻyân-ı saʻâdet hâzır oldılar. Ve
Sarây-ı Atîk’a âyîn ve üslûb-ı saltanat üzre kemâl-i rifʻat ü iclâl ile
nişân-ı saʻâdet-unvân vüzerâ-yı âlîşân taraflarından merâtib üzre zî-
kıymet cevâhir ile müzeyyen ü murassaʻ aʻlâ istefanlar ve zîbâ
levhler ve bilezikler ve hâtemler ve akimşe-i mütevenniʻa bî-hadd
götürülüp ve katar ile akçalar çekildi. Ve eşkâl-i şeker ve sâ’ir
mühimmât-ı lâzime varup, Sarây-ı Atîk’a vusûl buldukda, kâʻide-i
devlet üzre sağdıç Mehmed Paşa hazretleri iki hilʻat-ı fâhire ile
tesrîf buyuruldı. Ve Halîl Paşa hazretleri kethüdâlarına ve cümle
ağalarına bi-esrihim hilʻat-ı fâhireler geydirildi. Ve sâ’ir hüddam-ı
zevi’l-ihtirâm donluk kumaşlar ile ikrâm olundılar. Ve bi’l-cümle ol
gün bezl ü in’âm olunan akmişe ve hilʻat hadd ü adde mümkin
olmayup, lâ-yuhsâ atâ olundı.
Ve şehr-i mezbûrenün on ikinci güni fî yevmi’l-isneyn ki mefhar-ı
mevcûdât ve server-i kâ’inât şefîʻ-i yevm-i arasât habîb-i İlâhî –
Page | 538
aleyhi salavâtu’llâh– dünyâya geldüği mübârek günde a’lemü’l-
ulemâ’i’l-mütebahhirîn, yenbûʻu’l-fazl ve’l-yakîn Hâce-i Şâh-ı cihân
Mevlânâ Saʻdî Efendi –edâme’llâhu taʻâlâ fezâ’iluhû– hazretleri
Sarây-ı Atîk’da hâzır olup ve Dârüssaʻâde Ağası Hacı Mustafa Ağa
–dâme mecduhû– hazretleri hazret-i Sultân cenâbından vekîl ve
Mehmed Paşa hazretleri damad cânibinden vekîl olup, İbrahim Paşa
hazretleri nikâhı gibi üç yüz bin sikke-i hasene akd-i nikâh olundı.
Ve heman ol gün yine cihâz Halil Paşa hazretleri sarâyına nakl
olunmağa ibtidâ olunup, üç gün ale’t-tevâlî katar katar çekildi. Ve
cümle cihâz yüz katdur ve cevârî yüz re’sdür ve tevâşî kırk reʻsdür,
cemîʻan tecemmül üç yüz katar esterdür. Ve tahmîn-ı sahîh ile bahâ
beş yüz yükdür. Ve’l-ilmü inde’llâhi taʻâlâ. Ve cihâz alunduğı günde
kânûn-ı kadîm üzre kapu oğlanlarına ve harem-i muhterem
bolalarına ve bacılara câ’ize virilü-gelmişdür, yüz seksen bin akça
bi’t-temâm teslîm olmayınca cihâz yüklenmedi. Ve bu bâbda dahi
virilen kumaş ve hilʻat hadd ü hasrdan bîrûn olmağın tayy olundı.
Ziyâfet-i ulemâ-i izâm.
Ve şehr-i mezbûrenün yevmü’s-sülesâda ulemâ-ı izâm –
kesserehumu’llâhu ta’âlâ ilâ yevmi’l-kıyâm– hazretleri daʻvet
buyurulup iʻzâz u ikrâm olundılar. Mevle’il-mevâlî sâbıkâ
Müftilenâm ve Şeyhülislâm mütekâʻid Mevlânâ Şeyhî Efendi ve
Rûmili Kadıaskerliğinden mütekâʻid olanlardan Mevlânâ Kara
Çelebi oğlı Hüsam Efendi ve Mevlânâ Abdülbâkî Efendi ve Mevlânâ
Molla Ahmed Efendi ve sâ’ir mevâlî-i kirâm ziyâfet olundılar.
Ziyâfet-i cemʻiyyet-i kübrâ.
Yevmü’l-hamîs fî 15 rebî’ulevvel, celîlü’l-kadr ve aliyyü’ş-şân Halil
Paşa –edâme’llâhu taʻâlâ iclâlehû– hazretleri sarâyında sûr-ı
pürsürûr içün rûz-ı fîrûz-ı mezbûrda seherden aʻyân-ı devlet ü
saltanat vüzerâ-ı izâm ve ulemâ-i kirâm cemʻiyyet-i âlî idüp
oturdılar. Kâ’immakâm-ı sadr-ı izzet Ferhad Paşa –edâme’llâhu
taʻâlâ iclâlehû– hazretleri ve İbrahim Paşa hazretleri ve sağdıç
Mehmed Paşa hazretleri ve damad Halil Paşa hazretleri ve Hadım
Hasan Paşa hazretleri ve sâ’ir erkân-ı devlet ve cânib-i yesârda
a’lemü’l-ulemâi’l-izâm Hoca-i Şâh-ı cihân Saʻdî Efendi –
edâme’llâhu taʻâlâ fezâ’ilehû– hazretleri ve Rûmili Kadıaskeri
Mevlânâ Sunʻullah Efendi ve Anatolı Kadıasker Mevlânâ Ali Çelebi
Efendi ve İstanbul kadısı merhûm Ebussu’ûd-zâde Mevlânâ Mustafa
Çelebi Efendi ve Hoca Efendi-zâdeler Mevlânâ Mehmed Efendi sâ’ir
ihvâniyle gelüp Defterdâr efendilere takdîm olundılar. Defterdâr-ı
Anatolı Mahmud Efendi, Defterdâr-ı şıkk-ı sânî Yahya Efendi,
Defterdâr-ı Tuna Mustafa Çelebi Efendi ve sâ’irler ale’t-tertîb
oturıldı. Ve Sipâhiler numûne-i darb y harb gösterüp, üstâdâne
matrakcı-başı kırk nefer yoldaşlarıyle hasmâne cüst ü çâlâk matrak
oynadılar. Ve kemân-keşler zôr-ı bâzû gösterüp, darblar urup,
Page | 539
kerâmet mertebesine arz-ı kemâl-i idman ve hüner eylediler. Ve bir
fasl dahi mümtâz u ser-efrâz sâzendeler ve hoş-âvâz ve kâmil
gûyendeler dem-sâz olup, makâmât-ı ırâk ve hicâzda ser-âgâz idüp,
söz ü sâz ile ehl-i meclisi hoş-hâl eyleyüp dil-nevâzlıklar eylediler.
Ba’dehû envâʻ-ı niʻam-ı nâ-mütenâhî ile sımât-ı niʻmet çekildi. Ve
şerbetler içildi. Şükr ü sipâs ve minnetler olunup, hoş-elhân huffâz
kırâʻet-i Kelâmu’llâhi’l-Mecîd idüp, sorbe ve duʻâ vü senâʻ-i İlâhî
ile ihtitâm buldı. Baʻdehû kânûn-ı kadîm-i âdet-i sûr-ı selâtîn-i izâm
riʻâyet olunmak üzre erkân-ı saʻâdet nazarlarına alâ-merâtibihim
şekerden filler ve arslanlar ve atlar ve develer ve patirla ve zürâfeler
ve tuyûr envâʻından doğanlar ve turala ve meyve aksâmından ve
hubâbâtdan nakller sebetler ve siniler ile bî-hadd u pâyân çekildi. Ve
cümle erkân-ı saʻâdet haşmet ü şevket ile kalkup atlarına süvâr olup,
Sarây-ı Atîk’a müteveccih oldılar. Debdebe-i saltanat üzre velvele-i
tabl u nakkâre âleme âvâze saldı. Merhûm Kasım Paşa Çeşmesi
mukâbelesinde Sarây-ı Âmire burclarından kûşe burcda Pâdişâh-ı
cihân-penâh hazretleri bir şeh-nişîn-i âlî-şân âbâdân itdirmişlerdi.
Ve her-gâh serdâr-ı asâkir-i mansûre südde-i saʻâdetden alem-i
âlem-ârây-ı İslâmî efrâşte kılup gitdiklerinde şevket-i dîn-i mübîn
içün duʻâlar idüp, ol mahalde seyr buyururlardı. Rûz-ı fîrûz-ı sûrda
dahi aʻyân-ı devlet üzre âlî nazarları olup temâşâ eylediler. Ve
erkân-ı devlet izz ü ikbâl ile Sarây-ı Atîk’a varduklarında
eğlenmeyüp, hazret-i Sultân-ı âlî-şân kâ’ide-i kadîme-i selâtîn-i izâm
âyîn ve üslûbı üzre kırmızı atlas dûhte cibinlik içine cevâhirle
murassaʻ eğerlü at ve yedeği çekilüp ve hâce-serâ ağalar ve
hadımlar rikâb-ı hümâyûnlarınca yürüyüp ve mücevher ve murassaʻ
bahl önlerince götürülüp ve dahi on beşer zirâʻ iki minâre-misâl
nahl dilârâ ki üstâdân-ı cihân ızhâr-ı sanʻat ve mahâret ile bend
eylemişlerdi. Halk-ı âlem seyr ü temâşâsında hayrân kaldılar.
Kemâl-i rif’at ve iclâl ile bâ-izz ü nâz ola-geldüği üzre makarr-ı izz ü
saʻâdetlerine vâsıl olduklarında dâmen dâmen çil akçalar îsâr u
nisâr olundı. “Nasîblü yer köteği” meseli üzre mahrûm kalup,
hissedâr olmayanlar âh-ı hasret çeküp gitdiler. Fî 15 şehr-i
rebî’ulevvel. »21
« L’annonce et le rassemblement à l’occasion du mariage de Son Altesse la
chaste Sultane avec Son Excellence le vizir susdit Halil Pacha.
Dans le mois de Rebiülevvel de l’année 1002 [novembre 1593], Son
Excellence le vizir de rang illustre, détenteur de la gloire et dépositaire de la
dignité, Halil Pacha – que Dieu, qu’il soit glorifié, le rende éternel ! – un
ancien serviteur instruit parmi les vénérables et très honorables eunuques de
21
Selânikî, Tarih-i Selânikî : t. 1 p. 340-343.
Page | 540
félicité de Son Altesse le fortuné souverain, l’étoile des armées tel
Alexandre le Grand – que Dieu rende son caliphat éternel ! – dans le service
des coutumes de l’Etat et de la dynastie, reçut l’ordre de se montrer digne du
bonheur du service prospère de Son Altesse la Sultane, qui fait partie des
nobles femmes vertueuses de la dynastie – que sa vertu perdure ! A la suite
de quoi, Son Excellence le vizir de gloire aux pratiques religieuses propices,
Mehmed Pacha – que Dieu, qu’il soit glorifié, le rende éternel ! – fut
nommé à son service en tant que témoin.
Dans la première décade du mois susdit [25 novembre – 4 décembre1593],
les membres du Conseil furent exempts de leur service au sein du Conseil
pendant une semaine et ils s’occupèrent de la réalisation des affaires
indispensables pour l’heureuse cérémonie. Les vénérables eunuques du
harem du Palais impérial allèrent s’installer avec leurs bagages et affaires au
Vieux Palais. Pendant une semaine entière, les illustres princesses et les
généreux oulémas accomplirent leurs visites au harem [du Vieux Palais], où
ils furent entretenus et honorés dignement.
Le samedi, les Piliers de l’Etat, les notables fortunés et les illustres vizirs
rendirent une visite somptueuse au Vieux Palais. Ce jour-là, la communauté
des janissaires et de leurs apprentis allèrent chercher, là où ils se trouvaient,
trois cent adorables palmes de noces décorées de maints embellissements et
ornements et les apportèrent au Vieux Palais ; ce fut un spectacle
extraordinaire. Ce jour-là toujours, après les visites des illustres vizirs et des
piliers de l’Etat, Son Altesse le digne et prospère souverain doué de fortune
se rendit au Vieux Palais en grande pompe et majesté ; il s’amusa puis
retourna au Palais impérial avec dignité et gloire.
Le lendemain dimanche, les dignitaires fortunés se présentèrent au palais de
Son Excellence Halil Pacha. On apporta au Vieux Palais une succession
innombrable et incalculable de tiares de la plus belle manufacture, embellies
et décorées de pierres précieuses de grande valeur, de superbes levh,
bracelets et bagues [offerts] par l’illustre vizir porteur de la marque de la
félicité [Halil Pacha], [lors d’un cortège] d’une perfection pleine de gloire et
d’éminence, selon les coutumes et manières dynastiques. [A cette occasion],
on distribua une foultitude d’aspres. Les ouvrages en sucre et autres affaires
nécessaires [pour le mariage] arrivèrent ensuite. Lorsque Son Excellence le
sağdıç Mehmed Pacha se rendit au Vieux Palais, il fut honoré de sa visite
par [le don de] deux somptueuses robes d’honneur, comme le veut les
coutumes de l’Etat. On fit également revêtir le kethüda de Son Excellence
Halil Pacha, ainsi que chacun de ses agas. On offrit encore aux autres
eunuques très honorés des morceaux de tissus. En tout, il n’est pas possible
d’évaluer la quantité de tissus et robes d’honneur qui ont été donnés et
offerts ce jour-là, car les dons furent innombrables.
Le lundi, 12e jour du mois susdit [6 décembre 1593], qui correspondait au
vénérable jour d’anniversaire de la venue au monde du corps de gloire du
prince de l’univers, intercesseur au jour du Jugement dernier et aimé de
Page | 541
Dieu – le salut soit sur lui ! –, Son Excellence le professeur du souverain du
monde, le plus érudit des savants les plus doctes, la fontaine de savoir et de
connaissance, Mevlana Sadi Efendi – que Dieu, qu’il soit exalté, perpétue
ses vertus ! – se présenta au Vieux Palais ; on conclut le mariage contractuel
[en présence de] Son Excellence le chef des eunuques noirs Hacı Mustafa
Aga, représentant de la Sultane, et de Son Excellence Mehmed Pacha,
repésentant du gendre, avec un douaire de 300 000 pièces d’or, comme pour
le mariage de Son Excellence Ibrahim Pacha.
Ce jour-là, immédiatement [après], on commença à transporter le trousseau
[de la mariée] au palais de Halil Pacha : le transport, en enfilade, dura trois
jours d’affilée. En tout, le trousseau avait été réparti en 100 portions
[transportées séparement par dos d’animaux] ; les cariye étaient au nombre
de 100, de même que les eunuques ; l’ensemble de ces beautés constituait
une file de 300 mules. Une estimation correcte a évalué cette dépense à
50 000 000 kuruş. Dieu seul, qu’il soit exalté, détient le savoir.
Le jour du transport du trousseau, comme la somme de 180 000 aspres
traditionnellement versée en récompense aux bacı et aux bola du harem
vénérable et aux jeunes garçons de la Porte ne fut pas remise intégralement,
comme c’était la coutume, le trousseau ne fut pas monté [dans les
appartements de la future épouse]. C’est encore pour cette raison qu’un
nombre incalculable de tissus et robes d’honneur furent laissées à
l’extérieur.
Les visites des glorieux oulémas.
Le mardi du mois susdit [7 décembre 1593], Leurs Excellence les glorieux
oulémas – qu’ils bénéficient des bienfaits de Dieu – qu’il soit exalté ! – le
jour du jugement dernier – furent invités [à venir présenter leurs félicitations
au marié]. On leur offrit les dons et cadeaux [accoutumés]. Il y eut
notamment la visite du sage des sages, le précédent moufti de l’humanité et
cheikh-ul-islam à la retraite, Mevlana Şeyhî Efendi, et de Mevlana
Abdülbaki Efendi et de Mevlana Molla Ahmed Efendi, parmi les cadiaskers
à la retraite, et des autres juges [de rang] supérieur.
Les visites de la communauté des dignitaires.
Le jeudi 15 Rebiülevvel [9 décembre 1593], au petit matin, eut lieu le
rassemblement exalté des notables de l’Etat et de l’Empire, des glorieux
vizirs et des grands oulémas au palais de Son Excellence de gande valeur et
d’illustre gloire, Halil Pacha – que Dieu, qu’il soit exalté, perpétue sa
gloire ! – en vue de la cérémonie pleine de joie [prévue] en ce jour prospère.
le représentant de Son Excellence le grand vizir Ferhad Pacha – que Dieu,
qu’il soit exalté, perpétue sa gloire ! –, [qui était] Son Excellence Ibrahim
Pacha, Son Excellence le sağdıç Mehmed Pacha, Son Excellence Hadım
Hasan Pacha et les autres Piliers de l’Etat avançaient du côté gauche ; le
plus érudit des savant les plus doctes, Sadi Efendi – que Dieu, qu’il soit
exalté, perpétue ses vertus ! –, le cadiasker de Roumélie Mevlana Sunullah
Efendi, le cadiasker d’Anatolie Ali Çelebi Efendi, le fils du défunt Ebussuud
Page | 542
Mevlana Mustafa Çelebi Efendi, ancien cadi d’Istanbul, ainsi que Hoca
Efendizadeler Mevlana Mehmed Efendi et leurs autres confrères vinrent
[par le flanc droit]. On donna la préséance à ces Messieurs les Defterdar : le
defterdar d’Anatolie Mahmud Efendi, le defterdar-ı şıkk-ı sânî Yahya
Efendi, le defterdar du Danube Mustafa Çelebi Efendi et les autres
s’installèrent en ordre. Les janissaires manifestèrent l’exemple de la force et
du combat : avec 40 camarades parmi les matrakçıbaşı, ils jouèrent avec une
grande maîtrise à des combats de bâton avec hostilité et agilité. Les archers
firent des démonstrations de force et de dextérité, ils luttèrent en combat et
firent ainsi la démonstration de leur grande endurance et de leurs capacités.
Il y avait encore une section avec d’excellents et d’éminents musiciens et
chanteurs accomplis à la voix douce. Du début jusqu’à la fin, ils jouèrent du
makam d’Irak et du Hejaz. Ils mirent les membres de l’assemblée dans une
ambiance agréable par leurs chants et leur musique et jouèrent de façon fort
harmonieuse. Des marques de bonté furent témoignées par toutes sortes de
bienfaits infinis. Puis on but les sorbets. On exprima les remerciements et
gratifications, puis les mots très illustres de Dieu [= le Coran] furent récités
et [la réception] se conclut sur des conversations, des prières et des
récitations à Dieu.
Ensuite, sous le contrôle des Piliers de l’Etat s’étira, de façon ordonnée, une
procession infinie et innombrable de fruits, de grues, de faucons, de girafes,
de mules, de chameaux, de chevaux, de lions et d’éléphants en sucres,
transportés par portions et sections sur des plateaux et des plats, dans le
respect des lois anciennes relatives aux pratiques des cérémonies des
glorieuses princesses. Puis les Piliers de l’Etat se levèrent avec splendeur et
grandeur, montèrent leurs chevaux et se rendirent au Vieux Palais. La
clameur des tambours et des autres instruments des musiciens du mehter, en
accord avec le faste dynastique, annonçait au monde [l’arrivée du cortège].
Son Altesse le souverain refuge du monde avait fait faire un noble et
sublime balcon protégé par une baie vitrée dans une tour d’angle d’une des
tours du Palais impérial, à proximité de la fontaine du défunt Kasım Pacha.
Quand le commandant des armées toujours victorieuses levait la bannière du
royaume universel de l’Islam, c’est à cet endroit qu’il observait le départ
[des troupes] du Seuil de la Félicité. De même, le jour prospère de la
cérémonie [de mariage], il regarda les Piliers de l’Etat [depuis cette place] et
admira le spectacle.
Quand les Piliers de l’Etat furent parvenus au Vieux Palais avec gloire et
honneur, ils ne s’arrêtèrent pas, mais amenèrent [aussitôt, en cortège] Son
Altesse la Sultane très illustre, [dissimulée aux regards] derrière un voile de
satin rouge ouvragé, assise sur un cheval de grande valeur tout harnaché de
pierres précieuses, comme c’est la coutume et les pratiques lors de l’envoi
des princesses. Les eunuques et les agas supérieurs du palais marchaient à la
manière des écuyers impériaux et portaient devant eux les palmes de noces
tout en joyaux et pierres précieuses, dont deux palmes de noces sublimes,
Page | 543
semblables à des minarets de 15 coudées [de hauteur] chacun, qui avaient
captivé l’art et le talent des artistes du monde. On resta admiratif devant le
spectacle de la population du monde.
Pendant qu’ils se rendaient en direction de la résidence de gloire et de
félicité [du pacha], en un déplacement empreint des traditions et plein de
gloire et de coquetterie, dans [un arrangement] d’une perfection sublime et
magnifique, on distribua et offrit une très grande quantité d’aspres neufs.
Certains en furent privés, selon le proverbe “celui dont c’est la part recevra
des coups”, de sorte que ceux qui n’eurent pas leur part regrettèrent leur
perte et s’en allèrent. Le 15 du mois de Rebiülevvel [9 décembre 1593]. »
« Sene selâse ve elf vekâyi’indendir, rebîülevvel evâsıtında kerîme-i
Şâh-ı cihân Fâtıma Sultan Vezîr Halil Paşa’ya akd olunup, Eski-
saray’da cemʻiyyet-i nisâ, baʻdehû halvet vakt-i mesâ oldu. »22
« Les événements de l’année 1003. Dans la deuxième décade du mois de
Rebiulevvel [23 novembre – 3 décembre 1594], la fille du Chah du monde
Fatima Sultan fut mariée contractuellement au vizir Halil Pacha. Le
rassemblement des femmes prit place au Vieux Palais, après quoi tout le
monde se retira le soir venu. »
*
« L’arrivée d’un ambassadeur ouzbeg et les fiançailles du renégat d’Ancône, Paggi
(Khalil), avec une fille du sultan (6 décembre 1593 – 12 rebioul-ewwel 1002), furent
l’occasion d’un certain déploiement de magnificence, et jetèrent quelque éclat sur ces
dernières années du règne de Mourad. Pendant toute une semaine, les affaires du diwan
et de la Porte furent suspendues ; l’anniversaire de la naissance de Mohammed, le
contrat de mariage fut signé dans le vieux seraï, au nom de la sultane par le chef des
eunuques, au nom du fiancé par le vizir Mohammed, paranymphe, et au nom du sultan
par l’historien Seadeddin ; la dot de la princesse s’élevait à 300 000 ducats. Pendant
trois jours, trois cents rangs de bêtes de somme furent occupés à transporter la dot dans
le palais du fiancé, sous l’inspection de quarante eunuques. D’après un ancien usage,
Khalil dut distribuer aux gens du harem cent quatre-vingt mille aspres, sans le
paiement desquels personne n’aurait aidé au chargement de la dot. Les légistes et les
hauts fonctionnaires de l’Etat furent pendant trois jours splendidement traités, et
congédiés avec des sucreries représentant des figures d’éléphants, de lions, de chevaux,
de chameaux, de gazelles et autres. La princesse, montant un cheval dont les harnais
étincelaient de pierreries, accompagnées des eunuques qui tenaient un baldaquin de
22
İpşirli (éd.), Tarîh-i Na’îmâ: t. 1 p. 73.
Page | 544
satin rouge au-dessus de sa tête et précédée par trois cents palmes de noces, se rendit le
5 janvier 1594 (12 rebioul-akhir) au palais de son fiancé. »23
23
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 7 p. 147-148.
Page | 545
11) La fille de Gevherhan Sultane, fille de Selim II, et Sinan Paşazade Mehmed
Pacha (1598)
« Merhûm Vezîriaʻzam Sinan Paşa-oğlı Mehmed Paşa’nun Sultân-
zâdeye nişânı gitdüğidür.
Ve evâsıt-ı şehr-i rebî’ulâhirede merhûm Vezîriaʻzam Sinan Paşa-
oğlı Vezîr Mehmed Paşa hazretleri merhûm ve mağfurun-leh Sultân
Selim Han –tâbe serâhû– sultânından merhûm Piyâle Paşa
duhterinün ahterine nâm-zed olup, kânûn ve kâʻide-i kadîme-i
devlet üzre nişân-ı âlîşân tertib olınup, Vezîriaʻzam Mehmed Paşa
–edâmellâhu taʻâlâ iclâlehû– hazretlerine murassaʻ ve mükemmel
raht ve altun zencir ile at ve sultân-zâdelere yeleginden şerekelü
atlar ve bâ-tekellüf ser-â-ser ve akmişehâ-yı mütenevviʻa ve erkân-ı
saʻâdet ağaları şevket ü haşmet ile saʻâdetlü Sultân hazretleri
kapusına varup, âdet-i maʻrûfe üzre mihr-i muʻaccele teslîm olındı.
Müftilenâm ve Şeyhülislâm Hoca-i Şâh-ı Cihân Saʻdeddin Efendi
hazretleri elli bin altun akd-ı nikâh eylediler. [rebiulahir 1007]» 24
« Le mariage de Mehmed Pacha, fils du défunt grand vizir Sinan Pacha,
avec la Sultanzade.
Dans la deuxième décade du mois de Rebi-ül-ahir [10-20 novembre 1598],
Son Excellence le vizir Mehmed Pacha, fils du défunt grand vizir Sinan
Pacha, a été marié à l’auguste fille du défunt Piyale Pacha et de la Sultane,
[fille] du défunt Sultan Selim Han – que la paix soit sur lui. Les nobles
fiançailles furent organisées selon les lois de l’Empire et coutumes
ancestrales de l’Etat : les eunuques des piliers de l’Etat, accompagnés d’un
cheval dont les chaînes étaient en or et le harnais, splendide, tout en pierres
précieuses, destinés à Son Excellence le grand vizir Mehmed Pacha – que
Dieu, qu’Il soit exalté, perpétue sa gloire –, et d’un [autre] cheval de grande
valeur, recouvert du manteau des sultanzade et de diverses affaires
entièrement cérémonielles, se sont présentés à la porte de Sa Majesté la
Sultane fortunée. D’après les coutumes approuvées par la loi islamique, on
lui remit le mihr-i müeccel. Son Excellence Sadeddin Efendi, qui était le
chef des mouftis, le cheikh-ul-islam et le professeur du souverain du monde,
avait [en effet] conclu le contrat de mariage pour 50 000 pièces d’or. »
*
24
Selânikî, Tarih-i Selânikî : t. 2 p. 775.
Page | 546
« Les deux vizirs les plus considérés après Cicala et Khalil étaient les fils des deux
anciens grands vizirs, Hasan, fils de Sokolli, et Mohammed, fils de Sinan. Sokolli offrit
au sultan, à son retour de Hongrie, soixante-cinq vêtements précieux et douze harnais
d’argent, pour faire décider en sa faveur la question de préséance qui s’était élevée
entre lui et Sinan ; cependant ce dernier obtint le pas sur son concurrent par la faveur
de la sultane Walidé, et consolida encore son crédit par son mariage avec la fille de
Pialé, issue du sultan Selim. Les noces de Sinan et celles que le grand vizir Djerrah
Mohammed célèbra pour le mariage de sa fille, et la circoncision de ses fils, furent des
fêtes populaires ; la dernière fut d’autant plus brillante, que le grand vizir avait été lui-
même barbier, et avait fait l’office de chirurgien lors de la circoncision du sultan
régnant, circonstance qui lui valut le surnom de Djerrah (chirurgien). Ces fêtes
occupèrent les loisirs des habitants de Constantinople, pendant que la guerre ravageait
les frontières de Hongrie et que des révoltes éclatant çà et là sur divers points de
l’empire étaient étouffées dans le sang de leurs promoteurs. »25
25
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 7 p. 190.
Page | 547
12) Ayşe Sultane, fille de Murad III, et Yemişçi Hasan Pacha (1601)
« Çün İbrahim Paşa’nın haber-i intikâli muharremin yirminci
gününde [21.07.1601] Der-i devlete vusûl buldu, hâtem-i sadâret
Kaymakam Yemişci Hasan Paşa’ya verilip ber-vech-i isti’câl
Belgrad’a erişmek bâbında ferman-ı âlî-şân sudûr eyledi. Düstûr-ı
müşarün-ileyh dahi yirmi gün kadar Der-i devlette mekîn olup
serdar-ı sâbıkın hayme vü hargâh ve sâ’ir esbâb ve eskâl ve âlat-ı
sefer ve cimâl ü bigâli hibe tarîkiyle kendiye verilip hattâ
muhallefesi Â’işe Sultan dahi nâmzed kılındı. » 26
« La nouvelle de la mort d’Ibrahim Pacha arriva au Seuil de la Porte le 21
juillet 1601. Le sceau de l’Etat fut confié au kaymakam Yemişci Hasan
Pacha et l’on émit un firman illustre lui enjoignant de gagner Belgrade au
plus vite. Le ministre susdit mit vingt jours à prendre la tête du
gouvernement ; la tente et le pavillon du précédent serdar, toutes ses
affaires, ses bagages et ses armes, ses chameaux et ses mules lui furent
remis en présent. Il fut même marié à sa veuve, Ayşe Sultane. »
« Yeniçeri Ağası Ali Ağa sultana akd-i nikâh için serdar-ı ekrem
tarafından vekil olup Âsitâne’ye gönderildi. »27
« Le général en chef des armées [Yemişci Hasan Pacha] désigna Ali Ağa,
chef des janissaires, comme mandataire pour la conclusion de son mariage
avec la sultane et fut envoyé à la Porte. »
« Şevvâlin on ikinci günü [05.04.1602] rûz-ı hızır vâkiʻ olup Der-i
devlette Kaymakam Halil Paşa yevm-i mezburda refʻ olunup yeri ol
asırda Vezîr-i sâlis bulunan Şahinci Hasan Paşa’ya verildi. Ve geri
ol gün merhum İbrahim Paşa metrûkesi Â’işe Sultan ki Vezîr ü
Serdar Yemişci Hasan Paşa’ya nâmzed kılınıp akîb-i avdette
Yeniçeri Ağası Ali Ağa Paşa tarafından tezvice vekîl olup
gönderilmiş idi. Vezîrin kapı kethüdası Yemenli Hüseyin Ağa ve
Defter-emîni Abdi Çelebi yevm-i mezburda ale’s-sabah vekîl-i
26
İpşirli (éd.), Târih-i Na’îmâ : t. 1 p. 179. 27
İpşirli (éd.), Târih-i Na’îmâ : t. 1 p. 203.
Page | 548
müşârun-ileyh ile bir yere gelip dört bin altın mihr ile akd-i nikâh
ettiler. »28
« Le 12e jour du mois de şevvâl (5 avril 1602) était le jour de Hızır. Ce jour-
là, au Seuil de la Prospérité, le kaymakam Halil Pacha reçut une promotion
et sa place fut donnée à Şahinci Hasan Pacha, qui était alors 3e vizir. Ce
même jour, la veuve d’Ibrahim Pacha, Ayşe Sultane, reçut en remplacement
[de son époux] le vizir et serdar Yemişci Hasan Pacha : dès son retour, le
chef des janissaires Ali Ağa avait été nommé mandataire du Pacha pour son
mariage [avec la sultane] et avait été envoyé [à la Porte]. Ce jour-là, au petit
matin, le kethüda de la porte du vizir, Yemenli Hüseyin Ağa, et le
Responsable des registres [des propriétés foncières], Abdi Çelebi,
accompagnèrent le mandataire susmentionné et le contrat de mariage fut
signé avec un mehr de 4 000 pièces d’or. »
« Ve Âsitâne’den, Kapucular Kethudâsı Nasûh Ağa kılık u hilʻat ile
Belgrad’a dâhil olur ve dahi hatt-ı şerîf ile. Baltacılar Kethudâsı da
devletlü Sultân hazretleri, Sadr-ı aʻzam olan Hasan Paşa’ya nikâh
olduğu müjdesi mukarrer olup, üç kat şâdîlîk ve ferahlar oldukda,
şenlikler olup, cemîʻ Belgırad’da olan aʻyânlar mübârek-bâda hâzır
oldular. »29
« Parti d’Istanbul, le kethüda des kapıcı, Nasuh Ağa, entra dans Belgrade
revêtu de son costume et de sa robe d’honneur, sur ordre impérial. [Par
ailleurs], la bonne nouvelle du mariage de Sa Majesté l’illustre Sultane avec
le grand vizir Hasan Pacha fut confirmée par le kethüda des baltacı. Tandis
que ces trois niveaux de joie et de bonheur prenaient place, des festivités
eurent lieu. L’ensemble des notables de Belgrade participèrent aux
félicitations. [juin 1602- mai 1603] »
*
« Quelques jours après le départ d’Ofen [des représentants ottomans venus négocier la
paix], le 10 juillet 1601 (9 moharrem 1010), Ibrahim mourut ; sentant approcher sa fin,
il avait remis le commandement de l’armée à son neveu Mourtesa Pascha, et lui avait
signalé les affaires les plus importantes. Son corps fut transporté à Constantinople et
28
İpşirli (éd.), Târih-i Na’îmâ : t. 1 p. 207. 29
Yılmazer (éd.), Topçular Kâtibi Tarihi : t. 1 p. 344.
Page | 549
enseveli dans le tombeau qu’il avait fait construire dans le parvis de la mosquée des
princes. Le kaïmakam Hasan le fruitier fut élevé au grand vizirat, et chargé de prendre
des mains de Mourtesa le commandement de l’armée de Hongrie. On fit présent à
Hasan de tout l’attirail de campagne d’Ibrahim, de ses chevaux, de ses chameaux, de
ses mulets, et on lui promit même sa veuve la sultane Aïsché en mariage, à condition
qu’il partirait immédiatement pour la Hongrie. »30
*
« Le sultan récompensa le grand vizir de l’heureuse issue de la campagne [en
Hongrie], en lui donnant en mariage la veuve de son prédécesseur Ibrahim, la sultane
Aïsché ; pendant l’absence de Hasan, elle fut fiancée par procuration à l’aga des
janissaires, avec une dot de quarante mille ducats. L’ancien écuyer de Mohammed,
Nassouh Aga, qui à l’occasion du meurtre de la juive Kira avait été destitué sur la
demande des janissaires, porta à Hasan la lettre de félicitation du sultan ; il espérait à
la suite de cette mission être réintégré dans sa dignité, mais il dut se contenter d’être
nommé à une place de chambellan […]. »31
30
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 8 p. 8. 31
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 8 p. 11.
Page | 550
13) Ayşe Sultane, fille de Murad III, et Güzelce Mahmud Pacha (1604)
« Zuhûr-ı Güzelce Mahmud Paşa
Sâbıkâ Yemişci Paşa’nın sadme-i mekri ile bir nice müddet muhtefî
ve tebdil-i sûret ile baʻzı meşâyih-i sûfiyye zaviyelerinde münzevi
olan Güzelce Mahmud Paşa mazhar-ı iltifât-ı padişahî olup sene-i
mezbure [1604] saferi ibtidâsında vezâret ile kâm-yâb oldu. Ve
Yemişci metrûkesi Â’işe Sultan dört yüz bin akçe mehir ile kendüye
tezvîc olundu. »32
« La montée en puissance de Güzelce Mahmud Pacha.
Dans le passé, pour se prémunir contre les stratagèmes de Yemişçi Pacha,
Güzelce Mahmud Pacha s’était retiré et, ayant échangé son habit [contre
celui d’un derviche], il s’était caché pendant un certain temps dans la
zaviyye de Sofia. Par la suite, il rentra en grâce auprès du Padichah et au
début du mois de Safer de l’année susdite [1604], il se vit accorder le titre de
vizir. Il reçut également en mariage la veuve de Yemişçi, Ayşe Sultane,
pour un mehr de 400 000 aspres. »
32
İpşirli (éd.), Târih-i Na’îmâ : t. 1 p. 285.
Page | 551
14) Fatma Sultane, fille de Murad III, et Murad Pacha (1605)
« Ve Halil Paşa metrûkesi Fatıma Sultan bint-i Murad Han Tuna
muhâfazasında olan Vezîr Murad Paşa’ya tezvîc olunup Âsitâne’ye
daʻvet olundu. »33
« Et la veuve d’Halil Pacha, Fatima Sultane fille de Murad Han, fut mariée
au protecteur du Danube, Vezir Murad Pacha : il fut rappelé à la Porte [pour
cela]. »
*
« La sultane Fatima, fille de Mourad III et veuve de Khalil Pasha, fut fiancée au vizir
Mourad Pasha, qui avait été envoyé en Hongrie avec les pleins pouvoirs pour traiter de
la paix. [1605] »34
33
İpşirli (éd.), Tarîh-i Na’îmâ: t. 1 p. 289. 34
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 8 p. 39.
Page | 552
15) Gevherhan Sultane, fille d’Ahmed Ier, et Öküz Mehmed Pacha (1608-09)
« Dört sene beş ay tamamen Mısır’da hükûmet edip baʻdehû
Âsitâne-i saʻâdete daʻvet olundukta eğer Mısır’da ve eğer yollarda
olan emâkin ve mezârât-ı mübârekeyi ziyâret ve padişaha duʻâlar
ettirmekle celb-i menâfiʻ-i dünya vü âhiret ederek tarîk-i Şâm’dan
gelip Dârüssaltana’ya vüsûl buldu. Ve Padişah’ın Gevherhan Sultan
nâm duhterine sezâvâr görülmekle ol cenâb-ı saltanat-me’âba
damad oldu. [1608-09] »35
« Ayant gouverné l’Egypte pendant une durée totale de quatre ans et cinq
mois, il fut rappelé au Seuil de la Félicité. Il vint par la route de Şam,
ordonnant des prières pour le souverain sur toutes les tombes et lieux de
bonne auspice, tant en Egypte que sur les chemins [du retour], se constituant
ainsi des avantages profitables dans ce monde et dans l’autre, et arriva à
Istanbul. Considéré digne de [recevoir la main de] la fille du padichah
appelée Gevherhan Sultane, il devint gendre du détenteur de la
souverainté. »
« Bin yirmi senesinde Âsitâne’de saʻâdetlü Pâdişâh-ı ‘âlem-penâh
hazretleri, Saray-ı atîk’de Sultân hazretlerine sûr-i hümâyûn olduğu
zikr olunur ; sene 1020. Ba’dehû Vezîr-i a’zam Nasûh Paşa’ya ;
sene 1021.
Ve hâlâ mahrûse-i Mısır Vilâyeti’ne Vâlî olan Mehmed Paşa’ya
Âsitâne’den vezâret ile Kapudânlık sadaka olunmağın, baʻdehû
Mısır Eyâleti, Harem-i hümâyûn’da Silâhdâr Sûfî Mehmed Paşa’ya
sadaka olundukda, mezbûr Sûfî Mehmed Paşa, bin yirmi târîhinin
cumâdelâhırında Vezîr Kâyim-makâm olan Gürcü Hâdım Mehmed
Paşa’nın Kadırga Limanı kurbunda, Vezîr-i ‘atîk Mehmed Paşa’nın
sarayında sâkin idiler. Merkûm Sûfî Mehmed Paşa ol vakitde saraya
çıkdıkar. Baʻdehû kapusun görüp, mâh-ı mezbûrda teveccüh
buyurdular.
Ve Mısır’dan Vezîr Kapudân olan Mehmed Paşa, Âsitâne’ye, hazîne
ile daʻvet fermân olunmağın, At-meydânı’nda vâkiʻ İbrâhîm Paşa
Sarayı verilür. Lâkin içinde Vezîr Dâvud Paşa sâkin idiler. Tahliye
etmek fermân olundukda, mezbûr Vezîr Dâvud Paşa, Eski-odalar
başında olan Ferhâd Paşa sarayların beyʻ u şirâ etdiler. Ve At-
meydânı Sarayı’ndan tahliye olup, Vezîr Kapudân Paşa’nın
35
İpşirli (éd.), Târih-i Na’îmâ : t. 2 p. 365.
Page | 553
kethudâsı olan Kara Hâce, Mısır’dan mukaddem gelür. Mezbûr
sarayı meremmât etdiler ve levâzımların görüp. Ve saʻâdetlü
Pâdişâhımızın cânib-i şerîflerinden Sultân hazretlerin Kapudân
Vezîr Mehmed Paşa’ya nikâh olur. Ve Mevlânâ Şeyhülislâm ve
kadıʻaskerler ve vezîrler cemʻ olup, Eski Saray’da Dârü’s-saʻâde
Ağası ve Eski Saray Ağası ve sâyir ağayân ve mukarrebân ol
meclisde hâzır olurlar. Bir mübârek evkâtda, hutbe-i nikâh okunur,
baʻdehû ziyâfetler ve eşribelerden sonra tedârükde oldular.
Ve bin yirmi târîhinde, Vezîr Kapudân Mehmed Paşa, Mısır
hazînesin karadan gönderüp ve ‘âzîm pîşkeş, yarar atlar ve cündî
oğlanlar ve tefârîk metâʻlar ve Hindî kumaşlar ve hazîne teslîm
olunur. Baʻdehû Bahr-ı sefîd’den kalyon ile kilârları ve tevâbiʻleri
saraya dâhil olur. Ba’dehû Baş-defterdâr Vezîr Ahmed Paşa, hatt-ı
şerîf ile Vezîr Kapudân Mehmed Paşa’ya sağdıc olup, cemʻiyyet
tedârükü emr olundukda, Vezîr Kapudân Paşa Tersâne’ye dâhil
olur. Ve cedîd baştarda binâ ederler. Ve Tersâne Emîni ve Kethudâsı
rûz [u] şeb hizmetde.
Ve sûr-i hümâyûna mübâşeret olundukda, Eski Saray’da cemʻiyyet ;
evvelâ Dârü’s-saʻâde Ağası Mustafa Ağa, lâkin mervârîdden ve
cevâhirden bir nakıl işlenüp, kadîmden dokuz yüz doksan dört ve
doksan beş târîhinde merhûm ve mağfûr, Saʻîdü’l-hayât ve Şehîdü’l-
memât Sultân Murâd Hân hazretleri, Vezîr İbrâhîm Paşa’ya
saʻâdetlü Sultân hazretlerin nikâh etdükleri zemânda sûr-i
hümâyûnda. Kapudân-ı meşhûr, ‘atîk Vezîr ‘Ali Paşa sağdıcları
olur, cemîʻi hizmetlerin ana tevfîr ederler. Dahi cevherî nakıl iki
senede işlenür. Mezbûr nakıl-bendler ol vakitde üç hatun
karındaşlar, sanʻatlarında mâhir olup, mezbûre hatunlar işleyüp ve
kuyumcular altun ve gümüş levâzımların görüp, baʻdehû işlenürdü.
Nakıl-bendlerden baʻzıları merhûm olur ; lâkin kızları sıhhatde olup,
daʻvet olunur. Tekrâr cevherî nakılı mezkûr hatunlar dört
tabakaların işlenüp, üzerine Koz Bekcisi Hüseyin Ağa olup, cemîʻi
sîm ü zeri [ve] cevâhiri hisâb ile ve mîzân ile verilüp, baʻdehû bahâr
u eşcâr ve hubûbât ve şükûfe ve ‘acâyibâ işlenürdü. Tabaka tabaka
yedi zirâʻ idi. Ve hâlâ nakıl-bendler Fakır ü bî-çarenin ehli ve kayın
ana merhûm olup ve hizmetde idiler. Ve iki nakıl-ı kebîr, menâre
misâl biri Aksaray’da ve biri Bâb-ı Hîme’de mübâşeret olunmağın,
temâm oldukda, Tersâne halkı ru’esân ve ‘azebân her birini yüz
neferât getürüp, sanʻatlar ile ve önlerince neccârlar muhâlif olan
dükkânı ve saçakların bozup, Eski Saray’ın meydânında kodular. Ve
sûr-i hümâyûn emr olundukda, Eski Saray’da otuz gün cem’iyyetler
olup ve cemîʻi sultânlar daʻvet olurnur. Baʻdehû saʻâdetlü Pâdişâh-ı
‘âlem-penâh hazretleri mesrûr, Eski Saray’a göç emr olunup,
Yeniçeri Ağası ve Segbân-başı ve Kethudâ Bey ve yeniçeri zâbitleri
daʻvet olunur. Yeniçeri kullarına Eski Saray’da ziyâfetler olup ve
Page | 554
inʻâmlar ve ‘atâlar ihsân olur. Sîm tebsi ile çil akçalar yağmaları
olur. Baʻdehû müteferrika ve çaşnigîrler ve çavuşân ve Rikâb-ı
hümâyûn ağaları hizmetde idiler. Ve bölük ağaları ve kapu halkı
ziyâfet olup, baʻdehû mevcûd olan sipâhîlere üçer guruş ‘atıyye,
ağalar[ı] kapusunda tevzîʻ olunmağın. Vezîr Kâyim-makâm Gürcü
Mehmed Paşa idi. Dâhi Vezîr Kapudân-ı sâbık Halil Paşa
vezâretinde kalup, hass taʻyîn olunur. Vezîr Defterdâr Ahmed Paşa
sağdıclık hizmetinde.
Ve baʻde’s-sûr-i hümâyûn bir niçe eyyâm At-meydânı’nda İbrâhîm
Paşa Sarayı’nda, Vezîr Kapudân Mehmed Paşa’nın nişânı, bir
muʻazzam şekerden sanʻatlar ile iki tavîle atlar ve iki tavîle develer
ve filler ve gergedan ve zornepalar ve cemîʻi hayvânât ve murgân
envâʻı ve hubûbât kısmı sanduklar ile ; üç yüz neferât hemân şekerli
saf olup, getürüp, ol kadar katârlar akmişe ve dîbâ ve serâser ve
kadife ve atlas ve yüz katâr ve atlar ve cündîler silâhşorlar ayak
üzere süvâr olup ve cemîʻi vezîrler ve Defterdâr ve eşrâf-ı ‘ulemâ ve
ağayân-ı zî-şân önlerince ‘izzet ile ve sağdıc Vezîr Ahmed Paşa
‘izzet ile önlerince tabl u nakkâre ile At-meydânı’ndan Eski Saray’a
dâhil olurlar. Baʻdehû âteş-bâzlara teʻkîd olunur. Fişekler ve
kulleler ve kebîr hisârlar ve koçlar ve cemîʻi âteş sanʻatları Eski
Saray’da her gice yeniçeri ocağının ve cemîʻi vezîrlerün peşkeşleri
mukarer. Ve At-meydânı’nda düğün, her vakit mukarrer idi. Cemîʻi
ocaklarda herkes ziyâfet olunup, baʻdehû Eski Saray’da cemîʻi
Rikâb-ı hümâyûn ağaları ve müteferrika ve çavuş, çehârşenbih
eyyâmı çihâz alınur. Ve pençşenbih eyyâmı bir muʻazzam şenlikler
olur. Ol vakit mübârek sâʻat idi. Şehr-i İstanbul’da olan pîr ü civân
[ve] bây ü gedâ, hâne ve dükkânlarda olan halk ve ‘avrat u oğlan bir
mertebede izdihâm olur. Şehirde bir ferd kalmayup ; çavuşlar dolup,
kıyâmet günü oldu ; halk-ı ‘âlem izdihâmda. Ve süvârî olan kapu-
kulları ve Rikâb-ı hümâyûn ağaları ve cemîʻi sâdât ve ‘ulemâ’-i
kirâm ve kadıʻaskerler, vezîr-i ‘izâmlar ‘ünvân ile At-meydânı’ndan
Eski Saray meydânı içre bir mikdâr eğlenüp, baʻdehû kaʻidelerince
teveccüh ederler. Ve kebîr nakıllar önlerince bir alay saz ve envâʻı,
üstâd sâzendeler ve bir alay çeşteciler, Vezîr Defterdâr Ahmed Paşa
‘ünvân ile cemîʻi ağaları önlerince piyâde olup, giderlerdi. Baʻdehû
cevâhir nakılı, nakıl-bendlerden ve bevvâbân ve baltacılar ve Eski
Saray Ağası ve Dergâh-ı ‘âlî bevvâbları gürûh ile getürüp, baʻdehû
zülüflü baltacılar ve ağalar de Dârü’s-saʻâde Ağası ‘ünvân ile baʻzı
şîb ve sîm [ü] zer, direklü halvet-hâne, baʻdehû hâdım ağalar,
piyâde bir gürûh ile cibinlik içre saʻâdetlü Sultân hazretleri, ‘izzet
[ü] ikrâm ile etrâflarında Enderûn hâdım ağaları, mezkûr altun ve
cevherî cibinlik direklerin zabt ederlerdi. Baʻdehû bir alay kızlar
mestûr, süvârî birer hâdım ağalar ile geçüp, İbrâhîm Paşa’ya sene
Page | 555
bin yirmi cumâdelâhıre ve recebde düğün ve cemʻiyyet olunduğudur
ki, tahrîr olundu. »36
« En l’année 1020 [mars 1611-mars 1612] est mentionnée la cérémonie
impériale organisée par Sa Majesté le fortuné padichah refuge du monde,
dans la capitale, en l’honneur de Sa Majesté la Sultane résidant au Vieux
Palais. Puis celle en l’honneur du grand vizir Nasuh Pacha, en 1021 [mars
1612 – janvier 1613].
Comme l’office de kapudan avec rang de vizir avait été offert par le Siège
[litt. par la capitale] à Mehmed Pacha, alors gouverneur de la province
d’Egypte, on offrit ensuit la province d’Egypte à Sufi Mehmed Pacha,
silahdar dans le harem impérial. Le susdit Sufi Mehmed Pacha résidait, à la
date de Cemaziyelahır 1020 [août 1611], dans le palais de l’ancien vizir
[Sokollu ?] Mehmed Pacha, à proximité du [palais de] Kadirgalimanı du
vizir et kaymakam, Gürcü Hadım Mehmed Pacha. A cette période, le susdit
Sufi Mehmed Pacha sortit du palais. Après quoi, eu égard à sa position, le
même mois, on décida de l’honorer [de la province susdite].
Et le vizir-kapudan venant d’Egypte, Mehmed Pacha, ayant reçu l’ordre
l’invitant à venir à la Capitale avec le Trésor [d’Egypte], et on lui donna le
Palais d’Ibrahim Pacha sis sur l’Hippodrome. Cependant, à l’intérieur y
résidait le vizir Davud Pacha. L’ordre de vider les lieux lui ayant été
transmis, le susdit Davud Pacha acheta le palais de Ferhad Pacha, situé
devant le lieu-dit Eski-odalar. Puis, ayant quitté le palais de l’Hippodrome,
Kara Hace, kethuda du vizir-kapudan Pacha, venu précédemment d’Egypte,
s’y installa [dans l’attente de la venue de Mehmed Pacha]. Il fit faire des
réparations au palais susdit et on vit arriver les provisions. Puis l’on maria
Sa Majesté la Sultane issue de notre fortuné padichah au kapudan-vizir
Mehmed Pacha. [Pour cette occasion], Monseigneur le cheikh-ul-islam, les
cadiaskers et les vizirs se réunirent ; la rencontre se fit au Vieux Palais, en
présence du Chef des Eunuques Noirs, du Chef des eunuques du Vieux
Palais, des autres agas et des proches. A l’occasion de cet heureux
événement, on récita la prière du mariage, après quoi, après les visites et [la
distribution] des sorbets, on procéda aux préparations [en vue de la
cérémonie].
En 1020, le vizir-kapudan Mehmed Pacha envoya le Trésor d’Egypte par
voie terrestre : il le remit avec, en sus, des cadeaux magnifiques pour ses
supérieurs, de braves chevaux, de jeunes garçons fins cavaliers, des objets
rares et des tissus d’Inde. Puis les réserves de nourriture et autres
dépendances, venus par bâteau de la Méditerranée, furent remis au palais.
Le başdefterdar vizir Ahmed Pacha fut alors nommé, par ordre impérial,
garçon d’honneur du vizir-kapudan Mehmed Pacha et l’ordre de préparation
36
Yılmazer (éd.), Topçular Kâtibi Tarihi : t. 1 p. 595-598.
Page | 556
de l’assemblée ayant été émis, le vizir-kapudan Pacha se rendit à l’Arsenal.
Il fit construire une nouvelle bastard, sous la surveillance jour et nuit du
Commandant et du kethüda de l’Arsenal.
Lorsque la cérémonie impériale débuta, le rassemblement [eut lieu] au
Vieux Palais. Auparavant, Mustafa Ağa, Chef des eunuques noirs, avait fait
réaliser un palmier tout en perles et pierres précieuses. Par le passé, lorsque
Sa Majesté le défunt qui bénéficie du pardon divin, Sultan Murad Han, dont
la vie fut fortunée et la mort celle d’un şehîd, avait marié Sa Majesté la
fortunée Sultane au vizir Ibrahim Pacha, en 994-995, au moment de la
cérémonie impériale, le garçon d’honneur était le célèbre kapudan, l’ancien
vizir Ali Pacha : il avait multiplié les personnes à son service pour cette
réunion. Il avait également fait faire un palmier en perles précieuses, [dont
la préparation avait duré] deux ans. A cette époque, les personnes en charge
des palmiers étaient trois sœurs versées dans les arts. Sitôt que les joaillers
eurent fourni les provisions d’or et d’argent, elles se mirent au travail et
réalisèrent [le travail de décoration des palmiers]. Parmi ces femmes en
charge des palmiers, certaines vinrent à mourir. Mais elles avaient des filles
en bonne santé, qui furent appelées [à leur place]. Les femmes susdites
réalisèrent un palmier à quatre rangées de perles. Le Kozbekçi auprès d’elle
était Hüseyin Ağa. On lui remit tout à la fois l’argent, l’or et les pierres
précieuses, ainsi que les comptes et les mesures. Des fleurs et des arbres, des
graines et des fruits furent ainsi réalisées. Chaque niveau faisait sept
coudées. A ce jour, la famille et la belle-mère des malheureuses femmes
démunies responsables des palmiers sont décédées. Deux grands palmiers
étant en cours de réalisation, l’un à Aksaray ressemblant à une bougie,
l’autre à la Porte du Bois, lorsque ceux-ci furent terminés, les ru’es et les
‘azab du peuple de l’Arsenal envoyèrent chacun 100 d’entre eux : des
charpentiers venaient devant les œuvres d’art, détruisirent les boutiques et
les auvents des maisons qui posaient problème [à leur passage]. Puis lorsque
la cérémonie impériale fut ordonnée, il y eut des visites [litt. des
rassemblements] pendant 30 jours au Vieux Palais et l’ensemble des
princesses furent invitées. Puis Sa Majesté le fortuné Padichah refuge du
monde ordonna joyeusement le déplacement au Vieux Palais : le Chef des
janissaires, le Segbanbaşı, le Kethuda Bey et les officiers des janissaires
furent invités. Il y eut la visite au Vieux Palais aux kul des janissaires et des
cadeaux et des dons furent offerts. Il plut des aspres nouveaux [portés] sur
des plateaux d’argent. Après quoi, ils se mirent au service des müteferrika,
des çaşnigir, des çavuş, des agas des écuyers impériaux. Puis il y eut la
visite des agas des compagnies et des officiers du Palais, puis on offrit
ensuite trois kuruş à chacun des sipahis présents, qui furent distribués à la
porte des agas. Le kaymakam était le vizir Gürcü Mehmed Pacha. Il était
resté en place pendant le grand vizirat de l’ancien kapudan-vizir Halil Pacha
et on lui avait attribué un hass. Il était au service de celui chargé d’être
garçon d’honneur, le vizir-defterdar Ahmed Pacha.
Page | 557
Et après [avant ?] la cérémonie impériale, pendant un certain nombre de
jours, dans le palais d’Ibrahim Pacha à l’Hippodrome, la fiancée du vizir
Mehmed Pacha fit venir et ordonna par rangées environ 300 personnes, deux
lignes de chevaux, deux lignées de chameaux, des éléphants, un rhinocéros,
des zornepa [ ? ], toute une suite d’animaux, des oiseaux en tous genres qui
étaient autant de chefs d’œuvre réalisés en sucre et des boîtes de toutes
sortes [pour les petits objets ?]. Une incroyable succession de tapis et de
tissus de soie, de brocards, de velours et de satins furent montés sur des files
de centaines de chevaux et par les jeunes apprentis cavaliers et par les
silahşor à pieds. Devant eux se tenaient en grande gloire l’ensemble des
vizirs, le defterdar, les nobles oulémas et les agas de grande dignité avec
devant eux, en grande gloire, le garçon d’honneur, le vizir Ahmed Pacha, et
tous se rendirent de l’Hippodrome vers le Vieux Palais, accompagnés [des
joueurs] de davul et de timbales. Des jeux de feux furent organisés de façon
répétée. Chaque nuit, au Vieux Palais, des feux d’artifice, des tours, des
grandes forteresses, des béliers et tous les arts du feu étaient produits
comme cadeau de la part de l’ensemble des vizirs et du corps des janissaires.
Chaque instant de la cérémonie de mariage à l’Hippodrome avait été fixé [à
l’avance]. Une fois que tous les individus de chacun des corps eurent
accompli leurs visites, dans la nuit du mercredi, l’ensemble des agas des
écuyers impériaux, des müteferrika, des çavuş vinrent au Vieux Palais
prendre la dot. Dans la nuit du jeudi, des festivités grandioses eurent lieu.
Pendant ce temps arriva l’heure auguste. Vieux et jeune, riches et pauvres,
toutes les personnes dans les maisons et les boutiques, les femmes et les
enfants dans [toute] la ville d’Istanbul se pressèrent en ordre. Il ne demeura
pas un homme en ville. Les çavuş étaient à bout de nerf : tout le monde se
pressait là comme au jour du jugement dernier. Les kul de la Porte, les agas
des écuyers impériaux, l’ensemble des descendants du Prophète, des nobles
oulémas et des cadiaskers, ainsi que les honorables vizirs, venus de
l’hippodrome à cheval, attendirent un certain temps à l’intérieur de la cour
du Vieux Palais, après quoi ils se mirent en route selon les coutumes.
Précédant les grandes palmes venait un défilé de musiciens jouant de divers
instruments et un défilé de çeşteci, puis venaient, marchant à pied, le vizir-
defterdar Ahmed Pacha, en tête de tous les agas. Le palmier de pierres
précieuses qui suivait était porté par les responsables du palmier,
accompagnés des portiers, des baltacı, des portiers du Seuil Sublime et de
l’Aga du Vieux Palais. Après quoi venaient les gardiens du palais, les agas
avec [en tête] le Chef des eunuques noirs, qui portaient le lit nuptial à piliers
ainsi que de l’or, de l’argent et de la nourriture. Puis venaient les eunuques-
agas [du Bîrûn] et ceux de l’Enderun, marchant à pied et en groupe,
entourant avec gloire et honneur Sa Majesté la fortunée Sultane, [protégée]
derrière une moustiquaire dont ils tenaient les piliers d’or et incrustés de
pierres précieuses. Un défilé de jeunes filles voilées, escortées par des
eunuques-agas à cheval, suivait. Le rassemblement et la cérémonie du
Page | 558
mariage eurent lieu au [Palais] d’Ibrahim Pacha [et dura] du mois de
Cemaziyülahir à celui de Receb 1020 [août-septembre 1611], de la manière
décrite ci-dessus. »
*
« Après une administration si féconde en beaux résultats, il [Mohammed Koulkiran]
retourna à Constantinople avec les bénédictions de l’Egypte, et reçut de la main
d’Ahmed [Ier] sa propre fille, Ghewher Sultane. »37
*
« Cependant l’escadre égyptienne, qui tous les ans était le point de mire des flottes
maltaise et florentine, était arrivée heureusement à Constantinople avec douze cent
mille ducats formant le tribu de deux années de l’Egypte, sous la conduite d’OEgüz
Mohammed (Mohammed le Bœuf), fils d’un maréchal-ferrant de la capitale, élevé dans
le harem ; pour le récompenser, il fut nommé à la dignité de kapitan-pasha en
remplacement de Khalil, et fiancé à la fille du sultan Ahmed, âgée de trois ans. »38
*
« Le kapitan-pascha, Mohammed le Bœuf, épousa la sœur [fille] du sultan régnant […].
Le 13 juin 1612, les noces du kapitan-pascha et de la sœur [fille] aînée d’Ahmed furent
célébrées avec une pompe inouïe. Le defterdar Ekmekdjizadé remplit les fonctions de
paranymphe. On remarquait, dans la corbeille de la fiancée, un écrin étincelant de
pierreries, des pantoufles garnies de turquoises et de rubis ; un Koran doré sur tranche,
avec des agrafes de diamant ; une cassette en cristal contenant des diamants et des
perles pour une valeur de cent soixante mille ducats ; des bracelets, des colliers, des
ceintures, des diadèmes, des boucles d’oreilles, des bagues ; des anneaux pour les
articulations, appelés par les historiens ottomans les sept sphères dans lesquelles se
meuvent les beautés du harem. Vingt-sept porteurs étaient en outre chargés d’autant de
présents. Onze litières grillées, pleines de femmes de chambre et d’esclaves pour le
service de la fiancée, étaient conduites chacune par deux eunuques noirs ; vingt-huit
eunuques noirs accompagnaient autant de belles esclaves à cheval revêtues de robes
d’étoffe d’or. Deux cent quarante bêtes de somme étaient chargées de tentes, de tissus
d’or et d’argent, de tapis et de coussins. Tous ces présents, et la suite de la fiancée,
furent conduits solennellement dans le palais du kapitan-pascha. Quelques jours après,
la princesse s’y rendit elle-même. Le cortège était ouvert par cinq cent janissaires et
quatre-vingt émirs, suivis des imams, des scheïkhs, des mouderris, des danischments ou
étudiants, des kadiaskers et des vizirs ; puis venaient à droite de la fiancée le
kaïmakam, et à gauche le moufti ; car, d’après un sage règlement, dans les cérémonies
publiques, la droite est la place d’honneur des agas de la cour et de l’armée, et la
37
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 8 p. 79. 38
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 8 p. 87.
Page | 559
gauche celle des dignitaires de la loi ; de sorte qu’on a prévenu ainsi toute dispute sur
la préséance entre les agas et les oulémas. On voyait ensuite s’avancer la musique
turque, la musique égyptienne avec des tambours basques et des castagnettes ; les
joueurs de luth et de harpe accompagnaient les hymnes de noces. A ceux-ci succédaient
les ouvriers de l’arsenal, portant des pelles et des marteaux, des perches et des leviers,
pour renverser les boutiques et les maisons qui pourraient gêner la marche du cortège
et embarrasser les mouvements des énormes palmes nuptiales, dont la grosseur figurait
la force virile, et les fruits divers qui y étaient appendus la fécondité de la femme. Vingt
chambellans précédaient le paranymphe ; derrière ce dernier un grand nombre
d’esclaves portaient trois immenses flambeaux recouverts de tôle dorée, dont le dernier,
le plus grand de tous, brillait moins par sa flamme que par ses nombreuses pierreries
qui dardaient mille feux au soleil. Puis venait le reïs-efendi (le rédacteur du contrat de
mariage), suivi de cinquante officiers de la cour de la princesse. Enfin, on voyait
s’avancer les dais des noces en velours cramoisi, et un autre dais revêtu de lames d’or,
dont les rideaux d’étoffe également d’or traînaient de tous côtés à terre, et sous lequel
la sultane fiancée était à cheval entourée d’eunuques noirs. La voiture de gala de la
princesse, toute resplendissante d’or et traînée par quatre chevaux blancs, huit litières
pleines de femmes de chambre et d’eunuques, et vingt-cinq belles esclaves aux voiles et
aux cheveux flottants, fermaient le cortège. »39
*
« Le nouveau kapitan-pascha, Mohammed le Bœuf, qui depuis ses fiançailles avec la
fille du sultan, âgée de sept ans, était appelé Mohammed le Gendre, se mit en mer avec
trente galères pour interrompre le cours des entreprises des flottes chrétiennes. »40
39
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 8 p. 91-92. 40
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 8 p. 103.
Page | 560
16) Ayşe Sultane, fille d’Ahmed Ier, et Nasuh Pacha (1612)
« Ve zilhicce evâhirince [sene 1020] kerîme-i suğrâlarını Nasuh
Paşa’ya tezvîc için şeyhülislâm ve vüzerâ hazır olup akd-i nikâh
olundu. »41
« Et pendant la troisième décade du mois de Zilhicce [de l’année 1020 = 23
février au 4 mars 1612], le cheikh-ul-islam et les vizirs se retrouvèrent pour
le mariage de la fille mineure [du sultan] avec Nasuh Pacha et réalisèrent le
contrat de mariage. »
« Ve mâh-ı merkum hilâlinde [şevval, novembre – décembre 1612]
Vezîriaʻzam Nasuh Paşa’ya verilen Â’îşe Sultan mahalline îsâl
olunup velîme-i azîme tertib olundu. »42
« Et au cours du même mois [novembre-décembre 1612], Ayşe Sultane, qui
avait été donnée au grand vizir Nasuh Pacha, fut envoyée à celui-ci. Une
magnifique fête nuptiale fut organisée. »
« Ve sene-i mezbûrede [1021] saʻâdetlü Pâdişâh-ı ‘âlem-penâh
hazretleri, diğer Sultân hazretlerini Vezîr-i aʻzam Nasûh Paşa’ya
nâmzed edüp ve şerʻ-i şerîf ve hükm-i Rabbü’l-‘âlemîn emri üzere
nikâh olunup, müjde haberi Sadr-ı aʻzam hazretlerine irsâl
olundukda, mesrûr olup ve cemîʻi erkân-ı Devlet mübârek bâda
geldiler. »43
« Et l’année susdite [mars 1612 – janvier 1613], Sa Majesté le fortuné
padichah refuge du monde maria Sa Majesté, une autre Sultane, au grand
vizir Nasuh Pacha. Ils furent mariés selon la loi sacrée et les
commandements du prophète du monde. Lorsque la bonne nouvelle fut
communiquée à Son Excellence le grand vizir, il en fut enchanté et
l’ensemble des piliers de l’Etat vinrent le congratuler. »
41
İpşirli (éd.), Târih-i Na’îmâ : t. 2 p. 389. 42
İpşirli (éd.), Târih-i Na’îmâ : t. 2 p. 391. 43
Yılmazer (éd.), Topçular Kâtibi Tarihi : t. 1 p. 601.
Page | 561
« Ve bundan sonra saʻâdetlü Sultân hazretlerin Nasûh Paşa’ya ‘akd
ü nikâh olunmağın. Baʻdehû Eski Saray’da cemʻiyyet olup,
Şeyhülislâm hazretleri ve kadıʻaskerler Vezîr-i sânî Mehmed Paşa
sağdıc olup, Vezîr Gürcü Mehmed Paşa, Vezîr Dâvud Paşa, Vezîr
Hasan Paşa, Vezîr Yûsuf Paşa, Vezîr Halil Paşa, Vezîr Defterdâr
Ahmed Paşa. Ol mübârek sâʻatde nikâh olunup, baʻdehû eşribe-i
mümessek içilüp, baʻdehû hayr duʻâlar olup, herkes makâmlarına
gitdiler ; fî 20 şaʻbân sene 1021. Ve sûr-i hümâyûn fermân olunup ve
Behrâm Kethudâ tedârükde oldular. “Saʻâdetlü pâdişâh-ı ‘âlem-
penâh hazretleri Edirne’ye varup, baʻdehû geldükden sonra, sûr-i
hümâyûn ola” deyü fermân etdiler ; fî ramazân sene 1021. »44
« Après quoi, on maria par contrat Sa Majesté la Sultane fortunée à Nasuh
Pacha. Ensuite, une réunion eut lieu au Vieux Palais [en présence de] Son
Excellence le cheikh-ul-islam, des cadiaskers, du témoin et second vizir
Mehmed Pacha, du vizir Gürcü Mehmed Pacha, du vizir Davud Pacha, du
vizir Hasan Pacha, du vizir Yusuf Pacha, du vizir Halil Pacha et du vizir
defterdar Ahmed Pacha. Le mariage contractuel fut réalisé à cette heure de
bonne auspice, après quoi on fit boire des sorbets aromatisés de musc. Puis
on prononça les prières de bonne augure et tout le monde partit reprendre sa
place. Le 20 şaban 1021 [= 16 octobre 1612]. Et on ordonna [la réalisation
de] la cérémonie impériale, qui fut confiée à Behram Kethüda. Le firman
émis disait : “Sa Majesté le fortuné padichah refuge du monde va se rendre à
Edirne. Sitôt après son arrivée, que la cérémonie impériale ait lieu.” Dans le
mois de ramadan de l’année 1021 [26 octobre – 24 novembre 1612]. »
*
« Le grand vizir, Nassouh, fut fiancé, en présence de tous les vizirs et du moufti, à la
sœur cadette du souverain [Ahmed Ier] (février 1611 – silhidjé 1020). »45
*
« La fille aînée du sultan, fiancée au grand vizir Nassouh, alors en Asie, mourut. »46
44
Yılmazer (éd.), Topçular Kâtibi Tarihi : t. 1 p. 609. 45
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 8 p. 91. 46
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 8 p. 92. Hammer fournit en note les précisions suivantes : « Not many days after the Sultan’s second daughter promised to Nassut pasha was carried to her grave. Grimstone, p 907. La Croix, t. II, p. 91, l’appelle Koesem. Naïma, au contraire, l’appelle Aïsché ; mais comme il dit que la fiancée fut conduite dans son palais, il paraît qu’il est question de deux princesses, dont l’une mourut et dont l’autre devint son épouse. »
Page | 562
17) Ayşe Sultane, fille d’Ahmed Ier, et Hasan Pacha (1626)47
« Merkum Gürcü Mehmed Paşa tavâşidir, bir sahib-re’y ve sâbit
kadem vezîr-i vakûr idi. Türbe-i anber-sirişt hazret-i Eyyub’da
müheyyâ eylediği türbesinde defn olundu. Kapudan Receb Paşa
merhumun yerine kaymakam oldu. Darüsaaʻâde Ağası Koca El-hâc
Mustafa Ağa’nın saraçlığından neş’et edip matbah emîni, baʻdehû
çavuş-başı olan Hasan Ağa ol vakit mîr-âhur bulunmakla Receb
Paşa yerine kapudanlık mansıbiyle iʻzâz olundu. Ve Sultan Ahmed
Han’ın duhter-i saʻd-ahteri Â’işe Sultan merkum Kapudan Hasan
Pasa’ya tezvîc kılındı. »48
« Le susdit Gürcü Mehmed Pacha était un eunuque. Il fut un vizir digne,
détenteur de savoir et à la bonne fortune solidement établie. Il fut inhumé
dans le mausolée qu’il avait fait préparé à [proximité] du mausolée d’ambre
de Son Excellence Eyüp. Le kapudan Receb Pacha devint kaymakam à la
place du défunt. Issu des rangs des selliers du Chef des eunuques noirs,
Koca Elhac Mustafa Ağa, [devenu] par la suite Chef des cuisines puis
Çavuşbaşı, Hasan Haga fut gratifié de l’office de Kapudan, à la place de
Receb Pacha quand il était parvenu au rang de Maître des Ecuries. Et la fille
du Sultan Ahmed Han, l’étoile de la prospérité, Ayşe Sultane, fut donnée en
mariage au susdit Kapudan Hasan Pacha. [07-08.1626] »
*
« La place de kapitan pascha fut donnée à Hasan Aga, qui, d’ancien sellier du
kislaraga Moustafa, était devenu surveillant des cuisines et enfin tschaousch baschi.
Hasan reçut en même temps la main de la sultane Aïsché, sœur de Mourad. »49
47
Ce mariage est problématique, car il coïncide, dans les dates fournies, avec celui qu’Ayşe Sultane aurait également contracté avec Hafız Ahmed Pacha. L’une des deux unions lui est donc faussement attribuée, mais il nous a été impossible de déduire laquelle : Naima rapporte les deux et cite expressement « Ayşe Sultane, fille d’Ahmed Ier ». 48
İpşirli (éd.), Târih-i Na’îmâ : t. 2 p. 604. 49
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 9 p. 47.
Page | 563
18) Hanzade Sultane, fille d’Ahmed Ier, et Bayram Pacha (1620 ? 1638 ?)
« Tekrâr guluvv-ı asker olup Bayram Paşa olan ol asırda yeniçeri
ocağında kethudâ yeri iken zorbalar ile bir olup Sultân Ahmed’in
duhteri Hânzâde Sultân’ı nikâh ile akd-i nikâha çekdi. Bir çorbacı
pâresi iken bu kadar evzâʻ-i zorbalık etdi. »50
« L’armée s’étant de nouveau rebellée, celui qui faisait fonction de kethüda
dans la caserne des janissaires, qui était alors Bayram Pacha, s’entendit avec
les zorba ; il oeuvra pour la conclusion d’un mariage, établit par contrat,
avec la fille de Sultan Ahmed, Hanzade Sultane. Il n’était alors que çorbacı
quand il réalisa un tel acte de force. »
« Ve yeniçeri ocağında Bayram Ağa’ya Sultân verilüp, düğün olduğu
vakit, mâh-ı mezbûrda cemîʻi vükelâʻ-i ‘izâm daʻvet olunmağın, bir
‘azîm cemʻiyyet oldu. [1030 ?] »51
« Et l’on donna la sultane [Hanzade] à Bayram Ağa, qui faisait partie du
corps des janissaires. Le moment de la cérémonie arrivé, dans le mois
susdit, l’ensemble des grands dignitaires fut invité ; ce fut une formidable
assemblée [1020 ?]. »
*
« L’ancien kiaya des janissaires, Beïram Aga, qui avait entraîné le corps d’élite à faire
cause commune avec les sipahis dans la dernière révolte, fut nommé aga, tandis que
son prédécesseur Tscheschtedji fut dédommagé par le gouvernement de l’Egypte.
Beïram Aga reçut en outre la main d’une des sœurs du sultan ; les deux autres avaient
été mariées à Hafiz Pascha , gouverneur du Diarbekr, et au kapitan pascha Redjeb. »52
50
Dankoff, Karaman, Dağlı (éds.), Evliya Çelebi Seyahatnamesi : p. 106. 51
Yılmazer (éd.), Topçular Kâtibi Tarihi : t. 2 p. 761. 52
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 9 p. 6. Il précise ses sources, les relations vénitiennes : « Nozze d’una sorella del Sgr. col Aga dei Gianizare molto amato come principal autore del assenzione. Rel. ven. »
Page | 564
19) Gevherhan Sultane, fille d’Ahmed Ier, et Receb Pacha (1631)
« Ve Hâfız Ahmed Paşa’ya Diyârbekir Eyâleti sadaka olunmağın,
Karakaş Mehmed Paşa’ya nâmzâd Sultân hazretleri, Vezîr Hâfız
Ahmed Paşa’ya ihsân olundukda, nikâh olunmağın, Vezîr Receb
Paşa’ya Mehmed Paşa Sultân’ı nikâh olunup ve Haleb Beylerbeyisi
olan Vezîr Mustafa Paşa’ya Bağdâd Eyâleti sadaka olunup, Haleb
Eyâleti Abaza Paşa’ya ihsân olunmağın, baʻdehu Erzurum Eyâleti
sadaka olundu. »53
« La province de Diyarbakir ayant été donnée à Hafiz Ahmed Pacha, [la
main de] Sa Majesté la Sultane, [qui avait été] mariée à Karakaş Mehmed
Pacha, fut accordée au vizir Hafiz Ahmed Pacha et le mariage (contractuel)
fut réalisé. [Dans le même temps,] on réalisa également le mariage
(contractuel) de la Sultane de Mehmed Pacha avec le vizir Receb Pacha. Et
on offrit la province de Bagdad au vizir Mustafa Pacha, qui était gouverneur
d’Alep, tandis que la province d’Alep était accordée à Abaza Pacha, auquel
on offrit plus tard la province d’Erzurum. [1031] »
*
« Pendant cette expédition du kapitan pascha [Hasan], son beau-frère Redjeb Pasha,
époux de Fatima [erreur : Gevherhan], le kaïmakam et Mourteza Pasha, gouverneur
d’Ofen, conspiraient à sa perte ; son propre kaiya Serradjzadé, frère de Serradjzadé
mis à mort par le vieux Mourad Pasha, prêta les mains au complot ; mais sa trahison
lui coûta la vie, et Mourteza Pasha lui-même n’évita la vengeance du kapitan que par
une prompte fuite à Akkerman. […] »54
53
Yılmazer (éd.), Topçular Kâtibi Tarihi : t. 2 p. 757. 54
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 9 p. 87.
Page | 565
20) Ayşe Sultane, fille d’Ahmed Ier, et Hafiz Ahmed Pacha (1626 ? 1631 ?)55
« rebîülevvelin yirmi dokunzuncu günü [25.10.1631] yevm-i sebt idi
ki Hâfız Ahmed Paşa’yı sâniyen sadrıaʻzam ettiler. Hâfız Paşa yine
akl ü tecrübe sâhibi sâlih ü mütedeyyin tevârihe vâkıf bir vezîr-i ârif
olup Nasuh Paşa muhallefesi hâher-i padişah-ı cihân Âişe Sultan’ı
tezevvüc etmişti. Hem damad-ı padişahî hem kubbe-nişîn idi.»56
« Le 29e jour de Rebiulevvel [25 octobre 1631], un samedi, Hafız Ahmed
Pacha fut nommé grand vizir pour la seconde fois. Hafız Pacha était un vizir
avisé, possédant intelligence et expérience, pieux et religieux, à l’origine [de
la rédaction] de livres d’annales. Il épousa la sœur du padichah du monde,
Ayşe Sultane, veuve de Nasuh Pacha. Il était à la fois gendre impérial et
membre de la coupole. »
« Ve saʻâdetlü Sultân hazretlerin mukaddemâ şer‘-i sünnet-i
Rasûllullâh ‘a[leyhi’s-selâ]m ve Hakk Te’âlâ hazret[leri]nin emri
üzre nikâh olunmuş idi. Niçe müddet idi, cem‘ olunmayup, sûr-i
hümâyûn olur. Vükelâ‘-i Devlet ve ʻulemâ‘-i kirâmlara ziyâfetler
olup, zifâf gicesinde Vezîr Hâfız Ahmed Paşa’yı ber-murâd etdiler.
Baʻdehû Yeniçeri Ağalığı’ndan maʻzûl Husrev Ağa, mîrî
taraflarından bir mikdâr ıztırâb çekdiler. Baʻdehû sebeb-i devleti
olup, vezâret nasîb olur. Küçük Vezîr mertebesine vâsıl olup, sadrda
karâr etdiler. Ve Sultân hazretlerine nâmzâd oldular. Vezîr Husrev
Paşa da târîh-i mezbûrda vükelâ‘-i devlet ve ‘ulemâ‘-i kirâmları
daʻvet etdiler. Cem’iyyet-i hass olup, anlar da ber-murâd
oldular. »57
« Par le passé, Sa Majesté la fortunée Sultane avait été mariée [à Hafız
Ahmed Pacha] selon les ordres relatifs à la législation maritale du Prophète
de Dieu – le salut soit sur lui – et de Sa Majesté Divine. Après une grande
période sans qu’aucune réunion n’ait eu lieu, les festivités [nuptiales]
impériales eurent [finalement] lieu. La visite des représentants de l’Etat et
des vénérables oulémas eut [d’abord] lieu puis, dans la nuit de la cérémonie
55
Voir ce qui a été dit plus haut à propos du mariage d’Ayşe Sultane, fille d’Ahmed Ier, avec Hasan Pacha. 56
İpşirli (éd.), Târih-i Na’îmâ : t. 2 p. 696. 57
Yılmazer (éd.), Topçular Kâtibi Tarihi : t. 2 p. 830.
Page | 566
nuptiale, Vizir Hafiz Ahmed Pacha pénétra [dans la chambre nuptiale],
conformément à un ordre [impérial]. Par ailleurs, Husrev Ağa, démis de son
office de Chef des Janissaires, subit nombre de tourments de la part du
Trésor public. Puis, pour des raisons d’Etat, il reçut le rang de vizir. Parvenu
jeune à la position de vizir, il fut choisi au poste d’honneur [au grand
vizirat] et fut marié à Son Excellence la Sultane. Dans la même période [que
le mariage d’Hafiz Pacha], Husrev Pacha invita également les représentants
de l’Etat et les vénérables oulémas. Une réunion publique eut lieu et il reçut
également l’ordre [de pénétrer la chambre nuptiale]. »
*
« Il [Osman II] eut un moment l’intention de donner des époux aux deux cents
demoiselles du seraï, et il maria en effet deux de ses sœurs : l’une, qui à l’âge de sept
ans était veuve déjà du grand vizir Nassouh, à Hafiz Pasha, gouverneur de Wan, l’autre
à Baïram Aga, tournakdji-baschi des janissaires du Kaire, et qui devait y retourner
avec la flotte. »58
*
« A son arrivée, Hafiz reçut la jeune épouse qui lui était destinée, et devint ainsi le
beau-frère du sultan. »59
58
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 8 p. 148. Il précise encore : « Ha designato maritar 200 delle done che lo habitano (il seraglio vecchio), conchiuso ancora il matrimonio di due sorelle sue ; uno fu moglie di Nassuh con Hafispascia di Van, l’altra al Turnagi capo dei Janizari del Cairo. Naïma. » 59
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 9 p. 49. En note, il précise : « Peçevi, f. 306. Gionse Cafis, smonto nel Seraglio della sorella del Re destinatagli in moglie, con la quale ha celebrato le nozze. 13 marzo. Sir Thomas Roe s’exprime ainsi au sujet des intrigues du négociateur espagnol : He had gotten his faction the Capi aga within, the wife of the great Vesir of Babilon, sister to the Emperor, and by her means the husbands of two more, Regib the Captanbassa, and Biram late Aga of the Janisaris, Neg., p 452. Les quatre beaux-frères de Mourad étaient donc Hafiz, Redjeb, Beïram et le kapitan pascha Hasan. »
Page | 567
21) Fatma Sultane, fille d’Ahmed Ier, et Canpuladzade Mustafa Pacha (1636)
« Müverrih der ki mezbur Canpolad-zâdeye padişah hazretlerinin
vâfir iltifâtı olup Hasan Paşa muhallefesi Ayşe Sultanı tezvîc
etmişler idi. »60
« Les historiens racontent que Sa Majesté le padichach avait témoigné, à de
nombreuses reprises, de sa faveur envers Canpoladzade, [en vertu de quoi]
celui-ci avait reçu en mariage Ayşe Sultane, la veuve d’Hasan Pacha. »61
« Andan Kapudan Vezîr Cânbûlâdzâde Mustafâ Paşa : Dâmâd-ı
pâ[di]şâhî olup Murâd Hân’ın hemşîresi Fâtıma’ı tezvîc etmişdir.
Sene 1040’da kapudan olup Akdeniz’de küffâr gemilerinin nâm [ü]
nişânın refʻ edüp kaht [u] galâdan cemîʻi kâfiristân el-amân diyüp tâ
Meğrib-zemîninde Sebte Boğazı’na ve Malta ve Çiçilya ve
Mankortonya ve Kalavra ve Tementis kıyıların harâb [ü] yebâb edüp
Atina nâm şehrimiz limanında bir kalʻa-i azîm inşâ etmişdir. »62
« Puis le Kapudan Vizir Canbuladzade Mustafa Pacha : il fut gendre
impérial, ayant épousé la sœur de Murad Han, Fatima Sultane. En 1630-31,
il devint amiral et détruisit le nom et la marque des bâteaux infidèles en
Méditerranée. En raison de la disette et de la famine, la communauté des
infidèles s’écriait “Mon Dieu !”. Il détruisit et ruina les côtes de Tementis
(?), de Calabre, de Mankortonya, de Cicile, de Malte, jusqu’au détroit de
Gibraltar, dans les terres du Maghreb. Il fit construire une grande forteresse
dans le port de notre ville appelée Athènes. »
*
« Pendant que ces événements se passaient dans la capitale, Djanbouladzadé Moustafa
Pascha, arrivé à Erzeroum, fut invité par l’aga des janissaires à un banquet solennel à
Sultansikisi : ce fut son repas de mort ; car l’ordre du sultan, qui ordonnait son
supplice, fut exécuté dans la même journée. Malgré ses nombreux services militaires,
60
İpşirli (éd.), Târih-i Na’îmâ : t. 2 p. 834. 61
Naima et Hammer, qui relate l’alliance en suivant son récit, semblent se tromper sur l’identité de la princesse, épouse de Canpuladzade Mustafa Pacha : à cette date, Ayşe était déjà en couple, au contraire de Fatma ; Evliya Çelebi aurait donc vu juste. Il était, après tout, contemporain des événements. 62
Dankoff, Karaman, Dağlı (éds.), Evliya Çelebi Seyahatnamesi : p. 122.
Page | 568
malgré son alliance récente avec la sultane Aïsché, veuve de Hasan Pasha [erreur :
Fatma], jamais Mourad n’avait pu lui pardonner l’irrémissible offense dont il s’était
rendu coupable, lorsque, de concert avec le grand vizir Redjeb, il avait osé se porter
garant de la vie du favori Mousa pour l’abandonner perfidement à la fureur des
factieux. Djanboulazadé aurait ordonné en Karamanie le supplice de maint innocent, ce
qui servit de prétexte au sultan pour satisfaire une vengeance longtemps différée (28
moharrem 1046 – 2 juillet 1636). »63
63
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 9 p. 151.
Page | 569
22) Fatma Sultane et Ahmed Pacha (années 1635-40 ?)
« Bu esnâda Kapudan Bekir Paşa vefât ettiği haberi geldi. Mâh-ı
ramazanda [Kasım 1644] Yeniçeri Kâtibi Mehmed Efendi maʻzûl ve
yerine Arnavud Mehmed Efendi Yeniçeri efendisi oldu. Mukaddemâ
devr-i Sultan Murad Hânî’de silahdarlıktan Halebü’ş-şehbâ
eyâletiyle çıkıp baʻdehû iki defʻa Şâm-ı şerîf vâlisi olan Vezîr Ahmed
Paşa ki Fâtıma Sultan şevheridir, hatfe enfihi vefât eyledi.
İstanbul’da idâd-ı vüzerâda idi. »64
« A cette période arriva la nouvelle du décès de Kapudan Bekir Pacha. Dans
le mois de ramadan [novembre 1644], le scribe des janissaires, Mehmed
Efendi, fut licencié et à sa place, Arnavud Mehmed Efendi devint le scribe
des janissaires. Vezir Ahmed Pacha, qui était, sous le règne passé de Sultan
Murad IV, sorti de l’office de silahdar avec la province d’Alep la colorée
puis était devenu par deux fois gouverneur de la province sacrée de Şam, et
qui était le mari de Fatima Sultane65
, décéda de mort naturelle. Il faisait
partie des vizirs [en poste] à Istanbul. »
64
İpşirli (éd.), Târih-i Na’îmâ : t. 3 p. 1026-1027. 65
Ce mariage n’est pas mentionné par la plupart des auteurs parmi les mariages de la fille d’Ahmed Ier, Fatma Sultane, la seule princesse de ce nom à cette période. Néanmoins, il n’existe aucune contre-indication à la possibilité d’une union précise : à cette période donnée, Fatma Sultane n’était en effet mariée à personne (si l’on en croit les informations que nous avons pu collecter). Elle pourrait donc très bien avoir été mariée à cet Ahmed Pacha, sans que les historiens aient prêté attention à cette union.
Page | 570
23) Safiyye Hanım Sultane, petite-fille d’Ahmed Ier, et Siyavuş Pacha (1643)
« Anadolu eyâleti Tekeli’ye verildi. Siyavuş Paşa Âsitâne’ye geldikte
bir kaç gün kuleye konup baʻdehû afv olunup Adana eyâleti verilip
mâh-ı şevvalde Receb Paşa’nın Gevherhan Sultan’dan olan duhteri,
ki Safiye Hanım’dır, Siyavuş Paşa’ya tezvîc olunup damad oldu. »66
« Le gouvernorat de l’Anatolie fut donné à Tekeli [Pacha]. Lorsque Siyavuş
Pacha vint à la capitale, il fut placé quelques jours à la tour [= en prison]
avant d’être pardonné. On lui remit alors le gouvernorat d’Adana et, dans le
mois de şevval, la fille de Gevherhan Sultane et de Receb Pacha, Safiye
Hanım, fut mariée à Siyavuş Pacha ; il devint gendre [princier]. [1643]»
*
« Parmi les nombreux changements administratifs qui eurent lieu vers cette époque, il
faut remarquer la destitution de Siawousch Pasha, gouverneur de Haleb, qui rappelé à
Constantinople à cause de ses exactions, obtint bientôt après la main de Safiye-khan,
fille de la sultane Ghewehr, épouse de Redjeb Pasha. »67
66
İpşirli (éd.), Târih-i Na’îmâ : t. 3 p. 990. 67
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 10 p. 26.
Page | 571
24) Fatima Sultane et Musahip Fazlı Pacha (1646)
« Mousa Pascha avait succédé au silihdar dans les faveurs impériales. Le second vizir
Fazli Pascha le remplaça, et devint le confident et le gendre du sultan par ses
fiançailles avec la princesse Fatima, âgée seulement de trois ans. Il reçut en présent un
des châteaux qu’avait possédé Ibrahim Pascha, récemment exécuté, et qui avait été
successivement occupé par les plus puissants grands vizirs de l’empire : Ibrahim, favori
de Souleiman Ier ; Ibrahim, conquérant de Kanischa ; Ahmed Pascha, le gendre de
Roustem ; Moustafa Pascha, écuyer et favori de Mourad IV. »68
*
« A l’occasion des fiançailles solennelles du favori Fazli Pascha avec la fille du
sultan69
, le grand vizir Salih fut nommé paranymphe, distinction qui lui occasionna une
dépense de cinquante mille piastres. Les vizirs rivalisèrent entre eux de magnificence, et
firent faire de splendides palmes de noce en or et en argent ; ce fut pendant ces fêtes
que le grand écuyer destitué, gendre de la nourrice du sultan, fut rétabli dans ses
fonctions (11 mars 1646 – 23 moharrem 1056). »70
68
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 10 p. 64. 69
Il ne semble pas qu’Ibrahim ait eu de fille dénommée Fatima ; la seule Fatima dont nous ayons connaissance pour la période est la fille d’Ahmed Ier, qui elle-même ne semble pas avoir été mariée à ce Fazlı Pacha. Une confusion existe donc concernant l’identité de cette princesse. 70
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 10 p. 67-68.
Page | 572
25) Atike Sultane, fille d’Ibrahim, et Cafer Pacha puis Kenan Pacha (1648)
« Djafèr Pascha, qui avait été marié à la plus jeune fille d’Ibrahim, étant mort, la main
de la veuve enfant fut donnée à Kenaan Pascha, seigneur de l’étrier. »71
71
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 10 p. 72.
Page | 573
26) Kaya Sultane, fille de Murad IV, et Haydaragazade Mehmed Pacha (1649)
« Vers cette époque [début du règne de Mehmed IV] eurent lieu les noces de la fille du
dernier Sultan Ibrahim, Kia Sultane, avec Haïdaragazadé Mohammed ; le defterdar
Ibrahim Pascha remplit dans les fêtes de mariage les fonctions de paranymphe. Un
mois après, furent célébrées les fêtes de circoncision du Sultan et de ses trois frères. »72
72
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 10 p. 122.
Page | 574
27) Hanzade Sultane, fille d’Ahmed Ier, et Nakkaş Mustafa Pacha (1649)
« Ve mukaddemâ mâh-ı recebde Bostancı-başı olan Mustafa Ağa da
vezâret ile çıkup ve hem Bayram Paşa’nın Sultân hazretlerini
nâmzâd edüp, Vezîr-i aʻzam-ı sâbık merhûm Bayram Paşa’nın
saraylarına teveccüh edüp, baʻdehû Sultân hazretlerine nikâh olup,
mezbûr Vezîr sadrda karâr etdiler. [1049] »73
« Précédemment, dans le mois de receb, le bostancıbaşı Mustafa Ağa était
sorti [du palais] avec le rang de vizir et il fut marié à la Sultane de Bayram
Pacha ; il reçut en gratification supplémentaire les palais du défunt Bayram
Pacha, ancien grand vizir. Le mariage contractuel avec Sa Majesté la
Sultane ayant eu lieu, on décida de nommer ce dernier le grand vizir. [1049
= octobre 1639] »
« Kezâlik merhuma Han-zâde zevci Nakkâş Mustafa Paşa ve
Sivas’dan ma’zul Tekelü Paşa Süleyman Paşa ile maʻan Girit’e
me’mur oldular. »74
« De même, Nakkaş Mustafa Pacha, époux de la défunte Hanzade [Sultane],
Tekelü Pacha, démis de son office à Sivas, et Süleyman Paşa furent nommés
tous ensemble officiers à Girit. [1653] »
73
Yılmazer (éd.), Topçular Kâtibi Tarihi : t. 2 p. 1128. 74
İpşirli (éd.), Târih-i Na’îmâ : t. 3 p. 1458.
Page | 575
28) Ümmügülsüm Sultane, fille d’Ibrahim, et Ahmed Pacha (1653)
« kezâlik Tımışvar Vâlisi Ahmed Paşa ki, Ümmü Gülsüm Sultan
zevcidir. »75
« L’actuel gouverneur de Tımışvar est Ahmed Pacha ; il est l’époux
d’Ümmügülsüm Sultane. »
75
İpşirli (éd.), Târih-i Na’îmâ : t. 3 p. 1408.
Page | 576
29) Ayşe Sultane, fille d’Ahmed Ier, et İbşir Pacha (1655)
« Rebî’ül-âhir’ün on sekizinci Penc-şenbih güninde Paşa-yı
müşarun-ileyh [İbşir Paşa] alaylarıyla Üsküdar sahrâsına vâsıl ve
mukaddemâ kendüye tezvîc olunan Âyişe Sultân’un bağçesine dâhil
oldu. Fermân-ı Pâdişâhî üzere vüzerâ-yı izâm ve Şeyhü’l-islâm ve
kudât-ı asâkir ve sâ’ir ulemâ ve aʻyân-ı dîvân cemîʻan istikbâlde
bulunup ancak Kapudân Murâd Paşa ile Yeniçeri Ocağı baʻzı
mülâhaza sebebiyle Üsküdar’a ubûrdan menʻ olunmağın Paşa-yı
mezbûr bu mâddeden dahi ziyâde münfaʻil ve bî-huzûr olup ne aceb
kânûn-ı kadîm üzre Ocak halkı istikbâl itmedi ve Kapudân Paşa dahi
gelmedi deyü vehm-i kadîmi tecdîd itmişidi. »76
« Le jeudi 18 du mois de Rebiülahir, le pacha susmentionné [Ibşir Pacha]
arriva dans la plaine d’Üsküdar en grande cérémonie et il entra au jardin
d’Ayşe Sultane, à laquelle il avait été marié auparavant. D’après le
firman du padichah, les glorieux vizirs, le cheikh-ul-islam, les cadiaskers,
les autres oulémas et les notables du Divan se portèrent tous ensemble à
sa rencontre. Cependant, du fait de quelques critiques, le kapudan Murad
Pacha et le corps des janissaires ayant refusé de traverser à Üsküdar, le
pacha susdit s’en offensa et s’en irrita beaucoup. “Quelle surprise !
Contrairement aux lois canoniques, ni les gens des corps [militaires], ni
même le Kapudan Pacha ne sont venus à ma rencontre !” dit-il. [Ceci]
renforça ses craintes passées. »
« Şevketlü Pâdişâhımuzun âmme-i muhteremeleri Âyişe Sultân Sadr-
ı aʻzam İbşir Paşa’ya kable’s-sadâre tezvîc olunup henüz gerdek
olmamağın yigirmi birinci Pazar güni ikindiden sonra vüzerâ-yı
izâmla ikindiden sonra vüzerâ-yı izâmla Şeyhü’l-islâm Efendi
Sultân-ı müşârun-ileyhânun sarâyına varup iʻzâz ü ikrâmla Sadrʻı
aʻzâmı gice gerdeğe kodılar. Sağdıçları, Kapudân Vezîr Murâd Paşa
olmuşidi. »77
« La vénérable tante (paternelle) de notre majestueux Padişah Ayşe Sultane
avait été donnée en mariage au grand vizir Ibşir Paşa avant qu’il n’obtienne
cet office. Comme il n’avait pas encore pénétré la chambre nuptiale, le
76
Derin (éd.), Abdi Paşa vekâyı’-nâmesi : p. 73-74. 77
Derin (éd.), Abdi Paşa vekâyı’-nâmesi : p. 75.
Page | 577
dimanche 21 [Rebiyulahir 1065 = 28 février 1655] après la prière de l’après-
midi, le şeyhülislam et les vizirs de la coupole qui l’accompagnaient se
rendirent au palais de la Sultane susmentionnée. La nuit venue, ils
installèrent le grand vizir avec honneur et respect dans la chambre nuptiale.
Son témoin fut le vizir kapudan Murad Pacha. »
« Zifâf-ı vezîriaʻzam
Ertesi mâh-ı rebîülâhirin yirmi birinci [28.02.1655] ahad günü
vezîriaʻzamın namzedi Âʻişe Sultan hazretlerinin arûsu olup, leyle-i
isneynde vezîriaʻzam zifâfa duhûl etti. »78
« Le mariage du grand vizir.
Le lendemain, dimanche 21 du mois de Rebi-ul-ahir [28.02.1655], le grand
vizir se maria. Sa fiancée était Sa Majesté Ayşe Sultane. Dans la nuit du
lundi, le grand vizir pénétra dans la chambre nuptiale. »
78
İpşirli (éd.), Târih-i Na’îmâ : t. 4 p. 1585.
Page | 578
30) Atike Sultane, fille d’Ibrahim, et Müfettiş Ismail Pacha (années 1650) puis
Kasım Pacha
« Tullio Miglio, particolarità dell’Imp. Ott, dit d’Ismail Pascha : « Ismailbassa nacque
in Herzec, huomo alto, grasso, ha il naso grande, barba longa di colore di castagna, ha
voce sonora, e si sforza di mostre si terribile ; il defonto Vezir lo fece il suo Ciausbassi,
poi arrivo ancora a esser quello del G.S. ; l’anno 1659 fu speditto in Asia per sedare li
moti, il che gli riusci facilmente havendo fatto tagliare la testa a 6 000 persone. Il G.S.
in ricompensa gli diede per consorte la sua surella, gia moglie di Yaus Kenaanbassa ;
per questo matrimonio destinato Vezir di Buda, et l’anno passato, che il G.S. si mosse
da Costantinopoli, fu lasciato Caimacamo in questo governo, so porto con tanta
tirannia, che accusato dal Mufti, fu deposto e mandato al Governo d’Asak, inimico
mortale dei Christiani, erudele a maggior segno. »79
*
« De Broussa, où on avait exposé sur un trône, à la vénération du sérail, la plus sainte
relique du trésor impérial, le manteau (borda) du Prophète, le Sultan manda auprès de
lui le kaïmakam, Ismaïl Paşa, et lui conféra le titre de moufetisch (grand-inquisiteur).
Homme ardent dans l’acquisition de ses devoirs, et vizir zélé, Ismaïl était souvent
exposé aux injures de son harem, et surtout à celles de la sultane, veuve de Kenaan
Paşa à cause de la faiblesse de son organisation, comme homme et comme époux. »80
*
« La seconde [sœur du sultan], nommée Aatika, épousa d’abord le vizir Kenaan Pacha,
puis le vizir Yousouf Pacha, et en troisième lieu le kapitan Sinan Pacha, qui avait perdu
la bataille des Dardanelles contre les Vénitiens ; elle eut pour quatrième époux Ismaïl
Pacha, grand inquisiteur en Asie, qui fut tué à la bataille de Saint-Gotthardt ; enfin elle
contracta une cinquième union avec Kasim Pacha, l’un des pages de la chambre
intérieure, et chirurgien de profession, qui, lors de la circoncision du sultan
Mohammed, sut arrêter, au moyen d’une poudre astringente, une hémorragie qui avait
fait tomber le prince en défaillance, service que ce dernier récompensa plus tard en
donnant à Kasim le gouvernement de Temeswar. Battu par de Souches, Kasim devait
être puni de mort, lorsque le Sultan, en reconnaissance du sang qu’il lui avait conservé,
refusa de répandre le sien, et pour le sauver, lui donna la main de sa sœur, qu’un vice
de conformation avait empêché d’appartenir à ses premiers maris et qui, après dix-neuf
ans de mariage, entra vierge dans le harem de Kasim. Celui-ci la délivra de son
infirmité au moyen d’une opération qu’il pratiqua pendant le sommeil d’Aatika,
assoupie par un narcotique. Ce fut ainsi qu’il acquit des titres puissants aux bonnes
79
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 11 n°3 p. 329. 80
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 11 p. 43.
Page | 579
grâces de la princesse, comme précédemment il avait mérité la faveur particulière de
Mohammed IV. »81
81
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 12 p. 30.
Page | 580
31) Fatma Sultane, fille d’Ahmed Ier, et Melek Ahmed Pacha ( 1660)
« Köprülü Mehemmed Paşa’nın fevti ve oğlu Fâzıl Ahmed Paşa’nın
vezîr-i aʻzam olduğu, Kapucular Kethudâsı (---) Ağa ile haber gelüp
Foğraş nâm kalʻa altında bir azîm ceng ve bir azîm kar yağup mâh-ı
mezbûrun (---) günü kırk bin araba mâl-ı ganâyimle ve yüz bin esîr
ile Demirkapu’dan taşra çıkılup cümle asker-i İslâma meştâlar
verilüp Melek Ahmed Paşa efendimize Belgrad şehri kışla verilüp
zevk [ü] safâda iken Fâtıma Sultân binti Ahmed Hân nikâh
olunmuşdu.
Ol ecilden Melek Ahmed Paş’ya fermân-ı şehriyârî gelüp katʻ-ı
menâzıl Âsitâne-i devlete gelüp baʻde’z-zifâf Melek Ahmed Paşa
kubbe altında üç ay olup sene (---) târîhinde merhûm olup Eyyûb
Sultân mezâristânında Kiçi Mehemmed Efendi üstâdının ayağı ucuna
defn edüp bu garîb Evliyâ bî-kes kaldı. Hudâ kerîmdir. »82
« La nouvelle arriva par le kethüda des kapıcı, ----- Ağa, que Köprülü
Mehmed Pacha était mort et que son fils, Fazıl Ahmed Pacha, était devenu
grand vizir [à sa place]. Aux pieds de la citadelle dite Foğraş, un combat
formidable se déroulait sous une très forte pluie de neige. Le ---- du mois
susdit, on fit sortir par la Porte du Fer 40 000 voitures chargées de biens du
butin et 100 000 prisonniers de guerre tandis que l’on envoyait les soldats de
l’Islam à leurs quartiers d’hiver. Notre Seigneur Melek Ahmed Pacha reçut
l’hivernage de la ville de Belgrade et tandis qu’il vivait dans la paix et le
plaisir, il fut fiancé à Fatima Sultane, fille d’Ahmed Han.
Un firman impérial arriva auprès de Melek Ahmed Pacha à ce sujet ; [à la
suite de quoi] celui-ci se rendit au Seuil de la Félicité au gré de chacune des
étapes [du voyage] et, après le mariage, Melek Ahmed Pacha demeura trois
mois sous la coupole [= vizir siégeant au Divan] et mourut le ------. Il fut
inhumé au pied [de la stèle] de Maître Kiçi Mehmed Efendi, dans le
cimetière d’Eyüp Sultan. Ce pauvre Evliya demeura sans personne. Dieu est
grand. »
« sene 1072 Şaʻbânu’l-muʻazzamının ikinci hafta Cumʻartesi gün
sevâd-ı azîm ve bilâd-ı kadîm belde-i tayyibe, yaʻnî mahrûse-i
Kostantiniyye hamâhallâhu Taʻâlâ ani’l-beliyye olan şehr-i
İslâmbol’a bir alay-ı şevket ile dâhil olup Paşa efendimiz doğru
Köprülüzâde Fâzıl Ahmed Paşa’ya varup mülâkât olduklarında
82
Dankoff, Karaman, Dağlı (éd.), Evliya Çelebi Seyahatnamesi : p. 141.
Page | 581
hemân Sadrıaʻzam paşayı saʻâdetlü pâdişâha götürüp buluşdurdukda
saʻâdetlü pâdişâh, “Melek Lalam hoş geldin. Erdel gazân mübârek
ola. Bana ey hazîne tahsîl eylemişsiz. Berhordâr olup ekmeğim size
helâl olsun” deyüp niçe hayır duʻâlardan sonra paşaya bir semmûr
kürk ve on kîse guruş ihsân edüp, “Var Fâtıma Sultân halama düğün
edüp bu kîseleri harc-ı sûr eyle” dedikde paşa selâm verüp taşra
çıkdı. Ve cümle musâhiblerle buluşup görüşüp öpüşüp niçeleriyle el
ele yapışup baʻdehu vedâlaşup sarâyına gelüp kurbânlar kesilüp
cümle ağavâtlara ziyâfetler oldu. On günden sonra Ramazân-ı şerîfin
onuncu gün sünnet üzre sûr-ı zifâf olup sene 1072 Ramazân’ında
Melek Ahmed Paşa efendimiz Fâtıma Sultân binti Sultân Ahmed Hân’ı
izdivâclarında münderic edüp leyle-i zifâfda cümle Melek Ahmed
Paşalı Fâtıma Sultân’ın Ebû Ensârî kapusundaki sarây[ın]da tâ
sabâha dak cân sohbetleri etdik. Vakt-i Şâfiʻî kim oldu Melek Ahmed
Paşa efendimiz yine ke’l-evvel esbâbıyla gazab-âlûd taşraya çıkup
gözleri tas-ı pür-hûna dönmüş.
Cümle sika hüddâmları “Zifâf mübarek ola” dediklerinde “Dahi
salât-ı ışâ âbdestiyleyim” dediler.
Vakt-i Hanefî ki oldu “Seccâde” deyüp salât-ı fecri edâ edüp hakîre
eydir. “Evliyâm tîz bana karpuzcunun dörd çifte kayığın hâzır et, bir
yere gitsem gerek” buyurdular.
Hakîr eyitdim: “Sultânım, şimdi cemîʻi vüzerâ ve vükelâ ve ulemâ ve
sulehâ ve e’imme ve hutebâ ve meşâyih [ü] sâdât ve aʻyân-ı kibâr-ı
kübbâr cümle gelüp zifâf paçası yerler. Siz kanda gidersiz” dedikde.
“Belî kanda giderim, tîz kayık getir” deyü gazabâne tekellüm edüp
derhâl iskeleden karpuzcu kayığın getirdim. [...] Hemân Paşa’yı kâmil
kethudâsı ve hazînedârı ve gayri iş erlerin çağırup “Ziyâfete gelen
vüzerâ kardaşlarımızı ve cümle ulemâ efendilerimizi kanûn [u] kâʻide
üzre ağırlayup hoş iʻzâz u ikrâm [eylen], benüm sehel işim var” deyü
tenbîh ü teʻkîdler edüp silahdâr ve çukadâr ve mühürdâr ve hakîr,
Paşa ile kayığa süvâr olduğumuzda Paşa eyitdi : “Bizi tershâne
bağçesine götür” dedi. »83
« Le samedi de la deuxième semaine du mois estimé de Şaban de l’année
1072, il entra en cortège somptueux dans Islambol, la capitale majestueuse
des cités antiques, la ville plaisante, c’est-à-dire la cité de Constantinople –
que Dieu la protège contre tous les maux ! Notre seigneur pacha se rendit
auprès de Köprülüzade Fazıl Ahmed Pacha et, dès qu’ils se trouvèrent
ensemble, le grand vizir emmena aussitôt le pacha devant le souverain
fortuné. Durant cette rencontre, le fortuné souverain déclara : “Mon lala
Mekek, bienvenu ! Sois félicité pour ta guerre sainte en Transylvanie ! Vouz
83
Evliya Çelebi, Evliya Çelebi Seyahatnâmesi : t. 1 vol. 6 p. 73-74.
Page | 582
m’avez acquis un beau trésor. Soyez-en remercié et que mon pain vous sois
donné”. Après une multitude de prières de prospérité, il honora le pacha
d’une robe d’honneur en fourrure et de dix bourses de petite monnaire
[guruş]. “Va, épouse ma tante Fatma Sultane et fais usage de ces dix bourses
pour les dépenses des festivités” dit-il. Mon pacha fit sa révérence et sortit.
Il alla voir et trouver tous ses compagnons, ils s’embrassèrent et se prirent
dans les bras mutuellement à envie, puis se dirent au revoir et [Melek
Ahmed Pacha] se rendit à son palais, fit les sacrifices [d’usage] et les visites
de tous les dignitaires eurent lieu.
Dix jours plus tard, la cérémonie nuptiale eut lieu d’après les coutumes du
Prophète, le dixième jour du mois sacré du Ramadan. Pendant le mois de
Ramadan de l’année 1072 [29 avril 1662] eut lieu l’annonce du mariage de
notre Seigneur Melek Ahmed Pacha avec Fatma Sultane, la fille de Sultan
Ahmed Han. Lors de la nuit de noces, nous avons discuté vivement jusqu’au
petit matin dans le palais de la Fatma Sultane de Melek Ahmed Pacha, qui
se trouve au niveau de la porte d’Ebu Ensari, de sorte que vint l’heure de
Şafi’. Notre seigneur Melek Ahmed Pacha sortit alors plein de rage, toujours
dans sa tenue d’origine. Ses yeux étaient arrondis par la colère. Quand ses
proches serviteurs lui souhaitèrent “Félicitation pour tes noces !”, il répondit
“je suis toujours dans l’état de pureté (rituelle) de la prière de la nuit”.
L’heure de Hanefi arriva : “mon tapis de prière !” réclama-t-il, et il
accomplit la prière de l’aurore. Puis il ordonna au pauvre serviteur : “Mon
Evliya, prépare ma barque des vendeurs de pastèque à quatre rangées de
rames, j’ai quelque part où aller”. Ce pauvre serviteur que je suis répondit :
“Mon sultan, l’ensemble des vizirs et des représentants de l’Etat, des
oulémas, des imams, des cheikhs et descendants du Prophète, et tous les
autres dignitaires vont venir manger le poça de noces. Où allez-vous ?”
“Oui, où vais-je ?” dit-il, “apporte le caïque tout de suite”. Il parlait avec
irritation ; j’apportais aussitôt le caïque des vendeurs de pastèque depuis son
port d’attache [jusqu’au ponton du palais de Fatma Sultane]. […] Le pacha
de perfection convoqua son intendant et son Trésorier, ainsi que ses autres
agents et donna ses instructions : “Entretenez mes frères les vizirs et tous les
Seigneurs oulémas qui vont venir célébrer les noces ; montrez leur toutes les
marques de respect en accord avec les règles et les pratiques [protocolaires
d’usage]. J’ai quelque chose à accomplir.” Le silahdar, le çukadar, le
mühürdar et le pauvre que je suis embarquâmes dans le caïque avec le
pacha, qui ordonna : “Amenez-nous au jardin de l’arsenal”. »
« Şikâyet-i Melek berâ-yı Fâtıma Sultân binti Ahmed Hân
“Evliyâm, sır bunda kalsın. Bu leyle-i zifâfda sabâha dak benim ol
avretden çekdiğim azâb-ı elîmi Malta üsârâları çekmez. Estağfirullâh
ne bî-hayâ ve kalîlü’l-edeb müsrife avret olur. Hemân Bism-i İlâh ile
Page | 583
içeri hareme girüp kendüyi yerinde ber-karâr görüp helâli olsam
gerek dahi ibtidâ gecemiz olsa gerek, hakîre sehel ta`zîm [ü] tekrîmen
hareket gerek. Aslâ yerinden deprenmeyüp katı durdu. Hakîr ileri
varup dest bûsdan sonra,“Paşa hoş geldin”,“Hoş bulduk sultânımın
gül cemâlin gördük elhamdülillâh” deyü niçe gûne kelimât-ı dervîşâne
hüsn-i ülfet içün du`âlar etdim.
Aslâ otur demeyüp on iki kocadan mahlûle kalmış bir fertûte-i cihâne
iken yine nâ-şüküfte duhter-i pâkîze-ahter evzâ` [u] etvârın etdi.
Hemân dürr-i kelâm-ı evveli ol oldu kim,“Paşacığım, eğer benimle
geçinmek istersen, eğer hâzır ve eğer gâ’ib olup mansıblara gidersen
de mâh-be-mâh on beşer kîse masrûfum var. Ve Kiremitçi Mustafâ
Ağa kethudâma yüz kîse deynim var, ale’s-sabâh deynim ver. Ve her
yıl altı Marmara gemisi odunum alınur. Ve Selmân Beğime ve Ömer
Beğime ve Mukbil Ağama ve kethudâma beher yevm yüzer kîle arpa ve
yevmiyye onar vukiyye kahve ve onar vukiyye sükker-i mî`âd ve her
şeb onar vukiyye şem`-i asel-i kâfûrî ve niçe yüz tekâlîf-i mâlâ-yâ`nî
kelâmları gûyâ dilli defter gibi bir masrûf kelimâtları söyleyüp niçe
kerre yüzüme yapışdı.
Ben yine ayak üzre kadîd-i mahz gibi kethudâ kadını ve hazînedârı ve
musâhibeleri ve’l-hâsıl üç yüzden mütecâviz nisvân-ı sâhib-isyânlar
gelüp hakîrin destin bûs edüp kat-ender-kat durup,“İşte cânım paşa,
bunlar benim iç hüddâmlarımdır ve bir bu kadardan ziyâde taşrada
âzâdlı kızlarım ve anların ehl [ü] iyâlleri va[r], cümle yedi yüz
kimesnedir. Bunların ve anların cümle dîbâ ve şîb ve zerbâf ve çuka
yıllıkların ve cümle baltacı ev aşçı ve başçılar ve bâğbânlar ve
arabalar ve kara ağ[a]larım ve beğlerimin ve anların hüddâmının
cümle beş yüz kişinin yıllıkların verirsin ve illâ sen bilirsin” dedikde
ben eyitdim : “Vallâhi sultân efendim, ben hâlâ Erdel seferi
gazâsından gelir bir mücâhidün fî-sebîlillâh vezîrim. Ben ol seferde
yedi bin âdem besleyüp yüz yetmiş bin altun ve iki yüz kîse harc etdim
ve bu kadar raht ve zırh [u] zereh-külâh ve âlât-ı silâh satup yeniçeri
ocağından mu’âmele ile karz akçe dahi aldım. Ve ben zâlim değilim ki
mutasarrıf olduğum mansıblarda zulm edüp mâl alup seni bu isrâf
masrûf üzre besleyem. Ben bu kadar masrûfu çekmeğe kâdir değilim.
Benim bu kadar tevâbi` [u] levâhıkım var. Ben ehl-i seferim, bu
masrûfu çokdur. Lütf edüp sehel tenzîl buyurun. Kaya Sultân merhûme
kadar masrûfa tahammülüm vardır, ammâ bu beş kat masrafa tâkatım
yokdur” dedim.
Hemân ol dahi “Ya Paşacığım, beni Kaya Sultân gibi mi görürsün. O
benim kardaşım kızıdır, ammâ ben Sultân Ahmed Hân efendinin
kızıyım. Baka şu babam kölesini beni Kaya kız ile bir dutar” dedikde
Page | 584
ben eyitdim : “Hâşâ sultânım, ben seni anınla berâber dut[m]am84
.
Sen efendim Ahmed Hân kızı yetmiş yedi yaşında bir ih[ti]yâre
hâtûnsun ve çok mu`ammere olup çok yüz görüp on iki kocadan artık
kalmışsın, ammâ ben Kaya Sultân’ı on üç yaşında duhter-i pâkîze iken
babasından gayri er yüzün ve erkek sözün istimâ` et[me]mişken kız
oğlan kız alup Râbi`a-i Adeviyye gibi geçinüp benim taht-i nikâhımda
iken merhûme oldu. O bir pâre-i cüvân Kaya İsmihân-ı mâhtâb idi.
Sen oturuşmuş ve duruşmuş ve yüzü gözü büzümüş hâtûnsun. Hiç
efendim sultânım ben seni anınla berâber gördüm mi ?” dediğimde
hemân, Sultân eydir : “Baka güğeyi, çünki beni ihtiyâr bilirdin, yâ
beni niçün aldın” dedi. Ben dahi eyitdim: “Hâşâ ve kellâ ben seni
almakdan haberim yokdur. Ben Erdel seferinde haberim yok iken
İslâmbol’da sen beni almışsın. Bana nikâh haberi Erdel’de geldi. Ben
Kaya Sultân masrûfından kurtuldum deyü hamd edere Köprülü
merhûm seni bana vermiş. ‘Melek’e bir fîl verdim, beslesin’ demiş,
andan gebermiş. İste şimdi sana duş geldim, emir Allâh’ın” dedim.
Hemân Sultân eydir :“Paşam sen benimle geçinemezsin, ben seni diri
iken yâhûd ölü iken boşarım. Hemân bana bir Mısır hazînesi nikâhım
vermeğe hâzır ol” dedikde sabâha dak azîm mücâdele-i gûnâ-gûnlar
edüp ne zifâf gecesi leyle-i (---) gecesi olup âhir-i kâr vakt-i Şâfi`îde
ben dahi dedim ki,“Sultânım, bu dediğin masrûfât [u] müsrifâtları
cümle alınız. Bir dahi ben bunda gelirsem Hak Ta`âlâ cânım alsın”
deyüp taşra çıkdım ve sizinle sabâh namâzın tâ işâ âbdestiyle kılup
işte bu makâma gelüp hamd-i Hudâ du`âmız kabûl oldu. Estağfirullâh
bir dahi ben Fâtima Sultân sarâyına varmam ve inşâallâh artık yüzün
dahi görmem”deyü bükâ ederek Sultân ile geçen mâcerâ-yı
serencâmın Dershâne bâğçesinde hakîre nakîr ü kıtmîr takrîr edüp
andan yine kayığa binüp Bâğçekapusu iskelesinde atına süvâr olup
doğru Köprülüzâde Vezîria`zam Ahmed Paşa’ya varup vezîria`zam
ikrâmlar edüp “Zifâflar mübârek ola” deyüp Melek Paşa ile sa`âdetlü
pâdişâha gidüp buluşdukda, “Lalam Melek Paşa, halam ile zifâfın
mübârek ola” deyüp paşaya bir semmûr lipâçe geydirüp, “Melek
lalam, seni vezîria`zamının alt yanında kubbe altında ikinci vezîr edüp
Akfyonkarahisâr sancağın sana ber-vech-i arpalık hâss-ı hümâyûn
ihsân eyledim” deyüp paşa-yı hamûl “Emir pâdişâhımın” deyüp taşra
sarâyına gelüp kâmil üç ay dîvân-ı pâdişâhîye müdâvemete başladı da
hakîr müsellim ile Afyonkarahisâr’ına gitmeğe izin taleb etdiğimde
“Sen bize birkaç günden lâzımsın” deyüp izn-i şerîfleri olmadı.
Ve birkaç günden ba`zı müfsidîn-i bî-dîn zemmâm u nemmâm ve
deccâl u fassâl kimesneler, “Melek Ahmed Paşa Fâtıma Sultân ile
leyle-i zifâfda çekişmişler” deyü efvâh-ı nâs-ı hannâsda güft [ü] gû
84
La translittération fournie indique « dutam », mais il semble évident qu’il s’agit d’une erreur ; il faut lire sans nul doute « dutmam ».
Page | 585
olarak âhir-i kâr Sultân Mehemmed Hân’ın sem`-i hümâyûnlarına bu
haber vâsıl olunca bir arz günü sa`âdetlü pâdişâh-ı âlem-[pe]nâh
hazretleri paşaya buyurdular kim, “Melek Paşa lalam, benim halam
ile çekişdiler mi? Eyle olur er ü avret mâbeynine kimse giremez,
ammâ ben sizi yine barışdırır, görüşdürürüm” deyü latîfe-gûne
kelimâtlar olup Paşa arzdan çıkup ba`de’d’dîvân sarâyına geldi ve
salât-ı ebvâbîni kıldı ve âsûde-hâl durdu. »85
« Complainte de Melek à propos de Fatma Sultane, fille de Sultan Ahmed
Han.
“Mon Evliya, que cela reste un secret. Les tortures que j’ai enduré de cette
femme qui est la mienne pendant la nuit de noces jusqu’au matin ne se
trouvent pas même chez les captifs de Malte. Que Dieu me pardonne, mais
quelle femme immodeste, effrontée et extravagante ! Sitôt après être entré
dans le harem en récitant un bismillah, je l’ai vue installée à sa place.
Maintenant que je suis son mari et que c’est notre toute première nuit, elle
doit se comporter envers le malheureux que je suis avec un minimum de
respect et d’honneur. A aucun moment elle ne bougea d’un pouce ; elle resta
bien droite [à sa place]. Le pauvre que je suis s’approcha d’elle et, une fois
que j’eû embrassé sa main, elle déclara : “Bienvenu pacha”. “Avec plaisir.
Dieu soit remercié de m’avoir permis de voir la beauté du sourire de ma
sultane” et, de la sorte, je proférais de multiples prières gracieuses de toutes
sortes, selon la manière coutumière des paroles des derviches.
Pas une fois, elle ne m’invita à m’asseoir. Malgré le fait qu’elle est une
veuve totalement décrépie qui a connu douze maris, elle prenait des postures
et agissait comme une fille chaste non déflorée. La première perle qui sortit
de sa bouche fut la suivante : “Mon cher pacha, si tu veux t’entendre avec
moi, que tu sois présent ou absent, en route vers tes offices, mes dépenses
sont de 15 bourses par mois et chaque mois. J’ai aussi une dette de 100
bourses envers mon intendant, Kiremitçi Mustafa Aga : donne-lui son dû au
petit matin. Je reçois encore [la charge de] six bateaux de Marmara de bois
par an. Quant à mon Selman Beg, mon Ömer Beg, mon Mukbil Aga et mon
intendant, [leur entretien] journalier respectif est de 100 boisseaux d’orge,
de 10 vukiyye de café, 10 vukiyye de sucre raffiné et 10 vukiyye de cire
d’abeille. Elle déclama ainsi ces dépenses comme si elle récitait un regisre
de comptes et me les jetait au visage sans arrêter. Vinrent défiler devant
moi, toujours debout, tel un simple squelette, son intendante, sa trésorière,
ses compagnes et en tout plus de 300 femmes qui lui appartenaient ; elles
baisaient la main du malheureux que je suis et s’arrêtaient en rang. “Voilà,
mon cher pacha, ce sont mes servantes de l’intérieur. J’ai autant et plus de
filles affranchies à l’extérieur, avec leur famille et enfants, cela fait en tout
85
Evliyâ, Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, vol. 1 livre 6 p. 74-76.
Page | 586
700 personnes. Tu t’acquitteras de la dépense annuelle en soie, gaze,
brocard et drap des unes et des autres. Et de même pour les baltacı, les
cuisiniers, les başçı, les jardiniers, les voituriers, mes eunuques noirs et mes
begs, qui composent mes serviteurs et qui comptent au total 500 personnes.
Tout cela sans défaut, sache-le”.
A quoi je répondis : “Par Dieu, Madame ma sultane, je rentre juste de la
campagne en Transylvanie. Je suis un vizir combattant pour la foi sur la
voie de Dieu. Durant cette campagne, j’ai nourri 7 000 hommes, dépensé
170 000 pièces d’or et 200 bourses. Il m’a fallu vendre un grand nombre
d’équipements, de cuirasses, de casques et d’armes ; et encore que
j’emprunte de l’argent aux janissaires. Par ailleurs, je ne suis pas un tyran
qui oppresserait et prendrait les biens [des gens du peuple résidant sur les
terres] des offices qui m’ont été confiés, afin de pouvoir te nourrir selon ces
dépenses prodigieuses. Je n’ai pas la capacité de couvrir de telles dépenses.
Moi-même ai-je quelques serviteurs et domestiques [à entretenir]. Je suis un
homme de guerre : ces dépenses sont trop [élevées]. Je vous en prie,
réduisez-les un peu. J’ai la capacité de couvrir des dépenses équivalentes à
celles de la défunte Kaya Sultane, mais je n’ai pas les ressources pour
couvrir des dépenses cinq fois plus importantes.”
Elle rétorqua aussitôt : “Eh, mon cher petit pacha, me considérerais-tu
comme Kaya Sultane ? Elle était la fille de mon frère, tandis que je suis la
fille de ton seigneur Sultan Ahmed Han. Regardez cet esclave de mon père
qui me confonds avec Kaya la jeune !” Je lui répondis : “Que Dieu me
pardonne, ma sultane, il m’est impossible de te confondre avec elle. Tu es la
fille de mon seigneur Sultan Ahmed Han, tu es une vieille femme de
soixante-dix-sept ans, qui a vécu trop longtemps et a vu trop de visage
[d’hommes] ; tu as connu douze maris. Tandis que j’ai pris Kaya Sultane
quand elle était une fille chaste de treize ans, c’était alors encore une vierge
qui n’avait vu d’autres visages ni entendu d’autres voix que son père. Elle a
vécu comme Rabia la mystique et elle est décédée en étant toujours ma
femme. Elle était Kaya Ismihan, une femme sans égale, une lune
étincelante. Toi, tu es une vieille femme usée et décrépite, avec des rides au
visage. Comment pourrais-je jamais te confondre avec ma sultane ?” La
sultane répliqua aussitôt : “Voyez ce fiancé ! Tu fais savoir que je suis
vieille : pourquoi donc m’as-tu prise ?” A cela je lui dis : “Que Dieu me
pardonne. Je n’avais certainement aucune idée que j’allais t’épouser. Alors
que j’étais sans nouvelles en [pleine] campagne de Transylvanie, toi à
Islambol, tu m’as pris [pour époux]. La nouvelle du mariage m’est parvenue
en Transylvanie. Juste quand je remerciais Dieu en disant : “me voilà sauvé
des dépenses de Kaya Sultane”, le défunt Köprülü t’a donnée à moi. “J’ai
donné un éléphant à Melek, qu’il le nourrisse !” a-t-il déclaré [à cette
occasion] ; puis il est décédé. Voilà, je suis maintenant venu à toi. C’est la
volonté de Dieu.” La sultane déclara aussitôt : “Mon pacha, si tu ne peux
Page | 587
pas t’entendre avec moi, je divorcerai de toi, vivant ou mort ! Prépare-toi
tout de suite à me verser mon douaire d’un Trésor égyptien !”
Nous nous disputâmes de la sorte jusqu’au petit matin. Quelle nuit de
noces ! Quelle nuit de -------- ce fut ! Finalement, une heure avant la prière
de l’aurore, je [lui] dis : “Ma sultane, prenez donc toutes les dépenses et
prodigalités susdites. Et si je reviens jamais [un jour] ici, fasse que Dieu
prenne mon âme !” Je suis sorti et j’ai accompli la prière du matin, toujours
en état de pureté (rituelle) depuis celle du soir. Nous sommes venus ici ;
grâce à Dieu, nos prières ont été acceptées : “Dieu me pardonne, je ne
retournerai jamais au palais de Fatma Sultane et si Dieu le veut, je ne
reverrai jamais son visage”.
Il rapporta de la sorte le résultat des aventures qu’il traversa avec la sultane
au pauvre que je suis [= Evliya], en sanglotant, avec force précisions, dans
le jardin de l’arsenal. Puis nous remontâmes sur le caïque et, au niveau de la
Porte du Jardin, nous montâmes à cheval et nous rendîmes directement
auprès du grand vizir Köprülüzade Ahmed Pacha. Le grand vizir lui fit les
cadeaux [d’usage], lui souhaitant “que vos noces soient heureuses”, et ils se
rendirent ensemble auprès du souverain fortuné. A l’occasion de cette
rencontre, celui-ci félicita le pacha en ces termes : “Mon lala Melek Pacha,
que ton mariage avec ma tante soit heureux !” et il le fit vêtir d’une veste de
zibeline. Puis il ajouta : “Mon lala Melek, je t’ai fais deuxième vizir de la
coupole aux côtés du grand vizir et je t’ai doté du sancak d’Afyonkarahisar
comme donation impériale sous forme d’arpalik.” Le patient pacha
répondit : “C’est l’ordre de mon souverain” et, en sortant, il se rendit à son
palais. Il avait débuté au Conseil impérial depuis trois mois révolus et s’y
montrait assidû lorsque ce pauve malheureux demanda l’autorisation de se
rendre à Afyonkarahisar avec son müsallim, mais l’autorisation sacrée lui
fut refusée sous le prétexte : “Tu seras nécessaire pour quelques jours”.
Quelques jours plus tard, quelques calomniateurs et cerbères intrigants sans
foi firent courrir le bruit “Melek Ahmed Pacha et Fatma Sultane se sont
disputés pendant la nuit de noces”, de sorte que, sous forme de ragots
[transmis par] les langues des personnes diaboliques, la nouvelle parvint aux
oreilles augustes de Sultan Mehmed Han. Un jour d’audience, Son Altesse
le fortuné souverain refuge du monde ordonna : “Mon lala Melek Pacha,
vous êtez-vous disputés avec ma tante ? Ce sont des choses qui arrivent ;
personne ne doit interférer entre un homme et une femme ; mais je vais
quand même vous réconcilier et vous faire vous revoir” et il ajouta quelques
anecdotes. Le pacha quitta ensuite l’audience et, après [la séance du]
conseil, il se rendit à son palais ; il accomplit la prière ebvabin et s’arrêta [de
vivre] dans cet état de quiétude. »
Page | 588
32) Atike Sultane, fille d’Ahmed Ier, et Cerrah Kasım Pacha (1666)
« Deux mois après, Kasim Pascha, le nouveau gouverneur d’Ofen, notifia sa
nomination à Vienne par l’entremise d’un aga. Ce dernier, à la tête de trente-six
personnes, fut présenté à l’empereur en audience solennelle par le duc de Gonzaga.
Kasim épousa la sœur du sultan, promise au favori Kouloghli Moustafa, qui refusa cet
honneur, heureux de conserver sa liberté et la faveur du souverain. »86
86
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 11 p. 24.
Page | 589
33) Fatma Sultane, fille d’Ahmed Ier, et Yusuf Pacha (1667)
[p. 138 l. 21] ‘Ak d ü tezvîc-i Fât ima Sult ân be-cenâb-i vezîr-i mükerrem Yûsuf Paşa
[l. 22] Merh ûm ve ma fûrunleh Hudavendigâr-ı esbak Sult ân Ah med Hân
[l. 23] h az retleriniñ benât-ı muh teremâtından ‘ismetlü Fât ima Sult ân h az retleri
[l. 24] vüzerâ-yı ‘ızâmdan Silistre-i muh âfi i Yûsuf Paşa’ya ‘ak d ü tezvîc
olınmak
[l. 25] bâbında bundan ak dem fermân-ı hümâyûn ıs dar ve t araf-ı vezîr-i
merk ûmdan
[p. 139 l. 1] ik ti a éden levâzim ve mühimmât tekmîl ü ih z âr olınmış-idi. Mâh-i
Rebi-ül-evveliñ
[l. 2] on dördinci güni Şeyhü-l-islâm Efendi ve K â’im-mak âm Paşa ve
Haz inedâr
[l. 3] Mus âhib Yûsuf A a H avaz lı Bah çede ‘ak d olınan meclis-i nikâh a
Page | 590
[l. 4] gelüb dârü-s-sa’âdetü-l-şerîfe a asınıñ inh irâf-ı mizacından-nâşi’
Sult ân
[l. 5] müşârûn-ileyhâ h az retleri t arafından vekîl olan Mus â ib Yûsuf A a
[l. 6] ve vezir-i mûmà-ileyhiñ vekîli h uz ûrundan-s oñra Şeyhü-l-islâm Efendi
[l. 7] tesmiye-i mehr emsâl ile ‘ak d-ı nikâh eyledi. Hitâm-i mas lah atdan-
s oñra
[l. 8] Şeyhü-l-islâm Efendi ve K â’im-mak âm Paşa ve Mus âhib Yûsuf A a’ya
[l. 9] t araf-ı hümâyûndan birer samûr-i kürk ilbâs u ih sân buyuruldi.87
« Conclusion du contrat de mariage de Fatma Sultane avec Son Excellence
le vénérable vizir Yusuf Pacha.
Afin de marier Son Altesse la chaste Fatma Sultane, une des estimées filles
du précédent souverain défunt, Sultan Ahmed Han, avec le commandant de
Silistre, qui fait partie des glorieux vizirs, Yusuf Pacha, un firman impérial
avait été émis précédemment et les provisions et équipements nécessaires
avaient été rassemblées et préparées par le vizir susdit. Le 14e jour du mois
de Rebiyulevvel [de l’année 1078 = samedi 3 septembre 1667],
Monseigneur le Cheikhulislam, le Kaymakam Pacha et Musahib Yusuf Aga,
responsable du Trésor (Impérial), se sont réunis pour la signature du contrat
de mariage au Jardin dit Havazlı. Une fois arrivés Musahib Yusuf Aga,
représentant de Son Altesse la sultane susdite, dont la présence avait été
motivée par le mauvais état de santé du chef des eunuques noirs, et le
représentant du vizir susmentionné, Monseigneur le Cheikhulislam a conclu
le contrat de mariage en désignant un douaire selon les exemples [des cas
similaires]. Une fois l’affaire conclue, Monseigneur le Cheikhulislam, le
Kaymakam Pacha et Musahib Yusuf Aga furent chacun revêtus d’un caftan
de fourrure offerts de la part du souverain. »
« On altıncı Pazar-irtesinde [Rebiyulevvel 1078] fermân-ı Pâdişâhî
ile merhûm cennet-mekân Sultân Ahmed Hân benât-ı
muhteremâtından Fâtıma Sultân hazretleri, bi’l-fi’l Silistre
Beğlerbeğisi Vezîr Yûsuf Paşa’ya tezvîc olunmak mukarrer olıcak
Kâ’im-makâm Paşa ile Şeyhü’l-islâm Efendi ve Hazînedâr Musâhib
Yûsuf Ağa ve Paşa’yı mezbûrun vekîli, Havuzlı-bağçe’de akd-i
meclis idüp, bütün bir Mısır hazînesi mihr-i mü’eccel ile nikâh
87
Râşid, Târîh-i Râşid : vol. 1 p. 138-139.
Page | 591
olundu. Bu makûle mahallerde Sultân tarafından vekîl olmak.
Dârü’s-sa‘âde Ağası’na mahsûs iken ağa-yı müşârun-ileyh sâhib-
firâş olup meclis-i mezkûrda hâzır olmağla kâdir olmamağla
vekâleten Hazînedâr Ağa ol hidmeti edâ eyledi ve dâmâd-ı mükerrem
olan Paşa tarafından ol mahalde Şeyhü’l-islâm Efendi’ye ve Kâ’im-
makâm Paşa’ya ve Hazînedâr Yûsuf Ağa’ya fâhir semmûrlar ilbâs
olundu. »88
« Le lundi 16 [5 septembre 1667], un firman impérial vint annoncer que Sa
Majesté Fatima Sultane, une des honorables filles du défunt qui réside au
Paradis, Sultan Ahmed Han, serait mariée au Beylerbey de Silistre, Vizir
Yusuf Pacha et [dans ce but], le Kaymakam Pacha, Monsieur le cheikh-ul-
islam, Hazinedar Musahib Yusuf Aga et le mandataire du Pacha susdit se
sont réunis au Jardin Havuzlu [pour la conclusion] du contrat de mariage,
qui fut établi avec un mihr-i müeccel équivalent au montant d’un Trésor
d’Egypte complet [= le revenu annuel du tribut égyptien à la Porte]. A cette
occasion spéciale, le représentant de la Sultane – responsabilité qui incombe
[traditionnellement] au Chef des Eunuques Noirs en personne – ayant été
forcé de garder le lit, l’eunuque susdit avait été incapable de participer à
cette réunion : il délégua cette responsabilité de mandataire au Hazinedar
Aga. Devenu gendre vénérable, le Pacha fit revêtir de somptueux manteaux
de fourrures le cheik-ul-islam, le Kaymakam Pacha et Hazinedar Yusuf
Aga. »
*
« Un autre événement digne de fixer non seulement l’attention de l’historien Abdi, mais
celle de nos lecteurs, fut le mariage de la sultane Fatima (3 septembre – 14 rebioul-
ewwel), tante du sultan, exilée 22 ans auparavant par le sultan Ibrahim, avec ses deux
sœurs, Aïsché et Khanzadé, du sérail de la capitale dans celui d’Andrinople, et qui,
parvenue à l’âge de cinquante ans et plus, n’en épousa pas moins en grande pompe
Yousouf Pacha, gouverneur de Silistrie : elle reçut en dot un trésor égyptien ou six cent
mille ducats. A cette occasion, le moufti, le kaïmakam et le khazinedar favori Yousouf
Pacha, se rassemblèrent à Andrinople dans le jardin dit du bassin, et comme une
indisposition du kislaraga ne lui permettait pas de remplir auprès de la sultane, dans
les cérémonies du mariage, l’office de protecteur qui lui avait été confié, le khazinedar-
vizir Yousouf le remplaça dans cette solemnité. Il n’y avait pas encore bien longtemps
que ce dernier avait refusé pour femme la fille du sultan, désireux avant tout de
conserver sa liberté, et bien différent en cela de son prédécesseur, le favori Yousouf
Paşa, le vainqueur de la Canée, qui avait épousé une fille d’Ibrahim, la sultane Fatima.
88
Derin (éd.), Abdi Paşa vekâyı’-nâmesi : p. 266.
Page | 592
Le vizir-silahdar Yousouf, favori du sultan Ibrahim, s’était fiancé par ambition à la
sultane Fatima, âgée de 2 ans et demi, et sœur du sultan Mohammed. Quant au vizir et
gouverneur de Silistra, Yousouf, il avait accepté la main ou plutôt la dot de la sultane
Fatima, tante de Mohammed, bien qu’elle comptât plus d’un demi-siècle, tandis que le
vizir et favori le khazinedar Yousouf refusa l’honneur dangereux de devenir gendre du
Sultan. Ainsi, les deux Fatima, la première au berceau, la seconde au bord de la tombe,
enchaînées par des liens disproportionnés, se virent sacrifiées à l’aveugle ambition
d’esclaves parvenus et à l’égoïsme politique du souverain. »89
89
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 11 p. 137. Hammer mentionne ailleurs le mariage du vizir-
silahdar Yusuf, qui aurait été mariée à une fille d’Ibrahim dénommée également Fatima ; nous n’avons
malheureusement pas trouvé trace de ce mariage ailleurs : une confusion semble s’être installée. Voici
toujours le texte : « Ce fut encore un étranger, Joseph Maskovich, de Vrana en Dalmatie, devenu kapitan
pascha sous le nom d’Yousouf, dont les conseils valurent à l’empire la conquête de la Crète. Joseph
Maskovich, esclave de naissance d’Ali Aga, qui tenait en fief Varna et le pays entre Zara et Sebenico, eut
à essuyer bien des traverses dans les premiers temps de sa vie ; garçon d’écurie au service de Sinan, beg
de Nadin, il était dans un tel état de dénuement, qu’un jour une vieille femme lui donna par charité une
paire d’opanques ou bottines. Pendant son séjour à Bosnasérail, sa figure plein de grâce et d’esprit fur
remarquée par un chambellan qui vint à passer par la ville ; introduit par celui-ci au sérail avec une place
de portier et sept aspres de revenu quotidien, il devint bientôt baltadji et bostandji. Il succéda au
silihdar Moustafa dans la faveur du sultan [Ibrahim], et, après l’exécution du grand vizir Moustafa, il vit
grandir encore son crédit par sa nomination aux dignités de vizir et de kapitan pascha. Alibeg et Sinan
ses premiers maîtres nourrirent sa haine contre Venise par de faux rapports. Yousouf, qui avait envoyé à
son ancienne bienfaitrice de Nadin cinq cent piastres en reconnaissance de son présent d’opanques,
avait donné l’ordre en même temps de construire une mosquée à Vrana, lieu de sa naissance. Comme
on lui demandait s’il faudrait faire venir de la Pouille ou de la Hongrie les tuiles destinées à la toiture de
la mosquée, il répondit que, lorsqu’il serait temps, il porterait lui-même les tuiles nécessaires. Ces
paroles furent rapportées au divan par le baile vénitien comme faisant pressentir une violation de la
paix ; la haine d’Yousouf contre Venise n’en devint que plus violente, et la prise de l’escadre de
Sünbüllüaga lui présenta une belle occasion de réaliser son mauvais vouloir contre la République.
Yousouf, toujours prêt à exécuter les conseils qu’il donnait, fut nommé généralissime des forces de terre
et de mer rassemblées en apparence contre Malte ; et le Sultan, ajoutant encore de nouvelles faveurs
aux anciennes, lui fiança sa fille Fatima, âgée de deux ans et demi. » : Hammer, Histoire de l’Empire
ottoman : t. 10 p. 45.
Page | 593
34) Beyhan Sultane, fille d’Ibrahim, et Uzun Ibrahim Pacha
« En même temps, et tandis que Kunicky ravageait la Bessarabie, la chute de Kara
Moustafa se préparait à Andrinople. A la première nouvelle de la délivrance de Vienne,
dont toute la faute avait été rejetée sur le gouverneur d’Ofen, Ibrahim Pacha, qui venait
d’être exécuté, le Sultan envoya au grand vizir, conformément au kanoun, une lettre
autographe et un sabre orné de pierreries, comme une marque de reconnaissance pour
avoir sauvé l’armée d’une destruction complète. Mais lorsqu’on apprit le résultat de la
bataille de Parkany et la perte de Gran [juste après l’échec du second siège de Vienne],
les ennemis de Kara Moustafa eurent beau jeu pour agir contre lui, et parvinrent ainsi
à abattre sa puissance.
A leur tête étaient le grand écuyer, qui avait toujours été contraire à la campagne de
Vienne, le kizlaraga et la sœur de Mouhammed, la veuve du gouverneur d’Ofen qui
avait été exécuté, tous cherchaient à attiser le feu qui couvait sous la cendre. Le grand
chambellan Ghazazzadé Ahmedaga fut envoyé à Belgrade avec l’ordre d’apporter la
tête de Kara Moustafa. »90
90
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 12 p. 73-74.
Page | 594
35) Hadice Sultane, fille de Mehmed IV et Musahib Mustafa Pacha (1675)
« Beyân-ı sûr-ı hümâyûn-ı aris-i Sultânî
Duhter-i sa’d-ahter-i şehriyârî sa‘âdetlü Hadice Sultân hazretleri
Vezîr-i Sâni Musâhib Mustafa Paşa’ya sünnet-i seniyye üzre tezvîc
buyurulmak bâbında inâyet-i aliyye sudûr idüp sağdiç olan
Defterdâr Vezîr Ahmed Paşa mâh-ı mezbûrın yigirmi altıncı Penç-
şenbih güninde azîm alayla nişân getürdü. Dâmâd Paşa Sarâyı pür ü
zînete mübâşeret ve gice gündüz evnâ‘sından şenlikle müdâvemet
olundı.
Mâh-ı mezbûrun yigirmi sekizinci Cum’a-irtesinde ibtidâ vüzerâ-yı
izâm ziyâfet ve it‘âm olunıp, Kâdî-asker efendiler dahi bile idiler.
Yigirmi dokunzıncı Pazar güninde Şeyhü’l-islâm Efendi ziyâfet
olundı. Mevâlî ve müderrisîn dahi dâhil idiler.
Rebî‘ü’l-âhir’ün gurresi Pazar-irtesinde meşâyih ve e’imme ziyâfet
olundı.
Mâh-ı mezbûrun ikinci Salı güninde sipâh ve silâhdar ocakları
ziyâfet olundı.
Üçünci Çihâr-şenbih güninde Yeniçeri Ocağı ziyâfet olundı.
Dördinci Penc-şenbih güninde Rikâb-ı hümâyûn Ağaları ziyâfet
olundı. Yevm-i mezbûrda vüzerâ ve ulemâ ve Yeniçeri Ağası ve Bölük
Ağaları izn-i hümâyûnla Hâss-oda’ya varup cihâz-ı mülûkâneyi seyr
eylediler. Hakkâ ki şa‘şa‘asından gözler kamaşur emsâli sebkat
itmemiş, bî-nihâye şeffâf ve berrâk cevâhir ü bevâhir-i hurşid-i
işrâkla esvâb-ı bî-hisâb âlü’l-âl idi. Kâ’im-makâm Mustafa Paşa
dahi küçük Sultân hazretlerini tezvîc içün taraf-ı husrevânîden
mev‘ûd olup kürk giydi.
Beşinci Cum‘a güninde Istabl-ı âmire halkı ziyâfet olundı.
Altıncı Cum‘a-irtesinde Sultan-kapusu’nda müsâfir odasında vüzerâ
ve kâdî-asker efendiler mahzarında tarafeynün vekîllerin
mübâşeretiyle Şehü’l-islâm Ali efendi akd-i nikâh idüp cümleye
taraf-ı pâdişâhîden semmûr kürkler ihsân buyuruldu. Her birini
Dârü’s-sa‘âde Ağası Yusuf Ağa ber-vech-i ikrâm kendi eliyle ilbâs
eyledi ve Dâmâd Paşa cânibinden Dârü’s-sa‘âde Ağası’na
gönderilen kürki Sağdıç Paşa kendi eliyle giydüdü. Ba’dehû Rikâb-ı
hümâyûn ağaları ve selâtîn kethudâları cümle hil‘at giydiler.
Ba‘dehû kemâl-i ta‘zîm ve i‘zâz ile cihâz nakl olunup, Dâmâd Paşa
ve vüzerâya birer mükemmel at ihdâ eylediler.
Yedinci Pazar güninde Dîvân hâceleri ziyâfet olundu. Yevm-i
mezbûrda iki cânbâz biri biri ardınca Sultan Selîm Câmi‘-i
minâresinden Sarây-ı sûr meydanına gelinceye de ip üzerinden
uçdılar. Biri perçeminden ve biri bir ayağından.
Page | 595
Sekizinci Pazar-irtesinde vüzerâ kethudâları ziyâfet olundu.
Dokuzuncı Salı güninde yine cânbâz menâre-i mezbûreye muttasıl ip
üzerinden arkasında bağlu bir sabî ile pervâz idüp, nüzûle karîb
geldükde ip kırılup seyircilerden bir zımmînün üstüne düşdü. Amma
lutf-ı Hakk’la hiç birine helâk isâbet itmedi.
Onıncı Çihâr-şenbih güninde vüzerâ-yı izâm ve ulemâ-yı kirâm
Dârü’s-sa‘âdeti’l-aliyye kapusına varup, sa‘âdetlü Gelin Sultân
hazretlerini kemâl-ı ta‘zîm ü izzet ve zîb ü ziynet-i vâlâlarıyla
Dâmâd Paşa’nun sarâyına götürdüler. Vardıklarında at üzerinde
selâmlayup geldüklerinde, atlarından inüp kapunun dâhilinde
selâmladılar. Ol gün Dâmâd Paşa tarafından umûm üzre hil‘atler
ilbâs olunup, kına dahi anun sarâyında oldu.
On birinci Penc-şenbih güninde ikindiden sonra huzûr-ı pâdişâhîde
akd-ı meclîs-i ders olup, fermân-ı hümâyûn üzre ol encümen-i
şâhâneye vüzerâ-yı izâm ve ulemâ-yı kirâm dâhil olduklarında bu
fakîr dahi işâret-i aliyye mûcebince Tefsîr-i Kâdî’yı getürüp istimâ‘
iderdim. Sûre-i şerîfe-i Mülk’den kırâ‘at olunup Şeyhü’l-islâm Ali
Efendi ma‘nâ virdiler idi. Ol esnâda Hâce Feyzullah Efendi […]
âyet-i kerîmesine müte‘allik bir su‘âl-ı kavî îrâd idüp herkesi
murâkebe-i tefekkür ve te’emmülde iken bi-tevfiki’llâhi te‘âlâ bu
hakîr-ı kalîlü’l-bizâ‘a edâ-yı cevâba muvaffak olup mazhar-ı tahsîn-i
hüsrevânî olmuşdum. Bu gice salât-ı işâyı edâdan sonra vüzerâ-yı
izâm ve Şeyhü’l-islâm Efendi ve Kâdî-asker efendiler üst ve
mücevvezeleriyle üslûb-ı dîvân üzre Musâhib Paşa hazretlerini
kemâl-i tevkîr ü ta‘zîmle gerdek-hâneye kodılar. Kendü dahi üst
mücevveze giymişdi ve hîn-i duhûlda du‘âyı Vânî Efendi itmişdi.
Ba‘dehû vüzerâ-yı izâm ve ulemâ-yı kirâm ol mahalde bir mikdâr
celse-i hafîfe ile ârâm itdürülüp şerbet ve anber rengîn
makremelerile ikrâm olundular. Ba‘dehû dâmâd-ı mükerrem
Musâhib Paşa hazretleri taşra çıkup, vüzerâ-yı izâma ve ulemâ-yı
kirâma semmûr kürkler giydirüp her birini envâ‘-ı i‘zâz ü ihtirâmla
yolladılar. Ale’s-sabâh kendüler dahi şevketlü Pâdişâh-ı âlem-penâh
hazretlerinden ser-â-ser kürk giyüp, taraf-ı musâharet-i husrevânî
ile ser-efrâz oldular.
On üçüncü Cum‘a-irtesinde cebeci ve topçı ve tersâne ocakları
ziyâfet olundu. On dördinci Pazar güninde ma‘zûl beğlerbeğiler ve
beğlerden mevcûd olanlar ve kâdîlar ziyâfet olundu. Yevm-i
mezbûrda sarây-ı sûr meydanında Sultân Selîm Câmi‘i minâresinün
orta şerefesine bend olan ip üzerinden iki cânbâz bu minâreye
çıkdılar. Lâkin biri ardın ardın yine aşağa nüzûl itmekle merâmına
vusûl bulup dirliğe nâ’il oldu.
On beşinci Pazar-irtesinde düğün tamâm oldu. On yedinci Çihâr-
şenbih güninde atlu ve piyâde koşuları olup, Temurtaş Sahrâsı’ndan
seyr olundu. Cemâziye’l-âhirenün beşinci Salı güninde Mısır Eyâleti
Page | 596
Defterdâr Vezîr Ahmed Paşa’ya ve Defterdârlık Yeniçeri Kâtibi Hâcî
Mehmed Efendi’[ye] verildi.
Ramazân-ı şerîfün on yedinci Penc-şenbih güninde Bostancıbaşı
Osmân Ağa’ya vezâretle Âstâne-i Sa’âdet kâ’im-makâmlığı inâyet
buyuruldu. [H. 1086 = 1675-76]»91
« Description de la cérémonie royale de mariage de la mariée impériale.
La faveur très exaltée s’exprima dans la décision de marier Sa Majesté la
fortunée Hadice Sultane, fille de l’étoile de bonne auspice impériale, avec le
second vizir Musahib Mustafa Pacha, à l’occasion de la circoncision très
auguste. Le jeudi 26 du mois susdit [Rebiyulevvel 1086 = 20 juin 1675], le
vizir Defterdar Ahmed Pacha, qui agissait en tant que témoin, amena la
fiancée au cours d’un cortège magnifique. On entreprit de meubler et orner
le palais de Damad Pacha et on fit preuve d’assiduité dans les festivités
tenues jour et nuit.
Le samedi 28 du même mois 22 juin], il y eut d’abord les visites et banquets
pour les vizirs, auxquels les cadiaskers participèrent également.
Le dimanche 29 [23 juin], il y eut la visite de Monsieur le Cheikh-ul-islam.
Les juges et professeurs en étaient également.
Le lundi, 1er
jour du mois de Rebiülahir [24 juin], il y eut la visite des
cheikhs et des imams.
Le mardi 2 du mois susdit [25 juin], ce fut la visite des corps des sipahis et
des silahdar.
Le mercredi 3 [26 juin], eut lieu la visite du corps des janissaires.
Le jeudi 4 [27 juin], il y eut la visite des chefs des rikab impériaux. Le
même jour, les vizirs, les oulémas, le chef des janissaires et les chefs des
différentes compagnies militaires reçurent l’autorisation impériale de se
présenter à la Chambre privée pour jouir du spectacle du trousseau royal. A
la vérité, leurs yeux furent éblouis par sa splendeur, tant elle était sans
précédent. Il y avait là les plus beaux des vêtements décorés de pierreries
translucides et aussi étincellantes que la lumière du soleil en pleine canicule,
tous d’un montant sans égal. Mustafa Pacha ayant été choisi par le souverain
pour épouser Sa Majesté la petite Sultane, il fut revêtu d’un manteau de
fourrure.
Le vendredi 5 [28 juin], ce fut au tour de la visite du peuple des écuries
impériales.
Le Samedi 6 [29 juin], le contrat de mariage fut conclu par le cheikh-ul-
islam Ali Efendi, en présence des représentants des deux parties et de ces
Messieurs les vizirs et les cadiaskers, dans la Salle de réception de la
Sultankapusu ( ? ). Chacun se vit offrir des fourrures de zibeline par le
souverain et chacun fut vêtu de ces dons de la main même du Chef des
91
Derin (éd.), Abdi Paşa vekâyı’-nâmesi : p. 443-447.
Page | 597
Eunuques Noirs, Yusuf Ağa. Le Pacha [désigné comme] témoin fut
également habillé d’une fourrure, offerte par le gendre pacha, par
l’intermédiaire du Chef des Eunuques Noirs, qui l’habilla également de ses
propres mains. Après quoi le trousseau fut transporté dans le plus grand
respect et honneur. [A cette occasion], un cheval magnifique fut offert au
gendre pacha et à chacun des vizirs.
Le dimanche 7 [30 juin], il y eut la visite des Chancelliers du Conseil. Ce
jour-là, deux funambules firent des acrobaties sur une corde tendue entre le
minaret de la mosquée de Sultan Selim et la place du Palais de la
circoncision : [ils passèrent] l’un à la suite de l’autre, l’un attaché à la corde
par un pied, l’autre par les cheveux.
Le lundi 8 [1er
juillet], ce fut le tour de la visite des kethuda des vizirs.
Le mardi 9 [2 juillet], un autre funambule fit des acrobaties avec un garçon
accroché sur son dos, le long de la corde tendue à partir du minaret susdit.
Mais alors qu’il approchait de la descente, la corde cassa et il tomba sur un
zimmi parmi les spectateurs. Grâce à Dieu, personne ne fut blessé.
Le mercredi 10 [3 juillet], les vizirs et les oulémas se présentèrent à la porte
du Chef des Eunuques Noirs et amenèrent Sa Majesté la Sultane fortunée
fraîchement mariée au palais du gendre pacha dans le plus grand respect et
honneur, et avec force d’élégance et d’ornementations les plus exaltées. A
leur approche, ils firent leurs saluts à cheval ; mais sitôt arrivés, ils
descendirent de cheval et firent leurs saluts à [ceux] derrière la porte. Toute
la communauté rassemblée ce jour-là fut habillée de fourrures par le gendre
pacha. Le henné eut lieu également dans son palais.
Le jeudi 11 [4 juillet], après la prière de l’après-midi, eut lieu la meclis-i
ders [réunion à l’occasion du [1er
] cours [du prince aîné ?] en présence
impériale. Sur ordre impérial, tous les vizirs et oulémas furent présents à
cette assemblée royale, au cours de laquelle on fit apporter le Commentaire
du Cadi de ce pauvre [que je suis] et, sur signe impérial, je m’exécutais. La
sourate sacrée Mülk fut récitée et le cheikh-ul-islam Ali Efendi en fit
l’interprétation. A ce moment, Hace Feyzullah Efendi souligna un solide
problème concernant ce verset sacré : alors que tout le monde méditait et
délibérait sur cette question, votre humble serviteur de peu de savoir réussit,
grâce à l’aide de Dieu – qu’Il soit exalté – à en trouver la solution. Je fus
complimenté par la personne impériale.
Ce soir-là, après la prière de la nuit, les vizirs, Monsieur le Cheikh-ul-islam
et Messieurs les cadiaskers, qui portaient le üst et le mücevveze,
déposèrent Son Excellence Musahib Pacha dans la chambre nuptiale, sur un
divan à la mode. Lui-même était habillé d’un üst et d’un mücevveze et tandis
qu’il s’apprêtait à pénétrer [dans la chambre], Vani Efendi se mit à réciter
des prières. Les vizirs et oulémas purent alors profiter d’un court temps de
répit sur place, au cours duquel on leur offrit des sorbets et on les parfuma
d’ambre. Puis, Son Excellence le gendre vénérable Musahib Pacha sortit et
Page | 598
il fit revêtir de fourrures de zibeline les vizirs et les oulémas, et chacun fut
renvoyé avec toutes sortes de respect et de déférence.
Le matin, [Musahib Pacha] lui-même fut intégralement revêtu de fourrure
par Sa Majesté impériale, le padichah refuge du monde, et il vit sa dignité
s’élever par son alliance royale.
Le samedi 13 [6 juillet], il y eut la visite des corps des armuriers, des
artilleurs et de l’arsenal.
Le dimanche 14 [7 juillet], il y eut la visite des gouverneurs sans poste et de
ceux présents [en poste ?] parmi les beys et les cadis. Ce jour-là, sur la place
du Palais de la Circoncision, deux acrobates s’élancèrent sur une cordre liée
à mi-hauteur des minarets de la mosquée de Sultan Selim.
Malheureusement, alors qu’ils descendaient l’un sur le dos de l’autre, ils
atteignirent leur but et trouvèrent la paix éternelle.
Le lundi 15 [8 juillet 1675], la cérémonie de mariage prit fin.
Le mercredi 17 [10 juillet], il y eut encore des courses de cheval et à pieds,
qui furent contemplées depuis la plaine de Timurtaş.
Le mardi 5 du mois de Cemaziyelahir [27 août 1675], on donna la province
d’Egypte au vizir Defterdar Ahmed Pacha et l’office de defterdar au Scribe
des Janissaires, Haci Mehmed Efendi.
Le jeudi 17 du mois sacré du Ramadan [5 décembre 1675], le bostancıbaşı
Osman Ağa fut gratifié de la charge de kaymakam de la Capitale Fortunée. »
*
« Hatice Sultan’ın Düğün Merasimi.
- Musahip Mustafa Paşa’nın hediyeleri.
10 Haziran. Kuloğlanın (musahip veya gözde damat) [Musahip Mustafa Paşa]
hediyesi taşınırken görmeye gittik. Önden birkaç grup yeniçeri çeribeyi ile beraber
geçtiler, sonra yine pek çok yeniçeri, baş yöneticileriyle beraber onları takip etti.
Yeniçeri ağası altın işlemeli kıyafetiyle, çeribeyi yeşil kadifeler içinde, yeniçeri efendi
(veya avukat), sekreter veya memur; başçavuş küçük tüylü bir kavukla. Sonra birkaç
grup sipahi. Edirne surlarının subaşısı, (veya imparatorluk surlarının muhafızı veya
valisi). Hepsi Chaucer’in geniş kollu veya kolsuz kısa paltosu gibi saray giysilerini
giymişlerdi, kolsuz ancak C. Ricaut’nun kıtabında, kırk üçüncü sayfadaki bakire gibi,
hafifçe sarkan içi dışı kürklü altın gümüş işlemeli, saten veya kadifeden yapılmış vs.
cübbeler ile avukat kavuğu takan efendiden başka hepsi çavuş kavukları takmıştı.
Sonunda güzelce süslenmiş ve giydirilmiş ve her birinin içlerinde altın ve gümüş
olan boyalı iki küçük sandık veya kutu yüklenmiş otuz katır geliyordu; sonra iki sıra
halinde (caddenin iki tarafında) çavuş başlıkları takmış ve güzel giyinmiş, kollarında
içindekiler görünecek şekilde keten bohçalara sarılmış hediyeler taşıyan yüz on iki kişi
geçti. Bunlar altın ve gümüş, inci işlemeli, saten ve kadife kumaştan vs. yapılmış hırka
veya cübbelerdi; sonra yaya olarak yeniçeriler ve cebeciler geçti. Onların ardından
çekilen görkemli atlar arasında en arkada, şimdiye kadar böylesini görmediğimi itiraf
Page | 599
edebileceğim, saman rengi, altında bir yıldız olan, on beş karış boyunda olabileceğini
tahmin etiğimiz zarif bir doruk at vardı. Bunlar Büyük Efendinin dilediği gibi
kullanması için verilen hediyelerdi. Bunların arkasından iki küçük nahıl ve sonra üç
yarda kare alanında üstünde tümsekler ve yürüyüş yolları, ağaçların dallarında
balmumundan oldukça iyi bir şekilde yapılmış meyveler, ortasında bir yazlık köşk,
ağaçlar, çiçekler, ağaçların etrafına serpiştirilmiş kuş ve hayvanlar olan üç veya dört
tane suni bahçe getiriliyordu; iki tanesine bir saat düzeneği sayesinde aynı suyun
devridaim ettiği fıskiyeler taşınıyor ve başkalarındaki kadırga ustası (önceden
söylendiği gibi) onları bir düdükle idare ediyordu; sonra yolun iki tarafında bir yarda
iki buçuk ayak çapında tahtıravelli misali, iki esirin taşıdığı çerçevelerde şekerden
yapılmış yüz yirmi tane tasarım geçti. Bunlar, devekuşları, tavuskuşları, kuğular,
pelikanlar vs. aslanlar, atlar, tazılar, geyik, filler, koçlar, manda vs. idi (insan figürü
yapmak kanuna aykırıdır); hepsi acemi işi olup çok kaba yapılmıştı.
Sonra yeni bir grup yeniçeri ve cebeciler ve onların ardından bir Türk kadının
giyinme odasında ihtiyaç duyabileceği her şeyin bulunduğu hediyeler, iyi giyimli
adamlar tarafından herkesin görebileceği şekilde iyi saf halinde taşıyordu; bir çift
çizme (burada kadınlar normalde bunları giyerler), bir çift pabuç (bir çeşit ayakkabı),
terlikler, takunya veya tahta nalın. Bütün bunlar inci veya en azından değrsiz taşlarla
işlenmiş olup üstüne pırlanta ve rubiler vs. serpiştirilmişti. Kuyumculara gün doğmuştu,
değersiz olsalar bile, uzaktan gösterişli duruyor ve iyi para ediyorlardı.
Sonra Acem modasına uygun, samur, işlemeli, her birinin üstünde inci, rubi ve
büyük bir elmas ve dokuz büyük düğme ve ilik olan bir cübbe geldi; toka vazifesi gören
ikinci düğme veya iliğin üstünde her iki tarafta birer büyük elmas vardı. Sonra altın
çerçeveli ve değerli taşlar gömülmüş muhafazası olan yuvarlak gözlükler vardı. Şunu
bilmelisini ki burada bir hanımefendi olabilmek için kadınların da kemerli, bilezikeri,
topazları olması zorunludur; İngiltere’de her kadının bir siyah çantası olması gerektiği
gibi. Bilezikler bazen tel şeklinde bazen de plaka altından işlenir ve kalınlıkları bir
inçten dört veya beş ince vs. kadar değişir. Üzerinde elmas broşlar olan iki tane altın
zincir vardı ve en sonunda birkaç taşları olan bir çift vardı. Onları satan Yunanlı (bana
daha önceden göstermişti), bu küpelere beş bin zekin fiyat biçmişti veya üç bin sekiz yüz
sterlin.
Güzel küçük altın çerçeveli, üstü açık kristal bir bardağın içinde duran sade bir
altin yüzük açıkta taşınıyordu, üstünde on bir buçuk kırat gül şeklinde elmas bir taş
vardı. İnci ve mücevherlerle süslü tuvalet kutuları ve birkaç esans kutusu da aynı
şekilde geçirildi. Sonunda kenarları mücevherlerle süslü altından küçük bir taç
geçirildi. Sonra damadın vekili, defterdar (beya başhaznedar) at üstünde etrafa avuç
dolusu akçeler dağıtarak geçti. Gümüş tepsilerde mendillerin üstüne konulmuş olan
hediyeler çok yavaş, ağır adımlarla ve görkemli bir şekilde taşınıyordu. Defterdarın
arkasından at üstünde çalgıcıları; on iki kavalcı, bir o kadar davulcu, altı tranpet, altı
gövdeli davulcu, dört büyük zil çalan adam geliyordu. Onların ardından önde yaya
olarak giden efendilerinin atlarını çeken veya at üstünde giden hizmetkârlar vardı.
- Nikah merasimi.
Burada, evlenme ve nikah törenlerinin nasıl yapıldığı ile ilgili, benim
kaydedebildiğim en doğru kayıtları okuyacaksınız. İlk önce her şeyin vekiller ve biri
Page | 600
Avrupa diğeri Asya’dan iki kazaskerin şahidliğı ile yapıldığını bilmelisiniz. Gelinin
şahidi, kızlarağası veya haremağası, damadın şahidi ise deferdardı ve böylece işlem
yerine getirilirdi. Kızlarağası iki (kadı) şahitle sultanın kapısına giderek kapıyı vurur:
“Sultanım, seni Mustafa (musahip) veya sevilen kişi ile evlendirmek üzere beni vekil
tayin ediyor musun?” diye sorar. O, “evet” diyerek cevap verirdi. O bu soruyu (hiçbir
şekilde açılmaması gereken kapının arkasından) üç kere aynı şekilde tekrarlardı.
Sultanın artık geri dönme şansı olmadığı için bu cevap kadılar tarafından kaydedilirdi.
Aynı şahitler defterdarla beraber Mustafa veya kuloğlan yani damada yüz yüze aynı
kelimelerle aynı soruyu üç kere sorar ve o hepsine aynı cevabı verirdi: “Evet”. Sonra
bunlar hep beraber müftüye giderler. Onun huzurunda, müftü ortada olmak üzre,
kızlarağası (Türkiye’de tek lider olduğundan) solda, defterdar sağda, iki kadı onların
önünde alaturka bir şekilde veya orada ayaklarının dibinde alafranga bir şekilde
dururlar. Müftü onlara neden geldiklerini sorar; onlar, mutlu ve cennetle ilgili bir olayı
yerine getirmek için sultanla musahibi evlendirmek için geldikelerini söylerler.
Kızlarağası: “ben sultanın vekiliyim”, defterdar: “ben, Mustafa’nın vekiliyim”, kadılar,
“biz de şahidiz” derler. Sonra müftü Kızlarağası ve defterdara hitap ederek, ilk önce
Kızlarağası sorar: “Mustafa’yı kocan olarak kabul ediyormusun?” Bu üç kere
tekrarlanır ve her bir soruya kızlarağası cevap verir: “Evet”. Sonra aynısı kelimesi
kelimesine defterdara sorulur ve o da üç defa evet der. Sonra müftü ona çeyiz olarak ne
vadettiğini sorar; “o Kahire’nin bir yıllık iradı olan, 600.000 zekin” der; bu bizim
paramızla 33.750 sterlin eder. (Burada size Türkiye’de hoş bir kadına yapılacak en
büyük komplimanın ona gözlerinin Mısır’ın bir yıllık geliri kadar değerli olduğunu
söylemektir.) Sonra müftü defterdara üç defa sorar: “Verecek misin?”; o her zamanki
gibi cevap verir: “Evet”. Sonra müftü Bismillah der. Sonra hepsi ayağa kalkarak
evliliği tebrik ederler; sonra kahve ve şerbet ikramı yapılır. Büyük Efendi tarafından bu
kişilere 1.000 dolar değerinde altın işlemeli kumaş ve samur kürk hediye edilir;
şahidlere de 500 dolar değerinde cübbeler hediye edilir. Ya müftü ben olsaydım diye bir
endişem olmadı, ben de evlenme törenini onun kadar iyi idare edebilirdim. [...]
19 Haziran. Büyük Efendinin kızına verdiği çeyiz, her düğünde olduğu gibi
saraydan damadın evine taşındı, gelinin önünde kendine ait çoğu yelek ve giysiden
oluşan eşyalar giderdi. Pek çok kişi, yeniçeriler, cebeciler, vezirin korumaları, silahlı
askerler, kadılar ve diğer memurlar, kırmızı şapkalarıyla topçular tekrar diğerleriyle
beraber geri dönmek üzere saraya doğru yürürlerdi. Onların reisleri veya paşaları
üstündeki horoz tüyleri sayesinde ayrılabilen kürkten yapılmış bir şapka giyerdi; bunlar
kırmızı beyaz karışık olup, diğerlerininki ise tek renkti. Musahip solunda müftü ile
beraber gelirdi.
Orada bir, bir buçuk saat kaldık ve sonra şu sırayla geri döndüler: Önce
topçular, silahlı askerler ve vezirin korumaları; sonra Büyük Efendinin garsonları,
kaftanlar (veya saray elbiseleri) içinde: Bunlar sofrada ona hizmet ederler; sonra
başlarında çeribaşlarıyla dört veya beş kafile yeniçeri, saten veya kadife kürklü
kaftanlar içinde; sonra yeniçerilerin ağası kendi tayfasıyla vs., sonra pek çok öncü
birlikleri kürek ve süpürgeleriyle vs. sonra başlarında yeniçeri ağası ile bir o kadar
daha yeniçeri geçti. Onun çok sert bir adam olup, ondan bir şey isteyen birini ancak
keyfi isterse memnun ettiği ve her şeyi kendi istediği gibi yapan bir adam olduğu
Page | 601
söyleniyordu; daha önceden yeniçeri olmayan bir kişi de yeniçeri ağası olarak
atanabilir.
Yeniçeri ağası omzunda bir balta olan bir derviş tımarhane kaçkını ile
beraberdi. Sonra birkaç bölük yeniçeri ve cebeci; sonra kendilerini ayırt eden tüylerle
100 kadar çavuş, tam onların önünde sol tarafta; sonra sekiz veya on cellat yaya olarak
gidiyordu. Sonra yukarda anlatıldığı gibi esirler tarafından taşınan balmumundan
yapılmış iki bahçe; sonra iki sıra yeniçeri tarafından taşınan 40 küçük nahıl. Sonra
bazıları uzun kare şeklinde, kaftan kumaşından örtüler örtülmüş sepetler yüklenmiş olan
86 katır takip ediyordu. Bazılarında, iki yatak birarada ve yorgan vs. olup, yolda
içindekilerin görülmesi için sepetin kapağı biraz aralık bırakılmış ve üstü altın veya
gümüş iplikle veya incilerle işlenmiş, saten veya kadife kumaşlarla örtülmüştü. İkişer
tane siyah deri ile örtülmüş, daha küçük sepet (veya kapaklı sepetler) taşıyan üçüncü
parti katırlar onları takip ediyordu. Sonra yatak mefruşatı, dövülmüş altınla bzenmiş gri
saten paspaslar, aynı desende, altın kaplanmış birkaç deri ve kadife halı taşıyan on
adam geçti. Mum sofraları da (mum, saksı vs. koymak için yuvarlak şekilde deriden
yapılmış muhafazalar), aynı şekilde altınla kaplanmıştı; gümüşten yapılmış dört tane
çok büyük ve eklem yerleri altın kaplı fener. Sonra daha önceden söylenen sırada inci
ve elmaslarla süslenmiş çizmeler, pabuçlar, terlikler, nalınlar; bir örnek değerli taşlar
ve altından yapılmış pek çok çift bilezik ve kemerler; tuvalet aynaları, kuyumcu
dükkanlarında sergilendiği gibi dört kapalı ve altı açık kutuda mücevherler, inciler,
altinlar vs. inci ve mücevherlerle süslü küçük bir tabure ve küçük bir altın taç.
Bazıları bunların, artık gelinin malı olduğu için sadece geri taşınan Musahipin
(daha önce söylendiği gibi) hediyeleri olduğunu söylüyor; bazıları ise onların yeni
şeyler olduğunu düşünüyor.
Buların ardından sağında Kadıyla Reis Efendi [Dış İşleri Bakanı] geliyordu.
Sonra yine sağ tarafında bir başka kadıyla defterdar. Sonra sol tarafında Müftü (ilerde
onun hakkında daha fazla şey anlatılacak) olan Vezir. Kafilede Reis Efendinin biraz
önünde Vânî Efendi, bütün kahve ve hanlarda gevezelik eden büyük vaîz ve bunu çok iyi
yaptığına başım üstüne yemin edebilirim. Sonra onunla ilgili daha fazla şey anlatılacak.
Onların arkasında develerin üstünde çalgıcılar-kaval, trampet vs.; onları yeniçeriler ve
sonra, her birinin ön tarafında iki tane siyah hadım olan on iki faytonda cariyeler
izliyordu. Bazıları esmerdi, üç tanesi çok güzel giyinmişti. Arabaların arkasından at
üstünde onlar gibi iyi giyinmiş on iki siyah hadım daha geliyordu. Bütün bunlar geline
aitti ve onun malı olarak kabul edilirdi; çünkü birçok yerde olduğu gibi burada da,
yukarda gördüğünüz gibi, Roma Medeni Kanunu geçerlidir ve çeyizsiz evlilik olmaz.
Sonra kırk hizmetçi yaya olarak esirlerin eşyalarının yüklü olduğu atları çekerek geçti.
Onları kalabalık bir halk topluluğu takip ediyordu.
- Düğün alayı.
23 Haziran. Size söylediğim gibi her düğünde gelin evine bu adetler uygulanarak
getirilir. Damat hediyeleri nahıllara yükleyerek gönderir, sonra gelinin eşyaları törenle
getirilir ve onları takiben, kare şeklinde bir cumba veya en azından bir cibinliğin
altında gelin gelirdi. Kafilenin ardından önceki gibi ortasında balmumundan yapılmış
bir köşk ve içi meyve ve çiçek dolu iki bahçe taşınıyordu. Sonra yine her biri 160 esir
tarafından daha evvel anlatıldığı gibi halatlarla idare edilen nahıl geçti. Sonra
Page | 602
gümüşten yapılmış ve üstünde eğlenceler başlayıncayakılarak sonuna kadar o şekilde
yanacak olan iki küçük nahıl (Ermeniler ve Rumlar onları mumları yakarak taşır) vardı;
bunlar da çok büyük olup esirler tarafindan taşınıyordu. Sonra yengeç suratlı
Kızlarağası ve ondan sonra hemen (Dulcinia del Tobosa) melek gibi güzel Hatice
Sultan, (şimdiki hükümdarın büyük kızı) dışı gümüşle kaplanmış ve altınlarla süslenmiş,
tekerlekleri ve içindeki döşemelerde demir ve tahta kullanılmış ve mücevherlerle
süslenmişti. Tepelerinde mücevherlerle tutturulmuş, bit tutam tüy vardı. Öndeki atların
yan tarafında bir sürücü ve aynı taraftaki en arkadaki atın üstünde ise arabacı vardı.
Faytonun üstündeki örtü, güzelliğinin daha iyi farkedilmesi için kısmen toplanmıştı, iki
taraftaki sık kafeslerin arasından silik bir vücuttan başka bir şey görmek imkânsızdı.
İçerdeki hadımların ikisi etraftaki insanlara akçeler (bir gün karşılaşırsak size
bunlardan birkaç tanesini hediye edeceğim) atıyordu. Bir tanesinin yüzü esmer ve
hatları çok düzgündü. Edirne’de bir bahçede onunla ilgili hoş bir hikâye duydum, ama
şimdi anlatmayacağım. Tüylerle ve mücevherlerle süslenmiş altı tane at tarafından
çekilen iki fayto daha geliyordu; arkadakinde (kırmızı bir kumaşla örtülmüş ve asilce
yol alıyordu) olan çok güzel bir kadın ön başta küçük bir delik aralayarak bize baktı.
Yüzü ve başındaki süsler tamamıyla görünüyordu. Sadece çok güzel olduğunu
söylebilirim. Parmakları ve elinin bir kısmı yüzünden daha ön plandaydı ve ellerine
kırmızımsı sarı bir kına (burada adettendir) yakılmıştır. Bunlara dört zenci nezaret
ediyordu. Sonra altı atın çektiği ve iki zencinin refaket ettiği daha mütevazı iki araba.
Sonra bazısı iki, çoğu dört atlı her birinde bir hadım olan yirmi bir araba daha. Onları,
elbiseler yüklenmiş olan atları çeken hizmetçiler takip ediyordu. Yarım saat kadar
sonra Sultanın annesi, altınla bezenmiş gümüş bir faytonla geçti. Ona dört hadım ve
kalabalık bir baltacı grubu refakat ediyordu, ayrıca biraz önünden dört hadım
gidiyordu. Onların her birini, arkadaki yuvarlak koltuktan arabayı süren bir baltacı
olan ve ayrıca yanından da bir baltacınn yürüldüğü, dörder atın çektiği altı fayton takip
ediyordu. Sonra yine altı atın çektiği ve içinde diğerleri gibi iki baltacı olan üç görkemli
fayton geçti. En sonunda iki atlı ve bir baltacı tarafından sürülen bir fayton vardı. At
üstündekilere refakat eden pek çok zenci vardı, ancak düzensiz bir şekilde gidiyorlardı.
Arkadan halk onları takip ediyordu. [...]
Rebiülevvel ayı sona erince, her gün ikindide (9. Saat) Musahibin evinde (ev şehirdeydi)
eğlenceler yapılır ve bunlar bazen gece yarısına kadar sürerdi. Yeni ayı ilk gördükleri
gün kutlamalara başladılar, o gün ay onlara göre bir günlüktü ve bizim kayıtlarımıza
göre iki günlüktü; 28’inde bitirdiler. Kare şeklinde büyük bir avlu vardı; bir ucunda
musahip ve arkadaşlarının her an izleyici olarak hazır bulunduğu iki odalı bir daire
vardı. Diğer tarafta Büyük Efendinin genç şehzade ve onların sevdikleri kışılerin sık sık
geldiği büyük ve yüksek tavanlı tek bir oda vardı. Diğer bir köşede, gelin eve
getirildikden sonra (23. Gün olduğu söyleniyor), onun Valide Sultan’ın ve diğer
hanımefendilerin kafesli pencerelerin ardından, kendileri görünmeden olan biteni
seyrettikleri kare şeklinde bir oda vardı. Kapı yeniçerilerin ve yeni modaya uygun
yaşayan Türklerin girememesi için kapalı tutuluyorsa da bütün yabancılar hiçbir
zorlukla karşılaşmadan içeri girebilirlerdi. Ben birçok defa oraya girdim ve sırası
geldikçe gördüklerimi anlatacağım.
- Düğün eğlenceleri
Page | 603
İlk önce eğlenceler. Her gün önceden olduğu gibi dans gösterileri oluyordu; aralarda
aynı ufak skeçler yer alıyordu. İnsanlar komiklikleri ve ağır tempoda Arap danslarıyla
eğlendiriliyordu; bu sönük danslar bir köşede kurulmuş olan çadırların altında, halkın
ayakta seyrettiği tarafta yapılıyordu. Biz (Frenkler) canımız istediği zaman aşağı ve
yukarı dolaşmak ve istediğimiz zaman Büyük Efendinin ve musahibin yanına girip
çıkmak serbestliğine sahiptik. Onlar da ikindi ve akşam vakitlerinde dualarına gidiyor,
ancak spor gösterilerinde aynı hayvanlıkları alkışlıyorlardı. Yirmi veya otuz çift güreşçi
her gün ciltlerini baştan aşağı yağlıyorlardı; ilk önce toprağa, aslında ellerini düz
olarak birbirlerinin arasına alıyor, kendi ellerini öptükten sonra güreşe başlıyorlardı;
bunun anlamının gökte Allah ve yeryüzünde insanların onların iyi niyetlerine şahit
olmaları ve eğer terslik olursa, bunun istekleri dışında olduğu anlamına geldiği
söyleniyordu.
Çeşitli hünerler yapan ehil ayılar vardı; bir keresinde anadan doğma çıplak bir
çocuğun (bu amaçla eğitilmişti) bir ayıyla yaptığı güreşi izledim; çok beğenildi ve
önünde birkaç defa tekrarlandı. Bir gelişinde efendim Edirne’ye bir ayıyla özel olarak
güreştirilmiş ve onu bir defada yenmiş olan bir bekçi köpeği getirdi; onu Büyük
Efendiye hediye etti ve hediyesi memnuniyetle kabul edildi. Bizim bekçi köpeklerimize
burada Samson derler ve Büyük Efendi onlardan birkaç tane besler, bizim kaldığımız
evin yakınında onlar için bir yazlık evi vardır; ama bu köpek onların yarı
büyüklüğündeydi (onları birkaç kere görmüştüm) ve bu yüzden daha makbule geçti.
Aynı soytarılıklar, hokkabazlıklar, ip cambazlıkları, taş şişeleriyle bostancı ve diğerleri;
ama en iyi gösteri diğer tarafta daha ufak çapta izlediğimiz ip cambazları idi; ama
burada her gün, hayatımda gördüklerim kadar iyi ve bazı yönlerden onlardan çok daha
üstün onlarlarını izledim.
Şimdi İngiltere’de (eğer yapılsaydı) olağan kabul edilemeyecek bir şey anlatacağım.
Sultan Selim’in minare vera kulesinin yüksekliği benim ölçtüğüme göre 84 yarda
uzunluğunda idi, ancak size şimdi anlatacağim yerin uzunluğu 70 yarda bir ayaktır.
Minare ile avludaki evlerin tepesinin arasına bir ip bağlanmıştı; iki adam makaralarla
ipten aşağı kayıyordu, biri kendini saçlarından makaraya bağlamıştı, diğeri ise
makaraya bileğinden bağlı idi ve bazen onu elleriyle tutarak yolun bir kısmını
katediyor, bazen baş aşağı ipin uzunluğunca yol katediyordu. İlk sefer denendiğinde
halat o kadar esnemişti ki, sanki onları kurtarmaya kasten kimse gelmemiş gibi, evlerin
tepelerine ve Musahibin avlusundaki ağaçlara çarparak parçalanmışlardı. Her gün bir
iki kişi böyle göğüşleri üstüne kayıyordu. Bir gün kuvvetli bir genç sırtında bir çocuk ve
elinde bir davul ve davul sopasıyla kaymaya kalktı; tam yolun yarısına geldiklerinde ip
koptu ve ikisi birden bahçede diğerleri ile birlikte onları seyretmekte olan bir
Ermeni’nin üstüne düştü. Üçü de çok kötü yaralandılarsa da, Tanriya şükür iyileştiler.
Büyük Efendi onların tedavilerini üstlendi ve Ermeni’ye hayat boyu günde 20 asper
maaş bağladı; fakat o teşekkür ederek, büyük bir paşanın ona borcu olan 12 kese altının
ödenmesinden başka bir şey istemediğini bildirdi; paşa ölümü halinde parayı Büyük
Efendiden istemesini açıkça vasiyet etmişti. Büyük Efendi vasiyetin derhal yerine
getirilmesini emretti. Sadece omzu yerinden çıkmış ve vücudu yaralanmıştı; ama daha
sonra onun tamamen iyileşmiş olduğunu gördüm. Diğer ikisi de ödüllendirildi; adama
40 asperden maaş bağlandı ve çocuk saraya alındı. 27. Gün (bu ipi kullanabilecekleri
Page | 604
son gündü) iki adam ipin üstünde adım adım minareye kadar çıktı; biri tekrar yürüyerek
aşağı indi, diğeri ise minarenin tepesinde kaldı.
Şimdi size İngiltere’de hünerli bir şekilde boynunu kırmayı düşünen biri varsa ve
ikincisi (eğer şansı da yoksa) onu nasıl kırabileceğini anlatmış oldum. Her gece burada
daha önce anlattığım gibi fişek gösterileri oluyordu. Çok ilginç bir şekilde ateşle ele
geçirilen iki fil ve bir şato vardı; ama şehirde yangın çıkarmamak için büyük roket ve
fişekler atılmıyordu. Sizin fener işlerinizin bazıları burada da yapılıyor. Yine de burada
hayal edebileceğiniz en iyi şekilde ağırlandık ve günde birkaç defa bize limon şerbeti
ikram edildi (bir defasında aşağı katta bir odada kahve ve şekerlemeler); bizi oraya
götüren Ağa, Büyük Efendinin kızının düğününe gelip de bir şeyler yiyip içmeden
gitmenin çok ayıp olduğunu söyledi. Genellikle bizi ringe götürüp kendi başımıza
oturtuyorlardı ve çok sefer yanımızda kalabalığın bize yanaşmasının önleyen bir cebeci
veya yeniçeri oluyordu. Bize olan büyük sevgilerinden ziyade gösterişten yapıldığını
düşünüyorum; her gün sakalar veya sucular bir sürahi şerbet ve bardaklarla gelerek,
her tip insanın içinde, sürekli olarak bize şerbet ikram ediyorlardı. »92
*
« Le sultan oubliait la défaite de Khocim en dirigeant les préparatifs d’une double fête,
la circoncision de son fils et le mariage de sa fille, qui devait, au printemps prochain,
étonner les habitants d’Andrinople, mais qui, malgré sa magnificence, n’égala pas en
éclat et en durée la fête de la circoncision qui eut lieu sous le règne de Mourad III. »93
*
« Deux semaines après la circoncision du prince, le mariage de Khadidjé, fille du
sultan, avec le second vizir favori, Moustafa Pasha, fut célébré pendant quatorze jours
par des représentations, des parades, des festins et des représentations théâtrales. Un
écrit impérial confia au vizir-defterdar le soin d’accompagner la fiancée. La veille du
plus long jour de l’année, les cadeaux de noces du fiancé, que l’on désignait
habituellement sous la dénomination de nischan (signes), furent portés au sérail (20
juin 1675- 26 rebioulewwel 1086). Les janissaires, conduits par le kiayabeg et quatorze
de leurs colonels, ouvrirent la marche ; ils étaient suivis du tschaousch-baschi avec
soixante tschaouschs ; venaient ensuite les généraux de l’artillerie et des munitions,
cent fourriers de cour et les chambellans, puis trente portefaix chargés de sucreries, et
vingt janissaires tenant chacun un vase rempli de sorbet à l’embouchure duquel
s’élevait un arbre dont les branches pliaient sous une multitude de fruits confits.
Quarante autres portaient deux jardins artificiels de six pieds carrés, ornés de koeschks
d’or et de fontaines d’argent ; dix portaient sur leur tête des corbeilles pleines de
sucreries et couvertes de fleurs. Vingt tschaouschs tenaient chacun une corbeille
remplie d’étoffes de soie, de mousselines, de châles et de peignoirs brodés d’or ; vingt-
quatre autres portaient un pareil nombre de corbeilles, contenant chacune trois pièces
de riche étoffe, destinées à vêtir la fiancée. Les joyaux étaient portés par vingt
92
Covel, Bir Papazın Osmanlı Günlüğü : 146-157. 93
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 11 p. 215.
Page | 605
tschaouschs dans des bassins d’argent sur des étoffes brodées ; c’étaient un bonnet de
fin velours couvert de diamants disposés en forme de diadème ; quatre ceintures ornées
de diamants pour la Walidé, les deux Khasseki et le fiancé ; trois panaches de héron
enrichis de diamants pour la fiancée, la Khasseki et la fille de la petite Khasseki
destinée en mariage au kaïmakam Kara Moustafa ; deux Koran, dont les reliures
brodées d’or étincelaient de pierreries ; une paire de pendants d’oreilles en émeraude
du poids de cent karats, trois paires de bracelets en diamants pour la sultane mère, la
sultane favorite et la sultane fiancée ; enfin des boutons en diamants pour sa majesté le
Padischah ; venaient ensuite les fourrures de zibeline, d’hermine et de lynx, et deux
chevaux de main dont les housses étaient couvertes de perles, de saphirs, de rubis et de
turquoises ; enfin le defterdar et le reïs-efendi avec cent pages à cheval fermaient le
cortège qui fut reçu à la porte du sérail par le kizlaraga au nom de la fiancée.
Le palais du fiancé fut spécialement affecté à la célébration des fêtes du mariage, et,
pendant sept jours, les vizirs, les oulémas, les scheïkhs, les officiers des janissaires, des
sipahis et des silihdars, les officiers de l’étrier impérial y reçurent une hospitalité
splendide. Le huitième jour, le trousseau de la fiancée fut exposé dans la chambre
impériale, et, ce jour-là même, on revêtit le kaïmakam Kara Moustafa d’une fourrure de
zibeline pour honorer en lui le second gendre du sultan. Le dixième jour, les vizirs et les
mouftis furent invités à se rendre au sérail où le mariage fut célébré par ce dernier, et
où des fourrures furent distribuées à tous les assistants (30 juin 1675 – 6 rebioulakhir
1086). Après la cérémonie, les vizirs de la coupole se mirent à la tête du cortège
pompeux au milieu duquel le trousseau de la fiancée fut transporté dans la maison de
l’époux. On y remarqua, entre autres, deux jardins de sucre, souvenir emprunté aux
bocages de l’ancienne divinité des jardins, honorée chez les Grecs et les Romains,
quarante palmiers qui en étaient l’emblème et quatre-vingt-six muses, avec tous les
détail d’une parure féminine, disposés de manière à laisser voir, et les coussins brodés
de perles, et les voiles d’or, et les joyaux étincelants. La marche était fermée par douze
chars pleins de femmes esclaves qu’escortaient trente-six eunuques noirs. Les
exhibitions de bateleurs et de danseurs de corde se prolongèrent pendant trois jours ;
deux de ces derniers franchirent trois fois la distance qui sépare le minaret de la
Selimiyé du palais du fiancé sur une corde tendue entre ces deux édifices, en lançant
des flèches et en soutenant un enfant sur un de leurs bras. Le quatrième jour, la fiancée
sortit du sérail impérial et fut conduite par tous les vizirs et les grands dans celui de son
époux (4 juillet 1675 – 10 rebioulakhir 1085). Deux palmiers, en tout semblables à ceux
qui avaient orné la fête de la circoncision, et deux autres en argent de moindre
dimension, figuraient dans le cortège ; la fiancée était dans un char argenté, traîné par
six chevaux blancs et surmonté de banderoles qui flottaient au vent, couvertes de
paillettes d’or ; quatre autres chars à six chevaux et vingt-un à quatre chevaux
contenaient chacun deux eunuques ; leur chef précédait à cheval le char de la fiancée ;
venait ensuite à quelque distance la sultane Khasseki, mère de la fiancée, dans un char
argenté, suivi d’eunuques et d’esclaves femelles que contenaient dix autres chars. La
fiancée fut conduite, sous la forme seulement, à la chambre nuptiale : elle n’était pas en
âge d’être mariée, et le don de sa main ne prouvait qu’une marque de haute faveur ou
une spéculation assise sur son douaire ; car, dans le cas même où elle serait venue à
Page | 606
mourir avant la consommation du mariage, son époux aurait dû en tenir compte au
trésor impérial, ainsi que du trousseau. Les grands, les honorés et les savants, les plus
grands et les meilleurs, les vizirs et les émirs, les kadiaskers et les mollas furent ensuite
congédiés après avoir été parfumés d’ambre et d’eau de roses, après qu’on leur eut
offert le café et le sorbet, et qu’on les eut revêtus de fourrures et de kaftans. »94
*
« Il [Kara Mustafa Pacha] a épousé la sœur du grand vizir à l’âge de 28 ans. Elle en
avait 17. Il en a eu 2 enfants mâles qui sont morts ; l’un s’appelait Yusuf, l’autre
Mehmed. Elle est morte, il y a deux ans à la 31nième année de son âge. Il a quatre
odalisques. De la première il a deux filles et un garçon, les filles s’appellent, l’une
Fatma, qui est âgée de 10 ans et que son père a promise au selicdar du Grand Seigneur,
l’autre Emine et le garçon Yusuf.
De la seconde, une fille nommée Aïcha et un garçon qui s’appelle Mehmed.
De la troisième, il a une fille nommée Zeynep.
Il n’a point eu d’enfants de la quatrième. Il n’a pas encore épousé la fille du Grand
Seigneur, quoiqu’elle lui soit promise, dans la cérémonie ordinaire qui est que Sa
Hautesse, après avoir fait circoncire les deux princes ses fils et marié sa fille avec
Coulogli Mustafa Pacha, envoya dire au caymacam de le venir trouver. S’étant rendu
au sérail, le Grand Seigneur lui dit qu’il venait de marier sa fille aînée, qu’il lui
donnerait la seconde, qu’il se préparât à faire des noces dans trois ans, ensuite on le
revêtit en présence de Sa Hautesse d’une samour kurk, fourrure de samour avec du
brocard d’or.
Peu de jours après, Mustafa Pacha envoya un présent à cette princesse qui n’a pas
encore trois ans. Il consistait en cinq filles, six bocchas contenant chaque boccha un
habillement complet depuis la tête jusqu’aux pieds.
Deux vestes de brocard fourrées à la Sultane Kutchuc Hassaki sa mère.
A la nourrice de la princesse deux bocchas.
Au keislar aga de la princesse deux bocchas.
Au premier baltage deux bocchas. Au second aga noir et aux autres qui servent à la
sultane deux autres bocchas à partager entre eux. Le pacha ajouta à ce présent une
paire de pendants d’oreilles de diamant pour la princesse. Tous ces présents montaient
à 12 000 piastres. »95
94
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 11 p. 219-221. En notre, il précise : « N°4 p 219 : Saghdidj.
Raschid, I, f. 83. N°1 p 220 : Il faut redresser dans La Croix plusieurs erreurs de dates et de nombres, au
sujet desquelles il se met en contradiction avec les historiens turcs. Ainsi, La Croix fixe au 12 juin (p.150)
et Rycaut (dans Knolles, II, p. 255) au 10 juin la date du cortège. Ils se trompent tous deux ; car ces
présents furent apportés le 26 rebioul-ewwel (20 juin). N°2 p 220 : djihaz. Raschid, I, f.83. Mohammed
Defterdar, Le livre des cérémonies. N°1 p 221 : La Croix ne mentionne pas cette circonstance. Rycaut s’est
trompé de date : c’est le 30 et non le 19 qu’eut lieu le transport du trousseau. N°2 p 221 : Rycaut suppose
à tort que cette cérémonie eut lieu le 23 juin et non le 4 juillet ; l’usage du vieux style l’a d’ailleurs fait
tromper d’un jour. N°3 p 221 : Rycaut, p 253. Notwithstanding which (her death) he would be obliged to
pay her dowry which was said to be the sum of two years revenue of G. Cairo (1 200 000 ducats). » 95
Galland, Voyage à Constantinople : 188-189.
Page | 607
36) Rukiyye Sultane, fille de Murad IV, et Gürcü Mehmed Pacha (1693)
[l.14] Tevcîh-i eyâlet-i Erz urûm ve ‘ak d-i Ruk iyye Sult ân be-Gürci Meh med
Paşa
[l. 15] Erz urûm vâlîsi eyâlet-i Ba dad’a nak l ü tah vîl olınma la bu esnada
[l. 16] Edirne şehirinde bulınan Gürci Meh med Paşa eyâlet-i Erz urûm ile
[l. 17] tebcîl olub Hudâvendigâr-ı esbak merh ûm ve ma fûr Sult ân
[l. 18] Murâd Han Ġâzî ‘aleyhi rahmetü-l-bârî h az retleriniñ duh ter-i sa‘d-
[l. 19] ahterleri Ruk iyye Sult ân h az retleri kendüye ‘aḳd-i nikâh olınma la
[l. 20] İstânbûl’a varub Sult ân-ı müşârûn-ileyhâ ile zifâf vuḳu‘ından-s oñra
[l. 21] mans ıbına revâne olmak üzere fermân ve evâhir-i rebi-ü-l-âhirde ba‘de-
z-zifâf
[l. 22] ricâ-yı Sult ân-ı müşârûn-ileyhâ ıla paşa-yı mûmà-ileyhe rütbe-i ‘âliyye-i
[l. 23] vezâret dahi ‘inâyet ü ih sân olındı.96
« Nomination à la tête de la province d’Erzurum et mariage de Rukiyye
Sultane avec Gürcü Mehmed Pacha.
Comme le gouverneur d’Erzurum avait été transféré et nommé à la tête de la
province de Bagdad, Gürcü Mehmed Pacha, qui se trouvait à ce moment-là
96
Râşid, Târîh-i Râşid : vol. 2 p. 244.
Page | 608
à la ville d’Edirne, fut honoré de la province d’Erzurum. Il se rendit auprès
de Son Altesse Rukiyye Sultane, la glorieuse fille de l’ancien souverain
défunt, Son Altesse Sultan Murad Han Gazi – que la compassion exaltée de
Dieu soit sur lui –, à Istanbul. Une fois que le mariage avec la sultane
susdite fut accompli, il se préparait à partir prendre son office lorsqu’il reçut
un firman : dans la dernière décade du mois de Rebiyülahir [de l’année 1105
= 19 – 29 décembre 1693], après son mariage, le pacha susdit reçut la grâce
et la faveur d’obtenir le rang estimable de vizir sur la demande de la sultane
susdite. »
« Tevcîh-i eyâlet-i Erzurum ve ‘akd-i Rukıyye Sultân be-Gürcü
Mehemmed Paşa
Ve eyâlet-i mezbûre Erzurum Vâlîsi olan Vezîr-i mükerrem ‘Ali
Paşa’ya ihsân olunup ve Gürcü Mehemmed Paşa dahi ol esnâda
Edirne’de bulunmağla, eyâlet-i Erzurum kendüye ‘inâyet ve selâtin-i
‘atîkden merhûm u magfûrun-leh Sultân Murâd Hân – aleyhü’r-
rahmet ve’l-gafuran – hazretlerinin duhterleri Rukıyye Sultân
hazretleri Paşa-yı mûmâ-ileyhe ‘akd-i nikâh olunup, Âstâne’ye
vusûllerinde şeb-çerâğ-ı ziyâ-güster-i şebistân-ı zifâf olduktan sonra,
recây-ı Sultân-ı muşârün-ileyhâ ile pâye-i vizârete vaz‘-ı kadem ve
mazhar-ı iltifât-ı Şehriyârî ile dil-şâd u hurrem oldu, fi şehr rebîü’l-
âhır sene minhû [hamse ve mi’e ve elf]. »97
« Nomination à la province d’Erzurum et contrat de mariage de Rukiyye
Sultane avec Gürcü Mehmed Pacha.
La province susmentionnée fut accordée à l’honorable vizir Ali Pacha,
gouverneur d’Erzurum. Gürcü Mehmed Pacha, qui se trouvait alors à
Edirne, fut honoré de la province d’Erzurum et Son Altesse Rukiyye
Sultane, une des vieilles princesses et fille de Son Altesse, le défunt qui
bénéficie du pardon divin, Sultan Murad Han – que le pardon et la
bénédiction divine soit sur lui ! – fut mariée par contrat au susdit pacha. A
son arrivée à la capitale, on réalisa la pierre étincelante et lumineuse de la
cérémonie nuptiale dans les appartements privés ; sur les sollicitations de la
Sultane susmentionnée, on lui octroya la dignité de vizir et une telle
démonstration de bonne fortune et manifestation de la faveur impériale
répandit le bonheur et la bonne humeur. Le mois de Rebiülahir de l’an 1105
[novembre 1693]. »
97
Sarı, Zübde-i Vekayiât : 473.
Page | 609
37) Fatma Sultane, fille de Mehmed IV, et Tırnakçı Ibrahim Pacha (1695-96)
« ‘Akd-i kerîme-i Sultân Mehemmed Hân Fâtıma Sultân be-Tırnakçı
İbrahim Paşa, Vâlî-i Silistre.
Merhûm Sultân Mehemmed Hân – ‘aleyhü’r-rahmet ve’l-gufrân –
hazretlerinin duhter- i pâkîze-ahterlerinden Fâtıma Sultân – dâmet
‘ismethühâ – Silistre Vâlîsi olan Tırnakçı İbrahim Paşa’ya ‘akd ü
nikâh olunup, Eski Sarây kurbünde olan “Koca Yûsuf-Paşa Sarâyı”
dimekle ma‘rûf sarây, Sultân-ı müşârün-ilehâ içün taraf-ı Mîrîden
ferş olunmağla Vezîria‘zam ve sâ’ir vüzerâ, a‘yân ü eşrâf bi’l-cümle
Sarây-ı Cedîd-i ‘Âmireden mahall-i mezbûra gelince Sultân-ı
müşârün-ileyhânın önünce tertîb-i alay ile gelindi, fî minhû. »98
« Mariage contractuel de la fille de Sultan Mehmed Han, Fatima Sultane,
avec Tırnakçı Ibrahim Pacha, gouverneur de Silistre.
Fatima Sultane – que Dieu la protège –, une des filles étoiles de pureté de Sa
Majesté le défunt Sultan Mehmed Han – que le pardon et la bénédiction
divine soit sur lui – a été mariée de façon contractuelle au gouverneur de
Silistre, Tırnakçı Ibrahim Pacha. Le palais connu sous le nom de Palais de
Koca Yusuf Pacha, sis à proximité du Vieux Palais, avait été tapissé aux
frais du [Trésor] impérial pour la Sultane susmentionnée. Dans
l’ordonnancement du cortège, le grand vizir et les autres vizirs, les notables
et les grands personnages vinrent tous en tête de la Sultane susdite, tandis
qu’ils marchaient du Nouveau Palais Impérial en direction du quartier
susdit. L’année susdite [= 1107 / août 1695-juillet 1696]. »
« Vezîr Hızır Paşa’ya fermân olundukda, Hezargırad muhâfazası
hizmetine gönderilüp ve Bağdad Mîr-i mîrânlığı Vezîr Tırnakcı
Hasan Paşa’ya ihsân olunmağın. Tedârükünde olup, kapusu ile
Üsküdar’a nakl etmek üzere iken fermân-ı şerîf sâdır olur dîvân-ı
hümâyûn’a da‘vet olunmağın. Merhûm İbrâhîm Paşa Sarayı’nda
Sultân hazretlerine dame ‘ismetuhâ ile sûr-i hümâyûndan sonra,
Tırnakcı Hasan Paşa sadrda karâr etdükde, ‘azr-ı hümâyûndan
taşra çıkduklarında gazab-ı Pâdişâhî olur, katl olunmağın. Ve Şâm’ı
şerîf Eyâleti Ferhâd Paşa’ya ihsân olunur. »99
98
Sarı, Zübde-i Vekayiât : p. 576. 99
Yılmazer (éd.), Topçular Kâtibi Tarihi : t. 1 p. 352.
Page | 610
« L’ordre ayant été transmis au vizir Hızır Paşa, il fut envoyé au service du
commandant d’Hezargırad et le gouvernorat de Bagdad fut accordé au vizir
Tırnakcı Hasan Pacha, qui en prit le commandement. Alors qu’il était sur le
point de se rendre à Üsküdar, fort de sa fonction, un firman impérial fut
émis, le convoquant au divan impérial. Après la cérémonie impériale de son
mariage avec Sa Majesté la Sultane – que Dieu la protège – qui eut lieu dans
le Palais du défunt Ibrahim Pacha, on décida [d’accorder à] Tırnakcı Hasan
Pacha le poste le plus élevé. Mais au sortir d’une audience impériale,
comme il avait enjoint la colère impériale, il fut exécuté et la province
sacrée de Şam fut accordée à Ferhad Pacha. »
*
« Ces mesures prises, les queues de cheval furent arborées, et, douze jours après, le
Sultan [Mustafa II] se mit en marche pour Andrinople (8 avril 1695 – 5 ramazan 1107).
Peu de temps auparavant, deux fêtes de famille avaient donné lieu à une revue
solennelle, suivie d’illuminations. C’était d’une part, le mariage de Fatima, fille de
Mohammed IV, avec le gouverneur de Silistra, Tirnakdji Mohammed Pacha ; de l’autre,
la naissance d’une fille du sultan, la princesse Aïsché. »100
100
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 12 p. 206.
Page | 611
38) Ümmügülsüm Sultane, fille de Mehmed IV, et Çerkes Osman Pacha (1694)
« Sır Kâtibi Hattât Çerkes Osman Ağa – ki sonra vizâret ile çıkup,
rikâb-ı humâyûn kaymakamlığı ile Sultân Mehemmed Hân
merhûmun kızı Ümmü Gülsüm Sultân tezvîc olunmuşdur. Silahdar-ı
şehriyârî ve Enderûn-ı humâyûn ağalarından çuhadar ve rikâbdar
ve tülbend ağası ve ba‘z-ı mertebe musâhibleri kimi kapucubaşılık ve
kimi kapu ortası ulûfesi ve câ-be-câ ta‘yînât ile ihrâc olundu. »101
« Le secrétaire privé et calligraphe Çerkes Osman Aga, détenteur de l’office
de kaymakam des écuyers impériaux et qui plus tard sortit avec le rang de
vizir, fut marié à la fille du défunt Sultan Mehmed Han, Ümmügülsüm
Sultane. [A cette occasion], on fit sortir [du palais] le silahdar impérial, les
çuhadar des agas de l’enderun impérial, les écuyers, l’officier de la garde-
robe et quelques autres détenteurs de positions [au sein du palais], en les
nommant ici et là avec la rétribution tantôt de kapıcıbaşı, tantôt de kapıcı de
niveau intermédiaire. »
« Silâhdâr-ı şehriyârî Çerkes Osman Ağa rikâb-ı humâyûn
kaymakamlığı ünvâniyle Sarây-ı âmireden ihrâc ve rütbe-i vizâret
verilüp hâslar ta‘yîn ve Sultân Mehemmed merhûmun kızı Ümmü
Sultân tezvic olundu. [21 Receb 1104] »102
« On fit sortir du Palais impérial le silahdar impérial, Çerkes Osman Ağa
avec la dignité de kaymakam des écuyers impériaux et on lui donna le rang
de vizir. On lui attribua des has et il fut marié à la fille du défunt Sultan
Mehmed, Ümmü Sultane. [28 mars 1693]. »
« Der-zikr-i ‘akd-i nikâh ve rişte-keş-i izdivâc-ı Ümmü Gülsüm
Sultân be-Kâ’imakâm-ı rikâb ‘Osmân Paşa.
Hüdâvendigâr-ı sabık merhûm ve mağfûrun-leh Sultân Mehemmed
Hân ibn Sultân İbrahim hân – ‘aleyhü’r-rahmet ve’l-gafurân –
hazretlerinin duhter-i pâkîze-ahterleri ‘ismetlü Ümmü Gülsüm
Sultân – dâmet ‘ismetühâ – hazretleri ---------------- hadîs-i şerîfine
ri‘âyeten Rikâb-ı humâyûn-ı şevket-makrûnda Kâ’immakân olan
101
Özcan (éd.), Anonim Osmanlı Tarihi : p. 25. 102
Özcan (éd.), Anonim Osmanlı Tarihi : p. 48.
Page | 612
Vezîr-i rûşen-zamîr sa‘âdetlü ‘Osman Paşa hazretlerine ‘akd-i nikâh
ve rişte-keş-i izdivâc olmağla, işbu sene-i hamse ve mi’e ve elf
şa‘bânü’l-mu’azzamının onbeşinci günü mahrûsa-i Edirne’de
Beylerbeyi Hamâmı kurbünde tahliye vü ferş olunan Sinân Paşa-
Sarâyı’na, evvelâ şevketlü Pâdişâh-ı ‘âlem-penâh hazretleri devlet ü
ikbâl ile teşrîf, ba‘dehû devletlü Haseki Sultân hazretleri teşrîf
eyledikten sonra, Vezîr-i mükerrem Nişâncı Mehemmed Paşa
hazretleri ve Defterdâr İsma‘îl Paşa hazretleri ve sâ’ir ahâlî-i Divân
bi’l-cümle Sarây-ı humâyûndan Sultân-ı müşârün-ileyhânın önünce
düşüp, alay-ı ‘azîme ile devlet-hâne-i ‘âmireleri olan Sinân-Paşa
Sarâyı’na götürdüler, fî minhû. »103
« Description de la conclusion et de l’organisation [de la cérémonie] de
mariage d’Ümmügülsüm Sultane avec le kaymakam des écuyers, Osman
Pacha.
Son Altesse la fille du précédent souverain défunt, qui bénéficie du pardon
divin, Sultan Mehmed Han fils de Sultan Ibrahim Han – que le pardon et la
bénédiction divine soit sur lui ! –, l’étoile de pureté, la chaste Ümmügülsüm
Sultane, a été mariée à Son Excellence le vizir au cœur illuminé et glorieux,
kaymakam des écuyers impériaux, Osman Pacha, en considération du hadith
sacré ------ et la cérémonie du mariage a pris place le 15e jour du mois
estimé de şaban de l’année 1105 [11 avril 1694]. Une fois que Son Altesse
le majestueux padichah, refuge du monde, et Sa Majesté l’illustre Haseki
Sultane [eurent transmis] leurs souhaits de bonne augure et eurent honoré de
leur présence le Palais de Sinan Pacha, situé à proximité du Hamam du
Beylerbey, à Edirne, qui avait été décoré et tapissé [pour l’occasion], alors
Son Excellence le vénérable vizir Nişancı Mehmed Pacha, Son Excellence
Defterdar Ismail Pacha et les autres membres du Conseil vinrent au Palais
impérial se présenter devant la sultane susmentionnée ; les dirigeants du
gouvernement l’amenèrent ensuite au Palais de Sinan Pacha, en un cortège
majestueux. A la date susdite. »
103
Sarı, Zübde-i Vekayiât : p. 478.
Page | 613
[p. 249 l.16] ‘Ak d ü tezvîc-i Ümmü Gülsüm Sult ân be-k â’imak âm Rikâb‘Osmân Paşa
l.17] Hudavendigâr-ı sâbık merh ûm ve ma fûrle Sult ân Meh med Hân
[l. 18] Râbi’ Ġâzî ‘aliyye-r-rahmet ve-l-ma âzî h az retleriniñ duh ter-i sa‘d-
ahterleri
[l. 19] Ümmü Gülsüm Sult ân dâmet ‘ismetühâ h az retleri rikâb-i hümâyûn
[l. 20] pâdişâhîde k â’imak âm olan vezîr-i mükerrem ‘Osmân Paşa h az retlerine
[l. 21] irâde-i hümâyûn-i mülûkâne ile ‘ak d-ı nikâh olındık dan- s oñra
[l. 22] mah rûse-i Edirne’de Beglerbegi H amâmı k urbinde tahliye ü ferş
[l. 23] olınan merhûm Sinân Paşa Sarâyını mâh-ı şa‘bânü-l-mu‘a amıñ
[l. 24] on beşinci güni şevketlü pâdişâh-ı ‘âlem-penâh ve Hâsekî Sult ân
[l. 25] h az retleri teşrîf eylediklerinden-s oñra rikâb-i hümâyûnda
[p. 250 l. 1] mevcûd olan vüzerâ-i ‘i âm ü vükelâ-i devlet sarây-i hümâyûnâ
[l. 2] varub ‘arûs-i devlet-me’enûs h az retlerini âlây ıla zikrolınan
[l. 3] Sinân Paşa Sarâyına götürdüler.104
104
Râşid, Târîh-i Râşid : vol. 2 p. 249-250.
Page | 614
« Conclusion du mariage d’Ümmügülsüm Sultan avec le kaymakam Rikab
Osman Pacha
La fille estimée du précédent souverain défunt, Son Altesse Mehmed Han
IV Gazi – que la compassion exaltée de Dieu soit sur lui –, Son Altesse
Ümmügülsüm Sultane – que sa chasteté soit éternelle –, a été mariée
contractuellement, sur ordre impérial, à Son Excellence le vénérable vizir
Osman Pacha, kaymakam des Ecuyers Impériaux. Par la suite, le 15e jour du
mois estimé de Şaban [de l’année 1105 = dimanche 11 avril 1694], Leurs
Altesse l’auguste souverain du monde et la Haseki Sultane vinrent honorer
de leur présence le Palais du défunt Sinan Pacha, sis à proximité du Bain du
Gouverneur à Edirne, qui avait été vidé et le sol recouvert de tapis [pour
l’occasion]. Après quoi, les estimables vizirs et les représentants de l’Etat
qui étaient présents aux côtés du souverain se rendirent au Palais impérial et
ils amenèrent Son Altesse l’épouse fortunée en cortège au susdit Palais de
Sinan Pacha. »
*
« Le secrétaire intime du précédent souverain, le calligraphe Tscherkess Osman, fut
éloigné du Sérail avec la dignité de vizir – kaïmakam de l’étrier impérial, après s’être
fiancé à la sultane Oummi, fille du sultan Mohammed IV. »105
*
« Quelques jours plus tard [après le 7 avril 1694], on célébra les noces de la princesse
Oumm Koulsoum ou Oummi, fille de Mohammed IV, qui, trois ans auparavant, avait été
fiancée au vizir Osman Pacha. […] Le premier acte que Sourmeli Ali Pacha [nommé
grand vizir le 25 avril] jugea nécessaire pour se maintenir au premier poste de l’empire
fut l’éloignement du kaïmakam Osman Pacha, dont le mariage avec la princesse
Oummi venait d’augmenter l’influence. Un ordre du grand vizir, contre-signé par le
Sultan, lui enjoignit de partir en tout hâte pour Diarbekr et de prendre possession de ce
gouvernement ; mais à peine était-il parti, que cette place lucrative lui fut retirée, et
qu’on lui donna en échange le commandement de la Canée, poste infiniment
inférieur. »106
105
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 12 p. 164. 106
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 12 p. 181.
Page | 615
39) Hadice Sultane, fille de Mehmed IV, et Silahdar Hasan Pacha (1700-01)
‘Akd-i Hadîce Sultân be-vezîr Silahdâr Hasan Paşa
Bundan akdem fermân-fermây-ı vesî‘atü’l-mesâlik-i Osmânî olan
Sultân Mehemmed Hân hazretlerinin duhter-i pâkize-ahterleri
devletlü Hadîce Sultân – dâmet ‘ismetühâ – hazretleri Nedîm-i
Şehriyârî Vezîr Mustafa Paşa intikâlinden sonra kimesneye tezevvüc
olunmamakla, mukaddemâ hükûmet-i Mısr-ı Kâhire’den ma‘zûl
Silahdar Hasan Paşa’ya haly-bend-i ‘akd-i ‘akıd olup, şeb-çirâğ-ı
ziyâ-güster-i şebistân-ı zifâf olmağın, Paşa-yı müşârün-ileyh sene-i
mezbûrede vâkı‘ sefer-i humâyûna ‘azîmetden men‘ olunup ve ancak
masârif-i seferiyyeye imdâd olmak üzere yüzelli kîse akçe teslîm-i
Mîrî eyledi. [H. 1112 = 1700-1701] »107
« Mariage d’Hadice Sultane avec le vizir Silahdar Hasan Pacha.
Son Altesse l’étoile de chasteté, l’illustre Hadice Sultane, fille de Sa Majesté
Sultan Mehmed Han, dont émane l’ordre qui commande l’abondance des
territoires ottomans, qui n’avait pas été remariée depuis le décès du
compagnon intime impérial, Vizir Mustafa Pacha, fut liée par contrat au
silahdar Hasan Pacha, récemment libéré de son poste de gouverneur du
Caire d’Egypte. La lampe de nuit diffusant la lumière dans la chambre
nuptiale ayant été allumée, le pacha susmentioné reçut la grâce de quitter la
campagne militaire impériale qui avait lieu cette année-là [1700-1701], mais
pour venir en aide aux dépenses de la campagne, il remit 150 bourses
d’aspres au Trésor impérial. »
*
« Le prédécesseur de Firari, le vizir Silihdar Hasan Pacha, fut fiancé vers cette époque
à la fille du sultan Mohammed, veuve du favori Moustafa Pacha. Dans le but de plaire
à cette dernière, Hasan Pacha fut dispensé du service au camp, mais il fut obligé de
payer au trésor une somme de cent cinquante bourses. »108
107
Sarı, Zübde-i Vekayiât : p. 386. 108
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 12 p. 162.
Page | 616
40) Rukiye Sultane, fille de Murad IV, et Maktulzade Ali Bey (Pacha) (1702)
[l. 13] Tevecîh-i vüzerât ve ‘ak d ü tezvîc-i Ruk iye Sult ân be-Mak tûl-zâde
[l. 14] ‘Ali Bey
[l.15] S adra‘ am ‘amûca [= ‘amca]-zâde H üseyin Paşa h az retleriniñ man ûr-i
na ar-i
[l. 16] ‘inâyet âsafâneleri olan Mak tûl- zâde ‘Ali Bey evâsit -i şevvâl-
[l. 17] ül-mükeremde K andiye eyâleti ih sân-yla rütbe-i ‘âliye-i vezârete ısʻâd
ve duh ter-i
[l. 18] sa‘d-ahter-i pâdişâhî Ruk iye Sult ân dâmet ‘ismetühâ h az retleri
[l. 19] dahi kendüye ‘ak d ü nikâh olınma la dilşâd k ılındı.109
« Nomination au vizirat de Maktulzade Ali Beg et son mariage avec
Rukiyye Sultane.
Maktulzade Ali Beg, qui était l’objet des regards viziraux bienveillants de la
part du grand vizir Amcazade Hüseyin Pacha, se vit accorder la province de
Candie avec rang de vizir. En outre, la fille estimée du souverain, Son
Altesse Rukiyye Sultane – que sa chasteté soit éternelle –, lui ayant été
donnée en mariage de façon contractuelle, [leur union] fut réalisée avec
satisfaction. »
109
Râşid, Târîh-i Râşid : vol. 2 p. 528. Parmi les événements de l’année 1113, soit 1701-02.
Page | 617
« ‘Akd-i Rukıyye Sultân be-Maktûl-zâde ‘Ali Paşa.
Mârrü’z-zikr ‘Ali Paşa vizârete ıs‘ad ba‘dehû kerîme-i mükerreme-i Sultânî
Rukıyye Sultânı kendülere ‘akd- nikâh ile dil-şâd kılındı94
. Hâlâ vizâret ile
Kandiya uhâfızlığı ihsân buyurulan Vezîria‘zam-ı sâbık Maktûl Mustafa Paşa-
zâde ‘Ali Paşa manzûr-ı enzâr-ı ‘inâyet-i Pâdişâhî olup, duhter-i pâk-ahterleri
‘ismetlü ‘iffetlü Safiyye Sultân – dâmet ‘ismetühâ – hazretlerini huly-bend-i
‘akd-i nikâh buyurulmağla, kâşâne-i âmâli rûşen ü münevver kılındı, fî şehr-i
Şevvâl sene minhû [1113].»110
« Mariage contractuel de Rukiyye Sultane avec Maktulzade Ali Pacha.
Le susdit Ali Pacha fut élevé au rang de vizir ; après quoi, on conclut le
contrat de mariage qui l’unissait à la vénérable fille du souverain Rukiyye
Sultane. Actuellement, le fils du précédent grand vizir Maktul Mustafa
Pacha, Ali Pacha, se trouve dans les bonnes grâces impériales, qui lui ont
valu, en sus de son rang de vizirat, d’être honoré de l’office de gardien de
Candie ; la rédaction de son contrat de mariage avec la fille d’auguste
fortune, Son Altesse la chaste Safiyye Sultane – que sa vertu soit éternelle !
– ayant été ordonnée, l’événement fut conclu de façon brillante et lumineuse
dans la demeure des désirs, le mois de Şevval de l’année susdite [février
1702] ».
110
Sarı, Zübde-i Vekayiât : p. 723. Les phrases soulignées correspondent à des ajouts d’un autre manuscrit que celui utilisé comme référence, indiqués dans l’édition utilisée ici. Maktulzade Ali Pacha fut donc marié successivement à deux princesses ottomanes : Rukiyye Sultane d’abord, qui décéda probablement, puis Safiyye Sultane, fille de Mustafa II.
Page | 618
41) Emine Sultane, fille de Mustafa II, avec Hasan Pacha (1702)
[l. 15] Tezvîc-i kerîme-i mükereme-i şehriyârî
[l. 16] Emîne Sult ân h az retleri bundan ak dem emîr-ül-h âc ve Şâm vâlîsi
[l.17] olan H asan Paşa’ya vérilmek üzere murâd ve vezîr müşârun-ileyh
[l. 18] t arafından ‘âdet-i k adîme üzere tertîb-i nişân k abûl-ıla dilşâd k ılınmış-
iken
[l. 19] t arîk -i h acle sû’i tedbîrinden-nâşî faz âh ât-i ‘a îme-i h âdis
[l. 20] ü mâdde-i merk ûme kendüniñ na ar-ı iltifât pâdişâhîden suk ût ına
[l. 21] bâ‘is olma la Sult ân müşârun-ileyhâ paşayı mezbûre vérilmekden
[l. 22] firâ ve bu ‘izzet-i mah sûde ile h âlen silah dâr-i şehriyârî Çorlili
[l. 23] ‘Ali A a çirâ olındı.111
« Mariage de la vénérable fille du souverain.
Le souhait de donner [la main de] Son Altesse Emine Sultane à celui qui
était alors emir’ül-hac et gouverneur de la province de Şam, Hasan Pacha,
se concrétisa et l’organisation du mariage contractuel fut entreprise par le
vizir susdit, avec l’accord [impérial], selon les coutumes ancestrales. Or,
111
Raşid, Târîh-i Râşid : vol. 2 p. 529.
Page | 619
l’organisation détestable que celui-ci instaura sur la route du pélerinage
provoqua une grande honte qui causa la chute de la faveur que le souverain
lui témoignait. On revint sur la décision de donner la Sultane susdite au
pacha en question et, présentement, elle dépend du Silahdar impérial,
Çorlulu Ali Aga, qui enviait cet honneur. »
« Kerime-i mükerreme-i Şehriyârî Emîne Sultân hazretleri bundan
akdem Emîr-i hâclık ile Şâm Vâlîsi olan Hasan Paşa’ya virilmek
üzere murâd-ı humâyûn buyurulup ve Vezîr-i müşârün-ileyh
tarafından tertîb kabûliyle dilşâd kılınmış iken, tarîk-ı hacda sû’-i
tedbîrinden nâşî fazâhat-ı ‘azîme hâdis olduğundan, nazar-ı iltifât-ı
Pâdişâhîden sukûtuna bâ’is olmağla, Sultân-ı müşarün-ileyhâ,
mezburâ verilmekden ferâgat ve Silahdâr-ı Şehriyârî Çorlulu ‘Ali
Ağa ihrâc olundu.»112
« Un ordre impérial fut émis concernant le mariage de l’honorable fille
impériale, Sa Majesté Emine Sultane, avec l’ancien Commandant de la
caravane de pèlerinage et actuellement gouverneur de Şam. Tandis que
l’arrangement [du mariage] avait reçu le consentement du vizir
susmentionné, des actes honteux survinrent du côté de l’organisation sur la
route du pèlerinage ; de ce fait, et en raison de son discrédit dans la
considération de la faveur impériale, on abandonna [l’idée] de lui donner la
Sultane susmentionnée et [cette uion] fut transférée au silahdar impérial,
Çorlulu Ali Aga. »
‘Âdet-i kadîme üzere nişân dahi virilmiş idi. Lâkin Vezîr-i müşârün-
ileyh Mîrü’l-hâcc oldukda, ‘Urbân eşkıyâsı ile olan ma‘rekede
fazâhatı bâ‘is-i nefy olmağla, Sultân-ı müşârün-ileyhâ dahi hâlâ
Silahdâr-ı Şehriyârî ‘Ali Ağa’ya virilmek murâd-ı humâyûn
buyurulmağın, Ağa-yı müşârün-iley tarafından nişân tedârük ü teslîm
olundu, fî gurre-i zi’l-ka‘de sene 113. 113
« Il avait été fiancé [à la sultane] d’après les coutumes anciennes.
Cependant, lorsque le vizir susdit était Commandant de la caravane du
pèlerinage, des actes honteux survenus à l’occasion d’une bataille avec des
brigands bédouins arabes causèrent son exil, et on ordonna par firman
112
Sarı, Zübde-i Vekaiyât : p. 724. 113
Sarı, Zübde-i Vekaiyât : p. 724 : ajout, d’après un autre manuscrit.
Page | 620
impérial de donner la Sultane susmentionnée à Ali Aga, présentement
silahdar impérial. Les fiançailles furent préparées et réalisées par l’aga
susmentionné. Le premier jour du mois de Zilkade de l’année [1]113 [30
mars 1702]. »
Page | 621
42) Ayşe Sultane, Emine Sultane et Safiyye Sultane, filles de Mustafa II, avec
Köprülüzade Numan Pacha, Hasan Pacha et Kara Mustafapachazade Ali
Pacha (1702)
Page | 623
[l. 1 p. 243] ‘Ak d ü tezvîc-i Emîne Sult ân ve ‘Âyişe Sult ân.
[l. 2] Hüdâvendigâr-ı sâbık Sult ân Mus t afà Hân h az retleriniñ benât
[l. 3] ‘is met-i simâtlarından Emîne Sult ân h az retleri h âlâ s adrâ‘ am
[l. 4] olan Çorlili ‘Alî Paşa h az retlerine ve ‘Âyişe Sult ân
[l. 5] h az retleri vezîr-i mükerrem Köpili-zâde Nu‘mân Paşa h az retlerine
[l. 6] nâmzed ü izdivâc olduk larına binâ‘en h âlâ ‘ak d ü nikâh ları fermân
[l. 7] ü tertîb-i sûr-i pür-sürûrlarına izin-i hümâyûn ih sân olındı. K uz ât
[l. 8] ‘asakerden İstânbûl ma‘zûli olan Efendilere gelince ibtidâ-i ‘ulemâ
[l. 9] ve ba‘de divân h ocaları ve ocak a aları ve sa’ir vükelâ-i devlet
[l. 10] ‘alü-t-tertîb s adrâ‘ am sarâyına da‘vet ü z iyâfet ü lîmeye
[l. 11] mübâşeret olındı. Z iyâfetler tamam olduk dan-s oñra mâh-ı mezbûriñ
[l. 12] on sekinzinci güni şeyh-ül-islâm Ebe-zâde ‘Abdullah Efendi ve K apûdân
[l. 13] Elh âc İbrâhîm Paşa ve s adrâ‘ am keth udâsı ‘Abdurrah man A a
[l. 14] s udûr-ı a‘yân-ı devlet ile sâray-ı hümâyûna varub misâfir ot ası
[l. 15] nâm mevk ife iclâs olındılar. Sult ânlar t arafından ‘ak da vekîl olan
[l. 16] Dâr-üs-sa‘âde a ası Süleymân A a mevk if-i ma‘hûde gelüb ve
s adrâ‘ am
[l. 17] t arafından vekîl olan K apûdân Paşa ve Nu‘mân Paşa t arafından vekîl
olan
[l. 18] Kitâbcı ‘Alî Efendi vekâletler ile yiğirmi biñşer altûn mehr-i mü‘eccel
[l. 19] üzerine şeyh-ül-islâm Efendi ‘ak d-i nikâh étdikden- s oñra Âyâs ofya
[l. 20] şeyhi İsperî dâmâdı Mus t afà Efendi inşâd du‘â-ı h ut beye
[l. 21] â az étdiler. Ba‘dehu Sult ânlar t araflarından şeyh-ül-islâm Efendi’ye
[l. 22] birer s amûr-ı kürk ve K apûdân Paşa’ya Emîne Sult ân t arafından
[l. 23] ve Kitâbcı ‘Alî Efendi’ye ‘Âyişe Sult ân t arafından birer s amûr-ı kürk
[l. 24] ve Emîne Sult ân t arafından s adrâ’ am keth udâsına dahi
[l. 25] bir s amûr-ı kürk giydirilüb Âyâs ofya şeyhi Efendi’ye bir k âk um-ı kürk
[l. 1 p. 244] ve bil-cümle meclis-i ‘ak da h az ır olan â‘yân-ı devlete fâhir hil‘atlar
Page | 624
[l. 2] ilbâs olındı. S adrâ‘ am ve Nu‘mân Paşa h az retleri t araflarından
[l. 3] dahi Dâr-üs-sa‘âde a ası Süleymân A a’ya birer s amûr kürk ve
Baltacılar
[l. 4] Keth udâsı ve Bölükbaşılarına hil‘atlar ik tisâ olındı.
[l. 5] S adrâ‘ am h az retleri t arafından tertîb olunan nişân-dır.
[l. 6] elmâs-ı istefân bir * elmâs-ı çîrast [=çaprast] bir * elmâs-ı bilezik bir *
[l. 7] la‘lî s alk ûm-i küpe bir * mücevher âyına bir * elmâslı nikâb bir *
[l. 8] incûli mest ü pâypûş bir * altûn k aplu mücevher na‘lîn bir * sikke-i
h asene
[l. 9] iki biñ * şeker t able k ırk *
[l. 10] Vezîr-i mükerrem Nu‘mân Paşa t arafından tertîb olunan nişân-dır.
[l. 11] elmâs-ı istefân bir * elmâs-ı bilezik bir * zümrüd-i küppe bir * elmâslı
[l. 12] çirast [=çaprast] bir * altûn k aplu mücevher na‘lîn bir * mücevher mest
[l. 13] ü pâypûş bir * sikke-i h asene iki biñ * şeker t able k ırk * üzerlerine
[l. 14] boyama puşîdeler vaz ‘ u s âh ib-i devlet vâcib-ür-re‘âyâ a alarınıñ
[l. 15] her biri mücevezze ve orta k ûşâk ıla başları üzerine birer t able
[l. 16] götürüb bu üslûb üzere s adrâ‘ am sarâyından sarây-ı hümâyûna
[l. 17] irsâl ve yerlü yerlerine teslîm ü îs âl olunduk dan-s oñra Emîne Sult ân
[l. 18] h az retleriniñ cihâzları k at ârlara ve k apak lı ‘arabalara tah mîl
[l. 19] ve mu‘tâd üzere s adrâ‘ am sarâyına nak l-ı cihâz-ı mas lah atî tekmîl
[l. 20] olındı. Üç günden-s oñra yine erkân-i devlet-i ‘umûmi üzere sarây-ı
[l. 21] hümâyûna varub misâfır ot asında bir mik dâr meks ü istirâh atdan- s oñra
[l. 22] orta k apu evkende âtlarına süvâr olub mürettib-i âlây ıla Sult ân
[l. 23] müşârun-ileyhâ h az retlerini s adrâ‘ am h az retleriniñ sarâyına
götürdüler.
[l. 24] Âlây-ı temâşâ içün yevm-i mezbûrde şevketü Şehinşâh-ı devrân ve
devletlü Vâlide
[l. 25] Sult ân h az retleri vezîrâ‘ am sarâyına teşrîf ve iki gice
Page | 625
[l. 1 p. 245] anda beytütet şerîfiyle âs af-‘âlîşân h az retlerini telt îf buyurdılar114
.
« Mariage d’Emine Sultane et d’Ayşe Sultane
Parmi les filles marquées du signe de la chasteté de Son Altesse le précédent
souverain Sultan Mustafa Han, Son Altesse Emine Sultane avait été choisie
pour épouser Son Excellence Çorlulu Ali Pacha, actuellement grand vizir, et
Son Altesse Ayşe Sultane, pour épouser Son Excellence le vénérable vizir
Köprülüzade Numan Pacha. De ce fait, présentement, un firman a été émis
[stipulant] leur mariage et une autorisation impériale leur octroya la faveur
d’organiser les festivités pleines d’allégresse. L’ensemble des oulémas
jusqu’aux juges d’armée sans office à Istanbul ainsi que les divân hocâlar,
les chefs de régiment et tous les autres représentants de l’Etat entamèrent la
succession des invitations et des visites, au palais du grand vizir, dans le
cadre de cette organisation. Une fois les visites terminées, le 18e jour du
mois susdit [Muharrem 1120 = 9 avril 1708], le cheik-ul-islam Ebezade
Abdullah Efendi, le Kapudan Elhac Ibrahim Pacha, l’intendant du grand
vizir Abdurrahman Aga et les principaux Piliers de l’Etat se rendirent au
Palais impérial, où on les fit s’asseoir dans le lieu appelé la Salle de
réception. Le représentant des princesses à l’occasion du mariage
contractuel, le chef des eunuques noirs Süleyman Aga, vint [également] au
lieu susdit et les [deux] contrats de mariage furent conclu par Monsieur le
cheik-ul-islam, avec un douaire de 20 000 pièces d’or chacun, en présence
du représentant du grand-vizir, le Kapudan Pacha, et de celui de Numan
Pacha, Kitabcı Ali Efendi. Puis, le cheikh de Sainte-Sophie, Isperi Damadı
Mustafa Efendi, commença à réciter la prière de l’oraison. Monsieur le
cheik-ul-islam fut revêtu d’une robe d’honneur en fourrure de la part de
chacune des sultanes, puis le Kapudan Pacha, de la part d’Emine Sultane, et
Kitabcı Ali Efendi, de la part d’Ayşe Sultane, furent chacun revêtus d’une
robe d’honneur en fourrure ; et l’intendant du grand vizir fut également
revêtu d’une robe d’honneur en fourrure de la part d’Emine Sultane.
Monsieur le cheikh de Sainte-Sophie fut habillé d’une robe d’honneur en
zibeline. Pour leur part, l’ensemble des Piliers de l’Etat présents à
l’assemblée réunion à l’occasion de la signature de ces contrats reçurent des
cadeaux précieux. De leur côté, le grand vizir et Numan Pacha firent revêtir
chacun d’une robe d’honneur en fourrure le chef des eunuques noirs,
Süleyman Aga, et de robes d’honneur les intendants des baltacı et les chefs
de régiment.
Les fiançailles organisées par Son Excellence le grand vizir.
114
Râşid, Târîh-i Râşid : vol. 3 p. 243-245.
Page | 626
Une couronne de diamant ; une tresse de boutonnière en diamant ; un
bracelet en diamant ; une paire de boucles d’oreille en rubis en forme de
grappe; un miroir décoré de pierres précieuses ; un voile (nikâb) orné de
rubis ; une paire de chaussons (meşt) ornés de perles ; une paire de nalîn en
or plaqué et incrustées de perles ; 2 000 pièces d’or ; 40 plateaux de
sucreries.
Les fiançailles organisées par le vénérable vizir Numan Pacha.
Une couronne de diamant ; un bracelet en diamant ; une paire de boucles
d’oreille en émeraudes ; une tresse de boutonnière en diamant ; une paire de
nalîn en or plaqué et incrustées de perles ; une paire de chaussons (meşt)
incrustés de diamants ; 2 000 pièces d’or ; 40 plateaux de sucrerie,
recouverts d’un tissu peint.
Tous les commandants de celui qui détient les rênes de l’Etat et qui a le
peuple en charge [= le sultan] apportèrent chacun un plateau disposé sur leur
tête ainsi que des ceintures et des perles. Une fois qu’ils eurent apporté [les
affaires] du palais du grand vizir au Palais impérial de la manière qui a été
dite et qu’ils les eurent installées et disposées à leur place respective, eut
lieu, comme il se doit, le transport du trousseau de Son Altesse Emine
Sultane, qui avait été entassé et rangé dans des voitures fermées, disposées
en file, au palais du grand vizir. Trois jours plus tard, l’ensemble des
responsables de l’Etat se présentèrent de nouveau au Palais impérial. Après
s’être arrêtés et reposés un moment dans la Salle de réception, [ils se mirent
en route, à pied jusqu’à] la seconde porte, puis montèrent à cheval et de la
sorte amenèrent Son Altesse la sultane susdite au palais de Son Excellence
le grand vizir en un cortège dont la disposition avait été arrangée à l’avance.
Afin de contempler le spectable du cortège, le jour en question, l’auguste
prince de l’univers et la fortunée Reine mère se rendirent au palais du grand
vizir et y séjournèrent avec bonheur pendant deux nuits, illustrant ainsi la
faveur de Son Excellence le très noble grand vizir. »
« şevketlü hünkârımızın duhter-i sa‘d-ahterlerinden henüz sinn-i
şerîfeleri beşer altışaryaşında olan Ayişe Sultân ve Emîne Sultân
damet ismetühâ’nın birisi bundan akdem Şam Vâlisi Vezîr Hasan
Paşa’ya ve birisi Erzurum Muhâfızı Vezîr Numan Paşa’ya akd ü
nikâh olunup, hâleteleri merhûme Ümmü Sultân mahlûlünden
Turgudlu ve Uşşak ve mukata‘a-i ifrâz atmışbin guruşluk mıkdârı
havâs ifrâz ve Başmuhâsebeci Ali Efendi sultânlar kethudâsı nasb u
ta‘yîn ve hâsıl olan akçeleri dârüssaâde ağası ma‘rifetiyle teslîm ve
tedrîc ile cihâzları tekmîl ü tetmîm olunmak üzere nizâm verilmişidi.
Bunlardan küçük Zeyneb Sultân damet ismetüha dahi sene-i selâse-
aşere [ve] mi’e ve elf şevvâlinde [1113 = Mart 1702] vizâret ile
Kandiye eyâleti ihsân buyurulan Kara Mustafa Paşa-zâde Ali Paşa
Page | 627
hazretlerine akd olunup, mülûkâne cevâhir ü emti‘a tedârük ve
kâ’ide üzere nişân mühimmâtı görülüp, pâdişâh içün dahi bir at
eyerlenüp alay ile getürülüp, Harem-i humâyûna teslîm olundu. »115
« Les filles, étoiles de la chasteté, de notre souverain majestueux, qui étaient
encore dans leur âge fortuné de 5-6 ans chacune, Ayşe Sultane et Emine
Sultane – que la protection divine soit sur elles ! – furent mariées, l’une au
vizir Hasan Pacha, qui devint ensuite gouverneur de Şam, l’autre au gardien
d’Erzurum, le vizir Numan Pacha. On avait ordonné que leur soient
accordés les hâs de Turgutlu et Uşşak, avec leur mukata’a, rendus vacants
par la mort de leur tante paternelle, la défunte Ümmü Sultane, et dont les
revenus s’élevaient à 600 000 kuruş. Le Başmuhâsebeci Ali Efendi fut
nommé à la fonction de kethüda des sultanes, [avec pour responsabilité de
s’assurer] que le produit en aspre [de ces biens] leur soit remis en sus de leur
trousseau, avec mention au chef des eunuques noirs. Après elles, Zeyneb
Sultane “la petite” – que la protection divine soit sur elle ! – fut mariée à son
tour à Son Excellence Kara Mustafa Pachazade Ali Pacha, qui fut gratifié,
en mars 1702, de la province de Candie, avec rang de vizir116
. [A cette
occasion], on exposa toutes les choses incontournables des fiançailles,
comme les bijoux et autres biens de la Couronne, de façon continuelle et
ininterrompue. Un cheval fut également [offert] scellé pour le padichah : il
fut amené en grand pompe et remis au Harem Impérial. »
*
« Les sœurs de cette princesse [Rukiye S.], les sultanes Aïsché et Eminèh, âgées l’une de
cinq, l’autre de six ans, avaient été fiancées aux gouverneurs de Damas et d’Erzeroum,
Hasan et Nououman Pacha. Toutes deux recevaient annuellement sur les biens de la
couronne, devenus vacants par la mort de leur tante Oummi, une somme de soixante
mille piastres, provenant des impôts levés sur les tribus turcomanes de Torghoud et
d’Ouschak : mais Hasan Pacha était tombé bientôt dans la disgrâce, la main de la
sultane Aïsché [erreur : Emine] fut accordée au Silihdar Ali Pacha de Tschorli, plus
tard favori et grand vizir. »117
*
« Le gouverneur de Négrepont, Nououman Koeprülü Pacha, avait déjà été rappelé
antérieurement, du consentement d’Ali de Tschorli, afin de célébrer son mariage avec
115
Özcan (éd.), Anonim Osmanlı Tarihi : p. 148. 116
Il s’agit probablement d’une erreur : en 1702, Mustafa Pachazade Ali Pacha épousa bien une sultane, mais il s’agissait de Safiyye. L’auteur anonyme semble avoir confondu les princesses entre elles. 117
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 13 p. 15.
Page | 628
la sultane Aïsché, fille du sultan Moustafa ; la même faveur avait été accordée au fils du
grand vizir Kara Moustafa, qui avait épousé la sultane Safiyé, autre fille du sultan
Moustafa. Le retour de Nououman Koeprülü dans la capitale occupait alors tous les
habitants : le silihdar saisit cette occasion et celle que lui offrait le mécontentement du
sultan contre le grand vizir pour proposer à Ahmed III de nommer à la place d’Ali,
Nououman Koeprülü, héritier d’un nom qu’avait rendu célèbre le grand vizirat de
plusieurs de ses aïeux (15 juin 1710 – 18 rebioul-akhir). Le sultan suivit ce conseil ; il
envoya à Ali de Tschorli le grand chambellan, qui lui redemanda le sceau impérial, et
lui donna ordre de se rendre sans délai à Kafa, siège de son nouveau
gouvernement. »118
*
« Le tschaouschbaschi Moustafaaga était gendre du grand vizir[de Mehmed IV] Kara
Moustafa, mort sous le glaive du bourreau ; le fils de ce même Kara Moustafa, Alibeg,
s’était frayé la route des premières dignités, grâce à la protection du grand vizir actuel,
son parent. En recevant le titre de vizir, il avait été nommé gouverneur de Candie, et
avait obtenu la main de la princesse Rakiyé, fille du sultan régnant. »119
*
« Cinq mois après le départ de l’ambassadeur impérial de Constantinople, le Grand
Seigneur célébra les noces de trois de ses filles, de deux de ses nièces, et la circoncision
de quatre de ses fils. Ce n’est point parce que l’historiographe de l’empire Raschid a
consacré neuf feuillets in-folio à la description de ces fêtes, que nous en parlerons ici,
mais bien parce que Raschid nous donne des détails curieux et nouveaux sur la
hiérarchie et sur le cérémonial observés durant ces fêtes.
Les fiancés étaient le kapitan-pacha Souleïman, le nischandji-pacha Moustafa et Ali
Pacha, fils de Kara Moustafa Pacha, et gouverneur de Rakka ; ces trois dignitaires
épousèrent trois filles du sultan régnant. Sirké Osman Pacha reçut la main de la
princesse Oummetoullah, et le gouverneur de Négrepont, le silihdar Ibrahim, celle de la
princesse Aïsché, celle-là même qui avait été fiancée à Koeprülüzade Nououman Pacha,
et qui par sa mort avait recouvré sa liberté ; toutes deux étaient filles de Moustafa II. Le
Sultan, en choisissant pour inspecteur de la fête l’inspecteur des cuisines impériales,
Khalil, lui ordonna de faire confectionner en même temps quatre grandes palmes
nuptiales pour les quatre princes ses fils, et quarante autres plus petites avec un jardin
de sucre. Les palmes des princes, symbole d’une union fertile, avaient treize aunes de
hauteur et étaient divisées en cinq étages ; le jardin en sucre, long de six aunes sur
quatre de large, signifiait, dans le langage allégorique de l’Orient, que les douceurs du
mariage ne s’obtiennent qu’au prix de quelques douleurs physiques essuyées le jour des
noces. De grandes vergues et de larges voiles furent transportées de l’arsenal au sérail,
pour être employées à la construction d’une tente monstrueuse, sous laquelle se
118
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 13 p. 116-117. 119
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 13 p. 15. Ali Pacha épousa successivement deux sultanes, Rukiyye d’abord, puis Safiyye.
Page | 629
fabriquait les palmes de noces ; dix autres tentes plus petites étaient occupées par des
menuisiers, des serruriers, des peintres, des relieurs et des confiseurs chargés de la
confection du jardin en sucre. Khalil reçut ordre de se procurer pour le festin, dix mille
assiettes en bois ; sept mille neuf cents poulets à prendre dans les juridictions
européennes de Rodosto, d’Amedjik et de Schehrkoeïyi, et dans les juridictions
asiatiques de Goeledjik, de Yenidjé, de Tarakli et de Gülbazari, situées dans le sandjak
de Khoudawendkiar ; mille quatre cent cinquante dindons, trois mille poulardes, deux
mille pigeons, mille canards ; cent tasses de la forme de celles qu’on a coutume d’offrir,
remplies de sucreries, le jour anniversaire de la naissance du Prophète ; quinze mille
lampes destinées à l’illumination du lieu où devaient s’accomplir les différents
mariages ; mille lampyres de Mauritanie en forme de demi-lune, et dix mille pots pour
servir le sorbet. Des commissaires furent envoyés dans plusieurs provinces pour y
recruter des cuisiniers, des confiseurs, des chanteurs, des danseurs et des
saltimbanques ; cent vingt porteurs d’eau, munis d’outres imprégnées d’huile et
couverts de peaux de cuir de Russie, portant des pantalons de même cuir, furent
chargés de la police de ces fêtes : car, dans cette circonstance, on voulut maintenir
l’ordre sans être forcé de recourir aux coups de bâton et de massue. L’inspecteur Khalil
fut en outre chargé de fournir des vêtements neufs pour cinq mille enfants pauvres, qui,
à l’occasion de la circoncision des princes, devaient être comme eux circoncis aux frais
du sultan. Les lutteurs, les danseurs de corde et les bateleurs, qui arrivaient de toutes
les provinces de l’empire pour montrer leur adresse, furent placés sous la protection
des généraux des armuriers et des canonniers, et reçurent l’hospitalité du chef des
bouchers. On emprunta aux cuisines des janissaires, des canonniers et des armuriers,
des plats et de grands chaudrons ; aux fondations pieuses et aux palais des grands, des
vases d’étain et de cuivre ; enfin on fit servir toute la vaisselle des cuisines impériales.
Nous avons vu que, sous le règne de Souleïman le Grand, le grand vizir Ibrahim Pacha,
son favori, lors de la célébration de son mariage avec une princesse du sang, fut honoré
de la présence du sultan au festin qu’il donna à cette occasion, et que cette faveur le
rendit si fier que, dans ses lettres à l’empereur Charles V et au roi de Hongrie,
Ferdinand, il s’intitula : possesseur des noces (sahib es-sour). Sous Ahmed III, le tout-
puissant grand vizir, Damad Ibrahim Pacha, jouit d’un honneur non moins grand, car
son fils Mohammed, qu’il avait eu d’un premier mariage et qui fut circoncis avec les
princes, reçut comme eux deux palmes et un jardin en sucre, symboles de la force
virile ; seulement les siens furent d’une dimension moindre de moitié. Après que le
sultan et ses fils eurent examiné les palmes qui venaient d’être achevées dans le vieux
sérail, elles furent portées au nouveau sérail, d’où on les transféra, ainsi que les tentes
impériales et celles du grand vizir, sur l’Okmeïdan, place immense située sur une
colline derrière l’arsenal. Ce fut là que le kiayabeg et le defterdar, l’aga des
janissaires, les généraux de la garde à cheval et de l’étendard sacré, assistés du chef
des ouvriers chargés de dresser les tentes, présidèrent à la construction des tentes
nuptiales destinées aux grands dignitaires de la cour et de l’Etat.
On célébra d’abord le mariage de Sirké Osman Pacha avec la nièce du sultan, la
princesse Oummetoullah (15 septembre 1720 – 12 silkidé 1132). Son paranymphe
(saghdidj) conduisit, dans l’ordre accoutumé en pareilles circonstances, le cortège, et
Page | 630
portait les présents de noce du fiancé. A la tête du cortège, on portait des corbeilles
remplies des bourses d’or et des joyaux ; venaient ensuite des chevaux richement
caparaçonnés et les autres présents. Le moufti, après avoir appelé la bénédiction du
Ciel sur les fiancés, en la personne du kizlaraga qui représentait la princesse, et du
kiaya de Sirké Osman, remit à ce dernier, de la part du sultan, la dot de sa femme, qui
s’élevait à vingt mille ducats. Après ce cérémonial, on remit, de la part des nouveaux
mariés, de riches pelisses au premier eunuque, au valet de chambre, aux maîtres du
salut et des cérémonies, à l’écuyer et au référendaire ; puis ils furent congédiés après
avoir été encensés et abreuvés de café et de sorbet.
Un intervalle de quatre jours fut laissé entre le mariage de Sirké Osman, et la fête de la
circoncision des princes, qui dura seize jours entiers. »120
120
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 14 p. 24-26.
Page | 631
43) Fatma Sultane, fille d’Ahmed III, et Silahdar Ali Pacha (1709)
« Après les noces de ses deux nièces, le sultan songea à fiancer aussi sa fille Fatima,
âgée seulement de quatre ans. En vain, Ali Pasha essaya de dissuader le sultan
d’accorder la main de la jeune princesse au silihdar-pacha, son favori avoué ; elle fut
fiancée à ce dernier, auquel elle apporta la dot de quarante mille ducats ; de plus, le
sultan ajouta aux biens de la couronne, qu’il possédait déjà, les revenus de l’île de
Chypre. Les fiançailles furent célébrées avec un faste d’autant plus extraordinaire (16
mai 1709 – 6 rebioul-ewwel 1121) que le sultan se plaisait à ces sortes de
réjouissances. »121
121
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 13 p. 106.
Page | 633
[p. 319 l. 20] Vuk u‘-i zifâf-i S âfiye Sult ân be-Mak tûl-zâde ‘Âlî Paşa
[l. 21] Bundan ak dem Sult ân Mus t afà Hân h az retleriniñ duhter sa‘d-
[l. 22] ahterlerinden Mak tûl-zâde vezîr ‘Âlî Paşa h az retlerine nâ-müjd[e] ‘ak d
[l. 23] ü nikâh olan S âfiye Sult ân h az retleriyle zifâf içün
[l. 24] t araf-ı hümâyûndan is dâr-i emr-i ruhs at ve vezîr müşârun-ileyh
[l. 25] mut as arıf oldu ı Adana eyâletinden Âsitâne’ye da‘vet olınub
[p. 320 l. 1] geldiklerinde Süleymâniye’de vak ı‘ kendü sarây ‘âliyelerinde vüzerâ ü
‘ulemâ’ya
[l. 2] ‘alî-ül-tertîb z iyâfet ü it‘âm u icrâyı sünnet-i velîmede ihtimâm
[l. 3] buyurdular. Z iyâfetler tamâm olduk dan-s oñra mah-ı mezbûriñ dördüncü
[l. 4] sebt güni ‘Âlî Paşa t arafından sa dıcları Nişancı Süleyman Paşa
[l. 5] ve Sult ân h az retleri t arafından dâr-üs-sa‘âde a ası Süleymân A a
[l. 6] vekâletleri ile a a-ı müşârun-ileyhiñ Misâfir ot ası ta‘bîr olunur.
[l. 7] Ot alarında Şeyh-ül-islâm Efendi h az retleri on biñ altun
[l. 8] mehr-i mü’eccel üzerine ‘ak d-i nikâh édüb ba‘d’ül-du‘â Sult ân
[l. 9] h az retleri t arafından Şeyh-ül-islâm Efendi ve Dâr-üs-sa‘âde A ası
[l. 10] ve sa dıc Paşa h az retlerine samûr kürkler elbâs olındı.
[l. 11] T ok unzuncu pençenbe güni ‘alî-üs-seh ar bil-cümle vükelâ-i devlet sarây-ı
[l. 12] hümâyûna varub Sult ân h az retlerini müretteb âlây ila zikrolunan
[l. 13] Süleymâniye sarâyına götürdüklerinden-s oñra cümlesi me’zûn-i
[l. 14] ‘avdet ü ins irâf ve vezîr müşârun-ileyh ‘Alî Paşa h az retleri
[l. 15] ol gice mah rem-i halvethâne-i zifâf olub îrtesi [gün] pâdişâh-ı
‘alempenâh
[l. 16] h az retleri vezîr müşârun-ileyhiñ sarâyına teşrîf ve paşa-ı
[l. 17] müşârun-ileyhe h az retlerini ‘avât ıf-ı ‘aliyye-i mülukânelerinden bir
samûr kürk
[l. 18] elbâsıyla telt îf buyurdular.122
122
Râşid, Târîh-i Râşid : vol. 3 p. 319-320.
Page | 634
« L’événement des noces de Safiyye Sultane avec Maktulzade Ali Pacha.
Pour ses noces avec Son Altesse Safiyye Sultane, une des filles de grande
fortune de Son Altesse le sultan Mustafa Han, qui avait été mariée
auparavant par contrat au vizir Maktulzade Ali Pacha sans que l’événement
n’ait été accompagné d’une quelconque annonce réjouissante, le vizir susdit,
alors gouverneur de la province d’Adana, reçut de la part du souverain un
édit l’autorisant à prendre congé [de son office] et l’invitant [à se présenter]
au Seuil Sublime. A son arrivée, il organisa avec soin et dans un bel
arrangement les visites, les banquets et toutes les choses réalisées
traditionnellement à l’occasion de fêtes de mariage à l’attention des vizirs et
des oulémas, dans son propre palais exalté, situé [à proximité de] la
Süleymaniyye. Une fois les visites achevées, le samedi 14 du mois susdit,
Nişancı Süleyman Pacha, sağdıç d’Ali Pacha, et le chef des eunuques noirs
Süleyman Aga, représentant de Son Altesse la Sultane, furent convoqués à
la Salle de réception de l’eunuque susdit. Dans cette pièce, Son Excellence
Monsieur le Cheikh-ul-islam conclut le contrat de mariage avec un douaire
de 10 000 pièces d’or. Après les prières [d’usage], Leurs Excellences
Monsieur le Cheikh-ul-islam, le chef des eunuques noirs et le sağdıç pacha
furent revêtus de robes d’honneur en fourrure de la part de la sultane. Le
jeudi 19, au petit matin, l’ensemble des représentants de l’Etat se
présentèrent au Palais impérial et, dans une procession établie à l’avance, ils
amenèrent Son Altesse la Sultane au palais susdit [du quartier] de la
Süleymaniyye. Quand chacun d’entre eux eut reçu la permission de se
retirer et de s’en retourner [à leurs affaires], Son Excellence le vizir susdit
Ali Pacha passa cette nuit dans l’intimité de la chambre nuptiale privée. Le
lendemain, Son Altesse le Souverain du monde rendit visite au palais de Son
Excellence le vizir susdit et dans un geste de bonté royale, il fit au vizir
susdit la faveur de le faire revêtir d’une robe d’honneur en fourrure. »
Page | 635
45) Fatma Sultane, fille d’Ahmed III, et Nevşehirli Ibrahim Pacha
« Fatima, fille du sultan, qui avait alors quatorze ans et avait été fiancée au grand vizir
Damad Ali [auparavant silihdar], fut donnée en mariage au favori Ibrahim Pacha
[Nevşehirli], qui réunit ainsi au titre de kaïmakam celui de gendre du souverain. »123
123
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 13 p. 171.
Page | 636
46) Atike Sultane, Hadice Sultane et Ümmügülsüm Sultane, filles d’Ahmed III,
avec Mehmed Bey (ensuite pacha), Ali Beg et Çerkes Osmanpachazade
Ahmed Beg (1724)
« Plus heureux que ses prédécesseurs, dont les fils, à l’exception d’un seul destiné à
occuper un jour le trône, périssaient, suivant une ancienne loi barbare, sous la main du
bourreau, Ahmed III, depuis les dix années de son règne, s’était vu père de vingt-quatre
fils et filles, dont la moitié de cette nombreuse progéniture vivait encore. Trois ans
s’étaient écoulés depuis le jour où il avait célébré les noces de trois de ses filles et la
circoncision de quatre de ses fils. A l’époque où nous sommes arrivés, il fiança trois
autres de ses filles, Aatiké, Khadidjé et Oumm Koulsoum, la première avec
Mohammedbeg, la seconde avec Alibeg, et la troisième avec Ahmedbeg, fils de
Tscherkes Osman Pacha. Mais chacune d’elles, au lieu de recevoir, comme leurs sœurs
aînées, une dot de vingt mille ducats, ne reçut que la moitié de cette somme.
Nous avons trop souvent eu l’occasion de décrire les fêtes usitées lors du mariage des
princes et des princesses du sang d’Osman, pour décrire les solennités auxquelles
donnèrent lieu celui des trois princesses […]. »124
124
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 14 p. 39-40.
Page | 637
47) Saliha Sultane, Ayşe Sultane et Zeyneb Sultane, filles d’Ahmed III, avec
Mustafa Pacha, Silahdar Mehmed Pacha et Mustafa Pacha (1728)
« Ces diverses solennités alternaient avec les fêtes extraordinaires provoquées, tantôt
par le mariage des princesses du sang, tantôt par la première leçon donnée aux princes.
Ainsi, la sultane Safiyé, fille du sultan Moustafa II, et veuve du fils du grand vizir Kara
Moustafa, épousa en secondes noces Mirza Mohammed Pacha, ancien gouverneur des
bords du Phasus, depuis gouverneur de Candie ; les princesses Saliha, Aïsché et
Seïneb, filles du sultan, furent mariées, la première à Moustafa, gouverneur d’Eriwan,
fils de Deli Houseïn, la seconde au silihdar et secrétaire Mohammedaga, et la troisième
au second écuyer Moustafa, neveu du grand vizir. »125
125
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 14 p. 120.
Page | 638
48) Ayşe Sultane, fille de Mustafa II, et Ebubekir Pacha (1732)
« ʻAkd ü nikâh-ı tezvîc-i Ayşe Sultân be-Silahdâr-ı sâbık Ebûbekir
Paşa
Mâh-ı merkûmun [şevval 1144] yirmi beşinci günü Köprülüzâde
Nuʻmân Paşa merhûmun menkûha-i metrûkeleri saʻâdetlü Ayşe
Sultân dâmet ısmetühâ hazretleri sâbıkâ Silahdâr-ı şehriyârî ve hâlâ
Anadolu Beylerbeyisi olan Ebûbekir Paşa hazretlerine tezvîc olunup,
sultân-ı müşarun-ileyhânın Zeyrek’de vâkiʻ saraylarında ʻakd-i
cemʻiyyet-i nikâh ve bast-ı bisâtı sürûr u inşirâh olundu. »126
« Mariage contractuel d’Ayşe Sultane avec Ebubekir Pacha, ancien
Silahdar.
Le 25e jour du mois susdit [21 avril 1732], la veuve du défunt Köprülüzade
Numan Pacha, Sa Majesté la fortunée Ayşe Sultane – que Dieu la protège –
a été mariée à Son Excellence Ebubekir Pacha, ancien Silahdar impérial et
qui est actuellement gouverneur d’Anatolie. Les fêtes et réjouissances pour
la réunion du contrat de mariage et l’entrée dans le lit [nuptial] eurent lieu
dans le palais de la sultane susdite, sis à Zeyrek. »
« mansıb-ı Kapudân-i Deryâ’ya nâil ve mâh-ı merhûmun on
dokuzuncu cumʻa gicesi mukaddemâ kendüye ʻakd ü tezvîc
buyurulan Ayşe Sultân hazretlerinin ser-vakt-i dârü’z-zifâf-ı
Meryem-afâflarına dâhil ü vâsıl oldular. »127
« Ayant obtenu l’office de Commandant de la Mer, la nuit du vendredi 19
du mois susdit, il [Ebubekir Pacha] joignit et fut admis dans l’intimité de la
chambre privée, siège de la cérémonie nuptiale, de la Miryam de chasteté,
Sa Majesté Ayşe Sultane, avec laquelle il avait été marié par contrat. »
126
Subhî, Subhî Tarihi : p. 155 note 85 (ajout dans le manuscrit Sâmî). 127
Subhî, Subhî Tarihi : p. 159 note 88 (ajout dans le manuscrit Sâmî). Un nouveau grand vizir est nommé : étant en poste à Tebriz, on le rappelle pour venir prendre sa nouvelle position. Il s’empresse alors de revenir, avec les membres de sa suite, parmi lesquels se trouve Ebubekir Pacha. Ils passent le Bosphore depuis Üsküdar vers Istanbul (intra muros) le 17 du mois de Zilhicce 1144 = 11 juin 1732.
Page | 639
49) Asime Sultane, fille de Mustafa II, et Yakup Pacha (1733)
« Vekâyi-i sene-i sitte ve hamsîn ve miete ve elf.
Vukûʻi Alay-ı Âsime Sultân
Hâlâ Adana Vâlisi Yaʻkûb Paşa hazretlerinin hâcle-nişîn-i izdivâcı
olan sultân-ı müşarûn-ileyhâ hazretlerinin nahl-i berûmend-i ‘afâf
olan vücûd-ı ısmet-ittisâfları zîb-i âğûş-ı zifâf olmağla bâbil ü
müstaʻidd olmakdan nâşî, bundan mukaddem temşiyet-i emr-i
merkûm içün vezîr-i müşârün-ileh bâ-fermân-ı Âlî Dersaʻâdet’e
avdet ve baʻde’l-vürûd techîz ü tekmîl-i levâzım-ı sûr u sürûra
mübâderet olunup, baʻdehû mâh-ı muharremü’l-harâmın üçüncü
günü müretteb alay ile müşarün-ileyhâ hazretleri, Kadırga
Limanı’nda vâkiʻ sarây-ı âlîlerine îsâl olunmak emr ü fermân
buyurulmağın, yevm-i mezbûrda kâide-i kadîme-i Osmânî üzre sadrı-
aʻzam hazretleri ve kapudanpaşa ve ağa paşa hazerâtı bilcümle
erbâb-ı dîvân ve ulemâ-i aʻlâm ve kibâr-ı hâcegân ve dergâh-ı
muʻallâ kapucubaşıları ve ocaklar halkı ve ağayân ve sâir aʻyân u
erkân ile ale’s-seher Sarây-ı âmire-i Hazret-i Şehriyârîye varup,
Dârüssaʻâdeti’ş-şerîfe ağası Elhâc Beşir Ağa hazretlerinin inzimâm
u re’yi ve nezâret-i âlîleriyle iktizâ iden araba ve sâir malzeme her
ne ise techîz ü tekmîl itdirildikten sonra, tertîb-i alay olunup ibtidâ
asesbaşı neferâtiyle, baʻdehû serhengân-ı dîvân mücevvezeleriyle,
baʻdehû Dergâh-ı âlî müteferrikaları erkân kürkleriyle, baʻdehû
hâcegân-ı dîvân anların akabinde top arabacıbaşı ağa ocağının
kethüdâ ve zâbitânı ile anların ardında cebecibaşı ağa ocak-ı
mezbûr kethüdâsı ve sâir zâbitânı ile, baʻdehû dûdmân-ı
Bektâşiyye’nin umûmen çorbacıları ve bilcümle zâbitân ve kul
kethüdâsı, baʻdehû sipâh u silâhdâr ağaları, baʻdehû Dergâh-ı âlî
kapucubaşıları, baʻdehu defterdâr efendi ve defter emîni anların
ardında ulemâ-yı i’lâm efendiler Islâmbol maʻzûllerine dek ve
sadreyn-i muhteremeyn efendiler hazerâtı, baʻdehû kapudan paşa ve
ağa paşa hazerâtı hem-‘inân-ı murâfakat, baʻdehû tezkire-i evvel ve
sânî ve çavuşbaşı ve reîsülküttâb efendi, baʻdehû cenâb-ı sadâret-
penâhî kemâl-i ihtişâm u devlet ile güzerân ve der-‘akab tersâne
neferâtı mukaddemâ aʻdâd olunan altı aded sağir ve üç aded kebîr
ve bir aded yek-pâre sîmden tasniʻ olunmuş nahl-i zibâ ile hırâman
olup, baʻdehû Dârüssaʻâde ağası müşarün-ileyh hazretleri gerdûme-
i müşarün-ileyhânın pes ü pîşlerinde revân olan yüzden mütecâviz
keçelü kapucular ve birkaç yüz nefer teberdarân-ı Sarây-ı Atîk ve
musahibân-ı cenâb-ı şehriyârî ve sâir huddâm ve aʻyân-ı Harem-i
hümâyûn-ı tâcdârî pîşvâ olup, mükemmel ü müretteb alay-ı behcet-i
fermâ ile, Bâb-ı Hümâyûn’dan hurûc u zuhûr ve tarafeyn-i râhda
Page | 640
vâkiʻ dekâkîn ü büyût ve esvâkda keşîde-i karâ u ikâmet olan
temâşâiyân-ı enâma şevk-bahş-ı sürûr u hubûr olarak At
Meydanı’ndan mürûr ile Kadırga Limanı taʻbîr olunan mahalde
vâkiʻ sarây-ı merkûma vusûl bulduklarında, icrâ-yı resm-i âdîden
sonra her biri mahallerine hısset-yâb-ı kufûl oldular. »128
« Les événements de l’année 1733 (H.1156)
L’événement de la procession d’Asime Sultane
Comme le corps pur, le palmier-dattier qui porte les fruits de chasteté de Sa
Majesté la Sultane susmentionnée, mariée et installée dans la chambre
nuptiale de Son Excellence l’actuel gouverneur d’Adana, Yakub Pacha, était
prêt et disposé à la beauté de l’étreinte nuptiale, dans un premier temps, sur
commandement impérial, le vizir susmentionné se rendit auprès du Seuil de
la Félicité et pour l’accomplissement de l’ordre susdit, dès son arrivée, on
s’empressa en vue de la préparation et de l’achèvement des équipements
pour la cérémonie de mariage et les festivités. Le 3e jour du mois de
Muharrem [27 février 1743], l’ordre et le commandement d’envoyer en
grande procession Sa Majesté susmentionnée au Palais Sublime sis [dans le
quartier] de Kadirgalimanı ayant été donné, ce jour-là, en conformité avec
les traditions anciennes ottomanes, Son Excellence le grand vizir, Leurs
Excellences l’amiral et le chef des janissaires ainsi que les piliers du conseil,
les représentants des oulémas, le noble chef de la chancellerie, les kapıcıbaşı
de la Porte impériale, le peuple des cuisines, les agas et tous les autres
grands et petits officiers se présentèrent au petit matin au Palais Impérial de
Sa Majesté royale. Après avoir fait préparer la voiture et les autres affaires
nécessaires aux dernières touches d’équipement et de préparation [de la
cérémonie], la procession se mit en place, sous le contrôle auguste et avec le
consentement de Son Excellence le chef des eunuques noirs, Elhac Beşir
Ağa. Les capitaines de la garde venaient d’abord, marchant de façon
élégante, puis les hallebardiers du divan portant leur turban mücevveze129
,
puis les müteferrika de la Porte impériale portant le manteau de fourrure des
officiers, puis le chef de la chancellerie du conseil, directement suivi du chef
des cuirassiers, de l’intendant du corps susdit, et les autres officiers [des
cuirassiers], après quoi venaient les colonels suivis du chef des voituriers, de
l’intendant et des officiers du corps des agas, puis à leur suite d’autres
officiers du corps des janissaires ainsi que l’intendant des kul, après quoi les
chefs de la cavalerie et des porteurs de sabres, puis les kapıcıbaşı de la Porte
impériale, puis le Ministre des finances et le Directeur des registres de
propriétés foncières, puis à leur suite ces Messieurs les oulémas
128
Subhî, Subhî Tarihi : p. 765-766. 129
Un turban fait de plusieurs plis tressés, porté lors des occasions formelles comme faisant partie de l’ensemble de l’uniforme des fonctionnaires turcs
Page | 641
actuellement sans affectation et qui se trouvent à Istanbul, Leurs
Excellences Messieurs les deux cadiaskers, puis Leurs Excellences l’amiral
de la flotte et l’aga des janissaires tous deux côte à côte, puis le premier
secrétaire du Grand Vizir, le second, le chef de la garde impériale et le
Ministre des Affaires étrangères, après quoi il y eut le passage d’une
magnificence et d’un succès impeccable du grand vizir, suivi des personnes
de l’arsenal et, en plus grand nombre que par le passé, de six petits palmiers,
dont trois grands et un fabriqué tout en argent. Son Excellence
susmentionné le Chef des eunuques noirs venait ensuite à la tête de
centaines de kapıcı vêtus de feutres de grande valeur, de quelques centaines
de hallebardiers du Vieux Palais, des eunuques de la suite impériale et du
Vieux Palais ainsi que des chefs du Harem Impérial, marchant devant et
derrière le carrosse de la sultane susdite. Partis de la Porte de la Félicité sous
la forme d’un cortège de joie parfaitement arrangé, ils passèrent par la place
de l’hippodrome, donnant de la joie et du bonheur à l’humanité qui les
contemplait, installée tout le long de la route dans les boutiques, maisons et
échoppes se trouvant des deux côtés du chemin, et arrivèrent au palais de la
sultane, sis dans le quartier appelé Kadırga Limanı ; à ce moment-là, après
les cérémonies traditionnelles, chacun de son côté retourna à ses propres
affaires. »
Page | 642
50) Safiye Sultane, fille de Mustafa II, Saliha Sultane et Ayşe Sultane, filles
d’Ahmed III, avec Ebubekir Pacha, Ali Pacha et Ahmed Pacha (1740)
« Tezvîc-i Sultânân be-Vüzerâ-yı ‘İzâm
Pîrâye-bâş-ı hacle-gâh-ı ismet ve firûzende-i gevher-i tâc-ı iffet
Safiye Sultân ve Sâliha Sultân ve Ayşe Sultân hazerâtının gevher-
girân-kadr-ı izdivâc ile isâbe-tırâz-ı ibtihâc olmaları husûsuna bu
def‘a irâde-i aliyye-i pâdişâhî ta‘alluk eylemekden nâşî, müşarün-
ileyhâ Safiye Sultân mâh-ı rebîü’lâhırın gurresi Perşembe günü
sâbıkâ Cidde vâlisi olup, hâlâ Âsitâne-i sa‘âdet tarafina da‘vet
olunan vezîr-i mükerrem Bekir Paşa hazretlerine ve Sâliha Sultân
dahi yine mâh-ı merkûmun dördüncü pazarirtesi günü Belgrad
muhâfızı vezîr-i mükerrem Ali Paşa hazretlerine ve Ayşe Sultân dahi
Mora Muhassılı vezîr-i mükerrem Ahmed Paşa hazretlerine akd ü
tezvîc olunup taraf-ı sadrıa‘zamîden müşarün-ileyhim hazerâtının
her birine mahsûs âdemler irsâl ü tesyîr ve bu haber-i meserret-
semîr ile tebşîr olundular. »130
« Le mariage des sultanes avec les vizirs de la coupole :
Une fois que l’ordre impérial émanant du sultan fut transmis à celles qui
embellissent la chambre nuptiale de la pureté, les couronnes de perles et de
turquoises de la chasteté, Leurs Majestés Safiye Sultane, Saliha Sultane et
Ayşe Sultane, les informant de se réjouir de [la venue de] la perle très
précieuse du mariage, elles furent mariées par contrat : la susmentionnée
Safiye Sultane à Son Excellence le vénérable vizir Bekir Pacha,
précédemment gouverneur de Cidde et qui a présentement été rappelé au
Siège de la Félicité, le jeudi 1er
du mois de Rebiülahir [an 1153, soit le 26
juin 1740] ; puis de nouveau Saliha Sultane à Son Excellence le vénérable
vizir Ali Pacha, gardien de Belgrade, le lundi 14 du même mois ; ainsi
qu’Ayşe Sultane à Son Excellence le vénérable vizir Ahmed Pacha,
collecteur des taxes de la Morée. Le grand vizir a communiqué ces bonnes
nouvelles à Leurs Majestés susmentionnées par l’envoi de lettres, remises à
chacune par un envoyé spécial, et accompagnées de l’annonce de joyeuses
festivités nocturnes. »
« Âmeden- Kapudanpaşa be-Âsitâne-i Sa‘âdet
1156 Zilhicce. Bundan akdem Deryâ Kapudanlığı tevcîhiyle Âsitane-
i Sa‘âdet’e da‘vet olunan vezîr-i mükerrem Ahmed Paşa hazretleri
mâh-ı merkûmun yirmi ikinci günü Deraliyye’ye vürûd u vusûl ve
130
Subhî, Subhî Târihi : p. 625.
Page | 643
kapu kethüdâlarının hânesine nüzûl idüp, irtesi gün huzûr-ı cenâb-ı
sadâret-penâhîde hil‘at-ı kapudânî kılındıkdan sonra, mâh-ı
mezbûrun yirmi dördüncü Pazar günü Kethüdâyı sadr-ı âlî Şerîf
Halil Ağa hazretleri ba‘del-asr hâne-i mezkûreye teşrif buyurup,
müşârün-ileyhi mahall-i merkûmdan tahrîk ve mukaddemâ dâhil-i
serâ-perde-i izdivâcları olan Ayşe Sultân hazretlerinin
Demürkapu’da vaki‘ sarây-ı bî-hemtâlarına îsâl ü tesyîr ve icrâ-yı
emr-i zifâfa mübâderet ve müşârün-ileyh tarafından âmâde vü
müheyyâ olan ferve-i semmûru ba‘del-iktisâ avdet ü ric‘at
eylediler.»131
« Arrivée du Kapudan au Siège de la Félicité :
Son Excellence le vénérable vizir Ahmed Pacha, détenteur de l’office de
Kapudan de la mer, ayant été invité à comparaître au Siège de la Félicité, il
arriva le 22 du mois susdit [zilhicce 1156 = 6 février 1744] et se présenta à
la Sublime Porte ; il descendit à la Maison des kethüda de la Porte. Il fut
revêtu le lendemain de la robe d’honneur de l’amirauté, en présence du
grand vizir, puis, le dimanche 24 du même mois [8 février 1744], Son
Excellence le Kethüda du grand vizir, Şerif Halil Aga, honora de sa
présence la maison susdite, le milieu de l’après-midi passé. Il l’envoya au
palais qui n’a pas d’égal, sis à Demirkapı, de Sa Majesté Ayşe Sultane, qui
avait déjà passé, par le passé, le rideau du mariage. L’ordre d’exécution du
mariage ayant été établi, il se retira après avoir été habillé de robes de
zibeline, qui avaient été préparées et mises à disposition par le
susmentionné. »
131
Subhî, Subhî Târihi : p. 842-843.
Page | 645
ANNEXES D
LES PRINCESSES ET LA POLITIQUE
1. Nefise Hatun, fille de Murad Ier
2. Ilaldi Hatun, fille de Mehmed Ier
3. Fatma Hatun, fille de Mehmed Ier
4. Selçuk Hatun, fille de Mehmed Ier
5. Beyhan Sultane, fille de Selim Ier
6. Mihrimah Sultane, fille de Süleyman Ier
7. La puissance des sultanes sous le règne de Murad III
8. Atike Sultane, fille d’Ahmed Ier
9. Ayşe Sultane, fille d’Ahmed Ier
10. Contacts diplomatiques et usages des cadeaux entre le vice-roi de Naples et
les filles d’Ahmed Ier
11. Kaya Ismihan Sultane, fille de Murad IV
12. Hadice Sultane, fille de Mehmed IV
13. Emine Sultane, fille d’Ahmed III
14. Fatma Sultane, fille d’Ahmed III
Page | 647
1) Nefise Melek Hatun, fille de Murad Ier
« Hikâyet-i muhâsara-i Konya
Karaman-oglı çünki sınup kaçup, Konya’ya girüp, Murâd Han vardı,
Konya’yı muhâsara kıldı. Ammâ yasak itdi ki, bir ahad kimsenüñ bir
habbesine taʽarruz itmiye. Meger ki, Lâz çerisinden birkaç kâfir
müslimânlara müteʻârız olmışlar. Gâzî Murâd Han buyurdı, siyâsetle
depelediler. El-hâsıl, on iki gün Murâd Han Konya üzerinde oturup,
hîç ceng itmedi. Karaman-oglı zebûn olup, amân dileyüp, elçi
viribiyüp, tenezzül itdi. Kabûl itmediler,elçisini kovdılar.
Istişfâʽ-i Sultân Hatun mine’s-sultân
Ol Murâd Han kızı, Karaman-oglı Alâeddîn Beg’üñ hatunıydı.
Alâeddîn Beg gördi ki, Sultân Murâd’uñ gazabı var, amân virmeyüp
kendüyi ele getürmek ister. Hatun’a haber gönderüp eyitdi: “Eger
beni babañdan dilek itmezseñ Konya’yı alur ve beni helâk eyler. Lutf
idüp baña yarlık idüp, hünkâruñ varup elin öpüp, beni dilek idesin,
günâhumı afv itdüresin.” Sultân Hatun varup, Murâd Han’uñ ayagına
düşüp, yalvarup, hünkârdan dilek idüp, “bu kerre dahı günâhından
geç, artuk bunuñ gibi itmiye” diyüp, zûr u zârla cürmüni afv itdürüp,
hünkâr eyitdi: “Gelsün, benümile görüşsün, elim öpsün, tenezzül
eylesün ; ik lîmini yine kendüye vireyin.”
Sultan Hatun dahı, Alâeddîn Beg’e âdem gönderüp, “sabah gel,
hünkar elin öp” didi. Karaman-oglı işidüp sevindi, sabâh olunca cânı
az kaldı. Irte sabâh Konya’dan çıkup gelüp hünkâruñ elin öpüp,
ayagında baş koyup biñ dürli özrler itdi. Sultân Murâd Han bunuñ
itdûgi yaramazlıklara kalmayup, hünkâr yine ik lîmini kendüye
bagışladı. »1
« Histoire du siège de Konya.
Karamanoğlu ayant été mis en déroute, il s’enfuit et se réfugia dans Konya.
Murad Han arriva et fit le siège de Konya. Mais il interdit à ses troupes de
faire des dommages quelconques aux récoltes [litt. aux grains, céréales ou
baies] de qui que ce soit. Pourtant, quelques infidèles parmi les soldats de
Laz s’en prirent à des musulmans. Gazi Murad Han ordonna qu’ils soient
exécutés. Au total, Murad Han demeura 12 jours devant Konya, pendant
lesquels il n’y eut aucun combat. Karamanoğlu était sans force : il sollicita
sa reddition et envoya des ambassadeurs, qu’on daigna accepter. [Leurs
propositions] ne furent pas acceptées : on congédia les ambassadeurs.
Supplique de pardon de la part de Sultane Hatun, issue du sultan.
1 Neşrî, Cihânnümâ : p. 107-108. Les passages soulignés correspondent à des ajouts ou des précisions
dans les autres manuscrits conservés de cette histoire.
Page | 648
Cette fille de Murad Han était la femme de Karamanoğlu Alaeddin Beg.
Alaeddin Beg comprit que Sultan Murad était en grande colère, qu’il ne lui
accorderait pas de reddition, mais voulait s’emparer de sa personne. Il
envoya la nouvelle à sa femme en lui déclarant : “Si tu ne supplies pas ton
père pour moi, il s’emparera de Konya et me tuera. Prie-le, fais preuve de
bonté envers moi ; rends-toi auprès du souverain, embrasse-le, prie-le pour
moi, fais en sorte qu’il me pardonne ma faute”. Sultan Hatun se rendit
auprès de Murad Han et tomba à ses pieds ; elle l’implora, le suppliant de la
sorte: “passe lui encore cette faute, ne fais pas cela”. A force de mensonge et
de dissimulation, elle obtint le pardon de sa faute. Le souverain déclara:
“qu’il vienne et se présente à moi ; qu’il embrasse ma main et s’incline
devant moi et je lui rendrai de nouveau son territoire”.
Sultan Hatun envoya un homme à Alaeddin Beg avec la nouvelle “viens
demain matin, baise la main du souverain”. Karamanoğlu écouta et s’en
réjouit ; mais le matin venant, il lui restait peu d’énergie. Le matin suivant,
il sortit de Konya ; il vint, baisa la main du souverain, se prosterna à ses
pieds et lui présenta mille sortes d’excuses. Sultan Murad Han ne resta pas
sur [le souvenir] des mauvaises manières perpétrées par ce dernier ; le
souverain lui offrit de nouveau ses territoires ».
*
« Dans les premiers temps du règne de Mourad, Alaeddin, fils et successeur de
Yakhschi Beg, pour augmenter les embarras que la révolte des grands propriétaires
(akhi) de la Galatie avait suscités à Mourad, et afin de favoriser l’insurrection par une
diversion puissante, excita les Warsaks à se joindre aux rebelles d’Angora ; mais la
prise de cette ville et le mariage de Nefisé, fille de Mourad, avec Alaeddin, rétablirent
la paix pour quelques temps. A dater de ce moment, l’envieux Alaeddin chercha toutes
les occasions de rompre le traité qui l’unissait au souverain des Ottomans. Il crut en
avoir trouvé une des plus favorables dans la conjuration de Saoudji et dans la mort de
Kaïreddin Pacha. En conséquence, il réunit sous ses drapeaux les diverses tribus des
Warsaks et des Torghouds, les hordes de Baibourd et d’autres peuplades turcomanes et
tatares errantes dans l’Asie Mineure. Mourad ordonna à Timourtach, son beglerbeg
d’Europe, de se rendre en Asie avec toutes les troupes de ses provinces, parmi
lesquelles se trouvaient deux mille auxiliaires serviens. Puis il passa son armée en
revue dans la plaine de Kutahia et se disposa à marcher contre son nouvel ennemi.
Mais comme pendant le séjour de Mourad à Kutahia, le sultan d’Egypte lui avait fait
offrir, par une brillante ambassade, l’assurance de son amitié et de riches présents,
Karaman, craignant de se trouver entre deux ennemis, chercha à se réconcilier avec le
souverain ottoman et à s’excuser des ravages exercés par ses hordes dans le territoire
de Hamid. Mais il était trop tard ; le jeune vizir Ali Pacha, impatient de combattre,
rejeta toute proposition de paix, et l’ambassade d’Alaeddin s’en retourna talonnée par
l’armée ottomane. [récit de la bataille, dans la plaine d’Iconium, p. 149-150]
Page | 649
Immédiatement après cette victoire, le sultan mit le siège devant Koniah. Défense fut
faite à l’armée, sous les peines les plus sévères, de rien prendre aux habitants du pays.
Quelques Serviens ayant enfreint cet ordre, furent impitoyablement mis à mort,
châtiment inusité qui sema parmi ces utiles auxiliaires les germes d’une haine
implacable, mais qui gagna aux Ottomans la confiance des indigènes et leur assura
d’amples approvisionnements. Mourad assiégeait la ville depuis douze jours sans avoir
encore osé livrer l’assaut, lorsqu’Alaeddin, pénétré des dangers de sa position, prit le
parti d’envoyer son épouse dans le camp des Ottomans. Le sultan céda aux
supplications de sa fille et consentit à accorder la paix à Alaeddin, sous la condition
qu’il viendrait, en signe de soumission, lui baiser la main. Le prince de Karamanie se
résigna à cette humiliation qui lui assurait la possession de Koniah et de toutes ses
provinces, et dès ce moment la paix se rétablit entre les deux souverains. »2
*
« Bientôt, Bayezid entreprit une guerre contre son beau-frère Karaman [Alaeddin
Karamanoğlu], ainsi nommé à cause du nom du pays qu’il gouvernait. Sa capitale
s’appelait Laranda. Comme Karaman ne voulait pas se soumettre, Bayezid se mit en
campagne contre lui avec cent cinquante mille hommes. Quand Karaman vit que le roi
Bayezid marchait contre lui, il se mit en route avec soixante mille hommes qu’il tenait
pour les meilleurs de son pays, avec l’intention de résister au roi. Les deux armées se
rencontrèrent dans une plaine devant Konya, qui faisait partie du territoire de
Karaman, et commencèrent le combat. Deux batailles furent livrées en une seule
journée et personne ne put dominer l’autre. Les deux parties se mirent d’accord pour
une trêve pendant la nuit. Karaman fit un grand tintamarre de trompettes et de grosses
caisses. Il voulait ainsi tenir Bayezid en éveil et l’effrayer. Mais celui-ci donna l’ordre
de faire du feu pour préparer la nourriture et de l’éteindre ensuite. De nuit, il envoya
trente mille hommes derrière les lignes ennemies et les chargea de fondre sur elles dès
le lever du jour. Quand le jour se leva, Bayezid sonna l’attaque et les trente mille
hommes assaillirent l’ennemi à revers. Quand Karaman vit qu’il était cerné de deux
côtés, il se replia sur Konya pour organiser la défense. Mais Bayezid établit son camp
devant la ville, qu’il assiégea pendant onze jours sans pouvoir la prendre.
Alors les habitants envoyèrent à Bayezid une délégation l’informant qu’ils livreraient la
ville s’il épargnait les personnes et les biens. Il le leur promit et ils l’informèrent qu’il
pouvait venir prendre la ville, qu’ils capituleraient sur les remparts afin qu’il puisse
s’en emparer. Et c’est ce qui eut lieu. Quand Karaman vit que son beau-frère avait
atteint la ville, il fondit sur elle avec ses guerriers pour combattre intra muros. S’il
avait bénéficié ne serait-ce que du moindre appui de la part des citadins, il aurait pu
chasser Bayezid de la ville par la force. Il reconnut alors qu’il ne recevrait pas d’aide
et voulut prendre la fuite, mais il fut capturé et conduit devant Bayezid. Celui-ci lui dit :
« Pourquoi ne voulais-tu accepter la soumission ? » et Karaman répondit : « Parce que
je suis un chef comme toi. » Bayezid se mit en colère et demanda trois fois en criant si
quelqu’un pouvait se rendre maître de Karaman. Ce n’est qu’à la troisième fois que
2 Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 1 p. 148-150.
Page | 650
quelqu’un se présenta, s’empara de Karaman et le mena un peu à l’écart. Alors il le
décapita et revint vers Bayezid qui lui demanda ce qu’il avait fait de Karaman. Ce à
quoi il répondit : « Je l’ai décapité. » Bayezid se mit en colère et exigea que l’on fit à
cet homme exactement ce qu’il avait fait à Karaman. On le conduisit à l’endroit où il
avait été décapité et on lui coupa également la tête. Cela fut ainsi fait, car Bayezid
pensait que personne n’aurait eu l’audace de tuer sur-le-champ un chef aussi puissant,
une fois passée la colère du souverain.
Ensuite le roi ordonna de mettre la tête de Karaman au bout d’une pique et de la
montrer alentour pour que ceux qui étaient restés dans la ville, en apprenant que leur
chef avait été tué, se rendent d’autant plus vite. Enfin il occupa la ville de Konya avec
quelques-uns de ses hommes et se dirigea vers la capitale Laranda. Il fit savoir aux
habitants qu’il arrivait avec son armée et qu’ils devaient se rendre à lui. Au cas où ils
n’obtempéreraient point, ils y seraient contraints par l’épée. Les habitants envoyèrent
les quatre plus importants notables de la ville pour le prier d’épargner les personnes et
les biens. Ils lui firent également la proposition suivante : même si leur maître était
effectivement mort, il y avait encore dans la ville ses deux fils et Bayezid devrait
nommer l’un d’entre eux comme gouverneur. S’il était d’accord, ils lui remettraient la
ville. Bayezid promit de les épargner, eux et leurs biens et, s’il s’emparait de la ville, de
placer comme gouverneur un des fils de Karaman ou l’un des siens. Ils se séparèrent
là-dessus. Mais quand les citadins prirent connaissance de la réponse du roi, ils ne
voulurent pas lui livrer la ville, mais dirent que même si leur chef était mort, il restait
pourtant deux fils sous lesquels ils voulaient vivre ou mourir. Ils se défendirent cinq
jours contre le roi et quand il vit leur résistance, il renforça encore le contingent de
soldats, fit apporter des arquebuses et exécuter des travaux de retranchement.
Quand les fils de Karaman et leur mère [Nefise Melek Hatun] furent avertis de ces
préparatifs, ils firent venir auprès d’eux les meilleurs habitants de la ville et leur
dirent : « Vous voyez bien que nous ne pouvons résister à Bayezid, qui est le plus fort.
Nous serions affligés si vous deviez mourir à cause de nous, ce que nous ne voulons
pas. Aussi sommes-nous tombés d’accord avec notre mère pour nous rendre à sa
merci. » Ce langage plut beaucoup aux habitants. Aussi les fils de Karaman réunirent-
ils autour d’eux leur mère et les notables de la ville, ouvrirent les portes et sortirent. En
s’approchant de l’armée, la mère prit chacun de ses fils par la main et s’avança vers
Bayezid. Quand celui-ci vit sa sœur avec ses fils, il sortit de sa tente et s’avança vers
eux. Ils s’agenouillèrent devant lui, lui baisèrent les pieds, lui demandèrent grâce et lui
remirent les clefs de la ville. Alors le roi ordonna aux notables de se relever. Puis il
entra dans la ville et nomma un de ses seigneurs comme gouverneur. Mais il envoya sa
sœur et ses deux fils à Brousse, sa capitale. »3
3 Schiltberger, Captif des Tatars : 41-44.
Page | 651
2) Ilaldi Hatun, fille de Mehmed Ier
« Sultan Murâd anı işidüp, ne kadar kendüye tâbi’ kâfir leşkeri varısa
bile alup sürüp, Konya’ya çıkup, Karaman-oglı kaçup, Taş’a girüp,
Alâeddîn Çelebi bin Murâd Han babasıyla yüriyüp, Karaman ellerini
yakup, Lârende’yi urdi. Ve bi’l-cümle Konya’yı ve Lârende’yi cemî’
velâyetile harâba virdi. Ol kadar mezâlim oldı kim, fevka’l-hadd
Osmân beglerinden ol vakte dak kimseye zulm itmiş degüldi. Bu
mezâlime Karaman-oglı Ibrâhîm Beg bâ’is oldı.
Ve bi’l-cümle Karaman-oglı’nuñ hatunını, ki Sultân Murâd’uñ kız
karındaşıydı, vezîri Kara Server’ile viribiyüp, eyitdi: “Beni devletlü
sultânumdan dilek idüñ. Ayruk, tevbe-i Rabbenâ bunuñ gibi bir iş dahı
itmiyem’. Bunlar gelüp, hünkâr ayagına düşüp tazarruʽ itdiler.
Hemşîresi hünkâra eyitdi : “Çün gelüp, benüm evimi böyle harâb
idicek, eydüñ, beni buña virüp, niderdiñüz ?” diyüp tazarruʽ idüp,
agladı. Hünkâr terahhum idüp, Kara Server’e eyitdi : “Boynuña alur
mısın ki, ayruk böyle şenâʽât itmiye.” Kara Server eyitdi: “Devletlü
Sultânum! Evvelki hatâsında ben bile degüldüm. Ve hem bu hatâsına
dahı rızâm yoğidı. Hep Turkut-oglanlarınuñ igvâsıyla oldı. Kendü
dahı hatâsına muʽterif olup, ben kuluña eyitdi: “Var, hünkâr inandur,
suçumı afv itsün” didi. Hünkâr dahi Karaman-oglı’nuñ
yaramazlıklarına kalmayup suçını afv idüp, dönüp gitdi. Bu hâdisât
hicretüñ sekiz yüz kırk altısında vâkıʽ oldı. »4
« Sultan Murad se mit aussitôt à l’ouvrage ; il amena avec lui l’ensemble de
sa troupe de soldats infidèles engagés à son service et avança jusqu’à
Konya. Karamanoğlu s’enfuit et entra dans Taş. Alaeddin Çelebi, fils de
Murad Han, marcha sur lui avec son père, mit le feu aux pays de Karaman et
attaqua Larende. Il porta la destruction sur Konya et Larende et sur toute la
principauté. Telle fut l’oppression qu’ils subirent que jusque là nul n’en
avait subi de pareille de la part des Ottomans. Mais c’était bien
Karamanoğlu Ibrahim Bey qui était responsable de ces atrocités.
Karamanoğlu convoqua sa femme, qui était la soeur de Sultan Murad, ainsi
que le vizir Kara Server et leur déclara : “Demandez [mon pardon] à mon
illustre sultan. Par Dieu, à l’avenir, je ne ferai plus jamais rien de pareil !”
Ils vinrent se présenter devant le souverain et tombèrent à ses pieds dans une
prière humble. Sa soeur lui déclara : “Ainsi, vous venez chez moi [sur mon
territoire] pour y semer une telle destruction ; vous l’avez semée ; quel est
votre problème [qui justifie] ce que vous me faites subir ?” supplia-t-elle 4 Neşrî, Cihânnümâ : p. 292-293. Les éléments soulignés correspondent à des ajouts ou des précisions du
texte, tels que fournis par les autres manuscrits disponibles de cette chronique.
Page | 652
humblement et pleura-t-elle. [Le souverain] déclara à Kara Server : “Te
portes-tu garant qu’aucune malice ne soit faite à quiconque ?” Kara Server
répondit : “Mon fortuné sultan ! Au début, je n’étais même pas partie
prenante de cette faute, et je n’étais pas d’accord. Tout est venu des
incitations des Turkutoğlu. Quand [Karamanoğlu] lui-même a confessé sa
faute, il a dit à ton kul que je suis : “Rends-toi auprès du souverain et
convaincs-le de me pardonner ma faute”. Le souverain ne garda pas rancune
de la mauvaise conduite de Karamanoğlu ; il lui pardonna sa faute et se
retira [dans ses terres]. Ceci eut lieu en 846 de l’Hégire [1451]. »
*
« Ibrahimbeg refusa, et la guerre fut déclarée. Sarudjé Pacha entra dans la Karamanie
à la tête de l’armée d’expédition. Mourad parut lui-même bientôt après : les villes de
Begschehri, d’Akschehr et de Koniah tombèrent successivement en son pouvoir.
Ibrahim, effrayé, s’enfuit en Cilicie, d’où il députa au sultan un scheikh des Mevlevi,
chargé de négocier la paix. Mourad, désarmé par ses instances et par les supplications
de sa sœur, mariée à Ibrahimbeg, rendit à ce prince le territoire qu’il venait de
conquérir, et consentit à le laisser en possession de ses Etats : mais il lui imposa pour
condition de rétablir lui-même dans ses domaines le chef des tribus, Torghoud, qu’il en
avait injustement chassé, et d’envoyer son fils au service de la Sublime Porte. »5
*
« Cependant le prince de Karaman, le plus remuant des vassaux du sultan, avait pour la
troisième fois secoué le joug ; après avoir ravagé tout le pays entre Kutahia et Angora,
et depuis Boulawadin jusqu’à Sivrihissar, il prit successivement Akhissar, Akschehr et
Begschehr (la ville des princes). Mourad, laissant à ses généraux le soin de défendre les
frontières de l’empire en Europe contre les tentatives des Hongrois, passa en Asie pour
châtier son vassal : il pénétra dans la Karamanie, et saccagea Iconium, Larenda et
plusieurs autres villes. Mais les nouveaux succès d’Hunyade le rappelant en Europe, il
accorda aux prières de sa sœur, la femme du prince de Karaman, et de Kara Sourouri,
son vizir, le pardon du rebelle. Alaeddin, l’aîné des fils du sultan, qui l’avait
accompagné dans cette campagne, retourna dans ses Etats d’Arménie, et Mourad reprit
lui-même le chemin d’Andrinople. »6
5 Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 2 p. 141.
6 Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 2 p. 147-148.
Page | 653
3) Fatma Hatun, fille de Mehmed Ier
« Lâkin kâfir İzlâdi-derbendi’nüñ içine girüp oturdı. Hünkâr dahı
İzlâdi’ye müteveccih olup, gelüp birkaç gün anda oturup, kış olmagin
ugraşmaga mecâl olmayup, kâfir dahı zebûn olup, hemân bir gice
çekilüp gitdi. Ol hînde beglerbegi Kâsım Paşa’ydı. Kâfir kaçdi diyü
anı küffâruñ ardınca gönderdiler. Kâfirüñ hod bususı varmış, bunları
gâfilin ortaya alup, Halîl Paşa’nuñ karındaşı Mahmûd Çelebi’yi
tutdılar. Ol vakt, Bolu sancagı begiydi. Çünki, Ungurus kaçdi, Vılk-
oglı Rûm-ili beglerine bî-kıyâs ‘atâlar idüp, andan soñra hünkârı
sulha râzı itdiler. Hünkâr Vılk-oglı’na yine ik lîmini virdi, filori
himmetiyle. Ve dahı Vılk-oglı’nuñ iki oglını Tokat habsinden çıkarup,
yine atasına gönderdi. Ammâ gözlerine mîl çekilmişdi. Sultân Murâd
Edirne’ye gelicek kız kardaşı, ki Mahmûd Çelebi’nüñ hatunıydı,
mâtem sûretinde gelüp, hünkâruñ elin öpüp, tazarruʽ idüp Mahmûd
Çelebi’nüñ halâsı çün hünkâra yalvardı, hünkâruñ özi göyünüp,
Mahmud Çelebi’yi satun aldı. Semendire’yi yine kâfire virdi. »7
« Cependant, les infidèles pénétrèrent dans la forteresse (?) qui commandait
le défilé d’Izladi et s’y installèrent. Le souverain [Murad II] se tourna vers
Izladi et, parvenu sur place, il s’y arrêta quelques jours. Il n’était pas
possible de se battre en raison de l’hiver, mais les infidèles étaient épuisés :
une nuit, ils se retirèrent et s’en allèrent. Le gouverneur de la région était
Kasim Pacha. Lorsque [parvint la nouvelle] “Les infidèles ont fui”, on
l’envoya aux trousses des infidèles. C’était une embûche des infidèles dans
laquelle [les troupes ottomanes] tombèrent car ils ignoraient [ce piège]. Le
frère d’Halil Pacha [Candarlızade], Mahmud Çelebi, qui était alors bey du
sancak de Bolu, fut fait prisonnier. Ungurus s’étant enfui, Vilkoğlu fit des
dons immenses aux beys de Roumélie, puis il se résigna au traité de paix
avec le souverain [Murad II]. Celui-ci rendit [le commandement de] sa
région à Vilkoğlu, motivé par [le versement d’une certaine somme de]
florins. Il fit alors sortir de la prison de Tokat les deux fils de Vilkoğlu et les
renvoya auprès de leur père. Mais ils demeurèrent sous sa surveillance.
Tandis que Sultan Murad était en route pour Edirne, sa soeur, qui était la
femme de Mahmud Çelebi, vint [le voir], le visage déformé par le chagrin.
Elle embrassa la main du souverain, le supplia humblement, l’implora au
sujet de l’absence de Mahmud Çelebi. Pris de compassion, le souverain
racheta Mahmud Çelebi : il rendit Semendire aux infidèles. »
7 Neşrî, Cihânnümâ : p. 293-294. Les éléments soulignés correspondent à des ajouts ou précisions
fournis par les autres manuscrits.
Page | 654
*
« Parmi les chefs qui commandaient l’élite de l’armée, on remarquait les begs de Widin
et de Sofia, Alibeg, fils de Timourtasch, Balaban, beg de Tokat, Kasim Pacha,
beglerbeg de Roumélie, et Mahmoud Tschelebi, beg de Boli, gendre de Mourad [II, le
sultan] et frère du grand vizir Khalil. […] Les Turcs furent encore battus, et parmi les
prisonniers qui tombèrent entre les mains des croisés, on cite Kasim, le beglerbeg de
Roumélie, et Mahmoud Tschelebi, le sandjak de Boli, frère du grand vizir et gendre de
Mourad. Hunyade en fit massacrer cent soixante-dix, et ramena les deux begs à Ofen où
il entra en triomphe. […] Fatigué de faire la guerre et obsédé par les supplications de
sa seconde sœur, mariée à Mahmoud Tschelebi, prisonnier des chrétiens, [Murad II]
résolut de terminer la querelle qui désolait le nord-ouest de son empire ; à cet effet, il
restitua la Valachie au voïévode Drakul ; il rendit au despote Brankovic ses deux fils, et
les forteresses de Schehrkoeï, de Krussovaz et de Semendra ; il envoya en même temps
son chancelier, Grec renégat, auprès de Jean Hunyade, qu’il croyait vice-roi de
Hongrie, et auquel les historiens ottomans ont donné ce titre. Le général hongrois
détrompa l’ambassadeur qui s’adressait à lui pour négocier la paix, et le renvoya à la
diète du royaume, assemblée à Szegedin. Vladislas attendit jusqu’à l’entrée du
printemps des troupes auxiliaires, que ses alliés s’étaient engagés à lui fournir pour
continuer la croisade ; mais ne les voyant pas arriver, il céda enfin aux conseils
d’Hunyade et de Brankovich, qui, malgré les insinuations du pape et de l’empereur de
Constantinople, le pressaient d’accepter les propositions de Mourad. La paix fut
conclue et ratifiée à Szegedin, le 12 juillet 1444, pour dix ans et aux conditions
suivantes : la Servie et la Herzegovine seraient restituées à leur ancien maître, George
Brankovich. La Valachie serait réunie à la Hongrie ; le sultan paierait une somme de
soixante-dix mille ducats pour la rançon de Mahmoud Tschelebi, son gendre. »8
8 Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 2 p. 146-147.
Page | 655
4) Selçuk Hatun, fille de Mehmed Ier
« El-kıssa : Bu ahvâli Sultân Bâyezîd’e haber virdiler. Dî’l-hâl erkân-
ı devletile Üsküder’e geçüp, Cem’üñ üzerine yüridi. Selçük Hatun ki,
Sultân Murâd’uñ kızkarındaşıdur ve Sultân Mehemmed’üñ halasıdur,
Şükrullah-oglı Ahmed Çelebi’yile Bursa’dan gelüp, Sultân Bâyezîd’e
buluşup, suâl ve cevâb neyise olup, varup Cem’i Bursa’dan kaldurup,
Yeñi-şehr’e çıkardılar. Dirler ki, ekser Cem’i Yeñi-şehr’e getürmege
bâʽis olan Fenârî-oglı Hasan Çelebi-i merhûm idi. »9
« En bref : On transmit la nouvelle de cet événement [Cem s’empare de
Bursa et se proclame sultan] à Sultan Bayezid. Aussitôt, il passa à Üsküdar
avec les piliers de l’Etat et marcha sur Cem. Selçuk Hatun, qui était une des
sœurs de Sultan Murad et la tante de Sultan Mehmed, sortit de Bursa avec
Şükrullahoğlu Ahmed Çelebi [Mevlana Ayaz, dans un autre manuscrit] et
alla à la rencontre de Sultan Bayezid. Quelle que soit la conversation qu’ils
eurent, lorsqu’ils rentrèrent, ils firent sortir Cem de Bursa et s’en allèrent à
Yenişehir. On raconte que le défunt Fenarioğlu Hasan Çelebi fut la raison
principale à la venue de Cem à Yenişehir. »
9 Neşrî, Cihânnümâ : 372-373. Le surlignage suit les mêmes motifs que ce qui a été évoqué plus haut.
Page | 656
[l. 7] […] vâlid mâ cedleriniñ Selcûk Sult ân nâm
[l. 8] ‘amme-i muh teremesini ki Sult ân Çelebi h az retleriniñ kerîme-i
s ulbiyeleridir ‘ulemânıñ
[l. 9] mu ammer u fuz ulânıñ mü’teberî olan Mevlânâ Ayâs ve Şükrüllah oğlı
Ah med Çelebi
[l. 10] ile risâlet edâsı-içün Âsitâne-i sa`âdete revâna eyledi. Selcûk Sult ân dahi
[l. 11] şeref-i dest-bûs ila ser-firâz olıcak du`â u senâ-i merâsimin edadan-
s oñra
[l. 12] éyitdi ki “Pâdişâhım olmaz mı ki cân beraber olan birâder k ânını
dökmeğe aheng
[l. 13] ve ehl-i islâm araında îk âd-i nâ’îre-i cenk étméyesin. Rûmélî memâlik ile
[l. 14] iktifâ buyurub nât olı vilâyetiniñ eyâletini aña ercânî buyursañız itâ atıñ
[l. 15] ribk asından rak basın herkes ihrâc étmez ve min ba`d râh hilâfa gitmez
idi.
[l. 16] lav kâmat’ül-müşâcarât şacaran lam masmar illâ acaran fehvâsı zamîr-
i münîr pâdişâhîye
[l. 17] lâyih ve iki şâh-ı ‘âlî-câh ‘azm-ı rezm étse re âyâ ah vâli mik dâr olaca ı
[l. 18] ve az h [â]-dır. H us ûs en ol nihâl-i nevres dahi bâ -ı ik bâl ‘osmânîde
perveriş
[l. 19] bulub h adîk a-ı enîk ât-ı nîknâmîde nâmı olmuşdur. Münâza at-ı mülkiye
içün
[l. 20] anuñ gibi vücûdi nâ-bûd étmek lâyik -i mürüvet ü müvâfık -ı fütüvet değil-
dir.
[l. 21] Peygâm-i resûl mesmu`-i sem k abûl olmayub edâyı resâletde mecbûr
olduk ları
[l. 22] cihetden nevâziş-i teşrîf ile mürselleri cânibine irsâl buyurdılar.10
« La vénérable tante paternelle du père du grand-père [de Bayezid II], qui
est une des filles légitimes de Son Altesse Sultan Çelebi, Selcuk Sultane,
s’est rendue au Seuil de la Félicité en compagnie de Mevlana Ayas et de
Şükrüllahoğlu Ahmed Çelebi, qui jouissent d’un savoir [acquis au long]
10
Sadüddin, Tâcü-t-tevârîh : t. 2 p. 10.
Page | 657
d’une longue vie et de l’estime des gens de sciences, afin de réaliser leur
légation.
Après avoir présenté les louanges et prières coutumières d’une façon
distinguée lors de la cérémonie du baise-main sacré, Selçuk Hatun déclara :
“Ô Mon souverain, n’est-il pas possible que vous ne vous disposiez pas à
verser le sang d’un frère dont vous partagez l’âme et que vous n’allumiez
pas la flamme de la guerre au sein de la communauté musulmane ?
Contente-toi de diriger les territoires de Roumélie et accorde-lui la province
du gouvernorat d’Anatolie. [Ainsi] personne ne pliera son cou sous le joug
de la soumission et dorénavant, personne n’ira sur la voie de l’opposition.
Le sens du proverbe “si l’on ne cultive pas bien l’arbre, on ne récoltera que
des embêtements” est évident pour la conscience intérieure resplendissante
du souverain et si deux souverains qui occupent un trône élevé partent en
guerre [l’un contre l’autre], le peuple subira un grand nombre de sacrifices.
Particulièrement, cette jeune pousse d’arbre s’est nourrie dans le jardin de la
prospérité ottoman et a acquis la renommée d’un beau jardin planté d’arbres
de bonne réputation. Il n’est pas conforme à la magnanimité ni convenable à
l’esprit de générosité d’entreprendre la destruction d’un corps comme celui-
ci en raison d’une querelle pour sa possession.” On ne prêta pas l’oreille au
message de l’envoyée et comme ils étaient dans l’obligation d’accomplir
leur tâche de messagers, on renvoya les émissaires auprès de leur
mandataire [= Cem] en leur donnant congé de façon courtoise. »
Page | 658
5) Beyhan Sultane, fille de Selim Ier
« Ferhad Pacha qui, lors de l’expédition de Rhodes, avait cherché à assouvir, dans la
principauté de Soulkadr, sa rapacité et son instinct sanguinaire par l’extermination de
la famille Schehzouwar, avait continué à se montrer plutôt le bourreau que le
gouverneur de la province confiée à ses soins. Ses exactions et l’exécution de plus de six
cent personnes injustement mises à mort criaient vengeance. Süleyman, sur les plaintes
multipliées qui lui arrivèrent d’Asie, rappela Ferhad Pacha ; mais vaincu par les
instances de la sultane mère et de sa sœur épouse du coupable, il lui assigna le
gouvernement de Semendra avec sept cent mille aspres de traitement, dans l’espoir sans
doute qu’un pareil revenu mettrait des bornes à ses concussions, et que le voisinage du
siège du gouvernement lui imposerait une administration plus équitable. Mais rien ne
pouvait corriger la nature originellement mauvaise du Dalmate ; il opprima les
ressortissants de son nouveau gouvernement comme ceux de l’ancien, et appela sur lui
la colère du sultan, qui, dans cette circonstance, donna une nouvelle preuve de ses
sentiments d’inflexible justice, en le faisant exécuter, bien qu’il fût son beau-frère (4
moharrem 931 – 1er novembre 1524). »11
11
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 5 p. 31. Hammer cite, en note, ses sources, dont le rapport
de l’ambassadeur vénitien Piero Bragadino, pour l’année 1526 : « Ferhad bassa fu cugnado del Sgr.,
mediante la moie e la madre sostenuo, ha perso il Ghazali, Alaeddule [Schehzouwar] sua moglie sorella
del Signor belissima donna vestita di negro ».
Page | 659
6) Mihrimah Sultane, fille de Süleyman Ier
[l. 12 p. 440] Vezîr-i sânî Ah med Paşa. Arnâvûdî-ül-âs ıl bir sünh î ü lutfî âlıb-i
[l. 13] s âh ib-i devlet idi. H arem-i muh terem Süleymân Hân’ıdan k apucı
[l. 14] başılık-ıla çıkub baʻde yeñiçeri a ası s oñra Rûm-éli
[l. 15] beglerbegisi olub vezîr-i âʻ am Rüstem Paşa’nıñ Mihr-ü-mâh
[l. 16] Sult ân’dan vucûda gelen ‘ yşe Sult ân nâm düşîre-i gâm-rânî
[l. 17] tezvîc étmekle mah sûd-i ak rân olmuş idi. Ve bir defʻa Rûm-éli’ne
[l. 18] serdâr gönderilmiş idi. Ve lakin kendiden-s oñra yâd olunacak
[l. 19] bir h idmet görmedi. Ve s adr-ı âʻ ama bu ‘âbir serkeşlik sebebile
[l. 20] Piyâle Paşa tak dîm olunub vezîr-i sânî muk âmene iclâs étdirilüb
Page | 660
[l. 21] kendisi vezîr-i sâlis muk âmende k uʻûda riz â vérmemekle
[l. 22] birk aç gün maʻzûl oldı. S oñra ‘usr-ı murâd hânıda vezîr-i âʻ am
[l. 23] olub ve kemâl-ı ‘adl ü ins âf-ıla h areket eyledi. K at ʻâ
[l. 24] bî-günâhıñ ‘azl-ıyla k ânına girmedi. Ve mut lak a irtişâ alub vérmedi.
[l. 25] Emâr-i hezin-i ecel k âtıʻ ser-rişte-i amel olub altıncı ayda terk mih net
[l. 1 p. 441] dünyevî ve vâs ıl saʻâdet uhrevî oldı. Rah met-ül-lah teʻâlà ‘aliye.12
« Le deuxième vizir Ahmed Pacha13
.
Dignitaire le plus souvent prospère et aimable, d’origine albanaise. Il sortit
de l’honorable harem de Süleyman Han avec l’office de kapıcıbaşı, après
quoi il devint aga des janissaires puis gouverneur de Roumélie. Ayant
épousé Ayşe Sultane, la fille de Rüstem Pacha et de Mihrimah Sultane, dans
un état de virginité, il devint l’objet de la jalousie de ses pairs. A une
occasion, il fut envoyé en Roumélie comme commandant de l’armée, mais il
ne rencontra aucune action qui pusse permettre à son nom d’entrer dans les
mémoires. Piyale Pacha prit le pas sur lui aux côtés du grand vizir, contre
toutes les coutumes, et on se mit d’accord pour lui octroyer la place de
deuxième vizir. N’ayant témoigné aucune complaisance au sujet de sa
position de troisième vizir, il [Ahmed Pacha] fut démis de ses fonctions
quelques jours. Puis, à force d’assiduité envers la personne royale, il devint
grand vizir. Il se comporta [à cette charge] avec une grande justice et équité.
Son sang demeura pur de tout pêché ; il ne reçut ni ne donna jamais de pot-
de-vin. Eu égard à la longévité de vie qui lui avait été accordée, son action
fut ainsi interrompue et, six mois plus tard, il quitta le monde de l’affliction
et se rendit dans l’au-delà de la félicité. Que la compassion divine soit sur
lui. »
12
Peçevî, Tarîh-i Peçevî : p. 440-441. 13
Il s’agit d’une présentation des vizirs du règne de Süleyman Ier : cette présentation tient ainsi compte du statut de ce pacha pendant le règne de ce sultan (bien que la suite de sa carrière soit ensuite commentée).
Page | 661
« Bundan esbak Sultân Selim Han zemânında Ahmed Paşa hazretleri
dahi yiğirmi beş gün mikdârı zemân vezâretden ref’ buyurulup, üç yüz
bin akça tekâ’üd ta’yîn buyurulmuş-iken Mihrümâh Sultan hazretleri
şefâ’at eyleyüp, yine vezâret mukarrer buyuruldukda Piyâle Paşa
hazretleri takdîm fermân olunup Ahmed Paşa altına oturmak fermân
olunmışdı, fî sene 997. »14
« Par le passé, sous le règne de Sultan Selim Han, Son Excellence Ahmed Pacha
avait également été destitué du vizirat pour une période de 25 jours. Bien qu’on
lui avait attribué une pension de 3 000 aspres, Sa Majesté Mihrimah Sultane avait
intercédé [en sa faveur] : réinstallé au rang de vizir, Ahmed Pacha avait reçu
l’ordre de se présenter à Son Excellence Piyale Pacha et de s’asseoir en contre-
bas de ce dernier. Ceci eut lieu en 997 [novembre 1588-octobre 1589]. »
*
« Süleyman retint pendant une semaine les conseillers d’Isabelle [reine régente de
Hongrie] dans son camp, et débattit avec eux la question de savoir s’il ne conviendrait
pas d’emmener la reine à Constantinople. De son côté, Isabelle négocia la liberté de ses
conseillers par l’ancien ambassadeur de son père Sigismond auprès de la Porte ; elle
fut appuyée dans ses démarches par Rüstem Pacha, dont elle avait gagné la femme, la
sultane Mihrimah (lune des soleils), par de riches présents. »15
*
« Le drogman [à Istanbul pour négocier la paix entre Ferdinand et Süleyman] présenta
ensuite un mémoire dans lequel on demandait quatre-vingt-dix mille ducats comme
représentant l’arriéré de trois années de tribut, et la restitution de quelques prisonniers
turcs, désignés par la veuve de Rüstem, en échange de l’Espagnol don Alvaro, qu’on
avait mis en liberté à Constantinople. »16
*
« C’est à l’occasion de ces deux [trois] derniers mariages [les filles de Selim, en 1562]
qu’on se dispensa d’offrir à Busbek le dîner de cérémonie usité au départ d’un
ambassadeur ; on prétexta que la fille de Süleyman, veuve de Rüstem, occupée au
mariage de ses nièces, ne permettait à aucun membre de la famille de s’éloigner. Cette
princesse avait combattu autant que Rüstem son époux les prétentions de Selim à la
succession ; mais, en apprenant l’exécution de Bayezid, elle demanda à son père la
permission de se retirer à l’ancien sérail, et elle se réconcilia avec l’héritier présomptif.
14
Selânikî, Tarih-i Selânikî : t. 1 p. 185-186. 15
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 5 p. 167. 16
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 6 p. 81.
Page | 662
Elle engagea ensuite le grand vizir Ali à une grande expédition maritime contre Malte,
et promit d’armer à ses frais quatre cent galères ; mais Süleyman et Selim s’opposèrent
à ce projet pour ne pas priver la jeune mariée de la présence de son époux. Le grand
vizir n’aimait pas le kapitan pacha, à qui il voulait enlever sa place pour la donner à
l’aga des janissaires ; mais Pialé était trop bien établi dans la faveur du Sultan pour
concevoir des craintes sérieuses à cet égard. »17
*
« En outre, sa fille, la pieuse Mihrimah, ne cessait, ainsi que nous l’avons déjà dit, de
lui [Süleyman Ier] représenter la conquête de Malte comme l’une des plus belles et des
plus saintes entreprises contre les Infidèles. »18
*
« Hossuti [envoyé à la Porte par Maximilien pour négocier la paix, en 1566] arriva
avec des présents pour les vizirs et vingt prisonniers affranchis ; de ce nombre était le
vieux tschaousch Kasim, fait prisonnier quelques années auparavant par les soldats du
palatin Thomas Nadasdy, et dont la veuve de Rüstem avait expressément demandé la
mise en liberté. »19
*
« [Exposé des raisons qui poussèrent Süleyman à prendre lui-même la tête de l’armée,
en 1566] D’un autre côté, les représentations de sa fille Mihrimah et du sheikh
Noureddin vinrent le confirmer dans cette résolution : celui-ci lui reprochait d’avoir
trop longtemps négligé les devoirs d’un bon Musulman, en s’abstenant de conduire en
personne les guerres saintes contre les Infidèles. »20
*
« Roostem, by showing himself very eager that I should remain, gave me greater
freedom of action; he naturally realized how much he would promote the outbreak of
hostilities if we all departed and the peace negotiations already begun were broken off.
He was particularly opposed to war at this time with a foreign power, because, being a
man of foresight, he anticipated that, if Soleiman made an expedition into Hungary, his
sons were sure to seize the opportunity for some fresh attempt. He, therefore, summoned
17
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 6 p. 82. Hammer précise en note : « Prandium excusantes, quod Rustemi uxor apparantis nuptiis neptium e fratre Selimo muliebri more sit intenta, nullum cognatorum avocari pateretur ». Rapport de Busbek du 17 août 1562, aux Archives I.R. ; « La moglie di Rustem ha ricercato il Bassa di far, che il signor suo padre la ricevi nel Seraglio e di reconciliarla col Selimo ». Rapport de l’ambassadeur vénitien, aux Archives I.R. ; « S. Selim per sodisfar la figliuola maritata col capitano del mar pensa col Sr. non mandar fuer l’armata, e il Bassa per l’odio portato ad esso capitano dice, che consigliera al Sr. capitano l’aga dei Janiceri. » Rapport de l’ambassadeur vénitien, aux Archives I.R. 18
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 6 p. 103. 19
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 6 p. 110. 20
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 6 p. 111.
Page | 663
us to his house and detailed to my colleagues at great length the arguments which he
wished them to place before the Emperor with a view to the conclusion of peace. He
exhorted me to remain behind and not to abandon the task which I had undertaken, but
to preserve until I had brought it to a successful conclusion. He expressed his
conviction that the Emperor, who had never shown himself averse to peace, would
approve of my remaining at my post. I, on my part, raised objections and refused to
comply as far as I could conveniently and safely do so. My remarks spurred on Roostem
to further efforts and, to prevent my putting an end to all hopes of peace, he insisted that
his master was very eager to lead an army into Hungary, and would have done so long
ago but for the fact that he himself with the support and help of the women (meaning his
wife and his mother-in-law) held him back, to use his own expression, by clinging to the
hem of his raiment. He begged us not to provoke the sleeping lion and irritate him
against us. I, thereupon, became less vehement in my refusal, and said that I would no
longer refuse to remain, were it not that I feared that they would immediately lay the
blame on me if anything occurred against their wishes, though it was not in my power to
prevent this, and would vent their wrath on me. Roostem made me have no fear,
whatever happened, that I should be held responsible; if I would but remain, he would
protect me ‘as though I was his own brother’. »21
*
« 28 Mayıs’ta [1577] onu tersanenin yakınlarında bulunan padişahın hapishanesine
[Zından] götürdüler. Bir süre sonra Auersberg’in uşağı üstü başı yırtılmış ve saçı
uzamış bir halde saygıdeğer efendime geldi. Çünkü aynı hapishanede tutsak olarak
kalan Christoph’un o güne kadar yalan söylemiş olduğu, efendisi de oraya getirilince
ortaya çıktı. Christoph o güne kadar Steier yöresinin soylu bir ailesi olan Burgstahler
soyundan geldiğini ileri sürmüş, oysa Auersberg’in babasının seyisiymiş ve adı
Christoph Baumhauer olup Magdeburg kentindenmiş. Adam bu yalanları ile saygıdeğer
efendimi çok tehlikeli bir duruma sokmuş. Çünkü efendim onun gerçekten Burgstahler
olduğunu sanarak, onun ricası üzerine serbest bırakılması için girişimlerde bulunmuş,
hatta Rüstem Paşa’nın dul eşi olan yaşlı [Mihrimah] Sultanın aracılığı ile padişaha
haber yollamış, Sultan hanımada, paşanın 200 dukaya satın almak istediği bir saat
armağan etmiş. Çok güzel olan bu saat bir arslan şeklindeymiş ve zamanı haber vermek
için çalarken, arslan gözlerini devirip dilini çıkartıyormuş. Paşanın haberi olmadan bu
adamın serbest bırakılması için padişaha ricada bulunması yüzünden paşa kendisine
çok kızmış. Bu adamın kendini asilzade olarak tanıtması, diğer tutsaklar tarafından
itibar görmesine yaramışsa da, bir yandan da onu kötü bir duruma düşürmüş, çünkü
kendi ifadesine gore soylu bir aileden olduğu öğrenilince, kaçmaması için onu zincire
vurmuşlar. Böylece yalancılığı ona kazanç sağlayacağına ziyan getirmis. »22
*
21
Busbecq, Turkish Letters : 60. 22
Gerlach, Türkiye Günlüğü : t. 2 p. 592.
Page | 664
« 18 Ağustos’ta [1577] yeniden kalabalık bir Hıristiyan grubu Divana gidip paşanın
huzuruna çıkmışlar ve Yahudinin öldürülmesi için ısrar etmişler. Paşa, onlara şu yanıtı
vermiş: “Ben o Yahudiye sizin reva gördüğünüzden daha ağır bir ceza vereceğim ve
ona her gün 80 değnek vurduracağım. Böylece her gün ölümü tadacak. Bir yandan da
Yahudiler paşanın evine gidip paşaya ve kazaskere dindaşlarının hayatını
bağışlamaları için binlerce duka vaad etmişler. Ayrıca Rüstem Paşa’nın eşi olan yaşlı
Sultan Hanıma [Mihrimah] ve Mehmed Paşa’nın eşi olan Sultan Hanıma da [Ismihan]
Yahudinin affedilmesini sağlaması için bol miktarda para vaad etmişler. Paşa,
Yahudiye yeniden 70 değnek vurdurduğunda adam birkaç kez baygınlık geçirmiş. Fakat
Hıristiyanlar gene de tatmin olmamışlar ve ısrarla Islami hükmün uygulanmasını ve
öldürülmesi istemişler. Üstelik de Yahudiler onu zindanda zehirlemesinler diye, başında
nöbet tutan yeniçerinin yanına dört Hıristiyan nöbetçinin verilmesini istemişler. »23
*
« Bugün [1577] yemek esnasında tercüman Matthias, Sadrazam [Kara] Ahmed
Paşa’nın nasil boğdurulduğunu anlattı. Vaktiyle Sultan Süleyman, [Şehzade
Mustafa’nın boğdurulmasına sebep olmasından dolayı halkın düşmanlık duyduğu]
Sadrazam Rüstem Paşa’yı azledip yerine Ahmed Paşa’yı atamış; (aslında karısının
[Mihrimah] ve padişahın birlikte yaşamakta olduğu Rus kadınının [Hürrem] etkisi
altında kalarak Şehzade Mustafa’nın boğdurulmasını gerçekten de Rüstem Paşa
tezgâhlamıştır). Ahmed Paşa açıkça, kadınların (Rus kadınını kasdediyordu) egemenliği
altına giremeyeceğini söylerek sadrazam olmayı red etmiş fakat sonunda bu teklifi
kabul etmek zorunda kalmış ve padişah onun boyuna mührünü asmış. Buradaki âdete
göre, sadrazam, padişahın mührünü sırmalı bir kese içinde sürekli boyunda taşır.
Sultan Süleyman Asya yolculuğundan geri döndüğünde, iki saraylı kadın, yani Rüstem
Paşa ile evli olan padişahın kızı ve padişahın yatağını paylaştığı Rus karısı, Ahmed
Paşa’ya iftiralar atarak onu kötülemişler. Bunun üzerine günün birinde tüm vezirler
muted olduğu üzere Divan toplantısında yapılan görüşmeleri padişaha bildirmek üzere
huzura çıktıktan sonra geri dönecekleri zaman, bir ağa Ahmed Paşa’nın yanına
yaklaşmış ve onu kolundan tutarak, padişahın ona henüz gitmeyip orada kalmasını
buyurduğunu söylemiş. Ahmed Paşa o anda başına gelecekleri anlarmış. Diğer vezirler
dışarı çıktıktan sonra, padişah dairesinin kapı aralığında Ahmed Paşa’yı boğup, mührü
boynundan almışlar. »24
23
Gerlach, Türkiye Günlüğü : t. 2 p. 623. 24
Gerlach, Türkiye Günlüğü : t. 2 p. 729.
Page | 665
7) La puissance des sultanes sous le règne de Murad III
« Les princesses du sang, qui, par leur influence, élevèrent leurs maris et leurs favoris
aux plus hautes fonctions de l’empire, et surent, ou les y maintenir, ou, en cas de
déposition, sauver leur vie et leurs biens, étaient alors, […] les trois filles de Selim,
sœurs de Mourad, savoir la veuve de Sokolli, la veuve de Pialé et la femme du grand
vizir Siawousch ; ensuite la vieille sultane Mihrimah, fille de Süleyman le Grand, veuve
de Rüstem Pacha et belle-mère du grand vizir Ahmed Pacha, qui lui avait donné deux
petites-filles. […] Rongées d’ambition malgré leur âge, les veuves de Sokolli et de Pialé
n’eurent pas de repos qu’elles n’eussent convolé en secondes noces. La veuve de Pialé,
qui avait poignardé un jour de sa propre main une de ses esclaves parce qu’elle avait
vu son mari effleuré son cou en passant, épousa le troisième vizir Mohammed Pacha.
Esma, veuve de Sokolli, femme petite et laide, mais d’un esprit actif, après avoir
vainement espéré s’unir Osman Pacha, donna sa main à Kalaïlikof Ali Pacha,
successeur d’Oweïs Pacha dans le gouvernement d’Ofen, homme brave et habile à tous
les exercices de la guerre, mais qui fut universellement méprisé, parce qu’il avait
chassé sa femme et ses enfants, afin de pouvoir devenir l’époux d’une princesse de
sang. Le divorce arracha à sa femme des pleurs, dit Petschewi, qui auraient attendri les
rochers d’Ofen, et des imprécations qui abrégèrent les jours de l’ambitieux ; Ali Pacha
mourut en effet une année après, et fut enseveli sur une colline près d’Ofen. »25
*
« Le fils de Sokolli et celui de Pialé furent nommés, grâce au crédit de leur mère, le
premier vizir, le second sandjakbeg de Klis. »26
*
« Au commencement de son règne, Murad était exclusivement dominé par la Vénitienne
Baffa [Safiyye], et ne partageait son lit avec aucune autre esclave ; mais la mère
[Nurbanu] et la sœur [Ismihan] du Sultan ne tardèrent pas à donner des rivales à la
Vénitienne, et dès lors ce prince se livra avec emportement à son penchant naturel pour
la volupté, au point qu’à l’âge de cinquante ans, il avait été père deux cent fois. »27
*
« Parmi les femmes du séraï, quatre surtout régnèrent sur l’esprit de Mourad : ce fut
d’abord sa mère Nour-Banu (femme de lumière), et sa première épouse Safiyé (la pure),
issue de la noble maison vénitienne des Baffo. Safiyé étant partie dans sa jeunesse de
Venise pour Corfou, dont son père était gouverneur, fut prise chemin faisant par des
25
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 7 p. 73. 26
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 7 p. 73-74. En note, Hammer précise : « La Sultana fo moglie di Piale ora di Mohammedbassa terzo Vezir, ha ottenuto dal Sgr. il Sangiaco di Clissa per il secundo suo figlio con Piale. » Summario delle Relazione venet., dans les Archives I.R. 27
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 7 p. 146.
Page | 666
corsaires turcs et incorporée dans le harem de Mourad. Ce prince fut tellement dominé
par Safiyé, avant comme après son avènement, que, bien qu’il fût d’un tempérament très
voluptueux, il lui resta constamment fidèle. La mère de Mourad et sa sœur la sultane
Esmakhan, mariée au grand vizir Sokolli, craignant de voir absorber tout leur pouvoir
par celui de la Vénitienne, ou voulant augmenter les chances d’une succession régulière
au trône par un plus grand nombre d’enfants, n’eurent pas de repos qu’elles n’eussent
réussi à faire entrer dans le lit du Sultan de nouvelles esclaves ; l’une d’entre elles,
Hongroise de naissance, et plus rusée encore que belle, sut chasser pour un temps la
Vénitienne de l’esprit et de la couche de son maître. »28
*
« Le grand vizir ne se dissimulant pas le danger qui le menaçait, barricada son palais,
et s’enferma dans un cabinet attenant à celui de sa fiancée, la sultane veuve d’Ibrahim
[Ayşe Sultane, fille de Murad III] ; il ne pouvait aller chez elle, parce que les noces
n’avaient pas encore été terminées. »29
*
« Dans l’après-midi du même jour [4 octobre 1603], Hasan était occupé à écrire à la
sultane Validé, lorsque le chambellan Türk Ahmed lui apporta une lettre du sultan qui
lui annonçait sa destitution ; il se rendit immédiatement aux jardins de Südlidjé
appartenant à la sultane son épouse [Ayşe Sultane, fille de Murad III]. A la nouvelle de
la déposition du grand vizir, les janissaires se constituèrent en révolte ouverte ; ils
enfermèrent leur aga dans sa maison, et signifièrent au moufti et aux kadiaskers
d’obtenir la réinstallation de Hasan dans sa dignité, les menaçant, en cas contraire, de
piller et d’incendier leurs maisons. […] La révolte des janissaires fut apaisée par
l’intervention de leur nouvel aga et de leurs officiers. Dix jours après, dix eunuques se
rendirent au palais de Südlidjé, arrachèrent Hasan de l’appartement de la sultane, et
l’étranglèrent dans le jardin de Khanedan Aga. »30
*
« Khalil, d’abord kapitan-pascha, puis kaïmakam, ne conserva ses fonctions que grâce
à sa femme, sœur du sultan [Fatma Sultane, fille de Murad III]. Comme amiral de la
flotte, Khalil fit construire une baschtarde, ou galère impériale, à seize rangs de rame,
composés chacun de huit rameurs, et, d’après le Kanoun institué par Souleïman et
observé par Selim II et Mourad III, il la fit lancer à l’eau en présence du sultan. »31
28
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 7 p. 13-14. Selon ses dires, il se base sur les propos rapportés par Sagredo et Gerlach. 29
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 8 p. 17. 30
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 8 p. 20. 31
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 7 p. 190.
Page | 667
8) Atike Sultane, fille d’Ahmed Ier
« Tâ ki, bu esnâda doğancıbaşılıktan vezâretle çıkan Yusuf Paşa’ya
Ken’an Paşa muhallefesi tike Sultan ki, vâlide-i padişah-ı cihan
hazretlerinin mürebbiyesidir, namzed olup bu hafta nikâh olundukta
meclis-i nikâhda bulunan vüzerâ ve ulemâya hil’atler ve mu’tâd üzre
Surreler verilmek lâzım gelmekle tedârüki Dârüssa’âde agasına
tenbih olundukta, “ne altın vardır ve kürk vardır ki vereyim” deyü
muzâyaka gösterdi. İbrâm u âzar olundukta vâlide hazretlerine
haddinden ziyâde kelâm ve tavrından hâric cevab-ı hasâret-encâm
etmekle azl olunup kânûn üzre Eski-saray Ağası Bayram Ağa
Dârüssa’âde ağası oldu. »32
« A tel point que, pendant ce temps, la veuve de Kenan Pacha, Atike
Sultane, qui avait été la préceptrice de Sa Majesté la Mère du Padichah du
monde, avait reçu comme remplaçant Yusuf Pacha, sorti de l’office de Chef
des falconniers impériaux avec le rang de vizir. La signature du contrat
ayant eu lieu cette semaine, il fallait remettre des robes d’honneur et des
bourses d’argent selon la coutume aux oulémas et aux vizirs qui se
trouvaient présents lors de la réunion à l’occasion du mariage ; ceci ayant
été présenté au Chef des eunuques noirs, il proclama : “je n’ai ni or, ni
fourrure à donner”, révélant ainsi sa détresse. Sur cette insistance et cette
injure, ayant répondu d’une manière immodérée et arrogante à Sa Majesté la
[Reine] Mère, il fut démis [de son poste] et, d’après les règles de loi
sultaniennes, le [Chef des] eunuques du Vieux Palais, Bayram Ağa, devint
le Chef des Eunuques Noirs. [07.1652]»
*
« Les précautions prises par Tarkhoundji, pour s’assurer une administration libre
d’entraves, avaient annoncé au kislaraga Souleïman la fin de sa puissance. […]
Souleïman, humilié de voir ainsi son crédit ruiné, en manifesta grossièrement son dépit
à la sultane Walidé, lorsqu’il refusa pour les noces de la sultane Aatiké (veuve de
Kenaan Pascha) les kaftans et les bourses d’usages, en lui disant : « Je n’ai ni or ni
fourrures ». Il gagna à cette imprudente sortie d’être banni en Egypte et remplacé par
l’aga du vieux sérail. »33
32
İpşirli (éd.), Tarîh-i Na’îmâ: t. 3 p. 1410. 33
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 10 p. 158.
Page | 668
9) Ayşe Sultane, fille d’Ahmed Ier
« Ve ’işe Sultan’ın namzedi olan Haleb Vâlisi İbşir Paşa’yı ihtiyarda
icmâ’ etmişler idi. Ve ’işe Sultan’ın Baş-ağası Mercan Ağa sultan-ı
müşârün-ileyhâ tarafından Dârüssa’âde ağasına ve musâhiblere
hufyeten âmed-şüd edip İbşir Paşa’yı ihtiyar etmek bâbında tervîc ü
ta’rîfe sa’y üzere olduğundan ol tarafa meyl mütehakkık olmuş idi. »34
« Et on convint du choix du gouverneur d’Alep, Ibşir Pacha, qui était marié
à Ayşe Sultane. Le chef des ağa d’Ayşe Sultane, Mercan Ağa, se rendit à
plusieurs reprises auprès du Chef des eunuques noirs et des compagnons du
sultan de la part de la sultane susdite. Grâce aux efforts pour convaincre et
instruire au sujet de la nomination d’Ibşir Pacha, l’inclination en sa faveur
fut réalisée. »
« Çün Haseki Ağa vürûdundan sonra İbşir’in icâleten gelmeyeceği ve
sipah ve umerâya haberler gönderip Konya mecma’ına da’vet eylediği
ve eyâletleri kendi havâdârlarına tevcih sadedinde olduğu mütehakkık
oldu. Mührün ana gönderilmesine bâ’is ü bâdî olan Mercan Ağa ki
’işe Sultan’ın baş-ağası ve cümletü’l-mülkü ve İbşir’in sitâne’de
kapı kethüdâsı şeklinde tarafdarı ve Enderun ağalarıyla taşrada olan
a’yân ve erkân ile ihtilâtı olmakla umûr-ı devlette medhal-i azîm
sâhibi ve Dârüssa’âde ağasına mu’âdil vak’u i’tibâra mâlik tavâşî
idi. İçeri davet olunup padişah hazretleri ve Vâlide Sultan kendiye rû-i
‘itâb ile hitâb edip “Bu ne asıl iştir mühür gönderildikten sonra aşan
tuğyân eylemiş” dedikte Mercan’ın can başına sıçrayıp “Hayır
devletü padişahım, İbşir Paşa lalanız isyan eylemez yine padişahımıza
nâfi’ ba’zı husûs için avk etmiştir. Gelen kimseler mübâlağa edip
muhâlif söylerler, ferman buyurursanız kulunuz varıp getireyim” dedi.
“Var imdi getir” deyü tenbih buyuruldu. Bu ta’ahhüt ile Mercan Ağa
çıkıp yirmi kadar teberdar ve yedekçi ile menzile binip Haleb’e revâne
oldu. İki günden sonra sofa bekçisi dahi gönderildi. Yine der-akab
isti’câl için hatt-ı hümâyûn ile Hazînedar Musâhib Ali Ağa
gönderildi. »35
34
İpşirli (éd.), Tarîh-i Na’îmâ: t. 3 p. 1551. 35
İpşirli (éd.), Tarîh-i Na’îmâ: t. 4 p. 1562.
Page | 669
« Après l’arrivée d’Haseki Aga, on fit parvenir la nouvelle aux sipahis et
aux ümera qu’Ibşir ne viendrait pas immédiatement. Il devint certain qu’il
était invité au rassemblement à Konya et qu’il avait l’intention de se diriger
vers les grands domaines de son gouvernement provincial. A l’origine de
cette décision de lui envoyer le sceau [de l’Etat] était Mercan Aga, başaga
d’Ayşe Sultane, proche du kapı kethudası d’Ibşir stationné à la capitale et en
relation avec les agas de l’Enderun et les dirigeants et notables de
l’extérieur ; cet eunuque bénéficiait des meilleures relations dans les affaires
de l’Etat et d’une réputation d’estime presque aussi étendue que celle du
Chef des Eunuques noirs. Il fut convoqué à l’intérieur [= au Palais, en
séance privée]. Son Altesse le souverain et la Valide Sultane s’adressa à lui
le visage troublé : “Quelle étrange affaire que de se rebeller après avoir reçu
le sceau [de l’Etat] !” lança-t-on au visage de Mercan Aga, qui répondit :
“Non, mon estimable souverain, votre lala Ibşir Pacha n’est aucunement en
révolte. Il a repoussé [sa venue] pour des raisons profitables à notre
souverain. Certains viennent dire le contraire et ils exagèrent la situation. Si
vous en donnez l’ordre, je me rendrai auprès de votre kul et le ramènerai
[ici]”. On lui commanda alors : “Va, ramène-le prestemment”. Mercan Aga
partit avec cet engagement, se mit en route avec une vingtaine de teberdar et
de yedekçi et se rendit à Alep. Deux jours plus tard, on envoya également le
sofa bekçisi. Puis, pour hâter la conclusion de cette affaire, on envoya
encore Hazinedar Musahib Ali Aga, porteur d’un ordre impérial. »
« Firistâden-i Hoca Reyhan Ağa be-istimâlet-i İbşir Paşa. […]
Çavuş-başı Sarı Mahmud vardıkta ısdâr ettirdikleri hatt husûsu içün
dil-gîr olmuş imiş. Azl edip ’işe Sultan Kethüdâsı Ahmed Ağa’yı
nasb etti. »36
« Renvoi de Hoca Reyhan Aga par décision d’İbşir Pacha.
Lorsque le çavuşbaşı Sarı Mahmud arriva, il fut mortifié au sujet de l’ordre
qu’ils avaient émis. Il fut démis de ses fonctions et on nomma [à sa place] le
kethüdâ d’Ayşe Sultane, Ahmed Aga. »
*
« Le parti des chambres intérieures, qui aurait voulu pour grand vizir un dignitaire
sorti des rang des pages, opina pour Ipschir Pascha, à qui la main de la sultane Aïsché
avait été promise ; le chef des pages, l’aga Merdjan, s’efforça de gagner les eunuques à
la cause d’Ipschir par de belles promesses. Le Sultan et la sultane Walidé [Mehmed IV
36
İpşirli (éd.), Tarîh-i Na’îmâ : t. 4 p. 1579.
Page | 670
et Turhan Hadice Sultane] flottaient donc irrésolus entre Ipschir et Mourad. Le grand
vizir [Derwich Mohammed Pascha] ayant appris toutes ces délibérations, et voulant
prévenir la nomination du kapitan Mourad qu’il haïssait, envoya le sceau à
Mohammed, en lui recommandant de le donner à Ipschir. C’est ainsi que le grand
vizirat fut accordé à Ipschir, le plus indigne de tous ceux qui aspiraient à cette haute
dignité. »37
*
« Il destitua le tschaousch baschi et donna sa dignité au kiaya de la sultane Aïsché sa
fiancée ; […]. Ipschir descendit à Scutari au palais de sa fiancée la sultane Aïsché, où
on lui avait préparé un riche festin. Lorsqu’il fut assis, ayant à sa droite le moufti et à
sa gauche le kaïmakam Ahmed [Melek Paşa], il présenta au premier les anciens
rebelles ses compagnons. Le moufti, homme sage, sut dire à chacun d’eux quelque
chose d’agréable, mais à double sens. « La distinction avec laquelle vous traitez ces
faucons impériaux, ces braves compagnons, dit-il à Ipschir, garantit leur vaillance ».
Deux jours après, le grand vizir fit son entrée dans la capitale par la porte
d’Andrinople. […] Le lendemain, il célébra ses noces avec sa fiancée, la sultane
Aïsché. »38
*
« Le kapitain pascha Woïnak Ahmed, étant entré dans le port de Constantinople, par un
temps orageux, perdit, devant Dolmabagdjé, une de ses galères, dont on réussit
cependant à sauver l’équipage. La perte d’une galère en vue de la capitale et sous les
yeux du sultan et de la sultane Walidé, était plus dangereuse, pour les ministres, que
celle de nombreux vaisseaux dans des mers éloignées, parce qu’il était facile, dans ce
cas, de la dissimuler et de l’excuser ; d’un autre côté, le kapitan pascha, époux de la
sultane Aïsché, avait moins à redouter la colère du harem que le grand vizir [Sofi
Mohammed Pascha], qui ne se tenait par aucun lien de parenté à la famille
impériale. »39
37
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 10 p. 176. 38
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 10 p. 180-181. 39
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 10 p. 109.
Page | 671
10) Contacts diplomatiques et usage de cadeaux entre le vice-roi de Naples et les
filles d’Ahmed Ier
« Montalbano [envoyé par le vice-roi de Naples pour traiter de la paix avec l’Espagne]
comptait sur la faveur de trois sœurs du Sultan achetées par des présents et des
promesses et sur l’appui de leurs époux, le grand vizir Hafiz, le kapitan pasha Redjeb,
et Beïram Pasha l’ancien aga des janissaires. [1625] »40
40
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 9 p. 63.
Page | 672
11) Kaya Ismihan Sultane, fille de Murad IV
« Bir kaç gün mukaddem vezîr-i müşârun-iley kendi nâhiye-i
ahvâlinde zaʻf u sukût müşâhede ettikte sadâret sadedinde onlanları
tefrîk kasdın edip cümleden biri Arslan Paşa fevtiyle Bağdad mahlûl
oldukta Kaya Sumtan’ın halîl-i celîli Melek Ahmed Paşa’yı eyâlet-i
Bağdad ile muʻaccelen Üsküdar’a geçirmiş idi. Sultan dahi padişaha
iştikâ edip “Yakında gelmişti, şimdi niçin gider bari bana talâk
versin” dediğine binâ’en Melek Ahmed Paşa’nın Bağdad’a gitmesi
hilâf-ı rızâ-i hümâyûn olmuştu.
Çün üçüncü gün mührü tav’an getirip teslim eyledi. Yanlıs hisâb
Bağdad’dan döner meseli üzre padişah hazretleri Melek Ahmed
Paşa’yı da’vet edip mührü teslim edip sadrıa’zam ettiler. »41
« Quelques jours auparavant, le vizir susdit [Ibşir Pacha] ayant constaté sa
propre faiblesse et décadence dans le domaine de ses affaires, il se
débarrassa intentionnellement de ceux qui lorgnaient sur le grand vizirat ;
c’est à ce moment-là que le glorieux mari de Kaya Sultane, Melek Ahmed
Pacha, passa avec empressement à Üsküdar, [suite à sa récente promotion à
la tête de] la province de Bagdad, dont l’office était vacant avec la mort du
[précédent gouverneur], un certain Arslan Pacha. Mais la sultane s’en
plaignit au souverain : “Il vient juste de rentrer ! S’il y a une raison à son
départ immédiat, qu’on m’accorde alors le divorce !” Suite à cette
déclaration, le départ de Melek Ahmed Pacha fut invalidé par consentement
impérial.
De sorte que le troisième jour qui suivit, on lui apporta le sceau de l’État,
qui lui fut remis. Tandis qu’il revenait de son envoi erroné à Bagdad, le
souverain convoqua Melek Ahmed Pacha à ce sujet et lui remit le sceau de
l’État, faisant de lui son grand vizir. »
« Ezîn-cânib yine sadede rücû edelim. Uruscuk şehrinin zevk [u]
safâsın ederken sitâne-i sa âdet’den Serbevvâbân-ı âlî Bayrâm Ağa
kırk kapucıyla paşaya hatt-ı şerîfler getirüp Kudde Kethüdâ’yı kayd-
bend ile der-i devlete fermân-ı hümâyûn olup Melek Ahmed Paşa
efendimiz “Emir pâdişâhımın” deyüp Kudde Kethüdâ’yı Uruscuk
kal asına haps edüp ol ân mektûblar tahrîr olunup “Hâzır ol Evliyâm,
Kaya Sultân’ıma gidersin” deyüp yüz altun harçlık alup ol ân
mektûbları alup şehir kenarında âlem ağyârdan bî-haber atlarıma
41
İpşirli (éd.), Tarîh-i Na’îmâ : t. 3 p. 1266.
Page | 673
süvâr olup Ruscuk’dan cânib-i kıbleye bir gecede kal a-i Piravadi,
andan bir günde şehr-i Kırkkenîse, andan Topcular’da Kaya Sultân’a
varup bu hakîri hareme alup verâ-yı perde-i zenbûrîden hakîri
söyledüp paşanın Eflâk tarafına ubûr edüp hedâyâlar aldığın ve adl-i
adâletin nakl edüp Kudde Kethüdâ’yı kayd-bend ile kapucubaşı
berberbaşı Bayrâm Ağa mübâşeretiyle Uruscuk kal asında haps
olduğun Kaya Sultân’a bir bir takrîr etdikde Kaya Sultân gırîv yerine
saçın perîşân edüp gûyâ bir husrevânî küpe binüp azrak câdûya
dönüp “Vallahi Evliyâ Çelebi, benim paşamın kethüdâşı uğuruna iki
bin kisem giderse her çi bâd-âbâd ben bunu Siyâvûş Kazağa komam”
deyüp koçusuna binüp doğru Siyâvuş Paşa hâtûnu Receb Paşa
kerîmesi hânıma sultana varup “Tiz kocan çağır gelsin!” dedikde
Siyâvuş Paşa hareme girüp “Safâ geldin sultânım!” dedikde hemân
Kaya Sultân “Bre zâlim Siyâvuş! Efendin Sultân Murâd’ın vâlidesi,
benim büyük vâlidemi şehîd etdin. Kocam her kankı mansıb-ı âlî
alırsa üstünden alırdın. hir mührü dahi alup şimdi kethüdâsın haps
edüp katl etmek mi istersin? Paşam ile akrabâ değil misiz ve babam
Murâd Hân tâbe serâhın sen çukadârı, paşam silâhdârı olup kırk
ellişer yıllık hukûkunuz yok mu? Paşamın kethüdâsin hapisden ıtlâk
eyle. Yoksa ceddim rûhiyçün seni melâmet ederim, bu mühürden
selâmet bulamazsın” deyü gazab ile cevâb verdikde Siyâvuş Paşa
eydür: “Sultânım, senin paşanda pâdişâhın bin kesesi vardır. Kudde
Kethüdâ yediyle alınmışdır. Gelsin, muhâsebesin group yine paşasına
gitsin” deyince “Benim paşam üç bin kise kalemiyye avâ’idin kapu
arası hazînesine koyup edâ-yı deyn edüp bin kîse geçmişi vardır.
Defter-i pâdişâhîye mürâca at olunsun. Fi’l-vâkı ehlimin hazîne-i
pâdişâhîye deyni var ise ben edâ edeyim. Ne istersin benim paşamın
kethüdâsından?” deyüp gazab-âlûd olup andan kalkup vâlide sultana
ve sa âdetlü pâdişâha ve kızlarağası kâtil-i koca vâlide Dîv Süleymân
Ağa’ya varup nice yerlere dahi devr-i ebvâb edüp sarâyına geldi.
Üçüncü gün Kudde Kethüdâ’yı koçu içre kayd-bend ile Silâhdâr
ocağına teslîm edüp haps edüp bin kise taleb etdiklerinde ol gün Kaya
Sultân’ın tahrîkile Siyâvuş Paşa dîvân-ı pâdişâhîye varınca
Kızlarağası Dîv Süleymân Ağa “Ver mührü bre sefîh oğlan!” deyüp
zor-ı bâzû ile mührü Süleymân Ağa Siyâvuş Paşa’dan alup Gürcî
Mehemmed Paşa’ya mührü verüp Gürcî müstakil vezîria`zam olup
Siyâvuş Paşa’yı bostâncıbaşı kayığıyla Akdeniz’e nefy edüp sarâyında
cümle mâl [u] menâlin zabt edüp kendüleri uryân kaldı.
Ba`dehû akîblerince Rûmeli eyâleti ihsân olunup Kudde Kethüdâ bir
habbe vermeden hapisden Gürcî Paşa çıkarup yine paşaya revâne
oldu. »42
42
Evliyâ, Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi : vol. 1 livre 3 p. 187-188.
Page | 674
« Pendant que nous profitions des plaisirs de Rusçuk, un valet en chef du
nom de Bayram Aga, accompagné de quarante chambellans, apporta au
pacha un noble rescrit émanant du Siège de la Félicité et qui réclamait
l’envoi, sous chaînes, de Kudde Kethüda à la Porte. Se conformant au
commandement impérial, Melek Ahmed Pacha confina Kudde dans la
citadelle de Rusçuk et rédigea immédiatement des lettres qu’il me confia en
disant : « Prépare-toi, mon Evliya, tu vas te rendre auprès de ma Kaya
Sultane ». M’étant pourvu de cent pièces d’or pour les frais de voyage, je
pris aussitôt les lettres et, sans nouvelle des autres mondes, à proximité de la
ville, j’enfourchais mes chevaux. De Rusçuk, je partis en direction du sud et
parvins à la citadelle de Piravadi en une nuit, puis en un jour à la ville de
Kırkkenîse, puis je rejoignis Kaya Sultane [qui se trouvait] à Topçular. Elle
me fit aussitôt venir au harem et me questionna, dissimulée derrière le
grillage. Je lui fis le récit en détail de la traversée de la Valachie du pacha,
des cadeaux qu’il avait reçu, de la justice qu’il y avait restaurée, enfin de la
manière dont Kudde Kethüda avait été placé enchaîné dans la citadelle de
Rusçuk par l’intervention du valet en chef et barbier en chef, Bayram Aga.
Après avoir écouté mon récit, plutôt que de se mettre à pleurer, Kaya
Sultane libéra ses cheveux, s’engouffra dans une rage royale et se
transforma presque en sorcière. « Je jure devant Dieu, Evliya Çelebi, que
même si je dois dépenser 2 000 bourses au profit de l’intendant du pacha, ce
qui est fort possible, je ne l’abandonnerai pas aux griffes de Siyavuş ! » Elle
monta dans son carrosse et s’en alla directement chez l’épouse de Siyavuş,
la Hanım Sultane, fille de Receb Pacha. « Dépêche-toi ! Appelle ton
époux ! », dit-elle. Siyavuş Pacha entra dans le harem et lui souhaita la
bienvenue. « Toi, Siyavuş , le tyran ! » cria-t-elle, « Tu as assassiné ma
grand-mère [Kösem Sultane], la mère de ton Seigneur Murad ! Tu as volé
toutes les positions élevées que mon époux avait acquises ! Tu es finalement
parvenu à prendre le sceau [du grand vizirat] et maintenant, tu veux
emprisonner son intendant et le tuer ! N’êtes-vous pas, toi et mon mari, des
parents ? N’étais-tu pas le valet de mon père, le Sultan Murad – que Dieu
accorde le repos à son âme ! – quand il était porteur du sabre ? Ne vous êtes-
vous pas mutuellement souhaité d’attendre les quarante et cinquante ans ?
Libère l’intendant de mon pacha ou, sur l’âme de mon grand-père [Ahmed
Ier], je te maudirai et tu ne tireras aucun plaisir de ce sceau ! » Devant cette
explosion de rage, Siyavuş répondit : « Ma Sultane, ton pacha doit au
souverain 1000 bourses. Elles furent prises par la main de Kudde Kethüda.
Qu’il vienne s’en acquitter et il pourra retourner auprès de son pacha ».
« Mon pacha a déposé 3000 bourses au Trésor de la porte du milieu en
cadeaux de service. Il a payé la dette et s’est même acquitté d’un montant
supplémentaire de 1000 bourses. Contrôle le registre impérial ! Si mon
pacha doit quoi que ce soit au Trésor impérial, je m’en acquitterai. Qu’as-tu
Page | 675
à faire avec l’intendant de mon pacha ? » Toujours en colère, elle sortit et se
rendit auprès de la Reine mère puis de l’auguste souverain lui-même, puis
du chef des eunuques noirs, Div Süleyman Aga, qui avait assassiné
l’ancienne Reine mère. Elle poursuivit encore sa tournée en se rendant dans
quelques autres places avant de s’en retourner dans son palais. Trois jours
plus tard, Kudde Kethüda fut apporté par voiture, les fers aux pieds, au chef
du corps des silahdar, qui l’emprisonna et lui réclama les 1000 bourses.
Cependant que, le même jour, à l’instigation de Kaya Sultane, le monde se
mit à s’effondrer sur la tête de Siyavuş Pacha. À son arrivée au Conseil
impérial, le chef des eunuques noirs, Div Süleyman Aga, lui arracha de
force son sceau, lui criant : « Donne-moi le sceau, stupide garçon ! » et il le
donna à Gürcü Mehmed Pacha, qui devint grand vizir. On envoya en exil en
Méditerranée, sur le caïque du bostancıbaşı, Siyâvuş Pacha, dont on saisit
les richesses et les biens qui se trouvaient dans son palais, de sorte qu’il se
retrouvât sans rien.
A la suite de ça, on l’honora de la province de Roumélie et Gürcü Mehmed
Pacha libéra de prison Kudde Kethüda, qui retourna auprès du pacha sans
avoir déboursé un centime. »
« Tevcîh-i eyâlet-i Mısır be-Eyyub Paşa.
Sâbıkâ zikr olunan Mısır vak’asında ahâlî-i Mısır Der-i Devlete
Dilâver Ağa yediyle arz u mahzarlar gönderip vâlî-i Mısır Maksud
Paşa ile hüsn-i imtizâc edemediklerinden Yusuf köşküne
indirdiklerinin haberi geldikte Sultan Murad merhumun dadısı kocası
Vezîr Eyyub Paşa ki nişancı idi, Mısır eyaletine nasb olundu. Ve
Kâtibü’s-sır Ahmed Ağa içerinden nişancılık ile çıktı ve Mevkûfâtçı
Mehmed Efendi ki Kaya Sultan kethüdâsıdır, sâbikâ Sultan Murad
silahdarının mukarreb u mu’temedi idi. Silahdar Paşa katl olunup
kendisi devlette müte’ayyin adam olmakla bî-kes kalıp ortalığın
ihtilâlini görüp mütemevvil ü âkıl adam olmağın Eyyub Paşa ile
Mısır’a gitmeğe rağbet eyledi.
Bâ’is bu oldu ki, padişah sadrıa’zamı içeri çağırıp “Mısır’ı Eyyub
Lalama verdim” dedikte sadrıa’zam dahi “Güzel olmuş padişahım
ammâ Mevkûfâtçı Mehmed Efendi benimle Mısır’da bile idi, ziyâde
ehl-i vukûfdur. Eğer ol bile giderse iyi olur ve illâ yalnız giderse mâl-ı
mîrî tahsîlinde şâyed futûr u kusûr eyleye” dedikte padişah derhal
devât ve kalem isteyip “Sen ki Mevkûfâtçı Mehmed Efendisin, seni
Eyyub Lalama divân efendisi etmişim bile gidesin” deyü hatt-ı
hümâyûn verdi. Mevkûfâtçı ise eğerçi Mısır’a nev’an rağbet
göstermişti ammâ taraf-ı padişahîden hükm lâhik oldukta tefekkür
edip beher-sâl Kaya Sultan hâsları cizye bahasından ekall mertebe on
beş yük akçeye vâsıl ve mevkûfât mansıbından dahi beş yükden ziyâde
Page | 676
bilcümle beher sâl yirmi yükden ziyâde meblağa nâ’il ve kîsesi
havzasına bu kadar akçe dâhil olurken Darüssaltana’yı terk edip
bilâd-ı ba’îdeye gitmek meşâk gelmeğin Mısır’a rağbetten rücû’ edip
varıp isti’fâ-künân pây-ı hüdâvendigâra yüz sürdükte padişah cebînin
perçin edip “Başın keserim var git mal-ı Mısır’ın hesâbın senden
isterim” deyü buyurmakla icâbet edip gitti. »43
« Attribution de la province d’Egypte à Eyyub Pacha.
Dans les affaires d’Egypte mentionnées précédemment, les habitants
d’Egypte avaient fait parvenir une pétition collective au Siège de l’Etat par
l’intermédiaire de Dilaver Aga. La nouvelle qu’ils avaient fait descendre du
kiosque de Yusuf le gouverneur d’Egypte en raison de leur mésentente
réciproque étant parvenue, l’époux de la nourrice du défunt Sultan Murad,
Vizir Eyyub Pacha, qui était alors nişancı, avait été nommé à la tête de la
province d’Egypte. [A cette occasion], le secrétaire privé Ahmed Aga sortit
de l’intérieur [= du palais ; de l’Enderûn ?] avec le rang de nişancı et
Mevkufatçı Mehmed Efendi, kethüda de Kaya Sultane, fut admis et reçu
comme silahdar du précédent Sultan Murad. En homme déterminé, après
l’assassinat de Silahdar Pacha, ce dernier était [parvenu à] rester en grâce
sans interruption ; il avait vu [de ses yeux] la révolte populaire ; parce qu’il
était un homme intelligent et riche, on lui demanda de partir en Egypte avec
Eyyub Pacha.
Voici qu’elle en fut la raison. Le souverain convoqua le grand vizir et lui
dit : “J’ai donné l’Egypte à mon lala Eyyub”. A son tour, le grand vizir
répondit : “C’est une bonne chose, mon souverain, mais j’avais moi-même à
mes côtés en Egypte Mevkufatçı Mehmed Efendi, qui est en plus un homme
de savoir. Il serait bon que lui aussi y aille. Mais si [Eyyub Pacha] part seul,
fasse qu’il n’y ait pas de défaut et de manque dans la collecte du Trésor
public”. Sur quoi, le souverain réclama aussitôt un stylet et de l’encre et
donna l’ordre impérial suivant : “Toi, Mevkufatçı Mehmed Efendi, pars
avec mon lala Eyyub [en Egypte] : je te fais son secrétaire (officiel)”. Pour
sa part, bien que Mevkufatçı avait manifesté une certaine inclination envers
l’Egypte, le fait que l’ordre lui venait de la part du souverain le fit méditer.
Il recevait chaque année au minimum 500 000 aspres prélevés sur le revenu
de la cizye des has de Kaya Sultane et plus de 500 000 [aspres] pour sa
fonction de mevkufatçı, à quoi s’ajoutait encore plus de 2 000 000 [aspres]
en argent liquide : alors qu’il détenait une si grande richesse, il allait quitter
la capitale. Il revint sur sa décision d’aller en Egypte, ce pays lointain d’où
viennent les problèmes. Il vint et tandis qu’il présentait ses respects au
souverain en soumettant sa démission, le souverain empoigna son front et
43
İpşirli (éd.), Tarîh-i Na’îmâ : t. 3 p. 997 (mars-avril 1644).
Page | 677
déclara : “Alors je te couperai la tête ! Va, je te réclamerai les comptes des
revenus d’Egypte !” Il se plia à cet ordre et partit [en Egypte]. »
*
« L’ancien confident de Mourad IV avait amassé, aux jours de sa faveur, de grandes
richesses ; il s’était même rendu coupable, entre autres méfaits, de la soustraction de
quatre-vingt mille ducats, montant du tribut annuel de l’île de Chypre, qu’il aurait dû
employer à l’entretien de ses troupes. Le grand vizir prit occasion de cette ancienne
infidélité du silihdar Moustafa dans le maniement des deniers publics, pour ordonner
une enquête sur son administration ; l’instruction fut poussée avec vigueur, et les efforts
de Kara Moustafa furent servis indirectement par les intrigues de Mewkoufatdji
Mohammed Efendi, homme d’affaire de la princesse Kia Sultan. Mohammed Efendi
agissait de son côté auprès de la sultane mère pour obtenir le retour de Moustafa, et
faciliter son mariage avec la princesse Kia Sultan, mariage qui avait été projeté par
Mourad IV. L’enquête n’eut pour tout résultat que de faire entrer dans les caisses du
trésor cinquante mille piastres, équivalent de la fortune avouée par le silihdar ; mais le
grand vizir ayant appris, par quelques mots échappés à la sultane Walidé, les projets de
mariage, en prit occasion pour demander au Sultan une sentence de mort contre
Moustafa. Le bostandji baschi d’Andrinople, Sinan Aga fut chargé, conjointement avec
quarante bourreaux, d’exécuter le sanguinaire kattischérif. »44
*
« Lorsque le Sultan apprit la déposition de Makssoud [gouverneur d’Egypte] par les
troupes, il se tourna vers l’époux de la nourrice du sultan Mourad, le vieux vizir Eyoub
Pasha, qui était présent, et lui dit : « Je te donne le gouvernement d’Egypte ». Eyoub
baisa la terre et s’excusa de ne point accepter la faveur du Sultan, en alléguant son
incapacité pour un tel emploi ; Ibrahim répondit : « Ce qui est donné est donné ; va et
agis. » Eyoub dut en conséquence se rendre au Kaire ; mais il ne fut qu’un instrument
entre les mains de son secrétaire et de son kiaya, qui rétablirent tous les impôts abolis
par son prédécesseur. Le kiaya était Mewkoufatdji Mohammed Efendi, procureur de la
sultane Kia, qui avait été fiancée au silihdar récemment exécuté. Le grand vizir n’était
pas fâché d’éloigner ce machinateur d’intrigues, en lui donnant des fonctions auprès du
vizir Eyoub. »45
*
« L’ancien reïs efendi, Mewkoufatdji Mohammed, bien que protégé du khodja Rihan et
quoique s’occupant exclusivement de la traduction du Moulteka, fut exilé à Mitylène,
sous prétexte qu’il faisait intriguer son fils pour le retour de Melek Ahmed Pasha aux
44
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 10 p. 16. 45
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 10 p. 20.
Page | 678
affaires ; Moustafaaga, inspecteur des chambres et intendant de la sultane Kia, dut
pareillement partir pour Magnésie. »46
46
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 10 p. 149.
Page | 679
12) Hadice Sultane, fille de Mehmed IV
« Azl ü nasb-ı Muhâsebe-i Cizye
Gümüşhâne ve Ergani ve Keban ma’âdini emânetinden azl ile tenkîl
ve haps olunan Sadullah Efendi’nin el-yevm üzerinde olan
Muhâsebe-i Cizye mansıbı ref‘ olunup, Hân kapu kethüdâsı ve
Tersâne emîni ve ismetlü Hadîce Sultân kethüdâsı Mehmed
Efendi’ye tevcîh ve Tersâne emâneti mansıbı ile İnce Kara Ali Efendi
tebcîl ve merkûm Sadullah Efendi zimmetinde zuhûr iden mâl-ı
mevfûr mutâlebesiyle Yedikule’de haps ü tezlîl olundu. [H. 1145 =
1732-33]»47
« Destitution et nomination [au poste de responsable] des comptes de la
cizye.
L’officier des Comptes de la cizye, qui était présent le jour de
l’emprisonnement de Sadullah Efendi, qui avait été puni, à guise d’exemple,
par sa destitution de son office de dépositaire du trésor de Gümüşhane,
d’Ergani et de Keban, et emprisonné, fut libéré. On conféra [sa place] à
Mehmed Efendi, kethuda de la chaste Hadice Sultane, kapu kethuda du
souverain et Responsable de l’arsenal. On honora Ince Kara Ali Efendi du
rang d’Officier de l’arsenal. Mais lorsqu’il apparut qu’il avait été au service
du défunt Sadullah Efendi, il fut emprisonné et humilié par sa détention à
Yédikule, et la totalité de ses biens réquisitionnés. »
*
« La place de kaïmakam était occupée par un autre Hasan, surnommé le gendre, époux
de la sultane Khadidja, ancienne fiancée du grand vizir Kara Moustafa ; sa parenté
avec le Sultan lui ouvrit par la suite le chemin du grand vizirat. »48
*
« Le sultan, qui n’ignorait rien de toutes ces particularités, avait offert plusieurs fois
déjà le sceau de l’empire à son gendre Hasan ; mais celui-ci avait toujours refusé. Il
tenait cependant à s’en défaire, sentant bien qu’Ahmed Pacha, qui lui avait été imposé
comme grand vizir par la rébellion, serait toujours prêt à la fomenter par des menées
secrètes pour se maintenir en place. Mais enfin, assailli de suppliques qui demandaient
sa destitution, le sultan envoya le silihdar lui redemander le sceau. Ahmed Pacha, en
entendant cet ordre, fut tellement troublé qu’il ne put même pas défaire le nœud du
47
Subhî, Subhî Tarihi : p. 163. 48
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 13 p. 15.
Page | 680
cordon auquel il était attaché ; il le rendit avec la bourse qui le renfermait. On lui
signifia de se retirer dans sa maison située près de la Souleïmaniyé. Chemin faisant, il
rencontra son successeur, le gendre du sultan, Damad Hasan Pacha, qui l’apostropha
ainsi : « Mon frère pacha, si tu ne cherches pas à cacher tes trésors, tu n’auras rien à
craindre », lui donnant ainsi à entendre adroitement que, dans le cas contraire, il serait
livré à la torture. »49
*
« Damad Hasan Pacha, Grec né en Morée, était ce commandant de Khios qui, sous le
règne de Mohammed avait été retenu prisonnier pendant quelque temps dans
l’appartement du bourreau du sérail, en attendant que son sang coulât en expiation de
la reddition de l’île et de la forteresse de Khios aux Vénitiens. Il n’avait dû son salut
dans cette circonstance et sa nomination au gouvernement d’Azof, qu’à l’intercession
de la princesse, son épouse. Plus tard, il avait été nommé kaïmakam d’Andrinople, d’où
il était passé, en cette qualité, à Constantinople.
Devenu grand vizir, sa première démarche fut de se consulter avec le moufti sur les
moyens à prendre pour le maintien, ou plutôt le rétablissement de l’ordre. Dans cette
entrevue, le moufti, voulant faire sa cour à Damad Hasan, lui insinua qu’il devait sa
dignité à l’opinion publique. Protégé des rebelles, et depuis longtemps habitué à leur
langage, il lui dit : « Mon fils, c’est à la volonté du peuple assemblé que tu dois le
grand vizirat ». Ces paroles prouvèrent suffisamment au grand vizir que le moufti
n’avait pas encore perdu de vue les moyens dont il avait usé pour parvenir à la suprême
dignité législative ; cependant il lui répondit avec une amitié feinte, et, pour le
tranquilliser sur les suites de la parole inconsidérée qui venait de lui échapper, il
l’invita à l’accompagner chez le sultan. « Mais nous n’avons pas été appelés par lui, »
dit le moufti. « Il n’est pas besoin d’une invitation spéciale, » lui répliqua le grand vizir,
voulant ainsi faire connaître à son interlocuteur le degré de pouvoir et son influence
auprès du sultan, de même que celui-ci lui avait fait pressentir sa popularité et la
puissance des rebelles. Le matin même de sa nomination, Damad Hasan assista à la
distribution de la solde des troupes. »50
*
« Il ne lui fut pas aussi facile de donner la place de kizlaraga au trésorier Mohammed ;
il craignait, non sans raison, que, si elle revenait à Souleïman, le premier eunuque de la
Walidé, il ne pût se maintenir longtemps dans la dignité de grand vizir. Il communiqua
son projet au trésorier par l’entremise du nain Hamzaaga : mais Mohammedaga, moins
ambitieux que pusillanime, en fit part à l’eunuque, celui-ci à la Walidé, et cette dernière
au sultan. Ce que Hasan Pacha avait redouté arriva : le sultan éleva Souleïman à la
dignité de kizlaraga. A peine ce dernier fut-il en possession de sa place, qu’il fit jouer
tous les ressorts de son influence sur la Walidé pour hâter en secret la chute du grand
vizir. […] Dès que le grand vizir se fut éloigné pour se rendre au palais de son épouse,
49
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 13 p. 79. 50
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 13 p. 80.
Page | 681
la sultane Khadidjé, le grand chambellan alla le chercher pour lui redemander le sceau
de l’empire. En attendant son retour, le sultan se rendit au koeuschk de Bagdad, où il
voulut investir Kalaïli Ahmed du pouvoir suprême. Personne dans le sérail ni dans la
ville ne soupçonnait le changement projeté. Lorsque le sultan fut entré dans le koeuschk
et que l’on annonça l’approche du grand vizir, tout le monde crut voir arriver Damad
Hasan Pacha, le gendre d’Ahmed, mais tous furent saisis d’étonnement, en voyant
sortir de la chambre du kozbegdji et s’avancer vers le koeuschk, Kalaïli Ahmed Pacha.
Le grand vizir, que sa parenté avec le sultan n’avait pu maintenir à son poste, ni
protéger contre l’influence d’un eunuque, fut relégué avec son épouse la sultane
Khadidjé, à Nicomédie ; toutefois le sultan lui laissa, outre les biens de la couronne que
possédait sa femme, un revenu annuel de trente bourses. »51
*
« L’assemblée décida que le souverain se rendrait immédiatement à Constantinople,
précédé de l’étendard sacré, et suivi des princes et de toute sa cour. Avant de
s’embarquer, le Sultan voulut prendre encore une fois l’avis de sa sœur, la sultane
Khadidjé, qui lui conseilla de retenir auprès de lui tous ses ministres, afin de pouvoir
racheter sa vie en sacrifiant la leur, au cas où les rebelles demanderaient une
satisfaction de ce genre. »52
51
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 13 p. 86. 52
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 14 p. 115.
Page | 682
13) Emine Sultane, fille d’Ahmed III
« Le précédent silihdar, Ali de Tschorli, qu’on était sur le point d’éloigner en lui
donnant le titre de gouverneur de Haleb, obtint, grâce à l’intercession de sa femme et
de la mère du sultan Moustafa, la permission de rester à Constantinople et de prendre
place parmi les vizirs de la coupole. »53
53
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 13 p. 81.
Page | 683
14) Fatma Sultane, fille d’Ahmed III
« L’ambassadeur français, le marquis de Bonnac, fidèle à la promesse qu’il avait faite
au nom de sa cour de rendre la liberté à quatre-vingt prisonniers, en reconnaissance de
la permission de réparer l’église de Jérusalem accordée par la Porte, les emmena à
Constantinople, où la sultane Fatima et son époux, le grand vizir, firent don à chacun
d’eux, la première de douze, le second de huit piastres. »54
54
Hammer, Histoire de l’Empire ottoman : t. 14 p. 19.
Page | 685
ANNEXES E
LES FONDATIONS PIEUSES
1. Le legs pieux de Selçuk Hatun, fille de Mehmed Ier
2. Le legs pieux de Seyyide Hadice Hatun, petite-fille de Mehmed Ier
3. Le legs pieux de Fatma Hatun, fille de Bayezid II
4. Le legs pieux d’Aynişah Sultane, petite-fille de Bayezid II
5. Le legs pieux de Fatma Hanzade Sultane, petite-fille de Bayezid II
6. Le legs pieux de Neslişah Sultane, petite-fille de Bayezid II
7. Le legs pieux de Şah Sultane, fille de Selim Ier
8. Le legs pieux de Hanım Sultane, fille de Selim Ier
9. Le legs pieux de Mihrimah Sultane, fille de Süleyman Ier
10. Le legs pieux d’Ayşe Sultane, petite-fille de Süleyman Ier
11. Le legs pieux d’Ismihan Sultane, fille de Selim II
12. Le legs pieux de Gevherhan Sultane, fille de Selim II
13. Le legs pieux de Fatma Sultane, fille de Selim II
14. Le legs pieux d’Ayşe Sultane, fille de Murad III
15. Le legs pieux d’Atike Sultane, fille d’Ahmed Ier
16. Le legs pieux de Kaya Ismihan Sultane, fille de Murad IV, et de sa fille, Safiyye
Hanım Sultane
17. Le legs pieux d’Emine Sultane, fille de Mustafa II
18. Le legs pieux de Safiyye Sultane, fille de Mustafa II
19. Le legs pieux de Zahide Hanım Sultane, petite-fille de Mustafa II
20. Le legs pieux de Fatma Sultane, fille d’Ahmed III
21. Le legs pieux d’Esma Sultane, fille d’Ahmed III
22. Le legs pieux d’Ayşe Sultane, fille d’Ahmed III
23. Le legs pieux de Saliha Sultane, fille d’Ahmed III
24. Le legs pieux de Zeyneb Sultane, fille d’Ahmed III
Page | 686
Les fiches récapitulatives qui suivent répondent à des mises en forme répétitives qu’il
convient de préciser ici.
La section consacrée à la famille restitue les liens de parenté indiqués ou compréhensibles à
travers l’étude du vakf ; ils sont complétés par les renseignements familiaux que nous
possédons par ailleurs dans la littérature. Les titulatures (d’après les indications fournies dans
les vakfiyye) ont été raccourcies et répondent à la logique suivante :
- H. = Hatun - Ç. = Çelebi Be. = Beyefendi
- Ha. = Hanım - B. = Bey HS. = Hanım Sultane
- P. = Paşa - A. = Aga
Le tableau qui apparaît dans la section consacrée aux aspects financiers récapitule les
informations fournies par les actes de fondation du legs pieux considéré. Il répond à une
logique mixte : la colonne de gauche répond à une répartition des revenus selon leur type ; les
autres colonnes consistent en renseignements relatifs à chaque revenu inscrit. Les revenus
sont répartis en quatre catégories :
- Domanial : kariye ; çiftlik ; mezraʻ ; autre
- Immobilier : menzil ; yalı ; ev ; oda ; hücre ; boutiques et autres (four, …)
- Financier : biens en nature (pour financer la fondation) ; argent liquide (pour l’attribution
de prêts)
- Cas particuliers : jardins (bağ, bahçe, bostan) ; lieux de plaisance (sofa, divanhâne, etc.) ;
palais (saray)
Dans la colonne « quantité », on trouvera le nombre de revenus d’un même type pour la
localisation indiquée ensuite, à droite. La colonne « localisation » fournit les renseignements
relatifs à ce ou ces revenus, selon une succession d’information comme suit : le nom du
village, suivi du (des) nom(s) du district (kaza), puis, entre parenthèses, de la province et du
sancak, lorsque ces données ont été précisées. Par exemple :
- karye - 1 - ?, Manyes/Manias (Anatolie, Hüdavendigar)
doit se lire comme un village, dont le nom ne nous est pas connu, sis dans le kaza de Manyes
ou Manias [dans ce cas, le problème réside dans la lecture du nom], sis dans le sancak de
Hüdavendigar, dépendant de la province d’Anatolie. Note : Ist. signifie Istanbul.
La colonne « coût de location » ne concerne que les revenus de type immobilier et indique les
différentes sommes dont le locateur devra s’acquitter, selon le principe de la double location.
Par exemple, 400 kş + 1 a/jr se lit : 400 kuruş pour le prix muʻaccele (paiement immédiat) et 1
aspre par jour de prix müʻeccele (paiement reporté, versé à échéances régulières selon un
calcul effectué sur une base journalière ou annuelle).
La colonne « valeur » indique, quand les informations étaient disponibles, la valeur du bien
(quand il s’agit de l’immobilier), à partir de son coût d’achat, ou l’évaluation du montant de
ses revenus (quand il s’agit d’un bien domanial), à partir des taxes à prélever dessus.
La colonne « divers » fournit des renseignements disparates, au gré des informations fournies
par les vakfiyye : le nom de la parcelle de terre, indiqué alors entre guillemets ; des précisions
sur l’usage ; ou encore sur la forme architecturale du bâtiment.
Page | 687
LEGS PIEUX DE SELÇUK HATUN
La famille
Les constructions et réalisations architecturales
Selçuk Hatun a entrepris de nombreuses constructions, dont nous n’avons qu’une
connaissance très vague.
Ses vakfiyye attestent néanmoins de façon certaine la construction d’un mescid à Bursa, situé à
proximité du pont Haci Seyfettin.
Les œuvres à caractère religieux
En sus du mescid qu’elle a fait construire et dont elle a pourvu à l’entretien quotidien, elle a
également ordonné la récitation de prières et invocations, pour l’âme de membres de sa
famille (sa mère, trois de ses enfants défunts, Yusuf Çelebi, Ishak Bali et Hafsa Hatun, enfin
elle-même).
On remarquera que toutes les récitations et invocations ordonnées par la fondatrice sont
destinées à des membres de sa famille.
Ibrahim B.
Isfendiyaroğlu Selçuk H.
Seyyide
Hatice H.
Yusuf Ç.* Ishak Bali* Hafsa H.*
Ayşe Ha.* Zeyneb H.* Hundi H.*
Mahdumzade
Fatma H.*
Mahmud B.
Süleyman B.
Mehmed P.
Kameri H. Mehmed Ier
Page | 688
Les œuvres à caractère charitable
Parmi ses actions charitables, notons la création d’un établissement destiné à accueillir les
pauvres et/ou les derviş, où ils pourront non seulement être hébergés, mais également recevoir
de la nourriture : il s’agit, ni plus ni moins, que d’une version antérieure et à plus petite
échelle d’un imaret.
Les œuvres en faveur de la famille
Rentes :
Selçuk Hatun institue des rentes à vie à trois de ses descendantes :
- sa fille née de son mariage avec Ibrahim Bey Isfendiyaroğlu, Seyyide Hatice Hatun,
pour un montant de 15 dirhems par jour
- la fille de celle-ci, Ayşe Hanım, pour un montant de 2 dirhems par jour
- et une femme de son entourage (affranchie ?) Gülşirin binti Abdullah, pour un
montant de 1,5 dirhem par jour.
Charges :
# Vekil : Ø
# Kaimmakam-ı mütevelli : Ø
# Tevliyet (mütevelli) :
Ses descendants, puis Hamid Ağa bin Abdullah et ses propres descendants, puis ses affranchis.
# Nezaret :
Son azad (affranchis ?) Mahmud Ağa ibn Abdullah, puis ses autres azad hommes et leurs
descendants, puis le vali de la région.
# Katib :
Ismail Ağa bin Abdullah
# Cabi :
Ils sont au nombre de trois : Şimerd bin Abdullah puis les affranchis de la fondatrice ; Haci
Ilyas bin Abdullah ; Eşigüldü bin Abdullah.
Notons la différenciation « de genre » que semble avoir opérée la fondatrice : si elle octroie
un revenu sous forme de charge (tevliyet) à ses descendants hommes, elle accorde toutefois
des rentes aux filles. Toutes ne semblent cependant pas y avoir eu droit, sans qu’on ne soit en
mesure de formuler la moindre hypothèse à ce propos.
Par ailleurs, elle précise bien que les azad qui recevront une charge doivent être des hommes ;
les femmes semblent être interdites de ces offices. De nouveau, ce sont elles que l’on retrouve
parmi les rentières (exemple de Gülşirin binti Abdullah).
Page | 689
Les aspects financiers
Type de revenu Quantité Localisation Coût de
location
Valeur Divers
Domanial
- karye - 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- ?, Manyes/Manias
(Anatolie,
Hüdavendigar)
- ?, Ulubad
(Anatolie,
Hüdavendigar)
- ?, Kite
- ?, Mihaliç /
Muhalic (Anatolie,
Hüdavendigar)
- ?, Bursa
- « Kayca » ou
« Kayce »
- « Sasa »
- « Atlaslu »
- « Çemandra »
- « Kılıç »
- çiftlik
- mezraʻ - 2
- 1
- ?, Mihaliç/
Muhalic (Anatolie,
Hüdavendigar)
- Bursa, Soğanlık
- dits « Çoban yeri
- Autre :
Immobilier
- menzil - 1 - Bursa - résidence
personnelle
- yalı
- ev - 1 - Bursa
- oda
- hüccre - 22 - Bursa - dont 1 bâtiment
de 15 cellules
- boutique - 14 - Bursa - dont de peintre
(3), boucher (3),
kelleci (2),
cuisinier (1),
papuşçu (2)
- autre : - 1 four - Bursa - à boulanger
Financier
- biens en nature
- argent liquide
Cas particuliers
- jardins - 3 - Bursa - dits « Kâin
müntesib bahçesi »
et « Haci Ilyas
Bahçesi » (3e non
précisé)
- lieux de
plaisance
- palais
Page | 690
Les sources
VGMA D 608-2 s. 341 sıra 286 : 888 (1483)
VGMA D 608-2 s. 384 sıra 333 : 888 (1483)
VGMA D 581-2 s. 376 sıra 374 : 906 (1500)
VGMA D 581-2 s. 382 sıra 381 : 899 (1493)
VGMA D 581-2 s. 383 sıra 382 : 908 (1502)
Page | 691
LEGS PIEUX DE SEYYIDE HADICE HATUN
La famille
Les constructions et réalisations architecturales
Seyyid Hatice Hatun a ordonné la construction du mausolée de Seyyid Mehmed Buharri, à
Bursa.
Elle est également à l’origine d’une école, dont elle pourvoit à l’entretien, à Bursa, à
proximité du complexe d’Emir Sultan.
Enfin, on apprend qu’elle a ordonné la construction d’un certain nombre de cellules (chiffre
non spécifié) à Bursa, qu’elle a ensuite aliénées pour soutenir les revenus de son legs pieux.
Les œuvres à caractère religieux
En plus de la construction du mausolée de Seyyid Mehmed Buharri à Bursa, qui constitue une
œuvre religieuse à deux niveaux, individuel (démonstration de respect envers un personnage
pieux) et social (organisation d’un lieu de culte populaire), Hatice Hatun a également ordonné
plusieurs autres œuvres à caractère religieux.
Notons tout d’abord la création d’une école (darü’t-talim) à Bursa, qui permet ainsi la
diffusion de l’Islam orthodoxe et l’instruction, dans cette voie, d’un certain nombre d’enfants.
Par ailleurs, elle a surtout ordonné un certain nombre de récitations de prières et invocations,
pour l’âme du prophète et d’Ali, sa mère, deux de ses filles (Zeyneb Hatun et Hundi Hatun) et
une de ses petites-filles (Mahdumzade née de Hundi Hatun).
Ibrahim B.
Isfendiyaroğlu Selçuk H.
Seyyide
Hatice H.
Yusuf Ç.* Ishak Bali* Hafsa H.*
Ayşe Ha.* Zeyneb H.* Hundi H.*
Mahdumzade
Fatma H.*
Mahmud B.
Süleyman B.
Mehmed P.
Kameri H. Mehmed Ier
Page | 692
Les œuvres à caractère charitable
Nous n’avons trouvé aucune œuvre à caractère charitable.
Les œuvres en faveur de la famille
Rentes :
Hatice Hatun n’a accordé qu’une seule rente, à sa fille Fatima Hatun – la seule encore en vie,
semble-t-il. Son montant est cependant considérable, et s’élève à 1500 dirhems (bien que ce
ne soit pas précisé expressément, cette somme semble être annuelle, ce qui équivaut à environ
4 aspres par jour).
Charges :
# Vekil : Ø
# Kaimmakam-ı mütevelli : Ø
# Tevliyet (mütevelli) :
Elle-même, puis son fils Süleyman Bey, puis ses descendants jusqu’à extinction. Viendront
ensuite ses affranchis et leurs propres descendants, puis le choix reviendra au sultan.
# Nezaret :
La charge de nezaret est associée à celle de tevliyet, selon les mêmes prescriptions.
# Katib :
Son azad (affranchi ?) Cağfer bin Abdullah, puis les descendants (hommes) de ses azad.
# Cabi :
Comme collecteurs de taxe, elle a nommé Abdullahoğlu Hacı Yusuf (qui fait partie de ses
azad) et Tavaşi Hamza Ağa bin Abdullah.
Par ailleurs, pour la gestion particulière de deux de ses yoncalık, elle a nommé spécifiquement
deux de ses esclaves, du nom de Uğurlu et Hoşkadem.
Page | 693
Les aspects financiers
Type de revenu Quantité Localisation Coût de
location
Valeur Divers
Domanial
- karye - 1
- 1
- 2
- ?, Amasya
- ?, Simere
- ?, Merzifon
- « Kıte »
- « Buğa »
- « Karacavıran »
et « Akviran »
- çiftlik
- mezraʻ - 1
- 1
- ?, Yenişehir
- ?, Kine, près du village
Göbek
- dit « Dikilitaş »
- dit « Çolakcı
Ömer »
- autre :
Immobilier
- menzil
- yalı
- ev
- oda
- hüccre - 20 - Bursa
- boutique - 7
- plusieurs
- Bursa
- Bursa
- dont peintre (4)
- de başçı, sa
construction
- autre : - 6
luzernières
- Bursa
Financier
- biens en nature
- argent liquide
Cas particuliers
- jardins
- lieux de
plaisance
- palais
Les sources
VGMA D 608-2 s. 341 sıra 286 : 888 (1483)
VGMA D 608-2 s. 384 sıra 333 : 888 (1483)
VGMA D 581-2 s. 376 sıra 374 : 906 (1500)
VGMA D 581-2 s. 382 sıra 381 : 899 (1493)
VGMA D 581-2 s. 383 sıra 382 : 908 (1502)
Page | 694
LEGS PIEUX DE FATMA HATUN
La famille
Les constructions et réalisations architecturales
Aucune connue.
Les œuvres à caractère religieux
Le legs pieux connu de cette princesse consiste uniquement en la récitation de prières
pour l’âme de sa mère, Nigar Hatun, dans la zaviye du şeyh Abdi bin Eşref, à Iznik, ainsi que
dans la contribution partielle au financement de la susdite zaviye.
Les œuvres à caractère charitable
Aucune connue.
Les œuvres en faveur de la famille
Charges :
# Vekil :
Cevher Ağa bin Abdusselam.
# Tevliyet :
La fille de Şeyh Abdi, fondateur ou exerçant dans la zaviye où ont lieu les récitations de
prières.
Fatma
Nigar Hatun BAYEZID II
Page | 695
Les aspects financiers
Type de
revenu
Nombre Localisation Coût de
location
Valeur Divers
Domanial
- karye - 2 - Tana et Tarza, kaza de
Borlu
- çiftlik
- mezraʻ
- autre :
Immobilier
- menzil
- yalı
- ev
- oda
- hüccre
- boutique
- autre :
Financier
- biens en
nature
- argent liquide
Cas particuliers
- jardins
- lieux de
plaisance
- palais
Les sources
VGMA D 581 n° 428 : 915 (1509).
Page | 696
LEGS PIEUX D’AYNIŞAH SULTANE
La famille
Les constructions et réalisations architecturales
Aucune construction n’est attestée dans sa vakfiyye. Cependant, il est fait référence à
un autre acte de fondation, antérieur, que nous n’avons pas retrouvé (soit qu’il ait disparu, soit
qu’il soit conservé ailleurs), et dont on ne sait quel en était l’objet.
Les œuvres à caractère religieux
Aynişah Sultane a ordonné la récitation de prières, pour son âme, celles du prophète,
de sa famille et de ses compagnons, enfin pour Dieu.
Les œuvres à caractère charitable
Rien de mentionné.
Les œuvres en faveur de la famille
Rentes :
Aynişah Sultane a prévu deux rentes, destinées à deux de ses « azadlı », des esclaves
affranchis :
- Şevki, auquel elle destine 2 dirhems par jour de départ, puis 4 après mariage.
- Mihrivefa, qui se voit accordé une rente de 2 dirhems par jour.
La différence entre les deux semble tenir au sexe respectif des deux affranchis. La princesse
semble avoir pris en considération la nécessité de pourvoir aux besoins d’une famille dans le
cas de Şevki, un homme, dès lors qu’il sera marié. Mihrivefa, au contraire, en tant que femme,
n’a pas cette responsabilité, puisque son entretien serait à la charge de son époux, si elle
venait à se marier. Cette précision laisse entendre que cet argent avait pour but d’aider, dans
Abdullah
Aynişah
BAYEZID II
Page | 697
une très large mesure, leurs bénéficiaires à subvenir à leurs besoins, et ne doit donc pas être
vu comme une gratification purement désintéressée.
Charges :
# Mütevelli :
Il s’agit de Sünbül Ağa ibn Abdurrahman Ağa.
# Cabi :
Deux collecteurs de taxe sont mentionnés, Yunus fils d’Abdullah et Hasan fils d’Abdullah.
Page | 698
Les aspects financiers
Type de
revenu
Quantité Localisation Coût de
location
Valeur Divers
Domanial
- karye
- çiftlik
- mezraʻ
- autre :
Immobilier
- menzil - 1 - Bursa - 200 fiuri
(muaccele ?) +
4 000 dirhem
(müeccele)
- yalı
- ev
- oda
- hüccre
- boutique
- autre :
Financier
- biens en
nature
- argent liquide
Cas particuliers
- jardins
- lieux de
plaisance
- palais
Ici, seuls des financements de nature commerciale apparaissent. Les renseignements
concernant les revenus antérieurs, non précisés, semblent être également de même nature.
Les sources
VGMA D 609 n° 91 : 947 (1540)
Page | 699
LEGS PIEUX DE FATMA « HANZADE »
SULTANE
La famille
Les constructions et réalisations architecturales
En 1532, Fatma Sultane fait construire une medrese comprenant 14 cellules et 1 salle
de cours à Bursa, au lieu-dit Musa Baba, à laquelle s’ajoute un mektep, construit à côté.
En 1537, il est encore fait mention de la construction d’un hamam à Bursa, dit
Kükürtlü1 avec toutes ses dépendances. Par ailleurs, on découvre l’existence d’un mescid,
fondé auparavant par Fatma Hanzade Sultane à Bursa, à proximité du hamam dit ‘Çekirğe
hamamı’, mais la date de fondation n’est pas connue et l’on ne dispose d’aucun autre
renseignement à son propos.
En 1543, il est question d’une mosquée construite par Fatma Sultane, dans le village
de Kurşunlu (kaza d’Inegöl).
1 Il s’agirait du même hamam que celui dit Kaplıca, à Bursa, les deux noms étant attestés pour le même
bâtiment.
Mahmud
Hatice H.
BAYEZID II
Fatma
Hanzade
y Kasım B. Mustafa B.
Musa B. Orhan B. Emir B. Şehzade Mehmed B.
Des enfants
Page | 700
Les œuvres à caractère religieux
En 1532, Fatma Sultane ordonne la récitation de prières pour l’âme de deux
personnes :
- elle-même
- son fils décédé, Mustafa Bey, dans son türbe à Eyüp.
En 1526, elle ordonne de nouvelles récitations de prières, pour d’autres noms, que
ceux précédemment. Les nouveaux venus sont :
- le Prophète et sa famille
- son fils Kasım Bey bin Mehmet Bey
- sa petite-fille Hatice Hatun, née de son fils défunt Mustafa Bey
- ses deux parents, sans précision du nom de la mère (à moins qu’il faille comprendre que
son nom soit Babasile, comme le laisse entendre la translittération)2
- ses frères et sœurs : Musa Bey, Orhan Bey, Emir Bey et Şehzade Hatun.
En 1537, elle ajoute une nouvelle personne à la liste des bénéficiaires de ses prières :
- Mevlana Şeyh Muhiddin bin Mevlana Behauddin, le müderris de la medrese qu’elle a
fait construire quelques années plus tôt
Les œuvres à caractère charitable
Rien de mentionné.
Les œuvres en faveur de la famille
Rentes :
Seule une rente a été prévue par la fondatrice, destinée à sa petite-fille, Hatice Hatun, née de
Mustafa Bey, pour un montant de 5 dirhems par jour.
Charges :
# Vekil :
- 1532 : Sururi Çelebi bin Şaban, qui cumule cette charge avec celle de müderris de la
medrese de Pir Mehmed Paşa à Istanbul
- 1536 : Mevlana Çelebi bin Ibrahim
- 1537 : Mevlana Muhiddin bin Mevlana Şeyh Turgud
# Mütevelli :
- 1532 : Kasım Bey fils de Mehmed Bey (son fils)
- 1536 : non précisé
- 1537 : Mehmed Çelebi fils de Bali Sarıoğlu
2 La translittération est rédigée de la sorte : « ve üç cüz’ün tilavet sevabını vâkıfenin Babasile anasının
ruhlarına ». Son auteur semble donc avoir compris que Babasile correspondait au nom de la mère, d’où la
présence d’une majuscule. Cela me semble une mésinterprétation du document, qui peut se comprendre
également comme babası-yla anası, donc son père et sa mère. Cette interprétation me semble plus correcte,
dans la mesure où un tel nom serait plus que surprenant, s’agissant d’une concubine de la fin du 15e siècle, - la
préférence allait en faveur des noms de fleurs ou d’oiseaux.
Page | 701
# Tevliyet (mütevelli) :
- 1532 : elle-même puis les descendants de son fils défunt Mustafa Bey, puis ses affranchis,
puis choix du sultan
- 1536 : elle-même, puis son fils Kasım Bey et ses descendants, puis sa sœur Şehzade, puis
ses affranchis et leurs descendants, puis choix du sultan
- 1537 : idem
# Nezaret :
En 1532, deux nezaret distincts sont mentionnés : l’un général au vakf, l’autre spécifique à la
medrese (et peut-être également au mektep). Pour ce dernier, il s’agit du müderris de la
medrese, poste alors occupé par Mevlana Şeyh Muhiddin (mahdumu Mevlana Lutfullah
Çelebi), fils de Mevlana Bahaüddin. Pour celui général au vakf, la charge est donnée au cadi
de Bursa (où sont localisés les fondations et les revenus).
Page | 702
Les aspects financiers
Type de revenu Nombre Localisation Coût de
location
Valeur Divers
Domanial
- karye - 1 - Ayaturdu (kaza de
Vize)
- bien tasarruf + 2 moulins dits
Samkav
değirmenleri
- çiftlik
- mezraʻ - 2 Kurşunlu (kaza
d’Inegöl)
Dont 1 dit
Karacakaya
- autre :
Immobilier
- menzil
- yalı
- ev
- oda
- hüccre
- boutique - 10 - Bursa
(Alacamescit)
- autre :
> hammam :
> moulins :
> four
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 3
- 2
- 2 dits
Vekne
- Bursa (Musa Baba)
- Bursa, dit Kükürtlü
ou Kaplıca
- Çalce (kaza de
Yalakabad)
- Çelmik (kaza
d’Edirne)
- Karavize (kaza de
Vize)
- Kurşunlu (kaza
d’Inegöl)
- Istanbul
(Atmeydanı ;
Hüseyin Ağa camii)
- localisation
incertaine
- Hammam double
- pour femme ; sa
construction
- + l’esclave qui y
travaille pour le
premier
- + terrain vacant
Les sources
VGMA D 584 n° 71 : 939 (1532).
VGMA D 584 n° 74 : 943 (1536).
VGMA D 584 n° 75 : 944 (1537).
VGMA D 584 n° 72 : 950 (1543).
Page | 703
LEGS PIEUX DE NESLIŞAH SULTANE
La famille
Les constructions et réalisations architecturales
Les constructions de Neslişah Sultane sont assez bien identifiées, et semblent être
toutes parvenues jusqu’à nous.
La plus connue est certainement le petit complexe qu’elle a fondé à Istanbul, dans les
environs de la Porte d’Edirne, constitué d’un mescid (transformé plus tard, semble-t-il, en
mosquée) et d’une zaviyye.
A cela, s’ajoute la construction d’un menzil à Eyüp, destiné à servir de lieu de
résidence à certains membres du personnel de son complexe (imam ou muezzin).
Les œuvres à caractère religieux
Parmi les œuvres à caractère religieux fondées par Neslişah Sultane, il convient de
noter, avant tout, la création et l’entretien d’un petit complexe à Istanbul, dans les environs
d’Edirnekapı, comprenant un mescid, transformé par la suite, sur demande de la princesse, en
mosquée, et une zaviyye.
Par ailleurs, elle a également ordonné la récitation de prières, pour l’âme du prophète,
pour celle d’une personne de sa famille, sans que le lien de parenté soit clairement précisé
(Hüma Hatun), pour quatre autres personnes dont le lien avec elle-même n’est pas spécifié
(Cansefer Hatun, Dilaram Hatun, Semensima Hatun et Davud Bey), enfin pour elle-même. Il
est très probable que les dames mentionnées soient des membres de sa maisonnée.
Gevherimülûk S.
Neslişah S.
Dukakinzade
Mehmed B. > P.
Bayezid II
Iskender B.
Dukakinzade
Ahmed P.
Page | 704
Les œuvres à caractère charitable
Parmi les œuvres charitables, il faut mentionner sa zaviyye à Istanbul (quartier
d’Edirnekapı) : ses vakfiyye stipulent qu’elle a été pourvue d’une cuisine pour les hôtes ainsi
que d’un garde-manger pour les pauvres, lesquels bénéficieront de distributions de nourriture,
à l’occasion des jours saints. Ainsi, cette zaviyye fonctionne également comme un imaret.
Les œuvres en faveur de la famille
Rentes :
Neslişah Sultane ne semble avoir accordé qu’une seule rente, de 3 dirhems par jour, à un
certain Mercan Ağa bin Abdullah, dont on ignore quel fut son lien avec sa bienfaitrice.
Charges :
# Vekil :
Iskender Bey ibn Abdurrahman (également chargé du nezaret, pour la vakfiyye de 1553)
# Kaimmakam-ı mütevelli :
Mevlanâ Ibrahim bin Hamza (1542) > Mevlana Muhiddin bin Seyfullah (1544) > Hüseyin bin
Mehmed (1553)
# Tevliyet (mütevelli) :
Elle-même, puis ses cariye affranchies, puis leurs descendants.
# Nezaret :
Iskender Bey ibn Abdurrahman, également vekil (à partir de 1553)
# Katib : Ø
# Cabi : Ø
Il semblerait que Neslişah n’ait pas eu d’enfants : aucun n’est mentionné dans ses diverses
vakfiyye, et les charges sont toutes accordées à ses esclaves / affranchis.
Ainsi, elle précise que son menzil, son lieu de résidence (qu’elle a aliéné) deviendra celui de
ses cariye affranchies, veuves et pauvres, avant d’être loué.
Page | 705
Les aspects financiers
Type de revenu Quantité Localisation Coût de
location
Valeur Divers
Domanial
- karye
- çiftlik
- mezraʻ
- Autre : - animaux et
voitures
- 180 000 dirhem
d’argent
Immobilier
- menzil - 1
- 5
- Eyüp, Kasım Paşa
- Ist. : Neslişah
Sultan (2) + Saruca
Paşa + Mevlana
Gurani Hani +
Kürcübaşı
- résidence
personnelle
- dont 1
résidence de
l’imam
- yalı
- ev - 2
- 1
- Ist., Neslişah
Sultan
- Eyüp, village
Reus (Bergus ?)
- résidences
des muezzins
- oda
- hüccre
- boutique - 1 - Ist. Edirnekapı,
Neslişah Sultan
Camii
- de boulanger
- autre :
Financier
- biens en nature 220 000
dirhem
d’argent
- argent liquide 21 000
dirhem
d’argent
Cas particuliers
- jardins - 4 - Ist., Neslişah
Sultan
avec
dépendances
et annexes
- lieux de
plaisance
- palais
Les sources
VGMA D 574 s. 71 sıra 35 : 949 (1542)
VGMA D 574 s. 73 sıra 36 : 951 (1544)
VGMA D 574 s. 74 sıra 37 : 961 (1553)
Page | 706
LEGS PIEUX DE ŞAH SULTANE
La famille
Les constructions et réalisations architecturales
La vakfiyye de 1569 semble résumer l’ensemble des œuvres pieuses de la princesse Şah (Şahi)
Sultane. Voici la liste de ses constructions, toutes dans et hors des remparts d’Istanbul :
- à Eyüp, une mosquée, une zaviyye et un mekteb
- à Yenikapı, sur le complexe dit Şeyh Merkez Efendi, la mosquée et la zaviyye
- à Davud Paşa, une mosquée, une medrese, une muallimhane et une darül-hadis.
Soit au total, trois mosquées, deux couvents et trois écoles d’enseignements différents.
Elle est également à l’origine de la construction d’un certain nombre de bâtiments faits vakf,
adossés aux revenus de sa fondation, entre autre la cuisine, le four, 11 pièces et 1 boutique
d’un menzil à Istanbul, 4 boutiques dans le quartier de Yenibahçe.
Şah S.
Fatima H.
Neslihan S.
Vasfihan S.
Ismihan S. (Habsi ?) Hüseyin P.
Ahmed B. Mustafa B.
SELIM Ier
Page | 707
Les œuvres à caractère religieux
Hormis la construction et le financement de ces trois complexes, Şah Sultane n’a
ordonné que peu d’œuvres religieuses, au vu de l’importance de ses œuvres architecturales.
Elle prévoit, cependant, la récitation de prières pour plusieurs personnes, sur deux de ses
complexes :
# à Eyüp, pour
- elle-même
- ses parents
- Neslihan Sultane
chacun dans son türbe respectif, construit à proximité de sa mosquée.
# à Yenikapı, pour
- le Prophète
- le şeyh Merkez Efendi
dans le türbe de celui-ci (un des éléments du ce complexe qu’elle n’a pas fait construire elle-
même).
Par ailleurs, elle prévoit également le financement du personnel indispensable pour
une mosquée (qui n’est pas de son fait) à Gelibolu, dite Yazıcızade.
Les œuvres à caractère charitable
Aucune œuvre de ce type n’est précisée dans sa vakfiyye.
Page | 708
Les œuvres en faveur de la famille
Rentes :
Şah Sultane prévoit un grand nombre de rentes, destinées, très nettement, à des membres qui
lui étaient proches. On trouve ainsi, parmi les personnes de sa maisonnée, les rentes
suivantes bénéficiant :
- à sa fille Ismihan Sultane (et ses descendants), pour un montant de 50 aspres par jour
- à une de ses affranchies, Belkıs (et ses descendants), pour un montant de 20 aspres par
jour
- à une affranchie de son père, Nazperver Hatun, épouse de l’ancien şeyh de Medine,
pour une somme de 3 aspres par jour
- à la nourrice de sa petite-fille Vasfihan Sultane, Hasna Hatun, pour un montant de 2
aspres par jour.
A ces rentes s’ajoutent les parts d’héritage réparties entre sa petite-fille et la demi-sœur de
celle-ci (sur le tiers de l’héritage ouvert aux héritiers) :
- 7 000 filori à sa petite-fille Vasfihan Sultane
- 1 000 filori à la demi-sœur de celle-ci, Fatima Hatun.
Mais Şah Sultane constitue également des rentes individuelles à un certain nombre de
personnes gravitant dans son entourage, faisant partie de sa clientèle :
- à la fille du Şeyh Merkez Efendi, Ümmi Hatun, pour un montant de 2 aspres par jour
- à la fille du Şeyh Ahmed Efendi, Selime Hatun, pour un même montant
-
Charges :
# Vekil :
Recep Efendi ibn Hüseyin, qui fait partie de ses serviteurs, est nommé pour être son vekil.
(Il est encore question d’un second vekil, pour le vakf de sa fille, de sa petite-fille et de Fatima
Hatun semble-t-il : Seydi Efendi ibn Hüsnü ou Hasan, qui exerce la fonction de müderris.)
# Mütevelli :
Son mütevelli est Mehmed Çelebi bin Ali, tandis que celui prévu pour le vakf des trois filles
susdites est Mustafa Bey ibn Abdullah.
# Tevliyet :
Elle-même puis ses descendants, puis ses affranchis et leurs descendants.
Page | 709
Les aspects financiers
Type de
revenu
Quantité Localisation Coût de
location
Valeur Divers
Domanial
- karye - 12 Kaza de Dimetoka
- çiftlik
- mezraʻ
- autre :
Immobilier
- menzil - 1
- 1
- 1
- 1
- 2
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- Ist. (Hakim Çelebi)
- Ist. (Mimar Kemal)
- Ist. (Haci Ilyas)
- Ist. (env. Ayakapısı)
- Ist. (Karabaş, ext. Balat
kapısı)
- Galata (Lonca)
- Galata (Gülbar)
- Ist. (ext. Ayakapısı)
- Ist. (Eyüp kapısı)
- Ist. (Sarı Haddat)
- Ist. (Ekserci Şüca, ext.
Eyüp kapısı)
- 2000 fil.
- 62 000 a.
- 42 000 et
46 000 a.
- 80 000 a.
- 70 000 a.
- 30 000 a.
- 10 240 a.
- 96 000 a.
- 80 000 a.
- achat commun avec
Fatima Hatun
- + 1 boutique
- yalı
- ev - 1 - Ist. (quartier des Juifs)
- oda - 18 - Ist. (Mahmut Çelebi) - 1000 fil.
- hüccre
- boutique - 2
- 2
- 4
- Ist. (Yenibahçe)
- Ist. (quartier des Juifs)
- Ist. (Yenibahçe)
- 25 700 a.
- sa construction ; sur
terrain vakf : 10 a/an
de mukata’a
- autre :
> hamam
- 1
- 1
- Ist. (Yenibahçe)
- Eyüp
- double
Financier
- biens en
nature
- argent liquide
Cas particuliers
- jardins - 1 - Ist. (Hıdır Ilyas,
Eğrikapı)
- 15 000 a. - avec commodités
- lieux de
plaisance
- 1 - Ist. (Hıdır Ilyas,
Eğrikapı)
- 15 000 a. - avec commodités
- palais
Les sources
VGMA D 1993 n° 7 : 977 (1569)
Page | 710
LEGS PIEUX DE HANIM SULTANE
La famille
Les constructions et réalisations architecturales
Ces deux documents portent à notre connaissance l’existence d’une mosquée
construite par cette princesse, dite ‘Sultan camii’, et située à Istanbul dans le quartier Koğacı
Dede, à proximité d’Aksaray.
Les œuvres à caractère religieux
Rien de connu.
Les œuvres à caractère charitable
Rien de connu.
Les œuvres en faveur de la famille
Charges :
# Mütevelli :
Ahmed Efendi ibn Ömer.
SELIM Ier
Hanım
(Hadice ?) S.
Page | 711
Les aspects financiers
Type de
revenu
Quantité Localisation Coût de
location
Valeur Divers
Domanial
- karye
- çiftlik
- mezraʻ
- autre :
Immobilier
- menzil
- yalı
- ev
- oda
- hüccre
- boutique
- autre :
Financier
- biens en
nature
- argent liquide
Cas particuliers
- jardins
- lieux de
plaisance
- palais
Les sources
VGMA D 776 n° 191 : 1170 (1756)
VGMA D 776 n° 193 : 1190 (1776)
Page | 712
LEGS PIEUX DE MIHRIMAH SULTANE
La famille
Les constructions et réalisations architecturales
Mihrimah Sultane fut la plus active des princesses ottomanes en termes de réalisations
architecturales. Nonobstant un nombre considérable de fondations à Istanbul, il convient de
noter leur localisation géographique, leur dimension et finesse architecturale, expression
d’une nette volonté de s’afficher au plus haut de la scène publique.
Sa première grande réalisation est le complexe fondé à Üsküdar, au niveau de
l’embarcadère (soit à l’entrée orientale d’Istanbul). D’après la description fournie en 1549,
celui-ci regroupe une mosquée, une medrese, un imaret et un han. Cependant, la vakfiyye de
1558 indique l’ajout d’une muallimhane – ou mektebhane – et fournit des renseignements
supplémentaires sur les précédents bâtiments. Ainsi, la medrese comprend 16 cellules et une
salle de cours, l’imaret – également appelé misafirhane – 8 pièces, une cuisine et un cellier,
entre autres choses.
Sa deuxième grande réalisation se situe à l’entrée orientale de la capitale, juste au
niveau de la Porte d’Edirne. Elle comprend, dans la stricte enceinte, une mosquée et une
medrese, ainsi qu’un han et des boutiques alentours.
Mis à part ces deux complexes impériaux, Mihrimah Sultane est également à l’origine
d’autres fondations :
- une muallimhane (mektebhane) à Istanbul, dans le quartier dit Karabaş, à proximité de
Yenibahçe
- une medrese de 12 cellules et 1 salle de cours à Üsküdar
- 15 habitations à Galata, près de la Camii Atik, sur un terrain appartenant au vakf de Sainte-
Sophie
- le türbe de son époux, Rüstem Paşa, à proximité de celui de Şehzade Mehmed (son frère),
qui est intégré à l’evkâf d’Üsküdar
Mihrimah
Hanım Ayşe S.
Rüstem P.
(Hürrem S.)
Mahmud B.
Ahmed B./P.
Mehmed B. Mustafa B.
SÜLEYMAN Ier
Page | 713
Les œuvres à caractère religieux
Aux deux complexes socio-religieux d’Üsküdar et d’Edirnekapı s’ajoutent un certain
nombre d’autres prestations religieuses, fournies par la princesse à travers ses vakf. A
commencer par des récitations de prières, lectures du Coran et/ou récitations d’incantations.
Leurs bénéficiaires sont nombreux :
- elle-même
- la prospérité de la dynastie – tout particulièrement celle du règne de Süleyman Ier, son
père – et l’âme de ses détenteurs
- le prophète et sa famille
- sa daye
- sa fille
- son époux, Rüstem Paşa (dans son propre türbe)
- les différents occupants du türbe susmentionné
On notera que la dynastie est systématiquement mentionnée, preuve de l’attachement de cette
princesse à son lignage royal. Ici doit être mentionnée sa clause requérant des remerciements
publics hebdomadaires, au cours de la prière du vendredi soir, dans sa mosquée d’Üsküdar, à
pratiquer au nom du Prophète, de la dynastie et d’elle-même. Cette exigence souligne son
intérêt à associer publiquement son nom à celui de la dynastie, placée sous le patronage du
Prophète.
Elle prit également des mesures financières en faveur d’espaces religieux déjà fondés,
à savoir le mescid dit Hacı Kasım et celui dit Kemal Elisiri, tous deux à Istanbul.
Le tableau continue dans un tout autre domaine, celui du pèlerinage. En tant que
princesse ottomane, Mihrimah Sultane n’avait pas – ne devait pas – accomplir son pèlerinage.
Ceci ne l’empêcha pas de se sentir concernée par la question, aussi préconisa-t-elle une forte
somme (dont une partie était probablement destinée aux frais de séjour), pour financer
annuellement trois personnes chargées d’accomplir le pèlerinage en son nom. Si la pratique
était relativement répandue dans la société ottomane, notamment pour les femmes d’un rang
social élevé, il s’agit de notre unique mention concernant une princesse ottomane, sur toute la
période du 15e au mi-18
e s.
Enfin, une dernière annotation laisse perplexe par sa rareté, surtout à une période aussi
ancienne : Mihrimah Sultane ordonna la lecture annuelle, au 12e jour du mois de Rebiül-
evvel, du « Mevludname-i Nebi » devant l’assemblée des oulémas, conseillers religieux,
hommes pieux et récitants du Coran intégral.
Page | 714
Les œuvres à caractère charitable
Les œuvres charitables tiennent une place beaucoup moins importante dans les
fondations pieuses de Mihrimah Sultane. Il convient toutefois de mentionner la misafirhane
d’Üsküdar, même si les recherches récentes sur ce sujet ont démontré le peu d’intérêt que ces
structures montraient réellement envers les plus démunis.
Si la charité ne fait pas partie des principales priorités de la princesse, celles qu’elle
entreprit représentent des sommes qui dépassent de loin toutes celles vues jusque-là, et par la
suite. En effet, en sept. 1558, elle prévoit dans ses clauses l’envoi d’une somme totale de
500 000 pièces d’or (« hasene-i sultaniye »), destinée aux pauvres des deux Villes Saintes. La
répartition prévue est égale, 2500 pièces d’or par an pour chacune, qui seront acheminés avec
la caravane annuelle de pèlerinage.
La même année, elle vient également en soutien à des pauvres d’Istanbul, mais pas
n’importe lesquels : il est précisé que des dons de viande, pain et autres aliments de ce genre
doivent être fait pour les pauvres des han de son époux Rüstem Paşa, ainsi qu’aux étudiants
de la medrese du susdit. Ses prescriptions en leur faveur semblent moins justifiées par un
intérêt charitable que par son désir de soutenir l’œuvre de son défunt mari.
Notons encore la prévision d’une certaine somme annuelle d’argent, prévue pour
financer la préparation – selon les préceptes musulmans – du corps de voyageurs pauvres
décédés dans les han, sis le long du rivage du Bosphore ou dans les tabhane d’Üsküdar.
Les œuvres en faveur de la famille
Rentes :
Nous avons déjà vu qu’elle avait ordonné un certain nombre de récitations de prières
pour l’âme de sa daye. Son intérêt pour sa maisonnée ne s’arrête pas là. Les rentes accordées à
ses descendants sont à la hauteur de ses autres réalisations :
- sa fille, Ayşe Sultane, recevra 200 aspres par jour, en qualité de nazife
- chacun de ses petits-enfants (nés d’Ayşe Sultane), aussi bien garçons que filles,
recevront une rente annuelle de 50 aspres par jour : ces rentes seront transmises à leurs
propres enfants, après leurs décès
A ces rentes s’ajoutent celles pour la double charge du tevliyet et nezaret, accordée à
elle-même puis aux descendants de sa famille. La somme est précisée dans la vakfiyye datée
de 1570 : il est stipulé une somme de 40 aspres par jour, qui à sa mort deviendra 50 aspres par
jour. La raison la plus logique de cette surprenante augmentation est que, bien qu’elle soit la
détentrice officielle du tevliyet, c’est quelqu’un d’autre, son mütevelli (présentement Mehmed
Bey), qui s’occupe de la gestion des affaires quotidiennes de son vakf, de son vivant,. La
somme des 40 aspres correspondrait donc à celle qu’elle lui accorde pour ce travail, tandis
qu’à sa mort, la fonction reviendra à ses descendants, dans son intégralité – sa fille en premier
lieu. Ceci expliquerait l’augmentation ainsi prévue.
Page | 715
Charges :
# Vekil :
1549 : Mahmud Ağa bin Abdulmuin
1558 : Mahmud Ağa bin Abdulmuin
Mahmud Ağa bin Abdulhamit
1562 : Behram Kethuda ibn Abdüsselam
1567 : Behram Kethuda ibn Abdüsselam
1570 : Behram Kethuda ibn Abdüsselam
# Mütevelli :
1549 : Ahmed Çelebi ibn Mehmed
1558 : Ali Çelebi ibn Mehmed
Ali Çelebi ibn Mehmed
1562 : Mehmed Bey ibn Abdülhamid
1567 : Mehmed Bey ibn Abdülhamid
1570 : Mehmed Bey ibn Abdülmecid (le même que précédemment)
# Tevliyet :
1557 : elle-même, puis sa fille, puis ses descendants
1570 : elle-même, puis sa fille, puis ses descendants ; ses affranchis et leurs descendants ; les
affranchis de sa fille et leurs descendants
# Nezaret :
1557 : elle-même, puis sa fille, puis ses descendants
1570 : elle-même, puis sa fille, puis ses descendants ; ses affranchis et leurs descendants ; les
affranchis de sa fille et leurs descendants
# Katib :
1557 : ses affranchis
1570 : ses affranchis et leurs descendants ; idem pour ceux de sa fille
# Cabi :
1570 : ses affranchis et leurs descendants ; idem pour ceux de sa fille
Page | 716
Les aspects financiers
Type de
revenu
Quantité Localisation Coût de
location
Valeur Divers
Domanial
- karye - 10
- 4
- 1
- 1
- 5
- 8
- 3
- 1
- 2
- 1
- 6
- 1
- 8
- kaza Karaverye, sancak
de Paşa, Roumélie
- kaza Karakarye,
Roumélie
- kaza Verye, id.
- kaza Selanik, id.
- kaza Timurhisar, sancak
Menlik (Serrès)
- kaza
Cervi/Cernevi/Çernovi,
id.? Üsküp ?
- kaza
Nevrokob/Nevrefavide/
Nevrekop, id.?
- kaza Kıble, id. ?
- kaza Kalbe, Roumélie
- kaza Gökbuze, nahiye
Üsküdar, Anatolie
- kaza Filibe, Roumélie
- kaza Tatarpazarcık, id.
- kaza Samako/ Samakov,
id.
- Bodurum/Perudur-
ma, Kupani/Kopay,
Menelik/Minelek/Me
nlik, Neva/ Neva-
kasiri/Nova Kasrı,
Çukurova/Nevasil/
Novosel, Velçeşte,
Avalar, Kadıçayırı,
Hamzahur/Lefterhur,
Isfince/Iskanca,
- Yanoye, Inehor,
Longoz, Nevesil
- Isfence
- Kermid/Kiremitler
- Serbin, Eşerkılve,
Pesanik, Tetvedir,
Haronode
- Opar/Oper,
Ismail(ler),
Görülcüler/Gürliciler
/Güzelceler, Semerci,
Tetve/Tetova,
Kadıköy/Istiraklu/
Iştorkelova,
Kopanberud/Besaniç
=> Foyanyrod/Sataç,
Çerinevede/
Çerveravoda
- Libahda/Lipahve/
Liyahova,
Astarceste/Istaber-
hasta/Istorciste,
Dolnaniçe/ Dolya-
pence=> Bolfarico
- Aktavdır
- Çakırlar, Küçük
Izzeddinlü
- Nerdubanlu
- Nasuh Fakih et
Aktu/Aftu, Ali Fakih,
Izzendinlü/Izzetinli,
Timurtaş et Nevasil/
Novosel, KaraDavud,
Arçin/Marçove
- Istarlıca/Istiranca
- Haliye/Holra,
Haralve/Haralova,
Azlu Kukani/
Zilokokani,
Purudan/Berudan,
Haci Bedir/Büdeyr
ou Pirbudak, Alaca
Kilise, Nevesil,
Page | 717
- 6
- 2
- 34
- 3
- 3
- 3
- kaza Yenişehir, nahiye
Yalatimone
- kaza Yenişehir, nahiye
Gavra
- kaza Yenişehir (?),
Roumélie
- kaza Çatalca, sancak
Inebaltı
- kaza Keserice/Kesirime,
sancak Tarhala
- kaza Turnova,
Roumélie
Çamulu/Çamurlu,
- Yongaki, Kolitve,
Karatimurlar,
Türkmenler,
Kavacık, Çırak
Haliller
- Petrehur, Hacı
Haliller
- Bilatumune, Köçin,
Ahmedler/Cellahlar,
Orhanlar, Kethüda
obası, Avraniçe,
Duhanuri/Kadice,
Koknopetre/Kurayna,
Keşerli Köçek,
Dereli, Malasire,
Kozderesi, Ayo
Nikola, Yandelimnu,
Pazarlu obası/
Hacıobası, Bahşiler,
Porla/Buhuda,
Kilamaki, Osman
Pınarı, Hasan Baba,
Kızılkeçiler, Iptilaki,
Palamut/Kılamesire,
Bıyıklar/Kalfallar,
Bakraçtatarı, Subaşı,
Ömerler, Türkmeşlu,
Kırcabasan/Karaca
Ilyas Deresi, Sufiler,
Calınlugol/Halil
obası, Yorgalar,
Hassufi,
Südanlu/Müeymillez
- Gura/Kornu/Furto/
Nemure, Ayvaca/
Balyo Ayvarca,
Rakıbelü/Raktilo
- Aya/KiceKöy/
Yeniceköy, Dişan/
Duşanı/Büyük Köy,
Sinat Büzürg/Sinan
Bezrek
- Rohoviçe Müslim,
Rohoviçe Gebz,
Leskofça
- çiftlik
- mezraʻ - 1 - kaza Cervi, sancak
Menlik ?
- “Semerci”
- autre : - 1 çayır
- 8 moulins
- 1 moulin
- kaza Gökbuze, nahiye
Üsküdar
- kaza Yenişehir, sur la
Karasu
- Üsküdar
Page | 718
Type de
revenu
Quantité Localisation Coût de
location
Valeur Divers
Immobilier
- menzil
- yalı
- ev/hane - 7 - Üsküdar
- oda
- hüccre
- boutique - 10
- 15
- Üsküdar
- Galata
- autre :
Financier
- biens en
nature
- argent liquide
Cas particuliers
- jardins
- lieux de
plaisance
- palais
Les sources
VGMA D 635 n°1 : 957 (1549)
VGMA D 635 n°8 : 965 (sept. 1558)
VGMA D 635 n°12 : 965 (sept. 1558)
VGMA D 635 n°9 : 970 (1562)
VGMA D 635 n°10 : 975 (1567)
VGMA D 635 n°11 : 978 (1570)
Page | 719
LEGS PIEUX DE AYŞE SULTANE
La famille
Les constructions et réalisations architecturales
La plus connue de ses réalisations architecturales est probablement la mosquée qu’elle a fait
construire à Üsküdar pour le Şeyh Mahmud Efendi.
Moins connus, un han et un caravansérail sont également mentionnés parmi les fondations
réalisées par Ayşe Sultane, tous deux à Üsküdar, le premier sur des jardins lui appartenant
déjà en biens propres, le deuxième dans les environs de la medrese de Mehmed Paşa. A cela
s’ajoute la construction de locaux commerciaux, également à Üsküdar.
Par ailleurs, il convient de mentionner aussi des réparations réalisées par elle sur des
bâtiments plus anciens : il s’agit de la fontaine à l’entrée du mausolée (de Şeyh Hüdayî) et de
l’imaret ( ???? ), ainsi que du mescid Emir-i Ahur, lequel fut ensuite transformé en mosquée
sur sa demande.
Les œuvres à caractère religieux
Les œuvres à caractère religieux de cette princesse se divisent en deux groupes : le
premier consiste en récitations de prière, lecture de Coran et invocations diverses, le deuxième
en fondations en faveur du Şeyh Mahmud Efendi, dont elle était une fervente adepte.
En ce qui concerne les récitations et invocations, mise à part celles traditionnelles pour
Dieu et le Prophète, on note que la majorité d’entre elles sont ordonnées pour l’âme de
membres défunts de la famille : sa mère (Mihrimah Sultane), son époux (Ahmed Paşa), les
enfants de son époux (s’agirait-il de ceux nés d’un autre lit ?), deux de ses propres enfants
apparemment défunts (Hatice Hanım et Abdurrahman Bey), enfin pour elle-même. Leur lieu
de réalisation est intéressant : ces prières sont toutes faites dans des lieux fondés par elle-
Ayşe S.
Hürrem
Ahmed B. > P.
« Güzelce »
Mihrimah S.
Abdurrahman B. Hatice Ha.
Rüstem P.
Süleyman Ier
Fatıma Ha. Safiyye Ha.
Mehmed A.
Ahmed B.
Page | 720
même ou ses parents, ce qui souligne de façon marquante les interactions entre les différentes
fondations au sein d’une même famille (on trouve entre autre le türbe d’Ahmed Paşa, dans la
mosquée fondée par sa mère à Edirnekapı, et la medrese fondée par son père).
Cependant, il est intéressant de noter qu’elle ordonne également la récitation de telles
prières et invocations en faveur de la dynastie, de ses détenteurs, et surtout de sa perpétuation,
ce qui constitue une marque d’un fort sentiment d’appartenance à la dynastie dont elle est
issue.
Les œuvres à caractère charitable
La seule note de charité que l’on trouve dans les différentes vakfiyye d’Ayşe Sultane
consiste à prévoir la vente de son palais, constitué en bien propre à usage et transmission
familiale, après extinction de la lignée, en faveur des pauvres des Villes Saintes : l’argent
récolté par la vente sera envoyé dans ces deux villes, sans plus de précisions quant à sa
répartition.
Les œuvres en faveur de la famille
Charges :
# Vekil :
Mehmed Ağa ibn Abdusselam (ou Abdulmennan) (1594)
> Osman Ağa ibn Abdülmennan (1612)
> Ali Efendi bin Mustafa – précédemment institué comme nazir (1613)
> Veli Bey ibn Ali – précédemment institué comme mütevelli (1613 bis)
> Elhac Osman Dede ibn Abdurrahman (1624)
# Kaimmakam-ı mütevelli :
Elhac Yusuf bin Abdurrahman puis les affranchis de la fondatrice (1594)
> Ibrahim Aga ibn Hasan (1612)
> Veli Bey ibn Ali (1613)
# Tevliyet :
Les affranchis de la fondatrice puis leurs descendants (1594)
> Mehmed Ağa ibn Ahmed Bey (1624)
# Nezaret :
Les affranchis de la fondatrice puis leurs descendants (1594)
> précédemment son fils Abdurrahman Bey, décédé, remplacé par Ali Efendi ibn Mustafa
(1612) – il semblerait que nous n’ayons pas la vakfiyye qui institue son fils comme nazir
> aucune précision par la suite
# Katib :
Affranchis de la fondatrice puis leurs descendants (1594)
> aucune précision par la suite
# Cabi :
Affranchis de la fondatrice puis leurs descendants (1594)
> aucune précision par la suite
Il semblerait – et c’est également ce qui ressort des dispositions et indications fournies
dans les vakfiyye de sa mère Mihrimah Sultane, qu’Ayşe Sultane ait mis quelques années
Page | 721
avant d’avoir des enfants, ce qui expliquerait son premier choix en faveur de ses affranchis,
pour la nomination à un certain nombre de charges, transférées ensuite à ses propres enfants.
On remarquera néanmoins que, bien qu’elle ait eu plusieurs filles, seuls les hommes
ont été nommés à des charges officielles.
Les aspects financiers
Type de
revenu
Quantité Localisation Coût de
location
Valeur Divers
Domanial
- karye 2 Sancak : Selanik / kaza :
Avrethisarı
Héritage
maternel ; mülk
6 008
dinar
Noms : Kılkabış et
Tekirbelce
- çiftlik - 1
- 1
- nahiye Angıyd, karye
Topyeri
- même nahiye, karye
Merence
- mezraʻ
- Autre :
Immobilier
- menzil - 2 - Üsküdar, Mehmed Paşa
- yalı
- ev 1 Üsküdar, Demirkapı, au bord
de mer
Un ensemble de
toutes ses possessions
(surtout jardins) dans
cette zone
- oda - 21
- plusieurs
(bâtiments)
- id.
- Üsküdar, Mirahor
- Üsküdar, face à la kızkulesi
- Üsküdar, entre Ortakapı et
Dışkapı
- appelées « ağalar
odaları »
- hüccre 35 Ist., Atmeydanı Sa construction
- boutique - 30
- 8
- 1 espace
commercial
- 2
- 6
- Ist., Miri Aslanhane
- Ist., Arpa Emini
- Üsküdar, entre Büyükkapı
et Divar-ı kebir
- Ist., Firuz Ağa
- Üsküdar, Selman Ağa
- 26 aspres de
revenu par jour
- 11 aspres de
revenu par jour
- Avec terrains
- Piri Paşa iskelesi
- autre :
~ terrains
~ kayıkhane
- 1
- 2
- Ist., Kapıağası camii
- Üsküdar, Süleyman Ağa
- Dit « otluk anbarı »
Financier
- biens en
nature
- argent liquide
Page | 722
Type de
revenu
Quantité Localisation Coût de
location
Valeur Divers
Cas particuliers
- jardins - 7jardins
- 2 asmalık
- Üsküdar, dans une zone
allant du bord de mer face à
la Kızkulesi, Demirkapı,
Ortakapı, Dışkapı, Büyükkapı
et Divar-ı kebir
- idem
- respectivement de
35x23, 140x131,
135x78, 260x150,
200x125 et 150x55
coudées // comprend
diverses annexes et
installations
- de 105x47 et
106x78 coudées
- lieux de
plaisance
- 1 sofa
- 1
divanhane
- Üsküdar, face Kızkulesi
- Üsküdar, entre Ortakapı et
Dışkapı
- 105x42 coudées
- 49x34 coudées
- palais - 1 Istanbul, Mahmud Paşa camii - résidence
personnelle
Les sources
VGMA D 635-2 s. 33 sıra 2 : 1003 (1594)
VGMA D 635-2 s. 49 sıra 3 : 1003 (1594)
VGMA D 635-2 s. 58 sıra 4 : 1022 (1613)
VGMA D 635-2 s. 59 sıra 5 : 1022 (1613)
VGMA D 635-2 s. 60 sıra 6 : 1034 (1624)
VGMA D 635-2 s. 61 sıra 7 : date non précisée
VGMA D 635-2 s. 167 sıra 18 : 1021 (1612)
Page | 723
LEGS PIEUX D’ISMIHAN SULTANE
La famille
Les constructions et réalisations architecturales
D’après sa vakfiyye, Ismihan Sultane serait à l’origine de la construction de deux
mosquées (l’une à Istanbul, dans le quartier Çatladı Kasım, près de l’At Meydanı ; l’autre
dans le village de Mankaliye, aujourd’hui Mangalia, dans le district de Tekfur Gölü,
appartenant au sancak de Siliste en Roumélie) et d’une medrese à Eyüp, à proximité de la
mosquée portant ce nom. Par ailleurs, il faut ajouter la construction d’un menzil à Eyüp,
destiné à servir de résidence au müderris de cette medrese.
A cela s’ajoute également la construction d’un certain nombre de boutiques et espaces
commerciaux.
Les œuvres à caractère religieux
Hormis ses deux mosquées et sa medrese, Ismihan Sultane est également à l’origine de
récitations de prières, lectures de Coran et invocations diverses :
- au nom de son père, le sultan Selim II
- au nom de sa mère (sans que son nom soit précisé), dans le türbe familial d’Eyüp,
fondé par elle et son mari pour y recevoir la dépouille de leurs enfants, tous morts
jeunes
- au nom de ses enfants, enterrés dans le susdit türbe, et de tous ceux amenés à y résider
(ce qui implique également son mari)
- au nom du Prophète, à La Mecque
- au nom de Fatima, la fille du Prophète, dans son mausolée de La Mecque
Les œuvres à caractère charitable
Ismihan Sultane a ordonné des clauses particulières, consistant en des dotations
destinées à des jeunes filles ou veuves pauvres, pour la constitution de leur trousseau, afin
qu’elles puissent se marier. Elle prévoit ainsi une somme de 4 000 aspres pour 10 personnes
par an, avec la possibilité de doter 5 personnes supplémentaires par an, en cas de surplus
éventuel du vakf.
Ismihan Sokollu
Mehmed Paşa
SELIM II
Page | 724
Les œuvres en faveur de la famille
Charges :
# Vekil :
Abdulgani ibni Mihrişah
# Mütevelli :
Hüsrev Kethüda bin Abdurrahman
# Tevliyet :
Elle-même puis ses descendants.
# Nezaret :
Elle-même puis ses descendants.
# Katib :
Ses affranchis puis leurs descendants.
# Cabi :
Ses affranchis puis leurs descendants.
Les aspects financiers
Type de
revenu
Quantité Localisation Coût de
location
Valeur Divers
Domanial
- karye - 4
- 1
- 3
- 1
- 2
- 5
- Tekfu Gölü, Silistre
(Roumélie)
- Varna, Silistre
- Pervani, Silistre
- Silistre, Silistre
- Döpence, Kostendil
(Roumélie)
- Cermende, Kostendil
- Mankaliye ; Çukur
Ormanı ; Rahtuvan /
Balabanoğlu kapusu ;
Karasu Boğazı
- Kuyucak
- Yeni Arnavud ;
Eski Arnavud ;
Ayayorgi / Çukurova
- Kırpayça Siliç /
Kadıköy
- Popuşova ; Eslohçe
- Elvandere ; Büyük
Kozlıca ; Küçük
Kozlıca ; Yeniköy ;
Değirmen
- çiftlik
- mezraʻ
- autre :
- 8 moulins - kaza de Cermende,
Kostendil
- dits « Kapu Ağası
Değirmenleri », sur
la Meriç
Page | 725
Type de
revenu
Quantité Localisation Coût de
location
Valeur Divers
Immobilier
- menzil - 2 - Ist. (Helvacıbaşı)
- yalı
- ev
- oda
- hüccre
- boutique
- autre : - 1 marché - kaza de Pogoniye, liva
d’Uluniye
Financier
- bien en
nature
- argent liquide
Cas particuliers
- jardins
- lieux de
plaisance
- palais
Les sources
VGMA D 572 n° 53 : 980 (1572)
Page | 726
LEGS PIEUX DE GEVHERHAN SULTANE
La famille
Les constructions et réalisations architecturales
A Istanbul, Gevherhan Sultane a ordonné la construction d’une medrese, dans le
quartier Iğneci, à proximité du vakf de son époux Mehmed Pacha, près du Marché aux
femmes, comprenant 15 cellules et une salle de cours.
Elle a également ordonné des constructions hors d’Istanbul :
- 1 mosquée + 1 hamam et 1 imaret + 6 boutiques dans le village Fethü’l-Islam, en
Roumélie
- 1 mosquée dans le village Bostanböğü, dans le kaza d’Elmaluborlu en Anatolie
Les œuvres à caractère religieux
A ces constructions socio-religieuses s’ajoute l’aide financière apportée à une zaviyye
déjà existante, appelée Şeyh Ilyas Efendi Zaviyyesi, sise dans le village de Pilevne.
Hormis ces fondations, Gevherhan Sultane a également ordonné la récitation d’un
certain nombre de prières :
- pour l’âme du prophète, notamment dans son tombeau à Médine
- pour elle-même
Les œuvres à caractère charitable
En œuvre charitable, Gevherhan Sultane a ordonné une aide financière à l’intention de
10 orphelins chaque année ; le surplus du vakf devant être utilisé pour les pauvres.
Gevherhan S. Mehmed P.
Hatice H.S. Salih B. Ibrahim P.
SELIM II
Page | 727
Les œuvres en faveur de la famille
Rentes :
Gevherhan Sultane a organisé la distribution de rentes pour les membres de sa
maisonnée :
- à sa fille : 40 aspres par jour
- à son fils : 30 aspres par jour
- à ses vieilles affranchies ayant quitté sa résidence : 5 aspres par jour pour chacune
- à son kapuağa, Dilaver Ağa (vekil de sa seconde vakfiyye) : 10 aspres par jour
- à sa kethuda, Perizar Hatun : 8 aspres par jour
- à trois de ses kutcu, Şemsperi, Gülbahar et Bedirmah Hatun : respectivement 6, 6 et 5
aspres par jour
Charges :
# Vekil :
1609: Mustafa Çavuş ibni Abdullah (çavuş de la Porte)
1623: Dilaver Ağa (kapuağa)
# Mütevelli :
1609: Şehbaz Ağa ibni Abdülvahid (kapucubaşı de la Porte)
1623: Hasan bin Abdullah
# Tevliyet :
Elle-même, puis ses descendants, jusqu’à l’extinction de la lignée.
# Nezaret :
Le chef des eunuques noirs.
En 1623, Gevherhan Sultane installe également son gendre dans une fonction de surveillance
du vakf, en sus du chef des eunuques noirs : il reçoit, pour cela, 80 aspres par jour.
Page | 728
Les aspects financiers
Type de
revenu
Quantité Localisation Coût de
location
Valeur Divers
Domanial
- karye - 2
- 1
- 1
- 1
- 1
- 2
- 1
- Filibe, sancak Pasa,
Roumélie
- Dimetoka, id.
- Atina, sanc. Eğriboz
- Fener, Tirhala (Yanya)
- Badırcık, Ayna-i
Tahiyye
- Lofca, Niğbolu
- Izven (>Izdin), Eğriboz
- Köpüklü ;
Beganbeylü
- Kara Yusuflu
- Boleisnan
- Kubavaravaşi
- Kayalü
- Kahbora ; Tatva
- Istilce
- çiftlik
- mezraʻ
- autre : - 1 şetevi
- 2 pâturages
- 3 dalyan
- kaza Ipsala, Roumélie
- kaza Sofya, Roumélie
- kaza Gügercinlik,
sancak Semendira,
Roumélie
- y compris les
bâtiments et 2000
ağnam
- dits « Kosbatin »,
« Lipe » et « Orta
Keşişlik », sur le
Danube
Immobilier
- menzil
- yalı
- ev
- oda
- hüccre
- boutique - 6 - village Fethülislam,
Roumélie
- autre :
Financier
- bien en
nature
- argent liquide
Cas particuliers
- jardins
- lieux de
plaisance
- palais
Les sources
VGMA D 742 n° 67 : Ramazan 1018 (décembre 1609)
VGMA D 742 n° 68 : Ramazan 1032 (juillet 1623).
Page | 729
LEGS PIEUX DE FATMA SULTANE
La famille
Les constructions et réalisations architecturales
Fatma Sultane semble être à l’origine de la construction d’un complexe à Istanbul,
comprenant une mosquée, une medrese (appelée aussi dar-i tahsil) de 15 cellules et 1 salle de
cours, un mekteb (appelé aussi dar-i ta’lim) avec fontaine (sebil), un imaret avec écurie et
fontaine (sebil), enfin, un caravansérail avec fontaine (çeşme).
Les œuvres à caractère religieux
Outre la réalisation de ce complexe socio-religieux, Fatma Sultane a également
ordonné la récitation de prières et invocations :
- pour son âme
- pour l’âme de son père, Selim II, dans son mausolée
- pour l’âme de son époux, dans son mausolée à Eyüp
- général, à La Mecque, Médine et Damas
A cela, s’ajoute le financement prévu pour l’entretien d’une medrese, sise aux
alentours d’Eğrıkapı, à Istanbul, construite, semble-t-il, par quelqu’un d’autre.
Les œuvres à caractère charitable
Rien de mentionné.
Fatma S.
Osman Ef.
Siyavuş P.
Mehmed B. ( ?) Mustafa B.
( ?)
SELIM II
Page | 730
Les œuvres en faveur de la famille
Rentes :
Fatma Sultane a ordonné un grand nombre de rentes, pour des gens de sa maisonnée :
- Rabia Hatun, une de ses affranchies : 5 aspres par jour
- sa mère : 60 aspres par jour
- Ayşe Hatun, daye de Mehmed Bey – probablement son fils : 4 aspres par jour
- Zahide Hatun, sœur utérine de la précédente et daye de Mustafa Bey – probablement
son fils : 4 aspres par jour
- Gülhamer Bulâ : 5 aspres par jour
- Haydr Ağa : 5 aspres par jour
- Katib Ali Bey, havace de ses fils : 30 aspres par jour
- Hafız Mehmed, ancien serviteur retraité : 10 aspres par jour
Charges :
# Vekil :
1589 : son époux, Siyavuş Pacha
# Mütevelli :
1589 : Mustafa Bey ibn Abdülmecid
# Tevliyet :
1589 : elle-même > son mari, Siyavuş Pacha > les descendants de celui-ci.
Page | 731
Les aspects financiers
Type de
revenu
Quantité Localisation Coût de
location
Valeur Divers
Domanial
- karye - 5 - Yanya, sancak id. - Reyha ; Kapulasna ;
Birre ; Birrun ; Besin
- çiftlik
- mezraʻ
- autre : - 1 nahiye - Kurunduz, sancak de
Yanya
Immobilier
- menzil
- yalı
- ev
- oda
- hüccre
- boutique
- autre :
Financier
- bien en
nature
- argent liquide
Cas particuliers
- jardins
- lieux de
plaisance
- saray
Revenu total : 58 000 aspres par an
Les sources
VGMA D 732 n° 253 : 998 (1589)
VGMA D 732 n° 254 : sans date
Page | 732
LEGS PIEUX D’AYŞE SULTANE
La famille
Les constructions et réalisations architecturales
Parmi les constructions dues à Ayşe Sultane, on note une medrese (comprenant 6
cellules et 1 salle de cours), servant également de muallimhane, une fontaine (çeşme), devant
le mausolée de son premier époux, Ibrahim Paşa, ainsi qu’une autre, dont l’emplacement n’est
pas précisé.
En outre, il faut mentionner également la construction d’un bâtiment regroupant 25
pièces ainsi qu’un kayıkhâne, à Istanbul et quatre maisons de Juifs, toujours à Istanbul.
Relativement inhabituel, soulignons encore sa construction d’un pont, à Tatarpazarı :
l’absence de détails le concernant laisserait entendre qu’il ne s’agissait pas d’un ouvrage d’art,
mais plutôt d’une petite réalisation, destinée à faire face rapidement à des besoins ruraux.
Les œuvres à caractère religieux
En sus de la fondation et l’entretien d’une medrese – muallimhane créée sur ses
propres revenus, les œuvres religieuses d’Ayşe Sultane comprennent également l’ordonnance
de récitation de prières :
- au nom de son défunt époux, Ibrahim Pacha, dans son türbe sis près de la Şehzade
Camii et à Sainte-Sophie
- pour son mari, Mahmud Pacha, dans l’école qu’elle a fait construire
- pour la prospérité de la dynastie
- pour le Prophète
- pour elle-même, enfin
On notera que, de ses quatre époux successifs, seuls deux sont mentionnés et bénéficient de
prières, dans ses vakfiyye.
A cela s’ajoute le paiement annuel d’une somme destinée à couvrir les frais de voyage
d’une personne, qui réalisera, chaque année, le pèlerinage au nom de la princesse.
Enfin, il convient encore de noter qu’elle apporta son soutien financier à deux espaces
religieux fondés par d’autres, à savoir :
- la mosquée de Şeyh Emin Efendi, à Kasım Pacha (Istanbul)
- le complexe de son époux, à Tatarpazarı, en Roumélie
Mahmud Pacha Ayşe Ibrahim Pacha
MURAD III
Page | 733
Les œuvres à caractère charitable
Rien de mentionné.
Les œuvres en faveur de la famille
Charges :
# Vekil :
Janv. 1603: - Reyhan Ağa ibni Abdullah / Abdurrahman / Abdulmennan (le même dans les
trois vakfiyye de cette date).
1605: - Iskender Ağa ibn Abdüddeyyan
# Mütevelli :
Janv. 1603: - Sefer Ağa ibni Abdülmennan / Abdüddeyyan (le même dans les trois
vakfiyye)
1605: - Sefer Çavuş ibn Abdurrahman
# Tevliyet :
Sefer Ağa (son mütevelli) et ses descendants, puis une personne de l’extérieur (stipulé
qu’aucun de ses uteka ne doit être affecté à cette place)
# Nezaret :
Le chef des eunuques noirs.
Page | 734
Les aspects financiers
Type de
revenu
Quantité Localisation Coût de
location
Valeur Divers
Domanial
- karye - 3
- 2
- 4
- Buhayn (Egypte)
- Badracık (Inebahtı,
Roumélie)
- Harvuza(>Hırsova)
(Silistre, Roumélie)
- Mekeşe ; Saruhan
- Taya ; Ilıca / Sarı
Köy ; Karvan ;
Sarhanlı
- çiftlik - 1 - Amurfa, Cezire-i Kıbrıs
- mezraʻ - 1 - Badracık (Inebahtı,
Roumélie)
- « Makri Mihal »
- autre : - 4 moulins
- 8000
moutons
- 1200
moutons
- 1 kıslak
- Yanbolu (Roumélie)
- Filibe (Roumélie)
- Bolu (Anatolie)
- Harvuza (Silistre,
Roumélie)
- sur le Danube
Immobilier
- menzil - 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- Ist. (Balat, hors de la
Porte de Petru)
- Eyüp (Hasköy, Sütlüce)
- ville de Şam
- Ist. (Sarıdemirci)
- Ist. (Sarıcapaşa)
- Ist. (Abdi Subaşı)
- Ist. (Halil Paşa)
- Galata (Lonca)
- Galata (Sanfıranceşko)
- Galata (Sabbesti)
- yalı
- ev - 4 - Ist. - Yahudi haneler
- oda - 2
- 5
- Eyüp (Hasköy, Sütlüce)
- Ist. (Elhac Muhiddin,
près Edirnekapı)
- hüccre
- boutique - 25
- 2
- 250
- 61
- 5
- Ist. (Hızır Bey, prèsde
la mosquée Zeyrek)
- Eyüp (Hasköy, Sütlüce)
- Bolu, Anatolie
- Hama
- Ist. (Elhac Muhiddin,
près Edirnekapı)
- dans le marché dit
Eflani Pazarı
- dont 1 kahvehane
- autre : - 1
kayıkhâne
- 1 akar
- 4 masura
- 3 masura
- Ist. (hors de la Yahudi
Kapısı)
- Galata (Sanfıranceşka)
- Eyüp (Hasköy)
- Kara Ahmet
Page | 735
Type de
revenu
Quantité Localisation Coût de
location
Valeur Divers
Financier
- biens en
nature
- argent liquide
Cas particuliers
- jardins - 1
- 1
- 3
- Eyüp (Hasköy, Sütlüce)
- Ist. (At Meydanı,
attenant au Ibrahim Paşa
Sarayı)
- Eyüp (Hasköy, Sütlüce)
- terrain vacant
- réunis en un seul
- lieux de
plaisance
- palais
Les sources
Les vakfiyye d’Ayşe Sultane, disponibles au Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, sont conservés
sous deux formes : les documents originaux, conservés dans le Kasa 86, et les transcriptions
suivantes :
VGMA D 2138 n° 20 : 1011 (14 janv. 1603)
VGMA D 2138 n° 21 : 1011 (14 janv. 1603)
VGMA D 2138 n° 22 : 1011 (14 janv. 1603)
VGMA D 2138 n° 23 : 1013 (1605)
Page | 736
LEGS PIEUX D’ATIKE SULTANE
La famille
Les constructions et réalisations architecturales
Atike Sultane ne semble avoir entrepris, personnellement, aucune construction.
Cependant, elle a participé à l’entretien de réalisations qui étaient du fait de son mari, Kenan
Pacha, à savoir l’entretien d’une partie du personnel de la forteresse qu’il avait fait construire
à Tatarpınar, et du türbe du celui-ci à Istanbul, à proximité de la Kırk Çeşme.
Les œuvres à caractère religieux
En plus de pourvoir à l’entretien du mausolée de son défunt époux, elle a également
organisé la récitation de prières, pour elle-même et ce dernier.
Les œuvres à caractère charitable
Rien n’est mentionné dans la vakfiyye d’Atike Sultane, qui a été conservée.
Les œuvres en faveur de la famille
Charges :
# Tevliyet :
Elle-même, puis les descendants de son époux, Kenan Pacha.
# Nezaret :
Isa Ağa, kethuda de la princesse.
# Katib :
Ebubekir Pacha, qui se trouve être le scribe de Kenan Pacha.
Atike Kenan Pacha
AHMED Ier
Page | 737
Les aspects financiers
Type de
revenu
Quantité Localisation Coût de
location
Valeur Divers
Domanial
- karye - 1 - Tatarpınar, Roumélie
- çiftlik
- mezraʻ
- autre : - 1 arazi - Tatarpınar, Roumélie
Immobilier
- menzil
- yalı
- ev
- oda
- hüccre
- boutique
- autre :
Financier
- biens en
nature
- argent liquide
Cas particuliers
- jardins
- lieux de
plaisance
- palais
Les sources
VGMA D 623 n° 20 : 1062 (1652)
Page | 738
LEGS PIEUX DE KAYA ISMIHAN SULTANE ET
DE SA FILLE, SAFIYYE HANIM SULTANE
La famille
Les constructions et réalisations architecturales
Les diverses vakfiyye rédigées par Kaya Ismihan Sultane et sa fille, nous révèlent
l’existence d’un mekteb, dont la construction est attribuée à la princesse, bien qu’on en ignore
la date de fondation.
A cela s’ajoute la construction de deux menzil, dont Safiyye Hanım Sultane semble
s’attribuer la construction,- tout en déclarant qu’ils font partie des revenus établis par sa
mère, et qui sont destinés à servir de résidence à certains fonctionnaires du mekteb.
Les œuvres à caractère religieux
Outre la fondation et l’entretien du mekteb à Istanbul, sis sur la Divanyolu, dans le
quartier dit Hace Rüstem et à proximité d’Asmalı Mescidi, un certain nombre de récitations
de prières sont établies, pour :
- l’âme du Prophète
- la prospérité puis, après décès, l’âme de la mère d’Ismihan Sultane
- celle de Melek Ahmed Pacha (charte établie par Fatma Hanım Sultane, sa fille)
- celle de Süleyman Pacha (charte établie par Fatma Hanım Sultane, sa femme)
- celle de la fondatrice (charte établie par Fatma Hanım Sultane, sa fille), dans divers
lieux
- celle du sultan Mustafa Han (charte établie par Fatma Hanım Sultane)
Kaya Ismihan S. Melek Ahmed P.
Süleyman P.
Mahmud B.
Fatma H.S.
Ahmed B.
Muazzeze ( ?) S. MURAD IV
Page | 739
Précisons qu’une partie des prières ordonnées pour l’âme du Prophète et pour celle de la mère
de la fondatrice doivent être réalisées par des içoğlan du Palais impérial, ainsi que le stipulent
les documents.
Il convient encore de noter le financement de cours, à Sainte-Sophie, et l’entretien du
mausolée de la fondatrice, qu’elle partage en fait avec son parent, Mustafa Ier : ces deux
clauses, qui émanent des vakfiyye établies par Fatma Hanım Sultane, reposent sur les revenus
établis par sa mère.
Les œuvres à caractère charitable
En action charitable, le vakf de Kaya Ismihan Sultane révèle une dotation à l’égard de 40
jeunes garçons pauvres, choisis pour bénéficier de l’éducation de son mekteb, ainsi que l’aide
financière annuelle à 10 pauvres des Villes Saintes, à raison de 4 pièces d’or par an chacun.
Les œuvres en faveur de la famille
Charges :
# Vekil :
1656: Mustafa Ağa ibn Piyale Ağa (kethuda de Kaya Ismihan Sultane)
1715: Mehmed Ağa ibni’l-zülfikar (kethuda de Fatma Hanım Sultane)
1725: - Mehmed Ağa bin Abdullah (kethuda de Fatma Hanım Sultane)
- Derviş Mehmed Efendi bin Derviş Ahmed Efendi
# Mütevelli :
1656: Hasan Ağa ibni Abdülmennan
1715: Mustafa Ağa ibn Abdullah
1725: - Mehmed Ağa bin Hacı Mehmed
- Mustafa Ağa bin Abdullah
# Tevliyet :
Kaya Ismihan Sultane > Fatma Hanım Sultane > les fils de son époux, Süleyman Paşa
(d’abord Mahmud, l’aîné, puis Ahmed) > les fils et descendants de ce dernier
# Nezaret :
Le chef des eunuques noirs
Page | 740
Les aspects financiers
Type de
revenu
Quantité Localisation Coût de
location
Valeur Divers
Domanial
- karye
- çiftlik - 1 - Üsküdar - annexe au palais
- mezraʻ
- autre : - 1 arazi
- 2 arsa
- Üsküdar
- Üsküdar
- annexe au palais
- 1 annexe au palais ;
l’autre dans le village
Bulgurlu
Immobilier
- menzil - 12
- Ist. (Rüstem Paşa, sur la
Divanyolu)
- dont 9 autour de
son han et 2 pour
employés du mekteb
- yalı - 1
- 1
- Beşiktaş (Ortaköy)
- Eyüp (Şah Sultane)
- ev - 6 - Üsküdar
- oda - 8 - Ist. (Rüstem Paşa, sur la
Divanyolu)
- hüccre
- boutique - 1 - Ist. (Rüstem Paşa, sur la
Divanyolu)
- autre : - 1 han
- 1 kuyu
- Ist. (Rüstem Paşa, sur la
Divanyolu)
- Ist. (Rüstem Paşa, sur la
Divanyolu)
- 69 boutiques +
étable + toilettes
Financier
- biens en
nature
- 240 000
kuruş riyali
- Taux
d’intérêt :
11%
- argent liquide
Cas particuliers
- jardins - 3
- 2
- 2
- Beştiktaş (Ortaköy)
- Üsküdar
- village Bulgurlu
(Üsküdar)
- annexes au yalı :
terrain, bağ, bostan
- annexes au palais
- bağ
- lieux de
plaisance
- palais - 1
- 1
- Üsküdar
- Istanbul (intérieur de la
porte de Topkapı)
- son palais
Page | 741
Les sources
Les vakfiyye conservées au Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi concernant la fondation
pieuse de Kaya Ismihan Sultane consistent, en fait, en un acte de fondation établi par la
princesse elle-même, et cinq autres rédigées par sa fille, Fatma Hanım Sultane, concernant
pourtant la gestion de la même fondation, dont elle était devenue la gestionnaire. Il est
intéressant de noter qu’elle ne s’identifie pas en temps que gestionnaire du vakf de sa mère :
elle apparaît plutôt en position de fondatrice, alors qu’ elle ne fonde rien de nouveau, et
n’ajoute que le revenu que quelques maisons de Juifs. Il semblerait qu’elle se soit contentée
d’apporter de nouvelles chartes concernant l’usage des revenus et biens établis en legs pieux
par sa mère.
Dans la mesure où l’ensemble de ces documents participent à une même fondation, et
qu’il ne semble pas y avoir eu ni extension de revenus ni modification notable de l’orientation
du vakf initial, j’ai choisi de réunir ces documents sous le patronage de Kaya Ismihan Sultane,
afin de permettre une meilleure compréhension (elle est d’ailleurs la fondatrice principale,
même si nombre de ses réalisations ne sont connues que par les vakfiyye rédigées par sa fille).
Les documents sont les suivants :
VGMA D 2138 n° 3 : 1066 (1656) => dont l’original est conservé dans le Kasa 47
VGMA D 573 n° 9 : 1128 (1715)
VGMA D 623 n° 299 : Receb 1138 (mars 1726)
VGMA D 623 n° 298 : 7 Şaban 1138 (10 avril 1726)
VGMA D 573 n° 10 : 21 Şaban 1138 (24 avril 1726)
VGMA D 623 n° 300 : 21 Şevval 1138 (22 juin 1726)
Page | 742
LEGS PIEUX DE EMINE SULTANE
La famille
Les constructions et réalisations architecturales
Les documents nous révèlent l’existence de deux fondations entreprises par la
princesse, antérieures aux vakfiyye retrouvées. Il s’agit de la construction d’une mosquée à
Istanbul, sise à proximité de son palais (dans le quartier Iskender Ağa, à Istanbul), ainsi que
d’un hammam, à Eyüp.
Les œuvres à caractère religieux
Outre la construction et l’entretien de sa mosquée, Emine Sultane a également
contribué au financement de cours religieux, au sein de sa mosquée.
A cela s’ajoutent des récitations de prières et invocations, sans qu’aucun bénéficiaire
particulier ne soit mentionné.
Les œuvres à caractère charitable
Au niveau des œuvres charitables, il convient de noter la clause établie par la
princesse, selon laquelle à sa mort, l’ensemble de ses biens tasarruf serait vendu, et l’argent
ainsi récolté envoyé pour venir en aide aux pauvres des Villes Saintes. De même, elle leur
destine le surplus annuel de sa fondation.
Les œuvres en faveur de la famille
Charges :
# Vekil :
En 1739, il s’agit de son chef des ağa Elhac Abdullah Ağa ibn Abdulmuin.
EMINE
MUSTAFA II
Page | 743
# Mütevelli :
1739 : Elhac Hüseyn Ağa ibn Mahmud (son kethuda)
1747 : Osman Ağa ibn Ahmed
1750 : Bostanî Osman Ağa ibn Ahmed
# Tevliyet :
1739 : son kethüda, alors son mütevelli Elhac Hüseyin, puis quiconque occupant cette charge.
# Nezaret :
1739 : le chef des eunuques noirs
Les aspects financiers
Type de
revenu
Quantité Localisation Coût de
location
Valeur Divers
Domanial
- karye
- çiftlik
- mezraʻ
- autre :
Immobilier
- menzil - 2
- 1
- 1
- Ist. (Iskender Ağa)
- Galata (Kasım Paşa,
quartier Elhac Ahmed)
- Ist. (Daye Hatun)
- 100 kş + 1,5
a/jr
- 750 kş + 1,5
a/jr
- 200 kş
- 1000 kş
Tous ses tasarruf
- yalı - 1 - Eyüp, bord de mer Son tasarruf
- ev
- oda
- hüccre
- boutique
- autre : - 1 hamam - Eyüp, à côté du yalı Son tasarruf
Financier
- bien en
nature
- argent liquide
Cas particuliers
- jardins - 1 - Ist. (Abdullah Ağa, près
d’Aksaray)
Son tasarruf
- lieux de
plaisance
- palais
Les sources
VGMA D 736 n° 44 : 1152 (1739) : la version originale du document est conservée sous la
côte D 1450 kasa 96 (39 pg).
VGMA D 736 n° 42 : 1160 (1747)
VGMA D 736 n° 43 : 1163 (1750)
Page | 744
LEGS PIEUX DE SAFIYYE SULTANE
La famille
Les constructions et réalisations architecturales
L’œuvre architecturale de Safiyye Sultane se compose de petites réalisations,
effectuées à des moments différents, ce n’est donc pas un ensemble cohérent. Ce manque de
cohérence et la multiplication des actes de fondations, rendent difficile la reconstitution de
l’ensemble de ses constructions.
La plus ancienne vakfiyye que nous ayons – qui n’est probablement pas la première –
date de 1720 : difficilement lisible du fait d’une mauvaise conservation, on y apprend
néanmoins qu’elle fit construire une çeşme, entre autres constructions, sur un champ
appartenant au vakf de Bayezid II. La localisation est malheureusement illisible. Une çeşme
est encore mentionnée ultérieurement (1750 et 1751) – il semblerait qu’il s’agisse de la même
– pour laquelle il est précisé qu’elle a été construite par la princesse en face de son palais.
En septembre 1753, elle ordonne également l’entretien du mausolée de Süleyman Ier
(intérieur et extérieur), à payer sur le surplus des revenus de son vakf.
Les œuvres à caractère religieux
Les œuvres proprement religieuses ordonnées par Safiyye Sultane sont multiples, et
comme pour tout dans son œuvre pieuse, elles sont décidées, au fil du temps. J’ai choisi de les
regrouper par catégorie, pour mettre en valeur la portée religieuse de son œuvre, en ayant
soin, toutefois, de préciser en parenthèse les dates.
Une des premières actions de Safiyye Sultane fut de financer ce qu’on pourrait appeler
des conseillers religieux, chargés de dispenser « va’iz ve nasihat » :
- dans la mosquée de la Valide Sultane, dite Bey Camii, à Istanbul (20 déc. 1725)
- dans la mosquée Molla Şeref, à Istanbul (15 nov. 1739)
- dans la mosquée Sofiler, à Istanbul (10 mars 1750)
Safiyye Sultane a également financé des cours religieux, qui eurent lieu dans diverses
mosquées d’Istanbul, à partir de 1741 :
Safiyye S.
Zahide H.S.
Bahtiyar ou Bajtiyad
Emine H.
Ebubekir P.
Süleyman Be.
MUSTAFA II
Page | 745
- dans la mosquée de Mehmed II (26 oct. 1741)
- dans la mosquée de Sainte-Sophie (26 oct. 1741)
- dans la mosquée de Bayezid II (30 juin 1742)
- dans la mosquée de Molla Şeref (19 janv. 1748)
- dans la mosquée de Öksüzce (10 mars 1750)
- dans la mosquée Murad Paşa-yı Atik Camii à Aksaray (18 déc. 1752, portant
modification d’une clause antérieure, remontant à un document, datant de 1738-39,
qui ne nous est pas parvenu)
Parmi les autres actions religieuses de Safiyye Sultane, les récitations de prière sont
également nombreuses, que la charge en revienne à des conseillers religieux ou à des récitants
professionnels, etc. Les bénéficiaires de ces prières varient, de même que leur lieu de
réalisation, ou la date de leur mise en pratique :
- pour elle-même (à de nombreuses reprises, dans divers lieux)
- pour Şeyh Abdullah Efendi, un de ses conseillers religieux
- pour les musulmans, hommes et femmes (les deux sont précisés) en général
- pour sa mère (15 nov. 1739, dans la mosquée Molla Şerif à Istanbul)
Les œuvres à caractère charitable
Safiyye Sultane précise régulièrement que lorsque ses stipulations cesseront d’être
applicables, en raison de l’extinction des lignées par exemple, l’argent prévu pour chaque
réalisation, reviendra aux pauvres musulmans. Il s’agit-là d’une clause relativement banale,
qui n’est pas toujours mise par écrit dans les vakfiyye. Un point doit être souligné : si
multiples soient’ elles, chacune de ses vakfiyye est autonome l’une de l’ autre, ce n’est que
l’argent prévu par telle vakfiyye, pour telle action, qui reviendrait aux pauvres, à la disparition
des bénéficiaires, et non l’ensemble de l’argent doté au cours de ses diverses actes de
fondations. La distinction est importante, attendu que le nombre et la liste des bénéficiaires
peut varier d’une vakfiyye à l’autre, certaines étant ainsi susceptibles d’arriver à terme plus tôt
que d’autres.
Ce n’est qu’à partir de mars 1756 que Safiyye Sultane prend de réelles mesures, bien
qu’en proportions très limitées, en faveur des pauvres des Villes Saintes (Médine et La
Mecque) : pour un montant de 150 kuruş par an (10 mars 1750), de 70 pièces d’or par an au
total (18 déc. 1752), augmenté de 20 pièces d’or par an au total (3 nov. 1753)
Les œuvres en faveur de la famille
Rentes et biens tasarruf :
Safiyye Sultane ne semble pas avoir accordé de rentes à qui que ce soit. Cependant, elle a
constitué une série de biens tasarruf, d’abord pour elle-même, puis pour sa fille, ses
descendants, au titre de ses propres résidences :
- son palais Şah-ı Huban
- son yalı à Üsküdar
Page | 746
- son yalı à Beşiktaş
Charges :
# Vekil :
1720 : son gendre Süleyman Beyefendi
20 déc. 1725: Mehmed Efendi bin Husameddin (son kethuda)
15 nov. 1739: - Mustafa Ağa ibn Abdulkerim (son başağalar)
- Mustafa Ağa ibn Abdulkerim (son başağalar)
19 nov. 1739: - Şatır Mehmed Çelebi ibn Yusuf
- Şatır Mehmed Çelebi ibn Yusuf
26 oct. 1741: - son gendre Süleyman Beyefendi
- son gendre Süleyman Beyefendi
30 juin 1742: - son gendre Süleyman Beyefendi
- son gendre Süleyman Beyefendi
19 janv. 1748: - son gendre Süleyman Beyefendi (son kethuda)
- son gendre Süleyman Beyefendi (son kethuda)
- son gendre Süleyman Beyefendi (son kethuda)
23 nov. 1750: - son gendre Süleyman Beyefendi
6 sept. 1751 : - son gendre Süleyman Beyefendi (son kethuda)
18 déc. 1752 : - son gendre Süleyman Beyefendi (son kethuda)
- son gendre Süleyman Beyefendi (son kethuda)
- son gendre Süleyman Beyefendi (son kethuda)
30 mars 1753: - son gendre Süleyman Beyefendi (son kethuda)
2 sept. 1753 : - son gendre Süleyman Beyefendi (son kethuda)
- son gendre Süleyman Beyefendi (son kethuda)
3 nov. 1753 : - son gendre Süleyman Beyefendi (son kethuda)
5 mars 1754: - son gendre Süleyman Beyefendi (son kethuda)
- son gendre Süleyman Beyefendi (son kethuda)
30 avril 1757 : - son gendre Süleyman Beyefendi (son kethuda)
6 juin 1762 : - Elhac Ömer bin Mahmud
26 août 1762 : - son gendre Süleyman Beyefendi (son kethuda)
# Mütevelli :
1720 : Elhac Mustafa bin Hasan
nov. 1725 : Mehmed Efendi ibn Husameddin (son kethuda)
20 déc. 1725: - Ahmed Efendi ibn Ahmed
- Mehmed Efendi ibn Husameddin (son kethuda)
28 déc. 1725 : - Mehmed Efendi ibn Husameddin (son kethuda)
- Mehmed Efendi ibn Husameddin (son kethuda)
- Mehmed Efendi ibn Husameddin (son kethuda)
- Mehmed Efendi ibn Husameddin (son kethuda)
- Mehmed Efendi ibn Husameddin (son kethuda)
- Mehmed Efendi ibn Husameddin (son kethuda)
15 nov. 1739: - Elhac Mustafa Ağa ibn Elhac Musalli
- Osman Beyefendi ibn Kara Mustafa Pacha (son kethuda)
- Osman Beyefendi ibn Kara Mustafa Pacha (son kethuda)
- Elhac Mustafa Ağa ibn Elhac Musalli
- Osman Beyefendi ibn Kara Mustafa Pacha (son kethuda)
Page | 747
- Osman Beyefendi ibn Kara Mustafa Pacha (son kethuda)
- Osman Beyefendi ibn Kara Mustafa Pacha (son kethuda)
- Osman Beyefendi ibn Kara Mustafa Pacha (son kethuda)
- Osman Beyefendi ibn Kara Mustafa Pacha (son kethuda)
- Osman Beyefendi ibn Kara Mustafa Pacha (son kethuda)
- Osman Beyefendi ibn Kara Mustafa Pacha (son kethuda)
- Osman Beyefendi ibn Kara Mustafa Pacha (son kethuda)
16 nov. 1739: - Osman Beyefendi ibn Kara Mustafa Pacha (son kethuda)
- Osman Beyefendi ibn Kara Mustafa Pacha (son kethuda)
19 nov. 1739: - Osman Beyefendi ibn Kara Mustafa Pacha (son kethuda)
- Osman Beyefendi ibn Kara Mustafa Pacha (son kethuda)
- Osman Beyefendi ibn Kara Mustafa Pacha (son kethuda)
- Osman Beyefendi ibn Kara Mustafa Pacha (son kethuda)
26 oct. 1741: - Elhac Mustafa Efendi ibn Hasan
- Elhac Mustafa Efendi ibn Hasan
10 mars 1750: - Elhac Mustafa
23 nov. 1750: - Elhac Mustafa
6 sept. 1751 : - Mustafa
18 déc. 1752 : - Salih Efendi bin Ismail
- Salih Efendi bin Ismail
- Seyyid Elhac Musa Halife ibni Elhac Mehmed
30 mars 1753: - Seyyid Elhac Musa Halife ibni Elhac Mehmed
3 nov. 1753 : - Ahmed Ağa ibn Veli
30 avril 1757 : - son gendre Süleyman Beyefendi (son kethuda)1
- Ibrahim Efendi ibn Mustafa (son katib)
6 juin 1762 : - son gendre Süleyman Beyefendi (son kethuda)
24 août 1762 : - Ibrahim Efendi ibn Elhac Mustafa
26 août 1762 : - Ibrahim Efendi ibni Elhac Mustafa
# Tevliyet :
20 déc. 1725: Mehmed Efendi bin Husammedin, puis les descendants de Safiyye Sultane, puis
la lignée de ses affranchis
15 nov. 1739: - Elhac Mustafa Ağa ibn Elhac Musalli, puis les descendants de Safiyye
Sultane, puis la lignée de ses affranchis
- les kethuda de la princesse (qui que ce soit), puis les descendants de Safiyye
Sultane, puis la lignée de ses affranchis
26 oct. 1741: - Elhac Mustafa Efendi ibn Hasan, puis les descendants de Safiyye Sultane,
puis la lignée de ses affranchis
10 mars 1750: - Safiyye Sultane, puis sa fille Zahide, puis ses descendants, puis la lignée de
ses affranchis
# Nezaret :
Pour toutes les vakfiyye, il s’agit du chef des eunuques noirs du harem impérial.
# Katib + Cabi :
1 Le terme exact employé est « vakf-ı kaimmakam » et non « mütevelli ».
Page | 748
Les vakfiyye, qui les mentionnent, accordent ces deux tâches à une seule personne, qui reçoit
néanmoins, le salaire respectif pour chaque poste.
Lorsque précision est faite à leur sujet, il est juste dit que la personne choisie doit l’être sur
connaissance et acceptation de la sultane.
Une seule personne semble avoir été nommée à ce poste, un certain Teberdar Musa Çelebi /
Halife (parfois türbedar), encore appelé Seyyid Elhac Musa, Seyyif Elhac Musa Halife. On le
retrouve à de nombreuses reprises dans les témoins des actes de fondation, puis en tant que
mütevelli à partir de décembre 1752.
Les aspects financiers
Type de
revenu
Quantité Localisation Coût de
location
Valeur Divers
Domanial
- karye - 4 - kasaba d’Eyrimen,
Roumélie
- mukataa de 3000
a/an chacun
- çiftlik - 1
- 1
- Roumélie (kaza Ibrail)
- Roumélie (kaza Kazra
ou Kartıne, Morée)
- dit ‘vizir-i azam
Mustafa Paşa çiftliği’
- dit ‘Laste çiftliği’
ou ‘Lastoc çiftliği’
- mezraʿ
- autre :
Immobilier
- menzil2 - 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- Ist. (Çukur)
- Ist. (Davud Paşa)
- Eyüp (Bıçakcı)
- Ist. (Zeytun/Zeytunî)
- Ist. (Zeytun/Zeytunî)
- Ist. (Hacibe Hatun)
- Ist. (Mirahur)
- Ist. (Bascı)
- Ist. (Nuri Dede)
- Ist. (Mirahor)
- Ist. (Nuri Dede)
- Ist. (Ali Fakih)
- Ist. (Ibrahim Paşa)
- Ist. (Ibrahim Çavuş)
- Ist. (Sultan Bayezid)
- Ist. (Ördek Kasab)
- Ist. (Mirahor)
- Ist. (Sultan Bayezid)
- Ist. (Toptaşı)
- Ist. (Karabaş)
- Ist. (Seydi Ali Halife)
- Ist. (Elhac Ilyas)
- 200 kş + 2 a/jr
-150 kş + 1,5 a/jr
- 200 kş + 2 a/jr
- 200 kş + 1 a/jr
- 300 kş + 3 a/jr
- 100 kş + 1 a/jr
-250 kş + 2,5 a/jr
- 100 kş + 1 a/jr
- 100 kş + ???
-300 kş + 1,5 a/jr
-100 kş + 0,5 a/jr
- 100 kş + 1 a/jr
- 85 kş + 1 a/jr
- 200 kş + 1 a/jr
- 100 kş + 1 a/jr
- 200 kş + 1 a/jr
-300 kş + 1,5 a/jr
- 200 kş + 1 a/jr
- 300 kş + 1 a/jr
- 100 kş + 1 a/jr
- 100 kş + 1 a/jr
- 400 kş
- 300 kş
- 400 kş
- 400 kş
- 600 kş
- 200 kş
- 500 kş
- 200 kş
- 150 kş
- 400 kş
- 170 kş
- 290 kş
- 185 kş
- 295 kş
- 450 kş
- 297 kş
- 400 kş
- 187 kş
- 185 kş
2 La dernière vakfiyye que nous possédons de Safiyye Sultane, datée d’août 1762, établit un résumé de plusieurs
anciens actes de fondation. Elle donne un total de 27 menzil, ce qui ne correspond pas à notre propre relevé. De
plus, les localisations mentionnées ne sont pas non plus les mêmes que celles relevées auparavant. Deux
hypothèses sont envisageables : il peut y avoir eu des échanges de menzil, dont les ordres ne nous sont pas
connus, qui nous feraient perdre le fil des investissements, ou bien cette dernière vakfiyye n’est pas complète, du
point de vue des revenus. Pour ma part, dans la mesure où elle ne mentionne pas nombre d’autres revenus, ni
aucune des utilités religieuses de la princesse, il me semble qu’il ne faille pas considérer ce document comme un
résumé pertinent, même partiellement. Par ailleurs, son état de conservation est relativement mauvais, et
l’ensemble du document n’a pas pu être déchiffré.
Page | 749
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 3
- 2
- 1
- 1
- Ist. (Keçeci Piri ou
Gececi Peri)
- Ist. (………..)
- Ist. (Aşcıbaşı)
- Ist. (Çerağı Hasan)
- Ist. (Ibrahim Paşa,
intérieur de Sulurikapısı)
- Ist. (Kurt Mahmud
Kalesi)
- Ist. (Eyyüb Kethuda)
- Ist. (Semkeş Hacı
Sinan)
- Ist. (Defterdar Ahmed
Çelebi)
- Ist. (Tercüman Yunus)
- Ist. (Katib Muslihuddin)
- 200 kş + 1 a/jr
-500 kş + 2,5 a/jr
- 290 kş
- 680 kş
- yalı - 1
- 1
- Üsküdar (Sılacık)
- Galata (Beşiktaş)
- ?? + 6 a/jr ou
50 a/jr3
- ?? + 6 a/jr ou
50 a/jr4
- attenant au palais de
Hatice Sultane ; son
bien tasarruf
- sur terrain vakf de
Bayezid II (95 a/an
de mukataa) ; son
bien tasarruf
- ev
- oda - 6 - Ist. (Kalıcacılar Köşkü)
- hüccre
- boutique - 1
- 2
- Ist. (Kalıcacılar Köşkü)
- Ist.(Koca Mustafa Paşa)
- 200 kş + 1 a/jr
- 290 kş
- autre :
> hamam
> terrain
vacant
- 1
- 1
- Ist. (Defterdar Ahmed
Çelebi)
- Ist., à proximité de son
palais
- double ; attenant à
son palais
Financier
- biens en
nature
- argent liquide
(prêt)
- 1500 kuruş - taux prévu de 11
% ; argent réinvesti
ensuite dans l’achat
de menzil
Cas particuliers
- jardins - 1 - Ist. (Defterdar Ahmed
Çelebi)
- attenant à son palais
- lieux de
plaisance
- saray - 1 - Ist. (Kaliceciler Köşkü) - ??? + 20 a/jr - « Şah-ı Huban
sarayı »; initialement
un « grand menzil » ;
son bien tasarruf
3 Deux documents, de la même date (18 déc. 1752), nous donnent des informations différentes : le premier
précise 6 aspres par jour d’icare-i müeccele, le second 50. Par ailleurs, le premier précise qu’il s’agit d’un bien
tasarruf de la princesse, tandis que le second demeure silencieux sur ce sujet. 4 Idem
Page | 750
Les sources
VGMA D 46 n° 34 : 1133 (1720)
VGMA D 734 n° 165 : 1138 (28 nov. 1725)
VGMA D 734 n° 164 : 1138 (20 déc. 1725)
VGMA D 734 n° 171 : 1138 (20 déc. 1725)
VGMA D 734 n° 166 : 1138 (28 déc. 1725)
VGMA D 734 n° 167 : 1138 (28 déc. 1725)
VGMA D 734 n° 168 : 1138 (28 déc. 1725)
VGMA D 734 n° 169 : 1138 (28 déc. 1725)
VGMA D 734 n° 170 : 1138 (28 déc. 1725)
VGMA D 734 n° 172 : 1138 (28 déc. 1725)
VGMA D 46 n° 12 : 1152 (15 nov. 1739)
VGMA D 46 n° 13 : 1152 (15 nov. 1739)
VGMA D 46 n° 30 : 1152 (15 nov. 1739)
VGMA D 736 n° 52 : 1152 (15 nov. 1739)
VGMA D 736 n° 53 : 1152 (15 nov. 1739)
VGMA D 736 n° 54 : 1152 (15 nov. 1739)
VGMA D 736 n° 55 : 1152 (15 nov. 1739)
VGMA D 736 n° 56 : 1152 (15 nov. 1739)
VGMA D 736 n° 57 : 1152 (15 nov. 1739)
VGMA D 736 n° 58 : 1152 (15 nov. 1739)
VGMA D 736 n° 59 : 1152 (15 nov. 1739)
VGMA D 736 n° 60 : 1152 (15 nov. 1739)
VGMA D 736 n° 61 : 1152 (16 nov. 1739)
VGMA D 736 n° 62 : 1152 (16 nov. 1739)
VGMA D 736 n° 63 : 1152 (19 nov. 1739)
VGMA D 736 n° 64 : 1152 (19 nov. 1739)
VGMA D 736 n° 65 : 1152 (19 nov. 1739)
VGMA D 736 n° 66 : 1152 (19 nov. 1739)
VGMA D 46 n° 31 : 1154 (26 oct. 1741)
VGMA D 736 n° 71 : 1154 (26 oct. 1741)
VGMA D 46 paragraphe 2 : 1155 (30 juin 1742)
VGMA D 736 n° 72 : 1155 (30 juin 1742)
VGMA D 46 n° 33: 1161 (19 janv. 1748)
VGMA D 736 n° 73 : 1161 (19 janv. 1748)
VGMA D 46 n° 45 : 1163 (10 mars 1750)
VGMA D 738 n° 29 : 1163 (10 mars 1750)
VGMA D 738 n° 28 : 1163 (23 novembre 1750)
VGMA D 46 n° 36 : 1164 (6 sept. 1751)
VGMA D 738 n° 27 : 1164 (6 sept. 1751)
VGMA D 46 n° 37 : 1166 (18 déc. 1752)
VGMA D 738 n° 35 : 1166 (18 déc. 1752)
VGMA D 738 n° 37 : 1166 (18 déc. 1752)
VGMA D 46 n° 42 : 1166 (30 mars 1753)
VGMA D 46 n° 38 : 1166 (2 sept. 1753)
VGMA D 738 n° 39 : 1166 (2 sept. 1753)
VGMA D 46 n° 40 : 1167 (3 nov. 1753)
VGMA D 46 n° 39 : 1167 (5 mars 1754)
VGMA D 736 n° 68 : 1167 (5 mars 1754)
Page | 751
VGMA D 46 n° 41 : 1168 (10 déc. 1754)
VGMA D 46 n° 35 : 1170 (30 avril 1757)
VGMA D 738 n° 23 : 1170 (30 avril 1757)
VGMA D 734 n° 172 Derkenar : 1175 (6 juin 1762)
VGMA D 46 n° 11 : 1176 (24 août 1762)
VGMA D 46 n° 43 : 1176 (26 août 1762)
Page | 752
LEGS PIEUX DE ZAHIDE HANIM SULTANE
La famille
Les constructions et réalisations architecturales
Aucune construction mentionnée précisément, mais, d’après une phrase concernant le surplus
de son vakf, elle aurait peut-être entrepris la construction d’un mescid, d’un mekteb et d’une
fontaine (çeşme). Elle prévoit, en tout cas, qu’une partie du surplus sera utilisé pour les
réparations de ces différents édifices, sans préciser ni lesquels, ni de qui ils sont. Elle fait
visiblement référence à un document antérieur, qui ne nous est pas parvenu – ou qui n’a pas
encore été retrouvé.
Les œuvres à caractère religieux
L’essentiel de l’action de Zahide Hanım Sultan consiste en œuvres religieuses :
# Financement de cours
- dans la mosquée de Molla Şeref (Istanbul) [apprentissage du Coran] : 1163
- dans la mosquée Öksüzce (Istanbul) : 1163
# Récitations de prières et lecture du Coran :
- pour elle-même, mosquée Sofiler
- pour son père, Mirza Mehmed Pacha, Sainte-Sophie
- pour Fahri Usta, ancien serviteur de son père, mosquée de Mehmed II
# Conseils religieux :
- mosquée Sofiler (Istanbul)
# Soutien financier à des établissements déjà existants :
- la mosquée Sofiler (paiement du salaire de plusieurs employés)
- la mekteb du quartier de Seydi Bey (paiement du salaire du hoca et du charbon pour
l’hiver)
Safiyye Mirza Mehmed P.
MUSTAFA II
Zahide HS. Süleyman Be.
Ebubekir P.
Page | 753
Les œuvres à caractère charitable
L’autre facette de son action consiste en des dons d’argents, destinés à venir en aide aux
pauvres des Villes Saintes, mais à prélever sur le surplus :
- 150 kuruş par an (1163)
- Augmentation en 1166 : 200 kuruş par an (100 pour la Mecque, 100 pour Medine)
- Nouvelle augmentation en 1177 : 250 kuruş par an au total
- Nouvelle augmentation en 1189 : 260 kuruş par an
- Nouvelle augmentation en 1196 : 350 kuruş par an (auxquels viendront s’ajouter 500
kuruş annuel, après le décès d’une affranchie à laquelle Zahide accordait une rente)
Les œuvres en faveur de la famille
Rentes :
Nayab Hatun recevra une rente annuelle de 500 kuruş jusqu’à sa mort, l’argent devant ensuite
être ajouté à celui destiné aux pauvres des Villes Saintes.
Charges :
# Vekil :
1163 : Süleyman Beyefendi
1166 : id.
1170 : Elhac Ahmed Ağa ibn Veli, son kethüda des teberdaran (x2)
1175 : id.
1176 : Süleyman Beyefendi (x2)
1176 : Hafız Ibrahim Efendi ibn Elhac Mustafa (x2)
1177 : Süleyman Beyefendi
1189 : id.
1196 : id.
# Mütevelli :
1163 : Elhac Mustafa
1170 : Süleyman Beyefendi (x2) => kaymakam-i mütevelli
1175 : elle-même
1176 : Ibrahim Efendi ibn Elhac Mustafa (x2)
1176 : Süleyman Beyefendi (x3)
1189 : Mevlana Elhac Ibrahim Efendi ibn Halil
# Tevliyet :
Elle-même, puis sa mère, puis ses descendants, puis son époux, puis ses parents (akraba) et
leurs descendants, puis ses affranchis et leurs descendants.
# Nezaret :
Le chef des eunuques noirs.
# Katib :
1163 : Seyyid Muhammed ibn Ahmed
1176 : Ibrahim Efendi ibn Mustafa (également vekil) (x2)
# Cabi :
1163 : Ahmed Halife bin Veli, son kethüda des teberdaran
Page | 754
Les aspects financiers
Type de
revenu
Quantité Localisation Coût de
location
Valeur Divers
Domanial
- karye
- çiftlik - 1
- 1
- kaza Ibrail, Rumeli,
près de Beştepe
- nahiye Ergani, Anatolie
- Dit « Mustafa Paşa
Çiftliği »
- mezraʿ
- autre :
Immobilier
- menzil - 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- Tarsus, Ist.
- Dursun, Ist.
- Tutu ou Dudu Latif, Ist.
- Cihangir, Ist. (près
Akarca, kasaba Tophane
– Galata)
- Tarsus, Ist.
- Elhac Ahmed, Ist.
(kasaba Kasımpaşa –
Galata)
- Defterdar Ahmed
Çelebi, Ist.
- Cihangir, Ist. (kasaba
Tophane – Galata)
- Defterdar Ahmed
Çelebi, Ist.
- Maçka, Ist. (kasaba
Beşiktaş - Galata)
- Maçka, Ist. (kasaba
Beşiktaş - Galata)
- 100 kuruş + 10
a./moi s
- 660 kur. + 1
a/jr
- 1045 kur. + 2
a/jr
- ? + 1 a/jr
- ? + 2 a/jr
- 500 kur. + 1
a/jr
- 600 kur. + ?
- ? + 1,5 a/jr
- ? + 20 a/mois
- ? + 20 a/mois
- 143 kur.
- 330 kur.
- 800 kur.
- 1300 kur.
- 600 kur.
- 720 kur.
(?)
- yalı
- ev
- oda
- hüccre
- boutique
- autre :
Financier
- biens en
nature
- des
cadeaux,
offerts par le
sultan
- argent liquide
Cas particuliers
- jardins
- lieux de
plaisance
- palais
Page | 755
Les sources
VGMA D 738 n° 26 : 1163 (mars 1750)
VGMA D 738 n° 24 : 1166 (avril 1753)
VGMA D 46 n° 46 : 1166 (avril 1753)
VGMA D 46 n° 50 : 1170 (décembre 1756)
VGMA D 46 n° 48 : 1170 (juillet 1757)
VGMA D 46 n° 52 : 1175 (février 1762)
VGMA D 46 n° 53 : 1176 (août 1762)
VGMA D 46 n° 54 : 1176 (août 1762)
VGMA D 46 n° 56 : 1176 (octobre 1762)
VGMA D 46 n° 55 : 1176 (janvier 1763)
VGMA D 46 n° 47 : 1177 (novembre 1763)
VGMA D 46 n° 58 : 1189 (mars 1775)
VGMA D 46 n° 59 : 1196 (mai 1782)
Page | 756
LEGS PIEUX DE FATMA SULTANE
La famille
Les constructions et réalisations architecturales
La vakfiyye conservée de Fatma Sultane et Ibrahim Pacha révèle la construction d’un
certain nombre de bâtiments :
- une medrese, servant également de dershane, à Istanbul, à proximité de la Şehzade
Camii (sur un terrain appartenant à la princesse), constituée de 13 cellules et d’une
salle de cours
- deux fontaines (une çeşme et une sebil), établies à proximité de la medrese
- une bibliothèque, située au même endroit
- enfin 45 boutiques, toujours dans le même quartier.
Outre le fait que toutes ces constructions sont attribuées à la princesse elle-même, non à son
mari, il convient de noter que les réalisations des sont faites à un seul et même endroit
d’Istanbul, où elle bénéficiait de conditions favorables à cet effet ( détention de terrains).
Les œuvres à caractère religieux
Outre les réalisations susmentionnées, Fatma Sultane a également apporté son soutien
financier à diverses fondations préexistantes, en tous genres :
- la darüş-şifa fondée par Haseki Sultane dans le quartier d’Avretpazarı, à Istanbul
- le hamam de cette même fondatrice, situé à proximité
- la mosquée d’Ortaköy, construite par son époux
- le tekke de Beşiktaş
- le tekke de Vodena, en Roumélie
- la mosquée d’Eyüp
- le mescid de Baba Haydar à Eyüp
- la medrese de Cafer Pacha, à Eyüp
- la zaviyye de Koca Mustafa Pacha, à Istanbul
- le mekteb sis dans le quartier Elhac Hüsrev, à Eyüp
- la çeşme construite à proximité de la mosquée de Mehmed II
Fatma S. Ibrahim P. Ali P. Ahmed P.
Mustafa P. Y
Y Y Y Mustafa
P.
AHMED III
Page | 757
- la çeşme de la Porte Impériale des Janissaires
- la çeşme de l’Orta Camii
- la çeşme de Kethüda Kadın, près du Destereciyan pazarı
- le mescid d’Elhac Hasan, près du han de Mahmud Pacha
- la mosquée de Mirahor Yusuf Ağa, dans le village de Subaşı, sis en Anatolie dans le
kaza de Yalakabad
- la mosquée de Kılıç Ali Paşa à Beşiktaş
Elle a également ordonné la récitation de prières, en général et pour l’âme du
Prophète, dans divers lieux, avec une attention toute particulière pour les récitations faites à
La Mecque.
Les œuvres à caractère charitable
Mise à part la rédaction de la charte traditionnelle, stipulant que l’argent de la
fondation reviendrait aux pauvres des Villes Saintes après extinction des clauses prévues,
Fatma Sultane a entrepris une action charitable, visant à venir en aide financièrement à des
femmes et des membres du personnel de la darüş-şifa fondée par Haseki Sultane à
Avretpazarı, à Istanbul.
Les œuvres en faveur de la famille
Rentes :
Une rente est attribuée par la princesse aux descendants de Şeyh Elhac Mehmed résidant à La
Mecque, pour une somme annuelle de 10 sikke-i hasene.
A cela s’ajoute une rente dissimulée, destinée à 42 de ses affranchis résidant à La Mecque,
aussi bien hommes que femmes, en échange de la récitation de prières pour l’âme du
Prophète : ils se répartiront 266 aspres par jour, de façon équitable (soit une somme
individuelle de 6,33 aspres par jour).
Charges :
Dans la mesure où il s’agit d’une fondation commune avec son époux, sont mentionnés les
vekil (et leurs témoins) de chacun des deux fondateurs. Pour les autres charges, seule une
personne, nommée en accord avec les deux parties, est mentionnée.
# Vekil :
Süleyman Ağa ibni Mehmed, kethuda de la princesse, pour sa part; tandis que son époux,
Ibrahim Pacha, a nommé comme représentant son propre kethuda, Mehmed Ağa ibn Elhac
Mustafa Ağa.
# Mütevelli :
Osman Ağa, kethuda de la maisonnée du grand vizir.
Page | 758
# Tevliyet :
Le gendre d’Ibrahim Pacha, Mehmed Pacha > les descendants du grand vizir et époux de la
princesse > les affranchis de celui-ci et leurs descendants.
# Nezaret :
Le chef des eunuques noirs.
Les aspects financiers
Type de
revenu
Quantité Localisation Coût de
location
Valeur Divers
Domanial
- karye - 1
- 1
- Güzelhisar, Aydın
- Vazika, Karlıili
- dit Deronik
- dit Dragomisin
- çiftlik
- mezraʿ
- autre : - plusieurs
mukata’a
- Manastir (dans la ville),
sancak de Paşa
Immobilier
- menzil
- yalı
- ev
- oda
- hüccre
- boutique - 82 - Ist. (Şehzade Camii)
- autre :
Financier
- biens en
nature
- argent liquide
Cas particuliers
- jardins - 3 - Nakşe, cezairi bahri
sefit
- lieux de
plaisance
- palais
Page | 759
Les sources
Seule une vakfiyye a pu être trouvée dans l’ensemble des fichiers conservés au Vakiflar Genel
Müdürlüğü Arşivi :
VGMA D 38 n° 3 : 1141 (1729).
Il est intéressant de noter qu’il ne s’agit pas d’une vakfiyye personnelle à la princesse, mais
qui révèle une fondation commune avec son époux, Nevşehirli Ibrahim Pacha : l’influence de
son époux sur la fondation est d’ailleurs flagrante.
Notons encore l’existence de deux ordres relatifs au vakf de Fatma Sultane, qui ne sont
cependant pas des actes de fondations, et qui ne nous apportent aucun renseignement nouveau
quant à ses œuvres, qui ne soit connu par ailleurs. Il y est fait référence, entre autre, à une
mosquée attribuée à cette princesse : il s’agit, en fait, de la mosquée restaurée par cette
dernière, et qui prit par la suite son nom.
Quant aux revenus indiqués, il s’agit uniquement de ceux établis par la princesse – ceux-ci
n’étant très certainement pas complets.
Page | 760
LEGS PIEUX D’ESMA SULTANE
La famille
Les constructions et réalisations architecturales
Esma Sultane semble n’avoir ordonné que très peu de constructions architecturales.
Celles qui nous ont été révélées par les sources se limitent à un mekteb à Beşiktaş, à proximité
de son yalı / palais.
Les œuvres à caractère religieux
L’essentiel de l’œuvre d’Esma Sultane semble avoir consisté en fondations à caractère
religieux. Elles se divisent, cependant, en plusieurs catégories :
# le financement de conseils religieux (va’iz ve nasihat) à Istanbul
- dans la mosquée de Firuz Ağa, près de l’Atmeydanı
- dans la mosquée de Mimar Ayaş Ağa, près de la Şehzade Camii : au nom de sa mère
- dans la mosquée de Seyyid Mustafa Efendi, à Aksaray : au nom d’une de ses affranchies,
Hemnişin Kalfa
# le financement de cours religieux, dans diverses mosquées d’Istanbul
- dans la mosquée de Sainte-Sophie
- dans celle dite Bezzazı Cedid Camii
- dans la mosquée de Mehmed II : au nom d’une de ses affranchis, Ruhveş Hanım / Kalfa
binti Abdullah !
# la récitation de prières
- pour son mari, Muhsinzade Mehmet Pacha, dans la Cedide Valide Sultan Camii
Esma Muhsinzade Mehmet P.
Sadıka Kadın AHMED III
Page | 761
Les œuvres à caractère charitable
Comme dans la plupart des vakfiyye du 18e siècle, il est stipulé que l’argent reviendra
aux pauvres musulmans, dès lors que les clauses prescrites ne pourront plus être remplies.
A cela la fondatrice a ajouté – pratique, elle aussi, très répandue – une aide financière,
à prévoir sur le surplus des revenus du vakf.
Les œuvres en faveur de la famille
Rentes :
De façon relativement inhabituelle, Esma Sultane constitue un bien mülk comme
tasarruf pour une de ses esclaves, Ruhveş Kalfa binti Abdullah, dont le revenu mensuel est
estimé à 400 aspres. Cette Ruhveş réapparaît à plusieurs reprises au cours des vakfiyye
d’Esma Sultane, tantôt en tant que partenaire commerciale, tantôt en tant que bénéficiaire en
titre, de cours financés par la princesse.
Charges :
# Vekil :
- 15 sept. 1763 : Ali Ağa ibniAbdurrahim
- 20 oct. 1764 : Ahmet Beyefendi bin Kasım Ağa
- 4 mars 1765 : Elhac Mustafa Efendi bini Yahya Ağa
- 20 fev. 1767 : Elhac Mustafa Efendi bini Elhac Yahya Efendi
- 14 mai 1770 : Mehmet Efendi
- 2 juin 1770 : Mehmet Efendi
- 23 août 1771 : Elhac Mehmed Efendi ibn Elhac Yahya
- 10 mai 1773 : Çelebi Mehmed Efendi ibn Elhac Yahya Efendi (x2)
- 29 jlt 1773 : Çelebi Mehmed Efendi ibn Elhac Yahya
- 1er
mai 1775 : Çelebi Mehmed Efendi ibn Elhac Yahya Efendi
- 1er
avril 1776 : Elhac Mehmed Efendi ibn Elhac Abdurrahman
- 6 août 1776 : Çelebi Mehmed Efendi ibn Elhac Yahya Ağa
- 7 mai 1777 : Elhac Hasan Ağa ibn Mehmet
- 21 avril 1778 : Çelebi Mehmet Efendi (pour la vakfiyye où il n’est pas nommé mütevelli)^
# Mütevelli :
- 15 sept. 1763 : Elhac Osman ibni Ahmet
- 4 mars 1765 : Hafız Mahmut Efendi ibn Elhac Mustafa
- 20 fev. 1767 : Seyyid Mehmed Ağa ibn Yusuf
- 23 août 1771 : Elhac Mehmed Efendi ibn Elhac Yahya
- 10 mai 1773 : Hafız Mehmet (Mahmut ?) Efendi bin Mustafa (x2)
- 1er
mai 1775 : Mustafa Ağa ibni Hasan
- 1er
avril 1776 : Çelebi Mehmed Efendi ibn Elhac Yahya Ağa
- 6 août 1776 : Halil Efendi ibn Ahmed Efendi
- 13 mai 1776 : Çelebi Mehmed Efendi ibn Elhac Yahya Ağa
- 7 mai 1777 : Mehmet Sait Efendi bini Elhac Mehmet Efendi et Çelebi Mehmed Efendi (x2)
- 3 avril 1778 : Çelebi Mehmet Efendi
Page | 762
- 21 avril 1778 : Çelebi Mehmet Efendi (x2) et Mehmet Ağa ibn Osman
# Tevliyet :
- 15 sept. 1763 : elle-même, puis ses descendants, puis la lignée de ses affranchis, finalement
quelqu’un choisi par le nazır
- ? date inconnue ? : elle-même, puis la lignée de ses affranchis, puis sur choix du nazır
- 1er
avril 1776 : elle-même, puis son kethuda actuel Çelebi Mehmed Efendi, puis la lignée de
ses affranchis, puis sur choix du nazır
# Nezaret :
Le nazır de l’ensemble de ses fondations est le chef des eunuques noirs.
Les aspects financiers
Type de
revenu
Quantité Localisation Coût de
location
Valeur Divers
Domanial
- karye
- çiftlik - 1
- 1
- 2
- 1
- 1
- 1
- 1
- Teygoz (kaza Havass-ı
Refia)
- Havarız (kaza d’Edirne)
- Firuz (kaza Havass-ı
Refia, nahiye Çekmece-i
Sağir)
- ? (kaza Karatine,
Morée)
- ? (kaza Fenar, Morée)
- ? (kaza Silivri)
- ? (kaza Silivri)
- près de Davud Paşa
Sarayı
- dit ‘Ebekadın
çiftliği’
- dit ‘Valteşenki
çiftliği’
- dit ‘Idrice çiftliği’
- dit ‘Papazlı çiftliği’
- dit ‘Belnâmlı
çiftliği’
- mezraʿ
- autre :
Immobilier
- menzil - 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 2
- 2
- Ist. (Servi, près Mahmut
Paşa Veli Camii)
- Sakır Ceziresi
- Ist. (Firuz Ağa, près de
Kırkçeşme)
- Ist. (Mahmud Paşa)
- Eyüp (Servî)
- Eyüp (Zeyneb Hatun)
- Ist. (Saraç Ishak, près
Kumkapı)
- Galata (Beşiktaş,
Ekmekcioğlu deresi, près
Kuruçeşme)
- Galata (Beşiktaş,
Ekmekcioğlu deresi, près
Kuruçeşme)
- 400 kş + 1 a/jr
- 700 kş + 1 a/jr
- ?? + 200 a/mois
- 500 kş + 2 a/jr
- dont 1 à 2000
kş + 30 a/mois
- ?? + 1 a/jr pour
chacun des 2
- 500 kş
- 850 kş
- 1 000 kş
- dit ‘Otra’
- sur le vakf
d’Haydar Çavuş : 45
a/an de mukata’a
Page | 763
- yalı/sahilhane - 1 - Galata (Beşiktaş,
Ekmekcioğlu deresi, près
Kuruçeşme)
- ?? + 30 a/jr
- ev
- oda
- hüccre
- boutique - 8 - Ist. (Kadırga limanı) - 600 kş + 40
a/mois
- 900 kş - au pied de son
palais
- autre :
> matbah
> tavukluk /
ahor
- 1
- 3
- Galata (Beşiktaş,
Ekmekcioğlu deresi, près
Kuruçeşme)
- Galata (Beşiktaş,
Ekmekcioğlu deresi, près
Kuruçeşme)
- ?? + 1 a/jr
- ?? + 1 a/jr pour
le 1er
/ 3 a/jr pour
les 2 autres
- selamlık matbah +
réservoir d’eau
- les 2 plus chers
attenants à 2 menzil
Page | 764
Type de
revenu
Nombre Localisation Location
détention
Valeur Divers
Financier
- biens en
nature
- argent liquide
Cas particuliers
- jardins - 1
- 1
- 1
- 2
- Eyüp (Bıçakçı Ferhad)
- Galata (Beşiktaş,
Ekmekcioğlu deresi, près
Kuruçeşme
- Galata (Tophane, Firuz
Ağa)
- Üsküdar (près Maltepe)
- ?? + 200 a/mois
- ?? + 3 a/jr
- lieux de
plaisance
- palais - 1
- 1
- Beşiktaş
- Ist. (Kadırga limanı)
- ?? + 17 a/jr
- dit « Süleyman
sarayı » / terrain d’un
autre vakf : 600 a/an
de mukata’a / + un
terrain vacant
- son tasarruf
Les sources
VGMA D 740 n° 50 : 7 R.e 1177 (15 sept. 1763)
VGMA D 740 n° 51 : 23 R.a 1178 (20 oct. 1764)
VGMA D 740 n° 212 : 11 Ram. 1178 (4 mars 1765)
VGMA D 741 n° 154 : 21 Ram. 1180 (20 fev. 1767)
VGMA D 741 n° 149 : 18 Muh. 1184 (14 mai 1770)
VGMA D 741 n° 150 : 7 Sa. 1184 (2 juin 1770)
VGMA D 741 n° 151 : 12 Cem.ev. 1185 (23 août 1771)
VGMA D 741 n° 152 : 17 Sa. 1187 (10 mai 1773)
VGMA D 741 n° 153 : 9 Cem.ev. 1187 (29 jlt 1773)
VGMA D 741 n° 155 : 29 Sa. 1189 (1er mai 1775)
VGMA D 741 n° 156 et 156-1 : 11 Sa. 1190 (1er avril 1776)
VGMA D 741 n° 158 : 20 Cem.a. 1190 (6 août 1776)
VGMA D 741 n° 157 : 24 R.e. 1190 (13 mai 1776)
VGMA D 741 n° 194 : 29 R.e. 1191 (7 mai 1777)
VGMA D 741 n° 195 : 29 R.e. 1191 (7 mai 1777)
VGMA D 741 n° 196 : 29 R.e. 1191 (7 mai 1777)
VGMA D 741 n° 198 : 5 R.e. 1192 (3 avril 1778)
VGMA D 741 n° 197 : 23 R.e. 1192 (21 avril 1778)
VGMA D 741 n° 199 : 23 R.e. 1192 (21 avril 1778)
VGMA D 741 n° 218 : 23 R.e. 1192 (21 avril 1778)
Page | 765
LEGS PIEUX D’AYŞE SULTANE
La famille
Les constructions et réalisations architecturales
Dans les trois documents qui nous sont parvenus, seule la construction d’une fontaine
(çeşme) est mentionnée.
Les œuvres à caractère religieux
L’essentiel des prescriptions établies par Ayşe Sultane concerne des œuvres à
caractère religieux, parmi lesquelles se trouvent le financement de conseils religieux, dans la
mosquée de Daye Hatun à Istanbul, mais surtout la récitation de prières, pour son âme et celle
de son père, dans la mosquée de la Valide Sultane à Bahçekapısı.
Les œuvres à caractère charitable
Ayşe Sultane ne prévoit rien de particulier, si ce n’est l’utilisation de l’argent du vakf
au cas où les clauses établies ne seraient plus applicables.
Les œuvres en faveur de la famille
Charges :
# Vekil :
1736 : Elhac Ömer Ağa ibn Derviş (son kethuda)
1743 : Elhac Abdullah Ağa ibn Mehmed
1776 : Mehmed Nuri Beyefendi, son gendre et hacegan du conseil impérial
# Mütevelli :
Ayşe ABDULHAMID
Rukiye H.S. Mehmed Nuri B.
Efendi
AHMED III
Page | 766
1736 : Abdulkerim Ağa ibn Muharrem
1743 : idem
# Tevliyet :
1736 : elle-même
1776 : elle-même, puis sa fille Rukiye Hanım Sultane, puis ses descendants
# Nezaret :
Le chef des eunuques noirs, dont la nomination est répétée dans les différents documents.
Les aspects financiers
Type de
revenu
Quantité Localisation Coût de
location
Valeur Divers
Domanial
- karye - 1 - Iznikmid - 30 000 a/an - « Koru »
- çiftlik - 1
- 1
- Silivri
- Ankara, Kara Ilyaslı
- 10 000 a/an
- 36 000 a/an
- « Kara Hasanoğlu
çiftliği »
- « Muhatlı çiftliği »
- mezraʿ
- autre :
Immobilier
- menzil
- yalı
- ev
- oda
- hüccre
- boutique
- autre : - 3 moulins - Iznikmid - 12 000 a/an
Financier
- biens en
nature
- argent liquide
Cas particuliers
- jardins - 3 - Eyüp (Taşlıburun) - respectivement
12 000, 6 000 et
2 000 a/an
- lieux de
plaisance
- palais
Soit un revenu total à l’année de 108 000 aspres
Les sources
VGMA D 735 n° 93 : 1149 (1736)
VGMA D 737 n° 43 : 1156 (1743)
VGMA D 741 n° 141 : 1189 (1776)
Page | 767
LEGS PIEUX DE SALIHA SULTANE
La famille
Les constructions et réalisations architecturales
Aucune construction n’est mentionnée dans l’ensemble des documents relatifs à
l’œuvre de bienfaisance de Saliha Sultane.
Les œuvres à caractère religieux
Si elle n’a pas entrepris de constructions, Saliha Sultane a toutefois contribué à établir
de nombreuses oeuvres religieuses, telles que :
# le soutien financier à divers espaces religieux déjà construits :
- la mosquée d’Eyüp
- celle d’Elhac Mustafa, dans le village en Anatolie appelé Bucaler, sis dans le district
de Yabanabad
# le financement de cours religieux (enseignement et récitation du Coran compris), dans des
espaces religieux déjà existants :
- dans la mosquée de Mehmed II à Istanbul
- dans celle de Piri Pacha, à Istanbul
- dans le türbe d’Eyüp
- dans le türbe de son père, Ahmed III, dans l’enceinte de la Yeni Valide Camii à
Istanbul
# le financement de conseils religieux :
- dans la mosquée de Selim Ier à Istanbul
- dans la mosquée de Koca Mustafa Pacha à Istanbul
- dans la mosquée d’Eyüp
# la récitation de prières, dans diverses mosquées d’Istanbul, dont celle d’Eyüp, au nom de sa
mère, Hacce Hanım Kadın.
Saliha
Hacce Hanım Kadın AHMED III
Page | 768
Les œuvres à caractère charitable
Mis à part la clause légale selon laquelle l’argent doit, en fin de clauses, revenir aux
pauvres musulmans, les documents ne révèlent aucune action relevant de l’ordre de la charité.
Les œuvres en faveur de la famille
Charges :
# Vekil :
1738 : Beşir Ağa ibn Abdülmuin (son başağa) x2
1740 : idem.
18 mars 1776 : Ahmed Ağa ibn Abdullah
11 avril 1776 : Ahmed Ağa ibn Abdurrahman (son başağa)
1778 : idem
# Mütevelli :
1738 : Mehmet Ağa (son kethuda) x2
1740 : idem
18 mars 1776 : Yahyapaşazade Ali Bey (son kethuda et un des kapucubaşı de la Porte)
11 avril 1776 : idem
1778 : idem
# Tevliyet :
1738 : - elle-même, puis ses descendants
- elle-même, puis ses descendants ; ses affranchis puis leurs descendants
1740 : comme ci-dessus
# Nezaret :
Le nazır est, chaque fois, le chef des eunuques noirs.
Page | 769
Les aspects financiers
Type de
revenu
Quantité Localisation Coût de
location
Valeur Divers
Domanial
- karye
- çiftlik - 1 - Küçükçeşme
- mezraʻ
- autre :
Immobilier
- menzil - 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- Ist. (Cezeri Kasım Paşa,
près de Mahmud Paşa)
- kasaba Çekmece-i
suğra, kaza Havass-ı refia
- Galata (Kasım Paşa,
Yeleğirmeni)
- Ist. (Koruk Mahmud)
- Ist. (Hoca Rüstem,
Divanyolu)
- Ist. (Soğanağa)
- + jardin
- yalı
- ev
- oda
- hüccre
- boutique - 5 - Ist. (Hoca Rüstem,
Divanyolu)
- autre : - 1 tarla - Ist. (Yenibahçe) - dit Kuseyil tarlası
Financier
- biens en
nature
- argent liquide
Cas particuliers
- jardins - 2
- 2
- 1
- Göksu, kaza Yoroys,
près Anadolu hisarı
- kasaba Çekmece-i
suğra, kaza Havass-ı refia
- Eyüp (Otakçılar)
- « Sultan Beyazit
bahçesi » et « Hasan
Paşa bahçesi »
- mevzi dite kumsal
- palais
Les sources
VGMA D 736 n° 27-1 : 1151 (août 1738)
VGMA D 739 n° 138 : 1151 (août 1738)
VGMA D 739 n°139 : 1151 (fev. 1740)
VGMA D 741 n° 142 : 1190 (mars 1776)
VGMA D 741 n° 143 : 1190 (11 avril 1776)
VGMA D 736 n° 27-2 : 1190 (17 avril 1776)
VGMA D 741 n° 144 : 1190 (23 avril 1776)
VGMA D 747 n° 109 : 1192 (1778)
Une vakfiyye au moins, citée dans les documents, est manquante.
Page | 770
LEGS PIEUX DE ZEYNEB SULTANE
La famille
Les constructions et réalisations architecturales
Zeyneb Sultane est à l’origine de la construction d’un petit complexe religieux,
constitué d’une mosquée, d’un mekteb et d’une fontaine (sebil), à Istanbul, dans le quartier
Lale Hayreddin, près de Soğuk Çeşme.
Les œuvres à caractère religieux
Outre son complexe religieux, Zeyneb Sultane a ordonné d’autres œuvres religieuses,
telles que :
# le soutien financier pour certains membres du personnel de lieux de culte déjà existants :
- Sainte- Sophie
- Valide Sultane Camii, à Bağçekapısı
# des récitations de prières, notamment pour l’âme de sa sœur (ou demi-sœur) Atike Sultane
# le financement de cours religieux :
- dans la mosquée de Sainte-Sophie
- dans la Valide Sultane Camii, à Bağçekapısı
Enfin, il convient de noter la mention concernant l’organisation des fêtes religieuses
annuelles, données à l’occasion de la naissance du Prophète.
Les œuvres à caractère charitable
Les vakfiyye ne mentionnent aucune action charitable particulière, si ce n’est
l’utilisation du surplus pour soutenir les pauvres musulmans (sur le restant après réalisation
des divers travaux d’entretien ou restauration de son complexe) et l’utilisation complète des
revenus du vakf en leur faveur, après extinction des clauses.
Zeyneb
AHMED III
Page | 771
Les œuvres en faveur de la famille
Charges :
# Vekil :
1740 : Ibrahim Ağa
1769 : Ahmed Aga ibn Ali Efendi
1770: Ahmed Efendi ibn Abdullah
# Mütevelli :
1769 : Mehmed Efendi ibn Abdullah (ruznamceci)
1770: Seyyid Hasan Agaibn Hüseyin (son helvacılar ketudası)
# Tevliyet :
1740 : elle-même, puis ses kethuda.
1769 : elle-même, puis Melik Ahmed Paşa, kethuda de la Porte et ses descendants
1770 : elle-même puis ses kethuda
# Nezaret :
Chaque fois, le nazır est le chef des eunuques noirs du Harem impérial
# Katib :
1769 : Ahmed Efendi
1770: Ahmed Efendi ibn Abdullah (le même que précédemment, également vekil)
# Cabi :
1769 : Molla Abdi
Page | 772
Les aspects financiers
Type de
revenu
Quantité Localisation Coût de
location
Valeur Divers
Domanial
- karye
- çiftlik - 1 - près de Semendire, kaza
d’Üsküdar
- dit « merhume
Gevherhan Sultane
çiftliği »
- mezraʻ
- autre :
Immobilier
- menzil - 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- Eyüp (Şah Sultane)
- Ist. (Sahhaf Süleyman
- Ist. (Hopyar, près Hoca
Paşa)
- Ist. (Imam Ali, près
Bakkalı Mescidi)
- Galata (Kamer Hatun)
- Ist. (Hoca Hayreddin)
- Ist. (Elvanzade, près
Timurkapı)
- Ist. (Servi)
- Ist. (Ishak Paşa, près
Sainte-Sophie)
- Ist. (Akbıyık)
- Eyüp (quartier de la
grande mosquée, près
rivage)
- Ist. (Mustafa Bey)
- kasaba Beykoz
- Ist. (Yakub Ağa, près
Simkeşhane)
- kasaba Hasköy
(Kiremitçi Ahmed
Çelebi)
- Ist. (Mesih Paşayı Atik)
- Ist. (Koğacı Dede, près
Aksaray)
- ? + 4 a/jr
- ? + 37 a/jr
- ? + 10 a/jr
- ? + 1 a/jr
- ? + 1 a/jr
- ? + 1 a/jr
- ? + 1 a/jr
- ? + 2 a/jr
- ? + 3 a/jr
- ? + 3 a/jr
- ? + 2 a/jr
- ? + 4 a/jr
- ? + 2 a/jr
- yalı - 1
- 1
- 1
- 1
- Eyüp (Şah Sultane)
- Rumeli Hisarı (Elhac
Kemaleddin)
- Üsküdar (Kuzguncuk)
- Beşiktaş (Ortaköy)
- ? + 17 a/jr
- ? + 2 a/jr
- ? + 3 a/jr
- ? + 3 a/jr
- ev
- oda
- hüccre
- boutique - 50 (env.)
- 45
- Ist, près de Nuri Osman
Camii
- Ist. près du palais de la
princesse
- pour 25 d’entre
elles, 1 a/jr de
müeccele
chacune (soit 25
a/jr au total)
- autre : - 1 terrain de
menzil
- Ist. (Nakilli Mescid,
près de Paşakapısı)
- ? + 1,5 a/jr
Page | 773
Type de
revenu
Nombre Localisation Location
détention
Valeur Divers
Financier
- bien en
nature
- argent liquide
Cas particuliers
- jardins - 1
- 1
- 1
- 1
- village Sarlıca, dép.
Midilli
- village Kelemeye, id.
- Ist. (Iskender Paşa)
- Üsküdar (Reis, près
palais Feyzullah Efendi)
- ? + 0,5 a/jr
- lieux de
plaisance
- palais - 1 - Galata, Beşiktaş - ? + 20 a/jr - saray – sahilhane,
connu sous le nom de
Çırağan Yalısı =>
son bien
Les sources
VGMA D 736 n° 74 : 1153 (1740)
VGMA D 743 n° 80 : 1183 (1769)
VGMA D 743 n° 81 : 1184 (1770)
VGMA D 743 n° 82 : 1187 (1773)
Page | 775
BIBLIOGRAPHIE
Étant donné la multiplicité des sources et des études auxquelles nous avons eu recours pour
réaliser ce travail, nous avons opté pour une répartition thématique de la bibliographie qui
distingue, d’une part, les documents historiques (les sources) et, d’autre part, les travaux des
chercheurs en sciences sociales (l’historiographie), divisés eux-mêmes en sous-catégories.
Concernant les sources, les sous-divisions permettent d’isoler la documentation inédite
(manuscrite, en ottoman) de celle qui a fait l’objet de publications (translittérations de
l’ottoman en caractères latins ou éditions en caractères arabes). On trouvera en annexe un
grand nombre de textes et documents desquels nous avons ait usage, suivis de leur traduction.
La répartition des travaux historiographiques permet de mettre en valeur une ébauche non
exhaustive, mais que nous pensons tout de même assez complète, de la littérature concernant
les travaux sur les femmes et le genre dans le monde musulman à l’époque moderne. L’accent
a été mis principalement sur le monde ottoman, sans pour autant négliger certaines
contributions extérieures à cette société. Toutes les références indiquées n’ont pas
nécessairement été citées dans le texte, mais ont pu servir par ailleurs à construire notre
réflexion.
Enfin, nous avons choisi de distinguer les travaux relatifs à l’histoire ottomane, des travaux
extérieurs à cette société, qu’il s’agisse d’études de sociologie, d’anthropologie, ou encore de
recherches historiques sur des sociétés non ottomanes (sur les sociétés de cour européennes
notamment, ou encore sur les femmes et le genre dans d’autres aires culturelles ou à d’autres
époques).
Nous avons conscience qu’un tel choix rendra la consultation de la bibliographie plus
délicate ; nous croyons néanmoins que cette répartition a ses vertus et permettra, notamment,
une lecture plus rapide des fondements de notre réflexion.
Les références bibliographiques citées dans le texte sont mentionnées intégralement lorsqu’il
s’agit d’une première mention. Par la suite, afin d’éviter les répétitions inutiles, nous avons
pris le parti d’une mention éliptique du titre, qui en reprend les premiers mots ou ceux qui
sont les plus explicites (en turc, l’ordre des mots étant inversé, il s’agit généralement des
derniers). Dans certains cas, rares, où il existe plusieurs références d’un même auteur
commençant par les mêmes termes, ont alors été retenu les couples de mots les plus
significatifs. La raison de ce choix réside dans la volonté de permettre au lecteur de se faire
une idée immédiate des références invoquées. Nous reprochons, en effet, au système op. cit. et
id., ou encore au système américain (nom de l’auteur suivi de la date) d’imposer une
consultation systématique de la bibliographie générale pour permettre au lecteur de
comprendre, au cours de sa lecture, les références annoncées en notes. C’est un exercice
particulièrement fatigant dans le cas où il est fait référence à des auteurs prolixes, qui ont
publié plusieurs articles la même année, par exemple, ou qui ont à leur actif un grand nombre
d’ouvrages.
Page | 776
LES SOURCES
Sources inédites
o Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi (VGMA) :
D 38 n° 3 : 1141 (1729).
D 46 n° 11 : 1176 (24 août 1762) ; n° 12 : 1152 (15 nov. 1739) ; n° 13 : 1152 (15 nov. 1739) ;
n° 30 : 1152 (15 nov. 1739) ; n° 31 : 1154 (26 oct. 1741) ; n° 33: 1161 (19 janv. 1748) ; n°
34 : 1133 (1720) ; n° 35 : 1170 (30 avril 1757) ; n° 36 : 1164 (6 sept. 1751) ; n° 37 : 1166 (18
déc. 1752) ; n° 38 : 1166 (2 sept. 1753) ; n° 39 : 1167 (5 mars 1754) ; n° 40 : 1167 (3 nov.
1753) ; n° 41 : 1168 (10 déc. 1754) ; n° 42 : 1166 (30 mars 1753) ; n° 43 : 1176 (26 août
1762) ; n° 45 : 1163 (10 mars 1750) ; n° 46 : 1166 (avril 1753) ; n° 47 : 1177 (novembre
1763) ; n° 48 : 1170 (juillet 1757) ; n° 50 : 1170 (décembre 1756) ; n° 52 : 1175 (février
1762) ; n° 53 : 1176 (août 1762) ; n° 54 : 1176 (août 1762) ; n° 55 : 1176 (janvier 1763) ; n°
56 : 1176 (octobre 1762) ; n° 58 : 1189 (mars 1775) ; n° 59 : 1196 (mai 1782) ; paragraphe 2 :
1155 (30 juin 1742).
D 572 n° 53 : 980 (1572).
D 573 n° 9 : 1128 (1715) ; n° 10 : 21 Şaban 1138 (24 avril 1726).
D 574 s. 71 sıra 35 : 949 (1542) ; s. 73 sıra 36 : 951 (1544) ; s. 74 sıra 37 : 961 (1553).
D 581 n° 428 : 915 (1509).
D 581-2 s. 376 sıra 374 : 906 (1500) ; s. 376 sıra 374 : 906 (1500) ; s. 382 sıra 381 : 899
(1493) ; s. 382 sıra 381 : 899 (1493) ; s. 383 sıra 382 : 908 (1502) ; s. 383 sıra 382 : 908
(1502).
D 584 n° 71 : 939 (1532) ; n° 72 : 950 (1543) ; n° 74 : 943 (1536) ; n° 75 : 944 (1537).
D 608-2 s. 341 sıra 286 : 888 (1483) ; s. 341 sıra 286 : 888 (1483) ; s. 384 sıra 333 : 888
(1483) ; s. 384 sıra 333 : 888 (1483).
D 609 n° 91 : 947 (1540).
D 623 n° 20 : 1062 (1652)
D 623 n° 298 : 7 Şaban 1138 (10 avril 1726) ; n° 299 : Receb 1138 (mars 1726) ; n° 300 : 21
Şevval 1138 (22 juin 1726).
D 635 n°1 : 957 (1549) ; n°10 : 975 (1567) ; n°11 : 978 (1570) ; n°12 : 965 (sept. 1558) ; n°8 :
965 (sept. 1558) ; n°9 : 970 (1562).
D 635-2 s. 167 sıra 18 : 1021 (1612) ; s. 33 sıra 2 : 1003 (1594) ; s. 49 sıra 3 : 1003 (1594) ; s.
58 sıra 4 : 1022 (1613) ; s. 59 sıra 5 : 1022 (1613) ; s. 60 sıra 6 : 1034 (1624) ; s. 61 sıra 7 :
date non précisée
D 732 n° 253 : 998 (1589) ; n° 254 : sans date.
D 734 n° 164 : 1138 (20 déc. 1725) ; n° 165 : 1138 (28 nov. 1725) ; n° 166 : 1138 (28 déc.
1725) ; n° 167 : 1138 (28 déc. 1725) ; n° 168 : 1138 (28 déc. 1725) ; n° 169 : 1138 (28 déc.
1725) ; n° 170 : 1138 (28 déc. 1725) ; n° 171 : 1138 (20 déc. 1725) ; n° 172 Derkenar : 1175
(6 juin 1762) ; n° 172 : 1138 (28 déc. 1725).
D 735 n° 93 : 1149 (1736).
D 736 n° 27-1 : 1151 (août 1738) ; n° 27-2 : 1190 (17 avril 1776) ; n° 42 : 1160 (1747) ; n°
43 : 1163 (1750) ; n° 44 : 1152 (1739) ; n° 52 : 1152 (15 nov. 1739) ; n° 53 : 1152 (15 nov.
1739) ; n° 54 : 1152 (15 nov. 1739) ; n° 55 : 1152 (15 nov. 1739) ; n° 56 : 1152 (15 nov.
1739) ; n° 57 : 1152 (15 nov. 1739) ; n° 58 : 1152 (15 nov. 1739) ; n° 59 : 1152 (15 nov.
1739) ; n° 60 : 1152 (15 nov. 1739) ; n° 61 : 1152 (16 nov. 1739) ; n° 62 : 1152 (16 nov.
1739) ; n° 63 : 1152 (19 nov. 1739) ; n° 64 : 1152 (19 nov. 1739) ; n° 65 : 1152 (19 nov.
Page | 777
1739) ; n° 66 : 1152 (19 nov. 1739) ; n° 68 : 1167 (5 mars 1754) ; n° 71 : 1154 (26 oct.
1741) ; n° 72 : 1155 (30 juin 1742) ; n° 73 : 1161 (19 janv. 1748) ; n° 74 : 1153 (1740).
D 737 n° 43 : 1156 (1743).
D 738 n° 23 : 1170 (30 avril 1757) ; n° 24 : 1166 (avril 1753) ; n° 26 : 1163 (mars 1750) ; n°
27 : 1164 (6 sept. 1751) ; n° 28 : 1163 (23 novembre 1750) ; n° 29 : 1163 (10 mars 1750) ; n°
35 : 1166 (18 déc. 1752) ; n° 37 : 1166 (18 déc. 1752) ; n° 39 : 1166 (2 sept. 1753) ; n° 138 :
1151 (août 1738) ; n°139 : 1151 (fev. 1740).
D 740 n° 212 : 11 Ram. 1178 (4 mars 1765) ; n° 50 : 7 R.e 1177 (15 sept. 1763) ; n° 51 : 23
R.a 1178 (20 oct. 1764).
D 741 n° 141 : 1189 (1776) ; n° 142 : 1190 (mars 1776) ; n° 143 : 1190 (11 avril 1776) ; n°
144 : 1190 (23 avril 1776) ; n° 149 : 18 Muh. 1184 (14 mai 1770) ; n° 150 : 7 Sa. 1184 (2 juin
1770) ; n° 151 : 12 Cem.ev. 1185 (23 août 1771) ; n° 152 : 17 Sa. 1187 (10 mai 1773) ; n°
153 : 9 Cem.ev. 1187 (29 jlt 1773) ; n° 154 : 21 Ram. 1180 (20 fev. 1767) ; n° 155 : 29 Sa.
1189 (1er mai 1775) ; n° 156 et 156-1 : 11 Sa. 1190 (1er avril 1776) ; n° 157 : 24 R.e. 1190
(13 mai 1776) ; n° 158 : 20 Cem.a. 1190 (6 août 1776) ; n° 194 : 29 R.e. 1191 (7 mai 1777) ;
n° 195 : 29 R.e. 1191 (7 mai 1777) ; n° 196 : 29 R.e. 1191 (7 mai 1777) ; n° 197 : 23 R.e.
1192 (21 avril 1778) ; n° 198 : 5 R.e. 1192 (3 avril 1778) ; n° 199 : 23 R.e. 1192 (21 avril
1778) ; n° 218 : 23 R.e. 1192 (21 avril 1778).
D 742 n° 68 : Ramazan 1032 (juillet 1623).
D 743 n° 80 : 1183 (1769) ; n° 81 : 1184 (1770) ; n° 82 : 1187 (1773).
D 747 n° 109 : 1192 (1778).
D 776 n° 191 : 1170 (1756) ; n° 193 : 1190 (1776).
D 1450 kasa 96.
D 1993 n° 7 : 977 (1569).
D 2138 n° 20 : 1011 (14 janv. 1603) ; n° 21 : 1011 (14 janv. 1603) ; n° 22 : 1011 (14 janv.
1603) ; n° 23 : 1013 (1605) ; n° 3 : 1066 (1656).
Kasa 86.
Kasa 47.
o Osmanlı Başbakan Arşivileri (BAO) :
Evkaf 20/25, date de la fin du mois de Muharrem 1002 (Octobre 1593)
KK 7104 (1038-1039)
o Bibliothèque de la Nuruosmaniye :
Fonds Âli, Ms. 3409, folios 121 r-v.
o Archives du musée de Topkapı :
E 7924 ; E 7924/2 daté du 23 mai 1564
Page | 778
Sources éditées
Ecrits ottomans
AÇBA Leyla, Bir Çerkes prensesinin harem hatıraları, H. Açba (éd.), Istanbul, L&M
Yayınları, 2005 [3e édition].
AHMED Resmî Efendi, Hamîletü’l-küberâ, A. N. Turan (éd.), Istanbul, Kitabevi, 2000.
AKGÜNDÜZ Ahmed (éd.), Osmanlı Kanunnâmeleri ve Hukukî Tahlilleri, Tome 1 : Osmanlı
Hukukuna Giriş ve Fatih Devri Kanunnâmeleri, Istanbul, Fey Vakfı, 1990.
ARSLAN Mehmed (éd.), Osmanlı Saray Düğünleri ve Şenlikleri, Tome 1 : Manzûm
Sûrnâmeler, Istanbul, Sarayburnu Kitaplığı, 2008.
(éd.), Osmanlı Saray Düğünleri ve Şenlikleri, Tome 2 : İntizâmi Sûrnâmesi, Istanbul,
Sarayburnu Kitaplığı, 2009.
(éd.), Osmanlı Saray Düğünleri ve Şenlikleri, Tome 3 : Vehbi Sûrnâmesi, Istanbul,
Sarayburnu Kitaplığı, 2009.
(éd.), Osmanlı Saray Düğünleri ve Şenlikleri, Tome 4-5 : Lebib Sûrnâmesi, Hâfız
Mehmed Efendi (Hazin) Sûrnâmesi, Abdi Sûrnâmesi, Telhîsü’l-beyân’ın Sûrnâme kısmı,
Istanbul, Sarayburnu Kitaplığı, 2011.
ÂŞIKPAŞAZÂDE Derviş Ahmed, Tevârîh-i Âl-i ‘Osmân, Âşıkpaşazâde Tarihi, Istanbul,
Imprimerie Impériale, 1332 [1913].
BARKAN Ömer L. et AYVERDI Ekrem H., İstanbul vakıfları tahrîr defteri: 953 (1546)
târîhli, Istanbul, Baha Matbahası, 1970. (éd.), « İstanbul Saraylarına Ait Muhasebe Defterleri », Belgeler 9 / 13 (1979) : 1-380.
BEYÂNI Mustafa bin Carullah, Tezkiretü’ş-şuarâ, İ. Kutluk (éd.), Ankara, Türk Tarih
Kurumu, 1997.
BURSALI Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri I-III ve Ahmed Remzî Akyürek Miftâhu’l-kütüb
ve esâmî-i müellifîn fihristi, Ankara, Bizim Büro Basımevi, 2009.
CANATAR Mehmet (éd.), İstanbul Vakıfları Tahrîr Defteri: 1009 / 1600 Tarihli, Istanbul,
İstanbul Fetih Cemiyeti, 2004.
CAVİDAN Hanım (prenses), Harem Hayatı. Prenses Cavidan hanım’ın kaleminden
Harem’in gizemli dünyası, S. Hauser (trad.), Istanbul, İnkilâp, 2009.
CRANE Howard (éd.), The Garden of the Mosques. Hafiz Hüseyin Al-Ayvansarayî’s guide to
the Muslim monuments of Ottoman Istanbul, Leiden, Brill, 2000.
DANKOFF Robert (éd.), The Intimate Life of an Ottoman Statesman. Melek Ahmed Pasha
(1588-1662) as Portrayed in Evliya Çelebi’s Book of Travels, New York, State University of
New York, 1991.
Page | 779
DANKOFF Robert, KAHRAMAN Seyyit Ali, DAĞLI Yücel (éds.), Evliya Çelebi
Seyahatnamesi, 1. Kitap : Istanbul, Topkapı Sarayı Kütuphanesi Bağdat 304, Istanbul, Yapı
Kredi Yayınları, 2006.
DEMIREL Fatmagül, Dolmabahçe ve Yıldız Saraylarında Son Ziyaretler Son Ziyafetler, L.
Tınç (éd.), Istanbul, Doğan Kitap, 2007.
DURAN Tülay (éd.), Tarihimizde Vakıf Kuran Kadınlar: Hanım Sultan Vakfiyeleri, Istanbul,
Tarihî Araştırmalar ve Dokümantasyon Merkezleri Kurma ve Geliştirme Vakfı Yayını, 1990.
DERİN Fahri C. (éd.), Abdurrahman Abdi Paşa vekâyi’-nâmesi. Osmanlı tarihi (1648-1682),
Istanbul, Çamlıca, 2008.
ERTUĞ Necdet (éd.), Istanbul tarihî çeşmeler külliyatı, 3 volumes, Istanbul, Forart Basımevi,
2006.
EVLIYÂ Çelebi b. Derviş Mehemmed Zıllî, Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, 2 volumes, 10
livres, Istanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2011.
GALİTEKİN Ahmed Nezih (éd.), Hadîkatü’l-Cevâmi’. İstanbul Câmileri ve Diğer Dînî-Sivil
Mi’mârî Yapılar. Ayvansarâyî Hüseyîn Efendi, Alî Sâtı’ Efendi, Süleymân Besîm Efendi,
Istanbul, İşaret, 2001.
GÖKBİLGİN Tayyıp M., XV. – XVI. Asırlarda Edirne ve Paşa livâsı. Vakıflar – mülkler –
mukataalar, Istanbul, Üçler basımevi, 1952.
HÂFIZ Mehmed Efendi, 1720 Şehâdelerin Sünnet Düğünü. Sûr-ı Hümâyûn, S. A. Kahraman
(éd.), Istanbul, Kitap yayınevi, 2008.
HASAN BEYZÂDE Ahmed Paşa, Hasan Bey-zade tarihi, 3 volumes, Ş. N. Aykut (éd.),
Ankara, Türk Tarih Kurumu, 2004.
İPŞİRLİ Mehmet (éd.), Târîh-i Na’îmâ, 4 tomes, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 2007.
LEÏLA Hanoum, Le harem impérial au XIXe siècle. Un témoignage essentiel sur un univers
fascinant, Bruxelles, André Versaille, 2011.
MELEK Hanum, Thirty Years in the Harem: or, the Autobiography of Melek Hanum, wife of
H. H. Kıbrızlı Mehemet Pasha, Londres, Chapman and Hall, 1872.
NEŞRÎ Mevlânâ Mehmed, Cihânnümâ. Osmanlı tarihi (1288-1485), N. Öztürk (éd.),
Istanbul, Çamlıca, 2008.
OSMANOĞLU Ayşe, Babam Sultan Abdühamid. Hatıralarım, Istanbul, Selis Kitaplar, 2008
[2e édition].
ÖZCAN Abdülkadir (éd.), Anonim Osmanlı tarihi (1099-1116 / 1688-1704) Ankara, Türk
Tarih Kurumu, 2000.
Page | 780
PEÇEVÎ İbrahim Efendi, Tarîh-i Peçevî, F. Ç. Derin et V. Çabuk (éds.), Istanbul, Enderun
Kitabevi, 1980.
RÂŞİD, Râşid Târîhi, 6 volumes répartis en 3 tomes, Istanbul, 1865.
SARI Mehmed Paşa Defterdar, Zübde-i vekayiât. Tahlil ve metin. (1066-1116 / 1656-1704),
A. Özcan (éd.), Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1995.
SADÜDDIN, Tacü-t-tevârîh, 2 volumes, Istanbul, 1862.
SELÂNIKÎ Mustafa Efendi, Târih-i Selânikî, 2 tomes, M. İpşirli (éd.), Istanbul, Edebiyat
Fakültesi Basımevi, 1989.
SÖNMEZ Zeki, Mimar Sinan ile ilgili tarihi yazmalar – belgeler, Istanbul, Mimar Sinan
Üniversitesi Yayinlari, 1988.
SİMAVİ Lütfi, Son Osmanlı Sarayında Gördüklerim. Sultan Mehmed Reşad Hanın ve
Halifenin Sarayında Gördüklerim, Istanbul, Örgün yayınevi, 2004 [2e édition].
SUBHÎ Mehmed Efendi (Vak’anüvis), Subhî Tarihi, Samî ve Şâkir ile birlikte, M. Aydıner
(éd.), Istanbul, Kitabevi, 2007.
SÜREYYA Mehmed, Sicill-i Osmanî. Osmanlı Ünlüleri, S. A. Kahraman (trad.), 6 tomes,
Istanbul, Tarih Vakf Yurt Yayınları, 1996.
TAYYÂR-ZÂDE Atâ, Osmanlı Saray Tarihi, Târîh-i Enderûn, 5 vol., M. Arslan (éd.),
Istanbul, Kitabevi, 2010.
ULUÇAY Çağatay M., Haremden Mektuplar, Istanbul, Ötüken, 2011 [1re
édition : Istanbul,
Vakit Matbaası, 1956].
, Osmanlı Sultanlarına Aşk Mektupları, Istanbul, Saka Matbaası, 1950 [réédition
Istanbul, Ufuk Kitapları, 2001].
YİĞİT Ahmet, XVI. Yüzyıl Menteşe Livası Vakıflar (338 Numaralı Mufassal Evkâf Defteri H.
970 / M. 1562), Ankara, Barıs Platin Kitabevi, 2009.
YILMAZER Ziya (éd.), Topçular Kâtibi ‘Abdülkâdir (Kadri) Efendi Tarihi. Metin ve Tahlîl,
2 tomes, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 2003.
Ecrits occidentaux
BOBOVIUS Albertus, Topkapı. Relation du sérail du Grand Seigneur, Paris, Sindbad / Actes
Sud, 1999.
BON Ottoviano, The Sultan’s Seraglio. An intimate portrait of life at the Ottoman Court,
Introduction et annotations de Godfrey Goodwin, Londres, Saqi Books, 1996.
Page | 781
de BOURBON-PARME Isabelle, « Je meurs d’amour pour toi… ». Lettres à l’archiduchesse
Marie-Christine, 1760-1763, E. Badinter (éd.), Paris, Tallandier, 2008.
BUSBECQ Oghier G. de, Turkish Letters, Londres, Eland, 2005 (2me édition) [édition
française : Lettres turques, D. Arrighi (éd.), Paris, Honoré Champion, 2010 ; édition turque :
Türk Mektupları, H. C. Yalçın (trad.), Istanbul, Remzi Kitapevi, 1939].
CANTACASSIN Théodore Spandouyn, Petit Traicté de l’origine des Turcqs, Ch. Schefer
(éd.), Paris, 1896.
CANTEMIR Démétrius, Histoire de l’Empire ottoman, M. de Joncquières (trad.), Paris,
Jascques-Nicolas Leclerc, 1743.
COVEL John, Voyages en Turquie, 1675-1677, J.-P. Grélois (éd., trad.), Paris, Éditions P.
Lethielleux, 1998.
, Bir Papazın Osmanlı Günlügü. Saray, Merasimler, Gündelik Hayat, Istanbul, Dergâh
Yayınları, 2009.
du FRESNE-CANAYE Philippe, Fresne-Canaye Seyahatnamesi, 1573, T. Tunçdoğan (trad.),
Istanbul, Kitapyayınevi, 2008.
GALLAND Antoine, Voyage à Constantinople (1672 – 1673), Paris, Maisonneuve et Larose,
2002.
GERLACH Stephan, Türkiye günlüğü, 2 tomes, T. Noyan, K. Beydilli (trad.), Istanbul, Kitap
yayinevi, 2006.
GIRARD Georges (éd.), Correspondance entre Marie-Thérèse et Marie-Antoinette, Paris,
Editions Bernard Grasset, 1933.
KRITOVOULOS, History of Mehmed the Conqueror, Ch. T. Riggs (trad.), Princeton,
Princeton University Press, 1954.
LOUIS XIV, Mémoires suivis de Manière de montrer les jardins de Versailles, J. Cornette
(éd.), Paris, Editions Tallandier, 2007.
MONTAGU Lady Mary, L’islam au péril des femmes. Une Anglaise en Turquie au XVIIIe
siècle, A. M. Moulin et P. Chuvin (trad.), Paris, François Maspéro, 1981.
de NICOLAY Nicolas, Dans l’Empire de Soliman le Magnifique. Les navigations,
pérégrinations et voyages faits en la Turquie, Paris, Presses du CRNS, 1989.
NOYAN Türkis (éd.), Osmanlıda Bir Köle. Brettenli Michael Heberer’in Anıları 1585-1588,
Istanbul, Kitap Yayınevi, 2003.
RALAM Claes, İstanbul’a Bir Yolculuk, 1657-1658, A. Arel (trad.), Istanbul, Kitap Yayinevi,
2008.
Page | 782
PHILIPPIDES Marios (éd.), Byzantium, Europe and the Early Ottoman Sultans, 1373-1513.
An Anonymous Greek Chronicle of the Seventeenth Century (Codex Barberinus Graecus
111), New Rochelle / New York, Aristide D. Caratzas, 1990.
SCHILTBERGER Johannes, Captif des Tatars, J. Rollet (trad.), Toulouse, Anacharsis, 2008.
SPANDOUNES Théodore, On the origin of the Ottoman Empire, D. M. Nicol (trad.).
Cambridge, Cambridge University Press, 1997.
TELFER Buchan J. et BRUUN Philip J. (éds.), The Bondage and Travels of Johann
Schiltberger, A Native of Bavaria, in Europe, Asia, and Africa, 1396-1427. Londres, The
Hakluyt Society, 1879.
THEPAUT-CABASSET Corinne (éd.), Le Sérail des empereurs turcs. Relation manuscrite
du sieur de La Croix à la fin du règne du sultan Mehmed IV, Paris, Editions du CHTS, 2007.
THEVENOT Jean, Thévenot Seyahatnamesı. Stefanos Yerasimos’un Anısına, A. Berktay
(trad.), S. Yerasimos (éd.), Istanbul, Kitapyayınevi, 2009.
de VALOIS Marguerite, Mémoires et autres écrits de Marguerite de Valois, la reine Margot,
Y. Cazaux (éd.), Paris, Mercure de France, 1986 [2e édition].
VIAUX Aude (éd.), Lettres des souverains portugais à Charles Quint et à l’impératrice
(1528-1532) conservées aux archives de Simancas. Suivies en annexe de lettres de D. Maria
de Velasco et du Duc de Bragance, Lisbonne / Paris, Centre Culturel Calouste Gulbekian,
1994.
WILTHERS Robert, Büyük Efendi’nin Sarayı, C. Kayra (trad.), Istanbul, Pera Turizm ve
Ticaret, 1996.
Page | 783
L’HISTORIOGRAPHIE
Dictionnaires et encyclopédies
EI Encyclopédie de l’Islam, Leide / Paris, E. J. Brill / Picard et fils / Librairie C.
Klincksieck, 1913-1934 : 4 volumes.
EI 2 Encyclopédie de l’Islam, Nouvelle édition, Leiden, E. J. Brill, 1995-2009 : 13
volumes.
İA İslâm Ansiklopedisi. İslâm âlemi, coğrafya, etnoğrafya ve biyografya lûgati,
Istanbul, Maarif Matbaası / Millî eğitim basımevi, 1940-1974 : 12 volumes.
OA Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, Istanbul, Yapı Kredi
Yayınları, 1999 [2e édition 2008] : 2 volumes.
TDVİA Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,Istanbul, Ali Rıza Baskan Güzel
Sanatlar Matbaası, 1988-… : 42 volumes (à ce jour)
PAKALIN Mehmed Z., Osmanlı Tarihi deyimleri ve terimleri sözlüğü, 3 vol., Istanbul Devlet
Basımevi, Istanbul, 1971.
Redhouse, Redhouse Sözlüğü. Türkçe / Osmanlıca– İngilizce, Istanbul, SEV, 1998 [16e
édition].
Samy-Bey Fraschery, Dictionnaire Turc-Français, Constantinople, Ed. Mihran, 1885.
Sami Bey, Dictionnaire Français-Turc, Constantinople, Ed. Mihran, 1885.
SERTOĞLU Midhat, Osmanlı Tarih Lûgatı, Istanbul, Enderun Kitabevi, 1986.
Page | 784
Littérature sur les femmes et le genre dans le monde
musulman à l’époque moderne
‘ABD AR-RAZIQ Ahmad, La femme au temps des Mamlouks en Egypte, Caire, Institut
Français d’Archéologie Orientale du Caire, 1973.
ABDAL-REHIM A.-R. Abdal-Rahman, « The family and gender laws in Egypt during the
Ottoman period », dans Women, the family, and divorce laws in Islamic history, A. A. Sonbol
(éd.), Syracuse, Syracuse University Press, 1996, pp.96-111.
ABDEL-HAKIM Sahar S., « Gender politics in a colonial context: Victorian women’s
accounts of Egypt », dans Interpreting the Orient: travellers in Egypt and the Near East, P. et
J. Starkey (éds.), Reading, Ithaca, 2001 : 111-122.
‘ABDUR Rahman I. Doi, Women in Shari’ah (Islamic Law), London, Ta-Ha Publishers, Ltd.,
1989.
ABOU-EL-HAJ Rifa’at A., « The Role of Women in the Ottoman Empire: How the khassa
Reproduces the khassa – Elite reproduction in Sixteenth-Century Ottoman Jerusalem », dans
Festschrift Hans Georg Majer. Arts, Women and Scholars. S. Prätor et Ch. K. Neumann
(éds.), 2 vol, Istanbul, Simurg, 2002 : 185-194.
ABU-HABIB Lina, Gender and disability: women's experiences in the Middle East,
Oxford, Oxfam, 1997.
ADIYEKE Nuri, « Osmanlı İmparatorluğu’nda Tanzimat Dönemi Evlilikleri », dans Pax
Ottoman Nejat Göyünç Armağanı, Ankara, Yeni Türkiye yayını, 2001 : 121-150.
AFIFI Mohamed, « Le mariage et la vie sociale en Egypte au XVIIIe siècle », dans Histoire
économique et sociale de l'Empire ottoman et de la Turquie (1326-1960). Actes du Congrès
international tenu à Aix-en-Provence, 1994, D. Panzac (dir.), Paris, Peeters, 1995 : 301-304.
AHMED Leila, Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate, New
Haven, Yale University Press, 1992.
AKGÜNDÜZ Ahmed, İslâm Hukukunda Kölelik – Câriyelik Müessesesi ve Osmanlı’da
Harem, Istanbul, Osmanlı Araştırmaları Vakfı, 1995.
AKYILDIZ Ali, Refia Sultan, Mümin ve Müsrif Bir Padişah Kızı, Istanbul, Tarih Vakfı, 1998.
, « Kadınefendi », TDVİA : t. 24 p. 94-96.
AKYILMAZ Gül S., « Osmanlı Miras Hukukunda Kadının Statüsü », Gazi Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Dergisi XI / 1-2 (2007) : 471-502.
el-ALAMI Dawoud et HINCHCLIFFE D., Islamic marriage and divorce laws of the Arab
world, London, Kluwer Law International, 1996.
Page | 785
ALLÈS Elisabeth, « Une organisation de l’islam au féminin : le personnel des mosquées
féminines chinoises », Transmission du Savoir dans le Monde Musulman Périphérique :
Lettre d'Information 14 (1994) : 1-12.
, « L'islam chinois : femmes ahong », Études Orientales 13-14 (1994) : 163-167.
, « Des oulémas femmes : le cas des mosquées féminines en Chine », Revue des
Mondes Musulmans et de la Méditerranée 85-86 (1999) : 215-236.
ALTINAY Ahmet R., Kadınlar Saltanatı, Istanbul, Tarih Vakfı, 2005 [4e édition].
Anadolu Kadının 9000 Yılı (9000 Years of Anatolian Women), Istanbul, Turkish Republic,
Ministery of Culture, General Directorate of Monuments and Museum, 1994.
ANGELOMATIS-TSOUGARAKIS Helen, « Greek Women, 16th
-19th
Century: The
Travellers’ View », Mesaionika kai nea Ellinika 4 (1992) : 321-403.
, « Women in the Society of the Despotate of Epirus », Jahrbuch der Österreich
Byzantinistik 32 (1982) : 473-480.
ANSARY Mohammad Azher, « The Harem of the Great Mughals (Shabistan-i-Iqbal) »,
Islamic Culture 34 (1960) : 1-13.
ARBEL Benjamin, « Nûr Bânû (c. 1530-1583): A Venetian Sultana? », Turcica 24 (1992) :
241-259.
ARSEL İlhan, Şeriat ve Kadın, Istanbul, Kaynak Yayınları, 2006 [16e edition].
ARTAN Tülay, « From Charismatic Leadership to Collective Rule: Introducing Materials on
the Wealth and Power of Ottoman Princesses in the Eighteenth Century », Dünkü ve
Bugünüyle Toplum ve Ekonomi 4 (1993) : 53-94.
, « Noble Women Who Changed the Face of the Bosphorus and the Palaces of the
Sultanas », İstanbul (Biannual) 1 (1993) : 87-97.
, « The Kadırga Palace: An Architectural Reconstruction », Muqarnas 10 (1993) : 201-
211.
, « The Kadırga Palace Shrouded by the Mists of Time », Turcica XXI (1994) : 55-124.
, « Periods and problems of ottoman (women’s) patronage on the Via Egnatia », dans
The Via Egnatia under ottoman Rule 1380-1699. Halcyon Days in Crete II; A Symposium
Held in Rethymnon 9-11 January 1994, E. Zachariadou (éd.), Crete, Crete University Press,
1996 : 19-43.
, « 18th
century Ottoman princesses as collectors: frome Chinese to European porcelain
», Ars Orientalis (Globalizing Cultures: Art and Mobility in the Eighteenth Century) 39
(2011) : 113-146.
, « Royal weddings and the Grand Vezirate: institutional and symbolic change in the
early 18th
century », dans Royal Courts and Capitals, Artan T. et Kunt M. (éds.), Leiden,
Brill, 2011 : 339-399.
ASCHA Ghassan, « Polygamie in der moderne Arabische Rechtsliteratuur », Recht van de
Islam 11 (1994) : 25-54.
ATASOY Nurhan, « Scenes of Ottoman Women at Leisure », dans Festschrift Hans Georg
Majer. Arts, Women and Scholars, S. Prätor et Ch. K. Neumann (éds.), 2 vol., Istanbul,
Simurg, 2002 : 387-400.
Page | 786
ATIL Esin, « Islamic Women as Rulers and Patrons », Asian Art 6 (1993) : 3-12.
AUGUSTINOS Olga, « Eastern Concubines, Western Mistresses: Prévost’s Histoire d’une
Grecque moderne », dans Women in the Ottoman Balkans. Gender, Culture and History, A.
Buturovic et I. C. Schick (éds.), Londres / New York, I.B. Tauris, 2007 : 11-44.
AYDIN Akif M., « Osmanlı Hukukunda Nikah Akitleri », Osmanlı Araştırmaları III (1982) :
1-12.
, İslâm – Osmanlı Aile Hukuku, Istanbul, Marmara Universitesi Yayınları, 1985.
, « Kadın – İslâm’da Kadın », TDVİA : t. 24 p. 86-94.
AYNUR Hatice, Saliha Sultan’ın Düğününü Anlatan Surnameler, 1834, Harvard, Harvard
University Press, 1995.
BABAYAN Kathryn, « The ‘Aqâ’îd al-Nisâ: A Glimpse at Safavid Women in Local Isfahani
Culture », dans Women in the Medieval Islamic World, Hambly Gavin R.G. (éd.). New York:
St Martin’s Press, 1998 : 349-382.
BABINGER Franz, « Mihr-i Mâh Sultan », EI (2) : t. 7 p. 6-7.
BAER Gabriel, « Women and Waqf : An Analysis of the Istanbul Tahrir of 1545 », Asian and
African Studies 17 (1983) : 9-27.
, « Women and the Waqf : An Analysis of the Istanbul Tahrîr of 1546 », dans Studies
in Islamic Society: Contributions in Memory of Gabriel Baer, G. R. Warburg et G. G. Gilbar
(éds.), Haifa, Haifa University Press, 1984 : 9-27.
BAER Marc David, « Islamic Conversion Narratives of Women: Social Change and
Gendered Religious Hierarchy in Early Modern Ottoman Istanbul », Gender History 16
(2004) : 425-458.
BAER Eva, « Female images in early Islam », Damaszener Mitteilungen 11 / 1999 (2000) :
13-24.
BATES Ülkü Ü., « Women as Patrons of Architecture in Turkey », dans Women in the
Muslim World, L. Beck and K. Nikki (éds.), Cambridge (Mass.), Harvard University Press,
1978 : 245-260.
, « The Architectural Patronage of Ottoman Women », Asian Art 6 (1993) : 50-65.
, DENMARK Florence L., HELD Virginia, HELLY O. Dorothy, LEES Susan H.,
Women’s Realities, Women’s Choices: An Introduction to Women’s Studies, Oxford, Oxford
University Press, 1983.
BAYSUN Cavid M., « Mihr ü Mâh Sultan », İA : t. 8 p. 307-308.
BECK Lois, NIKKI Keddie (éds.), Women in the Muslim World, Cambridge Mass., Harvard
University Press, 1978.
BEHAR Cem et DUBEN Alan, Istanbul Households: Marriage, Family and Fertility, 1880-
1940, Cambridge, Cambridge University Press, 1991.
Page | 787
, « Neighborhood Nuptials: Islamic Personal Law and Local Customs: Marriage
Records in a Mahalle of Traditional Istanbul (1864-1907) », International Journal of Middle
East Studies, 36/4 (November 2004) : 537-559.
BEKİROĞLU Naza, Şair Nigâr Hanım, Istanbul, İletişim Yayınları, 1998.
BELDICEANU-STEINHERR Irène, « Les illusions d’une princesse : le sort des biens de
Mara Brankovic », dans Festschrift Hans Georg Majer. Arts, Women and Scholars. S. Prätor
et Ch. K. Neumann (éds.), 2 vol. Istanbul, Simurg, 2002 : 43-60.
BELGE Murat, « Rüstem ve Mihrimah », Tarih ve Toplum VII/37 (Ocak 1987) : 29-37.
BELL Joseph N., Love Theory in Later Hanbalite Islam, Albany, State University of New
York Press, 1979.
BENEDICT Peter et GÜRIZ Adnan, Türk Hukuk ve Toplumu Üzerine İncemeler, Ankara,
Türk Tarih Kurumu, 1974.
, « Türk Hukuk Reformu Açısından Başlık ve Mehr », dans Türk Hukuk ve Toplumu
Üzerine İncemeler, P. Benedict et A. Güriz (éds.), Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1974 : 1-40.
BENNASSAR Bartolomé, « Conversions, esclavage et commerce des femmes dans les
péninsules ibérique, italienne ou balkanique aux XVIe et XVIIe siècles », Dimensioni e
problemi della ricerca storica 2 (1996) : 101-109.
BERKEY Anthony, « Women and Islamic Education in the Mamluk Period », dans Women in
Middle Eastern History: Shifting Boundaries in Sex and Gender, K. R. Nikki et B. Baron
(éds.). New Haven, Yale University Press, 1991 : 143-157.
BHUIYAN Mosharraf H., « The mosque of Mariam Saleha (a typical Mughal mosque) »,
Dhaka University Studies 54 / I (1997) : 181-188.
BLAKE Stephen P., « Contributors to the Urban Landscape: Women Builders in Safavid
Isfahan and Mughal Shahjahanabad », dans Women in the Medieval Islamic World, Hambly
Gavin R.G. (éd.). New York: St Martin’s Press, 1998 : 407-428.
BONTE P., « Manière de dire ou manière de faire : peut-on parler d'un mariage “arabe” ? »,
dans Epouser au plus proche : inceste, prohibitions et stratégies matrimoniales autour de la
Méditerranée, P. Bonte (dir.), Paris, Editions de l'EHESS, 1994 : 371-398.
BOUSQUET Georges-Henri, L’éthique sexuelle de l’Islam, Paris, Maisonneuve et Larose,
1966 [2e édition revue et augmentée, 1
re édition 1953].
BOUTENEFF Patricia Fann, « Persecution and Perfidy: Women’s and Men’s Worldviews in
Pontic Greek Folktales », dans Women in the Ottoman Balkans. Gender, Culture and History,
A. Buturovic et I. C. Schick (éds.), Londres / New York, I.B. Tauris, 2007 : 45-72.
BOYLE John A., « Khatun », EI (2) : t. 4 p. 1164.
BRYER Anthony, « Greek Historians on the Turks: the Case of the First Byzantine-Ottoman
Marriage », dans The Writing of History in the Middle Ages: Essays Presented to Richard
Page | 788
William Southern, R. H. C. Davis et J. M. Wallace-Hadrill (éds.), Oxford, Clarendon Press,
1981 : 471-493.
BUTUROVIC Amila, SCHICK Irvin Cemil (éds.), Women in the Ottoman Balkans. Gender,
Culture and History, Londres / New York, I.B. Tauris, 2007.
BUTUROVIC Amila, « Love and/or Death? Women and Conflict Resolution in the
Traditional Bosnian Ballad », dans Women in the Ottoman Balkans. Gender, Culture and
History, A. Buturovic et I. C. Schick (éds.), Londres / New York, I.B. Tauris, 2007 : 73-98.
CHELHOD Joseph, « Du nouveau à propos du ‘matriarcat’ arabe », Journal Arabica 28
(1981) : 76-106.
CİN Halil, İslâm ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Yayınları, 1974.
, Eski Hukukumuzda Boşanma, Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yayınları, 1976.
COCO Carla, Secrets of the Harem, New York, Vendome, 1997.
CONTE E., « Choisir ses parents dans la société arabe : la situation à l'avènement de l'islam »,
dans Epouser au plus proche : inceste, prohibitions et stratégies matrimoniales autour de la
Méditerranée, P. Bonte (dir.), Paris, Editions de l’EHESS, 1994 : 165-187.
COPHET-ROUGIER E., « Le mariage “arabe” : une approche théorique », dans Epouser au
plus proche : inceste, prohibitions et stratégies matrimoniales autour de la Méditerranée, P.
Bonte (dir.), Paris, Editions de l’EHESS, 1994 : 453-473.
CROUTIER Alev L., Harem: The World Behind the Veil, New York, Abbeville Press, 1989.
ÇIKLA Ayşe, Architectural patronage of women in the early Ottoman era, Mémoire de
Master, Istanbul, Boğaziçi Üniversitesi, 2004.
DANKOFF Robert, « Marrying a Sultana: The Case of Melek Ahmed Paşa », dans Decision
Making and Change in the Ottoman Empire, C. E. Farah (éd.), Kirksville (Missouri), Thomas
Jefferson University Press, 1993 : 169-182.
DAVID Géza, « Manumissioned Femal Slaves at Galata and Istanbul Around 1700 », dans
Festschrift Hans Georg Majer. Arts, Women and Scholars. S. Prätor et Ch. K. Neumann
(éds.), 2 vol. Istanbul, Simurg, 2002 : 229-236.
DAVIDSON Olga M., « Women’s Lamentations as Protest in the ‘Shahnama’ », dans Women
in the Medieval Islamic World, Hambly Gavin R.G. (éd.), New York, St Martin’s Press, 1998
: 131-146.
DAVIS Fanny, The Ottoman Lady. A Social History from 1718 to 1918, New York / Wesport
Connecticut / Londres, Greenwood Press, 1986.
DELPLATO Joan, Multiple Wives, Multiple Pleasures: Representing the Harem, 1800-1875,
Teaneck, Farleigh Dickinson University Press, 2002.
Page | 789
DENGLER Ian C., « Turkish Women in the Ottoman Empire: The Classical Age », dans
Women in the Muslim World, E. Beck et K. Nikki (éds.), Cambridge Mass., Harvard
University Press, 1978 : 229-244.
DENICH Bette, « Sex and Power in the Balkans », dans Woman, Culture and Society, M.
Rosaldo et L. Lamphere (éds.), Stanford, Stanford University Press, 1974 : 243-262.
DENIS Jean, « Wâlide Sult ân », EI : t. 4 p. 1172-1178.
DEVEREUX Robert, « XIth Century Muslim Views on Women, Marriage, Love and Sex »,
Central Asiatic Journal 11 (1966) : 134-140.
DOUMANI Beshara, « Endowing Family: Waqf, Property Devolution, and Gender in Greater
Syria, 1800-1860 », Comparative Studies in Society and History 40 / 1 (1998) : 3-41.
DUMAS Juliette, « Hücreden saraya: 15-18. yüzyıllarda Osmanlı konutları », Toplumsal
Tarih 193 (Ocak 2010) : 18-25.
, « Bir duhtercığımız dünyaya geldi. III. Ahmed’in ilk kız çocuğu Fatma Sultan
doğumu şerefine düzenlenen şenlikler », Toplumsal Tarih 198 (Hazıran 2010) : 22-28.
, « Osmanlı Hareminden Fransız Sarayına : 16. Yüzyılda Osmanlı ve Fransız
Prensesleri Arasında bir Karşılaştırma », Toplumsal Tarih 202 (Ekim 2010) : 77-83.
, « Prenseslerin Değeri : 16. Yüzyılda Osmanlı ve Fransız Prensesleri Arasında bir
Karşılaştırma », Toplumsal Tarih 203 (Kasım 2010) : 76-81.
, « Bir Prenses bir Kulla Evlenirse : 14. Yüzyıldan 15. Yüzyılın İlk Yarısına,
Osmanlılarda İlkel Evlilik Sistemi », Toplumsal Tarih 209 (Mayis 2011) : 86-91.
, « Bir Prenses bir Kulla Evlenirse II : Osmanlıların Sıradışı Evlilik Sistemi (15. Yüzyıl
Ortalarından 16. Yüzyıl Ortalarına) », Toplumsal Tarih 210 (Haziran 2011) : 36-42.
, « Des esclaves pour époux… Réflexion sur les stratégies matrimoniales de la dynastie
ottomane », Clio. Histoire, femmes et sociétés 34 (2011) : 255-275.
, « Tanım ve Kulanımlarıyla: Klasik Çağda Dâmâd-ı Şehriyârî », Toplumsal Tarih 226
(Ekim 2012) : 34-40
, « Evlilikle Gelen Ek Yükümlükler: Erken Modern Dönemde Dâmâd-ı Şehriyârî II »,
Toplumsal Tarih 227 (Kasım 2012) : 72-79.
, « Conscience dynastique et familiale dans le patronage architectural des princesses
ottomanes à l’époque moderne », dans Hommes et femmes bâtisseurs. Traditions et stratégies
dans le monde oriental et occidental, S. Frommel et J. Dumas (dir.), Picard / Campisano /
IFEA, Paris / Rome / Istanbul, sous presse.
, « Patronage architectural à Istanbul : convergences et divergences de pratiques chez
les hommes et les femmes de l’élite au XVIe et XVIIe siècles », dans Hommes et femmes
bâtisseurs. Traditions et stratégies dans le monde oriental et occidental, S. Frommel et J.
Dumas (dir.), Picard / Campisano / IFEA, Paris / Rome / Istanbul, sous presse.
, « La princesse et l’esclave… Pragmatisme politique et stratégies matrimoniales à la
cour ottomane (XIVe – mi-XVIe siècle) », en cours de publication.
EL CHEIKH Nadia Maria, « In Search for the Ideal Spouse », Journal of the Economic and
Social History of the Orient vol. 45 (2002) : 179-196.
, « Gender and Politics: The Harem of al-Muqtadir », dans Gender in the Early
Medieval World: East and West, 300-900, L. Brubaker and J. Smith (éds.), Cambridge,
Cambridge University Press, 2004 : 147-161.
Page | 790
, « Revisiting the Abbasid Harems », Journal of Middle East Women's Studies 1(2005)
: 1-19.
, « Observations on Women's Education in Medieval Islamic Societies », dans F.
Georgeon et K. Kreiser (éds.), Enfance et jeunesse dans le monde musulman, Paris,
Maisonneuve et Larose, 2007 : 57-72.
ELIAS Jamal J., « Female and Feminine in Islamic Mysticism », The Muslim World 78
(1988) : 209-224.
ESPOSITO John L., Women in Muslim Family Law, Syracuse N.Y., Syracuse University
Press, 1982.
ESTABLET Colette et PASCUAL Jean-Paul, « A propos du sadaq ou mahr dans une région
arabe de l’Empire ottoman à l’aube du XVIIIe siècle », Droit et cultures 42 (2001) : 211-230.
EYİCE Semavi, « Fatma Sultan Camii. İstanbul Bâbıâli’de XVIII. Yüzyılda yaptırılan cami »,
TDVİA : t. 12 p. 262-264.
, « Fatma Sultan Mescidi. İstanbul Topkapıda XVI. Yüzyıla ait mescid », TDVİA : t. 12
p. 264.
FAROQHI Suraiya, « Crime, Women and Wealth in the Eighteenth-Century Anatolian
Countryside », dans Women in the Ottoman Empire. Middle Eastern Women in the Early
Modern Era. M.C. Zilfi (éd). Leiden / New York / Köln, Brill, 1997: 6-27.
, « From the Slave Market to Arafat: Biographies of Bursa Women of the Late
Fifteenth Century », Turkish Studies Association Bulletin 24 (2000) : 3-20.
, Stories of Men and Women. Establishing Status, Establishing Control, Istanbul, Eren,
2002.
, « Female Costumes in Late Fifteenth-Century Bursa », dans Ottoman Costumes.
From Textile to Identity, Ch. K. Neumann et F. Suraiya (éds.), Istanbul, Eren, 2004 : 81-91.
, « An Orthodox Woman Saint in an Ottoman Document », dans Syncrétismes et
hérésies dans l’Orient Seldjoukide et ottoman (XIVe-XVIIIe siècle). Actes du Colloque du
Collège de France, octobre 2001, G. Veinstein (dir.), Paris, Peeters, 2005 : 383-394.
FATHI Habiba, « Otines: the unknown women clerics of Central Asian Islam », Central Asia
Survey 16 / I (1997) : 27-43.
, « Les otines, sermonnaires inconnues de l'islam centrasiatique », Revue des Mondes
Musulmans et de la Méditerranée 85-86 (1999) : 185-201.
FAY Mary A., « Women and Waqf: Toward a Women Reconsideration of Women Place in
the Mamluk Household », International Journal of Middle East Studies 29/1 (Février 1997) :
33-51.
, « Women and Waqf: Property, Power and the Domain of Gender in Eighteenth-
Century Egypt », dans Women in the Ottoman Empire. Middle Eastern Women in the Early
Modern Era, M. C. Zilfi (éd.), Leiden / New York / Köln, Brill, 1997 : 28-47.
FERRIER Ronald W., « Women in Safavid Iran: The Evidence of European Travelers », dans
Women in the Medieval Islamic World, Hambly Gavin R.G. (éd.), New York, St Martin’s
Press, 1998 : 383-406.
Page | 791
FILAN Kerima, « Women Founders of Pious Endowments in Ottoman Bosnia », dans Women
in the Ottoman Balkans. Gender, Culture and History, A. Buturovic et I. C. Schick (éds.),
Londres / New York, I.B. Tauris, 2007 : 99-126.
FINDLY Ellison B., « The Pleasure of Women: Nur Jahan and Mughal Paintings », Asian Art
6 (1993) : 66-86.
GALANTE Abraham, Esther Kyra d’après de nouveaux documents, Constantinople, Société
anonyme de papeterie et d’imprimerie, 1926.
GERBER Haim, « Social and Economic Position of Women in an Ottoman City, Bursa
(1600-1700) », International Journal of Middle East Studies 12 (1980) : 231-244.
GEYER R., « Die arabischen Frauen in der Schlacht », Mitteilungen der Anthropologischen
Gesellschaft in Wien 39 (1909) : 148-155.
GÖÇEK Fatma M. et BAER M. David, « Social Boundaries of Ottoman Women’s
Experience in Eighteenth-Century Galata Court Records », dans Women in the Ottoman
Empire. Middle Eastern Women in the Early Modern Era, M. C. Zilfi (éd.), Leiden / New
York / Köln, Brill, 1997 : 48-65.
GROSRICHARD Alain, Structures du sérail. La fiction du despotisme asiatique dans
l’Occident classique, Paris, Editions du Seuil, 1979 [traduit en anglais : The Sultan’s Court.
European Fantasies of the East, Liz Heron (trans.), London / New York, Verso, 1998]
GUTHRIE Shirley, Arab women in the Middle Ages: private lives and public roles,
London, Saqi Books, 2001.
HAERI Shahla, Law of Desire: Temporary Marriage in Shi’i Iran, Syracuse N.Y., Syracuse
University Press, 1989.
HAMBLY Gavin R. G., « Becoming visible: Medieval Islamic Women in Historiography and
History », dans Women in the Medieval Islamic World, Hambly Gavin R.G. (éd.), New York,
St Martin’s Press, 1998 : 3-28.
, « Armed Women Retainers in the Zenanas of Indo-muslim Rulers: the Case of Bibi
Fatima », dans Women in the Medieval Islamic World, Hambly Gavin R.G. (éd.), New York,
St Martin’s Press, 1998 : 429-268.
(éd.), Women in the Medieval Islamic World, New York, St Martin’s Press, 1998.
HATEM Mervat F., « The Professionalization of Health and the Control of Women’s Bodies
as Modern Governmentalities in Nineteenth-Century Egypt », dans Women in the Ottoman
Empire. Middle Eastern Women in the Early Modern Era. M.C. Zilfi (éd). Leiden / New York
/ Köln, Brill, 1997 : 66-80.
, « The Politics of Sexuality and Gender in Segregated Patriarchal Systems: The Case
of Eighteenth- and Nineteenth-Century Egypt », Feminist Studies 12 (1986): 250-274.
HATHAWAY Jane, « Marriage Alliances among the Military Househoulds of Ottoman Egypt
», Annales Islamologiques 29 (1995) : 133-149.
Page | 792
HÉRITIER-AUGÉ F., « Identité de substance et parenté de lait dans le monde arabe », dans
Epouser au plus proche : inceste, prohibitions et stratégies matrimoniales autour de la
Méditerranée, P. Bonte (dir.), Paris, Editions de l’EHESS, 1994 : 149-164.
HUMPHREYS Stephen R., « Women as Patrons of Religious Architecture in Ayyubid
Damascus », Muqarnas 11 (1994) : 35-54.
IMBER Colin, « Zinâ in Ottoman Law », dans Contributions à l’histoire économique et
sociale de l’Empire ottoman, J.-L. Bacqué-Grammont et P. Dumont (éds.), Louvain, Peeters,
1983 : 59-92.
, « Involuntary’ Annulment of Marriage and Its Solutions in Ottoman Law », Turcica
25 (1993): 39-73.
, « Women, Marriage and Property: Mahr in the Behcetü’l-Fetâvâ of Yenişehirli
Abdullah », dans Women in the Ottoman Empire. Middle Eastern Women in the Early
Modern Era, M. C. Zilfi (éd.), Leiden / New York / Köln, Brill, 1997 : 81-104.
, « Guillaume Postel on Temporary Marriage », dans Festschrift Hans Georg Majer.
Arts, Women and Scholars, S. Prätor et Ch. K. Neumann (éds.), 2 vol, Istanbul, Simurg, 2002
: 179-184.
IVANOVA Svetlana, « The Divorce Between Zubaida Hatun and Esseid Osman Ağa:
Women in the Eighteenth-Century Shari’a Court of Rumeli », dans Women, the Family, and
Divorce Laws in Islamic History. Women, the Family and Divorce Laws in Islamic History,
A. Sonbol (éd.), Syracuse, Syracuse University Press, 1996 : 112-125.
, « Muslim and Christian Women Before the Kadı Court in Eighteenth Century
Rumeli: Marriage Problems », Oriente Moderno 18 / 79 (1999) : 161-176.
, « Judicial Treatment of the Matrimonial Problems of Christian Women in Rumeli
during the Seventeenth and Eighteenth Centuries », dans Women in the Ottoman Balkans.
Gender, Culture and History, A. Buturovic et I. C. Schick (éd.), Londres / New York, I.B.
Tauris, 2007 : 153-200.
JACKSON Peter, « Sultan Radiyya bint Iltutmish », dans Women in the Medieval Islamic
World, R. G. Hambly Gavin (éd.), New York, St Martin’s Press, 1998 : 181-198.
JENNINGS Ronald C., « Women in Early 17th
Century Ottoman Judicial Records – the
Sharia Court of Anatolian Kayseri », Journal of the Economic and Social History of the
Orient 18 (1975) : 53-113.
, « The Legal Position of Women in Kayseri, a Large Ottoman City, 1590-1630 »,
International Journal of Women’s Studies 3 (1980): 559-582.
, « Pilgrims View the Women of the Island of Venus », Balkans Studies 30 (1989) :
213-220.
, « Divorce in the Ottoman Sharia Court of Cyprus, 1580-1640 », Studia Islamica 78
(1993) : 155-167.
, Studies on Ottoman Social History in the Sixteenth and Seventeenth Centuries.
Womens, Zimmis and Sharia Courts in Kayseri, Cyprus and Trabzon, Istanbul, Isis Press
(Analecta Isisiana XXXIX), 1999.
KAHLE Paul E., « Gyps Woman of Egypt in the Thirteenth-Century AD. », Journal of the
Gypsy Lore Society 29 (1959) : 11-15.
KARACA Filiz Ç., « Hanım Sultan », TDVİA : t. 16 p. 28-29.
Page | 793
KARAMAN Hayreddin, İslâm’da Kadın ve Aile, Istanbul, Ensar Neşriyat, 1995.
KASDAGLI Aglaia E., « Dowry and inheritance in 17th-Century Naxos », Mélanges de
l'Ecole française de Rome, Italie et Méditerranée 110 /1 (1998) : 211-216.
, Land and Marriages Settlements in the Aegean: A Case Study of Seventeenth-century
Naxos, Venise / Crète, Hellenic institute of Byzantine and post-byzantine studies / Vikelea
municipal library of Iraklion, 1999.
, « Family and Inheritance in the Cyclades, 1500-1800: Present Knowledge and
Unanswered Questions », Journal of Family History 9 (2004) : 257-274.
KAYAALP-AKTAN Pınar, « The Atik Valide’s Endowment Deed: A Textual Analysis »
dans Feeding People, Feeding Power. Imarets in the Ottoman Empire, N. Ergin, Ch. K.
Neumann et A. Singer (éds.), Istanbul, Eren, 2007 : 261-274.
KEDDIE Nikki R. et BARON Beth (éds.), Women in Middle Eastern History: Shifting
Boundaries in Sex and Gender, New Haven, Yale University Press, 1991.
KEDDIE Nikki R, Women in the Middle East: Past and Present, Princeton, Princeton
University Press, 2007.
KHOURY Dina R., « Drawing Boundaries and Defining Spaces: Women and Space in
Ottoman Iraq », dans Women, the Family, and Divorce Laws in Islamic History. Women, the
Family and Divorce Laws in Islamic History, A. Sonbol (éd.), Syracuse, Syracuse University
Press, 1996 : 173-189.
, « Slippers at the Entrance or Behind the Closed Doors: Domestic and Public Spaces
for Mosuli Women », dans Women in the Ottoman Empire. Middle Eastern Women in the
Early Modern Era, M. C. Zilfi (éd.), Leiden / New York / Köln, Brill, 1997 : 105-127.
KIRPIK Orhan, « 1830 No’lu Şer’iyye Siciline Göre (1633-1644) Trabzon Toplumunda
Kadın », dans Trabzon Tarihi İlmî Toplantısı (6-8 Kasım 1998 Bildirileri), K. Çiçek, K. İnan,
H. Öksüz et A. Saydam (éds.), Trabzon, Trabzon Belediyesi Kültür Yayınları, 2000 : 26-286.
KONYALI Hakkı İ., « Bir hüccet iki vakfiyye », Vakıflar Dergisi 7 (1995) : 97-110.
, « Kanunî Sultan Süleyman’ın Annesi Hafsa Sultanın Vakfiyesi ve Manisa’daki Hayır
Eserleri », Vakıflar Dergisi 8 (1969) : 47-56.
KOROTAYEV Andrey, « Parallel-cousin (FBD) marriage, Islamization, and Arabization »,
Ethnology 39 / IV (2000) : 395-407.
KOZLOWSKI Gregory C., « Private Lives and Public Piety: Women and the Practice of
Islam in Mughal India », dans Women in the Medieval Islamic World, Hambly Gavin R.G.
(éd.), New York, St Martin’s Press, 1998 : 469-488.
KRUK Remke, « Warrior Women in Arabic Popular Romance: Qannâsa bint Muzâhim and
Other Valiant Ladies. Part I », Journal of Arabic Literature 24 (1993) : 213-230.
, « Warrior Women in Arabic Popular Romance: Qannâsa bint Muzâhim and Other
Valiant Ladies. Part II », Journal of Arabic Literature 25 (March 1994) : 16-33.
Page | 794
, « The Bold and the Beautiful: Women and ‘Fitna’ in the ‘Sirat Dhat Al-Himma: The
Story of Nura », dans Women in the Medieval Islamic World, Hambly Gavin R.G. (éd.), New
York, St Martin’s Press, 1998 : 99-116.
KURAN Aptullah, « Üsküdar’da Mihrimah Sultan Külliyesi », Boğaziçi üniversiti dergisi:
Hümaniter Bilimler 3 (1975) : 43-72.
KURT Abdurrahman, Bursa Sicillerine Göre Osmanlı Ailesi (1839-1876), Bursa, Uludağ
Universitesi Yayınları, 1998.
KÜTÜKÖĞLU Bekir, « Vâlide Sultan », İA : t. 13 p. 181.
LAIOU Sophia, « Christian Women in an Ottoman World: Interpersonal and Family Cases
Brought Before the Shari’a Court during the Sventeenth and Eighteenth Centuries (Cases
Involving the Greek Community) », dans Women in the Ottoman Balkans. Gender, Culture
and History, A. Buturovic et I. C. Schick (éd.), Londres / New York, I.B. Tauris, 2007 : 243-
272.
LUTFI Huda, « Al-Sakhâwî’s Kitâb al-Nisâ’ as a Source for the Social and Economic History
of Muslim Women During the Fifteenth Century AD », The Muslim World 21 (1981) : 104-
124.
, « Manners and Customs of Fourteenth-Century Cairene Women: Female Anarchy
versus Male Shar’i Order in Muslim Prescriptive Treatises », dans Women in Middle Eastern
History: Shifting Boundaries in Sex and Gender, N. R. Keddie et B. Baron (éds.), New
Haven, Yale University Press, 1991 : 99-121.
MAJER Hans G., « The Harem of Mustafa II (1695-1703) », Osmanlı Araştırmaları / Journal
of Ottoman Studies 12 (1992) : 431-444.
, « Individualized Sultans and Sexy Women: the Works of Musavvir Hüseyin and their
East-West context », Art turc, Turkish art, 10th International Congress of Turkish Art, 10e
Congrès international d'art turc, Genève-Geneva, 17-23 September 1995. 17-23 Septembre
1995, Actes-Proceedings, Genèves, Fondation Max Van Berchem, 1999 : 463-471.
MALIECKAL Bindu, « Slavery, Sex, and the Seraglio: ‘Turkish’ Women and Early Modern
Texts », dans The Mysterious and the Foreign in Early Modern England, H. Ostovich, M. V.
Silcox et G. Roebuck (éds.), Newark, University of Delaware Press, 2008 : 58-73.
MARCUS Abraham, « Men, Women and Property: Dealers in 18th
Century Aleppo », Journal
of the Economic and Social History of the Orient 26/2 (1983): 137-163.
MAREFAT Roya, « Timurid Women: Patronage and Power », Asian Art 6 (1993) : 28-49.
MARSOT Afaf L. Al-Sayyid (éd.), Society and the Sexes in Medieval Islam, Malibu, Undena
Publishing, 1979.
, Women and Men in Late Eighteenth-Century Egypt. Austin, University of Texas
Press, 1995.
MASUD Rahat N., « The Representation of Females in Mughal Paintings – in relation to their
social status », Lahore Museum Bulletin 13 / I (2000) : 25-31.
Page | 795
McGINTY Anna M., Becoming Muslim: Western Women’s Conversions to Islam, New York,
Palgrave Macmillan, 2006.
MELIKOFF Irène, « Recherche sur une Bacıyan-ı Rum: Kadıncık Ana », dans Festschrift
Hans Georg Majer. Arts, Women and Scholars, S. Prätor et Ch. K. Neumann (éds.), 2 vol.,
Istanbul, Simurg, 2002 : 1-10.
MELMAN Billie, Women’s Orients: English Women and the Middle East, 1718-1918.
Sensuality, Religion and Work, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1992.
MERIWETHER Margareth L., The Notable Families of Aleppo, 1770-1830: Networks and
Social Structure, PhD. Diss., University of Pennsylvania, 1981.
, « Women and Waqf Revisited: The Case of Aleppo, 1770-1840 », dans Women in the
Ottoman Empire. Middle Eastern Women in the Early Modern Era, M. C. Zilfi (éd), Leiden /
New York / Köln, Brill, 1997: 128-152.
et TUCKER Judith E., Social History of Women and Gender in the Modern Middle
East, Boulder (Colo.), Westview Press, 1999.
MERON Ya’akov, L’obligation alimentaire entre époux en droit musulman hanéfite, Paris,
Librairie générale de droit et de jurisprudence 1971.
MICKLEWRIGHT Nancy, « Musicians and Dancing Girls: Images of Women in Ottoman
Miniature Painting », dans Women in the Ottoman Empire. Middle Eastern Women in the
Early Modern Era, M. C. Zilfi (éd.), Leiden / New York / Köln, Brill, 1997: 153-168.
MISRA Rekha, Women in Moghul India, 1526-1748 AD, Delhi, Munshiram Manoharlal,
1967.
MORDTMANN J. H., « Die Judischen Kira im Serai der Sultane », Mitteilungen des
Seminars für Orientalische Sprachen 32 (1929) : 1-38.
MUKMINOVA Raziya, « Le rôle de la femme dans la société de l’Asie centrale sous les
Timourides et les Sheybanides », Cahiers de l’Asie Centrale 3-4 (1997) : 203-212.
MUSALLAM Basin F., Sex and Society in Islam: Birth Control before the Nineteenth
Century, Cambridge, Cambridge University Press, 1983.
NAJMABADI Afsaneh, « Reading for gender through Qajar painting », dans Royal Persian
paintings: the Qajar epoch, 1785-1925, L. S. Diba et M. Ekhtiar (éds.), Londres, Tauris /
Brooklyn Museum of Art, 1998 : 76-89.
NAMETAK Fehim, « Vakuf-nama Aiše kćeri Hadži Ahmeda iz Mostara », Prilozi za
orijentalnu filologipu 44-45 (1996) [« The vakufnama of Aiše, daughter of Hajji Ahmed of
Mostar »].
NASHAT Guity, TUCKER Judith E. (éds.), Women in the Middle East: Restoring Women to
History, Bloomington, Indiana University Press, 1999.
al-NOWAIHI Magda M., « Resisting silence in Arab women's autobiographies
», International Journal of Middle East Studies 33 / IV (2001) : 477-502.
Page | 796
ORTAYLI İlber, « Anadolu’da XVI. Yüzyılda Evlilik İlişkileri Üzerine Bazı Gözlemler »,
Osmanlı Araştırmaları 1 (1980) : 33-40.
ÖZCAN Abdülkadir, « Hatun », TDVİA t. 16 p. 499-500.
PAMUK Bilgehan, « Conditional Divorce in Ottoman Society: A Case from Seventeenth-
Century Erzurum », Bilig 44 (2008) : 111-122.
PEDANI Maria P., « Safiye’s Household and Venetian Diplomacy », Turcica 32 (2000) : 9-
32.
PEIRCE Leslie P., « The family as faction: dynamics politics in the reign of Süleyman », dans
Soliman the magnifique et son temps. Actes des IXe rencontres de l’Ecole du Louvre, Paris, 7-
10 mars 1990, G. Veinstein (éd.), Paris, La Documentation Française, 1992 : 105-116.
, The Imperial Harem, Women and Sovereignty in the Ottoman Empire, New York,
Oxford University Press, 1993.
, « Seniority, Sexuality and Social Order: The Vocabulary of Gender in Early Modern
Ottoman Society », dans Women in the Ottoman Empire. Middle Eastern Women in the Early
Modern Era, M. C. Zilfi (éd.), Leiden / New York / Köln, Brill, 1997 : 169-196.
, « Le dilemme de Fatma: Crime sexuel et culture juridique dans une cour ottomane au
début des Temps modernes », Annales. Histoire, Sciences Sociales 53/2 (Mars-Avril 1998) :
291-319.
, « ‘The Law Shall not Languish’ : Social Class and Public Conduct in Sixteenth-
century Ottoman Discource », dans Hermeneutics and Honor. Negotiating Female ‘Public’
Space in Islamic/ate Societies, A. Asfaruddin (éd.), Cambridge (Center for Middle Eastern
Studies), Harvard University, 1999 : 140-158.
, « ’She is trouble… And I Will Divorce Her’: Orality, Honor and Representation in
the Ottoman Court of ‘Aintab », dans Women in the Medieval Islamic World, Hambly Gavin
R.G. (éd.), New York, St Martin’s Press, 1998 : 269-300.
, « Gender and Sexual Propriety in Ottoman Royal Women’s Patronage », dans
Women, Patronage and Self-Representation in Islamic Societies, F. Ruggles (éd.), New York,
State University of New York, 2000 : 53-68.
, Morality Tales. Law and Gender in the Ottoman Court of Aintab, Berkeley C. A.,
University of California Press, 2003.
, « Domesticating Sexuality : Harem Culture in Ottoman Imperial Law », dans Harem
Histories: Lived Spaces and Envisioned Places, M. Booth (éd.), Durham / Londres, Duke
University Press, 2010 : 104-135.
PERRON Nicolas, Femmes arabes avant et depuis l’Islamisme, Paris, Librairie Nouvelle,
1858.
PETRY Carl F., « Class Solidarity versus Gender Gain : Women as Custodians of Property in
Later Medieval Egypt », dans Women in Middle Eastern History: Shifting Boundaries in Sex
and Gender, N. Keddie and B. Baron (éds.), New Haven, Yale University Press, 1991 : 122-
142.
, « Conjugal Rights versus Class Prerogatives: A Divorce Case in Mamluk Cairo »,
Women in the Medieval Islamic World, Hambly Gavin R.G. (éd.), New York, St Martin’s
Press, 1998 : 227-240.
Page | 797
PUCCI Suzanne R., « The Discrete Charms of the Exotic: Fictions of the Harem in
Eighteenth-Century France », dans Exoticism in the Enlightenment, G. S. Rousseau et Roy
Porter (éds.), Manchester, Manchester University Press, 1990 : 117-144.
RAFEQ Abdul-Karim, « Damascene Women in Probate Inventories: Two Samples: 1169
A.H. / 1755-56 & 1258 / 1842-43 », dans Festschrift Hans Georg Majer. Arts, Women and
Scholars. S. Prätor et Ch. K. Neumann (éds.), 2 vol. Istanbul, Simurg, 2002 : 265-280.
RAGIB Yusuf, « Al-Sayyida Nafisa, sa légende, son culte et son cimetière », Studia Islamica
44 (1976) : 61-86.
, « Al-Sayyida Nafisa, sa légende, son culte et son cimetière (II) », Studia Islamica 45
(1977) : 26-55.
RAHMATALLAH Maleeha, The Women of Baghdad in the Ninth and Tenth Centuries as
Revealed in the History of Baghdad of al-Hatib, Baghdad, Times Press, 1963.
REINDL-KIEL Hedda, « damet ismetûha–immer währe ihre Sittsamkeit: Frau und
Gesellschaft im Osmanischen Reich », Orientierungen 1 (1989) : 37-81.
, « A Woman timar Holder in Ankara Province during the Second Half of the 16th
Century », Journal of the Economic and Social History of the Orient 40/2 (1997) : 207-238.
RODED Ruth, Women in Islamic Biographical Collections: From Ibn Sa’d to Who’s Who,
Boulder, co. / Londres, Lynne Rienner Publishers, 1994.
ROSENTHAL Franz, « Fiction and Reality: Sources for the Role of Sex in Medieval Muslim
Society », dans Women and Men in Late Eighteenth-Century Egypt, A. Marsot (éd.), Austin,
University of Texas Press, 1995 : 3-22.
ROZEN M., « Public Space and Private Space among the Jews of Istanbul in the Sixteenth
and Seventeenth Century », Turcica 30 (1998) : 331-346.
RUGGLES Fairchild (éd.), Women, Patronage and Self-Representation in Islamic Societies,
Albany, State University of New York, 2000.
SADEK Noha, « Rasulid Women: Power and Patronage », Proceedins of the 22th Seminar for
Arabian Studies 19 (1989) : 121-136.
, « In the Queen of Sheba’s Footsteps: Women Patrons in Rasulid Yemen », Asian Art
6 (1993) : 14-27.
SAKAOĞLU Necdet, Bu Mülkün Kadın Sultanları. Vâlide Sultanlar, Hâtunlar, Hasekiler,
Kadınefendiler, Sultanefendiler, Istanbul, Oğlak Yayıncılık, 2009.
, « Kösem Sultan », OA : t. 2 p. 37-39.
, « Mihrimah Sultan », OA : t. 2 p. 213-214.
SALAKIDES Georgios, « Women in the Kadı Sicilleri of Yenişehir (Larissa) in the Middle of
the Seventeenth Century », dans Festschrift Hans Georg Majer. Arts, Women and Scholars, S.
Prätor et Ch. K. Neumann (éds.), 2 vol, Istanbul, Simurg, 2002 : 209-228.
Page | 798
SANDERS Paula, « Gendering the Ungendered Body: Hermaphrodites in Medieval Islamic
Law », dans N. Keddie et B. Baron (éds.), Women in Middle Eastern History: Shifting
Boundaries in Sex and Gender, New Haven, Yale University Press, 1991 : 74-95.
SCHACHT Joseph, « Nikâh. I-Dans l’Islam classique », EI (2) : t. VIII pp. 26-29.
SCHICK Irvin C., « Christian Maidens, Turkish ravishers: The Sexualization of National
Conflict in the Late Ottoman Period », dans Women in the Ottoman Balkans. Gender, Culture
and History, A. Buturovic et I. C. Schick (éds.), Londres / New York, I.B. Tauris, 2007 : 273-
306.
SENG Yvonne, « Standing at the Gates of Justice: Women in the Law Courts of early
Sixteenth-century Üsküdar, Istanbul », dans Contested States: Law, Hegemony and
Resistance. Hirsch S. et Lazarus-Black M. (éds.), New York, Routledge, 1994 : 184-206.
, « Invisible Women: Residents of Early Sixteenth-Century Istanbul », dans Women in
the Medieval Islamic World, Hambly Gavin R.G. (éd.), New York, St Martin’s Press, 1998 :
241-268.
SILAY Kemal, « Singing His Words: Ottoman Women Poets and the Power of Patriarchy »,
dans Women in the Ottoman Empire. Middle Eastern Women in the Early Modern Era, M.C.
Zilfi (éd), Leiden / New York / Köln, Brill, 1997 : 197-213.
SKILLITER Susan A., « Three Letters from the Ottoman ‘Sultana’ Safiye to Queen Elizabeth
I », dans Documents from Islamic Chanceries, S. M. Stern (éd.), Columbia S. C., S. M. Stern,
1965 : 119-157.
, « Catherine de’ Médici’s Turkish Ladies-in-waiting: A Dilemna in Franco-Ottoman
Diplomatic Relations », Turcica 7 (1975) : 188-204.
, « The Letters of the Venetian ‘Sultan’ Nûr Bânû and Her Kira to Venice », dans
Studia Turcologica Memoriae Alexii Bombaci Dicata, A. Gallotta et U. Marazzi (éds.),
Naples, Herder, 1982 : 515-536.
, « Khurrem », EI (2) : t. V p. 68-70.
SMITH Margaret, Rabi’a the Mystic and Her Fellow-Saints in Islam, Cambridge, Cambridge
University Press, 1928.
SOLIC Mirna, « Women in Ottoman Bosnia as Seen Through the Eyes of Luka Botic, a
Christian Poet », dans Women in the Ottoman Balkans. Gender, Culture and History, A.
Buturovic et I. C. Schick (éd.), Londres / New York, I.B. Tauris, 2007 : 307-334.
SONBOL Amira El-Azhary (éd.), Women, the Family and Divorce Laws in Islamic History,
Syracuse, Syracuse University Press, 1996.
, « Rape and Law in Ottoman and Modern Egypt », dans Women in the Ottoman
Empire. Middle Eastern Women in the Early Modern Era, M. C. Zilfi (éd), Leiden / New
York / Köln, Brill, 1997 : 214-131.
SOUCEK Priscilla P., « Timurid Women: A Cultural Perspective », dans Women in the
Medieval Islamic World, Hambly Gavin R. G. (éd.), New York, St Martin’s Press, 1998 : 199-
226.
Page | 799
SPAHO Fehim Dž, « Vakufnama Shahdidar, supruge Gazi Husrev-bega », dans Vakufname iz
Bosne i Hercegovine (XV i XVI vijek), L. Gazić (éd.), Sarajevo, Orijentalni institute u
Sarajevu, 1985 [« The vakufnama of Shahdidar, wife of Gazi Husrev Bey»].
SPECTORSKY Susan A., Chapters on Marriage and Divorce: Responses of Ibn Hanbal and
Ibn Rahwayh, Austin, University of Texas Press, 1993.
SPELLBERG Denise A., « Nizâm al-Mulk’s Manipulation of Tradition: ‘A’isha and the Role
of Women in the Islamic Government », Muslim World 78 (1988) : 111-117.
, « Political Action and Public Example: ‘A’isha and the Battle of the Camel », dans
Women in Middle Eastern History: Shifting Boundaries in Sex and Gender, N. Keddie and B.
Baron (éds.), New Haven, Yale University Press, 1991: 45-57.
, Politics, Gender and the Islamic Past: the Legacy of ‘A’isha bint Abi Bakr, New
York, Columbia University Press, 1994.
SPIES O., « Mahr », EI (2) : t. 6 p. 76-78.
ŚWIĘCICKA Elżbieta, « The diplomatic letters by Crimean Keräy ladies to the Swedish royal
house », Rocznik Orientalistyczny 55 / 1 (2003) : 57-90.
SZUPPE Maria, « La participation des femmes de la famille royale à l’exercice du pouvoir en
Iran safavide au XVIe siècle. I : L’importance politique et sociale de la parenté
matrilinéaire », Studia Iranica I/23 (1994) : 211-258.
, « La participation des femmes de la famille royale à l’exercice du pouvoir en Iran
safavide au XVIe siècle. II : L’entourage des princesses et leurs activités politiques », Studia
Iranica II/24 (1995) : 1-58.
, « The ‘Jewels of Wonder’: Learned Ladies and Princess Politicians in the Provinces
of Early Safavid Iran », dans Women in the Medieval Islamic World, Hambly Gavin R. G.
(éd.), New York, St Martin’s Press, 1998 : 325-348.
TABBAA Yasser, « ayfa Khātūn, regent queen and architectural patron », dans Women,
patronage, and self-representation in Islamic societies, D. F. Ruggles (éd.),
Albany (USA), State University of New York Press, 2000 : 17-34.
THYS-ŞENOCAK Lucienne, « Location, Expropriation and the Yeni Valide Complex in
Eminönü », dans Art turc, Turkish art, 10th International Congress of Turkish Art, 10e
Congrès international d'art turc, Genève-Geneva, 17-23 September 1995, 17-23 Septembre
1995, Actes-Proceedings, Genève, Fondation Max Van Berchem, 1999 : 675-680.
, « The Yeni Valide Mosque Complex of Eminönü, Istanbul (1597-1665): Gender and
Vision in Ottoman Architecture », dans Women, Patronage and Self-Representation in
Islamic Societies, F. Ruggles (éd.), Albany, State University of New York, 2000 : 69-90.
, Ottoman Women Builders. The Architectural Patronage of Hadice Turhan Sultan.
Aldershot, Ashgate, 2006 [traduit en turc : Hadice Turhan Sultan. Osmanlı
İmparatorluğu’nda Kadın Baniler, A. Ortaç (trad.). Istanbul, Kitap Yayınevi, 2009].
TIRMIZI S. A. I., Edicts from the Mughal Harem, Delhi, Idarah-i Adabiyat-i Delli, 1979.
TOLEDANO Ehud R., « Slave Dealers, Women, Pregnancy, and Abortion: The Story of a
Circassian Slave-Girl in Mid-Nineteenth Century Cairo », Slavery and Abolition 2/1 (1981) :
53-68.
Page | 800
TOLMACHEVA Marina A., « Ibn Battuta on Women’s Travel in the Dar al-Islam », dans
Women and the Journey: The Female Travel Experience, B. Frederick et S. H. McLeod (éds.),
Washington, Washington State University Press, 1993 : 114-140.
, « Female Piety and Patronage in the Medieval Hajj’ », dans Women in the Medieval
Islamic World, Hambly Gavin R.G. (éd.), New York, St Martin’s Press, 1998 : 161-180.
TOMICHE Nada, « The Situation of Egyptian Women in the First Half of the Nineteenth
Century », dans Beginnings of Modernization in the Middle East, W. R. Polk et R. L.
Chambers (éds.), Chicago, University of Chicago Press, 1968 : 171-184.
TUCKER Judith E., « Problems in the Historiography of Women in the Middle East : The
Case of Nineteenth-century Egypt », International Journal of Middle East Studies 15 (1983) :
321-336.
, Women in Nineteenth-Century Egypt, Cambridge, Cambridge University Press, 1985.
, « Marriage and Family in Nablus, 1720-1856: Toward a History of Arab Marriage »,
Journal of Family History 13 (1988) : 165-179.
, « Ties that Bound: Women and Family in Eighteenth- and Nineteenth-Century Nablus
», dans Women in Middle Eastern History: Shifting Boundaries of Sex and Gender, N. Keddie
et B. Baron (éds.), New Haven (Connecticut) / Londres, Yale University Press, 1991 : 233-
253.
, « The Fullness of Affection: Mothering in the Islamic Law of Ottoman Syria and
Palestine », dans Women in the Ottoman Empire. Middle Eastern Women in the Early Modern
Era, M. C. Zilfi (éd.), Leiden / New York / Köln, Brill, 1997 : 232-252.
, In The House of The Law. Gender and Islamic Law in Ottoman Syria and Palestine,
Berkeley / Los Angeles / Londres, University of California Press, 1998.
, Women, Family, and Gender in Islamic Law, Cambridge, Cambridge University
Press, 2008.
TURAN Ebru, « The Marriage of Ibrahim Pasha (ca. 1495-1536). The Rise of the Sultan
Süleyman’s Favorite to the Grand Vizierate and the Politics of the Elites in the Early
Sixteenth-Century Ottoman Empire », Turcica 41 (2009) : 3-36
ÜÇOK Bahriye, İslâm Devletlerinde Türk Nâibeler ve Kadın Hükümdarlar, Istanbul, Bilge
Kültür Sanat, 2011 (3e édition) [traduit en français par A. Çakmaklı sous le titre : Femmes
turques souveraines et régentes dans les Etats islamiques, Başarı Matbaacılık (sans date)].
UÇTUM Nejat R., « Hürrem ve Mihrümah Sultanların Polonya Kıralı II. Zigsmund’a
Yazdıkları Mektuplar », Belleten 44 (1980) : 697-715.
ULUÇAY Çağatay M., « XVIII. Asırda Yapılan Sultan Düğünlerine Umumî Bir Bakış »,
Yeni Tarih Dergisi 3 (Mars 1952) : 80-82, 90 [réédité dans Sancaktan Saraya, Seçme Yazılar,
M. S. Koz et H. Şahin (éds.), Istanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2012 : 279-283].
, « Fatma ve Safiye Sultanların düğünlerine ait bir araştırma », İstanbul Mecmuası 4
(1958) : 148-152.
, « İstanbul’da XVIII. ve XIX. Asırlarda Sultanların Doğumlarında Yapılan Törenler
ve Şenliklere Dair », İstanbul Enstitüsü Dergisi IV (1958) : 148-152 [réédité dans Sancaktan
Saraya, Seçme Yazılar, M. S. Koz et H. Şahin (éds.), Istanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2012 :
299-315].
, « II. Bayezid’in ailesi », Tarih Dergisi 10 (1959) : 105-124.
Page | 801
, « Kanuni Sultan Süleyman ve ailesi ile ilgili bazı notlar ve vesikalar », dans Kanuni
Armağanı, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1970 : 227-258.
, Padişahların kadınları ve kızları, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1992 [3e edition]
, Harem II, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 2001 [4e edition].
, « Beş yaşında iken nikâhlanan ve beşikte nişanlanan sultanlar », dans Sancaktan
Saraya, Seçme Yazılar, M. S. Koz et H. Şahin (éds.), Istanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2012 :
285-291 [1re
édition dans la revue Yeni Türk Tarih 4, Avril 1957].
UZUNÇARŞILI İsmail H., « Osmanlı Tarihi’nin İlk Devrelerine Aid Bazı Yanlışlıkların
Tashihi (Murad Hüdavendigar Kızı ve Karamanoğlu Alaeddin Bey’in Zevcesi’nin Adı
Nedir?) », Belleten XXI/81 (1957) : 173-188.
, « Yavuz Sultan Selim’in kızı Sultan Hanım ve oğlu Kara Osman Şah Bey
Vakfiyeleri », Belleten XL/159 (Juillet 1976) : 467-478.
, Osmanlı Devletinin Saray Teşkilâtı, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1988.
VAKA Demetra, Haremlik, some pages from the life of Turkish women, Boston / New York,
Houghton Mifflin company, 1909.
VEINSTEIN Gilles, « Femmes d’Avlonya (Vlöre) vers le milieu du XVIe siècle d’après les
actes des cadis », dans Festschrift Hans Georg Majer. Arts, Women and Scholars, S. Prätor et
Ch. K. Neumann (éds.), 2 vol., Istanbul, Simurg, 2002 : 195-208.
VIGUERA Maria J., « Asluhu li’ l-ma’alî: On the Social Status of Andalusî Women », dans
The Legacy of Muslim Spain, S. Kh. Jayyusi (éd.), Leiden, Brill, 1992 : 708-724.
VRYONIS Speros, « The Muslim Family in 13th
-14th
century Anatolia as Reflected in the
Writings of the Mawlawi Dervich Eflaki », dans The Ottoman Emirate (1300-1389),
Elizabeth Zachariadou (éd.), Rethymnon, Crete University Press, 1993 : 213-223.
WOLPER Ethel Sara, « Princess Safwat al-Dunyā wa al-Dīn and the Production of Sufi
Buildings and Hagiographies in Pre-Ottoman Anatolia », dans Women, patronage, and self-
representation in Islamic societies, D. F. Ruggles (éd.), Albany (USA),
State University of New York Press, 2000 : 35-52.
YEAZELL Ruth B., Harems of the Mind : Passages of Western Art and Literature, New
Haven, Yale University Press, 2000.
YOUNG William C., « The Ka’ba, Gender and the Rights of Pilgrimage », International
Journal of Middle East Studies 25 (1993) : 285-300.
ZACHARIADOU Elizabeth A. (éd.), The Ottoman Emirate (1300-1389), Rethymnon, Crete
University Press, 1993.
, « Notes on the Wives of the Emirs in Fourteenth-Century Anatolia », dans Festschrift
Hans Georg Majer. Arts, Women and Scholars, S. Prätor et Ch. K. Neumann (éds.), 2 vol.
Istanbul, Simurg, 2002 : 61-69.
ZARINEBAF-SHAHR Fariba, « Ottoman Women and the Tradition of Seeking Justice in the
Eighteenth Century », dans Women in the Ottoman Empire. Middle Eastern Women in the
Early Modern Era, M. C. Zilfi (éd.), Leiden / New York / Köln, Brill, 1997 : 253-263.
Page | 802
, « Women and the Public Eve in Eighteenth-Century Istanbul », dans Women in the
Medieval Islamic World, Hambly Gavin R.G. (éd.), New York, St Martin’s Press, 1998 : 301-
324.
, « The Role of Women in the Urban Economy of Istanbul, 1700-1850 », International
Labor and Working-Class History 60 (2001) : 141-152.
ZECEVIC Selma, « Missing Husbands, Waiting Wives, Bosnians Muftis: Fatwa Texts and
the Interpretation of Gendered Presences and Absences in Late Ottoman Bosnia », dans
Women in the Ottoman Balkans. Gender, Culture and History, A. Buturovic et I. C. Schick
(éds.), Londres / New York, I.B. Tauris, 2007 : 335-360.
ZEEVI Dror, « Women in 17th-Century Jerusalem: Western and Indigenous Perspectives »,
International Journal of Middle East Studies 27/2 (Mai 1995) : 157-173.
ZILFI Madeline C., « Ibrahim Pasha and the Women », dans Histoire économique et sociale
de l’Empire ottoman et de la Turquie (1326-1960), D. Panzac (éd.). Louvain, Peeters, 1995 :
555-559
(éd.), Women in the Ottoman Empire, Middle Eastern Women in the Early Modern
Era, Leiden / New York / Köln, Brill, 1997.
, « ‘We Don’t Get Along’: Women and Hul Divorce in the Eighteenth Century », in
dans Women in the Ottoman Empire. Middle Eastern Women in the Early Modern Era, M. C.
Zilfi (éd.), Leiden / New York / Köln, Brill, 1997 : 264-296.
, Women and Slavery in the Late Ottoman Empire, Cambridge, Cambdrige University
Press, 2010.
Page | 803
Ouvrages relatifs au domaine turco-ottoman
« İbrahim Paşa (Damat) », OA: t. 1 p. 634 ;
« İbrahim Paşa (Nevşehirli Damat) », OA : t. 1 p. 638-640.
« Sadeddin Efendi (Hoca) », OA: t. 2 p. 477-479.
ABDUL RAHIM Abu-Husayn, Provincial Leaderships in Syria, 1575-1650. Beirut,
Americain University in Beirut, 1985.
ABOU-EL-HAJ Rifa’at Ali, « The Ottoman Vizier and Pasha Households, 1683-1703: a
preliminary report », Journal of the Americain Oriental Society 94/4 (1972) : 438-447.
, The 1703 Rebellion and the Structure of the Ottoman Politics, Istanbul, Nederlands
Historisch-Archaeologisch Instituut te Istanbul, 1984.
, Formation of the Modern State. The Ottoman Empire, Sixteenth to Eighteenth
Centuries, Syracuse, Syracuse University Press, 2005 [2nd
edition].
AFYONCU Erhan, « Müteferrika », TDVİA 32 : 183-185.
, « Sokollu Mehmed Paşa », TDVİA 37 : 354-357.
AGMON Iris, Family & Court, Legal Culture and Modernity in Late Ottoman Palestine, New
York, Syracuse University Press, 2006.
AKGÜNDÜZ Ahmet, İslam Hukukunda ve Osmanlı Tatbikatinda Vakıf Müessesi, Ankara,
Türk Tarih Kurumu, 1988.
AKMAN Mehmet, Osmanlı Devletinde Kardeş Katli, Istanbul, Eren, 1998.
AKSAN H. Virginia, « Ottoman Political Writing, 1768-1808 », International Journal of
Middle East Studies 25/1 (février 1993) : 53-69.
AKTEPE Münir M., Patrona İsyânı 1730, Istanbul, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Yayınları, 1958.
, « Damad İbrâhim Paşa, Nevşehirli », TDVİA 8 : 441-443
ALDERSON A. D., The Structure of the Ottoman Dynasty, Oxford, Clarendon Press, 1956.
[réédtion : Wesport (Connecticut), Greenwood Press, 1982].
AL-NIKRITI Nabil, Şehzade Korkud (ca. 1458-1513) and the Articulation of the Early 16th
Century Ottoman Religious Identity, thèse de doctorat, Chicago, 2004.
ALPER Ömer M., « Ahmed Paşa (Melek) », OA : t. 1 p. 150-151.
, « Mehmed Paşa (Sultanzade, Civankapıcıbaşı) », OA : t. 2 p. 172.
ALTUNDAĞ Şinasi et TURAN Şerafettin, « Rüstem Paşa », İA : t. 9 p. 800-802.
ANAFARTA Nigâr, « Makbul İbrahim Paşa Kanuni’nin Damadı mıydı ? », Hayat Tarih
Mecmuası 8 (Eylül 1966) : 75-76.
Page | 804
ANASTASOPOULOS Antonis (éd.), Provincial Elites in the Ottoman Empire. Halcyon Days
in Crete V. A Symposium Held in Rethymno, 10-12 January 2003, Rethymno, Crete
University Press, 2005.
, « The Mixed Elite of a Balkan Town: Karaferye in the Second Half of the Eighteenth
Century », in Provincial Elites in the Ottoman Empire, Halcyon Days in Crete V. A
Symposium Held in Rethymno, 10-12 January 2003, A. Anastasopoulos (éd), Rethymno,
Crete University Press, 2005 : 259-268.
AND Metin, Kırk Gün Kırk Gece, Eski Donanma ve Şenliklerde Seyirlik Oyunları, Istanbul,
Taç Yayınları, 1959.
, « Osmanlı Düğünlerinde Nahıllar », Hayat Tarih Mecmuası 2 / 12 (Janvier 1969) :
16-19.
ATASOY Ali R. et ATASOY Mehmet C., Tokat, Reşadiye’li Sadrazam Seyyid Hasan Paşa.
Hayat Hikâyesi ve Eserleri 1679-1748, Istanbul,Yenilik Basımevi, 1990.
ATASOY Nurhan, İbrahim Paşa Sarayı, Istanbul, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi,
1972.
, 1582 Surname-i Hümayun, Düğün Kitabı, Istanbul, Koçbank, 1997.
ATİL Esin, « The Story of an Eighteenth-Century Ottoman Festival », Muqarnas 10 (1993) :
181-200.
, Levni and the Surnâme: The Story of an Eighteenth-Century Ottoman Festival.
Istanbul, Koçbank, 1999 [traduit en turc sous le titre : Levni ve Surnâme, Bir Osmanlı
Şenliğinin Öyküsü. Istanbul, Koçbank, 1999].
AYKUT Nezihi, « Damad İbrâhim Paşa », TDVİA : t. 8 p. 440-441.
AYVERDI Ekrem H., Osmanlı Mimârîsinde Çelebi ve II. Sultan Murad devri. 806-855
(1403-1451), İstanbul, Baha matbaasi, 1972.
, Osmanli mimarisinde Fatih devri. 804-886 (1451-81), Istanbul, Baha matbaasi, 1974.
, Avrupa’da Osmanli mimari eserleri: Bulgaristan, Yunanistan, Arnavudluk IV,
Istanbul, İstanbul Fetih Cemiyeti yayını, 1982.
et YÜKSEL Aydın İ., Osmanlı Mimarisinde II. Bâyezid Yavuz Selim Devri. 886-926
(1481-1520), Istanbul, İstanbul Fetih Cemiyeti yayını, 1983.
, İstanbul Mimarî Çağının Menşe’i, Osmanlı Mimarîsinin İlk Devri Ertuğrul, Osman,
Orhan Gaziler, Hüdâvendigâr ve Yıldırım Bayezid. 630-805 (1230-1402), Istanbul, İstanbul
Fetih Cemiyeti, 1989.
BABINGER Franz, Mahomet II, le Conquérant et son temps, 1432-1481. La grande peur du
monde au tournant de l’histoire, Paris, Payot, 1954.
BACQUE-GRAMMONT Jean-Louis, LAQUEUR Hans Peter, VATIN Nicolas, « Stelae
Turcicae I. Le cimetière de Küçük Aya Sofiya », Istanbuler Mitteilungen 34 (1984) : 393-403.
, Les Ottomans, les Safavides et leurs voisins, 1500-1524, Istanbul, Isis Press, 1987.
et VATIN Nicolas, « Stelae Turcicae III. Le cimetière de plein air de Şile », dans
Türkische Miszellen. Robert Anhegger Festschrift, Bacqué-Grammont et alii (éds.), Varia
Turcica IX (1987) : 45-61
Page | 805
, « L’apogée de l’Empire ottoman : les événements (1512-1606) », dans Histoire de
l’Empire ottoman. R. Mantran (dir.). Paris, Fayard, 1989 : 139-158.
, LAQUEUR Hans Peter, VATIN Nicolas, « Stelae Turcicae II. Cimetières de la
mosquée de Sokollu Mehmed Pasa à Kadırga Limanı , de Bostancı Ali et du türbe de Sokollu
Mehmed Pasa à Eyüp », Istanbuler Mitteilungen 36 (1990) : 260 p.
et VATIN Nicolas, « Stelae Turcicae IV. Le cimetière de la bourgade thrace de
Karacaköy », Anatolia Moderna – Yeni Anadolu 2 (1991) : 7-27
, DUMONT Paul, EDHEM Eldem, LAQUEUR Hans Peter, SAINT-LAURENT
Béatrice, VATIN Nicolas, ZARCONE Thierry, « Stelae Turcicae V. Le tekke bektachi de
Merdivenköy », Anatolia Moderna – Yeni Anadolu 2 (1991) : 29-135
et VATIN Nicolas, « Stelae Turcicae VI. Stèles funéraires de Sinop », Anatolia
Moderna – Yeni Anadolu 3 (1992) : 105-207
et TIBET Aksel (éds.), Cimetières et traditions funéraires dans le monde islamique,
Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1996.
BALTA Evangelia, Les vakifs de Serrès et de sa région (XVe et XVIe siècles), Athènes,
Centre de recherches néo-helléniques de la fondation nationale de la recherche scientifique,
1995.
BALTACI Câhid, XV-XVI asırlar Osmanlı Medreseleri, Istanbul, İrfan Matbaası, 1976.
BARKAN Ömer L., « Osmanlı Imparatorluğunda bir iskân ve kolonization metodu olarak
vakıflar ve temlikler. I. Istilâ devrinin kolonizatör türk dervişleri ve zaviyeler », Vakıflar
Dergisi 2 (1942) : 279-386.
, « Les déportations comme méthode de peuplement et de colonisation dans l’Empire
ottoman », İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuâsı IX (1949-50) : 67-131.
, « Osmanlı İparatorluğunda bir iskân ve kolonyzasyon metodu olarak sürgünler »,
İstanbul Üniversitesi Iktisat Fakültesi Mecmuası XV (1953-54) : 209-237.
, « Quelques observations sur l’organisation économique et sociale des villes
ottomanes des XVIe et XVIIe siècles », Recueil Société Jean Bodin II (1955) : 289-311.
, « Timar », İslam Ansiklopedisi 12 (1972) : 286-333.
, « ‘Feodal’ Düzen ve Osmanlı Timarı », dans Türkiye İktisat Tarihi Semineri, O.
Okyar (éd.), Ankara, Hacettepe Universitesi Yayınları, 1975 : 1-32.
BARKEY Karen, Bandits and Bureaucrats. The Ottoman Route to State Centralization,
Ithaca / Londres, Cornell University Press, 1994.
BARNES John R., An Introduction to Religious Foundations in the Ottoman Empire, Leiden,
Brill, 1986.
BAŞOĞLU F. Hasan, Funeral Rites and Ceremonies in Islam, Ankara, Ayyıldız, 1959.
BAYSUN Cavid M., Cem Sultan Hayatı ve Eseri, Güven Basımevi, Ankara, 1963.
, « Ahmad Pasha », EI (2) : t. 1 p. 291.
, « Ahmet Paşa », İA : t. 1 p. 193.
BAZIN Louis, « La vie intellectuelle et culturelle dans l’Empire ottoman », dans Histoire de
l’Empire ottoman, R. Mantran (dir.), Paris, Fayard, 1989 : 695-726.
Page | 806
BELDICEANU Nicoara, Le timar dans l’Etat ottoman (début XIVe – début XVIe siècle),
Wiesbaden, Harrassowitz, 1980.
, « L’organisation de l’Empire ottoman (XIVe-XVe siècles) », dans Histoire de
l’Empire ottoman. R. Mantran (dir.). Paris, Fayard, 1989 : 117-138.
BELDICEANU-STEINHERR Irène, Recherches sur les actes des règnes des sultans Osman,
Orkhan et Murad I. Munich, Societas Academica Dacoromana , 1967.
, « Les débuts : Osmân et Orkhân », dans Histoire de l’Empire ottoman. R. Mantran
(dir.). Paris, Fayard, 1989 : 15-36.
BERKI Ali H., Vakıflar, Istanbul, Cihan Kitaphanesi, 1941.
, Vakfa dair yazılan vakfiye ve benzerî vesikalarda geçen ıstılah ve tâbirler, Ankara,
1966.
BILICI Faruk, « Les waqf-s monétaires à l'époque ottomane : droit hanéfite et pratique »,
Revue du monde musulman et de la Méditerranée 79-80 (1996) : 73-88.
BORROMEO Elisabetta, Voyageurs occidentaux dans l’Empire ottoman (1600-1644).
Inventaire des récits et étude sur les itinéraires, les monuments remarqués et les populations
rencontrées (Roumélie, Cyclades, Crimée), Paris, Maisonneuve & Larose / IFEA, 2007.
BOUQUET Olivier, Les Pachas du Sultan. Essai sur les agents supérieurs de l’Etat ottoman
(1839-1909), Paris / Louvain, Peeters, 2007.
, « Onomasticon Ottomanicum : identification administrative et désignation sociale
dans l’État ottoman du XIXe siècle », Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée
127 (2010) : 213-235.
, « Comment les grandes familles ottomanes ont découvert la généalogie », Cahiers de
la Méditerranée 82 (juin 2011) : 297-324.
, « Famille, familles, grandes familles : une introduction », Cahiers de la Méditerranée
82 (juin 2011) : 189-211.
, « Le vieil homme et les tombes. Références ancestrales et mémoire lignagère dans un
cimetière de famille ottoman », Oriens 39 (2011) : 331-365.
BOWEN Harold, « Agha », EI (2) : t. 1 p. 253-254.
, « Beg », EI (2) : t. 1 p. 1194-1195.
BRUNSCHVIG Robert, « Abd », EI (2) : t. 1 p. 26-31.
CAN Selman, Belgelerle Çırağan Sarayı, Ankara, T.C. Kültür Bakanlığı yayınları, 1999.
CANBAKAL Hülya, « On the ‘Nobility’ of Provincial Notables », in Provincial Elites in the
Ottoman Empire, Halcyon Days in Crete V. A Symposium Held in Rethymno, 10-12 January
2003, A. Anastasopoulos (éd.), Rethymno, Crete University Press, 2005 : 39-50.
CERASI Maurice, Divanyolu, A. Özdamar (trad.), Istanbul, Kitap Yayınevi, 2006.
CLAYER Nathalie et VEINSTEIN Gilles, « L’Empire ottoman », dans Les Vies d’Allah. Les
ordres mystiques dans le monde musulman des origines à aujourd’hui, A. Popovic et G.
Veinstein (éds.), Paris, Fayard, 1996 : 322-341.
Page | 807
ÇIZAKÇA Murat, « Cash Waqfs of Bursa, 1555-1823 », Journal of the Economic and Social
History of the Orient XXXVIII/3 (1995) : 313-354.
ÇUBUK Vahid, Köprülüler, Istanbul, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınevi, 1988.
D’OHSSON Mouradja, Tableau général de l’empire othoman, Istanbul, Isis, 2001.
DEGUILHEM Randi (éd.), Le Waqf dans l’espace islamique. Outil de pouvoir socio-
politique, Damas, Institut Français de Damas, 1995.
DELILBAŞI Melek, « Christians Sipahis in the Tırhala Taxation Registers (Fifteenth and
Sixteenth Century », dans Provincial Elites in the Ottoman Empire, Halcyon Days in Crete V.
A Symposium Held in Rethymno, 10-12 January 2003, A. Anastasopoulos (éd.), Rethymno,
Crete University Press, 2005 : 87-114.
DEMETRIADES Vasilyadis, « Vakifs along the Via Egnatia », dans The Via Egnatia under
ottoman Rule 1380-1699, Halcyon Days in Crete II; A Symposium Held in Rethymnon 9-11
January 1994, E. Zachariadou (éd.), Crete, Crete university press, 1996 : 85-95.
DEMIREL Ömer, Osmanlı Vakıf-Şehir İlişkisine Bir Örnek: Sivas Hayatında Vakıfların Rolü,
Ankara, Türk Tarih Kurumu, 2000.
DENY Jean, « Pasha », EI (2) : t. VIII p. 287-290.
DERINGIL Selim, The Well-Protected Domains. Ideology and the Legitimation of Power in
the Ottoman Empire, 1876-1909, Londres / New York, I. B. Tauris, 1998.
DIJKEMA F. Th., The Ottoman historical monumental inscriptions in Edirne, Leiden, Brill,
1977.
DUBEN Alan, « Household Formation in Late Ottoman Istanbul », International Journal of
Middle East Studies 22/4 (Novembre 1990) : 419-435.
ELDEM Edhem, « L’écrit funéraire ottoman : création, reproduction, transmission », dans
Revue du monde musulman et de la Méditerranée : Oral et écrit dans le monde turco-
ottoman, 75-76 (1995) : 65-78.
, Death in Istanbul. Death and Its Rituals in Ottoman-Islamic Culture. Istanbul,
Ottoman Bank Archives, 2005.
et VATIN Nicolas, L’épitaphe ottomane musulmane XVIe-Xxe siècles. Contributions à
une histoire de la culture ottomane, Paris / Louvain / Dudey MA, Peeters, 2007.
EMECEN Feridun M., Osmanlı Klasik Çağında Hanedan, Devlet ve Toplum, Istanbul, Timaş,
2011.
ERGIN Nina, NEUMANN Christoph K., SINGER Amy (éds.), Feeding People, Feeding
Power: Imarets in the Ottoman Empire, Istanbul, Eren, 2007.
ERGIN Osman, Türk Şehirlerinde İmaret Sistemi, Istanbul, Cumhuriyet Matbaası, 1939.
EROĞLU Haldun, Osmanlı Devletinde Şehzadelik Kurumu, Ankara, Akçağ Yayınları, 2004.
Page | 808
ERTUĞ Zeynep T., XVI. Yüzyıl Osmanlı Devletinde Cülûs ve Cenâze Törenleri, Ankara, T.C.
Kültür Bakanlığı, 1999.
ESTABLET Colette et PASCUAL Jean-Paul, Familles et fortunes à Damas : 450 foyers
damascains en 1700. Damas, Institut Français de Damas, 1994.
et PASCUAL Jean-Paul, « Les inventaires après décès, sources froides d’un monde
vivant », Turcica 32 (2000) : 113-143.
EVİN Ahmet Ö., « The Tulip Age and the Definitions of ‘Westernization’ », dans Türkiye’nin
Sosyal ve Ekonomik Tarihi (1071-1920) Social and Economic History of Turkey (1071-1920),
O. Okyar et H. İnalcık (éds.), Ankara, Haceteppe Üniversitesi Yayınları, 1980 : 131-145.
FAROQHI Süreyya, « Vakıf Administration in the 16th
Century Konya: The Zaviye of
Sadreddin-i Konyevi », Journal of Economic and Social History of Orient 17 (1974) : 145-
172.
, « Civilian Society and Political Power in the Ottoman Empire: a Report on Research
in Collective Biography (1480-1830) », International Journal of Middle East Studies 17/1
(février 1985) : 109-117.
, Subjects of the Sultan: Culture and Daily Life in the Ottoman Empire, Londres, I.B.
Tauris, 2000.
, « Exporting Grain from the Anatolian South-West: The Power and Wealth of
Tekelioğlu Mehmed Ağa and his Magnate Household », dans Provincial Elites in the
Ottoman Empire. Halcyon Days in Crete V. A Symposium Held in Rethymno, 10-12 January
2003, A. Anastasopoulos (éd), Rethymno, Crete University Press, 2005 : 295-320.
FEKETE Lajos von, Die Siyaqat-Schrift in der Türkischen Finanzverwaltung, Beitrag zur
Türkischen Palaographie I-II. Budapest, Akademiai Kiado, 1955.
FINDLEY Caroline V., Bureaucratic Reform in the Ottoman Empire, The Sublime Porte,
1789-1922, Princeton, Princeton University Press, 1980.
FINKEL Caroline, Osman’s Dream : the Story of the Ottoman Empire, 1300-1923, New
York, Basic Books, 2006.
FLEISCHER Cornell H., Bureaucrat and Intellectual in the Ottoman Empire. The Historian
Mustafa Âli (1541-1600), Princeton, Princeton University Press, 1986.
FLEMMING Barbara, « Political Genealogies in the Sixteenth Century », The Journal of
Ottoman Studies 7-8 (1988) : 123-37.
, « Khodja Efendi », EI (2) : t. 5 pp. 27-28.
FODOR Pal, « A grand vizieral tehlis : a study in the Ottoman central administration 1566-
1656 », Archivum Ottomanicum 15 (1997) : 137-188.
FORAND Paul G., « The Relation of the Slave and the Client to the Master or Patron »,
International Journal of Middle East Studies 2 (1971) : 59-66.
FOTIC Aleksandar, « Belgrade: A Muslim and Non-Muslim Cultural Centre (Sixteenth-
Seventeenth Centuries) », dans Provincial Elites in the Ottoman Empire. Halcyon Days in
Page | 809
Crete V. A Symposium Held in Rethymno, 10-12 January 2003, A. Anastasopoulos (éd.),
Rethymno, Crete University Press, 2005 : 51-76.
FRIERSON Elizabeth B., « Women in Late Ottoman Intellectual History », dans Late
Ottoman Society: The Intellectual Legacy, E. Özdalga (éd.), Londres / New York, Routledge
Curzon, 2005 : 135-161.
GABRIEL Albert, Une capital turque : Brousse, Bursa, Paris, E. de Boccard, 1958.
GARA Eleni, « Moneylenders and Landownerts: In Search of Urban Muslim Elites in the
Early Modern Balkans », dans Provincial Elites in the Ottoman Empire. Halcyon Days in
Crete V. A Symposium Held in Rethymno, 10-12 January 2003, A. Anastasopoulos (éd.),
Rethymno, Crete University Press, 2005 : 135-148.
GERBER Haim, « The Waqf Institution of the Ottoman Empire », Asian and African Studies
17 (1983) : 29-45.
GIBBONS Herbert A., The Foundation of the Ottoman Empire, Oxford, Oxford University
Press, 1916.
GİZ Adnan, « Makbul İbrahim Paşa’nın Damatlığı Meselesi », Resimli Tarih Mecmuası IV/48
(décembre 1943) : 2793-2794.
GÖÇEK Fatma M., Rise of the Bourgeoisie, Demise of Empire. Ottoman Westernisation and
Social Change. New York / Oxford, Oxford University Press, 1995.
GÖKBILGIN Tayyıb M., « Rüstem Paşa ve Hakkındaki İthamlar », Tarih Dergisi 18 / 11-12
(1968) : 11-50.
, « İbrahim Han », İA : t. 5 p. 894-895.
, « Lûtfi Paşa », İA : t. 7 p. 96-101.
, « Müteferrika », İA : t. 8 p. 853-856.
GÖYÜNÇ Nejat, « Hane deyimi hakkında », Tarih Dergisi 32 (1979) : 331-348.
GRADEVA Rossita, « Towards a Portrait of ‘the Rich’ in Ottoman Provincial Society: Sofia
in the 1670s », in Provincial Elites in the Ottoman Empire, Halcyon Days in Crete V. A
Symposium Held in Rethymno, 10-12 January 2003, A. Anastasopoulos (éd.), Rethymno,
Crete University Press, 2005 : 149-200.
GRANDIN Nicole et GABORIEAU Marc (éd.), Madrasa. La transmission du savoir dans le
monde musulman, Paris, Editions Arguments, 1997.
GRISWOLD William J., The Great Anatolian Rebellion, 1000-1020 / 1591-1611, Berlin, K.
Schwarz, 1983.
, « A Sixteenth Century Ottoman Pious Foundation », Journal of the Economic and
Social History of the Orient 27 (1984) : 175-198.
GÜLER Mustafa, Osmanlı Devlet’inde Haremeyn Vakıfları (XVI. – XVII. Yüzyıllar), Istanbul,
Tarih ve Tabiat Vakfı, 2002.
Page | 810
GÜNDAY Dündar, Arşiv Belgelerinde Siyakat Yazısı Özellikleri ve Divan Rakamları,
Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1989.
GÜRAN Tevfik, Ekonomik ve Malî Yönleriyle Vakıflar. Süleymaniye ve Şehzade Süleyman
Paşa Vakıfları, Istanbul, Kitabevi, 2006.
HAMADEH Shirine, The City’s Pleasures: Istanbul in the Eighteenth Century, Seattle,
University of Washington Press, 2007.
HATHAWAY Jane, The Politics of Households in Ottoman Egypt: The Rise of the Qazdaglis.
Cambridge, Cambridge University Press, 1996.
et MORGAN David (éds.), The Politics of Households in Ottoman Egypt, Cambridge,
Cambridge University Press, 2002.
, « Bilateral Factionalism in the Ottoman Provinces », dans Provincial Elites in the
Ottoman Empire, Halcyon Days in Crete V. A Symposium Held in Rethymno, 10-12 January
2003, A. Anastasopoulos (éd.), Rethymno, Crete University Press, 2005 : 31-38.
, Beshir Agha: Chief Eunuch of the Ottoman Imperial Harem, Oxford, Oneworld
Publications, 2006.
, « Eunuch Households in Istanbul, Medina and Cairo during the Ottoman Era »,
Turcica 41 (2009) : 291-304.
HEFFENING Willi, « Waqf », EI : vol. 4 p. 1154-1162.
HEYD Uriel, Ottoman Documents on Palestine, 1552-1615: A Study of the Firman According
to the Mühimme Defteri, Oxford, Clarendon Press, 1960.
, Studies in Old Ottoman Criminal Law, Oxford, Clarendon Press, 1973.
HITZEL Frédéric, « Diplomatik Armağanlar: Osmanlı İmparatorluğu ile Batı Avrupa Ülkeleri
Arasında Modern Çağda Yapılan Kültürel Değiş-Tokuş », dans Harp ve Sulh. Avrupa ve
Osmanlılar, D. Couto (éd.), Ş. Tekeli (trad.), Istanbul, Kitap Yayınevi / IFEA / Fondation
Calouste Gulbekian, 2010 : 243-258.
HOEXTER Miriam, Endowments, Rulers and Community: Wakf al-Haramayn in Ottoman
Algiers. Leiden, Brill, 1998.
, « Wakf Studies in the Twentieth Century: The State of the Art », Journal of the
Economic and Social History of the Orient XXXXI (1998) : 474-495.
HOWARD Douglas A., « Ottoman Historiography and the Literature of ‘Decline’ of the
Sixteenth and Seventeenth Centuries », Journal of Asian History 22 / 1 (1988) : 52-77.
HÜSNÜ Sapancalı, Karamanoğulları. Hayât ve Vakâyi’ Tarihiyyeleri, N. Topal (éd.), Konya,
Kömen Yayınları, 2010.
İHSANOĞLU Ekmeleddin (éd.), History of the Ottoman State, Society and Civilisation, vol.
1. Istanbul, IRCICA, 2001.
IMBER Colin, « Paul Wittek’s ‘De la défaite d’Ankara à la prise de Constantinople’ »,
Osmanlı Araştırmaları 5 (1986) : 65-81.
, « The Ottoman Dynastic Myth », Turcica 19 (1987) : 7-27.
, The Ottoman Empire 1300-1481, Istanbul, Isis, 1990.
Page | 811
, Ebu’s-Su’ud. The Islamic Legal Tradition, Edimbourg, Edimbourg University Press,
1997.
, The Ottoman Empire 1300-1650, Houndmills / New York, Palgrave Macmillan,
2002.
, « Lutfi Pasha », EI (2) : t. 5 p. 837-838.
İNALCIK Halil, « The Ottoman Methods of conquest », Studia Islamica 2 (1954) : 104-129.
, « Mehmed the Conqueror (1432-1481) and His Time », Speculum 35 (1960) : 408-
427.
, « The Rise of Ottoman Historiography », dans Historians of the Middle East, B.
Lewis et P. Holt (éds.), Londres, Oxford University Press, 1962 : 152-167.
, « Capital Formation in the Ottoman Empire », Journal of the Economic History 29
(1969) : 97-140.
, « L’Empire ottoman », Actes du Ier Congrès Insternational des etude balkaniques et
sud-est européennes, III. Sofia, 1969 : 75-103.
, The Ottoman Empire. The Classical Age, 1300-1600, Londres, Phoenix, 1974 [1re
édition : Londres, Weidengeld and Nicolson, 1973].
, « Learning, the Medrese and the Ulema », dans The Ottoman Empire. The Classical
Age, 1300-1600, Londres, Phoenix, 1974 : 165-172.
, « The Central Administration », dans The Ottoman Empire. The Classical Age, 1300-
1600, Londres, Phoenix, 1974 : 89-103.
, « The Manner of Accession to the Throne », dans The Ottoman Empire. The
Classical Age, 1300-1600, Londres, Phoenix, 1974 : 59-64 [1re
édition : Londres, Weidengeld
and Nicolson, 1973].
, « The Ottoman Concept of State and the Class System », dans The Ottoman Empire.
The Classical Age, 1300-1600, Londres, Phoenix, 1974 : 65-69.
, « The Palace », dans The Ottoman Empire. The Classical Age, 1300-1600. Londres,
Phoenix, 1974 : 76-88.
, « The Provincial Administration and the Timar System », dans The Ottoman Empire.
The Classical Age, 1300-1600. Londres, Phoenix, 1974 : 104-120.
, « Tursun Beg, Historian of Mehmed the Conqueror’s Time », Wiener Zeitschrift für
die Kunde des Morgenslandes 69 (1977) : 55-71.
, « Impact of the Annales School on Ottoman Studies and New Findings », Journal of
the Fernand Braudel Center I (1978) : 69-96.
, « Military and Fiscal Transformation in the Ottoman Empire, 1600-1700 », Archivum
Ottomanicum VI (1980) : 283-337.
, « The Question of the Emergence of the Ottoman State », International Journal of
Turkish Studies II (1980) : 71-79.
, Studies in Ottoman Social and Economic History, Londres, Variorum Reprints, 1985.
et KAFADAR Cemal (éds.), Süleyman the Second and his Time, Istanbul, Isis, 1993.
, « State and Ideology under the Sultan Süleyman I », dans The Middle East and the
Balkans under the Ottoman Empire. Essays on Economy and Society, Indiana University,
Bloomington, 1993 : 70-94.
, « The Ottoman Succession and Its Relation to the Turkish Concept of Sovereignty »,
dans The Middle East and the Balkans under the Ottoman Empire. Essays on Economy and
Society, Bloomington, Indiana University, 1993 : 37-69.
, « Padişah », TDVİA : t. 34 p. 140-143.
, « Reis ül-küttâb », İA : t. 9 p. 671-683
, « Hüsrev Paşa », İA : t. 5 p. 613.
Page | 812
İPŞİRLİ Mehmet, « Ottoman State Organization », dans History of the Ottoman State, Society
and Civilisation, vol. 1, İ. Ekmeleddin (éd.), Istanbul, IRCICA, 2001 : 133-186.
ITZKOWITZ Norman, « Eigtheenth Century Ottoman Realities », Studica Islamica 16 (1962)
: 73-94.
IVANOVA Svetlana, « Varoş: The Elites of the Reaya in the Towns of Rumeli, Seventeenth-
Eighteenth Centuries », dans Provincial Elites in the Ottoman Empire, Halcyon Days in Crete
V. A Symposium Held in Rethymno, 10-12 January 2003, A. Anastasopoulos (éd.), Rethymno,
Crete University Press, 2005 : 201-246.
JENNINGS Ronald C., « Some Thoughts on the Gazi Thesis », Wiener Zeitschrift für die
Kunde Des Morgenlandes 76 (1986) : 151-161.
, « Pious Foundations in the Society and Economy of the Ottoman Trabzon, 1565-
1640 », Journal of the Economic and Social History of the Orient XXXIII (1990) : 271-336.
KAÇAR Mustafa, « Mihrimah Sultan », TDVİA : t. 30 p. 39-40.
KAFADAR Cemal, Between Two Worlds. The Construction of the Ottoman State, Berkeley /
Los Angeles / Londres, University of California Press, 1995.
KASTRITSIS Dimitris J., The Sons of Bayezid. Empire Building and Representation in the
Ottoman Civil War of 1402-1413, Leiden / Boston, Brill, 2009 [publié en turc sous le titre :
Bayezid’in Oğulları. 1402-1413 Osmanlı İç Savaşında İmparatorluk İnşası ve Temsil.
Istanbul, Kitap Yayınevi, 2010].
KAYA Güven İ., « Dukagin Oğulları ve Dukakinzâde Yahyâ Beğ », Çevren XIII/52 (1986) :
9-18.
KAZICI Ziya, Islamî ve Sosyal Açıdan Vakıflar, Istanbul, Marifet Yayınları, 1985.
KILIÇ Rüya, Osmanlı’da Seyyidler ve Şerifler, Istanbul, Kitap Yayınevi, 2005.
KOÇ Havva, « Mustafa Paşa (Çoban) », OA : t. 2 p. 309.
KONYALI Ismail H., Abideleri ve Kitabeleriyle Karaman Tarihi, Istanbul, Baha matbaasi,
1967.
, Âbideleri ve Kitâbeleriyle Üsküdar Tarihi, 2 volumes, Istanbul, Türkiye Yeşilay
Cemiyeti Yayınları, 1976-1977.
et al., Karaman Tarihi ve Kültürü, 7 vols., Konya, Karaman Valılığı, 2005.
KÖPRÜLÜ F. Mehmet, « Lutfî Paşa », Türkiyat Mecmuası I (1925) : 119-150.
, Les origines de l’Empire ottoman, Paris, Éditions de Boccard, 1935 [traduction
anglaise : The Origins of the Ottoman Empire, G. Leiser (éd. et trad.), Albany, University of
New York Press, 1959 ; traduction turque : Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluşu, Ankara,
Akçağ, 1959 et Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1984].
, « L’institution du vakf et l’importance historique de documents de vakf », Vakiflar
Dergisi 1 (1938) : 3-9 (partie française).
, « Âşık Paşazâde », İA : t. 1 p. 706-709.
Page | 813
KOZAK İbrahim Erol, Bir Sosyal Siyaset Müessesi Olarak Vakıf, Istanbul, Akabe Yayınları,
1985.
KRAMERS Johannes H., « Sultan », EI : t. 4 p. 568-571.
, « Sultan », EI (2) : t. 9 p. 849-851.
, « Sultan », İA : t. 11 p. 27.
KUBAN Doğan, Kaybolan Kent Hayalleri Ahşap Saraylar, Istanbul, Yem Yayın, 2001.
KÜÇÜKDAĞ Yusuf, II. Bayezid, Yavuz ve Kanûnî Devirlerinde Cemâlî Ailesi, Istanbul,
Aksarayî vakfı yayınları, 1995.
KUNT Metin İ., « Ethnic-Regional (Cins) Solidarity in the Seventeenth-Century Ottoman
Establishment », International Journal of Middle East Studies 5 (1974) : 233-239.
, « Kulların Kulları », Boğaziçi Üniversitesi Dergisi: Beşeri Bilimler 3 (1975) : 27-42.
, « Derviş Mehmed Paşa, Vezir and Entrepreneur: A Study in Ottoman Political-
Economic Theory and Practice », Turcica 9 (1977) : 197-214.
, The Sultan’s Servants: The Transformation of Ottoman Provincial Government,
1550-1650. New York, Columbia University Press, 1983.
, « The Waqf as an Instrument of Public Policy: Notes on the Köprülü Endowment »,
dans Studies in Ottoman History in Honor of Professor Victor Ménage, C. Heywood et C.
Imber (éds.), Istanbul, Isis, 1994 : 189-198.
KUNTER Halim Bakı, « Emir Sultan Vakıfları ve Fatih’in Emir Sultan Vakfiyesi », Vakıflar
Dergisi IV (1958) : 39-74.
KURAN Aptullah, « A Spatial Study of Three Ottoman Capitals: Bursa, Edirne, and Istanbul
», Muqarnas 13 (1996) : 114-131.
KURT Yılmaz, CEYHAN Muhammed, Osmanlı Paleografyası ve Osmanlı Diplomatikası,
Ankara, Akçağ, 2012.
KÜTÜKÖĞLU Mübahat S., Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatika), Istanbul, Kubbealtı
Neşriyatı, 1994.
LEEUWEN Richard van, Waqfs and Urban Structures. The Case of Ottoman Damascus,
Leiden, Brill, 1999.
LEWIS Bernard, « Ottoman Observers of Ottoman Decline », Islamic Studies 1 (1962) : 71-
87.
, « Bîrûn », EI 2 : t. I p. 1273.
, « Efendi », EI (2) : t. II p. 44-45.
LINANT DE BELLEFONDS Yvon, Des donations en droit musulman, Le Caire / Paris, imp.
D. Photiadis et Recueil Sirey, 1935.
, Traité de droit musulman comparé. T. 2 : le mariage, la dissolution du mariage,
Paris / La Haye, Mouton & Co, 1965.
, Traité de droit musulman comparé. T. 3 : filiation, incapacités, libéralités entre vifs,
Paris / La Haye, Mouton & Co, 1973.
Page | 814
LLOYD Seton, « Old Waterside Houses on the Bosphorus: Saffet Paşa Yalısı at Kanlıca
», Anatolian Studies VII (1957) : 163-suite.
LOWRY Heath W., The Nature of the Early Ottoman State, Albany, State University of New
York Press, 2003.
et ERÜNSAL İsmail E., Yenice-i Vardar’lı Evrenos Hanedanı: Notlar ve Belgeler,
Istanbul, Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları, 2010.
MANTRAN Robert (dir.), Histoire de l’Empire ottoman. Fayard, Paris, 1989.
, « L’Etat ottoman au XVIIe siècle : stabilisation ou déclin ? », dans Histoire de
l’Empire ottoman, R. Mantran (dir.), Paris, Fayard, 1989 : 227-264.
, « L’Etat ottoman au XVIIIe siècle : la pression européenne », dans Histoire de
l’Empire ottoman, R. Mantran (dir.), Paris, Fayard, 1989 : 265-286.
, La vie quotidienne à Istanbul au siècle de Soliman le Magnifique, Paris, Hachette,
1990 [2e édition ; Réédité sous le titre Istanbul au siècle de Soliman le Magnifique, Paris,
Hachette Littérature, 1994].
MANZ Beatrice Forbes, The Rise and Rule of Tamerlan, Cambridge, Cambridge University
Press, 1999 (2e édition).
MARCUS Abraham, The Middle East on the Eve of Modernity: Aleppo in the Eighteenth
Century, New York, Columbia University Press, 1989.
Mc CHESNEY Robert D., « Wakf and Public Policy: The Waqfs of Shah Abbas, 1011-1023 /
1602-1614 », Asian and African Studies XV (1981) : 165-190.
MELIKOFF Irène, « Ewrenos (Ghâzî Evrenos) », EI (2) : t. II p. 738-739.
, « Ewrenos Oghulları », EI (2) : t. II p. 739-740.
MENAGE Victor L., « The Beginnings of Ottoman Historiography », dans Historians of the
Middle East, B. Lewis et P. Holt (éds.), Londres, Oxford University Press, 1962 : 168-170.
, Neshri’s History of the Ottomans: The Sources and Development of the Text,
Londres, Oxford University Press, 1964.
, « Some Notes on the Devshirme », Bulletin of the School of Oriental and African
Studies 29 (1966) : 64-78.
MERİÇ Münevver Okur, Sultan Cem. Hayatı, Esareti, Edebî Kişiliği, Eserleri, Şiirleri,
Ankara, PYS Vakıf Sistem Matbaa, 2006.
MERIWETHER Margaret L., The Kin Who count: Family and Society in Ottoman Aleppo,
1770-1840, Austin, University of Texas Press, 1999.
MILLER Barnette, The Palace School of Muhammad the Conqueror, Cambridge, Cambridge
University Press, 1941.
MORDTMANN Johannes H., « Dâmâd », EI (2) : t. 2 p. 105-106.
MOUTAFTCHIEVA Vera, Le vakıf, un aspect de la structure socio-économique de l’Empire
ottoman (XVe – XVIIe s.), Sofia, Jusautor, 1981.
Page | 815
MÜLLER-WIENER Wolfgang, « Das Kavak Sarayı Ein Verlorene Baudenkmal Istanbuls »,
Istanbuler Mitteilungen 38 (1988) : 363-376.
MURPHEY Rhoads, Exploring Ottoman Sovereignty. Tradition, Image and Practice in the
Ottoman Imperial Household 1400-1800, Londres, Continuum, 2008.
, Essays on Ottoman Historians and Historiography, Istanbul, Eren, 2009.
, « The Historian Mustafa Safi’s version of the kingly virtues as presented in his
extended preface to volume one of the Zübdet’ûl-Tevarih, or Annals of sultan Ahmed, 1012-
1023 A.H. / 1603-1614 A.D. », dans Essays on Ottoman Historians and Historiography,
Istanbul, Eren, 2009 : 69-86 [1ère
édition dans Frontiers of Ottoman History, vol. 1, C. İmber,
K. Kiyotaki et R. Murphey (éds.), Londres, I. B. Tauris, 2005 : 5-24].
, « Ottoman historical writing in the seventeenth century: a survey of the general
development of the genre after the reign of Sultan Ahmed I (160”-1617) », dans Essays on
Ottoman Historians and Historiography, Istanbul, Eren, 2009 : 89-119 [1ère
édition dans
Archivum Ottomanicum, vol. 13 (1994) : 277-312].
NAGATA Yuzo, Muhsinzade Mehmed Paşa ve Âyanlık Müessesesi, Tokyo, Institute for the
Study of Languages and Cultures of Asia and Africa, 1976.
NECIPOĞLU Gülrü, Architecture, Ceremonial and Power: the Topkapı Palace in the
Fifteenth and Sixteenth Centuries, New York, The Architectural History Foundation Books,
1991.
, The Age of Sinan. Architectural culture in the Ottoman Empire, Londres, Reaktion
Books, 2005.
NUTKU Özdemir, « The Nahıl: A Symbol of Fertility in Ottoman Festivities », Annales de
l’université d’Ankara XII (1966) : 63-71.
, IV. Mehmed’in Edirne Şenliği, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1972.
, « Düğün (Türkler’de Düğün) », TDVİA : t. 10 p. 16-18
ÖNEY Gönül, Beylikler devri sanatı XIV. – XV. yüzyıl (1300-1453). Ankara, Türk Tarih
Kurumu, 1989.
ÖNKAL Hakkı, Osmanlı Hanedan Türbeleri, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1992.
ORTAYLI İlber, Osmanlı Toplumunda Aile, Istanbul, Pan yayıncılık, 2000.
OUALDI M’hamed, « D’Europe et d’Orient. Les approches de l’esclavage des chrétiens en
terre d’Islam », Annales. Histoire, Sciences sociales 63/4 (2008) : 829-843.
, Esclaves et maîtres. Les Mamelouks des Beys de Tunis du XVIIe siècle aux années
1880, Paris, Publictions de la Sorbonne, 2011.
ÖZCAN Abdülkadir, « Fatih’in teşkilât kanunnâmesi ve nizam-ı alem için kardeş katli
meselesi », İÜEF Tarih Dergisi 33 (1980-81) : 7-56.
, « Âşıkpaşazade », OA : t. 2 p. 261-262.
, « Âşıkpaşazâde », TDVİA 4 : 6-7.
, « Dukakinzâde Ahmed Paşa », TDVİA 9 : 550-551
, « Patrona İsyanı », TDVİA : t. 34 p. 189-192.
ÖZCAN Azmi, « Lutfî Paşa », OA : t. 2 p. 49-50.
Page | 816
ÖZCAN Tahsin, « Mehmet Paşa (Sokollu, Damat) », OA : t. 2 p. 168-172.
ÖZGÖREN-KINLI İrem, Analyse figurationnelle des fêtes imperiales et des divertissements
des élites ottomanes (XVIe-XIXe siècles). Thèse de doctorat. Paris, Université de Paris 1 –
Panthéon Sorbonne, 2011.
ÖZGÜDENLİ Osman G., « Sultan » : TDVİA t. 37 p. 496-497.
ÖZTUNA Yılmaz, Devletler ve Hânedanlar. Türkiye (1074-1990), Ankara, Kültür Bakanlığı
Yayınları, 1969.
ÖZTÜRK Said, Askeri Kassama ait Onyedinci Asır İstanbul Tereke Defterleri, Istanbul,
OSAV Yayınları, 1995.
, Osmanlı Arşiv Belgelerinde Siyakat Yazısı ve Tarihî Gelişimi, Istanbul, Ismanlı
Araştırmaları Vakfı, 1996.
PAMUK Şevket, A Monetary History of the Ottoman Empire, Cambridge, Cambridge
University Press, 2000.
PARMAKSIZOĞLU İsmet, « İbrahim Paşa », İA : t. 5/2 p. 915-919.
PARRY Vernon J., « İbrâhîm Pasha, Dâmâd », EI 2 : t. III p. 65-66.
, « Enderûn », EI 2 : t. II p. 715.
PEIRCE Leslie, « Entrepreneurial Success in Sixteenth-Century Ayntab: The Case of Seydi
Ahmed Boyacı, Local Notable », in Provincial Elites in the Ottoman Empire, Halcyon Days
in Crete V. A Symposium Held in Rethymno, 10-12 January 2003, A. Anastasopoulos (éd.),
Rethymno, Crete University Press, 2005 : 115-134.
PERI Oded, « Waqf and Ottoman Welfare Policy, The Poor Kitchen of Haseki Sultan in the
Eighteenth-Century Jerusalem », Journal of the Economic and Social History of the Orient
XXXV (1992) : 167-186.
PITCHER Donald E., Osmanlı İmparatorluğu Tarihsel Coğrafyası, B. Tırnakçı (trad.),
Istanbul, Yapı Kredi Yayınları, 1999 [3e edition].
PITERBERG Gabriel, « The Formation of an Ottoman Egyptian Elite in the 18th Century »,
International Journal of Middle East Studies 22/ 3 (août 1990) : 275-289.
POPOVIC Alexandre et VEINSTEIN Gilles (éds.), Les voies d’Allah. Les ordres mystiques
dans le monde musulman des origines à aujourd’hui, Paris, Fayard, 1996.
RAYMOND André, « Les provinces arabes (XVIe-XVIIIe siècle) », dans Histoire de
l’Empire ottoman, R. Mantran (dir.), Paris, Fayard, 1989 : 341-420.
REINDL-KIEL Hedda, Männer um Bâyezid. Eine prosopographische Studie über die Epoche
Sultan Bâyezîds II (1481-1512), Berlin, Klaus Schwarz, 1983.
Page | 817
, « East is East and West is West, and Sometimes the Twain Did Meet Diplomatic Gift
Exchange in the Ottoman Empire », dans Frontiers of Ottoman Studies, vol. 2, C. Imber, K.
Kiyotaki, R. Murphey (éds.), Londres, I. B. Tauris, 2005 : 113-123.
, « Power and Submission. Gifting at Royal Circumcision Festivals in the Ottoman
Empire (16th
-18th
Centuries) », Turcica 41 (2009) : 37-88
, « Luxury, Power Strategies, and the Question of Corruption. Gifting in the Ottoman
Elite (16th
-18th
Centuries) », dans Şehryârîn. Die Welt der Osmanen, die Osmanen in der
Welt. Wahrnehmungen, Begegnungen und Abgrenzungen. Illuminating the Ottoman World.
Perceptions, Encounters and Boundaries, Festschrift Hans Georg Majer, Y. Köse et T.
Wölker (éds.), Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2012 : 107-120.
RENIERI Irini, « Household Formation in 19th-Century Central Anatolia: The Case Study of
a Turkish-Speaking Orthodox Christian Community », International Journal of Middle East
Studies 34/3 (Août 2002) : 495-517.
REPP Richard C., The Müfti of Istanbul: A Study in the Development of the Ottoman Learned
Hierarchy, Londres, Ithaca Press, 1986.
ROUX Jean-Paul, Tamerlan, Paris, Fayard, 1991.
SAKAOĞLU Necdet, Anadolu Derebeyi Ocaklarından Köse Paşa Hanedanı, Ankara, Yurt
Yayınları, 1984.
, Bu Mülkün Sultanları. 36 Osmanlı Padişahı, Istanbul, Oğlak Yayıncılık, 2000.
, « Ahmed Paşa (Melek) », Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi : t. 1 p. 128-129.
SCHICK Leslie M., « The Place of Dress in Pre-Modern Costum Albums », dans Ottoman
Costumes. From Textile to Identity, Ch. K. Neumann et F. Suraiya (éds.), Istanbul, Eren, 2004
: 93-101.
SEFERCIOĞLU Nejat, « Dukakinzâde Ahmed Bey », TDVİA 9 : 549-550.
SIGALAS Nikos, « Devlet et Etat : du glissement sémantique d’un ancien concept du pouvoir
au début du XVIIIe siècle », dans Byzantina et Moderna. Mélanges en l’honneur d’Hellène
Antoniadès-Bibicou, G. Grivaud et S. Petmezas (éds.), Athènes, Editions Alexandria, 2007 :
385-415.
, « Des histoires des Sultans à l’histoire de l’Etat. Une enquête sur le temps du pouvoir
ottoman (XVIe-XVIIIe siècles) », dans Les Ottomans et le temps, F. Georgeon et F. Hitzel
(éds.), Paris, Editions du CNRS, 2012 : 99-128.
SILAY Kemal, « Ahmedî’s History of the Ottoman Dynasty », Journal of Turkish Studies 16
(1992) : 129-200.
SINGER Amy, Constructing Ottoman Beneficence. An Imperial Soup Kitchen in Jerusalem.
Albany, State University of New York Press, 2002 [traduction turque : Osmanlı’da
Hayırseverlik: Kudüs’te Bir Haseki Sultan İmareti, traduit par Dilek Şendil. Istanbul,
Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayını, 2004].
TAESCHNER Franz et WITTEK Paul, « Die Vezir Familie des Gandarlyzade », Der İslam
21 (1929) : 60-115.
, « Ashik-Pasha-zade », EI (2) : t. 1 p. 720.
Page | 818
TAMDOĞAN Işık, « La Famille », Dictionnaire de l’Empire Ottoman (à paraître).
TEKİNDAĞ M. C. Şehâbeddin, « Neşri », İA : t. IX p. 214-216.
TERZIOĞLU Derin, « The Imperial Circumcision Festival of 1582: an Interpretation »,
Muqarnas 12 (1995) : 84-100.
TEVHID Ahmet, « Menteşeoğullarından Ahmed Gazi Bey’in Hayratı Kitabeleri », Tarihî
Osmânî Ecümeni Mecmuası III/18 (1912) : 1146-1152.
TEZCAN Baki, The Second Empire, Political and Social Transformation in the Early Modern
World, Cambridge, Cambridge University Press, 2010.
THOMAS Lewis, A Study of Naima, New York, New York University Press, 1972.
TOKSOY Cemal, « Neşrî », OA : t. 2 p. 363-364.
TOLEDANO Ehud R., « The Emergence of Ottoman-local elites (1700-1900): a framework
for research », dans Middle Eastern Politics and Ideas: a History from Within, I. Pappé et M.
Ma’oz (éds.), Londres / New York, I. D. Tauris, 1997 : 145-162.
, Slavery and Abolition in the Ottoman Middle East, Seattle / London, University of
Washington Press, 1998.
TOPALOĞLU Aydın, « Rüstem Paşa », OA : t. 2 p. 470-472
TUCHELT K., « Das Yalı der Kıbrıslı Mustafa Paşa in Küçüksu », Istanbuler Mitteilungen 12
(1962) : 129-158.
TURAN Şerafettin, Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Taht Kavgaları, Istanbul, Kapı
Yayınları, 2011.
, « Hersekzâde Ahmed Paşa », TDVİA 17 : 235-237
, « Hoca Sâdeddin Efendi », TDVİA 18 : 196-198.
, « Sa’deddin », İA 10 : 27-32.
, « Peçevî, İbrâhîm », İA 9 : 543-545.
TURYAN Hasan, Bursa Evliyaları ve Tarihi Eserleri, Bursa, Öner Matbaası, 1982.
ÜLKEN Hilmi Ziya, « Vakıf Sistemi ve Türk Şehirciliği », Vakiflar Dergisi IX (1971) : 13-
37.
ULUÇAM Müjdat, « Ahmed Paşa (Kara) », OA : t. 2 p. 149.
URSINUS Michael, « The Çiftlik Sahibleri of Manastır as a Local Elite, Late Seventeenth to
Early Nineteenth Century », dans Provincial Elites in the Ottoman Empire, Halcyon Days in
Crete V, A Symposium Held in Rethymno, 10-12 January 2003, A. Anastasopoulos (éd.),
Rethymno, Crete University Press, 2005 : 247-258.
UZUNÇARŞILI İsmail H., Kapıkulu Ocakları, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1943-44.
, Osmanlı Devletinde İlmiye Teşkilâtı, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1965.
Page | 819
, « Kanunî Sultan Süleyman’ın Veziriâzamı Makbul ve Maktul İbrahim Paşa Padişah
Damadı Degıldi », Belleten XXIX/114 (Nisan 1965) : 355-361.
, Çandarlı Vezir Ailesi, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1974.
, « Evrenos », İA : t. 4 p. 413-418.
VALENSI Lucette, Venise et la Sublime Porte. La naissance du despote, Paris, Hachette,
1987.
VATIN Nicolas, « Sur le rôle de la stèle funéraire et l'aménagement des cimetières
musulmans d'Istanbul », dans Mélanges Professeur Robert Mantran, A. Temimi (éd.).
Zaghouan, 1988 : 293-297.
, « L’ascencion des Ottomans (1362-1451) », dans Histoire de l’Empire ottoman, R.
Mantran (dir.). Paris, Fayard, 1989 : 37-80.
, « L’ascencion des Ottomans (1451-1512) », dans Histoire de l’Empire ottoman, R.
Mantran (dir.), Paris, Fayard, 1989 : 81-116.
, « Les cimetières musulmans ottomans : source d'histoire sociale », dans Les villes
dans l'Empire ottoman : activités et sociétés, t. I, D. Panzac (éd.), Marseille, CNRS, 1991 :
149-163.
, « Macabre trafic : la destinée post-mortem du prince Djem », dans Mélanges offerts à
Louis Bazin par ses disciples, collègues et amis, J.-L. Bacqué-Grammont et R. Dor (éds.),
Paris, L’Harmattan, 1992 : 231-239.
et YERASIMOS Stéphane, « Documents sur les cimetières ottomans, I. Autorisations
d'inhumation et d'ouverture de cimetières à Istanbul intra-muros et à Eyüp (1565-1601) »,
Turcica XXV (1993) : 165-187.
et YERASIMOS Stéphane, « Documents sur les cimetières ottomans, II. Statut, police
et pratiques quotidiennes (1565-1585) », Turcica XXVI (1994) : 169-210.
et ZARCONE Thierry, « Un tekke bektachi d’Istanbul : le tekke de Karyağdı
(Eyüp) », dans Bektachiyya. Etudes sur l’ordre mystique des Bektachis et des groupes
relevant de Hadji Bektach, A. Popovic et G. Veinstein (éds.), Istanbul, Isis, 1995 : 215-250.
, « Aux origines du pèlerinage à Eyüp des sultans ottomans », Turcica XXVII (1995) :
91-99.
, « L'inhumation intra-muros à Istanbul à l'époque ottomane », dans Les Ottomans et
la mort. Permanences et mutations, G. Veinstein (éd.), Leyde, Brill, 1996 : 157-174.
(dir.), L’oral et l’écrit dans le monde turco-ottoman, numéro thématique de la Revue
du Monde Musulman et de la Méditerranée 75-76, Aix-en-Provence, 1996.
, « Remarques sur l’orale et l’écrit dans l’administration ottomane au XVIe siècle »,
dans L’oral et l’écrit dans le monde turco-ottoman, N. Vatin (dir.), numéro thématique de la
Revue du Monde Musulman et de la Méditerranée 75-76 (1996) : 143-154.
, Sultan Djem. Un prince ottoman dans l'Europe du XVe siècle d'après deux sources
contemporaines : Vâkı'ât-ı Sultân Cem, Œuvres de Guillaume Caoursin, Ankara, Société
Turque d'Histoire, 1997.
, « Relevés de dépenses à l’occasion des funérailles de membres de la famille
ottomane dans la seconde moitié du XVIIIe siècle », Turcica 30 (1998) : 347-370.
et YERASIMOS Stéphane, Les cimetières dans la ville. Statut, choix et organisation
des lieux d’inhumation dans Istanbul intra-muros, Istanbul / Paris, IFEA / Maisonneuve,
2001.
et VEINSTEIN Gilles, Le sérail ébranlé. Essai sur les morts, dépositions et
avènements des sultans ottomans, XIVe – XIXe siècle, Paris, Fayard, 2003.
, « Aperçu sur la mobilité des élites ottomans musulmanes locales d’après les stèles
funéraires », in Provincial Elites in the Ottoman Empire, Halcyon Days in Crete V. A
Page | 820
Symposium Held in Rethymno, 10-12 January 2003, A. Anastasopoulos (éd.), Rethymno,
Crete University Press, 2005 : 11-30.
, « Loi ou fatalité ? A propos du fratricide dans la dynastie ottomane », dans Mélanges
en l’honneur du Professeur Halil Inalcık, en cours de publication.
VEINSTEIN Gilles, « Ayân de la région d’Izmir et commerce du Levant (deuxième moitié du
XVIIIe siècle) », Etudes Balkaniques 3 (1976) : 71-83.
, « Asker et re’aya : aperçu sur les ordres dans la société ottomane », dans Le concept
de classe dans l’analyse des sociétés méditerranéennes, XVIe-XIXe siècles, Actes des journées
d’études, Bendor, 5-7 mai 1977, A. Nouschi (éd.), Cahiers de la Méditerranée. Nice, 1978 :
15-19.
, « Le patrimoine foncier de Panayote Bénakis, kocabaşı de Kalamata », Journal of
Turkish Studies 11 (1987) : 211-233.
, « L’empire dans sa grandeur (XVIe siècle) », dans Histoire de l’Empire ottoman. R.
Mantran (dir.). Paris, Fayard, 1989 : 159-226.
, « Les provinces balkaniques (1606-1774) », dans Histoire de l’Empire ottoman, sous
la direction de R. Mantran. Paris, Fayard, 1989 : 287-340.
(éd.), Soliman the magnifique et son temps. Actes des IXe rencontres de l’Ecole du
Louvre, Paris, 7-10 mars 1990, Paris, La Documentation Française, 1992.
(éd.), Les Ottomans et la mort : permanences et mutations, Leyde, Brill, 1996.
, « L’oralité dans les documents d’archives ottomans : paroles rapportées ou
imaginées ? », dans L’oral et l’écrit dans le monde turco-ottoman, N. Vatin (dir.), numéro
thématique de la Revue du Monde Musulman et de la Méditerranée 75-76 (1996) : 133-142.
, « Le modèle ottoman », dans Madrasa. La transmission du savoir dans le monde
musulman, N. Grandin et M. Gaborieau (éds.), Paris, Editions Arguments, 1997 : 73-83.
, « La tuğra ottomane », dans L’écriture du nom propre, A.-M. Christin (éd.), Paris,
L’Harmattan, 1998 : 149-162.
, « Charles Quint et Soliman le Magnifique : le grand défi », dans Carlos V.
Europeismo y Universalidad. Volume III : Los escenerarios del Imperio, J.-L. Castalleno et F.
G. Sanchez-Montez (éds.), Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoracion de los
Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2001 : 519-529.
, « Sur les na’ib ottomans », Jerusalem Studies in Arabic and Islam 25 (2001): 247-
267.
, « Les Ottomans : fonctionnarisation des clercs, cléricalisation de l’Etat ? », dans
Histoire des hommes de Dieu dans l’Islam et le Christianisme, D. Iogna-Prat et G. Veinstein
(éds.), Paris, Flammarion, 2003 : 178-202.
, « Chronologie différentielle des titres impériaux selon les supports utilisés. Quelques
exemples empruntés à la documentation ottomane », dans Evénement, Récit, Histoire
officielle. L’écriture de l’histoire dans les monarchies antiques, Actes du colloque du Collège
de France des 24-25 juin 2002, N. Grimal et M. Baud (éds.), Paris, Cybèle, 2004 : 259-269.
, « Le serviteur des deux saints sanctuaires et ses mahmal. Des Mamelouks aux
Ottomans », Turcica 41 (2009) : 229-246.
, « Sokollu Muhammed (Mehmed) Pasha », EI (2) : t. IX pp. 735-742.
von HAMMER Joseph, Histoire de l’Empire ottoman depuis son origine jusqu’à nos jours,
16 volumes, J.-J. Hellert (trad.), Istanbul, Isis, 1993-2000 [1re
édition Paris, 1835-1839].
WATENPAUGH Heghnar Z., « Deviant Dervishes: Space, Gender, and the Construction of
Antinomian Piety in Ottoman Aleppo », Journal of Middle East Studies 37 (2005) : 535-565.
Page | 821
WINTER Michael, Egyptian Society under Ottoman Rule 1517-1798, Londres / New York,
Routledge, 1992.
WITTEK Paul, The Rise of the Ottoman Empire, Londres, The Royal Asiatic Society of Great
Britain and Ireland, 1938.
, « De la défaite d’Ankara à la prise de Constantinople », Revue des Etudes Islamiques
12 (1938) : 1-34.
, « Notes sur la Tughra ottomane », Byzantine 18 (1948) : 311-334.
WOODHEAD Colin, « Rüstem Pasha », EI (2) : t. VIII p. 640-641.
, « Neshri », EI (2) : t. VIII p. 7-8.
WOODS John E., The Aqquyunlus. Clan, Confederation, Empire, Minneapolis / Chicago,
Bibliotheca Islamica, 1976.
YEDİYILDIZ Bahaeddin, « Vakıf Müessesinin XVIII. Asır Türk Toplumundaki Rolü »,
Vakıflar Dergisi XIV (1982) : 1-27.
, « Müessese-Toplum Münasebetleri Çerçevesinde XVIII. Asır Türk Toplumu ve
Vakıf Müessesi », Vakıflar Dergisi XV (1982) : 23-53.
, Institution du vakf au XVIIIe siècle en Turquie. Etude socio-historique, Ankara,
Éditions du Ministère de la Culture, 1990.
, « Ottoman Society », dans History of the Ottoman State, Society and Civilisation,
vol. 1., E. İhsanoğlu (éd.), Istanbul, IRCICA, 2001 : 491-558.
, « Vakıf », İA : t. XII p. 171-190.
YENIŞEHIRLIOĞLU Filiz, « Architectural Patronage of Ayan Families in Anatolia », dans
Provincial Elites in the Ottoman Empire, Halcyon Days in Crete V. A Symposium Held in
Rethymno, 10-12 January 2003, A. Anastasopoulos (éd.), Rethymno, Crete University Press,
2005 : 321-342.
YERASIMOS Stéphane, Les voyageurs dans l’Empire ottoman (XIVe-XVIe siècles).
Bibliographie, itinéraires et inventaires des lieux habités, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1991.
, « Le waqf du defterdar Ebu’l Fazl Efendi et ses bénéficiaires », Turcica 33 (2001) :
7-33.
, Constantinople. De Byzance à Istanbul, Paris, Editions Place des Victoires, 2000.
YILMAZ Muammer, Osmanlı’da Töre, Tören ve Alaylar, Istanbul, Elit Kültür, 2010.
YÜKSEL Hasan, « XVI.-XVII. Yüzyıllarda Osmanlı İdarî Yapısında Taşra Ümerasının
Yerine Dair Düşünceler », Belleten XLI (1997) : 163-197. , Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Hayatında Vakıfların Rolü (1585-1683), Sivas, Dilek
Matbaası, 1998.
ZACHARRIADOU Elizabeth (éd.), The Ottoman Emirate, 1300-1389. Rethymnon, Crète
University Press, 1993.
ZILFI Madeline C., « The Diary of a Müderris: A New Source for Ottoman Biography »,
Journal of Turkish Studies 1 (1977) : 157-174.
, « Elite Circulation in the Ottoman Empire: Great Mollas of the Eighteenth Century »,
Journal of the Economic and Social History of the Orient 26 (1983) : 318-364.
Page | 822
, « The Kadızadelis: Discordant Revivalism in Seventeenth Century Istanbul »,
Journal of Near Eastern Studies 45 / 4 (1986) : 251-269.
, The Politics of Piety: The Ottomans Ulema in the Postclassical Age (1600-1800),
Minneapolis, Bibliotheca Islamica, 1988.
Page | 823
Travaux extérieurs au domaine des études ottomanes
ADLER Alfred, La mort est le masque du roi. La royauté sacrée des Moundang du Tchad,
Paris, Payot, 1982.
, Le pouvoir et l'interdit : Royauté et religion en Afrique noire : Essais d'ethnologie
comparative, Paris, Albin Michel, 2000.
ABELES Marc, « Formation de l’Etat et « Royautés sacrées ». L’Etat sans classe »,
Anthropologie et sociétés 3 / 1 (1979) : 29-40.
AMBROSIO F. Alberto, « L’origine féminine des espaces soufis à Istanbul », dans Hommes
et femmes bâtisseurs, traditions et stratégies dans le monde oriental et occidental, S.
Frommel et J. Dumas (éds.), Paris / Rome / Istanbul, Picard / Campisano / IFEA, 2013 : 229-
237.
APOSTOLIDES Jean-Marie, Le roi-machine : politique et spectacle au temps de Louis XIV,
Paris, Minuit, 1981.
ARIES Philippe, Essais sur l’histoire de la mort en Occident du Moyen Âge à nos jours.
Paris, Editions du Seuil, 1975.
, L’enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime, Paris, Editions du Seuil, 1975.
ARIES Philippe, DUBY Georges (dir.), Histoire de la vie privée, Paris, Editions du Seuil,
1985.
BADINTER Elisabeth, L’amour en plus. Histoire de l’amour maternel, XVIIe-XXe siècle,
Paris, Flammarion, 1980.
, L’Infant de Parme, Paris, Fayard, 2008.
BEAUVALET-BOUTOUYRIE Scarlett, Être veuve sous l’Ancien Régime, Paris, Belin, 2001.
BELY Lucien, La société des princes, XVIe-XVIIIe siècles, Paris, Fayard, 1999.
BENNASSAR Bartolomé, Le lit, le pouvoir et la mort. Reines et princesses d’Europe de la
Renaissance aux Lumières, Paris, Editions de Fallois, 2006.
BERTRAND Romain, « L’ascèse pour la gloire. Trajectoires notabiliaires de la noblesse de
robe à Java (XVIIe – XIXe siècles) », Politix 17/65 (2004) : 17-44.
, Etat colonial, noblesse et nationalisme à Java. La Tradition parfaite, Paris, Karthala,
2005.
BLOCH Marc, Les rois thaumaturges: étude sur le caractère surnaturel attribué à la
puissance royale particulièrement en France et en Angleterre, Paris, Gallimard, 1983 [1re
édition, 1924].
, Apologie pour l’histoire ou Métier d’historien, préface de Jacques Le Goff, Paris,
Armand Colin, 2011 [1re
édition 2007].
BOLTANSKI Luc, Les cadres. La formation d’un groupe social, Paris, Minuit, 1982.
Page | 824
BOSQUET Marie-Françoise, MEURE Chantale, Le Féminin en Orient et en Occident, du
Moyen Âge à nos jours : mythes et réalités, Saint-Etienne, Publications de l’Université de
Saint-Etienne, 2011.
BOURDIEU Pierre, Choses dites, Paris, Editions de Minuit, 1987.
, La noblesse d’Etat, Paris, Editions de Minuit, 1989.
, Raisons pratiques. Sur la théorie de l’action, Paris, Editions du Seuil, 1994.
, La domination masculine, Paris, Editions du Seuil, 1998.
, « La parenté comme représentation et comme volonté », dans Esquisse d’une théorie
de la pratique, précédé de trois études d’éthnologie kabyle, Paris, Editions du Seuil, 2000 :
83-215.
, Le bal des célibataires. Crise de la société paysanne en Béarn, Paris, Editions du
Seuil, 2002.
, Méditations pascaliennes, Paris, Editions du Seuil, 2003.
BRAUDEL Fernand, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II,
Paris, Armand Colin, 1966 [2e édition révisée].
CAILLE Alain, Critique de la raison utilitaire. Manifeste du MAUSS, Paris, La Découverte,
2003.
, Anthropologie du don. Le tiers paradigme, Paris, La Découverte, 2007.
CASAGRANDE Carla, « La femme gardée », dans Histoire des femmes en Occident. T. II :
Le Moyen Âge. G. Duby et M. Perrot (éds.), (volume sous la direction de Ch. Klapisch-
Zuber). Paris, Perrin, 2002 : 99-142.
CHABAUD-RYCHTER Danielle, DESCOUTURES Virginie, DEVREUX Anne-Marie,
VARIKAS Eleni (dir.), Sous les sciences sociales, le genre. Relectures critiques de Max
Weber à Bruno Latour, Paris, La Découverte, 2010.
CHATENET Monique, La cour de France au XVIe siècle. Vie sociale et architecture, Paris,
Picard, 2002.
CHAUVAUD Frédéric, MALANDAIN Gilles (dir.), Impossibles victimes, impossibles
coupabes. Les femmes devant la justice (XIXe-XXe siècles), Rennes, Presses Universitaires de
Rennes, 2009.
CONTAMINE Philippe et CONTAMINE Geneviève (éds.), Autour de Marguerite d’Ecosse.
Reines, princesses et dames du XVe siècle, Paris, H. Champion, 1999.
, La noblesse au royaume de France, de Philippe le Bel à Louis XII, Paris, Presses
Universitaires de France, 1997.
, « Noblesse française, nobility et gentry anglaises à la fin du Moyen Âge : une
comparaison », dans La noblesse en question (XIIIe-XVe s.), numéro thématique de Cahiers
de recherches médiévales et humanistes 13 (2006) : 105-131.
COSANDEY Fanny, « La blancheur de nos lys. La reine de France au cœur de l’Etat royal »,
Revue d’histoire moderne et contemporaine 44/3 (juillet-septembre 1997) : 388-403.
, « De lance en quenouille. La place de la reine dans l’Etat moderne (XVIe-
XVIIe siècle) », Annales HSS (juillet-août 1997) n°4 : 799-820.
, La reine de France, Paris, Gallimard, 2000.
Page | 825
, « Les femmes en monarchie ; épouses ou héritières », dans Le genre face aux
mutations. Masculin et féminin, du Moyen Age à nos jours, L. Capdevila, S. Cassagnes, M.
Cocaud, D. Godineau, F. Rouquet, J. Sainclivier (dirs.), Rennes, Presses Uuniversitaires de
Rennes, 2003 : 201-209.
, « Représenter une reine de France. Marie de Médicis et le cycle de Rubens au palais
du Luxembourg », Clio 19 (2004) : 63-83.
, « Puissance maternelle et pouvoir politique : la régence des reines mères », Clio 21
(2005) : 63-83.
, « Les femmes en monarchie : présence féminine et construction monarchique », dans
Les femmes dans la société médiévale et moderne, P. Mane, F. Piponnier, M. Wilska, M.
Piber-Zbieranowska (éds.), Varsovie, Institut d'Histoire, Académie Polonaise des Sciences,
2005 : 79-96.
, « La maîtresse de nos biens. Pouvoir féminin et puissance dynastique dans la
monarchie d’Ancien Régime », Historical Relections/Réflexions historiques 32 /2 (summer
2006) : 381-401.
, « Anne de Bretagne, une princesse de la Renaissance ? » dans : Anne de Bretagne, une
histoire, un mythe, Nantes/Paris, Somogy Editions d’art/Château des ducs de Bretagne, 2007 :
31-38.
, « Les préséances à la cour des reines de France », dans Femmes et pouvoir politique.
Les princesses d¹Europe XVe-XVIII
e siècles, I. Poutrin et M.-K. Schaub (dir.), Paris, Bréal,
2007 : 267-278.
, « Reines de France, héritières espagnoles », dans Les cours d’Espagne et de France
au XVIIe siècle, Études réunies et présentées par Chantal Grell et Benoit Pellistrandi Madrid,
Casa de Velasquez, 2007 : 61-76.
, « Les régences de Catherine et Marie de Médicis : Un héritage italien ? », dans Le
donne Medici nel sistema europeo delle corti. XVI-XVIII secolo, Giulia Calvi et Ricardo
Spinelli (dir.), Firenze, Polistampa, 2008.
, « Préséances et sang royal à la cour de France à l’époque moderne », Cahiers de la
Méditerranée 77 (décembre 2008) : 19-26.
, « De la loi salique à la régence, le parcours singulier du pouvoir des reines », dans In
assenza del re. Le reggenti dal XIV al XVII secolo (Piemonte ed. Europa), F. Varallo (éd.),
Florence, Olschki, 2008 : 183-197.
CRAVERI Benedetta, Reines et favorites. Le pouvoir des femmes, Paris, Gallimard, 2007.
CROUZET Denis, Le haut cœur de Catherine de Médicis. Une raison politique aux temps de
la Saint-Barthélemy, Paris, Albin Michel, 2005.
DELIEGE Robert, Anthropologie de la famille et de la parenté, Paris, Armand Colin, 2011.
DEMADE Julien, « Parenté, noblesse et échec de la genèse de l’Etat. Le cas allemand »,
Annales. Histoire, sciences sociales 61 / 3 (2006) : 609-631.
DESCIMON Robert et HADDAD Elie (éds.), Epreuves de noblesse. Les expériences
nobiliaires de la haute robe parisienne (XVIe-XVIIIe siècle), Paris, Les belles lettres, 2010.
DUBOST Jean-François, « Le corps de la reine, objet politique : Marie de Médicis », dans
Femmes et pouvoir politique. Les princesses d’Europe, XVe-XVIII
e siècle. I. Poutrin et M-K.
Schaub (éds.), Rosny-sous-Bois, Bréal, 2007 : 235-265.
Page | 826
DUBY Georges et PERROT Michelle (éds), Histoire des femmes en Occident, 4 volumes,
Paris, Perrin, 2002.
DUFOURNET Jean, JORIS André, TOUBERT Pierre (éds.), Femmes, mariages, lignages,
XIIe-XIVe siècles. Mélanges offerts à Georges Duby, Bruxelles, De Boeck Université, 1992.
DUPRAT Annie, « Les princesses dans la propagande : Marie-Antoinette au miroir des reines
de France », dans Femmes et pouvoir politique. Les princesses d’Europe, XVe-XVIII
e siècle I.
Poutrin et M-K. Schaub (éds.), Rosny-sous-Bois, Bréal, 2007 : 294-309.
ELIAS Norbert, La société de cour, Paris, Flammarion, 1985.
FLANDRIN Jean-Louis, Familles. Parenté, maison, sexualité dans l’ancienne société, Paris,
Editions du Seuil, 1984.
FRAISSE Geneviève, La différence des sexes, Paris, Presses Universitaires de France, 1996.
FROMMEL Sabine et DUMAS Juliette (éds.), Hommes et femmes bâtisseurs, traditions et
stratégies dans le monde oriental et occidental, Paris / Rome / Istanbul, Picard / Campisano /
IFEA, sous presse.
GIESEY Ralph E., Le roi ne meurt jamais. Les obsèques royales dans la France de la
Renaissance, Paris, Flammarion, 1987 [2e édition].
, Cérémonial et puissance souveraine. France, XVe – XVIIe siècles, Paris, Armand
Colin, 1987.
GODELIER Maurice, L’énigme du don, Paris, Fayard, 1996.
, Métamorphoses de la parenté, Paris, Fayard, 2004.
GODINEAU Dominique, Les femmes dans la société française, 16e-18
e siècle, Paris, Armand
Colin, 2003.
GRUBER Alain-Charles, Les grandes fêtes et leur décor à l’époque de Louis XIV, Paris /
Genève, Droz, 1972.
GUAY Manuel, « Les émotions dans les cours princières au XVe siècle : entre manifestations
publiques et secrets », Questes 16 (2009) : 39-50.
HAAN Bertrand, L’amitié entre princes : une alliance franco-espagnole au temps des guerres
de religion, 1560-1570, Paris, Presses Universitaires de France, 2011.
HERITIER Françoise, Masculin / Féminin. La pensée de la différence, Paris, Odile Jacob,
1996.
HEUSCH Luc de, « Nouveaux regards sur la royauté sacrée », Anthropologie et Sociétés 5 / 3
(1981) : 65-84.
HOSBAWM Eric J., RANGER Terence O., L’invention de la tradition, Paris, Editions
Amsterdam, 2012 [nouvelle édition augmentée].
Page | 827
HOURS Bernard, Louis XV et sa Cour. Le roi, l’étiquette et le courtisan, Paris, Presses
Universitaires de France, 2002.
HUFTON Olwen, « Le travail et la famille », dans Histoire des femmes en Occident. T. III :
XVIe-XVIIIe siècle, G. Duby et M. Perrot (éds.), volume sous la direction de N. Z. Davis et A.
Farge, Paris, Perrin, 2002 : 25-63.
KANTOROWICZ Ernst, Les deux corps du roi, Paris, Gallimard, 1989.
KLAPISCH-ZUBER Christiane, La maison et le nom. Stratégies et rituels dans l’Italie de la
Renaissance, Paris, Editions de l’EHESS, 1990.
LEBRUN François, La vie conjugale sous l’ancien régime, Paris, Colin, 1975.
LEDUC Jean, Les historiens et le temps. Conceptions, problématiques, écritures, Paris,
Editions du Seuil, 1999.
LEFERME-FALGUIERES Frédérique, Les courtisans. Une société de spectacle sous
l’Ancien Régime, Paris, Presses Universitaires de France et Le Monde, 2007.
LEVI-STRAUSS Claude, Les structures élémentaires de la parenté, Berlin / New York,
Mouton de Gruy, 2002 [3e édition].
LEWIS W. Andrew, Le sang royal. La famille capétienne et l’Etat, France, Xe-XIVe siècle,
préface de G. Duby, J. Carlier (trad.), Paris, Gallimard, 1986.
MAKARIUS Lévi L., Le sacré et la violation des interdits, Paris, Payot, 1974.
MAUSS Marcel, Essai sur le don, Paris, Presses Universitaires de France, 2007.
MOINE Marie-Christine, Les fêtes à la cour du Roi Soleil, Paris, Sorlot et Lanore, 1984.
MUCHEMBLED Robert, Passions de femmes au temps de la reine Margot (1553-1615),
Paris, Editions du Seuil, 2003.
MULLER Jean-Claude, « La Royauté divine chez les Rukuba (Benue-Plateau State, Nigeria)
», L'Homme 15 / 1 (1975) : 5-27.
NASSIET Michel, Parenté, noblesse et Etats dynastiques, XVe – XVIe siècle, Paris, Editions
de l’EHESS, 2000.
, « Les reines héritières : d’Anne de Bretagne à Marie Stuart », dans Femmes et
pouvoir politique. Les princesses d’Europe, XVe-XVIII
e siècle, I. Poutrin et M-K. Schaub
(éds.), Rosny-sous-Bois, Bréal, 2007 : 134-144.
, La violence, une histoire sociale. France, XVIe-XVIIIe siècles, Seyssel, Champ
Vallon, 2011.
OPITZ Claudia, « Contraintes et libertés (1250-1500) », dans Histoire des femmes en
Occident. T. II : Le Moyen Âge, G. Duby et M. Perrot (éds.), volume sous la direction de Ch.
Klapisch-Zuber, Paris, Perrin, 2002 : 343-418.
Page | 828
PERCEVAL José M., « Epouser une princesse étrangère : les mariages espagnols », dans
Femmes et pouvoir politique. Les princesses d’Europe, XVe-XVIII
e siècle, I. Poutrin et M-K.
Schaub (éds.), Rosny-sous-Bois, Bréal, 2007 : 66-77.
PERROT Michelle, Mon histoire des femmes, Paris, Editions du Seuil, 2006.
, Histoire de chambres, Paris, Editions du Seuil, 2009.
POUTRIN Isabelle et SCHAUB Marie-Karine (éds.), Femmes et pouvoir politique. Les
princesses d’Europe, XVe-XVIII
e siècle, Rosny-sous-Bois, Bréal, 2007.
RIOT-SARCEY Michèle (éd.), De la différence des sexes. Le genre en histoire, Paris,
Larousse, 2010.
RUCQUOI Adeline, « Être noble en Espagne aux XVIe-XVIe siècles », dans Nobilitas.
Funktion und Repräsentation des Adels in Alteuropa, herausgegeben von Otto Gerhard Oexle
& Werner Paravicini, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1997 : 273-298.
, Aimer dans l’Espagne médiévale. Plaisirs licites et illicites, Paris, Les Belles Lettres,
2008.
SANCHEZ Magdalena, The Empress, The Queen and the Nun. Women and Power at the
Court of Philip of Spain, Baltimore / Londres, The John Hopkins University Press, 1998.
SUTTER FICHTNER Paula, « Dynastic Marriage in Sixteenth-Century Habsbourg
Diplomacy and Statecraft », The American Historical Review 81 (1976): 243-265.
TESTART Alain, Essai sur les fondements de la division sexuelle du travail chez les
chasseurs-cueilleurs, Paris, Editions de l’EHESS, 1986.
THEBAUD Françoise, Ecrire l’histoire des femmes et du genre, Paris, ENS Editions, 2007.
VERDIER Thierry, « Donna Olimpia Maldachini (Maildachini) Pamphilj, femme mécène au
temps d’Innocent X », dans Hommes et femmes bâtisseurs, traditions et stratégies dans le
monde oriental et occidental, S. Frommel et J. Dumas (éds.), Picard / Campisano / IFEA,
2013 : 239-249.
VEYNE Paul, Le pain et le cirque. Sociologie historique d’un pluralisme politique, Paris,
Editions du Seuil, 1976.
, La société romaine, Paris, Editions du Seuil, 1991.
VIENNOT Eliane, Marguerite de Valois, « la reine Margot », Paris, Perrin, 2005 [2e édition].
, La France, les femmes et le pouvoir. L’invention de la loi salique (Ve – XVIe siècle),
Paris, Perrin, 2006.
, La France, les femmes et le pouvoir. Les résistances de la société (XVIIe – XVIIIe
siècle), Paris, Perrin, 2008.
VERGUS Anne, DAVIDSON Denise, Le roman conjugal. Chroniques de la vie familiale à
l’époque de la Révolution et de l’Empire, Seyssel, Champ Vallon, 2011.
WILSON-CHEVALIER Kathleen, « Madeleine de Savoie et Anne de Montmorency : des
bâtisseurs conjugaux », dans Hommes et femmes bâtisseurs, traditions et stratégies dans le
Page | 829
monde oriental et occidental, S. Frommel et J. Dumas (éds.), Picard / Campisano / IFEA,
2013 : 123-134.
WAQUET Jean-Claude, « L’échec d’un mariage : Marguerite-Louise d’Orléans et Côme de
Médicis », dans Femmes et pouvoir politique. Les princesses d’Europe, XVe-XVIII
e siècle, I.
Poutrin et M-K. Schaub (éds.), Rosny-sous-Bois, Bréal, 2007 : 120-132.
WERNER Karl F., Naissance de la noblesse, Paris, Fayard / Pluriel, 2010.
ZUM KOLK Caroline, « Les difficultés des mariages internationaux : Renée de France et
Hercule d’Este », dans Femmes et pouvoir politique. Les princesses d’Europe, XVe-XVIII
e
siècle, I. Poutrin et M.-K. Schaub (éds.), Rosny-sous-Bois, Bréal, 2007 : 102-119.
Page | 831
LISTE DES TABLEAUX, GRAPHIQUES ET
CARTES
1. 1. Evolution de la titulature des descendantes indirectes des sultans……………………44
1. 2. Répartition des titres parmi les descendants des sultans……………………………...47
1. 3. Sommes allouées aux émoluments et frais de bouche en faveur des
şehzâdegân et leurs mères résidant au Vieux Palais, entre novembre
1555 et novembre 1556……………….………………………………………………58
1. 4. Dépenses en faveur des şehzâdegân et de leurs mères résidant à Topkapı
et dépendant de la section du Bîrûn, entre novembre 1555 et
novembre 1556…………………………………………………………….………….59
1. 5. Dépenses en faveur des sultânân, des şehzâdegân dépendants de la
section de l’Enderûn, à Topkapı, et de leurs mères, entre mai 1603
et mai 1604……………………………………………………………………………60
1. 6. Dépenses en faveur des sultânân dépendantes du Bîrûn de mai 1603 à
mai 1604………………………………………………………………………………61
1. 7. Dépenses en faveur des sultânân dépendantes du Bîrûn de février 1649 à
février 1650…………………………………………………………………...………62
1. 8. Les lieux d’inhumations hors Istanbul des princesses ottomanes aux XIVe
et XVe siècles…………………………………………………………………………76
1. 9. Les inhumations dans Istanbul des Sultanes et Hanım Sultanes : stratégies
dynastiques (de Mehmed II à Selim Ier) ……………………………………………..80
1. 10. Les inhumations dans Istanbul des Sultanes et Hanım Sultanes : stratégies
dynastiques (de Süleyman Ier à Mehmed III) ………………………………………..81
1. 11. Les inhumations dans Istanbul des Sultanes et Hanım Sultanes : stratégies
dynastiques (d’Ahmed Ier à Ibrahim) ………………………………………………..83
1. 12. Les inhumations dans Istanbul des Sultanes et Hanım Sultanes : stratégies
dynastiques (de Mehmed IV à Ahmed III) …………………………………………...85
1. 13. Les inhumations dans Istanbul des Sultanes et Hanım Sultanes : stratégies
non dynastiques……………………………………………………………………….90
1. 14. Les inhumations dans Istanbul des Sultanzade……………………………………….94
2. 15. Les mariages des filles de Bayezid II…………………………………………………133
2. 16. Les mariages des descendantes indirectes de Bayezid II……………………………..138
2. 17. Nombre des gendres impériaux au sein du groupe des vizirs
(de Süleyman Ier à Ahmed Ier)……………………………………………………...141
2. 18. Nombre et durée des mariages des sultanes du XVIIe et XVIII
e siècle……….……...182
3. 19. Evolution des montants des douaires des princesses ottomanes
(XVIe – XVIII
e siècles)………………………………………………………..……217
3. 20. Récapitulatif des cadeaux échangés à l’occasion des mariages des sultanes ………...246
4. 21. Les dotations des mütevelli des fondations d’Istanbul selon le registre
Page | 832
de l’année 1600……………………………………………………………...……....326
4. 22. Les dotations des mütevelli des fondations des princesses à Istanbul………….……327
4. 23. Position sociale des descendants des princesses au cours des générations……….…331
4. 24. Aperçu des carrières des kethüdâ des princesses ottomanes………………………...343
4. 25. Pyramide socioprofessionnelle des offices rétribués au sein
des vakf des princesses…………………………………………………………….349
5. 26. Nombre de legs pieux fondés à Istanbul par catégorie sociale jusqu’en 1600………384
5. 27. Répartition des fondations pieuses à Istanbul par catégorie sociale
jusqu’en 1600……………………………………………………………..…………385
5. 28. Les fondations des membres de l’élite ottomane au XVIIe siècle sur
l’ensemble de l’Empire (d’après l’étude d’Hasan Yüksel) …………………………386
5. 29. Typologie des œuvres architecturales réalisées par les membres de l’élite
ottomane masculine dans Istanbul intra muros………………………………….…..387
5. 30. Typologie des œuvres architecturales réalisées par les membres de l’élite
ottomane masculine dans Istanbul extra muros……………………………………..387
5. 31. Typologie des œuvres architecturales réalisées par les membres de l’élite
ottomane féminine dans Istanbul intra et extra muros………………………………393
5. 32. Nombre de princesses fondatrices par siècle ………………………………………..398
5. 33. Typologie des actions philanthropiques des filles de sultan par siècle………...........401
5. 34. Typologie des actions philanthropiques des descendantes indirectes des
sultans par siècle……………………………………………………………………..401
5. 35. Les domaines d’investissements économiques des filles de sultan …………………409
5. 36. Les domaines d’investissements économiques des descendantes indirectes
des sultans ………………………………………………………………………..…410
5. 37. Localisation des temlik transformés en vakf par les princesses ottomanes………….413
5. 38. Localisation des temlik transformés en vakf par les princesses ottomanes
dans la province de Roumélie……………………………………………………….415
Page | 833
TABLE DES MATIERES
Remerciements 3
Note sur la prononciation du turc 7
INTRODUCTION 9
1. La genèse d’une catégorie sociale atypique 10
2. La place des princesses dans la construction dynastique ottomane 11
3. Des modèles pour interroger les procédés politiques des sociétés de cour
à l’époque moderne 14
4. Des modèles pour étudier les procédés de production et de reproduction
des élites ottomanes à l’époque classique 16
5. Les balbutiements d’une recherche 17
6. Dépouillement des sources et construction de l’objet 19
7. De toutes ces choses qui n’ont pas pu être faites 28
8. Une histoire des princesses ottomanes en cinq chapitres 31
1 – L’ELABORATION D’UNE IDENTITE COMPLEXE 35
I. Etre princesse : un titre, un statut……………………………………………………….. 37
1. La création du titre : les hésitations de la dynastie 38
1. Apparition d’un titre catégoriel (fin-XVe siècle) 39
2. Elargissement des catégories d’ayant-droits au titre
(fin XVe – XVI
e siècle) 43
3. Affinement et stabilisation du concept (fin XVIe-XVIII
e siècle) 46
4. Stratégies commémoratives des exclus 49
2. L’élaboration d’une hiérarchie complexe 51
1. Les princesses dans la hiérarchie sociale ottomane 52
2. Des grandes princesses et des moins grandes 54
3. L’attribution des pensions comme marque dynastique 63
II. Une position à la frontière de la dynastie et de l’élite ………… ……….………………. 69
1. Le choix du lieu d’inhumation : une question de prestige 70
1. Les règles de localisation funéraire pour les membres de la
dynastie 70
2. Les membres de l’élite ottomane 74
2. Les demeures d’éternité des sultanes, hanım sultanes et sultanzade 75
1. Le XIVe–mi-XV
e siècle ou les difficultés du rapprochement
dynastique 75
2. Les stratégies dynastiques de l’inhumation des princesses
dans la capitale stambouliote (fin XVe – XVIII
e siècle) 79
3. Des inhumations en dehors des cadres dynastiques : le poids
des pratiques élitaires 90
4. Les Sultanzade, entre rapprochement familial et
rapprochement dynastique 94
III. Conjugalité et rapports hiérarchiques…………………………………………………… 98
1. Magnifier les époux : la création du titre de « dâmâd-ı şehriyârî » 99
Page | 834
1. Qui sont les « gendres impériaux » ? 99
2. Un titre purement honorifique 103
2. Les obligations maritales surérogatoires 104
1. Une inversion des rapports de soumission 104
2. L’obligation de monogamie 106
3. Le divorce, épée de Damoclès… pour les maris ! 108
4. D’un palais à l’autre : les résidences des princesses 113
Conclusion :
Une crise identitaire non irrésolue ……………………………………..………………………..…122
2 – LE JEU MATRIMONIAL 125
I. Des préférences matrimoniales marquées……………………………………………….. 129
1. Des alliances préférentielles exogamiques et isogamiques
(XIVe – mi-XV
e siècle) 129
2. La recherche d’un nouveau modèle marital (mi-XVe – mi-XVI
e siècle) 132
1. Une transition en trois phases : le cas des filles de Bayezid II 132
2. La consolidation du modèle (première moitié du XVIe siècle) 135
3. Un autre modèle de transition : le cas des descendantes indirectes
(mi-XVe – mi-XVI
e siècle) 137
3. La reproduction du système (mi-XVIe – mi-XVIII
e siècle) 140
II. Des stratégies matrimoniales à échelles multiples………………….…………………… 146
1. Le long processus d’affirmation de la supériorité ottomane
(XIVe – XV
e siècles) 147
1. S’imposer sur la scène internationale par le jeu des alliances 147
2. Une distribution triangulaire du pouvoir 152
2. « La famille comme faction » : alliance, pouvoir et clientélisme 157
1. Une faction dominée par le gendre impérial 160
2. Multiplier les alliances entre deux familles 161
3. Des Mihrimah Sultanzadeler aux Cigalazadeler 163
4. Les alliances des lignages princiers après les
secondes générations 164
III. Interaction des acteurs du marché matrimonial…………………………………………. 168
1. Par la grâce du sultan : le choix souverain du chef de famille 169
2. Sous l’œil de l’entremetteuse : le rôle indispensable des femmes 171
3. Tantôt soumis, tantôt indépendants : la puissance variable des
candidats 178
4. Attendre l’annonce de son mariage et s’en réjouir : la participation
limitée des princesses 182
Conclusion :
Des unions placées sous le signe de la dépendance ……………………………………………... 188
3 – LE DISCOURS CEREMONIEL 195
I. Le nikâh : un évènement privé transformé en cérémonie semi-publique ………………. 198
1. Le nikâh d’une sultane mariée pour la première fois 200
1. Les représentants des époux 200
2. Le représentant de l’autorité religieuse 204
3. Le sağdıç 205
Page | 835
4. Le public spectateur 207
2. Les nikâh lors des remariages des sultanes 209
3. Les nikâh des princesses indirectes 212
4. Les lieux de la cérémonie 214
5. Les douaires des princesses 215
II. Fêtes et cortèges nuptiaux : enjeux et conflits d’une cérémonie
impériale publique ……………………………………………………………………… 222
1. Les fêtes publiques 224
2. Les réceptions officielles 229
1. Les visites masculines 229
2. Les visites à la princesse 233
3. Le cortège nuptial 235
1. Espaces et temps de la parade 235
2. Acteurs et figurants : les protagonistes 237
4. Dépenses somptuaires et étalage de richesse 244
1. Une économie rituelle des cadeaux 246
2. Une relation agonistique à l’expression de la splendeur 252
5. Les düğün des princesses indirectes 257
Conclusion :
Un discours cérémoniel de la dynastie sur elle-même …………………………………………… 262
4 – LA POLITIQUE DU RESEAU 265
I. Champ du pouvoir et intériorisation des contraintes de l’action politique ……………… 267
1. Les conditions d’une action politique des princesses 268
1. Le champ politique et les conditions du pouvoir dans
l’espace ottoman 269
2. L’exclusion de l’exercice de la souveraineté 273
3. L’exclusion de la transmission de la souveraineté 276
2. Les ressorts familiaux d’une action politique des princesses 279
1. Protéger ses proches : une besogne ordinaire 280
2. Epauler son mari : un impératif chronique 284
3. Conseiller le sultan : la marque des plus puissantes 289
3. Ces femmes qui osent intervenir dans les affaires de l’Etat 292
1. Des souveraines “étrangères” suspectes 293
2. Des grandes diplomates évincées 296
3. Le temps des princesses de l’ombre 307
II. Parents, serviteurs et clients : les stratégies de promotion et de reproduction du
groupe familial …………………………………………………………………………... 313
1. Autopromotion lignagère 314
1. Maintenir son rang : le vakf comme instrument d’affirmation
de la notabilité 315
2. Infiltrer les carrières militaro-administratives 330
2. Assurer la prospérité de son entourage 339
1. Les serviteurs personnels des princesses 340
2. La clientèle extérieure et les relations avec l’ʻilmiyye 348
Conclusion :
Des instruments de consolidation du champ politique ottoman en factions………..………..…… 356
Page | 836
5 – LE JEU PHILANTHROPIQUE 359
I. Nature et usages de l’institution du vakf ……………………………………………….. 363
1. Une institution pluriséculaire 364
1. Définition et fonctionnement d’un vakf 364
2. Un instrument de (re)production des structures sociales 366
3. Les implications religieuses 371
4. Les utilisations politiques 372
2. Les fondateurs de vakf dans la société ottomane 376
1. Le patronage dynastique 377
2. L’activité philanthropique de l’élite masculine ottomane 384
3. Les femmes et la création de vakf dans l’Empire ottoman 391
II. Caractéristiques des vakf des princesses ottomanes……………………………………..396
1. Les princesses fondatrices et les autres 397
2. Un siècle de gloire, trois de modestie 399
1. Du bâti dispersé et modeste : le XVe siècle 401
2. L’effacement des descendantes indirectes, l’éclat architectural
des sultanes : le XVIe siècle 404
3. Le recul des activités philanthropiques des princesses
au XVIIe siècle 406
4. Une stabilité dans la médiocrité architecturale : le XVIIIe siècle 406
3. Des bourses de moins en moins renflouées 408
1. Capacités financières et domaines d’investissement
des princesses 408
2. Localisation des revenus et flux monétaires 412
III. Un instrument de production mémorielle ………………………………………………. 420
1. « A qui profite le crime ? » ou les enjeux de la philanthropie 421
1. Une commémoration individuelle disputée 422
2. Affirmation publique de soi 425
3. Un acte de noblesse 429
2. Renforcer la cohésion familiale par la constitution d’espaces de mémoire 431
1. Les palais : un espace lignager dans le monde terrestre 431
2. Les fondations religieuses : un espace familial dans le
domaine du sacré 434
Conclusion :
Une économie symbolique familiale ……………………………………………...………..… 436
CONCLUSION 439
1. Les princesses face aux paradigmes holiste et individualiste 441
2. Une classe avortée 442
3. Les sultans n’ont pas de famille 444
4. La question identitaire 446
5. Des femmes de pouvoir au pouvoir dénigré 448
ANNEXES A : LES PENSIONS DES PRINCESSES 451
1. Le registre BAO KK 7104 : extraits de l’original 453
2. Registre BAO KK 7104 : translittération partielle 461
Page | 837
3. Tableau récapitulatif des dotations accordées aux princesses,
d’après le registre BAO KK 7104
ANNEXES B : LES ARBRES GENEALOGIQUE 469
1. La succession des sultans 471
2. La descendance féminine de Murad Ier 473
3. La descendance féminine de Bayezid Ier 475
4. La descendance féminine de Mehmed Ier 477
5. La descendance féminine de Murad II 479
6. La descendance féminine de Mehmed II 481
7. La descendance féminine de Bayezid II 483
8. La descendance féminine de Selim Ier 485
9. La descendance féminine de Süleyman Ier 487
10. La descendance féminine de Selim II 489
11. La descendance féminine de Murad III 491
12. La descendance féminine de Mehmed III 493
13. La descendance féminine d’Ahmed Ier 495
14. La descendance féminine de Murad IV 497
15. La descendance féminine d’Ibrahim 499
16. La descendance féminine de Mehmed IV 501
17. La descendance féminine de Mustafa II 503
18. La descendance féminine d’Ahmed III 505
19. La famille d’Hümaşah Sultane, petite-fille de Süleyman Ier 507
20. La famille de Mihrimah Sultane, fille de Süleyman Ier 509
21. La famille de Sokollu Mehmed Pacha 511
22. La famille de Safiyye Sultane, fille de Murad IV 513
23. La famille de Nevşehirli Ibrahim Pacha 515
ANNEXES C : MARIAGES ET RELATIONS CONJUGALES 517
1. Hundi Hatun, fille de Bayezid Ier, mariée à Emir Bukhari 519
2. Oruz Hatun, fille de Bayezid Ier, et un prince timouride 520
3. Les alliances nouées autour des filles de Mehmed Ier 521
4. Fatma Hatun, fille de Murad II, et Zaganos Pacha 523
5. Şah Sultane, fille de Selim Ier, et Lutfi Pacha 524
6. Mihrimah Sultane, fille de Süleyman Ier, et Rüstem Pacha 525
7. Gevherhan Sultane, fille de Selim II, et Piyale Pacha 526
8. Ayşe Sultane, fille de Murad III, et Ibrahim Pacha (1586), suivi
d’une description des processions nuptiales données à l’occasion
des mariages antérieurs 527
9. Les mariages des descendantes indirectes de Süleyman Ier 534
10. Fatma Sultane, fille de Murad III, et Halil Pacha (1594) 537
11. La fille de Gevherhan Sultane, fille de Selim II, et Sinan Paşazade
Mehmed Pacha (1598) 545
12. Ayşe Sultane, fille de Murad III, et Yemişçi Hasan Pacha (1601) 547
13. Ayşe Sultane, fille de Murad III, et Güzelce Mahmud Pacha (1604) 550
14. Fatma Sultane, fille de Murad III, et Murad Pacha (1605) 551
15. Gevherhan Sultane, fille d’Ahmed Ier, et Öküz Mehmed Pacha (1608-09) 552
16. Ayşe Sultane, fille d’Ahmed Ier, et Nasuh Pacha (1612) 560
17. Ayşe Sultane, fille d’Ahmed Ier, et Hasan Pacha (1626) 562
Page | 838
18. Hanzade Sultane, fille d’Ahmed Ier, et Bayram Pacha (1620 ? 1638 ?) 563
19. Gevherhan Sultane, fille d’Ahmed Ier, et Receb Pacha (1631) 564
20. Ayşe Sultane, fille d’Ahmed Ier, et Hafız Ahmed Pacha (1626 ? 1631 ?) 565
21. Fatma Sultane, fille d’Ahmed Ier, et Canpuladzade Mustafa Pacha (1636) 567
22. Fatma Sultane et Ahmed Pacha (années 1635-40 ?) 569
23. Safiyye Hanım Sultane, petite-fille d’Ahmed Ier, et Siyavuş Pacha (1643) 570
24. Fatma Sultane et Musahib Fazlı Pacha (1646) 571
25. Atike Sultane, fille d’Ibrahim, et Cafer Pacha, puis Kenan Pacha (1648) 572
26. Kaya Sultane, fille d’Ibrahim, et Haydaragazade Mehmed Pacha (1649) 573
27. Hanzade Sultane, fille d’Ahmed Ier, et Nakkaş Mustafa Pacha (1649) 574
28. Ümmügülsüm Sultane, fille d’Ibrahim, et Ahmed Pacha (1653) 575
29. Ayşe Sultane, fille d’Ahmed Ier, et Ibşir Pacha (1655) 576
30. Atike Sultane, fille d’Ahmed Ier, et Müfettiş Ismail Pacha
(années 1650) puis Kasım Pacha 578
31. Fatma Sultane, fille d’Ahmed Ier, et Melek Ahmed Pacha (1660) 580
32. Atike Sultane, fille d’Ahmed Ier, et Cerrah Kasım Pacha (1666) 588
33. Fatma Sultane, fille d’Ahmed Ier, et Yusuf Pacha (1667) 589
34. Beyhan Sultane, fille d’Ibrahim, et Uzun Ibrahim Pacha 593
35. Hadice Sultane, fille de Mehmed IV, et Musahib Mustafa Pacha (1675) 594
36. Rukiyye Sultane, fille de Murad IV, et Gürcü Mehmed Pacha (1693) 607
37. Fatma Sultane, fille de Mehmed IV, et Tırnakçi Ibrahim Pacha (1695-96) 609
38. Ümmügülsüm Sultane, fille de Mehmed IV, et Çerkes Osman
Pacha (1694) 611
39. Hadice Sultane, fille de Mehmed IV, et Silahdar Hasan Pacha (1700-01) 615
40. Rukiyye Sultane, fille de Murad IV, et Maktulzade Ali Bey
(Pacha) (1702) 616
41. Emine Sultane, fille de Mustafa II, et Hasan Pacha (1702) 618
42. Ayşe Sultane, Emine Sultane et Safiyye Sultane, filles de Mustafa II,
avec Köprülüzade Numan Pacha, Çorlulu Ali Pacha et Kara
Mustafapaşazade Ali Pacha (1702) 621
43. Fatma Sultane, fille d’Ahmed III, et Silahdar Ali Pacha (1709) 631
44. Safiyye Sultane, fille de Mustafa II, et Maktulzade Ali Pacha (1710) 632
45. Fatma Sultane, fille d’Ahmed III, et Nevşehirli Ibrahim Pacha 635
46. Atike Sultane, Hadice Sultane et Ümmügülsüm Sultane, filles
d’Ahmed III, avec Mehmed Bey (puis Pacha), Ali Beg et Çerkes
Osmanpaşazade Ahmed Bey (1728) 636
47. Saliha Sultane, Ayşe Sultane et Zeyneb Sultane, filles d’Ahmed III,
avec Mustafa Pacha, Silahdar Ali Pacha et Mustafa Pacha (1728) 637
48. Ayşe Sultane, fille de Mustafa II, et Ebubekir Pacha (1732) 638
49. Asime Sultane, fille de Mustafa II, et Yakub Pacha (1733) 639
50. Safiyye Sultane, fille de Mustafa II, Saliha Sultane et Ayşe Sultane, filles
d’Ahmed III, avec Ebubekir Pacha, Ali Pacha et Ahmed Pacha (1740) 642
ANNEXES D : LES PRINCESSES ET LA POLITIQUE 645
1. Nefise Hatun, fille de Murad Ier 647
2. Ilaldi Hatun, fille de Mehmed Ier 651
3. Fatma Hatun, fille de Mehmed Ier 653
4. Selçuk Hatun, fille de Mehmed Ier 655
5. Beyhan Sultane, fille de Selim Ier 658
6. Mihrimah Sultane, fille de Süleyman Ier 659
7. La puissance des sultanes sous le règne de Murad III 665
Page | 839
8. Atike Sultane, fille d’Ahmed Ier 667
9. Ayşe Sultane, fille d’Ahmed Ier 668
10. Contacts diplomatiques et usages des cadeaux entre le vice-roi de
Naples et les filles d’Ahmed Ier 671
11. Kaya Ismihan Sultane, fille de Murad IV 672
12. Hadice Sultane, fille de Mehmed IV 679
13. Emine Sultane, fille d’Ahmed III 682
14. Fatma Sultane, fille d’Ahmed III 683
ANNEXES E : LES FONDATIONS PIEUSES DES PRINCESSES 685
1. Selçuk Hatun, fille de Mehmed Ier 687
2. Seyyide Hadice Hatun, petite-fille de Mehmed Ier 691
3. Fatma Hatun, fille de Bayezid II 694
4. Aynişah Sultane, petite-fille de Bayezid II 696
5. Fatma Hanzade Sultane, petite-fille de Bayezid II 699
6. Neslişah Sultane, petite-fille de Bayezid II 703
7. Şah Sultane, fille de Selim Ier 706
8. Hanım Sultane, fille de Selim Ier 710
9. Mihrimah Sultane, fille de Süleyman Ier 712
10. Ayşe Sultane, petite-fille de Süleyman Ier 719
11. Ismihan Sultane, fille de Selim II 723
12. Gevherhan Sultane, fille de Selim II 726
13. Fatma Sultane, fille de Selim II 729
14. Ayşe Sultane, fille de Murad III 732
15. Atike Sultane, fille d’Ahmed Ier 736
16. Kaya Ismihan Sultane, fille de Murad IV, et de sa fille,
Safiyye Hanım Sultane 738
17. Emine Sultane, fille de Mustafa II 742
18. Safiyye Sultane, fille de Mustafa II 744
19. Zahide Hanım Sultane, petite-fille de Mustafa II 752
20. Fatma Sultane, fille d’Ahmed III 756
21. Esma Sultane, fille d’Ahmed III 760
22. Ayşe Sultane, fille d’Ahmed III 765
23. Saliha Sultane, fille d’Ahmed III 767
24. Zeyneb Sultane, fille d’Ahmed III 770
BIBLIOGRAPHIE 775
LISTE DES TABLEAUX, CARTES ET GRAPHIQUES 831
TABLE DES MATIERES 833