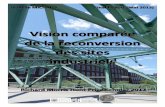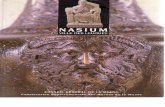Les moulages du Musée de Sculpture Comparée: Viollet-le-Duc et l’histoire naturelle de l’art
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Les moulages du Musée de Sculpture Comparée: Viollet-le-Duc et l’histoire naturelle de l’art
L’artiste savantà la conquête
du monde moderne
Textes réunis parANNE LAFONT
Équipe « Littératures, arts et savoirs » (LISAA – EA 4120) / Université Paris-EstInstitut National d’Histoire de l’Art (INHA)
P R E S S E S U N I V E R S I T A I R E S D E S T R A S B O U R G
2 0 0 9
publié avec le concours duCentre national du livre
XVII
14.2
. La
cath
édra
le id
éale,
dan
s l’a
rticle
« C
athé
drale
»,
Dict
ionn
aire
raiso
nné d
e l’a
rchi
tectu
re fr
ança
ise d
e Vi
ollet
-le-D
uc, I
I, 18
54-1
859,
p. 3
24.
14.1
. An
alyse
de l
a stru
ctur
e de
Not
re-D
ame d
e Dijo
n,
« Con
struc
tion
» du
Dict
ionn
aire
raiso
nné d
e l’a
rchi
tectu
re fr
ança
ise d
e Vi
ollet
-le-D
uc, I
V, 1
859,
p.
93.
XVIII
14.4. Le porche de Moissac complété et remonté en 1889 dans l’aile Passy du Trocadéro, Le Musée de sculpture comparée au Trocadéro, Armand Guérinet, s.d., I, pl. 3.
14.3. Vue de la salle du !""e siècle du Musée de Sculpture Comparée au Trocadéro, c. 1882-1889. Photographie par Médéric Mieusement. Au fond, le portail central du narthex de la Madeleine de Vézelay ; sur la gauche, le tympan du porche de Moissac ; au centre, les moulages d’antiques.
Les moulages du Musée de sculpture comparée :Viollet-le-Duc
et l’histoire naturelle de l’art
ISABELLE FLOUR *
Le Musée de sculpture comparée, fondé en 1879 par Eugène-EmmanuelViollet-le-Duc et mis en œuvre par la Commission des monuments histo-
riques après la mort du maître, représente peut-être l’acmé des transferts depuisles sciences naturelles vers l’histoire de l’art, qui furent particulièrement fécondsdepuis les tentatives d’antiquaires du XVIIIe siècle commeWinckelmann et Cayluspour fonder une histoire scientifique de l’art. Mais alors que les musées de beaux-arts, au mieux, se contentaient d’exposer le résultat de cette constitution du savoirsur l’art, à savoir une classification par écoles, le Musée de sculpture comparéeavait une tout autre ambition, celle d’en exposer la méthode. Le Musée de sculp-ture comparée constituait ainsi la traduction muséographique des écrits d’unViollet-le-Duc faisant bon usage de l’arsenal de théories scientifiques disponiblesen ce XIXe siècle positiviste, mêlant les paradigmes de l’anatomie comparée, desthéories évolutionnistes et de l’anthropologie dans son analyse de l’architecture etsa conception de l’histoire de l’art 1.
* Université Paris 1 – Panthéon – Sorbonne.1 Alors que la bibliographie est vaste concernant l’emprunt par Viollet-le-Duc de modèles
aux sciences naturelles dans ses écrits, l’analyse du programme du Musée de sculpturecomparée à la lumière de ces conclusions n’a été esquissée que tardivement, cf. RolandRecht, « Le Moulage et la naissance de l’histoire de l’art » et Willibald Sauerländer, « “Gypsasunt conservanda” : l’obsession de la sculpture comparée », Le Musée de sculpture comparée :naissance de l’histoire de l’art moderne, éd. du Patrimoine, 2001, p. 46-53 et p. 72-79,respectivement. Depuis la première rédaction de ce texte, en mars 2007, deux nouvellescontributions ont apporté des interprétations complémentaires sur le Musée de sculpturecomparée : Dominique de Font-Réaulx, « LeDictionnaire raisonné de l’architecture française,modèle du musée de Sculpture comparée. Esquisse d’une analyse comparée de deux œuvres
Une conception organiciste de l’architecture
Le Musée de sculpture comparée, au titre sibyllin et unique dans l’histoire desmusées de beaux-arts, ne peut se comprendre sans évoquer l’anatomie comparéequi constitue le modèle interprétatif de l’architecture pour Viollet-le-Duc.L’œuvre écrit de l’architecte supplée à ses projets de musée peu diserts 2 quant àson arrière-plan théorique, regorgeant pourtant d’analogies avec les sciences natu-relles. Ainsi, de même que le but de l’anatomie comparée est l’étude des di!érentsorganes et de leurs relations au sein d’un organisme vivant, le but du Musée desculpture comparée serait l’étude des fragments ou «membres d’architecture » ausein de l’édifice architectural. Rappelons en e!et que les écrits de l’architecte etrestaurateur révèlent une tension entre une démarche analytique marquée par lemodèle de la dissection et une théorie de la restauration fondée sur celui de lareconstitution3. Ces deux pôles de la méthode viollet-le-ducienne peuvent êtreillustrés par deux véritables icônes issues du volumineux Dictionnaire raisonné del’architecture française. D’une part, l’église Notre-Dame de Dijon dans l’article«Construction » constitue un exemple désormais fameux de dissection (ill. 14.1),de même que le choix de la forme même du Dictionnaire pour étudier les di!é-rentes parties de l’architecture « oblige, pour ainsi dire, à les disséquer séparément,tout en décrivant les fonctions et les transformations de ces diverses parties » 4.D’autre part, a contrario, la fiction de la cathédrale idéale du XIIIe siècle (ill. 14.2)illustre le procédé de reconstitution par déduction, qui sous-tend la définition dela restauration selon Viollet-le-Duc : « Restaurer un édifice, […] c’est le rétablirdans un état complet qui peut n’avoir jamais existé à un moment donné »5. Demême que le paléontologue reconstitue un squelette à partir de fragments d’os
majeures d’Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc », La Sculpture en Occident. Études o!ertes àJean-René Gaborit, sous la dir. de Geneviève Bresc-Bautier, Dijon, Faton, 2007, p. 320-331, et Dominique Jarassé, « En quête de lois et de rythmes. Contribution à une généa-logie du formalisme », L’Histoire de l’art et le comparatisme. Les horizons du détour, sous ladir. de Marc Bayard, Somogy, 2007, p. 71-90.
2 Eugène Viollet-le-Duc,Musée de Sculpture comparée appartenant aux divers Centres d’Art etaux diverses époques, Bastien et Brondeau, 1879, [11 juin], 10 p., et Musée de la sculpturecomparée. 2e Rapport, Bastien et Brondeau, 1879, [12 juillet], 19 p.
3 Voir Laurent Baridon, L’Imaginaire scientifique de Viollet-le-Duc, L’Harmattan, 1996,chapitres «Anatomie », «Organicisme », «Évolutionnisme », ainsi que «Anatomie comparéeet pensée évolutionniste dans la théorie et la pratique architecturale de Viollet-le-Duc »,L’Architecture, les sciences, et la culture de l’histoire au XIXe siècle, Saint-Étienne, Publicationsde l’Université de Saint-Étienne, 2001, p. 73-81 ; Martin Bressani, «Opposition et équi-libre : le rationalisme organique de Viollet-le-Duc », Revue de l’Art, 1996, n° 112, p. 28-37.
4 E. Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle,B. Bance puis Morel, 1854-1868, I (1854), p. VI.
5 Ibid., VIII (1866), article «Restauration », p. 14.
220 ISABELLE FLOUR
épars, le Cuvier de l’architecture reconstitue le monument à partir de fragments :« de même qu’en voyant la feuille d’une plante, on en déduit la plante entière ; l’osd’un animal, l’animal entier : en voyant un profil, on en déduit les membres d’ar-chitecture ; le membre d’architecture, le monument »6.
La muséographie du Musée de sculpture comparée allait hériter de cettetension entre dissection et reconstitution, entre fragment et monument, se révé-lant ici par le « cadrage » des moulages, allant du chapiteau au portail. La Sous-Commission du musée se fit très tôt un devoir de mouler des ensembles lorsqu’ilsprésentaient un intérêt7, et de nombreuses acquisitions furent décidées dans cesens, tels les grands portails de Vézelay, Saintes, Bordeaux, Beauvais, qui jalon-naient le parcours dès les premières années du musée. Ces morceaux d’architec-ture furent multipliés dans les décennies suivantes, atteignant des sommets demonumentalité avec le portique de la cour de l’hôtel Bernuy ou encore la« lanterne des morts » d’Avioth s’élevant à 14 m de hauteur sous les verrières duTrocadéro. Ici et là, cette obsession de la résurrection des monuments tantôtpoussait à la gre!e anatomique, dans le cas des statues décapitées de Bueil, dontles têtes originales étaient conservées au musée de Tours et dont les moulagesfurent rassemblés à ceux des corps des statues8, et tantôt confinait à l’anastylose,comme le montre l’exemple du portail de l’église Saint-Pierre de Moissac, dontles divers éléments – tympan, trumeau et piédroits – d’abord moulés isolément(ill. 14.3), furent complétés quelques années plus tard pour remonter le portailentier (ill. 14.4)9.
En outre, l’usage de la photographie dénote un autre mode de recontextuali-sation des fragments, quand le moulage du monument s’avérait impossible.Viollet-le-Duc préconisait cet expédient pour une dernière salle d’ornementa-tion, permettant au visiteur de resituer les fragments dans leur contexte originel.Si l’architecte limitait la présentation de photographies à cette dernière sectiond’ornementation, la Sous-Commission userait cependant de cette économie dela métonymie dans l’ensemble des galeries 10. Ainsi, alors que le spécialiste étaitcapable de déduire du fragment le monument, le néophyte devait pouvoir s’aiderde ces béquilles muséographiques que sont les photographies pour comprendrele rapport de l’ornement à la structure.
221LES MOULAGES DU MUSÉE DE SCULPTURE COMPARÉE
6 Ibid., VIII (1866), article « Style », p. 486, cité par L. Baridon, op. cit., 1996, p. 37.7 Archives du Musée des Monuments Français (AMMF), Procès-Verbaux de la Sous-
Commission du Musée de Sculpture Comparée (PV SC MSC), 17 décembre 1879, ainsique de nombreuses autres occurrences dans les procès-verbaux ultérieurs.
8 AMMF, PV SC MSC, 4 décembre 1880.9 AMMF et Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine (MAP), PV SC MSC, 6 juillet
et 12 octobre 1888 pour la décision de compléter et de remonter le moulage du porche.10 AMMF, PV SC MSC, 26 avril et 5 octobre 1882.
En définitive, cette conception organiciste de l’architecture, que Viollet-le-Ducpartageait avec d’autres11, nous autorise peut-être à considérer le Musée de sculp-ture comparée comme un musée d’architecture autant que comme un musée desculpture. À tout prendre, Viollet-le-Duc considère le décor, qu’il soit peint ousculpté, comme indissociable de l’architecture, comparant le rôle des trois artsmajeurs aux organes d’une plante « dont la structure interne appartiendrait à l’ar-chitecture, la forme extérieure à la sculpture, et les fleurs à la peinture »12. Car ene!et, c’est la préférence pour le primitif et, partant, pour l’ornement plutôt quepour la ronde-bosse13, qui est au principe duMusée de sculpture comparée, les pro-jets précurseurs du musée, émis en 1848 et en 1855, étant exclusivement consacrésà la sculpture monumentale du XIIe au XVIe siècle14. Or, précisément, voici ce quifait aux yeux de Viollet-le-Duc la qualité intrinsèque de la sculpture médiévale :
[…] dans l’art du moyen âge, la sculpture ne se sépare pas de l’architecture ;[…] la sculpture statuaire et la sculpture d’ornement sont si intimement liées,qu’on ne saurait faire l’histoire de l’une sans faire l’histoire de l’autre […]15Il ne serait pas possible, par exemple, d’enlever des porches de la cathédrale deChartres la statuaire, sans supprimer du même coup l’architecture16.
Aussi la section d’ornementation, achevant le parcours du musée, était-elleemployée à « constater dans quels cas, par exemple, la sculpture fait pour ainsidire corps avec l’architecture, dans quels cas, elle semble une décoration d’em-prunt appliquée »17. En 1887, l’architecte et disciple Anatole de Baudot deman-derait, pour son nouveau cours d’architecture française, le développement decette section d’ornementation, séparée de la statuaire, dans la galerie tout justeannexée de l’aile Passy du Trocadéro18. La proposition, rejetée au motif que dansla pratique il est bien di"cile de disjoindre la statuaire et l’ornementation, aurait
11 Sur l’organicisme en architecture, voir Caroline Van Eck, Organicism in Nineteenth-Century Architecture : an Inquiry into its "eoretical and Philosophical Background,Amsterdam, Architectura & Natura Press, 1994, et plus particulièrement sur Viollet-le-Duc, p. 235-240.
12 E. Viollet-le-Duc, Esthétique appliquée à l’histoire de l’art, ENSBA, 1994 [1864], p. 12.,cité par L. Baridon, op. cit., 1996, p. 211.
13 Ernst H. Gombrich, "e Preference for the Primitive : Episodes in the History of WesternTaste and Art, London, New York, Phaidon, 2002, en particulier «#e Emancipation ofFormal Values », p. 177-194.
14 Archives des Musées Nationaux (AMN), 5HH9, rapport de la Commission des Monu-ments Historiques, 24 novembre 1848 et 30 juin 1855, et lettre de Viollet-le-Duc, 15 juin1855.
15 E. Viollet-le-Duc, op. cit., VIII (1866), article « Sculpture », p. 98.16 Ibid., p. 174.17 E. Viollet-le-Duc, op. cit., 1879, [11 juin], p. 3 et p. 9.18 MAP, PV SC MSC, 23 novembre 1887.
222 ISABELLE FLOUR
cependant évité le redoublement chronologique des deux ailes. Ces débatspassionnés, provoqués par l’ambivalence du titre de Musée de sculpturecomparée, semblent aujourd’hui justifier le statut de musée d’architecture à partentière qui lui a été implicitement attribué par l’historiographie19.
Une histoire de l’art à prétention scientifique
Dans le même temps, le moulage allait servir les prétentions de démonstra-tion scientifique de l’histoire de l’art d’un Viollet-le-Duc nourri aux deuxmamelles des sciences naturelles, à savoir l’anatomie comparée et l’évolution-nisme. Le moulage, par sa fidélité à l’original, pouvait atteindre au statut depreuve objective et positive, légitimant la scientificité du propos muséogra-phique, et restituant la tridimensionnalité nécessaire à l’étude des volumes de lasculpture, tout en préservant les originaux in situ20. Viollet-le-Duc considéraitainsi ces reproductions, presque mécaniques, comme de véritables documents àl’appui de sa démonstration. L’exactitude de la reproduction n’était pas un vainmot pour ses émules. Ainsi, le sculpteur statuaire Adolphe-Victor Geo!roy-Dechaume orchestre l’exécution des moulages pour le musée, établissant en1881, à l’intention des multiples mouleurs, les matériaux et techniques autoriséset, surtout, recommandant le repérage des di!érentes parties de l’estampage pouréviter les inexactitudes lors de l’assemblage. Les retouches en creux dans les mou-les sont en outre proscrites, et enfin « sur l’épreuve en plâtre, il ne doit rien êtreretranché des coutures qui doivent rester apparentes, comme témoins irrécusa-bles de l’exactitude du travail »21. Car aux yeux de la Sous-Commission, la fidé-lité des reproductions prime sur leur illusionnisme. De manière générale, l’onpréfère prendre les moulages directement sur les originaux et éviter la pratiquedu surmoulage ; l’on prohibe les patines et les teintes, pour conserver la finessedu grain de la sculpture ; l’on refuse parfois des moulages jugés défectueux ouréalisés d’après des moules anciens et usés par le tirage des épreuves. Au demeu-
223LES MOULAGES DU MUSÉE DE SCULPTURE COMPARÉE
19 Le Musée de sculpture comparée est parfois intégré à l’historiographie des musées d’archi-tecture : Werner Szambien, Le Musée d’architecture, Picard, 1988, p. 8 ; Jean-Louis Cohen,« Exposer l’architecture », Une Cité à Chaillot, sous la dir. de J.-L. Cohen et Claude Eveno,Besançon, éd. de l’Imprimeur, 2001, p. 32 ; Fabienne Couvert, Exposer l’architecture : lemusée d’architecture en question, Rome, Diagonale, 1997, p. 46-47 ; Maurice Culot, « LesMusées d’architecture », Encyclopédie Universalis, 1999.
20 L’utilisation de ce médium fait au demeurant écho aux moulages anatomiques, utilisésaussi bien dans le domaine de l’anatomie comparée que dans l’enseignement artistique,ainsi qu’aux moulages de pièces archéologiques.
21 AMN, 5HH1, Instruction concernant les travaux de moulages à exécuter pour le Muséede Sculpture comparée, 1er janvier 1881.
rant, l’authenticité des originaux est également discutée : certaines commandessont ajournées après constatation, sur place, de leur état très restauré22.
Ainsi, alors que nombre d’œuvres originales étaient rendues inamovibles parle culte moderne des monuments, leur reproduction allait permettre l’établisse-ment d’une histoire de l’art fondée sur le comparatisme. L’article « Sculpture » duDictionnaire constitue vraisemblablement la première proposition par Viollet-le-Duc d’un musée de sculpture comparée :
[…] n’aurait-on pas déjà dû réunir, dans des salles spéciales, des moulages de lastatuaire antique et du moyen âge comparées. […] Si dans des salles on plaçaitparallèlement des figures grecques de l’époque éginétique et des figures duXIIe siècle de la statuaire française, on serait frappé des analogies de ces deux arts,non seulement quant à la forme, mais quant au faire. Si plus loin on mettait enregard des figures du développement grec et du XIIIe siècle français, on verraitpar quels points de contact nombreux se réunissent ces deux arts, si di!érentsdans leurs expressions23.
Là encore, les sciences naturelles, mais aussi l’anthropologie, fournissaient leparadigme muséographique du comparatisme. Si Viollet-le-Duc devait certaine-ment connaître la galerie d’anatomie comparée du Muséum24, il avait surtout étéétroitement associé à la création de deux musées nouveaux. Au sein du premier,le Musée des Antiquités Nationales de Saint-Germain-en-Laye, fondé en 1862 etouvert en 1867, était continûment caressé le projet d’une salle de comparaison,en fait, une section ethnographique, demeurée dans les limbes pendant plusieursdécennies25. Quant au second, le Musée d’Ethnographie du Trocadéro, fondé en1878, Viollet-le-Duc y avait particulièrement vanté les mérites de la comparaison,donnant un surcroît d’intérêt à des objets jugés de peu de valeur intrinsèque26.
22 MAP, PV SC MSC, 12 octobre 1888.23 E. Viollet-le-Duc, op. cit., VIII (1866), article « Sculpture », p. 153-154.24 Sur la galerie d’anatomie comparée du Muséum, voir la thèse de Cédric Crémière, La
Science au musée. L’anatomie comparée au Jardin du Roi puis au Musée d’histoire naturelle deParis 1745-1898, thèse soutenue en 2004 au Muséum National d’Histoire Naturelle sousla dir. de Michel Van Praët, 405 p. On sait notamment que Gottfried Semper, l’alter egoallemand de Viollet-le-Duc, la fréquentait pendant son séjour à Paris entre 1826 et 1830,voir C. Van Eck, op. cit., p. 228.
25 Voir Patricia Larrouy, Le Musée des Antiquités Nationales de la création à la IIIe République,École du Louvre, 1996, thèse de troisième cycle sous la direction d’Hélène Chew, 147 p. et« Les premières années du Musée des Antiquités nationales », Antiquités Nationales, 1998,n° 30, p. 197-206 ; Jean-Pierre Mohen, «Henri Hubert et la salle de Mars », AntiquitésNationales, 1980/81, n° 12-13, p. 85-89.
26 Nélia Dias, Le Musée d’Ethnographie du Trocadéro, 1878-1908. Anthropologie et muséologieen France, CNRS, 1991, p. 170 et voir le rapport de Viollet-le-Duc du 28 octobre 1878dans N. Dias (éd.), Ernest-#éodore Hamy, Les Origines du Musée d’Ethnographie, J.-M. Place, 1988 [1re éd. 1890], p. 295-302.
224 ISABELLE FLOUR
Dans l’autre aile du Palais du Trocadéro, Viollet-le-Duc maintenait donc en1879 le cap du comparatisme, devant révéler les « relations entre les sculpturesappartenant à di!érentes époques et civilisations », et qui serait vite étendu à l’en-semble du projet muséographique.
Cependant Viollet-le-Duc allait réconcilier deux théories antagonistes aupoint d’avoir provoqué le fameux débat de 1830 ou « querelle des analogues ».Se détournant, dans sa conception de l’histoire de l’art, du modèle fixiste etcatastrophiste découlant de l’anatomie comparée de Georges Cuvier, il épou-sait le modèle transformiste ou pré-évolutionniste d’Étienne Geo!roy-Saint-Hilaire27. Cette conception évolutionniste est parfaitement explicitée par leprogramme du musée, visant à mettre en évidence les lois analogues de l’évo-lution du style dans chacune des écoles de sculpture, selon un développementen trois phases inspiré du cycle de Winckelmann semblant être amputé de laphase de déclin :
Chez les peuples qui ont atteint un haut degré de civilisation, l’art de la sculp-ture se divise en 3 périodes :Imitation de la nature suivant une interprétation plus ou moins délicate et intel-ligente. Époque archaïque pendant laquelle on prétend fixer les types. Époqued’émancipation et de recherche du vrai dans le détail et perfectionnement desmoyens d’observation et d’exécution28.
Viollet-le-Duc utilise ici une méthode inductive, dérivant de la philosophiepositiviste et visant à établir des lois générales, car selon le théoricien, les lois del’architecture sont « les mêmes dans tous les pays et dans tous les temps »29. Ainsi,dans les trois premières salles du musée, la sculpture française du XIe au XVe sièclese mesure aux types égyptiens, assyriens et grecs. Dans les salles suivantes, duXVIe au XVIIIe siècle, la sculpture française est comparée aux écoles contempo-raines de sculpture, principalement d’Italie mais aussi d’Allemagne et d’Espagne.L’ultime version du projet adopte donc la comparaison sur l’ensemble duparcours muséographique, que ce soit de manière diachronique ou synchro-nique, autour de l’épine dorsale constituée par l’évolution de la sculpture fran-çaise du XIe au XVIIIe siècle.
225LES MOULAGES DU MUSÉE DE SCULPTURE COMPARÉE
27 L. Baridon, op. cit., 1996 et 2001.28 E. Viollet-le-Duc, op. cit., 1879, [11 juin], p. 3-4.29 E. Viollet-le-Duc, op. cit., I (1854), p. X, cité par Simona Talenti dans L’Histoire de l’ar-
chitecture en France. Emergence d’une discipline (1863-1914), Picard, 2000, p. 163.
Les apories du comparatisme :une muséographie résolument nationaliste
Cependant, les débats au sein de la Sous-Commission du musée témoignentdu désarroi dans lequel la mort de Viollet-le-Duc a plongé ses disciples. Pour unJules Quicherat, professeur d’archéologie médiévale à l’École des Chartes, « cettepensée a été patriotique, d’abord, et […] l’idée historique n’est venue s’y joindreque plus tard »30. D’ailleurs, le spectre de l’abandon de la comparaison et del’éviction des moulages d’antiques est agité à plusieurs reprises, dès 187931 et ànouveau en 1887. Robert de Lasteyrie invoque alors la perplexité du public : « cesmonuments exposés dans les premières salles comme termes de comparaison nefont que désorienter le public qui ne comprend pas leur raison d’être »32. Dèslors, on propose de troquer le titre hermétique de Musée de sculpture comparéepour celui de Musée des monuments français, changement entériné seulementen 1937 avec l’évacuation de la majeure partie des moulages d’œuvres étrangèreset la réorganisation du musée à l’occasion de l’Exposition Internationale.
Au demeurant, la perplexité du public avait été le mieux exprimée par lecritique d’art Louis Gonse, d’une sagacité exemplaire, et ce dès l’ouverture dumusée :
La théorie est tout au moins ingénieuse ; il nous est cependant impossible d’enaccepter les conclusions dans leur rigueur. Elle a fort bon air sur le papier, maisses vices sautent aux yeux. […] Les analogies de style et d’exécution sont pure-ment accidentelles ; elles n’ont aucun accent d’évidence et de continuité. Le seulrésultat de ce groupement aventureux a été de grandir outre mesure la puissancedécorative et architecturale de notre art du moyen âge. D’un côté, des morceauxdétachés des ensembles auxquels ils appartenaient ; de l’autre, les ensemblesentiers avec leur architecture servant de cadre, comme dans cet incomparable etgrandiose portail de Vézelay du XIIe siècle : ce n’est plus de la comparaison, c’estde l’écrasement. Est-ce le but secret poursuivi par Viollet-le-Duc ? Cela est bienpossible33.
En e!et, non seulement les moulages d’œuvres françaises étaient les plusmonumentaux, mais leur supériorité numérique les rendait d’autant plus « écra-sants ». Les moulages d’œuvres antiques et étrangères formèrent toujours laportion congrue des collections, 20 % en 1883, 14 % en 1925. Toutefois, cette«macédoine d’œuvres », selon le mot de Gonse, arrivait à ses fins, à savoir la
30 AMMF, PV SC MSC, 17 décembre 1879.31 Ibid.32 AMMF, PV SC MSC, 9 octobre 1887.33 Louis Gonse, « Le Musée des moulages du Trocadéro », Gazette des Beaux-Arts, 1882,
juillet-décembre, vol. 26, p. 63-68.
226 ISABELLE FLOUR
démonstration de la supériorité de l’art français. Viollet-le-Duc ne tonnait-il pas :« […] nous possédons en France des exemples antérieurs de plus d’un siècle [auxœuvres des Pisans du quatorzième siècle] et infiniment meilleurs au point de vuedu style et de l’exécution »34. Et Jules Quicherat d’entonner l’antienne à son touren 1880, fournissant un plaidoyer d’une teneur inhabituelle en faveur d’uneacquisition :
[…] la statue de Charles d’Anjou est la constatation de l’état de l’art en Italie auXIIIe siècle. Cette statue est en e!et inférieure de beaucoup aux statues faites enFrance à cette époque […] La comparaison qui en résultera ne servira qu’àmieux faire comprendre au public qu’aux XIIe et XIIIe siècles la sculpture fran-çaise était bien supérieure à la sculpture italienne35.
Cette hantise de l’académisme et de l’Italie découlait de la croyance en la thèsed’une France des deux races, Gauloise à l’origine, puis étou!ée par l’Empireromain, mais enfin régénérée par le sang aryen amené par les invasions barbares 36.Cependant, après la défaite de 1871 vécue par la France comme une humiliation,Viollet-le-Duc n’épargnait pas les voisins d’outre-Rhin, et l’analyse des influencesentre régions limitrophes ne laisse pas de prendre une tournure guerrière :
On voit comment au XVe siècle l’influence de l’École des Bords du Rhin et desFlandres envahit la Bourgogne. Comment la manière atteint les dernières limi-tes, mais comment aussi l’École de l’Île de France et celle de la Champagnerésistent à cette invasion37.
En revanche, à aucun moment Viollet-le-Duc ne dénigre l’art grec. Bien aucontraire, placer sur un pied d’égalité la sculpture de la Grèce antique et celle dela France médiévale c’était hisser cette dernière à la hauteur du canon suprêmede l’histoire de l’art. Mais tandis que l’art grec s’essou$ait dès la troisième salledans une phase de « décadence », l’art français poursuivait jusqu’au XVIIIe siècleson évolution glorieuse amputée de la phase du déclin, ainsi que le relève unLouis Gonse gonflé d’orgueil :
Depuis le commencement du XIe siècle jusqu’à l’époque actuelle, la chaîne estininterrompue ; l’évolution n’a point d’éclipse ; la sève conserve toute sa vigueuret s’étend dans tous les rameaux ; l’art de la sculpture est notre gloire la pluspure, la plus certaine38.
227LES MOULAGES DU MUSÉE DE SCULPTURE COMPARÉE
34 E. Viollet-le-Duc, op. cit., 1879 [11 juin], p. 5.35 AMMF, PV SC MSC, 13 novembre 1880.36 Eric Michaud, «Nord-Sud. Du nationalisme et du racisme en histoire de l’art », Critique,
1996, n° 586, p. 163-187, réédité dans Histoire de l’art. Une discipline à ses frontières,Hazan, 2005, p. 49-84.
37 E. Viollet-le-Duc, op. cit., 1879 [12 juillet], p. 2-3.38 L. Gonse, op. cit., p. 70.
C’est aussi dans une perspective de nationalisation du programme muséogra-phique qu’il faut comprendre la gre!e in extremis, dans le rapport dejuillet 1879, des XVIIe et XVIIIe siècles absents des premiers projets, quand bienmême Viollet-le-Duc en avait vitupéré l’académisme dans ses écrits, car à sesyeux la continuité est l’élément fondateur du caractère national : «Ce qui cons-titue les nationalités, c’est le lien qui unit étroitement les di!érentes périodes deleur existence »39. Établir cette filiation ininterrompue, c’était donc revendiquerpour l’art français une place au sein de la taxinomie des écoles d’art nationales.
Non content d’illustrer l’évolution de l’art national, Viollet-le-Duc souhaitaitencore en dessiner la géographie historique, procédant d’une fusion progressivedes diverses écoles régionales, entre le XIIe et le XVIe siècle, regroupées sous levocable unificateur de « la sculpture française ». Le double processus d’inclusion,d’une part, des écoles régionales, et d’exclusion, d’autre part, des écoles étran-gères40, était accusé par les cartels aux couleurs d’un schématisme cartogra-phique : jaune pour la France, gris pour l’étranger41. Cependant, alors que chezViollet-le-Duc la notion d’école renvoyait à un déterminisme du milieu auxaccents tainiens42, la Sous-Commission du musée allait déployer une vision pluspurement territoriale de la classification par nations. On verra ainsi curieusementles moulages de Strasbourg, d’abord classés au sein des œuvres étrangères, êtrerapatriés du côté français après la Grande Guerre, un reclassement dont la justi-fication est à chercher davantage dans les événements politiques contemporainsque dans un argument d’analyse stylistique43.
Et pourtant, malgré cette obsession de l’art français, l’on serait bien en peinede trouver un seul argument stylistique pour fonder cette catégorie reposant, defait, sur des arguments botaniques et anthropologiques. Puisque les diversesécoles de sculpture connaissent une évolution analogue dans le mode d’interpré-tation de la nature, les caractères distinctifs de l’école française résident aux yeuxde Viollet-le-Duc dans le choix des modèles : dans le domaine de l’ornementa-tion, les fleurs des champs locales44, dans le domaine de la statuaire, les typeslocaux. Ainsi, notre « anthropologiste », membre de la Société d’Anthropologiede Paris, connaissant Paul Broca comme Paul Topinard, l’un des apôtres de l’an-thropologie physique, et recommandant la lecture de l’Essai sur l’inégalité des
39 E. Viollet-le-Duc, op. cit., I (1854), p. III.40 Carlo Ginzburg, « Style. Inclusion et exclusion », À distance. Neuf essais sur le point de vue
en histoire, Gallimard, 2001, p. 117-146.41 AMMF, PV SC MSC, 26 avril 1882.42 L. Baridon, op. cit., 1996, chapitre «Milieu », p. 191-201.43 Comparer avec les catalogues antérieurs celui de 1925-1928 : Camille Enlart, Jules
Roussel, Catalogue général du Musée de sculpture comparée au Palais du Trocadéro,H. Laurens, 1925-1928, 3 vol.
44 E. Viollet-le-Duc, op. cit., V (1861), article « Flore », p. 485-524.
228 ISABELLE FLOUR
races de Gobineau, reconnaît àChartres « un vrai type duvieux Gaulois », ou dans lessculptures de Notre-Dame deParis une « physionomie toutefrançaise » 45 (ill. 14.5). Et,même lorsque la statuaire idéa-lise les types étudiés, le méritedes artistes médiévaux est decréer un canon français :
Ce canon, qui était loind’avoir la valeur de ceuxadmis par les artistes de labelle antiquité grecque,avait un mérite : il nousappartenait ; il était établisur l’observation des typesfrançais, il possédait sonoriginalité native46.
La convocation des théo-ries raciales participait de cette« quête de scientificité » del’histoire de l’art, qui faisait dessculptures médiévales de véri-tables documents anthropolo-giques, à l’appui de la cons-truction du mythe de « l’artfrançais ». De même qu’auMusée des Antiquités Nationales des moulages de visages de Gaulois pris sur desmonuments romains et hellénistiques devaient documenter l’histoire de la racegauloise47, le Musée de Sculpture Comparée n’était-il pas, également, un muséed’anthropologie physique historique comparée ?
229LES MOULAGES DU MUSÉE DE SCULPTURE COMPARÉE
45 E. Viollet-le-Duc, op. cit., VIII (1866), article « Sculpture », p. 113-122, p. 152, p. 167-169, digressions relevées par L. Baridon, op. cit., 1996, chapitre « Anthropologie », p. 43-57, puis par D. Jarassé, «Mythes raciaux et quête de scientificité dans la construction del’histoire de l’art en France 1840-1870 », Revue de l’Art, 2004, n° 146, p. 61-72.
46 Ibid., VIII (1866), article « Sculpture », p. 167-168.47 P. Larrouy, op. cit. 1996, p. 28 et p. 83.
14.5. Vierge du portail nord de Notre-Dame deParis, dans l’article « Sculpture » du
Dictionnaire raisonné de l’architecture françaisede Viollet-le-Duc, VIII, 1866, p. 169.
Du Musée de sculpture comparéeau Musée des monuments français :
l’échec du scientisme, le triomphe du nationalisme
Le Musée de sculpture comparée apparaît comme le couronnement de touteune vie d’e!orts pour fonder l’histoire de l’art en tant que science. Dans cetteperspective, le moulage, considéré comme un document objectif, semblait êtrel’illustration scientifique de premier choix pour l’histoire de la sculpture archi-tecturale, qui servait la devise positiviste de Viollet-le-Duc : «Voir, c’estsavoir »48. Mais les paradigmes empruntés aux sciences du vivant concouraienttous ici à étayer l’idéologie nationaliste : l’évolutionnisme justifiant l’existencehistorique de l’art français, l’anthropologie physique en définissant les spécifi-cités, et le comparatisme plaçant l’art national au sommet de la hiérarchie desécoles artistiques. Cependant, en passant du texte au musée, du Dictionnaireraisonné de l’architecture française au Musée de sculpture comparée, Viollet-le-Duc avait oublié que ce médium particulier qu’est le musée ne pouvait sou!rirl’économie du texte, dans la mesure où les exemples choisis n’induisaient pas leslois générales qu’il souhaitait mettre en évidence. L’échafaudage théorique passe-rait bientôt au second plan, avec l’abandon progressif du comparatisme, au profitd’une idéologie nationaliste toujours plus présente49.
48 L. Baridon, « “Voir c’est savoir”. Pratiques de la description chez Viollet-le-Duc », Le Textede l’œuvre d’art : la description, sous la dir. de R. Recht, Strasbourg, Colmar, PressesUniversitaires de Strasbourg, Musée Unterlinden, 1998, p. 78-87.
49 I. Flour, « Style, nation, patrimoine : du Musée de sculpture comparée au Musée desmonuments français (1879-1937) », Stratégies identitaires de conservation et de valorisationdu patrimoine, sous la dir. de Jean-Claude Némery, Michel Rautenberg et Fabrice#uriot,L’Harmattan, 2008, p. 33-41.
230 ISABELLE FLOUR