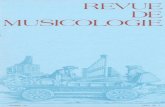Les Maisons de Justice et du Droit à l'Ile de la Réunion
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Les Maisons de Justice et du Droit à l'Ile de la Réunion
LES MAISONS DE JUSTICE ET DU DROIT À L’ILE DE LA RÉUNIONA LA RECHERCHE D’ALTERNATIVES ADAPTÉES À LA DIMENSION MULTICULTURELLE DE LA SOCIÉTÉ
CONTEMPORAINE
PAR RÉGIS LAFARGUE1
Article paru dans la revue Droit et Cultures, numéro hors-série,2001/3, p. 181 - 200
RÉSUMÉ
Les maisons de justice et du droit à la Réunion nées d’une crisesociale et urbaine, traduisent la prise en compte de la spécificitéculturelle d’une société insulaire marquée par ses communautés.Concurrentes des tribunaux d’instance, les maisons de justice et dudroit soulignent la nécessité d’un «maillon» entre l’institutionjudiciaire et une population qui semble appeler de ses vœuxl’instauration d’un véritable juge de paix.
Les maisons de justice et du droit à la Réunion sont nées de larencontre de plusieurs facteurs : une crise sociale et urbaine grave(dont témoignent les événements du quartier du Chaudron, à Saint-Denis, en 1991), et la prise de conscience de la spécificitéculturelle d’une société insulaire marquée par un fort sentimentcommunautaire2.
1 Magistrat, M. Régis Lafargue, a publié plusieurs études dans le champ del’anthropologie juridique. Ses travaux portent sur les expériences menées dans lePacifique-sud (L’expérience australienne d’adaptation du droit pénal à la dimensionculturelle, Archives de Politique Criminelle, n°18 ; Le Traité de Waitangi : leSymbole et le Droit, de la fondation d’une colonie à la naissance d’une nation,R.J.P.I.C., 2, 1999) comme sur celles menées en Afrique (l’Etat de droit et lenouveau Code des personnes et de la famille en Centrafrique, R.J.P.I.C., 1, 1997,et concernant l’Afrique du Sud : La place du droit coutumier dans la définition dunouvel ordre juridique démocratique, à paraître à Droit et Cultures).2 Les maisons de justice et du droit paraissent particulièrement adaptées à lastructure communautaire de la société réunionnaise dont les 700 000 habitants serépartissent ainsi qu’il suit : 36% de métis ou d’origine africaine, 30% d’origineeuropéenne (ce qui regroupe à la fois «créoles blancs» et métropolitains), 24%d’Indiens Tamouls, 5% d’Indiens musulmans, et 4% d’Asiatiques.
1
Si les préoccupations qui ont prévalu à leur création sont lesmêmes qu’en métropole, l’expérience réunionnaise des maisons dejustice et du droit paraît modelée par les acteurs locaux, en quelquesorte réappropriée par un tissu social dynamique. Leur intitulé,même, «maison de justice et du droit» est trompeur et ne renvoie pasfidèlement au «modèle» métropolitain. Elles s’assimilent plutôt à desantennes de justice si l’on s’en tient au contenu de leurs activités(actions d’information sur les droits, médiation pénale, conciliationcivile) et au fait que les magistrats du parquet n’y sont guèreprésents, pas plus que les magistrats du siège (et pour cause ellessont implantées à proximité des lieux de justice). C’est par leurassise immobilière qu’elles rejoignent le schéma classique desmaisons de justice et du droit : toutes sont dotées de locauxspécifiques mis à disposition par les mairies et nettementidentifiés. Les maisons de justice et du droit s’affichent et sevoient aussi bien, sinon mieux, que le tribunal d’instance local.Cette symbolique renforcée par l’idée communément répandue que lesmédiateurs-conciliateurs sont des «juges-pays» pose la question desavoir si l’expression juge de paix ne caractériserait pas mieux uneréalité qui a probablement dépassé les attentes de ceux qui, du côtéjudiciaire, initièrent ce partenariat avec les collectivités locales.
Cette spécificité réunionnaise peut s’expliquer par l’anciennetéde l’expérience, menée de façon concomitante avec les premièrestentatives métropolitaines en ce domaine, dès l’année 19913. L’absencede modèle a permis le développement d’une institution adaptée à lagéographie comme aux mentalités.
L’autre particularité de l’expérience réunionnaise tient àl’omniprésence des maisons de justice et du droit. Une décennie aprèsleur lancement, elles font incontestablement partie del’environnement institutionnel réunionnais : chaque commune en ayantune, voire plusieurs sur son territoire, ce qui porte leur nombretotal à 27 pour une population de 700 000 habitants.4
3 L’idée de maisons de justice implantées dans des quartiers en difficulté a étélancée en 1990 par le procureur de la République près le TGI de Pontoise, MarcMoinard (les deux premières créées étant celles de Cergy-Pontoise et de Sarcelles).C’est immédiatement après cette expérience pilote que se situe la création despremières maisons de justice et du droit à la Réunion, ces dernières comptant parmiles 15 premières maisons de justice et du droit créées en France à la suite de laréunion interministérielle du 12 juin 1991, laquelle arrêtait la création pourl’année 1991 de 13 nouvelles structures (en sus des deux MJD pilotes du Vald’Oise), parmi lesquelles 4 pour la seule île de la Réunion (Saint-Pierre, LeTampon, Saint-Joseph, et Saint-Leu). A ces quatre premières maisons de justice etdu droit réunionnaises viendront s’adjoindre, en 1992, trois autres maisons dejustice et du droit : Saint-Louis, L’Etang-Salé, et Cilaos.4 Les maisons de justice et du droit sont réparties sur quelques 2 512 km2 et surles ressorts de quatre tribunaux d’instance : ceux de Saint-Denis au nord, deSaint-Paul sur la côte ouest, de Saint-Benoît sur la côte est, et de Saint Pierre
2
L’expérience réunionnaise doit, comme en métropole, son essor àl’action de magistrats préoccupés de rétablir l’ordre public en sedotant d’un instrument qui fasse appel à la prévention et à larésolution amiable des conflits plutôt qu’à leur seul traitementpénal : le constat ayant été fait que de nombreux problèmes d’ordrepublic n’étaient que la forme exacerbée de litiges civils,antérieurs, non résolus.
Ce point constituera, du fait de l’intérêt qu’il revêt, notrepremier angle d’approche dans la présentation de cette expérience enminorant quelque peu l’aspect pénal (la médiation) pour privilégierl’aspect civil (la conciliation). Il paraît, en effet, essentiel des’attacher à décrire les rapports unissant les tribunaux d’instanceaux maisons de justice et du droit afin d’en faire ressortir unecomplémentarité qui va dans le sens du développement du règlementamiable des litiges, voulu par la récente réforme de la procédurecivile5.
De prime abord, les deux institutions apparaissent, à la Réunion,particulièrement concurrentes. La distinction entre tribunaux
au sud. Au sud, le tribunal de grande instance de Saint Pierre compte douze maisons de
justice et du droit, soit en suivant la côte, d’ouest en est, Saint Leu, L’Etang Salé,Saint-Louis, Saint-Pierre (Bois d’Olive et Terre-Sainte), Petite Ile, Saint-Joseph, Saint-Philippe,auxquelles il faut ajouter les maisons de justice et du droit des zones situées surles hauteurs dominant Saint-Pierre telles L’Entre-Deux, Le Tampon, ou enclavées telleCilaos (dans le cirque du même nom) et La Plaine des Cafres (zone de moyenne altitudecomprise entre le cirque de Cilaos et le volcan de la Fournaise).
Au nord, le Tribunal de grande instance de Saint-Denis en compte quinzeréparties sur les ressorts de trois tribunaux d’instance :
- quatre pour le Tribunal d’instance de Saint-Denis : Le Butor, Les Camélias, LaMontagne (sur les hauteurs de Saint-Denis) et Sainte-Marie (agglomération située à unedizaine de kilomètres à l’est de Saint-Denis) ;
- six autres maisons de justice et du droit situées sur le ressort du Tribunald’instance de Saint-Benoît, soit en suivant la côte du nord vers le sud, Saint-André,Bras-Panon, Saint-Benoît, et Sainte-Rose, et les maisons de justice et du droit de deuxzones enclavées : Salazie (dans le cirque du même nom) et la Plaine des Palmistes (zone demoyenne altitude comprise entre le cirque de Salazie et le volcan de laFournaise) ;
- enfin, cinq maisons de justice et du droit sur le ressort du Tribunald’instance de Saint-Paul lequel constituera le cadre privilégié de cette étude,soit Saint-Paul-ville, Saint-Paul-Plateau-Caillou, Saint-Paul-La Saline (soit trois maisons dejustice et du droit pour la seule commune de Saint-Paul, qui recouvre pratiquementtoute la zone touristique de l’Ile). Plus au nord, la commune du Port dispose d’unemaison du citoyen immergée dans un quartier dit «sensible». Enfin, tout au nord del’arrondissement la troisième commune, celle de La Possession a aussi sa maison dejustice et du droit.5 Loi n° 98-1163 du 18 décembre 1998 relative à l’accès au droit et à la résolutionamiable des conflits, et décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998. Voir les actes ducolloque organisé par la Cour d’appel de Rouen le 5 mai 2000 «Pour une procédurecivile rénovée : un an d’application du décret du 28 décembre 1998», Gazette du Palais,6 et 7 septembre 2000.
3
d’instance et maisons de justice et du droit est peu évidente pourbeaucoup d’usagers. Cette confusion s’explique par le fait que lesmaisons de justice et du droit n’ont pas été nécessairement créées làoù le déficit de services publics ou l’isolement appelaient uneprésence judiciaire. Les maisons de justice et du droit, présentesdans chaque commune, ne se limitent pas à compenser un maillagejudiciaire insuffisant. Elles permettent d’élargir la palette desréponses judiciaires ou de l’offre de service public envers lapopulation. De par cette complémentarité, que ne pouvaient ignorerles initiateurs du projet, et à la faveur du développement dessaisines directes par les usagers, les maisons de justice et du droitoffrent à maints égards l’apparence d’une voie alternative6. Cettecomplémentarité - que certains qualifieront de concurrence ou deredondance - des rôles et fonctions de chacune des deux institutionsnous est apparue frappante. Aussi, est-ce sous l’angle du dualismeinstitutionnel que nous appréhenderons ce phénomène, ce second angled’approche apparaissant tout aussi essentiel que le premier pourdéfinir les potentialités que recèle cette expérience.
Enfin, le succès des maisons de justice et du droit invite às’interroger sur l’éventualité d’un déficit d’image de la justiceétatique7, tout en soulignant la faiblesse d’un maillage judiciaireinapte à endiguer un besoin croissant de justice. Il démontre lemanque d’un «maillon» entre une institution judiciaire«technocratique» et une population qui semble appeler de ses vœuxl’institution d’un véritable juge de paix dont la crédibilité seraitd’autant plus forte qu’il serait lui-même un notable local d’abord aufait des préoccupations de chacun et non plus une institutionseulement préoccupée de dire une norme juridique, au surplus, souventbien mal comprise.
«Juge de paix» ou «maison de justice et du droit» ? Ce dernierintitulé apparaît, à maints égards, contestable. La difficulté àchoisir le terme le plus approprié n’enlève rien à l’intérêt del’expérience. Il souligne au contraire la vitalité et le dynamismed’une institution dont la légitimité a pu être contestée mais dontl’existence souligne la fonction essentielle reconnue au droit dansla régulation des rapports sociaux.
6 Cette observation est particulièrement vraie s’agissant de la circonscription dutribunal d’instance de Saint-Paul où, séparés d’à peine quelques centaines demètres, coexistent une justice professionnelle et une justice de médiateurs-conciliateurs bénévoles, si bien qu’il arrive fréquemment que les plaideurs seprésentent à la maison de justice et du droit en croyant aller au tribunal ou aucontraire au tribunal en croyant y trouver un médiateur-conciliateur.7 Voir sur ce point, Bernard Champion «le juge de quel droit ?», colloque tenu àl’Ecole Nationale de la Magistrature en décembre 1994 sur le thème «le juge :approche anthropologique d’une figure d’autorité».
4
Parce que les maisons de justice et du droit répondent à unbesoin, elles suscitent à leur tour une dynamique nouvelle :
- Un succès lié à un besoin de justice insatisfait (1ère partie) ;- Les perspectives nouvelles, nées de l’expérience des maisons de
justice et du droit (2ème partie).
Première partie - Un succès lié à un besoin de justice insatisfait.L’engouement suscité par les maisons de justice et du droit
s’explique par leur caractère apparemment «archaïque» (l’absence detechnicité apparente) par opposition au caractère «technocratique»des juridictions. Leur succès tient à un mode de fonctionnement qui,sur le plan individuel, consiste à traiter un problème humain ousocial dans sa globalité (section I) et qui , sur un plan pluscollectif s’avère plus apte que les juridictions à prendre enconsidération la spécificité du «terrain» (section II).
Section I - Le succès lié à la méthode : une «justice» qui abolitles barrières juridiques en prenant en compte la globalité d’unesituation.
Les maisons de justice et du droit s’impliquent dans larégulation des rapports sociaux en révélant un contentieux non traitépar la justice étatique ou en traitant le surplus d’un flux quisubmerge les juridictions existantes. Leur succès est d’abord unphénomène quantitatif, comme le montre le bilan de l’activité desmaisons de justice et du droit de la circonscription de Saint-Paulsur leurs cinq premières années de fonctionnement :
1994 1995 1996 1997 1998SAINT-PAUL VILLE 42 64 56 332 (28 saisines
judiciaires, 304saisines directes)
62 (18 saisinesjudiciaires, 44
saisines directes)SAINT-PAUL (LA SALINE) 103 (9 saisines
judiciaires, 94saisines directes)
22 (14 saisinesjudiciaires, 8
saisines directes)SAINT-PAUL (PLATEAU
CAILLOU)49 (5 saisinesjudiciaires, 44
saisines directes)
4 (dont 2 sursaisines directes)
BILAN DE L’ACTIVITÉ DESMJD DE LA COMMUNE DE
SAINT-PAUL
42 64 56 484 (42 saisinesjudiciaires, 442saisines directes)
88 (34 saisinesjudiciaires et 54saisines directes)
MJD DE LA COMMUNE DUPORT
21 48 19 417 (27 saisinesjudiciaires, 390
119 (12 saisinesjudiciaires et 107
5
saisines directes) saisines directes)MJD DE LA COMMUNE DE
LA POSSESSION18 12 6 51 (13 saisines
judiciaires, 38saisines directes)
65 (7 saisinesjudiciaires et 58saisines directes)
BILAN GÉNÉRAL DEL’ACTIVITÉ DES MJD DUTRIBUNAL D’INSTANCE DE
SAINT-PAUL
81 124 81 952 (82 saisines
judiciaires, et870 saisinesdirectes)
272 (53 saisines
judiciaires8 et 219saisines directes)
A titre de comparaison en 1998 alors même que les maisons dejustice et du droit de la circonscription de Saint Paul intervenaientdans 272 dossiers de conciliation, le tribunal d’instance de Saint-Paul avait rendu un peu plus de 800 jugements civils stricto sensu. Ilconvient de confronter ces chiffres au nombre extrêmement marginaldes appositions de formule exécutoire (la formule exécutoire n’a étédemandée qu’à 13 reprises, et n’a été apposée que sur 6 procès-verbaux d’accords9).
Plus éloquents encore sont les chiffres de l’année 1997. Cetteannée-là le tribunal de Saint-Paul avait rendu un millier dejugements civils, les maisons de justice et du droit de lacirconscription avaient été saisies de 952 demandes de conciliation(870 sur saisine directe, et 82 sur réquisition du parquet).
Ces données chiffrées soulignent le taux important des saisinesinitiées par les «plaideurs» eux-mêmes (ce qui apparaît dans notretableau sous l’intitulé «saisines directes») et non plus par leparquet ou le tribunal. Cela montre que les maisons de justice et dudroit obéissent, à peine quelques années après leur création, à unedynamique propre en révélant un contentieux sous-jacent.
Comme l’illustrent ces chiffres, les maisons de justice et dudroit ont été reçues favorablement en offrant au surplus l’image(selon l’expression courante) d’une «justice pays» dont labanalisation rejoint les aspirations d’une société de plus en plusmarquée par une attitude consumériste dans son rapport à la justice.
Leur succès s’explique donc par leur indéniable attrait pour denombreux plaideurs, lequel tient à la démarche des médiateurs-conciliateurs qui consiste à aborder les problèmes posés dans leur
8 Jusqu’au début de l’année 1998 les saisines judiciaires provenaient exclusivementdu parquet.9 Sur ces 13 demandes d’apposition de la formule exécutoire, soulignons que 4d’entre elles seront rejetées pour incompétence (la conciliation portant sur desquestions touchant au statut des personnes ou au droit de la famille) dans uncinquième dossier le signataire de l’accord a dénoncé les engagements souscritsdevant le conciliateur, enfin dans deux autres cas les parties n’ont pas déféré auxconvocations. Les demandes d’apposition de la formule exécutoire ont été tout aussiexceptionnelles pour l’année 1999.
6
globalité et non point à répondre à une question clairement définie.Cette approche supplée certaines carences de l’usager : le médiateur-conciliateur après avoir écouté, cherche à percevoir ce que lejusticiable potentiel a parfois du mal à exprimer. C’est cetteproximité, cette capacité d’écoute et, finalement, de conseil etd’orientation qui apparaissent déterminantes dans l’essor des maisonsde justice et du droit.
De plus, cette forme de justice répond aux attentes d’un«consommateur» qui y voit le moyen de satisfaire un besoin immédiat,et d’atteindre un résultat plus rapidement et plus simplement, mêmesi la sécurité juridique peut en pâtir.
Enfin, les maisons de justice et du droit apparaissent sansconteste adaptées à une société structurée en communautés. Lagéographie même milite en ce sens : les tribunaux d’instance sesituent sur le littoral au plus près d’une population où laproportion d’origine européenne est la plus forte. La proximitéculturelle conforte la proximité géographique : la situation estquasi caricaturale à Saint-Paul avec l’opposition entre les stationsbalnéaires de Boucan-Canot et de Saint-Gilles et les «hauts» peuplésde Tamouls, de Métis et d’Africains. Les «hauts» de Saint-Paulmajoritairement peuplés de créolophones, se trouvent distants parfoisde 30 à 40 km du tribunal d’instance s’agissant des lieux les pluséloignés ou enclavés (les «écarts»). Les maisons de justice et dudroit de La Saline, et de Plateau-Caillou constituent de ce point devue une avancée non négligeable en direction de populations souventlaissées à part de l’essor économique de l’île. A côté de cela, lesmaisons de justice et du droit de La Possession et surtout du Port sesituent dans des zones d’urbanisation récente et traitent desdifficultés liées à l’inadaptation à la vie urbaine d’une populationrestée rurale dans ses habitudes puisque venue des «hauts» pour êtrelogée dans des habitations à loyer modéré dont la construction a étéle moteur du développement de ces nouvelles zones urbaines. Cespopulations qui ont gardé l’habitude, par exemple, d’élever desanimaux domestiques, et de nombreux autres traits d’un mode de vieinadapté au confinement des villes, posent des problèmes fréquents devoisinage (tapage nocturne et diurne, incivilités chez les plusjeunes...) outre les problèmes liés à la nécessité de payer désormaisce qui autrefois était gratuit (eau, loyer). La politique dedéveloppement, axée sur l’obtention de subventions toujours plusimportantes en provenance de l’Etat ou de l’Union Européenne, a faitde ces populations le prétexte, voire les otages, d’un «progrès»social dont beaucoup dénoncent les effets pervers. Les maisons dejustice et du droit, dans ce contexte, contribuent à tempérer desrapports sociaux rendus difficiles du fait de l’inadaptation d’unepartie de la population à une urbanisation qui ne répond à aucun
7
projet économique ou social : le chômage disséminé dans les hauts aété simplement déplacé pour être concentré dans des poches depauvreté urbaine.
Impliquées dans la régulation des rapports sociaux au quotidien,les maisons de justice sont un lieu «à tout faire», sorte deconfessionnal social, caisse de résonance, gare de tri d’où partentdes requêtes à destination de l’institution judiciaire, lorsque aucuntraitement amiable n’a été possible.
En offrant l’image d’une justice «pays» (comme il est coutumierde le dire à la Réunion) cette préfiguration d’une justice«citoyenne», qui se situe en amont de la justice étatique participed’une fonction d’explication, voire d’éducation. Elle souligne lefait que la justice étatique est parfois trop rigide pour êtreréellement accessible à tous. Le déficit d’image de cette justiceofficielle est un facteur incontestable du succès des maisons dejustice et du droit, plébiscitées quotidiennement par ceux quipréfèrent saisir les «juges-pays» de la maison de justice et du droitplutôt que les magistrats professionnels du tribunal. Que de fois, legreffe du tribunal de Saint-Paul a dû indiquer le chemin à ceux quise présentaient au tribunal pour présenter une requête au médiateur-conciliateur de la maison de justice et du droit, que de fois laréaction naturelle chez le justiciable a été de vouloir éviter lecontact avec le tribunal d’instance pour aller confier son désarroi àceux qui, à 300 mètres de là, officiaient au sein de la maison dejustice et du droit dans un local de même standing et avec un accueiltout aussi dépouillé de forme et tout aussi peu distant.
Ce constat renvoie aux propos du Recteur Alliot qui constataitque l’une des fiertés des paysans Serer10 qu’il avait rencontrés auSénégal était, au soir de leur existence, de pouvoir dire qu’ilsn’avaient jamais eu, leur vie durant, à entrer dans un Palais dejustice. Ce qui n’excluait pas qu’ils aient jamais eu de litiges àsoumettre. Simplement, ils n’avaient jamais eu recours aux modescontentieux «modernes» de règlement de leurs différends, préférantselon l’expression d’Etienne Le Roy «régler les problèmes dans leventre du village»11. On peut y voir certes le rejet du droit moderneau profit du droit traditionnel dans le cas des populationsafricaines. On peut y voir, dans le cas réunionnais, une expressionde défiance à l’égard d’une justice perçue, d’abord, commel’instrument d’un Etat lointain (le discours du Parti CommunisteRéunionnais fustige quotidiennement le «néocolonialisme»qu’incarnerait selon lui l’appareil d’Etat).
10 Etienne et Jacqueline Le Roy (dir.), Un passeur entre les mondes, Publications de laSorbonne, 2000.11 Op. cit.
8
La prise en compte d’une situation individuelle dans sa globalitécivile et pénale (comme un fait social cohérent) constitue lefondement même de l’expérience réunionnaise des maisons de justice etdu droit. Cette approche globale, au-delà de certaines justificationspratiques,12 a même été perçue comme un moyen détourné par le parquetd’intervenir dans le domaine civil à une époque où les maisons dejustice et du droit étaient exclusivement placées sous la tutelle dece dernier.
Mais, le succès des maisons de justice et du droit n’est passeulement lié à cette démarche des médiateurs-conciliateurs, il tientaussi à la difficulté de certains justiciables à formuler leursdemandes. Il existe, sans conteste, un terrain favorable poursemblable expérience dans une île qui n’en finit pas de panser lesséquelles de son passé esclavagiste.
Section II - Un succès lié à une meilleure prise en compte desspécificités du «terrain».
L’essor des maisons de justice et du droit se nourrit du décalageréel ou supposé entre un système judiciaire technocratique et lesvaleurs de la société créole. Les maisons de justice et du droitpeuvent, dans ce contexte, apporter une réponse judiciaire modulableen fonction des spécificités locales, pour constituer une sorte dejustice «tout-terrain».
Confrontées à une société fondée sur la coexistence de plusieursgroupes ethniques, les maisons de justice et du droit paraissent, apriori, plus perméables et respectueuses du fort sentimentcommunautaire qui anime les composantes de la société réunionnaise,au surplus marquées par de véritables solidarités familiales. Carelles préservent la liberté du justiciable d’accepter ou de refuserle compromis. Elles offrent seulement un lieu d’écoute et derapprochement qui ne dépossède pas le justiciable (préoccupé de nepas voir un tiers s’ingérer dans sa vie privée) de la maîtrise de sonaffaire.
12 Le lien entre ces deux aspects s’imposait aussi pour des raisons tenant à laprise en charge budgétaire des frais de justice liés à l’activité des médiateurs-conciliateurs. Seules les actions de médiation pénale sont indemnisées, tandis quele volet civil de l’activité des médiateurs-conciliateurs ne l’est pas. Lerèglement du conflit pénal (seul rémunéré) passant d’abord par la résolution dulitige civil et par une conciliation non rémunérée, la scission entre ces deuxvolets (civil et pénal) décidée à la fin de l’année 1998 afin de rapprocherl’expérience réunionnaise du modèle métropolitain risque d’entraver à terme ledéveloppement de l’expérience. Car il faut bien l’admettre, les bonnes volontéspour traiter le contentieux pénal n’ont aujourd’hui aucune incitation (financière)à poursuivre leur action médiatrice dans le domaine civil.
9
Le rôle des maisons de justice et du droit à l'île de la Réunionapparaît, en outre, intimement lié à la barrière linguistique queconstitue le Français (ou le Créole) pour une partie de la populationqui s'est longtemps trouvée reléguée en marge du «pays légal » et desservices publics.
Alors que dans les colonies espagnoles, les esclaves amenés engrand nombre au début du XIXème siècle apprendront l’Espagnol dans leschamps de canne à sucre, au même moment dans les possessionsfrançaises la langue parlée dans le monde du travail, et jusque dansla «case» du planteur, était le Créole. La Réunion a donc subil’implantation des institutions de la République sans pour autant quela francisation de toutes les couches de la société soit une réalitétangible13. Le phénomène n’est pas sans conséquences quant à l’accès àcertains services publics, et quant à l’exercice effectif de certainsdroits. Enfin, la marginalisation du Créole14 a contribué à maintenirun fort taux d’analphabétisme, sans pour autant que disparaisse cetteculture devenue pour beaucoup un refuge, mais aussi un handicap dansune société qui tient le Français pour seule langue officielle. Dèslors, comment ne pas voir un lien entre la résistance àl'assimilation linguistique par rapport à la langue de la métropole,et la résistance à l'adoption des valeurs culturelles ou encore desnormes juridiques ? Faut-il s'étonner de voir une partie de lapopulation exclue par sa langue de l'accès aux services publics seréfugier dans des réponses ou des comportements en marge de nosnormes ?
De la même façon qu'existe une pratique linguistique perçue commerelevant d’un statut social supérieur et une pratique linguistiqueattachée aux rapports intra-communautaires ou intra-familiaux, onpeut être tenté de voir dans le succès des maisons de justice et dudroit l’incontournable nécessité d’une dualité de mode de règlementdes conflits. L’institution judiciaire consacrant un mode «classique»de règlement des conflits où l’Etat monopolise et «confisque» ledroit de décider ; tandis qu’un mode de règlement informel desconflits, intéressant plus particulièrement certains groupesethniques verrait sa consécration dans l’institution d’une sorte de« para-justice » où le plaideur conserverait la maîtrise de son
13 A la différence de la colonisation espagnole : l'Espagnol n'a pas généré deCréole. Il existe un Créole français en Haïti, mais n'existe pas de Créole espagnolen République Dominicaine. De la même façon alors que n'existe pas de Créoleespagnol à Cuba il existe un Créole anglais à la Jamaïque. La généralisation del'Espagnol est le fruit d’une volonté d’hispanisation qui est une constante dans lacolonisation espagnole qui la distingue de toutes les autres, française ouanglaise.14 Jusqu’à l’année 2000, le Créole ne bénéficiait pas du dispositif instauré par laloi Deixonne (loi n° 51-46 du 11 janvier 1951) relative aux « enseignements deslangues et dialectes régionaux ».
10
dossier. Les maisons de justice du droit, avec l’institution de lamédiation pénale, renouent avec une logique de justice privée,puisque les parties à un litige civil débouchant sur un comportementpénalement répréhensible peuvent en quelque sorte transiger sous lecontrôle d’un médiateur mandaté par le parquet.
Certes, cette présentation dualiste peut paraître bienartificielle si l’on considère que l’action des maisons de justice etdu droit les situe en amont de tout processus judiciaire.
Pourtant, un fait demeure qui légitime le rôle à la foisspécifique et complémentaire de cette «para-justice» : c’estprécisément parce que certains contentieux civils ne sont pas traitésque ces litiges débouchent sur des attitudes délinquantes. Lesmaisons de justice et du droit répondent donc à un besoin inassouvide justice soit par réticence du justiciable à saisir les tribunaux,soit par incapacité de ces derniers à faire face à une demandecroissante, soit enfin, par inadéquation des méthodes judiciairesface à l’attitude consumériste du justiciable. Ce dernier aspectapparaît essentiel. La popularité des maisons de justice et du droittient à la spécificité de leur approche : elles fonctionnent comme un«généraliste», à l’instar du notable qui autrefois écoutait pourtenter de désamorcer le contentieux. Les maisons de justice et dudroit sont devenues un lieu de médiation pénale, parce qu’elles sontun lieu d’écoute destiné à rechercher la cause d’un comportementdéviant. Et ce, que le différend intéresse le droit pénal ou le droitcivil, qu’il intéresse l’ordre public ou seulement les conceptionsmorales des uns ou des autres ou les valeurs partagées par telle outelle communauté particulière.
Quel que soit le qualificatif que l’on retiendra - «justicecommunautaire», «justice de paix» ou «justice tout-terrain» - lesmaisons de justice et du droit remplissent une fonction qui complètela gamme des réponses offertes par les juridictions, partout oùs’affirme la tendance à la «territorialisation» du droit.
La place qu’occupent les premières maisons de justice et du droità la Réunion, une décennie à peine après leur apparition, pose laquestion de savoir si elles ne remplissent pas la fonction à la foissymbolique et pratique que remplit ailleurs la justice «coutumière»,et si au-delà d’un nouveau mode de traitement des litiges cetteinstitution ne constitue pas l'amorce d'une ouverture de notresystème judiciaire vers une justice communautaire.
Deuxième partie - Les perspectives nouvelles, nées de l’expériencedes maisons de justice et du droit.
11
L’enracinement des maisons de justice et du droit dans le terreauréunionnais semble acquis, leur existence même souligne la nécessitéd’adapter les modes de fonctionnement du monde judiciaire, enreconnaissant une place plus large aux modes alternatifs de règlementdes confits. Mais le développement d’un véritable système alternatifde règlement des conflits qui n’en est encore qu’à ses débuts(section I), suppose d’assouplir les règles de procédures afin deménager des «passerelles» entre tribunaux et maisons de justice et dudroit et d’élaborer des règles afin de mieux coordonner leursinterventions respectives (section II).
Section I - La préfiguration d’un système alternatif auxdispositifs classiques.
Les maisons de justice et du droit soulignent la nécessité d’uneoffre de services concurrents fondée sur la capacité des juridictionsà déléguer certaines tâches et à entrer dans certains partenariats.
§ 1 - La nécessité pour la justice de «déléguer» certainesmissions.
De façon générale, les maisons de justice et du droits’inscrivent dans une logique d’évitement des voies contentieuses :en témoignent, tout à la fois, le nombre de dossiers qu’ellestraitent et le caractère marginal du recours à l’apposition de laformule exécutoire sur les procès-verbaux d’accord, que les partiesperçoivent comme une démarche ajoutant inutilement à leur effort deconciliation (en fait, elles n’y recourent que lorsqu’ellespressentent ou éprouvent déjà une difficulté dans l’exécution desengagements pris devant le conciliateur)15. Confier à des «délégués»du procureur certaines fonctions du parquet démultiplie l’action decelui-ci, mais confier en même temps des missions de conciliationcivile à ces mêmes personnes permet aussi de prévenir le contentieuxcivil.
Dans le domaine pénal, l’habitude de «déléguer» est désormais unmode normal de fonctionnement, avec le mécanisme du classement souscondition (médiation, réparation s’agissant des délinquants mineurs,rappel à la loi ou composition pénale)16. L’idée est parfaitementadmise que l’institution judiciaire puisse déléguer certainesfonctions à la société civile sans trahir sa mission. Cette approche
15 Voir, supra, note n° 8.16 Voir Code de procédure pénale, articles 41-1, 41-2 et 41-3 (issus de la loi n°99-515 du 23 juin 1999 renforçant l’efficacité de la procédure pénale, J.O. 24 juin1999, p. 9247).
12
nouvelle, au niveau des parquets, explique le rôle précurseur jouépar ces derniers dans les maisons de justice et du droit. Un rôlesouvent mal compris par les magistrats du siège.
Dans le domaine civil, une évolution semblable se dessineprogressivement de façon récente et plus modeste : la vocation que sesont forgées les maisons de justice et du droit à la Réunion estconforme à la philosophie de la loi n° 98-1163 du 18 décembre 1998relative à l’accès au droit et à la résolution amiable des conflits.La mission centrale des maisons de justice et du droit, à l’Ile de laRéunion, consiste dans l’information du public sur les droits. Cerôle est d’autant plus essentiel, qu’il s’exprime dans la langue desgens et non dans celle des institutions.
C’est à l’occasion de sa mission d’information que le médiateur-conciliateur peut souligner la nocivité sociale d’un comportement, etson caractère répréhensible. La prise de conscience de la normeparticipe de la réparation de l’infraction au plan pénal. De même, lerappel à la loi civile constitue l’amorce d’une prise de conscience,participant à la définition d’un modus vivendi en cas de rapports devoisinage troublés par des problèmes de mitoyenneté, de hauteur dehaies ou d’arbustes, d’empiétements, ou toutes autres difficultésqui, certes de minime importance, constituent la source de nombreuxconflits civils (en raison de l’exiguïté des parcelles, et de lapromiscuité inhérente à la densité des sites d’habitation) auxrépercussions parfois désastreuses au plan pénal.
De ce fait, les maisons de justice et du droit oeuvrent àl’apaisement de rapports sociaux susceptibles d’évoluerdangereusement. Certes, cette aide est «juridique» et non pas«judiciaire» pour reprendre la distinction proposée par le ProfesseurRené David dans sa préface aux travaux de l’Institut UniversitaireEuropéen.17 Avant même que ne se cristallise un contentieux, lesmédiateurs-conciliateurs peuvent apporter une information sur lesdroits et devoirs des uns et des autres : faire oeuvre de pédagogie.C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la proximité géographique dela maison de justice et du droit de Saint-Paul et du tribunald’instance loin de constituer un handicap souligne la complémentaritédu rôle de chacun. La maison de justice et du droit oriente vers letribunal les personnes qui ont défini une demande claire et préciseaprès avoir vainement tenté une conciliation. Inversement, lapersonne chargée de «l’accueil» au tribunal renvoie vers la maison dejustice et du droit les personnes qui se présentent en alléguantd’une situation qui ne trouve pas de traduction immédiate en termesde contentieux. La mission d’écoute, d’information, d’orientation, etla tentative de rapprochement des points de vue constitue un domaine17 Mauro Cappelletti et René David, Accès à la Justice et Etat-Providence, Economica,1984.
13
qui pour relever de l’accueil dans les juridictions s’apparente à uneconsultation sur les droits de chacun dans une phase pré-contentieuse. C’est là une mission que les juridictions, sollicitéespar le traitement des contentieux dont elles sont déjà saisies, n’ontplus guère le temps d’assumer.
L’action des maisons de justice et du droit, soit prépare etprécède la saisine de la juridiction (ce qui relève de la fonctiond’accueil traditionnellement assurée par les juridictions) soit, aucontraire, favorise l’évitement du contentieux en offrant dessolutions qui rendent inutiles le recours aux tribunaux. En outre,lorsque l’information sur les droits n’a pas permis de ramener lecalme ou lorsque la conciliation a échoué, l’action du médiateur-conciliateur n’aura pas été inutile : les procès-verbaux constatantl’échec de la conciliation constituent souvent des élémentspertinents pour l’information du tribunal.
§ 2 - Les maisons de justice et du droit soulignent la nécessitéde relais sociaux.
La réussite des maisons de justice et du droit à la Réunionsouligne la nécessité pour la justice de se doter d’instrumentsfavorisant une médiation culturelle entre deux modèles. On pourraitfaire la même observation s’agissant de certains pays africains oùl’on constate le rejet du droit «moderne» par la société autochtone18.Cette question intéresse aussi la métropole au regard du rôle quepourraient jouer les maisons de justice du droit à l'égard decommunautés immigrées d'Afrique qui pâtissent à la fois d’être tropdécalées par rapport à notre modèle culturel pour avoir recours à lajustice officielle, mais aussi de ne pouvoir recourir à des modes derèglement des conflits reposant sur l'autorité des notables demeurésau pays.
Le fonctionnement, au quotidien, des maisons de justice et dudroit et des tribunaux d’instance souligne une première évidence :tout d’abord, le traitement contentieux ne prend en compte qu’unepartie de la réalité juridique, et lorsque l’on parle de besoin dedroit cela ne signifie pas nécessairement un besoin de réponsesjudiciaires. La seule façon de satisfaire ce besoin de droit consisteà doter l’appareil judiciaire de relais, de partenaires et dans sonrapport aux communautés (qui existent à la Réunion comme dans lesvilles en France métropolitaine) de médiateurs culturels, puisqueleur rôle est d’informer en accomplissant un véritable travaild’éducation civique. Les maisons de justice et du droit sont donc,
18 Voir Régis Lafargue, L’Etat de droit et le nouveau code des personnes et de lafamille en Centrafrique, Revue Juridique et Politique, Indépendance et Coopération, n°1, 1997, p.49.
14
non seulement, des lieux de diagnostic d’une difficulté (et doncd’accueil et d’orientation vers les juridictions) mais, aussi, despédagogues de la vie en société remplissant le rôle autrefois jouépar les notables ou les «anciens» dans les sociétés traditionnelles.
Les médiateurs-conciliateurs incarnent une «para-justice»informelle et gratuite. Ils réalisent le rêve impossible d’unejustice au quotidien qui parlerait le langage du citoyen et surtoutqui n’engagerait à rien, une sorte de «galop d’essai» ou de procèsvirtuel sans conséquences en cas d’échec à trouver un accord. Et dece point de vue on ne peut faire l’amalgame en mettant sur un mêmeplan la conciliation tentée par le juge civil et celle mise en oeuvrepar le conciliateur de la maison de justice et du droit : leurssignifications respectives sont très différentes. Cette dernière estun vrai rapprochement, fondé sur la bonne volonté des uns et desautres, car réalisée sans perspective encore bien précise d’unprocès. Il s’agit d’une conciliation libérée de toute crainte liée àl’institution judiciaire. A l’inverse, la conciliation que le jugeréalise lui-même à l’audience ou qu’il confie à un conciliateur enrenvoyant l’affaire à une prochaine audience, constitue un épisoded’un traitement judiciaire, soit qu’elle soit le préalable à unedécision de justice, soit qu’elle constitue un incident d’instance,avec toute la tension psychologique qui s’attache à l’ultime chanceofferte aux parties d’éviter l’issue contentieuse.
La seconde fonction qu’incarnent les maisons de justice et dudroit est un rôle d’écoute et de négociation en dehors de touteperspective d’un procès, voire en marge de tout dispositif officielde règlement du conflit. Cela peut paraître contradictoire avecl’idée que le citoyen a besoin de réponses à ses difficultés. Pourautant, dans bien des cas, il cherche moins une décision qu’unarrangement officieux dont le conciliateur n’a été que le témoin,dont il a pu être le maître d’œuvre, mais dont il ne sera jamais lecenseur, ni a fortiori le garant. En témoigne la rareté du recours àl’apposition de la formule exécutoire. Faut-il y voir une défiancevis-à-vis de l’institution judiciaire ? Faut-il y voir plutôt la foidans la valeur de la parole donnée dans une société rurale où lesadversaires se connaissent et cohabitent au quotidien ? On pourraremarquer que dans les procédures commerciales, aussi, parce que lesparties se connaissent elles souhaitent éviter des solutions troptranchées qui constitueraient un obstacle à la poursuite de leursrapports commerciaux.
Les maisons de justice et du droit traduisent donc le besoin detrouver une alternative aux solutions officielles non pas seulementen raison de leur lourdeur ou de l’éloignement géographique,arguments qui ne se vérifient pas dans de nombreux cas, mais aussi dufait de la volonté de trouver des solutions qui lient le moins
15
possible. Le désir de certains plaideurs est de trouver dans lesmaisons de justice et du droit un organe de négociation permanent ycompris pour tenter d’atténuer les effets d’une décision devenuedéfinitive19. C’est la raison pour laquelle nous utilisons le terme desystème para-judiciaire pour désigner les maisons de justice et dudroit à la Réunion, qui certes sont nombreuses mais dont la proximitégéographique ne constitue pas l’atout décisif, puisque la maison dejustice et du droit de Saint-Paul-ville est celle qui draine, sur lacôte ouest, le plus de plaideurs.
Les maisons de justice et du droit incarnent un dispositif quidoit demeurer suffisamment en marge des tribunaux pour conserver sacrédibilité. Elles incarnent la vertu d’une justice dépouillée del’autorité qui s’attache à l’action de toute institution étatique, etl’idée d’un processus dans lequel le citoyen conserve la maîtrise deses intérêts au point de pouvoir y mettre fin quand bon lui semble.
L’attitude du justiciable montre que, par certains aspects, lesmaisons de justice du droit pourraient constituer un ersatz de justicetraditionnelle. Elles traduisent, à tout le moins, l'ouverture de nosinstitutions, à défaut de notre système judiciaire, vers une sociétépluriculturelle, comme c’est le cas (certes, sous d’autres formes) enNouvelle-Calédonie, et pour quelques temps encore à Mayotte20.
Mais pour développer des partenariats, encore faut-il pouvoirassouplir et aménager les règles de procédure.
Section II – La nécessité de règles permettant de coordonnerl’action des tribunaux et des maisons de justice et du droit.
Ainsi que le soulignent les médiateurs-conciliateurs eux-mêmes21
l’exigence d’une justice rapide, sans être sommaire, se renforce à
19 C’est ainsi qu’à la fin de l’année 1998 le conciliateur de Plateau-Caillou(localité située à 3 km de Saint-Paul) me téléphonait pour me proposer de recevoirdes plaideurs qui souhaitaient négocier. Il exposait que la Cour d’appel avaittranché un litige mais que néanmoins l’une des parties souhaitait entamer unenégociation sous l’égide du conciliateur de la maison de justice et du droit.L’anecdote montre bien que certains plaideurs perçoivent la maison de justice et dudroit comme un système alternatif aux juridictions.20 Le statut personnel particulier applicable à Mayotte a été réaffirmé par la Courde cassation dans un arrêt du 25 février 1997 (n° 67) qui affirme en même tempsl’applicabilité sur ce territoire de la République du Droit musulman. Ceparticularisme juridique, qu’incarne la juridiction du Cadi, est en voie de remiseen cause du fait de la modification statutaire qui pourrait voir ladépartementalisation de l’île imposer un principe d’intégration juridique.21 Voir, notamment, l’éloquent témoignage donné au Journal de l’Ile de la Réunion par MM.Jean VINCENT-DOLOR, médiateur-conciliateur à la maison de justice et du droit deSaint-Paul (ville) et Gérard BRUNEAU, médiateur-conciliateur à celle du Port, le 16mai 1998, sous le titre «La Réunion, département pilote en matière de prévention :Une matinée ordinaire à la maison de médiation».
16
mesure que le contentieux explose22. Les maisons de justice et dudroit seraient-elles ces sortes de «boutiques» du droit où l’ontrouve la solution à son problème avec un minimum de démarches ? Onpourrait être tenté de le penser lorsque l’on constate la demande dupublic envers les maisons de justice et du droit dans des domainesqui excèdent le cadre de leurs compétences (§ 1) et lorsquel’exigence du public pousse progressivement vers l’érosion duformalisme qui caractérise la procédure judiciaire (§ 2).
§ 1 - La demande du public pousse les maisons de justice et dudroit à élargir leur cadre de compétence.
La demande de conciliation est importante et s’accommode mal desrègles qui excluent le contentieux familial du domaine d’interventiondes conciliateurs. A l’occasion, on a même cherché à leur faireassumer une mission de recours permanent y compris contre desdécisions de justice passées en force de chose jugée.
Cette aspiration du justiciable à disposer d’un juge de paix «àtout faire» reste dans la logique qui a prévalu lors du lancement del’expérience. Le même personnage, à la fois médiateur etconciliateur, saisi au pénal de problèmes familiaux (non-représentation d’enfant, non-paiement de pensions alimentaires,violences conjugales ou violences à enfants...) est pratiquement misen demeure par les victimes ou encore par l’auteur de l’infraction detrouver un règlement du litige à sa source c’est à dire sur le plancivil (réaménagement des mesures accessoires au divorce ouorganisation de la séparation des concubins). Le règlement du litigecivil conditionne, là encore, la cessation de l’infraction ou sonnon-renouvellement. Dès lors, c’est la logique même de l’institution,à savoir le traitement global, qui pousse à s’évader des contraintesposées par les règles attributives de compétence qui apparaissentinadaptées aux attentes des victimes de l’infraction (convoquées pourune tentative de règlement à la demande du parquet) comme auxmédiateurs mandatés à cet effet. Les uns et les autres réunis pourtenter de sortir de l’impasse sont contraints, dans bien des cas, deconstater l’inutilité de cette confrontation autrement que pourconvenir de l’urgence à saisir le juge aux affaires familiales.
Cette incompétence ratione materiae du médiateur-conciliateur porteatteinte au crédit de l’institution que le plaideur apprécie à l’aunede sa capacité à éviter la saisine d’une juridiction. Rien d’étonnantalors à constater que les règles d’ordre public puissent parfois êtreignorées par des médiateurs-conciliateurs oeuvrant, dans l’urgence,au rétablissement effectif de l’ordre public. Là s’arrête la22 Environ 1300 jugements civils rendus par le Tribunal d’instance de Saint-Paul en1999.
17
collaboration entre les juges destinataires des procès-verbauxd’accord et les maisons de justice et du droit. Les premiers nepeuvent cautionner ce qui constitue une «dérive», tant que la loin’aura pas admis une procédure qui, par exemple, permettrait dans undélai limité à de tels accords de s’imposer jusqu’à leur entérinementéventuel par le juge aux affaires familiales. L’instauration d’unjuge de paix pour traiter certaines urgences familiales ne serait-elle pas adaptée à une demande sociale croissante de réponsessimples, souples et rapides, suscitée par l’explosion du contentieuxné du phénomène des familles recomposées ?
Certes, l’article 1441-4 du N.C.P.C.(Décret du 28 décembre 1998)permet depuis peu de demander au Président du Tribunal de grandeinstance de donner force exécutoire à des solutionstransactionnelles, en permettant de régulariser, a posteriori, desaccords qui pourraient avoir été trouvés devant un avocat ou devantun médiateur-conciliateur. Mais encore faudrait-il que cettedisposition ne demeure pas l’exception comme en matière d’appositionde formule exécutoire par le juge d’instance. Par ailleurs, ladualité de procédures (apposition de la formule exécutoire par lejuge d’instance en toutes matières et par le président du Tribunal degrande instance en matière de contentieux familial) ne facilite pasla compréhension par le citoyen du fonctionnement de l’institutionjudiciaire, la seconde éloigne géographiquement l’usager de celui quipeut apparaître comme son «juge naturel», à savoir le pôle constituéautour du juge d’instance agissant en partenariat avec lesmédiateurs-conciliateurs.
En définitive l’expérience s’avère quelque peu paradoxale : lesmaisons de justice et du droit conçues comme un moyen de fairereculer le « non-droit » et les « non-réponses » peuvent susciter despratiques déviantes (susceptibles d’être qualifiées de « non-droit »)nées de la volonté de certains justiciables d’éviter les appareilsjuridictionnels jugés trop lourds et trop lointains. Aussi ne faut-ilpas s’étonner de voir de nombreux magistrats professionnels contesterla légitimité de cette expérience à laquelle ils imputent lebrouillage des rôles et des procédures, à savoir un effet contraire àla pédagogie de la loi qui devait constituer la mission centrale desmaisons de justice et du droit.
Par ailleurs, le fait même de devoir saisir un magistratprofessionnel, aux fins d’entériner un accord constitue un obstaclepsychologique difficilement surmontable pour ceux des justiciablesque la barrière linguistique ou sociale relègue toujours en marge desjuridictions civiles et que seules les maisons de justice et du droitparviennent à atteindre.
18
Pour se conformer aux textes actuels, sauf à voir se développereffectivement le recours à l’article 1441-4 du N.C.P.C., les maisonsde justice et du droit devraient fonctionner en développant uncurieux mouvement d’attraction puis de rejet. Elles attireraient àelles le contentieux familial, le cerneraient, puis renverraient àd’autres le soin d’en trouver la solution, alors même que lejusticiable aurait vu la résolution de son différend à portée demain. En agissant ainsi elles frustreraient les espoirs mis dans unesolution immédiate du litige. Elles renverraient bien desjusticiables à la conscience de leur marginalité : ceux pour lesquelsla saisine du juge reste encore une démarche difficile sinonimpensable.
Refuser pour des motifs juridiques d’officialiser un accord,voire imposer un traitement judiciaire pour en vérifier larégularité, serait perçu comme une façon de dénier aux parties ledroit de s’accorder dans le domaine le plus sensible de la viesociale à la Réunion : le fonctionnement et l’équilibre de la viefamiliale. Les maisons de justice et du droit trahiraient leur rôle àfrustrer le justiciable d’un accord qu’il espère, et leconforteraient dans ses comportements asociaux. Le discrédit desmaisons de justice et du droit ne manquerait pas de rejaillir sur lajustice dans son ensemble. Car les instances judiciaires ne peuventsusciter impunément un espoir de conciliation tout en refusantensuite de reconnaître - de façon quasi-automatique - la force desaccords conclus dans ce cadre.
§ 2 - L’exigence du public pousse vers une «érosion» duformalisme judiciaire.
Conscient de la nécessité de «former» les conciliateurs (peuaprès mon arrivée en mars 1998 à Saint Paul) je les invitais àassister à tour de rôle aux audiences civiles. L’audience s’ouvraitsur l’invitation des parties, qui le souhaitaient, à se rapprocher duconciliateur présent.
Cette invitation permettait, notamment, de redéfinir les rôlesrespectifs du tribunal et de la maison de justice et du droit, que laproximité géographique et un manque de décorum communément partagéfaisaient souvent confondre.
Cette présence physique du médiateur-conciliateur à l’audienceoffrait une première opportunité de collaboration entre la maison dejustice et du droit et le juge d’instance. Lorsqu’à l’audience lesparties saisissaient le conciliateur pour une tentative deconciliation, le tribunal en prenait acte et renvoyait l’affaire àquinzaine pour laisser le temps aux parties de rechercher un accordultime avec l’aide du conciliateur. Cette procédure, aucun texte ne
19
la prévoyait avant décembre 1998. Il suffisait pourtant de prendreacte de la volonté des parties de porter l’affaire dont était saisile tribunal devant le médiateur-conciliateur.
La réforme de la procédure civile, liée à la loi du 18 décembre1998 institutionnalisant23 les maisons de justice et du droit, n’afait que conforter cette pratique. Car, le décret du 22 juillet 1996ne permettait au juge d’instance de désigner un conciliateur que dansl’hypothèse d’une saisine aux fins de tentative préalable deconciliation. Il a fallu attendre les articles 24 et 26 du décret du28 décembre 1998 pour voir cette possibilité étendue à toutes lesprocédures devant le tribunal d’instance, hormis les procédures deréféré. Désormais si la tentative de conciliation peut être menéecomme par le passé par le juge d’instance « Elle peut également être conduitepar un conciliateur de justice désigné sans formalités particulières par le juge avec l’accorddes parties ».24
L’autre occasion de collaboration entre le conciliateur et lejuge d’instance (qui n’apparaît pas explicitement dans les textes)résulte de la possibilité d’utiliser un accord signé devant leconciliateur à l’appui d’une procédure d’injonction de payer, ce quipermet en partie de compenser le faible recours à la procédured’apposition de la formule exécutoire. De plus, il est fréquent quel’accord ait été négocié entre les deux parties présentes mais qu’ilait été signé par les deux parties comparaissant séparément àquelques heures ou jours d’intervalle, si bien qu’il y a souvent loinde l’engagement souscrit à sa réalisation, et même de l’engagementsouscrit oralement à sa formalisation par écrit. En cas de difficultépour exécuter un accord, certes signé mais non revêtu de la formuleexécutoire, la solution consisterait à renvoyer les parties à saisirle tribunal par voie d’assignation ou de déclaration au greffe, avecle risque de voir le justiciable, excédé par le non-respect parl’autre de la parole donnée, préférer des solutions extrêmes plutôtque d’avoir recours au tribunal. Aussi, il apparaît utile d’inviterles parties (par conciliateurs interposés) à invoquer les accords nonrevêtus de la formule exécutoire à l’appui de requêtes en injonctionsde payer, cette procédure leur évitant d’avoir à comparaître devantle tribunal.
Les maisons de justice et du droit participent dans leur actionet leur philosophie à alimenter la tendance actuelle au développementdes modes non-contentieux de règlement des litiges. En témoigne ledécret du 28 décembre 1998 qui permet non seulement de saisir parrequête le président du Tribunal de grande instance en vue de
23 Jusque là, l’existence des maisons de justice et du droit reposait sur unecirculaire de la Chancellerie datée du 19 mars 1996.24 V. N.C.P.C., article 840 nouveau. Cette disposition est relayée par les articles847 et 847-3 nouveaux.
20
conférer force exécutoire à une transaction25, qui permet, aussi, desolliciter le «retrait du rôle» afin d’interrompre l’instance etd’engager une négociation26, et qui permet enfin d’élargir le domained’intervention du conciliateur devant le tribunal d’instance afind’éviter de laisser passer une chance de conciliation lorsque (parmanque de temps) le juge d’instance ne peut y procéder lui-même27.
Ces textes soulignent implicitement l’intérêt du partenariat,entre le médiateur-conciliateur et le juge d’instance, qui permet àce dernier de démultiplier son action. Mais la qualité de cepartenariat est essentielle, et constitue un instrument à doubletranchant car un mauvais accord réalisé devant le conciliateur oul’échec d’une conciliation peuvent aussi bien envenimer un conflit,et apporter une difficulté supplémentaire à la juridiction lorsquecette dernière aura par exemple à contredire une information donnéepar le conciliateur, soit erronée, soit mal interprétée par lejusticiable.
Conclusion :L’expérience réunionnaise des maisons de justice et du droit,
souligne le rôle que les «confettis de l’Empire» jouent dansl’expérimentation de solutions nouvelles que l’on envisageraitcertainement moins aisément en métropole. Mais il importe de segarder de toute lecture «exotique» qui conduirait à marginaliserl’expérience menée à la Réunion. Cette île est un département d’outre-mer : depuis 1946 s’y appliquent toutes les lois de la République28.Cette expérience n’aurait guère d’intérêt si elle ne pouvaitcontribuer à l’analyse du rôle des maisons de justice et du droit enmétropole, à condition toutefois que dans l’approche métropolitainesoit admise la nécessité de prendre en compte la dimensionpluriculturelle, et donc communautaire, de la société française.
Si le devenir de l’institution paraît assuré, il est permis de sedemander jusqu’où la dynamique actuelle conduira les maisons dejustice et du droit, et jusqu’où ira leur tendance àl’affranchissement. Alors qu’initialement, à la Réunion, laconciliation n’était que le corollaire de la médiation pénale,aujourd’hui, l’essentiel de l’activité civile du conciliateur reposesur la saisine spontanée des parties29. On peut voir dans cette
25 V. N.C.P.C., article 1441-4 nouveau.26 V. N.C.P.C., article 382.27 V. les articles 24 et 26 du décret de 1998.28 Loi de départementalisation du 19 mars 1946 (JORF 1946).29 Voir tableau récapitulatif, supra, les saisines directes représentaient en 1997,870 dossiers (pour 82 saisines parquet), et en 1998, 219 dossiers (pour 53 saisines
21
tendance à l’émancipation de la mission (civile) du conciliateur, parrapport à l’autorité judiciaire, la préfiguration d’une sorte de jugede paix dont la connaissance de la culture des parties serait l’atoutmajeur.
L’inadéquation des réponses judiciaires constitue le terreau surlequel s’épanouit une justice souple moins technicienne mais pluspragmatique. Et à l’image d’une justice figée qui se bande les yeuxpour ne point faillir, ne peut-on préférer celle d’une justice quiles ouvre au contraire pour rechercher le meilleur «rapport» socialpossible ? L’une met la loi au centre du dispositif, l’autre fait lechoix de placer la société au centre de ses préoccupations. Deuxlégitimités s’affrontent qui, en définitive, se complètentmutuellement. Faut-il rechercher autre chose qu’un équilibre entreces deux logiques ? Faut-il voir dans le développement des maisons dejustice et du droit l’ébauche d’une troisième voie entre le tout ourien judiciaire : une voie médiane qui privilégierait le traitementdes conflits par réduction des tensions, en rejetant l’optionclassique d’une cristallisation des conflits que peinent ensuite àapaiser nos «débats» judiciaires ? Si tel était le cas notre justicedite «moderne» renouerait alors avec la philosophie qui caractérisela justice rendue chez les «peuples premiers», en Afrique, enAustralie, en Nouvelle-Zélande, en Nouvelle-Calédonie... partout oùsurvit une justice dite «coutumière».
A défaut de trouver dans l’action des maisons de justice et dudroit une voie médiane, parions que le besoin de droit à défaut dejustice trouvera dans ces deux modèles concurrents la réponse à desattentes contrastées, tout en satisfaisant l’aspiration sociale àvoir réapparaître de véritables juges de paix. Car comme cela a étéfort justement rappelé : le besoin de justice ne doit pas se confondre avec le besoinde procès30.
judiciaires).30 Propos de Mme Guigou, rapporté par M. Douchy, Le Décret n° 98-1231 du 28 décembre1998 (...), Gaz. Pal. 1999. 1. p. 831.
22