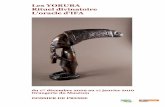Les figures de l'explorateur dans la presse du xixe siècle
-
Upload
univ-lille -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Les figures de l'explorateur dans la presse du xixe siècle
LES FIGURES DE L'EXPLORATEUR DANS LA PRESSE DU XIXESIÈCLE Isabelle Surun Nouveau Monde éditions | Le Temps des médias 2007/1 - n° 8pages 57 à 74
ISSN 1764-2507
Article disponible en ligne à l'adresse:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.cairn.info/revue-le-temps-des-medias-2007-1-page-57.htm--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour citer cet article :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Surun Isabelle, « Les figures de l'explorateur dans la presse du xixe siècle », Le Temps des médias, 2007/1 n° 8, p. 57-74. DOI : 10.3917/tdm.008.0057--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribution électronique Cairn.info pour Nouveau Monde éditions.© Nouveau Monde éditions. Tous droits réservés pour tous pays.
La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites desconditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votreétablissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière quece soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur enFrance. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.
1 / 1
Docu
men
t tél
écha
rgé
depu
is ww
w.ca
irn.in
fo -
Inst
itut d
'Etu
des
Politi
ques
de
Paris
- -
193
.54.
67.9
1 - 1
8/10
/201
2 17
h17.
© N
ouve
au M
onde
édi
tions
Docum
ent téléchargé depuis www.cairn.info - Institut d'Etudes Politiques de Paris - - 193.54.67.91 - 18/10/2012 17h17. © Nouveau M
onde éditions
Plus que tout autre voyageur, l’ex-plorateur aura posé la question de lacirculation de l’information et sollicitél’attention de la presse du XIXe siècle.Parce qu’il parcourt des espaces loin-tains définis par leur extériorité àl’égard d’un monde européen enexpansion1,maîtrisé et sillonné par lesréseaux d’information et de commu-nication constitués par les appareilsdiplomatiques ou coloniaux, les relaismissionnaires ou les postes commer-ciaux, les lignes de chemin de fer, denavigation ou de télégraphe, l’explo-rateur est hors de portée des outilsmédiatiques dont se dotent les sociétéseuropéennes. Pendant toute la duréede l’exploration, de la plongée dansl’inconnu, il est l’absent dont on estsans nouvelles. Pour peu que cetteabsence se prolonge au point de semuer en disparition, chancelleries etsociétés savantes, puis organes depresse, mobilisent leurs représentantsaux rivages connus ou envoient desémissaires dans « l’intérieur » de l’in-connu pour tenter de recueillir des
indices sur les circonstances de sa dis-parition ou de sa mort, tandis que sonretour sain et sauf en vient à constituerun événement en soi. Ainsi, c’est enretrouvant Livingstone à Ujiji,au borddu lac Tanganyika, le 10 novembre1871,et en faisant télégraphier la nou-velle au New York Herald, que le jour-naliste Henry Morton Stanley signe unscoop retentissant en même tempsqu’il immortalise l’image de l’explora-teur.
Pourtant, durant les deux premierstiers du XIXe siècle, si les revues spé-cialisées s’emparent de toute informa-tion concernant les voyages, la pressegénéraliste illustrée ne fait guère deplace à l’image de l’explorateur, quiparaît être le grand absent de l’explo-ration. L’émergence, dans les années1860 et surtout 1870,d’une iconogra-phie abondante qui érige l’explorateuren figure emblématique des sociétéseuropéennes et autorise à évoquer une« culture de l’exploration »2, contem-poraine d’une nouvelle phase de l’ex-pansion coloniale,conduit à s’interro-
57
Les figures de l’explorateur dans la presse du XIXe siècle
Isabelle Surun*
N °8 – automne 2007 Le Temps des Médias
* Maître de conférences en histoire contemporaine à l’Université de Lille-3,chercheur associé au CentreKoyré – CNRS/EHESS/MNHN.
Docu
men
t tél
écha
rgé
depu
is ww
w.ca
irn.in
fo -
Inst
itut d
'Etu
des
Politi
ques
de
Paris
- -
193
.54.
67.9
1 - 1
8/10
/201
2 17
h17.
© N
ouve
au M
onde
édi
tions
Docum
ent téléchargé depuis www.cairn.info - Institut d'Etudes Politiques de Paris - - 193.54.67.91 - 18/10/2012 17h17. © Nouveau M
onde éditions
ger sur les processus qui président à laconstruction d’une telle figure, sur lesmatériaux à partir desquels elle estfaçonnée, sur les significations qu’ellerevêt et sur les réemplois dont elle estl’objet au tournant des XIXe etXXe siècles, hors du champ propre àl’exploration.
Le présent article envisage l’explo-ration et sa réception comme unensemble de productions culturelles,complexe et non univoque, au seinduquel on peut déceler des perma-nences dans les traits constitutifs d’unefigure de l’explorateur et distinguer desconfigurations successives où s’agen-cent différemment supports et acteursassurant la médiatisation de l’explora-tion, statut de l’explorateur et imagi-naire dont il est le vecteur. Il constituele bilan provisoire d’une enquête encours3 qui a permis d’identifier dans lapresse française, et en particulier lapresse illustrée,des corpus cohérents ethomogènes par le traitement qu’ilsproposent de l’exploration.
L’explorateur,absent de l’exploration
La presse illustrée de la premièregénération4,essentiellement représen-tée en France par Le Magasin pittoresquefondé par Edouard Charton en 1833,se donne pour mission de faciliter l’ac-cès d’un large public à des savoirsconstitués de type encyclopédique,les« connaissances utiles »5. Un tel pro-gramme impose une prise en chargedes savoirs issus de l’exploration sou-
mise à la règle de l’après-coup : lesimages des voyages lointains présentéesdans ces recueils hebdomadaires n’ontacquis le statut de savoir constituéqu’après être passées au crible de lavalidation scientifique et de la publi-cation savante. Le Magasin pittoresquepublie ainsi en 1843 un article sur lesîles Sandwich tiré du voyage de Cook,paru en France en 1785, et une pré-sentation des îles Marquises issue ducompte rendu de l’expédition russe deKrusenstern (1803-1806) traduit enfrançais en 1821. Plus rarement, lesouci de rendre compte de décou-vertes récentes,dans un souci d’actua-lisation des savoirs,conduit à anticipersur la parution intégrale de l’ouvragesavant.C’est le cas des descriptions dela Nouvelle Zélande que publiel’hebdomadaire de Charton en 1833,d’après le voyage de Dumont d’Ur-ville6.
Le souci manifesté par L’Illustration,qui paraît à partir de 1843, de propo-ser à ses lecteurs des images des évé-nements, des lieux et des acteurs del’actualité, entraîne cet hebdomadaireà publier des comptes rendus desvoyages les plus récents,mais dans uneperspective étroitement limitée, dansles premières décennies au moins, auxespaces parcourus par des voyageursfrançais ou aux territoires conquis parla France.On trouve ainsi en 1843 desarticles sur les îles Marquises et Tahiti,dont Dupetit-Thouars a pris posses-sion l’année précédente, ou, en 1845,des images tirées du voyage au Choa(Abyssinie méridionale) de Rochet
58
DOSSIER : LE TOUR DU MONDE. MÉDIAS ET VOYAGES
Docu
men
t tél
écha
rgé
depu
is ww
w.ca
irn.in
fo -
Inst
itut d
'Etu
des
Politi
ques
de
Paris
- -
193
.54.
67.9
1 - 1
8/10
/201
2 17
h17.
© N
ouve
au M
onde
édi
tions
Docum
ent téléchargé depuis www.cairn.info - Institut d'Etudes Politiques de Paris - - 193.54.67.91 - 18/10/2012 17h17. © Nouveau M
onde éditions
d’Héricourt, dont le récit a été publiéen 1841.Au milieu du siècle,l’Afriqueest représentée par plusieurs articlestirés de rapports du lieutenant demarine Bouët sur ses relevés hydro-graphiques des rivières de la Côte del’Or et sur sa mission auprès du roi duDahomey7,ou de lettres de Faidherbe,gouverneur du Sénégal, relatantdiverses expéditions militaires ayantpermis la prise de villages et l’installa-tion de forts8. Ce n’est pas leur carac-tère lointain qui motive la représenta-tion de ces lieux, mais leur inclusiondans le domaine français,souvent mar-quée par la présence du drapeau tri-colore arboré par un fort ou un bateauà vapeur. On ne trouve en revancheaucun écho des grands voyages dedécouverte menés au même momentà l’intérieur du continent,à l’initiativedu gouvernement britannique,commeceux de Barth entre lac Tchad et Niger(1849-55) ou de Baikie sur le basNiger et la Bénoué (1854).
Les gravures sur bois proposées parla presse illustrée des deux premièresgénérations se caractérisent par leurvisée documentaire en présentant unecollection de vues (de villes et defleuves,en particulier) ou de scènes ettypes, parfois de planches botaniquesou zoologiques et d’objets ethnogra-phiques. Elles manifestent le doublehéritage du projet encyclopédique etdu voyage pittoresque en donnant àvoir des vues prises sur le monde,maisnon le sujet qui ordonne le regard :auteur de récits à la première per-sonne, le voyageur fait entendre sa
voix, mais il n’est jamais l’objet de lareprésentation.
La mise en intrigue de l’exploration
C’est ailleurs, dans les pages desrevues spécialisées consacrées auxvoyages et à la géographie, que s’éla-bore une mise en scène de l’explora-tion en acte, sur un mode discursif etcartographique, mais non iconogra-phique. Pour des raisons qui tiennentessentiellement à la dépendance cogni-tive des géographes à l’égard des voya-geurs, les premiers sont conduits àaccorder aux seconds une reconnais-sance à la fois scientifique et morale,tout en érigeant les voyages d’explora-tion au rang d’événements.
Le Bulletin de la Société de Géographie,qui paraît à partir de 1822, inscrit lesvoyages d’exploration au sein de l’en-treprise,savante et collective,de décou-verte du monde par la réduction sys-tématique des blancs de la carte. Iltémoigne des travaux d’une sociétésavante dont les membres assumentune fonction d’encadrement scienti-fique en constituant en énigme géo-graphique tel ou tel lieu du mondeainsi désigné à l’investigation des voya-geurs.Chaque voyage singulier entre-pris dans l’inconnu est alors appelé àprendre place au sein du grand récit dela découverte du monde,que les géo-graphes écrivent en même temps qu’ilsle mettent en scène comme dévoile-ment programmé de la surface de laterre. Les cartes publiées, qui figurent
59
LES FIGURES DE L’EXPLORATEUR DANS LA PRESSE DU XIXe SIÈCLE
Docu
men
t tél
écha
rgé
depu
is ww
w.ca
irn.in
fo -
Inst
itut d
'Etu
des
Politi
ques
de
Paris
- -
193
.54.
67.9
1 - 1
8/10
/201
2 17
h17.
© N
ouve
au M
onde
édi
tions
Docum
ent téléchargé depuis www.cairn.info - Institut d'Etudes Politiques de Paris - - 193.54.67.91 - 18/10/2012 17h17. © Nouveau M
onde éditions
les itinéraires des voyageurs construitspar les soins des géographes à partir desinformations rapportées, font preuvede l’avancement du travail et donnentà voir autant de déchirures infligées au« voile de l’ignorance »9.
Dans cette configuration,l’explora-teur devient un personnage dont la vieest précieuse tant qu’il n’est pas revenulivrer sa moisson d’informations,et enparticulier ses notes sur son propre iti-néraire.Tout ce qui fait obstacle à saprogression ou met sa vie en dangermenace l’avancement de la sciencegéographique. Dès lors, ce n’est plusseulement après-coup,à partir de récitsélaborés au retour, que l’explorateurest pris en considération,mais dès sondépart, et pendant toute la durée deson voyage.La Société de Géographieactive tout un réseau d’informateurs,consuls dans les grandes métropoleseuropéennes, commerçants ou mis-sionnaires présents sur les côtesd’Afrique, pour obtenir tout rensei-gnement sur la progression et l’état desanté de celui qui s’avance dans l’in-connu, et pour transmettre ses lettresexpédiées de l’intérieur à la côte. Enpubliant la correspondance reçue ainsique les comptes rendus des séances oùces informations sont commentées,son Bulletin traite l’exploration commeactualité et institue le genre des « nou-velles des voyageurs ».Les livraisons dupremier semestre de l’année 1828,parexemple, commentent divers rensei-gnements sur la mort de Clapperton,sur celle du fils de Mungo Park, partià la recherche de son père,ou sur l’as-
sassinat de Laing près de Tombouc-tou10.Le cahier de juin 1825 comporteun article dans lequel Jomard, à partirde renseignements erronés sur les cir-constances de la mort d’Oudney,attri-buée à un refroidissement contractélors d’une gelée nocturne en un lieusupposé voisin du lac Tchad, formuleune hypothèse sur l’altitude et le reliefde la région, d’après la températureenregistrée et la latitude attribuée aulieu : la mort du voyageur est devenueun fait géographique11. Lorsque levoyageur ne meurt pas en route, c’estson retour qui est salué comme évé-nement,tandis qu’il est lui-même reçusolennellement lors d’une séance de laSociété pour y être interrogé par desgéographes avides de renseignementset soucieux d’en vérifier l’authenticité.Le cas de René Caillié, inconnu surgidu désert et disant venir de Tombouc-tou,recueilli par le consul de France auMaroc, puis adressé à Jomard à qui ilconfie ses notes de voyage, en fournitun bon exemple, analysé ailleurs12.
Même limité dans sa diffusion à unpublic restreint de curieux et deconnaisseurs, ce bulletin mensuel acontribué à attiser l’intérêt pour la per-sonne de l’explorateur et à inscrire sesdécouvertes,par un suivi régulier,dansune temporalité de l’actualité, per-mettant à une presse généraliste des’emparer ensuite de l’événement,d’abord érigé comme tel dans le cadred’un agenda scientifique. En donnantune large place aux faits les plus dra-matiques susceptibles d’arrêter défini-tivement un voyageur,il a aussi consti-
60
DOSSIER : LE TOUR DU MONDE. MÉDIAS ET VOYAGES
Docu
men
t tél
écha
rgé
depu
is ww
w.ca
irn.in
fo -
Inst
itut d
'Etu
des
Politi
ques
de
Paris
- -
193
.54.
67.9
1 - 1
8/10
/201
2 17
h17.
© N
ouve
au M
onde
édi
tions
Docum
ent téléchargé depuis www.cairn.info - Institut d'Etudes Politiques de Paris - - 193.54.67.91 - 18/10/2012 17h17. © Nouveau M
onde éditions
tué l’atelier où s’est élaborée sur lemode du récit une figure de l’explo-rateur en martyr de la science, large-ment reprise par la suite dans d’autresconfigurations médiatiques.
Portraits d’explorateurs en piedLe magazine Le Tour du Monde, créé
en 1860 par Edouard Charton pourrépondre au goût pour les récits devoyage manifesté par un public de plusen plus large,réalise une synthèse entreles deux formes médiatiques évoquéesplus haut :poursuivant dans le domaineplus spécifique des voyages l’œuvre devulgarisation commencée avec leMagasin pittoresque,Charton affirme lanécessité d’accorder une part égale autexte et à la gravure, formule qui a faitle succès de la presse illustrée du pre-mier XIXe siècle ; par ailleurs, sansreprendre à son compte le programmede découverte du monde mis enœuvre par les géographes et réduire levoyage à l’exploration13,il fait du voya-geur l’initiateur d’une relation du lec-teur au monde,relation dont le journalse veut le médiateur14.
Dans un premier temps, Le Tour duMonde puise largement dans les publi-cations des sociétés de géographie,dont il se fait la chambre d’écho15. Ildonne un prolongement aux nouvellesde l’exploration, qui fournissent lamatière de nombreux articles brefs(«Découverte de grands lacs africains »ou « Nouvelles découvertes du doc-teur Livingstone » dans le premier vo-lume16) et prennent souvent la forme
de rubriques nécrologiques. Les deuxpremières livraisons s’ouvrent ainsi surdes dessins de paysages qui constituenten quelque sorte des monuments à desvoyageurs disparus : le premier repré-sente « le mont Gaurisankar »,ou Eve-rest, mesuré par le voyageur allemandHermann Schlagintweit, dont l’assas-sinat au Turkestan est relaté dans l’ar-ticle,tandis que le second,intitulé « SirJohn Franklin.L’Erèbe et la Terror dansles glaces », introduit un rapport sur ladécouverte de vestiges de cette expé-dition malheureuse17. Le thème de lamort de l’explorateur, qui s’imposed’emblée, était déjà présent dans lesrevues savantes,mais il acquiert ici unrelief qui ne fera que croître par la suitedans la presse illustrée. Le traitementiconographique de l’article sur Frank-lin,qui présente comme des « reliques »de l’expédition une série d’objetsretrouvés ainsi que le fac-similé d’unenote de bord signée de l’amiral, érigesymboliquement un tombeau au voya-geur.
Avec l’affirmation de son succèspublic18,la revue s’affranchit progressi-vement de sa dépendance envers lespublications des sociétés savantes, etobtient directement des voyageurs desrécits circonstanciés rédigés à la pre-mière personne, qui paraissent désor-mais, comme les feuilletons, en plu-sieurs livraisons successives, et s’éten-dent parfois sur plus d’une centaine depages. La personnalisation des voya-geurs est alors accentuée par la publi-cation de portraits en buste, générale-ment dessinés d’après photographie,
61
LES FIGURES DE L’EXPLORATEUR DANS LA PRESSE DU XIXe SIÈCLE
Docu
men
t tél
écha
rgé
depu
is ww
w.ca
irn.in
fo -
Inst
itut d
'Etu
des
Politi
ques
de
Paris
- -
193
.54.
67.9
1 - 1
8/10
/201
2 17
h17.
© N
ouve
au M
onde
édi
tions
Docum
ent téléchargé depuis www.cairn.info - Institut d'Etudes Politiques de Paris - - 193.54.67.91 - 18/10/2012 17h17. © Nouveau M
onde éditions
sur lesquels ils figurent en tenue deville, pour les civils, ou en uniforme,pour les militaires. À ces représenta-tions de facture classique, qui ne per-mettent pas d’identifier les voyageurscomme tels, la revue ajoute cependantdes portraits en pied, « en costume devoyage » ou dans une tenue locale quipermet d’exhiber tous les accessoiresd’un exotisme de pacotille. Le lieute-nant de vaisseau Eugène Mage, qui aeffectué une mission diplomatiquedans le haut Niger de 1863 à 1867,estainsi représenté à la fois en buste, enuniforme d’apparat, avec épaulettes etdécorations, et en pied, « revêtu d’unboubou-loma » brodé et de babouchesouvragées, dans un style oriental plusproche des tenues de Loti que desusages vestimentaires ouest africains(figure1)19. On est loin des représenta-tions du savant voyageur qu’a pu incar-ner au début du siècle Alexandre deHumboldt, représenté entouré de sesattributs du savoir,comme une « ency-clopédie ambulante »20.
La publication, dès les premièrespages du récit, d’un portrait en pied,en tenue de voyage, se généralise aupoint de devenir un trait caractéristiquedes voyageurs d’exploration. Dans lecompte rendu du voyage de l’expédi-tion polaire suédoise,paru en 1877,ellepermet de distinguer le chef de l’ex-pédition, Nordenskiöld, qui pose envêtements de fourrure, des autresmembres, représentés en tenue deville21.Ce portrait initial sert parfois dematrice à d’autres représentations. Lesillustrations qui accompagnent le récit
de Cameron en fournissent un bonexemple:le portrait du lieutenant,réa-lisé d’après photographie par ÉmileBayard, fournit tous les éléments de latenue du voyageur (veste à col officieret culotte de drap blanc, chaussettesmontantes et chaussures de marche,fusil et casque colonial posé au sol),repris par d’autres dessinateurs dans desscènes de traversées de rivières ou devisites à des chefs, où la silhouette deCameron,immédiatement identifiable,constitue une déclinaison du modèle22.
62
DOSSIER : LE TOUR DU MONDE. MÉDIAS ET VOYAGES
Figure 1. « M. Mage revêtu d’un boubou-loma », dessin d’Émile Bayard d’après l’al-bum de M. Mage. Le Tour du Monde, 1868,XVII, p.85.
Docu
men
t tél
écha
rgé
depu
is ww
w.ca
irn.in
fo -
Inst
itut d
'Etu
des
Politi
ques
de
Paris
- -
193
.54.
67.9
1 - 1
8/10
/201
2 17
h17.
© N
ouve
au M
onde
édi
tions
Docum
ent téléchargé depuis www.cairn.info - Institut d'Etudes Politiques de Paris - - 193.54.67.91 - 18/10/2012 17h17. © Nouveau M
onde éditions
En l’absence de photographie del’explorateur en tenue, l’éditeur trouved’autres moyens de suggérer la réalité duvoyage.Le récit du second voyage afri-cain de Stanley, « À travers le continentmystérieux »,s’ouvre ainsi sur deux por-traits du voyageur en buste réalisés à par-tir de clichés pris « lors de son départ »et « à l’époque de son retour »,présen-tés en vis-à-vis.Le dispositif placé sousles yeux du lecteur incite à la comparai-son entre un avant et un après et désignele voyage comme un entre-deux éprou-vant en donnant à voir son empreintesur la physionomie du voyageur : lesecond portrait montre un Stanley amai-gri,le regard fiévreux perdu dans le vide,la moustache moins fournie et,surtout,la chevelure blanchie23.
Avec LeTour du Monde,l’explorateurn’est plus seulement un pourvoyeurd’information géographique ou unmartyr de la science, il devient unpourvoyeur d’images du monde et lehéros de son propre récit. Il n’est plusseulement un nom,mais un visage sin-gulier, un costume qui évoque lesespaces traversés ou les conditions dudéplacement, un corps qui porte lesstigmates du voyage.
Scènes de genre et dramatisation de l’exploration
Dans Le Tour du Monde, mais aussidans L’Illustration ou dans le Journal desvoyages,ce voyageur incarné sort bien-tôt de l’espace iconographique réservéau portrait pour entrer dans la com-position de scènes de genre de plus en
plus stéréotypées qui donnent à voirl’exploration comme action et nonplus seulement comme déplacementdans l’inconnu.
Il occupe d’abord une place discrètedans le paysage où il figure comme unmembre parmi d’autres d’une colonneen marche et sert à la fois d’indicateurd’échelle et de faire valoir à une végé-tation exotique qui demeure l’objetprincipal d’une image à vocation didac-tique.Ainsi, dans le récit du voyage deMage publié par Le Tour du Monde en1868, la présence iconographique del’explorateur reste-t-elle limitée, endehors des portraits déjà mentionnés,àune scène de chasse et à une gravureintitulée « Forêt de rôniers » (figure 2),qui peut se lire comme une planchebotanique,tant la précision du trait dansla représentation du feuillage des arbresl’emporte sur celle du dessin des per-sonnages. L’image renouvelle certes legenre par l’insertion de la figure duvoyageur auquel elle confère le statut dumédiateur par lequel cette vue prise surle monde est devenue accessible au lec-teur,comme le montre le regard admi-ratif ou étonné que Mage,monté sur unâne, dirige vers la haute ramure desrôniers, mais elle banalise l’acte d’ex-plorer qu’elle présente sous le jourd’une promenade tranquille. De lamême façon, lorsque L’Illustration pré-sente la « découverte » des sources duNiger par Zweifel et Moustier,la repré-sentation des voyageurs, réduits à deuxpetites silhouettes de dos, admirant lepaysage grandiose qui s’étend devanteux,fait fonction de déictique à l’égard
63
LES FIGURES DE L’EXPLORATEUR DANS LA PRESSE DU XIXe SIÈCLE
Docu
men
t tél
écha
rgé
depu
is ww
w.ca
irn.in
fo -
Inst
itut d
'Etu
des
Politi
ques
de
Paris
- -
193
.54.
67.9
1 - 1
8/10
/201
2 17
h17.
© N
ouve
au M
onde
édi
tions
Docum
ent téléchargé depuis www.cairn.info - Institut d'Etudes Politiques de Paris - - 193.54.67.91 - 18/10/2012 17h17. © Nouveau M
onde éditions
64
DOSSIER : LE TOUR DU MONDE. MÉDIAS ET VOYAGES
Figure 2. « Forêt de rôniers », dessin de Émile Bayard d’après l’album de M. Mage.Le Tourdu Monde,1868,XVII, p.57.
Docu
men
t tél
écha
rgé
depu
is ww
w.ca
irn.in
fo -
Inst
itut d
'Etu
des
Politi
ques
de
Paris
- -
193
.54.
67.9
1 - 1
8/10
/201
2 17
h17.
© N
ouve
au M
onde
édi
tions
Docum
ent téléchargé depuis www.cairn.info - Institut d'Etudes Politiques de Paris - - 193.54.67.91 - 18/10/2012 17h17. © Nouveau M
onde éditions
de sources à peine visibles et authenti-fie la découverte en donnant à voir sonrésultat plutôt que les étapes de sa réa-lisation24.
Mais, alors que persiste une icono-graphie didactique composée deplanches botaniques, de vues de vil-lages et de rivières,de collections d’ob-jets ethnographiques parfois disposéssous forme de trophées,de portraits etde types, s’affirme aussi une imagerienouvelle qui donne à voir l’explora-tion en acte en présentant des scènestelles que les traversées de rivières,pas-sages périlleux de rapides en canot,ouprogressions difficiles en forêt dense,où l’on se fraie un chemin à lamachette.L’exploration,dès lors,n’estplus une promenade de santé,mais uneentreprise aventureuse dont l’explora-teur est le grand ordonnateur : situélégèrement à l’écart de la colonne enmarche ou à l’arrière de l’embarcation,il désigne d’un geste auguste la voie àprendre ou surveille depuis la rive lesopérations de transbordement. Il n’estplus dépendant de ses guides, maiscommande une colonne de porteursqu’il a lui-même recrutés.Cette modi-fication tient en partie à la chronolo-gie de l’exploration, qui privilégie,après les espaces ouverts de l’ouest afri-cain où l’on pouvait se déplacer en for-mation légère,les régions plus difficilesd’accès du bassin du Congo où sontorganisées des expéditions compre-nant parfois plusieurs centainesd’hommes. Mais elle consacre aussiune imagerie qui exalte l’hommeblanc en homme d’action et de com-
mandement, qui s’attribue parfois despouvoirs disciplinaires et apparaît enjuge25. Dès lors, les images qui mon-trent l’explorateur transporté enhamac ou en chaise à porteurs, loin denuire à l’affirmation de cette figurevirile,donnent à voir la supériorité deson statut et tendent à suggérer sadétermination : le texte nous apprenden effet que c’est un accès de fièvre quile conduit à choisir ce mode de loco-motion plutôt que de renoncer à pour-suivre sa route.
À cette superposition de langagesiconographiques correspond une plu-ralité des modes de fabrication desimages.Ainsi, l’illustration du récit devoyage de Cameron paru dans Le Tourdu Monde combine les gravures « tiréesde l’édition anglaise »,toujours de petitformat et à visée didactique,les paysagesou scènes ordinaires du voyage redes-sinées et agrandies « d’après l’éditionanglaise », et les scènes de genre réali-sées « d’après le texte et l’éditionanglaise », ou seulement « d’après letexte », où l’intervention éditoriale dela revue se révèle plus importante.Dansle dernier cas, l’image résulte d’uneinterprétation libre par le dessinateurd’un épisode anecdotique qui n’oc-cupe que quelques lignes dans le récit.Lorsque le dessinateur travaille d’aprèsdes croquis ou des photographies réa-lisés par le voyageur, le fait, toujoursmentionné comme gage d’authenti-cité,n’empêche nullement la manipu-lation de l’image.Les gravures réaliséesà partir des mauvais clichés pris parStanley lors de son second voyage sont
65
LES FIGURES DE L’EXPLORATEUR DANS LA PRESSE DU XIXe SIÈCLE
Docu
men
t tél
écha
rgé
depu
is ww
w.ca
irn.in
fo -
Inst
itut d
'Etu
des
Politi
ques
de
Paris
- -
193
.54.
67.9
1 - 1
8/10
/201
2 17
h17.
© N
ouve
au M
onde
édi
tions
Docum
ent téléchargé depuis www.cairn.info - Institut d'Etudes Politiques de Paris - - 193.54.67.91 - 18/10/2012 17h17. © Nouveau M
onde éditions
ainsi le résultat d’un travail de décou-page,de recadrage et de recomposition,combinant parfois plusieurs photogra-phie en une seule image26.
Un espace d’autonomie est ainsilaissé au dessinateur, qui s’en emparepour réaliser de véritables composi-tions,œuvres d’imagination élaboréesà partir de matériaux rapportés par levoyageur ou d’images déjà publiéesdans d’autres récits de voyages,formantdes scènes-type interchangeables.Cetteiconographie constitue un genre ensoi,dans lequel s’illustrent particulière-ment des dessinateurs comme EdouardRiou, qui excelle dans les paysages deforêt dense, auxquels il donne un tourfantasmagorique qui rappelle les dessinsde Gustave Doré.Riou compose ainsides scènes presque identiques pourillustrer le voyage de Jules Crevaux enGuyane en 1883,celui de Stanley dansle bassin du Congo en 1878 ou celui deBinger dans le nord de la Côte d’Ivoireen 1891 (figure 3).L’image saturée laissedeviner, dans une trouée de lumièreentre de hauts troncs dont on n’aper-çoit pas le sommet,quelques silhouetteshumaines noyées dans la végétation,frayant difficilement un chemin auvoyageur et à ses porteurs:l’explorationy apparaît comme une lutte acharnéecontre une nature démesurée.
Ces compositions iconographiquess’affranchissent d’autant plus aisémentd’un régime de représentation réfé-rentiel ou d’une visée didactique queleurs auteurs collaborent indifférem-ment à l’illustration de récits de voyageet d’œuvres de fiction. Riou a ainsi
réalisé les illustrations de plusieursromans d’aventure,en particulier Cinqsemaines en ballon de Jules Verne, paruen 1863,inspiré de récits d’explorationen Afrique dont la charge dramatiquea été considérablement accentuée. LeJournal des voyages et des aventures de terreet de mer, qui paraît à partir de 1877 àdestination d’un public de jeunes lec-teurs, brouille encore les limites enpubliant à la fois des romans d’aven-ture,des récits de voyage réels ou fictifset des textes d’information géogra-phique. Les motifs iconographiquescirculent ainsi d’un support ou d’ungenre à un autre,contribuant à faire del’illustration du voyage d’explorationun objet hybride et le réceptacle d’unimaginaire en gestation.
L’influence du roman d’aventure sefait sentir dans la restitution des récitsd’exploration, où se multiplient lesscènes de rencontres inopinées avecdes animaux sauvages ou d’affronte-ment avec les autochtones. La vio-lence, assumée par les protagonistes,devient un ingrédient constitutif de cesrécits dont les auteurs ne sont plusconsidérés comme des martyrs de lascience, mais comme des héros de lacivilisation, avant d’être invités à figu-rer au panthéon national.
Figures de l’explorateur après l’exploration
C’est la presse populaire à grandtirage27 qui fait de l’explorateur unefigure nationale. Elle bénéficie d’uneconjonction d’intérêts pour les mondes
66
DOSSIER : LE TOUR DU MONDE. MÉDIAS ET VOYAGES
Docu
men
t tél
écha
rgé
depu
is ww
w.ca
irn.in
fo -
Inst
itut d
'Etu
des
Politi
ques
de
Paris
- -
193
.54.
67.9
1 - 1
8/10
/201
2 17
h17.
© N
ouve
au M
onde
édi
tions
Docum
ent téléchargé depuis www.cairn.info - Institut d'Etudes Politiques de Paris - - 193.54.67.91 - 18/10/2012 17h17. © Nouveau M
onde éditions
67
Figure3. « La forêt », dessin de Riou, d’après les documents de l’auteur.Le Tour du Monde,1891,LXII, p.133.
LES FIGURES DE L’EXPLORATEUR DANS LA PRESSE DU XIXe SIÈCLE
Docu
men
t tél
écha
rgé
depu
is ww
w.ca
irn.in
fo -
Inst
itut d
'Etu
des
Politi
ques
de
Paris
- -
193
.54.
67.9
1 - 1
8/10
/201
2 17
h17.
© N
ouve
au M
onde
édi
tions
Docum
ent téléchargé depuis www.cairn.info - Institut d'Etudes Politiques de Paris - - 193.54.67.91 - 18/10/2012 17h17. © Nouveau M
onde éditions
lointains : dans les décennies qui pré-cèdent la Première Guerre mondiale,conquête coloniale et formation desalliances inscrivent la question de l’ex-ploration dans l’horizon d’une actua-lité des relations entre les nations euro-péennes et dans l’agenda d’une trans-formation des relations entre l’Europeet le reste du monde. Mais, paradoxa-lement, c’est lorsque l’explorationtouche à sa fin qu’elle fait l’objet de lamédiatisation la plus large.
On voit ainsi se manifester une cer-taine indécision dans l’emploi destermes : on appelle parfois « explora-teurs » des individus qui traversent desespaces déjà connus,mais qui se situentà l’avant du mouvement de conquêteet se font remarquer par quelqueaction d’éclat, caractérisée par sa rapi-dité et son audace, comme la « pointehardie » qui permet au commandantBonnier d’arborer le drapeau françaissur Tombouctou28, ou par la perfor-mance physique et morale que sa réa-lisation suppose.Alors qu’explorationet conquête coloniale se superposentinextricablement, les grandes figuresd’explorateurs deviennent des enjeuxnationaux et sont redéfinies à l’aide denouveaux critères. L’explorateur estdésormais inséparable du drapeau quil’accompagne et au nom duquel ilfoule le sol.Le voyage de Mizon entreNiger et Congo,considéré par Le PetitJournal comme très intéressant « tant aupoint de vue scientifique qu’au pointde vue commercial et politique », estillustré d’une gravure qui montrequelle stature l’intérêt national pouvait
alors conférer à l’explorateur dès lorsqu’il permettait d’affirmer la présencefrançaise (figure 4).Combinant portraiten pied et représentation fictive d’ex-ploration en acte, l’image présente unpersonnage portant le casque colonial,mais des vêtements civils, qui occupele devant de la scène et domine le pay-sage d’un regard tranquille.
La représentation n’est pas toujoursaussi univoque,comme le montre l’at-titude de la presse française qui opposeà Stanley, fustigé pour ses méthodesviolentes au service du roi des Belges,un Brazza érigé en héros d’une con-quête pacifique présentée comme unralliement spontané des populations àla France.Tandis que Le Petit Journalparvient encore en 1884 à distinguer lesdeux fonctions dans le même individuen évoquant un Stanley « que nouscombattons comme colonisateur,maisque nous admirons comme explora-teur »29,Le Petit Parisien veut voir en luiun modèle des « explorateurs anglais,grands amateurs de massacres et d’hé-catombes », bien contraire à celui desFrançais qui « ont horreur de la force,vont à travers les régions africaines sansarmes »,tandis que « leurs découvertes,qui n’ont arraché ni une goutte desang, ni un cri de douleur, n’enlèventpas à la France sa réputation d’huma-nité et son influence civilisatrice »30.Cesfigures d’explorateurs antagonistes per-mettent de construire le mythe bienfrançais du conquérant pacifique à par-tir des attributs du bon explorateur,tan-dis que la permanence du termemasque la transformation des pratiques.
68
DOSSIER : LE TOUR DU MONDE. MÉDIAS ET VOYAGES
Docu
men
t tél
écha
rgé
depu
is ww
w.ca
irn.in
fo -
Inst
itut d
'Etu
des
Politi
ques
de
Paris
- -
193
.54.
67.9
1 - 1
8/10
/201
2 17
h17.
© N
ouve
au M
onde
édi
tions
Docum
ent téléchargé depuis www.cairn.info - Institut d'Etudes Politiques de Paris - - 193.54.67.91 - 18/10/2012 17h17. © Nouveau M
onde éditions
Dans le même temps,l’iconographieabondante de ces suppléments hebdo-madaires permet de déceler une diffu-sion de l’imagerie de l’exploration endehors de son champ propre.La scène-type de progression en forêt trouveainsi une postérité parfois inattendue.Dans le domaine du fait divers,cher à lapresse populaire, elle sert par exemple
à illustrer l’évasion d’un forçat enGuyane par un dessin qui suggère lesdangers de la forêt par la présence deserpents et montre l’avancée du hérosdu jour accompagné de quatre porteursnoirs munis de coupe-coupe et d’unAnglais à casque colonial et fusil31.L’évacuation des Français de Tananariveaprès l’échec de la mission diploma-
69
Figure4. « Le lieutenant Mizon », dessin d’Henri Meyer,Le Petit Journal, Supplément illustré,9 juillet 1892.
LES FIGURES DE L’EXPLORATEUR DANS LA PRESSE DU XIXe SIÈCLE
Docu
men
t tél
écha
rgé
depu
is ww
w.ca
irn.in
fo -
Inst
itut d
'Etu
des
Politi
ques
de
Paris
- -
193
.54.
67.9
1 - 1
8/10
/201
2 17
h17.
© N
ouve
au M
onde
édi
tions
Docum
ent téléchargé depuis www.cairn.info - Institut d'Etudes Politiques de Paris - - 193.54.67.91 - 18/10/2012 17h17. © Nouveau M
onde éditions
tique de Le Myre de Vilers et leurretour à la côte,revers piteux de la pré-sence française, se mue presque, grâceà l’image d’une « grande forêt » aux« arbres gigantesques » et à ses « spec-tacles grandioses », en une épopéehéroïque32.Enfin,bien sûr,elle proposeun motif iconographique récurrent àl’illustration d’une conquête qui ditcette fois son nom,mais ne donne pasà voir la violence des affrontements :entémoigne cette image de l’expéditionde Madagascar, petite troupe progres-sant sous les ordres d’un officier encasque colonial pointant du doigt lavoie à suivre tandis que ses hommesentament les arbres à la hache (figure 5).La forêt, ici réduite à une brousse ar-borée, paraît domestiquée par deshommes dont la haute stature contrasteavec les minuscules silhouettes des des-sins de Riou auxquelles elle fait pour-tant écho,dans un jeu de références quiaffirme une continuité entre explora-tion et conquête et suggère l’aisanceavec laquelle le conquérant, hérosmoderne, emprunte les chemins diffi-ciles autrefois frayés par l’explorateur.
De la même façon, consacrant sonpremier reportage photographique à ladernière grande mission d’explora-tion,la Mission Marchand ou « missionCongo-Nil »,Le Petit Journal insiste surla modernité de l’entreprise en mon-trant la route ouverte à l’explosif, oule transport d’un vapeur en trancheset pièces détachées. Dans ce paysagehorizontal d’où la forêt a disparu,l’ex-ploration anticipe sur la colonisationen donnant à voir une nature aména-
gée33. Les enjeux internationaux del’événement et la nécessité de réparerl’humiliation nationale consécutive auretrait de la mission devant les Anglaisconduisent par ailleurs à une accen-tuation de la présence médiatique detous les personnages de l’expédition :de Marchand, directement représenténeuf fois en quatre ans, jusqu’au com-mandant Mangin, dont le mariagel’année suivante fait la une, en passantpar les tirailleurs sénégalais qui défilentdans Paris le 14 juillet 1899 avant d’êtrereçus dans le foyer du théâtre du Châ-telet où ils font leurs adieux à Mar-chand, ou encore les émouvantesretrouvailles du commandant et de sonpère34. L’explorateur devient, dans cecontexte particulier, un personnagesocial total.
À cette transformation des figures del’explorateur qui s’opère dans la pressetout au long du XIXe siècle correspondune profonde modification de la fonc-tion de l’exploration.Alors qu’elle par-ticipe encore, dans la première moitiédu siècle, d’une collecte de spécimensgéologiques, botaniques, zoologiquesou anthropologiques, mais aussi de« vues » du monde, accumulés en vuede leur classification taxinomique sur lemode du tableau naturaliste qui consti-tue un corps de savoirs à visée ency-clopédique,elle prend progressivementle sens d’une série d’actes érigés en évé-nements au sein du grand récit qui meten intrigue la découverte du monde etle dévoilement de la surface de la terrecomme appropriation symbolique,avant de se confondre avec le récit de
70
DOSSIER : LE TOUR DU MONDE. MÉDIAS ET VOYAGES
Docu
men
t tél
écha
rgé
depu
is ww
w.ca
irn.in
fo -
Inst
itut d
'Etu
des
Politi
ques
de
Paris
- -
193
.54.
67.9
1 - 1
8/10
/201
2 17
h17.
© N
ouve
au M
onde
édi
tions
Docum
ent téléchargé depuis www.cairn.info - Institut d'Etudes Politiques de Paris - - 193.54.67.91 - 18/10/2012 17h17. © Nouveau M
onde éditions
71
Figure5. « Expédition de Madagascar. Dans la brousse »,Le Petit Journal, Supplément illustré,25 août 1895.
LES FIGURES DE L’EXPLORATEUR DANS LA PRESSE DU XIXe SIÈCLE
Docu
men
t tél
écha
rgé
depu
is ww
w.ca
irn.in
fo -
Inst
itut d
'Etu
des
Politi
ques
de
Paris
- -
193
.54.
67.9
1 - 1
8/10
/201
2 17
h17.
© N
ouve
au M
onde
édi
tions
Docum
ent téléchargé depuis www.cairn.info - Institut d'Etudes Politiques de Paris - - 193.54.67.91 - 18/10/2012 17h17. © Nouveau M
onde éditions
son appropriation effective par laconquête.L’exploration atteint alors unstade réflexif où elle cesse de rappor-ter des images du monde qu’elle dé-couvre pour ne plus donner à voirqu’elle-même. Les images du mondenaturel et humain collectées dans laphase naturaliste sont ainsi reléguées austatut de décor d’une action menée par
un homme blanc. Ainsi se forge uneculture de l’exploration qui, tout enentretenant l’illusion de la continuitépar l’utilisation de ce décor,érige l’ex-plorateur en figure, voire en hérosnational, au moment même où l’ex-ploration, abandonnée comme modede connaissance du monde, cesse derelever d’un programme scientifique.
Notes1 Définissant l’espace de l’aventure par sonextériorité à un espace de « l’Europe » oude la « civilisation »,colonies comprises,Syl-vain Venayre a montré combien l’essor d’unimaginaire de l’aventure était étroitementcorrélé au rétrécissement inéluctable de cetespace : La Gloire de l’aventure. Genèse d’unemystique moderne, 1850-1940,Paris,Aubier,2002, p.46-51 et 154-160.
2Voir, pour le domaine britannique, FelixDriver,Geography Militant.Cultures of Explo-ration and Empire, Blackwell Publishers,2001,et pour la France, les travaux en coursd’Edward Berenson sur la réception deBrazza.
3 Il ne repose donc pas sur un dépouillementexhaustif de la presse du XIXe siècle oumême d’un titre particulier envisagé dans sacontinuité, mais sur une série de sondageseffectués dans les publications jugées les plusreprésentatives de leur génération pour laquestion étudiée.
4 On renvoie ici à la classification des quatregénérations de la presse illustrée européenneproposée par Jean-Pierre Bacot, La Presseillustrée au XIXe siècle. Une histoire oubliée,Limoges,Pulim,2005.
5 L’éphémère Journal des connaissances utiles,lancé par Émile de Girardin en 1831,appar-tient à cette génération.
6 Voir Marie-Laure Aurenche,Edouard Char-ton et l’invention du Magasin pittoresque(1833-1870), Paris, Champion, 2002, et« Les peuples sauvages dans le Magasin pitto-resque (1833-1870) : le pouvoir des images »in Sarga Moussa (dir.), L’idée de “race” dansles sciences humaines et la littérature (XVIIIe etXIXe siècles),Paris,L’Harmattan,2003,p.239-264.
7 L’Illustration, 28 juillet et 29 février 1849,17 juillet 1852. Le premier rapport a étéd’abord publié dans la Revue coloniale.Articlesreproduits dans Les grands dossiers de L’Illus-tration. Les expéditions africaines, Paris,SEFAG/L’Illustration, 1987.
8 Faidherbe envoie des dessins, publiés en1853 (I, p.223 et II, p.348), une lettre deSaint-Louis, datée du 4 juin 1854, publiéele 15 juillet 1854.
9 L’expression est récurrente sous la plumede géographes comme Jomard. Voir parexemple son article intitulé « Coup d’œilrapide sur les progrès et l’état actuel desdécouvertes dans l’intérieur de l’Afrique »,lu à l’assemblée générale de la Société de
72
DOSSIER : LE TOUR DU MONDE. MÉDIAS ET VOYAGES
Docu
men
t tél
écha
rgé
depu
is ww
w.ca
irn.in
fo -
Inst
itut d
'Etu
des
Politi
ques
de
Paris
- -
193
.54.
67.9
1 - 1
8/10
/201
2 17
h17.
© N
ouve
au M
onde
édi
tions
Docum
ent téléchargé depuis www.cairn.info - Institut d'Etudes Politiques de Paris - - 193.54.67.91 - 18/10/2012 17h17. © Nouveau M
onde éditions
Géographie en 1824 (Bulletin de la Société deGéographie, II, 1824, p.239-254).
10 Bulletin de la Société de Géographie, IX,1828, p.32, 132, 190, 194, 203-205, 219 et263.
11 Bulletin de la Société de Géographie, IV,1825, p.401-407.
12 Isabelle Surun, « Le carnet de route,archive du voyage.Notes manuscrites et récitdu voyage de René Caillié à Tombouctou »,Revue de la Bibliothèque nationale de France,n°22, 2006, p.30-37.
13 Dans la préface au premier volume de lapublication, Edouard Charton affirme eneffet une volonté de faire une place à toutessortes de voyageurs : « Parmi les voyageurs,les uns représentent la science,les autres l’art,d’autres le commerce ou l’industrie ; ceux-ci s’exposent à mille périls pour propagerleur foi,ceux-là sont simplement des obser-vateurs, des moralistes, ou ne recherchentque les émotions d’une existence errante etaventureuse. Toutes ces préoccupationsdiverses,même les plus frivoles en apparence,ont leur part d’utilité : le Tour du Monde n’enveut exclure aucune », Le Tour du Monde,1860, I, p.V.
14 « À toute heure,quelques voyageurs par-tent des différents points de l’Europe pourles régions lointaines : quel que soit leur iti-néraire, notre tâche sera désormais de lessuivre. » Ibid.,p.VIII.
15 Le premier volume propose ainsi une tra-duction française des rapports officiels ducapitaine Mac-Clintock chargé de recher-cher les traces de l’expédition dirigée parl’amiral Franklin,publiés par la Royal Geo-graphical Society (p.18-28).Le Tour du Mondene cache pas ses liens avec la Société de Géo-graphie de Paris, dont le vice président, LaRoquette,communique à la revue les notesmanuscrites d’un voyageur pour alimenter la
rédaction d’un article (p.2, note 2), et dontles propositions de prix publiées l’année pré-cédente sont reproduites (p.48).
16 Ibid.,p.12-15 et 62-64.
17 Ibid., p.1 et 17, dessins de Grandsire.
18 Le Tour du Monde atteint en 1866 un tiragede 33000 exemplaires,selon Jean Watelet,Lapresse illustrée en France, 1814-1914, Ville-neuve d’Ascq,Presses universitaires du Sep-tentrion, 2002 (fac-similé de la thèse d’Étatsoutenue en 1998), vol. 3, p.97.
19 Le Tour du Monde, 1868, XVII, respecti-vement p.112 et 85. À partir du volume II,cette revue est accessible en ligne sur Gallica.
20 Felix Driver,op. cit., p.11-16.
21 LeTour du Monde, 1877,XXXIII,respec-tivement p.184 et p.180-181, dessins deRonjat, d’après photographies.
22 Le Tour du Monde, 1877,XXXIII,p.9,des-sin d’Émile Bayard, d’après une photogra-phie ; « Pont sur le Loulindi », dessin de Th.Weber,p.78 ;XXXIV,dessins de D.Maillartp.117,137,141 ;dessin de Th.Weber p.121 ;dessin d’A. Rixens, p.123. Le récit intitulé« À travers l’Afrique. De Zanzibar à Ben-guela, le lieutenant Verney-Hovett Came-ron » a été publié en deux séries de livrai-sons courant sur les deux semestres de 1877.
23 Le Tour du Monde, 1878,XXXVI,p.8 et 9,dessins de Ronjat, d’après photographies.
24 L’Illustration, 5 février 1881.
25 C’est dans cette posture qu’apparaîtCameron,par exemple, dans un dessin d’É-mile Bayard où il fait mettre à la chaîne des« insolents » pour régler un incident survenuentre des villageois et l’un de ses serviteurs :LeTour du Monde,1877,XXXIII, p.21.
26 Voir l’analyse qu’en fait Mathilde Leducdans une conférence du 13 décembre 2005,intitulée « De l’explorer à l’illustrer : images
73
LES FIGURES DE L’EXPLORATEUR DANS LA PRESSE DU XIXe SIÈCLE
Docu
men
t tél
écha
rgé
depu
is ww
w.ca
irn.in
fo -
Inst
itut d
'Etu
des
Politi
ques
de
Paris
- -
193
.54.
67.9
1 - 1
8/10
/201
2 17
h17.
© N
ouve
au M
onde
édi
tions
Docum
ent téléchargé depuis www.cairn.info - Institut d'Etudes Politiques de Paris - - 193.54.67.91 - 18/10/2012 17h17. © Nouveau M
onde éditions
et récits d’exploration dans le bassin duCongo, à la fin du XIXe siècle », disponibleen ligne sur le site du Centre de recherchesur la littérature des voyages (www.crlv.org/)
27 Il s’agit de la « quatrième génération » dela presse illustrée identifiée par Jean-PierreBacot (op.cit.),essentiellement composée dessuppléments hebdomadaires illustrés desquotidiens populaires « à un sou », Le PetitJournal,Le Petit Parisien,Le Matin et Le Jour-nal, en particulier les deux premiers, quiatteignent un tirage d’un million d’exem-plaires, respectivement en 1897 et en 1902.Le Petit Journal fait paraître un supplémentà partir de 1881,mais il n’est illustré de gra-vures en couleur en pleine page qu’à partirde novembre 1890.
28 Supplément illustré du Petit Journal, 12février 1894.
29 Ibid., 24 août 1884,dans un article de Vil-lain qui consacre au docteur Ballay, compa-
gnon de Brazza, sa rubrique « l’homme dujour ».
30 Supplément du Petit Parisien,23 novembre1890, en commentaire d’une scène de can-nibalisme reproduite à partir d’une gravurede l’ouvrage de Stanley, Dans les ténèbres del’Afrique.
31 Supplément illustré du Petit Journal, 27décembre 1890, dessin de Meyer.
32 Ibid., 3 févier 1895.
33 Ibid., 28 mai 1899.Dessins de H.Meyerd’après les photographies du commandantMarchand et du capitaine Baratier : imagesen pleine page en une et dernière, et huitvignettes en pages intérieures.
34 Ibid., les 30 octobre 1898,16 avril,28 mai,4 juin,11,23 et 30 juillet 1899,13 mai et 30
septembre 1900, 9 mars et 20 avril 1902.
74
DOSSIER : LE TOUR DU MONDE. MÉDIAS ET VOYAGES
Docu
men
t tél
écha
rgé
depu
is ww
w.ca
irn.in
fo -
Inst
itut d
'Etu
des
Politi
ques
de
Paris
- -
193
.54.
67.9
1 - 1
8/10
/201
2 17
h17.
© N
ouve
au M
onde
édi
tions
Docum
ent téléchargé depuis www.cairn.info - Institut d'Etudes Politiques de Paris - - 193.54.67.91 - 18/10/2012 17h17. © Nouveau M
onde éditions