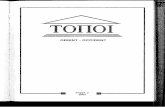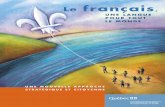Le principe d'autonomie dans le champ de la santé en Argentine
Les élites et l’architecture dans le centre de la Gaule durant le haut Moyen Âge. L’exemple de...
-
Upload
univ-lyon3 -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Les élites et l’architecture dans le centre de la Gaule durant le haut Moyen Âge. L’exemple de...
39Chr. Lauranson Rosaz : Les élites et l’architecture...
UDC: 316.344.42:72(445.7/.9Clermont)04/09 Chr. Lauranson-Rosaz726.6(445.7/.9Clermont)04 Universit Jean Moulin Lyon 3Original scientific paper Lyon, FranceManuscript received: 22. 01. 2007. Revised manuscript accepted: 15. 03. 2007.
Les ×lites et lÕarchitecture dans le centre de la Gaule durant le haut Moyen ‰ge
LÕexeMpLe de CLerMont en AuverGne : de LA CAth×drALe de nAMACe (ve s.) Ë CeLLe dÕ×tienne ii (xe s.)
ChristiAn LAurAnson-rosAz
Pour illustrer la question des élites et de l’architecture au Moyen Âge dans le centre de la Gaule au Xe si�cle, sont pris les exemples de deux grands év�ques d’Auvergne : Namace, au milieu du Ve si�cle, auteur de la premi�re cathédrale de Clermont, puis Étienne II qui, cinq si�cles plus tard, s’employa � la rebâtir dignement. Si on ne sait pas grand-chose du premier, en revanche la personnalité du second, son tr�s long “r�gne”, son action politique et réformatrice dans le milieu ecclésiastique, expliquent sa vocation de bâ-tisseur. Les sources utilisées permettant de préciser le programme architectural des deux év�ques bâtisseurs, sont d’une part pour Namace les cél�bres écrits de Grégoire de Tours, d’autre part pour Étienne une source “merveilleuse” et donc délicate, la Visio Rotberti du diacre Arnaud.
Les lites et larchitecture au Moyen ge : tel est le thme de ce 13e colloque. Pour lillustrer dans le centre de la Gaule durant le haut Moyen ge, je prendrai deux exemples, avec deux reprsentants de llite auvergnate et leurs uvres architecturales respectives : au milieu du Ve sicle, lvque Namatius alias Namace, auteur de la premire cathdrale de Clermont, puis la veille de lan mil son lointain successeur tienne II qui, cinq sicles aprs Namace, semploya rebtir dignement ladite cathdrale.
Cet essai entend donc du mme coup revoir la question des premiers difices en Auvergne, avant le grand essor de lart roman ; celle aussi des motivations de deux grands vques btisseurs : nous essaierons den savoir plus sur le premier, dans un contexte encore antique et dapparente dcadence architecturale. Quant au second, plus que son trs long rgne, sa personnalit et son action politique et rformatrice dans le milieu ecclsiastique expliquent sa vocation de btisseur.
Les sources permettant de prciser le programme archi-tectural des deux vques btisseurs, sont dune part pour Namace les clbres crits de Grgoire de Tours, dautre part pour tienne, ct des sources textuelles classiques, une source merveilleuse et dlicate, la Vision de labb Robert, qui permet dclairer laffaire.
Jutiliserai aussi videmment de manire abondante et critique les travaux de mes devanciers : Ren Rigodon1, Pierre-Franois et Gabriel Fournier2, Bernard Craplet3, May Vieillard-Troekouroff4, plus rcemment Pascale Chevalier5.
1 – Namace et la cathÉdrale du Ve si�cle, dÉdiÉe aux saiNts agricol et Vital.
crivant la fin du VIe sicle, Grgoire de Tours parle une douzaine de fois de la cathdrale de Clermont, dans son Histoire des Francs et ses autres uvres, hagiographiques6 : selon la tradition quil rapporte, le monument a t construit un sicle plus tt, vers le milieu du Ve sicle, par lvque Namatius alias Namace7. Cest au chapitre 16 du livre II de lHistoire des Francs :
Namace fit btir la cathdrale qui subsiste encore et qui est la plus ancienne de celles quon voit lintrieur des murs de la ville 8.Cest donc bien Namace quon devrait le transfert
suppos par la tradition clermontoise du groupe piscopal
Fig. 1. Vierge « rustique » auvergnate(BM Clermont-Ferrand, ms. 145, f ° 2v° et 3r°)
40
depuis le faubourg Saint-Alyre, alias vicus christianorum, jusqu la butte dominant la plaine des deux bras de la rivire Tiretaine9. Comme le dit bien Pierre-Franois Four-nier, la situation de la cathdrale actuelle, non loin du mur denceinte ce qui est courant entre deux portes de ce mur, sa permanence en cet endroit, ainsi que celle de ses annexes, donnent penser que celle du VIe sicle slevait au mme endroit 10.
Daprs Grgoire, Namace est le huitime vque chez les Arvernes 11, aprs Rustique et avant parque12, vers 450. Il est le premier vque btisseur, du moins intra muros, puisque le quartier chrtien ou Entressaints tait situ dans le faubourg juif de Saint-Alyre, au Nord de la ville.
Namatius et ejusmodi similes
On ne sait en fait que trs peu de choses de Nama-ce13 : dorigine auvergnate, il tait naturellement de race snatoriale, avec tout ce que cette identit implique alors14. Rustique et parque font partie du mme tissu social et familial, le second apparent directement lillustre famille de lempereur Avitus et de Sidoine15.
Christian Settipani, qui a travaill de manire gnrale sur laristocratie gallo-romaine et plus particulirement sur les relations familiales du grand vque Rurice de Limoges (v. 485-507), un vque lactivit politique, littraire et artistique dbordante, a prcis lidentit de notre Namace, apparent Rurice16 et qui a commenc sa carrire Vienne comme diacre de son parent lvque Claude Mamert en 44217. Les Namatii sont ainsi lis aux Claudii, dont lun des reprsentants est Rutilius Claudius Namati(an)us, pote et prfet de Rome dans lt 414. Un descendant de cette famille est le vir illuster Namatius, patrice de Provence, qui mourut en tant quvque de Vienne en 559, lge de 73 ans, homonyme de notre vque, et comme lui poux dune Euphrasia 18. De l en faire un seul et mme per-sonnage En tout cas, on le voit : Claudii, Ruricii, Anicii, Aviti, Euphrasii : cest toute la gentry du Midi de la Gaule qui dfile, lorsquon cherche montrer ou dmler les liens unissant ces membres respectables de llite tardo-antique dont Sidoine Apollinaire et Grgoire de Tours sont les plus illustres reprsentants pour lAuvergne.
la mme poque, on repre dautres porteurs du nom Namace, probablement parents : lun dentre eux est plus connu parce que correspondant de Sidoine en 469/470 et son compatriote, de mme rang et culture que lui19. Comme tout aristocrate de rang snatorial, il pratique lagriculture et la chasse, mais Sidoine lui conseille de ne pas trop se livrer cette dernire activit. Il lui envoie les libri logistorici de Varon et la chronographie dEusbe. Cest ainsi quon sait que Namace est alors Olron en Saintonge avec son pre, et y exerce des fonctions militaires : amiral de la flotte du roi wisigoth Euric, Sidoine vante ses talents de stratge, alors quil guerroie sur locan Atlantique contre les Saxons. Mais surtout ce qui aurait pu nous intresser sil stait agi de lvque , Sidoine fait allusion aux activits de btisseur de son ami, le mettant au rang de disciple de Vitruve .
Nous sommes vers 470. Sidoine nest pas encore vque il le sera peu aprs, en 471 jusque vers 486. Il nest pas encore aux prises avec les Wisigoths les hostilits souvriront en 472, et dureront jusquen 475. Cest lpoque dEuric (466-484) et de Victorius, qui sera son gouverneur pour lAquitaine premire (v. 480-489)20.
Alors que scroule lEmpire romain dOccident, le contexte nest pas aussi sombre quon pourrait le penser, et
en matire de btiment il est plutt la construction qu la destruction : Grgoire de Tours nous dit que Victorius voulut amliorer la cit (de Clermont), que les cryptes quon lui doit subsistent encore aujourdhui. la basilique de Saint-Julien cest lui qui a fait mettre les colonnes qui ont t poses dans ldifice. La basilique de Saint-Laurent-et-Saint-Germain du village de Lembron, cest lui qui la fait difier 21. Lpouse de lvque Namace, Euphrasie, ne sera pas de reste : cest elle qui fera difier la basilique de Saint-tienne dans le faubourg hors les murs22, glise o sera enterr son mari Namace, dont le tombeau est vnr vers lan mil23.
En lhonneur des bienheureux Agricol et Vital
Quant luvre de Namace, lglise principale, Grgoire de Tours la dsigne sous le nom decclesia, employ seul, sans indication de vocable24. deux reprises, il prcise que, de son temps, lecclesia tait situe lintrieur des murs de la cit, in civitate infra/intra muros civitatis25. Lespace relativement restreint dans lequel fut btie la nouvelle cathdrale contraignit dailleurs les architectes de strictes mesures26 : Grgoire rapporte les dimensions de ldifice et une description qui, pour reprendre lexpression de Pierre-Franois Fournier, ont donn de la tablature aux archologues 27 :
Elle a 150 pieds de long, 60 de large, mesurs lintrieur de la nef, et 50 pieds de haut jusqu la vote [plafond de bois pour May Vieillard-Troekouroff] 28. Ce qui donne 43,50 mtres de long sur 17,40 de large (dans la nef) et 14,50 de haut29.Il ne faut bien sr pas prendre la lettre les informations
techniques du texte, visiblement inspir par lApocalypse de Jean, mme si certains dtails intriguent :
lavant, il y a une abside de forme ronde30 et de chaque ct stendent des ailes dune lgante structure, ldifice entier est dispos en forme de croix31. Il a 42 fentres, 70 colonnes et 8 portes32. On y prouve la crainte de Dieu, une grande clart, et les religieux y respirent vraiment le plus souvent une odeur suave qui semble provenir daromates. Les parois du chur sont ornes de plusieurs espces de marbre ajustes ensemble .Ldifice a ainsi sans doute une riche dcoration
intrieure, linstar des basiliques contemporaines, dItalie ou dIstrie : contempler la basilique euphrasienne de Pore suffit donner une ide de ce que pouvait tre celle de Clermont
Grgoire relate ensuite la conscration de la cathdrale de Namace :
Ldifice ayant t achev dans lespace de douze ans, le bienheureux pontife envoya des prtres Bologne, ville dItalie, pour quils lui procurent des reliques des saints Agricol et Vital, qui comme nous lavons su trs certainement ont t crucifis pour le nom de Christ notre Dieu 33. Pour sa nouvelle glise Namace passait donc pour stre
procur des reliques des saints Agricol et Vital34, et il nest alors nulle mention dune ddicace la Vierge35. Ailleurs, dans sa Gloire des martyrs, Grgoire prcise :
Lvque dAuvergne Namace sollicita avec dvotion des reliques des saints martyrs, pour les placer dans lglise quil avait lui-mme construite ; il y envoya un prtre qui, parti avec la grce de Dieu, revint avec ce quil avait t chercher. Le prtre et ses compagnons, leur retour, firent une halte cinq milles de Clermont
41Chr. Lauranson Rosaz : Les élites et l’architecture...
et firent demander lvque ce quils devaient faire. Au matin, celui-ci avertit les citoyens et se hta daller en grande dvotion avec des cierges et des croix la rencontre des saintes reliques ; ayant runi les citoyens, le pontife ddia avec grande joie et une grande pit la sainte glise illustre par ces reliques36 . Le martyrologe hironymien mentionne le jour de la
conscration de la cathdrale de Namace au 14 mai : Arver-nus dedicatio ecclesie sancte Agricole37 ; il mentionne aussi une fte des saints martyrs Clermont le 10 dcembre : IIII id. Decembris et in civit(ate) arvernis sanctae Agriculae Uitalis mar(tyrum) 38. Au XIe sicle, cette fte a disparu du martyrologe, comme la ddicace de Namace39, mais on la retrouve sur une inscription des trois chsses que fit faire lvque Haddebert, au temps de Charlemagne, chsses qui se trouvaient encore au moment de la Rvolution sur le grand autel de la cathdrale :
Il y avait sur chacune une inscription en filigranes avec les mmes caractres et le mme travail, ces inscriptions furent transcrites au XVIIIe sicle40. La premire dit quau nom de Dieu tout puissant et des saints martyrs Agricol et Vital de la ville de Clermont, lvque Haddebert fit faire cette chsse, la 18e anne du rgne de Charlema-gne (786), avec divers dons ; le comte Ithier et dautres chrtiens runirent cet or et ces gemmes pour le bien de leurs mes La seconde au nom de Dieu tout-puis-sant et en lhonneur de sainte Marie et de saint Martial dont les reliques sont ici dposes, Haddebert fit faire une autre chsse ; la troisime : Ici il y a des reliques de la tte de saint Agricol et de lchine de saint Vital, lvque Haddebert les reut dans la cit de Bologne, du temps du roi Charles, le jour de leur fte le IV des ides de Dcembre . Il y avait donc deux chsses des saints Vital et Agricol41 : la premire, daprs lexpression les saints martyrs de la ville de Clermont , devait contenir les reliques que Namace avait fait venir de Bologne au Ve sicle, alors quHaddebert aurait mis dans lautre (il peut prciser) les reliques de la tte de saint Agricol et de lchine de saint Vital quil avait transportes lui-mme de Bologne. Ce nouvel apport de reliques, a-t-on pens, aurait correspondu une nouvelle conscration et de l une reconstruction de la cathdrale de Namace qui aurait t brle par Ppin le Bref dans son incendie de la ville en 76142, mais le rcit de lincendie ne parle pas de la cathdrale et, reconstruction et nouvelle conscration sont des hypothses que rien ne justifie 43. Dautres rcits de Grgoire contribuent par de menus
dtails restituer la vie de la cathdrale mrovingienne 44 : lvque parque, le successeur de Namace, habitait une petite proprit de lglise lintrieur des murs de la ville devenue ensuite la sacristie, et se rendait la nuit lautel de la cathdrale ; il trouva celle-ci un jour pleine de dmons et leur prince, habill comme une jolie femme, trnant sur le sige piscopal45. Le sanctuaire devait tre ferm par un voile sous lequel un jour une alouette chercha pntrer aprs avoir teint toutes les lampes46. Une cloche appelle les prtres matines47. Chramn envoie des missaires parler Firmin et sa belle-mre Csarie qui staient rfugis prs des portes de ldifice sacr et les jettent hors de lglise48 o ils ne bnficiaient plus du droit dasile, au contraire des prisonniers , leurs chanes stant miraculeusement brises la nuit, ils ouvrent les portes de leur prison qui devait se trouver lintrieur de la ville et entrent dans la cathdrale o, par la suite, lvque saint Avit leur rend la libert49.
Enfin, Grgoire de Tours nous informe qu leur mort les vques taient exposs dabord dans la cathdrale, ainsi en est-il de Sidoine Apollinaire (+ 489)50, du bienheureux Quintien (+ 525)51 et plus tard de saint Gall (+ 557)52.
Sautons prsent cinq sicles
2 – ÉtieNNe ii et la cathédrale du xe si�cle, dédiée � saiNte marie.
Lvque tienne II de Clermont, que les sources qualifient de pontifex inclytus53 et de precellentissimus episcopus54, mrite sans conteste dtre appel tienne II le Grand , car il est le prlat le plus marquant du diocse avant la Rforme grgorienne, avec un rle majeur dans la vie politique et bien sr religieuse de lAuvergne du Xe sicle55.
Pontifex inclytus et precellentissimus episcopus
tienne est issu du noble lignage des vicomtes de Clermont, fidles de la dynastie aquitano-gothique des Guillelmides : son pre, le vicomte Robert Ier, apparat dans les annes 920 comme lun des plus proches fidles de Guillaume le Pieux et de ses neveux et lun de leurs hritiers. tienne est lui-mme vassal royal des derniers rois carolingiens, Louis IV et Lothaire. Cest du premier quil reoit ds 942 la prestigieuse abbaye royale Sainte-Foy de Conques56, quil gardera devenu vque de Clermont sans doute aussi par la faveur royale, au plus tard en 94357. tienne se signale dj comme btisseur : lun des deux rcits de la translation des reliques de sainte Foi, celui en prose, mentionne la construction dune glise Conques par labb tienne, vque de Clermont, vnement qui pourrait avoir eu lieu vers 93758.
En tant quvque de Clermont, tienne II sige une quarantaine dannes, de 943 jusquen 984 au moins59. Son pontificat se singularise par une action engage rsolument pour le maintien de lordre dans le diocse. En tant que vassal royal, fidle du pouvoir carolingien, et la manire des vques defensores civitatis du Bas-Empire, il uvre pour le respect du droit : symbolique de cette action po-litique dtienne reste le fameux plaid de Clermont de 958, qui voque la rbellion des seniores Arvernici et montre lvque ramenant la paix, qui vaut mieux que tout (que omnia superat) 60. Dans le contexte de la non moins fameuse et dbattue mutation fodale , qui en Auvergne se traduit par des dprdations, usurpations et impositions de mauvaises coutumes 61 suivies de repentirs et de dguerpissements , la partie est rude62 : tienne ne doit-il pas sy prendre deux fois pour officialiser sa fonda-tion du prieur de Liziniat/Saint-Germain-Lembron, entre 945 et 96263 ? Pour contraindre les rcalcitrants, lvque de Clermont, reprenant une tradition remontant aux premiers temps carolingiens, inaugure la tenue dassembles de plein champ qui caractrisera les premiers pas de la Paix de Dieu , mouvement dont il est le promoteur, suivi par son voisin du Puy lvque Gui dAnjou64.
Tous deux se servent abondamment de la vnration des populations pour les saints et les reliques pour les amener respecter la paix, les biens dglise et des pau-vres Hagiophilie militante, qui caractrise pleinement le pontificat dtienne, lequel manifestait un grand intrt pour la conservation des saintes reliques , dira la Visio Rotberti 65.
Est-ce de son abbatiat Conques que date la fabrication de la clbre Majest de sainte Foi ? Sans doute, au vu
42
de sa commande ultrieure dune Majest de sainte Marie pour la cathdrale, jy reviendrai. tienne aurait ainsi eu un attachement particulier aux vierges en majest , ce genre douvrage si typique des rgions du centre de la Gaule que sont les bustes de saints reliquaires dont on a de si nombreux exemples : Conques et Clermont pour sainte Marie et sainte Foy, mais aussi Maurs pour saint Csaire, Bredons-Murat pour saint Pierre, Saint-Nectaire pour saint Baudime, au Monastier Saint-Chaffre en Velay pour saint Thofrde
Voil pour lhomme. Maintenant son uvre
Constructa mirifice
La tradition veut que lillustre pontife ait restaur la cathdrale de Clermont la cathdrale de Namace et lait consacre solennellement, un 2 juin : IIII non. [quatuor nonas] Iunii Arvernis civitate dedicatio basilicae Scae Mariae quam Stephanus inclitus pontifex miro honore fieri rogavit et ipse consecravit, dit le martyrologe du XIe sicle66 repris par deux calendriers du XIIIe conservs dans la Canone, recueil lusage des chanoines du chapitre cathdral de Clermont67. Au XVIIe sicle, en 1688 exactement, lun des membres dudit chapitre, le chanoine Jean Dufraisse, ajoute lanne de la conscration : 94568, date contestable et conteste69 parce que surgie don ne sait o et vhicule par la seule tradition locale70.
Mais mis part ce problme de date prcise, il ny a pas vraiment de raison sinon archologico-architecturale de contester lattribution tienne II de la construction de la deuxime cathdrale de Clermont, difice proto-roman ou post-carolingien pour reprendre les termes chers mon collgue Xavier Barral dont au XVIIe sicle et jusquau milieu du XIXe subsistaient les deux tours qui sont du ct de loccident et les deux parcelles de galerie que lon voit dans le clotre 71. Je rejoins lopinion dAlain Dierkens, qui travaillant simultanment sur les dossiers de labbaye de Mozac et de
la cathdrale de Clermont72, a rcemment fustig la trop grande prudence en matire de datation des historiens de lart, toujours rticents faire remonter les difices au-del du seuil critique de lan mil, voire mme au-del du dernier quart du XIe sicle73.
Il est vident que lvque tienne II est lorigine de travaux importants la cathdrale, comme le disent les sources. Comme Alain Dierkens, nous jugeons ds lors inutile de parler du remplacement de la cathdrale dtienne la fin du XIe ou au dbut du XIIe sicle, par un nouvel difice, en relation avec le voyage dUrbain II, un remplacement quaucun texte ne prouve74.
Si, comme laffirme Flodoard de Reims, la ville de Clermont a t pille par les Normands en 92375, une res-tauration/reconstruction de la cathdrale au tout dbut de lpiscopat dtienne est tout fait plausible, mais on sait ce quil en est des pillages normands, souvent aussi mythi-ques que ceux des Sarrasins En tout cas une campagne de restauration des glises a bien t mene au Xe sicle, et rapidement, daprs le Libellus de ecclesiis claromontanis, cet inventaire des glises de Clermont des alentours de lan mil76, qui numre, dans la ville mme 34 glises et en premier lieu la cathdrale (domum matris ecclesie) dont il mentionne lautel in honore sancte Marie et sancti Agricoli et Vitalis 77. La mention par le mme inventaire dun autel ddi saint Michel peut tre un argument supplmentaire pour une datation du Xe sicle, car cest bien alors que le culte de larchange connat en Occident un essor particulier78.
tienne II vnre en tout cas particulirement la Vierge Marie, dont le culte est aussi alors en vogue 79 : cest la mme poque, en 951 prcisment, que le collgue et voisin dtienne, lvque du Puy Gotiscalc, se rendant en plerinage pionnier au tombeau de laptre Jacques Compostelle en Galice, fait recopier par le moine Gomez de labbaye navarraise dAlbelda le trait sur la virginit de Marie de saint Ildefonse de Tolde80 : il est dusage de dire que cette initiative contribuera grandement lessor du
Fig. 2. La façade de la cathédrale d’Etienne II avant les reconstructions de Viollet-le-Duc (gravure de Mallay, 1848)
43Chr. Lauranson Rosaz : Les élites et l’architecture...
Puy, qui prcisment alors dlaisse son appellation antique dAnicium pour celle de Podium Sanct Mari, affirmant sa vocation de cit mariale par excellence 81.
tienne semble tout naturellement lorigine de la nou-velle ddicace Marie de la cathdrale de Clermont : en 910, propos dune donation de son prdcesseur Adalard, les saints Agricol et Vital taient encore les seuls patrons de la cathdrale82. Ils vont tre dsormais dabord associs, puis supplants par la sainte Vierge qui lemporte sur eux avant la fin du sicle83 enfin associs, parfois avec saint Laurent, au moins jusquau dbut du XIIIe sicle84.
La conscration a d avoir lieu trs peu de temps aprs llection dtienne, le temps dachever son uvre et dy ins-taller sa fameuse Vierge en Majest, que plusieurs chartes originales du chapitre cathdral de la seconde moiti du Xe sicle mentionnent trnant dans la nouvelle cathdrale85 :
Vtue, avec un baldaquin surmont dun cabochon de cristal , elle est expressment cite dans les deux inven-taires du trsor et des livres de la cathdrale qui nous sont parvenus en chartes originales de la seconde moiti du Xe sicle86. On possde un inventaire des reliques dont tien-ne II fit bourrer la statue, reliques prtendument apportes Clermont par saint Austremoine : imago matris Domini et imago filii ejus : cheveux et tunique mouille du lait de la Vierge, ongles, ombilic, prpuce, cheveu et barbe du Christ, sans oublier des fragments du Suaire et de divers instruments de la passion87
La Majest de Marie est surtout reprsente par un dessin la plume figurant au dbut de la fameuse Visio Rotberti 88, texte concernant labb Robert de Mozac lequel est cit entre 944 et 97489 mais rdig postrieurement par le diacre Arnaud.
On a donc ainsi divers textes ou documents nous ren-seignant sur la reconstruction de la cathdrale par tienne, sur sa conscration en lhonneur de la Vierge, sur sa beaut digne de la Jrusalem cleste . Sans donner de date prcise, ils orientent tous vers une fourchette chronologique correspondant au rgne dtienne, dans tous les cas avant 984, date de la mort dtienne, qui a consacr son uvre, donc la acheve, et y a plac solennellement sa Majest.
Avant den terminer, il convient de dire deux mots de la source la plus remarquable concernant la cathdrale dtienne, la Visio Rotberti, Vision de labb de Mozac Ro-bert rapporte par le sermon du diacre Arnaud, texte qui se trouve la fin des livres hagiographiques de Grgoire de Tours, dans le manuscrit 145 de la bibliothque de Clermont dj cit, du f 130 v au f 134 r 90. Dat de la fin du Xe/dbut XIe sicle, dit au XVIIe sicle par lrudit clermontois Jean Savaron, ce texte onirique fut redcouvert en 1923 par Mar-cel Brhier qui en donna les passages ayant trait la Vierge reliquaire91. Publi par Ren Rigodon en 1950, il a rcemment t rdit de manire critique par Dominique Iogna-Prat et Monique Goullet, afin dillustrer le dveloppement du culte marial aux temps carolingiens92.
Dans ce sermon emprunt une vie de labb Ro-bert comportant le rcit de sa vision, sont mls des rminiscences de lApocalypse 93 bien des traits intressant la cathdrale ; le diacre Arnaud crivait aprs la mort de labb Robert et celle dtienne II, soit aprs 984 ; il connaissait la cathdrale construite par le saint vque et la vierge reliquaire et sen inspirait son tour. Cest dans ce cadre que ce sermon pouvait prendre tout son intrt pour ses auditeurs :
tienne II construisit dans sa ville de Clermont une basilique en lhonneur de la mre de Dieu toujours vierge, admirable basilique comme on na de notre temps rien en-
trepris ni vu de semblable. La Vierge en lhonneur de laquelle il la difie et consacre la aid et inspir 94.
Lvque avait auprs de lui un clerc nomm Alleaume/Adalelmus, de grande naissance, qui savait travailler aussi bien la pierre que lor, bien connu de tous nos contempo-rains ; on ne pouvait le comparer aucun artiste connu auparavant ; ce fut lui qui traa avec un roseau le plan de cette glise et le ralisa magnifiquement. tienne II, en songe, entrane vers la basilique labb Drucbert, le prdcesseur de labb Robert, pour voir les grandes et belles constructions, clbres dans tout le pays quil a prpares pour dposer les reliques : et ayant pntr dans latrium, ils admirent, avant dy arriver, les portes, hautes de 8 coudes, larges de 4, et chaque porte com-portait deux admirables grandes roues, et sous chacune delles on en voyait trois autres avec au milieu comme une grosse noix ; chacune de ces portes tait dune beaut ineffable et semblait tre de marbre blanc, lune des roues tait dun vert profond, la seconde dun bleu dazur et la troisime comme un rubis 95. Les portes franchies, ils virent, rapporte labb Robert, des marches monter jusqu un pont dune construction admirable et les piliers des arches qui le portaient droite et gauche parais-saient tre de lor le plus pur. Fais attention en marchant sur ce pont, trs cher, dit le pontife, car je nen ai pas encore prouv la solidit ; alors quils savancent plus lintrieur, ils voient une rivire profonde dont Drucbert demande le nom, il lui fut aussitt rpondu que ctait le Physon, des escaliers droite et gauche du pont per-
Fig. 3. La Vierge en majesté d’Étiene II(BM Clermont-Ferrand, ms. 145, f ° 130 v°)
44
mettaient de monter en son milieu. Regardant du ct de lOrient, ils voient alors une uvre dune beaut ineffable : il y avait treize cryptes (chapelles votes), lOrient et il y en avait autant lOccident mais diffrentes ; il y avait dans celles qui se trouvaient dans la partie occidentale les douze signes du zodiaque dont nous ne pouvons dcrire un un la richesse car dans ces chapelles il y avait aussi de merveilleuses statues des douze aptres et aux pieds de chacun deux un autel de marbre et contre chacun de ces autels sept lampes brillaient. Mais parmi ces cryptes il y en avait une plus belle que toutes les autres ; elle avait une porte qui semblait tout en or et au sommet de cette porte il y avait douze fltes de cristal sur lesquelles taient fixes douze pierres prcieuses : les pierres prcieuses sur ces fltes surpas-saient en clat tout le reste enfin, dans la troisime crypte, au-dessus du milieu de la porte, il y avait un splendide aigle dor dont les pieds reposaient sur une pierre inconnue dune beaut indescriptible. Non loin dans un endroit plus lev, ils voient un agneau dune beaut merveilleuse et enfin, droite de lagneau sept toiles illuminaient le temple de leur splendeur ; ils aperoivent bientt le visage de Notre-Seigneur comme durant sa passion si bien que la crainte et langoisse permettent peine den contempler la majest sans prix car, au ct du Rdempteur, on voyait couler leau et le sang jusqu la ceinture. sa droite il y a la statue de sa mre en or prcieux et gauche celle de saint Jean dun trs beau travail. Mais lintrieur, dans le Saint des Saints, il y avait un autel surlev dune beaut indescriptible auquel on accdait par trois marches : sur lautel, la majest du Rdempteur y tait merveilleusement peinte de couleurs varies ; droite il y avait la Vierge, gauche, saint Michel et, de-ci de-l, des chrubins et des sraphins aux ailes ouvertes . Derrire lautel il y avait une magnifique colonne surmonte dun socle comme de jaspe o se trouvait la statue de la Vierge quavait fait faire le vnrable pontife . Le songe de labb Robert sachve, on en avertit lvque
tienne II : celui-ci ordonne dexcuter au plus vite ladite majest, dy placer les reliques dj mentionnes, qui taient
dposes dans la basilique et de les placer, comme il faut, derrire lautel ; sans aucun doute, il ny a pas de reliques plus prcieuses au monde ; le saint vque les vnrait et honorait plus que les autres reliques car il dposa les reliques des saints dans de nouvelles chsses dor et dargent, mais ces reliques de la Vierge, il voulut les honorer dune faon diffrente il y avait une cathdre en or et pierres trs prcieuses avec une statue de la mre de Dieu dun ouvrage admirable en or trs fin et celle de son fils Notre Seigneur, assis sur ses genoux, et cest dans celle statue quil dposa les clbres reliques .
* * *
De Namace tienne, cinq sicles se sont couls, en mme temps que le haut Moyen ge, poque rpute particulirement fruste, notamment en matire architec-turale.
Au Ve sicle, lcroulement de lempire ne semble pas particulirement propice au mcnat architectural, et pourtant lexemple de lvque Namace de Clermont illus-tre la continuit de lart de btir alors que le christianisme reconnu simpose lOccident. Parce que lAuvergne et le centre de la Gaule sont labri des Barbares ? On sait ce quil en est vraiment de la barbarie des envahisseurs , notamment des Wisigoths.
On a une mme version ngative du Xe sicle, appel le sicle de fer , celui des Normands, Hongrois et autres Sarrasins, celui de la fin de la dynastie carolingienne et de la problmatique mutation fodale. Depuis quelques dizaines dannes cependant, notamment grce la redcouverte des environs de lan Mil, certains historiens de lart sont revenus bon droit sur des prjugs architecturaux maintenant dpasss.
Pourquoi ne pas accorder un peu plus de crdit aux textes, fussent-ils parfois extra-ordinaires parce que relevant de lhagiographie et du miraculeux ? Celui qui plaide ainsi pour lattention aux textes devant un public essen-tiellement constitu dhistoriens de lart et darchologues, attentifs avant tout aux vestiges et aux objets, est dautant moins complex le faire quil est historien du droit et des institutions, donc trs (trop ?) respectueux des textes.
1 R. RIGODON, Vision de Robert, abb de Mozat, au sujet de la Basilique de la Mre de Dieu difie dans la Ville des Arvernes, relation par le diacre Arnaud, in Bulletin historique et scientifique de lAuvergne, LXX, 1950, p. 22-55.2 P.-Fr. FOURNIER, Clermont-Ferrand au VIe sicle, in . Desforges, G. et P.-Fr. Fournier, J.-J. Hatt, Fr. Imberdis (dir.), Nouvelles recherches sur les origines de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, 1970 (Publications de lInstitut dtudes du Massif Central, 5), p. 273-344.3 Chanoine B. CRAPLET, Cinq sicles dart en Auvergne (950-1450), in A.-G. Manry (dir.), Histoire de lAuvergne, Toulouse, 1974, p. 141-182, ici p. 146-155.4 M. VIEILLARD-TROEkOUROFF, La cathdrale de Clermont du Ve au XIIIe sicle, in Cahiers archologiques, fin de lAntiquit et Moyen ge, 11, Paris, 1960, p. 199-247, avec une bibliographie complte de la question ; EAD., Les monuments religieux de la Gaule daprs les uvres de Grgoire de Tours, thse Paris IV, 1974, Lille III (service de reproduction des thses) p. 73, (Clermont-Ferrand) Cathdrale des saints Vital et Agricol, p. 85-89. Avant elle, H. du RANQUET, Les fouilles du chevet de la cathdrale de Clermont, in Bulletin monumental, 1909, p. 311 ; ID., Clermont, la cathdrale, in Congrs archologique de France, 1924, p. 12-44. L. BRHIER, Les origines de larchitecture en Auvergne. Luvre des chapitres et des monastres, in Revue Mabillon, 4, 1923, p. 10. Dans le cadre douvrages dhistoire de lart plus gnraux, signalons du mme L. BRHIER, Lart en France des invasions barbares lpoque romane, Paris, 1930, p. 74 ; et de J. HUBERT, Larchitecture religieuse du haut Moyen ge, 1952, n 94.5 P. CHEVALIER, La crypte de la cathdrale de Clermont : nouvelles approches, in Lan mil. Fin dun monde ou renouveau ? (Actes des XXXIIIes Journes Romanes de Cuxa, 7-14 juillet 2000), Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, 32, 2001, p. 133-146 ; EAD., Larchologie du bti applique la rvision dune fouille ancienne, celle de la crypte de la cathdrale de Clermont, in I. Parron-kontis et N. Reveyron (d.), Archologie du bti. Pour une harmonisation des mthodes (Actes de la table ronde 9 et 10 novembre 2001. Muse archologique de Saint-Romain-en-Gal (Rhne), Paris, 2005, p. 87-94 (et notes 220-290 p. 155-157).
45Chr. Lauranson Rosaz : Les élites et l’architecture...
6 Douze fois selon M. VIEILLARD-TROEkOUROFF, op. cit. (n. 4). Dans sa thse, elle repre 13 occurrences : Lvque parchius, aprs avoir pass le temps du carme dans un oratoire de la banlieue, revenait en procession ad eclesiam suam : GRGOIRE DE TOURS, Libri historiarum X, alias Historia Francorum, abr. HF, d. B. krusch et W. Levison, MGH, SSRM, I, 1, Hanovre, 1951, et trad. R. Latouche, Paris, 1963, II, 21. Une nuit, il trouve plenam ecclesiam a demonibus (ibid.). Cum ante nocte minatus fuisset [Sidonium] de ecclesia velle extrahere, signum ad matutinis audiens fuisset commotum Nec istud sine haresi potest accipi ut in ecclesiam non obaudiatur sacerdos Dei [Sidonius] rogat suos ut eum in ecclesiam ferrent, cumque illuc inlatus fuisset presbiter ille nequam jussit cunctos cives in domo ecclesiae invitari (HF, II, 23). Firminus cum socra sua eclesiam petiit. Chramn dpche deux envoys avec lordre : Vi extrahite Firminum Caesariamque, socrum ejus, de eclesia Ingrediuntur eclesiam deambulantes per eclesiam ab eclesia ejeciunt (HF, IV, 13). Une alouette, entre in ecclesia Arverna, y teint les lumires (HF, IV, 31). Des clercs sont assembls in ecclesia Arverna (HF, IV, 35). Des prisonniers sont librs, miraculeusement ecclesiam ingressi sunt (HF, X, 6). Gal, nomm vque, in civitatem suscipitur et in sua ecclesia ordinatur (VP, VI, 3) ; il est outrag par un prtre in convivio ecclesie (ibid., VI, 4) ; un incendie ayant clat Clermont, ingressus ecclesiam, il y prie, puis marche droit au feu, qui steint (ibid., VI, 6) ; aprs sa mort, son corps in ecclesia deportatus fuisset, in ecclesiam defertur (HF, IV, 5, VP, VI, 7).7 M. VIEILLARD-TROEkOUROFF, op. cit. (n. 4), p. 200. Un vque dOrlans vers 581-587 (Mgr L. DUCHESNE, Fastes piscopaux de lancienne Gaule, Paris, 1907, I, 457), un autre dAngoulme en 627 (II, 69). Cf. M.-Th. MORLET, Les noms de personne sur le territoire de lancienne Gaule du VIe au XIIe sicle, II, Les noms latins ou transmis par le latin, Paris, 1972, p. 81 : Lonomastique pense que ce nom est un gentilice driv de Nama . . LE BLANT (Recueil des inscriptions chrtiennes de la Gaule antrieures au VIIIe sicle) offre 1 Namatius, 425 : il aurait dsign lvque de Vienne, mort en 522 ; sa tombe se trouverait dans lglise Saint-Pierre de Vienne. J. BAUDOT, Dictionnaire dhagiographie, Paris, 1925, signale deux saints de ce nom, le saint vque de Vienne et saint Namas, honor Rodez au Ve sicle.8 Cest lui qui par ses soins a bti une glise qui existe encore et qui, situe lintrieur des murs de la cit [note 11 infra] en est lglise mre .9 P.-Fr. FOURNIER, op. cit., p. 308-310 et 333-343, montre bien que le monastre Saint-Alyre eut, comme Saint-Seurin de Bordeaux, des prtentions la premire place des glises. Aux XVIe et XVIIe sicles, chaque nouvel vque de Clermont, aprs avoir sjourn Billom, devait passer une ou deux nuits labbaye Saint-Alyre avant dentrer dans la Cit par la porte des Gras, puis dans la cathdrale. G. ROUCHON, Notre-Dame de Clermont, Auvergne Littraire et Artistique, 2e et 3e cahiers, 1934, 11 anne, n 3, p. 65. Cette coutume, observe aussi Bordeaux, Prigueux et Vaison, suggre par la prsence de Notre-Dame-dEntre-Saints toute proche mais oublie, Saint-tienne reconstruite et Saint-Jean-Baptiste, explique quon y ait vu le groupe piscopal primitif. Ces transferts supposs (dont il ne fallait pas faire une loi, comme le remarquait justement dom J. DUBOIS, Lemplacement des premiers sanctuaires de Paris, in Journal des Savants, 1968, p. 5-44), et nous rappelons toute la prudence de P.-Fr. Fournier pour Clermont, ont t infirms depuis dans tous les cas o cela a t tent par les recherches archologiques et historiques les plus rcentes (voir dernirement Arles ou Bordeaux). Cette hypothse, considre autrefois comme trs probable, doit vraisemblablement tre aussi abandonne pour Clermont.10 P.-Fr. FOURNIER, Nouvelles recherches sur les origines de Clermont, 1964, p. 501-502, comparant la direction de laqueduc romain avec la situation des conduits qui rpartissaient leau dans la ville, a pu prciser que la cathdrale aurait occup lemplacement o cet aqueduc devait aboutir une sorte de bassin de rpartition.11 HF, II, 16, trad. R. Latouche, t. I, p. 105-106 : Aprs le dcs de lvque Rustique, saint Namatius a t cette poque le huitime vque chez les Arvernes .12 HF, II, 21. Prtre Clermont vers 490, puis vque, cf. Chr. SETTIPANI, Ruricius Ier vque de Limoges et ses relations familiales, in Francia, Band 18/1 (1991), Sigmaringen, 1991, p. 195-222 [Prosopograpghica X], notamment p. 205-209, d) Ruricius et les Namatii. Sur Eparchius, sa note 23, p. 199. galement R.W. MATHISEN, The Ecclesiastical Aristocracy of the Fifth Century Gaul : A Regional Analysis of Family Structures, diss. Wisconsin Univ., 1979, p. 371, et M. HEINZELMANN, Bischofsherrschaft in Gallien. Zur kontinuitt rmischer Fhrungsschichten vom 4. bis zum 7. Jahrhundert. Soziale, prosopographische und bildungsgeschitliche Aspekte, Mnchen, 1976 [Beihefte der Francia, 5], 1, 596.13 Gallia Christiana in Provincias Ecclesiastica Distributa (abr. GC ), 16 vol., Paris, 1715-1865, t. II (1720), col. 230-231. IX. S. NAMATIUS. Pergens Gregorius in extendo catalogo episcoporum su patri, docet lib. 2 hist. c. 16 Namatium qui uxorem habebat, S. Rustico subrogatum fuisse. Qui dificavit ecclesiam cathedralem seu seniorem, uti loquitur Gregorius, infra muros civitatis, habentem in longum pedes centum quinquaginta, in latum pedes sexaginta, in altum infra capsum usque cameram pedes quinquaginta : in ante absidem rotundam habens, ab utroque ascellas eleganti constructas opere ; totum dificium in modum crucis habetur expositum. Habet fenestras 24. columnas septuaginta, ostia octo Parietes ad altarium opere sarusrio, ex multo marmorum genere exornatos habet. Exacto ergo in duodecimo anno beatus pontifex dificio, Bononiam civitatem Itali sacerdotes dirigit, ut et reliquias sanctorum Vitalis et Agricol exhibeant quos pro nomine Christi Dei nostri manifestissime crucifixos esse cognovimus.
Uxor S. Namatii eodem studio pro gloria domus Dei accensa, basilicam S. Stephani dificavit in suburbio Arvernorum, qu ab annis circiter 200. nomen habet S. Eutropii, estque nunc ecclesia parochialis.
Ceterum olim rarissime dificat sunt ecclesi intra muros: nam plerque basilic super martyrum tumulos sunt construct, qui extra muros erant, cum olim vetitum esset in urbibus mortuorum cadavera condere.
Pia matrona cum basilicam hanc fucis colorum adornare vellet, tenebat librum in sinu suo, legens historias actionum antiquorum, pictoribus indicans qu in parietibus finger deberent, inquit Grgorius. Qu de ea subdit probant quant esset humilitatis hc sancta mulier , quippe qu ex veste astra et vili, pro paupere fmina sedente ad eleemosynam habita sit, nec dedignata fuerit frustum panis a mendico accipere; quam humilitatem Deus miraculo remuneravit. Sepultus est sanctus Namatius in ecclesia S. Stephani, ut docet libellus de ecclesiis notis Savaronis illustratus, c. XIII. In ecclesia S. Stephani, ubi Namatius, etc. et alia sanctorum corpora, quorum nomina nescimus, quiescunt. S. Namatii festum celebratur die 27. Octobris. De annis episcopatud S. Namatii Tillemontius tom. XV. commentariorum, ita conjicit: Forte successit Rustico an. 446. rexit usque ad 462. quo Eparchio locum dedit, qui obiit saltem an. 471. sed de his nihil constat. Quamvis titulo sancti sit insignitus, nullus tamen ejus cultui dies [primitus] est assignatus.14 k.F. STROHEkER, Der senatorische Adel im Sptantiken Gallien, Tbingen, 1948, p. 194 n 254, suivi par M. HEINZELMANN, op. cit. (n. 12), p. 230, n. 280 et R.W. MATHISEN, op. cit. (n. 12), p. 334 n. 614.15 k.F. STROHEkER, op. cit. (n. 13), Tableaux, notamment celui de la p. 199.16 Chr. SETTIPANI, op. cit. (n. 12). Citons sa note 69, p. 205 : On notera que les vques de Clermont du IVe au VIIIe s. portent des noms que lon re-trouve dans les grandes familles arvernes ou aquitaines (Rusticus [8], Namatius [9], Eparchius [10], Euphrasius [13], Caesarius [19], Gallus III [20] ou sont directement attests comme nobles ou apparents de grands personnages (Artemius [6], Apollinaris I [11], Abrunculus [12], Apollinaris II [14], Gallus I [16], Avitus I [18], Genesius [21], Praiectus [25], Avitus II [26], Bonetus [27] . Renvoi I. WOOD, The Ecclesiastical Politics of Merovingian Clermont, in Ideal and Reality in Frankish&Anglo-Saxon Society. Studies presented to J.M. Wallace-Hadrill, Oxford, 1983, p. 34-57, spc. p. 56-57. Lun des fils de Rurice de Limoges avait pous la fille de Namatius et de Ceraunia (ibid., p. 205).17 R.W. MATHISEN, op. cit. (n. 12), p. 220 ; Chr. SETTIPANI, op. cit. (n. 12), p. 206 : Quant la famille de lvque de Clermont, il pourrait sagir de celle des Claudii de Vienne, dont deux des reprsentants les plus illustres sont Rutilius Claudius Namati(an)us, pote et prfet de Rome dans lt 414, et Mamert Claudien (Mamertus Claudianus), frre de lvque saint Mamert (+ 475). Un descendant de cette famille est le vir illuster Namatius, patrice
46
de Provence, dorigine illustre, poux dEuphrasia, qui mourut en tant quvque de Vienne en, 559 lge de 73 ans . Il ajoute en n. 75 : Lpouse de Namatius, Euphrasia, tait de haute naissance (Fortunat, Carm., IV, 27 : ardua nobilitas proavorum luce coruscans). Elle appartient de toute vidence la famille des Euphrasii dAuvergne (tudie par R.W. MATHISEN, op. cit. [n. 12], p. 229-301), auxquels se rattachent notamment lvque Euphrasius de Clermont, parent de Ruriucius, Euphrasius, prtre Clermont, frre de Sallustius, fils dEvodius et petit-fils dHortensius, tous comtes de Clermont, Euphrasius, abb de Chamalires (prs de Clermont) c. 670 et enfin Euphrasia, fille du comte de Clermont Hictor et femme en 764 du comte de Limoges Rogerius/Roger . Ibid, p. 206 : le nom de Namatius se retrouve notamment dans la liste piscopale dAngoulme au VIe sicle (L. DUCHESNE, op. cit., p. 69, n 10).18 Chr. SETTIPANI, loc. cit.19 Lettres, d. A. Loyen, t. III, Paris, 1970. Livre VIII, lettre VI, SIDONIVS NAMATIO SVO SALVTEM. Le correspondant de Sidoine et son compatriote (dAuvergne ?), qui il envoie les libri logistorici de Varon et la chronographie dEusbe, est apparemment alors install en Saintonge et guerroie sur locan contre les Saxons (13-18). Sidoine fait surtout allusion ses activits de btisseur, mais aussi dagriculteur et de chasseur (10-11) : Chasses-tu ? Fais-tu btir ou tadonnes-tu aux travaux des champs ? Te livres-tu une seule de ces occupations ou chacune delles tour tour ou toutes la fois ? Pour ce qui est de Vitruve ou de Columelle, que tu suives les traces de lun des deux ou des deux ensemble, tu le fais trs bien, car tu as la comptence voulue pour imiter lun et lautre comme lun de leurs meilleurs disciples, je veux dire en tant quagriculteur ou en tant quarchitecte et parmi les plus valeureux. Par contre, je ne saurais trop te recommander de te flatter le moins possible de tes talents de chasseur .20 M. ROUCHE, LAquitaine des Wisigoths aux Arabes 418-781. Naissance dune rgion, Paris, 1979, p. 42.21 HF, II, 20.22 HF, II, 17 : Comme elle voulait la dcorer avec des peintures de couleur, elle tenait dans son sein un livre o elle lisait des histoires de lantiquit pour indiquer aux peintres ce quils devaient reprsenter sur les murs. Or il arriva un certain jour o elle tait assise dans la basilique et lisait quun pauvre y vint pour faire oraison. Voyant cette femme vtue de noir, dun ge dj avanc, il pensa que ctait une des indigentes et il tira un morceau de pain quil posa dans le sein de cette femme et sen alla. Loin de ddaigner le prsent du pauvre, qui navait pas devin sa personnalit, elle laccepta, le remercia et le serra. Elle le plaait devant elle ses repas et chaque jour en prenait un morceau quelle bnissait jusqu ce quil fut consomm .23 Libellus de ecclesiis claromontanis ou liste des glises et autels de Clermont, de la seconde moiti du Xe ou du XIe sicle, se trouve dans le ms 147 de la BCIU de Clermont-Ferrand, provenant de Saint-Alyre ; d. J. Savaron, De sanctis ecclesiis et monasteriis Claromontii, Paris, 1608, puis W. Levison, MGH, Scriptores rerum merovingicarum, t. VII (Hanovre-Leipzig, 1920), p. 454-467. Cf. infra, n. 76.24 M. VIEILLARD-TROEkOUROFF, op. cit. (n. 4).25 Hic (Namace) ecclesiam, qui (var. quae) nunc constat et senior infra (var. intra) muros civitatis habetur, suo studio fabricavit (HF, II, 16). P.-Fr. FOURNIER, loc. cit. (n. 2) : La traduction de lHF, par R. Latouche porte lextrieur des murs : il a bien voulu me mander quil sagit dune banale coquille dimpression pour intrieur. Sur lemplacement de lecclesia, voir aussi lpisode du juif converti, ch. 6. 26 La ville ancienne navait, malgr ses cinq portes, que 2,95 hectares : elle eut bien du mal recevoir ldifice, appuy contre le rempart occidental, et de dimensions consquentes, avec son plan basilical en croix avec deux ailes et abside Il restait si peu de place que lvque ne put btir de palais piscopal et se contenta dune maison, cf. M. ROUCHE, op. cit. (n. 20), p. 288, avec un tableau complet de la ville depuis le Ve sicle jusquau VIIIe sicle 27 P.-Fr. FOURNIER, loc. cit. (n. 2). Cf. Mgr L. DUCHESNE, Fastes piscopaux, II, 34 ; M. VIEILLARD-TROEkOUROFF, op. cit. (n. 4), p. 200-201.28 M. VIEILLARD-TROEkOUROFF, op. cit. (n. 4), p. 200, daprs GRGOIRE DE TOURS, HF, II, c. 16 : Hic ecclesiam qui nunc constat et senior intro, murus civitatis habetur, sue studio fabricavit, habentem in longe pedes 150, in lato pedes 60, id est infra capso, in alto us que cameram pedes 50, inante absidam rotundam habens, ab utroque latere ascellas eleganti constructas opere; totum aedificium in modum crucis habetur expositum. Habet fenestras 42, columpnas 70, ostia 8... Exactum ergo in duodecimo anno beatus pontifex edificium, Bononiae civitatem Italiae sacerdotes dirigit ut ei reliquias sanctorum Agricolae et Vitalis exhibeant, quos pro nomine Christi Dei nostri manifestissime crucifixos esse cognovimus . 29 Selon les calculs rectifis de Michel ROUCHE, loc. cit. (n. 20), la longueur serait de 44,40 m, la largeur intrieure de 17,86 m et la hauteur de 14,80 m. Il rajoute que cette cathdrale est lgrement plus petite que celle de Saint-Martin de Tours construite la mme poque par Perpetuus.30 Ibid. Diverses interprtations ont t donnes de cette description : pour Louis BRHIER, op. cit. (n. 4), p. 74, lglise avait lentre une abside ronde et la nef se terminait donc chaque extrmit par une abside. Interprtation reprise par mile MLE, La fin du paganisme en Gaule et les plus anciennes basiliques chrtiennes, Paris, 1950, p. 135 et note 2. Chez Grgoire de Tours, il nest pourtant question que dune abside. Pour un homme dglise comme Grgoire, le chevet, tait tout naturellement en avant (J. HUBERT, op. cit. (n. 4), p. 49).31 Ibid. Ldifice en forme de croix devait comporter un transept, fait assez remarquable en Gaule au Ve sicle, alors quon en trouve de nombreux exemples en Italie, en Grce et en Orient depuis le IVe sicle. Que signifient les ascellas , bras du transept daprs Mle, prothesis et diaconicon, daprs BRHIER, ou simplement bas-cts ? .32 Ibid. Comme dans les tentatives de restitution de Saint-Martin de Tours, on essaye en vain de rpartir fentres, colonnes et portes. Les chiffres de 70 colonnes et de 8 portes ne prouvent pas (comme le pense E. MLE, op. cit. (n. 30), p. 134) que la cathdrale avait de doubles bas-cts ; les colonnes peuvent tre utilises pour un atrium, des tribunes, un ciborium, et les portes distribues sur les cts ou au chevet comme Saint-Martin de Tours .33 Cette translation de reliques a t raconte par Grgoire de Tours dans son Liber in gloria martyrum (chap. 43).34 Ut scilicet eas in ecclesia quam ipse construxerat collocaret (GM, 43).35 Cest sous leurs vocables que sa ddicace figure au Martyrologe hironymien : Pridie idus maii (AA. SS., nov. II-1, p. 60 ; II-2, p. 253). Cf. M. VIEILLARD-TROEkOUROFF, op. cit. (n. 4), p. 204, n. 7.36 GM, 43 : Horum reliquias Namacius, Arvernorum episcopus .37 AA. SS. Nov. II, Bruxelles, 1894, p. 60. Au milieu du XVIIIe sicle, on voulut nouveau clbrer cette date.38 AA. SS., op. cit., p. 151. Hippolyte DELAHAyE, Les origines du culte des martyrs, Bruxelles, 1933, p. 343, ne mentionne pas linscription de la chsse et sexplique mal cette fte .39 Martyrologe du XIe sicle ; BnF, ms lat. 9085.40 M. VIEILLARD-TROEkOUROFF, op. cit. (n. 4), p. 204-205. Cf. sa note : La Gallia Christiana II, 1720, col. 253 et 254, reporte ces faits au temps de Charles le Simple alors que seul Charlemagne put faire donner Bologne des reliques un vque de Clermont, comme la peu aprs montr LANCELOT, Mmoire sur lancienne Gergovia, dans les Mmoires de lAcadmie des Inscriptions et Belles-Lettres IX, 1731, qui en donne un fac-simil, p. 422 (re-produit par A. TARDIEU, Histoire de la ville de Clermont, Moulins, 1870, p. 240), et apporte de nombreuses corrections au texte de la Gallia christiana. Les chsses furent fondues en 1792 .41 Le tmoignage de LANCELOT qui prit lempreinte de ces chsses, celui du chanoine P. AUDIGIER, Histoire manuscrite de lglise dAuvergne, dite Clermont-Ferrand en 1899, p. 341 [ou Histoire de la ville de Clermont, BnF, ms fr. II, 485 et daprs BALUZE, Histoire gnalogique de la Maison
47Chr. Lauranson Rosaz : Les élites et l’architecture...
dAuvergne [abr. HGMA], Paris, 1708, t. II [liv. I], p. 35], cit par R. RIGODON, op. cit., p. 40 : Aux deux extrmits au haut de lautel sont deux chsses o on t conserves les reliques des saints Agricol et Vital ne laissent aucun doute ce sujet.42 Le successeur de FRDGAIRE, MGH, Scr. rer. Merov. VII, 1888, p. 187.43 Cette opinion expose au XVIIIe sicle par le chanoine P. AUDIGIER, op. cit. (n. 41), p. 28, fut reprise par labb RAPHANEL, Lemplacement des gli-ses de Clermont au Xe sicle, in Bull. hist. et sc. de lAuvergne, 41, 1921, p. 107-116, 150-157 et 172-186 ; puis par H. du RANQUET, Clermont-Ferrand, la cathdrale, op. cit. (n. 4), p. 14, et La cathdrale de Clermont-Ferrand, 2e d., 1928, p. 7 et 8 ; enfin par le Dr P. BALME, Visite descriptive et historique de la cathdrale Notre-Dame de Clermont-Ferrand, 1947, p. 7 et La cathdrale Notre-Dame de Clermont, s. d. (aprs 1955), p. 2. cette prtendue cathdrale du VIIIe sicle, sont ainsi attribus lancienne crypte chapelles rayonnantes et les entrelacs qui sy trouvent.44 M. VIEILLARD-TROEkOUROFF, op. cit. (n. 4), p. 203-204.45 GC, II, 21 : Et quia eo tempore ecclesia .46 In sacrarium autem sub velo transiens, cicindelum extinguere voluit , HF, IV, 31.47 Signum ad matutinis , HF, II, 23.48 Ad regias aedes sacrae quae tunc reseratae fuerant , HF, IV, 13.49 HF, X, 6.50 HF, II, 23.51 HF, IV, 5.52 VP VI, 4, 6.53 Par le martyrologe du XIe sicle, cit. Cf. p. 209 : IIII non. Iunii Arvernis civitate dedicatio basilicae Scae MARIAE quam Stephanus inclitus pontifex miro honore fieri rogavit et ipse consecravit .54 Par le diacre Arnaud, infra : R. RIGODON, op. cit., p. 46 ; il poursuit : vir spectabilis genere : daprs P. AUDIGIER, op. cit. (n. 41), et daprs BALUZE, HGMA, loc. cit., p. 1, p. 35.55 Sur tienne II, voir notamment G. DESJARDINS, Cartulaire de labbaye de Conques en Rouergue, Paris, 1879, p. XL (gouverne Conques de 942 984) ; R. SVE, La seigneurie piscopale de Clermont des origines 1357, in Revue dAuvergne, 94, 1980, p. 103-105 (piscopat de 943 984 au plus tard ) ; A. POITRINEAU, Le diocse de Clermont, Paris, 1979, p. 285 (vque de 945 976 ) ; Chr. LAURANSON-ROSAZ, LAuvergne et ses marges (Velay, Gvaudan) du VIIIe au XIe sicle. La fin du monde antique ?, Le Puy-en-Velay, 1987, p. 235-237 ; J. BOUSQUET, Le Rouergue au premier Moyen ge (vers 800-vers 1250). Les pouvoirs, leurs rapports et leurs domaines, t. 1, Rodez, 1992, p. 279, 280, 283. Plus rcemment, J.-P. CHAMBON et Chr. LAURANSON-ROSAZ, Un nouveau document attribuer tienne II, vque de Clermont (ca 950ca 960), in Annales du Midi, Tome 114 n 239, juillet-septembre 2002, Mlanges et documents, p. 351-363. Sur le rle pacificateur de lvque de Clermont, Chr. LAURANSON-ROSAZ, Peace from the Mountains: The Auvergnat Origins of the Peace of God, in Th. Head and R. Landes (d.), The Peace of God. Social Violence and Religious Response in France around the year 1000, Ithaca-New-york, Cornell University Press, 1992, p. 104-134. Version franaise : La Paix populaire dans les Montagnes dAuvergne au Xe sicle, in Maisons de Dieu et Hommes dEglise. Florilge en lhonneur de Pierre-Roger Gaussin, Saint-tienne, 1992, p. 289-333.56 Les plus anciennes mentions connues du personnage, en tant quabb de Conques, remontent fvrier 942 : Conq. 145 et 246. tienne est cependant cit en 937, comme vque, dans un rcit de construction dune glise Conques (n. infra). Il est dit abb et vque dans Conq. 186 (avr. 946, cit.), abb dans Conq. 29 et 413 (janv. et mai 948), et 436 (fv. 956). Il nest ensuite cit que comme vque, avec Bgon et tienne abbs, cits ensemble ou non. Lun des deux rcits de la translation des reliques de sainte Foi dAgen Conques, celui en prose (AA. SS., Oct. III, p. 294) mentionne la construction dune glise Conques par labb tienne, vque de Clermont, vnement qui a pu se passer vers 937 (selon le P. GHESQUIER, bollandiste). Cf. P. DESCHAMPS, Lorfvrerie Conques vers lan 1000, in Bulletin monumental, CVI, 1948, p. 89, traduction du rcit de la translation de sainte Foy en prose, du dbut du XIe sicle : tienne, prlat de plus actifs et des plus entreprenants insista pour quon remplat lancienne glise devenue trop petite par une glise plus vaste. Aussi leva-t-on rapidement une basilique .57 La date de 937, souvent avance, pour le dbut de lpiscopat dtienne, est due au Pre GHESQUIER, bollandiste, qui date de vers cette anne lun des deux rcits de la translation des reliques de sainte Foi dAgen Conques, celui en prose (AA. SS., Oct. III, p. 294) mentionnant la construction dune glise Conques par labb Etienne, vque de Clermont : il est suivi par la Gallia christiana, II, col. 255-257.58 GHESQUIER, loc. cit.59 La date de 943 que lon retient pour la charte n 481 du cartulaire de Sauxillanges (donation des glises dAulnat et de Fournols), alors que son dou-ble, la charte n 16, est date de 953 (anno XVIII au lieu de VIII), est sujette caution. Les premires mentions de lpiscopat dtienne II viennent des cartulaires de Brioude et de Conques : Br. CCCCXXXIV, 7 octobre 945 ; Conq. 186, avril 946. Rajoutons une charte de Cluny (A. BERNARD et A. BRUEL, Recueil des chartes de labbaye de Cluny, Paris, 1876, n 792) rcemment redate par J.-P. CHAMBON (Pour la datation) de peu avant septembre 944 : Conq. 88 et 123, supra. Le terminus ad quem de lpiscopat dtienne est octobre 984, date laquelle il nest plus mentionn (Conq. 259 et 332). La Gallia christiana ne le fait vivre que jusquen 970 !60 Archives dpartementales du Puy-de-Dme, 3G Arm. 18, sac A, c. 4 : Anno incarnationis dominice DCCCCLVIII, indicione prima, accidit, in ipso anno, ut princepes Arvernorum se rebellarent. Sed, Domino adjuvante et Stefano Arvernorum episcopo regnante, pax, que omnia superat, intra fines nostros jam regnat. Interea accidit ut quidam ex principes, Calstus videlicet, aliquid de rebus alterius invaserat, videlicet alode cujusdam canonicum nomine Amblardum non juste sed injuste obtinuit. Ob hanc causam, propter quod injuste tenebat, venit prefatus Calstus et uxor sua Oda et infantes sui, Petrus videlicet et Hugo et Stephanus, in civitate Claromonte, ubi fulget Stephanus, ipsius sedis episcopus. Ibi adfuit Rotbertus vicecomes et Stefanus abba, et Rotbertus abba, et seniores laici et clerici, seu monachi ; et ibi se recognovit jam dictus Calstus illum alode in girgia (s.d. Girgoia) injuste tenuisset, et in presentia ipsius caterve stipulavit, et hanc noticiam guerpicionis fieri jussit et firmavit manu propria et infantes suos et suis militibus ab omnibus firmare fecit. Sig. Calsti. Sig. Ugoni. Sig. Stefani. Sig. Stephani episcopi. Sig. Rotbert vicecomitis. Sig. Rotbert abbas. Facta in mense septembris, feria V, annos IIII regnante Lothario rege. Teodericus scripsit.61 Chr. LAURANSON-ROSAZ, Des mauvaises aux bonnes coutumes, in M. Mousnier, J. Poumarde (d.), La coutume au village dans lEurope mdivale et moderne, Actes des XXes Journes Internationales dHistoire de lAbbaye de Flaran. Septembre 1998, Toulouse, 2001, p. 19-51.62 J.-P. POLy et . BOURNAZEL, La mutation fodale Xe-XIIe sicles, 1e dition Paris, 1980. Contra D. BARTHLEMy, La mutation fodale a-t-elle eu lieu ?, Paris, 1907. Sur le dbat, Chr. LAURANSON-ROSAZ, Le dbat sur la mutation fodale : tat de la question, in Pr. Urbanczyk (dir.), Europe around the year 1000, Warszawa (Varsovie), Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, 2001, p. 11-40. Autre publication dans la revue italienne Scienza & Politica, 26, Bologne, 2002, p. 3-24.63 Supra, chronologie.64 Chr. LAURANSON-ROSAZ, Peace from the Mountains..., op. cit. (n. 55), p. 104-134. Version franaise, La Paix populaire..., op. cit. (n. 55), p. 289-333.
48
65 Visio Rotberi, infra.66 BnF, ms lat. 9085, cit., f 28.67 Arch. dp. du Puy-de-D., 3G suppl. 15, f 65 et f 255. La premire mention indique le 2 juin arvernis civitate dedicatio basilice sanctae Mariae qua Stefanus inclitus pontifex miro honore fieri rogavit et ipse consecratur (f 65). La deuxime mention (f 255) est plus sobre et indique simplement la date du 2 juin : dedicatio arverniae sedis, toujours sans millsime. La date du millsime, 945, nest aucunement mentionne.68 Op. cit.69 Encore rcemment P. CHEVALIER, Larchologie du bti, op. cit. (n. 5), p. 87-94, ici p. 93 : Quelle datation pour la crypte ?70 Dufraisse est immdiatement suivi par son collgue le chanoine Pierre AUDIGIER, op. cit. La cause du succs semble due une question de prsance de Clermont par rapport Montferrand : P. CHEVALIER, loc. cit.71 Ces tours ont t dmolies en 1849. Les lments mentionns sont romans ou plus anciens. Ils attestent la prsence dun clotre (retrouv lors des fouilles de Ph. Arnaud).72 A. DIERkENS, Une abbaye mdivale face son pass : Saint-Pierre de Mozac, du IXe au XIIe sicle, in crire son histoire. Les communauts religieuses face leur pass. (Actes du 5e colloque international du CERCOR des 6-8 novembre 2002), Saint-tienne, 2005, p. 98-99.73 ID., notamment p. 98, n. 125. . VERGNOLLE (Les dbuts de lart roman..., op. cit., p. 169, n. 37) me semble faire preuve dune prudence excessive quand elle donne 1029 comme terminus ante quem. Tout comme P. CHEVALIER, La cathdrale de Clermont-Ferrand : la crypte, in Congrs Archologiques de France, 158e session (2000), p. 135-140 ( la p. 136), qui suggrait les deux premires dcennies du XIe sicle pour les vestiges architecturaux conservs (dats ensuite en 2004 par radiocarbone des annes 980-1020).74 Ibid., p. 99 : Par ailleurs, comme aucun texte mdival ne fait allusion des travaux importants aux environs de 1100, lexistence dune nouvelle cathdrale lie Urbain II doit tre mise en question. Ne faudrait-il pas plutt se demander sur quoi reposent les assertions de ceux qui veulent faire, tout prix, dpendre les glises majeures dAuvergne dune cathdrale romane qui remonterait la charnire des XIe et XIIe sicles et dont il faut bien avouer que lon ne sait pas grand chose ? .75 FLODOARD, Annales, d. Ph. LAUER, Paris, 1905, p. 12.76 Supra, n. 23. Sur ce texte, en dernier lieu, Chr. LAURANSON-ROSAZ, Culte et dvotions. Inventaire des glises, autels et reliques de Clermont, in O. Guyotjeannin et E. Poulle (d.), Autour de Gerbert d Aurillac. Le pape de lan mil, Album de documents comments, Paris, cole des chartes (coll. Matriaux pour lHistoire, 1), 1996, p. 212-217, dossier n 32. Plus rcemment, ma communication au colloque international Espace et liturgie au Moyen ge. Organisation de lespace ecclsial, 23-25 novembre 2006, Nantua, Ain, organis par lACR Morphogense de lespace ecclsial au Moyen ge, Universit Lumire Lyon 2 : Espace ecclsial et liturgie en Auvergne autour de lan Mil, partir du Libellus de sanctis ecclesiis et monasteriis Claromontii , actes paratre.77 Les autels secondaires sont ceux de la sainte Croix, de saint Gervais, de saint Jean-Baptiste, de saint Julien martyr et du saint Ange. Lautel de la sainte Croix tait couvert dun pallium fond de diverses couleurs. Le culte de saint Gervais, martyr de Milan, tait peut-tre li celui des martyrs bolonais, saint Vital et Agricol, retrouvs les uns et les autres par saint Ambroise ; le culte de saint Julien sexplique aisment par la clbrit du grand martyr de lAuvergne auquel Grgoire de Tours avait consacrs plusieurs livres . M. VIEILLARD-TROEkOUROFF, op. cit., p. 208-209.78 Ibid. : Lautel de saint Michel aurait fait lobjet dun sanctuaire particulier ; on fait au Xe ou XIe sicle une donation aux frres vivant en commun de la sainte mre de Dieu et en particulier pour le btiment de saint Michel . Au XVIIe sicle, le chanoine Jean DUFRAISSE (Lorigine des glises de France prouve par la succession des vques, avec la vie de saint Austremoine, 1688) mentionne cette glise Saint-Michel quae erat in porticu occidentale matris ecclesiae, comme je lai lu dans quelques-uns de nos anciens brviaires ; cest dans cette glise ou chapelle que notre saint Bonnet passait ses nuits en prires et reut de la Vierge une chasuble que nous conservons prcieusement ; elle (la chapelle) fut dtruite il y a environ trois sicles lorsquon fit dessein dachever lglise cathdrale qui est encore imparfaite de ce ct-l et quon voulait continuer jusques au grand degr des Gras, il ne reste prsentement que leffigie de cet archange sur la pointe de la muraille qui est du ct du couchant entre les deux grandes tours ou clochers quon y a poss en mmoire de cette dmolition . Il y eut aussi jusquau XVIIIe sicle une chapelle ddie saint Michel au premier tage de la tour romane sud (dplace alors dans la tour nord) . Pourquoi ne pas voir un tel autel saint Michel dans la cathdrale mme, avec la mention altare sancti Angeli ? Sur la diffusion du culte de saint Michel aux alentours de lan Mil, cf. Chr. LAURANSON-ROSAZ, De la Chiusa Cuix : la romania de lan mil sous le signe de larchange Michel et de laptre Pierre, in Lan mil. Fin dun monde ou renouveau ?, Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, 32, 2001, p. 89-101.79 Bien quattest ds le VIe sicle en Auvergne, notamment par Grgoire de Tours (G. FOURNIER, Le peuplement rural, n. 14 de la p. 62), il est revigor depuis le milieu du IXe sicle : D. IOGNA-PRAT, Le culte de la Vierge sous le rgne de Charles le Chauve, in Lart et la socit lpoque carolingienne (Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, XXIII, 1992). Perpignan, 1992, p. 97-116, repris dans D. Iognat-Prat, . Palazzo, D. Russo (dir.), Marie. Le culte de la Vierge dans la socit mdivale, Paris, 1996 ; ID., La Vierge en Majest du manuscrit 145 de la Bibliothque municipale de Clermont-Ferrand, in LEurope et la Bible, Clermont-Ferrand, 1992, p. 85-133 ; ID. galement avec M. GOULLET, La Vierge en Majest de Clermont-Ferrand, in Marie. Le culte de la Vierge op. cit., p. 383-404.80 Chr. LAURANSON-ROSAZ, Gotiscalc, vque du Puy (928-962), in Retour aux sources. Textes, tudes et documents dhistoire mdivale offerts Michel Parisse, Paris, 2004, p. 653-667.81 Odo de GISSEy, Discours historiques de Nostre Dame du Puy, Lyon, 1620, p. 257 sq. Cest juste aprs ce plerinage, entre 954 et 961, que vient au Puy labb Maieul de Cluny, galement dvot de la Vierge : D. IOGNA-PRAT, Agni immaculati. Recherches sur les sources hagiographiques relatives saint Maieul de Cluny (954-994), Paris, 1988, notamment p. 229 et n. 2, daprs la Vita sancti Maioli (BHL 5179), II. 12.82 Arch. dp. du Puy-de-Dme, 3G, Arm. 18, sac A, c. 2, mal date en 912 par M. COHENDy, Inventaire de toutes les chartes antrieures au XIIIe sicle, qui se trouvent dans le diffrents fonds darchives du dpt de la prfecture du Puy-de-Dme, in Annales scientifiques, littraires et industrielles de lAuvergne, 27, 1854, p. 356-357, suivi par M. VIEILLARD-TROEkOUROFF.83 Libellus de ecclesiis Supra, n. 23 et n. 76.84 Dans le Libellus (n 1) la cathdrale est nomme mater ecclesia et le premier autel est celui des saints Agricol et Vital : M. VIEILLARD-TROEkOUROFF, op. cit. (n. 4), p. 208, n. 3. Dans la Visio Rotberti (LXX, 46), il est dit super basilicam Dei genitricis Mariae Arvernensis. Dans la Vie de saint Alyre de Winebrand (d. de Gaiffier, Analecta Bollandiana, 1968, LXXXVI, 237, 251), sanct Mariae. Dans les plus anciennes chartes du chapitre cathdral de Clermont, Xe-XIIe sicles, on trouve 18 fois sainte Marie seule (Xe-XIIe sicles), 2 fois saints Agricole et Vital seuls (IXe-Xe sicles), 23 fois les trois saints ci-dessus ensemble (Xe-XIe sicles), 3 fois les mmes trois saints avec saint Laurent (Xe sicle) (M. COHENDy, op. cit. (n. 82), passim ; cf. M. VIEILLARD-TROEkOUROFF, loc. cit. (n. 4 et 6). 4 nonas junii, Arvernis civitate dedicatio basilice Sancte Marie, quam Stephanus, inclitus pontifex, miro honore fieri rogavit et ipse consecravit (Canone, Arch. dp. du Puy-de-D., 3G suppl., 15, reg., fol. 65 ; M. VIEILLARD-TROEkOUROFF, op. cit. (n. 4), p. 209-210).85 Arch. dp. du Puy-de-Dme, 3G, Arm. 18, sac A, c. 29 et 6 (inventaires du trsor de la cathdrale, mentionns infra, n. 86), et 11, donation de Vidraz sanct Dei cclesi qu constructa est mirifice in Claromontensi urbe et alm Dei Genitricis dicata honore , donation rappele dans le Cartulaire
49Chr. Lauranson Rosaz : Les élites et l’architecture...
en rouleau ou Mmorial contenant diverses donations, faites lglise dAuvergne , du dbut ou du milieu du XIe sicle, conserv dans le mme fonds darchives, c. 10. Sur ce document, rcemment J.-P. CHAMBON et Chr. LAURANSON-ROSAZ, Le bref de Saint-Martin de Cournon pour le chapitre cathdral de Clermont (11e sicle) : dition commente et tude des lments occitans, paratre dans le Bulletin historique et scientifique de lAuvergne. Les termes constructa mirifice voquent une restauration : aimable communication de mon collgue, le Professeur Alain Dubreucq. Le nom du do-nateur, Vidraz est particulirement rare : M.-Th. MORLET, Les noms de personne, op. cit. (n. 7), I, Les noms issus du germanique continental et les crations gallo-germaniques, p. 221). Notons donc un Vidradus, tmoin dune donation Brioude en 958 (n 301 du Cartulaire de Brioude, d. H. Doniol, Clermont-Ferrand-Paris, 1863), un Vidra(n)dus, donateur Sauxillanges sous les abbatiats de Mayeul (954-994) et Odilon de Cluny (994-1049) (ns 37 et 514 du Cartulaire de Sauxillanges, d. H. Doniol, Clermont-Ferrand, 1864), un Vidradus/Vidranus signataire des donations au mme tablissement sous Odilon (ns 187 et 284). Pour le fonds du chapitre cathdral, cf. M. COHENDy, op. cit. (n. 82), p. 353-459. Chr. LAURANSON-ROSAZ, M. DE FRAMOND, J.-P. CHAMBON (d.), Recueil des chartes du chapitre cathdral de Clermont en Auvergne. Chartes antrieures au XIIe sicle (892-1100), paratre.86 Maiestatem Sancte Mariae una vestita cum cibori(o) et botarico I de cristallo dit le premier inventaire (Arch. dp. du Puy-de-D., 3 G, Arm. 18, sac A, c. 25), Maiestatem Sanctae Marie I vestita cum ciborio cum uno cristallo dit le second (Ibid., c. 6). Nous avons exploit ce dernier dans Chr. LAU-RANSON-ROSAZ, Lglise de Clermont. Inventaire du trsor et des livres de la cathdrale, in O. Guyotjeannin et E. Poulle (d.), Autour de Gerbert dAurillac, op. cit. (n. 76), n 3, p. 13-18, et n. 2, p. 15 linventaire dsigne ici le ciborium plac au-dessus de la statue-reliquaire, lui-mme surmont dun cabochon de cristal . 87 . BALUZE, HGMA, loc. cit., p. 39 : Memoriale reliquiarum quas sanctus Austremonius secum detulit ad urbem Arvernum : In primis de umbilico filii Dei cum quinque unguibus de sinistra manu, prputium ipsius cum duabus unguibus de dextera manu, & de pannis quibus fuit involutus, & undeci-mam partem sudarii qu fuit ante oculos ejus cum sanguine ipsius, & de tunica, & de barba, & de capillis, & de prcincto ejus cum sanguine, & tres ungues ejus ex recisione manus dexter, & partem spine coron, & de pane quem ipse benedixit, & ex spongia ejus, & de sepulcro ipsius Domini, & ex virgis quibus csus fuit, & de capillis beat Mari tres, & brachiale ejus, & de vestimento ipsius cum lacte, & de pallio quod ipsa fecit. Has vero reliquias Stephanus Episcopus condivit in imagine matris Domini & in imagine filii ejus.88 Visio Rotberti abbatis Mozacensi, BCIU Clermont-Ferrand, ms 145, f 130-134, d. R. RIGODON, Vision de Robert, abb de Mozat, au sujet de la Basilique de la Mre de Dieu difie dans la Ville des Arvernes, relation par le diacre Arnaud, in Bull. hist. et scient. de lAuvergne, LXX, 1950, p. 22-55.89 944 ou peu avant : Arch. dp. du Puy-de-D., 3G, 18, A33 ; 953 : Saux. 481 ou 16 ; 958 : Arch. dp. du Puy-de-D., 3G, 18, A4 ; 959 : ibid., 3G, 11, Q1. 971-974 : Saux. 346, 349 et 356. Dans tous ces actes, Robert de Mozac signe de concert avec un tienne abb, immdiatement aprs lvque et son frre le vi-comte Robert, dont ils sont sans doute de proches parents, sans quil soit possible de les identifier davantage et donc de les rattacher la gnalogie.90 M. VIEILLARD-TROEkOUROFF, op. cit. (n. 4), p. 212 : Daprs la palographie comme daprs lillustration, les uvres de Grgoire de Tours auraient t copies la fin du Xe sicle, le sermon du diacre Arnaud au XIe sicle. Ce rcit est dans la tonalit de lpoque et on nimagine pas autrement le sermon dun diacre de lan 1000 .91 L. BRHIER, Les origines de larchitecture en Auvergne..., op. cit. (n. 4).92 M. GOULLET et D. IOGNA-PRAT, op. cit. (n. 79).93 Ibid. : Le climat onirique qui baigne le texte dArnaud est tout droit sorti des grandes visions scripturaires de la Jrusalem cleste, en particulier celles dEzchiel et surtout de lApocalypse. La description rve de la basilique mariale de Notre-Dame de Clermont est, en effet, incomprhensible si lon ne replace pas un certain nombre de passages-cls de lApocalypse (en particulier : 5,6 ; 12,1-6 et 21,19-20) larrire-plan de la Visio monachi Rotberti .94 Ibid.95 Ibid.
elite i arhitektura u ceNtralNome dijelu NekadašNje galije u raNome sredNjem Vijeku.Primjer grada clermoNta u PokrajiNi auVergNe: katedrala Namacija (V. st. ) i stjePaNa ii. (x. st. )
saŽetak
Pitanje srednjovjekovnih drutvenih elita i arhitekture u sreditu nekadanje Galije moe se pojasniti na primjerima dvojice velikih biskupa pokrajine Auvergne: Namacija, koji je ivio u V. st. i podigao prvu katedralu u Clermontu te Stjepana II., koji ju je u X. st. obnovio. Ako o prvome i ne znamo mnogo, onda sama linost drugog biskupa, kao i njegova vrlo duga vladavina te politiko i reformatorsko djelovanje u crkvenim krugovima pojanjavaju njegov graditeljski poziv. Izvori su kojima emo se koristiti za preciznije utvrivanje arhitek-tonskoga programa spomenute dvojice biskupa-graditelja: za Namacija slavni spisi Grgura Turonskoga, a za Stjepana udesan stoga i upitan Visio Roberti akona Arnauda.
1. Grgur Turonski opisuje Namacija kao biskupa gra-ditelja nove katedrale unutar gradskih zidina: ini se da je upravo on premjestio episkopalni kompleks iz predgraa Saint-Alyre, tzv. vicus christianorum, na breuljak koji do-minira dolinom to je tvore dva rukavca rijeke Tiretaine.
Novo je zdanje, sada intra muros, posveeno muenicima Agricolu i Vitalu, ije su relikvije donesene iz Bologne. Drugi Grgurovi tekstovi pomau u rekonstrukciji ivota Merovinke katedrale.
2. Pet stoljea kasnije Stjepan II. Veliki (943.-984.), najistaknutiji crkveni dostojanstvenik u biskupiji do gre-gorijanske reforme, nastavlja Namacijevo djelo: ve se u Conquesu, gdje je bivao opatom, spominje kao graditelj, a u to se vrijeme vjerojatno moe datirati slavna skulptura svete Foy, prototip Bogorodice u Slavi i bista-relikvijara, brojnih u sredinjemu dijelu nekadanje Galije. kada je postao biskup, aktivno je sudjelovao u odranju mira u pokrajini Auvergne: promicao je slavni pokret Bojeg mira te navodio vjernike da potuju mir, crkvena dobra i siromahe, uvelike se koristei pukim tovanje svetaca i relikvija.
Razliiti nas tekstovi i dokumenti izvjeuju o Stjepa-novoj obnovi katedrale i novoj posveti u ast Bogorodici te
50 Hortus Artium Mediev. Vol. 13/1 39-50 Chr. Lauranson-Rosaz Les Lites et L'ARCHiteCtuRe...
kako je ta promjena titulara prevagnula nad onom Nama-cijevom Agricolu i Vitalu. Iako bez precizna datiranja, svi izvori upuuju na kronoloko razdoblje koje odgovara Stjepanovu biskupskom stolovanju; u svakom sluaju prije njegove smrti 984. godine. Tako se ini posve loginim da je biskup pokreta izgradnje druge katedrale u Clermontu, protoromanika ili kasnokarolinka zdanja koje e se kra-jem XI. st. pregraditi.
kao veliki tovatelj Bogorodice Stjepan u svoju katedralu postavlja tada vrlo poznato, a danas izgubljeno zlatarsko djelo Bogorodica na prijestolju, nama poznato s crtea koji se nalazi na poetku djela Vision de Rotbert, opata iz Mozaca. Osim to predstavlja vaan tekst o udesnome, Vision de Rotbert govori nam i o Stjepanovoj katedrali, a autor akon Arnaud dobro poznaje graevinu, pa nam je njegova propovijed iz toga razloga zanimljiva.
Od Namacija do Sjepana proteklo je pet stoljea, a i razdoblje ranoga srednjega vijeka koje slovi kao posebno siromano, naroito u pogledu arhitektonske produkcije.
Peto stoljee s padom Carstva ne ini se osobito naklonje-no mecenatstvu u arhitekturi, pa ipak primjer biskupa Namacija iz Clermonta predstavlja kontinuitet graditeljske umjetnosti u razdoblju kad se priznato kranstvo namee na Zapadu. Zato to je ba podruje Auvergne i sredinje Galije zatieno od barbara? Poznato je kakvo je barbarstvo nekih osvajaa, posebice ono Vizigota.
Isto tako postoji negativno vienje X. stoljea, koje je nazi-vano stoljee maa, stoljee Normana, Ugra i Saracena, kraja karolinke dinastije te stoljee feudalnih previranja. Meutim u posljednjih nekoliko desetljea, zahvaljujui otkriima vezanim uz tisuitu godinu, neki su se povjesniari umjetnosti oslobo-dili predrasuda o arhitekturi, koje su sada prevladane.
Prevela: Martina Mitak