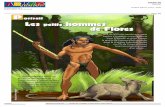LES COTES DE LYCIE ET DE CARIE DANS LES PORTULANS MEDIEVAUX
Transcript of LES COTES DE LYCIE ET DE CARIE DANS LES PORTULANS MEDIEVAUX
le genre des portulans a suscité peu de travauxcompréhensifs. ils n’ont que rarement été utilisésdans des travaux de géographie historique médiévale,surtout dans le cadre des possessions byzantines enMéditerranée orientale1. leur critique à cet effet né-cessite des compétences en topographie locale quel’auteur de ces lignes ne possède nullement. c’estpourquoi cet exposé se bornera, sans entrer dans desdéveloppements topographiques, à présenter cestextes, à souligner les précautions méthodologiquesà prendre et à analyser leur structure descriptivedans les provinces antiques de lycie et de carie.
nature et fOnctiOnsdes pOrtuLans
le terme “portulan” désigne au Moyen age, etbien au-delà, des livres en vulgaire contenant ce quenous appelons aujourd’hui des instructions nautiques– et non pas des cartes marines, comme dans l’usagesavant moderne qui est gravement fauti. ils dessinenttout ou partie d’un périple méditerranéen, auquelpeuvent s’ajouter la mer Noire et la façade atlantiquede l’europe et de l’afrique. ils apportent trois typesde renseignements :
1) la direction et la distance entre des pointsproches du littoral, souvent variables en fonctiondes aléas de la tradition manuscrite ;
2) la description plus ou moins précise desmouillages et de leurs approches ;
3) les pileggi, que l’on peut traduire par “traver-sées” et qui, dans les textes en latin, sont expriméespar les termes ou expressions “respicere”, “oppositus”,“e directo”, “contra”, “transfretus” : il s’agit desdeux aires de vents et de la distance qui définissentun trajet entre deux points éloignés de la côte, ouencore entre des îles et la terre ferme.
le premier document conservé qui répondeexactement à ces caractéristiques date de la deuxièmemoitié du Xiiie siècle : c’est le manuscrit du texteintitulé Conpasso de navegare2. On connaît nombrede témoins manuscrits plus tardifs, d’origine toscaneou vénitienne pour la plupart, dont il n’existe pas derecensement exhaustif3.
l’idée d’une origine antique des portulans est àécarter. On dispose d’autre part des traces précisesde l’existence, dès la fin du Xiie siècle, de textesoffrant tous les aspects des portulans. les donnéesrecueillies émanent évidemment de l’expérience desmarins ; mais nous sommes dans l’impossibilité dediscerner selon quels processus et dans quels milieuxcette expérience accumulée a pu être rassemblée,triée et systématisée, malgré diverses tentatives,parfois scurriles4.
precautiOns de methOde
la nature des documents tels qu’ils sont conservésimpose de prendre quelques précautions lorsqu’onles utilise pour tenter de retrouver les realia. cesprécautions concernent aussi bien les manuscritsque le contenu des portulans :
– semblables en cela aux cartes marines conser-vées, les manuscrits (pour la plupart en papier) nesemblent pas avoir connu les vicissitudes de l’usageà bord : point de traces d’humidité ou de maniementrépété. au contraire, ils sont de facture soignée,parfois même luxueuse ;
– l’usage nautique n’était pas la seule fonctionde ces manuscrits, ni sans doute la première. On yon trouve en effet, à côté des portulans, des textesqui intéressent la gente di mare, mais qui sont sansrapport direct avec la conduite des navires : donnéestechniques, comme des instructions pour la fabrication
*) ePhe.1) Kubitschek 1891 ; Motzo 1937 ; Pertusi 1977 ; Ferluga 1977 ; laronde - rigaud 1992 ; avraméa 1998 ; rigaud 2003 ; Gautier
Dalché 2002.2) ed. Motzo 1947.3) rien n’a été publié à ma connaissance sur ce sujet depuis le recensement très partiel de uzielli - amat di San Filippo 1882.4) résumé des hypothèses formulées par certains historiens imaginatifs dans Gautier Dalché 1995 : 42-43.
Anatolia Antiqua XiX (2011), p. 433-439
Patrick Gautier Dalche*
Les cOtes de Lycie et de carie dans Les
pOrtuLans medievaux
des voiles ou des problèmes d’arithmétique élémen-taire, et des données commerciales telles que des rè-glements divers et des tarifs douaniers.
D’où l’impression que les portulans conservésne sont pas nécessairement en tous points identiquesà ce dont disposaient réellement les pilotes des nefsou les uomini di consiglio des galées. il ne faut doncpas prendre bonnement ces manuscrits comme untémoignage immédiat des connaissances et des pra-tiques nautiques, mais plutôt pour un reflet de laculture de tout un milieu en rapport avec les activitésmaritimes, officiers des flottes des grandes citésmarchandes, marchands, notaires, etc. ces manuelsde l’art naval étaient à la fois des vade mecum quiexprimaient et magnifiaient l’ampleur et la subtilitédu savoir de tout un groupe social et des manuels deréférence servant, sans doute aussi, d’enseignement.enmatière maritime.
les précautions à prendre découlent aussi ducontenu des portulans eux-mêmes. Du fait qu’ilstranscrivent et rassemblent des expériences pratiquesétrangères aux canons littéraires, ils ont le caractère
mouvant de la littérature technique. ils peuvent re-cevoir des additions, subir des amputations ou êtreinterpolés. Même si l’on y retrouve des donnéesidentiques ou similaires, chaque texte présente doncune compilation différente, faite d’éléments d’originediverse et recueillant une multitude d’expériencesde navigation tout en y opérant des choix. ces com-pilations sont ordonnées à des buts précis dont lesraisons nous restent inconnues dans la plupart descas.
il y a enfin d’autres obstacles. les toponymes– aux graphies très variables – sont souvent d’iden-tification difficile et requièrent des compétencesprécises. le rivage lui-même s’est modifié depuisl’antiquité. enfin, la notion de “port” des portulansne correspond pas nécessairement à des installationsmatérielles ad hoc : est ainsi qualifié tout mouillageoù le navire trouve un refuge en cas de menace, no-tamment grâce à la présence d’îles ou d’écueilsproches du rivage. le refuge peut être de plus oumoins bonne qualité : une anfractuosité dans unecôte rocheuse, une plage dans une baie protégée des
434 PatricK Gautier Dalche
fig. 1 : Les côtes de Lycie et carie d’après le De viis maris et le De existencia riveriarum.
vents ont autant de titre à être qualifiées de port queles aménagements faits de main d’homme.
le recensement des manuscrits, l’analyse del’évolution du genre, la pesée des influences réci-proques et des emprunts entre différents témoinsn’ont pas encore été entrepris. il y a là, à coup sûr,un champ de recherche intéressant, qui relève autantde l’histoire culturelle que de l’histoire de la navi-gation.
il est nécessaire d’identifier les textes apportantdes données sur les côtes de carie et de lycie. lesdeux premiers dans l’ordre chronologique ne sontpas à proprement des portulans mais des élaborationslittéraires en latin, faites à partir de portulans àl’usage d’un public savant ou aristocratique :
– DvM, De viis maris (Fig. 1) : description duchemin de retour en France de Philippe auguste
lors de la iiie croisade, par un personnage participantau voyage5 ;
– Der, De existencia riveriarum et forma marisnostri Mediterranei (Fig. 1) : texte de la fin du Xiie
ou du début du Xiiie siècle, composé à partir deportulans et d’une carte6 ;
– cN et MS, Conpasso da navigare et MarinoSanudo, Liber secretorum fidelium crucis (Fig. 2) :le premier est une compilation systématique faitepar un personnage anonyme (2e moitié du Xiiie
siècle) ; Marino Sanudo en reprend une partie traduiteen latin dans son projet de croisade du premier tiersdu Xive siècle7 ;
– PM, portulan dit “Parma-Magliabecchi”, quicouvre comme le précédent l’ensemble de la Médi-terranée et de la mer Noire (manuscrits du Xve siè-cle)8 ;
5) ed. Gautier Dalché 2005 : 173-229.6) ed. Gautier Dalché 1995 : 111-178.7) respectivement éd. Motzo 1947 ; Bongars 1611, t. ii : 84-90 et 243-245 ; recopié dans Kretschmer 1909 : 237-246. Je n’utilise
pas le portulan de Grazia Pauli qui n’est qu’une variante du Conpasso (éd. terrosu asolu, 1987).8) Kretschmer 1909 : 268-358.
leS cOteS De lycie et De carie DaNS leS POrtulaNS MeDievauX 435
fig. 2 : Les côtes de Lycie et carie d’après le Conpasso de navegere,
marino sanudo, le portulan parma-magliabecchi et Grazioso Benincasa.
– GB, portulan de Grazioso Benincasa, officierde la marine vénitienne qui fut aussi cartographe. ilest original en ce que les renseignements qu’ils ren-ferment proviennent de l’expérience de l’auteur,comme il le souligne lui-même ; ce sont surtout desnotes sur la “conoscenza” des points remarquablesdu littoral (dates données : 1435 et 1445)9 ;
– rZ portulan dit “rizzo”, qui est une synthèsesystématique très diffusée par l’imprimerie à la findu Xve siècle10.
Les textes Les pLus anciens
les textes les plus anciens, DvM et Der renseignentsur les aspects généraux de la navigation sanss’attarder à énumérer tous les accidents de la côte.la côte sud-occidentale de la turquie y est présentéeselon deux référents structurant la description dulittoral qui impliquent une évidente faculté d’abs-traction par rapport à l’expérience :
– d’une part, les points où la côte prend uneorientation différente : à l’est le cap chelidonia(mons magnus et altissimus qui dicitur Gredene11,caput Yscilidonum insularum12) ; à l’Ouest, le caputTurkie (DvM), identique au portus Crio de Der13 :c’est, semble-t-il, la pointe de la péninsule de cnide,le Tropion promunturium14 ;
– d’autre part (seulement dans Der) les golfesqui se succèdent de Kekova à Milet : sinus inquo est civitas Cacabum (Kekova) ; portus in sinuPatera ; sinus Macri (Glaucos sinus) ; sinus Stinayhe(lac caunus ?) ; alius sinus (où se trouvent lesinsulae Symiarum/Symi) ; sinus Barbarie (Kerameiossinus) ; sinus Hereticorum (golfe correspondant àheraclea ad latmum ?) ; sinus Melamitorum15.
Deux particularités rédactionnelles de l’exposéde Der impliquent une connaissance assez précisede la disposition générale de la côte dans l’ensemblede la Méditerranée orientale, l’auteur ayant intégré
à la description des données hétérogènes. il a eneffet été poussé à compléter son texte par des réfé-rences antiques de façon à satisfaire aux demandesd’un clerc de la cathédrale de Pise. la riveria quis’étend du cap chelidonia à Crium (tropion pr.) setrouve ainsi, selon lui, dans la provincia Lisie Asieminoris qui succède à la cilicie, le littoral au-delàde Crium appartenant à l’isauria16. Dans le mêmeordre d’idées, il a ajouté un commentaire tiré deSolin sur le mont Chimaera proche d’Olympus, auNord du cap chelidonia, donc en dehors de cettesection, mais en l’appliquant à une réalité du mêmenom, bien que différente topographiquement puisqu’ils’agit d’une vallée située dans le cragus17. en outre,des points de la côte sont mis en rapport avec deslieux soit situés à l’intérieur des terres soit vers lamer. vers l’intérieur, il fait référence à iconium aunord de Patara et à thyatira, Philadelphie et Sardesà l’est et au Nord d’ephèse18. vers l’extérieur, la si-tuation de Patara et d’alexandrie sur un même mé-ridien (“respicit in austrum”), caractéristique desportulans, peut s’expliquer par l’existence d’uneliaison fréquentée entre le point le plus méridionalde la côte (l’Akroterion pr., un peu à l’est de Patara)et un port important de la rive méridionale de la mé-diterranée19. De même, le DvM signale la possibilitéd’aller du caput Turkiae vers les îles de l’egée etconstantinople par le “brachium sancti Georgii”,considéré comme un fleuve, ou vers rhodes, ouencore vers le cap Malée20.
Dans le DvM et le Der comme dans les portulanspostérieurs, la sécurité des mouillages est soulignée.le DvM oppose les îles et les ports tenus par les pi-rates, et ceux qui sont habités par les “boni christiani”.trois bons ports sont signalés, tous formés par desîles : Cachivis/Cacabum (îles Dolichistè, Kekova) ;Castellum Ruge/Castrum Rubeum (Megistè, Kaste-lorizo), Fornuli (îles Korsiai, entre Samos et icaros)21.enfin, la date précoce (fin Xiie siècle) et la curiosité
9) Kretschmer 1909 : 358.10) Kretschmer 1909 : 420-552.11) DvM, 221.12) Der, lignes 742, 746.13) DvM, 223, 224 ; Der, lignes 743, 789, 802.14) Kubitschek 1891 : 39-40 ; cf. les précisions dans les Gesta regis Ricardi du même auteur que le De viis maris, rapportant le
voyage de retour de Philippe auguste lors de la iiie croisade : “qui caput dicitur turkiae, quia ii qui ueniunt de apulia, et cursum suumin illa parte maris tenent, et appropinquant turkiae, primo uident montem illum qui dicitur caput turkiae”. éd. Stubbs, 1867, 197).
15) Der, respectivement lignes 749, 762, 768, 771, 775, 810, 813, 817.16) Ibid., lignes 801, 808.17) Ibid., lignes 756-760.18) Ibid., lignes 761, 832-834.19) Ibid., ligne 763.20) DvM, 224.21) Ibid., 221, 223 ; Der, lignes 749, 752, 820.
436 PatricK Gautier Dalche
de l’auteur qui est un clerc sont sans doute la causede notations sur les établissements en ruines quiparsèment le littoral : sur le fleuve Wincke (Finike,Phoinix) et de part et d’autre de Cachivis (Ke-kova)22.
Les textes pLus recents
a la différence de ces élaborations à visées géo-graphiques utilisant des portulans précoces disparus,les textes suivants sont de véritables recueils d’ins-tructions nautiques. l’aspect compilatoire apparaîtclairement, par exemple lorsque, dans cN, la suc-cession des points notés sur le rivage est interrompuepar un excursus sur les liaisons de rhodes avec lelittoral23.
les côtes sont suivies avec plus ou moins dedétail. ainsi, les côtes de carie et de lycie sontdécrites sous la rubrique Ecqui se comenza la starreade Costantinopoli, où le traitement des deux sections – détroit d’abydos-Samos d’une part, Samos-caca-bum/Kekova d’autre part –, est nettement différencié.la première est rapidement décrite et, en conséquence,comporte surtout des distances importantes (50milles et plus) séparant des points éloignés, tandisque la seconde entre davantage dans le détail enénumérant des points plus rapprochés, la structuredescriptive étant formée par des traversées d’un capà l’autre du littoral, ou d’un cap à une île proche durivage24. la préoccupation fondamentale de ce typed’énonciation est de souligner, dans la suite despoints mentionnés, ceux qui offrent desmouillages sûrs. ils sont quatre à être décrits defaçon précise ; mais on ne peut être certain, commeon va le voir, qu’ils sont les seuls à offrir cettequalité. c’est particulièrement net dans le cas ducapo Malfetano (Kynossema pr.), à l’Ouest de Sisco(Physcos), où le texte distingue deux “ports” : “enlo capo da ver levante à bom porto. en lo capo daponente à un altro bom porto25” ; de même dans PMqui mentionne deux ports sur un même cap de Mar-mora, l’un au Nord, l’autre au Sud (ce dernier est leporto Crio, donc le tropion pr.26. les autres bons
ports sont Simia, castello rosso, cacavo (p. 58,l. 13-22)27. GB y ajoute deux ports décrits avecsoin. Palatia / Palatra (à 10 milles au Se du port età 1 m. du rivage, il signale un “palazzo quadro”,puis un autre à 2 milles au NW) et Alto Luocho28.rZ semble indiquer aussi des ruines à Porto Grio :“Porto grio fo una gran citade et e ponidor29…”.
les atterrages et la nature des fonds sableux, ro-cheux, plats ou accidentés, favorable ou défavorableà l’ancrage, sont soulignés pour certains ports (parex. pour castello rosso), ainsi que la possibilité deravitaillement en eau30. le projet de croisade deMarino Sanudo reprend quelques passages duConpasso da navegare en une version plus complèteen latin dans l’intention de persuader les princeschrétiens d’entreprendre une croisade. ce traitexplique qu’il ne s’intéresse qu’à la succession despoints de la côte asiatique – plus nombreux quedans le Conpasso da navegare avec lequel il offredes parallèles –, sans prêter attention aux grandesîles. tous les ports y sont considérés comme bons, àl’exception des “scolia de chilidoniis” qui ont unparavegium, mais qui constituent un “statium timo-rosum”. la qualité d’un port dépend de trois facteurs.la sécurité ne consiste pas seulement dans un abordfacile et la protection du côté de la mer, mais encore“ex parte terrae”, où il arrive que le peuplement turcrende le séjour difficile. enfin, la présence d’eaupotable, soit courante, soit stockée dans des citernes,est systématiquement relevée.
Sans entrer dans les détails, la structure d’ensemblede la description de cette région peut être visualiséesur une carte. On y distingue plusieurs sortes d’indi-cations :
– des liaisons nombreuses entre les îles situéesface à la côte carienne, depuis Samos jusqu’à rhodes,et entre rhodes et le continent vers l’est ;
– des liaisons par transfretus, de rhodes vers lecap Malée et vers alexandrie ; des îles chélidoniennesvers alexandrie ;
– enfin, le littoral carien lui-même est peudétaillé, ce qui s’explique sans doute par la présenced’îles nombreuses servant de points de repère privi-
22) “et prope inde est fluuius qui dicitur Wincke et castellum est super eundem fluuium quod dicitur Winck et est desertum”(DvM, 221) ; “et ex utraque parte illius portus sunt montes altissimi in quibus secus mare fuerunt antiquitus ciuitates pulchre. Mododeserte sunt, sed ibi adhuc apparent ibi magne murorum ruine” (222).
23) cN, 57-58.24) Ibid., 56 sq.25) Ibid., 57, l. 9-10. 26) PM, 328.27) cN, 51, 58 ; PM, 330.28) GB, 395-396.29) rZ, 522. est-ce cnide ?30) “e<n> terra ferma so pluzore gisterne d’acqua dolce.” (cN, 58).
leS cOteS De lycie et De carie DaNS leS POrtulaNS MeDievauX 437
légiés ; ce n’est qu’à partir du Tropion pr. jusqu’auxîles chélidoniennes que les lieux-dits se multiplient,avec une prépondérance des points signalés à partirde Fiesco/Physcos vers l’est.
reste une ultime question difficile à résoudre.certains énoncés de trajets d’île à île semblent avoirété lus sur une carte, plutôt qu’être issus directementde pratique nautique . ainsi : “De lo dicto Scarpentoall’isola de rode Xl milliaria per greco. en quellavia vederete una isola che se clama Simia. ela dictaPiscopia e questa isola che a nome Simia da ver logreco31”. le passage ne se comprend que si on lerelie aux données qui sont rapportées quelques lignesauparavant : Simi se voit (d’assez loin) lorsqu’onsuit la route cos-Nyssiros-chalke-rhodes. Maiss’agit-il d’une route effectivement parcourue, oulue sur une carte ? c’est encore plus net dans le cassuivant. Dans PM, on lit : “Da cauo di Marmora acauo di Sacndia 40 m. quarta di mezodi ver scilocchoe in quel mezo e un golfo detto cosma fa buona
guardia per quella via che ve certe seche insulcauo32” et : “dall cauo di scandia alla citta d i rodi80 miglia33”. Si l’on considère, d’après la successiontopographique, que le cap de Marmora est le Termerionpr. et que le cap de Scandia se trouve sur la rive mé-ridionale de la presqu’île de cnide (sans doutel’Onougnathos pr.), le premier trajet coupe néces-sairement la presqu’île, et le second l’île de Symi.cette suspicion est rendue encore plus forte par uneremarque de Grazioso Benincasa. Dans le prologuede son portulan, il dit : “i quali porti et senbianze diterre non sono tratte niuna de la charta, ma sonotochate con mano et vegiute cholli ochi”, remarquequi fait supposer qu’il n’en allait pas toujours demême et que les auteurs des portulans comblaientles lacunes de leur documentation en recourant auxcartes marines34. c’est une ultime précaution à garderà l’esprit dans l’appréhension critique des donnéesdes portulans.
P.G.D.
31) Ibid., 57.32) PM, 328.33) Ibid., 329.34) GB, 358.
438 PatricK Gautier Dalche
avraméa, a., 1998 : “les côtes de l’asie mineured’après un texte pisan de la seconde moitié du Xiie
siècle”, in Byzantine Asia Minor (6th-12th cent.) (theSperos Basil vryonis center for the study of hellenism.hellenism : ancient, medieval, modern, vol. 27),athènes : 285-295.
Bongars, J., 1611 : Gesta Dei per Francos, t. ii, ha-novre.
Ferluga, J., 1977 : “les îles dalmates dans l’empirebyzantin”, in thiriet, F. (dir.), Symposion Byzantinon.Colloque international des historiens de Byzance, Stras-bourg, 25-29 sept. 1973 : Les îles de l’Empire byzantin,Byzantinische Forschungen, t. 5 : 35-71.
Gautier Dalché, P., 1995 : Carte marine et portulanau XIIe siècle. Le “Liber de existencia riueriarum etforma maris nostri Mediterranei” (Pise, circa 1200),rome.
–2005 : Du Yorkshire à l’Inde. Une “géographie”urbaine et maritime de la fin du XIIe siècle (Roger deHowden ?), Genève.
– 2002 : Portulans and the Byzantine world, dansTravels in the Byzantine world éd. r. Macrides (Publicationsof the Society for the Promotion of Byzantine Studies),ashgate : 59-71.
Kretschmer, K., 1909 : Die italienischen Portolanedes Mitelalters, Berlin (veröffentlichungen des institutsfür Meereskunde und des geographischen instituts an deruniversität Berlin).
Kubitschek, W., 1891 : “Zur historischen topographievon Kleinasien im Mittelater”, in Sizungsberichten derphilol.-hist. Cl. der kaiserlichen Akademie der Wissen-schaften, t. 124, n° viii.
laronde, a. et rigaud, Ph., 1992 : “le coste libichesecondo un portolano del secolo Xiii”, in Mastino, a.
(dir.), L’Africa romana. Atti del IX convegno di studio.Nuoro, 13-15 dic. 1991, t. ii, Sassari : 743-756.
Motzo, B.r., 1937 : “la Sardegna nel Compasso danavigare”, Archivio storico sardo, 1937.
– 1947 : Il Compasso da navigare, opera italianadella metà del secolo XIII, cagliari (annali della Facoltàdi lettere e filosofia della università di cagliari, vol.viii).
Pertusi, a., 1977 : “le isole Maltesi dall’ epoca bi-zantina al periodo normanno e svevo (secc. vi-Xiii) edescrizioni di esse dal sec. Xii al sec. Xvi”, in thiriet,F. (dir.), Symposion Byzantinon. Colloque internationaldes historiens de Byzance, Strasbourg, 25-29 sept. 1973 :Les îles de l’Empire byzantin, Byzantinische Forschungen,t. 5 : 253-305.
rigaud, Ph., 2003 : “les îles de la Provence (Liberinsularum Provinciae). essai sur la toponymie insulaire(Xiie-Xvie s.)”, in Des îles à la côte. Bulletin archéologiquede Provence, Suppl. 1 : 45-66.
Stubbs, W., 1867 : The chronicle of the reigns ofHenry II and Richard I. A.D. 1169-1192 known commonlyunder the name of Benedict of Petrborough, t. ii, londres(rerum Britannicarum Medii aevi scriptores, 49).
terrosu asole, a., 1987 : Il portolano di Graia Pauli.Opera italiana del secolo XIV trascritta a cura di BacchisioR. Motzo, cagliari.
uzielli, G. et amat di San Filippo, P., 1882 : “Map-paemundi, carte nautiche, portolani ed altri monumenticartografici specialmente italiani dei secoli Xiii-Xvii”,in Studi biografici e bibliografici sulla storia dellageografia in Italia, pubblicati in occasione delIII° Congresso geografico internazionale, t. ii, 2a ed.,rome.
leS cOteS De lycie et De carie DaNS leS POrtulaNS MeDievauX 439
BiBLiOGraphie