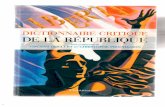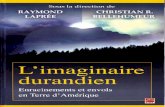Les couleurs de la République (Floch, Wölfflin et la photographie)
Les marabouts de la République
-
Upload
u-bordeaux4 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Les marabouts de la République
1
Mouhamadou Ndiaye
Les marabouts de la République
Etude sur l’évolution du pouvoir maraboutique au Sénégal
Master Interdisciplinaire Dynamiques Africaines 1
2
Sommaire
Sommaire................................................................................................................. 2
Introduction............................................................................................................. 3
Partie I
Les origines du pouvoir maraboutique.................................................................... 6
Refus d’assumer les charges politiques................................................................ 7
L’éloignement des cercles du pouvoir................................................................... 9
Le mépris face aux biens terrestres.................................................................... 11
Partie II
La construction du pouvoir maraboutique........................................................................ 15
Un poids économique certain ..............................................................................16
Politique et religion : une histoire d’amour.......................................................... 17
Les causes de l’implication politique................................................................... 20
Partie III
La délégitimation de la classe maraboutique. ..................................................................23
Un déclin d’influence ...........................................................................................24
Les causes du déclin de l’influence des marabouts.............................................. 25
Retour aux sources ...............................................................................................28
Conclusion......................................................................................................................... 31
Bibliographie .......................................................................................................................32
3
Introduction
Les modèles politiques reflètent des représentations du pouvoir et des relations d’autorité
propres aux sociétés et qui influent largement sur les systèmes politiques contemporains et
font que deux systèmes de même nature seront différemment interprétés et réappropriés d’une
société à une autre. Ce soubassement culturel des systèmes politiques est essentiel pour
comprendre leurs modes de fonctionnement. Un Etat pour organiser et distribuer le pouvoir
c'est-à-dire des systèmes politiques, terme qui représente l’ensemble des institutions, et des
relations qui les unissent, dont il se dote au niveau officiel. Certains modèles politiques ont été
institutionnalisés à l’échelle d’un Etat pour devenir des systèmes politiques alors que d’autres,
restés prégnants à des échelles réduites, cohabitent avec des systèmes politiques bien souvent
exogènes.
Le politique dans les pays de l’Afrique et plus particulièrement au Sénégal s'inscrit dans un
prolongement, fortement instrumentalisée par l'ensemble des catégories d'acteurs qui y
interviennent, des dispositifs endogènes et exogènes. Il faut le saisir dans les interactions des
espaces sociaux, des acteurs, des corporations.... La société sénégalaise comme toute société
humaine, s’organise autour de principes et de fondements. Elle était avant la colonisation, une
société d’ordres et de castes dans sa majorité, promue par des régimes monarchiques qui
privilégiaient la naissance au mérite en confinant les individus à des rôles et des statuts figés.
Mais, l’arrivée des colonisateurs, l’intronisation de l’école et le dépérissement du système
féodal ont en quelque sorte transformé certaines données et ont conduit a une remise en cause
de situations, notamment les représentations du pouvoir et les systèmes de castes qui étaient
en vigueur dans cette société. Ainsi, à partir de l'indépendance on assiste à l'émergence d'une
4
conceptualisation de l'Etat-nation. Cependant, cette construction se heurte aux résistances
propres à chaque civilisation dans son évolution vers le changement. L'un de ces obstacles au
Sénégal est l'existence d'une classe maraboutique.
Le mot marabout vient de l'arabe ribat (رباط) qui désigne à la base une place forte de l'armée
placée en territoire ennemi. Le développement du soufisme, le cœur spirituel de l'Islam,
amena ses adeptes à pratiquer l'isolement. Rien de mieux alors qu'un couvent de ce genre
éloigné de toute habitation, en milieu hostile donc. Ces couvents prirent le nom de ribat et ses
habitants, des murabitun ( رابطونم ). Ce genre de couvent se développa partout dans le monde
islamique, notamment dans le Maghreb de l'Afrique. Les colonisateurs français, à la
découverte de couvents, nommèrent ces ascètes « marabouts » et étendirent l'appellation à
tout chaykh (maître) soufi.
C'est donc à un maître de cette branche de l'Islam que se réfère la dénomination de marabout.
Au Sénégal, ces marabouts sont à la tête de confréries soufies. Véritable directeurs spirituels,
ils reçoivent l'allégeance (bay'ah بيعة ) et sont ainsi pour eux, comme le dit l'adage soufi,
comme le mort devant son laveur. Cela signifie donc que celui a prêté allégeance doit
obéissance au marabout dans toutes ses affaires spirituelles et même matérielles. En
contrepartie, le marabout l'aidera à soigner les défauts de son âme et l’amènera à la proximité
divine.
Cette classe maraboutique a toujours eu des rapports plus ou moins étroits avec les dirigeants
politiques. Mais cette proximité a été exacerbée au cours de l'histoire récente. Nous avons
divisé cette évolution en trois phases :
-la première couvre la dernière phase de l'histoire précoloniale et s'étend jusqu'aux années
1920. Cette période est marquée par l'importance des marabouts ascètes qui ont comme
sacerdoce de s'éloigner des milieux du gouvernement.
5
-la deuxième période débute dans les années 1920 et continue jusqu'à la fin du XXème siècle.
Les marabouts de cette époque s'engagent dans la politique et y exercent une réelle influence.
-La dernière période de notre classement commence vers les années 2000 et s'étend à nos
jours. On y remarque un retour des marabouts à leur rôle premier de directeurs spirituels.
Nous avons voulu limiter notre étude, pour des motifs de concision, à la période historique
débutant avec le XIXème siècle. Nous avons aussi qualifié les marabouts du XIXème de
marabouts de la « première génération » et leurs successeurs de ceux de la « deuxième
génération ». Ces appellations n'ont bien sûr qu'un but méthodologique.
Cette étude a pour but d'analyser les différentes phases par lesquelles sont passées les
marabouts du Sénégal dans leurs relations avec le pouvoir politique. L'objectif est de dégager
les tendances principales de ces relations, à travers le découpage historique précédent.
6
Partie I
Les origines du pouvoir maraboutique
Ce que l’on peut nommer le pouvoir maraboutique remonte à une assez longue tradition de
lettrés ayant influencé la vie des populations. En effet, il était de tradition dans le Sénégal
précolonial pour chaque famille musulmane, de s’affilier à un marabout qui était une sorte de
directeur de conscience. A lui revenait l’éducation des enfants dans les sciences islamiques
mais aussi la présidence des différentes cérémonies religieuses.
La figure du marabout était donc centrale dans la société sénégalaise, même non-islamisée.
Cette importance va se développer considérablement avec l’implantation dans le pays des
confréries soufies. Celles-ci ont en effet monopolisé la vie religieuse et donné un visage
unique à « l’Islam sénégalais ».
La première de ces confréries est celle de la Qadiriyya, la plus vieille branche soufie du
monde islamique. Née à Bagdad au XIème siècle, elle tire son prestige du grand saint Abdul
Qadir al Jilani. Elle s’est répandue au fil des siècles dans tous les pays islamiques. Introduite
au Sénégal par les maures, elle était pratiquement la seule voie soufie pratiquée jusqu’au
XIXème siècle.
7
La seconde de ces voies à avoir pénétré le Sénégal est la Tijaniyya de Chaykh Ahmad at
Tijani. Né dans l’actuelle Algérie au cours du XVIII siècle, c’est à Hajj Umar Tall que l’on
doit sa diffusion en Afrique de l’Ouest et plus particulièrement au Sénégal.
Le mouridisme parachève ce tableau, seule voie soufie d’origine locale. Son fondateur est
Ahmadou Bamba, lettré né en 1855. Son mouvement a rapidement été populaire dans les
couches paysannes.
L’institutionnalisation de ces voies pourrait laisser penser à une tentative de pression ou
d’accaparement du pouvoir politique. Paradoxalement, à la base, ces voies se réclamaient du
dépouillement le plus total et se désintéressaient donc de la politique. Reprenant l’idéal soufi
de la pauvreté spirituelle et matérielle, ces voies ainsi que leurs fondateurs promouvaient un
retrait du monde pour se consacrer à la vie spirituelle.
Le refus d’assumer les charges politiques
Les assises des principales voies soufies du Sénégal tournent autour du renoncement aux
fastes du bas-monde. Ce retrait est encore plus vif quand il est question de la sphère politique.
En effet, on remarque une profonde méfiance à l’égard du pouvoir et de ses détenteurs.
Selon cette méthodologie soufie, l’amour du pouvoir est le pire des maux. Une sagesse le
place même comme la source de tous les défauts de l’âme. On remarque donc dans cette
génération de marabouts, une forte réticence à être investi d’un quelconque pouvoir politique.
A ce propos, il est intéressant de citer l’attitude d’Ahmadou Bamba. Convié à se présenter au
roi du Cayor, dans l’espoir de remplacer son père défunt à son poste de juge, il rétorqua à ses
conseillers :
تحـز جـوائـز تغنـي كلماحيـن*** قالوا لي اركن ألبـواب السالطيـن
ولست راضي غير العلـم و الديـن***فقلـت حسبـي ربي و اكتفـيت به
8
1ألنـه جـلَّ يغنـيني ويـنـجينـي***ولست أرجووالأخشى سوى ملكـي
Ils m'ont dit de m'appuyer aux portes des rois...tu seras récompensé et riche toute ta vie
Je dis alors que mon Seigneur me suffit, je me tiens à Lui.... et je ne désire rien si ce n'est la
science et la religion
Et je n'espère ni n'ai peur si ce n'est de mon Roi.... parce que c'est Lui qui m'enrichit et me
sauve
Les marabouts de cette génération développaient donc une véritable aversion pour les charges
publiques et tout ce qui était du domaine de la gestion étatique. Cette attitude est même
retrouvée chez les marabouts qui ont exercé le rôle de chef de l'Etat ! Loin d'être une
contradiction, ces marabouts se sont retrouvés propulsés, du fait des circonstances, dans la
sphère du pouvoir sans en avoir fait la demande. D'ailleurs, dans leur pratique de ce pouvoir,
on remarque un détachement extraordinaire. Le professeur Christian Coulon dira de Hajj
Umar Tall :
« C'est que le mujahid du Fouta-Toro n'est en rien un fondateur d'empire comme toute
une mythologie coloniale, puis nationaliste, a voulu le faire croire. L'entreprise de
El Hadj Omar est une longue marche sans fin ; elle tient de l'errance du justicier
musulman plus que de la construction politique »2
Ce schéma est du chef d'Etat détestant le pouvoir est celui des marabouts de la république
Léboue du Cap-Vert. Fondée au XVIIème siècle pour échapper aux exactions du Damel du
Cayor, cette république avait à sa tête un grand marabout, doté d'un pouvoir purement
1Bamba Mbacké A, « Qalu li arkana…” poème mystique
2Coulon C « Les musulmans et le pouvoir en Afrique noire » Karthala, 1983
9
symbolique. La réalité des fonctions politiques était investie dans les autres personnalités
politiques et dirigeants locaux.
Cette défiance envers le pouvoir politique était aussi accompagnée pour ces marabouts d'un
éloignement des détenteurs du pouvoir.
L’éloignement des cercles de pouvoir
La classe maraboutique sénégalaise d'avant la colonisation peut être catégorisée en deux
groupes. D'un côté, il y avait les « savants des princes », qui faisaient office de conseillers, de
traducteurs et de diplomates auprès des cours des souverains.
De l'autre côté, vivait une classe maraboutique jalouse de son indépendance. Loin des cours et
occupés à l'enseignement islamique, ces marabouts avaient comme ligne de conduite de ne
pas fréquenter les princes et les détenteurs du pouvoir politique. Considérant le pouvoir
comme source de corruption morale, ils évitaient autant que possible de paraître devant les
princes.
C'est de cette seconde catégorie que seront issus les ancêtres des principales maisons
religieuses du Sénégal. Ces marabouts soufis ont montré un idéal de détachement et
d'indépendance de tout pouvoir politique.
A ce propos, Ahmadou Bamba versifie encore :
جوار مـن دورهم دور الشياطيـن***أو كيف يبعثني حب الحطـام إلـى
Ou bien comment l’amour des vanités de ce monde m’oblige t-il à
fréquenter des êtres dont la mesure est le parterre fleuri des démons
Il conclura plus loin :
10
ذاك عيب نفيـس ليس يخزينـيفـ***إن كان عيبي زهـد في حطامهـم
Si mon défaut est de m'éloigner des princes.... voici un défaut dont je ne rougirai point
Cette méfiance est généralisée chez ces marabouts. Il était de coutume pour eux de rester
éloignés des princes, aussi bien physiquement que par l'influence. Un proverbe en pays wolof
dit qu'un marabout ne doit jamais passer la nuit dans la même ville que le prince, leurs mœurs
étant diamétralement opposées. Il faut voir dans volonté un idéal ascétique de renoncement au
monde et au vice le plus tenace pour les soufis, l'amour du prestige et du pouvoir. Hajj Umar
Tall portera témoignage de cela :
« Je n'ai pas fréquenté les princes et je n'aime pas ceux qui les fréquentent. Le
prophète a dit « les meilleurs princes sont ceux qui fréquentent les savants, mais les
pires savants sont ceux qui fréquentent les princes »3
Cet éloignement des détenteurs du pouvoir influe fortement sur la construction de leur
communauté respective naissante. En effet, les marabouts de ce siècle ont mis en œuvre des
moyens de contournement pour échapper à la mainmise des pouvoirs en place. Cette méthode
avait pour but de leur assurer l'indépendance dans leur construction d'une société idéale.
L'escapisme fut pour la majorité d'entre eux un moyen de résistance contre l'ordre politique.
Ainsi, ces marabouts ont-ils pris l'habitude de fonder des villes et villages loin de toute
habitation et surtout des centres de décision politiques. C'est ainsi que hajj Umar Tall s'exila
volontairement de son Fouta Toro natal pour établir une terre d'Islam plus à l'Est. En effet,
hajj Umar Tall fut très critique envers la classe maraboutique locale qui, à ses yeux, avait trahi
3Cité par Drumont.F « l'anti-sultan ou al Hajj Omar Tall du Fouta, combattant de la foi » Nouvelles Editions
Africaines. Dakar-Abidjan. 1979.
11
les principes de la révolution Torodo en monopolisant le pouvoir au sein de quelques familles.
En butte à l'hostilité du pouvoir, sa solution à été de créer une nouvelle communauté
religieuse basée sur la le suivi de la tariqah tijanie.
De même, d'autres marabouts ont tenté et réussi des fois à se libérer du joug d'un pouvoir
politique oppressant. La révolte des marabouts du Ndiambour contre le Damel du Cayor est
connue comme étant une tentative de créer une communauté islamique autonome de ce
pouvoir politique. La répression qui a suivi cette révolte a obligé les marabouts à se réfugier
dans la presqu'île du Cap-vert. Ce renfort de marabouts hostiles à l'arbitraire Ceedo fut le
déclencheur de la révolte, cette fois réussie, des Lébous et de la création d'un état islamique
dans cette région.
La colonisation du Sénégal achevée à la fin du XIXème siècle a changé la nature de cet
escapisme au pouvoir central. Il s'est agi, à cette époque, de regrouper des populations dans
des villages éloignées des villes coloniales (Saint-Louis, Dakar, Gorée...) et d'y instaurer un
ordre de vie en autarcie. L'idéal d'un état appliquant les préceptes islamiques s'était éloigné, il
fallait donc recentrer les populations autour d'un guide et d'un idéal ascétique, loin des
préoccupations terrestres de la ville. Cette nouvelle méthode a donné naissance à des centres
religieux de Touba, Tivaouane, Daroul Mou'ti, Madina Gounass, Nioro du Rip....
A ces répulsions ouvertement déclarées, s'ajoute un mépris des biens terrestres pour ces
marabouts.
Le mépris face aux biens terrestres
Le soufisme est par excellence la doctrine de la pauvreté spirituelle et matérielle. D'ailleurs, le
mot soufisme ferait référence à un groupe de compagnons du prophète dénué de tout bien et
qui se consacrait à l'adoration. Les marabouts sénégalais ayant assis les bases du soufisme
dans ce pays ne pouvaient être en reste dans l'observance de cette tradition.
12
En effet, la pauvreté est présentée comme une vertu. Elle représente un refuge contre les
tentations du bas-monde. C'est pour cela que les marabouts soufis s'en sont éloignés et ont
montré un grand désintérêt pour les richesses matérielles.
Cette pauvreté est pour nous aussi une claire volonté de ne pas revendiquer un poids politique.
Cet éloignement des biens matériels concorde avec un effacement de la scène politique. On
remarque chez ces marabouts, une véritable volonté de s'éloigner de la richesse qui pourtant
pourrait leur donner un poids politique non négligeable, associé à leur audience auprès des
populations. Cette volonté est d'ailleurs illustrée par leur vie frugale, attestée même par leurs
ennemis, comme le prouve ce témoignage de Paul Marty :
« Il est hors de doute que Ahmadou Bamba est très charitable. Peut-être même, vu
l'abondance de ses aumônes, pourrait-on dire, qu'il est personnellement désintéressé,
si on était assuré que ces libéralités ne sont pas faites à dessein et pour attirer de plus
forts cadeaux4 »
L'auteur, bien que doutant de l'innocence de cette ascétisme, reconnaît volonté que ce
marabout était éloigné du désir de l'accumulation des richesses. C'est aussi ce qui ressort des
écrits propres d'un autre marabout de ce temps, Hajj Malick Sy :
« Il a été dit : si quelqu'un demandait une intervention auprès d'un grand souverain
par l'intermédiaire d'un de ses vizirs, pour obtenir un cadavre de chien ou d'âne, quel
4 [En ligne]Marty P, « Etudes sur l'Islam au Sénégal » http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k77474r
13
sort mériterait-il, sinon d'être chassé ? Il en est de même pour celui qui pour évoque
Dieu pour obtenir quelque chose de ce bas-monde5 »
Ce désintérêt est aussi prononcé chez les marabouts ayant accédé au pouvoir politique.
Thierno Souleymane Baal représente un exemple de cette vision ascétique que l'homme
politique doit accorder aux biens terrestres. S'adressant à ses compatriotes avec qui il vient de
chasser les despotes Dényanké, il propose son portrait du gouverneur idéal :
« Choisissez un homme savant, pieux et honnête qui n’accapare pas les richesses de ce
bas -monde pour son profit personnel ou pour celui de ses enfants.
Détrônez tout Imâm dont vous verrez la fortune s’accroître et confisquez l’ensemble
de ses biens.
Combattez-le et expulsez-le s’il s’entête.
Veuillez bien à ce que l’Imâmat ne soit pas transformé en une royauté héréditaire où
seuls les fils se succèdent à leurs pères.
Choisissez toujours un homme savant et travailleur.
Il ne faut jamais limiter le choix à une seule et même province.
Fondez-vous toujours sur le critère de l’aptitude » 6
5Hajj Malick Sy « kifayat al raghibin », traduit et annoté par le professeur Rawane Mbaye, Editions al Bouraq,
2003
6Extrait de « zuhur al basatin fi tarikh as sawadin », cité par Baila Wane dans « le Fuuta Tooro de Thierno
Suleymaan Baal à la fin de l'almamiyat (1770-1880) » colloque tenu en 1997 à Abuja
14
Ces données nous brossent un portrait assez complet sur la position des marabouts de cette
époque face au pouvoir politique. En effet, désintérêt, mépris et éloignement étaient leur
attitude favorite face aux gestionnaires de l'Etat et aux détenteurs du pouvoir. Cette attitude a
pu être vérifiée dans la majorité des familles religieuses actuellement implantées au Sénégal.
Les écrits des fondateurs de ces branches du soufisme ou même leurs actions témoignent de
leur volonté de n'avoir pas affaire avec les hommes politiques. On peut remarquer cependant,
dans les cas d’Ahmadou Bamba et de Hajj Malick Sy, une collaboration avec le pouvoir
colonial. En effet, ces marabouts ont exhorté et envoyé leurs disciples rejoindre l'armée
française lors de la première guerre mondiale. On peut considérer qu'il s'agit ici d'un cas
exceptionnel de coopération avec les pouvoirs politiques pour la réussite de leurs projets.
Dans l'ensemble, on remarque cependant une réelle volonté de se démarquer des gouvernants.
Cette volonté va être mise à l'épreuve de la construction nationale avec une sollicitation
accrue des pouvoirs séculiers. Le comportement de ces marabouts, que nous appellerons
arbitrairement de « deuxième génération », a fortement contrasté avec celui de leurs
devanciers.
15
Partie II
La construction du pouvoir maraboutique.
L'implication des marabouts dans les démarches politiciennes a pris son envol avec l'entrée
des noirs autochtones dans la vie politique du Sénégal colonial. Les communes du Sénégal
bénéficiaient en effet d'un siège de député à l'assemblée nationale française. Ce siège a été le
monopole des populations métisses ou créoles de Saint-Louis jusqu'au début du XXème
siècle. En 1914, le premier député noir, Blaise Diagne, est élu. Deux ans plus tard, le corps
électoral était élargi, avec l'octroi de la nationalité française aux habitants des quatre
communes. Ainsi, la population électorale noire des quatre communes du Sénégal devenait un
atout considérable pour qui voulait représenter la colonie. Pour s'attirer les faveurs de leurs
électeurs, les hommes politiques n'ont pas hésité à recourir aux marabouts qui étaient les
directeurs spirituels de nombre d'entre eux.
Cet épisode marque le début d'une relation jamais remise en cause entre les pouvoirs politique
et religieux. En effet, les politiques vont dès lors investir le champ religieux pour se bien faire
voir des marabouts les plus influents. En retour, ceux ci leur accorderaient leur aide dans leur
domaine d'élection. La fin de l'ère coloniale n'a pas démenti cette tendance, bien au contraire.
Les marabouts sont devenus, après l'indépendance, des acteurs incontournables du champ
16
social et politique. Cette situation a mené à une véritable alliance entre le politique et le
religieux, les deux champs se confondant même souvent.
Cette nouvelle donne contraste fortement avec la démarche adoptée par les prédécesseurs. En
effet, ceux là avait abandonné toute aspiration politique et se vouaient à un pieux ascétisme.
La nouvelle classe maraboutique elle, dispose de nombreuses ressources pécuniaires.
Un poids économique certain
Après la mort des guides fondateurs de leurs familles religieuses, les marabouts qui leur ont
succédé ont eu à résoudre le problème de la cohésion communautaire. Comment fallait-il
résoudre les nouveaux problèmes qui se posaient, tenant au leadership, au financement de la
voie... ? Ces marabouts ont choisi généralement de renforcer leur poids économique pour ne
pas disparaître et pouvoir être des interlocuteurs des pouvoirs en place. Dans les années 1920,
s'est ouverte une véritable course aux fronts pionniers dans le bassin arachidier. De nombreux
villages ont été construits dans cette région agricole avec pour but, la production industrielle.
Ces villages étaient organisés en communautés avec à leur tête un marabout, propriétaire des
terres pour qui ses disciples travaillaient en partie. Concernant cette intense activité agricole
de cette partie du XXème siècle, le rapport annuel de l'AOF (Afrique Occidentale Française)
de 1933 précise :
« A l'exemple des chefs religieux de la secte mouride, qui ont fait servir depuis
longtemps leur influence au développement des cultures, les marabouts des autres
sectes musulmanes encouragent à leur tour leurs adeptes à travailler la terre »7
Rocheteau nous donne l'évolution rapide de ces fronts pionniers qui sont devenus le poumon
de l'économie sénégalaise8. Ces terres restent donc la propriété du marabout qui aura ouvert
7Cité par Coulon C, « le marabout et le prince », Pedone, 1981
17
en premier ce front. Les retombées financières de cette agriculture industrielle sont énormes et
justifient le poids économique dont jouissent ces marabouts.
Mais il ne faut pas croire que l'influence économique des marabouts se limite au domaine de
l'agriculture. Au fil du temps, ils ont diversifié leurs activités et ont investi tous les champs de
la vie économique. Il n'est donc pas étonnant de voir qu'un grand nombre de banques, sociétés
immobilières, entreprises industrielles et commerciales sont la propriété exclusive ou partielle
de marabouts de différentes confréries.
Ce poids économique certain assure aux marabouts sénégalais une bonne assise pour peser sur
les décisions politiques. Ainsi, n'ont-ils pas hésité à en user en tissant de fortes relations avec
le pouvoir politique.
Politique et religion : une histoire d'amour
L'interaction entre le pouvoir républicain et la classe maraboutique a commencé véritablement
dans les années 1930. Sa première manifestation concrète est sûrement la course à la
députation entre Galandou Diouf et Blaise Diagne en 1928. En effet, ces élections voient le
soutien franc d'un marabout pour l'un ou l'autre des candidats. Ils 'agit en l'occurrence de deux
marabouts mourides concurrents, Mouhammadou Mustapha et de Mukhtar Mbacké,
respectivement fils et frère de Ahmadou Bamba.
Il s'agit d'un tournant car ces marabouts ont financé la campagne de leur candidat respectif.
De plus, ils ont appelé leurs adeptes à voter pour eux. Ces élections marquent l'entrée en
politique des marabouts pour préserver leurs intérêts communautaires ou personnels. Il s'est
établi dès lors entre politiciens et marabouts un contrat d'assistance mutuelle. Contre le
soutien financier et l'appel au vote, l'homme politique s'engage à favoriser la confrérie du
8http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_4/sci_hum/19963.pdf
18
marabout qui l'aura soutenu. Cette relation de clientélisme a marqué des décennies de la vie
politique sénégalaise. La présidence de Senghor (1960-1980) est illustre pour son
compagnonnage, scellé avant l'indépendance, avec le khalif général des mourides,
Muhammadou Fadilou Mbacké. Ainsi s'exprimait-il en 1966 :
« Le président Senghor est mon ami de tous les jours. Depuis que j'ai eu à le
connaître, il y a vingt et un ans, il a toujours tenu ses promesses. Je vous le confie et
vous demande de le suivre partout où il vous demandera de le suivre. Je suis sûr
qu'il mènera notre Sénégal à bon port »9
Cette relation entre le marabout et la sphère politique ne s'est pas arrêtée là. Elle embrasse
toutes les époques depuis l'indépendance et tous les niveaux politiques. Le soutien des
marabouts est sollicité pour établir les listes de candidats aux élections législatives ou pour les
élections locales. Ces investitures ont pour rôle d'attirer la sympathie des disciples pour une
telle liste au détriment d'une autre.
La pratique du « ndigueul », recommandation ayant force d'ordre, est utilisée dans les milieux
mourides pour encourager le politicien ayant eu les faveurs du marabout. Celui ci
« recommande » à ses disciples de donner leurs voix, leur soutien ou même de conforter
l'effort d'un homme politique. L'exemple éloquent d'une telle consigne est la recommandation
donnée par le khalif général des tijanes, Mouhammadoul Mansour Sy, de voter pour Abdou
Diouf aux élections de 2000, en prédisant sa victoire.
En contrepartie de ce soutien affiché, les marabouts reçoivent une aide de la sphère politique.
On remarque en effet une relation de clientélisme qui exige un retour pour service rendu. Ces
services rendus en contrepartie peuvent bénéficier personnellement au marabout ou à la
communauté.
9Extrait de Dakar-Matin du 9Juin 1966, cité dans « le marabout et le prince » de Christian Coulon
20
Il convient de rappeler l'action de Blaise Diagne, à la suite du soutien de Mouhamamdoul
Mustafa Mbacké, pour établir un permis de construction pour la grande mosquée de Touba.
De même, Blaise Diagne a été un soutien de la communauté mouride dans le litige qui les a
opposés l'architecte de cette mosquée.
Les gratifications de ce genre sont monnaie courante dans la vie politique sénégalaise. Les
chefs de l'Etat successifs se font un devoir d'assister financièrement les cérémonies des
familles religieuses. L'Etat emploie de gros moyens financiers, humains et techniques pour
assurer la réussite de ces commémorations. Cette aide ponctuelle est une forme de
contrepartie pour le soutien maraboutique.
Le président Abdoulaye Wade (2000-2012) a beaucoup usé de cette politique, en finançant les
projets des communautés religieuses nationales. Ainsi, l'Etat a financé entièrement les travaux
de la grande mosquée de Touba ainsi que d'autres travaux de voirie et la construction de
centres commerciaux dans la ville.
On remarque donc que l'autorité maraboutique s'est transformée en véritable pouvoir
revendicatif auprès du monde politique. Le passage du mépris du pouvoir à l'implication à
outrance ne s'est pas fait sans raisons.
Les causes de l’implication politique
Les raisons d'un tel changement doivent être cherchées, selon nous, à des sources multiples.
L'explication ne peut être uniforme et plusieurs facteurs ont concouru à tirer les marabouts de
leur retraite pour les propulser devant la scène politique.
Il est important de souligner que les marabouts ne sont pas entrés en politique de leur propre
initiative. Le mouvement de politisation de cette classe n'a pris de l'ampleur qu'avec la
confrontation des politiciens noirs pour obtenir le vote des populations autochtones. Ainsi, on
21
peut dire que cette politisation ne date vraiment que de l'affrontement entre Blaise Diagne et
Galandou Diouf. Pour toucher les habitants des quatre communes affiliées aux différents
marabouts, le meilleur moyen était tout simplement de faire jouer la solidarité confrérique en
mettant le marabout dans son camp politique.
De plus, ces politiciens avaient besoin de légitimation aux yeux de ces couches de la
population. L'établissement de la citoyenneté française à tous les habitants de la colonie et
donc l'extension du droit de vote, créait un fossé entre les politiciens occidentalisés, formés à
l'école européenne et les masses paysannes. Les hommes politiques avaient donc besoin de
relais fiables auprès des populations. Relais qui, sans forcément expliquer leur programme,
amèneraient ces électeurs à leur donner leurs voix. L'affrontement entre Lamine Gueye et
Léopold Senghor à la veille des indépendances illustre ce schéma.
Il ne faut pas négliger aussi l'effet de la société coloniale puis républicaine sur les marabouts.
La domination définitive des français sur le territoire sénégalais et leur maillage de plus en
plus précis du territoire ont sûrement prouvé aux marabouts qu'ils ne pouvaient éviter
d'interagir avec le monde politique. Celui ci les trouvait même dans leur monde reculé. Il
fallait donc composer avec lui et le maîtriser autant que possible. Les marabouts ont donc usé
de leur influence et de leur potentiel pour participer au jeu de pouvoir avec le monde colonial.
Ceci expliquerait d'ailleurs la facilité avec laquelle les mourides puis les autres confréries ont
ouvert des fronts pionniers pour développer la culture arachidière. Celle ci, bien que profitant
aux colons, leur assurait aussi un confort financier et un moyen de pression sur
l'administration.
Ce processus enclenché, il n'était plus possible de reculer après la proclamation de
l'indépendance. Les mêmes institutions restaient avec un changement d'acteurs. Mieux encore,
22
les nouveaux gouvernants, loin d'être enracinés dans la campagne, avaient besoin des services
des marabouts pour transmettre leurs politiques et briguer le suffrage populaire.
Aussi, ces marabouts sont des chefs de communauté. Ils ont la responsabilité morale d'assurer
sa survie économique et culturelle. Cette mission peut sembler difficile si le pouvoir politique
reste hostile. C'est peut-être donc par pragmatisme que la classe maraboutique a accepté peu à
peu de tisser des liens avec les acteurs politiques. La capacité de mobilisation des marabouts
n’était pas d’un grand secours durant la période coloniale. En effet, le droit de vote massif n’a
été institué qu’en 1958. Les ressources financières par contre sont un bon appât pour les
politiciens noirs, en butte à l'hostilité des milieux d'affaires de la colonie. Pour financer leurs
projets politiques, il fallait donc se tourner vers les rares africains capables de débourses
d’importantes sommes d’argent. Cela peut expliquer l'engouement vite prononcé des
marabouts et de leurs disciples aux travaux champêtres et au commerce.
Enfin, dans ce tableau, il ne faut pas oublier les facteurs personnels qui ont pu conduire les
marabouts à s'attacher à certaines personnalités. Des amitiés personnelles ont pu décider
certains marabouts à tenir un rôle politique et à soutenir un politicien au détriment d'un autre.
Il est de notoriété que Serigne chaykh Gaïndé Fatma était un soutien généreux de l'opposant
Abdoulaye Wade contre le président Senghor. Celui avait comme soutien indéfectible
Mouhammadoul Fadilou Mbacké. Pourtant, l'appartenance confrérique n'est pas gage
d'affinité politique. Cheikh Anta Diop, mouride pourtant et élevé dans la maison de Ahmadou
Bamba, essuiera un refus d'aide du khalif général des mourides qui appellera à voter pour
Abdou Diouf quelques années plus tard (1988)
Cette transition a été un tournant dans la relation du marabout avec le pouvoir politique. La
« première génération » avait théorisé un soufisme ascétique et de renoncement. Pourtant, les
générations suivantes ont acquis la richesse matérielle et politique. Et même plus, ces
23
marabouts ont exercé une énorme influence sur les dirigeants politiques. Il s'agit d'une
révolution dans la conception du marabout. D'un directeur spirituel, il passe à un homme
engagé socialement, qui s'enrichit, intrigue, agit pour ses intérêts. Il a une forte influence sur
le monde politique duquel il était censé s'éloigner.
S'il est vrai que ce marabout a acquis un poids considérable dans le monde politique, sa
crédibilité est mise à rude épreuve auprès des personnes qu'il est censé guider.
24
Partie III
La délégitimation de la classe maraboutique
L'évolution de la perception du marabout au sein du peuple est une jauge solide de la capacité
de mobilisation et de l'audience de cette classe religieuse. Le pouvoir du marabout étant
intimement lié à l'allégeance de son disciple et à sa totale soumission, son autorité par donc
fonction du respect et de la certitude de sainteté que le disciple lui octroie. Cet acte
d'allégeance implique donc que le guide religieux soit un thaumaturge, un être totalement
dédié à Dieu, d'une moralité sans faille et d'une probité à toute épreuve. Ce schéma de
domination charismatique et traditionnelle fait du chef une personnalité élevée au dessus des
tares du commun des hommes et de leurs passions.
Cette perception traditionnelle du marabout correspond à celle qu'avaient les populations de la
première génération de marabouts. En effet, l'ascèse auquel ces derniers se sont astreints, leur
charisme certain ainsi que leur éloignement des affaires du monde terrestre en ont fait des
modèles indétrônables au panthéon des grands hommes sénégalais.
Cette idéalisation n'a pas été le destin des marabouts de seconde génération dont nous avons
parlé. L'image du marabout a considérablement évolué au cours de la deuxième moitié du
XXème siècle. Il s'est peu à peu imposé dans l'esprit des sénégalais une critique du mode de
vie des marabouts, jusque là perçus comme étant intouchables. En effet, ces deux dernières
25
décennies ont vu un déclin prononcé de l'aura des marabouts impliqués dans la sphère
politique. Paradoxalement, on remarque un engouement fort envers ceux reproduisant le
stéréotype des marabouts de la première génération.
Un déclin d'influence
L'audience et l'influence du marabout se mesure d'abord au nombre de disciples qui lui sont
affiliés. Le marabout possédant le plus de disciples établit ainsi sa puissance mystique,
politique et économique. Mais cette audience n'est vraiment prouvée qu'à l'observance de ses
ordres et recommandations, les « ndigeul ».
L'histoire du ndigeul politique au Sénégal ne date pas de l'après-indépendance. En effet, dans
la période coloniale, des marabouts ont appelé ouvertement leurs disciples à adopter une
vision politique. Ce fut le cas lors du référendum de 1958 portant sur la communauté
française. Les marabouts de différentes confréries religieuses s'étaient massivement prononcés
pour le « oui » et avaient « recommandé à leurs disciples de suivre ce choix. Le résultat fut
sans appel, le « oui » l'emportant à plus de 81.000 voix contre 21.904.
Le ndigeul opérait aussi lors des élections présidentielles de 1988. Le khalif général des
mourides, Abdul Ahad Mbacké, appelait, via la télévision nationale, au soutien du président
sortant, Abdou Diouf. Selon lui, ne pas voter pour Abdou Diouf était tout simplement une
trahison vis à vis d’Ahmadou Bamba et de la voie mouride. Là aussi, la recommandation prit
effet et le président sortant fut réélu.
Cependant, cette époque de la vie politique semble bien révolue. La portée du ndigeul est on
ne peut plus remise en cause. Les marabouts qui s'y sont appuyés pour favoriser leur candidat
aux dernières élections ont eu d'amères surprises. En effet, l'entrée dans le XXIème siècle a
marqué un déclin irréversible de l'influence politique des marabouts.
26
Le premier à avoir fait cette expérience fut le khalif général des tijanes de Tivaouane.
Mouhammadoul Mansour Sy, à la tête de la plus grande confrérie du Sénégal en terme
d'adhérents, affichait son soutien indéfectible au même Abdou Diouf aux présidentielles de
2000. La victoire, disait-il, lui était acquise, quoi qu'il fasse. Il appelait donc ses disciples à
accompagner cette victoire en votant pour le candidat Abdou Diouf. La déconvenue du
président sortant fut un démenti formel du suivi de son ndigeul. En effet, Abdou Diouf avait
même été battu dans la ville de Tivaouane, pourtant centre de la Tijaniyyah sénégalaise.
Une expérience plus récente confirme cette lancée irréversible. Les élections de 2012 ont
donné lieu à une autre tentative maraboutique de diriger l'opinion politique. Chaykh Bethio
Thioune, leader mouride controversé au sein même de sa voie, réclamant avoir 10 millions de
disciples à travers le monde, appelait à voter pour Abdoulaye Wade, président sortant. Il
déclarait avoir vu en rêve le défunt khalif des mourides, Salih Mbacké, qui lui aurait annoncé
la victoire de Abdoulaye Wade. Il réitéra son appel aussi bien au premier tour qu'au second.
Pourtant, la défaite éclatante de ce candidat, à plus de 60% de suffrages, laissait les sénégalais
perplexes sur le nombre de votants parmi les disciples de Bethio Thioune.
Une question devient alors essentielle, comment ce mouvement de déclin des marabouts dans
la politique s'est-il amorcé ?
Les causes du déclin de l’influence des marabouts
Les causes de cette baisse d'influence sont à chercher, à n'en pas douter dans la prise de
conscience des jeunes générations mais aussi dans les attitudes des marabouts. Il est
indéniable que l'évolution d'une société aussi complexe que le Sénégal comporte des
bouleversements des ordres sociaux, des pouvoirs en place, des forces de pression. Ainsi n'est-
il pas étonnant de voir un ordre perdre de son influence au fur et à mesure que la population
s'en détourne. Cette marche de l'histoire est le sort qui a frappé la classe maraboutique
27
impliquée dans la politique. Ancienne force de conviction et de persuasion, représentant des
aspirations d'une grande catégorie de la population, la classe maraboutique avait fini de se
forger un statut d'interlocuteur privilégié des pouvoirs publics. Pourtant, à l'heure où la
sécularisation est galopante dans le reste du monde, on aurait pu s'étonner de cette influence
religieuse dans la gestion d'un Etat laïc. Une telle anomalie a fini par s'affaisser pour laisser la
place à de nouveaux mécanismes. Le fait n'est pas venu des pouvoirs publics, mais bien du
comportement même des marabouts.
Le disciple tient son marabout comme étant un modèle de détachement de la vie terrestre. Il
attend donc un comportement qui sied à cet ascétisme. Ainsi, peut-on comprendre la
déception et la désillusion des disciples quand son marabout se met au même niveau que les
politiciens, que le commun des sénégalais juge menteurs. En effet, voir des marabouts, censés
prôner l'attachement à la vie dernière, se battre pour obtenir des postes politiques peut créer
un fort sentiment de malaise et de doute.
On pourra relever ainsi les candidatures de leaders religieux ainsi que les déboires qui en ont
résulté. L'exemple célèbre est celui de chaykh Ahmed Tidiane Sy, fils du khalif général des
tijanes, chaykh Ababacar Sy. Engagé en politique auprès de Senghor, il se désavouera de lui et
créera son propre parti politique avant de revenir dans ses rangs. Très virulent contre le
régime en place, il fera même un séjour carcéral. Tous ces vicissitudes peuvent porter une
tache sur la personnalité religieuse d'un tel marabout. Pourtant, c'est lui qui sera porté à la tête
de la voie tijanie au Sénégal en 2012.
Un autre exemple est celui du marabout serigne Modou Kara Mbacké, de la famille mouride
de Daroul Mu'ti. Créateur du Parti de la Vérité et du Développement, il a soutenu Abdou
Diouf lors des élections de 2000. Il avait aussi annoncé sa victoire éclatante... Par la suite, il
s'est rapproché d’Abdoulaye Wade pour annoncer aussi sa victoire aux élections de 2012...
28
Les deux marabouts Bethio Thioune et Modou Kara Mbacké soutenant Abdoulaya Wade à
aux élections de 2007
29
Ces pirouettes entre candidats ainsi que les démentis de ses prophéties entachent fortement sa
vocation de marabout. Il est évident que de telles pratiques décrédibilisent les marabouts et
poussent les disciples à se poser des questions.
Justement, la remise en cause de l'ordre maraboutique découle en partie d'une prise de
conscience des masses sénégalaises. Celles ci ont de plus en plus accès à l'éducation, à
l'information et découvrent les autres cultures. Surtout, ils découvrent d'autres pays
musulmans, ayant leurs confréries religieuses, mais sans trace du fort poids politique et social
qu'elles ont au Sénégal. Au contraire, ils découvrent un soufisme cantonné dans les zawiyas
et ayant un rôle humanitaire profond. Les chefs de ces confréries affichent plutôt une
simplicité contrastant avec les fastes de certains marabouts locaux. Cette découverte pousse
cette jeune génération à remettre en cause le système confrérique tel que vécu au Sénégal. De
même, est remis en cause la légitimité islamique des marabouts à s'immiscer dans la politique
et à y dicter le choix de leur candidat. Ce facteur peut-être explicatif de l'échec avéré du
ndigeul dans cette génération.
Il faut aussi mentionner l'influence du mouvement wahhabite saoudien. Celui est
viscéralement opposé au soufisme ainsi qu'aux confréries religieuses. La conquête des terres
saintes par ce mouvement leur donne une certaine aura et une audience auprès des musulmans
sénégalais. La péninsule arabique étant le berceau de l'Islam, le royaume saoudien est perçu
par certains comme gardien de la pureté de la religion islamique. La propagande wahhabite
étant très active, les idées anti-confrériques n'ont pas manqué de germer au Sénégal aussi. La
nouvelle génération a ainsi changé de référence religieuse et par là même, de vision sur ces
marabouts. Leurs discours ou recommandations n'ont aucune chance d'être pris en compte par
ceux qui se sont faits sectateurs de l'Islam saoudien.
30
Un point qui pour nous est fondamental aussi est la politisation accrue de la population
sénégalaise. Il y a encore quelques décennies, les marabouts pouvaient dicter leur conduite
politique à leurs disciples. Ceux là, des paysans pour la plupart sans connexion avec le monde
politique, recevaient ces recommandations comme un fil d'Ariane dans un imbroglio où ils ne
comprenaient pas grand-chose. Ces marabouts pouvaient être vus comme des repères, des
chefs qui indiquaient à leurs ouailles la voie à suivre. Cette époque est définitivement révolue.
En effet, la jeune génération de sénégalais a été confrontée aux scandales de corruption des
gouvernements précédents. Elle a vécu les dures heures du chômage, de la précarité et du
manque d'infrastructures primaires. Ces événements ont éveillé sa conscience politique.
Désormais, ce sénégalais sait où se trouve son avantage et ses intérêts citoyens dans ce monde
politique. Il n'a point besoin d'un guide pour lui indiquer le candidat à qui accorder ses
suffrages. Mieux encore, son indignation est piquée au vif quand il voit ses leaders religieux
donner du crédit aux actions de politiciens dont il blâme la gestion. Voici ce qui le pousse à
faire fi du ndigeul des marabouts et de n'accorder confiance qu'à sa conviction profonde. Voici
ce qui pousse aussi le professeur Babacar Gueye à déclarer « le ndigel n'est plus
opérationnel ».10
Cet état de fait n'est pas sans conséquences sur la fonction du maraboutique
Le retour aux sources
Le déclin inéluctable du marabout politicien amorcé ces deux dernières décennies a contraint
les marabouts à se cantonner dans leur rôle premier. La déliquescence de leur influence sur les
populations dans leur choix politique est devenue évidente depuis les élections de 2000. Le
désaveu de l'ordre du khalif des tijanes a été un avertissement pour quiconque espérait jouer
un rôle dans la politique. En effet, ce marabout était l'un des plus, si ce n'est le plus influent du
10Radio RFM, entretien du 4 Mars 2012
31
pays. Pourtant son appel a été ignoré par ses disciples même. Il s'agissait d'un signal pour ces
marabouts pour qu'ils n'entravent pas les demandes sociales des populations pour des intérêts
particuliers. Dès lors, seuls quelques marabouts de moindre envergure se sont impliqué dans
le champ politique. Les plus influents sont revenus à la pratique de leurs ancêtres de la
« première génération ».
Cette nouvelle tendance se vérifie avec l'absence des principales familles religieuses dans le
monde de la politique. Les marabouts ont de plus en plus une propension à s'isoler du monde
terrestre et à s'occuper exclusivement des affaires de leur communauté. Ainsi, le nouveau
khalif général des mourides, serigne Sidy Mukhtar Mbacké a clairement dit, après son
intronisation, qu'il ne s'occuperait que de rendre pérenne l'héritage de Ahmadou Bamba, et
rien d'autre.
Un de ses prédécesseurs à la tête de la communauté mouride s'était déjà illustré par son
aversion du monde politique. Serigne Salih Mbacké avait effectivement interdit toute activité
politique dans la ville de Touba. Il avait en sus tenu tête aux autorités politiques pour que la
ville de Touba n'accueille pas les campagnes électorales lors des élections législatives de
2007.
Cette tendance est un retour aux sources pour ces marabouts qui se sont retrouvés impliqués
dans une sphère qui ne le leur était pas prédestinée. Reprenant leur rôle de directeur de
conscience et de guide vers le salut, les plus avertis d'entre eux ont renoncé à influer sur la vie
de la cité par leurs recommandations. Il faut dire que cette attitude rejoint les vœux de la
jeune génération de citoyens qui n'entend pas se faire imposer sa vision politique par des
chefs religieux. En effet, on voit l'émergence de sénégalais certes engagés dans leur
cheminement spirituel. Néanmoins, une distinction claire est établie entre le rôle du chef
religieux comme guide et celui d'un chef politique pas forcément des plus avisés. La vision
32
des jeunes en effet rejoint un schéma déjà établi par les marabouts de la « première
génération » et inscrivant le religieux comme un être vivant dans le monde mais insensible à
ses attraits.
33
Conclusion
Ce tableau nous a permis de voir les différentes étapes de l'évolution de la fonction
maraboutique dans les derniers siècles de l'histoire du Sénégal. On a confronté le portrait
originel d'un marabout volontairement retiré du monde politique et terrestre. Les
circonstances historiques ont fait ensuite émerger l'action maraboutique dans le monde
politique, action qui n'a cessé de croître. L'ivresse du pouvoir a pourtant créé des
débordements quand à l'exercice de cette influence. Ainsi, sa contestation puis son désaveu a
conduit les marabouts à adapter leur fonction et à redevenir des guides spirituels
exclusivement.
Dégager les différentes tendances de cette évolution est un travail nécessaire qui montre la
complexité de la société sénégalaise. De même, cette étude nous plonge dans la réalité du
pouvoir dans les pays d'Afrique. Loin de l'idéal laïc proclamé à l'indépendance, les Etats
d'Afrique doivent composer avec des sociétés traditionnelles déjà en place avant l'avènement
de la République. Ainsi, le fait religieux n'est pas un fait à occulter ? Bien au contraire, il
mérite un traitement analytique pour connaître ses rouages. Il serait évidemment illusoire de
vouloir calquer le modèle occidental laïc à ces sociétés ayant connu une tradition religieuse si
profonde. Ainsi, l'action des tenants du pouvoir religieux doit être mise de concert avec les
politiques publiques pour construire des nations sur la base de leur identité.
34
Bibliographie
Coulon C « Les musulmans et le pouvoir en Afrique noire » Karthala, 1983
Drumont F « l'anti-sultan ou al Hajj Omar Tall du Fouta, combattant de la foi » Nouvelles Editions
Africaines. Dakar-Abidjan. 1979.
Marty P, « Etudes sur l'Islam au Sénégal » http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k77474r
Hajj Malick Sy « kifayat al raghibin », traduit et annoté par le professeur Rawane Mbaye, Editions al
Bouraq, 2003
par Baila Wane dans « le Fuuta Tooro de Thierno Suleymaan Baal à la fin de l'almamiyat (1770-
1880) » colloque tenu en 1997 à Abuja
Coulon C, « le marabout et le prince », Pedone, 1981
Iconographie
« Le khalif général des mourides, Mouhammadoul Fadilou Mbacké et le président Senghor »,
page 19
Source : www.Dakarctu.com
« Les marabouts Bethio Thioune et Modou Kara Mbacké soutenant Abdoulaye Wade aux
élections de 2007 », page 28
Source : www.seneweb.com