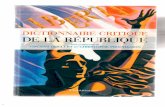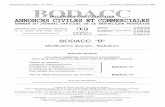La République populicide. Relire "Du système de dépopulation" de G. Babeuf
Transcript of La République populicide. Relire "Du système de dépopulation" de G. Babeuf
dix-huitième siècle, n° 43 (2011)
LA RéPUBLIQUE POPULICIDE RELIRE Du SyStème De Dépopulation
DE G. BABEUf
Rédigé dans l’urgence, et publié pour la première fois en décembre de l’année 1794, du système de dépopulation de Gracchus Babeuf se distingue du reste de la production pamphlétaire thermi-dorienne par sa longueur (194 pages dans sa version originale), sa documentation, son innovation et son ambition 1. Un texte mal-heureusement peu connu, trop peu considéré, rangé sous des qua-lificatifs tels que « halluciné et incantatoire », parfois « visionnaire jusqu’à l’hypotypose 2 », mais qui par sa rhétorique et ses motiva-tions profondes s’extrait d’emblée du cadre restreint du pamphlet, pour s’imposer à la fois comme témoignage et analyse, objet poli-tique et objet d’histoire, enfin écriture géniale et innovante. Son titre, dans son intégralité, est : du système de dépopulation, ou la vie et les crimes de carrier ; son procès et celui du comité révolutionnaire de Nantes : avec des recherches et des considérations politiques sur les vues du décemvirat ; dans l’invention de ce système ; sur la combinaison principale avec la guerre de Vendée ; et sur le projet de son application à toutes les parties de la République. Prenant l’occasion du retentissant procès, tenu du 23 novembre au 16 décembre 1794, de Jean-Bap-tiste Carrier, proconsul montagnard envoyé en mission à Nantes, Babeuf dresse un réquisitoire sans appel sur le gouvernement révo-lutionnaire et son théâtre des cruautés, la Vendée.
1. Pour l’analyse de ce texte, et par commodité pour le lecteur, nous nous servirons de sa réédition par MM. Reynald Secher, Jean-Joël Brégeon et Stéphane Courtois : Gracchus Babeuf, la Guerre de la Vendée et le système de dépopulation, Paris, Editions du Cerf, 2008 (désormais abrégé en sdd).
2. Eric Walter, « Babeuf écrivain : l’invention rhétorique d’un prophète », dans Présence de Babeuf : lumières, Révolution, communisme, Actes du colloque interna-tional sur Babeuf, Publications de la Sorbonne, Paris, 1994, p. 203.
434 RoNAN chAlmiN
Néanmoins, au-delà de la pénible mais utile récapitulation des atrocités vendéennes perpétrées sous les ordres même de la Convention, c’est à la dénonciation de la Terreur comme idéologie ayant pris les traits d’un « système de dépopulation » que veille ici l’auteur. Aussi, et pour Babeuf, et pour la France de Thermidor, le procès de Carrier devient-il le prétexte idéal pour intenter un autre procès, plus important sans doute, celui du gouvernement révolutionnaire lui-même, avec, en son épicentre, Robespierre, « l’âme de tout le désordre » (sdd, 115). De fait, Babeuf se lance dans un face-à-face sans concession, et démonte pièce par pièce la « machine politique » (sdd, 124), c’est son mot, « la mécanique et l’esprit du système » (sdd, 149) mise en branle par Robespierre. Dès 1794, Babeuf inaugure une lecture mécaniciste de la Terreur comme impeccable appareil d’Etat : ce n’est plus l’homme-machine dépeint par l’hédoniste La Mettrie, mais l’Etat-machine, devenue machine de mort, que la nouvelle machine, celle inventée par le docteur Guillotin, symbolise désormais. Sur la place de la Révolu-tion siège le couperet, qui actionne sa lame purificatrice jusqu’aux contrées les plus reculées de la République.
« Système de dépopulation », « système de dépeuplement », « système d’extermination » (sdd, 141), le tout bientôt résumé en « système de Robespierre » (sdd, 121), Babeuf, homme de son siècle, analyse, théorise, parle aisément la langue du « système » quand d’autres parleront eux du « système de la Terreur ». Babeuf réorganise le chaos, avec les moyens mis à sa disposition, que ce soit au niveau historique (les documents, lettres, journaux, témoi-gnages, décrets) ou au niveau idéologique (redistribution des terres, égalitarisme exacerbé des Jacobins, régénération, purification). Il est vrai que Babeuf s’engage dans une entreprise aussi audacieuse que périlleuse : comment expliquer « l’inexplicable Vendée 3 » (le mot est du célèbre Barère) ? Comment expliquer rationnellement, en pur autodidacte des Lumières qu’il est, le déchaînement inouï de violence en Vendée, summum de la Terreur, tant de la part des révolutionnaires que des contre-révolutionnaires ? En plein Thermi-dor épris de justice et de vengeance, Babeuf met l’horreur à l’ordre
3. Bertrand Barère, le moniteur, n° 18, p. 50.
lA RéPuBlique PoPulicide 435
du jour 4. Sans pudeur aucune, il dévoile « la partie tragique des annales de la République » (sdd, 124), mettant la nation face à ses crimes. Il expose au grand jour les « laideurs cadavéreuses » de la patrie, il déterre les morts, ouvre les charniers, cherche les cou-pables du « colosse de crimes » (sdd, 105). Reporter de l’horreur, Babeuf n’en interroge pas moins la politique de son époque et son fondement philosophique, et il n’hésite pas à remonter jusqu’à la tradition platonicienne, inscrivant alors la Terreur dans une sorte d’histoire pervertie de la philosophie occidentale. Le geste est bru-tal, servi par une écriture nerveuse, déclamatoire, inventive. Ce sera donc à la fois le scrupuleux compte-rendu des massacres ainsi que l’exposé théorisé de ce système de dépopulation organisé par le gouvernement révolutionnaire, ce « comité d’assassinats publics » (sdd, 147) ou encore « comité d’égorgerie » (sdd, 148), et exécuté en grande partie par ce Carrier « au furorisme le plus sanguinaire » (sdd, 105). Sous la phrase qui multiplie les effets de style pour mieux susciter l’émotion et l’indignation, il y a une réalité qui n’en finit pas d’atterrer l’opinion. La belle et noble révolution-régénéra-tion de 1789 s’est muée en dépopulation-épuration, selon la poli-tique terroriste à l’ordre du jour à partir de 1793, intronisant dans le sang une République non seulement homicide, mais notamment populicide, bourreau de son propre peuple. Babeuf n’a qu’une idée en tête, raconter l’histoire tragique de ce passage, celui de la régé-nération à l’épuration, celui de la toute-puissance du peuple à son éradication, celui du populaire au populicide.
*
Face à un tel déferlement de violence argumenté par des ana-lyses jugées souvent aberrantes, l’historiographie révolutionnaire moderne s’interroge encore sur la pertinence du système de dépopu-lation, et cette brochure de Babeuf, « immense poème dantesque 5 » reconnaîtra prosaïquement Michelet, se trouve divisée entre deux types d’interprétations opposées l’une à l’autre.
4. Bronislaw Baczko, Politiques de la Révolution française, folio histoire, Paris, Gallimard, 2008, p. 172.
5. Jules Michelet, histoire du xixe siècle, dans Œuvres complètes, tome XXI, Pa-ris, Flammarion, 1982, p. 102.
436 RoNAN chAlmiN
Il y a d’abord ceux qui, commodément, le considèrent comme un pamphlet acerbe, un brûlot provocant, une œuvre de combat contre l’ennemi du moment Robespierre. Le système de dépopula-tion serait une « légende noire 6 » de la Révolution parmi quantités d’autres, le « fantasme thermidorien d’un holocauste “populicide’’ décidé par l’état jacobin 7 ». Babeuf, sous couvert de révélations inédites, réglerait ainsi ses comptes avec « Maximilien le cruel », pour ensuite se rétracter et regretter son geste à la suite des purges thermidoriennes, en redorant le blason terni du défunt terroriste. La démonstration tournerait donc court. De cette vision officielle, citons, pour l’exemple, une autorité sur la période, B. Baczko : « Le texte est hallucinant, obsédé par des fantasmes qui s’enchaînent à la recherche du mot de l’énigme. On y reconnaît facilement, amal-gamés et fusionnés, les fantasmes qui hantaient l’Ancien Régime ainsi que ceux engendrés par la révolution 8… » Outre le fait que, dans son analyse, Baczko passe sous silence la question du par-tage des terres qui occupe cependant une place de choix dans la démonstration de Babeuf, comme leitmotiv socio-philosophique de la période, on voit bien comment la résistance face à ce texte s’organise, en refusant d’emblée ses interprétations. Par deux fois, le mot de « fantasmes » est employé, comme asséné. Baczko se refuse à admettre l’impensable, la programmation d’une destruc-tion humaine massive avec les moyens contemporains, autrement dit « la Terreur comme système de pouvoir qui serait apte à mettre en œuvre un plan d’exclusion et, partant, d’élimination de milliers, voire de millions, de citoyens afin d’assurer la réalisation de ses objectifs révolutionnaires 9 » – situation qui sera celle de la révo-lution russe de 1917. Ainsi Baczko peut se permettre de réduire l’analyse de Babeuf à une sorte de traumatisme fréquent à l’épo-que : « C’est un cas tout à fait remarquable de confusion propre à
6. Daniel Martin, « La Dépopulation au service de l’idéal social robespierriste, une légende “noire’’ avortée », dans la légende de la Révolution, Actes du colloque international de Clermont-Ferrand (juin 1986), Clermont-Ferrand, 1988.
7. E. Walter, « Babeuf écrivain : l’invention rhétorique d’un prophète », p. 203.8. Bronislaw Baczko, « “Monstres sanguinaires’’ et “circonstances fatales’’. Les
discours thermidoriens sur la Terreur », dans The French Revolution and the crea-tion of modern Political culture, François Furet et Mona Ozouf (ed.), vol. III, Oxford, England, Pergamon Press, 1989, p. 153-154.
9. ibid.
lA RéPuBlique PoPulicide 437
Thermidor, période elle-même trouble et troublante, marquée par la commotion de la Terreur et ses séquelles 10. » Pourtant Babeuf ne délire pas, et s’en défend même à l’avance : « Je déclare que je ne joue ici que le rôle d’historien franc et singulièrement libre, que je narre tout ce que je crois être la vérité… » (sdd, 121). Témoin à la barre dans le procès qu’il intente contre les principaux acteurs de son époque, il pense de façon systématique et tente de démonter les rouages d’une horrible machine qui a empêché « qu’une révolution, commencée par la sagesse et la vertu du peuple, ne se consolidât avec les mêmes éléments » (sdd, 104).
Il y a ceux ensuite qui en font un document à charge pour expliquer et confirmer la logique génocidaire mise en place par le gouvernement révolutionnaire en Vendée, lieu historique du « pre-mier génocide idéologique 11 ». Face aux attaques portées contre le libelle de Babeuf, Brégeon soutient : « Ce qui nous importe, c’est que Babeuf ait écrit du système de dépopulation, qu’il ait eu l’intelligence et le courage de dresser le réquisitoire d’un gouver-nement révolutionnaire qui avait ordonné les pires atrocités, qui s’était engagé, en Vendée, sur la voie du génocide 12. » La lecture ici est tout autre, moins critique, plus emphatique. Ce n’est plus fantasme mais réalité : il y aurait eu intention délibérée de la part du Comité de salut public d’organiser et de réaliser un « génocide franco-français 13 », que le texte de Babeuf révèle, à la stupéfac-tion générale. Ce qui importe ici, c’est moins l’explication que le résultat, la mort programmée en Vendée de milliers d’hommes, de femmes et d’enfants selon des méthodes d’une rare inhumanité. Courtois, spécialiste reconnu de la question, l’affirme : « [Babeuf ] a analysé avec finesse la tentative révolutionnaire d’exterminer la Vendée, préfiguration des génocides modernes 14. » Cette deuxième
10. B. Baczko, « “Monstres sanguinaires’’ et “circonstances fatales’’. Les dis-cours thermidoriens sur la Terreur », p. 157, note 28.
11. Pierre Chaunu, préface à Reynald Secher, le Génocide franco-français : la Vendée-Vengé, Paris, PUF, 1986.
12. Jean-Joël Brégeon, « Présentation de Gracchus Babeuf », dans Babeuf, la Guerre de la Vendée et le système de dépopulation, p. 97-98.
13. Selon la thèse très controversée de Reynald Secher, le Génocide franco-français, op. cit.
14. Stéphane Courtois, « Préface » à G. Babeuf, la Guerre de la Vendée et le système de dépopulation, p. 23.
438 RoNAN chAlmiN
lecture, moins consensuelle, fait de Babeuf un des précurseurs de la réflexion sur le génocide, formulé définitivement par le juriste Rafaël Lemkin au milieu du xxe siècle 15.
Voilà donc, exposée brièvement, la situation historiographique dans laquelle se trouve prisonnier du système de dépopulation. Entre ces deux lectures partiales et radicales tente de survivre ce texte inclassable. Légende ou vérité ? Longue hallucination ou sombre réalité ? Une chose est sûre, il nous faut aujourd’hui arracher le texte à la double confiscation dont il est victime, et le prendre, avec ses raisonnements impétueux, ses obsessions et ses propres peurs, pour ce qu’il est avant tout, une théorisation de la Terreur, et une réflexion d’ampleur sur le « délire révolutionnaire » qui frappe la toute neuve République, en tenant à distinguer le programme social de Robespierre – la redistribution – de sa manière – la dépo-pulation. Dans la cacophonie de Thermidor où retentit encore la chute d’une dictature subsiste la voix de Babeuf. Car son analyse est avant tout victimaire. Il se fait en ces temps de justice le porte-parole d’un peuple martyrisé au nom d’une plus grande égalité. Avec la Terreur, c’était le bourreau qui parlait ; avec Thermidor, c’est la victime qui s’exprime désormais.
*
Babeuf en est convaincu : « C’est dans le gouvernement révolu-tionnaire qu’il faut chercher tous les malheurs de la République ; et ceux de la Vendée forment le principal acte du drame sanglant dû à cet infâme gouvernement » (sdd, 153). Chose essentielle, mais d’ores et déjà problématique, du système de dépopulation vient se greffer sur un événement qui tend à lui seul à prouver son bien-fondé, la guerre de Vendée.
Quand on parle de la Vendée pendant la Révolution, de quoi parle-t-on exactement ? Symboliquement comme géographique-ment, la Vendée excède ses propres limites, et impose son statut d’exception, revêtant tous les artifices de l’imagination. La Vendée est cette zone insurrectionnelle à l’Ouest du pays, dont les habi-
15. Raphaël Lemkin, « Axis Rule in occupied europe: laws of occupation – Analysis of Government – Proposals for Redress », Washington, Carnegie Endow-ment for International Peace, 1944.
lA RéPuBlique PoPulicide 439
tants, nous explique Babeuf, « plongés dans la plus profonde igno-rance, et privés de toute communication entre eux, par le défaut des routes praticables, restèrent asservis aux nobles et aux prêtres, au milieu de la France libre » (sdd, 130). Cet isolement appelant le sang, Mona Ozouf le résumera simplement : « Le péché vendéen est l’insociabilité 16. » Terre isolée, population marginalisée et déva-lorisée par une propagande active, il n’en fallait pas moins pour la République d’enclencher le processus d’élimination à grands coups de chirurgie politique.
La Vendée est cette terre catholique fervente, royaliste de tradi-tion, contre-révolutionnaire par la force des choses, cette menace permanente qui pèse sur la France en pleine mutation républicaine. En fait, comme d’autres l’ont noté, la Vendée, c’est l’anti-principe même de la Révolution. Pis, c’est son mal, cet « horrible cancer intestin » (sdd, 130), le « chancre politique qui dévore le cœur de la République française 17 ». Elle est cette survivance de l’An-cien Régime en pleine révolution, ce résidu vicié de royauté qu’il faut éliminer, cette tare qu’il faut absolument purger 18. Tous ses habitants sont étiquetés « brigands », hors-la-loi, individus hors de la communauté républicaine promis à disparaître dans un avenir proche. Tous, sans exception. « L’aristocratie, les brigands furent dévorés ; mais aussi l’humanité fut atteinte, des innocents, des fem-mes et des enfants… » (sdd, 216). Que sont les femmes ? Des « sillons reproducteurs » qu’il faut absolument effacer 19. Que sont
16. Mona Ozouf, composition française. Retour sur une enfance bretonne, Paris, Gallimard, 2009, p. 192.
17. Bertrand Barère, discours tenu à la Convention le 1er octobre 1793, cité dans le moniteur du 7 octobre 1793.
18. En pleine guerre, Hérault de Séchelles écrivait expressément à Carrier : « Nous te conjurons d’aller à Nantes, sur-le-champ ; nous t’envoyons un arrêté qui te presse de purger cette ville » (Lettre citée par Babeuf, dans sdd, 174). Ce que Carrier fera avec exactitude : « Je ferai rouler les têtes dans Nantes, je régé-nérerai Nantes » (sdd, 197). C’est le moment des tristement célèbres noyades, parfois appelées « mariages républicains », dans une Loire rebaptisée « baignoire nationale », l’heure des exterminations dans les prisons ou camps de prisonniers, désignés comme « antichambres de la mort » ou « mouroirs », de tous les brigands de Vendée.
19. Dans la sous-catégorisation honteuse du populicide, on peut parler d’un véritable fémicide perpétré contre les femmes de la Vendée, objets de la violence la plus extrême.
440 RoNAN chAlmiN
les enfants ? De « futurs brigands », tout aussi dangereux que leurs aînés. Hommes, femmes, enfants, on le voit, la volonté de destruc-tion est globale. De ce conflit mélangeant indistinctement faits de guerre et exécutions sommaires, Babeuf résume avec ses mots : on y assassine « militairement » et on y assassine « révolutionnairement » (sdd, 185). Zone symbolique de confrontation entre l’ancien et le nouveau régime, entre l’ancien et le nouveau monde, la Vendée est le basculement d’un type de violence « légitime » à un autre, illégitime, mêlant aux pertes militaires des crimes de guerre, voire des crimes contre « l’humanité ». Non sans fierté, Carrier osera déclarer : « C’est par principe d’humanité que je purge la terre de la liberté de ces monstres 20. »
Comment s’expliquer une telle flambée de violence au cœur de la Révolution des droits de l’homme ? D’abord, Babeuf dépeint en quelques pages denses et clairvoyantes la situation générale en stigmatisant la « religion du républicanisme » (sdd, 127), où « on y voit prêchée la foi démocratique, exactement comme jadis celle de Christ au Mexique » (sdd, 127). On impose, par la force, le nouveau régime, aux ordres de : « Crois aux trois couleurs, ou je te poignarde » (sdd, 128). à la conversion par la raison et l’édu-cation, choix pacifique d’un Babeuf, on préfère, dans les rangs des Jacobins, la violence et le sang. « Il n’était point dit de recevoir à conversion, d’admettre au giron de la République quiconque aurait mis bas les armes et serait venu s’y présenter. Non, il était prescrit de tout tuer, tout brûler. Personne n’était plus censé, ne pouvait plus être cru, fidèle ou capable de se le rendre, dans ce pays déclaré en rébellion » (sdd, 128).
La traduction de cette situation en tous points exceptionnelle est à lire notamment dans l’article VII du décret du 1er août 1793 : « Les forêts seront abattues ; les repaires des rebelles seront détruits ; les récoltes seront coupées par les compagnies d’ouvriers, pour être portées sur les derrières de l’armée et les bestiaux seront saisis. La race rebelle sera exterminée, la Vendée détruite. » Une proclama-tion de la Convention nationale à l’armée de l’Ouest du 1er octo-
20. Jean-Baptiste Carrier, le moniteur, n° 98, 28 décembre 1793. Voir par ailleurs Alain Gérard, « Par principe d’humanité… » la terreur et la Vendée, Paris, Fayard, 1999.
lA RéPuBlique PoPulicide 441
bre 1793 enfonce le clou : « Soldats de la Liberté, il faut que tous les brigands de la Vendée soient exterminés avant la fin du mois d’octobre. Le salut de la patrie l’exige, l’impatience du peuple fran-çais le commande, son courage doit l’accomplir… » (sdd, 170). Avec de telles envolées, le massacre pouvait commencer.
Mais pourquoi, justement, une telle explosion de violence ? C’est ici, dans un passage crucial, que Babeuf expose « les caractères et les causes de la guerre de la Vendée », et tente de percer au cœur du système qu’il s’est donné pour mission de dénoncer. Et c’est, logi-quement, qu’on peut s’interroger sur la validité des thèses avancées par Babeuf dans ce « plan de destruction totale » (sdd, 148). Il tend à révéler l’existence d’un secret visant à exterminer une majo-rité de la population française, appliquant à la lettre une simple maxime de Rousseau : « Maximilien et son conseil avaient calculé qu’une vraie régénération de la France ne pouvait s’opérer qu’au moyen d’une nouvelle distribution du territoire et des hommes qui l’occupent », accomplissant ainsi « la grande conclusion de J. Jacques » : « Il faut que tous les citoyens aient assez et qu’aucun d’eux n’ait trop » (sdd, 116). En conséquence de quoi, « un dépeu-plement était indispensable, parce que, calcul fait, la population était en mesure excédante des ressources du sol, et des besoins de l’industrie utile : c’est-à dire que les hommes se pressaient trop chez nous pour que chacun y pût vivre à l’aise… » (sdd, 117). Enfin, « (et c’est là l’horrible conclusion), que la population surabondante pouvait aller à tant (il nous manque le bordereau des fameux légis-lateurs) il y aurait une portion de sans-culottes à sacrifier… » (sdd, 118). Voici le secret honteusement dissimulé selon Babeuf, la base de l’équation censée motiver la volonté d’extermination qui frap-pera la Vendée, puis d’autres régions d’insurrection, équation qui marie dorénavant deux systèmes complémentaires : « le système de dépopulation et de réformation du mode de division des pro-priétés » (sdd, 208). Ce système, appliqué en premier en Vendée, devenue sans le vouloir laboratoire de l’idéologie jacobine, repose-rait moins sur des considérations d’ordre militaire ou stratégique que sur des considérations d’ordre socio-économique. du système de dépopulation se veut donc la clé interprétative du sang versé par la Révolution, le pourquoi de l’explosion de la violence de l’an II, une
442 RoNAN chAlmiN
violence de moins en moins anarchique et de plus en plus systéma-tique. « Je donne, à mes contemporains et à l’histoire, une clé bien explicative d’un grand nombre de mesures dont l’ensemble avait paru présenter jusqu’ici un vaste problème politique » (sdd, 119). Face au mystère de cette violence graduelle et sérielle, Babeuf pense avoir trouvé le fin mot de l’histoire. En effet, « avec le système de dépopulation, nous instruit Babeuf, et de nouvelles dispositions répartitives des richesses entre ceux qui doivent rester, on explique tout, guerre de Vendée, guerre extérieure, proscriptions, guillotina-des, foudroyades, noyades, confiscations, maximum, réquisitions, préhensions, largesses à certaines portions d’individus, etc. » (sdd, 120). Cette révélation du prétendu secret a donc valeur d’expli-cation globale des mesures de la Terreur – « on explique tout » –, Babeuf partant de la simple observation des faits pour remonter à l’origine du mal, afin d’en mieux théoriser les causes.
*
Aussi, au-delà de la description-dénonciation des massacres commis en Vendée sur lesquels la critique se concentre principale-ment aujourd’hui, du système de dépopulation est l’occasion d’une analyse assumée de la tentative d’application scrupuleuse de la doc-trine égalitaire par le partage des terres ou loi agraire. L’insurrection de la Vendée n’a de sens, pour Babeuf, que parce qu’il s’agissait pour le gouvernement révolutionnaire de « faucher totalement » la population « dans une région qui, par sa beauté et sa bonté produc-tive, fournirait une vaste ressource à l’établissement des premières nouvelles colonies agrairiennes » (sdd, 129). Projet ambitieux, qui touche au cœur de la philosophie sociale du xviiie siècle, siècle par-tagé entre « chimère » de la loi agraire et maintien de la propriété, entre fier éloge de l’égalité et défense farouche de l’inégalité.
Remarquablement, c’est à un parfait jeu de lectures qu’on assiste ici : Robespierre lecteur de Rousseau, Babeuf lecteur de Robes-pierre – donc Babeuf lecteur de Rousseau –, mais aussi Babeuf lec-teur de lui-même. En effet, si cette brochure instaure un dialogue posthume jamais interrompu entre deux figures révolutionnaires majeures, Robespierre et Babeuf, elle est aussi le moment d’une clarification de Babeuf vis-à-vis de ses propres théories sociales en
lA RéPuBlique PoPulicide 443
pleine maturation. Par certains aspects, du système de dépopula-tion est une confession, ou plutôt une anti-confession, où Babeuf exprime plus ce qu’il n’attend pas de la Révolution que ce qu’il en attend, à travers la figure de son principal acteur. De fait, dans ce pamphlet thermidorien qu’on qualifie trop vite d’antirobespier-riste, Babeuf ose faire parler le tyran déchu, sans chercher à le cen-surer : « Je n’entends point censurer la partie politique du plan de Robespierre… » (sdd, 121). « Je vais plus loin, ajoute-t-il. Je dis que (dût-ce cette opinion paraître ressembler au système de Robespierre) soit que l’on combatte ou non, le sol d’un Etat doit assurer l’existence à tous les membres de cet état… » (sdd, 121). Où Babeuf se situe-t-il exactement dans la politique robespierriste ? Que pense-t-il exactement de Robespierre ? On sait qu’il aura tou-jours soin de distinguer deux personnes, le législateur et le dicta-teur21. Avec ce double Robespierre, Janus bi-frons de la Révolution, c’est une double Terreur que dessine Babeuf ; une bonne Terreur, qui tente d’accomplir les revendications des sans-culottes, et une mauvaise Terreur, qui engage ces mêmes sans-culottes sur la voie de l’extermination. En plein Thermidor, Babeuf ose voir le positif du projet jacobin, loin de la condamnation unanime, lorsque celui-ci pense « égalité ».
Ce problème concret d’une égale répartition assurant le « bon-heur commun », matrice de la doctrine babouviste, est une ques-tion à laquelle Babeuf réfléchit depuis longtemps, lui le bien nommé Gracchus en souvenir des Gracques, lui l’ancien feudiste en Picardie, dont l’œuvre la plus théorique reste le cadastre per-pétuel, ou démonstration des procédés convenables à la formation de cet important ouvrage, pour assurer les principes de l’Assiette et de la Répartition justes et permanentes, et de la perception facile d’une contribution unique, tant sur les Possessions territoriales, que sur les revenus personnels, d’octobre 1789. Dans le discours préliminaire,
21. « … Robespierre dans lequel il semble qu’on doive distinguer deux person-nes, c’est-à-dire Robespierre sincèrement patriote et ami des principes jusqu’au commencement de 1793, et Robespierre ambitieux, tyran et le plus profond des scélérats depuis cette époque. » Gracchus Babeuf, Journal de la liberté de la presse, n° 1, 17 fructidor an II. Concernant l’opinion partagée de Babeuf vis-à-vis de Ro-bespierre, on peut lire Victor Daline, « Robespierre et Danton vus par Babeuf », dans AhRF, n° 162, Paris, 1960
444 RoNAN chAlmiN
il imagine une division égale du territoire pour les 24 millions de Français, soit un total de « onze arpents » de terre cultivable pour une famille de quatre personnes. Ainsi seraient assurées « l’honnête médiocrité » et « la simplicité des mœurs » de la nation, gage de son bonheur, selon l’idéal républicain de frugalité proposé par la philosophie classique.
Mais comment réellement y parvenir ? Telle est l’interrogation qui sous-tend l’analyse de Babeuf, et qui fait de la Vendée, non le paradis réalisé de l’égalité mais le cauchemar égalitariste par excel-lence. à cette question essentielle posée à la Révolution, dont l’ab-sence de réponse ferait que « l’égalité de droits ne serait qu’un vain mot », que « l’aristocratie des propriétaires serait toujours réelle », que « le petit nombre serait toujours tyran de la masse » (sdd, 117), Robespierre répond lui, selon Babeuf, par la dépopulation. Ce sera l’expérience politique de la Terreur même. Si le système de dépopulation repose sur une motivation sociale comme le pense sincèrement Babeuf, son exécution est tout autre. Elle commande le sang, et s’édifie par l’extermination. On voit bien ici le che-minement de l’idée philosophique en idéologie, ici terroriste. La Terreur se fait accessoire indispensable de la pratique politique en tant qu’elle applique par la violence la théorie philosophique qui dit que : « Il faut que tous les citoyens aient assez et qu’aucun d’eux n’ait trop. » Alors, « qu’est-ce que le maximum, les préhensions, la commission de subsistances ? » Réponse de Babeuf : « le premier acte de prise de possession de toutes les propriétés par le gouverne-ment ». « Qu’est-ce que les guillotinades, des riches de préférence, et les confiscations sous des prétextes de toute espèce ? » Nouvelle réponse : « le second acte de la même investiture » (sdd, 119). Une fois encore, Babeuf explique la fin par les moyens, en appliquant sa propre logique aux événements.
Cette idée d’égalité envisagée par Robespierre est hautement problématique pour Babeuf, qui ne cessera d’hésiter sur le recours à la violence dans la réalisation de cet impératif idéologique. S’il veut toujours une redistribution égalitaire des terres dans la fou-lée de la Terreur, il la souhaite, et l’espère, sans effusion de sang : « Je réprouve ce point particulier de leur système. Outre que je ne crois pas avec eux que les productions du sol français n’aient jamais été en proportion inférieures aux besoins de tous ses habitants,
lA RéPuBlique PoPulicide 445
c’est que je suis encore, sur le chapitre de l’extermination, homme à préjugés » (sdd, 122). Sentiment louable, surtout à cette épo-que, et qui sera la marque de fabrique de Babeuf dans sa pratique révolutionnaire – il suffit de voir l’action stérile de la Conjuration des égaux. Si Robespierre, et le terrorisme avec lui, semble vou-loir appliquer le principe de redistribution égalitaire des terres par la violence, Babeuf croit lui en une résolution pacifique du pro-blème : « Je crois qu’alors les simples lois de la nature commandent au lieu de la dépopulation, la privation partielle de chacun des membres, pour satisfaire, par égalité, dans la proportion usuelle, les besoins de tous » (sdd, 96). On perçoit aisément la naïveté de la démarche. Comment appliquer la redistribution autrement que par la terreur ? Car Robespierre ne pouvait réussir son terrible projet qu’en « immolant les gros possesseurs et en imprimant une terreur si forte qu’elle fût capable de décider les autres à s’exécu-ter de bonne grâce » (sdd, 117). La Terreur devient dès lors le seul moyen de l’application du principe d’égalité. « Contrôlée et maîtrisée », elle apparaît comme un « moyen de recomposition égalitaire de la société 22 ». Conscient du danger d’une telle pro-position, Babeuf tient à rectifier : « Je n’ignore pas que Platon, Mably, Montesquieu et quelques autres ont parlé de la possibilité d’une population, excédant la mesure que le territoire est capable de soutenir. Aucun d’eux n’a l’audace d’insinuer le massacre de sang-froid de la portion qui surcharge l’état. […] Cette matière que, sans doute malheureusement, le génie de Robespierre a trop pesée et mal mûrie, est cependant digne de toute l’attention du Sénat, et qui ne songera pas à la réfléchir, n’est point législateur. » (sdd, 123). Explication audacieuse de la Terreur comme une mau-vaise lecture de la philosophie, une lecture pervertie.
En ce sens, du système de dépopulation serait une critique de l’éga-lité pratique, une critique tout à fait cohérente des effets de la Terreur comme, entre autres malheurs, réalisation désastreuse du principe d’égalité. Car c’est bien l’égalité qui est l’idée centrale du texte de Babeuf, « partie très essentielle du système » (sdd, 116), qui rap-proche et divise à la fois les deux hommes dans les fins et dans les
22. Claude Mazauric, article « Terreur », dans dictionnaire historique de la Révolution française, Paris, PUF, 1989, p. 1024.
446 RoNAN chAlmiN
moyens. Fort pertinemment, Babeuf expose ici la politique sociale de Robespierre sous la Terreur, marquée pour des historiens comme F. Furet par un « fanatisme égalitaire 23 », politique qui s’exprime malheureusement comme dépeuplement afin de promouvoir un meilleur (au sens d’égal) repeuplement. Par où fallait-il commencer ? Par la Vendée. « Il était incontesté qu’il fallait faire de la Vendée un pays absolument neuf, qu’il fallait, en un mot, une totale destruc-tion, et qu’après cela, on repeuplerait, on recomposerait des colonies toutes nouvelles, des soldats qui auraient combattu pour la liberté, entre lesquels seuls aurait été fait le partage des terres » (sdd, 143). Soit. Mais, après la Vendée ? Quelle autre partie de la population aurait été sacrifiée ? Pouvait-on croire à un simple cantonnement vendéen, quand Babeuf précise justement la volonté d’étendre le sys-tème de dépopulation « à toutes les parties de la République », sous principe de régénération nationale ? La Terreur de 1793 a réussi cet effroyable exploit, a permis, dit Babeuf, cette « horreur délirante que des Français s’entre-dévorassent, et qu’ils réduisissent en cendres une immense étendue de leur propre pays » (sdd, 137).
L’intelligence du réquisitoire de Babeuf montre que personne ne peut se targuer d’être à l’abri des effets de l’affreux système. C’est une erreur commune de croire que la Terreur comme violence rationna-lisée à fin politique ne concerne qu’une partie de la population, la partie déclarée ennemie. La Terreur, dans sa logique même, peut et doit s’appliquer à tout le monde. Elle est globale et non unilatérale. Babeuf tient à mettre les points sur les « i », en analysant clairement la manipulation idéologique dont ont été victimes les deux camps : « Je n’attaque point nos braves sans-culottes. Ils furent les instru-ments aveugles de la scélératesse des gouvernants. Comme leurs frères de la Vendée, ils furent égarés par l’erreur. L’erreur et l’erreur s’entre-tuaient. On entretint l’une et l’autre, à dessein de prolon-ger cet effet jusqu’à extinction. […] Ici c’est la même nation parmi laquelle on souffle le froid et le chaud ; c’est le même peuple qu’on divise entre deux parties pour le faire s’entre-massacrer, pour remplir
23. « La “Terreur’’ peut ainsi avoir trouvé une part de ses origines dans un fanatisme égalitaire né d’une pathologie inégalitaire de l’ancienne société. » Fran-çois Furet, article « Terreur », dans dictionnaire critique de la Révolution française, Paris, Flammarion, 1988, p. 169.
lA RéPuBlique PoPulicide 447
un infâme but politique encore inouï : sarcler la race humaine ! » (sdd, 150-151). Belle et triste explication, qui résume parfaitement le processus idéologique de destruction par la division mis en place par le gouvernement révolutionnaire. La création, par la propagande, de deux entités, l’une monstrueuse pour l’autre, et dont la seule solu-tion réside dans l’extermination stricto sensu de la population adverse. Babeuf insiste avec raison sur la scission opérée par la Terreur au sein du « même peuple ». La Terreur, c’est la division générée par la peur, ainsi que la définira Tallien : « Sous le système de la terreur, le pays a été divisé en deux classes : celle qui fait peur et celle qui a peur, en persécuteurs et persécutés 24. » La Terreur n’est donc pas une simple guerre, une guerre contre une force étrangère, mais une guerre intestine, une guerre fratricide, caïnique. Elle est un mal interne et non externe, une violence exercée par une minorité sur une majo-rité de la population d’une même nation. Derrière la monstruosité d’une guerre qu’on désignera comme civile, Babeuf dénonce, non sans perspicacité, la monstruosité oxymorique absolue, celle-là même surclassant les connus « Terreur et vertu » ou autre « despotisme de la liberté » : la République populicide – la République française massa-crant le peuple de France, pour son plus grand « bonheur ».
*
De cet état de fait inexcusable, un mot justement sort du lot, et frappe tant par sa nouveauté que par sa dureté. Il s’agit de « popu-licide », mot qui va servir à nommer l’innommable. Il est en effet intéressant de noter que Babeuf, dans l’acte d’accusation porté contre le gouvernement révolutionnaire et contre son instrument Carrier, se voit dans l’obligation d’employer une nouvelle terminologie, face au caractère proprement inouï des événements. Quand les mots manquent pour décrire une entreprise aussi inhumaine, il en faut de nouveaux, propres à définir un concept inédit et à frapper l’ima-gination. Il en sera ainsi de populicide, mot formé du radical latin populus, « peuple », et du suffixe « -cide », issu lui de caedere, « tuer », « détruire », « massacrer ». Le populicide, littéralement, c’est ce qui
24. Jean-Lambert Tallien, discours du 11 fructidor an II, cité dans l’Ancien moniteur, n° 21.
448 RoNAN chAlmiN
tue le peuple, ce qui le détruit, ce qui l’anéantit. On utilise le mot sous sa forme adjectivale ou nominale à l’époque, mais c’est surtout sa forme adjectivale qui survit à la Révolution française. Gracchus Babeuf en aurait la paternité, au moins l’usage confirmé, lui qui a cette grande sensibilité de la langue et le don pour la formule choc 25. Parlant de Desmoulins, il souligne à forte raison « l’insolence plébéi-cide » (sdd, 140) de ses vues sur la Vendée. Et il n’hésite pas à traiter les Français de « nationicides » (sdd, 219), insistant sur le caractère destructeur accordé non plus au peuple lui-même, comme entité physique, mais à la nation entière, comme entité politique – termi-nologie déjà utilisée contre le roi Louis XVI lors de son procès.
Le terme de « populicide » a retrouvé une seconde jeunesse ces dernières années, notamment grâce à la première réédition en 1987 du système de dépopulation par Secher et Brégeon. Il accompagne la réappréciation de la guerre de Vendée et son impact sur la mémoire nationale. En effet, le populicide est devenu en soi un enjeu mémo-riel de première importance, et le mot se doit d’être employé avec toutes les précautions qu’il suppose, trop vite considéré comme l’exacte traduction de « génocide 26 ».
Aussi faut-il préférer au mot trop perturbateur de « génocide » celui de « populicide », breveté pour l’occasion par Babeuf lui-même, mot plus juste dans sa définition. Car, dans le système de dépopulation mis en place en Vendée, il s’agit moins d’exterminer
25. Notons en passant que l’on doit encore à Babeuf les mots de terroriste et de terrorisme, dont il fait les premiers usages en septembre 1794, parlant fort à propos des « … patriotes terroristes (les Français aiment toujours la variété, cette expression va venir à la mode)… » G. Babeuf, Journal de la liberté de la presse, n° 4, septembre 1794, cité dans Annie Geffroy, « Terreur et terrorisme : les mots en héritage, du néologisme au concept », dans la Vendée. Après la terreur, la re-construction, Paris, Perrin, 1997, p. 155.
26. Dans la toute nouvelle réédition du texte de Babeuf, Brégeon apporte un bémol intéressant à ses propos d’alors : « Quant à l’introduction du concept de génocide dans les débats historiques, elle a peut-être plus embrouillé qu’éclairé les pistes. L’interprétation sémantique du texte de Babeuf est forcément délicate. Il n’a recours au terme “populicide’’ que sous sa forme “adjective’’. Bref, les mots de l’époque révolutionnaire ne coïncident pas exactement avec les termes que nous employons. » Brégeon, « Post-scriptum 2008 », dans Babeuf, la Guerre de la Vendée et le système de dépopulation, p. 98-99. C’est cet « exactement » qui change tout, et que nous cherchons à interroger ici. Autrement dit, est-ce que le génocide est l’équivalent du populicide ? Rien n’est moins sûr.
lA RéPuBlique PoPulicide 449
un groupe humain de type racial, ethnique ou religieux, qu’une partie indéterminée du peuple entier, vendéen en majorité mais aussi bon républicain. Babeuf ajoute en effet : « J’ai démontré que, dans le système de dépopulation, les gouvernants ont voulu diriger la partie d’exécution qui aurait lieu sur le théâtre de la Vendée, de manière à ce que la destruction s’opérât, d’abord sur une très grande partie de l’armée républicaine, et ensuite sur la totalité de la population vendéenne » (sdd, 164). L’important pour Babeuf est de dénoncer un massacre exercé non sur une minorité mais sur une majorité d’individus, le peuple en l’occurrence.
De dépeuplement, de dé-population, de « populicide » donc, c’est précisément le mot de peuple qui ressort, et de son meurtre intolérable pour Babeuf, si l’on considère justement que le peuple doit être l’objet de toute l’attention en période de révolution, et non l’objet de la répression ou de la destruction la plus sanglante. Babeuf s’emporte : « Spécialement chargé de prononcer au nom du peuple dans la cause de la Révolution, la sainte cause de l’humanité, je n’oublierai jamais que la première de toutes les lois, celle où tou-tes les autres viennent se centraliser, est le salut du peuple » (sdd, 214). Sans doute sera-ce le grief le plus fort que nourrira Babeuf à l’encontre de Robespierre, passant du statut envié de législateur à celui exécré de tyran. Juridiquement parlant, le populicide mené par l’Etat jacobin est alors le crime de lèse-révolution par excellence, qui vient s’ajouter à la déjà longue liste des crimes de lèse-majesté, lèse-nation, lèse-humanité, etc. Avec le populicide, c’est une classe qu’on extermine et non une race. La distinction est d’ordre social pour Babeuf, qui prêchera bientôt la « guerre atroce du riche contre le pauvre 27 ». Car, en fin de compte, c’est bien le peuple qui est la victime la plus touchée des atrocités commises, de quelque bord qu’il soit, dans ce que Babeuf qualifie de « système de carnage uni-
27. G. Babeuf, « Manifeste des plébéiens », dans le tribun du peuple, n° 35, 9 frimaire an IV (30 novembre 1795), dans ecrits, p. 280. On oppose aussi à l’époque les « ventres dorés » aux « ventres creux ». On sait que Marx a souvent critiqué cette vision primaire de la lutte des classes, entre riches et pauvres, et non entre bourgeois et prolétaires. Mais Mazauric a raison de préciser que Babeuf parle selon la réalité qui est la sienne, celle de la fin du 18e siècle, qui n’est pas un problème de possession mais de consommation. Voir Claude Mazauric, Babeuf et la conspiration pour l’égalité, Paris, éditions sociales, 1962, p. 23-24.
450 RoNAN chAlmiN
versel » (sdd, 140). C’est, des trois états, le nouvellement reconnu Tiers Etat qui est touché de plein fouet, et notamment cette sans-culotterie qui est le moteur même de l’effort révolutionnaire28. Babeuf, faisant parler les bourreaux, n’écrivait-il pas : « Il est temps de tourner la faux de la mort sur la totalité de cette race vendéenne, dont l’exaspération fanatique, que nous avons eu soin d’entretenir, nous a si bien servi » (sdd, 170). L’image de la faux qui fauche non plus les blés mais les hommes symbolise très bien ce mouvement de balancier mortel qu’est la Terreur, dans ce « système de dépeu-plement, dans lequel, rebelles et fidèles, tout est bon à détruire » (sdd, 119-120). Preuve sans doute que la notion de génocide reste elle-même très restrictive face à l’ampleur du massacre.
En définitive, cette notion-clé de « populicide » montre le rap-port toujours problématique entre la révolution et le peuple, son objet de prédilection. Le peuple est la matière révolutionnaire ; il est à la fois le matériau et l’œuvre, il est le moyen et la fin. En tant que tel, il devient malléable dans les mains des politiques, parfois protégé, parfois sacrifié, dans l’optique constante d’être régénéré. Le Peletier, secrétaire de la Convention, le dit : « Considérant à quel point l’espèce humaine est dégradée par le vice de notre ancien système social, je me suis convaincu de la nécessité d’opérer une entière régénération et, si je peux m’exprimer ainsi, de créer un nou-veau peuple. » Ce que démontre Babeuf page par page, c’est le ris-que fondamental encouru par toute révolution poursuivant un but de régénération : celui d’une désintégration de la communauté au moment de sa refondation. La révolution se situe constamment sur le fil du rasoir, à la fois aux bords du gouffre de la guerre civile et de la régénération, de l’édification et de la destruction. La Révolution française fait ce terrible constat qu’il faut exterminer une partie de la population pour la survie de l’autre, au point de parler sans fard de « régénération guillotinière 29 », et d’utiliser l’affreuse machine comme d’un scalpel chirurgical. Sublime et terrible métamorphose
28. Il est intéressant de noter que le mot de « populicide » est traduit en anglais par plebicide, ce qui renforce une fois encore l’idée de couche populaire décimée (la plèbe), et non les couches supérieures de la société.
29. Selon l’expression attribuée au médecin Marc-Antoine Baudot, prêt lui à supprimer un quart de la population alsacienne. Cité dans Xavier Martin, Régé-
lA RéPuBlique PoPulicide 451
à la fois, la révolution doit passer par un moment de purge inévi-table, ce que d’abord Babeuf reprochera amèrement à Robespierre, puis finira par encenser comme preuve de son génie politique. En effet, Babeuf change radicalement de discours sur ce dernier, et écrit en plein Directoire à son ami Bodson : « Mon opinion est qu’il fit bien. » Pour poursuivre, éclairant ainsi sa pensée : « Le salut de 25 millions d’hommes ne doit point être balancé contre le ménagement de quelques individus équivoques. Un régénérateur doit voir en grand. Il doit faucher tout ce qui le gêne, tout ce qui obstrue son passage, tout ce qui peut nuire à sa prompte arrivée au terme qu’il s’est prescrit. » Et de conclure : « Il est vrai que ces idées-là pouvaient entraîner toi et moi. Qu’est-ce que cela faisait si le bonheur commun fût venu au bout 30 ? » Babeuf, désespéré par la « dérévolution thermidorienne 31 », s’est converti tardivement au robespierrisme, au point d’en devenir le nouveau héraut, et de développer toute une rhétorique du sacrifice, individuel et collec-tif. Conscient du prix humain à payer par toute régénération, il parvient à la conclusion qu’il ne peut y avoir de révolution sans terreur – de révolution de fait et non de droit s’entend, pour parler la langue babouviste. Dans cette révolution mariée de force à la Terreur, le populicide devient un passage obligé, un acte nécessaire à la bonne marche révolutionnaire. Il devient un accessoire primor-dial au programme de régénération. Aussi le terrorisme, comme exacerbation de la régénération, est-il par essence un populicide. Parfois il travaille pour le peuple, souvent il travaille contre lui. C’est le grand mensonge de la Terreur, plus encore que son secret, que du système de dépopulation dénonce : non pas servir le peu-ple, mais se servir de lui, pour mieux le détruire, avec l’ambition déguisée de le reconstruire. Tantôt acte négatif, tantôt acte positif, Babeuf s’enferme dans ses propres contradictions, prêt à toutes les compromissions pour la réalisation immédiate du « bonheur com-mun » promis par la Constitution de 1793 et toujours absent. Mais c’est effrayé et désabusé face au recul de l’égalité sous Ther-
nérer l’espèce humaine. utopie médicale et lumières (1750-1850), Bouère, DMM, 2008, p. 102.
30. G. Babeuf, lettre du 9 ventôse an IV (28 février 1796) à Joseph Bodson, citée dans écrits, p. 285-286.
31. G. Babeuf, le tribun du Peuple, n° 34, 15 brumaire an IV.
452 RoNAN chAlmiN
midor et sous le Directoire, qu’il pourra tout de même déclarer en avril 1796, dans le tout dernier numéro du tribun du peuple, comme la fin d’un parcours populicide entamé depuis la dictature de l’an II sur les terres vendéennes ou dans les rues parisiennes : « Tout est consommé. La Terreur contre le Peuple est à l’ordre du jour 32. » contre le Peuple : simple ajout à la célèbre formule qui veut tout dire de l’échec patent de la révolution sociale de 1793 et du retour spectaculaire de l’individualisme bourgeois.
*
Les hésitations de Babeuf, passant de l’accusation féroce à la défense farouche de Robespierre, ne doivent pas cependant remettre en cause l’intérêt critique de son système de dépopulation, météore dans le ciel de Thermidor, cette articulation non pas fantasmatique mais théorique du plan d’action du gouvernement révolutionnaire dans les années 1793-1794, avec le démantèlement des mécanismes idéologiques et politiques de la Terreur comme imposition par le sang du principe d’égalité.
Alors, de tout ce sang versé au nom de l’égalité déplore Babeuf, ne demeure que les dernières lignes pleines d’indulgence de l’ouvrage qui, en prévenant de « l’abîme où l’insatiable vengeance pourrait précipiter les républicains et ensevelir la République » (sdd, 219), réclament que paix soit faite au sein d’un peuple français suffisam-ment décimé : « Puissent, en ces jours de clémence nationale, où les délégués du Peuple viennent d’accorder une amnistie à des Français horriblement égarés, qu’on avait vus longuement et frénétiquement atroces, journellement et opiniâtrement nationicides, puissent, enfin, tous les citoyens se réunir par les étreintes de la fraternité… » (sdd, 219). La fraternité étant, Babeuf le sait, la condition sine qua non de l’établissement et de l’affermissement de la liberté, et de l’égalité.
Ronan ChalminConnecticut College
32. G. Babeuf, le tribun du peuple, n° 43, 24 avril 1796, cité dans écrits, p. 297.