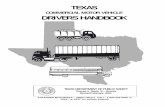Système endomembranaire - Objectif PASS Marseille
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of Système endomembranaire - Objectif PASS Marseille
1
Système endomembranaire
I. INTRODUCTION Caractéristiques du système endomembranaire (SE) :
- Présent uniquement chez les eucaryotes - Repose sur un ensembles d’éléments constitutifs : Cavités (RE ou Golgi) / Vésicules / Tubules
/ Canalicules / vacuoles Le SE désigne l’ensemble de tous les compartiments intracellulaires délimités par une membrane, SAUF les mitochondries et les peroxysomes. Le Système Endomembranaire réalise des échanges avec :
- Le cytosol - La membrane plasmique - Le milieu extracellulaire.
Figure 1 chapitre 8 : Les éléments constitutifs du SE-> ses relations avec le cytosol, ses relations avec la MP et le milieu extracellulaire Figure 2 chapitre 8 : Les 5 étapes du transport vésiculaire entre compartiments Les étapes du transport vésiculaire (vésicule à revêtement cytosolique) COP: COating Proteine FAPP: Four-Phosphate AdaPtor Protein Les étapes du transport vésiculaire : Les étapes : bourgeonnement et détachement ; puis déshabillage, transport et fusion. Ce transport va permettre le transport entre les différents compartiments : on parle d’un compartiment donneur et d’un compartiment receveur. On a une vésicule qui bourgeonne au niveau du compartiment donneur, nécessité de facteurs cytosoliques mais aussi parfois de protéines spécialisées. Cette vésicule est recouverte de revêtements protéiques : sur le schéma ce sont des revêtements cytosoliques (COP, FAPP, clathrines). Ces 3 types de revêtements doivent être éliminés pour que la vésicule soit transportée car impossibilité d’interaction avec les molécules du cytosquelette lorsque les vésicules sont recouvertes. Cette étape n’existe pas pour la cavéoline car c’est une protéine intégrale qui a une structure en épingle en cheveux qui ne gêne pas les interactions avec les protéines motrices du cytosquelette. Le bourgeonnement d’une vésicule recouverte de clathrine fait intervenir de la dynamine. Il y a intervention de facteurs cytosoliques et qui peuvent être spécifiques ou pas de ces compartiments. Les compartiments du SE sont :
- le RE qui est un compartiment regroupant le REG, le REL et l’enveloppe nucléaire (EN) - L’appareil de Golgi - Les endosomes (phagosomes) - Les lysosomes
En plus de ces compartiments, il existe tout un système de vésicules, tubules, canalicules et vacuoles permettant le transit entre les différents compartiments et entre les compartiments et la MP : ces éléments appartiennent également au SE.
2
Par ailleurs, concernant ces transports, 2 notions importantes les conditionnent :
- Les signaux d’adressage et de rétention pour un ou pour plusieurs compartiments = signaux spécifiques.
- Le Flux : o Membranaire vectoriel permanent : dans le sens de synthèse des protéines (de
retour vers Golgi et le RE) (Flux majoritaire, la majorité du matériel commence par être transportée comme ça)
o De retour vers Golgi et RE : moins important. (Si une protéine nécessite une glycosylation, elle va au Golgi, est glycosylée puis revient au RE car elle doit y résider. PAS pour toutes les protéines !)
II. LE RETICULUM ENDOPLASMIQUE
A. Définitions et caractéristiques Il est constitué de cavités, de vésicules, de tubules, de vacuoles et d’un réseau de canalicules qui réalisent un réseau à l’intérieur de la cellule. (Golgi : vésicules et saccules). Il est en continuité avec l’enveloppe nucléaire qui est elle-même du réticulum. 2 formes différentes de RE : (proportions variables selon la cellule)
- REG (Réticulum endoplasmique granulaire) avec des ribosomes sur la face cytosolique. - REL (Réticulum endoplasmique lisse) sans ribosome ➔ Ce sont deux formes particulières d’un même compartiment
Le nombre de REG/REL varie : - Selon la cellule (synthèse protéique : ++ REG) ➔ Cellules pancréatiques - Selon le moment de la vie cellulaire
o Synthèse protéique +++REG o Détoxification +++ REL (qui est éliminé après)
B. Fonctions communes à l’ensemble des cellules eucaryotes Il existe 10 grandes fonctions communes du RE et qui sont ubiquitaires à toutes les cellules eucaryotes :
3
1. Translocation des protéines solubles au cours de leur biosynthèse Translocation = passage d’un endroit à un autre CF Chapitre 4 Figure 2 : Les début cytosoliques de la synthèse des protéi,nes codées par génome nucléaire, leurs principales destinations
Les protéines solubles synthétisées par le RE peuvent avoir 3 destinations :
- La MP (protéines périphériques externes) - Le milieu extracellulaire (protéines qui vont être secrétées) - Les autres compartiments du SEM (RE, Golgi, Endosomes, Lysosomes)
Le flux membranaire est vectoriel et permanant. Rappel : sans signal d’adressage au RE, la protéine va continuer sa synthèse dans le cytosol. Fig.4 : Le signal d’adressage au RE (d’entrée au RE) : peptide signal SRP : Signal Recognition Particle : complexe ribonucléoprotéique fonctionne comme une protéine G monomérique (fixe le GTP et l’hydrolyse) Signal d’adressage : pendant la biosynthèse Le peptide signal est le signal de traversée de la membrane d’enveloppe du RE. C’est est une séquence consensus de 15-20 AA hydrophobes situés toujours à l’extrémité N-terminale (PM :20x100Da à 110 Da = 2 à 2,2 kDa environ). Extrémité C terminale est temporaire car en cours de biosynthèse, c’est un site d’accrochage pour d’autres AA. On a en N-terminale un AA hydrophile comme une méthionine (Met). Dès le début (la protéine est courte) de la synthèse de la protéine, la séquence va être reconnue par :
- Une particule cytosolique : la SRP (ribonucléoprotéine) RNP qui fixe le GTP et peut l’hydrolyser, activité proche des protéines G monomérique.
- D’autres facteurs cytosoliques : chaperons de la famille des Hsp qui vont également reconnaître ce peptide signal.
Remarque : 2 enzymes peuvent couper la séquence peptidique en fin de synthèse :
4
- Une peptidase du signal après le signal d’adressage au RE, 20-30 AA après la première méthionine.
- Un signal peptide peptidase (SPP) au niveau du signal d’adressage au RE. Fig.3 : Le début de la synthèse d’une protéine destinée à entrer dans le RE Le signal d’adressage au RE interagit avec la SRP couplée au GTP. La SRP est un complexe ribonucléotide et fonctionne comme une protéine G monomérique (fixe le GTP et le GDP, hydrolyse le GTP en GDP). Il y a aussi une reconnaissance par les protéines chaperons cytosoliques, spécifiquement Hsp 70. Fig.5 La translocation de protéines solubles dans la lumière du REG se fait en plusieurs étapes :
- Fixation de la SRP au signal d’adressage au RE peptide signal
- Interaction SRP - récepteur SRP, qui a lui aussi une activité GTPasique, ce qui va permettre de rapprocher la grosse sous unité du ribosome de la membrane d’enveloppe au translocon (permet l’entrée de la protéine en cours de synthèse, c’est un pore aqueux qui est fermé à ce moment-là) complexe protéique particulier de la membrane du RE. Il est fermé par la protéine BiP résidente du RE et chaperonne.
- Interaction ribosome-translocon qui va être à l’origine du début de la traduction de la protéine. Quand 70 à 80 AA vont être assemblés sous forme de chaine protéique, ces derniers vont exercer une pression sur le translocon qui va alors s’ouvrir. Cela constitue un signal pour le départ de BIP.
- Ouverture du translocon via le départ de BiP (protéine chaperon luminale qui maintient la fermeture de l’orifice luminal du translocon).
- Traversée du RE par la protéine grâce à des protéines chaperons qui la prennent en charge. Le peptide signal est dans la membrane du RE. → C’est notamment le cas de BIP.
- Le peptide signal va alors s’enchâsser dans la membrane. A ce moment-là, la SRP se détache de son récepteur via une hydrolyse du GTP de la part du SRP et de son récepteur. Tout le reste de la protéine rentrent dans la lumière du réticulum.
Remarque : Cette étape peut être inhibée en cas d’utilisation du GTP gamma S qui est un analogue non hydrolysable du GTP. On arrête alors la translocation de la protéine au niveau où il y a GTP gamma S. Remarque : Dès que la protéine rentre dans le RE, elle va subir plusieurs modifications traductionnelles, pendant la synthèse protéique dans la lumière du RE :
- Glycosylation (de type N ou de type C) - Formation de ponts SS « au fil de l’eau » (c’est à dire réalisé un peu n’importe comment, au
hasard : lorsqu’une Cystéine rencontre une autre Cystéine) entrainant ainsi un début de repliement particulier.
A la fin de synthèse :
- Ribosomes se détachent du RE avec séparation de la grosse et la petite sous-unité. - Coupure du peptide signal par la peptidase du signal qui se passe en fin de synthèse
séparation de deux sous unités dans le cytosol
5
- La protéine est complètement soluble. Fig.4 chapitre8 : Les deux clivages successifs du peptide signal Remarque : Cette protéine a une nouvelle extrémité N terminale ! La coupure/clivage du signal par la peptidase du signal, à la fin de la biosynthèse, a 2 conséquences sur la protéine :
- Solubiliser la protéine dans la lumière du RE qui peut poursuivre sa glycosylation et son repliement.
- Nouvelle extrémité N-terminale car la précédente est restée sur le peptide signal. La protéine a alors été raccourcie d’environ 20 AA (= -2,-2,2 kDa)
Le peptide signal sera quant à lui coupé dans la membrane du RE par une signal peptide peptidase pour donner 2 fragments. Les fragments du peptide signal pourront alors :
- Soit passer dans la lumière du RE : liaison au CMH-I pour constituer un peptide antigénique. - Soit passer dans le cytosol
o Destruction dans le protéasome après ubiquitinylation o Liaison calmoduline pour l’inhiber.
2. Biosynthèse des protéines TM
Pour toutes les protéines TMB, a 1 ou n segments TMB, destinée à la MP ou à d’autres compartiments du SEM : il existe 2 types de signaux d’adressage au RE (la protéine n’en aura qu’un : soit l’un, soit l’autre).
- Le 1er : le peptide signal : pareil que pour la protéine soluble (A) o Courte séquence d’AA hydrophobe à l’extrémité N-terminale o Reconnu par la SRP
o Clivé en fin de synthèse ( segment TM protéine mature).
- Le 2nd : n’est pas un peptide signal : c’est un signal d’adressage au RE qui sera le(s) futur(s) domaine(s) TMB (B)
o Courtes séquences AA hydrophobes qui peut être située n’importe où dans la protéine, N-terminale ou non
o Reconnu(s) par la SRP o Contrairement au peptide signal : cette séquence ne sera pas clivée(s)après la
synthèse : segment(s) TMB. On retrouve le signal dans sa séquence TMB.
Exemple : Protéine mature avec domaine de 20 AA hydrophobes prédits dans les banques de données
6
Remarque : Il existe des protéines qui possèdent à la fois un peptide signal et à la fois des domaines TM.
3. La Glycosylation des protéines solubles ou TM (pendant leur synthèse) : N-glycosylation (+ courante) ou C-glycosylation (+ rare)
Fig.6 : Construction sur la face cytosolique puis luminale du RE de l’arborisation sucrée destinée à la N-Glycosylation Il y a en premier lieu une construction de l’arborisation sucrée sur la face cytosolique du RE. Cette construction correspond à une association de lipides complexes :
- Dolichol - Phosphorylé - Précurseur de sucres couplés à des nucléotides (face cytosolique):
o GlcNAc couplée à l’UDP o Manose couplé au GDP
Il s’en suit un flip-flop du dolichol et des résidus sucrés : l’arborisation est alors endoluminale. D’autres facteurs arrivent eux aussi synthétisés dans le cytosol, sucres associés à des nucléotides qui vont etre éliminés. Il y a toujours 14 résidus sucrés Fig.7 : la N-glycosylation Il y a enfin un accrochage de l’arborisation à la protéine (au cours de sa biosynthèse) suivi d’un raccourcissement du nombre de résidus sucrés qui passe alors de 14 à 10. Arborisation sucrée comporte 14 résidus qui sont toujours les mêmes et sont accrochés à une asparagine qui est engagé dans une séquence consensus (Asp-X-Sérine/Thréonine), celle de la N-glycosylation. Attention : la N-glycosylation ne correspond pas uniquement à la fixation de l’arborisation sucrée sur la protéine : elle comprend également l’action de la glycosidase qui élimine les 4 résidus sucrés. On retrouve à la fin 10 résidus qui sont toujours les mêmes. A la sortie du RE, les protéines glycosylées le seront toutes de la même façon. Au niveau du golgi on a une modification ensuite.
Entrée dans le RE : soit grâce au peptide signal, soit grâce à un (aux) domaine(s) du TM.
7
Toutes les protéines N-glycosylées ont toujours les 10 mêmes résidus, les différences éventuelles proviennent de modifications ayant lieu dans le Golgi. C-glycosylation :
- Plus rare que N-glycosylation - Fixation de résidus mannose sur dolichol face cytosolique - Flip-flop
- Transfert C du tryptophane n°1 sur Tryptophane n°3 de la séquence consensus (Trp-X-XTrp)
4. Synthèse des protéines liées à la membrane par un GPI :
Ces protéines sont des glycoprotéines adressées aux radeaux lipidiques de la membrane plasmique (microdomaines riches en sphingolipides, cholestérol et gangliosides, éthanolamine, cavéolines). Fig.8 : La synthèse, dans la lumière du RE, de protéines liées à la bicouche lipidique par un glycosyl-phosphatidyl-inositol (GPI) Le groupement GPI est construit à partir de précurseurs cytosoliques (non montré), dans un premier temps sur la face cytosolique du RE à laquelle il est ancré via 2 acides gras. Il est ensuite transloqué dans la lumière du RE par flip-flop. Quand le GPI est luminal, il y a clivage et accrochage du GPI au niveau de la glycoprotéine.
Les protéines qui se fixent au GPI sont de protéines qui ont leur extrémité C-terminale dans le domaine cytosolique. L’extrémité C-terminale est raccourcie (20/30 AA) avec des groupements sucrés en plus. HC : GPI : composition :
- 2AG ancrés dans la bicouche - 1 oligosaccharide (inositol + autres sucres) - Ethanolamine, lié à l’extrémité C terminale de la protéine.
5. Repliement des protéines solubles et domaine luminal des protéines TM
Fig.9 : Les 2 mécanismes de repliement des protéines solubles sous l’action de chaperons solubles (PDI, BiP) ou TMB (Calnexine) Ce schéma concerne les protéines solubles. En revanche, on trouve les mêmes mécanismes concernant le domaine soluble des protéines TM. (Le domaine extracellulaire des protéines TMB sera évidemment pris en charge par des chaperons cytosoliques pour le repliement des domaines cytosoliques).
8
Les chaperons solubles du RE qui interviennent sont : - PDI (protéines disulfure isomérase) + Ca++ dépendant, pour l’établissement des ponts SS corrects définitifs. (Pas d’ATP) - BiP : conformation définitive.
- Autres chaperons du RE (exemple : calnexine TMB), pour l’acquisition de la bonne conformation de la protéine définitive. → Bip et Calnexine necessitent Ca++ et ATP. Des chaperons cytosoliques participent au repliement du domaine cytosolique des protéines TM. (Cadre bleu non abordé mais utile) Les protéines fixant le Ca++ :
− La Calnexine : chaperon transmembranaire du RE qui participe au repliement des protéines néosynthétisées et à leur N- et C-glycosylation
− La Pont Disulfure Isomérase : responsable de l’établissement des ponts SS définitifs
− La Calséquestrine (REL et R sarcoplasmique) : responsable du stockage des ions Ca++
− La Calmoduline : associée au Ca++, elle active/inactive les protéines-Kinases, myosines-kinases, adényl-cyclase, phosphodiestérase, NO-synthase.
6. Contrôle de qualité des protéines néosynthétisées avant l’exportation au Golgi :
On rappelle qu’au cours de la maturation de la protéine (Glycosylation, ponts SS…), cette dernière va pouvoir subir différentes modifications post traductionnelles via l’action d’enzymes et chaperons solubles et membranaires du RE et du cytosol. Il se peut que ces acteurs fassent des erreurs dans ces processus de modification post traductionnelles. Contrôle qualité : si la protéine est mal glycosylée ou mal configurée, elle ne sera pas exportée au Golgi. Elle sera alors rétro transloquée puis dégradée dans le protéasome. Même mécanisme pour le renouvellement des protéines membranaires et soluble du RE : normales (renouvellement) et anormales CF chapitre 4 fig 6 Rétro-translocation de la glycoprotines CFTR mutée et sa dégradation par le protéasome. Ce phénomène existe aussi dans le cadre de renouvellement de protéines.
7. Le RE envoie des signaux au noyau et au cytosol Fig.10 : 2 signaux émis par le RE, vers le cytosol et le génome nucléaire Le RE informe constamment le cytosol et le génome nucléaire de son fonctionnement et ainsi de toute anomalie éventuelle. Cela peut se faire par le biais de :
- Fragments du peptide signal qui repassent dans le cytosol où ils peuvent : o S’associer à la calmoduline, et ainsi réguler des voies métaboliques. o Etre dégradés dans le protéasome
➔ RE vers cytosol
9
- Libération de Ca++ en cas d’accumulation de protéines (solubles ou membranaires), (anormales ou normales) dans le RE.
➔ RE vers noyau Ce Ca++ est un signal au niveau du noyau car il va permettre d’activer des FRT importés dans le noyau grâce aux importines et se lier à l’ADN pour réguler la transcription de gêne. NFkB va pouvoir être utilisé pour réguler la transcription de gènes… Des anomalies du fonctionnement du RE s’accompagnent de signaux qui vont aboutir à des modifications transcriptionnelles. Fig.11 : Le cholestérol induit la synthèse d’un FRT par clivage du SREBP La membrane d’enveloppe du RE comporte des protéines dont le clivage dans le golgi donne naissance à des FRT. SCAP et SREBP : protéines de la membrane d’enveloppe de RE. Ces 2 protéines sont associées en dimère au niveau de la membrane d’enveloppe du RE grâce à la protéine INSIG. SCAP est activée par la diminution de la quantité de cholestérol membranaire du RE ce qui inhibe la liaison de INSIG avec SCAP ce qui active SCAP qui va aller vers le golgi avec SREBP au niveau de la membrane d’enveloppe du Golgi. Le dimère sera alors importé dans le Golgi où il sera clivé à 2 reprises. Ce clivage du dimère va les activer et va aboutir à la libération de :
- SREBP : libération de son domaine cytosolique qui va aller jouer un rôle de FRT dans le noyau en y étant importé par des importines ß
- SCAP qui va retourner dans la membrane du RE pour s’associer à nouveau à avec un autre SREBP. (Il y a un jeu de masquage/démasquage des séquences pour qu’elle retourne au RE)
Le fragment cytosolique de SREBP se fixe à l’ADN, joue le rôle de FRT, induit la transcription de gènes codant pour des protéines impliquées dans le métabolisme du cholestérol comme des récepteurs aux LDL. Le fragment se détache ensuite de l’ADN et est détruit dans le nucléoplasme par les protéasomes après ubiquitinylation.
8. Translocation de peptides antigéniques Fig.12 : L’entrée dans le RE de peptides antigéniques Translocation se fait dans quasiment toutes les cellules eucaryotes. On peut observer ici la translocation depuis le cytosol vers la lumière du RE de peptides « antigéniques » (16 à 20 AA) provenant de la protéolyse cytosolique par les protéasomes. Protéines virales Cette translocation s’effectue à l’entrée dans le RE via des perméases spécifiques appelées perméase TAP appartenant à la superfamille ABC, ces perméases ont donc une activité ATPasique. Dans la lumière du RE, peptidase ERAP qui clive les peptides antigéniques en plus petite taille : 8-10AA.
10
Il existe 2 types de peptides antigéniques : avant l’entrée dans la lumière du RE (16 à 20 AA) et après l’entrée dans le RE et clivés par ERAP (8 à 10 AA). Ces fragments antigéniques de 8 à 10AA seront alors pris en charge par le CMHI et seront ensuite exportés à la MP par le FMVP. Ils seront présentés LT CD8 cytotoxiques
9. Participe à la synthèse de Phosphoglycérides membranaires et cytosoliques du cholestérol
Fig.13 : Biosynthèse de phospholipides membranaires ou cytosoliques et leur devenir La synthèse des phosphoglycérides sur le feuillet cytosolique puis FLIP-FLOP ou liaison à protéines cytosoliques. La synthèse des phospholipides présente des points communs avec la N-glycosylation des protéines. Participation de la mitochondrie dans cette biosynthèse. La synthèse des phospholipides membranaires s’effectue à la surface d’une membrane préexistante, celle du RE. Le cytosol synthétise et apporte des précurseurs au feuillet cytosolique de la membrane du RE :
- Les AG (apporté par le coenzyme A qui sera libéré après) - Le glycérol (phosphaté) (glycérophospholipides) - Un nucléotide le CDP qui apporte les molécules à fonction alcool.
Ces phospholipides ont 2 devenirs :
- Ils peuvent passer au feuillet luminal du RE grâce à des mécanismes comparables à ceux décrits dans la MP (flip-flop) et entrent dans le FVMP.
- Ils peuvent aussi se lier à des protéines transporteuses qui les arrachent individuellement du feuillet cytosolique de la membrane du RE et les apportent à la mitochondrie, au peroxysome ou aux inclusions lipidiques.
Rappel : le RE joue un rôle dans la formation d’inclusions lipidiques et du peroxysome qui bourgeonnent tout 2 à partir de sa membrane. Membrane dans laquelle s’accumulent des phosphoglycérides que l’on retrouvera à la fois dans les inclusions et dans le peroxysome. Cf chapitre 4 fig 1 Constitution des inclusions lipidiques Monocouche de lipides constituée au niveau du feuillet cytosolique du RE + cavéoline+ d’autres protéines Le RE participe à la synthèse du Cholestérol qui fait appel à une voie métabolique spécifique. Au début : intervention d’une enzyme qui est une enzyme de la membrane d’enveloppe du RE. (CYP450). Il participe à une étape, en début de synthèse.
10. Stockage du calcium CF Fig.21, Ch.4 : Les ions calcium dans le cytosol et leurs sites de stockage Le RE comme le Golgi (BiP et PDI) + canaux de libération de Ca++ ➔ signalisations Remarque :
- Ce sont des Ca++ ATPase qui permettent au Ca ++ de rentrer dans le RE. - Alors que ce sont des récepteurs à l’IP3 (canaux de libération de calcium) qui lui permettent
de sortir.
11
Nous avons ainsi détaillé les grandes fonctions du RE communes à toutes les cellules eucaryotes. Nous allons maintenant nous intéresser à des fonctions plus spécifiques de cet organite.
C. Fonctions spécifiques du RE dans des cellules spécialisées
1. Synthèse de lipides destinés à l’exportation (REL) : surrénale et gonades A partir du cholestérol dans la matrice, de la mitochondrie et du REL grâce au CYP450 (cytochrome P450) qui sont des qui ont leur site actif au niveau de la matrice mitochondriale qui vont se servir de l’O2 et des e- qui proviennent du NADPH (cycle des pentoses). Le RE participe à la synthèse d’hormones stéroïdes à partir du cholestérol dans les cellules spécialisées. Elles sortent de la cellule par des perméases de type ABC pour se retrouver en extracellulaire. ➔Cf figure 9, chapitre 5 Synthèse et exportation des hormones stéroïdes Remarque : L’apport du cholestérol provient essentiellement de l’alimentation mais peut également provenir en fraction minoritaire de notre propre organisme qui en synthétise naturellement.
2. Fonction de détoxification au niveau des REL des hépatocytes Fig.14 : Les CYP450 du RE utilisent le NADPH et l’O2 pour la détoxification des drogues exogènes ou de métabolites endogènes, ont leurs sites actifs face cytosolique ➢ Hydroxylation +- glycurono-conjugaison ➢ Hydroxylation + sulfatation ➢ Solubilisation : les molécules (souvent lipophiles) seront hydrophiles.
En cas de présence d’un composé endogène ou exogène insoluble dans l’eau ou toxique, le RE va être capable de le prendre en charge. Ces composés sont souvent d’origine lipidique. On a une drogue qui est peu hydrosoluble, plutôt liposoluble. (Médicaments, drogues, alcool, certaines maladies…) Dans un premier temps, tous les composés vont subir une hydroxylation. Ceci ne suffit pas à les éliminer car les drogues ne sont pas encore assez solubles. 2 possibilités se présentent à ce moment-là :
- Soit la drogue ne rentre pas dans le RE et reste au niveau de sa face cytosolique. Elle sera alors sulfatée par un cytochrome P450 de la face cytosolique du RE. Dans ce cas-là (hydroxylation + sulfatation), cela suffit à faire sortir la drogue de la cellule via des perméases de type ABC (qui on le rappelle sont ATP dépendantes).
- Soit la drogue entre dans le RE pour être glycurono-conjuguée car la molécule n’est pas assez soluble. Elle est alors suffisamment soluble pour être exportée. Cette drogue se trouvant alors dans le SE, elle suivra le FVMP et sera exocytée.
→ Dans tous les cas : hydroxylation par P450 du RE. Attention : Il y a donc 2 possibilités de sortie/d’éliminer qui diffèrent selon le mécanisme de détoxification utilisé :
- Sortie par une perméase ABC de la MP - Sortie par exocytose
12
Exemple : - Ethanol (avec participation des peroxysomes (deuxième organite impliqué dans la
détoxification)) - Phénobarbital (Augmentation de la surface du REL)
III. L’APPAREIL DE GOLGI
A. Définitions et caractéristiques Localisation de cet appareil de Golgi :
- A proximité du noyau - A proximité du centre cellulaire
Fig.15 : Un dictyosome de l’appareil de Golgi Définitions : L’appareil de Golgi correspond à un ensemble de vésicules et de saccules aplatis. (Piles d’assiettes). Chaque pile de saccule forme un dictyosome. Selon l’état fonctionnel de la cellule, cette dernière comportera un ou plusieurs dictyosomes. Chaque sectorisation fonctionnelle du golgi possède un ou des marqueurs qui lui sont spécifiques. Cis= face d’entrée Trans= face de sortie Il y a un flux membranaire vectoriel permanent qui va du RE au réseau transgolgien. Il y a un marqueur S (métaux lourds) au niveau du saccule cis ; la face de sortie le saccule trans qui est marqué par le nucléoside di phosphatase. La phosphatase acide marque le réseau transgolgien TGN mais également les lysosomes. Entre le saccule cis d’entrée et le saccule trans de sortie on a des saccules médians. Il y a des vésicules qui assurent les transports, ainsi qui des canalicules. La compartimentation du Golgi est indispensable aux trafics membranaires, aux échanges avec le RE, et aux fonctions/localisation du Golgi.
13
B. Fonctions
1. La O-glycosylation des protéines Fig.16 : Les 3 mécanismes de glycosylation des protéines Résumé des 3 types de glycosylation qui peuvent se faire :
- Sur un résidu asparagine : N-glycosylation (REG) - Sur un résidu tryptophane : C-glycosylation (REG) - Sur un résidu sérine ou thréonine : O-glycosylation (Golgi médian, trans ou cytosol) n’est pas
uniquement une fonction de l‘appareil de golgi car elle se fait aussi dans le cytosol. On ajoute un sucre sur un Oxygène.
Remarque : Le tryptophane qui va être le support de la C-glycosylation est particulier dans la mesure où il doit être lié à une séquence consensus de C-glycosylation. Il en est de même pour l’asparagine support de la N-glycosylation. Ces séquences consensus correspondent à des enchainements particulier d’AA qui sont spécialement destinés à subir ces modifications post traductionnelles. Ainsi, pour qu’il y ait C-glycosylation, il faut 2 résidus tryptophane séparés d’exactement 2 AA de nature quelconque (=X sur le schéma). Il n’y a pas de séquences consensus pour la O-glycosylation, le sucre se fixe directement sur l’oxygène de la sérine ou la thréonine. On peut utiliser des endoglycosydases pour vérifier les O-glycosylation des protéines. En in vitro, il y a une utilisation d’endoglycosidases pour visualiser la maturation de la protéine.
2. Les modifications des sucres 3. La synthèse des sphingolipides Sulfatation
Fig.17 : La spécialisation fonctionnelle des citernes golgiennes On observe, au cours de la traversée d’une protéine dans le Golgi, une modification progressive de son arborisation sucrée, qu’elle se rapporte à la N, C et O glycosylation. Chaque citerne possède des enzymes spécifiques dont l’activité est liée à la diminution du pH du golgi Cis vers Trans. On observe enfin une synthèse de sphingolipides au niveau du feuillet luminal du Golgi cis et médian. Ces modifications peuvent être déficitaires en pathologie : CDG syndromes. Il y en a 2 types :
- Qui touche les mutations au niveau du RE - D’autre au niveau du Golgi.
CDG : Congenital Disorder of Glycosylation Mutation des enzymes de la N et O glycosylation, modification des arborisations sucrées…
14
4. Protéases du Golgi
2 types de protéase dans le Golgi, clivage de protéines en transit :
- À pH neutre (citernes proximales) près du RE → proximal par rapport au FVMP - À pH acide (citernes distales : trans et TGN)
5. Stockage du calcium
Chapitre 4 figure 21 Les ions calcium dansq le cytosol et leurs sites de stockage Les citernes golgiennes, pareillement au RE comportent une Ca++ ATPase, une protéine fixant les ions Ca++ dans la lumière et un canal de libération de type récepteur de l’IP3.
6. TGN : sous-compartiment à pH acide 7. Face de sortie et de tri
Fig.18 (schéma très important): Les 4 types de matériel membranaire exportés par le Golgi Trans et le Réseau Transgolgien (TGN) selon leur destination et la nature de leur revêtement cytosolique Le réseau TGN correspond à un espace/face de tri et de sortie des protéines du Golgi Il y a 4 types de revêtement de vésicule sont exportés depuis le Golgi :
- Dans le sens du FVMP : o Clathrine avec intervention pour le détachement de la vésicule d’une molécule de
dynamine puis déshabillement par Hsp 70. La vésicule est soit exocytée par sécrétion régulée soir va vers les endosomes ou lysosomes.
o Canalicules à FAPP : revêtement doit être éliminé pour que le canalicule soit transporté. Ce dernier va transporter à la MP des éléments de la sécrétion constitutive : qui ne répond PAS à un signal. Pas besoin de dynamine.
o Cavéoline : pas besoin de perdre son revêtement pour etre transportée. Apporte à la MP du matériel de la sécrétion constitutive : sphingolipides et glycoprotéines à GPI surtout.
- Dans le sens inverse du FMVP : vers le Golgi médian, cis, RE
o Coatomère (COPI) Chaque revêtement interviendra dans le transport d’un type de matériel qui lui est spécifique. Remarque : La bréfeldine A est une drogue extraite d’un champignon qui a pour effet de bloquer l’action de certaines protéines G, notamment la GEF et donc d’inhiber la formation de certains revêtements (FAPP et clathrine). Attention : Elle n’inhibe pas tous les revêtements (Cf : Cavéoline) La sécrétion constitutive assure renouvellement des constituants de la MP et exporte le matériel destiné à la MEC. La brefldine A bloque la GEF de certaines protéines G monomériques. Exception : dans sécrétion régulée, il y a des protéines membranaires donc c’est l’adressage à la membrane qui est régulée.
15
Les protéases du TGN membranaires ou solubles participent à la sécrétion régulée constitutives, rôle dans la maturation pendant le transport. Les protéines membranaires résidentes du TGN qui décrivent un cycle entre TGN, MP, endosomes (passent par des exocytoses et endocytoses). Ex : M6PCRR, perméases du cuivre, endoprotéases. Il y a une phosphatase ac, ATPases Cu++ H+ Une région particulière participe à la constituons de la vacuole autophagique. Autophagie = mécanisme cellulaire physiologique pour dégrader ses propres organites et molécules.
- Normal (Renouvellement) ou pathologie. Ex : intoxication et élimination du REL en excès - Voie de dégradation alternative et en coopération au protéasome.
Il y a 2 types d’autophagies : basale (en permanence) et induite (jeûne prolongé, stress cellulaire). Environ 30 protéines ATG (autophagie) participent à la formation et la régulation de la vacuole autophagique (autophagosome) qui sont des protéines cytosoliques pour la plupart, recrutés par conjugaisons analogues à l’ubiquitinylation. Il y a une participation à la constitution de la vacuole autophagique avec le RE et la MP.
On a formation des autophagosomes (vacuole autophagique) à partir de citernes spécialisées du TGN avec participation du RE et de la MP, fusions membranaires pour former un autophagosome (double membrane) qui entoure les protéines et/ou organites à détruire, fusion avec les lysosomes (hydrolases acides) et donc détruit son contenu.
Macroautophagie : les voies moléculaires et les mutations associées avec les « congenital disorders of autophagy » C’est un processus multi étapes :
16
8. Maturation du matériel exporté du TGN Il existe 2 types de matériel qui peuvent subir une maturation dans le TGN :
• Le matériel de la sécrétion régulée : Précurseur inactif qui sera maturé et coupé au cours de son transport (exemple : hormones)
• Le matériel de la sécrétion constitutive : Ex : protéines membranaires à destination de la membrane plasmique ou solubles à destination de la matrice Dans les 2 cas, protéases membranaires et solubles du TGN participent à la maturation.
IV. Endosomes et phagosomes
A. Définition Les caractéristiques de ces compartiments ne sont pas basées sur un critère morphologique hétérogène dans la mesure où leur forme peut être extrêmement variée. On va donc les classer via des critères fonctionnels et via le matériel qu’ils exportent ou qui sont importés vers eux. Les endosomes exportent du matériel vers la membrane plasmique et le milieu extracellulaire. Ils assurent également le recyclage à la membrane plasmique de protéines membranaires préalablement endocytées.
B. Fonctions Ils constituent un carrefour entre le Golgi trans, le cytosol, les lysosomes et la MP.
- Ils exportent le matériel vers la MP et vers le milieu extracellulaire - Rôle dans la présentation d’Ag - Ils délivrent du matériel au cytosol - Ils échangent du matériel avec le TGN - Apport de matériel endocyté aux lysosomes ou fusion avec les lysosomes
Figure 19 : les endosomes, carrefour entre la membrane plasmique, le Golgi trans, les lysosomes et le cytosol 2 sous compartiments de pH différent.
Molécules et/ou
Environ 30 protéines Atg (autophagie) participent à la formation et régulation de la vacuole autophagique (autophagosome) = protéines cytosoliques pour la plupart, recrutées par conjugaison analogues à l’ubiquitinylation.
17
Les endosomes reçoivent : - Des vésicules d’endocytose en provenance de la membrane plasmique Vésicule à clathrine déshabillée Vésicule dépourvue de revêtement connu Vésicule à cavéoline
- Des vésicules de transport du TGN (vésicule à clathérine déshabillée) qui apportent des
enzymes de type hydrolase et des pompes à proton H+ ATPase (qui acidifie de + en + le compartiment > endosomes précoces et tardifs)
Les endosomes exportent :
- Du matériel vers lysosomes (fusion) - Des vésicules de recyclage à la membrane plasmique de protéines endocytées (vésicules à
clathrine) - Des vésicules de retour vers le Golgi (vésicules à clathrine) - Du matériel vers le cytosol
On distingue 2 grands types d’endosomes :
- 1- Les endosomes précoces plus en rapport avec les phénomènes d’endocytose et d’exocytose au niveau de la MP. D’eux bourgeonne les vésicules de recyclage. Ils ont un pH proche de neutralité et possèdent des marqueurs spécifiques (comme Rab5) (protéine G monomérique). Ils contiennent des protéases du Golgi en transit : les endoprotéases insérées dans la membrane plasmique pour maturation du matériel de sécrétion (régulée et constitutive) et les endocytées et retours du Golgi. Même système pour le récepteur du Mannose 6 phosphate.
- Les endosomes tardifs ou corps multivésiculaire (MVB) : qui ont préalablement reçu une pompe à proton et des hydrolases acides en provenance du TGN par des vésicules de clathrine déshabillées ce qui entraine une réaction d’hydrolyse dans l’endosome tardif et dans le lysosome. Ils contiennent des vésicules dans sa lumière : exosomes (=vésicules produites par un mécanisme d’endocytose de la membrane d’enveloppe) qui peuvent être exocytés et libérés en extracellulaire. Ils possèdent un pH plus acide et des marqueurs spécifiques (comme Rab7) (protéines G monomériques). Il y a déjà des réactions d’hydrolyse dans les endosomes tardifs.
→ Ils assurent une maturation du matériel.
1. Les endosomes exportent du matériel vers la MP et le milieu extracellulaire
Cette exportation se déroule soit :
- Dans les conditions classiques (exportation d’une protéine après sa synthèse dans le SE) - Via un recyclage d’éléments membranaires spécifiques (ex : les récepteurs aux LDL)
Rappel : Figures 4/15 la mono- ou la poly-ubiquitinylation du domaine cytosolique des récepteurs membranaires comme un signal d’endocytose et d’adressage aux endosomes. Figure 30 chapitre 2 : endocytose et recyclage à la membrane des récepteurs des LDL
− La mono- ou poly-ubiquitinylation du domaine cytosolique des récepteurs membranaires comme signal d’endocytose et d’adressage aux endosomes. La déubiquitinylation est un signal de recyclage.
Voie de nutrition cellulaire
18
− Exocytose et recyclage à la membrane des récepteurs des LDL. Vésicules à clathrine pour le recyclage !!
2. Rôle dans la présentation d’antigènes et l’activation des lymphocytes T
Fig.20 : Endosomes et présentation des antigènes par le complexe majeur d’histocompatibilité de type II (CHM II) aux lymphocytes T CD4+ dans les cellules. « Présentatrice de l’antigène » Ces peptides antigéniques solubles sont produits dans les endosomes (phagosomes) et sont produits par l’hydrolyse partielle du matériel endocyté. Ces peptides sont fixés par le CMH de type II et l’ensemble est incorporé à la MP par exocytose, où le peptide est présenté à une sous population de Lymphocytes T porteurs de l’AG membranaire CD4. Ils peuvent aussi être inclus dans les exosomes, exocytés et présentés aux CD4+ Les exosomes ont un rôle de signaux de communication intercellulaire à la fois grâce aux protéines de la membrane d’enveloppe (CAM…) et aussi via des molécules cytosoliques qu’ils renferment (chaperons, ARNm, microARN…) Ne pas confonde avec : dans la plupart des cellules eucaryotes Figure 12 : l’entrée dans le RE de peptides antigéniques L’hydrolyse cytosolique de protéines ou de longs peptides en peptides de 16-20 AA, entrée dans le RE par perméases spécifiques : TAP (Transport Associated with Abtigen Processing = protéines ABC). Les peptides sont raccourcis (peptidase ERAP), liaison au CMH&, transport, exocyose et présentés aux lymphocytes T cytotoxique CD8.
3. Les endosomes et les lysosomes délivrent du matériel au cytosol Cf. Figure 2/30 Via des perméases : exemple le cholestérol Début de l’hydrolyse des LDL dans les endosomes et fin dans les lysosomes puis sortie du cholestérol dans le cytosol via des perméases spécifiques.
4. Échange de matériel avec le TGN Fig.19 : Les endosomes, carrefour entre la MP, le Golgi trans, les lysosomes et le cytosol Le TGN fournit des vésicules aux endosomes contenant notamment des hydrolases acides et des pompes à proton H+-ATPase ce qui a pour effet de transformer l’endosome précoce en endosome tardif puis en lysosome. Les endosomes fournissent des vésicules au TGN qui transportent des glycoprotéines TM résidentes du Golgi Trans et TGN. Ces vésicules effectuent en permanence des cycles d’endocytoses et d’exocytoses (endoprotéases, perméase du Cu+) entre le Golgi et les endosomes permettant le transport de certains éléments comme les récepteurs au mannose 6-Phosphate. (Transporteur des enzymes lysosomales solubles).
19
5. Apport de matériel endocyté aux lysosomes Ou fusion avec les lysosomes.
V. LES LYSOSOMES
A. Définitions Tout comme les endosomes, ils possèdent une morphologie assez hétérogène ce qui implique que leur caractérisation ne sera pas morphologique mais cytoenzymologique. En effet, ces lysosomes sont caractérisés par la présence d’une enzyme particulière, la phosphatase acide, que l’on retrouve également au niveau du Golgi trans et TGN. Cette enzyme pourra être mise en évidence par cytoenzymologie puis observable au MO ou au MET selon la manipulation. Rappel figure 5 chapitre 1 : Principe de la cytoenzymologie Lysosomes est une fusion de vésicule ou vacuole qui renferme des matériaux à dégrader avec une ou plusieurs vésicules de transport. Remarque : La phosphatase acide n’étant pas retrouvée uniquement dans les lysosomes, on ne peut pas dire que cette enzyme leur est spécifique.
B. Composants caractéristiques des lysosomes Fig.21 : Les composants caractéristiques du lysosome Les lysosomes contiennent 4 grands types de glycoprotéines TM ainsi qu’une multitude de glycoprotéines enzymatiques solubles fonctionnant à pH acide (pH=5) Dégradation de toutes les molécules biologiques : nucléases, protéases, glycodases, phosphatases,lipases, phospholipases… Rappel : Les composants majoritaires du lysosome sont les protéines solubles à pH de fonctionnement acide. Les 4 protéines TM du lysosome sont :
- Les Pompes à protons ou ATPase à H+
- Les Perméases spécifiques : o Exportation : de la lumière vers le cytosol : produits finaux du catabolisme
lysosomal : AA, cholestérol o Importation : directe, perméases ABC : du cytosol vers la lumière : matériaux à
hydrolyser
- Des glycoprotéines enzymatiques (ex : phosphatase acide → marqueur du TGN, golgi Trans et du lysosome)
- Des glycoprotéines non enzymatiques (ex : Lamp 1 et 2 → marqueurs spécifiques de la membrane du lysosome)
20
LAMP = Lysosomes Associated Membran Protein : marqueur spécifique de la membrane du lysosome
Les glycoprotéines enzymatiques solubles du lysosome (composant majoritaire) sont adressées aux lysosomes via un double système d’adresse :
- Grâce au mannose 6-P. - Grâce au récepteur du mannose 6-P
La phosphorylation du mannose se fait au niveau du Golgi cis. Dans le Golgi Trans elle s’associe au récepteur.
Le mannose -6-p de la protéine soluble est ajouté dans le Golgi cis (phosphorylation des résidus mannose en position 6), interaction avec le récepteur dans le TGN et adressage aux endosomes-lysosomes où il y a une dissociation du complexe enzyme-récepteur. Des enzymes solubles porteuses de mannose-6-phosphate sont fixées dans le Golgi trans (et le TGN) par une glycoprotéine transmembranaire, le récepteur du mannose-6-phosphate, qui les adresse au compartiment endosomal. Le récepteur du mannose-6-phosphate possède dans son domaine cytosolique le signal d’adressage vers les endosomes. Dans les endosomes, les enzymes se détachent de leur récepteur sous l’effet du pH acide, le récepteur du mannose-6-P libre est recyclé vers le Golgi trans et le TGN par l’intermédiaire d’une protéine recouverte de clathrine et de protéines d’adaptation. Les enzymes sont apportées au compartiment lysosomal. Fig.22 : Adressage à l’endosome/lysosome de ses enzymes solubles, porteuses des mannose-6-P grâce au récepteur du mannose-6-P La biosynthèse de ces enzymes solubles suit le schéma général des glycoprotéines solubles :
- Biosynthèse de la chaine protéique dans le REG - N-Glycosylation puis modification de l’arborisation sucrée dans le REG - Transport par le FMVP au golgi - Modifications dans le Golgi de l’arborisation sucrée qui conduit à la synthèse d’un mannose-
6-phosphate. Ces modifications sont spécifiques des enzymes lysosomales solubles, ce qui implique l’existence d’un mécanisme de reconnaissance sélectif.
Le mécanisme d’adressage aux lysosomes n’est pas efficace à 100% :
- Une partie des enzymes solubles est exportée vers la MP et exocytée dans le milieu extracellulaire.
21
- Une partie des récepteurs du mannose-6-phosphate est aussi incorporée dans la MP.
Ces récepteurs mal adressés à la MP sont capables de fixer des enzymes solubles circulant dans le milieu extracellulaire. Les complexes formés par ces enzymes solubles et les récepteurs du M-6-P sont alors récupérés par endocytoses. Les enzymes solubles sont adressées au compartiment lysosomal à partir des endosomes. On a ensuite un retour à la normale. Le transport est correct dans la majorité des cas mais il arrive qu’il ne le soit pas. A ce moment-là, le matériel va être adressé à la membrane puis exocyté. L’hydrolase acide qui n’a rien à faire dans le milieu extra cellulaire va être pris en charge par des récepteurs membranaires sur la face extracellulaire de la MP qui se chargeront de réimporter l’hydrolase acide au sein de la cellule pour que cette dernière puisse être adressé correctement aux endosomes/lysosomes.
C. Les voies d’entrée des matériaux à dégrader Lysosomes est une fusion de vésicule ou vacuole qui renferme des matériaux à dégrader avec une ou plusieurs vésicules de transport. Rappel :
➢ Autophagie : mécanisme cellulaire de dégradation de ses propres organites et molécules (renouvellement ou pathologie) exemple : intoxication et élimination du REL en excès
➢ Autophagosomes : origine de sa membrane= membrane préexistante : citerne spécialisée du TGN+RE+MP et protéines cytosololique Atg. Constitution d’une double membrane qui entoure l’organite et/ou la molécules avec un peu de cytosol, contient des hydrolases acides et début de digestion avant la fusion du lysosome.
Autophagie :
- Mise en jeu de protéines ATG (autophagie) environ 30 protéines, dans la formation et la régulation de l’autophagosomes, protéines cytosoliques (la plupart) recrutées par conjugaison analogue à l’ubiquitinylation.
- Marqueur des autophagosomes : protéines LC3-I (homologue d’Atg8) et surtout sa forme coupée ey conjuguée à la phosphatidyléthanolamine LC3-II
Fonction de l’autophagie :
➢ Autophagie basale : fonction d’élimination - Macromolécules (protéines normales ou non) : en coopération avec protéasome - Organites normaux endommagés ou devenus inutiles (renouvellement)
(mitochondries, peroxysomes et REL)
➢ Autophagie induite (jeune prolongé, stress métabolique agent infectieux) - Réutilisation des produits de dégradation protéique (AA) : source d’énergie ou
synthèse des protéines - Défense et pathogène (exemple bactérie)
Dysnfonctionnement de l’autophagie dans « congenital disorders of autophagy », cancer et pathologies neurodégénératives.
22
Fig.23 : Les matériaux à dégrader dans les lysosomes y accèdent par 4 voies différentes. MVB : multivesicular body (= corps multivesiculaire) Le lysosome est constitué par la fusion d’une ou plusieurs vésicules de transport (provenant du Golgi trans ou du TGN et qui contiennent les enzymes lysosomales et l’ATPase à protons) avec une vésicule ou vacuole (endosome, phagosome) qui renferme les matériaux à dégrader. Les matériaux à dégrader dans le compartiment lysosomal y accèdent par 4 grandes voies d’entrée :
- Endocytose - Phagocytose (Le phagosome est capable de fusionner temporairement avec un lysosome
pour lui transférer une partie de son contenu) → Ces 2 voies sont bloquées par la Mitose.
- Via des perméases (Lamp2A = Lamp2) - Par autophagie.
Remarque : L’autophagie est un mécanisme permettant à la cellule de dégrader ses propres organites ainsi que d’autre molécules spécifiques. Ce mécanisme intervient naturellement dans le renouvellement des constituants cellulaires. C’est notamment le cas des hépatocytes qui, de part leur fonction de détoxification, sont souvent amener à ‘‘synthétiser’’ une quantité importante de REL qui devront être éliminés une fois leur fonction de détoxification terminée. Elle concerne également des molécules. Au cours de l’autophagie, une portion de citerne spécialisée du TGN entoure l’organite ainsi que du cytosol. D’autres membranes s’y associent (RE et MbP). Cette portion de TGN contient des hydrolases acides qui vont être capable de dégrader ce qui a été entouré.
D. Les voies de sortie des matériaux après hydrolyse La sortie des lysosomes va pouvoir se faire via des :
- Perméases : sortie dans le cytosol - Vésicules de retour vers compartiment en amont dans le flux - Vésicules qui vont fusionner avec la membrane plasmique - Lysosomes fusion avec la membrane plasmique : exocytose
E. Biogénèse et fonctions
1. Biogénèse
La formation des lysosomes correspond à la fusion de vésicules(s) de transport avec une vésicule ou vacuole (endosome, phagosome, autophagosome) contenant des matériaux à dégrader. La vésicule de transport permet d’apporter des hydrolases acides, des pompes à proton H+ ATPase et des protéines membranaires spécifiques. Cette vésicule de transport provient toujours du TGN.
2. Fonction de dégradation et réutilisation des produits dégradés pour la nutrition
cellulaire Fonctions :
- Autophagie (dégradation/défense) - Hydrolyse par enzymes solubles : dégradation/nutrition (toutes les familles de molécules),
sortie via perméases et réutilisation par la cellule
23
Fig.24 : Résumé des fonctions hydrolytiques des lysosomes Les protéines ubiquitinylées sont partiellement dégradées dans le protéasome ont une séquence d’adressage au lysosome. Cette fonction de dégradation s’applique à toutes les familles de molécules. Remarque : Chaque produit de dégradation sera exporté dans le cytosol par une perméase qui lui est spécifique. Rappel : Les peptides ubiquitinylés, partiellement dégradés dans le protéasome, ont une séquence d’adressage au lysosome. Toutes les familles de molécules biologiques sont dégradées dans les lysosomes en leurs métabolites élémentaires qui passent dans le cytosol par des perméases (réutilisation par la cellule). Toutes les hydrolases présentent dans le schéma ne sont fonctionnelles que dans le lysosome, le pH étant adéquate à leur fonction.
3. Le devenir des lysosomes : - Ils peuvent se transformer en corps résiduels : c’est le cas des lysosomes âgés qui ont alors une fonction de stockage. - Ils peuvent exocyter une partie de leur contenu (notamment leur membrane) après stimulus :
- Nombreuses cellules épithéliales et fibroblastes : réparation de déchirures de membrane en réponse à une entrée de Ca++ dans le cytosol : migration des lysosomes au niveau de lésion et fusions membranaires
- Phagocytose frustrée (uniquement par des phagocytes professionnels) si le matériel est trop volumineux : exocytose du contenu enzymatique lysosomal (acide) → Fonction de défense.
Remarque : L’apport à la MP via des phénomènes d’exocytose sera généralement compensé par série d’endocytose afin de maintenir la balance exocytose endocytose équilibrée. Fig.25 : Un exemple d’exocytose du contenu enzymatique lysosomal par les cellules macrophagiques responsables du remodelage des tissus osseux et cartilagineux. Phagocytes professionnels : macrophages et dérivés, polynucléaires Ce phénomène se produit quand les phagocyteurs (macrophage, poly neutrophile, ostéoclaste, chondroclastes ...) ne peuvent pas internaliser leur cible en raison de l’importance de son volume. Les lysosomes de la cellule phagocyteuse vont donc se mettre à sécréter une grande partie de leurs constituants acides vers le milieu extracellulaire pour détruire directement la cible. Ce mécanisme est réalisé uniquement par des phagocytes professionnels. Il intervient au cours de fonction de défense ou dans des mécanismes très particuliers comme l’ostéogénèse. → Les lysosomes peuvent donc être à l’origine d’une dégradation en intracellulaire mais également en extracellulaire.
24
F. Lysosomes et pathologie humaine Il y a deux exemples de pathologies héréditaires :
- Une accumulation de molécules non dégradées - Accumulation du produit de dégradation
Il existe des maladies héréditaires du métabolisme altérant les fonctions des lysosomes, entrainant notamment une pathologie appelée la maladie de surcharge (Lysosomal Storage Disease (LSD)). En effet, en cas de disfonctionnement de ces lysosomes, on va observer au sein de la cellule une accumulation de molécules non dégradées ou de molécule dégradées mais ne pouvant pas sortir des lysosomes en raison d’une mutation des perméases. C’est cette accumulation de molécule dans le cytosol ou dans les lysosomes eux même qui est responsable de la maladie de surcharge. Pathologies acquises : impossible de faire une hydrolyse ; exemple pour les macrophages pulmonaires : matériel non biologique (pneumoconioses) ou exemple de matériel biologique d’organisation quasi minérale (exemple : acide urique et goutte) Fig.26 : La phagocytose par des macrophages alvéolaires de particules minérales (non biologiques) a pour conséquence la mort de ces cellules Macrophage alvéolaire : macrophage des alvéoles pulmonaires. Conséquence : une destruction progressive du tissu pulmonaire et une insuffisance respiratoire. D’autre part, il arrive dans certains cas que les lysosomes du macrophage ne puissent pas hydrolyser la particule phagocytée. C’est notamment le cas quand :
- Le matériel phagocyté est non biologique. Se produit notamment au niveau des poumons via l’inhalation de particule toxique entrainant des pneumoconioses et une destruction à terme des alvéoles pulmonaires.
- Le matériel biologique est d’organisation quasi minérale. C’est le cas au cours d’une maladie historiquement bien connu : la Goutte. Au cours de cette maladie, il y a formation de cristaux d’acide urique toxiques qui, une fois phagocytés par les macrophages, ne pourront non seulement pas être dégradé dans les lysosomes mais qui vont en plus donner l’ordre à ces lysosomes d’effectuer un processus de phagocytose frustrée. Le macrophage se met alors à sécréter des composants acides à tout va dans le milieu extra cellulaire entrainant la corrosion de l’intérieur du corps (notamment au niveau des articulations).
Les lysosomes des macrophages sont incapables d’hydrolyser du matériel non biologique ou du matériel d’origine biologique mais d’organisation quasi minérale. Si cela arrive, ils finissent par exploser au sein de la cellule en libérant leur composant acide ce qui provoque une apoptose brutale. On a l’exemple ici de l’inhalation pulmonaire de particules minérales ou métallique qui entraine une destruction progressive de la population de macrophage du tissu pulmonaire. La défense de ce dernier n’étant plus correctement assuré, on va avoir une destruction de ce tissu pulmonaire entrainant des insuffisances respiratoires. Autres exemples pulmonaires :
- Asbestose (inhalation de fibres d’amiante)
25
- Silicose (inhalation de particules de silice)
VI. LES FLUX MEMBRANAIRES
A. Les étapes : bourgeonnement/ détachement de vésicules /perte de revêtement
1. Revêtement de coatomères : Fig.27 : Le bourgeonnement de vésicules recouvertes de coatomères et leur déshabillage pendant leur transport dans le cytosol TGN, Golgi Trans La formation de ces revêtements est issue de la polymérisation de protéines cytosoliques de la famille COP. Revêtement = COP I + ARF L’activation de ARF 1 se fait par une GEF dont l’action peut être inhibée par de la Bréfeldine A au niveau Golgi. ARF activé et associé à du GTP va alors se fixer sur le compartiment donneur où elle va pouvoir recruter des COP 1 qui vont participer à la formation du revêtement. L’association des composants cytosoliques induit l’organisation du revêtement, le bourgeonnement et le détachement de la vésicule. ATTENTION : Le schéma présenté ne concerne qu’un modèle de bourgeonnement particulier ; celui faisant intervenir ARF 1 et COP 1. On est donc dans le TGN et le Golgi TRANS car ARF1 est spécifique !! Tout le reste est commun (elle a bien insisté sur ça). Donc ce n’est pas valable pour Golgi médian ou cis. Il existe de nombreux autres processus de bourgeonnement notamment liés à d’autre type de COP (COP 2,3 ...) et d’autre type d’ARF (ARF 2,3...). C’est ainsi qu’il existe des types d’ARF insensibles à l’action de la Bréfeldine A et donc qui peuvent également participer à la formation du revêtement en
26
‘‘toute condition’’. Ce n’est pas ce qui se passe au niveau du golgi médian ou cis. Si on parle seulement de protéines G, cela peut concerner aussi le médian ou le cis. Après leur détachement les vésicules à coatomères perdent leur revêtement : indispensable pour le transport cytosolique
2. Revêtement de clathrine Fig.28 : Le bourgeonnement golgien et le devenir des vésicules recouvertes de clathrine et de protéines d’adaptation.Golgi Trans ou TGN Le recrutement des protéines d’adaptation (activées par protéines G monomérique) qui seront associées à la clathrine est réalisé par ARF 1. Il va se produire successivement :
- La formation d’un revêtement de clathrine contenant de la clathrine et des protéines d’adaptation. Ce revêtement se fait sous forme de mailles hexagonales.
- Bourgeonnement de la vésicule entraine une déformation du réseau : mailles hexagonales et pentagonales.
- Détachement nécessite hydrolyse du GTP (non réalisé pour les coatomères) par la dynamine.
Concernant le Golgi trans et le TGN UNIQUEMENT : ARF1 va entrer dans la constitution du revêtement à Coatomère mais pas dans celui à Clathrine. En revanche, ARF1 sera indispensable pour les 2 revêtements. ARF1 participe quand même à la formation du revêtement à clathrine mais il ne fait pas partie du revêtement final de la clathrine. Remarque : L’action de la Brefeldine A inhibe donc les 2 types de revêtements. Mais pas la clathrine au niveau de la MbP par exemple. Une même vésicule peut être transportée par des vésicules avec un revêtement différent selon par
exemple la destination ou le compartiment d’origine. Rappel : chapitre 4 figure 20 : rôle de la dynamine dans le détachement de vésicules recouvertes de
clathrine au moment de leur endocytose Un même compartiment « donneur » produit des vésicules de revêtements différents (exemple
TGN). Une même protéine peut être transportée par des vésicules de revêtements différents.
B. Transport et adressage
1. Transport : Ce dernier concerne des vésicules non déshabillées (Cavéoline) ou déshabillées et se fait via :
- Des MAP motrices (Kinésines/Dynéines) associées aux MT : Transports de longues distances.
- Le cytosquelette cortical d’actine au niveau de la membrane plasmique : Transports de courtes distances.
27
2. Mécanismes d’adressage et de rétention au compartiment receveur → On ne parle pas ici du signal d’adressage au RE ! (Protéine en cours de synthèse) Les signaux sont différents pour les protéines TM et les protéines (à un endroit donné) solubles ! Permettent un maintient de composition spécifique de chaque compartiment. Remarque : Il n’y a qu’une seule possibilité de signal pour les glycoprotéines TM alors qu’il y en a deux pour les glycoprotéines solubles (Ex du mannose 6-Phosphate). Adressage et rétention à un compartiment du système endomenbranaire : Fig.29 : Les différents types de signaux d’adressage et de rétention des protéines spécifiques d’un compartiment du SEM Si mutation de ces signaux : exocytose de la protéine avec :
- Sécrétion dans le milieu extracellulaire (protéine soluble) - Insertion à la membrane plasmique (protéine TM)
➢ Adressage et rétention au RE :
Les GP transmembranaires : Les signaux d’adressage et de rétention dans le RE des GP transmembranaires sont portés par leur domaine cytosolique. Fig. 30 Les signaux d’adressage et de rétention des protéines dans le RE (en dehors du signal d’adressage au RE utilisé lors de la biosynthèse de la protéines) ERD : signal pour Golgi (1er segment TM) et pour RE (domaine cytosolique) Un exemple est la séquence KKXX, signal d’adressage et de rétention spécifique dans le RE des protéines TM. Le revêtement de coatomère COP1 reconnaît sélectivement cette séquence qui permet le retour du Golgi vers le RE des protéines membranaires. Les glycoprotéines solubles : Les glycoprotéines solubles possèdent un double signal d’adressage et de rétention dans le RE :
- L’un porté par la protéine elle-même - L’autre porté par le récepteur du premier signal.
Les 4 derniers AA de leur séquence peptidique constituent le motif KDEL : c’est le cas de BIP et PDI. Ces protéines sortent du RE par le FMVP, la séquence terminale KDEL de ces protéines est reconnue dans le Golgi cis et médian par une famille de glycoprotéines TM appelée ERD qui se fixent aux protéines du RE et les ramènent à ce compartiment. K = Lys ; D = Asp ; E = Glu ; L= Leu
28
Voir plus loin : figure 34 Le mécanisme de retour des protéines solubles du Golgi et du RE La séquence d’adressage et de rétention des protéines ERD pour le RE n’est active qu’après la fixation de la protéine soluble résidente du RE. ➢ Adressage et rétention au Golgi :
Le signal d’adressage et de rétention spécifique golgien des protéines de la famille ERD est porté par le premier de ses domaines transmembranaires TM1. Ces récepteurs possèdent donc 2 signaux d’adressage et de rétention :
- Le premier spécifique du Golgi porté par TM1 - Le deuxième spécifique du RE (séquence KKXX dans le domaine cytosolique) servant de
retour vers les RE des protéines solubles de ce compartiment. - Complexité avec la spécialisation des citernes du Golgi
➢ Adressage aux lysosomes :
Se fait via l’action du mannose 6-P et de son récepteur pour les protéines solubles. Se fait via un signal situé dans le domaine cytosolique de la séquence protéique pour le récepteur au M6P et pour les protéines lysosomales membranaires.
C. Fusion : vésicule-compartiment receveur
Fig.31 : L’approche, l’amarrage puis la fusion de la vésicule déshabillée avec le compartiment « receveur » Il y a un rapprochement de la vésicule. Vésicules +Rab (GTP)+ complexe d’approche. L’amarrage est procuit par interaction entre les protéines membranaires des deux compartiments + les facteurs cytosoliques. Si le compartiment est receveur alors dans la MP il y aura une sécrétion dans le milieu extracellulaire. Remarque : La fusion et l’exocytose : Ca++ hydrolyse du GTP :
- La spécificité de l’interaction vésicule-compartiment receveur assurée par la nature des complexes d’approches, SNARE et Rab qui diffèrent selon les compartiments.
- L’augmentation de surface membrane plasmique est compensée par endocytose qui permet
aussi la récupération des SNARES.
D. Flux membranaire vectoriel permanent Fig.32 : mise en évidence expérimentale du FMVP après incorporation de leucine marquée dans le pancréas exocrine Mise en évidence expérimentale : Expérience d’autoradiographique réalisé par l’équipe G. Palade (prix Nobel en 1974) : « pulse-chase ». Correspond à : Une incubation de coupes de tissu pancréatique exocrine avec de la Leucine (H 3leu et aa) marquée pendant 3 min : « pulse ».
29
Une seconde incubation avec Leu non marquée : « chase » et observation du marquage. Cette expérience a ainsi permis de mettre en évidence la cinétique de la synthèse protéique (REG puis Golgi puis grain de sécrétion). Fig.33 : Le FMVP RE au Golgi : COP II puis ERGIC (compartiment vésiculo-tubulaire qui se déplace vers Golgi cis et fusionne avec lui). Entre les citernes golgiennes : 2 mécanismes impliquant un transport par des tubules/vésicules et une maturation dans les citernes pour les grosses particules. A partir du Golgi Trans et TGN : vésicules (clathrine et cavéoline) ainsi que par des tubules/canalicules à FAPP Remarque : Brefeldine A ne bloque pas COP II mais bloque la fusion de ERGIC et du Glogi.
E. Flux de retour du golgi vers le RE - Permet le retour du Golgi au RE - Est permanent mais n’est visible que quand le flux membranaire vectoriel permanent est bloqué ! Il est donc minoritaire. Ce blocage expérimentale transitoire du FVMP peut être réalisé expérimentalement par utilisation de Brefeldine A (pour inhiber la GEF et certaines ARF) dont ARF 1. ➢ Action de la Brefeldine A :
Bloque GEF et ARF1 empêchant ainsi :
- La formation de tubules à FAPP à partir Golgi trans et TGN - La formation de vésicules à clathrine à partir Golgi trans et TGN - La formation de vésicules recouvertes de COP I à partir du Golgi trans et TGN - La fusion de ERGIC et Golgi cis
Ne bloque pas :
- La formation de vésicules recouvertes de COP II à partir RE
30
- La formation de tubules ou vésicules recouvertes de COP I à partir du Golgi cis/median vers le RE
- La formation de vésicules recouvertes de COP I à partir de l’ERGIC vers le RE Fig.34 : Le mécanisme de retour des protéines solubles du RE : du Golgi cis/médian au RE Quand le pH sera suffisamment acide, la protéine présentant un signal KDEL sera prise en charge par un récepteur ERD avec lequel elle restera accrochée tout le long de son transport vers le RE. La séquence d’adressage et de rétention des protéines ERD pour le RE n’est active qu’après fixation de la protéine soluble résidente du RE. La dissociation (pH) inactive le signal d’adressage au RE des récepteurs ERD qui repartent vers le Golgi. La dissociation ne pourra être réalisée qu’une fois le pH revenu à la normal, c’est à dire une fois que la protéine se trouvera dans le RE, ce qui permet au transport de s’effectuer jusqu’au bout (si tu veux que je te lâche, amène-moi dans le RE et après je te lâche). Les réponses aux questions 2019-2020 seront publiées demain, quand toutes les questions auront été posées REPONSES AUX QUESTIONS 2018 Les sucres en tant que sucres seuls sont aussi dans le cytosol. Sur le versant extracellulaire
les sucres sont liés à des protéines [cf chapitre sur la MP] (on le verra dans d’autres cours) ;
penser que les sucres sont uniquement sur le versant extracellulaire est un raccourci
dangereux car ils sont aussi dans le cytosol, sauf qu’ils sont seuls à ce niveau-là, pas liés. En
gros elle nous dit de faire attention à comment on interprète ce que disent les profs.
On n’a jamais dit que la vacuole lipidique fait parti du SEM, on a dit que le SEM participe à la
composition des sucres de la vacuole ! Ce n’est pas parce qu’elle est sur les schémas du cours
du SEM qu’elle en fait partie (comme le protéasome, on parle dans ce cours mais cela ne
veut pas dire que c’est un constituant du SEM).
Une protéine normale peut aussi se retrouver dans le cytosol par le mécanisme de rétro
translocation, ne concerne pas uniquement les protéines anormales.
La vésicule de cavéoline nécessite de la dynamine au niveau de la MEMBRANE pour le
bourgeonnement et le détachement au niveau de la membrane ; on ne le montre pas au
niveau du Golgi Trans donc non au niveau du Golgi Trans.
Les protéines membranaires sont des protéines qui sont liées à la membrane (en épingle à
cheveux = cavéoline, ancrées à la membrane par un AG, ancrées par un GPI…). Les protéines
transmembranaires sont les protéines qui traversent en TOTALITE la membrane.
On n’a pas à savoir la nature des protéines de revêtement à FAPP, elles nécessitent
probablement des protéines chaperonnes Hsp pour leur déshabillage mais on ne nous en
parle pas donc on n’a pas à le savoir.
Si on a une protéine transmembranaire qui possède le peptide signal et le signal
transmembranaire pour l’adressage au RE ; on considère qu’elle rentre dans le RE grâce au
peptide signal principalement, si celui-ci n’est PAS masqué.
De dolichol reste enchâssé dans la bicouche, il fait parti de la constitution de l’arborisation
sucrée mais celle qui est accrochée à la protéine et clivée (14 puis les 10 AA) ne comporte
PAS de dolichol.