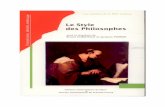Les cimetières du haut Moyen Âge en Languedoc. Des champs d'inhumations "à la campagne" aux...
-
Upload
anglais-upvd -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Les cimetières du haut Moyen Âge en Languedoc. Des champs d'inhumations "à la campagne" aux...
Ouvrage dirigé par
Sylvie Duchesne & éric Crubézy
avec les contributions de
M. Aguerre S. Bach I. Barthélémy abbé M. Bessou Y. Bruzek A. Catafau J.-P. Cazes Ch. Duhamel P. Dupouey P. Gaury J. Guyon A. Martin L. Morel P. Murail Cl. Raynaud F.-X. Ricaut T. Romon D. Rougé S. Sainte-Marie M. Vidal
Collection étudesPresses Universitaires de Perpignan
Sylvie Duchesne & éric Crubézy Directeurs
avec les contributions de M. Aguerre, S. Bach, I. Barthélémy, abbé M. Bessou, Y. Bruzek, A. Catafau, J.-P. Cazes, Ch. Duhamel, P. Dupouey, P. Gaury, J. Guyon, A. Martin, L. Morel, P. Murail, Cl. Raynaud,
F.-X. Ricaut, T. Romon, D. Rougé, S. Sainte-Marie, M. Vidal
Collection étudesPresses Universitaires de Perpignan
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Les auteurs
LES AUTEURS
M. Aguerre, odontologiste, anciennement laboratoire d’anthropobiologie de Bordeaux I
S. Bach, Service régional de l’archéologie et de la connaissance (Midi-Pyrénées), UMR 5608 Traces, Université de Toulouse
I. Barthélémy, Pr chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, Clermont Ferrand, anciennement UMR 5288
M. Bessou (†), Archéologue, prêtre, archéologie paléochrétienne, Tarn
Y. Bruzek, Directeur de recherches CNRS émérite, UMR 5199, PACEA, Université Bordeaux 1
A. Catafau, Maître de conférences, Université de Perpignan
J.-P. Cazes, archéologue, CCS Patrimoine
É. Crubézy, Pr. d’anthropobiologie, UMR 5288 CNRS, Université de Toulouse
S. Duchesne, chargée d’opération et de recherches, Inrap, UMR 5288, AMIS, Université de Toulouse
Ch. Duhamel, anciennement INRAP et laboratoire d’anthropobiologie de Bordeaux I
P. Dupouey, Archéologue, Médecin, Ordan Larroque, Gers
P. Gaury, odontologiste, anciennement laboratoire d’anthropobiologie de Bordeaux I
J. Guyon, directeur de recherches émérite, UMR 6573, Centre Camille Julian, Université de Marseille
A. Martin, Archéologue, Ordan Larroque, Gers
L. Morel, odontologiste, anciennement centre d’anthropobiologie, Toulouse
P. Murail, anciennement Pr. en anthropobiologie, laboratoire d’anthropobiologie de Bordeaux I
Cl. Raynaud, directeur de recherches CNRS, UMR 5140, Lattes
F.-X. Ricaut, chargé de recherches CNRS, UMR 5288, AMIS, Université de Toulouse
T. Romon, assistant d’étude et d’opération, Inrap, UMR 5199, PACEA, Université de Bordeaux 1
D. Rougé, Pr. de médecine légale, identification, UMR 5288, AMIS, Université de Toulouse
S. Sainte-Marie, odontologiste, anciennement laboratoire AMIS Toulouse
M. Vidal, anciennement conservateur régional de l’archéologie, UMR 5608 Traces, Université de Toulouse
8
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
5 Table des matières
REMERCIEMENTS 9
INTRODUCTION 11
I. PRÉSENTATION DES SITES 15
I. 1. La nécropole de la basilique du quartier du Plan, à Saint-Bertrand-de-Comminges (Haute-Garonne) 18I. 1.1. Les vestiges antérieurs 18I. 1.2. La basilique 20I. 1.3. Les inhumations 22I. 1.4. Le mobilier 22I. 1.5. Interprétations et datation 22
I. 2. La nécropole de Rivel, à Venerque (Haute-Garonne) 23I. 2.1. Les vestiges antérieurs 23I. 2.2. La nécropole 25I. 2.3. Le mobilier 30I. 2.4. Datation et commentaires 46
I. 3. La nécropole de La Gravette, à l’Isle-Jourdain (Gers) 48I. 3.1. Historique de la fouille 48I. 3.2. Les vestiges antérieurs 48I. 3.3. Les nécropoles 48I. 3.4. Les occupations 53I. 3.5. Les inhumations 55I. 3.6. Le mobilier 56I. 3.7. Chronologie et datation 58
I. 4. La nécropole de Saint-Brice-de-Cassan, à Ordan-Larroque (Gers) 58I. 4.1. Les vestiges antérieurs : la demeure aristocratique 58I. 4.2. La nécropole 59I. 4.3. Quelques données anthropologiques 61I. 4.4. Le mobilier 61I. 4.5. Chronologie et datation 61
I. 5. La nécropole de Vindrac (Tarn) 62I. 5.1. Historique des recherches et des fouilles 62I. 5.2. Esquisse historique 62I. 5.3. L’établissement funéraire du haut Moyen Âge 71I. 5.4. Les tombes 80I. 5.5. Le mobilier 84I. 5.6. Retour sur la chronologie : Vindrac, un site exemplaire pour son occupation continue 91
I. 6. Les cimetières des Horts et de l’Eglise, à Lunel-Viel (Hérault) 98I. 6.1. De l’agglomération antique au village médiéval 98I. 6.2. Les nécropoles 99I. 6.3. Le mobilier 102I. 6.4. Interprétations et datation 102
I. 7. Définition des populations anthropologiques 105
II. MATÉRIEL ET MÉTHODES 107
II. 1. Détermination de l’âge et du sexe 107II. 1.1. Détermination de l’âge 107II. 1.2. Diagnose sexuelle 107
II. 2. Recrutement et organisation 108II. 2.1. Les immatures 108II. 2.2. Les adultes 109II. 2.3. Les caractères discrets 109
II. 3. Morphologie 111II. 3.1. Analyse métrique 111
TABLE DES MATIÈRES
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
6Sous la direction de S. Duchesne et É. Crubezy
II. 3.2. Éstimation de la stature 112II. 3.3. Déformations crâniennes 112
II. 4. L’état sanitaire : la paléopathologie bucco-dentaire 112II. 4.1. Définition des échantillons 112II. 4.2. Identification 113II. 4.3. Critères et moyens d’étude 113
II. 5. Les pratiques funéraires 119II. 5.1. La position du défunt 119II. 5.2. Le mobilier 119
III. PRATIQUES FUNÉRAIRES 121
III. 1. La mise en place du défunt 121III. 1.1. L’inhumation 121III. 1.2. L’orientation 121
III. 2. La position du corps 121III. 2.1. Les membres supérieurs 122III. 2.2. Les membres inférieurs 125
VII. 3. Le mobilier 127
IV. RECRUTEMENT 131
IV. 1. La mortalité des immatures 131VI. 1.1. Analyse des quotients de mortalité 131IV. 1.2. Proportions immatures/adultes 133
IV. 2. La mortalité des adultes 134IV. 2.1. Répartition des adultes selon le sexe 134IV. 2.2. Répartition des adultes selon l’âge 134
IV. 3. Conclusions sur le recrutement 136IV. 3.1. La mortalité des enfants 136IV. 3.2. La mortalité des adultes 138
V. ORGANISATION : RÉPARTITION DES DONNÉES BIOLOGIQUES AU SEIN DE L'ESPACE FUNÉRAIRE 141
V. 1. Étude du nombre de sépultures individuelles et multiples 141V. 2. Organisation interne des nécropoles 141
V. 2.1. Répartition en fonction de l’âge et du sexe 141V. 2.2. Répartition en fonction des caractères discrets 143
VI. DONNÉES MORPHOLOGIQUES 147
VI. 1. Les caractéristiques morphométriques 147VI. 1.1. Les données crâniennes 147VI. 1.2. Les données post-crâniennes 152
VI. 2. Le dimorphisme sexuel 154VI. 3. La stature 154VI. 4. Comparaisons 157
VI. 4.1. Les données crâniennes 158VI. 4.2. Les données post-crâniennes 159
VI. 5. Conclusions sur les données métriques 162VI. 6. Les déformations crâniennes 164
VI. 6.1. Description 164VI. 6.2. Origine et fonction des déformations crâniennes 166
VI. 7. Les lésions crâniennes à Vindrac 168
TABLE DES MATIÈRES
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
7 Table des matières
VII. ETAT SANITAIRE : LA PALÉOPATHOLOGIE BUCCO-DENTAIRE 173
VII. 1. Pertes ante mortem. 173VII. 2. Étude des caries 174VII. 3. Étude des parodontopathies 179VII. 4. Étude du tartre 182VII. 5. Étude des usures dentaires 185VII. 6. Étude des atteintes apicales osseuses. 188VII. 7. Étude des hypoplasies linéaires de l’émail dentaire 188
VII. 7.1. Analyse des populations 188VII. 7.2. Analyse du stress 191VII. 7.3. Conclusions sur les hypoplasies 193
VII. 8. Conclusions sur la paléopathologie bucco-dentaire 195
CONCLUSIONS 199
Le monde des morts : permanences et évolutions 199Le monde des vivants : contexte régional 199
BIBLIOGRAPHIE 201
INDEX DES FIGURES 215
TABLE DES MATIÈRES
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Remerciements9
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
REMERCIEMENTS
‘état des connaissances des nécropoles du haut Moyen Âge dans le sud-ouest de la France, depuis plus d’un demi-siècle, doit beaucoup aux recherches pionnières de nombreux archéologues bénévoles, membres d’associations et de sociétés locales. Ce sont leurs travaux qui ont permis de donner aux fouilles programmées actuelles les bases référentielles nécessaires, complétant celle établie par C. Barrière-Flavy à la fin du XIXe siècle. Nous profitons de cette occasion pour rendre hommage à ces passionnés et sou-
vent anonymes de l’archéologie.
En dehors des participants à cet ouvrage, il nous est agréable de remercier Jean Guilaine qui initia une bonne partie des travaux anthropologiques de l’époque médiévale en Languedoc et Henri Duday, anthropo-biologiste, qui encadra les premiers travaux sur Venerque.
Si les fouilles de la nécropole de Rivel à Venerque purent avoir lieu c’est grâce à J.-P. Magnol, pro-fesseur à l’école vétérinaire de Toulouse, premier responsable de la fouille ; B. Marty du service régional de l’archéologie et Mme Marty, archéologue, pour leur disponibilité, leur accueil et leurs implications scienti-fiques ; P. Garston, G. Lavabre, et Mme Vidal pour leurs implications sur le terrain ; J.-L. Laffont qui était alors directeur du laboratoire de restauration des musées de la ville de Toulouse et Mme et M. J.-C. Boglio (†), propriétaires des terrains à l’époque.
À Vindrac ce fut l’enthousiasme, l’implication et la détermination de l’abbé M. Bessou (†) qui per-mirent la fouille et la publication de cet ouvrage demandée, il y a déjà trop longtemps, à quelques jours de son décès, à l’un d’entre nous, que R. Manuel poursuivit de son amicale pression. Nous remercions pour leurs implications, P. Périn alors qu’il était directeur du musée des Antiquités Nationales à Saint-Germain-en-Laye, M. Bompaire, M. Feugère et G. Deperot du CNRS ainsi que Ch. Pietri (†), professeur à l’Université Paris Sorbonne.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
IntroductionÉric Crubézy et Aymat Catafau
INTRODUCTION
ans le sud-ouest de ce qui est aujourd’hui la France, les archéologues ont décrit et fouillé, depuis le XIXe siècle des champs d’inhumations anciennement appelés nécropoles barbares ou cimetières mérovingiens, dont la particularité
est d’être situés à l’extérieur des villes ou des villages actuels. Par ailleurs, les premières églises romanes ont parfois encore autour d’elles un cimetière, ci-metière d’église, parfois paroissial. Les fouilles et les sondages entrepris autour des églises qui n’en étaient pas entourées ont démontré que cela résultait de leur condamnation à différentes époques, sou-vent récente par ailleurs. Ces constatations ont pré-valu jusque dans les années 1970/1980 ; jusque-là les problématiques étaient essentiellement centrées sur des questions chronologiques et ethniques, autre-ment dit d’identité des peuples « barbares » arrivés lors des « grandes invasions » que les chercheurs essayaient de retrouver à partir du mobilier associé aux défunts, voire à partir de la typologie crânienne (pour un survol historique voir Crubézy 1987). À cette époque de la recherche, les nécropoles médié-vales postérieures à l’an mil n’attiraient pas les cher-cheurs. En effet, elles sont souvent situées autour d’un lieu de culte parfois encore utilisé, elles ont servi pendant plusieurs centaines d’années, la chro-nologie relative, surtout avant l’enregistrement par U.S., y était difficile à saisir et l’absence de mobilier empêchait, avant la généralisation du C14 pour les époques récentes, toute chronologie absolue. Par ail-leurs, il s’agissait de cimetières chrétiens et l’on n’en-visageait même pas de problématique d’approche à leur égard, il semblait que tout fut connu et que dans ce domaine le vécu de nos arrière-grands-parents n’ait été guère différent de celui des populations mé-diévales. Le passage de l’un à l’autre de ces mondes des morts restait dans le flou, certes quelques églises et basiliques paléochrétiennes et pré-romanes étaient connues, des tombes avaient même été fouillées à l’intérieur et autour d’elles, mais les termes mêmes utilisés pour les décrire (« basilique cémétériale » par exemple) montraient que la question de leur recru-tement, en terme de population, n’était même pas envisagée. Par ailleurs, les tombes des alentours de l’an mil étaient complètement inconnues, les tombes rupestres, largement attribuées actuellement au
Xe siècle, étaient à cette époque considérées comme du XIe ou XIIe siècle, d’où des « trous » dans la chro-nologie.
À partir des années 1980, l’influence de l’École des Annales et de la Nouvelle Histoire transforme la re-cherche archéologique française. Avec l’intérêt gran-dissant porté à l’histoire de la mort (voir historique in Crubézy, Duchesne, Arlaud, 2006), le renouveau des études sur l’histoire religieuse et sur ce que l’on avait eu coutume d’appeler le Haut Moyen Âge mais qui était de plus en plus perçu comme une longue Antiquité tardive, de nouvelles problématiques ap-parurent. Elles purent se développer et s’enrichir durant plus de 20 ans grâce aux grandes fouilles et aux sondages souvent systématiques permis par l’ar-chéologie préventive. Ces nouvelles problématiques intéressèrent d’une part le « monde des morts » en tant que tel, notamment sa situation et son organi-sation, d’autre part l’étude des pratiques et des rites funéraires ainsi que le recrutement des cimetières (Crubézy et al. 2000).
Le Monde des morts et sa situation
En ce qui concerne le monde des morts et sa situation, les recherches les plus intéressantes de ces vingt der-nières années ont porté sur le maillage paroissial et sa genèse (Delaplace 2005). Il est apparu que ce maillage, qui forme encore la trame de nos communes, ne ré-sultait pas d’une naissance ex abrupto mais d’une longue transition entre le monde romain et le monde médiéval, transition qui avait abouti à la formation du paysage actuel. Ce renversement de perspec-tive était permis par la notion d’Antiquité tardive (Brown 1971, Marrou 1977), modification essentielle des découpages chronologiques et des périodisations classiques, qui permettait de valoriser les continuités et le changement, au détriment de la vision ancienne de décadence et de fin du monde romain.
Dans cette perspective, le monde des morts avait un rôle relativement ambigu selon les lieux. En effet, il se dégageait des principales études ou syn-thèses (Galinié, Zadora-Rio 1996) deux schémas, que nous serions tentés d’appeler classiques :
11
Éric Crubézy et Aymat Catafau
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Introduction
Dans certains cas, à la suite de l’apparition des lieux de culte dans les agglomérations, les morts confinés à l’extérieur des murs selon la vieille loi an-tique, auraient progressivement intégré l’espace vil-lageois ou urbain afin d’être inhumés près des lieux de culte, qui pouvaient dans certains endroits avoir accueilli précocement la dépouille de saints hommes, de clercs particulièrement reconnus ou d’évêques (Duval 1988).
Dans d’autres cas, les morts auraient, au contraire, pu être un pôle d’attraction pour l’habitat. En effet, les rites liés au culte des reliques et à la tombe des saints ou des évêques ont pu attirer les fidèles, cette attraction et cette popularisation entraînant la transition d’un culte privé et familial dans un mauso-lée à un culte public dans une église funéraire, comme à Saint-Just de Lyon (Reynaud 1996), ou d’une né-cropole antique à une basilique établie sur la tombe d’un martyr, comme à Saint-Martin de Tours (Gali-nié 1997) ou à Saint-Sernin de Toulouse (Cazes 2008). Des clercs sont nécessaires pour les cultes funéraires1 Sidoine et de véritables communautés monastiques ont pu les relayer (Reynaud 1996). Par ailleurs, les regroupements des populations à proximité des nécropoles ont pu favoriser le renouveau de certains quartiers suburbains.
Toutefois, la multiplication des études de cas a pu démontrer ces dernières années qu’à côté de ces schémas classiques, bien d’autres, peut-être tout aussi classiques, ont pu exister (Garnotel, Raynaud 1996). En ce qui concerne le sud-ouest de la France, trois sites permettent plus particulièrement d’envisager cette transition entre les champs d’inhumations à la campagne et les cimetières d’églises, il s’agit de Lu-nel-Viel (Raynaud 1996 et Raynaud 2010), de Saint-Côme-et-Damien à Montpellier (Crubézy, Duchesne, Arlaud 2006) et du site en cours de publication de la Gravette à L’Isle-Jourdain (Gers). À Lunel-Viel, à partir d’un habitat groupé dès le Ier siècle, on assiste à la polarisation précoce de l’habitat autour de l’église entre le VIe et le VIIIe siècle. À Montpellier, dont la naissance vers l’an mil se rattache au modèle de l’in-castellamento, le cimetière rural de Saints-Côme-et-Damien, situé autour d’une église primitive d’abord en bois puis en pierre, devient rapidement l’un des lieux d’inhumation de la nouvelle ville en cours de constitution, sans jamais accéder semble-t-il au sta-tut de paroisse. À L’Isle-Jourdain, dans le Gers, la formation du noyau ecclésial est précédée de deux
(1) Texte de Sidoine Apollinaire sur Saint Just de Lyon, V, 17.
cimetières, l’un autochtone et l’autre franc, ce dernier correspondant de toute évidence à l’implantation de sujets venus diriger la communauté lors de l’occupa-tion de la région par les troupes de Clovis, après la bataille de Vouillé, en 507.
Pour la période suivante, la genèse du cime-tière d’une paroisse rurale à l’époque carolingienne et sa structuration progressive, par la délimitation de son extension et l’organisation de son espace intérieur, ont été illustrées par la fouille de Vilarnau (Passarrius, Donat, Catafau 2008). L’utilisation sys-tématique des datations C14 et la périodisation des inhumations pont permis d’y distinguer différentes phases chronologiques.
Parallèlement à ces travaux archéologiques, les études historiques ont affiné notre connaissance du cimetière et de toutes les pratiques, usages et croyances qui président à sa mise en place au Moyen Âge. Depuis la mise au jour des origines carolin-giennes du cimetière chrétien (Treffort 1996), le ci-metière est devenu un objet d’étude historique. Les conditions de sa « naissance » ont particulièrement suscité l’intérêt des historiens. Ils ont mis en lumière les dimensions religieuses, liturgiques, mémorielles et sociales de la création de cet espace où sont redéfinis les rapports entre morts et vivants au sein de l’ecclesia (Lauwers 2005, Treffort 2007, Mémoires 2011).
L’étude des pratiques et des rites funéraires
L’étude des pratiques et des rites funéraires pour le Haut Moyen Âge se confond en partie avec une autre piste de recherche, dont dépend aussi la probléma-tique précédente, qui est celle de la christianisation de notre pays. L’arrivée du christianisme fut précoce en Gaule, toutefois, les étapes de sa légalisation puis de son affirmation comme religion exclusive s’étendent sur tout le IVe siècle. La religion chrétienne, conver-tie aux idéaux et à la culture du monde romain (Brown 1971), obtint enfin la conversion du monde romain au christianisme par l’édit de tolérance de Galère en 311, puis la conversion de Constantin en 312, et sa reconnaissance légale en 313. Cependant les mesures antichrétiennes, comme leur exclusion de l’enseignement, et les restitutions de biens confis-qués aux temples furent décidées sous Julien l’Apos-tat (361-363), témoignant de résistances opiniâtres des traditions religieuses. Les décennies suivantes
12
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
IntroductionÉric Crubézy et Aymat Catafau
furent marquées par une certaine volonté, de la part des empereurs Valentinien et Valens puis Gratien, d’assurer une certaine coexistence pacifique entre les cultes (Pietri 1995). En fait, il fallut attendre 392 pour que Théodose interdise la célébration du culte païen, même en privé. Celui-ci n’a sûrement pas dis-paru pour autant puisque l’interdiction est sans cesse renouvelée au Ve siècle. C’est vers cette époque qu’en Occident les évêques ont commencé à imposer vérita-blement une culture christianisée, d’autant plus que les royaumes qui succèdent à l’empire sont chrétiens et que le baptême de Clovis vers 500 conforta gran-dement l’Église. Bien que, semble-t-il, la majorité de la population des anciennes provinces de l’Empire ait été baptisée au VIe siècle (Maraval 2000), nous ne savons pas exactement ce que recouvrait le terme de christianisation. Nous avons peu de renseignements sur la pastorale et sur le contenu de la foi, et on peut soupçonner que pour de nombreux fidèles le risque de confusion avec des rites païens restait très grand. Il est probable qu’en de nombreux endroits des sur-vivances païennes se sont maintenues pendant plu-sieurs générations (MacMullen 1998).
Dans le sud-ouest de la France, région d’an-cienne et profonde romanisation, des communau-tés chrétiennes ont très tôt existé. Ainsi, il y en avait une à Toulouse en 250, date à laquelle fut martyrisé son premier évêque, Saturnin. Sa Passio mentionne la présence d’un groupe de chrétiens très peu nom-breux et d’une église toute petite (Cazes 1998). Toutefois, il faut attendre le IVe siècle pour qu’avec la paix de l’église apparaissent les premiers succes-seurs assurés de Saturnin. Une grande basilique fut achevée au tout début du Ve siècle et l’Église de Toulouse semble donc être bien structurée à partir du milieu du IVe siècle. Beaucoup plus à l’est, vers la vallée du Rhône où la christianisation fut plus précoce encore et plus développée, à Lunel-Viel, à quelques dizaines de kilomètres de Nîmes, auquel le village était relié par la voie romaine, il faut attendre le milieu du IVe siècle pour que les tombes prennent une orientation est/ouest (et non plus nord/sud) et à cette époque une sur deux livre encore des of-frandes (Raynaud 1996). Et dans la première moitié du Ve siècle certaines sépultures contiennent des dépôts monétaires, des pièces posées sur les yeux, sur la bouche ou contenues dans une bourse à la ceinture du défunt, selon une pratique caractéris-tique des croyances antiques, parfois perpétuée avec des monnaies où figure le chrisme ! (Raynaud 2010, 76-78). C’est certainement vers le milieu du Ve siècle que les cultes anciens ont dû disparaître (à l’excep-
tion peut-être du Pays basque), et de cette époque l’on peut dater une politique systématique d’éradi-cation ou de christianisation des derniers lieux de culte païens. Ainsi, la Passion de Vincent d’Agen, martyr, garde encore le souvenir d’un culte païen célébré près d’un « temple » appelé Vernemet ce qui signifiait en langue gauloise « le grand bois sacré », situé sur la rive gauche de la Garonne, qui semble avoir disparu au Ve siècle. Avant la fin de ce siècle, saint Amant détruit en Rouergue des lieux de cultes païens (Rouche 1979). Par souci d’efficacité, les saints préfèrent parfois christianiser un lieu de culte païen par le dépôt de reliques et le transfert des offrandes destinées primitivement à la divinité naturelle vers Dieu, au travers de l’intercession d’un saint. Ainsi, selon Grégoire de Tours, sur les bords du lac Saint-Andéol, en Aubrac, l’évêque de Javols établit une basilique contenant des reliques de Saint-Hilaire, et ordonna aux gens des environs, qui venaient jeter dans le lac des offrandes pour obtenir des guérisons, d’adresser désormais leurs dons à Dieu, par l’inter-médiaire du saint (Grégoire de Tours, Les sept livres des miracles, VII, 2, d’après Schmitt 1988).
L’étude des complexes transitions entre le monde antique et le monde médiéval s’oriente de-puis plusieurs décennies vers la valorisation d’un long processus de changements qui interagissent et se cumulent, sur un substrat de permanences plus durables qu’on ne l’imaginait. Les signes d’un profond bouleversement du sentiment religieux se multiplient dans l’Empire romain à partir de Marc Aurèle. Au premier plan de ces aspirations et de ces inquiétudes nouvelles figure la question de la mort, du sort de l’individu et de l’existence d’un au-delà. À ces questions répondent, de façon plus accessible que les anciennes philosophies élitistes, les nouvelles religions et cultes orientaux à « révélation » : leurs fi-dèles « convertis » au mystère d’une divinité de plus en plus abstraite, sont promis au salut après la mort, mais reçoivent aussi une règle de vie pour ici-bas, tout en ayant la certitude gratifiante de former part d’une communauté d’élus (Brown 1971).
Un certain nombre d’attitudes différentes face à la mort accompagnent ces changements, comme le recul progressif puis le quasi abandon de l’incinéra-tion, bien avant le succès de la religion chrétienne. L’apparition puis le succès de la religion chrétienne s’inscrit dans cette longue perspective de change-ments, qui s’étend du IIe au Ve siècle. Il est dès lors dé-licat de prendre la mesure de ce qui relève d’une évo-lution générale des croyances et du succès particulier
13
Éric Crubézy et Aymat Catafau
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Introduction
des rituels chrétiens, dans un domaine, celui des rituels autour de la mort, caractérisé par la longue survivance des traditions ancestrales et des gestes ritualisés
À la suite de nombreux historiens et exégètes, on insiste en outre de plus en plus sur la multiplicité et la diversité du christianisme à ses origines. Certains vont même jusqu’à parler de « christianismes primi-tifs » (Benoit 1999). Dans ce contexte, la définition et la mise en place d’une orthodoxie pour les inhumations par exemple, que nous situerons entre le IXe siècle et l’an mil et qui deviendrait dès lors la doctrine domi-nante, ne serait pas issue d’une donnée première mais bien le résultat d’un processus (Benoit 1999).
Par ailleurs, si pour l’historien l’une des ques-tions qui se pose est de savoir comment était vécue la vie chrétienne, pour l’archéologue le grand dilemme est bien de savoir comment était réalisée l’inhuma-tion chrétienne. Lorsque les morts sont déposés près de lieux de culte cela sous-entend qu’eux-mêmes ou leur entourage étaient chrétiens et que la façon dont ils vivaient leur foi les entraînait à être inhumés près de ces lieux saints. Nous pourrions donc prendre ces cas de sépulture près des sanctuaires chrétiens comme référence d’une adhésion des populations à la religion chrétienne. Cette reconstitution pure-ment spéculative des motivations de l’inhumation ad sanctos met en avant la foi des sujets, mais d’autres motifs guidaient peut-être ces actes : pour Cl. Ray-naud (1996) par exemple, en concédant à l’Église (re-présentée par l’église) la sauvegarde de ses morts, la communauté des vivants aurait pu viser avant tout à composer avec l’ordre nouveau. En effet, confir-mée comme institution officielle et seule détentrice de l’orthodoxie religieuse dans le royaume, l’Église franque est aussi une puissance politique et, de plus en plus, une grande propriétaire foncière. Se placer sous sa protection n’est pas qu’un geste de dévotion et n’a pas qu’un sens religieux (Rosenwein 1989), la maison Dieu est désormais le centre de la vie sociale (Iogna-Prat 2005), et le cimetière devenu lieu de défi-nition de la communauté chrétienne (Lauwers 2005). Le rapprochement des morts et de l’édifice de culte prend donc des sens multiples, parmi lesquels il n’est pas aisé d’établir des hiérarchies.
Mais quel sens a donc le maintien d’inhuma-tions extra-cimitériales, dans la période charnière des IXe-XIe siècles ? L’inhumation hors des limites du ci-metière doit-elle être toujours comprise comme une relégation, une exclusion (Garnotel, Paya 1996), la multiplication de ces découvertes n’oriente-t-elle pas les réflexions vers des explications moins exception-
nelles, telle que la permanence de pratiques d’inhu-mations en des espaces proches d’un habitat (Blaizot, Savino 2006). Une vision beaucoup plus diversifiée s’impose, dont les explications doivent aussi être multiples (Corrochano 2011).
Les progrès rapides des recherches en paléo-génétique permettent d’éclairer de façon nouvelle certains des problèmes posés depuis longtemps par les historiens et les archéologues sur les regroupe-ments familiaux au sein du cimetière, qui jusqu’au milieu des années 1990 étaient abordés seulement par des critères anthropologiques (caractères dis-crets) et que l’étude de l’ADN a confirmés (Crubézy et al. 1998). Mais les études paléogénétiques ouvrent aussi des perspectives nouvelles, en particulier dans le domaine des origines des populations et de leur mobilité, susceptibles de questionner à leur tour les données historiques (Crubézy, Alexeev 2007).
Sur toutes ces questions, on le voit, les progrès de la recherche archéologique ont été immenses de-puis une trentaine d’années. Au départ, l’archéologie du cimetière fut stimulée par les questionnements de la Nouvelle Histoire, mais, depuis, un dialogue beau-coup plus équilibré s’est établi entre les sources du sous-sol et les sources écrites. En effet les unes et les autres s’éclairent, ou s’interrogent, mutuellement, sans jamais, comme on s’en doute, parfaitement se superposer. Il est du plus grand intérêt de multi-plier les approches, les points d’observation, les col-lectes de données, comme Laurent Schneider l’a fait récemment pour le Languedoc-Roussillon (Schnei-der 2010). C’est bien ce que se propose cet ouvrage, réunissant les résultats issus de fouilles de nécro-poles et cimetières du Midi de la France, entre Haute-Garonne et Hérault, dans une chronologie étendue, du Ve au XIIe siècle. Nous souhaitons qu’il contribue, par l’apport de données archéologiques nouvelles, à enrichir les débats.
Cette publication est l’aboutissement d’un pro-gramme collectif de recherche (PCR), engagé de 1997 à 2000, afin d’étudier et de compiler les différentes études anthropologiques menées sur quelques sites du Haut Moyen Âge du grand Sud-Ouest de la France. Elles permettent de caractériser ces populations, encore mal connues pour cette époque et cette région. Les textes ont été finalisés en 2002, l’introduction a été révisée en 2012 et un complément bibliographique a été inséré à la fin de la bibliographie d’origine.
Éric Crubézy et Aymat Catafau
14
ES SITES ÉTUDIÉS APPARTIENNENT À DEUX RÉGIONS DU
SUD DE LA FRANCE : Midi-Pyrénées, avec cinqsites issus de trois départements, la Haute-Garonne (à Saint-Bertrand-de-Comminges etVenerque), le Gers (à L’Isle-Jourdain et Ordan-
Larroque), et le Tarn (à Vindrac-Alayrac), mais aussiLanguedoc-Roussillon, avec deux sites issus dudépartement de l’Hérault (à Lunel-Viel) (fig. 1).
La ville de Saint-Bertrand-de-Comminges estsituée à près de 110 km au sud-ouest de Toulouse,dans le piémont pyrénéen. Elle est au carrefourd’importantes voies de communications, terrestreset fluviales, qui lui permirent un fort développe-ment à l’époque antique. Elle devint une vaste etprospère ville gallo-romaine, puis ville épiscopale etchef-lieu de cité à l’époque paléochrétienne, avantd’être assiégée et détruite au VIe siècle par les inva-
I PRÉSENTATION DES SITES
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
15 Présentation des sites
L
Figure 1 : Localisation des sites funéraires étudiés.
source : d’après cartes Michelin
1 Saint-Bertrand-de-Comminges, nécropole de la basilique du quartier du Plan
3 Venerque, nécropole de Rivel
5 Ordan-Larroque, nécropole de Saint-Brice-de-Cassan
2 Lunel-Vieil, nécropole des Horts, cimetière de l’Église
4 Vindrac, nécropole
Nîmes
sions. Elle dut attendre Bertrand de l’Isle-Jourdain,évêque du Comminges en 1083, pour prendre unnouvel élan. À sa mort, il laissa derrière lui une citéépiscopale active, établie autour d’une nouvellecathédrale mais débordant largement de ses rem-parts. La basilique et la nécropole étudiée sontsituées en contrebas de Saint-Bertrand, en lisière dulieu-dit Le Plan, à proximité immédiate de la cha-pelle funéraire romane de Saint-Julien (parcellecadastrale 348) et du centre monumental de la villedu Haut-Empire (fig. 2).
Le village de Venerque est situé à environ 30km au sud-ouest de Toulouse, au pied d’une largetrouée formée par la plaine du ruisseau La Hise,affluent de l’Ariège. De part et d’autre, la lignecontinue des coteaux du Lauragais identifie un pay-sage vallonné sur et à la base duquel ont été recon-nus des établissements antiques. La nécropole étu-diée a été découverte dans le domaine de Rivel, àl’est du village, dans une zone en faible rupture depente, surmontant de 2,50 à 3 m La Hise (Labrousse1980 ; Lequément 1983 ; Vidal 1987, 1987-88 ; Clotteset al. 1989).
16Sous la direction de S. Duchesne et É. Crubezy
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 2 : Localisation de la basilique de la ville basse par rapport à l’habitat actuel (en hachures et aux
vestiges antiques repérés (Dessin : J.-C. Liger).
La ville de L’Isle-Jourdain est située à près de35 km à l’ouest de Toulouse, occupant une positionstratégique dès le début de l’ère chrétienne. En effet,elle est établie sur une importante voie de circula-tion entre Toulouse, Auch et Bordeaux, et à la fron-tière de l’Aquitaine et de la Septimanie, ce qui a per-mis son développement et sa pérennité sur plus demille ans en devenant une véritable agglomérationroutière. Le site étudié est implanté sur le versant ducoteau de Rozès, au sud de l’Isle-Jourdain, au lieu-dit La Gravette. Il est limité à l’est par les ruisseaux deCabriots et de l’Hesteil, et plus à l’ouest par la valléede la Save.
Le village d’Ordan-Larroque, fusion de quatrevillages (Ordan, Larroque, Meilhan et Ardenne), estsitué à près de 10 km au nord-ouest d’Auch, qui futévêché dès le IVe siècle, puis archevêché dès le IXe
siècle. La commune est traversée par une voie histo-rique, le chemin de César, qui reliait Toulouse à Eauze,qui fut la capitale de la Novempopulanie. La nécro-
pole étudiée, Saint-Brice-de-Cassan (parcelles 37 à40, section A), est située en fond de vallée sur la rivegauche de l’Auloue, affluent de la Baïse, à 3 km aunord du village.
Le village de Vindrac-Alayrac est situé dansl’Albigeois, zone de contact entre le Massif central etle Bassin Aquitain, dans la vallée du Cérou. Larivière s’infléchit pour ouvrir, au droit du village,sur une vallée large de 900 m environ, passageobligé au pied du village perché de Cordes (dudébut du XIII e siècle) pour l’axe Albi-Cahors. C’estune région conquise par les Romains à la fin du IIesiècle avant J.-C. Après les invasions du Ve siècle(Vandales, Suèves, Wisigoths, Francs, Sarrasins),l’Albigeois fut intégré à la Septimanie. Le site étudiéest au cœur du village, à quelques mètres au nord del’église (fig. 3).
Le village de Lunel-Viel est situé dans laplaine littorale languedocienne, à environ 30 km àl’est de Montpellier, en direction de Nîmes. Créé aucours du I er siècle après J.-C., le village est construit
17 Présentation des sites
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 3 : Situation de Vindrac (Tarn). Dessin et cliché M. Bessou.
Localisation de la basilique de la ville basse par rapport à l’habitat actuel (en hachures et aux vestiges
antiques repérés (Dessin : J.-C. Liger).
autour d’un carrefour routier. Il se développe jus-qu’au V e siècle, où de nouveaux quartiers apparais-sent. Le village se réorganise, notamment vers lenord-est, d’où il ne bougera plus. La nécropole desHorts est située en dehors de l’agglomération, àproximité de l’ancienne bourgade romaine, bien ausud des secteurs habités ; la nécropole de l’Église estsituée dans le quartier Saint-Vincent, proche del’église actuelle autour de laquelle se fixera plus tardle village (fig. 4).
I. 1. La nécropole de la basiliquedu quartier du Plan, à Saint-Bertrand-de-Comminges (Haute-Garonne)(Guyon J.)
I. 1.1. Les vestiges antérieurs
Les recherches récentes ont montré que la basilique aété bâtie à l’emplacement d’une vaste demeure,avant d’être étendue en empiétant sur les dépen-dances d’une autre domus qui fut luxueusement res-taurée pendant l’Antiquité tardive, et restera occu-pée alors même que la basilique était en fonction.
Les vestiges de cet urbanisme ancien sont à lafois plus simples et plus complexes qu’on ne l’a dit :plus simples parce qu’il faut renoncer à restituer le por-tique que M. Dieulafoy (1914) imaginait à hauteur del’extrémité orientale de la nef, supposant que l’édificechrétien avait remployé là, tels quels, les élémentsd’une colonnade ancienne ; plus compliqués parcequ’il faut distinguer dans les éléments antérieurs deuxet peut-être trois ensembles d’habitations (fig. 5).
Un premier ensemble est constitué par unevaste domus de 1000 m2 de superficie au moins quicouvrait - et au-delà - tout l’emplacement occupépar le premier bâtiment chrétien et ses annexes : elleétait limitée au nord par un mur long de 28 m - lemur 16 - et à l’ouest par une autre domus ; au sud,elle s’étendait peut-être jusqu’à un decumanus secon-daire reconnu par photographie aérienne et elledonnait sûrement à l’est sur une autre voie partiel-lement fouillée en 1986. Les recherches ont été tropponctuelles pour reconnaître suffisamment l’organi-sation générale de ce bâtiment de plan trapézoïdalqui a connu au moins trois phases dont seule la der-nière paraît appartenir à l’Antiquité tardive. La mai-son compte alors de grandes salles, d’une centainede mètres carrés de superficie (dont deux pourvues
18Sous la direction de S. Duchesne et É. Crubezy (Guyon J.)
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 4 : Situation de Lunel-Viel dans la plaine littorale languedocienne.
d’un chauffage par conduits rayonnants), qui peu-vent ouvrir, au nord-est comme au sud, sur descours. L’une des salles a été édifiée au détrimentd’un ensemble complexe - des petits thermes vrai-semblablement - qui a lui-même succédé à une pre-mière construction dont on ignore à peu près tout.
Le plan de la basilique ne reprend pas exacte-ment celui de ce bâti antérieur. Le mur nord de la nefchevauche ainsi le mur 16 au-dessus duquel ontégalement été construites les annexes nord, mais àl’inverse, deux autres murs de la domus ont été entiè-rement réutilisés : l’un dans le mur sud de la nef,dont seule la moitié est appartient en propre à labasilique ; l’autre pour servir de limite méridionaleaux annexes sud. Du coup, l’une des pièces chauf-fées de l’ancienne domus est restée mitoyenne des
annexes, sans que l’on puisse connaître sa destina-tion : a-t-elle gardé sa fonction première, au seind’une maison désormais amputée de la moitié de sasuperficie ? ou était-elle liée, d’une façon ou d’uneautre, à l’ensemble monumental chrétien ?
Au nord du mur 16 s’étendait un autre bâti-ment distinct, qu’on ne connaît que par un sondaged’une dizaine de mètres carrés de superficie, qui alivré des éléments de construction en adobe et desniveaux attribuables, en première analyse, au débutde l’Empire.
À l’ouest enfin, un troisième ensemble estconstitué par une très vaste domus sur les dépen-dances de laquelle a été installé le prétendu narthexde l’édifice chrétien. Ce dernier établissement est
19 Présentation des sites(Guyon J.)
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 5 : Plan général des fouilles du quartier du Plan. A l’ouest, fouilles de B. Sapène (1927-1931) ;
au sud-est, la basilique chrétienne dont une partie seulement (le « narthex ») empiète sur la grande
domus occidentale ; au sud, annexes de la basilique et autre domus fouillées de 1985 à 1992 (Dessin J.-
C. Liger, H. Delumeau d’après les relevés de B. Sapène et J.-L. Paillet).
bien connu par les fouilles anciennes de B. Sapène(1966) de part et d’autre de la route d’accès au site ;les recherches récentes ont confirmé qu’il a été bâtiau Ier siècle de notre ère (entre 30 et 60 ? ; Guyon,Paillet 1987, 9) sur un établissement plus ancien. Safaçade principale, longue d’une cinquantaine demètres sans doute, donne au nord sur l’une des ruesprincipales de la ville antique. Des pièces d’habita-tion échelonnées sur deux ou trois rangs en profon-deur sont distribuées autour d’une cour centrale de400 m2 de superficie ; elles couvrent au total plus de3000 m2. Au sud, un portique, peut-être cloisonnédans un second temps, donne sur un espace ouvert,cour ou jardin, agrémenté d’un grand bassin qui aété tranché par le mur ouest du « narthex ».
Cette domus fut restaurée, tout ou partie, dansle courant du IVe siècle. Les angles sud-est (les plusproches de la basilique) furent retransformés ensalles chauffées et l’une d’entre elles reçut un tapisde sol en mosaïque polychrome orné d’une grandenatte, datable sans doute d’un IVe siècle avancé,sinon du Ve siècle. Cet ensemble soigné fit l’objetd’un entretien attentif alors même qu’existait lemonument chrétien : des murs de renfort destinés àétayer les murs de la salle sud-est ont en effet étéappuyés contre les murs de la nef et du « narthex ».La disparition de la domus, également documentéepar la fouille, doit d’ailleurs être placée à une datesûrement tardive (VIe siècle ? ; Guyon, Paillet 1987,15), ce qui invite, dans ce cas aussi, à se demander sila maison a continué à vivre jusqu’au bout de sa viepropre ou si elle a été annexée, progressivement oud’un seul coup, aux monuments chrétiens.
Si de telles interrogations doivent rester sansréponse, le seul fait qu’on puisse les formuler suffità montrer que la basilique n’est pas née dans undésert ou au milieu d’un champ de ruines, mais bienau cœur d’un quartier de demeures luxueuses, oùelle a difficilement trouvé place ; ce qui corrige sen-siblement l’image généralement reçue de Saint-Ber-trand à la fin de l’Antiquité.
I. 1.2. La basilique
Le bâtiment n’est pas exactement orienté, mais dedirection générale nord-ouest/sud-est ; il mesurehors tout environ 45 m d’ouest en est sur 13,60 m dunord au sud (fig. 6). Les descriptions anciennes(Lizop 1931, 426-433) distinguent quatre éléments : àl’ouest, un « narthex » de 12 m de longueur dans-œuvre, au centre, une nef de 18,60 m de longueur
dans-œuvre, à l’est, un « chœur » plus étroit (9 m delargeur) composé « d’une travée rectangulaire de5,90 m de long terminée par un chevet à trois pans »(longueur totale : 12,90 m ; Lizop 1931, 432), et enfin,des annexes importantes au nord du chœur.
Ces descriptions signalent aussi le manqued’orthogonalité de certains éléments (qu’elles expli-quent par le remploi dans l’édifice de murs anté-rieurs) et laissent ouverte la question de savoir si lanef principale était unique ou divisée en trois vais-seaux par des colonnades.
Les recherches récentes permettent de privilé-gier la première solution : il n’existe en effet aucunindice probant pour l’existence de lignes internes desupports, et la largeur de l’édifice autorise sa cou-verture par une unique charpente. Elles invitent enoutre à remettre en cause la nomenclature tradition-nellement adoptée et à considérer que le plan singu-lier et l’allure très étirée de la basilique résultent deplusieurs transformations.
Ainsi, à l’ouest, l’existence d’un narthex estpour le moins problématique. La limite entre la nefet le « narthex » est en effet marquée par un mur 29qui appartient non pas au monument chrétien, maisà une vaste domus plus ancienne et cette limite seprésente de manière étrange. Les fondations desmurs du « narthex » et de la nef sont en effet pla-quées contre ce mur 29 mais il en va autrement enélévation où un témoin conservé de la premièreassise montre au contraire que ces mêmes murs du« narthex » et de la nef sont en parfaite continuitéau-dessus du mur 29 dérasé. Autant d’éléments quiinvitent à lire la limite entre nef et « narthex », noncomme une césure propre au monument chrétien,mais bien comme un témoin d’une séparation ini-tiale entre basilique et domus, qui fut abolie dans unsecond temps en raison des transformations dumonument chrétien.
Le « narthex » est en effet la seule partie de labasilique qui empiète, d’ailleurs marginalement, surl’emprise de la domus dont le jardin couvrait tout lesecteur ouest du site, et la description de son archi-tecture montrera par ailleurs combien il diffère dureste du monument chrétien : tout suggère donc qu’ilconstitue l’extension vers l’ouest d’une premièrebasilique adossée au mur 29 du jardin ; l’interpréta-tion est d’autant plus vraisemblable que les annexesméridionales de l’église, initialement limitées ellesaussi par le mur 29, ont également été prolongées de
20Sous la direction de S. Duchesne et É. Crubezy (Guyon J.)
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
la même façon en direction de l’ouest, sans doute aucours de la même campagne de travaux.
La basilique proprement dite a d’ailleursconnu une autre extension dans la direction oppo-sée, vers l’est. Les recherches récentes ont montré eneffet qu’à cet endroit, le « chevet à trois pans » décritpar R. Lizop n’était qu’une adjonction à un édificeinitialement terminé par un chevet plat, et que cenouveau chevet à pans coupés fut remanié par lasuite et alors réduit.
Le plan confus des annexes nord tient d’autrepart à l’existence de deux constructions superposées,mais d’organisation assez voisine (il faut y voir troissalles, agrandies dans un second temps), tandis que lesannexes méridionales, découvertes par les recherchesrécentes, ont connu plus de modifications encore.
Quatre états au moins peuvent être distinguer,conduisant un bâtiment relativement modeste à
l’origine (25 m x 13,60 m environ) à l’ample basi-lique aujourd’hui présentée au public :
État 1, une basilique terminée à l’est par unchevet plat et pourvu d’annexes : trois salles aunord, et au sud, un ensemble plus important orga-nisé autour d’une cour.
État 2, extension de la basilique, vers l’est, parl’adjonction d’un chevet à pans coupés qui empiètesur une rue ; vers l’ouest, par le prétendu « narthex »gagné sur la domus. Ces transformations (simulta-nées ?) s’accompagnent peut-être d’un agrandisse-ment des annexes nord et, à coup sûr, d’une exten-sion parallèle des annexes sud, d’ailleurs égalementtransformées : elles comptent alors une cour àl’ouest, des portiques à l’est.
État 3, transformation des annexes méridio-nales, formées désormais d’une longue cour, bordéeau nord et au sud par des portiques (peut-être cloi-sonnés au nord-ouest) ; réfection et rétrécissement(simultanés ?) du chevet à pans coupés.
21 Présentation des sites(Guyon J.)
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 6 : Etat successif de l’ensemble monumental paléochrétien et localisation des inhumations
(d’après dessin de J.-L. Paillet 1993).
enfin, État 4 , dernière modification desannexes sud, qui ne comptent plus qu’un ampleportique au nord, qui donne sur une cour.
I. 1.3. Les inhumations
Entre 1913 et 1926, vingt-sept sarcophages ont étédégagés à l’intérieur de la basilique. À l’exceptiondes exemplaires n°4 et 6, tous les sarcophages sontorientés, et les trois quarts ont été placés dans lamoitié septentrionale de l’édifice. Mais cette dispo-sition doit peut-être beaucoup au hasard, sauf dansle chœur où la conservation d’une notable partie dusoubassement du sol permet de supposer que lenombre des inhumations a toujours été réduit,ailleurs les récupérations ont sûrement été nom-breuses, car dans la nef, la stratigraphie était trèsbouleversée (Lizop 1914-1922, 246) et les cuves iso-lées ne manquent pas dans le village actuel... Autémoignage des fouilleurs, certaines cuves (n°3 et 14en particulier) étaient nettement au-dessous duniveau de sol et elles étaient d’ailleurs recouvertespar des dalles du pavement ; pour les installer, onavait même à l’occasion entaillé les murs plusanciens sous la nef : d’autres sarcophages aucontraire (n°1 et 2 par exemple) affleuraient le pave-ment ou le dépassaient peut-être.
Six autres sarcophages ont été repérés à l’exté-rieur de l’édifice : le premier, le long du mur de lanef, dès 1920 ; deux autres dans l’annexe sud-est en1986 (dont l’exemplaire n°30 qui a été creusé dansun bloc épigraphe en remploi), les trois derniersenfin, dans les annexes méridionales en 1988. Ilstémoignent de l’intense utilisation funéraire d’unsite où les inhumations en pleine terre avoisinentdes sépultures plus recherchées placées dans descuves.
Plus de cent trente tombes ont été fouillées oureconnues dans les annexes entre 1985 et 1992. Cesont pour la plupart de simples fosses entourées etcouvertes de cailloux et de matériaux de démolition.Leur densité est particulièrement importante auprèsde la basilique où elles ont été installées au prix par-fois de recoupements, sur plusieurs niveaux quirépondent aux exhaussements, d’ailleurs mesurés,liés aux différentes transformations des annexes.Ces tombes ont fait disparaître toute trace des solsoriginels et souvent détruit des murs, ce qui ne faci-lite guère les restitutions ; du moins offrent-elles uneimage approchée de l’importante nécropole qui
avait pris place également dans la basilique elle-même et à laquelle les premiers fouilleurs n’ontaccordé qu’une attention mesurée : quelques lignesdans les relations imprimées ou mes carnets inéditsde B. Sapène (1966).
I. 1.4. Le mobilier
L’intérêt majeur de la basilique et de ses annexesréside dans les sarcophages : les vingt-sept sarco-phages situés à l’intérieur sont en marbre de Saint-Béat pour la plupart, une cuve et un couvercle sont enmarbre rouge de Sost, et un sarcophage est en calcaire.
Un seul sarcophage (le n°7, aujourd’hui aumusée) portait à la fois un décor (un cercle entou-rant un chrisme flanqué des lettres alpha et oméga)et une inscription (Schenck 1991) :
da Xpe famulae tuae Aemilianae requiim et vitamaeternam
« donne, ô Christ à ta servante Aemiliana le reposet la vie éternelle »
Les individus inhumés dans les fosses simplesétaient déposés pour la plupart d’entre eux sansmatériel.
I. 1.5. Interprétations et datation
Les éléments d’appréciation manquent pour propo-ser une interprétation sûre de cet édifice : s’agit-ild’une basilique construite dès l’origine pour rece-voir des tombes ou d’un monument dans lequel lesinhumations n’auraient été installées que dans unsecond temps ? La deuxième interprétation avait lafaveur des premiers fouilleurs qui jugeaient que lesol avait été défoncé pour placer les cuves (Lizop1931, 437). On ne peut apprécier aujourd’hui la vali-dité de ce jugement puisque partout, leur fouille aété conduite jusqu’à la base des sarcophages, maisl’hypothèse paraît vraisemblable, surtout à présentque l’on connaît mieux l’environnement de la basi-lique. Est-il concevable en effet que l’on ait dès l’ori-gine, installé des tombes dans un secteur de la villeencore très urbanisé pendant l’Antiquité tardive,comme l’ont montré les fouilles des domus voisines ?Ce le serait en Espagne ou dans l’Africa romaine,c’est plus improbable dans notre pays, et ce, mêmesi la basilique n’est pas, comme le voulaient cesdécouvreurs « le plus ancien édifice religieux quel’on ait encore signalé en Gaule » (Dieulafoy 1914,
22Sous la direction de S. Duchesne et É. Crubezy (Guyon J.)
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
90). Les dernières publications consacrées au monu-ment (ainsi Gavelle 1982, 500-501) sont revenues àjuste titre sur cette appréciation, et la date qu’ellesproposent (première moitié du Ve siècle) semble cor-roborée par les fouilles récentes qui permettent deplacer au plus tôt après le premier tiers du Ve sièclela constitution du sol de circulation à l’extérieur desannexes sud, grâce à la présence dans le remblaisous-jacent de nombreuses émissions monétaires 4.
L’indice vaut pour la création de la basilique,non pour ces transformations successives qui ris-quent de rester à jamais indatables à cause des bou-leversements apportés par les inhumations ulté-rieures. Et les rapprochements typologiques neseront guère éclairant en la matière. En Gaule entout cas, cet édifice paraît isolé, et son plan, trèssimple avant l’adjonction du chevet polygonal, n’estpas caractéristique ; quant au chevet à trois pans lui-même - une disposition à laquelle on tenait puisqu’ila fait l’objet d’une reconstruction à l’identique, oupresque - il n’a pas grand rapport avec les absidespolygonales qu’on connaît dans d’autres régions.
Tout aussi imprécise restera sans doute la dated’apparition des inhumations au sein de cetensemble : les sarcophages sont indatables, saufpeut-être l’exemplaire décoré que l’on attribue, sansargument vraiment décisif, à la seconde moitié duVIe siècle (Ward-Perkins 1938, Fossard 1957). Toute-fois, les datations radiocarbones 5 réalisées surquelques squelettes confirment l’installation desépultures dans la basilique et ses annexes dans lesdernières décennies du VIe siècle.
Au moins est-il sûr qu’il faut décidément ins-crire dans la longue durée l’histoire d’un édifice aussisouvent transformé : s’il est plus vraisemblable, mal-gré le silence de Grégoire de Tours, qu’il existait bienencore lors des événements de 585 (comme églisecimétériale de l’ensemble Lugdunum ? ou de la seuleville haute, si Le Plan était alors réduit à l’état de« campagne » ?), rien ne prouve qu’il ait été détruit àl’occasion du sac de la ville ni même que le lieu ait étédéserté à l’issue du massacre généralisé qui suivitl’assaut, à en croire le même Grégoire de Tours 6.
Il faut croire, non à une brutale disparition,mais bien à la ruine progressive d’un édifice au seinduquel les fouilles ont mis en évidence des inhuma-tions très tardives, dont certaines ont été placées ausein de la couche de destruction ou au-dessus desmurs arasés. Deux d’entre elles ont été respective-ment datées par la méthode du radiocarbone desannées 619-845 et 790-987. Deux autres, encore plustardives, documentent son usage jusque dans unXIIe siècle avancé (995-1158 et 1041-1250). Ces sépul-tures prouvent bien la permanence de l’occupationet de l’affectation funéraire du lieu, dont témoigneaussi éloquemment la présence, à proximité immé-diate, de la chapelle funéraire romane de Saint-Julien, autour de laquelle s’organise, encore aujour-d’hui, le cimetière moderne du quartier du Plan.
I. 2. La nécropole de Rivel, à Venerque(Haute-Garonne)
(Vidal M.)
I.2.1. Les vestiges antérieurs
Venerque/Venercha en 1080 (Dauzat, Rostaing 1978,704) est connu pour avoir bénéficié dès l'époque caro-lingienne d'une communauté religieuse, transforméepar la règle de Saint-Benoît en abbaye bénédictine.Citée en 817 lors du grand synode réuni à Aix-la-Cha-pelle, puis en 819 dans la Noticia (Venercha), elle estensuite mentionnée en 960 à la suite de dons de bienseffectués par Hugues, évêque de Toulouse, en 1080 oùle territoire de l'abbaye est cédé par Guillem IV, comtede Toulouse à l'abbaye de Saint-Pons-de-Thomières(Hérault) (Dutil 1929, 216). Actuellement, il n'en sub-siste que la partie romane (abside et absidioles) del'église du village qui est dédiée à Saint-Pierre, hagio-toponyme ancien (Kneubuhler 1989, 289).
La situation privilégiée de cette communautéreligieuse d'époque carolingienne n'a aucun antécé-dent connu de l'Antiquité tardive, alors que le bilanqu'il est possible de faire actuellement de l'occupa-tion humaine (fig. 7), n'est révélateur que d'un étatdes connaissances sans doute encore largement lacu-naire. En effet, sur le territoire de la commune mais en
23 Présentation des sites(Vidal M.)
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
(4) Identifiées par J.-P. Bost.(5) Effectuées au laboratoire de Lyon(6) Historia Francorum, VII, 38 : cunctos interfeceruntut non remaneret mingens ad parietem ... nihil ibi praeter humum vacuamrelinquentes, « ils les tuèrent tous, afin qu’il ne restât personne pour pisser contre les murs..., ne laissant rien à cet endroitqu’une terre vide ».
dehors du village, ne sont signalés qu'une nécropoledu Ier Age du Fer à La Trinité (Müller 1978, 105-109),et trois établissements gallo-romains, l'un situé aulieu-dit Soulbet au nord (Ier-fin IIIe s. ap. J.-C.)(Labrousse 1980, 482), l'autre sur le point culminantdu Pech mais connu surtout comme étant d'époquemédiévale 7, le dernier à Adam à deux kilomètres ausud-est de Venerque et à moins de 500 m de la nécro-pole de Rivel. Etabli sur un plat en léger relief inclinévers le nord, il s'agit ici d'un site de haute époquedont les origines remontent au Ier s. av. J.-C.(amphores Dr. I), avec une occupation qui se poursuitau-delà de la période augustéenne (sigillée italique)
au moins durant le Haut-Empire (céramiques com-munes et sigillées sud-gauloises) (Vidal 1991,189).
En dehors de la nécropole mérovingienne deRivel connue depuis les années cinquante(Labrousse 1957, 258-259), une seconde était signa-lée anciennement au lieu-dit Montfrousi (fig. 7), prèset au-dessus du cimetière actuel (Barrière-Flavy1891, 533-538). Trente à quarante sépultures y ontété mises au jour, à côté d'un mobilier funéraire res-treint - plaque-boucle en bronze, ferrets, plaque-boucle et couteau en fer « d'origine méridionale » etdont certains pouvaient être d'influence wisigo-thique (?) (Barrière-Flavy 1901-1903,52-54).
24Sous la direction de S. Duchesne et É. Crubezy (Vidal M.)
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 7 : Venerque. Situation de la nécropole et des sites antiques, du haut Moyen Age et médiévaux
(M. Vidal).
I. 2.2. La nécropole
La localisation de la nécropole à 30 km de Toulousen'est pas en rapport avec la présence supposée d'unposte frontière avec la Septimanie wisigothique(Barrière-Flavy 1892, 31-32), cette dernière devantêtre reportée plus à l'est (Rouche 1979, 139, 145). Plu-sieurs campagnes de recherches étalées sur huit
années 8, ont permis la découverte et la fouille de128 sépultures 9 établies sur une surface de 1600 m2
(fig. 8) alors même que son emprise maximum estestimée, sur la base de sondages entrepris à plus de100 mètres à l'ouest à 12 000 m2 (300 m de L., 30/40m de l.) correspondant à plus d'un millier de sépul-tures si la densité et la répartition des tombes restentidentiques. Son implantation tout au long d'un
25 Présentation des sites(Vidal M.)
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 8 : Nécropole de Rivel à Venerque, plan de répartition des sépultures (M. Vidal).
dévers naturel dont le soubassement est constituéde molasse facilement exploitable, est limitée aunord par un affleurement de graviers et au sud parune formation compacte de sable. Cette dispositionintentionnelle la situe tout en longueur selon un axeest/ouest qui a pu être utilisé comme un axe derepère constant.
La disposition générale des sépultures paraît apriori relativement anarchique, mais des aligne-ments de tombes se distinguent quand même,autant dans le sens est/ouest que dans celuinord/sud, avec des espaces de 30 à 40 m2 qui sontlaissés vierges de toute autre implantation, observa-tions similaires reconnues dans d’autres nécropoles(Périn 1980, 360-361 ; Young 1984, 10, 15 et 45 ; Scu-
vée 1973, 68). De part et d'autre de ces alignements,dont le système d’organisation spatiale culturelle etchronologique ne doit rien au terme de nécropoles« en rangées » (Colardelle 1996, 309), se discernentdes concentrations plus ou moins denses avec desparamètres d'orientation fluctuants.
Bien peu de tombes sont orientées précisé-ment est/ouest (une dizaine tout au plus) ce quipermet d'observer, sur la base d'un axe virtuel prissur l'alignement de la tombe 44, sous tuiles (fig. 9),que plus l'éloignement par rapport à cet axe estimportant, plus le décalage vers l'est-sud-est (77tombes), voire vers le sud-est (30 tombes) s'amplifieavec des « aberrations » vers le sud-sud-est. Cesvariations d'amplitude qui ont fait l'objet de mul-
26Sous la direction de S. Duchesne et É. Crubezy (Vidal M.)
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
(7) Renseignements pris auprès de la « Cellule Carte Archéologique » du Service régional de l'archéologie (L. Sévègnes).(8) Responsable du chantier J.-P. Magnol, à l’époque professeur à l'École Nationale Vétérinaire de Toulouse, puis M. Vidal.(9) Dont des inhumations doubles, des dépôts annexes et des réductions, ce qui revient à 144 individus.
Figure 9 : Tombe 44, sous tuiles (B. Marty).
tiples interprétations 10, sont peut être dépendantes,pour la nécropole de Rivel, d'un fort relief qui àmoins de trois cent mètres limite l'horizon versl'ouest-sud-ouest.
On pourrait en outre penser que la prise encompte de l’orientation des sépultures selon les troisprincipaux groupes que l’on a pu définir, est en rap-port avec des phases d’utilisation distinctes de lanécropole. En fait, rien n’est moins sûr puisque, s’ily a bien une typochronologie à appliquer, cette der-nière n’est certainement pas dépendante d’undéplacement différencié dans le temps des secteursd’inhumation, deux des trois « ensembles » étantconcernés par les mêmes indices chronologiques.
Les fosses, creusées avec soin dans la molasse,présentent des parois verticales aux angles arrondisavec un fond plat ascendant vers l'est, et des formesrectangulaires (60 %), ovalaires (28 %) ou encore tra-pézoïdales (4 %) 11. Les dimensions sont générale-ment en rapport avec la taille de l'inhumé, entre1,50/2,10 m de long pour des largeurs comprisesentre 0,50 m et 0,65 m, mais avec quelques excep-tions (2,50 m/2,80 m de long et 0,95 m de large). Enrevanche, les profondeurs sont extrêmementvariables : elles évoluent entre 0,30 m et 1,10 m 12,sans qu'on puisse établir de critères avec les caracté-ristiques anthropologiques (hommes/femmes)(fig. 10) ou le statut social (présence ou absence demobilier) (Vidal 1991, 189) (fig. 8). Le comblementdes fosses, homogène, est composé d'un agglomératde terre végétale et de molasse issu du creusement,au travers duquel ne se distingue aucun élémentexogène.
L'acidité du terrain n'est pas sans consé-quences sur la nature des observations qu'il nous aété possible d’effectuer notamment sur le mode desinhumations. S'agit-il en effet de sépultures enatmosphère libre ou en pleine terre ? La questionreste posée et il n'est pas interdit de penser que lamise en parallèle des données de fouilles et cellesmalheureusement absentes des données anthropo-logiques faites in situ, aurait permis d'affiner laréflexion. Toujours est-il qu’a posteriori, sur la basede documents photographiques, bon nombre d'in-
humations paraissent avoir été en atmosphère libre(basculement des crânes, inversion des os longs,déplacements des avant-bras) (Crubézy 1986, 5 ;Colardelle 1996, 291). Sur les 128 sépultures déga-gées, cinq sont en cercueil cloué et sans doute mor-taisé ou en coffre (T.70, 83, 84, 95 ?, 106) et huit peut-être en brancard ? (T. 66, 82, 86, 91, 96 ?, 103, 112,116). Mais ne s'agirait-il pas des seuls indices subsis-tant d'un cercueil, si on tient compte de la topogra-phie des concentrations cercueils/brancards ? et deleur conservation différentielle (Henrion, Hunot1996, 200-203). La présence dans le même groupe, detrois sépultures (T. 94, 97, 99) qui comportaient «à latête» et dans l'axe de la fosse, un clou vertical poseun problème d'interprétation (fermeture de latombe par un couvercle en bois ?).
Un aménagement intérieur est perceptibledans la tombe 35, où le crâne du squelette repose surune banquette surélevée (Gaillard de Semainville1980, 160-161 ; Young 1984, 153), alors que les fossesdes tombes 14, 37 et 69 ont un profil sinueux en rap-port avec la position fléchie des membres inférieursdes inhumés. Ceci n'est pas d'ailleurs systématiquepuisque deux inhumations de même nature se trou-vent dans des fosses rectangulaires (T. 9 et 19).
Une seule sépulture (T. 44) (fig. 9) parfaite-ment orientée est-ouest est en coffre en bâtière (tegu-lae et imbrices) et se signale par un positionnementisolé des autres tombes en fosse. Sur ce type, les élé-ments de comparaisons régionaux manquent. Toutau plus nous pourrions, à titre d'exemple, regrouperles chronologies autour des V/VIIe siècles sur labase de la typologie de la basse vallée du Rhône(Gagnière 1960, 43-46 ; Gagnière, Granier 1982, 381-397), que P.-A. Février conteste (apparition dès leIIe s.) et que M. Colardelle situe chronologiquementaprès les coffres à section rectangulaire (Colardelle1983, 346). Des points de références peuvent encoreêtre trouvés dans les nécropoles de Pignan (Var) auV/VIe s. (Goudineau 1979, 560-561), et du Verdier àLunel-Viel (Hérault) dans un contexte du milieu duIVe s. (Raynaud 1988, 174), alors que B. Young et P.Périn situent leur base référentielle d'utilisationdans le Ve/VIe s. (Young, Périn 1991, 104). Plusrécemment, M. Colardelle sur la base de nouvelles
27 Présentation des sites(Vidal M.)
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
(10) Young 1977, 16-24 ; Van Doorselaer 1967, 129 et ss. ; Périn 1980, 114-115 ; Gaillard de Semainville 1980, 157 ; Colardelle1983, 362 et ss.(11) Forme peu courante, mais qui est signalée à Soyria (Pétrequin et al 1980, 171 ; Prampart 1983, 352).(12) Profondeurs prises à partir du sol d'utilisation de la nécropole, auquel il convient d'ajouter 0,15/0,35 m de terre végétale.
découvertes et d’analyses remarque qu’il s’agit deséries nombreuses qui appartiennent aux IV-VIIe s.(Colardelle 1996, 285). Le débat sur la typochronolo-gie de ce type de sépulture reste donc ouvert.
Comme cela est évoqué plus haut, l'examenprécis des attitudes funéraires (fig. 11) n'a pas ici étécontrôlé par un anthropologue et si le schéma despositions des corps peut paraître instructif, il n'en
28Sous la direction de S. Duchesne et É. Crubezy (Vidal M.)
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 10 : Nécropole de Rivel, répartition des hommes, femmes et enfants (M. Vidal, d’après Th. Romon).
demeure pas moins qu'il est sans doute inexact(Vidal 1991, 194). En effet, si la position, bras le longdu corps/jambes serrées représente 32 % de l'en-semble et celle bras pliés sur le pubis environ 10 %,
les positions intermédiaires - bras gauche ou droitallongés et bras gauche ou droit pliés sur le pubis -paraissent relativement douteuses et provoquéespar des phénomènes de décomposition. Par contre
29 Présentation des sites(Vidal M.)
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 11 : Nécropole de Rivel, plan de répartition des attitudes funéraires (M. Vidal).
le positionnement particulier des membres supé-rieurs pliés sur l'abdomen (2 %), a toutes chances decorrespondre à la réalité, compte tenu de la présencesystématique de mobilier. Tout ceci s'intègre doncdans les attitudes funéraires mérovingiennes déjàrépertoriées dans le nord et l'est de la Gaule (Young1977, 24-27 ; 1984, 150-153), de même que la positionsur le ventre de l’inhumé de la tombe T. 118 13.
I. 2.3. Le mobilier
Le mobilier funéraire qui confirme la présence d'in-humations habillées, n'est pas abondant si on se réfèreexclusivement à celui signalé in situ. En effet, sur 128sépultures, 23 seulement comportaient des piècesd'habillement, soit 17 % de l'ensemble (fig. 8). Si on yajoute la vingtaine d'éléments dispersés récupérés ensurface (plaques-boucles, contre-plaques, boucles,ardillons scutiformes,...) et que l'on admet qu'ils repré-sentent pour chacun d'entre eux une inhumationhabillée, la proportion atteint un peu plus de 33 %, cequi est sans doute plus proche de la réalité d’origine.
L'emplacement de ces objets est traditionnel :boucles et plaques-boucles au niveau de la ceinture,agrafes à double-crochets contre les temporaux ousous le maxillaire inférieur dans l'axe vertébral, sup-port d'aumônière à la partie droite du bassin, cou-teaux en baudrier... Plus rarement, quelques plaques-boucles ont été trouvées sur le crâne du défunt (T. 50)ou à ses pieds (T. 65, mais ici il s'agit d'une réutilisa-tion). Si on peut considérer, sur la seule base del'étude anthropologique, qu'il peut y avoir relation decause à effet entre la présence de mobilier et la natureféminine du défunt (Vidal 1991, 195 et 198), il n'estpas possible par contre d'y associer la position desmembres supérieurs, compte tenu de la faible pro-portion des squelettes étudiables.
S'agissant d'une présentation du site, il n'estpas dans nos objectifs d'étudier dans le détail cemobilier analysé déjà en grande partie (Vidal 1991,195-196). Tout au plus, pour valider la chronotypo-logie de cette nécropole, il convient de préciser cer-taines références. Pour les sépultures in situ :
30Sous la direction de S. Duchesne et É. Crubezy (Vidal M.)
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 12 : Nécropole de Rivel, mobilier de la tombe 2 (P. Venzac).
(13) Laumon 1977, 56 (fig. 3) et 59 ; Gaillard de Semainville 1980, 163 ; Piton 1985, 13 ; Mercier, Mercier-Rolland 1974, 45 ;Privati 1983, 29.
T. 2 : boucle moulée en léger incurvé à ardillon plat, étroitet chanfreiné ; agrafe plate à double-crochets en bronze, àbordure festonnée, à décor de cercles pointés et partie dechaînette. D’après P. Périn, ces agrafes apparaissent dans lecours du VIIe s. (Périn 1985, 156) ; perle bitronconique enpâte de verre orangée, datée dans le VIe s. (Périn 1985,496) ; bague en bas-argent à chaton rectangulaire inscrit età décor gravé avec des parallèles en Gaule du Nord (Young1984, 236). La datation d’ensemble s’inscrit dans le VIIe s.(fig. 12).
T. 9 : couteau en fer, à dos plat et incurvé (fig. 13).
T. 11 : plaque-boucle rectangulaire en bronze, ajourée d’unhippogriffe avec des motifs de cercles pointés gravés. Laboucle plus massive est godronnée et l’ardillon scutiformeest décoré de cercles pointés en rayons. D’un modèle peucourant dans le Sud-Ouest et sans doute d’inspiration Bur-gonde (Gaillard de Semainville 1980, 89), ce type est géné-ralement daté dans la seconde moitié du VIe/ début VIIe s.(Gaillard de Semainville, Vallet 1979, 67 et 72). Plus récem-ment, F. Stutz a inclus cette plaque à l’hippogriffe et au can-thare dans la deuxième moitié du VIe/première moitié duVIIe s. (Stutz 1998, 153 ; 2000, 40-41) (fig. 14).
31 Présentation des sites(Vidal M.)
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 13 : Nécropole de Rivel, mobilier de la tombe 9 (P. Venzac).
Figure 14 : Nécropole de Rivel, mobilier de la tombe 11 (P. Venzac).
T. 16 : plaque-boucle en bronze aux contours polylobés,terminés par deux excroissances et à sept rivets à basehachurée. Le décor se compose de deux médaillons à cerclesconcentriques ornés d'émail à incrustations de fils d'argenten arceau de même que l'ardillon scutiforme et le dessus dela boucle. Cette dernière est ornée en alternance de zoneshachurées en léger relief et de cercles pointés. Cette plaque(fig.15), typiquement aquitaine type D d’E. James = F.3 de S.Lerenter (James 1977, 148-149 ; Lerenter 1991, 231) estdatée de la fin VIe/ début VIIe s. (Boudartchouk 2000, 55 et57) et dans le VIIe (Stutz 2000,45).
T. 20 : agrafe à double-crochets en bronze formée d’unenroulement de lamelle sur une tigelle de section circulaire– dat. VIIe s. (fig. 16).
T. 24 : plaque-boucle à dix bossettes en bronze étamé. Ledécor typiquement aquitain est composé de quatre pan-neaux décoratifs : monstre bicéphale regardant en arrière,surmontant un encadrement rectangulaire dans lequel estinscrit un entrelacs à brins multiples avec, de part etd’autre, un serpent. Entre les deux têtes de rivets supé-rieures, se distingue un motif complexe et symétrique d’ins-piration serpentiforme. La boucle très peu épaisse est déco-rée dans le même style d’une composition indistincte alorsque le bouclier de l’ardillon comporte quatre ensemblessemi-circulaires enchevêtrés et alternés formant un nœudde Salomon.Rare dans le Sud-Ouest où elle n'est signalée que dans leGers, elle fait partie d'une production étrangère à larégion, ceci malgré un décor adapté au style aquitain ce qui
32Sous la direction de S. Duchesne et É. Crubezy (Vidal M.)
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 15 : Nécropole de Rivel, mobilier de la tombe 16 (P. Venzac).
Figure 16 : Nécropole de Rivel, mobilier de la tombe 20 (P. Venzac).
fait suggérer qu’il existe deux types de production (Stutz2000, 45). Groupe IVA d'E. James = type D21 de S. Lerenter,elle est datée de la fin du VIIe/début VIIIe s.(Vidal 1991, 198 ;Lerenter 1991, 230). Si cette plaque parait dater la phase laplus tardive de l'exploitation du site, la sépulture s'inscritpar contre dans un contexte du VIIe s., plus près des datesproposées par P. Périn, M. Colardelle et plus récemment en2000 par F. Stutz (seconde moitié du VIIe s.) (fig.17).
T. 25 : plaque-boucle et contre-plaque en fer à trois bos-settes et à décor bichrome damasquiné : lignes de bordureet tresse axiale en argent, hachures en cuivre. La boucle estornée d’un large filet d’argent, alors que le bouclier plus oumoins circulaire de l’ardillon, comporte un décor géomé-trique-hexagone et triples lignes tracées en croix en argent,
dans les quadrants desquels se distinguent des groupe-ments de ponctuation en cuivre. Cette plaque-boucle enforme de langue est datée de la première moitié du VIIe s.(Vidal 1991, 195 ; Stutz 1998, 153) et dans le VIIe (Stutz 2000,42) (fig. 18).
T. 38 : plaque-boucle rigide, ajourée et incomplète. Il s’agitd’un type septentrional qui est daté du VIe s. (Stutz 1998,142), dans sa dernière moitié (Stutz 2000, 40), voire de la finVIe/début VIIe s. (Cat. Expo. Poitiers 1989-1990, 218) (fig. 19)et que l’on retrouve entre autre dans la région de la Côtechalonnaise et mâconnaise (Gaillard de Semainville 1980,104=fig 16).
T. 40 : boucle en fer à ardillon droit (fig. 20).
33 Présentation des sites(Vidal M.)
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 17 : Nécropole de Rivel, mobilier de la tombe 24 (P. Venzac).
T. 45 : boucles en fer, dont une à ardillon droit (fig. 21).
T. 48 : boucle massive en bronze à ardillon scutiforme, dontla morphologie permet de l’inclure dans le VIe s. (Périn etalii 1985, 363).
Entre la T. 49 et la T. 50 : un dépôt intentionnel de deuxvases (fig. 22) a été mis au jour « à la tête » des deux sépul-tures et ceci sans que l’on puisse l’attribuer à l’une ou àl’autre. Il semble bien, d’après les observations, qu’il
s’agisse d’un dépôt hors fosses dans un contexte dont la T.50 est le meilleur marqueur (cf. infra, seconde moitiéVIe/début VIIe s). L’urne ovoïde tournée à fond concave et àlarge ouverture comporte une lèvre en déjeté extérieuravec un rétrécissement plat intérieur. Elle présente unepâte de couleur rosâtre, à dégraissant apparent, peu densemais grossier de particules de quartz, l’ensemble étantrecouvert par un engobe beaucoup plus pâle. Les compa-raisons régionales manquent mais notre exemplaire pré-sente certaines affinités morphologiques (fond et lèvre)
(Vidal M.)
avec une céramique provenant de la nécropole de Frénou-ville (Basse-Normandie), datée dans la fin du VIIe s. (Pilet1980, 143 et 255, pl.137). La coupe de couleur de pâte beigerosée « dure », recouverte d’un engobe à tendance blan-châtre est non tournée, avec un dégraissant apparent et
quelque peu grossier. Fortement évasée, elle comporte unelèvre pendante en bourrelet intérieur et une large rainureextérieure. Il n’y a pas, semble-t-il, d’exemples régionauxde la forme. Par contre, certaines analogies dans sa mor-phologie permettraient de la considérer comme un paral-
34Sous la direction de S. Duchesne et É. Crubezy
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 18 : Nécropole de Rivel, mobilier de la tombe 25 (P. Venzac).
Figure 19 : Nécropole de Rivel,
mobilier de la tombe 38 (P. Venzac).
Figure 20 : Nécropole de Rivel,
mobilier de la tombe 40 (P. Venzac).
(Vidal M.) 35 Présentation des sites
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 21 : Nécropole de Rivel, mobilier de la tombe 45 (P. Venzac).
Figure 22 : Nécropole de Rivel, dépôt céramique entre les tombes 49 et 50 (M. Vidal).
lèle aux formes signalées à Nîmes (Gard) et en Provenceoccidentale dans la première moitié du VIe s. (Raynaud1990, 239 ; 1993, 457 ; Meffre, Raynaud 1993, 496). Ledépôt s’est donc constitué dans le VIIe s.
T. 50 : plaque-boucle en bronze étamé à trois cabochons. Ledécor de type aquitain est simplifié à l’extrême et se com-pose d’un nœud de Salomon à entrelacs d’échelles encadrépar des doubles lignes de bordure. L’ardillon est en fer et laboucle de format réduit par rapport à la plaque n’est sansdoute pas d’origine. En dehors de ce critère qui marque desphénomènes de réutilisation/récupération, la nature dudécor qui est loin de présenter toutes les caractéristiquesd’une production aquitaine, justifie les remarques de F.Stutz lorsqu’elle évoque des tentatives locales d’imitations(Stutz 2000, 43). Type ID d'E. James, elle est datée de laseconde moitié du VIe/début VIIe s. (Vidal 1991, 195 et 199)(fig. 23) et dans le VIIe s. (Stutz 2000, 44).
T. 53 : plaque-boucle sensiblement rectangulaire, en ferdamasquiné et à cinq cabochons (fig. 24) Le décor mono-chrome se compose d'une suite de cercles sécants à échellesdont on peut trouver des équivalents sur une plaque en
bronze à dix bossettes de la collection Febvre à St Germain-en-Laye (Gaillard de Semainville, Vallet 1979, 60-61). Trèsfortement altéré, ce type de plaque est daté dans le VIIe s(Stutz 2000, 42) mais également dans sa première moitié(Stutz 1998, 153).
T. 54 : plaque-boucle en bronze (incomplète) à cinq bos-settes et à décor de motifs serpentiformes en échelle, avecune boucle de faible épaisseur et un ardillon à large bou-clier, à motif de monstres affrontés de part et d’autre dusupport de l’ardillon ; extrémité d’une plaque-boucle enbronze à dix bossettes (quatre sont conservés) ; supportd’aumonière en fer (fig. 25) avec sa boucle de fermeture enbronze (ardillon en fer) ; couteau en fer à soie plate dont ledos et le tranchant de la lame sont en incurvation ; contre-plaque semi-circulaire et clou en fer. L’état fortement altéréde la plaque-boucle en bronze empêche de préciser aveccertitude le type auquel elle appartient. Peut-être s’agit-ildu type B 21 (première moitié du VIIe) ou C 8 de S. Lerenter(1991, 228-229), ce qui s’accorderait dans une certainemesure à la chronologie, dans le VIIe s., du fragment cisailléde plaque-boucle à dix bossettes (Stutz 2000, 45). Leur asso-ciation avec la contre-plaque sans décor, de la seconde moi-
36Sous la direction de S. Duchesne et É. Crubezy (Vidal M.)
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 23 : Nécropole de Rivel, mobilier de la tombe 50 (P. Venzac).
tié du VIe s. (Stutz 2000, 40), provient sans doute d’uneréutilisation/récupération, bien que ce type perdure dans leVIIe s. (Stutz 1998, 152).
T. 55 : plaque-boucle ronde à trois bossettes en bronzeétamé et à décor aquitain de deux monstres affrontés. Laboucle peu épaisse comporte un ardillon à large bouclierdécoré d’arceaux plus ou moins sécants inclus, comme laplaque, dans des espaces pointillés. Il s’agit d’un type deplaque aquitaine groupe III E. James = type E de S. Lerenter,datée dans la seconde moitié du VIe s. (Stutz 1998, 152 ;2000, 40) et fin VIe/début VIIe s. (Vidal 1991, 196 et 199 ;Lerenter 1991, 230 ; Boudartchouk 2000, 50 et 70) (fig. 26).
T. 58 : boucle en fer à ardillon droit.
T. 60 : plaque-boucle rigide rectangulaire à double excrois-sances bilatérales avec, dans l’axe longitudinal, une termi-naison en arrondi terminée par un plat encoché. Le décorest ajouré – croisillon à double évidement, complété pardes cercles pointés reliés par un ou deux filets (fig. 27). Un
exemplaire identique a été trouvé en surface (fig. 33).D’après F.Stutz, il s’agit de plaques datées dans la deuxièmemoitié du VIe s. (Stutz 1998, 142 ; 2000, 40).
T. 62 : plaque-boucle en bronze étamé à cinq bossettes etaux contours polylobés terminés par deux crochets distauxrecourbés (fig. 28). La partie centrale de la plaque com-porte un tronc de pyramide en relief à base rectangulaireorné de deux cercles pointés sécants et de part et d’autreduquel deux motifs en croisillons de cercles pointés sontréunis par une triple rainure. Un double filet suit la borduresinueuse de la plaque. La boucle ovale est décorée parzones alternées de plages striées et inornées, alors que l’ar-dillon à large bouclier comporte deux cercles pointés oppo-sés réunis par un triple rainurage. Le décor ne semble passpécifiquement aquitain bien que des reproductions de laforme se situent en dehors de la vallée de la Garonne, entreLoire et Somme (Ajot 1985, 50) et que le décor puisse s’ap-parenter à celui d’une plaque rigide trilobée provenant deSallèles-d’Aude (Stutz 2000, 151). Type A2 de S. Lerenterqu'elle date d'après Cl. Lorren de la fin VIIe/ou début VIIIe s.
37 Présentation des sites(Vidal M.)
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 24 : Nécropole de Rivel, mobilier de la tombe 53 (J.-P. Muiguet).
(Lerenter 1991, 227), elle se situe dans la nécropole de Riveldans un contexte plus ancien de la fin du VIe/seconde moi-tié du VIIe s. Des plaques en tout point identiques sontsignalées à Bruch dans le Lot-et-Garonne et à Lourdes dansles Hautes-Pyrénées (Coupry 1965, 433 ; Boudartchouk1992, 41-42), ce qui pourrait confirmer un point de produc-tion aquitain, bien que la morphologie puisse être d’origineseptentrionale (Lerenter 1991, 231 ; Ajot 1985, 50) (fig. 23)et à rapprocher des plaques à bords festonnés du VIIe s.(Stutz 2000, 45). Une plaque triangulaire trilobée trouvéedans le Var comporte, outre un tronc de pyramide en relief,un même type de décor fait de cercles pointés reliés entreeux (Boyer 1972, 150-151).
T. 65 : plaque-boucle rectangulaire en fer (incomplète), àdécor damasquiné et à cabochons de bronze (deux conser-vés). Il s’agit d'une suite d'échelles et de motifs dentelés etréticulés encadrant une imitation de vannerie. La morpho-logie et le traitement du décor permettraient de la daterdans le VIIe s. et peut-être dans sa seconde moitié si on suitla chronologie de la tombe 50 de la nécropole de Curtil enSaône-et-Loire (Ajot 1985, 70 ; Vidal 1991, 196 ; Stutz 2000,42) (fig. 29).
T. 89 : boucle d’oreille en bronze très rudimentaire et à sec-tion ronde.
T. 125 : plaque-boucle en bronze aux contours polylobés,terminés par deux crochets distaux recourbés (fig. 30). Ledécor se compose comme pour la plaque de la sépulture 16,d’une suite de deux médaillons circulaires tangents, à décoralterné d'émail à incrustations de fils d'argent en arceauxet de dépressions régulières de format réduit, enserrant unpetit motif en nœud de Salomon. La boucle à méplat et l'ar-dillon à bouclier sont décorés de façon identique d’émail enchamplevé. Sur les sept rivets, trois sont à figurationhumaine ce qui est un motif relativement rare (Boube 1956,16 ; Monod, Rancoule 1969, 171-172 ; …). Type D d'E.James/F3 de S. Lerenter, sa datation s’inscrit dans la fin duVIe/début VIIe s. (Lerenter 1991, 231). En tout état de cause,la présence dans cette nécropole de deux plaques-bouclestypologiquement identiques et d'une troisième provenantde Revel (Haute-Garonne) (Barrière-Flavy 1901, pl. XXV ;James 1977, 149), confirme l'existence d'un centre de pro-duction régional (James 1977, 147-148 ; Périn 1978, 197).
38Sous la direction de S. Duchesne et É. Crubezy (Vidal M.)
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 25 : Nécropole de Rivel, mobilier de la tombe 54 (J.-P. Muiguet).
(Vidal M.) 39 Présentation des sites
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 26 : Nécropole de Rivel, mobilier de la
tombe 55 (J.-P. Muiguet).
Figure 27 : Nécropole de Rivel, mobilier de la
tombe 60 (P. Venzac).
Figure 28 : Nécropole de Rivel, mobilier de la tombe 62 (P. Venzac).
(Vidal M.)
plaque-boucle en bronze à neuf bossettes ornée detrois panneaux rectangulaires à décors d’entrelacs encadréspar d’autres panneaux plus étroits à entrelacs resserrés,l’ensemble étant complété par l’adjonction systématiquede ponctuations. La boucle est peu épaisse sans ornemen-tation, alors que l’ardillon scutiforme comporte lui aussi unentrelacs à plages réservées à ponctuations. Type IC d’E.James/B24 de S. Lerenter, cette catégorie de plaques estdatée de la fin du VIIe/début VIIIe s. (Lerenter 1991, 228),mais un exemplaire associé à une fibule pontée est signaléà Beaucaire-sur-Baïse (Gers) dans un contexte de la secondemoitié du VIIe s. (Larrieu et alii 1985, 72-73) (fig. 31). Cettedernière chronologie étant d’ailleurs la plus logique, sur-tout si on se réfère aux études récentes qui l’intègre plutôtdans le VIIe s. (Boudartchouk 2000, 56).
quatre ardillons scutiformes à décor d’entrelacs, d’essesou d’arceaux en bronze étamé, à plages ponctuées et dontun exemplaire est orné d’une figuration humaine. Ce typed’ardillon est commun au VIIe s. (Périn 1985, 166 ; Boudart-chouk 2000, 60) (fig. 31).
une boucle et un ardillon scutiforme de type massif,caractéristiques du VIe s. (Périn 1985, 467-469 ; Stutz 1998,140 ; Boudartchouk 2000, 60) (fig. 32).
un rivet scutiforme, étamé et à bords dentelés, daté luiaussi dans le VIe s. (Périn 1985, 470) (fig. 32).
plaque-boucle à compartiments creux décorés d’ali-gnements de cercles pointés et de petits points percutés enparallèle des dépressions. Un exemplaire sensiblementidentique dans son esprit décoratif se retrouve à Beaucaire-sur-Baïse au VIIe s. (Larrieu et al. 1985, 90-91, 141), maisdans une sépulture où l’association avec d’autres types demobilier pourrait permettre de la dater plutôt dans la findu VIe s./début VIIe s. On peut retrouver quelques analogiesavec les plaques-boucles rectangulaires festonnées que F.Stutz classe dans le VIIe s. (Stutz 2000, 43, 45) (fig. 32).
contre-plaque trilobée à trois rivets débordants sansdécor et à bords biseautés, dont la morphologie se retrouvedans plusieurs régions (Gaillard de Semainville 1980, 99,101), dont notamment dans l’Ariège (Boudartchouk 2000,66) dans la première moitié du VIIe s. (fig. 32).
plaque-boucle dont les trois éléments ont été trouvésdispersés. La plaque trilobée est décorée d’une représenta-tion schématique (personnage ?) formée d’une suite decercles pointés sécants et tangents. La boucle et l’ardillonscutiforme sont ornés de la même façon de cercles pointés
40Sous la direction de S. Duchesne et É. Crubezy
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 29 : Nécropole de Rivel, mobilier de la tombe 65 (J.-P. Muiguet).
À côté de ces pièces d’habillement retrouvées in situ, l’importance numérique des objets de parure récupé-rées en surface ou dans les terres perturbées par les charruages, nous conduit à un rapide inventaire :
41 Présentation des sites
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 30 : Nécropole de Rivel, mobilier de la tombe 125 (D. Schaad).
(Vidal M.)42Sous la direction de S. Duchesne et É. Crubezy
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 31 : Nécropole de Rivel, mobilier trouvé en surface (P. Venzac).
(Vidal M.) 43 Présentation des sites
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 32 : Nécropole de Rivel, mobilier trouvé en surface (P. Venzac).
(Vidal M.)44Sous la direction de S. Duchesne et É. Crubezy
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 33 : Nécropole de Rivel, mobilier trouvé en surface (P. Venzac).
(Vidal M.) 45 Présentation des sites
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 34 : Nécropole de Rivel, mobilier trouvé en surface (P. Venzac).
(alignement et tracé quadrangulaire). Ce type de plaquepeut être daté de la fin VIe s./début VIIe s. (Stutz 1998, 151-152), mais aussi dans la deuxième moitié du VIIe s. (Bou-dartchouk 2000, 66-67) (fig. 32).
plaques-boucles semi-circulaires à trois bossettes dontles décors ne paraissent pas spécifiquement aquitains : motifréticulé, grecques, dentelés et spiralés, gravés pour l’une etmotif complexe moulé de type géométrique pour l’autre. Ils’agit de plaques de la fin du VIe s./début VIIe s. dont l’originede production paraît se situer entre la région parisienne et laManche (Périn 1985, 473) mais aussi dans la deuxième moitiéVIe et VIIe s. (Gaillard de Semainville 1980, 85 ; Stutz 1998,152 ; 2000, 40 ; Boudartchouk 2000, 50) (fig. 33).
plaque-boucle triangulaire à trois bossettes et àdoubles excroissances latérales, à compartiments émailléset à inclusions de fils d’argent à motifs d’arceaux. Du typeH 12 de S. Lerenter, cette catégorie de plaque s’inscrit à par-
tir d’exemplaires sensiblement similaires dans le début duVIIe s. (Larrieu et alii 1985, 62, 67-68), dans le VIIe s. (Stutz2000, 45) et dans la fin du VIe/début VIIe s.(Boudartchouk2000, 70) (fig. 33)
plaque-boucle rigide à décor ajouré et à excroissanceslatérales et terminales. Des cercles pointés suivent lesespaces réservés. Un exemplaire identique provient de latombe 60, qui est datée dans la seconde moitié du VIe s.(Stutz 2000, 40) (fig. 33).
boucles ovales en bronze et en fer, anneau, boucletterectangulaire commune dans le VIe s. (Périn 1985, 369) ;ardillon, rivet, complètent ce rapide inventaire (fig. 34).Parmi ces dernières pièces, sont à relever la présence d’unecontre-plaque à bords festonnés du VIIe s. (Stutz 2000, 43)et l’extrémité d’une plaque à trois bossettes à décor de typeaquitain, argenté, formé d’un tracé longitudinal séparantdeux séries d’arceaux opposés… (fig. 34).
46Sous la direction de S. Duchesne et É. Crubezy (Vidal M.)
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
I. 2.4. Datation et commentaires
Sur la seule base du mobilier funéraire trouvé in situ,mais aussi avec la présence de céramiques tardives,la période d'utilisation de cette nécropole rurale doitpouvoir se situer à partir de la deuxième moitié duVIe, jusqu'à la fin du VIIe s., si on adopte une chro-nologie « basse » conséquence de la topochronolo-gie des sépultures ; dans la deuxième moitié VIe, finVIIe/début VIIIe s., si on s'appuie sur les donnéeschronologiques fournies par les plaques-boucles destombes 24 et 62. Même si cela peut paraître acquis àpartir des travaux récents, des chercheurs comme P.Périn, E. James, S. Lerenter et F. Stutz, il n'a échappéà personne que ce mobilier caractéristique de la val-lée de la Garonne et de ses marges a été longtempsconsidéré comme wisigothique, ceci à partir despublications que Cl. Barrière-Flavy a consacré àl'étude des sépultures barbares du Midi. (Barrière-Flavy 1892 et 1901).
L'étude stylistique et morphologique dumobilier suggère des identités de conception quiidentifient des productions typiquement aquitaines(plaques en bronze étamé, décor gravé à zonesréservées de pointillés, plaques moulées à décord'émail à inclusions, ...), mais aussi des productions« étrangères » (plaque à l'hippogriffe d'inspirationburgonde) et plaques-boucles semi-circulaires àdécor « non aquitain », plaques-boucles à dix bos-settes, dont la morphologie est exogène, mais dontle décor est aquitain, plaques-boucles dont des équi-valents se situent plutôt en Gaule septentrionale (enfer damasquiné, en bronze à trois bossettes et à
décor oculé, ...). Cela justifie de façon convaincantece qu'avait déjà perçu P. Périn lorsqu'il considéraitque le « phénomène » Aquitain était sans doute pluscomplexe et ne se limitait pas à une simple unité destyle (Périn 1978, 193-204). Même si un tiers seule-ment de cette nécropole a pu être fouillé, il n'endemeure pas moins que les résultats acquis restentexceptionnels et s'insèrent dans une réflexion réso-lument novatrice depuis les recherches effectuéespar Cl. Barrière-Flavy en 1891 et l'étude argumentéed'E. James sur le Sud-Ouest de la Gaule. Restera àinclure dans ce contexte chronologiquement biencadré, bon nombre de découvertes dispersées (Vidal1991, 197, 199, n. 62 à 67), mais également d'y inté-grer les résultats exceptionnels recueillis lors de lafouille de la nécropole de type Franc de l'Isle-Jour-dain dans le Gers et des quelques sépultures “Aqui-taines” mises au jour à proximité (Duhamel, Cazes,Boudartchouk 1995, 150-172 ; 1998, 126-136).
Comme nous l'avons déjà précisé la nécropolede Rivel n'est pas la seule à avoir été signalée àVenerque puisqu'en 1891 avait été repérée à Mont-frousi (fig. 7) une première nécropole mérovin-gienne (cf. infra). Le détail de cette découverteancienne souffre d'imprécisions, mais nous savonsqu'elle couvrait une surface de 80 à 100 pas de côtéet qu'une quarantaine de squelettes y ont été mis aujour. Tous étaient orientés tête à l'ouest et il s'agissaitexclusivement « d'hommes forts et de grandetaille » (?). Le mobilier métallique recueilli (bronzeet fer) (fig. 35) était placé vers le haut et sur le côtédes jambes, alors que les inhumations « avecboucles de bronze, aussi bien que celles avec boucles
de fer, étaient disséminées au milieu des inhuma-tions dépourvues de restes analogues, ce qui montrebien que l'ensemble du cimetière date bien d'unemême époque » :
être contemporaine de celle distante de plus d'unkm de Rivel. Ceci peut poser problème dans lamesure où il s'agit de cimetières peu éloignés, utili-sés durant les mêmes périodes avec un même facièsaquitain et ceci pour une densité de 400 à 500tombes sur 6 000 m2 environ (?) de Rivel et 8 000 m2
environ (?) pour celle de Montfrousi. Le lien quipourrait exister entre eux n'est pas facile à percevoir.Est-il dépendant de la présence d'un lieu de culteantérieur à la création de la communauté carolin-gienne ? (cf. infra), ou leur implantation différenciéeest-elle la conséquence directe de la continuité d'oc-cupation de domaines gallo-romains distincts ? Enl'état actuel des connaissances, ce genre de relationest difficile à établir et ceci d'autant plus si on étendnotre réflexion à un champ plus large de larecherche, au-delà de Venerque, vers Issus (décou-verte d'un sarcophage paléochrétien) (Briesenick1964, 158 ; Baccrabère 1965, 34-39), ou vers Grépiac(Fanum gallo-romain de Rapoti) avec sans doute uneautre nécropole du haut Moyen Âge (Lequément1986, 315 ; Colin 1993, 87).
47 Présentation des sites(Vidal M.)
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 35 : Nécropole de Montfrousi, objets mérovingiens (M. Vidal, d’après Cl. Barrière-Flavy 1891).
plaque-boucle semi-circulaire en bronze, à trois bos-settes, à ardillon scutiforme et à décor aquitain de pan-neaux aux côtés incurvés et d'arcs de cercles à espaces ponc-tués - Dat : fin VIe/début VIIe s.
boucle massive en bronze à ardillon scutiforme - Dat :VIe s.
boucle en bronze à profil «mouvementé» - Dat : parcomparaison avec des plaques-boucles, fin VIe/premièremoitié du VIIe s.
petites plaques-boucles et contre-plaque en bronze àdécor d'entrelacs - Dat : VIIe s.
élément terminal en bronze de courroie et à décord'entrelacs.
plaque-boucle semi-circulaire en fer à trois bossettes.Dat - fin VIe s. ?
plaque-boucle rectangulaire en fer, avec une seule bos-sette subsistante. Dat : ?
fiche à bélière en fer et un couteau.
Chronologiquement, la nécropole de Mont-frousi a été en fonction dans le VIe et le VIIe s. avecpeut-être une perduration de son utilisation au-delàà l’époque médiévale (fig. 35, A) et se trouve donc
Dans un contexte qui doit tout encore à desdécouvertes et références anciennes pour la plupartpeu conformes aux normes de la recherche scienti-fique, la nécropole de Rivel apparaissait pourl’époque, en 1986, comme un des seuls élémentsrégionaux de référence sur cette période du hautMoyen Âge. S’il conviendra de valider unerecherche qui a pu paraître novatrice, la reprise parla réactualisation des études sur le mobilier du tou-lousain (Boudartchouk et Stutz 2000) et le dévelop-pement des problématiques de fouilles sur des sitesde référence régionaux comme Tabariane, Teilhetdans l’Ariège (Portet, Claeys 1999, 39-40 ; Portet1999, 37-39), ne pourra que bénéficier au développe-ment de programmes sur le haut Moyen Âge enMidi-Pyrénées.
I. 3. La nécropole de La Gravette, àl’Isle-Jourdain (Gers) (Duhamel Ch., Cazes J.-P., Barthélémy I.,
Ricaut F.-X.)
I. 3.1. Historique de la fouille
Une première campagne de fouille, menée de sep-tembre 1992 à août 1993, a permis d’obtenir la topo-graphie générale du site. Elle affirme les originesantiques, prouve que l’occupation se poursuit sansinterruption pendant le haut Moyen Âge et se ter-mine brutalement au XIIe siècle, après une périoderomane. De plus, deux nécropoles, l’une franque,l’autre médiévale, sont découvertes et fouillées.Face à l’ampleur des premières découvertes et à larichesse du site (plusieurs nécropoles, dont un cime-tière franc et un noyau ecclésial comportant plu-sieurs éléments), une seconde campagne de fouilles,centrée sur le noyau ecclésial, fut effectuée de jan-vier à mai 1994 (fig. 36).
I. 3.2. Les vestiges antérieurs
L’existence d’une agglomération routière sur la voied’Aquitaine est attestée par, d’une part la découverted’un tronçon de voie large de plus de 6 mètres, identi-fiée comme appartenant à l’axe Toulouse/Auch/Bor-deaux, et d’autre part, par les restes de bâtiments etde four de potier (zone 1). D’autres éléments, dontles plus anciens remontent au Ier siècle avant J.-C.,
mais appartenant en majorité au IVe siècle (tuiles,céramiques estampées) prouvent l’importance del’agglomération. En fonction des distances préciséespar « l’itinéraire de Bordeaux à Jérusalem14 », onpeut donc situer la mutatio BUCCONIS, relais routiercité dans la liste des étapes que fournit ce documentdu IVe siècle. C’est à cette période, IVe siècle, quesont construits dans la partie orientale, à 50 m ausud de la voie, le mausolée et l’enclos de pierre,comportant des tombes de l’Antiquité tardive. Plusà l’ouest, un complexe cultuel et funéraire atteste lachristianisation : l’église et le baptistère paléochré-tiens sont édifiés dans le courant du Ve siècle, ce quien fait un pôle de christianisation privilégié aprèscelui de Toulouse (fig. 37 et 38).
I. 3.3. Les nécropoles
Au sein de cette agglomération, différentes nécro-poles ont été individualisées, comportant au totalsemble-t-il près de 1500 inhumations. Toutes lessépultures n’ont pu être fouillées, du fait de leurnombre et des délais. En particulier, il est noté dansle rapport de fouilles de 1997, que de très nom-breuses sépultures d’immatures ont été détruitessans être relevées, en particulier dans le secteur 8(Cazes 1997, 65). Trois axes chronologiques (Anti-quité tardive, haut Moyen Âge et Moyen Âge), troislieux différents (noyau ecclésial, zone franque,franges de l’habitat) nous permettront de distinguerplusieurs nécropoles (fig. 39).
Dans l’Antiquité, l’utilisation funéraire du siteest prouvée, de façon indirecte par des fragments desarcophages présents à titre de matériau de comble-ment en divers lieux, et surtout de façon directe, parl’érection du mausolée édifié au sein de la zone 4, aucontact duquel une sépulture d’enfant a été implan-tée, par l’existence d’un enclos au sud du mausoléeet au sein duquel une sépulture a été retrouvée, etenfin par la présence d’un sarcophage situé sous lemur de l’église paléochrétienne. Sans parler denécropole antique, une utilisation funéraire a doncexisté.
Dans la zone 4, la nécropole franque (fig. 40)s’est établie autour et sur ces structures antiques.Elle a conservé et intégré à sa fonction le mausoléeet l’enclos, dont le rôle funéraire devait donc encore
48Sous la direction de S. Duchesne et É. Crubezy Duhamel Ch., Cazes J.-P., Barthélémy I., Ricaut F.-X.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
(14) Itinera Romana, Ed. O. Cuntz, t.1, Leipzig, 1929, 86-102.
Duhamel Ch., Cazes J.-P., Barthélémy I., Ricaut F.-X. 49 Présentation des sites
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 37 : Plan général du site antique et mérovingien (S. Eusèbe) (Cazes 1997).
1 : zone artisanale, 2 : tracé de la voie, 3 : bâtiments résiduels, 4 : église paléochrétienne, 5 : extension
du VIIe siècle, 6 : baptistère, 7 : mausolée et nécropole franque.
Figure 36 : Plan général du site de La Gravette à L’Isle-Jourdain, division par zones (Barthélémy 1999).
Duhamel Ch., Cazes J.-P., Barthélémy I., Ricaut F.-X.50Sous la direction de S. Duchesne et É. Crubezy
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 38 : Plan général des vestiges paléochrétiens (Cazes 1997).
Figure 39 : Plan de localisation des principaux ensembles funéraires (Barthélémy 1999).
être défini. Cette nécropole mesure 25 mètres nord-sud sur 35 mètres est-ouest. Elle est limitée au nordet à l’ouest par un fossé qui forme un angle droit, ausud par un fossé médiéval, et à l’est enfin, par unfossé du XIe siècle qui comporte certaines sépul-tures. Sur les 85 sépultures de la zone 4, treize sontdatées du haut Moyen Âge, mais n’appartenaientpas à la nécropole franque ; neuf sont des expan-sions de la nécropole médiévale de la zone 2 (XIe-XIIe). Cette nécropole est très homogène : les 63sépultures (41 adultes, 13 adolescents et 9 enfantslors de la fouille) sont orientées nord-ouest/sud-ouest et organisées en rangées de direction nord-sud, comptant de 3 à 7 tombes. Ces rangées sontréparties en 2 noyaux (un nord-est, un sud-est cen-tré sur la sépulture 261). Quarante six de ces sépul-tures recelaient du mobilier homogène daté du VIe
au VIIe siècle, correspondant à la culture franque(Boudartchouk 1995, 357-410). Cette richesse enmobilier funéraire est rare et permet de distinguerce site des autres ensembles mérovingiens du sud-ouest de la France. Par ailleurs, l’alignement destombes et l’abondance du dépôt funéraire, relevantde la culture du nord-est de la Gaule mérovingienne,différencient ces sépultures de celles du haut MoyenÂge et de l’époque carolingienne. La présence decette nécropole témoigne de l’expansion des troupesde Clovis dans le royaume wisigothique après labataille de Vouillé (507). Cette nécropole n’a proba-blement été utilisée que peu de temps.
Le noyau cultuel et funéraire représente, dumoins sur le plan géographique, une individualitécertaine. La période paléochrétienne est caractériséepar l’implantation de la première basilique et dubaptistère au Ve siècle (fig. 38). Dès son édification,l’intérieur de l’église est utilisé comme lieu d’inhu-mation, à l’intérieur, des sarcophages dont la plu-part vont être réutilisés dans les siècles suivants.Seuls deux sarcophages d’enfant paraissent ne pasavoir été touchés. Pendant la période mérovin-gienne, la basilique accueille toujours des sépul-tures. Cependant, la zone des inhumations ne selimite plus alors à la basilique et à ses environsimmédiats. Les sépultures gagnent vers l’est etpénètrent même à l’intérieur du baptistère. C’est àcette période que se produit un fait culturel essentielsur le site : le noyau cultuel prend le relais de lanécropole franque pour les inhumations, attestantselon toute vraisemblance la présence d’une popu-lation étroitement liée au pouvoir mérovingien, quia établi sa domination politique sur la région. Lapériode carolingienne voit l’abandon de l’église
comme lieu d’inhumation, qui connaît alors commeendroit privilégié la zone entourant le chevet del’église. C’est durant les deux siècles entourant l’anmil que la nécropole prend toute son ampleursimultanément à la construction de l’église préro-mane et celle du troisième édifice, autour duquelétaient inhumés une majorité d’enfants. Le milieudu XIe siècle voit donc la construction de ladeuxième église romane et le développement versl’est et le nord du cimetière médiéval intra-muros. Ils’étend sur plus de 3000 m2 et sur plusieurs niveauxd’inhumations : il n’a pas été fouillé de façonexhaustive, mais semble comporter plus de 800sépultures.
À partir du Xe siècle, la nécropole extra-murosva être utilisée jusqu’au milieu du XIIe siècle, date del’abandon du village. La partie fouillée comporte 81sépultures réparties en deux groupes séparés parune bande de terrain de 5 mètres environ.
Ainsi, plus de 800 sépultures livrèrent desrestes humains pouvant se prêter à des analysesanthropobiologiques. Cette importante collectionostéologique, unique pour cette période dans larégion, peut être scindée en différents groupes sui-vants trois types d’éléments définis comme cultu-rels, géographiques et chronologiques. Les élémentsculturels (orientation des tombes, mobilier, etc) ontpermis de différencier un groupe de sépulturesappartenant à une population de culture franquetypique de la Gaule de l’Est. Les éléments géogra-phiques ont montré que la quasi-totalité des sépul-tures étaient réparties entre deux nécropoles, l’uneintra-muros, l’autre extra-muros. Les éléments chro-nologiques ont quant à eux permis de distinguerdeux grandes périodes regroupant la majorité dessépultures : le haut Moyen Âge, du VIe au IXe siècle ,et le Moyen Âge (ou périod médiévale) du Xe au XIIe
siècle (Duhamel 1995 ; Cazes 1997) (fig. 41).
Sur la base de ces critères, quatre groupes d’in-dividus sont définis, d’effectif sensiblement diffé-rent, inhumés dans des zones relativement bien cir-conscrites :
le groupe de sujets culturellement francs, inhu-més dans la zone 4, incluse entre les fossés interne etexterne dans la partie nord-est du site. Cet ensemblefunéraire typique de la Gaule de l’Est n’a été utiliséque durant 3 à 4 générations (VIe siècle).
le groupe de sujets inhumés durant le hautMoyen Âge (HMA autochtones) au sein de la zone 2(VI-IXe siècle). Les sépultures sont réparties à l’inté-
51 Présentation des sitesDuhamel Ch., Cazes J.-P., Barthélémy I., Ricaut F.-X.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Duhamel Ch., Cazes J.-P., Barthélémy I., Ricaut F.-X.52Sous la direction de S. Duchesne et É. Crubezy
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 40 : Nécropole franque de La Gravette à l’Isle-Jourdain (Barthélémy 1999).
rieur et à proximité des deux édifices religieux del’époque, c’est-à-dire le baptistère et l’église paléo-chrétienne.
le groupe de sujets inhumés à l’époque médié-vale au sein de la zone 2 (Pmed z2) et répartis autourdu principal édifice cultuel de l’époque, la basiliquepré-romane qui deviendra l’église romane (Xe-XIIe
siècle).et, le groupe médiéval de la zone 5 (Pmed z5)
inhumé au sein de la zone 5 à l’extérieur du fosséexterne. Les sépultures se répartissent en deuxgroupes séparés par un espace de 5 mètres vided’inhumations (Xe-XIIe siècle).
I. 3.4. Les occupations
L’occupation franque s’instaure au VIe siècle commele prouve la nécropole typiquement germanique,par son organisation en rangées, sa richesse enarmes (francisques, haches, lances…) et l’inhuma-tion probablement habillée. La création de la nécro-pole de l’Isle-Jourdain – La Gravette se situe après la
conquête franque de 507-508, qui voit la disparitiondu royaume de Toulouse. D’après Grégoire deTours15, après la bataille de Vouillé en 507, Clovishiverna à Bordeaux puis se dirigea vers Toulousequi tomba en 508. L’itinéraire de l’invasion suggérépar Grégoire de Tours (qui suit la voieBordeaux/Auch/Toulouse) passe précisément parle site de l’Isle-Jourdain où ladite voie a été repéréenon loin de la nécropole. Plusieurs chroniques sefont l’écho de cette poussée militaire brutale durantlaquelle le royaume de Toulouse est détruit et Tou-louse est incendiée. La présence d’un duc Laune-bode et de sa femme Berethrude, appartenant àl’ethnie franque et résidant à Toulouse vers lesannées 560, est attestée par un poème de VenanceFortunat16. Tous ces textes ramènent à la présencephysique des Francs dans le Toulousain au lende-main de l’invasion, élément pressenti par Rouche(1979). La présence d’un groupe armé caractérisépar du mobilier appartenant au faciès mérovingienau début du VIe siècle, le long d’une voie straté-gique, aux confins du territoire de la cité de Tou-louse n’a donc rien de si insolite.
53 Présentation des sitesDuhamel Ch., Cazes J.-P., Barthélémy I., Ricaut F.-X.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 41 : Plan général du site ecclésial de La Gravette, à l’Isle-Jourdain (S. Eusèbe) (Cazes 1997).
1 : église carolingienne, 2 : basilique pré-romane et église romane, 3 : chapelle du Xe s. ?, 4 : tour sei-
gneuriale ?, 5 : fossé ecclésial.
(15) Historia Francorum, II.37 : Chlodovecus vero apud Burdegalensem urbem hyemen agens, cunctos thesaures Alarici a Tolosa auferens.(16) P.L. T.88, Pars I Caput XI, Col. 99-100.
L’époque carolingienne voit s’intensifier, autour dunoyau ecclésial les activités domestiques et artisa-nales : l’église paléochrétienne est reconstruite,seule l’abside étant conservée. Plusieurs sarco-phages ont alors été scellés sous les murs, d’autressépultures étant déplacées hors de l’édifice. Cepen-dant, cette église étant plus petite que la précédente,certaines sépultures se retrouvent, ipso facto, à l’exté-rieur. C’est à cette période que la voie antiquesemble abandonnée, ainsi qu’en témoigne un dépôtcendreux domestique contenant une monnaie du Xe
siècle.
Les Xe et XIe siècles voient l’expansion du siteecclésial avec des modifications importantes : unenouvelle église, dite préromane, remplace les restesdu baptistère, et on note alors une concentrationimportante de sépultures autour de cet édifice.L’église carolingienne voisine paraît être fonction-nelle simultanément. De plus, est érigé un troisièmeédifice dont le pourtour comporte une proportionélevée de sépultures d’enfants. L’ensemble de lanécropole compte alors plusieurs centaines detombes. C’est à cette époque, vers l’an mil, qu’estcreusé le premier fossé dit ecclésial, d’environ 150mètres de diamètre, centré sur la plus grande église.On y voit, plutôt qu’un ouvrage défensif, la maté-rialisation du périmètre sacré établi autour de cer-tains lieux de culte, pratique réactualisée à la fin duXe siècle dans le contexte de la Paix de Dieu. L’habi-tat se déplace alors, les abords des lieux de culteconsacrés aux morts se peuplent de vivants. L’églisecarolingienne est désaffectée au cours de la premièremoitié du XIe siècle. La fin du XIe siècle voit laconstruction de l’église romane, à laquelle seraaffectée le patronage de Saint Martin. C’est lemoment où apparaît pour la première fois dans lesarchives conservées le nom d’Ictium ou Isc, l’égliseSain martin d’Icio étant possession du chapitrecathédral de Toulouse. Au cours du XIe siècle, lessignes d’occupation militaire et seigneuriale s’accu-mulent (traits d’arbalète, fer à chevaux). De plus,l’édification d’une tour seigneuriale en pierre,entourée de dépendances en terre, est fortementsignificative de la « révolution féodale ».
Au XIIe siècle, le village est fortifié par le creu-sement d’une double enceinte fossoyée. Le creuse-ment du fossé central détruit de nombreuses tombes– et l’on note une concentration d’ossements sur saberge interne, indiquant une récupération des resteshumains rassemblés en ossuaire. Le village d’Isccomporte donc alors un noyau central avec une par-
tie est, l’église Saint-Martin et la nécropole, et unepartie ouest, seigneuriale et militaire, qui représentealors le centre de gravité du site avec la tour et leshabitations. Entre les deux fossés s’étend l’agglomé-ration à la fois artisanale et domestique. La fouilledes alentours n’a mis en évidence que quelquesoutils agricoles, en particulier des restes de noria.
Une étude archivistique a été menée (Haute-feuille 1995) afin de préciser deux éléments : le pre-mier était de savoir si Ictium pouvait être associé àl’agglomération découverte lors des fouilles, ledeuxième était de confirmer l’abandon brutal dusite au milieu du XIIe siècle. Très peu de documentsd’archives ont pu être retrouvés pour le site de LaGravette. En effet, la documentation est inexistanteavant l’an mil, comme souvent dans le Sud-Ouest, etle site fut brutalement abandonné durant le XIIe
siècle. Un premier groupe de textes médiévaux per-met toutefois d’identifier la seigneurie d’Ictium à lafin du XIe siècle et fournit les premières mentionscertaines du village (actes du cartulaire de Saint-Ser-nin de Toulouse). Le deuxième document importantest constitué par la vita de Saint Bertrand de Com-minges, évêque du XIe siècle originaire d’Ictium. Cedocument a été rédigé vers 1150. Ce village n’appa-raît que quatre fois dans la documentation écritecontemporaine de son existence (actes du cartulaire)mais les renseignements sont géographiquementcohérents. Par ailleurs, l’existence du site et sonabandon sont mentionnés explicitement dans l’his-toire de la vie de Saint Bertrand. L’abandon inten-tionnel du site vers 1150 y est décrit ainsi que le bru-tal et général déplacement des habitants d’Ictium auprofit d’un nouveau centre de peuplement, le cas-trum de l’Isle. Les mentions des églises des deuxsites correspondent également avec cette chronolo-gie, Saint-Martin de Icio étant mentionné dans unebulle papale en 1163 (il s’agit probablement del’église romane), et 20 ans plus tard n’apparaît plusque Saint-Martin de Isla. Les raisons de ce déplace-ment n’apparaissent pas dans la documentationécrite : il est sans doute lié à une volonté seigneu-riale, al famille d’Ictium étant liée à la fois auxcomtes de Toulouse et à la famille d’Isla. Au total, lesdocuments d’archives correspondent globalementaux données de fouille, la chronologie de l’abandondu site étant assez bien cernée. Mais nous n’avonsaucun renseignement sur le smille ans d’occupationantérieure à l’abandon, ni sur l’organisation, ni surl’évolution du site.
54Sous la direction de S. Duchesne et É. Crubezy Duhamel Ch., Cazes J.-P., Barthélémy I., Ricaut F.-X.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
I. 3.5. Les inhumations
* Antiquité et haut Moyen Âge (V-IXe siècles)
Si quelques sépultures de ces périodes anciennesont été fouillées lors de la première campagne, lamajorité d’entre elles l’ont été durant la seconde.Elles ont été préférentiellement retrouvées dans lesecteurs 2, 9, 10, 12. Ont été observés :
de nombreux sarcophages rectangulaires (sép.394)ou trapézoïdaux (sép. 652), en calcaire le plus sou-vent, mais aussi en marbre (sép. 715). Ils ont fré-quemment une orientation nord-sud. Les resteshumains sont soit en connexion, soit bouleversés.Les sépultures sont uniques ou multiples succes-sives (comprenant l’inhumé le plus récent et lesréductions des inhumés précédents – sép. 167, 180),marquant la réutilisation fréquente des structures.Beaucoup de ces sarcophages se situent dans la nefde l’église paléochrétienne.
des sépultures en coffre de tegulae sont aussi retrou-vées. Les fosses sont creusées nord-sud et recouvertesde tuiles (sép. 1015), ou déjà orientées est-ouest et lacouverture est constituée de tuiles en bâtière (sép.359). Les inhumés sont sur le dos, avec les membressupérieurs en semi-flexion, et les membres inférieursen extension. La perturbation des sépultures sonttoutefois fréquentes (sép. 455, 739).
des sépultures en pleine terre, enfin, sont mention-nées, disposées souvent dans l’axe nord-sud. Ellessont souvent remaniées par, entre autres, les fonda-tions des divers édifices.
À partir du VIIIe siècle, la datation des tombesest difficile car le mobilier en disparaît complète-ment et la culture matérielle, en particulier de lacéramique, est méconnue.
* Le cimetière médiéval du noyau ecclésial (XIe etXIIe siècles)
Les fosses sépulcrales sont orientées à l’est, des diffé-rences d’orientation de quelques dizaines de gradesd’une sépulture à l’autre n’étant pas expliquées.
Dans le cimetière ecclésial du XIe siècle, il existeune représentation plus abondante du mode dedécomposition en espace vide, peu de sujets s’étant
décomposés en espace colmaté. Les crânes sontpresque toujours en butée contre le chevet de lafosse ou du contenant, maintenus dans la directiondu levant par des blocs de calcaire ou par unelogette céphalique associée à un type de fosse amé-nagée et recouverte (motivations rituelles). La posi-tion sur le dos est la règle sauf dans deux cas : l’ana-lyse des ossements suggère dans un cas une positionsur le côté (sép. 76), dans l’autre, une position sur leventre (adolescente enterrée intentionnellement enzone 4, en dehors de l’espace consacré de la zone 2,sép. 336). Il existe ponctuellement des recoupementsde sépultures, par ensemble de deux ou trois fossesnon contemporaines, pouvant évoquer un regrou-pement familial (sens biologique du terme) ou uneforte densité de sépultures amenant un chevauche-ment fortuit des fosses17.
Pour le cimetière ecclésial du XIIe siècle, plusieursremarques ont été faites :
plusieurs recoupements sont notés créant desensembles de trois ou quatre sépultures (regroupe-ment familial ou regroupement fortuit ?).
par ailleurs sont notées des sépultures secon-daires (en deux temps) avec réductions d’adultes oud’immatures.
les inhumations sont en général individuelles,bien que quelques cas de sépultures multiples soientnotés.
les ensevelissements en pleine terre sont les pluscourants sur les derniers niveaux d’inhumation. Laposition du corps sur le dos est invariable, lesmembres inférieurs sont en extension ou semi-flé-chis. Les membres supérieurs sont en extension oul’un des deux est en semi-flexion sur les os coxaux.
Il existe une forte densité d’inhumationsdémontrée par les réductions de sépultures. Larépartition par sexe ne retrouve pas d’organisationparticulière dans le cimetière ecclésial, la répartitionpar âge décèle un fort déficit d’immatures.
* Les sépultures privilégiées autour des édificescultuels
Les tombes bâties représentent un mode d’inhumationparticulier. Elles sont concentrées le long de la façadede l’église romane et près de son abside. Elles sont
55 Présentation des sitesDuhamel Ch., Cazes J.-P., Barthélémy I., Ricaut F.-X.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
(17) Lors de la première campagne de fouilles, au cours des sondages réalisés dans le secteur 2, plusieurs sépultures datantdes XI-XIIe siècles étaient groupées par lots de deux à cinq qui correspondent à des inhumations successives au mêmeendroit, non contemporaines.
délimitées par des blocs calcaires latéraux et recou-vertes par des dalles. Elles abritaient toutes uninhumé, parfois accompagné d’ossements réduitsappartenant à un ou plusieurs sujets déposés précé-demment. Les sujets sont inhumés sur le dos,membres inférieurs en extension, membres supé-rieurs en extension ou en légère semi-flexion. Cestombes sont réservées le plus souvent à des adultesmasculins (dont un pèlerin de Saint-Jacques-de-Com-postelle, accompagné d’une coquille homonyme).
* Les sépultures d’enfants en bas-âge
La fouille des abords des édifices cultuels (abordsimmédiats de l’église romane et abside de l’églisedu haut Moyen Âge) a retrouvé de nombreusessépultures d’enfants et a compensé partiellement lafaible proportion d’immatures retrouvée sur l’en-semble du site. Toutefois, et cela sera mis en évi-dence lors de l’étude paléodémographique, tous lesenfants n’étaient pas inhumés aux abords deséglises et il faut supposer qu’un autre lieu leur étaitréservé. Toutes les fosses sont orientées, pied de lasépulture à l’Est. Les enfants sont inhumés indivi-duellement sur le dos dans des fosses en pleine terreou sur un même emplacement qui sert à l’inhuma-tion successive de plusieurs sujets.
* La nécropole franque (S. Bach, Ch. Duhamel)
Une seule sépulture (261) a été l’objet d’un aména-gement de ses parois, avec du mortier de tuileau.Les autres fosses n’ont pas reçu de traitement parti-culier : elles sont creusées à même le substrat etadoptent des formes ovalaires. Les sujets sont allon-gés sur le dos, les pieds vers l’est (orientation géné-rale des fosses nord-ouest/sud-est). Les membressupérieurs sont en général en extension, l’un d’euxpouvant être replié sur le pubis, les membres infé-rieurs sont allongés. La plupart des inhumations ontété réalisées en pleine terre (fosses en gouttière),parfois avec des indices de constriction particulièreau niveau des coudes ou du thorax (linceul ?). Lesréceptacles identifiés sont des contenants en boiscalés par des briques de chant, souvent réservés auxenfants et aux adolescents, ou des contenants debois à fond concave. La répartition par sexe et parâge ne reflète pas, pour l’ensemble de la nécropole,d’organisation particulière. L’hypothèse d’une com-munauté principalement militaire par le nombreimportant d’armes trouvées, n’est pas validée parune distorsion dans le recrutement. Seul le nombred’enfants et de nouveau-nés indique un déficit par
rapport au nombre d’adultes. Il renvoie probable-ment à l’usage d’enterrer les plus jeunes dans unautre lieu, non découvert par la fouille.
* La zone 5 (S. Bach, Ch. Duhamel)
Les 81 sépultures renfermaient 82 sujets (sépulture224 contenant deux enfants) inhumés en fosseoblongue ou rectangulaire. Leur répartition nerépond pas, au sein de la zone 5 à des secteurs défi-nis en fonction de l’âge ou du sexe. Au cours del’étude descriptive des sépultures, trois modes d’in-humation ont été mis en lumière : en espace vide(contenants de bois ou coffrages), en espace confiné(linceul), en espace colmaté. Parmi les 68 sépulturespour lesquelles un mode d’inhumation a été perçu,il n’existait pas de relation particulière entre le sexe,l’âge et le mode d’inhumation. Les divers modesd’inhumation étaient répartis sur l’ensemble de lasurface, avec une prédominance globale d’inhuma-tions en pleine terre. Les inhumés sont sur le dos,avec les membres en extension, ou les membressupérieurs en semi-flexion et les membres inférieursen extension. Quelques cas d’oreillers funéraires ontété décelés, d’autres exemples révélant des aména-gements céphaliques constitués de pierres calcairesdestinés à maintenir le crâne en direction du levant.Les sépultures forment deux groupes aux orienta-tions légèrement différentes (est/ouest et nord-est/sud-est) séparés par une bande vierge de sépul-tures de 5 mètres environ, sans que l’on puissesavoir à quoi elle se rapporte (tracé de chemin à l’in-térieur du secteur funéraire ?).
Les cadres chronologiques de la zone 5 sontflous, en l’absence de dépôt funéraire. La topochrono-logie permet de dater les sépultures entre le Xe et lemilieu du XIIe siècle. Pour l’étude, l’ensemble dessépultures sera intégrée à la période médiévale. Nousvérifierons toutefois s’il n’existe pas de différence avecles individus de la nécropole médiévale intra-muros.
I. 3.6. Le mobilier
Le mobilier funéraire, étudié par J.-L. Boudartchouk(1995), est envisagé en différenciant les objets spéci-fiques retrouvés dans le nécropole franque des élé-ments funéraires contenus dans les autres sépul-tures. En raison du nombre important d’objets,l’inventaire n’est pas présenté ici, mais il est déve-loppé dans le document final de synthèse de 1995 etil sera présent dans la future monographie (publica-tion en cours).
56Sous la direction de S. Duchesne et É. Crubezy Duhamel Ch., Cazes J.-P., Barthélémy I., Ricaut F.-X.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
* Le mobilier funéraire de la nécropole franque
Plus de 300 objets ont été répertoriés et répartis en 88types dans les 46 sépultures ayant fait l’objet d’undépôt de mobilier. Ce mobilier est caractérisé parune homogénéité et une richesse typologique entout point comparables à celles d’une nécropolemérovingienne de Picardie ou de Moselle. De tellesassociations étaient jusqu’à présent inconnues dansle Toulousain. Pour notre étude, ces objets ont étéregroupés en 6 catégories.
La céramique et la verrerie
La céramique est relativement peu représentée. Lesdépôts sont uniques ou associés. Les céramiquesappartiennent essentiellement au faciès mérovin-gien typique, comparables à des exemplaires décou-verts au-delà du Rhin. Ce faciès céramique, com-mun au cœur du royaume franc était jusqu’alorsquasiment inconnu dans le Sud-Ouest. Sur le site deLa Gravette , il diffère radicalement du faciès«autochtone» du VIe siècle.
La verrerie est rarement observée : quelquesfragments de verre antique parfois retrouvés dansune aumônière, une seule petite bouteille caractéris-tique de l’époque mérovingienne précoce.
Les armes
Les porteurs d’armes sont particulièrement nom-breux sur la nécropole de La Gravette (13 cas sur 46inhumations à mobilier, soit 28%). Ces armes sonttrès diverses (francisques, haches, pointes de lance,poignard) mais présentent une homogénéité typolo-gique. Elles sont toutes caractéristiques de l’époquemérovingienne précoce.
Les objets de parure
Ces objets sont d’une grande variété typologique etparfois associés en nombre dans les tombes« riches », constituant alors un véritable costumed’apparat (sép. 333 par exemple). Il s’agit de fibules,de boucles d’oreille, de perles de collier.
Accessoires de buffleterie
L’essentiel des éléments de ceinture est constitué pardes plaque-boucles ovales en bronze ou en argent.
Les objets usuels et les objets réemployésd’origine antique
Les objets usuels sont ceux rencontrés habituelle-ment dans les nécropoles mérovingiennes du Nordet de l’Est de la Gaule (briquet, épingle, silex, pinceà épiler, fermoir d’aumônière…). Les objets réem-ployés sont des fragments de bronze, des tessons deverre ou de céramique, des monnaies antiques.
Les monnaies
On retrouve à plusieurs reprises des monnaiesantiques du IVe siècle, contenues dans l’aumônièreou déposées au niveau du crâne ou des mains quipeuvent être dans certains cas considérées commeune manifestation du rite de « l’obole à Charon ».Par ailleurs, la présence d’exemplaires d’Antonianusnon usés frappés à Trèves, ancienne capitale dul’Occident du IIIe siècle, revêt éventuellement unesignification particulière du fait de l’origine franquede l’inhumé.
* Le mobilier « autochtone »
Le mobilier funéraire des sépultures non franques duhaut Moyen Âge est peu abondant (18 sépultures)constitué par des objets de parure (bagues à chaton),des accessoires de buffleterie (plaque-boucles), desarmes (couteau, sép. 703), des monnaies antiques, desobjets usuels (peigne en os, silex) et un bol apode. Iln’existe pas le moindre exemple de mobilier « aqui-tain ». La datation de ce mobilier va du VIe au VIIIe
siècle. La possibilité d’inhumations de sujets respec-tant les coutumes septentrionales (inhumationhabillée avec dépôts d’objets d’inspiration franquesemblables à ceux rencontrés en Gaule du Nord à lamême époque) dans des sépultures de type méridio-nal (sarcophages rectangulaires du Ve et trapézoï-daux du VIe siècle) est évoquée.
Le mobilier funéraire médiéval est commeclassiquement très peu répandu, constitué essentiel-lement par des vases funéraires (sép. 529, 558, 589,659) et des monnaies médiévales ou antiques.
57 Présentation des sitesDuhamel Ch., Cazes J.-P., Barthélémy I., Ricaut F.-X.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
I. 3.7. Chronologie et datation
I. 4. La nécropolede Saint-Brice-de-Cassan,à Ordan-Larroque (Gers)(Dupouey P., Martin A., Vidal M., Duchesne S.)
I. 4.1. Les vestiges antérieurs :la demeure aristocratique
La mise en place d’un programme de prospection en1965 (Labrousse 1966, 437) sur la commune d’Or-dan-Larroque a permis de révéler, outre la présencede monuments encore en élévation (piles funérairesde Lasserre et de Peyrelongue), celle également denombreux sites gallo-romains inédits, ainsi que laredécouverte de l’établissement rural antique deSaint-Brice-de-Cassan18.
La villa gallo-romaine de Cassan, fouillée de1966 à 198519, n’est en fait connue que par la mise aujour de sa seule partie thermale (1000 m2 environ)qui correspond à ce qui paraît être la limite orientalede l’établissement. Maintes fois remaniée au coursd’une évolution architecturale comprenant aumoins quatre phases distinctes, et sans doute davan-tage si on se réfère aux états successifs proposésdans le rapport de l’année 198020, cette vaste villa estmaintenant mieux connue. Des prospectionsaériennes ont permis de matérialiser son secteurméridional, d’évaluer son emprise sur plus d’unhectare (Sillières, Petit 1994, 131), et de découvrirune pile funéraire et ses enclos à 70 m au sud-ouestde celle-ci (Soukiassian 1993, 213 ; 1994, 130 ; Sou-kiassian, Marty 1996, 110-111) (fig. 43).
58Sous la direction de S. Duchesne et É. Crubezy Dupouey P., Martin A., Vidal M., Duchesne S.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Périodes Siècles Vestiges toutes zones
Ie A.-C./Ie P.-C. Z1 : occupation artisanale
Antiquité classique II-IIIe Z3 : voie antique, habitat ?
Z1, Z3 : voie antique, occupation des abords
Z1 : occupation artisanale
Z2 : bâtiments, église, nécropole (?)
Période paléochrétienne IV-Ve Z3 : voie, habitats
Ve-début VIe (?) Z4 : mausolée, inhumations
Z2 : église, nécropole, baptistère
Z2 : église (extension ouest ?), nécropole, habitat (?)
Période franque VI-VIIe Z3 : voie antique, habitat probable
Z4 : nécropole, habitat probable
Z2 : église (extension occidentale), nécropole (?)
Z4 : non reconnue
Période protomédiévale fin VII-VIIIe Z2 : église, reconstruction de la nef, nécropole,
IX-Xe secteur artisanal dans baptistère, habitat
Z3 : habitat aggloméré le long de la voie
Z5 : nécropole (autre lieu de culte ?)
Z2 : groupe d'églises, grande nécropole, fossé ecclésial,
église carolingienne transformée en habitat, 1er pôle castral ?,
extension de l'habitat, zone artisanale à l'ouest
Z3 : agglomération (?)
Période ecclésiale X-XIe Z5 : nécropole (?)
Z2 : église romane, nécropole, fossé ecclésial, agglomération,
artisanat, habitat seigneurial
Z3 et 4 : agglomération (?)
Z5 : nécropole (?)
site castral au sein d'une double enceinte fossoyée
Période castrale 1er moitié XIIe Z2 : habitat aristocratique, dépendances, église, cimetière
Z3, Z4 : agglomération, activités artisanales
Z1, Z5 : occupations ponctuelles, habitat, four
Abandon du site après 1140-1160 Z2 : occupation ponctuelle fortifée (?)
Z3 ouest : sépultures (bas Moyen Âge) ?
Figure 42 : Chronologie générale de l’occupation du site (Cazes 1997).
L’importance des modifications subies a renducomplexe la compréhension d’un plan où les pre-mières constructions du Haut-Empire (seconde moi-tié du Ier siècle) sont difficiles à analyser (ont-ellesdéjà une fonction thermale ?). Les aménagements etsuperpositions successifs attestent de transforma-tions radicales (hypocaustes à conduits rayonnants,puis à pilettes), dont la logique est difficile à suivrejusque dans la fin de l’Antiquité (fin IVe siècle ap. J.-C.?). Les salles chaudes et froides associées à des bas-sins et baignoires laissent supposer un usage thermalprivé, peut-être double, du moins dans les derniersétats. Le répertoire décoratif, les mosaïques poly-chromes, le sol de tuileau orné d’incrustations, lesplacages de marbre et les enduits peints portenttémoignage du luxe de cette villa dont l’ornementa-tion évolue dès la seconde moitié du Ier siècle, enparticulier au cours du IIe siècle et ce jusque dans ledeuxième quart du IVe siècle (Balmelle 1987, 229-236).
On ne peut préciser la date d’abandon puis de des-truction de cet établissement résidentiel dont lesruines, encore visibles à coup sûr par endroits, ser-virent tardivement de nécropole.
I. 4.2. La nécropole
Le site, dont le toponyme fait référence à une églisedédiée à Saint-Brice, est connu depuis le XIXe siècle.Si l’hagiotoponyme Saint-Brice (Casano en 1262)atteste l’ancienneté de sa consécration21, les chartesecclésiastiques font mention des revenus de cetteéglise dès le XIe siècle, mais surtout à partir du milieudu XIIIe siècle et aussi au XVe siècle où sont signalésles bénéfices issus de Sancti Bricti et Sancti Christinede Cassano22. Cet édifice, sans doute proche, reste nonlocalisé, seules les sépultures ont été mises au jour.
Près de deux cent sept sépultures ont étédécouvertes : elles correspondent à un secteur d’in-humations dont la limite nord ne semble pas outre-passer l’emprise au sol de la villa qui se développeplus au sud.
Si la plupart des tombes suivent l’orientationest - ouest des murs de la villa, d’autres par contre,en bordure sud de la fouille, au-dessus du mur d’ab-side de l’hypocauste à conduits rayonnants, sontorientées nord-sud. Cette inversion d’orientationplus ou moins accentuée avec des tombes proches,orientées nord-ouest/sud-est, pose problème. Ellen’a pu être en effet constatée que dans ce seul sec-teur qui, par ailleurs, semble appartenir à la zone oùla nécropole paraît devoir poursuivre son extension(Dupouey, Martin 1996). La faible densité destombes dans la partie nord et leur concentration ausud suggère que l’on se trouve sur ou à proximité dela partie centrale de la nécropole, et au voisinaged’un édifice religieux.
Les inhumations sont, semble-t-il, pour la plu-part en espace libre, dans des fosses qui ont traverséles sols, coupé ou entamé le bâti antérieur et dont laforme est vraisemblablement quadrangulaire outrapézoïdale et anthropomorphe. S’il ne paraît pas yavoir eu de cercueil, on peut signaler surtout desentourages de pierres non jointives et rarementmaçonnées, des couvertures de pierres et de briquesen accumulation et certaines, partielles, situées auniveau de la tête et des pieds. Dans un seul cas, on apu observer une couche de mortier de chaux quiscellait l’ouverture d’une fosse. Les tombes peuventavoir un aménagement intérieur au niveau deslogettes encadrant la tête du défunt qui repose par-fois, en surélévation, sur une dalle ou une brique. Laposition générale des corps est allongée sur le dos,seul un cas est sur le ventre. Les membres supé-rieurs sont en majorité le long du corps, d’autresreposent sur le pubis ou les hanches, ou sont croiséssur les épaules, tandis que les jambes sont étendues,serrées. Le creusement de ces sépultures recoupesouvent des tombes plus anciennes dont les vestigesont été en partie regroupés dans des ossuaires oudispersés dans les terres de comblement.
59 Présentation des sitesDupouey P., Martin A., Vidal M., Duchesne S.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
(18) L’analyse de cette opération de fouilles conduite par P. Dupouey et A. Martin a été faite à partir des rapports de fouillesannuels, ainsi que sur la base d’une première publication de P. Dupouey en 1970 et de documents de synthèse concernantla villa gallo-romaine en 1979 (P. Dupouey, A. Martin) et la nécropole médiévale en 1996 (P. Dupouey, A. Martin), déposésau Service Régional de l’Archéologie de Midi-Pyrénées.(19) Labrousse 1968, 544 ; 1970, 421-422 ; 1972, 496-497 ; 1974, 482-483 ; Lequément 1983, 493 ; 1986, 324.(20) Dupouey, Martin 1979, 15 et 1980, fig. 11 ; Lapart, Petit 1993, 189.(21) Brice fut au Ve siècle le successeur de Martin sur le siège épiscopal de Tours (Griffe 1965, 306). (22) Dupouey, Martin 1979, 8 ; Dupouey 1982, 17 ; Lapart, Petit 1993, 321.
60Sous la direction de S. Duchesne et É. Crubezy Dupouey P., Martin A., Vidal M., Duchesne S.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 43 : Villa gallo-romaine (partie thermale) et nécropole.
Sép.79 : une lame de couteau en fer, à droite de la tête.Sép. 174 : une lame de couteau à l’intérieur d’un foyer
en amont du crâne d’une femme, et au niveau du bassin, unpeu au-dessus, un important semis de glumelles de céréales(orge ?) noircies.
Sép. 202 : centaines de petites graines d’euphorbiacées(Mercurialis annua). La structure de la tombe est très particu-lière : une fosse a d’abord été aménagée, le fond et lesbords de la fosse ont été ensuite tapissés d’une épaissecouche d’argile jaune, couverte de grosses dalles, scelléeségalement d’une couche d’argile, formant un « sarcophaged’argile ».
I. 4.3. Quelques donnéesanthropologiques
Les études métriques et l’analyse anthropologique,d’après les observations de terrain de P. Dupouey,quoique partielles et non synthétiques puisqu’ellesne portent encore que sur 152 des 202 inhumations,proposent des données intéressantes (Dupouey,Martin 1969 ; 1981, 17-20).
La taille des adultes varient entre 1,47 et 1,67 mpour 14 femmes et entre 1,68 et 1,82 m pour 29hommes. Il a été constaté 27% des décès avant lestade de l’adolescence. Pour les hommes, dans 13%des cas, le taux de mortalité se situe entre 20 et 30 ans,alors que pour le reste de la population, le décès inter-vient avant la soixantaine. En étudiant la pathologieosseuse, P. Dupouey a pu recenser des traces dedécalcification, d’abcès dentaires ou crâniens, detumeurs de type maladie de Paget, de fractures crâ-niennes avec survie, de fractures d’os longs réossi-fiées et quelques cas de lésions ayant entraîné le décèspar mort violente. Il signale de nombreuses suturesmétopiques persistantes, des anomalies au niveau dela présence d’osselets crâniens supplémentaires etd’une dissymétrie observée sur certains crânes.
I. 4.4. Le mobilier
La majorité des tombes n’a livré aucun mobilier ; seulesdix d’entre elles ont fourni des éléments de parure, desobjets de la vie quotidienne ou de la céramique.
À l’exception d’une fibule ansée de type ger-manique dont les équivalents sont datés de la fin duVe siècle, première moitié du VIe siècle (Kazanski1991, 136 ; Vallet 1997, 234) et pour laquelle il n’y apas d’assurance qu’elle provienne de la sépulture118 (Dupouey, Martin 1983, 22), trois inhumationssont associées à des agrafes à double crochets (sép.65, 10823, 12124). On en trouve de similaires aux VIIe
et VIIIe siècles (Colardelle 1983, 140), autour de l’anmil (Colardelle, Démians d’Archimbaud, Raynaud1996, 287-288 ; Stutz 1996, 166), ce qui est confirmépar les découvertes récentes de Salies-du-Salat(Haute-Garonne) où elles proviennent de milieux dela de l’époque mérovingienne et de la période caro-lingienne (Chopin, Boudartchouk 2000, 48-54).
Trois inhumations ont fait l’objet d’un dépôtde céramique entre les pieds du défunt (sép. 2, 14,136). Il s’agit de pégaus dont un à bec pincé nonponté, sans anse et à tétons sur la carène. Leur typo-chronologie permet de les situer dans les XIe/XIIIe
siècles (Colardelle 1983, 360, Barrère, Rey-Delqué1990, 233, Pringent 1996, 215-221, Pousthoumis,Cabot 1997-1998, 14, Lassure 1998, 557, Leenhardt1999, 142). Ces différentes comparaisons suggèrentune datation dans les XIIe/XIIIe siècles (Colardelle,Démians d’Archimbaud, Raynaud 1996, 289-291).
Enfin, trois inhumations associent des objets dela vie quotidienne, ici des couteaux, des graines, oules deux, sans que l’on puisse identifier une datation :
61 Présentation des sitesDupouey P., Martin A., Vidal M., Duchesne S.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
(23) Découverte un peu au-dessus de l’épaule gauche.(24) En place sur l’épaule droite.
I. 4.5. Chronologie et datation
Il est certain que cette rapide évaluation mériterad’être validée. La base documentaire issue de lafouille, pour abondante qu’elle soit, n’est pas sansposer problème notamment sur l’essai de restitu-tion, par phases, de la partie thermale de la villa, etsur celle de son abandon qui pourrait être plus tar-dive si l’on tient compte de la fibule ansée datéeentre la fin du Ve siècle et la première moitié du VIe
siècle.
En l’état actuel de nos connaissances, en tenantcompte des sépultures détruites et de celles qui ontfait l’objet d’un regroupement dans un ossuaire, ilnous paraît raisonnable de proposer une utilisationde cette nécropole de la fin du VIIe/début du VIIIe
siècle jusqu’au XIIIe siècle, ce que confirme les data-tions radiocarbones effectuées sur trois sépultures(sép. 90, 119 et 163), qui se situent entre 652 et 101725.
I. 5. La nécropole de Vindrac (Tarn)(Bessou M. †, Guyon J., Vidal M.)
I.5.1. Historique des recherches et desfouilles
Le nom de l’abbé Bessou est indissociable desrecherches conduites à Vindrac. Lors du creusementde tranchées d’adduction d’eau potable en 1970,c’est lui en effet qui eut le mérite d’identifier le gise-ment archéologique jusqu’alors insoupçonné du vil-lage et d’en percevoir aussitôt la richesse et l’intérêt,avant de le fouiller avec toute une équipe, en unedizaine de campagnes échelonnées de 1976 à 1988.La mort l’a malheureusement empêché d’en livrer lapublication définitive26. Le site antique et médiévalest sous la forme d’une butte artificielle de 65 menviron de diamètre et de 1,80 m de hauteur maxi-male pour une surface reconnue de 3 300 m2, mais iln’est probablement pas limité à cette éminence qu’ildoit déborder largement (fig. 44).
L’intérêt du site tient à la complexité d’unehistoire que son découvreur avait bien mise enlumière par ses fouilles et qu’il avait entrepris dedémêler en distinguant, au-dessus des restes d’unimportant établissement rural antique, pas moins dequatre édifices funéraires et/ou cultuels du hautMoyen Âge, auxquels a sûrement succédé pour finirun bâtiment médiéval, à vocation cultuelle oudéfensive (l’abbé Bessou hésitait sur l’interprétationà lui donner), dont le plan général reprend très lar-gement celui de l’un des édifices chrétiens anté-rieurs. Ces reconstructions étaient fondées sur l’in-time conviction d’un archéologue qui s’était montrésensible, avec les moyens de son temps, aussi bien àl’étude des stratigraphies qu’à celle des appareils -ses écrits comme ses relevés (fig. 45) en témoignent.
I.5.2. Esquisse historique
Maintenant que le site a été remblayé, on ne sauraitrevenir sur les interprétations de l’abbé Bessou augré d’intuitions qui naissent de la seule lecture desplans disponibles ; nos analyses s’appuieront doncconstamment sur les solides éléments de synthèsequ’il a laissés en faisant place, comme autant denotations marginales, aux interrogations qui peu-vent venir à leur lecture.
Il ne nous revient pas cependant d’étudier defaçon précise les caractéristiques d’un gisementdont les niveaux stratigraphiques s’interpénètrent,créant une multitude de perturbations qu’il est dif-ficile, au vu de la faible surface dégagée, d’interpré-ter valablement. Notre objectif est seulement d’ap-préhender de la façon la plus complète possible lesimplantations funéraires et cultuelles du hautMoyen Âge, ce qui sera l’affaire du chapitre suivant(I.5.3). Au préalable, il convient pourtant de brosserune esquisse d’ensemble de l’histoire du site quitraitera rapidement de ces établissements du hautMoyen Âge, pour s’attarder au contraire à la fois surles états antérieurs et sur les monuments médiévauxde Vindrac.
Aux origines, une occupation pré-romaine
Même s’ils paraissent fugaces, les indices d’une pre-mière fréquentation des lieux se signalent par la pré-sence d’un niveau stratigraphique dans lequelabondent les amphores vinaires italiques Dressel 1et qui a également livré un « plat campanien à ver-nis noir ». Sur une terrasse naturelle qui sera amé-nagée dès l’époque impériale, cette couche marquela présence d’une occupation dans le courant aumoins du Ier siècle avant J.-C.
62Sous la direction de S. Duchesne et É. Crubezy Dupouey P., Martin A., Vidal M., Duchesne S.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
(25) Références Pa 2044, Pa 2045 et Pa 2046 (intervalle de confiance à 2 sigma), J.-F. Saliège, laboratoire d’Océanographiedynamique et climatologique, UMR 121, Université P. M. Curie de Paris.(26) Mis à part les rapports de fouilles consultés au Service régional de l’Archéologie, l’essentiel de la documentation estaccessible à partir de différents supports éditoriaux. Il s’agit des chroniques de Gallia et Gallia Informations (Labrousse 1978et 1980 ; Lequément 1986 ; Clottes, Lequément et alii 1989), d’Archéologie Médiévale (Bessou 1985 et 1987), de publicationsdans Travaux et Recherches (Bessou 1977 et 1979), et dans Archéologie Tarnaise (Bessou 1985, 1987 et 1990). S’y ajoutent decourtes synthèses dans le catalogue de l’exposition, De l’âge du Fer aux Temps Barbares. Dix ans de recherches archéologiquesen Midi-Pyrénées, Toulouse, musée St Raymond (Bessou, Manuel 1987-1988), dans les Dossiers histoire et archéologie (Bessou1987) et enfin dans la CAG Tarn (1995).La base de notre contribution, entreprise à la demande de E.Crubézy, correspond à un rapport de synthèse sur les fouillesentreprises entre 1977 et 1986 (Bessou 1987) mis en forme à la demande de la Direction des Antiquités Historiques, puisd’un document dactylographié resté inédit où est intégré le résultat des sondages effectués en 1988.
Un important établissement rural du Haut-Empire
L’abbé Bessou n’avait traité que très brièvement desconstructions les plus anciennes du site sur les-quelles il se réservait probablement de revenir ; il ena cependant restitué les grandes lignes sur un cro-quis d’interprétation qui servira à guider notre des-cription (fig. 46).
De nombreux vestiges de constructions sontvisibles en effet sur ses relevés, principalement dansle secteur nord (le moins densément occupé par destombes, parce qu’il était situé en limite de la nécro-pole liée aux monuments chrétiens), mais égalementdans toute la partie méridionale où d’autres aligne-ments restent bien perceptibles en dépit de nom-breuses interruptions dues aux fosses des inhuma-
tions et des sarcophages. Nul doute donc que l’en-semble du site ait été, à l’origine, dévolu à un impor-tant établissement rural qui s’étendait certainement,de toutes parts, au-delà des limites d’une fouille quine couvre guère que 240 m2.
L’ensemble des murs sont ordonnés selondeux directions orthogonales, nord-nord-est/sud-sud-ouest pour l’une et est-sud-est/ouest-nord-ouest pour l’autre, qui ont également servi pourtous les bâtiments ultérieurs : premier élément depermanence, sur ce site qui n’en manque pas. Lasituation est cependant différente de part et d’autred’un long mur de direction nord-nord-est/sud-sud-ouest, longé à l’est par un caniveau large de0,40 m, qui traverse en écharpe l’ensemble du sec-teur fouillé, presque par le milieu. Ce mur, large de
63 Présentation des sitesDupouey P., Martin A., Vidal M., Duchesne S.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 44 : Vindrac, plan de situation de la nécropole (M. Bessou).
64Sous la direction de S. Duchesne et É. Crubezy Dupouey P., Martin A., Vidal M., Duchesne S.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 45 : Vindrac, coupe stratigraphique, secteur MN (M. Bessou).
Figure 46 : Vindrac, l’établissement rural du Haut-Empire (M. Bessou, modifié par J. Guyon et M. Vidal).
0,65 m et qui est parementé sur sa seule face, sert eneffet à marquer une césure entre une terrasse supé-rieure assez densément occupée, à l’ouest, et uneterrasse inférieure, à l’est, qui paraît au contraire, aumoins dans sa partie nord, répondre à un espaceouvert. À cet endroit, le fouilleur a en effet reportésur son plan des éléments de section carrée, assezrégulièrement espacés de 2,50 m environ d’axe enaxe, qui servaient probablement de fondations àdes piliers ou des colonnes, pour supporter la cou-verture d’un portique ou d’un appentis large deplus de 3 m qui était adossé au mur et bordait sansdoute une cour ou une zone cultivée. Cette dernièreinterprétation est fondée sur la stratigraphie du sec-teur, que le fouilleur a décrite « homogène dans sacoloration et sa composition : sombre, humifère,sans grosses pierres, comme une terre de jardin »(Bessou 1977-1986, 62). On ignore l’extension de cesupposé portique (ou appentis) dont quatre sup-ports de la couverture seulement ont été identifiésmais la présence d’un dernier support, à quelque3,20 m à l’est du dé le plus méridional, invite à ima-giner qu’il faisait retour dans cette direction, adosséà un mur de direction générale ouest-nord-ouest/est-sud-est qui n’a pas été retrouvé par lafouille, sans doute parce qu’il a été masqué par lemur nord du dernier monument construit auMoyen Âge sur le site, qui est distant de 2 m envi-ron de l’axe des dés méridionaux. L’hypothèse estd’autant plus vraisemblable qu’à l’autre extrémitédu chantier, à l’ouest, la fouille a révélé que le murde l’édifice médiéval était effectivement superposéà un mur plus long que lui, qui a été individualisésur 2,50 m de longueur jusqu’à la limite de l’af-fouillement au-delà de laquelle il se poursuit. Ilserait donc séduisant de restituer à son emplace-ment un autre mur majeur de l’établissement ruralprimitif qui aurait lui aussi traversé en écharpe, etpresque par son milieu, tout le secteur fouillé, per-pendiculairement à l’autre axe que nous avons pré-cédemment mis en évidence.
Sans doute ces deux murs n’ont-ils pas lemême statut puisque l’un a été reconnu surpresque toute sa longueur tandis que le secondreste largement hypothétique ; on ne doutera guèrecependant de l’existence de ce dernier si l’onremarque que les vestiges qui ont été repérés depart et d’autre de son tracé supposé ne sont pasexactement à l’alignement, même lorsqu’il s’agitd’un élément aussi important que le caniveau quitraverse continûment le site du nord-est au sud-ouest. Au sein de l’établissement, ce mur marquait
donc lui aussi une forte césure, plus importanteencore probablement que celle de l’autre axemajeur qui lui est perpendiculaire.
La fouille pourrait donc être divisée en quatresecteurs de taille et de nature assez inégales (fig.46) : au sud-ouest et peut-être au nord-ouest dont onignore à peu près tout, deux quartiers dévolus à despièces de service ou d’habitation reconnaissables aulâche carroyage de murs qui en marquent leslimites ; à l’opposé, un quadrant sud-est qui paraîtau contraire à peu près vide de toute construction, àl’instar de la cour à portiques ou du jardin bordéd’appentis qui couvraient certainement pour leurpart tout le quartier nord-est. Les constructions ulté-rieures et les inhumations sont trop denses pour quele plan soit autrement lisible, d’autant qu’on ne tientlà, on l’a dit, qu’une partie d’un ensemble sûrementplus vaste. Sans doute s’agit-il d’une villa qui étaitcertainement en activité dès le Haut Empire commeon peut le déduire des données de la fouille.
On se tournera d’abord vers les secteurs quiont été épargnés par la nécropole au nord du chan-tier car ils ont livré des éléments qui situent leuroccupation depuis les premiers temps augustéens(sigillées italiques) jusqu’au IIIe siècle de notre ère :outre des céramiques communes et tout un mobiliermétallique, le matériel exhumé comporte en effet uncertain nombre de productions de sigillées sud-gau-loise (Drag 4/22, 15/17, 18/31, 24/25, 27, 29, 30,35/36, 37, 44 ... ; Hermet 4/15, 8, 9 ; Ritt. 5, 8, 12, 14a ; Déch. 63, 67) et sigillées claires. Mais autant vautpour la documentation fournie par la fouille de troisfosses allongées que l’abbé Bessou interprétaitcomme des fosses/dépotoirs constituées au coursde la « transformation de la villa ». Outre de nom-breux éléments architecturaux (tuiles, briques, anté-fixes, enduits peints), leur mobilier comporte essen-tiellement en effet des sigillées sud-gauloisesd’époque augusto-tibérienne (Drag 17 a, 19, 24/25,29, 35/36 ; Ritt. 5 ; Halt. 14 ; Hermet 9). N’était la pré-sence dans la fosse centrale d’une sépulture à inhu-mation en caisson rectangulaire (L.: 1,00 m ; l.: 0,20m) que le fouilleur considérait « de peu postérieureà l’ouverture des fosses », on jugerait volontiers queces excavations relèvent toutes, sinon de la créationde la villa, du moins d’un chantier de constructiond’envergure à placer dans la seconde moitié du Ier
siècle de notre ère. Et c’est sans doute ce chantier quiest responsable de l’essentiel du plan de l’établisse-ment tel qu’on l’entrevoit aujourd’hui.
65 Présentation des sitesDupouey P., Martin A., Vidal M., Duchesne S.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Les transformations de la villa pendant l’Antiquitétardive
Au-dessus des ruines de l’établissement rural primitif,l’abbé Bessou avait cru reconnaître ce qu’il appelaitquatre chapelles qu’il avait numérotées de 1 à 4, « sansque cela comporte a priori une signification chronolo-gique » (fig. 47) : «la n° 1, située au nord, à chevet semicirculaire, regarde l’ouest ; la n° 2, située à l’ouest, pos-sède un chevet pentagonal et se tourne vers le nord ; lechevet pentagonal n° 3 est orienté à l’est ; la n° 4, dontnous ne connaissons que partie des murs latéraux, esttournée vers le sud. » (Bessou 1977-1986, 27-31).C’étaient là autant de bâtiments qui « par leur appa-reil, leurs dimensions réduites, la largeur constante deleurs murs (de 50 à 55 cm de large) montrent une évi-dente parenté » : « les fondations, qui s’enfoncent dansles dépôts gallo-romains tardifs de 50 à 65 cm selon lescas, ainsi que les murs en élévation sont maçonnés aumortier ; l’appareil irrégulier présente des pierres dediverses natures : pierres calcaires brutes, moellonséquarris de grès récupérés dans les ruines gallo-romaines » (Bessou 1977-1986, 27-31).
De ces quatre édifices, deux sont sûrement desétablissements du haut Moyen Âge que l’on exami-nera plus en détail (cf. chapitre I.5.3) : ce sont la cha-pelle 1, qui est une probable memoria, et la chapelle 3dans laquelle on reconnaît sans peine une églisefunéraire. Les deux autres chapelles ont bien ellesaussi accueilli des tombes, mais ce n’était sans doutepas là leur destination première, ce qui justifie qu’onles présente ici.
Le doute n’est guère permis pour la chapelle 4.Telle qu’elle a été restituée par l’abbé Bessou, il s’agiraiten effet d’un monument très allongé, de directiongénérale nord-nord-est/sud-sud-ouest, composéd’une nef barlongue, large de 3,30 m seulement dansœuvre pour une longueur minimale de 13,50 m, àlaquelle il faudrait d’ailleurs ajouter celle d’un chevetsupposé à placer au sud, hors de l’emprise de la fouille(Bessou, 1977-1986, 31 et 59). C’est là imaginer un bâti-ment au moins aussi long, mais sensiblement plusétroit, que l’église funéraire 3 : l’hypothèse est peu vrai-semblable, surtout s’agissant d’un édifice qui n’est pasorienté et pour lequel la restitution d’un chevet reste
66Sous la direction de S. Duchesne et É. Crubezy Dupouey P., Martin A., Vidal M., Duchesne S.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 47 : Vindrac, les chapelles du haut Moyen Âge (selon M. Bessou).
67 Présentation des sitesDupouey P., Martin A., Vidal M., Duchesne S.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
totalement gratuite. La solution la plus plausible estdonc de voir dans cette construction sûrement tardiveun probable témoin d’une reconstruction de la villa àla fin de l’Antiquité, comme l’archéologie en offre tantd’autres exemples, dans le Sud-Ouest comme ailleurs.Cette reconstruction fut d’ailleurs sans doute partielle,car la plupart des constructions réputées tardives parl’abbé Bessou occupent la moitié méridionale du site,au-delà de la forte césure de direction générale ouest-nord-ouest/est-sud-est que nous avons cru pouvoirreconnaître au sein de la villa primitive. Mais cela n’im-plique pas que le reste de l’établissement ait été aban-donné comme le montrent les monnaies de la fin duIVe siècle, un minimus de Constance II de 352-365 et unbronze de Gratien de 370-373, (Bessou 1979,3 ; CAGTarn 1995, 252) qui ont été retrouvées sous un sol enmortier dans le secteur de l’appentis du quadrantnord-est, qui fut donc certainement réaménagé luiaussi pendant l’Antiquité tardive, mais aussi les nom-breux tessons de céramique D.S.P., languedocienne etatlantique, livrés par la fouille de tout le secteur nord,qui répondent aux types Rigoir 1, 6, 15, 18, 21, 24 b, 26et 35.
Au sud, la partie reconstruite de la villa offre àl’analyse un plan assez cohérent, peut-être organiséautour d’une cour dont l’essentiel resterait à dégagerau sud-ouest de la zone fouillée. La chapelle 4 de lanomenclature de l’abbé Bessou constituerait l’aileorientale de ce nouveau bâtiment dont l’aile nordserait à rechercher au-dessous de l’église funéraire 3et de l’établissement médiéval qui lui a succédé :dans ce secteur en effet, les intervalles laissés entreles sarcophages laissent entrevoir l’existence de deuxmurs qui ont pu délimiter trois pièces échelonnéesd’est en ouest. Quant à l’aile occidentale, sa limitepourrait être marquée par le mur le plus à l’ouest,qui a bien été remployé comme mur de façade del’un des édifices funéraires du haut Moyen Âge,mais se poursuivait cependant plus au sud hors deslimites de la fouille : ce mur aurait bordé à l’ouest despièces dont les divisions ont été masquées par unpuissant mur médiéval, et à l’est, un espace ouvert -la cour déjà signalée -, dont l’extension d’est en ouestserait de quelque 6,50 m (fig. 48). Dans cette restitu-tion, il faut faire cependant sa place à l’unique élé-ment qui ait été construit au nord de l’axe de direc-
Figure 48 : Vindrac, l’établissement rural pendant l’Antiquité tardive (M. Bessou, modifié par J. Guyon
et M. Vidal).
tion générale ouest-nord-ouest/est-sud-est hérité dela villa primitive, qui marquait globalement la limitede la partie reconstruite : une abside pentagonale quia été accolée à cet axe, à hauteur de l’une des piècesde l’aile nord (Bessou 1979, 77-78). L’abbé Bessou, ons’en souvient, voyait dans cette abside le chevet de sachapelle 2, un petit monument qui aurait mesuré,dans œuvre, 7 m environ du nord au sud, absidecomprise, pour 4 m sans doute d’est en ouest. L’in-terprétation n’est pas invraisemblable, mais elle n’estpas certaine, d’autant que les tombes à rattachersûrement à cet établissement funéraire supposé sonttrès rares. Si l’on fait abstraction de celles qui ont étéplacées dans le corps principal de l’édifice et quipeuvent aussi bien relever de l’église funéraire 3 ouavoir été installées dans sa mouvance, on ne voitguère en effet que le sarcophage 3, placé dans l’ab-side. L’axe de ce sarcophage est pourtant oblique parrapport à celui des murs environnants et cette direc-tion anormale peut s’expliquer par la présence àproximité du sarcophage 4 dont la fosse de manu-tention a pour sa part entaillé l’abside, ce qui invite-rait à l’associer à la série des tombes installées aprèsl’arasement de ce petit établissement. Aussi est-ilpossible d’imaginer au contraire que l’abside faisaitégalement partie du programme de reconstructionde la villa à la façon de l’abside, pentagonale elleaussi, qui a été installée pendant l’Antiquité tardivesur le péribole du temple du forum de Conuenae(Saint-Bertrand-de-Comminges) lors de l’aménage-ment d’un petit ensemble thermal dont les autresmurs remployaient très largement ceux du monu-ment d’âge augustéen (Badie, Sablayrolles, Schenck1994). Et si l’on préfère juger qu’elle relève d’un édi-fice funéraire du haut Moyen Âge, il reste que cetédifice, comme l’église 3, aurait repris dans sonarchitecture des pans entiers de la villa primitive quel’Antiquité tardive avait profondément remodelée.
Les mutations décisives du haut Moyen Âge
Un mot suffira pour décrire les mutations du hautMoyen Âge sur lesquelles on reviendra dans toute lasuite de cette étude. Elles ont été marquées, commeon l’a vu, par la construction de deux, et peut-êtretrois, « chapelles » funéraires autour desquelles s’estdéveloppée une importante nécropole qui débordaitcertainement de toutes parts, sauf au nord, leslimites de la zone fouillée.
En dépit de cette reconnaissance partielle, lesite ne compte pas moins d’une centaine de sarco-phages et une vingtaine de sépultures en terre libreet en caisson et la vocation funéraire qu’il a ainsireçue du haut Moyen Âge a été décisive pour sonavenir. Sans cela, il serait probablement retourné àl’état de campagne, au lieu d’avoir accueilli un nou-vel édifice à époque romane.
Un édifice du premier âge roman
Le dernier édifice qui ait été élevé sur le site est unbâtiment particulièrement puissant (fig. 49), ce quiexplique les désordres qu’il a causés aux états anté-rieurs. Ses fondations profondes et la récupérationde matériaux facilement accessibles ont en effet pro-voqué la destruction presque totale du secondniveau de sarcophages alentour de l’église funéraire3 à l’emplacement de laquelle il a été construit : il nereste le plus souvent que le fond des cuves (fig. 50)ou leur empreinte dans le sol en béton qui recouvraitla première strate de tombes (fig. 51). Et c’est peut-être aussi à la faveur de son chantier de constructionque la quasi-totalité des sépultures a été pillée27.
Le plan est celui d’un édifice grossièrementorienté, d’une longueur hors tout de 15,50 m pourune largeur de 6,30 m, qui se compose d’une nefprobablement voûtée à en juger par l’épaisseur deses murs latéraux (1,05 m à 1,10 m) et d’un chevettrapu de forme trapézoïdale dont les murs ont uneépaisseur moindre (0,80 m).
Les fondations, épaisses de 1,40 m, reposent,entre 0,80 m et 1,40 m de profondeur, sur le sol natu-rel ; elles ont été construites en bourrage de tranchéeavec des matériaux de récupération (tambours decolonnes, pierres de parement, couvercles brisés desarcophages...) dont certains sont marqués d’unecroix à l’affleurement du bourrage. L’élévation, parendroits conservée sur une hauteur de 1,30 m,emploie des dalles larges et épaisses de calcairedolomitique schisteux, extraites de la carrière duGarissou, distante de 3 km, qui a également servi àla construction de la bastide toute proche de Cordesfondée par Raymond VII en 1222. Le sol n’estconservé que dans l’abside, sous la forme d’unniveau de mortier de tuileau.
68Sous la direction de S. Duchesne et É. Crubezy Dupouey P., Martin A., Vidal M., Duchesne S.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
(27) Dans son rapport de fouille de 1978, l’abbé Bessou signale en effet, p.2, « que l’examen des sarcophages a révélé en plu-sieurs fois des taches d’oxydation sur le fond des cuves à hauteur de la poitrine ou du bassin, indice de prélèvementsd’objets en bronze ».
Alentour du bâtiment, à une distance uni-forme de 3 m, ont été identifiés quelques élémentsd’un mur d’enceinte, construits à sec en pierres nonappareillées, qui est remarquable à la fois par sonépaisseur (1,15 m) et l’absence de fondations.D’après l’abbé Bessou, cet enclos, postérieur à l’édi-fice principal, n’aurait pas été achevé.
Sur l’ensemble du site ont en outre été retrou-vés des épandages presque ininterrompus decendres et de charbon de bois, des rejets de plaquesbrûlées et des foyers qui forment une couche épaisseparfois de 0,20 m au-dessus des couvercles de sarco-phages dont bon nombre sont noircis ou rougis. Plusà l’ouest et au sud-ouest, une autre nappe de char-
bons avec quelques foyers recouvre un éboulis depierres, alors que deux larges dépressions conser-vent une masse importante de grains calcinés, blé etféveroles. De toutes ces couches provient un abon-dant mobilier céramique et métallique (pégaux,oules, dournes, cruches, chapes articulées, boucles)qui paraît chronologiquement homogène : commeles monnaies, il s’intègre dans le XIIIe siècle28 mais atoute chance de se prolonger jusqu’au XIVe siècle.
À quoi l’on ajoutera pour finir une importantenécropole. Sur les franges est et sud du site, 70sépultures en terre libre et en caisson occupent eneffet plusieurs espaces hors de l’enclos médiéval etdes chapelles antérieures tandis qu’auprès de l’édi-
69 Présentation des sitesDupouey P., Martin A., Vidal M., Duchesne S.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 49 : Vindrac, l’établissement préroman et son mur de clôture (M. Bessou).
(28) Obole d’argent d’Albi (fin VI-début VIIe siècle) dans la nappe de combustion ; denier de Melgueil très fractionné desXIIe-XIIIe siècles ; deux monnaies de la cité de Cahors fin XIIe-XIIIe siècle dans le mortier désagrégé des niveaux de des-truction de l’édifice.
fice lui-même, de nombreux sarcophages du hautMoyen Âge ont été réutilisés pour de nouvellesinhumations. À cause de l’absence de céramiqueglaçurée, l’usage de ce cimetière ne paraît pas avoirdépassé le XIIIe siècle, mais les inhumations avaientdéjà commencé avant la construction du mur d’en-clos qui a occulté des sépultures en terre libre.
Il reste à interpréter le monument et à le dater.Sans exclure totalement qu’il puisse s’agir d’uneéglise fortifiée, l’abbé Bessou avait préféré voir enlui un fortin ou un poste de guet29 construit enmême temps que la bastide de Cordes en 1222 (Bes-sou 1977-1986, 11). Cette datation prenait appui surl’étude du matériel livré par les plus anciens des
niveaux cendreux retrouvés alentour du bâtiment,qu’il rattachait à son chantier de construction. Mais« ce fortin n’aurait duré que quelques années » : lejugement vient cette fois de l’examen des niveauxcendreux les plus récents, qui l’inclinait à penserque l’établissement avait été incendié et détruitassez tôt dans le XIIIe siècle. Il rattachait donc cettedestruction à une opération militaire, celle qu’amenée en 1227 Humbert de Beaulieu, le lieutenantde Louis VIII (Don de Vic, Don Vayssète, VI, 625). Ilfaut pourtant préférer sans hésitation pour cemonument la solution d’un édifice de culte, quel’abbé Bessou avait finalement écartée. À la massi-vité des murs près, on retrouve en effet ici, presquetrait pour trait, le plan de l’église 3 du haut Moyen
70Sous la direction de S. Duchesne et É. Crubezy Dupouey P., Martin A., Vidal M., Duchesne S.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 50 : Vindrac, église funéraire 3, annexe, deuxième et premier niveau de sarcophages, vue du
nord-ouest (sarcophage 79 en arrière-plan ; sarcophages 87, 77, 76, 76’ en plan intermédiaire ; sarco-
phage 78, 14 et 79 en premier plan) (M. Bessou).
(29) À cause de la présence d’une protection avancée qui ferait fonction de barbacane, avec un cordon d’escarpe pour l’en-ceinte.
Âge (fig. 52) dont le nouveau bâtiment a si bienrepris les grandes lignes qu’il en a fait disparaîtrel’essentiel et cela suffit pour juger qu’il s’agit à nou-veau d’une église, d’autant que les inhumations ontcontinué à proximité, ce qui se conçoit mieux pourun édifice religieux que pour un ouvrage militaire.
De cette dernière église du site, les indicesfournis par la fouille ne documentent que la des-truction - dans le courant du XIIIe siècle, ou plus tardencore - et non pas la construction, mais tout laisse àpenser qu’elle est beaucoup plus ancienne que ne lepensait son découvreur. Son plan est en effet trèsproche, par exemple, de celui de l’église de Saint-Léonard de Monediès, Grand-Vabre, dans l’Avey-ron, de la première moitié du XIe siècle (Fau 1987,533-534) et l’on pourrait lui trouver bien d’autresparallèles de même époque en Rouergue (Durand
1989 ; Fau 1990, 33-51), dans l’Hérault ou en Lan-guedoc méditerranéen et jusqu’en pays catalan(Durliat, Giry 1971 ; Giry 1983). C’est dire que l’édi-fice de Vindrac a participé selon toute apparence du« blanc manteau d’églises » que l’Occident a revêtuau lendemain de l’an Mil.
I.5.3. L’établissement funérairedu haut Moyen Âge
Comme on l’a vu, le site a été marqué au hautMoyen Âge par la construction de deux et peut-êtretrois édifices funéraires autour desquels s’est rapi-dement développée une importante nécropole. Oncommencera par ces édifices, avant de présenter lestombes et leur mobilier et de revenir pour terminersur la chronologie et ce qu’elle révèle de l’exempla-rité du site de Vindrac.
71 Présentation des sitesDupouey P., Martin A., Vidal M., Duchesne S.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 51 : Vindrac, église funéraire 3, annexe, niveau et séparation de béton au-dessus des sarco-
phages 7 et 14 (M. Bessou).
Les édifices et les enclos funéraires
À cause des remaniements médiévaux que l’on adits, les édifices du haut Moyen Âge sont assez malconservés ; il est possible cependant de deviner leurplan et de tenter d’établir leur chronologie.
La « chapelle » 1
De la « chapelle » 1, les constructions et inhuma-tions ultérieures n’ont guère épargné que l’essen-tiel de son mur est et l’intégralité de son mur nord,qui était prolongé à l’ouest par une abside curvi-ligne dont le tracé exact reste malaisé à restituer.L’abbé Bessou avait opté pour un demi-cercle maisl’on peut aussi, et plus vraisemblablement sansdoute, songer à une ouverture plus réduite et ima-giner que le bâtiment avait utilisé comme murméridional, soit l’ancien mur majeur de direction
ouest-nord-ouest/est-sud-est de la villa, soitencore un mur accolé à cet élément plus ancien(fig. 53).
Il s’agit en tout cas d’un petit édifice occidenté(6,10 m environ d’est en ouest dans œuvre, pour 2,80m à 3,30 m du nord au sud, selon le parti retenupour sa restitution), au sol recouvert par un bétonblanchâtre à inclusions décoratives (?) de petitespierres et de tuileau noir et rouge. Comme son planévoque bien celui des monuments funéraires del’Antiquité tardive, rien ne s’oppose à l’interpréter,ainsi que le voulait l’abbé Bessou, comme une memo-ria qui aurait été installée dans les ruines de la villaantérieure (ou à proximité d’une partie de la villaencore en fonction, comment savoir ?).
L’interprétation s’impose d’autant plus quel’édifice a certainement accueilli des inhumations :
72Sous la direction de S. Duchesne et É. Crubezy Dupouey P., Martin A., Vidal M., Duchesne S.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 52 : Vindrac, les établissements funéraires du haut Moyen Âge (M. Bessou, modifié par J. Guyon
et M. Vidal).
des tombes en pleine terre, mais aussi les sarco-phages 38, 39, 51 et 58 ; on hésitera seulement à don-ner au sarcophage 39 l’importance que lui accordaitl’abbé Bessou qui voyait en lui une inhumation pri-vilégiée - celle du fondateur, sans doute (Bessou1977-1986,54) - car la restitution qui a notre préfé-rence pour le plan à donner à la memoria ôte à ce sar-cophage la position axiale qu’il revêtait dans lareconstruction adoptée par le fouilleur.
Les termes chronologiques de l’utilisation de cemonument peuvent être appréciés, au moins grossiè-rement. Le terminus post quem non est donné par l’ins-tallation du sarcophage 40 sur son abside arasée pourl’occasion (fig. 54) ; or le mobilier de cette cuve est auplus tôt de la seconde moitié du VIe siècle. Quant auterminus ante quem non, il est fourni de façon beaucoupplus lâche par les dernières réfections de ce secteur de
la villa qui sont attribuables au plus tôt, comme on l’adit, à l’extrême fin du IVe siècle30. Pour resserrer l’in-tervalle chronologique ainsi ouvert, il importerait desavoir combien de temps l’établissement rural estresté en fonction avant de céder la place à des inhu-mations. La réponse est : moins d’un siècle probable-ment, car à 6 m à peine au sud de la memoria, trois sar-cophages (59, 60 et 110), datables par leur mobilier,témoignent, dès le tournant des années 500, d’unecolonisation d’une autre partie de la villa31 par destombes . On devra noter qu’avec leurs voisins, 61 et109, qui n’ont livré aucun matériel, ces sarcophagessont disposés à l’intérieur d’un espace clos dont on nesait s’il s’agit d’une création ex novo ou, plus proba-blement, d’une simple réutilisation (ou d’une trans-formation) d’une pièce de la villa pour un usage funé-raire. Cet espace pouvait être couvert si l’on en jugepar le sol en béton qui recouvrait les sarcophages :
73 Présentation des sitesDupouey P., Martin A., Vidal M., Duchesne S.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 53 : Vindrac, la chapelle 1
(30) Cette chronologie s’accorde, au moins en gros, avec celle qui avait été proposée par l’abbé Bessou pour cette chapelle(« en service au cours du Ve siècle, elle est hors d’usage au début du VIe siècle » : Bessou 1977 – 1986, 57), mais égalementavec celle de Millet 1997-1998, 91 : « elle était déjà hors d’usage à la fin du VIe siècle ».(31) C’est la datation du matériel de sarcophage 110, le plus précoce de l’ensemble du site.
faut-il voir là une autre memoria, 1’, d’un plan moinsélaboré que celui de la memoria 1 parce qu’il devaitpeut-être beaucoup au remploi d’élémentsantérieurs ? La question peut au moins être posée.
La possible chapelle 2
En décrivant les transformations de la villa originel-lement installée sur le site, nous avons dit nosdoutes sur l’existence de la chapelle 2 de la nomen-clature de l’abbé Bessou, qui pourrait n’être qu’unélément parmi d’autres de modifications apportéespendant l’Antiquité tardive à l’établissement rural.Il n’est pas à exclure cependant que cet élément aitpu être repris tel quel pendant le haut Moyen Âgepour être affecté à un usage funéraire ou que l’on aità cet époque adjoint une abside à une salle de la villapour en faire une memoria.
En ce cas, il faudrait croire à l’existence d’undeuxième édifice indépendant, situé 3 m à peine àl’ouest de la memoria 1 et selon un axe perpendicu-laire au sien. Le bâtiment compterait une nef de plansensiblement carré (5,20 m environ hors oeuvre dunord au sud pour 4,30 m d’est en ouest), prolongéeau nord par une abside pentagonale profonde de 2m environ, légèrement désaxée vers l’ouest (Bessou1977-1986, 24-28) (fig. 53).
En faveur de l’existence de cette autre chapellefunéraire (fig. 55), l’abbé Bessou avait tiré argument dela présence du sarcophage 20, qui l’avait frappé par sesgrandes dimensions et son couvercle à quatre pansavec arêtes en ronde bosse et dont il avait surtout notéque « sa position apparaissait centrale » (Bessou 1977-1986, 43), ce qui revenait à voir en lui, comme pour lesarcophage 39 de la memoria 1, une inhumation privi-
74Sous la direction de S. Duchesne et É. Crubezy Dupouey P., Martin A., Vidal M., Duchesne S.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 54 : Vindrac, memoria 1, premier niveau de sarcophages (37 et 40) sur l’abside et sarcophages
intérieurs 38 et 39, vue du nord (M. Bessou).
légiée. Cette disposition pourtant peut devoir beau-coup au hasard, c’est-à-dire à la nécessité d’exploiterau mieux un espace très densément occupé. Les autressarcophages, en tout cas, sont tous disposés selon unedirection générale ouest-sud-ouest/est-nord-est quiest aussi celle de la plupart des cuves de l’église funé-raire 3, dont six - pas moins (85 à 87 ; 91 à 93) (fig. 56) -ont d’ailleurs détruit le mur oriental de la memoria 2.Doit-on en déduire, avec l’abbé Bessou, que la memo-ria a finalement été englobée dans l’église 3 (Bessou1977-1986, 57) ? Ou bien faut-il croire qu’elle n’a jamaiseu une existence indépendante, sa nef n’étant autre ence cas que l’extrémité occidentale de l’église 3, tandisque son abside relèverait, comme il a déjà été dit, dudernier état d’occupation de la villa ?
Nous laisserons la question ouverte, obser-vant seulement que les uniques données chronolo-giques sur l’utilisation funéraire de ce supposé édi-
fice indépendant tiennent au mobilier du sarco-phage 19 (fig. 53), qui est attribuable au tournantdes VIe-VIIe siècles, soit une datation assez compa-rable à celle du sarcophage 85 tout proche dansl’église 3.
L’église funéraire 3
Ainsi qu’on l’a déjà signalé, l’église 3 a disparu pourl’essentiel sous l’église médiévale qui lui a succédé,mais l’abbé Bessou avait su en restituer le plan en seguidant sur l’ordonnance des sarcophages qui ontpris place sous son sol.
Elle compte une nef barlongue, large de 4,60 menviron et longue de 13,70 m dans œuvre (y comprisla possible memoria 2), qui était prolongée à l’est parun chevet pentagonal plus étroit (il est large de 4,00m et profond de 2.20 m environ) (fig. 57 et 58). L’ac-
75 Présentation des sitesDupouey P., Martin A., Vidal M., Duchesne S.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 55 : Vindrac, memoria ? 2, sarcophages 20 (en haut à gauche), 17, 16, 18 et 19 (M. Bessou).
cès se faisait sans doute par l’ouest où le sarcophage21, qui a entaillé les fondations du mur de façade, apu être installé sous un seuil, ce qui lui confèreraitune situation intentionnelle sur un lieu de passage(Sapin 1996, 75-76). C’est d’ailleurs cette sépulture« privilégiée » que provient la feuille en plomb ins-crite, ce qui ajoute à son caractère particulier. Pourles mêmes raisons, on songera aussi à une possibleouverture vers le nord, à hauteur du sarcophage 9.
Quelques traces d’un revêtement de sol enbéton sont conservés à l’ouest, au-dessus des sarco-phages 18, 20 et 22, tandis qu’à l’intérieur du chevet,subsiste sur une surface de 1,5 m2 un autre sol gros-
sier (mortier, tuileaux rouge, noir et violacé) La fouillea livré en outre quelques éléments d’architecture quipourraient être attribués à l’édifice, au même titre quedes fragments d’enduit polychrome32.
À l’exception du chevet, le plan résulte sansdoute du simple remploi d’éléments antérieurs :ceux de l’aile nord de la partie de la villa reconstruitependant l’Antiquité tardive. C’est pourquoi le bâti-ment n’est pas exactement orienté : il suit la direc-tion générale ouest-nord-ouest/est-sud-est héritéedes premiers établissements du site.
76Sous la direction de S. Duchesne et É. Crubezy Dupouey P., Martin A., Vidal M., Duchesne S.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 56 : Vindrac, église funéraire 3 (intérieur), sarcophages 72, 73 (arrière plan), 94, 95 (plan inter-
médiaire), 92, 93 (premier plan) et 91 (M. Bessou).
(32) Des plages rouges et jaunes et des filets disposés en chevrons sur un enduit de chaux (Bessou 1977-1986 et article, 31) ;mais ne s’agirait-il pas du décor de l’église médiévale ?
L’ensemble évoque d’assez près d’autres édi-fices du premier art chrétien : n’étaient l’échelle etles proportions qui sont assez différentes, on évo-querait volontiers par exemple à titre de parallèle labasilique du quartier du Plan de Conuenae (Saint-Bertrand-de-Comminges) (Cat. expo. St Bertrand1991, 27-41). L’analogie ne se limiterait d’ailleurs paslà, car, comme à Saint-Bertrand aussi, l’édifice deVindrac avait sûrement été pourvu d’annexesimportantes dont on peut déduire l’existence desplans et de la relation de l’abbé Bessou.
Sur tout le flanc nord de l’édifice, le rapport defouille signale en effet, au-dessus des sarcophagesles plus profonds (fig. 59), la présence de « plaquesde béton, quelquefois doublées d’une mince épais-seur de terre : cela peut être un béton propre àchaque sarcophage, comme c’est le cas pour les sar-cophages 37 à 40, ou un béton continu (fig. 63)recouvrant plusieurs sarcophages à la fois, comme iladvient sous les sarcophages 75, 76, 76bis, 79, 80 et14 et également au nord du sarcophage 79 » (Bessou1977-1986, 41). Comment ne pas interpréter ces solscomme ceux d’une annexe, un portique par
exemple, qui aurait flanqué l’édifice au nord etauquel on aurait accédé par la porte qu’il faut peut-être restituer à l’emplacement du sarcophage 9 ? Etautant vaut au sud pour la série des sarcophages 59à 61 et 109-110 (fig. 60) que nous avons déjà évoquéen supposant qu’ils pouvaient avoir été placés ausein d’un espace couvert de 4 x 3,50 m environ dansœuvre, la memoria 1’ : cette memoria supposée faisaitdésormais figure d’annexe adossée à la fois à l’égliseet au mur de l’aile orientale de la villa reconstruite.
On devra seulement noter que l’aménagementde l’annexe nord a nécessité l’arasement préalablede la memoria 1 dont l’abside a disparu sous le sol enbéton de cette annexe. Faut-il juger que cet arase-ment a eu lieu dès la construction de l’église funé-raire ou que la memoria a un temps subsisté, commeune sorte de première annexe au nord de l’église, àhauteur de l’épaulement de la nef (mais non dans
77 Présentation des sitesDupouey P., Martin A., Vidal M., Duchesne S.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 57 : Vindrac, église funéraire 3.
Figure 58 : Vindrac, église funéraire 3, chevet
pentagonal (M. Bessou).
son prolongement exact, ce qui constituerait, sibesoin était, un argument supplémentaire pourmontrer qu’elle est bien antérieure à l’église) ? Lafouille n’autorise aucune réponse assurée mais laquestion vaut au moins d’être posée dans la mesureoù, comme on le verra d’ici peu, les transformationsont été suffisamment nombreuses alentour del’église funéraire pour que l’annexe nord puisserelever indifféremment du programme de construc-tion primitif ou d’une extension d’envergure rendueindispensable par le grand nombre des tombes àaccueillir sous le couvert de l’établissement chrétien(fig. 61).
Ces tombes comptent à la fois des inhumationsdans des fosses et des sarcophages qui ont fait l’objet- les sarcophages surtout - d’une étude attentive del’abbé Bessou qui servira de base ci-après pour notre
propre étude des tombes. Notre seule réserve por-tera sur l’interprétation qu’il avait donnée du sarco-phage 70 car il n’est pas sûr, comme le voulait sondécouvreur, qu’il s’agisse d’un sarcophage doubledont la moitié méridionale aurait été détruite par lemur sud de l’église médiévale qui a succédé à l’église3 ; sa forme singulière, mais également les étrangesouvertures de son flanc sud pourraient s’expliquerpar le remploi d’une pièce initialement réservée à unusage autre que funéraire (fig. 62).
Mais l’intérêt de ces tombes est surtout leurchronologie qui s’échelonne de la seconde moitié duVIe siècle (pour le sarcophage 40 qui dépend de l’an-nexe nord de l’église) au milieu du VIIe siècle pourles plus récentes. Le premier terme de l’intervalleainsi ouvert pourrait convenir, au moins par à peuprès, pour la construction de l’église funéraire, d’au-
78Sous la direction de S. Duchesne et É. Crubezy Dupouey P., Martin A., Vidal M., Duchesne S.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 59 : Vindrac, église funéraire 3, annexe, premier niveau de sarcophages après enlèvement du
second niveau (75 en arrière plan ; 83, 77, 82, 81 en plan intermédiaire ; 78, 14, 7, 15 en premier plan)
(M. Bessou).
tant que le second état de la basilique chrétienne duquartier du Plan, à Saint-Bertrand-de-Comminges,que nous avons évoqué à titre de parallèle pour sonplan, paraît bien relever lui aussi du VIe siècle ; lesecond terme chronologique ne saurait êtreconfondu en revanche avec l’arrêt de l’utilisationd’une nécropole dont l’histoire est sûrement à placersous le signe de la longue durée.
Des exhaussements et des enclos, témoins d’unelongue utilisation de la nécropole
Il n’est guère douteux en effet que la nécropole estrestée très longtemps en usage. En sont témoins,principalement, ces superpositions de tombes que lafouille a surtout mises en évidence au contact del’église 3 mais qui répondaient sans doute, ainsi quel’avait bien vu l’abbé Bessou, à un phénomène plus
général dont nous avons du mal à appréhenderexactement l’importance à cause des spoliations quiont marqué la suite de l’histoire du site.
Au nord de l’église 3, ainsi, l’essentiel, sinon latotalité de l’annexe que nous avons cru pouvoir res-tituer a sûrement accueilli une deuxième strate desarcophages qui ont été installés au-dessus de sonsol en béton (fig. 62). Comme partout ailleurs, lescuves ont été disposées, tantôt parallèlement, tantôttransversalement aux murs directeurs, de sorte quel’on hésitera à croire, comme le faisait l’abbé Bessou,que le sarcophage 35 avait été intentionnellementdisposé par le travers du sarcophage 39 sous-jacentdans lequel il voyait la sépulture du fondateur de lamemoria 1 (Bessou 1977-1986, 54) (fig. 63) : la dispo-sition en croix que forment ainsi les deux tombesdoit sans doute tout au hasard.
79 Présentation des sitesDupouey P., Martin A., Vidal M., Duchesne S.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 60 : Vindrac, memoria 1’, étagement des sarcophages sur deux ou trois niveaux (sarcophages
59, 60 du niveau inférieur ; sarcophages 54, 55, 57, 58, 56 du niveau supérieur). Au premier plan, mur
méridional de la nef de l’église préromane (M. Bessou).
L’installation de ces nouvelles inhumations asûrement conduit en tout cas à un exhaussementgénéral de niveau dans l’annexe, qui aurait touchéjusqu’au seuil supposé de communication avecl’église adjacente car un nouveau sarcophage, 8, aété surimposé au sarcophage 9 que nous avons ima-giné placé sous ce seuil. La chose est d’autant plusétonnante que la fouille n’a révélé en revancheaucune superposition de sarcophages dans l’égliseelle-même : l’accès avait-il été condamné ou trans-formé en arcosolium pour accueillir le sarcophage8 ? ou avait-il été maintenu au prix de l’aménage-ment d’un ou deux degrés à l’intérieur de l’église ?On ne sait.
Au sud, d’autre part, un semblable exhausse-ment se rencontre dans l’autre annexe supposée del’église 3, l’ancienne memoria 1’, avec la série des sar-cophages 54 à 58 et 104 à 107 qui ont été placés au-dessus des sarcophages 59-61 et 109-110 (fig. 60). Ettant dans l’annexe nord que dans l’annexe sud, unnouveau sol en béton a été aménagé au-dessus de laseconde strate des sarcophages.
Outre ces annexes, il faut aussi compter àproximité de l’église avec la présence d’enclos quel’abbé Bessou avait cru pouvoir identifier. Le pre-
mier, à l’ouest, est cependant douteux car les deuxmurs articulés sur l’angle nord-ouest de l’église quien seraient les seuls témoins ne sont autres, proba-blement, que des murs de la villa dont on ne sait s’ilsétaient encore en élévation au haut Moyen Âge. Lesmêmes réserves ne valent pas pour le second enclos,au nord, dont subsiste l’angle nord-ouest, avec uncôté fondé sur un ancien mur de la villa et l’autre quiest parallèle au mur nord de l’église, à quelque 8 mde distance (fig. 64).
Ainsi se dessine, alentour de l’établissementchrétien, tout un réseau d’annexes et d’enclos, à laconfiguration changeante en fonction des exhausse-ments, comme on en connaît bien d’autres auprèsdes premiers monuments chrétiens : qu’il suffise desonger aux Alyscamps d’Arles ou à Saint-Victor deMarseille. Cette restitution de la topographie de lanécropole n’est pourtant fondée que sur les élé-ments les plus apparents, murs et sarcophages. Elleserait sûrement plus complexe et plus changeanteencore si l’on pouvait prendre en compte les inhu-mations dans de simples fosses pour lesquelles il asouvent été difficile à l’abbé Bessou de distinguercelles qui relevaient de la nécropole du haut MoyenÂge et celles qu’il convenait de rattacher au cime-tière médiéval ; sans parler des sarcophages eux-mêmes, dont beaucoup ont sûrement été remployéspour de nouvelles inhumations à une date indéter-minée. Ces hésitations ont un sens : elles plaident enfaveur d’une très longue utilisation, sinon d’une uti-lisation funéraire continue d’un site sur lequell’église 3 du haut Moyen Âge est en tout cas restéecontinûment visible, fût-ce à l’état de ruine : on necomprendrait pas sans cela que peu après l’an Mil,la dernière église du site ait été élevée à son exactemplacement.
I.5.4. Les tombes
Entre 110 et 120 sépultures en sarcophages ont puêtre dénombrées33 avec, si on se réfère au rapport desynthèse, entre quinze et vingt tombes en fosses.Pourtant, la lecture des rapports de fouilles nous apermis d'en recenser au moins vingt-six qui sesituent au même niveau que celui d'ouverture dessarcophages ou qui sont surmontées par des cuves,ce qui prouve leur antériorité34. Il convient en outred'intégrer quelques tombes en caisson de dalles,dont une au moins est antérieure à une sépulture ensarcophage (S.42). C'est donc un ensemble appro-chant les 150 tombes qui a pu être fouillé et étudié.
80Sous la direction de S. Duchesne et É. Crubezy Dupouey P., Martin A., Vidal M., Duchesne S.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 61 : Vindrac, église funéraire 3, transfor-
mation et annexe nord.
Sur les 115 sépultures en sarcophages réperto-riées dans le rapport de synthèse et l'article dacty-lographié, 93 sont détruites totalement ou partielle-ment, perturbées (brisées pour récupérer lemobilier funéraire), ou réemployées à l'époquemédiévale ce qui réduit considérablement l'intérêtde leur chronotypologie.
Qu'elles soient en sarcophages, en terre libre ouen caissons les tombes sont orientées est/ouest saufexceptions, puisque vingt et un sarcophages sontnord/sud35, anomalie considérée comme le résultatde déplacements liés à la construction de l'édificemédiéval (Bessou 1977-1986, 37). Il n'y a pas lieu deretenir une telle hypothèse : cette disposition tient ausouci d’exploiter au mieux l’espace disponible.
Les sarcophages monolithes en grès pour-raient avoir été extraits du massif forestier primairede La Grésigne, des communes toute proches deMarnaves au lieu-dit Cimetière des Anglais, de Ton-nac aux Vialards, de Vaour, mais aussi de la limitesud de la commune de Vindrac où se situe un gise-ment de meulières (Bessou 1978, 3 ; 1979, 80 ; CAGTarn 1995, 158 et 247 ; Millet 1997-1998, 85).
Les cuves (fig. 65) sont trapézoïdales avecquelques variantes de conception (trapèzes rec-tangles, à flancs courbes, à tête semi-circulaire) etelles comptaient, selon l’abbé Bessou, un bisome quinous apparaît problématique. Ces différences deforme n’ont aucune implication chronologique36.Les longueurs évoluent entre 1,74 et 2,22 m, pour
81 Présentation des sitesDupouey P., Martin A., Vidal M., Duchesne S.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 62 : Vindrac, église funéraire 3, sarcophage 70, bisome ? (M. Bessou).
(33) 115, par M.Bessou (article, 27) ; 120, dans la CAG Tarn, 1995, 253 ; 110, mentionnés par Melle Fl. Millet, 82.(34) Rapport 1979 : 2 sépultures (p.1) ; 5 sépultures (p.3) dont une sous le S.33, une au pied du S.34, deux sous S.30, deuxencadrant S.39 ; 1980/1981 (p.3), quinze sépultures dont cinq d’enfants ; 1984 (p.4), une dans le chevet pentagonal de lachapelle 3 (deux squelettes superposés dont un sur brancard) ; 1985, trois sépultures sous S.99 à S.101.(35) Sarcophages 10, 20, 21, 27, 41, 46, 47, 50, 51, 52 à 60, 71 et 102 du premier niveau (le plus profond) et 35 et 75 dudeuxième étage.(36) Trapèze rectangle : S.16 à 18, 22, 39, 48, 64, 72, 73, 81, 89, 100, 102 ; flancs courbes : S.3, 66, 109 ; tête semi-circulaire : S.36et 113 ; bisome : S.70.
une moyenne autour de 2 m. Les couvercles sontdans leur très grande majorité en bâtière à quatrepans et se répartissent sur l'ensemble des secteursde la nécropole. D'autres dont la morphologie estdifférente paraissent groupés - ceci étant illusoirecompte tenu des destructions - et sont à méplat lon-gitudinal, alors que les couvercles plats et épais,bombés ou à trois pans longitudinaux du type deBordeaux datés dans le VIIe siècle (Delahaye 1993,143-146) ne sont représentés qu'en un ou deuxexemplaires37 (fig. 65 et 66).
L'aménagement de l'intérieur des cuves per-met d'identifier quatre types de logettes cépha-liques - coussinets carrés, en quart de rond, enquart d'ovale, colonnettes (fig. 65, fig. 67) - lesdeux premiers étant dans quelques cas reliés parune plinthe étroite38, parfois assez élaborée (Millet1997-1998, 321).
Deux cas particuliers ont été mis en évidencepar M. Bessou, ceux du bisome S.70 et du S.110. Lepremier (L. 2,04 m, l. à la tête 1,30 m, l. aux pieds 0,80m, h. 0,62 m) dont les flancs sont ornés de neufsséries de chevrons superposés en inclinaison inver-sée, comporte une paroi percée de quatorze petitesouvertures en plein cintre. En dehors de ses dimen-sions (L. 1,83 m, 0,75 m à la tête, 0,47 m aux pieds)qui sortent quelque peu de la norme, la sépulture110 offrait la particularité de receler un lit/brancardde bois (1,40 m de L., 0,40 m de l.) qui n'était pas àses dimensions (Bessou 1977-1986, 39-40).
L'enfouissement des sarcophages répond àdes critères qui sont loin d'être systématiques,puisque les fosses individuelles qui les reçoivent, sielles atteignent parfois le sol naturel, ont aussi desprofondeurs variables, même pour des sarcophagesjuxtaposés (entre 1,74 et 2,16 m). La puissance decreusement s'adapte à la hauteur de la cuve, sonouverture affleurant le niveau du sol de circulationde l'Antiquité tardive comme cela a été reconnu enlimite nord de la nécropole. Les couvercles scellés aumortier étaient donc la seule partie visible de lasépulture.
82Sous la direction de S. Duchesne et É. Crubezy Dupouey P., Martin A., Vidal M., Duchesne S.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 63 : Vindrac, sarcophage 39 à l’ouverture
(M. Bessou).
(37) En bâtière à quatre pans : S.4 à 7, 9, 11, 15, 20, 21, 26, 32, 37, 39, 40, 42, 46, 55, 60, 61, 64, 73, 77, 82, 83, 85, 86, 89, 90, 93,95, 96, 102, 109, 110 ; à méplat longitudinal : S.87, 92, 94, 97, 99, 100 ; plats : S.18 et 98 ; bombés : S.22 et 81 ; trois pans : S.19.(38) Coussinets carrés : S.1, 3, 20, 27, 44, 49, 56, 95 ; quart de rond : S.5, 7, 9, 17 à 19, 21 à 23, 29, 33, 34, 37, 38, 40, 46, 59, 67,71, 76, 77, 79, 81, 82, 90, 92, 93, 94, 99, 100, 102, 105, 110 ; quart d'ovale : S.6, 14, 16, 24, 26, 31, 36, 39, 42, 45, 47, 48, 51, 52,60, 65, 83, 86, 88, 96, 109 ; colonnettes : S.43, 58, 68.
On a déjà dit que la presse des tombes alen-tour de l’église funéraire 3 avait conduit, au nordcomme au sud, à des superpositions de sarcophagesdans ses annexes : la deuxième strate compte unevingtaine de cuves (fig. 68), mais, du fait des des-tructions médiévales, elle était probablement plusfournie en réalité. Dans ces annexes, un sol construitrecouvrait tant le premier que le second niveau dessarcophages et il en allait peut-être de même dansl’église où le fait cependant n’a été vérifié qu’àl’ouest (donc sous l’emprise de la possible memoria2). On rappellera que ce sol en béton, parfois peintd’une teinte rouge vif39, pouvait être fait de plaquespropres à chaque sarcophage ou de plages plus
étendues couvrant plusieurs sarcophages à la fois40.Le béton comblait également les intervalles laissésentre les cuves, constituant ainsi des sortes de paroispour autant de caveaux individuels : c’est le casnotamment pour la tombe 76’ qui n’est pas un sar-cophage mais une construction entièrement béton-née. Des trous de 6 cm de diamètre ont parfois éténotés en outre à l’emplacement de ces parois ; ilspeuvent avoir reçu des supports de chancel en maté-riau périssable destinés à isoler et signaler certainestombes.
83 Présentation des sitesDupouey P., Martin A., Vidal M., Duchesne S.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 64 : Vindrac, coin nord/nord-est de l’enclos ? nord, sarcophages 64 et 65 (M. Bessou).
(39) Pour la plage de béton couvrant le sarcophage 14 et la cloison entre les sarcophages 14 et 79 (Bessou 1977-1986, 40).(40) Plaques et sarcophages au-dessus des sarcophages 3, 4, 7, 9, 15, 37, 39, 40, 81 et 82 (annexe nord) et 59, 60, 61, 109 et 110(annexe sud) pour le second niveau.
que six autres objets sont hors contexte (Bessou1977-1986, 46-56).
La présence de mobilier peut être associée avec lamorphologie des cuves et couvercles : on remarqued'abord que toutes les tombes « à mobilier » ont uncouvercle à quatre pans, que douze ont une cuve àaménagement céphalique à coussinets ronds, trois àcoussinets ovales et une à coussinet carré. Cetterelation qui pourrait susciter bien des réflexions nepeut être utilisée en l'état, car les prélèvementsd'objets peuvent avoir été nombreux, ce qui faussele raisonnement.
Sarc. 4 : à hauteur de la ceinture sur le côté gauche, boucleen fer ovale à ardillon droit (fig. 70) que l'on signale àBeaucaire-sur-Baïse (Gers) dans le début du VIIe s. (Larrieuet al 1985, 61-62).
Sarc. 5 : boucle en bronze rectangulaire à ardillon droit enfer (fig. 70), dont on trouve des équivalents dans la nécro-pole de Saint-Germain-des-Prés à Paris, et qui est communedurant le VIe s. (Périn 1985, 363, 470-471).
Sarc. 7 : bague en fer à chaton plat, circulaire (fig. 70).
Sarc. 15 : passe-courroie en bronze, à décor gravé de filetsparallèles à ses flancs et percé à son extrémité d'un trou derivet (fig. 70). Il s'agit d'une pièce ordinaire dont des exem-plaires identiques sont connus autant dans la région pari-sienne, qu'en Charentes-Maritimes durant le VIIe s. (Périn1985, 485 ; Cat. expo. Poitiers 1989-1990, 123) mais qui,compte tenu de son recouvrement par le S.79 daté de ladeuxième moitié du VIIe s. (milieu ?), doit pouvoir se situerdans la fin VIe/VIIe s.
Sarc. 16 : bouterolle massive en fer (fig. 70).
Sarc. 19 : au niveau de la tête, petite boucle rectangulaireen bronze typique du VIe s. (cf. T.5) et petit crochet de feren S (?). A hauteur du bassin et l'une contre l'autre, unebague et une plaque-boucle (fig. 71 et 72). La bague torsa-dée à trois fils (argent, bronze, cuivre), comporte un châtonlosangique en lame d'or à cinq bâtes, disposées en croix etmaintenant des petites pierres ou des pâtes de verre verteet bleu. On peut trouver des équivalents à Beaucaire-sur-Baïse (Gers) dans un contexte de la première moitié du VIe
s. (Larrieu et al 1985, 58-59). La plaque-boucle trilobée estdu type G.1 de la classification de S. Lerenter. Il s'agit d'untype à médaillons, particulier au Sud-Ouest, dont la partiemédiane est divisée en trois dépressions trapézoïdales lon-gitudinales, avec une extrémité à excroissances distales. Lescompartiments remplis d'émail sont à décor champlevé defils d'argent à motifs d'arceaux. Ce type de plaque caracté-ristique de la vallée de la Garonne est daté par Cl. Lorren dumilieu du VIe s. au milieu du VIIe s., à Beaucaire-sur-Baïse dudébut du VIIe s. (Lerenter 1985, 231 ; Larrieu et al 1985, 64,67-68, 136 ; Boudartchouk 2000, 70) et de la seconde moi-tié du VIe s. dans un caveau funéraire à Hitzkirch (Suisse)
L'état lamentable de conservation des sépul-tures, la plupart ayant été détruites ou réutilisées,n'a pas permis à M. Bessou d'entreprendre un relevédes gestes funéraires utilisés lors de l'inhumationdes défunts. Dans les trente neuf sarcophages dontM. Bessou a pu reconnaître le contenu, seuls quatresquelettes sont en bon état de conservation. C'estdire l'importance des destructions, des réutilisations(Bessou 1977-1986, 44) et des rejets d'ossementshumains que l'on retrouve à tous les niveaux del'époque médiévale, ce qui explique la rareté desobservations qu'il a été possible de faire.
I.5.5. Le mobilier
Malgré un pillage presque systématique, quelqueséléments de mobilier subsistent encore dansquelques tombes (fig. 69) et en position secondairedans les terres qui leur sont adjacentes. Vingt sépul-tures en sarcophage comportaient du mobilier deparure, preuve d'une inhumation habillée (S.4, 5, 7,15, 16, 19, 20, 21, 31, 40, 59, 60, 79, 82, 85, 90, 93, 94,96, 110) et une sépulture en terre libre (R.1), alors
84Sous la direction de S. Duchesne et É. Crubezy Dupouey P., Martin A., Vidal M., Duchesne S.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 65 : Typologie des cuves et de leur aména-
gement intérieur et typologie de couvercles (M.
Bessou, modifié par J. Guyon et M. Vidal).
85 Présentation des sitesDupouey P., Martin A., Vidal M., Duchesne S.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 66 : Typologie des couvercles (M. Bessou).
(Martin 1988, 89-101). Dat. proposée : fin VI/VIIe et sansdoute plutôt dans le VIe s.
Sarc. 20 : lame courbe en fer en forme de rasoir (?) au droitde la tête.
Sarc. 21 : au niveau du bassin sur le côté droit, feuille deplomb roulée (45 mm x 26 mm, en développé) (fig. 71), por-tant une inscription en cursive sur les deux faces qui n'a puêtre déchiffrée41 (fig. 67 et 68). Une feuille de même natureest signalée par E. Salin dans la Marne à Vouciennes (Salin1952, 348-349) et une seconde provient de la fouille récented’une sépulture de la fin du VIe s. à Teilhet, Tabariane dansl’Ariège (Portet, Claeys 1998, 40).
Sarc. 31 : vers les pieds, garniture de chaussures de formesemi-circulaire à échancrures latérales terminée par uneboucle rectangulaire à nervures transversales et à ardillondroit (fig. 71). Elle est sensiblement identique à une pièce
du VIIe s. trouvée à Pouzolles dans l'Hérault (Cat. expo.Lattes 1988, 224).
Sarc. 40 : à hauteur du bassin, plaque-boucle damasquinéeen fer. La plaque subcirculaire comporte un décor extrême-ment complexe en fils d'argent. Au centre, carré en cordond'échelle flanqué aux angles de rouelles. De part et d'autre,des motifs d'entrelacs, de lignes sinusoïdales, de grecqueset d'échelles suivent la bordure de la plaque. La boucle estornée de la même manière (échelles, grecques), alors quel'ardillon à base scutiforme est décoré d'un entrelacs àquatre brins encadré par un cordon d'échelle (fig. 71 et 75).Il s'agit ici d'un objet de type septentrional que l'onretrouve couramment dans des contextes de la secondemoitié du VIe et qui perdure durant le VIIe s. (Stutz 1998,151-152, 2000, 40-41).
Sarc. 59 : à hauteur du ventre, boucle en bronze ovale àardillon scutiforme d'un type commun au VIe s ; aux pieds,
(41) D’après M.Rouche, il « peut s’agir d’un texte d’exécration vouant tel ou tel personnage aux tourments éternels païens.Ecriture cursive romaine/mérovingienne » (cf. M. Bessou 1987-1988, 162). Elle a été soumise pour expertise à M. Lejeuneet à Ch. Pietri. Dans un courrier daté de l’année 1984, M. Lejeune écrit “qu’il s’agit de cursive latine tardive,… la languedevrait être aussi latine”.
bouclette rectangulaire en argent à bords biseautés et àardillon scutiforme dont on trouve des équivalents dans leVIe s, par exemple à Beaucaire-sur-Baïse (Gers) ; bouterollede fourreau en argent, ainsi qu'un mince fil d'argent enarceau, vestige d'une broderie (?) (Larrieu et al 1985, 147 ;Périn 1985, 303) (fig. 76).
Sarc. 60 : à hauteur de la ceinture, deux couteaux en ferassemblés par l'oxydation ce qui suppose qu'il s'agit d'unfourreau double, et rivet en bronze à cabochon pyramidalconnu au VIe s. « Au milieu du sarcophage », une boucleovale en bronze à ardillon à petite base scutiforme qu'onpeut également situer dans le courant du VIe s. (fig. 76). Lesquelette de cette sépulture a fait l’objet d’une analyse C14qui situe la chronologie entre 548/590, ce qui confirme etprécise l’inhumation de la seconde moitié du VIe siècle.
Sarc. 79 : entre les rotules, une garniture de jarretière enbronze, la seconde étant située au niveau des chevilles. Àleur hauteur, deux pièces de chaussures (plaque-boucle etcontre-plaque) en fer à décor damasquiné et deux passe-courroies en bronze à décor d'entrelacs pointillés. Les gar-nitures de jarretières sont ogivales à décor gravé d'unruban pointillé qui reprend la forme de l'objet en formantune boucle centrale. La boucle de forme ovale est ornée de
rayures transversales, alors que la base de l'ardillon scuti-forme comprend un filet continu qui en souligne les bor-dures (fig. 77 et 78). Des types sensiblement identiques peu-vent être aussi bien reconnus à Auch dans le Gers (VIe s.)(Lapart 1983, 14-16), qu'à Rouillé en Charentes, dans ladeuxième moitié du VIIe s. (Cat. expo. Poitiers 1989-1990,122). Les petites plaques-boucles en fer comportent undécor damasquiné à ruban d'échelle qui suit la forme desplaques et des rivets et qui encadre un motif serpentiformeà double anneau. Des comparaisons morphologiques et sty-listiques peuvent être faites avec des pièces de mêmenature datées dans la première moitié du VIIe s. ou dumilieu du VIIe s. (Périn 1985, 401 ; Stutz 1998, 153-155).
Sarc. 82 : petite boucle en fer, ovale.
Sarc. 85 : garniture triangulaire en fer de chaussure, sansdécor apparent ; boucle ovale en fer à ardillon droit que P.Périn date dans le début du VIIe s. (cf. T. 4) ; plaque-boucleen bronze à quatre échancrures latérales semi-circulaires età terminaison triangulaire, à décor imitant la taille géomé-trique biseautée (fig. 77 et 79). Qualifiée de « baroque »,elle se prolonge par une boucle rectangulaire godronnéeet un ardillon à base scutiforme. Fréquentes et probable-ment originaires du nord-ouest du bassin parisien, ce type
86Sous la direction de S. Duchesne et É. Crubezy Dupouey P., Martin A., Vidal M., Duchesne S.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 67 : Typologie des aménagements intérieurs des cuves de sarcophages (M. Bessou).
87 Présentation des sitesDupouey P., Martin A., Vidal M., Duchesne S.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 68 : Chapelle 3 et deuxième étage de sarcophages (M. Bessou, modifié par M. Vidal).
particulier de plaque que l'on signale dans le sud-ouest estgénéralement daté de la première moitié du VIIe s.42
Sarc. 90 : boucle ovale en fer.
Sarc. 93 : boucle ovale en bronze, à ardillon droit en fer(fig. 80).
Sarc. 94 : boucle en fer.
Sarc. 96 : à hauteur de la ceinture, petite boucle en fer.
Sarc. 110 : sur le bassin, boucle ovale en fer avec traces dedamasquinure à ardillon droit et une fibule en bronze ; surl'épaule gauche seconde fibule en bronze de même type.Au-delà du fait, que la boucle en fer est commune au VIe s.,les deux fibules peuvent être considérées comme des « fos-siles directeurs ». L'arc arqué et les pieds de la premièresont ornés de côtes transversales en léger relief et le ressortà corde interne s'enroule autour d'un axe à extrémités bou-letées. La seconde de même morphologie, mais sans décor,
est de technique mixte (ressort et axe en fer) (fig. 80). Ellessont toutes les deux du type d'Estagel et proviennent decontextes wisigothiques datés de la fin du Ve s. et du pre-mier tiers du VIe s.43. Il s’agit de la sépulture la plus anciennedu site marquée, en dehors du caractère wisigothique deson mobilier, par la présence d’une inhumation à déforma-tion crânienne (cf. infra).
Sépulture en terre libre, R1 : grande boucle ovale en bronzeà ardillon scutiforme décoré à son extrémité d'un losangegravé à quatre cantons oculés, associés à deux plaques derivets scutiformes décorés d'un double sillon et dont l'unest à module géminé (fig. 80). Nombreux en Aquitaine eten Septimanie, on les signale dans le VIe s. (Périn 1985, 469)et plus précisément dans son derniers tiers mais sans allerau-delà du début du VIIe s. (Stutz 1998, 140 ; Boudartchouk2000, 59, 62-63).
Sépulture en fosse, R3 : une analyse C14 sur le squelette apermis de déterminer une chronologie comprise entre 641et 766.
(42) Périn 1985, 373 ; Abaz 1987, 418 ; Stutz 1998, 152-153 ; 2000, 42-44.(43) Ripoll 1991, 111-132 ; Cat. expo. Lattes 1988, 184 ; Feugère 1988, 8.
Un certain nombre d'objets trouvés hors tombe sonttypochronologiquement intéressants (fig. 81). En avant duS.89, plaque-boucle rigide en bronze, à morphologie lyri-forme et excroissances latérales avec un décor ajouré. Objetd'inspiration wisigothique, il est daté dans la seconde moi-tié du VIe siècle, mais aussi dans le VIIe siècle, avec descontextes précis (Fingerlin 1967 ; Cat. expo. Lattes 1988,219) de la fin du VIe/début VIIe siècle (Ripoll 1991, 120).
Bien que l'étude de l’ensemble de ces pièces d'ha-billement soit limitée par le faible nombre d'objetsrecueillis in situ - sur 116 sépultures, 20 comportaient dumobilier dont seulement huit à dix peuvent être exploités -,elle prouve que cette nécropole a une durée d'utilisationcomprise entre la fin du Ve/premier tiers du VIe et la pre-mière moitié du VIIe s.44, et peut-être jusque vers la fin VIIe
s. avec la présence d'agrafes à double-crochets.
En fait, l’intérêt de ce matériel vient plutôt de sa dis-parité : aux côtés des objets aquitains attendus, il comptenombre d’éléments de parure issus du monde wisigothiqueou de Gaule septentrionale. C’est là un phénomène qui nemanque pas d’interroger, surtout si on le rapproche deconstatations similaires faites sur les sépultures de Larroque-Cestayrols et celles de la nécropole de Giroussens, dans leTarn (Cubaynes, Lasserre 1966, 303-310 ; Lassure 1991, 205-223) qui témoignent elles aussi de zones d’influence diffé-rentes aux marges du Toulousain (Stutz 2000, 37).
88Sous la direction de S. Duchesne et É. Crubezy Dupouey P., Martin A., Vidal M., Duchesne S.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 69 : Vindrac, tombes à mobilier et mobilier hors tombes (M. Bessou).
(44) Dans la CAG Tarn, cette nécropole est datée de la fin VIe au VIIe s. (p.254).
trois agrafes à double-crochets en bronze (deux exem-plaires) et en fer, trouvées près des S.5 et 30 et dans le sec-teur H. Quelquefois associés à des fibules ansées symé-triques, il s'agit d'un indice chronologique tardif daté de lafin du VIIe s. (Stutz 1998, 156-158).
un ardillon en bronze de boucle (secteur D).
applique circulaire en bois de cerf, à trois petits rivetsen fer. Une des faces est décorée d'une suite de quatredemi-cercles tangents à trois filets.
89 Présentation des sitesDupouey P., Martin A., Vidal M., Duchesne S.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 70 : Mobilier in situ dans les sarcophages S4 (n°1), S5 (n°2), S7 (n°3), S15 (n°4) et S16 (n°5) (M. Bessou).
90Sous la direction de S. Duchesne et É. Crubezy Dupouey P., Martin A., Vidal M., Duchesne S.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 71 : Mobilier in situ dans les sarcophages S19 (n°6 à 8), S21 (n°9), S31 (n°10) et S40 (n°11) (M. Bessou).
91 Présentation des sitesDupouey P., Martin A., Vidal M., Duchesne S.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 72 : Vindrac, Plaque-boucle (L. 95 mm) et bague (diamètre 19 mm) de la tombe 19 (M. Bessou).
I.5.6. Retour sur la chronologie :Vindrac, un site exemplaire pour sonoccupation continue
Les données chronologiques fournies par l’étude dumobilier funéraire ne doivent pas faire oublier cellesque nous avons signalées chemin faisant à proposde la céramique ou des monnaies car le rapproche-ment de toutes ces indications atteste pour le site deVindrac d’une continuité d’occupation tout à faitremarquable.
Rappelons en effet que les niveaux les plusprofonds laissent deviner l’existence d’un premierétablissement dont on doit tout ignorer sauf qu’il estantérieur à la romanisation de la contrée, ce qui n’estpas si courant. Et cette installation des IIe et Ie siècleavant notre ère a eu tôt fait de céder la place, dès lesdébuts de l’Empire sans doute, à une villa dont lesquelques mètres carrés qui ont été fouillés laissententrevoir qu’elle a connu au moins deux phasesimportantes au cours d’une histoire longue dequelque cinq siècles45. Or ces deux phases ont com-mandé, chacune à sa façon, tout le devenir du site.La première, qui est à placer dans la seconde moitiédu Ier siècle de notre ère, est responsable sinon desorientations (qui ont peut-être été héritées du
passé), du moins de la stricte ordonnance du réseaudes murs qui forme la trame des relevés archéolo-giques. La seconde, vers 400 ou un peu plus tard, ainscrit au sein de cette trame d’autres éléments éga-lement prégnants car les hommes du haut MoyenÂge ont repris pour leurs propres constructions despans entiers de ces réaménagements qui ont surtoutaffecté le secteur méridional de la zone fouillée.
Pour autant, ce n’est pas pour abriter desvivants, cette fois, que les murs de l’établissementromain ont été relevés, mais afin d’accueillir destombes. Cette présence nouvelle des morts, désor-mais sans retour, participait d’un processus pluslarge : celui de la christianisation des campagnesdont le site donne à voir et la (relative) précocité etla grande rapidité. La précocité : la tombe la plusancienne - le sarcophage 110 - date apparemment dutournant des années 500 ; elle relève donc sans doutede la troisième génération de fidèles dans la régionpuisque le premier évêque connu pour Albi estattesté aux alentours de 409 (Grégoire de Tours, His-toires, II, 13). L’indice paraîtrait modeste si la cuven’avait bientôt été flanquée de trois ou quatre autressarcophages qui ont sans doute pris place commeelle dans une des anciennes salles de la villa plus oumoins réaménagée pour l’occasion et tout laisse à
(45) Cette villa qui s’insère dans une occupation de l’espace où s’inscrivent également à moins d’une dizaine de kilomètresplus à l’ouest et au sud-ouest de deux sanctuaires gallo-romains (Bessou 1978, 187-218 ; CAG Tarn 1995, 247).
92Sous la direction de S. Duchesne et É. Crubezy Dupouey P., Martin A., Vidal M., Duchesne S.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 73 : Vindrac, inscription en cursives sur
feuille de plomb (M. Vidal, d’après M. Bessou).
penser d’autre part que l’investissement du reste dusite par des tombes a été des plus rapides. Ce juge-ment vient de la présence, quelques mètres à peineplus au nord, d’une memoria d’un plan plusconforme aux établissements funéraires de l’Anti-quité tardive que cette première memoria 1’ : c’est lachapelle 1 de la nomenclature de l’abbé Bessou pourlaquelle manquent des critères de datation aussiprécis. On la jugera cependant plus ou moinscontemporaine des tombes 110, 59 et 60, sinonmême antérieure à elles, pour peu qu’elle réponde àune inhumation privilégiée comme le voulait sondécouvreur. Et il faut peut-être compter égalementavec la possible chapelle 2, toute proche elle aussi,dont nous avons assez dit cependant combien sonexistence nous apparaissait problématique.
Or, très rapidement aussi, ces installationsfunéraires ont justifié l’installation d’une véritableéglise - la chapelle 3 de l’abbé Bessou - assez impor-tante pour avoir été, sans doute dans un second
temps, dotée d’annexes qui les ont tantôt respectéeset tantôt annihilées. L’affaire a été rondement menéeen effet, sans doute en l’espace de deux à trois géné-rations seulement, car dans la seconde moitié du VIe
siècle déjà, la memoria 1 avait certainement disparuau-dessous de l’annexe nord de l’église, comme entémoigne le mobilier du sarcophage 40 qui a étéplacé sous son couvert. On touche là au terme d’unprocessus complexe de transformations qui n’éton-nera guère les spécialistes de l’archéologie chré-tienne. Les monuments qu’ils étudient ont en effetpour particularité d’avoir connu d’incessantesmodifications tout au long de l’Antiquité tardive etdu haut Moyen Âge : songer à nouveau, dans larégion entendue au sens large du terme, à l’exemplede la basilique chrétienne de Saint-Bertrand-de-Comminges qui ne compte pas moins de quatreétats différents en moins de deux siècles sans doute.C’est assez dire qu’au sein des premiers monumentschrétiens de notre pays, Vindrac occupe désormaisune place de choix, qu’il doit à l’intuition et à la per-sévérance de l’abbé Bessou. C’est d’autant plus heu-reux que ces monuments ne sont pas si nombreux,spécialement dans la région. Voir ainsi le recense-ment que le Ministère de la Culture a publié sous letitre Les premiers monuments chrétiens de la France :son tome 2 (Duval 1996, 147-209) compte moins decinquante notices pour le Sud-Ouest et le Centre,dont aucune, il faut le noter, pour le département duTarn.
Alentour de l’église funéraire 3 qui constituaitdésormais, avec ses annexes, un élément majeur dela christianisation du paysage, les données archéo-logiques, on l’a vu, ne permettent pas de douter quela nécropole a été fréquentée au moins jusqu’à la findu VIIe siècle. En réalité, elle est probablement res-tée en usage beaucoup plus longtemps, au mêmetitre que l’église à laquelle elle était attachée. On necomprendrait pas sans cela l’installation au mêmeemplacement, peu après l’an Mil sans doute, d’unenouvelle église à nouveau flanquée d’un cimetière.L’évidence archéologique fait certes défaut pourattester d’une totale continuité des fonctions funé-raires mais cela peut tenir au fait que passée la fin duVIIe siècle, les tombes étaient vraisemblablementdésormais sans mobilier ou, en tout cas, sans mobi-lier que nous sachions dater. C’est là, finalement, lepoint sur lequel nous nous séparerons le plus déci-dément de l’abbé Bessou. Sensible à l’important hia-tus entre les deux temps forts de la chronologie qu’ilavait justement mis en évidence dans sa fouille - ledébut du haut Moyen Âge, qui a été marqué par la
93 Présentation des sitesDupouey P., Martin A., Vidal M., Duchesne S.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 74 : Vindrac, feuille de plomb inscrite (M. Bessou). Deux photos !
construction des premiers monuments chrétiens etle XIIIe siècle qui a signé la fin de l’histoire du site -il avait placé cette histoire sous le signe de la dis-continuité. On a assez vu par ce qui précède quepour notre part, nous préférerions songer plutôt àune occupation continue, à la fois cultuelle et funé-raire, de la butte de Vindrac entre les années 500 et1250 à 1300, dates rondes. Ce qui montre bien la partde subjectivité inhérente à toute synthèse archéolo-gique car ces deux interprétations sont égalementfondées l’une et l’autre sur une même documenta-tion : celle qu’avait soigneusement rassemblée l’in-venteur du site.
Figure 75 : Vindrac, Plaque-boucle à décor damas-
quiné (L. 80 mm) de la tombe 40 (M. Bessou).
94Sous la direction de S. Duchesne et É. Crubezy Dupouey P., Martin A., Vidal M., Duchesne S.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 76 : Vindrac, mobilier in situ dans les sarcophages S59 (n°12 à 15) et S60 (n°16 à 19) (M. Bessou).
95 Présentation des sitesDupouey P., Martin A., Vidal M., Duchesne S.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 77 : Vindrac, mobilier in situ dans les sarcophages S79 (n°20 à 26), S85 (n°27 à 28) et plaque-
boucle rigide hors de la tombe 89 (n°29) (M. Bessou)
96Sous la direction de S. Duchesne et É. Crubezy Dupouey P., Martin A., Vidal M., Duchesne S.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 78 : Vindrac, pièces d’habillement de la tombe 79 (n°6 et 7 en bronze, 1 à 3 en fer damasquiné)
(M. Bessou).
Figure 79 : Vindrac, Plaque-boucle (L. 78 mm) de la tombe 85 (M. Bessou).
97 Présentation des sitesDupouey P., Martin A., Vidal M., Duchesne S.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 80 : Vindrac, mobilier in situ dans les sarcophages S93 (n°30), S110 (n°31 à 33) et dans la tombe
en fosse R1 (n°34 à 36) (M. Bessou).
I. 6. Les cimetières des Horts et del’Eglise, à Lunel-Viel (Hérault) (Raynaud Cl., Murail P.)
I.6.1. De l’agglomération antique auvillage médiéval
Situation géographique
L’agglomération de Lunel-Viel a livré une ampledocumentation dont on rappellera uniquement lesgrands traits.
Créée ex-nihilo vers le milieu du Ier siècle, labourgade se développe autour d’un carrefour rou-tier, sur une modeste surface de 1 à 2 hectares (fig.82). Thermes publics, installations artisanales ethabitations voisinent pour organiser un pôle d’acti-vité agraire et d’échange contrôlant une dizained’établissements secondaires dispersés dans la cam-pagne alentour (Favory 1994). À partir d’une trameorientée selon les axes de la centuriation nîmoise,l’agglomération évolue tranquillement jusqu’audébut du Ve siècle, avec de profondes transforma-tions architecturales - abandon des édifices publics
puis réutilisation par l’habitat privé, abandon desvastes demeures « à l’italienne » pour des maisonshumbles.
Les premières décennies du Ve siècle mar-quent un tournant avec l’abandon progressif du vil-lage initial et la création de deux nouveaux quar-tiers, l’un au nord-ouest où s’installera plus tard -mais quand ? - l’église saint-Vincent, l’autre aunord-est, encore inexploré. Ce dernier sembleoccupé, d’après les ramassages de surface, jusquevers la fin du VIe siècle ou les premières années duVIIe siècle, puis l’habitat se concentre au nord-ouestd’où il ne bougera plus par la suite.
C’est au sud de l’église Saint-Vincent que l’onenregistre ensuite les traces d’un habitat durable,mais la présence du village médiéval et moderne nefavorise guère les fouilles, de sorte que l’organisa-tion nouvelle échappe à l’analyse. Par sa morpholo-gie parcellaire, sa forme ramassée et sa position cen-trale, ce quartier évoque l’image d’un villageresserré dans un enclos dont aucun vestige n’estencore connu. Si les maisons du haut Moyen Âgesont connues seulement à travers quelques trous de
98Sous la direction de S. Duchesne et É. Crubezy Raynaud Cl., Murail P
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 81 : Vindrac, mobilier hors tombe n°37 (près du S30), n°38 (secteur H), n°39 (près du S5), n°41
(fondations église funéraire 3) et n° 42 (secteur D) (M. Bessou).
poteaux ou tronçons de mur aperçus à l’occasion desondages, les aménagements agraires en périphérietémoignent bien du dynamisme de la communauté,notamment une aire d’ensilage dans les ruines d’unancien quartier gallo-romain (Raynaud 1990).
I.6.2. Les nécropoles
La nécropole des Horts
La nécropole des Horts (fig. 83) s’inscrit à plus d’untitre dans la continuité d’une conception antique dela cité des morts. En effet, bien des traits se ratta-chent à des traditions antiques : le cimetière en pleinchamp, à l’écart de l’habitat et non enclos, l’absenceprésumée de tout édifice religieux, l’organisation enrangées, la prépondérance de la sépulture indivi-duelle et la raréfaction des enfants. Toutefois, elle
répond également à une évolution des pratiquesfunéraires caractéristique du moment (V-VIe s.) avecle développement des tombes sous dalles et des sar-cophages, l’apparition de coffres en bois non cloués,l’adoption de l’inhumation habillée livrant des élé-ments de parure (fig. 84), et les premières représen-tations de la croix sur les stèles.
La fouille n’a pas été poussée à l’exhaustivitémais le cimetière semble à peu près circonscrit, seulela limite nord n’apparaissant pas nettement. La dis-position et la densité des 135 tombes fouillées auto-risent à restituer un ensemble de 170-180 tombes.Elles sont toutes orientées, à une exception près,selon un axe est/ouest, le squelette céphalique àl'ouest (Murail, Raynaud 1996).
99 Présentation des sitesRaynaud Cl., Murail P
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 82 : Localisation générale des secteurs d’habitats et de nécropoles.
1, secteur thermal ; 2, quartier ouest et zone agraire ; 3, quartier central ; 4, maisons et jardins du quar-
tier sud ; 5, chemin du Verdier ; 6, nécropole du Verdier ; 7, habitat du Verdier nord ; 8, zone agraire
et nécropole des Horts ; 9, chemin des Horts ; 10, noyau du village médiéval : quartier de l’église Saint-
Vincent et cimetière ; 11, bras fossile de la rivière Dardaillon.
La nécropole dégage le profil d’une commu-nauté apparemment stable et unie, qui enterre sesmorts dans un cadre d’une confortable modestie,sans ostentation mais avec une dignité et sans misèreaucune. Les plus aisés achètent à un atelier local dessarcophages de calcaire tendre, d’autres obtiennentdu même atelier de belles dalles qui, agencées soi-gneusement, donneront l’illusion de cuves mono-lithes, mais la plupart des défunts sont déposés dansdes coffres plus rustiques confectionnés en dalles ouen lauzes, en planches ou en assemblages mixtes.
L’inhumation demeure essentiellement indivi-duelle, même si l’on observe une légère progression dela réutilisation des tombes avec 1,26 mort par tombe.Cette tradition est seulement transgressée de façonexceptionnelle durant les dernières décennies de lanécropole lorsque de grands coffres accueillent 4 ou 5corps. Ce regroupement des morts se lit aussi en néga-tif dans 5 tombes (n°54, 59, 61, 71 et fait 18), soigneuse-ment vidées de leur contenu, geste bien différent dupillage et qui pourrait marquer la récupération de ladépouille d’ancêtres allant rejoindre leur famille aprèsl’abandon du cimetière au cours du VIIe siècle.
La nécropole de l’Eglise
Les premières sépultures du quartier Saint-Vincentapparaissent un peu plus tard que celles des Horts,dans la seconde moitié du VIe siècle (Raynaud 1977).Durant cette phase de coexistence avec les Horts, lecimetière livre essentiellement des coffres en dalles(45%) et des sarcophages (38%), sans que l’on puisseaffirmer si ce contraste (seulement 12% de sarco-phages aux Horts) reflète une différenciation socialeou un décalage chronologique.
D’abord organisé en rangées lâches selon lemodèle classique, le cimetière connaît une occupa-tion plus dense lorsqu’il devient après l’abandondes Horts l’unique cimetière villageois, qu’il resterajusqu’au milieu du XIXe siècle. Avec un taux moyende 2,8 individus par tombe dans la phase ancienne,l’entassement des morts ne cesse de s’affirmer,allant parfois jusqu’à 7 à 10 corps par tombe. Quantà la hiérarchisation sociale et aux conditions d’accèsau cimetière, la fouille (250 m2 et plusieurs son-dages) reste trop ponctuelle pour autoriser toutegénéralisation. Les enfants paraissent un peu plus
100Sous la direction de S. Duchesne et É. Crubezy Raynaud Cl., Murail P
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 83 : Lunel-Viel, plan de la nécropole des Horts.
101 Présentation des sitesRaynaud Cl., Murail P
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 84 : Lunel-Viel exemple de mobilier funéraire de la nécropole des Horts.
présents qu’aux Horts, mais des données aussi par-tielles peuvent être biaisées par un regroupementlocal comme les fouilles exhaustives de Dassargues(Lunel, Hérault) l’ont montré (Garnier et al 1995).L’absence de mobilier après le VIIe siècle ne favorisepas la perception de différences sociales, pas plusque l’architecture funéraire ne fait apparaître decontraste.
Abandon du cimetière aux champs et regrou-pement des morts marquent donc un tournant auVIIe siècle et une nouvelle étape dans la gestationvillageoise. Les ressorts du processus demeurentdans l’ombre faute d’une fouille sous l’actuelleéglise Saint-Vincent, rebâtie au début du XVIIe
siècle, après les ravages des guerres de religion. Onvoudrait évidemment expliquer la création du cime-tière par la construction d’une église dans la pre-mière moitié ou au milieu du VIe siècle, hypothèseacadémique mais tout à fait indémontrable pourl’heure. On sait seulement qu’une partie de la façadenord s’appuie sur l’arasement d’un mur de l’habitatdu Ve siècle, mais la stratigraphie ne livre aucun ter-minus antequem pour la construction de l’édifice.
La première évidence n’apparaît qu’au VIIIe
siècle - ou au début du IXe siècle, la datation descéramiques reste incertaine46 - avec le creusementd’un enclos fossoyé marquant définitivement l’em-prise de l’église sur l’organisation du cimetière. Unfossé large de 2 à 2,5 m et profond de 1,2 à1,3 m,enserre une aire ovalaire de 28 m sur 20 m dont l’em-prise sera scrupuleusement suivie par l’église jus-qu’à sa reconstruction moderne (Raynaud 1989,110). C’est bien là un tournant dans l’histoire duquartier, amis s’agit-il de la construction d’une nou-velle église ou seulement du réaménagement desabords d’un édifice préexistant ? Impossible de tran-cher mais la seconde hypothèse semble la plus plau-sible, tant il reste difficile d’envisager une commu-nauté florissante privée d’église jusqu’à l’époquecarolingienne (fig. 85).
Initialement développé sans contrainte, lechamp funéraire est désormais contenu à distancede l’édifice par le fossé qui n’hésite pas, lors de soncreusement, à amputer ou même détruire sarco-phages, coffres et tombes en fosse se trouvant surson tracé (fig. 86). Cette autorité du sanctuaire,inconcevable dans les cimetières antérieurs, s’ac-
compagne d’une forte attraction sur les tombes quise pressent autour de l’enclos et s’établissent mêmeparfois au fond du fossé, pratique surprenanteexprimant la volonté d’approcher au plus près del’église, peut-être aussi le souhait de recueillir leseaux s’écoulant de l’église et prenant une valeur lus-trale (tombes T. 44 et 47). Christianisme naïf entachéde paganisme, ces gestes n’en dénotent pas moinsun profond attachement à la religion et à l’édificequi matérialise désormais son emprise sur le village.
Le cadre et les règles funéraires semblent dèslors fixés. Progressivement colmaté par les limons,le fossé dut supplanté au XIe siècle par un mur d’en-ceinte pérennisant le tracé de l’enclos. Le cimetièreatteignit alors sa plus grande extension, s’étendantvers l’Est sur une centaine de mètres, apparemmentsans contrainte (Raynaud 1989, 107). Cette mutationsuperficielle et d’autres à venir ne modifièrent enrien la position de l’église qui veilla sur les mortsjusqu’à la translation du cimetière hors du village auXIXe siècle.
I.6.3. Le mobilier
La nécropole des Horts a livré un mobilier impor-tant, permettant une datation précise de l'ensemblefunéraire, du début du VIe au VIIIe siècle : les tombesles plus anciennes sont bien datées de la premièremoitié du VIe siècle grâce à un mobilier abondant.Pour la nécropole de l’Eglise, on note une absencede mobilier après le VIIe siècle.
I.6.4. Interprétations et datation
Les deux nécropoles présentent une typologie detombes bien distincte, illustrant des pratiques funé-raires différentes au sein d'une même population.Ce type de différence est retrouvé dans d'autres sites(Bizot 1988) et il est possible qu'elle reflète une struc-turation sociale. Crubézy et Raynaud (1988) ontmontré par ailleurs une augmentation des réutilisa-tions de tombes à partir du Ve siècle dans le sud-ouest de la France. L'exemple de Lunel-Vielconfirme une corrélation nette du phénomène avecl'utilisation des sarcophages et surtout prouvel'existence de plusieurs modes de gestion de l'es-pace funéraire pour une même localité. La très
102Sous la direction de S. Duchesne et É. Crubezy Raynaud Cl., Murail P
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
(46) Voir l’étude des céramiques dans C.A.T.H.M.A. 1993, 179-180.
103 Présentation des sitesRaynaud Cl., Murail P
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 85 : Lunel-Viel l’Eglise, les inhumations du haut Moyen Âge.
1, sarcophage ; 2, coffres de dalles ; 3, bâtière ; 4, coffre anthropomorphe ; 5, sépulture en pleine terre ;
6, coffre sans fond aménagé.
104Sous la direction de S. Duchesne et É. Crubezy Raynaud Cl., Murail P
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 86 : Lunel-Viel l’Église, l’église Saint-Vincent et le cimetière médiéval.
bonne datation de ces nécropoles à une époque cléde la mise en place du christianisme leur confère unin-térêt particulier pour comprendre l'organisationfunéraire d'une nécropole péri-phérique et d'unespace religieux.
I.7. Définition des populationsanthropologiques
Les populations anthropologiques issues des septsites précédemment exposés sont présentées dansun tableau récapitulatif, afin de définir et rappeler
leurs caractéristiques, donnant l’abréviation utiliséetout au long des études, le contexte, rural ou urbain,le type de site, d’église ou de champ d’inhumations,leur datation et le nombre de tombes. Ce dernier élé-ment varie de la présentation des sites, car ne sontpris en compte ici que les tombes munies de resteshumains étudiables : sont donc exclues le stombesvides, les tombes repérées mais non fouillées, lestombes pillées ou détruites (anciennement ourécemment47) (fig. 87).
105 Présentation des sitesRaynaud Cl., Murail P
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 87 : liste des sites et des données anthropologiques.
(47) Dans le cas de la nécropole de Saint-Brice-de-Cassan, les ossuaires qui n’ont pas été étudiés sont exclus.
Sites abréviation contexte site datation nbre de tombes
Saint-Bertrand-de-Comminges, SBC urbain église V-XII 130
nécropole du Plan
Lunel-Viel, LVE urbain église VI-IX 26
nécropole de l'Eglise (HMA)
Lunel-Viel, LVE urbain église VI-IX 13
nécropole de l'Eglise (fin HMA)
Lunel-Viel, LVE urbain église XI et plus 39
nécropole de l'Eglise (MED+MOD)
Lunel-Viel, nécropole des Horts LVH rural champ d'inhumation V/VI-VII 91
Ordan-Larroque, SBCa rural église ? VII-XIII 145
nécropole de St Brice de Cassan
Venerque, nécropole de Rivel VEN rural champ d'inhumation V-VII 127
Vindrac, nécropole VIN rural église VI-VII 15
Isle-Jourdain, GRA rural champ d'inhumation, église VI-XII 754
nécropole de la Gravette
Isle-Jourdain, GRA hma-autoch rural église VII-IX
nécropole de la Gravette
Isle-Jourdain, GRA hma-franc rural champ d'inhumation VI-VII 62
nécropole de la Gravette
Isle-Jourdain, GRA intermédiaire rural église
nécropole de la Gravette
Isle-Jourdain, GRA pmed rural église X-XII
nécropole de la Gravette
II. 1. Détermination de l’âge et du sexe(Romon Th., Murail P., Rougé D., Duchesne S.,
Bruzek Y.)
II. 1.1. Détermination de l’âge
La détermination de l'âge individuel au décès estessentiellement possible grâce au mode d'évolutionrelativement stable dans le temps du squelette aucours de la croissance. Une telle détermination estdonc relativement aisée chez les enfants maisdevient plus aléatoire chez les adultes : c’est pour-quoi deux approches différentes sont envisagées(Romon 1995).
les immatures
Seuls les phénomènes liés à la croissance tels quel'éruption dentaire et la soudure des épiphyses auxdiaphyses sont bien corrélés avec l'âge (Romon 1996).
Ainsi, le schéma de minéralisation des dentsdéciduales et permanentes, basé sur le degré d'érup-tion et de calcification dentaires (Ubelaker 1984) estune méthode efficace, puisque les corrélations avecl'âge sont bonnes, surtout pour les bas âges. Lorsqueles dents ne sont pas suffisamment conservées, lalongueur des os longs (Stloukal et Hanakova 1978)offre une autre possibilité d’estimation, même sicelle-ci est moins exacte.
Dans le cas des immatures décédés en périodepérinatale (fœtus de 6 mois lunaires et les nouveau-nésayant vécu moins d’un mois), l’âge a été déterminé pourle site de La Gravette en utilisant les tables de Fazekas etKosa (1978) qui repose sur l’observation des points d’os-sification des os longs ainsi que leur longueur.
Pour les sujets adolescents, les méthodes pré-cédentes ne sont plus suffisamment justes ; alors, ledegré de maturation du squelette (fusion des épi-physes aux diaphyses des os longs) devient le critèrele plus important. Au sens biologique, un adoles-cent se caractérise par la formation complète desdeuxièmes molaires maxillaires et mandibulaires(Murail 1996) et la suture sphéno-occipitale marquele passage à l’âge adulte lorsqu’elle se synostosecomplètement, entre 18 et 20 ans.
les adultes
Les méthodes directes ne permettent pas d'envisa-ger une répartition par classes d'âge au décès suffi-samment fine pour les adultes.
Toutefois, le degré de maturation de la clavi-cule comme marqueur d'âge permet de séparer lesadultes jeunes (moins de trente ans) des adultes plusâgés. En effet, l’extrémité médiale de la clavicule estle dernier point du corps à s’unir, vers 25 ans, et laligne épiphysaire disparaît vers 30 ans (Owings-Webb 1985).
Pour les adultes de plus de 30 ans, aucuneméthode d’estimation n’est satisfaisante aujour-d’hui en raison d’erreurs systématiques et d’unecorrélation à l’âge des différents critères peu perfor-mante. En effet, la précision atteinte est une fois surdeux supérieure à 10 ans (Masset 1990). Cependant,la méthode des vecteurs de probabilité (Masset1982), basée sur l’observation des sutures crâ-niennes, est l’une de celles qui éliminent la majoritédes erreurs. Elle consiste en une ventilation dechaque individu, d’après son degré de synostosecrânienne, selon la probabilité d’appartenance àchacune des classes d’âge (de 20-30 ans à plus de 80ans). Ce degré de synostose est obtenu par lamoyenne des stades des trois principales suturescrâniennes. La cotation des stades employée estcelle de Broca inversée (0 à 4 : absence de synostoseà synostose complète). Le résultat obtenu n'est pasun âge individuel, mais la répartition de la popula-tion des adultes décédés par classe d'âge.
II. 1.2. Diagnose sexuelle
Contrairement à la détermination de l’âge, la déter-mination sexuelle d'un individu n'est actuellementfiable que sur un sujet adulte. En effet, une telledétermination ne donne de bons résultats que sur lebassin, et uniquement si elle s'appuie sur des diffé-rences morphologico-fonctionnelles liées à la méca-nique obstétricale. Ces différences ne s’observentqu'après maturation sexuelle, ce qui rend actuelle-ment problématique les déterminations sur descoxaux d'enfants (Romon 1995).
II MATÉRIEL ET MÉTHODES
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
107 Matériel et méthodesRomon Th., Murail P., Rougé D., Duchesne S., Bruzek Y.
La méthode mise au point par Bruzek (1991)est à ce jour la plus pertinente (corrélation supé-rieure à 91% pour les pièces les moins bien conser-vées) (Romon 1996). Elle consiste en une évaluationvisuelle de cinq caractères sur les trois parties mor-phologiques de l’os coxal (ilium, ischium et pubis).Ils sont, dans un premier temps évalués isolément,donnant une préférence féminine, masculine ouindéterminée. Dans un second temps, une évalua-tion simultanée des cinq caractères propose une esti-mation sexuelle de l’os coxal considéré. Certainsindividus, pour lesquels une étude complète de l’oscoxal est impossible, ont été établis comme féminindu fait de la présence d’un sillon pré-auriculaire net.Cette présence indique dans 95% des cas une femme(Bruzek 1991).
Trois méthodes supplémentaires ont été employées :
l’utilisation de fonctions discriminantes sur les oscoxaux (Bruzek 1984, 1991 ; Schulter-Ellis et alii 1985 ;Novotny 1975), pour Vindrac et l’Isle-Jourdain ;
une analyse discriminante sur les variablesmétriques infra-crâniennes afin d’augmenter lenombre d’individus sexés en l’absence des oscoxaux, pour Saint-Bertrand-de-Comminges,Venerque et l’Isle-Jourdain. Les équations obtenues,spécifiques à ces sites, ne sauraient être utiliséespour des individus provenant d'autres gisements.Les résultats ont ensuite subi une sélection sévèreafin de ne conserver que les plus probables ;
et la méthode décrite par Ferembach et alii (1979)appliquée au crâne, lorsque les os coxaux étaientabsents, pour Vindrac. L'attribution d'un sexe n'a étéretenue seulement lorsque le crâne présentait descaractères très prononcés en faveur d'un sexe.
L’établissement de ces données biologiquesest essentiel, car il permet d'estimer la table de mor-talité et d'étudier le recrutement des populations.
II. 2. Recrutement et organisation(Romon Th., Murail P., Rougé D., Duchesne S.)
L’étude du recrutement a pour but de dresser untableau de répartition des décès par âges et parsexes, les seules données de mortalité auxquellesnous avons accès. À partir de ce tableau, on peutespérer reconstituer la démographie d’une popula-tion inhumée. Seulement, en raison de nombreuseslimites méthodologiques (notamment l’estimationde l’âge au décès des adultes) et de la nature même
de l’échantillon de population archéologique (repré-sentation de l’échantillon osseux en rapport avec lapopulation vivante), il est difficile de réaliser uneétude paléodémographique au sens strict (Murail1996).
Ainsi, le but de cette analyse est l’étude de lastructure par âges et par sexes, ce qui revient à déter-miner si l’échantillon étudié a une distribution sem-blable à celle d’une population naturelle, et préciserde quelle manière elle s’en écarte. Cela permet decaractériser l’échantillon, qui sera interpréter entermes de pratiques funéraires ou de stratégie defouille (Crubézy et alii 1998).
II. 2.1. Les immatures
La démarche suivie est le calcul des quotients demortalité à partir du dénombrement par classesd’âge. Les quotients sont ensuite comparés à unschéma de mortalité archaïque, applicables auxpopulations pré-jennériennes. Ils intègrent la varia-bilité statistique des quotients pour des espérancesde vie de 25 et 30 ans, à partir des tables types deLedermann (1969). Si le profil est conforme à ceschéma, l’échantillon étudié est assimilé à unepopulation naturelle, sinon il reflète des anomaliesdans la composition de la population, interprétéesalors comme une sélection des inhumés.
Les individus immatures sont répartis enclasses d’âge quinquennales, exception faite dedeux premières classes d’une durée d’un an et dequatre ans en années révolues. Afin de mettre enévidence des anomalies dues à un recrutement, etnon à des erreurs de répartition (Castex 1994 ; Sellier1996), le principe de conformité a été appliqué : ilrevient à isoler l'hypothèse la plus vraisemblable derépartition des enfants par classe d'âge au décès. Ils'appuie sur le fait que pour les populationsarchaïques, les courbes des quotients de mortalité(Ledermann 1969) présentent une allure identique :
un quotient de mortalité pour la classe 1-4 ansmaximum,
un quotient de mortalité pour la classe 5-9 ansminimum,
et le rapport entre les classes 5-9 et 10-14 ans(D(5-9)/D(10-14)) voisin de 2.
108Sous la direction de S. Duchesne et É. Crubezy Romon Th., Murail P., Rougé D., Duchesne S.,
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
II. 2.2. Les adultes
La méthode utilisée, les vecteurs de probabilitésappliqués aux sutures exocrâniennes (Masset 1982),permet de mesurer l’impact global de la mortalitésur une population de cimetière. Elle offre uneimage de la répartition par âge des adultes, en 7classes d’âge décennales. L’âge individuel n’est pasestimé mais un profil général est obtenu. Ainsi, lesdifficultés de la détermination de l’âge au décès desadultes et de la corrélation de l’indicateur avec l’âged’au moins 0,9 (le cas d’aucun, actuellement) sontécartées.
Ce profil général est suffisamment fiable pourdéterminer si la structure par âge est assimilable àune population naturelle. Il est alors comparé auschéma de mortalité archaïque, se référant auxtables types de Ledermann (1969). Les anomaliesrencontrées déterminent des populations anormale-ment jeunes ou âgées (Masset 1982).
II. 2.3. Les caractères discrets
En dehors des marqueurs génétiques, les caractèresdiscrets sont actuellement la principale voie d'étudepermettant les recherches sur les relations deparenté entre individus. Supposer un rapproche-ment génétique entre deux individus impliqued'une part que le déterminisme génétique de ces
caractères est connu, ce qui est rarement le cas, etd'autre part que ces individus possèdent de nom-breuses correspondances pour des variationsstables et rares de certains caractères (Ulrich 1965).Néanmoins, la similitude de caractères peut êtredue à des influences sensiblement identiques dumilieu (Crubézy 1991). Ainsi nous pouvons aussienvisager des liens entre différents individus, quiont partagé le même environnement, même si ledéterminisme génétique de leurs caractères com-muns n'est pas prépondérant.
Les caractères discrets sont des variations ana-tomiques, pouvant être codées présent ou absent. Letraitement statistique de ces données (tests du Chi_,de Fisher) en fonction des individus, de leur posi-tion dans le cimetière, mais aussi du côté présentantle caractère, de l'âge et du sexe de ces individus, per-met d’évaluer chaque caractère à sa juste valeur.Seuls les caractères suffisamment représentés dansla série pour pouvoir subir les tests statistiques sontprésentés (Crubézy et alii 1996).
Pour la nécropole de Rivel, le choix des carac-tères (Saunders 1978) est assez restreint du fait dumauvais état de conservation des ossements. Deplus, cette étude ayant déjà été entreprise pour les 44premiers sujets en 1986, les caractères utilisés par E.Crubézy, ont été repris. Ce sont ces mêmes carac-tères qui ont été utilisés pour la nécropole de Saint-Bertrand-de-Comminges (fig. 88).
109 Matériel et méthodesRomon Th., Murail P., Rougé D., Duchesne S.,
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Caractères discrets
Métopisme
Os wormiens
Foramen pariétal
Os au lambda
Perforation olécranienne
Partie non articulaire de la cavité sigmoïde
Insertion du brachial antérieur en gouttière
Troisième trochanter
Fosse hypotrochantérienne
Fossa soleï
Incisives en pelles
Figure 88 : Liste des caractères étudiés sur les nécropoles de Saint-Bertrand-de-Comminges48 et de Rivel.
(48) Du tout autant aux conditions de l’environnement physique (climat, nature des sols, etc) qu’aux pratiques funérairesd’inhumation en pleine terre, associées au fait que l’étude ostéoscopique des caractères discrets ne prend en compte quele ssujets adultes (car une majorité de ces caractères osseux disparaissent et apparaissent au cours de la croissance).
Pour la nécropole de Vindrac, les caractèresétudiés sont les facettes d'accroupissement sur letibia, la surface antéro-supérieure double du calca-neum, la présence d'un canal condylien postérieur,et la présence d'un canal hypoglosse bipartite (Saun-ders 1978).
Pour la nécropole de Saint-Bertrand-de-Com-minges, les autres caractères étudiés sont le troumentonnier, l’os acromial, l’apophyse sus-épineusede l’humérus, la fosse de Allen du fémur et la sacra-lisation de la 5e vertèbre lombaire (Saunders 1978).
Pour la nécropole de la Gravette, l’étude aporté sur un total de 43 caractères discrets, 22 carac-tères crâniens (Hauser, De Stephano 1989) et 21caractères localisés sur le squelette infra-crânien(Saunders 1978) (fig. 89). La conservation assezmédiocre des restes osseux a permis l’étude de 431individus : 35 individus culturellement francs, 55appartenant aux autochtones du haut Moyen Âge,279 individus inhumés à la période médiévale de lazone 2 et 47 sujets inhumés à la période médiévalede la zone 5.
110Sous la direction de S. Duchesne et É. Crubezy Romon Th., Murail P., Rougé D., Duchesne S.,
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 89 : liste des caractères étudiés sur la nécropole de la Gravette.
Caractères discrets crâniens Caractères discrets infra-crâniens
métopisme patella emarginata
sutura mendosa patella bipartita
facette condylienne double déhiscence de l'arc antérieur (atlas)
agénésie de la troisième molaire supérieure déhiscence de l'arc postérieur (atlas)
agénésie de la troisième molaire inférieure surface articulaire supérieure double (atlas)
torus palatin foramen transversaire incomplet (atlas)
épine trochléaire foramen transversaire incomplet (axis)
tubercule précondylien pont postérieur (atlas)
canal hypoglosse bipartite ou multiple pont latéral (atlas)
canal condylien intermédiaire pont rétro-articulaire (atlas)
processus para-condylien sacralisation de la cinquième vertèbre lombaire
pont mylo-hyoïdien spina bifida aperta
tubercule marginal spina bifida de la première vertèbre sacrée
torus mandibulaire fusion de la facette antérieure et moyenne (calcanuem)
os epactal facette antérieure absente (calcaneum)
os suturaire occipito-mastoïdien fusion de la facette moyenne et postérieure (calcanuem)
os japonicum calcaneum bipartita
trou zygomatico-facial double ou multiple calcaneum emarginata
trou zygomatico-facial absent épine sus-épitrochléenne (humerus)
foramen mentonnier double perforation olécrânienne (humerus)
foramen mentonnier absent perforation sternale
insicive en pelle
II. 3. Morphologie(Romon Th., Murail P., Crubézy E.)
II. 3.1. Analyse métrique
Données métriques
Les dimensions et les indices retenus sont ceux leplus souvent mesurés lors d’études des nécropoles(Martin, 1988)50.
111 Matériel et méthodesRomon Th., Murail P., Crubézy E.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
(50) Les abréviations ont été reprises de la thèse d’Isabelle Barthélémy (1999) afin d’harmoniser et de faciliter les études.
Crâne
Longueur maximum du crâneLargeur maximum du crâneHauteur porion bregmaLargeur bi-astérionLargeur frontale maximumLargeur frontale minimumIndices crânien horizontal, moyen de hauteur, fronto-pariétal,et frontal transverse
Humérus
Longueur maximum de l’humérus (Hln)Diamètre maximum de l’humérus (HDx)Diamètre minimum de l’humérus (Hdn)Largeur de l'épiphyse proximale de l’humérus (Hlp)Largeur de l'épiphyse distale de l’humérus (Hld)Périmètre minimum de l’humérus (Hpn)Diamètre transversal de la tête de l’humérus (HTt)Diamètre vertical de la tête de l’humérus (HTv)Indices de robustesse et diaphysaire de l’humérus (Hir, Hid)
Radius
Longueur maximum du radius (Rln)Périmètre minimum du radius (Rpn)Diamètre transversal maximum du radius (RDx)Diamètre antéro-postérieur du radius (Rap)Indices de robustesse et diaphysaire du radius (Rir, Rid)
Ulna
Longueur maximum de l'ulna (Uln)Longueur physiologique de l'ulna (Ulp)Périmètre minimum de l'ulna (Upn)Diamètre antéro-postérieur sous-sigmoïdien de l'ulna (Uda)Diamètre transversal sous-sigmoïdien de l'ulna (Udt)Indices de robustesse et de platôlénie de l’ulna (Uir, platôl)
Fémur
Longueur maximum du fémur (Fln)Diamètre antéro-postérieur au milieu du fémur (Fda)Diamètre transversal au milieu du fémur (Fdt)Diamètre antéro-postérieur sous trochantérien du fémur (Fsa)Diamètre tranversal sous trochantérien du fémur (Fst)Périmètre au milieu du fémur (Fpn)Largeur de l'épiphyse distale du fémur (Fld)Diamètre transversal de la tête du fémur (Ftt)Diamètre vertical de la tête du fémur (Ftv)Indices de robustesse, pilastrique et de platymérie du fémur(FiRp, FiP, FiPl)
Tibia
Longueur maximum du tibia (Tln)Longueur physiologique du tibia (Tlp)Périmètre minimum du tibia (Tpn)Diamètre antéro-postérieur au trou nourricier du tibia (TaN)Diamètre transversal au trou nourricier du tibia (TtN)Largeur de l'épiphyse proximale du tibia (TlP)Largeur de l'épiphyse distale du tibia (TlD)Indices de robustesse et cnémique du tibia (TiR, Tcn)
Deux types d'analyses ont été utilisées :
les analyses univariées décrivant chaque popu-lation, permettant de comparer les hommes et lesfemmes issus de celle-ci (tests de Student),
et les analyses multivariées (analyses en compo-santes principales - acp), permettant de caractériserla population étudiée par rapport à un ensembleplus vaste de nécropoles (contemporaines ou géo-graphiquement proches) (Romon 1996).
Elles ont donné lieu à des tests statistiques dont lesconditions d’application sont les suivantes :
le test t de Student, utilisé pour les effectifs infé-rieurs à 30 variables. Une valeur supérieure ou égaleà t =1,96, pour a=0.05 (risque d’erreur à 5%)démontrera une différence statistiquement signifi-cative entre les moyennes comparées. Une valeurinférieure à 1,96 démontrera l’absence de différenceentre les deux groupes comparés.
(Stat Lab, Guide de l'utilisateur, pp Test11-Test15) : pour une matrice de rang égal à deux, avecun total des cas attendus supérieur à vingt, et aucuncas attendu inférieur à cinq, il faut utiliser le testexact de Fisher. Sinon, si 80% des cas attendus sontsupérieurs à 5 et aucun inférieur à 1, il faut utiliserles tests du Chi_ (Romon 1996).
II. 3.2. Estimation de la stature
L’estimation de la stature a été déterminée à partirdes longueurs maximum des os longs pour les troissites étudiées, suivant la méthode des moindres rec-tangles (Cleveunot et Houët 1993). Ces équations,qui concernent le fémur, se distinguent des équa-tions de Trotter et Gleser, qui sous-estiment lesfortes statures et surestiment les faibles.
L’estimation de la stature à partir du squeletteest inadéquate pour l’étude des populationsanciennes. Il est donc préférable d’effectuer l’analysedes données métriques directement à partir des lon-gueurs des os longs lors des comparaisons entregroupes (Theureau 1998). La longueur maximum dufémur, fortement corrélée à la stature, a ainsi été utili-sée dans le cadre des comparaisons entre populations.
II. 3.3. Déformations crâniennes
Les déformations crâniennes artificielles sont obte-nues par l'application de forces exerçant une com-pression sur le crâne lors de sa croissance. Elles nepeuvent donc être réalisées que sur des crânesimmatures où les compressions exocrâniennes altè-rent la direction de la croissance neurocrâniennne.Ces déformations ne sont plus modifiables une foisla croissance de l'enfant terminée. E. Crubézy (1986)a montré sur les tombes 15 et 30 de la nécropole deVenerque qu'elles étaient obtenues par la ligaturesdes crânes des nouveau-nés dans une positiondéterminée à l'aide de planchettes et de bandagesdisposés sur le frontal et l'occipital.
Il nous faudra dans un premier temps démontrer lecaractère artificiel de ces déformations. Ceci estréalisable :
soit par des coupes scannographiques qui mon-trent une diminution voire une disparition dudiploé, au niveau des zones de compression (Cru-bézy 1986) ;
soit par une observation macroscopique fine. Siles déformations minimes sont difficiles à distinguerà l'oeil nu, celles plus accentuées sont aisément iden-tifiables.
Sur les 45 premiers individus de la nécropolede Venerque, E. Crubézy (1986) a montré que lesdéformations étaient caractérisées par trois pointsprincipaux : un frontal très aplati et étiré vers l'ar-rière, la présence d’une ensellure bregmatique, etune région occipitale est aplatie et une corde occipi-tale démesurée.
Cette méthode descriptive, à partir des crâneset des diagrammes sagittaux, suffit ici à la détermi-nation des déformations des séries considérées.
II. 4. L’état sanitaire :la paléopathologie bucco-dentaire
(Aguerre M., Gaury P., Sainte-Marie S., Morel L.,
Crubézy E.)
L’état sanitaire a été abordé par une étude de lapathologie bucco-dentaire, intéressant : les cariesdentaires, les parodontopathies, les dépôts tar-triques, les usures dentaires, les atteintes péri-api-cales, ainsi que les hypoplasies de l’émail dentaire.
II. 4.1. Définition des échantillons
L’étude de la paléopathologie bucco-dentaire aporté essentiellement sur des sujets adultes etquelques sujets adolescents (sites de Lunel), soit :
pour le site de Lunel-Viel l’Eglise, 34 sujets dont5 adolescents et 29 adultes (5 hommes et 2 femmes),
pour le site de Lunel-Viel Les Horts, 58 sujetsdont 9 adolescents et 49 adultes,
pour le site de Saint-Bertrand-de-Comminges,39 adultes dont 18 hommes et 11 femmes,
pour le site de Venerque, 40 adultes dont 16hommes et 8 femmes,
pour le site de Saint-Brice-de-Cassan, 171adultes dont 18 hommes et 34 femmes.
et, enfin, pour le site de l’Isle-Jourdain, 206adultes dont 120 hommes et 71 femmes.
L’étude des hypoplasies a porté sur 392 indi-vidus (fig. 90), 301 présentant des hypoplasieslinéaires de l’émail dentaire (77%), issus des nécro-poles de Lunel-Viel l’Eglise, Lunel-Viel Les Horts,
112Sous la direction de S. Duchesne et É. Crubezy Romon Th., Murail P., Crubézy E.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Saint-Bertrand-de-Comminges, Venerque et l’Isle-Jourdain. Les individus ayant un nombre de dentstrop réduit ainsi que les jeunes enfants dont l’âge nedépasse pas 2 ans ont été éliminés. Aucune hypo-plasie n’a été repérée sur les dents déciduales. Parconséquent, les hypoplasies observées dans cetteétude ne concernent que les dents permanentes.
L’état de conservation des dents est variable d’unsite à l’autre. En effet, les nécropoles de Lunel-Veill’Eglise et de Saint-Bertrand-de-Comminges, qui onten grande majorité des dents bien conservées (res-pectivement 84 et 76%), peuvent être opposées à
l’ensemble formé par les nécropoles de Lunel-VielLes Horts et de Rivel à Venerque, où les dents bienconservées sont minoritaires dans le premier site,soit absentes dans le second. Toutefois, l’état deconservation est sensiblement différent entre cesdeux nécropoles. La mauvaise conservation est duepour la nécropole des Horts, soit à la fragmentationdes dents (racines cassées, fendillées), soit à la dis-parition partielle ou totale de l’émail, tandis quepour la nécropole de Venerque, elle est due à l’actionde l’acide contenue dans les végétaux, qui a trans-formé la couche superficielle de l’émail.
113 Matériel et méthodesAguerre M., Gaury P., Sainte-Marie S., Morel L.,Crubézy E.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
sites LVE LVH SBC VEN GRA TotalInd. avec LEH 25 (71%) 46 (68%) 23 (48%) 21 (42%) (186) 98% 301 (77%)effectif total 35 68 48 51 190 392
Figure 90 : Répartition des individus présentant des hypoplasies linéaires de l’émail dentaire (LEH),
selon les sites. LVE, Lunel-Viel l’Eglise ; LVH, Lunel-Viel Les Horts ; SBC, St-Bertrand ; VEN, Venerque ;
GRA, la Gravette à l’Isle-Jourdain.
Cette analyse présente des problèmes de naturedifférente :
tout d’abord, la réduction de l’informationd’ordre quantitative (nombre de dents perduespost-mortem lors du fonctionnement d’espacesfunéraires, de la réutilisation des tombes avec ousans déplacement du précédent occupant), d’ordrequalitative (évolution taphonomique pouvant créerde fausses pathologies - dissolution du tartre parexemple due à l’acidité du sol), et l’absence d’infor-mations cliniques (absence des tissus mous atteints).
ensuite, le mélange de restes bucco-dentairesattribuables à plusieurs sujets dans la même tombe.
et enfin, la réduction de l’effectif, les indices partype de dents peuvent être en théorie calculés pourtoute la population, pour les groupes sexués, et pargroupe d’âge. Cependant, la multiplication desgroupes réduit l’effectif de chaque échantillon etréduit ainsi la puissance des tests effectués, doncl’intérêt même des valeurs moyennes obtenues.L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) nedonne pas de résultats statistiques sur un sous-groupe dont l’effectif est inférieur à 20 sujets ; orpour nous, 20 individus représentent déjà unnombre important de sujets à étudier.
II. 4.2. Identification
L’enregistrement des dents a été réalisé la nomen-clature internationale de l’OMS (fig. 91). Les dentssont numérotées de 1 à 8 pour la dent, précédées duchiffre du quadrant : 1 pour les dents maxillairesdroites, 2 pour les dents maxillaires gauches, 3 pourles dents mandibulaires droites, 4 pour les dentsmandibulaires gauches.
II. 4.3. Critères et moyens d’étude
L’intérêt de ces études est d’établir une moyennedes atteintes bucco-dentaires dans la populationétudiée et de la comparer à d’autres moyennes dansd’autres populations afin de déterminer s’il existedes différences significatives et d’essayer d’identi-fier l’origine de ces différences.
Cependant, les indices odontologiques, appli-quées aux populations vivantes, n’étaient pas directe-ment utilisables pour les données anthropologiques.Ainsi, la méthodologie (cf. infra), adaptée aux popula-tions inhumées (Aguerre et Gaury 1997), a été réaliséeafin d’être facilement employée par un chercheur nonodontologiste. De ce fait, elle peut être généralisée etdonc permettre des comparaisons aisées entre sites etainsi d’apporter de nombreux et précieux renseigne-ments sur les populations du passé.
Remarque : le nettoyage était un facteur de biais impor-tant, faisant perdre un grand nombre d’informations. Enconséquence, l’étude odontologique d’une série devraitbénéficier d’une toilette sommaire, éliminant les sédi-ments les plus grossiers. Les études nécessitant des paroisdentaires propres comme l’étude des hypoplasies del’émail devrait donc être postérieures à cette étape.
II. 4.3.1. Les caries dentaires
La carie est un processus pathologique d’origineexterne, localisé, entraînant un ramollissement destissus durs de la dent et aboutissant à la formationd’une cavité. C’est un processus maladif chroniquequi débute par une lésion microscopique et peutéventuellement progresser jusqu’au stade de cavitémacroscopique (OMS 1977). La carie est une mala-die d’étiologie plurifactorielle : la flore microbienne,l’alimentation (sucres acidogènes), la qualité des tis-sus dentaires de l’hôte et le temps d’exposition auxagents cariogènes.
Il convient de distinguer les lésions initiales,étudiées en microscopie, et les caries cliniques danslesquelles on distingue :
les caries du premier degré, intéressant l’émail
les caries du second degré, intéressant l’émail etla dentine
les caries du troisième degré, signant uneatteinte pulpaire (Baume 1962).
Enfin au-delà de l’atteinte pulpaire, l’infectionatteint les tissus péri-apicaux, le desmodonte, l’os etla circulation générale.
L’indice de carie est le moyen d’expressionnumérique pour apprécier la présence de la cariedentaire ; il peut exprimer une fréquence ou uneproportion, ainsi que la répartition en groupes d’in-dividus. Parmi les nombreux indices, deux seule-ment ont été retenus :
l’indice CAO de Klein et Palmer, le rapport entrele nombre de dents cariées et le nombre de total dedents permanentes normalement présentes sur l’ar-cade en fonction de l’âge du sujet.
CAO = C+A+ON
avec C, nombre de dents cariéesA, nombre de dents absentes à la suite de cariesO, nombre de dents obturéesN, nombre total de dents en fonction de l’âge du sujet (soit12 avant 6 ans, 24 de 8 à 12 ans, et 28 à partir de 12 ans ; lesdents de sagesse sont alors exclues de l’examen).
l’indice CAOs de Boedecker, le même indice queprécédemment ramené aux surfaces, le rapportentre le nombre de surfaces atteintes par dent et lenombre total de surfaces examinées.
CAOs = Cs+As+OsNs
avec Cs, nombre de surfaces dentaires cariéesAs, nombre de surfaces absentes à la suite de cariesOs, nombre de surfaces obturéesNs, nombre total de surfaces dentaires permanentes enfonction de l’âge du sujet (les dents monoradiculées, inci-sives et canines, ont 4 surfaces, les dents polyradiculées,prémolaires et molaires ont 5 surfaces). Donc, Ns = 148, encomptant les dents de sagesse.
Ces indices ne sont pas, tels quels, directementapplicables à l’étude des populations du passé. Eneffet, il n’existe à ce jour aucune trace de soin parobturation des dents cariées ; ainsi la notion dedents ou de surfaces obturées ne doit pas être appli-quée à ces individus. De plus, les dents absentesante-mortem peuvent être dues à d’autres facteursque l’atteinte carieuse (chocs, lyses osseuses impor-tantes). Ainsi, les indices CAO et CAOs sont doncréduits à CA et CAs : ils doivent être plus considéréscomme des indicateurs d’état bucco-dentaire quecomme des indicateurs d’état carieux stricts.
114Sous la direction de S. Duchesne et É. Crubezy Aguerre M., Gaury P., Sainte-Marie S., Morel L.,Crubézy E.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Dents droites gauches
permanentes M3 M2 M1 P2 P1 C I2 I1 I1 I2 C P1 P2 M1 M2 M3
supérieures 18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28
inférieures 48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38
Figure 91 : Désignation des dents permanentes selon l’OMS.
Les indices calculés sont alors :
l’indice CA, témoin du nombre de dents cariéessur le nombre de dents perdues ante-mortem, à lasuite de caries ou d’autres pathologies.
CA = C+A%N
avec C, nombre de dents cariéesA, nombre de dents absentes ante-mortemN, nombre total des dents présentes + A.
l’indice CAs, témoin du nombre de surfaces den-taires atteintes par la carie et des surfaces absentesante-mortem.
CAs = Cs+AsNs
avec Cs, nombre de surfaces dentaires cariéesAs, nombre de surfaces absentes ante-mortemNs, somme des surfaces présentes + As
Les moyens d’étude sont essentiellement unexamen simple à l’aide d’une sonde à extrémitépointue, indispensable, permettant de différencierune coloration ponctuelle d’un début de cavité.
II. 4. 3.2. Les parodontopathies
La parodontopathie est exprimée par une récessionalvéolaire, qui définit une différence entre la posi-tion observée de l’os par rapport à la jonctionémail/cément de la dent et la position saine normalede cette crête osseuse. Un grand choix d’indicesparodontaux sont à disposition, toutefois ils sonttous liés à des critères cliniques. Sans renseignementconcernant les tissus mous, l’étude a porté dès lorsuniquement sur les niveaux alvéolaires observables.
Ce sont les classes parodontales de Ramfjord(1967) qui ont servi de référence afin de constituerun indice objectivant une altération osseuse. Cetindice comprend 5 classes (fig. 92).
Ces altérations sont mesurées au moyen d’unesonde graduée à embout calibré sphérique (dia-mètre de 0,5 mm) entre crête osseuse et jonctionémail/cément. Les profondeurs de 2-6-9 mm sontdirectement obtenues en ajoutant aux profondeursde poche de Ramfjord (1967) la hauteur de l’attacheépithélio-conjonctive soit environ 2 mm. La mesurela plus profonde, quelle que soit la face, est retenue.
Pour les dents isolées, la profondeur de tartremesurable additionnée à la hauteur de l’attache épi-thélio-conjonctive (constante, 2 mm) permet d’esti-mer la perte osseuse correspondante.
L’indice parondotal individuel est l’additiondes scores maximum (numéros de classe d’atteinteparodontale) quelque soit le côté pour les différentsgroupes (incisivo-canin, 2 ou 5, prémolo-molairessupérieurs et inférieurs, 1 ou 3 et 4 ou 6). Le mini-mum est de 0, le maximum est de 16 (4x4). Cepen-dant, la rareté des bouches complètes a conduit àélaborer un score parodontal pour le maxillaire, unscore pour la mandibule, et enfin, un score global.
L’établissement du score parodontal prédéfinipar type de dent peut se faire mais il ne représenteraque des maxima, aussi sont présentées par dent lesproportions des différentes classes d’atteinte oubien une «moyenne» construite d’après la formule :
indice P (dent X) = [(1xa)+(2xb)+(3xc)+(4xd)+(5xe)] _ 1a+b+c+d+e
115 Matériel et méthodesAguerre M., Gaury P., Sainte-Marie S., Morel L.,Crubézy E.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 92 : Classes parodontales.
Classe 0
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Classe 4
pas d’altération ni de forme, ni d’aspect.
pas d’altération de forme, altération d’aspect de type pitting, pertuis vasculaires traduisant un débutde lyse alvéolaire lors de l’irritation gingivale prolongée.
perte de l’aspect sinusoïdal classique avec variation de la distance physiologique sommet de la crêtejonction émail/cément comprise entre 2 mm (ou 3 mm en palatin au maxillaire supérieur) et 6 mm.
perte osseuse comprise entre 6 mm et 9 mm.
perte osseuse supérieure à 9 mm.
avec a : nombre de dents de la classe P0b : nombre de dents de la classe P1c : nombre de dents de la classe P2d : nombre de dents de la classe P3e : nombre de dents de la classe P4
II. 4.3.3. Les dépôts tartriques
L’étude du tartre, c’est-à-dire des dépôts calcifiés,d’origine salivaire en odonto-stomatologie, est desti-née à déterminer l’importance de ce facteur patho-gène par 2 aspects : mécanique, insertion « en coin »dans le sillon ou les poches et irritation de la gencivemarginale, et biologique, support de la plaque micro-bienne avec sélection le long de la racine pour retrou-ver en fond de poche profonde des espèces anaéro-bies/aérobies facultatives plus agressives et moins encompétition avec la flore buccale commensale.
Le tartre est défini comme l’indicateur d’unelésion parodontale en adoptant les trois stades del’OMS (fig. 93).
À ce sujet, il conviendrait d’étudier le tartreavant tout lavage important des séries (Crubézy1988).
Afin d’établir un indice de tartre traduisantl’importance agressive du tartre sous-gingival et deses influences pathologiques, des coefficients diffé-rents ont été attribués à chaque stade :
1 pour la stade 03 pour le stade 1 soit un indice de tartre T = 1a+2b+9c9 pour le stade 2 a+b+c
avec a = nombre de dents dans le stade 0b = nombre de dents dans le stade 1c = nombre de dents dans le stade 2
Ainsi, un score T = 0 signifie pas de tartre,0<T<3 signifie un dépôt tartrique au-dessus de JEC,3<T<9 signifie un dépôt tartrique au-dessus et au-dessousde JEC.
116Sous la direction de S. Duchesne et É. Crubezy Aguerre M., Gaury P., Sainte-Marie S., Morel L.,Crubézy E.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Stade 0
Stade 1
Stade 2
auxquels nous ajoutons la classe TT
Classe TT
pas de tartre.
tartre au-dessus et sur la jonction émail/cément (JEC), correspondant à une lésion type gingiviteou parodontite débutante.
tartre au-dessus et au-dessous de JEC, de type sous-gingival (OMS 1986) correspondant à uneparodontite avec perte d’attache et modification du niveau osseux.
pas de tartre dans un contexte d’atteinte parodontale donc vraisemblablement absence d’infor-mation par perte des dépôts tartriques lors des manipulations, ou dissolution dans des sols acides.
Figure 93 : Classes du tartre.
II. 4.3.4. Les usures dentaires
La fonction masticatoire par elle-même n’a pas vrai-ment connu de changements dans les populationsdu passé récent, aussi ce sont plutôt des facteurs telsque la dureté ou l’abrasivité de l’alimentation quivont représenter des variables capables de modifierl’attrition, sans oublier les habitudes (tics, parafonc-tions) parmi lesquels le bruxisme occupe une placenon négligeable (Williams, Woodhead 1986).
Les méthodes d’étude sont nombreuses enanthropobiologie, elles tendent à représenter lavariation dans les habitudes alimentaires des popu-lations étudiées ainsi qu’à estimer l’âge au décès dessujets étudiés (Cross et alii 1986), peu valable en rai-
son d’un âge au décès sous estimé. Les usures lesplus importantes ne sont pas dues nécessairementaux abrasifs les plus gros, une action constanted’abrasif fin donne autant d’usure (Dahlberg 1963).
La méthode retenue est l’échelle d’usure deBrabant et Sally (1962) définie par 5 stades (fig. 94).
Cette échelle paraît peu précise, cependantson utilisation permet une cohérence des observa-tions avec des travaux antérieurs (Crubézy 1988).Elle permet en outre, en diminuant le nombre declasses, la diminution des erreurs inter-observateurs(Cross et al 1986). Enfin, elle autorise la commoditédiscutable de calculs de moyenne d’indices par typede dent ou individuel (Crubézy 1988), même s’il n’y
a pas de relation directe entre la classe d’usure etl’usure mesurée en mm à part pour les 2 premiersstades.
Les indices d’usure individuel et par type de dentsont exprimés par la formule suivante :
USU = [(1xa)+(2xb)+(3xc)+(4xd)+(5xe)] _ 1a+b+c+d+e
(-1 pour avoir un minimum à 0 et un minimum à 4correspondant aux classes d’usure)
avec a = nombre de dents du stade 0b = nombre de dents du stade 1c = nombre de dents du stade 2d = nombre de dents du stade 3e = nombre de dents du stade 4
II. 4.3.5. Les atteintes péri-apicales
Les traces osseuses d’atteintes infectieuses d’originedentaire ont été observées sans qu’il soit possible denommer ces atteintes (kystes, granulomes, fis-tules...) car il n’en persiste que les effets osseux.
Elles ont été notées en 0, pas de trace visible, et 1,atteinte infectieuse osseuse visible.
II. 4.3.6. Les hypoplasies linéaires del’émail dentaire
Définition
L’hypoplasie est une anomalie de l’émail dentaire, ellese manifeste sous forme de régions localisées dépour-vues d’émail ou sous forme d’une absence totale de lacouche de l’émail. Elle a longtemps été attribuée à des
interruptions de la maturation de l’émail. Les hypo-calcifications de l’émail surviendraient plutôt à lasuite de « poses » au cours de la formation de lamatrice dues à des événements de trois grands types :anomalies héréditaires, traumatismes localisés etstress du métabolisme (Goodman, Rose 1991). Elless’observent essentiellement sur les dents perma-nentes et beaucoup plus rarement sur les dents déci-duales ; en effet, l’émail des dents déciduales se formeavant la naissance, or le fœtus est protégé par l’orga-nisme maternel contre toute déficience sérieuse.
Les hypoplasies de l’émail sont rangées endeux catégories selon la classification de M. Héritier(1989) :
les hypoplasies partielles simples, regroupantles hypoplasies cupuliformes, linéaires ou en sillon,en bandes et en nappes.
les hypoplasies partielles complexes, qui sontdes altérations profondes de l’émail et de la dentine.
les hypoplasies généralisées, intéressant toutesles dents et leur donnant une teinte brune.
Seules ont été étudiées les hypoplasieslinéaires de l’émail dentaire, qui se présentent sousla forme d’un fin sillon s’ouvrant dans l’émail paral-lèlement au bord libre de la dent, et la circonscrivanttotalement. La profondeur des lésions est variable etva de la simple rainure superficielle à l’encoche bienmarquée. Plusieurs sillons peuvent s’étager à desdistances régulières et provoquer une morphologieen gradins, notamment sur les canines.
Six formes principales ont été déterminées,dans les limites d’une étude macroscopique, ran-gées par ordre croissant depuis les hypoplasies lesmoins marquées jusqu’aux hypoplasies les plusmarquées (fig. 95).
117 Matériel et méthodesAguerre M., Gaury P., Sainte-Marie S., Morel L.,Crubézy E.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 94 : Classes d’usure.
Stade 0
Stade 1
Stade 2
Stade 4
usure nulle ou négligeable.
usure concernant uniquement l’émail, et sans disparition des pointes cuspidiennes, sans exposi-tion de la dentine.
usure concernant l’émail, et la dentine apparaît partiellement avec usure des pointes cuspi-diennes plus ou moins complète.
Stade 3 la dentine est exposée, et une partie de la couronne est détruite.
la majeure partie de la couronne a disparu, et l’usure s’étend parfois jusqu’au collet dentaire.
Une forme particulière a été ajoutée : elle peuts’apparenter à une hypoplasie en bande à l’œil nucar la largeur de la dépression est importante. Tou-tefois, en l’observant à l’aide d’une loupe, la surfacedépressionnée n’est pas lisse, elle présente de finssillons très rapprochés les uns des autres, de sortequ’ils ne puissent être pas dénombrés. Dans ce cas,les hypoplasies enregistrées faisaient au moins lestrois quart de la face vestibulaire.
Chaque dent a été prise en compte, avec uneattention plus particulière pour les canines, les inci-sives et les 3e molaires. La canine étant considéréecomme la dent la plus souvent touchée, viennentensuite les incisives. L’enregistrement des hypopla-sies sur les 3e molaires permet d’avoir une approchedes stress apparu après 10 ans environ, puisque ledébut de la calcification des M3 se fait entre 7 et 10 anset que leur couronne est achevée entre 12 et 16 ans.
La lecture des hypoplasies s’est effectuée aumoyen d’une loupe à bandeau frontal avec grossis-sement de 3 fois, la dent étant exposée à un éclairagerasant, afin de faire ressortir le relief, et donc la pro-fondeur des hypoplasies.
L’estimation de l’âge d’apparition du stress
Il y a stress lorsque les facteurs habituels de résistancede l’organisme pour maintenir son homéostasie sontdépassés. Dans ce cas, l’organisme va développertoute une série de mécanismes qui sont le résultat deson adaptation. Si le stress a lieu en cours de crois-sance, alors il peut en troubler son développement.
Afin de connaître l’âge d’apparition du stress,la hauteur de l’hypoplasie a été mesurée en milli-mètres à l’aide d’un pied à coulisse à pointes. La
hauteur a été prise depuis la jonction émail/cémentjusqu’au milieu de l’hypoplasie quand cela étaitpossible, dans le plan médian de la face vestibulaire.
Ces mesures ont été comparées à une échellede référence donnant l’âge correspondant aux hypo-plasies (Goodman, Armelagos, Rose 1980). Toute-fois, ce schéma n’a pas été appliqué de façon tropstricte, car on admettrait alors que quelque soit lapopulation étudiée, la hauteur des couronnes estsystématiquement celle des populations préhisto-riques indiennes. Ainsi, par souci de justesse, il vautmieux prendre des intervalles d’un voire deux ans.
Cette échelle ne prenant pas en compte les 3emolaires, il n’est pas possible de lier la hauteur dustress à une classe d’âge précise. Toutefois, d’aprèsla calcification de cette dent, une hypoplasie situéeproche du collet ne peut être rapportée à une âgeantérieur à 12 ans et pourra donc être située dans laclasse 12-16 ans.
La notion d’individu
Un individu pour cette étude est défini comme unsujet comportant au moins 3 dents, qu’il s’agisse dedents en place ou de dents isolées. Cette définitionrevient à éliminer les cas extrêmes, c’est-à-dire lessujets les plus âgés, présentant une mandibule ouun maxillaire entièrement résorbé, et les sujets lesplus jeunes, dont l’âge est inférieur à 1 an.
Les critères utilisés par E. Crubézy (1988), àsavoir les sujets avec au moins une canine et 2 inci-sives ou bien une canine, 2 prémolaires et unemolaire, n’ont pas été repris car ils auraient réduitconsidérablement l’effectif initial.
118Sous la direction de S. Duchesne et É. Crubezy Aguerre M., Gaury P., Sainte-Marie S., Morel L.,Crubézy E.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 95 : Les différentes formes d’hypoplasie.
Forme 1
Forme 2
Forme 3
Forme 5
très faiblement marquée, difficilement perceptible à l’oeil nu mais net à l’aide d’une loupe avecun grossissement de 3,5 X.
faiblement marquée, sillon peu profond et mince, très net à l’oeil nu.
assez fortement marquée, sillon assez profond, net à l’oeil nu ainsi qu’au toucher.
Forme 4 fortement marquée, sillon profond, presque une «rainure».
aspect en gradins, une dent ayant au moins 2 hypoplasies et étant fortement marquées.
Forme 6 très fortement marquée, sillon très profond et large, pratiquement une hypoplasie en bande.
II. 5. Les pratiques funéraires(Duchesne S.)
Les pratiques funéraires ont été étudiées à partir desdocuments issus du terrain, à savoir les fiches d'en-registrement et les documents graphiques (photo-graphies ou dessins), et des publications déjà réali-sées, à l'aide des inventaires descriptifs.
II. 5.1. La position du défunt
L’analyse de la positon du corps s’est intéressée uni-quement à celle des membres, supérieurs et infé-rieurs. En effet, en l'absence d'observations anthro-pologiques systématiques dès le terrain, il n’a pasété possible de réaliser l’étude de la position de latête, qui nécessite l'observation de la base du crâneet des premières vertèbres cervicales généralementnon visibles sur les photographies.
Les membres supérieurs et inférieurs ont faitl'objet, quand cela était possible, d'une étude selonl'âge, le sexe et le mode d'inhumation.
les membres supérieurs
Cinq positions sont décrites ; les chiffres romainssont employés pour le membre supérieur droit, leschiffres arabes pour le membre supérieur gauche :
la première, l'avant-bras est en flexion maximalesur le bras (I 1),
la seconde, l'avant-bras est fléchi sur le thorax (II 2),
la troisième, l'avant-bras est fléchi à 90° (III 3),la quatrième, (IV 4) l'avant-bras est ramené sur le
pubis ou à la racine des membres inférieurs,et enfin, la cinquième, l'avant-bras est étendu le
long du corps (V 5).
Les positions asymétriques ont été redistribuéesde façon à rétablir la position du défunt lors de sondépôt dans la tombe, en éliminant les déplacementsdus au transport et à la décomposition du corps,même si les positions asymétriques sont possibles51
(Lorans 2000 ; Crubézy, Duchesne, Arlaud 2006).
les membres inférieurs
Deux positions des membres inférieurs sontdécrites, l'extension et la flexion ; trois concernentparticulièrement les pieds, écartés, rapprochés etjoints.
II. 5.2. Le mobilier
Le terme de mobilier funéraire s’applique aux objetscontenus dans une tombe, qu’ils aient été portés parle défunt ou déposés dans le contenant lui-même oula fosse. La première catégorie rassemble surtout lesaccessoires vestimentaires et les objets de parure, laseconde regroupe des éléments de nature et de sta-tuts très divers : objets de la vie quotidienne ayantappartenu au défunt (outils, armes, objets de toi-lette, objets de piété, etc.), objets à caractère magiqueou religieux, symboles de fonctions et de pouvoir(Lorans 2000).
119 Matériel et méthodesDuchesne S.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
(51) Discussion in Crubézy, Duchesne, Arlaud 2006.
III.1. La mise en place du défunt
III.1.1. L’inhumation
Tous les sujets des sites étudiés ont été inhumés,aucune trace d'incinération n'a été observée. L’inhu-mation est la pratique quasi exclusive en Gaule dèsle IVe siècle, donc avant la christianisation de l’en-semble de la population urbaine et rurale. L’inhu-mation est donc la règle et plus précisément l’inhu-mation individuelle (Lorans 2000).
Cependant, la pratique de la réinhumation,donc de la réutilisation de la tombe, a été observéesur tous les sites, par la présence de sépultures mul-tiples ou de réductions, parfois nombreuses. Or, leconcile de Macôn52 (585) fut longtemps interprétécomme interdisant cette pratique ; aujourd'hui, cer-tains auteurs interprètent ce concile comme l'inter-disant à tout individu autre que les proches desdéfunts, et pour G. de Semainville il confirmeraitmême l'impact accordée par l'Eglise à la famillepour les démarches funéraires.
III.1.2. L’orientation
Quelques soient les sites, étudiés ou comparés, lagrande majorité des individus inhumés sont orientés,la tête à l’ouest et les pieds à l’est. L’orientation strictedu corps représente le cas le plus répandu en Gauledès le IVe siècle, bien avant une christianisation enprofondeur des populations. Cet usage, qui n’a faitl’objet de prescriptions de la part de l’Eglise qu’à par-tir du XIe siècle, a lui aussi reçu une interprétationchrétienne : en inhumant le défunt tête à l’ouest, onpermet que sa prière soit directement dirigée versl’Orient, vers le Saint-Sépulcre (Lorans 2000).
La stricte orientation ouest-est est rarementobservée, les variantes nord-ouest/sud-est ou sud-ouest/nord-est sont plus fréquentes. Des considéra-tions pratiques ou topographiques ont alors pu
jouer, c'est le cas dans les sites étudiés avec le respectde l'orientation des murs comme par exemple à St-Bertrand-de-Comminges (de la basilique ou desannexes).
Dans le cas de Venerque, les diverses orienta-tions occupent globalement des parties différentesdu site, et sont peut-être à mettre en relation avec ledéveloppement topographique de l’espace sépul-cral : une orientation stricte ouest-est « avec la pré-sence de groupements familiaux » en premier lieu,puis de part et d'autre un développement en deuxpôles sud et nord, orienté nord-ouest/sud-est (NO-SE 1), puis un développement périphérique au sud-est, encore plus décalé nord-ouest/sud-est (NO-SE2), « avec la présence de secteurs réservés auxfemmes et enfants, puis aux enfants ». Cette réparti-tion peut être aussi chronologique mais aucunindice ne peut l'affirmer.
Pour le site de la Gravette, si quelques sépul-tures du haut Moyen Âge sont encore orientéesnord-sud, l’orientation est-ouest des tombes, bienque présentant de légères variations, est généraliséeà partir du VIIe siècle.
III.2. La position du corps
La quasi-totalité des inhumations est pratiquée lecorps allongé sur le dos, même si l’on observequelques exceptions. En effet, quelques sujets, issusdes sites de comparaisons (Costes-Gozon – Aveyron(Pujol 1998), Mouchan – Gers (Boube, fouet 1955)),sont allongés sur le côté pour des raisons pratiques,puisqu'il s'agit de sépultures multiples. Ainsi, plu-sieurs corps sont inhumés ensemble dans une mêmetombe, dont le caractère familial peut être supposé.
L’inhumation sur le dos n’est aucunement uneinnovation chrétienne mais les liturgistes, telGuillaume Durand, évêque de Mende au XIIIe
siècle, lui ont donné une valeur symbolique : le
III PRATIQUES FUNÉRAIRES
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
121 Pratiques funérairesDuchesne S.
(Duchesne S.)
(52) « Beaucoup de gens ouvrent les tombeaux et y déposent leurs propres défunts sur des corps non encore décomposés.Il est impie d'usurper un lieu sacré consacré aux morts sans la volonté des ayants droits… » cité par Salin, 375 (De Semain-ville 1984).
défunt regarde ainsi droit vers le ciel (Lorans 2000),symbolisant le sommeil du défunt attendant larésurrection (Lorans 1994).
Les différentes sources, écrites, iconogra-phiques ou sculpturales, ne laissent entrevoir desvariations rituelles que pour les bras et la tête(Lorans, 1990). Les sites étudiés n'ont pas fait l'objetd'observations anthropologiques systématiques dèsle terrain ; de ce fait, il n’est pas possible postérieu-rement de réaliser l’étude de la position de la tête,qui nécessite l'observation de la base du crâne et despremières vertèbres cervicales généralement nonvisibles sur les photographies.
Ainsi, l’analyse de la position du corps s’estintéressée uniquement à celle des membres, supé-rieurs et inférieurs53.
III.2.1. Les membres supérieurs
Pour les sites de plein champ, la quasi-totalité dessujets sont inhumés avec les membres supérieursétendus (plus de 90%, entre 90 et 97%), allongés lelong du corps ou les avant-bras ramenés sur lepubis. L’exception est alors la position des membressupérieurs sur le haut du corps.
Pour les sites autour d’une église, la positiondes membres supérieurs étendus est toujours pré-dominante, seulement dans une proportionmoindre, autour de 70%. Un peu moins d’un tiersont donc les membres supérieurs en position haute.
On retrouve ce cas de figure à Seyssel-Albigny(Haute-Savoie) avec 29% des sujets avec une posi-tion haute des membres supérieurs (Castex 1994), àMazerny (Ardennes) avec 32% (Young 1984), à Toulavec 33%, et à Chinon (Indre-et-Loire) avec 21%(Husi et alii 1990). Leur répartition sur St-Bertrandse groupe essentiellement dans les 3 m de la basi-lique (10/14), et plus volontiers à l’ouest pour laposition des membres sur la poitrine, alors que surLunel-Veil l’Eglise, aucune répartition ne sembleapparaître (faiblesse de l’échantillon ?). Dans le casde St-Bertrand, il s'agit peut être également d'unbiais du à la fouille incomplète du site. Lors descomparaisons, nous avons constaté la même chose,à savoir la prépondérance de la position desmembres supérieurs étendue (fig. 96, 97 et 98).
Ce constat général s’accorde bien avec ce qui aété maintenant observé sur un très grand nombre denécropoles du haut Moyen Âge, où la position bassedes membres supérieurs est la plus répandue, alorsqu’une position haute caractérise plutôt les inhuma-tions médiévales et modernes (Lorans 1994).
Seulement quatre sites régionaux présententune majorité de position haute (figure 98). Troisd’entre eux, Arcambal (Lot) (Grimbert 2000), LeCamp des Lacs (Aveyron) (Marlière 1998) et St-Mar-tin du Larzac (Aveyron) (Azémar et alii 1995) avaientpour point commun la même structure de tombe, lecoffre de dalles. Cependant, moins la forme de latombe que sa pérennité semble être à l’origine decette position. En effet, cette structure a fait l’objetdans les trois cas de réinhumations, parfois nom-
122Sous la direction de S. Duchesne et É. Crubezy Duchesne S.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 96 : Etude des membres supérieurs des sites étudiés (en %). SBC, St-Bertrand ; LVE, Lunel-Viel
l’Église ; LVH, Lunel-Viel Les Horts ; VEN, Venerque ; SBCa, St-Brice de Cassan.
membres supérieurs (%) n représentativité I1 II 2 III 3 IV 4 V 5
SBC 57 80 17 9 53 21
LVE 23 79 13 17 13 57
LVE fin ht MAge 11 85 64 9 18 9
LVH 30 47 4 13 83
VEN 53 44 8 45 47
VEN - OE 18 51 33 67
VEN - NO-SE 1 22 34 14 36 50
VEN - NO-SE 2 13 62 8 77 15
SBCa 120 60 2 6 8 37 48
(53) Le site de l’Isle-Jourdain, dont l’étude des pratiques funéraires, menée par S. Bach, est en cours, sera présentée dans lafuture monographie qui lui sera consacrée.
123 Pratiques funérairesDuchesne S.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 98 : Etude des membres supérieurs des sites étudiés et comparés. SBC, St-Bertrand ; LVE, Lunel-
Viel l’Église ; LVH, Lunel-Viel Les Horts ; VEN, Venerque ; SBCa, St-Brice de Cassan.
Figure 97: Etude des membres supérieurs des sites comparés (en %).
étude MS % St Raymond SBC Arcambal Beaucaire VEN LVH Mouchan Mirepoix LVE SBCa Camp des Lacs St Martin du Larzac Toulouse, Cité Judiciaire Izaux
I 1 2 14 16
II 2 6 17 86 8 4 58 13 6 47 29 5
III 3 3 9 3 8 11 17 8 30 14 26
IV 4 28 53 14 32 45 13 89 42 13 37 20 14 42 70
V 5 63 21 57 47 83 57 48 3 29 11 30
membres supérieurs (%) références n représentativité I 1 II 2 III 3 IV 4 V 5
St Raymond 32 48 6 3 28 63
IVe s. Arramond 1996 15 75 7 7 86
VIe s. 17 37 6 6 47 41
Arcambal Grimbert 2000 11 100 86 14
Beaucaire sur Baïse Larrieu et al 1985 37 35 8 3 32 57
Mouchan Boube, Fouet 1955 9 15 11 89
Mirepoix Hygounet 1983-1985 12 57 58 42
Camp des Lacs 30 39 47 30 20 3
ph. I 3 30 33 33 33
ph. II Marlière 1998 3 75 33 33 33
ph. III 19 42 47 26 21 5
ph. IV 5 45 60 40
St Martin du Larzac 7 32 14 29 14 14 29
St Martin début Azémar et al 1995 4 25 75
St Martin fin 2 100
Toulouse Cité Judiciaire 19 56 16 5 26 42 11
ph. 1A 3 33 33 33 33
ph. 1B Catalo et al 1999 10 77 20 10 10 50 10
ph. 1C 6 50 17 50 33
Izaux Coquerel 1965-1972 30 81 70 30
breuses, visibles par les réductions le long desparois extérieures ou intérieures, ainsi la positionobservée concerne le dernier inhumé. Pour exemplele Camp des Lacs (Marlière 1998) : dans plus de 50%des cas, le nouvel inhumé a les membres supérieursrepliés sur le haut du corps. Il en est de même pourSt-Martin et Arcambal, Lunel-Viel l'Eglise, et la CitéJudiciaire de Toulouse (Catalo et alii 1999). Il en estde même, avec un pourcentage moins important(25%), dans les sites plus précoces de Lunel-Viel lesHorts et de Beaucaire-sur-Baïse (Gers) (Larrieu et alii1985). Par ailleurs, au Camp des Lacs (Marlière1998) dans les premières phases du cimetière VI-VIIe
siècles, les membres supérieurs sont étendus, et deplus, la présence de deux sujets sans réinhumationsultérieures dans des coffres de dalles montrent cettemême position.
Ce changement aurait lieu au VIIe siècle,époque charnière entre la position haute et la posi-tion basse des membres supérieurs, comme celapeut-être le cas du site de Mirepoix (Ariège)(Hygounet 1983-1985), datée fin VII-déb VIIIe siècleoù les adultes ont une position égalitaire entre rame-nés sur le pubis et sur la poitrine.
L'évolution des mœurs liturgiques dévoilecertains changements : autour de l'an mil(900/1000), la coutume, devenue générale dès lehaut Moyen Âge, stipule que la prière se réalise lesmains jointes (Lorans 1990). Les positions chré-tiennes indiscutables, croisés sur la poitrine, ne sem-blent pas devoir apparaître avant la fin du VII-débVIIIe siècle, et perdureront pendant plusieurssiècles. En fait, les interventions de l'Église, dans lesrites funéraires, ne se font guère avant le VIIIe siècle.La position des bras croisés sur le pubis ou l'abdo-men peut évoquer une influence chrétienne, maisn'est pas, par elle-même, une démonstration suffi-sante (Young 1977 ; Pétrequin et alii 1980).
Enfin, il semble apparaître une chronologieentre les positions étendues, avec la position lesmembres allongés le long du corps plutôt antérieure
à la position des membres ramenés sur le pubis. Eneffet, cette position est majoritaire sur le site de l'An-tiquité tardive de St Raymond (Toulouse) (Arra-mond 1996), puis elle est retrouvée dans les sites VI-VIIe siècles où elle est moins représentée.Cependant, on retrouve également dans ces sites laprésence de dépôt funéraire dans les tombes (pré-sence de restes alimentaires et de charbons), commeBeaucaire-sur-Baïse (Gers) (Larrieu et alii 1985),Costes-Gozon (Aveyron) (Pujol 1998), ou bien unetypologie de tombes conservant encore un aspectantique (bâtière, coffres bois/cercueils) pour lessites de Lunel-Viel et de Venerque.
Les sources écrites ne font que très rarementallusion à la position qui est donnée au corps après lamort. La coutume très ancienne veut que les bras descadavres soient étendus le long du corps. Tertullienau IIe siècle parle de cette position. L’exemple desbras le long du corps est flagrant. En effet, cette posi-tion est souvent considérée comme une caractéris-tique des inhumations antérieures ou appartenant àune phase précoce de la christianisation (Lorans,1990). Ainsi, on peut y voir pour les sites V-VIIe sièclesle souvenir des usages funéraires de cette époque,toujours vivace au début de l'époque mérovingienne(Young, 1984) comme cela peut être le cas dansd'autres sites de la France (au travers de la typologiedes tombes, de l'orientation nord-sud, ou du dépôtfunéraire)54. Dans le cadre de Venerque, il semble queselon l'orientation, cette position régresse au profit dela position des membres supérieurs ramenés sur lepubis. Si l'on en croit certains auteurs, notamment P.Périn à propos des Ardennes, la position « avant-brasle long du corps-jambes écartées » pourrait être laplus ancienne, son remplacement dans le courant duVIIe siècle par la position « avant-bras croisés sur lebassin ou la poitrine-jambes serrées » pourrait êtredue à l'influence de l'Église (Gaillard de Semainville1980). La constatation faite pour les sites étudiés,concernant les bras, rejoint ce qui avait été observédans les Ardennes par P. Périn ; quant à l'interpréta-tion, il est difficile d'aller si loin pour nos régions enl'absence de datations précises55.
124Sous la direction de S. Duchesne et É. Crubezy Duchesne S.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
(54) Saine-Fontaine (Oise), orientation nord-sud, présence de charbons, céramique aux pieds (Legoux 1974) ; Dassargues(Hérault), tombes pleine terre, céramique (Garnier et alii 1995) ; Neuvicq-Montguyon (Charentes-Maritimes), céramique,tombes sous tegulae (Maurin 1971) ; Lorleau (Eure), céramique, cercueils (Dollfuss 1962) ; Estagel (Pyrénées-Orientales),coffres mixtes, charbons (Lantier 1942, 1949) ; Dieue-sur-Meuse (Lorraine), Mézières-Manchester et Mazerny (Ardennes),orientation nord-sud, coffres bois, charbons, céramique, monnaies (Young 1984) ; Vron (Somme), orientation nord-sud,cercueils, céramique, monnaie (Sellier 1986) ; Neuville-sur-Escaut (Nord), orientation nord-sud, cercueils, charbons (Han-tute 1989) ; Ennery (Moselle), tombes pleine terre, céramique, monnaies, dépôt animaux (Vidal 1990).(55) Datations réalisées presque uniquement sur le mobilier actuellement.
III.2.2. Les membres inférieurs
Pour les sites de plein champ, la majorité desmembres inférieurs sont étendus, le plus souventrapprochés et quelquefois serrés, pour Lunel-Viel lesHorts, alors qu'ils sont joints pour Venerque. Pour cedernier site, il faut noter la présence de 11% de sujets(4/38) les membres inférieurs fléchis. Toutefois,n'ayant pas fait l'objet d'une étude visuelle selon lamême grille que les autres sites, il est possible quel'observation « joints » puisse être assimilée à « rap-prochés », opposée globalement à « écartés ».
Pour les sites autour d’une église, l'ensembledes membres inférieurs est également étendu, seulle site de St-Bertrand-de-Comminges offre cetteétude, ils sont écartés ou joints indifféremment pourles adultes, et rapprochés pour les sujets immatures(fig. 99, 100 et 101).
Lors des comparaisons (fig. 101), les membresinférieurs ont tendance à se rapprocher suivant lachronologie :
pour l'Antiquité tardive, on constate le passaged'une position des membres inférieurs distante àune position rapprochée, que l'on retrouve en majo-rité dans les sites suivants, VI-VIIe ;
ensuite, à partir du VIIIe siècle, la position desmembres inférieurs jointe semble prédominantepour les adultes, alors que les sujets immaturescontinuent à avoir une position distante.
Toutefois, il est difficile de conclure car lesobservations précises ne sont pas nombreuses. Mais,le passage des jambes écartées aux jambes serréessemble a priori respecter. La constatation faite pourles sites étudiés, concernant les jambes, rejoint ce quiavait été observé dans les Ardennes par P. Périn ;
125 Pratiques funérairesDuchesne S.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 99 : Etude des membres inférieurs des sites étudiés (en %). SBC, St-Bertrand ; VEN, Venerque ;
SBCa, St-Brice de Cassan.
Figure 100 : Etude des membres inférieurs des sites comparés (en %).
membres inférieurs (%) n représentativité fléchis écartés rapprochés joints
SBC 63 65 40 24 36
VEN 40 31 10 100
VEN - OE 13 33 100
VEN - NO-SE 1 14 21 14 100
VEN - NO-SE 2 13 62 15 100
SBCa 141 71 33 60 8
membres inférieurs (%) références n représentativité fléchis écartés rapprochés joints
St Raymond 39 59 36 46 18
IVe s. Arramond 1996 12 60 50 33 17
VIe s. 27 59 30 52 19
Arcambal Grimbert 2000 7 64 13 43 57
Mirepoix Hygounet 1983-1985 12 57 33 42 25
Camp des Lacs 48 70 7 31 35 33
ph. I 8 40 24 38 38
ph. II 4 100 25 50 25
ph. III Marlière 1998 27 60 7 30 37 33
ph. IV 9 90 20 44 22 33
ph. V 3 50 67 33
St Martin du Larzac Azémar et al 1995 5 23 17 60 40
Toulouse Cité Judiciaire 26 76 13 46 54
ph. 1A 6 67 22 50 50
ph. 1B Catalo et al 1999 10 77 50 50
ph. 1C 10 83 17 40 60
126Sous la direction de S. Duchesne et É. Crubezy Duchesne S.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 101 : Etude des membres inférieurs des sites étudiés et comparés. SBC, St-Bertrand ; LVE, Lunel-
Viel l’Eglise ; LVH, Lunel-Viel Les Horts ; VEN, Venerque ; SBCa, St-Brice de Cassan ; TCJ, Toulouse Cité
Judiciaire (1999)
MI étudiés % écartés rapprochés joints n représentativité fléchis
St Raymond 36 46 18 39 59
St Ray IV 50 33 17 12 60
St Ray VI 30 52 19 27 59
SBC 40 24 36 63 65
Arcambal 43 57 7 64 13
VEN 90 40 31 10
VEN - J 100 13 33
VEN - O 86 14 21 14
VEN - R 85 13 62 15
SBCa 33 60 8 141 71
Mirepoix 33 42 25 12 57
Camp des Lacs 31 35 33 48 70 7
CDL I 24 38 38 8 40
CDL II 25 50 25 4 100
CDL III 30 37 33 27 60 7
CDL IV 44 22 33 9 90 20
CDL V 67 33 3 50
St Martin 60 40 5 23 17
Toulouse Cité Judiciaire 46 54 26 76 13
TCJ 1A 50 50 6 67 22
TCJ 1B 50 50 10 77
TCJ 1C 40 60 10 83 17
quant à l'interprétation, il est difficile d'aller si loinpour nos régions en l'absence d'échantillons fiableset datés. Aucune donnée déterminante relative aucontenant, à l'âge ou au sexe (Lorans 1990) n'a étépossible en raison de la faiblesse des échantillons.
III.3. Le mobilier
Pour le dépôt funéraire, une grande variabilité estretrouvée entre les sites, de plein champ ou autourd'une église, allant de 8% et 17% à St-Brice-de-Cas-san, St-Bertrand-de-Comminges, La Gravette et àVenerque, à 32% et 64% à Lunel-Viel, l'Eglise et lesHorts. Plusieurs hypothèses peuvent être émisespour expliquer ces écarts importants. Tout d’abord,une différence régionale entre l’est et l’ouest ; cepen-dant, selon les sites de comparaisons, le mobilier estprésent dans 20-30% des tombes, avec deux excep-tions à Beaucaire-sur-Baïse (Larrieu et alii 1985) et àMouchan (respectivement 54 et 44% des tombes)(Boube, Fouet 1955), et comme dans le sud-ouestélargi56. Ensuite, les fouilles anciennes ou despillages auraient pu faire disparaître une partie dumobilier ; par exemple à Saint-Brice-de-Cassan oùdifférents auteurs à la fin du XIXe et au début du XXe
siècle signalent la nécropole à travers quelquesdécouvertes provenant du site, une bague en argentet avec intailles bleu clair ou des bracelets. Enfin,une différence chronologique peut également inter-venir avec les sites de St-Bertrand-de-Comminges etSt-Brice-de-Cassan, dont la durée d’utilisation estplus longue (fig. 102, 103 et 104).
Toutefois, le mobilier est d'une grande homo-généité, représentée essentiellement par des acces-soires vestimentaires et de parure entre 70 et 80%(exception à St-Bertrand, à St-Brice et La Gravette,46%, 27% et 39% respectivement), puis des mon-naies et quelques objets usuels (couteaux, principa-lement, fusaïole et silex - Lunel-Viel les Horts).Cependant, certains sites présentent des particulari-tés, comme à St-Bertrand-de-Comminges, uneplaque de plomb roulée dans une tombe adulte(datée VII-IXe siècle) et deux coquillages (notam-ment une huître), dans une tombe d'adulte et unetombe d'adolescent, et comme St-Brice-de-Cassanavec des céramiques (une seule appartenant à lapériode chronologique concernée) ou une corne decervidé. Le site de La Gravette présente des diffé-rences de dépôt entre les périodes chronologiques,les accessoires vestimentaires et de parure sont
127 Pratiques funérairesDuchesne S.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 102 : Etude du mobilier des sites étudiés (en %). SBC, St-Bertrand ; LVE, Lunel-Viel l’Eglise ; LVH,
Lunel-Viel Les Horts ; VEN, Venerque ; SBCa, St-Brice de Cassan ; GRA hma, La Gravette (francs et
autochtones du haut Moyen Âge) ; GRA hma-autoch, La Gravette (autochtones du haut Moyen Âge) ;
GRA franc, La Gravette (nécropole franque) ; GRA pmed, La Gravette (période médiévale).
mobilier (%) n tombe représentativité vest./parure céramique monnaie objets usuels autres
couteau autres n
SBC 13 13 46 31 22
LV Eglise 7 32 75 25 25
LV Horts 41 64 76 4 15 4 19 2
VEN 21 17 91 9 9
VEN - OE 2 5 100
VEN - NO-SE 1 14 20 93 7 7
VEN - NO-SE 2 5 26 80 20 20
SBca 11 8 27 27 18 9 27 18
GRA 78 10 39 11 17 5 5 26
GRA hma 60 38 44 10 12 6 6 28
GRA hma-autoch 16 17 29 8 8 55
GRA franc 44 71 48 10 13 20 8 8 20
GRA pmed 18 2,5 10 21 48 21
(56) Essentiellement entre 20 et 40% dans les régions étudiées : Dassargues 29% (Garnier et alii 1995), St Mathieu de Tré-viers 38% (Hérault) (Arnal, Riquet 1959), Puymirol 39% (Lot-et-Garonne) (Désert et alii 1987), Estagel 34% (Pyrénées-Orientales) (Lantier 1949), Giroussens 39% (Tarn) (Lasserre 1988).
mobilier(%) références n représentativité vest./parure céramique monnaie objets usuels verre armes autres
couteau autres n
St Raymond 14 18 13 13 20 7 7 47
IVe s. Arramond 1996 5 23 20 20 60
VIe s. 9 16 9 9 27 10 10 9 36
Costes-Gozon Pujol 1998 9 24 89 11 11
Arcambal Grimbert 2000 3 27 100
Beaucaire sur Baïse Larrieu et al 1985 54 50 62 1 2 13 14 27 6 2
Mouchan Boube, Fouet 1955 18 31 57 3 6 11 17 14 9
Mirepoix Hygounet 1983-1985 6 29 86 14
Camp des Lacs 24 32 65 12 8 8 4 12
ph. I 5 50 67 17 17
ph. II 3 75 100
ph. III Marlière 1998 12 27 67 17 8 8 8
ph. IV 2 20 33 33 33 33
ph. V 2 33 50 50
St Martin du Larzac Azémar et al 1995 5 29 100
Toulouse Cité Judiciaire 2 6 100
ph. 1A
ph. 1B Catalo et al 1999 1 8 100
ph. 1C 1 8 100
majoritaires au haut Moyen Âge (francs et autoch-tones, 44%) et minoritaires à la période médiévale,et inversement pour les dépôts de monnaie (12% auhaut Moyen Âge et 48% à la période médiévale).
Aucune répartition spécifique selon l'âge ou lesexe n'a été relevée, en raison de la faiblesse deséchantillons mal sexés, excepté pour le site de La Gra-vette où l’importance de l’effectif a permis de validercette absence de répartition spécifique statistique-ment, et ce quelque soit le groupe considéré (francs,autochtones du haut Moyen Âge, carolingiens).
De plus, pour le site de La Gravette, il y a unedifférence de distribution du mobilier entre les troisgroupes de populations (francs, autochtones duhaut Moyen Âge, carolingiens à la période médié-vale). Les dépôts funéraires sont très abondantsdans les sépultures franques (71%), moins fréquentsdans les sépultures autochtones du haut Moyen Âge(38%), et quasiment absents dans les sépulturesmédiévales (2,5%). Cette différence est statistique-ment significative entre les francs et les deux autresgroupes (p(x_)<0,001) et entre les carolingiens et lesautochtones du haut Moyen Âge (p(x_)=0,003). Cesrésultats soulignent d’une part l’évolution des pra-tiques funéraires, se traduisant par une nette dimi-
nution des dépôts funéraires entre le haut MoyenÂge et la période médiévale (et comme indiqué pré-cédemment une différence dans le type de dépôtprincipal), et d’autre part les similitudes dans ledépôt funéraire au sein de la nécropole franque(71% de sépultures) avec l’ostentation funérairepropre aux groupes germaniques (Young 1977).
Notons pour finir que les dépôts d’armes sontnombreux dans le groupe franc (18 armes retrouvées,soit 20% des dépôts funéraires) puisqu’ils se retrou-vent dans 13 des 46 tombes à mobilier, et sont préfé-rentiellement associé aux sujets de sexe masculin.
Selon les sites de comparaison, la nature dumobilier change et diminue selon la chronologie (fig.104) : en effet, pour l'Antiquité tardive, l'essentiel secompose d'un dépôt de vaisselle (verre, céramique,60%) et de monnaies (20%), les accessoires vestimen-taires et de parure, relégués à 13%. Ensuite, ces der-niers constituent la majorité, voire l'exclusivité par-fois, du mobilier aux VI-VIIe siècles ; ils peuvent êtreassociés à des objets usuels (entre 10 et 20%), le plussouvent des couteaux, des objets de toilette ou de lavie quotidienne (silex, fusaïole), et à des monnaiesplus rarement (entre 3 et 13%). Enfin, trois sites ontfourni des armes, le site de Mouchan (16%) (Boube,
128Sous la direction de S. Duchesne et É. Crubezy Duchesne S.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 103 : Étude du mobilier des sites comparés.
129 Pratiques funérairesDuchesne S.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 104 : Étude du mobilier des sites étudiés et comparés.
(Pour le site de La Gravette, la différence entre verre et céramique n’a pas été possible d’après les infor-
mations disponibles, et les dépôts de ce type sont notifiés sous le terme céramique)
SBC, St-Bertrand ; LVE, Lunel-Viel l’Église ; LVH, Lunel-Viel Les Horts ; VEN, Venerque ;
SBCa, St-Brice de Cassan ; GRA hma, La Gravette (francs et autochtones du haut Moyen Âge) ; GRA
hma-autoch, La Gravette (autochtones du haut Moyen Âge) ; GRA franc, La Gravette (nécropole
franque) ;
GRA pmed, La Gravette (période médiévale) ; GRA, La Gravette (toutes périodes confondues).
acc. vest/parure monnaie Objets usuels céramique verre armes autres
St Raymond 13 20 7 13 47
Costes-Gozon 89 11
SBC 46 31 22
VEN 91 9
Arcambal 100
Beaucaire 62 2 27 1 6 2
LVH 76 4 19 2
Mouchan 57 3 17 14 9
Mirepoix 86 14
LVE 75 25
SBCa 27 27 27 18
Camp des Lacs 65 12 8 4 12
St Martin du Larzac 100
Toulouse Cité Judiciaire 100
GRA hma 44 12 6 10 28
GRA hma-autoch 29 8 8 55
GRA franc 48 13 8 10 20
GRA pmed 10 48 21 21
GRA 39 17 5 11 26
Fouet 1955), le site de la Gravette (15%) et le site deBeaucaire-sur-Baïse (Larrieu et alii 1985) a fourni éga-lement des couteaux-poignards (7%). Enfin, le site leplus récent (VIII-IXe siècle), la Cité Judiciaire (Cataloet alii 1999) ne présente quasiment plus de mobilier(6%), se résumant à de simples agrafes (tout commepour le site de la Gravette à la période médiévale,avec seulement 2,5% des sépultures contenant dumobilier). Cette diminution est également retrouvéelors des réinhumations, où le nouvel inhumé estenseveli avec nettement moins de mobilier (Campdes Lacs, de 50% à la phase VI-VIIe à 17% à la phaseVIII-IXe siècles) (Marlière 1998) ou sans mobilier(Costes-Gozon, mobilier en position remaniée)(Pujol 1998). Dans le site de Beaucaire-sur-Baïse, laforte présence de mobilier observée montre qu’elleest antérieure au début du VIIe siècle selon la typolo-gie, pour la plupart des réinhumations.
Ce schéma correspond également à ce qui estrencontré dans les autres cimetières du haut MoyenÂge en France. En effet, pour l’Antiquité tardive,l’importance est accordée traditionnellement à lavaisselle, élément majeur du dépôt funéraire (20 à50% des tombes à mobilier dans le plupart des sites)(Young 19977), et aux pièces de monnaies, alorsqu’on constate une relative pauvreté des ornementspersonnels. Tout le matériel peut alors être consi-déré comme une offrande aux morts (Young 1977).Puis, à l'époque mérovingienne, s'accroît une osten-tation funéraire, développée dès le IVe siècle avecl'arrivée de groupes germaniques, qui présentaientleurs morts dans l’éclat de leur puissance et leurrichesse (Young 1977). Le statut social se marquealors par la richesse déployée dans la tombe (Tref-fort 1996), essentiellement au VIIe siècle au traversde l'inhumation habillée, mais aussi au travers desobjets destinés à accompagner le mort (Treffort1996). La présence de quelques monnaies dans lestombes ne fait plus référence à l'obole à Charon, enraison d'une localisation différente, mais elle peutacquérir une signification politique, de fidélité (Tref-fort 1996) ou religieuse, de protection (Treffort 1996,Lorans 2000). Ensuite, la pratique du dépôt d'objetstend à se réduire à quelques éléments de costume, età la fin du VIIe siècle ou au début du VIIIe siècle, àdisparaître. Le développement du christianisme asouvent été invoqué pour expliquer l'abandon dudépôt de mobilier. L'Église n'a jamais condamné cesrites de manière canonique ; cependant, la lente dif-fusion du christianisme, au moyen du courant ascé-tique irlandais développé à partir du VIIe siècle enFrance, et de son action de la pastorale, a joué un
rôle dans le processus de cette disparition. En effet,ce courant prône l'humilité et la volonté de charité,à l'image des saints refusant les honneurs réservés àleur rang (Treffort 1996). Cette nouvelle attitudemodifie les pratiques funéraires : la tombe n'est utileque si elle est accompagnée de prières rituelles etdes gestes charitables. Ainsi, les biens, auparavantdéposés dans la tombe, sont maintenant destinésaux vivants : aumônes aux pauvres et dons à l'Eglisepermettront de recueillir des prières efficaces pourle salut de l'âme (Treffort 1996). Dès lors l’Églisereçut les richesses jusque-là enfouies dans lestombes des grands comme des plus humbles,constituant ainsi les trésors de ses sanctuaires enéchange de la prière pour les morts (Lorans 2000).
Ainsi, avant le VII-déb VIIIe siècle, il sembleque les démarches funéraires soient du domaineencore de la famille et des proches, aussi bien pourles sites de plein champ, que pour les sites autour deséglises, l'Église se désintéressant du problème maté-riel du traitement du cadavre et de la construction dela tombe (Young 1977 ; Treffort 1996). Tandis qu'en-suite, avec la diffusion du christianisme et le déve-loppement de la liturgie, venue d'Irlande avec uncourant d'ascétisme, prônant la pauvreté, l'humilité,la prière et les gestes charitables, et son appropria-tion et son développement par les classes favorisées,l'Église semble prendre petit à petit le « contrôle desmorts », et l'encadrement total des vivants, de lanaissance à la mort (Young 1977 ; Treffort 1996).
130Sous la direction de S. Duchesne et É. Crubezy Duchesne S.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
IV. 1. La mortalité des immatures
En appliquant le principe de conformité (Sellier1996), nous avons réparti ces données biologiquesbrutes en classes d'âges identiques à celles utiliséesdans les tables types de Ledermann (1969) (fig. 105).
IV. 1.1. Analyse des quotientsde mortalité
Les quotients de mortalité des enfants ont été calcu-lés pour une espérance de vie à la naissance de 25ans (e°0=25 ans) (fig. 106), et comparés aux tablestypes pour une espérance de vie comprise entre 25et 30 ans (fig. 107, - q+, limite supérieure poure°0=25, q-, limite inférieure pour e°0=30 ans). Lanécropole de Vindrac n’a pas fait l’objet de cetteétude car seulement deux enfants, âgés d’environ 6ans, constituent l’échantillon immature ; il n'y adonc ni enfant en bas-âge ni adolescent.
Les quotients de mortalité mettent en évi-dence une importante sous représentation des deuxpremières classes d’âge, les nourrissons et lesenfants en bas âge. Il s’agit d’anomalies non réduc-tibles qui ne peuvent être dues à la méthode. Pourles classes d’âge suivantes, ils se rapprochent du
schéma de mortalité archaïque. Ce biais, touchantessentiellement la classe 0-4 ans, est retrouvé dans lamajorité des nécropoles du haut Moyen Âge (Castex1994 ; Murail, Raynaud 1996). Cependant, l’inhuma-tion des nouveau-nés est plus élevée à Saint-Ber-trand-de-Comminges et à Saint-Brice-de-Cassan et àla Gravette, les trois sites ayant une durée pluslongue. Cette distribution, comme semble le suggé-rer la différence des inhumations des deux pre-mières classes d’âge sur le site de La Gravette pourle haut Moyen Âge et la période médiévale, estpeut-être à mettre en relation avec les changementsde mentalité à l’égard des enfants, après lesVII/VIIIe siècles. En effet, au cours de la périodecarolingienne, les habitudes mentales et matériellesface aux décès des jeunes enfants se modifient, etfavorisent leur inhumation dans le cimetière com-munautaire (Alduc-le-Bagousse, Pilet 1986).
Ils soulignent aussi le faible nombre d’adoles-cents (15-19 ans), pour Saint-Bertrand-de-Com-minges57, Saint-Brice-de-Cassan et Lunel-Viell’Eglise. Le cas de Lunel-Viel peut être élucidé facile-ment. Le site des Horts se caractérise par un fortpourcentage d'adolescents (8,3%) alors que celui del’Eglise présente une proportion d'adolescentsmoindre (1,8%). Cette différence, exprimée par le rap-port (5-10 ans)/(10-14 ans), fort aux Horts (égal à 5) et
IV RECRUTEMENT
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
131 RecrutementRomon Th., Murail P., Rougé D., Duchesne S.,
Crubézy E.
Romon Th., Murail P., Rougé D., Duchesne S., Crubézy E.
Figure 105 : Répartition des sujets immatures selon les classes d’âge et les sites étudiés.
SBC, St-Bertrand ; LVE, Lunel-Viel l’Église ; LVH, Lunel-Viel Les Horts ; VEN, Venerque ; SBCa, St-Brice de
Cassan ; VIN, Vindrac ; GRA hma, La Gravette (haut Moyen Âge) ; GRA pmed, La Gravette (période
médiévale).
Cl. d'âge n 0 1-4 5-9 10-14 15-19
SBC 40 5 14 10 5 6
SBC sud 23 5 8 6 3 1
LVE 11 0 2 4 4 1
LVH 32 2 9 10 2 9
VEN 33 1 9 10 5 8
SBCa 45 7 14 13 8 3
VIN 2 2
GRA hma 50 1 16 17 6 10
GRA pmed 233 40 92 53 21 27
(57) Et notamment les annexes sud, zone privilégiée et épargnées par les fouilles anciennes, qui présentent une forteconcentration d’inhumations (98 tombes, dont 23 sujets immatures).
132Sous la direction de S. Duchesne et É. CrubezyRomon Th., Murail P., Rougé D., Duchesne S.,
Crubézy E.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 106 : Répartition des sujets immatures des sites étudiés selon les quotients.
SBC, St-Bertrand ; LVE, Lunel-Viel l’Eglise ; LVH, Lunel-Viel Les Horts ; VEN, Venerque ; SBCa, St-Brice de
Cassan ; GRA hma, La Gravette (haut Moyen Âge) ; GRA pmed, La Gravette (période médiévale).
Figure 107a : Répartition des sujets immatures de la
nécropole de St-Bertrand-de-Comminges, selon les quo-
tients. En grisé, mortalité pour une espérance de vie
comprise entre 25 et 30 ans.
Figure 107b : Répartition des sujets immatures des
nécropoles de Lunel-Viel, selon les quotients. En grisé,
mortalité pour une espérance de vie comprise entre 25
et 30 ans.
Figure 107c : Répartition des sujets immatures de la
nécropole de Rivel à Venerque, selon les quotients. En
grisé, mortalité pour une espérance de vie comprise
entre 25 et 30 ans.
Quotients (q) q SBC q SBC sud q LVE q LVH q VEN q SBCa q GRA hma q GRA pmed e°0=25, q+ e°0=30, q-
0 27,78 51,02 0,00 18,52 6,90 46,05 6,33 63,90 459,78 188,02
1-4 80 86,02 34,48 84,91 62,50 96,55 101,91 157,00 607,61 160,9
5-9 62,11 70,59 89,29 103,09 74,07 99,24 120,57 107,29 123,64 37,95
10-14 33,11 37,97 98,04 22,99 40 67,80 48,39 47,62 67,64 22,08
15-19 41,10 13,16 43,48 105,88 66,67 27,27 84,75 64,29 97,02 29,61
Quotients (q) SBC SBC sud e°0=25, q+ e°0=30,q-
0 27,78 51,02 459,78 188,02
1-4 80 86,02 607,61 160,9
5-9 62,11 70,59 123,64 37,95
10-14 33,11 37,97 67,64 22,08
15-19 41,10 13,16 97,02 29,61
Quotients (q) l'Église Les Horts e°0=25, q+ e°0=30,q-
0 0,00 18,52 459,78 188,02
1-4 34,48 84,91 607,61 160,9
5-9 89,29 103,09 123,64 37,95
10-14 98,04 22,99 67,64 22,08
15-19 43,48 105,88 97,02 29,61
Quotients (q) VEN e°0=25, q+ e°0=30,q-
0 6,90 459,78 188,02
1-4 62,50 607,61 160,9
5-9 74,07 123,64 37,95
10-14 40 67,64 22,08
15-19 66,67 97,02 29,61
faible à l'Eglise (égal à 1), pourrait refléter une distri-bution différente. Cependant, elle n'est pas statisti-quement significative (a = 27 %), principalement enraison du faible effectif considéré. En réunissant lesdeux nécropoles, ce rapport de 2,33 est cependantproche de celui d'une population naturelle (égal à 2).L'échantillon de la population semble donc être sou-mis à une sélection, en faveur des adolescents et desenfants entre 5 et 10 ans dans la nécropole des Hortset des enfants entre 10 et 14 ans dans celle de l'Eglise(Murail, Raynaud 1996).
IV. 1.2. Proportions immatures/adultes
Les proportions immatures/adultes témoignentbien d’un effectif trop faible d’enfants inhumés dansces nécropoles (fig. 108), les démographes estimantà 40-45% environ la proportion des décès touchantles enfants et les adolescents pour les premierssiècles de notre ère (Castex 1994).
La nécropole de Saint-Brice-de-Cassan et deLa Gravette à la période du haut Moyen Âge pré-
sentent une proportion de 42% et 46% respective-ment, correspondant au schéma de mortalitéarchaïque ; cependant, cela n’est du qu’à une répar-tition anormale des individus : le nombre desenfants de plus de 5 ans compense le nombre insuf-fisant des enfants de moins de 5 ans.
La proportion relativement élevée de 59%pour la période médiévale du site de La Gravettepourrait, comme suggéré précédemment, témoi-gner d’un changement de mentalité aboutissant àune inhumation des jeunes enfants dans les cime-tières communautaires.
Les deux nécropoles de Lunel-Viel se différen-cient par des caractéristiques archéologiques nettes(nombre d'individus par tombe, typologie destombes), et par une sélection en fonction de l'âgelors de l'inhumation des enfants entre 5 et 14 ans.Dans l'hypothèse d'une fouille représentative del'ensemble des deux nécropoles, et en doublant l’ef-fectif immature du site de l’Église, le nombre desenfants entre 5 et 14 ans est équilibré par rapport àcelui des adultes. On peut donc proposer l'hypo-
133 RecrutementRomon Th., Murail P., Rougé D., Duchesne S.,
Crubézy E.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 107d : Répartition des sujets immatures de la
nécropole de St-Brice-de-Cassan selon les quotients. En
grisé, mortalité pour une espérance de vie comprise
entre 25 et 30 ans.
Figure 107e : Répartition des sujets immatures de la
nécropole de La Gravette à la période du haut Moyen
Âge (hma) et à la période médiévale (pmed), selon les
quotients. En grisé, mortalité pour une espérance de vie
comprise entre 25 et 30 ans.
Quotients (q) SBCa e°0=25, q+ e°0=30,q-
0 46,05 459,78 188,02
1-4 96,55 607,61 160,9
5-9 99,24 123,64 37,95
10-14 67,80 67,64 22,08
15-19 27,27 97,02 29,61
Quotients (q) hma pmed e°0=25, q+ e°0=30,q-
0 6,33 63,90 459,78 188,02
1-4 101,91 157,00 607,61 160,9
5-9 120,57 107,29 123,64 37,95
10-14 48,39 47,62 67,64 22,08
15-19 84,75 64,29 97,02 29,61
thèse - en raison du faible effectif et de la fouille nonexhaustive - de la complémentarité entre les deuxnécropoles (Murail, Raynaud 1996).
IV. 2. La mortalité des adultes
IV. 2.1. Répartition des adultesselon le sexe
Toutes les nécropoles ont plus de la moitié de leureffectif adulte sexé, à l’exception des sites de Lunel-Viel et de Venerque (fig. 109). Pour le site de Lunel-Viel les Horts, l'état de conservation des ossements,médiocre, ne permettait pas l'étude de la diagnosesexuelle.
Le sex ratio, rapport hommes/femmes, montreune sur représentation masculine pour les nécro-poles de Saint-Bertrand-de-Comminges, de Lunel-Viel l'Église et de la Gravette, et une sous représen-
tation pour celle de Saint-Brice-de-Cassan. Ces dif-férences avec le rapport théorique de 1 ne sont passtatistiquement significatives. Ces répartitions sontdonc compatibles avec une mortalité naturelle.
Dans le cas de Vindrac, le sex ratio souligne uneforte sur représentation masculine58. En raison dufaible effectif (n=13), il est inutile de tester statistique-ment l'hypothèse d'un recrutement particulier : cesite présente une sélection par rapport au sexe. Rap-pelons, toutefois, que seuls quelques sarcophages ontété étudiés, provenant de l’édifice et de ses annexes.
IV. 2.2. Répartitiondes adultes selon l’âge
La répartition des adultes des différents sites a étéeffectuée sexes réunis en raison des faibles effectifscrâniens, et pour une espérance de vie à la naissancede 25 ans59.
134Sous la direction de S. Duchesne et É. CrubezyRomon Th., Murail P., Rougé D., Duchesne S.,
Crubézy E.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 108 : Proportions immatures/adultes selon
les sites étudiés.
SBC, St-Bertrand ; LVE, Lunel-Viel l’Église ; LVH,
Lunel-Viel Les Horts ; VEN, Venerque ; SBCa, St-
Brice de Cassan ; VIN, Vindrac ; GRA hma, La Gra-
vette (haut Moyen Âge) ; GRA pmed, La Gravette
(période médiévale).
Figure 109 : Répartition des adultes selon le sexe
et les sites.
SBC, St-Bertrand ; LVE, Lunel-Viel l’Église ; LVH,
Lunel-Viel Les Horts ; VEN, Venerque ; SBCa, St-
Brice de Cassan ; VIN, Vindrac ; GRA hma, La Gra-
vette (haut Moyen Âge) ; GRA pmed, La Gravette
(période médiévale).
(58) En considérant uniquement les adultes sexés par l'os coxal, le sex ratio est égal à 4 ; en ajoutant les individus sexés parle crâne, le sex ratio égale alors 5,5.(59) À l’exception du site des Horts (Lunel-Viel), où la mauvaise conservation des ossements n’a pas permis de réaliser cetteétude. De même pour le site de la Gravette, seuls les sujets de la période médiévale ont été inclus dans cette étude, à causede la mauvaise conservation et du faible effectif des sujets du haut Moyen Âge.
Sites N imm N ad proportion imm/ad
SBC 40 140 29%
SBC sud 23 75 31%
LVE 11 44 25%
LVH 32 76 42%
VEN 33 112 29%
SBCa 45 107 42%
VIN 2 20 10%
GRA hma 50 108 46%
GRA pmed 233 393 59%
Adultes N N sexé M F sex ratio
SBC 140 51% 42 30 1,4
SBC sud 75 67% 30 20 1,5
LVE 44 34% 9 6 1,5
LVH 76 5% 4
VEN 112 38% 22 20 1,1
SBCa 107 55% 25 34 0,7
VIN 20 65% 11 2 5,5
GRA hma 108 79% 49 36 1,4
GRA pmed 393 83% 178 149 1,2
L'analyse des histogrammes sexes réunis (fig.110) montre un sureffectif des décédés (Dx) dans lapremière classe (20-29 ans), accompagné d'un déficitdans les classes âgées (50-59, 60-69, et 80 ans et plus).Par contre, les classes 30-39 et 40-49 ans comportentà peu près les effectifs théoriques attendus. Cetterépartition, décroissante, s’apparente au type« cimetière militaire » décrit par Cl. Masset (1982).Ce schéma se retrouve sur toutes les nécropoles, àl’exception de la nécropole de la Gravette (périodemédiévale).
Toutefois, le profil démographique de lanécropole de Rivel à Venerque s’approche de lacourbe de mortalité théorique (Ledermann 1969), àl’exception de la première classe d’âge. Le profil dela nécropole de la Gravette à l’Isle-Jourdain définitune population naturelle, alors que les profils desautres nécropoles s’en écarte.
L’étude en fonction du sexe a été possible pourdeux sites, Saint-Bertrand-de-Comminges et l’Isle-Jourdain (La Gravette). Pour Saint-Bertrand-de-Comminges, la répartition obtenue (Romon 1996)est tout à fait aberrante pour les femmes, tandis que
pour les hommes, la distribution déjà observée(forte mortalité de jeunes adultes) est accentuée.L'aberration des résultats pour les femmes est cer-tainement liée au nombre d'individus trop faible.Pour l’Isle-Jourdain, la répartition masculine estconforme à une mortalité naturelle, tandis que lamortalité féminine présente une sur-mortalité desjeunes femmes (20-30 ans).
Le site de Vindrac, avec ses 85% de sujets mas-culins, présente une population particulière, com-posée essentiellement d’hommes peu âgés.
Ainsi, la seule anomalie est la forte représenta-tion de la première classe d’âge, décrivant unepopulation jeune. L’étude a donc été poursuivie parl’examen de l’extrémité médiale de la clavicule quisépare les individus jeunes des sujets matures, afinde retrouver ou non le sureffectif des adultes jeunes.
Sur les 35 clavicules étudiées pour la nécro-pole de Saint-Bertrand-de-Comminges, 55% dessujets (soit 19/35) ne sont pas matures ; cela signifieque ces adultes appartiennent à la classe 20-29 ans,ceci indépendamment du sexe. Pour les annexes
135 RecrutementRomon Th., Murail P., Rougé D., Duchesne S.,
Crubézy E.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 110a : Répartition des sujets adultes selon
les effectifs décédés (Dx), e°=25 ans,
pour le site de Saint-Bertrand-de-Comminges.
Figure 110b : Répartition des sujets adultes selon
les effectifs décédés (Dx), e°=25 ans,
pour le site de Lunel-Viel l’Église.
SBC, n=27 Dx (Masset) Dx (Led., e°=25 ans)
20-29 7,2 4,24
30-39 4,5 3,96
40-49 3,7 3,67
50-59 3,5 4,03
60-69 3,2 4,89
70-79 3,7 4,40
80-w 1,1 1,67
LVE, n=15 Dx (Masset) Dx (Led.)
20-29 6,31 3,93
30-39 4,14 3,67
40-49 3,57 3,40
50-59 3,67 3,73
60-69 2,9 4,53
70-79 3,67 4,07
80-w 1,23 1,68
sud, c’est 59% des sujets (soit 17/29) qui appartien-nent à cette classe 20-29 ans. En comparaison avec lepourcentage établi par la méthode de Masset, de26% (7/27), nous constatons que l’observationdirecte montre encore davantage de sujets jeunes,définissant donc bien un recrutement en faveur desadultes jeunes.
Pour la nécropole de Saint-Brice-de-Cassan,sur les 65 clavicules étudiées, 11% des sujets (soit7/65) ne sont pas matures, alors qu’ils sont 23%selon la méthode de Masset. Nous constatons doncun accroissement de la classe d’âge 20-29 ans, signi-ficatif au test de Chi2 (égal à 5,10, supérieur à 3,84pour un seuil de 5%). On ne retrouve donc pas cettesurmortalité avec l’observation directe. Son explica-tion est alors peut-être à rechercher dans l’emploi dela méthode appliquée : sexes réunis. En effet, lerisque de biais s’accroît lorsque le rapport entre leseffectifs des deux sexes diffèrent sensiblement de 1(Masset 1982) ; or, le sex ratio est ici de 0,7.
Pour la nécropole de La Gravette à l’Isle-Jour-dain, d’après la clavicule ou la crête iliaque, la popu-lation féminine ne semble pas marquée par une pro-
portion de sujets jeunes (14/132), décédés entre 20 et30 ans, plus forte que la population masculine(8/168). Le test de Chi_ (égal à 3,18) est non signifi-catif pour un seuil de 5%. Cette surmortalité pour-rait en fait n’être que le reflet de la disparition descrânes ostéoporotiques des femmes âgées. Elle nepeut en tout cas être assimilée à un profil lié à unesélection des inhumés, en l’occurrence type « cime-tière militaire », aucune décroissance des effectifsavec l’âge n’étant observé.
IV. 3. Conclusions sur le recrutement
IV. 3.1. La mortalité des enfants
La faible représentativité des classes d’âge 0 et 1-4ans constituent donc l’anomalie principale del’échantillon immature décédé. C’est une donnéeclassique des nécropoles du haut Moyen Âge, encontradiction avec la réalité de la mortalité de cesclasses d’âge, qui, est estimée à 45% en moyenne,allant jusqu’à 55% maximum pour cette période60
(Pétrequin et alii 1980) et qui, encore au XVIIIe siècle,pouvait atteindre en France 58% des décédés (San-
136Sous la direction de S. Duchesne et É. CrubezyRomon Th., Murail P., Rougé D., Duchesne S.,
Crubézy E.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 110d : Répartition des sujets adultes selon
les effectifs décédés (Dx), e°=25 ans,
pour le site de Saint-Brice-de-Cassan.
Figure 110c : Répartition des sujets adultes selon
les effectifs décédés (Dx), e°=25 ans,
pour le site de Venerque.
VEN, n=26 Dx (Masset) Dx (Led.)
20-29 5,8 4,09
30-39 3,8 3,81
40-49 3,4 3,53
50-59 3,5 3,88
60-69 4 4,71
70-79 3,9 4,23
80-w 1,6 1,75
SBCa, n=73 Dx (Masset) Dx (Led.)
20-29 17,3 11,48
30-39 12,49 10,71
40-49 10,83 9,92
50-59 9,35 10,89
60-69 8,13 13,22
70-79 11,05 11,89
80-w 3,87 4,9
137 RecrutementRomon Th., Murail P., Rougé D., Duchesne S.,
Crubézy E.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 110e : Répartition des sujets adultes selon
les effectifs décédés (Dx), e°=25 ans,
pour le site de Vindrac.
Figure 110f : Répartition des sujets adultes selon
les effectifs décédés (Dx), e°=25 ans,
pour le site de la Gravette (période médiévale).
VIN, n=20 Dx (Masset) Dx (Led.)
20-29 4,80 3,14
30-39 3,65 2,93
40-49 2,85 2,72
50-59 2,50 2,98
60-69 2,40 3,62
70-79 2,40 3,26
80-w 1,00 1,34
GRA, n=100 Dx (Masset) Dx (Led.)
20-29 17,43 15,72
30-39 12,72 14,67
40-49 12,26 13,59
50-59 14,18 14,92
60-69 20,15 18,10
70-79 15,73 16,28
80-w 7,52 6,71
silbano-Collilieux 1994). Ce biais dans la représenta-tion des immatures signifie donc que la populationarchéologique étudiée est différente de la popula-tion naturelle dont elle est issue. Il y manque desenfants, et plus exactement, des nourrissons et desenfants en bas-âge.
Plusieurs interprétations ont déjà été émisespour tenter d’expliquer ce biais quasi-systématique.
Des critères de conservation différentielle ont étéévoqués :
soit la faible profondeur des sépultures des jeunesenfants, détruites par l’arasement du terrain. En effet,les travaux agricoles, et en particulier les labours, ontpu engendrer une conservation différentielle artifi-cielle liée à la profondeur des inhumations.
soit la moindre conservation des squelettes desenfants, si souvent invoquée. Il existe effectivementun lien entre l’âge et la conservation différentielle,
seulement il n’intervient que pour 3 à 10% des varia-tions de la conservation des os (Masset 1973, 1990,cité par Barthélémy 1999). Ainsi, cette interprétationne semble pas justifiée, l'âge au décès importe peusur la conservation des os.
L’existence d’un secteur réservé aux enfants horsdes limites de la nécropole ou en dehors de la zonefouillée est l’hypothèse la plus couramment admise.En effet, dans le monde chrétien, il existe souventune zonation évidente des cimetières, qui s’estmaintenu par ailleurs jusqu’à une époque trèsrécente (Tillier, Duday 1990). Cette hypothèse relèvedonc du critère de sélection à l’inhumation. Cetteinterprétation, envisagée pour trois des sites étu-diés, est réaliste pour les sites de Lunel-Viel, où l’onobserve l’inhumation préférentielle des enfantsentre 5 et 10 ans dans la nécropole périphérique (LesHorts) et des enfants entre 10 et 14 ans près de l'édi-fice religieux (l'Église).
(60) Compatible avec la démographie historique de 40-45% (Alduc-le-Bagousse, Sansilbano-Collilieux 1991).
Des arguments d’ordre socioculturel ont égale-ment souvent été évoqués pour justifier ce biais(Pilet et alii 1992 ; Sansilbano-Collilieux 1994) :
concernant le haut Moyen Âge, les crimes com-mis contre l’enfant sont fréquents et sans impor-tance, qu’il s’agisse de l’infanticide ou de l’avorte-ment. Les pénitentiels, sermons et textes normatifsecclésiastiques et laïcs montrent, en effet, les préoc-cupations engendrées par ces pratiques. Les dénon-ciations du Concile de Lérida de 524, le Concile deTolède de 589, la loi des wisigoths ou la loi des Ala-mans en témoignent. Il est probable que les enfantsayant subi un tel sort ne trouvaient pas place dans lecimetière.
les interdits de l’Église concernant les enfantsnon-baptisés, qui n’étaient pas inhumés dans lecimetière en raison de l’absence de reconnaissancesociale. Dans la société du Moyen Âge, le baptêmechrétien était administré après le sevrage, qui pou-vait être repoussé jusqu’à l’âge de trois ans dans lesmilieux défavorisés (Grégoire de Tours, Miracles deSt Martin, II, LI) et ceci malgré les incitations del’Eglise à faire baptiser rapidement les enfants pourne pas les exposer à la mort éternelle (Grégoire deTours, Historia Francorum, VI, 23, IX, 37). Les inter-dits de l’Église concernent les enfants non-baptiséset l’administration tardive du baptême participentsans doute à la faible représentativité des enfants enbas-âge dans les cimetières.
Toutefois, il semble que la situation commenceà changer pour les nouveau-nés dans les sites deSaint-Bertrand-de-Comminges, de la Gravette et deSaint-Brice-de-Cassan, où ils sont plus fréquem-ment inhumés que dans les autres sites. L’inhuma-tion des tout-petits dans le cimetière, quasi-inexis-tante auparavant, va progressivement devenir unepratique courante (Alduc-le-Bagousse, Pilet 1986 ;Alexandre-Bidon, Lett 1997). Elle pourrait être alorsle témoin indirect de la christianisation en profon-deur de la population et d’une reconnaissancesociale de l’enfant (Pilet et alii 1992).
L’anomalie du faible nombre d’adolescentsdans les sites d’église, peut être liée comme à Lunel-Viel à une sélection : les adolescents sont plutôt inhu-més au cimetière des Horts qu’à l’Église. En effet,l’anomalie disparaît si les populations des deux
cimetières sont réunies, comme pour les enfants âgésde 5 à 14 ans. Ainsi, une sélection pourrait égalementêtre envisagée pour les cimetières de Saint-Bertrand-de-Comminges et de Saint-Brice-de-Cassan.
IV. 3.2. La mortalité des adultes
* Répartition des adultes selon le sexe
Tous les sites étudiés, à l’exception d’un seul (Vin-drac), ont un sex ratio compatible avec une mortaliténaturelle : il y a autant d’hommes que de femmes.Cela constitue la règle générale pour les nécropoleset les cimetières du haut Moyen Âge, tant rurauxqu’urbains, avec ou sans édifice religieux.
Le site de Saint-Bertrand-de-Commingesmontre cependant une répartition par âge desadultes, en faveur des jeunes hommes, dont l’essen-tiel est situé dans les annexes sud. De même, le sitede Vindrac présente un sureffectif masculin impor-tant démontrant pour le secteur considéré, l’édificeet ses annexes, une sélection en fonction du sexe, eten relation avec les tombes fouillées. Cette présencede sujets masculins à l’intérieur de bâtiments reli-gieux a déjà été rencontré à Seyssel-Albigny (Bizot1988 ; Castex 1994), Viuz-Faverges « Saint-Jean-Bap-tiste » I-II (Buchet, Olive 1983) et Saint-Julien-en-Genevois (Buchet 1986), édifices ruraux (VI-IXe, VII-Xe et IX-VIIIe siècles), en Haute-Savoie, et à Tours(collégiale Saint-Martin) (Theureau 1995), édificeurbain (IV-IXe)61. Dans le cas de Tours, cette majora-tion des hommes peut être mis en relation avec lestatut de l’édifice et donc son personnel ecclésias-tique (moines, etc). Cependant, pour les autres, il estdifficile de définir ce groupe d’individus, d’autantplus que le statut de ces édifices n’est pas connu :religieux, notables, ce qui vient immédiatement àl’esprit, ou bien encore ouvriers, comme cela a étédémontré dans la basilique paléochrétienne d’Aliki(V-VIIe siècle, île de Thasos), en Grèce (Buchet 1986).
* Répartition des adultes selon l’âge
Dans tous les cas, les répartitions de la populationadulte sont identiques à ceux obtenus par Masset(1982) lors de l'étude d'un cimetière militaire, c'est-à-dire une forte proportion de sujets jeunes et lafaible représentation des sujets âgés.
138Sous la direction de S. Duchesne et É. CrubezyRomon Th., Murail P., Rougé D., Duchesne S.,
Crubézy E.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
(61) Le sex ratio de ces sites est respectivement de 3,8 ; 3 ; 5,6 et 7,5.
La seule exception concerne le site de la Gra-vette (période médiévale) pour lequel la mortalitéadulte est proche de la mortalité naturelle. Toute-fois, un biais du à la représentation de l’échantillon,seulement 19% des effectifs adultes de cette période,n’est pas à exclure.
Cette répartition dans le recrutement de la popula-tion adulte est une donnée courante du recrutementfunéraire62, qu’il est toujours difficile d’interpréter.En effet, deux hypothèses sont émises :
cette distribution correspond à un problème deméthodes, qui auraient tendance à rajeunir les indivi-dus les plus âgés (Simon 1987 ; Castex 1994 : cime-tière St Pierre à Dreux). Les méthodes utilisées, aussibien l’estimation de l’âge que la répartition de lamortalité (Sansilbano-Collilieux 1994), et les effectifsinsuffisants peuvent être pour partie responsables decette anomalie. L’emploi de la méthode probabilistede Masset sexes réunis reflète notamment une imagemoins fiable et fidèle de la structure par âge que laméthode où hommes et femmes sont individualisés.
139 RecrutementRomon Th., Murail P., Rougé D., Duchesne S.,
Crubézy E.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
(62) Sur le plan national, 34% des sites relevés dans la bibliographie (30/88), faisant l’objet d’une monographie, ou citéscomme élément de comparaison (ouvrage, article, thèse), présentent une étude de recrutement, et 70% de ces cimetièreset nécropoles du haut Moyen Âge présentent une surmortalité dans la classe d’âge 20-29 ans. Toutefois, il intéresse dans56% des cas les femmes, et dans 34% les hommes, et 9% pour lesquels le sexe n’était pas mentionné.
Figure 111 : Répartition des adultes (en %) selon les sites et les classes d’âge, e°0= 25 ans.
LVE, Lunel-Viel l’Église ; SBC, St-Bertrand ; VIN, Vindrac ; SBCa, St-Brice de Cassan ; VEN, Venerque ; GRA
pmed, La Gravette (période médiévale).
% LVE SBC VIN SBCa VEN GRA pmed Led, e°=25 Led, e°=30
20-29 28,3 26,7 24,5 23,7 22 17 16 13
30-39 17,9 16,7 18,6 17,1 15 13 15 13
40-49 17,0 13,7 14,5 14,8 13 12 14 13
50-59 12,3 13,0 12,8 12,8 13 14 15 15
60-69 7,9 11,9 12,2 11,1 15 20 18 19
70-79 11,6 13,7 12,2 15,1 15 16 16 18
80-w 4,9 4,1 5,1 5,3 6 8 7 8
total 100 100 100 100 100 100
cette distribution correspond bien à une sélection. Denombreux travaux ont déjà observé une surmorta-lité dans cette classe d’âge (20-29 ans), habituelle-ment attribuée à la surmortalité féminine. Les hypo-thèses alors avancées sont la mortalité maternelle,une sensibilité plus grande à certaines maladies et lerôle social des femmes (Jusot 1996 ; Crubézy et alii1998). Seulement ces hypothèses ne font pas l’una-nimité. De plus, la surmortalité pour cette tranched’âge peut aussi bien affecter les hommes, de nom-breux exemples peuvent en témoigner63.
Cette répartition concerne les cimetières avecou sans édifices religieux, elle est toutefois, plus pro-noncée dans les sites d’églises, Lunel-Viel l’Eglise etSaint-Bertrand-de-Comminges, Vindrac, que dansles deux sites de plein champ, Saint-Brice-de-Cassanet Venerque. De même, elle est plus marquée dansles cimetières suburbains que les cimetières ruraux.Cette constatation a déjà été faite par de nombreuxauteurs confirmant les variations de mortalité entrevilles et campagnes, la mortalité étant généralementplus forte dans le premier cas, pour des populationsmédiévales (Castex 1994 ; Simon 1986 et 1990) oudes périodes plus récentes (Perrenoud 1990, cité parSimon 1990).
L'étude du recrutement montre que les popu-lations étudiées ne représentent pas une populationnaturelle. Elles présentent une sous représentationdes enfants, due soit à une sélection en fonction del’âge (comme à Lunel-Viel) soit à l’organisation des
cimetières, et un sureffectif des adultes jeunes. Ilsemble plus difficile dans ce dernier cas de se pro-noncer en faveur d’un problème de méthodes, desélection, ou d’organisation des cimetières, d’autantplus que les sites considérés n’ont pas été fouillés defaçon exhaustive. Dans ce cas, la partie détruite ouencore non fouillée peut correspond aux anomaliesconstatés lors de l’étude du recrutement (Romon1996). Toutefois, les annexes sud de la basilique deSaint-Bertrand-de-Comminges, zone épargnée parles fouilles anciennes et à forte concentration d’in-humations, sont caractérisées par un recrutementspécifique de jeunes hommes (Romon 1996). Demême, il apparaît fort probable que le secteur étudiédu site de Vindrac abritait principalement deshommes (Crubézy, Murail, Viguier à paraître).
Si ce recrutement reflète donc bien la réalité,elles montrent des conditions de vie peu favorablesqui peuvent être liées à une brusque dégradationdes conditions de vie, observée à partir du VIe
siècle64. Deux causes sont jusqu’à présent retenues,une nette péjoration des conditions sanitaires enrelation avec l’instabilité politique de cette période,campagnes militaires, famines (Simon 1990) et unemortalité consécutive à des épidémies. En effet, lapeste sévissait au haut Moyen Âge (Castex 1994), etnotamment dans le sud de la France, « à l’exceptionde l’Aquitaine et de l’Espagne atlantique, tout levieux monde romain, urbanisé, fut ravagé par lapeste (justinienne) » (Rouche 1986, cité par Bouali,Vattéoni 1991), et aussi en Provence et à Marseille(Pouyé et alii 1994).
140Sous la direction de S. Duchesne et É. CrubezyRomon Th., Murail P., Rougé D., Duchesne S.,
Crubézy E.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
(63) À Giberville Le Martray (VIIe s, Pilet et alii 1990) ; Saint-Martin-de-Fontenay (Pilet et alii 1992) ; Roissard (Colardelle1983) ; Seyssel-Albigny (Bizot, Serralongue 1988) ; Satigny (Simon, Leemans 1991) ; Sézegnin (Simon 1990) ; Saint-Martin-de-Cognac (Sansilbano-Collilieux 1994) ; Hières-sur-Amby (Porte, Buchet 1985) ; Neuville-sur-Escaut (Hantute 1989) ;Châlon-sur-Saône et Beaune (Castex 1994).(64) Dans le Nord de la France, en Normandie, ainsi que dans le comté de Genève (Simon 1982 ; Blondiaux 1988 ; Pilet etalii 1990). Mais également dans le sud de la France, à Vaison (Bouali, Vattéoni 1991).
V. 1. Etude du nombre de sépulturesindividuelles et multiples
Les sites de Saint-Bertrand-de-Comminges, deLunel-Viel Les Horts, Saint-Brice-de-Cassan,Venerque, Vindrac65 et La Gravette ont une réparti-tion proche du nombre de sujets par tombe (fig. 112et 113). Le site de Lunel-Viel l’Eglise se différenciepar un nombre plus élevé de sujets par tombe, pra-tiquement le double.
Selon le nombre de sujets dans des tombesindividuelles ou multiples, les sites de Lunel-Viell’Église et de Venerque, de Saint-Brice-de-Cassan oude La Gravette représentent les deux types extrêmeset opposés d'organisation possible, alors que Saint-Bertrand-de-Comminges, Lunel-Viel Les Horts etVindrac représentent une organisation intermé-diaire (Romon 1996) (fig. 114).
V ORGANISATION :
RÉPARTITION BIOLOGIQUE AU SEINDE L’ESPACE FUNÉRAIRE
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
141Organisation : répartition biologique au sein de
l’espace funéraireRomon Th., Murail P., Rougé D., Duchesne S.,
Crubézy E.
Romon Th., Murail P., Rougé D., Duchesne S., Crubézy E.
Figure 112 : Données sur le nombre d'individus par tombes.
SBC, St-Bertrand ; LVE, Lunel-Viel l’Église ; LVH, Lunel-Viel Les Horts ; SBCa, St-Brice de Cassan ;
VEN, Venerque ; VIN, Vindrac ; GRA, La Gravette.
Sites Nb tombe Nb ind Nb ind/tombe Nb ind dans % ind dans Nb ind dans % ind dans
tombe individuelle tombe individuelle tombe multiple tombe multiple
SBC 130 180 1,38 95 53 85 47
LVE 20 56 2,80 6 11 50 89
LVH 91 115 1,26 67 58 48 42
SBCa 145 152 1,05 134 88 18 12
VEN 137 144 1,05 131 91 13 9
VIN 15 22 1,47 10 45 12 55
GRA 754 867 1,15 679 78 188 22
En ce qui concerne le recrutement, ces nécro-poles ont un point commun : l'anomalie du nombredes enfants de moins de 5 ans et des jeunes adultes.Comme évoqué précédemment (cf. chapitre III),exceptée cette anomalie, les nécropoles de Rivel àVenerque et de la Gravette à l’Isle-Jourdain s’appro-chent davantage que les autres d’une mortalité natu-relle. Toutefois, cette dernière présente une surmor-talité de femmes jeunes (Barthélémy 1999). Les deuxnécropoles de Lunel-Viel se différencient par descaractéristiques archéologiques ainsi que par unesélection en fonction de l'âge lors de l'inhumationdes enfants entre 5 et 14 ans (Murail, Raynaud 1996),mais en considérant l'ensemble des deux nécropoles,il s'agit ici aussi d'une population naturelle. Parcontre, le cimetière autour de la basilique chrétiennede Saint-Bertrand-de-Comminges ne présente pas lerecrutement d'une population naturelle mais une
sélection à l'inhumation de jeunes adultes de sexemasculin, il en va de même à Vindrac. Nous sommesalors en droit de nous demander si comme à Lunel-Viel il n'existerait pas d'autres secteurs d'inhuma-tions, peut-être extra-muros pour Saint-Bertrand oùserait enterré le reste de la population. Leur sommeformerait alors une population naturelle.
V. 2. Organisation interne des nécropoles
V. 2.1. Répartition en fonctionde l’âge et du sexe
La répartition des données biologiques, âge et sexe,sur le plan des nécropoles montre une certainehomogénéité pour les sites de Saint-Bertrand-de-Comminges, de Lunel-Viel (l’Église et Les Horts) et
(65) Seules les sépultures datées de façon certaine de l’époque mérovingienne ont été utilisées pour cette étude. Elles sontréparties en 10 sarcophages et 5 sépultures en pleine terre.
Saint-Brice-de-Cassan, du moins pour les zonesfouillées. Aucun secteur spécialisé n’apparaît. Tou-tefois, pour le site de Saint-Bertrand-de-Com-minges, seules les annexes sud ont fait l’objet decette étude, et il faut se rappeler que les annexeselles-mêmes constituent une zone spécialisée, oùl’on trouve une prédominance de jeunes hommes.
Pour les sites de Venerque, de Vindrac et de la Gra-vette, par contre, elle met en évidence une réparti-tion qui ne semble pas aléatoire :
pour la nécropole de Rivel à Venerque, plusieurssous-ensembles apparaissent :
tout d’abord au centre de la partie fouillée, lessépultures sont organisées autour des tombes 44 et81, celles d’un homme et d’une femme tous deuxbien conservés, inhumés sans mobilier. Il est intéres-sant de noter que l’individu masculin, le 44, est âgéet enterré dans une tombe en bâtière, caractéristique
du mode d’inhumation qui appartient au IVe siècleet dont l'utilisation se fait jusque dans le VIIe siècle.
puis, une concentration de tombes au sud-ouestsemble former un ensemble relativement homogène.
enfin, deux autres concentrations moins impor-tantes, sont situées l'une à l’extrémité est, l’autre lelong de la limite nord de la nécropole.
Les enfants semblent concentrés dans unemême zone topographique : les limites du site, liéesà la nature du sol difficile à creuser. De même, lesfemmes paraissent être préférentiellement concen-trées dans le secteur est de la partie fouillée de lanécropole. Selon les tests statistiques, cette concen-tration féminine n’est pas significative (test Chi_, p> 0,05), alors que celles des enfants l’est (test Chi_, p< 0, 05). Il existe donc bien un secteur réservé auxenfants, inhumés dans les zones limitrophes de lanécropole.
142Sous la direction de S. Duchesne et É. CrubezyRomon Th., Murail P., Rougé D., Duchesne S.,
Crubézy E.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 114 : Répartition du nombre d'individus dans une tombe individuelle ou multiple en % par site.
SBC, St-Bertrand ; LVE, Lunel-Viel l’Église ; LVH, Lunel-Viel Les Horts ; SBCa, St-Brice de Cassan ;
VEN, Venerque ; VIN, Vindrac ; GRA, La Gravette.
Figure 113 : Répartition du nombre d'individus par tombe pour chaque site.
SBC, St-Bertrand ; LVE, Lunel-Viel l’Église ; LVH, Lunel-Viel Les Horts ; SBCa, St-Brice de Cassan ;
VEN, Venerque ; VIN, Vindrac ; GRA, La Gravette.
Sites Nb tombe Nb ind Nb ind/tombe
SBC 130 180 1,38
LVE 20 56 2,80
LVH 91 115 1,26
SBCa 145 152 1,05
VEN 137 144 1,05
VIN 15 22 1,47
GRA 754 867 1,15
Sites % ind dans tombe % ind dans tombe
individuelle multiple
SBC 53 47
LVE 11 89
LVH 58 42
SBCa 88 12
VEN 91 9
VIN 45 55
GRA 78 22
pour Vindrac, il est plus difficile de conclure surcette répartition car la nécropole abrite principale-ment des hommes (18/22). Cependant, les deuxfemmes sont localisées en dehors des chapelles, et laprésence de l'enfant 94 indique que celles-cin'étaient pas strictement réservée aux adultes.
pour le site de La Gravette, plusieurs sous-ensemblesen fonction de l’âge et du sexe apparaissent :
la répartition des sépultures en fonction de l’âgemontre l’absence de zone d’inhumation dédiée auxadolescents ou adultes, mais indique clairement queles enfants entre 1 et 9 ans semblent concentrés auxabords de l’église du haut Moyen Âge et de l’égliseromane (89% des sépultures pour le secteur 5 et100% pour la zone 7), avec de plus, 68% et 77% desenfants de moins de 5 ans. Ces sites d’inhumationdes enfants aux abords des édifices cultuels ont étéretrouvés par Guillon (1997) dans le cimetièremédiéval de Tournedos en Normandie. Notonsaussi qu’il existe une assez grande similitude derépartition entre adultes, adolescents et enfantsentre le haut Moyen Âge et la période médiévale.
pour la période médiévale, il existe un déséqui-libre entre hommes et femmes inhumés intra-murosà l’intérieur du fossé interne (zone 2) avec une pré-dominance d’hommes (p(c_)=0,01), et au sein de lanécropole extra-muros (zone 5), avec cette fois unemajorité de femmes (p(c_)=0,03). Pour la zone 2, iln’existe pas de secteur où un des sexes est préféren-tiellement inhumé, bien que des secteurs (S12, S13 etS15) entourant la partie orientale de l’église romanerecèlent 65% environ de sépultures de sexe mascu-lin. Cette inégalité de répartition dans le sexe desinhumés entre zone 2 et zone 5, au cours de lapériode médiévale, doit néanmoins être nuancéepar le caractère non exhaustif de la fouille. De plus,l’espace nord de l’église, jusqu’au fossé (secteur 5),est riche en sépultures d’immatures et pauvre ensépultures d’adultes, et il est le seul secteur de lazone 2 où le nombre de sépultures féminines estplus élevé que le nombre de sépultures masculines.Le déficit d’immatures concerne la période médié-vale, les autochtones du haut Moyen Âge et lesfrancs (absence de sépultures d’immatures), et ilimplique leur inhumation dans des zones exté-rieures aux zones fouillées. Pour le haut MoyenÂge, il y a une prédominance des sépultures autoch-
tones masculines (67%), mais il n’existe pas derépartition spécifique des sépultures selon le sexe ausein des zones d’inhumation des autochtones duhaut Moyen Âge (à l’intérieur et extérieur de l’édi-fice cultuel) ainsi qu’au sein de l’enclos franc.
V. 2.2. Répartition en fonction descaractères discrets
Seules les nécropoles de Saint-Bertrand-de-Com-minges (annexes sud), de Saint-Brice-de-Cassan, deVenerque, de Vindrac et de la Gravette ont été étu-diées. Les sites de Lunel-Viel n’ont pu faire l’objet decette étude en raison du mauvais état de conserva-tion des ossements.
Les résultats concernant la nécropole de Saint-Bertrand-de-Comminges et de Saint-Brice-de-Cassann'ont malheureusement pas été très concluants. Eneffet, seul un rapprochement pour Saint-Bertrand surun seul caractère (la présence d’un os pré-interparié-tal) a été mis en évidence : deux individus (2274 et2276), un homme et une femme dont les sépultures serecoupent dans l'angle nord-ouest des annexes sud. Etpour Saint-Brice-de-Cassan, deux regroupements desujets proches ont été identifiés, sur la fosse de Allen,pour les sujets féminins des tombes 86 et 87 (issue ducomblement), et sur l’apophyse sus-épineuse de l’hu-mérus, pour les femmes des tombes 126 et 151.
En revanche, l'étude menée sur la nécropolede Rivel à Venerque a été intéressante : en effet, laconfrontation entre les sujets présentant des carac-tères discrets en commun et leurs répartitions dansl'espace funéraire permettent d'envisager que cettedernière n'est pas aléatoire. Plusieurs groupes peu-vent être dégagés :
les sujets 8 et 10, présentant une similitude frap-pante aussi bien du point de vue pathologiquequ'ostéométrique66 (Crubézy 1986), ont en communégalement des caractères discrets, dont certains sontrares. Ainsi, nous pouvons émettre l'hypothèse dejumeaux. De plus, la proximité de ces deux sépul-tures conforte l'existence d’un regroupement fami-lial, à forte prédominance génétique ici (jumeaux).
les sujets 28, 30 et 39, trois individus localisés surune même rangée verticale dans le même secteur ducimetière. Ils ont en commun au moins deux carac-
143Organisation : répartition biologique au sein de
l’espace funéraireRomon Th., Murail P., Rougé D., Duchesne S.,
Crubézy E.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
(66) En effet, les caractères métriques sont semblables, les principaux reliefs musculaires ont la même forme.
tères chacun, dont le métopisme, l'os au lambda et laperforation olécranienne qui sont des caractèresrares (Crubézy 1986).
les individus 81 et 72, relativement éloignés dansl'espace funéraire, appartenant à des sépulturesconsécutives dans une même rangée horizontale. Ilsont en commun plusieurs caractères dont au moinsun rare, les incisives en pelle.
les deux enfants des tombes juxtaposées 79 et 82,conservant tous les deux une suture métopique mal-gré leurs âges d'au moins cinq ans.
enfin, les individus 96, 101 et 106, appartenant à lamême rangée. Ils partagent au moins deux caractèresrares. Le sujet 116, un peu excentré, partage aussi descaractères avec les trois individus précédents.
L'analyse interne de la nécropole par les carac-tères discrets montre donc qu'il y a des regroupe-ments de type familiaux à l'intérieur des sous-ensembles archéologiques révélés par le plan ducimetière. Elle confirme donc l’existence des troiszones décrites précédemment. D’autre part, elledémontre l’existence d’une composante familialedans l'organisation de l'espace funéraire, fait accen-tué par la présence de jumeaux dans deux tombesvoisines.
Pour la nécropole de Vindrac, l'étude de carac-tères discrets a permis de mettre en évidencequelques particularités :
une très forte proportion (80%) de facettes d'ac-croupissement sur le tibia67, toujours bilatérale ettoujours identique (la facette est latérale et il n'y apas de facette médiale). Même si ce caractère n'estpas rare, sa fréquence très forte à Vindrac indiqueune homogénéité remarquable. Ce caractère, uni-formément réparti dans la nécropole, aussi biendans les sépultures en sarcophage que dans lessépultures en pleine terre, est donc présent chez laquasi totalité des hommes. Ceci renforce l'hypothèsedu recrutement particulier de la nécropole.
la fréquence de la surface antéro-supérieuredouble du calcaneum, présente dans 60% des cas,s'écarte de celles généralement observées dans despopulations du Moyen Âge dans le sud-ouest de la
France. Cependant, la fréquence de ce caractèrevarie beaucoup entre les populations. Sa répartitionest remarquable puisqu'elle concerne trois tombesdoubles ou multiples.
les sépultures 73, 90 et 94 possèdent en commundeux caractères : la présence d'un canal condylienpostérieur unilatéral à gauche, et la présence d'uncanal hypoglosse bipartite (unilatéral et bilatéral).La localisation rapprochée de ces individus à l'inté-rieur de la chapelle principale laisse penser à unregroupement particulier.
L'étude des autres caractères, notamment ceuxde la base du crâne n'a permis aucune conclusionquant au recrutement de la nécropole. Ainsi, lessépultures doubles ou multiples ne montrent pas desimilitude remarquable. Le secteur étudié du site deVindrac, défini par une prévalence des hommes(observation justifiée du fait de la faiblesse numé-rique des échantillons), présente des regroupementsà caractère familial ainsi qu’un comportement, lastation accroupie. La fréquence très élevée desfacettes d’accroupissement sur le tibia et leur répar-tition homogène renforce l’hypothèse d’un recrute-ment particulier de la nécropole.
Pour la nécropole de la Gravette, l’étude descaractères discrets montre que nombre d’entre euxsont partagés par des individus inhumés à proxi-mité, sous-entendant que l’organisation de ce sitefunéraire ne s’est pas déroulée de manière aléatoiremais repose au contraire sur la présence de trèsnombreux regroupements familiaux, et ce quelquesoit le groupe considéré (franc, autochtone du hautMoyen Âge, groupe médiéval inhumé dans lenoyau ecclésial en zone 2, et groupe médiévalinhumé à l’extérieur de l’enceinte en zone 5) (Ricaut2000). Dans chacun des quatre groupes considérés,plusieurs regroupements de sujets peuvent êtreidentifiés :
le groupe francDes 62 sujets adultes dénombrés, seuls 35 étaientsuffisamment bien conservés pour qu’une partie aumoins des caractères discrets sélectionnés soit étu-diée. Les caractères retenus étant à la base de regrou-pements sont les suivants : épine sus-épitrochléenne(sujets 430 et 269), pont postérieur de l’atlas (sujets444, 274 et 414), pont mylo-hyoïdien (sujets 444, 443
144Sous la direction de S. Duchesne et É. CrubezyRomon Th., Murail P., Rougé D., Duchesne S.,
Crubézy E.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
(67) L'apparition de ce caractère est régi par le comportement, conséquence de la station accroupie.
et 415), incisive en pelle maxillaire (sujets 418 et 419),agénésie de la troisième molaire inférieure (sujets415, 330 et 444), surface articulaire supérieuredouble de l’atlas (sujets 444, 443 et 414), pont rétro-articulaire de l’atlas (sujets 412 et 268). Certainsregroupements sont basés sur plusieurs caractèreset sont plus nombreux entre les sujets francs inhu-més dans la partie nord-est du site, à l’intérieur et àl’extérieur du mur limitant la zone de proximité aumausolée.
le groupe des autochtones du haut Moyen Âge Les caractères retenus étant à la base de regroupe-ments sont les suivants : canal hypoglosse double(sujets 726,1 et 725), torus mandibulaire (sujets 717et 735), perforation humérale (sujets 460 et 710 ;sujets 709 et 738), sacralisation de la cinquième ver-tèbre lombaire (sujets 711 et 738 ; sujets 728, 737 et723), trou zygomatico-facial double ou multiple(sujets 726,1, 726,2 et 458), sutura mendosa (sujets726,1 et 726,2), canal condylien intermédiaire (sujets698 et 458). En dehors de la sépulture 726, dont lesdeux sujets présentent plusieurs caractères en com-mun, aucun des autres regroupements ne met en jeuplus d’un caractère.
Pour chaque caractère discret à la base deregroupement, les regroupements se situent dansune seule des deux zones d’inhumation des autoch-tones du haut Moyen Âge, à savoir l’église paléo-chrétienne ou le baptistère, ce qui pourrait per-mettre d’envisager deux groupes autochtones auhaut Moyen Âge, chacun inhumant leur morts dansun endroit différent (l’un dans l’église paléochré-tienne, l’autre le baptistère).
le groupe médiéval inhumé au sein du noyau ecclésial(zone 2)Les 27 caractères étant à la base de 58 regroupe-ments sont les suivants :
Caractères à forte héritabilité soupçonnée : épinesus-épitrochléenne (sujets 476, 188, 64 et 285), canalhypoglosse double (sujets 476 et 516 ; sujets 62 et 59 ;sujets 21 et 56 ; sujets 698 et 361), pont mylohyoïdien(sujets 41 et 533 ; sujets 288 et 229 ; sujets 43 et 59 ;sujets 86,1 et 109 ; sujets 670 et 679 ; sujets 573 et 582),torus mandibulaire (sujets 646 et 590), trou zygoma-tico-facial double ou multiple (sujets 61, 56, 36 et 62 ;sujets 206 et 166), incisive en pelle (sujets 110 et137,3 ; sujets 517 682 et 666), perforation sternale(sujets 541 et 492 ; sujets 545 et 196), sacralisation dela cinquième vertèbre lombaire (sujets 572 et 576 ;sujets 206, 212 et 218) ;
Autre caractère : sutura mendosa (sujets 490 et558d), os epactal (sujets 51 et 231), suture métopique(sujets 231 et 291), agénésie de la troisième molairesupérieure (sujets 21 et 78 ; sujets 56 et 61 ; sujets 285et 166), agénésie de la troisième molaire inférieure(sujets 292, 139 et 171 ; sujets 47, 52, 56 et 59 ; sujets213 et 228), épine trochléaire (sujets 55 et 530), canalcondylien intermédiaire (sujets 216, 213, 208 et 185),os occipito-mastoïdien (sujets 488 et 531), foramenmentonnier double (sujets 205, 222 et 220 ; sujets 476et 512), surface articulaire supérieure double de l’at-las (sujets 45, 56 et 62 ; sujets 239 et 231 ; sujets 265 et454 ; sujets 110 et 121 ; sujets 292 et 109), calcaneusemarginata (sujets 561, 700 et 195 ; sujets 356 et 485 ;sujets 488 et 541 ; sujets 39, 61 et 76 ; sujets 646 et526,1 ; sujets 610 et 584 ; sujets 110 et 10), calcaneusbipartita (sujets 86,1 et 138), calcaneus : facette « anté-rieure » absente (sujets 216 et 219 ; sujets 356 et 651),spina bifida de la première vertèbre sacrale (sujets 280et 291), atlas : pont rétro-articulaire (sujets 216, 206,219 et 212 ; sujets 488 et 531 ; sujets 367 et 679 ; sujets121 et 141 ; sujets 558, 719 et 555), axis : foramentransversaire incomplet (sujets 36 et 51).
Un très grand nombre de regroupements ontété mis en évidence, certains d’entre eux sont baséssur plusieurs caractères, par exemple les sujets 61-61-59-56-21-36. L’ensemble des regroupementsdécelés laisse supposer que les inhumations ont étéaccomplies en fonction de liens bien particuliersentre les sujets, qui dans certains cas peuvent êtreconsidérés comme des liens de parenté.
le groupe médiéval inhumé à l’extérieur de l’enceinte(zone 5)Les caractères retenus étant à la base de 58 regrou-pements sont les suivants : canal hypoglosse double(sujets 105 et 152), agénésie de la troisième molairesupérieure (sujets 103 et 89 ; sujets 297 et 310), trouzygomatico-facial absent (sujets 307 et 314), atlas :pont rétro-articulaire (sujets 327 et 133 ; sujets 311 et297), suture métopique (sujets 315 et 89), foramenmentonnier double (sujets 181 et 182), atlas : surfacearticulaire supérieure double (sujets 302, 327, 118 et148), calcaneus emarginata (sujets 315, 253 et 308),calcaneus : facette « antérieure » absente (sujets 181et 252), atlas : pont postérieur (sujets 151, 305 et 310).
Les sépultures de la zone 5 sont réparties endeux groupes, l’un au sud et l’autre au nord, séparéspar une bande d’environ 5 mètres, vierge de touteinhumation. La plupart des caractères discrets for-ment une ou plusieurs regroupements dans l’une ou
145Organisation : répartition biologique au sein de
l’espace funéraireRomon Th., Murail P., Rougé D., Duchesne S.,
Crubézy E.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
l’autre des deux sous-zones, (seuls l’agénésie de latroisième molaire supérieure et le pont rétro-articu-laire sont à la base de regroupements au sein desdeux sous-zones), suggérant que probablementdeux groupes de population inhumaient leursmorts dans deux endroits distincts.
Il apparaît donc que pour les quatre groupesétudiés, l’organisation de leurs ensembles funé-raires semble reposer sur une répartition non aléa-toire des inhumations. De nombreux regroupe-ments ont été décelés, et certains d’entre eux ont uncaractère familial assez marqué car ils sont basés surdes caractères à forte héritabilité. De plus, pour lapopulation médiévale de la zone 5 et pour lesautochtones du haut Moyen Âge, les regroupe-ments mis en évidence laissent supposer l’existencedans chacun de ces groupes, de deux sous-groupesde sujets. La division topographique en deux zonesde la répartition des sépultures, église paléochré-tienne et baptistère pour la population autochtone,et zone nord et sud pour la population médiévale dela zone 5, se retrouve à travers les regroupementsmis en évidence.
De plus, il apparaît que certains caractèressont spécifiques à certains des groupes considérés.Certains caractères ont leur présence ou absencepropre à certains groupes, la patella bipartia (unique-ment présente au sein du groupe franc), le torusmandibulaire et le calcaneum emarginata (présentdans tous les groupes et absent du groupe franc), leforamen transversaire incomplet de l’atlas (unique-ment présent chez la population médiévale de lazone 2), le foramen transversaire incomplet del’axis, le calcaneum bipartita et la facette« antérieure » du calcaneum absente (spécifique auxdeux populations médiévales).
De la même manière, certains caractères sontsignificativement plus fréquents dans un groupeque dans un autre. (1)Le calcaneum emarginata est liéaux populations médiévales (Chi_=4 ; p=0,05).Absent du groupe franc, sa fréquence semble aug-menter au cours du temps, 6% chez les autochtonesdu haut Moyen Âge et aux environs de 15% dans lesdeux groupes médiévaux, ce qui pourrait être lesigne d’une certaine continuité de la population aucours du temps, et d’une origine allogène du groupefranc. (2) La perforation olécrânienne : aux environs de20% dans tous les groupes observés en dehors dugroupe franc (40%). La différence entre les francs etles autres groupes de population est significative
avec la population médiévale de la zone 2(Chi_=4,6 ; p=0,05), ce qui pourrait laisser entrevoirlà encore une origine allogène de la populationfranque. (3) La sacralisation de la cinquième vertèbrelombaire : ce caractère n’est réellement observableque dans deux groupes, les autochtones du hautMoyen Âge (46%) et le groupe médiéval de la zone2 (10%) ; la différence entre les deux est significative(Chi_=7,6 ; p=0,05). (4) Le sillon profond du calcaneum :fréquence identique chez les deux populations duhaut Moyen Âge (6%), elle augmente dans les popu-lations médiévales pour atteindre son maximumchez les médiévaux de la zone 5 (28%). Ce caractèreest significativement plus fréquent dans la popula-tion médiévale de la zone 5 que chez les autochtonesdu haut Moyen Âge (Chi_=4,2 ; p=0,05). L’évolutionde la fréquence de ce caractère pourrait donc être lesigne d’une certaine homogénéité de la populationau cours du temps et d’une certaine endogamie.
Un nombre non négligeable de caractères ontleur fréquence qui augmentent au cours du temps.Si on met entre parenthèses les problèmes d’effectif,l’explication pourrait être une certaine continuité etstabilité de la population, marquées par une pos-sible endogamie de certains groupes, notamment lesautochtones du haut Moyen Âge et la populationmédiévale de la zone 5.
En se basant sur les résultats ci-dessus, on voitque les associations et les différences entre lesgroupes varient suivant les caractères étudiés. Cer-taines fréquences de caractère semblent rapprocherles autochtones du haut Moyen Âge et la populationmédiévale de la zone 2, et écarter le groupe médié-val de la zone 5 et le groupe franc. Mais d’autrescaractères amènent des résultats opposés. Il semble-rait toutefois que les Francs soient le groupe qui sedétache le plus souvent des autres. De plus, lescaractères présents chez les deux populationsmédiévales (caractères spécifiques ou non à cesdeux populations) semblent rapprocher les femmesde la zone 5 des sujets de la zone 2 et est spécifiqueà un sexe de la population médiévale de la zone 5,dans la majorité des cas c’est au sexe féminin (facette« antérieure » du calcaneum absente, foramen transver-saire incomplet de l’axis, épine sus-épitrochléenne, spinabifida aperta…).
146Sous la direction de S. Duchesne et É. CrubezyRomon Th., Murail P., Rougé D., Duchesne S.,
Crubézy E.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
’analyse des caractères métriques participe à lareconstitution du profil biologique d’unepopulation. L’interprétation de leurs variationspermet dans un premier temps de soulignerl’homogénéité ou, au contraire, l’hétérogénéité
morphologique d’une série, et dans un second tempsd’étudier la variabilité au sein d’une région ou d’uneépoque à l’aide de comparaisons. Quatre sites ontfait l’objet de cette étude, Saint-Bertrand-de-Com-minges, Venerque, Vindrac et l’Isle-Jourdain.
VI. 1. Les caractéristiquesmorphométriques
VI. 1.1. Les données crâniennes
La distribution de l’indice crânien horizontal(fig.115) est différent selon les sites. En effet, lapopulation de Saint-Bertrand-de-Comminges estcaractérisée par la forme allongée du crâne (doli-chocrâne), voire très allongée, alors que les sujets deRivel (Venerque) se répartissent autant selon uneforme allongée qu’une forme légèrement arrondie(mésocrâne), et les sujets de Vindrac selon uneforme plutôt légèrement arrondie du crâne. Pour laGravette, à l’Isle-Jourdain, il existe une différencesignificative (p(c_)=0,0049) entre le haut Moyen Âge(forme courte, brachycrâne) et la période médiévale(mésocrâne).
Selon l’indice fronto-pariétal (fig. 116), lesfronts sont majoritairement représentés par desformes larges, voire même très larges68 pour lapopulation de Saint-Bertrand-de-Comminges. Laproportion de fronts de forme moyenne est cepen-dant importante dans les populations de Venerque(27%) et de Vindrac (39%). Pour le site de La Gra-vette, la distribution de l’indice fronto-pariétalindique que les fronts sont essentiellement de formeétroite (33%) et moyenne (43%). Il n’existe pas dedifférence significative entre le haut Moyen Âge etla période médiévale (p(c_)=0,71), ni entre les sexes(p(c_)=0,53).
La distribution de l’indice frontal transverse(fig. 117) identifie une majorité de forme moyenne-ment divergente du front (intermédiaire), voireexclusivement pour la population de Saint-Ber-trand-de-Comminges. Les populations deVenerque, de Vindrac et de La Gravette présententaussi dans près d’un tiers des cas une forme trèsdivergente du front. Pour la Gravette, il n’existe pasde différence de distribution entre les périodesmédiévale et du haut Moyen Âge (p(c_)=0,22), etentre les deux sexes (p(c_)=0,92).
L’indice mixte de hauteur (fig. 118) définit unemajorité des crânes de Saint-Bertrand-de-Com-minges et Vindrac de type moyen, alors que lescrânes de Venerque sont en majorité de type haut.Les crânes de La Gravette sont de type bas (50%) etmoyen (50%) sans qu’il existe de différence statisti-quement significative entre les périodes médiévaleet du haut Moyen Âge (p(c_)=0,85), et entre les deuxsexes (p(c_)=0,14).
Deux sites ont fait l’objet d’une étude plusdétaillée, les sites de Vindrac et de La Gravette.
Le site de Vindrac a permis une analyse desdimensions de la face, et une étude en relation avecles modes d’inhumation a été menée. Tout d’abord,les variables de la face définissent :
une face étroite ou moyenne ; elle n'est large quedans le cas d’un individu (un homme, Sp.93) ;
un prognathisme uniforme, selon l'indice gna-thique de Flower, la majorité ayant un maxillairenon saillant (orthognathe), et les autres (22%) légè-rement saillant (mésognathe) ;
un nez dont les trois formes sont représentées,large à 23% (platyrhinie), moyen à 31% (mésorhi-nien), et étroit à 46% (leptorhinien) ;
et enfin, une forme basse ou moyenne desorbites.
L’étude selon les modes d’inhumation (sarco-phages ou tombes en pleine terre) a été menée sansdistinction de sexe ; elle n’intéresse que la voûte crâ-nienne. En effet, seule une face des sujets inhumés
VI DONNÉES MORPHOLOGIQUES
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
147 Données morphologiquesRomon Th., Murail P., Duchesne S., Crubézy E.
Romon Th., Murail P., Duchesne S., Crubézy E.
(68) En effet, les variables définissent un indice supérieur à 73, caractérisant un front très large (Olivier, 1960).
L
148Sous la direction de S. Duchesne et É. Crubezy Romon Th., Murail P., Duchesne S., Crubézy E.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
sites Ind. crânien n très allongé allongé arrondi très arrondi
SBC F 11 36 55 9 0
SBC M 12 50 42 8
SBC I 1 100
SBC n 24 46 46 4 4
VEN F 7 0 29 29 43
VEN M 17 6 47 35 12
VEN I 5 40 60
VEN n 29 3 41 38 17
VIN F 2 50 0 50 0
VIN M 9 44 56
VIN I 7 29 57 14
VIN n 18 6 33 56 6
GRA hma F 2 50 50
GRA hma M 10 100
GRA hma n 13 92 8
GRA pmed F 6 17 33 50
GRA pmed M 8 63 25 13
GRA pmed n 14 7 50 36 7
sites très allongé allongé arrondi très arrondi
SBC 46 46 4 4
VEN 3 41 38 17
VIN 6 33 56 6
GRA hma 0 0 92 8
GRA pmed 7 50 36 7
Figure 115a : Distribution de l’indice crânien horizontal.
Figure 115b : Distribution de l’indice crânien horizontal (en %).
SBC, St-Bertrand ; VEN, Venerque ; VIN, Vindrac ; GRA hma, La Gravette, haut Moyen Âge ; GRA pmed,
La Gravette, période médiévale. F, Féminin ; M, Masculin ; I, indéterminé ; n, effectif total.
149 Données morphologiquesRomon Th., Murail P., Duchesne S., Crubézy E.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 116a : Distribution de l’indice fronto-pariétal.
Figure 116b : Distribution de l’indice fronto-pariétal (en %).
SBC, St-Bertrand ; VEN, Venerque ; VIN, Vindrac ; GRA, La Gravette.
F, Féminin ; M, Masculin ; I, indéterminé ; n, effectif total.
sites ind fronto-pariétal n étroit moyen large
SBC F 6 0 0 100
SBC M 11 9 0 91
SBC I 1 0 0 100
SBC n 18 6 0 94
VEN F 6 33 33 33
VEN M 14 29 29 43
VEN I 2 100
VEN n 22 27 27 45
VIN F 2 0 50 50
VIN M 9 11 44 44
VIN I 7 29 71
VIN n 18 6 39 56
GRA F 7 29 71 0
GRA M 14 36 29 36
GRA I
GRA n 21 33 43 24
sites étroit moyen large
SBC 6 0 100
VEN 27 27 45
VIN 6 39 56
GRA 0 0 24
150Sous la direction de S. Duchesne et É. Crubezy Romon Th., Murail P., Duchesne S., Crubézy E.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 117a : Distribution de l’indice frontal transverse.
Figure 117b : Distribution de l’indice frontal transverse (en %).
SBC, St-Bertrand ; VEN, Venerque ; VIN, Vindrac ; GRA, La Gravette.
F, Féminin ; M, Masculin ; I, indéterminé ; n, effectif total.
sites ind fronto-pariétal n divergent intermédiaire parallèle
SBC F 8 0 100 0
SBC M 12 0 100 0
SBC I 1 0 100 0
SBC n 21 0 100 0
VEN F 6 50 50 0
VEN M 15 27 73 0
VEN I 2 100 0
VEN n 23 30 70 0
VIN F 2 50 50 0
VIN M 9 33 67 0
VIN I 7 14 86 0
VIN n 18 28 72 0
GRA F 9 44 56 0
GRA M 13 38 62 0
GRA I
GRA n 22 41 59 0
sites divergent intermédiaire parallèle
SBC 0 100 0
VEN 30 70 0
VIN 28 72 0
GRA 41 59 0
151 Données morphologiquesRomon Th., Murail P., Duchesne S., Crubézy E.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 118a : Distribution de l’indice moyen de hauteur.
Figure 118b : Distribution de l’indice moyen de hauteur (en %).
SBC, St-Bertrand ; VEN, Venerque ; VIN, Vindrac ; GRA, La Gravette.
F, Féminin ; M, Masculin ; I, indéterminé ; n, effectif total.
sites ind moyen hteur n bas moyen haut
SBC F 10 30 60 10
SBC M 12 50 25 25
SBC I 1 100
SBC n 23 39 43 17
VEN F 5 60 0 40
VEN M 11 18 36 45
VEN I 2 0 50 50
VEN n 18 28 28 44
VIN F 2 50 50 0
VIN M 9 22 67 11
VIN I 5 20 40 40
VIN n 16 25 56 19
GRA F 7 43 57 0
GRA M 20 50 50 0
GRA I
GRA n 27 48 52 0
sites bas moyen haut
SBC 39 43 17
VEN 28 28 44
VIN 25 56 19
GRA 48 52 0
en pleine terre était étudiable, il n'était donc pas pos-sible de tester une différence éventuelle entre lesdeux modes d’inhumations. Une différence statisti-quement significative a été observée :
pour l’indice crânien horizontal (Student, a = 2%) : les sujets inhumés en pleine terre ont unemoyenne d'indice supérieure de 4 points par rap-port aux sujets inhumés en sarcophages ;
et, pour l’indice moyen de hauteur (Student, a =1/1000) : les sujets inhumés en sarcophage présen-tent des crânes bas ou moyens alors que les sujetsinhumés en pleine terre possèdent un crâne haut.
Ainsi, on note une division archéologique cor-rélée à une différenciation métrique remarquable,constatée sur la forme de la voûte du crâne. Ceci estintéressant puisque la contemporanéité des tombesen pleine terre et des sarcophages repose sur l'anté-riorité relative des tombes en pleine terre, mais rienne permet leur attribution à l'Antiquité. Noussommes donc en présence de deux hypothèses : lestombes en pleine terre ne sont pas contemporainesdes sarcophages mais elles appartiennent à l'Anti-quité, ou bien, il existe deux groupes de morpholo-gie crânienne différente, et cette séparation seretrouve dans le geste funéraire. La première hypo-thèse n’est pas retenue car deux tombes en pleineterre ont fait l’objet de datations, l’une est datée du3e tiers du VIe siècle (Sp. R1) et l’autre est datée entre641 et 766 (Sp. R3). La seconde hypothèse semblealors être validée.
Le site de La Gravette, de par la mauvaiseconservation des ossements, n’a permis l’analyseque de très peu de crânes (22), pour lesquels néan-moins 29 mesures et 15 indices ont été étudiés69. Parcontre, 204 mandibules et 183 mastoïdes ont pu êtreexploités.
Il apparaît qu’aucun indice ne permet de déce-ler une différence significative entre le haut MoyenÂge et la période médiévale, ou bien entre les sexes.Notons toutefois que les variables de la face définis-sent, en plus des quatre indices évoqués plus haut :
une face large ou moyenne ;un prognathisme qui, selon l’indice gnathique
de Flower, indique une majorité de maxillairesmésognathes (52%) et orthognathes (40%) ;
un nez dont les trois formes sont représentées,large à 25% (platyrhinien), moyen à 25% (mésorhi-nien), et étroit à 50% (leptorhinien) ;
des orbites généralement plus hautes chez leshommes que chez les femmes ;
une capacité crânienne sur le mode aristencé-phale (selon la classification de Braüer, 1988) ;
une hauteur du crâne majoritairement basse(tapeïnocrâne, 70%) et moyenne (métriocrâne, 30%) ;
des modules mastoïdiens féminins plus faiblesque les modules masculins ;
des mandibules dont les trois formes sont repré-sentées à part égale, avec la forme dolichognathe(allongée) majoritaire chez les sujets féminins et laforme brachygnathe (arrondie) majoritaire chez leshommes.
De plus, aucune anomalie de développementou de l’équilibre dento-facial n’a été dépisté. Quantà la possibilité de corréler types faciaux et localisa-tion géographique des sépultures, seule une trèsgrande similitude dans l’analyse céphalométriquede deux sujets (726,1 et 726,2) inhumés dans lamême sépulture a été détecté.
VI. 1.2. Les données post-crâniennes
* Mesures et indices
On observe quelques dispersions (p (F)) statis-tiquement différentes pour certaines variables70
(annexes).
Les indices de robustesse se répartissent demanière conforme à ce qui est observé pour lespopulations européennes (Olivier, 1960), les indicesféminins étant généralement plus faibles que lesindices masculins.
Les humérus sont essentiellement eurybra-chiques pour les populations de Saint-Bertrand-de-Comminges (82%) et de La Gravette (71%), voireexclusivement pour la population de Vindrac (fig.119). Une grande proportion de sujets de Venerque(45%), majoritairement féminins (12/17), ont des
152Sous la direction de S. Duchesne et É. Crubezy Romon Th., Murail P., Duchesne S., Crubézy E.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
(69) La téléradiocéphalométrie a été utilisée, et trois types d’analyses céphalométriques de profil (Downs 1948 ;Wylie etJohnson 1952 ; Bimler 1957) et une analyse céphalométrique de face (Sassouni 1958) ont été effectuées.(70) Pour Saint-Bertrand-de-Comminges, 9 variables sur 56, soit 16%, pour Venerque 13 variables sur 50 soit 26%, et pourVindrac aucune sur 16 variables.
153 Données morphologiquesRomon Th., Murail P., Duchesne S., Crubézy E.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 119a : Distribution de l’indice diaphysaire de l’humérus.
Figure 119b : Distribution de l’indice diaphysaire de l’humérus (en %).
SBC, St-Bertrand ; VEN, Venerque ; VIN, Vindrac ; GRA, La Gravette.
F, Féminin ; M, Masculin ; I, indéterminé ; n, effectif total.
sites Indice Humérus n platybrachie eurybrachie
SBC F 24 42 58
SBC M 35 3 97
SBC I 1 0 100
SBC n 60 18 82
VEN F 19 63 37
VEN M 22 32 68
VEN I 8 38 63
VEN n 49 45 55
VIN F 2 0 100
VIN M 8 0 100
VIN I 8 0 100
VIN n 18 0 100
GRA F 119 38 62
GRA M 149 21 79
GRA I
GRA n 268 29 71
sites platybrachie eurybrachie
SBC 18 82
VEN 45 55
VIN 0 100
GRA 29 71
humérus plus uniformes, avec un aplatissement dela diaphyse plus important. Il en est de même pourquelques sujets de Saint-Bertrand-de-Comminges(aussi féminins, 10/11), mais dans une proportionmoindre (18%).
Les ulnas sont en majorité eurôlènes pour lestrois sites considérés (Saint-Bertrand-de-Com-minges, Venerque, Vindrac) , le site de La Gravetten’ayant pas fait l’objet de cette étude (fig. 120). Tou-tefois, la répartition de cet indice de platôlénie estlégèrement différente entre Saint-Bertrand-de-Com-minges et Venerque, où la grande majorité des sujetsa un indice moyen, et Vindrac dont la distributionest plus étalée, avec notamment quelques sujetsmasculins présentant un ulna aplati. Cependant, ilfaut prendre ce résultat avec précaution en raison dela faiblesse de son échantillon (n=14). Cependant, ilfaut prendre ce résultat avec précaution en raison dela faiblesse de son échantillon (n=14). On note aussique les hommes de Venerque et de Vindrac ont unulna plus aplati alors que ceux de St-Bertrand-de-Comminges ont un ulna plutôt arrondi.
Pour le fémur, l’indice pilastrique détermineun pilastre faible en majorité, sauf à La Gravette oùle pilastre est majoritairement nul (fig. 121). Cepen-dant, des différences de répartition sont observéesici aussi avec, dans la population de Saint-Bertrand-de-Comminges, une grande proportion égalementde pilastre moyen, comme à Vindrac. La distribu-tion particulière de Vindrac est due à la faiblesse deson échantillon (n=16).
Le fémur se caractérise également par une dia-physe plutôt aplatie ou arrondie sous les trochantersà Saint-Bertrand-de-Comminges et La Gravette,alors que la majorité des sujets ont une diaphysefémorale aplatie transversalement à Venerque (fig.122). Le site de Vindrac n'a pas fait l'objet de cetteétude.
La diaphyse tibiale a essentiellement un apla-tissement inexistant, en grande majorité pour Saint-Bertrand-de-Comminges et Venerque (fig. 123). Ladistribution des sujets (masculins) de Vindrac estrépartie entre un aplatissement faible et inexistant. Ilfaut garder à l'esprit que l'échantillon de Vindrac estrestreint (n=13), et que ces résultats peuvent être dussimplement au faible nombre de sujets. Le site de LaGravette n’a pas fait l’objet de cette étude.
La répartition des données morphométriquessur le plan des nécropoles ne présentent pas d’ap-parentements évidents entre les sujets.
VI. 2. Le dimorphisme sexuel
L’étude a été réalisée pour chacune des variablesmétriques (dimensions et indices) et pour chaquepopulation. S’il n’existe pas de limite inférieure àl’effectif des groupes, nous avons cependant définiune limite arbitraire : le test sera en effet réalisé pourtoute variable dont l’effectif par groupe est supé-rieur ou égal à 5. Ainsi, le site de Vindrac est écartéde l’analyse, et de même, pour certaines variablescrâniennes et/ou infra-crâniennes dans les troisautres sites.
L’observation des variables et des indices crâ-niens montre que l’ensemble des dimensions ne pré-sentent pas de différences significatives entre lespopulations masculines et féminines (Romon 1996).Néanmoins, les variables et indices de la mandibuleet du module mastoïdien, uniquement mesuréspour le site de La Gravette, présentent un dimor-phisme sexuel marqué.
L’observation des variables infra-crâniennesmontre, quant à elles, que l’ensemble des dimen-sions présentent des valeurs significativement diffé-rentes entre les populations masculines et fémininesau sein de chaque site. En revanche, les indices deforme des os longs sont identiques.
Ainsi, pour les trois sites considérés, les diffé-rences sexuelles se caractérisent uniquement par defortes dimensions absolues infra-crâniennes, lesdimensions crâniennes et les indices de forme étantquant à eux similaires.
VI. 3. La stature
La stature moyenne des hommes est supérieure à lamoyenne des femmes, conséquence du dimor-phisme sexuel classique (fig. 124).
Toutefois, à Venerque, ce résultat est trèsimportant, il est peut-être accentué par le fait que lessujets graciles et donc petits sont souvent détermi-nés comme étant féminins, ainsi que par le faibleéchantillon étudié. Pour le site de Vindrac, la staturemasculine présente une moyenne et un écart-type
154Sous la direction de S. Duchesne et É. Crubezy Romon Th., Murail P., Duchesne S., Crubézy E.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
155 Données morphologiquesRomon Th., Murail P., Duchesne S., Crubézy E.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 120a : Distribution de l’indice d’aplatissement de l’ulna.
Figure 120b : Distribution de l’indice d’aplatissement de l’ulna (en %).
SBC, St-Bertrand ; VEN, Venerque ; VIN, Vindrac.
F, Féminin ; M, Masculin ; I, indéterminé ; n, effectif total.
sites Ulna n aplati moyen arrondi
SBC F 25 12 68 20
SBC M 35 9 74 17
SBC I 2 100
SBC n 62 10 73 18
VEN F 13 15 85
VEN M 22 27 68 5
VEN I 7 29 71
VEN n 42 24 74 2
VIN F 1 100
VIN M 8 25 63 13
VIN I 5 80 20
VIN n 14 43 50 7
sites aplati moyen arrondi
SBC 10 73 18
VEN 24 74 2
VIN 43 50 7
relativement forts, alors que les valeurs calculéespour Saint-Bertrand-de-Comminges et La Gravetteà l’Isle-Jourdain sont celles communément rencon-trées dans les nécropoles du haut Moyen Âge (San-silbano-Collilieux 1994).
L’estimation de la stature à partir du squelette n’estdonc pas satisfaisante pour l’étude des populationsanciennes. C’est pourquoi l’analyse des donnéesmétriques directement à partir de la longueur desfémurs a été réalisée (fig. 125). Les comparaisonsmenées entre les sites de Saint-Bertrand-de-Com-
156Sous la direction de S. Duchesne et É. Crubezy Romon Th., Murail P., Duchesne S., Crubézy E.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 121a : Distribution de l’indice pilastrique du fémur.
Figure 121b : Distribution de l’indice pilastrique du fémur (en %).
SBC, St-Bertrand ; VEN, Venerque ; VIN, Vindrac ; GRA, La Gravette.
F, Féminin ; M, Masculin ; I, indéterminé ; n, effectif total.
sites Fém - pilastre n nul faible moyen allongé
SBC F 24 25 42 25 8
SBC M 27 15 30 41 15
SBC I 1 100
SBC n 52 19 37 33 12
VEN F 19 16 58 16 11
VEN M 28 29 50 21
VEN I 19 42 37 16 5
VEN n 66 29 48 18 5
VIN F 1 100
VIN M 7 29 29 14 29
VIN I 8 50 13 38
VIN n 16 38 19 31 13
GRA F 129 93 6 1
GRA M 154 87 13
GRA I
GRA n 183 84 15 1
sites nul faible moyen allongé
SBC 19 37 33 12
VEN 29 48 18 5
VIN 38 19 31 13
GRA 84 15 1
157 Données morphologiquesRomon Th., Murail P., Duchesne S., Crubézy E.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
sites Fém - platymérie n très aplati aplati arrondi aplati transv
SBC F 25 8 60 28 4
SBC M 31 10 35 55
SBC I 1 100
SBC n 57 9 46 44 2
VEN F 21 10 14 33 43
VEN M 24 29 29 42
VEN I 19 16 26 11 47
VEN n 64 8 23 25 44
GRA F 135 21 47 31 1
GRA M 172 9 45 44 2
GRA I
GRA n 307 14 46 38 1
sites très aplatie aplatie arrondie aplatie transv
SBC 9 46 44 2
VEN 8 23 25 44
GRA 14 46 38 1
Figure 122a : Distribution de l’indice de platymérie du fémur.
Figure 122b : Distribution de l’indice de platymérie du fémur (en %).
SBC, St-Bertrand ; VEN, Venerque ; GRA, La Gravette.
F, Féminin ; M, Masculin ; I, indéterminé ; n, effectif total.
minges et Venerque montrent que la différence delongueur maximale du fémur n’est pas significative,ni pour les hommes ni pour les femmes (fig. 126).Les comparaisons menées avec le site de Vindrac n’aintéressé que les hommes, les femmes n’étant repré-sentées que par un seul individu. Ces comparaisonsmontrent également l’absence de différence signifi-cative de la longueur maximale du fémur entre leshommes de Vindrac et ceux des deux autres sites.
VI. 4. Comparaisons
Les principales données métriques et indiciaires ontété confrontés à celles de 3 populations afin de mieuxsituer les populations étudiées dans le contexterégional, et mieux appréhender leur morphologie.
158Sous la direction de S. Duchesne et É. Crubezy Romon Th., Murail P., Duchesne S., Crubézy E.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 123a : Distribution de l’indice cnémique du tibia.
Figure 123b : Distribution de l’indice cnémique du tibia (en %).
SBC, St-Bertrand ; VEN, Venerque ; VIN, Vindrac.
F, Féminin ; M, Masculin ; I, indéterminé ; n, effectif total.
sites Tibia- cnémique n aplati transv peu aplati aplatismt nul
SBC F 25 16 84
SBC M 36 14 86
SBC I 2 100
SBC n 63 0 14 86
VEN F 17 12 12 76
VEN M 19 11 11 79
VEN I 14 36 64
VEN n 50 8 18 74
VIN F 1 100
VIN M 7 57 43
VIN I 5 100
VIN n 13 0 31 69
sites aplatie transv peu aplatie aplatissmt nul
SBC 0 14 86
VEN 8 18 74
VIN 0 31 69
(71) Larrieu et al, 1985.(72) Audy et Riquet, 1962.
VI. 4.1. Les données crâniennes
Seulement 6 variables sont communes aux nécro-poles étudiées, ce sont la longueur maximale ducrâne, les largeurs frontales maximale et minimale,la largeur maximale du pariétal, la largeur biasté-rique et la hauteur porion-bregmatique. Les compa-
raisons ont été effectuées tout d'abord entre troissites étudiés, Saint-Bertrand-de-Comminges,Venerque et Vindrac, puis elles ont été élargies àdeux sites régionaux supplémentaires, Beaucaire-sur-Baïse71 (Gers) et Montferrand72 (Aude), afin decaractériser la morphologie de ces populations.Compte tenu de l’important biais découlant du
159 Données morphologiquesRomon Th., Murail P., Duchesne S., Crubézy E.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 124 : Estimation de la stature à Saint-Bertrand-de-Comminges (SBC), Venerque (VEN), Vindrac
(VIN) et La Gravette (GRA).
F, Féminin ; M, Masculin.
(73) Chaque population est également identifiée par une zone comme le site de l’Isle-Jourdain (Z2, dans l’église, Z3, autourde l’église, Z4, enclos franc, et Z5, autre espace funéraire éloigné de l’église et au-delà du fossé défensif), à savoir Z10,Venerque, Z11, Saint-Bertrand-de-Comminges, et Z12, Vindrac.
faible nombre de crânes étudiables par rapport auprès de 800 sépultures fouillées, le site de La Gra-vette n’a pas été inclus dans cette analyse.
Une première analyse, univariée, montre que :
entre St-Bertrand-de-Comminges et Venerque,sexes réunis, trois variables sur cinq et trois indicessur quatre présentent des différences de moyenneentre les individus, et, sexes séparés, une variablemasculine et aucune féminine ne présente de diffé-rence significative, mais les trois indices restentsignificatifs au seuil de 5%.
entre St-Bertrand-de-Comminges et Vindrac,sexes réunis, deux variables sur six et trois indicessur quatre sont significatifs, et sexes séparés, lesdeux variables masculines et deux indices sont dif-férents et aucune variable ni aucun indice fémininn’est différent entre les deux populations. Cepen-dant, il faut rappeler que l’effectif féminin de Vin-drac est limité à deux sujets.
entre Venerque et Vindrac, sexes réunis, une seulevariable est significative, et aucun indice, et sexesséparés, aucune variable ni indice n’est différententre les deux populations, masculine ou féminine.
Selon les analyses univariées, nous ne mettonspas en évidence de grandes différences, ni demoyenne, ni de variabilité. Nous devons tout de mêmenoter que pour chaque étude, la moyenne des largeursmaximales des crânes de Saint-Bertrand-de-Com-minges sont toujours significativement inférieures àcelles des autres nécropoles. Ainsi, la population deSaint-Bertrand-de-Comminges diffère des deux autres
populations, toutefois, cette différence s’exprimemoins sur le format du crâne que sur sa forme. Ces dif-férences sont plus prononcées avec les sujets deVenerque qu’avec ceux de Vindrac. Par ailleurs, ellestouchent plutôt les hommes que les femmes.
Une analyse en composantes principales, réa-lisées sur tous les individus et pour toutes lesvariables (fig. 127), montre que si chaque groupeforme un ensemble cohérent, tous se recoupent.Ainsi, les cinq populations sont plutôt homogènes etpartagent un même « pool » commun. Sur un dia-gramme hiérarchique, nous retrouvons cette homo-généité. Nous devons quand même noter le grandéloignement entre les hommes et les femmes deMontferrand. Cet éloignement peut s'expliquer parun problème méthodologique. En effet, les indivi-dus de ce cimetière ont été sexés sur des critères crâ-niens, méthode aujourd'hui abandonnée, amplifiantartificiellement les différences entre les sujets de labasilique cémétériale de Montferrand.
VI. 4.2. Les données post-crâniennes
Les éléments de comparaisons régionaux sont assezrares. En effet, aucune nécropole ne présente suffi-samment de données et correspond à la période etau milieu géographique concernés. Les comparai-sons ont donc été réalisées tout d'abord entre lessites de Saint-Bertrand-de-Comminges, Venerque,et Vindrac, puis ensuite avec La Gravette de l'Isle-Jourdain et ses différents groupes chronologiques(francs, autochtones, et carolingiens)73.
sites sexe n moy (cm) écart-type
SBC M 33 168,7 5,6
F 25 155,5 6,2
VEN M 17 174,8 4,9
F 13 155,3 8,4
VIN M 18 173,8 10,4
F 1 166,0
GRA M 113 172,5 4,14
F 90 160,2 3,83
160Sous la direction de S. Duchesne et É. Crubezy Romon Th., Murail P., Duchesne S., Crubézy E.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 125 : Distribution de la longueur des os longs.
SBC, St-Bertrand ; VEN, Venerque ; VIN, Vindrac ; GRA, La Gravette.
F, Féminin ; M, Masculin.
Figure 126 : Distribution de la longueur maximale du fémur
SBC, St-Bertrand ; VEN, Venerque ; VIN, Vindrac
F, Féminin ; M, Masculin ; en gras : test significatif au seuil de 5%.
Sites SBC VEN VIN GRA
F M T F M T F M T F M T
Hum 294 314 306 303 319 315 326 335 335 307 330 318
Radius 223 231 227 222 260 249 238 255 254 231 249 240
Ulna 243 261 253 286 281 258 276 276 251 272 262
Fémur 410 451 435 416 453 435 447 467 467 432 462 447
Tibia 344 369 358 350 366 357 372 377 383 360 388 374
comparaisons n SBC n VEN M SBC M VEN et SBC et VEN F p (F) ddl t p (t)
M 22 12 451 453 23,1 42,08 0,3 0,02 32 0,15 0,86
F 15 10 410 416 17,68 22,67 1,65 0,39 23 0,79 0,42
comparaisons n SBC n VIN M SBC M VIN et SBC et VIN F p (F) ddl t p (t)
M 22 7 451 467 23,1 27,83 0,35 0,01 27 0,97 0,15
comparaisons n VEN n VIN M VEN M VIN et VEN et VIN F p (F) ddl t p (t)
M 12 7 453 467 42,08 27,83 1,15 0,91 17 0,68 0,51
L’analyse univariée montre que l’ensemble desdimensions et des indices présentent des valeurssignificativement différentes entre les populations,et même en tenant compte séparément des hommeset des femmes (fig. 128). Les comparaisons menéesentre les trois populations, sexes réunis, indiquentque la population de Vindrac est la plus différente,et notamment avec la population de Saint-Bertrand-de-Comminges. Les études menées sexes séparésmontre que :
pour les hommes, la population masculine deSaint-Bertrand-de-Comminges est la plus différentedes trois, tandis que les deux autres sont assezproches. Les hommes de Saint-Bertrand-de-Com-minges présentent plus de différences sur la formedes os que sur le format avec les hommes deVenerque, contrairement à ceux de Vindrac où les dif-férences s’expriment davantage sur le format des os.
pour les femmes, seule la comparaison entreSaint-Bertrand-de-Comminges et Venerque est pos-sible, Vindrac ne présentant que deux femmes. Lapopulation féminine entre ces deux sites présentemoins de différences que les hommes, tant sur le for-mat que sur la forme des os.
Selon les analyses univariées, la population deVindrac semble donc former un groupe bien dis-tinct, de même que les hommes de Saint-Bertrand-de-Comminges.
Une analyse en composantes principales a étéréalisée pour toutes les variables, et avec les sujetsde La Gravette de l’Isle-Jourdain. L'étude des sujets(fig. 129) montre une homogénéité bien que chaquepopulation forment un ensemble cohérent. En effet,on reconnaît la population de Vindrac dont les sujets(presque tous masculins) sont groupés, celle deSaint-Bertrand-de-Comminges dont les sujets sontplus dispersés, celle de Venerque dont les sujets sontplus éparpillés encore. Ainsi, les trois populationssont plutôt homogènes et partagent un même« pool » commun. Enfin, la population de La Gra-vette recouvre la totalité de la variabilité de nos troispopulations, cela étant due sans doute aux diffé-rentes phases chronologiques.
161 Données morphologiquesRomon Th., Murail P., Duchesne S., Crubézy E.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 127 : Analyse en composantes principales pour les variables crâniennes.
Saint-Bertrand-de-Comminges (triangle vert), Venerque (triangle bleu), Vindrac (triangle cyan), Mont-
ferrand (carré jaune), et Beaucaire-sur-Baïse (losange rose).
Les variables sont représentées par des points roses (axe 1, 46,5%, axe 2, 20,8%).
L'étude des populations confirme l’homogé-néité précédente puisque que les trois sites étudiéssont regroupés au centre de l'analyse (fig. 130). Si leszones sont « éclatées » par rapport à nos popula-tions, c'est que l'une d'elles est plus différenciée.L'échantillon de La Gravette de l'Isle-Jourdain sedifférencie davantage de nos populations, et mêmeentre ses groupes chronologiques.
VI. 5. Conclusionssur les données métriques
L'étude de la variabilité des données métriquesmontre pour le Sud-Ouest de la France, au hautMoyen Âge, des populations relativement homo-gènes, avec un dimorphisme sexuel classique, iden-tique à ceux observés lors de toute étude de popula-
162Sous la direction de S. Duchesne et É. Crubezy Romon Th., Murail P., Duchesne S., Crubézy E.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 128 : Représentation des différences entre les populations étudiées, selon les dimensions et les indices.
SBC, St-Bertrand ; VEN, Venerque ; VIN, Vindrac.
F, Féminin ; M, Masculin.
Figure 129 : Analyse en composantes principales pour les variables infra-crâniennes.
Représentation des sujets.
Saint-Bertrand-de-Comminges (triangle vert), Venerque (triangle bleu), Vindrac (triangle cyan), La
Gravette de l’Isle-Jourdain (rond noir).
comparaisons mesures % indices % ttes variables %
SBC/VEN 13/30 43 5/11 45 18/41 44
pop totale SBC/VIN 19/20 95 4/10 40 23/30 77
VEN/VIN 15/20 75 2/10 20 17/30 57
SBC/VEN 11/30 37 5/10 50 16/30 53
M SBC/VIN 13/20 65 4/10 40 1730 57
VEN/VIN 6/20 30 1/10 10 7/30 23
F SBC/VEN 9/26 35 3/9 33 12/35 34
163 Données morphologiquesRomon Th., Murail P., Duchesne S., Crubézy E.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 130 : Analyse en composantes principales pour les variables infra-crâniennes.
Représentation des populations
(SBC, Saint-Bertrand-de-Comminges, VEN, Venerque, VIN, Vindrac, FRA-WIS-CAR, francs, autochtones
et carolingiens de l’Isle-Jourdain).
tions médiévales ou même actuelles. Même si cespopulations se différencient les unes des autres (parexemple, Vindrac ou les hommes de Saint-Bertrand-de-Comminges), elles appartiennent à un mêmeensemble, et partagent un même noyau commun.Ce résultat n'est vrai qu'à un niveau d'analyse« populationnel » ; à un niveau individuel, il seraitimpossible à un anthropologue, de pouvoir donnerla provenance géographique d'un individu isolé.
VI. 6. Les déformations crâniennes
Dans la nécropole de Rivel à Venerque, sept défor-mations crâniennes artificielles ont été identifiées àce jour (fig. 131). Elles correspondent, sur les 31crânes observables, à une fréquence de 22% ; ellesfont actuellement de la nécropole de Rivel le site oùcette fréquence est la plus forte pour le haut MoyenÂge en Europe Occidentale.
VI.6.1. Description
Les déformations crâniennes relevées à Venerquesont de même type, antéro-postérieure oblique, plusou moins marquée (très marquée pour les sujets 30,103 et 110, moins pour les sujets 15, 66, 116, 122) (fig.131). Le frontal est plus ou moins aplati, étiré versl’arrière, sauf les sujets 103 et 122 qui ont un frontalanguleux. La région occipitale est verticale, à l’ex-ception du sujet 66. Les bosses pariétales sont atté-nuées, excepté les sujets 15 et 103. Certains possè-dent une ensellure bregmatique (30, 66, 110, 122)tandis que d’autres ont seulement un aplatissementau niveau du bregma (103 et 116).
Le degré de déformation dépend du sexe : lescrânes féminins sont très déformés alors que lescrânes masculins le sont moins.
La répartition dans l'espace funéraire nesemble pas indiquer de distribution particulière,cependant l’échantillon est trop pauvre pour affir-mer ou infirmer cette hypothèse.
Deux sujets à Vindrac présentent une défor-mation crânienne. Pour l’un, le sujet 110, qui est latombe la plus ancienne de la nécropole (fin Ve-1etiers VIe siècle), la déformation se rapporte au typeantéro-postérieur oblique, rapporté par Imbelloni(1923) et repris par Falkenburger (1938) (Crubézy,Murail, Viguier à paraître). Dans ce cas, le frontal etl'occipital sont inclinés de manière parallèle. Dans lecas étudié, le frontal n'est pas affecté de manière fla-
grante. Cette déformation non contestable a donc uncaractère particulier, résidant dans l'aplatissementet la dépression très marquée des ptérions. Le sujet94 présente une voûte allongée et une dépressionpost-bregmatique qui concerne les pariétaux surtoute la dimension latérale. Le diagnostic est diffi-cile puisque la dépression, nette au toucher, n'appa-raît que peu sur le profil sagittal.
Pour affiner le diagnostic, nous avons comparéles indices corde/arc pour les parties frontale, parié-tale et occipitale, d'une part avec la population adultecomme référence et d'autre part avec une populationarchéologique d'enfants de 5, 6 et 8 ans (Stloukal et al1984). Nous avons employé la méthode de l'écart-réduit, avec ajustement des limites en fonction dunombre d'individus par la table de Student, afin deconclure à l'appartenance ou non d'un individu à lavariation de la population (fig. 132).
L'indice occipital de l'enfant 110 est toujoursexclu de la variation pour les trois populations deréférence âgées de 5, 6 et 8 ans (a =2 %, 2%, 9/1000).L'indice pariétal de l'enfant 110 est de même exclude ces populations ainsi que de celle de Vindrac (a =4%, 2%, 6%, 5%). Ces résultats indiquent que ladéformation peut être « décrite » par certainsindices de la voûte crânienne.
En revanche, les indices de l'enfant 94e ne sontexclus d'aucune population. Cela nous incite d'au-tant plus à ne pas considérer comme une déforma-tion la dépression observée.
164Sous la direction de S. Duchesne et É. Crubezy Romon Th., Murail P., Duchesne S., Crubézy E.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 131 : Déformations crâniennes (a : tombe
103, masculin ; b, tombe 110, féminin ; c, tombe
116, masculin ; d, tombe 122, masculin ; e, tombe
15, masculin ; f, tome 30, féminin ; g, tombe 66,
masculin).
165 Données morphologiquesRomon Th., Murail P., Duchesne S., Crubézy E.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
166Sous la direction de S. Duchesne et É. Crubezy Romon Th., Murail P., Duchesne S., Crubézy E.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
VI. 6. 2. Origine et fonctiondes déformations crâniennes
Les déformations crâniennes relevées à Venerque età Vindrac sont toutes de même type antéro-posté-rieur oblique, et les crânes féminins sont beaucoupplus déformés que les masculins sur le premier site.E. Crubézy (1986) interprète ce fait comme la consé-quence du port de la coiffe. Appliquée dès leur plusjeune âge chez les filles, elle accentuerait leurs défor-mations alors que chez les garçons, ces déforma-tions seraient moins marquées puisque aucun fac-
teur de compression n'agirait après la sortie du ber-ceau. Cependant, cette hypothèse souffre de la fai-blesse de notre échantillon.
Ce type de déformation, antéro-postérieuroblique, est du aux pressions exercées par lessangles qui maintiennent l’enfant dans son berceau(Buchet 1988). E. Crubézy (1986) a ainsi pu recher-cher la position des moyens de contention à partirdu crâne du sujet 30. Il s'est inspiré de figurines enterre cuite blanche gallo-romaines parmi lesquelleson connaît des représentations de plusieurs bébés
Figure 132 : Comparaisons des indices corde/arc pour les parties frontale, pariétale et occipitale (Vindrac).
167 Données morphologiquesRomon Th., Murail P., Duchesne S., Crubézy E.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
dans leurs berceaux. Ces berceaux comportent dessystèmes de sanglages permettant de maintenir lenourrisson : ils sont connus pour être à l'origine demalformations crâniennes. Ils étaient encore enusage à l'époque moderne dans nos campagnes.L'ensemble des pressions a pu être exercé par unminimum de deux bandeaux : un fronto-occipitalpassant au-dessus des orbites, peut-être accompa-gné d'une planchette, et un autre sensiblement dansle plan frontal passant en arrière de la fontanellebregmatique (fig. 133).
Les raisons de telles déformations sont bien sûrinconnues, mais deux hypothèses, l’une n’excluantpas l’autre, peuvent être envisagées (Crubézy 1990) :
tout d'abord, un rôle protecteur des moyens decontention contre le froid et les chocs du crâne par-ticulièrement fragile au niveau des fontanelles. Ladéformation crânienne résultante est alors un effetsecondaire ;
la seconde, une recherche esthétique desformes résultantes, les déformations sont alors l'ef-fet primaire.
Le site de Venerque présente la plus haute fré-quence de déformations crâniennes en Europe pourle haut Moyen Âge, 22% des crânes observables sontdéformés. Sa période d'utilisation, VIe et VIIe siècles,est postérieure aux grandes invasions, et donc auxgrands brassages de populations qu'elles ont entraî-nées. Ceci est confirmé par l'homogénéité du groupeet celle de l'ensemble des populations contempo-raines du Sud-Ouest de la France. La répartition desindividus porteurs de déformations dans l'espacefunéraire est aléatoire.
Toutes ces constatations semblent écarter lesliaisons entre cette pratique et la présence d'indivi-dus allochtones dans la nécropole. Les déformations
Figure 133 : Venerque, sujet de la tombe 30 (enfant dans son berceau).
Essai de reconstitution, E. Crubézy, 1986.
168Sous la direction de S. Duchesne et É. Crubezy Romon Th., Murail P., Duchesne S., Crubézy E.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
crâniennes de Venerque sont de simples faits cultu-rels, elles ne peuvent servir de marqueur ethniquepour démontrer la présence d'étrangers dans lanécropole. En effet, longtemps les archéologues etanthropologues ont voulu voir dans les déforma-tions crâniennes mérovingiennes la preuve de l'in-fluence des Barbares venus de l'Est (Zirov 1940 ;Wermer 1956 ; Sauter 1954 et 1961 ; Nemeskeri 1976 ;Simon 1979, cités par Crubézy 1990), tout particuliè-rement celle des Huns emmenant avec eux une cou-tume dont l'origine était, pensait-on, orientale.D'autres, comme E. Crubézy (1990), n'adhèrent pasà cette hypothèse, la coutume étant connue dans lemonde entier, dans des lieux et à des époques diffé-rentes (déjà plusieurs millénaires avant notre ère,Kiszely 1978).
Les liens entre différentes époques et diffé-rentes régions sont difficiles à retrouver, nous étu-dierons deux exemples :
les déformations des XVIIIe et XIXe siècles dans lamême région, la déformation Toulousaine (Crubézy1986 et 1990), étaient très différentes : par sa forme,généralement de type circulaire, par son intensité,beaucoup plus faible, et par sa fréquence, la majoritéde la population était déformée. Ces observationss'opposent toutes à celles effectuées sur la série deVenerque. Ce phénomène s'apparente plus à unemode vestimentaire où la déformation n'est quesecondaire, qu'à une réelle volonté de déformation.Cependant, nous ne pouvons émettre d'hypothèse àce sujet pour la population étudiée, ni affirmer unefiliation directe entre ces deux pratiques.
les déformations crâniennes étudiées par D. Cas-tex (1994) dans la nécropole de Saint-Etienne-de-Beaune (Ve et VIe siècles), de même période d'utili-sation que celle de Venerque, présente aussiquelques différences, notamment de contexte. Ils'agit en effet d'un site suburbain où deux groupespeuvent être séparés aussi bien par les pratiquesfunéraires que culturelles. Seuls trois sujets, tousféminins, présentent des déformations crâniennes.Vis à vis du mobilier, ils appartiennent tous les troisà l'ensemble supposé burgonde. Une fois encore cesobservations s'opposent à celles effectuées àVenerque. Dans ce cas la pratique des déformationscrâniennes se rapproche plus de celle définie par L.Buchet (1986), c'est-à-dire, la survivance de cou-tumes dans un petit groupe qui témoigne le désir dese distinguer des communautés voisines.
Dans le cas de Vindrac, la présence d'unedéformation crânienne affectant l'un des raresenfants présents dans la nécropole n'est sans doutepas un hasard. En effet, aucun des adultes étudiés neprésente une quelconque déformation de la voûtecrânienne.
Cette constatation est d'ailleurs renforcée parle caractère exceptionnel du sarcophage de l'enfant110. Selon M. Bessou, le sarcophage a été façonnépour un enfant : « La cuve est exceptionnellementlarge. Le fond est rigoureusement plat pour asseoirle lit de 1,40 x 0,40 où l'enfant repose habillé. Au-des-sus de lui, la face inférieure du couvercle est égale-ment creusée en berceau. Cet ensemble constitue unevéritable chambrette funéraire », ceci est encore plusmarqué lorsqu'on le met en parallèle avec la chrono-logie, puisqu'il s'agit d'une des tombes les plusanciennes de la nécropole (fin Ve- début VIe siècle),avec des pièces de parure de type wisigothique.
Cette attention particulière pour l'inhumationd'un enfant, l'un des rares de la nécropole et ladéformation crânienne qui l'affecte, confèrent à l'in-humation de cet enfant un caractère exceptionnel.
VI. 7. Les lésions crâniennes à Vindrac
Sur le site de Vindrac, trois crânes de sujets adultesont fait l’objet d’une attention toute particulière, eneffet ils présentaient des lésions originales. Si l’uned’entre elles, de type infectieuse, est inhabituelle, lesautres sont tout à fait exceptionnelles.
Le sarcophage 100
Deux crânes proviennent du sarcophage 100 : ilsétaient en position remaniée, issus des réductions decorps qui ont eu lieu au sein de la tombe.
Le crâne du sujet 3, intact, présente un orificesur le pariétal gauche. Le bord antérieur est situé à18 mm en arrière de la suture coronale et le borddroit recoupe la suture sagittale pour un tiers de lalésion. Cet orifice, de 15 mm de diamètre antéro-postérieur et de 13 mm de diamètre transverse, pré-sente des bords nets. Sa taille est identique entre lesfaces interne et externe du crâne. Autour de cettelésion, on observe sur la face externe un piqueté,qui commence à 10 mm de la suture coronale et setermine à 37 mm. Cette modification de la surfacede l’os mesure 25 mm de diamètre antéro-posté-rieur et 30 mm de diamètre transverse. Elle nedépasse pas 1 mm de profondeur, avec un maxi-
169 Données morphologiquesRomon Th., Murail P., Duchesne S., Crubézy E.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
mum situé à l’engrènement de la suture sagittale.Sur la face interne, le piqueté, très léger, n’altère pasla surface de l’os. Cette lésion évoque un foyer d’os-téite, une infection non spécifique, d’origineexterne et superficielle.
Le crâne du sujet 2, intact, présente sur le côtédroit du crâne un coup porté latéralement avec unobjet tranchant. Ce dernier a sectionné l’occipital,provoquant une écaille des lignes nuchales infé-rieures jusqu’au foramen magnum. Il a ensuite tran-ché le temporal droit, rabotant le processus mas-toïde, la partie terminale du processusstylo-mastoïdien et la branche montante de la man-dibule sur 3 cm, sans fracture complète mais avecdétachement de la partie inférieure (l’anglegoniaque) (fig. 134). L’orientation du coup permetd’évoquer en l’absence des vertèbres cervicales uneatteinte certaine de l’atlas, au niveau du processustransverse droit. Sur le plan dentaire, toutes lesdents étaient présentes avant la mort. Il manque parla chute post mortem les premières incisives supé-rieures, la première incisive inférieure gauche et la
canine inférieure droite. La première molaire infé-rieure droite est présente à l’état de racine (sansdoute une carie). Aucune dent ne présente d’éclate-ment ou de fissuration en liaison avec le coup. Lecoup aurait pu être porté par derrière, dans le dos, etlégèrement descendant, de droite à gauche, sous unangle de 15° par rapport à l’horizontale. Il est pro-bable que le geste ait été réalisé pour une décapita-tion, avec la tête posée sur un billot.
Le crâne isolé
Le troisième crâne a été découvert, isolé, dans lesédiment entre les sarcophages 3 et 4. Incomplet, iln’est représenté que par la voûte (frontal, pariétauxet écaille de l’occipital). Il présente cinq orifices, troiscomplets et circulaires, un quatrième incomplet etcirculaire, et un cinquième complet et irrégulier. Siles quatre premiers semblent suggérer des trépana-tions, le dernier est plus équivoque. En dehors deces lésions, aucune trace de traumatismes ou frac-tures n’est visible.
Figure 134 : Vindrac, sarcophage 100, sujet 2, coup sur la base du crâne du à une probable décapitation.
170Sous la direction de S. Duchesne et É. Crubezy Romon Th., Murail P., Duchesne S., Crubézy E.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Sur la partie gauche de la voûte, trois orificescirculaires sont présents. Un premier orifice, incom-plet, est situé en arrière de l’orbite gauche, à la jonc-tion fronto-zygomatique. Il mesure 25 mm de dia-mètre. L’ouverture laisse apparaître les tables interneet externe, le diploé et la partie interne de l’arcade. Latable interne à la partie supérieure de l’orifice estparfaitement lisse, comme polie. Le second orifice,antérieur, est situé sur le frontal à 8 mm de la lignevirtuelle de la suture métopique, et son bord posté-rieur est à 30 mm de la suture coronale. Il mesure 18mm de diamètre. Les ouvertures des tables interne etexterne sont pratiquement de même taille : l’orificeinterne est supérieur de 1 mm sur toute la circonfé-rence. Le troisième orifice, postérieur, est tangent àligne virtuelle de la suture métopique, et son bordpostérieur est à 4-5 mm de la suture coronale. Sondiamètre est de 22 mm. Les ouvertures interne etexterne ont la même taille (fig. 135).
Sur le pariétal droit, deux orifices sont pré-sents. Le premier, circulaire, est situé à 25 mm au-dessus de l’astérion. Son diamètre est de 23 mm. Les
ouvertures interne et externe ont la même taille. Lesecond est situé à 50 mm en arrière de la suture coro-nale et son bord gauche est à 10 mm de la suturesagittale. L’orifice, irrégulier, est oblique selon un axeantéro-postérieur, de droite à gauche, avec un anglede 45°. Son grand axe mesure 35 mm. La partie pos-térieure est régulière, la partie antérieure est irrégu-lière, sur 30 mm et de 5 à 10 mm de largeur. Ilrecoupe en partie la trace calcifiée de ce qui a pu êtreun niveau de matière organique dans la cavité crâ-nienne. La calcification concerne partiellement lebord postérieur de l’orifice (le bord inférieur en posi-tion d’inhumation). Cette situation permet de direque l’orifice a été constitué avant la mort (fig. 136).
La forme des orifices permet d’exclure une tré-panation par grattage, par incision ou par multiplespetits orifices. Leur forme régulière, à l’exception dela dernière ouverture, évoque l’utilisation d’unoutil, le trépan. Le crâne présente des trépanationscomplètes. Les orifices de trépanation ne sont pasassociés à un traumatisme justifiant l’intervention.Aucune trace de découpe du scalp n’a été relevée. Il
Figure 135 : Vindrac, crâne isolé, localisation des orifices sur la face latérale gauche.
171 Données morphologiquesRomon Th., Murail P., Duchesne S., Crubézy E.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
n’y a pas de trace de cicatrisation, ce qui permetd’évoquer un décès au cours de la trépanation oupeu de temps après, ou encore une intervention postmortem (à distance de la mort).
L’orifice antérieur situé sur le frontal présentela particularité d’avoir une ouverture de la tableinterne plus grande (rayon +1 à 2 mm) que la table
externe. Cette dernière présente deux discrètes irré-gularités osseuses (saillies de 0,5 à 1 mm), peu com-patibles avec une action débutée sur la table externe.Ainsi, cette ouverture a vraisemblablement été pra-tiquée post mortem, depuis la table interne.
Figure 136 : Vindrac, crâne isolé, localisation des orifices sur la face latérale droite.
’étude de la santé bucco-dentaire des sites deSaint-Bertrand-de-Comminges, de Lunel-Viel(l’Eglise et Les Horts), de Venerque, de Saint-Brice-de-Cassan et de l’Isle-Jourdain (La Gra-vette) permet d’approcher différentes patholo-
gies bucco-dentaires, et plus largement l’étatsanitaire74. Elle permet également d’appréhenderles habitudes alimentaires et les conditions de vie deces populations.
VII.1. Pertes ante mortem
Les pertes ante mortem sont de l'ordre de 7-10%quelque soit le site étudié (fig. 137). En déterminerl’origine est généralement difficile, voire impos-sible, car une fois l’alvéole résorbé, il ne reste plus detrace du phénomène (Bouali et Vattéoni 1991). Sil'âge peut être une des raisons de la chute ante mor-tem, d'autres facteurs, volontaires ou non, peuventêtre évoqués : l'extraction, le traumatisme, les phé-nomènes dégénératifs (usure) ou infectieux (carie,parodontopathie).
Les deux premiers phénomènes peuvent êtreécartés. En effet, afin de définir s'il s'agissait d'extra-ction intentionnelle, nous avons étudié la propor-tion des pertes dentaires et des débris radiculaires.Une forte proportion de chutes ante mortem associéeà un pourcentage très faible de débris radiculairespermettrait d'évoquer des extractions intention-
nelles. Cependant, le faible nombre de pertes (10%)ne semble pas suggérer cette hypothèse (Gaury1997). Par ailleurs, aucun traumatisme n'a étéreconnu dans nos séries.
Les phénomènes dégénératifs et infectieuxpeuvent être à l'origine de la perte dentaire. L'usure,par exemple, entraîne une ouverture de la chambrepulpaire, et prédispose ainsi à la carie. Par ailleurs,la carie intervient également en relation avec laparodontopathie75. Différencier chacun des facteursn'est pas évident, d'autant plus que les dents per-dues, les molaires principalement puis les prémo-laires, sont également celles qui sont le siège privilé-gié de la carie et de la parodontopathie.
Toutefois, dans les sites étudiées, la parodon-topathie et l'usure sont prépondérantes sur le sec-teur incisivo-canin tout d'abord, et seulement aprèssur les molaires et les prémolaires. La carie, elle,touche en premier lieu les molaires, puis les prémo-laires. Ainsi, la carie pourrait être le facteur principalde la perte dentaire.
De manière générale, les dents les plus tou-chées par les pertes ante mortem sont les molaires,puis les prémolaires. Ce sont elles également quisont les plus atteintes par les phénomènes infectieuxet dégénératifs, il est alors difficile de leur définirune origine précise.
VII ÉTAT SANITAIRE :
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
173 État sanitaire : la paléopathologie bucco-dentaire
Aguerre M., Gaury P., Sainte-Marie S., Morel L., Crubézy E.
LLA PALÉOPATHOLOGIE BUCCO-DENTAIRE
Aguerre M., Gaury P., Sainte-Marie S., Morel L.,Crubézy E.
Figure 137 : Pertes ante mortem et débris radiculaires selon les sites.
SBC, St-Bertrand ; LVE, Lunel-Viel l’Eglise ; LVH, Lunel-Viel Les Horts ; SBCa, St-Brice de Cassan ;
VEN, Venerque ; GRA, La Gravette.
(74) Si le site de Vindrac n’a fait pas l’objet d’une étude bucco-dentaire, celle de l’Isle-Jourdain est moins approfondie quecelles des autres sites.(75) L'évolution de ces deux facteurs peut être liée. En effet, l'évolution de la parodontopathie avec l'âge peut correspondreà une évolution carieuse par une adaptation de l'alimentation, et un sujet qui, jeune, a développé des caries, présenteraune parodontopathie, c'est le schéma courant des populations contemporaines (Aguerre 1997).
sites n pertes ante mortem % n dévris rad. %
SBC 58/594 10 24/594 4
LVE 44/486 9 9/486 2
LVH 68/743 9 10/743 1
VEN 83/820 10 30/820 4
SBCa 10
GRA 225/3031 7
Dans les sites de Saint-Brice-de-Cassan et deLa Gravette de l’Isle-Jourdain (Barthélémy et al1999), une étude par types de dent a été menée. Lesdents les plus touchées sont les molaires de façongénérale. Or ce sont également ces dents qui sont lesiège privilégié des caries, ce qui permet de suppo-ser, dans ce cas, qu'elles sont directement liées auxcaries.
Comparaisons
Les sites étudiés semblent présenter moins de pertesante mortem que les autres nécropoles de la mêmeépoque (fig. 138). En effet, même si leurs fréquencesse rapprochent des sites comme Goudelancourt(Morazzani 1994) ou Beauvais (Bouali, Vattéoni1991) la moyenne observée est supérieure, tant enmilieu rural (20%) qu'en milieu urbain (19%). Cettedifférence n'est cependant pas significative. Parailleurs, la présence d'un édifice religieux ne semblepas faire de différence.
Les dents atteintes sont identiques, à savoirprincipalement les dents jugales, molaires et prémo-laires. Cette distribution reflète souvent celle desparodontopathies et de la carie dentaire puisque lespertes ante mortem en constituent le stade ultime.Les chutes sont plus fréquentes en général chez leshommes, mais rarement de manière significative, àl'exception de Chartres (Castex 1994) où ce sont lesfemmes qui présentent significativement plus dechutes ante mortem que les hommes. De même, lesdents maxillaires font l'objet de chute plus fréquem-ment que les dents mandibulaires.
VII. 2. Étude des caries
Une grande uniformité des résultats est rencontréepour les cinq nécropoles étudiées à l’exception deSaint-Brice-de-Cassan où le nombre de sujetsatteints par la carie est le plus faible. La proportionde dents cariées est aussi homogène, à l’exceptionde Saint-Bertrand-de-Comminges où elle est la plusélevée et de l’Isle-Jourdain où elle est la plus basse(fig. 139, 140 et 141).
Les atteintes carieuses les plus fréquentes(indice CA) sont situées sur les molaires (fig. 142 et143). Plus les dents sont postérieures (maxillaires oumandibulaires), plus les atteintes sont nombreuses,ce qui n’est pas en soi une surprise odontologique.Ensuite, les pathologies les plus fortes sont enregis-trées sur le site de Saint-Bertrand-de-Comminges,notamment sur le groupe incisivo-canin maxillaire.Le site de Saint-Brice-de-Cassan présente desatteintes importantes au niveau des incisives cen-trales mandibulaires. Le site de La Gravette à l’Isle-Jourdain montre aussi que les molaires, et plus par-ticulièrement les premières molaires, sont les plustouchées ; aucune incisive latérale cariée n’a étéobservée (Barthélémy 1999).
L’indice CAs met en évidence le nombre desurfaces atteintes ante mortem. Il suit l’indice CA,autrement dit les dents les plus touchées en nombresont aussi celles qui sont le plus touchées en surface,
174Sous la direction de S. Duchesne et É. CrubezyAguerre M., Gaury P., Sainte-Marie S., Morel L.,
Crubézy E.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 138 : Pertes ante mortem des nécropoles de la même époque utilisées pour comparaison
HMA, haut Moyen Âge ; BMA, bas Moyen Âge.
sites références datation milieu église n dents n pertes %
ante mortem
St Martin Pilet et al 1994 V-VIIe rural ? 12
de Fontenay
Ennery Vidal 1999 VI-VIIe rural non 766 166 22
Chatel Vidal 1999 VI-VIIe rural non 1334 301 23
Raucourt Vidal 1999 VIIe rural non 910 197 22
Nomexy Vidal 1999 VIIIe rural non 909 205 23
Chinon Husi et al 1990 HMA urbain ? 2414 507 21
St Martin Sansilbano VII-VIIIe urbain oui 2340 525 22
de Cognac Collilieux 1994
Vaison Bouali, Vattéoni 1991 V-VIe urbain 2160 383 18
Beauvais Bouali, Vattéoni 1991 IV-Ve urbain 1393 193 14
Tours Theureau 1995 HMA-BMA urbain oui 7008 1425 20
175 État sanitaire : la paléopathologie bucco-dentaireAguerre M., Gaury P., Sainte-Marie S., Morel L.,
Crubézy E.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 139 : Nombre de sujets atteints par la carie.
SBC, St-Bertrand ; VEN, Venerque ; LVE, Lunel-Viel
l’Église ; LVH, Lunel-Viel Les Horts ; SBCa, St-Brice
de Cassan.
Figure 140 : Moyennes des indices CA et Cas,
selon les sites.
SBC, St-Bertrand ; VEN, Venerque ; LVE, Lunel-Viel
l’Église ; LVH, Lunel-Viel Les Horts ; SBCa, St-Brice
de Cassan ; GRA, La Gravette.
Figure 141 : Moyennes des indices CA et CAs (%), selon les sites.
SBC, St-Bertrand ; VEN, Venerque ; LVE, Lunel-Viel l’Église ; LVH, Lunel-Viel Les Horts ; SBCa, St-Brice de
Cassan ; GRA, La Gravette.
Figure 142a : Indice CA au maxillaire (%), selon les dents et les sites.
Figure 142b : Indice CA à la mandibule (%), selon les dents et les sites.
SBC, St-Bertrand ; VEN, Venerque ; LVE, Lunel-Viel l’Église ; LVH, Lunel-Viel Les Horts ; SBCa, St-Brice de Cassan.
sites n sujets %
SBC 37/39 95
VEN 37/40 93
LVE 30/34 88
LVH 50/58 86
SBca 73/93 78
sites CA moyen CAs moyen
SBC 47% 23%
VEN 34% 21%
LVE 33% 16%
LVH 34% 15%
SBca 31% 22%
GRA 9%
sites CAs moyen CA moyen
SBC 23% 47%
VEN 21% 34%
LVE 16% 33%
LVH 15% 34%
SBca 22% 31%
GRA 9%
sites D18 D17 D16 D15 D14 D13 D12 D11 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28
SBC 69 76 64 43 32 21 41 33 33 50 33 48 50 76 83 47
Vén 45 36 19 29 29 14 14 9 19 6 4 24 24 23 57 55
LVE 45 64 62 29 12 11 10 14 11 21 6 17 20 58 89 36
LVH 70 70 58 35 23 8 10 4 6 11 8 28 16 38 59 60
SBca 24 33 35 39 32 12 21 8 15 14 13 36 39 45 45 13
sites D38 D37 D36 D35 D34 D33 D32 D31 D41 D42 D43 D44 D45 D46 D47 D48
SBC 53 95 75 59 28 12 0 14 8 5 11 21 53 81 81 44
Vén 60 60 65 32 13 6 11 4 8 4 6 17 24 64 69 55
LVE 64 48 42 36 10 0 0 8 0 6 5 5 11 68 55 60
LVH 85 78 67 40 23 12 8 11 10 0 14 7 15 53 68 67
SBca 38 50 68 41 17 5 6 21 20 4 4 12 29 60 44 34
aussi bien au maxillaire qu’à la mandibule (fig. 144et 145). Cependant, le différentiel CA/CAs peutentraîner deux interprétations différentes, puisquequand l’indice CAs est important, il rattrape l’indiceCA :
soit cela marque une atteinte carieuse majeurequi progresse dans le temps,
soit une atteinte parodontale terminale avecperte des dents, une perte influençant le CAs majo-ritairement.
La nécropole de Saint-Brice-de-Cassan est glo-balement celle dont les dents ont le plus grandnombre de surfaces atteintes, notamment sur lesincisives centrales.
L’indice CA est corrélé avec l’âge : le nombrede dents cariées et de pertes ante mortem augmenteavec l’âge. Quelques sujets présentent des indicesCA et CAs anormalement élevés, expliqués :
pour les individus jeunes soit par une pathologiecarieuse importante (rôle des habitudes alimen-taires ou pathologie générale - diabète, hyposialie,nutriments mous ou hyperglucidiques), soit par unbiais dans la détermination de l’âge, à Saint-Ber-trand-de-Comminges, à Venerque, et à Lunel-Vielles Horts.
pour quelques sujets appartenant à la classed’âge de plus de 30 ans, par un âge avancépuisque le taux de caries progresse à mesure quel’âge augmente.
176Sous la direction de S. Duchesne et É. CrubezyAguerre M., Gaury P., Sainte-Marie S., Morel L.,
Crubézy E.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 143b : Indice CA à la mandibule, selon les dents et les sites.
SBC, St-Bertrand ; VEN, Venerque ; LVE, Lunel-Viel l’Église ; LVH, Lunel-Viel Les Horts ; SBCa, St-Brice de Cassan.
Figure 143a : Indice CA au maxillaire, selon les dents et les sites.
177 État sanitaire : la paléopathologie bucco-dentaireAguerre M., Gaury P., Sainte-Marie S., Morel L.,
Crubézy E.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 144b : Indice CAs à la mandibule (%), selon les dents et les sites.
SBC, St-Bertrand ; VEN, Venerque ; LVE, Lunel-Viel l’Église ; LVH, Lunel-Viel Les Horts ; SBCa, St-Brice de Cassan.
Figure 145b : Indice CAs à la mandibule, selon les dents et les sites.
SBC, St-Bertrand ; VEN, Venerque ; LVE, Lunel-Viel l’Église ; LVH, Lunel-Viel Les Horts ; SBCa, St-Brice de Cassan.
Figure 144a : Indice CAs au maxillaire (%), selon les dents et les sites.
Figure 145a : Indice CAs au maxillaire, selon les dents et les sites.
sites D18 D17 D16 D15 D14 D13 D12 D11 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28
SBC 23 32 34 25 18 7 18 17 17 25 15 24 28 42 41 20
Vén 11 22 8 22 23 7 7 6 13 6 1 18 10 8 31 24
LVE 9 25 39 13 7 7 5 14 11 11 6 12 20 39 44 15
LVH 16 27 27 25 15 5 10 4 6 7 8 10 12 20 20 10
SBca 50 62 47 52 40 20 23 8 15 18 17 18 41 49 65 62
sites D38 D37 D36 D35 D34 D33 D32 D31 D41 D42 D43 D44 D45 D46 D47 D48
SBC 53 95 75 59 28 12 0 14 8 5 11 21 53 81 81 44
Vén 28 31 51 25 11 6 6 4 5 4 2 7 16 52 46 29
LVE 19 22 25 24 2 0 0 8 0 6 1 1 2 35 19 24
LVH 26 32 38 25 8 4 4 9 6 0 9 1 9 35 30 21
SBca 52 69 72 40 19 9 6 22 20 4 6 16 35 68 65 55
enfin, pour les sujets ayant un indice CA peuimportant et un indice Cas significatif, par le pro-blème des extractions qui font diminuer le premierindice.
Aucune corrélation en fonction du sexe n’estapparue. En effet, les hommes présentent plus dedents atteintes par la carie que les femmes à Saint-Bertrand-de-Comminges (54 contre 45%). Lecontraire est observé à Venerque (38 % des femmescontre 26% des hommes, 39% de sexe indéterminé).
Comparaisons
Le nombre de sujets ayant des caries et la proportiondes dents atteintes sont très importants dans lessites étudiés, tant en milieu rural qu’en milieuurbain, avec ou sans édifice religieux, et pour toutesles classes d’âge considérées. En effet, selon la four-chette de Brabant (1963), le nombre de dents cariéesdans les sites gallo-romains et médiévaux de Franceet de Belgique est compris entre 4 et 15% (Pilet et al,1990 ; Theureau 1995), tandis que la proportion dessujets atteints est d’environ 30% pour l’Antiquité etle haut Moyen Âge, allant jusqu’à 50% au BasMoyen Âge (Theureau, 1995).
Plusieurs hypothèses peuvent être alors envi-sagées pour expliquer cette différence significative :(i) la population est âgée, (ii) des conditions sani-taires défavorables, (iii) l’alimentation, (iv) la situa-tion géographique, et enfin, (v) les voies de commu-nication. La première hypothèse ne tient pas, bienque la fréquence de la carie augmente avec l’âge, carle recrutement est en faveur de populations jeunes(cf. recrutement), et donc de conditions de viemédiocres, ce qui confirme la seconde hypothèse. Ladifférence pourrait être liée à une alimentation dif-férente, plus cariogène dans ces populations ; toute-fois, elle ne suffit pas à elle seule pour expliquercette fréquence élevée. La situation géographiquen’est pas retenue car dans la littérature de nombreuxsites en France, en milieu rural ou urbain, présen-tent également une forte proportion de sujetsatteints, dépassant largement 50%76. Cependant,
peu d’entre eux présentent une proportion de dentscariées aussi importante, seules les nécropoles deSaint-Saturnin-en-Plomeur pour le milieu rural(34%) (Giot, Monnier 1977), et de Beauvais (19%),Vaison (23%) (Bouali, Vattéoni 1991) et du baptistèrede Poitiers (30%) pour le milieu urbain77 (Sansil-bano-Collilieux 1994). Toutefois, le réseau des voiesde communication, plus développé en milieu forte-ment romanisé, comme le sud de la France, permetdes contacts permanents avec la vie urbaine, où lafréquence des caries est plus grande, en raison d’unaccès plus large à une nourriture plus cariogène(Baud 1991). Enfin, la fréquence élevée de cariesdans ces populations est peut-être due non pas à unseul mais à l’association de plusieurs de ces facteurs.
Les femmes sont plus touchées que leshommes dans la nécropole de Rivel à Venerque,alors que ce sont les hommes qui sont les plus tou-chés à Saint-Bertrand-de-Comminges, bien que cesdifférences ne soient pas significatives. Il en va demême pour le reste de la France, où le taux de carieen faveur des hommes ou des femmes ne semble paslier au milieu urbain ou rural78, ou à la présenced’un édifice religieux.
Si le site de Saint-Brice-de-Cassan et plus par-ticulièrement celui de La Gravette de l’Isle-Jourdain,présente le moins de dents atteintes, c’est peut-êtreque leur durée est plus longue, sachant que la fré-quence de carie diminue après le haut Moyen Âge.En effet, il y a une évolution pour les deux sexesentre le Bas-Empire et le Bas Moyen Âge, avec unmaximum d’atteintes au cours du haut Moyen Âge,puis une diminution au Moyen Âge (fig. 146). Cetteévolution se rencontre aussi pour l’ensemble desadultes et des adolescents79. De plus, le nombre defemmes touchées diminuent avec le temps alors quecelui des hommes augmentent. Or, le site de Saint-Brice-de-Cassan présente plus de femmes qued’hommes.
178Sous la direction de S. Duchesne et É. CrubezyAguerre M., Gaury P., Sainte-Marie S., Morel L.,
Crubézy E.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
(76) En milieu rural, en Lorraine, à Ennery, Chatel, Raucourt et Nomexy, entre 44-50% (Vidal 1999), Seyssel avec 52% (Cas-tex 1994), ou en Indre-et-Loire à Sublaines, avec 75% (Cordier et al 1974) ; en milieu urbain, dans l’est à Chalôn et à Beaune,50 et 61% (Castex 1994), dans le nord à Beauvais 78% (Bouali, Vattéoni 1991).(77) Aucun des sites ne semble présenter d’édifices religieux pour la période considérée.(78) Six sites urbains contre deux sites ruraux en faveur des femmes, et trois sites urbains contre un site rural en faveur deshommes, soit dans les deux cas 75% pour les sites urbains et 25% pour les sites ruraux.(79) Six sites ont fait l’objet de l’étude selon le sexe, et treize pour l’ensemble adultes et adolescents.
Si le site de Saint-Bertrand-de-Commingesprésente le plus d’atteintes, c’est peut-être le carac-tère urbain, particulièrement développé, qui est encause, ainsi que la présence d'hommes en plusgrand nombre que les femmes.
VII. 3. Etude des parodontopathies
Les atteintes parodontales (fig. 147) touchent entreun quart et la moitié des adultes (de 24 à 56%), etpratiquement toutes les dents observées (de 87 à98%80). Les sites d'église, sites également urbains,sont plus touchés que les autres pour le nombre desujets. De même, les hommes sont plus nombreuxque les femmes : à Saint-Bertrand-de-Comminges,78% des hommes sont touchés contre 73% desfemmes, et à Venerque, 63% des hommes contre 38%des femmes. Pour le site de l’Isle-Jourdain, l’étude aporté uniquement sur les mandibules : 15% d’entreelles sont atteintes de parodontolyses (26/173) (Bar-thélémy et al 1999).
Les atteintes parodontales, de manière géné-rale, touchent indistinctement la mandibule commele maxillaire. Cependant, en comparant les sitesd'églises avec les sites de plein champ, on constate
que l'atteinte est plus grande dans les sites de pleinchamp, et que la mandibule est alors plus touchée, àl'exception de Saint-Brice-de-Cassan, dont lesindices se rapprochent plutôt des sites d'église.
Le secteur incisivo-canin est plus touchéd'une manière générale, ensuite ce sont les molairespuis enfin, les prémolaires (figures 148 et 149). Lesincisives mandibulaires sont plus touchées que lesincisives maxillaires. Toutefois, une répartition dif-férente apparaît entre les sites d'églises, où l'atteinteest à peu près égale au maxillaire et où elle prédo-mine aux incisives et aux molaires mandibulaires,et les sites de plein champ, où elle prédomine auxincisives et aux canines maxillaires et mandibu-laires. Pour le site de l’Isle-Jourdain, les molairessont les plus touchées (22 atteintes sur 26) ; ellessont sectorisées et ne touchent que deux ou troisdents adjacentes.
On note pour Saint-Bertrand-de-Commingeset Venerque une atteinte maxillaire plus importantechez les hommes, la mandibule ne fournissant pasde différences significatives. Pour le site de Saint-Brice-de-Cassan, les dents féminines sont plusatteintes que les dents masculines, et de façon plussignificative à la mandibule.
179 État sanitaire : la paléopathologie bucco-dentaireAguerre M., Gaury P., Sainte-Marie S., Morel L.,
Crubézy E.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 146 : Évolution du nombre de sujets atteints par la carie, tous sites confondus, selon le sexe et
les périodes chronologiques.
% dents atteintes F M Ad
n sites 6 6 13
Bas Empire 17 2 11
haut Moyen Âge 27 20 25
Moyen Âge 7 8 11
bas Moyen Âge 7 9 10
% sujets atteints F M Ad
n sites 6 6 13
Bas Empire 75 18 43
haut Moyen Âge 70 38 76
Moyen Âge 69 56 55
bas Moyen Âge 40 63 61
(80) À l’exception de Lunel-Viel les Horts (25%), en raison du grand nombre de dents perdues post mortem.
180Sous la direction de S. Duchesne et É. CrubezyAguerre M., Gaury P., Sainte-Marie S., Morel L.,
Crubézy E.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 147 : Nombre de sujets et de dents atteints de parodontopathies selon les sites.
SBC, St-Bertrand ; LVE, Lunel-Viel l’Eglise ; LVH, Lunel-Viel Les Horts ; VEN, Venerque ; SBCa, St-Brice de
Cassan ; GRA, La Gravette.
Figure 148a : Indice parodontal moyen au maxil-
laire, selon les dents et les sites.
SBC, St-Bertrand ; LVE, Lunel-Viel l’Église ; LVH, Lunel-Viel Les Horts ; VEN, Venerque ; SBCa, St-Brice de Cassan.
Figure 149a : Indice parodontal moyen au maxillaire, selon les dents et les sites.
SBC, St-Bertrand ; LVE, Lunel-Viel l’Église ; LVH, Lunel-Viel Les Horts ; VEN, Venerque ; SBCa, St-Brice de Cassan.
Figure 148b : Indice parodontal moyen à la man-
dibule, selon les dents et les sites.
sites datation milieu église n sujets att % dents atteintes indice max indice mandb
SBC V-IX urbain oui 22/39 56 89 1,9 1,9
LVE VI-IX urbain oui 12/35 34 87 1,7 1,7
LVH VI-VII rural non 14/58 24 25 2,1 2,4
VEN V-VII rural non 18/40 45 88 2,4 2,5
SBCa VII-XIII rural ? 98 1,8 1,8
maxillaire I C P M total
SBC 1,9 1,9 1,6 2,1 1,9
LVE 1,7 1,9 1,8 1,7 1,7
sites église 1,8 1,9 1,7 1,9 1,8
LVH 2 2,2 1,8 2,4 2,1
VEN 2,8 3,2 2,1 2 2,4
SBca 1,9 1,8 1,7 1,8 1,8
sites plein champ 2,2 2,4 1,9 2,1 2,1
total 2,1 2,2 1,8 2 2
mandibule I C P M Total
SBC 2,3 1,6 1,6 2,1 1,9
LVE 1,8 1,7 1,5 1,7 1,7
sites église 2 1,7 1,5 1,9 1,8
LVH 2,9 2,3 2,2 2,1 2,4
VEN 3,1 3,1 2,2 2,1 2,5
SBca 1,9 2 1,8 1,8 1,8
sites plein champ 2,6 2,4 2,1 2 2,3
total 2,4 2,1 1,9 2 2,1
sites D18 D17 D16 D15 D14 D13 D12 D11 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28
SBC 1,9 2,6 2,1 1,4 1,6 1,8 2 1,9 2 1,8 2 2 1,3 2,1 2 1,9
LVE 1,3 1,9 2 1,8 1,9 1,9 1,7 1,4 2,2 1,6 1,9 1,8 1,6 1,6 1,6 1,7
LVH 2,3 2,1 2 1 2,3 2,1 2 2 2 2 2,3 1,7 2 2,3 2 3,5
VEN 1,5 1,9 2,8 2,1 2,4 3 2,3 2,7 3,3 2,8 3,4 1,8 2,2 2,2 2,1 1,6
SBca 1,7 1,7 1,8 1,7 1,7 1,6 1,9 1,8 1,9 1,8 2 1,8 1,6 1,9 1,9 1,7
L’indice parodontal augmente en fonction dela classe d’âge, à la mandibule comme au maxillaire.
Pour l'essentiel des sites, la classe 2, synonymede lyse osseuse, prédomine quelque soit les dents, àla mandibule ou au maxillaire (fig. 150). Les classes0 et 1, une atteinte normale, oscillent entre 20 et 30%,et les classes 3 et 4, une atteinte sévère, entre 10 et30% selon les sites. En général, ces dernières tou-chent les canines, les molaires et les incisives aumaxillaire, et les incisives, les canines et les molairesà la mandibule. Il n'y a pas de différence entre lessites d'église et les sites de plein champ. Seul le sitede Venerque offre une image totalement différente,avec une majorité d'atteintes sévères (55%). Ellestouchent au maxillaire les canines, les incisives et lesprémolaires, et à la mandibule les incisives et lescanines.
Comparaisons
Le nombre de sujets atteints par les parodontopa-thies semble plus important en milieu urbain qu'enmilieu rural (fig. 151). Toutefois, il faut être prudentcar peu de sites ont permis la comparaison, et uni-quement des sites d'églises, avec un nombre de
sujets atteints entre 50 et 70% (Chartres, Chalôn,Beaune, Seyssel ; Castex 1994), sauf un, St-Martin-de-Cognac (34%) (Sansilbano-Collilieux 1994). Leshommes sont en règle générale plus touchés que lesfemmes, mais la différence n’est pas significative.
Le nombre de dents atteintes est important, encomparaison avec 4 sites ruraux lorrains, de pleinchamp, dont le pourcentage de dents atteintes deparodontopathies est de 35% environ (Vidal, 1999).De même, le degré de gravité est nettement infé-rieur, puisque près de 90% des dents ont une
181 État sanitaire : la paléopathologie bucco-dentaireAguerre M., Gaury P., Sainte-Marie S., Morel L.,
Crubézy E.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 149b : Indice parodontal moyen à la mandibule, selon les dents et les sites.
SBC, St-Bertrand ; LVE, Lunel-Viel l’Église ; LVH, Lunel-Viel Les Horts ; VEN, Venerque ; SBCa, St-Brice de Cassan.
Figure 150 : Atteinte parodontale selon les dents
et les sites.
SBC, St-Bertrand ; LVE, Lunel-Viel l’Église ; LVH,
Lunel-Viel Les Horts ; VEN, Venerque ; SBCa, St-
Brice de Cassan.
sites D38 D37 D36 D35 D34 D33 D32 D31 D41 D42 D43 D44 D45 D46 D47 D48
SBC 2 2,2 2,3 1,4 1,5 1,4 1,9 2,5 2,3 2,3 1,8 1,8 1,7 2 1,9 2,1
LVE 2,1 1,6 1,5 1,5 1,3 1,6 1,9 1,7 1,8 1,9 1,8 1,6 1,5 1,8 1,9 1,5
LVH 2,3 2,4 2 2 2,1 2,1 2,8 2,8 3,3 2,8 2,4 2,4 2,4 1,8 2,1 2
VEN 2,2 2,5 2,2 2,1 2,5 3,1 3 3,1 3,3 3,1 3 2,4 1,9 1,8 1,6 2,4
SBca 1,7 1,9 1,9 1,6 1,9 1,9 2 1,9 1,7 1,8 2 1,8 1,7 1,8 1,8 1,6
atteinte normale moyenne sévère dents
(cl.0-1) (cl.2) (cl.3-4)
SBC 23 57 20 C, M=I
LVE 30 57 13 I=M
VEN 18 27 55 C=I
LVH 20 47 33 M=I
SBCa 29 61 10 I=M=C
atteinte normale (dont 65% même aucune atteinte),principalement aux molaires et prémolaires, etmoins de 5% ont une atteinte sévère, qui touche lesincisives et les canines ou les prémolaires. Quantaux sites urbains, essentiellement avec des églises,ils montrent une atteinte sévère plus importante parrapport à nos sites, en moyenne 40%.
VII. 4. Étude du tartre
Avant tout, il faut noter un biais important danscette étude : le lavage des dents et les différentesmanipulations sont une source importante de pertesd’informations, notamment à Venerque. Nous trou-vons une étrange corrélation concernant les sites deVenerque et Lunel-Viel Les Horts où les inhuma-tions sont en pleine terre et en dehors des villes, etpour lesquels les pertes d’informations sont impor-
tantes (près de 70%) (fig. 152). C’est l’inverse pourSaint-Bertrand-de-Comminges et Lunel-Viel l’Église(entre 5 et 10%). On peut alors émettre l’importancetopographique de la nécropole : la proximité del’édifice religieux associée à une différence dans lesterres de remblai paraissent plus conservatricespour les informations tartriques.
Tous les sujets, quelque soit le site étudié, ontprésenté au moins une dent avec du tartre. Cepen-dant, les sites de Venerque et de Lunel-Viel les Hortsne présentaient qu’un tiers de leur effectif, en raisondes nombreuses pertes post mortem. La proportionde dents atteintes est alors très variable selon lessites entre 15 et 79%. Pour le site de l’Isle-Jourdain,seuls trois cas de dépôts tartriques importants etintéressant la totalité de l’arcade mandibulaire sontobservés, soit 1,5%.
182Sous la direction de S. Duchesne et É. CrubezyAguerre M., Gaury P., Sainte-Marie S., Morel L.,
Crubézy E.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 151 : Atteinte parodontale des nécropoles de la même époque utilisées pour comparaisons.
SBC, St-Bertrand ; LVE, Lunel-Viel l’Eglise ; LVH, Lunel-Viel Les Horts ; VEN, Venerque ; SBCa, St-Brice de Cassan.
Figure 152 : Nombre de sujets et de dents atteints de tartre selon les sites.
SBC, St-Bertrand ; LVE, Lunel-Viel l’Église ; LVH, Lunel-Viel Les Horts ; VEN, Venerque ; SBCa, St-Brice de Cassan.
sites références datation milieu église atteinte normale atteinte moyenne atteinte sévère
St Martin Sansilbano VII-VIIIe urbain oui
de Cognac Collilieux 1994
Chartres Castex 1994 IV-Ve urbain ? 21 33 46
Chalôn Castex 1994 V-VIe urbain oui 59 24 18
Beaune Castex 1994 IV-VIe urbain oui 29 23 52
moyenne 36 27 39
Ennery Vidal 1999 VI-VIIe rural non 88 9 3
Chatel Vidal 1999 VI-VIIe rural non 89 7 4
Raucourt Vidal 1999 VIIe rural non 89 8 3
Nomexy Vidal 1999 VIIIe rural non 89 7 4
Seyssel Castex 1994 V-VIIe rural oui 29 29 41
moyenne 77 12 11
SBC V-IXe urbain oui 23 57 20
LVE VI-IXe urbain oui 31 57 12
VEN VI-VIIe rural non 18 27 55
LVH VI-VIIIe rural non 20 47 33
SBCa VII-XIIIe rural ? 29 61 10
sites perte infos % n sujets % n dents %
SBC 2/39 5 37/37 100 76/492 15
LVE 3/35 9 32/32 100 340/429 79
VEN 27/40 68 13/13 100 110/278 40
LVH 40/58 69 18/18 100 139/230 60
SBCa 607/840 72
Les indices de tartre sont importants pour lessecteurs molaires supérieurs et incisivo-caninsinférieurs (fig. 153 et 154), dans les sites d'églisecomme dans les sites de plein champ. Les odonto-logistes connaissent bien ces localisations puisquel’arrivée du flot salivaire sous-maxillaire et sublin-gual se fait au voisinage des faces vestibulaires desmolaires supérieures et des faces linguales des inci-sives inférieures.
Les indices progressent avec l’âge, les taux lesplus forts se trouvant chez les adultes de plus de 30ans. Toutefois, à Saint-Bertrand-de-Comminges
(Sp.2370-2542) et à Lunel-Viel l’Église (Sp.56-60),certains jeunes adultes ont un indice tartrique élevé.Deux hypothèses peuvent être évoquées : soit unbiais concernant l’âge, soit une production réelle-ment excessive de tartre, qui peut être d’originephysiologique (mastication et salivation impor-tantes), pathologique (diabète), ou bien issus de tics,type succion (pouce ou autre).
Les indices tartriques sont variables selon lesexe. En effet, à Saint-Bertrand-de-Comminges, leshommes présentent plus de tartre que les femmes,aussi bien à la mandibule qu’au maxillaire. L’hypo-
183 État sanitaire : la paléopathologie bucco-dentaireAguerre M., Gaury P., Sainte-Marie S., Morel L.,
Crubézy E.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 153a : Indices de tartre au maxillaire, selon
les dents et les sites.
Figure 154a : Indices de tartre au maxillaire, selon les dents et les sites.
SBC, St-Bertrand ; LVE, Lunel-Viel l’Eglise ; LVH, Lunel-Viel Les Horts ; VEN, Venerque ; SBCa, St-Brice de Cassan.
Figure 153b : Indices de tartre à la mandibule,
selon les dents et les sites.
SBC, St-Bertrand ; LVE, Lunel-Viel l’Église ; LVH, Lunel-Viel Les Horts ; VEN, Venerque ; SBCa, St-Brice de Cassan.
maxillaire I C P M total
SBC 4,6 4,2 5,2 5,6 5,1
LVE 4,3 4,6 4,4 5,3 4,7
LVH 2,1 2,1 2,8 4,1 3
VEN 1,9 1,3 1,7 3,1 2,2
SBca 3,1 3,5 3,5 3,5 3,4
total 3,2 3,1 3,5 4,4 3,7
mandibule I C P M total
SBC 7,1 6 5,2 5,7 6
LVE 5,7 5,2 5,1 5,7 5,5
LVH 3,8 4,8 3,4 4,4 4
VEN 4,1 3,4 3,3 3,1 3,4
SBca 6,2 5,2 4,5 4,3 4,9
total 5,4 4,9 4,3 4,6 4,8
sites D18 D17 D16 D15 D14 D13 D12 D11 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28
SBC 3,9 5,1 7,6 5,2 5 3,9 4,4 4,6 4,6 4,8 4,4 5,8 4,6 6,6 5,8 4,8
Vén 2 2,3 4 2,4 1,3 1 1 2,1 1 3,5 1,6 1,3 1,9 3,5 3,7
LVE 5,7 5,5 5,2 4 4,5 4,4 3,3 3 5,4 5,3 4,8 5 4,2 5 5,7 4,4
LVH 4 3 3,8 2,2 3,2 2,8 1,9 2,1 2,2 2,1 1,4 3,8 1,9 3,6 3,8 6,5
SBca 3,5 3,3 4,2 4 3,9 3,3 2,9 3,1 3,5 3 3,7 2,7 3,2 3,9 3,7 2,4
thèse d’une physiologie salivaire différente chez leshommes et les femmes, avancée pour Saint-Ber-trand, est abandonnée. En effet, sur le site de Saint-Brice-de-Cassan, les femmes ont plus de tartre queles hommes à la fois au maxillaire et à la mandibule.
Comparaisons
Tous les sujets étudiés présentent du tartre sur leursdents. Le pourcentage de dents atteintes dans lessites étudiés entre dans la variabilité rencontréedans les autres populations (de 30 à 70%) (fig. 155),que ce soit dans les sites d'églises ou dans les sites deplein champ, à l’exception de Saint-Bertrand-de-Comminges (15%). Toutefois, il ne faut pas oublierque ces fréquences sont extrêmement variables carelles dépendent du degré de conservation du tartre.De même, la plupart du temps, les hommes ou lesfemmes sont atteints de manière plus élevée, maisrarement de manière significative. Ainsi, seule uneétude de tartre réalisée sur un grand nombre de sitespourrait peut-être apporter des éclaircissementsquant aux différences rencontrées ici.
Quelque soit le site, avec église ou de pleinchamp, la localisation est sensiblement identique,plus à la mandibule qu'au maxillaire, respective-ment aux incisives et aux molaires, du fait de leurproximité des canaux excréteurs.
Le degré de tartre est faible dans la majoritédes cas, contrairement à ce qui est observé dans noséchantillons, où 20 à 30% des dents (Venerque etSaint-Brice-de-Cassan) présentent un taux de tartreélevé (fig. 156). Toutefois, il se rencontre aussi dansquelques sites, comme à Châlon, nécropole urbainedu V-VIe siècle (Castex 1994), ou à Montataire,nécropole rurale du V-VIIe siècles, où il est indiquéun dépôt tartrique abondant (Decormelle-Patin et al1999).
Ce degré de tartre élevé signifie qu'il ne pro-vient pas seulement du flux salivaire (tartre sus-gin-gival) mais aussi du fluide gingival, épanchementinflammatoire (tartre sous-gingival). Le tartreconstitue alors un élément primordial dans l'appari-tion et l'aggravation des maladies parodontales(Vidal 1999).
184Sous la direction de S. Duchesne et É. CrubezyAguerre M., Gaury P., Sainte-Marie S., Morel L.,
Crubézy E.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 154b : Indices de tartre à la mandibule, selon les dents et les sites.
SBC, St-Bertrand ; LVE, Lunel-Viel l’Eglise ; LVH, Lunel-Viel Les Horts ; VEN, Venerque ; SBCa, St-Brice de Cassan.
sites D38 D37 D36 D35 D34 D33 D32 D31 D41 D42 D43 D44 D45 D46 D47 D48
SBC 4,4 5,3 5,3 4,8 5,6 6 6,8 7,4 7,2 7,1 5,9 5,8 4,4 6,3 6,1 6,9
Vén 2,7 3,8 3,8 3 3,9 3,5 3,7 4,2 4,1 4,5 3,2 3,3 2,8 1,5 2,8 4
LVE 5 4,9 6 5 5,3 5 6 4,6 6,3 5,7 5,3 5,3 4,9 6,2 6,3 5,5
LVH 5,3 3,8 4,2 2,8 4,1 4,5 6 4 2,3 3 5,1 3,8 2,7 4,1 3,9 5
SBca 3,6 4,2 5,7 4,2 4,6 5,2 5,8 6,4 6,8 5,8 5,1 4,7 4,5 4,6 4,4 3,2
VII. 5. Étude des usures dentaires
Tous les sujets, ainsi que toutes les dents, présententune usure dentaire (fig. 157). Seuls un individu, unjeune adulte et quelques dents n’ont pas d’usure,représentant une infime proportion des échantillonsétudiés.
La répartition des stades d’usure est identiquequelque soit le site, d’église ou de plein champ, avec25-30% d’usure normale et 10-15% d’usure pronon-cée, sauf Saint-Brice-de-Cassan avec 25% (fig. 158).L’usure moyenne, non excessive (dentine partielle-ment mise à nue, les cuspides sont usées), est doncmajoritaire, avec 50-65% des dents atteintes.
L’indice individuel est compris pour tous lessites entre 1,7 et 1,9, indice d’usure significatif.
Les dents mandibulaires sont plus usées queles dents maxillaires. De manière générale, legroupe incisivo-canin et les molaires, notammentles premières, sont les plus atteints (fig. 159 et 160).
L’indice d’usure ne montre pas de différencesignificative entre les populations masculine etféminine, sauf dans le cas de Saint-Brice-de-Cassan.En effet, les dents féminines sont plus usées quecelles des hommes, pour chaque degré d’usure ;c’est au niveau de l’usure 5 (débris radiculaires) quecette supériorité est la plus marquée (fig. 161).
185 État sanitaire : la paléopathologie bucco-dentaireAguerre M., Gaury P., Sainte-Marie S., Morel L.,
Crubézy E.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 155 : Nombre de sujets et de dents atteints de tartre dans les nécropoles de la même époque
utilisées pour comparaisons.
Figure 156 : Degré de tartre selon les nécropoles
utilisées pour comparaisons.
VEN, Venerque ; SBCa, St-Brice de Cassan.
sites références datation milieu église sujets atteints % dents atteintes %
Goudelancourt Nice 1994 VI-VIIe rural non 55
Seyssel Castex 1994 V-VIIe rural oui 35
Ennery Vidal 1999 VI-VIIe rural non 60
Chatel Vidal 1999 VI-VIIe rural non 33
Raucourt Vidal 1999 VIIe rural non 32
Nomexy Vidal 1999 VIIIe rural non 28
Chartres Castex 1994 IV-Ve urbain ? 30
Chalôn Castex 1994 V-VIe urbain oui 47
Beaune Castex 1994 IV-VIe urbain oui 49
Beauvais Bouali, Vattéoni 1991 IV-Ve urbain non 73
Vaison Bouali, Vattéoni 1991 V-VIe urbain non 45
tartre % N faible moyen élevé
Ennery 551 97 3 0
Chatel 710 94 5 1
Raucourt 515 93 7 0
Nomexy 641 97 2 0
Chartres 58 35 7
Chalôn 50 31 19
Seyssel 80 10 10
Beaune 76 18 6
Beauvais 80 14 7
Vaison 87 12 1
VEN 272 60 20 20
SBCa 840 28 36 36 usures sujets dents
n % n %
SBC 39/39 100 507/510 99
LVE 35/35 100
VEN 40/40 100 519/520 100
LVH 57/58 98
SBCa 1930/1949 99
Figure 157 : Nombre de sujets et de dents atteints
d’usure dentaire selon les sites.
SBC, St-Bertrand ; LVE, Lunel-Viel l’Église ; LVH,
Lunel-Viel Les Horts ; VEN, Venerque ; SBCa, St-
Brice de Cassan.
Les degrés d’usure à Saint-Brice-de-Cassan etSaint-Bertrand-de-Comminges (notamment desincisives) sont globalement supérieurs à ceux desautres nécropoles. Deux hypothèses peuvent êtreavancées :
soit l’âge des sujets. Globalement la populationadulte possède un coefficient d’usure plus impor-tant. Toutefois, l'étude du recrutement a montré des
186Sous la direction de S. Duchesne et É. CrubezyAguerre M., Gaury P., Sainte-Marie S., Morel L.,
Crubézy E.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 158 : Répartition des stades d’usure dentaire selon les sites.
SBC, St-Bertrand ; LVE, Lunel-Viel l’Église ; LVH, Lunel-Viel Les Horts ; VEN, Venerque ; SBCa, St-Brice de Cassan.
Figure 159a : Indices d’usure selon les dents
maxillaires et les sites.
Figure 159b : Indices d’usure selon les dents man-
dibulaires et les sites.
Figure 160a : Indices d’usure selon les dents maxillaires et les sites.
SBC, St-Bertrand ; LVE, Lunel-Viel l’Eglise ; LVH, Lunel-Viel Les Horts ; VEN, Venerque ; SBCa, St-Brice de Cassan.
SBC, St-Bertrand ; LVE, Lunel-Viel l’Église ; LVH, Lunel-Viel Les Horts ; VEN, Venerque ; SBCa, St-Brice de Cassan.
sites milieu indice individuel att. normale att. moyenne att. sévère
st 0-1 st 2 st 3-4
SBC urbain 1,9 26 59 15
LVE urbain 1,7 25 64 10
moyenne urbain 1,8 26 62 13
VEN rural 1,9 32 54 14
LVH rural 1,9 25 65 9
SBCa rural 27 49 25
moyenne rural 1,9 28 56 16
maxillaire I C P M total
SBC 2,6 2 1,7 1,4 1,8
LVE 2 2,1 1,7 1,4 1,7
LVH 1,9 1,8 1,3 1,2 1,5
VEN 2 1,9 1,7 1,4 1,7
SBca 2,3 2,3 2,2 1,7 2
total 2,1 2 1,7 1,4 1,7
mandibule I C P M total
SBC 2 1,8 1,7 1,7 1,8
LVE 1,9 1,8 1,8 1,6 1,7
LVH 1,8 1,7 1,5 1,4 1,5
VEN 2 1,9 1,5 1,6 1,7
SBca 2 2,2 1,9 2 2
total 1,9 1,9 1,7 1,7 1,8
sites D18 D17 D16 D15 D14 D13 D12 D11 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28
SBC 1,1 1 2,2 1,8 1,6 2,1 2,6 2,9 3,1 1,8 1,9 1,7 1,6 1,7 1,3 0,9
VEN 0,8 1,4 2 1,6 1,7 2,1 2 2,3 2,1 1,5 2 1,8 1,8 1,9 1,2 0,8
LVE 0,6 1,2 1,6 1,5 1,3 1,9 1,9 2 1,7 2 1,6 1,2 1,3 1,6 1,3 0,7
LVH 0,7 1,5 1,8 1,5 1,8 1,7 1,7 2,3 2,3 1,5 2 1,6 1,9 2 1,5 1
SBca 1,3 1,7 2,1 2,1 2,3 2,2 2,3 2,3 2,3 2,1 2,3 2,1 2,1 2,3 1,8 1,2
populations plutôt jeunes et on remarque à Saint-Bertrand-de-Comminges que les adolescents ont uncoefficient d’usure significatif (entre 1,5 et 2),presque dans la moyenne des adultes. Les mêmesconstatations peuvent être faites pour Venerque etLunel-Viel l’Église, avec cependant des valeursatteignant la moyenne des adultes.
soit par un régime alimentaire dur, abrasif, lié àdes habitudes alimentaires particulières. Le fait queces deux sites, Saint-Brice-de-Cassan et Saint-Ber-trand-de-Comminges, appartiennent à la même airegéographique, à l’ouest de Toulouse, aurait pu ame-ner à des causes similaires, tel le régime alimentaire,propices à un degré d’usure supérieur à ceux desautres nécropoles (notamment Lunel-Viel). L'at-teinte déjà prononcée à l'adolescence, dans certainssites, laisse supposer une alimentation dure et abra-sive dès la petite enfance.
Ainsi, la seconde hypothèse semble la plusprobable ; toutefois, nous ne pourrions affiner cetteconclusion qu’avec une étude historique et archéolo-gique plus poussée de ces nécropoles. Nous connais-sons les écrits de Grégoire de Tours nous donnantune connaissance des habitudes alimentaires de laGaule mérovingienne, à savoir une consommationde pain et de légumes. Les repas de fête mettaient surles tables poulets et poissons. Les familles les plusaisées mangeaient de la viande et des fromages.
Les études de palynologie, de carpologie,d’anthracologie ont identifié l’utilisation de céréales(blé, orge, avoine, seigle, millet), de légumineuses(fèves, pois secs, lentilles) et de fruits frais (pommes,poires, pêches). A défaut d’autre étiologie, nouspouvons penser que les aliments pouvaient avoirdes propriétés abrasives, notamment par des pâtes àpain mêlées à des éléments d’usure de la meule,cause généralement évoquée dans la littérature.
187 État sanitaire : la paléopathologie bucco-dentaireAguerre M., Gaury P., Sainte-Marie S., Morel L.,
Crubézy E.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 160b : Indices d’usure selon les dents mandibulaires et les sites.
SBC, St-Bertrand ; LVE, Lunel-Viel l’Eglise ; LVH, Lunel-Viel Les Horts ; VEN, Venerque ; SBCa, St-Brice de Cassan.
Figure 161 : Répartition en % de chaque degré d’usure selon le sexe, Saint-Brice-de-Cassan (SBCa).
sites D38 D37 D36 D35 D34 D33 D32 D31 D41 D42 D43 D44 D45 D46 D47 D48
SBC 1,1 1,5 2,1 1,2 1,6 1,8 1,9 2,2 1,9 1,9 1,8 2,1 1,8 2 1,8 1,7
VEN 1,4 1,7 1,7 1,8 1,6 1,8 2 2 2 1,7 1,8 1,7 1,9 1,8 1,6 1,3
LVE 1,1 1,6 1,8 1,4 1,6 1,8 1,7 1,6 1,9 1,9 1,5 1,4 1,5 1,6 1,2 0,8
LVH 1,5 1,3 1,8 1,3 1,7 1,8 2 2,2 2,1 1,8 1,9 1,6 1,5 2 1,8 1,3
SBca 1,9 1,9 2,4 1,9 1,9 2,1 2 2 2,1 2 2,2 1,9 1,9 2,4 1,9 1,7
SBca usu0 usu1 usu2 usu3 usu4 usu5
M 50 48 36 32 36 25
F 50 52 64 68 64 75
Comparaisons
Dans les sites étudiés, l'usure dentaire semblehomogène, quelque soit le site, avec ou sans édifiereligieux, à la ville ou à la campagne, à l'exceptionde Saint-Brice-de-Cassan. Au contraire, lors descomparaisons, des différences s’expriment entre lessites d’église ou de plein champ, et non pas entre lessites urbains et ruraux (fig. 162). En effet, la distri-bution des usures est plus prononcée dans les sitesecclésiaux avec une majorité des atteintes modé-rées/sévères que dans les sites de plein champ.Dans ce cadre, le site de Saint-Brice-de-Cassan s'in-tègre bien à la variabilité observée dans les sitesecclésiaux français puisque 25% des dents ont uneatteinte sévère.
Les dents les plus atteintes sont celles que l’onobserve en général, les incisives, les canines et lespremières molaires. Cette répartition traduit la pertede la fonction sécante et l 'ordre d'éruption.
En règle générale, les hommes et les femmessont touchés de façon quasiment identique ; peu desites révèle une différence, Saint-Brice-de-Cassan enfaveur des femmes, Beaune en faveur des hommes(Castex 1994).
VII. 6. Étudedes atteintes apicales osseuses
Pour le site de Saint-Brice-de-Cassan, l’étude a portésur un effectif de 635 dents maxillaires et 1026 dentsmandibulaires, soit respectivement 17 et 29% deseffectifs totaux.
Les atteintes osseuses apicales sont plus fré-quentes au maxillaire (9%) qu’à la mandibule (3%),bien que leur nombre soit infime. Elles touchent lesprémolaires et les molaires. Les atteintes péri-api-cales montrent une distribution plus fréquente aumaxillaire, intéressant les prémolaires (13%).Aucune préférence masculine ou féminine n’estapparue pour cette étude.
Pour le site de l’Isle-Jourdain, 18 cas présen-tent un kyste radiculo-dentaire, soit 10% des mandi-bules (Barthélémy et al 1999).
VII. 7. Étude des hypoplasies linéairesde l’émail dentaire
VII. 7.1. Analyse des populations
* en fonction du nombre de sujets.
Si l’on considère l’âge des sujets, 57% des adultesont des hypoplasies, 86% des adolescents, et seule-ment 36% des enfants (figure 163). Il est logique detrouver une assez faible proportion d’hypoplasiesparmi le groupe des enfants, puisqu’il n’y en avaitaucune sur les dents déciduales. De plus, l’ensembledes couronnes (sauf celles des dents de sagesse) ontleur développement achevé à partir de 8 ans.
La liaison entre la population hypoplasiée etl’âge est très faible (coef. de Spearman R=0,254, pourune probabilité de 0,00026).
Les différences observées entre les sites ne sontpas significatives à l’exception de Saint-Bertrand-de-Comminges (coef. de Spearman R=0,437, pour uneprobabilité de 0,0019) où moins d’enfants sont tou-chés par rapport aux autres nécropoles (fig. 163).
Parmi les adultes, les sujets jeunes (20-29 ans)sont plus souvent touchés que les sujets matures (deplus de 30 ans) ( 83 contre 47%), quelque soit la nécro-pole. Cette différence est significative pour deux sitesseulement Lunel-Viel Les Horts et Venerque (fig. 164).
Plus de la moitié des individus sexés (Lunel-Viel l’Église, Saint-Bertrand-de-Comminges etVenerque) présentent des hypoplasies linéaires, soit53% (35/66). Elles touchent plus souvent les hommesque les femmes (58 contre 43%). Toutefois, cette diffé-rence n’est pas significative : la présence d’hypopla-sies n’est donc pas lié au sexe des individus.
Pour la nécropole de l’Isle-Jourdain, seuls lesadultes de plus de 30 ans ont été pris en compte, et98% en moyenne présentent au moins une caninehypoplasiée. Les hommes sont de manière généraleplus touchés que les femmes (Cheleux 2000).
* en fonction du nombre de dents.
Les sites présentant le plus de dents hypoplasiées,quelque soit la dent, sont Lunel-Viel l’Église etLunel-Viel les Horts, avec plus de 30% de dentsatteintes (fig. 165 et 166). Le site de Saint-Bertrand-de-Comminges est le moins touché.
188Sous la direction de S. Duchesne et É. CrubezyAguerre M., Gaury P., Sainte-Marie S., Morel L.,
Crubézy E.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
189 État sanitaire : la paléopathologie bucco-dentaireAguerre M., Gaury P., Sainte-Marie S., Morel L.,
Crubézy E.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 162 : Degré d’usure dentaire selon les nécropoles utilisées pour comparaisons.
Figure 163 : Répartition des sujets selon l’âge et les sites. (LHE, hypoplasie linéraire de l’émail dentaire)
SBC, St-Bertrand ; LVE, Lunel-Viel l’Église ; LVH, Lunel-Viel Les Horts ; VEN, Venerque.
Figure 164 : Répartition des adultes selon les sites. (LHE, hypoplasie linéraire de l’émail dentaire)
SBC, St-Bertrand ; LVE, Lunel-Viel l’Eglise ; LVH, Lunel-Viel Les Horts ; VEN, Venerque.
sites références datation milieu église att. normale att. moyenne att. sévère
Goudelancourt Nice 1994 VI-VIIe rural non puis maj enfin
Sublaines Cordier et al 1974 VI-VIIe rural non maj
St Vit Schweitzer et al 1988 VI-VIIe rural non 50 50
Ennery Vidal 1999 VI-VIIe rural non 53 42 4
Chatel Vidal 1999 VI-VIIe rural non 65 29 6
Raucourt Vidal 1999 VIIe rural non 68 26 6
Nomexy Vidal 1999 VIIIe rural non 69 28 3
moyenne 51 41 16
Chartres Castex 1994 IV-Ve urbain ? 60 40
Chalôn Castex 1994 V-VIe urbain oui 59 41
Beaune Castex 1994 IV-VIe urbain oui 84 16
Seyssel Castex 1994 V-VIIe rural oui 71 29
Giberville Martray Pilet et al 1990 VIe rural oui 54 19 28
Giberville Martray Pilet et al 1990 VII, rural oui 63 18 19
moyenne 20 52 29
sites LVE LVH SBC VEN Total %
adultes 28 48 35 36 147 73
adultes avec LEH 21 (75%) 30 (62%) 17 (48%) 16 (44%) 84 (57%)
adolescents 5 9 5 3 22 11
adol avec LEH 4 (80%) 8 (89%) 5 (100%) 2 (67%) 19 (86%)
enfants 2 11 8 12 33 16
enfants avec LEH 0 8 (73%) 1 (12%) 3 (25%) 12 (36%)
population totale 35 68 48 51 202 100
pop avec LEH 25 (71%) 46 (68%) 23 (48%) 21 (41%) 115 (57%)
sites LVE LVH SBC VEN Total
ad. jeunes 9 14 8 11 42
ad. jeunes avec LEH 8 (89%) 12 (86%) 6 (75%) 9 (82%) 35 (83%)
ad. matures 19 28 22 25 94
ad. matures avec LEH 13 (68%) 15 (54%) 9 (41%) 7 (28%) 44 (47%)
total 28 42 30 36 136
total avec LEH 21 27 15 16 79
Les dents les plus touchées sont la canine avec38% d’atteintes (avec en moyenne 1,6 hypoplasie),ensuite, c’est l’incisive, notamment latérale, avec23% (avec 1,55 hypoplasie), et enfin la 3e molaireavec 12% (avec 1 hypoplasie). Les canines maxil-laires et mandibulaires sont touchées dans lesmêmes proportions, respectivement 38,6 et 38%,
tandis que les incisives supérieures sont un peu plustouchées que les dents inférieures. Aucun côté pré-férentiel n’est atteint pour la canine, le côté droit estplus fréquent pour l’incisive et la 3e molaire.
Le nombre moyen d’hypoplasies, tous typesde dents confondus, est de 1,5. Les plus élevés sontceux des nécropoles de Lunel-Viel (l’Église et LesHorts), ces résultats se retrouvant pour chaque typede dents (canine, incisive et 3e molaire) (fig. 167).
Les atteintes majoritaires sont les hypoplasiessimples dans 87% des cas pour la canine et 60% pourl’incisive.
La forme la plus fréquente est la forme 2,hypoplasie linéaire faiblement marquée (sillon peuprofond et mince, mais très net et se distinguant àl’œil nu). Cependant, quelques canines présentent
une forme 5, en gradins : elles proviennent prati-quement toutes d’un même sujet (4/6), issu de lanécropole de Venerque, qui présente 55% de soneffectif (16/29) touché par des hypoplasies forte-ment marquées (aucune très faiblement marquéen’a été relevée). La nécropole des Horts se rapprochede ce site. A l’opposé, les nécropoles de Saint-Ber-trand-de-Comminges et de Lunel-Viel l’Église ontune majorité d’hypoplasies faiblement marquées,deux tiers pour le premier site et 56% pour le second.Deux incisives ont des hypoplasies dites « com-plexes », de forme 10 : il s’agit d’un grand nombred’hypoplasies présentes sur une hauteur bien pré-cise de la dent.
190Sous la direction de S. Duchesne et É. CrubezyAguerre M., Gaury P., Sainte-Marie S., Morel L.,
Crubézy E.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
sites LVE LVH SBC VEN Total
C avec LEH (n) 45 60 18 31 154
(%) 59 48 22 26 38
I avec LEH (n) 24 82 6 38 150
(%) 25 36 5 18 23
M3 avec LEH (n) 16 2 12 6 36
M3 (%) 27 2 18 7 12
total (n) 85 144 36 75 340
total (%) 37 33 13 18 25
sites LVE LVH SBC VEN
canine 59 48 22 26
incisive 25 36 5 18
3e molaire 27 2 18 7
Figure 165 : Répartition des dents hypoplasiées selon le type de dents et les sites. (C, canine, I, incisive,
M3, 3e molaire).
SBC, St-Bertrand ; LVE, Lunel-Viel l’Église ; LVH, Lunel-Viel Les Horts ; VEN, Venerque.
Figure 166 : Répartition des dents hypoplasiées selon les sites.
SBC, St-Bertrand ; LVE, Lunel-Viel l’Église ; LVH, Lunel-Viel Les Horts ; VEN, Venerque.
VII. 7.2. Analyse du stress
* Nombre de stress par sujets
Pour effectuer cette analyse, nous nous sommesbasés sur toute la denture. Le nombre de stress parsujet a pu être déterminé pour 113 individus sur untotal de 115 sujets. Le nombre moyen de stress parsujet est de 2,7 pour l’ensemble des nécropoles (fig.168).
La majorité des sujets ont un ou 2 stress, avecrespectivement 26% et 28% de l’effectif total. Lenombre maximal de stress par individu est de 8 pourl’ensemble des nécropoles, et ne concerne que deuxsujets ; seulement 4 individus ont plus de 5 stress.
La nécropole de Lunel-Viel l’Eglise est de loinla plus touchée avec en moyenne 4 stress par indi-vidu, 3 sujets présentent plus de 5 stress. La nécro-pole la moins touchée est Saint-Bertrand-de-Com-minges avec seulement 2 stress en moyenne parsujet ; aucun sujet ne présente plus de 5 stress.
Pour le site de La Gravette à l’Isle-Jourdain, lenombre moyen est aussi élevé avec 5 hypoplasiespour les canines supérieures et de 4 pour les caninesinférieures (Cheleux 2000), pour 142 adultes de plusde 30 ans.
* Intensité du stress
Afin de calculer l’intensité du stress, seuls les sujetsprésentant au moins 3 dents hypoplasiées ont étépris en compte ; par conséquent la population deréférence n’est constitué que de 73 sujets (fig. 169).
Le stress de degré 1, c’est-à-dire une seule denttouchée, est le plus souvent représenté, avec les troisquart de la population (fig. 170 et 171). 62% dessujets ont un stress important (45 sujets), 52% dessujets un stress très important (38 sujets), et seule-ment 6% des sujets un stress total, càd. de degré 4(plus de 6 dents touchées) (4 sujets).
La nécropole de Lunel-Viel l’Église a la plusforte proportion de sujets ayant un stress de degré 1ou un stress important. Ensuite, les sujets ayant unstress très important proviennent des nécropoles deVenerque et de Lunel-Viel l’Église. Enfin, les sujetsayant un stress total sont issus des nécropoles deVenerque et de Lunel-Viel Les Horts ; la nécropolede Saint-Bertrand-de-Comminges est dépourvue desujets ayant un stress total.
* Corrélation entre les dents hypoplasiées.
Dans cette analyse, nous nous sommes restreintsaux canines et aux incisives. Afin d’estimer la corré-lation entre les dents hypoplasiées, nous avons uti-lisé le coefficient de corrélation de Spearman. Deuxtypes de liaisons entre les dents ont été étudiés :
191 État sanitaire : la paléopathologie bucco-dentaireAguerre M., Gaury P., Sainte-Marie S., Morel L.,
Crubézy E.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
n hypo (%) LVE LVH SBC VEN Total
canine 1,8 1,6 1,5 1,3 1,6
incisive 1,9 1,6 1 1,3 1,5
3e molaire 1,1 1 1 1 1
total 1,7 1,6 1,3 1,3 1,5
sites N moy. méd. somme mini maxi
LVE 23 4,04 4 93 1 8
LVH 46 2,37 2 109 1 5
SBC 23 2 2 46 1 5
VEN 21 2,71 2 57 1 8
total 113 2,69 2 305 1 8
Figure 167 : Répartition du nombre moyen d’hypoplasies selon le type de dents et les sites.
(nhypo, nombre d’hypoplasies).
SBC, St-Bertrand ; LVE, Lunel-Viel l’Église ; LVH, Lunel-Viel Les Horts ; VEN, Venerque.
Figure 168 : Statistiques descriptives de la variable nombre de stress par sujet pour chaque nécropole.
SBC, St-Bertrand ; LVE, Lunel-Viel l’Église ; LVH, Lunel-Viel Les Horts ; VEN, Venerque.
les liaisons d’ordre général : le fait qu’une caninesoit hypoplasiée implique-t-il que la canine contro-latérale (par exemple) le soit également ?
les liaisons de 1er ordre, au sujet de la forme deshypoplasies : y a-t-il une correspondance dans lenombre d’hypoplasies et dans la nature du défautde l’émail, dans le cas d’un défaut autre qu’unehypoplasie ?
Corrélations entre les canines
Pour les liaisons d’ordre général, seules les deuxcanines supérieures (13 et 23) sont fortement corré-lées entre elles (p=0.000, R=0,9), ceci pour toutes lesnécropoles.
Pour les liaisons de 1er ordre, les corrélationsentre les canines sont plus fortes que les liaisonsd’ordre général.
La corrélation la plus forte s’observe toujoursentre les deux canines supérieures, plus prononcéeavec ces liaisons (R=0,946). Par conséquent, dans le
192Sous la direction de S. Duchesne et É. CrubezyAguerre M., Gaury P., Sainte-Marie S., Morel L.,
Crubézy E.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 169 : Répartition des effectifs pour l’étude de l’intensité du stress selon les sites.
SBC, St-Bertrand ; LVE, Lunel-Viel l’Église ; LVH, Lunel-Viel Les Horts ; VEN, Venerque.
Figure 171 : Répartition des stress selon leur intensité et les sites (en %).
SBC, St-Bertrand ; LVE, Lunel-Viel l’Église ; LVH, Lunel-Viel Les Horts ; VEN, Venerque.
Figure 170 : Répartition des stress selon leur intensité et les sites (en %).
SBC, St-Bertrand ; LVE, Lunel-Viel l’Église ; LVH, Lunel-Viel Les Horts ; VEN, Venerque.
sites LVE LVH SBC VEN total
n 21 27 11 14 73
stress LVE LVH SBC VEN
degré 1 90 56 73 86
important 81 56 55 50
très important 52 48 45 64
total 5 7 0 7
stress SBC LVE LVH VEN
degré 1 73 90 56 86
important 55 81 56 50
très important 45 52 48 64
total 0 5 7 7
cas des canines supérieures, nous pouvons parlerd’une forte correspondance entre ces deux caninespar rapport au nombre d’hypoplasies linéaires pardent, ainsi que pour les stress complexes et autresdéfauts de l’émail.
Corrélations entre les incisives
Seule la corrélation de 1er ordre entre les incisiveslatérales a été étudiée. Contrairement aux canines, lacorrélation la plus forte s’observe entre les deuxincisives inférieures (R=0,89).
Corrélations entre les canines et les incisives latérales
Pour les liaisons d’ordre général, les résultats nesont pas statistiquement significatifs pour les dentsinférieures (32-33 et 42-43). Les dents supérieuressont faiblement corrélées (12-13, R=0,37, et 22-23,R=0,39). Pour les liaisons de 1er ordre, le test estsignificatif seulement dans un cas : entre la canine etl’incisive droites. Toutefois, la corrélation entre cesdeux dents est faible.
Par conséquent, il n’existe pas de forte corres-pondance entre les incisives latérales et les caninesen ce qui concerne la présence ou l’absence d’hypo-plasie ou d’un autre défaut de l’émail, et le nombred’hypoplasies par dent.
* Age d’apparition du stress
L’âge d’apparition du stress a été étudié selon 5classes d’âge pour une population de 192 individus(fig. 172).
Les stress compris dans la classe 2 ; 4 ans sontnettement majoritaires, car ils regroupent 45% dessujets de l’ensemble des nécropoles. Les stress com-pris entre 4 et 6 ans est la seconde classe d’âge laplus fortement représentée avec 30% des individus.12% des sujets ont un stress (ou plus) apparu à la finde l’enfance. Les stress inférieurs à 2 ans et apparusentre 6 et 7 ans sont minoritaires au sein de la popu-lation étudiée (fig. 173 et 174).
Les stress apparus avant 2 ans sont sous-repré-sentés, notamment pour la nécropole de Saint-Ber-trand-de-Comminges. Les stress compris dans laclasse 2 ; 4 ans sont majoritaires pour toutes lesnécropoles à l’exception de Lunel-Viel l’Église.
La plus forte proportion de sujets ayant unstress apparu à la fin de l’enfance est la nécropole deSaint-Bertrand-de-Comminges (24%). Les sujets dela nécropole de Lunel-Viel Les Horts ont une trèsfaible proportion de stress apparus à partir de 6ans/6 ans et demi, voire une absence pour le site deLa Gravette à l’Isle-Jourdain.
VII. 7.3. Conclusions sur les hypoplasies
Dans les sites étudiés, 40 à 70% des sujets ont aumoins un défaut hypoplasique (fig. 175). Ces fré-quences, dans la variabilité des sites du haut MoyenAge, sont toutefois dans les limites supérieures de lavariation, notamment pour le milieu rural. Cela estvalable pour les adultes comme pour les enfants.
193 État sanitaire : la paléopathologie bucco-dentaireAguerre M., Gaury P., Sainte-Marie S., Morel L.,
Crubézy E.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 172 : Proportion des classes d’âge d’apparition du stress sur l’ensemble de la population.
Cl. âge (ans) 0,5 ; 2 2 ; 4 4 ; 6 6 ; 7 9 ; 12+ total
effectif 13 84 58 14 23 192
% 7 44 30 7 12 100
Cl. d'âge LVE LVH SBC VEN GRA Total
0,5 ; 2 3 (5%) 6 (10%) 1 (3%) 3 (8%) 345 (17%) 9
2 ; 4 19 (33%) 33 (55%) 15 (41%) 17 (45%) 1018 (51%) 45
4 ; 6 20 (35%) 17 (28%) 9 (24%) 12 (32%) 646 (32%) 30
6 ; 7 7 (12%) 2 (3%) 3 (8%) 2 (5%) 7
9/10 ; 12+ 8 (14%) 2 (3%) 9 (24%) 4 (11%) 13
Pop. réf. 57 60 37 38 2009
Figure 173 : Âge d’apparition du stress selon les classes d’âge et les sites.
SBC, St-Bertrand ; LVE, Lunel-Viel l’Église ; LVH, Lunel-Viel Les Horts ; VEN, Venerque ; GRA, La Gravette.
194Sous la direction de S. Duchesne et É. CrubezyAguerre M., Gaury P., Sainte-Marie S., Morel L.,
Crubézy E.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Figure 174 : Âge d’apparition du stress selon les classes d’âge et les sites.
SBC, St-Bertrand ; LVE, Lunel-Viel l’Eglise ; LVH, Lunel-Viel Les Horts ; VEN, Venerque ; GRA, La Gravette.
Figure 175 : Répartition du stress selon les nécropoles utilisées pour comparaisons.
Ad, adulte ; Im, immature.
Cl. d'âge LVE LVH SBC VEN GRA
0,5 ; 2 5 10 3 8 17
2 ; 4 33 55 41 45 51
4 ; 6 35 28 24 32 32
6 ; 7 12 3 8 5 à
9/10 ; 12+ 14 3 24 11 à
sites références datation milieu église pop % Ad % Im %
St Martin de Fontenay Pilet et al 1994 V-VIIe rural ? 0 0 0
Giberville Martray Pilet et al 1994 VI-VIIe rural oui 0 0 0
Goudelancourt Nice 1994 VI-VIIe rural non 17 18 13
Sannerville Lirose Pilet et al 1994 VI-VIIe rural 24
Alba Faure-Boucharlat, Ronco 1992 IV-Xe rural non 30
sites lorrains Vidal 1999 VI-VIIIe rural non 39 52 25-40
Seyssel Castex 1994 V-VIIe rural oui 40 56 24
moyenne rural 20 26 14
Blossac-Poitiers Sansilbano-Collilieux 1994 VII-Xe urbain non 15
Beauvais Bouali, Vattéoni 1991 IV-Ve urbain non 21 17 38
St Martin de Cognac Sansilbano-Collilieux 1994 VII-VIIIe urbain oui 28 21 43
Vaison Bouali, Vattéoni 1991 V-VIe urbain non 30 36 21
Baptistère -Poitiers Sansilbano-Collilieux 1994 IVe urbain 55
Beaune Castex 1994 IV-VIe urbain oui 62
Chartres Castex 1994 IV-Ve urbain ? 61 67 54
Chalôn Castex 1994 V-VIe urbain oui 86 85 87
moyenne urbain 47 43 49
Dans les sites étudiés, il n’y a pas de différence entreles sites d’église, urbains, et les sites de plein champ,ruraux81. Deux nécropoles se situent à l’opposél’une de l’autre :
Lunel-Viel l’Église est la nécropole comportantla plus forte proportion de sujets hypoplasiés avec71% de sa population, le plus grand nombre dedents hypoplasiées par sujet, (6,2), et une des plusgrandes intensités de stress (en moyenne 4 parsujet),
alors que Saint-Bertrand-de-Comminges amoins de la moitié de sa population hypoplasiée(48%), la plus faible proportion de dents hypopla-siées par sujet (3), et une faible intensité de stress (2par sujet). Ainsi, la nécropole de Saint-Bertrand-de-Comminges aurait un meilleur état sanitaire que lesautres nécropoles.
Les nécropoles de Lunel-Viel Les Horts et deVenerque se situent entre ces deux extrêmes. Mais ily a de fortes chances pour que les résultats obtenusdans cette étude soient inférieurs à la réalité. La rai-son essentielle est le mauvais état de conservationdes dents pour Venerque ; d’ailleurs il ne s’agit pasd’un hasard si les sujets hypoplasiés de Venerque neprésentent aucune hypoplasie faiblement marquée(forme 1). Il est fort probable que cette forme soitpassée inaperçue en raison de la transformation dela surface externe de l’émail.
Pour la nécropole des Horts il s’agirait princi-palement du petit effectif de dents conservées parindividu.
La nécropole de La Gravette à l’Isle-jourdainprésente une forte proportion de sujets hypoplasiéset la plus grande intensité de stress (avec 4 à 5 hypo-plasies par canines). Toutefois, il faut nuancer cesrésultats car seule une partie de la population, lesadultes de plus de 30 ans, et les canines ont étéprises en compte.
Les répartitions en fonction de l’âge ou dusexe ne montre pas de différence significative,comme ce qui est observé dans les autres nécropolesen France pour cette période.
Le nombre de stress par sujets est élevé (2,7).En effet, bien que la majorité des individus observésprésentent 1 ou 2 hypoplasies, nombreux sont ceuxqui présentent des atteintes multiples, supérieurs à3 hypoplasies (46%), pouvant aller jusqu’à 8 stress
(2%). De même, l’intensité du stress, le nombre dedents touchées, est élevée, puisque plus de la moitiéde sujets présentent un stress important ou trèsimportant. Les hypoplasies multiples attestentd’épisodes infectieux ou de malnutritions répétésvoire saisonniers (contraintes climatiques, Good-man et al 1980, cité par Vidal 1999).
L’âge d’apparition des hypoplasies est com-pris entre 2 et 4 ans essentiellement, et ensuite, entre4 et 6 ans. C’est une caractéristique que l’on retrouvedans d’autres populations, comme celles des siteslorrains du haut Moyen Age (Vidal 1999) ou celle deCanac dans l’Aveyron et celle de Saint-Etienne àToulouse, du Moyen Âge (du XI au XIIIe siècles).Cette recrudescence de stress, entre 2 et 4 ans est àmettre en relation avec « la crise du sevrage » (Cru-bézy et al 1998 ; Corruccini et al 1985 cité par Vidal1999), et cette classe d’âge constituerait une phasede transition par rapport à l’arrêt de l’allaitement.En effet, au haut Moyen Âge, la période d’allaite-ment se poursuit fréquemment jusqu’à 3 ans (Riché1966). Le passage d’une alimentation lactée à unealimentation solide conduit à des déséquilibresénergétiques, des carences protéiniques et/ou avita-minoses, dus à une insuffisance des apports nutri-tionnels quantitatifs et qualitatifs (Vidal 1999). Enoutre, l’alimentation de substitution est bien sou-vent identique à celle de l’adulte et ne bénéficienaturellement pas de la garantie de stérilité qu’offrele lait maternel. De ce fait, l’enfant sera plus vulné-rable à toutes sortes d’infections respiratoires oudigestives (diarrhées), infectieuses ou parasitaires,hématologiques qui affaibliront à leur tour le sys-tème immunitaire (Rose et al 1985 cité par Vidal1999).
VII. 8. Conclusionssur la paléopathologie bucco-dentaire
Les nécropoles étudiées présentent un état sanitairepassable au vu des atteintes bucco-dentaires. Bienque plus sévères, elles ne diffèrent en rien ni du hautMoyen Âge, ni de l’ère moderne.
Peu de différences sont observées entre les sitesd'église et les sites de plein champ. La nécropole deSaint-Bertrand-de-Comminges, la mieux conservée,montre un état sanitaire de la population apparem-
195 État sanitaire : la paléopathologie bucco-dentaireAguerre M., Gaury P., Sainte-Marie S., Morel L.,
Crubézy E.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
(81) Alors que dans les sites de comparaisons, il semble que les sites urbains aient une fréquence plus élevée que les sites ruraux.
ment meilleur que ne l’était celui des autres nécro-poles. L’état de conservation et les effectifs des sériessont peut-être à mettre en relation avec ce résultat.Toutes les pathologies bucco-dentaires sont liées àl’âge, l’atteinte est plus importante quand l’âge aug-mente. Par contre, la liaison au sexe est plus difficile àdéfinir, car elle est très variable d’un site à l’autre.
La pathologie carieuse est élevée dans cespopulations. Le manque d’hygiène par proliférationde la plaque bactérienne, l’alimentation glucidiquedont on sait d’après les écrits que les sucres sont pré-sents dans l’apport alimentaire depuis les Romains,et le terrain individuel plus ou moins dénutrie oucarencé au gré des conditions sociales et des possi-bilités de ravitaillement sont autant d’élémentsfavorables au développement de cette pathologie.Par ailleurs, la carie dentaire par ses complicationslocales, loco-régionales, ou générales, était un fac-teur important de stress, de douleurs, et de morbi-dité à une époque où l’antibiothérapie n’existait pas.
Les parodontopathies sont des pathologiesfréquentes au sein de ces populations, particulière-ment sur les populations adultes. Elles entraînentdes pertes significatives dentaires et par la suite unediminution du coefficient masticatoire. Elles sont lasource de pathologies associées générales : troublesdigestifs par manque de mastication, dénutritionpar douleurs et pertes de dents, et enfin, troubles del’articulation temporo-mandibulaire à cause desdésordres occlusaux consécutifs à la perte desorganes dentaires.
Les dépôts tartriques ont été notés sur des sec-teurs dentaires privilégiés, classiques en odontolo-gie. Cependant, du fait de leur importance, ils pro-viennent non seulement du flux salivaire maiségalement des épanchements inflammatoires dufluide gingival, et deviennent ainsi un élémentaggravant des maladies parodontales.
Les usures dentaires ont été relevées sur dessecteurs souvent touchés, les incisives, les canines etles premières molaires. Cette répartition traduit lafonctionnalité des dents et l'utilisation privilégiée dela fonction sécante au détriment des mouvementsde broyage, dans un premier temps. Elles présententaussi une proportion très élevée des atteintes
moyennes et sévères, qui se retrouvent uniquementà ce stade dans les bruxomanies ou dans des patho-logies neurologiques de notre époque. Le rôle del’alimentation est bien sûr en cause, malgré l’ab-sence d’éléments objectifs probants. En effet, l'évo-lution de l'usure dépend de l'action mécanique desaliments : des aliments durs et résistants produisentune attrition importante et inversement une alimen-tation molle, ne nécessitant pas un effort mastica-teur important, n'entraîne qu'une attrition légère82.
Les hypoplasies de l’émail dentaire ont étélocalisées uniquement sur la denture permanente,par conséquent elles ne sont pas dues à une infec-tion survenue lors de la grossesse. Seulement deuxformes ont été rencontrées, les hypoplasies linéaireset les hypoplasies en bande. Ainsi, elles ne peuventêtre dues à une malformation génétique (classéesdans les amélogénèses imparfaites, formes trèsrares). On serait donc tenter de conclure à descarences nutritionnelles. Dans les populationsactuelles dont le niveau sanitaire, le régime alimen-taire et l’état nutritionnel sont connus, les hypopla-sies ne sont pas dus à une forme aiguë de malnutri-tion, mais à une insuffisance marginale d’apports,des diarrhées au long cours, ou d’autres infectionschroniques, dans un contexte de pauvreté, confir-mant le lien entre hypoplasie et carences nutrition-nelles. Toutefois, elles ne sont pas responsables àelles seules de la présence des hypoplasies. En effet,leur étiologie relève d’un processus complexe formépar un ensemble de facteurs caractérisés par leursinteractions, comme le montrent les études cli-niques, épidémiologiques et expérimentales.
Comparaisons avec les textes
Les pathologies bucco-dentaires offre donc uneimage bien peu favorable de l'état sanitaire despopulations du sud-ouest au haut Moyen Âge. Eneffet, elles montrent des atteintes importantes pourtoutes les pathologies étudiées.
Cet état sanitaire défavorable pour les popula-tions du haut Moyen Age dans le sud-ouest de laFrance est à mettre en relation avec un régime ali-mentaire dur et abrasif, certainement dès l'enfance,des carences nutritionnelles et des épisodes infec-tieux répétés.
196Sous la direction de S. Duchesne et É. CrubezyAguerre M., Gaury P., Sainte-Marie S., Morel L.,
Crubézy E.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
(82) Bien entendu, il ne faut pas oublier que les facteurs anatomo-physiques comme le tonus musculaire, les défauts d'oc-clusion ainsi que les habitudes masticatoires entrent aussi en jeu (Vidal, 1999).
Les textes nous apportent très peu d'informa-tions sur le régime alimentaire et la préparation desaliments au haut Moyen Age. Il semble cependantque l'économie rurale de cette période soit essentiel-lement basée sur l'autosubsistance dont la culturecéréalière constitue la principale ressource. Lescéréales, consommées sous forme de pain confec-tionné à partir du froment et du seigle ou debouillies d'orge et d'avoine, constituent la base del'alimentation (Duby 1977 ; Le Goff 1989). Cettenourriture peu énergétique est complétée par deslégumineuses comme les fèves, les pois, des fruitssauvages ainsi que des glands et des baies cueillis enforêt (Fourquin 1989). La viande, rôtie, fumée oubouillie, accompagne le pain (Riché 1989).
La nourriture est principalement à base deféculents (légumineuses) et riche en amidon (pain).Ce régime alimentaire pauvre en sucre expliqueraitla fréquence relativement faible de la carie dentaire,les sucres métabolisés par les bactéries étant en faibleproportion ou facilement dilués par la salive. Cepen-dant, il existe une interaction entre la texture, la com-position chimique de l'alimentation et la fréquenced'exposition dentaire à une nourriture cariogène. Cetype d'alimentation est relativement adhérente, col-lante aux surfaces dentaires et difficilement éliminéepar la salive ou l'auto-nettoyage buccale. Son accu-mulation ainsi qu'une absence d'hygiène (nettoyagemécanique) entraîne une irritation des tissus gingi-vaux et donc une inflammation parodontale.
Outre ces facteurs extrinsèques, rappelonsl'importance des facteurs constitutionnels, indivi-duels ou collectifs, dans la susceptibilité de l'orga-nisme ainsi que sa capacité de défense face à certainsagents pathogènes.
197 État sanitaire : la paléopathologie bucco-dentaireAguerre M., Gaury P., Sainte-Marie S., Morel L.,
Crubézy E.
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Le monde des morts : permanences et évolutions
Dans le monde des morts, le recrutement, l’organisa-tion des espaces sépulcraux et les pratiques funé-raires témoignent de permanences, parfois modi-fiées par des apports nouveaux, qui peuvent être liésà l’influence de l’Église et au statut de ses édifices.
Recrutement
Les permanences rencontrées dans le cadre durecrutement sont la sous représentation des enfantsde moins de 5 ans, et la sur représentation desadultes jeunes, largement rencontrées dans de nom-breuses études de nécropoles et de cimetières. Tou-tefois, quelques changements peuvent être obser-vés. La présence plus fréquente des enfants âgés de0 à 4 ans, dans les sites dont la chronologie dépassele VIIIe siècle, peut être due à l’influence de l’Égliseet au statut accordé à l’enfant après cette date, mêmesi la proportion n’atteint pas encore la mortaliténaturelle. En effet, leur inhumation dans le cimetièreva progressivement devenir une pratique courante(Alduc-le-Bagousse, Pilet 1986 ; Alexandre-Bidon,Lett 1997), et cette évolution pourrait être le témoinde la christianisation en profondeur de la popula-tion et d’une reconnaissance sociale de l’enfant(Pilet et al 1992). Par ailleurs, la sur représentationdes adultes jeunes, plus prononcée en milieu urbain,confirme les différences de mortalité entre villes etcampagnes. Toutefois, cette majoration de jeunesadultes autour des églises concerne parfois davan-tage les hommes (Saint-Bertrand-de-Comminges,Vindrac) : elle est alors à mettre en relation avecl’Eglise et son personnel ecclésiastique (moines, etc),mais aussi son institution et les relations qu’elleentretenait avec les inhumés, soit économiques (sta-tut privilégié, notables) soit professionnelles (acti-vité professionnelle, ouvriers ; Buchet 1986).
Organisation
L’organisation des nécropoles et des cimetières étu-diés ne montre pas de structure immédiatement défi-nie, à l’exception de Venerque qui présente un sec-teur réservé aux enfants, et un autre aux femmes. Parailleurs, les sites de Venerque et Vindrac ont permisd’établir quelques liens de parenté sur la base de
caractères discrets, d’où la présence d’une compo-sante familiale dans l’organisation de ces nécropoles,un élément qui a sans doute toujours existé. Cepen-dant, d’autres composantes, comme pour les autresnécropoles, ont régi leur organisation interne ; il estaujourd’hui difficile de définir ces critères qui ontprévalu, la famille, l’alliance, ou la culture.
Pratiques funéraires
Les populations étudiées entrent bien dans le cadredes pratiques funéraires du haut Moyen Âge : outrela position générale du corps, en place depuis le IVe
siècle, avec les défunts inhumés sur le dos et dispo-sés globalement la tête à l’ouest, l’évolution consta-tée sur la position des membres et le dépôt funéraires’accorde bien avec ce qui a été maintenant observésur un très grand nombre de nécropoles en France.En effet, les membres supérieurs évoluent d’uneposition étendue vers une position haute à partir duVII-VIIIe siècle, et pour les membres inférieursd’une position écartée en faveur d’une position plusserrée. Il en va de même, pour le dépôt funéraire, oùla nature du mobilier change et où il diminue selonla chronologie, passant de l’Antiquité Tardive avecdes éléments de vaisselle et des monnaies aux inhu-mations habillées mérovingiennes avec quelquesobjets de la vie quotidienne puis à la fin du VIIe
siècle ou au début du VIIIe siècle à seulementquelques éléments de costume, voire quelquesépingles de linceul uniquement. Cette évolution estle témoin de la progression du christianisme et de ladiffusion de la liturgie, par le courant ascétiqueirlandais développé en France à partir du VIIe siècle.
Le monde des vivants :contexte régional
Le monde des vivants permet de définir la popula-tion dans son contexte régional et d’appréhenderson état sanitaire.
Morphologie
Les populations du sud-ouest de la France connais-sent une homogénéité morphologique au hautMoyen Âge, même si ces populations se différen-cient les unes des autres (par exemple, Vindrac, ou
CONCLUSIONS
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
199 Conclusions
les hommes de Saint-Bertrand-de-Comminges). Eneffet, la morphologie crânienne se différencie plutôtsur la forme du crâne que sur le format, contraire-ment à l’anatomie infra-crânienne, de manière géné-rale. Ainsi, bien que chaque population forment ungroupe cohérent, elles partagent des caractères com-muns, et appartiennent donc à un même ensemblehomogène. Cependant, la population de Venerquese démarque par la présence de déformations crâ-niennes artificielles, dont la fréquence est parailleurs la plus forte d’Europe occidentale.
Etat sanitaire
Les pathologies bucco-dentaires offre une imagebien peu favorable de l'état sanitaire des popula-tions du sud-ouest de la France au haut Moyen Âge.En effet, elles montrent des atteintes importantes
pour toutes les pathologies étudiées : carie, paro-dontopathie, tartre, usure dentaire, et hypoplasielinéaire de l’émail dentaire. Cet état sanitaire défa-vorable est à mettre en relation avec un régime ali-mentaire dur et abrasif, certainement dès l'enfance,des carences nutritionnelles et des épisodes infec-tieux répétés. Il est également conforté par un recru-tement en faveur d’une population jeune, qui est liéà une brusque dégradation des conditions de vie,observée à partir du VIe siècle (Bouali, Vattéoni1991). Deux hypothèses sont actuellement retenues,une nette péjoration des conditions sanitaires enrelation avec l’instabilité politique de cette période(Simon 1990), et une mortalité consécutive à des épi-démies, notamment la peste qui sévissait au hautMoyen Âge (Castex 1994 ; Bouali, Vattéoni 1991 ;Pouyé et al 1994).
200Sous la direction de S. Duchesne et É. Crubezy
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Abaz B., Lapart J., Noldin J.P., 1987Découvertes mérovingiennes à Sainte-Bazeille (Lot-et-Garonne) et dans sa région, Revue de l'Agenais, n°4, 391-426.
Aguerre M., 1997Paléopathologie bucco-dentaire d’un population du hautMoyen Age : Lunel-Viel (Hérault). Méthodologie etrésultats, Mémoire de DEA, Université de BordeauxI, inédit.
Ajot J., 1985La nécropole mérovingienne de la Croix du Munot à Cur-til-sous-Burnand (Saône-et-Loire). Fouilles du docteurLafond, Mémoires de l’Association française d’archéolo-gie mérovingienne, 1.
Alduc-Le Bagousse A., Pilet J., 1986Les sépultures d’enfants en édifices religieux :l’exemple du cimetière de l’église Notre-Dame àCherbourg (Manche), In : Buchet L. (dir.), Le matérielanthropologique provenant des édifices religieux, Actesdes 2e journées anthropologiques de Valbonne (6-8juin 1983). Notes et Monographies techniques n°19,CNRS, Paris, 61-69.
Alexandre-Bidon D., Lett D., 1997Les enfants au Moyen Age (Ve-XVe siècles). HachetteLittératures, La Vie Quotidienne, Paris.
Arramond J. Ch.(dir.), 1996Toulouse, Musée Saint-Raymond (Haute-Garonne),Document final de synthèse, Service Régional del’Archéologie (Midi-Pyrénées), Toulouse.
Audy, Riquet, 1962La basilique cémétériale de Montferrand (Aude), contri-bution à l'étude du peuplement des grandes invasions enGaule. Comptes rendus de l'Académie des Inscrip-tions et Belles-Lettres. Librairie Klincksieck, Paris,185-204.
Azémar R., Crubézy E.,Rakotondramasy Th, 1995Le cimetière rural du haut Moyen Age de Saint-Mar-tin-du-Larzac, contribution à l’étude des pratiquessépulcrales et de l’organisation des nécropoles, In :Gruat ph., 1995, 279-290.
Baccrabère G., 1965Deux sarcophages de l’École d’Aquitaine, MSAMF,XXXI, p.29-39.
Badie A., Sablayrolles R., Schenck J.-L.,1994Saint-Bertrand-de-Comminges, I. Le temple du forum etle monument à enceinte circulaire, Bordeaux.
Balmelle C., 1987Recueil général des mosaïques de la Gaule, IV, Provinced’Aquitaine, Xe supplément à Gallia, Paris.
Barrère M., Rey-Delqué M. (dir.), 1990Archéologie et vie quotidienne aux XIIIe-XIVe siècles enMidi-Pyrénées, Toulouse, Musée des Augustins.
Barrière-Flavy Cl., 1891Sépultures mérovingiennes découvertes à Venerque(Haute-Garonne), Revue des Pyrénées, III, 533-538.
Barrière-Flavy Cl., 1892Étude sur les sépultures barbares du Midi et de l'Ouestde la France, Industrie Wisigothique, Toulouse-Paris,31-32 (carte).
Barrière-Flavy Cl., 1901Les arts industriels des peuples barbares de la Gauledu Ve au VIIIe siècles, Toulouse-Paris, pl. XXV (n° 2).
Barrière-Flavy Cl., 1901-1903Sépultures barbares de Venerque (Haute-Garonne),BSAMF, 29-31, 52-54.
Barthélémy I., 1999Morphologie et évolution : le peuplement du sud-ouest de la France entre le VIe et le XIIe siècles. Lecas des nécropoles de La Gravette (Gers). Thèse dedoctorat, Université Paul Sabatier de Toulouse,inédit.
Barthélémy I., Telmon N., Crubézy E.,Rougé D., 1999Etude de la pathologie stomatologique et maxillo-faciale dans une population médiévale (X-XIIe
siècles) du sud-ouest de la France. Revue de Stomato-logie et de Chirurgie maxillofaciale, 100, n°3, 133-139.
BIBLIOGRAPHIE
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
201 Bibliographie
Baud C. A., 1991Urbs in rure : paléopathologie et paléonutrition despopulations rurales. In : Buchet L. (dir), Ville et cam-pagne en Europe occidentale (Ve-XIIIe siècle), Actes des5e journées anthropologiques de Valbonne (21-23mai 1990). Dossier de documentation archéologiquen°14, CNRS, Paris, 153-154.
Baume L.J., 1962Principes généraux pour une standardisation inter-nationale des statistiques sur la carie dentaire. Inter-national dental Journal de France, 12, 268-278.
Benoit A., 1999In : Aux origines du christianisme. Textes présentéspar P. Geoltrain, Gallimard, Paris, 511-517.
Bessou M., 1977Vestiges gallo-romains à Vindrac, Travaux etrecherches, 14, 139-148.
Bessou M., 1978Le fanum de Camp-Ferras à Loubers, Gallia, 36, 187-218.
Bessou M., 1979Aux origines de Vindrac (Tarn), Travaux et recherches,16, 76-88.
Bessou M., 1985aFouilles de Vindrac 1984, Archéologie Tarnaise, 3, 69-82.
Bessou M., 1985bChronique des fouilles médiévales. Vindrac (Tarn),Archéologie Médiévale, 15, 287.
Bessou M., 1987aVindrac (Tarn), Campagne 1985, Archéologie Tarnaise,4, 57-68.
Bessou M., 1987bChronique des fouilles médiévales. Vindrac (Tarn),Archéologie Médiévale, 17, 274-275.
Bessou M., 1987cLa nécropole de Vindrac (Tarn), Dossiers Histoire etArchéologie, 120, 82-83.
Bessou M., 1987dFouilles de Vindrac. Rapport de synthèse. 1977-1986,dactylographié, inédit.
Bessou M., 1990Campagne de fouilles 1986 à Vindrac, ArchéologieTarnaise, 5, 35-46.
Bessou M., Manuel R., 1987-88La nécropole mérovingienne de Vindrac (Tarn), Cat.de l’exposition, De l’Âge du Fer aux Temps Barbares.Dix ans de recherches archéologiques en Midi-Pyrénées,Toulouse, Musée Saint-Raymond, 159-163.
Bilmer H. P., 1957A roentgenoscopic method of analysis the facila corre-lations. Trans-European Orthodontic Society, 33, 241-253.
Bizot B., 1988Anthropologie de l’édifice funéraire d’AlbignyCondion (74). In : Buchet L. (dir) 1988. Anthropologieet histoire ou Anthropologie historique ?, Actes des troi-sièmes Journées Anthropologiques de Valbonne (28-30 mai 1986). Notes et Monographies techniquesn°24. Ed. CNRS, Paris, 227-240.
Bizot B., Serralongue J., 1988Un édifice funéraire du haut Moyen Age à SeysselAlbigny (Haute-Savoie). Archéologie du Midi Médié-val, VI, 25-49.
Blondiaux J., 1988Anthropologie physique du Haut-Escaut du IVe auVIIIe siècle). In : Buchet L. (dir), 1988. Anthropologie ethistoire ou Anthropologie historique ? Actes des troi-sièmes Journées Anthropologiques de Valbonne (28-30 mai 1986). Notes et Monographies techniquesn°24. Ed. CNRS, Paris, 215-226.
Bouali M., Vattéoni S., 1991Conditions de vie à la fin de l’Antiquité et au hautMoyen Age : changement ou continuité ? Approcheméthodologique. Exemple de deux nécropoles sub-urbaines : Beauvais (Oise), IV-Ve siècle et Vaison(Vaucluse), V-VIe siècle. In : Buchet L. (dir), 1991 –Ville et campagne en Europe occidentale (Ve-XIIIe siècle),Actes des cinquièmes journées anthropologiques deValbonne (21-23 mai 1990), Dossier de documenta-tion archéologique n°14, Ed CNRS, Paris, 25-40.
Boube J., 1956Le motif des griffons à la source de vie sur une plaque-boucle barbare de Puycasquier, Auch, 3-25.
Boube J., Fouet G., 1955La nécropole de Gelleneuve, rapport de fouille, ServiceRégional de l’Archéologie (Midi-Pyrénées), Toulouse.
202Sous la direction de S. Duchesne et É. Crubezy
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Boudartchouk J.-L . et alii, 2000Quelques ensembles de mobilier d’époque méro-vingienne provenant de nécropoles : Guilhamat deLacroix-Falgarde ; Le Hauré (et le Tourguil) de Dru-das, Saint-Michel-d’Aussiac de Le Burgaud (Haute-Garonne), Le Coulomé de Montégut (Gers),MSAMF, LX, 49-82.
Boudartchouk J.-L. (dir.), 1992Lourdes. Inventaire archéologique. Témoignages du peu-plement de la région de Lourdes, du Paléolithique à la findu Moyen Âge, Cat. De l’exposition, Lourdes.
Boyer R., 1972Pièces de mobilier funéraire du Haut Moyen-Âgedécouverte dans le Var, Hommage à Fernand Benoit,Institut International d’Etudes Ligures, Bordighera,148-154.
Braüer G., 1988Osteometrie. In : Knussmann R. et alii (Eds), Anthro-pologie. Handbuch Der Vergleichenden Biologie desMenschen Zugleich 4. Auflage des Lehrbuchs desAnthropologie begründet von Martin R., Band I., Wesenund Methoden der Anthropologie. New York, Stutt-gart : Gustav Fischer Verlag, 160-232.
Briesenick B., 1964Typologie und Chronologie der Südwest-GallischenSarkophage, Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zen-tralmuseums Mainz, 9, 76-182.
Bruzek J., 1984Dimorphisme sexuel de l’os coxal de l’homme du point devue ontogénique et phylogénique. Thèse de Doctoratd’Etat, Université Charles Prague, inédit.
Bruzek J., 1991Fiabilité des procédés de détermination du sexe à partir del’os coxal. Implications à l’étude du dimorphisme sexuelde l’homme fossile. Thèse de doctorat, Museum Natio-nal d’Histoire Naturelle, Institut de PaléontologieHumaine, inédit.
Buchet L., 1986L’inhumation en basilique funéraire : observations,interprétation et commentaires. In : Buchet L. (dir),Le matériel anthropologique provenant des édifices reli-gieux. Actes des deuxièmes Journées Anthropolo-giques de Valbonne (6-8 juin 1983). Notes et Mono-graphies techniques n°19. Ed. CNRS, Paris, 69-73.
Buchet L., 1988La déformation crânienne en Gaule et dans lesrégions limitrophes pendant le haut Moyen Age,son origine - sa valeur historique. Archéologie Médié-vale, XVIII, 55-71.
Buchet L., Olive Cl., 1983Interprétations provisoires. In : Colardelle M., 1983 –Sépultures et traditions funéraires du Ve au XIIIe siècledans les campagnes des Alpes françaises du Nord. Gre-noble, 419-423.
Carte Archéologique de la Gaule, Le Tarn, Paris, 1995.
Castex D., 1994Mortalité, morbidité, et gestion de l’espace funéraireau cours du Haut Moyen Age - Contributions spéci-fiques de l’anthropologie biologique. Thèse Univer-sité Bordeaux I.
Catalo J. et al., 1999La Cité Judiciaire de Toulouse (Haute-Garonne),Document final de synthèse de la phase 1, ServiceRégional de l’Archéologie (Midi-Pyrénées), Tou-louse.
Catalogue de l’exposition, Les derniers romains enSeptimanie, IVe –VIIIe siècles, Actes des IXe Journéesd’Archéologie mérovingienne, Lattes, 1988.
Catalogue de l’exposition, Pulchra imago. Fragmentsd’archéologie chrétienne, Saint-Bertrand-de-Com-minges, 1991.
Catalogue de l’exposition, Romains et Barbares entreLoire et Gironde IVe –Xe siècles, Poitiers, 1989-1990.
Cazes J.-P., 1996Le complexe de l’Isle-Jourdain : une église double,Antiquité Tardive, 4, 110-114.
Cazes J.-P., 1997L’Isle-Jourdain « La Gravette » (Gers), Documentfinal de synthèse, Service Régional de l’Archéologie(Midi-Pyrénées), Toulouse, 3 volumes.
Cazes J.-P., 1998La nécropole franque de Ictium à l’Isle-Jourdain(Gers), Acta Praehistorica et Archeologica,30, 126-136.
Cazes Q., 1998Le quartier canonial de la cathédrale Saint-Etienne deToulouse. Archéologie du Midi Médiéval, supplément 2.
203 Bibliographie
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Chaliand G., Mousset S., 19992000 ans de chrétientés. Editions Odile Jacob, Paris.
Cheleux N., 2000Les hypoplasies linéraires de l’émail dentaire des caninesdes adultes de la série de La Gravette. Memoire de DEA,Université Toulouse le Mirail, Toulouse, inédit.
Chopin J.-F. et alii, 2000Site du Collège des Trois vallées, Salies-du-Salat (3),Document final de synthèse.
Cleuvenot et Houët, 1993Propositions de nouvelles équations d’estimationde la sature applicables pour un sexe indéterminé etbasées sur les échantillons de Trotter et Gleser. Bul-letin et Mémoire de la Société d’Anthropologie de Paris,Paris, n.s., 5, 245-255.
Clottes J. Lequément R., Barrère M.,Vidal M., 1989Gallia Informations. Midi-Pyrénées, 1, 67-183.
Colardelle M., 1983Sépultures et traditions funéraires du Ve au XIIIe siècleap. J.-C. dans les campagnes des Alpes françaises duNord, Grenoble.
Colardelle M., 1996Terminologie descriptive des sépultures antiques etmédiévales, Archéologie du cimetière chrétien, Actes du2e colloque ARCHEA, Orléans 1994, 11e suppl. à laRAC, Tours 1996, 305-310.
Colardelle M., Démians d’Archimbaud G.,Raynaud Cl., 1996Typo-chronologie des sépultures du Bas-Empire à lafin du Moyen-Âge dans le Sud-Est de la Gaule,Archéologie du cimetière chrétien, Actes du 2e colloqueARCHEA, Orléans 1994, 11e supplément à la RAC,Tours 1996, 271-303.
Colin M.-G., 1993Grépiac, Cantemerle, Bilan Scientifique Midi-Pyré-nées, SRA 1992, 87.
Coquerel R., 1965-1972rapports de fouille : Izaux, la villa de Barthes(Hautes-Pyrénées), 1965, 1967, 1968, 1971, 1972.
Cordier G., Riquet R., Brabant H., 1974Le site archéologique du dolmen de Villaine àSublaines (Indre-et-Loire). Deuxième partie : cime-tière mérovingien, Gallia, 32, 63-221.
Coupry J., 1985Informations archéologiques, Gallia, XXIII, 413-442.
Cross J.F., Kerr N.W., Bruce M.F., 1986An evaluation of Scott’s method for scoring dentalwear. In : Cruwyse (dir.) - Teeth and anthropology,BAR International serie 291.
Crubézy E. et al, 1998Le paysan médiéval en Rouergue, cimetière et église deCanac (Campagnac, Aveyron). Musée archéologiquede Montrozier, guide archéologique n°5.
Crubézy E. et Raynaud C., 1988Le passage de la sépulture individuelle à la sépul-ture collective du IIIe siècle au XIIe siècle dans lesud-ouest de la France, In : Buchet L. (dir), Anthro-pologie et histoire ou anthropologie historique ?, Actesdes Troisièmes Journées Anthropologiques de Val-bonne, 1986, éditions du CNRS, 195-208.
Crubézy E., 1986La nécropole de Rivel (Venerque - Haute Garonne), Etudeanthropologique, essai d’interprétation palethnogra-phique. mémoire de diplôme de l'École des HautesEtudes en Sciences Sociales Toulouse, Vol. 1 et 2.
Crubézy E., 1988Interactions entre facteurs bioculturels, pathologie etcaractères discrets. Exemple d’une population médiévale :Canac (Aveyron). Thèse de médecine, Montpellier.
Crubézy E., 1990Merovingian skull deformations in the southwest ofFrance. One World Archeologie. In From the Baltic tothe Black Sea, Studies in Medieval Archeologie. Ed.Unwin Hyman Ltd, London, 18, 189-208.
Crubézy E., 1991Caractères discrets et évolution. Exemple d’une popula-tion nubienne : Missiminia, Soudan. Thèse d’Anthro-pologie, Université de Bordeaux.
Crubézy E., Dieulafait Ch. (dir), 1996Le comte de l’An Mil, Aquitania, supplément 8.
204Sous la direction de S. Duchesne et É. Crubezy
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Crubézy E., Duchesne S., Arlaud C.,2006La mort, les morts et la ville (Montpellier – Xe-XVIe
siècles). Editions Errance, Paris.
Crubézy E., Masset C., Lorans E., PerrinF., Tranoy L., 2000Archéologie Funéraire. Edts Errance, Paris.
Crubézy E., Murail P., Viguier J., àparaîtreVindrac : la nécropole du Haut Moyen Age, étude paléo-biologique.
Cubaynes R., Lasserre F., 1966Le cimetière wisigothique de Larroque-Cestayrols,Ogam, 105-106, 303-310.
Dahlberg A., 1963Analysis of the American indian dentition. In Sym-posia of the Society for the Study of Human Biology, V.Dental Anthropology, Pergamon Press.
Dauzat A., Rostaing Ch., 1978Dictionnaire étymologique des noms de lieux en France,Paris.
Delahaye G.-R., 1993Sarcophages de calcaire et de grés de la gaule méro-vingienne, prototypes et évolution, Antiquité Tar-dive, 1, 143-146.
Désert I. et al., 1987La nécropole mérovingienne du Touron à Puymirol(Lot-et-Garonne), Archéologie du Midi Médiéval, V, 93-108.
Dieulafoy M., 1914Basilique constantinienne... 59-90.
Don de Vic et Don Vayssète,Histoire Générale du Languedoc, VI et VIII.
Doorselaer A. (Van),1967Les nécropoles d’époque romaine en Gaule septentrionale,Dissertationes Archaeologicae Gandenses, X, Brugge
Downs W. B., 1948Variation in facial relationships : their significance intreatment and prognosis. American Journal of Ortho-dontics, 24, 812-840.
Duchesne S., 1997La nécropole mérovingienne de Saint-Brice-de-Cassan(Gers) : étude du recrutement et des pratiques funérairesen fonction du sexe et de l’âge. Mémoire de DEA, Uni-versité de Bordeaux I, inédit.
Duhamel Chr., Cazes J.-P., BoudartchoukJ.-L., 1995 Le site de la Gravette à L’Isle-Jourdain. Le secteurchrétien. La nécropole franque, Cat. de l’expositionArchéologie Toulousaine, Antiquité et haut Moyen-Âge.Découvertes récentes (1988-1995), Musée Saint-Ray-mond, Toulouse, 150-172.
Dupouey P., 1970Gisements archéologiques de la commune d’Ordan-la-Roque et rapport quadriennal de fouilles du site de Saint-Brice-de-Cassan, L’inconnu souterrain, Bulletin d’infor-mation du Spéléo-Club de Lutèce, Paris.
Dupouey P., 1981Domaines antiques, paroisses, communes : une évo-lution perçue à travers les documents, l’étude topo-nymique et l’inventaire archéologique d’un terri-toire (Ordan-Larroque, Gers), Actes de la troisièmejournée des archéologues gersois, SAHLSG, Auch, 5-29.
Dupouey P., Martin A., 1969, 1981,1983, 1985Chantier de Saint-Brice-de-Cassan (Ordan-Larroque,Gers), rapports de fouilles.
Dupouey P., Martin A., 1979Chantier de fouilles de Saint-Brice-de-Cassan, rapportde synthèse. Bâtiments.
Dupouey P., Martin A., 1996La nécropole médiévale du site de St-Brice-de-Cassan, 1 :état général des tombes, inédit.
Dupouey P., Martin A., 1996Site archéologique de Saint-Brice-de-Cassan, (villa gallo-romaine et cimetière médiéval). La nécropole médiévale.I : état général des tombes, Rapport complémentaire.
Durand G., 1989Les églises rurales du premier âge roman dans leRouergue méridional, Archéologie du Midi Médiéval,7, 3-42.
205 Bibliographie
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Durliat M., Giry J., 1971Chapelles préromanes à chœur quadrangulaire dudépartement de l’Hérault, Actes du 94e congrés natio-nal des Sociétés Savantes, Pau 1969 (Paris), 203-223.
Dutil L., 1929La Haute-Garonne et sa région. Géographie histo-rique, Toulouse-Paris, II, 216.
Duval A. (dir.), 1996Les premiers monuments chrétiens de la France. 2. Sud-Ouest et Centre, Paris
Duval Y., 1988Auprès des saints corps et âmes : l'inhumation « ad sanc-tos » dans la chrétienté d'Orient et d'Occident du IIIe auVIIe siècle, Paris.
Fau J.-Cl., 1987Grand Vabre (Aveyron), Saint-Léonard de Mone-diès, Le paysage monumental de la France autour de l'anMil, Paris, 533-534 et 539.
Fau J.-Cl., 1990Rouergue roman, Paris.
Faure-Boucharlat E., Ronco C., 1992Le cimetière Saint-Philippe à Alba-la-Romaine(Ardéche), Archéologie du Midi Médiéval, X, 113-135.
Fazekas G., Kosa F., 1978Forensic foetal osteology. Budapest.
Ferembach, Schwidetzky et Stloukal,1979Recommandations pour déterminer l’âge et le sexesur le squelette. Bulletin et Mémoire de la Société d'An-thropologie de Paris, Paris, 6, série XIII, 7-45.
Feugère M., 1988Fibules wisigothiques et de type germanique enGaule méridionale, Archéologie du Midi Médiéval, 6,3-11.
Fingerlin G., 1967Eine Schnalle mediterraner From aus dem Reihem-gräberfeld, Güttingen, Ldkres. Konstanz, BadischeFundberichte, 23, 159-183, pl.67-73.
Fossard D., 1957La chronologie des sarcophages..., 328.
Gagnière S., Granier J., 1982Le site paléochrétien de Saint-Etienne-de-Candauaux Angles (Gard) : documents inédits, RAN, XV,381-397.
Gagnière S.,1960Les sépultures à inhumation du IIIe au XIIIe siècle denotre ère dans la basse vallée du Rhône. Essai dechronologie typologique, CR, VII, 34-71.
Gaillard de Semainville H., 1980Les cimetières mérovingiens de la côte chalonnaise et de lacôte maconnaise, 3e suppl. à la RAE, Dijon, 89, 157-239.
Gaillard de Semainville H., Vallet F.,1979Fibules et plaques-boucles mérovingiennes de lacollection Febvre conservées au Musée des Antiqui-tés Nationales, Antiquités Nationales, 11, 57-77.
Galinié H., Zadora-Rio E. (dir), 1996Archéologie du cimetière chrétien. Actes du 2e ColloqueA.R.C.H.E.A, 11e supplément à la Revue Archéolo-gique du Centre de la France, Tours.
Garnier B. et al., 1995De la ferme au village : Dassargues du Ve au XIe
siècle (Lunel, Hérault), Archéologie du midi Médiéval,XIII, 1-78.
Garnotel A., Raynaud Cl., 1996Groupés ou dispersés ? Les morts et la société ruraleen Languedoc oriental (IVe-XIIe siècle). In GaliniéH., Zadora-Rio E. (dir), 1996, 139-152.
Gaury P., 1997Paléopathologie dentaire de populations du haut MoyenAge Saint-Bertrand-de-Comminges et Venerque (Haute-Garonne). Mémoire de DEA, Université de BordeauxI, inédit.
Gavelle R.,1982Sur une table d’autel inédite..., 489-505.
Giot P. R., Monnier J. L., 1977Le cimetière des anciens Bretons de Saint-Urnel ouSaint-Saturnin en Plomeur (Finistère), Gallia, 35,141-171.
Giry J., 1983Les vieilles églises à chevet carré de l’Hérault, Rodez.
206Sous la direction de S. Duchesne et É. Crubezy
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Goodman A.H., Armelagos G., Rose J.,1980Enamel hypoplasias as indicators of stress in threeprehistoric populations from Illinois. Human Bio-logy, 52 (september), n°3, 515-528.
Goodman A.H., Rose J.C., 1991Assessment of systemic physiological perturbationsfrom dental enamel hypoplasias and associated his-tological structures. Yearbook Biology, 60 (5), 781-791.
Goudineau Chr., 1979Informations archéologiques, Gallia, 37, 553-568.
Grégoire de Tours, 1951Historia Francorum, VII, 35, 37-38. In Monumenta Ger-maniae historica, Scriptores rerum merovingicarum, I, 1,355, 359-362.
Grégoire de Tours, 1995L’Histoire des Francs, Latouche R. trad., Paris.
Griffe E., 1966La Gaule chrétienne à l’époque romaine, L’église desGaules au Ve siècle, Paris, 2.
Grimbert L. (dir), 2000Arcambal, Travers de la Fontaine (Lot-46), Docu-ment final de synthèse, Service Régional de l’Ar-chéologie (Midi-Pyrénées), Toulouse.
Gruat Ph., 1998Croyances et rites funéraires en Rouergue, Des origines àl’An Mil. Guide d’archéologie n°6, Musée duRouergue, Montrozier.
Guillon M., 1997Anthropologie de terrain et paléodémographie : étudesméthodologiques sur les grands ensembles funériares.Applications au cimetière médiéval de Tournedos-Porte-joie (Eure), Thèse de odctorat, université de Bor-deaux, inédit
Guyon J., Paillet J.L., 1987La basilique chrétienne..., 50-51.
Guyon J., Paillet J.L., 1996Saint-Bertrand-de-Comminges. Basilique de la villebasse. In Les premiers monuments chrétiens de laFrance, 2. Sud-Ouest et Centre, Atlas archéologique dela France, Picard, 177-189.
Hantute G., 1989La nécropole de Neuville-sur-Escaut. Septentrion, Nord.
Henrion F., Hunot J.-Y.,1996Archéologie et technologie du cercueil et du cof-frage de bois, In : Archéologie du cimetière chrétien,Actes du 2e colloque ARCHEA, Orléans 1994, 11esuppl. à la RAC, Tours, 197-204.
Héritier M., 1989Anatomie pathologique des dents et de la muqueuse buc-cale. Masson, Paris.
Husi Ph. et al., 1990Les pratiques funéraires à Saint-Mexme de Chinondu Ve au XVIIIe siècles. Revue Archéologique duCentre de la France, 29, fasc. 2, 131-168.
Hygounet J. L., 1983-1985Les Olivettes, rapport de fouille, Service Régional del’Archéologie (Midi-Pyrénées), Toulouse.
James E., 1977The Merovingian Archaeology of South-West Gaul,BAR, 25.
Jusot V., 1996Surmortalité féminine et mortalité maternelle : réfé-rences, comparaisons et interprétations paléodémogra-phiques. Mémoire de DEA, Université de Bordeaux I,inédit.
Kazanski M., 1991Les Goths (Ier-VIIe après J.-C.), Paris.
Kiszely I., 1978The origins of artificial cranial deformation in Eur-asia from the Sixth millenium B. C. To the seventhcentury A. D., Oxford, British Archaeology reports,BAR Int. Ser. Suppl., 50.
Kneubuhler M. (dir.),1989Des solitudes habitées. Anciennes abbayes en Midi-Pyré-nées, Toulouse.
Labrousse M., 1957Informations archéologiques, Gallia, XV, 258-278.
Labrousse M., 1966Informations archéologiques, Gallia, 24, 411-448.
Labrousse M., 1968Informations archéologiques, Gallia, 26, 544.
207 Bibliographie
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Labrousse M., 1972Informations archéologiques, Gallia, 30, 496-497.
Labrousse M., 1978Informations archéologiques, Gallia, 36, 425-426.
Labrousse M., 1980Informations archéologiques, Gallia, 38, 463-505.
Labrousse M.,Informations archéologiques, Gallia, XXIV, 1966,411-448 ; XXVI, 1968, 515-557 ; XXVIII, 1970, 397-437 ; 30, 1972, 469-510 ; 32, 1974, 453-500.
Lantier R., 1942Le cimetière wisigothique d’Estagel (Pyrénées-Orientales), Gallia, I.
Lantier R., 1949Le cimetière wisigothique d’Estagel (Pyrénées-Orientales), Gallia, VIII, 55-80.
Lapart J., 1983Objets « mérovingiens » inédits ou peu connus duGers. Réflexions sur l'époque mérovingienne dansle Gers, Condomois et Armagnac. XXXVIIIe Congrèsd'études de la Fédération des Sociétés Académiques etSavantes, Languedoc-Pyrénées-Gascogne, Auch, 14,n° 5 et 9-16.
Lapart J., Petit C., 1993Le Gers, Carte Archéologique de la Gaule, Paris.
Larrieu M, Marty B., Périn P., CrubézyE., 1985La nécropole mérovingienne de la Turraque, Beaucaire-sur-Baïse (Gers), Sorèze.
Lassure J. M., 1988La nécropole wisigothique des Martels à Giroussens(Tarn), Archéologie du Midi Médiéval, VI, 51-64.
Lassure J.-M., 1991La nécropole wisigothique des Martels à Giroussens(Tarn), Gallo-romains, Wisigoths et Francs en Aquitaine,Septimanie et Espagne, Actes des VIIe journées interna-tionales d’archéologie mérovingienne, Toulouse 1985(Paris), 205-223.
Lassure J.-M., 1998La civilisation matérielle de la Gascogne aux XIIe et XIIIe
siècles. Le mobilier du site archéologique de Corné à l’Isle-Bouzon (Gers), Toulouse.
Laumon A., 1977La nécropole mérovingienne de Bettborn, Annuairede la Société d’Histoire et d’Archéologie de la Lorraine,LXXVII, 51-71 (fig. 3).
Ledermann S., 1969Nouvelles tables-types de mortalité. Institut Natio-nal d’Etudes démographiques, Travaux et documentsn°53, PUF, Paris.
Leenhardt M. et alii, 1999Un puits : reflet de la vie quotidienne à Montpellierau XIIIe siècle, Archéologie du Midi Médiéval, 17, 109-186.
Legoux L. et R., 1974Le cimetière mérovingien de Saine-Fontaine (Oise),Cahiers Archéologiques de Picardie, n°1-2, 123-180.
Lequément R., 1983Informations archéologiques, Gallia, 41, 473-503.
Lequément R., 1986Informations archéologiques, Gallia, 44, 309-333.
Lequément R., 1989Informations archéologiques, Gallia, 114.
Lerenter S., 1991Nouvelle approche typologique des plaques-bouclesmérovingiennes en bronze de type Aquitain, In : Gallo-romains, Wisigoths et Francs en Aquitaine, Septimanie etEspagne, Actes des VIIe Journées internationales d'ar-chéologie mérovingienne, Toulouse 1985, Paris, 225-257.
Lizop R., 1914-1922Second rapport sur les fouilles..., 241-249.
Lizop R., 1931Historique des deux cités..., 426-438.
Lorans E., 2000Le monde des morts de l’Antiquité tardive àl’époque moderne, In : Ferdière A. (dir), Archéologiefunéraire, Editions Errance, Paris, 155-193.
MacMullen R., 1998Christianisme et paganisme du IVe au VIIIe siècle. Paris.
Maraval P., 2000Vers l'Empire Chrétien. In : Aux origines du christia-nisme. Textes présentés par P. Geoltrain, Gallimard,Paris 467-472.
208Sous la direction de S. Duchesne et É. Crubezy
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Marlière P., 1998A75 : Le Pueh d’Auzet (1997) et le Camp des Lacs51998), Document final de synthèse, Service Régio-nal de l’Archéologie (Midi-Pyrénées), Toulouse.
Martin M., 1988Das frühmittelalterliche Grabgebäude unter derKirche St Pankratius in Hitzkirch, Archäologie derSchweiz, 11, 89-101.
Masset Cl., 1973La paléodémographie des populations inhumées.Essai de paléodémographie. L’homme, 13 (4), 95-131.
Masset Cl., 1982Estimation de l’âge au décès par les sutures crâniennes.Thèse, Paris.
Masset Cl., 1990Où en est la paléodémographie ?, Bulletins et Mémoiresde la Société d’Anthropologie de Paris, n. s., 2 (3-4), 109-122.
Maurin L., 1971Le cimetière mérovingien de Neuvicq-Montguyon(Charente-Maritime), Gallia, 29, 151-190.
Meffre J.-Cl., Raynaud Cl., 1993Céramique commune kaolinitique, Dictionnaire descéramiques antiques (VIIe s. av. n.è.- VIIe s. de n.è) enMéditerranée nord-occidentale (Provence, Languedoc,Ampurdan), Lattara, 6, 488-499.
Mercier C., Mercier-Rolland M., 1974Le cimetière burgonde de Monnet-la-Ville, AnnalesLittéraires de l’Université de Besançon, 25.
Millet Fl., 1997-1998Inventaire des nécropoles et sépultures isolées de l'Anti-quité Tardive (IIIe-VIIe siècle) dans le département duTarn : étude de la christianisation d'une région du sud-ouest de la Gaule, mémoire de maîtrise, dactylogra-phié, Toulouse UTM.
Monod A., Rancoule G., 1969Quelques objets de provenance audoise apparte-nant à la période romaine tardive et au HautMoyen-Âge, Bulletin de la Société d’Etudes Scienti-fiques de l’Aude, LXIX, 169-181.
Morazzani C., 1994La nécropole mérovingienne de Goudelancourt-lès-Pierrepont (Aisne), Revue Archéologique de Picardie,n°1/2, 9-19.
Morel L., 1996Étude des hypoplasies linéaires de l’émail dentaire dequatre séries médiévales du sud-ouest de la France.Mémoire de DEA, Université de Bordeaux I, inédit.
Müller A., 1978Le Champs d'Urne de la Trinité à Venerque, Pallas,25, 105-109.
Murail P., 1996Biologie et pratiques funéraires des populations d’époquehistorique : une démarche méthodologique appliquée à lanécropole gallo-romaine de Chantambre (Essonne).Thèse de doctorat, Université de Bordeaux I.
Murail P., Raynaud Cl., 1996Approche paléodémographique et division de l’es-pace funéraire : les nécropoles des VIe et VIIIe sièclesde Lunel-Viel. Bulletin et Mémoires de la Société d’An-thropologie de Paris, Paris, n.s., 5, 209-216.
Novotny V., 1975Diskriminantanalyse des Geschlechtsmerkale aufdem os coxae beim Menschen. In : Papers of the 19thCongress of Anthropologist Czechoslovak, Brno, 1-23.
OMS, 1977Enquêtes sur la santé bucco-dentaire. Méthodes fonda-mentales. OMS, Ed, Genève.
OMS, 1986Enquêtes sur la santé bucco-dentaire. Méthodes fonda-mentales. OMS, Ed, Genève.
Owings-Webb P.A., Suchey J.M., 1985Epiphyseal union of anterior iliac crest and medialclavicle in modern multiracial sample of Americanmales and females. American Journal of PhysicalAnthropology, 68, 457-466.
Périn P., 1978Compte-rendu de l'ouvrage d'E. James, The merovin-gian archeology of south-West Gaul, BAR, 1977, dans leBulletin Monumental, 136-II, 193-204.
Périn P., 1980La datation des tombes mérovingiennes : historique,méthodes, applications, Paris.
Périn P., 1985Catalogue d'art et d'histoire du musée Carnavalet, II,Collections mérovingiennes, Paris, 163-166, 363 (n°327b), 467-471 (n° 473 à 475).
209 Bibliographie
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Périn P., Velay P., Renou L., 1985Collections mérovingiennes, Cat. d’art et d’histoire dumusée Carnavalet, Paris.
Pétrequin P. et alii, 1980Le site funéraire de Soyria à Clairvaux-les-Lacs(Jura), Revue Archéologique de l’Est, XXXI, 157-230.
Pilet Ch. et al, 1990Les nécropoles de Giberville (Calvados), fin du Ve
siècle-fin du VIIe siècle. Archéologie Médiévale, XX, 2-129.
Pilet Ch. et al, 1992La nécropole de Saint-Martin-de-Fontenay (Calvados) Ve
siècle av. JC.-VIIe siècle ap. JC. 54e supplément à Gal-lia, Ed. CNRS, Paris.
Pilet Ch. Et al., 1992Le village de Sannerville « Lirose ». Fin de lapériode gauloise au VIIe siècle après J.-C., Archéolo-gie Médiévale, XXII, 1-190.
Pilet Chr., 1980La nécropole de Frénouville, BAR, 83, 3 volumes.
Piton D., 1985La nécropole de Nouvion-en-Ponthieu, Dossiersarchéologiques, historiques et culturels du Nord etdu Pas-de-Calais, 20.
Porte P., Buchet L., 1985La nécropole du haut Moyen Age des Grands Peu-pliers à Hières-sur-Amby (Isère). Etude d’une popu-lation dans son territoire. Archéologie Médiévale, XV,31-102.
Portet N., 2001Teilhet, Tabariane, Bilan scientifique Midi-Pyrénées,SRA 1999, 37-39.
Portet N., Claeys L., 1999Teilhet, Tabariane, Bilan scientifique Midi-Pyrénées,SRA 1998, 39-40.
Pousthoumis N., Cabot P. et M.-Cl., Réal I.et alii, 1997-98Sainte-Sigolène, sa vie, ses églises au Troclar(Lagrave, Tarn), AMM, 15-16, 1-65.
Pouyé B. et al, 1994Une nécropole de l’antiquité tardive à Cadarache(Saint-Paul-Lès-Durance, Bouches-du-Rhône).Archéologie Médiévale, XXIV, 51-135.
Prampart J.-Y., 1983Le cimetière mérovingien de Villethierry (Yonne),Revue Archéologique de l’Est, XXXIV, 345-359.
Pringent D., 1996Les céramiques funéraires (XIe-XVIIe siècles),Archéologie du cimetière chrétien, Actes du 2e colloqueARCHEA, Orléans 1994, 11e supplément à la RAC,Tours 1996, 215-224.
Privati B., 1983La nécropole de Sézegnin (IVe-VIIIe s.), Société d'Histoireet d'Archéologie de Genève, X, Genève.
Pujol J., 1998Les pratiques sépulcrales au haut Moyen Age enAveyron : l’exemple des rites funéraires à la nécro-pole paléochrétienne du Sabel (commune de Costes-Gozon), In : Gruat Ph., 1995, 239-254.
Ramfjord S. P., 1967The Periodontal Disease Index (PDI). J. Periodontal,Nov-Déc., 38 (6), suppl., 602-610.
Raynaud Cl., 1977Sarcophages du VIe s. à Lunel-Viel, Bull. de la Soc.d’Et. de Sète, VIII-IX, 123-133.
Raynaud Cl., 1988Nécropole de l'Antiquité tardive et du haut MoyenAge à Lunel-Viel (Hérault), In : Catalogue de l'expo-sition, Les derniers romains en Septimanie, IVe-VIIIe
siècles, Actes des IXe journées d’Archéologie Méro-vingienne, Lattes, 173-176.
Raynaud Cl., 1989Lunel-Viel, in L’église, le terroir, M Fixot et E. Zadora-Rio éd., Monographies du CRA n°1, Valbonne, 105-114.
Raynaud Cl., 1990Le village gallo-romain et médiéval du Lunel-Viel.Les fouilles du quartier ouest (1981-1983), AnnalesLittéraires de l’université de Besançon, 422, Paris, LesBelles Lettres.
Raynaud Cl., 1993Céramique commune grise tardive de Provence occiden-tale, Dictionnaire des céramiques antiques (VIe s. av. n.è.-VIIe s. de n.è) en Méditerranée nord-occidentale (Pro-vence, Languedoc, Ampurdan), Lattara, 6, 454-458.
210Sous la direction de S. Duchesne et É. Crubezy
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Reynaud J.F., 1996Les morts dans les cités épiscopales de Gaule du IVeau XIe siècle. In Galinié H., Zadora-Rio E. (dir), 1996,23-30.
Ricaut F. X., 2000Contribution des caractères discrets à l’étude du peuple-ment du sud-ouest de la France entre le VIe et le XIIe
siècles. Les nécropoles du site de La Gravette (l’Isle-Jour-dain, Gers). Mémoire de DEA, Ecole des HautesEtudes en Sciences Sociales, Toulouse.
Riché P., 1966Problèmes de démographie historique du hautMoyen Age. Annales de démographie historique. Sirey.
Ripoll Lopez G., 1991Materiales funerarios de la Hispania Visigoda : pro-blemas de cronologia y tipologia, Gallo-romains,Wisigoths et Francs en Aquitaine, Septimanie etEspagne, Actes des VIIe journées internationales d’ar-chéologie mérovingienne, Toulouse 1985 (Paris), 111-132.
Romon Th., 1995Recrutement et organisation de la nécropole des VIe etVIIe siècles de Rivel (Haute-Garonne), Mémoire deDEA, Université de Bordeaux I, inédit.
Romon Th., 1996Saint-Bertrand-de-Comminges, la basilique chrétienne.Etude anthropologique, Université de Bordeaux I,inédit.
Rouche M., 1979L'Aquitaine des Wisigoths aux Arabes (418-471). Nais-sance d'une région, Paris.
Saint-Marie S., 1998Paléopathologie bucco-dentaire d’une population inhu-mée : nécropole mérovingienne de Saint-Brice-de-Cassan(Gers). Mémoire de DEA, Université de Bordeaux I,inédit.
Salin E., 1952La civilisation mérovingienne, Les sépultures, Paris, II.
Sansilbano-Collilieux M., 1994Biologie et espace funéraire au Moyen Âge. Les nécro-poles de l’ancien évêché de Poitiers (fin IVe s.) et St-Mar-tin-de-Cognac (VIIe s.). Thèse, Université de Bor-deaux I, 2 vol., inédit.
Sapène B., 1966Saint-Bertrand-de-Comminges..., 109.
Sapin Chr., 1996Dans l’église ou hors l’église, quel choix pour l’in-humé, Archéologie du cimetière chrétien, Actes du 2e
colloque ARCHEA, Orléans 29 septembre-1er
octobre 1994, 11e suppl. à la RAC, Tours, 65-78.
Sassouni V., 1958Diagnosis and treatment planning via roentgeno-graphic cephalometry. American Journal of Orthodon-tics, 44, 433-463.
Saunders S. R., 1978The development and distribution of discontinous mor-phological variation of the human infracranial skeleton.Archaeological survey of Canada, NationalMuseums of Canada, Ottawa. Paper n°81.
Schenck J.-L., 1991Sarcophage d’Aemiliana, 76-78.
Schulter-Ellis F.-P., Hayek L.C., SchmidtD.-J., 1985Determination of sex with discriminant analysis ofnew pelvec bone measurements, part II. Journal ofForensic Sciences, 30, 178-185.
Schweitzer J. et al., 1988Le site néolithique, protohistorique et mérovingiende Saint-Vit (Doubs), II. La nécropole mérovin-gienne des Champs Traversains. Revue Archéologiquede l’Est, XXXIX, 231-272.
Scuvée F., 1973Le cimetière barbare de Réville (Manche), Fouilles1959-1966, Caen, 68.
Sellier Cl., 1986Développement topographique et caractères géné-raux de la nécrople de Vron (Somme), ArchéologieMédiévale, XVI, 7-32.
Sellier P., 1996La mise en évidence d'anomalies démographiqueset leurs interprétations : population, recrutement etpratiques funéraires du tumulus de Courtesoult. InPiningre JF. (dir) – Nécropoles et sociétés du premier âgedu Fer : le tumulus de Courtesoult (Haute-Saône). DAFn°54, Maison des Sciences de l'Homme, Paris, 188-202.
211 Bibliographie
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Sillières P., Petit C., 1994Saint-Lary, Ordan-Larroque et Jégun, BSR, 131-132.
Simon Ch., 1986Considérations paléodémographiques sur quelquesanciennes églises de Genève. In : Buchet L. (dir),1986, Le matériel anthropologique provenant des édificesreligieux. Notes et Monographies Techniques n°19,Ed. CNRS, Paris, 51-73.
Simon Ch., 1987Evolution de la synostose des sutures crâniennesdans quelques populations anciennes. In Duday H.,Masset Cl. - Anthropologie physique et archéologie,méthodes d’études des sépultures, CNRS, 239-244.
Simon Ch., 1990Quelques réflexions sur la paléodémographie. Bulle-tin et mémoires de la Société d’Anthropologie de Paris,n.s., t.2, n°3-4, 123-132.
Simon Ch., Leemans E., 1991Problème posé par une population moyenâgeuse dela campagne genevoise (Satigny-Genève). In :Buchet L. (dir), 1991 – Ville et campagne en Europeoccidentale (Ve-XIIIe siècle), Actes des cinquièmesjournées anthropologiques de Valbonne (21-23 mai1990), Dossier de documentation archéologiquen°14, Ed CNRS, Paris, 135-153.
Soukiassian G. , Marty B., 1996Ordan-Larroque, A. Cassan, BSR, 110-111.
Soukiassian G., 1993Piles funéraires du Sud-Ouest. Gers, Hautes-Pyré-nées, Ariège, BSR, 213-214.
Soukiassian G., Sillières P., 1994Piles funéraires du Sud-Ouest, BSR, 130.
Stloukal M., Hanakova H., 1978The length of long bones in ancient Slavonic popu-lations, with particular consideration to the ques-tions of growth. Homo, 29, 53-69.
Stutz F., 1996Les objets mérovingiens de type septentrional dansla moitié sud de la Gaule, Aquitania, XIV, 157-182.
Stutz F., 1998Les objets mérovingiens de type septentrional dansla moitié sud de la Gaule, Acta Praehistorica etArchaeologica, 30, 137-165.
Stutz F., 2000L’inhumation habillée à l’époque mérovingienne auSud de la Loire, MSAMF, LX, 33-47.
Theureau Ch., 1995Les sépultures de Tours (IV-XVIIe siècle). Etude dia-chronique et mésologique. Thèse de l’EPHE, 2 vol.,inédit.
Theureau Ch., 1998La population archéologique de Tours (IV-XVIIe
siècle). Etude anthropologique. Revue Archéologiquedu Centre de la France, supplément 14, Recherches surTours, 7.
Tillier A. M., Duday H., 1990Les enfants morts en période périnatale. In : Cru-bézy E., Duday H., Sellier P., Tillier A. M. (eds),Anthropologie et archéologie : dialogue sur lesensembles funéraires (réunion de Bordeaux, 15-16juin 1990), Bulletin et Mémoires de la Société d’Anthro-pologie de Paris, n. s., 2 (3-4), 89-98.
Treffort C., 1996L’Église carolingienne et la mort : christianisme, ritesfunéraires et pratiques commémoratives, Coll. d’histoireet d’archéologie médiévales, 3, Presses Universitairede Lyon, Lyon.
Trotter M., Gleser G., 1952Estimation of stature from long bones of AmericanWhites and Negroes. American Journal of PhysicalAnthropology, 10, 463-514.
Ubelaker D.H., 1984Human skeletal remains. Excavations, analysis, interpre-tations. Manuals on archaeology -2, revised edition,Taraxacum, Washington.
Ulrich 1965Totenhutten der neolithischen walternienburger gruppe.Alt-Thuringen, 7, 105-202.
Vallet F., 1997Regards critiques sur les témoins archéologiquesdes Francs en Gaule du Nord à l’époque de Childé-ric et de Clovis, AN, 29, 219-244.
Vidal M., 1987La nécropole d'époque mérovingienne de Venerque,Dossiers Histoire et Archéologie, 120, 80-82.
212Sous la direction de S. Duchesne et É. Crubezy
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
BibliographieSous la direction de S. Duchesne et É. Crubezy
Vidal M., 1991La nécropole mérovingienne de Rivel à Venerque(Haute-Garonne). Synthèse des résultats, Gallo-romains, Wisigoths et Francs en Aquitaine, Septi-manie et Espagne, Actes des VIIe journées internatio-nales d’archéologie mérovingienne, Toulouse 1985, p.189-204.
Vidal M.,1987-1988La nécropole mérovingienne de Venerque, Cat. de l’exposition De l’âge du Fer aux Temps Barbares. Dix ans de recherches archéologiques en Midi-Pyrénées, Mu-sée Saint-Raymond, Toulouse, p.154-158.
Vidal Ph., 1999Paléobiologie des populations du haut Moyen Âge en Lorraine, approche paléopathologique et paléoépidémiolo-gique, Thèse de doctorat, EPHE (Sciences de la Vie et de la Terre).
Ward-Perkins J.-B., 1938The sculpture..., 124-125.
Williams D.R., Woodhead C.M., 1986« Attrition ». A contemporary dental viewpoint. In : Cruwyse (dir.) - Teeth and anthropology, BAR Interna-tional serie 291.
Wylie W. L., Johnson E. L., 1952Rapid evaluation of facial dysplasia in the vertical plane. Angle Orthodontist, 22, 165-182.
Young B., 1977Paganisme, christianisation et rites funéraires méro-vingiens, Archéologie Médiévale, VII, 16-27.
Young B., 1984Quatre cimetières mérovingiens de l’Est de laFrance, Lavoye, Dieue-sur-Meuse, Mézières, Manchester et Mazerny : étude qualitative et quantitative des pra-tiques funéraires, BAR, 208.
Young B., Périn P., 1991Les nécropoles (IIIe-VIIIe siècle), Naissance des artschrétiens, Paris, 94-121.
213
Complément bibliographique
Blaizot F., Savino V., 2006Ensembles funéraires isolés dans la moyenne vallée du Rhône. In : Maufras O. (dir.), Habitats, nécropoles et paysages dans la moyenne et la basse vallée du Rhône (VIIe-XVe s.) : contribution des travaux du TGV-Médi-terranée à l’étude des sociétés rurales médiévales, D.A.F. n° 98, éd. de la Maison des sciences de l’homme, Paris, 281-338.
Brown P., 1971The World of Late antiquity, from Marcus Aurelius to Mohammad, (1e éd. Library of European Civilization), traduction française 1995 (La toge et la mitre, Thames et Hudson, Paris) et 2011 (Le monde de l’Antiquité tar-dive de Marc Aurèle à Mahomet, Editions de l’Univer-sité de Bruxelles), 47-56.
Cazes Q., 2008Saint-Sernin de Toulouse : de Saturnin au chef-d’œuvre de l’art roman, Graulhet.
Corrochano A., 2011Entre nécropoles et cimetières : tombes, lieux d’inhu-mation et mémoire funéraire à travers l’archéologie des VIIe-XIe siècles dans le sud de la France. In : Mé-moires, tombeaux et sépultures à l’époque romane, Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, tome XLII, Codalet, 59-64.
Crubézy É., Alexeev A., 2007Chamane. Kyys, jeune fille des glaces, éd. Errance, Paris.
Delaplace Ch. (dir.), 2005Aux origines de la paroisse rurale en Gaule méridionale, IVe-IXe siècles. Actes du colloque international (21-23 mars 2003), Éd. Errance, Toulouse.
Galinié H., 1997Tours de Grégoire et Tours des archives du sol. In : Gauthier N. et Galinié H. (éds), Grégoire de Tours et l’espace gaulois, Actes du congrès international, Tours (3-5 novembre 1994), Association Grégoire 94, Tours, 1997, 65-80.
Sous la direction de S. Duchesne et É. Crubezy
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
Bibliographie214
Garnotel A., Paya D., 1996Permanence et évolution du cimetière médiéval : exclusion et cohésion sociale en Languedoc du Ve siècle au XVe siècle. In : L’identité des populations archéologiques, Actes des XVIe Rencontres Internatio-nales d’Archéologie et d’Histoire d’Antibes, éditions A.P.D.C.A., Sophia-Antipolis, 303-322.
Iogna-Prat D., 2006La Maison Dieu : une histoire monumentale de l’Église au Moyen Âge (v. 800-v. 1200), éds du Seuil, Paris.
Lauwers M., 2005Naissance du cimetière : lieux sacrés et terre des morts dans l’Occident médiéval, Aubier Paris, 23-54 et 159-186.
Marrou H.-I., 1977 Décadence romaine ou Antiquité tardive ? IIIe-VIe siècle, Paris, 21-32.
Mémoires, 2011Mémoires, tombeaux et sépultures à l’époque romane, Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, tome XLII, Codalet.
Passarrius O., Donat R., Catafau A., 2008Vilarnau. Un village du Moyen Âge en Roussillon, Éd. Trabucaire, Perpignan, 149-160.
Pietri Ch., 1995Les succès : la liquidation du paganisme et le triomphe du catholicisme d’État. In : Pietri Ch. et L. (éds), Histoire du christianisme. 2. Naissance d’une chrétienté (250-430), Desclée, 399-434.
Raynaud Cl., 2010Les nécropoles de Lunel-Viel, Hérault, de l’Antiquité au Moyen Âge, éd. de l’Association de la Revue archéo-logique de Narbonnaise, Supplément 40.
Rosenwein B., 1989To be the neighbor of Saint Peter : the social meaning of Cluny’s property, 909-1049, éd. Ithaca, Cornell Univer-Ithaca, Cornell Univer-sity Press, Londres.
Schmitt J.-Cl., 1988Les « superstitions ». In : Le Goff J., Rémond R. (dir.), Histoire de la France religieuse, tome 1 Des dieux de la Gaule à la papauté d’Avignon, éd. du Seuil, Paris, 446-447.
Schneider L. (dir.), 2010 Archéologie des églises et des cimetières ruraux : les ap-ports récents de la documentation languedocienne, Dos-sier spécial de la revue Archéologie du Midi Médiéval, t. 28, Carcassonne, 131-248.
Treffort C., 2007Mémoires carolingiennes : l’épitaphe entre célébration mé-morielle, genre littéraire et manifeste politique, milieu VIIIe - début XIe siècle, Presses universitaires de Rennes.
INDEX DES FIGURES
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
215 Index des figures
Figure 1 : Localisation des sites funéraires étudiés.Figure 2 : Localisation de la basilique de la ville basse par rapport à l’habitat actuel (en hachures etaux vestiges antiques repérés (Dessin : J.-C. Liger).Figure 3 : Situation de Vindrac (Tarn). Dessin et cliché M. Bessou.Figure 4 : Situation de Lunel-Viel dans la plaine littorale languedocienne.Figure 5 : Plan général des fouilles du quartier du Plan. A l’ouest, fouilles de B. Sapène (1927-1931) ;au sud-est, la basilique chrétienne dont une partie seulement (le « narthex ») empiète sur la grandedomus occidentale ; au sud, annexes de la basilique et autre domus fouillées de 1985 à 1992 (DessinJ.-C. Liger, H. Delumeau d’après les relevés de B. Sapène et J.-L. Paillet).Figure 6 : Etat successif de l’ensemble monumental paléochrétien et localisation des inhumations(d’après dessin de J.-L. Paillet 1993).Figure 7 : Venerque. Situation de la nécropole et des sites antiques, du haut Moyen Age et médiévaux(M. Vidal).Figure 8 : Nécropole de Rivel à Venerque, plan de répartition des sépultures (M. Vidal).Figure 9 : Tombe 44, sous tuiles (B. Marty). Deux photos tombe et squeletteFigure 10 : Nécropole de Rivel, répartition des hommes, femmes et enfants (M. Vidal, d’après Th.Romon).Figure 11 : Nécropole de Rivel, plan de répartition des attitudes funéraires (M. Vidal).Figure 12 : Nécropole de Rivel, mobilier de la tombe 2 (P. Venzac).Figure 13 : Nécropole de Rivel, mobilier de la tombe 9 (P. Venzac).Figure 14 : Nécropole de Rivel, mobilier de la tombe 11 (P. Venzac).Figure 15 : Nécropole de Rivel, mobilier de la tombe 16 (P. Venzac).Figure 16 : Nécropole de Rivel, mobilier de la tombe 20 (P. Venzac).Figure 17 : Nécropole de Rivel, mobilier de la tombe 24 (P. Venzac).Figure 18 : Nécropole de Rivel, mobilier de la tombe 25 (P. Venzac).Figure 19 : Nécropole de Rivel, mobilier de la tombe 38 (P. Venzac).Figure 20 : Nécropole de Rivel, mobilier de la tombe 40 (P. Venzac).Figure 21 : Nécropole de Rivel, mobilier de la tombe 45 (P. Venzac).Figure 22 : Nécropole de Rivel, dépôt céramique entre les tombes 49 et 50 (M. Vidal).Figure 23 : Nécropole de Rivel, mobilier de la tombe 50 (P. Venzac).Figure 24 : Nécropole de Rivel, mobilier de la tombe 53 (J.-P. Muiguet).Figure 25 : Nécropole de Rivel, mobilier de la tombe 54 (J.-P. Muiguet).Figure 26 : Nécropole de Rivel, mobilier de la tombe 55 (J.-P. Muiguet).Figure 27 : Nécropole de Rivel, mobilier de la tombe 60 (P. Venzac).Figure 28: Nécropole de Rivel, mobilier de la tombe 62 (P. Venzac).Figure 29: Nécropole de Rivel, mobilier de la tombe 65 (J.-P. Muiguet).Figure 30 : Nécropole de Rivel, mobilier de la tombe 125 (D. Schaad).Figure 31 : Nécropole de Rivel, mobilier trouvé en surface (P. Venzac).Figure 32 : Nécropole de Rivel, mobilier trouvé en surface (P. Venzac).Figure 33 : Nécropole de Rivel, mobilier trouvé en surface (P. Venzac).Figure 34: Nécropole de Rivel, mobilier trouvé en surface (P. Venzac).Figure 35 : Nécropole de Montfrousi, objets mérovingiens (M. Vidal, d’après Cl. Barrière-Flavy 1891)Figure 36 : Plan général du site de La Gravette à L’Isle-Jourdain, division par zones (Barthélémy 1999)Figure 37 : Plan général du site antique et mérovingien (S. Eusèbe) (Cazes 1997)Figure 38 : Plan général des vestiges paléochrétiens (Cazes 1997).Figure 39 : Plan de localisation des principaux ensembles funéraires (Barthélémy 1999).Figure 40 : Nécropole franque de La Gravette à l’Isle-Jourdain (Barthélémy 1999).Figure 41 : Plan général du site ecclésial de La Gravette, à l’Isle-Jourdain (S. Eusèbe) (Cazes 1997).Figure 42 : Chronologie générale de l’occupation du site (Cazes 1997).Figure 43 : Villa gallo-romaine (partie thermale) et nécropole.Figure 44 : Vindrac, plan de situation de la nécropole (M. Bessou).Figure 45 : Vindrac, coupe stratigraphique, secteur MN (M. Bessou).Figure 46 : Vindrac, l’établissement rural du Haut-Empire (M. Bessou, modifié par J. Guyon et M. Vidal).Figure 47 : Vindrac, les chapelles du haut Moyen Âge (selon M. Bessou).Figure 48 : Vindrac, l’établissement rural pendant l’Antiquité tardive (M. Bessou, modifié par J.Guyon et M. Vidal).
1516
171819
21
24
252628
2930313132323334343435353637383939394041424344454749495050525358606364646667
INDEX DES FIGURES
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
216Sous la direction de S. Duchesne et É. Crubezy
Figure 49 : Vindrac, l’établissement préroman et son mur de clôture (M. Bessou).Figure 50 : Vindrac, église funéraire 3, annexe, deuxième et premier niveau de sarcophages, vue dunord-ouest (sarcophage 79 en arrière-plan ; sarcophages 87, 77, 76, 76’ en plan intermédiaire ; sarco-phage 78, 14 et 79 en premier plan) (M. Bessou).Figure 51 : Vindrac, église funéraire 3, annexe, niveau et séparation de béton au-dessus des sarco-phages 7 et 14 (M. Bessou).Figure 52 : Vindrac, les établissements funéraires du haut Moyen Âge (M. Bessou, modifié par J.Guyon et M. Vidal).Figure 53 : Vindrac, la chapelle 1.Figure 54 : Vindrac, memoria 1, premier niveau de sarcophages (37 et 40) sur l’abside et sarcophagesintérieurs 38 et 39, vue du nord (M. Bessou).Figure 55 : Vindrac, memoria ? 2, sarcophages 20 (en haut à gauche), 17, 16, 18 et 19 (M. Bessou).Figure 56 : Vindrac, église funéraire 3 (intérieur), sarcophages 72, 73 (arrière plan), 94, 95 (plan inter-médiaire), 92, 93 (premier plan) et 91 (M. Bessou).Figure 57 : Vindrac, église funéraire 3.Figure 58 : Vindrac, église funéraire 3, chevet pentagonal (M. Bessou).Figure 59 : Vindrac, église funéraire 3, annexe, premier niveau de sarcophages après enlèvement dusecond niveau (75 en arrière plan ; 83, 77, 82, 81 en plan intermédiaire ; 78, 14, 7, 15 en premier plan)(M. Bessou).Figure 60 : Vindrac, memoria 1’, étagement des sarcophages sur deux ou trois niveaux (sarcophages59, 60 du niveau inférieur ; sarcophages 54, 55, 57, 58, 56 du niveau supérieur). Au premier plan, murméridional de la nef de l’église préromane (M. Bessou).Figure 61 : Vindrac, église funéraire 3, transformation et annexe nord.Figure 62 : Vindrac, église funéraire 3, sarcophage 70, bisome ? (M. Bessou).Figure 63 : Vindrac, sarcophage 39 à l’ouverture (M. Bessou).Figure 64 : Vindrac, coin nord/nord-est de l’enclos ? nord, sarcophages 64 et 65 (M. Bessou).Figure 65 : Typologie des cuves et de leur aménagement intérieur et typologie de couvercles (M. Bes-sou, modifié par J. Guyon et M. Vidal).Figure 66 : Typologie des couvercles (M. Bessou).Figure 67 : Typologie des aménagements intérieurs des cuves de sarcophages (M. Bessou).Figure 68 : Chapelle 3 et deuxième étage de sarcophages (M. Bessou, modifié par M. Vidal).Figure 69 : Vindrac, tombes à mobilier et mobilier hors tombes (M. Bessou).Figure 70 : Mobilier in situ dans les sarcophages S4 (n°1), S5 (n°2), S7 (n°3), S15 (n°4) et S16 (n°5) (M.Bessou).Figure 71 : Mobilier in situ dans les sarcophages S19 (n°6 à 8), S21 (n°9), S31 (n°10) et S40 (n°11) (M.Bessou).Figure 72 : Vindrac, Plaque-boucle (L. 95 mm) et bague (diamètre 19 mm) de la tombe 19 (M. Bessou).Figure 73 : Vindrac, inscription en cursives sur feuille de plomb (M. Vidal, d’après M. Bessou).Figure 74 : Vindrac, feuille de plomb inscrite (M. Bessou).Figure 75 : Vindrac, Plaque-boucle à décor damasquiné (L. 80 mm) de la tombe 40 (M. Bessou).Figure 76 : Vindrac, mobilier in situ dans les sarcophages S59 (n°12 à 15) et S60 (n°16 à 19) (M. Bessou).Figure 77 : Vindrac, mobilier in situ dans les sarcophages S79 (n°20 à 26), S85 (n°27 à 28) et plaque-boucle rigide hors de la tombe 89 (n°29) (M. Bessou).Figure 78 : Vindrac, pièces d’habillement de la tombe 79 (n°6 et 7 en bronze, 1 à 3 en fer damasquiné)(M. Bessou).Figure 79 : Vindrac, Plaque-boucle (L. 78 mm) de la tombe 85 (M. Bessou).Figure 80 : Vindrac, mobilier in situ dans les sarcophages S93 (n°30), S110 (n°31 à 33) et dans la tombeen fosse R1 (n°34 à 36) (M. Bessou).Figure 81 : Vindrac, mobilier hors tombe n°37 (près du S30), n°38 (secteur H), n°39 (près du S5), n°41(fondations église funéraire 3) et n° 42 (secteur D) (M. Bessou).Figure 82 : Localisation générale des secteurs d’habitats et de nécropoles.Figure 83 : Lunel-Viel, plan de la nécropole des Horts.Figure 84 : Lunel-Viel exemple de mobilier funéraire de la nécropole des HortsFigure 85 : Lunel-Viel l’Église, les inhumations du haut Moyen Âge.Figure 86 : Lunel-Viel l’Église, l’église Saint-Vincent et le cimetière médiéval.Figure 87 : liste des sites et des données anthropologiques.
6970
71
72
7374
7576
777778
79
8081828384
8586878889
90
919293939495
96
9697
98
99100101103104105
INDEX DES FIGURES
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
217 Index des figures
Figure 88 : Liste des caractères étudiés sur les nécropoles.Figure 89 : liste des caractères étudiés sur la nécropole de la Gravette.Figure 90 : Répartition des individus présentant des hypoplasies linéaires de l’émail dentaire (LEH),selon les sites. LVE, Lunel-Viel l’Église ; LVH, Lunel-Viel Les Horts ; SBC, St-Bertrand ; VEN,Venerque ; GRA, la Gravette à l’Isle-Jourdain.Figure 91 : Désignation des dents permanentes selon l’OMS.Figure 92 : Classes parodontales.Figure 93 : Classes du tartre.Figure 94 : Classes d’usure.Figure 95 : Les différentes formes d’hypoplasie.Figure 96 : Étude des membres supérieurs des sites étudiés (en %). SBC, St-Bertrand ; LVE, Lunel-Viell’Église ; LVH, Lunel-Viel Les Horts ; VEN, Venerque ; SBCa, St-Brice de Cassan.Figure 97: Étude des membres supérieurs des sites comparés (en %).Figure 98 : Étude des membres supérieurs des sites étudiés et comparés. SBC, St-Bertrand ; LVE,Lunel-Viel l’Église ; LVH, Lunel-Viel Les Horts ; VEN, Venerque ; SBCa, St-Brice de Cassan.Figure 99 : Étude des membres inférieurs des sites étudiés (en %). SBC, St-Bertrand ; VEN, Venerque ;SBCa, St-Brice de Cassan.Figure 100 : Étude des membres inférieurs des sites comparés (en %).Figure 101 : Étude des membres inférieurs des sites étudiés et comparés. SBC, St-Bertrand ; LVE,Lunel-Viel l’Église ; LVH, Lunel-Viel Les Horts ; VEN, Venerque ; SBCa, St-Brice de Cassan ; TCJ, Tou-louse Cité Judiciaire (1999).Figure 102 : Étude du mobilier des sites étudiés (en %). SBC, St-Bertrand ; LVE, Lunel-Viel l’Église ;LVH, Lunel-Viel Les Horts ; VEN, Venerque ; SBCa, St-Brice de Cassan ; GRA hma, La Gravette (francset autochtones du haut Moyen Âge) ; GRA hma-autoch, La Gravette (autochtones du haut MoyenÂge) ; GRA franc, La Gravette (nécropole franque) ; GRA pmed, La Gravette (période médiévale).Figure 103 : Étude du mobilier des sites comparés.Figure 104 : Étude du mobilier des sites étudiés et comparés.Figure 105 : Répartition des sujets immatures selon les classes d’âge et les sites étudiés.Figure 106 : Répartition des sujets immatures des sites étudiés selon les quotients.Figure 107a : Répartition des sujets immatures de la nécropole de St-Bertrand-de-Comminges, selonles quotients. En grisé, mortalité pour une espérance de vie comprise entre 25 et 30 ans.Figure 107b : Répartition des sujets immatures des nécropoles de Lunel-Viel, selon les quotients. Engrisé, mortalité pour une espérance de vie comprise entre 25 et 30 ans.Figure 107c : Répartition des sujets immatures de la nécropole de Rivel à Venerque, selon les quo-tients. En grisé, mortalité pour une espérance de vie comprise entre 25 et 30 ans.Figure 107d : Répartition des sujets immatures de la nécropole de St-Brice-de-Cassan selon les quo-tients. En grisé, mortalité pour une espérance de vie comprise entre 25 et 30 ans.Figure 107e : Répartition des sujets immatures de la nécropole de La Gravette à la période du hautMoyen Âge (hma) et à la période médiévale (pmed), selon les quotients. En grisé, mortalité pour uneespérance de vie comprise entre 25 et 30 ans.Figure 108 : Proportions immatures/adultes selon les sites étudiés.Figure 109 : Répartition des adultes selon le sexe et les sites.Figure 110 : Répartition des sujets adultes selon les effectifs décédés (Dx), e°=25 ans.Figure 111 : Répartition des adultes (en %) selon les sites et les classes d’âge, e°0= 25 ans.Figure 112 : Données sur le nombre d'individus par tombes.Figure 113 : Répartition du nombre d'individus par tombe pour chaque site.Figure 114 : Répartition du nombre d'individus.Figure 115b : Distribution de l’indice crânien horizontal (en %).Figure 116b : Distribution de l’indice fronto-pariétal (en %).Figure 117b : Distribution de l’indice frontal transverse (en %).Figure 118b : Distribution de l’indice moyen de hauteur (en %).Figure 119b : Distribution de l’indice diaphysaire de l’humérus (en %).Figure 120b : Distribution de l’indice d’aplatissement de l’ulna (en %).Figure 121b : Distribution de l’indice pilastrique du fémur (en %).Figure 122b : Distribution de l’indice de platymérie du fémur (en %).Figure 123b : Distribution de l’indice cnémique du tibia (en %).
109110113
114115116117118122
123123
125
125126
127
128129131132132
132
132
133
133
134134
135-136-137139141142142148149150151153155156157158
INDEX DES FIGURES
Des champs d’inhumations « à la campagne » aux premiers cimetières d’églises
218Sous la direction de S. Duchesne et É. Crubezy
Figure 124 : Estimation de la stature à Saint-Bertrand-de-Comminges (SBC).Figure 125 : Distribution de la longueur des os longs.Figure 126 : Distribution de la longueur maximale du fémur.Figure 127 : Analyse en composantes principales pour les variables crâniennes.Figure 128 : Représentation des différences entre les populations étudiées.Figure 129 : Analyse en composantes principales pour les variables infra-crâniennes.Figure 130 : Analyse en composantes principales pour les variables infra-crâniennes.Figure 131 : Déformations crâniennes (a : tombe 103, masculin ; b, tombe 110, féminin ; c, tombe 116,masculin ; d, tombe 122, masculin ; e, tombe 15, masculin ; f, tome 30, féminin ; g, tombe 66, masculin).Figure 132 : Comparaisons des indices corde/arc pour les parties frontale, pariétale et occipitale (Vindrac).Figure 133 : Venerque, sujet de la tombe 30 (enfant dans son berceau) – Essai de reconstitution, E. Crubézy,1986.Figure 134 : Vindrac, sarcophage 100, sujet 2, coup sur la base du crâne du à une probable décapitation.Figure 135 : Vindrac, crâne isolé, localisation des orifices sur la face latérale gauche.Figure 136 : Vindrac, crâne isolé, localisation des orifices sur la face latérale droite.Figure 137 : Pertes ante mortem et débris radiculaires selon les sites.Figure 138 : Pertes ante mortem des nécropoles de la même époque utilisées pour comparaison.Figure 139 : Nombre de sujets atteints par la carie.Figure 140 : Moyennes des indices CA et Cas, selon les sites.Figure 141 : Moyennes des indices CA et CAs (%), selon les sites.Figure 142b : Indice CA à la mandibule (%), selon les dents et les sites.Figure 143b : Indice CA à la mandibule, selon les dents et les sites.Figure 144b : Indice CAs à la mandibule (%), selon les dents et les sites.Figure 145b : Indice CAs à la mandibule, selon les dents et les sites.Figure 146 : Évolution du nombre de sujets atteints par la carie, tous sites confondus, selon le sexe et lespériodes chronologiques.Figure 147 : Nombre de sujets et de dents atteints de parodontopathies selon les sites.Figure 148b : Indice parodontal moyen à la mandibule, selon les dents et les sites.Figure 149b : Indice parodontal moyen à la mandibule, selon les dents et les sites.Figure 150 : Atteinte parodontale selon les dents et les sites.Figure 151 : Atteinte parodontale des nécropoles de la même époque utilisées pour comparaisons.Figure 152 : Nombre de sujets et de dents atteints de tartre selon les sites.Figure 153b : Indices de tartre à la mandibule, selon les dents et les sites.Figure 154b : Indices de tartre à la mandibule, selon les dents et les sites.Figure 155 : Nombre de sujets et de dents atteints de tartre dans les nécropoles de la même époque utili-sées pour comparaisons.Figure 156 : Degré de tartre selon les nécropoles utilisées pour comparaisons.Figure 157 : Nombre de sujets et de dents atteints d’usure dentaire selon les sites.Figure 158 : Répartition des stades d’usure dentaire selon les sites.Figure 159b : Indices d’usure selon les dents mandibulaires et les sites.Figure 160b : Indices d’usure selon les dents mandibulaires et les sites.Figure 161 : Répartition en % de chaque degré d’usure selon le sexe, Saint-Brice-de-Cassan (SBCa)Figure 162 : Degré d’usure dentaire selon les nécropoles utilisées pour comparaisons.Figure 163 : Répartition des sujets selon l’âge et les sites.Figure 164 : Répartition des adultes selon les sites.Figure 165 : Répartition des dents hypoplasiées selon le type de dents et les sites.Figure 166 : Répartition des dents hypoplasiées selon les sites.Figure 167 : Répartition du nombre moyen d’hypoplasies.Figure 168 : Statistiques descriptives de la variable nombre de stress par sujet pour chaque nécropoleFigure 169 : Répartition des effectifs pour l’étude de l’intensité du stress selon les sites.Figure 170 : Répartition des stress selon leur intensité et les sites (en %).Figure 171 : Répartition des stress selon leur intensité et les sites (en %).Figure 172 : Proportion des classes d’âge d’apparition du stress sur l’ensemble de la populationFigure 173 : Âge d’apparition du stress selon les classes d’âge et les sites.Figure 174 : Âge d’apparition du stress selon les classes d’âge et les sites.Figure 175 : Répartition du stress selon les nécropoles utilisées pour comparaisons.
159160160161162162163
164-165
166167
169170171173174175175175175176177177179
180180-181180-181
181182182183
183-184185
185185186186187187189189189190190191191192192192193193194194
ont participé à cet ouvrage
Presses universitaires de Perpignan
Ministère de la Culture et de la Communication – sous-direction de l’archéologie
Conseil général de la Haute-Garonne
Conseil général du Tarn
Laboratoire d’anthropologie moléculaire et imagerie de synthèse de l’université Paul Sabatier à Toulouse
Institut national de recherches archéologiques préventives
Centre de recherches historiques sur les sociétés méditerranéennes - CRESEM - UPVD
Université de Perpignan Via Domitia
Ouvrage dirigé par Sylvie Duchesne & Éric Crubézy
avec les contributions de
M. Aguerre, odontologiste, anciennement laboratoire d’anthropobiologie de Bordeaux I
S. Bach, Service régional de l’archéologie et de la connaissance (Midi-Pyrénées), UMR 5608 Traces, Université de Toulouse
I. Barthélémy, Pr chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, Clermont Ferrand, anciennement UMR 5288
M. Bessou (†), archéologue, prêtre, archéologie paléochrétienne, Tarn
Y. Bruzek, Directeur de recherches CNRS émérite, UMR 5199, PACEA, Université Bordeaux 1
A. Catafau, maître de conférences, Université de Perpignan
J.-P. Cazes, archéologue, CCS Patrimoine
É. Crubézy, Pr. d’anthropobiologie, UMR 5288 CNRS, Université de Toulouse
S. Duchesne, chargée d’opération et de recherches, Inrap, UMR 5288, AMIS, Université de Toulouse
Ch. Duhamel, anciennement INRAP et laboratoire d’anthropobiologie de Bordeaux I
P. Dupouey, archéologue, Médecin, Ordan Larroque, Gers
P. Gaury, odontologiste, anciennement laboratoire d’anthropobiologie de Bordeaux I
J. Guyon, directeur de recherches émérite, UMR 6573, Centre Camille Julian, Université de Marseille
A. Martin, archéologue, Ordan Larroque, Gers
L. Morel, odontologiste, anciennement centre d’anthropobiologie, Toulouse
P. Murail, anciennement Pr. en anthropobiologie, laboratoire d’anthropobiologie de Bordeaux I
Cl. Raynaud, directeur de recherches CNRS, UMR 5140, Lattes
F.-X. Ricaut, chargé de recherches CNRS, UMR 5288, AMIS, Université de Toulouse
T. Romon, assistant d’étude et d’opération, Inrap, UMR 5199, PACEA, Université de Bordeaux 1
D. Rougé, Pr. de médecine légale, identification, UMR 5288, AMIS, Université de Toulouse
S. Sainte-Marie, odontologiste, anciennement laboratoire AMIS Toulouse
M. Vidal, anciennement conservateur régional de l’archéologie, UMR 5608 Traces, Université de Toulouse