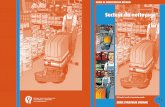Etude dendrochronologique du secteur « Saint-Nazaire » à Autun (France, Saône-et-Loire, 71)
Le marché européen du carbone adapté au secteur aérien : l'UE comme acteur de droit global ?
Transcript of Le marché européen du carbone adapté au secteur aérien : l'UE comme acteur de droit global ?
1
TRAVAIL DE FIN D’ETUDES
*
Master Complémentaire en Droit Européen
L'intégration du secteur aérien international au marché européen du carbone :
L'Union comme acteur du droit global ?
Réalisé sous la direction de
Benoît Frydman
Par
Jonathan Peuch
2013/2014
Institut d’Etudes Européennes, Bruxelles
3
Sommaire
Table des illustrations ........................................................................................................................... 3
Liste des principales abréviations ........................................................................................................ 4
Introduction ........................................................................................................................................ 6
I – Les politiques climatiques de l'Union et la pertinence de la théorie du droit global ............ 12
1) Les politiques européennes sur le changement climatique ............................................ 12 a) Histoires et principes des politiques contre le changement climatique ........................... 12 b) Aux origines de l'EU ETS : le protocole de Kyoto .......................................................... 15
2) Le marché européen du carbone : fonctionnement et limites ........................................ 18
3) Le marché européen du carbone : entre droit global et droit international ? ................ 23
II – L'intégration du secteur aérien au marché du carbone européen : l'Union comme acteur
international ? .................................................................................................................................. 27 1) Le secteur aérien : polluant et international ........................................................................ 27
2) L'intégration du secteur aérien civil au SEQE .................................................................... 30 3) L'affaire 366/10, un coup d'arrêt à la politique de l'Union .................................................. 33 4) Extraterritorialité politique c. Territorialité juridique .......................................................... 36
5) Les actes dérogatoires : quand le droit européen est suspendu ........................................... 38
III – Les stratégies globales de l’EU ETS ...................................................................................... 42 1) L'EU ETS : un modèle pour convaincre .............................................................................. 42 2) Diffuser le SEQE et les mécanismes basés sur le marché ................................................... 44
3) Quels éclairages de la théorie du droit global sur l’affaire ? ............................................... 50
Conclusion......................................................................................................................................... 53
Bibliographie .................................................................................................................................... 55
Table des illustrations
1) Quantité de crédits MDP attendus d’ici à 2012 par type de projet et par pays. Page 18.
2) Apports successifs des 3 phases au SEQE. Page 20.
3) Evolution du prix des quotas (2008-2013). Page 22.
4) Part du secteur des transports dans les émissions de GES dans l’UE (2010). Page 28.
5) Compagnies aériennes européennes et autres par Etats membre (2012). Page 31.
6) Carte globale des systèmes d’échange de quota d’émission (2013). Page 45.
7) Secteurs couverts par les ETS internationaux (2014). Page 47.
4
Liste des principales abréviations
ATA
CE
CJUE
CJCE
CO2
CCNUCC
CSC
ECX
EEE
ETS
EU
FOEN
GES
GIEC
IATA
ICAP
IETA
MBM
MDP
MOC
OACI
OJNI
OMC
ONG
ONU
PPMV
Q
SCEQE
SEQE
TFE
TFUE
TUE
UE
UQA
Air Transport Association
Commission Européenne
Cour de Justice de l’Union Européenne
Cour de Justice des Communautés Européennes
Dioxyde de Carbone
Convention-Cadre des Nations Unis sur le Changement Climatique
Captage et Stockage du Carbone
European Climate Exchange
Espace Economique Européen
Emission Trading Scheme
European Union
Federal Office for the Environment (Suisse)
Gaz à effet de serre
Groupe International pour l’Etude du Climat
International Air Transport Association
International Carbon Action Partnership
International Emissions Trading Association
Mécanisme Basé sur le Marché (Market-Based Mechanism)
Mécanisme de Développement Propre
Mise en Œuvre Conjointe (projet de)
Organisation de l’Aviation Civile International (ICAO)
Objet Juridique Non Identifié
Organisation Mondiale du Commerce
Organisation Non Gouvernementale
Organisation des Nations Unis
Parties par millions en volume
Quota
Système Communautaire d’Echange de Quota d’Emissions de gaz à effet de serre
Système d’Echange de Quota d’Emissions de gaz à effet de serre
Travail de Fin d’Etudes
Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne
Traité sur l’Union Européenne
Union Européenne
Unité de Quantité Attribuée
6
Introduction
La politique européenne de lutte contre le réchauffement climatique est l'une des plus
ambitieuses du monde, en même temps qu'elle est pleine de contradictions et d'égarements : de
contradictions, car sans cesse en collision avec d'autres acteurs, d'autres instruments, d'autres
manières de voir ; et d'égarement, car ces contradictions obligent à des vas-et-viens incessant entre
le « pouvoir » et le « vouloir ». Ce mémoire se propose de se pencher sur l'un des éléments de ce
grand puzzle, à savoir la volonté de l'Union européenne d'imposer au secteur aérien mondial son
système de réduction des émissions de gaz à effet de serre, volonté que l'on pourrait qualifiée de
globale dans ses limites abstraites (principe d'extra-territorialité). Le marché européen du carbone,
qui vise à régir les émissions de CO2 en leur fixant un prix, a été étendu à tous les vols entrants ou
sortants du territoire de l’Union. La Commission s'est heurtée aux vives oppositions du secteur
aérien international1, soutenu par la diplomatie des États-Unis, de la Chine, et de la Russie en tête.
Ces quelques lignes sont pleines d'évocation dont la définition et la mise en ordre seront la
principale préoccupation de ce mémoire. Ce dernier se situe au cœur d'un nœud que le politique et
le droit ont formé et que nous allons essayer de dénouer.
L’Union européenne comme acteur politique global est le personnage politique central de ce
mémoire, parce qu'il est engagé dans des politiques climatiques internes, mais aussi parce qu'il est
lié à un contexte extérieur exigeant et mouvant. Il convient d’emblée de définir la notion de
« global » qui renvoie à la théorie du droit global. Nous entendons par « droit global » un ensemble
de « normes et de dispositifs de contrôle qui ressemblent à des instruments juridiques de par la
fonction de régulation qui leur est assignée et qu’ils remplissent plus ou moins efficacement, mais
qui en diffèrent radicalement par les formes et les moyens qu’ils empruntent2 ». Il s’agit de penser
les transformations du droit dans la mondialisation, ou plutôt des formes de régulation qui
empruntent au juridique mais s’en écartent dans leurs sources et les ordres auxquels ils se réfèrent.
L’objet de la théorie du droit global est justement de s’efforcer de parvenir à une définition claire de
sa nature, qui en reste pour l’instant au stade de chantier auquel ce TFE cherche à apporter sa pierre
dans le domaine de la protection de l’environnement. En bref, « global » au sens de la théorie du
droit global relève de montages de dispositifs régulatoires3, et s’oppose avant tout à l’analogie du
changement d’échelle. Le droit global n’est pas une image du droit national élargi au monde. Sa
nature change en ce qu’il n’y a pas de supra-Etat mondial. Ce n’est pas non plus du droit
international qui est davantage figé dans sa forme et qui relève des rapports et autres interactions
historiques entre les Etats souverains. L’analyse de ce concept de « droit global » se poursuivra au
long de notre travail.
Le traité de Lisbonne fixe un cap et un cadre juridique à la politique de l’Union dans le
domaine de l’environnement avec la « promotion, sur le plan international, de mesures destinées à
faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement, et en particulier la lutte
contre le changement climatique » (article 191 TFUE). Suivant cette disposition, l'UE cherche
incontestablement à se positionner à l'international comme un acteur incontournable, surtout depuis
1 Voir de nombreux articles dans la presse européenne qui seront analysés plus bas dans le TFE. Notamment : El
Pais, « Una coalición antieuropea por la tasa del CO2 a los aviones », 21/02/2012 ; Financial Times, « China bars airlines from EU carbon tax », 06/02/2012 ; PressEurop, « Bras de fer UE-Chine sur le CO2 », 07/06/2011 ; Le Monde, « Le transport aérien fustige les quotas de CO2 que l'Europe lui imposera en 2012 », 06/06/2011.
2 Frydman, Benoît, « Comment penser le droit global ? », in : J.-Y. Chérot et B. Frydman (dir.), La science du droit dans la globalisation, Bruylant, Bruxelles, 2012, pp.17-48.
3 Dans le domaine de la science politique, cet effort de définition provoqué par la prise en compte de la mondialisation se retrouve en grande partie dans la notion de « régime complexe », telle qu’envisagée par exemple dans l’article suivant : Amandine Orsini, Jean-Frédéric Morin, Oran Young, « Regime Complexes : a Buzz, a Boom or a Boost for Global Governance ? », in : Global Governance n°19, 2003, p. 27-39.
7
que ses États membres ont décidé de lui attribuer le soin de superviser leurs politiques de réduction
d'émission de gaz carbone. Elle a mis en place un nombre impressionnant d'instrument, dont celui
qui nous occupera au long de cet exposé : le système d'échange de quota d'émission de gaz à effet
de serre (plus connu sous son appellation anglaise Emission trading Scheme – ETS, nous
l'appellerons « marché du carbone » par la suite) est établi par la directive 2003/87/CE, sur laquelle
nous reviendrons en détail dans notre deuxième chapitre.
Ce sujet est particulièrement saillant dans le contexte international car en 2015 aura lieu à
Paris la 21e Conférence des Parties à la Convention-Cadre des Nations Unis sur le Changement
Climatique (CCNUCC), dont l'objet sera de proposer un nouvel accord mondial de lutte contre le
réchauffement climatique en remplacement du Protocole de Kyoto. L'instrument qui ressortira des
négociations devra relever le défi de parvenir au consensus le plus large possible au niveau mondial
afin de garantir l'effectivité et l'application des décisions, tout en définissant des objectifs par nature
capables d'éviter une hausse des températures qui seraient catastrophiques pour la planète et ses
habitants. Les rapports du Groupe International pour l'Etude du Climat (GIEC) font références pour
la définition scientifique des seuils d'élévation des températures et des risques inhérents4. Le
Protocole de Kyoto cumule de nombreux défauts qu'il faut combler : objectif peu ambitieux, Etats
non signataires, engagement non contraignant, et imprécisions quant aux instruments.
Sur le plan intérieur, le Système d’Echange de Quota d’Emissions de gaz à effet de serre
(l’adjectif Communautaire a été supprimé depuis environ 2012 dans la doctrine) est l'initiative
européenne qui vise à remplir les obligations que l’Union et ses Etats membres ont contractées au
niveau international, à savoir une limitation à 2°C des températures grâce, entre autre, à une
réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à l'année de référence 1990.
L'agenda du marché du carbone européen est parallèle à celui de Kyoto. Il établit une « bulle »
fixant un objectif européen commun et permet une répartition des obligations contractées à
l'international. Son fonctionnement général est de mettre en place un marché de crédit-carbone qui
corresponde à des émissions d'air pollué. Ces crédits sont plafonnés dans le but d'organiser leur
rareté, et se faisant de fixer un coût qui doit inciter les entreprises concernées à investir dans des
moyens de production moins polluant. L'objectif étant que le coût des crédits-carbones doit être
supérieur aux coûts des investissements qui permettrait une baisse des émissions, et donc des
économies de crédit.
L'Union a par ailleurs repris les mécanismes de flexibilité qui sont définis par le Protocole
de Kyoto, qui permettent d'ajouter des crédits-carbones à ceux mis en circulation dans le marché. Le
Mécanisme de Développement Propre (MDP) permet à des entreprises d'investir dans des projets
économiques de développement durable dans certains pays du sud, dit de l'Annexe 2, en échange de
crédits délivrés par une autorité indépendante. Le mécanisme de Mise en Œuvre Conjointe (MOC)
permet aux États industrialisés de l’annexe 1 de développer ensemble des projets de réduction de
gaz à effet de serre. Ces mécanismes de flexibilité participent à l'augmentation du volume de crédit-
carbone disponible sur le marché. Or, le marché du carbone est soumis à de vives critiques en ce
qu'il peine à produire l'effet incitatif requis5. En effet, le volume de crédit-carbone disponible étant
4 « Telle qu’elle fut formulée en 1988 par l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et le Programme des Nations
unies pour l’environnement (PNUE), la mission du GIEC était de délivrer une expertise disciplinaire à caractère global au sujet des fondements scientifiques du changement climatique d’origine anthropique, censée refléter l’état des connaissances les plus poussées disponibles au sein des communautés scientifiques associées à ses travaux. En 1995, le GIEC fut lié à un nouveau commanditaire : la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. » Frydman, B., Ost, F., Van Waeyenbere, A., Les instruments juridiques et financiers de la lutte contre le réchauffement climatique, Working Papers du Centre Perelman de Philosphie du Droit, 01 (2011). http://philodroit.be
5 Ces critiques sont reconnus largement, par des ONG mais aussi par la Commission elle-même. En témoigne la Décision 1359/2013/UE du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 modifiant la directive 2003/87/CE afin de préciser les dispositions relatives au calendrier des enchères de quotas d'émission de gaz à effet de serre.
8
trop élevé, son prix est trop bas et le marché connaît un surplus structurel qui n’incite pas les
investissements.
Ces quelques mots plantent succinctement un décor politique et juridique qui a été perturbé
par un élément concernant la définition du champ d'application du marché du carbone, qui est limité
aux acteurs auxquels il impose des obligations. En effet, les États se sont engagés sur des objectifs
de réduction d'émission qu'ils doivent répercuter sur les unités émettrices présentes sur leur
territoire. Les secteurs concernés sont repris au titre de l'annexe 1 de la Directive 2003/87/CE du 19
juillet 2003. Il s'agit principalement des industries lourdes des secteurs de l'énergie, de la production
ou de la transformation de métaux ferreux, de l'industrie minérale, et des papeteries. Étaient
notamment exclus du projet initial de la directive initial les secteurs, pourtant très polluants, des
transports et de l'agriculture. C'est en étendant l'application du marché du carbone au secteur aérien
que l'Union a dû faire face à des obstacles au niveau international, et, finalement, reculer sur
certains points.
Cette modification paraît purement juridique au premier abord, et cohérente avec l'objectif
de la politique de lutte contre le changement climatique ; elle a suscité une levée de bouclier de la
part des compagnies aériennes américaines qui ont mené le problème devant la Cour de Justice de
l'Union européenne. Celle-ci a rendu, en Grande Chambre, l'arrêt C-366/106 qui a fait couler
beaucoup d'encre et a embarrassé la Commission européenne à bien des égards.
Cet arrêt est le point de départ de notre analyse et est une étape cruciale dans le litige qui
oppose, en l'espèce, la Air Transport Association of America et plusieurs compagnies aériennes
américaines, à la directive de l'Union qui est défendue par le Secretary of State for Energie and
Climate Change devant la High Court of Justice (England and Wales). Il s’agit d’une question
préjudicielle, dont l’objectif est, dans le cadre d’un dialogue entre juges, soit d’apprécier la validité
d’un acte, soit d’interpréter le droit européen. En l’espèce, il est demandé à la Cour de se prononcer
sur la validité de la directive 2003/87/CE7 au regard de certains principes coutumiers de droit
international, de la convention de Chicago (1958) qui réglemente l'aviation civile, du protocole de
Kyoto, et de l'accord Ciel Ouvert qui concerne les États-Unis et l'Union européenne. La volonté des
requérants est ici de rendre inapplicable l’acte en question au cas où la Cour le reconnaisse illégal. Il
ne s’agit pas d’une procédure en annulation. Nous reviendrons en détail sur cet arrêt dans notre
chapitre 2.
Pour l'instant, il nous importe de connaître la décision de la Cour, qui a déclaré que la
directive était valide au regard des moyens invoqués du droit international. Deux points doivent ici
retenir notre attention. Premièrement, la directive ne méconnaît pas le principe de territorialité en ce
qu'elle s'applique aux aéronefs en provenance ou au départ des territoires de l'Union. Or, les
requérants soutenaient que certains vols de nature international ne saurait relever d'un autre État que
celui où est établi le siège social de la compagnie. Deuxièmement, le contrôle des émissions de
carbone doit prendre en compte la durée complète du vol, et non seulement celui comprenant le
temps de survol du territoire UE, car le droit de l'Union vise un « niveau élevé de protection de
l'environnement ». Ces deux points nous occuperons longuement dans le mémoire, car ils illustrent
la volonté de l'Union de légiférer largement sur ces matières, avec l'échelle globale en ligne de mire.
L'obstacle auquel la Commission a dû faire face est le suivant : malgré la limpidité de
l'interprétation de la Cour de Justice, les compagnies internationales vont refuser de se plier au droit
européen. Elles vont contester l'argument du niveau élevé de protection, mais cette fois-ci, non plus
devant tribunal, mais bel et bien dans la sphère diplomatique. Ainsi, le 16 décembre 2011, Hillary
6 C.J.U.E. (grande chambre), 21 décembre 2011, (Air Transport Association of America), C-366/10, I-13755.
7 Directive n°2003/87/CE du parlement européen et du conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.
9
Clinton, alors secrétaire d'Etat américaine, envoyait un email à la Commissaire européenne au
Climat, Mme Connie Hedegaard, pour lui demander d'annuler ou de suspendre l'arrêt de la Cour.
Autre exemple, la Chine n'est pas en reste, à dénoncer une décision « unilatérale » de l'UE8.
Ces pressions, dont la nature diplomatique les exclue de l’ordre juridique stricto sensu, vont
pourtant avoir un impact très important sur la nature du droit européen, et va ouvrir un moment
auquel nous nous efforcerons d'être attentif : la Commission européenne va proposer une décision
visant à suspendre l'application du droit européen, car en effet, les partenaires internationaux
refusent de se soumettre aux quotas carbones. Mais comment l'organe exécutif de l'architecture
institutionnelle de l'Union peut-elle proposer de suspendre l'application de son droit ? Quelles
justifications internes vont être invoquées pour convaincre le Parlement et le Conseil de voter une
« dérogation » à l'application de la directive modifiée 2003/87/CE ? En quoi est-ce que
l'Organisation Internationale de l'Aviation Civile est-elle plus compétente que l'Union pour définir
les actes s'appliquant sur son territoire ?
Ces interrogations sont de l'ordre de la technique juridique. Elles ouvriront la question
centrale de ce mémoire qui concerne l'attitude de l'Union dans le monde au regard de ce cas. Si
l'article 191 TFUE vise la promotion de la politique environnementale de l'Union à l'extérieur, il
semblerait que la Commission ait pris son interprétation à la lettre, comme si le droit européen
pouvait octroyer des pouvoirs allant par-delà du politique, allant par-delà la souveraineté territoriale
des Etats. Les réticences diplomatiques ont eu un effet certain sur le droit de l'Union. Elles ont
rappelé à la Cour de Justice que le droit n'est pas un élément autonome de la mondialisation qui se
construit dans interdépendance du droit et du politique au niveau international. Force est de
constater qu’il n’existe ni un ordre juridique global, ni une absence de régulation, mais un
enchevêtrement d’ordres et de normes9. La théorie du cosmopolitisme relève, dans la discipline de
la philosophie politique, particulièrement les allers et retours du droit et du politique, notamment
dans la matière des droits de l’homme10
.
La problématique qui sera le fil rouge de ces lignes peut à présent être posée de manière
adéquate. Elle consiste à s'interroger, prenant cet arrêt de la CJUE comme expression de la volonté
de l'Union, sur la stratégie de cette dernière, sur son influence, sur la place du droit de l'Union dans
« l'ordre mondial ». Elle est formulée comme suit : « L'échec apparent de l'intégration du secteur
aérien mondial au marché européen du carbone peut-il nous renseigner sur la nature de l'Union
comme acteur du droit global ? ». Si on peut critiquer l'hubris de l'Union, la démesure des objectifs
de l'article 191 TFUE dans sa volonté de régler les problèmes environnementaux mondiaux, il est
aussi notable que la portée de ces politiques n'est pas sans conséquence. L'hypothèse de ce TFE est
la suivante : en acceptant que les négociations internationales se passent dans l'enceinte de l'OACI,
l'Union, d'une part, impose un agenda, et de l'autre, applique le principe de subsidiarité à l'échelon
global : s’il existe un organe global, multilatéral, plus pertinent que l'Union pour réglementer la
pollution de l'air du secteur aérien, il s'avère être adéquat de s'y rendre. Toutefois, la théorie du droit
global supporte l'argument que le développement d'un assemblage de politiques et de règles qui ne
se cristalliserait pas en un traité international traditionnel serait également à même d'apporter une
régulation, bien que décentralisée, à l'échelle mondiale.
Les instruments méthodologiques que nous allons déployer pour mener notre analyse
mélangent deux approches : d’une part, la technique juridique pure et d’autre part, la méthode de
l’étude de cas telle qu’elle a pu être menée par les tenants de la théorie du droit globale. La
technique juridique11
va se porter notamment sur les modifications apportées à la directive
8 Quatremer, J., « Transport aérien : la guerre des gaz à effet de serre aura-t-elle lieu ? », Blog Les coulisses de
Bruxelles, 21/12/2011.
9 Frydman, B., Op. Cit., section 1.2 : « Penser le droit sans l’ordre juridique », p.21-24.
10 Beck, U., Qu’est-ce que le Cosmopolitisme ?, édition Flammarion, 2006, p.273-285.
11 Corten, O., Méthodologie du droit international public, Bruxelles, édition de l’Université de Bruxelles, 2009.
10
2003/87/CE afin de permettre la dérogation à son application au secteur aérien, le temps que
l’Organisation Internationale de l’Aviation Civile prétende établir un cadre réglementaire. Elle va
permettre de mieux comprendre les principes et les justifications apportées par les institutions pour
ne pas appliquer correctement le droit européen tel qu’interprété par la Cour. La méthode de l’étude
de cas privilégie une approche multidisciplinaire et une multiplication des sources pour mieux
cerner le contexte politique et juridique dans lequel s’inscrivent le marché du carbone et le secteur
aérien12
. Nous nous inspirons des travaux précédents produits par le Centre Perelman pour déployer
notre analyse13
.
Cette approche s'avère être plus pertinente que celle qui transposerait les concepts de
souveraineté au niveau international. En effet, on pourrait considérer que le passage du droit
européen au droit international serait un échec de l'Union, qui une fois de plus aurait prouvé que
l'Europe est un État régional raté, sans influence et soumis aux dictats des Américains et des
Chinois. Néanmoins, cette analyse mettrait de côté la nature particulière de l'Union qui se définit
plus par sa vocation multilatérale et supranationale que par sa capacité à imposer ses décisions par
la force. On parle traditionnellement de soft power. Si l'OIAC adopte, suite à la détermination de la
Cour de Justice et aux coups de butoir des partenaires internationaux de l'Union, une réglementation
internationale concernant les règles environnementales de l'aviation civile, il sera impossible de
qualifier l'action de l'Union comme une reculade. Ce sera, au contraire, une promotion pleine et
entière de « mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de
l'environnement ». Cependant, le temps d'un accord international formel n'est pas arrivé, et les
politiques qui existent aujourd'hui en la matière de la pollution du secteur aérien sont encore
fragmentées. Une approche de ces phénomènes par la droit global sera, nous le verrons, propice à
mettre à jour certaines stratégies importantes. L'aboutissement de ce raisonnement est que l'ordre
international pourrait, soit, effectuer un pas de plus vers une approche multilatérale, qui consisterait
en une harmonisation juridique internationale de la matière du changement climatique, ou bien, que
l’Union européenne mènerait, parallèlement, une stratégie normative, en dehors du cadre classique,
mais qui participerait à la construction de régimes régulatoires hybrides.
Le plan qui structure cette réflexion reflète les différentes interprétations juridiques possibles
quant au rôle de l'Union Européenne dans la configuration des règles juridiques et normatives
mondiales. Sa première partie analyse en profondeur le fonctionnement et la structure du marché
européen du carbone, et effectue un tour d'horizon des autres politiques européennes mises en place
pour lutter contre le réchauffement climatique. Il sera question à cet endroit de saisir l'objet
« marché du carbone européen » tel qu'il est promut par l'UE sur le plan global, et tel qu'il est conçu
à l'exclusion du secteur aérien. Nous prendrons aussi le temps de distinguer précisément les notions
de droit global et de droit international, et d'envisager leurs manières respectives d'envisager la
matière du marché du carbone. Dans un second temps, nous nous tournerons vers les textes
réglementaires et surtout l'arrêt 366/10 de la Cour dont le contenu clarifie le champ d'application de
la directive 2003/87/CE. La spécificité de l'approche européenne sera soulignée, tout comme sa
stratégie pour promouvoir sa politique de lutte contre le changement climatique. A cet endroit, nous
décrirons en profondeur la méthode qu’a utilisée la Commission pour suspendre le droit européen
suite à la pression de ces partenaires internationaux dans l’OACI. Cet « échec » du droit ouvrira la
porte à la dernière partie de notre TFE, dont l’objectif est de mettre à jour les stratégies originales
de l’Union pour continuer à pousser en faveur d’une expansion des mécanismes basés sur le
marché. Ces stratégies émergent devant nous grâce à la théorie du droit global, car elles visent à
mettre en place des instruments à forte portée normative et régulatrice sans passer par l’ordre
juridique international. L'enjeu théorique finalement déployé par cette étude de cas est important
12 Frydman, B., op. cit., p. 40.
13 Voir chapitre 1.3 ; Rorive, I., « Regulating Internet Content through Intermediaries in Europe and the USA » (avec B. Frydman), Zeitschrift für Rechtssoziologie, vol. 23, (2002), pp. 41-59.
11
pour comprendre la genèse des normes juridiques globales en prenant l’exemple de la régulation des
émissions de gaz à effet de serre dans le secteur aérien international.
12
I – Les politiques climatiques de l'Union et la pertinence de la théorie du droit global
Cette première partie a pour vocation de présenter le fonctionnement du marché européen du
carbone (European Trading Scheme Ŕ EU ETS), sa place parmi les autres politiques climatiques de
l'Union, à l'intérieur du protocole de Kyoto, et la façon dont ce cas peut être étudié à l'aune la
théorie du droit global. Le Centre Perelman a déjà conduit des travaux à ce propos, dont une série
de conférences stimulantes dans laquelle nous puiserons14
.
1) Les politiques européennes sur le changement climatique
a) Histoires et principes des politiques contre le changement climatique
Le considérant 3 de la Directive 2008/101/CE expose à merveille la préoccupation de
l'Union quant à l'état du climat. Nous lui laissons d’amblé la parole : « Les découvertes scientifiques
les plus récentes, dont fait état le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
(GIEC) dans son quatrième rapport d’évaluation, démontrent encore plus clairement que les effets
néfastes des changements climatiques constituent une menace de plus en plus grave pour les
écosystèmes, la production alimentaire et la réalisation des objectifs du développement durable et
des objectifs du millénaire pour le développement, ainsi que pour la santé et la sécurité humaines.
Pour que l’objectif de 2 °C puisse être atteint, il est nécessaire de stabiliser la concentration de gaz à
effet de serre dans l’atmosphère à environ 450 ppmv équivalent CO2; pour ce faire, les émissions
planétaires de gaz à effet de serre devront atteindre leur maximum dans les dix à quinze prochaines
années et enregistrer des réductions mondiales considérables pour atteindre un niveau inférieur d’au
moins 50 % à celui de 1990 d’ici à 2050. » Par quelles étapes est passée l'Union européenne pour
adopter cette vision quasi catastrophique du changement climatique?
Les effets sur la nature et les sociétés humaines du réchauffement climatique sont prouvées
de manière quasi-irréfutable par les scientifiques du GIEC, de même que l'influence anthropique sur
le changement climatique. Son cinquième et dernier rapport15
, divisé en plusieurs volets publiés
entre septembre 2013 et avril 2014, a revu à la hausse, dans son jargon scientifique, la probabilité
que les hommes soient responsables du réchauffement (très probable : 95%-100%). Cependant, la
préoccupation publique est déjà ancienne ; les grandes étapes historiques de la lutte contre le
changement climatique peuvent être synthétisées comme suit.
La période inaugurée par le Sommet de Stockholm en 1972, le premier du genre organisé
par les Nations Unis et réunissant plusieurs centaines d'acteur, fût porteuse des premières politiques
de l'Union Européenne (la Communauté à ce moment là). À l’origine du traité de Rome, il n'existe
pas de fondement juridique à la politique communautaire de l'environnement. Les institutions ont
alors recours à l'article 100 CE qui permettait au Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la
Commission, d'arrêter « les directives pour le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des États membres qui ont une incidence directe sur
l'établissement ou le fonctionnement du marché commun. » C'est ainsi qu'est adopté en 1972 le 1er
Programme d'action pour l'environnement.
Il faut attendre l'Acte unique de 1986 pour que des dispositions spécifiques relatives à
14 Collectif, Les instruments juridiques et financiers de la lutte contre le réchauffement climatique. Working Papers du
Centre Perelman de Philosophie du Droit, 2011/01, http://www.philodroit.be
15 Groupe d'Expert International sur l'évolution du Climat, « Report : Climate change 2013 », disponible en ligne : http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/. D'autres documents et résumés sont disponibles sur le même site internet.
13
l'environnement apparaissent dans les traités. Depuis, elle ne cesse de prendre de la place dans la
vie de l'Union, d'une part en ce que les atteintes à l'environnement sont de plus en plus visibles,
présentes et scientifiquement documentées, d'autre part parce que les préoccupations des
populations sur ces sujets ouvrent une fenêtre politique médiatique importante pour les hommes et
femmes politiques, et les institutions.
Par la suite, le traité d'Amsterdam approfondit les compétences de l'Union dans le domaine,
et intègre le concept de développement durable dans les textes : « un développement qui répond aux
besoins présents sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs ». Plus
qu’ambiguë, cette expression a vue le jour politiquement en 1987 avec le rapport Brundtland, du
nom de sa présidente, chef du gouvernement de Norvège de l'époque, présenté lors du Sommet de
Rio. Il représente bien le compromis existant, depuis lors, entre les exigences d'une croissance
économique et la préoccupation pour l'environnement. D'après Marc Pallemaerts, le concept de
développement durable peut être considéré tour à tour comme « une remise en question de la
finalité du développement », et surtout comme « un synonyme de croissance économique ». Cette
ambivalence « le rend vulnérable à des réinterprétations privilégiant sa dimension économique aux
dépens de la protection de l'environnement16
». Cette exigence de conciliation est un pôle politique
des débats sur le changement climatique qui continue jusqu'à aujourd'hui17
.
Le dernier traité, celui de Lisbonne insiste sur le rôle international que doit jouer l'UE dans
la « promotion de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de
l'environnement » (art 191 TFUE). A cette occasion, une Direction Générale « Action pour le
Climat » a été mise en place, de même qu'on a nommé un Commissaire correspondant à
l'institution, qui est actuellement Connie Hedegaard. La prochaine étape importante concernant la
lutte contre le réchauffement climatique s'écrira en 2015, à Paris, lors des négociations qui doivent
aboutir à l'adoption d'une nouvelle réglementation internationale devant prendre la suite du
protocole de Kyoto.
Dans une Communication en date du 10 janvier 2007, la Commission réitère les objectifs et
préoccupations de l'Union européenne en la matière18
. Depuis le traité de Lisbonne, ils sont fixés
par les articles 191 et 193 TFUE. Ces objectifs sont la préservation, la protection et l’amélioration
de la qualité de l’environnement, la protection de la santé des personnes, l’utilisation prudente et
rationnelle des ressources naturelles, la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à
faire face aux problèmes régionaux ou mondiaux de l’environnement.
La Commission appelle «horizon 2020 » la ligne à suivre et les objectifs attenants à cette date
buttoir. Elle développe une stratégie surnommée 20*20*20 dont le contenu qui s'adresse aux
politiques internes de l'Union est résumé dans les trois points suivants. Ces objectifs ont été avalisés
par le Paquet Énergie Climat des 11 et 12 décembre 2008 par les 27 États membres de l'époque :
parvenir à 20% d'amélioration de l'efficacité énergétique de l'Union européenne
augmenter la part des énergies renouvelables à 20%
développer une politique européenne du stockage géologique du carbone
Ces mesures énergétiques constituent les différentes faces d'un ensemble de politiques
décidées au niveau de l'Union, dont l'objectif général est constitué d'une réduction des émissions de
gaz à effet de serre d'au moins 20% d'ici à 2020. En juillet dernier, la Commission Européenne a
proposé un objectif de politique climatique pour 203019
. Il possède la même grammaire : - 30%
d'émission carbone par rapport à 1990, et 30% d'énergie renouvelable.
16 Pallemaerts,M., « La conférence de Rio : grandeur et décadence du droit international de l'environnement », R.B.D.I.,
(1995), pp. 175-223.
17 Ramachandra, G., Environmentalism : a global history, Longman, 2001, New-York.
18 Communication COM 2007(2) final de la Commission Européenne, « Limiter le réchauffement de la planète à deux degrés Celsius – Route à suivre l'horizon 2020 et au delà ».
19 Hedegaard, C., « 30% energy efficiency proposal is good news for climate, investors and energy security », 2014. Disponible en ligne : http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/hedegaard/headlines/news/2014-07-23_01_en.htm
14
L'efficacité énergétique est une tentative pour concilier le maintien de la consommation
énergétique avec la préoccupation de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il s'agit de réduire
la consommation de GES, pas celle de l’énergie. Ce souci ambigu est au cœur du nœud normatif
des politiques climatiques qui a conduit à l'adoption du concept de développement durable. Ainsi,
cette phrase de la Commission issue de la Communication 2007(2) : « L'UE a déjà prouvé, par son
action interne, qu'il était possible de réduire les émissions de gaz à effet de serre sans compromettre
la croissance économique ». Parmi les exemples concrets d'amélioration de l'efficacité énergétique,
la Commission cite l'amélioration de l'isolement des bâtiments commerciaux et résidentiels. Il s'agit,
en bref, de réduire les gaspillages d'énergie et d'améliorer les rendements.
La proposition qui vise à développer les énergies renouvelables est l'un des aspects
constructifs et porteur de croissance de la communication. Il ne s'agit pas seulement de limiter les
émissions, mais d'améliorer les moyens de production de l'énergie d'un point de vue quantitatif et
d'éviter les restrictions destructrices de valeur économique. Ces mesures de substitution participent
ainsi de la réduction d'émission par le développement technologique d'énergie verte. La politique de
stockage géologique du carbone est organisée par la directive 2009/31/CE (dite directive CSC), qui
définit comme suit la technologie en question :
« Le captage et le stockage géologique du dioxyde de carbone (CSC) est une technologie de
transition qui contribuera à atténuer le changement climatique. Ce moyen consiste à capter
le dioxyde de carbone (CO2) émis par les installations industrielles, à le transporter vers un
site de stockage et à l’injecter dans une formation géologique souterraine adaptée en vue de
son stockage permanent20
. »
En plus de ces trois grands objectifs, l'Union Européenne s'appuie sur une série de principes
présents dans les traités que de nombreux travaux universitaires se sont attachés à interpréter, et qui
ne peuvent faire l'objet de longs développements dans ce TFE. Ces principes s'imposent à toutes les
politiques de l'Union, en vertu de l'article 11 TFUE. Ils sont énumérés dans l'article 191, paragraphe
2 TFUE : « La politique de l'Union dans le domaine de l'environnement vise un niveau de
protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de
l'Union. Elle est fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la
correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement et sur le principe du pollueur-
payeur. » Nous recommandons la lecture de l'ouvrage brillant de Nicolas De Sadeleer
(Commentaire Mégret) pour une analyse détaillée de ces principes, pendant que nous nous
contenterons de donner quelques pistes de réflexion.
Le principe de précaution est l'un des symboles du droit environnemental. Il est considéré
comme un principe général du droit européen et du droit international. Sa définition la plus aboutie
et la plus concise apparaît dans La déclaration sur les principes directeurs du développement
durable adopté dans le Conseil européen les 16 et 17 juin 2005 : « En cas d'incertitude scientifique,
mettre en œuvre des procédures d'évaluation et des mesures préventives appropriées afin d'éviter
des dommages à la santé humaine et à l'environnement. » Bien que présent dans les traités, il ne
bénéficie pas d'une définition claire et univoque, et il connaît bien des adversaires qui fustigent son
immobilisme et son côté réactionnaire21
. Il convient de souligner que les institutions internationales,
que les États, que la jurisprudence de la Cour et que les institutions européennes se sont aussi
interrogés sur le contenu de ce principe. D'après une communication de la Commission22
, le
principe contient deux aspects : 1) la décision politique d'agir, ou de ne pas agir ; 2) la manière
d'agir, qui suppose une identification d'effets potentiellement négatif et une évaluation scientifique
20 Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du
dioxyde de carbone. Considérant (4).
21 On trouve quantité d'article sur le sujet. Un exemple représentatif est le suivant : Layani, D., « Le principe de précaution au risque de croissance zéro ? », 2014. Disponible en ligne : http://www.huffingtonpost.fr/david-layani/risque-creation-entreprise_b_4568513.html « D'un principe d'action, qui doit permettre d'évaluer le risque pour une action plus éclairée, il est devenu un principe d'inaction fasciné par la chimère du risque zéro. »
22 Communication COM(2000)1 final, de la Commission européenne, 2 février 2000.
15
du risque.
Le principe du pollueur-payeur apparaît dans la Déclaration de Rio de 1992, en son principe
16 : « promouvoir l'internalisation des coûts de protection de l'environnement et l'utilisation
d'instruments économiques, en vertu du principe selon lequel c'est le pollueur qui doit, en principe,
assumer le coût de la pollution ». Ce principe est formulé en des termes peu prescriptifs, comme le
souligne Marc Pallemaerts. Il s'est néanmoins appliqué à des cas de jurisprudence précis et est
appliqué dans le droit dérivé, comme dans la Directive 75/442/CE concernant la gestion des
déchets. Il est énoncé par la Cour comme suit : « conformément au principe du pollueur-payeur, le
coût de l’élimination des déchets doit être supporté par les détenteurs antérieurs ou par le
producteur du produit générateur des déchets23
».
Le principe de correction des atteintes à l'environnement par priorité à la source est une
innovation du droit européen qui n'est pas reconnu au niveau international. Elle consiste à affirmer
que les atteintes à l'environnement doivent être corrigé le plus tôt, et le plus près possible du lieu de
production : « [Il] implique qu'il appartient à chaque région, commune ou autre entité locale de
prendre les mesures appropriées afin d'assurer la réception, le traitement et l'élimination de ses
propres déchets ; ceux-ci doivent donc être éliminés aussi près que possible de leur lieu de
production, en vue de limiter leur transport autant que faire se peut24
. » De plus, le principe affirme
qu'il faut attaquer le plus tôt possible les atteintes à l'environnement. Le programme d'action des
communautés européennes en matière d'environnement du 22 novembre 1973 a donné l'occasion au
conseil de déclarer qu'il convient « de tenir compte le plus tôt possible de l'incidence de tous les
processus techniques de planification et de décision sur l'environnement. »
Le dernier principe que nous aborderons est celui du haut niveau de protection de
l'environnement qui est défendue par l'Union, et qui a, justement, été arboré par la Cour lors de
l'affaire 366/10. La possibilité d'étendre le comptage de la distance parcouru par les avions à la
totalité de leur trajet, et pas seulement sur la partie au dessus du territoire de l'Union, a été justifié
par la Cour par le présent principe. Toutefois, si dans ce cas le principe a permis une élévation du
niveau de protection de l'environnement, il ne suffit pas qu'il faut choisir, lors de la définition d'une
politique, la meilleure protection possible ! La Cour l'a affirmé dans l'arrêt Safety Hi-Tech25
: « [Si]
le traité exige que la politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement vise un
niveau de protection élevé, un tel niveau, pour être compatible avec cette disposition, ne doit pas
nécessairement être le plus élevé possible. »
La compréhension de ces principes, ainsi que des objectifs de l'Union, même si abordé
succinctement, nous permet de saisir en partie la nature du marché européen du carbone auquel ils
se réfèrent. Les politiques climatiques de l'Union et le droit qui s'y réfère ne sont pas un bloc
monolithique, mais, plutôt, un système d'élément qu'il faut essayer de percevoir dans son ensemble.
En ce qui concerne le marché du carbone, son origine se trouve au niveau international, au moment
des négociations autour de la convention-cadre des Nations Unis sur le changement climatique.
b) Aux origines de l'EU ETS : le protocole de Kyoto
En 1992, dans le cadre du Sommet de la Terre de Rio, les chefs d'Etat et de gouvernement
ont reconnu la nécessité de lutter contre le changement climatique, et ont pour cela adopté une
convention cadre au niveau des Nations Unis. Ils ont pour cela adopté la Convention-Cadre des
23 CJCE, Commune de Mesquer, C-188/07, du 24 juin 2008.
24 CJCE, Commission c. Belgique, aff. C-2/9, du 9 juillet 1992.
25 CJCE, Safety Hi-Tech Srl c. S&T Srl, aff. C-284/95, du 14 juillet 1998
16
Nations Unis sur le Changement Climatique qui vise à « stabilisation des concentrations de gaz à
effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse
du système climatique26
». Ses membres participants se réunissent régulièrement sur une base
annuelle et doivent rendre opérationnel les objectifs politiques. Ce sont les Conférences des Parties.
Cinq ans plus tard, un protocole dont l'objectif est de mettre en place les instruments techniques
répondant aux exigences de la Convention-Cadre est adopté à Kyoto au Japon. Ce dernier avait été
conclu pour une durée limitée, et est arrivé à échéance le 31 décembre 2012. Malgré ses importantes
lacunes, il a été relancé pour une seconde période d'engagement pour une durée de 8 ans à daté du
1er janvier 2013, lors de la COP 17 qui s'est déroulée à Durban en décembre 2011.
Les lacunes du protocole s'expliquent par les tensions diplomatiques qui existent entre
plusieurs acteurs. Premièrement, les États développés sont accusés par les autres d'être responsables
du réchauffement actuel, car ils polluent beaucoup et depuis longtemps. La validité de cet argument
leur ont permis de négocier le principe de responsabilités communes mais différenciés des États en
fonction de leur responsabilité historique. La conséquence majeure est que les pays en
développement ne veulent pas être bloqués dans leur action au nom des principes
environnementaux qui les obligerait à adopter des technologies et des pratiques qui leur sont hors de
portés, les contraignant ainsi à une stagnation économique, alors que, dans le même temps, leur
responsabilité actuelle ne cesse de croître. Deuxièmement, les États développés ne veulent pas que
les politiques environnementales restreignent leurs « compétitivités » relativement aux États en
développement, qui n'en sont pas moins de redoutables adversaires économiques. En effet, les
normes environnementales se traduisent par des effets « positifs » sur les coûts qui nuisent à
l'efficacité économique des industries concernées, procurant un avantage comparatif à ceux qui ne
se soumettent pas à ces normes. L'enjeu est donc de rendre rentable ces transformations
environnementales imposées aux pollueurs pour les rendre économiquement acceptables. Ces
arguments expliquent la frilosité de certains États développés comme les États-Unis : « As you
know, I oppose the Kyoto Protocol because it exempts 80 percent of the world, including major
population centers such as China and India, from compliance, and would cause serious harm to the
U.S. economy27
. »
Par conséquent, il faut un accord global et équitable pour amener la totalité des États des
Nations Unis à signer et ratifier un texte ambitieux et contraignant, afin de réduire les pertes
relatives de compétitivité. La crainte mutuelle que s'inspirent les États est bien retranscrite dans
cette position de l'Union qui consiste à négocier une réduction de 30% des émissions par rapport à
1990 d'ici à 2020, à condition que les autres États développés en fassent autant ; sinon, elle
s'imposera à elle-même un objectif réduit à 20% afin de ne pas trop pénaliser, relativement, ses
entreprises. Les difficultés à négocier des accords internationaux ambitieux proviennent du fait que
les efforts des uns profitent à tous, car le réchauffement est global, tout en favorisent ceux qui ne
sont pas partis à l'accord en leur procurant des avantages économiques comparatifs.
Pour encourager l'adhésion la plus large possible des États aux politiques internationales
visant à lutter contre le changement climatique, les négociateurs du protocole de Kyoto ont défini
des mécanismes de flexibilité permettant d'installer de la souplesse dans la mise en œuvre des
objectifs. Seuls les 38 pays les plus industrialisés, partis à l'annexe B, se sont soumises à des efforts
contraignants et chiffrés quant aux réductions d'émission de gaz à effet de serre. Néanmoins, les
autres États parties peuvent participer à l'effort grâce à la mise en œuvre de projet avec ceux de
l'annexe B. Ces mécanismes sont aux nombres de trois : le MOC, le MDP et le marché international
du carbone. Ils permettent de remplir les obligations de Kyoto à moindre coût et ils intègrent l'idée
d'une flexibilité du coût lié à leur mise en œuvre, suivant le lieu d'émission : « Ce qui importe
26 Site internet officiel : http://unfccc.org
27 Lettre du Président Américain George W. Bush au sénateur Chuck Hagel, le 13 mars 2001.
17
désormais n'est plus le lieu de la réduction, mais son coût28
. »
Premièrement, le marché international du carbone est organisé autour de l'Unité de Quantité
Attribuée (UQA) aux pays de l'annexe B par l'article 17 du Protocole de Kyoto. Chaque pays a reçu
un certain nombre d'unité en 2008, en fonction de ses objectifs propres ; unités qui devront être
restitué en 2012. Si les émissions réelles d'un pays sont supérieurs ou un inférieur à un objectif, les
unités peuvent mises en vente sur le marché international. Ce système suit le principe du Cap &
Trade : chaque État fixe un plafond d'émission (cap) qu'il doit alors respecter en échangeant ses
crédits-carbones (trade). Le Journal International des Transactions (International Transaction Log)
enregistre les transactions. Il est basé à Londres. Le marché international du carbone ne s'est
véritablement mis en branle qu'à partir de 2009. En guise d'exemple, le Japon aurait déboursé
environ 100 millions entre 2008 et 2010 d'euros pour acquérir des unités aux États de l'Est de
l'Europe (Russie, Ukraine, République Tchèque) qui sont vues leurs émissions se réduire
drastiquement à cause de la récession provoqué par la chute de l'URSS. Il est notable que la chute
de l'activité en Europe et que le retrait des États-Unis du Protocole a créé un surplus de crédit-
carbone qui a revu à la baisse le volume transactions du marché.
Deuxièmement, le mécanisme de développement propre (MDP) (Clean Development
Mechanism) de projet fonctionne comme suit : les pays industrialisés payent pour des projets qui
réduisent ou évitent des émissions dans des nations moins riches et sont récompensés de crédits
pouvant être utilisés pour atteindre leurs propres objectifs d’émissions. Les pays receveurs
bénéficient gratuitement de technologies avancées qui permettent à leurs usines ou leurs
installations générant de l’électricité d’opérer de manière plus efficace. Néanmoins, il convient de
rester vigilent sur la bonne foi de ce mécanisme qui est aisément contournable. Deux risques
majeurs existent. D'abord, les évaluations des réductions d'émission étant réalisé dans les pays du
Sud, il faut s'assurer que les institutions de contrôle soit efficaces et fiables. Plusieurs organisations
non gouvernementales surveillent les demandes de projet29
, qui passent pourtant par un comité
indépendant, aussi basé à Londres. Il est toutefois fortement soupçonné de corruption par la société
civile. Ensuite, il ne faut pas que les pays du Sud soient mis en position de concurrence pour attirer
les investissements étrangers, car cela se ferait au détriment de leurs propres intérêts. En effet, ces
opérations sont profitables pour les entreprises qui investissent en ce qu’elles bénéficient de crédit-
carbone valorisable sur les marchés carbones en échange de leurs investissements dans des
technologies énergiquement plus efficaces, pendant que les pays bénéficient des projets industriels
économiquement porteurs. C'est ainsi qu'en 2011, environ 55% des projets MDP étaient localisés en
Chine30
:
28 Réseau Action Climat France, « Le mécanisme de développement propre », mars 2004.
29 On peut par exemple citer Carbon Market Watch, dont une antenne est basée à Saint-Gilles., et qui est parti d'un Réseau de Surveillance du Marché du Carbone beaucoup plus large et présent dans le monde entier : http://carbonmarketwatch.org/fr/carbon-market-watch-network/.
30 Delbosc, A., de Perthuis, C., « Les marchés du carbone expliqués », Bureau du Pacte Mondial de l'ONU, juillet 2009, http://www.cdcclimat.com/IMG/pdf/09-09_c4c-les_marches_du_carbone_expliques.pdf.
18
Enfin, le dernier mécanisme de projet imaginé par le protocole de Kyoto est le mécanisme
de Mise en Œuvre Conjointe (MOC) (Joint Implementation). Celui-ci fonctionne sur un principe
assez similaire à celui du MDP, à l'exception de la zone géographique. Son principal objectif est
d'attirer les investisseurs vers les projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il permet
ainsi le développement de nombreux projets en Europe de l'Est (80% des projets MOC sont basés
en Ukraine ou en Russie). Dans le cas du marché européen du carbone, il a aussi permet d'agir au
niveau de projets industriels qui n'étaient pas comptés parmi les 12 000 unités de production
sélectionnés par les autorités nationales et européennes dès l'origine : « Ce lien a joué un rôle
important dans l’identification des technologies de réduction des émissions et a fourni une
information utile à l’extension du périmètre du SCEQE31. »
Récapitulons : le marché européen du carbone s'inscrit dans un contexte international défini,
notamment, par la Convention-Cadre sur le changement climatique, et le protocole de Kyoto y
attenant. Il doit aussi se conformer à certains nombres de principes du droit environnemental qui
peuvent être, là aussi, internationaux ou purement européen. Enfin, les objectifs européens de la
politique climatique sont principalement coordonnés et définis par la Commission, pendant que les
moyens pour parvenir à leur réalisation ne se limitent pas au marché du carbone, bien que celui-ci
doive être considéré comme un élément déterminant de ce système. Comme souvent dans les
politiques internationales de l'environnement, l'organisation des instruments de régulation
s'apparente à ce que Jean-Frédéric Morin et Amandine Orsini à un régime complexe32
, caractérisé
par une fragmentation des institutions régisseuses, et dans lequel les liens entre le local et le global
s'entremêlent et se complètent. Une analyse de science politique qui pourrait s'avérer transposable
en philosophie du droit.
2) Le marché européen du carbone : fonctionnement et limites
31 Shishlov, I., Bellassen, V., Leguet, B., « Mise en oeuvre conjointe : un mécanisme pionnier dans les frontières d'une
limite sur les émissions », Etudes Climats, n°33, février 2012.
32 Morin, Jean-Frédéric, Orsini, Amandine & Young, Oran, op. cit.
19
L'Union européenne et ses États membres se sont engagés à respecter des engagements dans
le cadre du protocole de Kyoto qui représente une réduction de leurs émissions de gaz à effet de
serre, sur la période 2008-2012, de 8% par rapport à l'année de référence 1990. La mise en place du
marché du carbone a pour principal d'objectif de soutenir les États à réaliser ses engagements. A
cette fin, la directive 2003/87/CE a été adoptée pour organiser le Système d’Échange de Quota
d’Émission de Gaz à Effet de Serre33
. Celle-ci a ensuite été modifiée à plusieurs reprises. Nous
exposerons ici les aspects opérationnels du marché du carbone.
Le marché européen fonctionne, comme le marché international établi par le protocole de
Kyoto, sur le principe du cap & trade. Les États de l'Union s'attribuent, en fonction de leur émission
antérieure, une quantité de Quota (Q) par le biais de « plans nationaux d'allocation de quota » dont
les critères sont validés par la Commission. Chaque quota équivaut à une tonne de gaz à effet de
serre. Ces quantités peuvent ensuite être échangées sous forme de titre sur les marchés adéquats, sur
lesquels nous reviendrons. À la fin d'une certaine période, les émetteurs doivent prouver qu'ils ont
réduit leurs émissions en rendant à l'autorité publique le nombre de quotas qu'elle leur a alloué au
début de la période.
Au niveau de l'Union, 12 000 unités de production sont concernées, émanant de différents
secteurs énumérés par l'annexe 1 de la directive 2003/87/CE : il s'agit des secteurs de l'énergie, de la
production et de la transformation des métaux ferreux, de l'industrie minérale, industrie de pâte à
papier, de papier et de carton. Les entreprises concernées doivent, depuis le 1er janvier 2005, faire
des demandes d'autorisation pour émettre des gaz à effet de serre qui doivent décrire le lieu de
production, les matières employées pouvant émettre les gaz à effet de serre, les sources d'émission
de gaz, et les moyens de contrôle et de surveillance des émissions, conformément aux articles 4 et 5
de la directive34
.
Les acteurs opérant sont donc les entreprises privées, qui agissent dans un cadre défini par
les autorités publiques. Celles-ci ont pour objectif que les premières soient incitées à préférer
investir dans des technologies « vertes » permettant des réductions d'émission de gaz à effet de
serre, plutôt que devoir subir le coût engendré par la non-remise des quotas à la fin de la période,
qui se traduisent pas un coût économique ainsi que par le paiement d'une amende qui n'est pas
libératoire. C'est la Commission qui inflige les amendes directement aux entreprises, à la hauteur de
100 euros par tonne de GES excédentaire.
La distribution des crédits-carbones s'est étalée en trois phases progressives d'une allocation
gratuite des crédits jusqu'à la totale mise aux enchères35
. Il s'agit de parvenir à un objectif
environnemental (réduction des émissions de GES) à moindre coût pour les entreprises.
33 Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange
de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.
34 Article 4 : « Autorisation d'émettre des gaz à effet de serre
Les États membres veillent à ce que, à partir du 1er janvier 2005, aucune installation ne se livre à une activité visée à l'annexe I entraînant des émissions spécifiées en relation avec cette activité, à moins que son exploitant ne détienne une autorisation délivrée par une autorité compétente conformément aux articles 5 et 6, ou que l'installation ne soit temporairement exclue du système communautaire conformément à l'article 27. »
Article 5 : « Demande d'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre Toute demande d'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre adressée à l'autorité compétente comprend une description: a) de l'installation et de ses activités ainsi que des technologies utilisées; b) des matières premières et auxiliaires dont l'emploi est susceptible d'entraîner des émissions des gaz énumérés à l'annexe I; c) des sources d'émission des gaz énumérés à l'annexe I de l'installation; et d) des mesures prévues pour surveiller et déclarer les émissions, conformément aux lignes directrices adoptées en application de l'article 14. La demande comprend également un résumé non technique des informations visées au premier alinéa. »
35 Van Waeyenberge, Arnaud, « Le marché européen du carbone », p. 11, in : Collectif, Les instruments juridiques et financiers de la lutte contre le réchauffement climatique. Working Papers du Centre Perelman de Philosophie du Droit, 2011/01, http://wwwphilodroit.be
20
Apports successifs des 3 phases au SEQE
(Source : CDC Climat, 2012)
La première a débutée en 2005 et est caractérisée par la distribution des allocations de crédit, à titre
gratuit, aux unités de productions sélectionnées. Les échanges n'ont alors concerné que la mise en
conformité des unités avec leurs objectifs respectifs. Cette phase de gratuité a pour objectif
d'augmenter l'acceptabilité des entreprises à se voir fixer un prix à la pollution. Il s'agit aussi « de ne
pas punir une activité autrefois légal36
» sous peine d'économiquement fragiliser les entreprises qui
sont déjà naturellement peu enclines à supporter de nouvelles normes. Pendant la phase II, la part
des allocations mise aux enchères augmente à hauteur de 10% mais reste largement minoritaire.
Cette période recoupe celle prévue par le protocole de Kyoto (2008-2012). Enfin, la troisième dans
laquelle nous nous trouvons en ce moment glisse vers la mise aux enchères totales des quotas d'ici à
2020, avec une réduction progressive des volumes pour s'assurer d'atteindre les objectifs en
renforçant la pression sur les entreprises en raréfiant les titres échangeables. C'est donc le modèle
du Grandfathering qui est préconisé, car « les quotas d'une phase sont octroyés en fonction de la
pollution émise par les entreprises sur la période précédente37
». Cette troisième phase représente
l'achèvement de la politique de l'Union dans le domaine du changement climatique, en harmonisant
(au sens fort) les règlements et en transférant la gestion des volumes de quota au niveau des
institutions de Bruxelles.
La gestion des quotas s'effectue par la mise aux enchères des quotas attribués aux États
membres en fonction de leurs plans nationaux. La directive 2003/87/CE organise les modalités de
distribution des titres aux enchères38
:
88 % sont répartis entre les États membres sur base de leurs émissions;
10 % sont répartis à des fins de solidarité et de croissance;
36 Van Waeyenberge, Arnaud, Ibid, p. 11.
37 Idem, p. 11.
38 Commission européenne, « Système d’échange de quota d’émission de gaz à effet de serre », 2011. Disponible en ligne : http://europa.eu/legislation_summaries/energy/european_energy_policy/l28012_fr.htm
21
2 % sont répartis entre les États membres dont les émissions de gaz à effet de serre en 2005
étaient d’au moins 20 % inférieures à l’année de référence qui leur sont applicable en vertu
du protocole de Kyoto.
Cette mise aux enchères va profiter aux États qui récupèrent les bénéfices de la vente. Ils ont
l'obligation d'investir la moitié des sommes dégagées dans technologies ou politiques encouragent
la baisse des émissions de GES :
réduction des gaz à effet de serre;
développement des énergies renouvelables, ainsi que d’autres technologies contribuant à la
transition vers une économie à faible taux d’émissions de carbone;
mesures destinées à éviter le déboisement et à accroître le boisement et le reboisement;
piégeage par la sylviculture;
captage et stockage géologique;
adoption de moyens de transport à faible émission et les transports publics;
recherche en matière d’efficacité énergétique et de technologies propres;
amélioration de l’efficacité énergétique et l’isolation;
couverture des frais administratifs liés à la gestion du système européen.
Le marché du carbone permet donc, à la fois, une action du secteur privé et du secteur public.
Pendant que les premiers sont alors contraints d'améliorer l'efficacité énergétique de leurs moyens
de production, le second se voit doté de fond supplémentaire pour favoriser le développement un
technologique et politique, parallèlement industriel et environnemental, dans la veine du
« capitalisme vert ». De plus, les autorités publiques maintiennent une surveillance constante sur
l'évolution du marché comme l'atteste la proposition de Décision (2014) 20/239
sur laquelle nous
reviendrons sous peu.
Ces dispositifs juridiques ont conduit à la fixation d'un prix pour une tonne de GES :
désormais, polluer coûte de l'argent. L'instrument qui a été choisi par les institutions, et qui est
conforme avec le protocole de Kyoto, est la mise en place d'un marché qui doit encourager des
transformations dans la manière de produire, à moindre coût pour les entreprises privées. D'après
Anaïs Delbosc et Christian De Perthuis, l'option du marché permet de coupler la recherche de
l'efficacité énergétique à celle de l'efficacité économique40
. En fixant un coût au carbone, les
opérateurs privés peuvent aisément inscrire ce coût dans leurs choix quotidiens de meilleures
options disponibles en fonction de leur situation personnelle. Le régulateur se contente alors de
définir le plafond d'émission qu'il souhaite autoriser, qui correspond directement à l'objectif
environnemental voulu. Le plafond détermine à la fois l'objectif et le volume, conduisant à la
fixation d'un prix par les entreprises car ce plafond engendre une pression économique qui doit
inciter les opérateurs à diminuer leurs émissions en préférant investir dans des technologies
économes en énergie.
39 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant l’établissement et l’implémentation d’un
fond de réserve pour le marché carbone et amendant la directive 2003/87/CE, du 22 janvier 2014. http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/reform/docs/com_2014_20_en.pdf
40 « Les marchés carbones expliqués », Op. Cit., p. 11.
22
Évolution du prix d'une unité carbone
Il est très important de comprendre que, pour que fonctionne cet instrument, il faut que les prix
soient suffisamment élevés pour produire l'effet incitatif voulu. Or, le prix du carbone a été
plusieurs fois inférieurs aux attentes, ce qui conduit à rendre tout le système caduque: depuis 2012,
comme le montre le graphique élaboré par la Banque Mondiale, le prix est resté inférieur à 10 euros
la tonne de CO2. Les autorités doivent donc modifier structurellement le fonctionnement et la
nature du marché pour s'assurer de maintenir des prix suffisamment élevés.
Les causes de cette baisse des prix est bien connue, et résulte avant tout d'une baisse de la
conjoncture économique en Europe suite à la crise financière de 2008, mais surtout celle des dettes
souveraines qui en a résulté. Pourtant, l'architecture institutionnel du marché du carbone est aussi en
partie responsable car, d'une part, les mécanismes de flexibilité (MOC et MDP) ont participé à leur
tour à une augmentation des quotas disponibles, et d'autre part, le marché international connaît lui
aussi un excédant de quota. De plus, le marché est orienté par les objectifs environnementaux de
l'Union, qui ne prennent pas en compte les autres politiques énergétiques de l'Union, notamment les
soutiens aux énergies renouvelables. Pendant que les objectifs sont clairs pour les prochaines
années, ils ne le sont pas à l'horizon 2030, ce qui renforce la volatilité des prix en les rendant plus
vulnérables aux événements conjoncturels. Le graphique identifie la réactivité du marché à court-
terme, éclairant, du même coup, l'absence de vision longue. L'accumulation de ces facteurs explique
que la demande baisse à cause de la conjoncture, en même temps que la quantité de quota en
circulation sur le marché augmente ! Pendant le premier semestre 2013, le prix du quota a chuté
jusqu'à 3 euros la tonne, alors que le seuil incitatif, bien que vague, doit être supérieur à 10 euros
pour être efficace.
Afin de remédier à ces surplus, la Commission, en concertation avec plusieurs États membres, a mis
plusieurs options sur la table au début de cette année41
. Dès novembre 2012, Connie Hedegaard
41 Proposal for a Decision of the European Parliament and the Council concernant the establishment and operation of a
23
lançait un appel pour une réforme du marché carbone. Le marché était alors greffé d'un excédent
d'environ 2 milliards de quota qui rend son fonctionnement inefficace42
.
Parmi les 6 options proposées par la Commission, il a été retenu (après débat car certains États
membres peinaient à accepter une revalorisation du prix du quota, cela induisant un coût
supplémentaire sur les opérateurs privés43
) un gel dans la distribution des quotas lors des 3 années
suivant le vote d'une hauteur de 900 millions de tCO2 qui a été adopté par le Parlement européen le
3 juillet 2013. Si cette mesure peut permettre de soutenir, artificiellement, le court des quotas pour
quelques temps, certains analystes estiment qu'elle n'est pas suffisante pour couvrir les défauts
structurels du système à long-terme. Les institutions misent sur une reprise de l'activité en Europe,
mais la fragilité de leur volonté politique, plus préoccupée par la relance de l'économie que par
l'environnement, est un élément qu'il ne faut pas sous-estimer44
.
Le marché européen du carbone est donc un marché d'entreprises privées qui est fortement piloté
par les autorités publiques qui s'assurent (ou du moins essayent) de maintenir le prix du quota à un
niveau suffisant pour favoriser les investissements verts.
La financiarisation du secteur a été constatée par Arnaud Van Waeyenberge qui a analysé le
développement de nouvelle compétence chez certains intermédiaires financiers en vue de faciliter
les échanges de quotas45
. Des bourses spécialisées ont été mises en place, la principale étant l'ECX
de Londres. Elles organisent la plupart des échanges. Les entreprises privilégient, pour ces produits,
les bourses plutôt que le gré-à-gré. Les bourses permettent une diversification des modalités de
vente, et des produits financiers diversifiées : « En 2008, les 67 fonds d’investissement actifs sur le
marché du carbone ont géré plus de 10 milliards d’euros. »
Le système communautaire d'échange de quota d'émission est, finalement, un outil public dont
l'objectif est de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les 28 États de l'Union, plus la
Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. Il couvre environ 50% des émissions de carbone de l'Union et
s'avère être la pierre de touche de la politique climatique européenne : « Ainsi, le système de quotas
serait un instrument hybride de réglementation publique, sous forme de taxe, incluant des mécanismes
de flexibilité confiés à un marché artificiel. Le marché semble opportun car il permet de faire
fonctionner ensemble des engagements inégaux, de les harmoniser et de les amener automatiquement à
un certain état d’équilibre. La réglementation est nécessaire, car elle fonde le système46. »
3) Le marché européen du carbone : entre droit global et droit international ?
Dans cette partie, nous allons nous efforcer de préciser le cadre théorique dans lequel ce projet
s'engage. La théorie du droit global sera définie plus précisément, et, pour commencer, à partir de sa
différenciation par rapport au droit international classique. Enfin, nous démontrerons la pertinence
de ce cadre théorique pour éclairer sous un nouveau jour le comportement de l'Union, et, à cette fin,
notre hypothèse qui consiste à analyser l’événement de l'intégration du secteur aérien au marché du
carbone à partir de la théorie du droit global.
market stability reserve for the Union greenhous gas trading scheme and amending directive 2003/87/CE, du 22 janvier 2014. http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/reform/docs/com_2014_20_en.pdf
42 Communiqué de la Commission Européenne du 16 mai 2013, « Echange de quotas d’émissions : poursuite de la réduction des émissions mais augmentation de l’excédent de quotas en 2012 ». Disponible en ligne : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-437_fr.htm
43 Allix, Grégoire, « Sous l’effet de la crise, le marché du carbone part en fumée », Le Monde, avril 2013. Disponible en ligne : http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/04/04/sous-l-effet-de-la-crise-le-marche-carbone-europeen-part-en-fumee_3153467_3244.html
44 Sia Partner, « Marché du CO2 : les nouveautés de la phase III », juillet 2013. Disponible en ligne : http://energie.sia-partners.com/20130709/marche-du-co2-les-nouveautes-de-la-phase-iii/
45 Van Waeyenberge, Arnaud, Op. Cit., p. 14.
46 Frydman, Benoît, Op. Cit., p. 9.
24
Qu'est-ce que la théorie du droit global ? Il s'agit d'une école de pensée de sociologie du droit et de
philosophie du droit dont l'originalité est de s'intéresser au droit dans une optique dynamique,
empirique et finalement pragmatique, à l'aune d'une possible société mondiale. Il s'agit de
s'intéresser radicalement à autre chose que le droit positif. L'idée qui prévaut est que des
assemblages politiques, techniques, normatifs peuvent avoir le même rôle opérationnel et régulateur
que le texte juridique classique.
L’École de Bruxelles dont la théorie du droit global est une filiation a d'abord débuté par apporter au
droit positif une analyse sociologique. Sous l'influence de Chaïm Perelman, elle s'intéresse
particulièrement à l'étude des raisonnements non-formels47
, puis introduit le tournant argumentatif
dans les sciences juridiques notamment48
. Elle acquière une influence certaine en Belgique, puis au
niveau international49
.
Elle se focalise aujourd'hui autour de la théorie du droit global, qui est structurée autour d'un
programme de recherche dont les cibles seraient les « normes et dispositifs de contrôle qui
ressemblent à des instruments juridiques de par la fonction de régulation qui leur est assignée et
qu’ils remplissent plus ou moins efficacement, mais qui en diffèrent radicalement par les formes et
les moyens qu’ils empruntent50
. » Cette large définition donnée par Benoît Frydman est un
ambitieux appel à élargir les analyses juridiques à ces nouveaux moyens de contrôle, certains diront
de gouvernance dans le domaine de la science politique qui s'intéresse depuis longtemps à ces
dispositifs originaux.
En 1982, Stephen Krasner définissait les régimes internationaux, dont la définition est étonnamment
proche de celle de la théorie du droit global telle que l’École de Bruxelles la définie : « Des
principes, normes, règles et processus de décisions, implicites ou explicites, autour desquels les
attentes des acteurs convergent dans un champ donné des relations internationales51
. » La théorie
des régimes peut aussi observer des cristallisations de ces champs de règle en une organisation
spécifique, ou bien en un traité international classique, dit de droit positif.
S'il est important que les sciences juridiques prennent en charge ces dispositifs régulateurs, ce n'est
pas spécifiquement pour comprendre leurs modes de fonctionnement pour soi. Les relations
internationales comme champ des sciences politiques peuvent se charger adéquatement, dans les
sciences sociales, d'analyser les liens et les éléments générateurs de ces régimes. Néanmoins, si le
droit doit s'intéresser à ces dispositifs, c'est pour y intégrer la préoccupation cruciale de la justice.
Comment rendre justice dans ces dispositifs ? Comment faire respecter un état (et non pas un État)
de droit dans ces entrelacs de « principes, normes, règles et processus de décisions, implicites ou
explicites », ces « normes et dispositifs de contrôle » qui échappent à l’État et au droit international
classiques ?
Le droit international (public) est clair à ce niveau là : les États souverains, et certaines
organisations internationales, sujets de droit, ratifient un traité ou une convention qui sont la source
de ce système juridique. Ces textes de droit négociés, d'une nature généralement claire et décrivant
certaines obligations engagent leurs responsabilités, dont ils sont ensuite redevables de ces
engagements. Le non respect des engagements peut créer un litige susceptible d'être régler devant
47 Perelman, C., Logique juridique. Nouvelle rhétorique, Dalloz, Paris, 1976.
48 Perelman, C., Olbrechts-Tyteca, L., La nouvelle rhétorique. Traité de l'argumentation, Presse Universitaire de France, Paris, 1958.
49 Frydman, B., « Perelman et les juristes de l'Ecole de Bruxelles », Working Paper du Centre Perelman de Philosophie du Droit, 2011/07, http://philodroit.be
50 Frydman, B., « Comment penser le droit global ? », Op. Cit., p. 31-32.
51 Krasner, S., « Structural causes and regime consequences : Regimes as intervening variables », International Organization, (1982).
25
des cours internationales ou des cours arbitrales. Ainsi est respecté un principe de justice qui est
régit et interprété par le droit et ses juges dans le système classique du droit international.
Dans le cas du droit global, la situation est très différente, bien qu'à première vue il s'agisse aussi de
réguler des intérêts, des préoccupations, des relations. En effet, le système juridique dans lequel ces
relations s'inscrivent ont des sources diverses, et des sujets divers, produisant un bouleversement
des moyens de régulation que le droit peine à saisir52
. De plus, ces dispositifs ne remplacent pas le
droit international, mais plutôt le supplémente dans certaines domaines.
Certes, le droit international public classique a lui aussi intégré une interprétation plus large que le
droit positif strict : principes généraux, coutume, jurisprudence. D'après Olivier Corten, différentes
écoles d'interprétation coexistent et co-construisent le droit international53
. Bien que cette
élargissement de l'interprétation est louable car elle permet sans doute de mieux rendre justice, elle
n'est pas suffisante au sens où sa nature reste (et restera) interprétative. Il s'agit là d'enrichir
l'interprétation, mais pas de saisir des formes de régulation qui existent à côté de l'ordre juridique.
Pour le dire simplement, la théorie du droit global postule que les noyaux des « dispositifs de
contrôle » sont exclus de l'analyse juridique. Il s'agit de prendre le taureau par les cornes, d'aller au
cœur de ces dispositifs, et non pas de les invoquer comme des éléments périphériques
d'interprétation du droit positif.
C'est ainsi qu'il nous sommes invité à « penser le droit sans l'ordre juridique54
», c'est-à-dire non
pas au niveau « macro-juridique », celui qui privilégie le droit objectif international, mais au niveau
« micro-juridique », celui des individus compris au sens large. C'est en se mettant à la place des
individus, en considérant les options, les contraintes, les conditions, les déterminismes, les règles
qui pèsent sur eux que l'on sera en mesure de cerner ce qui fait droit, ce qui oblige.
La méthode de la théorie du droit global est donc, nécessairement, pragmatique, ce qui signifie que
les sujets d'étude choisis doivent chercher à comprendre ce qui pousse les individus à agir de telle
ou de telle manière. Il s'agit de sélectionner des cas pertinents : signifiant du point de vue social,
c'est-à-dire mettant des individus en situation peu lisible ; suffisamment large pour accéder au
niveau international ; et cependant non codifié par un droit positif qu'il suffirait d'interpréter
correctement.
Il s'agit par conséquent d'une méthode inductive, apport remarquable de la sociologie à la science
juridique en faveur duquel l’École de Bruxelles a joué un rôle considérable. Partant d'un cas d'étude
(case study), le chercheur doit alors s'efforcer de comprendre les raisons qui poussent les individus à
agir. C'est ensuite par la multiplication des cas et l'accumulation d'élément concordant et sans
contre-exemple qu'une méthode inductive apporte sa pierre à la science. A un moment donné, les
faits « parlent d'eux-mêmes », ce qui signifie que les chercheurs simplifient leurs résultats et
dégages alors des « lois » qui restent valables tant qu'aucun élément ne vient les contrecarrer.
Depuis son tournant global, l’École de Bruxelles s'efforce de multiplier les cas d'étude en ouvrant ce
que le Centre Perelman appelle des « chantiers55
» : La régulation des réseaux globaux de
communication, de l’Internet et des Univers Virtuels ; la responsabilité sociale des entreprises ; la
régulation globale des marchés financiers ; la lutte globale contre le réchauffement climatique et la
régulation des marchés de pollution ; le contentieux transnational des droits de l’homme et
l’intégration des systèmes de protection des droits de l’homme dans un monde globalisé ; les
normes techniques et les indicateurs comme instruments privilégiés de la régulation globale ; la
migration des concepts juridiques ; l’Europe comme laboratoire du droit global. Elle qualifie
52 Frydman, B., « Comment penser le droit global ? », Op. Cit.
53 Corten, O., Op. Cit.
54 Idem, chapitre 1.2.
55 On trouvera plus d’information à ce sujet sur le site internet du Centre Perelman : http://www.philodroit.be/-Droit-global-?lang=fr
26
d'Objet Juridique Non Identifié cette pléiade de domaines essentiels de la société mondiale, couvert
par des dispositifs de contrôle hétérogène et dont le fonctionnement juridique, ainsi qu'en terme de
justice, reste mal compris ; empruntant le mot à Jacques Delors, qui avait lui parlé, à propos de
l'Union européenne, « d'objet politique non identifié ».
Notre présent travail recoupe deux chantiers du Centre Perelman : celui de « la lutte globale contre
le réchauffement climatique et la régulation des marchés de pollution », ainsi que celui de
« l'Europe comme laboratoire du droit global ». En s'intéressant à l'intégration du secteur aérien
international au marché européen du carbone, il interroge en premier lieu les dispositifs
internationaux pour lutter contre le changement climatique. Or, nous l'avons vu, ne serait-ce qu'au
sein de l'Union, le marché du carbone n'est qu'une des multiples facettes des politiques climatiques
de l'Union, auxquelles il faut ajouter les initiatives individuelles, communales, régionales,
nationales et internationales ; sans compter qu'il faut aussi élargir, sous la pression de la lunette du
niveau global, les initiatives prises, pour leur compte propre, par d'autres États du monde. Le
Protocole de Kyoto n'est qu'un élément clé de cette architecture quasi-dadaïste.
Le rôle de l'Union européenne, à laquelle les États membres ont transféré des compétences
exclusives ce qui a conduit à l'harmonisation de la politique climatique, est aussi assez énigmatique,
et notre projet de recherche entend bien participer à éclaircir ce point. En effet, qu'est-ce que cela,
cette entité politique qui n'a acquis la personnalité juridique qu'avec le Traité de Lisbonne et qui,
pourtant voudrait réglementer le secteur aérien international ? Comment doser l'influence de l'Union
par rapport à celle des compagnies aériennes privées qui se sont élevées, frontalement, contre cette
politique climatique à peine ambitieuse ? Nous affirmons que la théorie du droit global est adéquate
pour appréhender cet état des choses, car force est de constater l'échec du droit positif à cet endroit :
alors que la Cour de Justice de l'Union a vérifié et confirmé la conformité du marché du carbone
avec le droit international, les institutions ont voté une dérogation concernant son application, le
temps que l’échelon international (Organisation Internationale de l'Aviation Civile) réglemente cette
affaire56
. Il faut donc placer la lorgnette de l'observateur juridique ailleurs que sur la règle positive
de droit européenne, car celle-ci, quel qu’en soit l'interprétation que chacun puisse en donner, a été
clarifiée par la Cour de Justice, mais reste cependant inappliquée !
Dans le domaine du changement climatique, l'Union joue sur plusieurs tableaux : droit
positif d'un côté ; négociation internationale de l'autre dans le but de faire converger les intérêts des
acteurs en question (les États, l'humanité en générale, l'environnement naturel, les entreprises
privées, les organisations non gouvernementales, les consommateurs...), peut être autour d'un traité
ambitieux, mais peut être, aussi, autour d'un régime juridique hétérogène visant à réglementer les
émissions de gaz à effet de serre dont ce conflit n'est qu'une des nombreuses composantes.
56 Décision n°377/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2013 dérogeant temporairement à la
directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté.
27
II – L'intégration du secteur aérien au marché du carbone européen : l'Union comme acteur
international ?
L'intégration du secteur aérien au marché européen du carbone précédent décrit ne s'est pas
complètement finalisée. Si les vols internes ont été, dès 2012, intégrés dans le marché carbone, qui
fonctionne depuis 2005, les vols internationaux restent à l'extérieur du système. Ce chapitre va
s'atteler à comprendre le plan que la Commission avait élaboré à l'attention du secteur aérien dans
sa globalité, avant d'analyser les raisons de l'échec de l'extension du marché aux vols externes. Il
interroge l'action des institutions sous le regard du droit international classique : quel est le droit
positif et les principes d'interprétation qui s'appliquent à cette politique climatique ? Comment les
compagnies aériennes ont-elles réussi à faire capoter la politique externe de l'Union ? Que peut-on
en tirer quant à l'influence et aux stratégies de l'Union sur le plan international et global ?
1) Le secteur aérien : polluant et international
Le secteur aérien représente aujourd'hui 2% des émissions mondiales de gaz carbonique
anthropique, et 8% de l'ensemble du trafic passagers dans le marché intérieur de l'Union. Ces
chiffres sont relativement modestes, mais doivent être lu à la lumière d'une forte prévision de
croissance du secteur, notamment dans les pays émergents, et de son fort taux de pollution. Le
facteur d'émission lié au « jet fuel » est très important : 3,15 tonnes de CO2 sont émises par tonne
de « jet fuel » brûlé :
« L’aviation exerce une incidence sur le climat de la planète car elle dégage des émissions
de dioxyde de carbone, d’oxydes d’azote, de vapeur d’eau, ainsi que des particules de
sulfate et de suie. Le GIEC a estimé que l’impact global actuel de l’aviation sur le climat
était deux à quatre fois plus important que l’effet résultant de ses seules émissions
antérieures de dioxyde de carbone. Il ressort des travaux de recherche menés récemment par
la Communauté que l’incidence totale de l’aviation sur le climat pourrait être deux fois plus
importante que celle du seul dioxyde de carbone. Toutefois, aucune de ces estimations ne
tient compte des effets très mal connus des nuages cirrus57
. »
Le trafic passager aérien de l'Union a connu une hausse de 66,2% entre 1995 et 201158
, dont
une hausse de 10% entre seulement 2010 et 2011. Pour ce qui concerne les émissions directes de
gaz à effet de serre, elles sont passés en valeur absolue pour le secteur aérien, de 83,9 millions de
tonne équivalent carbone en 1990 à 150,2 millions de tonne équivalent carbone en 2010 ; et en
valeur relative comme part dans les émissions liées au transport, de 8,8 % en 1990 à 12,4 % en
2010.
Les études publiées par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale s'attendent à un
doublement du trafic aérien mondial à l'horizon 2025, ce qui correspondrait à un doublement des
émissions de gaz à effet de serre en 2030 si rien n'est fait. Or, la Commission européenne, ainsi que
les organisations professionnelles (IATA, OACI) ont annoncé leur intention de réduire les émissions
de gaz à effet de serre de 50% entre 2005 et 2050! Deux moyens seraient avancés pour atteindre cet
57 Directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE
afin d’intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre. Considérant 19.
58 Commission Européenne, EU transport in figure : statistical pocketbook, 2013. Disponible en ligne : http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/pocketbook-2013_en.htm
28
objectif59
: les Emissions Trading Scheme qui pose une valeur économique aux gaz à effet de serre,
et le biofuel dont nous ne parlerons pas ici, mais qui consiste à remplacer le fuel de pétrole par du
fuel d'agro-carburant.
On comprend ainsi mieux la volonté de l'Union européenne de s'attaquer à ce secteur
polluant, malgré le fait que sa part soit à relativiser par rapport au transport routier, qui représente à
lui seul près de 72,1% des émissions de gaz à effet de serre :
Part des secteurs du transport dans les émissions de GES dans l'Union européenne en 2010.
(source : EU Pocketbook 2013)
Le Protocole de Kyoto demande aux parties de prendre des mesures concernant le secteur
aérien en son article 2.2. Cet engagement n'est pas obligatoire, et par conséquent, les réductions de
gaz à effet de serre que les États parties se sont engagés à effectuer (UE : -8%) ne comprennent pas
le secteur aérien60
:
« Les parties visées à l'annexe I cherchent à limiter ou réduire les émissions de gaz à effet de
serre non réglementés par le Protocole de Montréal provenant des combustibles de soute utilisés
dans les transports aériens et maritimes, en passant par l'intermédiaire de l'Organisation de l'aviation
civile internationale et de l'Organisation maritime internationale, respectivement. »
Qu'est-ce que l'Organisation de l'aviation civile internationale qui revient sans cesse dans
notre cas d'étude ? Il s'agit d'une agence spécialisée des Nations Unis, qui a été instaurée suite à la
signature de la Convention de Chicago, le 7 décembre 1944 dans la ville éponyme. Elle est entrée
en vigueur le 4 avril 1947, et ratifiée à l'origine par 52 États. Aujourd'hui, 191 États sont partis à la
Convention61
, ce qui renforce sa légitimité à réglementer le secteur aérien mondial.
L'objectif de la convention est la régulation et de la coordination du secteur aérien civil
international. Elle vise établir des règles communes entre les États signataires pour permettre, avant
tout, de préserver l'amitié entre les peuples et la coopération entre les nations, dont dépend la paix
mondiale. On retrouve à cet endroit les principes qui fondent les politiques d'après la seconde
guerre mondiale, et qui promeuvent la doctrine libérale du « doux commerce » de Montesquieu,
c'est-à-dire le remplacement des relations basés sur la puissance de type machiavélique par des
59 IFP Energies Nouvelles, « Le transport aérien et la problématique du CO2 : enjeux des mécanismes ETS et des
biojets », Panorama, Paris, 2013. Disponible en ligne : http://ifpenergiesnouvelles.fr
60 Directive 2008/101/CE, Considérant 27 : « Afin de garantir l’intégrité du système de comptabilisation pour le système communautaire, il convient, compte tenu du fait que les émissions de l’aviation internationale ne sont pas prises en compte dans les engagements des États membres au titre du protocole de Kyoto, que les quotas alloués au secteur de l’aviation soient uniquement utilisés pour respecter l’obligation des exploitants d’aéronefs de restituer des quotas conformément à la présente directive. »
61 http://www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/Chicago_FR.pdf Tous les États membres des Nations Unis sont partis à la Convention, à l'exception du Liechtenstein, Dominique et Tuvalu.
29
relations basés sur l'interdépendance et le développement réciproque62
; un principe assez similaire
que celui à la base de la création de l'Union européenne, et qui sont repris dans les considérant de la
convention.
« The Convention on International Civil Aviation set forth the purpose of ICAO:
"WHEREAS the future development of international civil aviation can greatly help to create
and preserve friendship and understanding among the nations and peoples of the world, yet
its abuse can become a threat to the general security; and
WHEREAS it is desirable to avoid friction and to promote that co-operation between nations
and peoples upon which the peace of the world depends;
THEREFORE, the undersigned governments having agreed on certain principles and
arrangements in order that international civil aviation may be developed in a safe and
orderly manner and that international air transport services may be established on the basis
of equality of opportunity and operated soundly and economically;
Have accordingly concluded this Convention to that end." »
La convention définie, dans sa première partie, les principes et normes auxquels les aéronefs
doivent se conformer dans les États signataires. Parmi ceux-ci, ont retrouve l'affirmation de la
souveraineté des États sur leurs territoires, l'interdiction d'utiliser des armes contre des aéronefs
civils, la non discrimination des compagnies ou des aéronefs en fonction de leur nationalité, ou
encore l'homogénéité des règles d'immatriculation des appareils. En ce qui concerne les droits de
douane, l'article 24 déclare : « Le carburant, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange,
l'équipement habituel et les provisions de bord se trouvant dans un aéronef d'un État contractant à
son arrivé sur le territoire d'un autre État contractant et s'y trouvant encore lors de son départ de ce
territoire, sont exempts des droit de douane, frais de visite ou autres droits et redevances similaires
imposés par l'Etat ou les autorités locales. » Cet article sera notamment agité par les compagnies
aériennes lors de l'affaire 366/10 afin de chercher à rendre illégal l'application du SEQE au secteur
de l'aviation civile.
La seconde partie de la convention organise l'OACI et en fixe ses objectifs, qui sont énoncés
comme suit :
« L'organisation a pour buts et objectifs d'élaborer les principes et les techniques de la
navigation aérienne internationale et de promouvoir la planification et le développement du
transport aérien international de manière à :
a) assurer le développement ordonné et sûr de l'aviation civile internationale dans le monde
entier ;
b) encourager les techniques de conception et d'exploitation des aéronefs à des fins
pacifiques ;
c) encourager le développement des voies aériennes, des aéroports et des installations et
services de navigation aérienne pour l'aviation civile internationale ;
d) répondre aux besoins des peuples du monde en matière de transport aérien sûr, régulier,
efficace, économique ;
e) prévenir le gaspillage économique résultant d'une concurrence déraisonnable ;
f) assurer le respect intégral des droits des États contractants et une possibilité équitable pour
62 Larrère, C., « Montesquieu et le doux commerce : un paradigme du libéralisme ? », Les cahiers de l'histoire, n°123,
(2014), p. 21-38. Disponible en ligne : http://chrhc.revues.org/3463.
30
chaque État contractant d'exploiter des entreprises de transport aérien international ;
g) éviter la discrimination entre États contractants ;
h) promouvoir la sécurité de vol dans la navigation aérienne internationale ;
i) promouvoir, en général, le développement de l'aéronautique civile internationale sous tous
ses aspects. »
L'article 48 énonce que « Chaque État contractant à l'Assemblée a droit à une voix. » Notons aussi
que l'Union européenne n'est pas partie à l'Organisation, mais que chacun de ses membres l'est.
Nous verrons par la suite les implications pour la politique de l'Union.
L'OACI fixe les normes et principes que doit respecter le secteur pour le monde entier. Elle
est, finalement, une institution des plus classiques en matière de droit internationale, dans le respect
de l'ordre juridique international : souveraineté des États contractants qui sont les sujets de ce droit ;
intégration dans l'ordre juridique des Nations Unis. Par rapport à notre cadre théorique, un passage à
l'OACI signifie par conséquent un ancrage dans le droit international, et une inadéquation à la
théorie du droit global. Une politique de l'Union qui se verrait transposée au niveau de l'OACI
devrait être interprétée comme relevant du pur droit international, et l'UE agirait alors comme un
acteur international classique, même dans l'hypothèse où elle serait un vecteur de multilatéralisme.
Ce qui compte, c'est la consécration de la règle en droit positif.
En revanche, le contournement de l'OACI, dans la mesure où aucune autre organisation ne
peut prétendre à ce statut d'institution de référence internationale en matière, validerait la hypothèse
d'un assemblage régulateur hétérogène, que le droit international classique ne saurait saisir
correctement et sur lequel il faudrait se pencher aux vues des éléments déjà accumulés pour
réglementer le secteur.
Le va-et-vient réguliers entre l'OACI et les institutions européennes est déjà éclairant sous
cet angle.
2) L'intégration du secteur aérien civil au SEQE
Au départ, le marché du carbone tel que conceptualisé par l'Union et concrétisé par la directive
2003/87/CE n'intégrait pas le secteur aérien. L'Union a dû attendre l'aval de l'OACI en 2004
concernant la reconnaissance du bien fondé des instruments régionaux pour répondre au problème
global des émissions de gaz à effet de serre, qui, conformément au Protocole de Kyoto (article 2,2)
est en charge de réglementer le secteur aérien en matière d'émission de GES.
En vertu du sixième programme d’action communautaire pour l’environnement institué par la
décision n°1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil, la Communauté doit définir et
prendre des mesures spécifiques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant des
avions si aucune action de cette nature n’est décidée au sein de l’OACI d’ici à 2002. Dans ses
conclusions d’octobre 2002, de décembre 2003 et d’octobre 2004, le Conseil a, à maintes reprises,
engagé la Commission à proposer des mesures en vue de réduire l’impact du transport aérien
international sur le climat63
.
C'est avec la Directive 2008/101/CE que les institutions européennes ont décidé d'apporter une
réponse au problème des émissions du secteur aérien, en intégrant ces dernières au SEQE. Le bien
fondé de cet instrument du marché, malgré ses défauts dont nous avons parlé précédemment, est
attesté notamment au niveau international. Le fonctionnement prévu et effectif est le même que
63 Directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, modifiant la directive
2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le Système Communautaire d'Echange de Quota d'Emission de gaz à effet de serre.
31
pour les unités industrielles prises en compte dès 2005. Sur la base des émissions des années
précédentes, les compagnies aériennes reçoivent des quotas, dont la fixation et la distribution des
volumes est harmonisée au niveau européen pour éviter toute distorsion de concurrence. En
fonction de l'emplacement de leurs sièges sociaux, les compagnies sont reliées à l’État membre
correspondant, qui est alors en charge de l'application de la directive. Il alloue les quotas et contrôle
les émissions.
Compagnies aériennes européennes et non-européennes par État membre
(source : CDC Climat recherche, à partir des données de la Commission européenne, février 2012)
Le secteur aérien constituerait le deuxième secteur du SEQE, comprenant 5300 compagnies
européennes ou étrangères, et qui représenterait environ 10% des volumes d'émission de GES au
niveau de l'Union64
.
Le volume total alloué aux compagnies aériennes est définie par l'article 3 quater de la directive :
« Quantité totale de quotas pour l’aviation
1. La quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d’aéronefs pour la période allant du
1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 correspond à 97 % des émissions historiques du
secteur de l’aviation.
64 Alberola, E., Solier, B., «L’inclusion de l’aviation internationale dans le système européen d’échange de quotas de CO2: un premier pas vers un système mondial?», Etude Climat n°34, CDC Climat Recherche, (2012).
32
2. La quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d’aéronefs pour la période visée à
l’article 11, paragraphe 2, débutant au 1er janvier 2013, et en l’absence de toute modification
à la suite de l’examen prévu à l’article 30, paragraphe 4, pour chaque période ultérieure,
correspond à 95 % des émissions historiques du secteur de l’aviation, multipliées par le
nombre d’années de la période. »
On assiste donc à une réduction progressive des quantités de quota allouées au secteur
aérien. Il est aussi décidé par la directive que 15% des quotas seront mis aux enchères à partir du
1er janvier 2013, dont les bénéfices serviront à financer des modes de transport moins polluant, le
Fond mondial pour la promotion de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables, ainsi que
des mesures visant à éviter le déboisement et à soutenir les politiques d'adaptation des pays en
développement.
Il est également convenu par la directive que le secteur aura accès aux mécanismes de
flexibilité par projet, afin de réduire par ce biais leurs émissions (Mécanisme de Développement
Propre et Projet de Mise en Œuvre Conjointe). Pour limiter les abus d'utilisation de ces mécanismes,
un plafond d'utilisation de 15 % leur est fixé.
Enfin, les quantités de quotas attribué sont définis par les émissions causées par « tous les
vols relevant des activités aériennes visées à l’annexe I au départ d’un aérodrome situé sur le
territoire d’un État membre ou à l’arrivée dans un tel aérodrome en provenance d’un pays tiers65
. »
L'année de référence est l'année civile se terminant 24 mois avant le début de la période à laquelle
se rapporte la mise aux enchères.
La décision 2011/389/UE66
a fixé les quantités de quotas attribués à l'aviation civile pour la période
correspondant à l'année 2012, puis 2013. L'article 1 déclare : « 1. Le nombre total de quotas pour l’ensemble de l’Union visé à l’article 3 quater, paragraphe 1,
de la directive 2003/87/CE pour la période allant du 1erjanvier 2012 au 31 décembre 2012
s’élève à 212 892 053.
2. Le nombre total de quotas pour l’ensemble de l’Union visé à l’article 3 quater, paragraphe 2,
de la directive 2003/87/CE pour chaque année de la période débutant au 1er janvier 2013 s’élève
à 208 502 526. »
L'article 2 a fixé la quantité de quota rendu disponible par une mise aux enchères à 31 275 379
tonnes d'émissions de gaz carbonique.
Qu'elle serait la répercussion de l'intégration du secteur aérien au SEQE sur le prix du billet des
consommateurs ? Le principal argument utilisé par les adversaires de l'intégration du secteur est en
effet que cela va se répercuter sur les passagers, et sur la santé économique des entreprises.
Il convient d'abord de souligner que les quotas sont essentiellement alloués à titre gratuit, à hauteur
de 85% sur la période 2013-2020. D'après la Commissaire de l'Union au Climat, Connie Hedegaard,
« Les coûts pour les passagers aériens dépendront de la manière dont les compagnies aériennes
répercuteront la valeur des 85 % de quotas gratuits67
. » Pour un vol transatlantique, le prix des
billets pourraient augmenter d'une fourchette allant approximativement de 2 à 12 euros, fourchette
qui dépend évidemment du coût du quota qui est assez volatile.
Le billet augmentera de 12 euros si les compagnies répercutent la totalité du coût théorique
du quota carbone sur les passagers, malgré le fait qu'elles les ont reçues gratuitement de la
Commission européenne. Étant donné que 15% des quotas ont été acheté aux enchères, environ
15% des quantités de quotas auront été un coût réel pour l'entreprise. Celui-ci équivaut à l'option la
65 Directive 2008/101/CE, article 1. Nous discutons plus bas, dans ce même chapitre le concept d'extraterritorialité.
66 Décision 2011/389/UE de la Commission, du 30 juin 2011, relative à la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union visée à l’article 3 sexies, paragraphe 3, points a) à d), de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté
67 Hedegaard, C., « Quelques faits concernant l'intégration du secteur aérien dans le SCEQE », 2013. Disponible en ligne : http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/hedegaard/headlines/articles/2011-09-29_01_fr.htm.
33
plus basse de la fourchette (2 euros). Les 10 euros de différence seront donc un bénéfice pour
l'entreprise : « Cette recette supplémentaire pourrait être utilisée, par exemple, pour moderniser la
flotte, pour améliorer le rendement d'utilisation du carburant et pour utiliser des combustibles
d'aviation non fossiles, ce qui contribuera non seulement à réduire les émissions, mais également à
limiter les coûts supplémentaires pour respecter les plafonds fixés68
. »
A l'inverse, si les compagnies aériennes décident de ne fixer l'augmentation du coût du billet
à la partie basse de la fourchette, elles ne généreront aucun bénéfice supplémentaire mais devraient
pouvoir vendre plus de billet. Cependant, plus le temps passe et plus les obligations du SEQE
deviennent importante : mieux vaut étaler l'adoption des meilleurs pratiques dans le temps, et le
calcul du risque est largement redevable au coût du quota qui est assez volatile. Il reviendra aux
entreprises de doser l'augmentation du coût du billet, et le coût des obligations environnementales
imposées par le SEQE.
Le prix du billet est aussi affecté par une série d'autres éléments qui relativisent aussi
l'impact de l'augmentation du coût induit par le SEQE. D'une part, l'efficacité énergétique augmente
en moyenne de 2,7% par an sur les dix dernières années, ce qui se traduit par des économies
réalisées au niveau des volumes de fuel utilisés. Cette hausse se traduit par une baisse des quotas
nécessaires, qui, de plus, ont un impact sur l'efficacité énergétique elle-même, puisqu'ils
encouragent à les réduire car ils sont un coût supplémentaire. N'oublions pas que si jamais une
compagnie arrive à réduire substantiellement ses émissions, elle pourra vendre les surplus de quota
qu'elle aura reçu à titre gratuit.
Le Cabinet-Conseil Sia a ainsi calculé que l'impact financier de la mesure sur l'ensemble des
compagnies opérants en Europe sera de l'ordre de 1,3 milliards d'euro, et représenter 4,5% du
marché carbone à l'horizon 2020, en retenant les hypothèses couramment admises par le secteur69
.
D'après lui, ce surcoût équivaudrait à 90 centimes d'euro par tranche de 1000 km aller-retour
parcourues. Une hausse de quelques pourcentages du coût du baril de pétrole aurait un impact
largement supérieur sur le prix du billet sur la mesure du SEQE.
Telles sont les grandes lignes de la politique de l'Union qui vise à faire participer le secteur
aérien à l'effort consenti par la plupart des autres industries afin de limiter le réchauffement
climatique qui « constituent une menace de plus en plus grave pour les écosystèmes, la production
alimentaire et la réalisation des objectifs du développement durable et des objectifs du millénaire
pour le développement, ainsi que pour la santé et la sécurité humaines70
. »
3) L'affaire 366/10, un coup d'arrêt à la politique de l'Union
Plusieurs compagnies aériennes ont contesté la validité de la directive 2008/101 devant la
Cour de Justice de l'Union européenne. L'affaire C-366/10 du 21 décembre 2011 est originaire du
Royaume-Uni, où sont d'ailleurs présentes la plupart des compagnies américaines qui ont intenté le
procès. Elles ont cherché à contester la validité des mesures de transposition de la directive. C'est la
High Court of Justice of England and Wales qui a reçu le recours en annulation introduit à
l'encontre des mesures de transposition, puis qui l'a fait parvenir à la Cour de Justice sous la forme
d'un renvoi préjudiciel en appréciation de validité.
Il s'agit d'une procédure juridique classique en droit européen, que d'attaquer une règle de
droit positif devant un tribunal au moment de sa transposition. La règle étant un acte dérivé du droit
européen, il s'agit d'une procédure qui cherche à désamorcer la politique de l'Union directement, en
68 Hedegaard, C., Ibid.
69 Richard, J., « Décollage difficile pour l'intégration de l'aviation dans le marché carbone européen », Energie & Environnement, 2012. Disponible en ligne : http://energie.sia-partners.com.
70 Directive 2008/101/CE, Considérant 3.
34
faisant valoir un certain nombre d'arguments juridiques et de principes d'interprétation. Cette affaire
est intéressante en ce qu'un acte de droit dérivé est attaqué à partir de principes et de textes issus du
droit international, ce qui n'est pas une procédure classique.
D'après la théorie du droit global, nous sommes ici, en revanche, en présence d'un cas ne
présentant pas de spécificité particulière car nous restons dans un contexte de droit positif classique.
Néanmoins, il s'agit de percevoir ce moment comme une étape essentielle de l'affaire dans son
ensemble, qui, elle, commence avec le Protocole de Kyoto et la volonté des États du monde de
réglementer les émissions de gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement climatique. En effet,
la Cour de Justice confirmera la validité de la directive 2003/87/CE modifiée par la directive
2008/101/CE, mais cette décision ne réglera pas l'affaire une bonne fois pour toute, soulignant les
limites d'une approche de droit positif, et appelant à une vision élargie à l'aide de la théorie du droit
global.
Les requérants sont les compagnies américaines suivantes : American Airlines, Continental
Airlines, United Airlines, soutenue par la Air Transport Association à laquelle elles sont également
parties. Elles se sont levés contre le Secretary of State for Energy and Climate Change, qui est
l'administration du Royaume-Uni en charge de mettre en place la directive 2003/87CE. Les motifs
qu'ils soulèvent touchent avant tout la validité de la directive au regard du droit international. Ils
invoquent la Convention de Chicago de 1947 dont nous avons parlé précédemment, le Protocole de
Kyoto, la Convention Ciel Ouvert ainsi que trois principes du droit international : souveraineté des
États sur leur espace aérien, illégitimité des revendications de souveraineté sur la haute mer, et la
liberté de survol de la haute mer.
La Cour commence par évaluer la pertinence des invocations du droit international. Il s'agit
de savoir si, de par la nature de l'Union, les accords internationaux soulevés lient ou pas les
institutions.
Elle rappelle, avant tout (point 47 de l'affaire), qu'elle est seule compétente pour apprécier la
validité d'un acte, afin de garantir la cohérence et l'homogénéité du droit européen (article 267
TFUE). Il ne saurait être question qu'un tribunal national soit à même d'annuler une directive.
Ensuite, elle souligne la primauté du droit international sur le droit européen (point 50). La Cour, à
la demande d'une juridiction de renvoi, est donc en mesure d'apprécier la validité d'un acte au
regard du droit international. La primauté est effective si l'Union est liée par l'acte, et si l'accord est
précis et inconditionnel, c'est-à-dire que la disposition comporte une obligation claire et précise qui
n'est subordonnée, dans son exécution ou dans ses effets, à l'intervention d'aucun acte ultérieur
(point 55).
Le raisonnement de la Cour consiste donc, dans un premier temps, à vérifier si les
dispositions internationales invoquées par les requérants répondent aux critères décris ci-dessus.
En ce qui concerne la Convention de Chicago, l'Union n'y est pas partie, mais en revanche,
l'ensemble de ses États membres l'est (point 60). A cet égard, la Cour rappelle que l'article 351
stipule que l'Union doit veiller à ne pas entraver l'exécution des engagements de ses États membres,
sans pour autant lier l'Union (point 61). Toutefois, si, et dans la mesure où l'Union aurait assumé
intégralement (point 63) les compétences précédemment partagées avec les États membres (point
62), les dispositions de la Convention auraient pour effet de lier l'Union. La Cour constate que
l'Union assume plusieurs compétences relatives à l'aviation civile, mais aussi que les États membres
gardent des prérogatives. La compétence reste partagée, et, par conséquent, la Convention de
Chicago ne peut lier l'Union. Notons ici que l'Avocat général a, de son côté, estimé que le niveau de
compétence exercé par l'Union était suffisant pour la lier à la Convention71
.
Le protocole de Kyoto présente une situation différente car l'Union l'a directement approuvé.
Par conséquent les dispositions forment partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union (point 73).
71 Conclusion de l'Avocat Général, point 66.
35
Toutefois, l'article 2,2 qui concerne le secteur aérien ne présente pas un caractère précis et
inconditionnel car il subordonne son exécution à des mesures futures. Le protocole ne saurait être
invoqué afin d'apprécier la validité de la directive (point 78).
S'agissant de l'accord « Ciel ouvert », ni sa nature ni son économie ne s'opposent à ce que la
Cour apprécie la validité d'un acte du droit de l'Union au regard des dispositions de cet accord
(point 84). De plus, étant donné qu'il met en place des règles qui s'appliquent directement et
immédiatement aux transporteurs aériens, leur conférant ainsi des droit susceptibles d'être invoqué à
l'entre des parties à cet accord, la Cour de Justice constate qu'elle peut apprécier la directive
2008/101 au regard de plusieurs de ses disposition : les articles 7, 11 et 15 (points 85 à 100).
La Cour, après avoir reconnu le bien fondé de l'invocation de l'accord Ciel Ouvert pour
apprécier la validité de la directive 2008/101/CE, s’attelle à juger les principes du droit international
soulevés par les requérants. Elle affirme en premier lieu que le droit international coutumier lie en
effet les institutions de l'Union (point 101). En second lieu, elle va examiner si les principes
évoqués sont reconnus comme faisant partie du droit international coutumier (point 102).
Trois premiers principes sont codifiés dans plusieurs conventions et n'ont été contestés par
aucun des États assistants à l'audience, ni membres de l'Union (11 sont présents), ni l'Islande, ni la
Norvège. La Cour est donc en mesure d'apprécier la validité de la directive sous leurs regards. Il
s'agit (point 103) du principe selon lequel chaque État dispose d'une souveraineté complète et
exclusive sur son propre espace aérien ; un autre selon lequel aucun État ne peut légitimement
prétendre soumettre une partie quelconque de la haute mer à sa souveraineté ; le dernier est le
principe de liberté de survol de la haute mer.
En revanche, la Cour déclare qu'il n'existe pas d'éléments suffisants pour établir le bien
fondé du principe aux termes duquel le principe qu'un navire en haute mer est soumis à la loi de son
pavillon devrait s'appliquer par analogie aux aéronefs survolant la haute mer. De plus, cette analogie
a été contestée par le Royaume-Uni et l'Allemagne (point 106).
Les principes peuvent être invoqués pour apprécier la validité d'un acte de l'Union s'ils sont
susceptibles de remettre en cause la compétence de l'Union, ou s’ils sont susceptibles d'affecter des
droits ou des obligations tirés du droit européen. Cependant, les principes généraux du droit
international sont par nature peu précis, et le contrôle juridictionnel ne peut que se limiter aux
erreurs manifestes d'appréciation quant aux conditions d'application de ces principes (point 110).
La Cour va à présent interpréter la directive au regard des motifs reconnues comme valable
pour ce faire. Il s'agit d'abord de déterminer en quoi la directive s'applique à des parties de vols
internationaux effectués en dehors de l'espace aérien.
Elle remarque d'abord que ladite directive ne s'applique pas par vocation à des vols
internationaux. Ce n'est que si un exploitant d'aéronef fait le choix d'exploiter une ligne aérienne
commerciale à l'arrivée ou au départ d'aéroports situés dans l'Union qu'il est soumis à la directive
2008/101/CE. Il est vrai que les exploitants doivent déclarer leurs émissions de carbone qui
concernent l'intégralité de ces vols (point 118), et qui donc dépassent l'espace aérien de l'Union. Or,
les trois principes de droit international invoqués sont liés au champ d'application territorial de la
directive (point 121), et les compétences de l'Union doivent être exercées dans le respect du droit
international aérien (point 123).
L'interprétation de la Cour est ici limpide, au point 124. C'est sans doute le point central de
cet arrêt : « la réglementation de l'Union peut être appliquée à un exploitant d'aéronef lorsque son
aéronef se trouve sur le territoire de l'un des États membres, et plus particulièrement, sur un
aérodrome situé sur un tel territoire, puisque, dans un tel cas, ledit aéronef est soumis à la pleine
juridiction de cet État membre et de l'Union. » Cette affirmation se retrouve déjà dans le considérant
9 de la directive 2008/101/CE qui avait comme anticipé cet argument aux moments des
négociations dans l'enceinte de l’OACI :
« À l’appendice L de la résolution A36-22 qu’elle a adoptée en septembre 2007, lors de sa
36e session, l’Assemblée de l’OACI prie instamment les États contractants de ne pas mettre
36
en œuvre un régime d’échange de droits d’émissions pour les exploitants d’aéronefs des
autres États contractants sauf sur la base d’un accord mutuel entre ces États. Rappelant que
la convention de Chicago reconnaît expressément le droit de chaque partie contractante à
appliquer ses propres lois et réglementations aériennes de manière non discriminatoire aux
aéronefs de tous les États, les États membres de la Communauté européenne et quinze autres
États européens ont formulé une réserve sur cette résolution et se réservent le droit, en vertu
de la convention de Chicago, d’adopter et d’appliquer, de manière non discriminatoire, des
mesures fondées sur le marché aux exploitants d’aéronefs de tous les États fournissant des
services aériens en direction, à partir ou à l’intérieur de leur territoire. »
Ainsi, la Cour de Justice rejoint la position politico-juridique que les États membres avaient
exprimée dans l'agence des Nations Unis. En définissant elle-même une marge d'appréciation pour
définir la portée des principes du droit international, la Cour renforce l'autonomie de l'ordre
juridique de l'Union, dans la filiation des arrêts Kadi72
. Elle démontre ici qu'elle n'est pas liée par
une interprétation extérieure du droit international, et que la marge de manœuvre dégagée s'exprime
en faveur de la politique climatique de l'Union et de son SEQE73
.
Pour renforcer cette position, la Cour, en son point 128, en appelle au principe du « niveau
de protection élevé de l'environnement ». Elle souligne que le législateur de l'Union peut en
principe faire le choix de définir les critères de son choix en ce qui concerne l'exercice d'une activité
commerciale sur son territoire. Elle rappelle, enfin, que la pollution de l'air, de la mer ou du
territoire terrestre est une politique internationale depuis la Convention-Cadre de 1992 et le
protocole de Kyoto. Au point 130, la Cour valide la directive au regard des principes invoqués.
Enfin, la Cour apprécie la validité de la directive au regard des articles 7, 11 et 15 de l'accord
« ciel ouvert ». C'est au regard de l'article 11 qu'un point important est soulevé. Les requérants
soutiennent que la directive ne saurait être valide car cet accord oblige l'Union à « exonérer de
droits, de taxes et de redevances le carburant embarqué ». Toutefois, le juge communautaire estime
que le système d'échange de quota, s'il vise la protection de l'environnement, est avant tout un
instrument de marché qui encourage et favorise la recherche des coûts les plus bas pour atteindre les
réductions (point 139). En cela, le coût concret de la mesure dépend de la différence entre les quotas
alloués et les quotas qui devront être restitués à la fin de la période. La Cour rappelle qu'il est même
possible qu'un exploitant réalise un bénéfice en vendant d'éventuels quotas rendus surnuméraires
(point 142). Il s'agit finalement d'une « mesure basée sur le marché », comme l'avait déjà souligné
Julianne Kokott dans ces conclusions. La Cour en conclue que la directive n'enfreint nullement
l'article 11 de l'accord « ciel ouvert ».
La Cour de Justice conclu que l'examen de la directive 2008/101/CE au regard des principes
coutumiers et des conventions du droit international ne sont pas de nature à affecter sa validité.
4) Extraterritorialité politique c. Territorialité juridique
Quels sont les points marquant de l'arrêt de la Cour de Justice ? D'abord, nous l'avons vu, la
Cour a apporté son soutien à la politique climatique de l'Union, en dégageant des marges de
manœuvres autour de l'interprétation des principes coutumiers du droit international. Il faut
souligner son volontarisme. Elle l'a aussi fait en n'assimilant pas le coût engendré par l'instrument
72 Affaires jointes C-402/O5 P et C-415/05 P, Kadi, [2008], Rec. p. I-06351.
73 Schiavo, L., « Droit de l'environnement et relations extérieures de l'Union européenne: Arrêt Air Transport Association of America et autres c. Secretary of State for Energy and Climate Change », Revue du Droit de l'Union européenne, 2011/4, pp. 736-741.
37
politique qu'est le SEQE à une simple taxe. La Cour a choisi de ne pas avoir une lecture stricte et
littérale des motifs invoqués par les requérants. Elle a souligné une fois encore l'autonomie de
l'ordre juridique de l'Union, qui, dans la hiérarchie des normes, se situe bien entre le droit
international et le droit dérivé. Toutefois, seule la Cour peut juger du contenu du droit international
afin de savoir si le droit dérivé y est conforme, car elle seule possède la compétence pour apprécier
la validité d'un acte de droit dérivé. Nous trouvons dans l'affaire Kadi que la Cour insiste sur sa
compétence exclusive pour effectuer le contrôle juridique des actes de l'Union. In fine, le juge
communautaire confirme le respect du principe de territorialité du SEQE et ouvre définitivement la
porte à l'inclusion du secteur aérien, même international, au marché européen du carbone.
Cette première analyse met en évidence, en nous reliant à la théorie du droit global, la
relative faiblesse du droit international en ce qu'il n'existe pas de voie de recours possible pour les
requérants face à la Cour de Justice de l'Union. La Cour Internationale de Justice de la Haye est
réservée aux seuls États et sa possible mise en branle en l'espèce est plus que spéculative.
Cependant, les requérants de l'affaire ATA ne sont pas satisfaits de l'arrêt de la Cour. Pour
leur part, ils estiment que la politique de l'Union fait preuve d'extraterritorialité en étendant le calcul
des émissions sur l'intégralité du vol, et non pas seulement sur la partie du vol ayant eu lieu au
dessus du territoire de l'Union. Pour eux, il y a bel et bien rupture de la souveraineté territoriale et
du destinataire de la norme du droit. Le dosage entre la territorialité et l'extraterritorialité est une
opération difficile, sur laquelle la Cour a tranché. Les conclusions de l'Avocat Général Julianne
Kokott allaient dans le même sens : « Le décollage et l'atterrissage représentent des éléments
particulièrement caractéristiques d'un vol donné, si bien [qu'il s'agit d'] un élément de rattachement
territorial suffisant pour que le vol en question soit intégré dans sa totalité dans le système UE
d'échange de quotas d'émission ».
Autre élément de non satisfaction pour les requérants, il est reproché par les compagnies
aériennes que le SEQE n'a pas été développé en conformité avec les traités internationaux, et
notamment le protocole de Kyoto qui affirmait que la mise en place de mesures visant à limiter les
émissions de GES devaient passer par l'OACI. Le juge, là aussi, estime que si Kyoto recommande
le passage par l'OACI, les États parties ne doivent pas nécessairement s'y limiter. Et de fait, les États
membres de l'Union avaient lancé des discussions à ce sujet dans ladite organisation sans que cela
ne mène nul part : nous avons vu qu'en 2004, une résolution reconnaissant le bien fondé des MBM
était adoptée. Dix ans plus tard, c'est une ébauche de projet qui doit être adoptée à session suivante
en 2016.
Face à ce jugement de la Cour, solide et favorable à la politique climatique de l'Union, il
reste des options aux requérants qui se situent ailleurs. Pour les percevoir, il faut élargir le champ
d'analyse de l'affaire, passant du droit positif au droit global.
Ils pourraient d'abord poursuivre l'Union devant l'OMC74
: « Une option qui semble
néanmoins hasardeuse car l'OMC ne contrôle le transport aérien qu'au travers d'une annexe75
à
l'accord sur le commerce des services. Annexe qui en réalité "exclut du champ d'application de
l'Accord la plus grande partie des services de transport aérien [et notamment] les droits de trafic et
les services directement liés au trafic", précise l'OMC. » De plus, comme la soulignée là encore
l'Avocat Général, le SEQE s'applique indistinctement à toutes les compagnies aériennes exploitants
une ligne dans un aéroport de l'Union. Au contraire, effectuer des distinctions entre des compagnies
internationales et des compagnies européennes serait considéré comme incompatible avec les règles
de concurrence de l'OMC.
74 Collet, P., « Marché carbone : l'Europe pourrait sortir renforcée de son opposition au transport aérien », Actu-
environnement.com, Paris, le 7 octobre 2011.
75 http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/26-gats_02_f.htm
38
Suite à la clarté du droit européen et international, c'est sur le terrain diplomatique et
politique que l'affaire va s'orienter. Dans un communiqué du mercredi 28 septembre 2011, comme
anticipant la réponse de la Cour de Justice, ou sans s'en préoccuper, Chinois et Russes "[s'opposent]
à toute décision unilatérale et contraignante, prise sans un accord des parties concernées sur la
question des émissions de carbone dans l'aviation", d'après l'agence de presse chinoise Xinhua76
.
Le 6 février, les autorités Chinoises interdisent officiellement à leurs 34 compagnies aériennes
opérant en Europe de se conformer au SEQE77
.
Le 21 février 2012, réagissant à l'arrêt de la Cour de Justice, au moment où l'OACI se réunit
à Moscou, le journal Espagnol El Pais relève que le ministre des transports Russes, Igor Levitin,
qualifie la décision de l'Union de « précipité » : « Tant que les actions des différents pays concernés
par le commerce des quotas ne seront pas concertés, il est nécessaire de suspendre l'application de la
directive aux compagnies des pays qui ne sont pas membres de l'Union78
». Dans le même article, il
est question d'une une coalition anti-européenne à l'intérieur de l'OACI, et d'une guerre
commerciale. Plusieurs autres médias ont couvert cet événement79
.
Dans une lettre du 18 décembre 2013 adressée aux dirigeants politiques du Royaume-Uni,
de l'Allemagne et de la France, une coalition d'ONG (AEF, Transport & Environement, Friends of
the Earth, Réseau Action Climat) demande une action proactive des États membres en faveur de la
proposition de la Commission80
. Elle dénonce le changement de posture de ces États qui ont décidé
de réduire le champ d'application du SEQE aux vols internes. Les ONG admettent que les États
agissent sous la pression de leurs partenaires internationaux, tout en affirmant que l'Union est en
mesure d'imposer sa politique. « This was in response to an American proposal at ICAO, which
China, India, Japan, Singapore, the UAE, Mexico, and others also endorced because it addressed
their concerns about extraterritoriality and reflected the Chicago Convention's clear confirmation
of states' absolute sovereignty in their airspace. » De plus, elles pensent qu'une telle retraite de
l'Union est de mauvaise augure pour adopter des politiques climatiques ambitieuses dans au sein de
l'OACI car elle fragilise son influence : « Politically, its sends the damaging signal that Europe is
not even prepared to defend a scope which regulates emissions from all flights operating within
Europe itself and whose consistency with member states' sovereign rights under the Chicago
Convetion was never questioned at ICAO. »
Même si, politiquement, il est possible de discuter des possibilités et de l'avenir du SEQE, il
faut pouvoir justifier juridiquement de sa suspension, alors même que la Cour de Justice s'est
prononcée clairement en faveur de sa mise en application à partir du 1er janvier 2012. En effet,
l'échec du droit international, ou, autrement dit, la non-application du droit européen ne peut se
passer d'une mise en conformité juridique du droit positif.
5) Les actes dérogatoires : quand le droit européen est suspendu
La solution que les institutions européennes ont adoptée pour « sauver » le droit européen
relève du bricolage. La directive 2008/101/CE, qui a modifié la directive 2003/87/CE qui est celle
du SEQE, a été adoptée le 19 novembre 2008. Elle prévoyait l'allocation des quotas aux exploitants
76 Collet, P., « Aviation : l'UE s'attire les foudres des professionnels », actu-environnement.com, Paris, le 29 septembre
2011.
77 Chaffin, J., Rabinovitch, S., « China bars airlines from EU carbon tax », Financial Times, 06/02/2012
78 Bonet, P., El Pais, « Una coalición antieuropea por la tasa del CO2 a los aviones », 21/02/2012. Traduction personnelle à partir de l'espagnol.
79 Voir par exemple : PressEurop, « Bras de fer UE-Chine sur le CO2 », 07/06/2011 ; Le Monde, « Le transport aérien fustige les quotas de CO2 que l'Europe lui imposera en 2012 », 06/06/2011.
80 La lettre est disponible sur le site des ONG, dont : http://www.rac-f.org/IMG/pdf/Lettre_des_ONG_-_aviation.pdf
39
d'aéronef le 1er janvier 2012, qui devait être rendus à la fin de la période, le 31 décembre 2012. Le
21 décembre 2011, la Cour de Justice a confirmé la validité de la directive une semaine avant sa
mise en œuvre, ouvrant la porte à son application. Pendant ce temps, à l'OACI, les discussions vont
bon train et les compagnies aériennes, soutenues par les gouvernements, dénoncent un acte
unilatéral et extraterritorial de l'Union. Sous la pression politique, l'Union recule.
Toutefois, le droit européen doit être appliqué. Quid de la directive 2003/87/CE ? Quid de la
souveraineté des institutions de l'Union ? Quid de la sécurité juridique ? Quid de l'efficacité du droit
européen ?
Pour répondre à ces épineuses questions, les institutions ont décidé d'adopter un « acte
dérogatoire », d'une nature innovante, unique à notre connaissance, et sans doute pas prévu par les
traités. Il existe de nombreuses dérogations en droit européen. Néanmoins, il s'agit ici d'une
dérogation au droit européen !
L'acte en question est la Décision n°377/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du
24 avril 2013 dérogeant temporairement à la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange
de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté. Elle a été proposée par la
Commission et rapidement adoptée par le Parlement et le Conseil suivant la procédure législative
ordinaire81
. Elle a été surnommée « Stop the clock ! », malheureusement rendu en français par
« Arrêtez la pendule ! ».
C'est dans ces considérant que la Décision expose sa raison d'être : « Une approche globale
face au problème de la croissance rapide des émissions provenant de l'aviation internationale
constituerait par conséquent le moyen le plus adapté et le plus efficace de réduire les émissions de
l'aviation. » (Considérant 1). Dans son considérant 5, il est souligné que l'élaboration de mesures
fondées sur le marché à un niveau mondial dans le cadre de l'OACI serait plus pertinente de par
l'échelle envisagée, que le seul niveau régional de l'UE. C'est avant tout une considération technique
qui prime : mieux vaut un instrument mondial basé sur un marché mondial, qu'un instrument basé
sur le marché européen qui empêcherait la réalisation du premier. Le considérant 6 donne
finalement la clé justificative : « Afin de faciliter ces progrès et de donner une impulsion
supplémentaire, il est souhaitable de reporter l'application des exigences [...] qui concernent les vols
à destination et en provenance d'aérodromes situés dans des pays hors de l'Union [...] ».
Cependant, l'argument ne parait pas tenir. En quoi est-ce que le fait que l'Union mette en
place un système régional d'échange de quota pour l'aviation empêche la réalisation d'un système
mondial ? Au contraire, mettre en place un tel système à l'échelle de l'Union européenne est une
manière de tester et d'élaborer l'instrument, de prendre les devants. Nous verrons d'ailleurs dans la
partie suivante que de nombreuses coopérations existent déjà entre le SEQE et d'autres instruments
de pays tiers. La fragilité de l'argument ne fait que souligner la prégnance des relations
internationales et des arguments géopolitiques et commerciaux que nous avons évoqués.
De plus, si le réchauffement climatique doit être combattu à l'échelle international pour avoir
une chance de vaincre, il est vain, de la part de l'Union, de chercher à imposer son instrument contre
l'avis de tous. Dans le domaine environnemental, la territorialité n'a pas de sens, car les enjeux sont
globaux. Or, l'Europe ne possède pas le leadership suffisant pour imposer au monde entier sa
volonté ; les États-Unis, la Russie, la Chine ne sont pas en manque de le lui faire comprendre au
sein de l'OACI. Finalement, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, l'Union doit ménager
ses alliés, et s'est bien le sens premier de la décision 377/2013/UE.
Dans son contenu, la décision, en son article premier, interdit aux États membres et à l'Union
européenne de prendre toutes sanctions à l'encontre des exploitants d'aéronef concernant la
déclaration des émissions pour les années 2010, 2011 et 2012, et surtout la restitution
correspondante des quotas de 2012. En cela, elle est une dérogation temporaire à la directive
81 D'après une Communication aux membres de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la
sécurité alimentaire du Parlement européen, du 18 décembre 2013.
40
2003/87/CE telle qu'elle avait été modifiée. En effet, elle ne remet pas en cause la directive
101/2008/CE qui prévoit également une seconde période s'ouvrant en 2013. L'Union préfère
attendre de voir les résultats et l'évolution des négociations au sein de l'OACI, dont les résultats
devraient parvenir au mois d'octobre 201082
.
D'après la Commission, la résolution A38-18 du 4 octobre 2013, validerait la stratégie de
l'Union qui consiste à basculer du SEQE régional à un Mécanisme Basé sur le Marché (MBM)
mondial. L'Union s'orienterait alors pleinement dans cette voie, et choisi alors de délaisser le moyen
qu'elle avait alors préalablement mis en place, à la savoir l'inclusion de l'aviation dans le SEQE.
Elle a adopté, à cette fin, le règlement UE 421/201483
, qui prolonge la décision dérogatoire,
désactive l'application du système d'échange de quota au secteur aérien, et interdit aux États
membres de prendre des sanctions à l'encontre des exploitants aériens à ce propos. Ironiquement, il
oblige les États membres à considérer que :
« Les exigences énoncées dans lesdites dispositions [(relatives aux quotas de l'aviation)]
sont satisfaites et ne prennent aucune mesure à l'encontre des exploitants d'aéronefs en ce
qui concerne : a) les émissions des vols à destination et en provenance d'aérodromes situés
dans des pays en dehors de l'Espace Economique européen (EEE) pour chaque année civile
du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 [...]. »
Dans son considérant 14, le règlement souligne la suspension de l'application du SEQE au secteur
aérien jusqu'à l'assemblée de l'OACI de 2016, suite à laquelle la Commission devra fournir un
rapport complet pour évaluer l'avancée de la mise en place d'un MBM mondial ; - envisageant une
éventuelle relance du MBM européen...
Notre analyse de la résolution de l'OACI A38-18 n'est pas aussi optimiste que celle de la
Commission. Elle qualifie « d'opinion scientifique » les rapports du GIEC. Elle souligne sans cesse
la nécessaire croissance du trafic aérien, et corolairement des émissions gazeuses, « jusqu'à ce que
des technologies et des carburants produisant moins d'émissions et d'autres mesures d'atténuation
soient mis en place ». Avant tout, elle encourage et invite les États parties à agir sans aucune forme
de contrainte ; elle compile des plans d'actions nationaux. C'est à partir du paragraphe 18 de la
Résolution qu'un MBM mondial est envisagée :
« 18. Décide d'élaborer un régime mondial de MBM pour l'aviation internationale, en tenant
compte des travaux demandés au paragraphe 19; »
Le paragraphe 19 dresse une liste de tâche à effectuer pour préparer le projet, qui devra être
présenté à la 39e session de l'OACI en 2016. C'est cette date qui tient en haleine la Commission.
Les tâches à effectuer sont les suivantes : mettre en balance les possibilités techniques des MBM et
les intérêts du secteur ; organiser des séminaires et des ateliers sur un régime mondial pour
l'aviation internationale ; déterminer les éléments de conception clés de mise en œuvre du régime
pour le rendre opérationnel à compter de 2020.
En adoptant une décision dérogatoire en 2013 pour la période 2012-2013, puis un règlement
dérogatoire pour la période 2013-2016, le législateur européen a complètement suspendu
l'application du SEQE au secteur aérien sous la pression de ses partenaires internationaux. Notons,
au passage, que le 21 mars 2014, les membres de la commission environnement du Parlement
européen avait rejeté le règlement UE 421/2014. Le Réseau Action Climat analyse ces résultats
82 Décision 377/2013/UE, considérant 6.
83 Règlement UE 421/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, en vue de la mise en oeuvre, d'ici 2020, d'une convention internationale portant application d'un mécanisme de marché mondial aux émissions de l'aviation internationale.
41
préliminaires comme suit : « A travers ce vote, les eurodéputés indiquent qu'ils n'acceptent pas que
l'Europe subisse un chantage de la part des chinois, des américains et d'autres pays qui l'obligent à
modifier ses politiques publiques à l'intérieur de son territoire. » L'ONG renverse finalement
l'argument de l'extraterritorialité !
Sans suivre jusqu'à bout ce raisonnement, notre analyse a mis en exergue l'équilibre sans
cesse remis en question entre le droit et la diplomatie. Il est certain qu'en suspendant l'application de
la directive 2003/87/CE dans sa version de 2012, les institutions ont subi un sérieux revers
politique. L'Europe veut assumer un leadership dans la lutte contre le changement climatique,
conformément même à l'article 191, 1 TFUE (« La promotion, sur le plan international, de mesures
destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l'environnement, et en particulier
la lutte contre le changement climatique. »). Elle a encore fort à faire en passant par l'arène du droit
international et de la diplomatie.
Depuis l'arrêt de la Cour de Justice du 21 décembre 2012, les négociations concernant la
régulation visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur aérien sont passées du
domaine du droit positif à celui des négociations diplomatiques au sein de l'organe spécialisé des
Nations Unis, l'OACI. Pour être exact, les deux ont toujours été liés, comme l'atteste les réactions
internationales suites aux « simples » publications des conclusions de l'Avocat Général84
. Ces
phénomènes correspondent aux politiques internationales classiques, qui mêlent droit international
et intérêts souverains des États. Contrainte, sous la pression, de suspendre l'application de ses
directives, l'Union n'exerce plus unilatéralement de politique climatique concernant l'aviation
internationale.
Cependant, il existe une autre stratégie de l'Union européenne qui se développe davantage à
partir de l'exemplarité. Elle consiste à diffuser le modèle de l'Emission Trading Scheme au près des
pays tiers, tout en assurant la conformité des systèmes nationaux en cour de développement avec le
SEQE. Il s'agirait d'une stratégie politico-technique élaborée par delà l'arène classique des relations
internationales qui s'avère bloquée par les intérêts nationaux divergents, et qui pourraient bien être
porteuse d'une autre manière effective de mettre en place des régulations internationales Ŕ ou plutôt,
globales. Ne pas imposer par la puissance, mais convaincre par l'exemplarité et la mise en
conformité technique.
84 Collet, P., Op. Cit.
42
III – Les stratégies globales de l’EU ETS
Cette dernière partie défendra l'idée que les limites de l'action de l'UE sur le plan international
classique voilent une partie de sa stratégie sur le plan global. Une stratégie qui en vient au soft
power, et qui vise à diffuser le modèle de l'Union (notamment l’EU ETS) en multipliant les accords
bilatéraux. Une stratégie bottom-up. La théorie du droit global permet de distinguer clairement les
deux niveaux, et d'éclairer sous un nouveau jour la construction des « normes et dispositifs de
contrôle » destinés à réguler le changement climatique en limitant les émissions de gaz à effet de
serre.
1) L'EU ETS : un modèle pour convaincre
Il existe de nombreuses manières de réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur
aérien. La Canada, par exemple, propose une série de mesures hétérogènes qui visent à réduire les
émissions carbone de l'aviation. Dans son Canada's Action Plan to Reduce Greenhouse Gas
Emissions from Aviation85
, il est proposé les mesures suivantes : moderniser la flotte, améliorer la
navigation et les distances des vols, améliorer la gestion du trafic (Air Trafic Management86
), puis
de manière plus subsidiaire : développement de technologies et de fuel alternatif, améliorer la
gestion environnemental des aéroports au sol, et optimiser la régulation internationale.
L'Union européenne, en choisissant d'inclure cette industrie au SEQE, a fait un choix
technique et politique. Ce choix s'insère dans une trame plus large, qui tient au rôle central que joue
le SEQE en Europe, et au rôle leader que ce dernier peut jouer au niveau mondial.
Dans une Communication de la Commission de 200587
, nous retrouvons les intentions
historiques des concepteurs du SEQE : « Il n’existe pas de solution technique simple et immédiate.
Il convient donc d’envisager une approche globale, de manière à renforcer l’action existante tout en
explorant de nouvelles pistes. » Dès l'origine du projet, les émissions de l'aviation sont appréhendés
d'un point de vue global. Le projet de la Commission rappelle clairement les manquements issus de
Kyoto et l'exemption dont a bénéficié le secteur aérien international (article 2.2). Elle affirme que
seule une politique volontariste pourra affronter le challenge. En son point 4.1 : « La Commission a
indiqué, dans sa communication de février 2005, que le transport aérien international devrait être
pris en compte dans toute stratégie post-2012 sur le changement climatique, afin d'inciter davantage
les États à agir par eux-mêmes et en coopération avec les autres. »
Le rôle que doit jouer le SCEQE est clairement international : « [Le groupe de travail]
veillera également à mener une réflexion sur la manière d’étendre le modèle communautaire à
d'autres pays à mesure que le SCEQE proprement dit s’étendra, et à chercher à supprimer une
quantité importante d’émissions conformément aux objectifs environnementaux de la lutte contre le
changement climatique. » Il est pensé que l'extension du SCEQE est inéluctable et s'effectuera
autour du centre piloté par les institutions. Ce discours apparaît comme mégalomaniaque au premier
regard, et il est amusant de comparer les intentions initiales et le développement historique du
projet.
De manière plus crucial pour notre analyse, nous trouvons dans la communication, écrit noir
sur blanc, que la solution que doit apporter l'Union au problème des émissions de l'aviation doit être
85 Disponible sur le site internet du gouvernement du canada : http://www.tc.gc.ca/eng/policy/acs-reduce-greenhouse-
gas-aviation-menu-3007.htm#ref15
86 Dans le cas du Canada, de nombreux détails sont donnés dans le document suivant : http://www.airlinecouncil.ca/pdf/NACC_FuelEfficiency_Final_Eng.pdf
87 Communication de la Commission COM(2005) 459 final, « Réduction de l'impact de l'aviation sur le changement climatique ».
43
pensé comme un modèle, multipliable et qui pourrait être recopié : « La Commission estime que
l’objectif à atteindre devrait être de réaliser un modèle praticable pour le marché des émissions en
Europe qui pourrait être étendu ou recopié au niveau mondial. L’étendue précise sera analysée dans
le groupe de travail à mettre en place tel que mentionné en annexe. » A la suite de cette affirmation,
nous retrouvons également la préoccupation technique, par nature internationale des émissions de
l'aviation : « En termes environnementaux, l’option préférée est de couvrir tous les vols au départ
des aéroports de l’UE, car en se limitant aux seuls vols «intracommunautaires» au départ et à
destination de l’UE, on ne tiendrait compte que de moins de 40% des émissions de tous les vols au
départ de l’UE. » C'était sans compter l'opposition des compagnies aériennes elles-mêmes que nous
avons constaté et analysé plus haut.
A travers la lecture de cette communication de la Commission prend distinctement forme la
nature du modèle voulu. Il s'agit avant tout de palier aux manques du protocole de Kyoto en ce qui
concerne l'aviation, et en même temps, de s'ériger en leader mondial dans le domaine. A cette fin, la
construction d'un modèle technique et normatif qui soit exportable et adaptable a été envisagée.
Du point de vue du droit global, cette attitude est très intéressante car elle est significative de
la construction d'une norme que l'on peut considérer comme un « équivalent fonctionnel » des
normes juridiques : « D'un point de vue pragmatique, le juriste peut et doit même s'intéresser à ces
normes en tant que celles-ci produisent ou tentent de produire des effets de régulations tels quelles
concurrencent, voire tendent à se substituer aux normes juridiques classiques88
. » Ainsi en est-il du
SEQE.
Si on isole de l'analyse l'inclusion du secteur aérien, le SEQE est déjà un instrument des plus
pertinents, en ce qu'il met en place une série d'obligation dans le chef des exploitants d'aéronef dont
l'intensité est définie à la fois par le marché et par le plafond de quota. L'obligation consiste à devoir
rendre les quotas en fin de période, dont le coût est un incitant. A l'effet finalement proche de celui
d'une taxe ou d'un impôt, les mécanismes basés sur le marché sont juridiquement originaux dans la
liberté et la marge de manœuvre laissées aux destinataires de la « norme ». Bien que caractérisé par
un fonctionnement mêlant obligation légale et incitant économique, il reste un instrument régional
destiné à transposer le protocole de Kyoto, au processus de construction issu d'une négociation entre
États, comparable, en droit européen, à la mise en œuvre d'une directive en droit national. Le SEQE
reste donc, en ce qui concerne sa genèse juridique, dans la filiation du protocole de Kyoto et du
droit international classique.
En revanche, si l'on regarde au plus près la construction juridique de la directive
2008/101/CE, son origine ne se trouve pas dans le protocole de Kyoto. Pourtant, son objectif est
bien de réglementer les émissions internationales de gaz à effet de serre issus du secteur aérien. En
effet, le protocole de Kyoto, comme nous l'avons déjà souligné, s'en remet notamment à l'OACI en
son article 2.2 pour prendre des mesures concernant l'aviation : « L’UE participe régulièrement et
supporte les activités de la CCNUCC et de l’OACI, activités qui contribuent à renforcer la
cohérence et à optimiser la participation aux efforts de réduction des émissions au niveau mondial.
Toutefois, comme c’est reconnu explicitement dans les déclarations politiques acceptées par ses
Parties contractantes, il n’est pas réaliste d’escompter que l’OACI prendra des décisions de portée
globale concernant des mesures spécifiques uniformes applicables par tous les pays89
. » Or, devant
l'absence de réaction à ce niveau là, la Commission décide de prendre les devants et de mettre en
place un instrument qui a vocation à s'appliquer au monde entier. Et en effet, il a fallu attendre 2010
pour que l'OACI témoigne de certaines avancées politiques.
Il s'agit finalement d'une norme ou plutôt d'un instrument définissant un certain nombre de
normes, créé à partir d'un vide juridique au niveau international. Son objectif n'en est pas moins de
« contrôler » ou « réguler » les émissions internationales du secteur aérien.
La méthode consiste à développer un instrument normatif régional, puis de chercher à
88 Frydman, B., Ibid, p. 13.
89 Communication de la Commission, COM(2005) 459 final.
44
l'étendre, à le copier, à le reproduire. Cela ne va pas sans difficulté, car, évidemment, les contextes
nationaux sont des déterminants essentiels, et qui sont généralement l'objet même des négociations
internationales. Le marché du carbone européen ne peut pas s'appliquer directement et tel quel dans
les autres parties du monde, et c'est pour cette raison que certain analyste préfère plus justement
parler de « prototype »90
. Ellerman trouve plusieurs spécificités européennes. Du point de vue des
avantages, l'Europe est une zone historiquement très morcelée, constituée de nombreux États. Le
SEQE fonctionne déjà avec une multitude d’États (30 actuellement). De plus, ces États sont socio-
économiquement très différents : l'Europe de l'Est est moins riche, et pollue beaucoup moins que
l'Europe de l'Ouest : « Europe has demonstrated that a multinational trading system, consisting of
sovereign nations with considerable disparities in economic circumstance and in willingness to
adopt climate change measures, can be constructed91
. » Autre aspect encourageant : les flux
internationaux ont fonctionné, et les États s'échangent avantageusement les quotas à un niveau
international, sans donc se limiter, aux frontières nationales.
En revanche, le même auteur souligne que l'Europe possède un gros avantage, qui est
l'Union européenne. Leurs institutions ont servi de colonne vertébrale à la mise en place du projet ;
on pourrait même dire que c'est elles qui l'ont promu. Ces structures régionales sont uniques au
monde avec un tel degré d'intégration. Or, il est essentiel que le contrôle des émissions, les normes
d'allocation ou encore les agences ou organismes en charge de la surveillance du système soit
centralisée pour permettre une fluidité et une confiance sur les marchés. Il faut être convaincu de la
substituabilité des produits financiers et des quotas pour accepter de agir dans un éventuel marché
international : « One can imagine that a central institution could emerge out of bilateral agreements
that might link the EU ETS with comparable systems out side of Europe. Something will be needed
to coordinate regulatory actions, to review periodic cap adjustments, and to negotiate with new
participants92
. »
L'Union ne sera jamais accepté par les autres pays du monde pour centraliser un marché
international des émissions d'aviation, et en même temps, on ne peut espérer un recopiage du
SEQE tel quel. Il convient alors de multiplier les associations et de donner l’exemple. La
collaboration internationale est indispensable pour contrôler le changement climatique. L'Union
européenne ne peut résoudre seule ce problème car elle n'est responsable que d'une part qui
représente environ 10% des émissions de GES. « En montrant l'exemple comme elle le fait
aujourd'hui, elle encourage ses partenaires à s'engager eux aussi. Et il faut reconnaître qu'ils sont
nombreux à avoir pris des mesures, même si l'effort collectif reste insuffisant93
. »
2) Diffuser le SEQE et les mécanismes basés sur le marché
Que va alors faire la Commission pour réguler les émissions de l'aviation ? Elle va d'abord
étendre son modèle à ses voisins. L'élargissement de l'UE va de pair avec l'élargissement du SEQE.
Le 16 avril 2003, 10 nouveaux États entrent formellement dans l'Union, qu'ils intègrent le 1er mai
2004. En 2007 sont entrée la Bulgarie et la Roumanie, et en 2013 la Croatie s'est jointe au cortège.
A chaque fois, ces pays intègrent le SEQE, qui, comme l'avait prédit la Commission, va donc en
s'étendant. D'autre part, en 2007, les trois États de l'EEE (Liechtenstein, Islande, Norvège) ont
rejoins le SEQE94
. En 2011, la directive 2008/101/CE a été incorporée à l'accord EEE incluant
l'aviation au même titre que le droit dérivé européen.
90 Ellerman, D., « The EU's Emissions Trading Scheme : a Prototype Global System ?, Global Change, MIT Press,
février 2009.
91 Ibid, p. 21.
92 Ibid, p. 22.
93 Hedegaard, C., Citation disponible sur le site de la commission européenne : http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/hedegaard/.../international_fr.htm
94 Disponible sur le site internet de la Commission : http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation/eea/index_en.htm
45
Surtout, l'Union européenne va développer des jumelages, superviser et conseiller les autres
États du monde qui souhaiteraient, eux-aussi, mettre en place un mécanisme basé sur le marché. Le
site internet de la Commission Action Climat fourmille d'articles à ce sujet : « The success of the
EU ETS has inspired other countries and regions to launch cap and trade schemes of their own, and
that fact is that the EU is cooperating very closely with other partners preparing and developing
carbon trading schemes, eager to learn about the EU experience and expertise95
. »
Il existe, au niveau mondial, plusieurs instruments hybrides qui mêlent objectifs politiques et
incitants économiques. Plusieurs rapports96
en exposent les caractéristiques, les forces et les
faiblesses, preuve de la co-construction au niveau global de ces instruments. La carte suivante
reprend les projets développés ou en cours de développement :
Carte des systèmes d'échange de quota d'émission.
(source : Banque Mondiale, 2013)
Il existe une multitude de projets qui sont en préparation dans le monde, basés soit au niveau
national, soit au niveau infranational. Aucun ne fonctionne exactement sur le modèle du SEQE, car
ils sont à chaque fois dépendant des contextes socio-économiques mais aussi politiques. Les critères
techniques les plus fondamentaux de différenciation sont : la fixation du prix du quota ; la fixation
95 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/hedegaard/headlines/news/2014-07-17_01_en.htm
96 Banque Mondiale, « Mapping Carbon Pricing Initiative », Carbone Finance, Washington D.C., mai 2013 ; International Carbon Action Partenership, « Emission trading worldwide », Status report, 2014 ; Un rapport de la Commission présente en annexe une description des autres systèmes régulant les émissions de l'aviation : Commission Européenne, « ETS Aviation Small Emitters », CLIMA.B.3, Bruxelles, mars 2014.
46
du plafond ou pas ; le volontarisme ou l'obligation ; les secteurs couverts ; les manières de
sanctionner ; les liens (linkage) entre les systèmes ; l'état d'élaboration du mécanisme. Nous
n'aborderons ici les grandes lignes de force de chacun des projets, et nous nous concentrerons sur le
rôle moteur joué par l'Union européenne dans leur diffusion.
Pour encourager ces mécanismes, l'Union européenne agit de manière multilatérale via des
programmes internationaux, et développe en même temps des partenariats bilatéraux. Cette
approche est strictement bottom-up mais n'en ait pas moins efficace, surtout à la vue des blocages
existant au sein de l'OACI.
Dans le cadre de la CCUNCC, l'UE a défini sa feuille de route pour la négociation qui aura
lieu à Paris en 2015 de l'accord qui prendre la suite du protocole de Kyoto97
. L'idée de la
Commission de fusionner le patchwork actuel en un unique régime global. Il s'agit donc de créer ce
patchwork, puis de le relier en cohérence autour d'une politique unique, dont elle serait à la fois
l'origine et la référence. Elle conceptualise en même temps sa politique intérieur pour 2030 et les
objectifs à fixer au futur accord international, qui elle-même doit être en cohérence avec les
objectifs fixés pour 2050 (EU 2050 Roadmap) qui vise une réduction de 80 à 95% des émissions de
GES. Pour ce faire, des études préliminaires indiquent que le facteur de réduction linéaire doit être
compris en 2,3% et 2,5%98
.
Pour diffuser les mécanismes basés sur le marché, l'Union européenne agit également de
manière indirecte en utilisant le Mécanisme de Développement Propre mis en place par le protocole
de Kyoto99
. Ce dernier est en effet utilisé pour construire des ponts entre les pays développés
(Annexe B) et les pays en développement. Bien que ces derniers ne se soient pas engagés à réduire
leurs émissions de GES, il leur est loisible de mettre en place des projets industriels utilisant des
technologies qui réduisent des émissions. La législation du SEQE permet le gain de crédit-carbone
sur quasi tous les types de projets industriels, à l'exception du nucléaire, de la reforestation et des
projets prévoyant la destruction des gaz industriels. Les quotas acquis via les MDP peuvent être
conservés au passage dans la phase III.
Cependant, depuis 2012, l'utilisation des MDP a chuté de manière spectaculaire pour
plusieurs raisons100
: le prix des quotas a tellement chuté en Europe que l'incitatif n'existe plus ;
devant l'abondance de quota, la Commission a décidé en 2013 de limiter les projets MDP aux pays
les moins développés (dont la Chine et l'Inde sont exclus, alors qu'ils produisent à eux deux plus de
la moitié des projets) ; les systèmes californien et québécois ont montré peu d'intérêt pour ce
mécanisme et ne les accepteront sans doute jamais car les États-Unis n'ont pas ratifié le protocole de
Kyoto. Pour Ranson et Stavins, si le MDP a pu jouer un rôle dans la diffusion des MBM dans les
pays en développement, la tendance actuelle met en évidence que les mécanismes de flexibilité ne
permettent pas l'émergence d'un marché global101
.
L'International Carbon Action Partnership (ICAP) est un programme gouvernemental
international qui a été créé le 29 octobre 2007102
. Il est essentiel pour notre sujet car il est la fenêtre
la plus claire et la plus porteuse de l'Union européenne pour promouvoir l'ETS. Il a été
officiellement mis en place par un groupe de 15 États pour lutter contre le réchauffement
climatique. Aujourd'hui, elle en compte 30, dont 12 États Européens, 15 États des États-Unis, puis
97 Hedegaard, C., « the Eu regrets the repeal of Australia’s carbon pricing mechanism », le 17 juillet 2014. Disponible
en ligne : http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/hedegaard/headlines/news/2014-07-17_01_en.htm 98 Commission Européenne, « Roadmap for moving to a low-carbon economy in 2050 », 11 avril 2013.
99 Nous avons déjà décris le fonctionnement technique de ce mécanisme dans le chapitre 1.
100 Ranson, M., Stavins, R., « Linkage of Greenhouse Gas Emissions Trading Systems : Learning from Experience », FEEM Working Paper, n°7.2014, février 2014, p. 25.
101 Idem.
102 Il existe aussi un programme privé qui réunit les entreprises privées intéressées pour promouvoir les marchés du carbone. Il s'agit de l'International Emissions Trading Associations. L'organisation est un lobby particulièrement actif au niveau européen (http://www.ieta.org/eu/)
47
l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le gouvernement administratif de la ville de Tokyo103
. A la
lecture du site internet, on comprend vite que l'objectif premier du partenariat est de promouvoir les
ETS : « Market based mecanisms offer the opportunity to achieve maximum greenhouse gas effect
emisions reductions on a global scale in the most economically efficiant manner104
. » Le site
propose notamment une carte interactive qui présente les différents ETS en fonctionnement, prévus
et considérés de part le monde. Il permet d'effectuer des comparaisons105
dans les manières de
mettre en place le même instrument technique tout en l'adaptant au contexte local. L'ICAP met en
place un forum international d'autorités publiques qui sont engagées dans la conceptualisation ou
l'implémentation de marché du carbone. Il établit un forum d'experts internationaux pour discuter
des problèmes de mise en œuvre, de compatibilité et de liaison (linkage).
Les projets les plus développés à l'heure actuelle sont l'EU ETS (2005), le Québec Cap-and-
Trade System (2012), le Californian Cap-and-Trade program (2012), et le New-Zeland ETS (2008).
La Chine, qui n'est pas membre de l'ICAP, a également lancé un ensemble de 7 ETS pilotes, rendu
autonome à l'échelle de ces provinces. Le premier à avoir été mis en place est celui de Shenzhen qui
a été lancé le 18 juin 2013. La Commission Nationale pour le Développement et les Réformes (le
puissant Ministère planificateur de la Chine) a annoncé son intention de construire un ETS national
à l'horizon 2015.
Parmi les marchés du carbone existant ou en projet dans le monde, très peu intègre encore le
secteur du transport. L'Union européenne, en essayant d'inclure le secteur aérien international au
SEQE, fait preuve d'avant-gardisme :
103 http://icapcarbonaction.com/partnership/members/ [Dernière consultation le 8 août 2014]. Europe : Allemagne,
Commission Européenne, Danemark, France, Italie, Grèce, Irlande, Pays-Bas, Norvège, Espagne, Royaume-Uni. Etats-Unis : Maine, Maryland, Massachusetts, New York, Vermont, Californie, Arizona, New Jersey, Nouveau Mexique, Oregon, Washington. Canada : Colombie Britannique, Manitoba, Ontario, Québec. États observateurs : Japon, Kazakhstan, République de Corée du Sud, Ukraine.
104 Http://icapcarbonaction.com/partnership/political-declaration/ « Role of Market-Based Solutions ».
105 http://icapcarbonaction.com/ets-map/
48
Secteurs couverts par les ETS internationaux
(source : ICAP, 2014).
L'ICAP met en ligne des informations au sujet des projets chinois en vue, sans doute, de
développer des partenariats et des associations. En effet, l'Union européenne concentre toute son
attention ce qu'elle appelle les linkages, c'est-à-dire les possibilités de réunir les différents marchés
carbone et de les faire fonctionner ensemble. La stratégie est de développer des associations par le
bas, et en même temps négocier des accords internationaux par le haut. De plus, les deux manières
d'agir se complètent et ne s'excluent pas comme le suggère Heitzig106
: plus les instruments mis en
place de manière indépendante par les pays seront similaires et assimilables (bottom-up), plus la
mise en place d'un marché mondial des émissions de carbone sera faisable (top-down). « Although
linkage will certainly help to reduce long-term abatement costs, it may also serve as an effective
mechanism for building institutional and political structure to support a futur climate agreement. »
Nous constatons, avec les linkages, à une convergence des normes et des instruments dont l'objectif
est de produire un effet régulateur mondial tout en contournant les blocages du droit international et
de la diplomatie classique.
D'après l'ICAP, les linkages permettent avant tout d'élargir les marchés, et donc d'offrir plus
de choix aux opérateurs privés afin de réduire leurs coûts et conduire à une convergence des coûts.
Ces associations peuvent être faites soit directement en connectant deux marchés bilatéralement,
soit indirectement en passant par les mécanismes de flexibilité tel que ceux mis en place par le
protocole de Kyoto (MDP et MOC). Une pleine association de deux marchés permet d'offrir à tous
les participants la meilleure option pour le meilleur prix. Elle entraîne une hausse de la demande qui
permet d'exploiter pour le mieux les options d'atténuation disponibles. Enfin, l'extension du marché
le met davantage à l'abri d'éventuel choc extérieur ou de manipulation des prix en réduisant la part
de marché relative des acteurs privés et publics.
Toutefois, afin de permettre ces associations, de nombreux facteurs doivent être pris en
compte dont l'étude est le principal propos de l'ICAP. Ces facteurs sont surtout d'ordre politique
(fixation des objectifs, contrôle plus ou moins étroit du marché, des prix et des mécanismes) et
économique (dans un pays en forte croissance comme la Chine, les opérateurs n'auront pas la même
attitude dans une économie en stagnation telle qu'en Europe). Ils sont aussi normatifs: il faut que le
suivi des émissions, la qualité des quotas (« une tonne est une tonne »), la vérification des standards
soient capables de créer la confiance qui est un pré requis pour un marché commun. De manière
générale, les autorités perdent leur marge de manœuvre et en flexibilité au fur et à mesure qu'elles
acceptent d'associer leur marché à un marché plus grand. Le cas général de l'Union européenne est
exemplaire à ce sujet. Pour palier à cela, il faut des mécanismes de coordination et de coopération
dont parle Ellerman107
et qui reste le plus grand défi des politiques climatiques globales : des
institutions sur lesquelles s'appuyer, pendant que les divergences d'intérêts et de contextes nationaux
rendent leur émergence très difficile.
L'exemple le plus réussi jusque là de linkage est le rapprochement du programme
Californien et du système Québécois. Ce dernier d'ailleurs a inclus le secteur aérien intérieur à son
marché du carbone. La Chine et les Etats-Unis mettent en place des programmes pour relier leurs
marchés régionaux. Comme mentionné, la Chine compte dès 2015 conceptualiser un système afin
de réunir ses 7 marchés pilotes.
De l'autre côté du Pacifique, les États-Unis ont mis en place deux sous systèmes qui sont
déjà reliés par certaines coopérations et échanges d'information : le Regional Greenhouse Gas
Initiative qui regroupe 5 États de la côte Est, pendant que le Western Climate Initiative réuni des
États de la côte Ouest et plusieurs provinces canadiennes. Des analystes américains observent que
la plupart des aspects des programmes sont prêt pour permettre un échange de quota dans un
106 Heitzig, J., « Bottom Up Strategic Linking of Carbon Markets : Which Climate Coalitions Would Farsighted Players
Form ? », Nota di Lavoro, n°48, 2013. http://feem.it
107 Ellerman, D., Ibid. Voir supra.
49
potentiel marché commun108
. D'après eux, le dernier obstacle majeur réside dans le prix d'allocation
initial des quotas. Ils proposent une méthode d'association par degré, identifiant 10 domaines,
chacun composé d'environ 4 facteurs, qu'il convient de réunir les uns après les autres. Ils estiment
les facteurs suivant le rôle (essentiel/périphérique) qu'ils jouent dans le fonctionnement du marché,
et suivant la difficulté potentielle de les associer (facile/difficile). Les éléments les plus importants
pour le fonctionnement d'un marché commun sont pour eux : les sanctions des opérateurs déviant,
le prix des quotas et les apports issus des mécanismes de flexibilité, les instruments de mesure et les
registres de comptabilité109
.
De son côté, la Commission européenne a mis en place deux projets d'association directe :
l'un avec l'Australie, l'autre avec la Suisse. De par la taille de son marché du carbone, l'Europe ne
peut que prétendre à des accords asymétriques ce qui ne facilite pas la tâche de s'étendre
internationalement. Le modèle Suisse a sans doute été conceptualisé dès le début pour être intégré
au marché européen, et le fonctionnement de l'accord d'association est plus proche des politiques
d'élargissement de l'Union à cause du lien étroit qui relie les deux entités politiques. *
Dans le Swiss ETS110
, les entreprises sont exemptées des taxes carbones qu'elles doivent
payer si elles ne sont pas parties au marché carbone. Ces taxes constituent un autre volet de la
politique climatique de la Suisse. La participation à l'ETS est obligatoire pour les grandes unités de
production qui possèdent plus de 20 MW de capacité installée. Elle est volontaire pour les unités
comprises en 10 et 20 MW. Le système, comme le SEQE, prévoit un plafonnement des quantités de
quota mis en circulation sur le marché qui est réduit chaque année. Les quantités allouées
gratuitement par unité de production suivent, là aussi comme l'EU ETS, la méthode du benchmark :
la quantité de quota nécessaire pour la production d'une unité est calculée à partir de la moyenne de
émissions causées par les 10% des unités de production les plus efficaces. Par exemple, pour
produire une tonne d'aluminium, les 10% des unités de production les plus efficaces ont besoin de
1,514 tonne de CO2. Les quotas sont ensuite distribués aux entreprises en fonction de leur
production. Si une entreprise nécessite plus de quota que ceux distribuée, elle peut en acheter aux
enchères. Enfin, les entreprises doivent enregistrer leurs émissions annuelles à l'administration
suisse (Federal Office for the Environment Ŕ FOEN) qui peut décider à tout moment de les vérifier
sur place.
Le couplage direct entre le marché carbone suisse et européen est envisagé sérieusement111
.
La dernière réunion de négociation a eu lieu à Berne le 12 décembre 2013 et s'est surtout concentré
sur certains aspects techniques concernant les registres nationaux et leur sûreté. L'objectif déclaré
des deux parties est d'aboutir à un accord avant l'été 2014. Les avantages attendues pour la Suisse
sont à la fois d'ordre économique et politique. Un marché plus grand met à disposition des
entreprises des prix plus bas et plus stables. La taille du marché suisse est à cet égard
problématique. Les entreprises suisses pourraient opérer sur les mêmes marchés sur leurs
partenaires européens ce qui réduirait les distorsions de concurrence. Enfin, il est convenu que les
droits d'émission auraient la même valeur pour remplir les obligations légales qui incombent aux
opérateurs privés.
L'accord avec l'Australie est tombé à l'eau cet été, suite à l'élection d'un gouvernement
conservateur en Australie en 2013, au grand désespoir de la Commission112
. En effet, cet accord
108 Burtraw, D., Palmer, K., Munnings, C., Weber, P., Woerman, M., « Linking by degrees : Incremental Alignment of
Cap-and-Trade Markets », Resources for the Future, n°13/04, Washington D.C., avril 2013.
109 Ibid, p. 17.
110 Les informations sont disponibles sur le site du ministère de l'environnement suisse: http://www.bafu.admin.ch/emissionshandel/05545/index.html?lang=eng
111 International Emission Trading Association, « Switzerland : A case Study Guide to Emission Trading », Report, mai 2013, p. 4. http://ieta.org/
112 Connie Hedegaard a déclaré sur le site de la Commission Action Climat à ce propos le 17 juillet 2014 : « The EU regrets the repeal of Australia's carbon pricing mechanism just as new carbon pricing initiatives are emerging all around the world. [...] The EU will continue to work toward global carbon pricing with all international partners. With
50
était une belle opportunité pour prouver au reste du monde la compatibilité de son système avec
celui issu d'un autre continent. Si d'un point de vu économique, la perte n'est pas très grande pour le
SEQE, c'est d'un point de vue politique que le bas blesse. Si le marché européen est de loin le plus
important en termes de quantité de quota pris en charge, il n'arrive pas pour l'instant à se lier avec
d'autres marchés que ceux de ses voisins immédiats malgré les efforts de la Commission que nous
avons décrit dans les détails. De plus, le projet australien devait aussi se connecter avec celui de
Californie, entraînant plusieurs maillons d'un éventuel futur marché international. Le couplage des
deux systèmes avait été programmé pour le 1er juillet 2018, et le mandat de négociation devait
commencer au milieu de l'année 2015. L’Australie avait revu son système en décidant de ne pas
implémenter de prix planché, et de limiter les apports de quotas par les mécanismes de projets à
12,5% au lieu de 50%. Toutefois, l'élimination du projet par le gouvernement australien oblige à
mettre de côte cette ambitieuse politique européenne113
.
L'Union européenne opère donc multilatéralement via des programmes internationaux, et
bilatéralement avec des États tiers afin de promouvoir les mécanismes basés sur le marché,
autrement dit ceux fixent un prix à la pollution. Si l'action directe de la Commission ne se fait pas
sentir autant qu'elle le souhaiterait, le climat des affaires concernant les marchés du carbone semble
tout de même prometteur. Elle promeut son instrument via des organisations internationales et des
forums d'expert qui supervisent et travaillent ensemble afin de rendre les marchés carbones
efficaces et compatibles. L'avenir nous dira si cette stratégie est la bonne, mais preuve est faite
qu'elle existe bel et bien. Une stratégie qui met en place des normes et instruments de contrôle afin
de réguler les émissions mondiales de GES. L'inclusion de l'aviation dans le marché du carbone
apparaît comme un élément supplémentaire destiné à faire de l'EU ETS le marché de référence
mondial des gaz à effet de serre, eux-mêmes ayant vocation à s'ériger en instrument de référence
pour réglementer les émissions de GES. « The growing network of decentralized, direct linkages
among these systems may turn out to be a key part of a future hybrid climate policy architecture 114
. »
3) Quels éclairages de la théorie du droit global sur l’affaire ?
En nous appuyant sur la théorie du droit global peut mener en dernier ressort notre analyse,
nous pouvons mettre à jour une série complexe d'événements internationaux qui peuvent être
considérés comme une source du régime global du changement climatique à venir. Nous avons
retourné la démarche juridique : au lieu de nous intéresser à l'interprétation du contenu de la règle
ou de l'acte, nous voulons savoir d'où viennent ces derniers, quelle est leurs sources. Il s'agirait,
pour employer une métaphore, d'une sorte de question de droit institutionnel à propos d'un État qui
n'existe pas ou que nous ne voyons pas.
En nous écartant de l'analyse stricte du droit positif et de l'analyse des négociations dans les
enceintes classiques où se jouent les lois, nous avons trouvé tout un pan des relations internationales
qui s'efforce de diffuser un instrument normatif (les marchés du carbone) afin de réguler quelque
chose au niveau mondial (les émissions de GES de l'aviation). En nous mettant sur la trace de cette
Objet Juridique Non Identifié (OJNI) qu'est la régulation des émissions de l'aviation internationale,
nous avons trouvé, au lieu d'une classique négociation dans une enceinte internationale, une
stratégie qui consiste à faire exister ce que l'on veut, à pousser l'existence de ces MBM jusqu'à les
rendre opérationnels et présents internationalement.
Les fondements de l'approche positive ne doivent pas être déniées ici, et ne le sont pas : nous
today's repeal of the Carbon Pricing Mechanism, the discussions to link Australian system and Europe's carbon market will evidently be discontinued. »
113 Milman, O., « Australia's carbon tax abolition draws international criticism », The Guardian, le 18 juillet 2014.
114 Ranson, M., Stavins, R., « Linkage of Greenhouse Gas Emissions Trading Systems : Learning from Experience », FEEM Working Paper, n°7.2014, février (2014).
51
avons fait la part belle à l'OACI et à l'affaire 366/10 de la Cour de Justice de l'Union. Et c'est
d'ailleurs en cherchant les conséquences de cette affaire que nous nous sommes retrouvés face à la
stratégie de l'Union, car l'affaire ne réglait pas tout, ne répondait pas à tout, et surtout, n'a pas clos la
question : comment réguler les émissions du trafic aérien international ? Alors que le droit positif
disait une chose, une autre chose se passait !
Cette stratégie consiste à créer une politique interne exemplaire, une politique qui est
nécessairement inter- et transnationale, complexe, qui s'inscrit dans un champ institutionnel
composé d’États souverains, d'un ordre juridique autonome, d'un pouvoir exécutif ambitieux, d'un
Parlement démocratique. Un champ qui gouverne 500 millions de citoyen européen. Une fois l'outil
public fonctionnel, l'Union le propose au reste du monde comme exemple ou modèle.
Il ne s'agit pas d'une politique « pure », car les objectifs ont déjà été négocié et sont fixés :
maintenir à un niveau vivable pour l'homme le réchauffement climatique ; ils ont aussi été traduit
techniquement : on parle de limiter ce réchauffement à 2°C. Et il ne s'agit pas non plus d'un simple
instrument technique, ni d'une règle juridique. Derrière le marché européen du carbone se cache une
manière de penser, d'organiser, de centraliser, peut être d'interpréter le monde : « Il faut » prendre au
sérieux la menace environnementale ; « il faut » le faire en diminuant au maximum les coûts ; « il
faut » une action concertée du monde entier ; « il faut » un instrument international et une politique
globale ; « il faut » être efficace ; « il faut... ». N'oublions pas non plus l'asymétrie du marché du
carbone au niveau mondial : le marché de l'Union couvre un peu plus de 2 milliards de tonnes
équivalant CO2. Les autres marchés pèseraient, cumulés, 1,8 milliards de tonnes équivalant CO2.
De quoi faire valoir ses droits au moment de prendre des décisions.
L'Union européenne n'est pas seule à proposer un instrument normatif, même si nous nous
sommes essentiellement concentrés ici sur le rapport entre droit européen et droit international et
sur sa stratégie personnelle. Une lecture superficielle du rapport de l'ICAP, dont nous avons
souligné l'influence européenne au sein de l'organisation, éclaire aussi l'attitude des autres
« partenaires ». Chacun essaye de vendre son instrument, d'être la référence, celui à qui on va venir
demander conseil ; et qui pourra, au besoin, agir à son avantage, et qui aura toujours une longueur
d'avance.
Ainsi, nous pouvons lire115
que le Regional Greenhouse Gas Initiative, a été dès l'origine
conçu comme un modèle de système d'échange pour d'autres régions et pour les États-Unis dans
l'ensemble. C'est lui qui, le premier, a lié la mise aux enchères de quotas alloués et les procédures
d'investissement pour promouvoir, dans le même temps, l'efficacité, l'énergie propre et le bien-être
des consommateurs. Les marchés carbones de Californie et du Québec ont organisé, quant à eux, le
premier système ETS transnational, dirigés par des gouvernements infranationaux116
. Avis aux
amateurs d’États fédéraux. Les japonais ne sont pas en reste117
: le Tokyo Cap-and-Trade Program
est le premier programme urbain du monde, incluant des bureaux, des bâtiments commerciaux et
des industries. Son programme est prévu pour s'adapter à un contexte urbain dense et grandement
consommateur d'énergie. Les chinois se démarquent aussi118
: ce sont les premiers à avoir mis en
place un marché carbone dans un pays en développement. Ce sont aussi les plus efficaces : le projet
pilote de Shenzhen a été lancé au bout de seulement un an de préparation ! Etc.
Ce que nous voyons apparaître en regardant de près la genèse de cette régulation globale des
émissions de GES, c'est un conflit de norme. Les normes, dans le contexte de la globalisation, sont
en pleine expansion pour de nombreuses raisons passionnantes qui s'en tiennent sans doute à
l'essence même de nos sociétés contemporaines, dont l'absence d’État mondial, une multiplication
des légitimités qui conduit à une multiplication des acteurs régulateurs (dont les entreprises et les
ONG), et une aversion toute démocratique pour les politiques du type command-and-control,
115 ICAP, Report 2014, Op. Cit., p. 13.
116 Idem, p. 14.
117 Idem, p. 17.
118 Idem, p. 19.
52
auquel on préfère le libre arbitre, le marketing et les incitants économiques. Malheureusement, ces
normes sont encore mal étudiées dans le champ des sciences juridiques, et ces évocations ne sont
que des intuitions. Dans les sciences politiques, le concept de soft power a pourtant fait fortune.
Le Centre Perelman s'est toutefois penché avec brio sur ces normes119
à mi-chemin entre le
politique, le technique et le juridique : « On préfère souvent continuer à séparer, selon la bonne
vieille constitution moderne, d’un côté, les normes techniques qui déterminent la fabrication, la
circulation et l’administration des choses et, de l’autre, les règles juridiques qui déterminent les
comportements et les rapports entre les hommes. Pourtant, cette distinction, si elle n’a jamais fait
sens, devient intenable lorsque les «choses» que l’on prétend administrer ne sont plus des produits,
mais des services, c’est-à-dire des activités humaines, et que les normes techniques se transforment
en normes de gestion et en outils de management120
. » La norme se situe donc à mi-chemin entre la
règle juridique, et la science des choses ou de la nature. De par cette location, elle est passée
inaperçue des juristes qui lui préfèrent les règles plus nobles constitutionnelles, institutionnelles ou
encore législatives. Pourtant, l'une des sources principales de ses régulations globales ne se trouvent
pas ailleurs que dans ces conflits de norme.
Nous l'avons vu avec le SEQE et son extension aux vols internationaux : les gouvernements
ne sont pas les seuls acteurs présents. Nous les retrouvons à côté des entreprises, des juges et des
ONG. Le monde global n'est pas qu'un monde international. Il est loin le temps du concert des
nations, le temps de la puissance par la force. Ce que la théorie du droit global met à jour dans le
cas du SEQE, c'est la manière dont les règles internationales sont mises au monde. Nous avons
assisté à une construction par le haut et par le bas. Par le bas, il s'agit de diffuser un modèle qui
correspond à des valeurs et des intérêts bilatéralement. Par le haut, il faut négocier avec ces
partenaires d'égal à égal, avec respect et dans la confiance ; il faut aussi créer un climat propice pour
convaincre, qui se fait par le bas.
Nul ne connaît encore les résultats de la 39e session de l'OACI et pour laquelle l'Union
européenne a suspendu le droit européen et ses politiques internes. Mais ce qui est sûr, c'est que ses
résultats ne seront pas le fruit d'un face-à-face tendu entre les présidents américain, chinois, ceux
des États membres, confortablement assis autour d'une table.
Cette analyse a d'ailleurs été portée dès 2012 par Nicole de Paula Domingos121
. Dans son
article, elle défend un point de vue qui rejoint le notre : ce qui compte, ce n'est pas la manière de
résoudre le problème, mais c'est de le faire en associant les autres. D'après elle, pour comprendre les
raisons de la levé de bouclier qu'a connu l'Union européenne après que la Cour de Justice ait
confirmé la validité, au regard du droit international, de la directive 2003/87/CE, il ne faut pas
regarder le contenu même de la régulation. Aucun État du monde, pas même les États-Unis, sont
contre les politiques environnementales ambitieuses, de l'Union ou autre. Par ailleurs, si la
Commission a bon espoir que l'EU ETS se propage, et que l'OACI adopte en 2016 les principes d'un
marché global des émissions de l'aviation, c'est que les États du monde sont également attentifs à
cette problématique.
L'Union, en proposant d'application le SEQE au secteur aérien international, n'a pas proposé
une mauvaise solution au problème du réchauffement climatique. Ce qui a été dénoncé par les
autres pays, c'est l'aspect unilatéral de la décision : « In summary, instead of collecting adherent
voices to its cause, the EU provoked extremely antagonistic reactions122
. » Et d'ailleurs, la condition
pour laquelle l'Union a accepté de suspendre l'inclusion de l'aviation est que des avancées soient
menées au niveau international de l'OACI. Elle a tout de même imposé son agenda. C'est bien la
119 Frydman, B., Van Waeyenberge, A., (Dir.), Gouverner par les standards et les indicateurs. De Hume au Ranking.,
coll. Penser le droit, éd. Bruylant, décembre 2013.
120 Frydman, B., « Prendre les standards et les indicateurs au sérieux », Working Paper du Centre Perelman de Philosophie du Droit, 2013/04. http://philodroit.be
121 De Paula Domingos, Nicole, « Fighting Climate Change in the Air : lessons from the EU directive on global aviation », Revista Brasileira de Politica International, vol. 55, Brasilia, 2012.
122 Ibid, part 3.
53
question de la norme et du leadership qui a finalement été posée dans cette affaire. « Besides
accusations of illegality and unilateralism, the EU put at risk the creation of a patchwork of
bureaucratic and conflicting rules, which, ultimately, could not properly address its main goal: to
cut aviation emissions123
. » Dans cette course à la norme référentielle, les États ne comptent pas être
en reste. Le monde multipolaire qui est aujourd'hui le notre oblige à multiplier les alliances, à
concevoir à plusieurs les instruments globaux, car ceux-ci ont un impact autant technique que
politique.
Conclusion
Le chemin reste long avant que le secteur de l’aviation ne se voit obliger de participer à
l’effort mondial contre le changement climatique. La tentative de l’Union européenne de suppléer
les carences du protocole de Kyoto et de légiférer pour que le marché du carbone s’applique aux
vols internationaux a été mise en échec. Elle ne l’a pas été par le droit européen, ni par le droit
international qui, unanimes, se sont exprimés en faveur de la directive 2003/87/CE, modifiée par la
directive 2008/101/CE afin d’y inclure l’aviation. La Cour de Justice de l’Union avait pourtant
tranché le 21 décembre 2011, dans l’affaire opposant les compagnies aériennes américaines au
Système d’Echange de Quotas d’Emissions de gaz à effet de serre : oui, les vols internationaux
devront, à partir du 1er
janvier 2012, se conformer au SEQE. Cependant, ce que notre cas a mis au
clair, c’est que le droit n’a pas suffit à faire la loi.
Les gouvernements des Etats-Unis, de Chine, d’Inde, de Russie, sont rapidement intervenus
en faveur de leurs compagnies aériennes. Usant de diplomatie au sens fort du terme, ils ont formé
une coalition antieuropéenne à l’intérieur de l’enceinte des Nations Unis chargée de réglementer le
secteur aérien : l’OACI. Celle-là qui, d’après le protocole de Kyoto (article 2.2), devait mettre en
place une politique globale pour lutter contre les émissions de l’aviation civile, a été, au contraire, le
lieu du verrouillage de la première politique internationale ambitieuse sur le sujet. Sous la pression,
et bien que poussant l’agenda en son sens, l’Union européenne a dû faire marcher arrière en
adoptant des actes dérogatoires (décision 377/2013/UE), temporaires, offrant une impunité aux
compagnies aériennes qui ne respecteraient pas le droit européen. Ainsi a été sacrifié le droit
européen. Néanmoins, malgré son isolement à l’intérieur de l’enceinte, l’Union européenne a tout
de même réussi à pousser l’agenda, et le sacrifice a eu une condition : que les discussions avancent
dans l’OACI pour apporter une solution globale aux émissions de l’aviation.
C’est à cet endroit précis que la théorie du droit global, de par son attention aux normes et
dispositifs de contrôle régulateurs, fonctionnellement équivalents à des règles de droit mais
différents dans leur nature, a pu apporter un éclairage essentiel pour saisir ce qui se passait. En effet,
une analyse superficielle aurait pu conclure que, grâce aux négociations à l’intérieur de l’OACI,
bientôt peut être, un traité international viendrait combler le manque laissé par le protocole de
Kyoto. Cela aurait manqué de clairvoyance.
L’Union européenne ne s’est pas contentée d’agir uniquement au niveau des enceintes
juridico-politiques classiques, là où, conformément à un ordre juridique comprenant sources et
destinataires, un texte de loi international pourrait être adopté. Au contraire, par le biais de mille
stratégies qui tiennent du soft power, cette capacité à convaincre et influence ses partenaires sans
jouer de la force, elle a continué d’avancer ces pions pour diffuser et étendre le SEQE. Elle finance
des programmes internationaux réunissant des experts en des forums de discussion en vue de
conceptualiser la mise en place de mécanismes basés sur le marché dans divers terreaux nationaux,
partout en vue de fixer un prix à la pollution, puis d’échanger ces nouveaux produits financiers dans
123 Ibid, voir les conclusions de son article.
54
un marché bientôt international. En premier lieu, l’ICAP est un puissant vecteur de discussion
politico-technique qui offre une plateforme pour échange des informations et optimiser les marchés
carbones nationaux avec pour ambition de peut être, un jour, les fusionner, les relier entre eux pour
former un grand marché global des émissions de carbone. Surtout, le SEQE est certainement le plus
important et le plus abouti de ces marchés au niveau mondial. Talentueuse pour faire vivre
ensemble 500 millions d’Européen dans 28 Etats, l’Union a néanmoins besoin de composer des
alliances, de tisser des partenariats pour diffuser son prototype. A ce moment là, l’aviation, comme
les autres industries polluantes, ne sauront plus sortir des mailles du filet. Quant à savoir si ces
efforts porteront leurs fruits, la réponse ne sera donnée qu’en 2015 à Paris, et en 2016 avec l’OACI.
Cette stratégie concerne les conflits de norme. Il ne s’agit pas d’imposer sa solution par la
diplomatie, mais de favoriser la propagation de l’instrument technique porteur de sens et de
référence, pas à pas, par le bas, « bottom-up ». Ainsi se mette en place les conditions pour qu’un
prototype avancé par un acteur global, ici l’Union européenne, se place au centre des négociations
internationales, s’impose progressivement jusqu’à devenir la meilleure solution. Le modèle
finalement adopté ne sera pas identique à l’initial. Il aura été adapté, discuté, modifié, transposé par
les partenaires-copieurs de la norme qui deviendra le vecteur référentiel, fonctionnellement une
règle de droit.
Comment expliquer cette démarche ? Nous ne pouvons ici qu’esquisser quelques hypothèses
car notre étude de cas ne peut répondre à cette question. L’inexistence d’un ordre juridique global
en est la principale cause. Il n’y a pas de super-Etat capable de dicter sa loi et d’organiser ses sujets.
Les relations internationales s’organisent de plus en plus avec un schéma multipolaire. Certes, les
Etats-Unis restent la puissance dominante. Certes, il existe encore une organisation centre-
périphéries. Toutefois, les acteurs se multiplient, et l’on retrouve à côté des Etats « puissants »
d’autres Etats, ainsi que des entreprises multinationales, des organisations internationales, des
organisations non-gouvernementales et souvent transnationales, qui peuvent faire jouer la
concurrence entre Etats, ou encore user du « forum shopping ». Dans ce monde là, la politique au
sens de l’organisation des intérêts bien compris des Etats n’est plus qu’un élément parmi d’autres,
car les interdépendances sont permanentes, et que la coordination limite toujours la liberté de
chacun.
La guerre des normes risque bien de continuer encore longtemps. Ces normes, qui, sous
couvert d’anonymat, de technicité, de science, avancent à pas feutrés mais agissent, au moins autant
que les règles du droit positif, qu’elles participent aussi à élaborer. L’Union européenne, de par sa
nature hybride, entre droit international et droit national, entre souveraineté et influence, entre
politique et technique, paraît bien adaptée pour évoluer dans cet environnement.
C’est sans doute dans cette optique là aussi qu’elle négocie le Transatlantic Trade and
Investment Partnership avec les Etats-Unis. Dans le domaine des accords de libre échange, il s’agit
aussi de multiplier à l’infini les accords bilatéraux : UE/Maroc ; UE/Canada ; UE/CARIFORM
(Caraïbe), UE/Chili ; UE/Suisse ; UE/Mexique. L’un des grands enjeux de ce rapprochement
transatlantique est précisément la définition des normes de référence. Même la Chine ne pourrait se
passer d’un marché de cette taille, aux normes duquel elle devrait se plier. Des normes qui,
finalement, restent toujours proche de la puissance.
55
Bibliographie
Doctrine
Ouvrages
Beck, U., Qu’est-ce que le Cosmopolitisme ?, édition Flammarion, Paris, 2006.
Corten, O., Méthodologie du droit international public, édition de l’ULB, Bruxelles, 2009.
De Sadeler, N., Environnement et marché intérieur, coll. Commentaire J. Mégret, Bruxelles, 2010.
Frydman, B., Van Waeyenberge, A., (Dir.), Gouverner par les standards et les indicateurs. De Hume au
Ranking., coll. Penser le droit, éd. Bruylant, décembre 2013.
Perelman, C., Logique juridique. Nouvelle rhétorique, Dalloz, Paris, 1976.
Perelman, C., Olbrechts-Tyteca, L., La nouvelle rhétorique. Traité de l'argumentation, Presse Universitaire de
France, Paris, 1958.
Ramachandra, G., Environmentalism : a global history, Longman, New-York, 2001.
Articles scientifiques
Alberola, E., Solier, B., «L’inclusion de l’aviation internationale dans le système européen d’échange de
quotas de CO2: un premier pas vers un système mondial?», Etude Climat n°34, CDC Climat Recherche,
(2012).
Burtraw, D., Palmer, K., Munnings, C., Weber, P., Woerman, M., « Linking by degrees : Incremental Alignment
of Cap-and-Trade Markets », Resources for the Future, n°13/04, Washington D.C., avril (2013).
Collectif, Les instruments juridiques et financiers de la lutte contre le réchauffement climatique. Working
Papers du Centre Perelman de Philosophie du Droit, 01 (2011). http://www.philodroit.be
Delbosc, A., de Perthuis, C., « Les marchés du carbone expliqués », Bureau du Pacte Mondial de l'ONU, juillet
(2009), http://www.cdcclimat.com/IMG/pdf/09-09_c4c-les_marches_du_carbone_expliques.pdf.
De Paula Domingos, Nicole, « Fighting Climate Change in the Air : lessons from the EU directive on global
aviation », Revista Brasileira de Politica International, vol. 55, Brasilia, (2012).
Ellerman, D., « The EU's Emissions Trading Scheme : a Prototype Global System ?, Global Change, MIT
Press, février (2009).
Frydman, B., Ost, F., Van Waeyenbere, A., Les instruments juridiques et financiers de la lutte contre le
réchauffement climatique, Working Papers du Centre Perelman de Philosphie du Droit, 01 (2011).
http://philodroit.be
Frydman, B., « Perelman et les juristes de l'Ecole de Bruxelles », Working Paper du Centre Perelman de
Philosophie du Droit, 07 (2011), http://philodroit.be
Frydman, B., « Prendre les standards et les indicateurs au sérieux », Working Paper du Centre Perelman de
Philosophie du Droit, 04 (2013). http://philodroit.be
Heitzig, J., « Bottom Up Strategic Linking of Carbon Markets : Which Climate Coalitions Would Farsighted
Players Form ? », Nota di Lavoro, n°48, (2013). http://feem.it
Krasner, S., « Structural causes and regime consequences : Regimes as intervening variables », International
Organization, (1982).
Larrère, C., « Montesquieu et le doux commerce : un paradigme du libéralisme ? », Les cahiers de l'histoire,
n°123, (2014), p. 21-38. Disponible en ligne : http://chrhc.revues.org/3463.
Orsini, A., Morin, J.-F., Young, O., « Regime Complexes : a Buzz, a Boom or a Boost for Global
Governance ? », Global Governance, n°19, (2003), p. 27-39.
Pallemaerts,M., « La conférence de Rio : grandeur et décadence du droit international de l'environnement »,
R.B.D.I., (1995), pp. 175-223.
Ranson, M., Stavins, R., « Linkage of Greenhouse Gas Emissions Trading Systems : Learning from
Experience », FEEM Working Paper, n°7.2014, février (2014), p. 25.
Rorive, I., « Regulating Internet Content through Intermediaries in Europe and the USA » (avec B. Frydman),
Zeitschrift für Rechtssoziologie, vol. 23, (2002), pp. 41-59.
Schiavo, L., « Droit de l'environnement et relations extérieures de l'Union européenne: Arrêt Air Transport
56
Association of America et autres c. Secretary of State for Energy and Climate Change », Revue du Droit de
l'Union européenne, 2011/4, pp. 736-741.
Shishlov, I., Bellassen, V., Leguet, B., « Mise en oeuvre conjointe : un mécanisme pionnier dans les frontières
d'une limite sur les émissions », Etudes Climats n°33, (2012).
Contributions à un ouvrage collectif
Frydman, B., « Comment penser le droit global ? », in : J.-Y. Chérot et B. Frydman (dir.), La science du droit
dans la globalisation, Bruylant, Bruxelles, 2012, pp.17-48. Van Waeyenberge, A., « Le marché européen du carbone », p. 11, in : Collectif, Les instruments juridiques et
financiers de la lutte contre le réchauffement climatique. Working Papers du Centre Perelman de Philosophie
du Droit, 2011/01, http://philodroit.be
Jurisprudence
Européenne
CJUE (grande chambre), Air Transport Association of America, 21 décembre 2011, C-366/10, I-13755. Et les conclusions
de l’Avocat général.
CJCE, (grande chambre), Kadi, Affaires jointes C-402/O5 P et C-415/05 P, 008, Rec. p. I-06351.
CJCE, Commune de Mesquer, C-188/07, du 24 juin 2008.
CJCE, Commission c. Belgique, aff. C-2/9, du 9 juillet 1992. CJCE, Safety Hi-Tech Srl c. S&T Srl, aff. C-284/95, du 14 juillet 1998.
Règlementation
Européenne
Communication COM(2005) 459 final, de la Commission Européenne, « Réduction de l'impact de l'aviation
sur le changement climatique ».
Communication COM 2007(2) final de la Commission Européenne, « Limiter le réchauffement de la planète à
deux degrés Celsius Ŕ Route à suivre l'horizon 2020 et au delà ».
Communication COM(2000)1 final, de la Commission européenne, 2 février 2000.
Décision 2011/389/UE de la Commission, du 30 juin 2011, relative à la quantité de quotas pour l’ensemble de
l’Union visée à l’article 3 sexies, paragraphe 3, points a) à d), de la directive 2003/87/CE du Parlement
européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la
Communauté
Décision 1359/2013/UE du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 modifiant la directive
2003/87/CE afin de préciser les dispositions relatives au calendrier des enchères de quotas d'émission de gaz à
effet de serre
Décision n°377/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2013 dérogeant temporairement à la
directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la
Communauté.
Directive 75/442/CEE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 1975 sur les déchets.
Directive 2003/87/CE du parlement européen et du conseil du 13 octobre 2003 établissant un système
d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE
du Conseil.
Directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive
2003/87/CE afin d’intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d’échange de quotas
d’émission de gaz à effet de serre.
Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique
du dioxyde de carbone.
57
Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant l’établissement et l’implémentation
d’un fond de réserve pour le marché carbone et amendant la directive 2003/87/CE, du 22 janvier 2014.
Règlement UE 421/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, modifiant la directive
2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la
Communauté, en vue de la mise en oeuvre, d'ici 2020, d'une convention internationale portant application d'un
mécanisme de marché mondial aux émissions de l'aviation internationale.
Internationale
Convention de l’Aviation Civile Internationale (Chicago, 7 décembre 1944).
Convention-Cadre des Nations Unis sur le changement climatique (New-York, 9 mai 1992).
Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement (Rio de Janeiro, 13 juin 1992).
Protocole de Kyoto sur le changement climatique (Kyoto, 11 décembre 1997).
Résolution A38-18 de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (4 octobre 2013).
Documents de référence
Banque Mondiale, « Mapping Carbon Pricing Initiative », Carbone Finance, Washington D.C., mai 2013 ;
Commission Européenne, « ETS Aviation Small Emitters », CLIMA.B.3, Bruxelles, mars 2014.
Commission Européenne, Communiqué du 16 mai 2013, « Echange de quotas d’émissions : poursuite de la
réduction des émissions mais augmentation de l’excédent de quotas en 2012 ». Disponible en ligne :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-437_fr.htm
Commission Européenne, « Roadmap for moving to a low-carbon economy in 2050 », 11 avril 2013.
Commission Européenne, EU transport in figure : statistical pocketbook, 2013. Disponible en ligne :
http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/pocketbook-2013_en.htm
Commission européenne, « Système d’échange de quota d’émission de gaz à effet de serre », 2011. Disponible
en ligne : http://europa.eu/legislation_summaries/energy/european_energy_policy/l28012_fr.htm
International Carbon Action Partenership, « Emission trading worldwide », Status report, 2014
International Emission Trading Association, « Switzerland : A case Study Guide to Emission Trading », Report,
mai 2013, p. 4. http://ieta.org/
Groupe d'Expert International sur l'évolution du Climat, « Report : Climate change 2013 », disponible en
ligne : http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/
Lettre du Président Américain George W. Bush au sénateur Chuck Hagel, le 13 mars 2001.
Parlement Européen, Communication aux membres de la commission de l'environnement, de la santé publique
et de la sécurité alimentaire, du 18 décembre 2013.
Réseau Action Climat France, « Le mécanisme de développement propre », mars 2004.
Articles dans la presse
Allix, Grégoire, « Sous l’effet de la crise, le marché du carbone part en fumée », Le Monde, avril 2013.
Bonet, P., « Una coalición antieuropea por la tasa del CO2 a los aviones », El Pais, 21/02/2012.
Chaffin, J., Rabinovitch, S., « China bars airlines from EU carbon tax », Financial Times, 06/02/2012.
Collet, P., « Aviation : l'UE s'attire les foudres des professionnels », actu-environnement.com, Paris, le 29
septembre 2011.
Collet, P., « Marché carbone : l'Europe pourrait sortir renforcée de son opposition au transport aérien », Actu-
environnement.com, Paris, le 7 octobre 2011.
Hedegaard, C., « the Eu regrets the repeal of Australia’s carbon pricing mechanism », le 17 juillet 2014.
Disponible en ligne : http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/hedegaard/headlines/news/2014-07-
17_01_en.htm
Hedegaard, C., « Quelques faits concernant l'intégration du secteur aérien dans le SCEQE », 2013. Disponible
en ligne : http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/hedegaard/headlines/articles/2011-09-29_01_fr.htm
Hedegaard, C., « 30% energy efficiency proposal is good news for climate, investors and energy security »,
58
2014. Disponible en ligne : http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/hedegaard/headlines/news/2014-07-
23_01_en.htm
IFP Energies Nouvelles, « Le transport aérien et la problématique du CO2 : enjeux des mécanismes ETS et des
biojets », Panorama, Paris, 2013. Disponible en ligne : http://ifpenergiesnouvelles.fr
Layani, D., « Le principe de précaution au risque de croissance zéro ? », 2014. Disponible en ligne :
http://www.huffingtonpost.fr/david-layani/risque-creation-entreprise_b_4568513.html
Milman, O., « Australia's carbon tax abolition draws international criticism », The Guardian, le 18 juillet 2014.
Normand, J.-M., « Le transport aérien fustige les quotas de CO2 que l'Europe lui imposera en 2012 », Le
Monde, 06 juin 2011. Disponible en ligne : http://www.lemonde.fr/economie/article/2011/06/06/le-transport-
aerien-fustige-les-quotas-de-co2-que-l-europe-lui-imposera-en-2012_1532469_3234.html
PressEurop, « Bras de fer UE-Chine sur le CO2 », 07/06/2011. Disponible en ligne :
http://www.voxeurop.eu/fr/content/news-brief/697561-bras-de-fer-ue-chine-sur-le-co2
Quatremer, J., « Transport aérien : la guerre des gaz à effet de serre aura-t-elle lieu ? », Blog Les coulisses de
Bruxelles, 21/12/2011.
Richard, J., « Décollage difficile pour l'intégration de l'aviation dans le marché carbone européen », Energie &
Environnement, 2012. Disponible en ligne : http://energie.sia-partners.com.
Sia Partner, « Marché du CO2 : les nouveautés de la phase III », juillet 2013. Disponible en ligne :
http://energie.sia-partners.com/20130709/marche-du-co2-les-nouveautes-de-la-phase-iii/