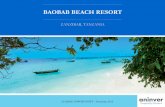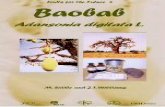Le cèdre et le baobab. L'immigration syro-libanaise en Afrique Occidentale Française, 1890-1914
Transcript of Le cèdre et le baobab. L'immigration syro-libanaise en Afrique Occidentale Française, 1890-1914
Université Paris I Panthéon-Sorbonne
UFR d' Histoire
École Normale Supérieure de Cachan
Département de Sciences Sociales
Université Saint-Joseph de Beyrouth
Faculté de Lettres et de Sciences Humaines
Département d' Histoire
Année universitaire 2012-2013
*************************
Le cèdre et le baobab.
L'immigration syro-libanaise dans les colonies françaises d'Afrique de l'Ouest
(1890-1914).
Mémoire de Master 1 présenté par
Julien Charnay
Directeur de recherche
(Sous la direction de)
M. Philippe Rygiel
1
Remerciements
Je tiens tout particulièrement à remercier M. Philippe Rygiel dont l'attention, les échanges,
les conseils aussi bien d'ordre théorique que pratique, ainsi que la critique toujours pertinente et
constructive, se sont avérés d'une aide précieuse.
Je remercie également Mlle Claire Miot pour ses relectures et ses conseils qui m'ont aidé
pendant la rédaction de ce mémoire.
Il me faut aussi mentionner les services des relations internationales de l'Université Saint-
Joseph de Beyrouth où j'ai passé le second semestre et plus particulièrement Mme Nayla
Hocheimy-Hajj et Mlle Rayanne Abou Mrad pour leur accueil chaleureux. Mme Carla Eddé et M.
Boutros Labaki m'ont quant à eux fait bénéficier de leur expérience de chercheurs et m'ont prodigué
de précieux conseils. Je pense également à M. Antoine Bitar et son épouse qui dans leur village de
Beit-Chabab m'ont ouvert leurs portes et livré leur histoire familiale. L'accueil que j'ai reçu au Liban
m'a conforté dans mon souhait d'étudier l'histoire du peuple libanais. J'espère y revenir à brève
échéance.
Je remercie tout autant ma famille, mes parents Jocelyne et Roger pour leur soutien sans
faille. Je pense aussi à mes camarades de Paris 1 et de l'ENS de Cachan avec qui les échanges se
sont révélés fructueux.
Enfin, je tiens à exprimer ma gratitude aux responsables pédagogiques du service des
relations internationales de l'Université Paris 1 notamment M. Jean-Marc Bonnisseau, Mme Annick
Foucrier et M. Damien Vialle. Face à des circonstances exceptionnelles, ces personnes ont su se
montrer particulièrement compréhensives et m'ont permis de vivre une expérience aussi bien
humaine que scientifique unique.
3
Introduction
Pour Fernand Braudel, historien dont les travaux sur la Méditerranée font toujours autorité1,
la montagne est bien cela : une fabrique d'hommes à l'usage d'autrui ; sa vie diffusée, prodiguée,
nourrit l'histoire entière de la mer2. Face aux crises de subsistance récurrentes du système agro-
pastoral, les habitants des montagnes méditerranéennes seraient, pour cet auteur, condamnés à
émigrer, prendre la mer, pour s' assurer un mieux-être socio-économique. Perchés au milieu des
cèdres, les villages des flancs de la Montagne libanaise pourraient, à première vue, bien illustrer ces
propos, tant ses habitants ont parcouru le Monde au tournant des XIXe et XXe siècles. En effet, le
plus souvent en provenance du port de Beyrouth, alors un des plus modernes de la cote levantine3,
se sont établis de vastes courants migratoires en direction de plusieurs régions du monde et
notamment, l'Afrique de l'Ouest où le pouvoir colonial européen se met alors définitivement en
place. Face à l'arrivée de plusieurs centaines de Syro-Libanais entre les années 1890 et 1914, le
pouvoir colonial français aura tôt fait de surveiller une immigration dont les succès économiques et
commerciaux se font rapidement sentir. Émergent alors différents enjeux dont le premier consiste à
nommer les individus en question.
Les Syro-Libanais entre réalité et représentations.
« Syriens », « Libanais », « Syro-Libanais », « Libano-Syriens » ou encore « Levantins »,
les appellations ne manquent pas pour désigner les migrants originaires des régions situées sur les
côtes du Levant, entre la chaîne du Taurus et la Palestine au Sud et de la Méditerranée au désert
syrien à l'Est. Il convient donc dans un premier temps d'aborder le problème de l'appellation des
migrants par les autorités françaises et coloniales dans un contexte où la grande recomposition
géopolitique associée à la disparition de l'Empire Ottoman n'a pas encore eu lieu. En effet, les
territoires du Liban et de la Syrie tels qu'ils sont dessinés à la suite du démembrement de l'Empire
après la ratification du Traité de Sèvres en 1920, sont partagés pour la période qui nous concerne,
1 BRAUDEL Fernand, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, Le livre de poche, coll. « Références », Paris, 1993 (1949), 3 volumes, 1714 p.
2 BRAUDEL Fernand, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, Armand Colin, Paris, 1966 (1949), 629 p., p. 46.
3 Sur l'émergence de Beyrouth et de son port modernisé en 1893, EDDE Carla, Beyrouth, naissance d'une capitale (1918-1924), Actes Sud, Arles, 2010, 397 p. Voir en particulier l'introduction.
4
entre les provinces ottomanes (vilayets) de Beyrouth et de Damas ainsi que par la province
autonome de la Mutassarrifiya Jabal Loubnan qui recoupe en grande partie le Mont-Liban. Le
Mont-Liban est alors perçu comme le foyer de peuplement traditionnel des communautés
chrétiennes du Levant (de la communauté maronite notamment) et son statut est garanti depuis 1861
par six puissances européennes4. Cette petite province autonome recoupe un territoire de 4 000
kilomètres carrés et abrite une population d'environ 500 000 habitants dans la seconde moitié du
XIXe siècle5. Parler de « nationalité libanaise » ou de « nationalité syrienne » ne se justifie donc,
juridiquement, qu'après la signature du Traité de Lausanne du 24 juillet 1923 qui octroie une
nationalité libanaise et une nationalité syrienne. Conformément à l'article 30 de ce traité, la France
devient la puissance mandataire de ces deux États et c'est en 1924 qu'elle établit les frontières
définitives entre ces deux entités. La France somme alors les ressortissants de ces deux nouveaux
États de spécifier leur nationalité dans un délai de deux ans6. Ainsi, les migrants qui quittent ces
régions « levantines » sont officiellement considérés comme des sujets ottomans et disposent donc
de passeports « turcs »7 entre 1890 et 1914. De ce fait, ils sont parfois identifiés comme tels dans les
sociétés d'accueil8.
Comme le souligne Salma Kojok, les différentes appellations utilisées par l'administration
coloniale française en A.O.F.(« Syriens », « Libanais », « Syro-Libanais », « Levantains »)
soulignent les difficultés pour identifier et évaluer ce processus migratoire pour des fonctionnaires
coloniaux qui n'ont qu'une connaissance toute relative de la géographie de l'Orient méditerranéen9.
Ce dernier constat peut être mis en relation avec la place qu'occupent les carrières coloniales parmi
la noblesse d'État française. Les administrateurs des colonies françaises sont principalement
recrutés d'une part, parmi les rangs d'anciens officiers coloniaux soit, d'autre part, pour les civils et à
partir de 1889, parmi les rangs de l' École coloniale, établissement public chargé de former les
cadres de l'administration coloniale. Cette dernière école recrute sur la base d'un concours annuel ;
4 Pour une synthèse sur l'histoire politique de la région dans la seconde moitié du XIXe siècle, voir CORM Georges, Le Liban contemporain, histoire et société, La Découverte, Paris, 2012 (2003), pp. 73-86.
5 TERNON Yves, L' Empire Ottoman : le déclin, la chute, l'effacement, Éditions du Félin/Éditions Michel de Maule, Paris, 2002, p. 176.
6 Traité de Lausanne du 24 juillet 1923, rendu définitif du 6 août 1924, Journal Officiel de la République Française, n° 231 du 31 août 1924 (p 8036). Section II. Nationalité. Voir en particulier les articles 34-35-36. Cités par DESBORDES Jean Gabriel, L'émigration libano-syrienne en A.O.F., Poitiers, Imprimerie Moderne, Renault et Cie, 1938, pp. 89-90.
7 AKARLI Engin, « Ottoman attitude towards Lebanese emigration » in HOURANI Albert, SHEHADI Nadil (sous la direction de), The Lebanese in the World. A Century of Emigration, I.B. Taurus, Londres, 1993, 742p., pp. 109-138.
8 Les migrants syro-libanais d'Amérique Latine sont ainsi désignés par les habitants de ces pays par le surnom de « Turcos », appellation qui est parfois ressentie comme stigmatisante par les migrants et leurs descendants. Voir les autobiographies recueillies par Sélim Abou de descendants de migrants « libanais » établis en Argentine au début des années 1960 in ABOU Sélim, Liban déraciné. Immigrés dans l'autre Amérique, L 'Harmattan, coll. « Connaissance des hommes », Paris, 1988, 717 p. Voir en particulier pp. 65-69 et pp. 363-364.
9 KOJOK Salma, Les Libanais e Côte d'Ivoire de 1920 à 1960, Thèse de Doctorat d'histoire soutenue à l'Université de Nantes en 2002, 522p. Voir p. 8.
5
elle offre ainsi 32 places en 191210. À partir d'une étude des dossiers personnels des administrateurs
coloniaux français, William B. Cohen soulignait d'ailleurs les lacunes de leur formation théorique et
portait un jugement sévère sur la qualité de l'enseignement donné dans cet établissement avant
1914. Selon lui, le niveau de cet établissement s'élève à partir des années 1920 lorsque celle-ci joue
un véritable rôle de sélection11. L'auteur concluait sur le caractère clientéliste du recrutement de
l'administration coloniale : en 1900, moins de la moitié des administrateurs avaient un baccalauréat
contre 75% en 191412.
Pour comprendre les représentations associées à chacune de ces appellations, il convient,
comme le recommande Lucien Febvre, de faire « l'histoire de ces mots »13. Ainsi, le terme de
« Levantin » né au XVIe siècle pour désigner les habitants du Proche-Orient (notamment les
populations non-musulmanes ) acquiert progressivement au XIXe siècle une connotation péjorative
voire raciste pour désigner des migrants n'ayant pas atteint un stade suffisamment « avancé » de
« civilisation » tant d'un point de vue moral que social14. L'appellation de « Syriens » relève quant à
elle de critères d'ordres ethnique, culturel et religieux15 pour désigner « les protégés spéciaux »
appartenant aux nationalités arabe, arménienne, rhodicienne, syrienne ou aux religions grecque,
orthodoxe, israélite ou latine. Sont donc considérés comme ayant la nationalité syrienne les
Chaldéens, les Druzes, les Libanais et les Syriens proprement dits professant l'une des religions
suivantes : grecque, malchite, catholique, maronite ou musulmane. Cependant, nous avons pu
rencontrer des archives où ce terme générique de « Syriens » est utilisé avec une forte connotation
péjorative mettant l'accent sur le caractère prétendument « malhonnête » des procédés commerciaux
des migrants syro-libanais16. La multiplicité des appellations utilisées par les autorités françaises
pour désigner les migrants originaires de cette région du Monde relève également d'un problème de
définition administrative et géographique de l'Orient méditerranéen, d'autant plus que les catégories
françaises ne recoupent pas celles utilisées par le pouvoir ottoman. Les services diplomatiques
français désignent en effet cette région par l'appellation de « Syrie », terme qui n'existe pas dans
l'organisation administrative ottomane17. La « Syrie » selon cette acception française, recoupe une
10 BOUCHE Denise, Histoire de la colonisation française. Tome second : Flux et reflux, 1815-1962. Fayard, Paris, 1991, p. 129
11 COHEN William B., Empereur sans spectre. Histoire des administrateurs de la France d'Outre-Mer et de l'École coloniale, Berger-Levrault coll. « Monde d'outre-mer », Paris, 1973. Traduit de l'anglais, Rulers of Empire, Stanford,1971.
12 COHEN William B., op. cit., p.13 FEBVRE Lucien, Combats pour l'histoire, Paris, Armand Colin, 1952, 456 p.14 KOJOK Salma, op. cit., p. 11.15 KOJOK Salma, op. cit., p. 8.16 Archives du Ministère des Affaires Étrangères, site de Nantes. Dossier Beyrouth consulat. Série A. Affaires consulaires. Émigration, 1891-1914 (Mnésys : 92PO/A/240). Rapport de mission du Gouverneur de Guinée Poulet, 1912. Non paginé.17 RIFFIER Jean, Les œuvres françaises en Syrie (1860-1923), L' Harmattan coll. « Comprendre le Moyen-Orient »,
Paris, 2000, pp. 294-301.
6
région s'étendant de la chaîne du Taurus au désert du Sinaï. En outre, si sa limite orientale demeure
floue, toutes les définitions françaises de la « Syrie » placent sa limite occidentale sur la
Méditerranée. Le Mont-Liban et la région de Beyrouth font donc partie intégrante de la « Syrie » au
sens de la diplomatie française. D'ailleurs, les services consulaires français disposent d'un Consulat
général de Syrie dont le siège se situe à Beyrouth et dont la circonscription est bornée par des
frontières originales, qui elles non plus, ne recoupent pas le découpage administratif ottoman de la
région. Cette circonscription consulaire s 'étend en effet de Haïfa et Nazareth au Sud, à Antioche au
Nord et à Homs à l'Est (Damas en est exclue).
Le travail de Salma Kojok a le mérite de faire une part à la mémoire des migrants et à leur
sentiment d'appartenance, ces derniers se désignant sous l'appellation de Ouled Arab (« Enfants
d'Arabes ») qui contient à la fois les appartenances libanaise, syrienne, palestinienne ou même
jordanienne. L'appellation de « Libanais » est également largement utilisée18, même si rappelons-le,
les témoignages que nous avons pu consulter ont été recueillis après la création d'un État libanais.
Rien n'indique que « ce sentiment d'appartenance libanais » se manifeste chez les migrants à une
date antérieure à 1920. Pour ce qui concerne notre étude qui porte donc sur une période antérieure à
la formation des États nationaux dans le Levant, nous préférerons donc l'appellation générique de
« Syro-Libanais » pour désigner des migrants originaires des provinces ottomanes de Damas et de
Beyrouth ainsi que la Moutassarifiya du Mont-Liban. Au regard des témoignages des migrants que
nous avons pu lire19, il semble que « le sentiment d'appartenance libanais » soit
confessionnellement situé c'est-à-dire particulièrement fort au sein des populations chrétiennes et
notamment chez les communautés maronites après la proclamation de l'État du Grand Liban en
1920. Au stade de notre étude, il nous est cependant difficile de distinguer parmi les populations
étudiées celles qui relèvent des différentes entités ottomanes citées plus haut. Aussi s'agit-il de
préciser que les différentes expressions désignant « la Montagne libanaise » que nous avons pu
relever en consultant les archives semblent se référer à la province autonome du Mont Liban.
L' Empire Ottoman au tournant des XIXe et XXe siècles.
Ce problème de définition s'avère d'autant plus aigu dans le contexte politique troublé du
Tanzimat. La période du Tanzimat initiée par le rescrit de Chambre des Roses de 1839 (hatt-i chérif)
et dont les ambitions étaient de non seulement de créer un État moderne mais aussi une véritable
citoyenneté ottomane en garantissant notamment l'égalité de tous devant la loi et devant l'impôt,
18 KOJOK Salma, op. cit., p. 10.19 Voir note 15.
7
quelque soit l' appartenance religieuse, manque ses objectifs. En effet dans la seconde moitié du
XIXe siècle, l'Empire Ottoman ne parvient pas à réformer sa structure administrative morcelée et à
faire émerger un pouvoir centralisé. La société ottomane a développé un art du vivre côte à côte,
beaucoup plus qu'un art du vivre ensemble 20. Malgré la réforme de l'administration provinciale de
1864 qui découpe l'Empire en différents échelons administratifs hiérarchisés comme suit : vilayet,
sandjak, kaza et nahiye, Constantinople ne peut remettre en cause l'organisation communautaire de
son empire. À cette hiérarchie administrative censée être subordonnée par Constantinople, se
superpose une organisation communautaire, fondée sur des critères religieux, les millets sur lesquels
Constantinople exerce un pouvoir plus ou moins direct. Le Tanzimat ne parvient pas, contrairement
aux espoirs des élites qui l'ont mis en œuvre, à enrayer le déclin de l'Empire tant territorial21
qu'économique22. Constatant l'échec de ces tentatives de réformes qui ne parviennent pas à enrayer
le démembrement territorial de l'Empire et l'ingérence européenne, le Sultan Abdülhamid II, à partir
de 1877, décide de recourir à une politique personnelle autoritaire dont la suspension de la
Constitution de 1876 est le signe le plus spectaculaire23. À la veille des années 1890, une opposition
de plus en plus vive à la politique du Sultan se structure avec en 1889, la fondation du Comité
Union et Progrès à la suite du rapprochement de deux cercles d'opposition, l'un exilé à Paris autour
de l'ancien député ottoman Khalil Ganem et son journal Jeune Turquie, en place depuis 1878, et
l'autre installé à Constantinople autour de la figure d' Ahmed Riza. Les Jeunes Turcs comme ils sont
désormais désignés prônent à la fois de profondes réformes d'inspiration libérale et défendent un
projet nationaliste turc, quitte à susciter le malentendu avec les membres non-turcs du mouvement24.
Face au Sultan sourd à toute tentative de réforme et incapable de redresser la situation militaire et
géopolitique de l'Empire, l'armée finit par se rallier au mouvement des Jeunes-Turcs. Les troupes de
Macédoine se mutinent en 1908 et gagnent rapidement l'Anatolie. La révolution jeune turque
aboutit au rétablissement de la Constitution de 1876 et à la destitution du Sultan par le Parlement
ottoman ainsi restauré dans ses prérogatives le 27 avril 1909. Son frère Mehmed V lui succède.
Ainsi au pouvoir entre 1909 et 1912, les Jeunes-Turcs mettent en œuvre leur projet d' État moderne
en abolissant les privilèges des minorités, selon une définition turque de la nation25. Le CUP exerce
une véritable dictature militaire et certaines de ses mesures affectent directement la région que nous
20 GEORGEON François, DUMONT Paul (sous la direction de), Vivre dans l'Empire Ottoman. Sociabilités et relations intercommunautaires (XVIII-XXe siècles), L' Harmattan, Paris, 1997, p. 271.
21 Sur le démembrement progressif de l'Empire jusqu'en 1914 voir TERNON Yves, L'Empire Ottoman : le déclin, la chute, l'effacement, Éditions du Félin/Éditions Michel de Maule, Paris, 2002, 575 p.
22 Sur l'aspect économique du déclin ottoman, voir THOBIE Jacques, Intérêts et impérialisme français dans l'empire ottoman (1895-1914), Publications de la Sorbonne, Paris, 1977.
23 Sur la politique hamidienne dans la seconde moitié du XIXe siècle, voir notamment GEORGEON François, Abdülhamid II, le sultan calife, Fayard, Paris, 2003, 528 p.
24 TERNON Yves, op. cit., pp. 231 sqq.25 TERNON Yves, op. cit., p. 244.
8
étudions plus particulièrement comme l'obligation du service militaire pour les non-Musulmans
jusqu'alors exemptés contre le paiement d'un tribut, le bedel. Une fois encore, ces bouleversements
politiques ne parviennent pas à enrayer le déclin ottoman comme l'attestent la révolte albanaise de
1910-1912, la perte de la Tripolitaine en 1911 et la crise balkanique des années 1912-1913. L' issue
du premier conflit balkanique consacre la fin de la « Turquie d'Europe » : le Traité de Londres du 30
mai 1912 sanctionne en effet la victoire des nations balkaniques coalisées. Le deuxième conflit
balkanique de 1913 permet cependant à l'Empire de récupérer la Thrace orientale. C'est donc
considérablement affaibli que l'Empire s'engage dans la Première Guerre mondiale en octobre 1914
aux côtés de la Triple-Alliance dans l'espoir de mettre un terme à l'ingérence russe, anglaise et
française. La loi martiale est décrétée et l'état de guerre justifie l'abolition des Capitulations et du
régime d'autonomie du Mont-Liban26.
L' Empire Ottoman demeure un conglomérat de petits groupes humains, peuples, tribus,
clans, communautés, familles, villages, chacun avec ses traditions, ses croyances, ses légendes, ses
comptes à régler27. Le territoire d'origine des migrants dont nous nous proposons d'étudier les
parcours est ainsi marqué par le morcellement. La côte levantine jusqu' au sandjak de Jérusalem au
Sud relève du vilayet de Beyrouth (créé à partir des parties littorales du vilayet de Syrie) alors que
l'intérieur des terres, de l' Anti-Liban au désert syrien, relève du vilayet de Syrie dont la capitale est
à Damas. La région d' Alep relève d'un autre vilayet qui s'étend en partie au Sud de l'Anatolie. Le
Mont-Liban, foyer traditionnel de communautés maronite et druze relève depuis 1861 d'un régime
d'autonomie spécifique et garanti par un conseil de six puissances européennes parmi lesquels la
France, le Royaume-Uni, la Prusse, l'Autriche-Hongrie, la Russie et l'Italie. À la suite des massacres
druzo-maronites de 1860 pendant lesquels la Sublime Porte fut accusée par les puissances
européennes d'avoir laissé s'envenimer la situation, la France décida d' envoyer le 16 août 1860 une
expédition militaire dirigée par le général Beaufort afin de mettre un terme aux exactions. Après les
travaux d'une commission d'enquête animée par la France, la Prusse, le Royaume-Uni, l'Autriche-
Hongrie, le Russie et l'Empire Ottoman, on proposa la création d'une entité administrative autonome
recoupant le Mont-Liban à savoir un petit territoire de 4 000 kilomètres carrés mais peuplé environ
de 500 000 habitants. Le Moutassarifat du Mont-Liban est ainsi isolé des villes de la côte (Beyrouth
et Tripoli notamment) et de la plaine agricole de la Bekaa. Mais il bénéficie du fait de son
autonomie vis-à-vis de Constantinople, de certains avantages comme une taxation foncière moins
importante ou encore une exemption de service militaire. Le Mont-Liban présente ainsi un relief
montagneux particulièrement contraignant marqué par des dénivelés importants : la chaîne du
26 TERNON Yves, op. cit., p. 288.27 TERNON Yves, op. cit., p. 175.
9
Mont-Liban présente des lignes de crête s'élevant à plus de 3 000 mètres d'altitude (3 063 mètres à
Qurnat es-Sawda) sur une longueur d'environ 150 kilomètres et ce à quelques dizaines de
kilomètres du niveau de la mer. Son orientation Nord-Sud rend de surcroît les communications
difficiles avec l'arrière-pays syrien. Ce relief a ainsi contribué à faire de cette région un abri pour
des communautés religieuses persécutées aussi bien chrétiennes que musulmanes ou druze au point
d'en faire un conservatoire de toutes les croyances et hérésies orientales.
Cette diversité religieuse a offert un motif d'intervention pour l'impérialisme français dans
ces régions de l' Empire Ottoman. La région du Levant, en raison des importantes communautés
chrétiennes orientales qu'elle abrite, est un terrain privilégié de l'impérialisme français depuis le
XVIe siècle, la France assumant un rôle de « protectrice » des Chrétiens d'Orient28. Les
capitulations signées dès 1536-1537 entre Soliman le Magnifique et François Ier ont posé le cadre
juridique de la pénétration des intérêts français dans l'Empire ottoman. Le Levant est donc
particulièrement touché certes indirectement, par la relance de la politique d'expansion coloniale par
les Républicains opportunistes à partir de 187929. La France républicaine appuie son action proto-
coloniale sur l'héritage des missions chrétiennes implantées dès la fin du XVIIe siècle à l'image des
Jésuites du Mont-Liban qui ouvrent leur collège d' Antoura en 165230 ou des Lazaristes et de leur
collège de Damas31. La diplomatie culturelle française entendue comme l'ensemble des moyens mis
en œuvre par un État ou des acteurs privés pour modifier l'opinion publique d'un autre pays 32 joue
un rôle non négligeable dans la naissance de ces flux migratoires. De même, d'autres acteurs
intéressés par le transports des immigrants comme les compagnies maritimes auxquelles sont
accordées des concessions postales dans les récentes colonies d'Afrique poussent en faveur de ces
départs. Semble donc s'esquisser un réseau mixte d'acteurs c'est à dire dominé par des acteurs
publics qui définissent les cadres juridiques dans lesquels ces flux s'inscrivent, et des acteurs privés
chargés de les véhiculer concrètement33.
L' A.O.F., une colonie d'accueil en voie de constitution.
Les migrants syro-libanais s'installent dans un territoire où le pouvoir colonial est en voie de
formation et de consolidation, ce qui leur laisse la voie à une installation pérenne. En effet, à la suite
28 Voir CLOAREC Vincent, « La France du Levant » in Revue Française d'Histoire d'Outre-Mer, t. 83, n°313|1996.29 BOUCHE Denise, Histoire de la colonisation française. T. II : Flux et reflux (1815-1962), Fayard, Paris, 1991.30 RIFFIER Jacques, op. cit., p. 68.31 BOCQUET Jérôme, Missionnaires français en terre d'Islam, Damas 1860-1914, Les Indes savantes, Paris, 2005.32 TOURNÈS Ludovic, « La fondation Rockefeller et la naissance de l'universalisme philanthropique américain » in
De Boeck Université|Critiques internationales, 2007/2, n°35, pp. 173-197.33 NOIRIEL Gérard, ouvrage cité, pp. 116 sqq.
10
de la relance de la politique coloniale par les Républicains opportunistes et du Congrès de Berlin de
1885 qui sanctionne un partage de l'Afrique entre les puissances européennes coloniales, la France
opère une extension de son empire. Celui-ci, à partir d' implantations côtières comme Saint-Louis
du Sénégal où les Français sont présents depuis 1818, s'étend jusqu'à ce que les possessions des
autres puissances européennes ne finissent par représenter que des enclaves (Delta du Niger
britannique, Togo allemand etc.)34. Au cours de la décennie 1890, la France institue progressivement
les différentes colonies qui vont constituer la Fédération de l' A.O.F. après avoir entrepris des
guerres de conquête accompagnées également d'expéditions commerciales menées par des officiers
coloniaux. Ainsi, en 1890, une expédition militaire vers l'Est permet la création de la colonie du
Soudan français qui est ainsi détachée du Sénégal ; la prise de Tombouctou ainsi que sa pacification
menée par le général Joffre le 12 janvier 1894 achève la conquête. En 1890 toujours, la colonie de
Guinée est instituée ; celle-ci reçoit en 1899 les pays malinkés du Haut-Niger, détachés du Soudan
Français. La Côte d'Ivoire est instituée en colonie autonome en 1893 après que l'officier Binger
rentra de son expédition vers la boucle du Niger avec une série de traités de protectorats avec des
souverains locaux (1887-1888)35 et que l' Angleterre lui reconnut sa souveraineté entre le Libéria et
la Gold Coast. Sur les bases de ces conquêtes et pour répondre aux risques que fait courir une trop
grande diversité d'entités politiques et administratives différentes pour son pouvoir colonial, la
France décide de réunir ces différentes colonies au sein d'une fédération dont la capitale sera à
Dakar, l' Afrique Occidentale Française, en 189536. Avec la création de cette fédération, le
colonisateur français fait le choix d'une administration centralisée et pyramidale : depuis sa
résidence de Dakar, le gouverneur général a autorité sur les lieutenants-gouverneurs de chaque
colonie qui eux-même, ont autorité sur les administrateurs de cercles et de subdivision, ce dernier
poste constituant le dernier échelon de l'administration coloniale en A.O.F. Mais le colonisateur
s'appuie également sur les chefs tribaux traditionnels qui sont sommés de prêter allégeance au
pouvoir colonial afin de maintenir leur influence et servent ainsi d'intermédiaires directs entre la
population africaine et le pouvoir colonial français. Cet effort administratif ne conclut pas pour
autant l'implantation française dans cette partie de l'Afrique. En effet, la pacification de la région
par le colonisateur français n'est pas encore achevée notamment dans l'arrière pays des colonies
littorales. Ainsi, les lieutenants Voulet et Chanoine n'entrent à Ouagadougou qu'en juillet 1896, la
pacification de l'arrière pays de forêt et de savane ivoirien, initiée par le lieutenant-gouverneur
Augoulvant en 1908 n'est achevée qu'en 1915 et la colonie du Dahomey n'est instauré qu'en 1897-
34 BOUCHE Denise, op. cit., p. 68.35 COQUERY VIDROVITCH Catherine, MONIOT Henri, L' Afrique noire de 1800 à nos jours, P.U.F coll. « Nouvelle
clio », Paris, 1974, p. 151.36 COQUERY VIDROVITCH Catherine, MONIOT Henri, op. cit., p. 159.
11
1898. De même, la recomposition des frontières internes à la fédération (entre les colonies) comme
l' illustre la création de la colonie de Haute-Volta en 1919 est un indice de la progressivité de
l'instauration du pouvoir colonial français en Afrique de l'Ouest. Les migrants syro-libanais
débarquent donc dans une colonie où le pouvoir français aussi bien politique qu'économique, est en
cours de consolidation.
Les enjeux historiographiques des études migratoires.
Pour commencer à cerner les raisons du départ des migrants syro-libanais en Afrique
Occidentale Française, il faut s'intéresser aux caractéristiques anthropologiques et religieuses des
populations du Mont-Liban. D'après l'étude de Dominique Chevallier37, celles-ci sont des variables
déterminantes dans la naissance et l'orientation de ces flux migratoires. Elles posent en effet les
bases d'une immigration dont les effectifs vont croissant à mesure que les autres routes migratoires
se referment et que la France initie sa politique d'exploitation en A.O.F. Les Syro-Libanais trouvent
presque naturellement une place d'intermédiaires économiques, sociaux et culturels entre Indigènes
noirs et colonisateurs blancs. La bibliographie anglo-saxonne s'est montrée particulièrement prolixe
sur les modalités d'insertion de ces populations au sein de l'économie de traite et de la société
coloniales d'Afrique de l 'Ouest française38.
Les sources qui rendent compte de l'existence de ces flux présentent cependant des biais
qu'il s'agit ici d'exposer brièvement. Comme le fait remarque Salma Kojok, les sources de
l'administration coloniale tendent à présenter l'immigration syro-libanaise comme exclusivement
masculine et comme une entreprise qui rencontre le plus souvent le succès, les fonctionnaires de
cette administration faisant état de quelques cas d'ascension socio-économique fulgurante39.
L'auteur explique ce biais par la préoccupation du colonisateur français dans l'exploitation
commerciale de la colonie, ce qui implique une imagedéformée de la réalité libanaise en Côte
d'Ivoire, qui est l'objet de son étude : celui-ci s'intéresse uniquement au cas de « grands
commerçants ». L'immigration syro-libanaise est alors perçue par l'administrateur français
principalement comme une immigration de la réussite. Les récits autobiographiques de migrants ou
de leurs descendants qui permettraient de recouper les archives issues de l'administration coloniale
et des services des Affaires Étrangères s'avèrent cependant rares. Citons cependant les mémoires de
37 CHEVALLIER Dominique, La Société du Mont-Liban à l'époque de la révolution industrielle en Europe, Geuthner, Paris, 1982.
38 Voir HOURANI Albert et SHEHADI Nadim (sous la direction de), The Lebanese in the world. A century of emigration, I.B. Tauris, Londres, 1993, 742 p.
39 KOJOK Salma, op. cit., pp. 12-27.
12
Nadia Filfili, fille de migrants libanais au Sénégal, qui furent publiées à Dakar en 197340. Le travail
imposant de l'ethnologue Sélim Abou sur quatre descendants de migrants libanais en Argentine au
début des années 196041, peut cependant nous donner un aperçu sur les processus d'insertion de ces
migrants dans une société d'accueil tout en gardant à l'esprit les spécificités de la société coloniale
naissante en A.O.F. entre 1890 et 1914. En effet, bien que portant sur des descendants d'immigrés
« libanais » de la seconde génération de l'Argentine des années 1960, le recueil de ces quatre
autobiographies a le mérite de donner une vision subjective de l'insertion de ces familles migrantes
au sein de la société et de l'économie locales. Au travers de ces témoignages, s'esquissent les
thématiques des relations avec les Criollos, Argentins descendants de migrants européens
(Espagnols et Italiens principalement) qui constituent le groupe ethnique majoritaire et qui occupe
le sommet de la hiérarchie socio-économique et symbolique de la société argentine dans les années
1950-1960, les pratiques de sociabilité de la communauté syro-libanaise ainsi que les
recompositions identitaires à l’œuvre chez les descendants de la seconde génération42.
La méconnaissance de l' histoire de l'immigration syro-libanaise en Afrique de l'Ouest peut
en partie s'explique par la place des études migratoires au sein du champ historique. En effet, malgré
l'importance du fait migratoire dans l'histoire sociale contemporaine de la France, l'immigration ne
devient que tardivement un objet d'investigation historique alors que d'autres sciences sociales ont
tenté de cerner ce processus dès les années 1930 (droit et économie dès les années 1930, sociologie
et démographie après 1945)43. Les travaux pionniers de Gérard Noiriel et notamment Le Creuset
français publié en 198844apparaissent comme des textes programmatiques fondateurs d'un nouveau
champ historiographique bien que ces travaux soient d'abord centrés sur le contrôle de ces flux par
l'État et sur les enjeux politiques de l'assimilation de ces immigrants dans la société française. A la
suite des travaux d' Abdelmalek Sayad en sociologie45, il convient de saisir ce processus social
complexe sous une double optique : il s'agit en effet de s'intéresser d'une part, au départ, à
l'émigration proprement dite du point de vue la société de départ et d'autre part, à l'insertion de ces
immigrants dans la société d'arrivée c'est à dire à l'immigration. En d'autres termes, nous nous
40 FILFILI Nadra, Ma vie, 50 ans au Sénégal, Dakar, 1973, 129 p.41 ABOU Sélim, op. cit.42 Dans une perspective ethnographique, l'auteur se donne pour ambition d'étudier plus précisément le processus d'acculturation formelle à l’œuvre chez ces descendants de migrants entendu comme l'adoption de cadres de pensée, de perception et de jugement influencés par la culture dominante, par opposition à l'acculturation formelle comme l'adoption par les migrants de gestes, coutumes et pratiques sociales propres à la société d'accueil et à sa culture dominante. La transcription de ces quatre autobiographies (deux hommes et deux femmes d'une quarantaine d'années et appartenant aux classes moyennes supérieures et à la communauté maronite) est suivie d'une étude « ethnopsychanalytique » que le lecteur pourra apprécier en fonction du degré de crédibilité qu'il attribue aux études psychanalytiques.43 BENABOU-LUCIDO Latifa, « Histoire du développement de la recherche universitaire française sur les migrations
internationales (1815-1999) » in Revue européenne des migrations internationales, vol. 27-n°3|2011.44 NOIRIEL Gérard, Le Creuset français, Seuil coll. « Points Histoire », Paris, 2006 (1988), 446 p.45 Voir SAYAD Abdelmalek, La Double absence, Seuil coll. « Liber », Paris, 1999, 437 p.
13
attacherons donc à croiser variables d'origine et variables d'aboutissement46. L' Afrique constitue un
terrain de l'expansion coloniale française dont les spécificités offrent l'occasion aux populations
migrantes libano-syriennes d'une implantation pérenne. La bibliographie que nous avons pu
consulter à ce sujet et notamment la bibliographie anglo-saxonne sur la politique coloniale suivie
par la Grande-Bretagne47 nous rappellent que d'emblée, l'Afrique subsaharienne n'est pas considérée
comme un territoire propice à l'installation pérenne de colons blancs. En effet, la maîtrise définitive
du territoire fut tardive, à savoir qu'elle n'intervint que dans les années 1890 et ces territoires
abritant une main d’œuvre abondante et servile. Ce choix de mise en valeur limitée favorise ainsi
l'ouverture de ces dernières aux émigrants syro-libanais.
Afin d'étudier l'insertion de ces flux migratoires dans la politique coloniale française, nous
nous proposerons donc de suivre trois axes d'étude portant sur les facteurs dialectiques de
répulsion/attraction alimentant ces flux, le réseau d'acteurs intéressés par leur organisation et leur
orientation, et enfin l' insertion des migrants dans l'économie et la société coloniales naissantes au
tournant des XIXe et XXe siècles.
46 SAYAD Abdelmalek, ouvrage cité, pp. 57 sqq.47 Voir CONSTANTINE Stephen et HARPER Marjory, Migration and Empire, Oxford University Press, coll. « The
Oxford History of the British Empire », Oxford, 2010.
14
Historiographie
L'intitulé de notre sujet nous invite à nous intéresser dans un premier temps à la société
d'émigration : dans la lignée d' Abdelmalek Sayad à propos des études migratoires, il s'agit de
cerner d'une part, les conditions historiques de la formation d'un excédent démographique et d'autre
part, les conditions par lesquelles cet excédent a été rendu disponible au départ.
1. Facteurs de répulsion et facteurs d'attraction, un cadre conceptuel traditionnel des études
migratoires
1.1. Remarques préliminaires
Comme le rappelle l' historienne Nancy Green, les facteurs de répulsion et d'attraction
constituent une dichotomie classique des études migratoires48. Ce vocabulaire issu de la science
économique à la fin du XIXe siècle se diffuse chez les chercheurs en sciences sociales afin de
déterminer l' importance de ces facteurs dans la naissance des flux migratoires. Il apparaît même
possible de distinguer différentes périodes historiques en fonction du poids accordé à chacun de ces
facteurs dans l'explication de ces flux. Pour Nancy Green, les sociétés industrialisées du XIXe
siècle, en insistant sur les facteurs de répulsion, distinguent entre une immigration spontanée et une
immigration contrainte ; la distinction entre les deux étant déterminée par l'état économique et
social des sociétés de départ. Cette conception des flux migratoires est perceptible dans le
vocabulaire employé dans les archives que nous avons pu consulter, notamment chez les
administrateurs coloniaux qui, à l'occasion, insistent sur la pauvreté désespérante qui règne dans la
Montagne libanaise comme facteur propice au départ49. Dans les premières années du XXe siècle
les chercheurs et les responsables politiques opèrent un tournant sémantique décisif en accordant
48 GREEN Nancy, Repenser les migrations, PUF coll. « Le Nœud gordien », Paris, 2006, pp. 88-94.49 Archives du Ministère des Affaires Étrangères, site de Nantes. Dossier Beyrouth consulat. Série A. Affaires consulaires. Émigration, 1891-1914 (Mnésys : 92PO/A/240). Rapport de mission du Gouverneur de Guinée Poulet, 1912. Non paginé.
16
une importance nouvelle aux facteurs d' attraction : la pression démographique dans les pays
d' émigration cède de plus en plus face à la demande d' immigrants des pays d'accueil. La question
devient alors de savoir si l' immigration est une cause ou un effet des modifications structurelles du
marché du travail dans les pays développés. L' économiste américain Harris Jerome livre une
théorie dont les résultats se montrent intéressants dans le cadre de notre étude.50 Contrairement à
l'image d'Épinal de l'immigrant aventurier, les cycles économiques aux États-Unis détermineraient
les vagues d'émigration que ce pays a accueillies au tournant des XIXe et XXe siècles. Ainsi
l'immigration serait fonction de la prospérité du pays d'accueil et de celle des immigrés déjà
installés ainsi que de l'aide que ceux-ci peuvent fournir aux candidats au départ (prêts pour le prix
du voyage, perspectives d'embauche dans le pays d'accueil notamment). L'auteur de cette théorie
reconnaît cependant que cette corrélation entre cycles économiques et vagues migratoires n'est pas
parfaite et que celle-ci semble s'appliquer plus aux travailleurs masculins peu qualifiés qu'aux
femmes et aux travailleurs qualifiés. Les archives que nous avons pu consulter témoignent de cette
perception particulière du phénomène migratoire au Mont-Liban. Nous pouvons citer ici le rapport
du gouverneur de la colonie de Guinée rédigé à l'été 1912 et consultable aux Archives du Ministère
des affaires étrangères à Nantes. Dans ce rapport rédigé à l'occasion d'une mission à laquelle le
gouverneur Poulet s'est livré dans le village de Beit-Chabab dans la Montagne libanaise en 1911 et
adressé aux Ministère des affaires étrangères, nous pouvons souligner l'imbrication de facteurs de
répulsion comme un sous-développement socio-économique qui règne dans la Montagne libanaise
(région faiblement industrialisée et où l'agriculture est principalement vivrière) et de facteurs
d'attraction. La Guinée apparaît du fait des échos des immigrés installés et surtout des
investissements immobiliers et fonciers effectués grâce à l'argent qu'ils rapportent de la colonie au
cours de retours temporaires dans le pays, comme un territoire offrant des opportunités de richesse
rapide. Les demeures d'immigrants agrandies et embellies grâce à l'argent de Guinée matérialisent la
réussite économique des migrants auprès de ceux qui ne sont pas encore parti. L'historien Dudley
Baines insiste en effet sur le fait que l'immigration relève d'un choix personnel (ou une stratégie
familiale) déterminé par les informations, les impressions sur les opportunités offertes par le
territoire choisi51. Les immigrants installés et leurs investissements tels qu'ils sont décrits par le
rapport Poulet apparaissent comme des relais fondamentaux de cette information. Leurs récits et
leurs recommandations. donnés aux candidats au départ ainsi qu'une certaine consommation
ostentatoire de la part de l'entourage des migrants restés au village et les investissements
50 JEROME Harris, Migration and business cycles, National Bureau of Economic Research, New-York, 1926. Voir en particulier le chapitre III, Employment opportunities for Immigrants.
51 BAINES Dudley, Migration in a mature economy. Emigration and internal migration and England and Wales, 1861-1900. Cambridge University Press, Cambridge, 2003, pp. 207-212.
17
immobiliers et fonciers agissent comme de véritables incitations au départ52
1.2. Pour une approche décentrée des filières migratoires
Il convient cependant de nuancer la portée heuristique des approches posées en termes de
facteurs de répulsion et d'attraction qui ont tendance à se focaliser abusivement sur les conditions
socio-économiques des espaces de départ et d'accueil au point parfois, d'en faire les facteurs
explicatifs exclusifs des migrations. Cette approche tendrait alors à éluder la question de
l'organisation et de l'autonomie des communautés migrantes ; en d'autres termes, il convient
d'enrichir cette approche en décentrant notre regard sur les communautés migrantes en tant que
telles. Pour illustrer ce propos, il faut questionner la spécificité montagnarde de flux migratoires en
question dans notre étude, à la lumière des travaux de Laurence Fontaine sur les migrations des
communautés alpines du Haut-Dauphiné et du Briançonnais à l'époque moderne53. En effet, les
différents travaux de Laurence Fontaine pointent les limites des approches traditionnelles des
migrations posées en termes de facteurs de répulsion et d'attraction. Celles-ci sont en effet basées
implicitement sur des représentations traditionnelles de l'écosystème montagnard54. Les approches
posées en termes de facteurs de répulsion et d'attraction font de la mobilité un phénomène majeur
de ces sociétés en raison de la crise structurelle des systèmes agro-pastoraux. La mobilité
saisonnière est notamment présentée comme une solution économique inévitable dans un milieu
offrant peu de ressources (agriculture à faibles rendements etc.) et ce, sur une temporalité courte
c'est-à-dire principalement lors des périodes de cultures qui sont bornées par des hivers longs et
rigoureux et qui condamnent les hommes à une oisiveté forcée. Le système agro-pastoral est alors
identifié comme un puissant facteur de répulsion et l'immigration comme une solution à la
reproduction des communautés montagnardes. Selon cette vision basée sur une conception
centre/périphéries, la montagne est vue comme une fabrique d'hommes à usage d'autrui pour
reprendre la formule de Fernand Braudel55. Laurence Fontaine appelle donc à décentrer le regard
52 Pour illustrer ce point, voir l'anecdote d'un savetier du village de Choueir, Faddoul Mitri Béchara, immigré au Brésil en 1885 et qui, deux années après son départ, envoie à son père plus de 50 livres sterling-or. Celui-ci aurait alors étalé le succès de son fils « en se pavanant » dans le souk de la ville, vêtu d'étoffes luxueuses in SAFA Élie, Essai sur l'émigration libanaise, thèse de Doctorat de droit soutenue à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth en 1959, pp. 234-235.
53 FONTAINE Laurence, Histoire du colportage en Europe (XV-XIXe siècles), Albin Michel coll. « L'évolution de l'humanité », Paris, 1993, 336 p.
54 FONTAINE Laurence, « Solidarités familiales et logiques migratoires en pays de montagne à l'époque moderne », in Annales, Économies, Sociétés, Civilisations, 45e année, n°6, 1990, pp. 1133-1150.
55 Cité par FONTAINE Laurence, « Migrations : espace et identité », in Bulletin du Centre Pierre Léon d'histoire économique et sociale, Université Lumière Lyon II, 2-3-4, 1992.
18
des approches posées en termes de facteurs de répulsion et d'attraction pour étudier l'organisation
des migrations par les communautés concernées et les rapports de pouvoir au sein de ces
communautés et ainsi réévaluer la complexité des flux migratoires. Les élites villageoises migrantes
sont ainsi amenées à jouer un rôle déterminant dans la naissance et l'orientation de ces flux et
structurent de véritables réseaux migratoires dans leur rôle d'intermédiaire56. Celles-ci sont
notamment pourvoyeuses d'informations sur les opportunités socio-économiques des espaces
d'accueil des migrations. L'un des principaux moteurs des migrations de métier alpines vient de
l'organisation multilocale des élites éclatées en plusieurs pôles géographiques. Tout en conservant
un lien très fort avec les villages d'origine, ces familles ont un accès privilégié à l'information sur
les besoins des divers pays, aussi bien que sur les membres de leur propre communauté 57. L'autrui
dont parle Fernand Braudel n'est pas forcément étranger à la communauté villageoise migrante si
nous suivons le raisonnement de Laurence Fontaine. La mémoire migratoire des villages de la
montagne libanaise souligne le poids de ces élites migrantes constituées d'entrepreneurs établis dans
les espaces d'accueil comme l'Afrique de l'Ouest et qui font appel aux jeunes du village cherchant à
s'insérer dans le marché du travail et qui les emploient dans leurs commerces et différentes
entreprises expatriées58. Bien que dépassant le strict cadre chronologique de notre étude, les
informations que nous pu récolté grâce aux entretiens réalisés à Beit-Chabab, village de la province
du Metn entretenant une forte tradition migratoire, ce point peut s'avérer être une piste stimulante
pour la poursuite de notre étude. De même, l'étude des flux migratoires syro-libanais en Afrique
occidentale française permet également d'enrichir la perspective de Laurence Fontaine. En effet, le
cas de l'émigration syro-libanaise entre les années 1890 et 1914 met en évidence des relations de
pouvoir qui s'établissent entre les migrants originaires des différents villages de la région et des
acteurs certes extérieurs à ces communautés mais qui poursuivent des intérêts économiques propres.
Nous parlons ici d'acteurs comme les agents commerciaux des compagnies maritimes, aussi bien les
agents officiels que des agents usurpant le nom de ces compagnies ou encore les petits
fonctionnaires de l'administration ottomane de Beyrouth59.
56 FONTAINE Laurence, « Montagnes et migrations d travail. Un essai de comparaison globale (XV-XXe siècles) », in Revue d'histoire moderne et contemporaine, 2005/2, n°52-2, pp. 26-48. Voir p. 28.
57 FONTAINE Laurence, op. cit. : « Montagne et migrations.... »., p. 29.58 Voir en annexe l'entretien avec Mme. Bitar, réalisé à Beit-Chabab le 9 avril 2013. Dans cet entretien, l'enquêtée
évoque le rôle d'un homme d'affaires originaire du village et qui a fondé plusieurs entreprises en Afrique et en Europe. Celui-ci est amené à embaucher certains jeunes du village dans ses différentes entreprises.
59 Voir pp. 21-24.
19
1.3. Le commerce migratoire
La consultation des archives de La Courneuve nous a amenés à réévaluer le rôle des
compagnies maritimes et notamment des Messageries Maritimes qui, en raison des concessions
postales dont elles bénéficient depuis leur création en 1851, disposent d'une position privilégiée en
Méditerranée. L'étude de Marie-Françoise Berneron Couvenhes sur cette compagnie permet de
cerner le contexte d’émergence d'une mondialisation des transports maritimes permise notamment
par le développement de la marine à vapeur à partir des années 1870/80 et le contexte d'une
tentative de constitution d'une marine marchande d'État60. Les compagnies se livrent alors à une
concurrence exacerbée pour le transport des marchandises et des passagers. Ainsi, les compagnies
ouvrent des agences et emploient des intermédiaires dans les pays d'émigration pour attirer des
candidats au départ61. Marie-Françoise Berneron Couvenhes nous éclaire sur les modalités de
recrutement des agents et sur leur système de rémunération. Face à la concurrence des autres
compagnies maritimes, les Messageries Maritimes ont de plus en plus recours à des agents locaux
recrutés sur place et qu'elle rémunère en grande partie par un système d'intéressement, de
commission, en fonction du nombre de billets vendus62. Un tel système pose le problème du
contrôle de l'activité de ces agents voir d'agents recruteurs « clandestins » qui n'hésitent pas à
usurper le nom des compagnies de navigation63. Ces acteurs agissent de concert avec d'autres
acteurs dont l'activité économique est basée sur l'accueil des migrants. La monographie réalisée par
Liliane Rada-Nasser sur la communauté libanaise de Marseille de 1840 à la fin des années 1980,
permet de souligner le rôle de réseaux hôteliers souvent animés par des immigrés syro-libanais64
dans cette ville qui apparaît comme la plaque-tournante de l'émigration en provenance de cette
région (correspondance des lignes méditerranéenne et atlantiques vers les Amériques et Dakar).
Nous pouvons ainsi souligner la concurrence que se livrent différents pays européens afin de capter
le transport des migrants65.
60 BERNERON COUVENHES Marie-Françoise, Les Messageries Maritimes. L'essor d'une grande compagnie de navigation française, 1851-1894, Presses de l'Université Paris-Sorbonne, Paris, 2007.61 CONSTANTINE Stephen et HARPER Marjory, ouvrage cité, p.298.62 BERNERON COUVENHES Marie-Chrisitine, ouvrage cité, pp. 447-502.63 CONSTANTINE Stephen et HARPER Marjory, ouvrage cité, pp. 299-300.64 NADA-NASSER Liliane, Ces Marseillais venus d'Orient. L'immigration libanaise à Marseille aux XIXe et XXe
siècles, Karthala, Paris, 2006, pp. 35-36.65 Sur la concurrence européenne pour le transport des migrants et l'émergence de Marseille comme principale plaque
tournante de l'émigration syro-libanaise dans le dernier quart du XIXe siècle, voir NADA-NASSER Liliane, ouvrage cité, p.28.
20
2. Esquisses d'une tableau de la société de départ et les mesures d'encadrement des départs
2.1. Tableau économique et social de la région au XIXe siècle
Il existe tout d'abord quelques synthèses relatives à l'histoire du Liban dont l'ambition
chronologique est plus ou moins étendue. Celle de Boutros Dib remonte de l'époque des Phéniciens
pour aller aux prémices de la guerre civile de 197566 tandis que celle de Denise Ammoun se
concentre sur la période inaugurée par les massacres communautaires de 1860 et se terminant avec
la fin de la guerre civile en 199067. Malgré leur aspect pédagogique et informatif, ces deux ouvrages
ne sauraient être pleinement mobilisés dans le cadre de notre étude en raison de leur recours trop
lacunaire aux sources et à la bibliographie scientifique sur la question (quand elles sont absentes
dans le premier cas). Le travail de Dominique Chevallier est en revanche d'une très grande valeur
scientifique68. Recoupant des archives françaises et libanaises, institutionnelles et privées69, l'auteur
nous offre un tableau structural de la société du Mont Liban des années 1830 aux massacres
communautaires de 1860. Il accorde ainsi une large place à l'analyse des structures segmentées
communautaires et religieuses encadrant les individus, au système économique préindustriel de la
Montagne libanaise et à l'évolution démographique de la population. Retenons d'ores et déjà que la
poussée démographique, plus ou moins forte en fonction des communautés religieuses70, ainsi que
la crise des industries traditionnelles (sériciculture notamment après l'ouverture du Canal de Suez en
1869 qui accroît sur les places européennes comme Marseille ou Lyon la concurrence entre la
production de soie de la région et celle de l'Extrême-Orient)71 ainsi que celle de l'agriculture
terrassière et vivrière de la région, sont de nature à agir comme des facteurs de répulsion, et donc
comme des facteurs propices au départ. Ce constat est également celui de plusieurs historiens anglo-
saxons ayant participé à l'ouvrage collectif dirigé par Albert Hourani et Nadim Shehadi72. Les
auteurs ayant collaboré à cet ouvrage font notamment état de l'évolution géographique des courants
66 DIB Boutros (sous la direction de), Histoire du Liban des origines au XXè siècle, Éditions Philippe Rey, Paris, 2006.67 AMMOUN Denise, Histoire du Liban contemporain, T. I : 1860-1943. Fayard, Paris, 1997.68 CHEVALLIER Dominique, La Société du Mont-Liban à l'époque de la révolution industrielle en Europe, Geuthner, Paris, 1982.69 Sur les archives mobilisées dans cette étude, voir l'inventaire dressé par l'auteur in CHEVALLIER Dominique, op.
cit., Avant propos pp. XII sqq.70 CHEVALLIER Dominique, op. cit., p. 13., pp. 41 sqq.71 CHEVALLIER Dominique, op. cit., pp. 210-256. Sur l'état de l'industrie séricicole au Mont-Liban, voir également
DUCOUSSO Georges (attaché au consulat de France à Beyrouth en 1913), L'industrie de la soie en Syrie, Paris-Beyrouth, 1913, chapitre VI.
72 HOURANI Albert et SHEHADI Nadim (sous la direction de), The Lebanese in the world. A century of emigration, I.B. Tauris, Londres, 1993, 712 p.
21
d'émigration issus de cette région entre 1860 et 1914 ainsi que des différentes routes choisies
(Amérique du Nord avant les Quota Laws de 1921/4, Amérique latine pour les rebutés des
règlements sanitaires états-uniens puis Afrique de l'Ouest à partir, véritablement, des années
192073). Le choix des destinations par les émigrants est déterminé par un ensemble de variables
d'origine parmi lesquelles l'appartenance communautaire et religieuse et le niveau de qualification
(alphabétisation) semblent jouer des rôles premiers74. D'après ces différents auteurs, les populations
chiites seraient majoritairement représentées au sein des migrants en Afrique de l'Ouest à partir des
années 1890 en raison notamment, d'un niveau d'instruction moindre (les différentes entreprises
d'éducation concernant principalement les populations chrétiennes) qui leur barre l'accès aux routes
de premier choix. Patricia Nabti fait ainsi état des restrictions posées par les autorités migratoires
américaines concernant ces émigrants arabes à partir de 1917 par le biais de règlements sanitaires,
des lois sur les quotas de 1921/4, des conditions de ressources préalables (condition lpc i.e. likely to
be a public charge) ainsi qu'en Australie qui jusqu'en 1945, cherche à promouvoir une politique
d'immigration basée sur des migrants blancs. À mesure que ces conditions restrictives se renforcent
à partir des années 1920, les routes sud-américaines et africaines deviennent donc d'autant plus
attrayantes.
2.2. La question de l'impérialisme français en Syrie et au Liban et le renoncement ottoman
Pour compléter notre étude centrée sur la société d'émigration, il faut s'intéresser aux
modalités de pénétration de l'impérialisme français dans l'Empire ottoman qui ont facilité
l'intervention des acteurs en jeu dans les mouvements migratoires syro-libanais. En effet, cet
impérialisme protéiforme et ancien, a donné un cadre légal à une forme d'ingérence des acteurs
publics et privés français dans la région, une région du Mont Liban qui depuis le règlement de 1861
devant mettre un terme aux massacres druzo-maronites, bénéficie d'un régime d'autonomie vis à vis
du pouvoir central de Constantinople. Ce régime d’exception, soutenu par un conseil de puissances
européennes au sein desquelles la France joue un rôle majeur, constitue un cadre politique et
juridique favorable au départ. La bibliographie se révèle plus développée concernant l'impérialisme
français dans l'Empire. Quoique centré sur les leviers économiques et financiers (question de la
dette ottomane notamment), l'ouvrage de Jacques Thobie a le mérite d 'en rappeler les mécanismes
73 Sur les premières lois restrictives visant par ricochet, les migrants libano-syriens en Australie et aux États-Unis, voir NABTI Patricia, Emigration from a Lebanese village : a case study of Bishmizzine, in HOURANI Albert et SHEHADIM Nadim, ouvrage cité, pp. 41-64.
74 Les individus les plus qualifiés, disposant d'un capital culturel relativement important, tendent à privilégier les États-Unis comme destination de leur immigration. Voir NAFF Alixa, Lebanese immigration into the United States, 1880 to present, in HOURANI Albert et SHEHADI Nadim, ouvrage cité, pp. 141-166.
22
et de revenir sur le fonctionnement des capitulations, un ensemble de conventions signées dès le
milieu du XVIe siècle et garantissant l'autonomie des intérêts étrangers dans l'Empire et le
renoncement de la Porte à les réguler75. Vincent Cloarec76 où encore Denise Bouche dans sa
synthèse portant sur la politique coloniale française au XIXè siècle77, insistent quant à eux sur
l'aspect plus culturel de cet impérialisme de la puissance protectrice des Catholiques d' Orient et de
son enseignement francophone.
Les archives que nous avons pu consulter sont également prolixes concernant la question de
la réglementation ottomane visant à contrôler les départs par le biais d'une législation plus ou moins
contraignante sur les passeports (pour les voyages extérieurs) et les tezkérés (document de voyage
nécessaire pour les voyages intérieurs à l'Empire) bien que cet aspect soit assez peu traité par la
bibliographie touchant à l'émigration libanaise. Engin Arkali, dans un article publié dans l'ouvrage
collectif dirigé par Albert Hourani et Nadim Shehadi, retrace l'évolution de l'attitude de
l'administration ottomane vis à vis de l'émigration libanaise qui à partir des années 1885-1887,
prend des proportions inquiétantes à ses yeux78. Le cas de l'émigration libanaise apparaît de nature à
saper la légitimité de l'État ottoman selon cet auteur : celui-ci se préoccupe des répercussions en
termes d'image que renvoie l'installation d'une population misérable dans différentes contrées
notamment de populations musulmanes dans la mesure où l'Empire ottoman se présente comme le
garant des Lieux Saints de l'islam et le protecteur des croyants. L'auteur de cet article place en 1898
la libéralisation de l'émigration décidée par l'État ottoman et motivée par le constat d'échec des
mesures de contrôle. L'application d'une législation contraignante sur l'émigration bute sur
l'enchevêtrement d'échelons administratifs sur lesquels le pouvoir ottoman a plus ou moins
d'emprise. En effet, la province du Mont-Liban est depuis les règlements de 1861, une province
autonome dont le statut est garanti par les puissances européennes et notamment la France,
l'établissement de la Mutassarifiya du Mont-Liban pouvant être interprétée comme le fruit de
l'ingérence européenne et notamment française dans l'Empire ottoman. Celui-ci cherche donc à
appliquer strictement une législation de contrôle de l'émigration à partir de cette province. Dans les
vilayets de Beyrouth et de Damas, l'application de ces dispositions se heurte à la corruption de
fonctionnaires locaux (les archives citent notamment la police de Beyrouth ainsi que les autorités
75 THOBIE Jacques, Intérêts et impérialisme français dans l'empire ottoman (1895-1914), Publications de la Sorbonne, Paris, 1977. Voir en particulier l'introduction.76 CLOAREC Vincent,« La France du Levant ou la spécificité impériale française au début du XXe siècle», Revue
française d’Histoire d’Outre-Mer, t. 83, n° 313, 4e trimestre 1996, p. 3-32. Dans cet article, l'auteur revient sur la notion de France du Levant, une expression inventée aux environs de 1900 par des personnalités du milieu catholique et missionnaire dans l'intention d'exalter « le dynamisme civilisateur congréganiste dans l'Empire ottoman ».77 BOUCHE Denise, Histoire de la colonisation française. T II : Flux et reflux (1815-1962), Paris, Fayard, 1991.78 AKARLI Engin, Ottoman attitude towards Lebanese emigration : 1885-1910 in HOURANI Albert et SHEHADI Nadim, ouvrage cité, pp. 109-138.
23
portuaires de cette ville) qui cherchent à profiter de ces flux migratoires par le biais de bakchichs.
Nous avons pu consulter dans cette optique les règlements édités par le gouvernement général du
Mont Liban édité en 1899 et celui du vilayet de Beyrouth édité en 1903 d'une part, et d'autre part,
plusieurs notes des autorités diplomatiques françaises de Beyrouth, Tripoli et Constantinople,
faisant état de la corruption des fonctionnaires locaux. Au vu des correspondances diplomatiques,
les autorités françaises manifestent le souci de respecter les règlements ottomans en dénonçant
certains embarquements clandestins sur des bateaux appartenant à des compagnies de navigation
françaises (compagnie de navigation à vapeur Cyprien Fabre et Messageries Maritimes notamment).
3. Les migrants syro-libanais en Afrique Occidentale Française
3.1. L'évolution quantitative des flux
Les études précédentes sur la communauté libanaise en Afrique de l' Ouest dépassent le
domaine de la recherche historique. Nous avons pu ainsi consulter des travaux d'ethnologie79, et
même de droit public80 sur la question. Les estimations quantitatives données par Jean-Gabriel
Desbordes et celles utilisées dans ces travaux font état d'effectifs relativement faibles avant un
décollage certain à partir des années 192081. Les sources que nous avons pu consulter signalent
l'arrivée des premiers émigrants dans les colonies dans les années 1890 notamment en Guinée82 qui
demeure la colonie abritant le plus d'émigrants syro-libanais au sein de la Fédération jusque dans les
années 1920. Il est vraisemblable que les premières arrivées de migrants syro-libanais dans les
colonies d'A.O.F. eurent lieu à Dakar, port de correspondance des lignes maritimes en provenance
de Méditerranée dans les années 1880 voire 187083, d'où un décalage temporel entre l'arrivée des
79 WEHBÉ Mohammed, La communauté libanaise en Côte d'Ivoire, thèse de doctorat d'ethnologie soutenue à l'université Paris VII en 1987.80 SAFA Élie, Essai sur l'émigration libanaise, Thèse de doctorat de droit soutenue à l'Université Saint-Joseph de
Beyrouth en 1959.81 DESBORDES Jean Gabriel, L'immigration libano-syrienne en Afrique Occidentale Française, Poitiers, Imprimerie
Moderne, Renault et Cie, 1938, pp. 17-23. Concernant notre période d'étude, nous remarquons que les migrants libano-syriens sont principalement présents dans les colonies de Guinée et du Sénégal, et au sein de celles-ci, dans les villes portuaires de Conakry et Dakar.
82 DESBORDES Jean Gabriel, ouvrage cité, p. 40. Rappelons toutefois les difficultés de l'administration coloniale d'enregistrer et de dater précisément l'arrivée des tout premiers migrants syro-libanais dans les colonies de l'Ouest africain dans un contexte où leur « pacification » n'est pas encore totalement achevée.
83 Sur les premières arrivées « officieuses » de migrants c'est-à-dire non enregistrées par l'administration coloniale,
24
premiers migrants dans les colonies d'A.O.F. et la prise de conscience de ce processus migratoire
par les autorités coloniales françaises. Pour une vision plus détaillée et plus concrète des filières
migratoires qui se mettent alors en place, nous pouvons signaler ici le rapport rédigé par le
gouverneur de cette colonie (Poulet) en 191284. Ce rapport adressé au Ministère des Affaires
Étrangères porte sur une mission que celui-ci a entreprise au Mont-Liban en 1911 afin de
comprendre les raisons d'une « immigration importante » et « mettant en cause », selon les termes
utilisés par son auteur, « les intérêts de l'entreprise coloniale de la France en Guinée », du fait de la
concurrence commerciale qu'entretient ce groupe sur les petits commerçants français et indigènes.
À la lumière de ses propos, il semblerait possible de retracer une filière migratoire ayant pour
origine le village de Beit-Chébab, localité d'où proviendraient près de 30% des migrants de Guinée.
Ainsi, en 1907, cette colonie comptait en 1896, 2 migrants puis 18 en 1897, 477 en 1907 et 1 137 en
1910. L'auteur s'efforce également à retracer la répartition communautaire de la « colonie syrienne
de Guinée » qui serait composée, pour la même année (1910) de 59% de Chrétiens maronites, 22%
de Musulmans, 6% d'Orthodoxes et 12% de Druzes (1% des migrants sont regroupés dans une
catégorie « Divers »). 82% de ces migrants seraient originaires de la province autonome du Mont-
Liban. Les sources nous donnent également des perceptions contradictoires des représentants du
pouvoir colonial français à propos de cette émigration. En effet, les représentants de l'administration
coloniale auxquels se rattache l'auteur du rapport cité, tendraient à souligner les dangers que
constitueraient l'implantation et la croissance de cette colonie syrienne et prônent la mise en place
de mesures juridiques pour la contrôler. À l'inverse, d'autres sources comme le mémoire d'études de
Jean-Gabriel Desbordes déjà cité, qualifient explicitement de positive pour le développement
économique de la Fédération la présence de ce groupe immigrant « aux qualités commerciales
remarquables ». Ce rapport Poulet nous renseigne également sur les moteurs de cette immigration
qui semble tenir d'une part, de facteurs de répulsion (le Gouverneur Poulet se désole d'une pauvreté
décourageante au Mont-Liban) et d'autre part, de facteurs d'attraction : le gouverneur signale que la
Guinée bénéficie d'une image positive au sein de cette population du fait des opportunités
d'enrichissement rapide qu'elle offre. La voie africaine semble donc bénéficier d'une attractivité en
tant que telle et ce, dès les années 1890, ce qui peut entrer en contradiction avec certains éléments
voir BOUMEDOUHA Saïd, « Change and continuty in the relationship between the Senegal and their Hosts », in HOURNAI Albert et SHEHADI Nadin, ouvrage cité, pp. 549-564. À titre d'exemple, les autorités administratives de la colonie du Sénégal n'enregistrent l'arrivée des migrants qu'à partir de 1896 alors que la mémoire des immigrants fait état d'une arrivée plus précoce, en lien avec le boom du cycle de l'arachide dans cette colonie dès les années 1876-1880.
84 Archives du Ministère des Affaires Étrangères, site de Nantes. Dossier Beyrouth consulat. Série A. Affaires consulaires. Émigration, 1891-1914 (Mnésys : 92PO/A/240). Rapport de mission du Gouverneur de Guinée Poulet, 1912. Non paginé.
25
de bibliographie présentant l'Afrique comme un choix par défaut pour les immigrants syro-
libanais85. La répartition géographique laisse donc entrevoir une préférence pour les colonies
francophones sur les colonies anglophones86 et au sein des premières, pour les colonies littorales
(Guinée et Sénégal pour la période qui concerne notre étude) par opposition aux colonies intérieures
de la Fédération (Niger et Mali actuels par exemples)87. L'évolution des courants migratoires suit
une évolution classique conformes aux résultats des travaux menés dans les différentes disciplines
des sciences humaines sur l'émigration à savoir, un « premier âge »88 où l'émigration est
principalement le fait de jeunes hommes venus seuls avant qu'une deuxième phase ne s'amorce, ici à
partir des années 1920, où les femmes se font beaucoup plus nombreuses. La bibliographie relative
à l'histoire économique de l'A.O.F nous signale que la répartition de la population migrante fait
tâche d'huile à partir des grands ports des colonies comme Conakry (modernisé au tournant des
années 1890 et 1900) et de Dakar vers l'intérieur des terres en suivant de façon privilégiée les lignes
de chemin de fer qui donnent naissance à de nouveaux centres commerciaux et déplacent le centre
de gravité économique des colonies89 (songeons au cas de Mamou sur la ligne de Conakry au Niger
qui selon les chiffres donnés par Catherine Coquery Vidrovitch, comptait en 1908, 150« Syriens »
pour 75 « Européens » et 2000 « Africains »90). Contrairement à notre hypothèse d'origine et celle
de Samir Amin présentant l'immigration libano-syrienne comme un instrument de la politique
coloniale française visant à saper l'émergence d'une bourgeoisie autochtone en A.O.F (Sénégal)91, il
85 Voir NABTI Paricia, op. cit. Dans cette étude de cas, l'auteure tend à présenter la route nord-américaine comme une route de premier choix réservée de fait aux migrants disposant du capital culturel et économique le plus élevé. Les autres routes migratoires comme la route sud-américaine et ouest-africaine tendent donc à être présentées comme des choix par défaut pour des migrants rebutés par les réglementation des États-Unis concernant l'entrée de migrants
originaires de la région du Levant ou ne disposant de suffisamment d'argent pour pousuivre, à partir de Marseille, leur voyage vers l'Amérique du Nord. Sur ce caractère « subi » du choix de la voie africaine, voir RADA NASSER Lliane, op. cit., pp. 29-30. Ainsi, les réglementations sanitaires, le manque de capital économique (en d'autres termes le prix trop élevé des billets pour l'Amérique du Noir) ainsi que les « mensonges » de certains capitaines de bateaux faisant croire aux migrants que le bateau sur lequel ils ont embarqué est bien à destination de l'Amérique du Nord alors que celui-ci se rend en Afrique sont évoqués comme les principales causes de l'arrivée de migrants syro-libanais en A.O.F. Il ne s'agit ici de contester l'existence de tels cas mais simplement de réévaluer l'image que les migrants pouvaient avoir avoir des colonies africaines en tant que territoires offrant des opportunités d'enrichissement rapide et relativement important.
86 KOJOK Salma, op. cit.,p. 38 : le critère de la francophonie ne semble pas avoir joué un rôle décisif dans le choix des colonies françaises d'Afrique de l'Ouest comme le montre la présence de migrants syro-libanais, à la même époque, dans les colonies britanniques de la région (Gold Coast, Sierra Leone) ainsi qu'au Libéria. La protection officieuse que la France prétend assumer auprès de cette population semble à ce propos, un facteur beaucoup plus déterminant.
87 Sur l'immigration côtière et l'importance des lignes commerciales de navigation européennes, voir notamment VAN DER LAAN Laurens, « Migration, Mobility and Sttlement of the Lebanese in West Africa » in HOURANI Albert et SHEHADI Nadim, ouvrage cité, pp. 531-548.
88 SAYAD Abedelmalek, ouvrage cité, pp. 60-64.89 MARFAING Laurence, L' Évolution du commerce au Sénégal, 1820-1930, L'Harmattan coll. « Racines du
présent », Paris, 1994, pp.87-97. 90 COQUERY-VIDROVITCH Catherine, GEORG Odile, L' Afrique occidentale au temps des Français, colonisateurs et colonisés, La Découverte, Paris, 1992, 91 AMIN Samir, « La politique française à l'égard de la bourgeoisie sénégalaise (1820-1960), in MEILLASSOUX Claude, L'évolution du commerce africain depuis le XIXe siècle en Afrique de l'Ouest, Oxford University Press, 1971, pp. 361-376.
26
semble que cette dernière soit autonome, du moins entretenue par les informations données par les
immigrés installés à leurs réseaux familiaux et d'inter-connaissance au Mont-Liban.
3.2. L'insertion des immigrants libanais dans le paysage social colonial
Les travaux et les sources que nous avons consultés font état d'un schéma d'intégration tout à
fait particulier à la population étudiée. Les émigrants syro-libanais investissent en effet
massivement le domaine du commerce de détail voire commerce de gros indépendant dans les
différentes régions où ils choisissent de s'installer92. Ainsi, en A.O.F., les émigrants syro-libanais
occupent progressivement une place spécifique au sein de l'économie de traite à savoir celle
d'intermédiaires entre cadres métropolitains du commerce des produits tropicaux et ceux issus des
cultures de plantation (arachide au Sénégal, cacao en Côte d'Ivoire) et paysans « indigènes »93. Cette
place dévolue, outre les aspirations professionnelles des émigrants, semblent être confortée par une
certaine idéologie coloniale. À rebours de l'entre soi métropolitain, les émigrants n'hésitent pas à
s'acculturer aux société autochtones afin d'accroître l'efficacité de leurs réseaux commerciaux
(apprentissage des langues locales comme le wolof par exemple). Reste encore à déterminer dans
quelles mesures les évolutions de l'implantation syro-libanaise sont spontanées et si elles n'ont pas
été en partie initiées en partie par les compagnies concessionnaires en charge de l'exploitation de
ces colonies. Mais au vu du regard plus que critique de certains représentants de l'administration
coloniale comme le gouverneur Poulet, il apparaît difficile de soutenir qu'une véritable politique
d'immigration ait été engagée par le pouvoir colonial français afin d'asseoir son assise économique
en A.O.F. Il convient à l'inverse d'insister sur l'autonomie des acteurs sur laquelle s'insère des
stratégies opportunistes d'autres acteurs intéressés, essentiellement d'un point de vue économique,
par l'organisation de ces flux migratoires. Les sources et la bibliographie tentent également de
dresser un tableau du mode de vie des commerçants syro-libanais. Celles-ci insistent toutes sur le
dénuement des immigrants à leur arrivée ainsi que leurs conditions de vie proches de l'indigence. Le
regard misérabiliste des sources décrit ainsi la promiscuité et l'insalubrité de l'habitat. Le
nomadisme est à la fois présenté comme un facteur de risques sanitaires (il est fait mention
d'épidémies de fièvre jaune et de choléra qui ont touché de façon préférentielle les Syro-Libanais et
92 Pour une description précise du système de colportage des pionniers syro-libanais en A.O.F. Voir notamment, SAFA Élie, Essai sur l'émigration libanaise, Thèse de doctorat de droit soutenue à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth en 1959, pp. 269 sqq.
93 BONIN Hubert, C.F.A.O. Cent ans de compétition, Économica, Paris, 1987, p. 79. SAFA Élie, op. cit., pp. 159 sqq. DESBORDES Jean-Gabriel, op. cit., pp.125-127.
27
qui ont pu même décourager l'émigration pour les années 1900 et 1904) et comme un atout
commercial décisif car accroissant la zone de chalandise couverte par ces commerçants, par
opposition à l'immobilité des structures « physiques » des Européens. Malgré le partage de
conditions de vie précaires, les migrants syro-libanais semblent manifester un « sentiment de
supériorité »94 nourri de l'intériorisation d'une certaine idéologie coloniale stigmatisante à l'encontre
des populations noires. De telles représentations peuvent être appréhendées au travers du
vocabulaire utilisé par les migrants pour désigner les populations africaines : au terme de Corails
utilisés par les Africains pour désigner les commerçants syro-libanais (référence aux objets et bijoux
en corail que certains colporteurs vendaient aux populations locales95), répond le terme arabe de
'abd (pluriel : abid96) servant à qualifier les populations noires et signifiant littéralement serviteur
(de Dieu) ou esclave, le terme étant alors considéré comme vexatoire pour les Africains. En résulte
une tendance à l'auto-ségrégation visible dans l'espace urbain. Pour Winder Bayly, l'isolement des
Syro-Libanais est visible à plusieurs niveaux97. Tout d'abord dans le schéma résidentiel des villes
d' A.O.F., les commerçants et éventuellement leur famille vivaient généralement dans leur boutique
(arrière salle ou au deuxième étage pour ceux ayant réussi à accumuler le capital nécessaire à la
construction d'une boutique en dur et ensuite, à son extension), ces boutiques étant regroupées sur
une ou plusieurs rues comme le signale la présence de plusieurs « rues du Liban » ou même de
villages nommés d'après le noms de villages de la Montagne libanaise. Dans les années 1920, des
regroupements associatifs communautaires éphémères voient le jour comme le Comité Syro-
Libanais en A.O.F. en 1926. Le même, les pratiques matrimoniales des migrants syro-libanais
traduit l’ambiguïté de leur insertion au sein de la société coloniale. Winder Bayly rappelle que dans
un contexte d'immigration principalement masculine, le concubinage avec des compagnes africaines
était relativement fréquent98 et constituait un facteur d'intégration puissant en incitant par exemple,
les migrants à apprendre les langues locales99. Cependant, les règles d'alliance suivies par ce groupe
social restent, malgré la rupture inhérente à la situation migratoire, déterminées par les normes
sociales du groupe d'appartenance selon des schémas similaires à ceux étudiés par Pierre Bourdieu
chez les sociétés kabyles méditerranéennes dans les années 1960100. Ainsi, après une période de
94 BAYLY Winder R., « The Lebanese in West Africa » in Comparative Studies in society and history, 4 (1961-2), pp. 296-333.95 DESBORDES Jean-Gabriel, op. cit., p. 47.96 BAYLY Winder R., « The Lebanese in West Africa » in Comparative Studies in society and history, 4 (1961-2), pp. 296-333. Voir pp. 321 sqq.97 BAYLY Winder R., op. cit., pp. 319 sqq.98 BAYLY Winder, op. cit., p. 320.99 BAYLY Winder, op. cit., p. 321.100BOURDIEU Pierre, Esquisse d'une théorie de la pratique précédé de trois études d'ethnologie kabyle, Librairie
Droz, Genève, 1972, pp. 71-127. Dans sa critique du schéma généalogique utilisé par certains anthropologues structuralistes selon lequel le mariage arabe est soumis à des règles complexes devant concilier des fonctions et des intérêts internes et externes au groupe familial, la famille apparaissant comme la principale entité sociale
28
concubinage plus ou moins longue avec des femmes africaines, il est coutumier pour les migrants
avant 1918101, de retourner au village d'origine et de se marier selon les règles du groupe
d'appartenance et notamment en respectant les règles de la communauté religieuse d'origine ou
alors, de faire venir en A.O.F., son épouse lorsque le migrant a quitté le groupe d'origine après son
mariage, et ce quand le capital économique accumulé le permet102. Ainsi, le principal problème posé
aux migrants d'Afrique était de se défaire d'un mariage de jouissance implicitement contracté avec
des femmes africaines103.
3.3. Les réseaux économiques et commerciaux des migrants syro-libanais en Afrique
Occidentale Française
La stratégie commerciale des migrants est également bien détaillée par les sources comme le
rapport Poulet et le rapport rédigé par Jean-Gabriel Desbordes en 1938104 (vraisemblablement un
mémoire d'études de l'École d'administration coloniale, la fonction de l'auteur est encore à
préciser). Les sources en présence insistent sur ce que nous pourrions qualifier d'avantage
compétitif dont jouissent les immigrés syro-libanais implantés en A.O.F. En effet, ces deux
dernières sources décrivent de façon précise le processus selon lequel les immigrés exercent une
structurante des sociétés arabes. Les règles traditionnelles entourant les stratégies d'alliance dans les sociétés arabes voire méditerranéennes, sont régies, d'après les auteurs cités par Pierre Bourdieu (pp. 74-76) d'une part, par des fonctions internes c'est à dire par la volonté de renforcer l'unité de la lignée et de limiter la tendance au fractionnement [...] dans une recherche d'intégration dans un espace plus large englobant à la limite tous les Arabes (op. cit., p. 74) et, d'autre part, par des fonctions externes et économiques c'est à dire associées à la transmission de l'héritage, l'endogamie (et notamment le mariage avec la cousine parallèle patrilinéaire) évitant le fractionnement du capital économique et foncier du groupe familial. Pierre Bourdieu précise quant à lui que le mariage arabe s'insère dans une tension entre intérieur et extérieur c'est-à-dire entre intégration (unification interne) de la lignée familiale et nécessité d'alliance vers l'extérieur. Dans cette perspective, les stratégies matrimoniales sont déterminées par le capital économique et symbolique de la famille (patrimoine, nombre d'hommes de la famille qui détermine sa force productive mais aussi politique) et la capacité de négociation de ses membres d'après un ordre hiérarchisé selon lequel les femmes, individus subalternes dans la hiérarchie symbolique, débutent des négociations officieuses et préalables à la conclusion d'un contrat de mariage, avant que des membres masculins plus prestigieux ne prennent le relais selon des modalités plus institutionnalisées, pp. 108-127. Bien que prenant pour terrain la société kabyle, l'auteur rappelle que ces règles matrimoniales prévalent dans les sociétés arabes. Pour notre propos, nous retiendrons que les stratégies matrimoniales des migrants restent déterminées par les schémas familiaux et communautaires du groupe d'appartenance malgré la situation migratoire. Le mariage mixte semblerait concerner bien davantage les descendants de deuxième voire de troisième génération.
101 BAYLY Winder, op. cit., p. 320.102 Sur les différentes modalités de mariage des migrants (retour dans la région d'origine pour le mariage, ou venue de
la compagne dans le pays de la migration), nous pouvons nous reporter au travail de collecte de biographies familiales réalisés par Sélim Abou à propos de migrants syro-libanais en Argentine au tournant des XIX et Xxè siècles. Voir ABOU Sélim, op. cit., pp. 36-270 (témoignage de Nayla, dont le grand père s'est installé en Argentine en 1912 avant de faire venir sa compagne en 1918) et pp. 371-479 (témoignage d' Amalia dont les grands-parents sont venus en couple en Argentine dans le dernier quart du XIXè siècle).
103 BAYLY Winder, op. cit., p. 321, p.322.104 Sur la pénétration des réseaux commerciaux des migrants syro-libanais à l'intérieur des terres, voir DESBORDES
Jean Gabriel, op. cit., pp. 45-46.
29
concurrence importante contre les commerçants européens et indigènes d'une part et, d'autre part,
contre les maisons de commerce. En effet, les immigrants libanais semblent disposer d'un capital
modeste et par conséquence, n'ont pas à assumer des coûts d'amortissement de ce capital à l'inverse
des petits commerçants européens qui s'installent dans des échoppes construites en dur dans les
centres commerciaux d'A.O.F. Le commerce libano-syrien apparaît, dans la période qui nous
concerne, comme un commerce de colportage itinérant, donc ne nécessitant pas la construction ou
l'achat de bâtiments où installer le commerce. Le capital initial est constitué de « pacotille » pour
reprendre les termes du rapport Poulet dont l’amortissement est rapidement garanti. Du fait de ces
coûts de production moindres, le commerçant syro-libanais peut proposer un prix d'achat plus élevé
au producteur local de matière première (caoutchouc en Guinée, arachide au Sénégal) et le revendre
à un prix moins élevé aux maisons de commerce. En d'autres termes, le commerçant syro-libanais
peut se permettre un bénéfice d'exploitation moins élevé car celui-ci a des coûts fixes à amortir
moins élevés. Ce problème est également souligné, dans le rapport Poulet, par un mode de vie
« syro-libanais» décrit de façon misérabiliste, d'après lequel ces immigrants ont un niveau de vie
proche de la pauvreté, voire de l'indigence, et donc moins dépendant de marges bénéficiaires
élevées. Le rapport de Jean-Gabriel Desbordes souligne les conséquences de cette concurrence par
les prix exercée de façon inconsciente par les immigrés syro-libanais sur les relations entretenues
entre ce groupe et les autres groupes sociaux présents dans la Fédération. Sous la pression des
commerçants européens et métropolitains plus particulièrement, l'administration coloniale française
est amenée à prendre des mesures d'ordre protectionniste visant à défendre le petit commerce
européen. Jean-Gabriel Desbordes cite ainsi la mise en place de droits de patente spécifiques aux
Syro-Libanais comme « la patente syrienne »instituée par arrêté du gouverneur général du Sénégal
le 16 juillet 1900105. De même, cette concurrence entraîne des réactions de la part du commerce
européen comme la formation d'ententes visant à exclure, ostraciser, les commerçants syro-libanais
comme en Guinée en 1904. Signalons maintenant que le mémoire d'études de Jean-Gabriel
Desbordes est parfaitement référencé concernant les dispositions réglementaires prises dans les
territoires de l'A.O.F par l'administration coloniale. Sont ainsi cités, Le Journal Officiel de l'A.O.F,
Le Journal Officiel de Guinée, Le Bulletin administratif du Sénégal, ainsi que plusieurs numéros de
la Quinzaine coloniale qui sont autant de sources directes que nous pouvons mobiliser afin de
cerner l'évolution de l'attitude des autorités coloniales et du milieu commerçant européen et
indigène face à l'émigration syro-libanaise. Les relations établies entre la communauté syro-
libanaise et les autres communautés installées en A.O.F. témoignent de l'assise de la première. Les
travaux de Saïd Boumedouha sont ainsi particulièrement révélateurs de la réussite « globale » de
105 DESBORDES Jean Gabriel, op. cit., p. 43.
30
cette communauté : ceux ci mettent en lumière les rancœurs se développant au sein d'une petite
classe moyenne blanche commerciale qui, marquée par une certaine idéologie coloniale, ne parvient
pas à établir des réseaux commerciaux aussi performants que ceux de leurs rivaux106. En résultent
des manifestations de xénophobie et des campagnes d'opinion notamment dans les années 1930 et
1940 stigmatisant la « malhonnêteté » des pratiques commerciales des Syro-Libanais. Ces
campagnes trouvent peu d'échos au sein de la population autochtone et au sein des autorités
coloniales françaises du fait de l'importance des fonctions que semblent remplir ces immigrés dans
l'économie de traite.
106 BOUMEDOUHA Saïd, op. cit.
31
Bibliographie classée et commentée
1. Méthodologie
FEBVRE Lucien, Combats pour l'histoire, Paris, Armand Colin, 1952, 456 p.
LEMERCIER Claire, « Analyse des réseaux et histoire », in Revue d'histoire moderne et
contemporaine, 2005/2, n° 52-2, pp. 88-112..
LEMERCIER Claire, ROSENTAL Pierre-André, « Pays ruraux et découpage de l'espace :
les réseaux migratoires dans la région lilloise au milieu du XIXe siècle », in Population, 55/4-5,
juillet-octobre 2000, pp. 691-726.
MERCKLE Pierre, Sociologie des réseaux sociaux, La Découverte, coll. « Repères », Paris,
2011, 128 p.
PROST Antoine, Douze leçons sur l'histoire, Seuil, coll. « Points Hisoire », Paris, 2010, 370
p.
2. Histoire du Liban et de l' Empire Ottoman
2.1. Histoire générale
AMMOUN Denise, Histoire du Liban contemporain, T. I : 1860-1943. Fayard, Paris, 1997,
528 p.
BOURDIEU Pierre, Esquisse d'une théorie de la pratique précédé de trois études
d'ethnologie kabyle, Librairie Droz, Genève, 1972, 267 p. Sur les règles d'alliance dans les sociétés
arabes.
BRAUDEL Fernand, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II,
32
Le livre de poche, coll. « Références », Paris, 1993 (1949), 3 volumes, 1714 p.
CHEVALLIER Dominique, La Société du Mont-Liban à l'époque de la révolution
industrielle en Europe, Geuthner, Paris, 1982, 316 p.
CORM Georges, Le Liban contemporain. Histoire et société. La Découverte, Paris, 2012
(2012), 430 p. Voir plus particulièrement pp. 5-86.
DIB Boutros (sous la direction de), Histoire du Liban des origines au XXè siècle, Éditions
Philippe Rey, Paris, 2006, 1006 p.
EDDE Carla, Beyrouth, naissance d'une capitale (1918-1924), Actes Sud, Arles, 2010, 397
p.
GEORGEON François, Abdülhamid II, le sultan calife, Fayard, Paris, 2003, 528 p.
GEORGEON François, DUMONT Paul (sous la direction de), Vivre dans l'Empire Ottoman.
Sociabilités et relations intercommunautaires (XVIII-XXe siècles), L' Harmattan, Paris, 1997, 350 p.
TERNON Yves, L' Empire Ottoman : le déclin, la chute, l'effacement, Éditions du
Félin/Éditions Michel de Maule, Paris, 2002, 575 p.
THOBIE Jacques, Intérêts et impérialisme français dans l'empire ottoman (1895-1914),
Publications de la Sorbonne, Paris, 1977, 817 p.
2.2. Présence occidentale en « Syrie »
BOCQUET Jérôme, Missionnaires français en terre d'islam. Damas, 1860-1914, Les Indes
savantes, Paris, 2005, 351 p.
CLOAREC Vincent,« La France du Levant ou la spécificité impériale française au début du
XXe siècle», Revue française d’Histoire d’Outre-Mer, t. 83, n° 313, 4e trimestre 1996, p. 3-32.
MAKDISI Ussama, Artillery of Heaven. American missionaries and the failed conversion of
the Middle East, Cornell University Press, Londres, 2008, 262 p.
RIFIER Jean, Les œuvres françaises en Syrie (1860-1923), L' Harmattan coll. « Comprendre
le Moyen-Orient », Paris, 2000, 378 p. Cet ouvrage est issu de la thèse de didactologie des langues
et des cultures soutenue par l'auteur à l'Université Paris III en 1999. Le propos ne répond pas aux
normes historiques d'administration de la preuve c'est à dire notamment, la mention des fonds
d'archives utilisés et l'utilisation de notes de fin de pages. Les références de l'auteur (notes
diplomatiques etc.) sont intégrées dans le corps du texte sous la forme de citations.
33
3. Histoire de l'Afrique Occidentale Française
3.1. Colonisation française et européenne en Afrique de l'Ouest
BOUCHE Denise, Histoire de la colonisation française. T II : Flux et reflux (1815-1962),
Paris, Fayard, 1991, 607 p.
COQUERY-VIDROVITCH Catherine, GEORG Odile, L' Afrique occidentale au temps des
Français, colonisateurs et colonisés, La Découverte, Paris, 1992, 460 p. Voir surtout le chapitre :
La politique économique coloniale.
COQUERY-VIDROVITCH Catherine, MONIOT Henri, L' Afrique noire de 1800 à nos
jours, P.U.F. Coll. « Nouvelle Clio », Paris, 1974, 462 p.
COHEN William B., Empereur sans sceptre. Histoire des administrateurs de la France
d'Outre-Mer et de l'École coloniale, Berger-Levrault coll. « Monde d'outre-mer », Paris, 1973, 304
p. Traduit de l'anglais, Rulers of Empire, Stanford,1971.
CROWDER Michael, West Africa under colonial rule, Londres, 1968, 293-8.
3.2. Histoire économique de l' Afrique Occidentale Française
BONIN Hubert, C.F.A.O. Cent ans de compétition, Économica, Paris, 1987, 560 p. Une
étude de la C.F.A.O axée autour d'une problématique relevant de la business history.
BONIN Hubert, C.F.A.O (1887-2007), la réinvention permanente du commerce outre-mer,
Publications de la Société Française d'Histoire d'Outre-Mer, Paris, 2008, 760 p.
MARFAING Laurence, Évolution du commerce au Sénégal, 1820-1930, L 'Harmattan coll.
« Les racines du présent », Paris, 1991, 320 p.
MARSEILLE Jacques, Empire colonial et capitalisme français. Histoire d’un divorce, Albin
Michel, Paris, 2005 (1984), 638 p.
VANHAEVERBEKE André, Rémunération et commerce extérieur. Essor d'une économie
paysanne exportatrice et termes de l'échange des producteurs d'arachide au Sénégal, Publications
de l'Université catholique de Louvain, Louvain, 1970, 253 p.
34
3.3. Histoire sociale de l'Afrique Occidentale Française et présence syro-libanaise en Afrique
de l'Ouest
AMIN Samir, « La politique française à l'égard de la bourgeoisie sénégalaise (1820-1960),
in MEILLASSOUX Claude, L'évolution du commerce africain depuis le XIXe siècle en Afrique de
l'Ouest, Oxford University Press, 1971, 444 P, pp. 361-376.
AMIN Samir, L' Afrique de l'Ouest bloquée. L'économie politique de la colonisation, 1880-
1970, Minuit, Paris, 1971, 322 p.
ARSAN Andrew Kerim, « Failing to stem the tide : Lebanese migration to French West
Africa and the competing prerogatives of the imperial State » in Comparative studies in society and
history, vol. 53, 2011, pp. 450-478.
BAYLY Winder R., « The Lebanese in West Africa » in Comparative Studies in society and
history, 4 (1961-2), pp. 296-333.
BIERWIRTH Chris, « French interests in the Levant and their impact on French immigrant
policy in West Africa », in Itinerario, European journal of overseas territories, vol. 26, n°1, pp. 9-
32.
BIGO Didier, The Lebanese communauty in Ivory Coast : a non-native network at the heart
of power ? in HOURANI Albert et SHEHADI Nadim, The Lebanese in the World. A Century of
Emigration, I.B. Taurus, Londres, 1993, 742 p., pp. 509-530.
BOUBA NOUHOU Alhadji, « Les Libano-Syriens au Sénégal. Trajectoire, accomodation et
confessionnalisme », in Confluences Méditerranée, 2012/4, n°83, pp. 135-141. Notons toutefois les
références multiples de l'auteur à la thèse de Samir Amin (cités plus haut) qui dans une perspective
marxisante, présente l'immigration syro-libanaise comme un instrument de la politique impérialiste
française en A.O.F. visant à briser l'émergence timide d'une bourgeoisie autochtone. Ces travaux
semblent répondre plus à des préoccupations d'ordre idéologique plutôt que véritablement
scientifique et historique (absence de mobilisation de sources et d'archives pour étayer le propos
notamment).
BOUMEDOUHA Saïd, Change and continuity in the relationship between the Senegal and
their hosts, in HOURANI Albert et SHEHADI Nadim, ouvrage cité, pp. 549-564.
COQUERY VIDROVITCH Catherine, Être étranger et migrant en Afrique : enjeux
identitaires et modes d'insertion. Volume I : Politiques migratoires et construction des identités, L'
Harmattan, Paris, 2003.
COQUERY VIDROVITCH Catherine, Être étranger et migrant en Afrique. Enjeux
identitaires et modes d'insertion. Volume II : Dynamiques migratoires, modalités d'insertion urbaine
35
et jeux d'acteurs, L'Harmattan, Paris, 2003. Ce travail imposant est surtout centré sur les
mouvements inter-africains. Seuls quelques articles peuvent nous intéresser directement pour notre
étude.
FILFILI Nadra, Ma vie, 50 ans au Sénégal, Dakar, 1973, 129 p. L'un des très rares
témoignages de migrants publiés.
HANNA Marwan, Lebanese Emigrants in West Africa. Their effects on Lebanon and West
Africa, University of Oxford Press, Oxford, 1958, 832 p.
HARFOUCHE Nabil, « Libanais en terre d'Afrique » in Arabies, Paris, mai 1987.
KOJOK Salma, Les Libanais en Côte d'Ivoire de 1920 à 1960, thèse de doctorat d'histoire
soutenue à l' Université de Nantes, 522 p.
O'BRIEN Rita Cruise, « Lebanese entrepreneur in Senegal : economic integration and the
politics of protection », in Cahiers d'études africaines. Vol. 15 n°157, 1975, pp. 95-115.
VAN DER LAAN H. Laurens, Migration, mobility and settlement in West Africa, in
HOURANI Albert et SHEHADI Nadim, ouvrage cité.
WEHBÉ Mohammed, La communauté libanaise en Côte d'Ivoire, thèse de doctorat
d'ethnologie soutenue à l'université Paris VII en 1987.
4. Migrations internationales et immigration syro-libanaise
4.1. Ouvrages et articles généraux
BAINES Dudley, Migration in a mature economy. Emigration and internal migration and
England and Wales, 1861-1900. Cambridge University Press, Cambridge, 2003 (1985), 372 p.
BENABOU-LUCIDO Latifa, « Histoire du développement de la recherche universitaire
française sur les migrations internationales (1815-1999) » in Revue européenne des migrations
internationales, vol. 27-n°3|2011.
BERNERON COUVENHES Marie-Françoise, Les Messageries Maritimes. L'essor d'une
grande compagnie de navigation française, 1851-1894, Presses de l'Université Paris-Sorbonne,
Paris, 2007, 839 p.
BOULANGER Patrick, « Témoignage sur le transport des émigrants en Méditerranée : les
36
rapports des capitaines des Messageries Maritimes, 1871-l1914 », in Navigation et migration en
Méditerranée, Éditions du CNRS, Paris, 1990, pp. 351-366.
BOURDIEU Pierre, Raisons pratiques. Sur la théorie de l'action, Seuil coll. « Points
Essais », Paris, 1994, 248 p. Sur la problématique de constance nominale et les procédés de
nomination des individus par les appareils d' état civil.
CONSTANTINE Stephen, « Emigrants and Empire : British settlement in the Dominions
between the wars, Manchester, 1990, 203 p.
FONTAINE Laurence, Histoire du colportage en Europe (XV-XIXe siècles), Albin Michel
coll. « L'évolution de l'humanité », Paris, 1993, 336 p.
FONTAINE Laurence, « Solidarités familiales et logiques migratoires en pays de montagne
à l'époque moderne », in Annales, Économies, Sociétés, Civilisations, 45e année, n°6, 1990, pp.
1133-1150.
FONTAINE Laurence, « Migrations : espace et identité », in Bulletin du Centre Pierre Léon
d'histoire économique et sociale, Université Lumière Lyon II, 2-3-4, 1992.
FONTAINE Laurence, « Montagnes et migrations d travail. Un essai de comparaison
globale (XV-XXe siècles) », in Revue d'histoire moderne et contemporaine, 2005/2, n°52-2, pp. 26-
48.
GREEN Nancy, Repenser les migrations, P.U.F coll. « Le nœud gordien », Paris, 2006. 144
p.
HARPER Marjory, CONSTANTINE Stephen, Migration and Empire, Oxford University
Press coll. « Oxford history of the British Empire Companion Series », Oxford, 2010, 396 p. Une
synthèse portant sur les mouvements migratoires internes à l'Empire britannique. Cet ouvrage nous
aidera pour une démarche comparative avec des courants migratoires organisés sur une base
ethnique au sein des colonies et des dominions britanniques tout au long du XIXe (coolies indiens
etc).
JEROME Harris, Migration and business cycles, National Bureau of Economic Studies,
New York, 1926.
NOIRIEL Gérard, Le Creuset français : Histoire de l'immigration, XIX-XXe siècles, Seuil
coll. « Points Histoire », 2006, 447 p.
NOIRIEL Gérard, État, nation et immigration, Folio Histoire, Paris, 2001, 590 p
SAYAD Abdelmalek, La Double-absence. Des illusions de l'émigré aux souffrances de
l'immigré, Seuil, coll. « Liber », Paris, 1999, 437 p.
37
4.2. Immigration libanaise, perspective générale
ABDULKARIM Amir, « Les Libanais en France : évolution et originalité » in Revue
européenne de migrations internationales. Vol. 9 n°1, pp. 113-129.
ABDULKARIM Amir, La diaspora libanaise en France : processus migratoire et économie
ethnique, L'Harmattan, Paris, 1996.
Ces deux premières références pour une approche comparative avec la communauté
libanaise établie en France.
ABOU Sélim, Liban déraciné. Immigrés dans l'autre Amérique, L' Harmattan coll.
« Connaissance des hommes », Paris, 1998, 718 p.
AKARLI Engin, Ottoman attitude towards Lebanese émigration : 1885-1910 in HOURANI
Albert et SHEHADI Nadim (sous la direction de), The Lebanese in the world. A Century of
emigration, I.B. Taurus, Londres, 1993, pp. 109-138. Principale publication du Centre for
Lebanese Studies de l'université d'Oxford et fondé par Albert Hourani à la fin des années 1980.
FERSAN Éliane, « Les immigrés syro-libanais au Brésil de 1920 à 1926 : perception du
corps consulaire français », mémoire de maîtrise soutenu à l'Université Saint-Esprit de Kaslik
(Liban).
HASHIMOTO Kohei, Lebanese population movement : 1920-1939. Towards a study, in
HOURANI Albert et SHEHADI Nadim, ouvrage cité.
ISSAWI Charles, The historical background of Lebanese emigration (1800-1914) in
HOURANI Albert et SHEHADI Nadim (sous la direction de), ouvrage cité.
KARPAT Kemal, « The Ottoman emigration to America, 1860-1914 » in International
Journal of Middle East Studies, 1985, pp. 175-209.
NABTI Patricia, « Emigration from a Lebanese village : a case study of Bishmizzine » in
HOURANI Albert et SHEHADI Nadim, ouvrage cité. Une étude de cas à partir d'un village de la
montagne libanaise entre les années 1900 et 1945.
LABAKI Boutros, « L'émigration libanaise en Afrique occidentale sub-saharienne » in
Revue européenne de migrations internationales. Vol. 9 n°2, pp. 91-112.
NAFF Alixa, Lebanese immigration into the United States : 1880 to present, in HOURANI
Albert et SHAHADI Nadim, ouvrage cité, pp. 41-64.
OWEN Roger, Lebanese migration in the context of World population, in HOURANI Albert
et SHAHADI Nadim, ouvrage cité.
RADA NASSER Liliane, Ces Marseillais venus d'Orient. L'immigration libanaise à
Marseille aux XIXe et XXe siècles, Karthala, Paris, 2006, 264 p. Cette étude monographique peut-
38
être utilisée de façon transversale dans l'optique de notre sujet. Sur la base d'entretiens effectués
avec des émigrés et descendants d'émigrés, l'auteure évoque l'insertion des émigrants dans les
sociétés d'accueil, la place de Marseille comme plaque tournante de l'émigration libanaise en
direction de l'Afrique de l'Ouest et sur le vécu de l'expérience migratoire.
SAFA Élie, Essai sur l'émigration libanaise, Thèse de doctorat de droit soutenue à
l'Université Saint-Joseph de Beyrouth en 1959.
39
1. Archives
1.1. Archives du Ministère des Affaires Étrangères, site de Nantes
Les cotes indiquées correspondent à la classification Mnésys utilisée dans les deux sites des
archives du Ministère des Affaires Étrangères à Nantes et à La Courneuve.
Le site des archives du Ministère des Affaires Étrangères de Nantes s'avère être le plus
fourni concernant la région de départ des flux migratoires que nous étudions.
92/PO/A/340 : dossier Beyrouth consulat. Série A. Embarquement d'émigrants ou
déserteurs
Cet ensemble de notes consulaires émises par le consulat de France à Beyrouth pour les
années 1890/1900 fait état de plusieurs plaintes émises par les autorités ottomanes à l'encontre des
compagnies de navigation française et notamment les Messageries Maritimes et la Compagnie de
navigation à vapeur Cyprien Fabre (citées explicitement) quant à l'embarquement d'immigrés
clandestins et de sujets de l'Empire qui ne se sont pas soumis à leurs obligations militaires (contexte
de réforme de la conscription dans le cadre des Tanzimat).
92PO/A/344 : dossier Beyrouth consulat. Série A. Dossier Messageries Maritimes. Procès
contre l'irrégularité du service. Quelques procès. Itinéraires et horaires des services.
Les documents les plus intéressants sont sans conteste les itinéraires et les plans de lignes
dont les escales sont choisies dans le cadre des concessions signées avec l'État. Nous constatons
qu'avec l'essor de de son port modernisé à partir des années 1890 pour accueillir la marine à vapeur,
Beyrouth devient un point névralgique des lignes desservant la Méditerranée orientale. Ces notes
font également état d'un conflit entre l'État et les Messageries concernant l'accession du port de
Tripoli de Syrie au statut d'escale obligatoire sur la ligne de Constantinople à Alexandrie en 1910, la
compagnie estimant que l'accroissement du trafic passager dans ce port ne justifie pas ce nouveau
statut.
41
92PO/A/161 : dossier Beyrouth consulat. Série A. Registre pour l'enregistrement des visas et
passeports. 1894.
Nous utiliserons ici un feuillet de 24 pages citant l'ensemble des individus ayant fait une
demande de visa ou de passeport pour se rendre au Mont-Liban. 5 individus originaires de la région
bénéficient du statut de protégé français dont 2 religieux maronites, signe de la tradition paternaliste
de la France envers les Chrétiens d'Orient.
92PO/A/240 : dossier Beyrouth consulat. Série A. Affaires consulaires. Émigration, 1891-
1914.
Ce dossier fourni est de loin celui qui nous intéressera le plus car cernant au plus près notre
objet d'étude. Nous retrouverons ici un nombre conséquent de notes diplomatiques relatives aux
flux migratoires au départ de la Montagne libanaise ainsi que plusieurs rapports rédigés par le
personnel diplomatique français concernant l'insertion des migrants dans leur pays de destination.
Nous pouvons citer ici Haïti, les États-Unis, le Brésil ainsi que la Guinée. Ce dernier rapport, rédigé
par le gouverneur de Guinée, Poulet, le 17 juillet 1912, s'avère d'autant plus précieux que son auteur
signale les difficultés liées à l'installation de la communauté libanaise dans cette colonie de l' A.O.F
et plus précisément la concurrence commerciale qu'elle mène contre les petits commerçants
métropolitains. Nous y retrouvons également un discours teinté d'idéologie coloniale et paternaliste.
Signalons que le rapport du gouverneur de Guinée, Poulet, daté de 1912, relate sa mission à
Beit Chabab. Nous pouvons ajouter que 'auteur s'est livré à une véritable enquête concernant le
parcours en Guinée d'émigrants issus de ce village de quelques milliers d'habitants de la Montagne
libanaise. L'auteur souligne l'importance des revenus tirés de l'émigration et qui se traduisent par
des investissement fonciers et immobiliers dans le village de la part des émigrants ayant rencontré
la fortune. Ces revenus importants rendent d'après l'auteur, toute tentative visant à freiner les départs
vain tant l'attrait exercé par l'Afrique de l'Ouest apparaissent importants. Cette précieuse description
nous permettra de cerner les mécanismes informels qui permettent à l'émigration de « s'auto-
entretenir » au sein d'une même communauté villageoise. Dans ce dossier, il est également
intéressant de nous penche sur des notes consulaires émises par des consuls en poste dans des pays
de prédilection de l'émigration syro-libanaise (Haïti, Amérique latine) qui soulignent le poids de la
protection morale que revendique officieusement la France vis-à-vis de ces populations. Ce statut
moral accordé aux ressortissants de la province sentimentale de la France semble expliquer les
hésitations des autorités coloniales françaises en A.O.F à mettre en place des mesures d'exception à
l'encontre des immigrés syro-libanais comme le réclament les commerçants métropolitains. Ces
raisons officieuses agissent de concert avec des raisons officiels puisqu'en raison d'accords conclus
42
avec l'Empire ottoman, les ressortissants ottomans bénéficient sur les territoires administrés par la
France de la clause de la nation la plus favorisée.
-sur les embarquements clandestins :
lettre du Consulat de France à Beyrouth du 7 juillet 1891. Embarquement clandestin sur le
Lutetia (Cyprien Fabre).
lettre de la compagnie Cyprien Fabre du 10 août 1891. Réponse de la compagnie à l'accusation
d'un embarquement clandestin sur le Lutetia.
lettre du Ministère des Affaires Étrangères du 15 septembre 1891. Embarquement clandestin sur
le Lutetia (Cyprien Fabre).
lettre du Vice-Consulat de France à Tripoli du 12 octobre 1891. Embarquement clandestin sur le
Lutetia.
lettre des Messageries Maritimes du 19 octobre 1891. Réponse aux accusation d'un
embarquement clandestin sur le Judith.
lettre de l'Ambassade de France près la Porte ottomane du 8 janvier 1892. Embarquements
clandestins à Tripoli.
lettre du Ministère des Affaires Étrangères du 21 janvier 1892. Embarquement clandestin sur le
Judith.
idem 1er février 1892. Embarquements clandestins mettant en cause la compagnie Cyprien
Fabre.
lettre de la Compagnie Cyprien Fabre du 23 février 1892. Réponse aux accusations ottomanes
concernant un embarquement clandestin sur le navire Foria.
lettre du 6 avril 1892 du Ministère des Affaires Étrangères. Embarquements clandestins sur deux
navires de la compagnie Cyprien Fabre.
lettre du 30 avril 1893 du Consulat de France à Beyrouth. Plainte ottomane contre les
Messageries Maritimes.
lettre de l'Ambassadeur de France près la Porte Ottomane du 3 mai 1893. Embarquements
clandestins à Jounieh mettant en cause les Messageries Maritimes. L'auteur insiste sur les vexations dont sont
victimes les migrants de la part des autorité du Vilayet de Beyrouth et qui encouragent selon l'auteur à la non
réalisation des démarches demandées.
lettre de l'Ambassade de France près la Porte Ottomane du 12 octobre 1893. Embarquements
clandestins sur la côte syrienne.
lettre du Chargé d'Affaires des France à Constantinople du 25 novembre 1893. Embarquements
clandestins mettant en cause les Messageries Maritimes et la compagnie Cyprien Fabre.
lettre du Consulat de France à Beyrouth du 7 janvier 1894. Embarquement clandestin
« chemise » 1905. Émigration libanaise à Tripoli. Ensemble de lettres émanant du Vice-Consulat
de France à Tripoli et du Mutassarif de Tripoli concernant des embarquements clandestins, le système de
délivrance de passeports par les autorités du Mont-Liban (dont Tripoli est limitrophe) et les mesures ottomanes sur
les départs.
43
lettre du Consulat de France du 23 mai 1911. Embarquement clandestin.
idem 27 mai 1911. Idem
lettre du Vilayet de Beyrouth du 31 mai 1911.
idem 23 septembre 1912.
lettre de l'Ambassade de France près la Porte Ottomane du 12 octobre 1912.
-sur les mesures d'encadrement de l'émigration syro-libanaise par le pouvoir ottoman et les
autorités de la province du Mont-Liban :
lettre de l'Ambassade de France près la Porte Ottomane du 28 avril 1886.
idem 12 juillet 1888
lettre du Ministère Impérial des Affaires Étrangères du 7 avril 1898. Réclamations au sujet du
rapatriement de 45 Libanais.
lettre des Messageries Maritimes du 20 octobre 1899. Sur les mesures par le Vali de Beyrouth sur
les embarquements des émigrants.
lettre du Gouvernement général du Mont-Liban du 21 octobre 1899. Réglementation des autorités
du Mont-Liban concernant le départ des migrants.
lettre du Gouvernement général du Mont-Liban du 28 mars 1903. Règlement pris par le Vilayet
de Beyrouth pour les migrants s'embarquant sur des navires battant pavillon étranger.
lettre de l'Ambassade de France près la Porte Ottomane du 16 juillet 1908
lettre du Vice-Consulat de France à Tripoli du 28 août 1904.
-sur le contrôle de l'activité des compagnies maritimes par les services consulaires français :
lettre de l'Ambassade de France près la Porte Ottomane du 18 avril 1889. Défense des
compagnies maritimes. Les capitaines des navires n'ont pas à se substituer à la police ottomane pour savoir si les
passagers ont bien respecter les formalités de départ (tezkéré ou passeport en règle).
circulaire confidentielle de l'Ambassade de France près la Porte Ottomane du 15 juin 1894.
Sanctions à prendre contre les compagnies maritimes se livrant à des embarquements clandestins.
lettre de l'Ambassadeur de France près la Porte Ottomane du 12 juillet 1894. :Règles à respecter
pour les compagnies maritimes françaises concernant l'embarquement de migrants.
note verbale de l'Ambassade de France près la Porte Ottomane du 18 février 1895. Demande de
dédommagement de la compagnie de navigation Paquet pour une perquisition jugée arbitraire par la police
ottomane.
lettre du Ministère des Affaires Étrangères du 29 août 1896. Débarquement de migrants syriens à
Marseille.
lettre du Ministère des Affaires Étrangères du 22 novembre 1902. Sur la limitation à 250 du
nombre de passagers imposée aux Messageries Maritimes.
lettre du Consulat de France à Beyrouth du 25 mai 1911.
idem 31 mai 1911.
44
lettre du Sous-Secrétaire d'État de la Marine du 27 janvier 1914. Concurrence de la compagnie
allemande Hamburg Amerika Linie sur le trafic méditerranéen.
circulaire de l'Ambassade de France près la Porte Ottomane. (itinéraires des lignes des
Messageries Maritimes).
lettre de l'Ambassade de France près la Porte Ottomane du 14 octobre 1912.
lettre du Ministère des Affaires Étrangères du 24 mars 1894 (projet de réorganisation des lignes
des Messageries Maritimes. Mise en place d'un service hebdomadaire déservant Beyrouth).
idem 29 décembre 1905 (itinéraires des lignes)
idem 27 décembre 1894 (projet d'ouverture d'une ligne Venise-Beyrouth par le Llyod autrichien).
idem 2 mai 1910
-sur l'attitude des compagnies maritimes :
lettre du Gouvernement général du Mont-Liban du 26 octobre 1899. Refus de la requête des
Messageries Maritimes pour l'ouverture d'un bureau de délivrance des passeports du Mont-Liban à Beyrouth.
note des Messageries Maritimes du 14 février 1910 : examen médical du passager du Niger
Habib Hunbaïchi par Paul Chambe.
lettre des Messageries Maritimes du 31 octobre 1912.
-sur l'attitude des services consulaires français envers les immigrants :
lettre du Ministère des Affaires Étrangères du 29 janvier 1891. Émigrants syriens en Haïti.
Rappeler aux Maronites la situation misérable qui peut les attendre en Amérique.
lettre du Vice-Consulat de France à Tripoli du 7 novembre 1891. Copie d'une lettre du médecin
sanitaire du Lutetia. Les embarquements clandestins ont des conséquences sanitaires fâcheuses pour l'épidémie
cholérique.
lettre de l'Ambassade de France près la Porte ottomane du 23 mars 1898. Réclamations de la
Porte sur le rapatriement de 45 Libanais.
lettre de reçu des Messageries Maritimes du 15 mars 1898. Accusé de réception de 925 francs de
la part du Consul de France à Beyrouth pour le rapatriement de 45 Libanais.
note de L. Renault du 9 mai 1898. Situation des sujets ottomans en Amérique du Sud.
lettre du Chargé d'Affaires de France à Pétropolis du 28 janvier 1902. Protection des Maronites
au Brésil.
rapport du Ministre de France en Haïti du 7 mars 1902. Problèmes pratiques et juridiques liés à la
protection des ressortissants ottomans originaires de Syrie et du Liban.
lettre du Ministre de France en Colombie du 25 mars 1902. Intérêts moraux et symboliques à la
protections des migrants syro-libanais.
lettre du Ministère des Affaires Étrangères du 2 août 1902. Protection des migrants syriens an
Amérique.
lettre du Gouvernement général du Mont-Liban du 28 mars 1903. Demande des autorités du
45
Mont-Liban au Consulat de France à Beyrouth de prendre des mesures contre les courtiers soumettant les
émigrants de retour à des vexations.
article intitulé L'émigration et la santé publique paru dans le journal Le Temps du 20 juillet 1906.
lettre du Chargé d'affaires de France à Constantinople du 21 juin 1907. Au sujet des émigrés
musulmans.
lettre du Consul général de France au Caire du 8 novembre 1910. Au sujet de l'article du
publiciste Refik bey el Azm paru dans le quotidien Garidah le 6 novembre 1910 dénonçant la désertion des
habitants de la Montagne libanaise qui abandonne la région et l'exploitation des terres cultivables pour migrer.
lettre du chargé d'affaires de France à Constantinople du 26 février 1912. Réclamations syriennes
en Haïti.
rapport du Consulat de France à Sao Paulo du 10 mars 1913.
lettre du Ministère des Affaires Étrangères du 16 mai 1913. Au sujet des colonies syriennes au
Brésil.
idem 10 juillet 1913. Situation des Syriens au Brésil.
lettre de l'Ambassade de France près la Porte Ottomane du 30 octobre 1913. Réclamations
syriennes en Haïti.
lettre de Khalil Saikali du 20 novembre 1913. Réclamations contre le gouvernement haïtien.
lettre du Président du Conseil du 16 avril 1914. Réclamations syriennes en Haïti.
lettre de G. Doumergues du 1er juin 1914. Au sujet d'un article de Al Ahwal traitant du sort des
Syriens dans les colonies. Article retranscrit.
rapport du Ministère des Affaires Étrangères du 21 septembre 1914. Loyalisme des colonies
syriennes en Afrique occidentale.
idem 21 octobre 1914. Au sujet des manifestations de loyalisme des groupes syriens en Afrique
occidentale.
-sur les acteurs périphériques engagés dans l'organisation de l'émigration syro-libanaise :
lettre du Consulat de France à Beyrouth du 30 octobre 1891. Embarquements clandestins. Il s'est
créé une industrie d'entrepreneurs d'émigrants dont les opérations consistent à racoler des émigrants et à les
embarquer à forfait pour un prix variant de 100 à 120 francs soit au mouillage soit si la police du port n'a pu être
gagnée, en mer à un point convenu d'avance.
article intitulé Pauvres émigrants signé par Arthur Dupin et paru dans le journal Le Journal du 18
avril 1908.
lettre du Ministère des Affaires Étrangères du 24 mai 1908. Au sujet du recrutement d'émigrants
syriens pour les Amériques.
lettre du Consul de France à Beyrouth du 24 mai 1909. Sur la création d'un hôtel réservé aux
migrants syriens en transit à Marseille.
lettre d'information confidentielle du Consulat de France à Beyrouth du 25 septembre 1910.
Enquête sur les agissements de Michel Hani, agent général d'émigration représentant à Beyrouth de l'agence
46
Lubin.
dépêche du Ministère des Affaires Étrangères du 3 décembre 1910. Sur les agissements de
Michel Hani.
rapport du Consul de France à Beyrouth du 13 avril 1911. Au sujet du voyage de M. le
Gouverneur Poulet à Beit-Chabab. Fiche de renseignements sur Michel Hani. Joint une note de la Banque
Ottomane du 29 septembre 1910.
92PO/A/350 : dossier Beyrouth consulat. Série A. Œuvres étrangères : Allemandes,
Américaines, Grecques, Russes. 1890-1914.
Il est fait mention des différentes œuvres scolaires organisées par les missions religieuses.
En lien avec la thématique de concurrence impérialiste culturelle entre les différentes puissances
occidentales dans la région. Nous serons amenés à étudier ce dossier plus tard au cours de notre
recherche.
92PO/A/240 : dossier Beyrouth consulat. Série A. Affaires consulaires. Émigration, 1891-
1914.
1.2. Archives du Ministère des Affaires Étrangères, site de La Courneuve
426QO/391 : dossier Embarquements clandestins d'émigrants libanais.
Cet ensemble de notes diplomatiques et de circulaires émises par le Consulat général de
Beyrouth et les services du M.A.E entre la 4 octobre 1884 et le 7 janvier 1894 font état de plusieurs
cas de navires appartenant aux compagnies des Messageries Maritimes (le Niger) et la compagnie
Duchon Doris (Hélène) ayant embarqué des émigrants syro-libanais qui n'ont pas répondu aux
conditions imposées par l'administration ottomane et celle de la province de la Montagne. Les
consuls réaffirment le cadres des capitulations qui interdisent formellement l'ingérence ottomane vis
à vis de ces compagnies françaises et précisent l'attitude à suivre pour les capitaines français qui
n'ont pas à se substituer aux autorités ottomanes dans ces fonctions de contrôle.
426QO/340 : dossier Affaires consulaires 1781-1908, volume Émigration libanaise et
syrienne.
Signalons ici un rapport rédigé par le consul général de Beyrouth, René de Sercey, et adressé
aux services du Ministre des affaires étrangères Théophile Delcassé (en date du 19 août 1903),
d'une vingtaine de pages portant sur l'émigration syrienne et libanaise. Outre le regard porté sur le
47
phénomène teinté d'idéologie coloniale et paternaliste, le consul tente de décrire en des termes
quantitatifs (estimation des effectifs atteignant les 80 000 départs entre 1888 et 1903 soit un
cinquième de la population du Mont Liban, répartition selon les différentes destinations etc) et
qualitatifs (composition ethnique et confessionnelle notamment).
426QO/285 : dossier Passeport/Permis de séjour, volume Règlement turc sur les passeports
(1895).
162PAAP/1 et 162PAAP/2 : Papiers René de Sercey.
Regroupement de la correspondance de ce consul pendant ses fonctions à Beyrouth entre
1898 et 1904.
51PAAP : Papiers Robert Coulondre.
Regroupement de la correspondance de ce suppléant au consulat général de France en Syrie
à Beyrouth entre 1912 et 1913
27CPCOM/146 : dossier Série C. Administrative, 1890-1940. Secours religieux. Allocations
aux établissements religieux. Beyrouth 1894-1904.
Ensemble de correspondance entre les responsable d'un établissement grec catholique et les
services du consulat français à Beyrouth. Sont évoqués les système de bourses allouées par la
France à l'établissement et en filigrane, le système de diplomatie culturelle français.
426QO/340 : dossier Affaires consulaires 1781-1908, volume Émigration libanaise et
syrienne.
Dans cet ensemble de correspondances déjà cité, il est mention de la concurrence exercée
par les compagnies étrangères pour le transport des émigrants (notamment la compagnie anglaise
Prince Line).
27CPCOM/143 : Alep (1894-1904)
Secours aux établissements religieux de la région d' Alep.
27CPCOM/153 : Damas (1894-1904)
Secours aux établissements de la région de Damas.
48
1.3. Archives libanaises
Nous avions prévu dans un premier temps de consulter les archives locales selon un
inventaire établi par Dominique Chevallier dans son ouvrage cité en bibliographie mais des
difficultés techniques nous ont empêchés de suivre ce programme. Signalons tout de même les
différents sites d'archives que nous pourrons consulter à plus ou moins courte échéance :
-les archives de la direction générale des antiquités du Liban : ces archives peuvent nous
renseigner sur la vie quotidienne villageoise au XIXè siècle tandis que les papiers des Khâzen et
des Bayhum, quoique rédigés en arabe, peuvent nous renseigner sur le système cadastral et fiscal de
la Montagne et sur le niveau de vie paysan (contrats de métaierie et de fermage).
-les archives de la Bibliothèque Orientale de l' Université Saint-Joseph.
-les archives de la Bibliothèque Nationale du Liban.
-les Archives Nationales du Liban, immeuble Picadilly, Hamra, Beyrouth.
-les archives communautaires orthodoxes et maronites
-la presse locale (Jafet Library et Bibliothèque orientale de l'Université Saint-Joseph de
Beyrouth).
Les documents consultables ici sont exclusivement en langue arabe (hormis celles de la
Bibliothèque orientale de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth). De plus, les Archives Nationales
libanaises ne sont pas entièrement classées et inventoriées, ce qui alourdit considérablement le
travail de recherche. Enfin, nous avons pu constater sur place que la Bibliothèque Nationale du
Liban est actuellement en pleine restructuration, les documents et ouvrages étant entreposés
provisoirement dans des hangars du port de Beyrouth.
1.4. Archives des Messageries Maritimes :
Sur les indications de Marie-Françoise Berneron Couvenhes, il est intéressant de consulter
les archives de la compagnie des Messageries Maritimes qui sont conservées par l'association
French Lines au Havre (liste de passagers, destinations etc.).
49
1.5. Archives Nationales, site de Paris.
Séries 200 MI 1100-3509 :Microfilms
Statistiques démographiques (population, répartition en fonction des entités administratives,
mortalité, naissances etc). D'après les indications de Boutros Labaki dans l'article que nous avons
cité.
2. Sources imprimées
2.1. Presse
L'A.O.F, écho de la Côte Occidentale d'Afrique, journal édité à Conakry, n°183, 10 février
1912.
Pétition des commerçants du Sine-Saloum au Lieutenant-Gouverneur du Sénégal réclamant
une législation contraignante contre les commerçants libano-syriens et dénonçant la coopération
entre certaines maisons de commerce française et ces commerçants levantins : les Syriens n'existent
que par les facilités que leur donnent les négociants et les commerçants français.
L'A.O.F, écho de la Côte Occidentale d'Afrique, Conakry, n°184, 17 février 1912
Article relatif à la démission de 4 commerçants français à la suite de la réélection en 1912,
d'un commerçant libanais à la Chambre de Commerce de Conakry.
2.2. Sources administratives
Bulletin administratif des actes du gouvernement du Sénégal, 1903, page 368.
Nous nous pencherons particulièrement sur l'arrêté municipal de Rufisque du 12 juin 1903
et l'arrêté municipal de Dakar du 24 juin 1903 instituant dans ces communes des droits spéciaux de
stationnement visant les colporteurs libano-syriens. Ceux-ci les encouragent à s'installer dans des
échoppes en bois dans les quartiers indigènes ou à l'intérieur des terres.
50
Bulletin administratif du Sénégal, 1900, page 352 : A.G.G du 16 juillet 1900 instituant une
patente pour les marchands syriens dans le Haut-Sénégal.
Bulletin administratif du Sénégal, 1906, p. 965 : Arrêté du Lieutenant-Gouverneur du
Sénégal du 29 septembre 1906. Voir articles 1,2 et 3.
Cet arrêté impose aux émigrants libano-syriens de fournir un état civil complet. Cette
mesure vise à freiner l'émigration et à calmer l'excitation des commerçants métropolitains.
Bulletin du comité de l'Afrique française, n°6, juin 1911, page 202 : règlement pour les
émigrants asiatiques.
Cette appellation désigne en réalité les Levantins. Les émigrants doivent fournir aux
autorités coloniales des justificatifs d'identité, des extraits de casier judiciaire vierge, de ressources
de revenus.
Bulletin officiel administratif de la Guinée française, 1897, p. 71 : arrêté local du 10 juillet
1897.
Porte obligation pour les étrangers d'une déclaration de séjour dans la colonie (attestation de
résidence, de sources de revenu, de moralité ie casier judiciaire vierge et droit d'immatriculation).
Journal Officiel de l' A.O.F, p. 201 : décision du 22 mai 1900 sur la délivrance de cartes
d'identité aux colporteurs syriens.
Journal Officiel de l' A.O.F du 13 mai 1911.
Règlement concernant le séjour des émigrants syro-libanais : attestation de résidence, de
sources de revenu, de moralité ie casier judiciaire vierge et droit d'immatriculation. Régime
appliqué à la Guinée française par l'arrêté local du 7 décembre 1910.
Journal officiel de l' A.O.F, 1910-1936.
Fait état des expulsion d'émigrants syro-libanais pour manquement aux règlements
concernant les conditions de séjour. 130 expulsions sur cette période.
Journal Officiel de Guinée 1910.
Liste des commerçants électeurs des membres de la chambre de commerce de Guinée.
51
Quinzaine coloniale, n°177 du 10 mai 1904.
Relatif à l'entente mise en place par les commerçants métropolitains, européens et guinéens
pour écarter les commerçants libano-syriens du marché en février et mars 1904 à Conakry et les
principales localités de Guinée (Boké, Dubreka et Coyah). Les signataires s'engagent à ne pas traiter
avec eux et ne pas leur louer de bâtiments. Ceux ci versent également un cautionnement variant
entre 100 et 10000 Francs pour garantir leur engagement.
Quinzaine coloniale, n°7 du 10 avril 1908 pp. 288.
Projet de taxation spéciale à l'encontre des commerçants levantins portée par les
commerçants métropolitains.
2.3. Rapports d' études
DESBORDES Jean-Gabriel, L'émigration libano-syrienne en A.O.F., Poitiers, Imprimerie
Moderne, Renault et Cie, 1938.
Flux migratoires de 1889 à 1913. Ce rapport est le mémoire d'étude de droit réalisé
vraisemblablement par un étudiant de l'École d'administration coloniale (cette information est
encore à confirmer) publié en 1938 à l'heure où l'indépendance des mandats syriens et libanais
tardent à être concrétisée malgré les accords de 1936. Dans son avant propos, l'auteur souhaite
œuvrer à la découverte de solutions pour réconcilier les frères ennemis que sont devenus les
commerçants européens et syro-libanais. Cette étude sonne comme un plaidoyer pour la liberté de
commerce et la libre concurrence et qualifie en des termes laudatifs la structuration et les
performances du commerce libano-syrien en A.O.F, ce qui tranche avec d'autres sources que nous
avons pu croiser et notamment le rapport du gouverneur de Guinée, Poulet. L'émigration libano-
syrienne est ainsi présentée comme un facteur de prospérité commerciale et économique pour la
colonie. Signalons enfin le discours au ton paternaliste pour désigner les populations syro-
libanaises.
HARFOUCHE Nabil, « La diaspora libanaise dans le monde », Jounieh, 1974 (en arabe), p.
51.
Repris par LABAKI Boutros, article cité.
52
3. Source orale
Entretien réalisé avec Mme Bitar, habitante de Beit-Chebab, Mont-Liban, réalisé à son
domicile le 9 avril 2013. Retranscription et analyse présentées en annexe.
53
1. Le réseau d'acteurs : entre migration spontanée et migration organisée, la manifestation
d'un impérialisme français ?
L' exploitation des premières sources et notamment la correspondance consulaire
consultable aux archives du Ministère des Affaires Étrangères nous a amenés à reconsidérer le poids
d'un réseau d'acteurs publics et privés ainsi que l'imbrication de leurs intérêts à favoriser ces
courants migratoires.
1.1. L'impérialisme culturel. Se constituer une clientèle
Un premier aspect de ce réseau relève de la diplomatie culturelle mise en œuvre par la
France en Syrie et au Liban. L'intervention française dans cette région est justifiée par la prétention
d'assumer un rôle de puissance protectrice des minorités chrétiennes de la région et notamment
celles qui se sont rapprochées d'un point de vue dogmatique et institutionnel de l'Église catholique
romaine (songeons au cas topique de la communauté maronite). La bibliographie relative à cet
impérialisme culturel insiste sur le caractère ancien de ces prétentions qui s'affirment dès le XVIIe
siècle ainsi que sur le rôle de l'enseignement congréganiste, qui est ainsi le principal vecteur
d'influence française dans la région. Malgré ses prétentions anti-cléricales, la IIIe République
colonialiste et expansionniste, s'inscrit pleinement dans cette continuité. Les Lazaristes et les
Jésuites jouent ainsi un rôle pionnier dès la fin du XVIIe siècle et les premiers bénéficient de la
confiance des autorités consulaires françaises car jugées plus à même de servir les intérêts français
(contrairement aux seconds qui dépendent directement de Rome). Citons à ce propos, la présence à
La Courneuve d'un fonds spécifique regroupant l'ensemble des correspondances diplomatiques
entre le Levant et le Ministère des Affaires Étrangères concernant les subventions à allouer aux
écoles congréganistes de la région. L'enseignement prodigué dans les institutions scolaires ouvertes
par les congrégations permettent de rendre l'horizon du départ envisageable. Il en va de même pour
les missions protestantes anglo-saxonnes implantées dans la région dès les années 1820 (création de
l'Université américaine de Beyrouth en 1866)107. Nous citerons ici l'étude de cas menée par Jérôme
Bocquet sur le le collège lazariste de Damas entre 1860 et 1914108.Le Liban, province sentimentale
107 Pour une étude des missions protestantes américaines dans cette région, voir MAKDISI Ussama, Artillery of Heaven. American missionaries and the failed conversion of the Middle East, Cornell University Press, Londres, 2008, 262 p.
108 BOCQUET Jérôme, Missionnaires français en terre d'islam. Damas, 1860-1914, Les Indes savantes, Paris, 2005, 352 p.
55
de la France 109 apparaît donc comme un terrain privilégié de la diplomatie culturelle française. À la
lumière des sources que nous mobiliserons, nous pouvons considérer cette diplomatie culturelle
française à l’œuvre dans le Levant comme l'un des instruments d'une politique clientéliste et
paternaliste visant à faire des émigrants libano-syriens des agents de l'influence française. L'article
d' Éliane Fersan110 montre à ce propos comment les autorités consulaires françaises au Brésil
perçoivent les immigrants implantés dans cette région : la protection informelle que le Consulat
accorde à ces immigrés doit explicitement en faire des agents promouvant le régime mandataire
auprès des populations syriennes et libanaises restées au pays. Ce type de considérations sont
également présentes parmi le personnel diplomatique français pendant la période qui nous concerne.
En effet, les archives nantaises du Ministère des Affaires Étrangères font état de l'opinion des
consuls d'Amérique du Sud à la suite d'une demande du Ministre des Affaires Étrangères, Théophile
Delcassé, en 1902. Ces notes diplomatiques permettent de préciser la nature de la protection que la
France cherche à assurer auprès des migrants syro-libanais. Le protectorat est en effet religieux et
s'adresse de façon privilégiée à la communauté maronite dans l'Empire ottoman. Pour Théophile
Delcassé, les Maronites immigrants doivent être considérés comme des sujets ottomans comme les
autres. Ces considérations semblent interdire une protection officielle qui passerait par exemple par
des dépôts de plaintes officiels des consulats français lorsque les intérêts des immigrants sont
menacés ou par la prise en charge de frais de rapatriement à titre d'exemples. Cependant, le Ministre
des Affaires Étrangères reconnaît le bien fondé et les intérêts que la France pourrait trouver en
protégeant officieusement les immigrants syro-libanais : ces traditions sont trop précieuses, d'autant
plus que l'Empire ottoman ne dispose pas de représentations diplomatiques dans les territoires de
l'immigration syro-libanaise. Même si la protection officieuse que la France a décidé d'assurer
auprès de ces populations est source de difficultés pour la légation [de Pétropolis, Brésil], difficultés
dont se plaignent certains consuls dans leur réponse au Ministre, celle-ci ne procure pas moins à la
France des avantages symboliques soulignés par ces mêmes consuls. Le consul de Caracas, M.
Boulard-Pouqueville, souligne dans sa réponse que cette protection est d'autant plus importante que
les Syro-Libanais constituent les seuls clients de la France. Dans le cas de l'Afrique occidentale
française, ce statut de protégés officieux de la France explique pourquoi l'administration coloniale
ne peut pas répondre complètement aux demandes des petits commerçants français pour des
mesures de contrôle de l'immigration syro-libanaise, immigration qui est source d'une concurrence
commerciale contre laquelle ils ont du mal à lutter.
109 DESBORDES Jean-Gabriel, op. cit., p. 3.110 FERSAN Éliane, « Les immigrés syro-libanais au Brésil de 1920 à 1926 : perception du corps consulaire français », mémoire de maîtrise soutenu à l'Université Saint-Esprit de Kaslik (Liban).
56
1.2. L'impérialisme économique au travers des compagnies maritimes
Les archives nantaises et de la Courneuve permettent de cerner dans le détail l'implication
des compagnies maritimes françaises dans l'émigration syro-libanaise. Plusieurs dossiers sont en
effet consacrés à la question des embarquements clandestins à savoir l’embarquement d'immigrants
n'ayant pas accompli les formalités administratives concernant les départs (obtention de tezkérés ou
de passeports)111. En effet, les autorités consulaires de Beyrouth et vice-consulaires de Tripoli (les
sources disponibles sur cette dernière entité ne recouvrent que l'année 1905112) signalent plusieurs
cas d'embarquements clandestins opérés le plus souvent à partir de Beyrouth ou de petits villages
côtiers situés à la périphérie de Beyrouth et de Tripoli. Les services consulaires de Beyrouth vont
même jusqu'à décrire des embarquements clandestins à même la plage en direction de Chypre où la
législation ottomane concernant l'émigration n'a pas cours. L'attitude des membres du corps
diplomatique français oscille entre la défense des compagnies françaises et la dénonciation de ces
pratiques. En effet, ceux-ci rappellent à plusieurs occasions que les capitaines des navires des
compagnies françaises n'ont pas à se substituer à la police ottomane concernant le contrôle des
candidats au départ et notamment la vérification des formalités administratives imposées avant le
départ. À l'inverse, nous avons pu lire des notes émanant du vice-consulat de Tripoli accusant la
compagnie de navigation Cyprien Fabre d'avoir réalisé délibérément des embarquements
d'émigrants clandestins113. Face à ces accusations ottomanes relayées par les autorités consulaires
françaises locales, les compagnies incriminées (Cyrprien Fabre et Messageries Maritimes)
répondent en soulignant le poids de la concurrence à laquelle elles sont soumises notamment de la
part d'autres compagnies européennes114. Cet argumentaire peut être repris par quelques agents du
corps diplomatique français notamment pour les Messageries Maritimes qui rappelons-le, sont liées
par des conventions avec l'État français. Les archives de La Courneuve nous montrent que le
Ministère des Affaires Étrangères manifeste un souci particulier pour la concurrence à laquelle cette
compagnie doit faire face et des réglementations qu'elle doit respecter dans le cadre des
conventions. La question de la limitation du nombre de passagers (250) est notamment soulevée et
les dirigeants de la compagnie trouve des relais au sein du Ministère pour la relever à 400 afin de
mieux répondre à la concurrence des autres compagnies européennes115. Il est alors possible
111 Archives du Ministère des Affaires Étrangères, site de Nantes, 92PO/A/240 : dossier Beyrouth consulat. Série A. Affaires consulaires. Émigration, 1891-1914.
112 Idem.113 Idem. Lettre du Consulat de France à Beyrouth du 7 juillet 1891. Embarquement clandestin sur le Lutetia (Cyprien
Fabre).114 Archives du Ministère des Affaires Étrangères, site de La Courneuve, 426QO/391 : dossier Embarquements
clandestins d'émigrants libanais. 115 Idem. Ces revendications, principalement portées par la compagnie des Messageries Maritimes, semblent trouver
57
d'entrevoir l'imbrication des intérêts de la compagnie et du Ministère.
1.3. Les réseaux d'intérêts locaux
La question des embarquements clandestins telle qu'elle est évoquée dans les archives
diplomatiques nous permet de mettre en lumière le rôle d'autres acteurs qui cherchent à profiter des
flux migratoires : les agents de recrutement et les petits fonctionnaires de police et des autorités
portuaires. La correspondance consulaire de Beyrouth et de Tripoli atteste de la corruption des
fonctionnaires locaux de la police et du port du Beyrouth qui, contre paiement de bakchich, laissent
embarquer les immigrants116. À propos d'embarquements clandestins réalisés sur des navires de la
compagnie de navigation à vapeur Cyprien Fabre, le consul de Beyrouth peut écrire dans une lettre
du 30 octobre 1891 qu'il s'est créé une industrie d'entrepreneurs d'émigrants dont les opérations
consistent à racoler des émigrants et à les embarquer à forfait pour un prix variant de 100 à 120
francs soit au mouillage soit si la police n'a pu être gagnée, en mer à un point convenu d'avance 117.
Il devient alors possible de dessiner un réseau d'acteurs locaux intéressés financièrement par
l'organisation des départs à partir de la côte libanaise allant de l'agent recruteur au fonctionnaire de
police chargé de contrôler et de faire appliquer la législation ottomane concernant l'émigration. Les
recruteurs vendent ainsi un forfait incluant notamment le billet, le versement de pot-de-vins aux
fonctionnaires de police etc. Les services consulaires français sont amenés à mener des enquêtes sur
certains passeurs : nous avons ainsi pu consulter des fiches de renseignements sur des agents
recruteurs basant leurs activités à Beyrouth, certains usurpant le nom des Messageries Maritimes118.
Une source dont l'émetteur est inconnue (consultable dans le dossier Émigration de Nantes) évoque
même le transport clandestin des migrants à Chypre où ceux-ci peuvent s'embarquer sur les navires
à destination de Marseille sans être inquiétés donc, par les autorités ottomanes. Ce point précis nous
des relais non seulement au sein des services consulaires de Beyrouth mais aussi au sein du Quai d' Orsay, notamment auprès du Ministre.
116 Sur la corruption des fonctionnaires locaux de l'administration ottomane qui rend inopérantes les tentatives de l'administration de la Sublime Porte de contrôle des départs de migrants à partir de Beyrouth, voir AKARLI Engin, op. cit.
117 Archives du Ministère des Affaires Étrangères, site de Nantes, 92PO/A/240 : dossier Beyrouth consulat. Série A. Affaires consulaires. Émigration, 1891-1914. Lettre du Consulat de France à Beyrouth du 30 octobre 1891
118 Archives du Ministère des Affaires Étrangères, site de Nantes, 92PO/A/240 : dossier Beyrouth consulat. Série A. Affaires consulaires. Émigration, 1891-1914. Lettre d'information confidentielle du Consulat de France à Beyrouth du 25 septembre 1910. Enquête sur les agissements de Michel Hani, agent général d'émigration représentant à Beyrouth de l'agence Lubin.
58
interdit d'établir un parallèle avec un aspect très étudié de l'histoire des migrations internationales
notamment par l'historiographie anglo-saxonne sur les politiques migratoires à l'intérieur des
empires coloniaux. Certains historiens anglo-saxons ont ainsi montré que les autorités britanniques
ont, tout au long du XIXe siècle, encouragé l'émigration de colons britanniques ou non-britanniques
afin de mettre en valeur certaines colonies et consolider l'impérialisme britannique notamment dans
les dominions blancs comme la Nouvelle-Zélande ou le Canada119. Aussi, nous remarquons que ce
véritable trafic migratoire apparaît comme étant principalement alimenté par des agents officieux,
du moins non accrédités par des compagnies maritimes ou alors d'agents recruteurs des compagnies
maritimes corrompus120. Il s'agit pour ces individus, de proposer un service de passage dont le prix
comprend les billets d'embarcation sur un navire, une commission (qui sert le plus souvent à
soudoyer les autorités de police et du port de Beyrouth) et éventuellement un hébergement dans un
hôtel dans un port de correspondance comme Marseille.
Concernant l'arrivée des migrants en Afrique de l'Ouest, il nous reste encore à déterminer
l'influence des compagnies françaises qui bénéficient de concessions concernant l'exploitation de
l'Afrique Occidentale Française à l'image de la C.F.A.O.
2. L'autonomie des flux migratoires entre les régions du Levant et l'Afrique Occidentale
Française.
Comme nous l'avons établi en introduction, l'Afrique apparaît d'emblée comme un territoire
où l'implantation pérenne de colons est exclue notamment du fait de la présence d'une main d’œuvre
locale abondante, ce qui rend moins impérative la venue de colons, du climat et des épidémies
tropicales décourageant la venue de colons européens etc.121. Ce désintéressement relatif ouvre la
119 Sur la politique migratoire interne à l'Empire britannique organisée par les agences de recrutement soutenues par les Dominions « blancs » (Canada, Australie, Nouvelle-Zélande notamment) voir CONSTANTINE Stephen et HARPER Marjory, ouvrage cité, pp. 278 sqq. Sans initier complètement les flux de départ, les agences et notamment les agents locaux qui organisent des tournées dans les campagnes britanniques finissent par convaincre les aspirants au départ (récits devant des assemblées, campagnes d'affichage notamment).
120 CONSTANTINE Stephen et HARPER Marjory, ouvrage cité, p. 297.121 CONSTANTINE Stephen et HARPER Marjory, ouvrage cité, pp. 117-121. Voir également BONIN Hubert, C.F.A.O. Cent ans de compétition, Économica, Paris, 1987, pp. 115-120 : sur les difficultés de recrutement de personnel métropolitain dans cette maison de commerce.
59
voie à l'accueil de flux migratoires syro-libanais autonomes.
2.1. L'appréhension de l'espace migratoire par les migrants
Le premier point que nous mobiliserons pour souligner l'autonomie des flux migratoires
entre régions levantines et A.O.F découle directement d'un dernier écueil que nous pouvons
formuler à l'encontre des approches posées en termes de facteurs de répulsion et d'attraction. Il s'agit
ici d'aborder l'espace migratoire en tant que tel et plus précisément, sa représentation subjective
pour les migrants ainsi que son appropriation en tant que ressource. En effet, ces approchent tendent
à représenter le flux migratoire comme un flux linéaire entre un pôle de départ et un pôle d'arrivée
et ont, de ce fait, du mal à penser la multipolarité des parcours migratoires122. Cette multipolarité est
pour Laurence Fontaine, le signe d'une représentation de l'espace comme ressource, un espace que
les migrants n'hésitent pas à quitter en fonction des opportunités économiques et des conditions
politiques et administratives d'accueil qu'il offre. En effet, un migrant peut au cours de son parcours
migratoire, traverser plusieurs territoires avant de s'établir définitivement sans évoquer la question
des retours temporaires entre le village d'origine et l'espace d'arrivée de la migration. Un rapport sur
l'émigration syro-libanaise en Guinée française rédigé par le lieutenant-gouverneur de la colonie en
1911 fait état de le multipolarité de ces parcours migratoires123. L'auteur de ce rapport, le
Lieutenant-gouverneur Poulet, cite notamment le cas d'un homme de 22 ans, Bichara Joacob al-
Ghoussoubi qui quitta son village de Beit-Chabab dans la montagne du Metn, à une vingtaine de
kilomètres de Beyrouth pour Dakar. Après quelques semaines dans ce qui constitue alors le
principal point d'entrée en A.O.F., le jeune homme se rend dans la colonie britannique du Sierra
Leone où il rencontre Assad Bitar, un commerçant originaire du même village et qui avait émigré
dans un premier temps en Argentine. Les deux hommes s'associent pour pratiquer le commerce
ambulant dans cette colonie mais puisque le commerce n'allait pas à leur gré selon les mots de
l'auteur de ce rapport, les deux hommes émigrent vers la colonie de Guinée française où la
concurrence semble moins vive. Après être restés trois jours à Conakry, les deux hommes
s'établissent à Boké, sur la côte Nord de la colonie. Mais cette première fois en Guinée ne leur fut
pas favorable, les deux hommes retournent à Freetown où ils se fixent pendant trois ans. En 1899,
122 FONATINE Laurence, op. cit., pp. 32-34.123 Archives du Ministère des Affaires Étrangères, site de Nantes. Dossier Beyrouth consulat. Série A. Affaires consulaires. Émigration, 1891-1914 (Mnésys : 92PO/A/240). Rapport de mission du lieutenant-gouverneur de Guinée Poulet, 1912. Non paginé.
60
les deux hommes rentrent à Beit-Chabab, Bichara avec un pécule de 6 000 Francs et Assad avec 4
000 Francs. Un an plus tard, Assad repart en Afrique, pour la Guinée où il meurt en 1902. Bichara
part en Guinée en 1901, mais malade (vraisemblablement une maladie tropicale), celui-ci doit
rentrer à Beit-Chabab en 1902 avec un pécule moins important à savoir 1200 Francs. Il repart
cependant en 1904 pour Conakry et établit un commerce tout en coopérant avec les maisons de
commerce métropolitaines. Il y reste un an et part ensuite pour Kindia, une petite ville située à 135
kilomètres au Nord de Conakry et plus à l'intérieur des terres. Il rejoint dans cette ville un
commerce tenu par un de ses parents, Abib Fayad el-Ghoussoubi, dans lequel il travaille deux ans.
Il rentre alors à Beit-Chabab en 1908 avec un pécule de 20 000 Francs. De même, le Lieutenant-
gouverneur cite le cas d'un autre migrant dénommé Ibrahim, qui avait émigré à Buenos Aires et d'où
il était revenu sans succès. Il part ensuite en Guinée puisqu' à Beit-Chabab, on dit couramment
d'ailleurs qu'on gagne son argent trois fois plus vite en Guinée qu'en Amérique124. Il effectue un
premier voyage de deux ans en Guinée avant de rentrer quelques mois à Beit-Chabab d'où il repart
avec son frère pour la même colonie. Ils y restent deux ans et en reviennent avec un pécule de 70
000 Francs.
2.2. Le cadre juridique de l'insertion des Syro-Libanais et les relations entretenues avec les
maisons de commerce
La politique de l'administration coloniale concernant les migrants syro-libanais oscille entre
des pressions contradictoires émanant d'acteurs différents. Les réactions véhémentes exprimées par
les commerçants métropolitains telles que nous en trouvons les traces dans les sources125 entraînent
une réaction de l'administration coloniale française qui doit chercher à concilier l'intérêt de ces
commerçants et les exigences associées à la protection « morale », paternaliste, qu'elle accorde aux
Syro-Libanais. L'administration coloniale ne peut pas répondre entièrement aux pressions des
commerçants français126 en imposant par exemple des mesures discriminantes à l'encontre des
commerçants syro-libanais. D'une part, ces mesures dérogeraient aux accords passés avec l'Empire
ottoman selon lesquels ses ressortissants bénéficient de la clause de la nation la plus favorisée127
tout en heurtant les principes libéraux d'égalité de traitement et de liberté commerciale auxquels
124 Idem.125 L'A.O.F, écho de la Côte Occidentale d'Afrique, journal édité à Conakry, n°183, 10 février 1912.126 Bulletin administratif du Sénégal, 1900, p. 352 . Bulletin administratif des actes du gouvernement du Sénégal,
1903, p. 368. Bulletin administratif du Sénégal, 1906, p. 965 : Arrêté du Lieutenant-Gouverneur du Sénégal du 29 septembre 1906. Voir articles 1,2 et 3.
127 DESBORDES Jean-Gabriel, op. cit., p.54, p. 58.
61
certains membres du corps diplomatique français sont très attachés128. D' autre part, elles nuiraient à
la réputation de la France aux yeux des populations levantines129. Les autorités coloniales d'A.O.F
sont donc amenées à adopter une position de compromis en imposant des conditions de séjour
spécifiques aux émigrants syro-libanais : attestation d'identité, justificatifs prouvant l'existence de
sources de revenus suffisantes pour recouvrir les frais d'un éventuel rapatriement, extraits de casiers
judiciaires vierges qui doivent garantir la moralité des migrants notamment130. Au nom de la liberté
commerciale, l'entrée des migrants reste tout au long de notre période, libre, en dehors de ces
dispositions dont les émigrants semblent s’accommoder facilement. Les réglementations sanitaires
apparaissent également comme un instrument détourné pour justifier un contrôle exercé sur ces
populations migrantes et mobiles au sein des colonies131. Comme nous l'avons souligné, la
description misérabiliste du mode de vie des populations syro-libanaises tend à les présenter comme
des agents privilégiés de transmissions de certaines épidémies comme le choléra132. Les différentes
épidémies qui frappent l' A.O.F au cours de notre période (en 1900 au Sénégal et au Soudan avec la
fièvre jaune par exemple133) sont ainsi l'occasion de nouvelles réglementations concernant le mode
de vie et les pratiques professionnelles des commerçants syro-libanais. Remarquons également que
les efforts de « nomination » et de contrôle de l'identité des migrants apparaissent comme les enjeux
principaux des premières mesures de contrôle des flux migratoires entrants en A.O.F., politique plus
ou moins inspirée des revendications du milieu des commerçants métropolitains. La mise en place
d'un système d'état civil agit comme un rite d'initiation qui amène les migrants à l'existence sociale
dans la colonie. Comme le souligne Pierre Bourdieu, la nomination comme institution sociale134 agit
comme un processus d'unification des manifestations multiples de l'être social : à travers
l'imposition et l'enregistrement d'une identité officielle, l'État cherche à assurer, symboliquement,
l'unité de l'individu et de son évolution sociale dans le territoire qui est sous son administration. Une
fois ce constat posé sur les fonctions sociale des procédés de nomination officielle, nous
128 Archives du Ministère des Affaires Étrangères, site de Nantes, dossier Beyrouth consulat. Série A. Affaires consulaires. Émigration, 1891-1914 (Mnésys : 92PO/A/240). Lettre de G. Doumergues du 1er juin 1914. Au sujet d'un article de Al Ahwal traitant du sort des Syriens dans les colonies. Article retranscrit.129 Les inquiétudes soulevées par la publication de l'article de Al Ahwal, soulignent l'importance en terme d'images
pour les membre des services consulaires dans la région, du soin que peuvent apporter les autorités françaises dans les colonies africaines pour les migrants.
130 Bulletin du comité de l'Afrique française, n°6, juin 1911, p. 202. Journal Officiel de l'A.O.F du 13 mai 1911.131 Archives du Ministère des Affaires Étrangères, site de Nantes. 92PO/A/240 : dossier Beyrouth consulat. Série A.
Affaires consulaires. Émigration, 1891-1914.132 Archives du Ministère des Affaires Étrangères, site de Nantes. 92PO/A/240 : Dossier Beyrouth consulat. Série A. Affaires consulaires. Émigration, 1891-1914. Rapport de mission du Gouverneur de Guinée Poulet, 1912. Non paginé.133 Journal Officiel de l' A.O.F, p. 201 : décision du 22 mai 1900 sur la délivrance de cartes d'identité aux colporteurs syriens. Cité par DESBORDES Jean-Gabriel, op. cit., p. 42. Cette décision prise par le Gouverneur Général de l' A.O.F. est présentée par l'auteur, comme un moyen pour les autorités de contrôler la mobilité des colporteurs syriens et libanais au sein de la Fédération.134 Sur la nomination comme institution sociale et les fonctions sociales des procédés d'état civil, voir BOURDIEU
Pierre, Raisons pratiques. Sur la théorie de l'action, Seuil, Paris, 1994, pp. 81-89.
62
comprenons l'enjeu que constitue la maîtrise des flux migratoires par l'État. En effet, la mobilité
intrinsèque des migrants, l'inconnu de leur identité antérieure puisque relevant d'un autre appareil
administratif, constitue un défi à son pouvoir contraignant sur les individus. L'inconnu, l'altérité de
l'individu remet en question la stabilité, la constance nominative135 des individus sur laquelle repose
l'ordre social. Les politiques d'identification, d’enregistrement et de classification des migrants,
classification arbitraire et indifférente aux particularités circonstancielles des individus, sont
amenées à se complexifier à mesure que d'une part, l'immigration devient une réalité sociale
quantitativement et qualitativement plus importante et complexe, et d'autre part, que la société
d'accueil en prenne une conscience plus aiguë comme le montre l'étude de Gérard Noiriel sur
l'évolution de la politique de contrôle migratoire française des années 1900 aux années 1930136.
2.3. Les relations ambivalentes entretenues avec les maisons de commerce coloniales
La bibliographie et les sources mobilisées semblent attester des relations ambivalentes
qu'entretiennent les commerçants immigrants levantins avec les maisons de commerce
métropolitaines implantées en A.O.F137. Les maisons de commerce adoptent elles aussi des attitudes
différentes vis à vis de ces immigrants en fonction de leur stratégie commerciale138. La bibliographie
portant sur l'économie de traite insiste sur les rivalités persistantes entre maisons de commerce
bordelaises (Maurel et Prom par exemple) et marseillaise comme la Compagnie Française d'Afrique
Occidentale notamment au Sénégal autour de la traite de l'arachide139. Les premières, tournées vers
une production qualitative destinée aux industries agro-alimentaires, font pression pour l'adoption
de mesures protectionnistes : le Sénégal doit devenir une chasse gardée du commerce français. La
C.F.A.O, étudiée par Hubert Bonin, est animée par une stratégie commerciale axée sur une
production de masse et donc, privilégie la quantité. L'arachide récoltée est alors destinée aux
industries non alimentaires comme la savonnerie et les huileries. La C.F.A.O milite donc pour la
liberté commerciale et pour une politique coloniale améliorant le niveau de vie des populations
locales qui permettrait l'extension de ses débouchés et donc, de son marché potentiel140. De ces
135 BOURDIEU Pierre, op. cit., p. 86.136 NOIRIEL Gérard, État, nation et immigration, Folio Histoire, Paris, 2001, pp. 478-505.137 Au vu des sources, il semble qu'un certain schéma puisse se dessiner selon lequel les migrants syro-libanais qui
s'insèrent dans le système de traite en se procurant des biens de consommation chez les maisons de commerce coloniales afin de les revendre contre la production agricole africaine. Les commerçants syro-libanais revendent ensuite cette dernière aux maisons de commerce et cherchent, une fois des bénéfices suffisamment importants dégagés, à s'en émanciper et à lancer une activité commerciale indépendante.
138 Voir BONIN Hubert, op. cit., p. 79.139 Sur la rivalité entre maisons de commerce bordelaises et marseillaises (principalement la C.F.A.O.) voir
MARFAING Laurence, op. cit., pp. 175-222.140 BONIN Hubert, op. cit., pp. 84 sqq.
63
différentes conceptions commerciales résultent logiquement deux attitudes différentes vis à vis des
commerçants immigrants syro-libanais : les maisons de commerce bordelaises tendraient à se
joindre aux plaintes des petits commerçants métropolitains qui dénoncent leurs procédés
malhonnêtes et appellent à des mesures de contrôles141. La C.F.A.O, comme d'autres petites maisons
de commerce, au nom de son credo libre-échangiste et libéral, tendrait à considérer cette
concurrence comme normale, voire essaierait de collaborer avec ce groupe social142. Hubert Bonin
cite à ce propos le refus de la C.F.A.O de s'associer à une entente des grandes maisons de commerce
visant à ostraciser les Syro-Libanais en 1904143.
141 DESBORDES Jean Gabriel, op. cit., p. 51.142 Sur les tentatives de certaines maisons de commerce de s'attacher es services des traitants libano-syriens, voir
DESBORDES Jean-Gabriel, op. cit., pp. 131-132.143 BONIN Hubert, op. cit., p. 79.
64
Conclusion
L'étude des flux migratoires entre les régions libanaise et syrienne permet de mettre au jour
un réseau complexe où l'autonomie des acteurs se mêle aux intérêts d'acteurs extérieurs. En effet, la
critique des approches traditionnelles des études migratoires en termes de facteurs de répulsion et
d'attraction doit nous appeler à décentrer notre regard sur la structuration interne des communautés
migrantes villageoises. Ce regard centré sur l'autonomie des acteurs, des immigrants, nous a ainsi
amenés à reconsidérer des visions atypiques de l'espace migratoire voire de l'immigration en tant
que telle. La migration peut ainsi être perçue comme une véritable stratégie pensée et organisée à
l'échelle interne. Comme le montre la mémoire de l'immigration, encore vivace dans les
communautés villageoises concernées, le départ et l'installation à l'étranger, est un acte réfléchi,
préparé et organisé par des acteurs de la communauté. Dans la poursuite de notre étude, il nous
faudra donc mobiliser des outils méthodologiques à mêmes de rendre compte de cette structuration
complexe. L'analyse en termes de réseau semble pouvoir fournir un cadre heuristique des plus
pertinents. Comme le fait noter Claire Lemercier, l'analyse de réseaux est particulièrement adaptée
aux raisonnements portant sur des flux : elle permet de mettre en évidence des goulots
d'étranglement, des intermédiaires privilégiés, des périphéries délaissées ou des centres
secondaires autonomes144. Quant à l'espace des migrations, il faut souligner un vision subjective du
territoire comme ressource ; le parcours migratoire ne saurait alors être linéaire mais fluctuant en
fonction des opportunités socio-économiques que le territoire en question présente. L' Afrique
Occidentale Française bénéficie d'une attractivité en tant que telle pour certaines communautés
villageoises entre les années 1890 et 1914. Disséquer la structuration interne des réseaux
migratoires en provenance des régions syro-libanaises implique de surmonter une difficulté d'ordre
archivistique que nous pensons pouvoir surmonter en consultant les archives coloniales d'Aix-en-
Provence. Il s'agira de s'intéresser aux certificats d'entrée, des fiches de renseignements qui furent
de plus en plus demander par les autorités coloniales françaises comme nous avons pu le constater.
La piste privilégiée de l'autonomie des réseaux migratoires ne doit cependant pas nous faire
perdre de vue le poids d'acteurs extérieurs, aussi bien privés que gouvernementaux, dans
l'organisation de ces flux, poids que nous ne pouvons pas négliger entre les années 1890 et 1914. En
effet, autour du transport des migrants et des activités commerciales des migrants syro-libanais dans
144 LEMERCIER Claire, « Analyse des réseaux et histoire », in Revue d'histoire moderne et contemporaine, 2005/2, n°52-2, pp. 88-112.
65
l'économie de traite de l'Afrique Occidentale Française, se dessine non seulement un véritable
commerce migratoire engageant des compagnies maritimes et des agents de recrutement
indépendants aux méthodes plus ou moins « officielles », mais aussi une véritable politique
commerciale dans les colonies. La diplomatie et le pouvoir colonial français ne se montrent pas
indifférents à la défense et à la régulation de ces intérêts économiques. En A.O.F., certaines maisons
de commerce et des administrateurs coloniaux prennent déjà conscience, entre 1890 et 1914, de
l'intérêt des pratiques commerciales des migrants syro-libanais. L'organisation des flux migratoires
et le traitement des migrants dans ses colonies d'Afrique de l'Ouest, intéressent également la France
et sa diplomatie. Là où le critère de la francophonie s'avère être peu déterminant dans le choix de
destination des migrants, il semble qu'un ensemble de facilités consulaires (protection officieuse des
migrants syro-libanais, ressortissants ottomans dans des zones où la diplomatie ottomane est
absente), l'image ancienne de protectrice des Chrétiens d'Orient ainsi que l'intérêt impérialiste
français dans la région de « Syrie », permettent d'esquisser un transnationnalisme sous drapeau
tricolore. L'accueil et la protection des migrants devient un moyen d'entretenir une image favorable
de la France auprès des Syro-Libanais. Ce dernier point revêt une importance de plus en plus
importante à mesure que les puissances européennes envisagent le dépeçage de l'Empire Ottoman et
que la France envisagera de concrétiser ses vues sur la « Syrie ».
Le cas de l'immigration syro-libanaise entre 1890 et 1914 illustre donc l'existence de réseaux
migratoires anciens et complexes où se mêlent intérêts extérieurs et autonomie des individus et
communautés migrantes.
66
Retranscription de l'entretien avec Mme Bitar, Beit-Chabab le 9 avril 2013.
Durée de l'entretien : environ 1h30.
Beit Chabab et l'émigration
Interviewée : Vous voulez qu'on commence par quoi ? Par Beit-Chabab ?
Enquêteur : … par l'histoire de Beit-Chabab.
I : Beit-Chabab est un village de la région du Metn, du Nord. C'est un très beau village qui était
depuis toujours le point de mire de toute la contrée. Il s'est distingué par beaucoup de choses :
d'abord par les bâtisses, le genre de bâtiments, des maisons couvertes de toits rouges. C'était ça le
point le plus important. Et puis Lamartine lui-même, quand il est venu au Liban, il s'était arrêté à
Sneit, c'est là où vous êtes descendu de Bikfaya, là, le point le plus haut de Beit-Chabab, il a regardé
et a dit : « Beit Chabab est comme une grenade ouverte ». Quand il a vu les belles maisons,
recouvertes de rouge etc., donc il a dit c'est comme une grenade ouverte. Il s'est tellement plu ici, et
puis Beit-Chabab, c'est pas parce que c'est notre village mais par rapport à d'autres villages, par
rapport à tous ceux qui étaient dans l'entourage, Beit-Chabab avait dépassé de beaucoup tout ce qui
était autour de lui.
E : En termes d'activités...?
I : ...Activités, culture, éducation, métiers, professions, travail, apprentissage, artisanat... tout, tout,
tout ! À tous les points de vues, Beit-Chabab était reconnu pour ça. Pendant que tous les villages
voisins crevaient... peut-être pas dans l'analphabétisme mais dans l'ignorance...
E : Oui, il y avait beaucoup d'écoles à Beit-Chabab ?
I : Oui Beit-Chabab était déjà célèbre pour tout ce qui est enseignement, éducation, apprentissage, et
tous les gens venaient à Beit-Chabab pour soit acheter, soit vendre leurs affaires, ce qu'ils ont à
vendre. Donc c'était un endroit vraiment très intéressant. C'était un point, pas touristique, un point
commercial. Un point d'éducation c'est-à-dire, tous les villages d'à côté envoyaient leurs enfants
apprendre à Beit-Chabab. Tous les villages d' à côté, tous les villages voisins, venaient acheter la
poterie, la soie, le tissu dima, Beit-Chabab est reconnu pour ça. Et ils venaient acheter les cloches.
Toutes les églises presque, pour ne pas dire 100 %, 90 % des églises du Liban, leurs cloches...
quand les cloches sonnaient, elles criaient : « Nous, nous sommes faites à Beit-Chabab ! ».
E : [amusé par l'image] C'est ce qu'on disait...
I : Voila, les cloches disaient ça parce que c'était un travail vraiment exceptionnel et c'était une seule
68
famille qui faisait ça, c'était la famille Naffah. La famille Naffah, c'est elle seule, deux frères, ont
appris ce métier et ils ont excellé, pour la fabrication des cloches. Et pour la poterie, il y a la famille
Fakhoury, bien-sûr, elle aussi, elle a vraiment excellé parce que du temps de nos ancêtres, de nos
grands-parents, peut-être les arrières grands-parents, il n'y avait pas les ustensiles de cuisine en
aluminium, en stainless (inox), en je sais pas quoi... Tout le monde cuisinait, tout le monde
employait les ustensiles en poterie.
I: D'accord.
E : Chaque maison exposait ce qu'elle avait comme poteries. Maintenant, de notre temps, c'est un
décor. C'est un décor. On se fait du plaisir d'acheter une grande cruche, une jarre, des fois on
cherche les anciennes poteries pour les exposer chez nous.
I : O.K...
E : dans les nouvelles villas, dans les nouvelles constructions. On se fait du prestige de mettre une
grande jarre juste devant...
E : ...l'entrée...
I : … l'entrée de la maison. On met des choses etc. Et puis la fabrication du tissu, le tissage, c'était la
famille Anayssé.
E : Donc il y avait une filature dans le village à l'époque?
I : Oui.
E :... qui employait beaucoup de monde ?
I : Oui bien-sûr. Il y avait beaucoup d'usines. Il y 'a un atelier pour la poterie, un grand atelier et cet
atelier, il se trouve au bas du village, dans la partie basse du village. Là-bas, ils ont en plein air.
Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de [cherche ses mots]
E : d'argile ?
I : L'argile, il y avait quelque chose qu'ils fabriquaient pour travailler ça. Pour la fabrication des
cloches, il y avait l'atelier lui-même, l'usine. C'était la maison des personnes dont je vous ai parlées
[les deux frères Naffah], et en bas [au premier étage de la maison], il y avait l'atelier. Vous voyez ?
E : Oui.
I : En bas, il y avait un atelier. La fabrication du tissu, la même chose. Les gens habitaient l'étage
supérieur ; l'étage qui est au rez de chaussé, c'était fait pour l'usine, l'usine qui contenait des
machines, beaucoup de machines...
E : avec les employés...
I : Oui. Bien-sûr. Dans tous les métiers, toutes les professions, il y avait des employés. Le tissage est
reconnu à Beit-Chabab grâce au tissage dima. C'est un tissu exceptionnel, on n'en trouve pas
ailleurs. Ceux qui viennent à Beit-Chabab sont très contents de prendre un tissu dima. Parce que ce
69
tissu, on en faisait des nappes, des tabliers, des traversins, des draps, des draps de lit... Et puis,
c'était bien parce que c'est durable. C'est un genre de tissu qui est très bien tissé de façon à ce que …
il ne se déchire pas facilement. Puis pour la fabrication de la soie. La soie. Presque toutes les
maisons de Beit-Chabab, je parle des ancêtres...
E : Il y avait des élevages de vers à soie ?
I : Oui bien-sûr. Nos ancêtres, de père en fils, ils ont appris ça, ils ont appris la profession. Presque
chaque maison élevait le ver à soie. Je ne veux pas dire toutes les maisons mais presque c'est à dire,
la majorité des maisons, la majorité des familles gardaient un endroit... Comment dirais-je..., qui est
vaste, un abris, un sous-sol peut-être. Ils ont une chambre qui est de côté, un peu loin de l'habitation.
Là par exemple, là où on est, on a une chambre en plus, on fait l'élevage des vers à soie dans la
maison. Ils disaient que c'était un porte-bonheur. Quand ils élevaient les vers à soie. Par exemple,
quelqu'un qui construisait une nouvelle maison, avant d'habiter la maison, ils élevaient les vers là-
bas. Dans la maison... vous voyez ?
E : Oui.
I : Donc le ver à soie, c'était du plaisir, c'était vraiment comment dirais-je... C'était de
l 'émerveillement de voir comment mettre les branches pour élever les vers à soie, les petites larves
etc. De jour en jour, on leur mettait à manger et elles grandissent, grandissent et elles sont devenues
des cocons, puis des chrysalides. À un moment donné, à la fin du terme, ils éclatent et puis voilà le
papillon qui sort. C'était toute une métamorphose qui émerveillait les grands et les petits. Et quand
on faisait la récolte des cocons, c'était ça la joie. Vous voyez ? On élevait le ver à soie... C'était de
ramasser tous ces cocons parce que le ver a tissé les fils de soie. Donc, il n'y a pas une famille qui
s'est spécialisée pour ça. Presque la majorité des familles élevaient le ver à soie.
E : Et la soie, ils la vendaient à qui ?
I : Oui, ils la vendaient. Il y avait beaucoup de commerçants qui venaient partout, pour acheter. Et
puis, je voulais dire seulement à quel point Beit-Chabab était considéré comme vraiment riche...
E : Réputé pour son artisanat, ses activités...
I : Oui, sa réputation. [son mari, le Docteur Antoine Bitar rentre dans le salon. Je le salue et le
remercie pour son accueil]. Oui, sa réputation, elle a même traversé les océans. Les gens, les
Libanais parlaient de leur village quand ils étaient à l'étranger et les Étrangers venaient au Liban,
leur destination était pour les villages qui étaient reconnus pour des choses qu'ils n'avaient pas là-
bas [dans leur pays d'origine]. Vous voyez ? Donc quand on était sous Mandat français, les Français
ont vu tout ce que le village faisait, tout ce que les villageois travaillaient, tout ce qu'ils faisaient. Il
y en a beaucoup qui ont appris à faire ça. Il y en a beaucoup qui ont acheté des choses comme ça.
Mais le point le plus important c'était la culture, l'instruction, l'apprentissage, l'éducation. Ça c'était
70
le point culminant.
E : Oui. Il y avait des écoles religieuses ?
I : Pas seulement des missions, il y 'avait des missions mais ces missions tenaient à enseigner le
« bon enseignement » c'est-à-dire tous les villages voisins envoyaient leurs enfants apprendre chez
nous, dans ce village, dans les écoles du village. Il y en avait beaucoup. Il y avait la Mission des
Saints-Coeurs, le Collège du Liban... Il y avait les Pères [demande à son mari en arabe]. Il y avait
les moines libanais dans le Collège du Liban. C'était pour les garçons, le Collège des Saint-Coeurs,
c'était pour les filles. D'abord jusqu' en classe de septième. Tout le cycle primaire était mixte. À
partir de la septième, on faisait la sélection : les garçons allaient au Collège du Liban et les filles
restaient là [le domicile des époux Bitar se situe à proximité de ce dernier établissement] aux Saints-
Coeurs. Et il y avait aussi la Renaissance, l'École de la Renaissance. [Le Dr. Bitar fait alors mention
de l'École officielle c'est-à-dire l'école publique du village ouverte en 1950. Mme Bitar lui précise
ensuite que ma recherche porte sur une période antérieure à cette date]. Puis après les années, il y a
eu l'École officielle. Donc les gens de ce village, ils ont cohabité, ils ont accompagné presque les
deux guerres mondiales. Pour la Première Guerre mondiale, nos ancêtres pour ne pas aller trop loin,
il y en a beaucoup qui ont quitté...
E : Oui, c'était une période assez dure pour la région...
I : Oui c''était la guerre, de la peur, c'était la Première Guerre mondiale, c'était pas la guerre de la
famine. La Deuxième c'était la guerre de la famine [Nous devons corriger ce propos en précisant
que c'est bien le premier conflit mondial qui s'est manifesté dans la région par une terrible famine
due aux effets du blocus terrestre ottoman autour de la Mutassarifiya et du blocus naval français
qui a privé la Montagne libanaise des productions agricoles de l'extérieur, de la plaine de la Bekaa
notamment]. Donc la Première Guerre mondiale, c'était la pauvreté, la peur, la misère... Les parents
se trouvaient dans l'embarras : ils faisaient tout pour éloigner leurs enfants parce que la guerre
n'était pas facile. Donc, il y a beaucoup de familles qui ont immigré, qui sont sorties pour travailler,
faire fortune, gagner de l'argent [Le Dr Bitar intervient pour indiquer les destinations des migrants].
L'Égypte, puis l'Afrique, puis les Amériques. Les deux Amériques. Et... comme c'était pas facile
pour eux, ils ont fait leur vie, ils ont commencé avec beaucoup de difficultés. D'abord, la difficulté
de la langue, la difficulté de l'adaptation, au mode de vie, la difficulté de l'embauche. Par exemple,
il y a eu beaucoup de personnes qui sont restées au chômage, un chômage vraiment cruel. Dans les
rues, il y en a qui ont vraiment subi la famine... beaucoup. Donc, puis après, ils se sont lancés petit à
petit, ils ont fait leur vie, ils ont construit, leur avenir. Bien sûr, ils ont fait leur famille. Et puis, cela
va sans dire que l'argent qu'il ramassait, ils envoyaient à leurs parents qui habitaient là, à Beit-
Chabab pour la continuité de la famille, pour continuer la vie de la famille.
71
I : … pour rénover la maison, l'agrandir...
E : Oui, oui, oui, voilà, c'est ça. Aider la famille à se remettre sur pieds. Surtout que la plupart des
gens étaient des paysans c'est à dire qu'ils travaillaient dans la terre qu'ils labouraient ici. Chaque
famille, par exemple les familles qui étaient aisées, avaient beaucoup de terrain, beaucoup d'eau...
Ils labouraient la terre, ils plantaient... Il y avait beaucoup de plantations, beaucoup de jardins.
Presque la plupart de ceux qui n'étaient pas instruits ont travaillé dans la terre : ils ont jardiné, ils
ont labouré, des fois le papa allait travailler dans le lot de son voisin, vous voyez ? Comme
travailleur, dans le jardin... Il travaillait pour subvenir aux besoins de sa famille. Donc c'était pas
faux du tout...Il n'y a pas de sous-métiers. Vivre et laisser les autres vivre. Tous ceux qui ont
immigré, ils ont immigré à leur jeune âge. Et puis, il y en a qui se sont faits là-bas, ils ont fait leur
vie là-bas. Ils sont pas revenus. Il y en a qui sont revenus après cinquante ans, après dix ans, il y en
a qui sont revenus après vingt-cinq ans... mais personne n'est rentré définitivement.
E : à Beit Chabab ?
I : Oui. Ils sont rentrés pour visiter leur famille. Pour trois mois, cinq mois, six mois... Ils venaient
passer l'été, voir leur famille et revenir. Il y en a qui ont fait partir leurs petits frères, leurs cousins,
leurs connaissances...
E : Donc ils les ramenaient du village et les faisaient travailler avec eux... ?
I : Oui c'est ça. Et dernièrement, après les années cinquante, il y a eu beaucoup d'immigration en
Afrique spécialement. Beaucoup de personnes de Beit-Chabab, beaucoup de familles qui ont fait
leur vie ailleurs... Donc la famille Achkar, la famille Hayek..., on va les compter, les énumérer :
Achkar, Hayek, Fakhoury, Moukarzel, Gabriel, Béjani, Yamin... Voilà les familles les plus
importantes.
E : Celles qui ont envoyé les plus de leurs membres...
I : Oui. Et Beit-Chabab est formé de ces familles. Et de ces familles, il y des descendants [ i.e. des
ramifications à partir d'un ancêtre commun et qui pris des noms différents]. Il y en a qui tiennent le
nom de la famille par exemple... disons X Fakhoury, un autre Fakhoury a pris le nom de X
Khoussoub... Il met pas Fakhoury. Les familles c'est le nom, puis de ce nom descendent des
branches. Il y en a qui gardent le nom de la famille, d'autres par exemple... [Mme Bitar me décrit la
généalogie de plusieurs familles du village et à sa demande, j'interromps l'enregistrement] . […].
Donc chaque famille à Beit-Chabab a construit sa propre église c'est-à-dire...
E : Ici ?
I : Oui, à Beit-Chabab même. Vous trouvez beaucoup de clochers et cela vous indique la place de la
famille. La famille Achkar a construit l'église de Saint-Antoine, la famille Hayek a construit l'église
de Notre-Dame de la Forêt ; la famille Gabriel a construit l'église de Notre-Dame des Saints, elle est
72
miraculeuse pour la guérison du cancer du sein, la famille Amin a construit l'église de Saint Jean-
Baptiste, la famille Fakhoury a construit la grande église dès que vous arrivez à Beit-Chabab d'en
bas [depuis Beyrouth/Jounieh] qui a deux clochers, elle est superbe : c'est l'église Notre-Dame, c'est
l'église la plus grande chez nous à Beit-Chabab, la famille Bejani a construit l'église de Saint-
Sassine. On a une famille ici qui est catholique [le Metn est une région maronite], elle a sa propre
église qui est l'église Saint-Joseph, pour la religion catholique. Chaque famille a construit son
église. Bien sûr, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. C'était l'argent envoyé par les
villageois de Beit-Chabab, les immigrés qui aidaient à la construction des églises. C'étaient les plus
aisées, ceux qui étaient fortunés, qui ont fait fortune, qui ont fait beaucoup d'argent, qui venaient en
été, pendant la saison d'été, trois mois, deux mois parfois un mois. Ils venaient, ils se mettaient en
commun, ils discutaient : « Comment faire ? »... Alors celui qui avait beaucoup de fortune, ils
donnait une grande somme d'argent : « Allez-y commencez, mettez la première pierre, faites les
fondations etc. ». Donc tout était érigé comme ça, tout était construit comme ça, de cette façon.
E : D'accord.
I : Pour construire ces églises, c'était la main d’œuvre de tous les villages et de la famille. C'est-à-
dire, il y a des gens qui travaillent le béton, d'autres la construction de la pierre, d'autres le
carrelage, d'autres le lissage, d'autres qui font le toit... Chacun son métier et tout le monde s'aidait et
tout le monde mettait la main pour élever leur église. Et le plus beau, c'est les jours des fêtes quand
toutes les cloches des églises de Beit-Chabab sonnaient et toutes les cloches comme je venais de
vous le dire, c'était fait chez la famille Naffah. Ça c'est Beit-Chabab, c'est connu pour ça.
E : Donc un village qui a beaucoup d'écoles, un artisanat réputé...
I : On a aussi des couvents... On a le couvent des Saints-Coeurs, l'école des Saint-Coeurs, on a le
couvent de Saint-Antoine de Padoue qui est juste à côté de l'église de Saint-Antoine. On a un
couvent pour les sœurs maronites, on a le couvent de Saint-Pierre à Mar Boutros où il y a un
ermitage. Donc c'était ça Beit-Chabab. C'était grand... et j'ai oublié de mentionner que Beit-Chabab
se trouve à 750 mètres d'altitude, depuis Beyrouth. Donc pendant la saison froide, on a chaque
année, on a les neiges. Ce ne sont pas des neiges importantes mais en bas de Beit-Chabab, on trouve
les dix centimètres de neige. Plus vous montez et plus ça hausse. Juste là-haut, là d'où vous êtes
descendu de Bikfaya, il y a la croix là-bas, ça fait quarante centimètres. Donc, avec le mauvais
temps, Beit-Chabab garde toujours sa beauté ! La neige fond, on revoit les toits rouges et les
habitants de Beit-Chabab sont des habitants actifs : on a souvent des expositions, on a la foire, on a
le festival, et tout ça c'est pour les travaux manuels, pour les travaux artisanaux, tout ce qui est
artisanal. On fait des fêtes, on célèbre l'Assomption de la Sainte-Vierge le 15 août. C'est un festival
chez nous puisque toutes les églises chez nous... On a beaucoup d'églises pour la Sainte-Vierge. J'ai
73
oublié de mentionner l'église Notre-Dame de l'Immaculée Conception... C'est pour quelle famille ?
[L' enquêtée interroge son mari qui s'est assis à côté d'elle, son mari lui répond qu'elle a été
construite par la famille Gabriel]. On a des églises qui ne sont pas pour tout le monde, elles ne sont
pas publiques. Il y a des églises qui sont privées c'est-à-dire un type de la famille, par exemple un
prêtre érige une église et c'est pour eux. Pour la famille elle-même.
E : Ces églises ont été construites avec l'argent des immigrés aussi ?
I : Oui ! Il y en a qui ont construit. Mais non, ça s'est fait avec l'argent de la personne elle-même.
Par exemple, moi je suis de la famille Gabriel, je veux construire une église pour la Sainte-Vierge et
c'est pour nous, de père en fils. Toute la génération qui va venir, pourra célébrer la messe... À un
moment donné, c'est la décision prise par le diocèse chez nous, par l'Archevêque, toutes les églises
devaient être publiques mais il y a des églises qui n'ont pas voulu. Elles sont restées pour la famille.
Pour les écoles j'ai déjà dit... L'enseignement chez nous était vraiment très bon... Les élèves qui
sortaient d'ici allaient directement à l'U.S.J. [L' Université Saint-Joseph], aux écoles françaises c'est
à dire, on avait pas les universités officielles. On avait l'Université Saint-Joseph et l'A.U.B
[prononcé avec un accent anglophone. L'acronyme désigne l' American University of Beirut,
établissement fondé par une mission protestante américaine dirigée par le Docteur Joseph Bliss et
financée par l'Université de l'État de New-York en 1866 sous le nom de Collège Protestant de Syrie.
Il est par la suite devenu une des plus prestigieuses universités libanaises. À la différence de
l'U.S.J. francophone, l' A.U.B. offre un enseignement anglophone]...
E : les jeunes de Beit-Chabab allaient plutôt à Saint-Joseph...
I : Voila. Maintenant de nos jours, toutes les universités qui se trouvent, toutes les facultés qui se
trouvent, les gens, les élèves, les jeunes de Beit-Chabab fréquentent ces universités, chacun selon
ses « débuts ». S'il a débuté anglophone, il va à l'université anglophone, s'il est francophone, il va à
l' U.S.J. On voit que la plupart de la nouvelle génération, se jette sur les études qui ne prennent pas
trop de temps, des études qui permettent des débouchés faciles de travail. Avec regret je le dis, tout
le monde ne peut pas travailler, ils apprennent, ils font la licence, ils font la maîtrise, ils font un tas
de choses, ils poussent leurs études et malheureusement... Il n'y a pas trop de débouchés au Liban.
Donc on se trouve dans la même situation qu'il y a plus de cinquante ans, vous voyez ?
E : D'accord.
I : On revient à ça... C'est le manque de travail qui pousse les jeunes à sortir faire leur vie là-bas.
Peut-être pas faire leur vie... il y en a qui sortent et qui disent : « Moi je ne sors pas pour rester
toujours là-bas, je reviens ».
E : Une fois installés là-bas...
I : Malheureusement, oui, ils se trouvent bien entourés là-bas : soit par l'État, le travail... Donc, ils
74
se trouvent tous bien... Regardez mon fils, ça fait dix ans qu'il est en France. Il ne comptait pas
rester là-bas, il est sorti pour pousser ses études... Donc il s'est avéré qu'il a été embauché avec un
contrat indéterminé... Donc il se trouve bien.
E : Oui bien sûr...
I : Donc c'est l'état de toute la génération qui sort. Avant, toute l' émigration était jetée... Le point de
mire c'était l'Afrique, l'Amérique et maintenant de nos jours, il y a le Golfe arabe, tout ce qui est
contrées arabes et Afrique...
E : L' Arabie...
I ; Oui tout le Golfe arabe. L' Arabie saoudite, la Tunisie, l'Égypte, la Jordanie, même la Syrie. Il y a
Dubaï, Abu-Dabi, le Qatar. Pour l'Amérique, de nos jours, les jeunes préfèrent le Canada aux États-
Unis. Il se trouve qu'au Canada, on a beaucoup de Libanais de Beit-Chabab, les jeunes. Dès qu'ils
ont démarré, ils envoient récupérer leurs parents, leurs frères puis leurs parents, comme quoi,
regroupement familial ! Donc ça se voit que... Ils vont là-bas, ils sont bien installés, l'État leur
donne beaucoup de facilités. Et puis dès qu'ils sont Canadiens, qu'ils ont la nationalité, ils
commencent à venir... Ils restent quelques mois au Canada puis les autres au Liban. Mais ils
répondent très simplement : « On est mieux installés là-bas ». Comme quoi, la cherté de vie, il n'y a
pas tellement de cherté de vie... Moi je parle depuis les derniers événements du Liban c'est-à-dire à
partir de l'année 1975...
E : Oui...
I : Il y a eu beaucoup d'émigration au Canada. Il y avait peut-être 5%, maintenant on trouve qu'il y a
peut-être plus de 70% qui vont au Canada. Je parle du Liban entièrement et spécialement à Beit-
Chabab, presque la moitié des immigrants sont au Canada. Les autres sont en Afrique.
E : Au Canada aussi bien anglais que français...
I : Oui, que ce soit le Québec ou les autres parties, Toronto etc. Donc ils vont là-bas puis ils
apprennent. D'abord, ceux qui sont sortis pendant la guerre, c'était pas si facile pour eux mais c'était
facile de s'intégrer, d'être admis. Maintenant pour être admis là-bas, il y a beaucoup de conditions
donc c'est plus difficile. Mais avec toute les difficultés, on voit que les gens se tuent pour aller dans
des pays qui puissent les aider à vivre. Avec la cherté de vie qui se trouve maintenant, qui règne
maintenant au Liban, tous les jeunes cherchent des pays où ils peuvent faire fortune sans trop passer
dans les coulisses de la cherté...
E : Oui bien sûr...
I : Alors ils cherchent les pays arabes, ils sont bien embauchés, en Afrique, ils sont très bien
embauchés. C'est-à-dire de la famille Achkar, on a des gens qui sont très bien, qui sont très aisés,
qui sont riches, des « richards », ils se sont faits eux-mêmes. Il n'y a pas quelqu'un qui les a enrichis.
75
Ce ne sont pas des riches de la guerre, ce sont des personnes qui ont bûché dur pour arriver et ils
sont en train de prendre des jeunes de Beit-Chabab. Ils ont construit eux-mêmes, ils ont crée leurs
entreprises. De la famille Achkar, on a quelqu'un qui est très très riche, c'est Z. Faddoul Achkar.
C'est un grand homme d'affaires, un très grand homme d'affaires ! Il est renommé et il a des
entreprises partout : en France, en Amérique, en Afrique, dans plusieurs endroits en Afrique et
presque tous les jeunes qui ne trouvent pas de travail ici, ils sont embauchés chez Achkar. Donc, ils
sont bien payés, ils sont logés, payés... Je ne sais pas si c'est à leurs frais mais au début, ils sont
comme ça : bien reçus. Et ils font de l'argent. Le jeune homme qui s'en va d'ici avec un diplôme,
disons... d'informatique par exemple, ou s'il a fait interior design etc, il y a beaucoup de choses...
Donc il va là-bas, il travaille, il trouve tout de suite du travail... Tandis qu'au Canada, tu peux pas
travailler tout de suite ! Tu as besoin d'être hébergé d'abord, tu as besoin d'entrer à l'université, de
travailler et d'avoir un diplôme canadien qui te permettra de travailler après. Tu n'as pas de permis
de travail si tu ne mets pas les pieds dans leur système d'éducation à eux. En France, c'est la même
chose donc... En Amérique [États-Unis], je ne sais pas si c'est la même chose... Ce que je sais c'est
qu'on a beaucoup de médecins qui vont se spécialiser en Amérique, on a des ingénieurs, on a des
informaticiens qui aimeraient bien avancer beaucoup plus, pousser beaucoup plus leurs études, ils
font des spécialités... Ils y a beaucoup de domaines ! Donc ils étudient, ils font le génie et ils vont
faire leur spécialisation dans une autre direction. Donc voilà en général, ce qui est pour
l'immigration jusqu'à présent. Beit-Chabab compte 14500 habitants maintenant ici... et autant
d'immigrants !
E : D'accord.
I : Vous voyez, c'est un grand village, et chaque maison a quelqu'un à l'étranger. Il n'y a pas une
maison qui n'a pas un enfant à l'étranger. Toutes les mamans vous disent : « Ah mon fils, ma fille,
mes enfants sont tous là-bas ! Nous sommes seuls ! ». Donc vous voyez, beaucoup de
lamentations...
E : Oui, l'éloignement est difficile à supporter.
I : Oui l'éloignement est pénible à supporter. Voila. [Le Dr. A. Bitar montre une de ses publications
portant sur l'histoire socio-économique de Beit-Chabab et plus précisément sur les métiers et les
activités pratiquées dans cette localité au tournant des XIX et XXe siècles. Il me donne
gracieusement cet exemplaire].
Itinéraires du grand-père et du père au Sénégal.
I : De ce qui est de mon côté à moi, mon grand-père a immigré pour le Sénégal...
E : Vous vous souvenez de l'année ?
76
I : Non, non, je ne me rappelle plus... Mon grand-père a quitté le Liban. Son village c'est Chéhouyé,
c'est juste là [me montre une direction avec son doigt], c'est à côté de Beit-Chabab mais ça fait suite
à Beit-Chabab. On est tous là de petits bourgs en petits hameaux mais qui font suite à Beit-Chabab.
Donc mon grand-père comme je vous le dis, a quitté pour le Sénégal... Bien sûr pendant la Première
Guerre [mondiale].
E : Pendant la Première Guerre mondiale ?
I : Oui pendant la Première Guerre mondiale. Il avait quatre garçons. Ma grand-mère a élevé ses
enfants et puis mon père qui est le second dans la famille a fait ses études à Marseille puis à l'appel
de son père, il est parti au Sénégal l'aider...
E : D'accord.
I : Donc mon père a été le bras droit de mon grand-père au Sénégal. Ils ont bâti la maison. Ils ont
commencé comme tous les Libanais, comme tous les immigrants, ils ont commencé avec beaucoup
de difficultés...
E : Ils travaillaient dans quoi ?
I : C'était la récolte de l'arachide, dans la moisson... Leur saison à eux, là-bas à eux, chez les Noirs
du Sénégal, ils avaient beaucoup de choses... Comme le Sénégal était sous Mandat français, on
envoyait tout de la France, tout : le tabac, les marchandises, le tissu, les robes, la viande... Tout,
tout, tout ! Ma mère me raconte. Mon père... mon défunt père, il nous racontait que tout venait de la
France. Comme quoi, le Sénégal était connu comme mandat français. Les militaires étaient là-bas,
mais ils menaient la belle vie. Ils étaient très aisés avec les Français. Quand mon grand-père est
mort, c'était mon père qui avait pris la relève...
E : Il est mort en quelle année ?
I : Je ne sais pas... Je ne me rappelle pas... Parce que quand il est mort, il y a longtemps... Mon père
était déjà « jeune », c'était déjà plus qu'un adolescent...
E : C'était un jeune homme...
I : Oui..., il a pris la responsabilité et c'était lui, c'était sur lui que tombait toute la responsabilité de
la famille qui était au Liban, à Beit-Chabab, à Chéhouyé. Donc comme il avait trois frères ici avec
sa maman, c'était mon père qui travaillait et il envoyait de l'argent à sa famille. Pourquoi ? Parce
que ses frères étaient plus petits que lui. Lui, il n'était pas l'aîné mais l'aîné était déjà malade, il est
tombé malade, il était immobilisé dans son lit. Il ne pouvait pas travailler donc c'était mon père qui
devait travailler pour envoyer à sa maman et à ses frères. Par la suite, son frère, le plus jeune, aussi,
il a pris la même destination. Il a rejoint mon père un peu plus tard... c'est à dire, il l'a rejoint, il
s'est marié, il l'a rejoint et sa famille... Donc mon père a construit un autre pavillon à côté de sa
maison pour mon oncle.
77
E : D'accord. À l'origine, il y avait...
I : … Il y avait mon grand-père qui avait construit la maison puis après la mort de mon grand-père,
mon père a travaillé des années puis son jeune frère est parti chez lui. Donc pour le loger, il lui a
construit une maison juste à côté de la sienne... C'est-à-dire, mon père et son jeune frère, mon oncle,
habitaient ensemble dans le même bâtiment mais une partie pour mon père et une pour mon oncle.
Et mon oncle aussi a fait le commerce. Mon père a commencé à faire le commerce là-bas. Ils
apportaient beaucoup de choses là-bas, ils les vendaient... Spécialement, les Noirs attendaient la
moisson des arachides, des cacahuètes là-bas... C'était la saison la plus importante pour eux. Ils
empruntaient l'argent des Blancs et avec l'argent ils achetaient, ils mettaient la main sur un terrain
où par exemple, il y avait des cacahuètes, ils payaient pour acheter la moisson. Chaque année était
différente de l'autre, il y avait des années où la récolte était vraiment bien, d'autres années qui
étaient mauvaises. Donc ils gagnaient l'argent de la récolte, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils rendaient
l'argent aux Blancs. Vous voyez, donc c'était ça le commerce entre eux. Il y avait beaucoup de
commerce entre eux... Par exemple mon père a fait beaucoup de choses... C'était différent. Par
exemple, la marchandise n'était pas toujours la même. À la fin c'est-à-dire depuis les années
cinquante, il a commencé à apporter des pièces détachées de la marque « Peugeot ». Et là-bas au
Sénégal, ils ont un hobby qui est très spécifique [sourire], c'est le vélo !
E : D'accord [amusé] !
I : Ils aiment le vélo ! Ils allaient au travail en vélo, vous ne voyiez que des vélos dans les rues.
Donc il a pris cette responsabilité mon père, il a commencé à apporter des pièces détachées, des
pièces de vélo, des accessoires... Tout ce qui servait à un vélo : les pneus, les roues, les châssis etc.
Donc, en fin de compte, comme il était très honnête, très droit, dans la traite des Noirs... Il ne
maltraitait pas les Noirs, au contraire, il les traitait avec beaucoup de compassion...
E : Il avait de bonnes relations...
I : Il avait beaucoup de relations. Il était vraiment un homme... d'honnêteté et d'honneur, alors on lui
a administré, comment dire... l'honneur d'être l'agent exclusif de la marque « Peugeot ». L'agent
exclusif dans tout le Sénégal, c'était chez lui que tous les commerçants venaient prendre les pièces
détachées de la marque « Peugeot ». Donc il s'est lancé dans ce commerce. Et puis mon frère aîné
l'a rejoint là-bas, comme quoi mon père a commencé à avoir des problèmes avec ses yeux, il devait
se faire opérer de la cataracte donc mon frère aîné a passé presque plus de dix ans là-bas pour aider
mon père. Comme il a élargit son travail... Et puis il a passé quarante ans au Sénégal mon père... Et
nous on était là...
E : Vous étiez au Liban ?
I : Maman et la famille, on est rentré au Liban. Pourquoi ? Parce que la moitié de la famille était là :
78
ils étaient pensionnaires à l'école des Saints-Coeurs, mes frères, mon frère aîné et mes deux sœurs.
Nous les petits qui sommes venus après, on était avec mes parents...
E : Au Sénégal ?
I : Oui au Sénégal, puis après on est rentré avec mes parents et définitivement, on s'est installé là. Et
mon père est resté là-bas. Depuis, il venait chaque année, il passait un ou deux mois avec nous en
été puis il rentrait parce qu'il avait son travail. Des fois il passait plus que deux mois. Selon la
moisson des cacahuètes et c'était toujours la moisson... La récolte là-bas. Tout le travail dépendait
de ce genre de travail chez les Noirs. Alors il a élargi son travail, il avait beaucoup d'employés, des
ouvriers, il avait des chauffeurs de camion qui transportaient les marchandises. Ils allaient dans
toutes les directions là-bas comme quoi... À Dakar, comme c'est la capitale donc, on devait prendre
toute la marchandise de là-bas, du port... Tout était comme ça. Et toutes les pièces venaient de
France. Vraiment, ils ont excellé dans ce travail. Puis il envoyait de l'argent : à chaque fois qu'il
venait, il apportait l'argent qu'il avait gagné. Donc on a bâti notre maison à nous, mon père a bâti
une maison à nous, comme on est sept enfants. Donc il n'a pas voulu hériter d'une maison, de ses
parents. Pourtant mes grands-parents étaient aisés, ils avaient plusieurs maisons. Mais lui, il a voulu
que son argent à lui... bâtir sa maison à lui.
E : Ici, à Beit-Chabab...
I : Oui au Liban, à Beit-Chabab. Ça s'est fait comme ça. Puis il est rentré à la fin, non,..., on était...
Pendant la guerre, pendant les événements du Liban. On était dans les années 1980, 1981-1982. Il
est rentré au Liban et puis, cinq ans après, il est décédé. Donc, on a plus rien qui nous relie au
Sénégal sauf des cousins.
E : Des cousins qui sont restés encore...
I : Oui mes cousins c'est-à-dire les enfants de mon oncle qui est parti rejoindre mon père. Mon père
a gardé le tout entre les mains de mon cousin là-bas. Il a vendu et il est rentré définitivement au
Liban. Maintenant, avec les événements, la situation qui se trouve en Afrique, il y a beaucoup de
personnes qui sont rentrées en France. Les Sénégalais, ils ont la nationalité sénégalaise, il y en a qui
ont eu la nationalité française. Donc ils envoient leurs enfants en France. Vu les problèmes...
E : D'accord.
I : L'immigration a pris un sens très important, très impressionnant pour les habitants de Beit-
Chabab. Depuis longtemps, il y a des personnes qui sont parties il y a cinquante ans, soixante ans,
vers le Ghana, pour le Mali, d'autres pour la Guinée...
E : Votre grand-père et votre père étaient en contact avec d'autres commerçants libanais ?
I : Oui, oui... Vu leur travail, vu le commerce qu'ils menaient, ils étaient obligés d'être en contact. Il
y avait toujours des relations. Souvent, ils allaient à des expos... Disons qu'au Mali..., ils allaient
79
faire des tours, des tournées... Ils faisaient la randonnée dans le Sénégal ! Surtout que chaque fois
qu'il y avait une nouvelle délégation qui venait exposer des choses à Dakar, à la capitale, ils
prenaient la voiture et ils allaient à deux cents kilomètres. Le Sénégal, c'est la ville la plus
importante après la capitale...
E : Kaolack ?
I : Kaolack, au Sénégal,..., Kaolack c'était la ville la plus importante, vu son point,... un point
stratégique de commerce, de relations...
E : Oui bien-sûr...
I :... inter-nations, inter-pays, inter-contrées... C'était un point très important. Il y avait les deux
sens : importation-exportation. Donc, ils importaient beaucoup de choses et ils exportaient
beaucoup de choses. Par exemple, Abidjan, si vous prenez Abidjan, c'est la ville la plus importante
au Monde pour le cacao. Il n'y en pas d'autres, sauf Abidjan ! C'est reconnu pour ça. Par exemple, le
Sénégal est reconnu pour les arachides... Le Ghana est reconnu pour d'autres choses. Il y a aussi
l'industrie du bois, l'industrie du béton, de la vanille... À Madagascar. Mon père a visité tout ce que
je suis en train de vous dire...
E : La Côte d'Ivoire, Madagascar...
I : Oui ! La Côte d'Ivoire, Madagascar, Soudan, le Mali... Tout, tout, tout, tout ! Il a tout visité là-
bas !
E : Pour ses activités professionnelles...
I : Oui ! Il était en très bonnes relations avec les Noirs. Tous ! Lui il est de nature très fraîche...
E : des relations amicales avec...
I : Oui ! Il considérait tout le monde, il respectait tout le monde, il se faisait imposer par tout le
monde avec cette nature qu'il avait.
E : Il employait beaucoup de Sénégalais dans son entreprise ?
I : Oui, oui... Tous les gens qui travaillent chez lui étaient des Noirs et ils l'aimaient beaucoup.
Quand il a voulu quitter le Sénégal, tous les gens ont pleuré. On l'appelait « Le Patron ».
E : un patron aimé...
I : Oui, il était tellement bien, il était généreux, il faisait beaucoup d'activités là-bas... Par exemple,
« la fête de la loterie ». À la Saint-Sylvestre, au Nouvel An, il faisait « la loterie ». Il vendait des
billets de loterie... À plusieurs reprises ils ont gagné mais les billets... Il vendait les billets de loterie
et il faisait une fête le soir pour faire le tirage...
E : D'accord. Tous les ans, tous les employés venaient...
I : Tous les gens qui étaient à côté de lui,tous les Arabes, tous les Blancs etc. Donc... Et il faisait la
fête, par exemple... On a beaucoup, au Sénégal, comme dans tous les pays d'Afrique, ce sont des
80
pays de poissons. Tout ce qui est fruits de mer, tout ce qui est fruits asiatiques... Tout se trouve là-
bas ! Donc on se plaisait à sortir quand on sortait pour faire une excursion, une promenade, une
journée au bord de la mer. C'était fantastique ! D'abord la nature, le temps, le climat, même s'il était
chaud... Mais on se plaisait ! Par exemple, les crustacés, les poissons... tous genres ! C'était
vraiment... Et puis c'était pas cher par rapport à maintenant, mais pour eux c'était pas mais...
Comme quoi, ils faisaient leur vie, ils devaient faire attention... Économiser ici, dépenser là... Vous
voyez ? Et il y avait ces liens qui étaient très très bons entre les Libanais. Par exemple, s'il y avait
un Libanais qui allait là-bas, tout le monde était prêt à le recevoir...
E : une solidarité entre...
I : Oui ! On avait des relations... vraiment.
E : Est-ce qu'il y avait des fêtes par exemple entre Libanais, dans la communauté libanaise ?
I : Oui bien-sûr ! Mais c'est ce que je vous dis...
E : … des fêtes religieuses...
I : Oui ! La fête de Minuit, la messe de Minuit, ils sortaient, ils faisaient la fête... Ils allaient dans
des restos, ils allaient fréquemment... Ils venaient souvent à la maison...
E : D'accord. Vous receviez beaucoup de monde ?
I : Oui beaucoup ! Tous les amis libanais venaient chez nous. Comme la maison est trop grande...
On était pas dans la maison, on restait dehors, dans le jardin, dans le parc qui était à côté de la
maison. C'était un parc très grand et ils mettaient les tables, ils mettaient les boissons. Ils
mangeaient... Là-bas, à cause de la chaleur, on est obligé de manger la viande... Alors c'était le gros
cochon de lait peut-être ! Le rôti...
E : … que vous mangiez...
I : Oui ! Le gigot, oui ! La fois où on a vu le moins de gens c'était vingt-cinq personnes. Alors
imaginez-vous que dans les fêtes, il y avait trop de monde !
E : [rires]
I : Alors quand maman voulait cuisiner, elle achetait le sac de dix kilos de riz.
E : C'est elle qui s'occupait de tout ?
I : Oui, mais elle avait des gens, elle avait des Noirs... Un employé qui allait faire les achats...
E : Du personnel de maison...
I : Elle avait deux dames, deux Noires, une qui prenait soin de nous. Bien-sûr, Maman ne laissait
pas les Noirs nous toucher. Ni le bain, ni le manger... Rien. Mais elle faisait le ménage, elle gardait
l’œil sur nous, elle repassait, elle balayait, elle nettoyait etc. Il y avait un gardien spécial pour le
jardin chez nous pour nous garder quand on est dans le jardin parce que c'est un pays chaud. Il y a
des serpents, pas mal de choses... Donc, il y avait un autre qui était le chef-cuisinier, ça veut dire
81
que Maman lui faisait la liste : « Va nous acheter telle, telle chose » sur le papier. Il allait faire les
achats et il revenait... Donc elle avait tous ces gens qui travaillaient avec elle mais c'est elle qui
dirigeait la cuisine. Imaginez-vous que pour faire un festin pareil, elle avait besoin de beaucoup de
choses. « Va au marché acheter une grande morue, un bar » etc...
E : Bien sûr...
I : Imaginez-vous ce genre... Qu'est-ce qu'elle va faire avec ça ? Mais elle se plaisait là-bas. Il y
avait les dames libanaises... C'est-à-dire les Libanais qui avaient épousé des dames libanaises, des
dames blanches. Elles étaient toutes en contact. Et Maman par exemple... Ils apportaient beaucoup
de choses de la France : des habits, des accessoires... Elle a fait le commerce Maman aussi avec
mon père.
E : Ah d'accord !
I : Elle était toujours avec lui au comptoir. Elle l'aidait... Vous voyez, Donc les dames là-bas
travaillaient avec leur mari. Vous voyez ? Le soir, ils venaient tous soit pour boire un verre, soit
pour manger le taboulé, faire la milouchi...Maman comptait préparer la milouchi. Elle faisait une
grande [indique la taille de l'ustensile avec ses bras]. Et c'était des Libanais qui venaient de tous
points pour venir manger. Elle faisait le kebbé. C'était pour elle ou pour mon père. C'était pour des
gens libanais... Vous voyez, je vous explique les liens...
E : Entre...
I : Oui ! Ils ont crée beaucoup de liens... Ils ont vraiment. C'était beau ! C'était beau ! Et quand mon
père est rentré là, il a vu les événements, les obus, les roquettes, il a dit : « C'est la plus grosse erreur
que j'ai commise dans ma vie. Pourquoi je suis rentré moi ? »
E : Oui...
I : Après quarante ans au Sénégal, il a regretté d'être rentré. La guerre, les obus... C'était pas...
C'était l'inquiétude, l'angoisse, il avait peur, chaque fois que l'un de nous sortait de la maison, il
restait toujours devant la fenêtre. Puis notre maison a eu sa part de dégâts : 21 coups de canon ! On
a gâté la maison, elle était nouvellement bâtie ! En pierres... Une bâtisse vraiment extra... Tout était
en dégât et une deuxième fois encore, elle a reçu sa part. Doc mon père, c'était ras-le-bol. Il a dit :
« C'est la plus grosse erreur que j'ai commise dans ma vie ! C'est d'être rentré au mauvais
moment »...
E : Au mauvais moment ! Bien sûr, bien sûr...Surtout que, comme vous le disiez, il avait de très
bonnes relations au Sénégal...
I : Oui ! Mais il n'avait pas idée de ce qu'il se passait ici. La guerre... Il ne savait pas qu'il y avait ça..
E : Ici à Beit-Chabab ?
I : Oui, oui, bien-sûr ! On a eu notre part...
82
E : Tous...
I : Oui tous. Il y en qui sont salariés, qui travaillent chez d'autres. Il y en a qui ont crée leur travail
et il y en a d'autres qui continuent à travailler chez d'autres. Par exemple, dans les entreprises. Il y a
des personnes qui ont commencé à travailler pour eux, leur travail privé à eux... D'autres, non. Ils
continuent à travailler dans l'entreprise. Ils sont des employés puis ils ont salariés. Mais ils sont tous
dans le commerce. Il y a beaucoup de gens là-bas : il y a le commerce du bois, il y a le commerce
du cacao, il y a le commerce des fruits, tout ce qui est fruits exotiques. Il y a l'ananas, il y a la
papaye, il y a les sapoti, l'avocat, tous les fruits qu'on puisse imaginer dans le Monde. C'est une terre
très fertile. Elle est très fertile. On plante quelque chose par terre. Le lendemain tu vois que ça
bourgeonne !
E : Déjà...
I : Oui. Par exemple, mon père défunt, le pauvre..., il avait pris avec lui la semence..., pour semer
des grains de concombre.
E : OK. Il voulait se lancer dans une exploitation agricole ?
I : Oui. On avait un petit, un grand, grand hall dehors, un grand jardin bien clôturé c'est-à-dire de...
disons 1500 mètres carrés. Il est à côté de la maison c'est-à-dire... mais il est clôturé.
E : Dans Kaolack ?
I : Oui. Dans Kaolack, là-bas. Et le gardien était là-bas. On avait des cocotiers, des avocatiers... On
avait beaucoup d'arbres même la papaye. Ça nous faisait plaisir de voir la papaye qui tombait
comme ça, qui pendait. Il y avait... Mon père, chaque fois qu'il venait au Liban, il prenait avec lui
des graines pour les semer là-bas.
E : D'accord.
I : Les concombres poussaient par exemple, ils étaient à deux doigts comme ça [montre la longueur
du concombre avec ses doigts]. Il appelait les amis libanais : « Venez on va prendre un verre. On va
manger quelque chose de libanais ». Et ils venaient manger les concombres, les tomates, la menthe
verte du Liban, le persil...
E : Il ramenait des graines et les faisait pousser dans le potager....
I : La milochi... Tout ce qui sortait du Liban, ils avaient du plaisir ! Même les oignons verts ! Il
plantait ça et dès que ça poussait... Les branches vertes, il les coupait pour les manger avec les
kebbé, avec la viande. On consommait beaucoup de viande, beaucoup de poisson
E : Vous aviez quand même une image du Liban... Enfin quelle image du Liban vous aviez quand
vous étiez petite. Comment vous vous imaginiez le Liban avant d'y venir... Parce que vous êtes née
en Afrique, c'est ça ?
I : Oui mais on ne connaissait pas trop le Liban nous autres parce que chaque fois qu'on nous
83
amenait au Liban, on était encore trop petit [L'enquêtée a quitté le Sénégal avec sa mère et ses
petits frères en 1956, lorsqu'elle n'avait que huit ans. Sa mère, ayant attrapé la malaria au Sénégal
décida, sur conseils médicaux, de retourner définitivement à Beit-Chabab] mais comme mes frères
étaient là, pensionnaires à l'école, on avait des relations. Mais moi de mon côté, mes frères sont plus
petits, ceux qui sont venus avec moi. Ma mère était enceinte quand elle est rentrée, elle attendait
mon petit frère. C'était le petit, le benjamin. Alors il y avait trois [enfants] ici et trois avec mes
parents au Sénégal. Et Maman attendait le dernier, le septième enfant. Donc nous trois, on est
rentré, on était petit. Moi j'avais presque huit ans, donc je ne savais pas trop le Liban, je ne le
connaissais pas. On nous amenait au Liban, on était trop petit. Je ne me rappelle pas trop de choses
jusqu'au moment où on est rentré définitivement avec Maman. J'ai commencé à faire la
connaissance de la famille, des oncles, des tantes. Le Liban... Je pleurais ! Je faisais des crises de
larmes. « Je veux rentrer là-bas ! ». Je ne voulais pas rester ici.
E : Rentrer au Sénégal ?
I : Oui, je ne voulais pas parce que ça ne me plaisait pas, je ne parlais pas l'Arabe.
E : D'accord.
I : Je ne comprenais rien. Tout ce qu'on me disait...
E : Vous ne parliez jamais Arabe à la maison entre vous ?
I : Entre nous on causait le Français.
E : Le Français. D'accord.
I : À la maison. Maman nous a obligés à apprendre l'Arabe parce qu'on devait rester définitivement.
E : Bien sûr.
I : On ne devait plus rentrer là-bas ! Donc c'était la chose extra qu'elle avait faite pour nous, c'était
de nous obliger à apprendre l'Arabe. Parce que tôt ou tard, on devait l'apprendre. Parler ça veut pas
dire seulement dire l'Arabe. Le plus important c'est de l'écrire et de le lire ! Donc elle a tenu à ce
que nous apprenions l'Arabe. Dans notre école ici, à l'école des Saints-Coeurs, on a fait nos études,
on s'est rattrapé en Arabe. Mes frères qui sont après moi, très petits, ils ont pu être basés. Mais moi,
j'ai fait entre les deux. C'est-à-dire que j'étais dans une classe plus haute que les classes de base. Je
prenais des cours intensifs en Arabe pour récupérer.
E : D'accord.
I : Et toujours avec des larmes, avec des pleurs. « Je veux pas, je veux revenir, je veux pas rester ici,
je comprends pas ! ». Chaque jour, je revenais en pleurant de l'école parce que tous les camarades
parlaient l'Arabe et moi je ne parlais pas l'Arabe.
E : Le Français était votre langue maternelle...
I : Oui. Je ne savais rien ! Et quand ils parlaient l'Arabe, je donnais l'oreille mais je ne comprenais
84
pas. Ça m'irritait de plus en plus. Puis après, ça allait. Ça a avancé. Alors Maman a dit : « Puisque
vous êtes bien calés e Français, donc on va parler l'Arabe. Parlez entre vous l'Arabe pour que votre
sœur puise récupérer ». Pour moi. Alors on a commencé à parler l'Arabe mais n'empêche que dans
tous nos langages, on s'utilisait l'un l'autre par le Français. Il n'y avait pas à part ça. Alors je me suis
mariée et j'ai appris à mes enfants le Français dès qu'ils étaient bébés. Ils sont rentrés dans la même
école là où j'ai appris et ils étaient les plus excellents !
E : [sourire]
I : Car c'étaient les seuls qui comprenaient le Français. C'étaient les seuls qui avançaient comme
quoi tous les cours, toutes les matières se donnaient en Français. Il n'y avait que quelques cours qui
se donnaient en Arabe. Voilà.
E : D'accord.
I : Et mon petit-frère aîné est né là. Le dernier est né ici. Et maintenant, il est à Madagascar. Il a
émigré en France... Nous, nous sommes rentrés au Liban et lui, il est sorti. Il avait sa classe
terminale. Il a terminé et il est allé en France étudier l'informatique. Donc là-bas, il a passé quelques
années puis il s'est marié, il a eu des enfants. Il est parti et actuellement, il est à Madagascar. Et là-
bas, il a son travail. Il travaille sur le réseau. Il a des entreprises qui travaillent sur le réseau.
E : D'accord. Juste pour revenir, sur votre père qui a fait ses études à Marseille... À l'université
donc ?
I : À l'école. Il apprenait à l'école...
E À quel âge donc était-il à Marseille ?
I : À quinze ans.
E : en pensionnat ?
I : Oui. Bien-sûr ! Il n'y avait personne avec lui. Son père est en Afrique, sa mère et son frère sont là
[au Liban]. Il était là-bas à l'école, il était pensionnaire...
E : Votre grand-père a décidé de l'envoyer en pensionnat à Marseille.
I : Mon père est allé à Marseille étudier puis à l'âge de quinze-seize ans, son père l'a rappelé
puisqu'il ne pouvait pas tenir le magasin tout seul. Et comme mon père, il a le Français de Marseille,
c'était à lui de diriger le travail de son père. Mon grand-père ne se trouvait pas dans le Français.
C'est un Libanais qui n'a pas appris le Français.
E : Ah d'accord.
I : Oui, il est parti au Sénégal, il a fait son travail mais il avait besoin de mon père parce qu'il a vu
que là-bas, on causait le Français. Donc il a appelé mon père. Là-bas, au Sénégal, ils ont leur
dialecte, le Wolof. Donc il a appris le Wolof mais pour faire des factures...
E : Oui, pour traiter avec les Sénégalais...
85
I : Oui pour traiter... Tout ça c'était mon père. C'est pas parce que c'est mon père... Mon père il a une
tête de maths donc quarante ans au Sénégal, avec la technologie de la calculatrice et tout ça... Il a
jamais utilisé une calculatrice ! Jamais.
E : dans sa tête...
I : … Alors voilà, c'était parce que mon père avait son Français, c'est pour ça qu'il avait besoin de
lui.
E : Oui parce que votre grand-père...
I : Oui, il n'était pas censé avoir des relations, communiquer en Français. Il communiquait en Wolof
avec les Noirs...
E : D'accord, il avait fait l'effort d'apprendre...
I : Oui bien-sûr. Il a passé toute sa vie comme ça. Bien-sûr, quelques bribes de parole, des mots
comme ça. Oui mais pas trop.
[L'entretien se conclut lorsque Mme Bitar quitte le salon de réception à l'entrée de la maison pour
préparer le café et une infusion pour son mari qui se plaint de maux de tête. Celui-ci a assisté à
l'entretien en l'entrecoupant de précisions sur l'histoire du village et des familles migrantes et en
présentant une de ses publications. Lorsque Mme Bitar revient, au bout de quelques minutes, elle
m'explique la recette des galettes des Rameaux et en quelles occasions les dames du village les
préparent].
86
Table des matières
Remerciements 3
Introduction 4
Première partie : Historiographie et bibliographie classée et commentée 15
Historiographie 16
1.Facteurs de répulsion et facteurs d'attraction, un cadre conceptuel traditionnel des études
migratoires 16
2. L'autonomie des flux migratoires entre les régions du Levant et l'Afrique Occidentale
Française 21
3. Les migrants syro-libanais en Afrique Occidentale Française 24
Bibliographie classée et commentée 32
Deuxième partie : Inventaire des sources 40
1. Archives 41
2. Sources imprimées 50
3. Source orale 53
Troisième partie : Premiers résultats 54
1. Le réseau d'acteurs : entre migration spontanée et migration organisée, la manifestation
87