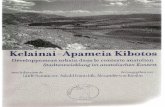La connaissance hypnotique
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
Transcript of La connaissance hypnotique
LA CONNAISSANCE HYPNOTIQUEThierry Melchior
Ce texte constitue une communication faite au Colloque deLa Hulpe « L’Unité de la Connaissance » organisé en 2001 par France-Culture et l’Université Libre de Bruxelles.
Il a été publié dans les Actes de ce colloque, l’ouvragecollectif De la science à la philosophie, Y a-t-il une unité de laconnaissance ? (sous la dir. de Michel Cazenave), Albin Michel /France-Culture / Université Libre de Bruxelles, 2005.
« Hypnose » et « connaissance » : le voisinage de ces deuxtermes ne va nullement de soi. L’hypnose, en effet, avec sesconnotations de sommeil et de suggestion, est sans doute biendavantage associée, dans notre culture, à l’idée d’un pouvoir,d’une domination d’une personne sur une autre. C’est d’ailleursà ce titre qu’elle fut rejetée par la psychanalyse qui,pourtant, en était née. C’est ainsi que, pendant tout levingtième siècle, s’est constitué un imaginaire culturel danslequel, hypnose et psychanalyse s’opposaient, la première étantcensée être du côté du pouvoir, de la force, du mensonge, de latromperie, de l’illusion, du paraître, de l’aliénation, del’obscurité et du Mal, tandis que la seconde était censée êtredu côté du savoir, de la vérité, du sens, de l’authenticité, del’être, de la liberté, de la lumière et du Bien. Dans cetteperspective, la connaissance hypnotique, quel que soit le sensque l’on puisse donner à une telle expression, ne pouvait être
1
qu’une contradiction dans les termes, une connaissance à peuprès nulle, une non-connaissance.
L’hypnose, pourtant, même au sein de cette polaritéculturelle, n’a jamais été totalement assignée à l’un de cespôles. Alors même qu’on lui reprochait de procéder par la forceet la tromperie, on lui a toujours reconnu, paradoxalement, uncertain pouvoir d’élucidation : l’hypnose serait capable,malgré tous ses défauts, de permettre aux sujets de leverl’amnésie dont sont frappés une partie de leurs souvenirs, dese les réapproprier et, par la même occasion, de guérir lessymptômes qui y sont associés. Freud lui-même le confirmaitencore en 1925, trente ans après qu’il eût abandonnél’hypnose : « Le succès pratique de la méthode cathartique [utilisantl’hypnose] était excellent. » (Freud, 1925). Nous verronsultérieurement ce que l’on peut en penser aujourd’hui, maiscontentons-nous, pour l’instant, d’un étonnement : commentdiable une voie qui procèderait par pouvoir, tromperie etillusion serait-elle à même d’accoucher de la vérité ?
Caractères communicationnels de l’induction hypnotique
Pour tenter d’y voir un peu plus clair dans la façon dontse joue, dans la pratique hypnotique, la question de la vérité,revenons en, pour l’analyser un peu, à la phénoménologie del’expérience : nous partirons de la façon dont HippolyteBernheim pratiquait, à la fin du siècle dernier. On ne pratiqueplus guère de la sorte aujourd’hui, en hypnothérapie1, depuisque Milton Erickson (entre autres) a élaboré diversestechniques plus subtiles, nettement moins autoritaires, plusindirectes et permissives, sans doute davantage en phase avecl’éthos démocratique d’aujourd’hui : mais ces procédéséricksoniens étant plus complexes à analyser, les formulationsde Bernheim nous fourniront un matériau plus facile à traiter.
Voici comment Bernheim nous raconte sa façon de procéder àune induction hypnotique :
« […] je lui dis : « Regardez-moi bien et ne songez qu’à dormir. Vous allez sentirune lourdeur dans les paupières, une fatigue dans vos yeux : ils clignotent, ils vont semouiller ; la vue devient confuse ; ils se ferment. » Quelques sujets ferment les yeux
1 Les hypnotiseurs de music-hall, en revanche, continuent à utiliser unstyle proche de celui de Bernheim.
2
immédiatement. Chez d’autres, je répète, j’accentue davantage, j’ajoute le geste ; peuimporte la nature du geste. Je place deux doigts de la main droite devant les yeux dela personne et je l’invite à les fixer, ou bien avec les deux mains je passe plusieurs foisde haut en bas devant ses yeux : ou bien encore je l’engage à fixer les miens et jetâche en même temps de concentrer toute son attention sur l’idée du sommeil. Je dis :« Vos paupières se ferment, vous ne pouvez plus les ouvrir. Vous éprouvez unelourdeur dans les bras, dans les jambes ; vous ne sentez plus rien ; le sommeil vient »,et j’ajoute d’un ton un peu impérieux : « Dormez. » Souvent ce mot emporte labalance ; les yeux se ferment ; le malade dort ou du moins est influencé. »(Bernheim, 1888)
Et au besoin, ajoute Bernheim, il faudra répéter lessuggestions : « Vos paupières sont collées, vous ne pouvez plus les ouvrir ; lebesoin de dormir devient de plus en plus profond ; vous ne pouvez plus résister. »
Il y aurait sans doute beaucoup à dire sur lescomportements non-verbaux de l’hypnotiste, dans ce drôle de jeuque l’on appelle une séance d’hypnose. Nous ne nous yattacherons pas particulièrement ici, suivant d’ailleurs encela une indication de Bernheim, qui nous dit, dans la suite dutexte, que « Les passes, la fixation des yeux ou des doigts de l’opérateur […] nesont pas absolument nécessaires. » Nous nous interrogerons plutôt surcertaines particularités de ce discours singulier que l’onappelle une induction hypnotique.
Une première chose qui ne frappe peut-être pas trèsclairement ici, parce que Bernheim nous donne une sorte derésumé de son induction, c’est la relative pauvreté et lagrande monotonie du discours : il y est question principalementdes yeux qui se ferment, du sommeil qui vient, etaccessoirement de sensations de lourdeur, et cela est répétéautant de fois qu’il le faudra pour que le sujet entre enhypnose. Cette monotonie n’est pas sans évoquer celle despasses pratiquées par les ancêtres des hypnotistes, lesmagnétiseurs - qui les croyaient susceptibles de rééquilibrerle fluide magnétique du malade - et on la retrouve aussi dansles formulations parfois très pauvres en information desinductions éricksoniennes2. Elles suggèrent que la sensory
2 Une induction de style éricksonien pourrait comporter des formulationsextrêmement pauvres en information du genre : « et vous pouvez remarquer certainessensations, peut-être différentes dans telle zone du corps ou dans telle autre, sensations qui semodifient, ici ou là, se transformant petit à petit en d’autres sensations, quelque peu différentes qui àleur tour évoluent sans qu’il soit possible de savoir d’avance comment, dans quelle zone exactement,
3
deprivation, l’isolation sensorielle joue un rôle dans lephénomène hypnotique, comme d’ailleurs dans la plupart sinondans tous les comportements dits de transe3. A ce titre, lesparoles répétées tant et plus par l’hypnotiste seraient dansune certaine mesure comparable au battement des instruments depercussion dans une cérémonie de type vaudou ou candomblé oudans bien d’autres rituels : elles n’apportent rien de neuf etfavorisent ainsi une baisse de la vigilance.
Ensuite, si l’on analyse les phrases prononcées parBernheim, on constate qu’elles consistent en une succession dedescriptions (« Vos paupières se ferment »), de prédictions (« ils vont semouiller ») et d’ordres (« Dormez »).
Les ordres ne sont nullement indispensables en hypnose, etles approches modernes non autoritaires les ont complètementabandonnés. Leur présence dans le texte de Bernheim auratoutefois l’intérêt de nous faire réfléchir sur lespropositions descriptives qu’ils émaillent.
« Vos paupières se ferment », cette phrase typique du discoursde l’hypnotique, est en effet une curieuse proposition : elle abien une forme descriptive, cela ne fait pas de doute, maiselle a la particularité d’être fausse, (ou encore fausse), aumoment ou elle est énoncée. A ce titre, elle pourrait releverdes diverses modalités du discours faux, soit le discourserroné, le discours mensonger ou le discours fictionnel. À premièrevue, aucune de ces catégories ne peut pourtant convenir : cediscours ne relève pas de l’erreur, dans la mesure oùl’hypnotiste sait fort bien qu’au moment il formule cettephrase, elle ne correspond pas (encore) à la réalité ; elle nerelève pas non plus du mensonge ou de la tromperie, parce qu’ilsait que le sujet sait qu’elle est fausse, et le but n’est
la lourdeur est en train de se développer et la détente qui l’accompagne en s’approfondissantprogressivement et en se répandant de proche en proche vers les zones voisines, tandis que ceprocessus continue à poursuivre son petit bonhomme de chemin… ». (Les constructionsgrammaticales sont dans ce type de communication, délibérémentdéfectueuses.)3 Quand les stimuli auxquels est soumis l’individu sont supprimés au maximum(caisson d’isolation sensorielle), ou quand ils sont rendus constants(monotonie), ou encore, ce qui revient à peu près au même, quand ils sonttrès répétitifs (rythmes), peu d’informations nouvelles lui parviennent.Des vécus apparentés à la rêverie, que l’on a coutume de désigner comme« états de conscience modifiée » tendent alors à se développer.
4
évidemment pas de faire croire que les yeux sont fermés tandisqu’en fait ils resteraient ouverts. Et il ne s’agit pas nonplus d’un discours ouvertement fictionnel dans la mesure où ilest supposé être sérieux.
Nous nous retrouvons donc dans un certain embarras pourcaractériser la nature du discours proféré par un hypnotistedans le cadre de ce que l’on appelle une induction.
La dimension injonctive des suggestions
Cet embarras, il serait possible, peut-être, de ledissiper assez rapidement. Par exemple en utilisant le mot« suggestion » et en considérant, tout simplement, que lespropositions de forme descriptive peuvent non seulement êtredes erreurs, des mensonges ou des fictions, mais qu’ellespeuvent aussi être des « suggestions ». On ferait alorsremarquer à bon droit que ce n’est sans doute pas par hasard sices énoncés de forme descriptive cohabitent avec des ordres :et l’on pourrait dire que les suggestions sont des énoncés quiont la même forme que les descriptions mais un usage qui estcelui de l’ordre, de la demande impérieuse ou du commandement.Une suggestion serait donc simplement une proposition de formedescriptive mais d’usage injonctif4.
Dans cette perspective, on pourrait dire que l’hypnoseprocède d’un type de communication dans lequel l’opérateurdonne des ordres au sujet, mais des ordres qui se dénient commetels, des ordres qui se dissimuleraient sous des apparencesbenoîtement descriptives : telle serait la définition correctedes suggestions.
Cette façon de voir les choses peut se défendre. Elle estrelativement en phase avec tout un courant de la rechercheexpérimentale contemporaine sur l’hypnose, un courantactuellement majoritaire, celui du courant dit anti-étatiste (non-state theorists) : il s’agit des théoriciens et des
4 La présence de prédictions dans ce contexte ne poserait pas de problèmesparticuliers puisque de toutes façons des énoncés descriptifs au futurpeuvent être, à côté de l’impératif, une des modalités du langageinjonctif, comme dans la phrase « Les enfants, maintenant vous allez rangervos jouets ! ».
5
chercheurs qui, à la suite de Sarbin, Barber et Spanos5 nepensent pas que l’hypnose relève de processus ou d’étatsmentaux particuliers et qui considèrent qu’elle consiste en unesorte de jeu de rôle (ou en une « restructuration sociale-cognitive »). Ils mettent l’accent sur la participation activedu sujet, au sens où, selon eux, celui-ci tenterait simplementde complaire aux demandes de la situation et à celles del’opérateur en fournissant le comportement supposé attendu.
Il y a sans doute une part de vérité dans cette manière devoir, au moins pour un certain nombre de sujets : la façon devivre l’expérience hypnotique est assez variable d’un sujet àun autre, comme l’ont montré les travaux de Didier Michaux(1995), et l’on peut penser que pour certains sujets, peut-êtremême pour la majorité d’entre eux, les propositions d’alluredescriptive formulées par l’hypnotiste équivalent à des ordresou à tout le moins à des demandes pressantes, auxquels ilsessayent de satisfaire « en jouant le jeu ». On peut mêmepenser que cette dimension joue, à un degré ou à un autre pourtous les sujets.
En même temps, peut-être cette conception dissipe-t-elleun peu trop rapidement l’embarras où nous nous trouvions, etcela en partie pour des raisons d’ordre idéologique.L’acharnement dont font preuve les chercheurs anglo-saxons pourréduire le phénomène hypnotique à des comportements somme toutefondamentalement normaux, banals, anodins, relevant de lapsychologie des processus les plus habituels, est en effet biencompréhensible et tout à fait légitime si l’on reconnaît que lascience a pour vocation de ramener le non-connu, en particulierquand il est entouré d’un halo de mystère, à du connu. On peutse demander toutefois, s’il n’y a pas autre chose en jeu : undes mythes les plus fondamentaux de la culture occidentale estsans doute le mythe de l’individu, un individu relativementmonadique, clos sur lui-même et supposé doué de raison, devolonté, de libre-arbitre assurant son autonomie. Le faithypnotique, s’il consistait en un phénomène où l’on pourrait seretrouver intégralement soumis à l’influence d’autrui, pourrait
5 On trouvera un résumé des positions de ces auteurs dans Quelques orientations de la recherche nord-américaine en hypnose de J.-R. Laurence et S. Garnier (in Chertok, 1984) et dans Hypnose : le conflit phénomène/représentation sociale et ses enjeux deD. Michaux (in Stengers, 1993)
6
venir heurter de plein fouet cet individu que l’Occident s’estinventé en Grèce et n’a cessé de peaufiner pendant plus de deuxmillénaires. D’où la nécessité de pouvoir ramener à tout prixson fonctionnement, y compris quand il est en hypnose, à unelogique où sa liberté n’est pas trop atteinte et où sa volontépeut continuer à jouer un rôle majeur.
C’est l’occasion de remarquer que la « volonté » et la« liberté » dont il est question ici, et qui constituent sansdoute le noyau dur de la construction de l’individu, sont ellesaussi, dans une large mesure, des constructions sociales, commeen témoigne, par exemple, le fait qu’une culture comme celle dela Chine les a totalement ignorées, au point de devoir créerdes néologismes, à une époque relativement récente, pour rendreles notions subsumées dans la tradition occidentale sous cestermes.
S’interroger sans plus sur le point de savoir dans quellemesure le comportement hypnotique est volontaire ou non, soitdans l’espoir de pouvoir le réduire à des comportementsvolontaires normaux congruents à l’idée d’individu, soit pourl’attribuer à un état particulier ou à des processus spéciaux,pourrait donc bien avoir pour effet de limiter, comme par uncordon sanitaire, les questions plus dérangeantes et plusessentielles que l’hypnose nous pose.
Les performatifs
Pour en revenir aux caractéristiques de la communicationhypnotique, telle que l’induction de Bernheim nous lesmanifeste, les propositions descriptives du type « Vos paupières seferment » pourraient par exemple être rapprochées d’unecatégorie de discours autre que celles de l’erreur, du mensongeou de la fiction. Nous pensons aux performatifs étudiés par lephilosophe John L. Austin (Austin, 1970). Il oppose cesexpressions aux simples expressions constatives. Un exemple decelles-ci serait « Cette table est en bois », tandis qu’unexemple de performatif serait « Je promets de venir ». Enénonçant une telle phrase, le locuteur n’est pas en train defaire une simple description de son action, il ne se borne pasà la constater. Il est en train de l’accomplir, enl’occurrence, il promet, il fait une promesse, et il le fait aumoyen de cette formule. Cette promesse peut être sincère ou
7
non, elle peut être tenue ou non. Mais une fois qu’elle estfaite, elle est faite, « une promesse est une promesse », commeon dit. Ce n’est pas parce que l’on énonce une propositionconstative comme « Je marche » que l’on marche, mais c’est bienparce que l’on dit « Je promets » que l’on promet. Unperformatif s’autoréalise.
Bien d’autres expressions sont de nature performative,comme par exemple « Je vous présente mes excuses », « Je vousfélicite », « Je vous déclare unis par les liens du mariage »,« Je baptise ce navire Queen Mary », « Nous protestons contrecette manière de faire ». Souvent, ces expressions font usagede verbes particuliers, comme « promettre », « nommer »,« déclarer », « proclamer », « protester », « baptiser »,utilisés à la première personne du singulier ou du pluriel, etc’est alors que leur fonction performative est la plus nette.Mais elles peuvent aussi utiliser des formes passives comme« L’état de siège est proclamé », « Vous êtes promu au grade degénéral », ou « La séance est levée ».
Si l’on considère ce dernier exemple, « La séance estlevée », on a affaire à une phrase de forme descriptive, et quipeut effectivement fonctionner dans un registre apparemmentpurement descriptif, quand elle est par exemple prononcée parun journaliste faisant un compte rendu parlementaire en direct.Mais quand elle est prononcée par le président de l’AssembléeNationale, (ou par le président d’un Conseil d’Administration),son usage n’est manifestement plus purement descriptif. Laprononcer revient à effectivement lever la séance. S’agit-ild’interpréter ceci comme un ordre ? On le pourrait. On pourraitdire qu’en prononçant cette phrase le président de la chambreordonne aux députés de s’en aller. On sent toutefois bien cequ’aurait d’inadéquat une telle interprétation. On comprendraitmal d’ailleurs que le président n’utilise pas une expressionplus directe comme « Veuillez partir, Messieurs lesdéputés ! ». C’est donc qu’autre chose est en jeu. Ouvrir oulever une séance, c’est la créer, l’instituer, dans son débutou sa fin, c’est en produire l’espace-temps qui lui est propre.Les performatifs mettent en jeu non seulement la fonctionpragmatique du langage, mais aussi sa fonction référentielle,en créant de la réalité. Certes, la séance qui est ainsi crééepar le performatif du président, ne l’est pas ex nihilo : saforme préexistait, de la même façon que lorsque l’on fait une
8
promesse particulière, on n’invente pas de toute pièces laforme « promesse ». On utilise ces formes, mais pour créer àchaque fois une réalité particulière, cette séance-ci, cettepromesse-ci.
Dire que le discours est ainsi sollicité par lesperformatifs au niveau de sa fonction référentielle pose doncun problème : un ré-férent est en effet ce à quoi est censé serapporter un discours, il est l’objet dont il parle, et cetobjet est supposé être déjà-là, il est supposé lui préexister.Or, voici qu’avec les performatifs, le discours semble créer cedont il parle, il semble le produire, même si c’est à partird’une forme qu’il n’a pas inventé, comme une séance deparlement ou une promesse.
C’est là un aspect des choses auquel Austin et sesdisciples n’ont peut-être pas prêté suffisamment d’attention :ils ont insisté sur le fait que les performatifs permettaientde faire des choses, comme s’excuser, promettre, nommer à unposte, baptiser, pardonner, avertir, déclarer, proclamer,plutôt que de les décrire. Le célèbre ouvrage d’Austins’intitule « How to do things with words » et l’on peut dire quedans son analyse il a probablement beaucoup plus mis l’accentsur « to do » que sur « things ». C’est ce qui l’a mené à abandonnerla distinction constatatifs/performatifs pour une autredistinction, celle des actes locutoires (le fait de dire),illocutoires (ce qu'on fait en disant) et perlocutoires (le résultatvisé ou obtenu par le fait de dire). L’idée d’Austin c’est que,quoi que l’on dise, on fait : même quand on énonce simplement« Cette table est en bois », une proposition typiquementconstative, on fait quelque chose, en l’occurrence on affirme.Tout acte locutoire est donc, selon Austin, en même temps unacte illocutoire : en disant ce que l’on dit, on fait.
Référence et proférence
Cette analyse n’est pas fausse, mais trop partielle. Enmettant l’accent sur le rapport interpersonnel dans lediscours, elle néglige de s’interroger sur la nature de sonrapport au réel. Or, ce rapport bouscule allègrement laconception classique du langage telle qu’elle s’incarne dans lanotion de référent. Avec les expressions performatives, leréférent n’est plus un pur déjà là, préexistant auquel on se
9
rapporte : il devient ce que le locuteur crée, ce qu’ilproduit : c’est ce qui nous a motivé à risquer le concept deproférence6, en considérant que le langage ne se borne pas à serapporter à du déjà existant, mais contribue à le créer par lediscours. Une fois cette création réalisée, une fois leproférent créé, il tend à se présenter à nous comme sesoutenant d’une existence indépendante de la nôtre, comme sis’était effacée en lui toute trace de sa création. C’est ainsique, pour reprendre un exemple déjà utilisé, si un journalistefait le commentaire en direct d’une séance au parlement, ilpourra avoir le sentiment que sa phrase « La séance est levée » a unefonction purement descriptive, purement constatative, et il enira de même pour ses auditeurs. Cette illusion peut fonctionnersans problème tant que l’on n’est pas dans une situation decrise institutionnelle majeure. Si l’on se trouvait à unepériode où le pouvoir est contesté, où il a perdu toutelégitimité aux yeux d’une part importante de la population, lespropos de ce journaliste n’apparaîtraient plus comme une simpledescription, mais seraient entendus comme prenant part à laproférence abusive et illégitime du prétendu président d’unpseudo parlement. Ce qui revient à dire qu’en période normale,quand règne un large consensus sur la légitimité du pouvoir,cette phrase du journaliste participe en fait à une co-proférence généralisée, tellement généralisée qu’elle revêt lesapparences d’une simple description d’un état de fait. Et l’onpeut se demander dans quelle mesure il n’en va pas de même pourtoutes les propositions descriptives.
C’est la raison pour laquelle il nous semble pertinent detraquer la performativité du langage non seulement dans ce quel’on fait en parlant (dimension horizontale, interlocutive,pragmatique du langage), mais aussi dans son rapport« vertical » au réel : quand on parle, le langage ne se bornejamais à refléter une réalité purement déjà là. Pour prendre unexemple emprunté à Lakoff et Johnson, d'une même personne, unlocuteur pourrait dire :
"1.J'ai invité une blonde pulpeuse à notre soirée
2.J'ai invité une violoncelliste renommée à notre soirée
3.J'ai invité une marxiste à notre soirée6 (Melchior, 1998)
10
4.J'ai invité une lesbienne à notre soirée." (Lakoff etJohnson, 1985)
Dans la théorie classique de la référence héritée deFrege, on dira que dans ces diverses phrases, le référent (oudénotation) est toujours le même, la personne X qui a étéinvitée mais que le sens est chaque fois différent. Le problèmeest de savoir pour qui ce référent est identique Cetteconception ne peut en effet se soutenir qu’à condition depostuler un sujet qui sait ce qu’il en est objectivement duréférent en question, un sujet divin, en quelque sorte,problème que nous retrouverons plus loin quand nous évoqueronsle problème du référent des énoncés fictionnels. Limitons-nousà remarquer pour l’instant que cette conception classique tendà évacuer la façon dont le langage construit son référent enl’insérant inévitablement dans un réseau de catégories, et luien intégrant en quelque sorte les significations propres à cescatégories. Pour le dire autrement, une femme peut être blonde,violoncelliste, marxiste et lesbienne tout à la fois, mais iln’en demeure pas moins que pour n’importe quel locuteur oudestinataire normalement constitué, une blonde est autre chosequ’une violoncelliste, qu’une marxiste ou qu’une lesbienne.
C’est d’ailleurs ce que Frege lui-même exprimait au toutdébut de son article Sinn und Bedeutung (1892) quand ilécrivait :
« Dans une perspective idéaliste et sceptique, peut-être a-t-on déjà soulevécette objection : « Tu parles ici, sans plus, de la lune comme d'un objet, mais d'oùtiens-tu que le nom « la lune » a une dénotation ? D'où tiens-tu que quoi que ce soitait une dénotation ? Je réponds que, en disant « la lune », il n'est pas dans monintention de parler de notre représentation de la lune, et que nous ne nouscontentons pas non plus du sens; nous supposons une dénotation. » (Frege,1971, nous soulignons.)
Quelques lignes plus loin Frege dit encore :
« il suffit de mettre en évidence le dessein tacitement impliqué dans la paroleet la pensée, pour qu'il soit légitime de parler de la dénotation d'un signe ».
C’est bien cet engagement référentiel, ontologique,inhérent au discours, le fait qu’il est toujours visée d’unhorizon extra-linguistique, qui apparaît dans son plein éclat à
11
l’occasion des performatifs et dans le discours hypnotique ;si cette proférentialité peut apparaître moins nettement dansles usages purement descriptifs du discours, elle y restenéanmoins présente, comme le texte de Frege que nous venons deciter le relève.
Ces quelques lignes de Frege, seront néanmoins viteamendées par lui : la dernière phrase que nous citions, danslaquelle il dit que « le dessein tacitement impliqué dans la parole et lapensée » légitime le fait « de parler de la dénotation d’un signe » se voitcorrigée par cette restriction de taille : « même s'il convientd'ajouter : au cas où une telle dénotation existe. »
Ce que Frege ne précise pas, encore une fois, c’est lepoint de savoir : pour qui, selon qui, aux yeux de qui, une telledénotation existerait ou n’existerait pas ? Le locuteur ? Ledestinataire ? Ou un Tiers, humain ou (plus vraisemblablement)divin ?
Ceci étant, dans quelle mesure la performativité, laproférentialité, à l’œuvre dans le discours est-elle à mêmed’éclairer ce qui se passe lors d’une induction hypnotique, ouinversement, dans quelle mesure cette dernière est-elle denature à éclairer cette performativité du discours ?
Le problème des comportements non-volontaires
La phrase de Bernheim « Vos paupières se ferment » concerne uncomportement qui fait partie de ceux ordinairement réputésvolontaires, le fait de fermer les paupières. Il n’en vatoutefois pas ainsi pour toutes les suggestions hypnotiques :elles peuvent consister en phrases telles que « Vous éprouvezune lourdeur dans les bras », « Un profond sentiment de joie sedéveloppe en vous », « Le bras devient de plus en plusengourdi, tellement engourdi qu’il en devient insensible »,« La sensation de brûlure diminue et fait place à une agréablesensation de fraîcheur tandis que votre peau cicatrise et sereconstitue petit à petit dans les zones qui avaient étéatteintes », « La migraine s’estompe et une agréable sensationde confort s’installe dans la tête », « Vous avez à présent sixans et vous jouer dans la cour de l’école ». Dans ces phrases,les comportements (au sens large), les vécus, les processus quisont suggérés ne relèvent pas de ce qui est couramment admis
12
relever de la volonté. L’idée qu’en les mettant en œuvre, lesujet ou le patient obéirait à un ordre voilé pose doncproblème, dans la mesure où un ordre ne peut avoir de sens ques’il concerne une action réputée volontaire. On ne peut guèreordonner à quelqu’un d’avoir faim !
Les théoriciens anti-étatistes, toujours soucieux dedénier toute spécificité aux phénomènes hypnotiques, ont tentéde résoudre cette difficulté de deux façons.
D’une part, ils ont essayé de minimiser l’importance etl’ampleur des comportements qui pouvaient ainsi êtreeffectivement obtenus. Il ressort de leurs travaux au coursd’expériences soigneusement contrôlées que l’hypnose seraitbien moins à même de produire des phénomènes étonnants qu’ellele prétendait. Ses effets seraient somme toute assez banals.Cette conclusion comporte une part de vérité indéniable,l’hypnose n’est pas aussi magique qu’on a pu le croire. Ils’agit cependant de se demander dans quelle mesure lesexpériences standardisées de laboratoire, menées par desexpérimentateurs souvent assez sceptiques, constituent lemeilleur contexte pour observer les phénomènes en question dansleur plus grande amplitude.
D’autre part, les anti-étatistes ont essayé de montrer queces phénomènes de type a priori non volontaires pouvaient dansune certaine mesure être produits par des sujets auxquels ondemandait de s’efforcer de les produire délibérément, enrecourant au besoin à l’imagerie mentale. Les résultats obtenustémoignent à leurs yeux du fait que tel est bien le cas.
Nous n’insisterons pas ici sur les problèmes que soulève ànos yeux ce genre d’expérimentation. Une des questions qui sepose est notamment celle de savoir dans quelle mesure lesexhortations à l’usage de la volonté témoignent effectivementdu fait que c’est elle qui est l’agent opérant : demander à unsujet de rendre délibérément son bras insensible, ou luidemander de délibérément se retrouver à l’âge de cinq ans,c’est aussi, inévitablement, lui communiquer, explicitement ouimplicitement, la certitude dans lequel on le tient de sacapacité à le faire. Ce qui s’apparente, qu’on le veuille ounon, à de la suggestion.
13
Par ailleurs, le fait que ces procédures font fréquemmentrecours à de l’imagerie mentale (on propose par exemple ausujet de s’imaginer que son bras s’engourdit) montre bienl’importance des représentations dans ce qui est ici en jeu. Detoutes évidence, dans leurs tentatives pour obtenir sansinduction hypnotique les mêmes effets que l’hypnose, les anti-étatistes ne font pas appel qu’à la volonté, mais aussi àl’imagination. On se retrouve donc assez près du registre de lasuggestion dans la mesure où celle-ci, procédant pardescription stimule l’imaginaire. La différence est qu’au lieude dire « Votre bras est insensible » comme le faitl’hypnotiseur classique, l’expérimentateur anti-étatiste diraquelque chose comme « Je vous demande d’imaginer que votre brasest insensible ». Ce qui revient à dire qu’avec ce genre deformulation, on se déplace vers un type de discours qui prenddes allures plus ouvertement fictionnelles. Cette manière deprocéder fait en effet penser à un roman sur la première pageduquel l’auteur aurait pris soin d’indiquer qu’il s’agit bel etbien d’un roman, d’une fiction donc, et que « touteressemblance avec des personnages ou des faits réels ne seraitqu’une pure coïncidence ». Ce qui n’a jamais empêché l’auteurde poursuivre à la page suivante par « La marquise sortit àcinq heures… » et ce qui n’a jamais empêché ses lecteurs decroire, en lisant ces lignes à l’existence d’une marquisesortant de chez elle.
La fiction créatrice
Il est donc possible également de rapprocher la suggestionhypnotique de la fiction. A la différence des formulationsanti-étatistes, une suggestion hypnotique normale, pourraitêtre considérée comme une fiction qui ne s’avoue pas commetelle, en tous cas pas explicitement. Ce rapprochement paraîtd’autant plus pertinent que quand nous assistons à desfictions, un film, une pièce de théâtre, la lecture d’un roman,nous vivons également toute une gamme de phénomènes sensoriels,affectifs et émotionnels : tout en tremblant pour la vie duhéros, avec le cœur qui bat la chamade, ou en pleurant àchaudes larmes sur le cruel destin de la pauvre héroïne, nousne sentons plus le contact de notre corps contre le siège(alors qu’il nous paraîtrait éventuellement fort inconfortablesi le film était ennuyeux), nous ne nous avisons plus guère dela présence de nos voisins, nous ne percevons plus les
14
indications lumineuses des sorties de secours, nous ne nousrendons pas compte du temps qui s’écoule, bref, nous vivons cequi se passe comme la réalité même, en mettant entreparenthèses le contexte réel et en produisant toute une sériede phénomènes qui relèvent également de l’expériencehypnotique.
Or dans les usages performatifs du discours, la fictionest, d’une certaine façon, également à l’œuvre. Dire que « Laséance est ouverte », n’est-ce pas, au moment où l’on formulecette phrase, dire quelque chose de faux, proférer unefiction ? Il se trouve, cependant, que dans le cas duperformatif, cette fiction se rend vraie, se réalise, se véri-fie aussitôt qu’elle est énoncée et par le fait même de sonénonciation. Tel n’est pas le cas, dira-t-on pour la fictionnormale, la fiction habituelle, celle qui ne relève pas d’unusage performatif particulier.
Cela n’est pourtant pas si évident. Les auteurs qui onttraité du rapport de la fiction au réel affirment en effet, lesuns, que le discours fictionnel a comme particularité de ne pasavoir de référent, d’autres qu’il ne réfère pas, en effet, mais faitsemblant de référer, d’autres encore qu’il a bien un référent maisque ce référent est imaginaire, qu’il est seulement un « être defiction ». Ce flottement est significatif : il témoigne bien dela difficulté à penser le problème de la référence.
Toute la question est, encore une fois, de savoir aux yeuxde qui, le référent d’un discours peut être dit soit réel, soitinexistant ou purement imaginaire. Quand Frege, prenantl’exemple d’Ulysse débarquant à Ithaque, nous affirme que cerécit a bien un sens, mais n’a pas de référent, qu’est-ce àdire ? Se mettrait-il à brutalement avoir un référent sid’aventure des archéologues découvraient des indices témoignantdu fait qu’Ulysse avait réellement existé ? Et s’il y avaitcontroverse entre les différents archéologues sur la question,ce référent vacillerait-il au gré des mouvements d’opinion tantque la controverse ne serait pas tranchée, à supposer qu’ellele soit un jour ? Dire qu’un discours est vrai, ou qu’aucontraire il est faux, ou encore que c’est une fiction,présuppose un observateur « en survol absolu », comme disaitMerleau-Ponty, juché au-dessus de la relation entre langage etréalité, et capable de dire infailliblement ce qu’il en est
15
effectivement de leur correspondance ou de leur noncorrespondance. La vérité comme l’erreur présupposent donc unDieu omniscient, et tout se passe comme si c’était le regard dece Dieu que tente d’approcher le consensus des humains. Il n’endemeure pas moins que, pour la personne qui croit au discoursqu’elle énonce ou à celui qu’on lui tient, le référent nesaurait être que réel, quoi que puissent en penser d’autres ouquoi que puisse en penser un hypothétique Dieu omniscient. Cequi revient à dire que même si la référence est tenue (parqui ?) pour « objectivement » inexistante, cela n’abolit pasla fonction proférentielle pour autant.
Freud disait que l’inconscient ignore la négation ; iln’est certes pas évident que quelque chose comme l’inconscientexiste, que ce soit celui de Sigmund Freud, de Mélanie Klein,de Jacques Lacan ou de Milton Erickson, mais il semble clairque la négation est une acquisition relativement tardive, cequi fait que le discours, quand il parle de quelque chose, nepeut manquer d’en susciter la proférence, même dans uneproposition négative. On a dit que « le mot est le meurtre dela chose », voulant dire par là qu’il s’y substitue ; ilconvient d’ajouter que de ce fait, la chose est devenue le fantôme dumot, autrement dit que sa proférence l’accompagne toujours.C’est ainsi qu’un roman érotique dont chaque phrase seraitprécédée par la clausule « Il n’est pas vrai que », necesserait pas d’être érotique pour autant d’être, même si celale rendrait, convenons-en, d’un genre quelque peu fastidieux àlire. C’est pourquoi aussi les rumeurs peuvent toujours êtredévastatrices : même démenties, il en restera toujours quelquechose.
L’usage thérapeutique et hypnotique de la proférence
La rhétorique hypnotique tient largement compte de ceprincipe quand, par exemple, pour favoriser une analgésie, ellese garde soigneusement de formulations telles que « Vous avezde moins en moins mal », « Vous souffrez de moins en moins »,« La douleur diminue », pour leur préférer des formulationsévoquant des réalités antagonistes à la douleur (par exemple,« Une sensation de fraîcheur se répand », « Une sorted’engourdissement se développe »). Et les pratiquesthérapeutiques inspirées de l’hypnose respecteront également ceprincipe de proférence en évitant tous les énoncés risquant de
16
réifier les difficultés ou de les aggraver et en utilisantaussi systématiquement que possible des formulations évoquantles ressources, les possibilités de changements dans le senscorrespondant aux objectifs du patient7.
L’un des courants issus de l’hypnose éricksonienne, lathérapie focalisée sur la solution de Steve DeShazer, va même jusqu’à seservir presque exclusivement du principe de proférence : oninvite simplement le patient à parler des exceptions à sesdifficultés, c’est-à-dire des circonstances où elles seproduisent moins souvent ou moins intensément, on lui posemille questions à ce sujet pour qu’il fournisse un maximum dedétails, on en favorise donc la proférence, on contribue par làà les faire exister. Au besoin, en s’inspirant des techniqueshypnotiques de progression en âge, on lui pose la question desavoir comment les choses se passeraient si, pendant la nuit,un miracle survenait le débarrassant de ce qui lui reste dedifficultés : à quoi s’en rendrait-il compte ? Que ferait-il dedifférent ? À quoi les autres s’en rendraient-ils compte ? Quiparmi ses proches s’en apercevrait en premier ? Commentréagirait-il ? Toutes ces questions (posées de préférence àl’indicatif présent plutôt qu’au futur ou au conditionnel) fontun usage massif et délibéré de la présupposition linguistique,elles présupposent toutes que le changement a déjà eu lieu, ellesinterrogent sur ses diverses modalités, et par là elles necessent de le proférer et d’en favoriser la réalisationeffective.
Les prédictions autoréalisantes
On s’aperçoit donc que croire réel le référent d’undiscours, ce qui est toujours l’attitude que spontanément nousavons tendance à adopter à un degré ou à un autre, a poureffet, dans un grand nombre de cas, d’en assurer laréalisation. En témoignent, bien au-delà de l’univers de lathérapie et de l’hypnose, les phénomènes qu’à la suite dusociologue américain Robert K. Merton on appelle prédictions7 On pourrait illustrer cette application généralisée du principe deproférence par un exemple emprunté à la vie quotidienne : il estprobablement plus utile de dire à Toto, « Il fait froid, à la récré souviens-toi de mettre ton bonnet », plutôt que de lui dire « N’oublie pas de mettreton bonnet ». Avec cette dernière formulation, on ne pourrait que favoriserl’oubli, ou, à tout le moins, rendre à l’enfant plus difficile l’exécutionde la consigne.
17
autoréalisantes (self-fulfilling prophecies). Quand par exemple uncélèbre « gourou » de la bourse publie dans le Wall Street Journalun article dans lequel il affirme que le cours d’une certainecatégorie d’actions va augmenter dans les semaines à venir, leslecteurs qui croient en la valeur de ses analyses vont acheterces actions avec pour effet que leur prix va effectivementaugmenter.
Dira-t-on dans ce cas que cette prédiction était vraie ?Elle l’est, certes, mais d’une manière bien particulièrepuisque c’est ici l’effet même de l’énonciation qui modifie leréférent. Au sens de la conception classique de la vérité, ileût fallu pour que l’on puisse parler d’un discours vrai quecelui ci reste enfermé dans le secret d’un tiroir de bureau,que l’énoncé reste sans influence sur son objet. Dès lors quel’énonciation interfère dans le référent de l’énoncé, il n’estplus possible de parler de vérité au sens classique du terme.
Ce genre de cas de figure est loin d’être rare. L’EffetRosenthal ou Effet Pygmalion étudié par la psychologie socialeen est un exemple bien connu : quand des classes d’élèves sontdécrites à certains enseignants comme bonnes, intelligentes,courageuses et motivées, tandis que d’autres, de niveauparfaitement identique, sont décrites à d’autres enseignantscomme faibles, paresseuses, peu coopératives et peu motivées,on constate qu’après quelque temps, les classes réputéesfaibles sont effectivement devenues plus faibles que lesclasses réputées bonnes.8.
Ces expériences sont importantes parce qu’elles mettent enévidence à quel point, à un degré ou à un autre, nos croyancesinfluencent constamment, dans notre vie quotidienne, la réalitéà laquelle nous avons affaire, pourvu qu’elle puisse en quelquefaçon dépendre de nous. Si une mère est persuadée, à tort ou àraison que son enfant souffre de telle ou telle déficience, sescroyances auront de bonnes probabilités, via son comportementverbal et non-verbal, de susciter ces déficiences. Si unsportif est convaincu de sa supériorité sur ses adversaires,
8 Il semblerait que les expériences relatives à l’Effet Pygmalion n’aientpas pu toujours être répliquées avec succès, sans doute parce qu’elles sontelles-mêmes sujettes à l’Effet Pygmalion, ce qui permettra à chacun, selonsa sensibilité, soit d’y voir une raison d’en douter, soit d’y voir uneconfirmation éclatante.
18
cela augmentera ses probabilités d’en triompher. Si un patientest convaincu que la pilule qu’on lui donne est un médicament,il aura de bonnes chances de s’en porter mieux, réalisant ainsiun Effet placebo.
Dans la mesure où ces croyances peuvent théoriquement êtreformulées sous la forme de propositions de forme purementdescriptive, elles nous montrent que ces descriptions, loin derester sans effet sur l’objet auquel elles réfèrent,interfèrent avec lui, contribuant ainsi à le produire ou à lemodifier, pour le pire comme pour le meilleur.
Une condition semble toutefois être requise pour que celapuisse se produire : il faut que l’interaction entre l’énoncéet son référent, par le biais de l’énonciation ou par lescomportements auxquels cet énoncé donne lieu, soit suffisammentforte.
Cette condition est manifestement remplie en hypnose,particulièrement s’il s’agit d’hypnothérapie, c’est-à-dire d’uncontexte où, plus que dans les situations de laboratoire, lesujet – en l’occurrence, le patient – est vivement intéressé àretirer un bénéfice du processus.
Dissociation et intralocution
La suggestion hypnotique, semble donc être au carrefourdes injonctifs, des performatifs, des discours fictionnels etdes descriptions auto-réalisantes. Mais elle manifestecependant une particularité que nous n’avons pas encore évoquéeet qui peut être de nature à mieux marquer sa différence. Ils’agit du fait que, dans la suggestion, au moins pendantl’induction, le référent du discours est identique, en tout ouen partie, à son destinataire. Ainsi, dans la phrase deBernheim « Vos paupières se ferment » c’est bien des paupières dusujet que Bernheim parle, et c’est à lui qu’il en parle.
Une première chose à relever, à ce propos, c’est que,quand on parle ainsi à quelqu’un de tel ou tel aspect de soncomportement, extérieur (ses paupières qui se ferment) ouintérieur (le calme ou la lourdeur qui s’installent en lui), onl’invite par là même à se mettre en position de spectateur parrapport à lui-même. En formulant un discours qui amène le sujet
19
à devenir simple observateur passif de lui-même, assistant àses propres faits et gestes, à ses propres vécus comme à autantde choses qui lui arrivent d’elles-mêmes, spontanément,automatiquement, sans intervention apparente de sa volonté, lelangage hypnotique favorise ce qu’il a coutume d’appeler une« dissociation ». Cette mise en spectateur passif du sujet estencore favorisée par le fait que les comportements décrits lesont selon des formulations dissociatives qui en font dessujets de l’action. L’hypnotiste ne dira pas « Vous fermez vospaupières », mais « Vos paupières se ferment » ; il ne dira pas« Vous vous calmez », mais « Le calme s’installe en vous »9.
Deuxièmement, très fréquemment, le discours hypnotiquesera amené à parler au sujet de ses propres états internes, commedans la phrase « Le calme s’installe en vous » ou comme dans« Vous voyez un paysage agréable dans lequel vous avez plaisirà vous promener ».
Ce genre de formulations, on n’y a pas suffisamment prêtéattention, procède allègrement à la violation d’une règleimplicite mais fondamentale de la communication humaine, unerègle qui stipule que seul le locuteur est habilité à asserter catégoriquementau sujet de ses états internes. Je peux affirmer légitimement « J’aifaim », « J’ai envie de faire l’amour » ou « Je pense àl’Italie », mais je ne peux pas légitimement dire « Vous avezfaim », « Vous avez envie de faire l’amour » ou « Vous pensez àl’Italie ». Si je le faisais, mon interlocuteur serait en droitde me remettre énergiquement à ma place en me faisant remarquerqu’il sait quand même mieux que moi ce qu’il pense ou ce qu’iléprouve. Tout se passe donc comme si un principe que l’onpourrait appeler « principe d’altérité », régissait la communicationhumaine ordinaire10. Il joue probablement un rôle fondamental
9 Notons au passage que la « règle fondamentale » de l’analyse, tellequ’elle fut formulée par Freud, favorise une dissociation analogue : lesujet est invité à observer ses pensées comme un voyageur en train quiregarderait défiler le paysage, et à communiquer sans réserves ce qu’ilvoit à son analyste. Dans l’analyse comme dans l’hypnose, le sujetconscient volontaire se retrouve donc relativement mis hors jeu, iln’intervient plus que comme spectateur assurant éventuellement un simplecommentaire en direct.
10 Il est bien possible que dans une culture aussi individualiste que laculture occidentale, ce principe joue un rôle bien plus important qu’end’autres lieux ou d’autres époques.
20
dans la constitution de l’identité personnelle : s’iln’existait pas, si tout un chacun pouvait légitimement etcatégoriquement affirmer des choses concernant le vécud’autrui, on voit mal comment, ainsi « squattés » par autruidans notre intimité, nous pourrions constituer notre propremonde intérieur. Il est certes indispensable que pendant lapériode où l’enfant est encore infans, ses parents mettent desmots sur ses vécus là où il est incapable d’en mettre lui-même.Mais il est nécessaire qu’ils le laissent en mettre lui-mêmedès qu’il commence à pouvoir le faire. S’ils persistent àasserter catégoriquement sur son vécu, alors qu’il est en âgeet en capacité de pouvoir le faire lui-même, il n’est pasimpossible que cela débouche sur de sérieuses difficultés,éventuellement certaines formes de psychoses, ainsi que l’ontsuggéré divers auteurs.
L’hypnose procède donc assez massivement à la violation dece principe d’altérité, même si, de nos jours, c’est sous uneforme assez peu autoritaire. Et l’on peut penser que cetteviolation n’intervient pas pour rien dans la sorte de bulle àdeux qui se constitue ainsi, dans un estompage des frontièresdu « je » et du « tu » et que les hypnotistes ont appelé« rapport », ce « rapport » qui, repris à un degré ou à unautre par Freud, est l’ancêtre de la notion de transfert enpsychanalyse. La communication hypnotique remplace ainsi leprocessus d’interlocution qui prévaut habituellement par unprocessus dans lequel le destinataire accepte, jusqu’à uncertain point et dans une mesure variable selon les cas, delaisser le locuteur énoncer ses états internes. Celui-cidevient ainsi l’intralocuteur de son sujet, et l’interlocution faitplace à une intralocution.
Il serait cependant erroné de penser que ces aspects de lacommunication hypnotique soient l’apanage de l’hypnose. Enpsychanalyse aussi, l’intralocution joue un rôle important dansla mesure où l’analysant accepte de laisser l’analyste lui direce qu’il en est du sens réel de ses propres paroles. Bien sûr,cela se fait subtilement : l’analyste ne dira pas « Je saismieux que vous ce que vous voulez réellement dire, je saismieux que vous ce que vous pensez et ce que vous éprouvez. »S’il le disait, il se verrait sans doute opposer une réactionvéhémente, comme c’est régulièrement le cas quand le principed’altérité nous semble brutalement mis à mal. Il n’en demeure
21
pas moins que le travail de l’analyste, ainsi que Freud l’adéfini, c’est d’interpréter et de fournir cette interprétationau patient. Ce faisant, il ne peut manquer d’interpréter, qu’ille veuille ou non, en fonction des références théoriquesauxquelles il adhère (freudiennes, lacaniennes, kleiniennes,jungiennes ou autres) ce qui l’amènera, inévitablement, à lesfaire partager peu ou prou à son patient. Il retrouvera parconséquent très largement ce qu’il s’était attendu à trouver,ce qui à ses yeux ne manquera pas de confirmer la justesse deses croyances théoriques.
La théorie mène donc le patient à s’y conformer, ce quisemble la confirmer, ce processus de conformation-confirmationréalisant ainsi une illustration de plus de la descriptionautoréalisante et de l’effet Pygmalion.
La psychanalyse a ainsi, on le voit, infiniment moinsrompu avec certains aspects de l’hypnose qu’elle ne le croitgénéralement, et la même chose est vraie pour tous les courantspsychothérapeutiques de type interprétatif. C’est ce qui nepeut manquer d’affecter d’un énorme coefficient d’incertitudeleur prétention à dire le vrai sur l’être humain, sesdifficultés, l’origine de celles-ci et les moyens d’y remédier.Il est d’autant plus important de le souligner qu’en cetteépoque de « désenchantement du monde », pour reprendrel’expression de Marcel Gauchet, la psychanalyse et quelquesautres courants thérapeutiques apparentés, prennent positionsur quantité de questions qui se posent à nous en ayant l’airde se livrer à de purs jugements de faits qui reviennent enréalité à proposer une doctrine morale, de facture globalementassez gréco-romano-chrétienne, mais sous des habits neufs,prenant ainsi le relais des théologies et des églisesdéfaillantes.
Les effets pragmatiques de la suggestion
De toute évidence, ce type de communication trèsparticulier constitué par ces descriptions injonctives-performatives-fictionnelles que sont les suggestions, et dont
22
nous avons décrit quelques aspects, n'a pas suffisamment retenul'attention des spécialistes. A découvrir ses particularités,on ne s'étonnera pas qu'elle favorise très souvent descomportements qui sont typiques de ceux habituellementconsidérés comme hypnotiques (sans qu'on ait eu besoin deprononcer une seule fois le mot « hypnose » ou l'un de sessynonymes). Ces effets comportementaux sont, par exemple :
- le fait que le destinataire semble répondre auxdescriptions de son comportement que le locuteur lui adresse enmanifestant ces comportements (ou en se conduisant de manièrecohérente avec elles);
- le fait que le destinataire semble perdre l'initiative de cequi se passe.
- les comportements suggérés semblent se produire d'eux-mêmes, d'une manière non-volontaire, spontanée.
- enfin, chez certaines personnes que, pour ce motif, onqualifiera de très « suggestibles », on pourra observer tout oupartie du spectre des phénomènes habituellement réputéshypnotiques (lévitation d'un bras, catalepsie, analgésie,régression en âge, hallucinations ...).
Quand un destinataire se voit adresser un certain nombrede messages assez pauvres en information, constitués depropositions descriptives dont le référent est son proprecomportement ou son propre vécu, avec une formulation qui faitde ceux-ci les sujets de l’action, ce destinataire peut donc enêtre affecté d'une manière particulière. Ce comportement se metà présenter certains écarts par rapport au comportement« normal », « ordinaire » et se met à ressembler auxcomportements réputés hypnotiques. En ce sens on peut dire quece type de communication est hypnogène.
La déclaration d'hypnose
La question est alors : si des phénomènes du genre de ceuxque l'on réfère à l'hypnose peuvent se produire sans qu'il soitbesoin de parler d'hypnose (ou d'utiliser ses synonymes),
23
qu'ajoute le fait de parler d'hypnose ? Ne conviendrait-il pas de dire quel'hypnose est tout simplement le résultat du type particulierde communication que nous venons d'exposer ?
Pour tenter de répondre à la question, le mieux est sansdoute d'en revenir, à nouveau, aux échanges communicationnelsmêmes.
Dans une induction relativement classique le mot« hypnose » (ou ses synonymes plus ou moins proches) apparaîtraen général de différentes façons :
1. Quand on fait état de certains comportements du sujeten leur attribuant la qualité d'être signes d'hypnose(ratification) ou moyens de l'entrée en hypnose (incorporation): par exemple : « le ralentissement de votre respiration qui manifeste votreentrée en transe.. »
Pour prendre ce dernier exemple, alors que la respirationn'avait jusque là aucune signification particulière, qu'ellen'était probablement même pas prise en considérationspécifiquement comme phénomène délimité, la voici mise enévidence et dotée d'une signification nouvelle : être moyen (ousigne) de la transe. Nous avons affaire là à un recadrage. Dansle processus d'induction, le terme « hypnose » sert doncd'abord à effectuer un recadrage (c'est-à-dire un changement designifications) d'une série de comportements ponctuels du sujetcomme hypnotiques ou hypnogènes.
2. Par le biais de suggestions directes ou indirectes (oude descriptions ?) établissant que la personne est hypnotisée(ou en train de le devenir). C'est dans cet usage que ladéclaration d'hypnose est la plus évidente, même quand elleadopte un style allusif : « Et vous continuez à entrer en transe ... », « Etmaintenant que votre main a touché votre visage, vous êtes totalement entré danscet état hypnotique .. ». Le sujet voit ainsi son comportement globalqualifié comme comportement hypnotique, comportement de transe.Nous avons là affaire à un second recadrage11 : c'est à présent latotalité du comportement du sujet qui, par ricochet, est en effetprogressivement recadrée comme "en hypnose". Tout ce qu'il fait,désormais pourra être placé sous le signe de l'hypnose. Il est
11 Ou, si l'on préfère, à un deuxième temps logique du recadrage.
24
"entré" dans un autre « état »; et cet autre état va affectertout son comportement.
3. Enfin, "hypnose" ou ses synonymes apparaîtrontéventuellement pour servir de support d'un certain nombre de prédicats :« Dans cet état de transe, vous avez accès à des informations, des souvenirs... vousêtes en contact avec d'autres parties de vous-même... vous êtes à même de favoriserdes changements au niveau corporel... ». Chez l'hypnotiseur autoritaire(hypnotiseur de music-hall, par exemple), un prédicat pourraitêtre : « Vous êtes sous hypnose et votre volonté est soumise à la mienne ». Chezcelui qui croit, ou veut faire croire, à la possibilité deretrouver les "vies antérieures", un prédicat serait : « ... etdans cet état d'hypnose, vous avez accès à toutes les vies que vous avez vécues... ».Chez celui qui utiliserait l'hypnose dans une perspectivereligieuse, les prédicats pourraient être : «… et dans cet état vousêtes bien davantage ouvert à cette Force supérieure, à cette Intelligence, à cetteTranscendance... » Notons en passant que, même lorsque cesprédicats ne sont pas formulés explicitement, ils sont souventsupposés connus du fait de l'immersion du sujet (et del'hypnotiste) dans une culture (ou une sub-culture) danslaquelle l'hypnose est censée posséder tout ou partie de cesattributs.
L'hypnose, opérateur de recadrage
L'hypnose semble ainsi fonctionner comme un opérateur derecadrage. Cet opérateur a pour fonction de redéfinir lecomportement global du destinataire comme radicalement changé.Mais changé comment ? Ce n'est pas facile à préciser : d'abordparce qu'au niveau phénoménologique, il n'est pas évident dutout de déterminer des critères clairs et univoques de l'étathypnotique, ensuite parce que la manière dont l’hypnose seravécue variera notablement d’un sujet à un autre,particulièrement dans des cultures ou à des époquesdifférentes.
Une bonne part de la richesse de l'hypnose nous paraîtrésider précisément dans le flou et l'ambiguïté de la nature duchangement à laquelle elle réfère. Les mots hypnose ou transesont vagues. Ils ne réfèrent pas à une réalité bien précise. Etce n'est sûrement pas par hasard que les mots qu'on utilisepour les expliciter ou leur servir de synonymes sont le plussouvent parmi les plus vagues et les plus généraux que la
25
langue puisse offrir (« état », « manière d'être », « mode defonctionnement », « mode de relation »). Inversement, s'il y atant de controverses théoriques, depuis trois siècles, sur laquestion de savoir si, dans tel ou tel contexte, il s'agit« vraiment » d'hypnose ou « seulement » d'autre chose, c'estbien parce que le contenu de l'hypnose est flou et ambigu. Defait, l'existence même de ces controverses interminables surl'existence de l'hypnose (Chertok et Stengers, 1989) ou sur sanature ne sont probablement pas une fatalité qui s'abattraitsans raison sur elle. Elles nous renseignent sur la nature mêmede l'hypnose. On est, en effet, en droit de penser que l'essencede l'hypnose est telle qu'elle ne peut que susciter ces controverses.
Autrement dit, il est permis de penser que l'on ne peut sedonner une chance de comprendre quelque chose à l'hypnose qu'enprenant radicalement en compte, comme faisant partie intégrante duphénomène, les controverses théoriques qu'elle suscite. Vouloirdéfinir strictement la réalité hypnotique comme une réalitépositive est sans doute une erreur. Pour que l'"hypnose" puisseexister, pour qu'elle puisse jouer son rôle il est tout à faitindispensable que le terme qui la désigne soit suffisamment flouet imprécis. Pour pouvoir fonctionner comme opérateur derecadrage, c'est-à-dire d'abord pour pouvoir recadrersuffisamment d'items de comportement comme signes d'hypnose (oumoyen d'y entrer), pour pouvoir proférer l'hypnose, il fautqu'un maximum de choses puisse faire farine à son moulin.
On pourrait reprendre, pour illustrer ce point, lacomparaison avec l'Effet Larsen. On sait que ce phénomène seproduit quand un micro est trop près d'un baffle, ou, si l'onpréfère, si le son est amplifié trop fort, de telle sorte quece qui sort du baffle est « trop » capté par le micro. Le microcapte et permet d'amplifier cela même qu'il produit, ce quiinstaure une boucle de rétroaction positive. Or, faitremarquable, pour que ce phénomène se produise, peu importe lanature du son qui est capté au départ : un Effet Larsen peut se produirependant le discours électoral d'un député socialiste, pendantun cours de chinois ou pendant un concert de musiquefolklorique bretonne. L'essentiel est que les sons de départ sesituent dans une gamme de fréquences se situant à l'intérieurde la bande passante du système.
26
De la même façon, en hypnose, il n'importe finalement pastellement que ce soit tel ou tel comportement qui soit épinglépar l'hypnotiste et renvoyé au sujet sous forme de description(puis de description injonctive). L'essentiel est qu'il puisseêtre incorporé dans la boucle de rétroaction positive queconstitue l'induction. Pour cette raison, pour qu'à peu prèsn'importe quel comportement puisse être incorporé, commen'importe quel son à l'origine de l'Effet Larsen, il faut quel'hypnose soit un signifiant suffisamment vague, suffisamment vide. Fautede quoi, comme un micro qui ne serait capable de capter qu'unebande de fréquence très étroite, elle ne pourrait pasaccueillir toute la diversité des phénomènes à amplifier.
En outre, pour pouvoir, dans un deuxième temps logique,recadrer la totalité du comportement du destinataire comme « enhypnose », et sachant à quel point les « comportements detranse » peuvent être divers, il importe également qu'« hypnose » soit un signifiant relativement vide. Autrementdit, pour parler en termes d'Effet Larsen, il faut que nonseulement le micro, mais également l'amplificateur et lesbaffles aient une bande de fréquence suffisamment large pourfaire sortir toutes les variétés de son. Avec une bande tropétroite, l'Effet Larsen ne pourrait pas se produire trèssouvent, et de même, avec un contenu trop précis, le terme« hypnose » ne pourrait pas fonctionner ou ne fonctionneraitque dans un nombre limité de cas.
D'autre part, le fait qu'il s'agisse d'un recadrageportant sur la totalité du comportement du destinataire (« il est enhypnose », ou « sous hypnose »), est loin d'être banal. D'ordinaireles recadrages portent plutôt sur certains aspects du comportementde l'individu (certains actes, certaines relations à autrui).Ici ce qui est recadré c'est tout : à la fois la relation àsoi, la relation à son corps, la relation à l'autre, larelation à la réalité, la relation au temps, absolument tout.C'est même la raison pour laquelle l'hypnose est, plus qu'unopérateur de recadrage : c'est un opérateur de méta-recadrage,tant ce recadrage est global et radical12. 12 Il existe quelques autres recadrages du comportement global : "ildort", "il est mort", "il est dieu (ou prophète)", "il est possédé", "il est ivre", "il est sous l'effetde drogues", "il est fou"... Ce dernier exemple nous fait toucher du doigttout l'intérêt qu'il y a à disposer d'un autre opérateur derecadrage global du comportement humain qui soit susceptible de
27
L'hypnose, signifiant (presque) vide
Dans la mesure où la compréhension d'un concept (sadéfinition) varie en raison inverse de son extension (la classed'individus tombant sous ce concept), la première est d'autantplus pauvre (le signifiant d'autant plus vide), que la secondeest plus vaste. Ce n'est donc pas par hasard que les termes quel'on utilise pour définir ce qu'est l'hypnose se caractérisentinvariablement par leur côté vague et général : pour pouvoirrecadrer (à peu près) tout et n'importe quoi, il faut que l'hypnose ne soit (presque)rien13.
Une autre façon de comprendre la signification vide, floueet ambiguë du signifiant "hypnose" est d'observer quel'hypnotiste recadre la totalité du comportement dudestinataire comme autre. Autre que quoi ? Autre que ce que sonétat "normal", "habituel", "ordinaire". Et comme la notiond'état "normal", "ordinaire" ou "habituel" est elle-mêmeextraordinairement floue, il est fatal que la notion d'étathypnotique le soit tout autant, et cela d'autant plus que« l'état normal » en question est bien moins l'état normalobjectif (à supposer que cette expression puisse avoir un sens)que ce qui est tenu pour tel, par l'opérateur et le sujet dans leconsensus hypnotique. Le jour improbable où l'on aura définirigoureusement l'état « normal », « naturel » ou « ordinaire »,l'hypnose pourra être totalement définie. Pas avant.
Si le mot hypnose a donc un sens, s’il n’est pas unsignifiant totalement vide, ce sens nous paraît résider dansl’idée d’un écart, d’une différence par rapport à l’étatnormal, habituel ou ordinaire. Selon les personnes, les
fonctionner dans un sens thérapeutique. L'hypnose constitue un telopérateur.13 Tout ceci nous permet de comprendre pourquoi la réflexionthéorique sur l'hypnose a si souvent aboutit à des controverses. Lecaractère vague du terme "hypnose" a, on peut le comprendre, menébeaucoup à la récuser comme un phénomène insuffisamment défini : lascience a horreur des signifiants flous. Nous pouvons dire à présentque l'hypnose au contraire est un phénomène relativement bien défini mais qui,pour pouvoir se produire, doit opérer avec un signifiant nécessairement peu défini.
28
époques, les lieux, les cultures ou sub-cultures, ce qui seraplus souvent consensuellement tenu comme écart significatif parrapport à la "normale" pourra, bien entendu, assez largementvarier.
Quelques invariants semblent cependant se manifester : ilsconcernent les rapports du volontaire et de l'involontaire, duconscient et de l'inconscient, du normal et du pathologique oudans certaines cultures ou sub-cultures, du profane et dusacré, du naturel et du surnaturel. Typiquement une personne enhypnose va être (censée être) capable de faire des chosesréputées involontaires (comme arrêter de saigner, faire partirdes verrues, cesser de percevoir des stimuli, oublier un faitqui vient de se produire, retrouver un fait oublié...) ou de neplus pouvoir faire des choses normalement accessibles à lavolonté (bouger un membre) ou de faire des choses réputéesvolontaires sur un mode involontaire (lévitation du bras), ouencore, dans certaines cultures ou sub-cultures, acquérir unstatut sacré ou être dotée de pouvoirs surnaturels ou êtrepossédée par un esprit ou un dieu ou encore être réduite à unniveau en quelque sorte infra-naturel, anormal, pathologique,comme le croyait par exemple Charcot.
Tout se passe donc comme si, en hypnose, les choses étaientmises à l'envers, un peu comme dans les fêtes carnavalesques ou lesSaturnales de l'Antiquité au cours desquelles les serviteursétaient, pour un jour, autorisés à jouir des privilèges desmaîtres, ou les femmes, des privilège des hommes. Ici,l'involontaire s'arroge les privilèges du volontaire,l'inconscient, les privilèges du conscient... L'hypnose est uneSaturnale de l'esprit.
L'induction semble donc fonctionner comme une invitation àdifférer, à produire un comportement radicalement autre. C'estdonc moins le contenu de ce comportement qui importe, que sonécart, son altérité, sa différance, pour utiliser un terme deJacques Derrida (1967). Ce qui en fait certes un signifiant unpeu moins vide, mais n'en fait toujours pas un signifiantparticulièrement plein.
Si l'hypnose est ce qui se développe quand on invite unsujet à produire un écart par rapport au comportement globalqui est le sien dans l'état réputé normal ou ordinaire, on peut
29
mieux comprendre les phénomènes (phénomènes hypnotiques ethypnothérapeutiques) qu'elle rend possible.
En aidant le sujet à produire un écart radical par rapportà son mode de comportement « ordinaire », on l'aide às'arracher aux rôles sociaux ordinaires et aux systèmes dereprésentations et de croyances qui y sont liés. On l'aide à selibérer des patterns qui structurent son comportement et lelimitent. Force est de constater que ces patterns, aussi utilessoient-ils, empêchent le développement de nombre de nospotentialités. Ou, pour prendre les choses par l'autre bout,force est de constater que l'écart radical opéré par l'hypnosenous remet en contact avec la créativité qui est en nous, avecl'imagination comme pouvoir de configurer tant le monde que nosmanières d'être et de nous comporter (Roustang, 1994).Paradoxalement, l’induction hypnotique apparaît ainsi comme unedéshypnotisation par rapport à l’hypnose fermée, quotidienne,accrochée à nos rôles, nos statuts et nos croyances, danslaquelle nous nous trouvons ordinairement14. C'est bien ce enquoi elle est peut être utile.
Le caractère mythique des théories
Dès lors que les hypnotistes adhèrent à certaines théoriesconcernant la nature de l'hypnose, ces croyances théoriquesvont influencer (consciemment ou inconsciemment, délibérémentou non) leur comportement verbal ou non-verbal avec les sujets.Il va donc influencer le comportement de ceux-ci. Toutecroyance théorique dans le domaine de l'hypnose et despsychothérapies sera inévitablement susceptible d'avoir deseffets pragmatiques et proférentiels sur le réel auquel ellesse rapportent.
14 Pierre Janet (1889) insistait sur le fait qu’il n’existait aucunespécificité à l’état hypnotique, en ce sens que n’importe quel comportementou vécu manifesté chez tel sujet pendant l’hypnose pouvait se retrouverchez un autre à l’état de veille et inversement. La seule caractéristique àses yeux était que chez un même sujet, le comportement de transe diffère ducomportement de veille. Il en concluait que « l’état second n’a d’autres caractères qued’être second ». A quoi l’on peut ajouter qu’alors, l’« état premier » (si l’onpeut dire) n’a d’autre caractère que d’être premier. Ce qui reviendrait àdire que nous sommes, au quotidien, dans une sorte d’hypnose fermée.
30
A cet égard, les discours psychologiques dans le champ del'hypnose comme dans celui des psychothérapies, constituentmoins des discours théoriques que des discours mythologiques.Les théories sur l'hypnose expliquent moins l'hypnose qu'ellesne la constituent comme telle. On ne peut mieux les désignerque sous l'appellation de "théories hypnotiques", en jouant surla double signification de l'expression : théories surl'hypnose et... théories qui hypnotisent. (De même que lesthéories psychanalytiques expliquent moins les réalitéspsychanalytiques qu'elles ne les constituent comme telles :elles sont des théories psychanalytiques au sens où ellesparticipent au processus analytique, elles "psychanalysent",via le comportement de l'analyste, et ce qu'il induit chezl'analysant, comme les théories hypnotiques participent àl'hypnose, "hypnotisent").
Il en va dans une large mesure de même pour toutes lesdisciplines que l’on regroupe dans les sciences humaines,l’économie et la sociologie, en particulier. Elles tiennent desdiscours qui, dans la mesure où ils sont diffusés dans lesocius, ne peuvent manquer de modeler certains aspects de celui-ci d’une manière qui peut donner une impression de vérité.C’était le cas du marxisme, au beaux jours du mouvementouvrier : en mettant l’accent sur la réalité fondamentale etincontournable de la lutte des classes, il est plus queprobable qu’il l’a intensifiée ; c’est également le cas desthéories économiques néo-libérales qui, par FMI et Banquemondiale interposés, contribuent à la mise à sac de la planèteen la livrant au règne sans partage de la loi de l’offre et dela demande.
En va-t-il de même pour les discours propres aux sciencesde la nature ? Quoi que l’on puisse raconter sur l’étoileSirius, ce n’est en principe pas cela qui la changera enquelque façon. Les sciences naturelles seraient donc enprincipe davantage, voire totalement indemnes des processus quenous évoquons. À y regarder de plus près, toutefois, cela estmoins sûr. On peut songer, par exemple, à la façon dont danscertains domaines la Biologie peut nous amener à modifier notrevision de l’homme (problèmes à implications bioéthiques), etplus radicalement la façon dont le darwinisme a pu influencerles conceptions sociales et politiques, notamment enfournissant une sorte de légitimité au struggle for life
31
capitaliste. D’autre part, la pharmacologie, par la façon dontelle nous concocte des médicaments, par exemple pour soigner la« dépression nerveuse », exerce une influence notable sur lafaçon dont l’homme contemporain se perçoit lui-même et donc surson comportement. On pourrait dire, d’une façon lapidaire etquelque peu provocatrice, que là où autrefois les travailleursfaisaient la grève, on leur envoyait les flics, tandis qu’àprésent quand une partie de l’individu n’en peut plus d’une viestressante et vide de sens, on lui administre le Prozac® ouquelque autre de ses acolytes, en lui faisant croire que cedont il souffre est simplement une « maladie » qu’il y a lieude « soigner » et qui n’aurait strictement rien à voir avecl’univers socio-économico-politique dans lequel il se trouve.
Quand à la Physique, la question est sans doute plusépineuse à traiter. On peut penser, toutefois à la façon dontCopernic et Galilée ont contribué à ébranler l’image quel’homme se faisait de lui-même. Mais de nos jours c’estprobablement plus par le biais des objets techniques (voiture,télévision, téléphone, ordinateur et tant d’autres…) que lerôle de ses énoncés dans le modelage de l’homme et de la naturese fait sentir, et il y aurait sans doute lieu d’interrogerplus systématiquement le rapport que ces énoncés entretiennentpragmatiquement, proférentiellement, de manière directe ouindirecte, avec le monde humain et naturel.
La question qui se pose ainsi est donc infiniment moinscelle de savoir dans quelle mesure les énoncés de la sciencesont « vrais » que celle de savoir quels effets ils produisent.
Conclusion
On pourrait penser que le curieux rapport du langage auréel manifesté avec éclat par les performatifs, les suggestionset les prédictions autoréalisantes, dans lesquels et parlesquels c’est le paysage qui se met à ressembler à la toile15,ne concernerait qu’une catégorie relativement restreinted’usages discursifs. Cette conception rassurante aurait biensûr le grand avantage de préserver l’idée d’un discours serapportant normalement au réel comme à un pur déjà-là, et, ensauvegardant ainsi la fonction référentielle classique du15 Ou peut-être « dans lequel le paysage et la toile s’engendrent mutuellement ».
32
langage, elle sauvegarderait aussi ce que nous appelons « lavérité » et que nous avons pris l’habitude de considérer -peut-être à tort - comme un précieux bien.
À prendre au sérieux ce qui se joue de manièreparticulièrement claire dans ce que l’on appelle une inductionhypnotique, on s’aperçoit que ce précieux bien est largementune illusion qui occulte la dimension pragmatique de nospratiques discursives.
Les réflexions qui précèdent invitent ainsi à relativiserl’importance que nous accordons traditionnellement à la véritédepuis Parménide et Platon, pour se soucier davantage de l’avalde nos discours : quel réel contribuent-ils à créer ? Quelseffets entraînent-ils quant au vivre ensemble des hommes ?Quelles mœurs favorisent-ils ? Quel univers de sensconfigurent-ils ? Manière peut-être de réactualiser l’approchedes sophistes, injustement dénigrés et caricaturés par Platon,à en croire Barbara Cassin16, et qui, particulièrementsensibles, comme le sont les hypnothérapeutes, à la dimensionrhétorique, pragmatique et proférentielle du langage, seposaient déjà ce genre de questions il y a près de deux millecinq cents ans. Manière peut-être de penser les choses d’unpoint de vue qui se voudrait « écosophique » - ce terme est deFélix Guattari17 - plutôt que principalement philosophique ouscientifique
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
AUSTIN J. L. Quand dire, c'est faire, Le Seuil, Paris,1970BERNHEIM H. De la suggestion dans ses applications à la thérapeutique, Doin, Paris, 1888.CASSIN B., L'effet sophistique, Gallimard, Paris, 1995.CHERTOK L. (sous la dir. de) Résurgence de l'hypnose. Une bataille de deux cents ans, Desclée de Brouwer, Paris, 1984.CHERTOK L. et STENGERS I. Le coeur et la raison... L'hypnose en question
16 (Cassin B., 1995)17 (Guattari F., 1992)
33
de Lavoisier à Lacan, Payot, Paris, 1989.DERRIDA J. L'écriture et la différence, Le Seuil, Paris, 1967.FREGE G. (1892) Sens et dénotation in Ecrits logiques et philosophiques, Le Seuil, Paris, 1971.FREUD S. (1925) Ma vie et la psychanalyse, Gallimard, Idées, Paris, 1950. GUATTARI F. (1992) Pour une refondation des pratiques sociales », texte repris dans Manière de voir, 52, « penser le XXIe siècle », Juillet-Août 2000.JANET P. L'automatisme psychologique, Félix Alcan, Paris, 1889.LAKOFF G., JONHSON M. Les métaphores dans la vie quotidienne, Ed. de Minuit, Paris, 1985.MELCHIOR Th. Créer le réel, hypnose et thérapie, Le Seuil, Paris, 1998.MICHAUX D. (sous la dir. de), La transe et l'hypnose, Imago, Paris, 1995.ROSENTHAL R. A., JACOBSON L. Pygmalion à l'école, Casterman, Tournai, 1971.STENGERS I. (sous la dir. de) Importance de l'hypnose, Coll. Les empêcheurs de penser en rond Synthélabo 1993.
34