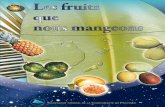Idéalisations analytiques: Winnicott, ses patients, et nous
Transcript of Idéalisations analytiques: Winnicott, ses patients, et nous
IDÉALISATIONS ANALYTIQUES : WINNICOTT, SES PATIENTS, ETNOUS Joyce Slochower Presses Universitaires de France | Revue française de psychanalyse 2014/4 - Vol. 78pages 1136 à 1149
ISSN 0035-2942
Article disponible en ligne à l'adresse:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.cairn.info/revue-francaise-de-psychanalyse-2014-4-page-1136.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour citer cet article :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Slochower Joyce, « Idéalisations analytiques : Winnicott, ses patients, et nous »,
Revue française de psychanalyse, 2014/4 Vol. 78, p. 1136-1149. DOI : 10.3917/rfp.784.1136
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribution électronique Cairn.info pour Presses Universitaires de France.
© Presses Universitaires de France. Tous droits réservés pour tous pays.
La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites desconditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votreétablissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière quece soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur enFrance. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.
1 / 1
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Sta
nfor
d U
nive
rsity
-
- 17
1.67
.216
.22
- 01
/10/
2014
03h
55. ©
Pre
sses
Uni
vers
itaire
s de
Fra
nce
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - S
tanford University - - 171.67.216.22 - 01/10/2014 03h55. ©
Presses U
niversitaires de France
24 juillet 2014 06:09 - Caractère - Collectif - Revue de psychanalyse - 175 x 240 - page 1136 / 1256 - © PUF - - © PUF -
24 juillet 2014 06:09 - Caractère - Collectif - Revue de psychanalyse - 175 x 240 - page 1136 / 1256 - © PUF -
24 juillet 2014 06:09 - Caractère - Collectif - Revue de psychanalyse - 175 x 240 - page 1137 / 1256 - © PUF - - © PUF -
Idéalisations analytiques : Winnicott, ses patients, et nous1
Joyce Slochower*
Comme tous les idéaux du moi (Freud, 1914c), les idéaux professionnels nous donnent l’image de celui ou celle que nous pourrions être et de la façon dont nous devrions agir dans le contexte de la cure. Implicites plutôt que clai-rement exprimés, de tels idéaux opèrent pour ainsi dire sous la surface du traitement, servant de modèles à l’analyste et parfois aussi au patient. Mais, souvent éloignés des réalités de nos capacités cliniques, ils en favorisent la méconnaissance tant à propos de l’analyste lui même qu’à propos du travail analytique.
Le thème de l’idéalisation n’est pas nouveau. Mais tout ce qui a été écrit sur sa dynamique, ses origines, son développement, ses fonctions et ses excès psycho-pathologiques semble se concentrer quasi exclusivement sur le patient (Slochower, 2005). On a fort peu parlé de la vulnérabilité de l’analyste face aux idéalisations du patient, et encore moins des idéalisations qui proviennent de l’analyste lui-même. Pourtant le consentement de l’analyste – ou son refus – à se prêter aux idéalisations du patient font bien plus qu’influer sur l’issue du processus en cours. Ils lui donnent forme (Slochower, 2003a, 2003b).
Dans cet article, j’explorerai la nature complexe des idéalisations par-tagées, en me concentrant sur la vulnérabilité de l’analyste à participer avec le patient à l’établissement et au maintien de ces illusions partagées. Tandis que
1. Cet article a été publié en anglais sous le titre : « Analytic Idealizations and the Disavowed: Winnicott, His patients and Us », Psychoanalytic Dialogues, 2011, 21:1, 3-21. Pour des raisons stric-tement éditoriales, la version traduite que nous présentons ici a dû être considérablement réduite.
* Joyce Slochower, Professeur émérite à Hunter College & Graduate Center, CUNY et NYU Postdoctoral Program, PINC à San Francisco, pratique la psychanalyse à New York City.
Idéalisations analytiques : Winnicott, ses patients, et nous
Joyce slochoWer
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Sta
nfor
d U
nive
rsity
-
- 17
1.67
.216
.22
- 01
/10/
2014
03h
55. ©
Pre
sses
Uni
vers
itaire
s de
Fra
nce
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - S
tanford University - - 171.67.216.22 - 01/10/2014 03h55. ©
Presses U
niversitaires de France
24 juillet 2014 06:09 - Caractère - Collectif - Revue de psychanalyse - 175 x 240 - page 1136 / 1256 - © PUF - - © PUF -
24 juillet 2014 06:09 - Caractère - Collectif - Revue de psychanalyse - 175 x 240 - page 1136 / 1256 - © PUF -
1137Idéalisations analytiques : Winnicott, ses patients, et nous
24 juillet 2014 06:09 - Caractère - Collectif - Revue de psychanalyse - 175 x 240 - page 1137 / 1256 - © PUF - - © PUF -
ces illusions se dessinent en général à partir du regard que le patient porte sur l’analyste, ce processus bascule parfois en sens inverse et c’est l’analyste qui idéalise alors le patient bien d’avantage que le contraire2.
ILLUSIONS ANALYTIQUES ET IDÉAL ANALYTIQUE
Voilà déjà quelques temps que la dynamique de l’idéalisation et de l’illusion m’intéresse. Le trope winnicottien du holding et les illusions qui lui sont asso-ciées ont fait l’objet pour moi d’une série d’articles et d’un livre (Slochower, 1991, 1992, 1994, 1996a, 1996b, 1996c, 199d, 2004, 2005). Je tiens à sou-ligner le besoin de certains patients d’une illusion d’accordage affectif, tout en tenant compte de l’expérience que, de son côté, l’analyste fait de ce besoin du holding, et de la façon dont il y réagit. Le holding devient un élément cen-tral du traitement quand le patient ne supporte pas que l’analyste soit un être séparé de lui, indépendant, ce qui est implicite dans des échanges interprétatifs ou expressifs « ordinaires », sans perturbations sérieuses et prolongées. À ce moment-là, l’analyste « tient » le patient en essayant de contenir, plutôt que d’articuler, les aspects dérangeants de sa séparation, tout en communiquant sa reconnaissance de la communication affective dominante du patient.
L’idéal du holding est en fin de compte irréalisable parce que certains aspects de la subjectivité de l’analyste (sa réaction au patient) font partie inté-grale de ce qu’il dit, de ce qu’il ne dit pas, de sa présence, même. C’est pour cette raison que je considère que les illusions du holding ont lieu dans l’espace intersubjectif, et qu’elles constituent un phénomène de co-création auquel le patient participe, consciemment ou inconsciemment.
À mesure que l’analyste essaie de contenir – et non de désavouer – sa sub-jectivité dissonante, le patient vaguement conscient de ces éléments de désac-cord met entre parenthèses (et parfois même dissocie) ces aspects dérangeants de l’altérité de l’analyste qui s’infiltrent, sans pour autant être entièrement acceptés. Ce type d’expérience du holding peut alors faciliter une tolérance à
2. Je voudrais exprimer ma reconnaissance à l’égard de Sue Grand et Adrienne Harris pour leur remarquable générosité, à Linda Hopkins, Dodi Goldman, et Roger Willoughby pour leurs contributions généreuses aux aspects historiques de cet article, à Teresa Lopez-Castro pour son aide dans la recherche des Archives Winnicott, à Annee Ackerman, Dafna Fuchs, Natasha Stovall, Leora Trub, et à mon fils Jesse Rodin pour leurs corrections perspicaces. Plusieurs personnes m’ont aidé pour la traduction de cet essai. Je voudrais remercier Henri Chabrol, Lara Vergnaud et Béatrice Puja pour leur générosité et compétence.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Sta
nfor
d U
nive
rsity
-
- 17
1.67
.216
.22
- 01
/10/
2014
03h
55. ©
Pre
sses
Uni
vers
itaire
s de
Fra
nce
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - S
tanford University - - 171.67.216.22 - 01/10/2014 03h55. ©
Presses U
niversitaires de France
1138 Joyce Slochower
24 juillet 2014 06:09 - Caractère - Collectif - Revue de psychanalyse - 175 x 240 - page 1138 / 1256 - © PUF - - © PUF -
24 juillet 2014 06:09 - Caractère - Collectif - Revue de psychanalyse - 175 x 240 - page 1139 / 1256 - © PUF - - © PUF -
la réciprocité, ce qui étaye le glissement de la relation à l’objet à l’utilisation de l’objet comme le décrit de façon si évocatrice Winnicott (1971).
[…] L’idée d’un analyste qui, dans le contexte du holding, est capable d’un
parfait accordage empathique, capable de mettre entre parenthèses sa subjec-tivité, et « d’être là » pour le patient, constitue un idéal professionnel. Mais nos idéaux professionnels peuvent prendre plusieurs formes selon la culture psychanalytique à laquelle nous appartenons. Ces idéaux, plus implicites qu’explicites, sous-jacents au traitement, influencent notre travail clinique, mais échappent à notre processus d’auto-évaluation. […] Cependant, ils peu-vent également constituer un danger si on y adhère d’une manière trop rigide, provoquant ainsi une tension, et même un affrontement, avec la réalité de notre état immuablement égocentrique.
Dans un livre récent (Slochower, 2014a, 2014b), j’examine ces moments d’affrontement et les différentes formes qu’ils peuvent prendre. […] Nous réa-gissons à notre désillusion par l’auto-condamnation ou la dénégation défen-sive, nous nous renfermons, plutôt que de nous ouvrir à l’autoréflexion. Il nous faut trouver une issue à ce type de clivage, pour humaniser notre expérience d’analystes vulnérables aux vicissitudes des états émotionnels, comme on peut le voir dans le travail de Winnicott avec Khan et Guntrip. […] Dans le cas de Khan, l’interpénétration du narcissisme provocant de Khan et de celui de Winnicott (Goldman, 2002) a façonné leurs rapports au cours du traitement qui a fini par être dominé par une idéalisation mutuellement construite mais asymétrique, plus prononcée quant à l’admiration plus intense et sans réserves de la part de Winnicott pour Khan. En revanche, la relation de Guntrip avec Winnicott impliquait une idéalisation partagée basée sur le transfert maternel très positif éprouvé par Guntrip à l’égard de Winnicott, la réponse de celui-ci, tout aussi élogieuse et chaleureuse, contribuant à une idéalisation relativement symétrique. Avant d’illustrer la dynamique de cette relation, il est important d’établir la nature de l’idéalisation dans le travail psychanalytique.
IDÉALISATION ET ILLUSION DANS LE PROCESSUS PSYCHANALYTIQUE
Idéalisation et illusion incarnent à la fois l’espoir et la forclusion du processus analytique. À un certain niveau, toutes deux constituent l’antithèse de la psychanalyse qui, par sa nature même, a pour but de démanteler tout système de valeurs rigide et profondément incrusté, niant défensivement la
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Sta
nfor
d U
nive
rsity
-
- 17
1.67
.216
.22
- 01
/10/
2014
03h
55. ©
Pre
sses
Uni
vers
itaire
s de
Fra
nce
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - S
tanford University - - 171.67.216.22 - 01/10/2014 03h55. ©
Presses U
niversitaires de France
24 juillet 2014 06:09 - Caractère - Collectif - Revue de psychanalyse - 175 x 240 - page 1138 / 1256 - © PUF - - © PUF -
1139Idéalisations analytiques : Winnicott, ses patients, et nous
24 juillet 2014 06:09 - Caractère - Collectif - Revue de psychanalyse - 175 x 240 - page 1139 / 1256 - © PUF - - © PUF -
« réalité. » Notre travail est de développer et d’élargir la capacité du patient à faire face à ce qui est. Pourtant, le rituel psychanalytique même (Hoffman, 1996), particulièrement son caractère asymétrique, et le faux-semblant d’objectivité faisant autorité qu’il implique (Renik, 1995), confère un certain degré d’idéalisation à cet exercice. L’analyste est celui qui « sait »: en termes lacaniens, « le sujet supposé savoir » (Lacan, 1964), et c’est ce qui, consti-tuant un aspect essentiel du transfert, doit être perlaboré et peut rarement être éludé. […]
Quand elles sont employées de façon rigide et excessive, les idéalisations de l’analyste peuvent avoir un aspect pathologique. Parfois, les fantasmes du patient à notre égard vont au-delà de nos capacités professionnelles et s’étendent à notre vie privée soi-disant parfaite. Bien que ces d’idéalisations semblent orientées vers l’extérieur, elles s’associent implicitement à des senti-ments d’autodénigrement de la part du patient qui se conçoit, comparé à l’ana-lyste, comme inadéquat, naïf, ou enfantin. […] Le patient se rend inférieur, ignorant, ou indésirable face à un analyste omniscient, tout puissant ; la réci-procité est sacrifiée au profit du maintien du lien (parfois même chargé d’un contenu sexuel) avec l’analyste.
Si, néanmoins, on se concentre exclusivement sur les aspects probléma-tiques de l’idéalisation, on finit par négliger ses dimensions positives, étant donné que le lien avec un analyste puissant et apparemment parfait est parfois un soutien vital, permettant d’établir un espace de traitement protégé, encou-rageant l’évolution thérapeutique, soutenant une nouvelle identification, ou fortifiant le moi. Comme le remarque Kohut (1971, 1977) les idéalisations remplissent un rôle crucial dans le développement de l’enfant, et sont essen-tielles au travail avec des patients narcissiquement vulnérables. Engagés avec modération, les fantasmes idéalisés à l’égard de l’analyste, du patient, ou des possibilités illimitées inhérentes au processus psychanalytique peuvent soute-nir le travail sans pour autant exclure la mise en question de soi, ouvrant ainsi le domaine du fantasque, du paradoxal (Ghent, 1992). Là, ce qui est désiré coexiste avec des aspects plus complexes du réel ; le patient tolère l’ambiguïté et l’incertitude, laissant derrière lui les pressions du moment pour s’avancer dans l’espace intérieur (Slochower, 1996c, 2004).
[…]Si les idéalisations fortifient parfois l’expérience thérapeutique du patient,
peuvent-elles avoir une utilité semblable pour l’analyste ? Un sens développé du potentiel thérapeutique nous permet de contrecarrer le doute de soi, de soutenir notre résistance émotionnelle, et nous donne accès au processus créa-tif. Mais être idéaliste peut provoquer en nous, analystes, des réactions bien différentes, tant positives que négatives. Théoriquement, il est possible que
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Sta
nfor
d U
nive
rsity
-
- 17
1.67
.216
.22
- 01
/10/
2014
03h
55. ©
Pre
sses
Uni
vers
itaire
s de
Fra
nce
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - S
tanford University - - 171.67.216.22 - 01/10/2014 03h55. ©
Presses U
niversitaires de France
1140 Joyce Slochower
24 juillet 2014 06:09 - Caractère - Collectif - Revue de psychanalyse - 175 x 240 - page 1140 / 1256 - © PUF - - © PUF -
24 juillet 2014 06:09 - Caractère - Collectif - Revue de psychanalyse - 175 x 240 - page 1141 / 1256 - © PUF - - © PUF -
nous nous opposions au manque de reconnaissance inhérent à l’idéalisation du patient, ou que nous réagissions au plaisir causé par cette idéalisation par de l’inconfort, des sentiments intenses de culpabilité, de honte, ou en marquant notre désaccord à être considéré ainsi. […]
Les idéalisations [de l’analyste] existent sous maintes formes. Les plus évi-dentes sont presque caricaturales et considérablement éloignées de la réalité. Pourtant, à partir du moment où nous rejetons l’archétype analytique héroïque, un autre type d’idéalisation peut être caché sous l’aspect de l’analyste vulné-rable et imparfait. Cette idée d’un analyste profondément humain, qui n’est pas sur la défensive, vient représenter d’une certaine manière (au moins dans l’école américaine contemporaine) une alternative, une espèce d’idéalisation retournée. C’est en partie un antidote utile aux excès analytiques de rigidité et de certitude, qui nous permet la défaillance. Néanmoins, un autre type d’auto-idéalisation peut le sous-tendre et en dissimuler la dynamique : en idéalisant notre aptitude à être vulnérable, nous obscurcissons notre résistance (à être vus si positivement) et notre angoisse (à l’idée d’un dévoilement possible) qui se cachent derrière.
Quelle qu’en soit la teneur, les idéalisations passagères sont d’une effecti-vité thérapeutique plus nette que celles qui sont fixées et rigides. Cependant, quand une forte idéalisation devient-elle excessive ? Notre évaluation sera iné-vitablement influencée par la théorie qui nous habite et la place que l’idéali-sation (thérapeutique ou problématique) y occupe. Étant donné qu’une relation idéalisée est asymétrique, ce que l’on éprouve à être idéalisé est étroitement lié à ce que l’on ressent à l’égard de notre propre autorité (voir Freidman, 2007). Renik (2007) a fortement préconisé de travailler pour une position éga-litaire susceptible de contrecarrer les idéalisations de nos savoir et autorité « supérieurs » alors que d’autres (Lander, 2007) ont souligné la sécurité (tem-poraire) inhérente à l’idéalisation par le patient. Ceux qui mettent l’accent sur le holding ont une tendance plus grande à trouver de la valeur à l’idéalisation que ceux qui placent l’action thérapeutique ailleurs, par exemple, dans l’inter-prétation prolongée (de l’hostilité clivée, par exemple) ou dans la réciprocité (Aron, 1991). Cependant les allégeances théoriques de l’analyste sont elles-mêmes façonnées ou au moins renforcées par son style personnel, dynami-quement déterminé (Crastnopol, 1999). Certains d’entre nous préfèrent rester plus ou moins « protégés » et peuvent inconsciemment (ou consciemment) accueillir ou même prolonger l’idéalisation par le patient à cause de ses effets flatteurs ou pour la protection contre le dévoilement qu’elle apporte. D’autres ne sont pas à l’aise avec le sentiment de n’être pas visibles ou d’être perçus de façon déformée ; ici, un besoin de reconnaissance peut conduire à rompre rapidement un transfert idéalisé pour introduire notre subjectivité.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Sta
nfor
d U
nive
rsity
-
- 17
1.67
.216
.22
- 01
/10/
2014
03h
55. ©
Pre
sses
Uni
vers
itaire
s de
Fra
nce
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - S
tanford University - - 171.67.216.22 - 01/10/2014 03h55. ©
Presses U
niversitaires de France
24 juillet 2014 06:09 - Caractère - Collectif - Revue de psychanalyse - 175 x 240 - page 1140 / 1256 - © PUF - - © PUF -
1141Idéalisations analytiques : Winnicott, ses patients, et nous
24 juillet 2014 06:09 - Caractère - Collectif - Revue de psychanalyse - 175 x 240 - page 1141 / 1256 - © PUF - - © PUF -
La croyance de Winnicott dans la valeur thérapeutique de la régression à la dépendance (dans le traitement des patients schizoïdes et psychotiques) encourageait particulièrement les idéalisations organisées autour des thèmes maternels. Ses patients, Margaret Little (1990) et Harry Guntrip (1996), décrivent Winnicott comme extrêmement empathique, sensible, capable de répondre aux besoins urgents, informulés. Ils croyaient qu’il était nécessaire au succès de leur analyse que Winnicott permette à ces transferts maternels de se développer naturellement sans interférer. Même Khan, qui critiqua souvent Winnicott, parle de façon émouvante de l’impact thérapeutique de la capacité de Winnicott à rester calme avec lui :
J’ai réussi à trois occasions à pénétrer dans mon Self… Ces trois occasions étaient phy-siques… Il était assis sur son siège et je me suis levé du divan et j’ai enfoncé ma tête sur le côté de sa veste. Je peux encore entendre son cœur battre. Tout le reste était calme… et j’étais en paix. Et D. W. n’interpréta jamais ces trois situations. Il m’avait permis d’atteindre ce point. (M. K., W. B., 3 mai 1971).
Khan évoque de façon manifeste la capacité remarquable de Winnicott au holding, sa volonté « d’être » l’objet maternel (en cassant les règles tradition-nelles si nécessaire). Comme la description par Little (1990) de la capacité de Winnicott à tolérer et à faire face à sa vulnérabilité et à sa dépendance à elle, Khan dépeint Winnicott comme une présence calme. Winnicott est l’objet de l’idéalisation plus qu’un participant à sa construction. Nous sommes réduits à spéculer sur ses réponses émotionnelles à cette idéalisation et sur son rôle dans le fait de susciter, soutenir ou contrer les visions thérapeutiques de ses patients.
MAIS DE QUI VIENT L’ILLUSION ?
Être admiré procure à l’analyste un antidote bienvenu au sentiment qu’il ne sait pas ce qu’il fait ou qu’il le fait mal. Indéniablement, il y a des moments où nous comptons sur l’admiration du patient, l’invitant à un pacte incons-cient mutuel : « Je t’aimerai si tu m’aimes ». Quand les besoins du patient et de l’analyste convergent, la dyade construit une vision de la sécurité, de la constance thérapeutique et du pouvoir soignant de l’analyste (Modell, 1975 ; Teicholz, 1999 ; Bauduin, Denis, 2003). Décrivant son travail avec un patient qui l’idéalisait, O’Shaughnessy (1992) suggère que « sous la pression du patient, l’analyste peut involontairement transformer l’analyse en refuge contre les perturbations, c’est-à-dire en enclave » (p. 610). O’Shaughnessy laisse entendre que l’analyste coopère avec le patient pour maintenir un espace
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Sta
nfor
d U
nive
rsity
-
- 17
1.67
.216
.22
- 01
/10/
2014
03h
55. ©
Pre
sses
Uni
vers
itaire
s de
Fra
nce
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - S
tanford University - - 171.67.216.22 - 01/10/2014 03h55. ©
Presses U
niversitaires de France
1142 Joyce Slochower
24 juillet 2014 06:09 - Caractère - Collectif - Revue de psychanalyse - 175 x 240 - page 1142 / 1256 - © PUF - - © PUF -
24 juillet 2014 06:09 - Caractère - Collectif - Revue de psychanalyse - 175 x 240 - page 1143 / 1256 - © PUF - - © PUF -
thérapeutique excessivement protégé qui exclut le négatif. À l’intérieur de cet espace sûr mais étroit, patient et analyste écartent tacitement les éléments per-turbateurs, orientant la relation thérapeutique dans la direction de la synchro-nie et de la réassurance.
Je propose l’idée que les idéalisations analytiques sont souvent construites conjointement, façonnées par les caractéristiques personnelles et les besoins du patient et de l’analyste. Quand nous attribuons les illusions exclusivement à nos patients (Grunberger, Chasseguet-Smirgel, 1986 ; Kernberg, 1984 ; Klein, 1940 ; Sullivan, 1972), nous cachons nos propres vulnérabilités pour nier l’espace entre le réel et l’idéal, entre ce qui est désiré et ce qui est. Il en résulte que, dans ce processus, notre participation tend à opérer silencieu-sement, demeurant implicite et non examinée.
Parfois, nous faisons plus qu’encourager tacitement le patient à nous idéa-liser ; nous adoptons pleinement une « vision dorée » du processus thérapeu-tique. Notre besoin de croire dans la possibilité d’une transformation par la psychanalyse nous conduit à chercher un arrière-fond de sécurité afin de nous soutenir (Sandler, 1992), de contrer nos doutes et notre anxiété au sujet de notre efficacité thérapeutique, de nous prouver à nous-même que nous avons atteint notre idéal professionnel. L’affirmation de soi se place dans une vision idéalisée de nous-mêmes, de notre capacité à un insight pénétrant, à l’authen-ticité, à l’accordage affectif, à l’ouverture émotionnelle, ou à la neutralité et à l’attention également flottante. Ce sont des plaisirs coupables, toutefois, car l’idéal professionnel nous interdit, du moins à la plupart d’entre nous, de chercher à obtenir des gratifications narcissiques de nos patients. Nous ne sommes pas supposés vouloir être admirés. Nous pouvons même placer au centre du processus analytique notre capacité à susciter et travailler la colère des patients et les autres affects « négatifs » ; si nous empêchions l’émergence du transfert négatif, nous échouerions à faire notre travail. Nous avons alors conscience que nous ne prenons pas la mesure de la vision idéalisée de notre patient. L’inconfort, ou même honte, peuvent suivre.
[…]Je pense que l’analyse de Masud Khan avec Winnicott fut caractérisée
par une idéalisation co-construite qui alternait avec d’intenses sentiments de compétition et de dédain. La relation thérapeutique se caractérisait par l’excès (Stein, 2006) et une absence de réflexion qui occasionnait un conflit avec la réalité. […] Certes, il n’est pas facile de savoir, par exemple, si l’admiration de Winnicott pour Khan lui rendait difficile de reconnaître ou, dans tous les cas, de faire face à l’extraordinaire tendance de Khan à se mal comporter. Winnicott a-t-il vu tout cela et a-t-il choisi délibérément de s’adapter aux besoins de Khan, ayant conclu que Khan ne pouvait pas être
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Sta
nfor
d U
nive
rsity
-
- 17
1.67
.216
.22
- 01
/10/
2014
03h
55. ©
Pre
sses
Uni
vers
itaire
s de
Fra
nce
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - S
tanford University - - 171.67.216.22 - 01/10/2014 03h55. ©
Presses U
niversitaires de France
24 juillet 2014 06:09 - Caractère - Collectif - Revue de psychanalyse - 175 x 240 - page 1142 / 1256 - © PUF - - © PUF -
1143Idéalisations analytiques : Winnicott, ses patients, et nous
24 juillet 2014 06:09 - Caractère - Collectif - Revue de psychanalyse - 175 x 240 - page 1143 / 1256 - © PUF - - © PUF -
aidé analytiquement ? Il est possible que les engagements personnels et extra-analytiques de Winnicott avec Khan aidèrent vraiment ce dernier à identifier et perlaborer des besoins insatisfaits. Goldman (2006) suggère que Winnicott a pu aider Khan à éviter un devenir encore plus catastrophique et contribua à la détérioration psychologique de Khan, tandis que Sandler (2004) croit que la relation de Winnicott avec Khan était « collusive et perverse », déterminée principalement par les problèmes psychiques de Winnicott. Mais je ne crois pas qu’il soit possible d’analyser le rôle de la position théorique de Winnicott à partir de ses croyances thérapeutiques plus dynamiquement déterminées, ou à partir de son investissement émotionnel et ses réactions personnelles à Khan.
Winnicott concevait comme une absolue nécessité de satisfaire les besoins (plutôt que les désirs) dans le travail avec les patients très vulnérables ; son article sur les tendances antisociales (1956), par exemple, souligne le rôle de la déprivation (la perte de quelque chose de bon) s’exprimant dans le vol. Il plaidait avec ferveur pour l’efficacité thérapeutique d’un cadre fiable (holding) qui satisfaisait les besoins de l’enfant (et du patient) et aidait à résister à la mise en acte. Winnicott était-il persuadé que Khan était ce que Freud (1916d) appelait une « exception », quelqu’un à qui les règles ne s’appliquaient pas (à cause des expériences précoces de déprivation de Khan) ? Ou tous deux construisirent-ils conjointement un pacte organisé sur le positif, une enclave d’idéalisation qui excluait ou obscurcissait des sentiments plus complexes de Winnicott pour son analysant ?
Les auto-idéalisations analytiques, qu’elles soient fondées sur des expé-riences de succès cliniques réelles ou sur des fantasmes, peuvent conduire faci-lement à un usage excessif, et même à des mésusages (Bauduin, Denis, 2003). Les idées de Winnicott sur les déprivations précoces et le besoin d’un analyste maternel assurant un holding semblent refléter des aspects de sa personna-lité, peut-être une idéalisation de ses capacités de réparation et du pouvoir curatif de sa sensibilité émotionnelle ; les deux visions soulignent les propres vulnérabilités et besoins de Winnicott aussi bien que son échec à éviter la destruction, et l’idéalisation de Khan par Winnicott semble claire. […] Godley (2003, p. 42) suggère explicitement que Winnicott était complètement « sous la coupe » de Khan, ce qui apparaît dans certaines lettres de Winnicott à – et au sujet de – Khan (Winnicott, 1959).
[…]Quant à Guntrip, rendant compte de son analyse avec Winnicott, il reprend
les propos de ce dernier : Vous aussi vous avez un bon sein. Vous avez toujours été capable de me donner plus que ce que vous ne prenez. Faire votre analyse a été une des choses les plus rassurantes qui me
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Sta
nfor
d U
nive
rsity
-
- 17
1.67
.216
.22
- 01
/10/
2014
03h
55. ©
Pre
sses
Uni
vers
itaire
s de
Fra
nce
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - S
tanford University - - 171.67.216.22 - 01/10/2014 03h55. ©
Presses U
niversitaires de France
1144 Joyce Slochower
24 juillet 2014 06:09 - Caractère - Collectif - Revue de psychanalyse - 175 x 240 - page 1144 / 1256 - © PUF - - © PUF -
24 juillet 2014 06:09 - Caractère - Collectif - Revue de psychanalyse - 175 x 240 - page 1145 / 1256 - © PUF - - © PUF -
soit arrivées. Le type avant vous m’a fait sentir que je n’étais pas bon du tout. Vous n’avez pas à être bon pour moi. Je n’en ai pas besoin et je peux m’en sortir sans cela, mais vous me faites du bien. (Guntrip, 1996, p. 750)3
Winnicott reconnaît ici ce qui est le plus souvent caché comme un plaisir secret – que l’idéalisation de Guntrip représentait un antidote aux sentiments négatifs de Winnicott sur son self (analytique). Le malaise de Winnicott à l’égard de cet investissement est également clair, même s’il est indirect ; Winnicott déclare qu’il n’a pas besoin de ce sentiment de bien-être éprouvé grâce à Guntrip, une déclaration que je comprends comme un déni. Je pense que Winnicott et Guntrip établirent une idéalisation plus symé-trique et réciproque que Winnicott et Khan. Cette idéalisation était extraor-dinairement monochromatique dans sa tonalité affective ; comme le note Eigen (1993), il y avait peu de place pour la colère ou la déception entre eux. […]
Il faut noter que Winnicott écrivit aussi abondamment sur la valeur et le caractère central de la colère dans le développement et le processus ana-lytique, soulignant l’importance de la survie de l’analyste (et de la mère) dans le mouvement de la relation d’objet à l’utilisation de l’objet (Winnicott, 1971). Néanmoins, Winnicott semble avoir été plus à l’aise dans une position parentale idéalisée que dans celle du sujet (ou de l’objet) de la colère, face à laquelle, suggère Hopkins (2003, 2006), il ne « survivait » pas toujours. Le besoin de Winnicott d’être admiré et d’admirer l’empêchait-il de faire face aux sentiments conflictuels de Khan à son sujet (Goldman, 2006 ; Hopkins, 2006) ? C’est mon sentiment, mais je soupçonne que cela les impliquait tous deux ; la position provoquante, souvent dédaigneuse de Khan à l’égard de son analyste a probablement contribué à l’idéalisation par Winnicott de Khan : les Work Books de Khan contiennent des commentaires arrogants, rejetants, et critiques sur Winnicott. Le ton dédaigneux de Khan est en opposition totale avec l’admiration manifeste de Winnicott pour son analysant. Était-ce un pacte tacite entre eux, une idéalisation superficiellement commune masquant une dynamique sado-masochiste cachée – un aspect douloureux de cette relation analytique ?
[…]
3. La traduction de ce texte de Guntrip dans La Nouvelle Revue de Psychanalyse (n° 15, 1977) est suivie de commentaires de J.-B. Portalis, D. Anzieu et G. Rosolato (p. 29-37).
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Sta
nfor
d U
nive
rsity
-
- 17
1.67
.216
.22
- 01
/10/
2014
03h
55. ©
Pre
sses
Uni
vers
itaire
s de
Fra
nce
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - S
tanford University - - 171.67.216.22 - 01/10/2014 03h55. ©
Presses U
niversitaires de France
24 juillet 2014 06:09 - Caractère - Collectif - Revue de psychanalyse - 175 x 240 - page 1144 / 1256 - © PUF - - © PUF -
1145Idéalisations analytiques : Winnicott, ses patients, et nous
24 juillet 2014 06:09 - Caractère - Collectif - Revue de psychanalyse - 175 x 240 - page 1145 / 1256 - © PUF - - © PUF -
IDÉAUX ANALYTIQUES ET LIMITES ANALYTIQUES
Presque tous les analystes sont à la recherche d’un idéal, d’un modèle pro-fessionnel qui puisse guider l’action bien qu’il soit par définition hors d’atteinte. Cet idéal prend différentes formes qui dépendent de nos choix théoriques, mais renvoie généralement à un « fond éthique commun » (Wallerstein, 1990). Nous sommes conscients de la vulnérabilité de nos patients et nous adhérons aux codes professionnels qui les protègent. Quelle que soit notre position théorique, nous nous engageons à leur fournir une attention intense et disciplinée, à privilégier leurs besoins, à réfléchir à toutes les situations où nous échouons à le faire.
Pourtant de tels idéaux analytiques sont assez éloignés d’une réalité mar-quée par nos intérêts personnels et notre vulnérabilité. Malgré les satisfactions considérables que nous retirons de notre travail, nous sommes rarement ca-pables de rester totalement disponibles pour chacun de nos patients tout le long de la semaine analytique, ou de mettre de côté toutes nos préoccupations per-sonnelles et toutes nos priorités pendant chaque heure de travail analytique.
[…]Il nous est difficile de penser à nos échecs sans rationalisation excessive
ou sans autoaccusation. Notre capacité à tolérer la dé-idéalisation – une per-turbation d’une image de soi professionnelle positive à nos propres yeux et à ceux du patient sans destruction – crée plus d’espace pour que les patients remarquent et abordent ces moments. En reconnaissant, réfléchissant et tra-vaillant sur l’impact d’une infraction, nous réintroduisons ce qui est caché dans l’espace thérapeutique où il peut être examiné.
Je terminerai en présentant une autre vision analytique idéalisée. C’est celle où l’idéalisation ouvre la voie, non à la dévaluation, mais, à la fois, à l’appréciation et la reconnaissance de notre humanité et nos dons réels, à notre capacité à fonctionner thérapeutiquement dans le contexte de notre vulnéra-bilité à l’échec et de notre capacité à faire face à ces échecs. Les conflits entre l’idéal et le réel ne peuvent être négociés que si nous n’exigeons la perfection ni de nous-mêmes, ni du processus. Lorsque nous maintenons la conscience de ces conflits, la situation analytique reste perméable et flexible, ouverte aux passages entre l’idéalisation et la dés-idéalisation; le patient et l’analyste tra-vaillent avec les fantasmes de l’un et de l’autre et peuvent supporter la des-truction de ces fantasmes. […]
Joyce Slochower15 W. 75th St.
NY, NY [email protected]
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Sta
nfor
d U
nive
rsity
-
- 17
1.67
.216
.22
- 01
/10/
2014
03h
55. ©
Pre
sses
Uni
vers
itaire
s de
Fra
nce
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - S
tanford University - - 171.67.216.22 - 01/10/2014 03h55. ©
Presses U
niversitaires de France
1146 Joyce Slochower
24 juillet 2014 06:09 - Caractère - Collectif - Revue de psychanalyse - 175 x 240 - page 1146 / 1256 - © PUF - - © PUF -
24 juillet 2014 06:09 - Caractère - Collectif - Revue de psychanalyse - 175 x 240 - page 1147 / 1256 - © PUF - - © PUF -
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Bauduin, A. Denis, P. (2003), La perversion narcissique de l’analyste et ses théories, Revue française de psychanalyse, t. LXVII, n° 3, p. 1007-1014.
Benjamin J. (1988), The bonds of love: Psychoanalysis, feminism, & the problem of domi-nation. New York: NY, Random House.
Boynton, R. S. (2005, June 10), The return of the repressed: The strange case of Masud Khan. Boston Review.
Campbell D. L. (2003), Réponse aux articles de Wynne Godley dans le Times et la London Review of Books, Revue française de psychanalyse, t. LXVII, n° 3, p. 1029-1030.
Campbell D. L. (2003), Réflexions sur la réaction de la Société britannique au récit que Wynne Godley a fait de son analyse avec Masud Khan, Revue française de psy-chanalyse, t. LXVII, n° 3, p. 1031-1032.
Chasseguet-Smirgel J. (1974), Perversion, idealization and sublimation. International Journal of Psycho-Analysis, 55, p. 349-357.
Chasseguet-Smirgel J. (1976), Some thoughts on the ego ideal: A contribution to the study of the illness of ideality, Psychoanalytic Quarterly, 45, p. 345-373.
Cooper J. (1993), Speak of me as I am: The life and work of Masud Khan. London: UK: Karnac.
Crastnopol M. (1999), The analyst’s professional self as a “third” influence on the dyad. When the analyst writes about the treatment. Psychoanalytic Dialogues, 9, p. 445-470.
Friedman L. (2007), Who needs a theory of therapeutic action? Psychoanalytic Quarterly, 76, p. 1635-1662.
Freud S. (1914c), Pour introduire le narcissisme, OCF-P, XII, p. 127-160 ; SE, XV, p. 67-102 ; GW, X, p. 137-170.
Freud S. (1915e), L’inconscient, OCF-P, XIII, p. 205-242 ; SE, XIV, p. 166-204 ; SE, XIV, p. 166-204 ; GW, X, p. 264-303.
Freud S. (1916d), Quelques types de caractère dégagés par la psychanalyse, OCF-P, XV, p. 15-40 ; SE, XIV, p. 311-333 ; GW, X, p. 364-391.
Gabbard, G., Peltz M. (2001), Speaking the unspeakable: Institutional reactions to boundary violations by training analysts. COPE Study. Journal of the American Psychoanalytic Association, 49, p. 659-673.
Godley W. (2001), Saving Masud Khan. London Review of Books ; Sauver Masud Khan, Revue française de psychanalyse, t. LXVII, n° 3, 2003, p. 1015-1028.
Goldman D. (1993), In search of the real: The origins and originality of D.W. Winnicott. New York: NY: Aronson.
Goldman D. (2002, July 6), The outrageous prince: The uncure of Masud Khan [Madeleine Davis Memorial Lecture], London, Squiggle Foundation.
Goldman D. (2006), The outrageous prince. Paper presented at the New York University Postdoctoral Program.
Grand S. (2002), The reproduction of evil, Hillsdale: NJ, The Analytic Press.Grotstein J. S. (1981), Splitting and projective identification, New York: NY, Aronson.Grunberger B., Chasseguet-Smirgel J. (1986), Freud or Reich? Psychoanalysis and illu-
sion, New Haven: CT, Yale University Press.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Sta
nfor
d U
nive
rsity
-
- 17
1.67
.216
.22
- 01
/10/
2014
03h
55. ©
Pre
sses
Uni
vers
itaire
s de
Fra
nce
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - S
tanford University - - 171.67.216.22 - 01/10/2014 03h55. ©
Presses U
niversitaires de France
24 juillet 2014 06:09 - Caractère - Collectif - Revue de psychanalyse - 175 x 240 - page 1146 / 1256 - © PUF - - © PUF -
1147Idéalisations analytiques : Winnicott, ses patients, et nous
24 juillet 2014 06:09 - Caractère - Collectif - Revue de psychanalyse - 175 x 240 - page 1147 / 1256 - © PUF - - © PUF -
Guntrip H. (1996), My experience of analysis with Fairbairn and Winnicott, International Journal of Psycho-Analysis, 77, p. 739-754 ; Mon expérience de l’analyse avec Fairbairn et Winnicott, Nouvelle Revue de psychanalyse, n° 15, 1977, p. 5-27.
Harris A., Sinsheimer K. (2007), The analyst’s vulnerability: Preserving and fine tuning analytic bodies. in F. Anderson (Ed.), Body to body (p. 255-274), Hillsdale: NJ, The Analytic Press.
Hopkins L. B (1998), D. W. Winnicott’s analysis of Masud Khan: A preliminary study of failures of object usage, Contemporary Psychoanalysis, 34, p. 5-47 ; L’analyse de Masud Khan par D. W. Winnicott : Une étude préliminaire des échecs de l’utili-sation de l’objet, Revue française de Psychanalyse, t. LXVII, n° 3, 2003, p. 1033-1058.
Hopkins L. B. (2006), False self: The life of Masud Khan, New York, Other Press.Kernberg O. (1975), Borderline conditions and pathological narcissism, New York, NY,
Aronson.Kernberg O. (1984), Severe personality disorders: Psychotherapeutic strategies, New
Haven: CT, Yale University Press.Khan M. (1962), [Letter to D.W. Winnicott], New York: D. W. Winnicott Collection,
Oskar Diethelm Library, Institute for the History of Psychiatry, Weill Medical College of Cornell University.
Klein M. (1940), Mourning and its relationship to manic-depressive states, in Love, guilt and reparation, and other works, 1921–1945 (p. 344-369). London, UK: Hogarth Press, 1975 ; Le deuil et ses rapports avec les états maniaco-dépressifs, in Essais de psychanalyse, trad. fr. Marguerite Derrida, Paris, Payot, 1989.
Klein M. (1946), Notes on some schizoid mechanisms, International Journal of Psycho-Analysis, 27, p. 99-110 ; Notes sur quelques mécanismes schizoïdes, in Développements de la psychanalyse, trad. fr. Willy Baranger, Paris, Puf, 2013.
Kohut H. (1971), The analysis of the self: A systematic approach to the psychoana-lytic treatment of narcissistic personality disorders, New York: NY, International Universities Press.
Kohut H. (1977), The restoration of the self, New York: NY, International Universities Press.
Lacan J. (1964), Le Séminaire, XI, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse. Paris, Le Seuil, 1964.
Lander R. (2007), The mechanisms of cure in psychoanalysis. Psychoanalytic Quarterly, 76, p. 1499-1512.
Loewald H. (1975), Psychoanalysis as an art and the fantasy character of the psycho-analytic situation, Journal of The American Psychoanalytic Association, 23, p. 277-299.
Little M. I. (1990), Psychotic anxieties and containment: A personal record of an analysis with Winnicott, New York, Aronson.
Milner M. (1955), The role of illusion in symbol formation, in, M. Klein, P. Heimann, R. Money-Kyrle (Eds.), New directions in psycho-analysis (p. 82-108), London:
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Sta
nfor
d U
nive
rsity
-
- 17
1.67
.216
.22
- 01
/10/
2014
03h
55. ©
Pre
sses
Uni
vers
itaire
s de
Fra
nce
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - S
tanford University - - 171.67.216.22 - 01/10/2014 03h55. ©
Presses U
niversitaires de France
1148 Joyce Slochower
24 juillet 2014 06:09 - Caractère - Collectif - Revue de psychanalyse - 175 x 240 - page 1148 / 1256 - © PUF - - © PUF -
24 juillet 2014 06:09 - Caractère - Collectif - Revue de psychanalyse - 175 x 240 - page 1149 / 1256 - © PUF - - © PUF -
UK, Tavistock ; Le rôle de l’illusion dans la formation du symbole, in Matière à symbolisation : art, création et psychanalyse, Paris, Delachaux et Niestlé, 2000.
Modell A. H. (1975), A narcissistic defense against affects and the illusion of self- sufficiency, International Journal of Psycho-Analysis, 56, p. 275-282.
O’Shaughnessy E. (1992), Enclaves and excursions, International Journal of Psycho-Analysis, 73, p. 603-611.
Ribas D. (2000), Donald Woods Winnicott, Paris, Puf.Renik O. (1995), The ideal of the anonymous analyst and the problem of self-disclosure,
Psychoanalytic Quarterly, 64, p. 466-495. Rodman R. (2003), Winnicott Cambridge: MA, Perseus. Sandler A. M. (2004), Institutional responses to boundary violations: The case of Masud
Khan. International Journal of Psycho-Analysis, 85, p. 27-44.Sandler J. (1992), Reflections on developments in the theory of psychoanalytic technique,
International Journal of Psycho-Analysis, 73, p. 189-198Slochower J. (1991), Variations in the analytic holding environment. International
Journal of Psycho-Analysis, 72, p. 709-718.Slochower J. (1992), A hateful borderline patient and the holding environment.
Contemporary Psychoanalysis, 28, p. 72-88.Slochower J. (1993), Mourning and the holding function of shiva, Contemporary
Psychoanalysis, 29, p. 352–367.Slochower J. (1994), The evolution of object usage and the holding environment,
Contemporary Psychoanalysis, 30, p. 135-151.Slochower J. (1996a; 2014a), Holding and psychoanalysis: A relational perspective,
Hillsdale: NJ, The Analytic Press.Slochower J. (1996b), Holding and the evolving maternal metaphor, Psychoanalytic
Review, 83, p. 195-218.Slochower J. (1996c), Holding and the fate of the analyst’s subjectivity, Psychoanalytic
Dialogues, 6, p. 323-353.Slochower J. (1996d), Reply to commentaries, Psychoanalytic Dialogues, 6, p. 379-390.Slochower J. (2003a), The analyst’s secret delinquencies, Psychoanalytic Dialogues, 13,
p. 451-469.Slochower J. (2003b), A rule of one’s own: Reply to commentaries, Psychoanalytic
Dialogues, 13, p. 521-525.Slochower J. (2004), But what do you want? The location of emotional experience,
Contemporary Psychoanalysis, 40, p. 577–602.Slochower J. (2005), Holding: Something old and something new, in L. Aron, A. Harris
(Eds.), Relational psychoanalysis: Innovation and expansion, Hillsdale: NJ, The Analytic Press, p. 29-49.
Slochower J. (2006a; 2014b), Psychoanalytic collisions, Hillsdale: NJ, The Analytic Press.Slochower J. (2006b), The psychoanalytic other, Invited discussion of Helen Gediman’s
paper, Psychoanalytic Dialogues, 16, p. 263-272.Slochower J. (2014a), Holding and Psychoanalytic: A Relational Perspective
(2nd Edition), New York, Routledge.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Sta
nfor
d U
nive
rsity
-
- 17
1.67
.216
.22
- 01
/10/
2014
03h
55. ©
Pre
sses
Uni
vers
itaire
s de
Fra
nce
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - S
tanford University - - 171.67.216.22 - 01/10/2014 03h55. ©
Presses U
niversitaires de France
24 juillet 2014 06:09 - Caractère - Collectif - Revue de psychanalyse - 175 x 240 - page 1148 / 1256 - © PUF - - © PUF -
1149Idéalisations analytiques : Winnicott, ses patients, et nous
24 juillet 2014 06:09 - Caractère - Collectif - Revue de psychanalyse - 175 x 240 - page 1149 / 1256 - © PUF - - © PUF -
Slochower J. (2014b), Psychoanalytic Collisions (2nd Edition), New York, Routledge. Stein R. (2006), Unforgetting and excess; the re-creation and the re-finding of suppressed
sexuality. Psychoanalytic Dialogues, 16, p. 763–778.Teicholz J. (1999), Kohut, Loewald, and the postmoderns: A comparative study of self
and relationships, Hillsdale: N.J., The Analytic Press.Wallerstein R.S. (1990), Psychoanalysis: The common ground. International Journal of
Psycho-Analysis, 71, p. 3-20.Willoughby R. (2005), Masud Khan: The myth and the reality, London, UK: Free
Association Books.Winnicott D. W. (1956), The antisocial tendency, in Collected papers: Through pediatrics
to psychoanalysis (p. 306-315), New York: NY, Basic Books, 1975a. ; La tendance antisociale, in De la pédiatrie à la psychanalyse, trad. fr. Jeannine Kalmanovitch, Paris, Payot, 1989.
Winnicott D. W. (1959), [Letter to Helen Carr], New York: N, D.W.Winnicott Collection, Oskar Diethelm Library, Institute for the History of Psychiatry, Weill Medical College of Cornell University.
Winnicott D. W. (1962), [Letter to M. Khan], New York: NY, D. W. Winnicott Collection, Oskar Diethelm Library, Institute for the History of Psychiatry, Weill Medical College of Cornell University.
Winnicott D. W. (1969), The mother-infant experience of mutuality, in Psychoanalytic explorations, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1989, p. 251-260.
Winnicott D. W. (1975b), The depressive position in normal emotional development, in Collected papers: Through pediatrics to psychoanalysis, New York: NY, Basic Books, p. 262-277 ; La position dépressive dans le développement affectif normal, in De la pédiatrie à la psychanalyse, trad. fr. Jeannine Kalmanovitch, Paris, Payot, 1989.
Winnicott D. W. (1989), The importance of the setting in meeting regression in psycho-analysis. In, Psychoanalytic explorations, Cambridge, MA: Harvard University Press, p. 99-100.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Sta
nfor
d U
nive
rsity
-
- 17
1.67
.216
.22
- 01
/10/
2014
03h
55. ©
Pre
sses
Uni
vers
itaire
s de
Fra
nce
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - S
tanford University - - 171.67.216.22 - 01/10/2014 03h55. ©
Presses U
niversitaires de France