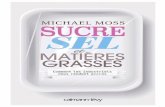Objets qui nous hantent, objets qui nous tentent
Transcript of Objets qui nous hantent, objets qui nous tentent
5
Introduction – « Nous, les objets »
En deux jours de 1953, Eugène Ionesco écrit Le nouveau locataire
(IONESCO, 1991). Relativement courte (une trentaine de pages) et gangré-
née par les didascalies, la pièce est le prétexte d’un entêtant ballet
d’objets. C’est là tout son argument : un locataire débarque avec une
valise dans son nouvel appartement. Il est suivi de déménageurs qui ne
vont cesser de remplir la scène de meubles et de bibelots : des vases et
des fauteuils, des tableaux, des armoires, des pendules. Le nombre de
possessions du nouveau locataire est tel que son déménagement engorge
toute la ville, voire tout le pays. La pièce ne peut se conclure que lorsque
la scène est totalement envahie par les objets et que le locataire, après
avoir congédié les déménageurs en leur ordonnant d’éteindre la lumière,
se retrouve seul dans le noir, miné par ses propres possessions.
Sur la scène de Ionesco, les objets ne sont pas des symboles,
mais bien les agents tout aussi muets qu’inquiétants de la défaite de
l’humain et de ses schèmes d’organisation. Les objets sont faits par
l’homme, selon sa mesure et pour ses besoins. Une fois qu’ils ont empli
le plateau de théâtre et assuré la défaite et la désertion d’un acteur/
personnage qui ne peut plus s’y mesurer, ils revêtent la force étrange
qu’ont expérimentée tous les spectateurs des Chaises : un amoncellement
de créations humaines se substitue aux hommes et nous dévisage, au
point que nous doutons de notre propre statut. L’expérimentation
théâtrale de Ionesco – avec bien d’autres tentatives artistiques et philoso-
phiques du XXe siècle – renverse ainsi la question millénaire : il ne s’agit
plus de savoir si les objets ont une âme mais si nous, nous en avons
encore une face à eux, et comment elle se tisse.
Parler de l’objet, « faire parler l’objet », revient alors à créer de
nouveaux objets pratiques et théoriques avec lesquels nous sommes,
irrémédiablement, embarqués. Mais faire parler l’objet ne va pas de soi.
Si l’ensemble des théories contemporaines de l’objet ont cherché à
s’extirper de l’opposition classique du sujet et de « ses » objets, les voies
empruntées peuvent, nous le verrons, aussi bien se croiser que diverger
radicalement.
Partant, est-il possible de livrer une définition claire et complète
des objets, ou faut-il se résoudre à constater leurs irréductibles attaches
relationnelles, historiques, culturelles ? Quelle extension convient-il de
donner à cette catégorie conceptuelle ? S’agit-il d’organiser, à travers et
par les objets, notre rapport au monde, de catégoriser ce dernier pour
mieux en synthétiser les significations ? Ou s’agit-il plutôt de nous laisser
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
6
jouer par eux, en un constant débordement de nos schèmes d’appré-
hension ? Dans la tradition philosophique moderne et contemporaine, ces
questions ont mené à une mosaïque d’interrogations conceptuelles rela-
tives au statut d’existence des objets de la pensée. Les articles réunis dans
ce premier numéro de L’Année Mosaïque en recensent quelques fragments
particulièrement signifiants.
Ainsi, loin de l’interprétation solipsiste et superficielle qui est
parfois donnée de l’idéalisme fichtéen, la contribution d’A. Dumont
entend démontrer que, chez Fichte, l’objet est perpétuellement engendré
par une performance de la conscience créatrice, dans une immanence de
l’image de l’Être qui engage entièrement le sujet et son monde. Dans les
courants proto-phénoménologiques puis phénoménologiques, il ne sera
plus question de performativité, mais bien d’intentionnalité : que visons-
nous, que produisons-nous comme catégorie lorsque nous pensons par
objet ? Serions-nous capables de produire des représentations sans
objet ? En retraçant les origines de la Gegenstandstheorie meinongienne à
travers les grands noms de la proto-phénoménologie autrichienne,
S. Richard fournit un historique des tensions qui permettront le dévelop-
pement d’une ontologie à même de penser différents modes d’être et
catégories de l’objet.
À la croisée de la métaphysique, de la logique et de la phéno-
ménologie, ces développements auront une influence considérable sur
la philosophie du XXe siècle. D’ailleurs, l’impact d’un tel bouleversement
ne se réduit pas à ses conséquences théorétiques : la contribution de
B. Straehli déploie, à rebours, tous les enjeux esthétiques des Recherches
logiques husserliennes à travers la notion spécifique d’« objet sonore »
élaborée par Pierre Schaeffer dans sa quête d’une refonte de la gram-
maire musicale et du solfège classique.
Du reste, les recherches en théorie de l’objet ont pu donner lieu,
dans la philosophie analytique, à un tournant radical dans la conceptua-
lisation de nos rapports au monde et au langage, à travers la question
des significations. Ainsi, dans les thèses de Quine, les objets constituent,
par définition, ce par quoi et de quoi nous parlons sans cesse. Selon lui,
« [p]arler d’objets s’est tellement invétéré en nous, que dire que nous
parlons d’objets semble quasiment ne rien dire du tout ; car comment y
aurait-il moyen de parler autrement ? » (QUINE, 1977 : 13). Dans la perspec-
tive immanentiste de Quine, c’est l’objectivation référentielle qui donne
cohérence au vécu sensible et permet de réunir, de lier les données
éparses de l’expérience (LAUGIER-RABATÉ, 1992 : 124-127). De la sorte,
l’objet peut se définir par son caractère stable et cohérent ; par le fait
qu’il synthétise des éléments divers en une totalité limitée. En cela, les
Loïc NICOLAS et Aline WIAME
7
objets seraient des entités saturables et comptables, « s’oppos[a]nt à la
fois aux événements et aux agrégats » (NEF, 1999 : 77). Pour fondatrice
qu’elle soit, cette position ne va pas sans poser de nouveaux problèmes
conceptuels. En fournissant une analyse fouillée du débat entre Strawson
et Davidson, la proposition de J. Maréchal donne un aperçu du travail
théorique auquel invite la philosophie analytique, particulièrement dans
le champ de la philosophie du langage. Quel est le statut de l’objet d’un
discours ? Doit-il avoir une matérialité ? Comment s’articule notre prati-
que des significations – et surtout, comment peut-elle, à partir de ses
objets, donner lieu à l’élaboration d’un système conceptuel ?
Ainsi la pensée trouve-t-elle, dans et par les objets, un formi-
dable moteur de création. Encore n’est-ce là qu’un mode d’existence
parmi d’autres. Nous le savons bien, nous qui vivons, chaque jour, avec
et contre les choses. Nous qui voyons le cours de nos actions modifié par
leur seule présence. L’article d’I. Barth souligne, par exemple, l’immense
défi que pose le développement des technologies de l’information et de
la communication : de l’électroménager « intelligent » au smartphones, tout
un monde se redessine. Il impose à la fois de réagencer les contours de ce
que nous qualifions d’« objet » et de retravailler en profondeur la manière
dont les sciences humaines construisent leur objet de recherche. La théorie
critique convoquée par l’auteur nous invite alors à lier innovations tech-
niques et imaginaire symbolique.
Or, c’est justement ce travail de l’imaginaire et de ses objets qui
est au cœur des pratiques artistiques. En posant son regard sur la
deuxième génération du surréalisme belge, M. Godet nous rappelle
combien l’objet peut se révéler « bouleversant ». Décadrant, « inutile » et
pourtant pénétrant, l’objet surréaliste est une protestation contre toute
pétrification de nos habitudes de vie. Ainsi peut-on le considérer comme
une source d’expérience relationnelle vivace du point de vue de l’empi-
risme radical défendu par William James. Réfutant l’opposition entre la
conscience (« subjective ») et ce qui constitue nos percepts (qui auraient
pour base un monde « objectif »), James invite à une ontologie pluraliste
des relations. Celle-ci ne jaillit jamais aussi nettement que dans les
transitions problématiques que l’expérience lui impose (JAMES, 2007b :
83-84). C’est là tout le sel de la méthode pragmatique, jamesienne
(JAMES, 2007a). La proposition de Th. Drumm démontre à quel point
cette méthode ne relève pas d’un pur et simple utilitarisme, comme on
l’entend parfois, mais exige que nous nous rendions capables de prendre
en compte les modalités spécifiques du passage allant des objets qui nous
permettent de penser à ceux qui confrontent notre pensée. Cela implique
toute une politique, tout un repositionnement théorique quant à la
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
8
publicité de ces choses dont nos biographies sont tissées, et qui nous font
vivre.
Entre les maisons closes de Buenos Aires et les ruses en appa-
rence nostalgiques des immigrés sur les rives du Rio de la Plata, l’article
de F. Courtois-l’Heureux se confronte, justement, à ces exigences en exa-
minant comment nous font agir les multiplicités des objets du tango
argentin, de la soi-disant « femme-objet » au fétichisme du talon-aiguille.
Ainsi est-elle amenée à développer les potentialités du constructivisme
contemporain, notamment à travers les thèses de Bruno Latour relatives
à l’objet « faitiche » (LATOUR, 1996).
À l’évidence, ce qui retient l’attention, c’est cette capacité à
inventer, rechercher, investir, réfléchir des objets en tous genres. Que ces
objets soient perceptibles ou qu’ils ne le soient pas : trop grands, trop
petits, trop loin, trop rapides. Mais encore qu’ils se développent dans des
dimensions abstraites ou concrètes, réelles ou irréelles, possibles ou
impossibles, naturelles ou artificielles, techniques ou esthétiques, etc.
Comprenons bien, le champ des objets ne saurait se réduire à celui de la
perception immédiate, à la seule réalité physique ou à de pures entités
mentales. Partant, la catégorie « objet » paraît sans limites, hormis celles
de nos capacités d’invention. Dès lors, chaque contributeur, depuis sa
discipline et sa tradition propres, aide à préciser les contours de la
catégorie, à en relever les apories, à en questionner les usages sociaux et
théoriques. Smartphones, objets d’arts, objets sonores, objets de discours,
fétiches, concepts, ce premier numéro de L’Année Mosaïque invite à une
aventure risquée… à la rencontre de nos hantises et de nos tentations.
Loïc NICOLAS et Aline WIAME
Bibliographie
IONESCO E., 1991, Théâtre complet, éd. E. Jacquart, Paris : Gallimard.
JAMES W., 2007a [1907], Le pragmatisme. Un nouveau nom pour d’anciennes
manières de penser, trad. N. Ferron, Paris : Flammarion.
JAMES W., 2007b [1912], Essais d’empirisme radical, trad. G. Garreta et
M. Girel, Paris : Flammarion.
LATOUR B., 1996, Petite réflexion sur le culte moderne des dieux faitiches,
Paris : Éditions Synthélabo.
LAUGIER-RABATÉ S., 1992, L’anthropologie logique de Quine. L’appren-
tissage de l’obvie, Paris : Vrin.
NEF F., 1999, L’objet quelconque. Recherches sur l’ontologie de l’objet,
Paris : Vrin.
QUINE W. V. O., 1977 [1966], Relativité de l’ontologie et quelques autres
essais, trad. J. Largeault, Paris : Aubier.
9
Iwan BARTH
Des « objets communicants » à l’imaginaire
social de la rationalisation : un objet de
recherche entre aspects matériel et
symbolique de l’interconnexion des TIC
Introduction
Les évolutions des industries de l’informatique, des télécom-
munications et de l’électronique grand public (electronic consumer)
ont conduit les centres de recherche et développement (R&D) atten-
ants à envisager l’émergence d’une informatique ubiquiste (ubiquitous
computing ou Ubicomp). Aujourd’hui également appelé Internet des
Objets – et auparavant, et avec quelques nuances : objets communi-
cants, intelligence ambiante, informatique (ou réseaux) pervasive(-ifs) – ce
champ d’innovation fédère des laboratoires publics, des organismes
nationaux et supranationaux de financement de la recherche, des
services R&D d’entreprises des secteurs suscités1. Il se matérialise
concrètement par un nombre important de colloques, conférences
internationales, revues et ouvrages scientifiques, programmes de
recherche, démonstrateurs et autre proof-of-concept, et enfin, de plus en
plus, par quelques innovations mises sur le marché de la consom-
mation de masse.
Ce secteur de l’innovation en technologies de l’information et
de la communication (TIC) a la prétention, de plus en plus actualisée,
de modifier notre conception des objets et environnements qui compo-
sent le cadre matériel de la vie quotidienne dans les sociétés occiden-
tales. Électroménager « intelligent » ou « communicant », équipements
domestiques ou urbains « sensibles au contexte » ou « en réseaux », mai-
son « connectée » (prenant la suite de la moribonde domotique) : autant
d’exemples génériques d’applications que permettent les capteurs, action-
1 Par exemple, respectivement : INRIA (Institut National de la Recherche en
Informatique et Automatismes – France) et Institut Fraunhöfer (Allemagne) ;
ANR (Agence Nationale de la Recherche – France) et 6e et 7e PCRD (Program-
me cadre de recherche et de développement) de la Commission de l’Union
Européenne ; Philips, France Télécom – Orange, Siemens, Fagor, etc.
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
10
neurs ou microprocesseurs embarqués dans une multitude d’objets
(ex : accéléromètres dans les smartphones), les étiquettes dite « intelli-
gentes » de type RFID, ou encore les réseaux sans fil de type Wi-Fi,
Wimax et autres.
Derrière une apparente uniformité, deux conceptions des objets
ainsi modifiés apparaissent dans ces recherches et tentatives d’inno-
vations. Conceptions qui posent une première difficulté au chercheur.
La première conception s’est donnée pour but de disséminer le plus
possible d’électronique, d’informatique, et – pour reprendre les termes
des concepteurs – de communication ou d’intelligence, dans les objets
usuels du quotidien. L’autre est plus problématique puisque, avec l’idée
de technologie calme, elle appelle tout simplement à une certaine dispa-
rition des artefacts, à un effacement de l’infrastructure technique et
matérielle.
Les sciences sociales, et plus particulièrement les sciences de
l’information et de la communication, sont fondées à investir ce
champ d’innovation – et ceci à plus d’un titre. Mais une recherche
sur ce thème (effectuée dans le cadre d’une thèse soutenue fin 2010)
ne peut revendiquer son inscription au sein des sciences sociales
qu’à condition de satisfaire à certains impératifs, particulièrement
visibles lors de la construction de l’objet de recherche : questionne-
ments sur la distance prise avec le sens commun, les pressions d’appli-
cation, sur la réflexivité, ou encore la charge critique contenue dans tel
ou tel positionnement épistémologique. Parmi ces interrogations,
celle portant sur la place à accorder aux objets « concrets », à l’aspect
« technique » et « matériel » du phénomène, nous paraît centrale et en
mesure d’éclairer quelques spécificités d’une recherche en sciences de
l’information et de la communication (SIC). Cette centralité est redoublée
par une autre difficulté, propre à ce sujet de recherche : ces objets
communicants sont marqués par une sorte de manque de « réalité » ou
de « concret » dû à leur existence sous forme essentiellement de projet
de recherche, de discours anticipatoires ou prospectifs, de prototypes
parfois, et bien plus rarement d’objet massivement commercialisés.
Cette réflexion sur la place du « technique » – pris dans sa
dimension aussi bien instrumentale-rationnelle que sociale-symbo-
lique – à l’intérieur d’un objet de recherche en sciences sociales,
couplée à une double exigence de montée en généralité de notre
propos et de mise à distance du champ observé, nous a incité à
modifier l’appellation même des objets concrets faisant l’objet de
notre investigation. La formule TIC interconnectées (ou mise en inter-
connexion des TIC) est donc venue remplacer les différents vocables
Iwan BARTH
11
en usage chez les concepteurs de R&D et autres chercheurs en intel-
ligence artificielle ou ambiante1.
Les deux compréhensions du terme « objet » qui se font jour
dans ce qui vient d’être évoqué structureront peu ou prou les deux
parties de cet article. Tout d’abord, dans le sens le plus trivial d’objet
du quotidien : l’informatisation dont il est ici question s’exerce sur
des objets matériels, produits de la technique et du travail. Le mode
de production industriel qui caractérise nos sociétés occidentales a
donné lieu à un fourmillement de ces objets, également objets de
consommation de masse. Le secteur d’activité qui prétend modifier leur
appréhension n’est donc pas anodin, et une rapide mise en perspective
historique permettra, dans un premier temps, d’en pointer quelques
représentations centrales.
La seconde compréhension est celle d’objet de recherche. Nous
rendrons compte alors des enjeux de sa construction. Parmi ceux-ci se
trouve notamment la définition du domaine des SIC. Celle-ci dépend
de la manière d’en constituer l’objet (DAVALLON, 2004). Nous ver-
rons que la variété des fondements théoriques de la discipline (pour
prendre deux extrêmes : théorie de l’information et cybernétique d’un
coté ; théorie critique et thème des industries culturelles de l’autre)
peut être vue comme un atout permettant de se saisir d’un objet
technique multiforme et n’empêchant pas un positionnement clair
quant à cet héritage. Au-delà de ces fondements historiques, nous
montrerons la fécondité d’un apport théorique en marge du champ
disciplinaire mais permettant de saisir et d’articuler les dimensions
techniques et symboliques des objets étudiés.
L’article s’appuiera, dans sa partie empirique autant que
théorique, sur notre travail de thèse. Lequel nous a conduit à
interroger l’imaginaire social de la conception des objets communi-
cants et de l’intelligence ambiante (BARTH, 2010). Les trois premières
années de cette recherche (de 2005 à 2008) ont été financées par le
service R&D de France Télécom – aujourd’hui Orange Labs. Le tra-
vail de terrain s’est déroulé au sein de cette institution connue au
niveau européen pour ses travaux en matière d’objets et de lieux
« communicants », et plus précisément dans le laboratoire rassem-
1 La différence entre les deux conceptions d’intelligence informatique peut
être grossièrement manifestée ainsi : l’intelligence artificielle voulait reproduire
dans une machine une modélisation du monde et un « raisonnement ration-
nel » ; l’intelligence ambiante cherche à coordonner des modélisations et rationali-
tés partielles et éparses dans l’environnement et à en faire émerger un « raison-
nement globalement efficace ».
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
12
blant quasi-exclusivement des concepteurs en informatique, électro-
nique, réseaux.
Les travaux sur l’imaginaire social nous ont permis d’élaborer
un objet de recherche aux multiples facettes qui, s’il est difficile d’appré-
hension à première vue, s’inscrit dans la contestation en acte d’une
excessive parcellisation des sciences sociales. C’est à cette seule condi-
tion, nous semble-t-il, qu’est possible un début de réponse à des ques-
tions sociétales, soulevées parfois à l’intérieur même du champ observé ;
envisageable aussi un positionnement critique face au réel du monde
social et aux possibles qu’il renferme.
1. Des choses qui pensent à l’Internet des Objets :
court aperçu de l’informatisation des objets (et)
du quotidien
Nous évoquions plus haut l’enjeu du vocable utilisé pour
désigner le phénomène technique observé, et la nécessité que nous
avons doublement éprouvée de s’en distancier. Objets communicants,
intelligence ambiante, informatique ubiquiste, ou Internet des Objets… Un
petit coup d’œil rétrospectif sur cette évolution lexicale et ce qu’elle
désigne laisse apparaître que le dernier vocable en date, à savoir
l’Internet-des-Objets, semble être l’appellation générale la plus propre
à rassembler en son sein les multiples déclinaisons qu’a connues la
mise en interconnexion des TIC, et dont le terme things that think –
choses pensantes ou qui pensent – a été l’une des premières tentatives
de désignation spécifique.
On peut d’ores et déjà distinguer deux grands courants évoqués
dans un texte de 2007 par un chercheur en intelligence artificielle. Texte
dont le titre propose d’ailleurs une appellation encore différente : « La
robotisation des objets ». F. Kaplan résume ainsi les deux approches
d’un même secteur d’innovation, dont il fait découler deux concep-
tions légèrement divergentes des objets ayant intégré en partie, voire
totalement, le triptyque capteurs / actionneurs / centre de calcul :
« Les objets technologiques peuvent s’efforcer de se faire oublier,
mais ils peuvent aussi enrichir nos vies en affirmant leur présence
ou leur autonomie. […] Entre les technologies “calmes” et les
technologies “piquantes”, le débat est ouvert. » (KAPLAN, 2007 : 25)
Iwan BARTH
13
La mention de « technologie calme » fait explicitement référence à Mark
Weiser2, figure centrale et régulièrement citée dans les recherches en
interconnexion de TIC. Cherchant à dépasser la forme du « PC », de
l’ordinateur « centralisateur », le but de l’informatique ubiquiste est de
« distribuer » le traitement de l’information dans l’environnement de
l’utilisateur. Ceci afin que les fonctionnalités fournies le soient en mobili-
sant le moins possible une attention « consciente ». Le concept de « tech-
nologie piquante », que Kaplan a construit en miroir, semble désigner
des dispositifs recherchant moins la discrétion qu’une certaine pro-
action, et qui, grâce aux nouvelles fonctionnalités apportées par les TIC,
seraient ainsi en capacité de bousculer l’habituel rapport aux objets.
1.1. Multiplication du nombre d’objets
« embarquant » des TIC
Quelques années plus tard est fondé, au sein du Massaschusset
Institue of Technology (MIT3), le consortium TTT : Things that think
(Choses qui pensent). Dans l’hypothèse de la dichotomie proposée
plus haut par Kaplan, c’est d’abord du côté des « technologies
piquantes » qu’on peut classer leurs travaux. Dès 1995, l’idée fonda-
trice de ce consortium – mêlant financement publique et « sponsoring »
des différents programmes de recherche par des partenaires privés –
est l’enfouissement d’« intelligence », de calcul (eng. computation) « à
la fois dans des objets et des environnements quotidiens ». Estimant
que l’existence (et l’intérêt) des objets ainsi « augmentés » électroni-
quement est aujourd’hui chose acquise, ses co-directeurs mettent
l’accent sur leur évolution et redéfinissent leur but comme suit :
« inventer le futur des objets et environnements numériquement
augmentés. […] Fondés sur l’interaction profonde des firmes spon-
sor, nos prototypes et démonstrateurs de recherche visent à inspirer
les produits et services de demain. » (Site web du consortium TTT :
http://ttt.media.mit.edu/vision/vision.html (notre traduction))
2 Mark Weiser (1952-1999), professeur et chercheur en informatique, a été à
la tête du laboratoire d’informatique du Palo-Alto Research Center (PARC),
centre de recherche et développement (R&D) de la firme Xerox, avant d’en
devenir son « technologue en chef » (chief technologist). Inventeur du concept
et du terme ubiquitous computing, ses articles à ce sujet dès la fin des années
1980 ont fait date. 3 Une bonne partie de l’histoire de l’informatisation des objets est, en effet,
d’origine nord-américaine.
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
14
Le MIT, institution-symbole de la recherche scientifique et des appli-
cations technologiques aux États-Unis, accueille également d’autres
équipes de recherche travaillant sur des thématiques voisines surtout
au sein du Media Lab. Ce dernier, consacré aux technologies de
l’information et de la communication, héberge ainsi notamment le
Center for Bits and Atoms (CBA), fondé par N. Gershenfeld4 en 2001.
Se définissant comme une « initiative interdisciplinaire », le Centre se
focalise sur l’interface entre les « sciences informatiques et les sciences
physiques » et fait sienne l’hypothèse suivante :
« Matériel et logiciel, forme et fonction, pensée et corps sont par
convention séparés, que ce soit dans les milieux académiques ou
industriels, mais [ne le sont] pas dans la nature. Beaucoup de nos
plus remarquables opportunités et défis technologiques résident
maintenant à leur intersection. » (Texte de présentation du Center
for Bits and Atoms sur son site web : http://cba.mit.edu/about (notre
traduction))
Dans ce courant de recherche et d’innovation technique, des notions
telles que phycones (contraction anglophone de icône physique),
interface tangible, ou machine-to-machine sont centrales. Les deux pre-
mières évoquent ce fameux « pont » entre le « monde de l’infor-
mation » et le « monde physique » qui vaut au CBA son acronyme.
L'idée d’impact « dans le monde réel », d’un échange ou traitement
d’information, se retrouve dans le concept d’actionneur. La notion de
machine-to-machine regroupe des recherches visant à remplacer l’inter-
vention humaine par une intermédiation technico-technique, au sens
où la collaboration entre machines est envisagée sans la présence,
l’action ou la décision du moindre opérateur humain. Cette média-
tion exclusivement technique est rendue possible par un autre
concept central : la sensibilité au contexte. Celle-ci est facilitée par des
capteurs – de pression, de présence, de température, etc. –, et surtout
par un module de calcul ou de traitement de l’information récoltée –
que cette dernière soit issue de « capteurs » ou inférée depuis l’utilisa-
tion de l’objet elle-même. Ce dernier module peut être présent physi-
quement dans l’objet par un microprocesseur embarqué, ou être
4 Professeur d’informatique et de physique au MIT et directeur du Center for
Bits and Atoms, Neil Gershenfeld a publié notamment When Things Start to
Think, Henry Holt and Company (1999), The Physics of Information Technology,
Cambridge University Press (2000), et Fab : The Coming Revolution On Your
Desktop – from Personal Computers To Personal Fabrication, Basic Books (2005).
Iwan BARTH
15
déporté via un réseau sans fil de type Wi-Fi, vers un ordinateur plus
classique.
D’autre groupes de recherches aux noms évocateurs, égale-
ment hébergés par la division Media Lab du MIT, témoignent de la
vitalité de ces thématiques : le Tangible Media Group, dirigé par le Pr
Hiroshi Ishii (co-directeur et fondateur du TTT), ou encore le Fluid
Interfaces Group, auparavant dénommé Ambient Intelligence Group.
1.2. Accent mis sur l’interconnexion : de l’intelligence
artificielle à l’intelligence ambiante
La dénomination d’intelligence ambiante apparaît plus tardi-
vement que celle d’informatique ubiquiste5. Le concept technologique
qui se cache derrière reprend pourtant certaines des idées-phares de la
vision de Mark Weiser. Notamment cette formule, dont on retrouve
un nombre important d’occurrences dans les articles scientifiques
relatifs à ce champ :
« Les technologies les plus profondes sont celles qui disparaissent.
Elles se fondent elles-mêmes dans le tissu de la vie quotidienne
jusqu’à s’y confondre. » (WEISER, 1991, notre traduction)
La vision précédente – relative aux objets intelligents – résonnait en
termes d’intégration, d’embarquement d’éléments électroniques per-
mettant les fonctions informatiques et/ou « communicationnelles »
dans les objets. Il est ici d’avantage question de se focaliser sur les
interactions de ces derniers, et même sur le service à délivrer à
l’utilisateur grâce à ces interactions. Les tenants de cette vision de
l’interconnexion des TIC souhaitent ainsi se rapprocher de la remar-
que énoncé par Weiser :
« Quelle serait la métaphore pour l’ordinateur du futur ? […] Un
bon outil est un outil qui disparaît. […] Des lunettes de vues sont
un bon outil – vous regardez le monde, non les lunettes. » (WEISER,
1991, notre traduction)
5 Sa présence est attestée en 2001 dans un document de la Commission
Européenne présentant les « grands challenges » de la recherche et de l’inno-vation ; le livre The New Everyday View on Ambient Intelligence, de S. Marzano
et E. Aarts a été publié en 2003.
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
16
C’est donc à une disparition ou, au moins, à un certain effacement des
objets que prétendrait conduire cette vision de l’interconnexion des TIC
synthétisée dans les expressions intelligence ambiante et informatique
ubiquiste. Le terme d’ubimedia proposé par Adam Greenfield6, essayiste
et spécialiste de l’« expérience utilisateur », reprend la même idée en
soulignant à la fois l’importance de la composante « information-
nelle » ajoutée aux fonctionnalités classiques des objets, et l’impact
probable de cet ajout sur les interactions quotidiennes. C’est ce qu’il
développe, au début d’EveryWare :
« Avec l’ubimedia, les vêtements, les pièces de la maison et les rues
deviennent des lieux de traitement et de médiation. Les objets
domestiques, qu’il s’agisse d’une cabine de douche ou d’un pot de
café, sont repensés comme autant d’endroits où l’on peut rassem-
bler des informations, les prendre en compte ou interagir avec elles.
Et tous les rites familiers de la vie quotidienne – notre manière de
nous réveiller, de nous rendre au travail, de faire les courses – sont
revus en une danse complexe mettant en jeu des informations sur
nous-mêmes, l’état du monde extérieur et les options dont nous
disposons à tout moment. » (GREENFIELD, 2007 : 8)
Encore faut-il comprendre qu’ici « interaction » se réfère non exclusi-
vement, mais principalement, au sens goffmanien du terme, c’est-à-
dire à sa dimension humaine7. C’est à la fois pour limiter les mal-
entendus et pour mettre à distance l’implicite anthropomorphe de
l’expression que nous avons choisi d’utiliser le terme « interconnexion »
dans le but de désigner l’aspect technico-technique de ce que certains
acteurs dénomment interaction « entre eux » des objets ou des dispositifs
« communicants ». Qu’il s’agisse d’intelligence ambiante, d’informatique
ubiquiste ou d’ubimedia, nous comprenons que c’est moins l’équipement
d’objets usuels en capacité (électronique) de traitement d’information
et de communication qui retient l’attention des concepteurs se plaçant
dans cette optique, que la mise en interconnexion elle-même. Adam
Greenfield va précisément bien dans ce sens :
6 Le néologisme francophone d’ubimedia est proposé par son traducteur,
C. Fiévet, pour figurer le jeu de mot intraduisible utilisé par A. Greenfield :
« everyware », homonyme de everywhere (partout) et formé par le suffixe -ware
sur le mode des concepts informatiques antagonistes hardware (matériel) et
software (logiciel). 7 Ce que confirme l’utilisation de l’expression « rites familiers de la vie
quotidienne » dans cette citation. Voir GOFFMAN, 1973, ou encore NIZET, RIGAUX,
2005.
Iwan BARTH
17
« Pour parvenir à une véritable utilité dans la pièce [domestique]
numérique, il faudrait au préalable comprendre que la mise en
réseau global est plus importante que la somme des parties qui
composent ce réseau. » (GREENFIELD, 2007 : 61)
Cette évolution du « progrès technique » et sa matérialisation probable
dans le cadre de la vie quotidienne de tout un chacun enthousiasment,
bien sûr, la plupart des concepteurs qui y prennent part et, au delà de
ce champ social, un nombre croissant d’amateurs plus ou moins
aguerris (voir pratiquants) des « nouvelles technologies ». Pourtant,
on voit parfois surgir en leur sein des moments de réflexivité critique, de
prise de distance, avec cette vision de l’avenir des objets technologi-
quement communicants voir intelligents. Ces moments prennent parfois
l’aspect d’une remarque fugace comme celle qui s’inscrit, en clôture
du texte « La robotisation des objets », à la suite du passage cité plus
haut :
« Entre les technologies “calmes” et les technologies “piquantes”, le
débat est ouvert. Au-delà des questions techniques, c’est une réflexion
sur la place de la technologie dans nos vies qui va naturellement
s’amorcer. » (KAPLAN, 2007 : 25)
Ces moments apparaissent d’autres fois sous la forme d’une réflexion
plus ambitieuse et conséquente, qui irrigue en partie, et le plus souvent
de manière discrète, un ouvrage « grand public » comme celui d’A.
Greenfield. La conclusion intitulée « Encore et toujours les mêmes
erreurs » est pourtant l’occasion pour celui-ci de résumer sans détours
ses interrogations :
« Bien sûr j’aimerais pouvoir [profiter de certaines fonctionnalités
de technologies ubiquistes]. […] Mais j’ai beaucoup de mal à croire
que nous puissions bénéficier de ces interventions ubiquistes à
moindre coût. Je vois trop combien les infrastructures qui nous
apporteront tout cela pourront aussi faciliter la répression, l’exclu-
sion et le rétablissement des classes ou de privilèges. Et par-dessus
tout, j’y vois une source de nuisance occasionnelle… ou perpé-
tuelle. » (GREENFIELD, 2007 : 254)
Ainsi à côté de l’enthousiasme naturel de chercheurs et de concepteurs
pour leur domaine d’activité, une « demande sociale » semble se faire
jour auprès d’acteurs de premier plan tels que Greenfield ou Kaplan :
celle-ci évoque l’imminence, la nécessité, ou le besoin d’une réflexion
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
18
publique, d’un débat sociétal (et donc politique) sur l’impact et la dif-
fusion de ces « objets interconnectés ».
2. Entre dimension technique, « sens commun » et
élaboration de l’objet scientifique : les enjeux de
la distanciation et du champ disciplinaire dans la
construction de l’objet de recherche
Le chercheur souhaitant se saisir de ce phénomène sociotech-
nique multiforme que constitue « la recherche et la conception en
interconnexion de TIC » ne peut ignorer l’existence de cette « demande
sociale », aussi timide soit-elle. Nous touchons là une partie de ce que
Jean Davallon pointe comme une double contrainte devant laquelle
est placé le chercheur. C’est en se positionnant par rapport à elle, ou
plus exactement en la surmontant, qu’il construit son objet de recherche.
Pour une part, une recherche dans le domaine de la communication
pose le problème de la mise à distance des « connaissances » produites
par le champ lui-même. Jean Davallon y voit un risque de sous-estimer
l’importance de la construction de l’objet de recherche :
« Le risque pour le chercheur est alors de croire qu’il va trouver
chez ces acteurs une “connaissance” de l’objet le dispensant pure-
ment et simplement de construire un objet de recherche, puisque
cette “connaissance” existe déjà à l’intérieur de cet objet lui-même. »
(DAVALLON, 2004 : 32)
Ainsi la formulation des questions sociétales entraînées par la diffu-
sion de l’interconnexion des TIC prouve bien, a minima, une réflexivité
de certains acteurs. De même l’utilisation de termes généralisants, tels
qu’objets ou outils, indique une certaine théorisation et une montée en
généralité à partir des innovations particulières. Ce point est d’autant
plus sensible ici que le « terrain » observé possède une composante
« scientifique ». Celle-ci, bien que fortement liée à d’autres aspects
(industriels, ou de politique publique, etc.), marque fortement de son
empreinte rationaliste des discours qui ne peuvent, pour autant, être
pris pour argent comptant.
Le second aspect de la contrainte résulte d’une « demande
sociale » tendant également à faire apparaître comme superflu le travail
de construction. Si nous avons esquissé plus haut celle relative au besoin
de débat public, une autre demande sociale en terme « d’application »
Iwan BARTH
19
cette fois apparaît bien plus pressante, comme le souligne Davallon,
concernant les recherches en communication.
« [L’autre aspect de la contrainte est], à l’inverse, d’une demande
sociale forte d’application de la connaissance ou des procédures
scientifiques pour réaliser ou améliorer effectivement les objets
concrets, c’est-à-dire les “moyens” de communication. » (DAVALLON,
2004 : 32)
Dans le cas précis de notre recherche de thèse sur l’interconnexion
des TIC, cet aspect était particulièrement sensible. Il se matérialisait,
pour notre part, au travers de conditions particulières à la pratique
de recherche elle-même : conséquence du financement de la thèse
par l’un des acteurs du champ qui représentait la contrepartie d’un
accès facilité au terrain.
Ces caractéristiques, si elles peuvent être rencontrées dans
d’autres domaines des sciences sociales, prennent un relief particu-
lier en SIC, estime Davallon, en raison de la place occupée par la
dimension technique à l’intérieur des objets de recherche : « du fait
même de la “nature” sociotechnique des objets [étudiés] » (DAVALLON,
2004 : 32). Rappelant que « refuser d’occulter la dimension technique » ne
doit pas être confondu avec « défendre une quelconque posture techni-
ciste », l’auteur précise que
« prendre acte de la dimension technique de l’objet, c’est, pour le
chercheur en sciences de l’information et de la communication,
d’abord et avant tout reconnaître qu’il a affaire à des complexes et
non à des objets unitaires. » (DAVALLON, 2004 : 34)
Dans l’héritage épistémologique des sciences de l’information et de
la communication, si les diverses approches théoriques de la commu-
nication peuvent être mobilisées, elles sont d’intérêts variables dans
la construction de l’objet de recherche précis.
2.1. Théorie de l’information, sociologie des usages
et Théorie critique : mise à profit inégale de la
pluralité épistémologique originelle des SIC
Lorsqu’il était plus haut question de la contrainte de mise à
distance des « connaissances » développées par le champ observé lui-
même, nous avons évoqué la difficulté supplémentaire que représente
sa composante scientifique. Ceci peut être accentué par la proximité
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
20
des références théoriques entre le champ observé et le champ disci-
plinaire. Dans l’ouvrage spécialisé Objets communicants, on peut ainsi
lire des développements sur la « théorie de l’information » (KINTZIG
et al., 2001 : 23 sq.). La conception (mathématisée) de la commu-
nication développée par C. Shannon fait bien sûr partie des classiques
des sciences de l’information et de la communication. Moins explicites,
les références permanentes à la circulation de l’information présentée
parfois comme un but en soi fait grandement appel aux théories
cybernétiques initiées par Wiener dans les années 1960.
Ces croisements de références peuvent être judicieusement
mis à profit pour : 1) contribuer à valider la pertinence du sujet de
recherche par rapport à l’inscription disciplinaire, et 2) se servir des
réactions et reconstructions théoriques entraînées par la fortune que
cette conception a eue en son temps, pour objectiver et mettre à dis-
tance les connaissances produites par « le terrain8 ». Mais à se saisir
trop rapidement de ces « coïncidences épistémologiques » entre
terrain et théorie, le risque est grand de ne pas parvenir à battre en
brèche cette « évidence9 » de l’objet technique, ni à « rendre visible
l’invisible de leur organisation, en tant qu’objets communicationnels »
(DAVALLON, 2004). Il apparaît qu’avec sa vision purement instru-
mentale de la technique, la théorie de l’information ne nous permet pas
de construire un cadre conceptuel à même d’accueillir le caractère
complexe et polymorphe de l’objet concret (l’interconnexion des TIC)
de la recherche.
Pour gagner en complexité et en pertinence, la sociologie des
usages, autre élément théorique central des SIC, apparaît dans un
second temps comme plus adapté à l’étude de nos objets techniques.
Cette approche a l’avantage de mettre l’accent sur la construction
sociale dans laquelle s’inscrit l’usage d’un objet, d’un dispositif,
irréductible à l’usage prescrit ou souhaité à l’origine, non plus qu’à
l’appréhension purement instrumentale de l’utilisation du dispositif.
8 « Conçue par et pour des ingénieurs des télécommunications, [les membres
de « l’École de Palo Alto »] font valoir que la théorie mathématique [de la
communication] doit leur être laissée, et que la communication doit être
étudiée par les sciences humaines à partir d’un modèle qui lui soit propre. »
(MATTELART, 2004 : 36). 9 Ceci d’autant plus que d’après A. et M. Mattelart : « Le modèle finalisé de
Shannon a induit une approche de la technique qui la réduit au rang
d’instrument. Cette perspective exclut toute problématisation qui définirait
la technique autrement qu’en termes de calcul, de planification et de pré-
diction. » (MATTELART, 2004 : 32).
Iwan BARTH
21
Ceci à condition de respecter les avertissements de certains pré-
curseurs des études d’usage sur les techniques d’information et de
communication, comme J. Jouët, qui critique les manquements à ces
fondamentaux qui se font parfois jour :
« Cette dérive émergente vers l’empirisme témoigne d’une cristal-
lisation sur l’objet qui l’emporte sur la problématique, et l’usage
instrumental des machines à communiquer devient parfois le
cœur de l’observation, en postulant implicitement que l’usage
peut se suffire à lui-même, existe en soi et n’est pas le fruit d’une
construction sociale. » (JOUËT, 2000 : 51310)
Dans ce même texte paru en 2000, la chercheuse faisait le lien entre
les changements intervenus dans les modalités et pratiques de recherche
et ce manque préoccupant de problématisation11.
Mais, du fait qu’ils s’inscrivent dans un processus d’innova-
tion plus ou moins avancé, nos objets observés ne facilitent pas une
approche par l’usage : soit qu’ils n’existent que « sur le papier », sous
la forme de projet de recherche, de scénario décrivant des « fonction-
nalités » ; soit qu’ils aient dépassé ce stade de peu, mais ne sont pas
parvenus à un stade de diffusion suffisamment vaste et prolongé
dans le temps pour avoir pu donner lieu à la formation d’usages
stabilisés12. Même s’il faut reconnaître que, depuis la clôture de la
phase empirique de cette recherche (mi-2009), deux bémols viennent
nuancer cet aspect : d’une part l’usage grandissant de smartphones
semble modifier peu à peu cet état des choses ; d’autre part, certains
10 Une dérive, ajoutait la chercheuse, qui « se remarque particulièrement
dans certains travaux sur les usages conduits en sciences de l’information et
de la communication. » (JOUËT, 2000 : 513) 11 « La mode des études d’usage est lancée. […] Par contre, cette prolifération
d’études d’usage, décontextualisées de toute problématique, n’est pas sans
avoir d’effets pervers sur la recherche scientifique elle-même. […] [L]es
contraintes croissantes imposées par les commanditaires (études à court terme
réalisées sur des objets de plus en plus ciblés) contribuent à favoriser l’empi-
risme. » (JOUËT, 2000 : 511). Dans ce même article, l’auteur notait l’importance,
pour une sociologie conséquente des usages des TIC, de garder à l’esprit la
dimension forcément interdisciplinaire de telles études… a fortiori si ces der-nières s’inscrivent dans cette interdiscipline que sont les sciences de l’infor-mation et de la communication (JOUËT, 2000 : 513). 12 Exemple : le « Pack Com’Box » (« détecteur de fumée communicant ») as-
sociant l’opérateur Orange, l’assureur Mondial Assistance et l’équipementier
Delta Dore, est commercialisé depuis 2008.
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
22
travaux tentent de s’attacher à l’étude critique d’usages de TIC non-
stabilisés (COUTANT, DOMENGET, 2011). L’attention à la conception
qui nous semble essentielle dans la compréhension de ces « nou-
veaux objets » (ou « hypothétiques nouveaux objets » pour les plus
prudents) est un autre aspect limitant l’intérêt des études d’usages.
Pour ces dernières, en effet, l’objet tend à se présenter comme un
« donné » : remettre en cause ou interroger des choix de conception,
les représentations du réel par les concepteurs, les discours sur les
aspects de la vie quotidienne nécessitant d’être « augmentés », le
mode de production, etc. depuis leur point de vue, n’est pas chose
aisée.
En convoquant la Théorie critique défendue par l’École de
Francfort, c’est sur un autre courant fondateur pour les sciences de
l’information et de la communication que nous nous appuyons. La
production industrielle des biens culturels – texte de Theodor W. Adorno
et Max Horkheimer emblématique de ce courant13 – rassemble deux
dimensions souvent disjointes par le sens commun, et dont la
réunion s’avère indispensable d’après nous pour une bonne compré-
hension de l’émergence et du développement de l’interconnexion
des TIC : la dimension technique / matérielle, et la dimension symbo-
lique / culturelle. Ici, le moment de la production fait bien l’objet
d’interrogations et de remises en question, ce qui souligne le carac-
tère produit, construit (dans tous les sens du terme) de l’objet étudié,
son historicité donc. Cette remise en question se fait en soulignant
l’ambiguïté du processus de rationalisation : promesse d’émancipation
par l’usage de la raison, mais aussi lourd d’aliénation nouvelle par
l’extension du pouvoir d’une certaine forme de rationalité.
Justement, les travaux de Marcuse et Habermas sur les
différents types de rationalités, tels qu’on peut les approcher dans La
technique et la science comme « idéologie », reprennent la théorie de Max
Weber – et même, en un sens, des écrits de jeunesse de Karl Marx –
sur la centralité de la rationalité instrumentale (ou par rapport à une
13 ADORNO, HORKHEIMER, 1974. Le courant dit de l’École de Francfort et la
Théorie critique qui lui est rattaché, est parfois dénommé webero-marxisme
ou freudo-marxisme. L’objectif en était l’actualisation du travail de critique
(de l’existant, des idéologies, des productions culturelles) marxien tout en se
démarquant de l’orientation économiciste prédominante. Analysant avec la
même vigueur l’évolution monopolistique et étatique du capitalisme et la
fossilisation de la théorie marxiste, les thèmes de recherche de ce courant
sont : l’industrialisation culturelle, la rationalisation instrumentale, la réification,
ou plus récemment le concept de reconnaissance.
Iwan BARTH
23
fin) dans les rapports sociaux issus du (et nécessaire au) capitalisme.
La critique que formule H. Marcuse à l’égard de cette rationalisation,
cristallisée dans la technique et la science moderne, porte sur sa fonction
idéologique, de légitimation de la domination.
« Aujourd’hui la domination se perpétue et s’étend non pas seule-
ment grâce à la technologie mais en tant que technologie, et cette
dernière fournit sa grande légitimation à un pouvoir politique qui
prend de l’extension et absorbe en lui toutes les sphères de la
civilisation. […] Ainsi la rationalité technologique ne met pas en
cause la légitimité de la domination, elle la défend plutôt, et l’horizon
instrumentaliste de la raison s’ouvre sur une société rationnellement
totalitaire. » (MARCUSE, 1968 : 181. Cité dans HABERMAS 1973 : 9)
Ce constat appellerait un changement au sein même des pratiques
techniques et scientifiques. Habermas, qui lui porte la contradiction,
estime pour sa part que c’est au niveau de la discussion rationnelle
au sein de l’espace public que doit se faire la régulation de la coloni-
sation du « monde vécu » par l’activité rationnelle par rapport à une fin,
soit le démasquage de la position idéologique de la technique et de la
science, corollaire d’une inévitable et dommageable dépolitisation de
la population.
« Une discussion publique, sans entraves et exempte de domination,
portant sur le caractère approprié et souhaitable des principes et nor-
mes orientant l’action, à la lumière des répercussions socio-culturelles
des sous-systèmes d’activité rationnelle par rapport à une fin qui sont
en train de se développer. » (HABERMAS, 1967 : 67)
Cette position part du postulat, que Habermas s’attache à expliciter,
de la technique et de la science comme inexorablement et exclu-
sivement liées à l’activité rationnelle par rapport à une fin et, en ce sens,
porteuses de domination dans le cas d’un déséquilibre trop impor-
tant avec l’activité communicationnelle. De ce postulat il tire un constat
théorique selon lequel aucune autre technique ou science n’est
possible.
Pour essentiels que soient ces éléments dans l’élaboration de
notre cadre théorique, un manque semblait se faire sentir dans
l’adéquation dudit cadre à la spécificité des « objets concrets » que
nous soumettions à l’investigation scientifique : ils sont un mélange à
la fois de technique et d’imaginaire. Un autre manque dans l’articu-
lation sociotechnique nous a semblé crucial : ce que notre recherche
empirique faisait apparaître n’était pas une science ou technique
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
24
« essentialisée », mais une activités concrète, déterminée de multiples
manières par le monde social environnant.
2.2. Critique de l’extension du domaine de la
rationalité instrumentale : apports théoriques
de l’imaginaire social
Ainsi, tout en revendiquant l’orientation et nombre d’outils
conceptuels de la Théorie critique, nous avons été incité à pousser au-
delà14, et un peu en marge des SIC notre outillage théorico-méthodo-
logique. Les travaux de Cornelius Castoriadis commencent à être bien
connus quant au thème de l’imaginaire. Mais la présence du mot dans le
titre de son maître ouvrage, L’institution imaginaire de la société, ne doit
pas conduire à réduire à ce thème la portée de son travail. Publiée peu
de temps avant celui-ci, sa contribution à l’Encyclopaedia Universalis
sous l’entrée « Technique » nous semble un passage obligé pour toute
réflexion sérieuse sur le sujet. Ce texte présente surtout l’avantage,
concernant l’objet d’étude dont il est question ici, de lier très fortement
les considérations en termes techniques / rationnels, et imaginaire /
construit social.
L’auteur souligne tout d’abord le caractère inextricable des
relations entre les faits « techniques » et les dimensions d’organisa-
tion sociale, s’appuyant pour cela largement sur les travaux d’André
Leroi-Gourhan. La perspective de ce dernier intéresse directement et
doublement les sciences de l’information et de la communication
lorsqu’il lie, dans un même continuum, Technique – Langage – Social :
« Ce triomphe progressif de l’outil [sur le monde matériel] est
inséparable de celui du langage, il ne s’agit en fait que d’un seul et
même phénomène au même titre que technique et société ne sont
qu’un même objet. » (LEROI-GOURHAN, 1964 : 292)
14 Et, en même temps, pas très loin, puisque tant Weber que Marx représentent
les soubassements théoriques de l’École de Francfort. Les références obligées de
Castoriadis aux deux premiers, ainsi qu’à Freud le rapprochent très fortement
de ce courant. Enfin H. Lefebvre (dont il n’est pas question ici, mais qui est
apparu comme un complément indispensable sur la notion de quotidien –
qu’il a été le premier à conceptualiser), bien qu’il ne soit pas classé habituel-
lement parmi les tenants de ce courant, en tant que marxiste hétérodoxe,
n’en est pourtant pas très éloigné.
Iwan BARTH
25
Castoriadis énonce une idée proche, mais distincte lorsqu’il parle de
la place d’un outil technique, « inisolable » de multiples « milieux »
ou, pour reprendre l’expression utilisée plus haut par Davallon,
« complexes ». L’idée d’un objet « pur », réductible à sa composante
technique-fonctionnelle est d’ailleurs, précise l’auteur, une concep-
tion très socio-centrée, propre à la société occidentale moderne,
consécutif de l’oubli (ou refoulement) de ce que cet objet « est pris
dans un réseau de significations ». L’auteur récuse ainsi l’idée d’une
neutralité des techniques « par rapport au social » – non sans avoir
auparavant acquiescé à l’idée d’une sorte de « neutralité axiolo-
gique », de consubstantialité de la raison instrumentale à une introu-
vable « essence » de la Technique :
« […] sans doute, considérée en et pour elle-même, l’activité
technicienne ne prend pas en compte la valeur des fins qui lui sont
proposées. […] Ainsi la technique apparaît comme wert-frei, neutre
quant à la valeur, référée à l’efficacité comme seule valeur. »
(CASTORIADIS, 1978 : 306)
Mais, ajoute-t-il vertement, « à l’échelle sociale et historique, ces considé-
rations deviennent des sophismes », se positionnant ainsi implicitement
dans la controverse théorique énoncée plus haut opposant Marcuse à
Habermas :
« Comment pourrait-on séparer les significations du monde posées
par une société, son “orientation” et ses “valeurs”, de ce qui est
pour elle le “faire efficace”. […] Toute société crée son monde,
interne et externe, et de cette création la technique n’est ni instru-
ment ni cause, mais dimension […]. » (CASTORIADIS, 1978 : 307)
De fait, cette dimension sociale-historique et signifiante de la tech-
nique d’une société particulière, cette inscription de la totalité sociale
dans la technique – et inversement –, se retrouve à une échelle plus
petite au niveau de l’objet technique lui-même. De sa construction à
son utilisation, il fait intervenir l’ensemble du monde social :
« [C]et objet est lui-même un produit ; sa genèse met donc à contri-
bution la totalité de l’existence sociale de la collectivité qui le fait
naître. […] Ce n’est pas seulement qu’il y a un ”style“ des inventions
et des artefacts propres à chaque culture (ou à des classes de cultures)
[…], c’est que dans l’ensemble technique s’exprime concrètement une
prise du monde. Mais l’ensemble technique lui-même est privé de
sens, technique ou quelconque, si on le sépare de l’ensemble écono-
mique et social. » (CASTORIADIS, 1978 : 309)
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
26
Ce qui permet de comprendre que l’enchâssement profond et
démultiplié du domaine technique dans le social peut être résumé par
la matérialisation ou plutôt, pour reprendre le vocabulaire de l’auteur,
par l’institution de ce que Castoriadis appelle les significations imagi-
naires sociales. Non pas que les objets et le système technique soient le
lieu privilégié de cette matérialisation : il en est un parmi les autres
domaines du social, et donc aussi lisible ici qu’ailleurs… Mais il faut
pour cela adopter une approche non fragmentaire ou non atomisée
des différents aspects de ce social-historique. Ce qui fait souscrire
l’auteur à l’idée que « à partir des significations imaginaires attachées
à un outil, la façon de s’en servir, sa forme, etc., on pourrait recons-
tituer tout l’imaginaire social » (CASTORIADIS, 2005 : 75). L’idée d’ima-
ginaire social est bien sûr d’abord théoriquement séduisante par la
possibilité qu’elle donne d’appréhender des constructions collectives
manquant de « réalité concrète » comme des productions dignes
d’étude tout autant que des objets massivement présents. Mais cette
approche nous semble surtout la plus à même de respecter la dimen-
sion de « complexe » de l’objet communicationnel sur laquelle insiste
Davallon.
En effet, plus que la recherche d’une essence de « la Techni-
que », l’essentiel est, pour Castoriadis, d’observer l’activité technique
et ses résultats dans le concret de leur matérialisation : avec leur part
de déterminations sociales et historiques chaque fois particulières,
autant qu’avec leur part de création chaque fois originale. Si essence
il y a, elle est pour l’auteur d’articuler une composante de rationalité-
par-rapport-à-une-fin – pour reprendre l’expression de Max Weber
puis de Jürgen Habermas – à une composante sociale-historique.
Celle-ci contient à la fois les conditions sociales et historiques « objec-
tives » particulières et les significations posées collectivement comme
centrales par la société considérée15. Ces significations sont qualifiées
par Castoriadis d’imaginaires, dans la mesure où elles ne peuvent être
déduites rationnellement de l’existant, mais sont de pures créations.
Il les qualifie également de sociales, dans la mesure où elles sont
15 Pour le type de société qui nous concerne, celui où se développe l’intercon-
nexion des TIC et les travaux d’informatique ubiquiste, C. Castoriadis
mentionne deux significations imaginaires sociales centrales, et plus ou
moins antagonistes : celle d’une « extension illimitée d’une pseudo-maîtrise
peudo-rationnelle », et celle de l’autonomie, « forcément à la fois sociale et
individuelle ». Les titres de ses derniers recueils (La montée de l’insignifiance ;
Une société à la dérive) témoignent de son appréciation de la montée en
puissance de la première signification par rapport à la seconde.
Iwan BARTH
27
produit par la collectivité et n’ont d’existence que par leur caractère
collectif. Bien qu’irriguant tout ce que chaque société produit (les
institutions au sens large : technique, langage, organisations, techni-
ques, etc. jusqu’aux formes spécifiques d’individus) en même temps
que les dépassant, ces significations ne peuvent s’approcher qu’indi-
rectement, par l’intermédiaire de ces « matérialisations » chaque fois
particulières. Les significations sociales d’une société sont donc lisibles
dans diverses institutions dont font partie l’ensemble technique et les
objets qui les constituent. Mais cette lecture implique de ne pas isoler
ou réduire à une seule dimension les objets ou techniques produits par
cette société.
Appliqué au cas de l’informatisation des objets, ce cadre
théorique nous conduit à plusieurs propositions couvrant les domaines
des systèmes matériel (technique), social et symbolique dans lesquels est
pris l’objet étudié initialement, l’interconnexion des TIC :
- Tenter de tirer, dans une démarche proche de celle de l’archéo-
logue, toutes les informations et les conséquences de la concep-
tion, de la production matérielle comme de la consommation
(réelles ou envisagées) de ces artefacts et dispositifs socio-
techniques. De la prise en compte du « milieu associé » des
objets communicants et autres capteurs ou terminaux consti-
tuant l’hypothétique Internet-des-objets peut être dégagée l’im-
portance d’institutions à étudier en priorité.
- Remettre en perspective à la fois synchronique et diachro-
nique deux institutions dans lesquels l’informatisation des
objets s’inscrit principalement : la Recherche et Développe-
ment en informatique, télécommunications et électronique
grand public d’un côté ; l’institution « logement », forme parti-
culière (fonctionnaliste et utilitariste) de l’institution trans-
historique « habitat16 » de l’autre. La rationalisation – instrumen-
tale – croissante des activités paraît être le maître mot commun,
et ancien, à l’évolution de ces deux secteurs.
- Mettre en avant les imaginaires présents dans les produc-
tions discursives liées à l’informatisation des objets et des
activités domestiques. Sont mises à jour trois justifications
16 Ce que nous n’avons fait que « par la bande » dans le travail de thèse, en
nous appuyant surtout sur des travaux traitant : 1- de l’histoire de la
mécanisation du traitement des données en entreprise d’un coté (GARDEY,
2008), et 2- de la rationalisation de l’architecture domestique de masse de
l’autre (PARAVICINI, 1988).
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
28
sociales principales où les notions de maîtrise et de son
accroissement sont omniprésentes, avec la rationalité tech-
nique comme moyen-fin : l’écologie (maîtrise de l’eau, de
l’énergie), la préoccupation socio-sanitaire (monitoring de
l’état de santé, maîtrise du lien social), l’amélioration du
confort et de la praticité de la vie quotidienne (maîtrise de la
complexité technologique).
Il s’agit là d’une présentation d’un plan de travail idéalisé
que la réalisation concrète du travail de thèse n’a pu mener que
partiellement à bien. Elle permet, à tout le moins, de montrer que,
tout en gardant à l’esprit de « prendre au sérieux » la part technique
de notre sujet d’étude, notre cheminement problématique a conduit à
un glissement : d’une préoccupation centrée sur des objets particu-
liers, nous sommes passé à celle des activités dont ils sont issus
(processus de conception), et dans lesquels ils s’inséreraient (activités
de la vie domestique). Ceci a rendu possible l’analyse d’objets dont
la matérialité concrète le dispute encore à la part imaginaire de leur
existence. La théorie des significations imaginaires sociales, de leur
institution et de leur altération, a été le moyen par lequel a pu être
construit un objet de recherche, articulant dimension communica-
tionnelle et institutionnelle de cette existence avec sa dimension
technique et matérielle.
Conclusion
Si la pression quant à l’applicabilité des résultats peut, voire
même doit, être tenue à distance d’une recherche en sciences sociales, la
question liée à la manière d’appréhender scientifiquement l’informatisa-
tion des objets et de l’environnement quotidien peut, plus difficilement,
ignorer une autre demande sociale. Exprimée (implicitement ou de
façon contradictoire) par certains acteurs du champ, elle pointe le besoin
ou l’imminence d’une réflexion dans l’espace public sur la forme et
l’ampleur des « technologies ubiquistes », sur la place de la technologie
dans nos sociétés et dans notre vie quotidienne. Mais le fait que notre
recherche montre que ces développements technologiques sont la résul-
tante, la concrétisation, l’institution la plus actuelle d’un imaginaire social
puissant, nous pousse à reformuler les termes de cette demande sociale.
Dans la mesure où ces développements technologiques répon-
dent d’une signification centrale et déjà anciennement installée au cœur
de l’édifice imaginaire social de nos sociétés, la, ou plutôt les questions
Iwan BARTH
29
auxquelles devrait s’atteler cette discussion publique revêtent un
caractère politique particulier. En effet, « la forme et l’ampleur » des
objets communicants ou intelligents, et celles du sous-système technique
dans lesquels ils s’inscrivent, sont déterminés en majeure partie par
les institutions ayant en charge leur production et leur diffusion. La
discussion publique souhaitée par certains concepteurs ne pourra
donc faire l’économie d’une réflexion dépassant le cadre rassurant et
bien délimité des objets et des technologies proprement dits. Elle ne
pourra pas éviter de remettre en question la manière (technique et
organisationnelle) dont sont conçus, produits, diffusés, et utilisés ces
objets, leur utilité et leur obsolescence. En un mot, l’organisation d’un tel
débat public impliquerait de s’interroger peu ou prou sur le mode de
production et de consommation industrialo-productiviste.
Bibliographie
ADORNO Th., HORKHEIMER M., 1974 [1944-1947], « La production in-
dustrielle des biens culturels », dans La dialectique de la raison, trad.
E. Kaufholz, Paris : Gallimard, p. 129-176.
BARTH I., 2010, Des TIC comme vecteur matériel et symbolique de rationa-
lisation et modélisation de la vie domestique, Thèse en sciences de l’infor-
mation et de la communication, Université de Lille 3.
CASTORIADIS C., 1978 [1973], « Technique », dans Les Carrefours du
labyrinthe, Paris : Éd. du Seuil, p. 289-324.
CASTORIADIS C., 1975, L’institution imaginaire de la société, Paris : Éd.
du Seuil.
CASTORIADIS C., 2005 [1987], « Les significations imaginaires sociales »,
dans Une société à la dérive, Paris : Éd. du Seuil, p. 65-92.
COUTANT A., DOMENGET J.-C., 2011, « Étudier les phénomènes en
cours de stabilisation : quelle posture de recherche pour la théorie
critique ? », Actes du Colloque Communications-organisations et pensées
critiques, Roubaix, 5 et 6 juillet 2011, texte consultable en ligne sur le
site du LASELDI : http://semlearn.pu-pm.univ-fcomte.fr/sites/default/-
files/coutant%20domenget%20posture%20critique.pdf.
DAVALLON J., 2004, « Objet concret, objet scientifique, objet de re-
cherche », Hermes, n° 38, p. 30-37.
GARDEY D., 2008, Écrire, Calculer, Classer. Comment une révolution de
papier a transformé les sociétés contemporaines (1800-1940), Paris : La
Découverte.
GOFFMAN E., 1973 [1959], La Mise en scène de la vie quotidienne, t. 1 La
Présentation de soi, Paris : Éd. de Minuit.
GREENFIELD A., 2007, Every[ware] La révolution de l’ubimedia, trad.
C. Fiévet, Limoges : FYP Éditions.
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
30
HABERMAS J., 1990 [1973], La technique et la science comme “idéologie”,
trad. J.-R. Ladmiral, Paris : Gallimard.
JOUËT J., 2000, « Retour critique sur la sociologie des usages »,
Réseaux, vol. 18, n° 100, p. 487-521.
KAPLAN F., 2007, « La robotisation des objets », dans M. LAYET et al.,
Futur 2.0, comprendre les 20 prochaines années, Limoges : FYP Éditions,
p. 24-25.
KINTZIG C et al. (dir.), 2001, Objets communicants, Paris : Hermès Science
Publications.
LEROI-GOURHAN A., 1995 [1964], Le geste et la parole. Technique et
langage, Paris : Albin Michel.
MARCUSE H., 1968 [1964], L’Homme unidimensionnel. Essai sur l'idéo-
logie de la société industrielle avancée, trad. M. Wittig, Paris : Éd. de
Minuit.
MATTELART A et M., 2004, Histoire des théories de la communication,
Paris : Éd. La Découverte.
NIZET J., Rigaux N., 2005, La sociologie de Erving Goffman, Paris : Éd.
La Découverte.
PARAVICINI U., 1988, Femmes et architecture domestique, une histoire
matérielle de l’habitat, Thèse de doctorat en architecture n° 714, EPFL,
Lausanne.
Texte de présentation du consortium Things that think (TTT)
consultable en ligne sur : http://ttt.media.mit.edu/vision/vision.html.
Texte de présentation du Center for Bits and Atoms (CBA) consul-
table en ligne sur : http://cba.mit.edu/about.
WEISER M., 1991, « The Computer for the 21st Century », Scientific
American, consultable en ligne sur : http://www.ubiq.com/hypertext/-
weiser/SciAmDraft3.html.
WEISER M., 1993, « The World is not a Desktop », consultable en
ligne sur les archives de l’auteur : http://www.ubiq.com/hypertext/-
weiser/ACMInteractions2.html.
31
Marie GODET
De l’« objet bouleversant » à L’Objet à
travers les âges. Évolution de la conception
et de l’utilisation de l’objet chez Marcel Mariën
et Christian Dotremont
Introduction
L’objet, entendu dans le sens d’une chose fabriquée afin de
répondre à un certain usage dans la vie quotidienne, occupe une
place importante dans le surréalisme belge. Mises en exergue par le
premier groupe de surréalistes bruxellois, les potentialités de l’objet
seront également soulignées et exploitées par la « deuxième généra-
tion », et particulièrement par les poètes Marcel Mariën et Christian
Dotremont. À partir des années 1960, période où le premier reprend
le « greffage » (MARIËN, 1994 : 13) d’objets, tandis que l’autre invente
le logogramme, leurs réalisations sont tellement éloignées que l’on a
tendance à oublier qu’ils ont, pendant les années de guerre, partagé
projets et préoccupations. Nés respectivement en 1920 et 1922, Mariën et
Dotremont se rencontrent au début de l’année 1941. Ils sont alors de
jeunes recrues d’un mouvement qui a déjà été bien défini autant en
France qu’en Belgique et qu’ils vont devoir s’approprier. L’intérêt
qu’ils manifestent à cette époque pour l’objet s’inscrit dans la
tendance qui s’est dessinée au début de la décennie précédente. L’objet,
parce qu’il est issu de la réalité, est considéré comme un moyen
privilégié pour s’attaquer à celle-ci, pour « changer la vie » (RIMBAUD,
1999 : 189), ce qui constitue la raison d’être du surréalisme1. Les habi-
tudes de vie comme de pensée limitent l’existence humaine, et ce sont
elles que les surréalistes – selon diverses techniques – s’efforcent de
combattre.
Cet aspect imprègnera le parcours de Mariën comme celui
de Dotremont, bien qu’il les incitera à orienter leur activité dans des
directions très différentes. Il est dès lors passionnant de remarquer
1 Sans doute y a-t-il aussi bien un lien à faire avec le désir de « transformer le
monde » que les uns puis les autres reprennent à Marx, mais cette problé-
matique mériterait une étude plus vaste.
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
32
que leurs premiers textes contiennent déjà l’amorce de conceptions
distinctes de l’objet, qui se reflèteront dans leurs relations avec les
membres du groupe de Bruxelles (que nous réduirons ici à ses deux
acteurs principaux, René Magritte et Paul Nougé).
Mariën, qui est rapidement devenu une figure incontour-
nable du groupe, écrit fréquemment sur et pour Magritte. En bon
disciple, il se révèle un critique perspicace et docile à la fois. Il em-
brasse par ailleurs pleinement les idées de Nougé, et travaillera à
leur diffusion en publiant ses écrits. La réalisation d’objets découle
presque logiquement de cet attrait pour les théories nougéennes, qui
évoquent fréquemment l’objet, et pour la peinture de Magritte, qui le
représente, donnant un sens nouveau aux « objets bouleversants »
définis par Nougé2.
S’il tente d’abord d’être apprécié par les membres du groupe
de Bruxelles, Dotremont n’y occupera jamais une place équivalente à
celle de Mariën. Cette situation semble moins imputable à ses séjours
à Paris durant l’Occupation qu’à sa propension à écrire sans se soucier
de l’approbation du groupe – dont il finira par s’écarter complètement.
Son intérêt pour l’objet ne s’exprime que rarement par des réalisations
concrètes, et il mettra d’ailleurs rapidement en question l’efficacité des
expositions d’objets.
C’est le parcours croisé de ces deux poètes, des années de guer-
re aux années 1960, que nous allons esquisser ici.
1. Projets d’objets
Au moment de leur rencontre, Mariën, qui rentre de huit
mois de captivité, a de l’avance : à peine introduit parmi les membres
du groupe de Bruxelles, il a en effet participé à l’exposition Surrealist
Objects and Poems de novembre 1937 à Londres. Il y a présenté un
objet qui est autant apprécié par les surréalistes qu’il est moqué par
les critiques, lui assurant une renommée qui n’a pas faibli : la lunette
nommée plus tard L’Introuvable3. Il a fondé sa maison d’édition,
l’Aiguille aimantée, à Anvers, écrit pour le London Bulletin, et publié
deux plaquettes, Malgré la nuit et La Chaise de sable. Dotremont vient,
quant à lui, de débarquer dans le surréalisme, après avoir envoyé sa
2 Notons que Magritte et Nougé se sont eux aussi livrés occasionnellement à
la création d’objets. 3 Verre et Perspex, 11 x 27 x 18 cm. Anvers, collection Sylvio Perlstein.
Marie GODET
33
plaquette Ancienne éternité à l’adresse de Raoul Ubac trouvée sur la
revue L’Invention collective.
L’intérêt que manifeste Mariën pour l’objet trouve son origine
dans les théories de Nougé, exposées avec le plus de clarté dans Les
Images défendues, l’essai qu’il consacre à Magritte. Écrit en 1931, cer-
tains extraits paraissent dans Le Surréalisme au service de la révolution en
1933, mais il ne sera publié entièrement qu’en 1943. C’est sans doute
pour cette raison que Mariën en suit aussi précisément le fil et en cite
des extraits dans sa Chaise de sable, rédigée en 1938. Nougé partage
avec les surréalistes parisiens la conviction que l’isolement, le dépay-
sement, ou la modification d’un paramètre d’un objet permet d’en
faire ce qu’il appelle un « objet bouleversant » apte à ébranler les
habitudes mentales de l’homme.
Il se distingue néanmoins des théories bretoniennes sur plu-
sieurs points : il préfère l’implication de la conscience à l’automa-
tisme, et privilégie la discrétion des interventions, rêvant que l’intro-
duction d’une virgule suffise à modifier la signification d’un texte
entier (NOUGÉ, 1980 : 241). Il favorise également l’utilisation de
l’objet banal, car selon lui « isolé, le charme d’un objet est en raison
directe de sa banalité : un moulin à café a moins de peine à nous
atteindre qu’un moulin à prières1 ». On retrouve nettement ces éléments
dans La Chaise de sable, et plus largement, on verra que Mariën comme
Dotremont s’inscrivent nettement dans un sillage plus nougéen que
bretonnien. Il n’est, dès lors, pas étonnant que lorsqu’il évoque pour
la première fois son désir de créer des objets, Mariën – qui dira plus
tard sa dette à l’égard de la peinture de Magritte – raconte avoir suivi un
tel exemple de modification minime d’un objet banal provocant un
effet saisissant :
« Un ancien sabotier me racontait comment il s’était plu à fabriquer
jadis des sabots dont les semelles se trouvaient placées dans le sens
contraire de la marche, de manière à ce qu’elles s’imprimassent sur
le sol en une direction adverse à celle que prenait celui qui les avait
aux pieds. » (MARIËN, 1940 : 14)
1 NOUGÉ, 1980 : 239. Breton au contraire manifeste un goût pour les objets
étranges, déconcertants : ainsi des objets trouvés (dont l’intérêt est qu’on ne
puisse en identifier la fonction originelle), des objets mathématiques (« ma-
quettes » de fonctions mathématiques incompréhensibles pour le profane)
ou des objets naturels (cristaux, racines de mandragore et autres curiosités).
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
34
Mariën appliquera la méthode dès le premier de ses objets, réalisé après
avoir cassé sa paire de lunettes, qu’il remonte en escamotant simple-
ment un verre, le transformant subitement en un objet inutilisable,
incompréhensible, et visiblement dérangeant lorsqu’on lit les articles
d’époque : un parfait objet bouleversant. Il crée ensuite d’autres objets
qu’il décrit dans La Chaise de sable. Cette plaquette, qu’il publie en 1940,
semble constituer l’introduction de Dotremont à la question. On voit
dans les lettres adressées par Dotremont à Mariën que l’aîné exerce un
certain ascendant sur son cadet2, et constitue sa référence en matière de
surréalisme. Dotremont lui écrit suite à la lecture de sa plaquette, en
mars 1941, qu’il a pour lui « beaucoup de questions3 », et trois mois plus
tard lui annonce qu’il a lui aussi imaginé des objets. Les circonstances
comme le type d’objets décrits par Dotremont laissent penser que ses
premiers signes d’intérêt pour l’objet doivent au moins autant à Mariën
qu’aux découvertes parisiennes.
Pourtant, dans sa Chaise de sable, Mariën montre qu’un an
après son premier objet il a déjà diversifié sa démarche. On trouve
encore « une cuiller hermétiquement fermée » (cet objet et les suivants
sont cités dans MARIËN, 1940 : 14) qui pourrait s’apparenter à L’Introu-
vable, œuvre déjà citée ; mais il a surtout expérimenté les associations
de deux objets. Certains d’entre eux étonnent par leur façon de se
combiner plus que par leur rapprochement, comme « une boule de
savon de toilette dans laquelle un robinet fiché attendait de libérer je
ne sais quel phlogistique réjuvénateur4 », « une brosse à dents avec
dents substituées aux poils, tragique épilogue de “Bérénice”5 », ou
« une scie faite de bois6 ».
2 En effet, Dotremont abreuve Mariën de déclarations d’amitié et relate leur
rencontre dans tous ses détails et davantage dans Le Papier à cigarettes de la
nécessité (commencé en 1942, DOTREMONT, 2007). Il parle de lui ou cite ses écrits
dans les articles qu’il rédige à l’époque, allant jusqu’à se dénommer « le Hyde »
de Mariën. En 1943, comme Mariën l’a fait, Dotremont crée sa maison d’édition,
le Serpent de mer. 3 DOTREMONT à Mariën, 14 mars 1941. 4 Intitulée Les Miroirs parallèles, elle fut confectionnée et détruite deux fois
(MARIËN, 1989 : 15). 5 Faisant référence à une nouvelle de Poe, elle est restée à l’état de projet,
mais un dentier portant le même titre a été présenté par Pierre Sanders à
l’exposition de Bruxelles de 1945. 6 Intitulée Le Grand Amour, elle fut réalisée en 1967 avec l’assistance d’un
ébéniste (MARIËN, 1989 : 15 – localisation inconnue). Une autre version avec
une lame en papier faux bois a été réalisée en 1979 (collection privée).
Marie GODET
35
D’autres créations associent par contre deux choses opposées,
causant ainsi un choc (« un cercueil monté sur un berceau »), ou un
contraste poétique (« un ”bagage“ composé d’une plume de colombe
rattachée par deux fils blancs et minces aux anneaux d’une forte
poignée de cuir », appelé La Traversée du rêve7). Mariën inaugure avec ce
dernier un procédé auquel il aura fréquemment recours, qui consiste à
monter son objet sur un fond, accentuant ainsi la ressemblance avec les
peintures de Magritte auxquelles il fait souvent référence. Enfin sa
« camisole de force pour la Vénus de Milo » s’inscrit dans la lignée des
interventions sur cette statue, qu’elles soient de Magritte ou de
Salvador Dali8. Cette diversité se retrouvera dans les objets que
Mariën créera à partir des années 1960. Les projets que Dotremont
expose laconiquement en juin 1941 se limitent à la transformation
d’un paramètre de l’objet, à la manière de L’Introuvable, et répondent
donc – volontairement ou non – aux critères définis par Nougé :
« Je compte aussi exposer à la rentrée (septembre) quelques dessins
et quelques objets surréal. que j’ai conçus et réalisés ici (une allumette
contenant des boîtes d’allum. – un pot avec une anse à l’intérieur
etc.)9. »
Si Dotremont précise qu’il les a réalisés (ce qui signifie peut-être qu’il
comptait les réaliser avant son retour), il n’en reste aucune trace10.
Contrairement à Mariën qui signe son entrée en surréalisme par un
objet mémorable et en imagine d’autres à la suite, l’intérêt de
Dotremont pour la conception d’objets reste faible, et il mettra d’ail-
leurs rapidement en doute l’efficacité de telles créations.
2. Idées d’objets
Les textes traitant de l’objet mélangent généralement l’objet
écrit à l’objet peint et à l’objet « réel », ceux de Mariën et Dotremont
ne faisant pas exception. Mariën a commencé sa réflexion avec La
7 1938-1945, matériaux divers, 62 x 37 cm (collection privée). 8 Magritte en peint une reproduction en plâtre (Les Menottes de cuivre, 1931,
37 x 11,5 x 11 cm. Bruxelles, Musée Magritte) ; Dali crée la Vénus de Milo aux
tiroirs (1936/1964, bronze peint et hermine, 98 x 32,5 x 34 cm. Rotterdam,
Museum Boijmans Van Beuningen). 9 DOTREMONT à Mariën, 27 juin 1941. 10 Notons que Mariën tournera une des poignées d’une passoire vers
l’intérieur en 1967 (Le Tombeau de Paul Colinet, collection Christian Bussy).
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
36
Chaise de sable et la poursuit dans un essai, Les Poids et les Mesures,
publié en 1943. Dotremont y est incité à l’occasion du numéro que
consacrent à l’objet les surréalistes parisiens de la « Main à Plume »,
préparé à partir de 1943 et abandonné avec la séparation du groupe
en 1944. Le sujet de son article lui est attribué : c’est « la vie de
l’objet », qu’il utilise comme titre (VERNAY, WALTER, 2008 : 239-246 et
GUIGON, 2005 : 171-178). Mariën, quant à lui, donne à la revue un
Traité non scientifique de la quatrième dimension (VERNAY, WALTER,
2008 : 226-229) qui reprend une partie de son essai et approfondit
certaines idées de La Chaise de sable. L’analyse de ces textes démontre
que la personnalité des deux jeunes poètes commence à s’affirmer.
La Chaise de sable contient un historique du traitement de
l’objet. Giorgio De Chirico y fait figure de « grand ancêtre » et Max
Ernst, par ses collages11, d’exception : il est, avec Magritte, sacré cham-
pion du dépaysement, « un des seuls à faire fructifier le monde neuf
esquissé par Chirico » (MARIËN, 1940 : 20). Comme Nougé, Mariën
voit dans l’intérêt pour les objets ordinaires la véritable originalité
du surréalisme :
« Sans doute, le facteur du fantastique, le penchant vers le bizarre,
ont engendré nombre d’œuvres de renom, mais peu s’attelèrent à
rendre le résidu mystérieux du moins marquant des objets, à
dévoiler la mélancolie réprimée de son cœur noir. » (MARIËN, 1940 :
20)
Cette formulation trahit néanmoins une divergence par rapport aux
théories nougéennes. Nougé, en effet, part du principe que puisque
la perception des objets n’est qu’une réception passive, le sens d’un
objet lui est donné par l’esprit. Mais comme ce sens est personnel à
chacun, l’existence de l’objet (qu’il se refuse à nier) n’est due qu’à un
compromis « qui résulte uniquement de la coïncidence par quelque
trait commun de nos inventions particulières » (NOUGÉ, 1980 : 87).
Pour Mariën l’objet n’est pas à inventer, mais à débusquer : il faut
s’efforcer d’en atteindre le contenu « lourd de secrets » (MARIËN,
1940 : 47). Or les sens (physiques) sont trompeurs et la « réalité » faite
seulement d’apparences, d’images, ce qu’il dénomme la « quatrième
11 Les collages cubistes intégrant « un morceau de réalité » sont fréquemment
cités par les surréalistes parisiens, mais ni Nougé ni Mariën ne les évoquent,
Nougé préférant citer dans « Une Expérience de Roland Penrose » [1938] le
Portrait du chevalier X de Derain dont le premier état contient un journal
véritable.
Marie GODET
37
dimension » des objets. Pour avoir accès à la profondeur de l’objet, il
faut mettre son esprit en action. Il valorise, dès lors, les œuvres de
Magritte, qui mettent à contribution l’esprit de leur spectateur, et
évitent de flatter les sens. Nous verrons que cet aspect sera prédomi-
nant dans ses activités futures.
Dotremont dans sa Vie de l’objet s’accorde avec Mariën, auquel il
renvoie d’ailleurs, sur l’impuissance de l’homme face à l’objet : « son
pouvoir ne peut que rarissimement porter sur l’essentiel » (GUIGON,
2005 : 175). Mais cette base étant acquise, il part dans la direction
opposée : il ne cherche pas à atteindre l’objet, mais s’intéresse à
l’influence que celui-ci a sur l’homme, remarquant qu’« [i]l faut être
victime d’une colossale distraction pour échapper aux influences de
l’objet » (GUIGON 2005, p. 174). C’est pourquoi il recommande de trans-
former les objets quotidiens en remettant en cause, au passage, l’effica-
cité du dépaysement et de la conception d’objets :
« L’objet surréaliste comme tel n’avait qu’une valeur démonstra-
tive, didactique ou scandaleuse. Cette valeur, et celle de tout le
surréalisme, pourraient même devenir si nous n’étions vigilants,
une valeur complémentaire. Il importe dès aujourd’hui de
surréaliser un à un les objets sans les enlever de leur milieu naturel,
non seulement dans un but de dépaysement, mais aussi dans un
but inverse et assez punique de naturalisation. Dresser une
bimbeloterie surréaliste en face de la bimbeloterie bourgeoise et
pulvérulente n’est plus fort efficace. Que les objets revus et corrigés
par LE DÉSIR pénètrent dans le camp rationaliste ! » (GUIGON,
2005 : 175-17612)
Il va même jusqu’à émettre des doutes quant au pouvoir des objets
ou des œuvres appréciés des surréalistes :
« Il se trouve des gens tout c’qu’y a d’bien qui auraient scrupule (ou
snobisme, bien entendu) à porter un doigt correcteur sur le
moindre objet usuel : livre, tasse, crayon… Veuillez remarquer que
les mêmes ont, pourraient avoir chez eux des Picasso, des Magritte,
des objets nègres ou surréalistes sans que ceux-ci les surprennent
12 Notons que la transcription faite par VERNAY, WALTER, 2008 : 243 diffère au
niveau de la ponctuation mais surtout au sujet du terme « punique »,
devenu « unique ». Nous n’avons pu vérifier le texte original. Par ailleurs,
Dotremont faisait déjà une remarque du même type, à propos de l’image
poétique cette fois, dans son article « Notes techniques sur l’image dite
surréaliste » (DOTREMONT, 1942).
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
38
(alors que ces toiles, ces objets sont, seraient pour nous d’intarissa-
bles sources de surprises). » (GUIGON, 2005 : 176)
C’est dans cette voie entamée alors d’une remise en question des
méthodes surréalistes que Dotremont s’enfoncera quelques années
plus tard, finissant par prendre ces méthodes à revers. Plus que
l’expression d’idées personnelles, ce texte montre déjà les caracté-
ristiques de ce qui deviendra le cœur de sa démarche13.
3. L’exposition Surréalisme de 1945 : tensions et convergence
Alors que les années qui suivent voient se conforter la place
de Mariën, les relations de Dotremont avec le groupe de Bruxelles se
dégradent. S’il s’efforce tout d’abord de plaire, il s’attire rapidement
la colère des autres membres du groupe par des écrits qui ne sont
pas à leur goût14. Les erreurs des débuts cèdent peu à peu la place à
des transgressions conscientes, et pourtant Dotremont tient à
poursuivre les collaborations – avec Mariën en particulier. Malgré de
nombreux projets avortés15, celles-ci se concrétisent notamment au
début de l’année 1945 par le collectif La Terre n’est pas une vallée de
larmes et les neuf numéros du Ciel bleu. Mais en août Dotremont a
l’imp(r)udence de publier un article à la défense de Jean Cocteau,
battant en brèche l’idée selon laquelle celui-ci est « un pitre »
(DOTREMONT, 1945 : 19). Or, il sait pertinemment que les Bruxellois
l’exècrent, ayant notamment perturbé la représentation de sa pièce
Les Mariés de la Tour Eiffel en 1926, et la sanction ne se fait pas atten-
dre : renouant avec la tradition surréaliste, ils excluent Dotremont le
7 septembre 1945. Finalement celui-ci sera tout de même autorisé à
participer à l’exposition surréaliste organisée par Magritte en décembre,
mais y sera « laissé dans l’ombre » (MARIËN, 1979 : 342). Dotremont
blâme son impulsivité :
13 Tous deux s’intéressent aussi aux rapports entre mots et objets, aspect que
nous ne pourrons développer ici. 14 Le 20 mai 1941 les surréalistes apprennent que Dotremont a écrit l’année
précédente un poème suite à l’assassinat de Joris Van Severen, animateur du
mouvement Verdinaso. En mars 1942, ils lui reprochent une attaque écrite
contre Pierre-Louis Flouquet, avec lequel Magritte était ami et avait partagé
un atelier en 1919-1920. 15 Ils auraient notamment dû présenter ensemble une conférence sur le
surréalisme à l’université de Louvain que Dotremont prononcera finalement
seul.
Marie GODET
39
« Je suis extrêmement paresseux quant à l’esprit de stratégie. J’agis
en suivant des impressions, des demi-idées, des idées parfois, des
goûts, des désirs, des besoins, une circonstance ou l’autre – mais
rarement par vanité ou par calcul16. »
Si cette tendance à passer d’un projet et d’une envie à l’autre se
poursuivra tout au long de son parcours (ce qui n’empêche que des
invariants s’en dégagent), sa fronde est pourtant bien réelle. Au
contraire, Mariën ne déviera jamais de la trajectoire surréaliste17 : les
désaccords sont inévitables. Aucune lettre entre eux de cette période
n’ayant été conservée, il est probable qu’ils aient été en froid, Mariën
s’étant bien évidemment rangé dans le camp opposé (MARIËN, 1979 :
342). On peut donc se demander s’il est dû au hasard que ce soit lors
de cette exposition, organisée du 15 décembre 1945 au 15 janvier
1946 à la galerie des Éditions La Boétie18 à Bruxelles, que leurs
démarches s’avèrent les plus proches.
Aux peintures, photos, collages et objets s’ajoutent des
inscriptions aux murs. Mariën qui dans les années précédentes a
plutôt expérimenté le collage et la photographie présente deux objets
de 1938, L’Introuvable et La Traversée du rêve. Mais il expose aussi une
création relevant davantage de l’installation que de l’objet, et qui
s’accorde parfaitement à l’inscription du peintre Oscar Dominguez :
« Je souhaite la mort de 30000 curés toutes les 3 minutes » (MARIËN,
1979 : 35819). Sa Plaisanterie peut-être mais assez PORTE est à mettre en
relation avec le tract à l’encontre du pape Pie XII qu’il publie à la
même époque (voir MARIËN, 1979 : 35620). Elle est ainsi décrite par un
journaliste dubitatif : « sur une table une assiette véritable garnie de
3 petits livres qui sont : les révélations mystérieuses, un petit calen-
drier liturgique et le cathéchisme [sic] de Malines, à demi enfouis
sous d’authentiques légumes en état de décomposition » (CHARLIER,
16 DOTREMONT à Mariën, 2 février 1946. 17 Ses convictions communistes sont les seules qu’il perdra, suite à son séjour
en Chine de 1963 à 1965. 18 Le fait que les Éditions La Boétie qui leur prêtent la galerie soient celles qui
aient publié l’article de Dotremont sur Cocteau ne semble pas gêner Magritte
outre mesure. Ajoutons que Dotremont commence à travailler pour ces éditions
après l’exposition. 19 Cet axe n’est cependant pas commun à toute l’exposition, et on ne peut
qu’être d’accord avec G. Durozoi qui souligne le manque de cohérence de
celle-ci (DUROZOI, 2004 : 457). 20 L’éducation catholique de Dotremont lui permet de remarquer que ce tract
est fondé sur une conception erronée de l’Église.
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
40
1946 : 5), que Mariën nous apprend être du ragoût (MARIËN, 1979 :
358).
Le seul objet présenté par Dotremont, sous le pseudonyme
de Christian Witz, est tout aussi explicite : L’Arbre du mal et du mal est
un sapin de Noël – c’est de circonstance – décoré d’insignes nazis.
Au-delà de la dénonciation de la proximité de ces deux « mythes
maléfiques », on peut y voir un acte de rébellion vis-à-vis de ses
parents très croyants21. Ces deux « installations » se caractérisent par
leur caractère provocateur, à l’opposé de la subversion subtile de
L’Introuvable et de la retenue nougéenne. La tendance anticatholique
de Mariën restera vive, et il l’affichera notamment dans le film qu’il
réalise en 1959-1960, L’Imitation du cinéma. Au contraire, Dotremont
abandonnera toute activité de ce type, et ira jusqu’à remettre en
question dès le mois de juin l’efficacité du scandale. Il écrit d’ailleurs
à Mariën pour le prévenir, sachant qu’il ne partagera pas son avis. La
concordance aura été de courte durée.
4. Surréalisme-révolutionnaire et révolution
contre les surréalistes
Au lendemain de l’exposition, Dotremont se remet à projeter
des collaborations avec les surréalistes bruxellois, mais annonce sans
ambages qu’il privilégie à présent l’« action directe22 ». On voit réap-
paraître les différences amorcées quelques années plus tôt dans leurs
textes sur l’objet : où Mariën privilégie comme Nougé un boulever-
sement destiné à l’esprit, Dotremont souhaite agir dans la réalité.
S’allier au Parti communiste lui semble alors le meilleur moyen d’y
parvenir, malgré l’échec de ses prédécesseurs qui avaient tenté d’en
faire autant (DUROZOI, 2004 et CANONNE, 2007). Alors que Breton,
rentré d’exil, rapproche le surréalisme de l’occultisme, et que
Magritte développe son surréalisme en plein soleil qui emprunte à
l’impressionnisme, Dotremont ressent la nécessité de fonder un
nouveau mouvement : le surréalisme-révolutionnaire. Au-delà de
leurs désaccords d’ordre personnel, cette différence dans la façon de
concevoir leur activité explique qu’en dépit de leurs convictions
politiques, les surréalistes bruxellois restent circonspects. Ils s’éloi-
21 Provocation d’autant plus forte que son père avait cessé d’exercer sa
profession de juriste suite à l’assassinat du bâtonnier Braffort, pour lequel il
travaillait, à cause de ses activités de résistance. 22 DOTREMONT à Mariën, 17 janvier 1946.
Marie GODET
41
gneront du mouvement après avoir signé en juin 1947 le texte qui lui
tient lieu de manifeste, Pas de quartiers dans la révolution23 !
En novembre 1948 la fondation de Cobra officialise la
rupture avec le groupe surréaliste-révolutionnaire français et fonde
une nouvelle alliance entre le groupe surréaliste-révolutionnaire
belge, le groupe danois Høst, présent dans le surréalisme-révolution-
naire via Asger Jorn, et les Hollandais de Reflex. Ce qui était au
départ un « ajustement » du surréalisme-révolutionnaire prend ensuite,
sous l’influence de la peinture danoise notamment, une tout autre
direction. La première exposition Cobra en Belgique, La Fin et les
Moyens, organisée en mars 1949 dans la galerie du Séminaire des
Arts du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, est pour Dotremont
l’occasion d’une mise au point. Sous couvert d’une exposition
surréaliste, il s’en prend, dans un article de présentation publié dans
la revue du Palais des Beaux-Arts, aux conceptions du groupe de
Bruxelles. Il part de cette distinction récurrente entre les deux types
de peinture surréaliste, « l’une plus ou moins délibérée, anti-
esthétique, ou pata-esthétique, celle de Magritte, Dali, Labisse ;
l’autre, plus ou moins automatique, qui ne craint pas de laisser jouer
les couleurs, les formes et les lignes, celle de Max Ernst, Miro,
Tanguy, Paalen, Masson » (DOTREMONT, 1949 : 8 bis). Selon lui,
Cobra veut « renverser cette primauté » du premier type, c’est-à-dire
« mettre au premier plan, des expériences où la peinture elle-même
soit expérimentée ». Il va jusqu’à justifier Cobra par la fidélité au
surréalisme :
« Alors que la poésie surréaliste s’occupait, et s’occupe (beaucoup
d’illusions en moins) de délivrer des documents de connaissance,
une “matière première” plus ou moins “arrangée en poème”, cette
peinture surréaliste se souciait de présenter des leçons de choses sur
un tableau relativement noir, et trop souvent se bornait à donner
des vignettes aux règles théoriques du surréalisme. » (DOTREMONT,
1949 : 8 bis)
Au contraire « [l]a plupart des tableaux de cette exposition-ci sont
beaucoup plus près de l’automatisme poétique surréaliste […] mais
23 Dotremont qui semble très contrarié rédige avec son groupe une motion
collective à l’encontre de Magritte et Nougé en novembre 1947. Notons aussi
que certaines raisons « topographiques » empêchent notamment Nougé de
s’engager réellement en politique (voir ARON, 1991 : 9-27).
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
42
en même temps beaucoup plus près de la peinture » (DOTREMONT,
1949 : 8 bis). Il poursuit :
« Il n’y a plus guère ici cette ironie intellectuelle qui s’empressait de
racheter ce que la sensibilité pouvait avoir livré, ce clin d’œil
sceptique et “scandaleux” qui mettait en garde le spectateur contre
une illusion réelle (c’est une pomme mais ce n’est pas une pomme)
qui reste quoi qu’on fasse le fond de la peinture. Il n’y a plus ici ce
complexe anti-spectateur. Regardez-nous de loin, ne touchez pas, et
d’ailleurs sortez, vous êtes trop bête. » (DOTREMONT, 1949 : 8 bis)
Après avoir très tôt exprimé ses doutes vis-à-vis de l’exposition
d’objets, Dotremont clame ici, avec une allusion à peine voilée à
Magritte, son rejet des fondements mêmes du surréalisme bruxel-
lois : il choisit la sensibilité face à l’intellect, la diffusion et l’accessibi-
lité au plus grand nombre face à la discrétion et à la hantise de
l’approbation du public24. Il cherchera désormais les réponses à ses
préoccupations en dehors du surréalisme tel qu’il est conçu à
Bruxelles.
5. L’Objet à travers les âges et Cobra
Le fait que Dotremont organise cinq mois plus tard une
exposition d’objets ne laisse dès lors pas de surprendre. L’Objet à
travers les âges a lieu du 6 au 13 août dans la même galerie que La Fin
et les Moyens, au Séminaire des Arts du Palais des Beaux-Arts de
Bruxelles. Elle ne reçoit pas d’écho dans la presse, et peu de commen-
taires contemporains ont été conservés, elle reste donc difficile à appré-
hender. Exposition du seul groupe surréaliste-révolutionnaire belge, elle
ne compte aucun peintre parmi les exposants : Marcel Havrenne, Paul
Bourgoignie, Joseph Noiret et Dotremont sont poètes, tandis que
Jacques Calonne est musicien. Dotremont décrit leur objectif dans le
texte qui fait office de catalogue :
« Dans un but purement poétique / quoique la connaissance y soit
pour quelque chose / le désir et la curiosité / étant originellement
identiques […] dans un but purement expérimental / quoique le
plaisir y soit pour quelque chose […] pour que l’objet se défasse /
24 Mariën collaborera néanmoins le mois suivant avec Dotremont et Joseph
Noiret (mais sous le pseudonyme de René Caluwaert) à un tract qu’ils
réalisent pour le premier Congrès mondial des Partisans de la Paix,
salle Pleyel à Paris : La Colombe de Picasso.
Marie GODET
43
de son gilet de gibus / de sa gibecière de gigognes / pour qu’il ne
parle plus de lui / en fonction de sa solde de fonctionnaire / pour
qu’il se décongestionne / pour qu’il se déconfonctionne / pour qu’il
ne fonctionne plus / mais qu’il marche / comme dans la vie / à
laquelle / le groupe / qui est membre / de la réalité / fatalement /
doit d’être et de sa main / ouvre ce qui n’était avant lui / que boîtes
que paquets. » (DOTREMONT, 1998 : 53, 57)
On constate dans les termes utilisés par Dotremont un balancement
entre les deux mouvements : la « connaissance » et le « désir »
resteront en effet associés au surréalisme, tandis que les termes
d’« expérimental » et de « plaisir » seront caractéristiques du vocabu-
laire de Cobra. Ils témoignent de ce que cette exposition, tout en
étant ancrée dans le surréalisme, annonce les innovations du nou-
veau mouvement25. Les objets côtoient quelques dessins et un
poème, Isabelle de Dotremont, ce qui relève de la « tradition »
surréaliste, comme cette volonté affirmée de libérer l’objet de sa
fonction. Mais l’exposition comporte une spécificité : la modification
de l’objet ou son association avec d’autres n’ont pas été jugées
nécessaires pour y parvenir. En effet, alors que certains objets ont été
transformés « à la manière surréaliste », résultant notamment en un
« téléphone-jaune d’œuf », d’autres sont présentés « dans leur état
naturel » : un réveille-matin, des pièces de monnaie « rangées dans
l’ordre de leurs dimensions sur les rayons d’un écrin de velours »
(DOTREMONT, 1970 : 13) ; des pommes de terre par Dotremont et un
bigoudi écrasé par Calonne. La discrétion nougéenne est en quelque
sorte poussée à l’extrême puisque l’intervention est ici réduite au
placement dans une salle d’exposition.
Or, les objets (réels) qui dans les expositions surréalistes se
contentaient d’être isolés sans subir de transformation étaient
toujours suffisamment étranges en eux-mêmes pour pouvoir s’en
dispenser ; les objets banals des surréalistes-révolutionnaires ne
peuvent en fait se comparer qu’aux ready-made de Marcel Duchamp,
premiers objets à avoir été placés dans une salle d’exposition en ne
subissant que de minimes interventions ; mais la finalité de cette
exposition est tout autre. Rappelons brièvement que les ready-made
n’ont été appréciés que tardivement en Europe, et que leur percep-
25 Dotremont jugera plus tard son texte trop surréaliste et trop politique,
mais il l’interprète alors en fonction de ses préoccupations du moment ; les
aspects surréalistes et politiques correspondent plutôt bien à la nature de
l’exposition.
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
44
tion est restée longtemps tributaire de la définition qu’en a fait Breton
dans son Dictionnaire abrégé du Surréalisme, considérée comme erronée
aujourd’hui, d’un « objet usuel promu à la dignité d’œuvre d’art par le
simple choix de l’artiste ». Selon la définition bretonienne, le ready-made
n’existe donc que par le passage du statut d’objet à celui d’œuvre
d’art ; au contraire les objets des Bruxellois ne subissent nulle trans-
substantiation, le dispositif n’a de sens que parce que les objets restent
objets – ils ont d’ailleurs pu retrouver leur fonction originelle juste
après l’exposition.
De plus la notion d’auteur, qui est capitale dans le procédé
du ready-made, est niée chez les surréalistes-révolutionnaires. Ce qui
distingue tel porte-bouteilles de celui de Duchamp, c’est sa signature.
Au-delà du positionnement dans une salle d’exposition, c’est elle qui
convoie le message : « ceci est une œuvre d’art ». Or les objets des
surréalistes-révolutionnaires n’avaient ni signature ni auteur. Le
« catalogue » ne citait pas les participants, non plus que les pièces
exposées. Où le ready-made remet en question le concept d’œuvre
d’art, et ainsi l’institution qui lui donne naissance, l’exposition de
Dotremont s’inscrit en marge de l’art, et non pas contre l’art. La
disposition dans une galerie n’est pas ici l’occasion d’une critique de
l’institution, mais est appréciée pour ce caractère de préciosité qu’elle
confère à ce qui s’y trouve.
En effet, loin d’une simple « plaisanterie » dadaïste, il s’agit
d’amorcer un nouveau rapport à l’objet, et à la vie quotidienne dont
il est le représentant. L’importance accordée à cette réalité, cette vie
qui reviennent à plusieurs reprises dans le catalogue (le groupe « est
membre de la réalité », les objets sont « mis dans des situations
délicates c’est-à-dire surréalistes comme dans la vie ») s’accorde aux
velléités d’action de Dotremont tout en reflétant l’influence (ouverte-
ment reconnue) du philosophe marxiste Henri Lefebvre. Dans le
premier volume de sa Critique de la vie quotidienne paru en 1947, celui-ci
déplore que les surréalistes aient fait l’erreur « de condamner en même
temps le réel abject de l’entre-deux-guerres et le réel humain – de
frapper de la même marque d’infamie le possible de l’homme et le
destin dégradant de la bourgeoisie » (LEFEBVRE, 1958 : 12126). Au lieu
de discréditer la vie quotidienne, Lefebvre invite à la réinvestir et à la
reconstruire.
26 Les surréalistes-révolutionnaires sont conscients qu’un conflit personnel
avec Breton a dû influencer sa perception du surréalisme.
Marie GODET
45
Ce rapprochement fait sans cesse dans l’exposition avec la
vie, avec l’extérieur (initialement le projet était de rendre audible dans la
salle les bruits de la rue) vient compenser le fait que Dotremont monte
une exposition d’objets comme il le reprochait aux surréalistes. À défaut
d’intervenir dans la vie, les surréalistes-révolutionnaires présentaient
ainsi comme dignes d’attention, voire précieux, ces objets quotidiens,
et incitaient les visiteurs à intervenir dans l’exposition, notamment en
piochant des vêtements dans un panier appelé Réserves de la sensibilité.
Plus que leurs facultés d’analyse, c’est leur corps et leur imagination que
les visiteurs devaient ainsi mettre en action. Il n’est plus question de
bouleversement, ni de l’objet, ni de l’esprit, mais de l’élargissement de la
perception, de l’enrichissement d’une relation, ce qui correspond tout à
fait à l’objectif de l’ouvrage de Lefebvre27. Le but n’est pas de
dépayser l’objet (même si cela a été nécessaire), de le déformer ou de
le combiner à d’autres, mais de le découvrir. Cette exposition témoi-
gne ainsi de l’envie de dépasser le surréalisme, mais également de la
difficulté à sortir de son modèle. Si Lefebvre voyait dans le marxisme
la réponse à cet appauvrissement de la vie quotidienne, et si, à l’époque,
les surréalistes-révolutionnaires embrassaient son point de vue, la colla-
boration effective avec le Parti Communiste de Belgique est malaisée et
se terminera à la fin de l’année 1949.
Dotremont doit donc s’efforcer de trouver une nouvelle voie, et
il la découvrira juste après cette exposition, au congrès de Bregnerød.
Les membres de Cobra séjournent dans une forêt danoise, avec pour
seule consigne de peindre la maison qu’on leur prête. Les discussions et
les moments de création sont intégrés aux activités manuelles, telles
que la coupe du bois : Dotremont est ravi. À la suite de ce séjour il ne
tentera plus de faire entrer la vie dans l’art, en présentant des objets
dans des musées, mais il fera entrer l’art dans la vie. Celui-ci ne sera
plus considéré comme une activité supérieure, nécessitant d’intenses
réflexions : Cobra valorise la peinture de la spontanéité qui relève du
corps, du geste, comme les autres activités quotidiennes. De plus, à
l’inverse du surréalisme, la peinture de Cobra se veut populaire, acces-
sible. C’est ainsi que Dotremont parvient à contrecarrer les défauts du
27 L’extrait souvent cité en témoigne : « Ce qui importe, ce n’est pas que j’aie
la possession (capitaliste ou égalitariste) de l’objet, c’est que j’en aie la
jouissance au sens humain et total de ce mot ; c’est que j’aie avec l’objet – qui
peut être une chose ou un être vivant – les rapports les plus complexes, les
plus riches en joie et en bonheur ». Mais cet aspect mériterait un développe-
ment, car l’objet est plus largement au cœur de l’ouvrage de Lefebvre et au
centre de sa théorie.
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
46
surréalisme qu’il relevait quelques mois plus tôt, et à agir efficacement
sur la vie. Mariën qui reste profondément attaché au surréalisme ne
comprend pas ce revirement et n’aura pas de mots assez durs pour
décrier Cobra :
« La primauté de la poésie, qui est le trait essentiel et irréductible
du surréalisme, est renoncée au bénéfice de l’art pour lui-même, de
l’art comme métier et distraction, de l’art comme misérable raison
de vivre, comme activité artisanale et sociale, auxiliaire crétinisant
des industries de l’ameublement. » (MARIËN, 1979 : 344)
6. Le retour à l’objet des années 1960
Alors que Dotremont cesse presque totalement les interven-
tions sur l’objet après L’Objet à travers les âges, Mariën les reprend dans
les années 1960 pour ne plus les abandonner. Les références à Magritte
sont telles que l’on a tendance à ne voir en ses objets qu’une (piètre)
construction en trois dimensions d’images qui auraient pu être peintes.
Mais on peut considérer que l’un est en quelque sorte le négatif de
l’autre. Si Mariën invitait à saisir la profondeur des objets présents
dans les peintures de Magritte, ses assemblages se fondent quant à
eux sur l’image, l’apparence des objets. Il reste volontairement « en
surface », créant des objets dont aucun n’aura la force de son premier,
et ce pour inscrire ses réalisations en dehors du champ de l’art. Il
s’agit, en quelque sorte, d’une réaffirmation ironique de ses idées sur
le leurre des sensations ; Mariën pousse à l’extrême la vigilance nougé-
enne en lui ajoutant une dose de cynisme et de négativité, nécessaire
selon lui à une époque où le mouvement atteint le succès public (voir
MARIËN, 1987 : 5-12).
Il est intéressant de comparer à cet égard le traitement respectif
de pommes de terre par Dotremont et par Mariën. Si celles de Dotre-
mont datent de L’Objet à travers les âges, ce n’est que dans les années
1960, influencé sans doute par l’omniprésence de l’objet sur la scène
artistique, qu’il se met à les commenter fréquemment, en en adaptant
alors l’interprétation. Il tient à les distinguer du Pop Art, dont la mise en
valeur de l’objet est celle de la société de consommation. Le Pop Art
célèbre les « produits finis », alors que ses pommes de terre étaient
crues, « comme pleines de toutes leurs possibilités » (DOTREMONT, 1970 :
13). Puisqu’elles étaient périssables, il était en outre impossible d’en faire
un objet de collection. Présentées dans une vitrine comme des objets
précieux, et pourtant prêtes à être mangées, elles invitaient le spectateur
Marie GODET
47
à leur accorder davantage d’attention qu’il ne le fait d’habitude – rien
de plus.
Or, à l’occasion d’une exposition surréaliste au Musée d’Art
moderne de Bruxelles au début des années 197028, Mariën a choisi
d’exposer lui aussi des pommes de terre29 :
« […] une vitrine me fut consacrée, juste sur le coin de la Montagne de
la Cour, où je présentai face à face, logées chacune dans un coquetier,
deux pommes de terre pourries entre lesquelles voletaient déjà,
prisonniers d’un caisson de plexiglas, une pléiade de moucherons. Cela
s’intitulait : À la mémoire du provisoire, et une légende précisait : “Deux
pommes de terre belges s’agonisant d’injures en plein vingtième
siècle”. Le tout était accompagné de ma signature, suivie des mil-
lésimes : 1920-1973. Destinée à la poubelle, où elle disparut deux mois
plus tard, cette œuvre occupait modestement la place des joyaux
exposés jadis dans leurs écrins de velours, et je me souviens, à l’époque
de ma plus profonde détresse, d’avoir tourné ce même coin en
échafaudant les plus meurtrières pensées à l’égard de leur proprié-
taire. » (MARIËN, 1988 : 109-110)
Les deux poètes partagent la volonté d’empêcher l’assimilation de leur
objet à une œuvre d’art, contrairement aux mouvements des années
1960 qui rempliront les musées de choses en tout genre. Mais leurs
intentions diffèrent : les pommes de terre de Mariën ne sont pas
exposées pour elles-mêmes, mais pour servir une idée – elles sont même
dans ce cas anthropomorphisées. De plus elles ne sont pas « pleines de
possibilités », mais pourries, destinées à la poubelle, à la manière du
ragoût de 1945. L’écrin utilisé dans L’Objet à travers les âges pour
présenter les pièces de monnaie sert ici un propos ironique, et même
vengeur : le bâtiment du musée abritait auparavant la joaillerie du beau-
père de celle qui fut la compagne de Mariën dans les années 1940-1950.
28 La date donnée sous-entend que l’exposition aurait eu lieu en 1973, mais ce
musée n’a pas organisé d’exposition surréaliste cette année-là. Cette installation
a donc soit eu lieu à une autre occasion, soit à une autre date. Les expositions
surréalistes les plus proches de cette date sont : Tendances surréalistes en Belgique.
Choix d’œuvres appartenant à nos collections (25 septembre – 22 novembre 1970) ;
Tendances surréalistes en Belgique. Œuvres appartenant aux collections des Musées
royaux des Beaux-Arts de Belgique (11 mars – 11 avril 1976) ; voire L'École belge des
années vingt à nos jours, appartenant aux collections des Musées royaux des Beaux-Arts
de Belgique (23 juillet – 8 septembre 1974). 29 Malgré l’écart temporel dans les réalisations il nous semble valable
d’établir cette comparaison car tous les commentateurs s’accordent pour
remarquer qu’il n’y a pas d’évolution dans le « style » de Mariën.
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
48
Son installation vise à dénoncer l’état d’esprit de ses compatriotes30, elle
est au service d’une « leçon », suivant l’expression de Dotremont, à
laquelle le spectateur n’est pas invité à prendre part. À cette entreprise
de sape, Dotremont préférera l’expérimentation et la création dites
« constructives ».
Conclusion
Porteurs d’un même héritage, celui du surréalisme bruxellois
défini par les écrits de Paul Nougé et les peintures de René Magritte,
Mariën et Dotremont l’assimileront en fonction de leurs propres préoc-
cupations et, en passant par l’objet, construiront finalement une œuvre
extrêmement personnelle. Les divergences entre ceux qui deviendront
les acteurs principaux de la « deuxième génération » du surréalisme
bruxellois seront pourtant fondées sur un aspect qu’ils continuent à
partager : l’extrême attention qu’ils accordent à la vie quotidienne.
Au-delà de ses objets, auxquels il dénie une identité artis-
tique31, Mariën fait preuve dans la totalité de ses activités de cette
vigilance apprise dans le surréalisme. Il refuse de réduire celui-ci à
un mouvement artistique ou littéraire, et le vit tel qu’il a été conçu,
comme une morale, une attitude face à la réalité. Cela l’amènera
notamment à soutenir des procès et à lancer des polémiques. Après
que Dotremont se soit éloigné de Magritte en se dissociant du surréa-
lisme, c’est au nom du surréalisme que Mariën s’en détachera à son
tour : il provoque la rupture en dénonçant en 1962 par un tract, Grande
baisse, le succès public et commercial de sa peinture.
Dotremont interprètera différemment, et de manière plus
concrète et positive, le mot d’ordre de Rimbaud. Après être parti à la
redécouverte des objets lors de l’exposition L’Objet à travers les âges, il
préfère se tourner vers ceux qui peuplent le monde réel avant
d’introduire l’art dans un milieu qui lui est étranger, celui de la vie
quotidienne. Au fil du temps l’intérêt pour l’objet semble donc chez
chacun d’eux se muer en une attitude face à la réalité ; si leur
attention vis-à-vis de la vie quotidienne est éthique, et se recoupe en
certains points, notamment dans la peur de voir le surréalisme se
réduire à une esthétique, leur conception même de cette réalité ne
30 Certaines de ses réalisations évoqueront les querelles linguistiques qui
devaient l’affecter d’autant plus que son père était flamand et sa mère
wallonne. 31 Il les exposera néanmoins dans des galeries et ils entreront, comme les
objets surréalistes d’ailleurs, dans des collections d’art.
Marie GODET
49
fera que s’éloigner. Pour Mariën elle est trompeuse, et à dénoncer, pour
Dotremont elle est riche et inspirante.
Bibliographie
ARON P., 1991, « Les groupes littéraires du surréalisme », Textyles,
n° 8 (« Surréalismes de Belgique »), p. 9-27.
CANONNE X., 2007, Le Surréalisme en Belgique 1924-2000, Bruxelles :
Fonds Mercator.
CHARLIER J.-M., 1946, « Freudisme pictural et messes noires sur-
réalistes », Vrai, 3e année, n° 2, p. 5.
DOTREMONT C., 1942, « Notes techniques sur l’image dite surréa-
liste », La Conquête du monde par l’image, p. 18.
DOTREMONT C., 1945, « Jean Cocteau », Pan collection, vol. 1, p. 19.
DOTREMONT C., 1949, « La Fin et les Moyens », Les Beaux-Arts, n° 445,
p. 8 bis.
DOTREMONT C., 1970, « Cobra, la peinture et l’objet », Les Beaux-Arts,
n° 1281, p. 12-13.
DOTREMONT C., 1998, Cobraland, Bruxelles : La Pierre d’Alun.
DOTREMONT C., 2007, Le Papier à cigarettes de la nécessité (roman in-
achevé), éd. de Stéphane Massonet, Bruxelles : Didier Devillez Éditeur.
DOTREMONT à Mariën : correspondance de C. DOTREMONT à M. Mariën,
Bruxelles, Archives et Musée de la littérature, M.L. 5041.
DUROZOI G., 2004, Histoire du mouvement surréaliste, Paris : Éd. Hazan.
GUIGON E. (éd.), 2005, L’Objet surréaliste, Paris : Éd. Jean-Michel Place.
LEFEBVRE H., 1958, Critique de la vie quotidienne, vol. I, Paris : L’Arche.
MARIËN M., 1940, La Chaise de sable, Bruxelles : L’Invention collective.
MARIËN M., 1979, L’Activité surréaliste en Belgique, Bruxelles : Éd.
Lebeer Hossman.
MARIËN M., 1987, Marcel Mariën. À la recherche de l’heure exacte 1013
ans avant l’an 3000, Bruxelles – Paris / Dunkerque, Galerie Isy Brachot /
École régionale des Beaux-Arts Georges Pompidou, s.d. / 27 juin – 30
août 1987.
MARIËN M., 1988, Le Radeau de la mémoire, édition de l’auteur [édi-
tion pirate parce que complète].
MARIËN M., 1989, Rétrospective des rétrospectives, Bruxelles, Galerie Isy
Brachot, 18 janvier – 25 février 1989.
MARIËN M., 1994, Marcel Mariën (1920-1993). Le lendemain de la mort,
La Louvière, Musée Ianchelevici, (s.d.).
NOUGÉ P., 1980, Histoire de ne pas rire, Lausanne : Éd. L’Âge d’homme.
RIMBAUD A., 1999 [1873], Poésies. Une saison en enfer. Illuminations,
Paris : Gallimard.
VERNAY A., WALTER R. (éd.), 2008, La Main à plume. Anthologie du sur-
réalisme sous l’Occupation, Paris : Éd. Syllepse.
51
Benjamin STRAEHLI
L’objet sonore et la musique
Introduction
Le travail théorique de Pierre Schaeffer a été principalement
tourné vers l’élaboration de ce qu’il a appelé un solfège de l’objet
sonore. Il s’agit de se doter d’un système de catégories permettant de
décrire ce que l’on entend avec plus de finesse et d’objectivité que ne
le permettent le vocabulaire courant et le solfège hérité de la tradi-
tion musicale. Ce solfège de l’objet sonore est également qualifié de
« généraliste » ou « généralisé » (SCHAEFFER, 1977 : 4911), dans la mesure
où ses concepts descriptifs doivent pouvoir s’appliquer à n’importe
quel son. Il n’en exclut donc aucun a priori, mais doit permettre
d’expliquer en termes clairs quelles sont les déterminations sensibles
d’un son qui le rendent propre ou impropre à être intégré à une
certaine structure musicale. Ce projet trouve une réalisation impo-
sante mais encore incomplète à certains égards dans le Traité des
objets musicaux.
En effet, on peut constater qu’elle rencontre trois types de
difficultés. Tout d’abord, le solfège ainsi produit comporte certaines
lacunes. Leur existence est attestée par Schaeffer lui-même, qui
déclare qu’on ne « saurait trop insister » sur elles, et qu’elles tiennent
tout simplement au fait que « la recherche n’est pas achevée »
(SCHAEFFER, 1977 : 664). Il faut néanmoins se demander si elles ne
sont vraiment dues qu’à cela ou si certaines ne proviennent pas de la
nature même de la démarche suivie. Ensuite, la notion même d’objet
sonore soulève des problèmes philosophiques. Il reste à préciser en
quel sens il peut exister quelque chose de tel que des « objets
sonores ». Enfin, cette démarche invite à voir dans la composition
musicale un agencement d’objets sonores judicieusement choisis. Or,
certaines techniques de composition, notamment contemporaines,
sont explicitement dirigées contre une telle idée2. La place nous
1 Cet ouvrage a d’abord connu une première édition en 1966, puis une seconde,
augmentée, en 1977. C’est de cette dernière dont nous nous servons. 2 Voir notamment DUFOURT, 2003 : 255-256 : « Dès qu’on se met à penser la
musique sous la forme d’une représentation conjointe d’éléments et de com-
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
52
manquerait ici si nous tentions de procéder à un examen approfondi
de toutes ces difficultés. Nous concentrerons donc notre attention sur
les difficultés philosophiques, et sur les liens qu’elles peuvent avoir
avec les lacunes du solfège. Pour cela nous nous efforcerons d’abord
de préciser le sens de la notion et les raisons pour lesquelles Pierre
Schaeffer en fait le cœur de ses investigations, avant de discuter de sa
pertinence.
1. Sens de la notion et justification de son emploi
1.1. Le besoin d’un retour au son concret
Dans une première approche, on peut définir l’objet sonore
comme le corrélat de l’audition, ce qui est « ouï » à proprement
parler, par opposition à ce qui est inféré ou compris à partir de cette
perception. L’élaboration précise de cette notion s’est étendue sur
plusieurs années et Schaeffer en a senti la nécessité dès ses premiers
travaux sur la musique qui l’ont rendu célèbre, à savoir l’invention
de la musique concrète, autrement dit cette manière de composer à
partir de sons enregistrés, par des opérations de montage, mixage,
filtrage. Encore aujourd’hui, c’est surtout pour cette invention que le
nom de Schaeffer est connu. Ce qui est peut-être moins connu, en
revanche, c’est que selon le témoignage de Schaeffer lui-même, l’inno-
vation dans la manière de composer était, pour lui, moins une fin en
soi qu’un moyen pour mener une recherche sur les conditions aux-
quelles le son peut devenir musique :
« Malgré la rupture radicale que ces nouvelles procédures impli-quaient par rapport au mode de composition traditionnel – ou
même à la faveur de cette rupture – j’essayais, non de détruire la
musique, mais d’en retrouver des lois générales. » (SCHAEFFER,
1977 : 669)
C’est dans le contexte d’une telle recherche que la notion d’objet sonore
prend toute son importance.
Pour comprendre la raison d’être de cette notion, et pour
justifier les affirmations du paragraphe précédent, il nous faut revenir
binaisons, on adopte des modes de pensée inadéquats […]. » Cette critique
n’est pas expressément dirigée contre Schaeffer, mais elle peut certainement
s’appliquer à sa démarche.
Benjamin STRAEHLI
53
aux origines de la musique concrète et aux raisons de l’intérêt porté
par Schaeffer aux sons enregistrés. Voici comment Schaeffer s’expli-
que sur le sens de l’adjectif « concret » : « Lorsqu’en 1948 j’ai proposé
le terme de “musique concrète”, j’entendais, par cet adjectif, marquer
une inversion dans le sens du travail musical. » (SCHAEFFER, 1977 :
23) Il s’agit d’une inversion par rapport à la musique classique
occidentale : le plus souvent, cette musique est d’abord notée sur la
partition avant de pouvoir être entendue ; dans le cas de la musique
concrète, au contraire, c’est le son qui est présent en premier, une
éventuelle « partition » ne pourrait être qu’une tentative de le décrire
a posteriori. L’une des fonctions possibles de cette inversion, que nous
allons examiner ici, réside dans sa dimension polémique : Schaeffer
indique qu’il s’agissait aussi de « lutter contre le parti pris d’abstrac-
tion qui avait envahi la musique contemporaine » (SCHAEFFER, 1977 :
24).
Ce sont principalement deux courants de cette musique qui
sont visés ici. Le premier est constitué par les musiques qui adoptent
un principe sériel. Efforçons-nous d’abord d’expliquer en quoi elles
feraient preuve d’un parti pris d’abstraction. Comme on le sait, la
technique sérielle trouve son origine dans l’œuvre de Schoenberg.
Celui-ci propose d’organiser les douze sons de la gamme chro-
matique en une série de manière à éviter les relations hiérarchiques de
la musique tonale. En outre, avant même d’imaginer ce procédé,
Schoenberg avait envisagé de traiter d’autres propriétés du son que
la hauteur de la même manière que celle-ci : ainsi suggérait-il de
faire des « mélodies de timbres » comme on fait des mélodies de
hauteurs. Ces deux idées, considérées ensemble, pouvaient assez
naturellement conduire à étendre le principe sériel à d’autres aspects
du son que la hauteur, bien que cette proposition n’ait pas été portée
par Schoenberg lui-même. La systématisation d’une telle technique
sera exposée par Pierre Boulez dans Penser la musique aujourd’hui. À
cette occasion, il définit quatre caractéristiques du son dont chacune
doit être traitée suivant une série : la hauteur, le timbre, la durée,
l’intensité. Cet ouvrage peut ainsi être vu comme un aboutissement
de ce parti pris d’abstraction que Schaeffer voyait à l’œuvre dès 1948.
Boulez revendique d’ailleurs un tel parti pris en reconnaissant
comme adversaires ceux qui veulent prendre le son concret pour
point de départ (BOULEZ, 1987 : 30). L’abstraction vient du fait que la
façon dont le son est appréhendé dans cette démarche ne provient
pas d’un examen approfondi de la perception auditive, et donc du
son tel qu’il est concrètement entendu, mais de la manière tradition-
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
54
nelle dont le son musical est traduit sur la partition (SCHAEFFER,
1977 : 50 et 309-311). Sur la partition, le timbre du son est indiqué par
le fait qu’il est noté dans la partie correspondant à un certain
instrument, et peut faire l’objet de quelques précisions, par exemple,
en ce qui concerne les instruments à cordes, avec des expressions
telles que « sur la touche » ou « sur le chevalet », qui informent
l’exécutant qu’il doit donner son coup d’archet à un certain endroit de la
corde, produisant ainsi une sonorité particulière. La hauteur est
indiquée par la position verticale de la note sur la portée, la durée
par la forme de la note et de sa queue, l’intensité par des signes de
nuance comme piano ou forte. Toute autre caractéristique du son est
ignorée par la partition. Or, peut-on prétendre qu’il n’y en a pas
d’autre, que celles-ci épuisent la description qu’on peut faire du son
perçu ?
Pour montrer que tel n’est pas le cas, nous prendrons un seul
exemple : une notion comme celle de timbre ne désigne en réalité
aucune caractéristique précise du son. Ce qu’on appelle de ce nom,
ce sont toutes les propriétés du son qui permettent d’identifier
l’instrument qui le joue, ou la manière particulière dont il est produit.
Or les traits qui permettent cette identification sont en réalité de
natures très diverses. Le spectre harmonique et son évolution dans le
temps jouent un rôle en ce domaine, mais aussi l’attaque, le mode
d’entretien du son1, etc. Or ces traits peuvent tout à fait être distingués
à l’oreille, et certains d’entre eux, même s’ils sont caractéristiques de
l’instrument, peuvent être altérés, par exemple dans un enregistrement,
sans que l’on cesse pour autant d’identifier ce « timbre instrumental »
(cette expérience est décrite dans SCHAEFFER, 1977 : 70-71). Ces distin-
ctions échappent à la partition traditionnelle, et donc à celui qui prend
les catégories qu’elle met en évidence pour un moyen de faire une
description satisfaisante du son perçu. La conséquence en est que le
compositeur qui tente de traiter le timbre comme une valeur
musicale susceptible d’une même organisation que la hauteur
s’expose à ce qu’il y ait un hiatus entre son intention et ce qui sera
réellement entendu. L’exemple qu’en donne Schaeffer est celui de la
Klangfarbenmelodie, ou « mélodie de timbres » :
« Prenons maintenant ce cas limite. Un basson, un piano, une
timbale, un violoncelle, une harpe, etc., jouant à la même hauteur,
sont censés créer une mélodie de timbres. Cette séquence, ou structure,
1 Les résultats des recherches qu’il a menées à ce sujet sont longuement
exposés par Schaeffer dans son Traité, et résumés dans : CHION, 1995 : 48-52.
Benjamin STRAEHLI
55
va donc se décrire en inversant les termes habituels. Dans les exemples
précédents, les timbres apparaissaient en général comme caractères, et
la hauteur comme valeur. Ici, tous les sons ayant un même caractère
de hauteur, il nous faut chercher autre part les valeurs. Mais, lorsque
nous tenterons de le faire, nous n’allons pas forcément trouver
devant nous une valeur évidente ; peut-être allons-nous reconnaître
encore des instruments et non une véritable Klangfarbenmelodie. Ces
timbres sont, ou trop marqués, ou trop flous, pour qu’il s’en dégage
une valeur nette, émergeant à notre écoute. » (SCHAEFFER, 1977 :
302)
Autrement dit, là où le compositeur veut faire entendre une mélodie
de timbres, l’auditeur perçoit une succession d’objets hétéroclites, car
chaque timbre instrumental présente un trop grand nombre de diffé-
rences avec les autres pour que l’oreille discerne quelle variation doit
retenir son attention. Une telle situation trouve donc selon Schaeffer
son origine dans la trop grande confiance accordée au système
traditionnel de notation et l’abstraction dont il fait preuve dans son
appréhension du son.
Le second courant caractérisé par ce parti pris d’abstraction
est la musique électronique, telle qu’elle était pratiquée à ses débuts
au studio de Cologne. Fondé en 1950 sous la direction de Herbert
Eimert, avec la collaboration scientifique de Werner Meyer-Eppler et
la participation de Stockhausen, le Studio de musique électronique
de Radio Cologne fut en effet le laboratoire d’une musique souvent
conçue en opposition à la musique concrète2. Dans ce courant, le son
est appréhendé non plus à partir de la partition traditionnelle, mais à
partir des connaissances acquises en physique sur le signal qui cause
nos impressions auditives. Cette cause se définit comme un ensemble
de variations de pression de l’air sur le tympan. Ces variations sont
entièrement descriptibles en termes de fréquence, durée et intensité.
Le compositeur de musique électronique manipule un signal
électrique descriptible de la même façon, qui sera converti en signal
acoustique par la membrane d’un haut-parleur. Il peut donc avoir le
sentiment qu’il s’occupe du son dans tous ses détails concrets, qu’il
ne fait abstraction de rien, puisque les paramètres sur lesquels il
travaille permettent effectivement une description exhaustive du
signal. Schaeffer commente ironiquement cette prétention en souli-
2 Dans le Traité, Schaeffer cite les déclarations de Stockhausen où ce dernier
exprime son « aversion » pour les expériences du groupe de musique
concrète (SCHAEFFER, 1977 : 622).
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
56
gnant le décalage entre le contrôle exercé sur les paramètres physi-
ques et l’imprévisibilité du résultat pour l’oreille :
« On conçoit que toute une génération de compositeurs, immé-diatement séduits par de telles équivalences, ait aussitôt entrepris
des constructions où tout pouvait être calculé à l’avance… sauf
l’effet produit. » (SCHAEFFER, 1977 : 583)
En réalité, fait observer Schaeffer, la corrélation entre les propriétés
physiques du signal et les qualités sensibles perçues est d’une telle
complexité que celui qui néglige l’étude du travail de l’oreille pour
ne s’occuper que du signal physique est, lui aussi, confronté à un
hiatus entre son intention et ce qui sera réellement entendu. Une des
intentions possibles était de créer n’importe quel type de timbre, soit
pour reconstituer celui d’instruments connus, soit pour produire
celui de tout nouvel instrument imaginable. Or les sons ainsi pro-
duits échouent à donner cette impression :
« […] un certain nombre d’effets, vite reconnaissables, révélaient à
coup sûr leur origine “électronique”. […] [C]ette source électroni-
que apparaissait comme un instrument parmi d’autres. Alors
qu’elle prétendait, soit reconstituer des timbres préexistants, soit
créer des timbres “inouïs” convenablement variés, elle marquait les
uns et les autres de son “timbre” propre […]. » (SCHAEFFER, 1977 :
58-59)
Ce timbre propre peut très bien être utilisé avec bonheur par le com-
positeur. Mais son existence imprévue montre les limites du pouvoir
sur le son que l’on peut acquérir en raisonnant abstraitement en
termes de durée, fréquence et intensité.
1.2. Le projet d’un solfège généralisé
Pour éviter les illusions que peut produire un excès d’abstrac-
tion, Schaeffer estime donc qu’il faut étudier de plus près la manière
dont le son est perçu par un auditeur en chair et en os. Cette étude
inclut une recherche expérimentale sur les corrélations entre pro-
priétés du signal acoustique et propriétés du son en tant qu’il est
3 Les « équivalences » en question sont celles que l’on a posées de manière
simpliste entre les paramètres physiques et les propriétés perçues, comme,
par exemple, entre la fréquence et la hauteur.
Benjamin STRAEHLI
57
entendu (SCHAEFFER, 1977 : 159-258), mais ne peut se réduire à elle.
En effet, encore faut-il être en mesure de décrire convenablement ces
caractéristiques entendues et, pour cela, il importe d’élaborer un
système de catégories permettant de classer les sons suivant ce que
l’oreille perçoit d’eux et de préciser les traits reconnaissables qui
rendent possible ce classement. Cette démarche correspond à l’inven-
tion d’un solfège dont le but, contrairement au solfège traditionnel
enseigné dans les conservatoires, n’est pas de saisir particulièrement
les traits musicalement pertinents des sons utilisés dans la musique
classique de l’Occident, mais plutôt de situer les sons utilisés par un
langage musical dans l’ensemble des sons possibles. C’est-à-dire que
dans le solfège généraliste voulu par Schaeffer, il doit devenir
possible de décrire une note de violon, ce que pouvait faire le solfège
traditionnel, mais qu’en outre il devient possible de formuler objecti-
vement les traits par lesquels elle se distingue à l’oreille de la même
note jouée par une flûte, aussi bien que d’un coup de cymbales,
d’une détonation ou d’un grincement de porte.
Précisons maintenant les bénéfices que Schaeffer espère
d’une telle entreprise. En ce qui concerne la pratique musicale, cela
doit permettre au compositeur contemporain de dire, mais aussi de
concevoir clairement ce qu’il veut faire entendre, sans rester prison-
nier de concepts obsolètes ou excessivement abstraits. Ce qui, par la
suite, favorise une juste comparaison entre l’intention et le résultat
sonore. Si le compositeur travaille, comme en musique concrète, avec
des sons enregistrés, le solfège généraliste lui offre un système de
classement des fragments dont il dispose, classement d’emblée pensé
en fonction de ce qui peut rendre le son musicalement intéressant.
Du point de vue théorique, ce solfège peut servir à une analyse, non
seulement de musiques contemporaines comme la concrète ou
l’électronique pour lesquelles le solfège traditionnel est insuffisant,
mais encore de musiques non occidentales pour lesquelles il est en
partie inadéquat (SCHAEFFER, 1977 : 16-18).
En outre, en montrant quelle est, dans l’ensemble des sons
possibles, la situation de ceux qu’a sélectionnés la tradition occiden-
tale, la démarche de Schaeffer conduit à expliquer l’intérêt particulier
que présentent ces sons et donc, de façon plus générale, à proposer
une conception de ce qui permet à des valeurs musicales d’émerger
d’un flux sonore. Elle ouvre ainsi des pistes de réflexion pour chercher
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
58
si d’autres langages musicaux aussi satisfaisants que ceux de Bach
ou de Mozart4 sont possibles.
Rien de tout cela ne pourrait être réalisé sans le recours à la
technologie héritée d’Edison, à savoir l’enregistrement des sons. En
effet, sans ce procédé, le caractère évanescent du son constituerait un
obstacle difficilement surmontable. L’élaboration du solfège doit se
faire à partir de l’étude de cas concrets, donc à partir de tentatives
pour décrire certains sons. Or, pour que les résultats obtenus aient de
la valeur, encore faut-il pouvoir contrôler la validité de la description
produite en la confrontant avec une nouvelle écoute du son. Et c’est
là quelque chose que l’on ne pourrait guère effectuer sans travailler
sur des sons enregistrés. Certes, il peut y avoir des sources sonores
capables de reproduire indéfiniment le même son à l’identique, par
exemple un orgue. Mais dans la plupart des cas, il est impossible, en
excitant deux fois le même corps sonore, d’être certain d’obtenir
deux fois le même son. En conséquence, si, par exemple, je m’exerce
à décrire le grincement de ma porte, une fois la description faite il
serait vain de chercher à la vérifier en faisant à nouveau grincer la
porte, car de toute évidence le grincement obtenu ne sera pas le
même que le premier.
C’est l’enregistrement qui permet de surmonter cette dif-
ficulté en rendant possible la réécoute du son. Mais cette réécoute n’a
pas seulement pour vertu de rendre les descriptions vérifiables. Elle
attire également l’attention sur un niveau de la perception auditive
qui nous échappe en situation ordinaire. Ordinairement, remarque
Schaeffer, nous écoutons le son avec deux intentions possibles. La
première consiste à traiter le son comme indice, c’est-à-dire à
chercher en lui une information sur l’événement qui le cause. C’est là
notre façon d’écouter la plupart des sons : il y a, dit Schaeffer, une
« tendance prioritaire et primitive à se servir du son pour renseigner
sur l’événement » (SCHAEFFER, 1977 : 120). La seconde est mise en
œuvre notamment à propos des sons du langage articulé : elle
consiste à traiter le son comme signe, c’est-à-dire à porter son atten-
tion sur la signification conventionnelle qu’il véhicule (CHION, 1995 :
82). Par exemple, si j’écoute un mot prononcé par quelqu’un, c’est
d’abord en tournant mon attention vers la signification de ce mot, et,
éventuellement, en interprétant la sonorité comme l’indice d’une
4 Nous citons ces deux musiciens en raison de la préférence marquée par
Schaeffer pour leur technique de composition : « Mozart et Bach ont en
commun de parler une langue qu’on peut encore croire être celle des dieux. »
(SCHAEFFER, 1952 : 165).
Benjamin STRAEHLI
59
propriété de cette personne, par exemple si son accent me révèle son
origine géographique. En revanche, dès lors que je réécoute
plusieurs fois ce même mot enregistré, la répétition fait perdre au
son toute valeur informative, puisqu’à chaque écoute, l’information
dont il est porteur est déjà connue. L’intérêt ne se porte plus que sur
le son lui-même, « l’ouï » en tant que tel, ce que Schaeffer appelle
l’objet sonore. Schaeffer résume les deux apports de la réécoute du
son enregistré en disant que la répétition du son épuise la « curiosité
des causes » à laquelle nous sommes « presque irrésistiblement
portés » :
« […] en épuisant cette curiosité, elle impose peu à peu l’objet
sonore comme une perception digne d’être observée pour elle-
même ; d’autre part, à la faveur d’écoutes plus attentives et plus
affinées, elle nous révèle progressivement la richesse de cette
perception. » (SCHAEFFER, 1977 : 93-94)
Cette opération consiste à viser, non plus ce dont le son peut être le
signe ou l’indice, mais uniquement les déterminations du son qui
s’offrent directement à l’oreille. Une telle opération peut évidem-
ment être effectuée en situation naturelle, et pas seulement dans
l’écoute de fragments enregistrés. Mais dans l’histoire de la forma-
tion des idées de Schaeffer, l’enregistrement a en quelque sorte
permis la prise de conscience de la possibilité d’une telle écoute à
propos de n’importe quel type de son. L’écoute qui vise le seul objet
sonore, et non tout ce dont il peut être le signe (que ce soit une
signification linguistique, un événement du monde ou une propriété
du signal acoustique) est appelée par Schaeffer « écoute réduite », en
référence à la réduction théorisée par Husserl en phénoménologie.
Celle-ci en effet conduit à suspendre la croyance au monde extérieur,
ainsi qu’à toute théorie le concernant, pour considérer les objets
simplement en tant qu’ils sont visés par nous à travers certains
vécus.
Il ne s’agit évidemment pas de dénoncer comme fausses
cette croyance ou ces théories, mais de ne pas les prendre pour
guides dans la description que l’on fait des objets et de la manière
dont ils nous apparaissent. Cela doit permettre de décrire ce qui
nous apparaît tel qu’il nous apparaît vraiment, sans dépasser les
limites du donné par l’ajout de présupposés théoriques. Schaeffer
voit là une démarche qui entre en consonance avec la sienne : en effet,
estime-t-il, si on pratique une telle réduction à propos de l’audition, cela
conduit à suspendre toute affirmation sur les causes physiques de ce
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
60
qui est entendu, donc à cesser de définir le son comme signal acous-
tique et de le traiter comme indice de quelque chose du monde.
L’objet sonore est donc ce qui reste une fois que l’on procède à une
telle réduction (SCHAEFFER, 1977 : 262-267).
Nous venons de voir comment le souci d’une approche
concrète de la musique avait amené Schaeffer à attacher une impor-
tance toute particulière aux sons enregistrés, par opposition aux sons
électroniques ou aux signes d’une partition, et comment l’étude de
ces sons enregistrés permettait d’élaborer la notion d’objet sonore. Il
faut maintenant expliquer pourquoi, selon Schaeffer, c’est justement
cette notion qui fournit le moyen de comprendre le phénomène
musical en évitant les excès d’abstraction. Quel rapport y a-t-il entre
objet sonore et musique ?
Pour répondre à cette question, il faut évidemment préciser
ce qu’on entend par « musique. » Schaeffer tire la définition qu’il en
donne d’un exemple apparemment trivial (SCHAEFFER, 1977 : 339) :
celui d’un enfant jouant à tendre un brin d’herbe entre ses mains
pour souffler dessus. Dans cet exemple, l’enfant produit des sons
pour le seul plaisir de les entendre, sans que ceux-ci aient la moindre
fonction d’informer qui que ce soit sur un quelconque objet du
monde. Schaeffer appelle donc « musique » cette activité qui consiste
à produire et à varier des sons pour le plaisir de l’oreille, sans
fonction d’indice ou de signe. L’exemple de l’enfant à l’herbe consti-
tuerait en quelque sorte le degré le plus simple, le moins élaboré
d’une telle activité, mais la définition peut, selon Schaeffer, s’appli-
quer également au Clavier bien tempéré de Bach.
Certes, dans le langage ordinaire, on parle aussi de musique
à propos d’activités qui ne correspondent pas strictement à cette
définition : dans de nombreuses pratiques artistiques, la musique est
mêlée à, ou encore mise au service d’une signification extra-musicale,
comme c’est le cas par exemple dans l’opéra. Inversement, des prati-
ques qui ne relèvent pas de ce qu’on appelle couramment « musique »
peuvent néanmoins présenter le souci d’une certaine musicalité
suivant la définition schaefférienne : par exemple, la simple diction
d’un texte peut avoir pour fonction première d’en véhiculer la
signification, tout en étant faite avec une recherche de la plus belle
sonorité possible, même si le sens du texte reste identique quelle que
soit la beauté ou la laideur de la voix qui l’énonce. Dans le cas le plus
général, la définition de la musique donnée par Schaeffer ne
correspond donc pas exactement à l’intention qui anime la pratique
artistique, ou du moins elle ne suffit pas à l’exprimer. Mais cette défi-
Benjamin STRAEHLI
61
nition met l’accent sur la caractéristique qui fait d’une certaine pratique,
une pratique musicale – en tout ou en partie. Une pratique ne s’apparente
à la musique que dans la mesure où elle cultive un plaisir d’entendre
irréductible à l’intérêt que nous pouvons éprouver pour l’information
véhiculée par le son.
Ces considérations doivent suffire à faire comprendre le lien
entre musique et objet sonore : il y a musique précisément quand la
production des sons est menée dans l’intention de susciter l’intérêt
pour les qualités audibles du son en elles-mêmes, donc pour ce
niveau que Schaeffer appelle l’objet sonore. C’est à ce niveau même
que doivent être recherchées les caractéristiques qui rendent le son
propre ou impropre à s’intégrer à une certaine musique. Sur ce point
Schaeffer relève que, devant la diversité des propriétés d’un objet
sonore, une musique se construit en privilégiant l’une de ces
qualités, et en faisant des variations de celle-ci et de leur organisation
la structure du morceau. Cette qualité dont les variations font
percevoir une structure musicale, Schaeffer l’appelle la valeur. Pour
qu’une telle valeur soit perceptible à travers une succession d’objets
sonores, il faut en outre que ces objets ne diffèrent pas excessivement
par d’autres aspects, qu’ils apparaissent comme appartenant au
même genre de son, bref qu’ils partagent un ensemble de propriétés
communes que Schaeffer appelle le « caractère. » Dans la musique
classique occidentale, la valeur par excellence serait la hauteur,
tandis que le timbre instrumental serait le caractère : dans une
mélodie jouée par exemple par un violon, l’unité du timbre du
violon fait que l’attention peut se porter sur les variations de hauteur
qui constituent la structure musicale, tandis que si chaque note était
jouée par un nouvel instrument, les sons différeraient entre eux par
un trop grand nombre d’aspects pour que la structure mélodique
reste clairement identifiable. Comme nous l’avons vu à propos de la
Klangfarbenmelodie, toute qualité du son n’est pas nécessairement
propre à devenir une valeur musicale. Un des enjeux du solfège de
l’objet sonore, qui étudie ces qualités et propose une manière de
décrire et de classer les sons à partir d’elles, est de mettre en
évidence les raisons pour lesquelles une certaine caractéristique du
son est plus propre qu’une autre à être traitée comme une valeur
(SCHAEFFER, 1977 : 300-304).
La place nous manque pour faire une étude approfondie des
résultats auxquels cette démarche aboutit. Nous ne pouvons, sur ce
point, que renvoyer le lecteur à certains ouvrages, en plus des livres
V et VI du Traité des objets musicaux lui-même. Le Guide des objets
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
62
sonores de M. Chion est entièrement consacré à en présenter les
acquis sous la forme d’un index (CHION, 1983). Le Son du même
auteur, dans un de ses chapitres (CHION, 2006 : 235-279), mène conjoin-
tement une présentation succincte des thèses du Traité et une critique
de certains points précis. Enfin, Pierre Schaeffer. Des transmissions à
Orphée, de Martial Robert, résume longuement le Traité tout en
restituant l’histoire de sa genèse et des discussions auxquelles il a donné
lieu (ROBERT, 1999 : 243-324). Notre propre discussion portera unique-
ment sur les difficultés conceptuelles qu’entraîne la notion d’objet
sonore telle que Schaeffer la définit. Nous ne parlerons des
éventuelles faiblesses du solfège que dans la mesure où elles sont
liées à ces problèmes conceptuels. Les analyses qui précèdent
doivent suffire à montrer à quel besoin un tel solfège répond ; mais
nous ne chercherons pas ici à dresser le bilan de ses succès et échecs :
ce sont ses fondements philosophiques qu’il s’agit maintenant
d’examiner.
2. Problèmes soulevés par la notion d’objet sonore
2.1. Le flou des descriptions et la recherche de
l’objectivité
La première difficulté que nous étudierons concerne la
prétention de Schaeffer à atteindre une certaine objectivité dans la
description des sons. C’est, rappelons-le, cette prétention même qui
le conduit à élaborer la notion d’objet sonore, pour signifier que le
son, même tel qu’il est perçu et non tel qu’il est mesuré par les
appareils du physicien, n’est pas un état d’âme subjectif, mais bien
un objet qui transcende les vécus à travers lesquels nous l’appré-
hendons, et sur lequel un accord des différents sujets est possible.
Or, certaines catégories du solfège généralisé ont un caractère assez
vague, et en conséquence on ne sait pas toujours laquelle doit
s’appliquer à un certain son concret. Michel Chion souligne que c’est
l’un des principaux reproches qui ont été adressés à Schaeffer :
« La classification schaefférienne est souvent contestée pour son
incapacité à donner une place nette aux cas extrêmes et à résoudre
par tout ou rien certains problèmes de choix : oui ou non, tel son
est-il tonique ou complexe ? Oui ou non, a-t-on affaire à un son
itératif ou à un son continu granuleux ? Ce son est-il trop long pour
être une impulsion ? Et ainsi de suite… » (CHION, 2006 : 256)
Benjamin STRAEHLI
63
Michel Chion conclut que la volonté de décider systématiquement
par tout ou rien est une erreur. Il entend par là qu’il n’y a souvent
pas de critère suffisamment précis pour dire si un certain son
appartient de plein droit à une catégorie ou s’il n’y appartient pas du
tout. Mais cela n’empêche pas cette catégorie d’être manifestement très
pertinente pour décrire un grand nombre de sons. Le flou en question
fait bel et bien partie de la perception, et toute démarche qui veut
décrire les objets tels que nous les percevons doit intégrer cet aspect. En
effet, comme le montre le passage suivant de Husserl, c’est justement
par des concepts vagues que s’expriment adéquatement les données
intuitives :
« Comme il faut amener les données intuitives des choses à une
expression conceptuelle appropriée en respectant leurs caractères
eidétiques donnés dans l’intuition, cela revient précisément à les
prendre comme elles se donnent. Or elles ne se donnent que sous
forme fluante […] [des données intuitives peuvent par exemple être
exprimées] de façon si simple, si compréhensible, si pleinement
appropriée, par des mots comme dentelé, entaillé, en forme de
lentille, d’ombelle, etc. ; ces simples concepts sont inexacts par nature
et non par hasard […]. » (HUSSERL, 1950 : 236)
Un concept présentant cette inexactitude n’en est pas moins clair et
pertinent, du moment qu’il renvoie à des expériences d’intuition
sensible parfaitement identifiables. Le fait que, dans le solfège de l’objet
sonore, les limites entre les catégories ne puissent pas toujours être
nettement tracées, n’est en fait qu’une conséquence de cette caracté-
ristique générale des données intuitives expliquée par Husserl.
2.2. L’objectivité et la phénoménologie
Une difficulté plus sérieuse concerne l’usage par Schaeffer de
la phénoménologie. C’est après plusieurs années de recherche qu’il a
pris connaissance de l’œuvre de Husserl, et s’est aperçu des conver-
gences possibles qu’elle pouvait offrir avec certains de ses propres
sujets de réflexion. L’usage qu’il en fait est-il correct ? Makis Solomos,
qui s‘est intéressé à cette question, conclut que Schaeffer a raison de se
réclamer de Husserl en ceci que dans les premiers livres du Traité il
prête attention au thème de l’écoute et donc à l’activité du sujet, mais
que sa façon de concevoir l’objet sonore le maintient finalement au
niveau d’une « pensée pré-phénoménologique », caractérisée par l’illu-
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
64
sion d’une « objectivité pure » (SOLOMOS, 19995). Cela signifierait que
dans sa manière d’étudier les objets sonores, Schaeffer négligerait la
corrélation entre les vécus du sujet et l’objet constitué. Il attribuerait
donc à ce dernier une sorte d’objectivité absolue, totalement indépen-
dante du sujet, ce qui rendrait le Traité des objets musicaux impuissant à
penser des musiques contemporaines caractérisées selon Solomos par
une « dissolution de l’objet » (SOLOMOS, 19996). Une telle critique
s’inscrit au fond, sans que Solomos le précise, dans la tradition qui
depuis Kant consiste à reprocher aux philosophies non transcendantales
de prendre le phénomène pour une chose en soi, et d’aboutir pour cette
raison à des apories.
Ce reproche est-il fondé ? Il s’appuie sur un trait réel du
Traité, à savoir que Schaeffer cherche à décrire les objets eux-mêmes
bien plus que leurs corrélations avec les vécus dans lesquels ils sont
constitués pour la conscience, ce que ferait une phénoménologie au
sens proprement husserlien. Néanmoins cette affirmation demande à
être nuancée. Schaeffer prend souvent soin de montrer comment
l’intention d’écoute détermine pour l’oreille l’appartenance d’un son
à telle ou telle catégorie du solfège. On peut en donner pour exemple
la description qu’il fait du caractère mouvant de la limite entre les
catégories de masse et de timbre harmonique, et de la façon dont
l’effort d’analyse de l’auditeur fait qu’un certain aspect du son est
perçu comme masse ou comme timbre (SCHAEFFER, 1977 : 524-525).
Mais il est vrai qu’il n’entreprend pas une étude systématique de ces
relations entre intention du sujet et manifestation d’une propriété de
l’objet.
En outre, il importe de faire remarquer que la phénoménolo-
gie n’interdit nullement de décrire les objets sans faire référence aux
vécus à travers lesquels ils sont appréhendés. Son but est bien de
justifier l’affirmation qu’il existe une connaissance objective, et si elle
prétend par là donner le fondement des sciences, cela ne signifie pas
qu’un mathématicien ou un physicien, quand ils élaborent leurs
théories, doivent commencer par décrire phénoménologiquement la
constitution de leur objet d’étude dans la conscience. L’objectivisme
pré-phénoménologique ne se révèle insuffisant, dans les textes de
Husserl, que lorsqu’on cherche précisément à élucider les rapports
5 Les expressions citées apparaissent dans le résumé qui accompagne la
version électronique de l’article, et ne figurent pas dans le volume où il fut
publié pour la première fois. 6 Solomos n’explique pas dans cet article le sens de cette expression, mais
renvoie simplement à ses autres travaux, dont un livre sur Xenakis.
Benjamin STRAEHLI
65
entre l’objet connu et le sujet connaissant. C’est alors qu’un objecti-
visme naïf, en considérant les vécus et leur contenu comme un
simple effet subjectif causé par l’action des choses sur nous, conduit
à sa propre négation en justifiant un scepticisme généralisé :
« Rien ne pouvait entamer la force propre de sciences exactes dont
la croissance avait été si rapide et qui étaient irréprochables dans
leurs prestations propres, rien ne pouvait entamer la foi dans leur
vérité. Et cependant, dès lors qu’on prenait en compte le fait que
ces prestations étaient celles de la conscience du sujet connaissant,
dès lors leur évidence et leur clarté se métamorphosaient en une
absurdité incompréhensible. » (HUSSERL, 1976 : 103-104)
La phénoménologie a pour fonction de surmonter cette difficulté-là
en montrant comment une véritable objectivité peut être atteinte à
travers les vécus. Mais les théories scientifiques ne sont pas invalidées
par le fait même qu’elles s’expriment dans le langage de l’objecti-
visme pré-phénoménologique. Aussi l’absence dans le Traité des
objets musicaux d’une investigation suffisamment approfondie des
corrélations entre objet sonore et vécu auditif n’ôte-t-elle rien à la
valeur des descriptions d’objet proposées.
Si Schaeffer fait appel à la phénoménologie, c’est simplement
pour justifier l’idée que, l’objet de la perception auditive étant
distinct du vécu perceptif lui-même, il est possible de le décrire avec
objectivité sans pour autant avoir à exprimer cette description en
termes de déterminations physico-mathématiques. En ne cherchant
pas à préciser davantage les conditions de possibilité de cette objecti-
vité, il reste certes en-deçà de la phénoménologie transcendantale,
mais il est légitime de sa part d’invoquer cette dernière comme fonde-
ment de sa propre démarche.
2.3. Réduction phénoménologique et réduction à
l’objet sonore
Cependant, il faut admettre que Schaeffer, tout en recon-
naissant qu’il est « loin de prétendre » (SCHAEFFER, 1977 : 262) au même
degré de rigueur que Husserl, semble ne pas avoir pris clairement
conscience des différences entre son solfège et la phénoménologie de
ce dernier. La différence relevée par Solomos est liée à une autre, plus
profonde, à savoir que la notion de réduction n’a pas exactement le
même sens chez les deux auteurs. Chez Husserl, elle signifie la mise
entre parenthèses de tout ce qui transcende le flux des vécus : les
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
66
objets visés ne sont alors considérés qu’en tant que corrélats des vécus
intentionnels, et non comme réalités ayant une existence indépen-
damment de la conscience. Mais alors, cette mise entre parenthèses doit
s’appliquer aussi à ce que Schaeffer nomme l’objet sonore, qui est bien
un objet transcendant et non un moment immanent d’un vécu. Or, sous
la plume de Schaeffer, le mot de réduction ne désigne qu’une réduction
à l’objet sonore, c’est-à-dire la mise entre parenthèses de toute théorie
sur la cause des sensations auditives. Cette mise entre parenthèses
une fois effectuée, ce que l’audition continue alors à viser est ce que
Schaeffer appelle l’objet sonore. Mais procéder ainsi, c’est bien laisser
non réduit l’objet visé. En comparaison de la réduction husserlienne,
la réduction schaefférienne s’arrête donc à mi-chemin, en ce qu’elle
laisse affranchi de la réduction un objet intentionnel transcendant.
Si l’on tient compte de ce que la réduction effectuée par
Schaeffer a d’insuffisant, on peut être amené à remettre en question
la distinction tranchée qu’il établit entre objet sonore et signal
acoustique. Certes, cette distinction semble pouvoir s’autoriser d’un
passage de Husserl lui-même dans la deuxième Recherche logique.
Passage que Schaeffer ne cite pas et dont il ignorait peut-être
l’existence, dans lequel Husserl parle de l’erreur « du matérialisme
banal qui cherche à nous faire croire que les sons sont en réalité des
vibrations de l’air, des excitations du nerf acoustique, etc. » (HUSSERL,
2002 : 243). Néanmoins Husserl ne précise aucunement ici de quelle
manière le son devrait être conçu. Il est probable qu’il veuille surtout
s’opposer à l’idée selon laquelle les vibrations seraient la réalité, et
les qualités perçues, une simple apparence illusoire alors qu’elles
appartiennent bien à l’objet que nous visons dans l’audition. Mais la
phénoménologie s’oppose de façon plus générale à toute théorie qui
veut que les déterminations physico-mathématiques et les détermi-
nations sensibles soient considérées comme appartenant à des entités
distinctes.
La théorie qui voit dans les déterminations physico-mathé-
matiques la seule véritable réalité tombe dans ce travers, mais c’est
aussi le cas de la théorie qui dissocie complètement objet sonore et
signal acoustique. Le retour aux choses mêmes exigé par la
phénoménologie conduit à dire que l’objet étudié par la physique est
bien celui-là même qui nous est donné dans l’intuition sensible, et
que les deux types de déterminations mentionnés sont bien deux
types de déterminations du même objet, quelle que soit la complexité
de leurs corrélations. Cette thèse est affirmée très clairement dans le
paragraphe 52 d’Ideen I : « […] c’est la chose même que nous percevons qui
Benjamin STRAEHLI
67
est toujours et par principe précisément la chose qu’étudie le physicien et
qu’il détermine scientifiquement » (HUSSERL, 1950 : 172-173).
La conception de l’objet sonore proposée par Schaeffer, en
négligeant cela, souffre donc d’une faiblesse qui n’est pas sans lien
avec deux lacunes de son solfège qu’ont remarquées certains de ses
collaborateurs et héritiers ; lacunes qui ont été liées entre elles par
des auteurs comme François Bayle ou Michel Chion. Tout d’abord, le
solfège généraliste reste muet quant à la spatialité du son. Cette
propriété du son, qui correspond bien à quelque chose d’audible,
soulève des problèmes dont on pourra se faire une idée en lisant le
chapitre qui y est consacré dans la Philosophie du son de Roberto
Casati et Jérôme Dokic (1994 : 118-1647), ainsi que la critique qu’en
fait Michel Chion dans Le Son (CHION, 2006 : 107-108). La question
essentielle dans ce débat est de savoir si le son doit être considéré
comme situé à l’endroit même où il est produit, et seulement percep-
tible dans l’espace environnant, ou s’il faut estimer, au contraire,
qu’il occupe réellement tout l’espace dans lequel on peut l’entendre
et qu’il provient du lieu de sa source sans s’y tenir lui-même8. Rien
dans le Traité des objets musicaux ne porte sur ces problèmes, ce qui
fait dire à Michel Chion que l’objet sonore est conçu « hors-espace »
(CHION, 2006 : 261). Cependant, Michel Chion n’envisage pas que
cela puisse être dû à la façon dont Schaeffer conçoit la réduction,
comme nous le proposons ici.
Ensuite, si Schaeffer, dans ses réflexions sur la technologie,
réserve une place importante aux différences entre le son tel qu’on
l’entend in situ et le son tel qu’il nous apparaît une fois capté par un
micro (SCHAEFFER, 1977 : 69-90), il ne cherche pas dans son solfège à
traduire cette différence. Une fois la notion d’objet sonore élaborée,
tout se passe comme si Schaeffer ne s’intéressait plus qu’à ce qui est
commun au son enregistré et au son in situ. Cela tient en partie à
l’absence de considération relative à l’espace, car une des différences
majeures entre les deux est justement que, dans bien des cas, le son
enregistré semble évoquer un espace (celui dans lequel il a été
enregistré) différent de celui dans lequel on se trouve quand on
l’écoute. Rien dans le solfège généraliste ne vise donc à expliquer
7 Les deux auteurs adoptent une position physicaliste à l’inverse de celle de
Schaeffer, dont ils semblent d’ailleurs ignorer les travaux. Cela rend
justement leur analyse intéressante au regard d’une phénoménologie qui ne
ferait pas de séparation radicale entre objet sonore et événement physique. 8 La première de ces thèses est soutenue par Casati et Dokic ; Chion propose
un alliage complexe entre les deux conceptions.
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
68
cette différence, ce qui fait que Schaeffer n’envisage pas qu’un son enre-
gistré puisse à certaines conditions être considéré comme l’image d’un
autre, comme le proposent François Bayle et Michel Chion à sa suite
(BAYLE, 1993 : 93-99 et CHION, 2006 : 266-268). Ces deux lacunes sont
liées à la faiblesse que nous avons constatée dans la définition de l’objet
sonore comme distinct de l’objet de la physique : en effet, à partir du
moment où l’on admet que l’objet de l’audition peut être considéré
comme un événement physique, il devient impossible de ne pas
reconnaître sa spatialité comme une caractéristique essentielle, et de
ne pas s’interroger en conséquence sur les différences que peut
entraîner la propriété d’être un son enregistré. Cela dit, il est fort
possible que le solfège de Schaeffer puisse apporter des éléments
pour traiter ces questions, notamment avec les catégories concernant
l’intensité du son, qui entre certainement en jeu dans la perception
de l’espace.
Les lacunes que nous venons de relever dans le solfège
généraliste ne sont donc pas sans lien avec ce qu’il y a de contestable
dans la définition que donne Schaeffer de l’objet sonore. Toutefois, il
reste possible qu’une poursuite des recherches parvienne à les
combler. Cette faiblesse n’est donc pas une raison de rejeter le sol-
fège lui-même. La meilleure chose à faire serait sans doute de
chercher à le ressaisir à partir d’une phénoménologie plus adéquate
de la perception auditive.
Conclusion
Les analyses qui précèdent ne présentent pas une évaluation
complète des apports de la notion d’objet sonore pour une étude de
la musique. Un tel bilan exigerait un examen des résultats obtenus
par les recherches qui s’appuient sur cette notion, ce que nous
n’avons pu faire ici. Néanmoins, nous pouvons prétendre avoir
contribué à cette évaluation sous certains rapports. Tout d’abord,
nous avons pu voir que cette notion répond à un réel besoin d’éviter
certaines illusions auxquelles peut mener une approche trop
abstraite de la musique. Ensuite, elle permet d’isoler, dans la percep-
tion auditive, un niveau qui joue un rôle certain dans l’appréciation
musicale des sons, et de montrer qu’il est possible d’en faire des
descriptions qui ne tombent pas dans le pur subjectivisme. Enfin, sa
définition soulève toutefois des difficultés conceptuelles, auxquelles
sont liées certaines lacunes du solfège ainsi produit. Il n’y a cependant
pas de raison de penser que ces lacunes seraient impossibles à com-
Benjamin STRAEHLI
69
bler ; mais le concept d’objet sonore devrait être réélaboré pour donner
au solfège un fondement plus solide.
Bibliographie
BAYLE F., 1993, Musique acousmatique. Propositions… positions, Paris :
Éd. Buchet/Chastel – INA-GRM.
BOULEZ P., 1987 [1963], Penser la musique aujourd’hui, Paris : Gallimard.
CASATI R., DOKIC J., 1994, La Philosophie du son, Nîmes : Éd. Jacqueline
Chambon.
CHION M., 1995 [1983], Guide des objets sonores. Pierre Schaeffer et la
recherche musicale, Paris : Éd. Buchet/Chastel.
CHION M., 2006, Le Son, Paris, Éd. Armand Colin.
DUFOURT H., 2003, « Les Bases théoriques et philosophiques de la
musique spectrale », Kairos, n° 21, p. 227-282.
HUSSERL E., 1950 [1913], Idées directrices pour une phénoménologie et
une philosophie phénoménologique pures. Tome premier : Introduction
générale à la phénoménologie pure, trad. P. Ricœur, Paris : Gallimard.
HUSSERL E., 1976 [1936], La Crise des sciences européennes et la
phénoménologie transcendantale, trad. G. Granel, Paris : Gallimard.
HUSSERL E., 2002 [1913], Recherches logiques. 2 : Recherches pour la
phénoménologie et la théorie de la connaissance. Première partie :
Recherches I et II, trad. H. Elie, avec la collaboration de L. Kelkel et
R. Schérer, Paris : PUF.
ROBERT M., 1999, Pierre Schaeffer : des Transmissions à Orphée, Paris :
L’Harmattan.
SCHAEFFER P., 1952, À la recherche d’une musique concrète, Paris : Éd.
du Seuil.
SCHAEFFER P., 1977, Traité des objets musicaux, Paris : Éd. du Seuil.
SOLOMOS M., 1999, « Schaeffer phénoménologue », consultable en
ligne sur : http://www.univ-montp3.fr/~solomos/Schaeff.html (article
publié initialement dans Ouïr, entendre écouter, comprendre après Schaef-
fer, Paris : Buchet/Chastel – INA/GRM, 1999, p. 53-67).
71
Fleur COURTOIS-L’HEUREUX
« Bon pied, bon œil ! »
Expériences fétichistes de l’objet à l’épreuve
de la danse
Figure 1 : « Abrazo » © Greet Busselot
Introduction
Le tango naît vers la fin du XIXe siècle sur les rives du Río de
la Plata à Buenos Aires. L’industrialisation naissante et une économie
d’agro-exportation favorisent, à cette époque, un contexte d’urbani-
sation, appelant une main d’œuvre exportée d’Europe, mais aussi
des créoles (issus de l’esclavage importé au temps de la colonisation
européenne) et des gauchos (population indigène composée de
cowboys de la Pampa). Ce mélange hybride d’immigrants, d’indi-
gènes et de créoles dans les banlieues portuaires de Buenos Aires
donne au tango naissant une coloration brouillée. Danse des pauvres,
l’élite argentine la dénigre en regard des valeurs européennes dont elle
veut être l’instigatrice. Le tango est considéré à ses débuts comme
barbare : primitif, « negro » ou relevant de la prostitution. Un mythe
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
72
naît, associant cette danse lascive au culte populaire du macho et à la
nostalgie des amours perdues par la dure loi de séparation de
l’immigration. Mais de jeunes aristocrates fréquentent les bordels des
quartiers pauvres de Buenos Aires et exportent le tango en Europe où
il se développe à une rapidité fulgurante. Ils en changent la chorégra-
phie pour la rendre plus respectable, et les Argentins ré-adoptent en
retour ce tango, « essoré » par l’idéologie européenne, pour en faire leur
étendard.
Il nous semble pourtant que cette manière de raconter
l’histoire de l’émergence du tango échoue à restituer la mosaïque
politique et esthétique de cette danse ; réduit le corps à corps,
l’étreinte, à une mise en scène sexuelle, peu à peu édulcorée par
l’élite européenne. Le tango ne serait-il attractif, voire « addictif »
(« et il l’est ! », selon tous les tangueros1), que parce qu’il ose, sous des
aspects élégants, un retour à des pulsions « barbares », « primitives »,
« populaires » ? Un empirisme radical de ce savoir-faire permet d’entrer
dans sa complexité et de rendre honneur à un autre savoir-dire (ou
« faire-savoir ») à son sujet. En référence à William James et à
ses Essais sur l’empirisme radical (publiés à titre posthume en 1912),
nous risquerons une incessante mise à l’épreuve (« un empirisme
radical ») des différentes objectivations discursives et non discur-
sives du tango en fonction de leurs capacités à changer le monde.
Ainsi, nous pourrons tenter de rendre honneur à une vision du
monde en mosaïque par laquelle James définit son empirisme
radical :
« C’est par essence une philosophie en mosaïque, une philosophie
des faits pluriels, comme celle de Hume et de ses descendants, qui
ne rapporte ces faits ni à des substances auxquelles ils seraient
inhérents ni à un esprit absolu qui les créerait comme ses objets.
Mais l’empirisme radical diffère de l’empirisme humien sur un
point particulier qui me fait lui ajouter l’épithète de “radical”. »
(JAMES, 2007 : 58)
1 Suite à un terrain ethnographique réalisé dans les milongas (bals de tango)
de Buenos Aires, en 2010, dans le cadre d’un post-doctorat en anthropologie
de la danse à l’Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, sous la
direction de Georgiana Wierre-Gore, nous avons compilé une série d’entretiens
et d’observations sur les vécus propres aux danseurs. Ils feront l’objet d’une
étude approfondie dans un ouvrage en préparation sur les modes d’action
dans le tango argentin, intitulé « Étreintes de sphinx », prévu pour 2012.
Fleur COURTOIS-L’HEUREUX
73
« Mosaïque » mais radicale sur ce nœud objectif : ne pas considérer
seulement les phénomènes perceptifs comme relevant de faits expé-
rientiels mais aussi toutes les relations qui les relient ou les délient.
William James fait éclater le trio ontologique classique (objet, sujet,
sujet-objet) et nous ouvre une cosmologie où chaque relation est à
elle seule une entité ontologique, un fait réel dont nous pouvons faire
l’expérience. La relation est « objet possible d’expérience ». « Vertigi-
neux ! », car si toute expérience est un nœud de relations, imaginez à
combien d’analyses infinitésimales nous sommes dorénavant contraints
pour approcher le singulier-pluriel (l’aspect « mosaïque ») d’une prati-
que, d’un phénomène, d’un savoir-faire ou d’un savoir-dire.
« Pour une telle philosophie, les relations qui relient les expériences
doivent elles-mêmes être des relations dont on fait l’expérience, et
toute relation, de quelque type qu’elle soit, dont on fait l’expérience,
doit être considérée comme aussi “réelle” que n’importe quoi d’autre
dans le système. » (JAMES, 2007 : 59)
Les relations de conjonction, de disjonction sont les plus évidentes
(et / ou bien). Mais il y a aussi tout le panel des rapports de proxi-
mité (contre / à côté / sous / sur), d’éloignement (loin / par là / dans le
temps et dans l’espace / dans la durée ou l’éternité de l’instant), de
jeu et de ruses (avec sagacité / de manière espiègle, inattendue,
risquée), de stratégie (avec ambition / sans vergogne / a priori). Il y a
tout le monde des adverbes, des conjonctions de coordination, de subor-
dination ; de ces petits mots qui permettent à la syntaxe d’agencer un
territoire vivant (LATOUR, 2007, voir aussi la présentation d’I. Stengers et
de B. Latour à SOURIAU, 2009).
L’empirisme radical nous a menée à expérimenter philoso-
phiquement la pratique du tango argentin dans des conséquences
imprévues quant au savoir-dire traditionnel, et surtout à compliquer
les rapports entre le dire et le faire, entre l’humain et le non-humain
et, enfin, entre différents registres pratiques et conceptuels de l’objet.
Des micro-descriptions expérientielles de l’étreinte dansante permet-
tent de fragiliser les rapports évidents (machos) homme-femme qui
condamnent le tango à une danse « élégamment lascive », ayant dompté
les pulsions barbares d’une sexualité stéréotypée.
Dans ce contexte, et d’ores et déjà animée par l’épistémologie
en mosaïque de James, le concept d’objet a pris une consistance
particulière, mouvante et agissante. Pour décrire ces devenirs d’objets,
nous avons emprunté à Bruno Latour son terme de « faitichisme »
(LATOUR, 2009). Ce dernier désigne un fétichisme élargi à tout ce qui
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
74
est « fabriqué-fabriquant » sans le dualisme implicite de l’humanisme
moderne entre vérité et croyance, entre faits objectifs (scientifiques) et
ce qui relève de la pure projection humaine (non scientifique et non
moderne). Alors que la sociologie critique et la psychanalyse freudienne
ramènent le fétichisme à des constructions sociales ou inconscientes,
Bruno Latour propose de le ressaisir à son niveau le plus immanent
en tant que co-construction objective et factuelle capable d’actions et
d’effets, indépendamment non seulement d’un sujet crédule mais
aussi de tout dualisme sujet/objet. Ainsi le fétiche (ou le « faitiche »)
ne doit désormais plus être considéré comme une projection illu-
soire, voire délibérément pragmatique (le fétichisme vu par l’anti-
fétichisme des « modernes »), mais comme un type d’objet particu-
lier, en même temps fabriqué humainement et acquérant une puis-
sance virtuelle non humaine, exigeante et imprévisible.
Tantôt, nous avons suivi le bricolage qui transforme la femme
en objet fétiche au sens « moderne », puis en « faitiche » au sens
latourien. Tantôt, ce sont les objets eux-mêmes qui résisteront aux
fétichismes (étroit et élargi), et feront faire d’autres actions qu’un jeu
de rôles inversés entre créateur et créature. Enfin, quelle est la puis-
sance d’action de certains objets, tels que des chaussures, quand ni le
faitichisme (« au-delà du vrai et du faux logocentriques »), ni l’anti-
fétichisme (« tout est rétro-projection ») ne viennent les reprendre
(HENNION, LATOUR, 1993) ? Qui commence, instaure l’entre-capture qui
donne consistance à la danse ? L’objet, l’agencement « tango » ou l’hu-
main ?
1. Le tango ou l’objet d’une politique du toucher
Les tangueros s’étreignent, ils touchent le corps de l’autre, le
guident par des impulsions du torse, des mains ou des jambes, des
pieds, de la joue. Une phénoménologie des sensations agence une
danse à deux, car en tango, on ne peut danser seul. C’est la commu-
nication des corps qui va permettre d’atteindre ou non cette fameuse
joie spinozienne du danseur où il « co-naît » avec la danse. La
convocation instaurée avec le corps de l’autre, un corps dansant,
multiplie les aléas des prises d’entre-captures organiques, rythmi-
ques et politiques. Son corps est singulier-pluriel. Je ne peux toucher
l’autre dans le tango – le toucher au sens de l’étreindre – de manière
dansante que parce que je le convoque sur le mode d’une entité
singulièrement multiple. L’autre m’échappe, et c’est parce qu’il
m’échappe que je le touche, que je le déplace vers un autre mou-
Fleur COURTOIS-L’HEUREUX
75
vement. Multiple, car toujours autre qu’une identité stabilisée de
manière éphémère. Parfois, je sens l’autre de manière fébrile, répon-
dant à côté des impulsions et de mes attentes ; parfois, de manière
intense, répondant justement mais en dehors de toute attente. Si l’on
se rejoint dans la danse, ce n’est pas parce que l’on fusionne grâce à
une reconnaissance réciproque et calculée mais parce qu’on rend
vivante une relation en mouvement, parce qu’on s’y suspend avec
tous les risques que cela comporte. Le fil invisible tendu par notre
toucher est celui des funambules, qui peuvent à tout moment rater le
bon équilibre ou le bon balancement. Cette communication précaire
des corps implique que je sorte de mon identité de sujet avec ses
résistances et ses volontés. Je dois me désubjectiver, sortir de mon
être quotidien pour accueillir non l’autre (un autre sujet avec ses
résistances et volontés) mais cette relation incertaine (l’étreinte en
elle-même) avec l’autre. Accueil non de l’autre, mais de la relation à
l’autre.
L’abrazo, étreinte propre au tango argentin, enveloppe une
intimité paradoxale où circulent et se conjuguent une distance et une
proximité. Les corps se resserrent l’un contre l’autre et pourtant ne
pourront faire vivre et préserver ce face à face dansant que dans le
maintien d’une distance, non pas seulement morale mais aussi très
physique, territoriale. Il y a un devenir et de la distance et de la
proximité, dont les agents de transformation sont les exigences de la
danse. La distance, au cœur même d’une intimité, peut être évoquée
par deux cas concrets et idéaux : l’amour et la politique. L’amour,
selon Rilke, est le respect absolu des distances entre âmes. Dans ses
Lettres à un jeune poète, il oppose à l’amour-fusion l’amour de l’épa-
nouissement infini et non totalisable de l’autre. On aime à la
condition que l’autre soit un monde inaccessible, étranger, inconnu.
Un jardin secret inviolable. Je l’aime parce que je ne peux et ne veux
le posséder et, tel le gardien de la loi chez Kafka, j’habite le seuil
d’une altérité impénétrable qui pourtant me pénètre. L’autre est un
dehors impénétrable mais pénétrant, selon la formule de Blanchot
(BLANCHOT 1955, et FOUCAULT 1966).
« Aimer n’a rien d’abord d’une absorption, d’un abandon ni d’une
union avec l’autre (car que serait l’union de choses qui ne sont pas
éclaircies, ne sont pas achevées, ne sont pas encore mises en
ordre ?), c’est une sublime occasion pour l’individu de mûrir, de
devenir quelque chose en lui-même, de devenir un monde, de
devenir pour l’amour d’un autre un monde pour lui-même, c’est
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
76
une grande et immodeste exigence qui s’adresse à lui, qui en fait un
élu et l’appelle à l’immensité. » (RILKE, 1994 : 77)
Cette forme d’amour idéale (car qui peut prétendre avoir aimé sans
volonté de possession, ou qui peut prétendre habiter pleinement le
seuil de l’immensité, sinon par fulgurances éparses ?) est retraduite
au niveau politique dans une très belle analyse de Erin Manning,
philosophe et danseuse de tango argentin. L’auteur oppose la
politique consensuelle de l’État-nation à la politique du toucher
dérivée du tango. D’Aristote à Locke ou Rousseau, de Kant au néo-
kantisme habermassien, l’idée du contrat social persiste à définir les
relations sociales en fonction d’un régime institutionnel. Les actions
individuelles y sont régies et limitées par un Tiers universel et anté-
rieur à toutes les singularités : l’État. Afin que l’homme ne soit pas
un loup pour l’homme (Hobbes), l’État assure à chaque individu un
territoire d’existence qui puisse co-exister avec les autres. Le citoyen
est assujetti à l’État, autrement dit à un espace-temps réglementé et
donné a priori comme naturel. Le contrat social est dit, en effet,
« naturel ». Le pluralisme des différences est dès lors toujours ramené
au naturalisme de l’État qui légitime les multiculturalismes sous la loi
de sa cohérence et de son régime. Le pluralisme y est relatif, ramené
au tout, « naturellement ». Manning oppose à ce régime consensuel
une politique du toucher, radicalement plurielle et sans instance
universelle et actuelle (naturelle) d’un tiers étatique. L’État ne serait
plus l’actualité d’un tout légiférant le pluralisme mais une totalité
potentielle dont l’horizon et le contenu idéal se modifieraient par le
pluralisme actuel irréductible des espaces et des temps, des durées
vitales et singulières qui recomposent un paysage perpétuellement en
devenir. Non plus un espace-temps donné mais des espaces et des
temps en co-transformation.
Dans le microcosme du tango, cet idéal démocratique se
marque dans la manière dont le toucher relie les corps. À travers les
points de contact (mains, joues, bustes, jambes, pieds, bras, dos), le
geste de toucher l’autre tend, crée une tension à jamais inaboutie
vers l’autre. Toucher, c’est ainsi engager la responsabilité d’un geste
à affecter, sans en transgresser les limites, le territoire existentiel de
l’autre et à le rendre réceptif à ce « tendre-vers ». C’est un geste
éthique et politique sans promesse d’une communication attendue,
d’un échange réussi. Le tango est improvisation de gestes. La réponse
à un geste, à un toucher est toujours une nouvelle question qui dessine
un trajet impromptu.
Fleur COURTOIS-L’HEUREUX
77
« Comme de nombreux danseurs de tangos l’ont souligné, guider,
c’est inviter ; ainsi le mouvement qui répondra à cette invitation
pourra demeurer improvisé. Ce dialogue est riche et complexe, plus
intime peut-être, que bien des échanges entre étrangers ou amou-reux. » (MANNING, 2009 : 143)
Échange intime dont le pacte d’engagement n’assure que l’écoute et
non le dialogue. J’écoute ; et soit n’entends pas là où il veut me
guider (ou me sensibiliser par son tact), soit refuse son invitation et
pars ailleurs. La danse à deux, la politique du geste, peut ne pas
avoir lieu. Le dialogue est alors sourd (d’une transparence fascisante)
si nous ne réussissons pas ce terrible défi démocratique et idéal :
affecter l’intouchabilité de l’autre. Nous nous écoutons mais restons
comme « déjà habitués » l’un à l’autre. Pire, nous nous entendons
mais en ramenant l’entente à un dialogue clair et distinct. Dans ce
dernier cas, le geste rate car il reste au niveau de ce qui est touchable
et pénétrable. En entrant dans le territoire de l’autre, en le rendant
pénétrable, on l’anéantit. C’est en respectant l’inconnu de l’autre et le
fil tendu d’une improvisation que j’affecte le geste dansant d’une
potentialité efficace : une humble et affirmative incertitude quant à la
réponse de l’autre. Loin d’une politique consensuelle dont la raison
recouvrirait et stabiliserait les échanges, la politique du toucher
propose un pluralisme irréductible des relations.
La relation n’est pas conçue comme une entité relative à des
termes (des sujets assujettis et une géographie étatique) mais comme
une entité absolue dont la potentialité est sa virtualité à tendre vers
un ailleurs, à actualiser le toucher dans une direction improvisée.
L’intime n’est donc pas le partage d’un même territoire mais
l’aventure risquée du fait qu’on partage la capacité à respecter le
territoire de l’autre comme puissance d’affectation inattendue. La
rationalité ne s’arrête pas à Kant ni à l’idée kantienne de sujets
autonomes dont la faculté de juger permet de se libérer des irratio-
nalités illusoires des croyances ou des idéologies. C’est à Rancière que
Manning fait allusion pour définir une démocratie non kantienne :
« S’il est quelque chose qui soit propre au politique, c’est rien de
plus et rien de moins que cette relation non pas entre des sujets,
mais entre deux termes contradictoires qui définissent le sujet. Le
politique disparaît au moment où l’on dénoue ce nœud composé
d’un sujet et d’une relation. » (RANCIÈRE, 2001)
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
78
Une politique du toucher suppose donc que les sujets qui se rencon-
trent ne s’accordent pas en fonction d’un consensus, par exemple, en
tango, d’un code de pas et d’une technique bien maîtrisée. Ils
risquent en permanence l’accord et le désaccord, et c’est ce risque qui
définit la relation incertaine et contradictoire qui permettra aux
danseurs de danser, de remplir la puissance de la danse. Si nous
revenons à la représentation historiographique du tango, évoquée au
début de cet article, on sent que, en entrant par la micro-description
empirique des gestes politiques du toucher, le consensus d’une
danse lascive et élégante, incarnant de manière « respectable » des
pulsions primitives, paraît quelque peu réducteur, voire décalé. Les
politiques du toucher amènent plutôt à envisager une micro-
politique de contre-pouvoir, une subversion du pouvoir en place.
Avec le toucher, rien n’est jamais acquis. La politique est toujours à
venir.
« C’est une politique errante qui incite le monde de la nuit à réorchestrer
ses systèmes de gouvernance et d’échange par l’intermédiaire des
corps qui existent non pas pour le monde extérieur mais pour
l’échange intérieur entre deux partenaires silencieux se déplaçant
doucement, les yeux mi-clos, vers l’aube. » (MANNING, 2009 : 140-
141)
2. La « femme-objet », un fétiche « faitichisé »
Un piège fatal. La frénésie du tango construit des êtres
étranges qui, à la tombée de la nuit, enfilent leurs bottes de sept lieues
au rythme envoûté d’un ronronnement de bandonéon. La danseuse
s’est déjà ruinée et se ruinera encore. Elle collectionne, consomme,
savoure les chaussures à hauts talons (hors de prix), dont le galbe
assure une esthétique féline et élancée. Certainement, elle doit être « la
plus belle pour aller danser » et, qui plus est, en souffrir. L’apparence
et, plus particulièrement, un certain apparat « terriblement ambigu »
concourent à agencer la force attractive du tango. Si la chaussure
féminine est connue pour être l’un des fétiches sexuels1 par excel-
1 Selon Freud ou Guy Rosolato, le fétichisme est un processus pervers en ce
qu’il substitue à l’absence phallique de la mère des objets, voire le corps (le
sien propre, dans le masochisme, celui de l’autre, dans le sadisme), qui
simuleront cette impossible figure de la jouissance. Retrouvant par là une
pseudo-maîtrise de la jouissance, le processus fétiche témoigne, néanmoins,
d’une perte de puissance primordiale, d’un manque de la Chose, qu’il comble,
Fleur COURTOIS-L’HEUREUX
79
lence, la mythographie du tango argentin l’exacerbe dans la figure
virginale de la prostituée. Épouse, mère, vierge et catin, la tanguera
assume et déjoue l’antique symbolique que lui assigne un système
phallocratique.
Revenons donc au bricolage historiographique et à ses reprises
« faitiches » (construites et agissantes) dans notre héritage contempo-
rain. Sur un plan, la tanguera est associée aux racines noires du tango
(candombe et milonga) que l’aristocratie coloniale d’Argentine, puis la
bourgeoisie européenne du XXe siècle récupérèrent sous forme d’une
érotisation exotique et transgressive : la femme fait bon ménage avec
l’idée d’une « danse lascive, bestiale, primitive et interdite2 », avec un
fonds obscur où se mêlent, dans une mauvaise conscience « blanche
moderne », attraction et discrimination positive. La traite des esclaves
noirs, exercée jusqu’à la fin du XIXe siècle sur les bords (orillas) del Río de
la Plata, est un « fait décisif » dans la construction hybride de la danse et
de la mythographie de la tanguera : « la femme a du sang de diable ».
Les noirs, des diables ? Constitués en sociétés mutuelles à partir de 1772,
les noirs libres et esclaves se retrouvaient pour perpétuer leurs rites et
leurs fêtes et pour résister de manière rusée au pouvoir des blancs.
Ainsi, « fous du roi », ou à l’image des inversions et travestissements
propres aux carnavals, ils n’hésitaient pas à se déguiser et à imiter les
bals de cour de façon à renverser les rôles et à les rendre grotesques.
Les danses de couple, « précieuses » chez les blancs, devenaient plus
franches chez les noirs, en s’associant à une musique plus forte et
plus rythmée grâce aux tambours3. Si la noblesse et l’Inquisition s’en
paradoxalement, en l’évidant : reconnaissance ultime, « sublime », de sa trans-cendance. Voir : FREUD, 1994 et ROSOLATO, 1967 : 9-40. 2 Elle sera notamment interdite en 1910 par le pape Pie X qui, trois ans plus
tard, séduit par le côté « essoré », lèvera l’interdiction. 3 À ses débuts, le tango était donc intimement lié au candombe des Noirs
soumis à l’esclavage. Le terme tango, certes associé au latin « tanguere »
(toucher), trouverait aussi des racines probables dans différentes langues
kongo. D’une part, il désignerait un lieu d’initiation où les rituels religieux
étaient accompagnés de rythmes de tambours et aurait fait glisser son
extension jusqu’à la musique elle-même. D’autre part, n’tangou signifie le
temps en lari et soleil en lingala. Les négriers nommèrent « tangos » les
« parcs à esclaves » avant qu’ils ne soient mis sur le bateau, ainsi que les
lieux où on les vendait. Ensuite, le terme s’appliqua tant « aux sociétés de
secours mutuel, aux confréries et naciones de Noirs affranchis ou libres
qu’aux lieux clos où l’on entreposait les tambours. […] Enfin on appelait
bailes de tango les danses et les jeux de tambours des Noirs qui intègreront les
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
80
offusquèrent, la danse et la musique des noirs s’infiltraient et atti-
raient les criollos, les immigrés et les nobles dandys qui l’exportèrent
jusqu’en Europe, en l’édulcorant.
Mais à la fin du XIXe siècle, le tango, « blanchi », est doréna-
vant assimilé aux lupanars (bordels) de Buenos Aires que fréquentait
la main d’œuvre émigrée d’Europe ou de la Pampa argentine. Le
mythe du « tango argentin » naît, en refoulant en partie le feu noir
mais en gardant une charge transgressive et « carnavalesque » où
l’on joue, masqué, à renverser le pouvoir. Cette dernière est néan-
moins réagencée dans le contexte d’une résistance politique des im-
migrés, des gauchos et des « criollos » (les créoles) contre un régime
qui les exploite et tue leurs rêves d’un nouveau continent et d’une
capitale promettant richesses et ascension sociale. Ainsi, les hommes
se retrouvent (milonguear : se rassembler pour danser et chanter)
dans le quartier du port où on les a entassés comme du bétail, et
miment sur des musiques aux accents nostalgiques des combats de
jambes de plus en plus sophistiqués. « Danse de résistance », encore
et toujours « barbare » aux yeux de l’élite, la milonga (le bal de tango)
enchevêtre des couples d’hommes qui, contre la désillusion et la
misère, théâtralisent une fête colorée de violence (jeux de jambes) et
de tristesse ; dramatisent une dignité qu’on ne pourra jamais leur
voler.
Les prostituées des lupanars ou des bordellos qui s’intègrent à
cette résistance masquée sont loin de renforcer, dans la pratique (au
contraire du mythe faitichisant qui fonctionne encore actuellement),
un quelconque machisme guerrier. Si certains danseurs anciens ou
actuels se prennent au piège du stéréotype d’un combat érotique et
passionnel entre l’homme des bas-fonds et la femme faussement
soumise (l’homme guide et la femme dispose, changeant de parte-
naire quand bon lui semble), la pratique appelle des contrastes qui
rendent presque « bête » celle ou celui qui danserait un jeu réduit au
seul mythe faitichisé.
« Le tango représente la sexualité exacerbée des Argentins et la
domination de la femme. Or tout danseur de tango suffisamment
expérimenté reconnaît ces attributs comme des stéréotypes dirigés à
l’endroit des Argentins ne cadrant pas même avec l’expérience de la
pratique en soi. » (SEGUIN, 2009 : 78)
comparsas du carnaval porteño à la fin du XIXe siècle. » Voir PLISSON, 2004 :
33.
Fleur COURTOIS-L’HEUREUX
81
Ainsi, les figures de la prostituée jouent et déjouent dans le mythe
encore agissant et internationalisé au moins deux personnages
« sacrés » qui finissent par créer une nouvelle espèce. Tantôt, pour
les immigrants désillusionnés, elles rappellent la femme laissée sur
l’autre continent ou dans sa terre d’origine : la prostituée est alors le
support d’un spectre d’amour éternel et absent à qui on offre un
rituel et une mémoire. Ayant toujours perdu l’aimée, toujours en
quête de sa terre, le tanguero perpétue l’idée de l’errance et de
l’incertitude.
« Car le voyageur qui s’enfuit tôt ou tard s’arrête en chemin et si
l’oubli qui détruit tout a tué mes rêves d’autrefois, il y a caché en
moi une humble lueur, la seule fortune qui reste en mon cœur4. »
Tantôt, la prostituée devient complice d’une pudique résistance. À
l’égal de l’homme, elle danse et exerce une agilité propre aux duels
de rue. La démonstration de sa technicité fait d’elle une alliée rusée,
« diabolique », là où il s’agit pour le couple d’impressionner par un
maniement de feintises et une maîtrise d’un tenir-ensemble élégant
et tout innocent. Démonstration de puissance déguisée dont une
lointaine origine pourrait être celle des feintes et parades guerrières
animales (nous pensons à trois références pour tisser la consistance
d’un tel phylum : DELEUZE, GUATTARI, 1997 ; DETIENNE et VERNANT,
2002 ; DESPRET, 1996). Au niveau humain, dans le terreau discipli-
naire mais non-discipliné des esclaves, le tango comme la capoeira
(HALLOY, 2002 : 75-94), danse de rue et de ruse, témoignent de cet art
d’esquives imbriquées sur différents registres hétérogènes (politique,
personnel, historique, mythique, social, esthétique).
Aujourd’hui, ce double héritage historiographique entre science
et fiction est repris et transformé en fonction du contexte de danse. Car
le tango argentin, désir devenu transnational, s’est exporté jusqu’à
Katmandu. À Buenos Aires, le tango reste national et est revendiqué
comme une identité : il est avant tout argentin et seul un Argentin peut
se permettre d’honorer sa substantifique moelle, ses étages mythiques
d’histoires faitichisées.
« Tanguero, raconte-moi : “J’ai cette sensation d’être bien ensem-
ble : une sensation qui va vers le sol et je me sens bien, bien, bien…
Je sens que mes mouvements viennent du plus profond de moi et je
4 Extrait de la chanson « Volver » écrite par Alfredo La Pera, cité par SALAS,
1989 : 221-222.
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
82
me réjouis avec cette sensation-là. Elle est parfois tellement juste
qu’elle est comme un arbre, une plante, une fleur, posés si justement
qu’ils rayonnent. J’ai la sensation de rayonner. J’arrive à me sentir bien
dans mon être et donc à bien communiquer avec ma partenaire. Je
sens qu’il y a quelque chose de juste. C’est un mouvement qui sort
de l’intérieur, c’est solide, ce n’est pas une sensiblerie. Et tu sais,
quand tu danses le tango, quand tu te sens chez toi et que les gens
te regardent, c’est très gênant. Le tango, c’est le chez-soi des
immigrants”5. »
Danser, pour un porteño, n’a donc pas du tout la même teneur que
pour un Japonais ou un Finlandais. Néanmoins, et c’est ici que nous
aimerions réagencer la mythographie de la tanguera et de ses
chaussures provocantes : l’incorporation de ces histoires, allant de la
résistance politique masquée aux spectres fétichisés, crée un style
(une manière de danser), et même davantage : une redondance du
style qui échappe à un pur constructivisme social.
3. « À talons aiguilles » : fétichisme ni humain, ni divin
Si nous prenons, par exemple, le concept d’objet en anthro-
pologie et, plus particulièrement, « la danse comme objet anthro-
pologique », on peut l’envisager au moins selon deux visions clas-
siques. D’une part, une vision structuraliste, formelle, voire cognitive,
qui formatera l’objet dans une perspective fonctionnelle, esthétique.
Ainsi, c’est l’aspect de création qui sera privilégié. D’autre part, une
vision contextuelle, sociologique, qui « expliquera » l’objet en tant que
pratique culturelle, politique, sociale. Dans ces deux visions, un
implicite est requis : l’objet n’existe qu’en fonction d’un monde
symbolique, métaphysique, religieux, social. L’objet appartient au
SOCIAL. Mais qu’est-ce que le social ? Cette question a sérieusement
posé problème à Bruno Latour et Antoine Hennion, non pas à
propos de la danse, mais à propos des objets esthétiques et socio-
logiques en général (HENNION, LATOUR, 1993 : 7-24). À la différence
du constructivisme social, ils ne considèrent pas qu’un objet d’étude
anthropologique se réduise à la construction d’un rapport de forces
sociales et symboliques mais qu’il y a d’autres paramètres qui
concourent à sa construction et que ces paramètres sont aussi non-
humains, non-sociologiques. À cet égard, le concept d’objet est recréé
5 Entretien réalisé avec un professeur de tango d’origine argentine, établi et
enseignant à Bruxelles.
Fleur COURTOIS-L’HEUREUX
83
selon deux principes qui impliquent le pragmatisme et l’empirisme
évoqués en début d’article : un principe d’irréduction et un principe
de médiation.
Comme le dit B. Latour, « agir, c’est faire agir ». Les actants de
la danse, danseurs et spectateurs, mais aussi tout ce qui se mobilise dans
le rituel de la danse (chaussures, vêtements, espace, sons, lieux, pou-
voirs humains et non-humains) co-agissent, s’entre-tiennent (parfois
aussi, il faut le dire, s’entre-tuent), interfèrent. Et, si la danse réussit, si
elle interfère à son tour, alors les actants auront été les médiateurs
d’une incarnation, d’un événement, d’une transformation, d’un
nouvel agencement festif, rituel, jouissif, politique, institutionnel : en
agissant, ils auront fait agir quelque chose qui les dépasse. Réussir
une danse, c’est être pris, capturé par elle. Ce processus suit un
« principe d’irréduction » (LATOUR, 2001 : 237-349) qui implique que
l’événement dansant (qui fait agir les danseurs au-delà d’eux-mêmes6)
n’est pas une réincarnation mais l’événement d’une concaténation
inédite.
La danse est un réseau dont les trajets sont irréductibles ni à
l’un d’entre eux ni à un tracé préalable (et le tango est essentiellement
une danse d’improvisation). Le chemin de chaque actant est singulier
en tant qu’il exprime, à la manière d’une monade, une réappropriation
transformatrice, selon sa place, ses intérêts et, à un certain moment
donné, le tout, un labyrinthe en perpétuel réagencement de ses
couloirs et de ses limites. Ainsi, Bruno Latour énonce pour son pro-
gramme d’une sociologie de l’acteur-réseau le caractère irréductible
du médiateur qui ne transporte pas une Cause ou une Idée, mais
transforme ce qui le lie et le retient (lui « importe ») en nouvelles
6 L’exploration du vécu des danseurs. Par exemple, ce professeur argentin,
enseignant dans une ruelle sombre de Schaerbeek, qui nous raconte : « Le
mouvement, c’est la communication des corps. C’est comme quand tu es
dans l’eau et que tu marches à contre-courant : tu communiques alors avec la
puissance de l’eau. Par contre, quand tu te places dans le sens du courant, tu
te laisses inerte, tu ne communiques plus. Quand tu vas contre l’eau, tu fais
quelque chose pour sentir l’eau : tu te connectes avec l’eau. C’est la même
chose avec le tango : tu arrives comme individu et, puis, dès que tu te mets
dans les bras de l’autre, tu ne peux plus rester un individu. Ce n’est pas
possible, tu empêcherais la communication des corps. » Et puis, Ana Maria,
tanguera de Buenos Aires disait : « Il se passe quelque chose d’autre ici, les
deux membres du couple de tango, l’homme et la femme recherchent
l’harmonie. Ils parlent d’aller ensemble, de se compléter – cela les entraîne
au-delà d’eux-mêmes. Sinon, comme on dit, “on danse seule” et ce n’est pas
du tango. » Voir TAYLOR, 2000 : 126.
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
84
connections avec les autres, et cela autant que dure le regroupement,
le rituel ou la danse, bref, l’objet de travail. Quand le travail se
transforme en plaisir et inversement.
« […] tous les acteurs que nous allons déployer peuvent se trouver
associés de telle sorte qu’ils font agir les autres. Ils y parviennent, non
pas à titre d’intermédiaires fidèles transportant une force qui
resterait tout du long semblable à elle-même, mais en entraînant des
transformations manifestées par les nombreux événements inattendus
déclenchés chez les autres médiateurs qui les suivent tout au long
de la chaîne. C’est ce que j’ai appelé le “principe d’irréduction” qui
résume la signification philosophique de la sociologie de l’acteur-
réseau. » (LATOUR, 2006 : 155)
Latour insiste sur le fait que dans ce réseau de pratiques, aucune
distance n’est possible pour voir et prononcer la vérité qui s’y retisse.
C’est au contraire dans la proximité (en dansant, par exemple) que
l’on trame une vérité. Et surtout, la capacité analytique ne meurt pas
dans la prolifération des médiations : elle prolifère à son tour comme
médiation différentielle. Bruno Latour et Antoine Hennion prennent
l’exemple d’une médiation entre l’objet scientifique et l’objet d’art
qui loin de les « désingulariser » dans la nuit où tous les chats sont
gris, rend possible un traitement différencié. Il y a un art de décrire
les relations sans pour autant tomber dans un relativisme stérile.
« On peut reprocher à cette pensée de la médiation ou des réseaux
de jeter avec la dénonciation critique toute possibilité analytique.
En abandonnant la critique – moderne – elle deviendrait post-moderne,
se délectant à la seule multiplication des médiateurs et à la seule
prolifération des réseaux hétérogènes. Autrement dit, elle serait
devenue fétichiste pour de bon, pensées d’ingénieurs fascinés par
les machines. Bref, un retour de Saint-Simon. Pire, ne serait-elle pas
fétichiste même au sens psychanalytique ? C’est-à-dire perverse, empê-chant de comprendre le tout pour jouir de se perdre dans les détails,
vibrant au grincement d’un archet sur une corde, au crissement
d’un stylet sur un physiographe, mais au fond incapable d’analyser
ce qui se passe.
Nous pensons au contraire que, loin de limiter les ressources analy-tiques et de plonger toute chose dans la nuit où toutes les vaches
sont grises, la comparaison systématique entre le régime de média-tion des objets d’art et des objets de science permettra d’extraire un
certain nombre de propriétés caractéristiques, rendant possible un
traitement différencié – différenciation qui était impossible aupara-vant, puisque l’objet de science et lui seul échappait à toute analyse
Fleur COURTOIS-L’HEUREUX
85
[l’objet scientifique était exempt de toute peine analytique puisque
innocent par nature de la perversion fétichiste]. » (HENNION, LATOUR,
1993 : 17)
Si nous poursuivons la médiation de Bruno Latour, l’objet anthropo-
logique (la danse, par exemple) ne transporte pas une signification, il
n’est pas un fidèle intermédiaire d’une culture, d’une histoire, d’une
symbolique ou d’une métaphysique appliquée d’ailleurs. L’objet a ici
une force à part entière qui transforme ceux qui l’abordent, qui crée
des médiations et de nouveaux types de connexion. La danse fait
agir, elle nous dépasse, elle doit rester quelque part une source d’exi-
gences qu’on ne peut expliquer totalement. Ces sources d’exigence
transforment les actants en médiateurs, qui, à leur tour, feront agir la
danse autrement.
L’exigence des chaussures à hauts talons pour les femmes
est-elle aussi non-sociale ? Selon une analyse sociologique classique,
autrement dit « anti-fétichiste »7, on expliquerait ce type de chaussu-
res, soit par l’exigence d’élégance (réappropriation aristocratique du
tango populaire), soit par l’influence historique (apparat de séduc-
tion des prostituées). Grâce au concept de médiation non-sociale de
Bruno Latour, la présence de ces chaussures agence un objet ayant sa
propre puissance (un faitiche fétichisé) à laquelle la médiation
humaine se plie et avec laquelle elle se complique. La posture du
tango argentin nécessite un équilibre parfait du haut du corps par
rapport au bas. Alors que le bas ne cesse d’enchaîner des mouve-
ments de rotation, le haut se dissocie et reste en symétrie avec le
torse du partenaire.
Pour arriver à une telle dissociation du corps sans perdre
l’équilibre, les chaussures à hauts talons, paradoxalement, assurent à
la femme de tourner vers l’avant ou vers l’arrière sans perdre son
axe. Si l’on fait l’expérience de tourner en faisant un pas en avant ou
7 Latour et Hennion résument ce qui fait la fierté mal placée des modernes
anti-fétichistes : la clairvoyance du vrai et du faux « qui nous empêche de
prendre des vessies totémiques pour des lanternes éclairantes » HENNION,
LATOUR, 1993 : 2. Si les anti-fétichistes brisent les idoles, ils s’empressent de
les re-fabriquer en inversant leur puissance. Ils rendent les objets capables de
tromper les hommes. Puis, ils bricolent de nouveaux types de fétiches : des
« faitiches », des faits qui auront la force de les faire plier, d’avoir autorité,
d’exiger des subsides, des articles… Mais un « fait sociologique », par
exemple, ne devient un « faitiche » que s’il réussit l’examen de médiations,
s’il est repris et repris au point de créer un événement social ou scientifique.
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
86
arrière et en gardant le haut de son corps immobile et dissocié des
mouvements de rotation du bassin, on se met automatiquement sur
la pointe des pieds. Ainsi les hauts talons vont induire des rotations
performantes, voire créer de nouvelles figures où se marquent de
manière encore plus forte des dissociations du corps (qu’on pense ici
au tango nuevo). Les hauts talons créent de la danse et deviennent
une puissance à laquelle les femmes sacrifient leur corps et leurs
mouvements, voire leur bourse : un faitiche fétichisé.
4. Corps ré-objectivé par l’abrazo
Idéal amoureux et idéal politique hantent les tangueros. Ils
jouent et rejouent l’idéal du couple, des relations amoureuses et
politiques. Des éléments non-dansants se mêlent aux éléments
proprement dansants dans un rapport pragmatique d’intimité
paradoxale. Les idéaux relationnels de respect, d’incertitude, d’impé-
nétrabilité, s’incorporent dans une qualité stylistique des gestes et du
toucher, les rendant efficaces à mener une improvisation tangotante.
L’écologie politique du toucher est ici une éthologie, un art de
manières de dire et de faire par l’entremise d’un corps en tension
extra-quotidienne8. Le corps est déterritorialisé et reterritorialisé
dans une configuration des organes des sens et des limites spatio-
temporelles.
Le « corps sans organe » d’Antonin Artaud nous rappelle que
le corps est une vaste inconnue. Démuni de ses rapports hiérarchiques
avec l’âme, avec l’invisible moral, religieux ou politique, avec la raison
ou encore avec les catégories scientifiques, « que peut un corps ? »
(question spinozienne), sinon persister dans un agencement dési-
rant comme rouage partiel, signifiant ou asignifiant (réponse deleu-
zienne et guattarienne) ? Plus que les territoires corporels, ce sera
l’agencement tango qu’il nous faudra ressaisir. Mais nous avancerons
à reculons, en partant de l’un des rouages partiels : les corps-tango
dans leur abandon à la retenue.
Le vécu du corps dans le tango est un territoire abstrait,
rendu impénétrable pour que fonctionne l’intimité des distances. Ce
territoire surgit en même temps qu’il conditionne la tension exercée
8 La notion de « tension extra-quotidienne » du corps dansant, dont le
régime d’énergie n’est pas fondé sur une économie mais bien sur une
dépense (afin que le geste soit, lui, juste et économique), est définie par
BARBA, SAVARESE, 2008.
Fleur COURTOIS-L’HEUREUX
87
par chacun des danseurs. Cette tension est comme un tiers volume,
tantôt physique, tantôt moral, tantôt abstrait, tantôt concret. Elle est
une conséquence qui définit les corps en suspension et en réorgani-
sation permanente.
Figure 2 : Le jeu de l’étreinte et du rythme9
Le corps du tanguero est pris dans un agencement dont il n’est qu’un
agent partiel, un « objet de médiation ». Redéfini et reconfiguré par
cet agencement, il s’invente un trajet pour tenir et persévérer. Ce
trajet n’est pas une linguistique mais une sémiotique non linguisti-
que de signes tactiques (un toucher rusé). Le danseur ne cherche pas
à trouver un équivalent du langage pour communiquer des énergies
tactiles. C’est l’agencement des flux tactiles, des échanges de toucher,
qui l’obligent à inventer des signes non significationnels et un corps
apte, tactiquement adapté.
La politique du toucher n’a que faire du monde linguistique
de la signification ou d’une communication basée sur la traduction
de choses en mots ou en actions. Une sémiotique du toucher adé-
quate à l’improvisation d’une coexistence intime et éphémère de
mondes intouchables implique que le tanguero ne rêve pas de com-
muniquer par le toucher comme il le ferait dans le langage : « Je te
touche là, donc, tu comprends que je t’invite à aller par là ». Le
danseur rêve au contraire que son geste ne soit pas comme un mot
9 Schéma réalisé par DINZEL, 1994. L’appareil dramatique désigne le jeu de
l’étreinte où se déroule l’intrigue et l’appareil expressif, le jeu rythmique
(« compás ») de jambes qui exprime, traduit ce qui se passe dans l’espace
supérieur, au niveau du tiers volume du cylindre (territoire concret et virtuel
de l’étreinte).
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
88
mais comme le ressort du geste de l’autre et de la danse tout entière.
Qu’il soit pris et non compris.
Néanmoins, nous acquiescerons bien volontiers au fait que
certains types de discussions langagières fonctionnent tout autant à
la manière de machines vivantes, avec des jeux rétroactifs de res-
sorts, des reprises inattendues d’énergies délaissées, des bouillon-
nements ou des tarissements d’enthousiasme. Discussions « pathi-
ques10 » qui fonctionnent en détraquant tout mécanisme institué du
langage communicationnel rationnel. La discussion pathique ne sert
qu’à véhiculer des flux, des partages et des recombinaisons d’énergies
de voix, d’émotions, de territoires corporels et incorporels, de forces
virtuelles-actuelles. « Cela fait trois heures, certes, que nous parlons
d’un vélo mais ce que nous avons échangé n’a rien à voir avec un savoir
du vélo : nous avons ri, réactivé ensemble des souvenirs, établi des
points de convergence et de divergence de nos personnalités. Le vélo
nous a baladés, nous a rapprochés ou éloignés. Il a fonctionné comme
une ritournelle, une machine abstraite. »
Dans sa « Lettre sur les aveugles », Diderot nous aidera à
mieux comprendre le concept de « corps sans organe » inventé par
Artaud et repris par Deleuze et, ainsi, notre « corps ré-objectivé dans
le tango ». L’homme moderne organise son corps en fonction de ce
qu’il considère être son organe (organon) majeur et hiérarchiquement
supérieur à tous les êtres : la raison, la conscience, la réflexivité,
l’esprit. Ainsi, la raison détermine-t-elle l’organe de la vue comme le
plus important, puis l’ouïe, le goût, le toucher, l’odorat. La raison,
dans l’histoire de la pensée, est avant tout contemplative (théorétique).
Un animal est donc défini inférieur en raison de son défaut de
réflexivité, même si l’œil du lynx est pourtant plus performant que
celui d’un humain. Son défaut « bestial » est d’être ramené aux sens
corporels et non à un sens réflexif que seul l’humain a le droit de
posséder et de définir. Et si les animaux possédaient eux aussi une
capacité réflexive mais n’éprouvaient pas le besoin de la suren-
chérir ? Diderot rapporte ainsi « le point de vue » des animaux :
10 Nous reprenons l’idée de « pathique » à GUATTARI, 2005. Sans pouvoir
entrer ici dans les détails complexes de l’hétérogénèse machinique,
associons, pour l’heure, « pathique » à ce qui relève d’affects non-humains et
non-discursifs qui participent d’une sémitiotique a-signifiante d’expressions
ou d’autopoïèses partielles de machines abstraites et transversales. Pour
indice, la ritournelle de Proust peut être prise comme le rouage d’une ma-
chine abstraite.
Fleur COURTOIS-L’HEUREUX
89
« Il a des bras, dit peut-être le moucheron, mais j’ai des ailes. S’il a
des armes, dit le lion, n’avons-nous pas des ongles ? L’éléphant
nous verra comme des insectes ; et tous les animaux, nous
accordant volontiers une raison avec laquelle nous aurions grand
besoin de leur instinct, se prétendront doués d’un instinct avec
lequel ils se passent fort bien de notre raison. Nous avons un si
violent penchant à surfaire nos qualités et à diminuer nos défauts,
qu’il semblerait presque que c’est à l’homme à faire le traité de la
force, et à l’animal celui de la raison. » (DIDEROT, 1880 : 50)
Ayant remis sur une même ligne horizontale animaux et humains,
êtres rationnels et non rationnels (ne sachant plus vraiment qui est
qui), Diderot revient sur la mise à égalité des organes. La qualité de
l’un ou de l’autre ne dépend pas d’une importance d’ordre hiérar-
chiquement naturel mais bien d’un processus de vie propre à chaque
être et à son devenir particulier. La vue ne doit plus être considérée
comme l’organe le plus important parce qu’il incarnerait le médium
le plus adéquat à la raison de l’homme mais comme un organe parmi
d’autres, développé en fonction d’occurrences multiples et variées,
mais jamais a priori. A priori, aucun organe n’est le plus important :
son importance se construira par la manière dont il s’adapte à l’agen-
cement qui le capture. L’aveugle de naissance n’a pas le défaut de la
vue. Ne pas voir ne lui manque pas et le développement de ses autres
organes n’est en rien une compensation.
En réalité, il a sa propre manière de voir : ses yeux sont dans
ses mains, ses oreilles, sa peau, ses sensations de chaleur, son nez,
etc. Il voit à travers tous ses organes. Sa vue, loin d’être concentrée
dans un seul organe, se distribue et s’affine en une multitude de sen-
sations élaborées, qu’un voyant pourrait envier. « Le corps est sans
organe » signifie, à la lumière (mais aussi au parfum, à la gifle ou à la
caresse, au tintement) de cette processualité pragmatique et anti-
fonctionnaliste des organes, un corps radicalement pluriel et sans
territorialisation fixée a priori. Nous ne naissons pas avec des yeux
pour voir et des pieds pour marcher. Une telle téléologie appartient
au règne d’une Raison imbue d’elle-même et aveugle. L’aveugle ne
secrète pas l’intime espoir de voir : il voit très bien déjà. Son rêve ?
Toucher la lune.
« Quelqu’un de nous s’avisa de demander à notre aveugle s’il serait
bien content d’avoir des yeux : “Si la curiosité ne me dominait pas,
dit-il, j’aimerais bien autant avoir de longs bras : il me semble que
mes mains m’instruiraient mieux de ce qui se passe dans la lune
que vos yeux ou vos télescopes ; et puis les yeux cessent plutôt de
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
90
voir que les mains de toucher. Il vaudrait donc autant qu’on perfec-tionnât en moi l’organe que j’ai, que de m’accorder celui qui me
manque”. » (DIDEROT, 1880 : 50.)
Le tanguero apprend à reconfigurer le régime de son corps et de ses
organes. L’agencement de l’équilibre à deux, d’une tension de distances
territoriales (voire cosmiques, politiques et éthiques) ou d’une proximité
intime des corps insuffle une ré-organisation. Les yeux de la femme
sont clos ou entr’ouverts : ils saisissent parfois un danger mais se
reposent bien plus souvent dans un vide de béatitude et de concen-
tration aveugle. Les yeux de l’homme fixent droit devant eux pour
maximiser une acuité périphérique qui lui permet de sinuer dans un
territoire mouvant.
Les yeux ne regardent pas : ils avertissent des déplacements
de bornes à éviter. Ils guettent des mobiles évanescents, sans visage,
sans corps, sans matérialité. Les yeux touchent et sondent tandis que
les pieds scrutent, analysent, observent attentivement et de manière
infinitésimale les contours des pieds de l’autre, de sa jambe. Le pied
caresse en reniflant la trace laissée sur la surface du sol. Tout à coup,
il la sent et bientôt mord sa proie, en l’invitant à traîner, à accélérer
ou à s’enflammer dans l’air. La tanguera écoute le pouls de son
partenaire par sa main laissée sur l’une de ses artères. Rapide, elle le
sait et le souffle dans ses cheveux vient le confirmer. Elle voit avec
l’organe de son toucher les infimes variations d’énergies que l’homme
tente d’impulser, d’assouvir ou de réfréner. Elle n’interprète pas mais
répond tout de même à cette parole sauvage et muette. Elle rapproche
son corps, se dissocie et retrouve une distance juste.
Conclusion : répondre « du tact au tact »
Lui, il guide ; elle, répond. Il calcule son prochain pas, elle
obéit à ses indications. Ainsi dira-t-il : « Mais ce n’est pas cela que je
t’ai demandé de faire ! ». Elle dira : « Je n’ai pas compris ce que tu as
voulu me dire : tu t’exprimes mal (au niveau corporel) et tu deviens
grossier (à tous les niveaux) ! ». Le couple s’érode dans des mots, et
la danse meurt. L’énigme se meurt car elle ne peut survivre dans un
régime de communication biunivoque d’« action-réaction ». Nous
irons même plus loin en avançant que ce régime de communication,
s’il s’impose à un moment ou l’autre de la danse, entraîne avec lui
une « sociologisation tragique » annulant toute possibilité d’événe-
ment dansant. On serait ici tenté de bifurquer sur une éthique de la
Fleur COURTOIS-L’HEUREUX
91
communication telle que Heidegger la conçoit dans sa Lettre sur
l’humanisme, mais nous n’éviterions pas, par son arbitrage, les mâchoires
du félin. S’il a montré, ô combien, que le réseau connexionniste des « on-
dit » était inapte à une véritable communication, sa proposition d’une
langue poétique, seule capable de performer le caractère incom-
municable de l’Être (Valéry a lui aussi opté pour cette réponse au
sphinx de la danse – VALÉRY, 1960), retombe à pieds joints dans ce
que nous nommons par exorcisme une « sociologisation tragique ».
Car le comble du tragique serait ici de transcender et de projeter dans
l’ombre une essence « tango », au cœur inviolable (dixit Parménide à
propos d’alétheia).
La sociologisation du tango se développe en zigzags rétroactifs
entre plusieurs pôles, tantôt internes et externalisés, tantôt externes et
internalisés. Du côté interne, des éléments saillants comme le couple, les
rôles de guidant-guidé entre l’homme et la femme, l’élégance érotique
vestimentaire, l’intimité ambigüe du corps à corps, les techniques
d’improvisation, le bal populaire, etc., sont repris (externalisés) dans
des discours historiques et sociologiques qui en développent les
aspects les plus attendus, fussent-ils contradictoires (le paradoxal est
fort apprécié pour caractériser l’essence du tango). Très vite, « socio-
logiquement parlant », le fait de danser en couple signifie qu’on
renoue soit avec un certain collectivisme (et avec les rôles politiques,
hiérarchiques ou égalitaires que cela suppose) contre l’individua-
lisme conquérant de nos sociétés capitalistes, soit avec un certain
regain pour l’idéal matrimonial du couple créé par la médiation
sociale du bal contre l’éclatement et la désillusion de la notion même
de couple, soit avec un pouvoir phallocratique auquel les femmes
s’abandonnent de manière subversive, soit encore avec l’individualisme
post-moderne qui promeut liberté totale des partenaires, relation
éphémère et implosion du sujet dans le brassage anonyme des corps
soudés mais solitaires. Ces externalisations discursives (qui tiennent
parfois dans une même étude sans s’exclure) surviennent autant chez
les historiens, sociologues et psychologues de la danse que chez les
médiateurs de la transmission pratique (professeurs et amateurs
expérimentés).
Ainsi se forgent des « on-dit », des habitudes de pensée (même
si elles sont souvent posées comme de fabuleuses controverses de pen-
sée) qui nourrissent le mythe paradoxal du tango d’anecdotes que tout
bon tanguero se doit un jour de répéter oralement mais aussi dans sa
manière de danser : rétro-action. Pour déforcer ou renforcer, selon les
occasions et les options, le machisme qui apparaît de manière assez
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
92
grossière dans la distinction des rôles (l’homme indique et la femme
exécute) les danseurs parleront de retour à une « galanterie oubliée »
(« l’homme propose, la femme dispose »), ou à une « nature refoulée »
(la virilité de l’homme et la séduction de la femme comme attributs
essentiels et quasi jouissifs). Si la plupart des discours externes tentent
de sauver le tango de son apparent agencement macho et conformiste,
leur internalisation dans les manières de penser et de faire agir la
danse suit le même statu quo de la modernité : le machisme, c’est
« mal » (selon une logique du bien et du mal tout aussi patriarcale).
Aussi, nous aimerions conclure cette traversée au carrefour
faitichiste et fétichiste de l’objet controversé du tango et de ses
« corps bien chaussés » ou « chosifiés », par une dernière tanguera,
ethnographe nocturne. Marta Elena Savigliano11, dans la mouvance
de l’ethnographie post-colonialiste et post-féministe, pointe dans le
cœur du « tango-macho » ce qui le fait battre à moitié, déjouant une
cartographie figée avec de faux paradoxes. Le machisme qui a cours
dans les milongas est un théâtre politique bien réel et bien imposé.
Mais cette scène flagrante est tellement caricaturale, lumineuse, que
les femmes gagnent à se faire voir dans cette lumière de la nuit. Dans
cette visibilité foudroyante du machisme, elles ont la possibilité
d’exposer leur propre pouvoir. Elles sortent du territoire de l’ombre
que le machisme insidieux leur accorde habituellement, voire le
transforment.
Si les premières femmes à avoir dansé le tango étaient des
prostituées de banlieues (« en las afueras del Río de la Plata »), l’adop-
tion bourgeoise et coloniale de la milonga les emmènera, elles et leurs
images sombres de femmes inexorablement soumises, vers une recon-
naissance un peu plus valorisante que la « victime ». Du statut de
« victime », elles pourront jouer avec les épouses et les maîtresses, puis
les femmes dites « libérées », la carte de la victimisation, sans pour
autant être réellement « victimes ». L’agencement de la milonga crée
un déplacement de la femme dans l’agencement du totalitarisme phal-
locratique. Savigliano a bien lu Foucault. La différence entre une
société disciplinaire et une société disciplinée (et le fait qu’elles ne se
recouvrent pas) se traduit chez elle par le déplacement d’une fémi-
nisation disciplinée vers un machisme disciplinaire où la femme
11 Originaire d’Argentine, docteur en sciences-politiques de l’Université de
Hawai-Manoa, professeur au département de danse de l’Université de
Californie (Riverside) et, surtout, résolument enracinée dans la pratique du
tango, elle offre plusieurs études qui tentent un dispositif révolutionnaire en
anthropologie et en ethnographie. Voir SAVIGLIANO, 1995, 2000, 2005.
Fleur COURTOIS-L’HEUREUX
93
conquiert un pouvoir de subversion : elle passe d’un processus de
subjectivation (une faitichisation fétichisée : une double puissance
rétroactive et s’entre-transformant) à un autre sous l’aspect d’une
même identité stéréotypée ou imposée (« le fétichisme de la femme-
objet »).
« True, women in tango did not have a global, revolutionary project in
mind ; instead, they displayed a series of concrete subversive moves
tempered by their interests in survival. In doing so, they reproduced the
female stereotypes : prostitutes, mistresses, wives… but, perhaps the
copies were not perfect – subversive reproductions ? The women aimed
at improving their embodied lives, which in that context meant gaining
a more rewarding exploitation, and this was not a minor endeavor. They
discovered there was something they could do ; they could move from
the accepted poverty of one territory – the outskirts – to the questionable
flashy lights of the downtown cabarets. Move. They were passionate
objects, not passive ones. Objects that had, if not a say, at least a move to
make in the power game. Women in tango are part object, part subject.
To paraphrase Jean Baudrillard, the stratagems of the milongueta had
the ironic thrust of a subjectivity in the process of being grasped
(BAUDRILLARD 1984 : 134)12. »
La tanguera vous salue !
12 SAVIGLIANO, 1995 : 70, notre traduction : « Au vrai, les femmes n’eurent pas
à l’esprit, dans le tango, de projet général ou révolutionnaire ; au lieu de
cela, elles exposèrent une série de mouvements concrets et subversifs,
tempérés par des intérêts de survie. En faisant cela, elles reproduisirent les
stéréotypes de la femelle : prostituées, maîtresses, épouses… mais peut-être
les copies n’étaient-elles pas parfaites – des reproductions subversives ? Les
femmes visaient à améliorer leurs vies personnelles, ce qui signifiait dans ce
contexte se faire exploiter avec plus de fruits, et ce n’était pas une mince
entreprise. Elles découvrirent qu’il y a avait quelque chose qu’elles pou-
vaient faire ; passer de la pauvreté résignée d’un territoire – les banlieues –
aux lumières voyantes et douteuses des cabarets des mauvais quartiers. Se
transporter. Elles étaient des objets passionnés, et non des objets passifs. Des
objets qui avaient, sinon un mot à dire, au moins un mouvement à faire dans
le jeu du pouvoir. Les femmes sont, dans le tango, à la fois objet et sujet.
Pour paraphraser Jean Baudrillard, les stratagèmes des milonguetas eurent
l’ironique devenir d’une subjectivité suscitant un processus de capture. »
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
94
Bibliographie
BARBA E., SAVARESE N., 2008, L’Energie qui danse. Un dictionnaire d’an-
thropologie théâtrale, 2e éd., trad. E. Deschamp-Pria, Montpellier : Éd.
l’Entretemps.
BLANCHOT M., 1955, L’espace littéraire, Paris : Gallimard.
DELEUZE G., GUATTARI F., 1997 [1980], « De la ritournelle », dans
Mille plateaux, Paris : Éd. de Minuit, p. 381-433.
DESPRET V., 1996, Naissance d’une théorie éthologique, Paris : Les Em-
pêcheurs de penser en rond.
DETIENNE M., VERNANT J.-P., 2002 [1974], Les ruses de l’intelligence. La
mètis des grecs, Paris : Flammarion, coll. « Champs ».
DIDEROT D., 1880, « Lettre sur les aveugles » (1749), dans Œuvres
choisies de Diderot, tome 1, Paris : Garnier Frères, p. 43-115.
DINZEL R., 1994, El tango, una danza. Esa ansiosa búsqueda de la
Libertad, Buenos Aires : Corregidor.
FOUCAULT M., 1986 [1966], La pensée du dehors, Montpellier : Éd. Fata
Morgana.
FREUD S., 1994, Le Fétichisme (1927), dans Œuvres complètes, XVIII,
Paris : PUF.
GUATTARI F., 2005 [1992], Chaosmose, Paris : Éd. Galilée.
HALLOY A., 2002, « Capoeira ou l'incarnation de la ”mandinga“ », dans
M. ASSENMAKER (dir.), Instabilités, plusieurs points de vue, Bruxelles : Éd.
Institut Saint Luc Art et Architecture, p. 75-94.
HENNION A., LATOUR B., 1993, « Objet d’art, objet de science. Note
sur les limites de l’antifétichisme », Sociologie de l’art, n° 6, p. 7-24.
JAMES W., 2007 [1912], Essais d’empirisme radical, trad. et prés. G. Garreta
et M. Girel, Paris : Flammarion.
LATOUR B, 2001 [1984], « Irréductions », dans Les microbes, guerre et
paix, Paris : La Découverte, p. 237-349.
LATOUR B., 2006, Changer de société. Refaire de la sociologie, Paris : La
Découverte, coll. « Armillaire ».
LATOUR B., 2007, Sur un livre d’Etienne Souriau : Les différents modes
d’existence, 2007, consultable en ligne sur : http://www.bruno-
latour.fr/articles/article/98-Souriau.pdf.
LATOUR B., 2009, Sur le culte moderne des dieux faitiches, Paris, Les
Empêcheurs de penser en rond – La Découverte.
MANNING E., 2009, Négocier l’influence. Le toucher et le tango, dans
F. JOYAL (dir.), Tango, corps à corps culturel, Québec : Presses de
l’Université du Québec, coll. « Santé et Société » p. 139-158.
PLISSON M., 2004 [2001], Tango. Du noir au blanc, Arles : Cité de la
Musique – Actes Sud, seconde éd. augmentée.
RANCIÈRE J., 2001, « Ten theses on politics », dans Theory and Event,
vol. 5, n° 3, 2001, consultable en ligne sur : http://muse.jhu.edu/jour-
nals/theory_and_event.
Fleur COURTOIS-L’HEUREUX
95
RILKE R. M., 1994, Lettres à un jeune poète et autres lettres (1903-1908),
trad. C. Porcell, Paris : Garnier Flammarion.
ROSOLATO G., 1967, « Étude des perversions sexuelles à partir du
fétichisme », dans Le désir et la perversion (collectif), Paris : Éd. du
Seuil, p. 9-40.
SALAS H., 1989, Le tango, Paris : Éd. Actes Sud.
SAVAGLIANO M. E., 1995, Tango and the Political Economy of Passion,
Boulder : Westview Press.
SAVAGLIANO M. E., 2000, « Nocturnal Ethnographies : Following
Cortázar in the Milongas of Buenos Aires », Revista transcultural de
Música.
SAVAGLIANO M. E., 2005, « Destination Buenos Aires : Tango and
Cinematic Sex Tourism », Cadernos PAGU 25, p. 327-356.
SEGUIN M., 2009, « Le tango argentin et les jeux de représentation.
Vers une déconstruction de son image stéréotypée et érotisée »,
dans F. JOYAL (dir.), Tango, corps à corps culturel, Québec : Presses de
l’Université du Québec, coll. « Santé et Société », p. 77-96.
SOURIAU E., 2009, Les différents modes d’existence (1943), suivi de De
l’œuvre à faire, présent. I. Stengers et B. Latour, Paris : PUF.
TAYLOR J., 2000, Tango, gifle et caresse, Terrain, n° 35, Danser, p. 125-
140.
VALÉRY P., 1960 [1936], « Philosophie de la danse », dans Œuvres I,
Paris : Gallimard.
97
Thierry DRUMM
La vie publique des choses.
Objets et choses de William James
Introduction : une pratique pauvre en objets
La philosophie comparée à d’autres pratiques se présente
immédiatement comme pauvre en objets, alors que la technique, l’art
et même la science ou la religion se présentent, au contraire, tout
aussi immédiatement comme riches en objets. Imagine-t-on un infor-
maticien sans ordinateur, un musicien sans instrument, et même un
géomètre sans compas, un fidèle sans fétiche ? On imagine pourtant
sans difficulté le philosophe seulement vêtu de ce qu’exige la
pudeur. Cependant, à y regarder de plus près, les objets moutonnent
aussi autour du berger de l’être : qu’est-ce que l’inspection de l’esprit
sans le morceau de cire, l’imagination sans le cinabre, la durée sans le
sucre, le Geviert sans la cruche ? N’en doutons pas : les philosophes
aussi font parler les objets, et leur demandent de les faire penser1.
Il faut néanmoins convenir que, plutôt que d’une présence,
c’est d’une survie de l’objet dont il faudrait parler à propos des
conditions qui lui sont réservées par le discours philosophique. Ce
n’est pas seulement le morceau de cire, le sucre et même (pourquoi
pas) le cinabre qui fondent, ce n’est pas seulement le contenu de la
cruche qui s’écoule, mais c’est tout objet que semble dissoudre la
présence du seul esprit ou de la pensée « pure », pour autant que ce
n’est jamais tel ou tel étant particulier mais la pensée elle-même ou
l’être (son double) qui sont dignes d’être pensés. Autrement dit (dans
une version plus épistémologique), c’est une recherche des condi-
tions de l’objectivité qui finit par se substituer à tout questionnement
se rapportant à un objet capable de forcer à penser. On a remplacé
1 Plusieurs auteurs s’y exercent admirablement dans l’ouvrage dirigé par
Lorraine Daston (DASTON, 2008) et qui porte précisément sur cette question,
mais dans les domaines de l’art et de la science plutôt que de la philosophie.
Dans son introduction, Lorraine Daston écrit : « Sans les choses, nous arrêterions
de parler. Nous deviendrions aussi muets que les choses sont prétendues l’être. »
(DASTON, 2008 : 9, ma traduction). Voir également le récent livre coordonné par
Sophie Houdart et Olivier Thiery (HOUDART, THIERY, 2011).
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
98
l’objet par l’objectivité2. Il ne reste plus alors qu’à s’émerveiller que
d’aucuns puissent perdre leur temps à penser quelque chose, au lieu
de s’efforcer d’être adéquats aux révolutions absolues de la pensée.
N’y a-t-il pas lieu pourtant de s’étonner qu’une pensée soit tenue
pour d’autant plus « objective » qu’elle ne dérive d’aucun commerce
avec un objet particulier ?
1. Porte d’entrée et porte de service
Le pragmatisme constitue, à cet égard, une exception notable,
en particulier chez William James où la philosophie se peuple de
molécules et de fantômes, de cactus mexicains et d’alpinistes, d’écu-
reuils et de tremblements de terre. On peut dire plus précisément que
l’objet importe à un double titre, car il passe aussi bien par la porte
d’entrée que par la porte de service (JAMES, 1981 : 1223 sq.), et la liste qui
précède illustre bien ce double rapport de la pensée aux objets,
correspondant au deux sens de l’expérience. Il y a deux formes de
rapport de la pensée aux objets et deux façons dont nous faisons une
expérience, une porte d’entrée et une porte de service.
Il y a une porte de service parce que nous ne pensons jamais
que grâce à certains objets qui rendent la pensée possible et la
permettent. Il y a une porte d’entrée parce que même quand ces
conditions sont diversement remplies, la pensée demande encore
d’être confrontée à des objets qui exigent qu’on les pense. Penserions-
nous, par exemple, sans langage et sans cerveaux ? Ces objets per-
mettent la pensée. Penserions-nous, par exemple, sans crise économique
et sans discours philosophiques ? Ces objets confrontent la pensée. En
généralisant la proposition jamesienne, on pourrait appeler « objet
permettant » celui qui, à telle occasion, sert de support concret à l’exercice
de la pensée, comme on pourrait appeler « objet confrontant » celui qui,
à telle occasion également, présente une résistance capable de nous
forcer à penser.
« La nature a de nombreuses méthodes pour produire le
même effet » (JAMES, 1981 : 1223, ma traduction). Il semble donc que
nous puissions regrouper ces méthodes sous deux aspects.
2 Nous verrons plus loin que cette substitution ne se comprend sans doute
elle-même qu’en fonction d’une substitution plus générale suivant laquelle
c’est l’objectivité et l’objet d’une part qui se substituent aux expériences et
aux choses d’autre part.
Thierry DRUMM
99
« Elle peut faire sonner nos oreilles au son d’une cloche ou par une
dose de quinine, nous faire voir jaune en étalant un champ de
boutons d’or sous nos yeux ou en mélangeant un peu de poudre de
santonine à notre nourriture. » (JAMES 1981 : 1223, ma traduction).
Ce qui distingue les agents passant par la porte d’entrée de ceux qui
passent par l’escalier de service, c’est que les premiers, en même
temps qu’ils affectent notre pensée, « deviennent immédiatement les
objets de l’esprit » (JAMES, 1981 : 1225, ma traduction), tandis que les
seconds, au moment d’entrer en relation avec notre pensée, « ne sont
pas les objets directs des effets qu’ils produisent » (JAMES, 1981 : 1225,
ma traduction). Les deux catégories n’en sont pas moins constituées
d’objets (directs ou indirects) sans lesquels la pensée ne serait rien
(voir aussi JAMES, 1981 : 417). Pour le dire encore autrement : il n’y a
guère de sens à s’interroger sur la présence, la position ou la situa-
tion de la pensée en soi, mais on peut dire qu’elle est cognitivement
mais non dynamiquement présente à la constellation d’Orion au moment
où je la perçois, tandis qu’elle est dynamiquement mais non cogniti-
vement en relation à mon cerveau ou plutôt à tout ce qui le constitue
(JAMES, 1981 : 210).
La composition des Principles of Psychology se caractérise par
la présence des nombreux « schémas » qui, en regard du texte, visent
à montrer ce dont il est question. La distinction entre les objets « front
door » et les objets « back door » est ainsi donnée à voir dans la figure
94, où l’on comprend que les « x » valent pour les objets qui permettent
la pensée, tandis que les « o » valent pour les éléments qui confrontent la
pensée. Comme tout modèle, le schéma est bien sûr beaucoup trop
simple, mais présente déjà l’intérêt de rappeler que nous ne pensons
pas sans cet objet si particulier qu’est le cerveau, même s’il faut
beaucoup d’autres choses pour penser et que la relation de la pensée au
cerveau ne saurait se comprendre en aucun sens intelligible comme
une simple réduction.
Nous ne manquerons d’ailleurs pas de voir combien la
distinction entre les objets « front door » et les objets « back door » n’est
qu’une première approximation fonctionnelle visant à dramatiser
diversement la façon dont les objets requièrent la pensée.
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
100
Figure 1 : Les nombreuses méthodes de la nature
2. Ce qui permet la pensée
Reprenons le fil de l’interrogation en commençant par
considérer la « porte de service » et les objets qui permettent la pensée.
On constate qu’il y a là toute une tradition philosophique et scien-
tifique très présente à l’époque de James, et, à bien des égards, triom-
phante aujourd’hui, qui se montre parfaitement prête à concevoir la
pensée en rapport à des objets à condition de comprendre ce rapport
comme une réduction. S’il nous faut un cerveau pour penser, ne
s’agit-il pas alors de dire que la pensée n’est que du cerveau ? Si nous
ne pensons pas sans être équipés d’une langue, ne s’agit-il pas de
dire que la pensée n’est que discours, seulement discours ? Quitte à
allonger autant qu’on veut la liste des objets que la pensée « n’est que »,
car dès l’instant où le principe est acquis, peu importe finalement qu’il
n’y ait qu’un objet (la « matière » ?) ou mille objets (les « conditions
matérielles » ?), de toute façon vous ne pensez plus quand vous croyez
penser.
C’est au contraire un parti pris constant chez James que
d’appeler ses lecteurs à résister au mot d’ordre réductionniste pour
lequel « le supérieur s’explique par l’inférieur et n’est jamais que
quelque chose de très inférieur » (JAMES, 2007b : 93). C’est comme si
un certain discours philosophique et scientifique avait réussi à
associer le renoncement à nos illusions et la découverte de la vérité, à
tel point que tout discours conduisant à renoncer à ce qui nous
importe ne peut être tenu sans produire sur nous une sorte d’« effet
de réel », et comme le dit James ironiquement :
Thierry DRUMM
101
« [...] un véritable amant de la vérité doit discourir sur le mode
héroïque [...], et avoir l’impression que, pour que la vérité soit la
vérité réelle, il faut qu’elle apporte finalement des messages de
mort à toutes nos satisfactions. » (JAMES, 1998 : 109)
James n’aura de cesse de dénoncer ce raisonnement vain et nihiliste
en son fond. Rien ne saurait justifier la réduction de ce que nous
pensons aux conditions qui permettent à la pensée de se produire. À
de très nombreuses reprises, mais particulièrement dans le premier
chapitre des Variétés de l’expérience religieuse intitulé « Religion et
neurologie » (JAMES, 1985 : 11-29), James insistera sur les préférences
secrètes qui, dans ces cas, guident ce que nous acceptons aussi bien
que ce que nous rejetons. Ainsi n’attribuera-t-on une pensée à un
engorgement du foie, qu’à condition de désapprouver dès le départ
cette pensée, ainsi réduite à néant par sa supposée « basse origine ».
Mais personne ne rejetterait pour les mêmes raisons les idées du
penseur qu’il approuve, quand bien même celui-ci serait affligé des
pires maux organiques.
On ne peut d’ailleurs disqualifier une pensée pour s’être
produite en rapport à des objets qu’en admettant qu’il lui soit possible
de se présenter comme un surgissement absolu. Un tel présupposé
apparaît pourtant comme un non-sens manifeste : quelqu’un a-t-il déjà
vu une idée se produire sans relation à rien1 ? Ou bien encore, est-on
victime du pire mélange des genres, en demandant que ne soit tenue
pour légitime que la pensée qui aura germé dans un corps où règne le
« silence des organes » : on moralise la pensée en exigeant qu’elle
corresponde à un mode de vie « sain » et à un état « normal ». En
réalité, et selon la logique pragmatiste, ce n’est donc jamais l’origine
d’une pensée qui témoigne pour sa vérité et sa fiabilité, mais seule-
ment les conséquences satisfaisantes auxquelles elle conduit.
Si la pensée n’a pas à rendre compte des conditions qui lui
ont permis de se produire, elle se peuple alors tout à coup de
cerveaux et de systèmes nerveux, de langues et de maladies, de
désirs et d’émotions, mais aussi de molécules. Du phosphore au
protoxyde d’azote en passant par le mescal, James s’est régulière-
ment intoxiqué sans parvenir, pour sa part et par ce biais2 (contraire-
1 Ou comme dit J. Dewey de façon plus générale : « On n’a jamais rien
découvert qui agisse en complète isolation. » DEWEY, 2003 : 68. 2 Il faudrait nuancer cette affirmation car James estime, par exemple, que
l’influence du chloroforme lui permit de mieux saisir les relations de res-
semblance et de différence telles qu’elles se constituent dans l’esprit. Voir la
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
102
ment à son ami Benjamin Paul Blood (1874 : 33)), à des résultats aussi
intéressants que ceux obtenus par le simple épuisement physique de
la marche conduisant à la libération de ressources insoupçonnées (le
« second souffle » (JAMES, 1982a et JAMES, 1982b)), ou obtenus par la
rencontre fortuite et exaltante d’un tremblement de terre dévastateur
(JAMES 1983b). Le traitement de texte par exemple, et peut-être le
café, ont sans doute changé la façon d’écrire et de puiser des idées ou
de fabriquer des conceptions, mais c’est le cas aussi de manières de faire
plus expérimentales encore (du moins en apparence) comme l’écriture
automatique ou la « planchette3 ». Tous ceux qui écrivent convoquent
un monde d’objets d’autant plus insensibles qu’ils sont plus présents
et plus impliqués dans la pensée qui les suppose.
3. Ce qui confronte la pensée
Il n’y a donc pas de pensée sans un monde de choses qui la
permettent et sans lesquelles elle ne serait rien, bien qu’il n’y ait
aucun sens à affirmer qu’elle n’est rien qu’elles. Mais la pensée ne se
produirait pas non plus sans d’autres objets, les objets « front door »,
qui la confrontent. C’est une autre tradition qu’il faut invoquer ici à
l’origine du pragmatisme et qui contribue à faire de celui-ci non pas
une philosophie de l’action, mais plutôt du suspens ou de l’empê-
chement de l’action.
Il ne semble pas exagéré de considérer le pragmatisme
comme une façon de tirer les conséquences de la proposition invitant
à se représenter le mental sur le modèle de l’action réflexe plutôt que
sur un modèle dualiste. On peut sommairement caractériser l’action
réflexe comme consistant à traduire notre expérience selon une tri-
partition fonctionnelle distinguant sensation, conception et action (ce
que James appelle « les trois départements de l’esprit » (JAMES, 2005b :
note 38 de JAMES, 1981 : 501 (ma traduction), où l’on peut lire : « J’ai tendance
à suspecter, sur la base de certaines données, que la philosophie ultime de la
différence et de la ressemblance devra être construite sur des expériences
d’intoxication, particulièrement au protoxyde d’azote, qui nous permet des
intuitions dont la subtilité est refusée à l’état de veille. » 3 Voir par exemple : JAMES, 1981 : 1213. La « planchette » est une sorte de
petit trépied. À l’un des pieds est fixé un crayon, aux deux autres sont fixées
des roulettes. Ce dispositif facilite ainsi l’écriture d’un sujet préalablement
plongé dans un état de transe hypnotique et dont la main repose sur la
planchette. Celle-ci, en obéissant aux moindres sollicitations, permet selon
James aux régions subconscientes du psychisme de s’exprimer plus facilement.
Thierry DRUMM
103
141)). L’enjeu est en effet de taille. On se représente habituellement la
pensée et le monde dans un face à face énigmatique, tout l’enjeu de
l’épistémologie se réduisant alors à distribuer à l’une et à l’autre les
mérites respectifs dans la constitution de la connaissance : dans
quelle mesure celle-ci dépend-elle de l’expérience ? Dans quelle
mesure dépend-elle, au contraire, de la pensée « pure » ?
À l’opposé d’une telle mise en scène, le pragmatisme nous
invite, pour sa part, à réinscrire la conception dans une réalité
sensible et active dont il n’aurait jamais fallu la séparer. La concep-
tion se comprend alors fonctionnellement comme une manière
d’agencer, de mêler, de compliquer, de supposer des objets de telle
sorte que nous puissions agir ou plutôt inventer ce que notre action
pourra être. La conception n’est plus en position de spectatrice par
rapport à une réalité « extérieure » qu’elle contemple, mais elle
apparaît comme un moment intermédiaire en continuité avec l’action
et la sensation. Nous concevons et nous sentons pour agir, en
négociant avec l’expérience la possibilité d’avoir confiance, sans
garantie définitive, en ce qui va se produire. C’est à cette condition et
quand cela marche que nous pouvons considérer notre conception
comme rationnelle : elle a créé un lien qui tient et qui fait tenir notre
action.
Nous sommes donc rationnels seulement pour autant que nous
ne pensons pas. Nous sommes tous rationalistes à chaque fois qu’il ne
s’agit pas de penser, parce que nos conceptions suffisent à nous
permettre d’agir dans la situation qui se présente et en fonction de buts
que nous nous proposons. Le sentiment de rationalité (JAMES, 2005b :
91-129 ; JAMES, 1981 : 253) est le sentiment même de l’absence de pensée,
non pas en réalité parce que nous ne pensons pas, mais parce que
nos moindres gestes sont équipés de croyances qui sont comme des
pensées enveloppées et embarquées par notre conduite qui les justifie
aussi longtemps qu’elle réussit.
Si nous sommes rationalistes à chaque fois que nous sommes
mécaniques (c’est-à-dire dans les trois quart de nos actions4), nous
sommes empiristes pour de bon à chaque fois que défaille notre
sentiment de rationalité, à chaque fois que nous sentons que la situation
exige qu’on y réponde d’une façon moins rapide que d’ordinaire, on
pourrait presque dire : à chaque fois que nous faisons l’épreuve de notre
bêtise. On sait l’intérêt de James pour Walt Whitman, le premier à
4 Selon l’expression de Leibniz (Monadologie, § 28), qui y voit au contraire un
mode d’être « empirique ».
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
104
avoir donné au poète les traits du Répondant (WHITMAN, 1990). On
pourrait dire, en un sens, que c’est non seulement le poète mais plus
encore le penseur en général que le pragmatisme va concevoir sous
ces traits. Le penseur n’est pas alors à comprendre comme celui qui
serait capable de répondre de et à la situation (et qui aurait ainsi
« réponse à tout »), mais comme celui qui se laisse affecter par la
situation telle qu’elle recèle une question exigeant l’invention de ce
qui sera sa réponse. Si la pensée se comprend elle-même comme
réponse, c’est que jamais elle ne correspond (JAMES, 1978a) à l’avance
ou par simple adaptation à ce qui nous confronte et à quoi rien ne
nous prépare tout à fait.
La pensée et la philosophie ne sont donc, en ce sens, pas
elles-mêmes concevables sans rapport aux objets, il n’y a de pensée
qu’en rapport avec des objets, jamais généraux, qui exigent qu’on les
pense, non pas en fonction de notions prédéfinies, mais à condition
de produire les concepts qui sauront, le mieux possible, inventer une
réponse. Il n’y a pas en ce sens de pensée générale ou en soi qui
puisse fournir à l’avance de quoi se saisir de l’objet nouveau qui
nous confronte. De ce point de vue, la philosophie se met alors à
résonner de termes qui n’y ont pas habituellement droit de cité,
comme la prudence ou le tact. Aucun concept, aussi particulières
soient les conséquences auxquelles il conduit, ne sera « jamais tout à
fait » (JAMES, 1978b : 189) le dernier mot de ce qu’il s’agit de penser :
« Que nous ayons l’esprit délicat ou l’esprit endurci, aucun de nous
n’est à la hauteur » (JAMES, 2007b : 105).
Inventer une réponse au lieu de contempler le monde engage
bien la pensée tout entière dans la dimension de l’éthique et de la
politique. C’est la pensée qui dépend de l’action, au lieu de la
traditionnelle soumission de l’action à la réflexion. Mais de là ne
dérive aucune « responsabilité » générale des humains, situant tou-
jours ces derniers en-dehors du monde. Il n’y a pas de responsabilité
infinie ouvrant les humains sur une tragique dignité supérieure, mais
seulement une réponse dont il faut veiller à ce qu’elle ne soit ni trop
rapide ni trop sommaire.
Et l’on s’aperçoit en ce sens qu’il s’est toujours agi pour James
non pas de révéler une vérité générale, mais de penser en rapport à son
époque5, de construire une conception qui puisse répondre aux sollicita-
5 Ainsi par exemple la première leçon du livre de James Le Pragmatisme (1907)
(JAMES, 2007b) porte sur « Le Dilemme de la Philosophie contemporaine », et le
titre original et complet de Philosophie de l’expérience (1909) (JAMES, 2007a) se
Thierry DRUMM
105
tions de son temps, et particulièrement à celles auxquelles rien, dans
notre pensée, ne nous prédispose à répondre. Il faut nous déprendre
du récit construisant une rupture épistémologique, ou un gouffre
infranchissable, entre le sujet connaissant et l’objet connu, comme dans
l’histoire (nullement métaphorique) de Ruskin (s. d. : 421-422) rapportée
par James, selon laquelle c’est finalement le refus de concevoir le rap-
port de nos idées à leurs objets qui permet de maintenir debout les
cloisons de notre pensée :
« Supposez, dit Ruskin, qu’à Londres, pendant un festin où les
jouissances du palais s’allient à la légèreté du cœur, les murailles de
la salle s’abattent soudain et que, pénétrant par la brèche ouverte,
des créatures humaines du voisinage viennent mêler leur famine et
leur misère à la gaieté de l’assemblée ; que tous ces êtres blêmis par
la mort, rendus hideux par le dénuement, anéantis par le désespoir,
envahissent tour à tour les tapis moelleux, et s’approchent chacun
du siège de chaque convive : leur jetterait-on seulement les miettes
du souper ? Leur ferait-on seulement l’aumône passagère d’un
regard ou d’une pensée ? Et pourtant, en dépit des faits, la simple
interposition d’une muraille entre la table de l’un et le lit de
douleur de l’autre ne change rien au rapport réel qui unit chaque
Riche à chaque Lazare – non plus que les quelques pieds de terre
qui constituent au surplus la seule frontière entre le bonheur et la
misère. » (JAMES, 2005b : 69-706)
On pourrait caractériser ce passage comme un effort de dramatisa-
tion, apte à rendre sensibles les enjeux et les conséquences qui accom-
pagnent l’exercice de la pensée. C’est au rationalisme qu’il faut, selon
James, attribuer le projet contraire, celui d’une définition de la
pensée l’isolant de ses conditions et de ses conséquences : une fois
monté en haut du mur, le penseur repousse l’échelle du pied (selon
la formule wittgensteinienne). Mais l’erreur la plus profonde consis-
terait à comprendre la dramatisation de la pensée que propose ici
James (en l’empruntant à Ruskin) comme une métaphore illustrant
un procès d’ordre strictement épistémologique. Il s’agit au contraire,
d’une part, d’accepter de nous exposer concrètement à tout ce qui
proteste contre la façon dont nous pensons. Il s’agit également, d’autre
part, de nous confronter à l’histoire qui a permis que notre pensée se
constitue au prix de la relégation d’un nombre incalculable d’êtres
lit : A Pluralistic Universe. Hibbert Lectures at Manchester College on the Present
Situation in Philosophy. 6 Ce passage est commenté dans STENGERS, 2007 : 156.
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
106
parmi les vaincus. Aussi faut-il penser la guerre aux Philippines, les épi-
démies de lynchage, le rapport à nos morts7.
4. La chose publique
On peut aller plus loin et affirmer que tant qu’on s’en tient à
une distinction entre, d’un côté, les objets qui permettent la pensée
et, de l’autre, ceux qui la confrontent, on en reste, en réalité, à une
première approximation qui n’est que peu satisfaisante (voir DEWEY,
1896), dans la mesure où elle repose encore, au fond, sur un
dualisme qui semble définir des objets soumis en droit à l’inspection
de notre esprit. On a déjà montré que la pensée ne se comprend plus
guère, chez James et parmi ces objets permettants et ces objets confron-
tants, que comme une activité liante, un passage entre ces objets. Ou
plutôt, c’est comme si les objets « back door » n’étaient qu’un autre nom
pour ces relations qui se pratiquent entre les objets. En un mot, la
pensée est avant tout un commerce, non pas avec, mais entre des
objets. On s’aperçoit d’autant mieux que, même dans les Principles of
Psychology où James adopte un dualisme de méthode, il est très peu
question de pensée en soi, même et surtout quand il s’agit de courant
de conscience ou d’« idées », dont James rappelle constamment
qu’on devrait plutôt les appeler des choses ou des objets. On parle en
effet toujours, et depuis les empiristes classiques8, d’association des
idées. Mais d’une part, le terme d’« idée » convient très mal pour
l’expérience à la fois complexe et globale que constitue notre courant
de pensée. Et, d’autre part, si l’on conçoit la pensée comme une
négociation buissonnante entre des objets « front door » et les objets
« back door », alors la pensée disparaît d’une certaine façon elle-même
en tant qu’objet.
Reprenons pas à pas ces différents points. À y regarder de
près, les relations constitutives de la pensée ne sauraient se décrire
7 On pourrait rappeler, à cet égard, la proposition deleuzienne d’après
laquelle si l’on « voit quelque chose qui traverse la vie, mais qui répugne à la
pensée, alors il faut forcer la pensée à le penser, en faire le point d'hallucination
de la pensée, une expérimentation qui fait violence à la pensée. Les empiristes ne
sont pas des théoriciens, ce sont des expérimentateurs : ils n’interprètent jamais,
ils n’ont pas de principes. » DELEUZE, PARNET, 1996 : 69. 8 Voir en particulier : LOCKE, 2001 : Livre II, chap. 33 ; HUME, 1991-1995 :
Livre I « De l’entendement », Première partie, Section IV, et HUME, 2008 :
Section III.
Thierry DRUMM
107
adéquatement, ni du point de vue des causes ni du point de vue des
effets, comme des associations d’idées.
« L’association, pour autant que le mot renvoie à un effet, est entre des
CHOSES PENSÉES – ce sont des CHOSES, et non des idées, qui sont
associées dans l’esprit. Nous devrions parler de l’association des
objets, non de l’association des idées. Et pour autant que l’association
renvoie à une cause, elle a lieu entre des processus dans le cerveau – ce
sont ceux-ci qui, en étant associés de certaines façons, déterminent
quels objets suivants doivent être pensés. » (JAMES, 1981 : 522-523,
ma traduction)
Le terme d’idée laisse supposer l’existence d’entités absolument
simples comme composants ultimes de la pensée et dont on interrogera
toujours le rapport au monde « objectif », quand au contraire notre
expérience se donne immédiatement comme une masse et une nasse,
un complexe de choses hétérogènes mais qui ne sauraient exister
isolément. De ces choses senties qui se mêlent les unes aux autres,
nous ne faisons des objets distincts ou des « choses pensées » que
secondairement et par abstraction. Et quand James se permet d’utiliser,
par facilité, le concept d’idée, il précise alors :
« Je me sers ici de la phraséologie commune pour de pures raisons
de commodité. Le lecteur qui s’est familiarisé avec le Chapitre IX
comprendra toujours, quand il entend parler de nombreuses idées
simultanément présentes à l’esprit et agissant les unes sur les
autres, que ce qu’on entend véritablement c’est un esprit avec une
seule idée devant lui, idée de nombreux objets, projets, raisons,
motifs, reliés les uns aux autres, certains d’une façon harmonieuse et
d’autres d’une façon antagoniste. Avec cet avertissement je n’hésiterai
plus à tomber de temps en temps dans le langage lockéen populaire,
bien que je le considère comme tout à fait erroné. » (JAMES, 1981 : 1136,
ma traduction)
Un soupçon se constitue même alors : la pensée comme entité
séparée n’est-elle pas partie prenante d’une mise en scène dans
laquelle tout est joué d’avance, c’est-à-dire où l’on va s’efforcer soit
de rendre peu à peu à la matière ce qu’on avait réservé à l’esprit, soit
de montrer que l’esprit obéit en fait à la matière ? La pensée « pure »
n’est-elle pas ce que doivent concéder, pour la réduire ou, au
contraire, pour la séparer, ceux qui ont des comptes à rendre à son
sujet pour l’avoir dès le départ admise comme une exception surna-
turelle ?
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
108
Deuxième soupçon : l’« objet » qui nous semble si familier
n’est-il pas le produit très rare et très exquis d’une pratique parti-
culière de mise en scène des choses, pratique coûteuse, patiente et
incertaine visant à obtenir d’elles un témoignage muet quant à tout
ce qui n’intéresse pas l’expérimentateur ? L’objectivité en ce sens ne
se comprendrait pas sans une élaboration délicate des choses visant à
les faire parler d’une façon qui réponde à des intérêts particuliers
(DASTON, GALISON, 2010). Mieux vaudrait alors nous servir du terme
de « chose » pour désigner de façon plus générale cet emmêlement
actif dont témoigne l’expérience : la chose, c’est ce qui cause ou ce
qui agit, tandis que l’objet ne se comprend pas sans un sujet auquel
nous ne croyons plus tout à fait…
Ce sont ces considérations dont on peut supposer qu’elles
auront conduit James à proposer, dans ses recherches proprement
métaphysiques et sous le nom d’empirisme radical, une nouvelle
philosophie de l’expérience. Dans celle-ci, les « objets » ou plutôt les
« choses », ou plus simplement les expériences, ne sont plus ni des
substances étrangères à un esprit qui les contemple, ni des impres-
sions mentales. Les expériences sont simplement ce qu’elles sont… ni
mentales ni physiques. Les choses acquièrent, dans ces conditions,
une vie beaucoup plus intense, car les relations qui les parcourent et
dont elles ne sont pas dissociables ne renvoient plus alors ni aux
formes transcendantales d’un esprit ni aux lois d’une nature, mais
sont elles-mêmes des fragments de l’expérience.
C’est ainsi cette volonté de se confronter à la philosophie de
son temps comme à une chose qui avait fini par produire ses propres
conséquences insatisfaisantes et même désastreuses pour certains9,
qui aboutit donc à la formulation d’une nouvelle métaphysique dans
laquelle les choses ne sont plus les projections privées d’une réalité
inconnaissable mais des expériences se déployant au grand air.
« Et, quoi que l’on veuille penser de la vie absente, cachée, et pour
ainsi dire privée, des choses, et quelles que soient les constructions
hypothétiques qu’on en fasse, il reste vrai que la vie publique des
choses, cette actualité présente par laquelle elles nous confrontent,
d’où dérivent toutes nos constructions théoriques, et à laquelle elles
doivent toutes revenir et se rattacher sous peine de flotter dans l’air
et dans l’irréel ; cette actualité, dis-je, est homogène, et non pas
9 Comme James lui-même, dont la grave dépression qu’il connut au début de
sa vie peut, sans aucun doute, être rattachée à l’influence de cette chose
étrange : une théorie philosophique, en l’occurrence déterministe.
Thierry DRUMM
109
seulement homogène, mais numériquement une, avec une certaine
partie de notre vie intérieure. » (JAMES, 2005a : 162)
Rien ne nous contraint à attribuer aux choses une existence privée tant
que nous ne condamnons pas notre propre pensée à vivre recluse entre
les parois d’un crâne. Ce n’est pas le moindre coup de génie du sens
commun, que d’admettre la publicité de toutes ces choses qui agitent
notre pensée. D’ailleurs plus que d’« existence », il faut parler de
« vie » publique, les choses devenant dès maintenant les principaux
personnages de nos biographies.
5. La chose politique
Les choses sont rendues à leur vie publique, et deux esprits
peuvent ainsi connaître la même chose10, car ils n’en seraient empê-
chés que si nous commettions encore l’erreur de distinguer l’esprit et
son objet, comme s’il s’agissait de deux choses… Mais si les choses
sont rendues à leur vie publique, nous sommes alors conduits à
affronter des questions plus politiques11.
On trouvera dans les Principles of Psychology, bien avant que
James ne développe sa métaphysique et dans le cadre même du
dualisme méthodologique qu’il maintient alors (donc dans un cadre
où la distinction méthodologique sujet/objet est provisoirement
maintenue), toute une série de remarques visant à « périphériser » la
conscience, à l’immerger, à nouveau, dans les choses, au lieu de l’en
séparer par le fossé à jamais infranchissable de la référence objective.
La tâche n’est pas mince car après la critique kantienne il s’agit de
redonner à notre expérience non seulement un corps mais même un
monde, un monde spatial, temporel et rempli d’objets. La « périphé-
risation » de la conscience que James met en place dans les Principles
of Psychology sera certes poussée à une puissance supérieure dans les
écrits métaphysiques. Mais dans la mesure où cette opération de
périphérisation peut être rattachée à la même ligne théorique, il
semble utile de revenir à certains développements présents dans les
Principles of Psychology. Ces développements, s’ils n’apparaîtront plus
10 Cf. JAMES, 2005a, essai 4 : « Comment deux esprits peuvent connaître une
même chose. » 11 Bruno Latour a plaidé pour que nous prenions au sérieux l’expression « Res-
publica ». Voir notamment LATOUR, 2005. On lit également dans LATOUR, 2004 :
88, à propos de « République » : « Ce mot vénérable convient admirablement si
l’on accepte de faire résonner plus fortement le mot res, le mot chose. »
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
110
par la suite, semblent rester tout à fait pertinents dans le cadre de la
cohérence supérieure produite par la construction de l’empirisme
radical. Il importe donc dans ce qui suit de ne pas oublier de trans-
poser aux choses ce que James dit des objets, de façon à obtenir une
version moins « thématique12 », c’est-à-dire un schème métaphysique
plus général pour une politique susceptible de n’accueillir rien que
l’expérience, mais toute l’expérience (JAMES, 2005a : 58).
On pourrait appeler « périphérisation » l’ensemble des cons-
tructions théoriques par lesquelles James rattache des modes d’expé-
riences traditionnellement conçus comme « mentaux » à des parties de
notre expérience traditionnellement conçues comme « physiques ».
C’est ainsi en fonction d’une telle opération théorique que James va
renégocier la signification de ce qu’on entend d’ordinaire par amour
de soi et même par conscience de soi.
La conscience de soi est habituellement rattachée à une entité
purement mentale, qui serait au fondement de notre expérience13. La
proposition jamesienne se caractérise au contraire par un renverse-
ment direct de la mise en scène :
« Notre premier, plus instinctif et moins développé type de
conscience est le type objectif ; et c’est seulement à mesure que la
réflexion se développe que nous devenons conscients d’un monde
intérieur. […] [l]a conscience subjective, se connaissant elle-même
comme subjective, n’existe d’abord pas. » (JAMES, 1981 : 679, ma
traduction)
Sans doute Descartes, en posant le sujet comme premier, ne se situe-
t-il pas au niveau de la conscience psychologique, il n’en demeure
pas moins que nous disposons là de toutes les conditions pour un
renversement de perspective si nous acceptons que nos conceptions
soient mises à l’épreuve par la proposition de l’empirisme radical
selon laquelle les expériences sont au moins ce qu’elles paraissent
être. Mais en quel sens cette conscience se développe-t-elle en plus ?
Au fond seulement au sens où la familiarité et la chaleur de certains
objets au sein de notre expérience nous habituent à leur compagnie.
Mon corps se caractérise par un certain nombre de sensations qui
sont presque toujours là, mais même la chaise sur laquelle j’étais
12 Sur le « thème » (par opposition à la version) comme absorption des mondes
des autres dans un idiome dont la valeur est tenue pour universelle, voir
DESPRET, 2001 : 327. 13 On peut attribuer à Descartes la conception d’une telle mise en scène.
Thierry DRUMM
111
assis garde un peu de ma chaleur. Mes habits, mes habitats, mes
habitudes (habeo : j’ai), mais aussi mes amis, mes souvenirs, tout cela
c’est un peu moi. Moi, c’est tout ce que je peux, à des degrés divers,
considérer comme mien, mais ce que je peux considérer comme mien,
ce sont toujours des objets (ou plutôt des choses).
Aussi la conscience de soi ne devrait-elle jamais être définie
comme la perception d’une entité purement mentale, mais seulement
en fonction de certains objets que je tiens pour miens. C’est un
ressaisissement de tout instant qui est nécessaire pour continuer à
peu près d’être soi. Ressaisissement dans lequel les objets sont pour
tout, tant c’est la seule chaleur de leur vieille camaraderie qui les
rappelle à nous : ce bon vieux pull, cette bonne vieille jambe. Même
et surtout les troubles de la personnalité devraient être envisagés de
cette façon, et s’il n’est pas rare que certains d’entre nous, appelés
amnésiques, se contentent d’oublier leur pull, d’autres, qu’on appelle
hystériques, oublient parfois leur jambe14.
Si la conscience de soi se rapporte concrètement à certains objets
considérés comme miens, alors l’amour de soi est en réalité une réaction
émotionnelle particulièrement chaleureuse vis-à-vis de ces objets.
« Ainsi les mots MOI et SOI, pour autant qu’ils éveillent un sentiment et
connotent une valeur émotionnelle, sont des désignations OBJECTIVES,
signifiant TOUTES LES CHOSES qui ont le pouvoir de produire, dans
un courant de conscience, une excitation d’une certaine sorte particulière. »
(JAMES, 1981 : 304, ma traduction)
D’un point de vue pragmatiste ce sont toujours les conséquences
d’une idée qui donnent la mesure de sa signification et de sa vérité.
Or, on peut tirer de cette nouvelle caractérisation de l’amour de soi
des conséquences politiques de première importance, dont il s’agit
d’évaluer la portée. On pourrait résumer ces conséquences de la façon
14 « [...] je pense que nous ne devrions pas parler du dédoublement du soi
comme s’il consistait dans l’échec à se combiner de la part de certains
systèmes d’idées qui le font habituellement. Il vaut mieux parler d’objets
habituellement combinés, et qui sont maintenant divisés entre les deux
« soi », dans les cas hystériques et automatiques en question. Chacun des soi
est dû à un système de voies cérébrales agissant par lui-même. Si le cerveau
agissait normalement et que les systèmes dissociés vinssent à se réunir à
nouveau, nous obtiendrions pour résultat une nouvelle affection de
conscience sous la forme d’un troisième « Soi » différent des deux autres,
mais connaissant leurs objets conjointement. » (JAMES, 1981 : 377-378, ma
traduction.)
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
112
suivante : tant que l’amour de soi était considéré, dans une perspective
dualiste, comme l’amour pour un principe différant en nature des objets
et définissant l’individu comme un sujet, alors la composition des
sociétés pouvait être rapportée à une théorie du contrat dans laquelle
des sujets de droits conviennent de limiter leurs égoïsmes. Le contrat est
alors dit « social », mais au sens où il se conclut entre des sujets étran-
gers au monde.
Ce sont ces conditions toutes entières dans lesquelles est pensée
l’opération politique qui paraissent pourtant dramatiquement abstraites,
et d’une abstraction qui n’est pas sans conséquences, lorsqu’elle autorise
à s’entendre en général, et derrière un « voile d’ignorance », sur ce
qu’on aura ensuite perdu les moyens d’entendre en particulier. Mais
si la conscience de soi et même l’amour de soi se rapportent à des
objets et seulement de façon dérivée à des sujets, alors une telle
opération n’est plus possible et le contrat fait place à des affaires qui
ne supposent plus du tout de limiter l’égoïsme de purs « sujets »,
mais de manipuler et d’agencer autrement nos objets.
Il n’est en ce sens plus envisageable de constituer de façon
satisfaisante une vie collective sans impliquer constamment les reven-
dications nouvelles. Mais ces revendications à leur tour ne corres-
pondent d’aucune façon à de purs surgissements subjectifs (d’où
viendraient-ils ?), mais traduisent plutôt la fabrication (du moins
faisons-en le pari) de relations nouvelles aux choses, inventant ce
que nous sommes. « De quoi je me mêle » ne s’adresse plus à celui
ou celle qui fait preuve d’une indiscrétion toute intellectuelle, mais
renvoie à l’exploration constitutive d’un tissu social constamment
rapiécé. Une telle proposition philosophique invite ainsi à de
nouvelles pratiques politiques écologiques où les objets sont parties
prenantes de nos conventions, non pas au sens où il faudrait tenir
compte d’eux, mais radicalement au sens où nous ne sommes rien
sans ces objets qui nous intéressent15.
En transposant pour finir ces résultats en fonction du modèle
plus cohérent que fournit l’empirisme radical et en rapport aux exi-
gences qu’ils visent à satisfaire, on pourrait s’exprimer ainsi : il est
temps de rendre aux choses non seulement la vie publique mais également la
politique confisquée par les sujets16.
15 « S’il ne fallait avoir qu’un terme unique pour désigner la condition dont
dépend la qualité impulsive ou inhibitrice des objets, on devrait l’appeler
leur intérêt. » (JAMES, 1981 : 1164, ma traduction.) 16 On ne saurait conclure cet article sans évoquer une dernière fois le travail
de B. Latour qui, en réclamant un « parlement des choses » (LATOUR, 1997 :
Thierry DRUMM
113
Bibliographie
BLOOD B. P., 1874, The Anaesthetic Revelation and The Gist of Philo-
sophy, Amsterdam (NY), 1874.
BURKHARDT F. H., BOWERS F. et SKRUPSKELIS I. (éd.), 1975-1988, The
Works of William James, 17 vol., Cambridge : Massachusetts and London,
England, Harvard University Press (en l’absence de traductions
françaises récentes, les références à W. James renvoient à cette
édition).
DASTON L. (éd.), 2008 [2004], Things That Talk, New York : Zone
Books.
DASTON L., GALISON P., 2010, Objectivity, New York : Zone Books.
DELEUZE G., PARNET C., 1996, Dialogues, Paris : Flammarion.
DESPRET V., 2001, Ces émotions qui nous fabriquent. Ethnopsychologie de
l’authenticité, Paris : Les Empêcheurs de penser en rond – Le Seuil.
DEWEY J., 1896, « The Reflex Arc Concept in Psychology », The Psycho-
logical Review, vol. III, n° 4, p. 357-370.
DEWEY J., 2003 [1927], Le public et ses problèmes, trad. J. Zask,
Publications de l’Université de Pau, Tours, Farrago, Paris : Éd. Léo
Scheer.
HOUDART S., THIERY O., 2011, Humains, non-humains – Comment repeu-
pler les sciences sociales, Paris : La Découverte.
HUME D., 1991-1995 [1739-1740], Traité de la nature humaine, trad.
Ph. Saltel, Ph. Baranger, J.-P. Cléro, Paris : Flammarion, coll. « GF ».
HUME D., 2008 [1748], Enquête sur l’entendement humain, introduc-
tion, trad. et notes par M. Malherbe, Paris : Vrin, coll. « Biblio-
thèque des textes philosophiques ».
JAMES W., 1978a, « Remarks on Spencer’s Definition of Mind as Corres-
pondence » (1878), dans The Works of William James : Essays in Philosophy,
p. 7-22.
JAMES W., 1978b, « A Pluralistic Mystic » (1910), dans The Works of William
James : Essays in Philosophy, p. 172-190.
JAMES W., 1981 [1890], The Works of William James : The Principles of
Psychology.
JAMES W., 1982a, « The Energies of Men » (1907), dans The Works of
William James : Essays in Religion and Morality, p. 129-146.
JAMES W., 1982b, « The Powers of Men » (1907), dans The Works of William
James : Essays in Religion and Morality, p. 147-161.
JAMES W., 1983a, « Consciousness Under Nitrous Oxide » (1898),
dans The Works of William James : Essays in Psychology, p. 322-324.
194-197) et en faisant appel aux « collectifs d’humains et de non-humains »
(LATOUR, 2004 : 98), donne une nouvelle importance au pragmatisme.
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
114
JAMES W., 1983b, « On Some Mental Effects of the Earthquake »
(1906), dans The Works of William James : Essays in Psychology, p. 331-
338.
JAMES W., 1985 [1902], The Works of William James : The Varieties of
Religious Experience.
JAMES W., 1998, La signification de la vérité, Lausanne : Antipodes.
JAMES W., 2005a, Essais d’empirisme radical, Marseille : Agone.
JAMES W., 2005b, La Volonté de croire, Paris : Les Empêcheurs de
penser en rond – Le Seuil.
JAMES W., 2007a, Philosophie de l’expérience. Un univers pluraliste,
Paris : Les Empêcheurs de penser en rond – Le Seuil.
JAMES W., 2007b, Le Pragmatisme, Paris : Flammarion.
LATOUR B., 1997, Nous n’avons jamais été modernes. Essai d’anthro-
pologie symétrique, Paris : La Découverte & Syros.
LATOUR B., 2004, Politiques de la nature. Comment faire entrer les
sciences en démocratie, Paris : La Découverte.
LATOUR B., 2005, « From Realpolitik to Dingpolitik – or How to Make
Things Public », dans B. LATOUR et P. WEIBEL (éd.), Making Things
Public– Atmospheres of Democracy, Cambridge (Mass.) : MIT Press.
LOCKE J., 2001 [1689], Essai sur l’entendement humain, trad. J.-M. Vienne,
Paris : Vrin, coll. « Bibliothèque des textes philosophiques ».
RUSKIN J., s. d., Proserpina ; Ariadne Florentina ; The Opening of the Crystal
Palace, Boston : Dana Estes & Company.
STENGERS I., 2007, « William James : une éthique de la pensée », dans
D. DEBAISE (éd.), Vie et expérimentation – Peirce, James, Dewey, Paris :
Vrin, coll. « Annales de l’Institut de Philosophie et de Sciences
Morales » (Université Libre de Bruxelles), p. 147-174.
WHITMAN W., 1990, « Song of the Answerer », dans Leaves of Grass,
London : Penguin Books, p. 129-132.
115
Augustin DUMONT
L’objet par l’image selon Fichte.
La constitution génétique de l’objectivité
dans la Wissenschaftslehre de 1813
As he was choosing which of these things to make it, still
working his fingers in the water, they curled round something
hard – a full drop of solid matter – and gradually dislodged a
large irregular lump, and brought it to the surface.
Virginia Woolf (2003 : 97)
Introduction1
Depuis de nombreuses années, la recherche fichtéenne inter-
nationale s’attache à réévaluer l’ensemble de la philosophie de
Johann Gottlieb Fichte (1762-1814). Elle porte son attention aussi bien
sur la philosophie fondamentale, spéculative et abstraite – les nom-
breuses réécritures de la Wissenschaftslehre ou Doctrine de la science –
que sur les applications pratiques de celle-ci – doctrines de l’État, du
droit, de l’éthique, etc. – ou encore sur ce que l’on nomme la philo-
sophie populaire, c’est-à-dire une série de textes adressés au grand
public (La Destination de l’homme, l’Initiation à la vie bienheureuse, etc.),
dont la grande qualité littéraire s’allie à un niveau conceptuel souvent
élevé.
Qu’a-t-il fallu « réévaluer » ? Il serait fastidieux d’énumérer
chacune des découvertes, ou chacun des tournants opérés par la
recherche fichtéenne depuis un bon demi-siècle. En outre, un tel
inventaire n’a guère sa place dans ce numéro interdisciplinaire
consacré à la problématique de « l’objet ». Contentons-nous donc,
pour faire court tout en liant le problème de la réception au thème
qui nous intéresse, d’évoquer ou de rappeler le désir, partagé par de
nombreux chercheurs tant en France qu’en Allemagne, en Belgique
1 Nous remercions chaleureusement Alessandro Bertinetto et Quentin Landenne
pour leur amicale compagnie fichtéenne et leurs précieux conseils.
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
116
ou dans le monde anglophone, d’extraire Fichte aussi bien des griffes
de Hegel que de celles de Kant. Longtemps relu à partir de la pensée
hégélienne, le « Titan d’Iéna » a été présenté à de multiples reprises,
et jusqu’après-guerre, comme le parangon de l’« idéalisme subjec-
tif », justement incapable d’accorder à l’« objet » une quelconque
valeur réelle. Fichte se serait contenté de percevoir dans l’objet le
négatif photographique d’une subjectivité toute-puissante, maître de
ses représentations, et en fin de compte acosmique. À cette compréhen-
sion unilatérale du premier des grands idéalistes allemands, Alexis
Philonenko et son école ont opposé, dans les années 1960, une lecture
radicalement kantienne de la Wissenschaftslehre. Réinscrivant Fichte
dans son projet d’accomplir la philosophie transcendantale de Kant,
dont il fut le disciple, cette interprétation assigne le fameux « moi
absolu » de la Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre (1794) à une
position de modestie, puisqu’il devait s’agir, avec ce concept, de renou-
veler la téléologie de l’Idée kantienne, celle d’une Idée seulement
régulatrice et guère constitutive. Cela signifie que, faute de pouvoir
fonder une connaissance objective, elle se contente d’indiquer l’horizon
d’un objet à réaliser. Ce dernier reçoit, dans ce cadre, le statut d’un
matériau pour la liberté humaine en tant qu’elle s’élabore à travers
de multiples réalisations pratiques, dont le droit est le pivot quasi
exclusif.
Aucune des deux lectures ne résiste à l’épreuve du texte. On l’a
certes abondamment souligné, celui-ci est d’une abstraction redoutable,
et d’une complexité assez inouïe dans la pensée moderne pour
brouiller les pistes de façon considérable, jusqu’à rendre périlleuse
toute investigation sur sa nature propre. Il l’est toutefois dans
l’exacte mesure où l’acte d’écrire, puissamment réinvesti par Fichte,
engage à reconsidérer de fond en comble l’acte même de philoso-
pher. Car la Wissenschaftslehre n’exige pas d’être « lue » : elle exige
d’être « effectuée », et pour ainsi dire « générée » dans la réflexion de
celui qui s’adonne à son étude. Passant outre, chacune à sa façon,
cette dimension de performance dans leur compréhension de la
Wissenschaftslehre, les lectures hégélienne et kantienne (au sens de la
lecture de Philonenko du moins, car dans un autre contexte inter-
prétatif, il est légitime d’évoquer le « kantisme » de Fichte) permet-
tent néanmoins, par leur caractère contradictoire, de dire aussi bien
la portée que l’ambivalence du concept fichtéen. En effet, celui-ci se
rattache aux ambitions colossales de l’idéalisme spéculatif tout en
voulant demeurer fidèle à la « métrique » du penser transcendantal,
Augustin DUMONT
117
soucieux de scander une à une les conditions de possibilité a priori de
l’expérience.
À partir d’une lecture du dernier Fichte, nous interrogerons
dans les pages qui vont suivre ce que le philosophe cherche à
comprendre dans l’« objet ». Parce que nous nous tenons explicitement
à distance des deux compréhensions de la Wissenschaftslehre évoquées,
il nous faudra tout d’abord revenir sur la dimension d’effectuation ou
de génération mentionnée à l’instant, au moyen d’une recontex-
tualisation succincte de la méthodologie de Fichte. Dans cette carac-
térisation, et suivant une stratégie interprétative désormais courante,
nous rendrons continues la philosophie d’Iéna (1794-1799) et celle de
la maturité (1804-1814) – du moins nous montrerons en quoi la
seconde peut s’entendre comme l’approfondissement de la première.
La Bildlehre, ou doctrine de l’image, qui se déploie dans les dernières
versions de la Wissenschaftslehre trouve son apogée dans les exposés
de 1812 et 1813. En nous penchant plus particulièrement sur l’un ou
l’autre passage-clé de cette dernière version, non encore traduite en
français bien que riche d’une magistrale compréhension de l’image
(interrompue par la reprise de la guerre prussienne contre la France),
et constituant l’avant-dernière reformulation du contenu spéculatif
de la Wissenschaftslehre, nous tenterons d’intégrer fermement la
conception fichtéenne de l’objet dans une pensée plus large de
l’image, en soulignant l’intérêt et la fécondité de cette entreprise.
Soucieux de nous inscrire dans la démarche collective et trans-
disciplinaire de ce numéro thématique, nous ne proposerons aucun
développement systématique du texte de 1813, et nous laisserons de
côté toute enquête comparative avec les autres exposés, pour ne
retenir que l’un ou l’autre résultat du travail de Fichte permettant de
renouveler notre réflexion sur l’« objet » et de rendre possible un
dialogue à son propos.
1. Contextualisation
Qu’est-ce qu’« effectuer » la Wissenschaftslehre ? Le point de
départ de cet agir philosophant réside dans l’« intuition intellec-
tuelle ». Une telle intuition vise à saisir l’identité sujet-objective qui
porte et soutient tout acte de la conscience. La saisie de l’identité est
un acte, l’acte par lequel l’agir pur, l’activité (Tätigkeit) originaire de
la conscience, se réfléchit elle-même. Il en va ainsi d’une saisie par
l’activité de sa propre auto-activité. Il ne s’agit évidemment pas de
recourir à l’intellectus archetypus rejeté avec fermeté par la Critique
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
118
kantienne, comme s’il pouvait y avoir une subjectivité capable, en se
passant de toute médiation sensible, de produire pour ainsi dire
« démiurgiquement » les objets mondains. Bien plutôt, il s’agit pour
Fichte d’opérer une simple réflexion, afin de lever le soupçon
d’empirisme qui pèse sur la doctrine kantienne elle-même, dans la
mesure où cette dernière présuppose l’existence de jugements de
connaissance (jugements synthétiques et analytiques) au départ de sa
recherche, ceux-ci engageant ipso facto l’existence en bonne et due
forme d’objets de ces propositions. De tels objets se voient à la fois
sommés de correspondre aux formes a priori de notre sensibilité pour
pouvoir faire l’objet d’une connaissance, et contraints d’excéder ces
formes, bien que ces dernières soient la seule et unique condition de
donation de l’objet.
De quelle façon la plus dépouillée des réflexions, celle-là
même qu’exige Fichte de son disciple, peut-elle remédier à ce
problème ? Refusant de reconduire la scission moderne du sujet et de
l’objet, le philosophe accuse la Critique de consacrer une telle
partition ou dichotomie, en ramassant toutes ses variations dans le
concept de « représentation (Vorstellung) ». Réfléchir, en contexte
strictement kantien, sur la condition de possibilité du rapport à
l’objet, cela reviendrait à présupposer l’être-évident de l’objet et à
reconduire, sans jamais mettre en doute son bien-fondé, le sujet qui
lui fait face. Au lieu même où Kant déploie la découverte majeure de
toute la modernité, selon Fichte, à savoir le transcendantal, il n’en
redonne pas moins – tout en tâchant de la déconstruire implicitement
– une nouvelle légitimité à l’opposition de la « pensée » et de l’« être »,
ou du « sujet » et de l’« objet ».
Aussi n’y a-t-il guère de sujet, chez Fichte, pas plus qu’il n’y a
d’objet, au commencement de tout acte philosophique. Au commence-
ment, il n’y a rien d’autre que l’acte de commencer, précisément, c’est-à-
dire l’acte de se réfléchir comme acte de commencer, ou encore l’acte
de réfléchir en tant que cette réflexion porte sur la réflexion qu’elle
est. L’aridité d’une telle démarche suffit à décourager les plus
téméraires des contemporains de Fichte. Qu’obtenons-nous donc de
si effrayant en réfléchissant ainsi ? En réalité, nous découvrons
seulement que toute scission entre le réfléchissant et le réfléchi, non
seulement présuppose l’identité de l’un et l’autre, mais encore la
produit nécessairement. En réfléchissant sur le réfléchissant, celui-ci
est réfléchi (objet) dans l’exacte mesure et à l’instant même où il est
réfléchissant (sujet). Sujet et objet, ici, ne sont ni des « étants » ni des
Augustin DUMONT
119
« substances » – ils sont sujet et objet d’un acte fondamentalement
« un » : la réflexivité.
Soyons plus précis. Sujet et objet se présentent en réalité
comme les pôles subjectif et objectif d’une activité pure, sujet-
objective, échappant à la représentation dans l’instant même où la
réflexion la convoque et la fait advenir à la conscience comme
représentation. En toute logique, une telle activité originaire n’est rien
d’autre que la pure et absolue réflexivité de l’agir, à entendre, non
comme le retour fatigué et surplombant d’une conscience sur elle-
même – qui se contemplerait comme un « objet » parmi d’autres –,
mais comme autoposition absolue, pouvoir irréductible et incondi-
tionné de se poser comme posé par soi, pouvoir de revenir en soi en
deçà de toute objectivation et de toute représentation, pure et simple
mobilité, absolue vitalité se soutenant d’elle-même dans sa génération
de soi. Cette réalité est condensée en 1794 dans la proposition fameuse :
« moi = moi ». Il faut être attentif sur ce point : le moi (Ich) n’est pas le
sujet (Subjekt). Bien qu’il ait sous la main les concepts classiques de la
modernité, Fichte n’y recourt pas. Du moins, il les internalise dans le
processus de la réflexion. Le moi ne contemple pas la force (Kraft) –
concept synonyme de l’agir –, il est purement et simplement auto-
production de la force de se poser comme posé par soi. Une telle
autoposition de la force est absolument constitutive, car sans elle la
sensation pas plus que la perception ou l’État de droit ne sont
possibles – et cela ne contredit nullement le caractère téléologique
(l’Idée au sens de Kant) qui lui est simultanément associé. À bon
droit, puisque la découverte de l’activité infinie est et ne peut-être
que le fait d’une conscience finie tendue vers l’infini d’un accomplis-
sement.
Faut-il dire, à la suite de Heidegger (Kantbuch), que ce post-
kantisme fait retour – après la tentative avortée d’en sortir (première
édition de la Critique de la raison pure) – vers une forme d’ontothéologie
classique ? C’est certainement une facilité dont il faut se dispenser. Non
seulement le moi absolu, également appelé l’« absolu » ou « Dieu » dans
les dernières périodes, ne s’apparente ni de près ni de loin à une forme
d’étant suprême, s’agissant uniquement de l’infinie réflexivité. Mais
en outre il est le fruit du plus rigoureux raisonnement exigé par toute
philosophie radicalement transcendantale digne de ce nom. Toute
position finie s’appuie, supporte et produit simultanément une réflexi-
vité irréductible à cette position, par conséquent infinie. Et ce, de telle
sorte qu’aux yeux de Fichte, Kant présuppose partout cette incondi-
tionnalité comme effectivement constitutive – la doctrine de l’aperception
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
120
transcendantale, dans la Critique de la raison pure, s’approchant du
reste au plus près de la découverte de Fichte1. Dieu, comme y insiste
à juste titre Christoph Asmuth (2007 : 49), est le nom de l’immanence
pure, d’une activité assurément irrécupérable dans la représentation,
mais condition de celle-ci, et qui, loin de « venir par le haut »,
s’avère, au contraire, seulement exister dans la performance autonome
de l’identité. En pensant, en disant, en effectuant le « moi = moi », ou
encore le « je suis », le philosophe fait lui-même advenir, en la
conditionnant, l’identité inconditionnée. En effet, ce qui se réalise (ce
qui s’atteste et s’invente tout à la fois) au moment de la performance,
c’est, d’une part, l’effectivité de l’agir pur, de l’absolu ou d’un « champ »
sujet-objectif, c’est-à-dire aussi bien an-objectif et a-subjectif (pour le dire
dans les termes de Jean-Christophe Goddard dont les travaux souli-
gnent avec force cette dimension, cf. GODDARD, 1999), d’autre part, la
scission de l’activité en activité posante et en activité posée à
l’intérieur de ce champ, à l’intérieur de l’activité autoposante / auto-
posée « une ».
Il est donc faux de déplorer l’absence d’un monde dans la
pensée fichtéenne, ou bien la pauvreté de l’« objet ». Soutenir cette
thèse, c’est ne pas voir qu’en contexte transcendantal la pensée doit
faire l’objet, littéralement. Il ne s’agit pas d’exiger de cette pensée
qu’elle fasse sortir la table et la chaise de l’« esprit », par un coup de
baguette magique : l’objectivité doit seulement faire l’objet d’une
rigoureuse déduction génétique à partir de l’autoréflexion et à travers
elle continuellement. C’est-à-dire que le philosophe doit voir, sous
ses propres yeux, chaque condition de possibilité de la conscience de
soi engendrer une nouvelle condition de possibilité de celle-ci, et ce
parce qu’il les produit lui-même en prenant conscience de soi
réflexivement.
Le philosophe fichtéen ne peut jamais, durant le temps qu’il
philosophe, partir du principe que les objets en soi sont là,
disponibles pour la connaissance. L’objet est toujours l’objet d’un acte
de se réfléchir comme opposition à soi, interne à l’autoposition
originaire. En disant « je suis », en effet, le philosophe découvre la
finitude de sa propre performance – contemporaine de l’autoposition
absolue – et la nécessité d’une opposition. Affirmer la coïncidence de
l’agissant et de l’agi revient à performer leur différence. De sorte que
le non-moi (Nicht-Ich) n’est pas davantage l’« étant extérieur », du
1 Doctrine essentielle pour Fichte, jusqu’aux derniers exposés. Cf. sur ce
point BONDELI, 2006.
Augustin DUMONT
121
moins en un sens rudimentaire, que le moi n’équivalait tout à l’heure
au « sujet ». En se génétisant de réflexion en réflexion, la pensée en
vient à caractériser de plus en plus précisément l’objet, à le comprendre
comme acte d’opposition du moi et du non-moi – quantitativement
« divisibles » – dans l’autoposition du moi, jusqu’à ce que soit déduite
la nécessité, pour le moi, de considérer le corrélat de son acte d’oppo-
sition comme quelque chose d’extérieur à soi, existant par soi, et
enfin comme nature. L’objet est ainsi un concept dont la densité va
croissant, au fil des développements : sa genèse suppose la déduction
de toutes les strates de l’affectivité, de la tendance (Tendenz) au sentiment
(Gefühl) en passant par la pulsion (Trieb) jusqu’au travail en tout point
central de l’imagination (Einbildungskraft).
2. L’image
Foyer de la vie sensible, l’imagination est la faculté qui
permet à la sujet-objectivité infinie de se sensibiliser, autrement dit
d’apparaître (erscheinen), c’est-à-dire encore de revêtir la forme
sensible finie de l’image (Bild). Sans qu’il soit ici possible de préciser
chaque étape d’un parcours complexe, au reste (très) diversement
exposé selon les versions de la philosophie spéculative de Fichte,
précisons que l’imagination assigne à l’absolu un espace et une
temporalité, et condense l’agir originaire en une série infinie de points,
de produits finis : les images sensibles.
En réalité, le moi, le savoir ou la conscience (autant de
synonymes), ne sont rien d’autre que cette activité de mise en image,
pouvoir pratique d’investir la vie sensible et d’œuvrer à la transfor-
mation du monde, le monde de l’apparaître. Le moi, qui ne peut se
réaliser comme agir imaginant qu’en étant sollicité par l’imagination
productrice d’autrui, s’advient à lui-même en tant que Verbe, c’est-à-
dire génération performatrice d’effets dans et par l’image. Le moi
philosophant le sait depuis qu’il a performé le « je suis » : de la
sensation à la vision, le moi est performant, et il l’est parce qu’il est
imaginant. Chaque acte de l’imagination suppose en effet une
création de nouveauté et une perturbation de l’ancienne configu-
ration de l’agir. Cela n’est toutefois possible que dans la mesure où
l’imagination se réfléchit elle-même et s’apparaît comme mise en
image autonome de l’être.
L’investissement du concept de l’être, après la Querelle de
l’athéisme – le philosophe, accusé de promouvoir une doctrine athée
et complaisante à l’égard de la Révolution française, démissionne de
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
122
l’Université d’Iéna en 1799 –, loin de signifier un retour de l’onto-
logie, confirme les premiers développements de Fichte : l’être (qui
n’est évidemment pas la chose en soi) existe en tant qu’être à travers
son apparition dans l’image. Simultanément, celle-ci s’auto-apparaît
comme rien qu’image de l’être, c’est-à-dire rien, puisque seul l’être
est, l’être étant tout ce qui est – tout ce qui est acte d’être.
Le style heurtant, voire chaotique, de nombreux textes
tardifs, et particulièrement de la Wissenschaftslehre de 1813 est dû au
fait qu’il s’agit de notes de cours, à la fois incomplètes et incroyable-
ment condensées. Mais il est aussi l’acte de la pensée en train de se
faire, le mouvement de la réflexion en marche. De sorte que le
« heurtant » est aussi et surtout « percutant », comme cet avertis-
sement issu de la première heure de cours de l’exposé de 1813 : « WL
[= Wissenschaftslehre], et non Seynslehre » (FICHTE, 2009 : 1322). Il n’y a
pas de doctrine de l’être possible, il n’y a qu’une doctrine du savoir
de l’être comme imagination réflexive de l’être. Par conséquent, il est
erroné de penser que l’objet serait secondaire chez Fichte dans la mesure
où l’ontologie l’est : il faut bien plutôt dire que l’objet intéresse seule-
ment l’image, le savoir ou la conscience de l’être – l’équation « être =
objet » est disqualifiée.
De fait, la science spéculative se présente depuis 1804 et
jusqu’à la mort de Fichte, comme une doctrine de l’image ou du
phénomène pur. Ce dernier ne fait l’objet d’aucune description : il est
purement et simplement déduit. Cette Lehre se déploie de façon
magistrale, tout d’abord à travers une aléthologie – une science de la
vérité, de la vérité du phénomène – et ensuite à travers la phénoméno-
logie proprement dite, science de l’apparition en tant que pure et
simple apparition de l’être comme images et perspectives. La phénomé-
nologie, autrement dit, doit s’entendre comme négation infiniment
diverse de l’être, ou comme néant3. Son déploiement conduit progressi-
vement (après 1804) l’Erscheinungslehre à absorber toute l’aléthologie.
La Wissenschaftslehre propose un savoir pur, le savoir du
savoir, qui est lui-même, comme le montre remarquablement
Quentin Landenne, non un point de vue ou une perspective phéno-
ménale parmi d’autres (LANDENNE, 2009 et LANDENNE, 2010), mais la
2 C’est nous qui traduisons toutes les citations de la WL-1813. 3 On veillera à tenir cette opposition dynamique de l’être et du néant à
distance de celle de Jean-Paul Sartre : il ne saurait échapper au lecteur
attentif que l’être, ici, n’a rien à voir avec l’« en soi » opposé au « pour-soi ».
Augustin DUMONT
123
genèse imaginative4 des points de vue, c’est-à-dire – car cette genèse
est et ne peut être qu’une image – le Standpunkt supérieur, celui de la
parfaite génétisation réflexive de l’auto-compréhension réflexive de
l’image réflexive de l’être – Standpunkt au fond lui-même acquis à la
multiplicité : celle des Wissenschaftslehren. On veillera à ne pas inter-
préter la récurrence de l’adjectif « réflexif » comme une figure rhétorique
complaisamment opaque, celle d’un philosophe gagné par le res-
sentiment, et dont le cercle de disciples s’est considérablement réduit
depuis l’époque d’Iéna. En réalité, la philosophie transcendantale doit
dans l’esprit de Fichte trouver ici son expression la plus systématique
et la plus cohérente. L’image, en effet, n’est image que dans la mesure
où elle s’apparaît à elle-même comme image de l’être sans s’assimiler à
l’être dont elle est seulement la négation, le génitif, la relativisation, la
mise en perspective sensible. De tout cela, loin d’en être le reflet, la
Wissenschaftslehre en est à son tour la mise en image active et
créatrice. C’est pourquoi la phénoménologie, dit l’exposé de 1812, ne
s’entreprend qu’« avec le sens artistique (mit dem Künstler Geiste)5 »
(FICHTE, 2002 : 48). Elle est une traversée spéculative de la multiplicité
des points de vue. Dans la spéculation, l’image pure du savoir se donne
à elle-même librement, de manière évidente, dans la pleine unité de son
concept, lequel ne se produit pas ailleurs que dans le système du
multiple :
« Il ne s’agit pas de dire que le concept d’unité est composé du
multiple mais qu’il acquiert sa pleine force (son résultat, son
efficience) à travers la multiplicité ; ce n’est qu’alors qu’il accède à
la visibilité dans la mesure où c’est uniquement grâce à ce résultat
qu’il peut devenir visible. » (FICHTE, 2002 : 48)
En réfléchissant absolument, le philosophe s’arrache à toute loi
factuelle et découvre le pouvoir ultime du schème, c’est-à-dire du
point d’unité et de disjonction entre l’Un et le multiple phénoménal.
Ce point est celui de la conscience de soi de la performance négatrice
de l’être. L’ignorance de l’acte même de performer l’image génère les
4 Parce que cette genèse de l’imagination n’est autre que la réflexion de
l’imagination transcendantale elle-même, il faut dire, avec Violetta Waibel,
qu’une « poiétique » immanente se libère à même la « mimétique » de la
Nachkonstruktion transcendantale constituée par la Wissenschaftslehre (cf. WAIBEL,
2007 : 177). 5 Traduction par I. Thomas-Fogiel indiquée en bibliographie. Nous la modifions
librement.
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
124
dites « philosophies de l’être/de l’éternité de l’être » qui, de Spinoza
à Schelling, finissent toujours en une forme de nihilisme – c’est là du
moins l’avis de Fichte. Celui-ci a toujours considéré Spinoza comme
son « meilleur ennemi », et – moins généreux à l’égard de celui qui
fut son disciple – l’injection de spinozisme dans sa propre doctrine
par Schelling comme une pure et simple mécompréhension de celle-
ci. Un tel nihilisme pose, à juste titre, l’être comme ce en dehors de
quoi il n’y a rien. Toutefois, la saisie elle-même de l’être, chez ces
auteurs, disparaît dans l’être, et cela ne saurait représenter une
solution acceptable : « Protestatio facto contraria ! En disant : il n’y a
rien en dehors de l’être, nous disons : il y a quelque chose en dehors
de l’être, à savoir, ce dire précisément » (FICHTE, 2002 : 52), écrit
encore Fichte en 1812. L’erreur de Spinoza et de Schelling consiste
ainsi en l’assimilation de l’absolu et du faktisch à l’intérieur de la
substance. Or, si nous partons du dire, nous partons du concept de
l’être, du Verbe et non de l’être, autrement dit, de l’image, de
l’apparition schématisante de l’être.
Nous savons (tel est le savoir) que l’image est image de
l’être, non parce que nous le pensons, mais parce nous réalisons
intuitivement l’unité avec l’être en nous-mêmes, dans la pratique du
geste philosophique. L’image apparaît ce faisant comme schème de
l’absolu, elle s’apparaît ensuite à elle-même, à travers une « introvision
(Einsicht) », ou encore à travers la « lumière (Licht) » – concept essentiel
en 1804 –, comme l’image multiple et changeante de l’être, qui seul est
en son unité immuable. Enfin, elle s’auto-réalise comme auto-apparition
de soi à l’intérieur de l’image de la Wissenschaftslehre, laquelle « doit »
(soll) apparaître « si » un monde doit être possible.
La formulation : « Si quelque chose doit apparaître (Soll…),
alors…, etc. », est tout à fait remarquable. Le Soll n’est autre que la
problématicité originaire et indépassable de la manifestation de
l’être. Comme l’a rigoureusement démontré Alexander Schnell, le
Soll condense une catégoricité et une hypothéticité6 : s’il doit y avoir
une phénoménalisation de l’être, alors sa nature transcendantale doit
pouvoir être exposée comme elle l’est dans la spéculation. Tel est le
saisissant « point de fuite » structurant toute la pensée transcendan-
tale, selon Fichte. Nous ne pouvons nous contenter d’une simple
hypothèse, sans quoi la science de l’a priori n’en est plus une.
Cependant, une proposition catégorique pure présuppose en réalité,
6 Voir sur ce point les analyses extrêmement pénétrantes de SCHNELL, 2009 :
32-38.
Augustin DUMONT
125
au moment de l’affirmation, un point de vue supérieur et irré-
ductible à partir duquel la démonstration se confère à elle-même
l’apodicticité. De sorte que le philosophe transcendantal, loin de
découvrir le Soll comme un désobligeant point d’arrêt, découvre au
contraire dans cette « butée » l’origine de toute vie, la pleine ressaisie
en soi du problème indépassable de la vie de la conscience comme
manifestation de l’être. Fine pointe du travail déductif le plus
rigoureux, le Soll affirme que si une phénoménalisation de l’être doit
être, alors cette phénoménalisation existe suivant les lois déduites.
Aussi l’image comme image de l’absolu est-elle fondamentalement et
de part en part, à travers chacune des strates qui constituent son
enveloppe transcendantale, un problème.
Le Soll est lui-même, dans sa « nécessité hypothétique »,
l’auto-monstration de la Bildlichkeit de l’être, en soi caché et soustrait
à la vision. Si l’être doit être, alors il devient dans la réflexion du
regard philosophant ce qu’il est, c’est-à-dire une image, au moment
où nous disons : « l’être est ». L’être est alors l’auto-compréhension
réflexive de soi par l’image, qui n’est rien, puisqu’il ne peut y avoir
dans l’être qu’inaltérabilité et immuabilité – l’une et l’autre immé-
diatement contredites par la performance de l’être en tant que telle, la
lumière en tant qu’auto-apparition de l’unité dans l’auto-apparition
du multiple. Une telle contradiction est un conflit sans fin, et ce
conflit régénère sans cesse le problème de l’image comme manifes-
tation sensible de l’être, hypothétiquement nécessaire, et dont les
multiples « solutions » social-historiques sont les infinies réponses à
une question infiniment renouvelée.
3. Vers l’objet
Dans le cadre de la science transcendantale du savoir
imageant, l’objet est au fond constamment perturbateur. Pourquoi ?
Parce qu’il est l’objet de l’image. Cette situation est pensée si pro-
fondément par Fichte que l’objet – en 1813 du moins – est presque
englouti dans le Bild. Le Gegenstand, comme posé en face de (Gegen-
stand), disparaît (presque), et l’Objekt lui-même se fait rare. C’est cela
qui est neuf et subversif : Fichte entend démontrer, pour ainsi dire
dans le dos de Kant dont il prétend accomplir la doctrine, que le face
à face objectivant n’est ni le terminus a quo ni le terminus ad quem de
notre rapport au monde. Mais justement : il n’y en a pas moins
quelque chose de fondamentalement résistant dans l’image : son
« objectivité », précisément.
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
126
Entendons bien, tout d’abord, que l’objet n’est pas « reflété »
par l’image. Le reflet mort et statique est ce dans quoi, aux yeux de
Fichte, Spinoza et Schelling se noient, puisque leur construction de
l’objet est elle-même immergée dans l’objet substantiel, et ainsi l’être-
apparaissant de l’objet échoue à apparaître à son tour dans la lumière
de la compréhension. Or, loin d’échanger le « poids » ou la densité de
l’objet contre son apparition phénoménale comme construction perfor-
mative de soi, Fichte tient les deux ensemble, refusant seulement de
faire de l’épaisseur de l’objet un problème strictement ontologique. En
régime transcendantal, l’objet pèse de tout son poids sur et dans
l’image.
En s’imageant elle-même comme image de l’être, peut-on lire
dans la version de 1812, l’apparition « se projette objectivement. Son
être objectif n’est rien d’autre que son propre produit qui est devenu
le voir, de par l’identité » (FICHTE, 2002 : 113). Si l’image est la copie
de l’absolu, nous ne partons jamais de l’absolu : l’image se pose
activement comme la copie d’un absolu qu’en réalité elle fait
advenir. L’image s’affirme absolument comme copie néantisante de
l’être, à l’aide de son auto-objectivation. L’image se reçoit de son
propre principe en tant que création inconditionnellement libre de la
multiplicité, comme « vouloir » (FICHTE, 2002 : 114), c’est-à-dire com-
me agir désirant, se reconnaissant en tant qu’image et se posant ainsi
comme « modèle (Vorbild) » (FICHTE, 2002 : 116), un modèle chargé
de s’incarner objectivement. Ce qui est modélisé, c’est l’être lui-même
à travers la multiplicité, c’est-à-dire à travers son image-copie
(Nachbild et Abbild). L’apparition se projette, mais elle ne saurait le
faire sans objectiver ou sensibiliser cette projection elle-même.
L’« objet » de l’image est ce qui « pèse » en elle. Non parce qu’il ralen-
tirait l’agir, contrairement à ce que l’on pourrait croire, mais parce
qu’il le motive et l’oriente, s’invitant dans le voir sensible comme cela
même qu’il faut vouloir projectivement afin de garantir toujours à
l’être une assise dans l’expérience. Il n’y a pas de réflexibilité – pour
reprendre ici l’ultime formulation de la loi à travers laquelle l’être peut
se manifester (« la compréhensibilité ou réflexibilité est la loi de
l’être » (FICHTE, 2009 : 150), lit-on en 1813) – qui ne se réfère à une
scission dans l’unité, par où un monde nous apparaît nécessairement
comme « à venir », se modélisant continuellement à travers l’appareil
volitif.
« Objectiver », on le voit, ne renvoie de prime abord à aucun
savoir « objectivant » au sens étroit du terme, bien que la Wissenschafts-
lehre permette à son lecteur de comprendre de quelle façon naît et se
Augustin DUMONT
127
développe un tel savoir. Loin de ne conférer aucune valeur ou de se
détourner pour ainsi dire par avance de cette « objectivité » du voir
tant remise en cause par la phénoménologie française de l’après-
guerre, ni même de la « représentation (Vorstellung) », puisqu’il existe
bien pour le regard un « être objectif », un « produit fini » déposé par la
réflexion, Fichte démontre néanmoins et avec insistance que le
problème de l’image et de la représentation ne saurait être ramassé
dans le face à face objectivant, qui n’est en fin de compte qu’une
possibilité de la vie de l’apparition.
En effet, l’énigme est celle d’une auto-manifestation de la
manifestation elle-même en tant qu’elle se leste d’une résistance à
projeter toujours et encore. Si un savoir de l’objet peut être vécu
comme « objectivant », celui-ci ne saurait pas davantage constituer le
point de départ que le point d’arrivée du geste philosophique. Du
moins si l’on entend par là une quelconque horizontalité entre un
sujet représentant et un objet préalable, cet objet fût-il le sujet lui-
même. On l’a dit : objectiver, ici, signifie d’abord activer le conflit du
Soll, lui donner une assise et une réalité sensible. Autrement dit,
objectiver revient à multiplier l’être dans sa manifestation s’auto-
apparaissant, et ce, à même la pro-jection volitive et modélisante de
tout le voir possible dans un acte réflexif de création.
Multiplier, sensibiliser, et inscrire le moi voyant au cœur de
son monde, dans un réseau de relations : telle est l’objectivation, ou
mieux, la création du savoir. La Wissenschaftslehre ne parle pour ainsi
dire de rien d’autre : elle est une pensée de la création de et par
l’image. L’objectivation repose sur un processus réflexif qui ne
présuppose ni l’objet en bonne et due forme ni l’objectivité de la
représentation. L’objectivation de l’image est la dynamique par où
l’image devient image, c’est-à-dire par où elle devient ce conflit
évoqué plus haut entre l’être et la performance de l’être, affrontement
creusé par la sourde résistance d’une « objectivité » immanente, et pour
cette raison générateur de nouveauté. L’objectivité est cela même que
l’apparition projette sensiblement et conflictuellement au-devant de
l’agir. En 1813, après leur avoir demandé de procéder à l’intuition
intellectuelle projective, Fichte s’adresse ainsi à ses disciples :
« Vous voyez bien que ceci est un nouveau monde de l’Einsicht,
dans la mesure où la conscience commune voit seulement les
images, mais n’arrive pas à voir l’imager (Bilden) à l’arrière-plan,
qu’elle produit, pas davantage qu’elle ne voit la loi, d’après laquelle
[elle voit]. » (FICHTE, 2009 : 135).
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
128
L’objet est l’objet d’un « nouveau monde ». C’est l’Einsicht qui est ici
opérante et révélée par le philosophe. L’Einsicht attache à l’unité de
l’être la disjonction qu’il est simultanément – en produisant l’une et
l’autre d’un seul tenant, la liaison étant l’origine de la multiplicité
elle-même. Aussi y a-t-il un objet de l’imager à entendre comme
résistance immanente à toute vision ou phénoménalisation de l’être,
résistance projetée en avant de soi, et opposée en ce sens précis –
opposition qui, parce qu’elle est, à même la performance de l’unité,
une apparition de l’apparition, ne s’assimile à aucun face à face
d’éléments statiques et hétérogènes. À cet égard justement, on se
gardera de confondre l’objet comme résistance dans l’image, capable
d’orienter celle-ci téléologiquement, avec l’objet comme dépôt mort,
d’où le regard du réaliste-matérialiste, croyant partir de la vie, part en
réalité. Ou plutôt, l’objet est l’un et l’autre, et le regard image
systématiquement l’objet de façon duplice, lui laissant toujours la
possibilité d’exister à titre de chose en soi pour la conscience. L’exposé
de 1813 poursuit :
« Dans la mesure où l’image est comprise dans la forme de l’être,
elle est une image par elle-même : son être donné et imagé est le
résultat de son par soi (durch sich) intérieur. En revanche, l’image en
tant qu’image ne repose pas sur elle-même : elle est seulement
image-copie (Nachbild), réflexion morte et pâtissante […] Cela
confère la forme du contraire (Gegensatz) aux deux formes. Dans la
forme de l’être, il n’est par conséquent pas de pure image, pas par
soi-même, car elle serait alors identique à l’image en tant qu’image,
et elle ne serait pas un contraire ; mais elle est image de l’image,
comme nous l’avons exprimé avec notre formule : l’image, non une
pure image, mais [une image] avec l’[image] apposée (mit dem
Beisatze), image de soi, par soi et à travers soi (aus sich von sich durch
sich Bild). » (FICHTE, 2009 : 142)
La duplicité est celle de l’organe du voir lui-même en tant qu’il voit
l’être, c’est-à-dire en tant qu’il l’institue performativement, sans
s’assimiler à lui. Parce que la séparation kantienne d’une faculté
réceptive et d’une faculté spontanée est supprimée, c’est la mani-
festation en général qui est duplice : la duplicité appartient à
l’entendement en tant que tel, celui-ci ne pouvant s’apparaître à soi
comme compréhension de l’être sans se scinder à même le voir :
« L’apparaître, ou l’entendement, se comprend absolument comme
image, mais se transforme tout de même en duplicité d’un être et de
l’image » (FICHTE, 2009 : 144). La duplicité ne signifie pas que l’un est
le « doublon » de l’autre : elle renvoie à un conflit pur et simple dans
Augustin DUMONT
129
l’acte de produire l’image. On ne saurait assez insister sur la dimen-
sion de conflit. Celle-ci a été pendant longtemps accolée aux seuls
textes de la période d’Iéna (on pense bien sûr au magistral §4 de la
Grundlage de 1794), au détriment des textes de la maturité, dans
lesquels on a traditionnellement lu l’émergence d’une métaphysique
contemplative de l’Un (cf. : BRACHTENDORF, 1995). Or, en 1813 – un
an avant sa mort – Fichte souligne à foison la « dramatique » interne
à l’image, à l’aide d’une écriture elle-même traversée par une tension
inouïe – qu’il faut reproduire minutieusement (avec la ponctuation
de l’auteur) –, nécessaire puisqu’elle doit générer performativement
la conscience de soi de l’image comme duplicité :
« L’être de l’image est simultanément hors de l’image, et dans l’image ;
mais une telle unité repose dans la forme de l’entendement –. Se
comprendre, en tant qu’image, par conséquent poser. (présentifiez-
vous (vergegenwärtigen Sie sich) la preuve ci-dessus. Forme-moi. / Forme,
je dis : en aucun cas, moi.) L’être de l’être absolument dans l’image ;
parce qu’il est image, mais l’image entraîne absolument son image avec
soi. Unité pure et absolue du concept, et intuition : moi = que je suis
l’image qui est par excellence. » (FICHTE, 2009 : 149)
Sans qu’il ne soit ici possible de décortiquer chaque synthèse ni
même chacune des avancées de l’exposé de 1813, l’on saisit à la
lecture des quelques passages retenus par nous que l’objet devra se
comprendre à l’aune de la Ichform sujet-objective, c’est-à-dire de la
production active de la différence de l’image à l’intérieur de l’être.
Cette Ichform n’est pas la subjectivité empirique (« Forme, je dis : en
aucun cas, moi ») mais la forme pure du comprendre imaginal dans
sa duplicité essentielle. Fichte évoque ainsi une Spaltung dans cette
forme entre l’« être-image (Bildseyn) et l’être-être (Seynseyn) » (FICHTE
2009, p. 150). Le philosophe semble avoir une conscience extrême de
la radicalité de la schize, ou disjonction originaire du moi. Il évoque
également, entre division et (risque de) délabrement – puisque ce
terme réunit les deux idées – un Zerfallen, d’où justement le concept
d’Objekt pourra réapparaître :
« La division (Zerfallen) absolue de l’entendement en une double
forme en général de l’être devrait être tout d’abord prouvée, en ce
qu’elle devrait (sollte) être à nouveau reconnue et employée dans
notre construction. […] La forme de l’empirie. où justement l’image
fondée est absolument cassée (zerschlagen) en être et image : l’un et
l’autre, totalement et absolument semblables suivant le contenu
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
130
(dans l’image de l’objet (Objekt), comme l’objet, et à nouveau en tant
qu’image et objet distincts). » (FICHTE, 2009 : 152)
L’image, manifestation du conflit entre l’être et sa manifestation,
projection à l’infini de l’agir de la résistance interne à la performance
de l’être, abrite en elle la possibilité, ou plus exactement, la nécessité
d’être vue et comprise également comme un objet distinct de l’image,
afin que puisse s’auto-apparaître l’image comme image d’un objet
extérieur. C’est ce « bougé » constant dans l’image qu’il faut accepter :
nous ne saisissons pas la spécificité de notre rapport au monde, selon
Fichte, si nous n’entrons pas résolument dans ce qu’il nommait déjà en
1794 le « flottement (Schweben) » de l’imagination transcendantale. Si la
science est « construite » (FICHTE, 2009 : 152) par nous, si nous pouvons
« introvoir (einsehen) génétiquement » (FICHTE, 2009 : 152) l’unité de
l’être dans sa Spaltung imaginale, alors nous pouvons accéder à la
singularité de l’objet fichtéen, qui est d’être l’objet projectif d’un acte
d’imager contradictoire. Par où l’objet schellingo-spinoziste trouve
l’explication génétique qui lui il manquait : l’entendement, se divisant
en être et image, « se divise lui-même encore une fois, en tant qu’il est
absolument, en tant que substance et principe absolu » (FICHTE,
2009 : 153). Une substance légitime mais en défaut de perspecti-
visme, pourrait-on dire, lorsqu’elle est posée au fondement de la
démarche réflexive, puisqu’elle confond la compréhension de l’objet
comme substance avec l’absolu. L’entendement « objectivement
absolu », dit Fichte, s’image/se forme (bildet sich) accidentaliter, « à tel
point qu’il pourrait être également objectif (objektiv) » (FICHTE, 2009 :
154).
Toutefois, la philosophie transcendantale démontre que
l’attitude dogmatique ne recouvre pas toute l’expérience du voir.
Non parce que cette appréhension de l’objet serait un simple
moment destiné à être surmonté par une sorte de variante fichtéenne
de l’Aufhebung hégélienne, car de celle-ci il ne saurait être question
dans la Wissenschaftslehre, mais parce que toute compréhension de
« l’objet de l’image » doit être justement rendue à son ambivalence
princeps.
4. Le schématisme
L’ambivalence de l’objet qui habite l’image apparaît donc
dans le geste réflexif à travers lequel l’entendement se saisit et se
comprend lui-même absolument. Il s’apparaît et se comprend comme
Augustin DUMONT
131
pouvoir d’apparaître. Mais qu’est-ce que cela signifie, demande Fichte ?
Dit négativement, il n’est pas question de présupposer l’être par
devers l’être de l’entendement. Mais alors nous le relativisons et
nous rattachons l’absolu inconditionné à notre détermination. Nous
ne pouvons pas davantage partir de n’importe quelle image,
« car à celle-ci correspond un être, qui risquerait de ne pas être co-
saisi (miterfasst). –. Il importe donc de comprendre que nous ne
pouvons pas partir de l’image et de l’être, là où l’un pose l’autre, et
c’est par cette position de l’un à côté de l’autre (durch deren
Nebeneinanderstellung), que l’entendement absolu se préserve
justement. Ce sont à vrai dire des images de l’intuition (Anschau-
ungsbilder), c’est-à-dire des images telles que leur principe est
l’entendement par son être pur et simple, sans toute l’image de
l’être-principe (Principseyns), donc dans son être invisible, lequel est
justement un être-principe. Dans tout cela, l’entendement n’est pas
absolument saisi. Il serait absolument saisi uniquement dans une
image du dénommé être-principe, dont il ne doit (soll) justement y
avoir immédiatement aucune image, suivant ce que nous avons dit
jusqu’ici. » (FICHTE, 2009 : 155-156)
De sorte que l’image de l’être-principe doit se comprendre comme le
pur concept de celui-ci. Dans ce concept, « un être-principe intuition-
nable de l’entendement ne serait pas seulement non-posé, mais il
serait expressément nié (negirt). – Il devrait en être ainsi » (FICHTE,
2009 : 156). Voilà donc la seule possibilité qui s’offre au Wissens-
chaftslehrer soucieux de comprendre absolument la compréhension
de l’être, ou encore de comprendre l’entendement absolu : il ne s’agit
pas d’arrêter la compréhension devant un être plus absolu que le
comprendre, mais de comprendre absolument que la compréhension
se pose absolument comme néant de tout être par le concept. En tant
qu’image de l’image, le concept est négation : il nie l’image en tant
qu’image, l’Einsicht, l’être-principe de tout être comme intuition
pure. Cette négation est elle-même l’objectivité : « Le concept absolu
est objectivement (objektiv) l’image de l’imagéité (Bildlichkeit) » (FICHTE,
2009 : 157).
En cela, la conscience, c’est-à-dire la totalité de ce qui est,
l’agir en sa sujet-objectivité sans reste, se caractérise, dès lors qu’elle
se pose de façon duplice comme création de nouveauté, par son
« schématisme (Schematismus) » (FICHTE, 2009 : 163) – nous le disions
déjà précédemment. Le schématisme est l’auto-génération de la
conscience comme seul moyen d’expression ou de manifestation de
l’être, pouvoir de revenir en soi sans qu’aucun soi substantiel ne
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
132
précède jamais l’activité de faire retour ni ne s’indique en elle. Le
« Ich », rappelons-le, ne peut jamais être mis à l’accusatif. Il n’y a
ainsi d’objet pour le regard, au sein de l’apparaître de l’être, que
dans la mesure où il est porté par un retour créateur, celui du Verbe
comme nomination (nominatif) pure et simple, comme création. Il
n’y a originairement aucune différence entre le retour et la projec-
tion. La conscience revient faire ce qu’elle doit (soll) encore faire être,
se projetant à l’infini dans son auto-affirmation : « je suis ». Précisément,
le schématisme garantit pour ainsi dire la possibilité, et à vrai dire
l’effectivité, d’une manifestation de l’être qui puisse toujours valoir
comme nominatif autonome de l’être, comme performance qui
n’accuse rien alors même qu’elle existe et se nourrit de transitivité.
Plus encore : cette nomination ne doit jamais cesser d’être le génitif
de l’être (le « je suis » est le nominatif de l’être). Cette situation est
évidemment, on ne saurait assez y insister, conflictuelle.
En tout état de cause, il faut comprendre « l’entendement en
tant que détermination continue d’un objet, en tant qu’image » (FICHTE,
2009 : 144). Or, cela suppose le pouvoir de se déterminer absolument
soi-même en tant qu’image absolue de l’image de l’être. Pour cette
raison, l’objet est absolument interne au schématisme comme auto-
détermination conflictuelle. Le schématisme génère sa propre objectivité
en réfléchissant le point où se rencontrent « l’unité et la multiplicité des
images » (FICHTE, 2009 : 160). De la sorte, il devient, plus précisément,
il se fait lui-même « l’objet pâtissant (leidende Gegenstand) d’un changement
à travers une loi imposée par la nécessité » (FICHTE, 2009 : 162).
L’entendement se fait donc bien lui-même objectivité et pâtir à
travers l’activité de se poser absolument comme le néant de l’être-
principe originaire. C’est là en effet la seule manière d’assumer la
contradiction de l’unité de l’être et de sa performance imaginale :
l’entendement est une image par l’image, écrit Fichte, il est « Durch,
Identität » (FICHTE, 2009 : 163).
Ainsi, « la réflexibilité et le schématisme, c’est du pareil au
même » (FICHTE, 2009 : 164). En effet, si l’intuition schématise l’être,
et si le concept schématise en le niant ce premier schème, par son
auto-objectivation, si, enfin, la réflexibilité n’est que la compréhension
par soi du schématisme, alors ils sont une seule et même chose, une
image sujet-objective soucieuse de reconduire partout et toujours son
autonomie.
Augustin DUMONT
133
Conclusion
On ne s’étonnera pas d’entendre Fichte évoquer à plusieurs
reprises « l’immanence (Immanenz) absolue » (FICHTE, 2009 : 167) de
l’image, dans la dernière leçon de 1813. Aucun concept ne pourrait
sans doute mieux résumer la trajectoire parcourue dans ces confé-
rences que celui d’immanence. Loin de supprimer ou simplement de
disqualifier l’objet, la Wissenschaftslehre rend toute interrogation
portant sur lui absolument solidaire du problème fondamental d’une
science transcendantale digne de ce nom : celui du schématisme,
c’est-à-dire de l’apparition en tant qu’apparition pure et simple de
l’être, en tant qu’apparition problématique de l’être, apparition de
l’être en tant que problème. Si cette thématique, nommée « phéno-
ménologie » dans la Wissenschaftslehre, indique un chemin qui mène à
Husserl, c’est uniquement sur un plan archi-fondationnel. Strictement
déductif et indifférent à toute « description », ce plan n’offre guère de
distinction précise entre les différentes « consciences d’image » pos-
sibles. Il démontre toutefois qu’il n’y a rien en dehors de l’image. S’il y a
de l’objet, c’est parce que l’image parvient à s’apparaître objectivement
à travers l’auto-compréhension de l’image par l’entendement, à
l’intérieur du seul champ de l’apparaître – et non parce que le « sujet »
tenterait de faire droit à un « objet » transcendant. Tout ce qui est
ressenti, perçu, imaginé ou remémoré est performé dans l’apparaître et
en tant qu’apparaître, et dans l’apparaître en tant qu’il s’apparaît à soi
de façon absolument immanente. Dès lors, si notre tâche est la trans-
formation du monde, tout investissement du monde et de ses objets est
nécessairement aussi puissant que déstabilisant, car la « distance » qui
nous sépare de ceux-ci est celle que nous sommes prêts à vouloir, elle
est celle en laquelle nous voulons croire lorsque nous nous activons
dans l’apparaître et que ce dernier se rend plus ou moins proche, plus
ou moins dangereux, plus ou moins inquiétant, plus ou moins pesant,
plus ou moins surprenant.
Bibliographie
ASMUTH Ch., 2007, « Transzendentalphilosophie oder absolute Meta-
physik ? Grundsätzliche Fragen an Fichtes Spätphilosophie », Fichte-
Studien, n° 31, p. 45-58.
BONDELI M., 2006, « Zum Begriff der Apperzeption in Fichtes Wis-
senschaftslehre 1813/1814 », Fichte-Studien, n° 28, p. 205-213.
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
134
BRACHTENDORF J., 1995, Fichtes Lehre vom Sein. Eine kritische Darstel-
lung der Wissenschaftslehren von 1794, 1798/99 und 1812, Paderborn :
Schöningh.
FICHTE J. G., 2002, Wissenschaftslehre 1812, dans J. G. FICHTE, Gesamt-
ausgabe der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, herausgegeben
von R. Lauth u.a., II, 13. Trad. I. Thomas-Fogiel : FICHTE J. G., 2005, La
Doctrine de la science de 1812, Paris : PUF.
FICHTE J. G., 2009, Wissenschaftslehre 1813, dans J. G. FICHTE, Gesamt-
ausgabe der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, herausgegeben
von R. Lauth u.a., II, 15.
GODDARD J.-CH, 1999, La philosophie fichtéenne de la vie. Le transcen-
dantal et le pathologique, Paris : Vrin.
LANDENNE Q., 2009, « Spéculation et liberté dans la philosophie de
l’histoire du Caractère de l’époque actuelle de J. G. Fichte (1804-
1805) », Revue de métaphysique et de morale, n° 64/4, p. 469-487.
LANDENNE Q., 2010, Point de vue transcendantal et philosophie appli-
quée chez J. G. Fichte. Le perspectivisme transcendantal comme épistémo-
logie critique de l’éthique appliquée, Thèse de doctorat en philosophie,
Université Libre de Bruxelles.
SCHNELL A., 2009, Réflexion et spéculation. L’idéalisme transcendantal
chez Fichte et Schelling, Grenoble : Éd. Jérôme Millon.
WAIBEL V., 2007, « Die bildende Kraft des Wissens vom Wissen in
der Spätphilosophie Johann Gottlieb Fichtes », Fichte-Studien, n° 31,
p. 175-185.
WOOLF V., 2003, « Solid Objects » (1920), dans V. WOOLF, A Haunted
House. The Complete Shorter Fiction, ed. S. Dick, London : Vintage
Books, p. 96-101.
135
Sébastien RICHARD
Au-delà de l’être et du non-être : les origines
de la Gegenstandstheorie meinongienne dans
la tradition philosophique autrichienne
Introduction
La Gegenstandstheorie développée par Meinong au tournant
du XIXe et du XXe siècles est une théorie de l’objet, une science dans
laquelle l’objet est conçu comme Gegen-stand, comme objet donné
dans son objectivité a priori, c’est-à-dire comme possédant une autonomie
par rapport à l’acte de sa saisie. On le sait, c’est particulièrement
dans l’École de Brentano que furent développées plusieurs théories
de l’objet à la fin du XIXe siècle. Dans cet article, nous nous attache-
rons à soutenir une thèse déjà énoncée par Jean-François Courtine, à
savoir :
« […] l’idée que la Gegenstandstheorie, approchée ou développée
plus ou moins complètement par Kasimir Twardowski, Alexius
Meinong, Ernst Mally et Husserl, est issue de la caractérisation
brentanienne de l’intentionalité et du problème des représentations
sans objet. » (COURTINE 2007 : 98)
Autrement dit, l’idée d’une théorie de l’objet ne s’est pas imposée d’un
coup dans la tradition philosophique autrichienne, mais a émergé
progressivement de la tentative de concilier deux thèses qui, prises
ensemble, semblent contradictoires : d’une part, la thèse bolzanienne
selon laquelle il y a des représentations sans objet et, d’autre part, la
thèse brentanienne selon laquelle tout acte psychique est dirigé vers
un objet.
1. Le problème des représentations sans objet
Si Bernard Bolzano occupe une place de tout premier plan
dans l’histoire de la philosophie, c’est, notamment, parce qu’il a dé-
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
136
fendu, à l’époque contemporaine1, et avant Frege, une forme d’« objec-
tivisme sémantique », c’est-à-dire la thèse selon laquelle le discours
renvoie à une forme d’objectivité qui en est indépendante. Cette thèse
a ensuite été soutenue différemment par Herbart, Lotze, Frege,
Meinong, Husserl, Reinach, Lask, Moore, Russell et Wittgenstein
(BENOIST, 2006 : 13). Même si Brentano s’y opposera, cet objectivisme
de la signification est typique de la tradition philosophique autri-
chienne et prend, chez certains auteurs, la forme d’un « platonisme »
de la signification2, mais on parlera plus proprement de « réalisme
sémantique », en ce que le « sens » est posé comme un type d’entités
en soi, ce qui permet, en retour, de lui assurer une objectivité. Cette
version ontologiquement extrême du réalisme sémantique a été
particulièrement soutenue par Frege, pour qui, par exemple, le
concept de nombre premier existait avant qu’il y eût des personnes
pour s’occuper d’arithmétique. Pour cet auteur, tous les concepts sont
ainsi doués d’une existence objective et indépendante (LARGEAULT,
1970 : 58).
Selon nous, ce qui fait l’un des intérêts de l’objectivisme
sémantique de Bolzano est, justement, qu’il ne succombe pas au
« préjugé en faveur de l’effectivité », inhérent à sa version réaliste.
Rappelons que le philosophe de Bohême appelle « proposition en
soi » (Satz an sich), ou « proposition objective », le « sens », le « con-
tenu », ou encore la « matière », d’un énoncé ou d’un jugement3. Or,
contrairement à ces deux derniers, les propositions en soi ne sont pas
comptées parmi les choses qui existent ; elles ne se trouvent en aucun
temps et en aucun lieu (BOLZANO, 2008 : 68). Il y a donc une indépen-
dance des propositions en soi par rapport au langage dans lequel
elles sont exprimées ou aux individus qui les pensent, sans que pour
autant elles soient conçues comme existant spatio-temporellement
dans un improbable drittes Reich frégéen.
Les propositions en soi possèdent des « composants »
(Bestandteile), ou « parties » (BENOIST, 2002 : 33-48), lesquels peuvent
1 Sur les antécédents médiévaux de cette thèse, on pourra consulter : DE LIBERA,
2002, ainsi que ELIE, 2000. 2 L’appellation de « platonisme » est, à notre avis, une erreur, mais il s’agit là
de l’expression consacrée. 3 Un énoncé est une « proposition parlée ou écrite », c’est-à-dire « tout discours
par lequel quelque chose est asserté ou affirmé » et qui doit toujours être soit
vrai, soit faux ; un jugement est une « proposition pensée », c’est-à-dire toute
proposition qui n’est pas exprimée par des mots, mais seulement pensée
(BOLZANO, 1985-1994 : (§ 19) 103).
Sébastien RICHARD
137
être soit des propositions entières, soit des « représentations en soi »
(Vorstellungen an sich), ou « représentations objectives ». Ces derniè-
res ne peuvent être vraies ou fausses, n’existent pas et sont la
« matière » (Stoff) (BOLZANO, 1985-1994 : (§ 48) 29) des représentations
subjectives qui les expriment. Bien que le terme de représentation
semble mal choisi ici, en ce qu’il induit une compréhension subjective
de cette notion – là où nous n’avons affaire qu’à de l’objectif –, il permet
surtout de souligner le type de relation qui lie une représentation en
soi à son objet :
« J’appelle objet d’une représentation toute chose réelle ou non
réelle dont on peut dire qu’elle est représentée par cette représen-
tation, ou encore dont traite une proposition où cette représentation
est une représentation-sujet. » (BOLZANO, 2008 : 71)
Par exemple, la représentation « étoile de première grandeur » repré-
sente Sirus, Régulus et Aldebaran ; la représentation « une racine de
l’équation x3–9x2+26x–24 = 0 » représente les nombres 2, 3 et 41. Nous
voyons qu’une représentation peut représenter un ou plusieurs objets.
Dans ce cas, elle est dite « objectuelle » (gegenständlich) (BOLZANO, 1985-
1994 : (§ 66) 105). Parmi les représentations objectuelles, il y en a
certaines qui ont un statut particulier, à savoir celles d’« extension
maximale2 », comme, par exemple, « quelque chose » (Etwas) ou « objet
en général » (Gegenstand überhaupt) (BOLZANO, 1985-1994 : (§ 99) 55-56)
qui représentent tout objet, réel ou irréel, possible ou impossible. Il y a
d’autres représentations équivalentes à celles-ci, comme « non-rien »
ou « quelque chose qui a la propriété b », où « b » est une propriété qui
appartient à tous les objets sans exception. Un exemple d’une telle
propriété serait l’identité à soi.
S’il y a des représentations d’extension maximale, il y a aussi
des « représentations sans objet » (gegenstandlose Vorstellungen), c’est-
à-dire des représentations qui ne représentent rien. Bolzano en
donne plusieurs exemples dans le célèbre § 67 de la Wissenschafts-
lehre. En suivant Twardowski (1993 : 106), nous pouvons les ranger
sous trois catégories (BOLZANO, 1985-1994 : (§ 67) 112-1133) :
1 Remarquons bien que la relation d’une représentation à un objet ne peut
être élucidée plus avant : elle est primitive (SEBESTIK, 1992 : 145). 2 L’« extension » d’une représentation est le domaine des objets qu’elle
représente. 3 On trouvera d’autres exemples dans SEBESTIK, 1992 : 184.
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
138
a) « les représentations qui enveloppent carrément la négation
de tout objet », comme la représentation « rien » (Nichts) ;
b) « les représentations auxquelles aucun objet ne correspond
parce que jusqu’à maintenant, dans l’expérience, il ne s’en
est montré aucune pareille », c’est-à-dire ce que nous pouvons
appeler des « représentations fictives », comme « montagne
d’or » ou « Dieu » (si les athées ont raison) ;
c) « les représentations auxquelles ne correspond aucun objet
pour le motif que, dans leur contenu, paraissent rassemblées
des déterminations contradictoires les unes avec les autres »,
c’est-à-dire ce que nous pouvons appeler des « représen-
tations contradictoires », comme « cercle carré », « vertu verte »,
« pentaèdre régulier » ou « √−1 ».
Les représentations sans objet sont bien des représentations, c’est-à-
dire qu’il s’agit bien de parties de propositions qui sont signifiantes,
bien qu’elles ne représentent pas d’objet.
Lorsque Bolzano parle de représentations sans objet, il ne
cède pas à la tentation qui consiste à croire qu’elles représentent des
objets qui n’existent pas. C’est pourtant en ce sens qu’Exner a lu
Bolzano :
« […] quand il y a être-impossible, il y a aussi des choses impos-
sibles. Et en fait, cela s’accorde tout à fait avec l’usage de la langue,
où l’on parle en général de choses réelles, non réelles, possibles,
impossibles. Mais il s’ensuit aussi que les représentations dont
l’objet ne peut jamais devenir réel représentent elles aussi une
chose, à savoir une chose impossible, à laquelle appartient aussi un
être, l’être-impossible ; ainsi, quoique relativement à l’objet elles
soient très différentes des autres, ces représentations ne peuvent
néanmoins être appelées des représentations sans objet. » (BOLZANO
et EXNER, 2008 : 129)
Rien ne saurait être plus opposé à la pensée de Bolzano. Certes, il y a,
pour lui, des représentations qui représentent des objets qui ne sont
pas réels, comme, par exemple, « la loi morale suprême », puisqu’elle
représente une proposition en soi, une certaine vérité en soi « qui
n’est rien d’existant et qui est pourtant quelque chose » (BOLZANO et
EXNER, 2008 : 119). Mais la représentation « cercle carré » ne repré-
sente aucun objet, pas même un objet impossible qui aurait un être
différent des objets réels ; elle ne représente tout simplement rien. Il
Sébastien RICHARD
139
semble que nous soyons naturellement conduits à l’interprétation
déformante d’Exner, d’une part, parce qu’aucune proposition ayant
une représentation sans objet en position sujet ne peut être vraie et,
d’autre part, parce qu’il soutient qu’une proposition comme « cercle
carré est une représentation sans objet » est vraie. Cela semble
contradictoire. Mais il n’en est rien. Selon Bolzano, dans la propo-
sition « cercle carré est une représentation sans objet », ce n’est pas la
représentation « cercle carré » qui est le sujet, mais la représentation
de cette représentation, laquelle a bien un objet, à savoir la repré-
sentation « cercle carré ». Autrement dit, ce qu’exprime, en fait, la
proposition « cercle carré est une représentation sans objet » c’est : « la
représentation cercle carré a la propriété d’être dépourvue d’objet »
(BOUVERESSE 2000 : 520).
Nous pouvons maintenant nous demander pourquoi la thèse
bolzanienne des représentations sans objet se constituera particuliè-
rement en problème dans l’École de Brentano. La raison principale
en est la thèse brentanienne de l’intentionalité de tout phénomène
psychique, c’est-à-dire de l’affirmation selon laquelle tout phénomène
psychique se caractérise par le fait d’être à propos de quelque chose,
d’avoir un rapport à un objet.
2. La thèse de l’in-existence intentionnelle des objets
La thèse de Brentano sur ce qui distingue les phénomènes
psychiques des phénomènes physiques est énoncée dans un passage
extrêmement célèbre de la Psychologie du point de vue empirique de
18744 :
« Ce qui caractérise tout phénomène psychique, c’est ce que les
Scolastiques du Moyen Âge ont appelé l’inexistence intentionnelle
[intentionale Inexistenz] (ou encore mentale) d’un objet [eines
Gegenstandes] et ce que nous pourrions appeler nous-mêmes – en
usant d’expressions qui n’excluent pas toute équivoque verbale – la
relation à un contenu [Beziehung auf einen Inhalt], la direction vers
un objet [Richtung auf ein Objekt] (sans qu’il faille entendre par là
une réalité [Realität]) ou objectivité immanente [immanente Gegen-
ständlichkeit]. Tout phénomène psychique contient en soi quelque
chose à titre d’objet [Objekt], mais chacun le contient à sa façon.
4 Sur ce texte, on pourra notamment consulter l’article suivant, qui apporte
des précisions précieuses : MAZZÙ, 2007 ; ainsi que GILSON, 1955 : 45 sq. ; et
ANTONELLI, 2009.
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
140
Dans la représentation [Vorstellung], c’est quelque chose qui est
représenté, dans le jugement quelque chose qui est admis ou rejeté,
dans l’amour quelque chose qui est aimé, dans la haine, quelque
chose qui est haï, dans le désir quelque chose qui est désiré et ainsi
de suite. » (BRENTANO, 2008 : 101-102)
Les phénomènes psychiques, par opposition aux phénomènes
physiques, peuvent donc être définis comme « les phénomènes qui
contiennent intentionnellement un objet [Gegenstand] en eux »
(BRENTANO, 2008 : 102). Or si un objet est contenu dans un phéno-
mène psychique, c’est qu’il possède une « inexistence intention-
nelle ». Cette thèse ne doit pas être comprise comme affirmant que
l’objet n’existe pas, mais bien au contraire comme affirmant qu’il
existe, à savoir dans l’esprit. C’est là tout le sens du préfixe in dans
Inexistenz.
Brentano n’entend pas ici faire œuvre de nouveauté. Il
emploie le terme « intentionnel » par référence aux auteurs scolasti-
ques. Par exemple, chez saint Thomas, l’objet connu a un être du
même ordre que la pensée. Il est connu sans matière, par sa forme
seule, c’est-à-dire « selon un mode d’être spirituel » (GILSON, 1997 : 287),
qui peut être qualifié d’« être intentionnel » (esse intentionale). Mais par-
delà les scolastiques, c’est aussi à Aristote que s’en réfère Brentano
(voir GILSON, 1955 : 48).
Il aurait pu utiliser, en lieu et place du terme « intentionnel »,
celui d’« objectif » (objective), au sens médiéval, c’est-à-dire « à la façon
d’un objet ». Il se serait ainsi au moins prémuni contre certaines mécom-
préhensions. Il y a en effet quelques auteurs qui comprirent inten-
tionnel au sens de « poursuite [subjective] vers un but », c’est-à-dire
d’Absicht (BRENTANO, 2008 : 199). Mais le terme « objectif » aurait très
certainement été encore plus mal compris, en ce que si pour les
scolastiques, et encore pour Descartes, est objectif ce qui est présent à la
pensée5, pour les modernes, au contraire, il désigne l’existence effective
extra-mentale.
Si Brentano emprunte aux scolastiques le terme « inten-
tionnel », c’est donc avant tout pour distinguer le mode d’être de
l’objet contenu dans un phénomène psychique du mode d’être effec-
tif. L’objet de l’acte intentionnel existe de manière « immanente », et
5 Lalande nous dit que « dans la langue scolastique, et encore au XVIIe siècle : est
objectif ou existe objectivement, ce qui constitue une idée, une représentation de
l’esprit, et non pas une réalité subsistant en elle-même et indépendante »
(LALANDE, 1926 : 695).
Sébastien RICHARD
141
non de manière effectivement réelle en dehors de l’esprit (voir
BRENTANO, 2008 : 101), et la question de savoir si un objet extérieur
lui correspond ou ne lui correspond pas n’a ici rien à voir. Il n’est en
tout cas pas nécessaire qu’un tel objet lui corresponde (BRENTANO,
1982 : 22).
La thèse brentanienne de l’inexistence intentionnelle de
l’objet ne sera pas sans poser quelques difficultés aux élèves du
maître de Würzbourg, difficultés dont Brentano était d’ailleurs lui-
même conscient6. La principale, pour notre propos, est celle liée à
l’ambiguïté qui affecte la notion même d’objet intentionnel. D’une
part, nous avons naturellement tendance à considérer l’objet comme
étant extra intellectum, donc de manière transcendante, alors qu’il
s’agit ici d’un objet immanent, et, d’autre part, Brentano nie que cet
objet soit l’« objet représenté » (vorgestelltes Objekt), l’objet tel qu’il est
représenté (BRENTANO, 1974 : 87). Mais alors, quel est le statut onto-
logique de cet objet, en particulier dans le cas des représentations sans
objet ? Comme le dit Courtine :
« si les phénomènes psychiques sont ceux qui contiennent
intentionnellement en eux un objet, abstraction faite du point de
savoir ce qu’il en est réellement de l’existence de l’objet, dans le
monde, ou hors de la conscience, et s’il y a des représentations sans
objet au sens réel et mondain de l’objectivité, la question se pose
naturellement de savoir comment fixer essentiellement et entitati-
vement cet “objet”. » (COURTINE, 2007 : 98)
En fait, ce sont les ambiguïtés mêmes qui grèvent la thèse d’in-
existence intentionnelle de l’objet de la représentation qui pousseront
les disciples de Brentano à approfondir la notion d’objet et à élaborer
une véritable théorie de l’objet.
3. La distinction du contenu et de l’objet
Si l’inexistence intentionnelle de l’objet devient la caractéris-
tique de tout phénomène psychique, l’étude des différentes manières
dont l’esprit se rapporte à un objet devient centrale pour la psycho-
logie au sens brentanien, c’est-à-dire au sens d’une « psychologie
descriptive ». Or, d’après Brentano, il y a trois façons fondamenta-
6 Voir la « Lettre de Brentano à Marty du 17 mars 1905 » dans BRENTANO,
1974 : 87-91.
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
142
lement différentes d’être dirigé vers un objet (voir GILSON, 1955 : 61-
71) :
« […] nous croyons nous aussi qu’on doit distinguer d’après leur
mode de relation à un contenu, trois classes principales d’activités
psychiques. […] nous donnons à la première le nom de représenta-
tion [Vorstellung], à la seconde le nom de jugement [Urteil], et à la
troisième le nom de mouvement affectif [Gemütsbewegung], d’inté-
rêt [Interesse] ou d’amour [Liebe]. » (BRENTANO, 2008 : 216)
C’est la notion de « représentation » qui nous intéresse ici plus particu-
lièrement. Nous pouvons d’autant plus légitimement nous y limiter
que, pour Brentano, tout phénomène psychique est une représentation
ou est fondé sur une représentation (BRENTANO, 2008 : 112). Ceci,
parce que c’est l’objet de la représentation qui peut, éventuellement,
devenir l’objet d’un jugement ou d’un mouvement affectif. La diffé-
rence entre les différentes classes de phénomènes psychiques ne réside
pas dans le contenu de l’acte psychique, mais dans la relation de l’acte
à l’objet.
Brentano précise ce qu’il entend par représentation de la
manière suivante :
« Nous parlons de représentation chaque fois que quelque chose
nous apparaît. Quand nous voyons quelque chose, nous nous
représentons une couleur ; quand nous entendons quelque chose,
nous nous représentons un son ; quand nous imaginons quelque
chose, nous nous représentons cette image. Employant le mot avec
cette signification générale, nous avons pu dire que l’activité
psychique ne pouvait jamais se rapporter à quelque chose qui ne
fût pas objet de représentation. » (BRENTANO, 2008 : 217)
La représentation est donc un phénomène psychique (d’apparence)
extrêmement simple : le fait que « quelque chose » (Etwas) nous
apparaît. Or, ce qui demeure ambigu dans cette explication, est
précisément ce « quelque chose » qui est représenté. Les premières
tentatives d’éclaircissement sur ce point sont généralement attri-
buées à Kazimierz Twardowski. Le philosophe polonais distingue,
en effet, « objet » et « contenu » de la représentation. Néanmoins, il
avait déjà été précédé sur cette voie par un élève de Meinong : Alois
Höfler.
Sébastien RICHARD
143
3.1. La triade acte-contenu-objet chez Höfler et
Twardowski
C’est en 1890 – au début de ce que Simons a pu appeler la
« décennie décisive » (SIMONS, 1989) pour le concept d’intentionalité –
qu’Alois Höfler publie un manuel de logique à l’intention des enfants
du secondaire de l’empire austro-hongrois. Au § 6 de cet ouvrage, écrit
en collaboration avec Meinong, Höfler écrit :
« 1. Ce que nous avons appelé “contenu de la représentation et du
jugement” se trouve entièrement à l’intérieur du sujet, de la même
façon que l’acte de représentation et de jugement lui-même. 2. Les
mots Gegenstand et Objekt sont employés en deux sortes de sens :
d’une part, pour cet existant en soi [an sich Bestehende] […] sur quoi
se dirige pour ainsi dire notre représenter et notre juger ; d’autre
part, pour l’“image” psychique existant “en” nous, plus ou moins
approchante de ce réel, laquelle quasi-image (plus justement :
signe) est identique à ce qui a été appelé, en 1, contenu. À la
différence de ce qui se tient en face, ou de l’objet, supposé comme
indépendant de la pensée, on appelle aussi le contenu d’un
représenter et d’un juger (de même : d’un sentir et d’un vouloir)
l’“objet immanent ou intentionnel” de ces apparitions psychiques. »
(HÖFLER, 1890 : § 6)
Donc, selon Höfler, lorsque nous nous représentons quelque chose,
nous avons un « acte de représentation », et ce qui est représenté dans
cet acte : un « contenu », lequel peut aussi être appelé « objet immanent
ou intentionnel ». Nous devons encore distinguer un autre sens de la
notion d’objet, à savoir celui de l’objet, « indépendant de la pensée »,
vers lequel s’oriente la représentation. Par conséquent, Meinong et son
disciple séparent ce qui semblait encore indistingué chez Brentano : le
contenu de l’acte de représentation, qui est immanent à la sphère
psychologique, et l’objet vers lequel s’oriente cet acte de représen-
tation, qui est extra-mental.
C’est à Twardowski qu’il reviendra de clarifier et de
déterminer plus précisément la tripartition de Höfler, dans son
ouvrage intitulé Sur la théorie du contenu et de l’objet des représentations,
paru en 1894. Pour ce faire, il commence par analyser un analogue
linguistique de la triade acte-contenu-objet. Selon le philosophe
polonais, un nom a trois fonctions (voir TWARDOWSKI, 1993 : 96).
Premièrement, « il informe que celui qui emploie le nom, se repré-
sente quelque chose ; il indique la présence d’un acte psychique chez
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
144
celui qui parle ». Deuxièmement, « il éveille chez l’auditeur un conte-
nu psychique déterminé » qui est la « signification » de ce nom. Troi-
sièmement, il dénomme un objet7. Lorsque nous utilisons un nom,
nous avons donc affaire à une triade de fonctions : information-
signification-dénomination (Kundgabe-Bedeutung-Nennung). Le nom
et la représentation ne sont évidemment pas sans rapport : le nom est
le signe d’une représentation. Nous venons de voir que le nom a,
notamment, pour fonction d’éveiller chez l’auditeur un contenu
psychique. Il s’agit en l’occurrence de l’acte qui consiste à se repré-
senter. Le nom éveille, par là, un contenu de représentation psy-
chique : sa signification (voir TWARDOWSKI, 1993 : 103). Or c’est en
vertu de cette signification que le nom nomme un objet. C’est ici que
l’analogie prend tout son sens :
« […] de même donc que l’éveil d’un contenu de représentation est
le moyen par lequel le nom nomme un objet, exactement de même
le contenu de représentation est lui-même le moyen par lequel
l’acte de représentation (dont il a été donné information par le nom)
représente un objet. » (TWARDOWSKI, 1993 : 103)
En conséquence, c’est par le moyen du contenu de représentation
que l’acte de représentation accède à son objet.
La représentation semble toujours affectée d’une certaine
ambiguïté, en ce qu’il semble qu’elle puisse représenter deux choses
différentes : d’une part, son contenu et, d’autre part, son objet. En
fait, il n’y a pas ici d’ambiguïté parce que, pour Twardowski, le
contenu et l’objet ne sont pas représentés dans le même sens
(TWARDOWSKI, 1993 : 97). Pour nous le faire comprendre, le philosophe
polonais a recours à une distinction déjà établie par Brentano : celle
entre « prédicats déterminants » et « prédicats modificateurs » (voir
BRENTANO, 2008 : 236-237). Un prédicat est dit « déterminant » (determi-
nierend) lorsqu’il enrichit « de nouvelles déterminations » le sujet
auquel il s’applique. Par exemple, lorsque je dis « un homme est
instruit », le prédicat « (est) instruit » enrichit le sujet « un homme »
de déterminations supplémentaires et présuppose, pour être vrai,
l’existence d’un homme.
7 Ces distinctions rappellent fortement celles faites par Husserl au début de
sa première Recherche logique (HUSSERL, 2002 : I, §§ 1-8). Néanmoins, le point
de vue encore psychologisant qu’elles expriment est rapidement dépassé par
Husserl au cours de cette même Recherche.
Sébastien RICHARD
145
Mais il y a aussi des prédicats modificateurs. Par exemple, si
je dis « un homme est mort », cette proposition ne suppose pas, pour
être vraie, l’existence d’un homme, mais seulement d’un homme
mort, lequel n’est plus du tout un homme ; c’est un cadavre. Le
prédicat « (est) mort » est ici modificateur. Twardowski transpose
cette distinction au niveau des « déterminations » qui peuvent être
appliquées à un nom et souligne que certaines déterminations peuvent
être tantôt déterminantes, tantôt modificatrices (TWARDOWSKI, 1993 : 97).
Par exemple, « faux » est une détermination de ce type puisque, dans
« un jugement faux », elle est déterminante (un jugement faux est
toujours un jugement, nous avons simplement réduit l’extension des
jugements aux seuls jugements qui sont faux), et, dans « un faux
diamant », elle est modificatrice (un faux diamant n’est pas un dia-
mant du tout).
Selon Twardowski, « représenté » est également une détermi-
nation de ce dernier type. Afin d’illustrer son propos, il utilise l’exemple
du prédicat « peint ». Celui-ci est déterminant dans l’expression « un
tableau peint », car un tableau peint est toujours un tableau. En
disant qu’un tableau est peint, nous ajoutons simplement de nouvel-
les déterminations à la notion de tableau, nous réduisons l’extension
du mot « tableau » à celle des tableaux qui sont peints, c’est-à-dire
des tableaux qui ne sont ni burinés, ni gravés, etc. Par contre, lorsque
nous disons « un paysage peint », la détermination est modificatrice
puisqu’un paysage peint n’est plus du tout un paysage, mais un
tableau. Ce qui montre, de plus, que le tableau peint et le paysage
peint ne font qu’un, du moins si le tableau représente ce paysage.
Toutefois, ce n’est pas parce qu’il est peint que le paysage
cesse d’être un véritable paysage. Il y a un sens dans lequel « peint »,
lorsqu’il est ajouté à « paysage », n’est pas modificateur. C’est par
exemple le cas si je dis : « je ne sais pas quel paysage est peint dans
ce tableau. » Ce à quoi je fais alors référence au moyen du mot
« paysage » n’est pas le tableau, mais le véritable paysage qui est
dans une certaine relation avec ce tableau. « Peint » est ici une déter-
mination déterminante : elle restreint l’extension des paysages à ceux
dont il existe une représentation picturale. En conséquence, « peint »
peut donc être soit modificateur, soit déterminant, lorsqu’il est
appliqué à « paysage ».
Considérons maintenant le cas de la représentation. La déter-
mination « représenté » peut d’abord être déterminante ou modifica-
trice, selon qu’elle s’applique au contenu de la représentation ou à
l’objet de la représentation. Dans « le contenu représenté », elle est déter-
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
146
minante, de la même manière que le tableau peint est encore un
tableau, et, dans « l’objet représenté », elle peut être modificatrice, au
sens où l’objet n’est plus alors un objet, de la même manière qu’un
« paysage peint » peut ne plus être un paysage mais un tableau. Dans
ce cas, le contenu et l’objet représentés sont identiques. Il s’agit, dans les
deux cas, d’une « image » (Bild) (spirituelle) de l’objet (TWARDOWSKI,
1993 : 99). En ce sens, la conception twardowskienne de la représen-
tation peut être qualifiée de « dépictive » (FISETTE, 2003 : 75), ou de
« picturale ».
La détermination « représenté » peut aussi être détermi-
nante, et non modificatrice, lorsqu’elle est appliquée à « objet » :
« […] nous avons vu que le paysage peint, l’image, présente
quelque chose qui n’est pas peint dans précisément ce sens.
Exactement de même, le contenu d’une représentation se relie à
quelque chose qui n’est pas contenu de représentation, mais objet
de cette représentation, d’une manière analogue à celle dont le
paysage est le “sujet” de l’image qui le présente. Et de même que le
paysage est, en image, copié sur cette image, amené à la
présentation [Darstellung], donc peint dans un sens différent du
précédent, exactement de même, par le contenu de la représenta-
tion, l’objet correspondant à cette représentation [Vorstellung]
devient, comme on a coutume de dire, copié en image spirituelle-
ment, donc représenté. Quand il est dit de l’objet, en ce dernier
sens, qu’il devient représenté, alors par là la signification du mot
objet ne devient nullement modifiée ; “l’objet devient représenté”
veut alors dire seulement qu’un objet est entré, avec un être capable
de représentation, dans une relation entièrement déterminée. Mais
il n’a pas par là cessé d’être objet. » (TWARDOWSKI, 1993 : 99-100)
Donc, par « objet représenté », nous pouvons soit vouloir dire le
contenu d’une représentation, soit l’objet qui est dans une relation
déterminée avec un sujet connaissant, lequel sujet accède à cet objet au
moyen d’une représentation. Le premier objet n’est, en fait, pas un
objet du tout, mais est le contenu d’une représentation, alors que le
deuxième est un objet véritable. En reprenant la terminologie de
Zimmermann8, du premier, nous pouvons dire qu’il est représenté
dans une représentation et, du second, qu’il est représenté par une
8 Robert Zimmermann était un élève de Bolzano. Il fut le professeur et le
superviseur officiel de Twardowski à Vienne, Brentano ayant été obligé de
démissionner de sa chaire en 1880. Cf. SMITH, 1994: 156.
Sébastien RICHARD
147
représentation, plus précisément, par son contenu (TWARDOWSKI, 1993 :
103).
Nous sommes maintenant en possession des distinctions con-
ceptuelles qui vont permettre à Twardowski de fournir une solution au
paradoxe des représentations sans objet dans le cadre de la thèse
d’intentionalité des phénomènes psychiques.
3.2. Twardowski sur les représentations sans objet
Au début du manuscrit sur les « Objets intentionnels » de 1894,
Husserl résume de manière particulièrement claire le problème auquel
se trouvèrent confrontés les brentaniens avec les représentations sans
objet :
« Si chaque représentation représente un objet, il y a bien alors pour
chacune un objet, donc : à chaque représentation correspond un
objet. Mais il vaut, d’autre part, comme une vérité non douteuse,
qu’il ne correspond pas à chaque représentation un objet, qu’il y a,
pour parler comme Bolzano, des “représentations sans objet”. »
(HUSSERL, 1993 : 279)
Le paradoxe des représentations sans objet tel qu’il se présente dans la
tradition intentionaliste brentanienne se laisse donc aisément formu-
ler. Il provient de l’affirmation simultanée de deux thèses contradic-
toires. D’une part, celle qui affirme que :
(1) à chaque représentation correspond un objet, qui découle
de l’affirmation psychologique selon laquelle « chaque représentation
représente un objet ». Il s’agit de la thèse d’intentionalité de toute
représentation. Et, d’autre part, celle qui énonce que :
(2) il ne correspond pas à chaque représentation un objet, qui
est la thèse bolzanienne selon laquelle il y a des représentations sans
objet. Comment Twardowski résout-il le paradoxe qui résulte de la
réunion de ces deux thèses ? Sa stratégie est double.
Premièrement, il va tout simplement disqualifier la repré-
sentation « rien ». Il s’agit de montrer que nous n’avons pas du tout
affaire à une représentation. Deuxièmement, il va nier la thèse (2).
Autrement dit, pour lui, à toute représentation correspond bien un objet.
Commençons par envisager le premier point.
La critique du mot « rien » à titre de véritable représentation,
c’est-à-dire comme étant une expression « catégorématique », est tout
à fait intéressante. Elle part du présupposé que cette expression est
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
148
complexe, qu’elle est dérivée par négation nominale de l’expression
« quelque chose » :
« D’une manière générale la signification de “nihil” a été placée à
égalité avec celle de “nonens”, et aujourd’hui on pense aussi que
“rien” est simplement un substitut de l’expression “non-quelque
chose”. » (TWARDOWSKI, 1993 : 106)
Or cette opération qui permet d’obtenir une nouvelle expression de
signification tout à fait déterminée par l’ajout du préfixe « non » à
une expression catégorématique n’est permise, selon Twardowski,
que s’il y a un terme d’extension plus large qui comprend l’extension
du terme catégorématique et celle de sa négation. Autrement dit,
l’adjonction de « non » avec une expression qui représente quelque
chose n’est possible que si elle opère un partage au sein d’une repré-
sentation d’une généralité plus grande que celle des deux repré-
sentations ainsi obtenues. Par exemple, nous pouvons former « non-
Grecs » à partir de « Grec » parce que ces deux expressions divisent
une représentation d’ordre supérieur, à savoir celle des hommes. Pour
pouvoir effectuer cette opération, il faut donc un domaine d’objets
préalable, par rapport auquel la division est « pertinente » (BENOIST,
2001 : 72).
Mais, dès lors, qu’en est-il de la représentation « rien » ? Si
« rien » est obtenu par négation de « quelque chose », il faut qu’il y
ait une représentation d’« ordre supérieur » à celle du quelque chose,
pour qu’elle soit légitime. Or « il est clair qu’avec “quelque chose”,
une représentation devient désignée par rapport à laquelle aucune
autre ne se place à un ordre supérieur » (TWARDOWSKI, 1993 : 107).
La raison en est simple : s’il y avait quelque chose d’ordre supérieur
au quelque chose, celui-ci serait encore quelque chose, c’est-à-dire la
même représentation, et non une représentation plus générale.
Par conséquent, « rien » n’est en aucune façon une expres-
sion catégorématique, mais bien une expression syncatégorématique,
en l’occurrence « une partie constitutive des propositions négatives »
(TWARDOWSKI, 1993 : 108). Ce que Twardowski soutient en fait par là,
c’est que les propositions dans lesquelles l’expression « rien »
apparaît peuvent être paraphrasées de manière à mettre en évidence
sa fonction d’opérateur. Par exemple, « rien n’est éternel » signifie,
en fait, qu’« il n’y a pas quelque chose d’éternel », ou « je ne vois rien »
signifie qu’« il n’y a pas quelque chose de vu par moi », etc. Dans une
proposition, « rien » ne fonctionne pas comme un terme authentique,
une expression qui signifie une représentation, mais comme un opé-
Sébastien RICHARD
149
rateur logique analogue à « aucun », de sorte que lorsque nous disons
une phrase du type « ceci n’est rien », elle signifie, en fait, « il n’y a pas
quelque chose tel que ceci ».
La stratégie de Twardowski concernant les deux autres
espèces de représentations sans objet est différente de celle qu’il a
mobilisée face au rien. Il ne s’agit plus ici de disqualifier leur statut
de représentations authentiques, mais plutôt de soutenir que, si ces
représentations ont bien un objet, celui-ci possède seulement une
« existence intentionnelle », et non « effective ». Pour le comprendre,
envisageons le cas des représentations qui, comme « cercle carré »,
contiennent des parties contradictoires. En elles « se trouvent réunies
des marques distinctives incompatibles ». Le nom « cercle carré » éveille
un contenu de représentation complexe qui contient les marques
distinctives « cercle » et « carré », de telle sorte que ce nom ne peut
nommer un objet existant. Mais soulignons que la représentation
« cercle carré » n’est pas elle-même contradictoire et, en vertu de la
théorie twardowskienne de la représentation, elle doit donner accès
à un objet : s’il y a un contenu de représentation, il y a un objet qui
lui correspond. Le philosophe polonais est donc conduit à affirmer
que la représentation « cercle carré » possède à la fois un contenu et un
objet, bien que ce dernier n’existe pas.
En fait, il faut bien s’entendre ici sur le sens dans lequel est
prise la notion d’existence. Si l’objet en question n’a pas d’existence
effective, il a, par contre, une « existence intentionnelle ». Qu’est-ce à
dire ? Simplement qu’il n’a pas d’existence à proprement parler,
mais seulement une existence « en tant que représenté au sens de
l’objet de la représentation » (TWARDOWSKI, 1993 : 109). La locution « en
tant que représenté » est ici modificatrice : l’existence de quelque
chose en tant que représenté n’est, en fait, plus une existence, c’est
seulement une existence « phénoménale », intentionnelle – ces deux
termes devant être compris en un sens modificateur. Il faut donc
déconnecter « être représenté » et existence (BENOIST, 2001 : 81). Arrivés à ce point, nous pourrions être tentés de croire que
l’objet qui n’existe pas dans une représentation sans objet est le
contenu de cette représentation. Mais Twardowski nous met très
clairement en garde contre une telle interprétation. L’objet dont il est
ici question est bien celui qui est représenté par la représentation,
c’est-à-dire l’objet véritable en relation avec le sujet connaissant, et
non celui qui est représenté dans la représentation, c’est-à-dire son
contenu. Il convient de fermement distinguer les deux qui diffèrent
toto genere (TWARDOWSKI, 1993 : 115). Twardowski en veut notamment
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
150
pour preuve le cas des énoncés existentiels négatifs vrais. Par exemple,
lorsque je dis « il n’y a pas de cercle carré », il est évident que ce sur
quoi porte mon jugement d’inexistence n’est pas le contenu de la
représentation, qui lui doit bien exister, du moins à titre de partie de
l’acte de ma représentation ; il est « réel ». C’est l’objet lui-même dont
je nie qu’il existe. Dès lors, comme le dit Benoist, « on est forcé de
convenir que la représentation ne peut être découverte (après coup)
“sans objet” que dans la mesure même où, en un certain sens, elle en a
un » (BENOIST, 2001 : 81).
La solution twardowskienne au paradoxe des représenta-
tions sans objet ne consiste donc pas à éliminer le troisième terme de
la triade acte-contenu-objet. Toute représentation a bien un objet ; il
n’existe simplement pas dans le cas des représentations sans objet.
La question que nous pouvons alors légitimement nous poser est
celle du statut ontologique de cet objet inexistant, car il semble qu’il
faille bien qu’en un certain sens il y ait un objet, même si celui-ci n’est
pas le sens de l’existence actuelle.
4. Première approche twardowskienne de la théorie de
l’objet
Nous avons vu que Twardowski qualifiait d’existence inten-
tionnelle le mode d’être propre aux objets représentés par les représen-
tations sans objet. Mais nous avons également vu que l’existence
intentionnelle n’est pas une existence du tout. Le philosophe polonais
semble donc rejeter l’idée même de mode d’existence. Ce qu’il faut
plutôt comprendre, c’est que le quelque chose, l’objet (en général),
est au-delà de la question de l’existence et de la non-existence, hors
de l’être et du non-être. Plus précisément, l’objet, le Gegenstand, est
dissocié de l’existence :
« L’objet est quelque chose d’autre que l’existant ; à de nombreux
objets, en plus de leur objectivité, en plus de leur propriété
intrinsèque à devenir représentés (ce qui est le sens propre du mot
“essentia”), revient encore aussi l’existence, à d’autres, non. Est
aussi bien un objet (ens habens actualem existentiam) ce qui existe,
que ce qui, encore, pourrait seulement exister (ens possibile) ; mieux,
même ce qui ne peut jamais exister, mais seulement devenir
représenté (ens rationis), est un objet ; en bref, tout ce qui est non pas
rien, mais en un sens quelconque, quelque chose, est un objet. »
(TWARDOWSKI, 1993 : 123)
Sébastien RICHARD
151
En fait, l’existence de l’objet d’une représentation lui est toujours
extrinsèque, elle lui est ajoutée (COURTINE, 2007 : 104). Remarquons
que cela est parfaitement en accord avec la théorie brentanienne des
jugements que reprend Twardowski. Pour Brentano, contrairement à
Kant, un jugement ne se laisse pas réduire à une liaison de repré-
sentations, mais est une relation intentionnelle qui se fonde toujours
sur une représentation. De ce point de vue, c’est l’objet même de la
représentation qui est jugé. La différence entre un jugement et une
représentation réside alors dans la relation à l’objet. Dans le juge-
ment, l’objet n’est pas simplement représenté, il fait aussi l’objet
d’une prise de position théorique : il est « admis » (angenommen) ou
« refusé » (verworfen), c’est-à-dire qu’il est accepté comme vrai ou
comme faux. Cette partie psychologique de la théorie brentanienne
du jugement est bien résumée dans le passage suivant de la Psycho-
logie du point de vue empirique :
« Quand nous disons que la représentation et le jugement cons-
tituent deux classes fondamentales distinctes d’actes psychiques,
cela signifie, d’après ce qui précède, qu’ils correspondent à deux
modes absolument différents de la conscience qu’on prend d’un
objet. Nous ne nions pas que tout jugement ait pour condition une
représentation. Nous prétendons au contraire que tout objet jugé
entre sous une double forme dans la conscience : à titre d’objet
représenté, à titre d’objet affirmé ou nié. » (BRENTANO, 2008 : 221)
À cela s’ajoute une thèse logique forte : tout jugement catégorique,
c’est-à-dire les quatre formes fondamentales de propositions que l’on
retrouve dans le carré des oppositions de la syllogistique aristotélico-
scolastique, est réductible à un jugement existentiel négatif ou positif
(Cf. BRENTANO, 2008 : 2339).
Étant donné cette théorie brentanienne du jugement, et moyen-
nant les modifications que lui apportent la distinction du contenu et de
l’objet de la représentation10, il est alors tout à fait possible de penser
l’objet en tant que représenté comme indépendant de l’existence ou de
9 Sur l’interprétation par Brentano de la syllogistique traditionnelle et les
innovations qu’il tente d’apporter à cette dernière, voir notamment SIMONS,
2004. 10 Si la théorie du jugement de Twardowski est largement inspirée de celle
de son maître, elle est loin de lui être identique. Une étude sérieuse de la
première demanderait l’analyse des cours qu’a donnés Twardowski sur la
logique durant le semestre d’hiver 1894-1895 à Vienne, ce que nous ne
pouvons faire ici. Sur ce point, cf. BETTI, 2005.
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
152
la non-existence, ces dernières constituant le « contenu du juge-
ment » (TWARDOWSKI, 1993 : 9311). Par conséquent, au niveau de la
représentation, l’objet est indépendant de son existence ou de son
inexistence, il est un pur représentable12 : « aux objets appartiennent,
dans leur ensemble, les catégories du représentable » (TWARDOWSKI,
1993 : 122). Dès lors que tout, à l’exception du rien, peut être objet de
représentation, Twardowski se croit autorisé à qualifier l’objet de
summum genus :
« Or puisque tout, sans que le sujet qui se représente y fasse
exception, peut être objet [Gegenstand], objet [Objekt] d’une repré-
sentation, c’est donc comme justifié que se montre ce qui est
soutenu par ceux qui voient dans l’objet le summum genus. Tout ce
qui est, est un objet de représentation possible ; tout ce qui est, est
quelque chose. Et c’est donc ici le point par lequel la discussion
psychologique sur la distinction de l’objet de représentation d’avec
le contenu de représentation vient déboucher sur la métaphy-
sique. » (TWARDOWSKI, 1993 : 122-123, trad. légèrement modifiée)
La distinction du contenu et de l’objet de représentation débouche
donc, pour Twardowski, « sur la métaphysique ». Mais à quelle méta-
physique avons-nous affaire ici ? Il s’agit tout simplement de la science
aristotélicienne de l’étant en tant qu’étant, identifiée à la théorie de
l’objet considéré en général, c’est-à-dire sans restriction à un type
d’objets déterminés :
« Une science qui attire dans le cercle de ses considérations tous les
objets, aussi bien ceux qui sont physiques que ceux qui sont
psychiques, ceux qui sont réels aussi bien que ceux qui sont non-
réels, ceux qui existent que ceux qui n’existent pas, et qui recherche les
lois auxquelles les objets en général – et pas seulement un groupe
déterminé d’entre eux – obéissent, voilà ce qu’est la métaphysique. C’est
le sens qui est circonscrit ici de la vénérable définition suivant laquelle la
métaphysique est la science de l’étant en tant que tel. » (TWARDOWSKI,
1993 : 125, trad. légèrement modifiée)
11 Si c’est bien le même objet qui est représenté et jugé, le contenu de la
représentation et celui du jugement, eux, ne sont pas identiques. Le contenu
est, dans le cas de la représentation, le mode de présentation de l’objet et, dans le
cas du jugement, l’existence ou l’inexistence de l’objet. 12 Soulignons que, dès lors, la théorie twardowskienne de l’objet reste une
théorie de l’objet de la représentation
Sébastien RICHARD
153
Conclusion
La théorie de l’objet à laquelle aboutit Twardowski pour
résoudre le problème des représentations sans objet n’est qu’une
ébauche embryonnaire. Ce qui la différencie de l’ontologie, de la méta-
physique et de la logique est, de plus, encore relativement flou. Mais
c’est à un autre élève de Brentano, Alexius Meinong, qu’il devait
revenir de lui donner un statut disciplinaire plus précis et de la
développer dans toute son étendue, distinguant notamment plusieurs
catégories d’objets (réels, idéaux, incomplets, impossibles, etc.), et
plusieurs modes de l’« il y a » (es gibt) de l’objet (existence, persistance,
hors-l’être).
Bibliographie
ANTONELLI M., 2009, « Franz Brentano et l’“inexistence intention-
nelle” », Philosophiques, n° 36, p. 467-487.
BENOIST J., 2001, Représentations sans objet. Aux origines de la phéno-
ménologie et de la philosophie analytique, Paris : PUF.
BENOIST J., 2002, Entre acte et sens. La théorie phénoménologique de la signifi-
cation, Paris : Vrin.
BENOIST J., 2006, « Variétés d’objectivisme sémantique », dans J. BENOIST
(éd.), Propositions et états de choses. Entre être et sens, Paris : Vrin, p. 13-49.
BETTI A., 2005, « Propositions et états de choses chez Twardowski »,
Dialogue, n° 44, p. 469-492.
BOLZANO B., 1985-1994 [1837], Wissenschaftslehre. Versuch einer
ausführlichen und grösstentheils neuen Darstellung der Logik mit steter
Rücksicht auf deren bisherige Bearbeiter, éd. J. Berg, dans B. BOLZANO,
Gesamtausgabe, I, 11-14 (12 vols.), Stuttgart-Bad Cannstatt : Friedrich
Frommann.
BOLZANO B., 2008 [1975], De la méthode mathématique, trad. D. Lelarge
et al., dans B. BOLZANO, De la méthode mathématique. Correspondance
Bolzano-Exner, Paris : Vrin, p. 67-109.
BOLZANO B., EXNER F., 2008 [1935], Correspondance Bernard Bolzano-
Franz Exner, trad. J. Croizer et al., dans B. BOLZANO, De la méthode
mathématique. Correspondance Bolzano-Exner, Paris : Vrin, p. 111-223.
BOUVERESSE J., 2000, « Sur les représentations sans objet », Les études
philosophiques, n° 4, p. 519-534.
BRENTANO Fr., 2008 [1874], Psychologie du point de vue empirique, trad.
M. de Gandillac, revue par J.-Fr. Courtine, Paris : Vrin.
BRENTANO Fr., 1974 [1930], Wahrheit und Evidenz. Erkenntnistheoretische
Abhandlungen und Briefe, Hambourg : Felix Meiner.
BRENTANO Fr., 1982, Deskriptive Psychologie, éd. R. Chisholm et W. Baum-
gartner, Hambourg : Felix Meiner.
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
154
COURTINE J.-Fr., 2007, La cause de la phénoménologie, Paris : PUF.
DE LIBERA A., 2002, La référence vide. Théories de la proposition, Paris :
PUF.
ELIE H., 2000 [1936], Le signifiable par complexe. La proposition et son
objet. Grégoire de Rimini, Meinong, Russell, Paris : Vrin.
FISETTE D., 2003, « Représentations. Husserl critique de Twardowski »,
dans D. FISETTE, S. LAPOINTE (éds.), Aux origines de la phénoménologie.
Husserl et le contexte des Recherches logiques, Paris – Québec : Vrin –
Les Presses de l’Université Laval, p. 61-91.
GILSON É., 1997, Le thomisme. Introduction à la philosophie de Saint
Thomas d’Aquin, 6e éd., Paris : Vrin.
GILSON L., 1955, La psychologie descriptive selon Franz Brentano, Paris :
Vrin.
HÖFLER A., 1890, Logik, Prague : Tempsky.
HUSSERL E., 1993 [1894], « Objets intentionnels », trad. J. English, dans
E. HUSSERL, K. TWARDOWSKI, Sur les objets intentionnels (1893-1901), Paris :
Vrin, p. 279-326.
HUSSERL E., 2002 [1913], Recherches logiques. Tome 2. Recherches pour
la phénoménologie et la théorie de la connaissance, trad. H. Elie, avec la
collaboration de L. Kelkel et R. Schérer, Paris : PUF.
LALANDE A., 1999 [1926], Vocabulaire technique et critique de la philoso-
phie, 5e éd., Paris : PUF.
LARGEAULT J., 1970, Logique et philosophie chez Frege, Paris – Louvain :
Nauwelaerts.
MAZZÙ A., 2007, « Quelques précisions à propos du “rapport inten-
tionnel” chez Franz Brentano », dans L. COULOUBARITSIS, A. MAZZÙ
(éd.), Questions sur l’intentionalité, Bruxelles : Ousia, p. 233-253.
SEBESTIK J., 1992, Logique et mathématique chez Bernard Bolzano, Paris :
Vrin.
SIMONS P., 1989, « L’intentionalité : la décennie décisive », dans D.
LAURIER, Fr. LEPAGE (éd.), Essais sur le langage et l’intentionalité, Mont-
réal-Paris : Bellarmin-Vrin, p. 17-33.
SIMONS P., 2004, « Judging Correctly : Brentano and the Reform of
Elementary Logic », dans D. JACQUETTE, The Cambridge Companion to
Brentano, Cambridge : Cambridge University Press, p. 45-65.
SMITH B., 1994, Austrian Philosophy : the Legacy of Franz Brentano, Chica-
go and LaSalle : Open Court Publishing Company.
TWARDOWSKI K., 1993 [1894], « Sur la théorie du contenu et de l’objet
des représentations », trad. J. English, dans E. HUSSERL, K. TWARDOW-
SKI, Sur les objets intentionnels (1893-1901), Paris : Vrin, p. 85-200.
155
Julien MARÉCHAL
L’objet et le système conceptuel
Introduction
Parler de grève serait-il ultimement et nécessairement parler
d’ouvriers et d’usines ? Et pourquoi pas plutôt de revendications et
d’arrêts de travail ? Plus généralement, l’objet de notre discours doit-
il être d'un certain type ? Si nos propos portent sur quelque chose,
pouvons-nous trouver des conditions générales contraignantes quant
à ce quelque chose ? Le fait qu’un individu particulier soit objet de
discours impose-t-il des contraintes sur la manière dont nous l’iden-
tifions ?
Nous entendrons ici par « objet » ce à propos de quoi un locu-
teur affirme quelque chose, la question étant de savoir si l’on peut et
doit déduire quelque chose du fait qu’il est objet de discours. Nous
examinerons de manière contrastée une tentative de détermination
de ces conditions minimales de tout objet de discours, si notre discours
doit pouvoir parler du monde. Cette tentative, marquant un renouveau
métaphysique en philosophie analytique, est due à P. F. Strawson.
Nous nous intéresserons d’abord à deux contraintes possibles rela-
tives au type fondamental de l’objet de notre discours (section 1) et
aux raisons de ces contraintes (sections 2 et 3), pour terminer par la
formulation d’une difficulté liée à la principale raison de cette
contrainte chez Strawson (section 4).
Nous réalisons ce programme en introduisant d’abord au
débat entre D. Davidson et Strawson sur la primauté ontologique des
corps matériels ou des événements, en extrayant ensuite pour chacun
une exigence fondamentale que cette primauté est censée garantir, et en
présentant enfin deux résolutions possibles (l’une synthétique, l’autre
analytique) d’une critique couramment adressée à l’approche de
Strawson. La résolution analytique permettra de déterminer et de
critiquer ce qui motive Strawson à privilégier la catégorie de corps
matériel au sein de notre appareil conceptuel.
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
156
1. Corps matériel et événement
En ce qui concerne la question des conditions minimales que
tout objet de discours doit satisfaire pour être objet de discours, la
discussion entre Strawson et Davidson est édifiante1. Strawson a
avancé, et Davidson contesté, que notre discours à propos du monde
devait nécessairement contenir in fine une référence à un corps
matériel (QUINTON, 1979 ; HARMAN, 1981 et THALBERG, 1978). Dans
une situation simple (mais cruciale) d’identification d’un « particu-
lier » (un objet de discours déterminé, un « individu »), doit-on
reconnaître que tout concept dépende dans son application, d’une
manière ou d’une autre, de la catégorie de corps matériel ? Ou peut-
on attribuer la priorité conceptuelle à une autre catégorie, ou même à
une catégorie tout court ? Nous nous intéresserons ici à ce qui presse
Strawson dans un sens, et Davidson dans l’autre sens, du point de
vue de leur modèle communicationnel, ainsi qu’à leur conception
des relations existant entre les divers concepts qui composent notre
langage.
L’ouvrage Individuals apporte une réponse métaphysique et
logico-linguistique à la question de l’organisation de nos catégories
conceptuelles (STRAWSON, 1959). Ce qui caractérise la première partie
de la réponse (qui consiste en une « métaphysique descriptive »), sur
laquelle nous nous concentrons, est le cadre discursif que Strawson
déploie : l’individuation de l’objet se réalise dans un contexte
communicationnel, une situation d’interlocution articulant les pers-
pectives du locuteur et de l’auditeur qui échangent à propos du
monde. L’usage linguistique est en effet le point de contact avec la
réalité conceptuelle que Strawson tente de systématiser (STRAWSON,
1962). Il expose à partir de là les conditions nécessaires de toute
individuation en tant qu’elles seules garantissent la communicabilité
du contenu de nos énonciations. Pour arriver à ces conditions,
Strawson imagine des situations où un objet doit être différencié de
tout autre et fait varier dramatiquement les circonstances générales,
comme avec le modèle d’un monde purement sonore ou celui d’un
monde de réduplication massive des objets (STRAWSON, 1959 : 67 sq. ;
19 sq., respectivement). La conclusion de Strawson est la suivante :
1 La structure générale du débat est la suivante : nos pratiques langagières
effectives font office d’explanandum et l’argument est qu’une catégorie
conceptuelle (celle de corps matériel selon Strawson, celle d’événement selon
Davidson) figure à titre essentiel dans l’explanans.
Julien MARÉCHAL
157
ces conditions ne peuvent que prendre la forme d’un schème concep-
tuel donnant un cadre spatio-temporel unique et stable dont les
interlocuteurs sont à chaque fois le centre à partir duquel ils peuvent
situer leur interlocuteur ainsi que l’objet du discours2. Un schème
conceptuel ne présentant pas ces traits de stabilité et d’unicité ne
pourrait garantir la communicabilité du contenu exprimé par le
locuteur. Strawson avance que deux concepts, qu’il appelle les « particu-
liers de base », garantissent la stabilité et l’unicité de notre cadre de
référence : prioritairement, le concept de corps matériel (auquel on
attribue des prédicats physiques) et, secondairement, celui de person-
ne (ce type de corps matériel auquel on attribue des prédicats physi-
ques et des prédicats psychiques (STRAWSON, 1959 : 38 sq. ; 87 sq.,
respectivement)). La démonstration de Strawson conclut donc à la
nécessité de ces deux concepts garantissant les conditions d’indivi-
duation des particuliers et donc, plus généralement, des conditions
de la communication.
Cet exercice de métaphysique descriptive n’a pas convaincu
Davidson (DAVIDSON, 1980b : 173-175). Selon ce dernier, rien n’oblige
à penser que les corps matériels constituent une catégorie fondamen-
tale ; rien n’indique qu’il y ait une quelconque asymétrie ou dépen-
dance entre ces concepts : il existe des cas où les événements permet-
tent d’identifier des corps matériels, et vice-versa. Si l’on insiste à
poser la question de la priorité entre concepts, la catégorie d’événe-
ment peut même prétendre à un statut plus fondamental dans de
nombreux contextes.
Le fossé qui les sépare est manifeste pour les contextes
d’action3. D’une part, Strawson avance qu’une attribution de respon-
sabilité n’est possible qu’en vertu de la disponibilité de la catégorie
de personne, corps matériel qui peut recevoir tant des prédicats
physiques que des prédicats psychiques. On prédique donc une
2 Un schème conceptuel s’entend chez Strawson comme un ensemble de
concepts entretenant des liens de dépendance (par exemple : appliquer le
concept d’action exige de pouvoir appliquer le concept d’intention ; appli-
quer le concept d’esprit présuppose que le concept de corps s’applique
aussi). Cependant, si certains concepts semblent souvent s’appliquer de ma-
nière concurrente, et s’ils semblent souvent présenter un lien de dépendance,
il faut s’interroger sur la nécessité de ce lien. Autrement dit, nos concepts
doivent-ils former un système ? Nous abordons cette question dans la
section 4. 3 Cf. notamment la comparaison de ces deux approches dans la quatrième
étude de RICŒUR, 1990.
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
158
action d’une personne, de ce corps matériel que je peux identifier au
sein de mon cadre de référence (STRAWSON, 1959 : 89). Du point de
vue de Davidson, l’analyse des phrases d’action montre que la
catégorie d’événements joue un rôle bien plus essentiel que celle de
corps matériel. Une action est un événement que je peux identifier
grâce aux mouvements physiques d’un agent et à ses conséquences.
Si un corps matériel est bien impliqué dans ce qui se passe, c’est
pourtant ses mouvements en tant qu’événement qui permettent de
constater que quelque chose s’est passé et que quelque chose a été
fait4.
Cependant, nous ne pouvons exagérer le versant ontologi-
que de cette discussion. Ce qui est crucial dans la situation commu-
nicationnelle d’identification du particulier, tant pour Davidson que
pour Strawson, c’est que ces corps ou événements soient localisables,
datables, mesurables, etc. Selon Davidson, il en va donc plus de leur
particularité que de leur matérialité (EVNINE, 1991 : 30). D’un point de
vue communicationnel, il est essentiel d’identifier le rôle joué par
l’objet de référence dans notre système de croyances. Davidson
produit ainsi un recadrage important : Strawson se soucie trop du
type des individus alors que ce qui est nécessaire est qu’ils soient
individuables – des objets de communication. Or rien dans l’idée
d’individuation ne semble impliquer ou présupposer l’idée de
matérialité. Quelle raison peut-on trouver à cette insistance sur le
type du particulier si l’identification ne semble pas l’exiger ?
2. Homérique
S’il est évident, tant pour Strawson que pour Davidson, que
le particulier doit pouvoir être identifié par le locuteur et l’auditeur,
pourquoi Strawson pose-t-il l’exigence supplémentaire de sa maté-
rialité ? Nous venons de suggérer que Davidson rejetait la priorité
conceptuelle en partie en vertu du fait que la situation communi-
cationnelle n’exigeait aucune catégorie conceptuelle particulière. Il
est alors tentant de raisonner de manière symétrique et de faire
remonter la préférence pour la matérialité jusqu’au modèle commu-
nicationnel de Strawson. Ce dernier ne parlait-il pas d’une « lutte
4 Il expose son critère d’identification de l’action dans DAVIDSON, 1980a : 46 ;
cf. aussi la conclusion de l’article, p. 59 : « We must conclude, perhaps with a
shock of surprise, that our primitive actions, the ones we do not do by doing
something else, mere movements of the body – these are all the actions there
are. We never do more than move our bodies : the rest is up to nature. »
Julien MARÉCHAL
159
homérique » entre son modèle et celui de Davidson (STRAWSON,
1971b : 172, notre traduction5) ? Si cette hypothèse se justifie chez
Davidson, il n’en est rien chez Strawson – c’est même l’inverse qui
semble plutôt être le cas.
Selon nous, la question de la priorité conceptuelle s’évanouit
au sein du modèle communicationnel proposé par Davidson, la
situation de l’interprète radical. Il s’agit d’une situation d’interpréta-
tion des actions linguistiques et non linguistiques d’un individu par
un interprète dans un environnement partagé sans connaissance
préalable de ses croyances et de son langage. L’individuation est un
processus d’identification de la cause d’une locution ou d’une
croyance d’un locuteur par un interprète (DAVIDSON, 2001d : 151).
Cela consiste fondamentalement en une approche par « triangula-
tion » : une ligne imaginaire tracée par la perception va du locuteur
A vers l’objet C, une autre ligne du locuteur B à C, et une dernière
ligne relie B à A. L’endroit où les deux premières lignes se rencon-
trent définit l’objet du discours. En présence de A et de C, B peut
déterminer la cause de la locution de A et la comparer aux croyances
qu’il entretient lui-même relativement à cette cause (DAVIDSON,
2001c : 105 ; DAVIDSON, 1992 : 255-256 ; pour une présentation de la
triangulation en termes de types de connaissance, voir DAVIDSON,
2001e). Toute attribution de contenu aux attitudes et phrases du
locuteur repose sur l’identification de leur cause par l’interprète et de
la relation de cette cause aux croyances de l’interprète.
Il faut remarquer que la procédure d’interprétation radicale
a des prétentions similaires à celles de la métaphysique descriptive :
« [Elle est la] seule position à partir de laquelle on puisse avoir
accès […] [aux] contenus de toute pensée portant sur une quel-
conque réalité objective […,] seule situation à partir de laquelle on
peut envisager les conditions de possibilité d’une expérience
possible. » (ENGEL, 1994 : 239)
Seule la situation de l’interprète radical, qui triangule et assigne des
attitudes propositionnelles à un locuteur en vertu de l’identification
5 Il décrit de cette manière le débat entre les défenseurs d’une approche de la
signification par les règles (Davidson) et les défenseurs d’une explication de
la signification par les intentions (P. Grice et lui-même). Selon Strawson, ces
deux positions sont irréconciliables.
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
160
de la cause de ces attitudes dans un environnement partagé6, impose
les conditions de compréhension des actions linguistiques. Et aucune
notion normative telle que « convention » ou « règle » ne doit jouer
de rôle.
De ce point de vue interprétatif, une énonciation peut se
concevoir comme un événement naturel en lien à d’autres événements
recevant une description en termes psychologiques sans devoir poser la
maîtrise d’un système conventionnel par les interlocuteurs (DAVIDSON,
2005). Interpréter cesse d’être l’exercice d’une compétence particulière
distincte de celle qui consiste à connaître et à nous orienter dans le
monde. La catégorie d’événement est donc tout adéquate pour
rendre compte de la relation du particulier à la croyance comme une
relation de cause à effet (DAVIDSON, 1980b : 178). Et de plus, les
événements se laissent facilement redécrire en vertu de leurs effets,
notamment en termes de croyances et d’objets de croyance (DAVID-
SON, 1975 : 161). Mais du point de vue de l’interprète, c’est la notion de
croyance (et celle, corrélative, de vérité) qui est nécessaire (DAVIDSON,
1975 : 170).
Lorsqu’il est question pour Strawson de donner un modèle
de la communication, il considère la reconnaissance de l’intention
ouverte du locuteur comme essentielle (STRAWSON, 19697). La signifi-
cation linguistique est expliquée en termes du locuteur signifiant
quelque chose par une énonciation adressée à un auditeur en une
occasion particulière (STRAWSON, 1964 : 155-157) ; et, corrélativement,
le langage est un système de règles pour l’accomplissement de nos
intentions de communication (STRAWSON, 1964 : 160). Cette préférence
pour les intentions (plutôt que les croyances) s’explique aisément du
point de vue des conditions nécessaires de la communication : le
schème conceptuel s’applique aux actions d’autrui (en ce compris ses
actes linguistiques) grâce à l’identification du particulier de base
qu’il est, pouvant recevoir des prédicats physiques et psychiques
6 Une attitude propositionnelle est une relation cognitive qu’un locuteur (ou
un auditeur ou un agent) entretient envers une proposition (chez Davidson,
l’attitude propositionnelle fondamentale est celle de « tenir-pour-vrai »). 7 Voir aussi sa réponse à l’article de J. McDowell : « No general elucidation of
the nature of language (of linguistic meaning or linguistic behaviour) is
possible without reference to the concept of communication-intention, of
audience-directed intentions on the part of speakers », STRAWSON, 1980 : 285.
« Ouverte » signifie que l’intention doit être publiquement reconnue comme
telle pour produire l’effet qu’elle est censée produire en tant qu’intention de
communication.
Julien MARÉCHAL
161
(une personne). Mais appliquer aux idées de Strawson l’hypothèse
d’une détermination de l’organisation de nos concepts à partir du
modèle communicationnel ne mène nulle part, sinon à infirmer cette
hypothèse : son modèle communicationnel, basé sur la reconnais-
sance d’intention, apparaît suivre harmonieusement l’exigence d’iden-
tification d’un corps matériel pour l’attribution d’une intention et, par
la suite, d’une énonciation.
Chez Strawson, si le modèle de communication ne détermine
de lui-même aucune priorité conceptuelle, la réussite d’un échange est
ultimement conditionnée par la disponibilité d’un certain concept :
l’identification et la réidentification ne sont possibles qu’à l’intérieur
d’un cadre de référence unique et stable, lui-même dérivé de la
représentation fondamentale d’une relation entre tous les corps
matériels qui n’apparaît intelligible qu’en vertu de la catégorie de
corps matériel. Ce qui présuppose la matérialité ultime des parti-
culiers à propos desquels nous parlons, c’est cette idée naturelle que
nous avons « de toute chose matérielle étant spatialement reliée à
chaque moment à tout autre à tout moment » (STRAWSON, 1959 : 35,
notre traduction). En conséquence, si Strawson prend comme point
de départ l’usage du langage en situation, et, plus précisément dans
ce cas, l’usage du langage en vue de l’identification d’un particulier,
la catégorie de corps matériel rend compte d’une représentation
fondamentale. Elle supporte une idée essentielle à notre conduite
dans le monde. L’exposition de la structure de notre expérience du
monde découle ainsi d’une exigence d’intelligibilité de nos idées et
croyances fondamentales, ces croyances qui reflètent la nature
humaine, ses besoins et sa situation (STRAWSON, 1966 : 44). Au fond,
le processus paradigmatique fixant les conditions minimales de toute
identification semble différent chez Davidson et Strawson. Comme
nous venons de le voir, l’objectivité de l’identification est garantie
dans un cas par la situation d’interaction elle-même, et dans l’autre
par la possession du schème conceptuel. Mais le modèle d’iden-
tification présente une différence importante.
D’une part, la triangulation demande d’identifier un objet
comme étant la même cause de l’attitude du locuteur et de l’attitude
de l’interprète. Le modèle communicationnel de Davidson articule
essentiellement la perspective du locuteur et celle de l’interprète8.
D’autre part, l’identification chez Strawson « implique de penser que
8 Ces deux perspectives articulent à leur tour trois types de connaissance :
subjective, intersubjective et objective (DAVIDSON, 2001e).
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
162
quelque chose est le même » (STRAWSON, 1959 : 31, notre traduction,
notre emphase) ; mais au sens où le schème conceptuel permet
d’identifier ce quelque chose comme étant le même, encore. Ainsi, le
fait que l’objet puisse être réidentifié est essentiel dans les deux cas
(ce qui est indiqué par le terme « même »), mais la modalité de
réidentification chez Strawson est d’abord celle de la continuité
d’une occasion à une autre (« encore »). Du point de vue de chaque
interlocuteur, le schème stabilise l’expérience du monde. De manière
lapidaire, la condition d’identification de l’interprète radical est la
simultanéité de l’expérience, alors que chez Strawson, c’est la conti-
nuité de l’expérience qui importe. Et si la continuité de l’expérience
est le critère final, il semble intuitif de dire que les corps matériels
ont une certaine priorité sur les événements.
3. Vocabulaire
La matérialité est introduite par Strawson comme ce qui
seule peut garantir qu’il y ait quelque chose comme une continuité
de notre expérience du monde, et donc qui offre la possibilité d’une
structure ou d’une cohérence à notre expérience du monde, mais
aussi à l’ensemble de nos concepts. Du point de vue de Strawson, le
modèle de l’interprète radical ne peut rendre compte de cette
cohérence, qu’elle soit cognitive ou conceptuelle. Si les interlocuteurs
déterminent chacun en situation un ensemble de croyances relatif à
l’objet de discours (un ensemble que nous appellerons un système
cognitif), ce qui garantit selon Strawson l’identification de l’objet de dis-
cours (qui supporte chaque système cognitif) est un système conceptuel.
Que le système conceptuel ait une telle importance pour la constitution
de tout système cognitif a été vivement critiqué.
Le cas du sceptique est particulièrement édifiant à cet égard9.
Selon Strawson, le sceptique qui remet en question l’objectivité de
notre expérience du monde rejette en fait le schème à l’intérieur
même duquel il formule son doute (STRAWSON, 1959 : 35). Dans la
mesure où un doute ne peut prendre place qu’à l’intérieur du
schème conceptuel, ce doute ne pourrait remettre en cause une idée
qui est constitutive du schème. Strawson considère que le sceptique
9 Pour ce thème et les critiques traditionnellement adressées à Strawson sur
ce point, voir PUTNAM, 1998 : 280-281 ; ainsi que le collectif Langage ordinaire
et métaphysique : Strawson de manière générale (BENOIST, LAUGIER, 2005).
Julien MARÉCHAL
163
ne comprend pas les conditions de possibilité de l’expression même
de son doute et qu’il se rend donc lui-même inintelligible.
Mais en offrant une sorte de déduction de nos catégories de
pensée fondamentales, comme celle de corps matériel, en réponse à
un défi adressé à nos croyances naturelles, comme celle relative à
l’existence du monde, Strawson marierait du même coup Hume à
Kant, mariage difficile, produisant un balancement entre une exigence
transcendantale et un naturalisme, entre une démarche déductive et
une démarche assertorique purement descriptive de nos usages langa-
giers (BENOIST, LAUGIER, 2005 : 85-116). Le reproche est que Strawson
utilise l’idée de schème conceptuel pour fonder l’objectivité de notre
expérience du monde et de nos pratiques langagières.
Nous considérerons deux résolutions possibles, mais antithé-
tiques, de cette tension générale perçue entre le système conceptuel
et le système cognitif. La première consiste à opter pour la notion de
« vocabulaire » qui élimine l’idée de schème conceptuel. La seconde
propose de différencier des niveaux de description internes au schème
conceptuel pris dans une acceptation large et à revoir ensuite la
prétention à la réfutation du sceptique en fonction de ces niveaux (cf.
section 4). De ce point de vue, il apparaîtra que le reproche ci-dessus
doit être qualifié.
La notion de « vocabulaire » due à R. Rorty incorpore dif-
férentes critiques de l’empirisme menant à l’abolition des distinc-
tions tranchées entre énoncé analytique et énoncé synthétique, entre
signification et croyance (BRANDOM, 2000 : 159), ou encore entre
schème conceptuel et contenu. Selon cette dernière critique formulée
par Davidson (2001b), l’idée de schème, au sens d’une structure de
croyances ou de concepts, organisant un contenu indépendant (une
expérience ou un donné quelconque) est inutile : si l’idée de la
possession d’un schème ne prend sens que par opposition à un autre
schème, les conditions mêmes de l’interprétation radicale limitent
toute identification d’un schème radicalement autre. En consé-
quence, l’idée du langage comme d’un medium ou tertium, comme ce
qui ce qui nous permet de structurer notre expérience du monde, est
abandonnée. Reprenant la perspective de l’interprète radical et
rejetant cette idée de structure intermédiaire entre les locuteurs et le
monde, Rorty (par ex. 1991 : 166) considère qu’un vocabulaire est un
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
164
« outil », une stratégie d’orientation, d’adaptation et de survie d’un
organisme dans son environnement10.
La notion de vocabulaire a connu récemment un développe-
ment important dans les travaux de R. Brandom pertinent pour notre
propos. Brandom mobilise le modèle de l’interprète radical et la
notion de vocabulaire dans le cadre d’une « métaphysique systémati-
que », entendue comme un effort consistant à produire « un vocabu-
laire dans lequel tout peut être dit » (voir BRANDOM, 2000 : 180-181).
Brandom entreprend une explication de ce qui nous caractérise
comme des sujets rationnels, connaissant et agissant, qui font preuve
d’une autorité et d'une responsabilité dont dépendent leurs asser-
tions en situation de communication (BRANDOM, 1994). Ce point de
départ pragmatique exige ainsi de détailler la structure particulière
de nos pratiques sociales qui permet d’identifier les types de contenu
que ces pratiques confèrent à nos attitudes et à nos actes de parole.
Cela implique d’exclure tout recours essentiel au concept de
représentation, de systématiser la relation de l’usage à la significa-
tion, et d’arriver à une complétude expressive (« un vocabulaire dans
lequel tout peut être dit »). L’hypothèse fondamentale est donc
qu’une telle explicitation pourrait être atteinte par l’usage d’un voca-
bulaire autre que le langage ordinaire, dans lequel « tout pourrait
être dit ».
Dans ce cadre, il suggère un programme d’élaboration d’une
logique des relations entre signification et usage permettant de déter-
miner des relations entre vocabulaires via les pratiques suffisantes
pour les doter d’un contenu (BRANDOM, 2008 : 7 sq.). Ce programme
est ainsi une reprise pragmatiste du projet analytique d’explicitation
des relations sémantiques entre différents vocabulaires (physique,
psychique, normatif, factuel, etc.11). Ces relations prennent notamment
la forme d’une pratique qui serait condition suffisante du
« déploiement » d’un vocabulaire, ou d’un vocabulaire qui serait
condition suffisante de la « spécification » d’une pratique. L’hypo-
thèse est qu’il est possible d’examiner les relations entre nos vocabu-
laires et nos pratiques de manière générale et de les ordonner en
vertu de leur puissance expressive. Ce faisant, Brandom rejoint la
10 Pour l’analogie entre vocabulaires et outils, cf. RORTY, 1989 : 11, 12, 21 et
55 ; pour l’analogie entre vocabulaire et stratégie d’orientation et de survie
(coping with), cf. RORTY, 1991 : 1, 5 et 120. 11 Un projet qui a été dominé durant l’époque analytique classique par
l’empirisme et le naturalisme en tant que « vocabulaires de base » (BRAN-
DOM, 2008 : 2).
Julien MARÉCHAL
165
réponse de Strawson à une attitude à la Wittgenstein qui se limiterait
à une simple observation des usages ou qui limiterait par principe
toute entreprise de mise en relation systématique des différents jeux
de langage12. Tous deux s’accordent ainsi sur la nécessité de dépasser
la simple description pour une systématisation qui expose la struc-
ture de nos concepts et vocabulaires (BRANDOM, 2008 : 4-7 ; BRAN-
DOM, 1994 : XII-XIII, 29, 74-76, 187 et 343 ; STRAWSON, 1963 : 51813).
Cependant, le programme de Brandom n’est réalisable qu’en
construisant un vocabulaire artificiel lié à un modèle idéal de
communication (BRANDOM, 1994 : XXIII). Or Strawson met en garde
contre l’usage de modèles idéaux, car ils produisent « une sorte
d’aveuglement sélectif qui supprime une grande partie du champ »
d’investigation (bien qu’il ajoute immédiatement : « mais qui en
laisse ressortir une partie avec un éclat tout particulier » (STRAWSON,
1963 : 515, notre traduction)) :
« Le producteur de paradoxe philosophique, ou celui qui souffre de
perplexité philosophique, est temporairement dominé par un mode
d’opération logique des expressions, ou par une manière d’utiliser
le langage, ou par un type logique ou catégorie d’objet, ou par une
sorte d’explication, ou par un ensemble de cas d’applications d’un
concept donné ; et tente d’observer, d’expliquer quelque chose qui
est différent, en termes de, ou en analogie à, son modèle favori. »
(STRAWSON, 1963 : 515, notre traduction)
S’il formule surtout cette critique contre les projets de traduction et
de paraphrase idéale (dus aux « constructionnistes »), elle s’applique
à tous les cas-modèles, en ce compris le modèle de l’interprète
radical. Le « philosophe critique » (le métaphysicien descriptif) se
doit de restaurer un équilibre entre les fonctionnements de nos con-
cepts tels que décrits par un système formel et tels qu’ils fonc-
tionnent effectivement.
12 Un exemple de cette attitude wittgensteinienne se retrouve chez Putnam :
« In everyday language we employ many different kinds of discourses,
discourses subject to different standards and possessing sorts of applications,
with different logical and features – different “language games” in Wittgen-
stein’s sense – […] it is an illusion that there could be just one sort of language
game which could be sufficient for the description of all of reality ! » (PUTNAM,
2004 : 21-22). 13 Et tous les deux insistent sur le fait que cette structure évolue en fonction
de nos pratiques : STRAWSON, 1966 : 44 ; BRANDOM, 2000 : 181.
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
166
Deux observations découlent de cette mise en garde. Premiè-
rement, au-delà du fait que cette notion de vocabulaire est en total
porte-à-faux avec les thèses de Strawson14, du point de vue de la
question de l’exposition de nos concepts et vocabulaires, la notion
dépend fondamentalement du modèle communicationnel de l’inter-
prète radical15. Et, en l’état, ce modèle est incapable de rendre compte
de la stabilité de notre cadre de référence (cf. supra, section 2) : la
question de la priorité conceptuelle ne peut être éludée. Deuxième-
ment, bien que la logique des relations entre vocabulaires et
pratiques de Brandom tente précisément de rendre compte de la
priorité de tel vocabulaire sur tel autre, un tel programme participe
du point de vue de Strawson d’une entreprise de traduction ou de
paraphrase formelle de notre langage ordinaire, une construction
d’un vocabulaire alternatif et artificiel qui représente tout au plus un
but accessoire du programme analytique (STRAWSON, 1963 : 513) : le
point de départ doit nécessairement être l’usage normal de nos
expressions, et non un modèle idéal16. Selon Strawson, le schème
conceptuel produit par le philosophe doit pouvoir être reconnu
comme étant le nôtre.
14 Cf. par exemple sa défense avec Grice de la distinction entre analytique et
synthétique, GRICE, STRAWSON, 1966. 15 Nous trouvons une instanciation de cette idée chez J. Habermas, qui a
formulé des critiques reposant en partie sur les conséquences réductionnis-
tes de l’usage du modèle de l’interprète radical chez Brandom. Chez ce
dernier, le processus langagier serait conçu de façon « hyperthéorique », la
communication tendant à se réduire à une relation épistémique. Lorsque
Brandom thématise le rôle de la deuxième personne par sa capacité à
« apprécier » l’acte de parole d’autrui (BRANDOM, 1994 : 61) plutôt que par sa
capacité à y répondre – par oui, par non, ou encore en s’abstenant –, il aurait
tendance à négliger la spécificité de l’attitude performative de tout
participant à la communication, et donc à la confondre avec le point de vue
objectif de l’observateur. Or, selon Habermas, sans la réponse d’un interlo-cuteur, aucun engagement ne peut être pris pour les suites de l’interaction :
la responsabilité pratique ne peut se réduire, du point de vue du participant,
à la responsabilité épistémique (HABERMAS, 2001 : 120). Cependant, pour
Strawson, à la différence d’Habermas, un modèle communicationnel ne peut
encore être une base suffisante pour rendre compte de nos pratiques
langagières. 16 C’est ainsi que Brandom construit d’abord sa logique des vocabulaires
pour ensuite la retrouver à l’œuvre dans les pratiques effectives, BRANDOM,
2008 : 180.
Julien MARÉCHAL
167
4. Necessitatum
Les notions de « vocabulaire » ou de « schème conceptuel »,
sous la plume de Rorty, Davidson ou Brandom, ne peuvent faire
justice aux analyses de Strawson. En conséquence, une seconde voie
consiste à différencier ce que leur modèle communicationnel dis-
sout17. La notion de schème conceptuel est complexe ; il est instructif
de la déployer. La citation suivante articule déjà différentes notions à
distinguer de la notion de schème conceptuel :
« Au moyen de références identifiantes, nous agençons les rapports
et histoires d’autres personnes avec les nôtres à l’intérieur de
l’histoire unique de la réalité empirique ; et cet agencement, cette
connexion, repose ultimement sur la mise en relation de particu-
liers qui figurent dans ces histoires au sein du système spatio-
temporel que nous occupons nous-mêmes. » (STRAWSON, 1959 : 29,
notre traduction)
Nous avons déjà distingué entre système cognitif et système concep-
tuel : un système cognitif est un ensemble de jugements ou de
croyances interdépendants générés dans une situation particulière (un
« rapport » ou une « histoire », dans les termes de Strawson). Par
contre, un système conceptuel est un ensemble de concepts organisé
en fonction des asymétries et liens de dépendance qu’ils entretiennent.
D’un côté, la notion de système cognitif peut encore être précisée : il
peut s’agir soit d’un système cognitif individuel, soit d’un système
cognitif socialement intégré (« l’unique histoire sur la réalité empiri-
que »). De l’autre, nous distinguons l’idée de système conceptuel de
celle de schème conceptuel au sens large dans la mesure où la première
intègre des concepts en une structure de dépendance et la seconde
comprend des croyances fondamentales reflétant notre situation dans le
17 Nous suivons ainsi une stratégie de désimplication que J. L. Austin a utilisée
dans un autre contexte (la question des idées innées) : « We may distinguish
several questions : Do I know the meaning of the word x ? Do I know that
there are x’s ? Do I know that there is an x here ? Do I know that this is the x
which is here ? » (AUSTIN, 1979a : 46 n. 1). Par opposition à la section précé-
dente qui a exposé une solution synthétique à la tension critiquée entre le
système conceptuel et le système cognitif via la notion de vocabulaire, la
présente section emprunte une voie analytique permettant d’identifier
différents plans argumentatifs chez Strawson oblitérés par la solution syn-thétique.
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
168
monde (des « croyances naturelles », telle que : « Il existe un monde
extérieur »).
La notion de cadre de référence (framework ou network) est
encore différente : elle consiste en un système de relations entre
particuliers indexé par le point de référence qu’est chaque sujet (un
système de référence). Et ce système de référence sous-tend tout
système cognitif individuel. Par extrapolation, un système sociale-
ment intégré est sous-tendu par un cadre de référence intégré, c’est-
à-dire un système de référence qui correspond à l’idée « de toute
chose matérielle étant spatialement reliée à chaque moment à tout
autre à tout moment » (STRAWSON, 1959 : 35, notre traduction). En
conséquence, en usant du terme « schème conceptuel », il est aisé de
faire entrer croyances, concepts et cadre de référence sous un même
chapeau. Si cette idée générale est parfois utile (comme ce qui orga-
nise et supporte tout système cognitif partageable), mais si son abus
a été justement critiqué par Davidson (comme dans l’identification de
schèmes radicalement autres), chaque niveau de description (système
cognitif, système conceptuel, système de référence) dispose d’une
fonction propre.
Il semble qu’un défi sceptique puisse être articulé à diffé-
rents niveaux18. Par exemple, la formulation du défi sceptique dans
Individuals concernait la question de la réidentification (STRAWSON,
1959 : 31 sq.) : étant donné un individu dans un système cognitif et ce
que nous avons identifié comme le même individu dans un autre
système cognitif, ne peut-on pas toujours douter qu’il s’agisse en fait
du même individu dans l’un et dans l’autre système ? L’idée est que
ce doute n’est possible qu’en possession d’un critère d’identité qui
permet de relier les deux systèmes cognitifs, ce que le sceptique met
justement en doute. Autrement dit, il n’est possible de douter que
des individus rencontrés en différentes occasions soient en fait le
même que si ces différentes occasions ne sont pas indépendantes. La
question de la réidentification est liée à une relation entre différents
systèmes cognitifs garantie par la stabilité d’un système de référence
les sous-tendant, sans que la réponse à ce défi offre une justification
de nos pratiques.
Un second défi est la réduplication massive des particuliers à
propos desquels nous parlons (STRAWSON, 1959 : 19). Une descrip-
18 Cela va dans le sens de l’idée d’une variété de scepticismes (STRAWSON,
1985) bien que les types qu’il aborde dans cet ouvrage diffèrent de ceux que
nous identifions ici.
Julien MARÉCHAL
169
tion en des termes généraux ne peut éliminer le doute portant sur
l’identification du particulier : il est toujours possible que tel particulier
satisfasse la description alors que c’est tel autre particulier, satisfaisant
lui aussi la description, qui était visé par le locuteur. Aucune connais-
sance ne peut suffire pour éliminer ce doute. Le succès de l’identi-
fication est garanti par la localisation unique de ce particulier dans un
système de référence unique (STRAWSON, 1959 : 20-22). Dans ce cas,
c’est l’unicité du système de relations spatio-temporelles qui répond
au défi sceptique.
Mais un défi sceptique quant à l’existence du monde dans
son ensemble, et un défi relatif aux raisons d’avoir telle ou telle
croyance sont d’un autre genre contre lequel la notion de système
conceptuel est impuissante (voir STRAWSON, 1985 : 2 et 21-22). Le
système conceptuel peut seulement répondre à un souci d’intelligibi-
lité (de cohérence) de l’ensemble de croyances naturelles, pas le
justifier ou le fonder. L’exposition du système conceptuel ne fournit
aucune raison, mais montre seulement le sens de ces croyances
naturelles du point de vue de nos concepts, c’est-à-dire la manière
dont ils sont liés à des concepts. Loin de sombrer dans l’absurdité, le
discours du sceptique acquiert en fait une intelligibilité minimale
grâce au système conceptuel, sans que son défi présente d'intérêt
pour la raison humaine (STRAWSON, 1999 : 291). Le système concep-
tuel sert ainsi à dévoiler des présuppositions conceptuelles, non des
présuppositions sémantiques ou pratiques (des conduites et des
croyances naturelles). Cela implique une retraite du point de vue des
premières accusations d’absurdité trouvées dans Individuals, mais
c’est une retraite que Strawson a néanmoins acceptée (STRAWSON,
1999 : 292). En conséquence, si le schème conceptuel est utilisé de
manière indifférenciée et à dessein justificatif, la tension critiquée
apparaît inévitablement.
Cependant, malgré ce traitement analytique de l’idée de
schème conceptuel, toute difficulté n’est pas éliminée. Sans la catégorie
de corps matériel en tant que particulier tridimensionnel restant iden-
tique à lui-même à travers le temps, il ne pourrait être question en une
occasion d’identifier tel objet comme étant le même qu’en telle autre
occasion. Si un sujet construit un système cognitif en une occasion
donnée, composé de croyances reliées les unes aux autres relatives à
tel ou tel particulier, mais qu’il ne dispose pas de la catégorie de
corps matériel, il lui serait impossible de relier ce système à tout autre
système qu’il construirait à un moment ultérieur. La possibilité d’inté-
grer nos systèmes cognitifs à travers le temps est soumise à la disponi-
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
170
bilité d’un système conceptuel fondé sur la catégorie de corps matériel,
c’est-à-dire d’« objets relativement constants entretenant les uns avec les
autres des relations spatiales relativement fixes ou régulièrement
changeantes » (STRAWSON, 1959 : 53). Donc, d’une part, cette catégorie
permet de relier nos systèmes cognitifs en un système intégré unique ;
d’autre part, cette intégration n’est possible qu’en vertu de l’idée de la
persévérance du corps matériel qui donne une stabilité au cadre de
référence :
« Une condition de notre possession de ce schème conceptuel est
l’acceptation inconditionnelle de l’identité des particuliers dans au
moins certains cas d’observation discontinue. » (STRAWSON, 1959 : 35,
notre traduction)
La priorité de la catégorie de corps matériel est donc attribuée en
vertu de l’unité et de la stabilité qu’elle confère à nos systèmes cogni-
tifs ; et la revendication est qu’elle seule est apte à produire un
système de référence unique et stable pour l’expérience du monde.
Ces deux propriétés de la catégorie de corps matériel relatives à la
construction des systèmes cognitifs se complètent par une troisième :
la catégorie confère une cohérence à notre système conceptuel dans
son ensemble. La catégorie est « fondamentale » parce que les autres
catégories conceptuelles en dépendent ultimement pour leur applica-
tion. C’est ainsi que l’application de la catégorie d’événement présup-
pose la catégorie de corps matériel (STRAWSON, 1959 : 52).
In fine, Strawson s’intéresse à la structure de l’expérience du
point de vue du sujet, et tente de donner une défense de l’expérience
subjective dans toute sa richesse (voir la réponse à Putnam dans
STRAWSON, 1998 : 292). Il ne vise qu’une condition de cohérence, exigence
d’interdépendance de nos concepts. Ainsi,
« la tâche de la philosophie analytique [consiste à…] établir les
connexions entre les caractéristiques et éléments structurels
majeurs de notre schème conceptuel – l’exposer, non pas comme un
système déductif rigide, mais comme un tout cohérent dont les
parties se supportent mutuellement, et sont mutuellement dépen-dantes, s’encastrant de manière intelligible. » (STRAWSON, 1985 : 23,
notre traduction)
On ne pourrait trop insister sur cette troisième condition : pour
Strawson, les concepts doivent s’agencer entre eux et former un sys-
Julien MARÉCHAL
171
tème (même s’il est moins que déductif), sans quoi les autres condi-
tions ne peuvent tenir.
Ce qui est critiquable dans cette idée est que la cohérence du
système conceptuel fonctionne comme un necessitatum19. J. L. Austin a
formulé une critique de cette idée lors d’une discussion du vocabulaire
de l’action :
« On doit se souvenir qu’il n’y a aucune nécessité à ce que les
divers modèles utilisés en créant un vocabulaire, ancien ou récent,
doivent tous s’agencer correctement en un modèle ou schème
unique et total, par exemple, de la réalisation des actions. Il est
possible, et en effet très probable, que notre assortiment de modèles
en inclura certains, ou beaucoup, qui se recouvrent, entrent en
conflit, ou plus généralement sont simplement disparates20. »
Selon Austin, le langage ordinaire contient des modèles. Ces modèles
sont des représentations de comment les choses se passent. Austin
partage avec Strawson l’idée que les faits relatifs à l’usage du langage
ordinaire disposent d’un privilège par rapport aux usages créés par
les philosophes. Mais il ne s’ensuit pas pour autant que ces modèles
« naturels » du langage ordinaire soient toujours adéquats (AUSTIN
1979b : 185) : un modèle peut ne pas nous être utile et peut amener à
mal représenter les faits. Malgré ces mises en garde, Austin considère
qu’en tant que constructions, les modèles peuvent néanmoins nous
aider à examiner les faits relatifs à la pensée, à l’action, au langage, à la
sensation, ou autre.
19 D’autres exigences pourraient être associées au projet de description du
système conceptuel : simplicité, complétude, etc. ; et de telles exigences
peuvent avoir un autre statut, comme celui de desideratum. Pour ces considé-
rations appliquées au système cognitif, voir RESCHER, BRANDOM, 1980 : 137. 20 AUSTIN, 1979b : 203. Et il continue en note : « This is by way of general
warning in philosophy. It seems to be too readily assumed that if we can
only discover the true meanings of each of a cluster of key terms, usually
historic terms, that we use in some particular field (as, for example, “right”,
“good” and the rest in morals), then it must without question transpire that
each will fit into place in some single, interlocking, consistent, conceptual
scheme. Not only is there no reason to assume this, but all historical
probability is against it, especially in the case of a language derived from
such various civilizations as ours is. We may cheerfully use, and with
weight, terms which are not so much head-on incompatible as simply
disparate, which just do not fit in or even on. Just as we cheerfully subscribe
to, or have the grace to be torn between, simply disparate ideals – why must
there be a conceivable amalgam, the Good Life for Man ? »
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
172
Mais à moins d’être ramenés à un modèle fondamental
(comme Brandom tente de le faire, cf. supra), ces modèles ne forment
pas nécessairement un système : ils n’entretiennent pas nécessaire-
ment des liens de compatibilité, ou d’incompatibilité, mais sont peut-
être simplement différents. La difficulté de la position de Strawson
est ici de poser qu’il est nécessaire, pour expliquer la richesse de
notre expérience du monde, que ces concepts et les modèles qu’ils
mobilisent s’intègrent en un système. La thèse de la cohérence du
système conceptuel exige que tout modèle dépende du modèle de
l’expérience du corps matériel. Or, tant du point de vue de l’interprète
radical que de celui d’Austin, il s’agit là d’un cas d’« aveuglement
sélectif ». Si le modèle communicationnel de l’interprète radical sous-
détermine notre système conceptuel, tant du point de vue de Davidson
que d’Austin, l’idée de système conceptuel surdétermine la structure de
nos pratiques langagières. Une fois l’exigence de matérialité dérivée de
la cohérence du système conceptuel, appliquer la critique d’Austin
revient donc à reconnaître que Strawson impose indûment un type aux
objets de nos discours.
De plus, faire de la cohérence du système conceptuel un
necessitatum place Strawson dans une position difficile. Nous avons vu
que le programme de Brandom consistait à prendre un vocabulaire
artificiel et à l’appliquer à tous les vocabulaires. En un mot, la systé-
matisation est possible parce qu’il existe un modèle idéal suffisant
pour permettre une analyse des vocabulaires : la systématisation va
de pair avec l’« aveuglement sélectif ». Mais Strawson se met en
difficulté en critiquant l’utilisation de modèles idéaux et en exigeant
la systématisation des divers modèles utilisés. Strawson se laisse
enfermer par deux décisions difficilement conciliables : rendre acces-
soire la construction de cas idéaux et faire de la cohérence du sys-
tème conceptuel un necessitatum.
Conclusion
La matérialité est-elle une condition minimale à remplir
pour être un objet de discours ? Nous avons vu comment le débat
entre Strawson et Davidson articule des catégories différentes, corps
matériel ou événement, en tant que ces catégories satisfont à des
conditions réputées nécessaires de tout discours sensé. Si la situation
d’interlocution est le point de départ de leurs investigations, c’est
soit une exigence de convergence des attitudes sur une cause com-
mune, soit une exigence de continuité de l’expérience qui prime au
Julien MARÉCHAL
173
final. Selon Strawson, seule la matérialité de l’objet de discours peut
garantir ce dernier aspect de l’expérience empirique. Et à cette
continuité de l’expérience correspond la cohérence de nos concepts,
c’est-à-dire l’idée de schème – l’idée que nos concepts sont organisés.
Mais cette cohérence, en tant que nécessité, surdétermine les relations
pouvant exister entre nos concepts et, en conséquence, surdétermine
aussi la structure de nos pratiques langagières. Cela donne des raisons
de penser que l’exigence de matérialité n’est pas nécessairement une
condition minimale de tout objet de discours.
Bibliographie
AUSTIN J. L., 1979a, « Are There A Priori Concepts ? », dans J. O. URMSON,
G. J. WARNOCK (éd.), Philosophical Papers, Oxford : Oxford University
Press, p. 32-54.
AUSTIN J. L., 1979b, « A Plea for Excuses », dans J. O. URMSON,
G. J. WARNOCK (éd.), Philosophical Papers, Oxford : Oxford University
Press, p. 175-204.
BENOIST J., LAUGIER S. (éd.), 2005, Langage ordinaire et métaphysique :
Strawson, Paris : Vrin.
BRANDOM R., 1994, Making it explicit : Reasoning, representing and dis-
cursive commitment, Cambridge : Harvard University Press.
BRANDOM R., 2000, « Vocabularies of Pragmatism : Synthesizing
Naturalism and Historicism », dans R. BRANDOM (éd.), Rorty and
His Critics, Malden : Blackwell Publishing, p. 156-183.
BRANDOM R., 2008, Between Saying and Doing. Towards an Analytic
Pragmatism, Oxford : Oxford University Press.
DAVIDSON D., 1980a, « Agency », dans D. DAVIDSON, Essays on Actions
and Events, Oxford : Clarendon Press, p. 43-62.
DAVIDSON D., 1980b, « The Individuation of Events », dans D. DAVID-
SON, Essays on Actions and Events, Oxford : Clarendon Press, p. 163-180.
DAVIDSON D., 1992, « Jusqu’où va le caractère public d’une langue ? »,
trad. P. Klossowski, dans J. SEBESTIK, A. SOULEZ (éd.), Wittgenstein et la
philosophie aujourd’hui, Paris : Méridiens Klinskieck, p. 241-259.
DAVIDSON D., 2001a, « Thought and Talk », dans D. DAVIDSON, Inquiries
into truth and interpretation, Oxford : Clarendon Press, p. 155-170.
DAVIDSON D., 2001b, « On the Very Idea of a Conceptual Scheme »,
dans D. DAVIDSON, Inquiries into truth and interpretation, Oxford :
Clarendon Press, p. 183-198.
DAVIDSON D., 2001c, « Rational Animals », dans D. DAVIDSON, Sub-
jective, Intersubjective, Objective, Oxford : Clarendon Press, p. 95-106.
DAVIDSON D., 2001d, « A Coherence Theory of Truth and Knowledge »,
dans D. DAVIDSON, Subjective, Intersubjective, Objective, Oxford : Claren-
don Press, p. 137-153.
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
174
DAVIDSON D., 2001e, « Three Varieties of Knowledge », dans D. DAVID-
SON, Subjective, Intersubjective, Objective, Oxford : Clarendon Press,
p. 205-220.
DAVIDSON D., 2005, « A Nice Derangement of Epitaphs », dans
D. DAVIDSON, Truth, Language, and History, Oxford : Clarendon Press,
p. 89-108.
ENGEL P., 1994, Davidson et la philosophie du langage, Paris : PUF.
EVNINE S., 1991, Donald Davidson, Standford : Standford University
Press.
GRICE P., STRAWSON P. F., 1956, « In Defense of a Dogma », The Philo-
sophical Review, vol. 65, p. 141-158.
HABERMAS J., 2001, « De Kant à Hegel : la pragmatique linguistique
de Robert Brandom », dans J. HABERMAS, Vérité et justification, trad.
R. Rochlitz, Paris : Gallimard, p. 81-124.
HARMAN G., 1981, « The Essential Grammar of Action (and other) Senten-
ces », Philosophia, vol. 10, p. 209-216.
MCDOWELL J., 1980, « Meaning, Communication, and Knowledge »,
dans Z. VAN STRAATEN (éd.), Philosophical Subjects : Essays Presented
to P. F. Strawson, Oxford : Clarendon Press, p. 117-139.
PUTNAM H., 1998, « Strawson and Skepticism », dans L. E. HAHN (éd.),
The Philosophy of P. F. Strawson, Chicago and LaSalle : Open Court Pu-
blishing Company, p. 273-287.
PUTNAM H., 2004, Ethics Without Ontology, Cambridge : Harvard
University Press.
QUINTON A., 1979, « Objects and Events », Mind, vol. 88, p. 197-214.
RESCHER N., BRANDOM R., 1980, The Logic of Inconsistency : A Study in
Non-Standard Possible-World Semantics and Ontology, Oxford : Black-
well Publishing.
RICŒUR P., 1990, Soi-même comme un autre, Paris : Éd. du Seuil.
RORTY R., 1989, Contingency, Irony, and Solidarity, Cambridge : Cam-
bridge University Press.
RORTY R., 1991, Objectivism, Relativism, and Truth. Philosophical Papers,
Volume 1, Cambridge : Cambridge University Press.
STRAWSON P. F., 1959, Individuals. An Essay in Descriptive Metaphysics,
London : Methuen.
STRAWSON P. F., 1962, « Analyse, science et métaphysique », Cahiers de Royau-
mont. La philosophie analytique, Paris : Éd. de Minuit, p. 105-118.
STRAWSON P. F., 1963, « Carnap on Constructed Systems Versus Natural
Languages in Analytic Philosophy », dans P. A. SCHILPP (éd.), The
Philosophy of Rudolf Carnap, La Salle : Open Court, p. 503-518.
STRAWSON P. F., 1966, The Bounds of Sense : An Essay on Kant’s Criti-
que of Pure Reason, London : Methuen.
STRAWSON P. F., 1971a, « Intention and Convention in Speech Acts »,
dans P. F. STRAWSON, Logico-Linguistic Papers, Methuen : London,
p. 149-169.
Julien MARÉCHAL
175
STRAWSON P. F, 1971b, « Meaning and Truth », dans P. F. STRAWSON,
Logico-Linguistic Papers, London : Methuen, p. 170-189.
STRAWSON P. F., 1980, « P. F. Strawson Replies », dans Z. VAN STRA-
ATEN (éd.), Philosophical Subjects : Essays Presented to P. F. Strawson,
Oxford : Clarendon Press, p. 260-296.
STRAWSON P. F., 1985, Skepticism and Naturalism : Some Varieties, London :
Methuen.
STRAWSON P. F., 1998, « Reply to Hilary Putnam », dans L. E. HAHN
(éd.), The Philosophy of P. F. Strawson, Chicago : Open Court, p. 288-
292.
THALBERG I., 1978, « The Irreducibility of Events », Analysis, vol. 38,
p. 1-9.
179
Fabian BALTHAZART
La lente émancipation de l’orchestre dans
le motet à grand chœur versaillais
Introduction
« Le Roi est mort ! Vive le Roi ! » Par ce célèbre adage, l’on
signifiait que si la personne physique du roi régnant n’était plus, la
fonction royale perdurait sans discontinuer par l’intronisation du
successeur. Cette subordination de l’homme, le roi, à une fonction de
droit divin, la royauté, était, sous l’Ancien Régime, représentée par
une symbolique souvent immuable qui se transmettait de roi en roi.
Citons, entre autre exemple, l’héraldique fleur de lys. Incontestable-
ment, les motets à grands chœurs1 joués à la messe quotidienne des
trois derniers Bourbon, et ce depuis la prise de règne effective de
Louis XIV en 1663, jusqu’à l’abolition de la royauté en 1792, sont un
exemple parfait de cette symbolique. Mais en quoi ce genre musical
est-il pérenne ? Durant ce siècle et demi qui a vu la musique passer
de l’esthétique baroque au style classique, comment ce genre s’est-il
adapté, quels en furent les changements les plus marquants ?
Le présent article propose de parcourir ce genre majeur de la
musique sacrée à travers un élément immuable2 de celui-ci – le chœur –
dans sa relation avec l’orchestre à cordes « à la française3 » qui lui, en
revanche, s’est métamorphosé au cours du temps. Précisons que, notre
article se focalisant sur le rapport entre ces deux formations musi-
cales, nous n’aborderons pas l’écriture orchestrale des récits et des
1 Nous préférons la dénomination « motet à grand chœur » qui était utilisée
aux XVIIe et XVIIIe siècles pour désigner ce genre, plutôt que celle, pourtant
plus usitée, de « grand motet français ». 2 À l’inverse de l’orchestre, le chœur de la Chapelle-Royale conservera toutes
ses spécificités (cf. infra « les spécificités du chœur à la française ») de la fin
de la Renaissance à la Révolution. 3 Précisons qu’en France, comme dans le reste de l’Europe, l’orchestre n’est pas
une formation standardisée. Dans le présent article, lorsque nous parlons de
l’orchestre, nous sous-entendons l’orchestre à cordes « à la française » (ou
« de type lullyste ») à savoir, deux parties principales (le dessus de violon et
la basse) et deux ou trois parties intermédiaires.
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
180
ritournelles. De même, nous ne traiterons ici que des compositeurs actifs
à la Chapelle-Royale, ou qui y ont directement été associés. Nous ne
parlerons donc pas des différentes pratiques du motet à grand chœur
dans les grands centres religieux de Paris ou de province. De plus,
voulant observer et comprendre un processus évolutif d’un état à un
autre, nous limiterons dans le temps nos investigations : de la
naissance du genre autour de 1660 aux années 1740 qui ont vu la fin
de la carrière d’André Campra (1660-1744) et l’avènement d’une nou-
velle génération de musiciens tels que Jean-Joseph Cassanéa de
Mondonville (1711-1771).
1. Le motet à grand chœur versaillais : quelques
considérations historiques et formelles
Du sacre de Louis XIV en 1655 à sa prise de règne effective
en 1661, les grandes cérémonies religieuses soulignant d’importants
événements dynastiques vont toujours vers plus de faste et de splen-
deur. Lors de ces célébrations, les musiciens de la Chapelle-Royale
s’associent, de plus en plus fréquemment, aux Vingt-quatre Violons du
roi1, d’abord hors des églises, conformément au statut du violon alors
instrument de plein air, puis dans les églises. Ces réunions extraor-
dinaires, auxquelles s’adjoignent ponctuellement les musiciens de la
Chambre et les hautbois de l’Écurie, se multiplient entre 1659 et 1661
lors des festivités marquant le traité de paix avec l’Espagne, le
mariage du roi avec l’infante Marie-Thérèse d’Autriche, et la nais-
sance du Grand Dauphin. Ces déploiements de force concourant à la
magnificence de la cérémonie influent sur les formes musicales sacrées
en vigueur. Les compositeurs exploitant ces nouvelles sonorités en
jouant notamment sur les contrastes de masses et le rapport chœur/
orchestre, c’est la forme même qui évolue donnant ainsi naissance au
genre appelé « motet à grand chœur ».
Tous les grands centres religieux de France imitent dès lors
ce royal modèle, invitent ainsi la monarchie dans le culte et rappro-
chent leurs fidèles du roi. Ceci est particulièrement visible dans les
textes exploités par les compositeurs où la figure de David est
confondue avec celle du roi, ou dans les Te Deum qui célébraient tout
événement heureux lié à la monarchie. À partir de 1663 et du recru-
tement de Henry Du Mont (1610-1684) et Pierre Robert (ca. 1615-
1 « Orchestre à cordes attaché à la Musique de la Chambre, du début du
XVIIe siècle à 1761, appelé aussi Grande Bande » : BENOIT, 1996.
Fabian BALTHAZART
181
1699), la forme s’impose à la messe quotidienne du roi. Mais seul
l’effectif permanent de la Chapelle, c’est-à-dire le chœur avec quelques
musiciens mais sans la symphonie, est requis. Il faut attendre 1683 et
l’installation de la Cour à Versailles pour que les effectifs des cérémonies
extraordinaires soient transposés aux célébrations ordinaires.
À cette occasion, Louis XIV réorganise sa Chapelle et recrute,
sur concours, quatre nouveaux sous-maîtres2. L’orchestre, également
restructuré, est augmenté de « symphonistes3 » et permet désormais
l’exécution de motets à grand chœur à la messe quotidienne du roi4. De
cette nouvelle génération de compositeurs, Michel-Richard de Lalande
(1757-1726) émergera et marquera la Chapelle-Royale de sa longue
carrière (43 ans). Il suit l’évolution stylistique de la musique et l’adapte
au motet à grand chœur en s’inscrivant dans la continuité de ses
prédécesseurs. Il fixe un modèle formel dont les caractéristiques fonda-
mentales resteront identiques jusqu’à l’extinction du genre à la fin de
l’Ancien Régime. Un des grands changements que Lalande apporte au
genre est son organisation par numéros distincts. Dans les motets des
compositeurs de la génération de Du Mont et Robert, les versets mis en
musique sont unifiés par des symphonies et donc, récits et chœurs se
succèdent sans guère d’interruption. Un motet de Lully ou de Du Mont
se structure en trois ou quatre grandes sections. Lalande quant à lui,
organise en entités autonomes bien distinctes chaque partie du texte mis
en musique. Si le verset est généralement la cellule organique qui
détermine la découpe du texte, dans un texte non biblique, c’est le vers ou
la strophe. Quoiqu’il en soit, chaque partie du texte est maintenant traitée
indépendamment des autres avec un début, une fin, une unité musicale
thématique et un effectif propre. C’est la tonalité générale de l’œuvre et la
succession des modulations qui unifient désormais le motet.
2 La Chapelle-Musique était placée sous l’autorité du maître de chapelle, fonc-tion honorifique confiée à un ecclésiastique de haut rang. Les sous-maîtres, en
nombre variable de un à quatre, étaient des musiciens, prêtres ou laïcs, et
avaient, entre autres charges, la responsabilité des exécutions musicales de la
messe du roi. Voir MARAL, 2002 : 63-65. 3 « Celuy qui joue des instruments, ou qui compose les pièces qu’on jouë
dessus » : FURETIÈRE, 1690. 4 Avant 1683, l’effectif ordinaire de la Chapelle-Musique se compose, en plus
du chœur et des solistes, de la basse continue et de seulement deux dessus
de violon. En 1692, l’État de la France recense quatre dessus, une haute-
contre, une taille, une quinte et deux basses de violon, deux flûtes d’Alle-magne, une grosse basse ou théorbe, deux bassons et une basse de cromorne.
Voir MARAL, 2002 : 78.
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
182
S’il est impossible de définir un plan type du « motet à numé-
ros » tant les possibilités offertes par cette forme sont multiples et
l’imagination des compositeurs sans limites, nous pouvons en revanche
tenter un relevé d’éléments d’organisation suffisamment redondants
pour les instituer en modèles. Ainsi, se retrouvent très souvent dans les
motets à grand chœur du XVIIIe siècle jusqu’à environ 1780, période
de déclin du genre, les éléments suivants :
1. une symphonie liminaire directement enchainée à
2. un récit, le plus souvent pour soliste ou duo de solistes et
dont le matériau musical a été annoncé dans la symphonie
qui l’a précédé ;
3. un chœur ;
4. une succession de récits en solo, duo, trio ou quatuor et de
chœurs en ordre et nombre variable entrecoupés ou non de
ritournelles instrumentales ;
5. un grand chœur final, parfois fugué.
2. Les spécificités du chœur « à la française »
Pour bien comprendre le rapport qui régit le chœur et
l’orchestre dans le grand motet français, il faut d’abord s’intéresser
aux caractéristiques de ceux-ci. Alors qu’en Italie, le chœur passe
progressivement au cours du XVIIe siècle de cinq à quatre parties, le
chœur « à la française » reste, dans la tradition polyphonique de la
renaissance, à cinq voix et non mixte : quatre voix chantées par des
hommes (hautes-contre, tailles, basses-tailles et basses) et une par des
enfants (dessus). Une des caractéristiques inhérentes à cette disposition
est un espace entre la tessiture des dessus et la voix de haute-contre
venant juste en dessous. Pour dénommer ce vide, nous reprendrons
l’expression de « creux français » employée par Jean Duron (1990 : 101).
Figure 1 : Les tessitures du chœur à la française
Les trois parties de hautes-contre, de tailles et de basses-tailles cor-
Fabian BALTHAZART
183
respondent à trois voix de ténors et ont pour rôle de colorer la partie
des basses. La partie de dessus évolue bien au-dessus de ce quatuor de
voix d’hommes « compact et sombre » (DURON, 1990 : 101), puisqu’il
existe ordinairement un intervalle supérieur à la sixte entre dessus et
hautes-contre.
Le premier rôle de l’orchestre dans les chœurs est simplement
de doubler les chanteurs. La nomenclature des voix et de l’orchestre est
à ce sujet sans équivoque. À chaque partie du chœur correspond une
tessiture de violon (Dessus (D)5 – Dessus de violon (Dvn) ; Haute-contre
(Hc) – Haute-contre de violon (Hcvn) ; Taille (T) – Taille de violon (Tvn) ;
Basse-taille (Bt) – Quinte de violon (Qvn) ; Basse (B) – Basse de violon
(Bvn) / Basse continue (Bc)). Mais les compositeurs ne vont pas systéma-
tiquement respecter cet ordre établi. Au contraire, ils vont profiter de
ce rôle de doublure pour combler le « creux français » en doublant à
l’octave telle ou telle autre voix. Pour illustrer ce propos, voici un
exemple extrait du Beati quorum de Michel-Richard de Lalande.
Figure 2 : Michel-Richard de LALANDE, Beati quorum Remissæ sunt S.5,
mes. 89-100
Nous remarquons qu’en octaviant à la haute-contre de violon, d’abord
5 Par commodité, dans les exemples musicaux qui suivront, nous userons des
abréviations ci-après entre parenthèses.
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
184
les tailles (mes. 89-92) puis les basses-tailles (mes. 95-99), Lalande com-
ble systématiquement tout intervalle supérieur à la quarte. Comme nous
pouvons le voir sur le deuxième temps de la mesure 97, il n’hésite pas à
quitter la voix de Bt pour combler la sixte en ajoutant un ré formant
ainsi un accord de sixte et quinte.
Bien que ces techniques puissent être facilement résumées en
un tableau, leur utilisation diffère selon les compositeurs et les époques.
Droite Taille octaviée Basse-taille octaviée
D Dvn D Dvn D Dvn
Hc Hcvn Hc 8va Hcvn Hc 8va Hcvn
T Tvn T Tvn T Tvn
Bt Qvn Bt Qvn Bt Qvn
B Bc B Bc B Bc
Les seules constantes que nous pouvons observer sont les doublures
du Dessus par les Dessus de violon, et celles de la basse par la Basse
continue. Si, comme à toute règle, il y a souvent des exceptions, ce
tableau met néanmoins en lumière le rôle primordial des parties inter-
médiaires puisque c’est d’elles que dépendront les variations de sono-
rité de l’orchestre.
Dans les chœurs, le rôle de l’orchestre est donc de renforcer
le contrepoint vocal en le doublant, ainsi que de pallier la faiblesse
de celui-ci en comblant le « creux français ». Cependant, l’évolution
du motet à grand chœur en une succession de tableaux indépendants
va peu à peu libérer l’orchestre de son assujettissement à la polypho-
nie vocale. C’est cette lente émancipation que nous nous proposons
d’observer au travers des œuvres des compositeurs s’étant succédé
au service du roi en sa Chapelle.
3. Le rôle de l’orchestre : de la doublure à l’illustration
Fabian BALTHAZART
185
3.1. La génération de 1663 : la naissance du genre
Avant 1683, comme nous l’avons expliqué, il convient de distin-
guer cérémonies ordinaires et extraordinaires. L’objet de notre propos
étant le rapport chœur/orchestre, nous ne nous préoccuperons logique-
ment que des œuvres où les deux formations sont présentes. Or, comme
nous l’avons précisé plus haut, l’orchestre à cordes lullyste n’est en con-
frontation avec le chœur que lors des cérémonies extraordinaires. Ce qui
pose d’emblée un problème de source. Examinons la situation de cha-
cun des compositeurs de cette génération.
En 1662, Jean Veillot, en poste depuis 1651, meurt, laissant à
Thomas Gobert seul la charge de sous-maître que celui-ci détenait
depuis 1638. Du premier ne nous sont parvenus que trois motets
dont un, daté de 1644, est trop ancien pour notre étude et les deux
autres Motets de Mr Veillot (O filii et filiae et Sacris solemniis) ont été
copiés par l’atelier d’André Danican Philidor entre 1690 et 1700. Si
ces deux œuvres présentent toutes les caractéristiques du motet
pré-versaillais, il pourrait s’agir de révisions. Néanmoins, nous remar-
quons que les doublures de l’orchestre sont strictes par rapport aux
voix et que Veillot semble privilégier la Basse-taille octaviée à la haute-
contre.
Du deuxième, Thomas Gobert, tous les motets à grand chœur
ont été perdus. De Gabriel Expilly (ca. 1630-ca. 1690), en poste de 1664
à 1669, n’aurait été publié que les Motets et élévations dont seuls les
textes subsistent. Les figures les plus marquantes de cette génération
de sous-maître sont sans conteste Henry Du Mont (1610-1684) et
Pierre Robert (ca. 1615-1699) tout deux engagés en 1663 et retraités en
1683. La source principale de leurs motets est une luxueuse édition
de Christophe Ballard (ROBERT, Motets pour la Chapelle du Roy..., 1684,
et DU MONT, Motets pour la Chapelle du Roy..., 1686) datée d’après
l’installation de la cour à Versailles et de la réforme de la Chapelle
qui s’ensuivit. Originellement destinées au cadre ordinaire de la
messe quotidienne du roi et donc à un orchestre restreint, ces œuvres
ont été révisées afin de les conformer à la nouvelle esthétique voulue
par Louis XIV pour sa Chapelle. De récentes études musicologiques
ont relevé de « troublantes incohérences musicales » (LECONTE, 2008 :
136) dans l’édition de ces motets6. Ces révisions, et les incohérences qui
6 J. Duron relève dans l’édition Ballard des motets de Du Mont des erreurs
de contrepoint qu’il est impossible d’attribuer au compositeur. Son hypo-
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
186
y sont liées, touchant exclusivement l’orchestre, nous ne pouvons consi-
dérer ces œuvres comme représentatives du motet pré-versaillais et ne
les prendrons dès lors pas en compte pour notre étude.
Reste donc Jean-Baptiste Lully (1632-1687). Lequel, bien qu’il
ne fût jamais sous-maître, écrivit néanmoins de magnifiques grands
motets destinés à des cérémonies extraordinaires. Au nombre de
onze, les motets de Lully peuvent être classés en trois groupes distincts
dans le temps :
- les premières productions : Jubilate Deo omnis terra LWV 77/16
(1660) ; Miserere LWV 25 (1664) ; O lachrymæ LWV 26 (1664) ;
Plaude lætare LWV 37 (1668) ;
- le Te Deum LWV 55, daté de 1677, seule pièce du genre de cette
décennie ;
- les dernières œuvres : De profundis LWV 62 (1683) ; Dies iræ
LWV 64/1 (1683) ; Exaudiat LWV 77/15 (1685) ; Quare fremuerunt
LWV 67 (1685).
À cette liste s’ajoutent le Benedictus LWV 64/2, et le Notus in Judea
Deus LWV 77/17 qui, à ce jour, n’ont pu être datés précisément. Le
premier, présent dans l’édition Ballard de 1684 (Motets à deux chœurs
pour la Chapelle du Roy...) est donc antérieur à cette date. Absent de
cette même édition, le second est communément considéré comme
postérieur à 1684 et serait donc un des derniers motets à grand chœur
de Lully.
Pour les motets de la première période, nous avons concentré
nos observations sur le Miserere et le Plaude lætare. Nous pouvons dire
que dans ces deux œuvres, l’orchestre se borne à doubler les voix.
Cependant, il semble que Lully oscille entre deux logiques bien diffé-
rentes. L’une, très simple, où chaque voix de l’orchestre double son
homonyme du chœur, l’autre, plus complexe où Lully passe très rapide-
ment d’un système de doublure à un autre, ce qui a pour effet de recréer
un nouveau contrepoint à l’orchestre.
thèse est que les parties de haute-contre et taille de violon ont été réalisées
par un arrangeur peu habile (voir DURON, 2005).
Fabian BALTHAZART
187
Figure 3 : Jean-Baptiste LULLY, Plaude lætare Gallia LWV 37, mes. 12-25
Cet extrait montre la première intervention des chœurs du Plaude lætare
Gallia juste après la symphonie d’introduction. Il réunit un orchestre « à
la française » à cinq parties et, ce qui est caractéristique des motets pré-
versaillais, un petit chœur de solistes et un grand chœur. Nous
pouvons le diviser en trois sections : la première (mes. 12 à 17) joue
sur l’alternance petit chœur/grand chœur ; la seconde, très courte
(mes. 18-19) reprend ce jeu mais en opposant l’orchestre et les deux
chœurs ; la troisième (mes. 20-25) conclut ce premier énoncé du
premier vers en unissant toutes les forces en présence.
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
188
Les dessus de violon et la basse continue doublant respective-
ment les dessus et basse du chœur, nous remarquons que Lully passe
sans cesse d’un système de doublure à un autre. Dans la première
section de ce court extrait, la voix de haute-contre de violon va suc-
cessivement doubler les seconds dessus du petit chœur, les basses-
tailles à l’octave, à nouveau les seconds dessus, les hautes-contre,
mesure seize les tailles puis les basses-tailles octaviées, et enfin, à nou-
veau les hautes-contre. En plus de parcourir tous les types de dou-
blures possibles en six mesures, Lully écrit également un contrepoint
indépendant du chœur (mes. 15 tierce, quinte et puis sixte de la basse)
qui lui permet de combler les dixièmes et octaves entre dessus et
haute-contre.
Si le petit chœur, le grand chœur et l’orchestre interagissent
entre eux par des jeux d’alternance, l’examen des doublures7 révèle
qu’il s’agit bien de trois entités indépendantes auxquelles il faut
ajouter le groupe réalisant la basse continue et que toutes sont écrites
pour sonner de manière pleine et entière seules. Dans ce type d’écri-
ture, les différents groupes sont additionnés et non pas fusionnés
comme c’est le cas lors de doublures d’une voix par une autre sur plu-
sieurs mesures. Nous avons pu le constater dans l’exemple de Lalande
cité plus haut. Dans son Notus in Judea Deus, plus tardif, Lully semble
avoir également intégré ce système de doublure moins complexe où
chœur et orchestre semblent se fondre en une seule entité. Ceci est
particulièrement clair pour la voix de haute-contre qui oscille sans
cesse entre une doublure droite des hautes-contre du chœur et les
basses-tailles octaviées. Cette tendance qui se confirme dans l’Exaudiat
et le Quare fremuerunt, est une première évolution dans le rapport
chœur/orchestre. Dans les manuscrits du Dies iræ et du De profundis que
nous avons pu consulter pour la présente recherche, l’orchestre est copié
en réduction ce qui ne nous a pas permis d’observer les systèmes de
doublures.
3.2. La génération de 1683 : le motet versaillais
L’installation définitive de la cour au château de Versailles, en
1682, donne lieu l’année suivante à une nouvelle réorganisation de la
Chapelle. Mis à la retraite, Henry Du Mont et Pierre Robert sont
remplacés par quatre nouveaux sous-maîtres recrutés sur concours :
7 Pour une étude des doublures entre grand chœur et petit chœur dans les
grands motets pré-versaillais, nous renvoyons à : LECONTE, 2008.
Fabian BALTHAZART
189
Nicolas Goupillet (ca. 1650-1713), Pascal Colasse (1649-1709), Guil-
laume Minoret (1650-1720) et Michel Richard de Lalande (1757-1726).
Louis XIV en personne donne à cette occasion une nouvelle direction
esthétique à la Chapelle-Musique en demandant que soient intégrés à sa
messe quotidienne des motets avec symphonies tels que ceux joués dans
les cérémonies extraordinaires. Chez les compositeurs de cette géné-
ration, les grands chœurs homorythmiques, initiés par Lully dans son
Te Deum mais pratiquement absents des motets de Robert et Du
Mont, vont se généraliser. Écrits le plus souvent avec des rythmes
récurrents, des accords parfaits et très peu de notes de figurations,
ces chœurs renforcent l’effet de grandeur, de gloire et de majesté
voulu par le pouvoir royal. Ce type d’écriture qui s’émancipe de la
tradition polyphonique héritée de la Renaissance va renforcer le lien
chœur/orchestre en les unissant en une seule entité.
Toutes les œuvres de Goupillet ayant disparues, il nous reste
de cette génération, outre l’abondante production de Lalande sur
laquelle nous reviendrons, trois motets à grand chœur de Colasse et
six de Minoret. Tous les motets de ce dernier ont été composés avant
1697 (BABA, 2008). Quant aux trois motets de Pascal Colasse, il s’agit
d’une copie de Philidor de 1704 mais ils sont probablement bien
antérieurs à cette date. Ces neuf partitions sont donc de la première
génération des motets à grand chœur versaillais héritières directes des
dernières œuvres sacrées de Lully. La grande majorité des chœurs
chez Colasse sont homorythmiques et les doublures sont toujours
droites. L’orchestre est donc une simple réplique instrumentale du
chœur8. Bien plus complexe est l’écriture orchestrale de Minoret.
Les six motets retrouvés sont des œuvres composées tôt dans
sa carrière et ne représentent, selon la musicologue Yuriko Baba, que
le dixième de sa production totale. Très proche des derniers motets
de Lully, Minoret favorise la doublure de la basse-taille à l’octave aux
hautes-contre de violon. Cependant, nous avons remarqué que ponc-
tuellement, les dessus de violon peuvent, pendant une mesure ou
deux, s’éloigner de la doublure stricte au profit d’une écriture plus
instrumentale.
8 La banalité de la réalisation des parties intermédiaires de l’orchestre nous
fait sérieusement douter qu’elles puissent être de l’auteur de la première
tempête musicale, dans la tragédie lyrique Thétis et Pélée, ou du Ballet des
saisons. Un examen rapide à cette dernière partition confirme notre senti-
ment.
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
190
Figure 4 : Guillaume MINORET, Venite exultemus, p 12 1r système
Nous ne ferons pas ici l’inventaire des diverses sources des quelques
soixante-dix-sept motets à grand chœur de Lalande recensés à ce
jour (SAWKINS, 2006). Nous nous concentrerons sur deux sources princi-
pales essentielles pour notre étude : les dix volumes copiés par Philidor
l’Aîné par ordre du roi en 1689, et la collection « Cauvin » du nom de ce
collectionneur qui fit copier autour de 1742 des motets de Lalande
d’après des sources antérieures. Réalisées plus de quinze ans après la
mort du compositeur, ces partitions font appel à un orchestre à
quatre, avec deux parties intérieures, et non plus à cinq. La partie de
quinte de violon est désormais absente de l’orchestre. Mais outre ce
changement de morphologie, c’est l’écriture orchestrale dans son
ensemble qui est repensée.
Durant toute sa carrière, Lalande a souvent remanié ses compo-
sitions parfois de manière très profonde, nous laissant ainsi d’un même
motet des versions très différentes. Pour ce qui est semblable dans les
chœurs des sept motets communs aux collections Philidor de 1689 et
Cauvin9, nous rencontrons différentes situations :
- La texture à cinq parties est recréée en divisant le pupitre des
dessus de violon, ce qui donne lieu à une nouvelle répartition
des voix à l’orchestre. Très souvent, une des voix intérieures du
9 Pour les concordances des sources des motets de Lalande, on consultera :
SAWKINS, 2008.
Fabian BALTHAZART
191
chœur (taille ou basse-taille), est doublée à l’octave supérieure
au dessus de violon1, passant ainsi au-dessus des dessus de
violons2 qui doublent les dessus du chœur. (ex : Miserere chœur
Avertes faciem tuam).
- La partie de quinte est tout simplement enlevée sans autre
modification (ex : Exaudi Deus deprecationem). Un orchestre à
quatre parties double donc le chœur à cinq voix.
- Les dessus de violon sont divisés mais les premiers dessus
ne doublent pas de voix du chœur et jouent une partie libre
souvent plus concertante, les seconds dessus assurant la
doublure des dessus du chœur. (ex : Te Deum chœur Et lauda-
mus). Nous avons donc ici une texture orchestrale à cinq dont
quatre doublent le chœur.
- Les deux parties de dessus de violon jouent des parties libres
concertantes laissant aux seules deux parties intermédiaires
le soin de doubler le chœur. Celles-ci doublant alternative-
ment les voix de haute-contre, taille et basse-taille, les dessus
du chœur ne sont plus doublés.
Cette dernière situation est la plus éclairante du changement qui
s’opère dans la conception du rôle de l’orchestre dans les motets à
grand chœur de la première moitié du XVIIIe siècle. Mais d’où vient
la nécessité de ce changement de conception, pourquoi les compo-
siteurs ont-ils ressenti le besoin d’écrire à l’orchestre des parties
concertantes indépendantes du chœur ? Un motet étant la mise en
musique d’un texte, c’est dans le sens de celui-ci que nous trouverons
réponse à nos interrogations. Examinons à titre d’exemple la mise en
musique par Lalande des deux derniers vers du psaume 50 Miserere
mei Deus dans les versions Philidor et Cauvin. Cette demande de
pardon se termine sur une prière du roi David afin que ses péchés ne
soient pas préjudiciables au peuple d’Israël :
Benigne fac, Domine, in bona voluntate tua Sion : ut ædificentur muri Jeru-salem.
Tunc acceptabis sacrificium justitiæ, oblationes & holocausta ; tunc imponent
super altare tuum vitulos10.
10 « Que mes péchés, Seigneur, n’arrêtent pas le cours de vos bontés sur
Sion ; faites que nous puissions bâtir les murs de Jérusalem. Alors vous accep-terez avec joie mes offrandes, & mes holocaustes, comme les sacrifices d’un
homme que la pénitence aura justifié ; alors le peuple, à mon exemple, chargera
vos autels de victimes. » Trad. : LALLEMAND, 1715 : 163-164.
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
192
Lalande divise ces derniers versets en trois parties dans le grand
chœur final du motet. La première partie, commence en sol mineur,
ton de la dominante, et les mots Benigne fac, Domine, in bona voluntate
tua Sion sont énoncés deux fois d’abord par le petit chœur puis le
grand. L’écriture strictement homorythmique et la mesure à 3/2
impliquant un tempo relativement lent évoquent la figure de David
implorant le Seigneur. Très peu de différences existent entre les deux
versions de ce verset. Soulignons néanmoins dans l’écriture pour orches-
tre dans le grand chœur, la doublure des hautes-contre à l’octave par les
premiers dessus de violon et l’ajout de diminutions dans les deux
parties de violons. Ces ajouts assurant une continuité de noires presque
ininterrompue avant le repos cadentiel rendent cette version moins
monolithique et plus cantabile que la version Philidor.
Cependant, l’homorythmie totale chœur / orchestre de cette
version antérieure souligne mieux la prosodie, notamment sur le mot
Domine particulièrement bien mis en valeur. Dans la deuxième partie, a
4 tems tres vifs, comme nous pouvons le lire sur le manuscrit Cauvin, la
démarche est la même. L’introduction de doubles croches aux deux
parties de violon renforce le contraste avec le verset précédent, ajoute à
la nervosité de la musique et au sentiment d’urgence qui se dégage de
cette écriture plus polyphonique au détriment de la mise en valeur du
mot muri. Pour le dernier vers, un nouveau changement de tempo,
vivement, et un retour à une écriture majoritairement homorythmique.
Entre ces deux versions, ce que la mise en musique de ces
versets a gagné en évocation, elle l’a perdu en sémantique. C’est donc
le sentiment poétique qui prime désormais sur la mise en valeur du
sens littéral du verset. Pour renforcer ce pouvoir évocateur, l’écriture
instrumentale, influencée par la musique italienne et les formes
profanes comme l’opéra, va aller vers plus de virtuosité et d’autono-
mie. Le problème de ce manuscrit Cauvin est que nous ne savons pas
exactement dans quelles circonstances ces versions des motets de
Lalande furent jouées. Qu’en est-il à Versailles à la même époque ?
3.3. La génération de 1723 : les musiciens du régent
En 1722, après la régence, Louis XV réintègre Versailles et
réorganise les différentes institutions dont la Chapelle. Sont nommés
aux côtés de Lalande : André Campra (1660-1744), Nicolas Bernier
(1664-1734) et Charles-Hubert Gervais (1671-1744). Ne pouvant
prétendre atteindre l’exhaustivité dans le cadre imparti à cet article,
et notre but étant de montrer un processus évolutif, nous n’exami-
Fabian BALTHAZART
193
nerons pas dans le détail les productions de ces compositeurs. Mais,
pour se convaincre que la Chapelle-Royale a suivi l’évolution que
nous avons pu observer depuis les manuscrits copiés par Philidor en
1689, nous porterons notre regard sur le Notus in Judea Deus de André
Campra (Pseaumes mis en musique à grand chœur..., Livre premier, 1737).
Dans le dernier verset de ce psaume Terribili, & ei qui offert spiritum
principum, terribili apud reges terræ11, Campra écrit à l’orchestre des bat-
teries, des gammes et des arpèges en double croches rapides évoquant
la violence de ce texte.
Figure 5 : CAMPARA, Notus in Judea Deus, p 60-61
Remarquons que dans ce chœur, plus aucun instrument ne double
de voix. Ce type d’écriture très virtuose mais particulièrement évoca-
teur requiert toutes les forces instrumentales en présence et demande
donc un orchestre totalement indépendant du chœur. Par compa-
raison, Lully, dans la mise en musique du même verset de ce psaume,
use d’un tout autre procédé. Il met en valeur aux voix extrêmes le mot
terribili par un saut mélodique entre la première et la deuxième
syllabe.
11 « Faites des vœux à ce Dieu terrible, qui ôte quand il lui plaît, la vie aux
princes, & qui se rend redoutable à tous les Rois de la terre. » Trad. :
LALLEMAND, 1715 : 243.
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
194
Figure 6 : LULLY, Notus in Judea Deus, p 103
Comme dans la première version des motets de Lalande, c’est ici le
mot qui prime sur l’image.
3.4. Les successeurs
Les recrutements de Henri Madin (1698-1748) en 1737, et de
Antoine Blanchard (1696-1770) en 1738 assurèrent la continuité. Mais
l’arrivée de Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville (1711-1771) dès
1740, montre à l’évidence la volonté des autorités de la Chapelle de
maintenir sa musique en phase avec son temps. Ces compositeurs,
tout en respectant les modèles du genre établis par Lalande, aban-
donnent définitivement l’orchestre lullyste, et feront des chœurs de
véritables tableaux. Nous refermerons ici notre exploration du rapport
chœur/orchestre dans ce répertoire en laissant la parole à un témoin de
l’époque sur l’effet produit par le sixième verset12 du psaume Cæli
enarrant gloriam Dei mis en musique par Mondonville :
« Mais voici, Monsieur, le grand, le sublime morceau, qui dans ce Motet
de toutes beautés, éleve, ravit, transporte l’ame & lui offre le plus beau
spectacle de la nature : c’est le morceau qui rend le cinquième & le
12 Exultavit ut gigas ad currendam viam, a summo cælo egressio ejus / « Il va plein
d’ardeur comme un géant commencer sa course : il part d’un bout du ciel et
il passe jusqu’à l’autre sans qu’il y ait personne qui se cache à sa chaleur ».
Trad. : LALLEMAND, 1715 : 50.
Fabian BALTHAZART
195
sixième verset du Pseaume, où le Prophète, pour nous peindre la gloire
& la grandeur de Dieu, s’attache au plus beau de ses ouvrages, au soleil
qu’il peint comme un Epoux &c. Une mélodie douce & majestueuse
prépare le récit d’une Basse taille qui s’élevant d’une manière insen-sible, annonce l’astre du jour, le fait voir dans tout l’éclat de son cours,
& semble décrire avec lui sa brillante carriere. [...] Bientôt la mélodie
devient plus forte, le Chœur s’unit à la Basse-taille pour représenter
avec plus d’énergie l’ascension du soleil sur l’horizon & la chaleur
qu’il répand sur toute la nature. [...] Enfin, après ce morceau admi-rable, la Basse-taille, chante seule, chaque parole du premier verset, que
le Chœur reprend ensuite. Cette reprise est d’un goût d’autant plus
analogue au sujet que les premières paroles sont comme la conséquence
de toute la pièce : les Cieux publient la gloire de Dieu. » (JOANNET, 1756 : 303.
Cité dans FAVIER, 2009 : 231)
4. Mise en perspective de la démarche
Notre projet consiste à observer, sur une période d’un peu
moins d’un siècle, un unique paramètre de l’évolution de l’orchestre
dans les motets à grand chœur : l’accompagnement orchestral des
chœurs. Mais ce focus est à mettre en perspective, d’une part, avec la
forme du grand motet dans sa globalité (l’écriture pour orchestre
évolue-t-elle parallèlement dans l’accompagnement des récits ?) et,
d’autre part, avec l’évolution des formes profanes telles que l’opéra.
Cependant, si limitée que la perspective puisse paraître, elle nous
permet d’ouvrir nos observations à l’évolution suivie par la pensée
créatrice au XVIIIe siècle. Les changements observés dans l’orchestre
reflètent plus une évolution de la pensée musicale qu’un simple
changement d’esthétique. L’étude de la mise en musique d’un texte
sacré ne peut être déconnecté de son contexte spirituel.
Les motets de Robert, Du Mont ou Lully sont encore ancrés
dans une pensée rhétorique. La musique est soumise au texte et doit
mettre en valeur le sens littéral de celui-ci. À l’époque où Lalande
commence sa carrière de compositeur, s’installe chez des penseurs
comme Boileau ou Fénelon la notion de sublime : « Le sublime n’est
pas proprement une chose qui se prouve et qui se démontre ; mais
c’est un merveilleux qui saisit, qui frappe et qui se fait sentir » (BOILEAU-
DESPRÉAUX, 1966 : 546. Cité dans FAVIER, 2008 : 125). Le texte sacré va,
dans cette esthétique de l’effet, être exprimé non plus uniquement litté-
ralement au moyen de figures de style, mais aussi par la description du
ressenti poétique du texte. L’affect prend le pas sur la rhétorique. Dans
cette nouvelle perspective, c’est à l’orchestre, phalange instrumentale du
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
196
motet à grand chœur et donc non-assujetti aux mots, d’assumer la des-
cription de ce « merveilleux » qui se ressent mais ne se dit pas.
Comprendre le contexte spirituel dans lequel étaient plongés les
compositeurs de la Chapelle-Royale de Versailles est aussi important
pour la connaissance de l’écriture orchestrale dans les motets à grand
chœur que les paramètres techniques comme l’harmonie et le contre-
point, ou encore que l’organologie. Cette approche sémantique trouvera
une application directe dans la restauration des parties intérieures de
l’orchestre. Nous n’avons qu’à peine évoqué cette problématique lorsque
nous avons parlé des sources du Dies iræ et du De profundis de Lully.
Mais, à l’époque dont il est question ici, il n’est pas rare que pour des
raisons musicales, de gain de temps et d’économie, les œuvres ne soient
pas toujours copiées dans leur intégralité. Elles ne contiennent que les
parties principales : chœurs, solistes, dessus de violon et basse continue.
Pour restituer cette musique aujourd’hui, les « parties » manquantes
(haute-contre, taille et quinte de violon) doivent être recomposées
selon les critères esthétiques de l’époque.
Cette recherche ne fait que lever un coin du voile sur cette
problématique complexe qu’est le rapport chœur/orchestre. Néanmoins,
elle nourrira notre pratique de la restauration et, de facto, contribuera à
la diffusion de ces musiques auprès du public.
Bibliographie
1. Sources manuscrites (partitions)
COLLASSE P., 1704, Motets de monsieur Colasse, Maître de Musique de la
Chapelle du Roy, & Maître de Musique & Compositeur de la Chambre de
sa Majesté. Copiez par Ordre exprés de son Altesse Serenissime Monsei-
gneur le Comte de Toulouze, par M. Philidor l’aîné, Ordinaire de la Musique
du Roy, & Garde de toute sa Bibliothèque de Musique, & par son fils aîné,
Versailles (F-Pn, Rés F-1678).
MINORET G., 1697, Motets de Monsieur Minoret, Maitre De musique de
la Chapelle du Roy. Copiez par Philidor Laisné ordinaire de la musique du
Roy et l’un des deux gardiens de la bibliotheque de musique de sa Majesté,
2 tomes, Versailles (F-Pn, Rés F-932 (1-2)).
LALANDE M.-R. de, ca. 1740, Motets à grand chœur de M. de la lande,
Maître de Musique de la Chapelle, 21 tomes, n.l. (F-V, Ms mus 216-
237).
LALANDE M.-R. de, 1689, Motets de M De Lalande Sur-intendant de la
Musique de la Chambre Et maistre de Musique de la Chapelle du Roy
Recueillis par Philidor Laisne en 1689, 10 tomes, Versailles (F-V, Ms
mus 8-17).
Fabian BALTHAZART
197
LULLY J.-B., 1700, Benedictus & De profundis, copié par A. Philidor,
Versailles (F-Pn, Rés-Vma Ms 1215 (3)).
LULLY J.-B., 1690-1700, Partitions de plusieurs grands motets de Mons.r
de Lully, copié par A. Philidor, Versailles (F-Pn, Rés F-669).
LULLY J.-B., 1700, Miserere et Te Deum Laudamus de Mr de Lully, copié
par A. Philidor, Versailles (F-Pn, Rés-Vma Ms 1215 (1)).
LULLY J.-B., 1700, Notus In judea de Mr de lully et Miserere mei deus
Italien de Mr de lully [attr. Rayée], copié par A. Philidor, Versailles
(F-Pn, Rés-Vma Ms 1215 (5)).
LULLY J.-B., 1700, Exaudiat te Dominus ; Quare fremuerunt, copié par
A. Philidor, Versailles (F-Pn, Rés-Vma Ms 1215 (4)).
LULLY J.-B., 1700, Plaude Laetare galia et Dies Irae dies Illa De Mr
Delully, copié par A. Philidor, Versailles (F-Pn, Rés-Vma Ms 1215
(2)).
VEILLOT J., Motets de Mr Veillot, copié par Fr. Fossard entre 1690 et
1700, ( F-Pn, Rés. F-542).
2. Sources imprimées
2.1. Partitions
CAMPRA A., 1737, Pseaumes mis en musique à grand chœur… Livre
premier, Paris : M. de La Croix, veuve Boivin, Le Clerc (F-Pn, Vm1 –
1090).
DU MONT H., 1686, Motets pour la Chapelle du Roy..., Paris : Christophe
Ballard (F-Pn, Rés Vm1 – 98(1-16)).
LULLY J.-B., 1684, Motets à deux chœurs pour la Chapelle du Roy...,
Paris : Christophe Ballard (F-Pn, Vm1 – 1039).
ROBERT P., 1684, Motets pour la Chapelle du Roy..., Paris : Christophe
Ballard (F-Pn, Vm1 – 1038).
2.2. Ouvrages
BOILEAU-DESPRÉAUX N., 1966 [1710], Réflexion X ou réfutation d’une
dissertation de Monsieur Le Clerc contre Longin, dans Œuvres complètes,
éd. A. Adam, Paris : Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade ».
EXPILLY G., Motets et élévations de M. Expilly. Pour le quartier de juillet,
aoust & septembre 1666, s.l., s.n., s.d. (F-Pn, B-2524)
FURETIÈRE A., 1690, Dictionnaire universel, La Haye : A. et R. Leers.
JOANNET J.-B., 1756, Lettre sur les ouvrages et œuvres de piétés, dédiées à
la reine, t. 2, Paris : Lambert.
LALLEMAND J.-P. (Le P.), 1715 [1708], Le sens propre et littéral des
pseaumes de David, Paris : François Montalant, (5e éd.).
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
198
3. Ouvrages et articles des XXe et XXIe siècles
BABA Y., 2008, « Introduction à », G. Minoret, les motets vol. I et II,
Versailles : Éd. du CMBV.
BARTHÉLEMY M., 1990, André Campra : sa vie et son œuvre (1660-1744),
Arles : Éd. Actes Sud.
BENOIT M. (éd.), 1992, Dictionnaire de la musique en France aux XVIIe et
XVIIIe siècles, Paris : Éd. Fayard.
DURON J., 2008, « Oüyt-on, jamais, telle muzique ? Les nouveaux canons
de la musique française sous le règne de Louis XIV (1650-1675) », dans
J. DURON (èd.), Regards sur la musique : La naissance du style français
1650-1673, Wavre : Éd. Pierre Mardaga, p. 11-52.
DURON J., 1990, « Le rapport chœur-orchestre dans les grands motets de
Lully », dans J. DE LA GORCE, H. SCHNEIDER (éd.), Jean-Baptiste Lully.
Actes du colloque, St-Germain-en-Laye-Heidelberg 1987, Laaber : Laaber-
Verlag, p. 99-144.
DURON J., 1984, L’orchestre à cordes français avant 1715, Nouveaux
problèmes : les quintes de violon, Revue de musicologie, 70/2, p. 260-269.
DECOBERT L., 1994, « Les chœurs dans les grands motets de Henry
Dumont (1610-1684) », Revue de musicologie, 80/1, p. 39-80.
FAVIER Th., 2009, Le motet à grand chœur, Gloria in Gallia Deo, Paris : Éd.
Fayard.
FAVIER Th., 2008, « Lalande et le sublime : doctrines rhétoriques et tradi-tion oratoire dans ses premiers grands motets », dans L. SAWKINS (éd.),
Lalande et ses contemporains, Actes du colloque international : Versailles 2001
Hommage à Marcelle Benoit, Marandeuil : Éd. des Abbesses, p. 119-142.
LA GORCE J., 2002, Jean-Baptiste Lully, Paris, Éd. Fayard.
LECONTE Th., 2008, « Le petit chœur », dans J. DURON (èd.), Regards sur
la musique : La naissance du style français 1650-1673, Wavre : Éd. Pierre
Mardaga, p. 135-180.
MARAL A., 2002, La Chapelle royale de Versailles sous Louis XIV : céré-
monial, liturgie et musique, Liège : Éd. Pierre Mardaga.
MONTAGNIER J.-P. C., 2000, Chanter Dieu en la Chapelle royale : le grand
motet et ses supports littéraires, Revue de musicologie, 86/2, p. 217-263.
SAWKINS L., 2008, « Lalande’s grands motets : source revision and
execusion », dans L. SAWKINS (éd.), Lalande et ses contemporains, Actes du
colloque international : Versailles 2001 Hommage à Marcelle Benoit, Maran-
deuil : Éd. des Abbesses, p. 151-167.
SAWKINS L., 2006, A Thematic Catalogue of the Works of Michel-Richard
de Lalande (1757-1726), New York : Oxford University Press.
SAWKINS L., 1989, « Chronology and Evolution of the Grand Motet at
the Court of Louis XIV : Evidence from the Livres du Roi and the
Works of Perrin, the sous-maitres and Lully », dans J. HAJDU HEYER
(éd.), Jean-Baptiste Lully and the Music of the French Baroque, Cam-
bridge : Cambridge University Press, p. 41-79.
TESSIER A., 1931, Un catalogue de la bibliothèque de la Musique du Roi au
Fabian BALTHAZART
199
château de Versailles, Revue de musicologie, 12.
4. Partitions en éditions modernes
CAMPRA A., 2007, Grand dixit Dominus, Collection Chœur & Orchestre,
Versailles : Éd. du Centre de Musique Baroque de Versailles.
LALANDE M.-R. de, 2004, Audite Cæli, Cahiers de musique 95, Versail-
les : Éd. du Centre de Musique Baroque de Versailles.
LALANDE M.-R. de, 2004, Quam dilecta (version primitive : avant 1683)
[S. 12], Cahiers de musique 98, Versailles : Éd. du Centre de Musi-
que Baroque de Versailles.
LALANDE M.-R. de, 2003, Beati quorum Remissæ sunt [S.5], Cahiers de
musique 96, Versailles : Éd. du Centre de Musique Baroque de Ver-
sailles.
LALANDE M.-R. de, 2002, Deitatis majestatem, Cahiers de musique 96,
Versailles : Éd. du Centre de Musique Baroque de Versailles.
MINORET G., 2008, Les motets, vol. 1 : Venite exultemus Domino ; Currite
populi ; Prope es tu Domine, anthologies : motets III. 5, éd. de Yuriko
Baba, Versailles : Éd. du Centre de Musique Baroque de Versailles.
201
Nathanaël MASSELOT et
Gautier DASSONNEVILLE
Magie et constitution chez le premier Sartre.
Vers une figure de la néantisation
Introduction
En radicalisant l’idée husserlienne d’intentionnalité, Sartre se
dote d’une définition essentielle pour penser la conscience à nouveaux
frais. En témoigne son premier compte rendu sur la question où la
conscience apparaît purifiée et « claire comme un grand vent » (SARTRE,
2005). De cet enthousiasme du départ, le jeune phénoménologue tire
une thématisation qui lui est propre, en interrogeant le rapport de la
conscience au monde puis à l’être à partir de la fonction néantisante
de celle-ci. Or, cela ne va pas sans un effort conceptuel considérable
pour ressaisir le problème de la constitution1 d’une conscience
unitaire dans un effort initial pour désubstancialiser la conscience
tout en conservant les éléments coextensifs à une psychologie2.
Aussi proposons-nous dans cette étude d’observer comment
le motif de la magie permet au premier Sartre d’accéder au concept
mieux connu de néantisation. S’il convient bien d’opposer conscience
magique et conscience néantisante, nous souhaitons, chemin faisant,
rétablir l’importance du rapport entre magie et néantisation et
proposer une lecture qui se refuse à voir une solution de continuité
entre ces deux types de conscience.
En reprenant le terme de « magie », Sartre entre clairement en
dialogue avec l’anthropologie du début du XXe siècle. L’héritage de M.
Mauss et de L. Lévy-Bruhl, et les apports d’Alain, Bergson et Freud,
qui font figures de passeurs, ont récemment été mis en évidence en
1 La reprise du thème central de la phénoménologie husserlienne qu’est la
« constitution », (cf. SOKOLOWSKI, 1970) ne va pas sans d’importants déplace-
ments, et nous ne visons pas ici le sens technique de la constitution husser-lienne. On reprendra seulement l’idée générale que la constitution est consti-tution d’une unité, ici celle de la conscience personnelle. 2 Ces éléments seront renvoyés à la transcendance et à la réflexion. En
témoignent les éléments dressés pour une « Égologie » (SARTRE, 2003a : 72).
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
202
différents endroits1. Mais comme on sait, Sartre fait souvent un usage
assez libre des notions héritées et s’en sert en tant qu’elles ont une
valeur heuristique pour ses propres développements. C’est pourquoi
nous abordons ici la fonction de la magie dans le cadre spécifique qu’est
la phénoménologie sartrienne (1934-1943), à savoir le travail philoso-
phique qui se déploie à partir de La Transcendance de l’Ego (1936), en
passant par les deux études relatives à la Psyché – L’Esquisse d’une théorie
des émotions (1939) et L’Imaginaire (1940) – jusqu’à l’opus magnum de
Sartre, L’Être et le néant (1943) (SARTRE 2003a ; SARTRE 2003b ; SARTRE
2007 ; SARTRE 20012). Pendant cette période, Sartre tente de tirer partie
des résultats de la phénoménologie pour les mettre au service d’abord
d’une psychologie, puis d’une ontologie phénoménologiques.
À travers cet itinéraire, la magie se présente comme le fil
directeur par lequel Sartre, découvrant progressivement la possibilité
néantisante de la conscience, tente de surmonter un certain nombre
de difficultés. On commencera par identifier les premières caracté-
ristiques du magique dans le cadre de la distinction sartrienne de la
conscience et du psychisme. Comment la magie devient-elle un
concept opératoire pour analyser les dimensions les plus saillantes
de la conscience ? Cela conduira à évaluer la reprise et l’importance
du magique dans l’analyse de deux types spécifiques de conscience,
à savoir la conscience émotive et la conscience imageante. Dans
quelle mesure la fonction de la néantisation apparaît-elle sur arrière-
fond de magie ? Enfin, nous analyserons la néantisation dans L’Être
et le néant et nous nous interrogerons sur les raisons de la persévé-
rance du motif de la magie. Quelle est la nécessité de conserver la
magie comme un élément résiduel lors de la thématisation de la
néantisation ? Pourquoi Sartre, alors qu’il thématise la néantisation
pour elle-même, continue-t-il à faire référence à la magie ? Dans
quelle mesure la néantisation peut-elle s’émanciper du magique ? En
quel sens serait-on justifié à parler de la « magie de la néantisation »
chez Sartre ?
1 Voir en bibliographie les travaux de Gregory Cormann (CORMANN, 2006 et
2011) sur l’héritage maussien ; de Frédéric Keck (KECK, 2008) sur l’influence
de Lucien Lévy-Bruhl, et de Sarah Richmond (RICHMOND, 2010) pour une
reprise générale des diverses influences. 2 Nous laissons volontairement de côté L’Imagination (1936) qui adopte une
perspective principalement historique.
Nathanaël MASSELOT et Gautier DASSONNEVILLE
203
1. Un problème de constitution : liaison et inversion
Dans La Transcendance de l’Ego, Sartre passe le Je et le Moi3 à
l’épreuve d’une purification du champ transcendantal de la conscience
et montre que l’Ego est une unité constituée qui apparaît à l’occasion
du passage de la conscience irréfléchie à la réflexion. Rejetant ainsi
l’Ego à la transcendance, c’est tout le psychisme qui est avec lui
expulsé hors du champ de la conscience irréfléchie absolue4. L’Ego se
présente alors comme « l’unité idéale (noématique) et indirecte de la
série infinie de nos consciences réfléchies » (SARTRE, 2003a : 43). Or, si
l’Ego est l’unité du psychisme – c’est-à-dire des états, qualités et
actions – il faut rendre compte du statut de chacun de ces éléments
psychiques qui le constituent, et préciser leur relation avec la
conscience irréfléchie. C’est dans ce contexte que Sartre a pour la
première fois recours au magique pour décrire un fait de conscience
irrationnel : l’inversion du rapport entre la conscience irréfléchie et ses
états réfléchis.
Considérons donc d’abord avec Sartre le problème de l’« éma-
nation » qui apparaît à travers l’analyse d’« une expérience réflexive de
haine » (SARTRE, 2003a : 45). En tant qu’objet transcendant, ma haine est
un état de l’objet Pierre-haïssable. Sartre distingue cet objet « haine »
de la répulsion, qui elle est immanente. La haine est un objet tran-
scendant qui apparaît dans l’expérience que je fais de Pierre, pour être
au-delà de cette expérience. À travers l’expérience de Pierre, se
donne l’objet « haine » qui est, qui a une consistance, et qui n’est ni
Pierre ni de la conscience. Pour que la conscience irréfléchie soit
conscience d’un objet mondain transcendant, par exemple d’une
chaise, il faut que cette chaise existe indépendamment de ma relation
à elle, qu’elle soit un centre d’opacité pour la conscience irréfléchie
translucide. De même qu’il exige que l’objet spatio-temporel soit déjà
constitué, en l’affirmant comme étant premier sur la conscience que
j’en prends, de même Sartre suggère qu’il faut tenir pour constitué,
dans la réflexion, l’objet transcendant « haine » à travers l’apparition
3 Le Je et le Moi sont les deux aspects d’une même réalité, l’Ego. Le Je est
l’Ego comme unité des actions ; le Moi est l’Ego comme unité des états et des
qualités. Il s’agit d’une distinction tout à fait formelle (SARTRE, 2003a : 44). 4 En 1936, Sartre considère la conscience comme étant cause de soi : la conscience
est « individualisée rigoureusement dans la durée » (SARTRE, 2003a : 33) ; « rien
ne peut agir sur la conscience, parce qu’elle est cause de soi », (SARTRE, 2003a :
64) ; la spontanéité de la conscience « se donne avant tout comme spontanéité
individuée et impersonnelle » (SARTRE, 2003a : 78).
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
204
de la conscience répugnée de Pierre. L’intentionnalité ayant été radi-
calisée à toute forme de conscience possible, il faut que l’unité se
situe non pas dans un foyer immanent, mais dans un point focal
transcendant : l’unité, ici la haine, doit être visée. En cela, la haine doit
« comme précéder » la visée. Il faut donc que l’objet de la conscience
réfléchie « haine » préexiste à la conscience irréfléchie. C’est cette
inversion logique, et partant, une inversion phénoménologique, que Sartre
décrit au moyen de la catégorie générale du magique : « La conscience de
dégoût apparaît à la réflexion comme une émanation spontanée de la
haine » (SARTRE, 2003a : 51), et non l’inverse. La répulsion, conscience
irréfléchie, se donne alors comme « se produisant elle-même à l’occa-
sion de la haine et aux dépens de la haine ». Ce lien n’est pas logique
mais magique : « Nous reconnaissons volontiers que le rapport de la
haine à l’Erlebnis particulier de répulsion n’est pas logique. C’est un
lien magique, assurément » (SARTRE, 2003a : 51).
Par le magique, Sartre insiste sur une inversion des termes
du rapport entre la conscience et ses états. La catégorie d’émanation
donne un premier aperçu du vaste domaine qu’est le magique, et il
annonce ainsi : « on verra bientôt que c’est en termes exclusivement
magiques qu’il faut parler des rapports du moi à la conscience »
(SARTRE, 2003a : 51). En effet, après avoir passé en revue séparément
les états, les actions et les qualités, Sartre analyse la constitution de
l’Ego en tant qu’il en est une synthèse psychique. Il montre que le
rapport de l’Ego à ses éléments psychiques est un rapport de pro-
duction poétique ou de création. Or, pour insister sur la nature
spécifique du lien qui unit l’Ego à ses états, Sartre parle de « proces-
sion », en résonnance directe avec ce qu’il a qualifié plus haut d’« éma-
nation ». Sartre affirme ainsi l’idée que l’Ego produit ses états autant
qu’il est ses états. Il note également qu’il existe divers types de proces-
sion de l’Ego à ses états, mais que la plupart du temps la procession
est magique. C’est que cet acte de création se donne comme sponta-
néité mais celle-ci n’est pas pure car l’Ego n’est créateur que pour une
conscience qui le pose de manière inadéquate comme pôle de
production, en sens inverse de l’ordre « réel5 » de production :
« […] ce qui est premier réellement, ce sont les consciences, à travers
lesquelles se constituent les états, puis à travers ceux-ci, l’Ego. Mais,
comme l’ordre est renversé par une conscience qui s’emprisonne
dans le Monde pour se fuir, les consciences sont données comme
émanant des états et les états comme produits par l’Ego. Il s’ensuit
5 Le terme est de Sartre lui-même.
Nathanaël MASSELOT et Gautier DASSONNEVILLE
205
que la conscience projette sa propre spontanéité dans l’objet Ego
pour lui conférer le pouvoir créateur qui lui est absolument
nécessaire. Seulement cette spontanéité, représentée et hypostasiée
dans un objet devient une spontanéité bâtarde et dégradée, qui
conserve magiquement sa puissance créatrice tout en devenant
passive. D’où l’irrationalité profonde de la notion d’Ego. » (SARTRE,
2003a : 63)
Ainsi la catégorie du magique semble bien qualifier une constitution
dont les termes sont inversés et qui permet de rendre compte d’une
unité constituée au-delà de l’immanence. L’Ego est l’objet transcen-
dant qui représente et hypostasie la conscience. Mais si la conscience
est absolument translucide, sur quelle base s’établit alors cette
représentation ? Ce n’est pas la conscience elle-même qui se constitue
dans un Ego ; c’est l’Ego qui, sur le plan de la réflexion, se constitue
comme le représentant de la conscience irréfléchie qui n’a aucune-
ment besoin de lui. Cette relation est donc magique pour Sartre, car
si l’Ego est le signe de la conscience, cependant il ne lui appartient
précisément pas : le gain de l’analyse sartrienne de l’Ego est juste-
ment de libérer le champ transcendantal et de le purifier. D’où le
reflux de l’Ego hors de la conscience absolue, pure spontanéité, car il
est quant à lui une spontanéité passive, une pseudo-spontanéité
(SARTRE, 2003a : 62) ou encore une spontanéité inintelligible (SARTRE,
2003a : 63). On peut dire de l’Ego qu’il représente à sa façon la con-
science, dans une réification, une hypostase.
L’Ego est l’objet transcendant spécial qui résulte de la ten-
tative pour une conscience de se poser elle-même mais qui, n’ayant
pas d’immanence, ne peut que poser un dehors. Avec l’Ego, la
conscience se pose elle-même comme altérité, et c’est pourquoi Sartre
confirme la fameuse formule de Rimbaud dans sa lettre dite du
Voyant : « Je est un autre » (SARTRE, 2003a : 78). L’Ego, transcendant
non mondain, renvoie donc à la conscience en l’absence de celle-ci : il
en est l’image. « Tout se passe donc, écrit Sartre, comme si la con-
science constituait l’Ego comme une fausse représentation d’elle-
même, comme si elle s’hypnotisait sur cet Ego qu’elle a constitué, s’y
absorbait, comme si elle en faisait sa sauvegarde et sa loi » (SARTRE,
2003a : 82).
Dans cette relation spéculaire où la conscience semble se
projeter6 dans l’Ego, Sartre identifie différentes « catégories dynami-
6 Sartre reviendra sur les défauts d’une explication par projection dans L’être
et le néant. Essai d’ontologie phénoménologique en s’opposant à une projection
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
206
ques » (DE COOREBYTER, 2000 : 475-479) (actualisation, émanation,
création) dont l’efficacité repose sur leur nature de lien spécifique et
sur l’opération fondamentale de l’inversion. Ce sont ces différents
procès que l’on peut subsumer sous la catégorie générale du magique.
Pour rendre compte d’un certain « fait irrationnel » de la conscience,
Sartre se dote d’un champ lexical7 qui forme une constellation con-
ceptuelle dont le magique semble être l’opérateur cardinal.
À l’issue de ce premier temps, nous sommes en mesure d’af-
firmer que la découverte du magique permet à Sartre de surmonter
une double exigence : réaliser une synthèse transcendante (rôle éminent
de la liaison) et rendre compte de la constitution sans immanence (rôle
éminent de l’inversion).
2. Conduite d’évasion et quasi-présence : opposition de la
magie et de la néantisation ?
Dans l’Esquisse d’une théorie des émotions puis dans L’Imaginaire,
Sartre réinvestit la catégorie du magique pour gagner la dimension
phénoménologique de l’analyse psychologique. Nous remarquons
avec Vincent de Coorebyter que le « sens dynamique du magique » mis
au jour dans La Transcendance de l’Ego se trouve relayé par « un sens
original, qu’[il qualifie] d’existentiel8 » :
affective de la conscience sur la chose. Cf. SARTRE, 2001 : 650 sq. Nous y
reviendrons. 7 Les termes d’« émanation » et de « procession » caractérisent tous deux le
dogme de la Trinité en théologie chrétienne, à savoir qu’ils désignent,
chacun selon sa nuance, la production d’une personne divine par une autre.
Dans le contexte de la métaphysique de Plotin, ils désignent également l’acte
éternel d’engendrement des hypostases divines, dans un mouvement de
« dégradation », par lequel Dieu (l’Un) engendre le monde. À cette sémantique
mystico-religieuse s’ajoute celle de l’anthropologie : « envoûtement », « partici-
pation », « sorcier », « sorcellerie ». Dans SARTRE, 1995 et SARTRE, 2007, on trou-
vera aussi « incantation ». 8 V. De Coorebyter, consacre toute une sous-partie du chapitre 12 à la
définition du « sens du magique » (DE COOREBYTER, 2000 : 487). Il identifie
ainsi quatre sens principaux du magique : 1/ un sens anthropologique ; 2/ un
sens existentiel ; 3/ un sens dynamique, et enfin, 4/ un sens esthétique. Nous
nous accordons avec lui sur cette identification mais souhaitons toutefois la
compléter en revenant sur la démarche générale qui anime cette analyse et
qui vise à circonscrire les usages de la notion de magie et à en minimiser la
portée interprétative : « L’équation entre psychologie et magie prend ainsi un
sens dépréciatif, sur lequel nous devons nous attarder car la catégorie du
Nathanaël MASSELOT et Gautier DASSONNEVILLE
207
« L’émotion, et dans une moindre mesure les pantomimes de
l’imagination et le jeu de l’acteur, sont des conduites de déréali-sation du monde ou de réalisation de l’imaginaire : la liberté tente
ainsi de dévitaliser le concret ou de matérialiser les vues de l’esprit
pour échapper à sa situation-dans-le-monde. » (DE COOREBYTER,
2000 : 484)
Nous souhaitons avancer ici plus clairement vers l’idée que la décou-
verte progressive de la fonction néantisante de la conscience est
contemporaine de la thématisation de l’émotion comme conduite
magique d’évasion et de celle de l’imagination comme acte magique
de quasi-présence.
L’Esquisse d’une théorie des émotions définit en premier lieu la
conscience émotionnelle comme conscience irréfléchie qui est d’abord
et avant tout conscience du monde (SARTRE, 1995 : 70). Cependant,
l’émotion apparaît dans un monde qui est vécu comme difficile, c’est-à-
dire un monde dans lequel les potentialités qui le constituent et par
lesquelles s’articule l’action ne sont plus perçues comme réalisables.
Face à cette difficulté, le sujet de l’émotion transforme le monde de
manière à le « vivre comme si les rapports aux choses et à leurs poten-
tialités n’étaient plus réglés par des processus déterministes mais par la
magie » (SARTRE, 1995 : 79).
Ayant établi un lien entre intention et conduite, Sartre peut
spécifier la nature de chacun des termes en s’appuyant d’abord sur
l’exemple de la peur passive9 : une bête féroce fonce droit sur moi et,
sous le coup de l’émotion, je m’évanouis. L’émotion se caractérise alors
comme « conduite d’évasion » qui a été commandée par une « intention
annihilante ». Ne pouvant éviter le danger par la voie rationnelle d’une
décision sur les plans de l’action réelle et de la causalité déterministe,
« j’ai voulu l’anéantir ». Cette puissance de négation qui innerve la
conscience émotive se retrouve dans l’analyse de trois autres exemples
d’émotions : la tristesse passive « vise à supprimer l’obligation de cher-
cher [de] nouvelles voies, de transformer la structure du monde […] »
(SARTRE, 1995 : 86) ; la tristesse active est spécifiée comme « conduite
magique prête à équivoque », écrit-il avant d’ajouter, « […] cela ne permet
pas d’ériger le magique en thème privilégié du sartrisme […]. » (DE COORE-
BYTER, 2000 : 484). 9 Les conclusions de l’exemple de la peur passive seront reconduites pour
celui de la peur active, la fuite étant décrite comme un « évanouissement
joué », et la négation de l’objet du danger par tout le corps. SARTRE, 2003a :
84-85.
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
208
négative » (SARTRE, 1995 : 88) ; et enfin la joie est négation de l’absence
(comme l’imagination par la suite, la joie est « une conduite magique
qui tend à réaliser par incantation la possession de l’objet désiré comme
totalité instantanée » (SARTRE, 1995 : 91).
Néanmoins, il semble y avoir un effet de retour de la
conduite d’évasion sur l’intention, et cet effet suit « les limites de
mon action magique sur le monde : je peux supprimer [le danger]
comme objet de conscience mais je ne le puis qu’en supprimant la
conscience elle-même » (SARTRE, 1995 : 84). L’intention annihilante
commande la conduite ineffective qui, à son tour, amène la con-
science à « s’anéantir, pour anéantir l’objet avec elle » (SARTRE, 1995 :
85). Nous entrevoyons ici que l’émotion ne place pas la conscience
dans une position de pure passivité face à la situation qu’elle vit,
mais relève davantage d’une forme exténuée de liberté. En ce sens,
Grégory Cormann montre que l’émotion n’est pas l’abandon
unilatéral de la responsabilité qui procèderait de l’impuissance de la
conscience :
« L’émotion renvoie à la condition ontologique de la conscience.
L’émotion n’exprime pas la pure impuissance de la conscience et la
capacité de celle-ci à s’y enfoncer. Elle manifeste, à l’inverse, la
puissance de la conscience, en tant que cette puissance est toujours
finie – c’est en ce sens encore que l’émotion chez Sartre n’est pas, au
fond, une manière d’échapper aux contraintes du monde ; elle désigne
la manière dont nous “faisons avec” ces contraintes. Aussi, [la théorie
sartrienne] renvoie[-t-elle] à l’expérience que la conscience fait de sa
négativité en situation, en tant qu’elle a à assumer son projet sans
qu’elle puisse jamais coïncider avec elle-même. » (CORMANN 2012,
trad. de l’auteur).
Dans le fond, la conscience émotive est une expérience dans laquelle
la conscience éprouve tout à la fois et soudainement son absoluité et
sa finitude (elle se limite elle-même jusqu’à anéantir un certain mode
de son existence) ainsi que son incarnation et sa situation (elle
découvre son corps comme affection ou comme affecté10). « Un pas
plus loin », ajoute Grégory Cormann, « cela signifie que les émotions
chez Sartre ne sont pas autant de dénégations du monde, mais des
modes de régulation de notre rapport au monde » (CORMANN, 2012).
Si le rôle de l’intention annihilante est primordial dans le basculement
10 Le corps est affection face au monde et affecté par la conscience elle-même
dans la conduite qui prend la forme d’une comédie ou d’un jeu.
Nathanaël MASSELOT et Gautier DASSONNEVILLE
209
vers la conscience magique, reste que la conscience a à vivre par la suite
le monde qu’elle vient d’invoquer et de constituer. Elle a à le vivre
pleinement et, pourrait-on dire, comme collée à lui : « c’est avec ce qu’elle
a de plus intime en elle qu’elle le constitue, avec cette présence à elle-
même, sans distance, de son point de vue sur le monde » (SARTRE, 1995 :
98-99). Il y a donc bien un double mouvement de négation du monde et
de constitution magique du monde.
L’émotion comme l’imagination connaissent chacune une gam-
me infiniment variée d’expressions, différenciées par l’intention qui
préside à chacune, elle-même motivée par la situation (SARTRE, 1995 :
106 ; SARTRE, 2007 : 355-356 ; SARTRE, 2001 : 530). Toutefois, dans le cas de
l’émotion, la conscience est constitutive d’un monde auquel elle croit et
auquel elle adhère sans distance. De ce fait, elle est à la fois agissante
(transformation du monde) et agie (transformation de soi) : nous
retrouvons ici le sens dynamique du magique comme « synthèse irration-
nelle de spontanéité et de passivité » tel que nous l’avons rencontré
dans La Transcendance de l’Ego. À ce titre, il est significatif que L’Esquisse
conçoive la précipitation de la conscience dans le monde magique de
l’émotion comme une dégradation (SARTRE, 1995 : 98) et qu’elle s’achève
sur la considération de l’émotion sur le plan de la conscience réflexive
avec l’exemple de la haine. Tout comme l’Ego est « compromis » par ses
états, Sartre montre que la réflexion est bien souvent « complice » de la
conscience émotive. Il commence à se manifester une cohérence dans le
rôle du magique au sein des écrits phénoménologiques de Sartre et il
nous faut maintenant y rattacher la « psychologie phénoménologique
de l’imagination » d’abord, et « l’essai d’ontologie phénoménologi-
que » ensuite.
Dans L’Imaginaire on assiste avec l’image à une existence
irréelle : l’image se fonde sur une couche perceptive du monde qu’elle
irréalise (en lui important un savoir). Elle nous renvoie à une existence
non mondaine : « l’objet irréel existe, il existe comme irréel, comme
inagissant, sans doute ; mais son existence est indéniable ». Comme
la synthèse réalisée par l’Ego que nous avons rencontrée dans le
premier moment de l’analyse, l’acte d’imagination « est un acte magi-
que » (SARTRE, 2007 : 239). Le point capital de l’analyse de L’Imagi-
naire est d’aboutir à l’explicitation de la conscience imageante comme
étant « à la fois constitution et néantisation du monde » (SARTRE, 2007 :
357).
On souligne souvent que, dans L’Imaginaire, le magique
renvoie à la possibilité pour la conscience de s’opposer activement au
monde, en y faisant surgir une visée irréalisante, due à l’action d’un
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
210
« esprit traînant parmi les choses », selon la formule que Sartre em-
prunte à Alain. Mais la formule elle-même montre bien aussi à quel
point la conscience imageante est toujours en péril. S’il « traîne », c’est
que l’esprit est toujours susceptible de s’opacifier. Le cas du rêve, par
exemple, renvoie à une expérience imaginaire où pourtant la con-
science se fait captive. Cet état précaire de la conscience imageante
apparaît très nettement dans la description par Sartre d’un schéma-
tisme qui intervient dans le passage réciproque entre le signe et
l’image, entre le pur savoir et le savoir imageant encore : « Le schème
a ceci de particulier qu’il est intermédiaire entre l’image et le signe.
[…] En lui-même il n’est rien » (SARTRE, 2007 : 65). On comprend
aussi, dans cette perspective, que l’image ne puisse pas exister dans un
monde : « l’idée même de monde implique pour ses objets la double
condition suivante : il faut qu’ils soient rigoureusement individués ; il
faut qu’ils soient en équilibre avec un milieu. C’est pourquoi il n’y a pas
de monde irréel parce qu’aucun objet irréel ne remplit cette double
condition » (SARTRE, 2007 : 254). Sartre ira dans ce sens jusqu’à décrire
l’image comme un objet-fantôme qui se présente « comme une négation
de la condition d’être dans le monde, comme un anti-monde » (SARTRE,
2007 : 261), dénonçant ainsi très explicitement la précarité de la visée
imageante.
Cet état instable apparaît très nettement encore dans l’expé-
rience relatée de l’imitation, lorsqu’à travers le corps de la fantaisiste
Franconay, je reconnais Maurice Chevalier. Cette expérience permet à
Sartre de marquer le rôle essentiel de l’affectivité lors de certaines
visées imageantes, telle que la conscience d’imitation. Sartre en vient
ainsi à dégager deux principes : « 1. Toute perception s’accompagne
d’une réaction affective. 2. Tout sentiment est sentiment de quelque
chose, c’est-à-dire qu’il vise son objet d’une certaine manière et
projette sur lui une certaine qualité » (SARTRE, 2007 : 62). Sartre en
vient à remarquer, dans cette forme de conscience, « un état hybride
[…] qui vaudrait d’être décrit pour lui seul » (SARTRE, 2007 : 64).
Cette expérience du mime nous semble rejoindre cette « magie
incarnée, cette croyance intégrée au corps même » récemment souli-
gnée par Giovannangeli, qui en conclut que chez Sartre : « entre la
conduite magique de la conscience qui s’émeut et la quasi-présence
magique de l’intuition imageante, la conséquence est bonne » (GIOVAN-
NANGELI, 2010 : 251).
Ainsi, par la magie, la conscience n’instaure pas seulement
une distance vis-à-vis du monde en accomplissant une visée irréali-
sante, mais la conscience magique est aussi une conscience agie qui
Nathanaël MASSELOT et Gautier DASSONNEVILLE
211
vit l’émotion. Dans la magie de l’imagination, la conscience surmonte,
en ce sens, la conduite émotive. Elle la dépasse en la reprenant, sans
l’annihiler. Elle transforme le monde, mais en transformant le monde,
elle se transforme. Finalement, on peut dire que l’imagination ne trans-
forme pas l’objet en un néant. Cet objet ne manque pas généralement
d’une matière, mais « l’objet en image est un manque défini, il se dessine
en creux » (SARTRE, 2007 : 24211). Néantiser, ce serait en ce sens non pas
seulement constituer mais plus précisément constituer l’être en creux. Il
nous faut alors suivre l’intuition de Sartre, qui remarque très
justement que « le rapport de l’objet à la matière de l’imitation est
[…] un rapport de possession » (SARTRE, 2007 : 64. C’est Sartre qui
souligne). Il convient donc de ressaisir la possibilité pour l’être d’appa-
raître au pour-soi comme déterminé, dans un rapport de possession à
distance. C’est sur ce dernier plan que nous allons voir ressurgir le
magique.
3. Le défi de la néantisation constituante : le magique,
champ résiduel de la néantisation
L’Être et le néant, à partir de l’examen de l’apparaître, conduit
à reconnaître au sein de l’Être deux régions d’être : l’en-soi et le pour-
soi. L’en-soi est caractérisé comme pure plénitude, pure présence12.
La position de l’en-soi par lui-même impliquerait une distance, que
seul le pour-soi, qualifié comme « cet être qui est ce qu’il n’est pas et
qui n’est pas ce qu’il est », est capable d’instituer. L’examen de la dis-
tance révèle le pour-soi comme la source responsable des « négatités13 ».
Mais il y a plus : le pour-soi, loin d’être une simple négation, « n’est pas
11 Sartre illustre ce trait de la manière suivante : « un mur blanc en image,
c’est un mur blanc qui manque dans la perception ». Au contraire, le malade
psychasthénique ne met pas le réel en image mais tout lui apparaît irréel, cf.
SARTRE, 2007 : 294. Pour lui, l’antériorité phénoménologique du réel, le
rapport au réel, sont rompus. 12 « L’être est. L’être est en soi. L’être est ce qu’il est. » SARTRE, 2001 : 33. 13 « Ce que nous venons de montrer par l’examen de la distance, nous aurions
pu tout aussi bien le faire voir en décrivant des réalités comme l’absence,
l’altération, l’altérité, la répulsion, le regret, la distraction, etc. Il existe une
quantité infinie de réalités qui ne sont pas seulement objets de jugement,
mais qui sont éprouvées, combattues, redoutées, etc., par l’être humain, et
qui sont habitées par la négation dans leur intrastructure, comme par une
condition nécessaire de leur existence. Nous les appellerons des négatités »
(SARTRE, 2001 : 56).
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
212
seulement l’être par qui les négatités se dévoilent dans le monde, il est
aussi celui qui peut prendre des attitudes négatives vis-à-vis de soi »
(SARTRE, 2001 : 81). On est donc entraîné dans un deuxième mouve-
ment, que Sartre nomme ipséité, et qu’il décrit comme « un degré de
néantisation plus poussé ». De quoi s’agit-il ? Si l’en-soi se caractérise
par sa présence à distance, le soi, par contre, se caractérise davantage
comme une absence : « c’est cette libre nécessité d’être là-bas sous forme
de manque qui constitue l’ipséité ou second aspect essentiel de la
personne » (SARTRE, 2001 : 140).
En indiquant deux degrés de néantisation, Sartre suggère de
distinguer deux formes de transcendance. Il nous donne à considérer
un double rapport à la transcendance, lorsque, dans le chapitre III de
la deuxième partie relatif à la transcendance, en particulier dans
l’élucidation du type de relation entre le pour-soi et l’en-soi, il envisage
deux manières pour la conscience de se rapporter à la transcendance.
« Le pour-soi ne peut être que sur le mode d’un reflet se faisant refléter
comme n’étant pas un certain être » (SARTRE, 2001 : 210). Or, cet être peut
relever de deux ordres : ou bien une pure transcendance, ou bien celle
du soi, réflexive et par conséquent impure. Mais toute l’originalité de
l’analyse sartrienne, consiste à articuler le caractère impur de la
réflexion à sa dimension constituante. Impur ne signifie pas non
constituant, bien au contraire : « il faut distinguer la réflexion pure de
la réflexion impure ou constituante : car c’est la réflexion impure qui
constitue la succession des faits psychiques ou psychè » (SARTRE, 2001 :
195).
La détermination de la pure transcendance relève de la
négation externe, « qui apparaît comme un pur lien d’extériorité établi
entre deux êtres par un témoin » comme « lorsque je dis, par exemple :
La “tasse n’est pas l’encrier” » (SARTRE, 2001 : 211). Le pour-soi est ici
témoin d’une détermination qui lui échappe, et qui « ne peut paraître
un caractère objectif » (SARTRE, 2001 : 221) ni de la tasse, ni de l’encrier ;
comme le note Sartre, « son extériorité même exige donc qu’elle
demeure “en l’air”, extérieure au pour-soi comme à l’en-soi » (SARTRE,
2001 : 222). Au contraire, la négation qui caractérise le pour-soi est dite
« interne », dans la mesure où elle concerne « une relation telle entre
deux êtres que celui qui est nié de l’autre qualifie l’autre, par son
absence même, au cœur de son essence » (SARTRE, 2001 : 221). Il
s’ensuit cette conséquence apparemment paradoxale, à savoir qu’« il
ne se peut donc que j’aie quelque expérience de l’objet qui n’est pas
moi, avant de le constituer comme objet » (SARTRE, 2001 : 212. Nous
soulignons). Ainsi, les négations internes définissent-elles un sys-
Nathanaël MASSELOT et Gautier DASSONNEVILLE
213
tème, où « l’en-soi se dévoile dans son indifférence à tout ce qui n’est
pas soi » (SARTRE, 2001 : 222). Le psychique, « objectivation du pour-
soi » (SARTRE, 2001 : 203), possède une spontanéité dégradée, qui n’est
ni de l’ordre de la pure spontanéité néantisante du pour-soi (négation
interne), ni de l’ordre de la pure inertie de l’en-soi (négation externe)
qui est déterminé en dehors de toute relation : des « sentiments [sont]
individués et séparés par nature » (SARTRE, 2001 : 204), et « l’encrier n’est
pas la table ». C’est que l’objet psychique revêt une influence à distance.
C’est pourquoi Sartre va jusqu’à concéder que le terme soi, dans l’« en-
soi » est une caractéristique impropre, dans la mesure où le soi ne
saurait être une propriété de l’être en-soi, pas davantage, évidem-
ment, que du pour-soi. Il s’établit entre le pour-soi et le soi un
rapport de possession spéciale, non pas d’apparition distanciée
(reflété-reflétant) mais de possession à distance, qui va être qualifiée
de magique :
« Il faut renoncer à réduire l’irrationnel de la causalité psychique :
cette causalité est la dégradation en magique, dans un en-soi qui est
ce qu’il est à sa place, d’un pour-soi ek-statique qui est son être à
distance de soi. L’action magique à distance et par influence est le
résultat nécessaire de ce relâchement des liens d’être. » (SARTRE,
2001 : 203)
Les circuits de l’ipséité nous renvoient ainsi non pas à la néantisation
de l’en-soi transcendant, mais à celle du soi, qui se caractérise par
une présence-absente14. Il est à ce titre remarquable que si l’analyse
des circuits de l’ipséité appelle une élucidation immédiate de la tem-
poralité, Sartre prend le soin d’indiquer que cet examen n’a pour but
que de participer à l’élucidation du véritable problème qui l’occupe :
« celui de la relation originelle de la conscience avec l’être » (SARTRE,
2001 : 141). Il est ainsi amené à dissocier deux manières pour la
conscience de se tenir à distance de l’être. Si la notion de reflet élucide
la relation du pour-soi à l’en-soi, Sartre ne revient pas sur la notion qui
14 « Ainsi l’Ego apparaît à la conscience comme un en-soi transcendant,
comme un existant du monde humain, non comme de la conscience. Mais il
n’en faudrait pas conclure que le pour-soi est une pure et simple contem-
plation “impersonnelle”. Simplement, loin que l’Ego soit le pôle person-
nalisant d’une conscience qui, sans lui, demeurerait au stade impersonnel,
c’est au contraire la conscience dans son ipséité fondamentale qui permet
l’apparition de l’Ego, dans certaines conditions, comme le phénomène
transcendant de cette ipséité » (SARTRE, 2001 : 140).
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
214
serait capable d’acheminer vers une compréhension adéquate de la
relation du pour-soi à cet autre transcendant qu’est le soi. La présence à
soi, comme Sartre y reviendra dans sa conclusion générale, présente
différentes directions de néantisation, et Sartre de distinguer une
« néantisation ek-statique des trois dimensions temporelles » et [une]
« néantisation gémellée du couple reflété-reflétant » (SARTRE, 2001 : 668).
Le magique n’est donc pas simple distance, mais marque la
possibilité d’une action à distance, sur le plan du psychique. L’examen
du soi aboutit ainsi à une décompression des liens d’être, qui remet en
question la dichotomie de l’ontologie régionale en-soi/pour-soi. Le
magique permet de penser le caractère idéal de la négation, qui ne
peut être saisie que dans une structure de reflet (premier degré de
néantisation) à partir d’un témoin (second degré de néantisation). Le
magique semble donc avoir une fonction de limite entre l’irréfléchi et
le réfléchi, étant entendu que cette limite n’est pas une ligne, une
séparation nette, mais un champ. Le magique est un champ de
passage, transfrontalier, de dégradation, le lieu où le néant flotte, et
où l’en-soi est mis en question par le pour-soi en tant qu’il s’apparaît
non pas selon la structure reflété/reflétant, mais selon le degré de
néantisation plus poussé qu’est l’ipséité. L’en-soi y apparaît doté de
qualités, mais ce dévoilement s’accomplit « au ralenti » (SARTRE,
2001 : 653), et témoigne d’« une tendance de l’en-soi d’indifférence »
(SARTRE, 2001 : 653).
C’est à partir du soi que s’annonce l’en-soi pour le pour-soi.
Le psychique, dans le relâchement des liens d’êtres qu’il implique,
indique donc un espace où le pour-soi s’achemine vers l’appro-
priation d’un soi, lequel demeure inatteignable. Le champ magique
est le lieu par excellence de la hantise, où le néant flotte en permanence
au milieu de l’en-soi, selon les deux pôles opposés que définissent la
valeur (voir notamment (SARTRE, 2001 : 129-130) comme dépassement
d’être, et l’« antivaleur » (SARTRE, 2001 : 657) comme retombée du pour-
soi dans l’en-soi, par engloutissement dans le soi. Sartre est ainsi justifié
à parler du soi comme d’un idéal : « le soi représente donc une distance
idéale dans l’immanence du sujet par rapport à lui-même, une façon de
ne pas être sa propre coïncidence » (SARTRE, 2001 : 113). En effet, « nous
avons vu […] que le soi ne pouvait habiter la conscience. Il est, si l’on
veut, la raison du mouvement infini par quoi le reflet renvoie au reflétant
et celui-ci au reflet ; par définition, il est un idéal, une limite » (SARTRE,
2001 : 140).
Le magique est témoin d’une action à distance sous le regard
du pour-soi : « Ainsi, dans la mesure où je m’apparais comme créant
Nathanaël MASSELOT et Gautier DASSONNEVILLE
215
les objets par le seul rapport d’appropriation, ces objets sont moi. […]
Je suis ce que j’ai. […]. La possession est un rapport magique : je suis
ces objets que je possède, mais dehors, face à moi : je les crée comme
indépendants de moi ; ce que je possède, c’est moi hors de moi, hors
de toute subjectivité, comme un en-soi qui m’échappe à chaque
instant et dont je perpétue à chaque instant la création » (SARTRE, 2001 :
637). J’y « retrouve la relation d’être de la création, mais inversée »
(SARTRE, 2001 : 639). L’analyse d’une qualité affective particulière, la
viscosité, est destinée à montrer que l’en-soi n’est pas qualifié par
projection affective : « le visqueux, note Sartre, ne symbolise aucune
conduite psychique, a priori : il manifeste une certaine relation de l’être
avec lui-même et cette relation est originellement psychisée parce que je
l’ai découverte dans une ébauche d’appropriation et que la viscosité m’a
renvoyé mon image » (SARTRE, 2001 : 658). La description de la viscosité
se situe donc à un niveau d’analyse qui témoigne à la fois de cette
décompression d’être typique du magique et qui engage une action à
distance sous le regard d’un témoin qui hante le pour-soi, seconde
caractéristique du magique. Ainsi pourrions-nous peut-être aller jusqu’à
suggérer d’imputer à la catégorie générale de magique la possibilité
d’une élucidation de la liaison de l’en-soi et du pour-soi, à partir de
l’inversion qui se manifeste dans ce que Sartre appelle « un schème
ontologique valable par delà la distinction du psychique et du non-
psychique » (SARTRE, 2001 : 658).
Le magique apparaît comme un concept constitutif de l’être-
au-monde sartrien, identifié ici dans les limites de la psyché. Le
magique définit ce champ résiduel où, dans son effort pour néantiser
l’en-soi, le pour-soi s’apparaît comme le témoin de la constitution.
Mais la constitution n’apparaît jamais que réflexivement, c’est-à-dire
à partir d’un psychique constitué idéalement, qui « cite » ou fait
signe vers l’activité néantisante irréfléchie. Ainsi, le magique défini-
rait en ce sens le champ où la constitution spécifique (on l’a vu, en
creux, inverse) opérée par la néantisation se révèle, au sens photo-
graphique du terme. La causalité magique n’est plus mise au jour
comme une explication « inférieure en principe » mais bel et bien
principielle. Or, c’est ce terrain instable qui doit fournir le terreau des
explications de l’être-au-monde, et où Sartre ira chercher les motifs de
la psychanalyse existentielle. Dans cette description du magique comme
« une certaine catégorie », comme « une structure objective du monde
en même temps qu’une antivaleur », on retrouve évidemment la dimen-
sion anthropologique sur laquelle Sartre conclut son analyse : la réalité-
humaine comme passion en tant que « projet direct de métamorphoser
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
216
son propre pour-soi en en-soi-pour-soi et projet d’appropriation du
monde comme totalité d’être-en-soi, sous les espèces d’une qualité
fondamentale » (SARTRE, 2001 : 662).
Conclusion
Il est temps de conclure notre analyse, en revenant sur ses
résultats. Par la magie, Sartre semble amené à informer l’implicite de
l’activité néantisante du pour-soi lorsqu’il se rapporte à l’en-soi par
négation interne : ce rapport n’est possible que si la néantisation
s’opère sous le témoin qu’est l’Ego, signe de la personne. Le magique
permet à l’être déterminé de l’en-soi d’être « cité » (SARTRE, 2001 : 22) à
travers le psychisme comme témoin de l’activité néantisante. L’Ego
serait cette empreinte, non mondaine, invisible mais visée, cet objet
doté d’une transcendance spéciale, qu’on ne peut désigner qu’au
travers d’une catégorie spéciale, non thématisée mais indispensable à
la compréhension adéquate de l’être-au-monde sartrien : la magie.
Pour autant, comme Sartre le répète, la conscience n’a nullement
besoin de l’Ego pour se faire personnelle15. Il n’en est que le signe, le
témoin. De même, l’activité néantisante n’est donc pas elle-même à
proprement parler magique : « magique » est le titre qui désigne le
champ transcendant spécial où l’activité néantisante peut être citée.
Le magique est l’implicite de l’activité néantisante dans la mesure où
il permet l’élucidation de la néantisation à un niveau spécifique : non
pas la relation immédiate du pour-soi à l’en-soi mais cette relation
envisagée à partir de la qualification de l’en-soi telle qu’elle apparaît
au pour-soi dans une distance idéale à soi. Ce n’est qu’à la réflexion
que le magique livre son témoignage : être-témoin suppose une
distance entre le pour-soi et l’en-soi que seul le « soi », dénominateur
commun de cette opération, peut assurer.
La description du domaine magique permet de rendre compte
de l’immanence qui s’est coulée dans la transcendance : il témoigne
d’un épanchement du pour-soi dans l’en-soi. Aussi y a-t-il une teneur
métaphysique de la qualité, comme celle du jaune du citron. Cette
qualité est destinée à rester celle d’« un être qui nous échappe tota-
15 « Ainsi, dès qu’elle surgit, la conscience, par le pur mouvement néantisant
de la réflexion, se fait personnelle : car ce qui confère à un être l’existence
personnelle, ce n’est pas la possession d’un Ego – qui n’est que le signe de la
personnalité – mais c’est le fait d’exister pour-soi comme présence à soi »
(SARTRE, 2001 : 140).
Nathanaël MASSELOT et Gautier DASSONNEVILLE
217
lement » ; elle est « être révélé comme symbole de l’être en soi » (SARTRE,
2001 : 650). Et Sartre, en s’opposant à une explication de cette qualité par
projection affective consacre une nouvelle catégorie d’analyse : le
magique spécifie la constitution sartrienne comme création par éma-
nation. L’en-soi m’apparaît doté de qualités, qui reflètent magiquement
mon rapport irréfléchi à l’être qu’est la néantisation. Ce n’est qu’à la
réflexion que l’être apparaît comme qualitatif : le magique donne un
coefficient métaphysique, qui demeure au-delà de l’explication phéno-
ménologique.
On pourrait finalement avancer l’idée qu’au-delà de la struc-
ture magique de la conscience que nous nous sommes efforcés de
dégager univoquement, le résidu magique lié à l’activité néantisante
indique une plurivocité du magique. Sartre y verrait peut-être un
versant noétique (la structure magique de constitution de la qualité de
l’en-soi dans la structure du reflet à partir du témoin qu’est le soi) et un
versant noématique (le monde magique spécifique à chaque pour-soi
reflété). L’articulation entre ces deux dimensions du magique fournit
ultimement, pensons-nous, la possibilité de comprendre le caractère
unitaire de la conscience. « L’immanence, conclut justement Sartre,
sera toujours limitée par la dimension d’en-soi du phénomène et la
transcendance par sa dimension de pour-soi ». L’élucidation de la
relation du pour-soi à l’en-soi engage dès lors un « néant idéal », qui
peut être décrit en s’installant au niveau le plus intime de l’activité
néantisante, mais intime ne signifie pas ici immanent : il s’agit du
champ résiduel magique que la néantisation laisse flotter autour d’elle,
où la détermination se reflète vis-à-vis d’un témoin.
Bibliographie
CORMANN G., 2006, « L’enfant (et le) sauvage : entre L’Idiot de la
famille de Sartre et La Pensée sauvage de Lévi-Strauss », dans P. ALVES,
J. M. SANTOS et A. FRANCO DE SA (dir.), Humano e Inumano. A Dignidade
do Homem e os Novos Desafios, Actas do Segundo Congresso Interna-
cional da Associação Portuguesa de Filosofia Fenomenológica, Centro
de Filosofia, Lisboa, p. 379-394.
CORMANN G., 2011, « Passion et liberté. Le programme phénoméno-
logique de Sartre », dans Ph. CABESTAN et J.-P. ZARADER (dir.), Lectures de
Sartre, Paris : Ellipses, p. 93-115.
CORMANN G., 2012 [à paraître], « Existenz, Körpertechniken und
Gewalt bei Sartre. Skizzen zu einer politischen Anthropologie der
Emotionen », dans H. FEGER et M. HACKELA (éd.), Existenzphiloso-
phie und Ethik, Berlin : De Gruyter.
DE COOREBYTER V., 2000, Sartre face à la phénoménologie. Autour de
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
218
« L’intentionnalité » et de « La transcendance de l’ego », Bruxelles :
Ousia.
GIOVANNANGELI D., 2010, Figures de la facticité. Réflexions phénomé-
nologiques, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, coll. « Anthropologie et philoso-
phie sociale ».
KECK F., 2008, Lucien Lévy-Bruhl, entre philosophie et anthropologie.
Contradiction et participation, Paris : CNRS Éditions.
RICHMOND S., 2010, « Magic in Sartre’s early philosophy », dans Jonathan
Webber (ed.), Reading Sartre. On phenomenology and existentialism,
Londres & New-York : Routledge, p. 145-160.
SARTRE J.-P., 2005, « Une idée fondamentale de la phénoménologie
de Husserl : l’intentionnalité » (1939), dans Situations philosophiques,
Paris : Gallimard, coll. « Tel », p. 9-12.
SARTRE J.-P., 2003a [1936], La Transcendance de l’Ego. Esquisse d’une
description phénoménologique, Paris : Vrin.
SARTRE J.-P., 1995 [1939], Esquisse d’une théorie des émotions, Paris :
Hermann.
SARTRE J.-P., 2003b [1936], L’Imagination, Paris : PUF, coll. « Quadrige ».
SARTRE J.-P., 2007 [1940], L’Imaginaire. Psychologie phénoménologique
de l’imagination, Paris : Gallimard, coll. « Folio – Essais ».
SARTRE J.-P., 2001 [1943], L’Être et le néant. Essai d’ontologie phénomé-
nologique, Paris : Gallimard, coll. « Tel ».
SOKOLOWSKI R., 1970, The formation of Husserl’s concept of consti-
tution, The Hague : M. Nijhoff.
219
COMPTES RENDUS
DIDI-HUBERMAN Georges, Remontages du temps subi. L’œil
de l’histoire 2, Paris, Éd. de Minuit, coll. « Paradoxe », 2010
(249 p.).
Second opus de L’œil de l’histoire, réflexion inaugurée lors d’un
précédent ouvrage sur le journal d’exil de Bertolt Brecht, Remontages
du temps subi se présente comme un montage d’essais sur les tentatives
– les essais précisément – de montage de la violence. Ces tentatives
sont tour à tour cinématographiques par les travaux de Samuel Fuller
et de Harun Farocki, photographiques par le témoignage d’Agustí
Centelles et plastiques à travers l’œuvre de Christian Boltanski. G. Didi-
Huberman déploie ainsi les multiples enjeux, nécessairement actuels,
du montage d’images, et ce avec l’appui anachronique d’auteurs
qu’il côtoie désormais régulièrement : Walter Benjamin, Aby Warburg
ou encore Theodor W. Adorno.
S’opposant au tragique constat de la saturation de notre mé-
moire commune et de l’illisibilité irrévocable de certaines images de
l’histoire, cet ouvrage ne cesse d’étudier des dispositifs de montage
comme autant de « machines de guerre » deleuziennes. Des machines
d’images produites pour objecter d’autres images ; pour contrer le
pouvoir de celles-ci par la puissance de celles-là. Des constructions à
jamais inachevées pour réapprendre à regarder ce qu’on pense à tort
avoir trop vu. Cinéaste contemporain d’origine allemande, Harun
Farocki est l’un des artisans de ces modestes machines qui s’efforcent
de réarmer les yeux du spectateur ; de ré-ouvrir le temps et de ré-
ouvrir les camps. Car ce sont notamment les images d’Auschwitz qui
sont ici remises sur la table de montage, retravaillées non comme la
limite absolue du nommable, mais comme cet incomparable moment
de l’histoire qu’il nous faut, pour cela même, comparer sans relâche ;
qu’il nous faut inlassablement remonter, remontrer.
Dans Bilder der Welt und Inschrift des Krieges (Image du monde et
inscription de la guerre), Farocki retravaille ainsi les images aériennes de
l’armée américaine survolant le camp en avril 1944. Les interprètes de
l’époque identifièrent aisément les différentes usines bordant le camp
d’Auschwitz, mais n’étant pas chargés de trouver le camp lui-même,
jamais ne le virent. À travers ce remontage d’images, Farocki, à l’instar
d’Adorno ou d’Horkheimer, repose la question des Lumières en la
liant ici intimement à celle de la reconnaissance aérienne (Aufklärung).
La raison moderne éclairée est ainsi rapprochée au plus près du
phénomène de guerre, de l’image technique dans laquelle toute mise
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
220
en lumière est couplée à la destruction programmée de ce qui est
éclairé. Les Lumières partagent leur nom avec un événement exem-
plifiant notre incapacité à voir ce qui nous apparaît, ce qui surgit devant
nous. L’Aufklärung est nouée aux images produites pour ne pas voir.
En demeurant au niveau de l’image dans son analyse et sa
dénonciation de la barbarie engendrée par la rationalité moderne,
Georges Didi-Huberman semble rester en marge du débat, ne parvenir
à poser son accusation que contre un épiphénomène. Mais le domaine
des images est tout sauf collatéral. Au sens de Didi-Huberman, il est
même tout à fait central dans la destruction des vies humaines. Et de
prendre pour exemple un autre travail de Farocki dans lequel une
caméra de surveillance au sein d’une prison américaine se voit unie à
un fusil (Ich glaubte Gefangene zu zehen). Lorsqu’une dispute entre
détenus éclate, l’oeil mécanique cible et tue.
Farocki récupère les images-rebuts, les petits riens dont
personne ne se préoccupe, tel le chiffonnier de Walter Benjamin,
créateur d’une histoire anonyme. C’est le cas également de Boltanski qui
accumule les vêtements usés qui seront remontés, démontés par une
gigantesque grue mécanique. C’est encore le cas d’Agustí Centelles,
humilié parmi les humiliés, photographiant les latrines de son camp.
Entre leurs mains, ces bouts de chiffon deviennent explosifs. Ils les
montent, souvent les remontent dans l’espoir de leur rendre une
certaine lisibilité. Suivant en cela Farocki, Didi-Huberman rapproche
l’acte de montage de la tâche, exigeante et modeste, du paveur de rues.
Lançant chaque pierre en l’air, le paveur décide au vol où sera sa place
exacte. En prolongeant la métaphore, l’image prenant place provisoi-
rement au sein d’un montage prend également position dans l’espace
public, elle est ici littéralement rendue à la rue.
Monter les images pour fendre la violence du monde, monter
pour relier l’histoire. Fendre et lier, re-fendre et relier, c’est ici la
dialectique du travail de montage, travail d’une patience engendrée par
la colère, par l’urgence de remonter le temps subi.
Natacha PFEIFFER
BIMBENET Étienne, L’animal que je ne suis plus, Paris, Galli-
mard, coll. « Folio essais », 2011 (512 p.).
On n’a pas fini de poser la question de l’homme. Si son origine
animale est aujourd’hui largement admise et abondamment étudiée,
la longue histoire de ce qu’il possède en propre ne continue pas
COMPTES RENDUS
221
moins de se dérouler avec minutie, en marge d’une éthologie qui
affaiblit pourtant les lignes fortifiées de l’exception humaine. L’hom-
me, puisqu’il persiste à vouloir se définir, se pense désormais tant
comme être naturel partageant les assises biologiques de tout vivant,
que comme seul porteur d’une dimension symbolique qu’aucune
comparaison avec les comportements animaux n’inquiète. De peur
de sombrer dans un réductionnisme physicaliste ou au contraire
dans un obscurantisme métaphysique, il semble qu’il faille désormais
endosser les deux uniformes du naturalisme et de l’humanisme. À cette
condition pourra-t-on penser à nouveaux frais l’essence humaine sans
pour autant couper le fil généalogique de l’évolution.
C’est ce que fait Étienne Bimbenet tout en creusant considéra-
blement l’écart – en témoigne le titre de son ouvrage – entre l’homme et
son origine zoologique. La paléoanthropologie a beau nous avoir révélé
notre ancêtre commun et la génétique un patrimoine extrêmement
proche de celui des grands singes, rien ne saurait selon lui masquer le
saut qualitatif opéré par le bipède à travers la convergence d’une série
de fonctions (technique, langagière et sociale) qui l’excluent des autres
mortels. Bien plus, l’intégration progressive de ces spécificités l’aurait
façonné en un être structural, en une totalité nouvelle irréductible à ses
éléments simples. Le phantasme d’une nature primitive doit donc à
jamais être abandonné ; notre animalité n’a pas été enfouie sous des
strates de perfectionnements successifs mais diluée dans un « dépas-
sement de la nature vers la culture ». Le postulat de départ est clair :
l’homme ne peut pas être défait et n’est pas à voir comme un animal
superlatif mais comme un être radicalement à part.
Pour l’auteur, seule une phénoménologie bien conduite (qui
s’intéresserait davantage au procès hominisant) pourrait seconder la
science dans sa caractérisation de la différence anthropologique et
permettre au philosophe de montrer avec certitude, à travers l’analyse
descriptive de l’expérience vécue, que celle-ci est essentiellement diffé-
rente de l’expérience animale. Bimbenet essaye de nous convaincre, au
fil d’une enquête approfondie, que l’animal est pauvre en monde parce
qu’il est entièrement ouvert sur son milieu, accaparé par lui et enfermé
dans le cercle de ses besoins immédiats. L’animalité serait en ce sens
subjectivité pure, seule source d’un véritable perspectivisme, d’un point
de vue total et unifiant. Dans ce paysage, l’attitude naturelle, croyance
illusoire en un monde objectif, devient le privilège exclusif de l’homme.
La rupture ontologique ainsi consacrée se poursuit à travers
une analyse des perceptions et langages humains et animaux. Si
nous ne sommes plus des animaux pour Bimbenet, c’est que nous
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
222
avons dépassé leur perspectivisme univoque pour le multiplier à
l’infini. Dans cette prolifération du symbole au-delà du signe réside
la « performance » de l’humain qui allie l’unification vitale et la dissé-
mination du voir. Nous sommes capables d’attention conjointe, de
partage social, d’intersubjectivité, bref, d’une sortie hors de soi dans
un geste de reconnaissance de l’altérité d’autrui. Le monde devient
pour nous transcendance et c’est ce réalisme (le fait de croire en un
monde commun) qui serait constitutif de notre humanité et que
seule la réduction phénoménologique permettrait de faire apparaître
sur fond d’une subjectivité que nous partageons avec le vivant.
L’auteur en appelle ainsi à une autre métaphysique qui, loin de faire
de l’homme le trait d’union entre deux mondes ou deux substances,
affirmerait pleinement la dimension illusoire de l’absolu comme carac-
téristique de la vie humaine.
Finalement, c’est une idée classique de la pensée occidentale
qui est reconduite ici. Même si l’avènement de l’homme n’est plus
d’origine divine et que les animaux ne sont pas considérés comme des
machines, le dualisme n’en est pas moins déplacé dans un mouvement
allant du substantialisme vers les fonctions. Tout en faisant l’effort de
reformuler le problème de la différence anthropologique, ce que l’auteur
concède à l’animal est aussitôt recouvert par son dépassement irré-
ductible chez l’homme. Aucun comportement gratuit, aucune liberté
d’action : le vivant non humain, quel qu’il soit, ne sort jamais d’une
visée instrumentale et est exclusivement envisagé sous l’angle fonction-
naliste et sur le mode pratique. C’est oublier que de telles explications
sont toujours relatives à la création de rapports qui leur préexistent et
dont le sens et l’expression sont trop souvent réduits à la causalité.
Enfin, s’il est vrai que la littérature éthologique prolifère depuis
quelques années et que l’on assiste à ce que d’aucuns ont pu nommer
un « tournant animaliste » dans diverses disciplines, on peut s’étonner
qu’Étienne Bimbenet s’érige en pourfendeur de ce qu’il appelle le « zèle
égalitariste » ou le « relativisme quasi dogmatique » et qu’il dénonce la
position zoocentrique comme étant trop confortable. Ces courants
restent en effet largement minoritaires et nouveaux au regard d’un
anthropocentrisme scientifique et philosophique séculaire.
Valérie GLANSDORFF
223
ABSTRACTS
Iwan BARTH
Des « objets communicants » à l’imaginaire social de la
rationalisation : un objet de recherche entre aspects matériel et
symbolique de l’interconnexion des TIC
From “smart things” to imaginary of rationalisation :
A research object between concrete and symbolic aspects
of ICT interconnection
Information and Communication technologies (IT) are slowly modifying our
perception of the most everyday objects. The interconnection of these objects
is currently being developed in two ways. Increasing the number and power
of “things-that-think” with embedded IT elements is the first one. Creating
an “ambient intelligence” and networking those objects to make them almost
“disappear” is the second one. A theoretical framework is needed to analyse
this phenomenon. Numerous historical resources in communication studies
fail to reflect the polymorphous nature of the innovation in ubiquitous com-
puting. Therefore, the critical theory and the theory of social imaginary are
chosen due to their un-clustered approach to the social field. Constructing the
subject of the research in this way enables us to keep the complexity and
multiplicity of communicating objects, and to take a critical look at the “social
demands” naturally linked to this subject.
Marie GODET
De l’« objet bouleversant » à L’Objet à travers les âges.
Évolution de la conception et de l’utilisation de l’objet chez
Marcel Mariën et Christian Dotremont
From the “objet bouleversant” to L’Objet à travers les âges.
Evolution of the conception and use of the object in the work of
Marcel Mariën and Christian Dotremont
This article aims to outline the development of the notion of object in “second-
generation” Belgian surrealism through the figures of Marcel Mariën and
Christian Dotremont. Both showed their interest in the object as soon as they
had joined the surrealist movement. This interest fits in a broader trend from
the early thirties on. Influenced by the writings of Paul Nougé and the pain-
tings of René Magritte, both poets would assimilate their Brussels legacy
according to their own concerns and, by making use of the object, eventually
develop a very personal body of work. Their divergences, however, remained
rooted in an aspect they continued to share : the meticulous attention they
gave to everyday life.
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
224
Benjamin STRAEHLI
L’objet sonore et la musique
Sound-object and music
Pierre Schaeffer has claimed that we need to use a concept such as “sound-
object”, if we want to do musical research. He argues this claim by referring
to Husserl’s phenomenology, and elaborates a solfeggio of “sound-objects”.
This concept is interesting, on the one hand because it highlights something
in audition that plays a role in musical evaluation, and on the other hand
because it shows that it is possible to describe it without falling into simple
subjectivism. Nevertheless, its definition raises some problems, especially
concerning the relationship between a physical sound-wave and a “sound-
object”. The present article explains this concept’s meaning and the reasons
why Schaeffer uses it. Finally, we will try to establish if the concept, regarding
the encountered problems, is still relevant.
Fleur COURTOIS-L’HEUREUX
« Bon pied, bon œil ! » Expériences fétichistes de l’objet à
l’épreuve de la danse
Feetish Tango : Experimenting with fetishistic experiences
of the object through dance
By infiltrating itself into the historic, mythical and practical constructions of
argentinian tango, a mosaic of analytical registers shall multiply the concep-
tual spectrum of the object. The woman-object, tango as an anthropological
object, the shoe as a phallocratic or dancing fetish (nor human, nor divine), the
desubjectivized and re-objectified body will be as many sacrificed objects in
this study. The power of these objects will continue to act and to tinker with
uncertain borders. This article has taken the perspective of not making the
objects speak but to testify of what the objects “that make do” are till their
own making.
Thierry DRUMM
La vie publique des choses – Objets et choses de William James
The public life of things. Objects and things in William James
Few human practices have carried deprivation, or even hatred, towards
objects, so far as philosophy seems to have done : it would be challenging to
mention another practice as devoid of objects as philosophy is. Nevertheless
pragmatism and William James’ thought offer tools not only to overcome this
disaffection – which is close to denial – but also to understand its theoretic
ABSTRACTS
225
reasons and to assess its practical consequences. Indeed James puts forward a
twofold account of the way in which though requires objects, thought being
no longer understandable as anything else than a shift between “empowering”
objects and “confronting” objects. This first formulation nevertheless leads
James even further, when it comes to give back to the object its particularity
within a certain relation to things which, as for them, demand to exist not
only “for a thinker” but publicly and even politically.
Augustin DUMONT
L’objet par l’image selon Fichte. La constitution génétique de
l’objectivité dans la Wissenschaftslehre de 1813
The Object through Image according to Fichte. The genetic
constitution of objectivity in 1813’s Wissenschaftslehre
This paper aims at questioning the concept of “object” in Fichte’s penul-timate version of Science of Knowledge. Far from neglecting the problem
because of his so-called praise of omnipotent subjectivity, Fichte suggests to
back down over it from the point of view of a philosophy of image. This is
why the object has to be the result of a complicated genesis of a being’s
image as schematism and pure apparition.
Sébastien RICHARD
Au-delà de l’être et du non-être : les origines de la
Gegenstandstheorie meinongienne dans la tradition philosophique
autrichienne
Beyond Being and Non-Being : The Origins of the Meinongian
Gegenstandstheorie in the Austrian Philosophical Tradition
The present paper studies the way in which the theory of objects, as fully
developed by Meinong at the beginning of the XXe century, arose in the
Austrian philosophical tradition from the problematic encounter of two
theories : on the one hand, the Bolzanian thesis that there are objectless
representations and, on the other hand, the Brentanian thesis of the inten-tional inexistence of the mental phenomena. The thesis put forward in this
paper is that the solution to this problem in Twardowski’s philosophy
consists of maintaining that for every representation there is an objectual
correlate. This solution leads to the development of a theory of objects in
general in which the objects are considered independently of their existence
or their non-existence, that is beyond being and non-being.
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
226
Julien MARÉCHAL
L’objet et le système conceptuel
Object and Conceptual System
The rebirth of metaphysics in analytic philosophy championed by P. F. Strawson
is characterised by a commitment to understanding the use of our concepts in a
communicational setting. Strawson thought that the category of material object
was fundamental to our ways of communicating. D. Davidson produced
various criticisms of this claim but, more importantly, offered a very successful
model of communication in which the constitution of the object of discourse
could be investigated. Even though they both stress that such a starting
point is mandatory, what matters in the end is, for one, that our experience
be continuous and, for the other, that our attitudes converge on a shared
cause. According to Strawson, only the materiality of objects can secure the
former property. And the continuity of experience appears to require the
coherence of our concepts, i.e. the idea of a conceptual scheme. But, in the
end, the claim that coherence is necessary overdetermines the description of
our linguistic practices.
Fabian BALTHAZART
La lente émancipation de l’orchestre dans le motet à grand chœur
versaillais
The slow emancipation of the orchestra in the
Motet à Grand Choeur at the Chapelle Royale of Versailles
The study of composition mechanisms is essential for anyone who wants to
restore an incomplete partition. It also helps to seize the spirit of a specific
type of artistic creation at one specific period in its relation with the contem-porary philosophical or spiritual trends. In the present article, this approach
has been applied to the relations that govern the choir and orchestra in the
French grand motet from 1660, birth of the genre, and 1744, death of Campra
and the time when Mondonville took office at the Chapelle-Royale. In the
production of composers attached to this prestigious musical institution of
the Ancien Régime, the orchestra gradually freed itself from its dependence
on the choir. Departing from the observation of this slow evolution, we will
conclude by making a parallel with a change occurring at the same time in
the spiritual and artistic perception of the biblical texts which were turned
into musical masterpiece.
ABSTRACTS
227
Nathanaël MASSELOT et Gautier DASSONNEVILLE
Magie et constitution chez le premier Sartre. Vers une figure
de la néantisation
Magic and constitution in the early Sartre. Towards a figure
of nihilation
The aim of this paper is to show how the theme of magic leads the early Sartre
to the well-known concept of nihilation. In order to reach this goal we will use
the problem of the constitution of personal consciousness as a guiding
thread. After having identified the main features of magic within the frame-work of Sartre’s distinction between consciousness and the psychic, we will
first point out how magic helps clarifying some of the core elements of
consciousness as such. We will then compare the different kinds of magic at
stake in imaginative and emotional consciousness. We will finally turn to Being
and Nothingness where, on our reading, the field of magic appears to disclose the
activity of nihilation beyond the dichotomy of being-in-itself / for-itself. As a
conclusion, we will argue that magic can be considered as a residual element,
as it were, of the process of nihilation.
229
CONTRIBUTEURS
Fabian BALTHAZART, boursier Mini-Arc de l’Université Libre de Bruxelles,
prépare une thèse (à l’ULB et au Conservatoire Royal de Mons) sur la restau-ration des Grands Motets français de la première moitié du XVIIIe siècle.
Iwan BARTH est docteur en Sciences de l’Information et de la Communication,
chercheur associé au laboratoire GERIICO – Lille 3 et post-doctorant au labora-toire AGIM de Grenoble. Ses travaux interrogent les implications techniques et
communicationnelles de la modélisation, aussi bien dans l’espace domestique
qu’en organisations.
Fleur COURTOIS-L’HEUREUX est docteur en philosophie et Chargée de recher-ches du F.R.S.-FNRS. Elle travaille entre philosophie et danse au Groupe d’étu-des constructivistes de l’Université Libre de Bruxelles. Elle est également profes-seur de philosophie à l’INSAS.
Gautier DASSONNEVILLE prépare une thèse de philosophie en co-tutelle
(entre les Universités de Liège et de Lille 3) consacrée à la magie et au “magique”
dans la phénoménologie sartrienne. Il bénéficie d’un subside fédéral pour la
recherche en sciences humaines.
Thierry DRUMM enseigne la philosophie en France et poursuit une thèse
sur la pensée de William James. Il est rattaché au Centre de recherche en
Philosophie de l’Université Libre de Bruxelles.
Augustin DUMONT est docteur en philosophie et Chargé de cours invité
aux Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles. Ses recherches portent
sur l’affectivité, l’imagination et le langage dans l’idéalisme et le romantisme
allemands.
Valérie GLANSDORFF est Assistante au Centre de recherche en Philosophie
de l’Université Libre de Bruxelles. Elle prépare une thèse sur l’apparence ani-male dans l’horizon épistémologique contemporain.
Marie GODET est Assistante pour l’Art contemporain au Département
d’Histoire, Histoire de l’art et Archéologie de l’Université Libre de Bruxelles.
Elle poursuit une thèse sur l’objet dans le surréalisme de Belgique et de France.
Julien MARÉCHAL est docteur en philosophie et membre de l’Institut supé-rieur de philosophie de l’Université Catholique de Louvain. Ses travaux
portent sur la théorie des actes de parole, ainsi que sur les rapports entre
philosophie du langage et pragmatisme.
L’Année Mosaïque – 2012 / 1
230
Nathanaël MASSELOT est Allocataire-moniteur à l’Université Charles-de-
Gaulle Lille 3. Il prépare une thèse de philosophie sur le temps et l’individua-tion dans la philosophie transcendantale chez Kant et Husserl.
Loïc NICOLAS est docteur en rhétorique et Chargé de recherches du F.R.S.-
FNRS. Il est membre du Groupe de recherche en Rhétorique et en Argumen-tation Linguistique de l’Université Libre de Bruxelles. Il travaille sur la
pensée de Chaïm Perelman et l’histoire des théories de l’argumentation.
Natacha PFEIFFER prépare une thèse sur le corps cinématographique. Elle
est chercheuse en philosophie rattachée au Centre Prospéro (langage, image,
connaissance) des Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles.
Sébastien RICHARD est docteur en philosophie. Avec Marc Peeters, il dirige
le Groupe de recherche en ontologie formelle et logique développementale au
sein du Centre de recherche en Philosophie de l’Université Libre de Bruxelles.
Benjamin STRAEHLI prépare une thèse sur le savoir de l’harmoniste et son
objectivité. Il est rattaché à l’École doctorale « Sciences de l’homme et de la
société » de l’Université Charles-de-Gaulle Lille 3.
Aline WIAME est Aspirante du F.R.S.-FNRS et doctorante en philosophie à
l’Université Libre de Bruxelles. Sa thèse est consacrée à l’esthétique et aux
implications philosophiques de la défiguration dans l’écriture théâtrale du
vingtième siècle.