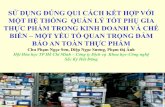Paria Une exception qui éclaire la règle
-
Upload
univ-paris8 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Paria Une exception qui éclaire la règle
1
La figure Paria : une exception qui éclaire la règle Deux âmes, hélas! habitaient ma poitrine, Et l'une ou l'autre serait coupée de sa sœur Goethe Oh, why was I born with a different face Why was I not born like the rest of my race? When I look each on starts when I speak I offend Hhen I'm silent and passive and loose every friend William Blake Jamais la rhétorique des droits de l'homme n'a tant co-existé avec la prolifération d'hommes et
de femmes privées de cette condition première qu'Arendt associe à l'exercice des droits : une
place dans le monde qui garantit que nos opinions ont du poids et nos actions de l'effet1. Cette
antinomie nous la vivons comme une anomalie, une déviation provisoire de la règle qui,
depuis au moins deux siècles, fonde l'universalité des droits sur l'humanité commune. Elle est
plus visible dans des moments de crise, quand des millions de personnes se trouvent privées
de toute appartenance à un monde commun, mais il s'est avéré extrêmement difficile de la
repérer dans le fonctionnement "ordinaire" des démocraties modernes, dans le destin
quotidien, que celles-ci ont fait et font toujours subir à des catégories entières d'individus qui,
avant d'être jugés sur leurs opinons et leurs actions, sont mis à part au nom de ce qu'ils sont,
selon une évaluation hiérarchique de "leur" différence.
C'est cette antinomie qu'exprime la figure du paria dont l’apparition au sein de la culture et du
vocabulaire politique occidental est semée de paradoxes et d'ironies: La première et non la
moindre concerne le mot lui même qui, bien qu'originaire de l'Inde, est … inconnu à cette
adresse2. Produit d'un usage métonymique du mot tamoul parayan3 fait par les Européens, il
n'a jamais appartenu au vocabulaire des indiens4 et son emploi métaphorique est souvent
perçu, encore aujourd'hui, comme une insulte colonialiste qui reprend en son compte la vision
1 2 "The word Paria is unknown"'(in our sense?) "to all natives, unless as learned from us." Sir. Henry, Yule, HOBSON-JOBSON: A glossary of colloquial Anglo-Indian words and phrases, and of kindred terms, etymological, historical, geographical and discursive. New ed. edited by William Crooke, London, : J. Murray, 1903, Entrée "Pariah, Parriar" p. 678 3 Cf. Parayan (Petit Robert) ou palayan, parayer, periyer, selon les la provenance linguistique des européens qui l'ont transcrit, qui signifie "joueur de tambour", groupe considéré comme impur. "L'expression" dit Max Weber "serait du point de vue hinduiste, tout-à-fait incorrecte. La caste Pulayan ou Parayan de l'Inde du Sud est loin d'être la couche socialement la plus inférieure" (..). Nous utilisons l'expression 'paria' ici en nous appuyant sur la signification européenne, devenue maintenant habituelle, de façon semblable que au terme 'kadi' dans 'justice de kadi' , Le judaïsme antique, Paris, Plon 1982, p. 12. 4 Désignés de Harijans (enfants de Dieu), l'appelation euphémique que leur avait accordée Mahatma Gandhi, les intouchables sont aujourd'hui officiellement connus et désignés comme dalits (peuples écrasés ou opprimés).
2
brahmanique de l'intouchabilité5. Cette critique concerne, certes, surtout l'usage anglais du
mot pariah dont le sens courant, "voyou"6, l'emporte largement sur la métaphore politique
désignant l'exclusion et l'inégalité. Non pas que cette dernier soit exempte de colonialisme; il
suffit de rappeler que non seulement le mot est introduit dans le vocabulaire occidental par
les premiers colonisateurs portugais7, mais aussi – autre ironie significative – que ses premiers
usages critiques font leur apparition au moment où la critique de l’autorité arbitraire repousse
la hiérarchie et les privilèges héréditaires hors de l'Europe, pour les associer à l’obscurantisme
oriental.
Or, cette tension inhérente au choix d'un terme emprunté à la hiérarchie de caste pour rendre
compte d'une société où la hiérarchie devient illégitime, est précisément ce qui nous intéresse
ici car c'est autour d'elle, et des mécompréhensions qu'elle comporte, que se constitue le
champ sémantique qui donne à la figure du paria sa singularité "occidentale" et son historicité.
Il est impossible dans le cadre de ce texte de retracer les méandres d'une telle constitution, je
ne vais en donner que quelques répères. Bien qu'introduit depuis le début du 16ème siècle, le
mot n'entre dans l’espace public littéraire et politique de l’Europe qu’à la fin du 18ème. Il y est
précédé par le mot caste8 dont la première connotation péjorative remonte à Montesquieu qui
souligne l'élément nouveau qui va donner au paria toute sa force contestataire : l’aversion et le
mépris attachés désormais à l’infériorité de rang qui rompt la solidarité humaine9.
L’apparition du mot paria dans les textes des Lumières radicalise cette connotation critique de
la caste en l’attachant à une dénonciation systématique de l’autorité arbitraire. C'est le cas de
l’Encyclopédie (Pareas, Poulias, Poulichis), mais surtout de la littérature anticolonialiste,
notamment du célèbre ouvrage de l’abbé Raynal Histoire philosophique et politique des
établissements et du commerce européen des deux Indes (1770) qui malgré la censure,
connaîtra plus d’une quinzaine d’éditions clandestines jusqu'à la Révolution. Le vif intérêt
5 Connus sous le noms de 6 Cf. l'expression "pariah dogs" pour chien errant ou sans maître. L'Irak, le Cuba ou la Libye sont courramment désignés par les médias de "pariah states" et Slobadan Milosevic de "international pariah". Inversément, le mot Pundit, qui désignait traditionnellement les Brahmanes est utilisé comme synonyme de chercheur ou d'expert. 7 La première occurrence du mot que j'ai trouvée, Pareas vient de Duarte Barbosa (1516) qui a servi le roi du Portugal en Inde de 500 à 1517. Cf. Duarte BARBOSA, The Book of Duarte Barbosa, An account of the countries bordering on the Indian Ocean and their inhabitants … completed about the year 1518," tr. Mansel Longworth Dames, New Delhi, Asian Educational Services, 1989, vol. 1 p. 53-58, qui est une source précieuse pour les premières décennies de l'empire maritime portughais en Asie. 8 Cf. HOBSON-JOBSON: op. cit.. Plus tard MANDELSIO, Voyages célèbres et remarquables, faits de Perse aux Indes orientales par Mandelsio, trad. de l'allemand par Wicquefort, 1659 et THEVENOT, Troisième partie des voyages de M. de Thevenot, P., C. Barbin, 1684
3
pour les récits de voyage et pour l’exotisme, moyen privilégié de communication des idées
des Lumières, sert à populariser au sein du public lettré le sort réservé aux intouchables
indiens dans des termes qui disent peut-être moins sur la hiérarchie des castes que sur les
préoccupations politiques européennes dans cette fin du XVIIIème siècle: le mépris et
l’impureté qu’ils portent comme une tare de naissance, les emplois dégradants qu’ils
occupent dans la division du travail, les rituels de séparation et de purification, les interdits de
la commensalité qui marquent leurs rapports avec les autres castes, leur "mise au ban" de
l’humanité.
C’est paradoxalement au moment où le concept d’humanité fait son entrée triomphante
comme horizon de l’universalité des droits que le paria s’introduit dans le vocabulaire
politique de la Révolution pour exprimer la perplexité ou l’indignation face à la difficulté
d’inclure dans ce nouveau concept certaines catégories d’individus : " Faut-il tant de
verbiages et de citations pour prouver qu’un juif est un homme et qu’il est injuste de le punir
dès sa naissance pour les vices réels et supposés qu’on reproche à d’autres hommes avec
lesquels il n’a rien de commun que la croyance ? ", écrivait Zalkind Hourwitz à la veille de la
Révolution10. Si "l'exclusion (…) d'une moitié du genre humain par l'autre est quelque chose
d'impossible à expliquer selon le principe abstrait [des droits de l'homme] (…) sur quoi repose
votre constitution ?", écrivait Mary Wollstonecraft à Talleyrand dont le rapport avait exclu les
femmes de l'instruction publique11. Les "femmes font-elles partie du genre humain" ?
demandera quelques mois plus tard, le député Charlier lors de la fermeture de leur clubs12.
C'est à cette période, marquée par les débats passionnés au sujet de l'émancipation des juifs,
des "hommes de couleur libres", des femmes, que remontent les premières œuvres littéraires
et dramatiques qui diffuseront la figure du paria et la problématique qui l'accompagne au sein
9 MONTESQUIEU, L’esprit des lois, livre XXIV, chap.22, GF Flammarion, 1979, p. 156 . « Ces distinctions sont liées à une certaine aversion pour les autres hommes », sont « bien différentes des sentiments que doivent faire naître les différences de rang qui parmi nous contiennent l’amour pour les inférieurs » 10 Zalkind HOURWITZ, Apologie des juifs., 1789, Reédition par M. LÖWY et E. VARIKAS, Liberté, égalité, pluralité. Zalkind Hourwitz, Apologie des Juifs, (1788), Paris Syllepse, 2001 p. 37. 11 Mary WOLLSTONECRAFT, "To M. Talleyrand-Périgord, Late Bishop of Autun", in The Vindication. The Rights of Men, the Rights of Woman, edited by D.L.MACDONALD & Kathleen SCHERF, Ontario, Broadview literary texts, 1997, p. 103. Wollstonecraft se réfère au Rapport sur l'instruction Publique fait au nom du comité de Constitution à l'Assemblée Nationale en 1791 dans lequel Talleyrand soutient que l'entorse à l'universalité des droits que constitue l'exclusion des femmes de l'instruction publque est nécessaire au bonheur du plus grand nombre et en particulier des femmes. 12 L'objection de Charlier intervient le 9 Brumaire, après le rapport d'André Amar, qui au nom du Comité de sûreté générale, propose de détruire "ces Sociétés Populaires de femmes" Cf. Pour avoir oublié les vertus de son sexe. Olympe de Gouges et la critique de l'universalisme abstrait", in Sciences Politiques, 4-5 (1993)
4
d'un large public. Publiée en 1791, la Chaumière Indienne de Bernardin de Saint-Pierre est,
avec l'ouvrage de Raynal, une des sources les plus importantes de la diffusion du mot en
Europe. Présentant le héro sous les traits du bon sauvage, ce compte philosophique inaugure
un topos littéraire qui accorde au paria l'aura poétique dont le romantisme entoure l'individu
solitaire, l’individu assujetti ou résistant aux normes sociales qui nivellent ou repriment ses
élans authentiques, sa singularité. La chaumière marque durablement l'imaginaire littéraire et
artistique du paria de cette ambiguïté caractéristique qui en fait le symbole d'une marginalité à
la fois imposée et revendiquée, figure d'une altérité irréductible idéalisée et d'une humanité
partagée dans la dénonciation de l'injustice et de l'exclusion. En octobre 1792, un an après sa
publication, la Chaumière Indienne, adaptée en opéra en un acte avec le titre le Paria, est
présentée au théâtre de la rue Feydau à Paris avec la musique de Gaveau13.
La littérature, le théâtre et l'opéra jouent un rôle décisif à la diffusion large et rapide de la
problématique du paria à travers l'Europe. Sous la plume de Hugo, Michelet, George Sand, ,
de Blake, de Wollstonecraft, de Mary Shelley et de Joseph Conrad, de Ola Hanson et de
Strindberg, de Susan B. Anthony et de W.E.B. Dubois il deviendra une figure familière des
espaces publics littéraire et politique du XIXème siècle. L'art dramatique en particulier
introduit cette problématique au sein d'un espace public plébéien en pleine formation. Deux
pièces notamment concourrent à populariser ce mot et asseoir son sens métaphorique au début
des années 182014. Le Paria de Casimir Delavigne, présenté au théâtre de l'Odéon en 1821,
raconte l'histoire d'un intouchable qui, quoique privé du droit de servir son pays, sauve par
son courage sa patrie et devient chef de guerriers avant d'être découvert et condamné à mort
par ceux qu'il avait sauvé. Classé par Stendal parmi les pièces les plus populaires de l'époque,
il est traduit en plusieurs langues et fournit le matériau d'un nombre considérable d'opéras,
mélodrames et danses; de Venise à Varsovie, et de Naples à Paris l'injustice qui fait des parias
"une race étrangère au sein de sa patrie", emportent les publics aux sons de Donizetti, Carafa
de Colobrano ou du compositeur républicain polonais Moniuszko15 .
13 Cf. . Correspondance littéraire, philosophique et critique Tome seizième, par Grimm, Diderot, R Novembre 1792. 14 Le Robert donne en effet la 1821 pour le sens figuré du paria: "Personne mise au ban d'une société, d'un groupe. exclu. Traiter qqn comme un vrai paria. Vivre en paria, repoussé de tous. 15 Pour quelques exemples des productions les plus connues, Il Paria, musique de Carafa de Colobrano présenté à La Fenice de Venise 1826, Il Paria, Ballo, produite par Madame Brambilla, corégraphie de Salvatore Taglioni à Milan, 1827, Il Paria melodrame en deux actes, musique da Gaetano Donizetti et libretto di Domenico Gilardoni présenté en janvier 1829 au Teatro San Carlo de Naples, Paria opera en trois actes. Libretto de J. Chęciński musique de Stanislaw Moniuszko, présenté pour la première fois en Varsovie en, 1869, Il Paria, melodrame en trois actes, poésie de Stefano Interdonato musique de G. Villafiorita présenté au Théâtre della
5
Thème par excellence romantique, "le tableau de la situation du Paria (...) faisant horreur à ses
semblables sans l'avoir mérité par aucune faute" attire les compositeurs en quête d'œuvres
dramatiques qui font appel à l'imagination et à la passion16; il offre un terrain d'exploration de
la nouvelle esthétique romantique telle qu'on la trouve chez Germaine de Stäel: incarnant la
subjectivité de "l'homme sensible", le paria et ses impasses parlent à l'intériorité du spectateur
ou du lecteur tout en ouvrant une voie aux rapports de la littérature avec la société et la
politique"17. Le paria peut ainsi offrir un langage d'auto-représentation, expression non
dépourvue de narcissisme, d'un statut individuel qui, bien que lié avec l'existence d'un groupe
méprisé ou exclu, est vécu et communiqué dans ce qu'il y a de plus singulier et d'irréductible.
Rien n'exprime mieux ce mélange d'esthétique et de politique qui façonne la figure du paria
comme auto-représetnation que la lettre de Flora Tristan à Traviès à propos de son portrait:
"Songez à présent au costume que vous me mettrez, dans quelles attitudes je serai posée. Songez, mon cher frère, que ce portrait sera celui de la Paria – de la femme née Andalouse et condamnée par la Société à passer sa jeunesse dans les larmes et sans amour ! Enfin de cette pauvre femme assassinée et traînée devant les juges non pas comme victime, mais comme coupable.18
La deuxième pièce, Der Paria, est une parabole sur le destin des juifs allemands qui malgré
leur adhésion au projet de l'émancipation se trouvaient confrontés à une discrimination
systématique et se voyaient toujours des étrangers dans leur propre pays. L'auteur, Michael
Beer, un brillant poète et dramaturge, appartennait à une famille éminente de l'Aufklärung juif
berlinois qui comptait à part le jeune Michael, le grand compositeur, Jacob Meyerbeer et
l'astronome Wilhelm Beer19. Beer met en scène un intouchable qui, né dans une tribu
méprisée, est mis au ban de la communauté. Il est prêt à donner sa vie pour sa patrie, mais
personne ne veut de ce sacrifice. Joué avec un grand succès à Berlin, en 1823, puis à Paris en
1826, cette pièce constitue peut-être la source la plus importante de la diffusion du mot en
Allemagne et de son association durable avec la position des juifs après l'émancipation. Elle
Pergola Firenze. en février 1872. A quoi il faut ajouter la mise nemusique des poèmes avec ce thème comme le lieder d'Hugo Wolf à partir de La prière du Paria de Goethe. 16 Germaine de STAEL,De l'influence des passions sur le bonheur des individus et des nations, 1796, section 3. 17 "C'est ainsi qu'existe l'homme sensible sur cette terre; il est aussi d'une race proscrite, sa langue n'est point entendue, ses sentiments l'isolent, ses désirs ne sont jamais accomplis et ce qui l'environne ou s'éloigne de lui ou ne s'en rapproche que pour le blesser" Germaine de STAEL, De l'influence des passions sur le bonheur des individus et des nations, 1796, section 3. Cf. ainsi De la Littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales, Paris, Minard 1959 et en particulier 18 Flora Tristan. La Paria et son rêve, éd. Presses Sorbonne nouvelle, p. 102. 19 Cf. Deborah HERTZ, "Ihre Offenes Haus. Amalia Beer und die Berliner Reform", Kalonymos, 2/1 (1999).
6
est la source de toute une tradition théorique, à commencer par le "peuple paria" de Max
Weber20, qui notamment en Allemagne fera du paria le cadre conceptuel d'une réflexion
sociologique et philosophique.
L'émancipation et ses ambiguïtés est un moment clef dans la généalogie qui nous intéresse et
attache durablement la figure du paria aux promesses inaccomplies des droits de l'homme et
leur substrat l'humanité. On le voit non seulement en France, mais en Angleterre où les rares
références au champ sémantique du paria viennent précisément de la tradition minoritaire
inaugurée par ceux qu'on appelle "les jacobins anglais", ce cercle d'intellectuels21 qui ont pris
la défense de la révolution française et de l'universalité des droits de l'homme face à l'eloge
burkien des droits hérités des ancêtres. Dans sa Défense des drotis des hommes, Mary
Wollstonecraft s'y réfère pour critiquer la logique de caste qui soustend l'apologie du préjugé
entrepris par Burke dans ses Réflexions. Au "préjugé dégradant mais vénérable" de la
naissance qui prédestine chacun à la position de ses ancêtres, elle oppose la possibilité d'un
nouveau commencement qui échoit à chaque individu déclaré libre par naissance grâce au
principe de l'universalité des droits22.
L'association du paria à l’exigence d’une véritable application du principe d’universalité se
renforce dans les luttes pour les droits politiques et le suffrage universel et culmine dans les
discours révolutionnaires de 1848, notamment dans le langage politique du féminisme, où il
souligne l’imposture d’un suffrage qui se déclare universel alors même qu’une moitié de la
population en est exclue.: "Ainsi pauvres femmes dans la République de 1848 qui a pour
mission d’abolir les privilèges, il existera des parias, et ces parias ce seront vous"23. Quelques
années plus tard Engels s'en sert pour dénoncer la "destruction" du suffrage universel qui a
refait des ouvriers français "ce qu’ils étaient au temps de Louis Philippe : des parias
politiques, sans droits reconnus, sans vote, sans fusils"24.
20 Avec l'Abbé Raynal Cf. Freddy RAPHAEL, "Les Juifs en tant que peuple paria dans l'oeuvre de Max Weber" Social compass, 1976, Vol.23(4), pp.397-426 et L'Etranger et le paria dans l'œuvre de Max Weber et de Georg Simmel, Archives des Sciences Sociales des Religions, 61/1 (1986). 21 Tom Paine, Joseph Priestley, Richard Price, William Blake, Mary Wollstonecraft, William Wordsworth, Samuel Coleridge, William Godwin, Mary et Percy Shelley. 22 Cf. Mary WOLLSTONECRAFT, " A Vindication of the Rights of Men" (1790), in The Vindications op.cit., p. 87. 23 La voix des femmes, 26 avril 1848. 24 Cité par J. Texier Révolution et démocratie chez Marx et Engels Paris PUF 1998 p. 312.
7
Le paria n’est cependant pas qu'une figure de l'exclusion politique. Dans un système de
légitimation qui fait de l’humanité commune la source de l’égalité des droits, la non-
reconnaissance des droits que subit le paria fait peser un soupçon sur sa pleine appartenance à
l’humanité et tend à associer à son infériorité sociale une infériorité anthropologique. Le
mépris, l'insulte, le rejet, la honte, qui accompagnent l'exclusion et la mise à part, est
précisément ce qui distingue le paria des autres figures de l'oppression. Le rapport étroit entre
ces deux dimensions est puissamment affirmé par la paria la plus célèbre du 19ème siècle, par
la paria la plus célèbre du 19ème siècle, Flora Tristan qui, dans l'Union ouvrière, souligne le
rapport étroit entre la reconnaissance de la communauuté anthropologique et la constitution de
l’unité politique d’une classe à qui il revient dorénavant de réaliser la promesse universaliste
de 1789. Ici les images d'impureté, de pourriture, de pollution, qui enveloppent la féminité
dans une altérité méprisée sont mis en rapport avec l'exclusion politique, sociale, religieuse
des femmes et à sa légitimation par le savoir et la science.
"Cela doit être un profond sujet de douleur pour les sages des sages de penser qu'ils descendent de la race femme (…) quelle honte pour eux d'avoir été conçus dans les flancs d'une semblable créature, d'avoir sucé son lait, d'être resté sous sa tutelle une grande partie de leur vie. Oh, il est bien probable que si ces sages avaient pu mettre la femme hors la nature, comme ils l'ont mise hors l'Eglise, hors la loi, hors la société, ils se seraient épargnés la honte de descendre d'une femme"25.
En insistant sur le fait qu'une telle constitution est impossible tant que les femmes "attendent
encore leur 1789", Tristan sait bien que les ouvriers n'ont pas le pouvoir d'abroger les lois
anciennes et d'en faire des nouvelles". Mais proclamer les droits de la femme "dans les
mêmes termes que vos pères ont proclamé les vôtres", "reconnaître au moins en principe" son
"individu social", inscrire "l'égalité absolue de l'homme et de la femme" dans une Charte
ouvrière, c'est constituer "l'unité humaine"26 rompue non seulement par l'exclusion
institutionnelle qui est leur lot depuis la révolution mais aussi par la mise à part qu'elles
subissent au sein de leur propre classe.
"Suis-je juif ? Suis-je un homme"27? "Qu'est-ce donc, je ne suis plus un homme parce que je
suis juif? écrivait Bernard Lazare en 190228. Si la question de la reconnaissance de l’unité
humaine se pose, c’est que celle-ci est sérieusement mise en doute par le rejet de la société
25 Flora TRISTAN, L’union ouvrière. (1844). Paris Editions des femmes1986, p. 185-186. Souligné dans le texte 26 Ibid. p. p. 209, 211, 213. Souligné dans le texte 27 Bernard LAZARE, Le fumier de Job, Texte établi par Philippe Oriol, Paris, HonéChampion, p.26. 28W.E.B. DU BOIS, "The Souls of Black Folks" (1903) in The Oxford W.E.B. Dubois Reader, edited by Eric.J. Sundquist, New York/Oxford, Oxford U.P,. 1998, p. 27.
8
chrétienne qui lui fait "une situation de paria", même chez ceux qui sont ses amis : "… je sens
que la communication morale et intellectuelle est interrompue par la survivance du préjugé.
Un mur est dressé, je le sais"29. Presqu'au même moment, de l'autre côté de l'océan W.E.B.
Dubois, sociologue et romancier américain et un des grands leaders de la communauté noire,
décrit ce mur qui empêche le noir émancipé de participer à "l'unité humaine", comme un
"voile" du préjugé: la "croyance sincère et passionnée selon laquelle, quelque part entre
l'homme et les bovins, Dieu créa un tertium quid et le nomma Nègre – une créature
clownesque, simplette, parfois même attachante dans ses limitations, mais strictement
prédestinée à marcher derrière un voile"30. Du Bois est un des premiers en Amérique à
explorer le parallèle entre les noirs et les intouchables indiens, comme le fera plus tard Martin
Luther King31. Il connaissait Max Weber qui avait lu et apprécié The Souls of Black Folks32 et
publié un de ses articles dans sa revue33. Etudiant en Allemagne, il n'allait jamais oublier la
voix tonitruante de Treitschke exposer l'infériorité des mulâtres: "j'avais l'impression qu'il me
perçait de son regard même si, en réalité, il ne m'avait probablement pas remarqué. 'Sie
fulhen niedriger' Ils se sentent inférieurs"34.
Des années 1820 à la fin du 19ème siècle et jusqu'à nos jours, la figure du paria scande les
moments, les formes multiples et les discontinuités de l'antinomie qui l'a engendré : le
rétablissement de l'esclavage, le Code Civil de Napoléon, la persistance de la couverture et de
la vente de l'épouse en Angleterre, l'exclusion des femmes du suffrage "universel", la barbarie
raciste de la "Reconstruction" après la Proclamation de l'Emancipation en Amérique, les
revirements de l'abolition de l'esclavage et de la servitude dans les Balkans, l'affaire Dreyfus,
la colonisation, le carnet anthropométrique des tsiganes. Elle porte les traces de pratiques
d'infériorisation et de déshumanisation purgées de la mémoire collective occidentale, bien
qu'adoptées au grand jour sur le sol même de l'Europe : des tsiganes de la Roumanie,
rencontrés par Vaillant dans les années 1850, travaillant nus, chaînes aux pieds et attelés à des
jougs d'animaux – esclaves dont le destin séculaire était ignoré des campagnes abolitionnistes
29 Ibid., p. 25. 30 Ibid., p 146. 31 W.E.B. DU BOIS, "The Souls of Black Folks" et surtout son roman Dark Pricess. A romance, (1928), University Press of Mississippi, 1995. 32 Cf. Manning MARABLE, W.E.B. Du Bois. Black Radical Democrat, Boston, Tayne Publishers 1986 p. 17. Selon Marable, Weber avait suggéré qu'il fallait traduire ce livre en allemand 33 W.E.B. DU BOIS "Die Negerfrage in dev Vereingten Staaten" in Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, Tübingen 22 (1906), p. 31-79. 34 W.E.B. DU BOIS, Dusk of Dawn, New York, Library of America, 1986, p. 626.
9
européennes de la même époque 35; des pygmées exposés aux côté des chimpangés qui font la
une des New York Times en 190636; des "indigènes", exhibés devant les publics civilisés des
métropoles du 19ème et 20ème siècles dont la provenance suit les rythmes de la colonisation et
les exigences de la science37. Répertoire de vécus personnels difficilement communicables, la
figure du paria enregistre et transmet les meurtrissures de ceux qui "traînent leur singulière
existence parmi toutes les classes dont [ils] ne peuvent être"38: l'humiliation de l'apôtre du
socialisme exclue par ses camarades les plus chers du premier banquet organisé après la mort
de Fourrier39; le choc du juif internationaliste, qui ignore tout des juifs, devant les cris de
"mort aux juifs"; la solitude pétrifiée du jeune étudiant noir épris de culture européenne, dans
un amphithéâtre où rétentissent des discours sur l'infériorité des mulâtres; "l'insécurité,
l'angoisse, la terreur" de l'injure à laquelle est exposé chaque adolescent(e) homosexuel(le)40.
Il n'est pas alors étonnant que tout au long du 20ème siècle et jusqu'à nos jours, elle ne cesse de
faire surface, depuis le journal de l'Union Inter Coloniale, intitulé Le Paria41 et les discours de
Martin Luther King, aux combats actuels des aborigènes de l'Australie (P.A.R.I.A.H.)42 et la
défense des droits de l'immigration algérienne43.
La figure du "paria", telle qu'elle prend forme dans les traditions savantes et plébéiennes,
l'espace public, la littérature et les analyses scientifiques des deux derniers siècles, renvoie à
un large éventail de rapports sociaux et de positionnements individuels et collectifs qui sont
irréductibles les uns aux autres. C'est sans doute la raison pour laquelle on l'étudie le plus
35 Cf. J.A., VAILLANT, Les Rômes: histoire vraie des vrais Bohémiens, Paris, Dentu and Cie, 1857, p. 409-412. Au sujet de l'esclavage séculaire des tsiganes dans les Balkans cf. Ian HANCOCK, The Pariah Syndrome:An account of Gypsy slavery and persecution, Ann Arbor, Karoma Publishers, 1987. 36 Phillips Verner BRADFORD and Harvey BLUME, The Pygmy in the Zoo", New York, St. Martin's Press, 1992. 37 Cf. Nicolas Bancel, Pascal Blanchard et Laurent Gervereau, Images et colonies, Achac-BDIC, Paris, 1993, et Zoos humains: de la vénus hottentote aux reality shows, s. la dir. de Nicolas Bancel, Pascal Blanchard, Gilles Boetsch, Eric Deroo, Sandrine Lemaire. Paris, Editions La Découverte,Textes à l'Appui, 2002. et Laurent Gervereau 38 Germaine de STAEL, Germaine de STAEL, De la Littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales, Paris, Minard 1959, t. 2, p. 333 39 Dans une lettre de 1838, Flora Tristan somme son ami, Victor Considérant, de s'expliquer sur le fait qu'elle a été exclue, comme femme, du premier banquet pour commémorer la mort de Fourrier. Un jour dira-t-elle les parias seront admis au grand banquet de l'humanité., Flora TRISTAN, Lettres, réunies, présentées et annotées par Stéphane Michaud, Paris éditions du Seul 1980, p. 79 40 Cf. Didier ERIBON, Réflexions sur la question gay, Fayard, Paris, 1999, p. 99. 41 Fondée en 1921, elle était composée de militants communistes de l'Afrique, des Antilles même de l'Indochine comme par exemple Ho Chi Minh Cf. aussi Philippe DEWITTE Les mouvements nègres en France, L’Harmattan, 1985. Je tiens à remercier Claude Liauzu pour cette information 42 PARIAH : People Against Racism In Aboriginal Homelands 43 Cf. Les Algériens, parias dans toute l'Europe ? Pétiton pour une législation plus juste et plus humaine en faveur des ressortissants algériens en France juin 2000.
10
souvent en relation avec la position sociale d'un groupe précis, faisant abstraction de sa
polysémie et de sa capacité protéenne à revêtir les formes les plus diverses d'oppression et
d'exclusion. La polysémie et la polymorphie sont néanmoins constitutives de la figure du
paria, de sa pérennité et, je voudrais proposer ici, de son potentiel euristique. Plutôt que de les
mettre de côté, plutôt que les traiter comme des imperfections qui compromettent la rigueur
de tel idéal type qui correspondrait à telle expérience ou position sociale qui nous intéresse,
on pourrait essayer de comprendre ce qui permet que cette figure puisse renvoyer à de
rapports de nature et d'origine si différentes.
Un tel parti pris implique tout d'abord de traiter le paria pour ce qu'il est, une figure de la
modernité occidentale dont on n'a, par conséquent, pas à mesurer la pertinence à l'aune de sa
correspondance avec le système des castes de l'Inde. De ce point de vue, les approximations et
les malentendus loin d'invalider la pertinence de cette figure, devraient au contraire nous
intéresser, car elles révèlent en quoi les sociétés issues de révolutions de droit naturel, ou
fondées sur l'universalité des droits, aient pu se reconnaître dans un système social si étranger
au leur. Si par exemple jusqu'à la fin du 19ème siècle la métaphore du paria repose sur une
confusion entre les Sudras, la dernière caste de la hiérarchie indienne, et les hors-caste, cette
confusion est extrêmement productive pour explorer la positions sui-generis dedans/dehors44
qui marque le destin des parias modernes de l'Europe.
Prendre au sérieux la polysémie du paria, situer au cœur de sa conceptualité le large éventail
de situations et de subjectivités qu'il couvre, implique, en deuxième lieu de déplacer notre
attention de chacun des groupes stigmatisés au processus de stigmatisation lui-même, du
problème de la différence – ou de la différence comme problème – à celui de la différentiation
hiérarchique. Ce changement de perspective permet de repenser le caractère parenthétique ou
exceptionnel qu'on a tendance à attribuer à l'expérience de chaque groupe traité séparément; il
fait apparaître ces diverses formes d'infériorisation et d'exclusion, qu'on étudie rarement
ensemble, non plus comme des exceptions qui confirmeraient la règle, mais comme
manifestations ou symptômes d’une configuration historiquement inédite qui établit une
corrélation nouvelle entre dominations et formes de subjectivation d’ordres et d’origines
différents, en les rattachant à une même logique de légitimation. Une configuration qui,
44 C'est en effet cette tension qui caractérise dès le début ses définitions dans les dictionnaires tel que celui de L’Académie Française (1835), le Larousse (1867), le Littré (1869) : le paria y est défini en même temps comme étant en dehors de la société, et comme occupant le dernier échelon de la société.
11
mobilisant en même temps la loi générale et la loi particulière, permet de percevoir le sujet
individuel des droits à la fois comme un atome abstraitement similaire et par conséquent
comparable à tous les autres (au regard de la loi générale à laquelle il était assujetti) et comme
indivisible du groupe, dont il est issu et par conséquent incomparable aux autres (quant à sa
capacité d'élaborer la loi générale). Le paria, quel qu'il soit, est ainsi confronté à un dilemme
impossible à résoudre : en tant que membre d'un groupe "différent", il peut être légitimement
exclu de l'égalité des droits au nom de "sa" différence ; en tant qu'individu, il ne peut jouir de
l'égalité que dans la mesure de sa similitude au groupe dominant qui établit le dénominateur
commun de comparaison.
C’est ce double dispositif de légitimation qui fait la singularité de la notion de paria : dans un
monde où l’abolition des privilèges de naissance semble libérer la (co)existence humaine des
contraintes antérieures à la volonté humaine, le paria est situé dans une position d’altérité
hétérodéfinie qui le prive simultanément de l’humanité qu’il partage avec les autres membres
de la communauté politique et de sa singularité, de ce qui le différencie de tous les autres
individus. Evaluée sur la base d'une hiérarchie prépolitique, "sa" différence est perçue comme
conséquence ou fonction inévitable du groupe auquel il appartient. Selon la logique
complémentaire du pur et de l’impur qui il emprunte à son ancêtre indien - il n’y a pas de
brahmane sans intouchable – il demeure prisonnier d’un binôme hiérarchique (nomade-
sédentaire, blanc-noir, gentil-juif, homme-femme, national-étranger) ;; c’est pourquoi il ne
peut être accepté tel qu’il ou elle est, un juif, une femme, un étranger, une lesbienne, mais en
tant qu’exception qui confirme la règle de l’infériorité de son groupe.
La première conséquence d'une telle construction aporétique de la différence, c'est que celle-
ci devient incontournable pour le paria. La seule chose qu'il ne peut plus être c'est un pur et
simple être humain. Il aura beau singer les chrétiens45, essayer de "délaver son âme nègre
dans un flot d'Américanisme blanc"46, il ne pourra disparaître parmi les voisins. Parvenu, "il
se verra rappeler son origine" impur "47. Quel que soit sa reconnaissance, "l'exception
admise"48 traînera derrière elle, comme le disait Lammenais à propos de Sand et de Stern un
45 Hannah ARENDT, The Jew as a pariah, sous la dir. De Ron H. FELDMAN, N.York, Grove Press, 1976, p. 68. 46 W.E.B. DU BOIS, "The Souls of Black Folk", op. cit. p. 102. 47 Bernard LAZARE, op.cit. p. 88. 48 Expression utilisé par Balzac à propos de son héroïne Béatrix, inspirée de George Sand. Honoré de BALZAC, Béatrix, Paris Garnier Flammarion, 1979, p. 106
12
"odeur de lupanar49. Perçu prioritairement par sa différence50, il ou elle est marqué(e) comme
membre d’une catégorie à part, même quand il jouit formellement d'une égalité des droits.
Mais le caractère systématique de marquage demeure, lui, invisible dans un système où la
catégorisation discriminatoire, même quand elle fait l’objet de la loi doit toujours demeurer
implicite. Hautement visible, dans la société française dans ce tournant du 19ème siècle obsédé
par la sécurité, le "Romanichel" disparaît entièrement de la loi 1912 qui le constitue pourtant
en catégorie criminelle à part sous couvert de comportement nomade malhonnête51. Ce
mélange sui-generis de visibilité/invisibilité est ainsi la deuxième conséquence de cette
construction de la différence marquée par la déroutante symétrie entre la stigmatisation et la
catégorie stigmatisée. Elles sont, comme le souligne Bauman, toutes les deux illégitimes,
obligées de cacher leur véritable identité, de chercher des justifications trompeuses.
L'expérience du paria devient dès lors clandestine, indicible, incommunicable. D'où
l'importance stratégique de nommer le paria, de donner un nom à son oppression au lieu de la
subsumer dans un universel élaboré derrière son dos; de mentionner à l'exemple de Flora
Tristan et, un siècle plus tard, d'Hannah Arendt, dans laquelle de ses identités l'humanité
commune est insultée. La construction de la différence est, enfin, en même temps une
construction sociale de l'universel et du particulier, vu que la différence n'est plus un rapport
mais une déviation de la norme, ce qui situe le paria du côté du particulier. Son expérience ne
peut jamais être paradigmatique, elle est frappée du sceau de l'insignifiance, de la trivilialité,
du particularisme.
D'une certaine manière, l’ambiguïté fondamentale de l’émancipation qui a accordé l’égalité
sous forme de privilège, semble relativiser la nouveauté de cette configuration politique; elle
semble faire du paria une métaphore de ce qu’on pourrait appeler la persistance inexplicable
de l’ancien régime. La profusion des références aux privilèges de naissance, à l’aristocratie
de couleur, au féodalisme marital qui accompagnent le champ conceptuel du paria, soulignent
ce sentiment de continuité incongrue entre anciens et nouveaux modes de légitimation
politique. Après l'émancipation, "le nègre" était traité "exactement comme dans les années
précédentes, comme s'il avait pas de droits que l'homme blanc se devait de respecter", écrit
49 Cf. Michèle RIOT-SARCEY, Eleni VARIKAS, Réflexions sur la notion d'exceptionalité, Les Cahiers du GRIF, 37/38 (1988) p. 86. 50 "La plus générale de ses qualités, le fait qu'elle était femme, et que comme telle elle servait les fonctions propres à son sexe, a abouti à la classifier avec toutes les autres femmes, sous un concept général Cf. G. SIMMEL, Conflict and the Web of Group Affiliation. N. York, 1972
13
en 1899 George W. Henderson dans un article sur la citoyenneté des noirs américains. "(…)
un code ciriminel était fait spécialement pour lui, créant une série de délits qui ne pouvaient
s'appliquer sur l'homme blanc (…) Le nègre était désormais un paria, un exclu (outcast)
social et politique. En échangeant sa servitude avec la liberté, il avait perdu la protection que
lui assurait les intérêts de son maître et se trouvait exposé à de nouveaux dangers…"52. Ce
qui accorde au noir l'attribut de paria, c'est l'entorse à la règle générale, la logique flagrante
d'exception qui co-existe de manière ordinaire avec les références universalistes de la
Constitution.
Un "long atavisme" avait préparé le juif à l’état de paria. Il en va de même pour d'autres
groupes, les femmes, les tsiganes, les noirs, les "invertis". La symbolique de l’impureté, de la
souillure, de la corruption, de la pourriture, du pêché originel ou du déicide, inextricablement
attachés au mépris, à l’aversion et la peur qu’inspire le paria moderne, les images
caricaturales comme le nez crochu et les cornes du juif, réactivaient des représentations très
anciennes. Mais cette continuité est souvent trompeuse car elle cache de notre horizon la
reformulation et la nouvelle dynamique de tous ces préjugés dans le cadre politique de la
modernité universaliste. La relation entre infériorité sociale du paria en infériorité
anthropologique qui conteste la pleine humanité du paria, est paradoxalement liée à
l’universalisme du droit naturel qui fait de l’humanité commune la source puissante de
l’universalité des droits.
Arrachée à l’au-delà où l’avait reléguée les enseignements de l’église, le droit naturel et son
substrat, la nature humaine commune, du fournissait pour la première fois, à une si grande
échelle, la possibilité de comparer avec légitimité diverses conditions sociales, la possibilité
de réclamer la liberté et l’égalité ici et maintenant. Mais c’est à cause de cette instabilité
nouvelle que l’universalisme introduisit au cœur de la légitimation de la domination que la
mise en cause de l’unité du genre humain devient possible. Ce processus certes avait déjà
commencé bien avant l'émancipation: les procédés de la pureza del sangre en Espagne, les
disputes de Valladolid qui avaient fait peser un doute sur la qualité de veros homines des
indiens, enfin l'état d'exception dans les pratiques et la législation de l'esclavage et de la
51 Le marquage du tsigane est opéré par une distinction entre les nomades honnêtes et autres forains français et le reste qui devront porter un carnet anthropométrique. Cf. Christoffe DELCLITTE, « Tsiganes en France au tournant du siècle création d’une catégorie » in Tumultes 11 (1998). 52 George W. HENDERSON "History of Negro Citizenship", African Methodist Episcopal Church Review, 15/3 (1899), p. 699-700. C'est moi qui souligne
14
colonisation furent des terrainsprécoces où s’inventait de fait l’art d’une catégorisation
hiérarchique spécifiquement moderne. Mais la figure de paria suppose le principe de
l'universalité des droits et sa pertinence dépend de sa capacité de traduire et d'exposer la
coexistence du principe formel une loi générale pour tous qui fonde l‘égalité de tous les
individus avec le principe, souvent tacite et informel, de la loi particulière. Vue de cet angle, la généalogie du paria n'éclaire plus seulement l'histoire de tel ou tel groupe,
mais l'histoire de la démocratie elle-même. Elle offre une perspective dans laquelle le statut
parenthétique dont jouissent ces expériences d'infériorisation et d'exclusion devient
problématique. Plutôt qu'un idéal type, le paria offre un champ d'interrogation dans lequel les
péripéties de l'universalisme et de la démocratie historique pourraient être revisitées et re-
évaluées à la lumière non seulement de ce qui a été accompli, mais aussi du point de vue de
leur potentialités inaccomplies, des idées, perceptions et actions qu'ils ont rendu pensables et
possibles. La diversité des positions qui rendent possible l'énoncé "je suis un paria",
contestent, en effet, les termes dans lesquels la démocratie historique se donne à penser.
Situant au cœur du politique des expériences qui furent et sont toujours frappées du sceau de
minorisation et l’exception, elle témoigne obstinément du caractère systématique d'un ordre
dans lequel la hiérarchie, ne pouvant dire son nom, est obligée de recourir à une construction
hiérarchique et essentialiste des différences. Mais elle témoigne, inversément, des exigences
d'une utopie démocratique qui s'ébauche depuis deux siècles dans les fragments de cette
tradition rebelle de parias qui, pour être "cachée", ne fait pas moins partie de l'histoire de la
démocratie. Si ce témoignage trouve plus souvent abri dans l’expression littéraire et
artistique53 que dans les sciences dites humaines, c’est que celles-ci trahissant "la promesse
faite à l’esprit humain", traitent comme accessoires ou irrationnels les fragments uniques de
l’expérience humaine dans lesquels s’exprime l’universel54. Parce qu’elle met en lumière des
faits rendus invisibles par la ruse de l’abstraction, l'expérience paria se déploie souvent dans
ce terrain déserté par le scientisme positiviste, que Woolf appelait de manière caractéristique,
more truth than fact55. Elle se réfugie volontiers dans les histoires, les incidents, les légendes
parsemés dans les essais et textes théoriques de W.E.B. Du Bois, d'Hannah Arendt, de
Virginia Woolf, de Walter Benjamin, de Hans Mayer, de Zygmunt Bauman, de Toni
53 Cf. à ce propos le remarquable ouvrage de Hans MAYER, Les marginaux. Femmes, juifs et homosexuels dans la littérature européenne, Albin Michel, 1994. 54 Théodor ADORNO, Notes sur la littérature, Paris, Flammarion 1984, p. 12-13.
15
Morrisson et tant d'autres, ramenant la pensée à ce qui est sa source: la concrétude de
l'expérience humaine.
Cette tradition se nourrit certes du non-accomplissement historique d’une promesse : que les
êtres humains ne seront plus jugés selon leur naissance, mais selon cette qualité
exclusivement humaine de devenir quelque chose qui ne saurait être définie d’avance, quelque
chose d'imprévisible parce dépendant de leur action, de celle des autres. Mais loin de conclure
de cet échec historique à son inéluctabilité, elle fait de l'écart entre principes et pratiques le
lieu privilégié de la puissance imaginative de la création démocratique. Exerçant à merveille
l'art de la "mécompréhension" qu'Arend attribue au paria rebelle, cette tradition détourne les
ruses de l'abstraction en définissant les droits de l'homme comme ceux de "chaque individu
particulier"56. Voyant dans les dichotomies faciles entre assimilation et absolutisme
identitaires les pièges d'une assignation à domicile, elle oppose à toute définition normative et
hétérodéfinie des besoins humains l'"éventail infini de possibilités individuelles" dont
témoigne la pluralité des expériences humaines57. Refusant la concurrence des victimes, elle
voit émerger des ruines du ghetto de Varsovie l'impossibilité de penser 'l'esclavage,
l'émancipation, la caste aux USA (…)" comme "des choses uniques et séparées"58. Puisant
dans l'excédent utopique qui réside malgré tout dans le concept d’humanité, cette tradition a
traduit la destinée "exceptionnelle" du paria en une fugure de la destinée humaine dans le
monde moderne.
Rien n'exprime mieux ce potentiel que le personnage de Charlot, le petit bonhomme qui a si
puissament fait accéder le vécu marginal du paria à la dignité de l'expérience humaine
universelle. La superbe lecture qu'en fait Hannah Arendt repose vraisemblablement sur un
malentendu, les origines juives de Chaplin, une légende qui date du temps du Dictateur que
Chaplin lui-même, d'origine tsigane59, a entretenu jusqu'à la chutte du nazisme, par volonté de
ne pas se différencier du peuple juif persécuté. Mais ce malentendu ne fait qu'ajouter à la
valeur de l'analyse. Car juif ou tsigane comme son créateur, le petit bonhomme de Chaplin
tire sa grandeur de sa capacité d'incarner la peur ancestrale des parias, de tous les parias
devant les représentants d'un ordre qui les met à part. Se servant du rire, le "sentiment le plus
55 Virginia Woolf, Un chambre à soi, (1929) Paris 10/18, 2002, p. 6. 56 Mary WOLLSTONECRAFT, op. cit. 57 Viola KLEIN, The Feminine Character. History of an Ideology (1946), London, Routlege and Kegan Paul 2nd ed. 1972 , p. 87. 58 W. E. B. DU BOIS, op.cit., p .472.
16
international et le plus révolutionnaire des masses"60, Chaplin a su décliner la critique incisive
de la position inhumaine du paria avec l'inventivité créatrice d'’une imagination nourrie de ce
qui dans le vécu du paria n'existe que comme espérance d'une autre existence. Sa défiance
"des lois de l'espace, du temps et de la gravitation"61, loin d'être une fuite en avant, une
"compensation imaginaire", pointe aux exigences d'une utopie humaniste que, dans ses
hésitations, discontinuités et réapparitions, la tradition rebelle a introduit durablement dans
l'horizon de la modernité.
1. in Paria une figure de la Modernité, sous la direction de M. Leibovici et E. Varikas, Tumultes 21-22 (2003)
59 Ian HANCOCK, We Are the Romani People, Hatfield, University of Hertfordshire Press, 2003. 60 "Rückblick auf Chaplin" in Walter BENJAMIN, Gesammelte Schriften III, ed. Hella Tiedemann-Bartels, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1980, p. 159. 61 Siegfried KRACAUER, Theory of Film, New York, Oxford University Press, 1960, p. 88.