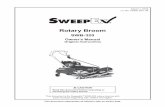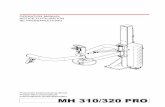Glaseux — 320 — deur Du soleil chaleureus. CHASSIGNET ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
6 -
download
0
Transcript of Glaseux — 320 — deur Du soleil chaleureus. CHASSIGNET ...
GLASEUX — 320 —
deur Du soleil chaleureus. CHASSIGNET, le Mespris de la vie, sonn. 364. — Mais elle est sans le mal, et moy sans le remède, Moi extrêmement chaud, elle extrêmement froide, Si je porte mon feu, elle porte son glas R É G N I E R , ŒUV. posth., Complainte.
Ferré à glaz. Ferré à glace. — (Fig.). Mes deux sœurs... avoient mis dedans ce beau Sixième, comme en presses (car il estoit couvert de grosses aisses, et ferré à glaz) leurs guimples, manchons et collerettes. R A B E L A I S , IV, 52. Glaseux. Glaiseux. — Terre. Féconde... gla-zeuse. M. D E L A P O R T E , Epithetes, 395 r° et v°. — La plaine poissonneuse, L'air, et le feu, et la terre glaseuse. P. M A T T H I E U , Aman, IV, p. 101. Glasonné. Revêtu de gazon. — Laquelle allée estoit glasonnee, fossoyee et plantée artificiellement d'arbres d'un costé et d'autre. Chos. fait, à l'entrevue de Ch. IX av. la Reine cathol, 50 r° (G., Compl., Gazonner). Glasser 1 et 2, v. Glacer 1 et 2.
Glassis. Glacier. — Contre les hauts rochers et glassis inaccessibles. L E M A I R E D E B E L G E S , la Couronne Margaritique (IV, 139).
Glastir, v. Glatir.
Glatayafe, terme de mépris. — Ce biel courtisan nous remonstra vien dans le vatteau que nous falloit aboir vottes et coussinets, de quoi nous nous moquions entre nous, comme cela n'estoit propre qu'à Francimants, lingues peluts et gla-tayafes. A U B I G N É , Faeneste, I, 3. Glateron, v. Gleteron.
Glatiere. Rampe d'accès. — La glatiere d'une porte. 1537. Lille (G.). — Pour les huis des gra-tieres de Fave et d'Esquigneaux. Ib. — Le bareau de la gratiere des martres. Ib. — Depuis le cellier S4 Paul jusques à la glatiere du rempart. 1601. Dépenses effectuées pour la joyeuse entrée des archiducs Albert et Isabelle (G.). — Les murs depuis le cellier S' Paul jusques à la glatiere pour monter au rempart estoient couverts de draps noirs et jaulne et azuré et jaulne, coulleurs de Flandres et Bourgogne. Ib. (G.). Glatir. Glapir. — Tout ainsi quun grand cerf ramé... pource quil noyoit plus nulz chiens glat-tir... se couche sur lherbe verde en lombre du bossage fueillu pour respirer à loisir. L E M A I R E D E B E L G E S , la Couronne Margaritique (IV, 28). — Je jaindz, je glastys, j'esternue. Ane Poés. franc., VI, 207. — A sainct Hilarion faisant ses prières se monstroit tantost un loup qui hurloit, tantost un regnard qui glatissoit. L E L O Y E R , Hist. des Spectres, IV, 13. Crier. — Cest sans raison que je voys glatissant
Apres toy, ville et trahistresse Nemese, Car tu ne quis oncques m e donner ayse. M I C H E L D'AMBOISE, la Babilon, 22 r".
Glatissant. Glapissant. — Abbay ou Abboy... enroué, glapissant ou glatissant, jappeur. M. D E LA P O R T E , Epithetes, l v°. — Chien. Abboyant... glatissant. ID., ib., 81 r° etv°. — (Fig.). Advoca-ceau. Turbulent... glapissant ou glattissant. ID., ib., 1 v°. Glatissement. Cri aigu. — Les dits doivent
estre sans morsure : les jeux sans offense et des-honnesteté : le ris sans glatissement. L E M A I R E D E B E L G E S , la Couronne Margaritique (IV, 103).
Glattir, v. Glatir. Glauce. Glauque. — 1503. La seconde couleur
[de l'œil] est glauce. Le Guidon en françoys, 49 b,
édit. de 1534 (Vaganay, Pour l'hist. du franc, moderne).
Glay i. Glaïeul. — Acorus est appelle en françois glay, et croist es eaues et aussi es mon-taignes et en haut pays, et est appelle d'aucuns venerea ou affrodisia. Jard. de santé, I, 6 (G.). — Passeroses, passeveloux, glays, noyelles, liz, pen-cees, muguets, roses et œilletz herbuz. LEMAIRE D E B E L G E S , Illustr., I, 29. — Or la fleur du glay mettez y, Qui est doulce et a couleur ynde. Ane. Pois, franc., XIII, 143. — Glays, et herbe tren-chant, la peau vous entamez. PASSERAT, Vers d'amour (I, 29). — La veue du soleil fait recueillir les fleurs de la flambe, autrement appellee glay, S' F R A N Ç O I S D E S A L E S , Amour de Dieu, VI, 7.
Glay 2. Sorte de trompette. — Le roy de Thunes, le roy de Tramessan et le roy de Bugie vindrent devant Aflrique en leurs conrrois, selonc leur coustume, à tous leurs naqueres, tabours, cymballes, freteaux et glays. Hist. de Loys III de Bourbon, p. 294, édit. de 1612 (G.).
Glaz, Glazeux, v. Glas, Glaseux. Glazon. Masse, bloc, motte. — Ayantz...
amassé force mottes et glazons de terre, y édifièrent un hault tribunal. E T . D E LA PLANCHE, trad. des cinq prem. livres des Annales de TACITE, L. I, p. 13. — Et le plan de dessus De terre grasse estoit et lourds glazons moussus. M A U R I C E SCÈVE, Microcosme, L. I, p. 26. — Gazon ou Glazon. Vert, terreux, herbu, carré, predial. C'est une motte de terre herbue. M. D E L A P O R T E , Epithetes, 189 v°.
Glazonneux. — Terre. Féconde... glazon-neuse. M. D E L A P O R T E , Epithetes, 395 r°.
Glefve, v. Glaive. Glen, v. Glan. Glene. Glane. — La douce, agréable Cybelle
D u doux avril se faisoit belle... Et pilloit de sa blanche main Sur l'esté, sur Ceres l'heureuse, L'espic, la glenne planteureuse. A U B I G N É , le Primtems, III, 31. — (Fig.). Disputons à plein fons, il y a icy champ pour faire glene. B E R O A L D E D E VERVILLE, Palais des curieux, p. 432 (G., Compl.),
Glener. Glaner. — Il fera aussi mal glener ceste année. R A B E L A I S , II, 12. — Il permet... à ceux qui sont loez pour faire moisson, de glener et de recueillir en leur main les espics comme une poignée. C A L V I N , Serm. sur le Deuter., 136 (XXVIII, 136). — Le peuple oysif, par qui sont ramassez Les blonds espis hors des gerbes laissez, Qui en glainant évitent pauvreté. BAÏF, Poèmes, L. IX (II, 426). — (Fig.). Glainant après, ce peu d'espis je t'offre. P. D U V A L , Triomphe de Vérité, p. 115. — C'est ce que j'ay glenné de la moisson fertile Des plus gentils esprits. R. BELLEAU, tes Amours des pierres précieuses, Discours (II, 163). — Par eux est perpétré le monstrueux carnage, Qui de quinze ans entiers aiant faict les moissons D e François, glene encor le reste en cent façons. A U B I G N É , tes Tragiques, I (IV, 60). — Sur la fin de l'année soixante-neuf, nous avons laissé à glener comment le comte de Lude... s'avança pour desloger Pluviaut de Marans. ID., Hist. univ., V, 25.
Gleneur. Glaneur. — Mangeant mon bled en herbe... j'espargne... les gleneurs. RABELAIS, III, 2. — C o m m e on voit le gleneur Recueillir les espics après le moissonneur. D u B E L L A Y , Disc, au roy sur la trefve de l'an 1555. — Comme on void le gleneur Cheminant pas à pas recueillir les reliques De ce qui va tumbant après le moissonneur. In., Antiq. de Rome, 30. — L'un coupe, l'autre en-
— 321 — GLISSEMMENT
gerbe, et l'épiant glenneur Va talonnant les pas du courbe moissonneur. R. BELLEAU, la Bergerie, ire j0urn., l'Esté (I, 207). — Mais je suis seulement ainsi que le glaineur Desrobant les épies laissez du moissonneur. A M . J A M Y N , ŒUV. poet., L. IV, 163 v°. — (Fig.). Il [Dieu] parle seulement de glener après la moisson. Or aujourd'huy on verra de terribles gleneurs. CA L V I N , Serm. sur le Deuter.,lil (XXVIII, 200).
(Adj.]. Les gleneurs escadrons des chaleureuses cailles. D u B A R T A S , 2e Semaine, 1 " Jour, les Furies, o. 120.
(Fém.). Gleneresse. — Qu'il ne soit glenneur ou gleneresse qui glenne en aultruy camp en l'absence de celuy a qui c'est. 1507. Prév. de Vimeu (G.). Glenne, Glenner, Glenneur, v. Glene, Glener,
Gleneur. Glenure. Glanure. — Dieu donc se reserve,
comme une espèce d'hommage, la glenure. CA L VIN, Serm. sur le Deuter., 141 (XXVIII, 199). — Je vous ay donné la terre de Canaan : voire, mais je me suis réservé la glenure. ID., ib. (XXVIII, 203-204). Glere. Humeur? — O sage et gentile Nature,
Qui contrains dessous la closture D'une tant délicate peau, Une gelée, une douce eau, Une eau con-fitte, une eau succree, Une glere si bien serrée De petis rameux entrelas. R. B E L L E A U , Petites Inventions, la Cerise (I, 75). Glereux, v. Glaireux. Gleteron. Grateron. — L'erbe nommée bar-
dana, c'est gleteron. Jard. de santé, I, 18 (G.). — En son saye avoit plus de vingt et six petites bou-gettes et fasques tousjours pleines, l'uned'un petit d'eau... l'aultre de glaterons empenez de petites plumes de oysons ou de chappons, qu'il gettoit sus les robes et bonnetz des bonnes gens. R A B E LAIS, 11,16. — Voicy les bledz tout à coup se mourir, Aspres forestz par les blez se nourrir, Glet-trons, chardons, yvrayes malheureuses. P E L E T I E R DU M A N S , 1er Liv. des Georgiques, p. 56. — L'herbe au tigneux, qu'on appelle gletteron... oste le venin de la vipère. C O T E R E A U , trad. de Co-LUMELLE, VI, 17. — Nos gueretz pleins de ronze, espines, glouterons. L. P A P O N , Pastorelle, 1,1. — Gleteron ou glouteron, dict aussi bardane et per-sonata en Languedoc, lampourde, vient facilement de racine et de semence. O. D E S E R R E S , Théâtre d'agric, VI, 15. — Appliquer contre les douleurs de jointures venans de fraction la racine deglotteron, en Languedoc ditte lampourdes. ID., &, VIII, 5. On donne aussi ce nom aux piquants de cette
plante. — Quant à la bardane, ses glouterons, qui s'attachent à tout ce qu'ils rencontrent, sont fort considérables. D u PI N E T , trad. de P L I N E , X X I , 17 (G). Gleu i. Paille, chaume. —• As-tu pas veu cer
tains laboureurs, que quand ils veulent semer une terre deux années suivantes, ils font brusler le gleu, ou paille restée du blé qui aura esté coup-Pé...? PALISSY, Recepte véritable, p. 22. — Tout cela est recouvert bien haut en forme de piramide de glu, comme une petite grange. M O N T A I G N E , Journ. de voyage, p. 188. Botte [de paille]. — Une douzaine de cotterets
et un ghiy de feurre. Texte de 1515 (G.). — Pour un cent de gluys devant couvrir la maison dud. Bardot. 1515-1516 (G). — Pour l'achat d'un cent de gluytz de paille. 1527-1528 (G.). Gleu 2, v. Glu.
Glic. Sorte de jeu de cartes. — Le glic est un jeu moult très beau Et à galians trop plus honneste. — Quant à moy, je suis toute preste. Ça, les cartes, mon beau seigneur. Ane Théâtre franc., III, 45. — A u cent, au triquetrac, N'au glic aussi, ny au jeu de la flac Plus ne jourray. R. D E C O L L E R Y E , Epistres, 21. —• A u flux, au cent, au glic, au tricquetrac II s'esbatoit, souvent estoit à flac. ID., Epitaphes, 1. — J'ay cartes, tarots et des p reste... Pour jouer au gay, à la prime... A u glic ou bien au passe-dix. Ane Poés. franc., I, 95. — Pensez-vous que les fondateurs de vos bénéfices vous les ayent donnez pour ne faire autre chose que paillarder et jouer au glic? H. E S T I E N N E , Apol pour Her., ch. 7 (1, 112). — Ces vers m'estoient ce qu'aux autres un jeu de prime, de flux, de glic, de renette, de triquetrac ou de lourche. E. P A S Q U I E R , Lettres, VIII, 1. — L'un au flux, l'autre au glic et l'autre à la renette, Un autre au triquetrac ou au tarot se jette. CL. G A U C H E T , la Plaisir des champs, l'Hyver, la Darue, p. 312. — Je la trouvay... Jouant au glic assize près du feu. G. D U R A N T , ŒUV. poet., 44 v°.
Gliçure, v. Glissure. Glifoirée. Ce qu'on lance avec une seringue.
— Il ne craint leurs ongles [des diables], leurs dents... ny leurs fourches à trois cornes, ny tous leurs engins, avec lesquels ils jettent leurs glifoi-rées sulphureuses et leurs pots pleins d'une puante charongne. Trad. de F O L E N G O , L. X I X (II, 144).
Glimpe Sorte de torche. — Je ne vis onques tant de scendeaux, tant de flambeaux, de torches, deglimpes etd'agiots. R A B E L A I S , V, 10.
Glir (glis, gliris). Loir. — Combien de fois, combien elle eut d'envie Sur l'ours, les glirs, les taissons endormis ! L A B O E T I E , Plaintes de Brada-mant, p. 258. — Hà, que les glix sont heureux qui sommeillent Six mois en l'an, et point ne se res-veillent. R O N S A R D , le Bocage royal, lre part. (III, 281). Gliron. Loir. — Que dirons nous que les ratz
et glirons ne s'approchent point de ces gentilz dieux sans estre frottez? Trad. de B U L L I N G E R , la Source d'erreur, I, 34, p. 450. —• On dit que la terre d'Auspourg est mortelle aux glirons. ID., ib., p. 451. — Icy soudain deviennent gras comme glirons. R A B E L A I S , V, 4. — Et vous, comme glissons [sic], du sommeil assommez, En sales volup-tez tout le jour vous chommez. CH A S S I G N E T , te Mespris de la vie, sonn. 102. — La ville de Paris avoit esté anciennement bastie de ceste façon... qu'on n'y voyoit ni glirons ni serpens. L E L O Y E R , Hist. des Spectres, IV, 21. — Le dormard en gliron doit encore revivre. Les Fanfares des Roule Bontemps, p. 32.
Gliseur. Marguillier. —• Les glizeurs de S. Estienne. 1530. Lille (G.). — Les gliseurs et maim-bours de S* Mikiel de Dechy. 6 déc. 1534. Arch. mun. Douai.
Glissable. Glissant. — Lieus glissables. F O S SETIER, Cron. Marg., X, v, 10 (G.).
Glissantement. Par un glissement, subrepticement. — Mon œil peu caut beuvant alterément D'une beauté l'amoureuse douceur, Glissantement m'attira dans le cœur Le doux venin d'ag-greable tourment. P O N T U S D E T Y A R D , Erreurs amoureuses, L. III, sonn. 32.
Glisse. Glaise. — Terre glisse. Trad. de VHyst. des plant, de L. F O U S C H , ch. 151 (G., Compl.).
Glissemment. E n se répandant peu à peu. — Je demanderais volontiers, si le feu s'avivoit si
IV 21
GLISSEE
glissemment qu'il occupast toute la région élémentaire, ne faudrait il pas qu'il eust consumée toute l'humidité, et qu'en luy défaillant nourriture il s'esteignist et consumast soy mesmes? P O N TUS D E T Y A R D , De la nature du monde, 120 r° (G.). Glissée. Glissade. — En cheminant il ferme
l'ongle comme s'il alloit d'asseurance, puis tout soudain il s'efforce et l'ouvre, faisant de grandes glissées, donnant des os en terre. L I E B A U L T , Mais. rust., p. 792 (G.).
Glisser (subst.). — La tresillustre princesse, coulourant sa face pasle et verecunde dune couleur rosaïque, confessa tacitement avoir honte de son glisser. L E M A I R E D E B E M G E S , la Couronne Margaritique (IV, 43).
Glisseux. Glissant. — A u chemin glisseux, pour empescher le cours De Salie en ses pas supposant, il se dresse. 1583. Trad. de VIRGILE, 171 b (Vaganay, Deux mille mots). Glisson, v. Gliron. Glissure. Glissement. — Voila donc quant à
ce temps opportun : et à ceste glissure dont parle Moyse. CALVIN, Serm. sur le Deuter., 187 (XXIX, 53). — [Le lièvre] Tost repris, tost échapé, D'une fuiarde gliçure Coule sans estre hapé. BAÏF, Poèmes, L. I (II, 51).
Trace de glissement. —• L'un des Barbares... apperceut... les glissures et froissures de l'herbe. A M Y O T , De la fortune des Romains, 12.
Glix, v. Glir, Glizeur, v. Gliseur. Globeau, dimin. de globe. — A qui puis-je,
de grâce, en ce globeau terreux, Représenter en vers la grave tragédie D'Ulysse, fleur des Grecs, qu'à vous de qui la vie Ne semble en rien quiter à ses faits généreux? J. D E C H A M P - R E P U S , Poésies diverses, p. 79. — De sorte que les corps de ce globeau terreux Se rengent au travail, sans se montrer oiseux. ID., Ulysse, II, p. 28.
Glober. Arrondir en forme de globe. — D'un long festu sur terre en rond il le luy trace [le ciel], Le globant spacieux. M A U R I C E S C È V E , Microcosme, L. III, p. 70. Globeux. Qui a la forme d'un globe, sphé-
rique. — Puis le feu, puis la lune et les astres globeux, Puis la voûte du ciel qui tourne à Pentour d'eux. R O N S A R D , Poèmes, L. II, la Paix (V, 201). — Rondeur ou Rotondité. Egale, mobile, unie, spherique, céleste, globeuse ou globuleuse. M. D E LA P O R T E , Epithetes, 359 r°. — Sphère. Mobile, ronde, tournoyante, globeuse ou globuleuse. ID., ib., 385 v°. — Ce qui est depuis le mesme equa-teur jusques au pôle du midy se n o m m e contre-climatz : et ou les antipodes sont contemplez par juste raison, au moins si lon accorde que la terre soit globeuse. T H E V E T , Cosmogr., XXII, 4. — Rien ne vit immortel sur la terre globeuse. R. GA R N I E R , Cornelie, 471. — Le chantre sacré... A dit, pinçant son lut sucré... Que rien en ce globeux séjour N'est si franc de la main d'Atrope Qu'il ne périsse quelque jour. ID., la Troade, 1211. — Rien ne te sert d'un aelai vagabond Avoir tenté les maisons aërees, Et de l'esprit parcouru, moribond, Le globeux tour des pôles aetherees. Luc D E L A P O R T E , trad. d'HoRACE, Odes, I, 28.
Qui a le corps rond? — D'autre part, les poissons de la mer Lybienne Se voyent naturels, Li-gustique et Thyrrene, L'hippocampe menu, le palombe globeux, Qui de la mer d'jEgypte a les rivages beux. R I V A U D E A U , Hymne de Marie Tira-queau, p. 213.
Globle. Globe. — Alors que le soleil fait éclipse à la terre (Le globle de la lune estant mis entredeux) La terre se lamente. A M . J A M Y N , édit. Bru-net, p. 117.
Globosité. Caractère de ce qui est spherique — J'ay prins esgard de cecy sur la mer, mesme où les vaisseaux qui nous estoient lointains, l cause de la globosité et rondeur de l'élément, nous sembloient directement opposez. T H E V E T Cosmogr., XII, 22. Globulent. En forme de globules. — Icelle semence doit estre blanche, splendide et claire, glutineuse, globulente. A M B R . P A R É , L. XVIII Préface.
Globuleux (H. D. T. 1611). — Boule. Ronde ou arrondie, spherique... globuleuse. M. DE LA P O R T E , Epithetes, 55 r°. Cf. Globeux.
Gloe. Assemblage de menu bois, fagot, cotret, —• Mettre en gloes les branqs des quesnes pour en faire des sommes. 1586. Compte de S1 Berlin, Béthune (G.). — Des bocquillons font les gloes et fagots. Ib. (G.). — Puis après fit mettre toutes les bourrées et coterets, bûches, gloes [sic], cordes, falourdes et coipeaux de trente deux arpens deux perches de bois de haute fustaye dessous iceluy estang, et allumer un feu clair flambant. PH, D'ALCRIPE, la Nouvelle Fabrique, p. 135. Gloire. Orgueil, vanité, jactance. — Ce fut lors que toy troublé ou de vin, ou de gloire, ou de la fiance que tu avois en ton fort chasteau, parlas si oultrageusement à moy. Amadis, I, 14. — II m e semble que vous ne devez avoir nulle envye sur sa teste, qui n'est pleine que de gloire et oultrecuydance, et que la luy devez laisser pour chose qu'elle vaille. Ib., III, 17. — Je doubtois que vous estimissiez gloire en moy, qui suis ung simple gentil homme, de m'adresser en heu qu'il ne m'appartient de regarder. M A R G . D E NAV., Heptam., 10. — Il a cœur noble et un esprit hautain : C o m m e Accius qui point ne se Ievoit Devant Caesar, non pour gloire qu'avoit, Mais pour monstrer qu'honneur et révérence Gist au savoir plus qu'aux gens d'apparence. C H . FONTAINE, le Pas-setemps des amis, p. 274. — C'est un garçon qui est mon jeune frère : A qui aussi la jeunesse fait croire Tout ce qu'il pense. Il est tout plein de gloire. D E S M A S U R E S , David combattant, 1296. — C'est grand cas qu'estant en ce poinct Jeune et beau, en luy n'y a point De gloire à la beauté compagne, Qui tout au pris de soy desdaigne. ID., David triomphant, 619. — Par où on vouloit peindre non tant la sottise que la gloire naturelle à la nation dequoy estoit le compte. Ce sont vices tous-jours conjoincts. M O N T A I G N E , I, 4 (I, 26). — 11 y a une autre sorte de gloire, qui est une trop bonne opinion que nous concevons de nostre valeur. ID„ II, 17 (III, 19). — Il y a deux parties en ceste gloire : sçavoir est de s'estimer trop, et n'estimer pas assez autruy. ID., ib. (III, 22). — La jalousie d'un mary... la ruze d'une chambrière, la malice d'un page, la meschanceté d'un laquais, la gloire d'un sot suffisoit et bailloit matière de deviser a tous ceux de la seree. GUILL. B O U C H E T , 18e Seree (III, 172). — Par... folle ostentation et gloire. ID., 33e Seree (V, 13). — La pluspart des prédicateurs qui se mettent en chaire le font plus par gloire, faste et vanité que pour aedifîcation. B R A N T Ô M E , Cap. franc., le grand roy François (III, 135). — Ce mareschal de Montejean fut acomparé en son temps à M. de Lautreq sur sa présomption et sa gloire. ID., ib., le mareschal f Montejean (III, 206). — Il s'y perdit tellementde
— 3:
— 323 — GLORIFIEMENT gloire qu'il se mist à desdaigner M. d'Andelot, qui estoit son couronnel. ID., Couronnels franc. (V, 3 4 1 ) •
On écrit souvent glore. — Pour acquérir n o m de glore et le perpétuer en faisant œuvre meri-tore. P. FABRI, l'Art de Rhétorique, L. I, p. 140. — Toute leur peine une glore povrète, U n faus honneur, ne cesse pourchassant. J E A N D O U B L E T , Elégies, 19. — Par mes escris ta glore volerait. ID., ib., 24. — Et de ta glore le souci. ID., ib., 26. Gloirette, dimin. de gloire. — J'ay préféré
malheureuse gloirette à la vie : mais maintenant j'enten bien que c'est une vraye sottise. F. B R E TIN, trad. de L U C I E N , Devis des mors, 15. — Désir de petite gloirette. ID., ib., le Précepteur des harangueurs, 14. — Ceux qui leur donnent une misérable gloirette, des vains honneurs, et qui leur applaudissent à leur dam. ID., ib., Epistres de Pha-laris, 58. Gloirieux, v. Glorieux. Glommereux. Aggloméré. — Masse. Lourde...
glommereuse, serrée. M. D E L A P O R T E , Epithetes, g57 v°. Glore, v. Gloire. Gloria fllia (?). — Je veulx la bouteille esgou-
ter Pour sçavoir se plus rien n'y a ; C'est droit gloria filia Pour laver ses dens. Ane Théâtre franc., I, 220. Gloriation (gloriatio). Louange, glorification.
— Gloriacion de vérité. J. B O U C H E T , la Noble dame, 153 V (G). Action de glorifier. — Vostre gloriation n'est
pas bonne. CALVIN, la Rible françoise, lre Epistre aux Corinthiens (LVII, 420). Glorier (se). Se glorifier. — L'Anglets qui s'en
glorie. A. M O R I N , Siège de Boulogne, quatr. 134 (G.). Gloriette 1. Gloriole, vanité. — Icy n'aurait
. lieu l'accusation de gloriette, veu que rejecte ' assez loing de moy arrogance. N. D E B R I S , Institut., 16 T» (G.). Gloriette 2. Sorte de petit bâtiment, de pa
villon. — A vendu, werpy, cédé, transporté et clamé quicte a tousjours heritablement a Pierres de Cardes, espissier, ung gardin, lieu et heritaige, avecq une gloriette de plaisance et ung celier. Texte de 1538. Tournai (G., Compl.). — U n g gardin, estable, lieu et heritaige avecq une gloriette de plaisance, et ung celier estant desoubz icelle gloriette. Texte de 1552. Tournai (G, Compl.). — De transférer les boucheries et poissonneries du petit pont appelées gloriettes ez boucheries, poissonneries et places de nouvel basties. Lett. de 1570 (G). Glorieusement. Avec orgueil, vanité, jac
tance. — [Cléon] dit tout glorieusement quil ne craignoit point les Lacedemoniens. S E Y S S E L , trad de T H U C Y D I D E , IV, 4 (122 r<>). — Le bon tout quand le tousseux, glorieusement, en plein acte tenu chez les Mathurins, requist ses chausses et saulsices. R A B E L A I S , I, 20. — Comment... osez-vous tant glorieusement m e respondre, et faire indiscrètement la sotte et dédaigneuse? B E ROALDE D E V E R V I L L E , Voyage des princes fortunez, p. 79. Glorieuseté. Gloire. — Pour donner a i nomme part à sa glorieuseté. F O S S E T I E R , Cron. Marg., I, 24 v° (G.). Jactance. — Irriter ses ennemis a jour decli-
209roe(G)8l°rieUSeté' n°n audace- ID- ib- H>
Glorieux. Qui aime la gloire, avide de gloire — Les princes sont glorieux, et combattent plus pour la gloire et l'honneur que pour acquest M O N L U C , Commentaires, L. III (II, 108). — Je m e retiray... aussi content du bon visage de m o n maistre c o m m e s'il m'eust donné quelque riche présent : car j'ay esté tousjours glorieux. ID., ib. (11, 132).
Orgueilleux, vaniteux, présomptueux. — Et fut accomplie la promesse que Cleon avoit faicte aux Athéniens a son partement encores quelle eust esté folle et glorieuse. S E Y S S E L , trad de T H U C Y D I D E , IV, 4 (127 r°). — Se mocquans de ces beaulx fouaciers glorieux, qui avoient trouvé maie encontre, par faulte de s'estre seignez de la bonne main au matin. R A B E L A I S , 1, 25. — H estoit si glorieulx et oultrecuydé qu'il pensoit en venir ayséemeht au dessus. Amadis, III, 7. — Il de son cousté paouvre plus que ne feut Irus. A u demourant glorieux, oultrecuydé, intolérable. R A B E L A I S , III, 25. — Ceux qui d'esprit ont vives estincelles Fuyent le fol poète et glorieux. C H . F O N T A I N E , les Ruisseaux de Fontaine, p. 30. — L'honneur dont vous parlez ne m e rend glorieux. A Dieu seul il est deu. D E S M A S U R E S , David triomphant, 113. — Si elle est bien riche... elle sera glorieuse, et vous mesprisera. G U I L L . B O U C H E T , 5e Seree (I, 230). — Il devint si glorieux et insupportable qu'il se rendoit fort mal voulu des gens de bien. Var. hist. et litt., I, 170. — Il projecte (tant il est glorieux) de se battre et tirer contre son maistre. B R A N T Ô M E , Cap. franc., M. d'Aus-sun (IV, 15).
(Subst.). C'est un glorieux qui se complaist en son ignorance, se moquant de tous ceux ausquelz Dieu a fait plus de grâces qu'à luy. C A L V I N , Epistre contre un cor délier (VII, 351). —• Tu es un glorieux... Je cognoy ta malice et de quelle façon Ton cœur tient son orgueil. D E S M A S U R E S , David combattant, 1271. — T u es un glorieux : ouy, res-pondoit-il, car il m e sied et m'appartient, pour avoir toutes les parties et forteresses requises à un brave et galant gentil-homme. D u FA I L , Contes d'Eutrapel, 11 (I, 169).
O n trouve la graphie gloirieux. — Nous traicte-rons du gloirieux pontife termaxime romain. P H . D E M A R N I X , Differ. de la Relig., I, n, Préface.
Glorifiable. Qui doit être glorifié. — Dieu est benissable glorifiable et louable. M O N T A I G N E , trad. de R. S E B O N , ch. 175. — Dieu est souverainement glorifiable et louable. ID., ib., ch. 204. — C o m m e estant glorifiable. ID., ib., ch. 279.
Glorifiance. Action de glorifier, de se glorifier, glorification. — La jactation et glorifiance de noz faits et pouvoirs illustres nha point de lieu en la matière subjette. L E M A I R E D E B E L G E S , Illustr., I, 32. — Achilles entraina vilainement le corps du noble Hector jusques au tombeau de Patroclus. Et illecques le colloqua sur la terre, par manière de vantise et de glorifiance. ID., ib., Il, 19.
Orgueil, vanité. —> Ces choses ne mesmeuvent en rien à glorifiance, ainçois eusse esté trop plus contente sil se fust déporté de non faire envers m o y telle poursuite damours, c o m m e il feit : et que honnoree ne meust de si haut guerdon. ID., ib., 1, 26. — Fol donc s'escript qui prent glorifiance Pour estre aymé. Contredicts de Songe-creux, 162 r° (G.).
Gloriflement. Action de glorifier, de se glorifier. — Si nous tenons jusques à la fin la fiance et le gloriflement de nostre espérance. C A L V I N , Instit., IV, p. 193. — Si la foy exclud tout glori-
G L O R I F I E R — 324 —
fiement : la justice de foy ne peut nullement consister avec celle des œuvres. ID., ib., VI, p. 356.
Glorifier, Se glorifier que. Se glorifier de ce que — TJn payen se glorifioit qu'il devenoit vieux en apprenant. CALVIN, Instit., X, p. 569.
Gloriflque. Glorieux. — Dieu, roy glorifique. J. B O U C H E T , Labyr. de fort., 68 r° (G.).
Glorin. Sorte de poisson. — Le glorin est mis au ranc des poiscons plats et cartilagineux, ainsi qu'est la raye. D u P I N E T , trad. du Comment, sur Dioscoride, II, 19 (G.). — C'est m o y qui ay tué le sage roy d'Itace Et non l'os du glorin. F. B R E T I N , trad. de L U C I E N , Tragédie de Podagrie, p. 693.
Glosateur. Glossateur. — Ce que ceux qui ont cognoissance de la langue italienne peuvent voir aux glosateurs de Pétrarque. T A H U R E A U , 1er Dialogue du Democritic, p. 13-14. — L'exposition que ces bons glosateurs adjoustent puis après est beaucoup pire que ces définitions. CA L V I N , Instit. (1560), III, iv, 1. — Ce sont paroles si énormes et prodigieuses que le glosateur du droit canon est contraint de dire que si les lecteurs n'estoyent bien advisez et discrets, ils pourroyent estre induits par icelles en hérésie pire que celle de Beren-gaire. ID., ib., IV, xvn, 12.
Glose. N'entendre ni texte ni glose. Ne rien comprendre. — Je te confesse n'entendre ni texte ni glose en tout ce beau discours. C. D. K. P., trad. de GELLI, Discours fantastiques de Justin Tonnelier, Disc. IV, p. 102. En glose aucune. E n rien. — Le roy, a m y jus
ques au bout des doctes, après qu'il sçaura combien tu te donnes de peine d'avoir plusieurs livres, ne te délaissera en glose aucune. F. B R E T I N , trad. de L U C I E N , Contre un ignorant ayant grande multitude de livres, 22.
Glose d'Orléans. Glose qui obscurcit le texte, mauvais commentaire. — Et puis faict une glose d'Orléans, qui dict couvertement que je vueil cor-rumpre les jurisdictions des bailliages. P. F A B R I , l'Art de Rhétorique, L. I, p. 268. — Il entend une façon de Bible qui estoit premièrement d'un' interprétation faicte à leur poste, et puis glosée de la glose d'Orléans, à-sçavoir qui gastoit le texte. H. E S T I E N N E , Apol. pour Her., ch. 30 (II, 153). — Pourquoy donc rejectez vous ce commandement et, tournant la truye au foing (comme lon dit) y apportez vous des gloses et constructions d'Orléans? Var. hist. et litt., X, 64. — Si par fortune il se trouve quelqu'un grossièrement opiniastre qui, secouant les oreilles contre la raison, vueille faire des gloses d'Orléans. Les Fanfares des Roule Bon-temps, p. 51. — Son zèle au service du roy doit excuser l'essor de sa plume, qu'on ne doit pas pour cela tant rongner au Palais, comme certains aris-tarques font, qui glosent sur la glose d'Orléans Var. hist. et litt., Il, 294. Gloser (trans.). Commenter. — Aucuns se
sont avancés de gloser et interpréter nosdites ordonnances autrement qu'on ne doit, en faveur desdits banqueroutiers et fugitifs. 4 oct. 1540 Ordonn. de Charles Quint. — Il n'est pas loy-sible... de gloser témérairement les choses qui sont clairement exprimées en l'Escriture C A L VIN, Instit., XII, p. 631. — Il glose ce passage de sainct Paul, où il est dit que la foy est réputée à justice à ceux qui n'ont point d'œuvres mais croyent en celuy qui justifie le pécheur. ID Instit. (1560), III, xi, 6. — J'en voy qui estudient et glosent leurs almanacs, et nous en allèguent lauthonte aux choses qui se passent. M O N TAIGNE, I, il (I, 55). — Les fines gens remar
quent bien plus curieusement et plus de choses mais ils les glosent. ID., I, 30 (I, 256).
Critiquer. — Mais chacun a ou son parlé glosé O u deprisé, ou comme nul tenu. M A R G . DE NAV ' tes Marguerites, Comed. de la Nativ. de J. C. Il] 45). — Heureux et trop heureux, si son outrecuidance, Subtile, n'eust glosé la céleste ordonnance. D u B A R T A S , 2 e Semaine, 4e Jour, les Trophées p. 350. — La response fut que ceux-là ne sen-toyent point la paix qui glosoyent les commandements du gouverneur. A U B I G N É , Hist uni» IV, 3. Alléguer. — C'est abuser, quelque raison que
glose Le sage humain, car trop chère est la chose. M A R G . D E NAV., Triomphe de l'Agneau (III, 14).'
Objecter. — 11 n'est parlé de procureur, bien que ce feust en matière civile, afin que quelque esprit de contradiction ne m'aille point gloser que ce feust en cas de crime. L'HOSPITAL, Reformat, de la Justice, 4e part. (IV, 341).
Louer. — Tousjours pense A gaigner le bon home et lui complaire en tout. Veut il poetas-trer? glose le jusqu'au bout. FR. HABERT, trad, d'HoRACE, Satyres, II, 5, Paraphrase.
Glossate. Glossateur. — Je les mettrois volontiers avec ce sot glossate quand il dit que nos roys jouissent de ce droit de facto, non de jure. E. P A S Q U I E R , Recherches, III, 17.
Glossatoire. Qui fait des gloses. — Deus-sent... les... interprètes de la scholastique prudence m e dérober de leur bande glossatoire. 1554. L E C A R O N , la Claire, 19 (Vaganay, Deux mille mots). Glosse. Glose. — Si l'analogie de la foy est su
jette a vos glosses et opinions, il le faut dire franchement. S4 F R A N Ç O I S D E SALES, Controverses, II, v m , 3. — Si vous glossés etl'Escriture et l'article de foy mesme, comme confirmeras vous vostre glosse? ID., ib.
Glosseur. Glossateur ? Glose ? — Il dit... qu'ils vendent leurs commentaires et expositions en lieu de la parolle de Dieu... qu'ils se servent de leurs glosseurs en lieu de la parolle de Dieu. PH, D E M A R N I X , Corresp. et Mélanges, p. 441, Glossocome (yXioo-iroxopLecov). — Pour laquelle
chose [la réduction des luxations] ont inventé une infinité de machines et instrumens (appelés glos-socomes). A M B R . P A R É , Introd., ch. 27. — Glos-socomes signifie tous instrumens qui servent à réduire les fractures ou luxations. ID., XII, 8.
Glotir, v. Gloutir. Glotteron, v. Gleteron. Gloud, v. Glout. Glou-gloutement. Glouglou. — D'où d'un
glou-gloutement doulx Ton eau jaillit gazouil-leuse. Luc D E L A P O R T E , trad. d'HoRACE, Odes, 111,13. Glouglouter. Faire glouglou. — Donne-moy
viste un jambon sous ta treille, Et la bouteille Grosse à merveille Glougloute auprès de moy, R O N S A R D , Pièces retranchées, Odes (VI, 95). — Bouteille. Panssue, vineuse, glougloutante. M. DE LA P O R T E , Epithetes, 56 r°. Glout. Glouton, avide. — Si saouleray ton go
sier maigre et glout. L E M A I R E D E BELGES, lre Epistre de l'Amant verd (III, 14). — Le chien léger de près le semble joindre [le lièvre]... Puis de ses dentz (ouvrant sa gueulle gloute) Rase ses piedz. M A R O T , L. I de la Metamorph. (III, 186). -~ Ilz ont ouvert dessus moy languissant Leur gueule
— 325 — G L O U T O N N I E
gloute. ID., Ps. de David., 18. — Plus une soif est gloute, Moins le breuvage on goûte, Tant soit-il doucereux. BAÏF, l'Amour de Francine, L. III (I, 222). — Pour-ce les Grecs ont dit que glout de faim extrême Saturne dévorait ses propres enfans mesme. R O N S A R D , Elégies, 2, édit. de 1623 (VI, 312). — Ainsi l'on voit Phydropic altéré... Plus d'une gorge gloute il avalle de l'onde, Moins estancher sa soif à mesme l'eau profonde. BAÏF, Diverses amours, L. III (I, 372). — Plustost un tigre glout de m a chair se nourrisse. R. GARNIER, Marc Antoine, 396. — Deux hommes, desquels l'un est glout et craintif, et l'autre sobre et hardy. A M B R . P A R É , I, 18. — Du ciel descendre II void le gloud milan qui vient pour le surprendre. CL. G A U C H E T , te Plaisir des champs, le Printemps, Bergers amoureux, p. 84. — Oyseaux glouts qui vivez de proye et de rapine. P. MATTHIEU, Aman, I, p. 4. —• Le boire et le manger trop glout et trop avide Nous oste meinte-fois la vie et la santé. CHASSIGNET, te Mespris de lavie, sonn. 111. — (Fig.). O ciel, osas tu voir telle inhumanité? Et toy, terre maudite, en telle iniquité, Boire gloutte et succer le sang de l'innocent...? M A U R I C E S C È V E , Microcosme, L. I, p. 28. — Celuy qui d'un courage franc Prodigue vaillamment son sang Pour le salut de la patrie... Comme un peuple ne tombe pas De la mort gloute le repas. R. GARNIER, Cornelie, 1250. (Au sens moral). Avide. — Par cest apologue il
appert Que par vouloir embrasser tout Et estre trop cupide et glout Le plus souvent le tout on perd. H A U D E N T , Apologues d'EsoPE, 1, 169. — L'ambition des grands et la gloute avarice. BAÏF, Poèmes, L. V (II, 226). — Tousjours depuis mon espérance gloute Demeura sobre. V A U Q U E L I N D E LA FRESNAYE, Sat. franc., A M. de Tiron. —• Ils se sont assouvis, leur gloutte convoitise Parmy tant d'abondance en fin se voit remise. D E S P O R T E S , Ps. de David, 11. Glout de. Avide de. — Or estoit il bien glout
d'honneur. J. D'AUTON, Chron., 135 v° (G.). — Or en este tant glout [de nouvelles] que tu t'ap-prestes A les manger avant qu'elles soient prestes. DES PÉRIERS, Prognost. des Prognost. (I, 133). — Quand ma femme future seroit aussi gloutte du plaisir vénérien que fut oncques Messalina. R A B E LAIS, III, 27. — Car rien je ne redoute Au pris de sa fureur qui de sang est si gloute. R. G A R N I E R , Marc Antoine, 1845. Glout. Avare. — Icelluy ouvrier fut si ingrat et
glout de son sçavoir quil ne le voulut oncques enseigner à homme. G. T O R Y , Champ fleury, Préface. — Aucuns mont volu demovoir de ce faire, disant que je ne la debvoye tant manifester, mais garder en secret pour moy. Saulve leur honneur me semble que non, et que je ne doibs estre glout de science honneste et bonne. ID., ib., L. 1,1 r». Gloutement. Gloutonnement, avidement. —
Voyantz les moutons ce glan cheoir, Le sont venus si glouttement Devourer. H A U D E N T , Apologues d ESOPE, I, 105. — Thenot... Ayant gloutement avalle Sans mascher maint jambon salé. R O N -*ARD. Gayetez, 8, édit. de 1623 (VI, 347). — U est Père, ta malvoisie De Candie Qu'ilz avalent gloutement. O. D E M A G N Y , Gayetez, p. 7 6 . — On voit se bouter Par les buissons la chèvre, et gloutement brouter. R. B E L L E A U , Prognostiques et Présages (II, 351). — Une biche peureuse... A este mise en proye à un lyon gourmant, Qui l'a oevant mes yeux en pièces déchirée, Et sa tremblante chair gloutement dévorée. R. G A R N I E R , la iroade, 1260. — Trop boire de vin pur et fumeux, manger trop gloutement les viandes. A M B R . P A R É ,
VI, 6. — As tu point veu comment il boit bien, et comme il dévore gloutement la viande qu'on luy met devant? F. B R E T I N , trad. de LU C I E N , De ceux qui vivent à gages, 17. — (Fig.). La bouche m'agrée Que ta voix sucrée De son miel a peu, Et qui sur Parnase De Peau de Pégase Gloutement a beu. R O N S A R D , Odes, II, 2. — Paissez-vous d'une envie pâle, Paissez-vous, traistres, gloutement. T A H U R E A U , Premières Poésies (I, 72). — Que pleut à Dieu que je peusse vomir du plus profond du cueur les enseignemens de ces sots et superstitieus amis du monde, d'aussi grand courage que gloutement je les ai dévorés. ID., Sec. Dialogue du Democritic, p. 185. — Ce doux har-peur qui, d'un fredon lyrique, Si chastement sur ses cordes chanta Que de son chant la fureur enchanta Qui gloutement ronge l'âme impudique. ID., Sonnets, 67. — Desployant librement es ce-lestes contrées Ses ailes de mon sang gloutement enyvrees. R. B E L L E A U , la Bergerie, 2e Journ., Complainte de Promethee (II, 15). — Pour abreuver D'erreur ceux qui d'erreur gloutement se repaissent. D u B A R T A S , lre Semaine, 1" Jour, p. 36. — Les douceurs que nous avons avalé si gloutement se fondent puis en amertumes et repentirs. C H A R R O N , Sagesse, III, 38.
Glouteron, v. Gleteron. Gloutir. Engloutir. — Meneurs d'autres estes
aveugles qui coulez le chevrel et glotissez le charnel. Bible, Mathieu, 25 (G.). — Q u e servirait il de raconter les undes effroyables et gloutissantes...? F. B R E T I N , trad. de L U C I E N , Toxaris, 19.
Glouton. Ce mot s'emploie quelquefois dans un sens vague et peut être traduit par coquin. Il faut probablement voir là une influence italienne. — Ah ! injuste, trompeuse et traistresse fortune I combien me doy-je plaindre de toy 1 —•• Au contraire, monsieur, avez occasion de vous en louer plus qu'homme du monde, et luy devriez faire bastir une chappelle et la dédier en son nom. — Ha ! glouton, tu te gosses. L A R I V E Y , te Laquais, II, 1. — Quoy ! mon fils te semble-il homme de prison? — Il m'est advis qu'oy, puis que le guet l'y a faict mettre. — O quel glouton I — Pourquoy? — Pour avoir esté trouvé saisy d'armes. ID., ib., III, 3. — Et ce pendant, où est il? — Vous ay-je pas dit qu'il est allé porterdes lettres? — O meschant glouton ! ID., te Morfondu, IV, 7. Gloutonnie. Gloutonnerie. — Les deux plus
singuliers chefz d œuvre que nature feist onques touchant margarites, perles ou unions, Cleopatra, royne d'Egypte, les eut en possesse par le moyen des roys d'Orient, dont, par oultrageuse gloutonnie, lune dicelles fondue en tresfort vinaigre, fut par elle beue et absorbée en un souper. L E M A I R E D E B E L G E S , la Couronne Margaritique (IV, 65). — Tu chasseras d'autour de toy la gloutonnie, qui vitupère le corps et avance la mort. A. SEVIN, trad. de B O C C A C E , te Philocope, L. VII, 173 r°. — Semblablement vous devez vous garder De gloutonnie, et vous contregarder De trop jecter voustre cueur aux viandes. J. B O U C H E T , Epistres morales du Traverseur, I, 9. — Ce qui gaste et corrompt non seulement les conditions de l'ame, mais aussi les complexions du corps, quand on luy lasche ainsi en abandon la bride à toute sensualité et à toute gloutonnie. A M Y O T , Lycurgue, 10. — Gloutonnie... De maint irritement affriandant la gueule. M A U R I C E S C È V E , Microcosme, L. II, p. 41. — La foy, la vérité de la terre est bannie, Et régnent en leur lieu luxure et gloutonnie. R O N S A R D , Remonstrance au peuple de France (V, 374). — L'homme estant par son appétit desordonné
G L O U T O N N E M E N T — 326 —
de voluptez et par sa gloutonnie tiré à toutes choses... il est seul de toutes les créatures vivantes qui mange de tout. A M Y O T , Que les bestes brutes usent de la raison, 8. — Afin que l'aliment ne s'escoulast trop tost, et que n'eussions une insatiable gloutonnie et voracité. A M B R . P A R É , I, 15. — ' N e ramassez jamais soubz le pied du tréteau Les morceaux espandus : c'est une gloutonnie. M m e s D E S R O C H E S , Secondes Œuvres, les Enigmes de Pythagore. — Ains quelquefois encor, ô gloutonnie estrange ! Pour remplir ses boyaux, ses boyaux elle mange. D u B A R T A S , 2e Semaine, 1er j0ur, les Furies, 99 r°. — Le démon de gourmandise et de gloutonnie. L E L O Y E R , Hist. des Spectres, II, 7. — Il [saint Bernard] dit donques que le jeusne a esté institué de Nostre Seigneur pour remède à nostre bouche, à nostre gourmandise et à nostre gloutonie. S* F R A N Ç O I S D E SALES, Sermons recueillis, 54 (X, 183). — Il y avoit des vivres et des vins pour deux ans ; mais ilz gous-pillarent, beurent et mangearent tout avec une gloutonnie que, sans le malheur qui arriva à M. de PAutreq... la ville estoit perdue. B R A N T Ô M E , Cap. estr., le Couronnel Framsberg (I, 355). Avidité. — Galba avoit bien dit que sa con
duite sur les vivres seroit mal gouvernée : si que les provinces ne pourraient remplir sa gloutonnie si ample. M I C H E L D E T O U R S , trad. de S U É T O N E , IX, 241 r°.
Gloutonnement (H. D. T. La Fontaine). — 1570. Tous les Italiens ayant esté enyvrez trop glotonnement de cest espoir, et Livie estant mort soudainement, comme on ne leur tint pas promesse, les Pirentes prindrent premièrement les armes. G. H E R V E T , trad. de la Cité de Dieu, I, 96 b, A, édit. de 1578 (Vaganay, Pour l'hist. du franc, moderne). — 1585. Tu fais, ô Tout puissant... que le scorpion du sang de ses petis Soûle gloutonnement ses cruels appétis. D u B A R T A S , 550 (Vaganay, Deux mille mots).
Glouttement, v. Gloutement. Glower. Réduire en menu bois, mettre en fa
gots. — On glauwe des arbres abatus des vents. 1535. S4 Orner (G., Gloer). — Pour glower LXI sommes de brancaiges en gros bois a n s. vi d. la somme. 1538. Ib. (G.). — Glower le gros bois 1586. Béthune (G.). Gin 1. Piège fait de glu. (Masc). — Aux
chesnes s'engendre et se prend U n glu ou visqueuse matière. H A U D E N T , Apologues d'ÉsoPE, II, 55. —• Gluz. Empestrante... visqueuse... Le glu se fait en diverses sortes... On use de ceste diction au masc. et fem. M. D E LA P O R T E , Epithetes, 193 v°. — Le meilleur glu est celui qui est fait des grains du gui. ID., ib,, 201 r°. — Je sçay bien que le glus, qu'aucuns appellent besq, est composé de matières grasses. PALISSY, Discours admirables, Des terres d'argile, p. 299. — Divers autres moiens y a-il pour prendre... oiseaux gros et menus, à l'amorce, à la pipee... au feu, au glu, au laqs. O. D E S E R R E S , Théâtre d'agric, VIII, 7. — Cingar... pense quelque stratagème, avec lequel il peut prendre au piège Tognazze, comme au glu on attrappe l'oye sauvage. Trad. de F O LEN G O , Merlin Coccaie, L. VI (I, 157). — (Fig.). H o m m e impourveu, tu es surpris au glus De volupté. F O R C A D E L , ŒUV. poet., p. 24. — Il faut chercher espérance plus forte Pour prendre au glus mon espérance morte. V A U Q U E L I N D E L A F R E S N A Y E , Satyres franc., A M. de Tiron. — De son vouloir le glus secrettement attire D'un grand mal un grand bien. P. M A T T H I E U , Aman, I, i
Le mot se présente sous beaucoup de formes : glus (voir l'alinéa précédent), gluc, glud, glue] gleu, gleux, gluy, gly. — Encor je croy, si j'en en-voyois plus, Qu'il le prendrait, car ils ont tant de glus Dedans leurs mains, ces faiseurs de pipée, Que toute chose où touchent est grippée. MAROT| Epistres, 27. — La glus est la mort des oiseaux! B E R E A U , Eglogues, 9. — Je garde à Pasithée une linote en cage, Que j'ay prise à la glus. RONSARD, Eclogues, 5 (III, 447). — Elle avoit des apas, Des rets, des hameçons et de la glus pour prendre Les crédules esprits qui la vouloient attendre. ID., Elégies, 21 (IV, 117). — Dois-je estre plus rétif à ne m'empestrer plus En appâts de la cour ainsi qu'en une glus? J E A N D E LA TAILLE, te Courtisan retiré. — Ne du fort gluc ne m e puis desbrancher De l'arbre vert digne à toute louange. VASQUIN PHILIEUL, trad. de P É T R A R Q U E , L. I, sonn. 127, — Vertu, noblesse, honneur, grâce et beaulté Et doulx accueil m'ont sus l'arbre jette Ou je fus pris au gluc sans le sentir. ID., ib., sonn. 172. — 0! qu'en ce guy tel signe fut compris (Puis que le glud se fait de ses feuillages) Que vostre cœur du mien deust estre pris ! M E L I N D E S4 GELAYS, ES-trenes (II, 209). — Puis voyant que son ret, et son haim, et sa glue S'en alloit clair au jour, il se mit, de regnard Qu'il estoit, en peau d'ours et de fier léopard. L'Ixion hespagnol, dans Tricotel, édit. de la Sat. Men., Il, 262. — Entre lesquelles [anguilles] en fut prise une au gleu. P H . D'ALCRIPE, la Nouvelle Fabrique, p. 51. —• Soudain passeras outre, en évitant la gleux qui est autour de telle chose. F. B R E T I N , trad. de LUCIEN, Comment il faut escrire une histoire, 57. — Cueillir les houx piquans en la forest, pour faire du gluy à prendre les petis oiselets ramages. L E M A I R E D E BELGES, Illustr., I, 21. — Hz emmiellent les poiz et mettent gluy en tour la viande, comme Poyseleur, P. D E C H A N G Y , Instit. de la femme chrest., 1,14. — Ledanon se trouve en la barbe du bouc, comme gly en l'arbre. SALIAT, trad. d'HÉRODOTE, 111,112.
Glu 2, v. Gteul. Gluantement. D'une manière gluante. — Icy
pour dur ciment nuict et jour on amasse Des estangs bitumeux l'eau gluantement grasse. Du B A R T A S , Sec. Semaine, Sec. Jour, Babylone, p. 190.
Gluber (glubere). — Elles commencèrent es-corcher l'home, ou gluber, comme le nomme Catulle, par la partie qui plus leurs hayte. RABELAIS, III, 18.
Gluc 1, v. Glul. Gluc 2. — Le tailleur (distinguo par gluc en
clop) ne peut oster la maladie, qui n'a plus de force. C H O L I È R E S , 4e Matinée, p. 123. — H est bien séant que sçachiez d'où c'est que vous vient ce qui tombe en vos mains, distinguo par gluc. ID., les Ap.-disnées, Aux liseurs. — (Ce mot s'emploie pour dire que le raisonnement qui précède ne conclut rien. Cf. Ergo gluc).
Glud, Glue, v. Glul. Gluement. Fait de coller. — L'agglutination
des paupières est double ; l'une se faict avec des tuniques des yeux, l'autre des paupières entr'elles, Ce gluement advient de l'incision de l'ongle ou sebel, ou chair superflue. J O U B E R T , Gr. chir., p. 505 (G.). — De sorte que l'humidité soit convertie à collement et gluement. ID., ib., p. 6'° (G.). Gluer. Prendre à la glu. — (Fig.). Vostre grâce,
vostre maintien M e gluent en vostre entretien.
— 327 — GLUTINER
DES PÉRIERS, Nouv. Récr., 102. — Je suis content encor que jamais aux boutiques On ne trouve mon livre aux grand's foires publiques : Ni qu'il soit recherché par tous ces hommes vains Qui n'ont que de la glus pour gluer en leurs mains. VAUQUELIN D E LA FRESNAYE, Satyres franc., L IV, A Vauquelin de Sassy. Se gluer. Se coller. — Les greffes se gluent et
collent beaucoup mieux. LIEBAULT, Mais, rust.,
Glué. Enduit de glu. — Or' en semant le bord de vergettes gluées... Je me cachay sous l'herbe au pied d'un arbrisseau, Attendant que la soif ferait venir l'oiseau. RONSARD, Eclogues, 1 (III, 365), — Tel en l'air se levant sesauve parderriere Loing des brilloërs gluez et de la flamme fiere. CL. GAUCHET, te Plaisir des champs, VHyver, la Darue, p. 308. Pris à la glu. — (Fig.). Ce marchant... se voyant
prins et glué. Du FAIL, Contes d'Eutrapel, 31 (II, 128). Glueur. Qualité de ce qui est gluant. — Vous
semblerait il que leurs toiles [des araignées] faites à jour, la polissure d'icelles, la glueur et ténacité de la trame ne vienne bien à propos à leur chasse? Du PINET, trad. de PLINE, XI, 24 (G.).
Glueuseté. Ce qui est gluant. — Quant on met celle semence dedans eaue, elle s'enfle tantost et engrossist et y vient une glueuseté. Le Grand Herbier, 78 v° (G.). Chose gluante, visqueuse. — Ainsi il y appella
une viscosité, laquelle glueuseté soit mise sus apostume. Jard. de santé, I, 15 (G.). Glueusité. Qualité de ce qui est gluant. — Et
est celuy [balsame] a eslire auquel il appert aucune gonmosité dedans ou glueusité quand on le froisse ou casse. Le Grand Herbier, 16 r° (G.). Glueux. Gluant, visqueux. — La maulve
champestre est glueuse. Jard. de santé, 1,15 (G.). — Les anciens les enduysoyent [les images des dieux] et coulouroyent de terre glueuse. Trad. de BULLINGER, ta Source d'erreur, I, 10, p. 118. — Bitume. Fort, liquide... glueux ou glutineux. M. DE LA PORTE, Epithetes, 52 r°. — Gui. Perlé, glueux ou glutineux. ID., ib., 200 v°. — Mais l'air glueux d'une espaisse gelée Et d'une neige en la pluye meslée... S'est contre luy cruellement armé. RONSARD, tes Elemens ennemis de l'hydre (V, 441). — Aussi espais que neiges innombrables Que Pair glueux à bas fait trébucher. ID., Franciade, I (III, 30). — Tant plus qu'il bat de l'aile et que plus il s'efforce De se desempestrer, plus la glueuse amorce L'attache et le retient. DESPORTES, Roland furieux, p. 327. — La salive espaisse et glueuse. AMBR. PARÉ, 1,14. —• Il est aussi requis que les terres où l'on veut ériger marez soyent tenantes, glueuses ou visqueuses. PALISSY, Discours admirables, Du sel commun, p. 251. — Une terre visqueuse, grasse et glueuse. ID., ib., Des terres d'argile, p. 299. — Par l'argille glueux de ces hermes-guerets. L. PAPON, Pastorelle, 1, 1. — Les Sabeans... recréent leur cerveau et se guérissent avec l'odeur d'un limon glueux que les Latins appellent bitumen. GUILL. BOUCHET, 17e Seree (III, 170). — (Fig.). Noyon, garde toy bien de brancher comme moy Sur ces rameaux glueux. GREVIN, Olimpe, II, p. 236. — Si, vaincu du travail, le sommeil ocieux De son glueux plumeau vient esventer mes yeux. NUY S E M E N T , Œuv. poet., 63 r°. Qui s'aide de la glu. — Un cruel oiseleur par
glueuse cautelle L'a prise et l'a tuée. RONSARD, Amours de Mark (I, 188).
Sujet à se coller aux mains. — (Fig.). Il fault donc regarder Qu'à la foy de plusieurs on ne baille à garder La finance du roy : car elle est fort glueuse. Du BELLAY, Discours sur le sacre de François II. — Argent. Blanc... glueux, fin, cor-rompeur. M. DE LA PORTE. Epithetes, 31 r°. Tenace, persistant. — [L'espoir] en prison nous
vient mettre... Et d'un désir si glueux abuser Que ne povons de luy nous dessaisir. MAURICE SCÈVE, Délie, 276. Gluant (fig.), avide. — Quand nous aurons les
mains glueuses pour attirer les presens et pour les retenir, voila nos yeux bandez. CALVIN, Serm. sur le Deuter., 101 (XXVII, 419). — S'il vous plaist de régler voz finances en sorte Que les glueuses mains ne puissent retenir Les deniers qui devraient en voz coffres venir. Du BELLAY, Ample discours au roy. — Au ministère util de ceux qui pour les princes, Ou bien pour un publicq, les deniers des provinces Doivent asseoir, lever, assembler, départir, Les faisans nettement rentrer et resortir D'une main non glueuse. JODELLE, tes Discours de Jules César (II, 236).
Gluiere. Treillis. — A Thomas Bauduin, voi-riereur a la Bassee, m 1. pour avoir fait une gluiere et mis une toille au devant de la veriere de madame la comtesse. 1610. La Bassée (G.). Gluiot. Paille. — Les gluyos pour faire les tes
tes a leyer les dites vingnes. 1510. Corbie (G.). — Cinq dizeaulx de gluiot de seigle. Texte de 1595 (G.)-Glume. — Paille ou glume des meusniers. Dans
PH. D E MARNIX, Ecrits polit, et histor., p. 296. Gluon. Gluau. 7— Et tout ainsi que l'on prent
les oyseaulx Avec Papast, les gluons et pipeaulx. CH. FONTAINE, la Contr'amye de court, 12 v°. — Gluau ou Gluon. Captieux, délié, tendu, subtil. M. D E LA PORTE, Epithetes, 193 v°. — Se perdant tout ainsi que l'innocent oyseau Tombé dans les gluons au coulant d'un ruisseau, Qui, s'efforçant voler, plus s'englue et se lie. R. BELLEAU, la Rer-gerie, 2e Journ., les Amours de David (II, 150). —• Tel [oiseau] se pensant saulver du gluon qui le tient, Retombe en un plus fort. CL. GAUCHET, te Plaisir des champs, l'Esté, Divers plaisirs, p. 167. — De loing le merle vient, qui peu à peu s'approche, Et trouve branchettant un gluon qui l'accroche. ID., ib. — Les uns... s'amusent A tendre des gluons aux oiseaux qu'ils abusent. ID., ib., VHyver, Divers plaisirs, p. 299. — (Fig.). L'empoisonné gluon de la volupté. J. D E BAR-RAUD, trad. des Epist. dorées de GUEVARA, 15 v° (G.). Glutination. Agglutination, cicatrisation. —
Avec le temps... l'endroit de telle glutination se trouve plus ferme et plus dur que l'autre partie non rompue. A M B R . PARÉ, XIII, 3. Glutiner. Coller, cicatriser. — Les fueilles de
ulmus... glutinent les plaies récentes. CANAPPE, trad. de Gui de CHAUL. (G). — Le premier [moyen] et le plus commun est d'approcher les lèvres de la playe, et appliquer... medicamens lesquels auront vertu de restreindre, glutiner, réfrigérer et desseicher. AMBR. PARÉ, VII, 7. —'Nature reunit et glutine le crâne par un callus, comme elle fait aussi es autres parties du corps. ID., VIII, 6. — Par ainsi la playe sera glutinee tant par ladite suture que par les medicamens. ID , ib., VIII, 26. — Albucrasis dit que pour neuf causes les ulcères sont difficiles à glutiner, incarner et cicatriser. ID., XI, 4. — (Fig.). Il [Amour] avoit fait forger un nouveau traict, et l'avoit
GLUTINOSITÉ — 328 —
trempé dans les douceurs de la mesme délicatesse dont couloit le suc amoureux qui glutinoit les âmes de Cambile et de Cavaliree. B E R O A L D E DE VE R V I L L E , Voyage des princes fortunez, p. 103. Se glutiner. Se coller. — Une sanie qui fait que
les palpebres se glutinent de nuit ensemble, et les rend chassieuses. A M B R . P A R É , X V , 11.
Se cicatriser. — Pour ce il ne faut que le chirurgien doute aucunement que lesdites playes se puissent glutiner et clorre. ID., IX, 6. — Les os, à cause de leur seicheresse, ne se peuvent aisément glutiner, comme fait la chair. ID., XIII, 3.
Glutiné. Collé. — Et qui ta face a Dedalus dirait, Son laberinthe imparfaict laisserait, Prenant ses aelles de cyre glutinees. M I C H E L D'AMBOISE, Epistres et lettres amoureuses, 109 r°.
Glutinosité. Qualité de ce qui est gluant, visqueux. —• Il ne resterait humidité et glutinosité compétente. A M B R . P A R É , Introd., ch. 15. — Ce qui se fait par une cohérence et glutinosité de matière visqueuse. ID., VI, 14. — Peu de personnes pensent que l'on la puisse faire aisée à boire [la térébenthine], attendu sa glutinosité et espais-seur. ID., XVI, 21.
Gluy 1, Gluy 2, v. Gleu 1, Glu 1. Gluyot, Gly, v. Gluiot, Glu 1. Glyphouoire. Clifoire, seringue. — Les venes
emulgentes, comme deux glyphouoires. R A B E LAIS, IV, 30.
Gnacelle. Sorte de plante. — Point ne portoit fleur, benjoin, gnacelle. Adolesc de 3. D U FOUIL-L O U X (G.).
Gnao. Miaou. — Le chat veut bien respondre gnao, mais non pas donner secours. Trad. de F O L E N G O , L. II (I, 53). — On y oit aussi les matoux chanter gnao, gnao. Ib., L. X V (II, 36). — C o m m e vous verriez un chat quand estant tombé en l'eau on le tire par la queue, et... se prend à crier gnao, gnao. Ib., L. X X I V (II, 299). Gnaver, latin, par plaisanterie. Je gnave opère
de. Je m'applique à, je m'efforce de (operam na-vare, and gnavare). — Je gnave opère et par vêles et rames je m e enite de le locupleter de la redun-dance latinicome. R A B E L A I S , II, 6.
Gnille l (?). — Pour l'amour de toi, ô grand prince de Rome, duquel Homère prophetisoit tantost, toi qui l'as miraculifiee de nouveau, qui as tant baillé à coudre aux Romains, leur ayant tant desenseveli de gnilles. B E R O A L D E D E V E R V I L L E , te Moyen de parvenir, Remonstrance (I, 149). Var eguilles (Royer). Gnille 2. —• Vous avez en somme... les ele-mens, principes... puissances et causes de parvenir tout du long à l'usage de Genève, et sans rien requérir, comme une gnille de beurre frais. B E R O A L D E D E V E R V I L L E , te Moyen de parvenir, Parlement (1,167). Var. : livre, gnille (Royer). Gnippe. Guenippe. — Quoi! vous petez? lui
disje. — Vere, monsieur, dit elle, c'est que j'ay mangé des poix. — C'estoit donc une fausse gnippe. — Ouy, elle avoit estudié avec celles muses Aganippes, d'où vient ce bel epitecte. B E R O A L D E D E V E R V I L L E , te Moyen de parvenir, Instance (II, 105). Var. : guenippe (Royer).
Gnome. Gnomon. — Horologes tracés et ronds et angulaires... Maints autres poligons, desquels le gnome droit Suit ombreux le soleil tournant à tout endroit. M A U R I C E S C È V E , Microcosme, L. III, p. 91. Gnomon, dans un sens libre. — Il n'y a que ces
deux raisons... qui empeschent les femmes de prester leur gnomon. B E R O A L D E D E VERVILLE U Moyen de parvenir, Texte (I, 220).
Gnongnon. Gronderie. — Se quelque aubade La matinade M e font ces gentilz compaignon J'auray du groin et du gnongnon. G. ALIONE' Poes. fr. (G.).
Goabins, mets imaginaire. — L a royne fut servie la première de goabins, qui est une viande fort exquise au pays de Lanternoys, car je n'en vey jamais ailleurs. Navigation du Compagnon à la Bouteille, B. Gob (tout de). Tout de go, tout d'un trait, d'un seul coup. — L'oyseau... s'assit en la vallée' de Préaux, où il avalla le pauvre berger tout de gob. P H . D'ALCRIPE, la Nouvelle Fabrique, p. 82. — Il l'avalla tout de gob, sans mascher. ID., il., p. 142. —• [Le rat] vint tomber entre les pieds d'un grand coq d'Inde, qui le print subitement et l'avalla tout de gob. ID., ib., p. 158.
Gobbemouche (H. D. T. 1611).—Cemaistre gobbemouche a toutes les prééminences impériales, roialles et sacerdotales en sa manche, P H . D E M A R N I X , Differ. de la Relig., 1, n, 9. Gobe. Fier. — Incontinent la chevelure paincte, Maintenant veue en la rose excellente, Tomba aussi par cheute violente Dessus la terre, estant gobe et jolïe D'ainsi se veoir tout à coup embellie D u tainct des fleurs cheutes à l'environ. D E S P É R I E R S , Des Roses (I, 70).
Gobeau. Gobelet, coupe. — De boire l'eau il eut remors, La craingnant comme qui est mors De quelque mastin enragé : Ne souffrant le vin outragé Par meslange, non plus que fait Quelque goubeau de lyerre fait. F O R C A D E L , ŒUV. poet., p. 206. — 1561. Ung gobeau sans pied, d'argent doré. Invent, du chasteau de Pau, fol. 59 (Gay, Gloss. archéol). —• C o m m e la fresle aiguière et le fresle goubeau Qu'on voit s'entre-choquer entre les mains d'un page Versent soudainement l'un et l'autre breuvage. D u B A R T A S , lre Semaine, Sec. Jour, p. 65. —• Sa main est son gobeau, l'argenté ruisselet Son plus doux hypocras. ID., ib., 3e Jour, p. 153. — Il leur alloit au devant à pied, et leur presentoit un gobeau de lait de jument, breuvage qui leur est en délices. M O N T A I G N E , I, 48 (I, 402). — Le Caecube et en noir teinct Du pressoir calene espreinct Tu pourras le raisin boire : Ni le sep falernien, Ni le tortu formien One mes gobeaus ne tempère, Luc D E L A P O R T E , trad. d'HoRACE, Odes, I, 20. — Si tendre chaque année Te tombe un chevreau, Ni large la vinée Manque au cyprin gobeau. ID., ib., III, 18. — Je doneroi des go-beaux. (Lat. : donarem paieras). ID., ib., IV, 8.— Cest autre qui, surprins par le charmeur repos, Gist parmy les flascons, les tasses et les pots, Par le coup qu'il reçoit en sa ronflante gorge, Dans ses propres goubeaux le vin humé regorge. Du BARTAS, 2e Semaine, 3e Jour, la Vocation, p. 449. —• Le meuble de table... tasses, goubeaux, esguieres, O. D E S E R R E S , Théâtre d'agric, VIII, 3. — (Fig.). Hé ! ne sçavez vous pas Que nous cinglons tous-jours droit au port du trespas, Où les premiers anchrez sont les premiers en gloire, Que la nécessité nous contrainct tous de boire En ce gobeau broyé par les mains du destin? D u BARTAS, la 2e Semaine, 4e Jour, la Décadence, p. 525. — Nous avons beau nous plaire à la joye mondaine, Humant des voluptez le venimeus gobeau. CHASSIG N E T , te Mespris de la vie, sonn. 405. Morceau. — Il la mangea si diligemment qu'il
n'eut loisir de se torcher les babines, là où il
329 — GODDON
demeura de petis gobeaux de ceste candelée. D E S PÉRIERS, Nouv. Récr., 72. La Coupe, constellation. — Orion, PEridan, la
Balene, Le Chien et l'Avant-chien à la brûlante halene,' Le Lièvre, la Grand Nef, et l'Hydre et le Gobeau. Du B A R T A S , lre Semaine, 4e Jour, p. 178. — Note : C'est l'une des quinze estoilles remar-i quees par les astronomes au pôle méridional, autrement appelle la Coupe, et Crater des Latins. Gobelet. Renoncule. — Encore n'y est mau-
; vaise [dans les prés] la petite mauve sauvage, ny le gobelet ou renoncule. L I E B A U L T , Mais, rust., IV, 4 (G.). Gobelin. Sorte de lutin, d'esprit follet, de dé
mon — Le pape... luy dit : Daemonium habes? — In manica mea, respondit le Normand. Et en disant cela il mit la main en sa manche pour tirer ses lettres. Le pape fut un petit surpris, pensant qu'il allast tirer le gobelin de sa manche. D E S P É RIERS, Nouv. Récr., 1. — Salomon eut la perfection de ceste pierre, et si congneut par inspiration divine la grande et merveilleuse propriétéd'icelle, qui estoit de contraindre les gobelins. ID., ib., 13. — Il se trouve assez de maisons esquelles ces esprits et gobelins hantent, et ne cessent de troubler le repos de ceux qui y habitent. L E L O Y E R , Hist. des Spectres, IV, 18. — (Fig.). Et vous res-veur, vieux gobelin, Vous pouvez bien cercher à paistre. R. B E L L E A U , la Reconnue, V, 2. Gobelle. Gobelet. — Une de ces grandes go-
belles toutes pleines. J. D E L E R Y , Voy. au Brésil, 1,150 (G). Gobelot. Gobelet. — One Basselin ne voullut
de laitage, Et toy, Farin, le hais plus que la mort ; Mais pour vuider centz fois le gobelot, Tu le ferais, et encor davantage. J. L E H O U X , Chans. du Vau de Vire, Suppl. 3. Gobequinault. — Belistre... gobequinault,
i. gourmand ou affamé. M. D E L A P O R T E , Epithetes, 48 r°. Gobet. Morceau, pièce. — En aille ainsi comme
il pourra, Mais ce gobet m e demourra Pour soup-per. Act. des Apost., 1,107 b (G.). — U n gobet de gris chasteau giron contenant quatre aunes. 1510. Inventaire. Arch. Finistère (G.). Gobin. Bossu. — Le duc de Mantoue, qu'on
appelloit le Gobin, parce qu'il estoit fort bossu. BRANTÔME, des Dames, part. II (IX, 361). Gobion (gobio). — Les pescheurs se soeffrent
mouillier de l'eaue de la mer pour prendre ung gobion. FOSSETIER, Cron. Marg., VIII, iv, 31 (G., Compl.). Gobissan, Gobisson. Sorte de hoqueton. —
D'autres [Sarrazins] estoient couverts de gobis-sans ou hocquetons contrepointez d'oeillets, faits à la mode de leur pays. CL. F A U C H E T , Antiquitez, V, 19. — Quant aux hommes de cheval, ils... en-dossoient un gobisson : mot retenu par les villageois d'environ Langres. C'estoit un vestement long jusques sus les cuisses et contre-pointe. ID., Origines des chevaliers, L. II, 522 v°. Gobi es (lire globes [des yeux]). — Si la mer
Persienne estoit desemperlee, Vos dents y servi-royent de perles : et l'allée De vos gobles germains d'escarboucles de pris. B O Y S S I È R E S , Sec. Œuv., G4r°.
Goblet. Gobelet. — Gobelet ou Goblet. Profond, dore, petit. M. D E LA P O R T E , Epithetes, 193 v°. On dit aussi goubelet. — [Gargantua] se pignoit
d un goubelet. R A B E L A I S , 1,1.
Goubelet. Sorte de gâteau. — Icy gist Jean de la Fontaine, Qui en son temps a pris grand'peine A faire tartre et goubelets. T A B O U R O T D E S A C C O R D S , les Bigarrures, 1, 22.
Gobuee (terre). Terre à laquelle on a mis le feu. — Une boisselee et demie de terre gobuee par ledit Bouer, tenant au gobuys que laboure Julien Texereau. 1519. Ste Croix. Arch. Vienne (G.).
Gobuys. Terre pelée à laquelle on met le feu. Voir Gobuee (terre).
Gocourt. U n peu court. — Le premier à qui il s'adressa estoit vestu d'une robbe gocourte. R A BELAIS, V, 16 (édit. de 1562).
Gocterot. Sorte d'ornement, lambrequin ou frange. — 1501. U n ciel à doubles goucteros. Ung ciel de soye rouge à double gocterot garni de dos-siel. Le beuffet garni d'un ciel à simple gocterot avec ung dosciel en soye rouge. Invent. del'Hostel-Dieu de Beaune (Gay, Gloss. archéol).
Godaillier, v. Godallier. Godale. Sorte de bière. — Et ung petit de vin
plain d'eau Ou de cervoise ou de goudalle, Qui est un breuvaige ort et salle. E. D ' A M E R V A L , la Deablerie, 6 v°. — Et puis demain courra le bruit Qu'il fault boire de la godale. Ane Poés. franc., II, 319. — Faisons les tous, si vous m e voulez croire, Aller humer leur cervoise et godale. M A ROT, Ballades, 9. — Mais plusieurs, par mesme frerie, Souvent y beuveront goudall. Ane Poés. franc., XII, 185. — Voulez vous mesler du vin et de la goudalle ensemble. P A L S G R A V E , Esclare, p. 457. — Une couppe de goodalle a tout une testée est bonne et saine au matyn pour la veue dune personne. ID., ib., p. 760. — [Gargantua] beut cent tonneaux de godale et trente et demy de citre a cause quil ne avoit point de vin. Les Grandes Cronicques Gargantuines, p. 39, var. — J'en suis maistre, j'en sçay les tours, Soit à brasser bierre ou godalle. Ane Poés. franc., I, 76. — Ce mot qui est yci mis avec le vin signifie tout bruvage composé c o m m e on fait du poiray et de la bière, de la cervoise, de la godalle : tous ces bruvages qui sont ainsi faits là où il n'y a point abondance de vins. C A L V I N , Serm. sur l'Harmon. evangel, 3 (XLVI, 34). — Que chascun tavernier de goudaille tienne semblables justes mesures de lots et demy lots. 1568. Ordonn. sur la franche foire de Audruick (G.). — Non seulement eux : mais leurs pères Et pères grands, avec leurs mères Et mères grands et bizayeuls, De mémoire immémoriale Sont abreuvez d'une godale Qui leur oste le goust de mieux. BAÏF, Mimes, L. II (V, 102). — Leur défendant très expressément la cervoise... la tezanne, la godalle, la bière. Var. hist. et litt., IV, 53.
Godallier. Buveur de godale. — Mais les dronquars, godalliers ignorans, D u boys tortu n'ont point gousté le fruict. 1521. Chans. sur le siège de Mézières (G.). — Godailliers remplis de paresse N'enchériront jà les fagots. Ane Poés. franc., IV, 40.
Godart, v. Jument. Goddon. H o m m e sensuel, trop adonné au plai
sir, à la bonne chère. — Je retourne aux prélats : ausquels parlant Maillard dit... « O gros goddons, damnez infâmes, escrits au livre du diable, larrons et sacrilèges (comme dit S. Bernard), pensez-vous que les fondateurs de vos bénéfices vous les ayent donnez pour ne faire autre chose que paillarder et jouer au glic? » H. E S T I E N N E , Apol. pour Her., ch. 7 (I, 112). — On accusera le pauvre, mais on
— 330 GODE 1
se taira du gros goddon. Lequel mot j'ay bien voulu expresseement retenir, comme estant un très bon mot françois (combien qu'aujourd'huy il soit quasi du tout hors d'usage). ID., ib., ch. 9 (1,130). Gode 1. Brebis qui a cessé de porter. — J'ay
trois vaches, une chèvre, et une noire gode, lesquelles en tout temps m e font des caillotins. Trad de F O L E N G O , L. VII (1,170).
Gode 2 (?). Sentir sa gode. — Je vous estoys ceint sur la brode D'ung beau baudrier riche et plaisant, Tant soit peu ne sentoys m a gode. R. D E C O L L E R Y E , Monologue du Résolu.
Gode 3. H o m m e mou, efféminé. — C'a esté une lourde beste, laquelle neantmoins à tort Homère a tant louée, et ce lasche gode de Virgile, et toute la bande des poètes. Trad. de F O L E N G O , L. X X (II, 186). Gode 4. Bon. — A Dieu, la gode m'amye. 1591.
Lett. miss, de Henri IV, IV, 426 (G.). Gode chère. Bonne chère. — Lun... convioit
toute la bende au prochain dimenche à mesme banquet et pareilles cérémonies, ou estimoit leur faire gode chère. D u FAIL, Propos rustiques, ch. 4, p. 33. — Et l'attirans au bord [une baleine], se resjouissent et font gode-chere, et partissent, chacun ayant sa portion. A M B R . P A R É , Appendice au Livre des monstres, 1. — Il faut donques que la bourse luy soit bien fournie, pour recevoir des roys et princes au festin, et faire god-chère avec eux. P H . D E M A R N I X , Differ. de la Relig., Additions. — Faisant un jour le guet cependant que sa maistresse estoit en sa chambre avec son amy et faisoit gode chère. B R A N T Ô M E , des Dames, part. II (IX, 546).
Godeau. Outil de vigneron, façon de planter la vigne. — La crossette il enterre, ou le tendre scion, Maintenant en godeau et tantost en rayon, Houe la vigne en mars, la bine, tierce, émonde. D u B A R T A S , Sec. Semaine, Sec. Jour, l'Arche, p. 179. — En deux manières la plante-on communément [la vigne basse]... au fossé ouvert et à la taravelle, d'aucuns appellee la fiche, et, en Anjou, le godeau. O. D E S E R R E S , Théâtre d'agric, 111,4. Godemare, mot languedocien. Gros ventre. —
Il y a un godemard espagnol qui se fait porter à la procession dans une chaire percée. A U B I G N É , Faeneste, IV, 13.
(Jeu de mots sur l'antienne Gaude Maria.) — Le godemarre des cinq ordres des mendians. R A BELAIS, II, 7. — En temps de godemarre. ID., 11,12. On rattache au sens primitif l'emploi de gode-
mare comme mot produisant un effet de stupeur et arrêtant tout mouvement. — Ainsi... que chacun commençoit à manger, je fus tout esbahy que le maistre de la maison va dire tout haut, Gode-mar, et lors chacun cessa de manger, demeurans tous comme statues... Je dis en moy-mesmes, voyant que ce seul mot de godemar les avoit rendu immobiles... que godemar estoit un mot de magie et sorcelerie, lequel estant prononcé on se trouvoit si bien enchanté qu'on ne pouvoit manger ne boire. Nostre hoste m e voyant plus esbahy que les autres, qui sçavoient bien que vouloit dire godemar, me va dire que celuy qu'on avoit tant attendu venoit, et qu'à ceste cause, à fin qu'il trouvast à manger et de quoy souper, il avoit faict godemare. Ce dernier venu ayant prins place, sans que personne bougeast de la sienne, et le godemare estant levé, chacun se prend à ce qu'il aimoit, et à man
ger comme ils avoient fait à l'entrée de table GUIL L . B O U C H E T , 26e Seree (IV, 150-151).
Godemichi, mot libre. — Je me plains de sa main et de son godmicy, C'est un gros instrument par le bout étrecy, Dont chaste elle corrompt toute nuict sa jeunesse. R O N S A R D , Pièces retranchées, Sonnets (VI, 31). — Je m'en rapporte aux godemichi de velours et d'yvoire qui sont enfournez en la grottesque. CHOLIÈRES, 4e Matinée, p. 158. — O légère fortune ! Qui donne à l'un un œuf, et à l'autre une prune ; Qui fait que d'un vieil gant les dames de Paris Font des gaudemi-chés, à faute de maris. Var. hist. et litt., IV, 40 -V. Gode 4.
Godence. Faire un sacrifice à sainct Godence, Faire bonne chère. — Si j'avois à point un veau, mais qu'il fust de lait et gras, car il m'en faut faire un sacrifice, ceste mesme nuit je feroy la be-zongne... — Vous l'aurez à ce soir. — J'en feray le sacrifice ceste nuit. •— (Le valet, à part). A sainct Godence. J E A N D E LA TAILLE, le Negro-mant, I, 3.
Goderon. Moulure sur le bord d'une pièce d'orfèvrerie. — Ung grant bassin a laver mains, le fondz a un esmail au millieu, ou il y a des armes, six gauldrons sizellez de feulles a Pentour. 1514, Invent, de la duchesse de Valentinois (G., Compl,), — 1 5 3 2 . U n pot d'agate garny d'un pied d'argent doré et façonné de goderons tout droicts. Cm.pt, de la gr. command. de S1 Den. (G., Compl.), — 1596. Une cadre à Pentour enrichie de gauldheron doré et argenté. Inventaire, Arch. Doubs (6,, Compl.). — (Compar.). Et cuidant voir Venus, céleste fille, Née en la mer, et la ronde coquille De blanche nacre, avec ses goderons, Qui luy servit de barque et d'avirons. F O R C A D E L , ŒUV. poet., p. 62. — Les yeux [de l'étalon]gros, grands, noirs et clairs comme miroirs, emboutissans en hors, ainsi que goderons. O. D E SERRES, Théâtre d'agric, IV, 10. Pli rond d'un linge empesé. — Que le goderon
et les poignets de sa chemise fussent sales et du tout deslavez. 1581. La Cabinet du roy de France, p. 371 (G., Compl.).—C'est une baverette pour les empescher de mouiller leurs goderons lors qu'ils hument le brouet. CHOLIÈRES, 6e Ap.-disnée, p. 245. — Ses chemises à grands goldrons, L'ESTOILE, Mém., 1™ part., p. 60 (G, Compl.).-Quelle lascheté de courage est ce d'emprunter son estime d'un cheval, d'une plume, d'un goderon? S* F R A N Ç O I S D E S A L E S , Vie dévote, III, 4.
Goderonner. Orner de gros plis. — Je sçay marchander, achepter Toutes sortes de marchandises, Empeser collets et chemises Et les godron-ner bien et beau. Ane Poés. franc., I, 92. —JFig.). Elle vous a gentiment et gorgiasement pare et godronné ceste action de baptesme en galante dame de nopces, avec force nouveaux attours etam-quets. P H . D E M A R N I X , Differ. de la Relig., II, rv, 14. — Les chanoines avisez de ce faire, on vit chapitre monologifiquement troublé, et tellement estonné que, godronnant sa mine de toutes sortes d'opinions, ne sceut que respondre, sinon se proposer un jeusne d'un an. B E R O A L D E D E VERVILIE, te Moyen de parvenir, Enseignement (I, 98).
«Se gauderonner. Se parer de linge à gros pus. Voyez... C o m m e il se gauderonne, il se frise, use peint. D u B A R T A S , Judith, V, p. 399. - Pensez J, courtisans nouveaux, Tant damerets, tant damoiseaux : Dont celuy qui mieux se godronné, »e fraise et frise et pasfillonne, S'estime un biengrana cavalier. H. E S T I E N N E , Dial. du lang. franc. Ml-, 1,14.
— 331 GODINET
Goderonné. Bordé d'un goderon. — Couppes et autres vaisselles d'argent, bien burinées, bien gol-dronnees. SIBILET, Diale les fol. am. (G., Compl.). Orné de moulures. — Ruffet. Eslevé, reluysant,
poly... goderonné, yvoirin. M. D E L A P O R T E , Epithetes 59 r°. — Lict... nuptial, goderonné, plumera. 1D„ ib., 240 v°. Orné de gras plis. — J'ayme mieux voir sa col
lerette... Qu'une gorgère godronnée Avecques l'empoix arrestée Sur Pesearrure. T A B O U R O T D E S ACCORDS, tes Bigarrures, IV, 3. — Des plus belles etdesliees toilles, dont la Flandre... est la mieux fournie, pour se faire des rabats des mieux gode-ronnés. Var. hist. et litt., I, 165. Plissé, formant des plis. — Une grand masse
seiche au milieu suspendue, Lourde et pesante forme en rondeur estendue, De monts goderonnee et de plaines unie. M A U R I C E S C È V E , Microcosme, L. I, p. 5. — Le cèdre, le laurier richement façonnés Ornent de leurs rameaux ses plis goderonnés. Du BARTAS. 2e Semaine, 4e Jour, la Magnificence, p. 388. — Des poires se voient rondes, longues, goderonnees, pointues, mousses. O. D E SERRES, Théâtre d'agric., VI, 26. Portant du linge à goderons, à gros plis. —• Pour
me faire l'amour il ne faut qu'on se farde, Qu'au miroir paresseux la face on se regarde... Qu'on soit bien gaudronné. R O N S A R D , te Bocage royal, 2epart. (III, 341). — C o m m e n t entendez-vous ces mots, bien qualifiez? — J'enten gentilshommes bien godronnez, bien frisez, bien fraisez, bien passefillonnez. H. E S T I E N N E , Dial. du lang. franc. ital, I, 211. —• J'ay espérance de vous en faire voir aujourd'huy chez M. Philalethe : pareillement quelque gentilhomme bien godronné, bien fraisé... — De ces deux [mots]-ci, godronné et fraisé, l'un me fait souvenir de ce que les menu-siers souloyent dire un châlit godronné : quant à l'autre, il me remet en mémoire les fraises de veau. — Vous n'estes pas si loin de l'intelligence des mots dont j'ay usé que vous pensez. Car les colets de chemise sont godronnez et fraisez à l'imitation des deux chouses dont vous venez de parler. ID., ib., I, 215. — Si je n'ay le visage tant beau, beau, comme ces petits godronnez, qu'on ne sçait s'ils sont femmes ou hommes, ce m'est tout un. LARIVEY, la Vefve, I, 3. — Ceste beauté naïve... me plaist sans comparaison plus que ces grandes dames si attiffées, goderonnees, licées, frisées et pimpantes. T O U R N E B U , tes Contens, II, 2.—Lesdamerets aux moustaches turquesques... Fardez, frisez, comme femmes coiffez, E m m a n -chonnez, empesez, attifez, Goderonnez d'une fraise poupine. V A U Q U E L I N D E LA F R E S N A Y E , Sat. franc., L. III, A J. A. de Baïf. — 11 y a autres infinis jeux damoiselets de ceste sorte ; si vous les voulez plus naïfvement sçavoir, addressez-vous aux mieux goderonnees et attintées filles. TABOUROT D E S A C C O R D S , tes Bigarrures, I, 8. —
Ces fraisez, ces Medors, ces petits Adonis, Qui portent les rabats bien froncez, bien unis ; Ces fils gauderonnez, d'un patar la douzaine, Voyent presque tousjours leur espérance vaine Var. hist. e* lut., IV, 45. — (Fig.). Heliodorus, ce bon evesque de Tricea, ayma mieux perdre la dignité, le profit, la dévotion d'une prelature si vénérable que de perdre sa fille : fille qui dure encore bien gentille : mais à Padventure pourtant un peu trop curieusement et mollement goderonnee pour nlle ecclésiastique et sacerdotale. M O N T A I G N E , II, 8 (II, 97). — Ceste Calomnie est unedamoiselle... accoustree et habillée proprement, nette et bien goderonnee. V A U Q U E L I N D E L A F R E S N A Y E , De ne croire à la calomnie.
Godet. Verre, coupe. — Boire en tasse, — Boire en goudet, Tout nostre saoult, — A plaine panse. Ane Théâtre franc., II, 280. — Ung verre aussi et un godet. Ane Poés franc., X, 134. — Dieu sceit s'elles buvoient et s'elles levoient le goudet. P H . D E V I G N E U L L E S , tes Cent nouvelles nouvelles (Ch. H. Livingstone, Rev. duXVIe siècle, X, 195). — Chascun vouloit recueillir de ceste rosée et en boire à plein godet. R A B E L A I S , 11,2. — Enfans, beuvez à pleins guodetz. ID., III, Prologue. — Je suis prest... boire plain godet du fleuve Lethe. ID., V, 15. — 11 demanda à boire en ce godet riche où il faisoit ses grandz carroux. B R A N T Ô M E , Cap. estr., M. de Rure (I, 317). — (Fig.). Par long temps avoir en mont Parnase versé... et du fons cabalin beu à plein godet. R A BELAIS, V, Prologue.
(Proverbe). A un chacun son godet. Chacun son métier. — Nous ne sommes théologiens ; à un chascun son godet. C H O L I È R E S , 8e Ap.-disnée, p. 316.
Godier (?), —Godier portant quelque pièce de vache. Acte de 1527. Péronne (G.).
Godin. Gai, agréable, qui plaît. — Tenez-vous pour tous résolus Que Bon Temps vient le grand galot, Accoutré en godin fallot. Ane Poés. franc., IV, 149. — Ça, m a godine. Ane Théâtre franc., II, 342. — Mais, ô Amour, dy moy, sçauroit on voir, Mesmes au ciel, déesse si godine Et si parfaite en beautez que Claudine...? G U Y D E T O U R S , Souspirs amoureux, II, 56.
Godine. Courtisane? — Les ambubaies, les go-dines, Sour les vœus de ces bons chalans... Y font plats de popons, concombres. 1560. Cuisine papale, p. 67 (G.).
Godinement. Gaîment, avec joie. — Quand godinement je baise L'immortel passevelours De sa bouche. G U Y D E T O U R S , Mignardises amoureuses (II, 47).
Godinet. Gai, réjoui, agréable. — Elle gente, godinette. Chans. norm. du XVIe siècle (G.). — Et que je serai godinet, Je serai plus gay que satir. La Femme veuve (G.).
Joli, gracieux. — Veez m e cy, coincte et jolye, Gracieuse et godinette. Ane Théâtre franc., III, 42. — J'é le corps plaisant, godinet. Ane Poés. franc., VIII, 334. — Amoureuse ou Amante. Belle... gente, frisque, godinette. M. D E LA P O R T E , Epithetes, 21 r°. — Fay asseoir puis après la belle Morinet, Dont les yeux, le maintien et le ris godinet, La prudence et l'honneur et la bouche vermeille Animeraient un roc d'amour et de merveille. G U Y D E T O U R S , Paradis d'Amour (II, 24). — Entrons, godinette, rondelette, doucelette ; vien m a toute belle, colombelle, tourterelle. LARIV E Y , tes Tromperies, II, 1.
Godinette (subst.). — Entretenir ses gaudi-nettes. Ane Théâtre franc., Il, 274. — Or brief entre les godinettes, En ris et petites minettes, Elle a le bruyt jusques aux cieulx. R. D E C O L L E R Y E , Monsieur de Delà et Monsieur de Deçà. — Jeunes tendrons, gaillardes godinettes, Vous y viendrez. ID., Cry pour l'abbé de l'église d'Auxerre. — Je ne ris autant d'un an que Je feis l'autre hier du banquet, Des comptes, devises, caquet, Jeux, mots, ridz, chansons et sornettes De quatre jeunes godinettes. Ane Poés. franc., II, 285. — Dedans un caduc hermitage Arriva une godinette Qui desiroit d'estre nonnette. Ib., II, 292. — La godinette m e disoit d'une petite bouchette douce et amoureuse. L A R I V E Y , les Tromperies, 1, 3. — Si à la renverse on vous jette, N'en dites mot, m a godinette. ID., ib., III, 5.
G0DM1CY — 332 —
Godmicy, v. Godemichi.
Godon, nom injurieux donné aux Anglais. — De trente mille de ces godons gros veaux N'en retourna que six mille à Bourdeaulx. Ane Poés. franc., III, 50. — Par quoy je tiens mes ennemys les paillars godons d'Angleterre. Ib., Il, 79. — A criz et cors les godons corps à corps Tiendront leurs gordz, jà ilz y ont visé ; Tantost se perd royaulme divisé. C R É T I N , Invect. sur la journ. des Espérons, p. 173. — Je congnoys bien... Que ces godons, anciens ennemys, Et Allemans ont charge lance et picque Pour m e venir piller grange et boutique. Ane Poés. franc., XII, 249. — [Les fils du roi Jean] par grant guerre Hors France ont mis les godons d'Angleterre. J. B O U C H E T , Epistres familières du Traverseur, 33.
Godot. Verre, gobelet. — A tous les repas je te bailleray un godot de vin tout fin plein. N I C O L A S D E T R O Y E S , te Grand Parangon, 15.
Godranner, v. Gouderonner. Godronnement. Gros plis du linge. — Quand
vous viendrez à la cour, il se pourra faire que vous trouverez les godronnemens, fraisemens, passe-flllonnemens un peu d'autre façon. H. E S T I E N N E , Dial. du lang. franc, ital, 1, 216. —> Pour parler à bon escient tant des godronnemens et de leurs dépendances que des raquettes, ces chouses meri-teroyent plustost une censure platonique. ID., ib., 1,219. Godronner, v. Goderonner.
Goeulle (?). — A Boniface de Nayere, escri-gnier, pour avoir... livré trois culs de lampe, une goeulle et six nœuds, estant le tout mis au barreau de fer servant de sommier au conclave. Compte de 1596. Lille (G.).
Goffe 1 (?). — Pour le palestrage, goffe, sar-rure et clou. 1544. Compt. des cordel. d'Orl. (G.). Goffe 2. Lourd, grossier, sot. — D u quel vo
cable goffe, pour chose lourde et mal seyante, ilz [les Romains] usent encores aujourdhuy. G. T O RY, Champ fleury, Lettres adjouxtees, 73 r°. — [Lu-cilius] Poète rude et goffe, A u reste prompt aux vers, et gentil philosophe. F R . H A B E R T , trad. d'HoRACE, Satyres, I, 4, Paraphrase. —- M o y ce nonobstant Alexandre... qui pour la grandeur de mes faits emportay le surnom de Grand, suis réputé lourd et goffe, pour m'estre dit fils de Jupiter. E. P A S Q U I E R , Pour-parler d'Alexandre (I, 1059). — C'est (disent-ils) une façon de parler goffe, que quelcun employé des prières à l'endret de son ami intime. H. E S T I E N N E , Dial. du lang. franc, ital, 1,40. — Ainsi est belle la comédie, si... la fable est... tissue d e graves et plaisans discours, plains de sentences, comparaisons, m e afores, railleries... non d'inepties qui, comme choses goffes et peu honnestes, font rire les ignorans. L A R I V E Y , la Vefve, Prologue. —• Ils faisoient mile jeux... et chantoient une infinité de vers, toutefois goffes et mal faits : lesquels ils apeloient comédie. V A U Q U E L I N D E L A F R E S N A Y E , Sat. franc., Discours. — La loy soubs qui Pestât sa force a prise, Garde la bien, pour goffe qu'elle soit. Pi-B R A C , Quatrains, 89. — La diversité des opinions est si grande que les hommes qu'on pense de meilleur jugement... aucunefois... se moquent de ce qui est docte et bien faict, et donnent louange à ce qui est grossier et gauffe. G U I L L . B O U C H E T , Disc. sur les Serees (I, xn). — Je n'emploie que ce que les Ténèbres de Mariage ont peu vous en apprendre ; vous les avez leu avec m o y : il y a du lourd et du gauffe, si peut on en tirer quelque
chose à propos pour ce que je vous propose. CHO-LIÊRES, 2 e Ap.-disnée, p. 105. — Je pense avoir leu autant qu'homme de mon temps, mais onques livre ne tomba entre mes mains si goffe et ridicule que cet inepte cartel. ID., 8e Ap.-disnée p. 355. — Ovide... dit qu'estant banny en laScy-thie, pour tromper son malheur, avoit appris de faire des vers à la romaine en ce langage goffe et barbare. E. P A S Q U I E R , Recherches, VII, 11.—A la suite desquels le temps produisit une infinité de docteurs qui descouvrirent leurs conceptions en un latin goffe et grossier. ID., ib., VIII, 14.-Encores que vous y trouviez du sçavoir, toutes-fois en l'estallement d'iceluy, le débit se faisoit en une langue latine goffe. ID., ib., IX, 29. — Je passerais légèrement ceste sorte de philosophes, desquels l'opinion gauffe et pleine d'erreur auroit esté rejettee pieça de toutes les escholes et académies. L E L O Y E R , Hist. des Spectres, I, 6. — Et si ne veux pas dire Qu'à l'heure qu'ils oyoient quelque bon mot pour rire En leurs chants, chanterais, sons, servantois, tançons, Pastorelles, de-ports, soûlas, sonnets, chansons... Goffes, tout leur plaisoit. V A U Q U E L I N D E L A FRESNAYE, An poet.. II, p. 73. — Tous... te prient de venir au tournoy, lequel sans toy ne sçauroit rien valoir, et sera une chose tenue à l'advenir pour goffe et sang aucune grâce si tu n'y compare. Trad. de FOL E N G O , L. I (I, 15). — Pour lors nos dames franco yses estoyent goffes en leurs habitz, ny si gentiment comm'aujourdhuy. B R A N T Ô M E , Cap. franc., le Roy Charles VIII (II, 291, var.). Lettres goffes. — Puis... viennent... les lettres
goffes et lourdes, que Sigismunde Fante appelle lettres imperialles et bullatiques, mais je les appelle goffes et lourdes, pource quelles demorerent en R o m m e du temps que les Goths la subver-tirent et mirent en cendre. G. TORY, Champ fleury, Lettres adjouxtees, 73 r°. — En après sont les [lettres] caldaiques. Les goffes, quon dit autrement impériales et bullatiques. ID., ib., v°du titre. Goffement. Lourdement, grossièrement, sottement. — Quand nous parlons d'un ouvrage faict à l'antique... nous le disons par mespris... c o m m e si nous disions faict lourdement, et, comme disent aujourd'huy les nouveaux parleurs de françois, goffement. H. E S T I E N N E , Apol pour Her., ch. 3 (I, 59). — Il acheta une fois un diamant faux fort goffement fait. Quoy voyant un sien amy, luy dit : Vous n'avez guères à faire de porter cette biffe. T A B O U R O T D E S AC C O R D S , Apoph-thegmes du sieur Gaulard. — Il me deplait grandement qu'il m e faille mettre en cette biblioteque plusieurs auteurs dont les uns ont escrit si goffement... autres heretiquement. D u VERDIER, Bi-blioth. (G.). — Les Espagnols trouvèrent un temple où estoit une idole fabriquée assez gauffe-ment et grossièrement. L E L O Y E R , Hist. des Spectres, IV, 12. — Les paysans de la Grèce en usoient assez gauffement et rustiquement es assemblées qu'ils faisoient pour boire d'autant à la grecque et yvroigner es cabarets. ID., ib., VIII, 3. Gofferie. Lourdeur, grossièreté, sottise. — Ce langage italianizé luy semblet fort strane, voire avoir de la gofferie et balorderie. H. ESTIENNE, Dial. du lang. franc, ital, Philausone aux lecteurs, —• Si vos oreilles... estoyent accommodées à la leggiadresse courtisanesque, en lieu qu'elles sont accommodées à la gofferie et balorderie pedan-tesque, ceste pronontiation de Francés vous seni; bleret avoir beaucoup plus de garbe que celle qui dit François. ID., ib., II, 260. — C e n'est pas mer-
veille que la cour en gros soit subjette aux mauvaises prononciations, outre la gaufferie des particuliers, à cause des nouveaux courtisans bara-goins qui surviennent chaqu'un jour. Les Advis delà demoiselle D E G O U R N A Y , L. I, p. 443 (G.). Goffrer. Engouffrer. — Celuy, après long
prier, se tret vite L'armet du chief, è manifeste fit Q'Arîodant, pleuré par tote Escosse, N'étoet gof-fré an l'aqaticque fosse. T A I L L E M O N T , Genièvre, p. 145. Gogaille. Réjouissance. — On rit à fente de
naseau, On bat des mains, on gausse, on raille, Boutique ouverte de gogaille. Les Fanfares des Roule Bontemps, p. 122. Gogant. Se réjouissant. — A son Perrin le vins
dire, Qui gogant se print à rire. V A U Q U E L I N D E LA FRESNAYE, Foresteries, I, 12.
Gogayer (se), v. Gogoyer (se).
Gogette. Fillette? —• Pour Dieu, ne le vueillez point croire, M a doulcinette, m a mignonne, M a gogette, ma toute bonne. Ane Théâtre franc., II, 199. Gogo. Aise, réjouissance. — Aussi tost qu'elle
est accordée, Le cueur luy dit : Gogo se pert. Ane Poés. franc., III, 171. A gogo, à plein guoguo. A l'aise. — Trouvant
Malheur, à gogo, je l'empongne Tout marmiteux avec sa laide trongne. J E A N D E LA TAILLE, Combat de Fortune et de Pauvreté. —• La chosette... faicte... à plein guogo. R A B E L A I S , 111, 18. Gogoyer (se). Faire bonne chère, s'ébattre,
prendre du plaisir. — Chascun si se gogoye la veille Saint-Martin ; Il n'est grand ne petit qui ne boyve du vin. Ane Poés. franc., VI, 194. — Ils veulent tousjours avoir quelque relasche. Ils sont comme un mauvais payeur, quand on lui viendra demander la dette : il sait bien qu'il faut qu'il paye, et mesmes qu'il le peut bien faire, mais il est bien aise de se gogueyer avec son argent un jour ou deux. CALVIN, Serm. sur le liv. de Job, 114 (XXXIV, 665). — Ce bon frère ayant apperceu deux beaux pourceaux se goguayans sur un fumier. H. ESTIENNE, Apol. pour Her., ch. 39 (II, 399). — Moy qui n'ay bougé d'estre couché en ceste place, prenant du bon temps et m e go-goyant à plaisir. L A R I V E Y , trad. des Facétieuses Nuits de STRAPAROLE, X, 2. Bien venir, prospérer. — Elle vient mieux
d'estre souvent arrousee, et se gogaye à l'eau quand le temps se porte un peu sec. L I E B A U L T , Mass. rust, p. 262 (G.). — Le prunier de Damas se refait et gogaye mieux en contrée seiche et d'air chaud qu'il ne fait ailleurs. ID., ib., p. 471 (G.). Goguayer (se), v. Gogoyer (se). Gogue 1. Gaîté, bonne humeur. Estre en ses
gogues. Être en verve, en humeur de rire, de plaisanter, de parler. — Le roy, qui estoit en ses gogues, fit appeller Tindaro, et luy commanda qu'il tirast sa cornemuse, au son de laquelle il fit dancer plusieurs dances. L E M A Ç O N , trad. de BOCCACE, Decameron, VI, 10. — Or fault-il bien noter d'avantage en cest idyllie de Theocrite [tes Syracusaines], asçavoir que les propos que tiennent les deux femmes qui y sont introduictes ont beaucoup de l'air (s'il est loisible d'ainsi parler) des propos qu'on oit tenir à nos bonnes galloises, et principalement à celles de Paris, quand elles sont en leurs gogues et qu'elles mettent leurs maris sur le bureau. H. E S T I E N N E , Conformité, II, 2. — Janne parle tousjours seulette, Redit
GOGUIER
tout et ne celle rien, Vrayment elle en contera bien, Janne est maintenant en ses gogues. R. BELLEAU, la Reconnue, 1,1. — Vous estes en vos gogues, monsieur Philausone. — Pour vous parler à bon escient, je n'ay aucune souvenance d'autre distinction entre le grand et le petit ordre. H. E S T I E N N E , Dial. du lang. franc, ital, I, 360. Godefroy voit le m ê m e mot dans l'emploi sui
vant : sorte de hachis, de farce. —• Par la guogue cenomanique, dist Epistemon. R A B E L A I S , IV, 65. —• Elle sçavoit fort dextrement composer des gogues, des tourtes, des tartes, des crespes, de la bouillie. Trad. de F O L E N G O , L. VI (1,162).
Gogue 3, v. Guogue. Gogue 3. Purgatif. — Je desadvoue le diable,
si tout ce qui dedans feut empacqueté ne feut sus l'instant empoisonné, pourry et guasté : encens..., généralement tout, drogues, guogues et senogues. R A B E L A I S , IV, 52. — Confections, pouldres, breuvages, drogues, gogues et sené-gogues. P H . D E M A R N I X , Differ. de la Relig., I. m , 1. —• Pour tirer quintessences de toute espèce de drogues, gogues et senegogues. ID., ib., I, m , 4.
Goguelu. Joyeux, plaisant, gaillard. — Bouffon. Plaisant, flateur... baguenaudeur, guoguelu. M. D E LA P O R T E , Epithetes, 54 v°. — (Subst.). Sathan, mon gentil trupelu, Mon fafelu, mon goguelu, Mon mignon, mon grant dorelot. E. D ' A M E R V A L , Liv. de la deablerie, 40 d (G,). — Grippe-minaud faisant semblant n'entendre ce propos s'adresse à Panurge, disant : Orça, orça, orça, et toy, guoguelu, n'y veux tu rien dire? R A BELAIS, V, 13. — Car la bossue et la belle barbière A u goguelu firent passer carrière. Var. hist. et litt., VIII, 87.
(Adj.). Orgueilleux, présomptueux. — Vanteur. Glorieux, thrasonien, goguelu. M. D E LA P O R T E , Epithetes, 413 v°. — (Subst.). Toutesfois aucuns goguelus Qui voyent leurs vignes florir, S'i fient et sont résolus Plus que gensdarmes dissolus. J. Bo u-CHET, les Regnars travers, les voyes perill, 45 b (G.). — [Les fouaciers] les oultragerent grandement, les appellans... gaubregeux,goguelus, cla-quedens. R A B E L A I S , 1, 25.
Goguenarder (se). Se moquer. — Ils se go-guenardent de nous. J. D. F. S., Prop. d'Epic-TETE, 277 (G., Compl.).
Goguenardie. Goguenarderie. —• Sur telles goguenardies, le serpent s'en va. Trad. de F O L E N G O , L. X X I (II, 209).
Goguenette. Propos joyeux. —• En lisant ses chansonnettes, Que j'empli de goguenettes. J. G O D A R D , tes Goguettes (G.).
Gogueter. Se réjouir. —• Par ce moyen le re-gnard fin et cault Eschappa lors saultant et go-guetant Dessus le bord de ce puis. H A U D E N T , Apologues d'EsoPE, I, 1. — Une grand trouppe féminine L'autr'yer je vey, faisant la mine, En sousriant et goguetant. Ane Poés. franc., VI, 179.
Goguette. Propos joyeux. — J'attendrai le silence, qui sera l'heure où ils seront bien enten-tifs à ce que dira le pascient, et n'y a point dangé de leur conter goguettes. A U B I G N É , Faeneste, 1, 12. — Le courdelier à qui ye m e confessai abant aller au comvat m e dit gouguettes de ce paillard, et m e le despeignit comme le fraudeur des ruses que bous boiez en Amadis. ID., ib., II, 16.
Gogueyer (se), v. Gogoyer (se). Goguier. Sorte de noyer. — Une fustaye De
rares gruotiers, bigarreaux, merisiers, Dattiers, perdrigonniers, goguiers et cerisiers. CL. G A U -
13 —
GOHÉE — 334 "
CHET, te Plaisir des champs, le Printemps, Beau-jour, p. 16.
Gohée. Joie, plaisir, mine joyeuse. — Monsieur le porcher, voyant sa truye, fut le plus aise du monde. Hé ! Dieu sait la gohée qu'elle lui fit. P H . D'ALCRIPE, la Nouvelle Fabrique, p. 63. — L'hyver venu, sous la meule est pilee L'huyle d'olif, en joyeuse gohee. 1608. L E B L A N C , Georgiques, 70 v° (G.). Gohiere. Sorte de tarte. — Chars de prinsel
par trences. Bourlettes de veau. Josnes canart rosty. Châtrons. Tartes de grousielles. Gohieres. Mém. d'un souper de noces. 1587. Lille (G., Goiere). — Maintenant dirons quelque mot de la dextérité de faire gasteaux, flamiches, tourteaux, tartes, gohieres et autres pastisseries. L I E B A U L T , Mais, rust., V, 22 (G.).
Goildronner, v. Gouderonner. Goildronneur. Celui qui enduit de goudron.
— 11 fut rataconneur tyrofageux et goildronneur de mommye. R A B E L A I S , II, 13. — Jules César et Pompée estoient guoildronneurs de navires. ID., II, 30. Goin. Gond. —• Et entrèrent tant à la foulle
qu'ilz mirent la porte presque hors des goins. M O N L U C , Commentaires, L. II (I, 289). Goiran. Bondrée, sorte d'oiseau de proie. — Il
n'y a petit berger en la Limagne d'Auvergne qui ne sçache cognoistre le goiran et le prendre par engins... le plus souvent au lasset. B E L O N , Nat. des oys. (G.). Goissement. Aboiement. — Imitant le goisse-
ment du chien. AB. MATTHIEU, Devis de la lang. fr., II,9ro(G). Goitereux. Goitreux. — Chantre... goitereux,
i qui a grosse gorge. M. D E LA PORTE, Epithetes, 73 v°. Goitrou. Goitreux? — Il avoit un gay en
délices... et le nommoit son goitrou. RABELAIS, IV, Ancien Prologue. Goitre? — La guorge, comme une chausse
d'hippocras. Le nou, comme un baril : auquel pendoient deux guoytrouz de bronze bien beaulx et harmonieux, en forme d'une horologe de sable. RABELAIS, IV, 31. Goittre (fém.). — Il se faut conserver aussi Du
ris du tiran endurcy... De la goittre savoisienne, De la crotte parisienne. Var. hist. et litt., III, 197. Goldran. — La haute pommelle est faite de
bois d'ebene, où sont marquées douze espaces contrefaites en petits goldrans, lesquels par le subtil mouvement d'une calamité ou eguille aimantée enseignent les quatre divisions de la terre. R. BELLEAU, la Bergerie, 1" journ_ (T, 305). Goldronné, v. Goderonner.
Golette 1. Goulet. — Le port de laquelle [cité] est en la golette de ce fleuve. LÉON, Descr de l'Afr., I, 371 (G., Compl.). Golette 2. Cotte de mailles. — La façon du temps présent est d'armer l'homme de pied d'un hallecret complet ou d'une chemise ou golette de maille et de câbasset. GUILL. D U BELLAY, Discipl
milit., L. I, 20 v° (Gay, Gloss. archéol). Golfarin. Goulu, glouton. — Golfarins, goulus
et voraces. P L A T I N E , De honneste volupté, 81 r° (G.). — Gueux de Lubie, cagnardiers, gonfarins. Ane Poés. franc., V, 149. — Ceux qui pourraient eschaper y demeurent et meurent, mais non pas
des Italiens, car ilne s'en trouve point de pauvres sinon que de François qui ont esté appauvris par le pillage fait par telz goulfarins. Var. hist. et lut VII, 269. — Engorgevin, par la clémence bacchique roy des francs pions... commandent des escervelez, grand goulpharin de Grève. Ib IV 48. "' '
Golfer. Engouffrer? — O monde téméraire et pervers, de cultiver et mettre en avant ce qui sert à golfer les vents, les orages et les tourbillons : comme si le flot de l'eau n'estoit assez bastant pour charrier ce superbe animal ! Du PINET, trad de P L I N E , X I X , Préf. (G.).
Goliathique. Semblable à Goliath. —- Cest Espagnol... luy manda qu'il estoit trop jeune pour s'attaquer à luy, qui estoit un vieil routier, affre et espouvante goliathique. CHOLIÈRES,
6e Ap.-disnée, p. 246. Gollole (?). — Faire quatre golloles en la tour
d'orloige. Compt. de 1507. Avallon (G.). Golphe (H. D. T. 1606). —1561. [La postérité
de Cham]... saisit toute la contrée... et ne cessa, jusques à tant qu'elle eust attaint, suyvant son cours de golphe et rivage marin, les extremitezde l'Océan. J. D E M A U M O N T , trad. de ZONARE, 37 C (Vaganay, Pour l'hist. du franc, moderne). Gomene, v. Gumene. G o m m e (masc). —• L'ambre est un gomme dis
tillant des rochers. M. D E LA PORTE, Epithetes, 18 v°. — Gomme... roux, luysant... larmeux... Ce mot est masculin et féminin. ID., ib., 194 r». Gommeleux. Gommeux. — Myrrhe. Indienne,
odorante, arabienne, gommeleuse. M. DE LA PORTE, Epithetes, 276 v°, Gommene, v. Gumene. Gommere. Fard. — La troisième, avec des cau
tères appliqués es lieux qu'on sait, et avec gom-meres ou fards, et autres qui décorent et consolident la face et les autres membres. JOUBERT, Gr. chir., p. 435 (G.). Gommeux. Résineux. — Francus, qui tient une
torche fumeuse, Boute le feu : la flameche gom-meuse D'un pied tortu rampant à petit saut, En se suivant s'en-vole jusqu'au haut. RONSARD, Franciade, III (III, 100). — [Francus] De fort genevre allume un petit feu Qui devint grand, prenant sa nourriture Des pins gommeux qui sont secs de nature. ID., ib., IV (III, 139). Qui brûle ardemment. — (Fig.). L'ardante dis
corde, Qui les a rembrasez d'un tison plus gommeux. N U Y S E M E N T , ŒUV. poet., 17 v0. —Quel feu tousjours bruslant et quel tison gommeux, Quelle fournaise (ô dieux !) dedans les os cachée, Brasil-loit sang et sens de la pauvre attachée, Ainsi qu'un Promethé sur le roc mal-heureux? ID., ib., 38 r°. Gommosité. Ce qui est gommeux. — Et est
celuy [balsame] a eslire, auquel il appert aucune gommosité dedans ou glueusité quand on le froisse ou casse. Le Grant herbier, 16 r° (G.). — Et flue de luy [l'euphorbe] moult de gommosité, Jard. de santé, I, 179 (G.). Gomorriser. User de pratiques contre nature.
— Qui voudrait y gomorriser à la romanesque, ou exercer la communion catholique clémentine des femmes. P H . D E M A R N I X , Differ. de la Relig., U, v, 6.
Gomphanon, v. Gonfalon. Gond. Se tenir sur ses gonds. Se conduire rai-
sonnablement. — Pour vaincre Goliath, il fau-droit un Nembrot... Tien toy donc sur tes gonds : et n'attire léger Sur toy l'effort mortel d'un si certain danger. Du B A R T A S , 2e Semaine, 4e Jour, les Trophées, p. 353. Hors des gonds. En dehors. — Ceux-là furent
desnaturez, ingratz, et hors des gondz de toute humanité. B R A N T Ô M E , Cap. franc., le Roy Char-Us IX (V, 262). Déraisonnablement, faussement. — Maistre
Gentian... a un petit parlé hors des gonds, quand il a dit que nous prions seulement les saincts qu'ils prient pour nous. P H . D E M A R N I X , Differ. de la Relig., II, m , 5. Jeter hors des gonds. Tromper. — La dame, qui
n'estoit point logicienne, et à qui il falloit peu de chose pour la jetter hors des gonds, creut ou fit semblant de croire que le beaupere disoit vérité. LE M A Ç O N , trad. de B O C C A C E , Decameron, VII, 3. Gondelle. Gondole. — Avec des limes ayant
destaché des sentines et gondelles qui estoient dedens les fossez, enchaisnees au pied de la muraille. FR. D E R A B U T I N , Comment., 1 (G., Compl.). Gondole. Barque. — N'avons point veu quatre
âmes Qui, traistresses, rompant les statuts de la Mort, Dans m a gondole mesme ont traversé mon port...? P. D E B R A C H , Poèmes et Mesl., L. IV, Cartel pour Choron. Sorte de coupe. — Ils s'entrefirent de très-
grands présents de chevaux, de nacelles d'or et d'argent : qui semblent avoir esté des vaisseaux à boire comme ceux qu'aujourd'huy l'on appelle gondolles, pource qu'elles sont faites ainsi que ces petits batteaux passagers dont l'on use à Venise pour tragueter les canaux de ceste ville. F A U C H E T , Origines des chevaliers, 1,1. —• 1602. Une gon-dolle de jaspre vert, avec le pied de mesme, garny d'or et esmaillée de blanc et de rouge, pes. 7 0. %. Inv. du duc de Biron, fol. 33 (Gay, Gloss. archéol). Gondre. Sorte de vaisseau. — Grand nombre
d'esquiphes, gondrez et almadis, equippees de mattelotz. Entrée de Henri II à Rouen, 45 v° (G.). Goney. Sorte de vêtement. — Des goneys de
drap vert. xvie s. Invent, de Montbéliard (G., Gonet). Gonfalon. Bannière, enseigne. —• Alors jectent
au vent enseignes, gouffanons. J. M A R O T , Voy. de Venise, 83 v» (G, Compl.). — Les croix et les con-fanons devant. L E M A I R E D E B E L G E S , Pompe funéralle de Phelipes de Castille (IV, 248). — Bombardes et canons, Meubles de guerre, enseignes, confanons. ID., Epistre du Roy à Hector de Troye (III, 80). — Portans croix, banieres, confalons, baldachins. RABELAIS, IV, 48. — [Dans le temple de Vénus]. Les confanons, de couleur assortie, Sont les atours d'accoustremens gorriers... Lesquelz on porte aux festes voulentiers. ID., la Concorde des deux langages, 1 " part. (III, 108). — Hz se paissent enfans de trompes et canons, De fifres, de tabours, d'enseignes, gomphanons. D u B E L -U Y , les Regrets, 114. — On ne void que soldats, enseignes, gomphanons. ID., ib., 116. — Et quand, environné de tant de gonffanons, Fit braquer tout d'un rang cent pièces de canons. R O N -ruRo' Poemes' L- I. Harangue du duc de Guise (V, 22). — (Fig.). Car libéral tu es et charitable, sortant d'honneur l'enseigne et gonffanon. J. M A -ROT, Rondeaux, 47 (G, Compl.). — En chasteté elle excède Lucresse : De vif esprit, de constance et sagesse, C'en est l'enseigne et le droict gonf-ianon. CL. M A R O T , Rondeaux, 23. Gonfanonnier. Porteur d'enseigne, de ban-
GON1N (MAISTRE)
nière. — Vous y voirez... un demy géant... con-falonmer des Ichthyophages. RABELAIS, IV, 29. — Confalonnier. Porte enseigne. ID., Briefve Déclaration (III, 202). — Charles le Simple... arrivé au douziesme an de son aage, Hervé, arche-vesque de Rheims... sacre et couronne ce jeune prince, et tout d'une main se faict confanonnier de ses armes. E. P A S Q U I E R , Recherches, II, 10.
Chef. — U n escardeur d e laine... fut créé confalonnier et prince de la cité [Florence]. L. L E R O Y , trad. des Politiques ^'ARISTOTE, V, 5 (Commentaire). — Nous avions... fait décapiter Gabaston, chevalier du guet, pour s'estre rendu leur protecteur [des huguenots], et pendre les Cagers père et fils, confanonniers de leurs entreprises. E. P A S QUIER, Recherches, III, 45. — Ils sontd'advis, et signamment Bartole, confanonnier de tous les autres, que ceste loy a lieu non seulement pour l'immeuble, ains pour le meuble. ID., Lettres, XIX, 15.
(Fém.). Gonfannoniere. — (Fig.). La blanche Vérité, comme gonfannoniere, Deux Testamens ouvers porte pour estendars. Du BARTAS, te Triomphe de la Foy, I. Gonfle. Gonflé. — Ou faut percer la pierre...
et te la prendre au col, Nourrice, et tu verras ton tetin flacque et mol Soudain gonfle de laict, et sentiras estendre La peau qui fletrissoit et com-mençoit à pendre. R. B E L L E A U , tes Amours des Pierres précieuses, la Pierre laicteuse (II, 258). — Desja sur le figuier la figue s'engrossist, Pleine et gonfledelaict. lu., Eglogues sacrées, 2(1,305). — Tu verras ton troupeau gras et gonfle de lait. ID., ib.
Gonfler (H. D. T. Ambr. Paré). — 1559. La grappe de raisin fresche trouble le corps et gonfle l'estomac. M. M A T H É E , trad. de DIOSCORIDE, 444 a (Vaganay, Pour l'hist. du franc, moderne).
Gonin (maistre). Célèbre faiseur de tours, dont le nom est souvent généralisé et souvent aussi employé pour exprimer l'idée d'une très grande adresse. — Jamais le bon maistre Gonin N e fut plus expert en science. Ane Poés. franc., 1, 86. — Vertu bien ! qu'est cecy? quel Proteus ou maistre Gonin tu es ! Comment I tu as tantost eu changé de visage. D E S P É R I E R S , Cymbalum, II (I, 335). — Ay-je pas joué un tour de maistre Gonyn? LARIV E Y , te Laquais, IV, 1. — Quand nous allons en leur païs et qu'ils aperçoyvent ces grandes fraises verdugales des femmes et les longs cheveux des hommes, et leurs espées qu'ils portent derrière le dos, ils courent après comme les petis enfans de Paris font après maistre Gonin. L A N O U E , Disc polit, et milit., VIII, p. 196. — Le diable... retourne, et, après mille tours de passe-passe de maistre Gonnin pour espouvanter le convers, il se change en tonneau. L E L O Y E R , Hist. des Spectres, IV, 13. — Les rabbins tiennent que du nom de megonan on peut encore appeler ceux qui charment et fascinent les yeux des regardans et les ensorcelent par la veue, leur faisant voir une chose pour autre, qu'en France on n o m m e maistres Gonnins. ID., VII, 2. — (Fernand de Gon-zague). C'estoit un h o m m e qui entendoit bien les tours de passe-passe, non de maistre Gonin, mais de Machiavel. B R A N T Ô M E , Cap. franc., le Mareschal de Brissac (IV, 66). — Pour asseurer si c'est ou laine, ou soye, ou lin, Il faut en devinaille estre maistre Gonin. R É G N I E R , Sat. 10. La bourse de maistre Gonin. La bourse d'un es
camoteur. — Il ne fait que crier tacitement, Vanité des vanitez, et tout plein de vanité, comme la bourse de maistre Gonin. Les Fanfares des Roule Bontemps, p. 57.
35
GONNE 1 — 336 —
Gonne i. Sorte de cotte descendant jusqu'au mollet. — Gonne et gonnelle, comme encores en Italie, signifioit lors cotte et saye. F A U C H E T , Antiquitez, XII, 17. — La gonne, gonnelle ou cotte longue jusques au gras des jambes, de soye (volontiers) et sans manches. ID., Origines des chevaliers^. II,524r°.
Gonne 2. Sorte de baril. — Le seigneur doit avoir le gonne de cervoise pour troys deniers d'obole d'acquist, et la somme de poisson pour douze deniers d'acquist. 1507. Prév. de Vimeu (G., Compl.). Gonnelle. Sorte de cotte. — Colletz, pour-
poincts, cottes, gonnelles, verdugualles. R A B E L A I S , IV, 52. —- En hiver elles [les femmes de Fez] se vestent de certaines gonnelles à manches larges et cousues par devant à la mode des hommes. L É O A F R I C A N U S , édit. Temporal, 1.1, p. 380 (Gay, Gloss. archéol). — Le jour du combat il avoit sur ses armes une cotte d'armes de drap gris, qu'on appelloit lors gonnelle, qui est un vieil mot françois comme encore on en use aujourd'huy en plusieurs endroits de ce royaume. D u H A I L L A N , Hist. d'Anjou, 1 r° (G.). — Geoffroy Grise-gon-nelle (c'est à dire cotte grise) tua Ethelusse. F A U CHET, Antiquitez, XII, 17. Soutane. — Le prestre... estant party en gon
nelle (comme s'il venoit de servir à une nopce) s'en retourna à l'église. L E M A Ç O N , trad. de B O C CACE, Decameron, V11I, 2.
Jupe. — Si vous m e prestez trente douzains... j'en retireray de l'usurier m a gonnelle de pers et mon devanteau des festes. ID., ib. Gonnin, v. Gonin.
Gonnion (?). — Les gonnyons d'un mollin a Wedde. 1514. Lille (G.). — Pour avoir livré les gonnions. Ib. Gonorute. Celui qui a la gonorrhée. — Les go-norutes, c'est assavoir les fluens en semence. B O U R G O I N G , Bat. jud., VI, 18 (G.).
Gontier, v. Franc gontier. Gonver (?). — Ce seigneur sera nostre hos-tage ; Puis qu'il nous a ainsi promis, Le gonver luy en est remis Par le voloir impérial. 1565. Hist. de S^ Martin (G.). Gonyn, Goodalle, Gope, v. Gonin, Godale, Gaupe.
Gorbaut. Fossé. — Donner ordre a tenir les rues nectes et donner conduite aux gorbaulx pour évacuer les eaux et immundicitez. 15 févr. 1518. Arch. mun. Agen (G.).
Tantost des plus haultes tours Lancer te vouldras aux gours. ID., ib., 11.
Gord 2. Piège. — Tu rompts accords... Sans sonner cors Fais tendre gortz En ta ratière. CRE-TIN, Apparit. de Jaq. de Chabannes. — A criz et cors les godons corps à corps Tiendront leurs gordz, jà ilz y ont visé. ID., Invect. sur h journ, des Espérons. Dans une rivière, lieu disposé pour attirer et
prendre le poisson (G.). — Ledict poisson... S'en est venu par un grand desespoir Si rudement frapper dedens un gort Que tost après en a receu la mort. H A U D E N T , Apologues d'EsoPE, I, 25,
Goreau. Joug. — Pourras tu lier l'elephanta ton goreau pour ahener? L E F E V R E D'EST., Bible, Job, 39 (G., Goherel). — Joue ou gourreau. Trad! de Q U I N T E C U R C E , II, 3, 1534 (G). — (Fig.). De
moy et de vous osteray le dur gorreau de l'importable servitude ou vous estes. FOSSETIER, Cron. Marg., II, 93 v° (G.). — Et dirent que aulcunes cités avoient esté ennemiement attentées, et que sans doubte, se remède n'y estoit mys, toute la région de Thrace violentée prenderoit le gorreau des Macédoniens. ID., ib., VIII, m , 7 (G.). —Occupation grande est crée a tous hommes; et ung grief goreau sus les filz de Adam. L E FEVRE D'EST., Bible, Ecclesiast., 40.
Goret (rime). — Il est une autre fort basse rythme que l'en appelle rithme de goret ou de boutechouque, qui garde mesure en syllabes, mais en la rithme a pou ou point de convenience, P. F A B R I , l'Art de Rhétorique, L. II, p. 27. — Je, rime goret, La rime des rimes, Si je suis appert, Vous le veez par signes. Ane Poés. franc., III, 118. — L'ung rime en goret. Contred. de Songe-creux, 27 r° (G.). — Ce que les resveurs du temps passé ont appelle la ryme goret, et j'appelle ryme de village, ne mérite d'estre nombrée entre les espèces de ryme, non plus qu'elle est usurpée entre gens d'esprit. SEBILLET, Art poet., 1,7. Gorgaillet. Courcaillet. — Le ventre se came
lote et ride de telle sorte qu'on y pourrait jouer à primus secundus, ou bien servirait à en faire un gorgaillet pour appeller les cailles. GUILL. BOUC H E T , 23e Seree (IV, 2).
Gorge. Mentir par la gorge. Mentir effrontément. — Vous avez beau dire, ce n'est que sable, tout ce que vous autres avez amassé. — Vous mentez par la gorge. D E S PÉRIERS, Cymbalum, II (I, 337). Donner à qqn un dementy par la gorge. L'accuser
d'un mensonge effronté. — Mon fils est homme de bien, et n'y a h o m m e qui m'osast dire le contraire que je ne luy donnasse un dementy par la gorge. T O U R N E B U , les Contens, IV, 4.
Crier, parler gorge desployee. Crier, parler d'une voix très haute, très bruyamment. — La femme s'escria à gorge desployee, disant à Saûl qu'il l'avoit trompée. L E L O Y E R , Hist. des Spectres, VII, 7. — S'il ne fust mort si tost comm' il fit, il eust faict beaucoup parler de luy, et à gorge bien desployee. B R A N T Ô M E , Cap. franc., M. de Salvoy-son (IV, 97).
A gorge ouverte. Ouvertement. — Si nous faisons comparaison de Job avec ceux qui blasphèment Dieu à gorge ouverte... combien telles gens sont-ils à condamner? CALVIN, Serm. sur le liv. de Job, 11 (XXXIII, 150).
Crier à gorge rompue. Crier très fort, de manière à se rompre la gorge. — Pensez que ce vous est un grand plaisir, quand vous avez si longuement... crié à gorge rompue, que ce bouvier vous
Gord 1. Gouffre, abîme, étendue d'eau. — Là fut ung gord plein de fange et de bourbe, Qui son eau trouble horriblement recourbe. D u B E L L A Y , L. VI de l'Éneide, édit. M.-L., I, 408. — Nous avons veu du bord thusque Le Tibre roux d'un cours brusque Ses flotz roidement retors D u roi les monuments amples Et de Veste les saincts temples Aller jecter d'ondeux gords. Luc D E L A P O R T E , trad. d'HoRACE, Odes, I, 2. — Quelgourg, ou quelz fleuves barbares D'une civile guerre ignares? ID., ib., II, 1. — Le caut nocher poeneen Craint le gord bosphoreen. ID., ib., Il, 13. — Et de l'enroué Adrie En vain fuions-nous les gordz. ID., ib., II, 14. — Je sçai quel est et le noir flanc Des gourds d'Adrie, et en quoi blanc D'un traistre front pèche Iapyge. ID., ib., III, 27. — Mais jurons toutz sur ces parolles : Que, quand s'eslevant du creux gour Les pierres sur-nageront molles, Impermis ne soit le retour. ID., ib., Epodes, 16. —
— 337 — G O R G E R E
demande que c'est que vous dites. D E S PÉRIERS, Nouv. Récr., 69. . %
A plaisir de gorge. — Apres se esbaudissoient a chanter musicalement à quatre et cinq parties, ou sus un thème à plaisir de gorge. R A B E L A I S , I 23. ' A menue gorge. Doucement, faiblement. — Ses compaignons quelquefois hurlent après luy comme des loups eschauffez en amour, et quelquefois fredonnent et gozillent à menue gorge, comme des petits cochons qu'on a troussé par la jambe pour les aller sacrifier à la brocheterie. PH. D E M A R N I X , Differ. de la Relig., II, i, 21. Se couper la gorge, v. Couper. Chatouilleux de la gorge, v. Chatouilleux. Addonné à la gorge. Aimant la bonne chère? —
A tels entrepreneurs [de voyages lointains] il leur est besoin n'estre sujets à maladie, et moins ad-donnez à la gorge. T H E V E T , Cosmogr., XII, 1. Gorge. Ce qu'on avale, nourriture. — Disent les
maistres faulconniere que ne soit jamais donnée grosse gorge aux oyseaulx. F R A N C H I È R E S , Fauc, 14 r° (G., Compl.). — Terre de sang enyvree Des corps nuds qui, sans tombeaux, Servent de gorge aux corbeaux, Aux chiens et loups de curée. R. BELLEAU, Petites Inventions, Chant de triomphe (L ioO). —• Tousjours le foie immortel à Pentour Lui menge et ronge un merveilleux vautour... Là prend il gorge : et d'une faim dépite Paist la poitrine, et sous icelle habite. D E S M A S U R E S , Enéide, VI, p. 305. Voler sur sa gorge, terme de fauconnerie. Voler
immédiatement après s'être repu. — Ainsi font les faulconniere : quand ilz ont peu leurs oyzeaulx, ils ne les font voler sus leurs guorges : ilz les laissent enduire sus la perche. R A B E L A I S , III, 15. — (Fig.). On dit Je ne vole point sur ma gorge, en refusant de danser ou faire quelque autre exercice un peu violent incontinent après le repas. H. E S TIENNE, Precellence, p. 130. Rendre sa gorge. Vomir. — Si ton cueur se
trouve saisy De quelque ennuyeuse tristesse, Ou bien d'une grande liesse, A l'amy te deschargeras ; Sçais tu comment t'allégeras? Tout ainsi, par le sang sainct George, C o m m e si tu rendois ta gorge Le jour d'un caresme prenant. M A R O T , Dialogue de deux amoureux. — Tous ces bonnes gens rendoyent là leurs gorges devant tout le monde, comme s'ilz eussent escorché le regnard. R A B E LAIS, II, 16. — Pantagruel se parforce de rendre sa gorge. ID., II, 33. — Personne de l'assemblée oncques par la marine ne rendit sa guorge, et n'eut perturbation d'estomach ne de teste. ID., IV, 1. — Ceulx qui sont malades et rendent leur gorge sur la mer reprennent leurs esprits quand ils voient de près la terre. A M Y O T , Propos de table, 1,4. Gorge chaude. Nourriture de l'oiseau de proie,
quand elle consiste en la chair d'un animal qui vient d'être tué. — Ainsi que les milans de par-deça prennent gorge chaulde de poussins et oisons. T H E V E T , Cosmogr., V, 10. Au figuré, bon repas, régal. — Je voys tenter
les hereticques, ce sont âmes friandes en carbon-jiade : monsieur Lucifer a sa cholicque, ce luy sera 'une guorge chaulde. R A B E L A I S , IV, 46. — Il retira l'ame d'un sien devotaire, et la feit retourner au corps, après qu'elle eut desja par sentence esté livrée aux sergeants et satellites plutoniques, lesquels en alloient faire une gorge chaude à leur dame Proserpine. P H . D E M A R N I X , Differ. de la Relig., I, \, IQ. Faire une gorge chaude de. Se régaler de, manger avec plaisir. —11... vous print monsieur de l'Ours IV
et le mist en pièces comme un poulet, et vous en fist une bonne gorge chaulde pour ce repas. R A B E LAIS, II, 4. —• Si j'ay disné ! dit-il, ouy, et fort bien, car j'ay faict une gorge chaude d'une couple de perdris. D E S P É R I E R S , NOUV. Récr., 72. — Si aucun est parvenu jusqu'à la vieillesse, ilz l'assomment et en font gorges chaudes. SALIAT, trad. d'HÉRODOTE, III, 99. — Encore y a-t'il une sorte d'animaux qu'on appelle hyènes, qui sçavent contrefaire le langage des pastres, et qui, ayans appris le n o m de l'un d'eux, ils l'appellent pour le faire sortir de son toict et puis en faire une gorge chaude. E. P A S Q U I E R , Lettres, X, 1. — Nous fusmes contraints de reprendre haleine, n'osants pas si inconsidérément entrer en ces lieux soubs-terrains, crainte que quelque meschante beste ne fist une gorge chaude de nous. Supplément du Ca-tholicon, 2, dans Tricotel, édit. de la Sat. Men., Il, 25. — Il se préparait pour m e venir dévorer et faire une gorge chaude de si peu que j'avoisde bon sang. B E R O A L D E D E V E R V I L L E , Voyage des princes fortunez, p. 24.
Gorge chaude. Grand butin. — Leur ville est prise par force, pillée et saccagée par les siens, qui en firent une gorge chaude. E. P A S Q U I E R , Lettres, XIII, 16. Succès prompt, facile. — 11 y a plus à craindre
en nostre entreprise... contre une ville qui est... environnée de marests... Vous sçavez quelle est la nature du François, qui veut, dés son entrée, estre servy d'une gorge chaude : autrement à la longue il se ralentit. ID., ib., V, 12. — Trouvant à l'entrée quelques lansquenets, qui leur voulurent résister, ce leur fut une gorge chaude, car ils furent taillez en pièces. ID., ib., X V I , 2.
Faire une gorge chaude. Eprouver un grand plaisir. — Par une mesme façon de métaphore prise de la fauconnerie, nous disons d'un qui recevra une grand'joye de quelque bonne aventure qui luy est survenue, Il en fera une gorge chaude. H. E S T I E N N E , Precellence, p. 130. Faire gorge fraische. Se régaler. — Il est bien
vray que j'avois, neantmoins toutes ses faveurs, une frivole peur, qui m e faisoit penser qu'au renouveau il ferait de m a triste chair gorge fraische avant que s'en aller. B E R O A L D E D E V E R VILLE, Voyage des princes fortunez, p. 26.
Gorgé. Gonflé. (Fig.). Orgueilleux. — Ceulx cy sont si insolents, si gorgez et si aveuglez qu'ils n'estiment plus ny amys ny anemis. Mars 1569. Négoe de la France dans le Levant, III, 58 (G., Compl.). Gorgée. Nourriture. — Entre les oyseaux,
l'ourahouassoub est le plus redouté, comme celuy qui vaincq tous les autres, et en prend gorgée. THEVET, Cosmogr., XXI, 5. Parole. Ruer une gorgée. Prononcer une invec
tive. — Apres avoir par forme bien rengee La fiere Mort durement oultragee... Vous viendrez cy ruer une gorgée Encontre Envie, inutile, enragée. LEMAIRE D E BELGES, la Plainte du Désiré (111,178). Gorgelette, dimin. de gorge. — Fausse meur
trière bellete, Qui cete douce gorgelete De ta dent as osé trencher. JEAN DOUBLET, Sur la mort d'un petit perroquet. — Je mordoy sa gorgelette. G. D U RANT, Œuv. poet., 166 r°. Gorgere. Sorte de guimpe, de collerette. —
Dieu... en lieu de ce leur donnera puanteur pour suave odeur, corde pour seincture, et la haire pour gorgieres. P. D E CHANGY, Instit. de la femme chrest., I, 9. — Maintenant les lingieres Ont œuvre assez seulement en gorgieres. FERRY JULYOT, lre part., 10 (3e Elégie). — J'ayme mieux 22
GORGERET — 338
voir sa collerette D'une toile rousse clairette... Qu'une gorgère godronnée Avecques l'empoix arrestée Sur l'escarrure. T A B O U R O T DES ACCORDS, tes Bigarrures, IV, 3. — Une gorgiere de toile d'argent blanche. 1611. Inv. du château de Pailly (G) Partie de l'armure couvrant la gorge. — Ils
avoient aussi une gorgiere que nous appelions hausse-col. FAUCHET, Origines des chevaliers, L. II, 523 r°. Gorgeret. Sorte de guimpe, de collerette. —
Mais de gorgeretz n'useras Ne de barbute aucunement. Ane Poés. franc., VIII, 294. Gorgerette. Sorte de guimpe.de collerette. —
Avoir fault des robes, des cotes, Habis de teste et gorgeretes. Sotties, III, 293. — Vouz avez toute nette Rompu de bout en bout ma belle gorgerette. CL. GAUCHET, te Plaisir des champs, l'Automne, Divers plaisirs, p. 269. — N'allois-tu pas soubs-levant La gorgerette ennemie Qui se met-toit au devant De ce beau sein de ma belle...? G. DURANT, ŒUV. poet., 119 r°. — Elle avoit prins une chemise blanche, une gorgerette, un garderobe; bref elle estoit en beau point. B E R O A L D E D E VERVILLE, te Moyen de parvenir, Bénédiction (I, 211). Gorgeri. Partie inférieure du casque, servant
à protéger le cou. —• Un chascun d'entre eulx... dressèrent un grand boys, auquel y pendirent une selle d'armes... un gantelet, une masse, des gous-setz, des grèves, un gorgery. RABELAIS, II, 27. — Sur les flancs estoient les deux mille haquebu-tiers... couvers de gorgeris et cabassetz. Amadis, IV, 15. — Les uns... nettoioient... goussetz, guor-geriz, hoguines. RABELAIS, III, Prologue. Gorgerin 1. De la gorge. — Venus les menasse
aigrement des escrouelles gorgerines. RABELAIS, Pantagr. Prognost., ch. 6. Gorgerin 2. Partie de l'armure couvrant la
gorge et une partie du corps. — Luy arrivé, envoya les armes au bon chevalier pour en avoir le choix, qui estoient d'ung estoc et d'ung poignart, eulx armez de gorgerin et secrète. L E LOY A L SERVITEUR, Hist. de Bayart, ch. 22. — Les autres harnois de corps seront la chemise ou gorgerin, manches et gants de maille, et cabassets descouverts. R. D E FOURQUEVAUX, Instructions sur le faict de la guerre (A. Lefranc, Rev. du XVIe siècle, III, 133). — Je me jectis à coup perdu dens la salle, ayant un gorgerin de maille, comme les Ale-mandz pourtoinct en ce temps-là, qui me cou-vroict presque tout le corps et la moytié des bras. MO N L U C , Commentaires, L. I (I, 79). — M. de Bayard... luy va donner un si merveilleux coup dans la gorge que, nonobstant la bonté du gorgerin, l'estoc entra dans la gorge quatre bons doigts. BRANTÔME, Disc, sur les duels (VI, 266). Sorte de guimpe ou de collerette. — Cabinet
garny de ceintures... De mancherons, de brace-letz, De gorgerins et de colletz De perles d'Orient semez. Ane Poés. franc., VI, 266. — Toutes beautez à mes yeux ne sont rien Au pris du sein, qui souspirant secoue Son gorgerin sous qui doucement noue Un petit flot que Venus dirait sien. RONSARD, Amours de Cassandre (1, 54). — Par toy, Zephyre, ma veue Cuida jouyr de ce sein Et de sa poitrine nue, Dont le marbre blanc et plein En cent petites secousses Le gorgerin rehaussoit. G. D U R A N T , ŒUV. poet., 119 r°. Collier. —• Pour carcans, orillettes, jaserans,
gorgerins, chaines, brasseletz et telz affiquetz et metaulx, penses-tu estre meilleure? P. D E
C H A N G Y , Instit. de la femme chrest., I, 9. — Dieu ostera la façon de leurs souliers, carcans... verges, pierreries, gorgerins, miroers, passemens, bordures. ID., ib.
H. Estienne constate que les cousturiers ont emprunté le mot gorgerin au vocabulaire de la guerre. — Quelle mousche a piqué les cousturiers (que vous appelez tailleurs) d'emprunter les noms des instruments de guerre? — Ils ne commancent pas d'aujourdhuy, car il-y-a long temps qu'ils ont emprunté le mot gorgerin. Dial. du lang. franc ital.,1, 251. Gorgeron. Gorge. — Les choulx en yver
purgent la flegme, adoulcissent le gorgeron et font bonne voix. PLATINE, De honneste volupté, 76 v» (G.). — Leur maie angine, qui leur suffocastle gorgeron avec Pepiglotide. RABELAIS, V, 18. Gorge-rouge. Rouge-gorge. — Voicy pour le
premier la sotte gorge-rouge Qui vient et titiant de branche en branche bouge. CL. GAUCHET, Je Plaisir des champs, VHyver, la Pipée, p. 276. — On y voit aussi des linottes, des gorges rouges, des alouettes. Trad. de FOLENGO, L. XIV (11,11). Gorgeter. Chanter. — Polymnya faisoit maint
beau cantique... Clio prenoit a gorgeter grant gloire. J. BOUCHET, Epistres familières du Traverseur, 23. Exprimer par la voix. — Brief tant y eut de
douleurs gorgectees, Tant de sanglotz et de langueurs gectees. Ane Poés. franc., XIII, 404. Gorgette, dimin. de gorge. Gorge, gosier. —
Car là void on simulacres massif z, Idoles peints et vives imagettes... Qui des griefz maux ou personnes subjettes Sont maintes fois, ainsi que par miracle, Donnent respons de leurs douces gor-gettes. LEMAIRE D E BELGES, la Concorde des deux langages, lre part. (III, 107). — Ne chantez plus, refrénez vos gorgettes, Tous oyselletz. MAROT, Ballades, 12. — Oyez vous Ce bruyt tant doulx Decligner de la gorgette Du geay mignot, Dulinot Et de la frisque alloette. D E S PÉRIERS, ŒUV. diverses, 1, 59. — J'ouy un chant trespiteux exprimer Roulant au long de sa blanche gorgette. FORCADEL, Œuv. poet., p. 38. — Ores que les douces gorgettes Des Daulienes sont muettes. RONSARD, Gayetez, 2 (II, 37). — Et les gorgettes des oyseaux Qui chantoient en douce harmonie. TAHUREAU, Inconstance des choses (II, 222). — En parlant des gratieux propos, je n'enten pas de ces petis mots affectez où il n'y a que des U et des II de peur d'écorcher ces gorgettes délicates. ID., Sec. Dùd. du Democritic, p. 108. — Où voles-te, colombelle? D'où viens-tu, mignonne belle? Où prens-tu tant de senteurs, Tant de parfum, tant d'odeurs Qu'allant par Pair tu soupires Et de ta gorgette tires Goutte à goutte, et les respans Par les bois et par les champs. R. BELLEAU, Odes d'Ara-CREON (1,12-13). — Elle deslors m'attendantEs-coutoit la chansonnette Du rossignol, accordant Ses amours de sa gorgette. JODELLE, tes Amours, Chanson (II, 80). — C o m m e le rossignol, qui sur le renouveau Ne fait que gazouiller, et de sa voix foiblette Ne peut encor enfler sa petite gorgette. R. BELLEAU, la Bergerie, 2e Journ., Complainte de Promethee (II, 16). — Ta chanson... Quii dure si longuement Que je m'estonne comment SOUBS ta vois trop eslevée Ta gorgette n'est crevée. P. D E BRACH, Poèmes, L. I, 62 r°. — (Fig.). W des zéphyrs les gorgettes décloses. RONSARD, Amours de Cassandre (i, 29). — Respirant aux frais soupirs Des mignardelets zephirs, Qui ue leurs douces gorgettes Rodent au tour des fleurettes. G. D U R A N T , ŒUV. poet., 151 v°.
1,1 (i Gorge, poitrine. — Maintenant sont ces propres dmagettes Parfaitement à mon gré bien parées. 3i reluiront leurs faces et gorgettes De blanc ;esmail et de couleurs subjettes A qui ne sont point td'autres comparées. L E M A I R E D E B E L G E S , la ^Couronne Margaritique (IV, 160). — Cent fois je shaise et ton front et tes yeux, Ton sein, ta main, sta bouche, ta gorgette. T A H U R E A U , Sonnets, 79. — tJe baiseroy sa gorgette charnue. G U Y D E T O U R S , \Souspirs amoureux, L. II (1, 41). — O col plus blanc que neige, ô gorgette de laict I ID., ib.,
4L. UI (I, 67). D Gorgias 1. Joli, gracieux, élégant, bien vêtu. *— Celle clere brunette tant gorgiase, laquelle ("aussi porte habit de nymphe, fut jadis lune de noz [jcompaignes. L E M A I R E D E B E L G E S , Illustr., 1, 41. '•— Si aucun est venuste, Prudent et beau, gorgias 1 et robuste Plus que nul autre, est ce pas bien rai-cson Qu'il en soit fier? M A R O T , Oraisons, 1. — ! Iceux furent suivis par quatre trompettes et un estanterol de gens de cheval... les plus gorgias "qu'on pourrait souhaiter. R A B E L A I S , la Scioma-1 chie (III, 399). — II trouva sa femme plus belle, ïplus gorgiase et plus joieuse qu'elle n'avoit ac-icoustumé. M A R G . D E NAV., Heptam., 8. — L'un «appelloit une guorgiase bachelette... Bon jour, mon estrille. RABELAIS, IV, 9. — Il est malaisé à ; croire qu'Epaminondas, qui se vantoit de laisser îpour toute postérité des filles qui f eroyent un jour j honneur à leur père (c'estoyent les deux nobles victoires qu'il avoit gaigne sur les Lacedemo-;niens) eust volontiers consenty d'esçhanger f celles-là aux plus gorgiases de toute la'Grèce. ÎMONTAIGNE, II, 8 (II, 100). — Ces femmes icy l estoient fort gorgiases et magnifiquement accous-trees..F. BRETIN, trad. de L U C I E N , la Vraye his-' toire, II, 46. — (Ironiquement). Ce guorgias Euri-:pides... tous jours a mesdict des femmes. R A B E -• LAIS, IV, 65.
(En parlant des choses.) Elégant, beau, gracieux, richement orné. — A u chanfrein du dit cheval ung grave et gorgias plumas. L E M A I R E D E 'BELGES, Pompe funéralle de Phelipes de Castille • (IV, 251). —• Hz firent faire cent galères oultre lordinaire tresbelles et gorgiases. SEYSSEL, trad. de THUCYDIDE, II, 6 (51 v°). — 11 avoit ung fort • gorgias acoustrement de broderie. L E L O Y A L SERVITEUR, Hist. de Bayart, ch. 54. — Quand il eut prins la plus gorgiase" et mieulx parfumée de toutes ses chemises. M A R G . D E NAV., Heptam., 4. — Porter une robbe gorgiase et longue jusqu'aux talons : ageancer mignardement ta perruque. F. BRETIN, trad. de LU C I E N , tes Amours, 3, p. 390. — Quoy et qui les rend aimables? certes ce sont bien leurs beautez et leurs gentillesses, mais aussi leurs gorgiases façons de s'habiller. B R A N T Ô M E , des Dames, part. II (IX, 323). (En parlant des choses de l'esprit.) — Est-il
escript portant crédit ou tiltre De gorgiase et amoureuse epistre, O cueur royal, qui puisse à l'advenir Jusques icy t'esmouvoir à venir? C R É TIN, Epistre à Charles VIII, p. 175. — Ceste venuste qui est en la langue attique, c'est a dire ceste doulceur délectable et gorgiase de langaige coinct et polly. B U D É , Instit. du prince, édit. J. Foucher, ch. U . Beau, glorieux. — Que ferons nous à ce cappi-
taine Jehan-Paule Monfron, qui nous cuyde avoir par finesses? Il luy fault donner une venue, et si vous povez faire ce que je vous diray, nous ferons une des gorgiases choses que fut faicte cent ans a. LE LOYAL SERVITEUR, Hist. de Bayart, ch. 40. —• Ce fut une gorgiase deffaicte [des Vénitiens] et prouffitable aux François, car s'ilz [les Vénitiens]
339 — GORGIASEMENT
toussent entrez dedans Bresse, jamais n'eust esté reprise. ID., ib., ch. 49.
(Subst.). H o m m e élégant. — Advisés y, mes gorgias de court... L'un est veste de long, l'autre de court, Frisque et gourt pour mieux suivre la court. Ane Poés. franc., IX, 326. — Les mal ves-tuz et ceulx qui sont vaincuz De fain souvent ont les monceaux d'escutz. Les gorgias et gourmans les despendent. J. B O U C H E T , Epistres morales du Traverseur, II, 7. A la gorgiase. Gracieusement. — Bien, mes
sieurs, va il dire en se riant à la gorgiase, il faut que je quitte m a propre volonté pour m e ranger à la vostre. C H O L I È R E S , 8e Ap.-disnée, p. 314-315.
Brantôme considère le mot comme étranger à l'usage commun. — Aussi ne voyoit-on rien si brave, si bien en poinct, ny si gorgias (ilz usoient de ce mot lors parmy les soldatz du Piedmont) ; car, quand à leurs armes, elles estoient la pluspart dorées et gravées ; pour les accoustremens ce n'estoit que tout soye. Couronnels franc. (VI, 106). Gorgias 2. Sorte de collet, de guimpe. — Car ains que soyez esveillée, Mes gorgias sont empesez Et m a robe toute habillée. Ane Poés. franc., V, 28. — Vous demandez les gorgias quarrez Clotz et serrez pour chauffer la poictrine. Ib., VIII, 248. —• Tetin qui t'enfles et repoulses Ton gorgias de deux bons poulses. M A R O T , Epigrammes, 78. — Beaucop de filles venoint en sa maison... pour tailler et coudre chemises et gorgias. N I C O L A S D E T R O Y E S , le Grand Parangon, 51, p. 225. — Les autres [adorent] les cheveux entortillez de quelques femmes, leurs robbes, leurs ceintures, leurs chemises, leurs gorgias. Trad. de B U L L I N G E R , la Source d'erreur, I, 35, p. 465. — Aussi le sage Gorgias Te défend très estroicte-ment, Tant en colletz qu'en gorgias, La pourfil-leure et passement. Ane Poés. franc., VIII, 295. — De gorge nous avons gorgerette et gorgias, qui est le collet dont les femmes couvrent leurs poic-trines. M. D E L A P O R T E , Epithetes, 194 r°. — Mâchâtes... apporte un petit escrin qu'il ouvre, et tira de dedans l'anneau d'or et le colet ou gorgias que Philinnion luy avoit laissé la nuict première qu'elle coucha avec Mâchâtes. L E L O Y E R , Hist. des Spectres, III, 11. Gorgiasement. Élégamment, luxueusement, magnifiquement. —• Ung chascun patron allant en si long voyage se parforcoit de faire que son navire fust le mieulx et le plus gorgiasement equippé. SE Y S S E L , trad. de T H U C Y D I D E , VI, 6 (192 r°). — Deux mille souldars deslitte, distribuez par bendes, qui estoient tous richement et gorgiasement armez et accoustrez. ID., Guerres civiles, L. VI, extraict de P L U T A R Q U E , ch. 1. — Ceste mayson est gorgiasement adoubée, or décorée au pris quelle souloyt estre. P A L S G R A V E , Esclare, p. 508. — Gorgiasement veste. J. B O U C H E T , Ann. d'Aquit., 36 v° (G.). —• Alison... luy promist que bientost luy baillerait ung bel amoureux qui l'entretiendrait gorgi sèment. N I C O L A S D E T R O Y E S , te Grand Parangon, 51, p. 244. — En la place entra... une enseigne de gens de pied, tous gorgiasement accoustrez. R A B E L A I S , la Sciomachie (III, 399). — Le président... commanda à sa femme de s'abiller plus gorgiasement qu'elle n'avoit accoustumé, et se trouver en toutes com-paignyes, dances et festes. M A R G . D E NAV., Heptam., 36. — 11 luy a commandé qu'elle s'allast parer le plus gorgiasement que faire pourrait. A M Y O T , Hist. Mthiop., L. V, 62 r°. — Breton estoit guorgiasement armé, mesmement de grefves etsolleretz asserez. R A B E L A I S , IV, 11 (II, 309). —
GORGIASER — 340 —
La dame jeune... belle, délicate, vestue gorgiasement. ID., V, 19. Gracieusement. — Mais elle a prins une fleute
dalmant Et a sonné si gorgiassement Avec Chiron un bransle decouppé. MICHEL D'AMBOISE, Propos fantastiques, 2. — Les filles... leurs quenoilles sur la hanche, filoient : les unes assises en lieu plus eslevé... à fin de faire plus gorgiasement piroueter leurs fuseaux. D u FAIL, Contes d'Eutrapel, 11 (I, 164).
Habilement. — Certes l'entreprise Est faicte gorgiasement. Sotties, II, 291. — Saincte Mère Eglise a... gorgiasement embelly tout ce que d'ailleurs elle avoit emprunté. P H . D E M A R N I X , Differ. de la Relig., I, v, 8.
Gorgiaser. Orner, parer, embellir. — Des deniers quelle [la Grèce] a nécessairement contribuez pour la guerre des Barbares, nous en dorons et gorgiasons nostre ville. G. D E S E L V E , Huict Vies de P L U T A R Q U E , Périclès, 35 r°.
Se gorgiaser. Se parer. —• Soy gorgiaser curieusement en accoustremens. B U D É , Instit. du prince, édit. J. Foucher, ch. 52. — Ainsi m e suis je acous-tré, non pour m e guorgiaser et pomper : mais pour le gré du malade lequel je visite. R A B E L A I S , IV, A Odet de Chastillon. — Certains petitz Jans-pill' hommes de bas relief, qui à Couillatris avoient le petit pré et le petit moulin vendu pour soy gourgiaser à la monstre. ID., IV, Prologue. — Il imagina tous moiens possibles au monde pour bien se parer, diaprer et gorgiaser. P H . D E M A R NIX, Differ. de la Relig., II, v, 3. — (Fig.). Ce quil y a entremeslé de la philosophie, il ne fault point penser quil laye emprunté dailleurs, ne quil se soit gorgyasé des plumes de aultruy. G. D E S E L V E , Huict Vies de P L U T A R Q U E , Prologue du translateur. — Pourveu qu'ils [certains écrivains] se gorgiasent en la nouvelleté, il ne leur chaut de l'efficace. Pour saisir un nouveau mot, ils quittent l'ordinaire, souvent plus tort et plus nerveux. M O N T A I G N E , III, 5 (III, 359).
Faire le beau. — La première raison de la servitude volontaire, c'est la coustume : comme des plus braves courtaus, qui au commencement mordent le frein et puis s'en jouent, et là où n'a gueres ruoient contre la selle, ils se parent maintenant dans les harnois, et tous fiers se gorgiasent soubs la barde. L A B O E T I E , Servitude volontaire, p. 29.
Gorgiaseté. Élégance, richesse du costume, mode élégante, ce qui est élégant. — Sa gloire et sa réputation ne consiste point en telles pompes et gorgiasetez. SEYSSEL, la Grand monarchie, II, 21 (G.). — Ceste pauvre fille... se retira du tout à Dieu, laissant les mondanitez et gorgiasetez de la court. M A R G . D E NAV., Heptam., 21. — D'aultre costé luy faschoit fort la despence qu'il estoit con-trainct de faire pour entretenir sa gorgiaseté et pour suyvre la court. ID., ib., 59. — Adonc... se destituèrent honteusement de toute ceste gorgiaseté dequoy ilz sestoient si fièrement eslevez J. L E B L O N D , trad. de T H . M O R U S , l'Isle d'Utopie, L. II, 56 r». — Il n'y avoit que pompe et gorgia-setté parmy les soldatz du Piedmont alors. B R A N T Ô M E , Couronnels franc. (VI, 107). — On donne le los à la reyne Isabel de Bavières, femme du roy Charles sixiesme, d'avoir aporté en France les pompes et les gorgiasetez pour bien habiller superbement et gorgiasement les dames. ID., des Dames, part. l,Marg., reinedeFr. etNav. (VIII, 31).
Grâce. — Avec ses guestres et sabots, non sans raison, pour sa gorgiaseté receut ce nom. D E S A U T E L S , Mitistoire barragouyne, ch. 3.
(En parlant des choses.) — La propriété et gorgiaseté du conte. L E M A Ç O N , trad. de BOCCACE Decameron, II, 8. — Ceste élégance et gorgiaseté de paroles. J. D E M A U M O N T , trad. des Œuv de S' JUSTIN, 42 r° (G.).
Gorgiement. Jactance, vanité, faste. — Ilz fuient tous grans gorgimens, Hz ne quierent que avoir liesse Seulement. Contredictz de Songecreux 12 r° (G.). — D'ambition et de grans gorgiemens' Ib., 119 r° (G.).
Gorgiere, v. Gorgere.
Gorgonia. Corail. — Gorgonia, ou corail, naissant au fons de la mer, est une plante verde... et... incontinent après avoir senty l'air, devient vermeille et sendurcit en pierre. LEMAIRE DE B E L G E S , la Couronne Margaritique (IV, 84).
Gorgonien. De la Gorgone. — Quel autre sang gorgonien engendre En ce terroy ce poulain furieux...? D E S A U T E L S , Epigrammes. — Les plumes de l'aisle D u fils gorgonien. BOYSSIÈRES, Sec Œuv., 33 v°.
Gorgonner. Gargouiller. — Quant tu es en ung ventre, il tonne, Il ronfle, il braille, il gorgonne, Ane Poés. franc., IV, 108.
Gorgophore. (Lire gorgophone, de Yopyoçivoç), Meurtrière de la Gorgone. — Ils doivent pieça estre en travail de quelque nouvelle Minerve gorgophore. P H . D E M A R N I X , Differ. de la Relig., I, iv, 10.
Gorguet. Gorge. —• Je voy a lueil quon ne peult faire guet Si deligent contre les loups maul-ditz Que noz moutons nempoignent au gorguet, L E M A I R E D E B E L G E S , te Temple d'Honneur et de Vertus (IV, 208). Dire son gorguet. Dire ce qu'on a à dire. — Ce
sermon est peu civile, mais, o Quirites romains, je diray mon gorguet. FOSSETIER, Cron. Marg., VIII, m , 16 (G.).
Gorguillon, v. Gurgulion. Goriphee. Coryphée. —• Ce grand goriphée
d'Apollon, ce prodige du Parnasse. Var. hist. et litt., V, 268.
Gormander, v. Gourmander.
Gorre i. Élégance, mode élégante, faste, chose élégante. — Car, comme on voit, de gorres anciennes Compte ne font, n'aussi de vieilles bagues, Mais sont ennuyt grandes praticiennes Pour inventer mille petites bragues. Ane Poés. franc., XII, 9. — Estre vestu à l'avantage, A la gorre du temps présent. Ane Théâtre franc., I, 224. — Leur façon est humaine, sociale, Savant sa court, tresbien mondanisant, Et leurs habits de gorre spéciale. L E M A I R E D E B E L G E S , la Concorde des deux langages, 1™ part. (III, 122). — Il n'y avoit femme si petite, de Pestât dont je suis, qui n'eust robbe neuve d'escarlate de Paris, ou de bon fin noir... et grandes cottes de camelot ou de damas... et aussi le chapperon à l'avenant, et le tout fait à la nouvelle gorre avec la ceinture de mesme. N I C O L A S D E T R O Y E S , te Grand Parangon, 52. — Porter soullois gorre trop excellante, A mon blond chief de vellours riche atour. Ane Poés. franc., X11I, 421. — Tu es excessivement parée et vestue entre tant de nudz et indigens, et toutes gorres dyabolicques en faictz et en dictz s'en ensuyvent. P. D E C H A N G Y , Instit. de la femme chrest., I, 9.
Femme à la grand'gorre. — Nous oyons aussi comment les prescheurs susdicts crient contre les pompes des femmes, et comment Maillard de sa
— 3
part les appelle femmes à la grand'gorre, et femmes gorrières. H. E S T I E N N E , Apol pour Her., ch. 9 (1,131). — Quant aux femmes, madame à la grand'gorre (comme parlent les prescheurs d'alors) n'avoit elle pas bonne grâce quand elP avoit veste sa robbe, les manches de laquelle estoyent si larges qu'elles suffiroyent maintenant à en faire une entière? ID., ib., ch. 28 (II, 130). Faire gorre. Se parer, se pavaner. — Je luy
donne, pour faire gorre, Meschanceté, vie misérable, A son coul pour chaîne gros cable. A ne Poés. franc., X, 140. — Ou par les champs on fait la gorre et brague. J. B O U C H E T , Epistres morales du Traverseur, I, 2. Gorre 2. Syphilis. — Mais le commun, quand
il la rencontra, La nommoit gorre, ou la vérole grosse. LEMA I R E D E B E L G E S , Sec. Conte de Cupido et d'Atrepos (III, 54). — On luy présenta la bouteille : « Je n'y boiray point ; autre y but, Qui comme moy paya tribut... Et puis je crains d'avoir la gorre, Ainsi que mon prédécesseur. Ane. Poés. franc., I, 289. — La gorre de Rouen je trahie. /*., IV, 257. — Lequel... morut de la gourre en l'hospitault Sainct Nicollais. J A C O M I N HUSSON, Chron. de Metz, p. 252 (G.). — Ceste grande gorre de vérole, ainsi baptisée par ceux de Rouen sur son commencement. D u FAIL, Contes d'Eutrapel, 28 (II, 90). — Voicy arriver un franc-à-tripe, qui se fait penser une meschante main de gorre qu'il avoit. Or... on ne se peust tenir de rire et moquer de sa vilaine main, tant elle estoit crouste-levee et ulcérée. GUILL. B O U C H E T , 27e Seree (IV, 200). Gorreau 1. Porc, goret. — U n gorreau fort
petit s'efforçant se deffendre de la mâchoire. Trad. de GALIEN, p. 15 (G., Gorel). — De là est venu le nom de ceste sauce exquise qu'on appelle myrte-tum ; et aussi le goust qu'on donne à la venaison de sangliers et gorreaux avec le fruict du meurte. Du PINET, trad. du Comment, sur Dioscoride, I, 128 (G., Gorel). Gorreau 2, v. Goreau. Gorrerie. Luxe, faste. — A veoir leur conte
nance, Leur gorrerie et fringuerie, Grant estât, bobant, pomperie. E. D ' A M E R V A L , Livre de la Deablerie, 48 b (G.). Gorrette. Coup. — Le peuple là assemblé, qui
n'aime la chiquanerie ne les chicaneurs, s'oppose à sa capture, et à force de gorrettes et de coups orbes, font lascher la prinse à ces preneurs. GUILL. BOUCHET, 27e Seree (IV, 203). Gorrier 1. Élégant, galant, paré, bien vêtu. —
Je trouvay ung noble et gracieux seigneur tenant parla main une dame gorrière. Ane Poés. franc., XII, 271. — Quattre chambrières Assez mignonnes et gorrières Prindrent complot, comme il me semble, D'aller aux estuves ensemble. Ane Poés. franc., II, 286. — Laisné de ses enfans... ayant espousé une jeune femme qui aymoit a estre gorrière et faire grosse despence, ne pouvoit comporter l'escharcetéde son père. G. D E S E L V E , Huict Vies de P L U T A R Q U E , Périclès, 44 r°. — A Venus il a faict prière... De la muer pour son playsir En femme mignonne et gorrière. H A U D E N T , Apologues d'EsoPE, I, 3. —• Je prie à Dieu que pour honneur acquerra Et mériter couronne de laurier, Vous ne pensiez qu'à vous tenir gourier, Brave en la paix et couard en la guerre. M E L I N D E S* G E -U Y S , Contre un envieux (I, 244). —• Des femmes est la nature d'aimer Plustost et mieux cinq festes à chommer Qu'un jour ouvrier, tant soyent bonnes ouvrières, Ou pour danser, ou pour estre
G O R RIEREMENT
gorrières. DES MASURES, David triomphant, 1120. — Quelques gouges des Hurbecs attifées en damoiselles, et braves comme espousées, mar-choient par entre les troupes aussi gorrières que petits paons. B E L O N , Cronique (Delaunay, Rev. du XVIe siècle, XII, 91). — Amoureuse ou Amante. Belle... miste, popine, gorrière. M. D E LA P O R T E , Epithetes, 21 r°. — C e s courtisans gorriers, Ces mignons, ces menons, ces abateurs de filles. E. PA S QUIER, Sonnets divers (II, 920). — [Heaumes] quelquesfois parez de fleurs d'orfaverie, voire de pierres précieuses : que les gorriers chevaliers, par cointise, y faisoient attacher. F A U C H E T , Origines des chevaliers, L. II, 523 v°.
(En parlant d'un cheval). Élégamment harnaché. —• Les dames montées sus belles hacquenees avecques leur palefroy gourrier. R A B E L A I S , 1, 57.
(En parlant des choses). Élégant, somptueux, magnifique. —• Les confanons de couleur assortie Sont les atours d'accoustremens gorriers. L E M A I R E D E B E L G E S , la Concorde des deux langages, lre part. (III, 108). —• Desquels n'avoit nul qui ne fust accoustré et couvert, tant cheval que homme, de drap d'or en diverses façons et en diverses devises, qu'estoit une chose bien gorrière a veoir. 16 févr. 1514. Négoc. ent. laFr. et l'Autr., t. II, p. 60 (G.). — O chambre très gorrière belle... Chambre de riches couleurs paincte. Ane Poés. franc., VI, 245. — Plus de cent De Sainct Vincent En toute façon si gourrière Vont regar-dans Et gardans Leur ample et belle bannière. D E S P É R I E R S , Voyage à N.-D. de l'Isle. — L'autruche qui dévore Le fer belliqueux et décore, En plumars toutes et gorriers Les morions des preux guerriers. F O R C A D E L , ŒUV. poet., p. 55.
(Subst.). Gorrier, Gorrière. H o m m e élégant, bien vêtu ; femme élégante, bien vêtue. — Lors vindrent des gorriers nouveaulx. G R I N G O R E , Sotye nouvelle des Croniqueurs (Sotties, II, 221). — Quant la mignonne, la gorrière M e veit acoustré en falot, El m e dist en cete manière. R. D E C O L L E R Y E , Monologue du Résolu. — Ainsi feras tu mieux De ne point tant mirer ni le beau, ni le mieux, Que monstre à descouvert madame la gorrière, Que d'adviser le laid qu'elle cache en derrière Dessoubz ses beaux habits. FR. H A B E R T , trad. d'HoRACE, Satyres, I, 2, Paraphrase. — Puis qu'il te plaist, compose Tous les jours quelque chose, Gaste force papiers : Et si ces beaux gorriers S'en fâchent, n'aye crainte De répondre à leur plainte... Que mien est le dommage. BAÏF, Passetems, L. I (IV, 206).
Faire le gorrier, de la gorrière. — Plusieurs [serviteurs] verrez qui ont les grans deniers De leurs seigneurs dont ils font les gorriers, Et a la fin, quand c'est au compte rendre, N'ont pas ung soûl. J. B O U C H E T , Epistres morales du Traverseur, 1,11. — B o n n e s dames, entretenez Voz maris par bonne manière Et trop fort ne les ransonnez Pour faire trop de la gorrière. Ane Théâtre franc., I, 249.
A la gorrière. A la mode élégante, — Il a la morgue... d'un vray croquemesse et d'un maistre souflecalice à la gorrière. P H . D E M A R N I X , Differ. de la Relig., II, i, 14.
Gorrier 2. Se pavaner? (G.). — Gorriers che-tifz, gens de lasche courage, Qui par outrage portez vos larges manches, De gorrier vous faictes rouge raige. Ane Poés. franc., VIII, 84.
Gorrierement. Élégamment. — Se ung h o m m e est remply de science Et n'est gourrierement vestu, De tout le monde c'est l'usance, Ne sera prisé ung festu. Ane Théâtre franc., II, 271.
1 —
G O R R O N (ABUS DE) 342
— Aussi estoit il très gorrierement habillé à la façon de son pays. D E S AUTELS, Mitistoire barra-gouyne, ch. 3. —• (Ironiquement). Ce maistre pi-taut vous gaschoit si gorrierement ses mottets savoyars qu'il en eut bien peu de la compagnie qui ne pissa dans ses chausses. C H O L I È R E S , lre Ap.-disnée, p. 45. Bien. — Il se treuve des hommes... qui bas-
tissent des enfans aussi gorrierement qu'aucun de la parroisse de S. Eustache, qui n'ont de barbe au menton non plus qu'il y en a dans le creux de vostre main. ID., 6e Ap.-disnée, p. 243.
Gorron (abus de). —'Ce messager... délivrait à cestui son sac, à l'autre son pacquet, et à plusieurs séparez par rangs et ordres du beurre, chap-pons, langues fumées, et quatre ou cinq pochées de falsitez et appellations comme d'abus de Gorron. D u FAIL, Contes d'Eutrapel, 30 (II, 109). Selon Philipot, le mot Goron ne désigne pas un jeune porc, mais une bourgade du Bas-Maine dont les habitants étaient particulièrement réputés pour leur penchant au faux témoignage. Le sac du messager contenait donc des falsitez ou faux témoignages, et des appels contre les abus des faux témoins de Gorron.
Gort 1, v. Gord. Gort 2. Bâton court faisant partie d'une ri
delle. — Le cent de gors a charette (G.). Gosier. Gorge, poitrine. —• Paris... considéra...
aussi la grâce de son fosselu menton et la blancheur délicieuse de son gosier crystallin. L E M A I R E D E B E L G E S , Illustr., I, 33.
Gossampine. Gossampin, sorte d'arbre. — Tous les arbres laniflcques des Seres, les gossam-pines de Tyle en la mer Persicque. R A B E L A I S , III, 51.
Gosse. Gousse. — Je ne donrois les gosses de trois fèves De ton advis qui sent à l'envieux. F O R CADEL, Œuv. poet., p. 219. Gosseau, dimin. de gosse, gousse. — Prenez
cendre de gosseaux de fèves. A M B R . P A R É , XXV, 32. Gosser, Gosserie, v. Gausser, Gausserie.
Gossette, dimin. de gosse, gousse. — Icelles gossettes se fendent en trois ou quatre parties quand la semence est meure. L'ESCLUSE, trad. de VHist. des plantes de D O D O E N S , I, 50 (G.).
Gossis. (Lire gosier). — Par elle le boulet fumeusement vomi Par un gossis d'airain contre un mur ennemy Broyera, tonnerreux, les rochers mesme en poudre. D u B A R T A S , Sec. Semaine, Sec. Jour, les Colomnes, p. 271.
Gosterot, v. Gocterot.
Got 1, nom fictif sous lequel sont désignés les moines. — Icy près de vous est cestuy pour veoir si parmy vous recognoistra une magnifique espèce de gots, oiseaux de proye terribles... lesquels ils disent estre en vostre monde. R A B E L A I S V, 5. Voir Sainéan, Rev. des Et. rab., VIII, 151.
Got 2. Gotz et Magotz. — Les Gos et Magos voyant que il estoit pire que ung grant dyable pour eulx ne luy sçavoyent que faire fors tendre le dos : et demandoyent mercy. Les Grandes Cro-nicques de Gargantua (t. IV, p. 37). — Il y avoit ung géant qui avoit douze coudées de hault qui estoit pour soustenir la partie des Gos et Magos Ib. (IV 49). — Cy n'entrez pas, hypocrites, bi-gotz, Vieulx matagotz, marmiteux borsouflez Torcoulx, badaulx plus que n'estoient les Gotz
N y Ostrogotz, précurseurs des magotz, Haires cagotz, caffars empantouflez. RABELAIS, I, 54. J Ils sont de chaude rencontrée, Bigots, cagots, godz et magodz, Fagotz, escargotz et margotz, M A R O T , Epistres, 63. Sainéan rapproche Gotz et Magotz de Gog et Magog. Voir Rev. des Et. rab VI, 297.
Gotisme. Poésie du moyen âge. — Donk le go-tisme je lêss' é je pran lêz erres de ses vieus Grés é Latins. BAÏF, Etrénes de Poézie fransoêze, au Roê (V, 300). Gotte. Sorte de danse. Navig. du Compagnon à
la Bouteille, C.
Gotticquement. En lettres gothiques. — Il luy aprenoit à escripre gotticquement. RABELAIS, 1 14.
Gottis. D u temps des Goths, du moyen âge. — Combien que maintenant nous lisons en nostre langue gallique... plusieurs excellens escripts et que peu de reliques restent de capharderie et siècle gottis. R A B E L A I S , V, Prologue.
Gouache. Perdrix grise. — Est à présupposer que la perdrix grise ou gouache n'a pas este co-gneue en grec. B E L O N , Nat. des oys. (G., Goeche).
Gouaulx. Sorte de cépage de qualité inférieure. — Fut statué que tous ceux qui avoient des plantes de gouaulx en leurs vignes les feroient arracher dans trois ans. 1598. Enquereurs de Toul (G.). — Fu faicte la recherche des septz et gouaulx, de ceux qui n'avoient faict le debvoirde les arracher. 1601. Ib. (G.).
Goube (?). — Chevaux bais, l'un a chanfrain blancq et yeulx vairrons, et l'autre a aureilles goubes. 1557. Lille (G.).
Goubeau, Goubelet, v. Gobeau, Goblet.
Goubillet. Sorte de gobelet. — Les coupes estoient de toutes sortes... un goubillet, un collu, F. B R E T I N , trad. de L U C I E N , Lexiphane, 7.
Goucterot, v. Gocterot.
Gouderon. Goudron. — Les courbes de la nef, cent fois marmotonnees Par le choq aboyant des ondes obstinées, Perdent leur gouderon : et plus vont en avant, Plus le mortel hyver, baillantes, vont beuvant. D u B A R T A S , 2e Semaine, Jonas, p. 398.
On dit aussi goudron. — On met du goudran et de la poix sur les planches du navire. E. BINET, Merv. de nat., p. 110 (G., Compl.). Gouderonner. Goudronner. — [Diogène] le
tournoit [son tonneau]... gouldronnoit, mitton-noit. R A B E L A I S , III, Prologue. — Le sapin, la pesse, la meleze fournissent de bois fort propre a, flotter sur les eaux, etsirendentlapoixetlaresine pour les godranner et poisser. A M Y O T , Propos de table, V, 3. — Ils ont leurs cheveux si longs qu'ils leur passent le nombril, lesquels ils poissent et gouderonnent de gomme et autres matières, THEV E T , Cosmogr., XI, 7.
Gouildronné. Goudronné. — C. goildronné. R A B E L A I S , III, 26. — Œufz fritz... barbouillez, gouildronnez. ID., IV, 60. — Les enfermez y jet-tèrent un amas de javelles gouildronnées, et ce feu leur donna quelque temps pour parlementer, A U B I G N É , Hist. univ., XIII, 21.
Gouderope. Espèce d'huître. — On tient que portant sur soy une gouderope simplement, elle guérira de la tierce. D u PINET, trad. de PLINEI X X X I I , 10 (G.). Goudet, v. Godet.
— 343 — GOUJAT Goudouez. Accoudoir? — Le lict, l'orillier, le
goudouez, le couessin de balle d'orge. Ane Poés. franc., IV, 279.
Gouest. Variété de raisin. — Les noms des raisins... sont... prunelat, gouest, abeillane. O. D E SERRES, Théâtre d'agric, III, 2.
Gouet, v. Goy.
Gouetron. Goitre. — Ce qu'on dit en françois gouetre ou gouetron, en grec, bronchocele. A M B R . PARÉ, VI, 9. — Aussi ont-ils appelé endémie une maladie qui est propre et familière en certain pays, comme les escrouelles en Espagne, le gouetron en Savoye. ID., XXIV, 1. Goufarin, Gouffanon, v. Golfarin, Gonfanon.
Gouffique. Sorte de coquillage. — Nous avons veu ung chasteau fait d'esquailles de gouffiques et une roche de fin or d'un costé, et d'autre costé tout de cristal. Var. hist. et litt., V, 165. Gouffre. Golfe. — Finablement la fortune des
vents les transporta dedens la mer de Carpathie et en la mer Pamphylienne, là ou est le gouffre de Sathalie près du rivage de Turquie. L E M A I R E D E BELGES, Illustr., II, 11. — Nous navigions ensemble par le gouffre Arpin pour aller en Helles-pont. B. D E LA GRISE, trad. de G U E V A R A , l'Orloge des princes, 1,17. — Quand il fut dedans le gouffre que l'on appelle Heliaque. A M Y O T , trad. de DIODORE, XI, 1. — Le gouffre de la Moree n'estoit aucunement lieu propre ny commode à combattre pour eulx. ID., ib., XI, 3. — Eurybiades... voulant... se retirer dedans le gouffre du Peloponese, là où toute l'armée de terre des Peloponesiens estoit assemblée, Themistocles y contredit. ID., Thémistocle, 11. —> Les autres allèrent premier en I'isle d'Euboee, et de là aux Oetaiens et par tout le gouffre de Malea. ID., Périclès, 11. — Cleopatra entreprenoit... de faire enlever ses navires de l'une mer, et les faire traîner et charier jusques en l'autre par dessus ce destroit, et après que ses navires seroyent descendues dedans ce gouffre d'Arabie... s'en aller... habiter en quelque terre sur l'Océan. ID., ib., 69. — Lors que le capitaine génois Christophle Coulomb... eut apporté en Es-paigne les premières nouvelles de la coste par luy descouverte entre la région Parienne et le gouffre d'Uraba. CHOLIÈRES, lre Matinée, p. 19. — Cf. Goulfe. Gouffreux. De la nature d'un gouffre. — Dans l'abisme gouffreux de la mer plus profonde. P. DE B R A C H , 1er Liv. des Poèmes, l'Aimée, 1 r°. — La scylléenne rage Le costé droit assiège, et au gosjer gouffreux Charybde tient la gauche. 1583. VIRGILE, 138 b (Vaganay, Deux mille mots). — (Fig.). Ou soit qu'il allumast un autre clair flambeau Sur le front de l'amas encor tout voilé d'eau : Qui, volant à Pentour, donnoit le jour par ordre Aux embrouillez climats de ce goufreux desordre. Du BA R T A S , lre Semaine, 1er jour> p 26. — Ainsi tout ce grand univers, Ce beau bastiment tant divers, Est sorti du goufreux desordre D u chaos en soy mutiné. R A O U L CAILLER, dans la Puce d'E. Pasquier (II, 978). Goufle, v. Gonfle. Goufreux, v. Gouffreux. Gouge. Femme, fille. — En son eage virile
[Grandgousier] espousa Gargamelle, fille du roy des Parpaillos, belle gouge et de bonne troigne. RABELAIS, I, 3. — Voilà les enchantemens que lont ces gouges mal-heureuses par les coings secrets. Trad. de F O L E N G O , L. X V I (II, 67)
Savante. — D'un prestre chapelain à ung chevalier de Bourgogne, lequel fut amoureux de la gouge du dit chevalier. N I C O L A S D E T R O Y E S , te Grand Parangon, Table, p. XLV. Gougeart. Valet d'armée. — Un gougeart et
un h o m m e y laissèrent la vie. A. M O R I N , Siège de Boulogne, 13 (G.). — Il avoit avec luy des soldatz et goujards assez légers d'entendement et de mœurs impudiques. Chos. mem. escr. par FR. R I -C H E R , p. 99 (G.). — Vous suivrez le bagaige à grands coups d'estrivières, L'injure et le mespris des goujards inhumains. Var. hist. et litt., IV, 364. — L'inhumanité des soldats et desloyauté des goujards. Ib., VII, 299.
Gougeat, v. Goujat. Gougeataille, collectif péjoratif. — Il fit
[avancer?] ce qu'il avoit d'harquebusiers, ses coureurs, et laissa eschaper au devant quelque gougeataille. A U B I G N É , Hist. univ., XI, 16.
Gougourde. Gourde. — Deux gougourdes De vin trop pesantes et lourdes. Les Muses incognues (G., Compl.).
Gouguette, Gouillard, v. Goguette, Goulliard. Gouimphe. Sorte de bonnet de femme (Le
Double), ou Gond (Albarel). Voir Rev. des Et. rab., III, 236). — La voulte [du cerveau] comme un gouimphe. R A B E L A I S , IV, 30.
Goujard 1, v. Gougeart.
Goujard 2. Sorte de poisson. — Avec les pans de rets et les trubles on prent les mulets... les goujars de mer et les loubines. A M Y O T , Quels animaux sont les plus advisez, 26. Goujat. Valet d'armée. — Goujats, fourbissez
m a rondelle. BAÏF, le Rrave, I, 1. — Ils passèrent tous ces pauvres soldats au trenchant de l'espée, et n'y demeura un seul gougeat qui ne sentist la mesme furie. T H E V E T , Cosmogr., XIV, 12. — Combien avons nous de goujats compaignons de nostre gloire? M O N T A I G N E , II, 16 (III, 12). — Il n'y a si petit corporel, sergent de bande, lance-pessade, soldat, voire mesme goujat, qui ne vous dise que c'est le moins de ce que je sçay faire. T O U R N E B U , tes Contens, IV, 2. — Ceste libéralité fut si générale que jusques aux goujats des soldats chacun bailla. L A N O U E , Disc, polit, et milit., X X V I , 2, p. 748. — Ceux qui les portoient [les mousquets] les nommoit-on mousquetaires, très-bien appoinctez et respectez, jusques à avoir de grands et forts gojatz qui les leur portoient. B R A N T Ô M E , Cap. estr., le Duc d'Albe (I, 103). — On a veu des simples soldatz, voire des pionniers et gouyatz, en faire de mesnies. ID., Couronnels franc. (VI, 110). — Force l'avoient veu, aux premières guerres, goujat du sergent Navarre. ID., ib. (VI, 197). — Aussi peu profita l'escalade générale, que l'on présenta de tous costez, repoussée par fort peu de soldats, qui s'aidoyent des femmes et des goujats. A U B I G N É , Hist. univ., VII, 11.
Goujate. Servante. — En voiant son mary le sarot en la teste et le belluteau entre les mains, se print si fort à rire... que à peyne luy peut elle dire : « Goujate, combien veulx tu par moys de ton labeur? » M A R G . D E NAV., Heptam., 69. — De quel courage souffrirons-nous que nos esclaves, ces petites goujattes d'amour... ces pissepots de nos maris, nous bravent...? Var, hist. et litt., V, 301. — Je te feray taire, maraude. — Aux mains, coquin I... Ne sçais tu pas... que je suis soldate? — Je sçay bien que tu as esté goujatte, et que tu as couru le régiment de Picardie. A U B I G N É , Sancy, II, 1.
GOUJON . — 344 —
Goujon. Fer, chaîne. — Or estoit le dessein de nos braves guerriers D'arracher les goujons à tous les prisonniers, Pour s'en servir après à finir l'entreprise. MONTCHRESTIEN, tes Lacenes, III, p. 183.
Gouju. Robuste. — Mondit frère... jugea en soy-mesme que ceste garce ne pouvoit avoir un chancre, estant ainsi grasse, potelée et goujue. AMBR. PARÉ, XIX, 22.
Goulafrer. Dévorer. — (Fig.). Mais ilz sont des enfans prodigues, Grans despensiers, gasteurs de biens, Goulafrent tout, n'espargnent riens. E. D'AMERVAL, Liv. de la Deablerie, 24 a (G.).
Goulee. Ce qui peut être contenu dans la bouche ou la gueule, ce qu'on tient dans la bouche ou la gueule. — J'estois possible beuvant cho-pine... ma jument ayant une goulée de foing devant elle. Du FAIL, Baliverneries d'Eutrapel, p. 18. —• Il prioit ceux et celles de la compagnie qui... estoyent bons catholiques de prendre une goulée d'herbe à belles dens. H. ESTIENNE, Apol. pour Her., ch. 36 (II, 249). — [Un renard] s'en vint cautement happer à belles dents une pie... mais il ne la print seulement que par la queue, qui la causa de s'envoller subitement... et fut le pauvre naudin eslevé fort haut, qui onc ne lascha sa goullee. PH. D'ALCRIPE, la Nouvelle Fabrique, 102. Ce que l'on a à dire, ce que l'on dit. — Chascun
a getté sa goulée, Parlant sur nous à la volée. Ane Poés. franc., XII, 291. — Chacun des regar-dans avança sa goulee, et profera la somme du prix des délices qu'il avoit imaginées. BE R O A L D E D E VERVILLE, te Moyen de parvenir, Cérémonie (I, 30). — Si tost que quelqu'un ouvrait la bouche pour prononcer sa goulee, aussi tost les secrétaires le mettoient par estât. ID., ib., Vidimus (1, 47). D'une goulee. D'un seul trait. — J'estime (si tu
avois faute d'auditeurs) que tu viendrais librement à quelque colomne ou quelque statue, pour vomir ensemblement tout cecy d'une goulee. F. BRETIN, trad. de LUCIEN, te Banquet ou les Lapites, 4. Goulet. Goulot, col. — Le goulet de l'urne. 1549. Entrée de Henry II à Paris (G., Compl.). — Une bouteille qui a le goullet estroict. J. L E BLOND, Liv. de pol. hum., 53 v° (G., Compl.). — Si d'adventure il y avoit quelque ordure et quelque limon au fond, il s'arrestoit aux orées du ventre [du gobelet laconique] et n'en venoit par le goulet que la plus nette partie à la bouche de celuy qui y beuvoit. A M Y O T , Lycurgue, 9. — Ils ressembloient aux vases qui ont le goulet estroict. A M Y O T , Comment il faut ouir, 18. —• La grue, l'aiant aussi convié à son tour à disner, luy présenta la viande dedans une bouteille qui avoit le goullet long et estroit. ID., Propos de table, 1,1.— Si feit apporter un vaisseau de terre qui avoit le goulet fort estroict. ID., ib., I, 4. Ouverture étroite, passage étroit. — Il nous
dist... que nous les verrions bien par ce petit goulet de fenestre. RABELAIS, V, 16, édit. de 1562. — Pour vanger son fils, sa congnee II a sus le champ empongnee, Se plante au goulet du serpent. Et tant attendre délibère Que celle méchante vipère, S'ellesort, il tue l'attrapant. BAÏF, lesMimes, L. III (V, 165). — Il prend les calices d'or et d'argent, qu'il met en un sac, lequel ne luy semblant pas assez plein, il rompt encores un crucifix, emplissant le sac jusques au goulet. FAUCHET, Lang. et Poes. franc., II, 89. Goulette. Petit canal. — Auquel lieu se joinct le ruisseau de Vauharlantz à la rivière de Bièvre,
provenant des goulettes que les particuliers font à ladite rivière pour arrouser leurs prez. Var. hist et litt., II, 225. Goulfarin, v. Golfarin.
Goulfe. Golfe. — Entre l'onde Erythrée et le goulfe Persique. Du BARTAS, Sec. Semaine, Sec. Jour, les Colonies, p. 225. — Nous estions prests à passer le goulphe de Livourne, qui est très-dangereux. BR A N T Ô M E , Sermens et juremens espaignok (VII, 200). Gouffre. — Les goulfes engouleurs les no
chers tant n'estonnent. P. MATTHIEU, Aman, I, p. 18. — (Fig.). Constance ne faict voyle a tant d'opinions... Et sage ne s'embarque aux goulfes de ces doutes. L. P A P O N (Suppl.), la Constance, p. 11. — Voila les trois goulphes et précipices d'où peu de gens se sauvent. CHARRON, Sagesse, 1,19. Goulier 1. Bouche. — Ainsi les pauvres gens
vivent d'ombrages : cela leur passe rasibus du goulier. B E R O A L D E D E VERVILLE, te Moyen de parvenir, Chapitre gênerai (1, 124). Goulier 2. Criard ? — O misérable et goulier
fresaye, va et chante sur la maison ou ilz habitent. Trad. de BOCCACE, Flammette, ch. vi, 82 r°. Gonllardement. Gloutonnement. — Le loup
mangeue goullardement. Jard. de santé, II, 88 (G., Goliardement). Grossièrement. — Duquel [M. de Guise] ilz
parlent si goffement et goullardement qu'homme, s'il n'estoit extrêmement hérétique, n'en auseroit avoir approché. CO N D É , Mém., p. 642 (G., Goliardement) . Goulle. Embouchure. — [Le Tigre] entre en
la mer par deux goulles comme si elles se depar-toyent l'une de l'autre. JEAN-ALFONSE SAINTON-GEAIS, Cosmographie, p. 358 (Sainéan, Rev. des Et. rab., X, 49). Goullee, Goullet, v. Goulee, Goulet. Goulliard. Glouton. — Gouillard, tu prensle
gras pour toy. Sotties, II, 293. — Parlons de ces goinfres gouillards. 1594. Plais, dev. des supposts du S1 de la Coquille (G., Goliurt). — Augustins, rustres et gouillars. 1560. Cuisine papale, p. 21 (G. Goliart). Qui exprime la gloutonnerie. — A leur lever
pensoient à leurs bobances, En s'abillant disoient goulliars motz. GRINGORE, tes Folles entreprises, 1, 134. Goulousant. Avide. — Elle [yvresse] est de
tous maulx goulousans. J. BOUCHET, Regnars travers., 95 r° (G., Golosant). Goulpharin, Goulphe, v. Golfarin, Goulfe. Goupil, noté comme vieux mot. — Nous trou
vons goupil pour renard (comme en ce proverbe, A goupil endormi ne chet rien en la gueule...). H. ESTIENNE, Precellence, p. 251. Goupiller (?). — Les deités (sujet des vieilles
fables) Ont seules goupillé aux forets devoyables, Aux grottes, aux rochers, aux esgarés déserts, Fuyant la multitude, ont aimé les bois verds. Ri-VAUDEAU, Hymne de Marie Tiraqueau. Gouppellette, dimin. de goupil, renard. —
Prenez les petites gouppellettes qui honnissent et mangeussent les vignes. Bible, Cant. de Salo-mon, ch. 1 (G., Goupillette). Gour, Gourd 1, v. Gord. Gourd 2. Engourdi, paralysé, maladroit. —
[Jésus-Christ] Sa deité monstre par ses miracles
En guérissant les gens demoniacles, Faisant parler muetz et ouyr sours, Et aller droit les courbes et les gours. J. B O U C H E T , Epistres familières du Traverseur, 90. —• S'ils nous ont vaillans assaillis, Nous n'avons eu les cœurs faillis, N y les bras gourds à nous défendre. R. G A R N I E R , Antigone, 1499. — Luy mesme y court soudain, s'appelle malheureux, Gemist, soupire, pleure, et ses gourdes mains rue Sur ses cheveux grisons et sa barbe chenue. ID., ib., 2541. — Celuy qui a des crevasses aux doigts, ou qui les a gourdz. M O N TAIGNE, II, 12. — Les mains, je les ay si gourdes que je ne sçay pas escrire seulement pour moy. ID„ II, 17 (III, 33). — (Fig.). En l'hiver, quand le ciel de néges nous menace, Et que les gourdes eaux se raidissent en glace. B E R E A U , Eglogues, 3. Qui engourdit. — Froid, Froidureur, ou Froi
dure. Aspre... gourd, i. roide ou endormy. M. D E LA PORTE, Epithetes, 184 r° et v°. — Tousjours Tardant esté ne dure Sur le sein des champs endurci, Et tousjours la gourde froidure Ne les endurcist pas aussi. R. G A R N I E R , Marc Antoine, 163. Gourd 3. Riche, bien paré. — Tel mendye qui
a esté bien gourt. Ane Théâtre franc., III, 250. Bon. — Pour complaire aux gourmetz, Deslibe-
rez desjuner de gours metz. CRÉTIN, Débat sur le passetemps des chiens et oyseaux, 96. — Voicy du gourd piot à une aureille, Avec des aulx, oignon-netz et bon pain. Ane Poés. franc., I, 241. Gourd, en ce sens, appartenait peut-être à l'ar
got. — Ils nomment... du vin du pivois... quand le vin est bon, il est gourd. GUILL. B O U C H E T ,
15* Seree (III, 129). Brouer dessus le gourt. Aimer à boire de bon vin.
— A tous vrais gueux qui brouent dessus le gourt, Je leur laisse, pour toute recompense, Mon kalendrier. Ane Poés. franc., V, 151. Sur le gourd. Bien vêtu, bien paré, avec faste,
élégamment. — Ha, dit Rouen, si la noblesse accourt Par devers moy, j'espère sur le gourt Monstrer largesse en toute esjoyssance D'avoir le roy. J. M A R O T , Cinquante rondeaux, 5 (G). — Bagues, aneaulx, coquilles et templectes Et béa-tilles sur le gourt façonnées. Ane Poés. franc., XII, 44. — La dame me veit sur le gourt, Gay et gaillard, selon la mode. R. D E C O L L E R Y E , Monologue du Résolu. —• Marchant je suis de gorre au temps qui court... Pour ung carcan bien garny, sur le gourd, On me bailla soubdain de la plus chière. Ane. Poés. franc., II, 108. — Apres qu'un de mes compagnons, Estant accoustré sur le gourt, M'eut bien fait cognoistre les noms De tous mes seigneurs de la cour. Nie. A U B E R T , dans Bourgueville, Rech. de la Neustrie, 1, 45 (G.). Gourd 4, mot d'argot. Fourberie. Enterver le
gourd. S'entendre au métier de gueux. — Il n'estoit coesme, n'ayant parvenu à ce degré, ains estoit simple blesche, et sortoit de pechonnerie, toutefois entervoit le gourd. Var. hist. et litt., VIII, 150. — Je fus accosté de tous les péchons, Wesches et coesmelotiers hurez, pour sçavoir si j'entervois le gourd et tontine, m e demandans le mot et les façons de la cérémonie. Ib., VIII, 154. Gourdement, mot d'argot. Beaucoup. — Nous
passons temps joyeusement ; Nous rivons le bis gourdement. Farce trouvée à Fribourg (P. Aebis-cher, Rev. du XVIe siècle, XI, 171). Gourd-foullement (pour gourfoulement). Con
tusion, dommage. — A fin de nettoyer son corps ît résoudre les meurtrisseures et gourd-foullement ïu'il a eu en sortant hors du ventre de sa mère. MIBR. P A R É , XVIII, 17.
GOURMANDEMENT
Gourdi, mot d'argot. — Huré ou gourdi. Bon vin ou mauvais. Var. hist. et litt., VIII, 184.
Gourdier, v. Haut gourdier.
Gourdine, Tenture, rideau. — 1523. Une aultre gourdine de taffetas cramoisy de 4 aulnes de long et 4 aulnes un cart de large. Inv. de Marguerite d'Autriche, 133 v° (Gay, Gloss. archéol). — 1558. Une grande baignerie de teille blanche : assavoir ciel et dossiel et les gordines tenant ensemble. Inv. de Philippe II, 9 v° (Gay). — 1597. Une gordine de taffetas violet pour tendre devant la table d'autel en quaresme. Inventaire, 74 v° (Gay). Gourdy. Engourdi. — (Subst.). Agardes ce
gourdy, il est si poussif qua payne peult il parler. P A L S G R A V E , Esclare, p. 429.
Goureaulx. Sorte d'étouppes. — 1597. Nuls ouvriers tels qu'ils soient ne doivent mettre goureaulx en neuf ouvrage. Stat. des tonneliers de Laon (Gay, Gloss. archéol).
Gourfouler. Endommager. — Dedans un beau jardin long, large et spacieux, Peuplé de mille fleurs qui ne craignent l'injure D'un yver englacé tout roidy de froidure, Et qui gourfoule tout d'un pas audacieux. L A R I V E Y , trad. des Facétieuses Nuits de S T R A P A R O L E , XI, 1.
Gourfoule. Endommagé, maltraité. — U n es-tranger à qui le faict n'eust point touché en eust bien ploré, de veoir un si beau lieu ainsi despouillé de sa beaulté, et toute la terre gourfoulée. A M Y O T , Daphnis et Chloé, L. IV, 65 v°.
En désordre. —• Elle... tira le verrouil, et ouvrit au bon h o m m e Calasiris, lequel (voyant ses cheveux ainsi gourfoulez et emmeslez, sa cote dessirée sur l'estomach, ses yeux encore tous enflez, tesmoignans la fureur d'impatience en laquelle elle avoit esté avant que s'endormir) en entendit incontinent bien la cause. A M Y O T , Hist. Mthiop., L. VI, 68 r<>.
Gourgiaser, v. Gorgiaser. Gourgonceau (?). — Lequel tenoit grand ri
gueur aux gens d'église, les appellant grimauds gourgonceaux. J. V A U L T I E R , Hist. des chos. fait. en ce roy., p. 169 (G.).
Gourgouille. Bouillonnement, agitation. — Chacun demeurant dedans les limites de son devoir... le peuple ne fust entré en gourgouille. E. P A S Q U I E R , Lettres, XIII, 17.
Gourgouillement. Gargouillement. — Réduisant une hargne, si on oit des vents, comme un gourgouillement, on la juge intestinale. A M B R . P A R É , Introd., ch. 23.
Gourgous. Querelle. — Y eut quelques paroles entre eux de racoustrement sur quelque gourgous qui avoit esté à Amboise entre mesdites dames la mère du roy et belle mère de mondit sieur de Bourbon, a cause du mal traitement de mondit sieur. M A R I L L A C , Vie du Conn. de Rour-bon(G.). Gourgue. Canal de moulin. —• Acquisition de
moulin du Luc avecques toutes les eaux, def-fuytes, gourgues et autres appartenances et dep-pendances. 1er août 1521. Arch. Gir. (G.).
Gourguillon, v. Gurgulion. Gourier, v. Gorrier. Gourmandement. Gloutonnement. — Les
biches... viandent gourmandement. D u FOUIL-L O U X , Ven., ch. 22 (G.).
Avidement. — Et ne doibt une femme avoir les
15
GOURMANDER — 346 —
yeux si gourmandement fichez sur le devant de son mary qu'elle n'en puisse veoir le derrière, où besoingest. M O N T A I G N E , III, 9 (IV, 85).
Gourmander (intrans.). Manger avec gourmandise, avec excès. —• Toute la nuict luy et les siens ne cessèrent de baller ou de gourmander. Amadis, II, 19. — Camille... se tenoit tout coy... jusque a ce quil eut advisé ceulx qui estoient sor-tiz au fourrage estre esquartez et espanduz parmy les champs : et les aultres qui estoient demourez au camp ne faire aultre chose que gourmander et yvrongner. G. D E S E L V E , Huict Vies de P L U T A R Q U E , Camille, 29 r°. — On m e doit moins reprendre De tel soûlas que de long dormir prendre... Ou qu'a jouer a paulme, detz et cartes, Ou gormander près des pintes et quartes. J. B O U CHET, Epistres familières du Traverseur, 41. — Le vin est bon de soy, et la viande, Mais qui de vin et viande gourmande, Buvant, mangeant par trop, s'en trouve mal. ID., Epistres morales du Traverseur, I, 7. — Manger du bon (qui bien y vise) N'est gourmander, mais friander, N'est gourmandise, ains friandise. C H . F O N T A I N E , Epigrammes, L. I. — Les valets des Medes... s'es-toyent mis à yvrongner, gourmander. J. D E VI N TEMILLE, trad. de la Cyropedie, IV, 10. —• II surprend ses ennemis, et se rue sur eux de nuict, voire alors qu'ils pouvoyent estre à leurs aises, et après avoir bien beu, mangé et gourmande. CAL VIN, Serm. sur la Genèse, 1er sur Melchisedec (XXIII, 647). — Si on voit qu'un enfant gourmande trop, on ostera ce vice, et luy retranchera on ses morceaux. ID., Serm. sur le Deuter., 127 (XXVIII, 35). —• Ces bons biberons (qui estoient à table le doz au feu) les font seoir près d'eux... de sorte qu'un chacun fist tel devoir de gourmander et grenouiller qu'à grand peine peurent assez tost trouver leurs maisons pour dormir. Les Comptes du monde adventureux, 41 (II, 55). — Ilz n'avoyent ordonné guet ny gardes quelconques, ains estoyent espars ça et là par les maisons à gourmander et yvrongner ensemble. A M Y O T , Camille, 35. —• Mais c'est chose à Dieu détestable, D'estre assis trois heures à table A yvrongner et gourmander. H. E S T I E N N E , Apol. pour Her., ch. 20 (I, 424). —• Il resjouira et contentera plus la compagnie que celuy qui s'enyvreroit et gourmand eroit jusques au crever avec eulx. A M Y O T ,
Règles et préceptes de santé, 5. — Les jours de festes... ne leur est imputé à vice de s'en-yvrer et gourmander, mais à grand honneur. T H E V E T ,
Cosmogr., X X , 12. — Les vers de Petronius... ne m'inciteroient point à boire... mais m e feroient bien penser ailleurs qu'à m'enyvrer et gourmander. GUILL. B O U C H E T , lre Seree (I, 39).
(Trans.). Manger gloutonnement, avidement, dévorer. — Jamais h o m m e ne sceut mieulx prendre, larder, roustir et aprester, voyre, par Dieu démembrer et gourmander poulie que moy. R A B E L A I S , 1, 34. — Il y avoit des oblations faites aux povres de ces décimes ici : car il n'est pas dit que les sacrificateurs d eussent tout gourmander, mais qu'ils se dismeroyent eux-mesmes. CALVIN, Serm. sur la Genèse, 3e de Melchisedec (XXIII, 671). — Irus, maraut tout rempli de malheur, Melanthius aussi, le conseilleur De gourmander le tien bestail, gourmandent. C H . F O N T A I N E , tes XXI Epistres rf'OviDE, Ep. 1, p. 24. — Quel bien tire celuy de ses terres fertiles, Sinon voir de ses yeux cent bouches inutiles Gourmander tout le sien? R. B E L L E A U , Discours de la Vanité, ch. 5 (II, 278). — Mais à qui mieux mieux lon gourmande, Par honeur, toute la viande. BAÏF, te Brave, III, 1. — A quoy, glouton oyseau, du
ventre renaissant D u fils du bon Japet te vas-tu repaissant? Assez et trop long-temps son poulmon tu gourmandes. R É G N I E R , Sat. 10.
Avaler. — Ainsi que la perle indienne Que la prodigue Egyptienne Gourmanda seule en un repas. R. B E L L E A U , tes Amours des pierres précieuses, la Perle (II, 190). — Les uns en jouyssent sans jouyr, gourmandent cette proye et ne la savourent pas. A U B I G N É , Médit, sur le Ps 16 m 215). " l '
Gaspiller. — Peu vault maison où gist povre conduicte, Et que l'on voit la famille reduicte A yvrongner, paillarder, friander, Et du maistre bletz, vins, biens gourmander. R. D E COLLERYE Rondeaux, 51. — Ceux qui ont des biens les gourmandent tous seulz, ou les tiennent serrez, sans avoir pitié de leurs povres frères, pour subvenir à leur indigence. CALVIN, Contre les libertins, ch. 21 (VII, 215). — Exerçons-nous donc en ceste doctrine : c'est, quand nous passons par ce monde, que nous ne gourmandions point les biens que Dieu nous envoyé, pour estre ici comme bestes brutes, ayans les museaux fourrez en terre. ID., Serm. sur le Deuter., 12 (XXVI, 22).— Si un h o m m e a gourmande tout son bien, et qu'il n'ait plus rien de quoy payer, sera il quitte de ses detes pour cela? ID., Serm. sur l'Epitre aux Ga-lates, 11 (L, 493). — II est temps d'accuser ceux-là qui ne font rien Sinon vendre leur rente et gourmander leur bien. R O N S A R D , Hymnes, L. II, Hymne de l'Or (IV, 351). — La corneille tu es, ô sotte et sans cervelle ! Pour autant qu'au plus beau de ta saison nouvelle Tu gourmandes la fleur de tes jeunes amours. LARIVEY, les Tromperies, IV, 5.
Dévorer, mettre au pillage. — Car il n'y a nul gentilhomme riche Des habitans de Pile de Du-liche, L'ile de Same et Zacynthe l'ombreuse, Et nul seigneur d'Ithacque la scabreuse Qui tous ma mère à l'envy ne demandent En mariage : et sans cesse gourmandent Nostre maison. PELETIER DU M A N S , L. I de l'Odyssée, p. 21. — Voila donc comme le pape et tous les siens sont forclos de ce qu'ils prétendent leur appartenir de droict : et s'ils gourmandent les biens qui estoyent dédiez à ceux qui servent à l'Eglise de Dieu, il faudra en la fin qu'ils en rendent conte. CALVIN, Serm. sur le Deuter., 70 (XXVII, 26). — Le gendarme pillard nous outrage, et par force Gourmande nostre bien. B E R E A U , Eglogues, 3. —• Un prince de valeur doit plus tost hazarder Le combat que de voir ses pays gourmander. J E A N D E LA TAILLE, U Prince Nécessaire, ch. 3. — Si plus nos vieux corbeaux gourmandent vos finances... Et si quelque affamé nouvellement venu Veut manger en un jour tout vostre revenu. R O N S A R D , te Bocage royal, lre part. (III, 207).
Dévorer [un livre], le lire avidement, vite, — Il aiguisoit m a faim, ne me laissant qu'à la desro-bée gourmander ces livres. M O N T A I G N E , I, 25 (I, 218). — Pour le lire fructueusement, il ne le faut pas gourmander, ains le faut peser et priser, et chapitre après chapitre le ruminer. S* FRANÇOIS D E SALES, Lettres, 184 (XII, 190). Dominer, maîtriser, tyranniser. — A Theodose succédèrent deux jeunes garçons ses enfans, Arcade et Honore, commandez, ou pour mieux dire gourmandez, pendant leurs minoritez, par Ruffin et Stilicon, leurs gouverneurs. E. PASQUIER, Recherches, I, 7. — [L'âme] le devoit chastier [le corps] et punir bien aigrement pour sa des-bordee et licencieuse intempérance, et nous la luy laissons seigneurier, gourmander et tyranniser. MONTAIGNE, trad. de R. S E B O N , ch. 232. — L'esprit
fut gourmande par le cors, son organe, Et le cors de l'esprit ne fut que la prison. A U B I G N É , te Prim-temps, II, 16. —• Outre l'inclination au vice, il semble qu'ils [les princes] y adjoustent encore le plaisir de gourmander et sousmettre à leurs pieds les observances publiques. M O N T A I G N E , I, 42 (I, 363) — La bestise et la sagesse se rencontrent en mesme poinct de sentiment et de resolution à la souffrance des accidens humains : les sages gourmandent et commandent le mal, et les autres l'ignorent. ID., I, 54 (1, 428). — Je sçay qu'on peut gourmander l'effort de ce plaisir... et n'ay point trouvé Venus si impérieuse déesse que plusieurs et plus reformez que moy la tesmoignent. ID. 11,11 (11,138).—Si nous pensions par vertu estre tousjours maistres de nostre ennemy et le gourmander à nostre poste, nous serions bien marris qu'il nous eschappast, comme il faict en mourant. ID., Il, 27 (III, 105). — Rompez la [votre affection] à divers désirs, desquels il y en ayt un régent et un maistre, si vous voulez, mais de peur, qu'il ne vous gourmande et tyrannise, affaiblissez le... en le divisant et divertissant. ID., III, 4 (III, 306). — Je voy nonchalamment la mort, quand je la voy universellement, comme fin de la vie. Je la gourmande en bloc : par le menu, elle me pille. ID., ib. (111, 309). — [Le connétable de Saint-Pol] soùstenu du vent de tant de faveurs... commandoit ou, pour mieux dire, gourmandoit un roy de France et un grand duc de Bourgongne. E. PASQUIER, Recherches, VI, 10. — L'avare est aux richesses, non elles à luy, et il est dit avoir des biens comme la fièvre, laquelle tient et gourmande l'homme, non lùy elle. C H A R RON, Sagesse, 1, 21. — C'est un grand bien de se maintenir en la possession de gourmander la gourmandise mesme, et tenir l'appétit sensuel et le cors sujet à la loy de l'esprit. S* F R A N Ç O I S D E SALES, Vie dévote, III, 23. — En quelle réputation vous auront ils... de vous voir... souspirer honteusement pour une petite basteleuse et de condition abjecte qui, sous ombre d'un petit esclat de beauté passagère, fera gloire d'avoir gourmande le plus bel esprit du monde? B E ROALDE D E VERVILLE, Voyage des princes fortunez, p. 111. Tenir sous le feu du canon, de l'arquebuse. —
A la Corraterie les approches sont tellement gour-mandees par ceste mesme eslevation... que la ville est saine de costé. A U B I G N É , Lettres de sources diverses, 27 (I, 590). — En peu de temps... la bresche fut raisonnable, battue en courtine de bas en haut par deux moyennes logées au bout du fauxbourg, et de plus gourmandée en front d'une barricade plantée sur la contr'escarpe. ID., Hist. univ., V, 27. — Ceste petite place gourmandée fut bien tost toute en bresches. ID., ib., VII, 10. Maltraiter, tourmenter, faire souffrir. — J'es
time... que... le glaive soit esté baillé aux seigneurs pour défendre les petits et les gens de bien d'estre gourmandez par les plus forts et par les meschans. R. D E F O U R Q U E V A U X , Instruct. sur le faict de la guerre (A. Lefranc, Rev. du XVIe siècle, III, 119). — Ce sont donc les peuples mesmes qui se laissent ou plustost se font gourmander, puis qu'en cessant de servir ils en seraient quittes. L A BOETIE, Servitude volontaire, p. 9. — La nature... n'a pas envoie icy bas les plus forts ny les plus avisez, comme des brigans armés dans une forest, pour y gourmander les plus foibles. ID., ib., p. 16. — Ceulx qui vivent de larcin... et brigandaiges privez et publics, ceulx qui sont accoustumez à violence, outraiges et oppressions, qui veulent incessamment gourmander les petits. L'HOSPI-
GOURMETER
TAL, Reformation de la Justice, 2e part. (IV, 89). — Tullius Marcellinus... voulant anticiper l'heure de sa destinée, pour se deffaire d'une maladie qui le gourmandoit plus qu'il ne vouloit souffrir... appella ses amis pour en délibérer. M O N T A I G N E , II, 13 (II, 390). — Celle-là seule [une galère] gourmandée d'arquebusades, fut prise avec l'aide des forçats, qui se rendirent ennemis de leur maistre au cri de liberté. A U B I G N É , Hist. univ., V, 25.
Gourmanderie, v. Gourmandeur. Gourmandeur. Gourmand, dissipateur. — Les
caffardeux jouans aux dez et gourmendeurs. E. D ' A M E R V A L , Liv. de la Deablerie, 89 b (G.).
(Jeu de mots sur gourmandeur et commandeur, gourmanderie et commanderie). —• Comment les oiseaux gourmandeurs sont muets en l'Isle sonnante. RA B E L A I S , V, 5. — Nous les appelons gourmandeurs, et ont grand nombre de riches gourmanderies en vostre monde. ID., ib.
Gourmandie. Gourmandise. — Epistre envoyée par l'acteur, faisant mention de mardi gras et karesme, de gourmandie et sobriété. J. B O U CHET, Epistres familières du Traverseur, 52. — De grant gourmandie Et boire trop procède paillar-die. ID., Epistres morales du Traverseur, 1,1. — Que sobre on soit de vin et de viande, Car gourmandie a luxure affriande. ID., ib. — Hz ne vouldroient maculer leur noblesse De gourmandie, et, qui pis est, d'yvresse. ID., ib., Il, i, 15.
Gourmendeur, v. Gourmandeur. Gourmer 1. Se gourmer. Jeter sa gourme. —
Chair de tortue qui premièrement aura esté nourrie en quelque jardin, pour se gourmer et purger de ses humidités excrementitielles. A M B R . P A R É , X X , i, 35. Gourmer 2. Frapper, battre, réprimander. —
Vous en voulez bien à nos pauvres mains : il faut que, cependant que friponniez en galoche, quel-cun qui est aujourd'huy advocat vous ait grommé. CHO L I È R E S , 3e Matinée, p. 93. — Phi-lippes, l'épissié, a esté grommé pour avoir chanté une chanson lubrique. Var. hist. et litt., I, 218.
Se gourmer. Se battre. — S'il eust fallu venir aux coups de poings, les femmes estoient plus propres pour effrayer que pour se grommer et soustenir le choc realifique. CHOLIÈRES, 5e Ap.-disnée, p. 195.
? — Tel on voit le poulain dont la bouche trop forte Par bois et par rochers son escuyer emporte, Et, maugré l'esperon, la houssine et la main, Se gourmer de sa bride et n'obéir au frein. R O N SARD, Discours des misères de ce temps (V, 335). Gourmet. Agent s'occupant de la garde des vins. — Gourmet. Soucieux, taste-vin, veillant ou vigilant, fidèle. C'est celuy auquel le marchant de vin commet la garde de sa marchandise, quand elle vient par eau. M. D E LA P O R T E , Epithetes, 195 ro — puis s'en va en la maison d'un gourmet, où il demande si on les pourrait mener en quelque bonne cave du lieu, pour y achepter jusques à soixante ou quatre-vingts queues de vin. T A B O U R O T D E S A C C O R D S , Escraignes dijonnoises, 28. Gourmeter. Gourmeté. Ayant une gourmette. — Qui prend pour son armet de son voisin l'armet... Qui d'un mousse baston s'arme au lieu d'une lance, Qui cuide encor songer, qui court en diligence, Qui dessus le destrier non encor gourmeté Monte sans espérons. D u B A R T A S , Judith, VI, p. 414.
Grommetter. Gourmer, maîtriser. — Le corps
7 —
GOURMICTÉ
grommettant, Il ira beaucoup plus au devoir profitant. Les Fanfares des Roule Bontemps, p. 27.
Gourmicté (?). — Tous peuples te despriseront, Te pilleront et destruyront Pour loyer de ta gourmicté. Moral à cinq personnages, dans le Théâtre mystique, p. 206.
Gournaud. Sorte de poisson. — Langoustes, Espelans. Guourneaulx. Truites. RABELAIS, IV, 60. — Dorades, rougets, gournauds. A M B R . PARÉ. XXIV, 22. Gournay (le pont de). (Phrase proverbiale).
— Vous n'avez pointde honte d'estreveusde tant de personnes qui vous regardent ! Vous ne devez vous soucier de rien. Vous avez passé sur le pont de Gournay. LARIVEY, tes Jaloux, IV, 3. Gourne, mot d'argot. — Hau rivage trutage,
Gourt à biart à nozis ; Lime gourne rivage, Son yme foncera le bis. Var. hist. et litt., VIII, 181. Gournitique, mot d'argot. — Il a limé en ter-
natique et gournitique. Var. hist. et litt., VIII, 155. Gourpin. Sainéan attribue à ce mot le sens de
bonne dupe. — Et si bien parvins à mes pointz Que les envoyé sans pourpoins, Et laissèrent toutes leurs plumes. — Pouac ! Cela sont mes coustumes. Ne les laissez gourpin ne hargne. Farce trouvée à Fribourg (P. Aebischer, Rev. du XVIe siècle, XI, 167). — En flouant le gourpin plumé, J'en ay maint sire desplumé. Ib., p. 168.
Gourre 1, v. Gorre 2. Gourre 2. — Joueurs, pipeurs, d'estuves les
piliers, Borgnes, goûteux, de gourre chanceliers. F E R R Y J U L Y O T , lre part., 28, Joyeux cry d'un abbé. (Les premiers mots porteraient à rapprocher gourre du verbe gourrer, tromper, et à lui donner le sens de tromperie; le vers suivant y ferait plutôt voir une forme de gorre, syphilis.)
Gourrement. Fastueusement. — A tous commande qu'il souviengne De moy maintenir gourrement, Affin que mon estât maintiengne. Ane. Théâtre franc., Il, 268. Gourrer 1. Vivre fastueusement. — Il n'en
tend pas qu'on vous baille le sien Pour en gourrer en pompeux entretien. J. B O U C H E T , Opuse, p. 133 (G). Gourrer 2, mot d'argot. Tromper. — Tantost
après voicy arriver les maistres cordonniers, ayans chacun une botte en la main : et se doutans qu'ils estoient gourrez, se regardans l'un l'autre, seprinrentàrire. GUILL. B O U C H E T , 15e Seree (III, 127). — Pour m'engarder d'estre affiné (qu'ils appellent gourre) des mattois qui mattent, je voudrais bien entendre leur jargon. ID., ib. (III, 129).
Voler. — Le marchand, pensant que ce fussent gens attiltrez pour gourrer sa chasuble, qui estoit de velours cramoisi, va aussi après le curé... criant au larron, au bailleur de foin à la mule, qui emporte et desrobe m a chasuble. ID., ib. (111,107)
Gourrier 1, v. Gorrier 1. Gourrier 2. Syphilitique. — Ulcère gourriere.
CH A S S I G N E T , PS., 77 (G.).
Gourrierement, v. Gorrierement.
Gourselot. Sorte de cheval. — Les aultres. pour leur nayfve agilité qu'apporte jeunesse, estoient montez sur gourselotz harnachez et cape-rensonnez conformeement à leur habit. Entr. de Henry II à Rouen, 9 r° (G.).
Gourron. Porc. — Je prins quatre boyceaux
de mousture au garnier que je faict mouldrepour les gourrons. 1534. Ms. du Poitou (G.).
Gourt, v. Gourd 3.
Gourt razis, terme d'argot. — Gourt razis, ar-chevesque. Var. hist. et litt., VIII, 184.
Gouspiller. Maltraiter, malmener, tourmenter. — Les chiens... mirent et sa chappe, qui estoit de veloux rouge, et son aube, et son omitton en cent pièces, et le gouspillerent de sorte que ses habillemens mesmes estoient tous à lambeaux. GUILL. B O U C H E T , Ie Seree (II, 49). — Il est tous-jours proclive aux femmes de disconvenir à leurs maris. Elles sesissent a deus mains toute occasion excusable de les gouspiller. M O N T A I G N E , II, 8, var. (Il, 88 et V, 104). — Si madamoiselle de Bourgoigne se fust mariée avecq'un autre qui fust esté pusilanime... le roy Louis la gouspilloit estrangement et la despouilloit delapluspartde ses terres et places, voire des meilleures, comm'il avoit desjà accommancé. B R A N T Ô M E , Cap. estr., l'Empereur Maximilien (I, 76). — (Fig.). 11 y gouspille la chasteté, il y deschire la continence, il y terrasse la modestie. D u VAIR, De la prière (p. 40). Gaspiller. — Après qu'ilz y eurent tout mangé
et gouspille, quatre compagnies qu'on avoit laissé dedans y mirent le feu. B R A N T Ô M E , Cap. estr., Guillaume de Fustemberg (1, 351). — Il y avoit des vivres et des vins pour deux ans ; mais ilz gous-pillarent, beurent et mangearent tout. ID., ib., U Couronne! Framsberg (I, 355). — (Fig.). La jeunesse des dieux aux hommes n'est donnée Pour gouspiller sa fleur ; ainsi qu'on voit fanir La rose par le chaud, ainsi, mal gouvernée, La jeunesse s'enfuit sans jamais revenir. Les derniers vers de R O N S A R D (VI, 300).
Gouspille. Maltraité, endommagé. — Cette lyonne... Le voile prit trouvé sans la maistresse, Et, de sa dent partout ensanglanté, Le laissa là gouspille et gasté. A M . J A M Y N , ŒUV. poet., L. V, 279 v°.
Gouspilleur. Gaspilleur. — Et leurs fils des-bauchez perdent en un printemps Le labeur malacquis de leurs pères, et comme Le père a déterré le simple gentilhomme Par procez embrouillé, les fils en sont vengeurs Et des biens paternels gous-pilleurs et mangeurs. R O N S A R D , Hymne de Mercure (VI, 317).
Gousse, mot d'argot. Gousse razis. Abbé. Var. hist. et lut., VIII, 185.
Gousser, mot d'argot. Manger. — Quand nous goussasmes les harens Que nous trouvasmes au caignard. Act. des Apost., 1,106 b (G.). — Gousser, c'est manger. GUILL. B O U C H E T , 15e Seree (III, 130). — Là attrimions Vomie sans zerver, et la goussions ou fouquions pour de l'aubert, c'est a dire manger ou vendre. Var. hist. et litt., VIII, 152. — Gousser, manger. Ib., VIII, 186.
Couper la gorge. — Le guelier te gousse, c'est a dire, les avives te coupent la gorge. GUILL. BOUCHET, 15e Seree (III, 130). Bien gousse. Bien repu. — 11 saccagea les meil
leures maisons... puis estant bien gousse, il se moqua des huguenots qui estoyent si crédules. R É G N I E R D E L A P L A N C H E , Hist. de l'Estat de France, I, 216.
Gousset. Pièce de l'armure protégeant le dessous du bras. — Un gantelet, une masse, des gous-setz, des grèves. R A B E L A I S , II, 27. — Les uns.., nettoioient... brassalz, tassettes, goussetz. ID., 1H. Prologue. — D'une genetaire luy donna en 1 es-
— 34
paule au travers du gousset. J. D ' A U T O N , Chron., 166 r" (G.). Aisselle. — Gymnaste... souleva le moyne par
lesgoussetz. R A B E L A I S , 1, 42. Gousseur (?). — Savatier. Bobelineux, carre
leur... gousseur. M. D E LA P O R T E , Epithetes, 368 v°. Goussu, dérivé de gousse. — Escosse. Tendre,
goussue... febveuse. M. D E L A P O R T E , Epithetes, 163 r». Goust. Trouver goust à. Approuver. — A son
dire chascun trouva goust, et sur l'heure fust conclusion prise qu'ilz partiraient au point du jour. L E L O Y A L SERVITEUR, Hist. de Bayart, ch. 40. Venir à goust. Plaire, être agréable. — Jamais...
ne beuvoit vin, au moins quand il n'en avoit point qui luy vint à goust. L E M A Ç O N , trad. de B O C CACE, Decameron, IV, 2. De goust. Agréable. — Ceus là, quand la liberté
seroit entièrement perdue et toute hors du monde, l'imaginent et la sentent en leur esprit, et ancore la savourent, et la servitude ne leur est de goust, pour tant bien qu'on l'accoustre. L A B O E T I E , Servitude volontaire, p. 30. Goustable. Qui peut être goûté. — Il n'y a es
autres choses sensibles aucune similitude ou imitation de meurs, comme es touchables et gous-tables. L. L E R O Y , trad. des Politiques d'ARISTOTE, VIII, 5. — L'ame de l'homme n'est pas visible, car elle est sans couleur... n'est pas goustable, car elle n'a nulle saveur. M O N T A I G N E , trad. deR. SEBON, ch. 217.
Agréable. — L'araignée suce l'umeur de la teste et vit de telle proye des mousches, car telle humeur est proprement goustable a icelle, ainsi comme le miel est goustable a la mousche qui fait miel. Jard. de santé, 11,11 (G.). Mangeable. — Ou des desers bruslans et are-
neux, Defaillans d'eau et de tout fruit goustable. LÉON, Descr. de l'Afr., Commend. (G.). Goustement. Action de goûter. — (Fig.). Ja
mais nous devons passer un seul jour bon de vie, sinon en goustement de cecy. B. D E LA GRISE, trad. de G U E V A R A , l'Orloge des princes, III, 20. Gouster. Gouster à. Être du goût de, agréable
à. — C'est une practique que les jésuites usent assez ordinairement quand ils font imprimer les livres des anciens Pères, et s'advisent trop tard de raier ou corriger ce que ne gouste à leurs palais. PH. D E M A R N I X , Differ. de la Relig., I, iv, 7. — Le poisson n'eut pas bien gousté à messieurs les prélats sans pain, et principalement sans vin. ID., ib., II, n, 7. — Ayant par force d'armes con-trainct les cardinaux assemblés à Bouloigne d'es-lire un pape qui luy fut agréable, comme ils en eurent nommé trois ou quatre qui ne luy gous-toient pas, il demanda le manteau de S. Pierre... et s'en vestit bien et beau, disant, Je suis pape moy-mesme. ID., ib., II, v, 3. (Formes). Futur. — Vostre goust, qui à soi est
si souvent contraire, Ne goustra l'amer doux, ni la douceur amere. A U B I G N É , tes Tragiques, VII (IV, 308). — Quand en perfection L'ame et le corps goustront la résurrection. ID., ib., V (IV, 229). (Subst.). Gouster. Goût. — Qu'il soit mon voir,
mon parler, mon toucher, Et mon ouyr, mon gouster, mon marcher. M A R G . D E NAV., tes Marguerites, Oraison de l'ame fidèle (1,131). Goustier (?). — Jamais ne sceut de ses gens se
défaire, Qu'il ne fallust, pour tel sot marché faire, Qu'on le menast si bien le goustier Pour quérir
GOUTTE ROSE
femme à Chasteau-Gontier. BOURDIGNÉ, Pierre Faifeu, ch. 44.
Goutette, v. Gouttette.
Goutier. Partie d'un ciel de lit. — Ung grand goutier de tapisserie. Invent, du X V I e siècle. Arch. Nord (G.).
Goutiere, v. Gouttière.
Gouttage. Goutte (au sens de maladie). — Je vous deusse dire que je porte mon bras en es-charpe pour une harquebuzade, et vous pour le gouttage. B R A N T Ô M E , Cap. franc., M. de Sansac (III, 403). Goutte, employé pour désigner une très petite
quantité. Ne pas dormir une seule goutte. Ne pas dormir un seul instant. — Il n'avoict dormy une seule goutte de toute la nuict. M O N L U C , Commentaires, L. II (1, 392). —• Toute la nuict nous fail-leust faire la centinelle... et ne dormismes une seule goutte. ID., ib., L. IV (II, 292).
Goutte devient une sorte de particule accessoire de la négative, comme pas et point. — Il y a deux jours et demy Que de pain je ne mangay goutte. Ane Théâtre franc., 11, 67. — Ensemble avons concorde si unie Que, quand tu ris, je n'ay goutte de dueil. L E M A I R E D E B E L G E S , la Plainte du Désiré (III, 169). —• Enfans, ne pleurez goutte. R A BELAIS, II, 30. — Des chandelles qu'on luy portera, il ne verra goutte plus clair. ID., Pantagr. Prognost., ch. 6. — Roi en son temps des Amycles, qui goutte N'alloient parlant. D E S M A S U R E S , Enéide, X, p. 529.
Goutte (mère), v. Mère goutte. La goutte, sorte de danse. R A B E L A I S , V, 33 ms. Goutte désignant une maladie. Express, pro-
verb. : N'avoir pas la goutte aux dents. Manger avec avidité. — Gens soubzmis... à Sol... seront sains et alaigres, et n'auront la goutte es dentz quand ilz seront de nopces. R A B E L A I S , Pantagr. Prognost., ch. 5. Les gouttes. La goutte. — Ainsi preschoit à Si-
nays un caphart que sainct Antoine metoit le feu es jambes. Sainct Eutrope faisoit les hydropiques. Sainct Gildas les folz. Sainct Genou les gouttes. R A B E L A I S , I, 45. —• Quels nouveaux remèdes avoit trouvé ce philosophe-là contre la douleur? quels cataplasmes contre les gouttes? D u VAIR, Philosophie morale des stoïques, p. 273. —• Voyant un sien amy qui avoit les goûtes, et se plaignoit de l'extrême douleur qu'il sentoit aux jambes. TAB O U R O T D E S A C C O R D S , Apophthegmes du sieur Gaulard, 2e Pause. — Monsieur de Lyon sçait que les gouttes viennent bien sans cela. Sat. Men., Harangue de M. le Lieutenant, p. 91. — De remédier et obvier aux nécessitez et oppressions du clergé, il n'est pas en m a puissance, et mes gouttes ne m e donnent pas loisir d'y penser. Ib., Harangue de M. de Lyon, p. 132. — Le roy n'y estoit présent, parce qu'il estoit grandement affligé de ses gouttes. E. PA S Q U I E R , Recherches, VI, 11.
Goutté. Tacheté. — A Robert Mangot, orfèvre, pour ung jaspe vert goutté de sang. 1551. Compt. roy., Laborde (G.).
Goutte de lin. Sorte de plante. — Autre soin n'est requis aux lins de là jusques à la cueillete, que de les descharger d'une meschante herbe ap-pellee goutte de lin ou pialet. O. D E S E R R E S , Théâtre d'agric, VI, 29. Goutte rose. Couperose. —• Nous parlerons
d'une rougeur estrange qui se fait au nez et aux joues... La goutte rose est plus grande en hyver qu'en esté. A M B R . P A R É , X X V , 45. — L'eau qui
19 —
GOUTTETTE — 350 —
est distillée de ses fleurs oste la goutte roze de la face. O. D E S E R R E S , Théâtre d'agric, VI, 15. — Contre la couperose, autrement ditte goutte-roze, ces remèdes seront emploies. ID., ib., VIII, 5. Gouttette, dimin. de goutte. — 11 .faut, pour
l'amour des gens, Ne fust ce qu'une gouttette Boire. J. L E Houx, Chansons du Vau de Vire, I, 36. — Or n'en beuvons, sinon une goutette. ID., ib., I, 70. — Je vous vens une goutette, Une goûte clairelette. T A B O U R O T D E S A C C O R D S , tes Bigarrures, 1, 19. Goutteur. Celui qui boit la goutte. — Beu-
veurs tresillustres, et vous goutteurs tresprecieux. RA B E L A I S , IV, Ane. Prologue. — Parquoy beu-veurs, parquoy goûteurs iceux en veullent avoir fruition totalle. ID., V, Prologue.
Goutteux. Qui goutte. — Et tandis tu m e per-dois, Torchant ta bouche mouillée, De chacun de tes beaux doits, C o m m e s'elle estoit souillée De quelque reste goûteux De ce bayseret moiteux. BAÏF, les Amours de Meline, L. II (I, 73). Celui qui boit la goutte. — Bonnes gens, beu-
veurs tresillustres, et vous, goutteux tresprecieux. R A B E L A I S , III, Prologue. — Tout beu-veur de bien, tout goutteux de bien, altérez, ve-nens à ce mien tonneau... beuvent franchement, librement, hardiment, sans rien payer, et ne l'es-pargnent. ID., ib. — Je ne Pay perse que pour vous, gens de bien, beuveurs de la prime cuvée, et goutteux de franc alleu. ID., ib. — (Dorveaux pense que goutteux, dans ce prologue, est employé au sens médical. Il est possible que Rabelais joue sur les deux sens possibles.) Gouttière. Bande d'étoffe, lambrequin. —
Laquelle [chapelle royale] fut toute paincte de noir à six estaiges ou gouttières. L E M A I R E D E B E L G E S , Pompe funéralle de Phelipes de Castille (IV, 246). — La première des dictes gouttières ou estaiges quarrez estoit tendu d'un fin drap noir. ID., ib. (IV, 247). — 1513. Ceste salle de dueil feut tendue haut et bas et par les deux costez de drap d'or noir, et par dessus de taffetas de pareille couleur. Sur icelluy taffetas y avoit une goutiere ou sainture de velours, armoyée aux armes de lad. dame, avec sa devise et une cordelière bien enrichie d'or. Cérémonial de France, p. 100 (Gay, Gloss. archéol). — 1523. 3 goùtieres servant auâ. ciel à 2 endrois, frangiées de fil d'or, soye blanche et verde, contenant la première de longueur 2 aulnes et largeur un cartier. Invent, de Marguerite d'Autriche, fol. 64 (Gay). Il n'est pas facile de voir si à ce sens de gout
tière on peut rattacher l'emploi suivant. — D'une seule goutiere te maintiens tu, il ne te demorera pas grandes viandes. N I C O L A S D E T R O Y E S , le Grand Parangon, 51, p. 255. Bonnet à quatre goùtieres, v. Bonnet. Goutiere, terme de vénerie. Raie creuse le long
du merrein du bois d'un cerf. — Il jugeoit un vieil cerf... A la grosse perleure, aux goùtieres, aux cors. R O N S A R D , Eurymedon et Calliree (I, 234). Gouvard. Goujat, valet d'armée. — Les sol
dats et gouvards seront... cassez et congédiez. Var. hist. et litt., IX, 140. Gouvernail. Le gouvernai Sorte de danse. RAB E L A I S , V, 33 ms. — Governeil. Navig. du compagnon à la bouteille, C. (Forme du pluriel.) — Lesquelz... leur rom-
poient et coppoient par le bas les avirons et gou-vernaux. SEYSSEL, trad. d'AppiEN, Guerre li-byque, ch. 13. —• Rompans leurs gouvernaulx, leurs avirons et leurs banez. ID., ib., Guerres ci- I
viles, V, 11. — Plusieurs [navires] avoient gou-vernaulx des deux costez. E T . D E LA PLANCB*, trad. des cinq prem. liv. des Annales de TACITE L. II, 51 v°. — Ayans retiré les ancres, ilz s'ad-venturerent en la mer, laschant quant et quant les joinctures des gouvernaux. CALVIN, Bibk franc., Act. des Apost., 27 (LVII, 371).
Gouvernance. Gouvernement. — Les habitans de Sainct Pol ont tousjours ressorty en la gouvernance d'Arras. 1545. Pap. d'Et. de Gran-velle, III, 121. — Quand les sentences se donneront sans acception de dignité, de majesté et saincteté romaine : et que les qualités par le monde insérées se reformeront de prelatures et principaultés, en dispensations et gouvernances. B U D É , Instit. du prince, ch. 3.
Conduite. — Cela ne trouverez chez moy. Vous y trouverez bonne foy, Bon renon, bonne gouvernance. Ane Théâtre franc., III, 197.
Régime, construction. — Six praepositions, o, au, aux, de, du, des, embrassent toute la gouvernance des noms et des verbes. R A M U S , Grammaire, II, 12. Gouvernant. Gouverneur. — Antyllas, le filz
aisné de Fulvia fut tué, pource que Theodorus son gouvernant le livra aux gens de guerre. A M Y O T , Antoine, 81.
Gouvernation. Gouvernement. — Le prince est en grand péril de la salvation de son ame, si en sa gouvernation et authorité il n'ha tousjours devant les yeulx la crainte et amour du suprême prince. B. D E L A GRISE, trad. de GUEVARA, VOr-loge des princes, 1,20.
Gouverne. Gouverneur. — Si lui vindrent au-devant hors les portes les gouvernes de la ville [d'Arras], entre lescruelz estoit le bon Grisart, majeur d'icelle. L E M A I R E D E BE L G E S , Chronique annale (IV, 483).
Gouvernement (bon). Sorte de danse. RABELAIS, V, 33 ms.
Gouverner. Soigner. — Il y avoit un médecin excellent en son art, nommé Charicles, lequel n'avoit point accoustumé de gouverner le prince en ses maladies, toutesfois il luy aydoit de son conseil. E T . D E L A P L A N C H E , trad. des cinq prem. liv. des Annales de TACITE, L. V, 204 v°. — Elle excusoit Garite, disant qu'elle estoit empeschee à gouverner son père, qui se trouvoit mal. LOUV E A U , trad. d'ApuLÉE, VIII, 2. — Quand j'ac-questeray quelque bonne maladie, ils ne me feront pas gouverner, ils ne mettront guières à me mettre dehors. Var. hist. et litt., IX, 193. — Pleust à Dieu qu'elle fust encore au monde, à la charge de la gouverner encore autant que j'ay fait. Ib., IX, 197.
Parler à, s'entretenir avec. — A présent gouverne Chrêmes, qui ne te desdira jamais, Si pour moy le veux supplier. D E S PÉRIERS, l'Andru, V, 6. — A ce que je voy, vous avez longuement gouverné le roy Perion, lequel je ne veiz oncques desarmé, et désire grandement le cognoistre. Amadis, 111, 6. — Vous serez ordinairement avec moy et ces damoyselles, à ce que sans empesche-ment nous puissions plus ayséement vous gouverner. Ib., III, 11. — Vous achèverez le discours de vostre entreprinse : puis gouvernez les dames si bon vous semble. Ib., V, 31. — Ne dire à tous venans tout cela que l'on pense, Et d'un maigre discours gouverner Pestranger. D u BELLAY, les Regrets, 85. — Le devoir de la court, et l'entretien commun Dont il fault gouverner un fascheux importun. ID., Jeux rustiques, Hymne de la Surdtié,
— Je fis la révérence à M. le chancelier, que je rouvernay teste à teste environ une bonne heure. E PASQUIER, Lettres, V, 3. — De ce pas entrons dans la salle, où M. Loisel commence de gouverner la mère, moy, la fille. ID., ib., VI, 7. — Je ne luy eu si tost dict que Vincent seroit bien aise veoir sa fille, qu'il m'a respondu : Que ne m e le disiez-vous plutost?... Qu'il vienne souper avecques nous... alors la pourra-il veoir et gouverner à son aise. L A R I V E Y , tes Jaloux, III, 2. — Donnez moy un quart d'heure pour vous gouverner. J'ay quelque chose a vous dire qui vous importe et a moy aussy. J. D E C A H A I G N E S , l'Avari-cieux, I, 4. — Et dites moy que je pourrais encore Voir dePhoebus la bande que j'honore... Et dites moy que, lors que je voudroy, Ronsard, Baïf gouverner je pourroy. V A U Q U E L I N D E LA F R E S N A Y E , Sat. franc., A M. de Tiron. — Je prins la hardiesse de gouverner à quartier teste à teste, ce bon cardinal et prince. E. PASQUIER, Lettres, XII, 2. — Un tiers... moins amoureux que moy, Mais beaucoup plus hardy, vous compte son émoy, Vous gouverne à l'aureille. G. D U R A N T , ŒUV. poet., 84 r°. — C'estoit un plaisir [le jeu de paume] auquel il finit ses jours, et moy jeune homme qui n'y pre-nois pas moins de plaisir que luy, le gouvernois de fois à autre par occasion. E. PA S Q U I E R , Re-eherches, IV, 15. — 11 me souvient que, le gouvernant un jour entre autres sur la poésie, il luy advint de me dire que, si un Ronsard avoit le dessus d'un Jodelle le matin, l'aprés-disnée Jodelle l'em-porteroit de Ronsard. ID., ib., VII, 6. — Lisez le Palmerin d'Olive, vous ne trouverez point que ceux qui gouvernent les roys usent de cette façon déparier, Vostre Majesté. ID., ib., VIII, 5. — II les pria de se retirer, désirant gouverner à part M. le premier président. ID., ib., VIII, 39. —> Cestuy est le troisiesme aage de son restablissement, dont je vous veux gouverner par le chapitre suivant. ID., ib., IX, 38. — Il fit bonne chère à tous, voire aux principaux des Seize, qui le gouvernèrent pendant son soupper. ID., Lettres, XVII, 2. — Toute cette aprésdisnée se passa par entremets, tantost à faire son testament... tantost à gouverner les deux hommes d'Eglise sur le faict de sa conscience. ID., ib., XVII, 5. — J'ay eu le loisir de gouverner deux ou trois fois le bon M. Galemand, avec autant de proffit que j'en ay jamais recueilly d'autre conversation quelconque. S* F R A N Ç O I S D E SALES, Lettres, 159 (XII, 118). Gouverner une femme. Lui faire la cour. — De
quelles dames estoyent ces portraits, à-sçavoir mon si de celles que les maistres desdicts livres gouvernoyent, ou de celles qu'ils désiroyent gouverner, cela ne puis-je pas dire. H. E S T I E N N E , Apol. pour Her., ch. 38 (II, 333). — Qui a quelque maistresse, il la va gouverner. CL. G A U C H E T , le Plaisir des champs, le Printemps, Discours du chasseur et du citadin, p. 96. — Il avoit ouy faire compte, il y avoit long temps, d'un quidam qui gouvernoit la femme de son voisin, et Falloit voir si souvent qu'à la fin le mary s'en apperceut. GUILL. B O U C H E T , 32« Seree (V, 6). — On dit d'un
homme qui laisse gouverner sa femme ou ses parentes à quelques uns, cest homme est bien ladre, il ne sent point quand on luy pique la chair. ID., W Seree (V, 133). Gouverner. Discuter l'opinion de. — C'est en
quoy je le gouverneray cy-après [Baronius], pour examiner si son opinion est telle qu'il présuppose. E. PASQUIER, Recherches, V, 13. Gouverner paisiblement. Avoir de l'influence
sur, dominer. — George, cardinal d'Amboise, qui gouvernoit paisiblement le cœur et oreille de
GOUVERT
Louys XII son maistre. ID., ib., IX, 42. — Il possède le roy, le gouverne paisiblement, tout passe par ses mains, et son conseil et ses affaires. B R A N T Ô M E , Cap. franc., le Mareschal de Bellegarde (V, 199). —• Ce gentilhomme s'opiniastra de quicte, son pays, et de faire service au duc Octavie, qui le prit en telle amytié qu'il le gouverna despuis fort paisiblement. ID., Couronnels franc. (V, 391). — U n duc et pair de France [le duc d'Epernon], et colonel de l'infanterie, et qui avoit gouverné paisiblement son roy, et manié l'espace de dix ans tous les affaires de l'Estat. ID., Discours sur les duels (VI, 433). — Elle... pourrait tirer beaucoup de bons services, offices et plaisirs de luy, puisqu'il gouvernoit si paisiblement le roy son maistre. ID., des Dames, part. 1, Marg., reine de Fr. et Nav. (VIII, 63).
Se gouverner. S'entretenir. — C o m m e le seigneur du Hamel, mon voisin, et moy retournions en nos maisons, luy m'entretenant par les rues, et moy m e gouvernant à part moy, je fis ce quatrain. E. PA S Q U I E R , Lettres, XIX, 11. •—• Pendant cet entre-devis, Nostre Seigneur Jesus-Christ les vint acoster, feignant ne sçavoir quels estoient les propos dont ils se gouvernoient. ID., ib., X X , 9. — Je ne suis jamais seul, pour estre tousjours avec moy, et... à faute de compagnie, je m e gouverne moy-mesme. ID., ib., XXII, 4.
Gouverneur. Chef d'un navire. —• Considérez... quelle seureté auroient les navigans si les galiotz n'observoient le commandement du gouverneur. D E R O Z I E R S , trad. de D I O N CASSIUS, Hist. rom., L. XLI, ch. 30 (59 r°).
Archonte. •—• Et ne s'en sauva que ceulx qui eurent moyen de faire intercéder pour eulx les femmes des gouverneurs de la ville. A M Y O T , Solon, 12.
Démagogue. — Les Lacedaemoniens... haïs-soyent Pericles et tous les autres gouverneurs. ID., Périclès, 10. Sorte de poisson. — Le petit poisson quon ap
pelle gouverneur, de la forme et grandeur dun goyon... est tousjours avec quelque grande baleine, et va devant elle luy dressant son chemin. PASQUIE R , Opuscules de P L U T A R Q U E , p. 179.
(Fém.). Gouverneresse. — Gouverneresse bien et léalement De par deçà très excellentement Tu as vescu. Ane Poés. franc., XI, 98. — O Galaxes, pacifique déesse, Qui de la paix estes gouverneresse. M I C H E L D'AMBOISE, Epistres et lettres amoureuses, 118 r°. — Dont, dame la gouverneresse, Faictes nous de voz brus largesse. Sotties, III, 95. Gouvert. Gouvernail. — Et sus ma mer tant la tourmente abonde, Qu'elle est des vents ja vaincue, et de l'onde, Et desarmée, et sans mast et gouvert. V A S Q U I N PHILIEUL, trad. de P É T R A R Q U E , L. I, sonn. 174. — Et sans gouvert est en mer très mal seure. ID., ib., L. II, sonn. 18. — Regard en quel horrible Orage et indicible Seul je suis sans gouvert. ID., ib., L. II, chant 9. Puissance. — L'aure céleste, esprit du laurier
vert... H a dessus moy tel pouvoir et gouvert Qu'avoit Méduse en more transformé. ID., ib., L. 1, sonn. 120. Conduite, façon d'agir. — Chantres legiers hors
de tout bon gouvert. Ane Poés. franc., VI, 22. — Honte amoureuse et dueil au cueur m e poingt, Et suis marri de mon lasche gouvert. V A S Q U I N PHILIEUL, trad. de P É T R A R Q U E , L. I, sonn. 76. — Et toy, mon cœur tant de souspirs nourry, Las, povre esprit de ton gouvert marry. ID., ib., L. III, A Jan Ange Papius. — Touchant au second point, comment on les applique [les ventouses], et du re-
,1 —
GOUVET — 352 —
gime ou gouvert qu'il y faut observer, il y a trois choses à considérer. J O U B E R T , Gr. chir., p. 614 (G.). Gouvet. — Adoncques... commencèrent es-
gourgeter et achever ceulx qu'il avoit desja meur-triz. Sçavez vous de quelz ferremens? A beaulx gouvetz, qui sont petitz demy cousteaux dont les petitz enfans de nostre pays cernent les noix. RAB E L A I S , I, 27.
Gouy. Sorte de grain. — Le meunier qui vient de battre sa meule doit moudre trois quartiers de gouy. Act. de 1525. Péronne (G.).
Gouyat, v. Goujat.
Gouyon, v. Gayon,
petits cochons qu'on a troussé par la jambe pom les aller sacrifier à la brocheterie. PH . DE MAHHIX Differ. de la Relig., II, i, 21.
Vomir. — Mais non, plustost bouchez d'un mouchoir vos narines... Ou bien fleurez un peu quelques fleurs de jardins, De peur de gozillervos tripes et boudins. T R O T E R E L , les Corrivaux, II2
Grabat. Lit (sans idée défavorable). — Lefaut lier et bander [l'enfant] en son petit grabat de si bonne façon que son col et son dos ne soyent aucunement courbés. A M B R . P A R É , XVIII, 28.
Grabeau. Examen. — Remettons à vostre retour le grabeau et belutement de ces matières. R A B E L A I S , III, 16.
Grabeler. Passer au crible (fig.), examiner. -Le prièrent vouloir le procès canabasser et grabeler à poinct. R A B E L A I S , II, 10. — La court n'a encores bien grabelé toutes les pièces. L'arrest sera donné es prochaines calendes grecques, b., I, 20. — Affin que le procès bien ventilé, grabelé et debatu vieigne par succession de temps à sa maturité. ID., III, 40. — A p r e s avoir de lune et autre part examiné la matière et au long grabellé la querelle, fut conclud... que le prochain di-menche donneroyent le choc à ceux de Flameaux, D u FAIL, Propos rustiques, ch. 9, p. 67. — Les quelz alloient au concile de Chesil pour grabeler les articles de la foy contre les nouveaulx haere-ticques. R A B E L A I S , IV, 18. — Combien qu'on ne veit oncq' condamner un excez Auparavant qu'on eust grabelé le procez. E. PASQUIER, Jeux poet., lie part., Elégie (II, 840). — Ceulx là sont des hommes justes et vertueux, non pas ces foireux qui, voyants qu'il n'y avoit plus rien à grabeler en leur Palais de nostre ville, et que tous leurs sacs estoient vuides ou penduz au croc, s'en sont allez à Tours. Sat. Men., Harangue du sieur de Rieux, p. 168. — Nous le verrouillerons de bonnes et fortes raisons... examinans et grabelans tout ce que nos desvoiés au contraire produire désire-roient. P H . D E M A R N I X , Differ. de la Relig., 1,4, Préface. Soumettre à un examen, à une enquête. —Là
on voulut grabeler les gouverneurs qui mettoyent leur garnison en la bourse... On voulut toucher à ceux qui aux despens du party prenoyent des pensions. A U B I G N É , Sa Vie à ses enfants (1, 86).
Grabeleur. Celui qui examine. — Des cer-veaulx à bourlets grabeleurs de corrections ne me parlez. R A B E L A I S , III, Prologue. — Ces grabeleurs et caquetars playdeurs. F. BRETIN, trad. de L U C I E N , D U cercheur de repue franche, 51. —- Ces bons pères du concile de Trente ordonnent expressément qu'il y aura par tout de ces maistres grabeleurs de correction. P H . D E MARNIX, Differ. ae la Relig., I, v, 1.
Grabouil, v. Garbouil Grabué. — Que l'Escriture soit obscure et nul
lement intelligible qu'aux docteurs grabuez et à ceux de leur race. P H . D E M A R N I X , Differ. de la Relig., 11, i, 1.
Grâce. Faire grâce. Faire une grâce, accorder une faveur. — Le tien office est de me faire grâce ; Le mien sera d'adviser que je face Tes bons plaisirs. M A R O T , Elégies, 5. — Car aultre don pour le présent ne requeroit des cieulx, sinon qu il luy feust faict grâce de luy complaire en quelque service agréable. R A B E L A I S , 1, 15. — O qu'a peu de gens c'est que la Muse fait grâce De suivre le haut trac de l'immortelle trace! C H . FONTAINE, Odes, 14. — Mais quant vous leur avés faict grâce, Tost se refroisdit leur désir : Si l'on les renvoyé et des-
Governeil, v. Gouvernai
Govion. Gosier. — La corde m e estraignit le govion, et enserra le conduit de respirer. L O U V E A U , trad. d'ApuLÉE, I, 5.
Goy 1. Sorte de serpe ou de couteau. —• U n grant fer de pique, gouez, serpes, fers de cheval et autres ferrailles. Texte de 1511 (G., Gouet). — Car elle estoit la bergère de paix, Laquelle sceut dresser accords parfaicts Entre bergers, alors que par le monde Taschoient l'un l'autre à se rendre deffaicts A coup de goy, de houlette et de funde. M A R O T , Complaintes, 4. — L'aspre altère, comme un gouet. R A B E L A I S , IV, 30. —• Ung goy pour es-guiser les paulx des antes. 1553. Compt. de Diane de Poitiers (G.). —• Je vy desur le bord le tige d'un beau fresne Droit sans nœuds et sans plis : lors me levant soudain J'empoignay d'alegresse un goy dedans la main, Puis coupant par le pied le tige armé d'escorce, Je le fis chanceler et trébucher à force, Desur le pré voisin estendu de son long. R O N S A R D , Eclogues, 1 (III, 364). —• Goy est une petite serpe de vignerons. T A B O U R O T D E S A C C O R D S , tes Escraignes dijonnoises, Prologue. Goy 2, v. Renier. Goyard. Sorte de serpe ou de couteau. —
Deux goyards et deux pioches. 1525. Arch. mun. Orléans (G.). — 1527. 4 gouyars pour couper les espines... 8 goyars, 3 serpes, 4 congniés. Inv. de l'engin de balisage à Rlois (Gay, Gloss. archéol). — 1538. Une hallebarde, un goyard et 2 bâtons faicts en façon de langue de beuf, 40 s. Inv. de Cl. Brachet (Gay). Goyon, forme dialectale. Goujon. — Les mor-
mours, les cagnes, les goyons et les laictiers qui sont le milan, le chrysot et le scorpion, sont prins et traînés hors de leau par le retz qu'on appelle double ou espervier. P A S Q U I E R , Opuscules de P L U T A R Q U E , p. 170. —• Les anchois fraischement prins, le camare, les goyons, et tout le menu poisson. C O T E R E A U , trad. de C O L U M E L L E , VIII, 17. — Tons. Goyons. Meusniers. Escrevisses. R A B E L A I S , IV, 60. — [M°>e de Dampierre] ne l'appelloit jamais que Goyon, parce que c'estoit son surnom, et que jamais Goyon, fust poisson ou homme, ne valut rien. B R A N T Ô M E , Cap. franc., le Mareschal de Matignon (V, 166). Gozal. — Pantagruel... luy demanda. Avez
vous icy le gozal céleste messaigier?... C'estoit un pigeon prins on colombier de Gargantua. R A B E LAIS, IV, 3. —• Ilz prenoient le gozal, et par les postes le faisoient de main en main jusques sus les lieux porter dont ils affectoient les nouvelles. ID., ib. — Gozal. En hebrieu, pigeon, colombe. ID., BriefveDéclaration (III, 398). Goziller. Crier. —• Ses compagnons... fre
donnent et gozillent à menue gorge, comme des
chasse, Un désespoir les vient saisir. Brief, l'amoureux ne vous pourchasse Que pour en tirer du plaisir. Rimes de P. D E L A V A L , p. 39. — Mon sort m'a faict grâce, de ne m'avoir présenté des occasions qui me peussent tenter et divertir mon affection de la commune et légitime ordonnance. M O N -'TAIGNE, II, 8 (11, 93). — Dieu faict grâce à ceux 'à qui il soustrait la vie par le menu. C'est le seul bénéfice de la vieillesse. La dernière mort en sera d'autant moins plaine et nuisible : elle ne tuera plus qu'un demy ou un quart d'homme. ID., III, 13 (IV, 261). Faire présent. —• Ces beaux chevaux sont issuz
de la race Des grands coursiers dont Jupiter fit grâce Au prince tros. SALEL, Iliade, V, 77 r°. C'est vostre grâce. Avec votre permission. —
Vous n'escrirez pas toute la journée ensemble toutes deux. — C'est vostre grâce, et encore la plus grand part de la nuict. F R . D'AMBOISE, les Neapolitaines, III, 7. De sa grâce. Par bonne grâce, gracieusement,
obligeamment. — Ce bon personnage cy m'a accompagné de sa grâce. F. BR E T I N , trad. de L U CIEN, lo Navigation, 4. — Vous m'avez ja de vostre grâce enseigné tout le jeu du haut-bois. ID., ib., Armonis, 1. — (Ironiquement). Les voleurs de leur grâce ne m'en veulent pas particulièrement. M O N T A I G N E , III, 9 (IV, 79). — Cerongneux las d'aller se frottoit à mes bas, Et fust pour estriller ses galles ou ses crottes, De sa grâce il gressa mes chausses pour mes bottes. R É G N I E R , Sat. 10. A la grâce. Dans les bonnes grâces. — [Eu-
drome] leur promist qu'il leur aiderait, ce qu'il pourrait bien faire, estant à la grâce de son maistre, à cause qu'il estoit son frère de laict. AMYOT, Daphnis et Chloé, L. IV, 66 v°. Maie grâce. Défaveur, disgrâce. •— On voit que
nul ne veut avoir les maies grâces, mais qu'on ne demande qu'à complaire. Et à qui? Aux plus meschans. CALVIN, Serm. sur la seconde à Timothee, 3 (LIV, 37). — Il n'est point de doute que nous n'ayons encouru sa male-grace, son courroux et son indignation paternelle. M O N T A I G N E , trad. de R. SEBON, ch. 229. — Ce qui meit en maie grâce de Dionysius Dion, Samion de Philippus, et Cleo-menes de Ptolomeus, et fut à la fin cause de leur totale ruine. A M Y O T , Comment on pourra discerner le flatteur d'avec l'amy, 9. — C'est faict en homme prudent et sage de sçavoir bien éviter la male-grace et le mauvais bruit. ID., Propos de table, I, 4. — Il me mist en la maie grâce de M. de Guyse. M O N L U C , Commentaires, L. IV (II, 214). Faire grâce avec. Faire grâce à? faire la paix
avec ? — Seigneur, tu as fait grâce avec ton serviteur, selon ta promesse. CALVIN, Serm. sur le Ps. CXIX, 9 (XXXII, 581). Grâce. Reconnaissance. — Grâce est la vertu
par laquelle lhomme ha souvenance de lamytié dautruy et des services à luy faits, et ha voulenté de les guerdonner. L E M A I R E D E B E L G E S , la Couronne Margaritique (IV, 83). Faire grâce. Rendre grâce. —«Suppliés donc
Jésus à joinctes mains Qu'il m e délivre des tirans inhumains, Faulx hereticques pleins de toute fallace, Et de bon cueur à Dieu j'en feray grâce. Ane. Poés. franc., IV, 102. (Par adaptation). Grâces est employé d'une fa
çon analogique pour désigner certaines prières aux dieux du paganisme... — Il fut au festin des nopees de Euryptolemus son nepveu, encore n'y demoura il que jusques aux grâces quand lon offre du vin aux dieux. A M Y O T , Périclès, 7. — Apres que les tables furent ostees... nous ren-IV
GRACIER
dismes grâces aux dieux en leur espanchant un peu de vin : et la menestriere aiant un peu chanté après grâces, se retira incontinent de la sale. ID., te Banquet des sept sages, 5.
La grâce à Dieu. Grâce à Dieu. — La grâce à Dieu, les biens que je conserve Sont si très haulx que je m e n o m m e serve Et humble fille à celluy qui tout poise. L E M A I R E D E B E L G E S , te Temple d'Honneur et de Vertus (IV, 219). — Le bon hom m e luy respond qu'il n'en avoit point esté malade [des oreilles] et qu'il avoit tousjours bien ouy, la grâce à Dieu. D E S P É R I E R S , NOUV. Récr., 10. — La grâce à Dieu, il a esté tousjours aussi droict que pièce de nous. L E M A Ç O N , trad. de B O C CACE, Decameron, II, 1. — Or sommes nous, la grâce à Dieu, par beaucoup de perilz et de flotz étrangers, renâuz au port à seureté. D u B E L L A Y , Deffence, Conclusion. — Le point que m e console, C'est que la pauvreté comme moy les afîolle, Et que, la grâce à Dieu, Phœbus et son troupeau, Nous n'eusmes sur le dos jamais un bon manteau. R É G N I E R , Sat. 2. La Dieu grâce. Grâce à Dieu. — Or avons nous
tant proufité, la Dieu grâce, que assez ample con-gnoissance nous est apparue de lancienne amplitude des royaumes de Bourgongne et d'Autriche la basse. L E M A I R E D E B E L G E S , Illustr., III, 3 (II, 422). — Madame, la Dieu grâce et la vostre, j'ay ce que je desirois. L E M A Ç O N , trad. de B O C C A C E , Decameron, III, 9.
Grâce tienne. Par ta grâce. — Ton doulx venin, grâce tienne, m e fit Idolâtrer en ta divine image. M A U R I C E S C È V E , Délie, 3.
De grâce, vos bonnes grâces, expressions à la mode. — Il ne cherchera autre chose qu'à trouver le moyen de faire venir à propos aucun de ces mots, comme folâtre, fat... disgrâce, de grâce. TAH U R E A U , 1er Dialogue du Democritic, p. 34. — Quand vous avez ainsi parlé, Dite-moy de grâce, Vous avez usé d'une façon de parler italianizee, qui emporte prière. H. E S T I E N N E , Dial du lang. franc, ital, 1, 43. — Au lieu qu'on diset, il n'y a pas long temps, Vostre bonne grâce, maintenant on dit en pluriel, Vos bonnes grâces. ID., ib., II, 124.
Je salueray vos bonnes grâces. — Depuis quelque temps est venue une coustume de dire aussi, quand on boit à quelcun, Je salueray vos bonnes grâces, OU En saluant vos bonnes grâces. ID., ib. Donne grâce. Sorte de rideau. — Une bonne
grâce de velours. 1548. Tournai (G., Compl.). — Deux bonnes grâces, deux quenouilles, le tout en damas fanné. 1599. Inv. de Gab. d'Estrees (G., Compl.).
Sorte de manchon. —• Or ne faut il pas que j'oublie de vous demander si les dames outre cela portent aussi ce que on appeloit Des contenances. — ... Ce nom de contenances commence à se perdre en la cour... — Quel mot donc a pris sa place...? — Manchons... — Il m e semble que ce qu'on appeloit Des contenances, je Pay ouy appeler aussi Des bonnes grâces. — Je n'oy ni l'un ni l'autre en la cour. H. E S T I E N N E , Dial. du lang. franc, ital, I, 227.
Gracelet, v. Grasselet. Gracelette, dimin. de grâce. — Rose vermeil-
lette, Epan ta douceur, Pour me rendre seur De ta gracelette. L E C A R O N , Poésies, 63 v°.
Gracette, dimin. de grâce. — Amour logé dans le séjour d'honneur Etincelloit cent gracettes plaisantes. L E C A R O N , Poésies, 65 v°.
Gracier. Gratifier, mettre en possession. — Moy malheureux, qui suis tant endormi Que rien 23
53 —
GRACIEUSET 354 —
ne peut me gracier de l'aise, Estant tousjours de moymesme ennemi. L E CARON, Sonetz, 63. Récompenser. — Vous joviennes Charités, De
ce ciel estes flambeaux, Qui graciez les mérites Par voz regardz tousjours beaux. ID., te Ciel des Grâces (44 v°). Remercier. — Ils ne l'adorèrent, honorèrent,
servirent et gratùerent comme Dieu. FOSSETIER, Cron. Marg., V, v, 14 (G.). — Créateur du ciel et de la terre, Nous te debvons tous bien mercyer ; Tant en France que en Engleterre, Nous sommes tenuz te gracyer. Ane Poés. franc., XI, 139. — Prenez en vous soûlas, joye et liesse, Et graciez Jésus le roy des roys. Ib., VI, 288. Gracieuset, dimin. de gracieux. —• La gra
cieuse courtoisie et la courtoisie gracieusette du gentil seigneur, pareillement la doulce humilité et l'umble doulceur de la noble dame me firent plus gracieux accueil qu'à moy n'appartenoit. Ane Poés. franc., XII, 274. Peut-être faut-il lire la courtoise gracieuseté. Le procédé de croisement serait ainsi le même que dans la doulce humilité et l'umble doulceur. Gracieux seigneur. Sorte de poisson. (Lifter*:
gras seigneur). — Gracieux seigneurs. Empereurs. Anges de mer. RABELAIS, IV, 60. — Les Bretons font grand cas d'un poisson de leur contrée nommé gracieux seigneur ; il est longuet et sans escailles, tousjours attaché aux rocs, et le nomment gracieux seigneur pource qu'ils trouvent estrange que, se tenant à une place à son aise comme un seigneur, il devient moult gras. BELON, p. 435 (Sainéan, Rev. du XVIe siècle, V, 34). Gracile (gracilis). Délicat. — Voire et si est
ton style coppieux... Treselegant, venuste, et fort gracile. J. BOUCHET, Epistres familières du Traverseur, 47. — Maistre Jehan Marot Estoit fluent, Greban doulx et gracile. ID., ib., 67. Graciole. Sorte de plante des marais. — La
graciole ou grâce de Dieu est très amere, aucunement astringente, laxative. J. DES MOUL., Comm. de MATTHIOLE sur Dioscoride, p. 402 (G., Compl., Gratiole). Gracule (graculus, geai), latinisme par plai
santerie. — Là du gracule, et plaisant Philomene, Te resjouyt la douce cantilene. Epistre du Lymo-sin, dans les Œuv. de Rabelais, III, 276. Gracyer, v. Gracier. Grade. Marche. — Allés donc au festin, on
vous en faict instance... Mignonne, avancés leur le grade de vos pas. L. PAPON, Discours à Mue Panfile (I, 46). Degré. — Ces deux filles estoient d'une maison
de Florence, assez noble... qui, pour estre parvenue à son grade de foelicité, alloit diminuant peu à peu de ses richesses. N. D E M O N T R E U X , Prem. Liv. des Bergeries de Juliette, Journ. III, 136 r°. — C'est aussy le suprême grade de l'aumosne chrestienne que de procurer le salut des âmes. S* FRANÇOIS D E SALES, Lettres, 63 (XI, 171). — C'est le deuxiesme grade de la justification, de bien espérer, après le bien croire. ID., Sermons autogr., 4 (VII, 76). — Ceste espérance est mère du désir, troisiesme grade de la justification. ID., ib. (VII, 77). Rang, dignité. — Quelle douleur devons nous
penser que fut cete cy, pensant au grade et grandeur de celle [Jocaste] qui envoyoit ainsi exposer son enfant? G. C. D. T., trad. de BOCCACE, Fiam-mette, L. VII, p. 422-423. — Hé, ne la charges point, pour les lever en grade De prestance, d'orgueil, ces robes de parade D'une charge impor
tune, en leur lustre clignant. L. PAPON, Discours i Mne Panfile (I, 34). — One une Bradamantaux jouxtes assailhie, Superbe, ne parut de si brave sailhie Que Panfile disposte en grade triumphant Couloit sur ce pavé de galbe repiaphant. In., ib (1, 51). — Ainsy faut-il par 1er des reliques, images ou instrumens des saintz, laissant chaque chose en son grade. S4 FRANÇOIS D E SALES,Defensedek Croix, IV, 9. — Un amy desireroit que son amy fust roy. Quand il l'est... il faict un acte de contentement, d'ayse et de resjouyssance du grade que Pamy possède. ID., Sermons autogr., 22 (VU, 99). — (Sophonisbe à Massinisse). Tu craindras pour tes sœurs que le destin sans foy Peut abaisser de grade aussi bien comme moy. MONTCHRESTIEN, la Cartaginoise, II, p. 130. —• Elle sceut entretenir son grade et auctorité si impérieusement que nul n'y osoit contredire. BRANTÔME, des Dames, part. I, Disc. 2, Catherine de Medicis (VII, 352). — Un jour chez toi est plus précieux que mille au palais des grands, desquels les grades plus eslevez ne sont que pièges et fientes à qui les co-gnoist bien. AUBIGNÉ, Médit, sur le Ps. 84 (II, 145). — Les honneurs de ce monde estoient hontes au prix Des grades eslevez au céleste pourpris, ID., tes Tragiques, VII (IV, 305). — Maintenant (quelle honte !) il n'est chose plus vile [que les vers] : Ils marchent les pieds nus, tristement descouverts 1 Qui leur rendra leur grade aujourd'huy par la France? Var. hist. et litt., 1, 73. De grade. D'un rang élevé. — A cheval on voit
mieus ; mais c'est affaire ou aus chetifs comme moi, ou aus jeunes hommes sur des chevaus de service... Les persones de grade ne vont qu'en coche. MONTAIGNE, Journ. de voyage, p. 257.
Grade est noté comme mot à la mode. — Ils trouvent plus beau ceux qui sont en ce grade que ceux qui sont en ce degré. H. ESTIENNE, Dial. du lang. franc, ital, I, 131.
Grade se trouve employé comme mot féminin, — Bien gastee... seroit-elle d'avoir l'accointance d'un brave roy, et le mary d'estre son compai-gnon, à qui et à elle fairoit de grands biens et donnerait de bonnes grades, et ne leur seroit jamais ingrat. BRANTÔME, Rodomontades espaignolles (VII, 172). Gradive. (Gradivus, un des noms de Mars.)
Belliqueux. — Bacche ou Bacchus. Joyeux, amiable... doux, gradive. M. DE LA PORTE, Epithetes, 42 r° et v°. Graduaire. — Le graduaire, lequel se nomme
aussi Pofficiaire, contient les offices et introïts, PH. D E MARNIX, Differ. de la Relig., I, iv, 7. Graduer. Élever à un grade. — Je mettray ma
robbe d'escarlate avec laquelle je fus gradué. LE M A Ç O N , trad. de BOCCACE, Decameron, VIII, 9.
Gradué. Elevé à un grade. — Puis [marchoient] les cent gentils-hommes de fraiz graduez par la sainte Union. Sat. Men., Abrégé des Estats, p. 47. — Touchant des meurtres et effusions de sang, u y estoit maistre gradué et docteur passé. PH. DE MARNIX, Differ. de la Relig., II, v, 3. — (Subst.). Un jeune apprenty de justice nouvellement pourveu d'une inférieure judicatere, ayant, par avis de quelques graduez, condamné un couppe-bourse d'avoir l'aureille couppée. TABOUROT DES ACCORDS, les Bigarrures, I, 6. Graffer. Agrafer. — Elles en ton honneur
d'une boucle azurée Graffoyent sur les genoux leur cotte figurée, Et trepignans en rond, ainsi que petits fans, En ballant, sauteloyent. RONSARD, Hymnes, L. II, Hymne de Bacchus (IV, 359).
— 355 — GRAINE
Grafflon 1. Sorte de cerise à pulpe dure. — Parmi lequel paraissent pour les plus prisées les duracines, appellées aussi greffions, mot pris en Dauphiné généralement pour toutes sortes de guines. O. D E S E R R E S , Théâtre d'agric, VI, 26. Grafflon 2. — Ingobol grafflon, c'est à dire
juge fiscal. F A U C H E T , Antiquitez, V, 5. — Une scare des plus vaillans hommes d'Austrazie et Bourgongne, conduite par leurs ducs et greffions : que je pense en cest endroit signifier comtes, ou leurslieutenans. ID., ib., V, 9. Graffir. Saisir. — U n ange mist sur m o y la
poue Pour moy graffir. Farce trouvée à Fribourg (P. Aebischer, Rev. du XVIe siècle, XI, 167). Grafigner. Êgratigner, griffer. — Ilz luy gra-
phinoient le nez. R A B E L A I S , 1, 11. — Ceux qui ne sont accoustumez qu'au parler de ceste ville, où on ne dit point autrement que graphigner ou egra-phigner, n'entendroyent pas le graffiare dont use Boccace. H. ES T I E N N E , Precellence, p. 311. — Il n'y a plus moyen que je vous puisse grafigner ; vous voilà en seureté, il faut que j'y sois aussi ; ce fut à dire qu'il lui arracha les dents, afin que, lui ne pouvant grafigner, ne peust aussi estre mordu. AUBIGNÉ, Faeneste, III, 5. Graffinant. Qui égratigne, qui griffe. — Cepen
dant ce chetif devant luy se remontre, Pensant de se sauver. L'autre le prend soudain, Et met sur son collet sa graffinante main. M A R I E D E R O M I E U , Enigme, p. 87. Graigne, v. Gaigne 3. Graile. Sorte de trompette donnant un son
aigu. — Sonner des gresles a lassault estoit sonner des trompettes. G. T O R Y , Champ fleury, Aux lecteurs. —1561. Un valet de chiens doit prendre sa trompe et sonner 4 ou 5 motsdegresle. D U F O U I L -LOUX, Ven. (Gay, Gloss. archéol). — [Les Wes-triens] pour»encores donner plus grand effroy, faisoient de tous costez sonner leurs cors, grailles, nacaires et trompettes, pour monstrer que tout le corps de leur armée estoit là présent. F A U C H E T , Antiquitez, V, 1. — Tout resonne de grailles, clairons et trompettes en signe de victoire. ID., ib., IX, 4. — Puis, embouchants la trompe, après le cerf fuiant Sonnent le coup de gresle. CL. G A U CHET, te Plaisir des champs, l'Esté, Chasse du cerf, p. 189. — Et le gresle sonnant Va les champs et les bois et le cerf estonnant. ID., ib., var. Graille 1. Corneille. — Parmy ces vautours et
ces grailles Sont quelques cygnes bien chantons. 0. D E M A G N Y , Odes, l, 97. Graille 2, v. Graile. Grailler. Croasser. —> Les corbeaux voletoient
a Pentour de luy, graillans et croaillans. Hist. pit. du prince Erastus, 208 v° (G.). Grailleux. Qui croasse. — Corbeau ou Corbin.
Noir, grailleux, affamé. M. D E L A P O R T E , Epithetes, 93 v°. Grain. N'estre pas dans le grain. Être mal à
l'aise. — Mais pour ce qu'estant là je n'estois dans le grain... J'allois doublant le pas, comme un qui tend le vent. R É G N I E R , Sat. 10. Capable de manger, d'engloutir à un grain de
sel. Cette locution exprime l'idée de force apparente, et surtout celle de fanfaronnade. — Nous avons des ennemis qui sont plus forts et plus robustes en comparaison de nous que n'ont point eu les Israélites quand ils devoyent entrer en la terre de Canaan. Il semble qu'ils nous doivent manger à un grain de sel, comme on dit. CALVIN, Serm. sur le Deuter., 15 (XXVI, 61). — Nous en
voyons beaucoup de fols qui parlent de la guerre, et leur semble qu'ils doyvent manger tout à un grain de sel. ID., ib., 173 (XXVIII, 603). — H faut bien donc que nous nous défiions de nos vertus... et qu'aussi il y ait une telle crainte qui nous sollicite à cause de nos ennemis, qui nous pourroyent du premier coup engloutir à un grain de sel (comme on dit). ID., Serm. sur l'Epitre aux Ephe-siens, 45 (Ll, 821).
Grain d'orge. Petite mesure de longueur. — A prendre la toyse pour six piedz, le pied de douze poulces, et le poulce de six grains d'orge. Amadis, IV, 2.
Grain, nom d'un poids très petit. — (Fig.). Nostre françois mis en balance avec le grec ou latin, se trouve foible et léger de quelques grains. E. P A S Q U I E R , Lettres, 1, 2. — Aiant autant beu que lui... si est-ce qu'à la fin du jeu il en avoit trois grains plus que moi. GUILL. B O U C H E T , 1 " Seree (I, 45).
Léger de deux grains. Châtré. — Mais que direz-vous des femmes? Quand on leur parle d'un qui est léger de deux grains, ne craignez ja qu'elles s'en approchent. C H O L I È R E S , 4e Matinée, p. 157. — Si j'estois magistrat... à fin qu'on ne se mo-quast point de la mariée, tous ceux qui sont légers de deux grains... seroient tenus de le venir déclarer. GUILL. B O U C H E T , 5e Seree (I, 198). — Le
droict canon veut que ceux qui se sont rendus légers de deux grains, encores que ce test par dévotion... soient forbannis et exclus des sainctes ordres. ID., 8e Seree (II, 118). — Et si ne laissera ce chastré, pour estre léger de deux grains, d'estre bon capitaine hongre. ID., 36e Seree (V, 123).
Relatif à la castration. — La matière que maniez est legiere de deux grains, partant je ne m'esmerveille pas si vous syllogisez si fort à la legiere. C H O L I È R E S , 4e Matinée, p. 167.
D'un grain. D'une petite quantité, de très peu. — Vous plaist-il voir comme ils tirent court d'un grain? Mettons au contrepoix Pad vis de deux philosophes et de deux sectes tres-differentes. M O N TAIGNE, 1, 38 (I, 314). — Nos opinions s'entent les unes sur les autres. La première sert de tige à la seconde : la seconde à la tierce. Nous eschellons ainsi de degré en degré. Et advient de là que le plus haut monté a souvent plus d'honneur que de mérite. Car il n'est monté que d'un grain sur les espaules du penultime. ID., III, 13 (IV, 213).
Grain, désignant une très petite quantité, arrive au sens de pas du tout, puis devient une particule accessoire de la négation, comme pas, point, goutte. — Il a tant esté orgueilleux Que povres gens ne prisoit grain. Ane Théâtre franc., III, 412. — Or d'or et d'argent je n'ay grain. R. D E C O L L E R Y E , Monsieur de Delà et Monsieur de Deçà. — Couillatris soublieve la coingnee d'or... puis dict à Mercure. Marmes, ceste cy n'est mie la mienne. Je n'en veux grain. RABELAIS, IV, Prologue.
Grain. Rien. — Or sus, sans parler mot ne graing, Vielhart, d'icy vous fault bouger. Sotties, II, 43. Non. — Les rachepterez vous? — Grain. — Les
faut il pas tous brusler? — Faut. RABELAIS, V, 28. Grainchon. Petit grain. —- Et ne mengeoient
chose yssante de vigne jusque au grainchon croissant dedens le grain du roisin. FOSSETIER, Cron. Marg., 1,144 v° (G.). Graine. Graine de paradis. Poivre de Guinée.
— Voulez vous encores un traict de hîppocras blanc? Ne ayez paour de l'esquinance, non. Il n'y
GRAINER — 356 —
a dedans ne squinanthi, ne zinzembre, ne graine de paradis. RABELAIS, III, 32.
Garder [une fille] à graine. Ne pas la marier. — Elles corrigent Pair pestilentieux, et si ces senteurs relèvent les filles qu'on garde à graine de leurs syncopes. G U I L L . B O U C H E T , 17e Seree (111, 167)_ _ j e conseille aux pères de ne garder leurs filles à graine, et les admoneste de les marier. ID., 22e seree (111, 300).
Graine. Cochenille, écarlate. — Ses senteurs de chemins forains, Ses coquars afulés en gresne, Desordre les tient cy en renne. Sotties, II, 310. — D'assez bonne laine et tainct en grene. R A B E L A I S , II, 12. — Voulés vous une pièce de veloux violet cramoysi tainct en grene...? ID., 11, 21. — Pour son saie furent levez dix et huyt cens aulnes de velours bleu tainct en grene. ID., 1, 8. — Il y a des hommes... qui voyent contre cœur les robes teintes en greine, les robes d'escarlate. L A B O E TIE, tes Règles de mariage de P L U T A R Q U E , ch. 47. — Le sacrificateur commandera qu'il prene... deux passereaux vifs et nets, du bois de cèdre, et du fil teint en graine, et de l'hyssope. C A L V I N , la Bible franc., Levitique, 14 (LVI, 169). — (Fig.). Fol tainct en graine. R A B E L A I S , III, 38. — Il est impossible que le raion de justice esclatte en aucun beau lustre, si l'ame, d'où elle part, n'est taincte bien au vif dedans la graine céleste de pieté. P H . D E M A R N I X , Corresp. et Mélanges, p. 438. Sous l'influence latine, on écrit grane pour
graine. — Touchant les granes que vous ay envoyées, je vous puis bien asseurer que ce sont des meilleures de Naples. R A B E L A I S , Lettres (III, 360). — On vend bien icy encores d'aultres granes, comme d'ceillets d'Alexandrie, de violes matro-nales. ID., ib.
Grainer, v. Grener.
Grainet, dimin. de grain. — Et les lares servans, les gobelins folets... Qu'on chasse avec du mil, de la peine faschés Qu'ils ont à recuillir ces grainets espanchés. J. D U C H E S N E , te Grand miroir du monde, L. II, p. 61.
Grain eux. Qui a des grains, — Apres avoir sié les graineuses crinières, Les bons et beaux presens de la dame Ceres. I M B E R T , Sonnets exoter., lTevaxt, p. 40 (G.).
Graion. Tige. — La première année fault oster tous les sions, tellement que le seul graion (latin : simplex stilus) soit un peu plus hault que la fosse. C O T E R E A U , trad. de C O L U M E L L E , V, 9.
Graisler. Griller. — Le vieux bon h o m m e Grandgousier... qui après souper se chauffe les couilles à un beau clair et grand feu... attendent graisler des châtaines. R A B E L A I S , 1, 2.
Graisleté. Caractère de ce qui est mince. — La grandeur, la graisleté, la couleur moyennement vermeille, tes cheveux blons et non point contre-faicts. L O U V E A U , trad. d'ApuLÉE, II, 1.
Graisse. A graisse, en gresse. A l'engrais. — C o m m e un lion pressé de faim et de furie, Trouvant des bœufs à graisse en la verte prarie, Sur tous en choisis! un. M O N T C H R E S T I E N , tes Lacenes, III, p. 183. — Feirent aussi provision de bestiail le plus cher qu'ilz peurent trouver, et le tindrent en gresse. SALIAT, trad. d'HÉRODOTE, VII, 119.
Haute graisse. État d'un animal très gras. — Ainsi de longue-main les pourceaux estans traités, ils parviendront au premier degré de haute graisse. O. D E S E R R E S , Théâtre d'agric, IV, 15.
De haute graisse. Très gras. — Et un chapon de
haulte gresse. Sotties, III, 194. —Moutons de Levant, moutons de haulte fustaye, moutons de haulte gresse. R A B E L A I S , IV, 6. — Moiennantles quelles choses, les tiendrés gras tout l'hyver, et plus outre, tant longuement qu'il vous plaira dont aurés tous-jours des moutons de haute' graisse. O. D E S E R R E S , Théâtre d'agric, IV, 13.
(Fig.). D e grande valeur, de haute qualité, -Pour fleurer, sentir et estimer ces beaulx livres de haulte gresse. R A B E L A I S , I, Prologe. — Tenir en mue vient aussi de la fauconnerie : comme il a esté escrit de quelque personnage qu'il tenoit en m u e une putain de haute gresse. H. ESTIENNE Precellence, p. 131. — Phriné, putin de haute' gresse et renommée, vainquit l'arrest de mort contre elle donné, en se despouillant toute nue D u FAIL, Contes d'Eutrapel, 29 (II, 104).
Beste de haute graisse. Celui qui est sot au plus haut point. — Vous croyez fort aisément que vous estes habile personne, et possible vostre voisin croit le contraire, et que vous estes une beste de haute graisse en dépit du caresme. BEROALDE DE V E R V I L L E , te Moyen de parvenir, Paragraphe (I 84).
Dans la phrase suivante, l'expression semble employée à double sens : de grande valeur, et aussi graissé par un long usage. — Soixante et neuf bréviaires de haulte gresse. RABELAIS, II, 7
A graisse d'argent. A prix d'argent. — Les autres, pour le jour d'huy, poursuivans ambitieusement les offices, et encores à gresse d'argent, sans y pouvoir quelquefois attaindre : vous non seulement ne le poursuyvant, mais, qui plus est, absent et ne le sçachant, avez esté appelle à ce haut degré. E. P A S Q U I E R , Lettres, Vil, 7. — Ludovic Sforce, qui avoit esté chassé, se retira en Allemagne, dont il tira grandes forces à gresse d'argent. ID., Recherches, VI, 20. — La plus-part des Italiens, es causes qui leur importoient, se venoient vouer à ses pieds, l'espace ne cinq et six mois, pour tirer de luy consultation enflée de plusieurs allégations, qu'il leur vendoit à gresse d'argent. ID., Lettres, X I X , 12.
Graisser. Engraisser. Mettre gresser. Mettre à l'engrais. — U met gresser ses bœufs et tendres genissons Pour en faire l'argent. CL. GAUCHET, U Plaisir des champs, le Printemps, Discours, p. 121,
Graisser le poignet. Donner de l'argent. — La Motte Gondrin... sentant ses gens escouler d'heure en heure, pource aussi que le légat ne lui graissoit le poignet assez à son gré... envoya devers Montbrun, pour traicter la paix. RÉGNIER DE L A P L A N C H E , Hist. de l'Estat de France, 1, 349.
Gresse. Oint. (Subst.). Celui qui a reçu l'onction. — [Le signe du sang] pour estre réservé en propre à je ne sçay combien de tonduz et gressez, a esté défendu aux laies et profanes. CALVIN, Instit. (1560), IV, xvn, 47.
Graissier. Marchand de graisse fondue. — Les graissiers, ongueliers, poulaillers et cabaretiers de la ville de Mons. Texte de 1530 (G, Compl.).
Graine (gramen, herbe, gazon). — Ayant ses chevaulx petits et légers, pourtant quilz ne men-geoient fors herbe et grame, et à ceste cause estoient acoustumez d'endurer faim et soif. SEYSSEL, trad. d'AppiEN, Guerre libyque, ch. H. Gramellotte, mets imaginaire. — La royne
feit apporter le vin, et les happelourdes confites en jus de gramellotte. Navig. du Compagnon àU Bouteille, G.
Grammaire. Littérature. —Charondas législateur préféra la grammaire, c'est à dire la cognois-
sance des lettres, à toutes autres sciences. L. L E ROY , trad. des Politiques CPARISTOTE, VIII, 3, Commentaire. Latin. — La grammaire, ou, pour mieux dire, le
latin (car il est designé par ce mot entre le vulgaire [en Italie]). C. D. K. P., trad. de GE L L I , Discours fantastiques de Justin Tonnelier, Disc. IV, p U23. — Beaucoup de personnes vous estiment fort sçavant en grammaire... mais en nostre langue vous me semblez un grand sot. ID., ib., p. 125. (Jeu de mots). — Ce bon homme... maintenoit
que l'univers se destruisoit à faute de grammere : car cette grammere, qui vient de grandis mater, tiendroit tous ses enfans en paix, s'ils faisoient d'elle Testât qu'ils doivent. A U B I G N É , Faeneste, 111,22. Le mot se trouve écrit grammoire, granmoyre.
— Mais pensent bien que plus n'en soit mémoire En nul endroit, es loix ne en grammoire : Parquoy me prient que tout mette en escript. B O U R D I G N É , Pierre Faifeu, l'Acteur. — Leur promettant à leur faire asçavoir Chouses cachées, chouses hors de mémoire Qui excédent et logicque et granmoyre. ID., ib., ch. 19. Grammairien (adj.). Grammatical, relatif au
langage. — Question grammerienne. J. D E CA S -TELNAU, Faç. et coust. des ane Gaulois, 33 v° (G., Compl.). — A d'aucuns c'est un pur estude grammairien : à d'autres, l'anatomie de la philosophie, par laquelle les plus abstruses parties de nostre nature se pénètrent. M O N T A I G N E , I, 25 (1,191). — Ny les subtilitez grammairiennes, ny l'ingénieuse contexture de parolles et d'argumentations n'y servent. ID., 11,10 (11,116). Grammairien (subst.). Grammairien, érudit,
celui qui enseignait à lire et à écrire. — Tibère... envoya quérir tous les grammariens de Rome. DEROZIERS, trad. de D I O N CASSIUS, Hist. rom., L. LVII, ch. 120 (249 r°). — A l'exemple d'Horace, qui a chanté en xix sortes de vers, comme disent les grammariens. D u B E L L A Y , Deffence, II, 4. — Un autre grammarien luy dit quelque autre fois qu'il avoit Homère corrigé de sa main. AMY O T , Alcibiade, 1. — Luy mesme luy enseigna les lettres [à son fils], combien qu'il eust un serf nommé Milon, honeste h o m m e et bon grammarien, qui en enseignoit beaucoup d'autres. ID., Caton le Censeur, 20. —• Dionysius se moquoit des grammariens, qui ont soin de s'enquérir des maux d'Ulysses, et ignorent les propres. M O N T A I G N E , I, 24 (1,166). —• Chacun sçait que tu es grammarien. F. BRETIN, trad. de L U C I E N , De ceux qui vivent à gages, 25. Grammatique. (Adj.). Grammatical. —• Art grammatique ou bien dialectique. C R É T I N , Translation du chant de misère, p. 262. — Pour vous parler en termes grammatiques, vous voyez qu'il y-a un relatif sans antécédent. H. E S T I E N N E , Dial. du lang. franc, ital, I, 308. Correct, classique. — U n h o m m e docte... a mis
par escrit... que toute l'Afrique et Barbarie est tenue de la langue arabique, et tous soubz la loy de Mahomet, approchans à la vulgaire et grammatique : et que le différent n'y est non plus que le latin et l'italien. T H E V E T , Cosmogr., V, 12. — Les Candiots, qui ont la langue plus fluide et friande, s'approchans plus de la grammatique que les Cypriots. ID., ib., Vil, 3. — Aussi commença la différence du latin grammatic ou des anciens autheurs, et du commun peuple, dés lors en Italie appelle vulgaire latin. F A U C H E T , Antiquitez, V, 2. — Quant à la langue latine (entendez la
GRANCE
grammatique) il s'en aydoit comme de sa maternelle. ID., ib., VIII, 18.
(Subst.). Grammaire, lettres. —• Moïse enseigna la grammatique et toute sapience à ses Hebrieux. L A BOD., Harmon., p. 10 (G). Grammairien. — Soy pourveoir de orateur et
grammaticque ydoines a ladicte régence. 30 mai 1541 (G.). Arch. mun. Montauban. — Jehan Phi-liteau gramaticque. 16 août 1546. Ib. (G.). Grammatiste. Celui qui enseignait à lire et à
écrire. — Ce grammatiste Denys. D'ESPENCE, Deux notables traictez, 45 r° (G. Compl.).
Grammairien. — La superstition de tels gram-matistes resveurs pour l'e imparfaict, qu'ils appellent foeminin. D E S A U T E L S , Mitistoire barra-gouyne, ch. 14. Gramment. Grandement, beaucoup. — A brief
parler, j'estoye ainsy Mignon comme cest enfant sy, Et si n'avoye gramment plus d'aage. Ane Théâtre franc., Il, 331. — En ung destour, sans granment besongner, Faifeu luy dist. BOURDIGNÉ, Pierre Faifeu, ch. 19. —• Touchant des biens de ce monde, il n'en avoit pas granment. NICOLAS DE TROYES, te Grand Parangon, 10. — Mais certes il se deult gramment De t'ouyr irreveramment Parler d'une telle princesse. MAROT, Epistres, 51. — L'homme à l'homme estant dieu, et l'homme à l'homme loup, Qui peut gramment aider, et peut nuire beaucoup. MAURICE SCÈVE, Microcosme, L. III, p. 99. — Les Sarmates ne se sont jamais gramment amusez à faire édifices somptueux. THEVET, Cosmogr., XX, 2. Longtemps. — Celuy qui trespassa A Nar-
bonne, n'a pas gramment, Avoit lors le gouvernement. GRINGORE, Sotye nouv. des Croniqueurs (Sotties, II, 220). Grammerci. Grand merci. — Mes beaux pères
religieux, Vous disnez pour un grammercy... Pleust à Dieu que je fusse ainsi ! C o m m e vous vivrais sans soucy. B R O D E A U dans Marot, Epigrammes, 45. — J'en dis le grammercis à m a vive amitié, De quoy j'y voy si cler, et du peuple ay pitié. L A B O E T I E , Sonnets, 14. — Ils ne vivent que des aumosnes des gens de bien et de grammercis. H. E S T I E N N E , Apol pour Her., ch. 22 (II, 39). — Qui m e louerait d'estre bon pilote, d'estre bien modeste, ou d'estre bien chaste, je ne luy en devrais nul grammercy. M O N T A I G N E , III, 5 (III, 322). — Je supplie instamment sa saincte miséricorde que jamais je ne doive un essentiel grammercy à personne. ID., III, 9 (IV, 74). Grammere, Grammerien, v. Grammaire,
Grammairien. Grammoire, v. Grammaire.
Grampe (goutte), v. Crampe 1. Granat. Grenat. — Fines pierres précieuses,
comme... agates, granatz, saphirs. Navigation du Compagnon à la Bouteille, B. Granate. Grenade. — Le chef, le dos et la
gente poictrine Sont de couleur rouge, de la plus fine Qu'on saiche veoir, et de telle couleur Qu'est (de la p o m m e ou granate) la fleur. G U Y D E LA G A R D E , Hist. du Phoenix.
Granatié. Grenadier. — Ung grand feston faict de arbres de granatié. 1533. M E R C I E R , Entr. deFr. 7er (G., Compl.).
Grance (?), noté comme mot à la mode. — Grance, politese, traguet, une armée bien leste... se trouvèrent aussi sur les rangs. D u FAIL, Contes d'Eutrapel, 33 (II, 159).
7 —
GRANCHE 1 — 358 —
Granche 1, v. Grange.
Granche 2. Carcasse. — Qu'on leur baille la grandie de mon oye... S'ilz ont grant fain, ilz la rongeront bien. Ane Poés. franc., XIII, 8. — Bistoquet mené promener... Les chiennes de noble lignage, Et leur donne la collassion De quelque grange de chapon Ou de quelque fraische carcasse De poulie d'Inde ou de bécasse. G U Y D E T O U R S , Meslanges (II, 84). Grancher. De grange. — Aire. Large... unie, plaine, granchere ou grancheuse. M. D E L A P O R T E , Epithetes, 14 r°.
Grancheux, v. Grancher.
Grand. Grand homme. Homme de haut rang, homme puissant. — Passé le temps du dueil, les barons et grans hommes de son royaulme vindrent en sa présence pour le couronner. A. SEVIN, trad. de B O C C A C E , te Philocope, L. VII, 173 v°. —• Il n'est gueres seur pour les rois de souffrir entre leurs grands hommes une mortelle inimitié : d'autant que volontiers elle tire après soy la division des subjects d'un mesme royaume. F A U C H E T , Antiquitez, V, 12.
Grand marché, v. Marché. Grand s'emploie encore souvent au féminin
sans e final. Mais souvent aussi une apostrophe en tient la place. — Le beau verger des lettres plantureux Nous reproduict ses fleurs et grans jonchées. M A R O T , l'Enfer. — Et grassement ap-prins la paternelle Langue françoyse, es grands courts estimée. ID., ib. — Je veiz Diogenes qui se prelassoit en magnificence avec une grand robbe de poulpre. R A B E L A I S , II, 30. — Toutes mes grans richesses excellentes. M A R O T , Epistres, 42. — Ces grans roches haultaines. ID., ib., 48. — Veistes vous jamais librairie Chés les grands dames? ID., trad. de deux Colloques d'EnASME, 1. — En fin passay les grans froides montaignes. ID., D U temps de son exil à Ferrare. — Tous reves-tus de grands robes de dueil. R. B E L L E A U , la Bergerie,2e Journ., Chant de triomphe (II, 34). — V i c toire avoit de grans ailes dorées. R O N S A R D , te Bocage royal, lle part. (III, 263). — La plus grand part de ce que nous sçavons est la moindre de celles que nous ignorons. M O N T A I G N E , II, 12 (II, 236). — Avant la guerre Peloponnesiaque, il n'estoit pas grands nouvelles de cette science ID., II, 37 (III, 217). — Sa grand bouche demeure ouverte à tous propos. A U B I G N É , les Tragiques, III (IV, 128). — C'est bien malheur, ou trop grand'oubliance. M A R O T , Epistres, 35. — Le suppliant que par sa grand'doulceur De mon estât te fasse successeur. ID., ib. — Et en ostant son bonnet de la teste, A mercié mille foys la grand'-beste. ID., ib., 11. — Trèshumblement requérant vostre grâce De pardonner à m a trop grand'-audace. ID., ib., 27. — Celuy qui jecte ainsi feu à plante Veult enflammer quelque grand'parenté. ID., l'Enfer. — Là d'un costé auras la grand'clos-ture De saulx espez. ID., Eglogue au Roy. — Si peut on faindre Aucunes foys une amytié Qui n'est pas si grand' la moitié C o m m e on la de-monstre par signes. ID., Dialogue de deux amoureux. — L'horrible enfer de ta grand'cruauté. D u B E L L A Y , l'Olive, 53. — Le ciel a veu trois fois par son oblique voye Recommencer son cours la grand'lampe du jour. ID., tes Regrets, 36 — Ne requérant aux dieux plus grand'felicité. ID., ib„ ™ ' — L e c o r P s a u n e grand'part à nostre estre. M O N T A I G N E , II, 37 (III, 217). — Il ne verra jamais De la grand'Babylon les murs ny le palais. R. G A R N I E R , les Juifves, 1686. — S'enrichir de
bonne heure est une grand'sagesse. RÉGNIER Sat. 13.
O n trouve grande tante pour grand'tante, où la tradition a maintenu l'ancienne forme. — Ma grande tante Laurence. R A B E L A I S , III, 7.
Grandesse. Grandeur. — Pour louer les biens de fortune, nous diron leur grandesse, leur gerre leur qualité. P. F A B R I , l'Art de Rhétorique, L, I,' p. 35. — Tu sentiroys beaucoup de plaisirs dé veoir la grandesse des richesses que j'ay apporté d'Asie. B. D E L A GRISE, trad. de GU E V A R A , l'Orloge des princes, III, 14. — Ce que le naturel cours des choses n'avoit peu monstrer aux saiges avec petit et rare dommaige, c'est assavoir de supporter patiemment les infortunes et malheurs, la grandesse d'iceulx l'enseigna non seulement aux saiges, mais aussi aux simples gens. L E MAÇOS, trad. de B O C C A C E , Decameron, Preamb.
Grandeur morale, grandeur du rang. — Si est tolérance une vertu par laquelle un fort courage d'homme ne se brise point ou déchet de sa grandesse, pour la difficulté des maux apparents, L E M A I R E D E B E L G E S , la Couronne Margaritique (IV, 128). — Il [Paris] touchoit une chanson de sa harpe mélodieuse, pensant bien ententivement à la grandesse de la maison paternelle. ID., Illustr., I, 30. — Ils les nommèrent Celtes, cestadire nobles, à cause de leur haute générosité et grandesse de cœur. ID., ib., III, 1 (II, 269). —Puis, en monstrant sa divine largesse Et en faisant notoire sa grandesse, [Le Christ] Feit tout acoup le luy-sant ciel ouvrir. M A R G . D E NAV., tes Marguerites, Triomphe de l'Agneau (III, 60). — La vraye grandesse n'est à un prince de tenir et posséder beaucoup, sinon qu'il puisse profiter beaucoup, B. D E L A GRISE, trad. de G U E V A R A , l'Orloge des princes, 1,10. — Plus haulte grandesse est sçavoir enseigner à autres philosophes que pouvoir commander à mille chevalliers. ID., ib., II, 30. — L a grandesse et authorité vostre gardera que personne ne s'auzera bouger. M O N L U C , Lettres, 63 (IV, 172). — Je prie à Dieu qu'il face la grâce à tous ceulx qui sont de vostre conseil qu'ils vous conseillent sy bien que nous vous puissions veoir en la prospérité et grandesse que j'ay veu voz prédécesseurs. ID., ib., 193 (V, 147). —Auroit bien des rois la grandeur En sa grandesse un plus grand heur? BAÏF, Poèmes, L. III (II, 154).—De ce conseil et de la résolution que vous prendras vous despend et représente tout l'honneur, grandesse, authorité, conservation et asseurance de vostre estât. M O N L U C , Commentaires, L. III (II, 39). — Avecques le conseil de telles gens, vous ne pouvés faillir de maintenir vostre grandesse et grande renommée et réputation. ID., ib., L. VII (111,491). Age adulte. —• Affin que le roy, quand il sera
grand, ne m e puisse reprocher que, ayant charge de luy, j'aye adhéré et consenti à luy faire perdre sa liberté et monarchie, j'ayme mieulx quicterle royaulme de France, et m'en aller vivre, attan-dant sa grandesse, en Italie ou aultre lieu. MONLUC, Lettres, 97 (IV, 298). Exploit. — Triumpher à mon povoir sur vistes
chevaulx, lances en main et enseignes en l'aer, faisant tous faictz et grandesses d'armes. A. SEVIN, trad. de B O C C A C E , te Philocope, L. II, 38 v". Grandet. Un peu grand, assez grand. — [Paris] par trait de temps devint grandet, tant quil pouvoit aller et commençoit à parler. LEMAIRE D E B E L G E S , Illustr., I, 21. — Aussi bailla la royne Thetis son filz Achilles, quand il fut grandet, a Chiron le sage centaure son ayeul, pour le nourrir
et introduire en tous exercices que filz de prince doit savoir. ID., ib., I, 36. — Vien hardyment : car quand grandet seras... Tu trouveras un siècle pour aprendre En peu de temps ce qu'enfant peut comprendre. M A R O T , Avant naissance du 3e enfant de la duch. de Ferrare. — Mon filz, tu es désormais grandet, ce sera bien fait que tu commences à veoir toy-mesmes tes affaires. L E M A ÇON, trad. de B O C C A C E , Decameron, IV, 8. — Les bleds qui ja grandets se font Tous hérissez d'es-pics. R O N S A R D , Epitaphe d'André Blondel (V, 294). — Une fille et deux fils, Qui jà grandets ensemble accollés s'entrejouent. M A U R I C E S C È V E , Microcosme, L. I, p. 24. — Jusqu'à ce que le temps avec Page l'avise Que sa fille est grandette, et qu'il est meshui temps De luy faire quitter ses jeunes passe-temps. P. D E B R A C H , Elégie à son livre. — Ils estoyent joints vis à vis, et comme si un plus petit enfant en vouloit accoler un plus grandet. M O N T A I G N E , 11,30, var. 1580-82-87 (III, 130, et V, 199). — Grandette je devins, et son fils creut aussi. P. D E B R A C H , Hierusalem, IV, 32 r°. — Elle fait bouillir le pot, berce l'enfant, donne la mamelle à un autre, au plus grandet elle donne une crouste de pain à ronger. Trad. de F O L E N G O , L. VI (I, 161). — Estans devenues un peu plus grandettes et fermes d'âge, fut... grande l'amitié que portions l'une à l'autre. L A R I V E Y , la Constance, I, 2. — Quand elles furent ung peu grandettes, de l'aage de trois ou quatre ans, elle pria le roy son mary de luy laisser et donner l'aisnée toute à soy. B R A N T Ô M E , des Dames, part. I, Eliza-beth de Fr., reine d'Esp. (VIII, 15). — M e voyant grandette et constante en la resolution que j'avois prise, il m'y confirma. B E R O A L D E D E V E R V I L L E , Voyage des princes fortunez, p. 73. Grandile (?). — Contre le tige de ce trophée
estoient posées sur le grandile deux effigies d'hommes captives. N O G U I E R , Hist. tolos., p. 24 (G.).—Lelongdugrandille. ID., ib., p. 25 (G.). Grandiloquacitation, mot forgé. Langage
pompeux, grand style. — Il est... en matière de grandiloquacitation, un vaisseau d'éloquence tul-lienne. PH. D E M A R N I X , Differ. de la Relig., 1,1, 5. Grandiloquence. — La variété des concep
tions, qui s'appellent grandiloquence, ou oraison démonstrative. B U D É , Instit. du prince, ch. 4. Grandimement, superlatif forgé par plaisan
terie. Très grandement. — Nul mieux de toy, gentillime poëte, Heur que chascun grandimement souhaite, Façonne un vers doulcimement naïf. Du BELLAY, à J. Ant. de Baïf. Grandipotent. Ayant une grande puissance.
— Illec est le manoir et le seur réceptacle D'Honneur, le roy puissant, juste, grandipotent, Qui maints riches guerdons à tous cœurs nobles tend. LEMAIRE D E B E L G E S , la Concorde des deux langages, 2e part. (111,130). Grand père (tiers). Trisaïeul. — Le tiers
grand père de Néron, nommé Cneus Domitius, en son office de tribune, fut en la haine des prestres et pontifes. M I C H E L D E T O U R S , trad. de S U É T O N E , VI, 188 v». Grane, v. Graine.
Grange 1. Ce mot, dans ses différents sens, a souvent la forme granche. — En halles et grandies, desquelles la couverture commance pour la plus part bien près de terre, pour éviter limpetuosité des grans ventz. G. T O R Y , Champ fleury, L. II, 19 r°. — Si vous voulez rien a mon père, il bat en la granche. P A L S G R A V E , Esclare,
GRANMENT, GRANMOYRE
p. 755. — En la saison qu'on vanne Le beau froment hors la granche ou cabanne. SALEL, Iliade, V, 85 r°. — Tu scez assez (soit en maisons ou grandies) Que les colombes qui sont belles et blanches Ayment souvent les pigeons bruns ou noirs. C H . F O N T A I N E , les XXI Epistres CPOVIDE, Ep. 21, p. 411. — L'eur de m a main fera voir dans nos granches Les purs fromens jusqu'aux tuiles tassés. J E A N D O U B L E T , Elégies, 16.
Ferme, métairie. — Il en achapte force mestai-ries, force granges, force cens, force mas. R A B E LAIS, IV, Prologue. — Tout astre aussy, terre et mer, ville et grange. V A S Q U I N PHILIEUL, trad. de P É T R A R Q U E , L. IV, Triomphe d'Eternité ou de Divinité, p. 404. — Ladite testatrice... a doté, fondé et légué à ladite église de Parcieu en Dombes une pension annuelle et perpétuelle d'une asnee vin et une mesure bled froment bon, pur et marchand, mesure dudit lieu, laquelle pension elle impose sur sa grange et tenement qu'elle a audit lieu de Parcieu. Testament de L O U I S E L A B É (I, 167). — Item, donne et lègue icelle testatrice à aultre Pernette, sa vieille chambrière, qu'elle tient à la grange de Parcieu, une pension viagère de 10 livres, d'un poinçon de trois asnees de vin et d'une asnee bled froment. Ib. (1, 169-170). — Ladite testatrice... lègue... audit sr Thomas Fortin... les usufruicts, prouflts, revenus et jouissance de la grange et tenement qu'elle a audit lieu de Parcieu, en quoy que ladite grange consiste, soit en mesonnaiges, bastiments, jardins, fonds, héritages et immeubles quelconques. Ib. (1 171). Etable. — C o m m e un pourceau grongne après
une truye, Et comme on voit un pigeon à la fuye Se retirer, et un beuf à la grange, Ainsi je tourne autour de la vendange. M E L I N D E S1 G E L A Y S , Rondeaux, 6 (I, 307).
Grange 2, v. Granche 2. Grangée, mot collectif. Ceux qui sont dans une
grange. — Il y a quelqu'un des vieillards qui, le matin, avant qu'ils se mettent à manger, presche en commun toute la grangée. M O N T A I G N E , I, 30 (1,261). Granger. Fermier, métayer. — Gens soubz-
mis... à Sol, comme... jardiniers, grangiers, cloi-siers. R A B E L A I S , Pantagr. Prognost., ch. 5. — La mesme testatrice donne et lègue à Benoist Frotté, son grangier dudit lieu de Parcieu, la somme de 10 livres. Testament de L O U I S E L A B É (I, 171). — Le métayer... est ainsi appelle en France, de métairie : et en Dauphiné, granger, de grange. O. D E S E R R E S , Théâtre d'agric, I, 8. —• Je trouv' en ce granger, metay ou fermier plusieurs actes de grande prudence. S' F R A N Ç O I S D E SALES, Sermons autogr., 56 (VII, 388).
(Fig.). — Dieu gard le granger qui moyssonne Les divers fruits non périssables. C H . F O N T A I N E , Ode pour dieugard à la ville de Paris, 63. — Les autres peuples possèdent les terres en propriété : mais je vous tien comme mes grangers, je ne veux point que vous soyez comme propriétaires. CA L VIN, Serm. sur le Deuter., 93 (XXVII, 316). — (Adam et Eve). Les grangers du grand Dieu, une parfaicte couple. P. M A T T H I E U , Vasthi, IV, p. 76.
Grangette, dimin. de grange. — Debout, en Bethléem coures, Sur du foin, dans une grangette, Au maillot vous le trouvères. B U T T E T , te 1er Liv. des vers, ode 18.
Grangier, v. Granger. Granment, Granmoyre, v. Gramment, Gram
maire.
9 —
GRANOULHE
Granoulhe. Coussinet. — 28 livres de bronze, pour faire les granoulhes, syve coussinets du pont levis de la porte. 1572-82. Arch. mun. Agen (G.).
Grape, v. Grappe 2.
Grapeau, dimin. de grappe. — Aux vignes le bourgeon Defourre le grapeau de son tendre coton. BAÏF, te Premier des Météores (II, 8).
Grapelé. Qui accompagne les grappes. — Le pampre grapelé reverdist en sa trace [de Bacchus]. A M . J A M Y N , Œuv. poet., L. IV, 164 r°.
Grapelette, dimin de grappe. — Ses grape-lettes grenues Y renaistront chacun an. 1574. PE R R I N , 80 b (Vaganay, Deux mille mots).
Graper, v. Grapper 1.
Graphe. Stylet pour écrire. — Tous il les laisse aux hystoriographes, Ce leur partient passer par soubz leurs graphes. B O U R D I G N É , Pierre Faifeu, l'Acteur.
Grapher. Écrire. — Ne dictes rien, et m e donnez Ce petit mot pour epitaphe, Et que sur mon corps on le graphe. M A R O T , Epistres, 62. Couvrir d'écriture. — C o m m e doulx miel cil qui
ta bouche het Salut te dict, docte prudent Bouchet graphe en diligence. J A C Q U E S D E P U Y T E S -S O N à J. Bouchet dans les Epistres familières du Traverseur, 85.
Graphe. Ecrit. — Lettres cubitailles graphees a la porte. FOSSETIER, Cron. Marg., VIII, n, 14 (G.). Grapheur. Graveur. — Grapheur d'ymages.
FOSSETIER, Cron. Marg., IX, i, 9 (G., Compl.). Graphide (ypa<ptç, ypaçt'Soç, dessin). Image. —
Vous m e usez icy de belles graphides et diaty-poses. RA B E L A I S , III, 5.
Graphigner, Graphiner, v. Grafigner.
Grapissant. — Liarre ou Lierre. Verdoyant, fueillu, surrampant... gravissant ou grapissant. M. D E LA P O R T E , Epithetes, 239 v°.
Grappaux, v. Crapaud.
Grappe 1. Excroissances autour du paturon des solipèdes (G., Compl.). — Les grappes, qui sont mules et gales aux talons [du cheval]. LIE-B A U L T , Mais, rust., p. 169 (G., Compl.). Grappe 2. Grappin, crochet, crampon, griffe.
— Je n'ay pas paour que on la m e oste, Se je mes une fois la grape. Ane Théâtre franc., 111,143. — Par le dehors les pierres sont joinctes a grappes de fer a plombeure. SEYSSEL, trad. de T H U C Y D I D E , 1,11 (27 v°). — Il estbesoing... davoir de grappes de fer si nous en povons finer pour les attacher et retenir [les navires ennemis] quant ilz nous viendront chocquer. ID., ib., VII, 12 (237 v°). — Les ennemys considerans quilz estoient trois navires contre un... jecterent leurs grappes et arpagons de fer, pour linvestir et arrester. ID., trad. d'Ap-PIEN, Guerre syriaque, ch. 3. —Alcibiades... meit à fond partie de ses vaisseaux... et en trouva plusieurs autres à l'ancre tout contre la terre, qu'il tascha d'emmener aussi en les tirant en mer avec des mains et grappes de fer. A M Y O T , trad. de D I O D O R E , XI11, 18. — Peut estre que plusieurs n'entendroyent pas aggrappato en Boccace (encore qu'il vienne de nostre aggrapper : que j'estime avoir son origine du mot grappes, qu'on porte de peur de glisser sur la glace). H. E S T I E N N E , Precellence, p. 311.
Grappe 3, v. Crampe 1. Grapper 1. Cueillir le raisin, grappiller. — De
m a pipe enroillée Je sonneray, sans plus me sou-cyer Soit de tailler, houer, graper, syer. Ane. Poé franc., I, 241. — Je n'ay voulu ressembler ceux qui vont graper après vendanges et glaner après les moissons. C O R R O Z E T , Parn. des poètes franc. (G.). — Dieu donc se reserve comme une espèce d'hommage la glenure et les autres choses : que les povres puissent grapper, qu'ils puissent recueillir les olives. CALV I N , Serm. sur le Deuter 141 (XXVIII, 199). — Qu'ils s'abstiennent du bien d'autruy : sinon quand ils pourront ou glener ou grapper après moisson et vendange. ID , il (XXVIII, 200). — (Fig.). Il est encores plus ignorant et meschant que ces povres ignorans icy, qui grappent au moins mal qu'ils peuvent... et qui en trois petits mots vendangent le clos. RABELAIS, V, 16 (1562). Grapper 2. Prendre, saisir. — Il l'avalla ; mais
Dieu sache l'encombre Qu'il luy a fait, car aux boyaux le grappe. B O U R D I G N É , Pierre Faifeu, ch. 4.
Grapperon. — Des bourgeons et drageons stériles, qui n'apporteront grand fruict, que les vignerons appellent grapperons ou regaing. COTE-R E A U , trad. de C O L U M E L L E , III, 18.
Grappeter. — Je ne sçache femme qui se sceut passer qu'elle ne grappetast pour le moins une demye douzaine de bonnes fois la nuict. DES AUTELS, Mitistoire barragouyne, ch. 2.
Grappette, dimin. de grappe. — Ces grap-pettes blondes De nouveaux raisins. BAÏF, Passe-tems, L. III (IV, 363).
Grappeux. En grappes,formantdes grappes.— Desquelles [feuilles] neantmoins quelques unes estans closes portent un fruit grappeus. Du PI N E T , trad. de DIOSCORIDE, II, 161 (G.). — Elle produit plusours tiges feuillues, a la cime desquelles sortent de fleurs herbeuses et grappeuses. ID., ib., II, 162 (G.). — Raisin. Empampré... grappu ou grappeux. M. D E LA PORTE, Epithetes, 348 v°.
Grappu. En grappes, formant des grappes. — Son fruict retire à celuy du lentisque et est noir, douçastre, et grappu comme un raisin. Du PINET, trad. de DIOSCORIDE, I, 108 (G.),— Cette plante produict un fruict rouge et grappu. ID., trad. de P L I N E , XIII, 21. — Amome. Odoriférant... assyrien, blanc, grappu. M. D E LA PORTE, Epithetes, 19 v°. — Pampre ou Pompe. Bourgeonneux, fueillu... grappu. ID., ib., 299 r°. — Peuplier. Grappu, larmeux, rivager, fueillu. ID., ib., 316 v°. — Raffle. Grappue, seiche, inutile, égrenée, mes-chante. ID., ib., 348 r°. — TVoesne. Mouson, blanc, raisineux, grappu, odorant. ID., ib., 407 V.
Gras. Degré, escalier. — Les murailles soubs-tenant les clostures et couverture du gras et poissonnerie de ceste ville ruynoient. 1536. Reg. consul, de Limoges (G.). — L'entrée et sortie dud, gras estoyent mal aisées. Ib. (G.).
Grasier, v. Crassier. Grasselet. U n peu gras, grassouillet. — Un
peu plus bas en miroir arrondi, Tout potelé, grasselet, rebondi, C o m m e celuy de Venus, pein son ventre. R O N S A R D , Amours de Cassandre, ElegM a Janet (1,123). — Ces jarrets et ces genoux Douillets, grasselets et mouls. BAÏF, les Amours de Meline, L. II (I, 66). — Une jeune pucelette, Puce-lette grasselette, Qu'esperdument j'aime mieux Que mon cœur ny que mes yeux. RONSARD, Gayetez, 4 (II, 46). — L'une d'un sein grasselet Et d'un bel œil brunelet Dans ses beautez tient
31
na vie Eperdument asservie. ID., ib. (11, 48). — 3acrons luy ces roses belles... Ce col de neige et de aict, Et ce beau sein grasselet. O. D E M A G N Y , les Gayetez, 10. — Aproche toi tost, m a ninfete, Pour roir ta gorge gracelete. V A U Q U E L I N D E LA FR E S NAYE, les Foresteries, II, 2. — Puis quand j'ar-reste l'oeil sur ses bras grasselets. BAÏF, l'Amour de Francine, L. III (I, 239). —• Dessous s'esten-doit marbrine Sa grasselette poitrine. ID., Diverses Amours, L. III (I, 378). — Je vouldrois estre le colet Qui sur vostre sein grasselet Couvre ces deux tétons d'ivoire. O. D E M A G N Y , Odes, II, 163. — Ta main blanche et grasselette. A U B I G N É , le Primtems, I, 35. — Elle est si mignardelette, Si poupine et gracelette. P. D E B R A C H , les Amours d'Aymee, L. I, ode 3. — Son menton rondelet, Grasselet, jumelet. CL. G A R N I E R , Amour victorieux (S. Ratel, Rev. du XVIe siècle, XII, 25). — Ma dextre, l'instrument du mal que je m e brasse, Découvre son beau sein, potelu, grasselet. D u MAS, Lydie, p. 5. — Jamais le loup n'y ravit des troupeaux L'humble brebiz ou le tendre aignelet, Ny le faulcon le pigeon grasselet. O. D E M A G N Y , les Gayetez, p. 86. — La main de la sage nature Meit jadis son art et sa cure Pour le faire [un petit chien] beau de tout point Et d'un grasselet en bon poinct. ID., Odes, II, 80. — Ses estebles pour mettre et le porc grasselet Et les grands bœufs en gresse et ses vaches à laict. CL. G A U CHET, te Plaisir des champs, le Printemps, Discours du chasseur et du citadin, p. 101. — C'est l'aigneau d'holocauste qu'il nous faut offrir a Dieu, il le faut donq tenir en bon point et grasselet. S* FRANÇOIS D E SALES, Lettres, 660 (XV, 17).
Grasselu. Un peu gras, grassouillet. — Hà, peintre, tu n'as rien encores Achevé, si tu ne colores Au vif ce menton fosselu, Poli, grasselu, pommelu. R. B E L L E A U , la Bergerie, lre Journ., le Portrait de sa maistresse (1, 263). Grassesse. Qualité de ce qui est gras. — Il en
sourdit une autre [humeur] claire, qui ne diffe-roit de rien, ny en odeur ny en goust et saveur, de l'huile naturelle, ayant le lustre et la grassesse si semblable que lon n'y eust sceu trouver ny co-gnoistre aucune différence. A M Y O T , Alexandre, 57. Embonpoint. — C'est une pierre qui favorise à
la digestion et à la grassesse. L A BOD., Harmon., p. 110 (G). Grasset. Un peu gras. — Beauté est tousjours
aymable, laquelle semble estre ne sçay quoy mol, tendre et grasset, qui soudain coule et passe en nous. D E S PÉRIERS, trad. du Lysis de P L A T O N (I, 32). — Ny le reply de sa gorge grassette, Ny son menton rondement fosselu. R O N S A R D , Amours de Cassandre (I, 24). — Montre ta grasséte joue. BAÏF, tes Amours de Meline, L. II (I, 57). — Une jeune pucelette... A la moitié de m a vie Eperdument asservie De son grasset en-bon-point. R O N SARD, Gayetez, 4 (II, 46). — Le mary... devint amoureux de ceste chambrière, jeune, affetee et grassette. Les Comptes du monde adventureux, 6 (1, 42). — O main courte et grassette ! D u B E L LAY, les Regrets, 91. — Le col grasset, courte 1 oreille. ID., Jeux rustiques, Epitaphe d'un chat. — Elle est longuette, grassette, et marquée de deux petits plis sous le menton. R. B E L L E A U , la Bergerie, lre Journ (Ij 25g). _ De la plus grassette partie De sa grève au tour arrondie. ID., ib., le Portrait de sa maistresse (I, 264). — O col charnu, ton grasset embompoint Comme beaucoup ne nous découvre point Des nerfs tendus alors que tu te tournes. G U Y D E TOURS, Souspirs amoureux, L. 1 (1, 34). — Dorothée est grassette,
GRATIA DEI
douillette, rondelette et en bon point. LARIVEY, tes Tromperies, I, 3.
Grasseté. Embonpoint. — Byas fist engraisser deux mulles... et les mist hors de la cité, et trouvées des ennemis furent menées a Aliatuc qui, admirant la grasseté d'icelles, estima la cité plaine de vitailles. FOSSETIER, Cron. Marg., Il, 71 r° (G.). Chose grasse. — Ces grassetez demeurent partie
en la cendre partie en la suye. Trésor de E V O N I M E , p. 187 (G.).
Grasseté de langue. Grasseyement. — Une grasseté de langue quil avoit, laquelle eust esté vice en ung aultre, luy seoit moult bien... De celle grasseté de langue, Aristophanes le poète en faict mention par certains mètres, esquelz soy moc-quant dung nommé Theorus, il contrefaict et imite ledict Alcibiades prononceant l au lieu de r, comme font ceulx qui ont celluy vice de langue. G. D E S E L V E , Huict Vies de P L U T A R Q U E , Alci-biade, 60 r°. Grassettement. Avec une forme un peu grasse, un corps un peu gras. — Et sa gorge dessous, bien plus blanche que lait, Qui à son sein poly si bien jointe s'allie, Enflant grassettement sa charnure polie. BAÏF, l'Amour de Francine, L. III (I, 239). —• Sieds après la Du-Lut, grassettement mignarde. G U Y D E T O U R S , Paradis d'Amour (11,19). Grat. Endroit où les poules grattent. Au grat,
allez au grat. Allez-vous en. —• Gaigne le hault : au grat, au grat, Grippeminaux, vous renifliez. M A R O T , te Grup de Cl. Marot, édit. Guiffrey, II, 464. — Fi, fy, au grat, au diable, tel pend art, Qui de Lhuter veult porter lestandart. Six dames de Paris à Cl. Marot, édit. Guiffrey, III, 138. — Allez donc au grat, correcteurs ingrats, et vous grattez le cul au soleil. B E R O A L D E D E V E R V I L L E , te Moyen de parvenir, Correlaire (I, 59).
Envoyer au grat. Éconduire, envoyer promener. —• Gardez vous bien de voir un tel ingrat, Ains soit chassé, et envoyé au grat. Rymes de P E R N E T T E D U GUILLET, p. 124. — Xantus...
leur dist qu'il falloit couper les attaches : mais les laquais le renvoyèrent au grat, jusqu'à luy dire que, s'il en avoit coupé tant seulement une, qu'on jetterait toutes les robbes aval-l'eau. Les Fanfares des Roule Bontemps, p. 75.
Gratantes, mot d'argot. Mains. Var. hist. et litt., VIII, 182.
Grateleux. De la grattelle. —• Ciron. Grate-leux, demengeant. M. D E L A P O R T E , Epithetes, 86 r°.
De m ê m e nature que la grattelle. — Galle. Ron-gneuse, vilaine, teigneuse... grateleuse... crous-teuse. ID., ib., 187 v°.
Qui a la grattelle. — Ceux qui sont naiz au Cancre seront gratelleux. A N T . D U M O U L I N , trad. de J. D'INDAGINE, Reigles des maladies, p. 177. — (Subst.). Une fontaine d'eaue tiède, où vont volontiers se baigner les grateleux, rongneux et lépreux. T H E V E T , Cosmogr., X X , 6.
Gratelle employé dans le sens de grattement. — Sa femme... l'asceura que de ceste gratelle mal aulcun ne luy adviendrait. RA B E L A I S , IV, 47.
Gratemain. — D'où ils seraient contraints de recevoir une odeur punaise, laquelle les priverait du doux entretien de leurs dames... du doux propos, gratemains, meneries. Var. hist. et litt., V, 117.
Gratia dei. — Avec une petite emplastre de
51
GRATIER, GRATIERE — 362 —
gratia dei. AMBR. PARÉ, XV, 8. — Il faut curer l'ulcère et mettre l'emplastre de gratia dei. ID., X X I , 25.
Gratier, Gratiere, v. Gracier, Glatiere.
Gratieusement. Agréablement. — La vigne qui croist auprès de la mandragore tire par infusion sa force et sa vertu, de sorte que le vin qui en vient endort doucement et gratieusement ceux qui en boivent. D u V A I R , Eloq. franc., édit. Ra-douant, p. 158.
Gratieux. Modéré ? — La nécessité m e pressera de m e retirer vers les Allemaignes, afin d'y vivre à plus gratieux prix que je ne fais en ceste ville. P H . D E M A R N I X , Ecrits polit, et histor., p. 311.
Gratificable. Reconnaissant. — Les dieux sçavent fort bien qui les servent et qui les offensent, qui les ayment et qui les hayent... qui sont gratificables et qui sont ingratz. B. D E L A GRISE, trad. de G U E V A R A , l'Orloge des princes, III, 38. Gratification. Caractère de ce qui fait plaisir.
— Ils sont injustes d'exiger ce que je ne doy pas plus rigoureusement beaucoup qu'ils n'exigent d'eux ce qu'ils doivent. En m'y condemnant, ils effacent la gratification de l'action et la gratitude qui m'en seroit deue. M O N T A I G N E , I, 25 (1, 218). Satisfaction, plaisir, joie. — L'honneste est
stable et permanent, fournissant à celuy qui l'a faict une gratification constante. ID., II, 8 (II, 76). — Il ne m e souvient point de m'estre jamais veu galleux. Si est la gratterie des gratifications de nature les plus douces. ID., 111,13 (IV, 255). — S'accorder bien avec soy, vivre à l'aise, sans aucune peine ny dispute au dedans, plein de joye, de paix, d'allégresse et gratification envers soy mesme. C H A R R O N , Sagesse, II, 12. — Aux choses ambiguës... le meilleur est se jetter au party où il y a plus d'honnesteté et de justice. Car encore qu'il en mesadvienne, si restera-il tousjours une gratification au dedans et une gloire au dehors d'avoir choisi le meilleur. ID., ib., III 4.
Service, faveur, bienfait. — Tous plaisirs et toutes gratifications ne sont pas bien logées en toutes gens. Epaminondas avoit fait emprisonner un garçon desbauché ; Pélopidas le pria de le mettre en liberté en sa faveur ; il l'en refusa, et l'accorda à une sienne garse, qui aussi l'en pria : disant que c'estoit une gratification deue à une amie, non à un capitaine. M O N T A I G N E , I, 29 (I, 249). —• La mort violente de trois grands enfants luy ayant esté envoyée en un jour, pour un aspre coup de verge, comme il est à croire : peu s'en fallut qu'il ne la print à faveur et gratification singulière du ciel. ID., I, 40 (I, 341). — Le roy luy fit présent du gouvernement de Bourgongne : qui n'estoit pas tant une gratification que recognois-sance des grands services qu'il avoit receus de luy. E. P A S Q U I E R , Lettres, XVII, 4. — Je vous renonce, amitiés infidelleg et desloyales, services perdus et misérables, gratifications ingrates, complaisances fascheuses. S4 F R A N Ç O I S D E SA L E S , Vie dévote, I, 10. ^ Reconnaissance. — Je ne dis rien sans raison...
S'ils en ont une meilleure qui destruise la mienne, je l'escouteray avec plaisir, et gratification à qui la dira. C H A R R O N , Sagesse, Préface.
Gratificque. Reconnaissant. — Parquoy les gratificques Romains luy firent une statue a cheval a perpetuele mémoire de sa vertu. FOSSETIER, Cron. Marg., II, 146 v» (G.). Gratifier (intrans.). Faire plaisir, être agréa
ble. — Celuy dont lopinion nest pas approuvée ne
sera meu de la changer pour gratifier a la multi-tude. S E Y S S E L , trad. de T H U C Y D I D E , III, 7 (91 voi" — Clearidas refusa de remettre ladicte cité dé Amphipolis pour gratifier aux Chalcides. b., i{ V, 3 (159 v°). — Ainsi parla il, cuidant gratifiera Pausanias. SALIAT, trad. d'HÉRODOTE, IX, 79, _ Theseus qui... desiroit gratifier au peuple se par. tit pour aller combatre le taureau de Marathon A M Y O T , Thésée, 14. — Voulant gratifier à ces familles, en les faisant, à faulses enseignes, descendre de la race du roy Numa. ID., Numa, 21._ Les flatteurs, pour gratifier à Cleopatra, feirent pareillement chasser plusieurs autres des meilleurs serviteurs et amis qu'eust Antonius. ID, Antoine, 59. — On peut veoir à l'œil, quand la superstition veut gratifier à Dieu, en combien de follies elle s'enveloppe comme en se jouant. CAL-VIN, Instit. (1560), I, iv, 3. — V o u s desirez gratifier à ces messieurs les docteurs. H. ESTIENNE Dial. du lang. franc, ital., I, 369. — Amestris...' fit pour une fois ensevelir touts vifs quatorze jouvenceaux... pour gratifier à quelque dieu souster-rain. M O N T A I G N E , II, 12 (II, 265).
Donner .satisfaction. — Antonius... desiroit aussi gratifier à PtolomaeUs en sa requeste et prière. A M Y O T , Antoine, 3. —• Il n'y a rien plus propre à sa nature que de gratifier aux requestes de ceux qui le supplient. CALVIN, Instit. (1560), III, xx, 13. — L'Escriture recite que Dieu a quelquefois gratifié à des requestes lesquelles toutes-fois n'estoyent point procedees d'un cœur paisible ne bien rangé. ID., ib., III, xx, 15.
Gratifier de. Donner la satisfaction de, accorder. — D'avoir inhumainement rejette toutes publiques supplications, prieras d'ambassadeurs... pour gratifier de sa retraitte aux prières de sa mère, cela n'estoit pas tant honorer sa mère que deshonorer son païs. A M Y O T , Compar. d'Akibiaie et de Coriolan, 4.
Gratifier à. Féliciter. — Tous luy gratifièrent de son retour, ainsi que pareillement estoit advenu à Demosthenes quand il revint à Athènes. SEYSSEL, trad. d'AppiEN, Guerres civiles, II, 3,—Tu fais dedans mon cœur un beau désir renaistre De le ceindre en ces bras, de luy gratifier D'avoir sceu vaincre Achile en ce combat dernier. MONTCHRESTIEN, Hector, V, p. 59.
Gratifier (trans.). Être agréable à, faire plaisir à. — Pource que c'est à moy aussi que cest apostat s'est attaché pour gratifier ses maistres, j'ay prins la charge de luy respondre. T H . D E BÈZE, Vie de Calvin. — A quel usage les deschirements... des Mahometans, qui s'esbalaffrent le visage, l'estomach, les membres, pour gratifier leur prophète...? M O N T A I G N E , II, 12 (II, 266).
Gratifier qqn de. Être agréable à qqn par. — C'estoit une humeur farouche, de vouloir gratifier l'architecte de la subversion de son bastiment, ID., ib. (II, 265). Lui donner la satisfaction de. — Il faudra gra
tifier le malade de se tenir et situer en la façon qui luy sera plus aisée, qui luy viendra mieux a plaisir. A M B R . P A R É , VIII, 17.
Se gratifier. Se réjouir, être heureux, éprouver du plaisir. — Et m e gratifie singulièrement que cette correction m e soit arrivée en un aage naturellement enclin à l'avarice. M O N T A I G N E , 1, 40 (I, 348). — Il est peu d'hommes addonnez à la poésie qui ne se gratifiassent plus d'estre pères de l'Enéide que du plus beau garçon de Rome. ID., II, 8 (II, 100). — Je suis envieux du bon-heur de ceux qui se sçavent resjouyr et gratifier en leur besongne. ID., II, 17 (III, 25-26).
Se féliciter. — Je m e suis maintenu en equam-
— 363 GRATUITÉ
ï
'lité et pure indifférence... Dequoy je m e gratifie, ('autant que je voy c o m m u n é m e n t faillir au contraire. ID., III, 10 (IV, 134). * Se rendre agréable. —• C o m m e qu'il esperast par tiest artifice se gratiffier à Tibère. D E R O Z I E R S , Ifrad de D I O N C A S S I U S , Hist. rom., L. LVII, i:h. 122 (251 r°). *! Gratigner. Gratter. —• Gratigne m o n dos et fe te gratigneray ton orteyl. P A L S G R A V E , Esclare, V 486. — Car sans cesse il gratignoit Quand ce lesir le poingnoit. D u B E L L A Y , Jeux rustiques, Epitaphe d'un petit chien. —• Sauter, pour le faire 'Ave, Sur la table, et trépigner, Follastrer et gratiner. ID., ib. — (Fig.). 11 proteste qu'il n'entend le gratigner sinon ceux qui se sentent rongneux. PH. D E M A R N I X , Corresp. et Mélanges, p. 443. Egratigner. — Les chiens nous mordent, les
chats nous gratignent. B. D E L A G R I S E , trad. de G U E V A R A , l'Orloge des princes, III, 33. — S'il m e gratigne, je le mordray. A U B I G N É , Faeneste, III, 5. Gratin. Critique, blâme? — Ai je faict, je m'en vien, sans craindre ni gratin, Ni mauvais bruit de nom, ni rival à m a done. F R , H A B E R T , trad. d'HoRACE, Satyres, II, 7. Gratis 1. Terre grattée. — Toutes ces pièces destachées, peu eslevées, peu espesses, plus enflées de bois que de terre, et qui n'eurent guères qu'un gratis au lieu de fossé. A U B I G N É , Hist. univ., IX, 12. Gratis 2. Don gratuit. De gratis. E n don gra
tuit. — 1 1 leur remonstra que ce avoit esté de gratis, et de sa libéralité. R A B E L A I S , I, 20. Gratitude. Action agréable, plaisir. — Se a
ma faveur tu luy faitz aulcun plaisir ou gratitude, je l'airoys si tresagreable que je le reputeray estre faict a moymesmes. P. F A B R I , l'Art de Rhétorique, L. l,p. 288. Faveur. — Le premier don de justice est juger
Selon droicture, et a tous adjuger Par équité, raison et rectitude Ce qui est leur, sans don ne gratitude. J. B O U C H E T , Epistres morales du Traverseur, II, i, 10. Gratte. Grattelle. — Item est privilège de vieilles gens leur tomber les cheveux sans pigner, et bien souvent leur venir de menue gratte sur le col. G U T E R R Y , trad. des Epistres dorées de G U E VARA, II, 272 (G.).
Gratter. Gratter les rongnes de qqn, à qqn. Lui faire des reproches mérités, le blâmer. —• 11 y en a d'aucuns qui m e trouvent trop rigoreux... Si on demande la cause de leur mescontentement : c'est d'autant qu'ilz ne peuvent souffrir qu'on leur gratte leur rongne. C A L V I N , Excuse aux Nicode-mites (VI, 594). — Que les h o m m e s se justifient tant qu'ils voudront, qu'un chacun gratte les rongnes de son compagnon, et qu'ils s'applaudissent en leurs maux... tant y a que Dieu ne laisse point de regarder du ciel. ID., Serm. sur le hv. de Job, 58 (XXXIII, 729). — Toutes fois et qualités que sa parole nous gratte les rongnes et quelle nous reprend, souffrons cela en patience. Ip, ib., 132 ( X X X V , 172). — Ceux qui seront ainsi reprins, et ausquels on gratte les rongnes sontpicquez et envenimez. ID., Serm. sur la première à Timothee, 43 (LUI, 517). Gratter qqn sur sa rongne. Lui reprocher son
vice. — 11 estoit riche et avoit son affection à ses mens : et ne congnoissoit point que cela fust vice. Nostre Seigneur donc le vient gratter sur sa rongne, à fin qu'il congnoisse son mal. ID., Contre les libertins, ch. 21 (VII, 217).
Gratter qqn où il luy démange, v. Démanger. Se grater. Se féliciter, se louer. — Mais je n'ex
cuse pas les censeurs de Socrate, De qui l'esprit rongneux de soy mesme se grate, S'idolâtre, s'admire. R É G N I E R , Sat. 10.
(Expressions proverbiales.) — Pour déclarer que les empeschemens ne nous laissent aucun loisir, nous disons, Je n'ay pas le loisir de me moucher, ou, de me gratter l'oreille. H. E S T I E N N E , Conformité, ch. 2, p. 184. — Par cy devant j'ay esté mal édifié, quand on nous appelloit papaux, papistes ou papicoles : je m'en grattoye la teste et le prenoye au poinct d'honneur, pensant qu'on nous faisoit injure. P H . D E M A R N I X , Differ. de la Relig., I, i, 6. Gratterie. Action de se gratter. — Il ne me
souvient point de m'estre jamais veu galleux. Si est la gratterie des gratifications de nature les plus douces. M O N T A I G N E , III, 13 (IV, 255).
Grattoire. Instrument avec lequel on gratte. — La bonne vieille... prenant la mesme grattoire pour briser son fourmage. D u PINET, trad. du Comment, sur Dioscoride, IV, 73 (G.). Gratuit. Don? — Sans aultre gratuit de re
compense escripte Que celle qui se rend de l'envie au mérite. L. P A P O N , Meslanges (II, 146). Gratuité. Bienfait, faveur, don. —• Pour tous
lesquelz bienfaits et gratuitez ilz ont tousjours à leur pouvoir usurpé les terres impériales tant de lempire oriental comme occidental. L E M A I R E D E B E L G E S , la Légende des Vénitiens, ch. 2. —• Ils peuvent espérer... d'avoir plusieurs autres gratuitez de sa grâce et majesté, avec le temps, plus espoir qu'ils ne s'attendent. S E Y S S E L , Hist. de Louys XII, Vict. sur les Vénitiens, p. 331-332. — Noz progeniteurs ont faict plusieurs bénéfices et gratuitez par le temps passé aux Grégeois. ID., trad. de D I O D O R E , 1, 25. —• Elle [Cratesipolis] estoit a merveilles aymee des gensdarmes, pour les plaisirs et gratuitez quelle leur faisoit, car elle leur soubvenoit en leurs nécessitez. ID., ib., II, 31. — Hz estoient honnorez et cheriz de tous, et si leur faisoient tous grans dons et plusieurs aultres gratuitez. ID., ib., III, 28. — Racompte aussi les biens, honneurs, gravitez [lire gratuitez] et plaisirs que tu ingrat as receuz de moy. Trad. de B O C C A C E , Flammette (1537), ch. v, 47 r°. — Apres que Moyse a parlé de Dan, il adjouste de Nephtali : Qu'il sera saoulé de la faveur, ou bon plaisir, ou gratuité : (car le mot emporte cela, une amour gratuite). C A L V I N , Serm. sur le Deuter., 197 ( X X I X , 189). — Les Samiens disent que les Lace-demoniens estendirent leurs gratuitez jusque tant, parce qu'autrefoiz ilz les avoient aidé sur mer contre les Messeniens. S A L I A T , trad. d'HÉRO-D O T E , III, 47. — 11 le feit à sa prière, disant que c'estoit de telles gratuitez qu'il falloit concéder aux amies et concubines. A M Y O T , Dicts des roys et cap., Epaminondas, 1. — Volontiers ces gens s'addressent aux Latins pour chrestienner leurs enfans, non pour zèle qu'ils ayent à la façon de faire des Latins, mais pour en tirer quelque profit : car les parrains leur font quelque gratuité, et des presens à l'enfant et à la mère. T H E V E T , Cosmogr., XVI11,11. Bonté, affection, bienveillance. — Toy donc,
Seigneur, ta promesse et tes hommes Garde et maintien par ta gratuité. M A R O T , PS. deDavid,l2. — O Dieu, aye pitié de moi selon ta gratuité, selon la grandeur de tes compassions, efface mes forfaits. A U B I G N É , Médit, sur le Ps. 51 (II, 174). — Racontera-on ta gratuité au sepulchre et ta fidélité au tombeau? ID., trad. du Ps. 88 (II, 191).
GRATUITEMENT — 364 —
Bonne volonté, affection. — 11 ne les avoit pas sous soy ne sous son empire. Ils estoyent là venus comme de gratuité : estans ses amis et alliez, ils l'ont secouru. CALVIN, Serm. sur la Genèse, 3e de Melchisedec (XXIII, 676) Par la gratuité. Sans peine. — Aussi en guerre
une victoire obtenue de force est plus signalée, plus ardente et plaisante que par la gratuité. B R A N T Ô M E , des Dames, part. Il (IX, 41).
Reconnaissance. — Les hommes entendans sa magnanimité [de Ptolémée] et la gratuité qui! avoit envers son prince et seigneur, venoient de tous costez... luy offrir leur service a la guerre. SEYSSEL, trad. de D I O D O R E , I, 11 (15 v°). —
C'est la nature de gratuité. Car le temps, qui toutes choses ronge et diminue, augmente et ac-croist les biensfaictz. R A B E L A I S , I, 50. — Force m e sera... estre ingrat réputé par impotence de gratuité. ID., IV, 4. Gratuitement. Par affection, par bienveil
lance. — Vueille nous, par ta clémence infinie, gratuitement pardonner noz offences. C A L V I N , la Forme des prières (VI, 175).
Gratulation (gratulatio). Action de grâces, félicitation. —• Tout le ciel a esté remply des louanges et gratulations que vous mesmes et vos pèresfeistes. R A B E L A I S , 1, 50. —Voyant... toute la cité remplye de joye, de gratulations et de sacrifices, je ne me tenois point pour cela asseuré. G. D E S E L V E , Huict Vies de P L U T A R Q U E , Paul Emile, 121 v°. — Il fut receu et instruit par Mor-villiers de Pestât du royaume, que chacun détes-toit la mauvaise journée pour le péril qui parois-soit, et qu'il n'usast d'aucunes gratulations sur ce faict. A U B I G N É , Hist. univ., VI, 15.
Gratulatoire (gratulatorius, de félicitation). — Je suis contrainct changer mon instituée oraison gratulatoire en recommendatoire et paroles excusatoires. M A R T . D U B E L L A Y , Mém., L. IV,
127 r° (G.). — Sous autre chef... sont les [lettres closes] nonciatoires... collaudatoires, gratula-toires. 1583. J. P A P O N , Troisième Notaire, 57 (Vaganay, Deux mille mots). — Après les lettres gra-tulatoires du pape et les responses du roi d'Espagne. A U B I G N É , Hist. univ., VI, 17.
Gratuler (gratulari). Gratuler qqch à qqn. Féliciter qqn de qqch, — 1 1 gratule le retour à Pompée Vare. Luc D E L A P O R T E , trad. d'HoRACE, Odes, II, /.
Gratuler. Remercier. — Ohé m a femme, quel maintien As tu en gratulant les dieux ! Therence en franc., 218 c (G.). Gratuse. Râpe. — Ceste gratuse, et ces bour-settes Aux espices, et ces pincettes. BAÏF, Passe-tems, L. I (IV, 246). ,,Grft,usé- RâPé- _ Tu adjousteras deux roux d œufs batus ensemble, ung peu de fromaige vieux gratuse. PL A T I N E , De koneste volupté, 80 r° (G ) — Quand [le pigeon] sera demy cuyt, l'inspergiras de sel et pain gratuse. ID., ib„ 66 r° (G ) — Deux pains gratusés. ID., ib., 81 r° (G.). Gravable. Qui doit être gravé. — En un tableau orin gravable est la sentence du divin Platon. 1554. L E C A R O N , la Claire, 33 (Vaganay Deux mille mots). ' Gravaigne. — Ainsi soubs soy Boote, es glaceuses campagnes, Tardif, void des oiseaux qu'on appelle gravaignes,- Qui sont fils, comme on dit, de certains arbrisseaux Que leur fueille féconde anime dans les eaux. D u B A R T A S , 1 " Semaine, 6e Jour, p. 309.
Gravail. Gravier. — Qu'il n'y ait fueille d'arbre ou gravail de ruisseau Qui ne sentele fan que m a poitrine jette. BAÏF, l'Amour de Franri». L. 1 (I, 133). w'
Grave 1. Lourd, pesant. — Et commença mon ventre enfler et croistre Par nouveau fait qui an dedans peut estre : Et la charge furtivement bâtie M e rendoit grave et toute pesantie. CH, FON-TAINE, les XXI Epistres d'OviDE, Ep. 11, p 210 — Les gros poteaux gisans en terre on vôid D'or barbarin tant superbes et graves. D E S MASUBES Enéide, II, p. 89. — Les corps graves et terrestres' A M Y O T , De la face de la lune, 13. — La terre est comme la base et fin des choses graves vers le centre, ainsi que le feu est la fin et base de ce qui est léger vers le ciel. T H E V E T , Cosmogr., I, 3 _ L'humeur de l'arbre, selon le naturel et propriété des choses graves, tendant en bas, porte par conséquent sa nourriture en tel endroit. 0. n S E R R E S , Théâtre d'agric, VI, 19.
Lourd (fig.), pénible. — Plusieurs de ces impositions et tributz... seront moult graves à supporter. D E R O Z I E R S , trad. de D I O N CASSIUS, Hist rom., L. L U , ch. 86 (194 r°). — Je ne voy par quelle cause te doives mouvoir à désirer la monarchie, pour autant que, oultre ce que elle est moult moleste aux peuples, encores à toy seroit beaucoup plus grave. ID., ib., L. II, ch. 85 (187 r°).
Sévère, sombre. — Ne vous souvient il plus comment il [Antoine] estoit grave et terrible en son aspect seulement, et plus moleste encores en ses faictz? ID., ib., L. XLV, ch. 59 (109 r°).
Qui a du poids, de l'autorité. — Damascene, auteur grave, atteste avoir veu une fille velue comme un ours. A M B R . P A R É , XIX, 9.
(Subst.). Gravité. — Donc admirant le grave de l'honneur Qui en l'ouvert de ton front seigneurie. M A U R I C E S C È V E , Délie, 146.
Grave 2. Grève. — On quel lieu ne trouva grand exercice, sinon des guaharriers jouans aux luettes sur la grave. RABELAIS, U, 5. — Il estoit sur le rivaige de la mer a regarder les corps de ceulx qui avoient esté tuez, lesquelz la mer avoit gecté en la grave. G. D E SELVE, Huict Vies de P L U T A R Q U E , Thémistocle, 1 v°. — C'est grand'-hideur de la voir [la tigresse] enrager sur la grave pour la perte de ses petis. M. D E LA PORTE, Epithetes, 401 r°. — Et avoit faict aprester quatre pièces de campaigne, lesquelles estoient desjà sur la grave. M O N L U C , Commentaires, L. V (II, 430), — Ils vous supplient de leur vouloir donner un navire qui est sur la grave, qui ne vaut rien.., pour le despecer et s'en chauffer. BRANTÔME, Cap. franc., le Connestable Anne de Montmorency (III, 305). — (Fig.). Donne toy garde des rochers de cupidité effrénée, de la grave doutrecuidance. LEM A I R E D E B E L G E S , Illustr., I, 31.
Sable. — [L'intelligence de Dieu] voit et compte actuellement et tout en un coup les gouttes de la mer Oceane et la grave de ses rives. M O N T A I G N E , trad. de R. S E B O N , ch. 30. — Des
reytres alemands, tocseins de nos tremeurs, Qui, semés plus espais que les plus vives greines, Nombre-passent le fonds des graves des arènes, L. P A P O N , Pastorelle, II, 2.
Gravier, gravât. — Il sera incessamment be-songné a l'évacuation des graves et immundices estans au dict faux bourg. Pièce de 1584 (G.).
Terre où il y du gravier. — Vente d'une vigne en graves de Bordeaux. 19 mars 1525. Arch. Gironde (G.).
Gravelle. — Les choses aperitives... acheminent cette matière gluante, de laquelle se bastit
— 365 — G R A V 0 1 S
î grave et la pierre, et conduisent contre-bas ce lui se commence à durcir et amasser aux reins. MONTAIGNE, II, 37 (111, 222). — J'entens toutes ois par ceux qui l'essayèrent [un remède] que la noindre petite grave ne daigna s'en esmouvoir. D ib. (III, 232). —• Les ans m'ont évidemment aict tarir aucuns rheumes. Pourquoy non ces •xcremens qui fournissent de matière à la grave? in., III, 13 (IV, 248). Gravedat (?). — T o u t cela marchoit avec tel
•egret de se retirer et avec tel gravedat qu'à une ieue du passage ils virent à leur droite le comte le Hohenloo avec sa troupe. A U B I G N É , Hist. •mw., XIV, 28. Gravelé. De la nature du gravier. — Belle
sle... Où les clairs diamans, où les rubis tre-luisent, Où l'or croist à foison, où les perles se puisent Comme aux bords de la mer les sablons tavelez. G. D U R A N T , ŒUV. poet., 212 r°. Gravelée (cendre de). Cendre provenant de
lie de vin brûlée (G.). —Cendre de chesne, de gravelée, tithymal, pommelée, de figuier. A M B R . PARÉ, XXV, 32.
Graveleur. Celui qui est malade de la gra-velle. — Lesdits curez leur souffloient en la bouche et les nourrissoyent de vent, comme d'une viande céleste, propre à guérir les goûteux, grave-leurs et cacochimes. Sat. Men., Tableaux de l'escalier de la salle des Estats, p. 292. Graveleux. De la nature du gravier. — Tes-
moing la Palestine au peuple circoncis, Où, le cours d'un esté, de m a dextre j'occis Plus de sou-dars rompus que leur Jordan ne porte D'arène graveleuse au sein de la mer Morte. R. G A R N I E R , Porcie, 1144. Où il y a du gravier. — Le doux sommeil le
prend entre mille fleurettes, A u bruit d'une fontaine et de ses ondelettes Qui gargouillent autour, ou d'un coudre mouelleux, O u d'un saule qui fend son chemin graveleux. ID., Hippolyte, 1232. Gravelin (?), — Des sentinelles sont posées au
gravelin de la Grand Porte. 1589. Avallon (G.). Graveliste. Celui qui est malade de la gra-
velle. — Les sindics des malades, flebvreus, pul-moniques, catareux... pieristes ou gravelistes. Var. hist. et litt., V, 99. Gravement. Action de graver. —'L'estime que
lesgensdebien font de vous nedepend ni du gravement ni du razement de ces armoyries. S' F R A N ÇOIS D E SALES, Lettres, 931 (XVI, 100).
Graver 1. Marquer. — Veu que Péché, que Dieu voulut mauldire, D e plus en plus m'a gravé de son faictz. P. D U V A L , Morallité à six personnages, p. 137. — O champs, ô monts, ô vaux, que les courriers célestes Ont gravé de leurs pas ! D u BARTAS, 2" Semaine, 3e Jour, les Capitaines, p. 467. y
Gravé. Marqué. — L'autre... Vante un brave soldat, à la face de tous, Son adresse, son heur, sa force et son courage, Et son esprit vanteur, repeu de son dommage, Estelle un estomac gravé de mille coups. A U B I G N É , le Primtems, 11,16. Graver 2. Gravir, monter, grimper. — Allez en
la ville gravant comme un rat contre la muraille. RABELAIS, 11, 28. — L'enfant... entra en la vene creuse, et gravant par le diaphragme jusques au dessus des espaules... sortit par l'aureille senestre. ID., I, 6. — [Gargantua] gravoit es arbres c o m m e un chat. ID., I, 23. — Sy quelq'un gravoyt en une arbre pensant y estre en seureté, [frère Jean] icel-
luy de son baston empaloyt par le fondement. ID., I, 27. — Par tous les lieux de m a prison rompue Gravay au lieu où je vous avoys veue. M A R G . D E N A V . , Dern. Poés., les Prisons de la reyne de Nav., p. 134. — Je viz chacun qui d'estatz en estatz Montoit, gravoit jusques aux potestatz. E A D . , ib., p. 159. — Voire d'un cœur si généreux Il court et recourt après eux, Que s'ils ne gra-voient tout à l'heure Sur les traveteaux je m'as-seure Qu'il les mettrait en cent morceaux. G U Y D E T O U R S , les Meslanges (II, 84). Gravesse. Poids, fardeau, charge. — Chascung y pourra parler, et sera ouy librement devant le roy le tiez-estat déduire ses gravesses et charges. L ' H O S P I T A L , Harangues (I, 349). — Les impositions et gravesses mises sur le peuple et les tailles excessives aydent grandement à la cherté. Var. hist. et litt., VII, 188. Graveté. Pesanteur. — L'amomum engendre en la teste graveté et douleur. Jard. de santé, I, 22 (G.). Senteur forte. — [La fleur de l'aurore] a bonne
odeur avecques une petite graveté et force de amere saveur. Ib., 1,2 (G.). — Cardamomun plein de graveté. Ib., I, 93 (G.).
Graviere 1. Gravier, sable. — Les Israélites estoient innombrables comme la graviere de la mer. FOSSETIER, Cron. Marg., Il, 2 v° (G.). Graviere 2. Partie de l'armure protégeant la
jambe. —• Que le bouclier soit un queuistre, et les gravieres d'escailles d'huistres. F. BRETIN, trad. de L U C I E N , Comment il faut escrire une histoire, 23.
Gravillon. Gravier, grain de sable. — Duquel [Tage] on comptoit que les areines estoient d'or, ainsi que lon disoit aussi du Pactole d'Asie, pource qu'il y a parmi quelques gravillons dorez. T H E VET, Cosmogr., XIII, 1. — Près d'un village n o m m é Roane, y a un petit torrent... où souvent aussi lon trouve des gravillons dorez. ID., ib., XIV, 12. Gravissime. Qui a beaucoup de poids, d'autorité. — Acteur gravissime. FOSSETIER, Cron. Marg., V, vi, 1 (G.).
Gravité. Pesanteur. — Chascune chose eust tendu pour sa légèreté ou gravité aux lieux où elles sont assises. A M Y O T , De la face de la lune, 15.
Orgueil, arrogance. — Plus encores les mescon-tentoient les aultres façons de faire que leur tenoit Démétrius. tant en difficulté de audience comme en responses trop haultaines : et lacrimonie et gravité intolérable quil tenoit. S E Y S S E L Successeurs d'Alexandre, IV, 7. — Il estoit assis dedans sa chaire, avec une grandeur et une gravité insupportables. A M Y O T , Coriolan, 30. — Luy [Juba] estoit h o m m e insupportable pour la gravité qu'il tenoit, et pour l'oultrecuidance et la gloire dont il estoit plein. ID., Caton d'Utique, 57.
Sévérité, rigueur. — Trajan... s'estudia tous-jours d'estre doux à l'endroit du peuple, révérend envers le sénat et débonnaire à tous, n'ayant jamais usé de gravité envers aucun, sinon aux ennemis de la republique romaine. M. D E L A P O R T E , Epithetes, 405 v°.
En gravité. Avec gravité. — Elle, race des rais, marchoit en gravité A u milieu de sa troupe, et passoit les plus belles, C o m m e l'aube la nuict de ses fiâmes nouvelles. R O N S A R D , la Charité (II, 68). Gravois. Gravier, sable. — Le meilleur est celuy que l'Éthiope indois Trouve dedans le sein de son riche gravois. R. B E L L E A U , les Amours des pierres précieuses, la Pierre d'aymant (II, 186). —
GRAVONNER 366 —
Pendant que ses filets, sa ligne, son harnois Se sechoyent estendus moites sur le gravois. ID., la Bergerie, 2e Journ., le Pescheur (II, 53). — Les saumons, citadins des costes poissonnières, Reposent dans la mer, l'ombre sur le gravois, L'huitre contre le roc, les cerfs dedans les bois, ID., ib. (Il, 58-59). — Auprès de ce ruisseau qui fait si doux murmure, Roulant ses claires eaux sur le pierreux gravois. BAÏF, Eglogue 4 (III, 27). — A u fond de la fontaine en lieu de blond gravois Luisoit le diamant qui honore les doigs. A M . JAM Y N , Œuv. poet., L. III, 127 r°. — Us s'esbatoyent au long d'un clair ruisseau Qui frisoit murmurant par le gravois son eau. D u B A R T A S , 2e Semaine, 1er Jour, les Artifices, p. 151.
Gravonner (?). — (Intrans.). U n n o m m é Jean de Retz et la grosse Janneton y fouillèrent, bêchèrent, piochèrent, houerent, gravonnerent, louchèrent et forcèrent. P H . D'ALCRIPE, la Nouvelle Fabrique, p. 88.
(Trans.). Tirailler, tourmenter. — La pauvre jument, qui estoit entre eux deux couchée, se sentant ainsi gravonner, se leva subitement, soubslevant quand et soy monsieur le loup et madame la chièvre. ID., ib., p. 126.
Grawe. Croc. — Grawes savans pour thirer les cruyaulx et herbes croissans en la machonnerie des machelers du rivaige. 1526. Béthune (G., Gravet). Grazal. Sorte de vase. — Plats trancheurs et
grazals d'estains et autres fournitures et uten-cilles nécessaires pour bien et honestement estre servis dans leurs réfections. Ch. de 1543 (G.). — 11 jetta plus de deux greaux de merde. T A B O U R O T D E S A C C O R D S , Escraignes dijonnoises, 34. Graziner. Crier (se dit de l'oie). — La brebis bailera.l'oyegrazinera, le pourceau grongnera. Gu-T E R R Y , trad. des Ep. dor. de G U E V A R A , p. 276 (G.).
Gré. A gré. A souhait. — Dieu est puissant, doulx et propice, Et nous donra lumière à gré. M A R O T , PS. de David, 45.
Venir à gré, retourner à gré. Être agréable, plaire. — Je feroys des chansons A ta louenge (ô Pan, dieu tressacré) Voyre chansons qui te vien-droyent à gré. ID., Eglogue au roy. — [Le juge] ne peut attribuer à punition ce qui vient à gré à celuy qui le souffre. M O N T A I G N E , II, 12 (II, 266). — Vous promettant prester telle continue à cest œuvre (si j'ay le moindre sentiment qu'il vous retourne à gré) qu'avant quelques révolutions d'années aurez les autres [livres] ensuivans. E. P A S Q U I E R , Lettres, II, 1.
Prendre à gré. Être content de, consentir à. — Les citoyens de Paris... se offrirent d'entretenir et nourrir sa jument tant qu'il luy plairoit. Ce que Gargantua print bien à gré. R A B E L A I S , I, 21.
Sentir bon gré. Savoir bon gré. — La royne et luy m'en sentirent bon gré. M O N L U C , Commentaires, L. IV (II, 161). — Et feusmes au lever de mon dit seigneur de Montpensier, lequel m e sentit fort bon gré de la dilligence que j'avois faicte à le venir trouver. ID., ib., L. V (III, 57).
Être reconnaissant. — Et m e suis jette en ce discours à quartier, à propos du bon gré que je sens à Aul. Gellius de nous avoir laissé par escript ce compte de ses actions [de Plutarque]. M O N TAIGNE, II, 31 (III, 136).
Sentir mauvais gré. Savoir mauvais gré. — Le roy de Navarre m'en sentit si mauvais gré qu'il m'en voulloit mal mortel. M O N L U C , Commentaires, L. V (II, 341).
Tout de gré. A dessein. — Calasiris... leur conta
tout des le commencement... en passant tout de gré aucunes choses qu'il estimoit n'estre point expédient que Nausicles entendist. AMYOT, Hist Mthiop., L. V, 56 r°. — Trachinus estoit bien ayse de cest embrassement, et tout de gré differoit de luy promettre, afin qu'elle y demourast tant plus long temps. ID., ib., 60 r°.
Bongré moi. D e mon bon gré. — Si doucement je m e vi captiver Aux chaînons d'or des rets ou je demeure, Que bongré moi en m a peine arresté, Cette prison m'est douce liberté. BUTTET, l'Anal-thée,3,p. 194.
Malagré. Difficilement. — Ja mal agré peuvent les grosses eaux Se contenir d'entrer dans les vaisseaux. P E L E T I E R D U M A N S , 1er Liv. des
Georgiques, p. 65. Au maulgré de. Malgré. A son malgré. Malgré
lui. — Si fut pour celle cause Camille declairépar le sénat au maulgré du peuple dictateur pour la quatriesme foys. G. D E S E L V E , Huict Fies de PLUT A R Q U E , Camille, 28 v°. —• Tellefoys il le domp-toit [le peuple] a son malgré, et le contraignoitde condescendre à ce que luy estoit prouffltable. ID., ib., Périclès, 37 r°. Bon gré maugré (adv.). Bon gré mal gré. — Que
dirons nous de la plus grand part de nous qui avons bon gré maugré adoré et honnoré les images? Trad. de B U L L I N G E R , la Source d'erreur, 1, 29, p. 391.
(Prép.). En dépit de, malgré. — 1 1 luy a promis Que, bon gré maugré ses amis, L'espousera. DES P É R I E R S , l'Andrie, III, 1. — On ne faict rien qui serve, Quand on le faict bon gré maulgré Minerve, C H . F O N T A I N E dans Marot, Epistres, 52. — I! [Métellus] s'oublia jusques à dire des paroles présomptueuses, et user de fieres menaces, qu'il ferait ce qu'il avoit entrepris bon gré mal gré le sénat. A M Y O T , Caton d'Utique, 26. — 11 sera fort aisé de les transplanter en leur ordre, bongré malgré leurs pères et mères. E. PASQUIER, Recherches, III, 44. — Charles bon gré mal-gré toux ceux qui luy vouloient résister, estoit autant obey par deçà qu'en Austrasie. F A U C H E T , Antiquùez,V, 17,
Bon gré en ait ma vie, Bongré ma vie. Sorte d'exclamation, signifiant, à peu près, merci de m a vie. — N e voye-je pas là Claude? Ho bon gré en ait m a vie, il m e destourbera. JEAN DE U TAILLE, les Corrivaus, III, 3. — Mais il se fault bien contenir D'en approcher, bon gré ma vie, M A R O T , Epigrammes, 78. — La mort a eu, bongré m a vie, Sus nostre pape gay envie. FORCADEL, Œuv. poet., p. 193. Savoir bon gré que, construit avec l'indicatif, -~
Or vous sçay je bon gré que vous estes homme de promesse. H. E S T I E N N E , Dial. du lang. franc. ital, II, 1. Greal, v. Grazal.
Grec. Helléniste. — Jay esté deceu dung secours auquel je mattendoie : cestassavoir du cardinal Byzarion... qui est... excellent grec entre les latins, et excellent latin entre les grecs. Uu-R E N T V A L L E , Prologue de la trad. de Thucydide de Seyssel. — Il est au jourdhuy bien peu de gens lettrés qui soient latins consommés et accompli, et trespeu qui soient suffisamment grecs. BUDE, Instit. du prince, ch. 4. — Je ne suis ne grec, ne hebrieu, ne poëte, ne rhétoricien, ains un simple artisan, bien pauvrement instruit aux lettr^-PALISSY, Recepte véritable, Au mareschal de Montmorency, p. 5. — On dit aujourdhuy . Cestuy-la est bon latin et bon grec, pour signifier. cestuy-la sçait bon latin et bon grec. H. ESTIENNE, Conformité, L. I, p. 60.
Habile. — Je parle de ce qu'on dit en la cour, faire de bons offices au roy ou à la reine, ou à monsieur, ou aux autres princes... Et ceux qui les font sont appeliez hommes de service, et faut qu'ils ayent l'esprit sublin : et qu'ils soyent grecs, comme aussi nous parlons entre nous courtisans de ceux qui sont les plus habiles. ID., Dial. du lang. franc, ital, 1,122. —• On dit bien aussi quel-quesfois II est grec... mais cela ne s'entend pas touchant le sçavoir d es lettres ou sciences greques, mais de maintes ruses, principalement courtisa-nesques. ID., ib., Il, 180. ! Roire à la grecque. Boire copieusement et sans eau. — C'est boire comme il faut, et à la grecque. Du FAIL, Contes d'Eutrapel, 3 (1,104). — Laissant là ces beuveurs à la grecque, qui ne mesloient jamais l'eau et le vin ensemble, on commença à parler de ceux qui en mettent. GUILL. B O U C H E T , !'l»e Seree (I, 52). —• Ils se présentent aux Lacede-moniens qui, pensans que c'estoient leurs dieux, se mirent à faire bonne chère, et boire d'autant à la grecque. L E L O Y E R , Hist. des Spectres, I, 9. — Cela ne se faisoit point sans danse de vilage, et sans boire d'autant à la grecque. ID., ib, VII, 10. r Grecs (prononc). —- Ce sont livres latins et • grecz. — J'entens bien, ilz vous sont aigretz. M A ROT, trad. de deux Colloques d'ÉRASME, I. — Ne me vantez plus, ô Grecz, De Narcisse les regrez. Du BELLAY, les Deux Marguerites. —• Ainsi Do-lon, ayant dit les secretz D u camp troyen, mourut par les deux Grecz. O. D E M A G N Y , les Amours, sonn. 89. — Fameux Ulysse, honneur de tous les Grecs, De nostre bord approche toy plus près. RONSARD, Amour de Marie, le Chant des Serenes (I, 200), — Sur le patron des plus secrets Poètes romains et poètes grecs. R. B E L L E A U , Petites Inventions, le Papillon (I, 52). — Et le divin Jodelle, Qui hautain renouvelle Les tragiques regrets Des braves Grecs. O. D E M A G N Y , Dern. Poés., p. 31. — Si vous jugez entièrement les Grecs Tous de mesme ordre et de mesmes degrez. DES MASURES, Enéide, II, p. 62. — [Eumolpe et Orphée] Qui l'antique magie apportèrent aux Grecs, Qui des flambeaux du ciel cogneurent les secrets. R O N S A R D , Response à quelque ministre (V, 399). —• Car dormant il apprit les thresors et secrets Des Hebrieux, des Latins, des Chaldées, des Grecs. E. PASQUIER, Epitaphes (II, 930). — Survivre à mes enfans en dix ans massacrez Au siège d'Ilion par les cousteaux des Grecs. R. G A R NIER, la Troade, 1740. — Si quelqu'un devant vous, si quelqu'un puis après Imite en mesme endroit les Latins et les Grecs. V A U Q U E L I N D E LA FRESNAYE, Art poet., 1, 27. — Passant, cy gist Rapin, la gloire de son âge, Superbe honneur de Pinde et de ses beaux secrets, Qui vivant surpassa les Latins et les Grecs. R É G N I E R , Sur la mort de Rapin.
Grecanique. Grec. — Je pensoys... que toutes ces choses fussent faictes par les François en dérision des dieux grecaniques. G. T O R Y , Champ fleury, h. 1,2 v°.
Grecaniser. Gréciser. — Je ne veux pas dire fm P.™168 °iue n°us tenons en foy et hommage de IEglise ou des Universitez... mais de celles que nous avons rendues nostres, comme les latines, le tout sans grecaniser ou latiniser, permettez-moy d ainsi le dire. E. PASQUIER, Recherches, VIII, 2. Affecter l'hellénisme ? — Ainsi que dict Ac-
curse, lequel en cela j'ayme autant croira qu'Al-JW*' ^ ^reganise- comme luy. D E S A U T E L S , Mihstoire barragouyne, ch. 10. Grecaniseur. Celui qui emploie des mots ou
G R E D 1 L L E R
des tours grecs. — Sans lesquelles langues n'ont pas laissé aucuns d'estre tresbons poètes, et paradventure plus naïfz que les grecaniseurs, lati-niseurs et italianiseurs en françois. B. A N E A U , Quintil Horatian, p. 189. — Je supplie tres-hum-blement ceux ausquels les Muses ont inspiré leur faveur de n'estre plus latineurs ni grecaniseurs. R O N S A R D , Franciade, Préface de 1587 (III, 535). Greciien. Grec. — En langue greciienne. FOSSETIER, Cron. Marg., I, 43 r° (G.). Gréciser. Imiter la langue grecque, employer les mots et les tours grecs. — Tu ne fais autre chose par tout lceuvre mesme au second livre que nous induire à gréciser et latiniser en françoys. B. A N E A U , Quintil Horatian, p. 172. — Les Romains... voulurent eux-mesmes peu à peu gréciser : ne s'appercevans que par telle imitation ils perdoient la naifveté de leur langue. F A U C H E T , Lang. et poes. franc., I, 6. Suivre la religion catholique grecque. — Ils [les
Valaques] sont chrestiens, mais ils grecisent, comme les Russiens, Podoliens et Moscovites. T H E V E T , Cosmogr., X X , 5.
Grecisant. Qui suit la religion catholique grecque. —• Les Grecs en ce païs là [la Terre-Sainte]... sont si mal affectionnez aux Latins que le Turc ne nous hait pas tant que ce chrestien grecisant. T H E V E T , Cosmogr., VI, 9. — Pour ne donner occasion au Grec grecisant de quitter ou renoncer le christianisme. ID., ib., VI, 12. — J'ay veu l'endroit plusieurs fois, que me monstrerent ces chrestiens grecisans. ID., ib., XIV, 11. —• Les chrestiens grecisans, maronites et arméniens l'estiment estre au nombre des saincts. ID., ib., XVI, 15. Greciseur. Helléniste. — Si ces hommes res-
suscitoient de présent, ils n'entendraient non plus une de leurs oraisons récitées par le plus sçavant greciseur d'entre nous que nous n'entendrions un Bas-Breton : lequel, n'estant jamais sorty de son païs et sçachant seulement lire, voudrait prononcer quelque beau poëme françois. F A U C H E T , Lang. et poes. franc., I, 6. Grecisme. Langue grecque. — [Les Parisiens] sont dictz Parrhesiens en grecisme, c'est à dire fiers en parler. R A B E L A I S , I, 17. — Pour voir au bout de la si ces messieurs de ville Ne le chasti-ront pas de sa praesomption Aussi sévèrement qu'un jour en vision M e fit le roi Quirin, père du latinisme, Indigné de m e voir studieux du grecisme. F R . H A B E R T , trad. d'HoRACE, Satyres, 1, 10, Paraphrase. — Nous avons... maintesfois argué de grecisme ensemble. D u FAIL, Propos rustiques, ch. 13, p. 95.
Grecques, v. Gregues. Gredil. Gril? Le mot est employé comme nom
d'un cabaret. — Le Baril d'or est bas percé; Le Barillet est défoncé ; le trou du Grédil sent l'es-vent. Ane Poés. franc., XI, 75. — Le Grand Grédil, qu'on dit le trou, Nourrist chiens pour harer au loup. Ib., XI, 79.
Grediller. Griller (trans.). — Et si je faulx, qu'on m e gredille. Sotties, III, 106. — Mille petis amours, folastres papillons, A u feu de nos plaisirs se gredilloient les ailes. G. D U R A N T , Œuv. poet., 19 r°.
Friser au fer chaud. — Elle crespe, elle an elle, elle gredille et frize Le poil plus court, qui pointe, et du grand se divise. P. D E B R A C H , Hierusalem, XVI, 6 v».
Se grediller. Se recroqueviller. — U n parche-
37 —
GRÉEMENT (?) — 368 —
min se serre et gredille lors qu'on le met trop près du feu. A M B R . PARÉ, XVIII, 87.
Gredille. Frisé, crêpé. — Sous ton poil gredille en menus crespillons Estincellent tes yeux comme ceux des coulons. R. BELLEAU, Eglogues sacrées, 4 (II, 308). — Sitost qu'il Padvisa, sa barbe espar-pillée, Noire, en petits serpens en devint gredil-lée ; Ses gros yeulx il tourna flambans et furieux. Ane Poés. franc., III, 308. — O cheveux gredillez en menus crespillons... ! R. BELLEAU, la Bergerie, 2e Journ., Baisers (II, 104). — Je mignot'rois ses cheveux gredillez. G U Y D E TOURS, Souspirs amoureux, L. II (I, 41). Gréement (?). — Or commencèrent et furent
mis les deux champions l'ung devant l'autre... et puis montèrent sur leurs chevaulx et se main-tindrent du premier moult gréement, car bien cognoissoint les armes. NICOLAS D E TROVES, le Grand Parangon, 11. Gréer. Consentir, accorder. — De ce et autres
promesses qu'ils s'entrefirent et gréèrent bailleraient l'un a l'autre chacun vingt pleiges de leurs hommes. L E B A U D , Chron. de Vitré, ch. 18 (G.). — Il n'avoit esté convenu, gréé, accordé, ne cheu soubs les promesses, grez, consentement et passements nuls ne aucuns desdits points. ID., Hist. de Bret., ch. 50 (G.).
Gref, v. Grief. Greffe 1. Stylet, poinçon. — Il dit, Je vou-
droye que tous mes propos fussent escrits, qu'ils fussent engravez avec un greffe de fer. CALVIN, Serm. sur le liv. de Job, 11 (XXXIV, 123). — Je désire que mes propos soyent escrits, qu'ils soyent enregistrez en un livre, avec un greffe de fer, en plomb, ou en pierre, à perpétuité. ID., la Bible franc., Job, 19 (LVI, 538).
Greffe 2 (masc). — Le bout du greffe ne doibt point estre amoindry et accoustré de plus de troys doigs de long. C O T E R E A U , trad. de C O L U -M E L L E , IV, 29. — Le bon jardinier... ente des greffes nouveaux, qui rapportent des fruits souefs. E. PASQUIER, Lettres, II, 12. — Il [l'Amour] en retient de l'inconstance De la mer et de la naissance De sa mère, aussi le bourgeon Retient du greffe, et le sourgeon Du naturel de la fontaine. R. B E L L E A U , Petites Inventions, Chanson (1, 124). — Tu vas denter L'aubespin pour l'enter, Ou le prunier, y mettant au millieu U n petit greffe. J. D E BOYSSIÈRES, Prem. Œuv., 111 r°. — C o m m e un greffe estranger enté de main en l'arbre plus ancien. C H A R R O N , Discours chrestiens, Rédemption,^, p. 222. — Donne-moy... de ce greffe, afin que je l'ente en mon jardin, pour m e rapporter de ce fruit. E. PASQUIER, Recherches, VIII, 40. — En y mettant de bons greffes, on se peuple des meilleures races de raisins qu'on puisse choisir. O. D E S E R R E S , Théâtre d'agric, 111, 4. — Pour la petitesse du tronc, un seul greffe y sera mis. ID., ib., VI, 18. — Le tige communique sa saveur à tous les fruitz que les greffes produisent, en telle sorte que chasque fruit ne laisse pas de garder la propriété naturelle du greffe duquel il est procédé. S* F R A N Ç O I S D E SALES, Amour de Dieu, XI, 5. Greffier. Greffiere (fig). — Oubliez-vous les
mains... De nos conceptions diligentes greftieres, Ministres de l'esprit et du corps vivandières? D u B A R T A S , lre Semaine, 6e Jour, p. 288. — La mémoire est des yeux la fidelle greffiere. ID., ib., p. 299. — L'histoire... Des faits plus merveilleux la fidelle greffiere. P. M A T T H I E U , Aman, IV, p. 88.
Greffier. Sorte de chien de chasse. — Chien... joubard, greffier, harpaud. M. D E L A P O R T E , Epi
thetes, 81 r° et v°. — Ilz sont grandz comme lévriers et ont la teste aussy belle que les brac-ques, ilz s'appellent greffiers. CHARLES IX Chasse royale, ch. 10 (G.). Greffieur. Greffier. — Je viendray aux mots
de nos chiquaneries françoises, qui sont aux car-nots de nos greffieurs seulement. TABOUROT DES A C C O R D S , les Bigarrures, I, 21.
Greffion. Sorte de cerise. — Non plus pouvons-nous dire pourquoi d'autres cerises sont dittes pinguereaux, rodanes, greffions et semblables : très-bien des musquates, dont le goust rend raison de leur appellation. O. D E SERRES Théâtre d'agric, VI, 26. Greffon. Jeune branche pour la greffe. —
Propre et vraye cause aux plantes de la production, du nourrissement et... de la génération de leurs semblables par les semences, rameaux et greffons de l'un engendrant l'autre. PONTUS DE T Y A R D , trad. de l'Amour de L É O N HEBRIEU, Dial. II, p. 138. Grefvement, v. Grièvement. Gregable. Apte à vivre en troupe. — Les
grues sont sociables et gregables. BOAYSTUAU, Inst. des princes, 9 v° (G.). Gregail, mot collectif. Troupeau. — Ung jour
Gylon alloit dessus les champs Par ung grand chault, si chault et plein d'encombre Que les oyseauls en desusoient leurs chantz, Et tout gregail en estoit mat et sombre. G. COLIN BUCHEE, Poésies, 87. Grégaire (gregarius miles, simple soldat). —
Les centurions et decurions qui delaissoient les stations bellicqueuses punit par peine capitalle comme simples chevaliers sans ordre nommez grégaires. M I C H E L D E T O U R S , trad. de SUÉTONE, II, 55 r°. • Greganiser, v. Grecaniser. Grege (grex, gregis). Troupeau. — Ayans expo
sez leurs grèges aux Romains, affin qu'ilz les poussent assaillir quant ilz seroyent occupez et espars pour le butin. DEROZIERS, trad. de DION CASSIUS, Hist. rom., L. X X X V I I , ch. 5 (11 v°).
Grégeois. Grec. —• Je n'ay entrepris de faire comparaison de nous à ceulx la, pour ne faire tort à la vertu francoyse, la conférant à la vanité gregeoyse. D u B E L L A Y , Deffence, II, l2-.— Xerxe... envoia ses ambassadeurs par les cités grégeoises demander de l'eau et de la terre. LA B O E T I E , Servitude volontaire, p. 25. — (Subst.). Donnez-moy la lyre d'Homère, Dont la corde n'est point meurdriere, N y reteinte au sang des Grégeois. R. B E L L E A U , Odes <£'ANACRÉON (I, 39).
Gregoise hystoire. Fiction. — Ne croyez pas ce qu'on avancera De telz propos, car c'est gregoise hystoire, Jamais ne fut. G. COLIN BÛCHER, Poésies, 229. Gregesque. Grecque. — J'ay veu maintes
femmes grequesques Ayans marys subjectz aux lois turquesques. B. D E L A B O R D E R I E , Voyagea Constantinople (Bourrilly, Bev. des Et. rab., IX, 211).
A la gregesque. A la manière grecque. — On en af aict [des chausses] à l'hespagnole, à l'italienne... Et à la fin on s'est mis à en faire sans brayette, que les uns ont appelé chausses à la gregesque, ou à la gargesque : les autres, tout en un mot, gre-gesques, ou gargesques, ou garguesques. H. hs-TIENNE, Dial du lang. franc, ital, I, 281.
(Subst., voir ci-dessus). — Si nous fussions nez
avec condition de cotillons et de greguesques, il ne faut faire doubte que nature n'eust arme d'une peau plus espoisse ce qu'elle eust abandonné à la baterie des saisons. M O N T A I G N E , I, 35 (I, 286). — A ung tailleur pour faire ledict pourpoint et une paire de gargaisses de cramoisy brun. 1580. Compt. de tut., Arch. Finist. (G.). — D'autres qui portent la garguesque de velours. Cabin. du roy de Fr., 101, édit. de 1581 (G.). — Je le trouvay sans pourpoint, sur son lict, n'ayant qu'unes greguesques sur soy. E. P A S Q U I E R , Lettres, XIII, 6. La phrase suivante indique un autre sens. —
Les femmes d'Orient en outre les chausses ont pour leur ornement des brayes ou garguesques fort précieuses de quoy elles se ceignent les reins. LABoD.,.ffamott.,p. 759 (G.). Gregues. Sorte de haut-de-chausses. — A quoy faire la monstre que nous faisons à cette heure de nos pièces en forme, soubs nos grecques...? M O N T A I G N E , III, 5 (III, 339). — 1588. Des grègues de satin blanc fassonné. Inv. du prince de Condé, p. 152 (Gay, Gloss. archéol). — 1591. Une paire de grèges de drap de bure toutes chamarrées en long de 3 en 3 de galon de soie gris blanc. 3e Compte roy. de P. de Labruyere, 28 v° (Gay). —1591. Une grègue de taffetas vert, garny de 5 passements sur chacune cuisse. Vente du S* de Beaujeu (Gay). —1593. Pour avoir fait une paire de grègues de satin noir faictes à l'espa-gnolle. Argenterie du roi (Gay). —1595. Une paire de grecques satin noir. 5e Compte de P. de Labruyere, fol. 114 (Gay). — U n homme... Dont le rabat est sale, et la chausse rompue, Ses gregues au genou, au coude son pourpoint. R É G N I E R , Sat. 2. Greigneur. Plus grand. — Du roy Loys son filz euz grans biens et honneurs, Mais Charles roy régnant men feit dassez greigneurs. Poésies attribuées à L E M A I R E D E B E L G E S (IV, 352). —• Et sembloit à trestous que ce seroit le plus grand mal et le greigneur inconvénient qui peut advenir au dict royaume. SEYSSEL, Hist. de Louys XII, p. 222. —• Ces deux dignitez [le consulat et le tribunat], qui se commencèrent à continuer en greigneur contention et fureur lune contre lautre, se creoient par le sénat et par le peuple. ID., trad. d'AppiEN, Guerres civiles, 1,1. — Nous avons greigneur be-soing de conseiller comme l'en se gardera des pe-rilz ja a nous appareillez que de prendre comme ceulx cy seront a mort livrez. P. F A B R I , l'Art de Rhétorique, L. I, p. 50. — Quand les nouvelles furent espandues parmy les deux armées que le bon chevalier avoit esté tué... mesmement au camp des Espaignolz, combien que se feust l'ung des hommes du monde dont ilz eussent greigneur craincte, en furent tous... desplaisans merveilleusement. L E L O Y A L S E R V I T E U R , Hist. de Bayart, ch. 65. —• 11 régnera tousjours quelque bataille Entre les gens, tant moindres que greigneurs. Ane Poés. franc., VI, 41. — Il est greigneur, nompas de corpulence, Mais de sçavoir, a Homère et Hortense. M I C H E L D'AMBOISE, Ballade de la puissance d'Amours, 57 v°. — Car la victoire... Vient, non au plus fort ou greigneur, Ains à qui luy plaist [à Dieu]. R A B E L A I S , II, 27. — Vous verrez ceulx qui ont quelque apparence... Bailler placetz, suyvir les grans seigneurs, Se mesurais a l'aulne des grigneurs. J. B O U C H E T , Epistres morales du Traverseur, 11, 2. — Si voz seigneurs Font des péchez comme vous, ou grigneurs... Il n'appartient a vous de les blasmer. ID., ib., II, vi, 4. — Ceste fable nous faict recordz Deslyre roys, prelatz, seigneurs C o m m e ilz sont IV
GREMOIRE
en vertu greigneurs, Et non a la beaulté du corps. H A U D E N T , Apologues d'EsoPE, I, 39. — C o m m e Juno ayme son mary frère, Greigneur des dieux, et des hommes le roy. D E S A U T E L S , Suite du Bepos de plus grand travail, p. 88. — Les surabondans ou extraordinaires n'auront rien, en quelque nombre qu'ilz soyent, grigneur ou moindre. L. L E R O Y , trad. des Politiques <f AR I S T O T E , II, 4. — C o m m e un nombre est comparé à l'autre : ainsi peult estre une proportion comparée à l'autre, estant égale, greigneure, ou moindre. ID., ib., V, 1, Commentaire. — Ciel... greigneur, i. le plus grand. M. D E L A P O R T E , Epithetes, 84 v°. — L'au-thorité d'un dieu en terre est incomparablement greigneur et plus pregnante en plénitude du sainct Esprit que d'un h o m m e qui n'a que deux oreilles. P H . D E M A R N I X , Differ. de la Relig., I, iv, 8.
Greine, v. Graine. Grêlé. Ondulé. —• Que les femmes de façon
nette S'accoustrent en habit honneste, Avec modestie et vergongne Qui leur pudicité tesmoigne, Non point en cheveux tortillez, Passefillons frisez, gréiez. Ane Poés. franc., I, 299.
Grêler, v. Gresler. Grelet. Trembler le grelet. Grelotter. —
Veut-on que je couche icy? Seray-je encores longtemps En ce maigre passetemps? Mynuict est pieça sonné, Par Dieu, c'est bien promené ! Je fay bien de leur vallet, D'icy trembler le grelet. M E L I N D E S4 G E L A Y S , Chansons, 2 (II, 218). Cf.
Grelot. Grelleau. Sorte d'instrument pour passer le
grain. — Pour peignes, quinquallerye, piastre, grelleaux, cribles, sacz. Texte de 1570 (G.).
Grelot. Trembler le grelot. Grelotter. — Cependant que ces pauvres niais sont là à trembler le grelot, épandre soupirs, et baiser le crouillet de la porte. T A H U R E A U , 1er Dialogue du Democritic, p. 22. — Ils trembloient le grelot auparavant! car l'hyver cette année a esté long, rude et tardif. Var. hist. et litt., II, 282. Cf. Grelet. Tremblotter. — A u contraire des quemands et
belistres qui, pour abuser le monde, mettent de la paille en leurs souliers, se saulpoudrans les jambes pour mieux trembler le grelot. Supplément du Catholicon, 9, dans Tricotel, édit. de la Sat. Men., II, 72. Greloté. Qui a les cheveux ondulés. — Les
dames popines, grasses, maigres, fardées, grelo-tées. Var. hist. et litt., V, 100.
Gremeau. Grumeau. —• A raison des gremeaux de sang qui, en quelque partie qu'ils tombent, ac-querans qualité vénéneuse par corruption du sang sailli de ses vaisseaux, affoiblissent et dissipent grandement les forces du cœur. A M B R . P A R É , VIII, 32. — On voyoit sortir avec ladite injection de petits trombus et gremeaux de sang. ID., ib.
Gremeler, v. Grumeler. Gremial. Morceau de soie qu'on met sur les ge
noux du prélat officiant quand il s'assied (G.). — U n gremial bleu et rouge, de soye, pour les inno-cens. 1542. Inv. du trésor de la chapelle des ducs de Savoie, p. 152 (G.). — 1545. Ung gremyal à claire voye blanc, doublé de taffetas rouge. Inv. de N.-D. de Paris, 4 v° (Gay, Gloss. archéol). — 1578. Le fourniment de l'évêque des innocents... Ung gremyal de damas figuré avec ses franges. Inv. de la chap. des ducs de Savoye, p. 118 (Gay). Gremil, v. Grenil.
Gremoire, v. Grimoire. 24
>9
GREMYAL — 370 —
Gremyal, v. Gremial.
Grenad, v. Grenat. Grenade Pomme grenade, Pomme de grenade.
Grenade. — Les mil en lieu de couronnes portoient au bout de leurs piques pommes grenades d'or. SALIAT, trad. d'HÉRODOTE, VII, 41. — [Gargantua] tenoit une pomme de grenade en sa main, et la donnoit à qui luy pourrait ouster. RABELAIS, I, 23. — Comme un jour il eust ouvert une pomme de grenade belle et grosse à merveilles, et que quelqu'un des assistons luy deman-dast de quelle chose il voudrait avoir autant comme il y avoit de grains dedans ceste pomme, il respondit, de Zopyres. A M Y O T , Dicts des anciens roys, etc., Darius, 3. Par anachronisme, la grenade, engin de guerre,
nous est montrée au temps de David. — Maint cercle flamboyant, mainte ardante grenade Deçà de là tournoyé autour de sa salade. MONTCHRESTIEN, David, IV, p. 225. Grenadiere. Lieu planté de grenadiers. — Tout ce qu'à ces défauts on peut, est de ne se fournir des races trop aigres et des sujettes à crever sur l'arbre, quand il sera question d'édifier la grenadiere. O. D E SERRES, Théâtre d'agric, VI, 26. Grenage, mot collectif, ensemble des plantes à
graine. — [Plantes] petites et basses sont herbes, qui... sont de trois sortes : grenaiges, sçavoir bleds de diverses espèces et légumes, 2. herbes potagères, 3. herbes saladieres et aigres. CHARRON, Discours chrestiens, II, 9. Droit sur les grains. — Je vous prye aussi de
tenir la main a la conservation des grenages de mes rentes et affermes de mon duché d'Albret. 19 nov. 1572. Lett. miss, de H E N R I IV, t. I, p. 48 (G). Grenaille. — Ils [les monnayeurs] ont aussi grenaille, qui est billon ou quelque métal à part, qu'on retire de l'eau après qu'on l'a jette dedans tout chaud, au sortir du creuset. H. ESTIENNE, Precellence, p. 140. Grenaison. Production de la graine. — En si peu de gerbes qu'on recueillit en la moisson de ceste dernière année, la grenaison y fut si grande que le cent de gerbes faisoient 20 ou 22 boisseaux. HATON, Mém., I, 744 (G., Compl.). Ensemble de graines. — La grenaison semée.
E. BINET, Merv. de nat., p. 275 (G., Compl.). Grenale. Grenade ? — Embastonnez et equip-pez de force feux artificiels, trombes, grenales, fusées et mortiers. PH. D E MARNIX, Differ. de la Relig., Additions. Grenat. Grenade. — Le beau grenad à la joue vermeille, Et le cytran, délices de Marseille, Fleurit es champs de la Provence à gré. RONSARD, Pièces retranchées, Hymne de France (VI, 148)! — La est la pomme colorée... La l'orange jaune dorée, La le beau grenat rougissant. Du BELLAY, La Corne d'abondance. Grenade, dans le sens de projectile. — Ceux
qui estoient en la poupe de la françoise jetèrent en l'angloise des grenats de feu. Nie. DE L A N G E S Chron. de Himb. Vellay, 40 (G., Compl.). Rouge grenat. Sorte d'éclair. — La fouldre, l'es-
clair, les lanciz, le mau lubec, le rouge grenat, le tonnoire, la tempeste, tous les diables sont par les vallées. RABELAIS, III, 28. Grene, v. Graine.
Grener. Façonner en grains. — Avec Pair tempère la solaire chaleur Change ceste rosée en la
douce liqueur Du tereniabin : puis la cuisant, la graine En petits floconets de couton ou de laine J. D U CHESNE, le Grand miroir du monde, L V p. 193. ' '
Grené. Qui a des grains ? — Et le lierre grené qui dans les murs s'enlace. A M . JAMYN ŒW poet., L. IV, 164 r°. Mis en grains. — Il commanda à Mont-
lue de jetter dedans la place deux cens bons hommes de renfort qu'il leur envoyoit avec autres quatre charges de mesches, de plomb et de poudre menue grenee. Du VILLARS, Mém., IV, an 1553 (G.). — Une caque de cent livres de poudre menue grenee. J. VAULTIER, Hist. des chos. faites en ce roy., p. 267 (G.). Granuleux. — Pommes grannees. PLATINE, De
honneste volupté, 12 v° (G.). Poulain grené, v. Poulain. Grenete, v. Grenette.
Grenetier. Qui amasse le grain. — Puis à la grenetière et soigneuse fourmy... pour recompense de son travail, il luy assigna le cerveau tendre. LOUVEAU, trad. des Facétieuses Nuits de STRAPAROLE, III, 4.
(Subst.). Officier du grenier à sel. — Grenetier. Publique, soigneux, actif, gabeleur, vigilant, ad-*" modiateur, royal, provide, odieux, tributaire, soucieux. M. D E LA PORTE. Epithetes, 197 r°. — Con-' science et équité vouloyent-elles que pour une mesme cause il fist brusler le grenetier de Sainct-Disier pour luthérien, comme ainsi soit que tous les jours il allast à la messe, par le tesmoignage de tout le pays? RÉGNIER D E LA PLANCHE, Hist. de l'Estat de France, I, 329. Grenette. Marché aux grains. — Je say ung
gentilhomme de Pyémont logé en la Grenète. LE L O Y A L SERVITEUR, Hist. de Bayart, ch. 8. — Combien qu'ils eussent accoustumé de toute ancienneté... d'avoir et percevoir tous les ans, en tiltre d'aumosne, trente asnees de seigle sus nostre grenette de Lyon. PARADIN, Hist. de Lyon, p. 212 (G.). — Lesquels... ont descouvert un secret tel qu'ayans leurs bources bien fournyes, ont achepté chacun particulièrement parmy les grenettes et marchez... une très grande quantité de bled. Ane. Poés. franc., II, 172. — Ils n'ont peu avoir des grains, sinon à la miséricorde de ces escumeursde grenettes. ID., ib. Greneux. Des grains. — L'esté, dont la cha
leur aux terres agréable Meurist tout, n'a meuri la greneuse saison. A M . JAMYN, ŒUV. poet., L. II, 89 v°. — J'ayme le gay printemps et le greneux esté. N. D E M O N T R E U X , Prem. liv. des Bergeries de Juliette, Journ. IV, 185 r°. Grenier. Lieu où Pon met le grain. — Reste à
parler d'une autre sorte de grenier... Ce sont des fosses profondes creusées dans terre, qu'on appelle cros, dans lesquelles on descend avec escheles pour y porter et rapporter le bled. O. DE SERRES, Théâtre d'agric, 11, 1. Grenier d'eau. Réservoir d'eau. — A la cherge
de luy livrer quant bon luy samblera mes fossetz pour luy servir de greniers d'eaues a son molin. 1« mai 1565 (G., Compl.). Pour grenier on trouve les formes garnier, guer-
nier, gernier. — Se je sçavois parler latin Ainsi que font ces cordeliers, J'arois de blé les plains gar-niers. R. D E COLLERYE, Satyre pour les habitans d'Auxerre. — En me voyant de petit meuble nu Et sans argent autant gros que menu, N'en cave vin, n'aussi en garnier blé... Triste j'en suis et mesgre devenu. ID., Rondeaux, 48. — Blé en gar-
— 371 GRES1LL0N 1
1er ne gerbes n'ay engranges. ID., ib., 53. — Puis ;mldra bien couvrir le pot et bouscher, et le lettre en un garnier bien sec. C O T E R E A U , trad. de (lioLUMELLE, XII, 15. — Que les guarniers pu-Jicques soient remplis de ce qui apartient a la vie. , L E B L O N D , trad. de T H . M O R U S , L'Isle d'Utopie, L. II, 101 v°. — Non pas de ces royaumes en air, dont, pour toute royalle possession, l'un n'a lue des armoiries peintes, non plus que qui gar-eroit la clef d'un garnier dont un autre, qui en puiroit, auroit changé la clef, la porte et la ser-!ure. R É G N I E R D E LA P L A N C H E , le Livre des Mar-
.hans, II, 316. — Le sépulcre eust lors esté Sa se-ulture certaine S'il n'eust au garnier monté En semblant et hors d'haleine. Chanson de Fifi, .ans Tricotel, édit de la Sat. Men., II, 210. — lomment Faifeu alla en Poictou, où en une hos-ellerie fist monter son cheval au guernier à 'avoyne. B O U R D I G N É , Pierre Faifeu, ch. 17 (titre). - L'automne est appelle le gernier, le cellier et la danté des humains. M. D E L A P O R T E , Epithetes, lr°. Grenil. Sorte de plante. — Graine de gremil
irinse en vin blanc. J. D E S M O U L . , Comm. de ]Iaih. (G.). — La plus-part usoit aussi d'huile aicte de fleurs d'oignon de lis... ou bien usoit de Tenil, en latin milium salis. GUILL. B O U C H E T , 13" Seree (IV, 47). Grenoiller, v. Grenouiller.
Grenon. Moustache. — On dit, en un commun iroverbe, Qu'on ne craint homme, s'il n'a barbe, ït que nul homme n'a renom S'il ne porte barbe IU [lire ou?] grenon. Ane Poés. franc., II, 213.
Grenouillaut, dimin. de grenouille. — Ou quand on voit] les pères germains des petits gre-louillaux Sans trêve gazouiller la teste hors des aux. R. B E L L E A U , la Bergerie, 2 e Journ., Appa-ences de la lune (II, 65).
Grenouille. Roy de grenouilles. — Tesmoing e povre Vulcanus, qui fit le sobresault de 'Olympe en l'isle de Lemnos, tournoiant depuis 3 matin jusqu'au soir en l'air, comme un roy de renouilles. P H . D E M A R N I X , Differ. de la Relig., , m, 13.
Grenouiller. Barboter. — Le cappitaine Jac-iuyn... grenoilla en l'eaue longuement; mais enfin... fut saulvé... plus mort que vif. L E L O Y A L 'SERVITEUR, Hist. de Bayart, ch. 47. — Pour "toutes maladies, ils se baignent, et sont à grenouiller dans l'eau quasi d'un soleil à l'autre. 'MONTAIGNE, II, 37 (III, 225). — Quant au being, 'die trouve de tresdouce température ; et de vray les enfans de six mois et d'un an sont ordinairement à grenouiller dedans. ID., Journ. de voyage, P-72- — Jacquin, tombé à plomb, grenouilloit au ,profond de l'eau, chargé de ses armes. E. P A S QUIER, Recherches, VIII, 41. — Venant à passer la ronde, elle ouyt murmurer et grenouiller dans eau. B R A N T Ô M E , Cap. franc., M. de Salvoyson (IV, 103). r i y, y i Boire abondamment. — Ces bons biberons (qui estaient à table le doz au feu) le font seoir près deux... de sorte qu'un chacun fist tel devoir de gourmander et grenouiller qu'à grand peine peurent assez tost trouver leurs maisons pour aormir. Les Comptes du monde adventureux, 41 1W> 55). Parler indistinctement. — Il se fait souventes-
IOIS sous la langue une aposteme qui empesche de men proférer la parole, appellée... en nostre langue grenouille : pource que les patiens difficile
ment peuvent articuler et interpréter leur langage sinon en grenouillant. A M B R . P A R É , VI, 5.
Grenouillant. Ressemblant à un coassement. — Ils engendrent grande quantité d'humeurs froides et pituiteuses, lesquelles le plus souvent s'amassent au boyau n o m m é colon, lequel par ce moyen se tend et fait un bruit grenouillant, presque semblable aux cris des grenouilles. ID., Introd., ch. 6.
Grenouillet (faire le). — Et je serais encor près d'un tel précipice Si je n'allois tout doux faisant le grenouillet Aux Pères, à Luyne, à Brante, à Cadenet. Var. hist. et litt., IV, 20.
Grenouillier. De grenouille. — Mais l'enroué de la voix grenouilliere, Marescageuse, hideuse, coutumiere D'avant-crier la pluye ou le beau temps, M e rompt l'oreille en ce joyeux printemps. A M . J A M Y N , ŒUV. poet., L. V, 256 r°.
De la nature des grenouilles. — Ceste race [des moines et nonnains], sans s'accoupler par mariage, se multiplie neantmoins à l'usage des gy-rines grenouillères, presques en un clin d'ceil. P H . D E M A R N I X , Differ. de la Relig., I, iv, 5.
(Subst.). Grenoillier. — Mais fuys tousjours ces grenoilliers, O ù grans despens se font, pour voir, Et aultres gens irréguliers. Ane Poés. franc., X, 90. D'après le second vers, grenoillier semblerait signifier lieu où l'on boit, taverne ; d'après le troisième, buveur, celui qui fréquente les tavernes.
Grenouillon, dimin. de grenouille. — Mes lizardins, mes grenouillons. Act. des Apost., II, 102 d (G., Grenoillon). — Le limon escumeux se transforme souvent En un verd grenouillon qui, formé du devant, Non du derrière encor, dans la bourbe se joue, Moitié vif, moitié mort, moitié chair, moitié boue. D u B A R T A S , lre Semaine, Sec. Jour, p. 66. — C o m m e un grenouillon au frais de la rosée. M O R N A Y , Lett. (G.). '
Grepir, v. Guerpir. Grequer. — Orça, pourquoy ne diret-on aussi
tost grequer, en le prenant du latin graecari? Car graecari, c'estet bien faire carous. H. E S T I E N N E , Dial du lang. franc, ital, I, 87.
Grequesque, v. Gregesque. Gresamine. — Des gresamines, fruict déli
cieux. R A B E L A I S , V, 33 ms. Gresieux (os). — Os gresieux, en latin grandi-
nosum, est un des quatre os de la première partie du pied après le talon, l'astragale ou osselet, et le naviculaire ou esquif. J O U B E R T , Interpr. des dict. anat. (G.).
Grésiller. Griller. —• (Fig.). J'endesve, je de-guene, je grezille d'estre marié. R A B E L A I S , III, 7. — Zambelle, à qui les dents gresilloient d'envie de manger quelque chose. Trad. de F O L E N G O , Merlin Coccaie, L. IV (I, 93).
Gresillon 1. Grillon. — Le gresillon aux prez rejargonnoit, Perçant, criard, d'une voix égris-sante. T A H U R E A U , Sonnets, 80. — Faisant telle oraison, les âmes sont venues, Ainsi que grésillons greslettes et menues, Pépier à Pentour de mon luth, qui sonnoit Et de son chant piteux les mânes estonnoit. R O N S A R D , Elégies, l'Orphée (IV, 85). —• Et le freslon armé, qui les raisins moissonne, De son bruit enroué par l'antre ne bourdonne, Mais les beaux grésillons, qui de leurs cris trenchans Salu'ront les pasteurs à leur retour des champs. ID., Eclogues, 3 (III, 408). — Gresilon ou Grillon... Ceste beste aime les lieux chauds, et se trouve ordinairement es fours des boulangers et
GRESILLON 2 — 372 —
pasticiers. M. D E LA PORTE, Epithetes, 197 v°. — Puis que du jour la hauteur plus brûlante Darde du ciel son ardeur violante Aux champs grillez : or que par les buissons Les grezillons reveillent leurs chansons. BAÏF, Eglogues, 10 (III, 57). — Non ! de regrets je me mords Que je n'estois avec elle, Ou que n'estois sauterelle, Ou grasset ou gre-zillon. G U Y D E TOURS, Souspirs amoureux, L. III (I, 81). Gresillon 2. Menotte, chaîne. — Combien...
ha elle rendu de Chartres et de prisons vuides? Quantes grosses chaînes pesantes et grevables ha elle fait descharger, et quants fers et grésillons ha elle évacuez? LEMAIRE D E BELGES, la Couronne Margaritique (IV, 93). — Fêtes mètre ce porteur aux gressellons pour lui fere rendre conte de tout ce qu'il vous porte. Oct. 1525. Lettre de la duchesse d'Angoulesme (G.). — Pour la seconde fois sera pilorié et mis en grésillons telle espace qu'il plaira a la discrétion de justice. 1603. Régi de police pour la ville d'Estaires (G.). — (Fig.). Au regard de Sensualité et Jeunesse, furent mises es grezillons du monde et de la chair, qui est ung tourment assez grant et douloureux a longuement supporter. J. BOUCHET, la Noble dame, 68 r° (G.), — Les grezillons de dévotion. RABELAIS, II, 7. — Soixante et deux ans as esté en la prison du corps, et ja veulent cheoir les grésillons et fers de tes piedz. B. D E LA GRISE, trad. de GUEVARA, l'Orloge des princes, III, 51. Sorte d'instrument de torture. — On apporta
des grésillons, èsquelz on luy mist les deux poulces, pour le veoir parler d'une autre sorte. L E LOYAL SERVITEUR, Hist. de Bayart, ch. 40. — Il le tient à la torture, voire en une torture diverse : comme si, après luy avoir baillé la géhenne, il luy donnoit les grésillons. CALVIN, Serm. sur la Genèse, 1er sur le sacrifice d'Abraham (XXIII, 752). Gresillonner 1. Faire le bruit du grillon. —
Ils rugissent comme lions, ils gresillonnent comme grillons, ils caquettent comme cicongnes. AMBR. PARÉ, Livre des animaux, 25. Gresillonner 2. Tourmenter. — A ceste cause
icelles sont venues De tous costez cest ours environner, Puis par après, tant grosses que menues, A le picquer, poindre et dardillonner. Quand il se veist ainsi gresillonner, Il s'escria. H A U D E N T , Apologues <fESOPE, II, 97. Gresle 1. Mince (sans idée défavorable). —
Son gresle corps tant alaigre et joly... A devant soy deux boules ou mammelles, A ce satin, qui les couvre, rebelles. FORCADEL, ŒUV. poet., p. 20. — De Pitho vy le corps gresle et bien né. ID., ib., p. 43. — Lors que tes doigts gresles et yvoirins Ont délecté les mesmes romarins. ID., ib, p. 124. Aigre, froid, vif (en parlant du vent). — Les
quels [voisins] incontinent à ce cry, qui estour-dissoit et se faisoit ouyr de bien loin, par ce vent gresle et tempestatif, se trouvèrent sur le lieu équipez et embastonnez. Du FAIL, Contes d'Eutrapel, 8 (1,144). Gresle 2, v. Graile. Greslement. Avec minceur, avec finesse. —
L'ionique au tiers haut il rangeoit Plus greslement menue. MAURICE SCÈVE, Microcosme, L. III, p. 93. — Il admirait... Ores son col, or' ses mains blanches, Ores ses bras greslement longs. G U Y D E TOURS, Souspirs amoureux, L. I (I, 19). Avec un son clair, aigu. — Greslement la
trompe sonne. CL. GAUCHET, le Plaisir des champs, l'Esté, Chasse du lièvre à force, p. 135. —
Les valletz près du corps sonneront greslement Pour chiens, et laisseront à la meute acharnée Manger, pour meilleur metz, la beste abandonnée ID., ib„ p. 210. Gresler 1. Sonner d'un son clair, aigu. — Et
ne luy plaist tant ouyr les deschantz Des instrumens que prendre à son gré Pair, Et aux abboys faire trompes gresler. CRÉTIN, Débat sur le passe-temps des chiens et oyseaux, p. 78. Sonner d'un instrument dont le son est clair,
aigu. — Ainsi chascun s'apreste A crier, à gresler! Lors s'esleve un grand bruit Du cor et de l'abboy de la meute qui suyt. CL. GAUCHET, le Plaisir as champs, le Printemps, Chasse du renard, p. 27. — Et pour les rappeler [les chiens], De la trompe bien haut commençons à gresler. ID., ib., l'Esté, Chasse du loup, p. 158. Greslant. Qui sonne d'un son clair, aigu. — Lors
redouble le bruit, et la trompe greslante Qu'on void le cerf à veue avecques les voix chante. ID., ib., Chasse du cerf, p. 195. Gresler 2 (trans.). Lancer comme la grêle. —
Eux, dardant les roches brisées, Haussoyent par la guerre cent bras : Eux, ombrageant tous les combas, Gresloyent leurs flèches aiguisées. RONSARD, Odes, I, 10 (11, 127). — Celuy qui print la croix... quoy qu'on luy greslast dessus une infinité de dars, nepeut onques estreoffensé. S* FRANÇOIS D E SALES, Défense de la Croix, II, 11. — (Fig.). Que ne dis tu, puis que je t'ay servie Entre plusieurs de nôtre nation, Qu'amortiras la forte passion, Grêlant en moy de sa fureur la pluye? PH. B U G N Y O N , Erotasrnes de Phidie et Gelasine, sonn. 38. — L'astre dont la saincte flamme Au plus joyeux de mon ame Pluvoit un printemps de fleurs Plus ne gresle en mon courage Qu'un perpétuel orage Et de souspirs et de pleurs. Du BELLAY, Jeux rustiques, Chant de l'Amour et de VHyver. — Vostre front m'est (en deux beaux arcs voûtés) Un ciel iré, sur moi greslant ses haines. BUTTET, l'Amalthee, 152, p. 269. Cribler. — Le bon bled... n'est vénal ou mar
chand , et propre pour mettre au moulin, s'il n'est gresle et nettoyé de poussière et de menu bour-rier, si bien qu'il ne demeure que le pur grain. LE LOYER, Hist. des Spectres, VI, 3. Estre gresle. Être frappé de la grêle. — Les
vignes furent greslees. J. PUSSOT, Journalier, p. 87 (G., Compl.).
Gresler (intrans.). Être frappé de la grêle. — (Fig.). Quel reconfort ont ceux qui greslent d'infortune? R. GARNIER, Porcie, 1207.
Gresle. Semé, parsemé. — Ces robbes brochées d'or, greslees de pierreries, herminees de martres. E. BINET, Merv. de nat., p. 487 (G., Compl.). Greslet, dimin. de gresle, mince, fin. — Yvoire
[des doigts] où sont cinq perlettes Tresluisante-ment greslettes, Ornans les bouts finissans De cinq boutons fleurissans. RONSARD, Odes, V, 13. — Venus aux rians yeux... A la jambe greslette, à la grève naïfve. TAHUREAU, Premières Poésies (1, 86). — Voyant ceste main greslette, Ceste main mignardelette, Qui peut les cœurs arracher. O. D E M A G N Y , les Gayetez, p. 5. — Suy-moy donc, tu seras la plus que bien venue, Quenoille, des deux bouts et greslette et menue. RONSARD, Amours de Marie, la Quenoille (I, 196). — Pourquoy donc me plaist tant la voix Meslee au fredon des beaux doigts De Philis, quand sur l'epinette Elle glisse sa main grellette... ? VAUQUELIN DE U
FRESNAYE, Idillies et Pastorales, I, 58. — De sa taille elle estoit greslette, Et toutesfois assez refaite, Entre grasse et maigre, enbonpoinct. BAIE,
— 373 — GREVABLE
Passetems, L. I (IV, 220). — Car toute garce m'est bonne... Ou soit qu'elle soit gracéte, Ou soit qu'elle soit grailéte. ID., ib., L. III (IV, 335). Mince, léger, immatériel. — Et son ombre
greslette [de Du Bellay] Volloit de place en place, ainsi qu'une alouette Voile devant le chien. R O N SARD, Discours à Loys des Masures (V, 364). Un peu grêle (en parlant du son). — Une gres
lette vois Foible et sans force il entreoyoit à peine. R O N S A R D , Poèmes, L. I, Hylas (V, 130). — Mille autres milliers d'esprits, D'amour autrefois espris, Se chesment, en voix greslettes, D u sort de leurs amourettes. G. D U R A N T , ŒUV. poet., 170 r°. Gresleté. Caractère de ce qui est grêle,
mince. — Gresleté et maigreur viennent par faute d'humeur. A N T . D U M O U L I N , trad. de J. D'INDA-GINE, Complexions des hommes, p. 269. Gresleur. Qui fait tomber la grêle. — Et
entra en ceste opinion, que les saincts susditz estoient saincts gresleurs, geleurs, et guasteurs du bourgeon. RABELAIS, III, 33. Gresieux. Où il y a de la grêle. — M a nym
phette... Cueillant les fleurs, des raiz de son œillade Essuya l'air gresieux et pluvieux. R O N S A R D , Amours de Cassandre (I, 72). — Tousjours d'un air gresieux les champs herissonnez N'ont aux chaudes moissons leurs espics esgrenez. R. G A R NIER, Porcie, 1213. — Air. Subtil... net, gros, sombre, gresieux. M. D E LA P O R T E , Epithetes, 13 v°. —• Mais ainsi que l'on voit le tout-voyant soleil Darder sur l'univers la clarté de son œil, Ores que l'espesseur d'une gresleuse nue S'oppose bien souvent pour nous oster sa veue. P. D E BRACH, les Amours d'Aymee, L. I, Elégie 3. Orage gresieux, amas gresieux. — A peine eut
dit qu'une grand'nue De poignans frasions est venue Se desborder toute à la fois Dessus la face des Indois, Qui, plus fort qu'un gresieux orage, De coups martela leur visage. R O N S A R D , Gayetez, le Freslon (II, 45). — Si tu le fais, je n'ay pas crainte Ny des frimas, ny de l'atteinte Des coups d'un orage gresieux. R. B E L L E A U , Petites inventions, la Cerise (I, 77). — Voici le froid, le chault, les mauvais vens venir, Ou l'orage gresieux. J. BEREAU, Eglogues, 3. — Les neiges, les frimas, Les tourbillans rouans, et le gresieux amas Rebluté dedans l'air, en pelottes menues. R. B E L LEAU, Discours de la Vanité, ch. 1. — Orage. Impétueux... hiemal, gresieux. M. D E LA P O R T E , Epithetes, 290 v°. — Mais estant loin de toi, cela ne me contente Non plus que si le ciel eust trompé mon attente D'un orage gresieux. P. D E B R A C H , les Amours d'Aymee, L. I, Eleg. pastor., 4. Greslier (adj.). Qui a un son grêle. — Une
cornemuse... un fifre, un tabourin greslier, une trompette, un hannissement de cheval, toutes choses servantes pour la guerre. D u FAIL, Contes d'Eutrapel, 19 (1,260). (Subst.). Sorte de cor de chasse au son grêle. —
Dedans la sale du logis... la corne de cerf ferrée et attachée au plancher, où pendoient bonnets, chapeaux, gresliers, couples et lesses pour les chiens. ID., ib., 22 (II, 31). Voir Philipot, Style et langue de Noël du Fail Gresne, Gresse, v. Graine, Graisse. Gressellon, v. Gresillon 2. Gresser, v. Graisser. Gresset 1. Sorte de rainette. — 11 y a trois
sortes de crapauds : a sçavoir les verdiers, autrement nommez gressets : les crapauds d'eau, et les
crapauds muets. G R E V I N , des Venins, II, 20 (G., Compl., Graisset). — Toinette, fen en deux parts ce gresset, Contre Gilet tire le gauche osset (Serre le sang) pour moy le dextre tire, A fin qu'amour en son rang le martyre, Et de son mal je me moque à mon tour. BAÏF, Eglogues, 5 (III, 31). — Grenouilles qui jasez quand l'an se renouvelle, Vous, gressets, qui servez aux charmes, comme on dit, Criez en autre part vostre antique querelle. R O N S A R D , Sonnets pour Hélène, L. II, Stances pour la fontaine d'Hélène (I, 333). Gresset 2. Sorte de mesure de liquide. — Un gresset plein de vin. 1529. Corbie (G.). Gressin. Engrais. — Mesmes ils daignent bien, et ne sont point si lasches Qu'ils n'amassent la bouze et des bœufs et des vaches Pour dessus le fumier augmenter le gressin. CL. G A U C H E T , le Plaisir des champs, le Printemps, Discours du chasseur et du citadin, p. 115. Gret. Sorte de bordure. — Pour m i c et demy
d'hermines employées a facer un bord en façon de gret large de semye hermyne, attaché a jour d'un veloux bleu semé de fleurs de lis. 1515. Obsèques de Louis XII (G.).
Greussante (pomme de). P o m m e de grosse ente (Philipot). — J'en vy deux, l'un chargé d'un bissac plein d'un costé de pommes de greussante, en l'autre de saulcices et force moustarde. D u FAIL, Baliverneries d'Eutrapel, p. 41. Grevable. Lourd. — Quantes grosses chaines pesantes et grevables ha elle faitdescharger... ? L E MAIRE D E B E L G E S , la Couronne Margaritique (IV, 93). — Quelque mule grasse en bon poinct, Bien nourrie d'orge en l'estable, De rien ne se soulcioit point Et ne portoit chose grevable. C O R R O Z E T , Fables CPESOPE, 86.
Important. — Vers lesquels suis, possible est, redevable De six escus, qui n'est somme grevable Ne grande aussi. Ane Poés. franc., Vil, 159.
Douloureux (physiquement). — Vertus il a medicinables, Car les fistulles très grevables Souvent par celluy sont guaries. Ane Poés. franc., XIII, 82. Pénible. — Les malheureux Troyens, ainsi cer-
tiorez par mon oracle de leur remède grevable, se déterminèrent à lexecuter, de peur de pis avoir. L E M A I R E D E B E L G E S , Illustr., I, 34. — A tout le moins ne me seroit grevable Le tien départ. M I C H E L D E R O C H A Y à Ch. Fontaine, dans le Passe-temps des Amis, p. 316. Fatigant. —• Ma guyde alloit devant, ainsi
qu'experte, Et moy après en vouloir ferme et stable D'y pervenir : tant m e feust il grevable. M I C H E L D'AMBOISE, trad. de F R E G O S O , le Ris de
D E M O C R I T E , ch. 2.
Nuisible. — Par tous moyens dame doit paix chercher, Car il n'est riens en ce monde tant cher, Ne que discord aux hommes tant gravable. J. M A R O T , Doctrin. des princesses, 18 (G.). —• Elle, trescurieuse de sa bonne valitude, ne le prioit pas sans plus incessamment d éviter tous forts excès et grevable intempérance. Mais qui plus fort est... suivoit communément son trescher seigneur et espoux... cuidant que par sa présence songneuse elle le peust préserver de tout inconvénient. L E MAIRE D E B E L G E S , la Couronne Margaritique (IV, 81) — N'aymez que raysonnablement, Sans en prendre ne mal ne heurt Qui soit grevable aucunement. Ane Poés. franc., IV, 21. — Car le grant bien que luy fis et honneur M'est très grevable et vient à deshonneur. Ib., XIII, 118. — Les gens hebrieux appelloient publicains Telz collecteurs
GREVAI N — 374 —
de deniers souverains, Et les tenoient comme gens détestables, Pécheurs publiez, et au peuple grevables. J. BOUCHET, Epistres morales du Traverseur, II, 7.
Grevain. Pénible, douloureux. — Et de leurs alaines... Ils enflent leurs vaines, Sans douleurs grevaines Chantans chans nouveaux. L E M A I R E D E B E L G E S , le Temple d'Honneur et de Vertus (IV, 199). — C'est ascavoir des misères humaines, Labeur, douleurs, maladies grevaines, Guerre, famine. J. B O U C H E T , Epistres familières du Traverseur, 11. — Tu seul obtins celle riche toison, Et achevas labeurs et si grans peines Qu'oncques homme n'en soutint si greveines. C H . F O N T A I N E , les XXI Epistres d'OviDE, Ep. 12, p. 230. Grevance. Dommage, préjudice, affliction. —
Car ces faulx loups cerchent leurs alibis Pour aux pasteurs faire quelque grevance. G R I N G O R E , les Folles Entreprises (I, 70). — Mais tous noz cueurs de deuil [la mort] endurcira, Veu quelle a fait a ung chascun grevance. L E M A I R E D E B E L G E S , Exploration de Pitié (IV, 173). — Aux affligez de famine et grevances... Il ha donné les plus grandes richesses. D E S PÉ R I E R S , Cantique de la Vierge (I, 86). —• Ton labourage Je voy perdu par ce cruel orage, Que seulement ne nous porte grevance, Mais (qui plus est) il destruit la semence. M A R O T , Complainte d'un pastoureau chrestien. — Si on voyoit en figure ou paincture les calamitez et grevances que les enfans engendrent a leurs mères, l'on aurait en crainte de porter comme serpens venimeux. P. D E C H A N G Y , Instit. de la femme chrest., II, 10. — Le roy des Navarroys... Feit de grands maulx en la terre de France : Et feit au filz de Jan telle grevance. J. B O U C H E T , Epistres familières du Traverseur, 1. — Les aultres lors voyant telle grevance Que leur faisoit ce chat par les surprendre Pour les menger. H A U D E N T , Apologues d'EsoPE, II, 20. — Davantage, dénote dissipation de son patrimoine, oppression et grevance de ses parens et aftins. A N T . D U M O U L I N , trad. de J. D'INDAGINE, Chiromance, p. 109. — Car plus je n'ay en ce monde espérance De la revoir : et l'attendre est grevance. V A S Q U I N P H I LIEUL, trad. de P É T R A R Q U E , L. II, chant 1. — La navigation sera avec grevance et grand dommage, non seulement de la charge et de la navire, mais aussi de noz vies. CALVIN, la Bible franc., Act. des Apost., 27 (LVII, 369). — Venus, qui ha en mer grande puissance, Te gardera de mal et de grevance. C H . F O N T A I N E , les XXI Epistres d'OviDE, Ep. 21, p. 425. — Qu'il [le prince]... vive de son revenu sans porter grevance à aulcun. J. L E B L O N D , trad. de T H . M O R U S , l'Isle d'Utopie, L. 1,26 v°. — Mon ame en telle grevance Refusoit toute allégeance. T H . D E B È Z E , PS. de David, 77. Chose désagréable. — Aux bonnes [femmes] ne
dis grevance, Rien de mal, de desplaisance. Ane Poés. franc ., V, 198. Grevant. Pénible. — Ceste fantaisie mestoit si grevante que je ne la pouvoys chasser de mon imagination. Trad.deBoccACE, Flammette (1537) ch. m , 33 v°. Nuisible. — Les dactiles... sont indigestes et
grevantes a la teste. Jard. de santé, I, 154 (G.). Grevarain. Celui qui vit sur la grève? — Tous grevarains, maraudes, cagnardières, Qui de prier ne sçavent la façon. Ane Poés. franc., V, 150. Grève 1. Jambe, mollet. — En mes jambes les gouttes sont enflées, Qui difforment de tout en tout la grefve. Ane Poés. franc., Il, 108. — Il avoit très belles griefves, et bien proportionnez
au reste de sa stature. R A B E L A I S , I, 8. — Es uns escarbouilloyt la cervelle, es aultres... sphaceloyt les grèves. ID., I, 27. — L'un d'entre eulx... vint pousser avec le pied l'un de ces esclops, et en donne un grand coup contre la grève de ce curé; lequel, sentant une extresme douleur, ne se peust tenir qu'il ne portast la main à sa jambe. DES PÉRIERS, Nouv. Récr., 79. — C'est toy qui laves sa hanche, Sa grève et sa cuisse blanche. RONSARD, Odes, V, 13. — Et ces grèves rondelettes Sur deux rondelets talons. BAÏF. les Amours de Meline, L. II (I, 66). — Hz avoient aux piedz brodequins de nerfs qui ne passoient la moictié de la grève. SALIAT, trad. d'HÉRODOTE, VII, 75. — (Aux déesses des bois). Couvrez la tendre chair de vos grèves divines D u cuir damasquiné de vos courtes botines. R O N S A R D , Poèmes, L. I, la Chasse (V, 38). — Et or' tournant au bal, où gaie elle se rue, Sa robbe rétroussant, fait voir sa grève nue. BUTTET, l'Hymne de Venus. — De sa cuisse, de ses genoux... De la plus grassette partie De sa grève au tour arrondie. R. B E L L E A U , la Bergerie, 1™ Journ., le Portrait de sa maistresse (I, 264). — Cerés, si de nos blés grande planté se levé, Nous te ferons de marbre, et, d'espis couronnée, Par dessous ton surcot tu monstreras ta grève. BAÏF, Eglogues, U (III, 66). — Tandis que grave en la françoise scène, Ta grève ornant de tragique chaussure.., Tu fais marcher une Didon malseine. ID., Passe-tems, L. IV, A Jodelle (IV, 394). — [Vénus] montre, Bondissant haut, une grève qui est D'un si beau tour que telle on ne rencontre. AM. JAMYN, Œuv. poet., L. III, 125 v°. — Ses deux grèves s'armoient de jambières d'airain. P. DE BRACH, Poèmes et Mesl, L. I, Monomachie deDavid et Goliath. — Elle estoit... fort blanche aussi par le corps, et la charnure belle, et son cuir net... et ung enbonpoinct très-riche, la jambe et la grève très-belle, ainsi que j'ay ouy dire aussi à de ses dames. B R A N T Ô M E , des Dames, part. I, Catherine de Medicis (VII, 342).
A my grève, à demi-grève. A mi-jambe. — Les Paphlagoniens... aians aux pieds solerets jusqu'à my grave. SALIAT, trad. d'HÉRODOTE, VII, 72. — Le brodequin haulsé A demi-grève, et d'un cordon lassé. R. B E L L E A U , la Bergerie, lie Journ., la Chasteté (I, 223).
Grève. Jambière. — Hz avoient en jambes pour grèves feutres rouges. SALIAT, trad. d'HÉRODOTE, VII, 76.
Bas. — Jambes de lyz, qui toutes surmontez A bien danser, monstrez vostre teinture, Vostre longueur et de quelle peinture II faut trasser les grèves que portez. G U Y D E TOURS, Souspirs amoureux, L. 1 (I, 36).
Partie de l'armure protégeant la jambe. — Un gantelet, une masse, des goussetz, des grèves. RABELAIS, II, 27. — Premièrement print ses grèves forgées D'arain luisant, unies et rangées A doux d'argent. S A L E L , Iliade, XI, 193 r°. — Les uns... nettoioient... caliges, grèves, soleretz, esprons, R A B E L A I S , III, Prologue. — Me faictez souvenir... du veu aussi du plaisant Hespaignol Michel Doris, qui porta le trançon de grève en sa jambe, ID., III, 24. — Ilz ont... des grèves aux jambes, qui leur prenent depuis les talions jusques aux genoux, là ou elles s'attachent aux cuyssotz du haubert. A M Y O T , Hùt. Mthiop., L. IX, 103 V . Breton estoit guorgiasement armé, mesmement de grefves et solleretz asserez. RABELAIS, IV, H-— Les Lyciens... portoient la cuirasse avec grèves aux jambes. SALIAT, trad. ' H É R O D O T E , VII, W-— [Les Thraciens] estoyent de grands et puissans hommes, qui portoyent devant eulx des escus de
— 375 — GREVER 1
fer bien fourby et luisant, les jambes armées de grèves et de cuissots. A M Y O T , Paul Emile, 18. — Ce que Philopoemen corrigea, en leur persuadant... de s'armer les testes de bons morrions, les corps dehalecrets, et les cuisses et jambes de bons cuissots et bonnes grefves. ID., Philopémen, 9. — Il prist ses beaux cuissots et ses grèves encor, Grèves faites d'argent et jointes à doux d'or. RONSARD, Poèmes, L. I, Harangue du duc de Guise (V, 22). — Et sur la cyme en trophée attacha Du mort géan les armes despouillées, Cuissots sanglans, grèves de sang mouillées, Maille, plastron, gantelets et brassars. R O N S A R D , Franciade, III (III, 96). — Premièrement il mit des graves ajancees Avec boucles d'argent sur ses jambes pressées. A M . J A M Y N , Iliade, XIX, 148 r°. — Puis qu'il vous plaist, amis, je quitte ceste maille, Cet armet, cet escu, ces graves, ces brassars. M O N T CHRESTIEN, Hector, II, p. 27. — Couvert, à la vieille françoise, d'armes argentées, jusques aux grèves et sollerets, le visage descouvert et la barbe blanche comme neige. A U B I G N É , Hist. univ., V, 17. — (Fig.). Dieu et la saincte et indivise Trinité... est un bon et asseuré phylactère, c'est une bonne armeure, ce sont de bonnes grèves aux pieds pour fouler à fiance l'aspic et le basilic d'enfer. L E L O Y E R , Hist. des Spectres, VIII, 8. Grève 2. Sorte de raie séparant les cheveux. — Damoyselles, marchandes, courtisiennes... Sont practiciennes de se coiffer en gresve. Ane Poés. franc., VIII, 248. — Hz s'entrepeignoyent et my-partissoient leurs cheveux en grave. A M Y O T , Daphnis et Chloé, L. I, 13 v°. — 11 [Suréna] se fardoit le visage, et portoit les cheveux mespartis en grève à la guise des Medois. ID., Crassus, 24. — Les femmes ont tousjours plus que les hommes Faute et besoin d'heure pour se parer. A leurs cheveux en grève séparer, La bandelette attacher haute et basse, Peigner, coiffer, mirer, un an se passe. D E S M A S U R E S , David triomphant, 336. — Tantost, s'entrepeignant, en grève partissoyent Leurs cheveux crespelus. R. B E L L E A U , la Bergerie, Ve Journ., l'Esté (I, 209). — Fay luy les cheveux houpelus, Frisez, retors, blonds, crespelus, Que simplement on entrevoye Sans coeffe un beau cordon de soye De ses couleurs, pour voir partis En grève leurs anneaux tortis. ID., ib., le Portrait de sa maistresse (I, 260). — 11 y avoit un certain droict de chevelure, qui n'appartenoit qu'aux roys : lesquels... avoient privilège de porter les cheveux longs, parfumez et mipartis en grève. T H E V E T , Cosmogr., X V , 14. Grevein, v. Grevain. Grever 1 (trans.). Accabler sous un fardeau. —
Aussi Diane bien apprise Rougissoit du berger d'Amphryse, Son frère, quand ell' le trouvoit Chargé d'un faix qui le gravoit, Courant par la plaine bruslante Apres une fascheuse amante. R. B E L L E A U , Petites Inventions, Election de sa demeure (1, 81). — (Fig.). Ce mesme prescheur... se plaind en quelques lieux des princes qui griefvent leurs subjects de tailles et gabelles. H. E S T I E N N E , Apol pour Her., ch. 6 (I, 96). Echauffer à l'excès, brûler. — Mets m o y dessus
la mer d'où le soleil se levé... Ou sur les sablons cuits que son chaud rayon grève. BAÏF, les Amours deMeline,h. I (1,34). Nuire à, faire tort à, faire du mal à, faire souf
frir. — Le prudent h o m m e peult faire deux choses ensemble : cestasavoir se deffendre, et regarder aussi par quel moyen il pourra mieux grever son adversaire en lassaillant. L E M A I R E D E B E L G E S ,
Illustr., I, 31. — O Seigneur, que de gens A nuyre diligens, Qui m e troublent et grèvent ! M A R O T , Ps. de David, 3. — La similitude, dont ilz nous veulent griefver, est importune. CAL V I N , Instit., II, p. 106. — La y eut dur conflict, par ce que les deux armées s'assemblèrent pour grever l'une l'aultre. Amadis, III, 5. — Le beuf... plus cuyct estant... plus delectoit le palat, moins grevoit le stomach. R A B E L A I S , III, 15. — Le vice, la mort, la pauvreté, les maladies, sont subjets graves et qui grèvent. M O N T A I G N E , III, 5 (ILJ, 313). — Donc que les haineux qui m e grèvent Soient saisis de honte et de peur. D E S P O R T E S , PS. de David, 6.
Affliger, mécontenter. — Le dueil qui est celé Griefve trop plus que s'il est révélé. M A R O T , Elégies, 20. — 11 n'entend point que ses gens vivent à discrétion, c'est à dire sans payer, mais à discrétion du pape, qui est ce qui plus griefve le pape. R A B E L A I S , Lettres (III, 342). — V o u s m e touchez droictement au mal qui m e griefve le plus. Amadis, V, 34. — Le retardement grevoit trop par sa longueur le cueur de la jeunesse. J. D E L A L A N D E , trad. de D I C T Y S D E C R È T E , L. 1,13 r°. — Ce qui
greva et offensa encore plus le peuple que tout cela fut le temple de Concorde, qu'Opimius feit bastir, pource qu'il sembloit qu'il... triumphast pour avoir fait mourir tant de citoyens romains. A M Y O T , Caius Gracchus, 17. — Que resves-tu, Toinet, tout seul pensif et sombre...? Qui te grève le cœur? BAÏF, Eglogues, 17 (III, 89). — Monsieur, vous serez cardinal, Nous sçavons où vous tient le mal, Mais que cela plus ne vous grève. Sat. Men., A M. de Lyon, p. 303. — En fin comme m a voix, ondoyante à grans flots, Eust trouvé le passage entre mille sanglots, M e forçant en l'ac-cez du tourment qui m e grève, J'obtins de mes douleurs à mes pleurs quelque trêve. R É G N I E R , Cloris et Phylis.
(Intrans.). Grever à. Être pénible à, affliger, mécontenter. — Tant luy grevoit de ce que le moyne ne comparait aulcunement qu'il ne vouloit ny boyre ny manger. R A B E L A I S , I, 45. — Or sus, délivrons le peuple romain de ce grand soucy, puis qu'ainsi est qu'il luy griefve et luy semble trop long d'attendre la mort naturelle de ce pauvre vieillard. A M Y O T , Flaminius, 20. — Encore n'y avoit il rien qui tant despleust et grevast au peuple que l'oultrageuse et dissolue luxure et insolence de ces satellites. ID., Marius, 44. —• Il estoit contrainct, voulust ou non, de supporter la vaine gloire et folle arrogance de cest égyptien : ce qui luy grevoit beaucoup. ID., Agésilas, 37.
Se grever. S'alourdir. — Et elle assise, en se cuydant lever, Sentit son corps si pesamment grever Qu'oncques ne sceut mouvoir une joincture. M A R O T , L. Il de la Metamorph. (III, 243). Le réfléchi est omis devant l'infinitif dépendant d'un autre verbe. Se grever de. Se donner de la peine pour. —
Pour la vie si brève, Faut-il tant qu'on se grève D'amasser et d'avoir? R O N S A R D , Pièces retranchées, Odes (VI, 70). Se grever. Se nuire. — Il s'offense et se fait tort,
estant cause à soy mesme de ce qu'il transgresse les loix, en quoy il se griefve et se blesse soy mesme indignement. A M Y O T , les Contredicts des stoïques, 16.
Grever (impers.). Il me grieve. Je suis affligé, mécontenté, il m'est pénible, désagréable. — il m e grieve fort de vostre infortune. Amadis, 1, 5. — II faisoit tout ce qu'on luy commandoit par gracieuseté, et rien par crainte, luy faisant plus grand mal de se sentir blasmer qu'il ne luy grevoit de travailler. A M Y O T , Agésilas, 2. — Ses familiers
GREVER 2 — 376 —
vouloyent vivre en délices sans plus se travailler, et leur grevoit d'aller davantage errans par le monde d'une guerre en une autre. ID., Alexandre, 41. —• Quelle intention penses-tu avoir en ceux ausquels n'a point grevé de composer quelques centaines de miliers de livres sus ces matières? F. B R E T I N , trad. de L U C I E N , Ermotin, 56. — Il leur grieve alors de rompre leur entreprise. ID., ib., 75. — Il le falloit faire : mais s'il le fit sans regret, s'il ne luy greva de le faire, c'est signe que sa conscience est en mauvais termes. M O N T A I G N E , 111,1 (111,256). Grevé. Alourdi. — Elle n'estoit pas grevée ne
pesante de la conception du Filz de Dieu. Le Repos de conscience, ch. 6 (G.). Endommagé, souffrant, blessé, infirme. — Le
roy Loys est mesgre et las, Et a esté, quoy qu'on en die, Persécuté de maladie, Dont il s'est trouvé fort grevé. G R I N G O R E , S1 Loys, L. V. (II, 142). — [Gargantua] montoit au hault d'une maison comme un rat, descendoit puis du hault en bas en telle composition des membres que de la cheute n'estoit aulcunement grevé. R A B E L A I S , I, 23. — On pourrait trouver estrange que Dieu repousse ici de son Eglise ceux qui sont grevez en leurs corps. CALV I N , Serm. sur le Deuter., 130 (XXVIII, 64).
Grever 2. Séparer [les cheveux] par une raie. — Ça, m a pucelete, je veus Qu'ores tu grèves tes cheveus. V A U Q U E L I N D E LA F R E S N A Y E , les Foresteries, II, 2. Grevet. Sorte de croc. — Cinq grilz de di
verses grandeurs, une fourche, deux grevetz. Invent, de Guill. Arthus (G. Baurain, Rev. des Et. rab., X, 90).
Greveure. Maladie, infirmité. — Quand Dieu condamne la greveure qui sera au corps, c'est pour signifier que ceux qui le vouloyent servir et desi-royent d'approcher de luy devoyent estre entiers et en leurs corps et en leurs âmes. CALV I N , Serm. sur le Deuter., 130 (XXVIII, 64). — Celuy qui est rompu par greveure et celuy qui est chastré n'entreront point en l'Eglise de l'Eternel. ID., la Rible franc., Deuteronome, 23 (LVI, 300). — Les gre-veures ont aussi par fois servy de recommandation et faveur. J'en ay veu la surdité en affectation. M O N T A I G N E , III, 7 (IV, 7).
Hernie. — Ceste herbe... guerist entièrement les hergnes et greveures. D u PINE T , trad. de PLINE, X X , 13 (G.). — Tomber en hergne et greveure. J. G. P., Occult. merv. de nat., p. 63 (G.). — Des hargnes ou greveures, qui sont tumeurs aux aines et aux bourses des testicules. A M B R . P A R É , VI, 13. — U n prestre... avoit une hargne intestinale complette... Voyant sa greveure, je luy dis. ID., VI, 15. Greziller, Grezillon 1 et 2, v. Grésiller, Gre
sillon 1 et 2. Griache, v. Griesche.
Griays, terme de fauconnerie, nom qu'on donnait à l'oiseau sauvage. — (Par plaisanterie). Fol griays. R A B E L A I S , 111, 38. Gribane. Sorte de bateau. — Gribane de bois à bastir ou à brusler. Arr. du Conseil d'Estât, 1612 (G., Gabanné). Gribel. Crible. — Ung gribel pour tamiser le
cauch et thieullee. 1502. Béthune (G.). Gribloir. Crible. — A Jehan Breguen pour
avoir faict deux nouveaux gribloirs pour nettover le bled. 1580. S* Orner (G.). Gricement. Grincement. — Lors urlemens,
criz et gemissemens Et gricemens seront si exécrables Que estonneront anges, hommes et diables. Ane Poés. franc., IX, 79. — E n enfern'a que angoisses et tourmens, Embrasemens, frissons et tremblemens, Et grissemens de dens abhominables. Ib., IX, 80.
Gricher, v. Grisser.
Grief i. Lourd, pesant. — (Fig.). Ce seroit, disent-ilz, un fardeau trop grief aux chrestiens! C A L V I N , Instit., III, p. 171. Pénible, douloureux, désagréable. — S'il veult
sauver sa vie, il est contreinct d'abandonner sa femme. Ce qui luy estoit plus grief que beaucoup de mortz. ID., ib., VII, p. 441. — Je suis con-trainct... le servir en personne avec mes chevaliers, ce qui m'est bien gref d'accomplir. Amadis, 111,2. — Je... le feray pour l'amour de vous, combien qu'il m e soit grief de veoir si près de moy mon grand ennemy. Ib., III, 7. — Pour mieux porter la peine grieve et dure. M A R O T , le Riche en pauvreté. — Parquoy te prie et semons de rechief Qu'il ne te soit de les venir veoir grief. RABELAIS, Epistre à J. Bouchet (III, 301). — De beaucoup m e seroit moins grieve m a douleur Si tu croyois au moins ce que je d y de cœur. BAÏF, l'Amour de Francine, L. II (I, 178). — Vous me laissez tout seul en un tourment si gref Que je mourray de dueil, d'ire et de jalousie. R O N S A R D , Amours de Marie (I, 171). — Ce vain plaisir, ce tant peu de faveur, Léger payment de si griefve douleur. R. B E L L E A U , Petites Inventions, Amour médecin (I, 140). — Tu sois la bien venue, ô bienheureuse trefve !... Puis que seule tu as la vertu d'enchanter De noz travaulx passez la souvenance grève. D u B E L L A Y , les Regrets, 126. — Le secours que vous nous cuidez faire maintenant nous est plus grief que l'abandon que vous feistes alors de nous ne nous a esté douloureux. A M Y O T , Romulus, 19. — S'il ne nous fasche pas d'estre disciples de Jésus Christ, qu'il ne nous soit point grief de suyvre la façon de profiter qu'il nous a monstree. CA L V I N , Instit. (1560), I, xiv, 4. — N'aperçois-tu.., Le grief tourment dans m a poitrine enclos? BAÏF, Diverses Amours, L. I (I, 326). — De plus grefs maux que ne sont tous ceux ci Avons souflers. D E S M A S U R E S , Enéide, 1, p. 15. — Je trouve par expérience que c'est plustost l'impatience de l'imagination de la mort qui nous rend impatiens de la douleur : et que nous la sentons doublement grieve de ce qu'elle nous menace de mourir. MONTAIGNE, I, 40 (I, 333). — Il leur est grief et moleste... de voir que ceux dont elle a triomphé en sa persévérance triomphent pour le jourd'huy d'elle. E. P A S Q U I E R , Lettres, VI, 1. — Le pis que je voye aux autres maladies, c'est qu'elles ne sont pas si griefves en leur effect comme elles sont en leur yssue. M O N T A I G N E , III, 13 (IV, 249). Grave, coupable. — Quelle iniquité y a-il plus
griefve que rébellion? CALVIN, Instit., IV, p. 286. Grave, dangereux. — Il estoit en griefve mala
die tombé. R A B E L A I S , IV, 17. — Il [Tullus Hos-tilius] tumba en une griefve, estrange et perverse maladie. A M Y O T , Numa, 22. — Démétrius estoit tumbé en une griefve maladie en tresgrand danger de sa personne. ID., Pyrrhus, 10.
En mauvaise santé. — Ainsi quil estoit en jeunesse. .. ainsi fut il depuis en son empire tousjours grief et malade. M I C H E L D E T O U R S , trad. de SUÉT O N E , V, 181 r°.
Sévère, rigoureux. — Il estoit grief exacteur des disciplines militaires, les voulant estre fort observées. M I C H E L D E T O U R S , trad. de SUÉTONE, I, 29 v°. — Ayans donques ces sentences si
griefves esté prononcées à l'encontre d'Alcibiades, au partir de la ville de Thuries, il s'en alla au Peloponese. AMYOT, Alcibiade, 23. — Le Seigneur dénonce icy une vengeance si grieve qu'elle ne se peut restreindre à la vie présente. CALVIN, Instit. (1560), II, vm, 19. Malfaisant, nuisible. — Depuis lors seulement,
ils ont apperceu que le serein leur appesantissoit la teste... et que les vents de l'automne estoyent plus griefs que ceux du printemps. MONTAIGNE, 11,37 (111,228). Funeste. —• Adonc ce grief et pestilent mal,
l'amour de Cleopatra... commença à se rallumer de rechef. AMYOT, Antoine, 36. Cruel. — Ha que je crains qung grief serpent
soubz lherbe Musse ne soit pour nous mordre en aguet. LEMAIRE DE BELGES, le Temple d'Honneur et de Vertus (IV, 208). — Ne dictes jamais cela, dict la pucelle, et ne me soyez, en le disant, plus grief que ne sont les maux que j'endure. A M Y O T , Hist.Mthiop.,h. I,12r°. Triste. — Race des hommes déplorée, Oiez
d'une ninfe éploree Un grief et lamentable chant. BAÏF, Poèmes, L. IX (II, 438). (Prononc, grief comptant pour une syllabe. Cf.
les alinéas précédents). —• Mais ce pandant, la roine, ja blessée D'un grief souci, Hourrist en sa pensée Ce qui la blesse. Du BELLAY, L. IV de l'Enéide. — Trop grief est le tourment des jaloux amoureux. BAÏF, l'Amour de Francine, L. I (1, 110). — Il faudrait que le cœur fut d'une roche dure Qui ne s'amoliroit à ces griefves douleurs. MONTCHRESTIEN, les Lacenes, IV, p. 188. On écrit souvent gref (voir les alinéas précé
dents). —• Et d'empres eux tu vois l'infâme chien... Lequel osa ton noble corps toucher Par gref forfait, qui trop luy cousta cher. LEMAIRE D E BELGES, 2e Epistre de l'Amant verd (III, 23). — Grefve chose est tout ce que j'ay dit ores, Mais voycy (las !) plus grefve chose encores. MAROT, l'Amour fugitif de LUCIEN. — Le cas est bien gref et estrange. D E S PÉRIERS, trad. du Lysis de PLATON (1,16). — Et le soleil ne sçauroit veoir... Une autre tristesse plus grefve. O. D E M A G N Y , Odes, II, 174. — Si fut espris de gref courroux alors. DES MASURES, Enéide, I, p. 10. Grief 2. Malheur, affliction. — Sans avoir dou
leur ne compassion du grief de son peuple destruit et desconfit, de la désolation de sa noble cité déserte... elle seoit au giron de son adultère. LEMAIRE DE BELGES, Illustr., Il, 8. — Dy nous qui est le Seigneur et le chef A qui devons recompter nostre gref Pour en avoir secours. MARG. D E NAV., les Marguerites, Oraison de l'ame fidèle (1,123). Mal. — Il advint Que sur ce rat Pespouse vint
Mettre ses gris pour dire en bref, Ne luy pensant faire aulcun gref. HAUD E N T , Apologues CTESOPE, 11,111. Estre à grief. Être pénible. — 11 luy estoit à
grief de voir tant de chrestiens encadenez et menez esclaves. BRANTÔME, Cap. estr., dom Phillipe, roy d'Espaigne (II, 86). Griefment, v. Grièvement. Griefve, Griefvement, Griefver, v. Grève 1,
Grièvement, Grever 1. Griesche 1. Poule griesche. — [Les poules] qui
auront les argots de derrière ainsi haults... seront griesches, et ne vouldront endurer estre couvertes des coqs, et ne ponnent gueres. COTEREAU, trad. de COLUMELLE, VIII, 2. — Toutes poules... désireuses de couver ne sont propres à ce mestier. Les plus jeunes de deux ans n'y valent rien, ne les griesches. O. DE SERRES, Théâtre d'agric, V, 2. — I
77 — GRIF
(Par comparaison). Je suis la femme d'un coquu... je conserve bien mon bon homme en sa qualité sans faire faute de mon corps non plus qu'une nonnain griesche. BEROALDE DE VERVILLE, le Moyen de parvenir, Partie (I, 256). Ortie griesche. — Puis luy frottez le fondement
D'orties griesches par temps chaud. Ane Poés. franc., I, 168. —• Il y a plusieurs espèces d'orties, mais la sauvage, autrement nommée griesche ou griache, a les fueilles plus petites que les autres et est beaucoup plus piquante. M. D E LA PORTE, Epithetes, 294 r°. — On peut appliquer sur la douleur des orties griesches. AMBR. PARÉ, XXI, 20. — Car la griesche ortie et le piquant chardon Sont à les manier plus doux que Cupidon. PASSERAT, Vers d'amour (I, 29).
Griesche 2. Volant, sorte de jeu. — A la griesche. RABELAIS, I, 22.
Grièvement. Péniblement, difficilement, avec peine. —• Les avaricieux portent grefvement l'injure à eulx faitte en la diminution de leurs biens. L. L E R O Y , trad. des Politiques d'ARISTOTE, V, 11. — Il estoit ja extrêmement las, et parloit griefvement à peine. F. BRETIN, trad. de LUCIEN, Jupiter tragique, 11. Gravement, fortement. — Xantippus, estant
griefvement indigné contre son père, alloit mesdi-sant de luy en public par la ville. A M Y O T , Périclès, 36. Sévèrement. — Ceux qui aucunement esti-
moient que le Dieu habitast aux temples con-struictz de mains d'hommes furent grièvement reprins par S. Estienne. CALVIN, Instit., IX, p. 540. — Si je faisoys ce que vous dites, certes j'en pourroys estre griefvement reprins devant Dieu. Amadis, II, 22. — Son oncle le reprenoit griefvement de sa témérité. J. D E VINTEMILLE, trad. de la Cyropedie, I, 3. Sérieusement. —• Quand il alloit, les genoulx
luy estoient foibles, qui estoit une chose qui fort le deshonnestoit quand il vouloit faire quelque chose griefvement. MICHEL D E TOURS, trad. de SUÉTONE, V, 181 r°.
(Prononc. : ie comtpant pour une syllabe). — L'ystoire voy de Udo desperé Et comme il fut griefment improperé. R. DE COLLERYE, Rondeaux, 88. — Pour quelque ennuy qui soit prochain de moy, Quelque deffault qui grièvement me presse. MAROT , le Riche en pauvreté. —• Amour si griefvement est venu me blesser. BAÏF, les Amours de Meline, L. I, A Ronsard (I, 51). — De la divinité grièvement offencée. PONTUS DE TYARD, NOUV. Œuv. poet., Sonnets d'amour, 19. On écrit aussi grefvement. — Elle attendit
l'heure propre et le poinct Pour s'en venger grefvement et appoinct. MARO T , L. II de la Metamorph. (III, 225). — 11 a grefvement péché. RABELAIS, III, 22.
Grif. Griffe. — De sorte qu'avecques les dents Et les grifs, qui entroyent dedans Leurs chairs si profond, se blessèrent. CORROZET, Fables d'EsoPE, 113. — Si fut son griph picquant Déplumé et va-gant Par avant arrogant A son revol Romain. B. A N E A U , Lyon marchant. — Combien qu'il ayt gris aussi durs que fer Dont il se sert pour aultruy esgriffer. H A U D E N T , Apologues d'EsoPE, 1,111. — Laigle, croyant cestuy conseil, va prendre Loystre en ses gris. ID., ib., I, 121. — Il meurdrissoit de ses griz et ses croqz Et debelloit pour vray tous aultres coqz. ID., ib., II, 60. — Ruants, hurtants, mordents, De piedz, de grifz, de cornes et de dens. B. A N E A U , Imagination poétique, p. 57. —
I Défions nous de leur malle teste, Mulerye, tenson
77 —
GRIFEUX 378 —
et tempeste, De leur bec, gryz, ongles, ergos. Sotties, III, 298.
Grifeux. Qui a des griffes. — Bien t'eusse fait bossue et contrefaicte, Des bras aussi detors et mains grifeuses, Que je t'ay fait doulces, délicieuses. F E R R Y J U L Y O T , lre part., 10 (3e Elégie).
Griffade. — Griffade, c'est la ferrure ou bien blessure de beste onglée à serres. E. B I N E T , Merv. de nat., p. 62 (G., Compl.).
Griffé. Qui a des griffes. — Nous veismes un grand dogue à deux testes de chien... griffé comme un diable de Lamballe. R A B E L A I S , V, 16 (1562). — Ne vois-tu pas qu'un œuf engendre un coq Creste, grifé et barbu, qui le choq D'un autre coq ne craint à la bataille? R O N S A R D , Poèmes, L. I, Discours de l'altération des choses humaines (V, 115). — Coq. Ayme-jour, creste... griffé ou griffu. M. D E LA P O R T E , Epithetes, 92 v°. Griffée. Coup de griffe. — (Fig.). Pour garder
que nul fier Vent fulmineux n'y mette ses griffées. L E M A I R E D E B E L G E S , la Couronne Margaritique (IV, 155). Griffer. Saisir avec les griffes. — (Fig.. Je)
souhaite, pour bien faire mon floc, Trouver larrons saisir à l'avantaige ; Pour les griffer, prendre en tache et en bloc Tout le butin qu'ilz ont eu au fourraige. Ane Poés. franc., 1, 313.
Gratter, racler. — Recouvert et mené a main la dite maison des escolles, carrelé, marelle les chambres basses et haultes, et le tout griffé, blanchi. Compt. de 1587. Dun-le-Roi (G.).
Griffé. Saisi dans les griffes. — A u chocq la plume vole De la raideur du coup qui si mortel affole Le pauvre oiseau griffé que, le col roidissant Et les jambes, il meurt de la douleur qu'il sent. CL. G A U C H E T , le Plaisir des champs, VHyver, Vol pour le merle, p. 298. Grifflere. Griffe. — Le blanc lyon de sa grif-fiere Luy feit bien ses aelles descendre. 1521. Chans. sur le siège de Mezieres (G.). Griffon 1. Pillard, brigand, homme menant une vie sauvage. — Les gryphons et marrons des montaignes de Savoie. R A B E L A I S , Pantagr. Prognost., 1. —• Estes vous encores icy, griphons de tous les diables? ID., Pantagr., V, 15. — Certains Arabes, ayans tué trois de noz gens et despouillé de leurs vestemens, ces diables de griffons vont prendre leurs corps et les ruer dedans [la mer Morte]. T H E V E T , Cosmogr., VI, 9. — Conférant avec un de ces griffons encenseurs arabes, et m'enquerant pourquoy ils usoient de telles suffu-migations. ID., ib., X, 1. — Dés que ces griffons barbares [les sauvages] se furent apperceuz de la fraude, ils n'avoyent garde de bailler un seul brin de farine qu'ils n'eussent premièrement fait es-preuve de la bonté de la poudre. ID., ib., X X I , 14. — Les autres ministres des juges sont les ser-gens, que Pon peut appeller les harpyes et griffons du peuple. R É G N I E R D E LA P L A N C H E , Hist. de l'Estat de France, II, 74.
Griffon de montagne. — Issans du guischet, fusmes conduits jusques au port par certains griphons de montagnes. R A B E L A I S , V, 13. — Lors que ces griffons montaignois sont en guerre, il y fait dangereux aborder, à cause qu'ils tuent ou prennent esclaves les passans. T H E V E T , Cosmogr., I, 9. — Les rustaux de la campaigne et griffons des montaignes du païs cataien... en nourrissent quelques mois de Pan leurs elephans, chameaux et chevaux. ID., ib., V, 4. — Jaçoit qu'il y ait assez d'autre poisson, et que ces griffons de mon-
taigne soient asseurez... qu'il n'y a autre i___ qui cause la maladie graveleuse qui les tourmente que le manger de cestuy cy, si ne vivent ils presque d'autre viande. ID., ib., V, 8. — Mon-taignes à la vérité si fascheuses qu'il est presque impossible que h o m m e puisse trouver addresse pour y aller, non plus que de chemin frayé par celles de Georgianie : tellement que les uns et les autres de ces griffons de montaigne tiennent presque ceux qu'ils recognoissent pour seigneurs en sujection. ID., ib., IX, 8.
Le mot griffon s'emploie aussi comme mot injurieux de sens vague. — Que diable demande ce griffon? L A R I V E Y , les Escolliers, IV, 2.
(Fém.). Griffonne. — Vieille qui la mort espou-vante, Gorge sans dents, noire et béante, Vieille griffonne des enfers. Les Fanfares des Roule Ron-temps, p. 7. — (Adj.). Il gesnoit les humains d'un cueur félon hautain, Et d'une extrême rage et griffonne avarice, Ravisseur, leur ostoit leur manger et leur pain. J. D E BOYSSIÈRES, Prem. Œuv., 8 r°. — On voit continuellement voleter des enseignes, esquelles sont brodées des aigles grifonnes. Trad. de F O L E N G O , L. X V (II, 31).
Pied de griffon, v. Pied. Griffon 2. Griffonneur. — J'ey cogneu tel es-
perlucat Et tel griffon de parchemin. Sotties, III, 87. — Ce griffon commingeois... dit au mesme chapitre une bourde aussi peu recevable que la première. T H E V E T , Cosmogr., XI, 8.
Greffier. —• Ainsi (peu près) au juge devisay, Et en parlant un griffon advisay, Qui de sa croche et ravissante pâte Escrivoit là l'an, le jour et la date De m a prison. M A R O T , l'Enfer. — Prince, ce griffon qui m e gronde Semble Jouan qui se mordoit, ID., Epigrammes, 47 (Réplique à un greffier).
Griffon griffault. — « Genève ! dit le juge ; vraiment, vous m e la baillez belle ! C'est un griffon griffault ; il demeure à Nismes..'. » Et de fait y avoit un greffier à Nismes qui s'appelloit Genève. D E S P É R I E R S , NOUV. Récr., 66.
Griffonner 1. Saisir, s'emparer de. — Quand les forgerons et autres ouvriers ferrez seroient pires cinq cens mille fois qu'ils ne sont, quand les peines et fatigues de ceux qui harpient à griffonner l'or seroient plus grandes que ne les avez fait... cela ne justifie aucunement du profrit ou du dommage de l'or ou du fer. CHOLIÈRES, 1" Matinée, p. 29. Maltraiter. — 11 se desgorge sur papes et pa
pistes. .. et en fin parlant des juges laiz, il vous les griffonne comme il fault. T H E V E T , Cosmogr., IX, 8.
Griffonner 2 (H. D. T. 1611). — 1555. Nostre vulgaire... voyant quelque peinture lourdement esbauchée l'appelle ouvrage griffonné. P. BELON, Hist. de la nat. des oys., 82 (Vaganay, Pour l'hist, du franc, moderne). Griffonnier. Qui saisit avec les griffes. —
(Fig.). Lequel [Bernardin Ochin]... alla en Aile-maigne se soumettre entre les pattes griffonmeres de Martin Luther. T H E V E T , Cosmogr., XVII, 2.
Griffu. Qui a des griffes. — Que les grifus, les dragons inhumains, Que l'enfançon d'Alcmene estoufa de ses mains, Ne vindrent des-membrer de leurs griffes bourrelles Mon corps pendant encor à vos chères mamelles? R- "A*" NIER, Porcie, 1680. — Léopard ou Liepard. Cruel, affricain, viste, griffu. M. D E LA PORTE, Epithetes, 238 v°. — C o m m e lyons griffus au coronai obstinez. R. G A R N I E R , Antigone, 312. — Voyani à son resveil quelque dragon griffu. P. MATTHIEU,
— 379 — GRILLONNER 2
Aman, I, p. 18. — Il [un lion] luy donne l'assaut, Et de ses pieds griffus déchire d'un plein saut Les taureaux ricanans par le long des planures. J. D E CHAMP-REPUS, Ulysse, I, p. 50. — (Par comparaison). Il demeure empestré, le neud tousjours se serre, Et les chevaux ardans le traînent contre terre A travers les halliers et les buissons touffus, Qui le vont deschirant avec leurs doigts griffus. R. GARNIER, Hippolyte, 2118. — (Fig.). U n soing grifu qui, comme une Furie, M e ronge impatient. RONSARD, Meslanges, 1555 (VI, 369). — Soing. Mordant, griffu, rongeard, misérable, soliciteux. M. D E LA P O R T E , Epithetes, 379 v°. En forme de griffe. — Il fut jadis un peintre de
renom... Qui souloit peindre avec face agréable, Avec beaux yeux et beaux cheveux le diable, Ne luy faisant ni les ongles griffus, Le front cornu, ni les cheveux touffus. V A U Q U E L I N D E L A F R E S NAYE, Sat. franc., L. IV, A M. Le Riais. Grifonne, Grifu, v. Griffon 1, Griffu. Grigne. Maussade. — Il luy dit qu'estoit
feinte en ses pleurs et peinte en ses fleurs, qui la faisoit ainsi grigne. T A B O U R O T D E S A C C O R D S , les Rigarrures, I, 8. Grigneur, v. Greigneur. Grignon. Morceau de pain. — Helas ! (dit Ja-
quet) ma doucette, Si plus cher ne t'est ton grignon Que moy, Jaquinot ton mignon, Approche-toy, mignardelette. R O N S A R D , Gayetez, 5. 1553 (VI, 343). — Chacun ayant desployé son industrie, nous trouvasmes avoir gagné quatre chandelles de roux, un cizeau... un grignon, un fromage. A U B I G N É , Faeneste, III, 3. Grignoter. Manger. — Luy, qui enrageoit de
faim et de soif, se mit à table et commença très-bien à souper et à grinoter. N I C O L A S D E T R O Y E S , le Grand Parangon, 6. — Banquetons, gringno-tans, divisans et faisans beaulx et cours discours. RABELAIS, IV, 55.
Grignoter de. Dire du bout des lèvres. — Là... grignotte d'un transon de quelque missicque pre-cation. RABELAIS, II, 6. — [Gargantua] tout lor-dement grignotant d'un transon de grâces, se lavoit les mains de vin frais. ID., I, 22. On écrit aussi gringnoter. — Là les nourrit et
allaicta [trois levrauts] jusques à ce qu'ils f eussent grands, et qu'ils peussent gringnoter le laceron, PH. D'ALCRIPE, la Nouvelle Fabrique, p. 114. Cf. le premier alinéa. Grignoteur. Mangeur. —• L'hoste en son
temps avoit esté bon raillard, grand grignoteur. RABELAIS, V, 16.
Grignotis. Ce que l'on mange, nourriture. — Lentz lymassons n'eurent plus que ronger ; Leur grignotis perdirent petitz vers. Ane Poés. franc., 1,249. Griguenoter, v. Gringuenoter.
Gril, Grilet, v. Grille, Grillet. Grillant. Glissant. — Le lieu plein de profond
bourbier empeschoit qu'ilz ne se peussent tenir fermes ny marcher avant : pource qu'il estoit grillant et lubricque. E T . D E L A P L A N C H E , trad. des cinq prem. liv. des Annales de TACITE, L. I, 38 r0. — Glace. Froide, gelée... grillante ou glissante. M. D E LA P O R T E , Epithetes, 192 v°. — Glissade. Unie, grillante, prompte, dangereuse, roulante. ID., ib., 193 r°. Grille. Gril. —• La faute vint que l'apprentis
avoit tousjours ouy dire grille en féminin, et non pas gril. D E S PÉ R I E R S , NOUV. Récr., 46. — Il y a
puis après la grille sur laquelle il (saint Laurent) fut rosty. CALVIN, Traité des Reliques (VI, 445). — Les aultres tenens... paelles, pales, cocquasses, grisles, fourguons, tenailles, lichefretes. R A B E LAIS, IV, 41. —-Et comme on voit un haranc sur la grille Se revenir. M E L I N D E S* G E L A Y S , Rondeaux, 1. — C o m m e une paire de maquereaux sur la grille. A U B I G N É , Sancy, I, 1.
Inversement, on emploie gril dans le sens de grille. — Avec extrême diligence, retireras le fruit à-tout la cueillera persee, le jettant sur le gril ou trelis. O. D E S E R R E S , Théâtre d'agric, VIII, 2. — U n gril de fer... soustenant le bois ou le charbon, qu'on y mettra par une porte longue et estroite. ID., ib„ VIII, 4. Grillet 1. Grelot. — D'argent a une fosse
d'azur, chargée de grilets d'or. 1523. Arch. Eure (G., Compl.). Grillet 2. Grillon. — Mais le grillet, jalouse fantasie, Qui sans cesser chante tout ce qu'il cuyde, Et la pensée et l'ame ayant saisie, M e laisse vif à m a doulce homicide. M A U R I C E S C Ê V E , Délie, 153. — U n milan et un grillet ne voyent pas lun comme lautre, et les aigles ne voilent pas comme les perdrix. P A S Q U I E R , Opuscules de P L U T A R Q U E , p. 120. — Ces bestioles n'estons pas plus grosses que nos grillets. J E A N D E L E R Y , Voy. au Brésil, 1,180, Gaffarel (G.). — (Fig.). Je ne doute point que l'impératrice vostre femme n'ayt de grillets et de tintouyns en la teste, de sorte que, par vengeance ou pour quelque autre fin, elle s'essaye à vous tourmenter. Hist. pit. du prince Erastus, 59 v° (G.).
Grilleté. Portant un grelot. — U n esprevier grilleté d'or. E. B I N E T , Merv. de nat., p. 364 (G., Compl.). Grilleux 1. De la nature d'une grille. —•
Treillis. Ferré, grilleux, entr'ouvert. M. D E LA P O R T E , Epithetes, 406 v°.
Grilleux 2. Qui fait griller. — C o m m e en bon marmiton Les traicté chaudement la grilleuse Alecton. Les Fanfares des Roule Rontemps, p. 22.
Grillon. Caprice, lubie. — Parlez tout doulx, car il tient de la lune, Et a la teste massive de grillons. Ane Théâtre franc., III, 258. — D'un chevalier aagé qui feit sortir les grillons de la teste de sa femme par une saignée, et laquelle auparavant il ne pouvoit tenir soubz bride qu'elle ne luy feist souvent des traitz trop gaillards et brusques. D E S P É R I E R S , NOUV. Récr., 127 (titre). — Tandis que le sang decouloit du bras de ceste damoy-selle, son mary, qui sentoit oculairement les grillons s'affoiblir, commanda fermer ceste veine et ouvrir celle du bras senestre, ce qui fut pareillement fait. Tellement que la pauvre damoyselle resta demy morte. ID., ib., 127. — Je veux sçavoir à quoy tend son dessein, et veoir... si par une petite tromperie je luy puis tirer les grillons de la teste. L A R I V E Y , la Constance, II, 4. 'Grillonner 1. Bruire comme un grillon. —
C o m m e si je devois prendre à plaisir de sentir grillonner une voix et babiller dedans m a teste. C. D. K. P., trad. de G E L L I , Discours fantastiques de Justin Tonnelier, Disc. I, p. 16-17.
Grillonner 2. Griller (trans.). — Mars n'est point si cruel aussi en ses batailles C o m m e m e sont d'amour les crochets et tenailles, Qui, rouges de son feu, m e grillonnent la chair. J. D E B O Y S SIÈRES, Prem. Œuv., 59 r°. Se grillonner. Griller (intrans.). — M a face mar-
tiree est comme sur l'enclume Le fer aulbe et ar-
GRILLONNIER — 380 —
dant que la fournaise allume, Ainsi rouge, bouillante, et petit à petit Au milieu des ardeurs se grillonne et rostit. ID., Sec. Œuv., 15 v°.
Grillonnier. Bestiole grillonniere. Grillon. — L'un des plus impertinents hommes de nostre temps... veult par son lourd esprit maintenir que ces bestioles grillonnieres, et salemandres aussi, se nourrissent, non, dit-il, au dedans du feu, ains es environs. THEVET, Cosmogr., IX, 8. Grillons. Instrument de torture. —* Le peuple
commancea... à crier, Qu'il ait la géhenne, Qu'on luy baille les grillons à ce meschant : Il a menty. A M Y O T , DU trop parler, 13. — Les autres tyrans... nourrissent des bourreaux et des gehenneurs, ils inventent des fers chauds à brusler, des grillons. ID., Que le vice seul est suffisant pour rendre l'homme malheureux, 2. — Quand leurs maistres ou bien des tyrans leur donnent les grillons, vous ne leur entendez pas jetter un seul cry. ID., ib. — Des prisons les plus hautes Est banny le sommeil, car les grillons ferrez Sont les tappis velus et mate embourrez. AUBIGNÉ, les Tragiques, III (IV, 133). Grillot. Grillon. — Apres d'un grillot les
chansons. 1560. Cuisine papale, p. 18 (G.). Grillot (pomme de). — Il y a peu de pommes
d'esté, ne s'en recognoissant guiere plus de deux espèces, l'une est la petite pomme-saint-Jan, meure environ le commencement de juillet, l'autre est du mois d'aoust, ditte de grillot. O. D E SERRES, Théâtre d'agric, VI, 26. Grillotement, v. Grilloter.
Grilloter (intrans.). Trembloter, tinter. — Les femmes appellent cymbales celles [perles] qu'elles portent pendues es aureilles, en nombre, comme si elles prenoyent plaisir d'ouyr grillotter les perles à leurs oreilles. Du PINET, trad. de PLINE, IX, 35 (G., Compl.). — Si on la secoust [cette pierre], on sentira grillotter quelque chose dedans. ID., ib., X, 3 (G., Compl.). — L'aëtite, qu'on croit, grillottant, estre enceint, Sert à l'enfantement, sur la cuisse estant ceint. J. D U CHESNE, le Grand Miroir du monde, L. IV, p. 143. — Les dames... ont accoustumé de pendre des perles en nombre a leurs oreilles, pour le playsir, dit Pline, qu'elles ont a les sentir grilloter, s'entre-touchant l'une l'autre. S* FRANÇOIS D E SALES, Vie dévote, III, 38. (Trans.). Secouer. — On cognoit aussi les bons
œufs en l'eau : car ceux qui ne sont pleins nagent sur l'eau, mais les autres vont à fond. Au reste les œufs qu'on a esprouvez à les grilloter ne valent rien à les mettre couver, pource qu'on a confondu et desraciné par ce grillotement les veines vitales et generatives des œufs. Du PINET, trad. de PLINE, X, 54 (G., Compl.). Grillotier. Rôtisseur. — Trajan estoit pes-
cheurdegrenoilles... Lucullegrillotier. RABELAIS, II, 30. —• Gens soubzmis... à Mars, comme... to-quassiers, grillotiers, chercuitiers. ID., Pantagr. Prognost., ch. 5. Grillotis. Tintement. — La première chose qu'un mari doit avoir d'une femme, et que la femme luy doit fidèlement garder, c'est l'oreille, affin que nul langage ou bruit n'y puisse entrer, sinon le doux et amiable grillotis des paroles chastes et pudiques, qui sont les perles orientales de l'Evangile. S4 FRANÇOIS D E SALES, Vie dévote, III, 38.
Grimaceur. Faiseur de grimaces. — A ce pro
pos ces grimaceurs Font en cuisine grant tumulte, 1560. Cuisine papale, p. 82.
Grimandisé, v. Grimaudisé.
Grimaud. Écolier des classes de grammaire. — Les petits grimaulx les appellent en grammaire iambus. RABELAIS, II, 1. — De présent à difficulté seroys je receu en la première classe des petitz grimaulx, qui en mon eage virile estoys (non à tord) réputé le plus sçavant dudict siècle. ID,, II, 8. — Voylà les doux de S. Paul bien rabbatus, le voylà bien renvoyé au collège des grimaux. PH. D E MARNIX, Differ. de la Relig., I, m, 8. — Quand il estoit régent de la troisiesme en Bourgongne, il en eust fouetté ses grimaux, s'ils n'eussent mieux fait. AUBIGNÉ, Sancy, II, 1. — (Par extens.). 11 semble de premier coup avoir quelque apparence à son dire : mais voicy que j'appelleray à mon aide un petit grimault de dialectique, qui a seulement veu ses quinque voces, comme l'on dit, CHARRON, les Trois Veritez, III, 8, Adv. Maître des classes de grammaire. — Tous ces
grimaulx, artiens et intrans commencèrent frapper des mains. RABELAIS, II, 18. — Puys y accourut le maistre d'escholle avecques tous ses pédagogues, grimaulx et escholiers. Ip., IV, 48. — L'on reproche à M. Duplecis un sollecisme avec une sotte piaffe d'insultations, longs et niais discours du fouet de grimaus et d'escole. AUBIGNÉ, Lett. de pieté et de théol, 15 (1, 409). — (Par extens.). Maistres grimauds et massorites de la sophistique ethologique romaine. PH. DE MARNIX, Differ. de la Relig., II, i, 2. Pédant. — Quand tels grimmaus ne reprennent
d'un poëme que telles choses... lors le poëte se doit assurer d'avoir bien dit. RONSARD, Odes, Avertiss. au lecteur, 1550 (II, 481). — Je ne say quelz grimaux italiens, qui ne pouvoient faire un chetif commentaire sans invective. DES AUTELS, Réplique à Meigret, p. 56-57. Diable, ombre d'un mort. — Canidie et Sa-
gane... viennent... verser dans la terre Du sang d'un noir agneau pour parler aux grimauds. FR, HABERT, trad. d'HoRACE, Satyres, 1, 8, Paraphrase. — Au surplus j'ai mémoire Que mes vieilles putains gazouillent le grimoire Avec leurs laids grimauds : et mettent dans un trou Quelques dents de serpent avec du poil de loup. ID., ib. Protestant. — Défense de converser cum his
qui dicuntur huguenots aut grimautz. 2 juin 1561. Fécamp (G., Compl.).
(Adj.). En maint endroict il fut reprins à tort par ce magister, extraict de grimaude pédanterie, D E S AUTELS, Mitistoire barragouyne, ch. 14. Grimaude. Grammaire ; éléments d'une science
quelconque. — C'estoit un homme de labeur, assez aysé, qui avoit mené deux siens fils à Poy-tiers pour estudier en grimaulde. DES PÉRIERS, Nouv. Récr., 71. Ecole élémentaire. — Après avoir esté, par ung
long temps, A la grimaulde, il faillut changer temps, Aller au droict pour y avoir pratique. BOURDIGNÉ, Pierre Faifeu, ch. 3. — Un sage docteur extraict de la grimaude pedantesque mateologale. PH. D E MARNIX, Differ. de la Relig-, II, v, 5. Grimauder. Dire de vaines paroles. — B ni a
parole si ferme que l'homme passionné ne phe a son biais, mais cela s'appelle chicaner et grimauder devant les bonnes âmes. S' FRANÇOIS DE SALES, Défense de la Croix, III, 10. Grimauderie. Science pedantesque, vaine.—
Ce bon docteur en grimauderie catholique ro-
maine. P H . D E M A R N I X , Differ. de la Relig., I, n, 3. — Il faut bien avoir paperasse les bobulaires de la grimauderie théologicque romaine, pour reco-gnoistre le maistre d'entre les valets. ID., ib., I, iv, 2. — Bellarmin nous desploie force belles reigles de grimauderie, pour sçavoir discerner les vraies traditions d'avecq les fausses. ID., ib., 1, v, Préface. Verbiage pedantesque et vide. — Pour mettre
différence entre tes meigres grimauderies et les plus haultes inventions de ceux qui rameinent la philosophie dignement avecques les Muses en France. D E S A U T E L S , Réplique à Meigret, p. 19. Grimaudisé. Conforme à l'usage des pédants.
— Parlant... en révérence bien autre que pedantesque grimandisée [sic], il s'assied de belle audace au trosne judicial de Dieu. P H . D E M A R N I X . Differ. de la Relig., II, iv, 3. Grimaulde, v. Grimaude. Grime. Femme chagrine, maussade. — E par-
dieu, elle n'est pas baghe Qu'il faille mettre a tel estime, Car ce n'est que une vieille grime. G. ALIONE, Poes. franc. (G). Grimelin. Petit écolier. — Ce livre si sujet à
répréhension qu'il n'y aura pas jusques aux petits grimelins qui ne se meslent d'en faire une affixe au collège. T A B O U R O T D E S A C C O R D S , les Bigarrures, Préface. Grimmaud, v. Grimaud. Grimoire. Formulaire magique. — A u tour de
luy estoient troys presbtres bien ras et tonsurez, lisants le grimoyre, et conjurans les diables. R A BELAIS, IV, 45.
Langage de convention. —• Mais on lit à leurs yeux et dans leur contenance Que la bouche ne parle ainsi que l'ame pense, Et que c'est, mon amy, un gremoire et des mots Dont tous les courtisans endorment les plus sots. R É G N I E R , Sat. 4. (Fém.). — Quand j'oy parler, disoit-il, de dia-
fierne, de sypogronde, de valetèbre, de thoulas, je pense que ce sont des mots de la grimoire. T A B O U ROT DES A C C O R D S , les Bigarrures, 1, 4. Grimolé. Bigarré. — Harnecheures... verdes,
rouges, bleues, grimolees, piolees. P H . D E M A R NIX, Differ. de la Relig., I, iv, 5. Grimpart. Grimpant. — Les bras longs et tor-
tus du lierre grimpart. R O N S A R D , Elégies, 8 (IV, 59). Grimper (trans.). Accrocher. — [Les hiron
delles] se grimpent et liaisonnent si bien les aisles, pieds et jambes, les uns contre les autres, que lon les voit cheoir du hault en bas aussi drues que gresle. T H E V E T , Cosmogr., X X , 2. — (Fig.). Les dieux laisseraient leur Olympe, Et viendraient voir la beauté qui m e grimpe Le cœur martir de langoisseuse peine Que l'amitié concède que je prene. P H . B U G N Y O N , Erotasmes de Phidie et Gelasine, p. 5. (Intrans.). Grimper à terre. S'étendre à terre. —
Les fraiziers en seront conduits d'un particulier traitement. C'est en ne leur permettant de grimper à terre, ains les contraignant à s'eslever en haut. O. D E SER R E S , Théâtre d'agric, VI, 12. Se grimper. Grimper en s'accrochant. —• Te-
not... à l'arbre met La main, puis le pied, et se hausse Se grimpant jusques au sommet. B U T T E T , Sec. liv. des Vers, ode 28. — Bref, ainsi qu'au déluge, ou Nature patit, Les uns, pour le recours du salut de ses havres, Se grimpèrent, contreintz, à la cime des abres. L. P A P O N , Pastorelle, 1,1. — Les Espagnols nageoient par centeines dans la
51 — GRINGOTER
mer, et se grimpoient avec les mains à nos navires, comme des chats. Var. hist. et litt., 1,147.
Grimpeure. Action de s'accrocher, de grimper en s'accrochant. — L'hierre si fort n'estreint pas De la grimpeure de ses bras Le chesne qu'il ayme ou la plante. O. D E M A G N Y , Odes, I, 53. — Là, sans tailler, la nourricière plante D u bon Denys, d'une grimpeure lente S'entortillant, meurira ses raisins De son bon gré sur les ormes voisins. R O N SARD, Poèmes, L. II, les Isles fortunées (V, 159). Grinceter. Grincer. — Ce mastin aboyeur de
mon entière vie, Grincetant de ses dents escu-meuses d'envie Traistrement contre moy, bave sur mon renom. BAÏF, Poèmes, L. III (II, 111).
Gringatoire (?). — Le Triacleur. Seigneurs, voicy d'un gringatoire Ung très bon morcel et friant. Ane Théâtre franc., II, 53.
Gringoller. Dégringoler. — L'un du haut d'une butte en bas, sans se blesser, Gringollera roulant. CL. G A U C H E T , le Plaisir des champs, VHyver, la Darue, p. 306.
Gringotaige. Chant, gazouillement. — L'oy-seau s'en va, de moy fuyant, Et délaissa son grin-gottaige. Ane Poés. franc., III, 13. — Et voit on en beaucoup de lieux que plusieurs ne sçavent congnoistre ung fa, doncques un fagot, mais ont voix assez accordantes, s'en meslent plus que les ouvriers, mais nonobstant leurs gringotaiges on voit que beaucoup de quartiers ne treuvent pas grans avantaiges. J. B O U C H E T , les Regnars traversons, 42 c (G.).
Gringotement. Gazouillement. — Hz comparant les chansons, vers, hymnes... aux chanz et gringottement des rossignoletz et des cignes. PA S Q U I E R , Opuscules de P L U T A R Q U E , p. 154.
Tintement. — Pendoient autour de moy des sonnettes qui faisoient un plaisant gringotement. F. B R E T I N , trad. de L U C I E N , Lucin, 48.
Gringoter (intrans.). Chanter, gazouiller. — Le rossignol y gringote à merveilles. Ane Poés. franc., VIII, 230. — Aussi chantent ils bien pour eux. Vous ne vistes onques rossignols mieux gringoter qu'ils font en plat, quant ils voyent ces deux bastons dorez. R A B E L A I S , V, 6. — Oy les chantres oyselets, Qui doucetement gringotent. BAÏF, l'Amour de Francine, L. III (I, 230). — Gay rossignol, honneur de la ramée, Qui jour et nuit courtise ton aimée... Et t'esclatent d'une voix qui gringote Ores en haute, ores en basse note... Hachant, coupant, entrerompant ton chant De cent fredons, tu donnes à ta femme Un doux martel, amoureux de m a dame. R O N S A R D , Poèmes, L. I, le Rossignol (V, 107). —• Les rossignols... gringottent et desgorgent ainsi que peut faire le plus parfait chantre du monde. A M B R . P A R É , Livre des animaux, 19. — Ces chantres ailez, Qui sur les verds rameaux des buissons reculez Gringotent le matin. D u B A R T A S , 2e Semaine, 2e Jour, Babylone, p. 196. — Lhors qu'ilz [les rossignols] se desgoisent le mieux, ilz y ont plus de complaysance, et cet accroissement de complaysance les porte a faire des plus grans efîortz de mieux gringotter. S* F R A N Ç O I S D E SALE S , Amour de Dieu, V, 8.
(Trans.). Chanter. —• Dans ces bois le rossigno-let, De son gosier mignardelet, Une chanson m'a gringotee. V A U Q U E L I N D E LA F R E S N A Y E , Idillies et Pastorales, I, 5 8 . — Le chantre rossignol, d'un frais ombre couvert, Gringotte sa chanson dans le bocage vert. BAÏF, le Premier des Météores (II, 8). —. Gentil petit oiseau, qui de ta chanson gaye,
!1
GRINGOTEUX — 382 —
Quand j'escris en ma chambre, enchantes mes ennuis, Gringotant mil fredons. JEAN D E LA TAILLE, A un sien merle. — Les oyseaux tandis par les bois Gringottent en doucettes voix Mainte et mainte chanson divine. BAÏF, Poèmes, L. 111 (II, 153). — Le Scythe Anacharsis... estent en un banquet, escoutant des chantres gringotans une chanson, enquis s'il y avoit en Scythie de tels chantres, respondit, il n'y a pas mesmes de vignes. GUILL. B O U C H E T , 4" Seree (I, 160). — (Fig.). N'est ce pas icy la chanson que vous nous grin-gottés sempiternellement en haute note : asça-voir, que vostre siège romain ne descherra jamais...? P H . D E M A R N I X , Differ. de la Relig., I, m , 7. Jouer sur un instrument. — Le gay berger
parmy les champs gringote D'un chalumeau une chanson sans note. C H . F O N T A I N E , trad. du Remède d'amour, p. 370.
Murmurer. — Vous en voulez bien à ces pauvres gens, répliqua le sr Camille (gringottent entre ses dents la patenostre de singe avec aussi bonne grâce qu'avoit Socrates lors qu'il se pince-toit la barbe). C H O L I È R E S , 6e Ap.-disnée, p. 201.
Déplorer par un chant. — N'ois-tu le rossignol, chantre cecropien, Qui se plaint toute nuict du forfait ancien D u malheureux Terée, et d'une langue habile Gringote par les bois la mort de son Ityle? R O N S A R D , Elégies, 8 (IV, 59).
Gringote. Gazouillé. — Des mignos oisillons le gringote ramage Sous un beau jour poignant t'effraye le courage. BAÏF, Poèmes, L. III (II, 115).
Chanté, modulé, orné de fioritures. — C'est une chanson gringotée ; La musique en est bien notée. M A R O T , Epistres, 24. — Nostre vicaire, un jour de feste, Chantoit un Agnus gringote, Tant qu'il pouvoit, à plaine teste. M E L I N D E S1 G E L A Y S , D'un Curé (1, 274). — Des abus qui ont accompagné ceste belle musique gringotée et ces orgues et tels badinages. T H . D E B È Z E , PS. de David, 149, Argument. — Il croit... qu'une bonne messe bien chantée, bien gringotée et bien fredonnée vaut autant que l'intercession que le Filz de Dieu fait pour nous. P H . D E M A R N I X , Differ. de la Relig., II, i, 17. — On avoit introduit en quelques églises une musique gringotée et decouppee de nouvelles notes et feintes. L E L O Y E R , Hist. des Spectres, VII1.3.
Gringoter sa voix. Faire des modulations, des fioritures. — Soit qu'en un rossignol il gringote sa voix. BAÏF, l'Amour de Francine, L. II (1,185). — Si Guillemot surpasse, A gringoter sa voix, le rossignol ramage. ID., Eglogues, 11 (III, 68).
Voix gringotée. Voix qui fait des modulations, des fioritures. — A coup les arondelles M e rompent mon someil, Et de voix gringotees Leurs plaintes sanglotees Renouvellent icy. ID., l'Amour de Francine, L. III (I, 217). — Si tu veux parler de la fille de Pandion, ell'est rude et inepte à son regard : encor' qu'elle ait accoustumé de degoiser une voix bien gringotée. F. B R E T I N , trad. de L U C I E N , les Images, 13. — Athias roy des Scythes... jugea... que beaucoup mieux aimerait ouïr hannir un fier et courageux cheval... que telles voix artificielles et de guet à pans gringot-tees. D u FAIL, Contes d'Eutrapel, 19 (I, 260). Gringoteux. Qui chante, qui gazouille. — Rossignol ou Rossignolet. Amoureux, plaisant, jasard... gringoteux. M. D E L A P O R T E , Epithetes, 360 v°. — (Subst.). Adieu, oiseaux; adieu mes gringoteux. Var. hist. et litt., VI, 154. Gringotis. Modulation, fioriture. — Qu'on oste ce chant mol et rompu, ou il y a du gringotis
et du bruit, et mille prononciations de mots. Le Cabinet du roy de France, p. 177 (G.).
Gringottement, Gringotter, v. Gringotement, Gringoter.
Gringueloter (intrans.). Chanter, gazouiller, — La voix d'un asne est agréable aux asnes, et n'en pensent point de plus douce, encore qu'elle fut de rossignol gringuelottant à l'ombrage. Trad de F O L E N G O , L. X X I (II, 200).
(Trans.). Chanter. — Ces quatre... gringuelo-toyent divers motets, et par tels plaisants chants adoucissoient la peine et le travail du chemin. ID ib. (II, 197). Gringuenaude. Crotte, ordure. — SemblaMe-
ment est declairé innocent du cas privilégié des gringuenaudes. R A B E L A I S , II, 13. — Des gringue-nauldes à la joncade. ID., V, 33 ms. — Elles eurent aussi force minchardes pouldrées de gringuenaudes fines. Navigation du Compagnon à la Bouteille, B. — Ce cul ridé à m a maistresse Imprime, touchant à sa fesse, Mille coches en un monceau De gringuenaudes de pourceau. AUBIG N É , le Primtems, III, 20. — Porteur de rogatons, qui presches et collaudes Les grains touchez du pape et les vends un escu, Combien te faudroit-il de quatre gringuenaudes Que le pape eut tiré des thresors de son eu? ID., Pièces epigrammat., 29. — (Fig.). Pensez quilz ont une grande grâce quant ilz disent, après boyre, quiz ont le cerveau tout encornimatibulé et emburelucoqué... dung tas de gringuenauldes. G. T O R Y , Champ fleury, Aux lecteurs. Gringuenaudier, dérivé de gringuenaude. —
Par l'opinion de deux gringuenaudiers aussi fole-ment interprétée comme fadement inventée. RABELAIS, IV, Ancien Prologue.
Gringuenoter (intrans.). Chanter. — Principalement pour le bassus de devant l'église, qui gringuenotoit à fil retors tout de mesme que si Pon eust voulu abouter deux talonnieres de sarge drappee de ce pays icy à un bas de soye de Normandie. Le prem. acte du synode nocturne, 15 (G.).
(Trans.). Chanter. — En quoy consistent les bonnes œuvres? En toutes sortes de dévotions et bonnes intentions sur lesquelles le clergé peut trouver à mordre, à faire sonner, chanter, gringuenoter, marmoter, brimboter... ou barboter force messes. H. E S T I E N N E , Apol. pour Her., ch. 39 (II, 352). — Se souvenant de l'antienne qu'il avoit gringuenotée toute la nuit. ID„ ib. (II, 393). — Le rossignol... gringuenotte cent façons de chant. Trad. de F O L E N G O , L. XIV (II, 11). — Le pauvre... griguenotoit ce Salve avec une voix horrifique. B E R O A L D E D E VERVILLE, le Moyen de parvenir, Sof Passuc (II, 23). Exprimer en chantant. — Parquoy je veux
comme luy Gringuenoter mon ennuy Pour consoler m a ruine. E. PA S Q U I E R , Recherches, VII, 9.
Grinoter, v. Grignoter. Griote, v. Griotte 1. Grioteux. Riche en gruau. — Pour faire pain
du blé de Brie, faut se gouverner tout autrement, d'autant qu'iceluy blé est grioteux plus que celuy de la France ou de Beausse. LIEBAULT, Mais, rust., p. 669 (G.).
Griotier (H. D. T. 1583). — 1557. L'arbre qui çorte les grosses guignes et le gryotier se plantent es vergers. C H . D E L'ESCLUSE, trad. de DODOENS, Hist. des plantes, 507 (Vaganay, Pour l'hist. du franc, moderne).
On dit aussi gruotier. — Une fustaye De rares
— 383 — GRIPPER
?uotiers, bigarreaux, merisiers. CL. GAUCHET, le laisir des champs, le Printems, Beaujour, p. 16. Griotier à rozes. — Parmi ces arbres de plaisir '
nous logerons le griotier à rozes. C'est un grand arbre semblable en bois et fueilles au cerisier aigre, ne produisant aucun fruit, ains seulement des rozes incarnates. O. D E S E R R E S , Théâtre d'agric, VI, 10. Griotte 1. Cerise aigre. Avaler une griotte. Su
bir une chose désagréable. — Franc-Cœur, homme généreux et vaillant, cicatrisé en sa réputation... luy estant grief et amer d'avaler ceste griotte... desfie et despite Nécessité. Dans Bran-ôme, Opuscules et pièces diverses (X, 114-115). Griotte 2. — Griotte. Seiche, farineuse, enfan-
ine, blanche. La meilleure griotte se fait avec de 'orge frais et nouveau que lon rostit moyenne-nent, puis on le fait moudre : vulgairement on 'appelle brioche. M. D E L A P O R T E , Epithetes, .98 v°. — Afin qu'ayans du pain et estans rem-)lis de griottes seiches puissions dormir. F. B R E TIN, trad. de L U C I E N , les Saturnales, 21. Grip 1. V o l . — Trompez vostre vallet subject
mgrip, baillez luy vostre bourse. D u FA I L , Bali-:erneries d'Eutrapel, p. 29. Grip 2. Sorte de bateau. — Si tost que leurs
aoulouars furent gaignez, sortirent par ung dar-riere grant nombre d'iceulx estans dedans barches stbrigandins, etaudesceu des nostres approchèrent ung grip viz a viz du boulouart ou noz gens estoyent et la dedans entrèrent. J. D ' A U T O N , Chron., 49 v° (G.). — Et s'en alla jusque contre les murailles de la ville, où estoit attaché un grip des Turcs chargé de figues et de raisins. ID., ib., III, 29 (Gay, Gloss. archéol). — 1520. Les vaisseaux soubtils sont [à Venise] gallères bastardes, galères soubtilles, fustes, brigandins, grips, leux, armadis. A N T . D E C O N F L A N S , les Faits de la marine (Gay). — 11 n'y aura celuy de la terre qui avecquesnasselles... grips, tungales, paraons... ne les aille secourir. L E L O Y E R , Hist. des Spectres, IV, 17. Grip'argent. —• Advocat. Légiste, criatfd...
grip'argent, ingénieux. M. D E L A P O R T E , Epithetes, 7 v°. Gripaume. Sorte de plante. —• La gripaume
donc est quasi semblable à l'ortie. D u P I N E T , trad. de DIOSCORIDE, IV, 89 (G.). — Gripaume ou Agripaume. Champestre, amere, chiquetee. Ceste herbe, qui est au goust amere, resemble presque à l'ortie, et croist par tout le long des chemins, des hayes, et alentour des murailles. M. D E L A P O R T E , Epithetes, 198 v°. Griper, v. Gripper. Gripenr. Celui qui saisit. — [Bacchus] trem
blant de peur De cheoir es mains de ce cruel gri-peur. SALEL, Iliade, VI, 103 r°. — Les abuseurs ordinaires, Ces fins gripeurs inutils. C H . F O N TAINE, Raviss* de Proserpine, p. 450. Griph, Griphon, v. Grif, Griffon 1. Griphonneau, dimin. de griffon 1. Brigand,
pillard. — Ce fut un marrane, n o m m é Daniel Flo-rus... qui embrassa tout le premier ceste nouvelle doctrine, et permit brigander les biens de ses voisins : puis feit une reigle, en laquelle estoient contenus plusieurs articles que ces griphonneaux dévoient observer et garder. T H E V E T , Cosmogr., A VI, 13. Grippart. Voleur. — Cependant faut noter que le vermillon est fort aisé à derobber : aussi les
peintres s'en savent bien aider : car après avoir bien chargé leurs pinceaux de vermillon, ils les lavent souvent pour les descharger ; et cependant le vermillon va au fond de l'eau, qui demeure aux peintres grippars. D u PINET, trad. de PLINE, X XXIII, 7 (G.).
Grippe i. Griffon. — Aucunes bestes appellees grippes, qui ont esles et sont très cruelles. Quant elles voyent les hommes, elles leur courent sus et les descirent. Jard. de santé, Ois., 56 (G.).
Grippe 2. Rapine. — Il y avoit bien plus proche séquelle Pour legarderd'estendre illec ces grippes ; Car les susditz Loys, Charles, Phelippes Avoient laissé des filles. Ane. Poés. franc., III, 46. — Dites moy pourquoy c'est qu'on vous représente, vous autres messieurs les advocats... sous le creon des Harpyes. Cela ne nous certifie d'autre, sinon que vous aymez fort la grippe. CH O L I È R E S , 3e Matinée, p. 113. Grippée. Action de saisir. •— Ung oyseleur ung
jour alloit Chasser oyseaulx à la pipée ; II veid ung coulom qui volloit Dont il pensoit faire grippée. C O R R O Z E T , Fables <f E S O P E , 50.
Grippe-gain. H o m m e rapace. — Que fait ce grippe-gain? Pour abbaisser les cornes à ses affranchis, il tend à ce que, pour le service qu'ils luy dévoient, ils eussent à le suivre lors qu'il irait en pratique. C H O L I È R E S , lre Ap.-disnée, p. 58.
Grippe-menaudier, v. Grippeminaudier. Grippeminaud. H o m m e rapace.—-Cy n'entrez
pas, vous, usuriers chichars... Grippeminaulx, avalleurs de frimars. R A B E L A I S , I, 54. — Il fait une prosopopée d'Ulysse descendu aux enfers, lequel demande au divin Tirese le moien de se remettre sus en ses biens. Le tout pour nous représenter les inventions et subtilitez des grippe-minaux de son temps. FR. H A B E R T , trad. d'HoRACE, Satyres, II, 5, Paraphrase. Grippeminaudier. Celui qui est rapace ; spé
cial*, suppôt de justice. — Il fut en danger d'estre tramé à jambes rebindaines de quelque diableton qui estoit de la race des grippe-menau-diers. P H . D E M A R N I X , Differ. de la Relig., II, iv, 17. — - L e bras séculier avec un bon nombre de hallebardiers et satellites, serrargents, grippemi-naudiers, loupgaroux, griffons et chats fourrez. ID., ib., Additions. Grippeminon. — Je vous renvoie à l'Enfer de
Marot et à Rabelais, sous ses Raminagrobis et grippeminons. C H O L I È R E S , 3e Matinée, p. 115.
Gripper. Saisir, s'emparer de, prendre, voler. — Tant par la guerre, usure, que rapine, Sur chascun as maintes villes grippées. J. M A R O T , Voy. de Venise, 31 r° (G., Compl.). —• Ainsi en est la povre ame grippée : Si tel' douleur luy faict rien confesser, Rhadamantus la fait prendre ou fesser. CL. M A R O T , l'Enfer. — Hz ont tant de glus Dedans leurs mains, ces faiseurs de pipée, Que toute chose où touchent est grippée. ID., Epistres, 27. — Ils grippent tout, dévorent tout. R A B E L A I S , V, 11. — Ces bestes la [les autruches] peuvent gripper des pierres, et les jettent contre ceux qui les poursuivent. CALVIN, Serm. sur le liv. de Job, 152 (XXXV, 424). — Boy donc, et prens ton plaisir, Pendant qu'en as le loisir, De peur qu'une maladie, En te grippant, ne te die, Il vous faut mourir. R. BELLEAU, Odes 'ANACREON (1, 17). — Lesquels [oiseaux] voyans ce poisson volant en Pair, ne faillent de le gripper et s'en repaistre. THEVET, Cosmogr., XXII, 10. — Au lieu que les autres ava-ricieux désirent de gripper l'argent par tous
GRIPPERIE — 384 —
moyens, ceux ci se contentent de humer les honneurs. H. ESTIENNE, Dial. du lang. franc, ital, II, 65.
(Sans complément). — Quant au Palays, tous-jours il grippe. M A R O T , Epistres, 44.
(Intrans.). S'accrocher, grimper. —• Jonathas monta en grippant des mains et des piedz. L E F E V R E D'EST., Bible, Sam., 1, 14 (G., Compl., Grimper). — Ung aultre regnard, ayant peur Du veneur, court vers une haye ; Mais lors fut trompé le trompeur, Quand pour gripper à mont s'essaye. C O R R O Z E T , Fables d'EsoPE, 73. — El' vient se coucher et estendre Soubz le pied d'un arbre en tel' sorte Que pour certain el' semble morte Aux singes, lesquelz sont au hault grippez, de paour de son assault. H A U D E N T , Apologues d'EsopE, II, 54.
(Trans.). Grimper à. — Jay gryppé plus de vingt arbres au jourdhuy. P A L S G R A V E , Esclare, p. 485. Se gripper. S'accrocher. — Plus fort que le
lierre Qui se gripe à Pentour D u chesne aiihé, cju'il serre Enlassé de maint tour. R O N S A R D , Pièces retranchées, Odes (VI, 53). — On voyt que de nature aux uns sont déniez En leur création les jambes et les piez, Pour tout ont obtenu au costé quelque serre Pour se griper aux murs. A U B I G N É , la Création, IX (III, 386). Gripperie. Rapacité. — L'Escriture Sainte nous donne de fort riches tesmoignages des menaces que Dieu fait contre vostre gripperie. C H O LIÈRES, 3e Matinée, p. 115. Gris 1. Lettres grises. Lettres gravées contenant des parties vides qui les font paraître grises (G., Compl.). — Toutes et chacunes les letres grecques, casses, matrices, moulles, letres grises. 10 avril 1556 (G., Compl.).
Gris. Maussade. — Quel visage euz tu d'elle? — Gris. — Ne te rit elle jamais? — Point. M A R O T , Dialogue de deux amoureux.
(Subst.). Sorte de gros drap gris. — Et note que n'y employeras Drap que d'un gros gris de Rouen. Ane Poés. franc., VIII, 297. — Ce jeune religieux portoit quant et luy quatre ou cinq aulnes de beau gris cordelier, lequel on avoit donné audit beau père pour luy faire ung abit. N I C O L A S D E T R O Y E S , le Grand Parangon, 3. — Il avoit une fois faict un manteau d'un gris de Rouan à un sien compère chaussetier. D E S PÉRIERS, Nouv. Récr., 46. — Ceste parolle est tresvraye, que soubz du gris ou du bureau habite bien souvent un courage de pourpre : et d'autre part que soubz soye et veloux quelquefois est caché un humble cœur. CALVIN, Instit., XIV, p. 714. — Je me veux rendre hermite et faire pénitence... U n long habit de gris le corps m e couvrira. D E S P O R T E S , Diane, II, 8. — Et son jeune babouin de maistre, Qui prend un paletot de gris Pour venir troubler mes espris. FR. P E R R I N , les Escoliers, IV, 8. — Vestu par toute parure d'une longue robe d'ung gris de très-petit pris... ceint d'une corde nouée à façon de cordellier. B R A N T Ô M E , des Dames, part. I, Jehanne II, reyne de Naples (VIII, 187). Sainct Gris. Saint François, le gris étant la cou
leur du vêtement des Franciscains. Sang sainct Gris, juron. — Sang sainct Gris, dist Xenomanes, est il fouet compétent pour mener ceste touppie? RABELAIS, IV, 9.
Ni en vert ni en gris. Nullement, d'aucune façon. —- Je ne sçaurois empescher sa crédulité, ni la malice des calomniateurs. Je sçai bien, pourtant, que vrayment je n'ay parlé ni en vert ni en gri d'elle a M. de Lux. S* F R A N Ç O I S D E SALES,
Lettres, 613 (XIV, 336).
Gris-violant. — Qu'il soit tout couvert D'un damas gris-violant ou de beau satin vert. Guy DB T O U R S , Paradis d'amour (II, 17). Le gris considéré comme la couleur de l'espé
rance. — Je souhayte avoir la jouyssance D'une pour qui le gris m e fault porter Pour demonstrer que vis en espérance. Ane Poes. franc., I, 310. — Prens à mercy ce povre chevalier De gris vestu, car tu m'as faict tel grâce De m'avoir mys hors de' mondaine tresse. Ib., III, 279. — En espérant de vous veoir seulle à seul, Tout le courroux pour lequel je m e deul Je geste hors, d'un courage récent. Le gris m e plaist, le bleu vous est décent, Telles couleurs tousjours porter je vueil, Pensant en vous. R. D E C O L L E R Y E , Rondeaux, 20.
Gris 2, v. Grif. Grisard. Gris, grisâtre. — La friande perdris,
la palombe grisarde. D u B A R T A S , lre Semaine, 5e Jour, p. 241. — Le masle est plus noir et aie col rouge, la femelle plus grisarde. MONTAIGNE, Journ. de voyage, p. 126. Grisonnant, ayant la barbe ou les cheveux gris,
— Ces pédantes, Talon, qui desja tous grisars De barbe et de cheveux, mais jeunes de science, Se vont vantant par tout d'une sotte éloquence, G R E V I N , la Gelodacrye, L. Il, p. 305. —Venantle jour, l'Aurore vergogneuse Sortoit du lit de son Titon grisard. B U T T E T , VAmalthee, 180, p. 283. — Ainsi disoit Charon à la barbe grisarde. Ane. Poés. franc., III, 318. — Et ce grizard Neptun, monarque de la mer, Ne craignit sa grandeur en cheval transformer. J. D E CHAMP-REPUS, Ulysse, III, p. 47. De cordelier. — Le fratre, ayant tousjours ce
feu couvert, qui par chacun jour augmentoit ceste grisarde chaleur, ne peust tant commander à soy mesmes qu'il ne renvoyast son petit messager accoustumé. Les Comptes du monde adventu-reux, 23 (I, 127).
H o m m e habillé de gris. — (A un ermite). Aies, grosse beste cornue, Aies, grissars, aies sous-dextre. Sotties, III, 93. — Messieurs les cordeliers et deux jeunes garses qui servoient de novices furent plus estonnées que du premier son de matines... La crainte... fist user ces grisards de leur mestier, qui est du plat de la langue. Les Comptes du monde adventureux, 13(1, 78). — Dame Agathe commença soy confesser [à un cordelier]... Ce grisard, cognoissant si bon commencement, s'efforça de la reconforter de doulces et emmiellées paroles. Ib., 28 (1,158).
Grisatier. Grisonnant? — Comme jadis les docteurs de Paris furent assemblez sur la difficulté de ceste matière, il y eut quelque vieillard des plus grisatiers d'entre eux qui en faisoit petit cas. P H . D E M A R N I X , Differ. de la Relig., Il, v, 1.
Griser, v. Grisser. Grisesse. Age où Pon a les cheveux gris. —
Tandis que de ta jeunesse Rude fuit loing la grisesse. Luc D E L A P O R T E , trad. d'HoRACE, Odes, I, 9. — La jouvence au poli menton Et la beauté fuient légères : L'aride grisesse à son tour Mous poulsant le lascif amour Et le somne aise des paulpieres. ID., ib., II, 11.
Grisle, v. Grille. Grislement. Bruit de ce qui grille. — Bruslant
ne faisoit grislement ne bruyt aulcun. RABELAIS, III, 17. Grislet. Gril. — Le grand grisletdela cuisine,
1586. Mobil, de la halle de Béthune (G., Grillet i). Grisogole. — Les pasteurs et villageois font
— 385 — GRIVELÉ
amas de petites pierres, qui tirent sur la couleur de celles que nous nommons grisogoles, verdelettes des deux costez. T H E V E T , Cosmogr., X X , 6.
Grisolite, v. Chrysolithe.
Grison (adj.). Un peu gris, tirant sur le gris, grisâtre. — Montées sur haquenees de poil grison. J. B O U C H E T , la Noble dame, 10 v° (G., Compl.). — La Saône va sur les prez et buyssons Laver les piedz des arbres esbahis, Qui vont tremblans avec leurs chefs grisons. C H . F O N T A I N E , les Ruisseaux de Fontaine, p. 75. — Le feu, sortant d'un enfumé tison, Gaigne tousjours le haut, rouant à flot grison Contre le ciel courbé. C H A S S I G N E T , le Mespris de la vie, sonn. 192. Grisonnant, gris. — Les uns seroient contre
raison pendus, Ou aigrement sur la roue esten-dus... Les uns pourris en estroicte prison, Et enterrez avec le poil grison. FR. H A B E R T , Déplorât. de Du Prat, p. 26. — Ne vous arrestez point à la vieille prison Qui enferme mon corps, ny à mon poil grison, A mon menton fleuri. R O N S A R D , Elégies, 1 (IV, 7). — Depuis que mon pelage, De noir qu'il souloit estre, est grison devenu. BAÏF, Antigone, IV, 4. —• Par ces cheveux grisons, tesmoins de mes vieus ans. R. G A R N I E R , Hippolyte, 833. — II s'habilla en vieille à la teste grisonne. A U B I G N É , le Printemps, I, 29. — Maistresse, je n'ay pas les cheveux si grisons Qu'une autre de bon cœur ne prenne vostre place. R O N S A R D , Sonnets pour Hélène, I, 22. — Les femmes qui en sont fardées... auront les dents ternies, le poil grison. GUILL. BOUCHET, 5e Seree (I, 172). — Qu'heureux est le folastre à la teste grisonne Qui brusquement eust dit... RÉGNIER, Sat. 8. — Et desploiant en Pair sa perruque grisonne. A U B I G N É , les Tragiques, I (IV, 53). Qui a la barbe ou les cheveux gris, grisonnants.
— Aujourdhuy sont icy arrivez les ambassadeurs de Venise, quatre bons vieillards tous grisons. RABELAIS, Lettres (III, 355). — Je viz venir au devant un vieillart tout grison. L O U V E A U , trad. d'ApuLÉE, II, 4. — L'ordonnance terrible Faicte au père Abraham sembloit bien impossible Et non gardable aux deux, et au fils de souffrir, Et au père grison faire son fils mourir. R I V A U D E A U , Aman, I, p. 56. — C'est que mon humeur libre à l'amour est sugette, Que j'ayme mes plaisirs, et que les passetems Des amours m'ont rendu grison avant le tans. R É G N I E R , Sat. 5. Aage grison. Age où l'on a les cheveux gris. —
N'est ce pour faire voir que de l'aage grison L'on ne peut espuiser le sens et la raison? G. D U B U Y S , l'Ame du vieillard (G., Compl.). — Seigneur, Pes-poir de mon penser, Ne m e vueille au loin de-chasser Durant la vieillesse grisonne. D E S P O R T E S , Ps. de David, 70. Grison. Triste. — Vray est que yver, foible,
froid et grison Nuyt à nature et sa vertu reprime. MAROY, Epigrammes, 23. — Le printemps, qui devoit chasser l'hyver grison, En lieu de fleurs blanchit de negeuse toison. A M . J A M Y N , ŒUV. poet., L. Il, 89 v°. ^ (Subst.). Grison. Pou. — Quant des grisons que j'ay tant démenez... J'ay proposez qu'ilz seront ordonnez Aux médecins, car je les ay donnez Aux jacopins, pour souvent leur esbatre. Ane Poes. franc., V, 153. Temps gris, triste. — Lorsque de toutes parts
le froid hyver amasse La neige par les champs et par les eaux la glace (Sans que le vent picquant de ce triste grison M e puisse emprisonné tenir à la maison). CL. G A U C H E T , le Plaisir des champs, VHyver, Divers plaisirs, p. 287. IV
Pierre de gryson. Sorte de grès. — Pantagruel en abatit un qui avoit nom Riflandouille, qui estoit armé à hault appareil, c'estoit de pierres de gryson. R A B E L A I S , II, 29.
Grisonnement. Fait de devenir gris. — Les indices de vieillesse du cheval sont la mine melan-cholique... grisonnement de poil à ceux qui de nature l'ont obscur. O. D E S E R R E S , Théâtre d'agric., IV, 10. Grisonner (trans.). Rendre gris. — L'iver qui ja s'aprochoit pour grisonner les coupeaux des montaignes. N O G U I E R , Hist. tolos., p. 395 (G., Compl.).
Grisonné. Couvert de cheveux gris. — Les bons vieillards à testes grisonnées. R O N S A R D , Fran-ciade, I (III, 19). — Et vous, o surannées... Dont les yeux sont terniz et les fronts sillonnez De rides et de plis, et les chefs grisonnez. G U Y D E T O U R S , Paradis d'amour (II, 27).
Dont les cheveux sont devenus gris. — Mes livres sont les deux, ta louange est l'estoille Qui luisante y esclaire et transpare le voile D u Tithon grisonné qui, amy du séjour Et du lit paresseux, porte envie au beau jour. B O Y S S I È R E S , Secondes Œuv., 2 v°. —• Devois-tu habandonner ton père ja grisonné d'ans et courbé de vieillesse...? N. D E M O N T R E U X , Prem. Liv. des Bergeries de Juliette, Journ. III, 161 v°. Grisonneure. Fait de devenir gris. — Le poil
de la barbe estant plus fort et plus roide que celuy des cheveux, dont il résiste mieux à la grisonneure. GUILL. B O U C H E T , 34e Seree (V, 55).
Grisonnier. H o m m e vêtu de gris. — (A des ermites). De parler a vous j'entreprens, Gros grissans, grissons, grisonniers. Sotties, III, 96.
Grissant, v. Grisonnier. Grissart, v. Grisard. Grissement, v. Gricement. Grisser. Grincer. — Mort est tombé à la ren
verse Tout aussy tost qu'il a pissé Contre la croix et a grissé Les dentz par ung terrible effort. G R I N G O R E , S* Loys, L. IV (II, 113). — 11 fist rouiller ses deux yeulx en sa teste, Griche les dentz et pallist sa couleur. Ane Poés. franc., Il, 234. —• Nostre espousé toutes foys De cela ne fut pas content ; Si se téust, grisant les dens. Ib., 111,9. — Je congnoys ung fol que veult tellement gryn-cher ses dens quil bailleroyt paour a ung homme. P A L S G R A V E , Esclare, p. 501. —• Ledit Jehan n'estoit pas content, mais regardoit de travers, fronçant le nez, rouilant les yeux, grissant les dens. N I C O L A S D E T R O Y E S , le Grand Parangon, 50. — Fors qu'il [le lion] donnast dedens, Monstrant ses gris, et en grissant les dentz. H A U D E N T , Apologues d'EsoPE, 1,111.
Grisson, v. Grisonnier. Griveau, dimin. de grive. — [L'homme rus
tique] Tend des rets à claire lice, Les dois au griveau glouton. Luc D E LA P O R T E , trad. d'HoRACE, Epodes, 2.
Grivelé. (Cf. Grivolé). De deux couleurs, de plusieurs couleurs, bigarré, bariolé. — Il est venu ung gentilastre L'autre jour jusques à mon astre... Tuer m a poule grivelée, Celle qui ponnoit les gros œufz. Ane Théâtre franc., Il, 389. — Le jeu lors et le ris, les libres chansonetes... Règne entre les garçons qui, aux filles meslez, Emplissent les hoteaux de raisins grivelez. BAÏF, le Premier des Météores (II, 9). — Adieu donques, frelon aeslé, Beau frelon, frelon grivelé. P. D E B R A C H , Poèmes, 25
GRIVOLÉ — 386 —
L. I, l'Aimée (38 v°). — En ce lieu trouva sa truye... laquelle avoit cochonné quinze grands beaux petits cochons grivelez qui la suivoient. PH. D'ALCRIPE, la Nouvelle Fabrique, p. 63. — O n compte que de l'air les troupes grivelees Et les hostes des champs, des monts et des vallées, Dessus le poinct d'honneur s'estans entragassez, Eurent devant la terre un chatouilleux procez. D u B A R T A S , 2e Semaine, 4e Jour, la Décadence, p. 517. — U n bonnet d'escarlate grivelee fourré de peaux de connin. J E A N D E L A TA I L L E , Estats de la Ligue.
Grivolé. (Cf. Grivelé). De diverses couleurs, bigarré, bariolé. —• Le tiers estaige estoit de marbre rouge grivollé. Amadis, IV, 2. — U n tas de villaines, immondes et pestilentes bestes, noires, guarres, fauves, blanches, cendrées, grivolées. R A BELAIS, 111,21. — Quelque poincture de dracon-neaulx grivolez, que les Arabes appellent meden. ID., III, 22. — Papillon tousjours voletant, Grivolé de cent mille sortes En cent mille habits que tu portes. R. B E L L E A U , Petites Inventions, le Papillon (I, 50). — Variété. Diverse... entremeslee, passementeuse, grivolee. M. D E L A P O R T E , Epithetes, 413 v°. — Pour vous paistre de fleurs, papillons grivolez, Jeu des petits enfans, ça et la vous volez. J. P A S S E R A T , Vers d'amour (1, 26). — Là, nous verrons à tire d'aillé Voler la jazarde arondelle Après les petits papillons, Et après la turtre craintive Se lancer d'une aisle hastive Les grivolez esmerillons. G U Y D E T O U R S , Mignardises amoureuses (II, 35). Grivolement. Bariolage. — L'Aurore D'un
clair grivolement l'huis d'un beau jour décore. D u B A R T A S , 2e Semaine, Sec. Jour, Babylone, p. 191.
Grivollé, v. Grivolé. Griz, Grizard, v. Grif, Grisard. Grizelle, terme de marine. Enfléchure. — Le
pilot... feist caller les boulingues... et de toutes lesantemnesneresterquelesgrizellesetcoustieres. R A B E L A I S , IV, 18.
Grobe. Saleté attachée au fond des ustensiles de cuisine (G.). — Ceste herbe fait aisément tomber les grobes des pots, pour dures et invétérées qu'elles soient, la mettant bouillir dedans, encores que, pour laver qu'on face lesdits pots, ladite crotte ne s'en aille point. D u PI N E T , trad. de PLINE, X X , 9 (G.).
Grobianisme. Grossièreté, incivilité. — Il ne vous faudra pas estonner, quand vous serez à la cour, si vous voyez que plusieurs chouses qui estoyent trouvées fort inciviles le temps passé, et qui aussi vrayement sentent leur grobianisme, y sont maintenant les fort bien venues. H. E S TIENNE, Dial. du lang. franc, ital, I, 257. Grobiner. Voler. — D'un barbier a qui la
main tremble Et d'un cousturier qui va l'amble Quant il a du drap grobiné, Gardez vous d'y estre trompé. Sotties, III, 318.
Grobis i. Gros chat, chat qui fait le gros dos. (Fig.). H o m m e important, h o m m e qui fait l'important.— Tenir je m e veulx des gros bis... Devenir m e fault hypocrite. Ane Poés. franc., XI, 297. — Qui faict cela? les taxeurs, ou la crainte De ces gros biz, dont j'oy faire grant plaincte, Car en ce cas le plus riche et plus fort Est supporté par le pauvre, a grant tort. J. B O U C H E T , Epistres morales du Traverseur, II, 7.
Faire du grobis, trancher du grobis. Faire l'important. — Se Chascun n'avoit qu'une es-
plingue, Si veult il faire du grosbis ; Chascun se pare, Chascun fringue. Ane Poés. franc., X, 156, — Tel faict maintenant du grobis Qui tantost sera bien camus. Act. des Apost., I, 14 b (G.). — Je veiz maistre Jean le Maire qui contrefaisoit du pape, et à tous ces pauvres roys et papes de ce monde faisoit baiser ses piedz, et en faisant du grobis leur donnoit sa bénédiction. RABELAIS, II, 30. — A u cueur gist tout, et non pas aux habitz, Si pour drap d'or ou trancher du gros bis Les ennemys mors par terre on ruoit, Trop bien cela porter on en devrait, Mais tout le bien qui en vient sont debitz. J. M A R O T , Voy. de Venise, 49 r° (G.). — Le bon Gallus prent ses meilleurs habitz, Sert d'escuyer, et tranche du gros bis. CRÉTIN, A Fr. Charbonnier, p. 234. — De femmes tranchant du gros bis, Qui despendent tant en abis Que le mary est mal diné, Libéra nos, Domine. Sotties, III, 297. — Regardez... ces autheurs de Germanie : comme, quand ils veulent hausser leur nation jusques à la lune, ils trenchent du gros bis. DES A U T E L S , Mitistoire barragouyne, Proeme.
Grobis 2. Domino de grobis. — Avecques ton froc et ton domino de grobis retourne à Rami-nagrobis. R A B E L A I S , III, 23. — Nous avons envie de passer aux autres ordres demonians, pour te deciffrer aussy leur Domini de grobis. PH. DE M A R N I X , Differ. de la Relig., 1, iv, 4. — Les autres... ont changé de frocq et de domino de grobis. ID., ib., II, i, 3. — Si quelque part tu trouve un vieil haillon de quelque drap de couleur enfumée ou de fueille morte, et que tu t'en accommodes un frocq, un domino de grobis, ou une chausse d'hypocras. ID., ib., Il, i, 3.
Grocer. Grogner. — Et qu'esse cy? En grousse-tu? Ane Théâtre franc., III, 323. — Il m'a faict tant de ruderies En l'assiete de ses tailles Que toutes les m'a faict payer, Et si n'en eusse osé grousser. Ib., III, 380. — Alors ung personnier De ceste bende entreprint le négoce, En se vantant par son Dieu que qui groce Bien le tiendra. B O U R D I G N É , Pierre Faifeu, ch. 37. — Qui dict? qui grosse? qui en veult?... Vienne cy monstrer sa vaillance, Qui veult jouster trois coups de lance. Ane Poés. franc., XIII, 34.
Groenet. — Ung groenet de fer a tirer char, Invent, de 1511 (G., Groignet2).
Groesse, v. Groisse. Grognerie. Action de grogner. — Combien
que de droict le grouin et la grognerie en appartienne aux esleus privativement à tous autres. Var. hist. et litt., I, 216. Grohan. — Et dit on pour voir que César,
estant au pais d'Anjou, fit édifier et construire un chasteau et théâtre pour sa demeure hors la ville d'Angiers et près l'un des portaux d'icelle, lequel est a présent en ruine, et n'y paroist plus que les fondemens, et est en langage angevin appelle grohan. Chron. d'Anjou, p. 15 (G.).
Grohant, mot d'argot. — Grohant, pourceau, Var. hist. et litt., VIII, 187. Groigne. Grognement, murmure, mauvaise
humeur. —• Honte, qu'est de Paour engendrée... Oncque ne fit bonne cendrée, Mais tousjours est pleine de groigne. Ane Poés. franc., III, 209. — Par mon serment, bien j'aperçoy Que de vous n'en ystra que grongnes. Ib., IV, 12. — Pour endurer un peu de grongnes, Ung peu de courroux, de vergongnes, Autant en emporte le vent. R. DE C O L L E R Y E , Dialogue des abusez. — Les serviteurs qu'on bat... Tousjours feront a regret et en
— 387 — GRONDER
jrongne En murmurant leur ouvrage et besongne. J. B O U C H E T , Epistres morales du Traverseur, I, 12.
Groignipotent, mot forgé. — Il faut par nécessité qu'icy en terre l'Eglise militante ait un chef universel et visible, un juge souverain et monarque groignipotent. P H . D E M A R N I X , Differ. de la Relig., I, 2. Préface. Groignon 1. Museau, visage. — M'amye, levez
legroignon. M A R O T , Rondeaux, 79.
Groignon 2. Variété de pêche. — A autre usage ne sont non plus propres les presses, pavies, mirecotons, alampers, groignons... et semblables fruits à noiau. O. D E S E R R E S , Théâtre d'agric, VI, 26. Groin. Grognement, mauvaise humeur, dépit,
colère. — Mais cestuy chien d'un grand despit et groing Contre le bœuf de sèslever eust soing. H A U D E N T , Apologues d'EsoPE, I, 165. — Représentez vous icy les troignes et putes cares d'une femme lors qu'elle est en tel affaire. Maistre Nicolas n'avoit que du groin, qu'il portoit mal en gré. CHOLIÈRES, 4e Matinée, p. 162. — Maistre Nicolas... ne pensoit plus au groin de sa femme. ID., ib., p. 163. —• Les autres se portent pour ennemies de leurs espoux, lesquels elles servent de groin, de chagrin et de reproches. ID., 7e Matinée, p. 270. — J'ay remarqué bien soigneusement vostre compte de l'AIemand qui, pour drelotter, flatter et mignarder sa femme, n'estoit repris que de mines et de groins. ID., 3e Ap.-disnée, p. 128. — Combien que de droict le grouin et la grognerie en appartienne aux esleus privativement à tous autres. Var. hist. et litt., I, 216. Dommage. — Bien munytz sont de choses né
cessaires, Pour corriger tous ennemys faulsaires Qui nous vouldroyent porter quelque groing. Ane Poés. franc., 1,185. Débat, querelle. — La jalousie luy est conco
mitante... dont sourdent plusieurs rixes, que-reles, groins et dissipations. C H O L I È R E S , 6e Matinée, p. 237. En groin. En querelle. — Xanthippe estoit
tousjours en groin avec luy. ID., 5e Matinée, p. 211. Faire les groins, faire bon groin. Grogner, que
reller. — L'autre menasse et faict les groings. R. D E C O L L E R Y E , Monologue d'une dame. — Ilz sont toutes frappées d'un coing, Et si font toutes bon groing, Bonne teste, bon œil, bon bec, Et jouent voluntiers du rebec. Ane Poés. franc., 111, 266. Groingnenr (H. D. T. 1680). — Ceulx qui ne sont de feu, terre, ny d'eau, N y d'air aussi, mais de la quinte essence, Particuliers, groingneurs comme un porceau, Vouldront sus tous cracher de la prudence. Ane Poés. franc., VI, 30. Groiselle, Groselier, v. Groseille, Groseiller. Groisilier, v. Groseiller. Groisse. Grossesse. — Si au troisiesme moys
elles engraissent, leur fruict sera héritier du def-funct. Et la groisse congneue, poussent hardiment oultre, et vogue la gualee, puis que la panse est pleine. R A B E L A I S , 1 , 3 . — Quand la nonnain sœur Fessue feut par le jeune briffault d a m Royd-dimet engraissée, et, la groisse congneue, appellée parl'abbesse en chapitre. ID., III, 19. — Puis que ton heureuse portée Passe de la groesse usitée Le terme des neuf moys courans. B A Ï F , Poèmes, u V H l (II, 383). — Quant au préservatif qu'ils teignent que Iris prit en sa groisse, on l'inter-Prete, voix véritable. A M Y O T , De Isis et d'Osiris,
68. — Cet appétit desreglé et goust malade qu'elles ont au temps de leurs graisses, elles Pont en l'ame en tout temps. M O N T A I G N E , II, 8 (II, 95). —• Bientost après son mariage, elle fut enceinte... et fit ce qu'elle peut pour cacher sa groisse. B R A N T Ô M E , Rodomontades espaignolles (VII, 164). — De plusieurs grandes et moyennes dames en ay-je cogneu et ouy parler, qui ont sou-haitté plusieurs fois les cinquante ans chargez sur elles, pour les empescher de la groisse. ID., des Dames, part. II (IX, 338). — Mes compaignes... très-bien ont sceu remédier à leurs graisses et à leurs couches. ID., ib. (IX, 552).
Groizelle, v. Groseille. Grole. Corneille, corbeau. — Abattage des nids de grolles. Pièce de 1523 (G.). — Outardes. grues, oyes saulvaiges, chocas, tourtres, corbins, grolles aillées. J E A N - A L F O N S E S A I N T O N G E A Ï S , Cosmographie (Sainéan, Rev. des Et. rab., X, 45). —• Je voyois d'autre part cueillir les noix aux groles, qui se resjouyssoient en prenant leur repas et disner sur lesdits noyers. PAL I S S Y , Recepte véritable, p. 87. — Une grole, n'ayant aussi rien à disner, pensant que ledit renard fust mort, se va poser sur son ventre. ID., ib„ p. 88.
L'un des jeux de Gargantua. R A B E L A I S , I, 22. Centre de la cible. — Il avoit veu... le pasadouz
de Carquelin droict entrant dedans la grolle on mylieu du blanc. R A B E L A I S , IV, 52.
Grolle, v. Grole. Grollé. Grillé. — 11 les faut eschauffer avec
miel, froment, avoine et febves grollees. LIE-B A U L T , Mais, rust., p. 105 (G.). Grollier. Noix grolliere. Grosse noix à coquille très dure. —• Carpalim d'une coquille de noix grosliere faisoit un beau, petit, joyeulx et harmonieux moulinet. R A B E L A I S , IV, 63.
Noyer grollier. Noyer produisant les noix grol-lieres. — [Gargantua] feist aporter son curedentz, et sortant vers le noyer grollier vous denigea messieurs les pèlerins. R A B E L A I S , I, 38. —• 11 n'y a que la belle cinamome triée, et le beau sucre fin, avecques le bon vin blanc du cru de la Deviniere, en la plante du grand cormier, au dessus du noyer groslier. ID., 111, 32. Gromette. Gourmette. — ix paires de bottes et une gromette et deux paires de hocqtz a mulles. 1530. Valenciennes (G., Compl., Gourmette).
Grommelé. Qui est en grumeaux. — Le bain en chaleur tempérée a ceste utilité qu'il lasche et raréfie le cuir, fond et dissoult le sang grommelé. AMBR. PARÉ, X, 2.
Grommeler, Grommeleur, Grommellement, V. Grumeler, Grumeleur, Grumellement. Grommer, Grommet, Grommetter, v. Gourmer 2, Gourmet 2, Gourmeter.
Grondard. Grognon. — Pyonniers et soul-dars, Grans, rustres et grondars, Chascun s'en va sa voye. Ane Poés. franc., VIII, 78.
Grondeler. Bruire, murmurer, gronder. —• Comment ceste eaue grand elle en courrant sur ces pierres. P A L S G R A V E , Esclare, p.618.
Grondellement. Bruit, murmure, grondement. — Je os bien par le grondellement, or gron-dissement, or groulement de leaue quelle na pas son cours de playne allée, or tout hony. P A L S G R A V E , Esclare, p. 694. Gronder (subst.). — Aussi n'est il subject...
A u babil d'une femme, au long prosne d'un
GRONDEUR — 388 —
prestre, Au gronder d'un vallet, aux injures d'un maistre. D u B E L L A Y , Jeux rustiques, Hymne de la Surdité. —• Vous gaillard et dispos Avecque le baston... cesser alheure fistes Le gronder de ces chiens. BAÏF, Poèmes, L. V (II, 230). — Mais un murmure bas, C o m m e celuy qu'on sent partir de la marine Quand on est loin du bord : ou le gronder qui fine Le tonnerre bruyant. BAÏF, Passe-tems, L. III (IV, 351). Grondeur (H. D. T. 1611). — Mais j'entens un
grondeur Calvin. J. L A M B E R T , Discours evange-liques, II, 119 a (Vaganay, Pour l'hist. du franc. moderne). Grondeux. Qui gronde, grognon. — Que Poly-
nice serve aux bestes de pasture, Sur la terre gisant privé de sépulture? Qu'on ne le pleure point? que le grondeux Charon Le face erser cent ans sans passer PAcheron? R. G A R N I E R , Antigone, 1538. Grondin, mot d'argot. — U n grondin, c'est un
porc. GUI L L . B O U C H E T , 15e Seree (III, 129).
Grongne, v. Groigne.
Grongnet. Museau, visage. — Et puis en lieu qu'il ne sont de velours, C'est leur façon d'en porter les poignetz Et gourgias comme celles de Tours, Pour donner lustre à leurs sades gron-gnetz. Ane Poés. franc., XII, 10. — Mais neantmoins qu'il fut lors les jours gras, Parlé ne fut d'aucun menu fatras, Quoy qu'il y eust plusieurs sades grongnetz. Ib., VI, 131. Grongneusement. En grognant. — U n porc
enflé grongneusement ronflant Veut provoquer la Minerve à son chant. V A U Q U E L I N D E L A F R E S N A Y E , les Foresteries, I, 6. Grongneux. Grognon, grondeur. — Qui
grongne, qui?... Dehors, grongneux. Farce trouvée à Fribourg (P. Aebischer, Rev. du XVIe siècle, XI, 190). — Grongneux, despit, présomptueux, Ian-gara, Je fay l'amour au bon vin et au boire. E. P A S Q U I E R , les Jeux poétiques, 5e part,, 15 (II, 893). —• Ce sera une criarde, une grongneuse, une rechignée. CHOLIÈRES, 2e Ap.-disnée, p. 94. — Ardez, dit-elle, mon mari est un grongneux, il est chiche et ne fait que penser à son avarice. B E R O A L D E D E V E R V I L L E , le Moyen de parvenir, Respect (II, 42). Gronnissement. Grognement. — Ce poisson...
retire aucunement aux porcs terrestres : car il a semblable gronnissement. T H E V E T , Singul de la Fr. ant., ch. 20 (G.). Murmure, roucoulement. — Les colombes ne
font pas leur gronnissement seulement es occasions de tristesse, ains encor en celles de l'amour et de la joye. S* F R A N Ç O I S D E SAL E S , Amour de Dieu, VI, 2, var.
Gros. Grand. — Il estimoït bien qu'il en ferait ung h o m m e dont il aurait une fois gros honneur. L E L O Y A L SERVITEUR, Hist. de Bayart, ch. 5. — Le roy d'Arragon porta gros honneur au cappi-taine Loys d'Ars et au bon chevalier. ID., ib., ch. 27. — Ainsi furent gaignées les barrières de devant Padoue en plain midy, où les François acquirent gros honneur. ID., ib., ch. 33. — Ce fut une grosse pitié. ID., ib., ch. 16. — Ou mois de décembre alla le roy de France visiter le pape en la cité de Boulongne, qui luy fist gros recueil. ID., ib., ch. 60. — Si par lecture d'elle ou d'autruy n'est instruicte, n'aura gros esgard a son vice. P. D E C H A N G Y , Instit. de la femme chrest., I, 4. — Que diray-je de cet autre grand monarque, qui desiroit plus le renaistre d'Homère que le gaing
d'une grosse battaille? D u B E L L A Y , Deffence, II 5. — Apres avoir esté plus de deux grosses heures tenu pour trespassé, je commençay à me mouvoir M O N T A I G N E , II, 6 (II, 57). — Dés toute ancienneté les rives des remarquables fleuves et orées des grandes forests, ont esté choisies pour la construction des grosses villes. O. D E SERRES, Théâtre d'agric, Vil, Avant-propos.
(En parlant d'une personne, d'une famille). Grand, important, considérable. — Ne doubtez pas qu'il ne m'ayt recité C o m m e il estoit traicté et visité Des gros seigneurs et d'aultre populaire. B O U R D I G N É , Pierre Faifeu, Epistre. — Ung cent d'autres gros seigneurs et cappitaines. L E LOYAL S E R V I T E U R , Hist. de Bayart, ch. 55. — En ceste propre saison estoit un procès pendant en la court entre deux gros seigneurs. RABELAIS, II, 10. —• Ceulx qui avoient esté gros seigneurs en ce monde icy guaingnoyent leur pauvre meschante et paillarde vie là bas. ID., II, 30. — Estant encores la court troublée de la mort de tant de princes et gros seigneurs. Amadis, V, 54. — Il dict bien aussi n'estre mon estât suyvre les cours des gros seigneurs. R A B E L A I S , V, 7. — Quand vous devriez crever et vous enfler gros comme un bœuf, comme feit la mère grenouille, vous ne serez jamais si gros seigneur que luy. Sat. Men., Harangue du recteur Roze, p. 155. — Lequel ayant veu la caisse, la print, et l'ayant ouverte, trouva dedans ces trois petits enfans qui rioient ; et pour autant qu'ils estoient si beaux, il pensa incontinent qu'ils estoient fils de quelque grosse dame. L O U V E A U , trad. des Facétieuses Nuits de STRAPA-ROLE, IV, 3. — Vous estes riche, et je suis pauvre ; vous estes grand seigneur, et je suis de travail ; vous voudriez des grosses dames, et je suis de basse condition. ID., ib., V, 4. — De gros cappitaines en plein camp de bataille. RABELAIS, II, 12, — Marchoit aussi ce grand capitaine don Pedro de Navarre, et plusieurs autres gros prisonniers, B R A N T Ô M E , Cap. franc,, M. de Nemours, Gaston de Foix (111, 17). — Il apperceut bien parles riches accoustremens de la dame qu'il avoit trouvée qu'elle devoit estre quelque gentil-femme de grosse maison. L E M A Ç O N , trad. de B O C C A C E , Decameron, II, 7. — Il y a... diversité grande entre les historiens touchant le temps auquel régna le roy N u m a Pompilius, encore que quelques uns vueillent dériver de luy la noblesse de plusieurs grosses maisons. A M Y O T , Numa, 1.
Gros air. Air épais, lourd. — Et tout feust bon qui est maulvais... Et groshairs, et toutes nuées Nantissent comme les fumées Dancent fondu, ou aultre gomme. M I C H E L D'AMBOISE, Comphinctes de l'Esclave fortuné, 18 v°. — Air. Subtil... net, gros, sombre. M. D E L A P O R T E , Epithetes, 13 v0.— Vien doncques, mon Ronsard, à fin que parles champs, Par les bois, par "les eaux, nous allions retrenchantz Les soucis, les ennuis et l'humeur inutile Que cause en nos cerveaux le gros aer delà ville. CL. G A U C H E T , le Plaisir des champs, le Printemps, Beaujour, p. 8. Gros sang. Sang épais. — Ceux qui sont lépreux
de ce gros sang et de ceste humeur froide demeurent long temps en leur ladrerie. GUILL. BOUCHET, 36e Seree (V, 125).
Gros estât. Grossesse. — Ce porteur vous dira le gros estât ou il m'a laissée,-qui est tel que le roy et Madame ont bien veu qu'il ne pouvoit mener loing, car je m e doubte d'estre au septiesme mois. Mars 1530. Lett. de M A R G . D'AN G., 77 (G., Compl.).
Grosse haleine. Essoufflement. Estre à la grosse haleine. Être essoufflé. — Tout ainsi qu'un grand cerf ramé, après longues courses et grans penu
eschappez, estant à la grosse haleine... se couche sur lherbe verde. L E M A I R E D E B E L G E S , la Couronne Margaritique (IV, 28). — Lors bataillent ensemble... et à la fin la pouvre femme n'en peut plus et entre en grosse hallaine. N I C O L A S D E TROYES, le Grand Parangon, 52. — Les Barbares... fondoyent en sueur au soleil, et estoyent incontinent à la grosse halene. A M Y O T , Marius, 26. — Quant à sa voix, qui estoit petite et foible, il la renforcea à courir contremont des coustaux qui estoyent droits et roides, en prononceant quand et quand à la grosse haleine quelques ha-rengues ou quelques vers qu'il sçavoit par cueur. ID., Démosthène, 11. — Dussé-je estre à la grosse haleine, Je m'en fuirai bien vistement. J. G O DARD, les Desguisez, III, 4. —> Mon maistre maintenant, peut-estre, A bien de la peine et du mal A froter quelque grand cheval, En soufflant à la grosse haleine. ID., ib. Gros cœur. Cœur orgueilleux ; orgueil. — Telles
gens qui ne prenent point plus gros cueur pour prospérité qui leur advienne ne faillent gueres souvent. SEYSSEL, trad. de T H U C Y D I D E , IV, 2 (118 v°). — Car il n'est cueur, tant soit gros, qui ne tremble, Si voz vouloirs on sent uniz ensemble. MAROT, Chants divers, 14. —• Elle estoit de gros cœur et dur, et ne faisoit guères voulentiers cela que son mary luy commendoit. N I C O L A S D E TROYES, le Grand Parangon, 52. — Qui par mes-dire à part son prochain grève, Qui a cueur gros et les sourcilz esleve, L'un mettray bas, l'autre souffrir pour vray Je ne pourray. M A R O T , PS. de David, 37. — Ce quilz mettoient en avant a intention que Marcius... abaissast son gros cueur et se monstrast humilié. G. D E S E L V E , Huict Vies de PLUTARQUE, Coriolan, 85 r°. — Souvent m'as vu souspirer et me plaindre... Mais tant estoit ton gros cœur endurci Que tu n'avois de m a douleur merci. CH. F O N T A I N E , les XXI Epistres d'OviDE, Ep. 15, p. 280. —• Donte moy ce gros cœur, lequel te fait hausser Le front escervelé si superbe et si rogue, Comme si tu estois des vertus pédagogue. RONSARD, Response à quelque ministre (V, 418). — Les Grecs ont esté en cest endroit mieux conseillez que nous et que les Latins, de ne se vouloir dire valets des femmes... de peur d'enfler le cœur à celles qui l'auroyent desja assez gros de nature. H. ESTIENNE, Conformité, I, 2, p. 92. — Toutefois son gros cœur a bien l'outrecuidance De se vanter égal à moy, qui donne à tous Une palle terreur quand je suis en courroux. A M . J A M Y N , Iliade, XV, 55 r°. —• Il avoit le cœur trop gros de nature, et accoustumé à trop haute fortune... pour... se démettre à la bassesse de deffendre son innocence. MONTAIGNE, II, 5 (II, 50). — J'ay ainsi l'ame poltrone que je ne mesure pas la bonne fortune selon sa hauteur, je la mesure selon sa facilité. Mais si je n'ay point le cœur gros assez, je Pay à l'equipollent ouvert, et qui m'ordonne de publier hardiment sa foiblesse. ID., III, 7 (IV, 3). — V o u s avez le cœur trop gros, et vostre courage vous perd : vous avez des pensées vastes qui ne se peuvent arrester où elles doivent et s'humilier devant sa majesté. D u VAI R , Médit, sur Job, ch. 15. Cœur grossier, vil. — Craindre en tout heurt
est indice de gras et lasche cœur. R A B E L A I S , IV, 22. Gros courage. Orgueil. — A bien parler d'ung
villennier, S'il trouve aucun en son dangier, 11 luy fait orgueilleux visaige, En luy monstrant son gros couraige. Ane Poés. franc., VII, 72. Gros estomac. Orgueil. Voir Estomac. Tenir gros termes. Se montrer orgueilleux. —
GROS
Marcius, qui estoit desja rempli de fastuosité et qui tenoit gros termes, estant révéré et tenu en admiration par les principaulx, se monstre ouvertement contraire et répugnant aux tribuns. G. D E SE L V E S , Huict Vies de P L U T A R Q U E , Coriolan, 83 r°. —• Mamercus tenoit gros termes, et se pri-soit beaucop de ce quil scavoit composer quelques poèmes et tragédies. ID., ib., Timoleon, 104 r°.
Gros. Simple, grossier. — Lesdictes [lettres] latines estoient en ce temps la encore en leur gros et rude stile. G. T O R Y , Champ fleury, L. I, 6 v°. — Les façons de faire et conditions des grosses gens et ruraux luy plaisoient plus que celles de la ville. L E M A Ç O N , trad. de B O C C A C E , Decameron,\, 1. — Comment leur enseignes tu à ton gré d'estre curieux de ton bien? —• Je les enseigne, ô Socrates, d'une façon certes fort grosse et planiere. L A BO E T I E , trad. de la Mesnagerie de X E N O P H O N , ch. 20. — Il faut aller a la bonne foy en la dévotion, et, comme Pon dit, a la grosse mode. S* F R A N Ç O I S D E SALE S , Lettres, 912 (XVI, 68).
Simple, grossier, lourd (en parlant de l'esprit, du langage). — Mon rude concevoir sest esclarcy, mon gros entendement sest ouvert. L E M A I R E D E B E L G E S , Illustr., I, 25. —• Je ne te sen point de si gros entendement que tu n'eusses cogneu en icelle des choses qui te f eroient parler plus correctement sur ceste matière. L E M A Ç O N , trad. de B O C C A C E , Decameron, II, 9. — Calandrin (qui avoit gros entendement) avoit desja oublié son nom. ID., ib., VIII, 3. —• Je voy bien que l'yvraye estouffe le bon blé, Et si n'ay pas l'esprit si gros ne si troublé Que je ne sente bien que l'Eglise première Par le temps a perdu beaucoup de sa lumière. R O N S A R D , Response à quelque ministre (V, 410). — S'il venoit d'aventure quelque grosse teste, qui voulut ignorer les preuves mises en mon cabinet, je ne demanderais autre jugement que le vostre. PALISSY, Discours admirables, A Anthoine de Ponts. —• Ennius, qui disoit en son gros langage avant que sa langue latine fust purifiée... G. T O R Y , Champ fleury, L. I, 4 v°. —• Nous disons... il parle du latin de cuisine... Les autres disent gros latin, et au contraire du latin sublin, celuy qui est le plus fin. H. E S T I E N N E , Conformité, I, 1, p. 59.
Gros chrestien. Chrétien tiède, peu zélé. — Ilz n'ont pas Dieu de leur costé... mais c'est de quoy ces gros chrestiens et masses terrestres se soucient le moins. L'HOSPITAL, Reformation de la Justice, 3e part. (IV, 163). — Je serais un mauvais François, voire un très-gros chrestien, si je ne trouvois vostre foy et créance bonne. E. PAS Q U I E R , Lettres, X X I , 4.
Grosse conscience. Conscience large, peu scrupuleuse. — J'ay des paroissiens de grosse conscience, et ne vont à l'oferande non plus que chiens. NICOLAS D E T R O Y E S , le Grand Parangon, 9. —C'est un abbrègement qui tourne à trop grand avantage au vendeur et désavantage à l'acheteur : je di quand un marchand de grosse conscience rencontre un acheteur qui n'a point encores esté des-jeuné de ce nouveau stile. H. E S T I E N N E , Apol pour Her., ch. 16 (I, 321).
Grosses paroles. Paroles violentes, injures. — Pour raison desquelles choses... usèrent de grosses parolles ausdictz ambassadeurs et les renvoyèrent sans aultre conclusion. SEYSSEL, trad. de T H U C Y D I D E , V, 6 (166 r°). —• César... sen alla luy mesmes devers Lepidus, et luy reprocha son ingratitude, dont ilz vindrent à grosses parolles. ID., trad. D'APPIEN, Guerres civiles, V, 13. — D o m p Alonce se plaignoit oultrageusement du mauvais traicte-ment qu'il disoit luy avoir esté fait, et en gectoit grosses parolles peu honnestes. L E L O Y A L SERVI-
39 —
GROS — 390 —
TEUR, Hist. de Bayart, ch. 21. — II usa de grosses parolles alencontre de Theramenes, le menassant de le faire mourir. A M Y O T , trad. de DIODORE, XIV, 1. — Bessus... feit un grand festin à ses amys, auquel il entra en grosses parolles contre l'un de ses plus privez amys. ID., ib., XVII, 18. — Junius ne vouloit point qu'il [Galba] sortist : mais Celsus et Lacon l'admonestoyent fort de ce faire, jusques à dire de grosses paroles à Junius qui l'en divertissoit. ID., Galba, 26. — Luy, après avoir enduré d'elle plusieurs reproches et grosses paroles... inventa telle finesse. H. E S T I E N N E , Apol. pour Her., ch. 15 (I, 241). — Il vint trouver le roy, et luy demanda, usant de grosses paroles, pour-Suoy il luy avoit refusé sa maison. ID., ib., ch. 34 I, 201). — Quand il [Homère] veut décrire les
grosses paroles que dit Agamemnon au prebstre d'Apollon. A M Y O T , Comment il faut lire les poètes, 4.
Tenir grosse troigne. Agir avec violence. — L'Ouest, bruyant aux gouffres abismaulx, Faisant aux nefz inestimables maulx, Vint campeger devers la Picardie, La Flandre aussi et toute Normandie, Et en rigueur il tint si grosse troigne Qu'il passa oultre au dedans la Bourgoigne. Ane Poés. franc., X, 33.
Gros (subst.). Les gros. Les hommes puissants, importants, les grands. — Le peuple menu de Samie se mit en armes contre les gros. SEYSSEL, trad. de T H U C Y D I D E , VIII, 4 (252 v°). — Les gros de la ville luy furent à ce contraires, craignant qu'il n'en sortist autre effect que une sédition civile. A M Y O T , Tiberius Gracchus, 8.
Les plus gros. Les plus importants, les principaux. — Nicogenes, qui estoit le plus riche h o m m e de toute la Eolie, et qui avoit congnoissance et amytié avecques les plus gros de Lasie. G. D E SE L V E , Huict Vies de P L U T A R Q U E , Thémistocle, 10.v°. — [Lycurgue] pour venir au dessus de la commune, se fortifia des plus gros de la ville. A M Y O T , Compar. de Lycurgue et de Numa, 4. — Les plus gros de la ville... hasterent son parlement le plus qu'ilz peurent. ID., Alcibiade, 35. — Martius... estoit estimé et honoré de tous les plus gros de la ville. ID., Coriolan, 13. — Les plus gros et plus gens de bien de la ville, voyans le tort qu'on luy faisoit, prirent sa cause en main. ID., Aristide, 4. — Les plus gros de la ville panchoient merveilleusement au traicté. A U B I G N É , Hist univ., VI, 10. Faire du gros. Faire l'important. — Ces
exemples dévoient bien faire cesser le caquet à ceux qui font tant des gros à cause de leurs pierreries et bagues. GUILL. B O U C H E T , 33e Seree (V, 10).
Au gros du chesne, v. Chesne. Au gros du jour. A u milieu du jour. — Le bon
Abraham estant en la vallée de Mambré, a l'entrée de sa tente ou pavillon, au gros du jour, vit troys personnes qui estoyent anges. S» F R A N Ç O I S D E SALES, Sermons autographes, 20 (VII, 183).
Au gros du corps. A u sens littéral. — Ce qui les a trompez... c'est le mot de transmutation, qui est en S. Thomas, qu'ils veulent prendre au gros du corps et en sa propre signification. L E L O Y E R , Hist. des Spectres, II, 7. — Lavatier prend aussi au gros du corps ce qu'es Actes des Apostres sainct Estienne aurait prononcé lors de son martyre. ID., ib., VI, 2. De gros en gros. En se bornant à l'essentiel, au
plus important. — L'histoire m e semble trop belle... pour ne pas, au moins de gros en gros, selon le tems, l'expliquer. S* F R A N Ç O I S D E SALES, Sermons autogr., 3 (Vil, 61). — Et n'est pas requis de faire si exactement l'examen, mais seule
ment de gros en gros. ID., Lettres, 361 (XIII, 216), — Dites seulement de gros en gros les principales fautes que vous aurés commises. ID., ib., 393 (XIII, 278). — Le soir... vous pourras... faire la reveue de ce que vous aurés fait parmi la journée, de gros en gros. ID., ib., 808 (XV, 269). — Toutes ces choses concluent le traitté, lequel nous lair-rons avancer pour disposer de gros en gros nostre lecteur à la cognoissance de ce qui se passe en toutes les parties du monde. A U B I G N É , Hist. univ., 1,13.
Gros. Corps de troupe. — M. de Salvoyson... assemble les garnisons de Valance, Verne et; Cazal, et faict un gros, et vint trouver l'ennemy. B R A N T Ô M E , Cap. franc., M. de Salvoyson (IV, 99), — Le duc de Montmorenci, descouplant à propos sur ce foible scadron, le remena battant ce qui estoit devant lui, sans mesler pour lors ; ce qui fit avancer l'admirai qui congna tout jusques dans le gros du duc. Ceste charge eut si bonne mine que... tout ce gros si bien doré print la fuite. A U B I G N É , Hist. univ., IV, 9. — 11 fit rafraischir les siens par gens de cheval et de pied et retirer les Turcs à leur gros. ID., ib., IV, 19. — L'aisné des deux comtes, trente pas devant son gros, et l'admirai autant devant le sien, se rencontrent, ID., ib., V, 17. —Chaseron... n'eust jamais pu faire son gros sans mille cinq cents hommes de pied, qui lui vindrent des bords des Sévènes. 1D„ ib., XIV, 14. — Le mareschal... ne se vid plutost soixante chevaux ensemble qu'il fit une charge dans.le dernier gros. ID., ib., XIV, 18.
Gros. Sorte de monnaie. — Quand ce caphard et fallacieux h o m m e Veist qu'il n'avoit peu venir à son esme Touchant l'escu, au personnage mesme 11 a requis qu'à cestuy jour de l'an II estrenast d'aulcun gros de millan. H A U D E N T , Apologues dt'EsoPE, II, 103. — Aujourdhuy les changeurs ne usent point de ce terme dragmes, mais disent un gros, pour icelle, qui sont deux estellinset demy. C H . F O N T A I N E , Nouvelles et antiques merveilles, I I . — La royne d'Angleterre... mist un impost de deux escus sol, trois gros et un denier sur chacune pièce de drap. J. B O D I N , Republique, VI, 2.
Gros (adv.). Fort. — Quant il fut en la chambre enclos, Grant et jambu comme il estoit, Il se print à crier si gros Que à grant peine on l'entendoit. Ane Poés. franc., X, 167. Parler gros. Parler haut. — Je parle bien gros,
qu'on m'entende, Se mes oraisons en sont bresves. Ane Poés. franc., XII, 80.
Parler avec hauteur, avec arrogance. — E t se font redouter en parlant gros, comme s'ils estoyent montez au ciel pour mespriser tout le monde. T H . D E B È Z E , PS. de David, 73, Paraphrase. — Quand Sipierre eut amené leurs compagnies de gendarmerie et que tous leurs amis furent venus à leur secours, en sorte qu'ils avoyent autour d'eux comme une armée, ils commencèrent à lever la teste et à parler gros. RÉG N I E R D E L A P L A N C H E , Hist. de l'Estat de France, I, 138. Coucher gros. Mettre un gros enjeu. Voir Cou
cher. Gros bec. Sorte d'oiseau. — Encor n'avons
trouvé autre propre nom françoys mieux a propos pour nommer cest oyseau que de l'appeller gros bec, car il a le bec moult gros pour sa corpulence. B E L O N , Nat. des oys. (G., Compl.).
Gros bis, v. Grobis. Groseille. Le mot s'emploie pour exprimer
l'idée de très peu de chose. — Bazochiens ne prise une groseille. R. D E C O L L E R Y E , Aultre Crypour le»
clercs du Chastellet. —• Merde pour l'imprimeur Lequel nous vient cy rompre les cervelles De ses traictez non vallans deux groiselles. C H . F O N TAINE, Epistre àSagonet à La Hueterie, dans Marot, Epistres, 52. —• Ores qu'il eut faict dix fois sa prière, tout cela ne luy sert pas d'une groiselle. PH. D E M A R N I X , Differ. de la Relig., 11, n, 7. — Mais quel profit de ce présent rongneux qui ne vaut trois grosselles? Pourquoy ne Pavez-vous refusé? LARIVE Y , les Tromperies, IV, 5. Le mot s'écrit de diverses façons. Cf. ci-dessus.
— Aussi y a... forces grouselles et fraizes. J E A N -ALFONSE SAINTONGEAIS, Cosmographie (Sainéan, Rev. des Et. rab., X, 45). — Mais si vous cueillez des groyselles, Envoyez m'en. M A R O T , Rondeaux, 41 _ Elle a beau tainct, un parler de bon zelle Et le tetin rond comme un egroizelle. ID., iô.,45.— — En esté je t'apporteroy U n plain paneret de groiselles. O. D E M A G N Y , Odes, II, 20. — Groiselle ou Groselle. Sure, espineuse, ronde, aigrette. M. D E LA P O R T E , Epithetes, 198 v°. — Ici siéra bien le groseiller... Le fruit qu'il produit, appelle grosselle, est appétissant. O. D E S E R R E S , Théâtre d'agric, VI, 10. — Des figues molles, des pomes, des poires et des gruselles. G. T O R Y , Champ fleury, L. III, 57 r°. Groseillier. — (Expressions proverbiales). Il ne faudra qu'un grozelier, par maniera de dire, pour nous faire accroire que nous sommes invincibles. CALVIN, Serm. surleDeuter., 161 (XXVIII, 451). —• Je besongnerois plus seurement si Lambert y estoit... Mais où le pourroit-on trouver maintenant?... Ce seroit chercher des raisins sur des groseillers. L A R I V E Y , le Morfondu, V, 4. On écrit groselier, groiselier, groisilier, gruse-
lier. — Petit jardin qui arroses Tes groseliers et tes rozes De ce petit ruisselet. A U B I G N É , le Primtems, III, 23. — Et le bouton des nouveaux groi-seliers. R O N S A R D , Poèmes, L. I, la Salade (V, 77). — Les rosiers et groisiliers se forment des espines picquantes pour leur defence. PALISSY, Discours admirables, Coppie des escrits, p. 363. —• Je vis aussi les rosiers et gruseliers. ID., Recepte véritable, p. 84. Groslier, v. Grollier. Grosselet. Un peu gros. —• Je veis la rosée espandre, Et sur les choulx ses rondelettes gouttes Courir, couler, pour s'entrebaiser toutes ; Puis tout soudain devenir grosselettes. D E S P É RIERS, des Roses (I, 69). — Menton. Fosselu, branlant, rondelet... grosselet. M. D E L A P O R T E , Epithetes, 262 r°. — Je vy dessus les choux fueillus Jouster les goûtes rondelettes, Qui de l'eau tombant de là-sus Se faisoyent déjà grosselettes. BAÏF, Poèmes, L. IV (II, 196). — La beauté des yeux est qu'ils soyent grosselets. L. G U Y O N , Miroir de la beauté, I, 195 (G.). Grosselle, v. Groseille. Grossement. Avec grosseur. — Un homme qui avoit le visage large et grossement charnu. T H E VET, Cosmogr., VI, 5. En grossissant. — Allez encore un coup, mi
gnardes, dans la mer, Voir les flots aboyans grossement écumer. T A H U R E A U , Premières Poésies (I, 89). — [Les démons] Ores en un tonneau grossement s'eslargissent, Ores en peloton rondement s'estrecissent. R O N S A R D , Hymnes, L. I, les Daimons (IV, 220). Grossement acompaigné. Accompagné d'une
grosse troupe. — Le cardinal d'Escaigne... se mist en fuyte bien et grossement acompaigné,
G R O S S E R 1 E
comme de quatre à cinq cens chevaulx. LE LOYAL SERVITEUR, Hist. de Bayart, ch. 16.
Grossement. Grandement. — U n roole de lettres missives de plusieurs sénateurs et personnages grossement auctorisés en la ville. B U D É , Instit. du prince, édit. J. Foucher, ch. 47. — Alexandre en bien faisant a Porus... qui estoit si grossement renommé en Inde. ID., ib., ch. 50.
En termes simples, faciles à comprendre. — Qui est cause que nostre Seigneur parle ainsi grossement en l'Escriture saincte? C'est sa bonté infinie que, voyant que nous avons les esprits trop lourds, il bégaye avec nous. CALVIN, Serm. sur le liv. de Job, 103 (XXXIV, 529). — 11 est vray que Dieu n'a point mestier de registre, car il ne perdra point mémoire à la façon des hommes, mais l'Escriture, à cause de nostre rudesse et infirmité. ID., Serm. sur le liv. de Daniel, 33 (XL1, 678). — Les cérémonies de la Loy sont comme charnelles. Pourquoy? Car Dieu a voulu grossement instruire le peuple à venir où il devoit. ID., Serm. sur VEpitre aux Galates, 16 (L, 470).
Grossièrement. — Les nacelles... ne sont que d'une pièce seulement, et de quelque gros tronc d'arbre cave grassement et rudement. A M Y O T , Hist. Mthiop., L. 1,14 v°. —- Onques aucun estât avare D u peuple grossement barbare N'ha sceu tant mes espris mouvoir Que mon trop plus ferme courage Ne se soit ancré davantage Sus la constance du sçavoir. T A H U R E A U , Premières Poésies (I, 59). —Voulentiers se vestoit assez grossement. S A U V A G E D E F O N T E N A I L L E S , Hist. du royaume de Naples, 230 r° (G.). —• Lon cognoissoit assez que c'estoit une feincte et un jeu qu'ilz jouoyent assez grossement, luy et Marius, car on veoit le jour à travers. A M Y O T , Marius, 14. — U n vieillard... vestu grossement d'une meschante robbe toute usée. ID., Agésilas, 36. — Bien que mes vers grossement je desploye. E. P A S Q U I E R , les Jeux poétiques, lre part., 1 (II, 829). Grosser 1. Écrire, rédiger. — Bonne partye
des articles sont ja grossez en parcemin. 1559. Pap. d'Et. de Granvelle, V, 571 (G.).
Grosser 2, v. Grocer. Grosserie. Caractère de ce qui est gros, grand.
— U avoit assiégé le Bois de Vincennes, place grande pour chasteau, composé du plus grand fossé et du mur le plus avantageux qui se puisse voir ; cela en carré est flanqué de huit tours ou plustost huit donjons... Mais ceste grosserie de-mandoit une grande dépense de poudres et boulets. A U B I G N É , Hist. univ., XIII, 5.
Grossièreté, sottise, ignorance. — La nation hellenienne, pour estre fort adroicte et esloingnée de grosserie, de tout temps s'est voulu séparer des nations barbares. SALIAT, trad. d'HÉRODOTE, I, 60. — Luy mesme le premier commencea à se mocquer de la grosserie et lourderie du service de sa maison, auprès de la sumptuosité, propreté et élégance de celuy de Cleopatra. A M Y O T , Antoine, 27. — La grosserie hebetee de leur sentiment. ID., De la musique, 38. — L'œuvre... repurgee de ses premières faultes et de sa rusticité et grosserie. B E L L E F O R E S T , Secr. de l'agric, p. 366 (G.). — Elle se moque de moy, m e reprochant la grosserie de mon esprit. J. M A U G I N , Noble Trist. de Leonn., ch. 42 (G.). — Les uns... ont... establiloix, basti villes et forteresses, composé et adouci la grosserie populaire. D u FAIL, Contes d'Eutrapel, 30 (II, 107). — Je m'employe à faire valoir la vanité mesme et la grosserie, si elle m'apporte du contentement. M O N T A I G N E , III, 9, var. 1588 (IV, 113 et V, 262). — C'estoit une grand' grosserie et mau-
H
G R O S S E S S E — 392 —
vaise raison. B R A N T Ô M E , le grand roy François (III, 97). — Vous ne devez pas avoir regret que je laisse en arrière tout ce qui a escript en France auparavant le roy François, à cause de leur barbare grosserie. A U B I G N É , Lettres de poincts de science, 11 (I, 457).
Chose grossière. — Bien heureux estoit le capitaine qui pouvoit dire avoir en sa compaignie vingt ou trente harquebuz et fournimens de Milan. Certes, ce n'estoit que grosserie ; mais peu à peu on en fit venir. B R A N T Ô M E , Couronnels franc. (VI, 74). — (Les parures d'autrefois). Ce ne sont que toutes grosseries, bifferies et drôleries, au prix des belles et superbes façons, coiffures gentilles, inventions et ornemens de nostre reyne. ID., des Dames, part. I, Marg., reine de Fr. et de Nav., (VIII, 31). La grosserie de la famille. Les serviteurs. — Le
noier est fort utile au mesnage, le fournissant pour toute l'année de nois et d'huile, tant pour manger en la grosserie de la famille... que pour brusler à la lampe. O. D E S E R R E S , Théâtre d'agric, VI, 26. Grossesse. Grosseur. — Teste inclinant un peu sur la grossesse. M O N T A I G N E , II, 17, var. 80-82-87 (III, 32 et V, 180). — Que si voulez cognoistre... si un h o m m e peut devenir père, entre plusieurs signes trois se trouvent : sçavoir la grossesse de la voix : secondement la barbe touffue, rude, noire... tiercement la grandeur et grosseur du nez. GUILL. B O U C H E T , 3e Seree (I, 99).
Grossièreté. — La grossesse des humeurs. Jard. de santé, 1,1 (G.). — Pour la grossesse et espesseur de leur tempérament... ils [les animaux] n'ont ny discours de raison ny sentiment. A M Y O T , Opinions des philosophes, V, 20. — Avec plus de facilité treuvons-nous des laboureurs propres à conduire la sorte des bestes qu'ils ont pratiquées que ne ferions nous pour en gouverner d'autres contre leur coustume, pour la grossesse de l'esprit de telles gens, qui difficilement se ploient à faire chose nouvelle, quoy que facile et de grande utilité. O. D E S E R R E S , Théâtre d'agric, II, 2. — Le vin cuit de mesme adoucit le vin... Le miel aussi a semblable vertu, mais sa grossesse manifeste trop notoirement la tromperie, faisant le vin estre gras. ID., ib., III, 10. — Bien que telle espèce de soie, pour sa grossesse, soit de petit prix au respect de l'autre, si ne laisse-elle pourtant de faire bon revenu. ID., ib, V, 15. — La grossesse de tel viande fait tels raiforts estre réservés pour le commun du mesnage. I D , ib VI, 7. "
Ce qui est grossier. — Ceux se sont le plus de-ceus qui le plus ont esloigné de leurs maisons les granges, estableries et logis du bestail, quoique fondés en ce principalement que, ne tenans prés d'eux la grossesse du mesnage, sans bruit et à l'aise vouloient vivre de leur revenu. ID., ib., I, 5. Grosset. Un peu gros. — Exceptez un assez grosset, lequel... feit un son tel que font les chas-taignes jectees en la braze sans estre entonmees lors que s'esclattent. R A B E L A I S , IV, 56. — Pein moy sa lèvre doucelette, Fort attrayante, un peu grassette. R. B E L L E A U , Odes <f A N A C R E O N (1, 25). — Adieu donc, lèvre grassette, Adieu rose, adieu perlette. ID., Petites Inventions (I, 122). — Et vous gembe grassette. D u B E L L A Y , les Regrets, 91. — Pein-la [sa bouche] fraischement vermeillette, Fort attrayante, un peu grassette. ID., la Bergerie', lle Journ.. le Portrait de sa maistresse (1, 262). — Si de fortune il s'y rencontre quelque corps un peu plus grosset qu'il ne faut pour passer tous ces
destroicts. M O N T A I G N E , II, 37 (III, 223). — Es-cheant d'enter les arbres ja grossets, conviendra en chacun arbre loger deux greffes. O. D E SERRES Théâtre d'agric, VI, 18. —• Lors que leurs petits colombeaux sont un petit grossets. S* FRANÇOIS D E S A L E S , Entretiens spirituels, 7 (VI, 113, var.).
Grosseté. Grossièreté. — La grasseté de l'eau se decuit. Miroir d'alquimie, p. 20 (G.).
Grosseur. Grossesse. — Maire Ata... print une femme de son païs : et elle estant enceinte, luy prinst fantasie de s'en aller es régions lointaines : pource, prenant sa femme, se meit en chemin, Elle, qui estoit pesante à cause de sa grosseur, ne pouvant aller autant que son mary, se meist à reposer. T H E V E T , Cosmogr., X X I , 6.
Grossièreté. — Pour le grosseur et le inurbanité et rudesse du peuple de Scithie. FOSSETIER, Cron. Marg., I, 56 v° (G.). — Selon qu'il estoit nécessaire à la grosseur de nostre esprit et à nostre arrogance, le Seigneur nous a baillé sa Loy escrite, pour nous rendre plus certain tesmoi-gnage de ce qui estoit trop obscur en la loy naturelle. C A L V I N , Instit. (1560), II, vin, 1. — IIfaudrait donc... que les personnes melancholiques eussent les oreilles grandes, qui signifieroit une imbécillité et grosseur d'esprit. GUILL. BOUCHET, lbe Seree (lll, 5b).
Grossier. Grossière. Grosse, enceinte. — Si vous alaictez des enfans, Je tiens qu'ilz [vos te-tins] seront triumphans, Ou si vous devenez grossière, Ilz vous vauldront bien gibecière, Car les deux peaulx estans tendues Seront grandz bources estendues. F E R R Y J U L Y O T , lre part., 26 (Facete Epistre à une dame).
Grossier. Important? — Pour un marchand que Pon trouvoit du temps dudict roy Louys on-ziesme, riche et grossier, à Paris, à Rouen, à Lyon... l'on en trouve de ce règne plus de cinquante. S E Y S S E L , Hist. de Louys XII, p. 113.
Marchand grossier. Marchand en gros. — Ar-tile estoit marchant grossier, et faisoit grand trafic de marchandises. L A R I V E Y , trad. des Facétieuses Nuits de S T R A P A R O L E , VI, 1. — Un marchand grossier, demeurant rue Sainct Denys, à l'enseigne du Gros Tournois. A M B R . P A R É , Apologie (III, 683). L'expression marchand grossier semble désigner
d'autres que les marchands en gros. — Entrant en la maison d'un marchant grossier proche de là, il acheta un soufflet tout neuf. T A B O U R O T DES A C C O R D S , Escraignes dijonnoises, 4.
(Subst.). Grossier. Marchand en gros, et probablement aussi certains autres marchands. — Plourez, plourez, lingières et mercières, Doulces censières, geôlières financières, Gentes grossières; cloez moy ces estaulx. Ane Poés. franc., X11I, 399. — Je ne mets en ce ranc un monde d'escri-vains Qui de mille cayers nous barbouillent les mains, Ne servant qu'aux beurriers et aux fripiers libraires, Aux merciers, aux grossiers et aux apothicaires. R I V A U D E A U , A Janne de Foix, p. 40. — Mittit ad quaerendum les drappiers, les grossiers, marchans de soye, et se fait accoustrer de pied en cap. H. E S T I E N N E , Apol. pour Her., ch. 31 (H, 161), — Jenevoysi volontiers Les boutiques des grossiers C o m m e j'ayme en chaque rue Les bouchons des taverniers. J. L E H O U X , les Chansons du Vau de Vire, II, 20. — En icelle se tiennent les orfèvres, les grossiers et marchans, et ceux qui sont commis sur les monnoyes. TH E V E T , Cosmogr., 1,1. — [La myrrhe] que nos grossiers et apothicaires vendent. ID., ib., IV, 12, — Orfèvres et grossiers de richesse infinie. CL. G A U C H E T , le
— 393 — GROUEE
se retirans en ceste Misie, y ont passé leur aage, vivans dans desgrottesqueset spelonques. ID., ib., XX, 5. Ornement capricieux. —• Puis prenant har
diesse, ils entrèrent dedans Le saint horreur de l'antre... Ils furent esbahis de voir le partiment. E n un lieu si désert, d'un si beau bastiment... De voir que la Nature avoit portrait les murs De gro-- tesque si vive en des rochers si durs. R O N S A R D , Eclogues, 3 (III, 405). — Pensif il se retire Dans un antre couvert d'un naturel porphyre, Que Pes-gout d'un rocher par un froid air glacé De grotesques jadis semble avoir lambrissé. D u B A R T A S , 2e Semaine, 1er jour^ Eden, p. 30. — Le corps [d'une robe] est figuré de fueillages moresques, D'oisillons, de lézards, et d'estranges grotesques Faictes d'orfèvrerie. ID., ib., 4e Jour, la Décadence, p. 515. — (Fig.). Plus il alla sur l'aage, plus il s'adonna à ce sujet, y apportant tousjours quelque nouvelle grotesque. E. P A S Q U I E R , Recherches, VII, 12. — Et prenez-moy les plus extrêmes E n sagesse, ils vivent de mesmes, N'estant l'humain entendement Qu'une grotesque seulement. R É G N I E R , Œ U V . posth., Satyre.
Tapisserie formant des dessins capricieux. — Toutes les objections qui nous ont esté icy faites ressemblent à ces tapisseries que l'on appelle grotesques. E. P A S Q U I E R , Plaidoyé pour le duc de Lorraine (I, 1092). — Je... désire que le lecteur prenne ce chapitre et le précèdent de moy comme une grotesque entre les tapisseries. ID., Recherches, VII, 14.
(Par plaisanterie). Les grottesques ventriculieres. Les intestins. — O n dirait que de vostre vie ne fistes autre chose que doser, medeciner et syrin-guer des clisteres dans les grothesques ventriculieres. C H O L I È R E S , 8e Ap.-disnée, p. 326.
Grottesque, dans un sens libre. — Il y en a dix mille... qui... pour jouer au plus seur, jouent à mets couverts. Je m'en rapporte aux godemichi de velours et d'yvoire qui sont enfournez en la grottesque. ID., 4e Matinée, p. 158.
Cf. Crotesque, qui est le m ê m e mot.
Plaisir des champs, Printemps, Discours du chasseur et du citadin, o. 97. Personnage important, de haut rang. — A u re
gard des prélats, seigneurs et autres grossiers, ils ne se contentent pas d'avoir toute sorte de vaisselle, tant de table que de cuisine, d'argent, s'il n'est doré, et mesmes aucuns en ont grande quantité d'or massif. S E Y S S E L , Hist. de Louys XII, p. 112. — Si Brasidas neust eu la conduicte des grossiers du pays, qui ont accoustumé de gouverner le peuple plus par force que par auctorité et par justice, jamaisn'eust peu passer. ID., trad. de THUCYDIDE, IV, 10 (135 v°).
Le grossier de la famille. Les serviteurs. — Pour autres n'est destinée telle chair [des chèvres] que pour le grossier de la famille. O. D E S E R R E S , Théâtre d'agric, IV, 14. A la grossière. En gros, sans entrer dans le
détail. —• 11 est bon de parler ainsi confusément et à la grossière, afin de retenir tousjours les simples en leur simplicité. P H . D E M A R N I X , Differ. de la Relig., Il, i, 5. Grossièrement. — Ils parloient bien à l'antique
et à la grossière. B R A N T Ô M E , Cap. franc., M. de Montoison (II, 410). Grossir. Grossir le cœur. Donner du courage,
delà fierté. — (L'escrime). C'est un art utile à sa fin... duquel la cognoissance a grossi le cœur à aucuns, outre leur mesure naturelle. M O N T A I G N E , II, 27 (111,108). Grossissement. Fait de s'alourdir (en parlant
de l'air). — Les brouillas et nuages ne sont pas glacements de Pair, ains seulement espaississe-ments et grossissements d'un air humide et vaporeux. A M Y O T , D U premier froid, 14. Grosso modo. Grossièrement. — Quand nous
parlons d'un ouvrage faict à l'antique... nous le disons par mespris... comme si nous disions faict lourdement, et (comme disent aujourd'huy les nouveaux parleurs de françois) goffement. Le vulgaire de Paris dit aussi grosso modo. H. E S T I E N N E , Apol pour Her., ch. 3 (I, 59). Grossoye. Action de grossoyer, de transcrire
[un acte]. — Et aud. procureur pour la grossoye de lad. requeste, 11. x s. Texte de 1536 (G.). Grotesque (adj.). Souterrain. — Jadis la plus
part de ce peuple en la campagne se tenoit dans des cavernes, tout ainsi que vous en voyez en Touraine : de sorte que sur le toict de leurs maisons grotesques leurs bestelettes paissoient le thim et serpoulet bastard. T H E V E T , Cosmogr., 1,12. (Subst.). Lieu souterrain, grotte, souterrain,
caverne. — Un des gens de Jean Baptiste le conduit à une petite grotesque où il lisoit, laquelle estoit tapissée de beaux lauriers. B E L L E F O R E S T , Secr. de l'agric, p. 189 (G.). — Estans en devisant parvenus à ceste gentille petite grotesque si bien enrichie d'antiquailles. ID., l'Agric. de G A L L O (même ouvrage), 19e Journ., p. 329 (Gay, Gloss. archéol). — La pluspart se sauvèrent es grotesques etsouterranes. T H E V E T , Cosmogr., I, 7. — Tout_auprès est une grotesque où l'apostre estoit gardé avec ses compaignons. ID., ib., I, 12. — Ceux qui sont près de la mer n'ont point de villes, ains vivent ou par les grottesques ou dans des cabanes et logettes. ID., ib., I, 15. — A u dessus de ladite caverne ou grotesque, le feu soldan d'Egypte fit bastir une fort belle mosquée. ID., ib., VI, 1. —. Le palais de ce redouté capitaine estoit une grotesque assez creuse dans la roche du mont Oreb. ID., ib., VI, 2. — Ces fuyars lesquels,
Grotesquer. Tracer capricieusement. — J'iroys donc pour néant à ces cimes chenues, Aux bouillons de leurs eaux, des superstitions, D'où ces poetezins tirent leurs fictions Et grotesquent les tretz de leurs songes estranges, Puyzer ce que je veux escrire a ses louanges. L. P A P O N , la Constance (Suppl., p. 2). Groton (cf. Crotton). Grotte, caverne, souterrain. — Nous glissez aux grattons Ou le pieux Muée est cheu tout rance, Ou Tulle riche et le Martien Ance, Pouldre et ombre restons. Luc D E LA P O R T E , trad. d'HoRACE, Odes, IV, 7. —• A ces mots il se tut, et la bande infernalle A l'instant avec luy se perdit de mes yeux, Et chacun d'eux hurlant dans un grotton devalle. Var. hist. et litt., X, 93.
Trou, fosse. — [L'enfant] Paraissant dans le groton... Autant que jusqu'au menton U n corps suspendu en l'onde. Luc D E L A P O R T E , trad. d ' H O R A C E , Epodes, 5.
Réduit sombre, étroit. — (Dans l'arche de Noé). —• D'où vient... que si peu de fourrage, Si peu de grain froissé, si peu de doux breuvage, Suffit pour substenter tant d'animaux gloutons, Qui vivent confinez dans ces obscurs grotons. D u B A R T A S , 2e Semaine, 2e Jour, l'Arche, p. 169. Grottesque, Grotton, v. Grotesque, Groton. Grouee. Récolte des fruits. — Me suis ingéré mettre par escrit icelles joyeuses histoires, alliant
GROUETTE — 394 —
excellents traicts de la vérité, fidellement recueillis à la grouee des meilleurs arbres de la forest de Lyons. P H . D'ALCRIPE, la Nouvelle Fabrique, Aux bénévoles lecteurs. — Lesquelles roupies deviennent perles aussitost qu'elles sont tombées à terre, que les gens de ce pays vont tous les matins cueillir par pannerées, comme l'on fait la grouée des fruits. ID., ib., p. 35.
Grouette. Partie du sol contenant des-pierres, du gravier, des cailloux. — Les terres glaireuses, pierreuses ou grouetteuses et graveleuses, et qui ont force cailloux ou argille en fond et couvers de terre, sont bonnes, pourveu qu'il ait de la terre parmy, et qu'elles soyent souvent rafraischies de labour jusques à leur grouette. L I E B A U L T , Mais. rust., p. 687 (G., Compl.). Grouetteux. Contenant des pierres, du gravier, des cailloux. — Si l'on plante la vigne en terre graveleuse, grouetteuse et pierreuse, labeur en terroir n'est requis si profond. L I E B A U L T , Mais. rust., VI, 2 (G.). Grougouller. Gargouiller. — [Les intestins] font bruit et grougoullent comme il se fait aux hernies intestinales. A M B R . P A R É , XVIII, 93.
Grouillis. Grouillement. — Sa pance affamée, Hydropique tousjours de vent et de fumée, De se farcir tant plus le boudin dextrement, Pauvre grouillis de vers, en bref leur aliment. Les Fanfares des Roule Bontemps, p. 25. Grouin, v. Groin.
Groulard. Sorte d'oiseau. — On le voit se tenir sur les haultes summitez des buissons, et remuer tousjours les aelles, et pource qu'il est ainsi inconstant, on Pa n o m m é un traquet. Les autres l'ont n o m m é un thyon... autres un groulard. B E L O N , Nat. des ois. (G.) Groulement. Mouvement. — La colombe... fait son petit chant ou gémissement retenant sa respiration au dedans d'elle, et par le groulement et retour qu'elle fait de son haleine sans la laisser sortir, en réussit son chant. S4 F R A N Ç O I S D E SALES, Sermons recueillis, 7 (IX, 48). Grouler (trans.). Faire retentir. — Mais comme on voit qu'en éclairs le tonnerre, Prêt de tout accabler, Groule le ciel, d'un grand bruit, qui la terre Prontement fet trembler. B U T T E T , le Second livre des vers, ode 9. Agiter. •— Venez, bourrelles sœurs... E n vos
testes grouslez vos couleuvres sifflantes. BAÏF, Poèmes, L. III (II, 112).
(Intrans.). Faira du bruit. — Si j'entr'oyois quelque chose en la rue Grouler de nuict, j'avoy l'ame esperdue. R O N S A R D , Elégies, 12 (IV, 88).
Gronder. — Mon ventre croulle, je pence qui! y a des grenouilles dedans. P A L S G R A V E , Esclare, p. 502.
Grogner. — A quoy mon ours ne faict faute d'obéir promptement et sans grouler. P H . D E M A R N I X , Differ. de la Relig., I, v, 10. — Aucuns eslisoient quelque bon h o m m e simple de moyne, qui n'eust osé grouler ny commander faire autre chose sinon ce qu'il leur plaisoit. B R A N T Ô M E , le grand roy François (III, 107). S'agiter, grouiller. — Mais de quoy pourras-tu
servir? Tu ne sçais aller ne parler. — Il ne sert riens que de grouller ; Aussi est-il souvent escoux. Ane Théâtre franc., III, 307. — Je sens mille amoureaux en sa place grouler. BAÏF, l'Amour de Francine, L. I (1, 120). — Sous mille ennuis nos sens émeus tressaillent : Mille serpents groullent
dans nostre cœur. ID., Diverses amours, L II (1 336).
Grouler de. Être rempli de l'agitation, du grouillement de. — Bien que de cent troupeaux ne groulle une montagne. ID., l'Amour de Francine, L. IV (I, 245). — Dans ses os sa mouëÛe Groulle de chenilleaux. ID., Passetems, L. III (IV 346).
Groumeler, v. Gruméler.
Grouselle, v. Groseille.
Grousler, v. Grouler.
Grousser, v. Grocer.
Grouter. Crépir. — Si y avoit une tour des Dejectz ruineuse et dangereuse de tomber pour sa haulteur, si fut advisé d'icelle abbattre a la raison de la muraille, et icelle grouter, reparer et cranel-ler. 1534. Reg. cons. de Lim„ I, 243 (G.).
Groyer (se). Se vanter. — Il se groye trop. P A L S G R A V E , Esclare, p. 461. — Quant il a bien beu, il se vante gorgiasement de sa vaillantise, or il se groye. ID., ib., p. 500.
Groyselle, v. Groseille.
Grozelier, v. Groseillier.
Gru. Gruau. — Tant a Meulenc comment a Mante, Par tout j'ey moulu orge et gru. Sotties, III, 85. — L'on doit faire et livrer au convent des gruz d'avenne. 1550. Arch. Jura (G.). —Bien pourriez jargonner gru gru, Ou en phyole manger gru, Car col avez grand et nerveux. F E R R Y JUL Y O T , lre part., 26 (Facete Epistre à une damé). Gruau, dimin. de grue. — Quelquefoys un loup
dévora Une brebis totallement Fors un os qui luy demoura Hers au gosier, qui tellement Le tour-mentoit que seullement Ne demandoit plus qu'a mourir, S'un gruyau liberallement Ne le fust venu secourir. H A U D E N T , Apologues «TESOPE, 1,117.— Esdites isles on prend les sacres et les petits gruaux pour friands morceaux. D u PINET, trad. de P L I N E , X, 49 (G., Compl.).
Grue. Le mot grue figure dans plusieurs expressions proverbiales. — [Gargantua] prenoit les grues du premier sault. RABELAIS, I, H. — De rien je fais brides à veaux, A la saint Jean je tends aux grues, Je plante des pois par les rues, R É G N I E R , Œuvres posthumes, Satyre. — En suy-vant l'un l'autre comme grues, ilz se séduisent mutuellement, d'autant que nul ne suit la parolle de Dieu. C A L V I N , Que doit faire un homme fidèle entre les papistes (VI, 564). — Si nous suyvons la multitud e comme les vaches, ou les grues (comme on dit)... nous serons desadvouez de Dieu. ID., Serm. sur l'Harmon. evangel, 34 (XLVI, 413). — Quand les papistes ensuyvent les Juifs... ils sont fols, et s'en vont là comme des grues, sans entendre nulle raison. ID., ib. (XLVI, 419).
Proposer de la grue et conclure de la cigogne, v. Cigogne.
Col de grue, v. Col Bailler la grue. Faire tomber. — (Fig.). Ma
bonne amye, j'ay songé Que prends les grues volantes. Que dit cela? est ce congé Et refus des choses plaisantes, Que souz paroles trop cuisantes M e donras, m e baillant la grue? CH. FONTAINE, la Fontaine d'Amour, Epigramme. Faire la jambe de grue. Faire le pied de grue. •—
Avez-vous proposé de faire icy longtemps la jambe de grue? T O U R N E B U , les Contens, L 3.
Faire de la grue. — Madame, vostre prisonnier, Il faict encor là de la grue. Luy voulez-vous prison nyer? Car il va et court par la rue ; Qu'il n'ayt
plus la plume si drue, Et le gardez de tant voler. DES PÉRIERS, A la royne de Nav. (1,154).
Bec de grue, v. Bec. La grue. L'un des jeux de Gargantua. R A B E
LAIS, I, 22.
Grue. Sot. — Quand jeune pigeon femme englue, Elle le fait devenir grue, Et croyre impossi-bilià. Ane Poés. franc., I, 5. — Mais de souffrir chose si mal congnue, Par mon serment, je ne suis plus si grue. M A R O T , Ballades, 4. — Mais ce lyon (qui jamais ne fut grue) Trouva moyen et manière et matière. D'ongles et dens, de rompre la ratière. ID., Epistres, 11. — Nous usons de ce mot de grue en ceste mesme signification de sot. Car C'est une grue vaut autant que C'est un sot, C'est un niais. H. E S T I E N N E , Apol. pour Her., ch. 3 (I, 65). — Ton geôlier à ce conte est bien grue, Puisqu'il te laisse ainsi e m m y la rue Coucher tout seul. PASSERAT, Elégies, 5. — H a ! j'entens bien le patelmage ; je ne suis pas si grue. FR. D'AMBOISE, les Neapolitaines, I, 2. — Je ne suis pas si grue gue je ne sçache bien que le beau a pour oppose le laid. CHOLIÈRES, 5e Matinée, p. 185. — Quant aux flateurs, estiment-ils les personnes si grues que de se laisser corrompre par leur langage macquereau et sottes excuses? T A BOUROT DES A C C O R D S , les Bigarrures, Préface. Lâche? — La lascheté des Gruriens luy porta
beaucoup de perte de ce cousté ; je ne viz jamais de plus grands grues que ces gens là, indignes de porter armes, s'ilz ne sont rendus plus courageux. M O N L U C , Commentaires, L. II (I, 275). Gruer. Attendre. — Mais tous les jours gruer
soubz l'asseurance Que ceste fiebvre aura sa gue-rison, Je dy qu'espoir est la grand prurison Qui nous chatouille a toute chose extrême, Et qui noz ans use en doulce prison, C o m m e un printemps soubz la maigre caresme. M A U R I C E S C E V E , Délie, 99. Gruger. Écraser, broyer. — Elle le grugea plus
menu que n'est menue la poussière. L A R I V E Y , trad. des Facétieuses Nuits de S T R A P A R O L E , VI, 4. Gru gru, onomatopée. Voir Gru.
Gruier. Expert. — Grand ruffien et gruier de tous les bordeaux. L'ESTOILE, Mém., lTe part., p. 65 (G). Grumelé. Qui est en grumeaux. — L'ange-
licque fait fondre le sang grumelé. G U E R O U L T , trad. de l'Hyst. des plantes de L. F O U S C H , ch. 43 (G., Compl.). Grumeler. Gronder. — Tout oyselet, soit masle ou soit femelle, Ses esles bat et murmure et grumelle, Faisant son dueil et formant sa plaintive. LE M A I R E D E B E L G E S , les Regrets de la dame infortunée (III, 192). — Hé Scylle, Scylle, las! ceste dolente rive, Voire son flot piteux qui gru-melant arrive Des ondeuses campaignes M e plaint et me lamente. R O N S A R D , Odes, III, 18. — La mer... aucunefois s'esleve Dedans le ciel pendue, et d'un horrible tour Se roulle en groumelant aux rives d'alentour. ID., Hymnes, L. 1, Hymne de Calays et de Zethes (IV, 178). — Quand il fait mauvais temps et qu'on oit le tonnerre Grumeler pesle-mesle au ciel. G R E V I N , la Gelodacrie, p. 102. — A tant la nymphe en parlant dévala Son chef sous l'eau : Ponde qui çà qui là Flot dessus flot en se ridant grommelle, D'un long tortis l'engloutit dessous elle. R O N S A R D , Franciade, III (III, 92). — Achab, ne crains tu pas Le fouldre qui desja grommelé dans le bras D u Dieu dompte-tyrans? Du BARTAS, 2e Semaine, 4e Jour, le Schisme, p. 501.
GRUNAL
Grommeler, grogner. — Tousjours la Commune grumelle. G R I N G O R E , le Prince des Sotz, sottie (I, 222). — La Commune grumelera Sans cesser, et se meslera De parler à tort, à travers. ID., ib. (I, 223). — L'Eglise mect son estudie A avoir biens, qui que en grumelle. ID., ib., Moralité (I, 261). — Hz laissent parler la femelle ; Se d'aventure aucun gremelle, Il sera tenu aux aboys. Ane Poés. franc., III, 181. — Je voy la derrière quelcun qui grumeleroit vouluntiers, et seforceroit comme en-vyeux m e nuyre sil pouvoit. G. T O R Y , Champ fleury, L. I, 1 v°.
Grumeler à. Grommeler contre. — Puis le mari à sa fumelle Hongne, frongne, grongne, grumelle. R. D E C O L L E R Y E , Monologue du Résolu, p. 61.
Grumeler (trans.). Faire des reproches à, grommeler contre. — Mais grumeler vueil à m a porte Mon filz le prince, en telle sorte Qu'il diminue sanoblesse. G R I N G O R E , le Prince des Sotz, sottie (I, 224). Grumeleur. Qui grommelle, qui grogne. —• S'il vient quelque mutin Grumeleur ou lutin Qui te face hutin Pour avoir ton butin, Prens fourche, houe et pic. Ane Poés. franc., VIII, 88. — Malade. Allengouri... morne, grommeleur. M. D E LA P O R T E , Epithetes, 251 r°. Grumelin, dimin. de grumel, grumeau? —
Pour la quarte assiette elles eurent des halle-dosses aux grumelins. Navig. du Compagnon à la Bouteille, B. Grumellement. Grondement. — J'ay faict comme le chat qui par son grommelement descouvre son larrecin. L A R I V E Y , la Vefve, V, 5. Grognement. — L'importun piolement des
d'Indes, canes, oyes et poules communes, le grumellement des pourceaux. O. D E S E R R E S , Théâtre d'agric, V, 4. — U n grommellement desplaisant et hargneux. Les Muses incognues, l'Avarre Mar-got (G.). Roucoulement. — [Les colombes] ne changent
point d'air, ains font le mesme grommellement pour preuve de leur contentement qu'elles font pour manifester leur douleur. S' F R A N Ç O I S D E SALES, Entretiens spirituels, 1 (VI, 117). —• Les colombes... font leur grommellement a bec clos et enfermé, roulant une voix dans leur gosier et poitrine. ID., Amour de Dieu, VI, 2. Grumeux. Formé de grumeaux. —• Telle va
peur dissoult, subtilie, incise et rompt la matière grumeuse, gypseuse et endurcie. AMBR. PARÉ, XXI, 25. Qui a des grains, des pépins. — [L'homme] osa
le noir raisin grumeux Espraindre, et de son jus vermeillement fumeux En buvant s'enyvrer. MAURICE SCÈVE, Microcosme, L. II, p. 41.
Grumillon. Petit grumeau. — Le passevelours jaune est de faculté incisive et sabtiliante. Et par ce son couppet ou summité beue en vin provoque les flueurs des menstrues ; et tient on qu'elle fait fondre les grumillons de sang caillé non seulement en l'estomac, mais aussi en la vescie. GUEROULT, trad. de l'Hyst. des plant, de FOUSCH, ch. 34 (G., Compl.). Grumpher. Gronder, murmurer. — [Raison]
alors vous congnoissant amis, De toutes pars en-voyera ses amys Pour faire feu de joye en grand triumphe, Si l'un de vous contre l'autre ne grumphe. FE R R Y JULYOT, lre part., 29 (Epistre aux escholiers). Grunal. — Aussi des Indes est abordée une
herbe en Hollande dont la nouveauté et la qualité
)5
GRUNELER — 396 —
la font rechercher... En Hollande elle est appellee grunal. O. D E S E R R E S , Théâtre d'agric, VI, 10.
Gruneler. Gronder. — Les pigeons sont rudes aux colombelles de la jalousie quilz ont... car ilz les battent a coup de bec et les tancent... groi-gnans du gozier, grondans, grenelant du gozier. S* F R A N Ç O I S D E SALES, Amour de Dieu, lre rédact., L. X (V, 442).
Grunement. Roucoulement. — Les colombes ne font pas leur grunement seulement es occasions de tristesse, ains encor en celles de l'amour et de la joye. S1 F R A N Ç O I S D E SALES, Amour de Dieu, VI, 2.
Gruolleux. Riche en gruau. — Le grain [du blé de Brie] est court et gruolleux plus que les autres, ce qui fait poiser le grain. LI E B A U L T , Mais. rust., p. 663 (G.). Gruon, dimin. de grue. — Puis ses servants des
cuisines sortoient Et en grand plat un gruon apportaient. FR. H A B E R T , trad. d'HoRACE, Satyres, II, 8. — Grue... Le dim. Gruon. M. D E LA P O R T E , Epithetes, 199 r°.
Gruotier, v. Griotier.
Gruotte. Gruau. — Les fueilles tendres du laurier, broyées et incorporées en gruotte sèche, sont singulières aux inflammations des yeux. Du PINET, trad. de PLINE, XXIII, 8 (G.). — Les fueilles [des violettes de mars] enduites seules avec gruotte seiche, sont fort bonnes aux ardeurs de l'estomac. M. D E LA P O R T E , Epithetes, 424 r°. Grup, substantif du verbe gruper, saisir, empoi
gner. — N'enquerés pet ou bon vin creust Car sur tous estas y sont grupt. Sotties, III, 118. — Grup, grup à la ville et aux champs : Grup, grup sur les prestres marchands : Grup, grup sur ces gens de village. M A R O T , le Grup de Cl. Marot, édit. Guiffrey, II, 439.
? Pour attraper or ou chevance Tu passe grup ou l'oyseau sacre. Ane Poés. franc., XI, 303.
Gruppade. Violent coup de vent. — Le mais-tral accompaigné d'un cole effréné, de noires gruppades, de terribles sions, de mortelles bourrasques. RA B E L A I S , IV, 18. Gruppement. Action de saisir. — Par fraudu-
lentes poinctures, gruppemens harpyiacques, im-portunitez freslonnicques. RABELA I S , III, 21.
Grupper. Attraper, saisir. — Je le vous grup-peray au crue. RABELAIS, III, 12. — Qui desrobbe ne sugse, mais gruppe : ne avalle, mais emballe, ravist et joue de passe passe. ID., III, 18. — Qui sçait s'ilz [les diables] useraient de qui pro quo, et en lieu de Raminagrobis grupperoient le paouvre Panurge quitte? ID., III, 23. — J'attens qu'on face la lessive, Où, avec une main hastive, Je gruppe ce dont j'ay besoin. Ane Poés. franc., I, 97. — Un chat... poursuivoit un gros rat de grenier dans une gouttière, lequel estant presque entre les griffes dudit chat, se cuida jetter de haut en bas pour se sauver, et le chat après le pensant grupper. P H . D'ALCRIPE, la Nouvelle Fabrique, p. 55. Grimper. — Et en disant ces mots, soudain
gruppe sur la table et enlevé ceste teste. Trad. de •FOLENGO, L. X V (II, 28).
Grupt, v. Grup. Grurie, v. Gruyrie. Gruselier, Gruselle, v. Groseillier, Groseille. Gruser (se). S'irriter. — Je m e grusoie de six
ou sept jours, et maintenant vous me voulez se
vrer de deux ans. C H O L I È R E S , 9e Matinée, p. 317 — Parce que je recognoissoie que quelques oiseaux ne peuvent porter la lueur des rayons solaires, je m e fis entendre qu'il se pouvoit faire que ce monsieur avoit aucunement occasion de se gruser. ID., les Apres-disnées, Aux liseurs.
Grusler. Faire sécher. — Je grusle des poys, P A L S G R A V E , Esclare, p. 652.
Gruyau 1, v. Gruau.
Gruyau 2. — Dieu commande a la neige qu'elle descende en la terre, et aux pluyes de l'hyver, et au gruyau de sa force (latin : imbri fortitu-dinis suae). L E F E V R E D'EST., Bible, Job XXXVIII, 6 (G.). Gruyer 1. Garde de forêts. — Par forestier est
entendu celuy qui est garde de forest... quelques uns l'appellent aussi gruyer. H. ESTIENNE, Dial. du lang. franc, ital, I, 78. — Quelques uns ont opinion que gruyer soit celuy qui a la charge de marquer les arbres qu'il faut couper. ID., ib., 1,79.
(Antiq.). — Il convient suyvre cest ordre es champs et dresser à leurs magistratz, qu'ilz appellent gruyers et arpenteurs quelques bastillons et lieux pour manger servans à la garde. L. LE R O Y , trad. des Politiques ^'ARISTOTE, VII, 12. Gruyer 2. Coq gruyer. — Les quelles il con
vint toutes tuer... réservé un grand coq gruyer qui eschapa vaillamment. P H . D'ALCRIPE, la Nouvelle Fabrique, p. 134.
Gruyrie. Administration des forêts. — Epistre à sire Estienne Fichet, en son vivant greffier de la gruyrie de Dijon. R. D E C O L L E R Y E , Epistres, 17 (titre). Sorte de droit de justice. — (Par plaisanterie).
A l'entretenement Des drolles du païs, qui avoient la grurie Tant sur les bons morceaux que sur la rusterie. F R . H A B E R T , trad. d'HoRACE, Satyres, II, 3 (Paraphrase). Gryncher, Gryotier, v. Crisser, Griotier. Gryphe. Griffon. — Byteres, ophyres, stryges,
gryphes. R A B E L A I S , V, 29. — Ou bien l'avare au fier gryphe ressemble, Qui fouit l'or et pour au-truy l'assemble. F O R C A D E L , ŒUV. poet., p. 29. Gryphon, Grypper, Gryson, v. Griffon 1,
Gripper, Grison. Gryz, v. Grif.
Guaban, v. Gaban.
Guabarrier. Portefaix d'une gabarre. — On quel lieu ne trouva grand exercice, sinon des gua-barriers jouans aux luettes sur la grave. RABELAIS, II, 5.
Guabarrot. Petite gabarre. — Prinrent ung guabarrot chargé de metailhe. 1562. Dep. de deux jur. Arch. Gironde (G., Gabarrot).
Guabeler, Guabeleur, v. Gabeler, Gabelew.
Guabet. Girouette. — Voyez le guabet de la hune. R A B E L A I S , IV, 65.
Guaigner 1, Guaigner 2, v. Gaigner, Guigner. Guaillard, Guaingnedenier, Gualant,
Gualentement, Gualee, v. Gaillard, Gaignedenier, Galant, Galantement, Galee.
Gualentir. Fortifier. — Pour gualentir les nerfz, on luy avoit faict deux grosses saulmones de plomb. R A B E L A I S , I, 23.
Gualimart, v. Galemard.
Gualinotte. Gelinotte. — Six mille poulletz
et autant de pigeons, six cens gualinottes. R A B E LAIS, I, 37.
Gualleace, Guallefretier, Gualler, Gualle verdine, Guallier, Gualois, v. Galeace, Gale-fretier, Galer, Galvardine, Galier, Galois. Gualot. Le grand gualot. A u grand galop. —
Puis le grand gualot courut après. R A B E L A I S , I, 43 — Les Andouilles... se mirent en fuyte le grand guallot. ID., IV, 41. Gualous. Galeux. — Cy n'entrez pas, vous
rassotez mastins... N y vous gualous verollez jusqu'à l'ours. RABELAIS, I, 54.
Gualvardine, v. Galvardine.
Guambayer (se). Gambader. —Puis se guam-bayoit, penadoit et paillardoit parmy le lict. R A BELAIS, I, 21.
Guanne. Sorte de plante. — En ceste coste [du cap de Palme] les gens vivent de riz et racines que l'on appelle guannes. J E A N - A L F O N S E SAINTON-GEAIS, Cosmographie, p. 334 (Sainéan, Rev. des Et. rab., X, 42). Guarand, v. Garant.
Guarant, terme de marine désignant un cordage ? — Plante le heaulme. Tiens fort à guarant. RABELAIS, IV, 22.
Guarantage, Guarbe, Guarbin, Guarder, v. Garentage, Garbe, Garbin, Garder.
Guare derrière. Porte de derrière. — (Fig.). Mais ce sera ung traicté qui aura ung guare derrière, et duquel la ou ils se sentiront forts se desenvelopperont. 19 août 1521. Lett. du chanc du Prat à Louise de S av. (G.). Guareguare, v. Garegare.
Guarement. Action de se garer. — Voilà pourquoy ne faut point que les marys pensent autrement réduire leurs femmes, après qu'elles ont fait la première fausse pointe de leur honneur, sinon de leur lascher la bride, et leur recommander seulement la discrétion et tout guarement d'escan-dale. B R A N T Ô M E , des Dames, part. II (IX, 132). Guarentir, v. Garantir. Guare serre. Sorte de sonnerie maritime. —
Par le conseil du pilot feurent sonnées les trom-petes de la thalamege en intonation de guare serre. RABELAIS, IV, 33.
Guargareon, Guargarizer, Guarigue, v. Gargareon, Gargariser, Garrigue.
Guarir. Protéger, sauver. Voir Guérite. Guérir. — Pour cuyder guarir ceste playe ilz
ont inventé un moyen d'acquérir dignité. CALVIN, Instit., XII, p. 648. — Venus guarit son bien aymé filz iEneas blessé en la cuisse dextre. R A B E LAIS, IV, 62. — Comment la Quinte-Essence gua-rissoit les malades par chansons. I D ., V, 19. — Au seul escart d'un plus secret ombrage, Je sens guarir ceste amoureuse rage Qui m e r'afole au plus verd de mes mois. R O N S A R D , Amours de Cassandre (I, 7). — Ne guarist-il pas la morsure D'aspics noiraux...? R. B E L L E A U , Petites Inventions, la Tortue (1, 68). — La déesse... luy enseigna une médecine de laquelle il guarit facilement le patient. A M Y O T , Périclès, 13. — Soyez moy douce et guarissez m a playe. R O N S A R D , Elégies, 17 (IV, 101). — V i e n donc, vin de couleur belle... Garir mon rheume et m a toux ! J E A N L E H O U X , Chansons du Vau de Vire, I, 77. — Il faut que de mon mal seule ayez connoissance, Puis que de m'en guarir seule avez la puissance. D E S P O R T E S ,
GUAR1TE
Elégies, 1,10. — Se complaire outre mesure de ce qu'on est... est à mon advis la substance de ce vice [la présomption]. Le suprême remède à le guarir, c'est faire tout le rebours de ce que ceux icy ordonnent. M O N T A I G N E , II, 6 (II, 66). — [Les médecins] pour ne guarir le cerveau au préjudice de l'estomach, offencent l'estomach et empirent le cerveau. ID., II, 37 (III, 222). — Le duc de Sa-voye en avoit aussi pris, pour le guarir de la boulimie et gloutonnie. Sat. Men., Vertu du Catholi-con, p. 42. — Et toutes pour guarir se reforçoient de boire. R É G N I E R , Sat. 11. Ne guarir de rien. Ne servir à rien. — Tant de
voyages à la court, tant de cahiers de remons-trances et de supplications en peuvent faire foy. Tout cela n'a guary de rien : le mal s'augmentent tousjours s'est rendu presque incurable. 1580. Lett. miss, de H E N R I IV, t. I, p. 286 (G.). — De vous dire son nom il ne guarit de rien. R É G N I E R Sat. 10.
Guarir que. Éviter que. — Pour guarir qu'un homme ne voise en garouage. C Y R E F O U C A U L T , trad. d'ARisTENET, p. 82, Liseux (G., Garouage).
Guérir (subst.). — Quand venoit au guérir, ils jettoient grande effusion de sang par la bouche, E. PASQUIER, Recherches, IV, 28. Guarison. Guérison. — Tout consulté, ont remis au printemps M a guarison. M A R O T , Epistres, 29. — La cérémonie ne se devoit prétendre sinon de ceux qui avoient la grâce de donner garison : non pas de ces bourreaux, qui sont plus puissans à tuer et meurtrir que à guérir. CALVIN, Instit., XIII, p. 684. —• Les chirurgiens ayans veu ses playes luy donnèrent espérance de briefve guarison. Amadis, IV, 23. — Puis nous monstra les orgues, desquelles sonnant faisoit ces admirables guarisons. RA B E L A I S , V, 19. —• Ha mort, ô douce mort, mort seule guarison Des esprits oppressez d'une estrange prison. J O D E L L E , Cléopatre, IV (1,139). — Quand Dieu navre ainsi ses fidèles, il adoucit incontinent leurs playes et y donne guarison. CALVIN, Serm. sur le liv. de Job, 35 (XXXIII, 433). — La guarison en vos mains vous avez D u mal d'amour qui jusqu'au cœur me touche. D E S P O R T E S , Diane, II, 17. —• M e rencontrant un jour à Thoulouse chez un riche vieillard pulmonique et traittant avec luy des moyens de sa guarison. M O N T A I G N E , I, 20 (I, 105). — Les médecins luy conseillèrent d'user d'une grande abstinence. Ayant jeune deux jours, il est si bien amendé qu'ils luy déclarent sa guarison. ID., II, 13 (II, 390). — L e malade n'est pas à plaindre, qui a la guarison en sa manche. ID., III, 3 (III, 295). — La descharge du mal présent n'est pas guarison. ID., III, 9 (IV, 60).
Guarisseur. Guérisseur. — O vanité ! ô oyseux gaudisseurs ! Aymez, prisez, reçuz de gua-risseurs De gens lesquels n'ont point de maulx extresmes : Des guarisseurs? mais guarisseurs eulx mesmes. D E S PÉRIERS, Prognost. des prognost. (I, 136). Guarite. Guérite, créneau. — Ayant ainsi prié
le Dieu des exercites, Le gouverneur pourvoit de soldats les garites. D u B A R T A S , Judith, III, p. 374. —• Ce garitez vient de garite : de laquelle on s'aidoit aussi es portes : comme nous voyons en cest endroit du R o m m a n de Perceforest, Adonc s'en vient la guette aux garites de la porte. H. E S T I E N N E , Precellence, p. 358. — Les anges du ciel estoient disposez en chasque fenestre, comme en autant de garites. L E L O Y E R , Hist. des Spectres, IV, 24. — Le mareschal d'Amville... faisoit ses entrées es villes réformées comme s'il
17 —
GUARLANDE — 398 —
les eust prises par force, faisant planter les drapeaux aux tours et guarites. A U B I G N É , Hist. univ., IV, 1. — Les garites de pierres de taille brisées de mousquetade, on regagne par eschèles le dessus d'une tour. ID., ib., XI, 4.
Gagner à la guérite, gagner la guérite, prendre la garite. S'enfuir. — Et gens de bien et les meschans Ont tout gaigne à la guérite. M A R O T , Epistres, 63. — [Le loup] s'est arresté ; Mais oyant approcher la tempestante suite, D'un pied non paresseux il gagne la guérite. CL. G A U C H E T , le Plaisir des champs, VHyver, Chasse du loup, p. 322. — Poltrot jusques là estoit demeuré en cervelle, mais soudain qu'il eut fait le coup, se trouva tellement esperdu, qu'ayant pris la garite pour se sauver, quelque fracassement qu'il fit toute la nuit, qui fut de plus de dix lieues, il se trouva le matin au milieu du camp des Suisses. E. PASQUIER, Lettres, IV, 20. — Le chasseur qui poursuit par une adresse vite U n lièvre qui par l'haut d'un mont prend la garite. P. M A T T H I E U , Vasthi, V, p. 101. Guarlande, v. Girlande.
Guarnier, v. Grenier. Guarnir, Guarnison, Guarre, Guarrigue,
Guarrot, Guast, Guasteur, Guatte, Gua-vache, v. Garnir, Garnison, Garre, Garrigue, Garrot, Gast. Gasteur, Gatte, Gavache. Guart. — Dieu sauve et deffende celle Qui
sous sa robe recelle Le guart [lire quart] qu'on ne connoist pas. P A S S E R A T , Estrenes (II, 161).
Guay. Geai. Voir Gay 2.
Guayer, v. Gueer.
Guayeté, v. Gayeté.
Gubernateur (gubernator). Pilote. — Luy seul... monta sur petit navigage... et ne permist point le gubernateur de la nef en dangier de périr entre les procelles et tempestes marines et fluctueuses undes rétrocéder. M I C H E L D E T O U R S , trad. de S U É T O N E , I, 27 v°. Gouverneur, chef, souverain. — Les seigneurs
de Lunel et tous les magnats et principaux gu-bernateurs avec toute la noblesse du pays. J. D ' A U T O N , Chron., I, 37 (G.). — Gubernateur et pillier de l'esglise, Reveramment par devant vous m'adresse. G R I N G O R E , Chasse du cerf des cerfs (I, 167). — C'estoit mon tuteur curateur, Mon zélateur gubernateur. R. D E C O L L E R Y E , Complainctes, 1. — Gens d'auctorité, Politicques, gubernateurs. Ane Poés. franc., XI, 47. — Toy, Neptun us, gubernateur des rieulx. Ib., XI, 94. — Survindrent les lettres de Junias Vindice, qui le supplioit et exortoit quil se feist empereur pour tout lhumain lignage, duc et gubernateur. M I C H E L D E T O U R S , trad. de S U É T O N E , VII, 224 v°.
(En parlant de Dieu). — Lesquelz le souverain gubernateur de ceste mer mondaine a voulu retirer à luy. L E M A I R E D E B E L G E S , le Temple d'Honneur et de Vertus (IV, 184). — O Dieu tressainct et égal gubernateur du ciel et de la terre. Trad. de B O C C A C E , Flammette (1537), ch. n, 29 r°. — Dieu tout puissant, éternel rédempteur, De tout le monde unie gubernateur. P H . B U G N Y O N , Ero-tasmes de Phidie et Gelasine, Oraison à J.-C, p. 64.
(Fém.). Gubernatrice. —• Dame régente es cieulx impératrice, De tous humains humble gubernatrice. M I C H E L D'AMBOISE, Rondeaux, 149 r°. — Estant à Juno plus appropriée l'universalité de l'air, elle est à raison nommée la vertu gubernatrice de tout le monde. P O N T U S D E T Y A R D ,
trad. de l'Amour de L É O N H E B R I E U , Dial. H, p. 219. — Ceste vertu semble estre seule politique] et presque gubernatrice des actions, charges, dignitez et administrations dispersées par toutes les parties de la chose publique. L E C A R O N , la Claire, 36 (Vaganay, Deux mille mots). — Et là j'ay prins Nature pour tutrice, Et de mes ans jeunes gubernatrice. F E R R Y J U L Y O T , lre part., 11 (4e Elegk).
Gué. Pousser au gué. Pousser en avant? —Mais comment est-ce que la chose... Dont vous m'avez interrogué Nous a si fort poussez au gué? Où sommes nous venus ainsi? J O D E L L E , Eugène, 11,2.
Taster le gué, sonder le gué. Tâter le terrain; dans une entreprise, voir quels sont les risques. — Je ne sçay à quelle fin ilz avoient posé ce terme, sinon qu'ilz vouloient taster le gué ; et peult-estre que, si le roy de France eust eu du pire, en lieu de courir aux Véniciens, eussent couru sur luy-mesmes. L E L O Y A L S E R V I T E U R , Hist. de Bayart, ch. 28. — Ce disoit elle pour sonder le gay, et entendre asseurément de Norandel si ses parolles estoient teintes ou non. Amadis, V, 43. — Luy... voulant sonder le gué davantage aux propos de Philopole... luy dit. E. PASQUIER, MonophUe, L. I (II, 702). — Cestuy... sonde le gay de tous costez, pour voir quelle issue pourrait avoir cette requeste. ID., Recherches, III, 44. — II [César].., ne passa jamais son armée en lieu qu'il n'eust premièrement recognu. Et... quand il fit l'entreprise de trajetter en Angleterre, il fut le premier à sonder le gué. M O N T A I G N E , II, 34 (III, 169). — Nous trouvasmes cest expédient que, avant qu'entrer en capitulation particulière, nous deussions sonder le gué, pour sçavoir si le ducq de Parme voudrait traicter generallement avecq toutes les provinces unies. P H . D E M A R N I X , Corresp. et Mélanges, p. 422. — Avant que de partir, il envoya trois evesques à Paris, comme avant-coureurs, pour sonder le gué. E. PASQUIER, Recherches, V, 25.
Tenter le gué. Explorer le terrain. — Hydaspes pensa que ce ne seroit pas sagement fait à luy d'entrer pour lors en personne dedans la ville : mais bien y envoya il deux bendes de gens de pied bien armez pour tenter le gué et descouvrir s'il n'y avoit point quelque embusche. AMYOT, Hist. Mïhiop., L. IX, 102 v°. Courir le risque, tenter l'aventure. — Quand
ils se oubliroyent jusques-là de tenter le gué, il n'y a si petit marchant ne artisan... qui ne leur résistassent en face. R É G N I E R D E LA PLANCHE, Livre des marchands, II, 271. — Je vas tanterle gué, et vaille que vaille. L A R I V E Y , les Escoliers, 1,3. .
Gué. Abreuvoir. — Harpoys employé a cimenter lesdits guet et fontaine. 1521. Acquits de Laon (G.). Boire à petit gué. Boire peu. —• Boyre à si petit
gué : c'est pour rompre son poictral. RABELAIS, 1,5.
Gueder (se). Se gonfler. — Moy, qui n'ay bougé d'estre couché en ceste place... ay prins... tant de gibier que c'est merveille, et dont je me suis tant guedé et remply que j'en crevé. LARIV E Y , trad. des Facétieuses Nuits de STRAPAROLE, X, 2. — O le brave h o m m e que le seigneur Am-broise ! Ce vilain avoit préparé un banquet pour faire nopees. C o m m e je m'y suis guedé, comme l'alaine m e flaire bon ! ID., la Vefve, II, 6.
Guedé. Gonflé. — Et nostre batelier lequel, guedé à flac, Se mit à chansoner les amours de samie. FR . H A B E R T , trad. d'HoRACE, Satyres, 1,5, Paraphrase. — Heures n'estoient envers vous que
minutes Quant vostre ventre estoit plain et guedé. Ane Poés. franc., XI, 70. — Si j'avoie donné deux coups dans ces barbes féminines, principalement guedé et en Pestât que je suis, ce seroit fait de moy. C H O L I È R E S , 6e Ap.-disnée, p. 230. Guedofle, v. Guedoufle.
Guedon-Guedon. Façons, manières. — Ces conditions furent acceptées de tous, encores que les filles en fissent un peu de guedon-guedon. TABOUROT D E S A C C O R D S , Escraignes dijonnoises (III, 235). I Guedoufle. Petite bouteille, flacon. — 1 1 avoit une petite guedoufle pleine de vieille huyle. R A BELAIS, II, 16. — Une guedofle de vinaigre. ID., Il, 27. — Que nuist sçavoir tousjours, et tous-jours aprendre, feust ce d'un sot, d'un pot, d'une guedoufle, d'une moufle, d'une pantoufle? ID., III, 16. — Quaresme-prenant... avoit... les couilles comme une guedoufle. ID., IV, 31. Gueer (trans.). Passera gué. —• Esloignerent
le passaige et se misrent a gueer la rivière. J. D'AUTON, Chron., I, 259 (G., Compl.). — Les seigneurs et dames francoys... trouvèrent les petitz ruisseaux si fort creuz que à peine les peurent ilz gueyer. M A R G . D E NAV., Heptam., Prologue. — On le choisira [le cheval]... prompt et asseuré à gayer les rivières, à passer sur les ponts. O. D E SERRES, Théâtre d'agric, IV, 10. — Ceux qui ne pouvoient guayer les rivières se mettoient sur leurs boucliers, qui leur servoient de bateaux. LESGARBOT, Hist. de la Nouv. Fr., III, 828 (G. Compl,). Faire boire [un cheval] à un abreuvoir, à une
rivière, etc. — L'un faisoit semblant de relier la courroye de son soulier qui estoit desliee, l'autre de vouloir guayer son cheval, l'autre boire. AMYOT, Paul Emile, 23. Faire rafraîchir [un cheval] dans l'eau. — La
mer Adriatique n'est pas loing delà, laquelle on nomme le golfe de Venise ; vers icelle Cingar alloit pour guayer ses chevaux. Trad. de F O L E N G O , L. XII (I, 320). Se gueer. Être guéable. — Le long de la rivière
de Lain, qui servoit seulement de barrière a ces deux armées, encores qu'elle se guee entre ces deux villes pour le moins en une douzaine de lieux. Faits memor. adv. en 1587, 34 v° (G., Compl.). Gueer (subst.). Action de passer à gué. — Au
gayer d'une rivière... ils l'assaillirent. L E M A Ç O N , trad. de BOCCACE , Decameron, II, 2. Guel. Bai? — Vache en poil guel. 21 oct. 1510.
Arch. Finist. (G.). — Ung beuff guel. Deux génisses l'une guel et l'autre garre. Ib. Gueldin, v. Guildin. Guelfe 1. A la guelfe. En prenant pour soi la
meilleure part, en frustrant l'un des partageants (La Curne). — Cingar... divise ce poisson en trois parts seulement à la guelfe, ne faisant que trois portions de tout : la première vers la teste, la seconde estoit du corps, et la troisiesme estoit de la queue. Trad. de F O L E N G O , L. X V (II, 22). Le passage nous montre quatre convives, dont l'un n'aura rien. En mettant la plume au côté droit du bonnet.
— Aucunefois en accoustrement d'homme Je pas-sageoy pompeusement par R o m e Sur un cheval de mesme enharnaché, Et le pennache à la guelphe attaché, Ne me monstrois moins superbe et vaillante Qu'une Marphise ou une Bradamante. D u BELLAY, Jeux rustiques, la Vieille Courtisanne. —
GUEMENTER
Et tousjours... estoit fort bien accoustrée d'un fort beau et riche habillement de cheval, sans oublier surtout le chapeau bien garny de plumes et à la guelfe porté. B R A N T Ô M E , des Dames, part. 1, Diane de France (VIII, 143). Guelfe 2. Sorte de petit navire. — Il aborda une guelfe au navire de nostre capitaine. L É O N , Descr. de l'Afrique, Voy. de Corsai, II, 150 (G.).
Gueliel, Guelier 1, mot d'argot. — Gueliel, le diable. Var. hist. et litt., VIII, 181. — En quelques carriers du pays d'Anjou on usurpe le nom de guelier pour un diable. L E L O Y E R , Hist. des Spectres, III, 5.
Vain guelier. Garou. Var. hist. et litt., VIII, 190. Guelier 2, mot d'argot. — Le guelier te gousse, c'est à dire, les avives te coupent la gorge. GUILL. B O U C H E T , 15e Seree (III, 130).
Guelphe, v. Guelfe 1.
Guementer (trans.). Se lamenter au sujet de, plaindre. — O noble roy de France, Tant aymé et requis... Ung chacun te guemente En te plaignant très fort. 1525. Chans. sur la bat. de Pavie (G., Guaimenter). Se lamenter sur, se plaindre de. —• Aussi ne
vous doibvent mouvoir a pitié les lamentations et misérables remonstrances quilz font en requérant a leur ayde les sepulchres de voz ancestres et gue-mentant leur solitude. SEYSSEL, trad. de T H U C Y DIDE, III, 10 (99 r°). — En guementant toutesfois sa fortune et son malheur, en la manière que le roy Menelaus guementoit la sienne. ID., Success. d'Alexandre, IV, 9. — Ainsi guementoit sa vie, De vain espoir espérant, Ton Sauvageot, las, craignant Que ne lui fusses ravie. V A U Q U E L I N D E LA F R E S N A Y E , les Foresteries, II, 1. S'informer de, demander. — Elle [l'Eglise ro
maine] a tracassé, couru, trépigné de tous costés pour fonder et quementer ce qu'il y avoit de beau et pretieux es boutiques des aultres marchands. P H . D E M A R N I X , Differ. de la Relig., Il, v, 8.
(Intrans.). S'occuper. — De chantz plaisans ne fault plus guermenter, Mais en douleurs vous expérimenter. CRÉTIN, Deplor. sur le trespas d'Okergan, p. 43.
Se guementer. Se plaindre, se lamenter. — Qui confort n'a, si s'en guermente. Ane Poés. franc., IX, 127. — Nulluy se peult ny doibt gamenter ou plaindre de la pesanteur et charge des armes. Trad. de F L A V E V E G E C E , IV, 44 (G., Guaimenter). — Ce nest a tort si je pleure ou lamente, Si tellement je m e plains et guermente. M I C H E L D'AMBOISE, Epistres et Lettres amoureuses, 117 v°. — Flamette en soy griefvement tourmentée en se guermentant faict ses extresmes exclamations. M A U R I C E S C È V E , la Deplourable Fin de Flamete, ch. 25. — Se guermentant et douleant faict une exclamation contre amours. Trad. de B O C C A C E , Flammette (1537), ch. i, 12 v°. — Menelaus moult travaille et labeure, Moult se guermente, et souvent pleint et pleure. C H . F O N T A I N E , les XXI Epistres CTOVIDE, Ep. 13, p. 245.
S'occuper. — Quant en lyesse estoye De nulle chose point ne m e guermentoye, Fors seullement de faire bonne chère. Ane Poés. franc., XII, 98.
S'informer. — Il est de présent pauvre gaignedenier à Lyon... Et tousjours se guemente à tous estrangiers de la venue des cocquecigrues, espérant certainement... estre à leur venue réintégré à son royaulme. R A B E L A I S , I, 49. — En D. Claude empereur prédécesseur de Aurelian, auquel se guementant de sa postérité, advint ce vers en sort. ID., III, 10. — Si commencèrent courir,
)9 —
GUENAUD — 400 —
s'enquérir, guementer, informer par quel moyen, en quel lieu, en quel jour, à quelle heure... luy estoit ce grand thesaur advenu. ID., IV, Prologue. — Tibère... se guementant es gens doctes... qui estoit cestuy Pan, trouva par leur raport qu'il avoit esté filz de Mercure et de Pénélope. ID., IV, 28. — S'escrierent... tous ensemble demandans. Le avez vous veu, gens passagiers?... — Qui est il? demanda frère Jan. Par la mort beuf, je l'assommeray de coups. Pensant qu'ilz se gue-mentassent de quelque larron, meurtrier et sacrilège. ID., IV, 48.
Se demander. — Quelques uns... s'estonneront de premier abord, lisants ce filtre, Nouvelles des régions de la lune, se guementans... si faire se peut qu'ayons monté si haut sans tomber. Supplément du Catholicon, Préface, dans Tricotel, édit. de la Sat. Men., II, 14. Guenaud. Gueux, mendiant. — Les guenaulx
de sainct Innocent se chauffoyent le cul des osse-mens des mors. R A B E L A I S , II, 7. — U n tas de cor-netz tous pleins de puises et poux, qu'il emprun-toit des guenaulx de sainct Innocent. ID., 11, 16. — Ne pensez que je Paye mis au colliege de pouil-lerie qu'on nomme Montagu, mieulx le eusse voulu mettre entre les guenaux de sainct Innocent. ID., I, 37. — Nous ne sçavions où loger, et estions devenus... pauvres comme guenaux. Supplément du Catholicon, 2, dans Tricotel, édit. de la Sat. Men,, II, 22.
Pou. — Vous voulez nous priver d'un si précieux joyau qu'est la barbe, parce qu'il y a des guenaux qui prennent leur repaire es forests bar-besques ! CH O L I È R E S , 6e Ap.-disnée, p. 272.
Guenchir. Se détourner. — [La lance de Mé-nélas] attaingnit Paris jusques à la chemise. Et de fait eust entamé sa poitrine, se neust esté quil guenchit au coup, et se humilia soupplement à costé. L E M A I R E D E B E L G E S , Illustr., Il, 17.
Guenet (oye), v. Oye. Gueniche. Guenon. — [Ils] mangeoyent de la
chair de beuf, de vache, d'ours, de gueniche. L. G U Y O N , Miroir de la beauté, II, 39 (G,). Guenichon, dimin. de gueniche. — Le gueni-
chon qui fait la moue, Qui du lion s'atache et joue A la queue, en fin l'ennuira. BAÏF, les Mimes, L. II (V, 86).
Guenon. Sorte de singe de petite taille à longue queue. — Fin come un viel guenon. FR. H A B E R T , trad. d'HoRACE, Satyres, II, 5, Paraphrase. —• C'est luy qui gouverna sous Jules un guenon, Et qui pour son guenon eust mainte prelature. O. D E M A G N Y , les Souspirs, sonn. 143. — Les plus dangereux entra les singes sont les magots et ba-boins : mais les guenons et marmots sont les plus amiables de tous. M. D E LA P O R T E , Epithetes, 378 v°. — Tu as le nez comme un guenon. BAÏF, Passetems, L. III (IV, 367). — Si le lion en sa fièvre entre, Le guenon logé dans son ventre De cure au lion servira. ID., les Mimes, L. II (V, 86). — A l'enfant ne baille une espee, N y au guenon une poupée. ID., ib., L. III (V, 172). — Je voy l'accort guenon, la mignarde belete. D u B A R T A S , lre Semaine, 6e Jour, p. 264. — (Fig.). Je tueray Mardoché, ce grommelant guenon. P. M A T T H I E U , Aman, III, p. 76. Imitateur (dans un sens péjoratif). — Telle que
le François qui, guenon affeté Des estrangeres mœurs, se paist de nouveauté : Et se mue, inconstant, si souvent de chemise Que de ses vains habits la façon il déguise. D u B A R T A S , lre Semaine, 2e Jour, p. 51. — (A Satan). Tout cela seroit peu,
si ta maligne audace Espargnoit pour le moins des saincts anges la face : Et si pour aveugler les plus fins des humains, Guenon, tu n'imitois du Tout-puissant les mains. ID., 2e Semaine, 1er Jour, l'Imposture, p. 60. — Ils ont, ainsi que nous, une Bible, une Loy, Tant ils sont fins guenons de l'Eglise fidèle. ID., le Triomphe de la Foy, ch. 2, p. 436. — Il [Aman] veut qu'on le révère, et qu'au monde on le prise, Tant ce guenon de roy si bien son front desguise. P. MATTHIEU, Aman, II, p. 35. A la guenonne. C o m m e les guenons. — La gorge
douillette et mignonne, La queue longue à la guenonne. D u B E L L A Y , Jeux rustiques, Epitaphe d'un chat. Guepiere, v. Guespiere. Guepillon. Goupillon. — Guepillon. Asper
geant, retors, longuet, touffu, nettoyant. M. DE LA P O R T E , Epithetes, 199 r°. — Il ne faut que s'armer la teste d'un coqueluchon... les mains d'un guepillon d'eau bénite. P H . D E MARNIX, Differ. de la Relig., 1, v, 10. — Elle leur subvient avec de l'eau lustrale gringorienne, de laquelle on arrouse fort dévotement leurs sepulchres avec un asperget ou guepillon de soie de porc. ID., ib., II, iv, 20. — Souvent il l'encensoit, et aveclegui-pillon l'aspergeoit d'eau bénite. Trad. de FOL E N G O , L. IX (1,242). Guepillonner. Jeter avec un goupillon. — Si
tu te guepillonnes par les moustaches un trançon d'eau bénite. P H . D E M A R N I X , Differ. de la Relig., II,i,3. Asperger. — Des lors tant que le cyprès ait levé,
faut faire le guet sur les fourmis, et aussi le gues-pillonner d'eau de trois en trois jours avant soleil levé. L I E B A U L T , Mais, rust., p. 332 (G.). Bien guepillonné. — Un asperges d'eau bénite
bien guepillonné y servirait d'exposition et de commentaire. ID., ib., 1, iv, 17. Guepillonneux, dérivé de guepillon. — As
pergez. Retors... arrousant, guepillonneux. M. DE LA P O R T E , Epithetes, 34 v°. Guerbe, Guerbé, v. Garbe. Guerda, exclamation. — Guerda ! voiez vous
comment ils sont nostres? P H . D E MARNIX, Differ. de la Relig., I, iv, 16.
Guerdon 1. Récompense. — Elle [Hélène] prenoit singulière volupté en deux choses : lune de ce quelle avoit esté louée par la déesse Venus, et lautre de ce que Paris pour son guerdon lavoit préférée aux richesses de dame Juno et aux vertus de la déesse Pallas. L E M A I R E D E BELGES, Illustr., II, 7. — La Mère vous fera des biens Si vous vouliez estre des siens ; Par elle aurez de grans gardons. G R I N G O R E , le Prince des Sotz, sottie (I, 234). — Las ! quels mercys tu rends pour un tel don ! O quel ingrat et contraire guerdon ! M A R O T , Tristes vers de B E R O A L D E . — Parquoy, ainsi qu'à chascun son mérite Requiert esgal et semblable guerdon, Méritera mon léger démente D'estre puny d'un plus léger pardon. MAURICE S C È V E , Délie, 32. — [Jupiter] Baisant ses filles, leur commande De luy requérir, pour guerdon De leurs chansons, quelque beau don. RONSARD, Odes, I, 10 (II, 130). — Vien donque, Somme, et distile Sur mes yeux ton onde utile, Et tu auras en pur don U n beau tableau pour guerdon. 1D;, ib., IV, 8. — Epialtes... pour l'espoir qu'il avoit de reporter quelque bon guerdon, luy enseigna une sente qui conduisoit aux Thermopyles. OA-LIAT, trad. d'HÉRODOTE, VII, 213. — Quel piteux loyer et guerdon d'un long et cordial ser-
vice ! E. PASQUIER, Lettres amoureuses, 5 (II, gjO). — Or avoient tous déjà receu leurs dons, Bien glorieux de si riches guerdons. D E S M A SURES, Enéide, V, p. 223. — Ainsi, pour le guerdon de vos vertus prisées, Puissent à tout jamais les plaines Elysees Verser en vos gosiers le nectar précieux Et le manger divin que savourent les dieux. R. GARNIER, Porcie, 279. — (Au laurier). Tu seras de la victoire Et la couronne et la gloire, Quand le vaincueur pour guerdon De solemnelle mémoire Recevra ta fueille en don. BAÏF, Poèmes, L. I (II, 54). — Quant à moy, si le verd lierre, Guerdon des doctes frons, enserre Mes tempes d'un chapeau gaillard, Je suis faict dieu. ID., ib., L. VII (II, 363). — Pource en guerdon de sa fidélité Et de ses faicts qui l'avoyent mérité, On le fit chef de cinquante hommes d'armes. A M . J A M Y N , Œuv. poet., L. V, 301 v°. — Un bien fait n'est jamais fraudé de son guerdon. D u B A R T A S , 2e Semaine, 4e Jour, le Schisme, p. 502. — L'ame qui demeureroit en estre souffriroit la peyne deue aux péchés, et recevrait le guerdon des vertus. S' FRANÇOIS D E SALES, Controverses, III, n, 5. —
Pourquoy plus tost a tes fautes passées Ne pences tu, te souvenant des biens Et du guerdon que Dieu promet aux siens? P. D E B R A C H , Hieru-salem, II, 92 v°. — Le guerdon seul de gloire est propre et convenable A couronner en l'homme une action louable. M O N T C H R E S T I E N , Hector, III, p. 35. — O Seigneur, tes bontez ceste audace m'inspirent, Promettant aux pécheurs qui vers toy se retirent, Non seulement pitié, mais faveur et guerdon. B E R T A U T , Cantique, p. 9. Rétribution, paiement. — Il nous faudra main
tenant voir par quelz moyens ilz se sont entrete-nuz avecques les princes chrestiens : quelz privilèges ils ont d'eux : et quelz guerdons ilz leur en ont rendu. L E M A I R E D E B E L G E S , la Légende des Vénitiens, ch. 2. — Mais de quoi faut-il payer un si grand don? D'un présent tant haut où seroit le guerdon...? A U B I G N É , Poes. relig. en vers mesurés (III, 280). Dédommagement. — Or donques de la peine
Et de l'ennuy dont mon amour est pleine, Je recevray pour guerdon le trespas? BAÏF, les Amours de Meline, L. I (1,17). — Si celuy qui n'a pas faict ce dequoy on l'accuse est assez patient pour supporter ces tourments, pourquoy ne le sera celuy qui l'a faict, un si beau guerdon que la vie luy estant proposé? M O N T A I G N E , II, 5 (II, 50). Punition. — Le galant te decepvra... pour ce ue c'est le pris et guerdon de folle amour. P. D E HANGY, Instit. de la femme chrest., I, 14. — J'ay
advancé ma ruyne honteuse, recevant justement le guerdon que méritent ceulx lesquelz... cuident remédier à un mal par l'acheminement d'un aultre pire. Amadis, V, 5. — Une autre vanité sur la terre habitable Se fait de jour en jour, c'est qu'il advient au bon Ce qui deust advenir au méchant pour guerdon. R. B E L L E A U , Discours de la Vanité, ch. 8 (11, 285). — Qu'il rôtisse aux brasiers où les plus tourmentez Reçoivent le guerdon de leurs mechancetez. R. G A R N I E R , Porcie, 1647. — 11 s'attaque à Junon, dont ne veit que l'idole, Prompt et juste guerdon de son emprise foie. R. BELLEAU, la Bergerie, 2e Journ., Amour ambitieux d'Ixion (II, 25). Guerdon 2, v. Gardon 1.
Guerdonnement. Récompense. — Pour les bienfaicts et guerdonnemens de leur service, que Pompeie leur avoit promis, et ne les en avoit encore satisfaicts. B U D É , Instit. du prince, ch. 48. Guerdonner (trans.). Récompenser. — [Osi-IV
GUERDONNER
ris] alla en la terre des Indes et des Ethiopiens, ausquelz il feit de grans biens, en monstrant au rude peuple la manière de labourer la terre et une bonne manière de vivre en ordre de police et justice, en punissant les mauvais et guerdonnant les bons. L E M A I R E D E B E L G E S , Illustr., I, 7. — [Jupiter] Bien m e congneut et bien m e guerdonna Lors qu'à sa sœur Pallas il m e donna. M A R O T , l'Enfer. — Dame, on vient guerdonner d'une amour mutuelle Mon amour envers toy, t'acor-dant de m'aimer. BAÏF, l'Amour de Francine, L. I (1, 117). — Honneur, le seul loyer qui la vertu guerdonne. D u B E L L A Y , Discours au roy sur la poésie. — Que la seule vertu seulement on guerdonne : Si tu le fais ainsi, tu seras bien servi. R O N S A R D , Eclogues, 1 (111, 392). — Autrement vous feriez pis qu'un Scythe barbare, Si vous guerdonniez moins qui a plus mérité. BAÏF, Poèmes, L. II (II, 103). — Tout prince doit au crime attacher le supplice, Et de ses bons sujets guerdonner le service. R. G A R N I E R , les Juifves, 260. — Nous en voyons plusieurs en une cour, quand ils ont receu quelque beau présent de leur prince, ne cesser de le magnifier, disans : O que nous avons un bon maistre, qui nous guerdonne de si belles recompenses! L A N O U E , Disc polit. et milit., XXIV, p. 619. — Si les mauvais François sont bien recompensez, Si les plus gens de bien sont les moins avancez, Soyons un peu mes-chants. On guerdonne l'offense : Qui n'a point faict de mal n'a point de recompense. Sat. Men., 2e Advis de l'imprimeur. — Le duc de Saxe faisoit faire en sa présence des homélies sur les similitudes de David et de ce prince, honnoroit et guer-donnoit ceux qui trouvoient plus de grâces au dernier qu'au premier. A U B I G N É , Sancy, II, 3.
Mal récompenser, payer [d'ingratitude]. — Puis que mon feu violant De ces tourments tu guerdones. BAÏF, les Amours de Meline, L. II (I, 74). — Que m e sert, discourant sur m a perte, aviser Qu'on se moque du mal qui trop m e passionne, Et que d'un fier dédain mon martyre on guerdonne...? A M . J A M Y N , ŒUV. poet., L. IV, 164 v°.
Punir. — Tu seras maintenant guerdonnée selon ton tresgrief pechié. A. SEVIN, trad. de B O C CACE, le Philocope, L. VII, 155 r°. — Dieu, pour guerdonner sa vie mauvaise et ses débauches, luy donna le salaire qu'il meritoit. L E L O Y E R , Hist. des Spectres, IV, 26. Se dédommager de. — Te jurant par les eaux
d'embas... Que tu recouvrerois ta perte, Et qu'encore un temps demourrois Avecques ta fille, et pourrois Guerdonner ta peine soufferte. O. D E M A G N Y , Odes, 1, 8.
(Intrans.). Donner une récompense ou une punition. — Très doux Dieu, je vous remercie, Car on ne vous peult trop louer ; Or bien sçavez gar-donner A chascun selon sa déserte. Ane Théâtre franc., III, 285.
Guerdonner qqch à qqn. Récompenser qqn de qqch. — Soyez secourable à povres veufves et aux orphelins, et Dieu vous le guerdonnera. L E LOYAL SERVITEUR, Hist. de Bayart, ch. 2. Se guerdonner. Se récompenser. — Donque
fuïez ce mauvais guerdonneur Qu'on nomme amour. Ne suivez que l'honneur. Le saint honneur luy-mesme se guerdonne. BAÏF, Poèmes, L. IV (II, 190).
Guerdonne. Récompensé. — En me suyvant vous avez blasonné, Dont haultement je me sens guerdonne. MARO T , Epistres, 41. Dédommagé. — Francine, tu me dis si tu estois certaine Que je t'aymasse autant comme je te le 26
)1
GUERDONNEUR — 402 —
dy... Que je seroy bien tost guerdonne de ma peine. BAÏF, l'Amour de Francine, L. Il (1, 148). — Si vostre esprit divin, tout au ciel adonné, Un jour tant seulement s'abaissoit en la terre, Pour voir de quels liens vostre rigueur m'enserre, Assez je m e tiendrais en mes maux guerdonne. D E S PORTES, Cleonice, 38. — Là se voit, à main droite, une figure sainte D u paradis heureux des amans fortunez, De leurs longues douleurs à la fin guer-donnez. ID., Elégies, L. II, Eurylas.
Doué. — Vostre aage est tant de grâces guerdonne Qu'à tous les coups un printemps estimable Pour vostre yver seroit abandonné. M A ROT, Epigrammes, 112.
Guerdonneur. Celui qui récompense et qui punit. — Le Dieu puissant, le juste guerdonneur... Préservera le filz, père et grant père. Ane Poés. franc., I, 231. —• O dieu tenant, maistre de la tempeste, D'un feu vangeur foudroyé ceste teste, Si de nos faits tu es vray guerdonneur. BAÏF, les Amours de Meline, L. I (1, 31). — Le ciel guerdonneur Des bons et des mauvais. P. M A T T H I E U , Vasthi, III, p. 53. Celui qui récompense. — Lautre estoit ton
frare germain, le bon roy Charles huytiesme... le facteur atraiant des engins scientifiques, l'excitateur des lettres et le guerdonneur des mérites. L E M A I R E D E B E L G E S , le Temple d'Honneur et de Vertus (IV, 227). — (A Minos). Roy juste guerdonneur, Voicy lesprit dun gracieux amant. ID., 2e Epistre de l'Amant verd (III, 26). — Et toy, amy, croy moy, car guerdonneur Je te seray, si craintif ne te sens. M A R O T , Epistres, 2. —• Droict à chascun, remply de vray honneur : A un chascun libéral guerdonneur. FR. H A B E R T , Deplor. de Du Prat. — Vostre beauté le commande et ordonne, Et vostre los de vertu guerdonneur. M E LIN D E S* G E L A Y S , Huitains (II, 51). — C o m m e les grans je sacre ton honneur A u Dieu qui t'est si large guerdonneur Qu'on voit tes vers te couronner toy mesme. C L A U D E G H U G E T à O. de Magny, dans les Amours, p. 16. —• Le Temps certain, qui les hommes avance, De ses vertus sera le guerdonneur. R O N S A R D , Sonnets divers (VI, 337). —• Vray est que le peu d'honneur Que porte à ces neuf Charités Ce siècle, ingrat guerdonneur De tous vertueux mérites, M'a fait d'esprit, d'ieux et mains Fouiller les loix des Romains. B E R E A U , Odes, 2. — L'homme a le libéral arbitre, entant qu'il est homme, par lequel il faict ses œuvres méritoires ou desmeritoires : d'où il s'ensuit par nécessité qu'il y a en nature quelque guerdonneur et quelque punisseur. M O N T A I G N E , trad. de R. S E B O N , ch. 86. — (A Homère). Je te salue, éternel guerdonneur Des preux guerriers : par toy leur bel honneur Florit encor. BAÏF, Poèmes, L. II (II, 87). — [Le bon avocat] Monstrant... Que de soy-mesme guerdonneur, Il est chiche de son honneur. E. PASQUIER, Lettres, VIII, 10.
Celui qui dédommage. — Permets, Ronsard, permets, divin sonneur, Ainsi que toy, que d'une forte haleine Je puisse aussi galoper par la plaine D u dieu qui fut de tes maux guerdonneur. E. PA S QUIER, les Jeux poétiques, 2e part., 6 (II, 859). Celui qui punit. — Plaise-toy donc, ô juste
guerdonneur, De ce forfaict, s'il te plaist, me venger. Ane Poés. franc., 1, 248.
(Fém.). Guerdonneresse. — O Phoebe, ingrate et maie guerdonneresse des bons services. Trad. de B O C C A C E , Flammette (1537), ch. ni, 36 r°.
Gueres. Beaucoup. (Dans les deux premiers exemples, guerés a peut-être le sens de longtemps. Voir l'alinéa suivant.) Par le corbieu I il ne
vous dict chose qu'il ne face, si vous luy eschauf. fez guères le poil. D E S PÉRIERS, Cymbalum Dial. I (I, 325). — Si vous m'importunez guières plus, au lieu de vous marier à l'empereur, je vous feray espouser une tour ou vous ne verrez de vostre vie soleil ny lune. Amadis, III, 18. — fl est faict de nostre guère, qui signifie beaucoup, H. E S T I E N N E , Precellence, p. 323. — Je... ne suis pas h o m m e qui m e laisse guère garroter le jugement par préoccupation. M O N T A I G N E , III, H (iy 163).
Longtemps. — Et si la lèvre eust gueres de-mouré Contre la mienne, elle m'eust succé l'ame, M A R O T , Rondeaux, 57. — Si tu continues gueres tes propos, tu m e renverseras et brouilleras le cerveau. C. D. K. P., trad. de GELLI, Discours fantastiques de Justin Tonnelier, Disc. Il, p. 38. — C'est ce que nous dirions, Si tu le tiens guère en k bouche. Ce qui vaut autant que si nous disions, Si tu le tiens long temps en la bouche. H. ESTIENNE, Precellence, p. 322. N'avoit gueres, v. Nagueres. Pas gueres. Guère, pas beaucoup, pas très. —
Un jour qu'il l'avoit envoyé à la ville, Fouquet ne faillit point à se jetter dedans un jeu depaulme qui n'estoit pas guères loing de la maison. DES PÉRIERS, Nouv. Récr., 10. — La maison dont estoit Themistocles n'a pas gueres aidé à sa gloire : car son père... estoit bien citoyen d'Athènes, mais non pas des plus apparents de la ville. A M Y O T , Thémistocle, 1. — L'autheur... n'est pas gueres suffisant pour authoriser une histoire. ID., Propos de table, 1,10. — Je ne suis pas gueres délibéré à leur siringuer ces considérations dans le cerveau. P. D E C O R N U , ŒUV. poet., Advertisse-ment au lecteur. — Celuy qui defendoit les femmes va demander à leur adversaire quelle raison il avoit de dire que les femmes n'estoient pas gueres sages. GUILL. B O U C H E T , 3e Seree (I, 88). Non gueres, non pas gueres. Dans quelques-uns
des exemples qui suivent, non gueres, non pas gueres pourraient se traduire par peu, médiocrement. Dans les autres, il faudrait un changement complet de construction. — Je ne parleray de tant de métiers, arz et sciences qui florissent entre nous, comme la musique, peinture, statuaire, architecture et autres, non gueres moins que jadis entre les Grecz et Romains. Du BELUÏ, Deffence, II, 12. — Pantodas... s'achemina vers ceste place de Delion avec grosse puissance, car il avoit avec luy non gueres moins de vingt mil hommes de pied et mil hommes de cheval. AMYOT, trad. de D I O D O R E , XII, 21. — Non gueres loin, sur le tertre prochain, Vit à Pescart un chesne au large sein, Aux larges bras. R O N S A R D , Franciade, III (III, 96). — Il y avoict ung costeau en pendent du cousté de Serizolles et de Sommarive qu'estoict un taillis non guières espois. MONLUC, Commentaires, L. II (I, 266). — Duquel ils usent en leurs fourrures, à cause que sa peau est fort chaude et saine, quoy que non guère belle. THEVET, Cosmogr., XIX, 12. — J'avoy pris un cheval bien aisé, mais non guère ferme. MONTAIGNE, II, ? (II, 57). — Je m'en suis souventes fois confesse, mais non pas guères repenty. M A R G . DE NAV., Heptam., 25. Non gueres. Peu de temps. — En ceste contem
plation je mendormis et non gueres, car je fus tantost esveillé par un esprit familier. LEMAIRE D E B E L G E S , la Concorde des deux langages, 2epart. (III, 132). — Non gueres devant il avoit este institué par Anaclete, aussi evesque de Rome, que tous chrestiens tous les jours communiquassent. CALVIN, Instit., XII, p. 651. — Il arriva non
— 403 — GUERROYABLE
eueres après. DEROZIERS, trad. de DION CASSIUS, Hist. rom., h. L, ch. 78 (170 r"). Ne valoir gueres avecques rien. N e valoir rien. —
Lequel à l'occasion de ses richesses estoit toujours suivy d'un monde de batteurs de pavé, gens sans adveu et mauvais garnements, et qui ne valoient gueres avecques rien. L A R I V E Y , trad. des Facétieuses Nuits de S T R A P A R O L E , X , 5. Gueret (?). — Celuy... Qui cent fois a peigné
son crin nettement beau, Et l'a soulé cent fois dans le creux de sa targe D'aveine, de gueret, et d'une espeautre large. D u B A R T A S , 2 e Semaine, 3 Jour, la Vocation, p. 445. Guereter. Labourer, bêcher. — Pour trois
journées emploiees a gueretter les parquetz aux artichaux. 1557. Compt. de Diane de Poitiers (G., Gareter). — D e deux en deux ans on chargera le fonds de terre de Polivete à la manière des autres labourages, pour avoir tant plus de loisir de le guereter, pour le rendre tant plus capable à ce service. O. D E S E R R E S , Théâtre d'agric, VI, 26. Gueriment, Guérir, v. Gariment, Guarir. Guerissement. Guérison. — Choses contraires
a la sanation et guerrissement de sa maladie. FOSSETIER, Cron. Marg., II, 60 v°. — E n quoy prenoit soubdain guerissement. J. B O U C H E T , Epistres familières du Traverseur, 14. — Mespri-sans leur guerissement, et ne tenans compte du commandement du médecin. A N T . D U M O U L I N , trad. de P L U T A R Q U E , De ne prendre à usure, p. 207. Guérisseuse, féminin de guérisseur. — II vous
salue en ces deux qualités, à fin que vous appreniez et deveniez non seulement medecineuses et guérisseuses, mais encores peintresses. S* F R A N ÇOIS D E S A L E S , Sermons recueillis, 50 (X, 117). Guérite. — O n disoit murs crénelez : c o m m e
aussi, murs crestelez : et murs garitez. Et ce garitez vient de garite, H. E S T I E N N E , Precellence, p. 358. — [Les guérites], C'estoient des retraites pratiquées sur l'espoisseur des murailles, ainsi appel-loiees pource qu'elles guerrissoient et sauvoient ceux qui en surprises avoient loisir de s'y retirer... lesquelles ont donné leur n o m aux murs gueritez, pour estre garnis de telles defîences. F A U C H E T , Origines des chevaliers, L. II, 522 v°. Guerlande, v. Garlande. Guérie, synonyme de louche. —• Il avoit prins
expressément sa femme guérie, luy estant louche, afin qu'on ne le peust tromper, l'un regardant d'un costé et l'autre d'un autre. G U I L L . B O U C H E T , 19e .Seree (III, 241). Guermenter, v. Guementer, Guerp. — Combien que de droit c o m m u n les
empereurs romains avoient accoustumé de saisir et réunir les biens vacans au domaine de la république, si est-ce que le particulier pouvoit s'en faire seigneur, trouvant la chose délaissée, que nous appelions guerp, et déguerpir pour délaisser. 0. B O D I N , Republique, I, 11. Guerpelé. Dépouillé? — U n e corneille estoit
toute pelée, Dont se voyant estre ainsi guerpelée, Délibéra les plumes recuillir Daultres oyseaulx. H A U D E N T , Apologues d'EsoPE, 1,140. — L a teste en fin il eut pelée C o m m e une pie et en aoust guerpelée. ID., ib., II, 48. Guerpir (trans.). Abandonner, délaisser, quit-
ter-~ Attendu quilz [les Athéniens] nous avoient ayde contre les Thebains... il neust pas esté honneste a nous de les guerpir et abandonner. S E Y S
SEL, trad. de T H U C Y D I D E , III, 9 (95 r°). — A p r e s quil maura guerpy et refusé destre avec m o y aux dangiers de la fortune. ID., ib., VI, 14 (207 v°). — Encores dedans avoit deux ou trois cens hommes, qui se misrent en deffense assez rude pour le commencement, mais enfin guerpirent le fort en fuyant. L E L O Y A L S E R V I T E U R , Hist. de Bayart, ch. 27. — Les François... firent une telle charge sur leurs ennemys qu'ilz leur firent guerpir la place. ID., ib., ch. 33. — A sa venue furent Véniciens maltraictez et guerpirent la cytadelle, faisans myne se vouloir retirer vers la ville. ID., ib.x ch. 50. — De ce comte de Bretaigne fait mention le jeu parti... et le fait parler avec Gaces Brûlez : lui demandant si, ayant loyaument aimé une dame, et il s'apperçoive qu'elle vueille le trahir : s'il doit attendre, ou la guerpir. F A U C H E T , Lang. et Poes. franc., II, 63. — U n tenancier de plusieurs fonds par luy tenus sous mesmes cens, ne peut en quitter et grepir un ou deux sans le tout. 1585. J. P A P O N , Premier Notaire, 126 (Vaganay, Deux mille mots, Grepir).
(Intrans.). S'en aller, partir. — Ton Ulpian n'a il R o m e chérie Et oublié Tyrus ou la Surie? Ayant guerpi, il recogneut à R o m e Que tout le monde est patrie de l'homme. F O R C A D E L , ŒUV. poet., p. 13.
Guerrant (?). — Qu'on m e le serre en la Bastille, lui [le roi de Navarre] et tous ses guerrans. L'ESTOILE, Mém., 2e part., p. 91 (G.).
Guerre, adj., v. Garre. Guerreable, v. Guerroyable. Guerrel (?). — Pour parer le ban torniz de la
dicte chambre a ung drapt rouge et trois guer-reaulz semblables. 1501. Invent, de l'Hôtel Dieu de Beaune (G.).
Guerrer. Attaquer, combattre. — Les gouverneurs et patrons [des navires] sestudioient les ungs a guerrer ceulx des ennemys, et les aultres a deffendre les leurs. S E Y S S E L , trad. de T H U C Y D I D E , VII, 12 (240 r°).
Se guerrer. S'attaquer, se combattre. —• Sans assemblées communes se guerroient les ungs voisins les aultres, ainsi que les occasions leur vendent. ID., ib., I, 1 (5 r°).
Guerrierelette, dimin. de guerrière. — M a mignonnelette, M a guerrierelette, Frappe moy encor. L E C A R O N , Poésies, 64 r°.
Guerrierement. A la façon d'un guerrier. — Puis s'adressant à Gad, Ruben et Manassé... Guerrierement facond, il leur tient tel langage. D u B A R T A S , 2 e Semaine, 3e Jour, les Capitaines, p. 468.
Guerrir, v. Guérite. Guerrissement, v. Guerissement. Guerroyable. Guerrier. — Considérant que
fortune est muable E t que partye est forte et guerroyable. J. M A R O T , Voiage de Venise, 40 r° (G.). — Et chevauchèrent tous ensemble accom-paignez des trompettes, clairons et aultres instrumens qui muèrent leurs piteux et guerroyables sons en joye et plaisir. A. S E V I N , trad. de B O C C A C E , le Philocope, L. VI, 144 v°. — Jule César... qui plus prés approchea des vertus imperatoires et guerroyables... du grand Alexandre. B U D É , Instit. du prince, édit. J. Foucher, ch. 36.
Place guerroyable. Place où Pon combat. — Ce jour le roy ung herault va transmettre A u c a m p Sainct Marc, leur requérant permettre Jour de bataille et place guerroyable. J. M A R O T , Voiage de Venise, 58 r° (G.).
GUERROYANT — 404 —
Guerre guerroyable. Guerre régulière, conforme aux usages. — Mais une chose a fait digne et louable Plus qu'onques roy, car il est véritable Qu'il a mis sus en guerre guerroyable Telle exer-cite. ID., ib., 46 r° (G.). — 11 y fut deux ans entiers, menant la guerre guerroyable, et tenant le siège volant alentour desdits sept chasteaux. L E M A I R E D E B E L G E S , Syach Ismail, 3e part. (III, 214).— Je veulx seullement parler des fortunes qui advindrent au bon chevalier sans paour et sans reprouche durant la guerre guerroyable que eurent ensemble François et Espaignolz. L E L O Y A L S E R V I T E U R , Hist. de Bayart, ch. 18. — Vous confessastes en assemblée de conseil les Car-thaginiens estre veincuz par moy, sans ressource tant de combat que de guerre guerroyable. B U D É , Instit. du prince, ch. 42. — Rocquemamel et ses gens ont esté contraincts se jetter dans une autre ville, qui est à vostre Majesté, et se font la guerre guerréable. M O N L U C , Lettres, 160 (V, 79). — Lesquelles garnisons continuèrent tout l'hiver en guerre guerroyable, sans faire grandes ny mémorables choses. M A R T . D U B E L L A Y , Mém., L. VIII, 248 v° (G.). — (Fig.). Les saincts pères commencèrent à faire guerres guerroiables, en empoignant le glaive de sainct Paul en lieu des clefs de sainct Pierre. P H . D E M A R N I X , Differ. de la Relig., 1, ni, 15. Guerroyant. Guerrier, combattant. — Cous-
tumes contraires aux anciennes coustumes des bons guerroyans du ternps passé. L'Arbre des batailles, 102 v° (G., Compl.). Guerroyement. Lutte, acte de guerre. —
Après plusieurs guerroyemens, chacun se soub-mettoit à ce commun Parlement. E. PASQ U I E R , Recherches, II, 2.
Guerroyement de. Lutte contre. —Quelejesuiste oste de son opinion toutes ces rafles, par lesquelles il s'avantage en grandeur dedans Rome, et persévère au guerroyement de l'heresie, non par l'espée, mère de sédition, ains par sa plume. E. PA S Q U I E R , Lettres, X X , 1.
Guerroyer. Guerrier, qui fait la guerre. — Si les princes guerroyers et cruelz comme toy héritassent les vies de ceulx que ils tuent pour augmenter et alonger leurs vies. B. D E LA GRISE, trad. de G U E V A R A , l'Orloge des princes, I, 33.
Guerroyere. Guerrière. — Laquelle [herbe] pour tel débat feut dicte polemonia, comme guerroyere. R A B E L A I S , III, 50.
Guerroyeur. Guerrier. — Le commun bruit courait que, par le bien parler de luy, il acquérait trop plus de victoires que par le moyen de ses vaillantises, lesquelles toutes fois ce gentil guerroyeur Hannibal disoit seconder celles d'Alexandre. E. P A S Q U I E R , Pour-parler du prince (1,1022). — Avant que vinst des canons le tonnerre, Avant qu'on vist les François guerroyeurs Mesler du fer et du feu les fureurs. H. E S T I E N N E , Dial. du lang. franc, ital, Epistre de Celtophile.
Guerroyeux. Guerrier. — Mais [le duc] veille au ciel et bien nous voit çabas Envelopez de guerroyeux debatz. L E M A I R E D E B E L G E S , le Temple d'Honneur et de Vertus (IV, 236). — Dont mainte dame est de noir affublée, Et maudit trop ces guerroyeux débats. ID., la Plainte du Désiré (III, 180). — Mais si plus tost tu veux que tes chevaux Soient convenans aux guerroyeux travaux. L E B L A N C , Georgiques, 78 r° (G.).
Guespe, v. Mousche. Guespiere. Guêpier. — Il n'eust osé assaillir...
une guepiere de mouches qu'on appelle est guespes. H A T O N , Mém., an 1567 (G., Compl.).— (Fig.). Tout cela ensemble nous en produit un exaim [de colères] comme d'abeilles, et une guespiere. A M Y O T , Comment il faut refréner la cholere 13, — Ceux qui cherchent un exaim, ou toute une' ruchee, par manière de dire, d'amis, ne se donnent de garde qu'ils tombent en une guespiere d'ennemis, lu., De la pluralité d'amis, 1. — Ordel'Anti-coton on ne peut dire autre chose, sinon que c'est l'œuvre d'un insigne calomniateur, une fourmil-liere de faussetez, une chenilliere d'impostures et une guespiere de calomnies. Resp. à l Anti-Coton p. 13 (G., Compl,).
Guespillonner, v. Guepittonner. Guespin 1. Surnom donné aux Orléanais. — Bru de Bessin, bru angevyne, Bru de Touraine et bru guespine. Sotties, III, 88. — Une dame d'Orléans, gentile et honneste, encores qu'elle fust guespine. D E S P É R I E R S , Nouv. Récr. 54. — Mais j'ay cest heur que m a naissance C'est Orléans, le cœur de France... — 11 est trop ouvert et bénin Et courtois pour un bon guespin. BAÏF, le Brave, III, 1. — Nous... ne nous formalizons pas beaucoup contre les guespins, quand il leur eschappe de dire qu'ils parlent aussi bon françois que nous qui sommes Parisiens. H. ESTIENNE, Precellence, p. 170. — Intervient un Picoté, guespin delà ville d'Orléans, réfugié aux Païs-Bas. E. PASQUIER, Lettres, XVII, 4. Guespin 2 (?). — [Le roi] alloit ainsi seuî; de peur que par le mouvement de la trouppe, les atomes de Democrite ne se vinssent unir à la cire de ses yeux, pour y engendrer quelques roitelets guespins. B E R O A L D E D E VERVI L L E , le Moyen de parvenir, Remonstrance (1, 150).
Guestré (juge). — Je voy cette façon défaire estre observée tant à l'endroit des juges royaux qu'autres juges guestrez et pedanées. E. PASQUIER, Recherches, II, 4. Guet 1. Guetteur, sentinelle. — (Fig.). Ceux
que Dieu a ordonnez pour anoncer sa Parole sont comme des guets, et... s'ilz ne veulent point crier quand ils voyent quelque mal ou danger prochains, les âmes seront requises de leurs mains. C A L V I N , Serm. sur la seconde à Timothee, 25 (LIV, 298). Corps de garde. Voir Corps de garde, t. II,
p. 560, col. 2. (Antiq.). Le guet. Les gardes. — Gracilius Laco,
cappitaine du guet de la nuict. DEROZIERS, trad. de D I O N CASSIUS, Hist. rom., L. LVII, ch. 122 (254 v°). — Environ l'heure que lon remue le guet au matin, lon apperceut dessus le camp de Caesar... une grande clarté... ce que Caesar luy mesme dit avoir veu ainsi comme il alloit visiter ses guets. A M Y O T , Pompée, 68. — Le capitaine du guet... passa d'adventure par là devant, visitant les gardes. ID., Aratus, 7. — Tigillinus, capitaine du guet à Rome. M O N T A I G N E , 1,19 (I, 88).
(Antiq.). Veille, chacune des quatre parties de la nuit chez les Romains. — 11 se mettait à lire quelque livre jusques au troisième guet de la nuict. A M Y O T , Brutus, 36.
Mot du guet. Mot d'ordre. — Muntius s'en alla avec aucunes gardes demander le mot du guet, D E R O Z I E R S , trad. de D I O N CASSIUS, Hist. rom., L. XLIII, ch. 47 (85 v°). — Fulvie... portoit une espée ceincte et donnoit aux souldardz chascun jour le mot du guet. ID., ib., L. XLVIII, ch. 66 (141 v°). — C'est Apollo qui feut pour mot du guet le jour d'icelle bataille. RABELAIS, 111,10.—
— 405 — GUETTE
Je présuppose que tel estoit le mot du guet au jour de la bataille. ID., IV, Ancien prologue. — Or donques mettons nous en ordre. Nabuzardan vous sera pour mot du guet. ID., IV, 39. — Si y eut adonc grand nombre de Macédoniens qui accoururent à luy et luy demandèrent le mot du guet, comme à leur souverain prince et à leur roy. AMYOT, Pyrrhus, 11. — Aratus... alla trouver les soudards, puis leur donna pour le mot du guet Apollo favorable. ID., Aratus, 1. (Fig.). Formule conventionnelle. — Ils [les mé
decins] guérissent les malades avec herbes et racines crues et cuictes et pulvérisées, y adjoustans gresses d'oyseaux, bestes et poissons, et plusieurs autres choses que le vulgaire ne congnoist, et que aussi ils ne veulent enseigner, sinon à ceux de leur secte : comme s'ils avoient fait quelque serment et ne voulussent que aucun sceust leur mot du guet. T H E V E T , Cosmogr., XXII, 4. Entendre le mot du guet. Savoir les finesses. —
Elle, qui estoit rusée et qui entèndoit le mot du guet. L O U V E A U , trad. des Facétieuses Nuits de STRAPAROLE, 1, 3.
Estre du guet. Subir un dommage, une chose désagréable. — 11 est bien vray qu'il fut fort compris dans le traicté de Madrid... mais le roy le rompit tout à trac quand il fut en France : si bien que M. de Bourbon fut du guet. B R A N T Ô M E , Cap. estr., M. de Bourbon (I, 260). — Trouvant un bon brocard dans leur bouche, il faut qu'elles le crachent... J'en ay cogneu force à nostre cour de telle humeur, et les appelloit-on marquis et marquises de belle-bouche : mais aussi bien souvent s'en trouvoyent du guet. ID., des Dames, part. II (IX, 451). Estre du guet d'après minuict. M ê m e sens. — Je
cuyday avoir le baut et estre du guet d'après minuict. Du FAIL, Contes d'Eutrapel, 28 (II, 91). Guet 2. Quai. — Je la prends [une clef] et la jette, du gué des Augustins où j'estois, dans la rivière d'en bas. B R A N T Ô M E , Cap. franc., le Mareschal de Bellegarde (V, 208). — Et le vismes tout seul en l'isle, qui attendoit son homme, et les deux guetz bordez d'une infinité de monde. ID., Couronnels franc. (VI,183). — 11... se loge l'espace de quinze jours en ceste petite maison, qui est au bout du guet des Augustins. ID., Disc, sur les duels (VI, 332). Guet-apens. Par guet-apens. — Cestuy mary et son filz... de guet à pens tuèrent Abecé. R A B E LAIS, III, 44. — Ce cousin gardoit comme l'or l'histoire d'un chien qui fut si fidèle à son maistre, après sa mort, que toutes les fois qu'il rencontrait celuy qui l'avoit assassiné et occis de guet à pent, il Passailloit et se ruoit sur luy. GUILL. B O U C H E T , 7e Seree (II, 62). De parti pris, d'une façon préméditée. — Si je
fasche de guet à pens tout le monde par mon boire et mon manger, et que je scandalize et trouble mes prochains, que sera-ce? CALVIN, Serm. sur l'Epitre aux Corinthiens, 8 (XLIX, 681). — S'il m'a abandonné de guet-à-pens, c'est un mauvais garniment qui ne mérite de r'entrer en grâce avecq' moy. E. PASQ U I E R , Lettres amoureuses, 3 (II, 807). —Voici qu'ils allèguent, O comment?... il semble qu'on vueille despiter de guet-apens ceux qui desja sont ennemis de l'Evangile. C A L VIN, Serm. sur l'Epitre aux Galates, 34 (LI, 9 ) . — Celuy abuserait de la bonté du roy qui ferait un meurtre de sang froid, de guet à pens, et contre sa conscience, en se fiant à la grâce qu'il obtiendrait d'iceluy. H. E S T I E N N E , Dial. du lang. franc, ital, II, 206. — Ceux-là méritent d'estre punis qui font
mal de guet à pens. J. D E C A H A I G N E S , l'Avari-cieux, IV, 9.
On trouve aussi guet à pensée, déformation de guet apensé. — Pour avoir tué de guet à pensée le sieur de Mirabeau, afin de demeurer quitte de l'argent qu'il luy devoit. R É G N I E R D E L A P L A N CHE, Hist. de l'Estat de France, I, 348. Guette. Guet, action de guetter. — Et quand
il dort son grand dieu, Pan vermeil, Prend de luy garde avec mainte nymphette : Sylvan cornu et Faunus font la guette. M A U R I C E S C È V E , Saulsaye, p. 31.
A la guette. Aux aguets. — Quand on voit un h o m m e ou une femme a la guette pour voir si on luy présente le devant, si on l'appelle bien de ses filtres, les grans s'en moquent, les esgaux s'en piquent et les moindres s'en scandalisent. S' F R A N Ç O I S D E SALES, Vie dévote, III, 7.
De bonne guette. Faisant bonne garde, vigilant. — Il fault qu'ils [les chiens] soyent vigilants et de bonne guette. C O T E R E A U , trad. de C O L U M E L L E , VII, 12. — Bistoquet est de bonne guette, Et dès qu'on heurte le loquet Pour ouvrir l'huys, ce Bistoquet En grommelant court à la porte. G U Y D E T O U R S , Meslanges (II, 81). — Ces chiens de garde... seront vigilans, de bonne guette... faciles à abbaier à toutes nouvelles survenues. O. D E S E R R E S , Théâtre d'agric, IV, 16. De grand guette. Devant être gardé avec soin. —
L'honneur est de grand garde et guete. Le grand thresor que c'est l'honneur ! BAÏF, Mimes, L. I (V, 29).
Guette. Guetteur. — La guète sonna pour sçavoir où il estoit, mais il ne fut point trouvé. L E L O Y A L S E R V I T E U R , Hist. de Bayart, ch. 20. — Alors s'en partit la guette, qui alla dire au géant les nouvelles. Amadis, I, 12. — Doubtant que la guette du chasteau le descouvrist, se retira plus avant dans la montagne. Ib., I, 36. — Ainsi qu'ilz faisoient diligence, la guette les descouvrit, qui aussi tost en advertit le conte. Ib., III, 1. — Va, et ordonne une guette, qui rapporte ce qu'il aura veu. CALVIN, Bible franc., Isaïe, 21 (LVI, 609). — Les guettes apperceurent qu'ils s'embarquoient. F A U C H E T , Antiquitez, X, 19. — Elles [les grues] ont leurs veilles bien disposées, et leurs guettes qui font le guet de nuict. A M B R . P A R É , Livre des animaux, 16. — Les guettes rapportèrent qu'ils voyoient un navire fort loing du port. F. B R E T I N , trad. de L U C I E N , la Vraye histoire, II, 26. — Ceste ville n'avoit pour habitant que la guette du clocher. A U B I G N É , Hist. univ., XI, 1.
(Fig.). Iceulx et semblables délices ne sont pas guydes pour les vertuz, mais plus tost espies et guettes pour les vices. B. D E LA GRISE, trad. de G U E V A R A , l'Orloge des princes, II, 30. — Sous la Loy les sacrificateurs se sont desbauchez. Voila pourquoy les prophètes crient contre eux que ce sont chiens muets, que ce sont des guettes aveugles, que Dieu les avoit constituez comme en un degré haut, afin qu'ils fissent bon guet pour conserver le peuple et la vraye religion : or ils ont esté aveugles. CA L V I N , Serm. sur le Deuter., 194 (XXIX, 148). — Elles [les oreilles] nous sont comme guettes et sentinelles pour ouyr et entendre les commodités ou incommodités de tout nostre corps. A M B R . P A R É , IV, 10.
Lieu d'où Pon guette. — Tout ainsy comme les feuz et lumières se monstrant par une haulte guette : c'est à dire par une haulte tour, estant sur une coste marine, ou le feu se monstre au loing, pour addresser ceulx qui naviguent de nuict par mer. B U D É , Instit. du prince, ch. 27. — Hy-daspes voyant de la tour de son éléphant (ne plus
GUETTER — 406 —
ne moins que s'il eust esté en quelque haulte guette) la victoire toute évidente et asseurée. A M Y O T , Hist. JEthiop., L. IX, 105 r°. — Estant... la bute couverte d'arbres et de brossailles, les ennemis avoyent mis un h o m m e sur la plus haulte guette qui y fust, pour faire le guet et les advertir s'il verrait rien venir. ID., Marcellus, 29. — Il avoit nouvelles en un jour de tout son empire, depuis le destroit d'Hellespont jusques à l'Indie orientale, par feux, et sentinelles assises es hautes guettes. J. B O D I N , Republique, IV, 6. — L'empereur sortit bellement de sa guette et vint visiter les fortunez. B E R O A L D E D E V E R V I L L E , Voyage des princes fortunez, p. 264. — (Fig.). Et ne leur servit pas celle colonie a celle guerre tant seulement, mais leur a servy tousjours depuis, et sert encores a présent, comme une guette et ung réceptacle pour tenir les voisins en subjection. SEYSSEL, trad. de D I O D O R E , II, 55 (68 r°). — Je suis tous les jours en m a guette, o mon Seigneur, j'y suis assiduellement. CALVIN, Bibl: franc., Isaïe, 21 (LVI, 609). — Si m e semble que je voy maintenant, comme de dessus une haute guette, venir la Vertu et la Fortune à la plaiderie de ceste cause. A M Y O T , De la fortune des Romains, 3.
Lieu élevé, qu'on voit de loin. —• Antigonus... dit... que la cité d'Athènes estoit comme une guette de toute la terre, laquelle incontinent ferait reluire par tout le monde la gloire de ses gestes, comme un brandon qui flamboyé dessus une haulte tour. A M Y O T , Démétrius, 8.
Trompette du guet. — Ayant esté ordonné aus-dits gens du guet heures et lieux pour eux trouver et assembler par chacune nuict au son de la guette. 1539. Edit de Fr. I (G., Gait).
Guetter. (Trans.). Faire attention à. — Ils descendent un rocher précipiteux, qui estoit sans garde à cause de la difficulté. Là il falut rouler et guetter les enfans et personnes moins vigoureuses. A U B I G N É , Hist. univ., III, 7.
(Intrans.). Prendre garde. — Mortels, guettez à vous : nul ho m m e ne sçait l'heure Qu'il luy convient sortir hors de ceste demeure. BAÏF, Pas-setems, L. III (IV. 315).
Se guetter. Veiller, prendre garde. — Minerve tousjours en soupson Se guete d'une autre façon. BAÏF, Devis des dieux, 2 (IV, 164).
Se douter, se défier, être sur ses gardes. — Quand nous ne nous guettons, cette petite fleur qui hyer estoit saine en l'arbre... un remeil de gelée la gaste et anichile. B. D E LA GRISE, trad. de G U E V A R A , l'Orloge des princes, 1, 42. — Navrée on m a voire jusqu'à ce point Que je mourray d'où ne m e guettoye point. H A U D E N T , Apologues d'EsoPE, I, 46.
Se guetter de. Se défier de, être sur ses gardes contre. — Sans prévoir ny penser à la malice de fortune : qui essaye communément à troubler telles assemblées, lors que moins on se guette d'elle. Amadis, I, 30. — Plus il y avoit d'espace D'où m e monstray jusques à celle place, Où à l'abry les deux frères estoyent, De tout l'abus d'autant moins se guettoyent, Croyans le faux. BAÏF, Poèmes, L. V (II, 248). — Employant toute son industrie à se guetter des embusches et tromperies des ennemis. F A U C H E T , Antiquitez, VIII, 7. — On se peut garder de sa fortune, quoyque l'on s'en guette assez. P H . D'ALCRIPE, la Nouvelle Fabrique, p. 29. — Ce cruel tyran auquel, comme jeune, ne vous estant guettée de luy, vous vous estes simplement assujettie. G. C. D. T., trad. de B O C C A C E , Flammette, L. 1, p. 35,
Gueu, v. Gueux 1.
Gueude. Société, confrérie. — Un adveu et desnombrement baillé au roy par les confrères et suppôts de la société vulgairement appellee gueude marchande, en la ville de Monstreuil sur la mer. Mai 1518 (G., Gelde 1). — Ils seroient venusaSeclin en forme degheude. 1526. Lille (G.).
Gueule 1. Pour certains animaux, nous employons le mot bouche, tandis que le xvie siècle disait gueule. — De cheval donné tousjours regar-doyt en la gueulle. R A B E L A I S , 1,11. — Nous mettons aux chevaux les brides en leurs gueules. CALVIN, Bible franc., Epitre de Jacques, 3 (LVII, 583). — L'eschaufement de gueule [du cheval] est guéri par le seul laver avec fort vinaigre, souvent réitéré, de la gueule et de la langue. O. D E SERRES, Théâtre d'agric, VIII, 6. — Et ne luy eust monté en la bouche en plus qu'un grain de millet en la gueulle d'un asne. R A B E L A I S , II, 25. — Sainct Paul amené ce passage : Qu'on ne liera point la gueule du bœuf qui travaille. CALVIN, Serm. sur le Deuter., 125 (XXVI1T, 11). — Il est escrit, Qu'on ne lie point la gueule du bœuf qui foule le grain, OU qui laboure la terre. ID., Serm. sur la première à Timothee, 42 (LUI, 505).
Gueule. Gourmandise. — Tourment, ennuy, courroux, detraction, Gueulle, fureur et telle autre mesgnie Lui font la court et tiennent compagnie. M A R G . D E NAV., les Marguerites, Triomphe de l'Agneau (III, 10). — Les allechemens de Venus, la gueule et les ocieuses plumes ont chassé d'entre les hommes tout désir de l'immortalité. Du BELL A Y , Deffence, II, 5. — Bien que ce roy soit magnanime et fort... L'amour, la gueule et les plaisirs qui font Rougir de honte un prince le feront Esclave roy de vilaine luxure. R O N S A R D , Fran-ciade, IV (III, 165). — Les clercs... montez en biens se laissèrent aller aux plaisirs et délices de la gueulle. F A U C H E T , Antiquitez, IV, 13. — Trouvants un sien petit bois pavé de champignons, ce fut à qui mieux mieux en mangeroit... De ceste desbauche de gueule, le malheur tomba particulièrement sur moy : car trois jours après... je fus... assailly d'une forte fièvre. E. PASQUIER, Lettres, X X I , 1.
Friandise de gueule. Chose agréable au goût. — Celuy qui commandoit en qualité de maistre cuisinier. .. estoit subtil et inventif à trouver friandises de gueule et plaisantes au palais. Trad. de F O L E N G O , L. 1 (I, 22).
Adonné à sa gueule. Gourmand, recherchant la bonne chère. — Les hommes addonnez à leur gueule plus qu'à toute autre chose auraient commencé à préparer des banquets somptueux en la commémoration de leurs morts. L E LOYER, Hist. des Spectres, VII, 8. Officier de gueule. Serviteur chargé de s'occuper
de la table, des repas. — Les officiers de gueule dressèrent les tables et buffetz. RABELAIS, IV, 64.
Harnois de gueule, munitions de gueule. Vivres, provisions de bouche. — Luy mesmes... alla faire attester son artillerie et charger force munitions, tant de harnoys d'armes que de gueulles. RABELAIS, 1, 26. — Nous sommes icy assez mal ayi-tuaillez, et pourveuz maigrement des harnoys de gueule. ID., I, 32. — Il n'est icy question que de harnois de gueule. GUILL. B O U C H E T , 15e Seree (III, 103). — Quant aux munitions de gueule et de guerre, ils y mirent ordre par leur bourse, c'est à dire povrement et misérablement. AUBIGNÉ, Hist. univ., IX, 6. —• Il avoit embarqué à la Rochelle trois canons avec leur équipage... armes et munitions de guerre et de gueule. ID., ib., XII, "• — Les preneurs avoyent tenu prêts dans Privas
toutes munitions de guerre et degueule. ID., Lett. U Mém. d'Estât, kl (1,270). Science de gueule. Gastronomie. — Il m'a fait
un discours de cette science de gueule, avec une gravité et contenance magistrale, comme s'il m'eust parlé de quelque grand poinct de théologie. M O N T A I G N E , I, 51 (I, 419).
A gueule desployee, à gueule ouverte. Ouvertement, avec imprudence. — Nous voyons beaucoup de coureurs et d'affronteurs qui abusent des noms des serviteurs de Dieu, et ne leur chaut de mentir à gueule desployee (comme on dit). C A L VIN, Serm. sur l'Epitre aux Galates, 9 (L, 379). — On verra ces galans... qui en sont venus jusques-là, de blasphémer ainsi Dieu à gueule ouverte. ID., Serm. sur la première à Timothee, 40 (LUI, 487). Mot de gueule. Mot plaisant, mot pour rire,
mot libre. — Revenans des champs, chascun avoit son mot de gueule pour gaudir lun lautre. Du FAIL, Propos rustiques, ch. 2, p. 18. — Affermant que elles [les fées] sont bonnes commères, et voulentiers leur eust dict le petit mot de gueule, sil eust osé. ID., ib., ch. 5, p. 37. — Pantagruel ne le voulut : disant estre follie faire reserve de ce dont jamais l'on n'a faulte : et que tousjours on a en main, comme sont motz de gueule entre tous bons et joyeulx pantagruelistes. R A B E L A I S , IV, 56. — Cependant qu'ils ont le vent en poupe, ils plaisantent en se moquant de Dieu, mesmes ils font gloire de brocarder et dire mots de gueule pour abaisser sa vertu. CALVIN, Instit. (1560), I, iv, 4. — Vrayment, Marion, je m'asseure Que, quand tu faudras par le bec, On ira dans Seine à pied sec : Tu as tousjours le mot de gueulle. G R E VIN, les Esbahis, I, 2. — Apprenons donc à détester et fuir une telle peste, quand un h o m m e aura sa langue desbordee pour dire des mots de gueule (comme on parle). CALVIN, Serm. sur l'Epitre aux Ephesiens, 32 (LI, 644). — Je m e mets à suivre quelque jeune seigneur nouveau venu ; j'ay tous-jours le mot de gueule, et m e dédie à luy complaire en tout ce qu'il veut. F R . D'AMBOISE, les Neapolitaines, 1,4. — Ceste matière eust esté fort propre à desployer sur les festes de S. Pansart, auquel temps un chacun sçait que fleurissent les mots de gueule. CHO L I È R E S , 4e Matinée (Des chastrez), p. 121. — Encore que je sois mal duict à cette lutte pour avoir toute m a vie faict provision d'honneur et non de mots de gueule dont leur ouvrage est farcy. Lettre de V I L L E R O Y à Du Vair, dans Tricotel, édit. de la Sat. Men., II, 172. — Nous en avons encores un autre [proverbe] assez ord et sale, quand nous disons qu'un h o m m e qui est fort crotté est crotté en archidiacre, qui semblerait de première rencontre plustost mot de gueule que proverbe. E. P A S Q U I E R , Recherches, VIII, 33. Gueule fresche. Bouche gourmande. — Ce
pauvre homme qui jadis, quand il estoit au comble de sa plus haute félicité, nourrissoit les gueules fresches de plusieurs flatteurs affamez. LARIVEY, trad. des Facétieuses Nuits de ST R A P A -ROLE, X111,13. Avoir la gueule fresche. Dire des paroles vives,
plaisantes. — Il a la gueule fresche et dit mots nouveaux. T O U R N E B U , les Contens, II, 6. Avoir la gueule pavée. Être sans conscience. —
Quoi qu'il ait la gueule pavée, et fust ce bien pour avaller charbons de feu... si ne peut il venir à bout de ces scrupules. P H . D E M A R N I X , Differ. de la Relig., 1, n, 5. Gueule. Ouverture. — Il fit la robbe pour l'ephod totalement de hyacinthe, d'ouvrage tissu.
GUIBRAY
Il y avoit une gueule au milieu de la robbe (comme la gueule d'un haubergeon) ayant un orlet à Pentour de sa gueule, afin qu'elle ne se deschirast point. CA L V I N , Bibl. franc., Exode, 39 (LVI, 144). — Pour conserver le puits nettement, aucuns en tiennent les gueules fermées. O. D E S E R R E S , Théâtre d'agric, VII, 4. — La teste de la ville avoit encores un fossé de quinze brasses de gueule et cinq de profond. A U B I G N É , Hist. univ., XII, 12. Gueule 2. Masse de métal chauffé à blanc. —
Nous avions aussi des vuglaires et martinets, ressemblant à ces gros marteaux qui aux forges battent les gueules, pour les rendre en longues barres. F A U C H E T , Origines des chevaliers, L. II, 529 v°. Gueulee. Ce que peut contenir la gueule, la
bouche. — (Fig.). Ne pensez plus que France soit a craindre... Se elle a sa loy toutes gens veult constraindre Plus embrassant quelle ne peut es-traindre, Si n'estes pas pourtant pour sa gheulee. L E M A I R E D E B E L G E S , les Chansons de Namur (IV, 304). Dire à pleine gueulee. Dire librement, ouverte
ment. — Or dittes à pleine gueulee. B E R O A L D E D E V E R V I L L E , le Moyen de parvenir, Kalendrier (II, 214).
Gueullard. Grande gueule. — Ayans en teste au lieu d'un cabasset quelques grans gueullars de lions, panthères, tigres, onces et autres bestes cruelles, pour les rendre plus terribles. V I G E N È R E , Comm. de CES., Annot., p. 46 (G., Compl.). Gueulle, v. Gueule. Gueusement. A la façon d'un gueux. —• U n
jeun' h o m m e natif de Nogarol... s'en vint en Flandres tout gueusement habillé et tout malotru. B R A N T Ô M E , Cap. estr., le Prince d'Orange (II, 170).
Gueux 1. Gueux de l'hostiere, v. Hostiere. Mot de gueux. Mot d'argot. — En escrivant il
faut user de discrétion pour s'abstenir des vocables et façons de parler qui tiennent de la gosserie trop vulgaire et approchent des mots de gueux. H. E S T I E N N E , Apol. pour Her., Introd. (I, xn). — A u lieu de cercher les plus graves mots et manières de parler, pour applicquer à un tel sub-ject, on voit évidemment que cest homme s'est estudié à cercher les mots de gueux, ou pour le moins tels qu'ils fissent amuser les lecteurs à rire. ID., iô.,ch. 14 (1,199).
On écrit aussi gueu. — Payez moy, disoit le ros-tisseur au gueu qui mettoit son pain sur la fumée du rost. D u FAIL, Contes d'Eutrapel, 31 (II, 131).
Gueue, fém. de Gueu. — De m a part me jettay à corps perdu sur une gueue qui avoit servi les confrères de Hurlep. ID., ib., 32 (II, 145).
Gueux 2. — Or n'est-ce pas assez, Pour estre maistre gueux, d'acheter aux marchez Force poisson bien cher. F R . H A B E R T , trad. d'HoRACE, Satyres, II, 4. Paraphrase. Il faut probablement lire queux, cuisinier.
Gueyer, v. Gueer. Guezelle (?). — Pleurez, seigneurs, bour
geoises, damoiselles, Doulces guezelles. Ane Poés. franc., XIII, 400.
Guiberge, v. Guimberge. Guibet. Moustique ? — Les moucherons et gui-
bets nous troublent en esté. D E S P A R R O N , Lett., 20 (G.).
Guibray. Mal entendre sa Guibray. Faire un mauvais marché. — (Fig.). J'en ay veu tropes.
7 —
GUICHET — 408 —
comme grus Qui se faisoyent fraper et bastre Pour suyvre un povre gentilastre Qui n'avoit rien au pays de Bray ; C'est mal entendu sa Guibray. Sotties, III, 87.
Finesse de la Guibray. Ruse que l'on pratique aux foires, aux marchés. — Ce marchant avec ses finesses de la Guibray (qui est le rendez-vous des meschans complots et monopoles de toute la France) se voyant prins et glué, se présente au gentilhomme. D u FAIL, Contes d'Eutrapel, 31 (II, 31).
Guichet. Petite porte. — 11 n'y a maison qui n'ayt huis en la rue, et un guichet ou postes aux jardins. J. L E B L O N D , trad. de T H . M O R U S , l'Isle d'Utopie, L. II, 38 r°. — La bonne vieille sempiternelle (garde de la pauvre prisonnière) sortit du chasteau par un petit guichet, pour parler à quelques pourvoyanciers, ce qu'appercevant le gentil escolier, promptement se lance dedans ledit guichet. P H . D'ALCRIPE, la Nouvelle Fabrique, p. 150. (Par plaisanterie). Les symptômes et acci-
dens de la peur servent de faire ouvrir le guichet du serrail auquel à temps la matière fécale est retenue. GUILL. B O U C H E T , 25e Seree (IV, 123). —
Ceste fille femme à toute peine consent estre visitée par une matrone et sage femme, que le vulgaire appelle madame du guichet. ID., 19e Seree (III, 190). Guicheté, dérivé de guichet. — Porte. Ver
rouillée, puissante, liminaire... guichetee. M. D E L A P O R T E , Epithetes, 333 v°.
GuichoD. Sorte de grand verre. — Je vous diray le garçon Qui a faict ceste chanson, Quand toute la compaignie Aura vuidé son guichon. J. L E H O U X , Chansons du Vau de Vire, II, 20. Guicte. Canard. — De ne tenir et nourrir en
ycelle [ville] oyes, guictes et pourceaulx, pour l'immundicité et puantise qui succèdent d'iceulx. 15 févr. 1518. Regl. des consuls d'Agen (G.) Guidage. — N'est permis qu'au prince souve
rain de bailler bref de conduicte, que les Italiens appellent guidage. J. B O D I N , Republique, 1,11.
Guide. Action de guider, conduite, direction. — Le roy Bavo... illec sarresta par oracle fatal et par la guide d'un loup blanc, qui le guida selon la response des dieux. L E M A I R E D E B E L G E S , Illustr., III, 1 (II, 285). — Tous philosophes... à bien et seurement et plaisamment parfaire le chemin de la congnoissance divine... ont estimé deux choses nécessaires, guyde de Dieu et compagnie d'homme. R A B E L A I S , V, 47. — Les Barbares coururent toute la Phocide souz la guide des Thessa-liens. SALIAT, trad. d'HÉRODOTE, VIII, 32. — Europe, que les dieux Ne daignent plus regarder de leurs yeux, Et que je fuy de bon cœur sous ta guide. R O N S A R D , Poèmes, L. II, les Isles fortunées (V, 163). —• Sous m a guide tousjours, qui de leur navigage M'estois faite compaigne en tout ce grand voyage. J O D E L L E , Recueil des Inscriptions (1, 262). — Vent, le balay des ondes et de Pair... Vien t'en, poupier, ton haleine enfermer Dedans m a voile, afin que sous ta guide J'aille tenter ce grand royaume humide. R O N S A R D , Franciade, I (III, 39). — C'estoit Iphition qui menoit sous sa guide Plusieurs peuples au choq du vacarme homicide. A M . J A M Y N , Iliade, X X , 160 v°. — L'histoire est aussi nécessaire pour la guide du corps. F A U C H E T , Antiquitez, A u roy. — Les Arabes... nous apprennent que la vie des hommes nous est signifiée par le soleil, auquel ils attribuoient la guide, reigle et conduite tant du cerveau que du
cœur. C H O L I È R E S , 8e Ap.-disnée, p. 309. — Selon les desseins qu'en aurés fait par la guide de la fantasie et la commodité des lieux. O. D E SERRES, Théâtre d'agric, VI, 13.
Guide, féminin quand il désigne l'action de guider, est féminin aussi lorsqu'il désigne la personne qui guide. — Si m e tapis au plus près de ma guide [Mercure]. L E M A I R E D E B E L G E S , 2e Epistre de l'Amant verd (III, 20). — Gandalin... advisa les feuz du camp de leurs ennemys qu'il monstra à la guide, luy demandant s'il pourroit... y conduire leurs gens. Amadis, IV, 23. —• [A l'Amour] Tu es et l'escorte et la guide Des feux qui roulent par les deux. R. B E L L E A U , Petites Inventions (I, 155). — Pallas sa guide estoit [d'Ulysse]. Du B E L L A Y , les Regrets, 40. — L'oracle d'Apollo... luy avoit respondu qu'il prinst Venus pour sa guide. A M Y O T , Thésée, 18. — Crassus ledit luy mesme au plus desloyal et plus infidèle qui fust en toute la ville, n o m m é Andromachus, qu'il avoit encore choisi pour sa guide. ID., Crassus, 29. — Quand Dieu nous propose un bon exemple, c'est autant comme s'il nous envoyoit une guide pour dire, Je ne veux point que vous erriez. CALVIN, Serm. sur la seconde à Timothee, 7 (LIV, 82). — Soit le Seigneur m a guide. D E S M A S U R E S , David combattant, 475. — Car il est seul qui commande et préside Dedans le ciel, c'est l'escorte et la guide Des fourvoyans. R. B E L L E A U , la Bergerie, 2e Journ., Chant de triomphe (II, 36). — Car en secret à la guide commande... De me tuer, en payment de m a foy. BAÏF, Poèmes, L. V (11, 253). — Ayant choisi Moral pour vertueuse guide, Qui surmonte Chiron, le maistre d'Eacide. RONSARD, le Bocage royal, 2e part. (III, 337). — Et luy bail-lay aussi une de mes guydes, qu'il fist monter en croppe ; de sorte que nous eusmes trois trouppes, et chascune sa guyde. M O N L U C , Commentaires, L. I (I, 117). — [A Dieu]. Tu m'as couronné roy de France et de Polongne. Tu as esté ma guide es païs estrangers. PA S S E R A T , Plainte de Cleophon. — Je prie Amour, que je tiens pour mon dieu et pour mon seigneur, qu'il vueille estre ma guide et mon astre bénin. FR . D'AMBOISE, les Neapoli-taines, III, 13. — O Dieu! mon seul refuge et m a guide asseurée ! D E S P O R T E S , Œuvres chres. (P- 501).
Guide est féminin aussi quand il désigne une chose. — Pour par leur force au paradis aller, En desdaignant la guide et saufconduit, Qui est la foy. M A R O T , Serm. du bon pasteur et du mauvais. — C'est une bonne guide pour se retrouver quand on s'esgare que de garder et retenir en mémoire quelques marques et enseignes que lon a prinses avecq' ses amis. A M Y O T , Hist. Mihiop., L. V, 52 r°. — Vous estimez le travail estre la vraye guyde pour parvenir aux plaisirs de la vie. J. DE V I N T E M I L L E , trad. de la Cyropedie, 1, 7. — Flambeau digne de luire aux deux, Mieux que celluy qui fut la guide D u pauvre jouvenceau d'Abyde. O. D E M A G N Y , Odes, II, 231.— Ta faveur sera ma Piéride, L'argument de mes vers et de mes vers la guide. BAÏF, Eglogues, 1 (III, 10). — Avoir pour toute guide un désir téméraire, Et, comme les li-tans, au ciel vouloir monter. DESPORTES, les Amours d'Hippolyte, 44. — Et l'œil, ma seule guide en l'amoureux voyage, Peu fidelle, me laisse au plus fascheux passage. ID., ib., Stances. — L a plus seure guide de nos actions est la longue ancienneté. E. PASQUIER, Recherches, III, 37. --Octroyé à la nature, et refuse aux désirs ; Qu'elle, et non ta fureur, soit ta loy, soit ta guide. AUBIG N É , les Tragiques, Il (IV, 111). Guidelle. Sorte de danse. — Pendant lesquels
[jours] print plaisir aux danses que l'on appelle le trihory de Bretaigne, et les guidelles et le pas-sepied et le guilloret. Voy. du roy Ch. IX par son roy., 33 v» (G.). Guideur. Guide, conducteur. — Lors mon
guideur me mena par les ombres... Jusques au lac qui Lethes est nommé. L E M A I R E D E B E L G E S , 2e Epistre de l'Amant verd (III, 26). — V o u s , Car-duce, guideur des chariots des femmes, soyez le dernier après le bagage. J. D E V I N T E M I L L E , trad. Ae la Cyropedie, VI, 8. Guidon. Action de guider, conduite. — C'estoit
le jour qu'à la Vierge sacrée Chacun, suivant des prestres le guidon, Faisoit, dévot, d'un cierge ardent un don. E. PASQUIER, les Jeux poétiques, 1" part., 6 (II, 831). Guide. — Et puis Amour, qui est nostre gui
don, De l'autre part tiendra pour grieve offense Un tel mespris de son dard et brandon. L E M A I R E DE BELGES, la Concorde des deux langages, Ve part. (III, 118). — Guydon d'honneur, en racueil excellente, Joyeuse en dict, ferme en cueur et pensée... Beauté, bonté vous ont tant avancée En doulx regard que tout cueur se délecte. R. D E C O L L E R Y E , Epistres, 12. — Les François... très joyeulx d'avoir recouvert leur vray guidon d'honneur, s'en retournèrent lyement en leur camp. L E L O Y A L SERVITEUR, Hist. de Ray art, ch. 25. — Au dieu Phebus, qui est le vray guidon, De ma harpe feray présent et don. C H . F O N T A I N E , les XXI Epistres d'OviDE, Ep. 21, p. 423. — Nymphes, le seur appuy et Punique secours, L'enseigne et le guidon de mes chastes amours. R. BELLEAU, Eglogues sacrées, 5 (II, 313). —• Tu auras pour guidon Mercure auprès de toy, Et il t'approchera du généreux Pelide. A M . J A M Y N , Iliade, XXIV, 224 v°. —• Ils sont de noz desseins les asseurez guidons, Ils ont pouvoir sur nous. P. MATTHIEU, Vasthi, II, p. 41. Chose qui guide. — I, qui est nostre guydon et
principalle lettre proportionnaire a faire toutes les autres. G. T O R Y , Champ fleury, L. II, 12 v°. — Il vaudrait mieux, suivant un message céleste (Quand mesme il seroit faux) mettre aux dieux ma fiance Que suivra pour guidon m a fresle cognoissance. JODELLE, Didon, 1 (I, 160). — N'est-ce à fin de nous contenter En nostre maison, sans tenter Mille maux que l'heure importune A pour guidon de la fortune? B. B E L L E A U , Petites Inventions, la Tortue (I, 68).'— [Leslivres] nous servent de guidon asseuré au haut et souverain bien. E. PASQUIER, Pour-parler du prince (I, 1022). — Ne suis-je icy assisté de nostre Pragmatique Sanction, vrày guidon de nostre discipline ecclésiastique? ID., Recherches, III, 44. — Une seule princesse y reluit sans égale : Et c'est ceste beauté, dont la grandeur royale Nous sert en la vertu d'un céleste guidon. B E R T A U T , Pour le ballet des Princesses des Isles, p. 496. — De ces moindres flambeaux estincelans aux deux, Entre tous le naucher en a remarqué deux, Pour luy estre guidons tant vers le pôle artique Que tirant au midy pour trouver l'antartique. A U B I G N É , la Création, VII (III, 374). Guières, v. Gueres. Guige. — Lequel [écu]... ils embrassoient par les enarm.es, c'est à dire passoient les bras par les guiges, je croy courroyes. F A U C H E T , Origines des chevaliers, L. II, 523 v°. Guignade. Action de guigner, de jeter un coup d'œil. — Œillades, guignades, voustades, Aubades, fringades, bringades, Passades, poussades,
GUILDIN
gambades Se font pour acquérir ma grâce. R. D E C O L L E R Y E , Monologue d'une dame. — U [Louis XI] fit signe seulement de l'œil à Tristan l'Hermite, son grand prévost ; car le plus souvant il n'usoit pas d'autres commandemens, sinon par guignades et signes. B R A N T Ô M E , Cap. estr., don Juan d'Autriche (II, 132). Guignement. Action de guigner. — Guigne-ment menassant. J. G. P., Occult. merv. de nat., p. 300 (G.).
Clignement. — Les vices de la veue sont... les fistules, les inflammations, les tumeurs, pustules... guignemens, contorsions de veue en haut et en bas, fréquent mouvement de la paupière. L E L O Y E R , Hist. des Spectres, II, 1.
Guignement de teste. Signe de tête. — Alonge-mens de pieds, baisemens de mains... guignemens de teste, toussemens, souspirs. Var. hist. et litt, V, 119.
Guigner (trans.). Regarder du coin de l'œil, négligemment. — Quant est des choses nécessaires, ou il les mesprise du tout, ou au lieu de les regarder, il les guigne comme en passant. CALVIN, Instit. (1560), II, n, 12. Cligner. — Tes yeux muguets à demy decou-
vers As destorné, les guignants de travers, Pour altérer ta visée pudique. F E R R Y J U L Y O T , lrepart., 10 (3e Elégie). — Elle guignoit les yeux de travers, bransloit et crouloit la teste sans cesse. L E L O Y E R , Hist. des Spectres, VII, 7. Lancer en visant. — [Jupiter] My-courbant
son sein en bas, Et dressant bien haut le bras, Contre eux guigna la tempeste. R O N S A R D , Odes, I, 10 (II, 130).
(Intrans.). Regarder du coin de l'œil. — Fermant l'œil gausche entièrement et guaignant du dextre. R A B E L A I S , II, 19.
Faire signe. — (Fig.). Il y a dans Plutarque beaucoup de discours estendus... mais il y en a mille qu'il n'a que touché simplement : il guigne seulement du doigt par où nous irons. M O N TAIGNE, 1, 25 (1,191). Se guigner. Regarder de travers. —• Advisez
comment ceste garce se guyngne. P A L S G R A V E , Esclare, p. 706.
Se faire signe mutuellement. — Ils se gui-gnoyent l'un l'autre que l'occasion estoit propre à leur besoigne. M O N T A I G N E , I, 33 (I, 281). Guignet. Petit coin. — Pareillement vindrent
les trois estatz Et d'autres gens et dames à grand tes ; Tout en fut plain par cornetz et guignetz. Ane Poés. franc., VI, 131. Guigneter, dérivé de guigner. — En guigne-
tant l'hypostase en l'urine. 1574. P E R R I N , 19 (Vaganay, Deux mille mots). Guigneur. Qui vise. — Archer. Porte-carquois,
adroit... diligent, guigneur. M. D E LA P O R T E , Epithetes, 30 r°. Guignoter. Clignoter. — Mes pupilles sont
comme encrées, guignottantes à tous coups et lar-mentantes. F. B R E T I N , trad. de L U C I E N , Lexi-phane, 4.
Guignoter qqn. Lui lancer de petits coups d'œil. — Tout bas tout bas des lèvres marmotoit, Et d'yeux lascifs dru dru me guignotoit. BAÏF, Eglogues, 12 (III, 70).
Guildin. Cheval anglais qui va l'amble. — Pour autant que je suis très gay, Le guilledin chacun m'appelle ; Léger suis comme ung papegay, Frétillant comme ung arondelle. Ane Poés. franc., VIII, 334. — Voylà mon genêt, voy là mon guil-
i9 —
GU1LDR0N (COURIR LE) — 410 —
din, mon lavedan, mon traquenard. RABELAIS, I, 12. — L'isle [de Samos] est abondante en che-vaulx de couleur fauve, qui sont communément petits et sont tous guildins de nature, comme en Angleterre, sans qu'il s'en trouve aucun trottier. BELON, Singularitez, I, 25 (G., Compl.). — L'An-glois use de Parc et de lance en guerre, et l'Esco-çois aussi, assez mal montez, tant les uns que les autres : bien que leurs guildins soient disposts et légers à merveilles, mais ce n'est monture propre pour la guerre. T H E V E T , Cosmogr., X V I , 9. — Ayant recouvert une couple de beaux et rares guilledins. 3 sept. 1580. Lett. de M A R I E S T U A R T (G., Compl.). — (Fig.). Seroit besoin de les laisser seulement un demi an au service du magnifique seigneur faute d'argent... pour apprendre à con-noistre les oranges et à s'escurer les dents devant disner, car c'est la seule méthode pour faire aller amble tels guildins. Supplément du Catholicon, 9, dans Tricotel, édit. de la Sat. Men., II, 67.
(Fém.). Guilledine, Gueldine. — Haquenee. Blanche, mignarde, angloise, gueldine. M. D E LA P O R T E , Epithetes, 203 v°. — La reyne y alla à cheval, et ses dames et seigneurs, sur des hacque-nées guilledines du pays, telles quelles, et harne-chées de mesmes. B R A N T Ô M E , des Dames, part. I, Disc. 3, la Reyned'Escosse (VII, 419). — II... avoit encor amené une fort belle guilledine à mon père, que le roy luy envoyoit. ID., Vie de François de Bourdeille (X, 56). — (Fig.). Grand lézarde porte fard, Guilledine destraquée, Vieille pucelle estri-quee. T A B O U R O T D E S A C C O R D S , les Bigarrures, I, 22. •—• Aussi disoit-on pour lors, quand il l'es-pousa, qu'il avoit pris et chevauchoit une jeune guilledine qui bientost le mènerait en paradis tout droict. B R A N T Ô M E , Cap. franc., le Roy Louis XII (II, 369). Guildron (courir le). Courir l'aventure. —
Avisez à choisir, ou de complaire à vos prophètes de Gascongne et retourner courir le guildron, en nous faisant jouer à sauve qui peut, ou à vaincre la Ligue, qui ne craint rien de vous tant que vostre conversion. A U B I G N É , Hist. univ., XIII, 24.
Guilee. Pluie, averse. — Tandis n'a pieu de l'air fors que guilee D'eau rose et musc. F O R C A D E L , Œuv. poet., p. 82. — Puis que le bœuf se lesche contremont, Le ciel promet la guilee et bruine Aux champs paoureux, menassez de ravine. ID., ib., p. 242. — Guillee d'eau. Pluvieuse, soudaine, violente, humide, nuageuse, courte, pétillante, froide, impétueuse. M. D E L A P O R T E , Epithetes, 201 r°. — Je... n'ay pas esté si tost à la Râpée que j'ay senti tomber une guillee d'eau, ce qui a esté cause que j'ay tourné bride. T O U R N E B U , les Contens, IV, 3 . — Le franc ozier... craint les gelées et guillees de mars. L I E B A U L T , Mais, rust., IV, 7 (G.). — (Par extens.). Son dernier trait de feu Est son dernier cotton, qui finist peu à peu, Se consomme et se perd, comme fait la guilee De l'huile de navette en la lampe bruslee. CHASSIGNET, le Mespris de la vie, p. 92. Guillardet. Gaillardet, terme de marine.
Sorte de bannière triangulaire. — Cestuy costé dressa vers le guillardet. R A B E L A I S , V, 17.
Guillaume. Gaillard, bon vivant. — Je dy que je n'estois Clément, N y Marot, mais un bon Guillaume, Qui pour le proufit du royaume Portois en grande diligence Pacquet et lettre de créance. M A R O T , Epistres, 62. — Quand il vous plaist vous avez gens letrez... Quand il vous plaist, les dez, cartes et paulme, Quand il vous plaist, quelque joyeux Guillaume. J. B O U C H E T , Epistres fami
lières du Traverseur, 27. — Je voy souvent jouer au jeu de paulme Ung jour entier avec quelque Guillaume, Sans rien manger, ou aultre jeu d'ha-zart. ID., Epistres morales du Traverseur, VIII 4 U n h o m m e quelconque, insignifiant. — Voici
tes paroles : « J'ay trouvé selon le commun abus d'escrire, joint l'opinion qu'on peult tirer de l'œuvre, que quelque Guillaume y estoit caché. » Ces mots donq joint l'opinion... veu que mon œuvre est si peu de chose, veulent dire que d'homme qui soit ainsi appelle ne peult sortir rien de bon. D E S A U T E L S , Réplique à Meigret, p. 13. — Puis un Guilhaulme Qui aubadant la fleur de ses ans fasche. V A S Q U I N PHILIEUL, trad. de PÉT R A R Q U E , L. IV, Triomphe d'Amour, ch. 4. — Nous avons deux noms, desquels nous baptizons en commun propos ceux qu'estimons de peu d'ef-fect, les nommans Jeans ou Guillaumes. E. PASQUIER, Recherches, VIII, 59.
Gautier et Guillaume, v. Gautier. Pierre ou Guillaume. U n homme quelconque,
le premier venu. — Où asseons nous cette renommée, que nous allons questant avec si grand'-peine. C'est en somme Pierre ou Guillaume, qui la porte, prend en garde, et à qui elle touche... Et ce Pierre ou Guillaume, qu'est-ce qu'une voix pour tous potages? M O N T A I G N E , I, 46 (1, 382 et 383).
Guillaume (prononc). — Glaume Lorris fit le romant De la Rose subtillement. Ane Poés. franc., VII, 6. — Jehan Marot et Guillaume Crétin Ont bien fait ouir leur retn. Ib., VII, 8. —Voy le françois aussi beau que latin De ce doyen maistre Glaume Crétin. J. B O U C H E T , Epistres familières du Traverseur, 22.
Guille 1. Longue gaule sur laquelle les rets sont tendus. — Ses cordeaux il délace, Et tire tant qu'il peut ; la guille saulte en l'aer, Et les moineaux surpris, en cuidant s'en voiler, Demeurent enrestez. C L . G A U C H E T , le Plaisir des champs, le Printemps, Disc du chasseur et du citadin, p. 120. — Aux pieux jumeaux on joint les guilles d'un costé. ID., ib., l'Automne, le Foliot, p. 273. — Le cordeau de dessus tendu bien roide-ment Est en estât tenu par la guille. ID., ib., VHyver, Chasse aux ramiers, p. 294.
Fausset. — Pour ne se décevoir, est nécessaire tirer souvent du vin de la cuve par la guille ou espine. O. D E S E R R E S , Théâtre d'agric, III, 8. — Pour à quoy remédier faut... en tirer un demi verre par la guille ou espine. ID., ib., III, 10.
(Dans un sens libre). Voir Espondrille. Guille 2. Tromperie. H. Estienne cite le mot
comme sorti de l'usage. — Pour signifier tromperie ils usoyent d e plusieurs mots qui ne sont point aujourdhuy en usage, entre lesquels estoit guille. Precellence, p. 198.
Guillebardeux (?). — U n taillandier... mit en vente ses marteaux, soufflets et enclume, sa meulle à pollir et la pluspart de ses autres outils et guillebardeux. P H . D'ALCRIPE, la Nouvelle Fabrique, p. 30.
Guilledin, Guillee, v. Guildin, Guilee. Guillemin. Sot ? — En quoy vous aprenez que
c'est de la jurisprudence, et des sumptuositez de ces guilmins. Supplément du Catholicon, 7, dans Tricotel, édit. de la Sat. Men., II, 56.
Guillemin campene (?). — Gueux de Phostiere, guillemin campeine, happelopin. D E S AUTELS, Mitistoire bjarragouyne, ch. 5.
Guillemin baille my ma lance. L'un des jeux de Gargantua. R A B E L A I S , I, 22.
Guillemot. — Le guillemot est jeune pluvier
— 411 — GUIMPLE
qui n'a pas encore mué. BELON, Nat. des ois., p. 261 (G. Compl.).
Guillery (H. D. T. 1771). — Pour abecher les passereaux qui ne bougèrent d'estourdir les accouplez de leur guillery. Prem. acte du Synode noct., 15 (G., Compl.). Guilieschis. Guillochis. — L'arc triomphal...
estoit richement doré, tant en cannelures de pilastres, guilieschis de la frize qu'en autre fueillage. PARADIN, Hist. de Lyon, p. 337 (G.). Guillibondaine (?). —• Encore avois deux
bons chevaulx estables, Voira, ou jumens, que tenois en estables, Pour m e porter et mes guilli-bondaines... Esgullettes, rubens, tricquedon-daines. Ane Poés. franc., XIII, 4. Guillier. Jeu de jonchets. — Une boite de
boys dans laquelle il y a un j eu d e guillier d'y voire. 1520. Inv. de Franc. Ie1 de Luxembourg (Gay, Gloss. archéol). Guillogé. Guilloché. — 6 paires d'estriers do
rez d'or moullu et argentez d'argent moullu faitz à compartimens et guillogez et poincté de dya-mant, 120 1. 1570. Cpte de l'écurie du roi, 42 v° (Gay, Gloss. archéol). Guillon (franc)? — Les gentilshommes,
francs guillons et gens de pied de la prevosté. 1515-16. Arch. Meuse (G.). Guilloppé. H o m m e dupé. — Je luy laisse,
voyre contant, Qu'en fin il sera mal content, En dangier d'aller pain questant, Aussi saige que ung guilloppé. Ane Poés. franc., X, 136. Guillot le songeur. Ce personnage légen
daire est pris pour type de l'homme perplexe, embarrassé, incertain. Estre chez Guillot le songeur, c'est être dans la perplexité, l'embarras, l'incertitude. — J'en suys bien ches Guillot le songeur. J'ay songé tant et plus, mais je n'y entends note. RABELAIS, III, 14. —Monsieur l'admirai demeura quatre ou cinq jours ne sçaichant de quel boys faire flesches, et logé chez Guillot le songeur. MONLUC, Commentaires, L. VII (III, 384). — Comment entendez-vous ces mots, bien qualifiez? — J'enten gentils-hommes bien godronnez, bien frisez, bien fraisez, bien passefillonnez. — Vous me mettez bien chez Guillot le songeur touchant ces quatre qualitez. Car quand je parti de France, on ne parloit aucunement de qualifier ainsi les gentils-hommes. H. E S T I E N N E , Dial. du lang. franc, ital, I, 211. — Quand ce vient à les accommoder au poinct, ils en sont tous chez Guillot le songeur et n'en sçavent venir à bout non plus que prendre la lune avec les dents. P H . D E M A R N I X , Differ. de la Relig., II, i, 10. — Hz y perdent leur escrime : car quand une fois les femmes ont mis ce ver coquin amoureux dans leurs testes, les en-voyent à toute heure chez Guillot le songeur. BRANTÔME, des Dames, part. II (IX, 142). (Par analogie). Guillot le menteur. — Il pourrait
sembler que maistre Gentian aurait icy soufflé en la cornemuse de Guillot le menteur [= aurait menti]. P H . D E M A R N I X , Differ. de la Relig., Il, iv, 1. Guilmin, v. Guillemin. Guilverdon (?). — Emburelucocquees de
guilverdons. R A B E L A I S , II, 13. Guimaulx (prez). — Coiraux : sont beufz en-
gressez à la crèche et prez guimaulx. Prez guimaulx : sont qui portent herbe deux fois Pan. R A BELAIS, I, 4.
Guimbarde (à la). L'une des nombreuses
sortes de rabats. — Levez la main, le beau fils, et gardez de gaster vostre ranver à la guimbarde. Var. hist. et litt., I, 217.
Guimbelet. Foret. — Pour deux guymbeletz et des pincettes. 1584. S4 Georges. Arch. Vienne (G.). — L'espine ou la guille : en France appellee foret, et l'instrument avec lequel l'on perce le tonneau, guimbelet. O. D E S E R R E S , Théâtre d'agric, VIII, 1. — C o m m e on vend les bonnets et les guimbelets dans une foire, se crient force traictez de la société de Bourdeaux. A U B I G N É , Faeneste, IV, 18. Guimberge. Cadre, moulure d'encadrement. — A Loys du Bueil... pour avoir painct de fin azur le champ sur fleur de lix de l'image du crucifix, et ramendé les faultes, qui estoient des ailles de fin or, tant aux personnages que à la guiberge, 19 1. t. Texte de 1545 dans Laborde, Cptes des bâtim. du roi, II, 284 (Gay, Gloss. archéol). — 1561. J'ay veu des ouvrages faicts à la mode françoise où il y avoit des guimberges et mou-chettes (ainsi que les ouvriers les appellent) quasi semblables à ce que je veux dire. P H . D E L'OR M E , Architecture, L. VII, p. 13 (Gay). — Clefs en façon de soufflet, avec des guymberges, mouchettes, clairevoyes, feuillages, crestes de choux. ID., ib., p. 110 (Gay). — Et fault asseoir et appliquer au dessus de lad. poultre une guimberge soutenue de 2 pilastres canelez. 1565. Eglise S* Aspais de Me-lun (Gay).
Guimper, v. Guimpler. Guimpeure.. Guipure. — Enrichis de passe-mens, guimpeures. L'ESTOILE, Mém., lie part., p. 137 (G., Compl., Guipure).
Guimple. Guimpe. — Sans atour et sans guimple. L E M A I R E D E B E L G E S , lre Epistre de l'Amant verd (III, 7). — Il est bien vray que tou-rel, voille ou guymple, Fort scapullaire ou autre habit de corps Ne rend jamais h o m m e ou femme plus simple. Ane Poés. franc., VIII, 173. — Maugré l'œil verd et soye découpée, N y guymple d'or de la belle Laïs. F O R C A D E L , ŒUV. poet., p. 132. — Mes deux sœurs... avoient mis dedans ce beau sixiesme, comme en presses, leurs guimples, manchons et collerettes savonnées de frays, bien blanches et empesées. R A B E L A I S , IV, 52. — Leurs guimples, collerettes, baverettes, couvrechefz et tout aultre linge y devint plus noir qu'un sac de charbonnier. ID., ib. — Le Seigneur ostera... les roquets, les mantelets, les guimples et les bourses, les mirouers, les toillettes, les diadèmes. CALVIN, la Bible franc., Isaïe, 3 (LVI, 586).
Morceau d'étoffe. — C'estoit ung plat plain de miel blanc couvert d'une guimple de soye cramoi-sine. R A B E L A I S , V, 33 ms.
O n dit aussi guinfe. — Que sert... Umbrer ces flotz unis de ces trames de guinfes? Carites, donnés luy la coyffure des ninfes. L. P A P O N , Disc, à MUe Panfile (I, 31).
Guimple (masc). — Puis tout le chef d'un guimple elles se cachent, Qui bien plissé jusqu'aux pieds leur pendoit. R O N S A R D , Franciade, III (III, 87). — Puis un beau guimple afubla par dessus... Qui leur couvroit du chef jusqu'à la plante. ID., ib., IV (III, 127). — Apollon au chef orin Admire en sa beauté simple Cyrene, bien que son crin, Non couvert d'un d"ougé guimple, En l'air pendille tremblard. BAÏF, Poèmes, L. III (II, 130). — Son guimple plus que flamme estincelloit dehors, Bordé, semé par tout de gazerans retors Et de boutons luisants. ID., ib., L. VI (II, 283). — Dessus son dos dans un guimple de toyle Le vent
GU1MPLER 1 — 41
s'entourne ainsi qu'en une voyle. ID., ib., L. IX (II, 430). — Ni à toi mon eschançon, Ni à moi ceiîict de ce guimple Soubs l'humble treille raiant Le myrte n'est messeant. Luc D E LA P O R T E , trad. d'HoRACE, Odes, I, 38. Guimpler 1. Se guimpler. Se parer d'une
guimpe. — Ne vous ornez, guymplez, lassez, fardez Pour vous monstrer d'apparence tresbelles. J. B O U C H E T , Epistres morales du Traverseur, I, 4. — Bref pour représenter au vif l'image mesme De famine, il nous faut contempler le quaresme, Qui ne sçauroit si bien se coeffer et guimper Qu'a tout son beau discours je m e laisse piper. Les Fanfares des Roule Bontemps, 17.
S'attacher à une coiffure. — On dit que deux joiaux posez aux joeux Pythiques se guimplerent d'euxmesmes à deux femmes de quelques capitaines phocéens. SALIAT, trad. de G E O R G E G E -MISTE, L. II, 241 v°.
Guimpler 2. Estre guimple. Contracter la syphilis. — Que sçavons nous qui nous en adviendra, la verolle ou de l'argent? Il ne faut qu'un hazard semblable à celui de la belle fille, qui le premier coup qu'elle le fit fut guimplee. B E R O A L D E D E V E R V I L L E , le Moyen de parvenir, Minute (I, 140). Guin. Action de guigner, de faire signe. — La
pucelle Rhétorique... percevant à un seul guin dœil lentente de sa dame, disposa sa contenance ainsi que pour parler. L E M A I R E D E B E L G E S , la Plainte du Désiré (III, 168). — Tout sous le vueil et guin du grand designateur De si haute fabrique, et seul architecteur. M A U R I C E S C È V E , Microcosme, L. I,p. 5. Guinberge, v. Guimberge. Guincher. Détourner. — Si je ne m e feusse
point guynché le corps, il meust faict ung maul-vais tour. P A L S G R A V E , Esclare, p. 785. — Faune amoureux des nymphes forestières, Qui, en guin-chant leur fuyte en mille tours, D'un vol léger se moquent de ton cours Qui ne les peut garder d'estre premières. D E S A U T E L S , Amoureux repos, sonn. 78.
Guinchant. Tourné, incliné. — Dont estoit enlevé le beau pignon vers soleil couchant, guinchant un peu sur le midy d'un costé. D u FAIL, Baliverneries d'Eutrapel, p. 45.
Guindage. Action de guinder, de tirer en haut. — Si le tonel se perdoit par deffault de guindaige ou de cordaige, le maistre est tenu a le poyer aux marchans. Coût, de Bret., 207 v°, édit. de 1517 (G., Compl.). — Pource qu'il n'y avoit nul accès au haut de cette roche que par la ville ou en se faisant guinder par des cordages, il donna à une tour bastie exprès pour deffendre l'endroit du guindage. A U B I G N É , Hist. univ., XIII, 17.
Guindal. Treuil. — Arbalestes garnies de guyndalz, cordes et noix. 1542. Inv. des arnoys. Montauban (G.). — Le paillard outil d'un amant se bande sans guindal de lui-mesme. B E R O A L D E D E V E R V I L L E , le Moyen de parvenir, Annotation (I, 206). —• (Fig.). Je maintiens vray semblable-ment Que l'homme mortel lon peut dire Une arba-leste proprement Tendue au guindal de martyre. F E R R Y J U L Y O T , lre part., 30 (A Claude Petre-mand). — Il dit que le pape est caché ou comprins en ces mots. Il y a un corps et un esprit. Et le guindal avec lequel il le tire hors de ce cachot est Que, tout ainsi comme en un corps naturel l'unité y est gardée, à cause que tous les membres obéissent à la teste : ainsi pareillement l'union de l'Eglise est
alors maintenue quand tout le monde obéît à un pape de Rome. P H . D E M A R N I X , Differ. de la Relig., I, n,2.
Guindelle. Sorte de bateau. — Deux guin-delles de sel. 1521-31. Act. consul, de Lyon (G.).
Guinder (trans.). Élever. — La muse peult d'une vie immortelle Te bien-heurer, guindant par l'univers Ton nom porté sur l'aisle de mes vers. B E R E A U , Eglogues, 1. — Il voyoit bien qu'au deffaut de la lignée de Frideric, Rodolphe seroit guindé à l'empire. CHOLIÈRES, 8e Ap.-disnée, p. 362. — Tandis levant mes yeux au rond de l'orizon, Je guindé au firmament ma dévote oraison. P. M A T T H I E U , Vasthi, III, p. 62.
Gravir. — O u bien, seul, à part moy, battant une campaigne, Traversant un taillis, guindant une montaigne. B R A N T Ô M E , Poés. inéd., 143 (X, 490).
(Intrans.). Hisser les voiles. — Le prince.., ayant lors vingt quatre navires... fit guinder, se met aux trousses de Lansac. A U B I G N É , Hist. univ., VIII, 17.
Se guinder. S'élever. — Muse, qui autrefois chantas la verde Olive, Empenne tes deux flancs d'une plume nouvelle, Et te guindant au ciel avecques plus haulte aile, Vole où est d'Apollon la belle plante vive. D u B E L L A Y , les Regrets, 171. — Ce-pendant (Pelletier) que dessus ton Euclide Tu monstres ce qu'en vain ont tant cherché les vieux, Et qu'en despit du vice et du siècle envieux, Tu te guindés au ciel comme un second Alcide. ID., ib., 189. — Foulans la terre aux pieds, nous nous guindons au ciel. O. D E LA N O U E , Poés., p. 302 (G., Compl.). — Je relevé mon cœur sur les formes plus belles, M e guindant vers le ciel d'un vol audacieux. B E R O A L D E D E VERVILLE, Voyage des princes fortunez, p. 436.
Se guinder à. Se placer sur. — Puis se guindans au chemin oportun, sans autrement se peiner ou fatiguer, se trouvoient au lieu destiné. RABELAIS, V, 25.
Guindé. Élevé. — (Les Idées). Lors peu à peu devers le ciel guindées Dessus l'engin de leurs divines aeles, Voilent au seing des beautez éternelles. D u B E L L A Y , l'Olive, 112. — Monté dessus le dos des chérubins mouvans, Il vole droict, guindé sur les aisles des vents. A U B I G N É , les Tragiques, VI (IV, 272).
Guindolier. Sorte d'arbre fruitier. — Le noyau du guindolier, autrement dit jujubier, se fiche à la manière et façon du perfiguier. LIEB A U L T , Mais, rust., p. 400 (G.).
Guindoule. Sorte de fruit. — Les guyndoles habondent grandement en Languedoc. Galien dit que lesdictes guyndoles sont peu nutritives et sont de dure digestion. P L A T I N E , De honneste volupté, 15 v° (G.). — La jujube ou guindoule ressemble la cornoaille en figure, en couleur, et en ce qu'elle a un noiau dedans. O. D E SERRES, Théâtre d'agric, VI, 26.
Guindoux. Sorte d'arbre fruitier. — B ente Dedans des sauvageaux un poignant chateignier, U n poirier, un pommier, un guindoux, un prunier. B E R E A U , Eglogues, 3, p. 28.
Guindre. Instrument servant à dévider la soie. — De la façon... des roues ou tours, nommes a Paris desvidoirs : et à Tours guindres : ou comment on les doit mouvoir, si ce sera à la main, au pied ou à l'eau... n'est besoin de parler encest endroit. O. D E S E R R E S , Théâtre d'agric, V, 15.
Guinfe, v. Guimple.
— 41 3 — GUISE
Guingaude. Aiguière en métal sur trois pieds. — Cinq potz à laver, trois mesures de coivre, deux guingaudes. Invent, de Guill Arthus (G. Beaurain, Rev. des Et. rab., X, 90). Guinguoys, adj. Qui est de travers. — Fol
guinguoys. RA B E L A I S , III, 38.
Guinier. Guignier. — Poirier n'y a, ny guy-nier, ni pommier Qui tous les ans ne chargent un sommier. M A R G . D E N A V . , les Marguerites, Comed. du Désert (II, 202). — 1544. Arbres plantez pour le plaisir : comme cerisiers, guinniers, abricots et autres semblables. J. L E B L O N D , trad. de G. D'A U -RIGNY, le Livre de police humaine, 98 b (Vaganay, Rev. des Et. rab., IX, 308). — Ainsi qu'au renouveau Un beau guinier par gros trochets fait naistre Son fruit touffu. R O N S A R D , Poèmes, L. I, la Lyre (V, 54). — Nous planterons les ceriziers et guiniers environ le plus court jour de l'an, si nous voulons suivre la doctrine des antiques : lesquels arbres, pour la rarité, ils traitoient curieusement. 0. D E SER R E S , Théâtre d'agric, VI, 26. Guinsal. Corde, lien. — Les Locres Epize-
phyres ordonnèrent, pour mieux et plus soigneusement garder les anciennes ordonnances, que nul ne pourrait mettre en délibération aucune chose contre l'ancienne loy ou coustume de la ville, qu'il n'eust le guinsal au col et ne fust es mains de l'exécuteur de la justice, pour l'estrangler incontinent, si sa proposition estoit jugée desraisonnable par le conseil de la Republique. Disc. cont. la maison roy. de Fr., p. 224, édit. de 1587 (G.). Guinterne, v. Guiterne. Guipillon, v. Guepillon. Guippe. Jupe? cotte? — Vous le pouvés tous
cognoistre, messieurs, si ce n'est à la façon de sa guippe, ce sera pour le moins à la couture. P H . D E MARNIX, Differ. de la Relig., 1, m , 4. Guippelin (?). — Qui est il? — C'est un guip-
pelin, Et le mal de sainct Mathelin Le tient au sommet de la teste. Sotties, III, 222. Guippon, Guirlande, v. Gipon, Girlande. Guirlander. Parer d'une guirlande, d'une
couronne. — Te gyrlander le front des plus fameux lauriers. J. D E VITEL, Prem. exerc. poet., Prinse du mont S1 Michel (G., Compl.). Guirlande. Paré d'une guirlande, d'une cou
ronne. — Les boucs sus les pies de derrière avéque leurs cornes de costé combatront, et les victorieus de fleurs auront les cornes guirlandées. V A U Q U E LIN D E LA F R E S N A Y E , Foresteries, II, 9. — Je diray vos vertus, guirlande de laurier. J. D E C H A M P -HEPUS, Poésies diverses, p. 81. — Ne paroistray-je pas botté, espronné, moustache et guirlande? Var. hist. et litt., VI, 34. — D'un autre costé estoit une grande déesse... elle estoit guirlandée de fleurs blanches. Ib., X, 269. Guiroflée. Giroflée. — Il ordonne en ce lieu
la marguerite, il baille Aux œillez ce quarreau, il met en cestuy-cy La guiroflée, après en cestuy le soucy. B E R E A U , Eglogues, 3. Guisarme. Sorte de hallebarde. — Mort im
portune et ses dards et guisarmes Luy ont tant fait de terribles vacarmes Que langue n'est qui le sceust exprimer. L E M A I R E D E B E L G E S , la Couronne Margaritique (IV, 38). — Rasteaux esden-tez, fourches ferrées, guisarmes, badelaires, ale-melles ployees, javelotz... et autres bastons inva-sibles. ID., Illustr., I, 23. — Les gladiateurs et meurtriers alloient manifestement avecques cous-teaulx et guisarmes par les champs et lieux di
vers. M I C H E L D E T O U R S , trad. de S U É T O N E , II, 60 v°. — Chacun adonc aux belliqueux vacarmes Se veult monstrer ; prennent lances, guysarmes. M A R O T , Vers inédits, Chant 23. — Pour souldaier gensdarmes Tant a cheval qu'a pied portant gi-sarmes. J. B O U C H E T , Epistres morales du Traverseur, II, vi, 6. — Les uns... nettoioient... salades, bavieres, cappelines, guisarmes. R A B E L A I S , III, Prologue. — Et comme bien rusez gendarmes, Des Grecs et des Romains aussi Prenons les bouclers et guyzarmes. D u B E L L A Y , la Lyre chrestienne. Guiscard, cité comme mot normand. — C'est ce Robert lequel, par son excellent esprit et astuce grande, fust n o m m é Guiscard, qui en la langue des Normands signifie ingénieux et rusé. A N T . D U V E R D I E R , Div. leçons, p. 405, édit. de 1616 (G.). Guise. Manière, façon. — Là ou ton sens se perd et se desbrise Et de fournir ne scait trouver la guise, Il ne faut ja que d'atteindre j'y vise. L E M A I R E D E B E L G E S , la Plainte du Désiré (III, 169). — M o n vouloir, certes, ne prétend Le contredire en nulle guise. G R I N G O R E , £' Loys, L. VI (II, 188). — Onques n'eut convoitise Biens amasser, mais biens pensoit la guyse, Quand n'en avoit, soub-dain en recouvrer. B O U R D I G N É , Pierre Faifeu, ch. 32. — Le Monde... Est vestu de guise indécente. Sotties, III, 43. — Vien, Vérité, qui rien ne nous desguise... Brusle Cuyder par sy subtile guise Qu'en Dieu tout seul congnoissons qui nous sommes. M A R G . D E N A V . , les Marguerites, Oraison de l'ame fidèle (1, 98). — Sa robe et le reste de son vestement aprochoit assez de la guyse de vestir des Grecz. A M Y O T , Hist. Mthiop., L. II, 23 v°. — Quand au temple nous serons Agenouillez, nous ferons Les dévots selon la guise De ceux qui pour louer Dieu Humbles se courbent au lieu Le plus secret de l'église. R O N S A R D , Amours de Cassandre, Stanses (1, 63). — Leur ancienne guise de vestir n'estoit pas ionienne, mais carienne. SALIAT, trad. d'HÉRODOTE, V, 88. — E n fin sort la princesse, De trouppe grande accompagnée estant, Et le manteau sidonien portant Peint et bordé de somptueuse guise. D E S M A S U R E S , Enéide, IV, p. 168. — M o n cher Belleau, voicy la vraye guise Dont faut soufrir que ce dieu nous attise,... Aimons ainsi. BAÏF, Diverses Amours, L. I (I, 323). — Nous endurons des maux en mainte guyse Pour deffendre ces sainctes gens d'Eglise. Var. hist. et litt., II, 337.
Manière d'agir. — Il est bruyt que chascun Offense Dieu, qui n'est pas bonne guise. M A R O T , Rondeaux, 75. — Ce n'est la guise des amoureux, ainsi avoir bragues avalades. R A B E L A I S , III, 7.— Bien heureux qui, d'afaires loing, N'ayant de nulles debtes soing, Et ne mettant la vieille guise De la gent d'or à nonchaloir, Avec ses toreaux fait valoir La terre par son père acquise. BAÏF, Poèmes, L. III (II, 152). — Et neantmoins ay tousjours vescu dedans m a parroisse, avec m o n curé, à la vieille guise. E. P A S Q U I E R , Lettres, XXI, 2. Aspect, apparence. — Lors la déesse aux yeux
ardens s'avise D'autre moyen, en ayant pris la guise De Thelemacq' vers la cité s'en part. PELE-TIER D U M A N S , L. II de l'Odyssée, p. 46. —
J'ouvre, et est vrai que j'avise D'un petit enfant la guise, Mais il portoit arc turquois, Longues ailes et carquois. J E A N D O U B L E T , Epigrammes, p. 121.
Sorte. — Pour les cloches avoient sons de ta-bours... Pour l'eaue benoiste, de vins d'estrange guise. G R I N G O R E , les Folles entreprises (I, 134). —
GUISTE — 414 —
A bas y est, la chère fiere et torte : De qui la bande entière d'une guise D'armes s'accoutre insigne et fort exquise. D E S MASURES, Enéide, X, p. 503. Condition. — Noncez à gens de toutes guises
Ses œuvres grandes et exquises. M A R O T , PS. de David, 9. De grand guise. De haute condition. — Il n'ap
partient à chevalier (de telle race que vous estes) avoir en sa garde dame de si grand guise. Amadis, I, 44. De haute guise. De haute apparence. — Un
dévot religieux de l'abbaye de Clugny veid en songe un homme beau par excellence et lumineux... Le religieux s'enquist qui estoit cest homme de si haute guise. L E LOYER, Hist. des Spectres, VI, 13. De haute condition. — J'entends des grandes
dames et de haute guise, et non des petites, communes et de basse marche. BR A N T Ô M E , des Dames, part. II (IX, 78). A la guise. A la manière, à la façon. — Ses che
veux... espars à la guise des bacchantes, luy des-cendoient bien fort bas par derrière. A M Y O T , Hist. Mthiop., L. I, 2 r°. — Les Barbares, abusez pource qu'ilz veirent que c'estoient voiles persienes, et que les hommes semblablement estoient vestes à leur guise, pensèrent certainement que ce fussent de leurs galères. ID., trad. de DIODORE, XI, 13. — Et eulx en ces trente jours feirent un solennel sacrifice à Hercules et à Jupiter sauveur, avec un tournoy et des jeux à la guise grecque. ID., ib., XIV, 8. — Dieu ne veut point estre servi à la guise des idoles. CALVIN, Serm. sur le Deuter., 81 (XXVII, 162). — Cestuy Mutius... cherchant le moyen de pouvoir occire le roy Porsena, se vestit à la guise des Thoscans : et parlant bien le langage thoscan, s'en alla en son camp. A M Y O T , Publicola, 17. — Perseus... vestu d'une robbe noire et ayant des pantoufles aux pieds à la guise de son païs. ID., Paul Emile, 34. — Xenophon... loue et prise la response d'Apollo, par laquelle il commanda que chacun servist à Dieu à la guise et façon de ses pères, et selon l'usage et coustume de sa ville. CALVIN, Instit. (1560), I,v, 12. — Je veu parmy que facions, à la guise Des doux pigeons, cent jeux de mignardise. BAÏF, Diverses Amours, L. II (I, 339). — Tant par-sur tous on doit l'homme estimer... Dont le souci bien modéré tempère Sous luy le peuple, à la guise d'un père. RONSARD, le Bocage royal, lre part. (III, 279). — Cela est pour reprimer la hardiesse de ceux qui se dispensent pour le jour d'huy de faire presches à la guise de la ville de Genève. E. PASQUIER, Lettres, IV, 4. A guise. A la manière, à la façon. — Il mit à
mort un grand serpent qui desoloit le pays, et en sema les dens, à guise de grains, dans la terre. CHOLIÈRES, lre Matinée, p. 54. — S. Mère Eglise nous a pourveus... d'une seconde planche et table pour nous sauver de ces ondes, à guise d'un sainct Christoffle. PH. D E MARNIX,Differ. delaRelig., II, iv, 14. — Les règles... sont la vraye eschelle par laquelle elles doivent, à guise d'anges, monter à Dieu par charité et descendre en elles mesmes par humilité. S1 FRANÇOIS D E SALES, Entretiens spirituels, 1 (VI, 10). — Comme la foy, l'espérance et la charité sont des vertus qui ont leur origine de la bonté divine, aussi en tirent-elles leur augmentation et perfection, à guise des avettes, lesquelles estant extraittes du miel prennent aussi leur nourriture d'iceluy. ID., Amour de Dieu, III, 2. — Il fut roulé et agité très rudement dans un instrument fait exprès, à guise de la vis d'un pressoir. ID., ib., X, 8. — Ces dieux, courbez à guise de maçons, Portoient la pierre en diverses façons.
CL. GARNIER, Livre de la Franciade (S. Ratel Rev. du XVIe siècle, XII, 6). A guise que. De la manière dont, comme. — Je
voudrais avoir droit de les leur demander... à la guise que Cyrus exhortoit ses soldats, Qui m'ay-mera, si me suive. MONTAIGNE, III, 5 (III, 388), En guise. A la manière. — Les oreilles nous
fault porter En la guise d'un chien pendant. Ane. Poés. franc., I, 21. — Les heures sont faictez pour l'homme, et non l'homme pour les heures. Pourtant je foys des miennes à guise d'estrivieres. RABELAIS, I, 41. — Mais eux, en guise de bons agriculteurs, l'ont... transmuée d'un lieu sauvaigeen un domestique. Du BELLAY, Deffence, I, 3. — Que l'air, le vent et l'eau favorisent ma dame, Et que nul flot bossu ne destourbe sa rame. En guise d'un estang sans vague paresseux Aille le cours de Loire. RO N S A R D , Amours de Marie, le Voyage de Tours (1, 167). — Metellus Pius... sembloit... n'embrasser pas assez vivement les occasions de la guerre, que Sertorius, par sa soudaineté et sa légèreté luy ravissoit d'entre les mains, en se trouvant à tous coups devant luy alors qu'il y pensoit le moins, plus tost en guise de capitaine de brigans qu'autrement. A M Y O T , Pompée, 17.— Apres luy marchoit un qui, avec son manteau, son baston, ses pantoufles, et avec une barbe en guise de bouc, signifioit estre un philosophe. LOUVEAU, trad. d'ApuLÉE, XI, 3. — En guise d'escar-boucle est cest escu luisant. J. DE BOYSSIÈRES, Sec. chant d'ARiosTE, p. 45. — Tous ceux qui désirent vivre comme vrays hommes, mais non en guise de bestes. LARIVEY, la Constance, V, 8. — Pour l'œil d'un fat bigot l'affronteur hypocrite De chapelets s'enchaine en guise d'un hermite. AUBIGNÉ, les Tragiques, V (IV, 199). En la guise, en guise. Sous la forme, l'aspect,
l'apparence, en prenant la forme, l'aspect, l'apparence. — Les Phéniciens le pourtrayoient [Noë Janus] en guise dun dragon qui mordoit sa queue. LEMAIRE D E BELGES, Illustr., 1, 5. — Jupiter.., se transforma en guise dun taureau, selon les fables. ID., ib., II, 11. — Il se trouva ung diable, en guise d'un jeune garson de village, lequel diable estoit là venu pour tenter ces pauvres gens. NICOLAS D E TROYES, le Grand Parangon, 18. — Je me contreferay en guise d'un impotent, tu me prendras d'un costé et Stechi de l'autre, comme si je ne pouvoye cheminer de moy-mesmes. LE MAÇON, trad. de BOCCACE, Decameron, II, 1. — En dormant luy apparurent les trois nymphes en guise de trois belles grandes femmes à demy nues. A M Y O T , Daphnis et Chloé, L. II, 32 r°. — Près luy Pallas s'est trouvée, en la guise Du vieil Mentor, de corps, de voix aussi. PELETIER D U MANS, L. II de l'Odyssée, p. 41. — Mars s'estant transformé en guise d'un berger. A M Y O T , Collation d'aucunes hist. romaines, 26. — Ullixes l'alla descouvrir [Achille] en guise de marchant ou contreporteur en la maison de ce roy, où il estoit déguisé en fille. BR A N T Ô M E , Cap. franc., le grand Roy François (III, 119). — Chouppes, voulant aider sa foiblesse de quelque ruse, passe le pont de Chelandre, et se met sur la piste des ennemis pour approcher d'eux en guise d'un secours nouveau. AUBIGNÉ, Hist. univ., IX, 7. Guiste. Sorte de mesure. — Laye a le casse ou
guiste de chucre. 1512. S* Orner (G.). Guisterne, v. Guiterne. Guitayre, v. Guiterre. Guiterne. Sorte d'instrument à cordes. —
Tous vieux flageots, guisternes primeraines... Sont assourdis par harpes souveraines. LEMAIRE
— 415 — GUODELURER
DE BELGES, La Concorde des deux langages, l" part. (III, 110). — Fleustes, lutz, guinternes. BONIVARD, Adv. et dev. des leng. (G.). — Si tu veux aporter ta guyterne, et que tu chantes un peu avec elle de ces chansons amoureuses que tu sçais. L E M A Ç O N , trad. de B O C C A C E , Decameron, IX, 5. — La bonne personne... donne resveilz et aubades de sa vieille guiterre qu'on souloit nommer guiterne. D u FAIL, Propos rustiques, ch. 14, p. 174. — Les pieds, comme une guinterne. R A B E LAIS, IV, 31. — Au commencement, ceux qui apprennent à jouer de la guiterne gastent volontiers les cordes et le fust. L A B O E T I E , trad. de la Mesnagerie de X E N O P H O N , ch. 5. — Une lyre ne leur seroit pas mieux séante [aux Muses], ny une guiterne, que de mettre un accord bien avenant en la maison. ID., trad. des Règles de Mariage de PLUTARQUE, p. 162. — Mais que d'un luth joint à la voix, Et d'une guiterne entonnée, Et d'un cornet et d'un haulbois On chante dez la matinée. 0. DE M A G N Y , Odes, 1, 128. — Guiterne ou Gui-terre... La guiterne est comme un diminutif du luth. M. D E LA P O R T E , Epithetes, 201 v°. — Gau-chent prend l'espinette, Silve prend la guiterne, et Popot la musette. CL. G A U C H E T , le Plaisir des champs, l'Automne, Divers plaisirs, p. 264. — Une guiterne et vieille et mal montée, D'une sçavante main dextrement pincetee, Nous rend un son plus doux qu'un parfait instrument, Que les doigts d'un bouvier battent grossièrement. D u B A R T A S , 2e Semaine, 1er Jour, l'Imposture, p. 59. — Le mouvement d'un pouce Donne ame aux nerfs divers d'une guiterne douce. ID., ib., 4e Jour, la Magnificence, p. 393. — En croisant les doigts sur sa meschante guiterne. D u FAIL, Contes d'Eutrapel, 19 (I, 255). — Et vous, manche de guiterne, Souple comme un chat qu'on berne, Guayne à mettre des cousteaux. T A B O U R O T D E S A C C O R D S , les Bigarrures, I, 22. — Embouchez vos trompettes, Animez violons, guiternes, espinettes. D u BARTAS, la Lepanthe, p. 415. — U n vray maigre bouffon, avec sa guitterne et son braillement de chansons à Pespaignolle. B R A N T Ô M E , Cap. estr., le Mareschal d'Estrozze (II, 265). — J'ay veu des esclaves turcz en chanter des chansons sur leurs grandes guyternes. ID., Cap. franc., M. Parisot (V, 234).
Guiternier, Joueur de guiterne, de lyre. — Il y avoit à la porte Sainct Victor un peintre et un guiternier qui introduisirent chascun un apprentif esdites assemblées. R É G N I E R D E L A P L A N C H E , Hist. de l'Estat de France, I, 50. — Teridates... se moquoit de Néron, et disoit infinis maux de luy, l'appelant charretier, guiternier. G E N T I L L E T , Disc sur les moy. de bien gouverner, p. 117 (G.). Guiterre. Guitare, et, par extens., lyre. — Faites dés ceste heure mienne La guiterre teienne Par moy vive de rechef. BAÏF, les Amours de Meline, L. II, Aux Muses et à Venus (I, 91). — Ter-psichore fredonnoit Sur sa hautaine guiterre. T A HUREAU, Prem. Poes. (1, 20). — Si tu entendz quelquefoys Le fredon de m a guitayre. ID., ib. (I, 78). — Aux doux fredons de m a guiterre Je feray parler de m a terre. ID., ib. (I, 171). — Puis resveillé ma guiterre je touche, Et m'adossant contre une vieille souche, Je dy les vers que Tityre chantoit. R O N S A R D , Gayetez, 3 (II, 40). — Don-ron' nous au roy de Dele Ceste guiterre si belle? O. D E M A G N Y , Gayetez, p. 5. — La fille portant le lierre, Fredonnant dessus sa guitterre, Dance d'un pied mignardelet. R. B E L L E A U , Odes d'Ayx-CREON (I, il). — C o m m e Amphion tira les gros cartiers de pierre Pour emmurer sa ville au son de
sa guiterre. R O N S A R D , Eclogues, 3 (III, 407). — La mesme main qui sur la gent troyenne Avoit brandi la hache pelienne, Par fois touchoit sa guiterre d'un son Qui respondoit à sa douce chanson. BAÏF, Poèmes, L. II (II, 73). — Soit pour sembler un second dieu de guerre, Soit pour toucher de Phebus la guiterre. A M . J A M Y N , ŒUV. poet., L. V, 300 r°. — Prenons harpe et guiterre, et toutes en sonnons. R. G A R N I E R , les Juifves, 1206. — Jouer de la guiterre et donner les mati-nades aux seignores et damoiselles. F R . D'AMBOISE, les Neapolitaines, I, 3.
Guitterne, Guitterre, v. Guiterne, Guiterre. Guittural. Guttural. — L'embouchement des
chassetrapes guitturales. R A B E L A I S , II, 13. Guide. Association, confrérie. — Les doyens
des guides n'estoient aussi sans jalousie au regard desdits colonnels. P H . D E M A R N I X , Ecrits polit, et histor., p. 247. — Touchant les guides, ils fesoient presques un ordinaire de refuzer ce qui leur estoit commandé, test ce pour aller sur les forts tenir la garde, ou de contribuer pionniers, et autres choses semblables. ID., ib., p. 249.
Gule (gula). Gueule. — Ces basilics nous font mourir : Mais ô combien sa gule est pire, Qui jamais ne vint à s'ouvrir Que pour trahir ou pour mesdire. D u M A S , ŒUV. meslees, p. 244.
Gulosité (gulositas). Gloutonnerie, voracité. — Ung yvrongne ayme tousjours sa crapule et gulosité. Prem. vol. des exp. des Ep. et Ev. de Kar., f° 43 (G.). — Toute gulosité et nimieuse replection de vin et viande sont causes d'énormes péchez. Ib., 1 r° (G.). — Gulosité s'efforce de me induire A gourmander en crapuleux sabat. J. B O U C H E T , Triumphes de la noble dame, 2 r°. — Que si, sans t'en donner de peine, tu retombes derechef à ceste gulosité insatiable : j'estimeray tousjours que m a remonstrance aura esté assez suffisante. F. B R E TIN, trad. de L U C I E N , Lexiphane, 24.
G u m e n e Gros câble. —- Le prodenou est en pièces... nos gumenes sont presque tous roupts. R A B E L A I S , IV, 18. — Ne tenoys je l'arbre sceure-ment des mains, et plus droict que ne feroient deux cens gumenes...? ID., IV, 22. — Epistemon avoit une main toute au dedans escorchee et sanglante par avoir en violence grande retenu un des gumenes. ID., IV, 23. —• Ayans serpé nos ancres et gumenes, feismes voile au doux zephyre. ID., V, 17. — Estroitement lièrent en tous les endroits les gumenes. ID., ib. — Le vent de siroch commença petit à petit, et se renforça sur le vespre, jusques à estre moult impétueux : lequel nous contraignit plier toutes les voyles et nous contenter d'une petite, qu'il nous convint descendre jusques à mi mas, et la renforcer de bonnes gom-menes et gros chables. B E L O N , Singularitez, II, 15 (G.). — Les ancres retenues à belles chesnes de fer en lieu de gumenes et cordages. V I G E N E R E , Comment, de C É S A R , p. 102 (G.). — Antenne, espallier, terzerol, trinquet, gomenes, qui sont les grosses cordes. T H E V E T , Cosmogr., VII, 12.
Gunocratie, déformation de gynêcocratie. — Ce propos fut rompu par madame de Bonneval la bonne femme... qui, après avoir discouru sur la félicité d'Angleterre durant la reine Elizabeth, maintint qu'il f aloit mettre la France en gunocratie. A U B I G N É , Faeneste, III, 22.
Guodebillaux, v. Gaudebillaux. Guodelurer. Caresser? — Elles feurent far-
fouillees, guodelurees et intimées. R A B E L A I S , IV, 35.
GUODEPIE
Guodepie. Morue. — Truites. Lavaretz. Guo-depies. Poulpres. RABELAIS, IV, 60.
Guodet, Guogo, v. Godet, Gogo.
Guogue. Boyau. — La poictrine, le faye, la râtelle, les trippes, la gogue, la vessye. RABELAIS, IV'7- A
Sorte de cornemuse. — A u son des vezes et pi-boles, des guogues et des vessies. ID., IV, 36.
(Fig.). H o m m e sans énergie. — Tous nos hommes ne sont que couilles : Lasches gogues, flaques andouilles : Qui ont du mou en lieu de cueur. BAÏF, les Mimes, L. IV (V, 212). Guoguelu, Guoildronneur, v. Goguelu, Goil
dronneur. Guorge, Guorgeri, Guorgias, Guorgiase-
ment, Guorgiaser, Guourneau, Guoyon, Guoytron, v. Gorge, Gorgeri, Gorgias, Gorgiasement, Gorgiaser, Gournaud, Goyon, Goitron.
Gurene. L'une des pièces servant au fonctionnement d'un moulin à eau. — Le preneur d'un moulin a eaue est tenu d'entretenir ledit mollin de tous harnas mouvans et travaillans, comme chevilles, aubes, coiaulx, cuignets, gurenes et choppines. 1611. Noyon (G.).
Gurgite. Canal. — Car tout le feu horrible et noir De nostre ténébreux manoir Se rend par veines et gurgites A ces estuves dessusdictes. Act. des Apost., vol. I, 44 d (G.).
Gurgulion (gurgulio). Charançon. — Les bestes nommées gurgulions ou garguetons. Jard. de santé, 1, 180 (G.). — Toutes choses qui proviennent des champs cultivez avec fien sont de mauvais suc et moins sain. Et mesmes le froment et tous autres bleds en sont plustost assailliz des cossons ou gourguillons. J. G. P., Occult. merv. de nat., p. 191 (G.). — Si leurs richesses consistent en molins, l'eaue les emmaine, si ce sont... greniers pleins de bleds, les gorguillons les mangent. Gu-T E R R Y , Epit. dorées de G U E V A R A , II, 54 (G.).
Gusman. — S'il y a des gentilshommes et des gusmans, qu'ilz appellent ainsi parmy eux [les soldats espagnols]. B R A N T Ô M E , Rodomontades es-paignolles (VII, 146).
Gustatif (H. D. T. Ambr. Paré). — 1503. A elle [la langue] viennent nerfz gustatifz. Le Guidon en franc, 51 c, édit. de 1534 (Vaganay, Pour l'hist. du franc, moderne).
Gustation (gustatio, action dégoûter). — Subitement fut produict fruict en grande abondance, et beaucoup de manières de gustations concupis-cibles. L E F E V R E D'EST., Bible, Esdras, IV, 6 (G., Compl.).
Guster (gustare, goûter), latinisme par plaisanterie. — Aussi tost qu'elles ont Gusté tes dicts d'excelse aménité. Epistre du Lymosin, dans les Œuv. de Rabelais, III, 275. Gutte (gutta, larme coulant de certains arbres).
— Myrre et gutte et casse sentent [sortent ?] de tes vestemens venans des maisons de yvire. L E F E V R E D'EST., Bible, Ps. 44 (G.).
Guttule (guttula, petite goutte). — Quant l'arc apparoit avec petites gouttes, la nue est basse, laquelle survenante après grandes sécheresses aux arbres ja naturellement odoriferes, la petite humidité des guttules ja cuite, elle se convertit insensiblement en vapeurs odorantes. L E B L A N C , trad. de C A R D A N , 84 v° (G.).
Guy, v. Gif. Guyacoux. Mets imaginaire. — D u guyacoux.
16 —
RABELAIS, V, 33 ms.
Guybrequin. Vilebrequin. — Ung guybrequin, ung petit tarière. 1517. Inventaire (G., Compl.),
Guyde, v. Guide.
Guydement. Conduite. — Les guydemens ou inductions des eaues. Trad. de F L A V E VEGECE, II, 10 (G.).
Guydon, v. Guidon.
Guye. Grue. — Ung cable neuf, deux ou trois boutz de vielz cables, une guye a aller l'engin du balivage. Invent, de 1527 (G.).
Guylleroche (?). — Pencez quilz ont une grande grâce, quant ilz disent après boyre quiz ont le cerveau tout encornimatibulé et embureh-coqué... dung tas de gringuenauldes et guylle-roches. G. T O R Y , Champ fleury, Aux lecteurs.
Guymbelet, v. Guimbelet.
Guymbeletier. Fabricant de forets. — Maistre guymbeletier. 14 nov. 1528. Arch. Gironde (G.).
Guymberge, Guymple, Guympler, Guyn-cher, Guyndal, v. Guimberge, Guimple, Guimpler 1, Guincher, Guindal.
Guynde. L'un des accessoires de l'équipement, — 1532. Sept paires de grandes guyndes de fil tissu en 3 doubles, doublez de toille par dedans, garnies de boules de fer renforcé et de longues courroies de cuir double pour servir à armer les gentilshommes qui couraient au hault appareil [du tournoi de Rouen], 4 1. 4 s. Cpte de l'écurie du roi, f° 29 (Gay, Gloss. archéol).
Guyndole, v. Guindoule. Guyne. Guigne. — Voici des responses bien
fines... — Monsieur, j'ay veu ung plat de guynes Où les plus rouges estoient prises. M A R G . D E NAV., l'Inquisiteur, édit. Leroux de Lincy et Montai-glon, IV, 81.
Guyne de meurier. — Les dentz noires, jaulnes, dorées, pourries, qui bransloient es machouères, comme les toylles de ung moulin à vent... les ba-lièvres en couleur de guynes de meurier. Ane. Poés. franc., IV, 278.
Guynette 1. Pintade. — Becquefigues. Guy-nettes. Pluviers. R A B E L A I S , IV, 59. Guynette 2. Béquille. — Si d'aventure je ne
tomboye en un fossé en la suyvant, et que je me rompisse une jambe, au moyen de quoy je fusse contrainct de la suyvre à quatre pattes, ou avec des potences ou guynettes, comme ce vray prophète Ragot. Navig. du Compagnon à la Bouteûle Prologue.
Guyngner, Guynier, v. Guigner, Guignier.
Guypé. Orné de broderie. — Une casaque a la damasquine, de veloux noir menu découpé, doublé de toille d'argent, enrichie et guypee d'une précieuse et subtile broderie. Entr. de Henry U a Rouen, 39 r° (G.).
Guysarme, Guyse, Guyterne, v. Guisarme, Guise, Guiterne.
Guyterner. Torturer (?). — Que les fortes fièvres Vous puissent guyterner les os. Act. des Apost., 1, 22 d (G.).
Guyzarme, v. Guisarme.
Gygantal, v. Gigantal.
Gymnasien. — Il [Antoine] fut persuadé à estre principal entre les gymnasiens, assavoir exercites publicques aux Alexandrins. DEBO-
— 4'
ZIERS, trad. de D I O N CASSIUS, Hist. rom., L. L, ch. 78 (168 r°). Gymnastique. Maître de gymnastique. —
Combien qu'on ne desirast l'exacte ou habitude ou science des choses concernans la palestre : toutefois le pedotribe et gymnastique ne doit moins acquérir ceste faculté. L. L E R O Y , trad. des Politiques d'ARISTOTE, IV, 1. Gymnice. Gymnique. — [Domitien] institua
au Capitolle de Juppiter la bataille quinquennalle triple, cest a sçavoir des musiciens, chevaliers, équestres et gymnices. M I C H E L D E T O U R S , trad. de S U É T O N E , XII, 267 r°.
Gynecocratie (H. D. T. 1576). — Ceste prudente gynecocratie, souz laquelle Testât publique est vertueusement policé. R O N S A R D , Régies, Mascarades et Bergerie, Epistre à la royne d'Angleterre (Vaganay, Pour l'hist. du franc, moderne). Gynandre (-yûvavSpoç, androgyne). — Jusques
au neud joly Encor témoin de l'antique gynandre. DE S A U T E L S , Amoureux repos, sonn. 69.
Gyp, Gyppon, v. Gif, Gippon 2.
Gypse. Gypseux. — Eaues gypsees. P L A T I N E , De honneste volupté, 3 v° (G., Gipsé). — Gicones thracien, ne trouvez pas estrange Qu'une vostre fontaine en pierre le bois change, Qu'elle emmar-brisse autour de ses gypsees eaux A quiconques en boit les molâtres boyaux. D u C H E S N E , 6e Livre du Grand miroir du monde, p. 11 (G.). Ressemblant à du plâtre. — Elles sont faites et
engendrées de pituite gypsée, grosse et visqueuse. AMBR. P A R É , V, 19. — Plusieurs tumeurs glanduleuses... dans lesquelles estoit contenue une ma
il. Marquée à l'H (?). — Si elle [l'ordonnance] est observée, nous aurons plus de biens et moins de coups. Nous sommes le plus souvent marquées à l'H, pour monstrer que nostre peau est tendre : on ne le jugeroit pas à nostre mine reformés comme la tirelire d'un enfant rouge. Var. hist. et lut., X, 183. Haan, v. Ahan. Habaliné. Bouleversé. — Le lieu auquel con
vint le peuple tout folfié et habaliné fut Nesle. RABELAIS, I, 17.
Habandon,Habandonner,v..4£ancfon,^4ôan-donner. Habene (habena). — Habenes, c'est assavoir
licolz et ligatures pour attacher les chevaulx. BOURGOING, Bat. jud., III, 8 (G.).
Habile. Apte, propre, convenable. — Voyant ce César n'avoir l'aage habile à estre capitaine. DEROZIERS, trad. de D I O N CASSIUS, Hist. rom., L. XLVI, ch. 60 (118 r°). — Ce grand et excellent royaume, duquel la grâce de l'Eternel nous a rendu ou imputé habiles successeurs. C H O L I È R E S , 4e Ap.-disnée, p. 188. Habile à succéder. Ayant la capacité légale de
succéder. — Il y avoit trois familles qui sont habiles à succéder à la couronne de ces royaumes, ainsi que nous disons en France, les princes du sang. T H E V E T , Cosmogr., XI, 16. — Ayants un si brave et généreux prince en ce degré, sans con-
H A B I L E
tiere gypsée. ID., ib. — Lesdits humeurs ne font des nœuds aux jointures, comme fait celuy qui cause la goûte, lequel laisse une matière gypsée incurable. ID., X X I , 2.
Gyrer, v. Girer.
Gyrine (rane). Têtard. — Les gentilhome, s'il n'est paralytique de sens et plus stupide qu'une rane gyrine, sera contrainct luy donner bastonnades. R A B E L A I S , IV, 12. — Rane gyrine. Grenoille informe. Les grenoilles en leur première génération sont dictes gyrins, et ne sont qu'une chair petite, noire, avecques deux grands ceilz et une queue. Dont estoient dictz les sots gyrins. ID., BriefveDeclar. (III, 198-199). Gyrlande, Gyrlander, v. Girlande, Guir-lander. Gyrognomoniqne (ySpoç, circuit, Tvwp"x<5ç, sententieux). — La gyrognomonique circumbili-vagination. R A B E L A I S , III, 22. — La gyrognomonique circunvolubilipaternoterisation. P H . D E M A R N I X , Differ. de la Relig., I, v, Préface. Gyromantie. Divination par le tournoiement. — Par gyromantie : je te feray icy tournoyer force cercles. R A B E L A I S , III, 25. — [Divination] par virevoltemens de la personne, qu'Artemidore appelle gyromancie. L E L O Y E R , Hist. des Spectres, VII, 2.
Gyronner, v. Gironner.
Gyrouet. Girouette. — Gyrouet, de yOpoç. H. E S T I E N N E , Conformité, Mots françois pris du grec. — Gyrouet ou Gyrouette. Inconstante, légère, venteuse. M. D E L A P O R T E , Epithetes, 202 r°.
troverse ni dispute qu'il ne soit le vray, naturel et légitime héritier, et plus habile à succéder à la couronne. Sat. Men., Harangue de M. d'Aubray, p. 274.
Prompt à profiter d'une occasion, à agir, à poursuivre une entreprise. — Ce mot lui fit gaigner les chevaux de poste, et avec eux Brouage en deux jours et demi... Il fut habile à succéder, et depuis opiniastre contre les grandes menaces qu'il receut. A U B I G N É , Hist. univ., IX, 15. — [Le Fresne] approcha le soldat qui estoit en faction à la porte, lui donne d'un poignard dans le sein d'une main, et de l'autre ouvre le guichet. Roche-Morte fut habile à succéder, qui entra assés à temps pour tuer un qui vouloit sauter au collet du Fresne. ID., ib., X, 13. — Ces deux pièces prises, il fut habile à succéder avec les autres forces et neuf canons qui marchoyent à son cul. ID., ib., XIII, 22. — Quelques pistolets firent donner du nez à terre aux défendeurs. Sur les corps desquels mirent le genouil et puis le pied les plus habiles à succéder. ID., ib., XIV, 20.
L'expression s'emploie aussi pour une chose promptement faite. — Ces quatorze hommes... ayant saisi les portes, le reste de la maison fut habille à succéder [= fut pris tout de suite après]. ID., ib., VII, 15.
Habile de. Propre à, capable de. — Et s'il estoit autrement, de dix mille Religieux n'en seroit un habille D'avoir salut, car tousjours empeschez En
7 —
H
IV 27
HABILEMENT — 418 —
ce seroient par semblables péchez. J. BOUCHET, Epistres morales du Traverseur, I, 2.
Habile. Agile, dispos, rapide. — Et entrepre-noit à chasser non seulement... les daims légers, les chamois bien saillans, les chevaux habiles. L E M A I R E D E B E L G E S , Illustr., I, 23. — Ces Gara-mantes poursuivent dans chariots, comme si chassoient après bestes sauvages, les Troglodites Egyptiens : parce qu'ilz sont habiles de pied plus que tous hommes. SALIAT, trad. d'HÉRODOTE, IV, 183. — Et des chevaux courans aux pieds habiles Dessus le champ le batement redouble. D E S M A S U R E S , Enéide, XI, p. 607. — Qui tout soudain courant d'un pas habille Son bestail laisse : et retourne en la ville. BAÏF, Poèmes, L. IV (II, 181). — Or ne veulent ils pas que leur Apis soit par trop gras, ny eux aussi, ains veulent que leurs âmes soient estayees de corps légers, habiles et dispos. A M Y O T , De Isis et d'Osiris, 5. — Antiloq ce-pendant, messager bien habille, Pour dire son message arriva près d'Achille. A M . J A M Y N , Iliade, XVIII, 119 v°. — Ainsi marchons de rang et d'une allure habile, Semble que nous courions pour surprendre une ville. CL. G A U C H E T , le Plaisir des champs, VHyver, la Darue, p. 306. — Les dieux font des miracles. Les procès, que font-ils? les plus goûteux troter, Galoper les boiteux, pour les solliciter, Les rendants au besoin prompts, dispos et habiles. P A S S E R A T , la Divinité des Procès. — Les enfans nourris par une chèvre sont habiles et légers. GU I L L . B O U C H E T , 24e Seree (IV, 71). Prompt, agissant vite. — Il le désarçonna, et
tomba luy et le cheval à terre, parquoy le cheval (plus habile que son maistre) se voyant en liberté gaigna les champs. Amadis, I, 9. — Il [le cheval] tomba mort en la place et Amadis dessoubz : qui ne peult estre si habille que, devant qu'il eust moyen de se relever, le chevalier ne l'oultrageast fort. Ib., I, 27. — Il ne nous faut point avoir la langue si habile, de decliquer incontinent ce que nous pensons de Dieu. CA L V I N , Serm. sur le liv. de Job, 138 ( X X X V , 246). — Ayant doncques esté Agis ainsi exécuté, Leonidas ne fut pas assez habille pour surprendre aussi Archidamus son frère, car il s'en fouit incontinent. A M Y O T , Cléomène, 1. — N'est-ce pas un bonnet finement composé... Que, quant sur la teste est d'aulcun h o m m e posé... Chascun à l'obéir est prompt et fort habile? Ane Poés. franc., I, 274. — Ils périssoyent à sa veue sans la gelée qui survint, au commencement de laquelle les refformez furent habiles à retirer leurs vaisseaux et leurs gens. A U B I G N É , Hist. univ., XI, 28.
O n trouve habil sans e final. — Ils disent qu'un habil h o m m e peut bien prendre femme : mais que de l'espouser c'est à faire à un sot. M O N T A I G N E , Lettres (IV, 305).
Habilement. Vite, rapidement, promptement. — Quand il se vit hors des yeux de ceulx qui la luy avoyent veu prendre [une haquenée], il monte habilement dessus, et devant à Villeneufve. D E S PÉ R I E R S , NOUV. Récr., 24. — Le capitaine... commanda à ses gens qu'ilz chargeassent habilement tout le pillage. A M Y O T , Hist. Mthiop., L. I, 3 r°. — Vous faictes bien de préparer voz armes, mais vestez les habilement, et commendez quant et quant que chascun de voz gentz s'arme : car il vient contre vous plus grand nombre d'ennemys qu'il ne fit oncques. ID., ib., 13 r°. — II l'envoyoit par tout pour haster toutes sortes de gens de guerre, et les faire habilement marcher vers la ville de Syené. ID., ib., L. VIII, 96 r°. — Leonidas... leur commanda qu'ilz desjeunassent doncques habilement, estans asseurez qu'ilz
soupperoient en l'autre monde. ID., trad. de DIOD O R E , XI, 2. — Lors m e levay toute pleine d'es-moy, Sautent du lict assez habilement. CH. FONTAINE, les XXI Epistres d'OviDE, Ep. 10, p. 186, — Sylla... commanda aux premiers arrivez de ses gens qu'ilz desjeunassent habilement, et tout incontinent les rengea en bataille. A M Y O T , Sylla, 29. — Que ne deslogeons nous doncques bien habillement, Mercure? Car nous ne ferons pas chose qui vaille, vers un h o m m e si bien environné de telle infanterie. F. B R E T I N , trad, de LUCIEN, Timon, 31. — V a t'en d'icy au gibet, dit elle, meschant! va t'en habillement dormir ailleurs. ID., ib., Lu-cin, 56. — Maistre Jacob et les autres prebstres ne musent gueres : ils se despouillent habilement de leurs aubes, de leurs amits et de leurs robbes, et s'en viennent premièrement droit à la table. Trad. de F O L E N G O , L. IX (I, 236). — Fuyez d'icy vistement, et escampez habilement. Ib., L. X X I V (II, 285). — Elle composa toutes ses Nouvelles, la pluspart dans sa lytiere en allant par pays... et les mettoit par escrit aussi tost et habilement, ou plus, que si on luy eust ditté. B R A N T Ô M E , des Dames, part. I, Marg. reine de Nav. (VIII, 126). Habileté. Vitesse, rapidité. — Il en conte encores un autre qui s'accorde avec cestuy-ci quant à l'habileté des pieds. H. E S T I E N N E , Apol. pour Her., ch. 15 (I, 227). Habilité. Aptitude. — Le philosophe qui ne tenoit l'habilité que d'une chose seulement estoit peu estimé en la republicque. B. D E LA GRISE, trad. de G U E V A R A , l'Orloge des princes, l, 21. — A u prince ne surmonte grande sagesse qui commet chose d'importance à l'homme qui ne sçait s'il tient abillité pour en venir à chef. ID., ib., II, 35. — Ceux qui ont escrit des habilitez des saincts ne s'accordent point. H. E S T I E N N E , Apol. pour Her., ch. 38 (II, 316). — J'appelle vertus frivoles certaines habilités et qualités vaines que les foibles espritz appellent vertes et perfections. S' F R A N Ç O I S D E S A L E S , Vie dévote, III, 17. — [Les
vertus célestes] sont compaignes inséparables de la charité, si elles ne sont ses proprietez et habilitez. ID., Amour de Dieu, IV, 3. Adresse, agilité. — Il voudra essayer son habi
lité et sa force. CA L V I N , Serm. sur l'Epitre aux Ephesiens, 23 (LI, 536). — Pour monstrer l'habilité de sa main. A M Y O T , Comment on pourra discerner le flatteur d'avec l'amy, 27. — O qu'il monstre une grande habilité de son corps ! Trad. de F O L E N G O , L. VII (1,179).
Habileté de l'esprit. — Pour veôir la grande habilité qu'estoit en toy, j'ay tousjours procuré pour toy offices honnorables. B. D E LA GRISE, trad. de G U E V A R A , l'Orloge des princes, III, 26. — Tu seule es cause de m a subtilité. Par toy me vint icelle habilité. C H . F O N T A I N E , les XXI Epistres ÉZ'OVIDE, Ep. 19, p. 379. — Il appelle mensonges tous desguisemens, toutes finesses : brief toutes ces habilitez que les hommes ont et ausquelles ils se glorifient. CA L V I N , Serm. sur l'Epitre aux Ephesiens, 30 (LI, 626). — L'habilité n'a esté guère moindre en l'anatomie de ce mot sacerdos. H. E S T I E N N E , Apol. pour Her., ch. 37 (II, 270). Une licence tyrannique, ou habilité ingénieuse s'appliquant à mal faire. L. L E R O Y , trad. des Politiques d'ARISTOTE, I, 2, Commentaire. — Elle estoit vraye fille de France et en cella et en bon esprit et habilité, qu'elle a tousjours bien monstre en secondant sagement et habillement monsieur son mary au gouvernement de ses seigneuries et dominations. B R A N T Ô M E , des Dames, part, h
— 419 — HABILLEMENT 1
Claude de France, duch. de Lorraine (VIII, 139). Procédé habile, adroit ; tour d'adresse. — De
supplier pour mon utilité Par ce rondeau, ce n'est qu'habilité. R. D E C O L L E R Y E , Rondeaux, 60. — Ceulx de la ville, pour retarder louvraige des ennemis, sadviserent d'une telle habilité. S E Y S S E L , trad. de T H U C Y D I D E , II, 12. — Ce ne sera chose hors de propos de reciter icy l'habilité d'un bon compaignon. D E S P É R I E R S , NOUV. Récr., 96. — Que ne propensez vous ce pendant quelque habilité, pour destourner ce que vous craignez? A M Y O T , Hist. Mthiop., L. VI, 68 v°. — O n leur donnoit bien fort peu à manger, à fin que la nécessité les contraignist à soy hazarder hardiment et à inventer quelque habilité pour en desrober subtilement. ID., Lycurgue, 17. — Lon dit que Pytha-goras apprivoisa une aigle... et plusieurs autres telles habilitez et actes que lon en compte, qui sembloyent estre miracles. ID., Numa, 8. — Pour donques le conduire en seureté à la cour, Nico-genes s'advisa d'une telle habilité. ID., Thémistocle, 26. — Les capitaines adviserent ensemble de surprendre les Sarrazins par une habilité qui fut telle. F A U C H E T , Antiquitez, VII, 13. — C'est chose injuste de mettre de grans prix à des habilités et industries de si peu d'importance, comme sont les habilités des jeux. S' F R A N Ç O I S D E S A L E S , Vie dévote, III, 31. Promptitude, rapidité. — Voyant qu'un des
serviteurs desservoit les mets quasi aussi tost qu'ils estoyent servis, pour en remettre d'autres, et n'ay ans accoustemé ceste habilité, ni aussi ne la trouvant de bonne grâce, il demanda audict ambassadeur de quel pays estoit ce serviteur. H. ESTIENNE, Dial. du lang. franc, ital, I, 128. Habiliter. Rendre apte, propre. — Nous en
avons [des drogues et plantes] qui eschaufîent, excitent et habilitent l'home à l'acte vénérien. RABELAIS, III, 31. — Le corps est premièrement habilité et préparé à loger l'ame. M O N T A I G N E , trad. de R. S E B O N , ch. 314. — La suavité de la Sagesse éternelle a disposé de ne point appliquer son essence à nostre entendement qu'elle ne l'ait préparé, revigoré et habilité, pour recevoir une veue si eminente et disproportionnée à sa condition comme est la veue de la Divinité. S* F R A N ÇOIS D E SALES, Amour de Dieu, III, 14. Habituer. — 0 bon prélat, qui ton cœur habi
lites A Dieu servir, l'aymer, creindre et luy plaire. DES M A S U R E S , PS. de David, A l'evesque de Toul. Exercer, rendre dispos, propre à la lutte. —
Palestre est un lieu préparé pour exercer les jeunes gens a la luete, ainsi que les Grecz anciennement faisoyent pour habiliter les corps des jeunes gens et les rendre plus adextres a la guerre. B U D É , Instit. du prince, édit. J. Foucher, ch. 39. — Dieu qui règne et vit Le fort débilite, Et l'humble David En force habilite. D E S M A S U R E S , David combattant, 1738. S'habiliter. Se rendre apte, propre, s'exercer. —
A laquelle [guerre] ne se peuvent aiseement habiliter et rendre expers. SE Y S S E L , trad. de T H U C Y DIDE, 1,18 (42 v°). — Le roy du ciel, dont la main merveilleuse Jecte où luy plaist la fouldre périlleuse, Ne s'y pourrait luy mesme habiliter. M A -ROT, L. II de la Metamorph. (III, 204). — Y en avoit qui s'abilitoient à tirer cailloux dextrement. J. D E LA L A N D E , trad. de D I C T Y S D E C R È T E ,
L. IV, 73 v°. — Mesme pour l'heure... se ver-goigne-il de desgoiser ce ramage. Toutefois j'espère qu'il s'y habilitera peu à peu et en polira la rudesse par les doulceurs de nostre aer. Luc D E L A PORTE, trad. d'HoRACE, Odes, Epistre dedica- I toire. — Nous... entrerons en des ravissemens |
fort aymables, lesquels ne nous osteront pourtant pas l'usage ni les fonctions de nos puissances, qui, par ce divin rencontre que nous ferons de la Sainte Vierge, s'habiliteront merveilleusement pour mieux et plus parfaittement louer et glorifier Dieu. S* F R A N Ç O I S D E S A L E S , Sermons récueillis, 57 (X, 242).
Se rendre habile. — Avant que se mettre à l'amour, elle estoit fort peu habile ; mais l'ayant traitté, elle devint l'une des spirituelles et habiles femmes de France..., Et de fait, ce n'est pas la seule que j'ay veue qui s'est habilitée pour avoir traitté l'amour. B R A N T Ô M E , des Dames, part. II (IX, 217). F
Se disposer. — Qu'à te louer à jamais s'habilite Et vive en toy ton peuple israelite. D E S M A S U R E S , David combattant, 1713.
S'habiliter de. Se disposer à. — Cueurs oppressez de souffrance mortelle Pour ceste mort, dont ne fut onc mort telle, De plourer fault que chacun s'abilite. Ane Poés. franc., XII, 116.
Habillage. Action de préparer. — E n l'abbil-laige d'un jigot de venoison. 1530. Acquit. Arch. mun. Laon (G., Compl.). — L'abbillaige d'un levrault. Ib. — Aux rostisseurs, pour l'abillage D'une grosse pièce sans plus Prest a larder, selon l'usage, Aura un douzain et non plus. 1577. Chanson (G., Compl.).
Habillement. — Il se vestit en robbe de village, Puis par dessus print ung autre habillage. B O U R D I G N É , Pierre Faifeu, ch. 38.
Habille, Habillement (adv.), v. Habile, Habilement. Habillement 1. Habillement de teste. Coiffure.
— Duquel jugement lautre fut si très desplaisante que, a grans pleurs et larmes, jecta son habillement de teste par terre et se arrachea les cheveulx. S E Y S S E L , trad. de D I O D O R E , II, 13 (49 v°). — Il trouva sa femme qui encor n'avoit achevé de raccoustrer son habillement de teste. L E M A Ç O N , trad. de B O C C A C E , Decameron, VIII, 8. — Le turban... est l'ancien habillement de teste des Scythes. T H E V E T , Cosmogr., VI, 5.
(Spécialement). Coiffure de guerre, casque, heaume. — Ilz avoient estrange habillement de teste, car il estoit comme ung chapperon de da-moyselle. L E L O Y A L S E R V I T E U R , Hist. de Bayart, ch. 40. — Morrions, cabassetz ou autre habillement de teste a la legiere. M I C H E L D'AMBOISE, Guidon des gens de guerre, p. 149 (G., Compl.). — Les Massagetes... couvrent d'orfaverie leurs ha-billemens de teste, leurs bauldriers et halecretz. SALIAT, trad. d'HÉRODOTE, I, 215. — Ils notoient d'infamie ceux qui en une desconfiture jettoient leurs boucliers, et non pas ceux qui jettoient ou leurs corps de cuirasses, ou leurs habillements de teste. A M Y O T , Dicts des Lacedem., Demaratus, 2. — Bien en y a il qui ont habillement de teste, soit salade, bourguignote ou morion. T H E V E T , Cosmogr., XIX, 12. — L'escu presse l'escu, l'habillement de teste Plein de crins de cheval et luisant par la creste Sur un autre s'appuye. A M . J A M Y N , Iliade, XIII, 16 r°. — D'un coup d'harquebuse qu'il receut sur l'os pariétal, ayant un habillement de teste, lequel la balle enfonça sans estre rompu. A M B R . P A R É , VIII, 8. — Toute la beauté de l'homme de cheval s'est convertie en difformité : car son habillement de teste ressemble à un pot de fer. L A N O U E , Disc, polit, et milit., X V , p. 342. — Ces trois cavaliers descrochent leurs heaumes et habillemens de teste. Trad. de Fo-
I L E N G O , L. XII (I, 320). — Leduc d'Albe servoit | le roy... luy donnant sa picque, son espée, luy
H A B I L L E M E N T 2 — 420 —
accoustrant son habillement de teste et ses autres armes. B R A N T Ô M E , Cap. estr., le Duc d'Albe (I, 114). — Estant mené vers le roy, il le recogneut par ses armes, son habillement de teste, sa cotte d'armes. ID., Cap. franc., le Roy Charles VIII (II, 314). — Il estoit armé richement de toutes ses armes, fors l'habillement de teste. ID., Disc, sur les duels (VI, 446). — II n'y a rien encor de si beau à voir que ces braves légionnaires romains avec leurs habillemens de teste. ID., Rodomontades es-paignolles (VII, 9). — Le roi, sans laisser son habillement de teste, alla faire chanter le Te Deum à Nostre-Dame. A U B I G N É , Hist. univ., XIV, 3. — Pour ce que la vanité est l'élément de la guerre, j'y désire une guerre de pennaches... pour les arborer aux habillemens de teste des chefs et hommes armez aux assauts et sorties d'importance. ID., Missives et dise milit., 21 (1,183). Habillement de teste est noté comme remplaçant
heaume et armet. — O n a appelé un habillement de teste ce qu'on nommet autresfois un heaume. H. E S T I E N N E , Dial. du lang. franc, ital, I, 252. — Ce que nos anciens appelleront heaume, on l'ap-pella sous François premier armet, nous le nommons maintenant habillement de teste. E. P A S QUIER, Recherches, VIII, 3. Habillement 2 (adv.), v. Habilement. Habiller. Apprêter, préparer. — Et le trouva... en une meschante maison, ayant son soupper trespovrement habillé. S E Y S S E L , trad. d'AppiEN, Guerres civiles, IV, 6. — Et mesme-ment fussent ore les viandes ja cuytes et abillees pour soupper et banequeter. M I C H E L D E T O U R S ,
trad. de S U É T O N E , I, 20 r°. — Ceulx qui habil-loient les viandes délicatement, comme les taver-niers, pasticiers et bourdeliers, macquereaulx et autres. ID., ib., III, 113 r°. — Il faisoit le lict et lavoit la lesscive, il mettoit la table, il abilloit le manger. B. D E L A G R I S E , trad. de G U E V A R A , l'Orloge des princes, II, 6. — Il m'a voulu habiller ce desjeuner, avant le repas entier. Amadis, 1,13. — [Daphnis] tira de son bissac force petitz gasteaux, et des oyseaux qu'il avoit pris, lesquelz ilz abil-lerent pour soupper. A M Y O T , Daphnis et Chloé, L. III, 46 r°. — Il le tua [un sanglier], il l'habilla, il l'escorcha, il le trencha. P H . D'ALCRIPE, la Nouvelle Fabrique, p. 109. — Et l'assiégeasmes du cousté de la tanerie où ils abillent les cuirs. M O N LUC, Commentaires, L. VI (II, 443). — [Un Laco-nien] ayant achepté du poisson, le bailla à habiller à un tavernier, qui luy demanda du fourmage et de l'huile pour ce faire. G U I L L . B O U C H E T , 6e Seree (II, 23). — Apres que Angle eut vendu son poisson, la dame avoit abillé à disner. N I C O L A S D E
T R O Y E S , le Grand Parangon, 36. — Noz prédécesseurs menoient anciennement les femmes à la guerre pour abiller à manger aux sains et avoir cure et soing des blessez. B. D E L A G R I S E , trad. de G U E V A R A , l'Orloge des princes, III, 15. — Tout artifice pour amasser argent y estoit permis aux esclaves et aux ilotes, estant estimé aussi vil comme le mestier d'habiller à soupper et de faire la cuisine. A M Y O T , Compar. de Lycurgue et de Numa, 2. — Mais je ne fais rien ce matin Autre chose que babiller, Si m e faut-il tost habiller A disner pour nostre monsieur. R. B E L L E A U , la Reconnue, I, 2. Habiller à rire. Faire rire, prêter à rire. — Je vous allegueray à ce propos le conte d'une damoi-selle que vous et moy cognoissons, qui vous habillera à rire pour toutes les fois qu'il vous en souviendra. F R . D ' A M B O I S E , Dialogues et devis des damoiselles, I, 40 r°. — Une personne vestue de tant
de couleurs... habille à rire aux regardant. ID ib., 44 v°. Habiller. Réparer. — Le Basque... trouva
domp Alonce descendu, qui habilloit les sangles de son cheval, qui estoient rompues. L E LOYAL S E R V I T E U R , Hist. de Bayart, ch. 20.
Panser. — Menelaus se hasta de jetter son dard par grand force et roideur : tellement quil traversa la main d'Helenus de part en part. Et atout iceluy Helenus se retira vers ses gens pour se faire habiller. L E M A I R E D E B E L G E S , Illustr., III, l (II, 282). — Il luy pria qu'elle enseignast quelque bon cirurgien, et qui peust hastivement le venir habiller. L E L O Y A L S E R V I T E U R , Hist. de Bayart, ch. 50. — Peon habilla Sa griefve playe, et santé luy bailla. S A L E L , Iliade, V, 81 v°. — Il s'en est allé faire habiller son œil, pour ce qu'il y a encore un petitde mal. AMYOT, Hist. AUthiop., L. VII, 79r0.— Parce qu'il avoit esté trois jours après sa blessure sans estre habillé... trouvasmes grande quantité de vers en sadite playe, et grande feteur. AMBR. P A R É , VIII, 26. — Les malades... accusent souvent les chirurgiens de négligence, qui ne les habillent qu'une fois le jour. ID., XI, 12. — Pareille faute font ceux qui, en habillant souvent les ulcères, les essuient bien fort. ID., ib. — L'espoux, estant habillé de sa playe par Dionice, fut emporté en sa maison. F. B R E T I N , trad. de LUCIEN, le Banquet ou les Lapites, 47.
Se vêtir de, porter. — J'habille nuict et jour un vestement de dueil. CH A S S I G N E T , PS., 37 (G,, Compl.). — C o m m e un manteau se frippé habillé trop souvent. ID., ib., 101 (G., Compl.).
(Jeu de mots sur le sens d'apprêter et celui de vêtir). — Je laveroys voluntiers les tripes de ce veau que j'ay ce matin habillé. RABELAIS, 1,5.— Quand les bouchers font un examen à l'aspirant, ils... le font despouiller et le visitent : cela faict, ils lui disent qu'il se reveste, ce qu'ayant faict et le voyant gay et ralu, ils lui disent, « Or ça, mon ami, vous estes passé maistre boucher, vous avez habillé un veau. » B E R O A L D E D E VERVILLE, le Moyen de parvenir, Contract (II, 155). Habiller (subst.). Action d'habiller, de faire sa
toilette. — Les soirs ceste vieille dame portoit des confitures à ceste princesse pour sa collation, à quoy assistoit le gentil homme, qui... n'estoit refusé d'estre à son habiller et deshabiller. MARG. D E N A V . , Heptam., 4. — Entre aultres il y avoit ung jeune gentil-homme... qui la poursuivoyt de si près qu'il ne falloyt d'estre à son habiller et deshabiller. E A D . , ib., 53.
Habilleur. Celui qui soigne, qui panse. — Un autre nous conta qu'une bonne commère de sa rue, tirant un peu sur l'aage, estant tombée, s'estoit escroupionnee, et qu'estant habillée, elle avoit dit à son habilleur, lequel auroit remédié à la dislocation : Monsieur mon ami, j'ay grand'peur que je ne m'aideray jamais si bien de ceste partie comme j'ay faict autresfois. GUILL. BOUCHET,
3e Seree (I, 129). — Les Suisses... pensans qu'il se fut rompu ou disloqué une jambe en tombant... l'empoignent qui çà qui là : les uns le tenans, les autres luy tirans les jambes à leur force, pensans luy rabiller la fracture et dislocation. Ce pauvre boyteux, ne sentant que le mal que ces beaux habilleurs de Suysses luy faisoient... crioit a pleine teste. ID., 35e Seree (V, 87). Habin, mot d'argot. Chien. — Ils m'apprin-drent à faire de mon baston le faux montant, le râteau, la quige habin. Var. hist. et litt., VIII, 156. — Habin, Chien. Ib., VIII, 186. Habit. Manière d'être. — Il vint souvent me
reveoir, combien qu'il fust assez transmué dhabit et de contenance. Trad. de BOCCACE, Flammette (1537), ch. n, 28 v°. Habitude, disposition habituelle. — Nous, par
lexercitation que prenons entour les histoires... recepvant continuellement en nostre mémoire les beaux et louables faitz des hommes vertueux, faisons cest habit en nous, et nous disposons nous mesmes a regecter... toute vicieuse, illiberale ou deshonneste affection. G. D E SELVE, Huict Vies de PLUTARQUE, Paul Emile, 107 r°. — Emylius vint a exercer celle justice par lhabit de vertu qui sestoit desja faict en luy pour avoir esté institué et nourry soubz bonnes loix et en une telle patrie, parmy tant de gens vertueux. ID., ib., Compar. de Timoleon et de Paul Emile, 123 r°. Occupation. — Apres Nabugodonosor demoura
Zoroastes, qui fust inventeur de l'art magicque, lequel estoit roy de Batrina, homme très expert en armes, mais encore plus en lettres et habitz speculatifz. Triumph. de PÉTRARQUE, 134 r° (G.). Habit dissimulé. Déguisement. — De nuict
quinze [habitants] ont esté contraincts par les dites troupes en habits dissimulés se sauver par les boys et buyssons. 16 févr. 1576. Arch. mun. Semur (G., Compl.). Habitable (adj.). Qui peut se trouver habi
tuellement. — O tressaincte pitié habitable es délicates pensées de jeunesse, gouverne le frein dicelle par plus forte et dure main que tu ne as faict jusques a présent. Trad. de BOCCACE, Flammette (1537), ch. vi, 73 v°. (Subst.). Lieu habité. — [Les Amazones] des
cendues à terre et cheminans par l'habitable, pillèrent le premier trouppeau de chevaux qu'elles rencontrèrent. SALIAT, trad. d'HÉRODOTE, IV, 110. — Vous n'avez besoing de trouver port en un lieu seulement, mais par tout l'habitable ou vous passerez. ID., ib., VII, 49. Habitablement. De manière à être habité. —
Dieu... L'eau de l'eau divisa : l'une son firmament, L'autre dessous monstre la terre descouverte, Pource habitablement aux animaux ouverte. MAURICE SCÈVE, Microcosme, L. III, p. 87. Habitacle. Habitation, demeure. —• Et vi
vront povres laboureurs seurement en leurs habitacles, comme prelatz en chambres bien nattées. MAROT, Epistres, 4. — Et qui est celluy qui sera Si heureux que par grâce aura Sur ton saint mont seur habitacle? ID., PS. de David, 15. — Est-il [Abraham] retourné au lieu de son habitacle? Il en est de rechef chassé par famine. CALVIN, Instit., VII, p. 441. — L e sepulchre sera leur habitacle. ID., ib., p. 448. — Au tour de moy seront tous mes miracles, A celle fin qu'en toutes habitacles A tousjours mais il soit fait mention Du bon Ragot la conversation. Ane Poés. franc., V, 150. Habitateur. Habitant. — Les Troyens,
comme possesseurs et habitateurs de Gaule, déduisent leur extraction depuis leur premier Saturne et roy nommé Samothes. LEMAIRE DE BELGES, Illustr., I, 1. — Je voy icy les Vénitiens, ceux de Dalmace et de Histrie, et autres habitateurs dentour la mer Adriatique. ID., Schismes et Conciles, 2e part. (III, 283). — Les princes... Font oppressions inciviles Sur les bourgeois habitateurs. CORROZET, Fables CTESOPE, 119. — En oultre leur promirent donner citez et pays, les consignons pour habitateurs et possesseurs de ce territoire. DEROZIERS, trad. de DION CASSIUS, Hist. rom., L. XLVII, ch. 63 (130 r°). — En telle jubilation verras et orras les mystères de paradis,
HABITER
ou les habitateurs sont tous en souveraine res-jouyssance. P. DE CHANGY, De l'office du mary, ch. 14. — Les premiers habitateurs de la mer Adriatique se renommoient d'un Anthenor. E. PASQUIER, Recherches, 1,14. — Ce païs a retenu encor quelque chose de la naïfveté des anciens habitateurs. THEVET, Cosmogr., IX, 9. — Or parlant de Polongne ay-je tenu propos des Slaves, qui ont esté les premiers habitateurs de Boesme. ID., ib., XX, 10. — Qui d'entre vous connoit POlimpe? personne, certes, ne plus ne moins que les habitateurs d'iceluy ne sçavent que c'est de nostre mont Chidabbe. S4 FRANÇOIS D E SALES, Controverses, I, n, 5. — Quelquefois le pays vaincu est tellement nettoyé des premiers habitateurs que les nouvelles colonies y plantent du tout leurs langues. E. PASQUIER, Recherches, VIII, 1. — Je suis dedans ton cœur -et sur ton cœur, car j'en suis l'habitateur et le maistre. S' FRANÇOIS D E SALES, Amour de Dieu, L. X, lre rédact. (V, 431).
(Fém.). Habitateresse. — Habitateresse de la vallée. Le Fevre d'Est., Bible, Jer., 21 (G.). Habitation. Commerce sexuel. — Ceste femme
gist d'enfant, donc elle a eu habitation d'homme. P. FABRI, l'Art de Rhétorique, L. I, p. 98. — Le laict d'une nourrice qui a souvent affaire aux hommes n'est pas bon... Et la raison en est de ce que par fréquente habitation le meilleur et le plus subtil du laict se retire à la matrice. GUILL. B O U CHET, 24e Seree (IV, 66). — Encor dit-on que l'habitation de telles femmes en est fort délicieuse, pour quelque certain mouvement et agitation qui ne se rencontre pas aux autres. BRANTÔME, des Dames, part. I, Disc. 1, Anne de Bretagne (VII, 310). — Du temps de ce roy Henry troisième fut fait ce pasquin muet de ce livre de peintures que j'ay dit cy-devant, de plusieurs dames en leurs postures et habitations avec leur homme. ID., ib., part. II (IX, 524). — Jusques à reprocher leurs amours et habitations avec leurs cochers, pages, laquais et estaffiers qui les conduisoyent. ID., ib. (IX, 527). Habiter (trans.). Peupler. — Faisant le dict
Robertval ung voiage... en l'isle de Canadas... pour habiter le pays de chrestiens mena avecq luy de toutes sortes d'artisans. M A R G . D E NAV., Heptam., 67. L'édition Jacob donne habituer, qui peut avoir le même sens. Avoir un commerce sexuel avec. — Lors que
les femelles sont preingz, les masles ne leur touchent, ny elles consentent estre touchées ny habitées. B. D E LA GRISE, trad. de GUEVARA, l'Orloge des princes, II, 11. — Les hommes... devraient eulx eslongner de leurs femmes et se garder de les habiter charnellement lors qu'elles sont enceinctes. ID., ib. — Madame la comtesse de Foix, sa femme... laquelle dict qu'elle aime mieux mourir que d'estre habitée de luy, et a dict que son mariage a esté faict par sort et par charme, et du tout contre sa volonté. Var. hist. et litt., VI, 205.
(Latinisme). Avoir souvent, faire habituellement. — Considerans un peu la vie tragique et servitude de ceux qui habitent la guerre, laquelle est si austère et rigoureuse que les bestes brutes I'auroient en horreur. BOAISTUAU, Théâtre du monde, f° 380 (G., Compl.). II serait peut-être plus simple de traduire habiter par vivre dans.
(Intrans.). Habiter à, avec. Avoir des relations sexuelles avec. — Fault qu'ils passent une rivière qu'on appelle Magrouffa quant ilz veulent habiter aux femmes. Var. hist. et litt., V, 167. — Les
M
HABITESSE — 422 —
hommes aiment et habitent avec les femmes de plus grande affection, mais les femmes aiment et habitent avec les hommes plus perseveramment. GUILL. B O U C H E T , 3e Seree (I, 102). — J'ay bien ouy dire pis d'un grand seigneur... qu'avant qu'aller habiter avec sa femme se faisoit fouetter, ne pouvant s'esmouvoir ny relever sa nature baissante sans ce sot remède. B R A N T Ô M E , des Dames, part. II (IX, 286).
S'habiter. S'établir. — Des long temps une grande partie deulx sestoient habitez aux champs ou ilz tenoient leur mesnaige. SEYSSEL, trad. de T H U C Y D I D E , II, 4 (49 r°). — Les Peloponesiens... leur donnèrent la cité de Thyree pour leur habitation... et illec une partie desdictz Egines sabita. ID., ib., II, 6 (52 v°). — [Alcméon] se habita et régna la empres le quartier ou sont a présent les Œniades. ID., ib., II, 20 (78 v°). — Leurs ancestres en retournant du siège de Troie par mer furent par la tempeste de mer qui dispersa lors les Achives jettez en celuy quartier et illec s'arres-terent et s'habitèrent. ID., ib., IV, 16 (147 v°). Estre habité. Être établi, habiter. — Les estran-
giers qui estoient habitez en la ville. ID., ib., II, 4 (48 v°). — Ceux qui sont habitez près les bouches du Nil... Ainsi n'oyent le bruit des eaux précipitées. A M . J A M Y N , ŒUV. poet., L. IV, 209 r°.
Habitesse. Habitation. — Depuis que jay le mourir entendu De celle la a qui honneur fut deu Plus qua déesse Qui preigne ou ciel ou en terre habitesse. M I C H E L D'AMBOISE, Complainctes, 132 v°.
Habiteur. Habitant. — O habiteurs de Hieru-salem, que par adventure mon indignation ysse comme feu et arde. Bible (1543), Hieremie, 4 (G.). — Les anciens Gaulois, lorsqu'ils avoient conqueste nouvellement un pays, estoient coustu-miers d'en exterminer de tout poinct les premiers habiteurs. E. PAS Q U I E R , Recherches, 1, 3. Habition (habitio, fait d'avoir). — Quant au délectable, sa délectation ne consiste point en possession, ny en habition. 1551. D. S A U V A G E , trad. de L É O N H E B R I E U , 37 (Vaganay, Deux mille mots). Habituation. Manière d'être. — Je remetz tel affaire a la délibération et discrétion des parens pour y avoir l'advis et conseil, selon la qualité, esperit et habituation des personnes. P. D E C H A N G Y , Instit. de la femme chrest., 1, 3. Action de s'habituer, habitude. — Employez
donc la part intellective Par une vraye habituation A aymer Dieu sans variation. J. B O U C H E T , Labyr. de fort., 125 r° (G.). — Dont vient habitua-cion de vertus. ID., la Noble Dame, 53 v° (G.). — Par ce moien ne s'est point exurgée Encontre vous l'habituation De folz plaisirs. ID., Epistres morales du Traverseur, 1,14. — Mais je crains fort par tant prendre et donner Que des presens la fréquentation N'engendre en fin habituation. C H . F O N T A I N E , la Contr'amye de court, 14 r°. Habitude. État physique, complexion, tempérament. — Par ce médicament luy nettoya toute l'altération et perverse habitude du cerveau. R A BELAIS, I, 23. — Et me semble moult convenable que tu eslises en l'ordre équestre certains jeunes hommes de dixhuyt ans, considéré que en cest aage moult se demonstre tant l'aptitude du cou-raige que la bonne habitude du corps. D E R O Z I E R S , trad. de D I O N CASSIUS, Hist. rom., L. L U , ch. 85 (191 r°). — Point soupper... seroit le meilleur, attendu vostre bon en poinct et habitude. R A B E LAIS, III, 13. —Vostre belle taille, stature, gran
deur de corps, habitude de beaulté, de forme, et traicts du visaige. B U D É , Instit. du prince, ch. 7. — Et ne trouvay oncques, à ce propos, bonne celle considération des anciens Romains, qui à douze ans permirent marier les filles, et les hommes à quatorze : ayans seulement égard à l'habitude du corps, et non de l'esprit. E. PASQUIER, Monophile, L. I (II, 715). — Titus Quin-tius luy dit un jour, semblant se moquer de l'habitude de son corps : O Philopoemen, tu as bien belles mains et belles jambes, mais tu n'as point de ventre : pource qu'il estoit fort gresle et fort menu par le fond du corps. A M Y O T , Philopémen, 2. — Plus que ne sçauroit faire la neige en refrai-chissant et resserrant toute l'habitude du corps, qui se va autrement dissolvant. ID., Propos de table, III, 5. — Il luy dist que... fichant... sa pensée sur cette allégresse et vigueur qui regorgeoit de mon adolescence, et remplissant tous ses sens de cet estât florissant en quoy j'estoy lors, son habitude s'en pourrait amender. MONTAIGNE, I, 20 (I, 106). — L'homme bien charnu et muscu-leux, et qui a une habitude de corps ferme... est sanguin. A M B R . P A R É , Introd., ch. 6. — Toutes ces choses... rendent le sang phlegmatique, et par conséquent changent toute l'habitude de nostre corps. ID., ib. — La matière vénéneuse contenue aux humeurs et en toute l'habitude du corps. ID., X X I V , 26. — Quant à l'habitude de son corps, il fut trape et replet. Luc D E LA P O R T E , Vie d'Horace. — Dans un esprit chagrin la manie se met, L'avertin se transforme au mal de Mahumet, La mauvaise habitude en froide hydropisie. Du BARTAS, 2e Semaine, 1er Jour, les Furies, p. 119. — Si vous jettez de l'or tout rouge, bruslant et enflammé dedans du vin, ceste liqueur dorée est trés-singuliere à renforcer et nous remettre en nostre naturelle habitude. CHOLIÈRES, lr6 Matinée, p. 41. — La goutte du sarment rend l'habitude de leur corps du tout humide. ID., 9e Matinée, p. 323. — Ils asseuroient qu'il falloit regarder à l'habitude des personnes : les hommes rouges et sanguins ayans plus de révélation par songes que les autres. GUILL. B O U C H E T , 16e Seree (III, 145). — Comment est-ce que puisse estre immuee l'habitude d'un h o m m e sain et dispos en moins de rien ; et qu'il tombe en maladie si tost que l'œil charmeur l'aura regardé? L E L O Y E R , Hist. des Spectres, II, 6. — Petit l'appellé-je [Charles VIII] pour avoir esté de petite stature et tendre habitude de corps, mais fort grand et magnanime d'âme et de courage. B R A N T Ô M E , Cap. franc., le Roy Charles VIII (II, 283). — Les médecins, craignans la débilité et foible habitude du roy, eurent peur que telle douleur pût porter préjudice à sa santé. 1D•><*?* Dames, part. I, Disc. 1, Anne de Bretagne (VII, 312). — Je croy que si cette dame [Diane de Poitiers] eust encor vescu cent ans, qu'elle n'eust jamais vieilly, fust de visage, tant il estoit bien composé, fust du corps caché et couvert, tant il estoit de bonne trempe et belle habitude. ID., ib., part. II (IX, 356-357). — Si elle eust vescu encore dix ans, sa beauté ne s'en fust nullement effacée, tant elle estoit de bonne et belle habitude, te., Orais. fun. de Mme de Bourdeille (X, 69).
(En parlant des choses). Nature, manière d'être, état. — Je pense que beaucoup plus facile chose soit à quelque ung avoir cure de la bonne habitude de l'esprit que du corps. DEROZIERS, trad. de DION CASSIUS, Hist. rom., L. VIII, ch. 38 (18 v°). -S'il est vray ce que lon dit d'avantage, que jamais il [le figuier] n'est touché de la foudre, cela se doit référer et attribuer à l'amertume et mauvaise habitude du tronc. A M Y O T , Propos de table, V, 9.
— 423 — HABLEUR
L'habitude de l'air produit quant et soy les esprits plus doux ou plus hagards. E. PAS Q U I E R , Lettres, VII, 6. — Saint Irenee dit que l'habitude ou figure de la croix a cinq boutz ou pointes : deux en longueur, deux en largeur, une au milieu sur laquelle s'appuye celuy qui est crucifié. S1 F R A N ÇOIS D E SALES, Défense de la Croix, II, 1. Manière d'être, disposition d'esprit, qualité mo
rale, — Cest le temple dédié à deux habitudes divines : cest assavoir honneur et vertu. L E M A I R E DE BELGES, le Temple d'Honneur et de Vertus (IV, 225). — Plus de fermeté que la science n'en fournit onques à aucun qui n'y fust nay et préparé de soy-mesmes par habitude naturelle. M O N T A I G N E , 11,12 (11,222). Faire habitude. Séjourner. — Sept mois entiers
fist léans habitude. Ane Poés. franc., VI, 161. Habituer. Établir. — Ilz faisoient la guerre
aux Athéniens que lon avoit habituez en leur ville de Mytilene. A M Y O T , trad. de D I O D O R E , XII, 21. — Le lieu et terre ou le seigneur Fortin s'est venu planter et habituer sa maison, teintures et chau-drieres sont du propre patrimoine de Sainct Cosme. R O N S A R D , Lettres (VI, 483). — Il y a sept ans passez que l'avez habituée en ceste ville, chez moy : aymée et honorée de tout nostre voisiné. E. PASQUIER, Lettres, XXII, 10. Peupler. Voir Habiter. S'habituer. S'établir. — Les anciens citoyens
de la ville de Sybaris... s'allèrent ensemble habituer au long de la rivière de la Tarante. A M Y O T , trad. de D I O D O R E , XII, 6. — [Les Teutons et les Cimbres] alloyent cherchans des terres qui fussent suffisantes pour les soustenir et nourrir, et des villes où ilz se peussent habituer et arrester pour vivre. ID., Marius, 11. — Entre les descendans de Hercules qui se meslerent parmy les Doriens... le plus grand nombre et les plus apparents se logèrent et habituèrent en la ville de Sparte. ID., Lysandre, 24. — La ville estoit colonie des Athéniens... au moyen dequoy plusieurs, fuyans la tyrannie d'Aristion, s'y en alloyent habituer, et y avoyent tout droit de bourgeoisie. ID., Lucullus, 19. — Ils entrèrent es Gaules pour s'y habituer à jamais, avec un gênerai bannissement des Romains. E. PASQUIER, Recherches, 1,7. — A Nantes un jeune homme, fils D'un Portugais, qui au païs De long temps s'est habitué. BAÏF, le Brave, 1, 2. — Mandron... luy offrit la moitié de sa terre et de sa ville, s'il vouloit venir s'habituer en la ville de Pityoessa avec partie des Phocaïens pour peupler le païs. A M Y O T , Vertueux faicts des femmes, Lampsace. — Ne suis-je pas bien heureux de m'estre venu habituer en une si bonne ville que ceste cy, et d'avoir quitté nostre misérable païs, subjet à tant de guerres? J E A N D E L A TAILLE, les Corrivaus, IV, 2. — Auquel temps les Lombards commencèrent premièrement à s'habituer le long du Danube. T H E V E T , Cosmogr., X V , 14. —Autres depuis, attirez par la bonté et fertilité du terroir, s'y en allèrent avec leurs femmes et enfans, et commencèrent à s'y habituer. M O N T A I G N E , I, 30 (I, 256). — A la suitte de cette corruption... il y en survint incontinent un' autre... par le moyen d'une médecin, à qui il print envie d'espouser une de leurs filles et de s'habituer parmy eux. ID., II, 37 (III, 228). — Isocrates disoit que la ville d Athènes plaisoit à la mode que font les dames qu'on sert par amour ; chacun aymoit à s'y venir promener et y passer son temps : nul de l'aymoit pour l'espouser : c'est à dire pour s'y habituer et domicilier. ID., III, 5 (III, 331). — Ses escoliers, advertis de sa nouvelle demeure, quittèrent les leurs, pour se venir habituer prés de luy. E. PA S
QUIER, Recherches, VI, 17. — Il y avoit un marchand luquois qui s'estoit habitué dés long-temps dans l'Angleterre. ID., ib., VI, 37. — Il y eut un Diophante, natif de la Macédoine, qui s'estoit venu habituer en une ville de l'Arabie Heureuse nommée Abise. L E L O Y E R , Hist. des Spectres, II, 3. — La dernière pièce du préparatif fut une déclaration de guerre, par laquelle le roi... rappelle tous ses naturels François qui s'estoyent habituez dans les terres du duc de Savoye. A U B I G N É , Hist. univ., XV, 7. Habitué. Établi. — Ilz feirent encore mourir
soixante estrangers les plus riches qui fussent habituez à Athènes pour avoir leurs biens. A M Y O T , trad. de D I O D O R E , XIV, 2. — Les compagnons de guerre qui avoyent esté soubz la charge de Pompeius... possedoyent de bonnes terres, estant habituez en de belles villes comme gros et riches bourgeois. ID., Lucullus, 34.
Habituel. — En ayant si long temps fait comme une habituée coustume. SIBILET, Contram., p. 54 (G., Compl.).
Habité.— De Chastelroge au port sont arrivez, Ville qui est sur un mont située, De Grecz et Turcs ensemble habituée. B E R T R A N D D E L A B O R -DERIE, Voyage de Constantinople (Bourrilly, Rev. des Et. rab., IX, 204).
Habillé, vêtu. — Moult richement habituez et vestes. J. D ' A U T O N , Chron., 63 r° (G.). — La noble vierge Pallas... estoit habituée de trois riches vestemens de diverses couleurs. L E M A I R E D E B E L G E S , Illustr., I, 31. — Habitués de robes noires. 1529. Reg. cons. de Limoges, 1,185 (G.). — Bien habituez en bonnes robes honnorablement. 1532. Ib., 1, 217 (G.). — Quatre grands barbus habituez comme en docteurs. Cérém. franc., 1,188 (G.). Malhabitué. Ayant une mauvaise complexion.
— Aux corps vieux, jeunes et bien tempérés, et aussi aux intemperés et malhabitués. A M B R . P A R É , XIII, 1. Habladour. Hâbleur. — Ce habladour... se fit mordre au tetin... et print après de son the-riaque, lequel ne luy servoit qu'à donner couleur pour abuser et tromper le peuple. A M B R . P A R É , XXIII, 30. Hable. Havre. — Il n'est gallere, encor que le grant dyable En fust patron, s'elle approchoit mon hable, Qu'on ne la mist par esclatz comme ung verre. J. M A R O T , Voy. de Gènes, 24 v° (G., Compl.). — C o m m e Agamemnon retournoit, Egistus envoya de ses amys au hable de la mer. P. F A B R I , l'Art de Rhétorique, L. I, p. 105. — Je vous rompray a tous la teste et rompray vostre hable et voz murailles. Grandes Cronicques Gar-gantuines, p. 52, var. — Le Hable [nom d'une taverne] est du tout accablé. Ane. Poés. franc., XI, 76. — La jetter dans un hable, ou havre, ou plage, qui est un bord de mer sans fond. E. B I N E T , Merv. de nat., p. 104 (G., Compl.). Habler. Parler. — Une très-belle et honneste dame qui habloit un peu l'espaignol. B R A N T Ô M E , des Dames, part. II (IX, 717).
Dire. — Je vous prie m e dire que peult tant habler la pucelle peu sçavante avec le jeune im-becille mal expérimenté en bon art. P. D E C H A N G Y , Instit. de la femme chrest., I, 12. Hâbleur (H. D. T. 1611). — 1555. De là viennent les beaux hâbleurs et bons charlatans. BIL L O N , le Fort inexpugnable, 21 b (Vaganay, Pour l'hist. du franc, moderne). — A la cour le flatteur on surnomme amiable... Le hâbleur elo-
HABREGIER
quent, sage le peu parlant. JEAN DE LA TAILLE, le Courtisan retiré. — Ce gentil deffroqué dit que j'ay telle opinion de moy que je démentirais volontiers iElian... Je laisse ce hâbleur pour continuer mon discours. T H E V E T , Cosmogr., VIII, 2. — Ton Louvre, ore si brave en pompeus courtisans, Foisonne en tels hâbleurs. L A JESS É E , Prem. Œuv. franc., 282 (Vaganay, Pour l'hist. du franc. moderne). — Ces monts enfante-rats, ces hâbleurs enfumez... Médisent de nos vers. J A C Q U E S D E PI N C É , dans la Main d'E. Pasquier (II, 1014). Habregier, v. Abréger.
Hache i (prononc). — L'un ayant la jambe persee : l'autre la teste entamée d'un coup d'ache. F. B R E T I N , trad. de L U C I E N , Toxaris, 55. — Son nom... est grec et... signifie une ache et doloire. GUILL. B O U C H E T , 28e Seree (IV, 225). — La fa
çon... et enrichissement desdictes gallères de leurs poupes et proues, tant pour l'art de l'ache qu'on appelle la charpente en Levant que pour la me-nuizerie. B R A N T Ô M E , Cap. franc., le grand Roy Henry II (111,253).
Hache 2. Pot contenant une matière enflammée. — La tresplendissante clarté de leurs cierges, chandelles, haches, fallots et lanternes. P H . D E M A R N I X , Differ. de la Relig., I, i, 8. — Ils sont esclairés de force falots, haches et lanternes. ID., ib., I, m , 2. — Festes... illuminées d'un grand renfort de haches et de falots. ID., ib., II, i, 3. — Les unes [des festes] célébrées à simple baston et à simples cierges, les autres à double baston, et avec multiplication de haches et falots. ID., ib. Hacher (intrans.). Battre des ailes en volant. — Le pigeon soubdain s'en vole haschant en incroyable hastiveté. R A B E L A I S , IV, 3. — Sept paires de sacres leur apparurent hachans dru et menu après deux paires d'autours. SALIAT, trad. d'HÉRODOTE, III, 76. — Les oiseaux... Quittent le gant cogneu, et dru hachant de l'aisle, Suivent l'oiseau fuyard. CL. G A U C H E T , le Plaisir des champs, l'Automne, Vol pour champs, p. 281. — En forme d'un blanc oiseau, hachant des ailes. G. C. D. T., trad. de B O C C A C E , Fiammette, L. I, p. 47. Battre le sol en courant. — Hachant menu des
pieds luy volletoit derrière, O u sembloit volleter la double talonniere. BAÏF, Poèmes, L. VI (II, 311).
(Trans.). Parcourir en battant de l'aile. — Puis à chef bas [Mercure] enfonçant sa volée, Ores à poincte, ores d'un grand contour Hachoit menu tout le ciel d'alentour. R O N S A R D , Franciade, I (111,17). Hachi gigotis. D u Bellay emploie ce terme au
sujet de vers très menus, très courts. — Apres en rimes héroïques Tu feis de gros vers bedonniques, Puis en d'autres vers plus petis Tu feis des hachi-gigotis. Jeux rustiques, A Rertran Rergier. Hachon. Petite hache. — L'envieux vieillard luy bailla entre col et chaperon d'un hachon qu'il avoit caché sous sa robe. Hist. pit. du prince Eras-tus, 39 v° (G.). Hachot. Petite hache. — Le cappitaine donna aux principaulx des hachotz, es aultres des cou-teaulx, et es femmes des patenostres. Navig. fait. par Jacq. Cartier en 1535 et 36, p. 26 (G.).
Hacquebat, Hacquebar. Sorte de bière faible. — Je sçay batre, fouir une aire, Venner, brasser houppe, gaudalle Et hacquebat. Ane Poés. franc., XIII, 174, — Ung lot de hacquebar. 1548. Bé
thune (G.). — Deux lots de hacqbar. 1561 S4 Orner (G.).
Hacquebouze. Arquebuse. — Comme Dieu le voulut permettre, fut tiré un coup de hacquebouze dont la pierre le vint frapper au travers des reins. L E L O Y A L S E R V I T E U R , Hist. de Bayart, ch. 64. — Contre l'aquebouze la fonde, Contre la' picque le baston. A U B I G N É , les Tragiques, Préface. Hacquebouzier. Arquebusier.— Ilz gectèrent aux deux esles d'ung grant chemin force hacque-butiers et hacquebouziers. L E L O Y A L SERVITEUR, Hist. de Bayart, ch. 64. — Sept mille hommes de pied, dont il y en avoit deux mille haquebuziers. Amadis, IV, 15. Hacquebute. Arquebuse. — Souventefoys par devant la maison De Monseigneur viennent à grand' foyson Donner l'aulbade à coups de hac-quebutes. M A R O T , Epistres, 3. — Amour a faict de mon cueur une bute, Et guerre m'a navré de haquebute. ID., Elégies, 1. — Et avoit mis ung homme de pied derrière chascun cheval, garny de hacquebute. L E L O Y A L SERVITEUR, Hist. de Bayart, ch. 25. — Ilz faisoient tant de bruyt que les hacquebutes ne povoient estre ouyes. ID., ib., ch. 50. — A tous faisoit laisser leurs picques, espees, lances et hacquebutes. RABELAIS, 1,44.— Lors... commencèrent les harquebuziers àlascher par intervalles leurs haquebuttes. Amadis, IV, 14. — Il y a pourtant belles buttes, Et seroit bien mauvais archer, Ou mal tirant des haquebuttes, Qui ferait faute à le toucher. M E L I N D E S* GELA Y S , Contre un mal disant (II, 252). — Il y en a [des femmes] qui aimeroyent mieux porter une haquebute sur leur col qu'une quenouille. CALVIN, Serm. sur le Deuter., 126 (XXVIII, 19). — Tous-jours l'arc bandé, ou la hacquebute chargée. ID., Serm. sur l'Harmon. evangel, 34 (XLVI, 403).— Depuis que les haquebutes ont esté tenues pour le vieil jeu (ainsi qu'on le dit en commun proverbe) et qu'on est venu aux pistoles et pistolets de tout qualibre. H. E S T I E N N E , Apol. pour Her., ch. 18 (I, 364). — Cest instrument s'appella depuis haquebute, et maintenant a pris le nom de harque-buze. F A U C H E T , Origines des chevaliers, L. II, 530 v°. — Dedans et en la grand' fenestre sur la cheminée, trois hacquebutes (c'est pitié, il faut à ceste heure dire harquebuses). Du FAIL, Contes d'Eutrapel, 22 (II, 31-32).
Hacquebuter (intrans.). Tirer de l'arquebuse. — C. hacquebutant. R A B E L A I S , III, 26.
(Trans.). Arquebuser. — Le pendre ou hacquebuter. Disc, sur le saccag. des églises, 70 r° (G.).
Hacquebutier. Arquebusier. — Hallebar-diers, aussi gens d'ordonnance Se mettent sus avec plusieurs piquiers, Hacquebutiers et subtilz canoniers. G R I N G O R E , l'Entreprise de Venise (I, 155). — Ses hacquebutiers faisoient beaucoup de mal aux François. L E L O Y A L SERVITEUR, Hist. de Bayart, ch. 39. — U n de ces deux haquebutiers Par mal viser fault lourdement. M A R O T , Epigrammes, 42. — L'avant guarde, en laquelle furent contez seize mille quatorze hacquebutiers. R A B E L A I S , 1,26. — Autant en est-il en une armée : les uns sont à l'artillerie, les autres sont haquebutiers, les autres gens de cheval, les autres piquiers, ou autrement. CALVIN, Serm. sur le Ps. cxix, 5 (XXXII, 536). — C o m m e s'il y avoit des archiers ou hacquebutiers qui tirassent au blanc, te., Serm. sur la première à Timothee, 10 (LUI, 118).
(Adj.). Où l'on emploie l'arquebuse. — Escarmouche. Aspre, furieuse... haquebutiere. M. DE LA P O R T E , Epithetes, 161 v°.
— 4
— 425 — HAIE
Hacquenée. Aller la hacquenée. Aller au pas de la haquenée. — Il y en ha... de jeunes gens qui sont si pesans que l'on auroit plustost appris à un boeuf à aller la hacquenée qu'à eux à danser. D E S PÉRIERS, Nouv. Récr., 38. (Prononc). — L'autre a la perruque taigneuse
D'une acquenee faryneuse. AUBIGNÉ, le Primtems, III, 20. — Montée sur son hacquenée. BRANTÔME, Cap. franc., M. d'Imbercourt (II, 405). — Il y eut aussi une planchette d'or qui estoit à l'as-quenée de la duchesse quand elle chevauchoit dessus, te., ib., M. de Salvoyson (IV, 106). Haemorrutes (a oppuToç, dont le sang coule).
Hémorroïdes. — Je me donne à tous les diables si les rhagadies et haemorrutes ne m'en ad-vindrent. RABELAIS, IV, 52. Haerediter, Haeritage, v. Herediter, Héri
tage. Hagard, terme de fauconnerie. Non dressé,
sauvage. — Oizeaux aguars, peregrins, essors, ra-pineux, saulvaiges. RABELAIS, IV, 57. — D'où vient... qu'icy de toutes parts Me sont venus au poing les oiseaux plus hagars Sans estre reclamez? Du BARTAS, 2e Semaine, 2e Jour, l'Arche, p. 169. (Fig.). Sauvage, farouche. — Plus qu'un che
vreuil ma Francine est fuyarde, Plus que le vent ou le coulant d'une eau, Plus dédaigneuse et cent fois plus hagarde Que celle-là qui devint un rou-seau. R. BELLEAU, la Rergerie, lre Journ. (1, 301). — Dieu m'a faict d'une nature si hagarde que je ne crains rien tant que d'escrire à mes bons seigneurs et amis. E. PASQUIER, Lettres, XV, 6. Rude, brusque, violent. — Je voudrais... lors
que fortune se monstre envers nous hagarde, que nous nous exposassions, pour le bien de nostre pays, volontairement aux dangers. ID., Pour-parler du prince (1, 1028). — Qui est celui qui ne trouve un roy plain de debonnaireté, lequel par honnestes remonstrances veut tirer de ses sujets ce que quelques esprits hagards penseroient pouvoir estre exigé par une puissance absolue? ID., Recherches, II, 7. — S'elle ne veut de son bon gré, Je l'envoiray bon gré mal gré. — Aa, monsieur, donnez vous bien garde D'user de façon si hagarde, Mais portez vous y doucement. BAÏF, le Brave, IV, 3. — Aussi est-il de nos ignaciens, lesquels faisans contenance de soustenir l'Eglise de Dieu, la minent et ruineront de fond en comble au long aller. Toutesfois, parce que ma proposition semblera peut-être hagarde à quelques âmes chatouilleuses, je vous supplie... vouloir suspendre vos jugemens jusques à ce qu'ayez tout au long entendu mes raisons. E. PASQUIER, Recherches, III, 44. — U parloit de rompre la caveche à tout le monde... Bref, estoit si hagard qu'on ne le pouvoit tenir. Supplément du Catholicon, chap. 10 dans Tricotel, édit. de la Sat. Men., II, 81. Ombrageux, indocile. — Ce jeune prince se
comporta avecques une telle modestie envers ce peuple hagard [les Génois] qu'il gagna grandement sa bonne grâce. E. PASQUIER, Recherches, Vi, 28. Hautain. — Vous m'avez honoré, et non pas
comme ceux Qui caressent les gens pour une fois ou deux, Puis, le matin venu, hagards, ne les co-gnoissent, Pensant estre honnis si les yeux ils abaissent Pour regarder quelqu'un. RONSARD, Pièces retranchées, Poèmes (VI, 192). — Tu ne dédaignes point, d'un haussebec de teste, Ny d'un sourcy hagard, des petits la requeste. ID., Amours diverses, A N. de Neufville (I, 346). Déraisonnable. — Il seroit impossible de dire
combien de propositions hagardes furent mises en avant au desavantage du roy. E. PASQUIER, Recherches, II, 7. — Ne soyons poinct si vilains et hagardz Que de laisser ce bon vin aux soldartz Qui nous font tant d'oultrage. J. L E H O U X , Chansons du Vau de Vire, 1, 66. Hagarder. Traiter avec dédain? — Qui
doutent que ceus là ne portent impatiemment d'estre hagardes par un inconnu n'aiant encores ataint le vintiesme de son âge, né en un païs qui est sur les lisières de la mer d'ignorance, et frais-ecloz, diront-ils, des entre-mondes d'Epicure? Ri-VAUDEAU, Lettre à Honorât Prévost (Marcel Raymond, Rev. du XVIe siècle, XIII, 258). Hagardement. D'une manière farouche. —
Ces fieres furies, Qui exercent sur moy mille bourrelleries Et qui, de cent regards hagardement lancez, Me rendent les poulmons d'outre en outre percez. N U Y S E M E N T , Œuv. poet., 94 v°. D'une manière étrange. — Ausquelles... il
s'addressoit assez hagardement, leur disoit qu'il les vouloit rendre participantes de sa grâce et de sa lumière, et leur faisoit ouvrir la bouche pour prophétiser comme luy. L E LOYER, Hist. des Spectres, II, 3. — A ces paroles, ainsi hagardement prononcées par Polycrite, le peuple accourut à la foule et, se ruant sur luy, taschoit, mais en vain, de l'offenser. ID., ib., III, 12. — L'empereur assis et les amans appeliez, voicy un qui se présenta assez hagardement. BE R O A L D E D E VERVILLE, Voyage des princes fortunez, p. 584. Hagios, Haguilleneuf, v. Agios, Aguillan-
neuf. H a ha. — Vieille ha ha, vieille hon hon, Vieille
corneille, vieux héron. TABOUROT DES ACCORDS, les Bigarrures, I, 22. Hahan, v. Ahan. Hahay. Tapage. — Bazochiens, qu'on ne se
mescontente, Car il est dict, sans faire grant hahay, Que vous jourrez ce joly moys de may. R. D E ' COLLERYE, Cry contre les clers du Chastellet. Haictément. Avec plaisir. — O que félicité
sera loing desdictes republicques, si les philosophes sont desdaigneux de communicquer leur conseil aux roys et princes. — Ilz ne sont pas, dit il, si ingratz quilz ne le feïssent haictément... si les princes et roys estoient appareillez d'obéir à leurs bonnes opinions. J. L E BLOND, trad. de TH. M O R U S , l'Isle d'Utopie, L. I, 21 v°. — Les femmes des Syphograntz cherchent diligemment une nourrice, et n'est difficile à trouver, car celles qui le peuvent faire ne font chose plus haictément que cela. ID., ib., L. II, 49 r° et v°. Haicter, v. Haiter. Haie. Refuser la haye. Refuser de marcher en
rangs serrés. — Dont messire Charles d'Amboise, ayant la charge de toute l'armée, voyant si grosse puissance d'ennemys, doubtant que le seigneur de la Palixe et ses gens ne fussent assez pour sous-tenir le faix de tant d'ennemys, volut la faire monter trois mille Allemans, lesquelz refusèrent la haye, disant qu'ilz ne se departyroyent point s'ilz ne montoyent tous ensemble, et plusieurs fois refusèrent a monter. J. D'AUTON, Chron., 65 v° (G., Compl.).
(Prononc). — Boyssières à travers de l'haye l'aperçoit. J. D E BOYSSIÈRES, Prem. Œuv., 41 r°. — La belle cerisaye Rangée tout le long de la treille et de l'haye. ID., ib., 114 v°. — Passons par ceste saulaie Pour entrer dedans ceste haie. P. DE CORNU, ŒUV. poet., p. 111.
H A I E R — 42
Haier. Entourer de haies. — Et ne faut qu'il allègue mes champs estre mal clos, car je suis celuy (possible) qui regarde autant de près à les bien clorre et hayer. D u FAIL, Propos rustiques, 1, p. 88. Barrer par une haie, par un obstacle. — Ayant
toute la nuict fait esplaner et délivrer les chemins et traverses des bois que les ennemis avoient haie et empesché. R A B U T I N , Commentaires, VI (G.). — (Fig.). Il ne suffit au prince, ainsi que dit le sage, De destourner l'ouye au danger de la rage De quelque reporteur, et d'espines hayer Les oreilles, afin de ne point l'escouter. G. D U B U Y S , l'Oreille du prince, 27 r° (G.).
Haieteur. Celui qui prend soin des haies. —-Jehan Le Blan, haieteur, n s. pour avoir serquelé les verdes haies. 1510 (G.). — Ung haieteur nettoyé les verdes haies des fossez de la ville. 1511. Béthune (G.).
Haiette, dimin. de haie. — Sur les herbelettes, Herbes verdelettes Verdoyent feuillettes Feuillant les haiettes. L E M A I R E D E B E L G E S , le Temple d'Honneur et de Vertus (IV, 196). — Souventes-fois se reposoient au mylieu de leurs troupeaux, souz le doux umbrage des hayettes fueillues. ID., Illustr., I, 27. — L'un de çà, l'un de là, en saute-lant volette Et saulte voletant pour franchir la hayette. CL. G A U C H E T , le Plaisir des champs, l'Automne, la Pipée, p. 277. — S'il marche dédaigneux par dessus les plançons Des aires compartis en diverses façons, Et qu'il rompe en passant les bordures tondues Et d'un gentil dedal les hayettes fendues. V A U Q U E L I N D E L A F R E S N A Y E , Art poétique, II.
Haigne. Haine ? — J'enflambay son courage à pousser les enseignes Dans PI taie trempée en venimeuses haignes. R. G A R N I E R , Porcie, 1168.
Haigner. Murmurer, être mécontent, souffrir. — Sans jurer ni haigner. A. M O R I N , Siège de Boul, 21 (G.). — Vous voulez... qu'une pauvre pucelle, qui est ensoulfrée d'un feu plus véhément que n'est le grégeois, haigne en son ardeur sous les os secs d'un vieil chenu. C H O L I È R E S , 7e Matinée, p. 265. Haillon, employé dans le sens d'habit. —- En
quelque pays qui est des limites de France, on fait si grand honneur à ce mot haillons que, quand on verra des robes de velours, voire de drap d'or, on dira, O les beaux haillons ! H. E S T I E N N E , Dial. du lang. franc, ital, I, 368. Haillonner. Vêtir, couvrir. — Ami, despouil-
lés-moy cette riche ecarlate... Haillonnés-moy de toile. R I V A U D E A U , Aman, V, p. 127. — Pource [les premiers hommes] cousurent ils des fueilles de figuier dont ils bâillonnèrent leur nature devant qu'avoir l'usage d'autre invention. J. D E M O N T L Y A R D , trad. 3' A P U L É E , 478 r° (G.).
(Dans un sens libre). — Je m'en reporte au confesseur de madame Louyse, laquelle luy disoit en confession qu'un moine l'avoit haillonnee. B E R O A L D E D E V E R V I L L E , le Moyen de parvenir, Em-blesme (II, 13). — Je veux mal à celles qui le font pour se venger, comme la huguenotte de Lyon, qui disoit à son mari qui la batoit : « Va, chien, vilain, par despit de toy, grand excommunié, j'iray tant à la messe, et me feray tant haillonner. » ID., ib., Elégie (II, 36). — Elle eust mieux aimé se faire haillonner à une douzaine de moines qu'à lui. Ip., ib., Fantaisie (II, 229). Haillonné. Couvert de haillons. — Les chiens...
le gouspillerent de sorte que ses habillemens mesmes estoient tous à lambeaux. Estant sauvé
avec peine... il demande à monsieur s'il vouloit pas ouïr la messe. Ce monsieur, le voyant ainsi haillonné, respond que non. GUILL. BOUCHET Ie Seree (II, 49).
Haillonneux. Composé de haillons. — H te faudra d'un habit haillonneux Vestir ton corps. R O N S A R D , Poèmes, L. I, Paroles de Calypso (V, 68). Vêtu de haillons. — Belistre. Pouilleux, malau-
tru, rapetassé... haillonneux. M. D E LA PORTE, Epithetes, 48 r°. — Mendiant ou Mendieur. Pauvre... rapetassé, haillonneux. ID., ib., 261 v°. — De mesme se peut tapir un généreux et robuste courage en un corps haillonneux et mal en point. J. D E M O N T L Y A R D , trad. d'APULÉE, 253 v° (G.).
Haim. Hameçon. — [Panurge avait] force provision de haims et claveaulx, dont il acouploit souvent les hommes et les femmes en compaignies ou ilz estoient serrez. R A B E L A I S , II, 16. — Avecques un petit aim lon prent de gros poissons. B. D E L A GR I S E , trad. de G U E V A R A , l'Orloge des princes, III, 34. — Ne penses pas qu'il y ait... poisson aucun qui, pour la friandise du ver, s'accroche plus tost dans le haim que tous les peuples s'aleschent vistement à la servitude. L A BOETIE, Servitude volontaire, p. 36. — Si de ma tremblante gaule Je puis lever hors de l'eau Pris à l'haim le gros barbeau Qui hante au pied de ce saule. RONS A R D , Gayetez, Vœu d'un pescheur (II, 59). — Ainsi voit-on le pescheur sur les eaux, Par l'aim caché sous une amorce belle Les poissons pris banir de leurs ruisseaux. BAÏF, Diverses Amours, L. I (I, 292). — Il m e sembloit que dessus une roche J'estois assis avecques mon haim croche, Pour épier les poissons dessous l'eau, Et qu'à mon haim s'en accrochoit un beau. A M . JAMYN, Œuv. poet., L. V, 226 r° et v°. — M a raison sans combatre abandonna la place, Et mon cœur se vit pris comme un poisson à l'hain. RONSARD, Sonnets pour Hélène, 1,12. — Il ne faut plus nourrir cest enfant qui m e ronge, Qui les crédules prend comme un poisson à l'hain. ID., ib., II, 74. — C'est une psette, laquelle s'est frottée au haim, puis l'a englouty, elle est prise. F. BRETIN, trad. de L U C I E N , le Pescheur, 49. — D'un petit haim on prend le gros poisson. CHASSIGNET, le Mespris de la vie, sonn. 351.
(Fig.). Ilz... mettent... le hain ou hameçon en l'amorse, comme le pescheur. P. D E CHANGY, Instit. de la femme chrest., I, 14. — Ce sont les haims, les appaz et l'amorse, Les traictz, les rez qui m a débile force Ont captivé d'une humble violence. D u B E L L A Y , l'Olive, 65. — Je veux mourir pour tes beautez, maistresse, Pour ce bel œil qui m e prit à son hain. R O N S A R D , Amours de Cassandre (I, 23). — Ce ne sont q^haims, qu'amorces et qu'apas De son bel œil qui m'allèche en sa nasse. ID., ib., I, 65. — Les amorces des biens hautains N'ont point tant d'appast en leurs hains Qu'elles déçoivent ta sagesse. TAHUR E A U , Prem. Poes. (I, 49). — Où prit Amour encor ces filets et ces lesses, Ces haims et ces apasts que sans fin tu m e dresses...? O. D E MAG N Y , les Souspirs, sonn. 32. — Heureux vrayment celuy qui jeune d'ans s'en-volle, Fraudant les haims de ceste vie folle, Qui tousjours nous abuse, et d'un espoir trop vain Nous va pipant tousjours du lendemain. R O N S A R D , EpUapne d'Ant. Chasteigner (V, 276). — Ulysse... Sans s'allécher à l'haim de tels appas, Pensoit tous-jours à voir sa vraye femme Et son païs agréable à son ame. A M . J A M Y N , Œuv. poet., L. I, 2r°. D'un autre appast cet hain, pour m'attraper,
— 42
Faudrait cacher. V A U Q U E L I N D E LA F R E S N A Y E , Sat. franc., A M. de Tiron. — Ne vois-tu pas que ce ne sont que feintes, Que ce n'est rien qu'un parler alléchant... Qu'un haim caché sous des paroles sainctes? G U Y D E T O U R S , Souspirs amoureux, L. I (L 16). — Sous cet argent, il m'est advis que je voy reluire l'hain qui nous doit attacher par la gorge. LARIVEY, les Tromperies, III, 1. Hain, v. Haim.
Haine (Prononc). 1° h muette.— Bien faisoit à considérer l'hay ne et malveillance que avoient contre les dicts Vénitiens généralement tous les princes. SEYSSEL, Hist. de Louys XII, Vict. sur les Vénitiens, p. 276. — [Tibère] voulut demons-trer son hayne envers les sénateurs. D E R O Z I E R S , trad. de D I O N CASSIUS, Hist. rom., L. LVII, ch. 122 (257 r°). — Jérusalem... M e feit en croix innocent mourir d'hayne. F E R R Y J U L Y O T , lre part., 19, trad. de L A C T A N C E . — De là l'haine, l'envie et l'homicide main. P. M A T T H I E U , Vasthi, IV, p. 81. — S'esloigner de l'effort de l'haine et de l'envie. ID., Aman, II, p. 38. — Passer, loin d'haine et d'envie, Le printemps de nostre vie. G. D U R A N T , ŒUV. poet., 109 r°. — Il ne luy mons-tra jamais aucun semblant mauvais d'hayne ny de passion contre luy. B R A N T Ô M E , Cap. franc., le grand Roy François (III, 147). •— Elle [la fortune] aura fmallement payé le reste de son hayne en ceste publique plainte et deuil de toute la France. ID., Rodomontades espaignolles (VII, 70). — Que maudit soit-il, pour l'hayne et envie que je luy porte. ID., des Dames, part. II (IX, 569).
2° ai formant deux syllabes, de sorte que haine rime avec des mots en -ine. — Apres amour aussi vient la hayne... Tant qu'à mon tour le lyz est à ruyne. Ane. Poés. franc., IX, 300. — On trouve en escript qu'ung tirant, Qui estoit queux d'une cuysine, Si le prist par grande hayne. Ib., I, 206. Haineur. Celui qui hait, ennemi, — En endu
rant sont vaincuz les hayneurs. G R I N G O R E , les Folles Entreprises (1, 129). — A fin que si aucun des satrapes... s'efforçoit de révolter, il trouvast en la mesme région des aversaires et haineurs pour luy résister. J. D E V I N T E M I L L E , trad. de la Cyropedie, VIII, 8. — Ces haineurs des hommes se forgent une privée et solitaire vie. L E C A R O N , Dialogues, I, 2 (55 v°). — V o u s estes plus fort Que ce meschant qui fait sentir la mort A ses haineurs seulement par finesse. G R E V I N , Poésies, les Jeux Olimpiques (p. 30). — Aborder un César qui n'eut jamais haineur Qui soudain ne sentit l'effort de sa fureur. ID., César, 1, p. 3. — Endurer l'arrogance de leurs hayneurs et envieux. 1573. Du PREAU, 196 (Vaganay, Deux mille mots). — César, privé par ses haineurs, Citoyen, des communs honneurs, Contraint de se défendre, Alla les armes prendre. R. GARNIER, Cornelie, 1499. — Et si par eux mon ame est de la mort prochaine, Pourquoy ne fuy-je au moins les haineurs de m a vie? NuY-SEMENT, ŒUV. poet., 54 v°. — Et mes loyaux sou-dars pour ma querelle armez, Qu'elle vient d'inciter, l'inhumaine, à se rendre A César mon haineur. R. GARNIER, Marc Antoine, 893. — Je feis que mes haineurs contre moy s'esleverent. ID., ib., 1161. — Un prince... Qui scait si bien dompter les ennemis du roy Et rembarrer l'orgueil des haineurs de la foy. CL. G A U C H E T , le Plaisir des champs, VHyver, Chasse du cerf, p. 335. — Mais des bons qui la paix et la justice honorent... Il a tousjours le soin, leurs sceptres il maintient, Et contre tous haineurs leur querelle soustient. R. GARNIER, Tragédies, au Roy. — Nous pouvons prattiquer... l'enseignement de Plutarque, qu'on
HAINEUX 2
doit retirer utilité de son hayneur. S4 FRANÇOIS DE SALES, Controverses, Avant-propos (1,15 var.). — Le hayneur est en tourment, le hay est à son aise. CHARRON, Sagesse, I, 26.
(Adj.). Des ennemis. — Il verra que ma dextre, au sang haineur souillée, Sera, quoy qu'il m'en fasche, au sien propre mouillée. R. G A R N I E R , Cornelie, 1123. Haineusement. Avec haine. — Si, ne voulant à aucun plaire, Presqu'à soy-mesme on veut desplaire, Haineusement ambitieux. T A H U R E A U , Prem. Poes. (1, 140). Haineux 1. Objet de haine, odieux. — Adonc se print le triste roy Priam à plourer misérablement... voyant que ores il... estoit tombé en la malvueillance de ses subjets propres. Si dit à Antenor et à tous les assistons quil leur laissoit la charge totale de lappointement... Et que pource quil leur estoit ainsi devenu hayneux, il se tien-droit désormais solitaire en son palais. L E M A I R E D E B E L G E S , Illustr., II, 22.
Celui qui hait, ennemi. — Et dirons ce que sçaurons dire De tes maulx pour plus fort te nuyre, Car nous sommes tes aigneuses. Ane Poés. franc, VII, 106. — Tu me monstres le dos des ennemis, Et mes hayneux j'ay en ruyne mis. M A R O T , Ps. de David, 16. — Que sa pensée au Seigneur soit ravie, Qui de tous maux seul la soulagera, De ses hayneux aussi la vengera. ID., le Riche en po-vreté. — Si j'avois un haineux qui machinast m a mort, Pour m e contre-venger d'un si fier adversaire, Je voudrais qu'il aimast les yeux de m a contraire. R O N S A R D , Amours de Marie (I, 182). — Il [Ulysse] feit de ses haineux une belle vengeance, Pour m e venger des miens je ne suis assez fort. D u B E L L A Y , les Regrets, 40. — R o m les folles menaces, O Pan, de mes haineux. BAÏF, Eglogues, 3 (III, 19). — Tous mes autres haineux m'atta-quans n'avoyent peu Consommer mon espoir. A U B I G N É , le Primtems, 1, 9. — Or trionfons, Antoine, et aux dieux rendons grâces D'avoir de nos haineux rabbatu les audaces. R. G A R N I E R , Corne-lie, 1370. — Elle [la France] a tousjours, d'une ordre bien dressée, De ses haineux la force renversée. V A U Q U E L I N D E L A F R E S N A Y E , Pour la monarchie de ce royaume. — David, tout au contraire, est haineux capital Des ennemis du roy. D u B A R TAS, 2e Semaine, 4e Jour, les Trophées, p. 350 ter. — J'ay rompu les desseins de ton prince adversaire. J'ay contraint tes haineux jusques à te bien faire. M O N T C H R E S T I E N , David, V, p. 231. — En cela le vainqueur ne demeurant plus fort Que de voir son haineux le premier à la mort. A U B I G N É , les Tragiques, I (IV, 35). — Père de ses subjects, amy du misérable, Terrible à ses haineux, mais à nul mesprisable. ID., ib., II (IV, 86).
(Prononc). 1° h muette. — E1P assoupit son haineuse discorde. L E C A R O N , Poésies, le Démon d'amour, 30 r°. — Et prevoiant que Justice voul-Ioit Laisser la terre ou l'haineux sang coulloit. ID., ib., 34 v°. 2° ai formant deux syllabes. — Quand la force
italique et la fleur des François Par estrif hayneux firent mortelz exploits. L E M A I R E D E B E L G E S , les Regrets de la dame infortunée (III, 196).
3° aigneux. (Voir le 1er exemple du 2e alinéa). — Qui faict cela qu'aucuns d'un naturel aygneux Ne peuvent demeurer sans avoir guerre entr'eux? A U B I G N É , la Création, X (III, 399).
Haineux 2. Il faut peut-être lire haiveux, pour aiveux, eveux, aqueux. — Les autres humeurs sont exhallees par la véhémence du feu, qui chasse les matières haineuses et humides. PALISSY, Re-
7 —
H A Ï R — 428 —
cepte véritable, p. 21. — Voila qui me donna occasion d'entendre et cognoistre que toutes les pierres transparentes sont la pluspart de matière haineuse, et de tant plus elles sont haineuses, elles résistent plus vaillamment au feu. ID., ib., p. 48. IIair, v. Air. Haïr. Haïr à. Haïr de. — Mon ame de sa com-
plexion refuit la menterie et haït mesme à la penser. M O N T A I G N E , II, 17 (III, 41).
Haïr de mort. Haïr mortellement. — Affin qu'il ne feust tortycolly (car telles gens il haïssoit de mort). R A B E L A I S , II, 30.
Se haïr. S'ennuyer, ne pas se plaire. •— Tibère... pource qu'il se hayoit en toutes villes, colonies et lieux assiz en terre ferme, s'alla cacher en la solitaire isle de Capree. E T . D E LA P L A N C H E , trad. des cinq prem. liv. des Annales de TACITE, L. IV, p. 167. — J'aime Tibur lors que je suis à Rome, I estant je m'i hai, signe d'un léger homme. Trad. d'HoRACE (1583), Epistres, I, 8.
(Formes). Les formes non inchoatives se maintiennent encore à beaucoup de temps. Indicatif présent. — Bien souvent, étonnez de
la difficulté et longueur d'apprendre des motz seulement, nous laissons tout par desespoir, et hayons les lettres premier que les ayons goûtées. Du B E L L A Y , Deffence, I, 10. — C'est ce qui fait que nous trouvons Du tout bon ce qui est des nostres, Que nous hayons et dédaignons, Fut il bon, ce qui est des autres. J O D E L L E , Ode de la chasse (II, 318). — Vous m'estes contraire Et me hayez. D E S P O R T E S , les Amours d'Hippolyte, Chanson. — On dit aussi en termes escorchez que vous hayez tant, C'est un humoriste : ou, Il a du ca-pricce. H. E S T I E N N E , Dial. du lang. franc, ital, I, 287. — Marastres hayent naturellement les enfans des premières femmes de leurs marys. L E MAIRE D E B E L G E S , Illustr., III, 2 (II, 407). — Les
voisins... te hayent mortellement. D E S P É R I E R S , Des mal contens (I, 100). — O Seigneur... tu as espars tes ennemis, et tous ceux qui te hayent s'enfuyent arrière de toy. CALVIN, Serm. sur le Ps. 124 (XXXII, 475). — De l'un en l'autre ainsi chassez, ils cheent, Et tous ensemble également les hayent. A M Y O T , De Isis et d'Osiris, 26. — En telle nouveauté, il ne faut point alléguer qu'on fréquente ceux qui parlent avec jugement. Car tels personnages, ce sont ceux qui hayent le plus ces mots qui sont creus en une nuict. H. E S T I E N N E , Dial. du lang. franc, ital, II, 280.
Imparfait. — Ne hayois tu pas Démosthène plus que tous tes ennemis? F. B R E T I N , trad. de LU C I E N , Louange de Démosthène, 32. — Eneas... avoit dissension avec Paris : et le hayoit, à cause de ce qu'il avoit violé et prophané le temple d'Apollo. L E M A I R E D E B E L G E S , Illustr., II, 20. — Il a dit... que s'il me tenoit qu'il me ferait mourir, et que j'estoye l'homme vivant qu'il hayoit le plus. L E L O Y A L SERVITEUR, Hist. de Bayart, ch. 45. — Je m'esbahis pourquoy elle me hayoit tant, veu qu'oncques je ne la veiz. Amadis, I, 23. — Combien qu'elle portast peu d'amytié à Amadis... si hayoit elle encores plus le roy Lisuart. Ib., IV, 12. — Elle hayoit mortellement ce qu'elle avoyt aymé. M A R G . D E NAV., Heptam., 35. — Quiconque soit l'auteur, il est aisé à voir qu'il ne hayoit point les moines, ains semble parler comme estant du nombre. H. E S T I E N N E , Apol. pour Her., ch. 24 (II, 69). — Ce qu'on raconte du roy Antigone avet bien aussi bonne grâce, qu'il aimet bien les traistres ce pendant qu'ils faisoyent la trahison : depuis qu'ils l'avoyent faicte, qu'il les hayet. ID., Dial. du lang. franc, ital, II, 39. — Maugiron... haioit mon frère d'une telle haine
qu'il conjuroit sa ruine en toutes façons. MARC, D E V A L O I S , Mémoires, p. 130. — Les damoiselles et femmes de chambre de ladite royne Polypo hayoient mortellement Heleine, pource que leur seigneur le roy Tlepolemus avoit prins mort à cause d'elle. L E M A I R E D E B E L G E S , Illustr., II, 23. — Hz haioient les Thessaliens, lesquelz si eussent tenu le party des Grecz, je pense que de leur part ilz eussent medizé. SALIAT, trad. d'HÉRODOTE VIII, 30. Impératif. — Hay, hais, hait, haions, haiez,
hayent. R A M U S , Grammaire, ch. 17. Subjonctif présent. — La première chose, ce
sera d'apprendre à escorcher des mots italiens : encore que je haye cela mortellement. H. ESTIENN E , Dial. du lang. franc, ital., I, 285. — Encores ne craindray-je de te dire alors cecy (ores que tu m e hay es comme ennemy). F. BRETIN, trad. de L U C I E N , le Déshérité, 31. — Ne pensez pas que son hoste elle haye En le tuant ou en luy faisant playe. C H . F O N T A I N E , la Contr'amye de court, 6 v°. — N'y a aucun qui haye ou mesprise ceux qui sont tousjours en armes. J. D E VINTEMILLE, trad. de la Cyropedie, III, 4. — Le soing praesentement joieux Haie de chercher soulcieux Ce qui oultre doibt naistre. Luc D E LA PORTE, trad. d'HoRACE, Odes, II, 16. — Mais il n'est rien qu'ici ces hommes hayent tant Que l'homme dont ils vont les seuls membres portant, La seule face aussi. J O D E L L E , les Discours de Jules César (II, 239).
Participe présent. — Mais le bon roy, hayant mondanité, Ne fist conte de telle dignité. GRING O R E , les Folles Entreprises (I, 29). —Mais Juppi-ter hayant faulse Discorde... Y envoya derechef par grand cure Son grand héraut et truchement Mercure. L E M A I R E D E B E L G E S , 3e Conte de Cupido et d'Atropos (III, 65). — Aymé gens... Qui font justice en chacun lieu, Craignant Dieu, hayant avarice. G R I N G O R E , S* Loys, L. VIII (II, 271).— Les dieux hayantz ingratitude vile Nous font sentir double vengeance amere. M A U R I C E SCÈVE, Délie, 391. — Hayant les ceulx qui veullent prendre paine A m e tuer. H A U D E N T , Apologues d'EsopE, I, 51. — Mais maintenant le penser mesme M e cause une douleur extrême, Me hayant moymesme en pensant Cela que j'allois pourchassant. R. B E L L E A U , Petites Inventions, A l'Amour (1, 156). — Je prioy... Qu'un couple si parfait s'entr'aimast longuement, Hayant plus que la mort ceux qui, brûlez d'envie, Troubloient l'heureux repos d'une si douce vie. DESPORTES, Elégies, L. I, Discours. — Car aussi tost qu'ils ont acquis pouvoir, Ils vont hayant ce qu'ils nom-moyent leur vie. A M . J A M Y N , ŒUV. poet., L. V, 263 r°. — Tandis que ce grand homme a esté des-pité, Hayant Agamemnon, moins dure estoit la peine De combatre aisément l'armée achaïenne. ID., Iliade, XVIII, 126 v°. — Sçache au moins la postérité Que, hayans telle nouveauté, Passiez par ce nouveau langage Comme par un mauvais passage. H. E S T I E N N E , Dial. du lang. franc, ital., Condoléance aux courtisans (I, 12). Futur et conditionnel (ai ne forme qu'une syl
labe). — J'aymois I'amy devant couvertement; Et je hairray tout aultre doublement. HEROET, la Parfaicte Amye, L. II, v. 734. — Celuy que je hay vif, mort je ne l'aimeray. — Celuy que j'aime vif, mort je ne le hairay. BAÏF, Antigone, III, 1- — Je hairay pour jamais lorgueil de ces maistresses, Mmes D E S R O C H E S , Tobie, se. 5. — Ainsi chascun, quelque part que tu soys, Hayt et hayrra ta faulse progenie. M A R O T , Tristes vers de BEROALDE (III, 142). — Le défunt te haira pour bien bonne
— 429 — HAIT
raison. BAÏF, Antigone, I, 1. — Sera le patron de bien vivre... Haira l'hypocrisie à mort. ID., les Mimes, L. IV (V, 214). — Sil ki t'ém' au bankêt konvîras, non ki te hêra. ID., les Bezognes é Jours d'Eziode (V, 387). — (Au Printemps). Trop hai-rons nous ta verde fioriture, Si te figure H a si mauvais augure Qu'à ton venir Mort nous jette ses dards. L E M A I R E D E B E L G E S , Couplets de la Valitude (III, 94). — Devant les yeulx vous viendra honte honneste, Et n'en hairrez cil qui vous admonneste. M A R O T , l'Enfer. — Gagne donques d'elles ce point Que les deus ne me hayront point Qui auront le desavantage. BAÏF, Devis des dieux, 1 (IV, 150). — Les bons beuveurs de nuict du meilleur vin de ville T'hairont si tu refuse à boire quand et eulx. Trad. d'HoRACE, Epistres (1583), I, 18. — Mais de mes maux le pire estoit la dure absence De mon soleil, sans qui je hairois la clarté. JODELLE, les Amours, sonn. 36. Participe passé. (Dans le vers suivant, hay ne
compte que pour une syllabe). — Hà, peuple que j'ay hay, hà nation maudite. R I V A U D E A U , Aman, III, p. 98. Les formes inchoatives s'étaient introduites
dans des emplois où elles ne sont pas maintenues, aux personnes du singulier du présent de l'indicatif, et à la 2e personne du singulier de l'impératif : ai (ou ay) compte pour deux syllabes dans les exemples suivants : Indicatif présent. — A h ! que je hay le soudard
Qui ha le courage couard, Et qui par une lasche fuite... Le danger de la mort évite. R. G A R N I E R , Porcie, 1393. — Amy, ne t'en esbahy ; Mon jugement et ma plume Sont forgez dessus l'enclume D'une que j'aime et hay. E. P A S Q U I E R , Monopole, Au lecteur (II, 695). — En aimant ces Romains tu haïs la vertu. M O N T C H R E S T I E N , la Car-taginoise, IV, p. 144. — U n bien savant gueres ne poind et mord, Mais les poignants haït jusqu'à la mort. M E L I N D E S* G E L A Y S , Ballades, 1 (II, 2). — Car on ne veoit en cueur qui obeist Jamais orgueil, sur tous vices l'hayst. J. B O U C H E T , Epistres familières du Traverseur, 116. — Plus est servy le corps, plus faict de plaincte... Plus on le prie et moins il obeist, Plus est aymé, Plus son salut hayst. ID., Epistres morales du Traverseur, 1,4. — Qui aime la vertu et qui haïst le vice, Qui est riche de biens, de moyens, de faveurs. R I V A U D E A U , Hymne de Marie Tiraqueau. — Le ciel sous sa masse ronde Hait l'affronté sourcy. P. M A T T H I E U , Vasthi, IV, p. 96. — Le peuple qu'il hait et qu'il nomme idolâtre. ID., Aman, II, p. 45. — Qui haït le plaisir, fuit toute compaignie. B R A N T Ô M E , Poés. inéd., 127 (X, 480). Impératif. — A y m é donques (Ronsard) comme
pouvant haïr, Haïs donques (Ronsard) comme pouvant aymer. D u B E L L A Y , les Regrets, 140. — Aime-les, elles te hairont : Haï-les, elles t'aimeront. BAÏF, l'Eunuque, IV, 7. — Nulle amitié n est immuable : Nulle inimitié perdurable. Haï comme pouvant aimer : Et comme pouvant haïr aime. ID., les Mimes, L. II (V, 122). (Prononc.) : h muette ou absente. — Le sens et
1 entendement de se reconnoistre et d'haïr la ti-rannie. L A BOET I E , Servitude volontaire, p. 30. — Quelle amitié peut on espérer de celui qui a bien le cœur si dur que d'haïr son royaume...? ID., ift. p 51. — Tous les autres [auteurs de la Saint-harthélemy] sont mortz par permission divine, puisque Dieu n'ahist tant que le sang respandu de quelque créature que ce soit. B R A N T Ô M E , Cap. franc., l'Admirai de Chastillon (IV, 301).— Les huguenotz l'hayssoient fort. ID., ib., le Mareschal de Saint-André (V, 36). — M M . de Montmorency
l'ahissoient fort. ID., Couronnels franc. (V, 358).
Haire 1. Tourment, ennui. — Le bon feut à la procession : en laquelle feurent veuz plus de six cens mille et quatorze chiens à Pentour d'elle, lesquelz luy faisoyent mille hayres. R A B E L A I S , II, 22. — Ceulx qui se marient Ainsi qu'il fault, et en ce ne varient... Sont bien heureux, et auront peu de haire En leurs espritz. J. B O U C H E T , Epistres morales du Traverseur, 1,1.
Haire 2, v. Hère. Haire 3. Exclamation servant à exciter. — Mieux eut valu la hayre Pourter pour voz harnoys Que crier : haire, haire, Et mourir soubz voz boys. 1515. 2e Chans. sur la bataille de Marignan (G.). — On m'a mis les chiens à m a queue, criant hère, hère, et m'ont prins par la robbe et par les jambes. CALVIN, Discours d'adieu aux ministres (IX, 892). — Tu estois la retraitte de mon peuple, et tu cries haire, haire, après ceux qui venoyent se cacher sous ton ombre. ID., Serm. sur le Deuter p. 778 b, édit. de 1567 (G.). — Cf. Harer.
Haireux (?). — L'ung fait le haireux eschauffé, Et l'autre empoigne l'estofîé, Et mengut tout jusqu'à la paille. Farce trouvée à Fribourg (P. Aebis-cher, Rev. du XVIe siècle, XI, 169).
Hairizoner (?). — Les arches et avant becz des quelz pontz auparavant et aux deux coustez des dictes voûtez seront faictz de taille brochée et hairizonez de chaux et de sable desditz deux coustez. 1531. Arch. M.-et-L. (G.).
Hairronnier, v. Heronnier. Haïssable (H. D. T. 1611). — 1 5 8 4 . U n air
empesté est haïssable aux corps bien complexion-nez. J. D E B A R R A U D , trad. de G U E V A R A , Epist. dorées, IV, 44 b (Vaganay, Pour l'hist. du franc. moderne).
Haïsseur. Celui qui hait, ennemi. — Pour aller héberger en un plus beau séjour, Auquel les bons esprits et haïsseurs de vices Jouissent en repos d'éternelles délices. R I V A U D E A U , A C. d'Aunis. — Diogenes... estoit juge bien plus aigre et plus poignant... et par conséquent plus juste à mon humeur que Timon, celuy qui fut surnommé le hais-seur des hommes. M O N T A I G N E , I, 50 (I, 415).— Timon, cest insigne et beau haïsseur d'hommes. D u FAIL, Contes d'Eutrapel, 27 (II, 86). — U n de la seree, haïsseur de songes, va en s'escriant dire, O que ceux se peuvent dire heureux qui ne songent point! GUILL. B O U C H E T , 16e Seree (III, 146). Hait. A son hait. A son gré, à son aise. — Il est bien heureux, qui a Tout ; Car il a le vent à son het. Ane Théâtre franc., III, 199. — Ceste dict à soubzhait, Et ceste aussi bien babille à son hait. CRÉTIN, Débat sur le passetemps des chiens et oyseaux, p. 85. — Paris le print, et but à son hait. Et après avoir savouré la noble liqueur... il parla en ceste manière. L E M A I R E D E B E L G E S , Illustr., 1, 25. — Si l'un s'en rit, si l'autre est à son hait, Si l'un s'esbat, si l'autre se recrée. M A R O T , Epistres, 5. De bon hait. De bon cœur, avec plaisir. — Mais
je vous jure, sur mon ame, Qu'il le faisoit de très bon hayt. A ne. Théâtre franc., 1, 373. — Venez et allons de bon hayt A Instruction que je voy. Ib., III, 12. — Je vais, je viens, je me defferre, Avec mon corps, si très de hait Que, si je tumboye jus à terre, Je combatroys de meilleur hayt. Ane Poés. franc., VIII, 330. — Certes j'y enten-droye D'aussi bon hayt que regnard en tendre oye Frappe ses dentz. CR É T I N , A maistre Fran-
H A I T E R — 430 —
çois Charbonnier, p. 221. — Lesquelles gualoises voluntiers et de bon hayt font plaisir à gens de bien. R A B E L A I S , III, 2. — Pantagruel pria un chascun soy mettre en office et debvoir pour reparer le briz. Ce que feirent, et de bon hayt. ID., IV, 25.
De bonne humeur. — Il trouva son maistre joyeux et de bon hait, et soy addonnant a devis solacieux. B U D É , Instit. du prince, édit. J. Foucher, ch. 42.
Cf. Dehait. Haiter. Plaire, faire plaisir. — Je vous pro-
metz que bien m e haitte Vostre maintien, m a chère dame. Je ne vy meshuy, sur mon ame, Rien qui me fust plus aggreable. Ane. Théâtre franc., III, 42. — La compaignie qui m e haitte, C'est de les veoir soirs et matins Près de moy. Ane Poés. franc., IX, 105. — Or emprunter du gros et du menu Depuis troys ans de fait m'a convenu Pour un procès qui guières ne m e haicte. R. D E COL L E R Y E , Rondeaux, 68. — Vostre ouvrage très bien me haitte, Mais qu'alliez tout doulcettement A ce premier commencement, Pource que je suis trop jeunette. Petit traicté contenant la fleur de toute joyeuseté (G.). — Il a payé la naturelle debte Que nous payerons, combien qu'a tous ne hayte. Dieu a mis fin a ses mondains labeurs. J. B O U CHET, Epistres familières du Traverseur, 86. — Elles commencèrent escorcher l'home, ou gluber, comme le nomme Catulle, par la partie qui plus leurs hayte. R A B E L A I S , III, 18. — De ceux qui n'appetent rien Nud je sui la compaignie : Et, fuiard, des riches grands Quitter m e haite les rangs. Luc D E LA P O R T E , trad. d'HoRACE, Odes, III, 16. Se hetter de. Prendre plaisir à. — Amasse,
amasse, assemble, assemble, Sans jamais de rien te hetter. BAÏF, les Mimes, L. I (V, 49). Hayté. Sain, bien portant. — Je sçay bien le
lieu et la terre Dont il yssit hayté et sain. Ane Poés. franc., I, 205. — Je n'ay pied ne membre retraict ; Si suis sain et haictié et droit. Ib., III, 89. — Il n'est indécent a la fille qu'elle soit ceincte et environnée d'ung devantier ou serviette, ap-prester pour ses père, mère, mary ou enfans, soient haytiez ou débilitez. P. D E C H A N G Y , Instit. de la femme chrest., I, 3. En bon état d'esprit. — Maistre fol, a qui ap
peliez vous de la sentence du roy? — A vous mesmes (dict il) sire, mais que vous soyez plus haitte et esveillé que vous n'estes. B U D É , Instit. du prince, édit. J. Foucher, ch. 32. Content, heureux. — Je ne veiz homme de
quoy je fusse plus haicté. J. L E B L O N D , trad. de T H . M O R U S , l'Isle d'Utopie, L. I, 3 r°. Haiz (?). — De souhaitter autant vault une
fève Semée parmy des pierres ou des haiz. Ane. Poés. franc., III, 154. Halainer, v. Halener.
Halas. Hélas. — Halas, halas, mon amy. RABELAIS, IV, 6. — Halas, halas... Vouldriez vous bien damner vostre ame? ID., IV, 54. Dans ce mot composé, las reste encore va
riable. — H a lasse vous avez faict office de cruelle pitié. Trad. de B O C C A C E , Flammette (1537), ch. vi, 75 r°. ' Halcyone, v. Alcyone. Haie. En vénerie et en fauconnerie, cri pour exciter les chiens et les oiseaux. — Il ne luy fault que lascher les longes, je diz l'aiguillette, luy monstrer de près la proye : et dire, haie, compai-gnon. R A B E L A I S , III, 27.
Halebarde. (Emploi du mot pour désigner des armes dans l'antiquité). — [Les Thraces] estoyent de grands et puissans hommes... branlans sur leurs espaules droittes des pesantes et massives halebardes. A M Y O T , Paul Emile, 18. — Et corn-batoyent les soudards à grands coups de picques de halebardes et de javelines, et jettoyent des pots et lances à feu. ID., Antoine, 66. — Ceux qui pour lors veilloient au prochain corps de garde Vestent le corselet, prennent la halebarde. MONTCHRESTIEN, la Cartaginoise, I, p. 123.
(Prononc). — Avec son hallebarde sur le col, M O N L U C , Commentaires, L. III (II, 57). — Je baissay la teste, ayant l'espée en la main, et mon page, qui pourtoict mon halebarde, auprès de moy. ID., ib., L. IV (II, 218). — Cingar... tenoit son halebarde bas, toute preste à s'en servir. Trad. de F O L E N G O , L. XII (I, 331). — La Burthe, perdant patience, luy donna de l'hallebarde... à travers le corps. B R A N T Ô M E , Couronnels franc. (VI, 4). — Il vint à estre poussé fort rudement d'un Souysse... avec son hallebarde. ID., ib. (VI, 44). — La Loue... fut tué d'un coup d'hallebarde. A U B I G N É , Hist. univ., V, 22. — Son halebarde ostée, un rondacher le trainoit par un pied en bas. ID., ib., VI, 12. — Vous y voyez un moine qui se crevé un œil de l'hallebarde de celui qui va devant. ID., Faeneste, IV, 13. Halebardier (adj.). — Hante. Dure, ferme, javelineuse... halebardiere. M. D E LA PORTE, £pi-thetes, 203 v°.
(Subst.). Garde armé d'une hallebarde. Le mot s'emploie quelquefois pour traduire des mots grecs de sens analogue. — Ainsi le peuple autho-risa la proposition d'Ariston touchant l'ottroy des hallebardiers. A M Y O T , Solon, 30. — C'estoient deux hallebardiers d'Archias qui battoient à la porte, estant envoyez à grande haste devers Cha-ron... Charon leur demanda... s'il y avoit rien de nouveau : Nous n'en sçavons rien, dirent ces ser-gens. ID., De l'esprit familier de Socrates. Hallebardiere. Femme d'un marchand de halle
bardes. — Adieu la grand hallebardiere. MAROT, Gracieux adieu aux dames de Paris, édit. Guiffrey, 111,127.
(Prononc). 1° Accompagnez... des albardiers pour les garder. A U B I G N É , Hist. univ., XIII, 29. 2° A u meilleu de leur trouppe voyoit on leurs
enseignes au vent, accompaignées de halbardiers. Amadis, IV, 15.
Halebran. Jeune canard sauvage. — Une autrefois ilz prenoyent grand plaisir à tendre aux oyseaux, et avec des lacz courans et colletz prenoyent des oyes sauvages, des halebrans et os-tardes. AMYOT-, Daphnis et Chloé, L. II, 26 v°. — Hallebrans. Maulvyz. Flammans. RABELAIS, IV, 59. — Canards, albrans, oisons et autres sortes de gibier. ID., V, 14. — Et autres fois te partsde Montferrand Pour descouvrir par les champs l'al-lebrand Qui en may erre Souz l'herbe raiz de terre. J. D E BO Y S S I È R E S , Prem. Œuv., 111 v°. — Je vous laisse à penser combien il y pouvoit avoir des halebrants, considéré qu'à chasque nichée il y en a souvent jusques à seize et dix-sept. C'est un manger exquis à la dodine. P H . D'ALCRIPE,^ Nouvelle Fabrique, p. 69. — Apres sont les geh-notes dites de Numidie, espèce de faisan, puisses poules d'eau, le héron, l'otarde, le hallebran, 1 ai-grete. O. D E S E R R E S , Théâtre d'agric, V, 1. Halebrener. Chasser l'halebran. — Christophe La Chievre, charpentier, fournit deux nacelles pour servir a monseigneur pour aller halle-
brener a la saison aux estangs de Choupy. 1538. Arch. Meuse (G.). Halebrené. Fatigué d'avoir chassé l'halebran.
— Nos sacres sont allebrenez. BAÏF, les Mimes, L. IU (V, 170). (Par extens.). Fatigué, éreinté. — A troys che
vrons hallebrenez de canabasserie. RABELAIS, II, 13, — Le Goitron trois jours après retourna tout hallebrené et fasche de ces guerres, ayant un œil poché. ID., IV, Ane Prologue. — Par laquelle aussi feut Quaresmeprenant declairé breneux, hallebrené et stoefisé. ID., IV, 35. — Tu es tout herissonné, tout hallebrené, tout lanterné. ID., V, ;_ —Voyez comment il est hallebrené. ID., V, 27. — Cestui-cy est vieil, albrané, Radoteux, tané, bazané. BAÏF, l'Eunuque, IV, 4. — Car par les lieux buyssonneux En vain il [le lièvre] recourt, péneux, Hallebrené de la chasse. CL. GAUCHET, le Plaisir des champs, l'Esté, Chasse du lièvre à force, p. 143. — Un matin qu'il pleuvoit, tonnoit, gresloit, tempestoit, Guillemin, allant au marché vendre un peu de fil, fut contraint s'en retourner à î'hostel, mouillé, harassé, et tout hallebrené. Du FAIL, Contes d'Eutrapel, 32 (II, 147). — Il n'est ny marchant, ny procureur, ny soldat, qui ne quitte sa besongne pour courre à cette autre : et le crocheteur, et le savetier, tous harassez et hallebrenez qu'ils sont de travail et de faim. MONTAIGNE, III, 5 (III, 342). — Quelques uns des plus halbrenez... d'entre ces maranes et mes-creans s'estonneront de premier abord, lisants ce filtre, Nouvelles des régions de la lune. Supplément du Catholicon, Préface, dans Tricotel, édit. de la Sat. Men., II, 14. — [Balde] n'ayant encor les jambes bien fortes ny les pieds bien asseurez, pendant qu'il s'efforce de courir et de vouloir voler comme l'oyseau, tout halebrené, tombe souvent en terre, et gaigne de bonnes beignes au front. Trad. de FOLENGO, L. III (I, 56). — [L'armée du roi] estoit fort allebrenée et mal menée, pour les grandes incommoditez qu'elle avoit pâty. BRANTÔME, Cap. franc., le Mareschal de Montefan (III, 211). — Plusieurs y en a qui aymeroyent mieux un bon artisan de Vénus, frais et bien émoulu, que quatre de ceux de Mars, ainsi allebrenez. ID., des Dames, part. II (IX, 400). (Subst.). Ces albrenez qui tousjours sont au cul
d'un alembic, cuidants qu'il n'y a qu'à soufler pour devenir riches. Supplément du Catholicon, ch. 8, dans Tricotel, édit. de la Sat. Men., II, 61. Halecret. Corselet de fer protégeant la poi
trine et le dos. — D'autre costé voyt on le plus souvent Lorges jecter ses enseignes au vent, Pour ses piétons faire usiter aux armes... Grans hommes sont en ordre triumphans... Fort bien armez, corps, testes, bras et gorges : Aussi dict on : les hallecretz de Lorges. M A R O T , Epistres, 3. Ici, le mot halecret semble désigner le soldat portant un halecret. — Le bon chevalier... emprunta ung halecret d'ung adventurier, qu'il mist sur sadicte robbe, -et monta sur ung gaillart coursier. LE LOYAL SERVITEUR, Hist. de Bayart, ch. 49. — En leurs divises... font protraire... non et un alcret, pour non durabit. RABELAIS, I, 9. — Elisor... feit faire ung grand mirouer d'acier, en façon de hallecret, et, l'ayant mis devant son esto-mach, le couvrit très bien d'ung manteau de frise noire. MARG. D E NAV., Heptam., 24. — Les armes que nous prendrons pour le corps seront ceulx cy : premièrement le hallecret complet et tassettes jusques au dessoubs du genouil. R. D E FOURQUE-VAUX, Instruct. sur le faict de la guerre (A. Le-franc, Rev. du XVIe siècle, III, 139). — Mars en fut poinct, si que la dure trempe Du hallecret ne
HALEDOSSË
l'a pas secouru, Quand le petit aveugle l'a féru. FORCADEL, ŒUV. poet., p. 130. — C'est autant comme si un homme estoit bien equippé, qu'il eust et hallecret, et heaume, et espee, et bouclier, et qu'il pendist tout cela au croc. CALVIN, Serm. sur le liv. de Job, 12 (XXXIII, 158). — Il vestit le fer enrouillé D'un halecret fait à la suisse. 1562. Chans. des corporiaux (G.). — Avoir continuellement le cul sur la selle, le halecret sur le dos, le casque en la teste. SULLY, Œcon. roy., ch. 38 (G.). — Dix-huict Escossois, la plus part percés de coups, comme n'ayans pour armes que des ha-lecrets d'Escosse de lames clouées entre deux cuirs. AUBIGNÉ, Hist. univ., XI, 17. (Par comparaison). — Dieu luy a donné [au hé
risson de mer] moyen de sçavoir faire plusieurs espines piquantes, par dessus son halecret et forteresse. PALISSY, Recepte véritable, De la ville de forteresse, p. 117.
(Fig.). — Donner pour Dieu, c'est ung fort ale-cret Pour batailler ou public ou secret Contre le diable. J. BOUCHET, les Triumphes de la noble dame, 42 v° (G.). — Noz armes sont, comme sainct Paul nous advertit, le bouclier de la foy, le glaive de la parole, le heaume de salut, le halecret de justice. CALVIN, Lettres, 3685 (XIX, 232). — Ains lors que dans leur cœur les semences divines Ont pris de longue main des profondes racines, Et qu'ils ont l'estomac d'un halecret vestu Fait à preuve d'ennuis, espais, à froid-batu. Du BARTAS, 2e Semaine, 3e Jour, les Pères, p. 310. Armure (dans un sens général). — Styx d'un
noir halecret rampare Ses bras, ses jambes et son sein. RONSARD, Odes, I, 10 (II, 128). Le mot halecret désigne souvent des armures de
l'antiquité. — Ilz [les Carthaginois] avoient leurs corps armez de bons halecretz. G. D E SELVE, Huict Vies de PLUTARQUE, Timoleon, 102 v°. — Il y avoit entre aultres choses mil halecretz moult excellemment ouvrez et dix mil boucliers. ID., ib., 103 v°. — Vous serez armez ayans un hallecret en doz, l'escu en la senestre... l'espée ou cymeterre en la dextre. J. D E VINTEMILLE, trad. de la Cyropedie, II, 3. — Car il revint tout le dernier des Grecz, Qui portent tous de fer les hallecretz. PE-LETIER D U M A N S , L. I de l'Odyssée, 22 r°. — Leurs hallecretz leur pesoient beaucoup. ET. D E LA PLANCHE, trad. des cinq prem. liv. des Annales de TACITE, L. I, 38 r°. — Demosthenes... prit avec luy dix mille hommes bien armez de bons halecrets, et autant d'autres armés à la legiere. A M Y O T , trad. de DIODORE, XIII, 5. — Son armée estoit de vingt mille hommes de pied, la moytié armez de halecrets et autres armes pesantes, et l'autre moytié à la legiere. ID., ib., XIII, 25.— Le tyran Dionysius... vivoit en perpétuelle crainte, et estoit contraint de porter par dessoubz sa robbe un halecret. ID., ib., XIV, Proeme. — Ce que Philopoemen corrigea, en leur persuadant... de s'armer les testes de bons morrions, les corps de halecrets, et les cuisses et jambes de bons cuissots et bonnes grefves. ID., Philopoemen, 9. — Ne cesserons nous jamais, après un si long temps, d'avoir le halecret sur le dos, et le pavois sur le bras? ID., César, 37. — Le hallecret d'or et de cuivre blanc Met-il au dos. D E S MASURES, Enéide, XII, p. 618. — (A Holopherne). Prince... Le plus chery du ciel, le plus fort, le plus sage Qui porte espee au flanc, sur le dos halecret. Du BARTAS, Judith, IV, p. 392. — Il receut la blessure au fond de sa poitrine, Et la pointe rompit le halecret serré Dont contre les dangiers son corps fut emmuré. A M . JAMYN, Iliade, XIII, 23 v°. Haledossé (?). — II... déployé force filets,
11
HALEFERTIER — 432 —
harnas, toilles et traîneaux pour chasser au vent, et y enserrer des belles escrevisses haledossées par imagination. P H . D E M A R N I X , Differ. de la Relig., I, m , 7. — Cf. Halledosse. Halefertier. Gueux. Cf. Galefretier. — Je vis
passer un petit régiment de dix sept capussins espagnols, pauvres halefertiers. L'ESTOILE, Mém., 2e part., p. 56 (G.).
Haleine. Grosse haleine, v. Gros. Tirer son haleine. Respirer. — C'est ceste amour
que nature enracine, Qui de mon poing fait batre m a poictrine, Et qui me fait avec pleurs souspirer Tant que ne puis mon aleine tirer. C H . F O N T A I N E , les Ruisseaux de Fontaine, p. 50. — A grand peine ose-t-il son haleine tirer. R É G N I E R , ŒUV. posth., Elégie. Retirer son haleine. Respirer. — Je suis tant
altéré qu'à peine Puis-je retirer mon haleine, Pour la grande chaleur qui m'ard. R. B E L L E A U , Odes CZ'ANACREON (I, 20).
Ravoir son haleine. Respirer. — U n gros vilain pourceau, qui ne pouvoit pas à grand'peine remuer un doigt, qui ne pouvoit pas ravoir son alleine (comme on dit). CALVIN, Serm. sur le liv. de Daniel, 35 (XLII, 21). Haleine. Odorat. — Son object est l'odeur, qui
est une qualité en nostre haleine et fleurement, sortant de choses mistes, esquelles est plus ou moins mistionnée une humidité aërée. A M B R . P A R É , IV, 7.
(Prononc). — Il reçoit la haleine de ce gros bœuf et de cet asne. S* F R A N Ç O I S D E SALES, Lettres, 940 (XVI, 121).
Haleinee, v. Halenee. Haleinement. Souffle. — Les vents etesiens d'haleinements fumeux Pesle-mesle accouplez et poursuivant leur route, Courent, bruyant, sifflant de violence toute. R. B E L L E A U , les Apparences célestes (II, 336). Haleiner, v. Halener.
Halenee. Souffle. — Vent des vents souverain, Qui voletant d'aeles bien empanées Fais respirer de soueves halenées Ta doulce Flore au visage serein. D u B E L L A Y , l'Olive, 87. — La mer ne s'enfle, forcenée, Aussi tost que Coré jette quelque halenee : Ains commence à blanchir. D u B A R T A S , Judith, II, p. 367. — Alentour de la terre y aiant encore beaucoup de matière comprise et espessie par les battemens des vents et les halenées des astres. A M Y C T , Opinions des philosophes, I, 4. — Où de Tempe les tiédeurs D'une Heureuse halenee Le ciel parfument d'odeurs. R. G A R N I E R , la Troade, 1148. — Les vens... D'une douce halenee en ta loge souflans. P. D E C O R N U , ŒUV. poet., p. 133. — Par le contraire vent en soufflantes bouffées Le feu va ratisant ses ardeurs estouffées : Il bruit au bruit du vent, souffle au soufflet venteux, Murmure, gronde, cracque à longues hal-lenees. R É G N I E R , ŒUV. posth., Stances. Action de prendre haleine. — Devant que
l'aborder [Vézelay], plusieurs haleinees sont requises pour monter jusques au pied des murailles. T H E V E T , Cosmogr., XIV, 19. D'une halenee. D'un trait, sans reprendre ha
leine. — Il s'en alla mettre en franchise au collège de Montaigu, courent tout d'une aliénée, sans regarder derrière soy. D E S P É R I E R S , NOUV. Récr., 63. D'un commun accord, d'une même voix. —
Elle en sera (ce pense je) estrenée, Car les haul-boys l'ont bien chanté anuyct, Et d'un accord et tous d'une aliénée Ont appelle la bien heureuse
nuyct. M A R O T , Chants divers, 3. — Je voy le peuple qui la suyt Admirer sa grâce bien née, Et murmurer d'un commun bruit Ces vers d'une longue halenee, O Hymen, Hymen, Hymenee O. D E M A G N Y , Odes, I, 130.
Halener (intrans.). Respirer. — Mon nez es-touppe ses conduitz : Plus n'ay, pour aliéner, per-tuis ; M a bouche aplatist et estresse. Ane Poés. franc., VII, 101. —Belle saulce verd... laquelle.., vous faict bon ventre, bien rotter... mouscher, haleiner, inspirer, respirer. RABELAIS, III, 2. — Bouche, vrayment source de vérité, Qui rien d'humain alenant ne respire. BAÏF, l'Amour de Francine, L. IV (I, 254). — Les chèvres, selon Alcmeon, haleynent par les oreilles et non par les naseaux. S4 F R A N Ç O I S D E SALES, Vie dévote, III 21. Souffler. — Les petis ventz alors n'ont aliéné,
Mais les forts ventz encores en souspirent. MAROT, Complainctes, 4. — Desja le doux zephire de la prime vere commençoit à alener. A M Y O T , Hist. Mthiop., L. V, 59 r°. — [Le vent] halena souefve-ment tout le long du jour, refreschissant les Barbares et leur bestail aussi. A M Y O T , Sertorius, 17. — Hé ! combien voyons-nous de tels Ephraïmites En ce temps malheureux, qui vivent hypocrites Dans l'Eglise, tandis qu'un zephyre clément Contre sa saincte poupe haleine heureusement! D u B A R T A S , Judith, III, p. 373. — La fortune tousjours n'halaine point en pouppe Au valeureux César. ID., 2e Semaine, 4e Jour, les Trophées, p. 356 bis.
Exhaler une odeur. — Sa bouche de cinabre et de musc toute pleine, Et qui plus doucement qu'une Sabee halaine. D u B A R T A S , Judith, IV, p. 391.
(Trans.). Respirer [l'air]. — Je m'esbahis comment... il daigne halener de nostre aer, passer par le chemin où nous passons. R É G N I E R DE LA P L A N C H E , Livre des Marchons, II, 280. — Chacun se sent de Pair qu'il haleine, et, où il vit, suit le train de vivre suivy de tous. C H A R R O N , Sagesse, L. II, Préface. Exhaler par la respiration, insuffler. — J'ha-
lene ainsi la chaleur de m a bouche Pour reschauf-fer mes mains où elle touche. CORROZET, Fables rf'EsoPE, 117. — Le saint souflement De la bouche de Dieu leur halenoit en l'ame Une fureur divine. V A U Q U E L I N D E LA F R E S N A Y E , Art. poet., 1, p. 5.
— De moy, qui suis tout flame et de nuit et de jour, Qui n'haleine que feu, ne respire qu'amour, Je me laisse emporter à mes fiâmes communes. R É G N I E R , Sat. 1. —Cette suprême bonté haleyne et inspire en nous les désirs et intentions de son cœur. S* F R A N Ç O I S D E SALES, Amour de Dieu, VIII, 10.
Toucher de son haleine. — Et si prochain il est De ses talons que jà de son alaine Ses beaulx cheveulx tous espars il alaine. M A R O T , L. I de la Metamorph. (III, 186). — Puis nous asseura que pour descouvrir le fard, qu'il ne falloit que tenir en sa bouche du saffran, et puis que veniez à halener une femme fardée, son fard n'aura pas si tost senty ce saffran qu'il tombera de luy mesme. GUILL. B O U C H E T , 5e Seree (1,173). — Elle infecte le ciel par la noire fumée Qui sort de ses nazeaux, elle haleine les fleurs, Les fleurs perdent d'un coup la vie et les couleurs. A U B I G N É , les Tragiques, 1 (IV, 55). Toucher d'un souffle. — Et y sont les rues si
bien dressées que toute la ville est halenee au plus grand chauld d'esté des vents du nord, quedon appelle etesies. A M Y O T , trad. de DIODORE, XVII, 11. — Bien heureux le zefir qui alêne son teint,
— 433 — H A L E R 3
BAÏF, l'Amour de Francine, L. I (I, 128). — Mon Dieu, quel vent si chaud m'alene le visage? ID., ib., L. Il (I, 191). — Le Mardien le réconforta, et luy asseura que le fleuve qu'ilz demandoyent estoit bien près de là, ce qu'il conjecturoit par un doulx vent humide qui les halenoit. A M Y O T , Antoine, 48. — Ils sont soufflés et halenés souvent d'une sorte de vent méridional qu'ils appellent aultan. A M B R . P A R É , L. IX, Disc. 2. Respirer l'odeur de. — Main dont mes pleurs
j'ay esté apaisant, Et qu'halenant, baisant et rebaisant, J'ay attiédie en mes bouillantes larmes. TAH U R E A U , les Mignardises, sonn. 52. — (Fig.). Quant au duc de Nemours et à Cipierre, on leur faisoit halener la grandeur qu'ils devoyent espérer, délivrant le roy de tous ces hérétiques. R É GNIER D E LA P L A N C H E , Hist. de l'Estat de France, 11,83. Découvrir. — E n peu de temps leur imposture
fut halenee, et se tourna tout leur feu inopinément enfumée. E. PA S Q U I E R , Lettres, I, 8. — Celuy qui halena premièrement son fard fut ce grand et docte Adrien de Tournebu... lequel luy fit une plaisante epistre sous ceste intitulation, Ego tibi. ID., ib., IX, 9. — Ayant ramené devant mes yeux tout ce qui s'est passé, et que, lors qu'ils vindrent en cette ville... ils estoient pauvres comme la mesme pauvreté, et toutesfois maintenant qu'il n'y a... compagnie qui soit plus riche que cette-cy, je commençay lors d'haleiner leur fard. ID., Recherches, III, 44. Parler à, s'entretenir avec, fréquenter, appro
cher de. — Pour parler du faict militaire, qu'il haleine les capitaines et guerriers : pour la chasse, les veneurs : pour les finances, les thresoriers. E. PASQUIER, Lettres, II, 12. —• Tout ce que je vous ay ci-dessus discouru, je le tiens en foy et hommage de M. de Pisany, l'un des plus sages preud'hommes que nous ayons jamais halené en ceste France. ID., ib., XIII, 18. — Ce grand chancelier fust estimé huguenot par plusieurs, ores qu'il n'en tint aucune tache, et je m'en croy pour avoir cest honneur de le voir et halener. ID., Recherches, III, 18. — Je ne vy jamais grand seigneur accompagné de plus grande preud'hommie que luy, et en ay haleine plusieurs. ID., ib., VI, 9. — Nostre roy sainct Louys le voulut voir [Robert de Sorbon] ; et après l'avoir haleine, luy fit quelquesfois cet honneur de le faire disner avec luy. ID., ib., IX, 15. — Depuis que j'ay eu cet honneur d'haleiner le roy, il luy est souvent advenu de déclarer publiquement qu'il vouloit bas-tir dedans Paris les villes de R o m e et d'Athènes. ID., ib., IX, 18. — Deslors que le poëte Catulle eut haleine Virgile en sa jeunesse, il recognut un naturel en luy si propre à la poésie qu'il fut contraint de prononcer ce demy vers en son honneur, magnaspes altéraRomae. ID., Lettres, XXII, 2. — Ce n'estoit que reproches contre le prince, accusé d'avoir halené les filles de la raine, comme il parut depuis. A U B I G N É , Hist. univ., III, 26. — Ce mépris lui fut si dur qu'il ne les voulut jamais ni voir ni halener depuis. ID., ib., VIII, 2 . — Mulei-Mahamet et ses conseilliers tendoyent à temporiser... pour une espérance qu'avoit tousjours Ma-hamet, que les forces de son ennemi se donnèrent à lui s'il les hallenoit. ID., ib., IX, 19. — Il est vray qu'il a esté détenu aprez quelque es-meute du peuple contre luy, mais principalement pour empescher qu'il n'halenast M. le connestable sur le poinct de sa défection. ID., Lettres et Mém. dEstat, 16 (I, 225). — Je m'en reveins à Genève, et presentay requeste à la seigneurie pour me donner commissaires à faire une curieuse enqueste IV
de mes propos et actions entre tous ceux que j'avois halené. ID., Lett. d'aff. personn., 13 (I, 308).
Fréquenter [un lieu]. — Quant au mot de coquin, c'est un mendiant volontaire, qui halené ordinairement les cuisines, que les Latins nomment coquinas. E. P A S Q U I E R , Recherches, VIII, 42. Aborder, affronter. — On ne sçauroit dire au
trement qu'il n'ayt esté l'un des plus hasardeux et des plus déterminez soldatz de la France, et autant cherchant la fumée des harquebusades, et les alloit allainer tousjours désarmé et en pour-poinct. B R A N T Ô M E , Couronnels franc. (V, 327). — En ayant veu cinq ou six par terre, ils n'hale-nèrent point les picques et se sauvèrent comme ils purent. A U B I G N É , Hist. univ., VII, 16. — Les habitans, s'estans ralliez aux maisons plus prochaines... firent un gros dans la rue proche de la porte, que Favas n'osa halener. ID., ib., XIV, 19.
S'alleiner. S'insuffler. — Le feu vous dénie sa chaleur naturelle, et l'air s'alleine à mes poumons. N. D E M O N T R E U X , Prem. Liv. des Bergeries de Juliette, Journ. V, 271 r°. Halenant. Respirant le souffle du vent. — La
douce rosée te soit Tousjours quotidiane, Et le vent qu'en chassant reçoit L'halenante Diane. R O N S A R D , Pièces retranchées, Ode à la forest de Gastine (VI, 115). Haler 1 (trans.). Chauffer excessivement, brûler. — L'autre [semence] cheut en lieu pierreux, où elle n'avoit guère de terre, et incontinent elle se leva, car elle n'avoit point de terre profonde. Et le soleil levé, elle fut haslée, et à cause qu'elle n'avoit pas de racine, elle seicha. CAL V I N , Rible franc., Evang. Marc, 4 (LVII, 94). — Adonques vint l'esté Qui halla tout le ciel : et si ce n'eust esté Que Junon envoya Iris sa messagère, Qui la pluye amassa de son aile légère Et tempera le feu de moiteuse froideur, Le monde fust péri d'une excessive ardeur. R O N S A R D , Hymnes, L. II, Hymne du Printemps (IV, 301). — Quel poète dirait bien L'heur, le profit et le bien Que ce hous fait à son maistre? En juillet le garde d'estre Dedans sa chambre halle. ID., Poèmes, L. II, le Houx (V, 171).
Halé. Brûlé. — Dés la terre gelée Des Scythes englacez jusques à la hallée Des Mores bazanez. R O N S A R D , Hymnes, L. I, Hymne de Charles, cardinal de Lorraine (IV, 228). — O u celles qu'on trouve ou le Nil Dessus les campagnes haslees Attraine son limon fertil. R. B E L L E A U , Pierres précieuses, l'Esmeraude (II, 215).
Desséché. — Car ilz ont l'estomach halle C o m m e la gueulle d'ung four chault. Act. des Apost., vol. I, 67 b (G.). — Il fault boire, Car j'ay mengé si très salle Que j'en ay le gosier halle. G R I N G O R E , S* Loys, L. IX (II, 311). Haler 2 (intrans.). Haler de la langue, haler.
Tirer la langue. — Il [un loup] haloit de la langue un demi-pié tirée. A M . J A M Y N , ŒUV. poet., L. I, Poème de la Chasse, 75 r°. — Ceste vieille arriva... comme une vieille renarde que les païsans auroyent poursuivie plus de six cens pas... laquelle ainsi malmenée... s'escoule tirant la langue dehors un pied de long. Ainsi estoit de ceste vieille... laquelle... haie tant qu'elle peut, et haletant rapporte qu'elle venoit de voir la face d'un bel homme. Trad. de F O L E N G O , L. X X I V (II, 280). — (Fig.). Il halle comment une beste, et connoist bien sa faute, il est contes. CAL V I N , Serm. sur le liv. de Daniel, 2 (XLI, 338).
Haler 3. Lancer, exciter. — Car pour chasser la faulse lice, J'eusse halle grans chiens exprès. C H . F O N T A I N E , la Fontaine d'Amour, Epigr. — 28
H A L E T E M E N T — 434 —
Chassant aux chevreux, exhorter et haller les chiens après. PASQUIER, Opuscules de P L U T A R Q U E , p. 109. — C'est faire comme un meschant veneur, qui halle et appelle tousjours son chien, encores qu'il ne voye ny lièvre ny beste. J. D E V I N T E
MILLE, trad. de la Cyropedie, I, 8. — Je haslay mon mastin après le larronneau, Qui si près le suivit qu'il le prist au manteau : Il se sauva pourtant, et de la loure mienne Tousjours sonne depuis, et jure qu'elle est sienne. R O N S A R D , Eclogues, 4 (III, 430). — Je hâle bellement m o n chien après la belle : Si je ne le hâlois, il irait davant elle A u bord luy faire feste et luy licher la main, BAÏF, Eglogues, 19 (III, 112). — Cesarin... frappant ses mains l'une contre l'autre et sifflant sourdement entre ses dents, halla ses trois animaux contre ceste lourde et furieuse beste. L A R I V E Y , trad. des Facétieuses Nuits de S T R A P A R O L E , X, 3. — Le censier les sépare [deux chiens] et séparez les garde, Et si au mesme temps quelque loup se hazarde D'espier sa maison, il les haie sur luy. Ane Poés. franc., IX, 12. — Par tout on crie : Au loup ! Pour Dieu, halez voz meutes. Ib. — Contre ceste truye Ramon fit haler ses chiens. L E L O Y E R ,
Hist. des Spectres, IV, 13. — (Par comparaison). Je parle des courts, et de tous les aultres grands qui les ont ainsy rudement traictez et effarouchez, menant le peuple à leur plaisir, et le hallant comme un chien après ces pauvres gens. L'Hos-PITAL, Mémoires (II, 208). — On fera le semblable des autres princes et grands seigneurs de ce royaume. Premièrement on les divisera entr'eux... et avec les faux bruits et calomnies on halera les peuples après eux. Et après qu'on les aura rendus odieux aux peuples et desarmez de l'autorité, on les fera retirer à leurs maisons. D u V A I R , Actions et traictez oratoires, Exhort. à la paix, p. 77. Halé. Lancé, excité. — Aspres mastins et
chiens bien ameutez, Hallez après, le tenoyent [un sanglier] aux costez. P A S S E R A T , Adonis (1, 24).
Traqué. — Lorsque le cerf fort longuement vené Halle se voit et presque malmené, Il cherche l'eau. ID., le Cerf d'amour (I, 18). Halètement. Action de haleter. — Lorsqu'on voit que les seules veines des flancs sont celles qui se meuvent sans que rien plus bouge au halètement du cheval. B E L L E F O R E S T , Secr. de l'agric, p. 266 (G., Compl.). — Au lieu duquel pantois on escrit pantois : d'où vient pantoiser, qu'on lit au R o m m a n d'Alexandre, dict du halletement d'un homme travaillé. H. E S T I E N N E , Precellence, p. 122-123. Haleter (trans.). Exhaler. — [Les Harpies] la viande arrachèrent Hors de ses vuides mains, haletant une odeur Qui empuantissoit des chevaliers le cœur. R O N S A R D , Hymnes, L. I, Hymne de Calays et de Zethés (IV, 174). — Je pers en vain le temps haletant mes accens, Ainsi que feit Orphée après son Euridice. N U Y S E M E N T , Œuv. poet., 54 v°. — Et son large gosier halette une fumée Qui forme autour de luy une espaisse nuée. ID., ib., 82 r°. Haleyner, v. Halener. _ Halig-orne (?). — Nos belles reigles monastiques et autres semblables haligornes qui ont esté inventées plus de mille ans après le deces des Apostres. P H . D E M A R N I X , Differ. de la Relig., I, iv, 17. — Une infinité d'autres haligornes, hane-banes, idées, atomes, fanfreluches. ID., ib., II, I, 3. Halis. Sec. — Le bois qui est couppé au temps que le vent est au nord, il est plus halis et plus fort
que non pas en esté. PALISSY, Recepte véritable p. 29.
Haliteux. Sec ? — Les signes communs de la fièvre éphémère sont chaleur douce, haliteuse et suave à l'attouchement. A M B R . P A R É , X X , i, 7.
Halitre. Dessèchement. — La graine toute humide, aiant trempé vingt-quatre heures, est mise trois grains joints ensemble... après doucement couverte avec deux ou trois brins de balai et tant qu'il suffise pour la défendre du halitre et mauvais vent. O. D E S E R R E S , Théâtre d'agric VI, 9.
Halitueux. Chaud ? — La vapeur halitueuse et douce. A M B R . P A R É , I, 35.
Hallainer, v. Halener. Halle. Salle. — Brise les gons des portes infer-
nalles, Puis délivre des ténébreuses halles Le pouvre A d a m et toute sa séquelle. Act. des Apost II, 24 c (G., Haie 1).
Salle de justice. — Cestuy home de bien apoinc-toit plus de procès qu'il n'en estoit vuidé en tout le palais de Poictiers, en l'auditoire de Monsmo-rillon, en la halle de Parthenay le vieulx. RABELAIS, III, 41.
Hallebarde, v. Halebarde, Hallebarder. — Ne vous amusez pas à ces
messieurs les gens de lettres, qui sont si tres-sçavans qu'ils en sont tout sots. Vous les verrez hallebardans avec de grands lambeaux de latin effarouchans les fauvettes. B E R O A L D E D E VER
VILLE, le Moyen de parvenir, Poinct (I, 8). Royer traduit : manœuvrant pompeusement.
Hallebardier, v. Halebardier. Hallebarque. Hallebarde. — Ils furent receus
de coups d'hallebarques et d'espee. AUBIGNÉ, Hist. univ., X, 9.
Halleboter (intrans.). Grappiller. — Sinon que messieurs de la court feissent par bémol commandement à la verolle de non plus allebouter après. les maignans. R A B E L A I S , II, H . — Je me donne au diable s'ilz ne sont en nostre cloz, et tant bien couppent et seps et raisins qu'il n'y aura, par le corps Dieu, de quatre années que halleboter dedans. ID., I, 27.
(Trans., dans un sens libre). — M a commère, mananda, depeschons nous, car si ces gendarmes nous vont une fois trouver, nous serons tant hal-lebottees. D u FAIL, Baliverneries d'Eutrapel, P-42.
Hallebran, Hallebrené, Hallecret, v. Halebran, Halebrener, Halecret.
Halledosse. Mets imaginaire. — Pour la quarte assiette elles eurent des halledosses aux grumelins. Navigation du Compagnon à la Bouteille, B.
H a lie née, Haller 1, 2 et 3, v. Halener, Haler 1, 2 et 3.
Hallerre. Treuil, cabestan ? — On amené a Béthune six pieches d'artillerie avecq aucuns hal-lerres. 1551. Béthune (G.).
Halletement, v. Halètement. Hallette, dimin. de halle. — Avons donné po-
voir de faire ediffier et ériger une petite hallette en une place a tous appartenant... Et laquelle hallette nous voulons... que les boulengiers et saulniers... y venderont leur pain et sel. 1504. Arch. Meurthe (G.). Hallongner. Caresser. — J'en sçay bien qui
hantent le monde, Et qui font tresbien leur be-songne, Qui ayment bien qu'on les hallongne, Et n'ont pas, c'est où je m e fonde, Petit tetin. R. D E COLLERYE, Rondeaux, 70.
Hallot. Hallier. — Je sçay faire d'ung cat ung quien, Faulquier prez, abastre halos. Ane. Poés. franc., XIII, 162. — Je sçay abbatre aux boys hallotz. Ib., XIII, 181. — On acheté des plantes de hallotz pour planter autour des dodennes des rempars. Compt. de 1595. Lille (G., Halot). Hallotant. Haletant. — Ains sont altérez et
hallotans de soif. L A B O D E R I E , Harmon., p. 251 (G.). Halloterie. Lieu rempli de halliers, de buis
sons. — L'halloterie de Noyelle-sous-Lens. Pièce du XVIe s. (G., Haloterie). — Les halloteries de Louez. 1542. Lens (G., Haloterie). Hallure. Chaleur excessive, brûlure. — Mais
et de faim et de froidure, Mais et de soif et de hallure, Vous avez vos trois cors vous trois Bien plus secs que le plus sec bois. BAÏF, Passetems, L. III (IV, 337). Halte (masc). — Le mareschal... après un
long halte, retourna à la première place. A U B I G N É , Hist. univ., X, 17. (Prononc). — Il ne se peut excuser d'avoir faict
alte et temporisé avec les forces qu'il comman-doit, cependant qu'on enfonçoit M. le connes-table. M O N T A I G N E , I, 45 (1,376). — C'est la dextre du ciel dont l'invisible effort, S'armant pour vous sauver, fait faire alte à la mort. B E R T A U T , Panna-rette. — Cependant que tous les autres faisoient les grands efforts et ruoient les coups... le mareschal s'amusa tousjours à faire son alte et à tenir son ost coy. B R A N T Ô M E , Cap. franc., le Mareschal deGié (II, 351). En alte. Faisant halte. — Il vid le chemin et les
deux champs des deux costez pleins de mesches et d'hommes en alte. A U B I G N É , Hist. univ., V, 27. Le mot, venu de l'allemand en passant par
l'italien, est signalé comme nouveau. — La pitié est quand il me faut user de ceux [des mots] desquels si on me demandet le pays, je ne le sçaures dire, comme, pour exemple, quand je di, faire alte pour s'arrester. H. E S T I E N N E , Dial. du lang. franc, ital, I, 362. Haltou. Halte. — La trouppe des ennemis...
fist haltou auprès dudict ruisseau. M O N L U C , Commentaires, L. I (I, 54). — C o m m e nous feusmes à demy cart de lieue d'Auriolle, je fiz haltou. ID., ib. (I, 117). — Et prins le chasteau et la ville de Mieulan, où je fiz haltou, attendant M. de Chavi-gny. ID., ib. (1,129). — Estans arrivés sur le bord de la rivière, ilz firent haltou. ID., ib. (I, 141). — Nous feismes haltou, atendant M. de la Valette. lD.,iè.,L.VI (111,190). Hamaille. — C'est comme les Turcs de main
tenant font en leur hamailles et nesques qu'ils portent en leur sein pour plastron et pour corps de cuirasse. Et qu'est-ce de ces hamailles ou amulettes et préservatifs? C'est le commancement de l'Evangile de sainct Jean où il est parlé du Verbe incarné. L E L O Y E R , Hist. des Spectres, VIII, 6. Hambour. Sorte de tonneau. — Vingt-quatre
hambours de bière... De cervoise trente-deux pipes. Ane. Poés. franc., 1, 15. — Baril ou hem-bourg de saumon. 1561 (G.). — Le grand tonneau blanc... le moyen dit hambourq. 1570 (G.). — A Caen, les artisans qui avoyent nombre de serviteurs se fournissoyent chaque samedy d'un hambour de bière, qui est comme un quartan de pipe
HANCHE 1
qui estoit porté sur des trainnes. BOURGUEVILLE, Rech. de la Neustrie, II, 83 (G.).
Hameau. Hameçon. — Pour cela bailler et monstrer par exemple, disoit en oultre que les pescheurs qui peschent avecques hameaulx dor ou dargent estoient bien insensez, pource que si leurs dietz hameaulx estoient par les poissons de-tenus, ou perdus es rivières, que le poisson lequel ilz auroient prins ne vauldroit pas à moitié ce quilz auroient perdu. M I C H E L D E T O U R S , trad. de S U É T O N E , II, 56 r°.
Hameçon. (Prononc). — Si que leur ennemy, au lieu d'un beau poisson, N e tire qu'un cordeau despourveu d'hameçon. Mais le craintif mulet du hameçon n'approche. D u B A R T A S , lre Semaine, 5e Jour, p. 224. — Considère la poincte crochue du hamesson. F. B R E T I N , trad. de L U C I E N , De ceux qui vivent à gages avec les grands, 3. Hameçonné. Crochu. — Le sommet des scapes ou tiges [du chardon] menasse de sa teste pic-quante et herissonnée, renversant ses esguillons et poinctes legierement hamessonnees retorses en façon d'hamesson. Trad. de l'Hyst. des plantes de L. F O U S C H , ch. 82 (G.). — Atomes durs, aspres, hameçonnez, Qui pour tuer ont esté façonnez. A M . J A M Y N , Œuv. poet., L. IV, 212 v°.
Hameçonner. Prendre à l'hameçon.— (Fig.). U n roy par sa beauté hameçonne les âmes. P. M A T T H I E U , Vasthi, I, p. 15.
Hameçonne. Pris à l'hameçon. — (Fig.). Le sain y court, le malade s'y glisse, Hameçonnez de ce beau frontispice. G. L. B. V. D. L. au sieur de Neri, en fête de la Nouvelle Fabrique. Hameçonneux. D'hameçon. — Croc. Rouillé, poudreux... hameçonneux. M. D E L A P O R T E , Epithetes, 100 r°. Hamesson, Hamessonné, v. Hameçon, Hame
çonne. Hamette (?). — Les aulcuns portoient ha-
mettes ou capelines de cuir bouilli, et les aulcuns d'osier. S* R E M Y , Mém., ch. 62 (G.).
Hamiau. Hameau. — Aristote ayant monstre l'assemblée civile ou politique, qu'on appelle cité, estre meilleure que les autres assemblées ou compagnies particulières, comme celles de la maison, hamiau, bourg, et autres inférieures. L. L E R O Y , trad. des Politiques d'ARISTOTE, I, 1, Commentaire. — Ainsi sont les hamiaulx, villages et bourgs. ID., ib.
H a m m o n (corne de), v. Corne. H a n (à. son), expression d'argot.— Chanter,
c'est parler : j'ay chanté à son han, j'ay parlé à luy. GUILL. B O U C H E T , 15<> Seree (III, 130).
H anap. — (Fig.). Poisons bien aussi ceste prière qu'il a réitérée trois fois : assavoir, Père, s'il est possible, que ce hanap soit osté arrière de moy. C A L V I N , Instit. (1560), II, xvi, 12.
(Prononc). — Attendez que je vous donne à boyre dedans cestuy hanat nestorien. R A B E L A I S , III, 32. — U n grant hanat plein de vin. ID., III, 45. — La tierce pour divise avoit un beau et profond hanat de porcelaine. ID., IV, 1. — De rechef beut à luy plein hanat de bon vin lanternoys. ID., IV, 6. — Une des filles... luy praesenta un grand hanat plein de vin extravaguant. ID., IV, 51.
Hanappee. Sorte démesure de grains. — S o u s charge de hanappee et demye hanappee froment. 14 nov. 1549. Lesneven (G.).
Hanche 1. De croc et de hanche, v. Croc.
J5
HANCHE 2
(Prononc). — A toy, dit il, Silvan, une pleine escuelle Je donray de fromaige et de bons mac-querons... A toy, vermeille Flore, une anche de chevreau, A toy, chaste Diane, un cerf en un chaudeau. O. D E M A G N Y , les Souspirs, sonn. 144. — Vostre hanche va semblant une mothe scellée De neige cincte autour, non encor violée. B R A N T Ô M E , Poés. inéd., 131 (X, 482).
Hanche 2. Anche. — Marsyas, qui inventa la hanche pour emboucher le haubois. A M Y O T , Comment il faut refréner la cholere, 6.
Hanehet, dimin. d'anche? — (Fig.). Escript au lieu de peine palatine De plume agreste a heure matutine, C'est de celuy dont rude est le hanehet, Vostre servant treshumble Jan Bouchet. J. B O U CHET, Epistres familières du Traverseur, 18.
Handon. Espèce de serpent venimeux. — Har-menes. Handons. Icles. R A B E L A I S , IV, 64.
Hanebane, mot dialectal. Jusquiame. — La hannebanne, que l'on n o m m e la mort aux oisons. L I E B A U L T , Mais, rust., I, 16 (G.).
(Fig.). Les hanebanes des evesques. R A B E L A I S , II, 7. Voir Haligorne. Hanede (à la), nom d'une certaine manière
d'enter. — O n ente en perche ou à la hanede. LIEB A U L T , Mais, rust., p. 427 (G., Hamede).
Haneletz (cresson). Cresson alénois. — Le cresson haneletz est une herbe de laquelle nous usons en la sallade. Il est chaud et sec au tiers degré, et est en vertu forment semblable a eruca. La Nef de santé, 31 r° (G.).
Hanelit. Souffle, respiration? — D u hanelit aspirant, boursouflé. Ane. Poés. franc., XIII, 389. — Virginité vous associe aux anges, Chasse de vous les laidures estranges De volupté, pour recepvoir on lict De purité le tant doulx hannelit D u bon Jésus, qui souvent vous visite. J. B O U CHET, Epistres morales du Traverseur, 1, 4. — Quant au tiers poinct et principalle clause, Qui est sçavoir bien congnoistre la cause De tant de maulx, j'entends des corporelz, Sur nous venans et sur noz corps mortelz, Hippocrates en l'hanne-lit la pose, Hierophilus es humeurs la dispose. ID., ib., Il, v m , 4. Hanicroche. Arme à fer recourbé. — Les
autres... esguisoient vouges, picques, rançons, halebardes, hanicroches, volains. R A B E L A I S , III, Prologue. — Et n'estoit jamais asseuré leur capitaine conquereur qu'il ne vist trois rangs de fossez devant et derrière luy, tous bien hérissez de piques et hanicroches, tant il estoit de sa nature sujet à estre effrayé. Supplément du Catholicon, 10, dans Tricotel, édit. de la Sat. Men., II, 80. Mets imaginaire. — Elles eurent des nudrilles
bouillies en eau froide de peur qu'elles ne sentissent la fumée, et puis après les hannicroches rosties. Navigation du Compagnon à la Bouteille, B.
Hanicrochement. Crochet, attache. — Les femmes estoient... embesoignees... à emballer leurs pelotons, engraisser leurs forcettes... enve-loper leurs quenouilles, confondre leurs hanicro-chemens, instruire leurs metz. D u FAIL, Baliver-neries d'Eutrapel, p. 42.
(Fig.). Ce qui accroche, retient; empêchement, difficulté. — Les hanicrochemens des confesseurs. R A B E L A I S , II, 7. — Ce patelinage touchant la résidence romaine n'est qu'un compte forgé à plaisir, plein de hanicrochemens et contradictions. P H . D E M A R N I X , Differ. de la Relig., 1, n, 5. — Ils y rencontrent tant de hannicrochements...
qu'a chasque pas ils y demeurent agrippez. ID., ib., II, i, 7. — Afin que les bonnes simples gens ne fussent en doute ou inquiétude d'esprit se trouvans empiegez en ces hannicrochemens. ID., ib., II, i, 13. — Une infinité de grands et beaux volumes, contenans tous les hanicrochemens des pères confesseurs. ID., ib., II, iv, 17.
Hanicrocher. Accrocher. — Les femmes estoient plus embesoignees que vingt à emballer leurs pelotons... contrepasser leurs espingliers, hanicrocher leurs moustardiers. Du FAIL, les Ba-liverneries d'Eutrapel, p. 42.
Hanir, v. Hannir.
Hanlo (?). — Mais el est sy faicte au hanlo Qu'el n'a ne pityé ne pitace De frère portant la besace. Sotties, III, 91.
Hannebanne, Hannelit, v. Hanebane, Hanelit,
Hanner. Hennir. — (Subst.). Hennissement.— L'hanner des chevaux. J O U B E R T , Err. pop., I, iv, 2 (G.).
Hannetonniere. Lieu où Panurge assemble des hannetons. — J'ayme mieux leur donner toute m a cacqueroliere, ensemble ma hannetonniere. R A B E L A I S , III, 5.
Hannibal. (Prononc). — Car vaincre Hanni-bal, et pouvoir par ses mains Destourner le bonheur de Carthage aux Romains... RONSARD, Elégies, 1 (IV, 8). — Contemple Hannibal. Ce foudre de la guerre... Est vaincu par ceux-là dont il estoit vainqueur. M O N T C H R E S T I E N , la Cartagi-noise, IV, p. 146. Hannicroche, Hannicrocbement, v. Hani
croche, Hanicrochement.
Hannir. Hennir. — Au tour de luy... han-nissent les chevaulx. R A B E L A I S , III, 13. — Deux coursiers blancs haniront D'une longue voix aiguë. R O N S A R D , Odes, III, 3. — Six mi-poissons hannissans, Faisans jalir l'eau marine... Trai-noyent un char azuré Sur un rouage doré. BAÏF, Poèmes, L. III (II, 137). — La plus-part des chevaux hannissent en mourant. M O N T A I G N E , III, 12 (IV, 194). — (Fig.). Frère Jan hannissoit du bout du nez. R A B E L A I S , IV, 52.
Hennir (subst.). Hennissement. — Escumer, se gourmer, et d'un brave hennir Monstrer prendre courroux qu'on le vient retenir. JODELLE, Epithalame (II, 121).
(Prononc). — Sur l'hannissant cheval qui ma personne sert. P. M A T T H I E U , Aman, IV, p. 84.
Hannissement. Hennissement. — Les hannis-semens des chevaulx. R A B E L A I S , IV, 56. — Là des fougueux chevaux les clers hannissemens. Du B A R T A S , Judith, III, p. 375. — Aucuns après avoir esté vaincus, venans... leur apporter de 1 or et des viandes, ne faillirent d'en aller offrir aux chevaux, prenans leur hannissement pour langage de composition. M O N T A I G N E , I, 48 (I, 402). — U [un cheval] revient à ses importuns bannissements. ID., II, 15 (II, 397).
Hannoné. Se dit des chiens auxquels on suspend un bâton au cou pour les empêcher de courir (G.). — Nul ne poeult cachier ne voiler a bestes ne oysiaux sauvaiges, tenir ne mener chiens sans estre accouplés ou hannonés. 1507. Prév. de Mon-treuil (G.).
Hannouard, v. Hanouard. Hanoche, mot d'argot. — Hanoche. Jument.
Var. hist. et litt., VIII, 184.
4:
Hanois, mot d'argot. — Hanois. Cheval. Var. hist. et litt., VIII, 184.
Hanouard. Porteur de sel du grenier de Paris. — Les vingt-quatre mesureurs de sel, les vingt quatre henouards porteurs de sel. G. C O R R O Z E T , Antiq. de Paris, p. 240 (G.). — Apres estoit portée l'effigie du roy par dessoubz par les hannouars de Paris qui ont ce privilège. 1559. Convoy et obsèques de Henry II (G.). — Par privilèges les hanouars dudit Paris, qui sont porteurs de sel, portoient par dessous lesdits cercueil et effigie. D u TILLET, Rec. des roys de France, p. 341 (G.). Hansager. Arrogant. — L'hoste en voulsist
bien tost estre délivre, Mais il ne peut, tant sont ilz hansagers. L E M A I R E D E B E L G E S , 1er Conte de Cupido et d'Atropos (III, 41). Lire hasager? Voir Hausagerie. Hansart. Coutelas. — Mais il advint... Que
d'un tel deuil fut ce rusticque esprins Vers le serpent qu'un hansart il a prins, Dont l'a navré et jusqu'au sang blessé. H A U D E N T , Apologues d'BsoPE, I, 137. Hansenx (?).— L'aleine luy faillant hanseux
il halletoit. BAÏF, Poèmes, L. VI (II, 315). Hant. Action de hanter. — L'hyène après le
hant de l'homme Sa vie et ses forces consomme. BAÏF, les Mimes, L. II (V, 86).
Hante. Bois, manche. — Les fers de voz lances, qui sont voz houlettes cleres et bien aguisees, aux grosses hantes de mesplier, tresluisent au soleil. LEMAIRE D E B E L G E S , Illustr., I, 22. — Il luy
donna tel coup qu'il rompit la hante de la hache d'Amadis. Amadis, I, 19. —- Ce disant luy donna de la hante de sa lance... rudement sur la teste. Ib., I, 25. — II... portoit en sa main une javeline dont la hante fut de fresne et la pointe d'arain. AMY O T , Hist. Mthiop., L. III, 33 r°. — Il receut un coup mortel à travers l'estomac d'un baston de long bois, dont la hante se rompit, et le fer avec le tronçon luy demoura dedans le corps. ID., trad. de D I O D O R E , X V , 23. — Flavius... prit une enseigne en sa main, et marcha au devant de ces bestes [les éléphants], à la première desquelles il donna si rudement de la hante de l'enseigne qu'il la feit tourner arrière. ID., Marcellus, 26. — S'estant défendu... avec la hante d'une pertuisane. C. D. K. P., trad. de GE L L I , Discours fantastiques de Justin Tonnelier, Disc, ix, p. 305. — Ils nom-moient... phalarica une certaine espèce de javeline. .. la hante, revestue d'estouppe empoixée et huilée, s'enflammoit de sa course. M O N T A I G N E , I, 48 (I, 398). — Je tes n'a pas long temps assailly du chien de mon voisin, d'aventure j'avois une pertuisane, dont je m e défends contre ce chien seulement de la hante. GU I L L . B O U C H E T , 7e Seree (II, 58). — Viendra jamais le temps... Quelerouil mangera les haches émoulues, Que les hantes seront des lances vermoulues? V A U Q U E L I N D E L A FRESNAYE, Art poet., III, p. 83. — Il n'a pas mesme oublié les clous qui sont comme serpentant à Pentour de la hante, car les plus près de la lame aussi bien que le bois sont tachez de sang. D'URFÉ, l'Astrée, I, 11 (G.). Pique, lance. — La plus grand partie d'eulx
[les Parthes] sont archiers à cheval portans certaines hantes es mains. D E R O Z I E R S , trad. de D I O N CASSIUS, Hist. rom., L. X L , ch. 24 (41 v 0 ) . — Quant aux piquenaires ou piquiers, c'estoit ceux qui portoient des hantes menues de bois long de quinze et dixhuict piedz, comme la sarisse macédonienne. F A U C H E T , Origines des chevaliers, L. II, 530 v°.
HAPPE
Hanteleure. Manche. -- L'un prit la hante-leure, et l'autre la verge d'icelui. Mém. de la Ligue, t. III, p. 719.
Hautement. Fréquentation. — Il se retira de ceste riche et docte ville d'Athènes, pour demeurer aux champs, près icelle, afin de mieux et sans bruit esplucher les mystères divins et secrets des choses naturelles : bien entendant comme la fréquentation et hantement des hommes résistent à telle profession. D u FAIL, Contes d'Eutrapel, 35 (II, 221). Hanter (trans.). Pratiquer. — Ledit roy Tros
hanta fort les armes... Et eut une guerre par mer contre Jupiter troisième de ce nom, roy de lisle de Crète. L E M A I R E D E B E L G E S , Illustr., I, 17.
(Intrans.). Aller souvent, se trouver habituellement. — Les autres disent... qu'un autre Py-thagoras... vint en Italie, là ou il hanta autour de N u m a , et luy aida à gouverner et ordonner son royaume. A M Y O T , Numa, 1. — Il commencea bien tard à hanter en la ville et à gouster les façons de faire de Rome. ID., Marius, 3. — Encore se déposa il luy mesme vouluntairement de son estât de dictateur... hantant comme personne privée parmy les autres citoyens en la place. ID., Sylla, 34.
Hanter avec. Vivre habituellement avec. — Il estoit obéissant à tous ceulx avec qui il hantoit. ID., Fabius Maximus, 1. Se hanter. Se trouver. — Et seul icy seurement
il se hante. MAURICE SCÈVE, Saulsaye, p. 25. Hanter (subst.). — Puis que tu as l'heur et l'ad-
dresse De servir si belle maistresse, Et de qui tu te peux vanter D'avoir la veue et le hanter. M E LIN D E S1 GELAYS, Chansons, 8.
(Prononc). — Et qu'on doit grandement fuir l'humaine race A qui ne plaist d'hanter la féminine grâce. M A R I E D E ROMIEU, l'Excellence de la femme, p. 31.
Hanteur. Celui qui fréquente. — C o m m e ses barbes morfondus Qui sont demy mors et fondus D'estre senglés parmy les rains, Ses hentours de chemins forains. Sotties, III, 310 et 348. — Les gourmands et hanteurs de tavernes ne demandent que du pourceau, mesmement s'il est salé. G U I L L . B O U C H E T , 15e Seree (III, 103).
Hantise. Fréquentation. — Il advint à ces deux théologiens, dont j'avois quitté la hantise l'espace de trois ans et plus, se ramentevoir de moy. E. P A S Q U I E R , Lettres, XXII, 12.
Relations amoureuses, sexuelles. — Et disent les poètes que, pource qu'Anchises se vanta davoir eu hantise avec ladite déesse Venus, elle le priva de la veue. L E M A I R E D E B E L G E S , Illustr., I, 17. — Muleasses roy de Thunes... reprochoit la mémoire de Mahomet, son père, de sa hantise avec les femmes, l'appellant brode, efféminé, engen-dreur d'enfants. M O N T A I G N E , II, 8 (II, 82). — Solon... ne taxe qu'à trois fois par mois cette hantise conjugale. ID., III, 5 (III, 334).
Hape-gibet, Hapelopin, Hapelourde, v. Happe-gibet, Happelopin, Happelourde.
Hapelourde. Trompé par l'apparence? — Tant qu'ainsi par des vains objects hapelourde, Il ne saurait pas vivre autre que débordé. Les Fanfares des Roule Bontemps, p. 27.
Happe. Crochet, attache. — Quatre coupples de happes mises aus gamions. 1553. Compt. de Diane de Poitiers, p. 146 (G.). — Seize appes em-ploiees aux essieulx desd. gamions. 1556. Ib., p. 155 (G.). — Si on a coupé et emporté toute la
17
H A P P E B O U R S E — 438 —
bourse, il faut joindre les bords de la playe, les approchant avec des happes ou crochets. D A -LESCH., Chir., p. 195 (G.). — Ni les happes ni Peguille ne demandent aucune violence faicte aux parties qu'elles joignent et approchent. ID., ib., p. 614 (G.).
Happebourse. Voleur de bourses. — Depuis que nos couppebourses ou happebourses se sont frottez aux robbes de ceux d'Italie... on a bien veu d'autres tours d'habileté qu'on n'avoit ac-coustumé de voir. H. E S T I E N N E , Apol. pour Her., ch. 15 (I, 212). H a p p e foye. Sorte d'oiseau de mer. — Parmi
la pescherie nous eûmes aussi le plaisir de voir prendre de ces oiseaux que les mariniers appellent happe foyes à cause de leur avidité à recueillir les foyes de morues que l'on jette en mer. M A R C LES-
CARBOT, Hist. de la Nouv. France, II, 510 (G., Compl.). Happe-gibet. H o m m e dont la destinée est
d'être pendu. — Brigand. Voleur, homicide... hape-gibet. M. D E L A P O R T E , Epithetes, 57-58. — Meurtrier. Inhumain, assassineur... pendart, happe-gibet. ID., ib., 265 v°. Happe happe (jouer de). Voler, dérober. — Car en jouant de happe, happe, Blandiz les gens, et puis les frappe. G R I N G O R E , les Folles Entreprises (I, 112). Happelopin. Celui qui happe les morceaux, parasite. — Trouvez vous y aussi, menestriers, Hapelopins, macquereaux, couratiers. R. D E COLL E R Y E , Cry pour l'abbé d'Auxerre. — Vêla la fin de mocqueurs et farseurs, Happelopins, oyseux et gaudisseurs. Six dames de Paris à Cl. Marot, dans Marot, édit. Guiffrey, III, 137. — [Les fouaciers] les oultragerentgrandement, les appellans... hapelopins, trainneguainnes, gentilz flocquetz. RABE L A I S , I, 25. — Gueux de l'hostiere... happe-lopin. D E S A U T E L S , Mitistoire barragouyne, ch. 5. — Il en devint coquin, endebté au valable Par tout chez les marchandz, pour tenir tousjours table A ces happelopins. FR . H A B E R T , trad. d'HoRACE, Satyres, I, 2, Paraphrase. — Parasite. Escornifleur, blandissant, flatteur... happe-lopin. M. D E LA P O R T E , Epithetes, 301 v°. — Du cercheur de repue franche, ou qu'il y a un art de happelopins. (Titre). F. BRE T I N , trad. de LUCIEN. — Le happelopin tout soudain aquiert une heureuse foison de vivres, dez aussi tost qu'il a commencé son art. ID., ib., Du cercheur de repeue franche, 14. — Tous autres et quelconques frères happelopins de prestres, curés, chanoines, protonotaires, chap-pelains, moines. P H . D E M A R N I X , Differ. de la Relig., I, i, 2. — Aux filtres hauts et honorables Des happelopins et flatteurs. L A R I V E Y , les Tromperies, I, 3. — (Fig.). Les autres [péchés] ne sont que petits happelopins foireux, c'est à dire péchez légers, journaliers et véniels. P H . D E M A R NIX, Differ. de la Relig., II, iv, 17. Sycophante. — M a vraye richesse, que ny le
flateur blandissant, ny le happelopin menas-sant... ne me sçauroient oster. F. BR E T I N , trad. de LUCIEN, Timon, 36. Happelopiner. Faire le parasite. —Lopiner, n'est-ce point alimenter et paistre? — Ouy vraye-ment. — C'est donc chose toute notoire que parasiter et happelopiner n'est autre chose. F. B R E TIN, trad. de LUC I E N , DU cercheur de repue franche, 60. Happelourde. Fausse pierre précieuse (au propre ou au figuré). — Il m'a voulu engeoller I
d'une happelourde qu'il m e vouloit faire croire estre un ruby de trente escus ; mais je m'asseure qu'il ne sçauroit valloir trois sols. LARIVEY, les Esprits, III, 5. — Je ne mets point en œuvre'des pierres fausses et contrefaites, ny des hapelourdes comme plusieurs, ains des vrais diamans, rubis et esmeraudes prises dans le sacré cabinet de l'Escriture. D u B A R T A S , lre Semaine, Advertissement. — Je luy fis paroistre comme il s'estoit trompé prenant botte de foing pour fille, regnard pour marte, et hapelourde pour rubis. Supplément du Catholicon, 1, dans Tricotel, édit. de la Sat. Men. II, 20. — Permettons à un chacun de vendre indifféremment doublet et happelourdes avec le dit rubis et diamant. Var. hist. et litt., II, 192. — Puis, se relevant la moustache... pensant éblouir les yeux à tout le monde par l'éclat d'un diamant qui sera quelque happelourde du Palais. Ib,, II, 316. — Il ne falloit point... prendre le faux prétexte de l'oppression des Eglises reformées. C'est une fueille blafarde que l'on met sous une hapelourde pour la faire passer pour diamant. Ib., X, 278. Personne qui n'a qu'une apparence trompeuse.
— Les rodomons et bravaches et belles happelourdes. L'HOSPITAL, Reformat, de la Justice, 5e part. (V, 47). — Il est à craindre qu'este affection volluntaire ne vous face prendre quelque happelourde, au lieu d'ung bon cappitaine. MONLUC, Commentaires, L. V (III, 55). — Tu n'es rien Qu'une rosse fardée ou une hapelourde, Pour tromper, décevoir et bastir une bourde. BOYSSIÈRES, VEstrille et drogue au quereleux pédant, p. 21. — Fay seulement bonne trongne, car tu es une assez belle happelourde, et capable d'en tromper une bien afïettee. D u FAIL, Contes d'Eutrapel, 30 (II, 113). — Se pourroit-il bien faire que madame Louyse fust si despourveue d'entendement que de bailler sa fille à ce capitaine... — Non, non, ne pense pas que ce beau capitaine de trois cuites y puisse jamais parvenir. Vrayement, elle seroit pourveue d'une belle happelourde! T O U R N E B U , les Contens, I, 4. — Allons, Messieurs de Lorraine, avec vostre hardelle de princes, nous vous tenons pour fantosmes de protection, sangsues du sang des princes de France, hapelourdes, fustes evantées, reliques de saincts, qui n'avez ne force ne vertu ! Sat. Men., Harangue de M. a" Au-bray, p. 281-282. — Tel nous baillant pour serviteur Qui n'est autre qu'un crocheteur, Qu'un pipeur ou qu'un apelourde. Les Fanfares des Roule Bontemps, p. 143. — La belle happelourde! il semble un homme de paille, un fantosme, un es-pouvantail de chenevière. LARIVEY, les Tromperies, II, 1.
Objet de qualité inférieure, dont l'apparence est trompeuse. — Le satin qu'on appelle de Bruges est une hapelourde pour ceux qui n'en ont de longtemps manié jamais. H. ESTIENNE, Apol pour Her., ch. 16 (I, 323). — Tout ce qu'il fault apporter pour trafiquer avec ces insulaires, c'est du fer, de la porcelaine, vieilles hapelourdes de peu de valeur, et quelque pièce de taffetas et toile. T H E V E T , Cosmogr., XII, 8. Fausse doctrine, paroles trompeuses. — Combien estoit il nécessaire de ne s'abbandonner pas à ces espritz, et, premier que de les suivre, esprou-ver s'ilz estoyent de Dieu ou non ! Helas, il ne manquoit pas de pierres de touche pour descouvrir le bas or de leurs happelourdes. S' FRANÇOIS D E SALES, les Controverses, part. II, Avant-propos. — Qui sondera au fons de leur doctrine verra clair comme le jour que ce n'est qu'une happelourde saffranee, telle que celle que le diable produisoit quand il tentoit Nostre Seigneur. ID.,
— 4
ib., part. III, Avant-propos. — (La religion, au dire des athées). Ce n'est qu'une happelourde, un plaisant amusement des peuples, occupation des simples, pour extorquer d'eux tel respect et obéissance que l'on veut. C H A R R O N , les Trois Veritez, I, 4. — Ils allèguent l'Epistre liminaire de Calvin en son Institution, qui est une vraye hapelourde pour amuser les simples. ID., ib., III, 2, Adv. — Ils nous veulent introduire leurs songes et inventions, les targuent du voile du Sainct Esprit et de leurs nouvelles inspirations, qui est une vraye happelourde et imposture. ID., ib., III, 14, Adv. — Ce que je trouve de plus abominable aux escrits de ces curieux, c'est que, pour fueilles de leurs hapelourdes et pour mieux rendre plausibles leurs estranges maximes, ils osent se couvrir de l'authorité des pères et patriarches anciens. Var. hist. et litt., 1, 119. D'une manière générale, tout ce qui n'a qu'une
apparence trompeuse. — Cette splendeur escla-tante, cete prospérité riante des meschants est une happe-lourde, une pierre fausse, belle mine à mauvais jeu. C H A R R O N , Discours chrestiens, I, 9. — Quant aux tristesses cérémonieuses et duels publics tant affectez et pratiquez par les anciens... quelle plus grande imposture et plus vilaine hapelourde pourroit on trouver par tout ailleurs? ID., Sagesse, I, 31. — Pour descouvrir et sçavoir quelle est la vraye preud'hommie, il ne se faut arrester aux actions, ce n'est que le marc et le plus grossier, et souvent une happelourde et un masque. ID., ib., II, 3. Happelourdier. Imposteur. — V a donc, res-
veur, yvrongne, rien-ne-vault, Happelourdier, punays, jennin, badault. Ane Poés. franc., X, 12. Happesouppe. Grande cuiller pour servir la
soupe. — Aux portiers je donne ces deux assietes : aux muletiers, ces dix happesouppes. R A B E L A I S , IV, 13. Marmiton ? — Parolle non escrite, grandement
estimée entre les friands happe-souppes et taille-boudins de la cuisine papalle. P H . D E M A R N I X , Differ. de la Relig., I, iv, 16. Happevent. Auvent ? — O n met deux grans
penneaulx de verrière à une happevent en la halle, et on place ix losenghes. 1501. Lille (G.). Happevillain. — 1594. Ces bastons en croix
que nostre interprète n o m m e sautereau, combien qu'en françois se dient happevillain. J. B E S S O N , Théâtre des instrum., fig. 10 (Gay, Gloss. archéol). — 1629. Deux happevillains de fer. Inv. de l'hôtel de Salm. (Gay). Hapsicore (à t'xopoç, dégoûté). — Comment
donc disent ces messieurs qui sont si délicats et si hapsicores? J'ay usé de ce mot en despit de leur délicatesse : que diroyent-ils qu'il sent? H. E S TIENNE, Dial. du lang. franc, ital, II, 195. Haquebute, Haquebutier, Haquebuzier, v.
Hacquebute, Hacquebutier, Hacquebouzier. Hara, v. Haras. Haran. Hareng. Haran soret, v. Soret. (Proverbe). — Mariez vous à la fille d'un mar
chant ou autre du tiers estât, vos enfans auront l'esprit ordinairement tendu à la boutique, finesses et interests ; car la poche sent tousjours le haran. Du FAIL, Contes d'Eutrapel, 1 (1, 86). — Depuis se trouva honoré du titre de conseiller en cour souveraine, combien que la poche sentist tousjours le haran, Naturam expellas furca. ID., s*., 15 (1,207). (Prononc). — Une paouvre femme revande-
HARANGUEUR
resse d'harans. BRANTÔME, Rodomontades espai-gnolles (VII, 21).
Harangier. Pêcheur de harengs. — Et n'y a ne rhyme ne raison en leurs propos, non plus que si des harangiers vouloyent disputer d'astrologie. CAL V I N , Contre les libertins, ch. 4 (VII, 161). Harangue (Prononc). — Et fist son harangue
funerale par le commandement du peuple Hype-rides. S E Y S S E L , trad. de D I O D O R E , I, 4 (8 v°). — A la fin de son harangue. ID., ib., III, 2 (87 v°). — D u commencement de son harangue. ID., Successeurs d'Alexandre, IV, 3 (137 v°). — Ce pastoureau... V a commencer à former de sa langue Une piteuse et lamentable harangue. M A R O T , Complainte d'un pastour. chrest. — Il print son arc, et, desliant sa langue, A ses soldats fit une telle harangue. J E A N D E L A TAILLE, Mort de Paris Alexandre. —- Ainsi que Caton a remarqué en son harangue du douaire. C H O L I È R E S , 2e Ap.-disnée, p. 81. — Caesar n'en fit pas de mesmes... le jour advant la bataille de Farsale, dans l'harangue que Lucain nous représente. B R A N T Ô M E , Cap. estr., le Duc d'Albe (I, 111). — Jacques de Bergamo... a mis par escrit l'harangue que le roy fit ce jour à ceux de son armée. ID., Cap. franc., le Roy Charles VIII (II, 316). — Il l'ouyst en son harangue philosophale. ID., ib., le Roy Louys XI (II, 348). — Commencement de l'assemblée et sommaires d'harangues. A U B I G N É , Hist. univ., II, 24. — Le roi... ne fit pas paroistre en son harangue l'attention à la guerre huguenote qu'il avoit promise. ID., ib., VIII, 6.
Haranguer (trans.). Dire dans une harangue. — Et harangua en plain conseil tout ce qui se peut dire pour le roy de France. B E L L E F O R E S T , Chron. et ann. de France, an 1558 (G., Compl.). Haranguer un propos. Tenir un propos. —
Puis... s'en va au gardien haranguer telz propos. Comptes du monde adventureux, 23 (I, 129).
(Intrans.). Haranguer à. Haranguer, faire un discours à. — Ainsi que Crassus parloit et haren-goit à son exercite. S E Y S S E L , trad. d'AppiEN, Guerre parthique, ch. 1. — Ilz luy décernèrent les dietz honneurs : et envoyèrent leurs messagers en sa maison pour luy harenguer. ID., Guerres civiles, L. VI extraict de P L U T A R Q U E , ch. 1. — Il haranguoit au peuple, séant en son siège royal. ID., Hist. eccles., II, 10 (G., Compl.). — Antipa-ter... menassant les Athéniens d'aller mettre le siège devant leur ville, s'ils ne luy rendoient les orateurs qui harenguoient au peuple contre luy. A M Y O T , Vie des dix orateurs, Démosthène. — Ung certain jour il haranguoit au peuple. L'HOSPITAL, Reformation de la Justice, 3e part. (IV, 192). — Haranguant au peuple et se justifiant contre l'envie des grands. ID., ib., 6e part. (V, 237). — Lucius Martius haranguant à ses soldats en Hes-pagne... fut veu estinceler en feux qui sortirent de sa teste. L E L O Y E R , Hist. des Spectres, IV, 20.
Haranguer (subst.). — Les presens d'Agamemnon, N y le nom Des plus nobles de l'armée, N y leur haranguer si long Ne sceut onq' Donter son ire enflammée. D u B E L L A Y , Au seigneur de Lan-sac (V, 319).
(Prononc). — Je n'ay jamais faict profession d'haranguer. V I G E N È R E cité par H. Estienne, Precellence, p. 62.
Harangueur (H. D. T. 1539). — Nous orateurs et harengueurs, qui prennent si grant plaisir a sçavoir bien persuader, auront loy de monstrer la force de leur éloquence en autres matières de moindre importance. S E Y S S E L , trad. de T H U C Y D I D E , III, 6 (90 r°). — Si telz harengueurs veulent
39 —
HARANGUEUX — 440 —
monstrer leur sçavoir et lelegance de leur langaige. ID., trad. de DIODORE, III, 1 (85 r°).
(Fém.). Harangueuse. — La vaillance ne remue point la langue, mais les mains, n'est point harangueuse, mais exécute. CHARRON, Sagesse, 111,3. Harangueux. Delà nature d'une harangue.—
Oraison. Nombreuse, docte, grave... harangueuse. M. D E LA PORTE, Epithetes, 291 r°. — Sermon. Evangelique, dévot, harangueux. ID., ib., 376 r°.
Haranier. Qui est de la couleur des harengs saurs. — Les frères minimes, haraniers, enfumez. RABELAIS, V, 26.
Haras. Troupeau, troupe. — Voicy, pour renfort de bataille, Des Espaignolz ung grand hara. Ane. Poés. franc., XIII, 27. — Sans le vouloir divin, qui torna le meschef Sur des haras de porcs. FR. H ABERT, trad. d'HoRACE, Satyres, II, 3. Paraphrase. — Pour avoir esté toute sa vie un excellent pourceau de l'haras épicurien. PH. D E M A R NIX, Differ. de la Relig., II, v, 3. De bon haras. De bonne race. — Il ha tousjours
bien faict en sa charge et par tout où il s'est trouvé ; aussi estoit-il de très bon haras. B R A N T Ô M E , Cap. estr., don Garcye de Tolledo (II, 44).
(Prononc). Il avoit avancé son aage par la Visitation qu'il luy convenoit faire de l'haras de ses femmes et concubines. C H O L I È R E S , 4e Matinée, p. 152. Cf. le 3e exemple du 1er alinéa. Harassement. État d'une personne harassée. — De s'esloigner du parc durant l'hiver, mesmes après un si long harassement, il n'y avoit point d'apparence. M A R C L E S C A R B O T , Hist. de la Nouv. France, I, 479 (G., Compl.).
Tracas, tourment. — Plusieurs grands affaires, lesquels donnent plus de troubles et de harasse-ments à ceux qui s'en retirent qu'à ceulx qui y demeurent. A M Y O T , Si l'homme d'aage se doit encore mesler des affaires publiques, 1. Harasser. Harceler. — Encores plus de mal leur faisoient les petitz navires legiers des Syracusains, qui les vendent assaillir et harasser a getz de treetz et de main de tous coustez. S E Y S S E L , trad. de T H U C Y D I D E , VII, 7 (229 v°). — Il mist a lopposite les meilleurs gens de cheval quil eust, non pas pour chocquer les ennemys, mais pour les arasser allant et venant autour de eulx. ID., trad. de D I O D O R E , II, 12 (47 r°). — Les Syracusains doncques vindrent par plusieurs jours de renc harasser le camp des Athéniens tant par mer que par terre, pour tascher à les attirer au combat. A M Y O T , trad. de D I O D O R E , XIII, 4. — Minutius... aussi tost qu'il [Fabius] eut le dos tourné commencea incontinent à harasser les ennemis. ID., Fabius Maximus, 8. — Ce fauls rousseau Porcius aux yeux pers, Qui harassoit et mordoit tout le monde, Pluto ne veult qu'il entre en ses enfers, Quoy qu'il soit mort, de peur qu'il ne luy gronde. ID., Caton le Censeur, 1. — Ilz [les Parthes] ne pouvoyent pas seulement résister aux Arméniens qui les harassoyent. ID., Lucullus, 36. — Pompeius, se trouvant ainsi rebutté et harassé au sénat, fut contrainct de recourir aux tribuns du peuple. ID., Pompée, 46. — A force de harasser les Achaeïens et les provoquer hardiment, il les contraignit à la fin de venir à la bataille. ID., Cléomène, 14. — Socrates montoit... vers la maison d'Andocydes, interrogant par le chemin tous-jours, et harassant de questions Eutyphron, par manière de jeu. ID., De l'esprit familier de Socrates. — M. le daulphin, ayant laissé M. le mareschal du Biez à Montmeil pour harasser Bou- i
logne, alla trouver le roy. M O N L U C , Commentaires L. II (I, 306). — Les plus grands et la plus part de' la noblesse, se voyant ainsi harassez par ces deux exécuteurs des entreprises de ceux de Guise, prindrent les armes pour la conservation de leurs personnes, de leurs femmes, enfans, biens et possessions, et pour la religion. R É G N I E R DE LA P L A N C H E , Hist. de l'Estat de France, I, 194. — I] court à toute bride ; aussi qui veult chasser Et prendre un cerf bien tost, il le fait herasser Des bons chiens de la meute. CL. G A U C H E T , le Plaisir des champs, l'Esté, Chasse du cerf, p. 190.— [Courtisans] si harassez par les usuriers qu'ils ne le seroyent pas davantage en galère. L A N O U E , Disc. polit, et milit., VIII, p. 193. — Ils eurent beaucoup de maux à passer le Périgort, surtout à la Dordongne, harassez de communes et de petites garnisons, qui leur assommoient tousjours quel-cun. A U B I G N É , Hist. univ., V, 20.
Harassier. Celui qui prend soin d'un haras. — C o m m e Eumenes, en passant au long du mont Ida, ou estoit un des haras du roy, en eut pris et emmené des chevaux autant qu'il en voulut, et en eust envoyé une lettre patente de certification aux harassiers et escuyers qui en avoyent la charge, Antipater... s'en prit à rire. A M Y O T , EU-mène, 8.
Harats. Amas, trousseau. — Lors que nostre Seigneur Jésus Christ livroit entre les mains de l'Eglise romaine la maistresse clef du royaume des deux, il luy donna quant et quant un gros harats et pendant de six clefs, avec lesquelles elle rece-voit plaine et absolue puissance et authorité d'ouvrir et serrer tous les buffets, coffres, bahus et armaires de la S. Escriture à sa fantasie. PH. DE M A R N I X , Differ. de la Relig., II, i, 1.
Harau, v. Haro. Harauder. Crier haro sur, attaquer. — S'il y
a aucun lequel, n'estant gradué riere vostre faculté, veuille attenter des cures en l'enclos de vos destroits, vous le haraudez. CHOLIÈRES, 2e Matinée, p. 70. — A la court ordindrement on a de coustume de faire la guerre aux jeunes gens au commancement de leur advènement, et les har-celler et harauder. B R A N T Ô M E , Couronnels franc. (VI, 144). — Vous les verrez crier, hurler après eux, et les harauder sans en espargner aucun. ID., des Dames, part. II (IX, 527).
Blâmer. — Quant mesmes vous ne vous mes-prendriez en la signification du nom de coelicole, si est ce que vous seriez à harauder de ce que vous voulez que nos astrologues adorent le ciel. C H O L I È R E S , 8e Ap.-disnée, p. 334.
Harbelestier, Harberier, \.Arbalestier,Ar-brier. Harce. Herse. — Je feray une gaigne à harce
A ne Poés. franc., I, 87. — Si demourerent Daphnis et Nape ensemble sur Paire, et en chassant les bœufz en rond avec les harces faisoyent sortir le bled hors des espiz. A M Y O T , Daphnis et Chloé, L. III, 58 v°.
Herse d'une porte fortifiée. — Elle apperceut ouvrir la porte du donjon et saillir un chevalier armé... après lequel l'on laissa abaisser une harce et fermer l'huis. Amadis, 1, 1. — Aussi tost leur fauldra abaisser la harce de la porte. Ib., III, 6. •— Hz n'eurent moyen d'y pourveoir, ains feurent le pont levys et les harses entièrement embrazées. Ib., V, 29. — Elle... s'enfouit dedans la sépulture qu'elle avoit fait bastir, là ou elle feit serrer les portes et abbatre les grilles et les harses qui se fer-
' moyent à grosses serrures et fortes barrières.
— 441 — HARDEMENT 1
AMYOT , Antoine, 76. — Portes... fortifiées de barrières traversantes et de harses coulisses. ID., Propos de table, VII, 5.
Harce gaye, v. Azagaye.
Harceler. Herselé. Rompu à la dispute. — Ce que est la vraye diète prescripte par l'art de bonne et seure medicine, quoy qu'un tas de ba-daulx medicins herselez en l'officine des sophistes conseillent le contraire. R A B E L A I S , I, 23. (Prononc). 1° Or sois te le très bien venu, Et
ne t'en vas, qui que t'harcelle. D E S P É R I E R S , De l'appétit recouvert. 2° U n cinge en une famille est tousjours moc-
qué et herselé. R A B E L A I S , I, 40. — Comment estimeriez vous bien Que je ne sois fille de bien, Pour m'avoir ainsi hercelee? V A U Q U E L I N D E L A F R E S NAYE, Idillies, II, 54. Cf. le 1er alinéa.
Harceleur. Celui qui harcèle. — Et toutesfois qu'il soit fort courageux, Impugnateur, harceleur, oultrageux, Ce nonobstant ne pourra il durer A maintz effortz survenans endurer. D E S P É R I E R S , Des quatre princesses de vie humaine (I, 127). Querelleur, chicaneur. — Les autres plaideurs
harseleurs, Cavilleux, hoqueleux, brouilleurs. E. D A M E R V A L , Livre de la deablerie, 58 b (G.). — Advocasseau. Turbulent... malin, effronté, adaïeur, i. harceleur. M. D E L A P O R T E , Epithetes, 1 v°. — Harceleur. Chiquenneux, processif. ID., ib., 203 v°. — Plaidereau. Chicaneur... adaïeur, i. harceleur. ID., ib., 325 r°.
Harceleux. Chicaneur. — Toi qui plaideux etharceleux, Aussi nourriceulx de procès, Hantes aussi et tous broulleux, Tes besongnes pas bien ne fais. Ane Poés. franc., II, 51. — Negotiateur. Diligent, factieux, actif... harcelé ou harceleux. M. D E LA P O R T E , Epithetes, 278 v°. Plein de chicane. — Tirade. Violente, aspre,
viste, roide, harceleuse. ID., ib., 401 v°. Harcellement. Action de harceler. — Avecques moy pour s'y rendre il s'avoie... Non meu de luy : mais comme forcément Estant esmeu de mon harcellement. P. D E B R A C H , Imitations, Aminte, III, 1. Harconnier. Que l'on met à l'arçon de la selle. — Pistole ou Pistolet. Meurtrière, enflam-bee... harsonniere. M. D E L A P O R T E , Epithetes, 324 r°. — Maie. Pesante, grosse... hardeux, har-çonniere. ID., ib., 251 v°. Hardage. Hardes, bagage, divers objets. — Ilz trouverront encores céans tout ce qu'il leur feut esté : les chevaliers leurs chevaulx et armes... et les dames leurs pallefrois et hardaige. Amadis, V, 25. —- Les pauvres gens de la ville de Paris, et aultres qui avoient meilleur moyen, furent contraints de brusler leur menuiserie de laquelle ilz avoient le moings à faire, comme tonneaulx, vieilles couches, meschants coffres et aultre hardage. H A T O N , Mém., an 1565 (G.). Harde 1. Troupeau. — Beaucoup mieux il vaudrait De harde entière ici sept bouveaux ores Sacrifier, et sept brebis encores. D E S M A S U R E S , Enéide, VI, p. 267. — Tyrrhus... Qui du roial bestail en mainte harde Estoit le maistre : et qui avoit la garde De la campagne, en païs large et loin. ID., ib., VII, p. 360. — Il avoit cinq troupeaux De bergerie : et des pastis ses gardes De gros bestail lui ramenoient cinq hardes. ID., ib., F" 3+6i'-— Tel fut J'eufaut prodigue quand, quittant l'infâme compaignie ou la harde des por-ceaux entre lesquelz il avoit vescu, il vint es bras
de son père. S* F R A N Ç O I S D E S A L E S , Amour de Dieu, X, 4.
^ Harde 2. Le mot peut désigner toutes sortes d'objets. — Vivres, artillerie, munitions, robbes, deniers et aultres hardes. R A B E L A I S , III, 49.
On trouve aussi kardre. — Elle prit tous les papiers, hardres et meubles de son mary. C H O L I È R E S , 6e Matinée, p. 228. Harde 3. Échange. — Que ne prend il envie à quelqu'une de faire cette noble harde socratique du corps à l'esprit, achetant au prix de ses cuisses une intelligence et génération philosophique et spirituelle, le plus haut prix où elle les puisse monter. M O N T A I G N E , III, 5 (III, 390). Hardé. Muni, pourvu. — Ilz ouyrent les Vin-dellois, qui sen venoyent bien hardez et fasquez. D u FAIL, Propos rustiques, ch. 10, p. 80. — Equipage. Fourny... ample, eousteux, hardé ou hardeux. M. D E LA P O R T E , Epithetes, 160 r°. Hardeau. Garçon. — Luy ennuya avoir ung tel fardeau. S'en despescher bien vouloit le hardeau. B O U R D I G N É , Pierre Faifeu, ch. 41. — J'ay un aultre hardeau (ainsi appellent-ilz aux champs un garson, et une garce une hardelle). D E S P É RIERS, Nouv. Récr., 15. — Il eut un filz n o m m é Tenot Dendin, grand hardeau et gualant home. R A B E L A I S , III, 41. — Il se faisoit des fileries qu'ils appellent veillois... où se trouvoient de tous les environs plusieurs jeunes valets et hardeaux illec s'assemblans. D u FAIL, Contes d'Eutrapel H (I, 163). Hardelle. Fille. — Mais attendons Perronnelle...
C'est une bonne hardelle, Elle chante jolyment. Noëls nouveaux, dans Gasté, édit. de J. Le Houx, p. 215. — La hardelle au cœur dédaigneux Jette son ongle egratigneux Sur Tenot, sa gorge et sa face. V A U Q U E L I N D E L A F R E S N A Y E , Idillies, 11, 40. — Voicy bon sidre nouveau... Si j'en beuvois souvent, Faudrait la hardelle. J. L E Houx, Chansons du Vau de Vire, I, 64. — Pour n'avoir daigné, en tenant aux prairies de Chasteau-le-tard, respondre aux chansons que les hardelles de Ro-lard disoient de l'autre costé. D u FAIL, Contes d'Eutrapel, 11 (I, 167). — Je te renvoiray bien aux champs et aux moutons... Tu n'estois rien sans moy qu'une simple hardelle, Et je t'ai faict porter l'habit de damoyselle. S O N N E T D E C O U R -VAL, Sat. Men. contre les femmes, dans Gasté, édit. de J. Le Houx, p. 215. Hardelle 1. Troupeau. — (Fig.). Allons, Messieurs de Lorraine, avec vostre hardelle de princes, nous vous tenons pour fantosmes de protection. Sat. Men., Harangue de M. d'Aubray, p. 281.
Hardelle 2, v. Hardeau. Hardement i. Hardiesse. — Laquelle chose jay attemptee de propre presumptif hardement, car je congnois m a faculté trop basse pour satisf-faire à la dignité de si haulte besongne. L E M A I R E D E B E L G E S , le Temple d'Honneur et de Vertus (IV, 190). — Le tresbon et tresbenin facteur et père de tout le monde resveilla en Occident une maison et famille illustre, comme celle des Macabees, qui eut le pouvoir et hardement de garder son peuple destre honni et contaminé de la loy des mescreans. L E M A I R E D E B E L G E S , Illustr., III, 3 (II, 463). — Noblesse vient premièrement Des gens tenant foy et promesse, Qui en eulx eurent hardement, Force, loyaulté et prouesse. Ane. Poés. franc., XII, 81. — Jurement de Normant, Bave de Picart, Hardement de Lombart... Confession de béguine, Tout ne vault une poitevine.
HARDEMENT 2 — 442 —
Ib., VI, 197. — Accompaigné ne suis pas seulle-ment De ducz, de roys, de princes valeureux, De chevaliers de très grant hardement. Ib., IV, 197. — Themistocles... fut le premier qui eut le hardement de dire aux Athéniens quil failloit dominer la mer. S E Y S S E L , trad. de T H U C Y D I D E , I, 11
(27 v°). — Entre lesquelz en y eut ung qui eut le hardement de luy dire quil estoit de nécessité ormais quil se rendist a la volunté de Seleucus. ID., Successeurs d'Alexandre, IV, 10. — Voicy ung paisant de villaige... Ung h o m m e de bon hardement. Ane. Poés. franc., XIII, 26. — O n le congnoist, et voit on en mains lieux Pour sa beauté, sa force et hardement... Cest Cupido, filz de Venus unicque. M I C H E L D ' A M B O I S E , les Cent Epigrammes, 48 r°. — Tant ne craindray lhor-reur de ce passaige Que je ne mette hardement et couraige Pour parvenir si je puis bonnement A celle avoir que jayme tellement. ID., Com-plainctes, 123 v°. — Ne audace ne hardement luy deffailloit. D E R O Z I E R S , trad. de D I O N CASSIUS, Hist. rom., L. X X X V I I , ch. 4 (4 r°). — [Gabi-nius] entra la nuict en la cité, et n'eut hardement de partir hors Italie par bonne espace de temps. ID., ib., L. X X X I X , ch. 21 (38 r 0 ) . — Anthoine... voyant qu'il ne rencontrait aucun barbare suspecta pour ce qu'ilz se fussent mis en fuyte, et de ce print hardement. ID., ib., L. X L l X , ch. 73 (161 r°).
(En mauvaise part). Effronterie, impudence. — Le hardement et peu de honte... ne se doit remédier sinon par griefve punition. B. D E L A GRI S E , trad. de G U E V A R A , l'Orloge des princes, I, 36. Hardement 2. Hardiment. — Quand on verra un h o m m e qui jure en table et en rue, on luy pourra dire hardement : Mon amy, non seulement tu abuses du nom de Dieu, mais tu es parjure quand le nom de Dieu est ainsi profané en ta bouche. CALVIN, Serm. sur la Genèse, 3e de Melchisedec (XXIII, 679). Harder. Troquer, échanger. — O ! que de bon cueur mes livres harderois Pour les escotz ou tu serais, Gentil breuvage ! J. L E H O U X , Chans. du Vau de Vire, II, 23. — Ils hardent fort heureusement, et couvrent fort bien le vice d'un cheval. Var. hist. et litt., VIII, 178. — Bouillon propose à tous ces grands le dessein de s'emparer de la cour, en tuant Ancre, lequel ayant hardé la lieute-nance de roy de Picardie et citadelle d'Amiens avec celle de Normandie qu'avoit Montbazon, il s'estoit encores réservé le gouvernement de Pe-ronne, Mondidier et Roye. S U L L Y , Œcon. roy., ch. 227 (G.). Hardeux. Contenant des hardes. — Bagage. Enfardelé... pacqueté, hardeux. M. D E L A P O R T E , Epithetes, 43 r°. — Équipage. Fourny... ample, cousteux, hardé ou hardeux. ID., ib., 160 r°. — Maie. Pesante, grosse... maniable, hardeux. ID., ib., 251 v°. — Parquet. Troussé, onéreux, chargé ou chargeant... hardeux. ID., ib., 301 r°. Hardi 1. (Prononc.). — Il fait avoir à l'hardy la victoire. Rimes de P. D E L A V A L , p. 89.
Petite pièce de monnaie valant un liard. — Les quatre quartiers et la teste Ne cousteront que deux hardis. Ane Poés. franc., XII, 159. — Quand j'ay mangé cela [une poire cuite] et beu une jaste de vin (qui vault loyaulment la pinte de Paris), avec un pain d'un hardy, je m e trouve aussi bien de cela comme si j'avois mangé toutes les viandes du monde. D E S P É R I E R S , NOUV. Récr., 57. — Marché faict a sis ardicts pour tour de charrette. 1562. Arch. Gironde (G.). — A neuf
ardietz la livre [de chandelle]. Ib. — Il se mit en dispute avec un pauvre forçat qui lui demandoit un hardit. A U B I G N É , Faeneste, III, 6.
Le mot s'emploie souvent dans le sens de très peu de chose. — Ces chevaliers estoient si très-hardis Que de leur vie ne donnoyent deux ardiz, A ne Poés. franc., X, 237. — Au temps qui court tu ne vaulx ung hardy. J. B O U C H E T , Epistres familières du Traverseur, 22. — Il fit demourer à coucher un mareschal de camp huguenot, qui le lendemain au partir, boyant qu'on ne donnoitpas un hardit à l'hoste, fut vien simple de payer. AUB I G N É , Faeneste, TV, 6.
(Jeu de mots). — Il y a longtemps que j'ay leu la valeur des monnoies... Une portugaise vaut deux espagnoles... un hardy deux couards. TAB O U R O T D E S A C C O R D S , les Bigarrures, I, 6.
Hardi 2. Variété de poire. — La poire du printemps... de hardi, de pucelle. O. D E SERRES, Théâtre d'agric, VI, 26. Hardier 1. Enhardir. — L'humilité de ta
digne personne, A u tien sçavoir bien séant et consonne, M a hardie de te faire présent Du mien labeur. J. B O U C H E T , Epistres familières du Traverseur, 46. — Si mon esprit et plume tant j'har-die Que par escript et museyn art die A vous, monsieur, ce que pense m on cueur, Ne le prenez, si vous plaist, a rigueur. ID., ib., 111.
Hardier de, à. Enhardir à. — Ce démon estoit une ardeur desprit vive et gaillarde, qui faisoit entreprendre à Socrates ce que les philosophes ses devanciers n'avoient jamais excogité, qui le har-dioit en toutes compagnies de dire son advis, non moins que Pallas hardioit Telemaque à parler devant le vieillard Nestor. L E L O Y E R , Hist. des Spectres, IV, 17.
Se hardier. S'enhardir. — Vous suppliant, illustre et haulte dame, Que l'acceptez, et que n'encoure blasme Si moy pauvret si tresfort je m'hardie Que de mon bien ce petit vous dédie. J. B O U C H E T , Epistres familières du Traverseur, 95. — Tant s'hardia m a trépide simplesse Qu'elle ausa bien à vous tous destiner Une epistolle. ID., Epistres morales du Traverseur, II, 4. — Le jeune h o m m e à ceste prière devint perplex et estonné à bon escient, ne sçachant que dire ou que faire ; mais en fin prenant courage et se hardiant, deslie sa langue. L E L O Y E R , Hist. des Spectres, III, H. — Le religieux esbahy eut soupçon que c'est une vision, et, se hardiant un peu, demanda à ces chevaliers et soldats qui ils estoient. ID., ib., VII, 16.
.Se hardier de, se hardier. S'enhardir à, avoir la hardiesse de. — La quelle chose ne pouvés bonnement dire en langage latin, si vous ne vous har-diez de dire illatabilis. G. T O R Y , Champ fleury, L. II, Il r°. — Je ne vous puis plus celier une pensée que j'ay sur le cueur, vous suppliant qu'elle ne vous soit desplaisante, si tant je me hardie la vous desclairer. J. B O U C H E T , la Noble dame, 67 r° (G.). — M e pardonnant si par trop je m'hardie De te rescrire, et si lettre dédie Si familière a toy, bien méritant Avoir d'honneur cent mille fois autant. ID., Epistres familières du Traverseur, 108. — Le doys je escrire, attendu le canon Qui le défend? il semblerait que non, Mais je suis clerc tonsuré, qui m'hardie En charité a en faire tragédie. ID., Epistres morales du Traverseur, 1,1.
Hardier 2. Se hardier. Se mettre en embuscade. — Pour le fait tost expédier, Il nous conviendra hardier Et mettre nostre frère à mort, A quelque coing. Ane Théâtre franc., III, 107.
Hardiesse. (Prononc). — C'est soubs couleur
de justice, de prudence, d'hardiesse. SEYSSEL , Hist. de Louys XII, Proesme. — N y de mon luth argentin les passages harmonieus, fredonnez d'hardiesse. P H . B U G N Y O N , Erotasmes de Phidie et Gélasine, sonn. 62. — Ce n'estoit pas faulte d'hardiesse. M O N L U C , Commentaires, L. VII (III, 278). — En m'ostant l'hardiesse et l'heur de contempler. J. D E BOYSSIÈRES, Prem. Œuv., 65 r°. — A grand peine a-il eu l'hardiesse, o mon père, De te venir monstrer tant de calamité. ID., Trois. Œuv., p. 57. — Il y a plus de braverie en son fait que d'hardiesse. T O U R N E B U , les Contens, III, 1. — Si je ne craignoie que mon hardiesse vous desa-greast. CHOLIÈRES, 4e Ap.-disnée, p. 138. — Ce n'est pas peu d'hardiesse attacquer les monarques. P. M A T T H I E U , Aman, IV, p. 105. — Ce tyran toutesfois, m'allumant d'hardiesse, M e fait idolâtrer une belle princesse. ID., Clytemnestre, II, p. 7. — Si Dieu me donne la capacité et l'hardiesse de parler à la royne m a mère. M A R G U E R I T E DE VALOIS, Mémoires, p. 16. — La fortune... est journallière en l'hardiesse aussi bien qu'en la pusillanimité. B R A N T Ô M E , Cap. estr., Barthélémy d'Alviano (II, 192). — Il monstra belles preuves de son hardiesse. ID., Cap. franc., M. d'Aussun (IV, 7). Hardillon. Ardillon. — De cuissots escaillez ses cuisses il garnit Liez de hardillons et de boucle argentine. A M . J A M Y N , Iliade, XVI, 75 v°. Hardiment 1. Hardiesse.— Dont procède tel hardiment à m a petitesse... que de dédier et intituler à vostre sacrée et tresredoutee majesté la lecture de ceste mienne petite œuvre...? L E M A I R E DE BELGES, Schismes et Conciles (III, 231). — Comment Auray je en moy le cœur ny hardiment De reculer à son commandement...? D E S P É RIERS, l'Andrie, I, 5. Hardiment 2 (adv.). Avec certitude. — Et hardiment croyez qu'il n'y eut petit ne grand dedans Paris qu'il ne se trouvast au lieu. R A B E L A I S , II, 18. Certainement. — Hardiment il y aura de bien
chauffez si le fornier ne s'endort. ID., Pantagr. Prognost., Au liseur. — Vous aultres, qui aymez le vin... sy me suyvez : car hardiment que sainct Antoine me arde sy ceulx tastent du pyot qui n'auront secouru la vigne. ID., Gargantua, 27. — Hardiment, il ne s'en fera rien, puisque vous ne l'avez pas voulu croire. D E S P É R I E R S , Cymbalum, Dial. I (I, 326). — Il l'a eschappée belle... — Hardiment I il a eu belle vezarde. F R . D'AMBOISE, fes Neapolitaines, III, 6. Hardiment que. Certainement. — E n ce point
entra en la salle ou l'on banquetoit, et hardiment qu'il espoventa bien l'assistance. R A B E L A I S , II, 4. — De nostre cousté nous ne vous fauldrons. Et hardiment que je vous en tueray beaucoup. ID., Hardine. Sable, gravier. — Aucuns buissons et roueusses estent dans les hardines des fosses. 1509. Péronne (G.). Hardir. Enhardir, exciter. — Faut prendre tous les vieux bassets et les coupler ; puis laisser aller les jeunes, les hardissant, en terre, en criant : Coule à luy. L I E B A U L T , Mais, rust., p. 807 (G.). — Ces gens icy... hors leur enthusiasme, estoient les plus sages et tempérez du monde... et n'entraient point aussi en furie qu'au son de la fleuste phrygienne qui les excitoit et hardissoit contr'eux mesmes. L E L O Y E R , Hist. des Spectres, VIII, 3. •Se hardir. S'enhardir. — Les Arabes avoient
HARER
leurs cymbales par lesquels ils se hardissoient. ID., ib., II, 5.
Se hardir de. S'enhardir à, avoir la hardiesse de. — Pour s'estre hardy d'un peu le regarder, j'en suis chastié. B O Y S S I È R E S , Prem. Œuv., 53 v°.
Hardi. Enhardi. — Ceux de Same, hardis par son absence, Ne redoutent le fer de sa guerrière lance. J. D E C H A M P - R E P U S , Ulysse, II, p. 24.
Hardistesse. Hardiesse. — [Biblis] n'eut la hardistesse de se descouvrir par paroles propres, mais escrivit son inconvenable désir. A. SEVIN, trad. de B O C C A C E , le Philocope, L. V, 112 r°.
Hardit, v. Hardi.
Hardot. Sorte de crochet. — Le cheval à bas ou à pouel doibt 2 den. Et s'il maine à hardotz, dont qu'il soit, doibt un den. 1581. Tarif et péage du marquisat de Nesle (Gay, Gloss. archéol).
Hardre, v. Harde 2.
Hardré. Qui n'a pas de coquille. — La trop grasse ou qui a le flux de ventre fait l'œuf hardie. L I E B A U L T , Mais, rust., 1, 15 (G.).
Hardy, v. Hardi.
Hare, v. Harer.
Haré. Hâlé. — D'autres ont la chair d'oyson ou d'estourneau plumé, harée, brodequinée, et plus noire qu'un beau diable. B R A N T Ô M E , des Dames, part. II (IX, 264).
Harekelt. — Là les estrangers receurent le harekelt des deniers qu'avoyent fourni volontairement les princes allemands. A U B I G N É , Hist. univ., III, 12. Note de l'éditeur : Droit de passage payé en argent.
Harengue, Harenguer, Harengueur, v. Harangue, Haranguer, Harangueur.
Harennier. — Tels vendeurs [de garum] estoient nommez cetarii, qui n'ont encor gaigne aucun nom françois, qui ne les vouldroit nommer harenniers. B E L O N , Singularitez, I, 75 (G.).
Harer (trans.). Lancer, exciter. — Voyez l'astre veneur, qui du loup suit la trace, D u lièvre et du chevreuil, ne cessant de crier, Harlou, har-lou, à route, or' flattant son limier, Or' harant son braquet, qui parmi ses valees Poursuit en clabau-dant les ourses estoilees. J. D U C H E S N E , le Grand miroir du monde, L. IV, p. 121.
Chasser. — Toutes les foys que l'on nous trouve en la cuysine, on nous hue, on nous hare, on nous menace, on nous chasse. D E S PÉR I E R S , Cymbalum, Dial. IV (I, 370). Harer à. Lancer contre, exciter contre. — S'il
vient quelque mutin... Qui te face hutin Pour avoir ton butin, Prens fourche, houe et pic... Hare-luy ton mastin, Et luy donne ung tatin Soudain, sans dire pic. Ane Poés. franc., VIII, 88. — Et le varlet lors respondit... Sire, voulen-tiers le feray, Et voz chiens luy hareray. Alors le varlet, sans attendre, Alla aux chiens courant les prendre, Et les hare appertement Sur le ladre moult asprement. Ane Théâtre franc., III, 269.
(Intrans.). Harer. Donner la chasse. — A toutes gens abbayer et harer. H A U D E N T , Apologues d'EsoPE, I, 159. — Le Grand Grédil, qu'on dit le trou, Nourrist chiens pour harer au loup. Ane Poés. franc., XI, 79. Haré. Poursuivi. — [Hebre] Caut d'une flesche
certaine A bien darder au travers D'un haré troupeau de cerfs Brossants esmeus par la plaine. Luc D E L A P O R T E , trad. d'HoRACE, Odes, III, 12. Hare, cri pour exciter. — O hare, mastin, hare
13 —
HARGNE 1 — 444 —
hare, Apres, après, après, après. Act. des Apost., vol. II, 181 c (G., Haler). — Ils sont comme des chiens qui abbayent, ils crient, harre, harre, après. CA L V I N , Serm. sur le Deuter., 12 (XXVI, 22).
Hargne 1. Querelle, débat. — Il proposa comment que ce fust de se tirer hors de ces espines pour éviter les hargnes, plaintes et querelles de ses citoyens. A M Y O T , Solon, 25. — Il y a quelquefois de petites hargnes et riottes souvent répétées... lesquelles par succession de temps engendrent de si grandes aliénations de vouluntez entre des personnes qu'elles ne peuvent plus vivre ni habiter ensemble. ID., Paul Emile, 5. — Il y avoit tousjours entre ces deux citez, à cause de leur voisinage, quelques hargnes et quelques querelles à demesler. ID., Démosthène, 17. — Débats, controublemens, hargnes et jalousies. J O D E L L E , les Amours, Autre chapitre d'amour (II, 40). — Mais combien ces docteurs par leurs hargnes malignes Avoyent peu l'Evangile et forcer et fausser. ID., Contre les ministres de la nouvelle opinion (II, 138). — Des courroux nous en avons plus que tous les jours, qui engendrent des hargnes et riottes. A M Y O T , Comment il faut refréner la cholere, 11. — Il y a d'autres hargnes dont il se faut donner garde entre les frères qui sont de pareil aage, ou bien peu esloignez l'un de l'autre, lesquelles passions sont petites, mais continuelles et en grand nombre. ID., De l'amitié fraternelle, 16. — Ceulx qui ne peuvent supporter les premières hargnes et riottes des filles ressemblent proprement à ceux qui quitteraient la grappe de raisin à un autre, pour autant qu'ils l'auraient veue qu'elle n'estoit que verjus. ID., les Préceptes de mariage, 2. — Aussi y a il quelquefois de petites hargnes et querelles quotidianes et continuelles entre le mary et la femme, que ceux de dehors ne voient ny ne cognoissent pas. ID., ib., 22. — Les femmes ont... bien souvent de petites hargnes et querelles alencontre de leurs domestiques, servans ou servantes. ID., Demandes des choses romaines, 9. — Leurs hergnes et leur malignité... foulent aux pieds les grâces et douceurs mesmes de Venus. M O N T A I G N E , III, 5 (III, 333). — N'y oyt-on pas journellement les crieries des maistres contre leurs valets... les hargnes et débats des maris et des femmes...? D u V A I R , Ouvert, du Parlement en oct. 1607, p. 834.
Désagrément, chagrin, malheur. — (La toux). C'est une tresmauvaise hargne. R. D E C O L L E R Y E , Complaintes, 1. — Il y a plusieurs telles hargnes secrettes en ceulx qui sont riches... que le vulgaire ne cognoist pas. A M Y O T , De la tranquillité de l'ame et repos de l'esprit, 11. — Mieux vaut mourir faisant espargne Que vivre souffreteux en hargne. BAÏF, les Mimes, L. III (V, 159). — Quoy !... il y a donc de la hargne parmy les plus grandes délices que j'eusse sceu penser? C H O LIÈRES, 5e Matinée, p. 178.
Hargne 2. Hernie. — Elle est aussi un souverain et singulier remède, pour ceux qui sont tourmentés de hergne ou descente de boiau. O. D E S E R R E S , Théâtre d'agric, VI, 15. — Pour remettre le boiau avalé, mal tresdouloureux et tresimpor-tun, appelle la hargne. ID., ib., VIII, 5.
l'un de l'autre, non pas en hargnant et noisant l'un contre l'autre. A M Y O T , les Préceptes de mariage, Préambule.
Se débattre. — Seus si [les bœufs] ne métront an piéses la charrû Hêrgnans : non du labour demifét la bezongne ne lêront. BAÏF, les Bezognes d'Eziode (V, 340).
Se hargner à. Lutter contre. — Le bonhomme est si revesche et contraire à soy mesmes qu'il se hargne à son propre naturel. CHOLIÈRES, 7e Matinée, p. 263.
Hargneux. Querelleur. — Tous deux estoient braves et vaillans... tous deux poinctilleux, har-nieux et scallabreux. B R A N T Ô M E , Disc sur les duels (VI, 404).
Gonflé. — (Fig.). Belleau ne parle pas comme on parle à la ville, Il a des mots hargneux, bouffis et relevez, Qui du peuple aujourd'huy ne sont pas aprouvez. R É G N I E R , Sat. 9.
(Prononc, au sens actuel). 1° De chevaulx paisibles et bien domptez naissent poullains her-gneux, incorrigibles et retifz. B. D E LA GRISE, trad. de G U E V A R R A , l'Orloge des princes, I, 44. — Il estoit rechigné, hergneux et solitaire. RONS A R D , Hymnes, L. II, Hymne de VHyver (IV, 327). — C o m m e ayant un rapporteur très rude et her-gnieux d'une fiebvre quarte. A U B I G N É , Faeneste, IV, 5.
2° Le mondain est harnieux, maussade, amer et melancholique au défaut des prospérités terrestres. S* F R A N Ç O I S D E SALES, Amour de Dieu, XI, 21.
Harborins. L'un des mets servis à la table de Quinte Essence. — A son disner rien ne mangeoit, fors quelques cathegories... abstractions, harho-rins. R A B E L A I S , V, 19. Harhorim, mot araméen, signifie pensées, concepts. Voir Sainéan, Rev. des Et. rab., VI, 306.
Haria caria. — Besongnes tu fort? — Pelle melle, Tousjours haria caria. Farce trouvée à Fri-bourg (P. Aebischer, Rev. du XVIe siècle, XI, 131).
Hariage. Tourment, tracas. — Pour venir au thesme predict Et deschifrer le hariage Qu'a le bon h o m m e en mariage, Je trouve qu'il est en tourment Toute sa vie. Ane Poés. franc., II, 6. — En celuy mariage O u il sera, par quelconque ariage De povreté qui puisse survenir Sans y penser, y fera biens venir. J. B O U C H E T , Epistres morales du Traverseur, 1,7.
Harier. Tourmenter, harceler. — Car soing, cure et vieillesse Incessamment me viennent harier. J. M A R O T , 50 Rondeaux, 42. — J'entens cela des mal appairiez, Qui à tous coups sont tencés, hariez De leurs femmes, dont n'osent faire plaincte. Ane Poés. franc., XII, 15. — Quant de nouveau fus marié, J'euz bon temps environ troys jours ; Je n'estoye point harié. 26., IV, 10. — Jeunes enfans, qui le train de mesndge Entreprenez pour estre mariez, Myeux vous vaudroit avoir sur votre naige Que vous y mettre pour estre hariez. Ib., III, 129. — Et serez tansez, hariez De voz femmes à tous propos. R. DE COLL E R Y E , Sermon pour une nopce. — L'en me détient, l'en m e harie, L'en m e dit : Tu es ung meschant. Contred. de Songecreux, 4 r° (G.). — B™< tout conclud, tant l'alla harier Que content fut qu'on l'allast marier. B O U R D I G N É , Pierre Faifeu, ch. 44. — Quant un h o m m e est sy harié, 11 est bien fâché de sa vye. Sotties, III, 74. — Doubteux esmoy, qui parler m'a contrainct, Mon povre espoir voudrait bien divertir ; II le harie, il le serre
Hargner. Se quereller, débattre. — Nous nous sommes tant mis à la raison et leur avons tellement satisfaict sur cette dernière querelle que, s'ils n'ont envie de hargner, ils n'auront plus a quoy s'arrester qu'ils ne parachèvent encore de nous rendre le Castellet. 1559. Lett. du C A R D . D E L O R R A I N E (G.). — A fin que les conjoints par mariage eussent gracieusement ce qu'ils voudroient
et estrainct. D E S P É R I E R S , A Mme laSeneschale de Poictou. — C'est grant pitié, je te prometz, Que de povres gens mariez. Ilz sont bien souvent hariez ; On m'a dit que c'est une mort. Ane Théâtre franc., II, 306. — Pour en particulier sur l'enfant discourir S'il aura longue vie, ou en bref doit mourir... Chez soy, ou hors, errant, puni de son delict, Guerdonne de vertu, celibe ou marié, Des siens ou estrangers aymé ou harié. M A U R I C E SCÈVE, Microcosme, L. III, p. 83. Diffamer. — La mariée est bien du marié Pour
le présent, mais soubdain harié O n l'a vers elle, et par faulx rapportz faire Tant que vouldroit du marché se défaire : Car on luy dist qu'il n'est qu'ung gaudisseur. B O U R D I G N É , Pierre Faifeu, ch. 44. Harié. Tourmenté, souffrant. — J'entends tous
ceulx lesquelz sont mariez, Que souvent voy de tristesse hariez. J. B O U C H E T , Epistres familières du Traverseur, 122. Importuné. — Procureur. Cauteleux, subtil...
harié, i. importuné. M. D E L A P O R T E , Epithetes, 340 v°. Mal arrié. En mauvais état. Il faut probable
ment reconnaître là non pas le verbe harier, mais le verbe arroyer. — Y a il poinct de vieilz gens mariez Tous chacieulx, et tresmal arriez, Qui sont après leurs jeunes chamberieres Pour en user en lascives manières? J. B O U C H E T , Epistres morales du Traverseur, I, 14. Harigot. Sorte d'instrument de musique. —
Un pasteur qui au fond des valées Fait paistre son troupeau par les pastis herbeux, Qui tient un harigot et fleute entre les bœufs. R O N S A R D , Hymnes, L. II, Hymne de VAutonne (IV, 313). — Margot Qui fait sauter ses bœufs au son du harigot. ID., Eclogues, 2 (III, 399). — U n bataillon de soings ne rompt vostre pensée, Quand meslez l'arigot à la flûte dorée. J. D E C H A M P - R E P U S , Ulysse, II, p. 34. — Celuy qui sous l'habit d'un pasteur estranger, A u son de l'herigot obscurcissant son estre, D'Admete le troupeau mena quelquefois paistre. D u M A S , ŒUV. meslees, p. 97. Haringue. — La grosse verolle, la galle de
Naples... la pourperie, l'astringue, la veringue, la haringue. Ane Poés. franc., IV, 270. Hariole (bariolas). Devin, sorcier. — Divina
teurs, astronomes, aurioles, et aultres gens superstitieux. J. B O U C H E T , la Noble dame, 90 r° (G.). — Il tenoit en sa maison royalle... arioles, arus-pices et phitons. B. D E L A GRISE, trad. de G U E VARA, l'Orloge des princes, I, 23. — Alors luy fut predict par les divins et arioles qu'il tomberoit quelque jour en la puissance d'un Gaulois. P A R A -DIN, Hist. de Lyon, p. 402 (G.). — Les carthu-miens sont ceux que nous appelons enchanteurs et harioles, lesquels en proférant quelques paroles ou par certains caractères font transmuer la vue de ceux qui les contemplent faire et les regardent. TAILLEPIED, Hist. de l'Estat et republ. des une Franc., p. 10 (G.). Hariter, v. Hériter.
t Harie. — Nous avons trouvé un oyseau de rivière de moult belle couleur orengee, que les habitants des orées sur la rivière de Loire, comme est Cosne, la Charité, Nevers, ont constamment nommé un herle ou harie. B E L O N , Nat. des oys. (G., Compl.). Harlequine (à la). — Grande nymphe à la narlequine, Qui s'est brisé toute l'eschine Dessus le pavé du bordeau. R É G N I E R , Ode sur une vieille maquerelle.
HARNACHEURE
Harlequinesque. Imitant un arlequin. — Les moiens qu'il emploie sont la pluspart faux et malicieusement controuvés, et comme tels seront jugés par la court harlequinesque. LESTOILE, Mém., lre part., p. 195 (G., Compl., Arlequi-nesque).
Harloup. Cri pour exciter contre le loup. — Alors s'entend un cry : le harloup se redouble Après ce dévoreur. CL. G A U C H E T , le Plaisir des champs, l'Esté, Chasse du loup, p. 163. — Mais j'oy parmy le bois Oudin qui coup sur coup D'une haultaine voix crie : Harloup ! harloup ! ID., ib., VHyver, Chasse du loup, p. 316. — [Le loup] Sans avoir chien bien près entend de toutes parts Crier Harloup ! Harloup ! ID., ib., p. 322. — Cf. Harer.
Harmene. Sorte de serpent. — Harmenes. Handons. Icles. R A B E L A I S , IV, 64. Harmet, v. Armet.
Harmon. Partie d'une voiture. — Ferrure de timons et harmons. 1562. Arch. Gir. (G.).
Harmonial. Harmonieux. — Entre les personnes il se rencontre par fois une certaine similitude et harmoniale correspondence de l'une à l'autre. P O N T U S D E T Y A R D , trad. de l'Amour de L É O N H E B R I E U , Dial. II, p. 116. — Le sage mer-curial avec prudence harmoniale, et douce et suave éloquence... sert le prince. ID., ib., p. 249. — Le Soleil... tient la lire, laquelle lon le feint avoir eue de Mercure, qui donne la concordance et harmoniale pondération. ID., ib., p. 253.
Harmonie. (Prononc).— Le Soleil... est celuy qui gouverne la harmonie. P O N T U S D E T Y A R D , trad. de l'Amour de L É O N H E B R I E U , Dial. Il, p. 253. — La harmonie, aux doux concens nourrie Des sept accords. ID., Erreurs amoureuses, L. I, Disgrâce, p. 20. — Comparans le corps à la lyre et l'ame à la harmonie. L. L E R O Y , trad. des Politiques 'ARISTOTE, VIII, 5, Commentaire.
Harmonique. Harmonieux. — Sa douce éloquence et voix harmonique raisonnoit parmy le palais. L E M A I R E D E B E L G E S , Illustr., II, 6.
(Subst.). Celui qui s'occupe de musique. — Il ne faut pas se descourager... ains faut faire comme les harmoniques et musiciens, en rebouchant tousjours la poincte des [choses] adverses par la recordation des prospères. A M Y O T , De la tranquillité de l'ame et repos de l'esprit, 15.
Harmoniquement. Avec harmonie, avec accord. — S'il est gouverné et conduit royalement, c'est à dire harmoniquement. J. B O D I N , Republique, VI, 6. — II n'y a doubte que l'Estat ainsi gouverné harmoniquement n'eust esté beaucoup plus asseuré. ID., ib. — Le sage roy doibt gouverner son royaume harmoniquement, entremes-lant doucement les nobles et roturiers, les riches et les pauvres. ID., ib. Harnacheur. Celui qui harnache, ou celui qui
fait des armures. — (Fig.). Tout beau, messieurs les protestans : nostre harnacheur Lindasinus vous attrappera bien en voz filets. P H . D E M A R NIX, Differ. de la Relig., I, iv, 16. — Nos hugue-nauts ne sçauroyent s'ayder de ces passages pour eschapper les horions et mornifles de nostre pano-plique harnacheur. ID., ib.
Celui qui fait des harnais. — Hemekeur de la Vasne. 1573. Valenciennes (G.).
Harnacheure. Harnachement, armure. — Chevaux, chariots, harnacheures, C A Y E T , Chron. nov., p. 739, Michaud (G.). — (Fig.). S. François,
5
HARNAS — 446 —
qui a esté le forgeron de ceste benoitte harna-cheure. P H . D E M A R N I X , Differ. de la Relig., I, iv, 3. — Plusieurs princes... ont faict grande bannière de pouvoir, à l'heure de leur mort, estre armez de ceste harnacheure [le froc des cordeliers]. ID., ib. — Le bon Wilhelmus Lindanus en forge toute sa panoplie ou complète harnacheure grégeoise, pour combattre les hereticques. ID., ib., I, iv, 11.
Équipement, costume. — Surpellis, chasubles... estolles, et autres harnacheures et masquerades. ID., ib., I, iv, 5.
Outillage — Une harnecure nouvelle pour le grand mollin. 1552. S* Orner (G.).
H a m a s . Armure. — (Fig.). Pour nous forger un harnas et rondache à preuve de toutes ces canonnades. P H . D E M A R N I X , Differ. de la Relig., II, i, 17. — Sa panoplie, c'est à dire un harnas tout complet avec espées, rondaches et tout ce qu'il y faut. ID., ib., II, i, 17.
Harnais. — Les Massagetes... font d'erain les bardes de leurs chevaux, et entre les pièces de leurs harnas font mors et bossettes d'or. SALIAT, trad. d'HÉRODOTE, I, 215.
Attirail de chasse. — (Fig.). II... déployé force filets, harnas, teilles et traineaux pour chasser au vent. P H . D E M A R N I X , Differ. de la Relig., I, ni, 7. Harneché. Harnaché. — Montées sur de belles hacquenées tant bien harnechées. B R A N T Ô M E , des Dames, part. I, Disc. 2, Catherine de Médicis (VII, 399). — Montée sur une belle hacquenée blanche harnechée fort superbement. ID., ib., Marg., reine de Fr. et Nav. (VIII, 41).
Harnois. Armure. — Il fault que maintenant de harnoys je charge mes pauvres espaules. R A BELAIS, I, 28. — Balan... estoit armé d'un harnois cler à merveilles. Amadis, IV, 33. — Or estoit la chaleur grande et extresme, et le chevalier si eschauffé en son harnois qu'il fut contraint oster son heaulme de la teste. Ib., V, 3. — Urgande feit armer ses chevaliers des harnoix qu'elle leur avoit apportez, qui estoient blancz, ayans devant et derrière une croix vermeille. Ib., V, 42. — J'ay les espaules toutes usées à force de porter harnois. R A B E L A I S , III, 7. — S'il se voit quelqu'un tué par le défaut d'un harnois, il n'en est guère moindre nombre que l'empeschement des armes a faict perdre. M O N T A I G N E , II, 9 (II, 103). — Démétrius fit faire pour luy et pour Alcinus... à chacun un harnois complet du poids de six vingts livres, là où les communs harnois n'en pesoient que soixante. ID., ib. (II, 106). — Il [César] aymoit qu'ils fussent richement armez, et leur faisoit porter des harnois gravez, dorez et argentez. ID., II, 34 (III, 166). — (Fig.). II fault... que ces deux langues soint entendues de celuy qui veut acquérir cete copie et richesse d'invention, première et principale pièce du harnoys de l'orateur. D u B E L L A Y , Deffence, 1, 5. — Il ne vous est advenu d'articuler en tous vos discours quand, comment, en quel lieu je m e sois jamais abouché avecques luy ; qui estoit toutesfois la principale pièce de vostre harnois, pour m e combatre. E. P A S Q U I E R , Lettres, XII, 1.
Attirail. — Pendant que ses filets, sa ligne, son harnois Se sechoyent estendus moites sur le gravois. R. B E L L E A U , la Bergerie, 2e Journ., le Pescheur (II, 53).
Porter le harnois. Porter les armes. — Camil-Ius... feit armer tous ceulx qui estoyent en aage de porter le harnois. A M Y O T , Camille, 23. Harnois de gueule. Provisions de bouche. (Cf.
Gueulé). — Toutes les chevilles et peaux de la
charrette doivent estre garnis de flaecons et bouteilles, et doit avoir au bout de la charrette un coffre de bois plein de coqs d'Inde froids, jambons, langues de bœuf et autres bons harnois de gueule. D u F O U I L L O U X , Ven., ch. 62 (Gay, Gloss. archéol).
S'eschauffer en son harnois. Se mettre en colère, — Benoist monsieur, dist Panurge [à Dindenault} vous eschauffez en vostre harnois. RABELAIS, ivi 7. Se passionner à l'excès. — La jeunesse bouil
lante s'eschauffe si avant en son harnois toute endormie qu'elle assouvit en songe ses amoureux désirs. M O N T A I G N E , I, 20 (I, 106). — Apres que ledit sieur archevesque eut fini son epiphoneme en grande émotion de corps et de voix, il demanda permission tout bas... de se retirer pour changer de chemise, parce qu'il s'estoit eschauffé en son harnois. Sat. Men., après la Harangue de M. de Lyon, p. 135. — Si quelque fois ils s'eschauffent en leur harnois, une bouteille de vin théologal en fera la refrescade. P H . D E M A R N I X , Differ. delà Relig., I, ni, 1.
Fourbir le harnois, expression libre. — Chascun exerceoit son penard : chascun desrouilloit son bracquemard. F e m m e n'estoit, tant preude ou vieille feust, qui ne feist fourbir son harnoys. R A B E L A I S , III, Prologue.
(Jeu de mots). — Les brigues estoient pour l'archiduc Ernest... Puis, quand ils se sont apperceus que cest Ernest n'estoit point harnois qui nous fust duisant, ils ont parlé d'un prince de France. Sat. Men., Harangue de M. d'Aubray, p. 262.
(Prononc). —• D'un jonc tortis l'harnois à un verd saule il lie. D O R Â T , Epithalame d'Anne de Joyeuse, p. 28. — Je veux daguer mon flanc, endosser la cuirace, Et contre mon mary me charger de l'harnois. P. M A T T H I E U , Clytemnestre, III, p. 38. — Brusquet... luy oste la belle housse et l'harnois et la selle. B R A N T Ô M E , Cap. estr., le Mareschal d'Estrozze (II, 247). — Il donna un coup d'espee au travers le corps d'un gentilhomme au deffautde l'harnois. ID., Cap. franc., leConnestabk Anne de Montmorency (III, 327). — Ayant esté blessé en trois endroits, l'un d'un coup de pistollet dans le bras gauche, et l'autre d'espee dans le corps au deffaut de l'arnois. ID., Rodomontades espaignolles (VII, 106). — Estans rompus et froissez de l'harnois qu'ils ont tant porté. ID., des Dames, part. II (IX, 400).
Haro. S'escrier harol Appeler à l'dde. — Ma mère avoit paour quil ny eust des larrons a la mayson et elle sescria harol alarme. PALSGRAVE, Esclare, p. 501.
Faire haro. Crier haro. — Si tu ne la rens [une bourse pleine d'or], je vois faire harau sur toy. J. D E C A H A I G N E S , l'Avaricieux, IV, 9. — En Normandie, quand quelqu'un fait le haro sur vous, u faut par nécessité... que vous faciez solennellement vostre entrée en prison. D u FAIL, Contes d'Eutrapel, 2 (I, 97).
Harou. Défense. — Les bonnes femmes entrèrent dans ledit bled (en despit du harou). P H . D'ALCRIPE, la Nouvelle Fabrique, p. 107.
Crier harou contre. Crier haro sur. — Chacun crioit harou contre luy. E. PASQUIER, Recherches VI, 29. — Pour le regard des damoiselles, la patience leur eschappa, lesquelles, par un commun vœu, crièrent contre luy un harou de Normandie. ID., Lettres, XXII, 4.
Harol, v. Haro. Harolleur. Ménétrier, musicien. — Il '"^tet
appartient ausdits relligieux de pourveoir de ha-
— 447 — HARPER 2
rolleurs et joueurs d'instrumens tant pour servir a Dieu et a l'église comme pour faire danser et recréer les jeunes gens et aultres les jours des festes et patrons que l'on dit ducasses. 1507. Prév. deVimeu (G.). Harondelle, v. Arondélle.
Harou, v. Haro.
Harouenne. — D'autres pensent que ce mot [haro] vienne de harouenna : qui en vieil françois teulch signifloit le lieu où se tenoit la justice : comme si celuy qui crie haro appelloit sa partie à l'harouenne ou lieu de la justice, pour avoir raison de sa violence. CL. F A U C H E T , Antiquitez, XI, 8. Harpade. Action de se saisir l'un l'autre. —
Les violentes harpades de la drogue et du mal sont tousjours à nostre perte, puis que la querelle se desmesle chez nous. M O N T A I G N E , II, 37 (III, 211). Harpagon, v. Arpagon.
Harpail. Troupe d'animaux. — Les cerfz marins n'eurent de luy appuy; Mais le herpail suivent pour le jourd'uy. G R I N G O R E , Chasse du cerf des cerfs (I, 161). troupe de gueux. — Cette compagnie fut am
plifiée de plus de 600 hommes de faict et aultant de harpail. H A T O N , Mém., an 1574 (G.). Harpaille, terme de mépris. Canaille, gens
sans valeur. — Caresme donc anime la harpaille A débeller le sien grand adversaire. Ane Poés. franc., X, 122. — Tout autant quil avoit bonnes gens et bien aguerriz, il les mist aux aisles dung costé et d'aultre. Et quant au front ou mylieu de son armée, il le remplit de harpaille et de tout ce qui estoit en son ost le moins propre a la guerre. G. D E SELVE, Huict Vies de P L U T A R Q U E , Fabius, 53 r°. Harpailler. Saisir. — Il fut hapé, harpaille et
défait de ces malheureux Mores avec cinquante autres des nôtres, qui passèrent tous par le fil de l'epee. L É O N , Descr. de l'Afr., II, 24 (G., Compl.). Harpailleur. Mineur. — Cyre estoit vachier...
Nestor harpailleur. R A B E L A I S , II, 30. — Gens soubzmis... à Mercure, comme... harpailleurs, ri-masseurs. ID., Pantagr. Prognost., ch. 5. (Fig.). Celui qui fouille, scrutateur. — Une bonne
partie des anciens philosophes qui se sont mons-trez grands harpailleurs des secrets de nature. D u PINET, trad. du Commentaire sur Dioscoride, Epistre (G). Harpand. Espèce de chien. — Chien... jou-
bard, greffier, harpaud. M. D E L A P O R T E , Epithetes, 81 r° et v°. _ Harpe 1. Ce mot est souvent employé pour désigner la lyre. — Néron... dédié fut au jeu de la herpe. M I C H E L D E T O U R S , trad. de S U É T O N E , VI, 196 r°. — Les neuf Muses avec Apollon tenant sa harpe. Amadis, IV, 2. — Voir d'autres exemples ci-dessous. (Prononc). — 1° Fay que Orpheus ait son
harpe jolie. Ane Poés. franc., XI, 32. 2° Si Orpheus venoit cy en présence Pour de sa
herpe jouer à sa plaisance, Point ne sçauroit me bailler reconfort. Ane. Poés. franc., XII, 98. — En la herpe tu es ung nouveau Orpheus. P. F A BRI, l'Art de Rhétorique, L. I, p. 229. — (Avec le sens actuel). On usoit au dict temps passé de dire herper, pour fouer de la herpe. G. T O R Y , Champ fleury, Aux lecteurs. — David, qui jouoit de la herpe, Disoit à Dieu : Tibi soli. M A R O T , le Grup de Cl. Marot, dans l'édit. Guiffrey, II, 457. — Les
humains... pourront... prendre logis les uns à l'Aigle d'or, les aultres au Mouton, les aultres à la Couronne, les aultres à la Herpe. R A B E L A I S , III, 51. — Aussi seras tu, beste immonde, Damné, comme une malle serpe. Et je seray, comme une herpe, Sauvé, en paradis gaillard. ID., V, 46.
Harpe 2. Action de saisir. — Les meurtres par les champs, le massacre aux cités Harpes à touttes mains, et soubz cette bruyne, Ce tout, qui se dément, du trosne à sa ruyne. L. P A P O N , la Constance (Suppl., p. 25).
Peut-être faut-il reconnaître le m ê m e mot dans harpe désignant un oiseau de proie. — Les harpes et milans du semblable se bandent, Et joints entr'eux ainsi du sacre se défendent. J. D U C H E S N E , le Grand Miroir du Monde, L. IV, p. 146.
(Jeu de mots sur harpe, instrument de musique, et harpe, action de saisir). — Vous autres advocats.. . vous prenez grand plaisir que vos mains fredonnent à la harpe. C H O L I È R E S , 3e Matinée, p. 93.
Harper 1 (intrans.). Jouer de la harpe ou de la lyre. — Arion harpant E n mer se respant, Ung daulphin hapant Le feist eschappant Sans grant préjudice. L E M A I R E D E B E L G E S , le Temple d'Honneur et de Vertus (IV, 196). — D'un vieil Ter-. pandre ou d'un vieil Amphion, D'un Apollo harpant en sa coquille On n'ha plus cure, et si les défile on. ID., la Concorde des deux langages, lTe part. (III, 110). — Musiciens de leurs voix symphonisent... Soufflent, harpent, tympanent, citharisent. ID., ib. (III, 112). — Pour avoir le mieulx chanté et harpe. M I C H E L D E T O U R S , trad. de S U É T O N E , VI, 199 r°. — Or toutefois puisse oublier m a dextre L'art de harper, avant qu'on te voye estre, Hierusalem, hors de mon souvenir. M A R O T , PS. de David, 48. — Le beau Paris, appuyé sur un tronc, Harpoit alors qu'il vit parmy les nues Venir à luy les trois déesses nues. R O N SAR D , Gayetez, 3 (II, 40). — Moy, je m'atten qu'en lieu de plus harper, Il vous viendra le royaume usurper. D E S M A S U R E S , David fugitif, 1129. — Il a prins plaisir à harper et chanter le mieux qu'il a peu. D u FAIL, Contes d'Eutrapel, 31 (II, 131).
(Trans.). Chanter [qqch) en s'accompagnant de la lyre. — II... promisf chanter et harper la fable de Niobes femme Damphion. M I C H E L D E T O U R S , trad. de S U É T O N E , VI, 199 r°.
Harper 2. Saisir. — L'escrime des poings représente le charger l'ennemy et se couvrir de luy, la luicte le harper et terrasser. A M Y O T , Propos de table, III, 5. — Si quelque riche homme... rece-voit plusieurs convives... puis les feist servir opu-lemment : et que ce pendant l'un d'eux vint à harper et engloutir le tout. F. B R E T I N , trad. de L U CIEN, le Cinique, 6. — Et de grands ongles retors... M'offrirai, ombre sans corps, Harpant voz faces tyranes. Luc D E L A P O R T E , trad. d'HoRACE, Epodes, 5.
Se harper. S'accrocher. — Ladasin tomba dans l'eaue, ou sans doubte il se feust noyé... sans aulcuns saulx, ou il se harpa. Amadis, II, 8. — U n se deslia, et fuit au portique de Ceres Thesmophore, ou il fut repris, et se harpant aux portes, si bien qu'on ne l'en povoit eracher, ilz luy copperent les mains. SALIAT, trad. d'HÉRODOTE, VI, 91.
S'attacher. — (Au sens abstrait). Pardon requiers se, pour m e contenter, J'ay entreprins d'ouvriers mescontenter, Lisant ceste œuvre où très-mal je m e herpe. Ane Poés. franc., XIII, 411. — Je suis très capable d'acquérir et maintenir des amitiez rares et exquises. D'autant que je me harpe avec si grande faim aux accointances qui
HARPER 3 — 448 —
reviennent à mon goust... que je ne faux pas ay-sement de m'y attacher. M O N T A I G N E , III, 3 (III, 285). — Aucuns sages... n'ont pas craint de se harper et engager jusques au vif à plusieurs ob-jects. ID., III, 10 (IV, 138).
S'accrocher, s'attacher dans la lutte. — Le da-moysel... s'en courut droit à celuy qui s'estoit harpe à son frère, auquel il arracha l'arc et luy en donna au plus hault de la teste de toute sa puissance. Amadis, I, 3.
Se saisir l'un l'autre. — Amadis... se lança sur Gasiman, qu'il saisit au corps... et se harperent essayans par tous moyens à abbatre l'un l'aultre. Amadis, I, 28. — Apres maint dur coup d'espee se harperent l'un l'aultre. Et à pous et de bras et de teste taschoient à qui plus tost abbatroit son en-nemy. Ib., V, 15. — Lors eux picquez jettent arcs et carquois, Et se harpants, or de force, or d'adresse A qui mieux mieux chacun d'eux s'en-trepresse. E. P A S Q U I E R , Sonnets divers (II, 919). — Vous ne les desprenez pas à vostre poste quand ils se sont une fois harpez. M O N T A I G N E , I, 48 (I, 395). — Luttant en ceste manière, sont contraints de se harper l'un l'autre : encores que souvent ils s'escoulent des mains. F. B R E T I N , trad. de L U C I E N , Anacarsis, 28. Herpé. Accroché. — Brissac void le petit navire
Beaumont herpé avec le vice-amiral, et à chasque main abordé de cinq ou six navires ou galions. A U B I G N É , Hist. univ., X, 21. Harper 3. Se harper. S'élargir, s'étendre? — [Atalante et Hippomène changés en lions] D'es-paule et d'estomac en large se harpans, Evidez par le flanc desja panchent rampans. BAÏF, Poèmes, L. VI (II, 316). Harpeur. Joueur de lyre. — Jadis on vit le harpeur Arion En haulte mer porté sur un daul-phin. B. A N E A U , Lyon marchant. — L'esprit divin et la divine grâce De ce parler, qui du harpeur de Thrace Eust les ennuiz doulcement enchantez. D u B E L L A Y , Treize sonnets de l'honneste amour, 12. — Et toutefois le sainct harpeur de Thrace, Par les accords-de son luth adoucy, Jadis aux bois et aux rochers aussi, C o m m e l'on dict, feit bien suyvre sa trace. ID., les Amours, 29. — Le divin harpeur de Thrace... Armoit de si douce audace Sa lyre. D E S A U T E L S , Façons lyriques, VII, 4. — Si le harpeur ancien Qui perdit deux fois sa femme Corrumpit l'air thracien D'une furieuse flamme. D u B E L L A Y , Ode au seigneur des Essors. — O n dit du vieil harpeur de Thrace Qu'il faisoit jadis à sa trace Suyvre les rochers et les boys. O. D E M A G N Y , Odes, I, 27. — O saint harpeur, Apollon Grynien. ID., Dern. Poés., p. 4. — Le harpeur qui dans la Thrace Donna les premières lois, Et qui feit suivre sa trace Et aux rochers et aux bois. J O D E L L E , Ode au comte d'Alcinois (II, 327). — Sans ensuivre pourtant ce dieu [Apollon] Chasseur et harpeur, et sans prendre A u lieu de m a lyre un épieu, J'aime mieux m a lyre retendre. ID., Ode de la Chasse (II, 298). — Tu te trompes, harpeur, en pençant esmouvoir Pluton avec ton chant pour ta femme r'avoir. P. D E B R A C H , Poèmes et Mes-langes, L. IV, Mascarade des Ames. — O de la claire Thalie Harpeur et maistre, Phœbus. Luc D E L A P O R T E , trad. d'HoRACE, Odes, IV, 6. — Les Thraces marquèrent au front leurs femmes parce que leurs mères avoient ja pieça occis injurieuse-ment ce grand harpeur Orpheus. D u F A I L , Contes d'Eutrapel, 1 (I, 71). — Le harpeur thracien que l'amoureuse flamme Fit descendre aus enfers pour ramener sa femme. P A S S E R A T , Contre Phoebus et les Muses.
Poète. — (A Ronsard). Fameux harpeur et prince de noz odes, Laisse ton Loir haultain de ta victoire, Et vien sonner au rivage de Loire De tes chansons les plus nouvelles modes. D u BELLAY l'Olive, 60. — Horace, harpeur latin, Estant fils d'un libertin, Basse et lente avoit l'audace. RONS A R D , Odes, 1,11. — (A son luth). Par toy je plais, et par toy je suis leu : C'est toy qui fais que Ronsard soit esleu Harpeur françois. ID., ib., I, 22.— [Les vainqueurs des jeux de la Grèce] Avec la victoire esveillerent Le mestier des premiers har-peurs. ID., ib., V, 2. — Ainsi, Bellay, pour ton Olive, Nostre postérité t'escrive A u reng des plus divins harpeurs. O. D E M A G N Y , Gayetez, p. 60.— J'animeroy maintz beaux fredons lyriques, Qui m e feroyent du vray Christ couronner, Qu'as entrepris de ta lire sonner, Autant ou mieux que les harpeurs antiques. T A H U R E A U , Sonnets, 54.— O que je n'ay les Muses en partage, Comme Ronsard, nostre harpeur divin ! ID., ib., 60. — 0 vieil harpeur grégeois ! que sept villes approuvent Pour leur cher nourrisson. O. D E M A G N Y , Odes, II, 56. — Tu as fait que la voix aux Latins soit passée D u cygne qui chantoit sur la rive Dircee, Ne t'effrayant des mots de ce harpeur latin. RONSARD, Sonnets à div. personnes (II, 28). — Pour ce ensuivant les pas du fils de Nicomache, Du harpeur de Calabre, et tout ce que remâche Vide, et Minturne après, j'ay cest œuvre apresté. VAUQ U E L I N D E L A F R E S N A Y E , Art poet., I, p. 3. — En
ce genre sur tous proposer tu te dois L'inimitable main de Pindare gregois Et du harpeur latin. ID., ib., p. 24.
(Adj.). Lyrique. — Le vers tragic, le comic, le harpeur. D u B E L L A Y , Sonnets divers, 37, édit. Chamard, II, 285.
(Fém.). Harperesse. — Une jeune fille harpe-resse. Therence en franc., 230 v° (G.).
Harpiac. De harpie. — Par fraudulentespoinc-tures, gruppemens harpyiacques, importunite! freslonnicques. R A B E L A I S , III, 21.
Semblable aux harpies. — Tandis ce grand Orithien Cherche tousjours nouveau moyen Pour faire une brave sortie Sur cet harpiac estranger, Lequel descend pour te manger De l'extrémité de Scythie. M m e s D E S R O C H E S , Odes, 8. Harpie. Harpon. —Chymon... ayant prins un
harpie de fer, le jecta de grande force sur la poupe des Rhodiens qui gaignoient pays vistement, et la joignit par force à la proue de son vaisseau. LE M A Ç O N , trad. de B O C C A C E , Decameron, V, 1. Harpie. (Prononc). — Plume d'arpye ou de
quelque chouette. D E S PÉRIERS, Pour Marot contre Sagon (1,177). — Ton poil est doux comme une ortie : Ta main une griffe d'harpye. BAÏF, Passetems, L. III (IV, 367). — Au lieu de dieux du ciel, c'estoient bien dieux d'enfer, Qui permirent jamais qu'un tel essaim d'harpyes... Fust mis sur terre. L'Ixion hespagnol, dans Tricotel, édit. de la Sat. Men., II, 258. — Escoutés à combien d'harpies Vous faites manger vostre bien. Var. hist. et litt., II, 199.
Harpien. D e harpie. — Griffe. Croche ou crochue, lyonne, pillarde... harpienne. M. DE u P O R T E , Epithetes, 198 r". — Ongle. Tendre, pointu... harpien. ID., ib., 239 v°.
Harpier (intrans.). Agir c o m m e une harpie. — Quand les forgerons et autres ouvriers ferrez seraient pires cinq cens mille fois qu'ils ne sont, quand les peines et fatigues de ceux qui harpient à griffonner l'or seroient plus grandes que les avez fait... cela ne justifie aucunement du promt
ou du dommage de l'or ou du fer. CH O L I È R E S , 1" Matinée, p. 29. (Trans.). Prendre comme une harpie. — L'Es
criture Sainte nous donne de fort riches tesmoi-gnages des menaces que Dieu fait contre vostre gripperie ; l'exécution desquelles tend à ce que ce que vous aurez harpyé et rapine en quinze ou vingt ans s'esvanouira en moins d'un an. ID., 3e Matinée, p. 116. Harpin. Joueur de lyre. — Linus et Orpheus,
nobles harpins de Grèce. TAILLEPIED, Hist. de l'Estat et republ des anc Franc., L. II, 22 v° (G.). Harpon (H. D. T. 1611). — 1553. La manière
de placquer et vestir les murailles, ensemble des clefz ou harpons. J. M A R T I N , trad. d'ALBERTi, Architecture, 48 a (Vaganay, Pour l'hist. du franc. moderne). Harpoys. — Harpoys employé à cimenter les-
dits guet et fontaine. 1521. Laon (G.). Harpye, Harpyer, Harpyiaque, v. Harpie,
Harpier, Harpiac.
Harquebouze, v. Harquebus.
Harquebus, Harquebuze. Arquebuse. Cf. Hacquebute, qui est le même mot. — Et aymoit tous honnestes exercices, et surtout à forger des canons d'arquebus. B R A N T Ô M E , Cap. estr., M. de Savoye (II, 151). — Lorsque nous tournasmes de Malte, il nous falloit cacher et rompre tous les fusts de nos belles harquebus que nous y avions porté. ID., Cap. franc., M. de Montmorency (III, 356). — Ils... jetterent l'harquebouze à la main gauche. A U B I G N É , Hist. univ., XI, 17. (Antiq.). Arc. — A quoy se pourroit quelqu'un
servir de gens... qui voy ans seulement le sang perdent courage, et meurent avant que d'estre parvenus à la portée de l'harquebuze de leurs ennemis? F. BRETIN, trad. de L U C I E N , Anacarsis, 25. Harquebus (masc). — D'une balle sortie à l'ef
fort de la pouldre D'un puissant harquebus, pénétrant comme fouldre, Il est frappé à mort. Anc. Poés. franc., VIII, 27. — Qu'ilz eussent à se pourvoir et garnir de bons harquebuz. B R A N T Ô M E , Capitaines espagnols (I, 342). — Il prit un grand harquebuz de chasse qu'il avoit, et en tira tout plein de coups à eux. ID., Cap. franc., le Roy Charles IX (V, 256). — Allans à Malte, portions le simple harquebuz et le fourniment. ID., Couronnels franc. (VI, 31). Harquebuse. (Prononc). — Le mary avecq sa
harquebuze et elle avecq des pierres se defen-doient si bien que... les bestes ne les osoient approcher. M A R G . D E NAV., Heptam., 6 7 . — Tous-jours la harquebuze ou la paume champestre Me retient en travail tout le jour arresté. R O N S A R D , Amours de Marie (I, 152). — A coups de harquebouze ou à coups de mousquette. ID., Poèmes, L. I, les Armes (V, 32). — Apres m'avoir tiré cinq coups de harquebuse. ID., Remonstrance au peuple de France (V, 381). — Pouvans user de la harquebouze ou plustost haquebute contre les bestes rousses. H. ES T I E N N E , Precellence, p. 119. — De la harquebouse, il en tire à l'adventure. M O N TAIGNE, II, 12 (II, 362). — Dans la forest de Retz je me suis transporté, La harquebuze en main. CL. G A U C H E T , le Plaisir des champs, le Printemps, Chasse du blaireau, p. 36. — Ains vistement en main je prends la harquebuze. ID., ib., Divers plaisirs, p. 43. — En joue il a toujours joincte la harquebuze. ID., ib., l'Automne, Chasse du sanglier, p. 233. — La harquebuze... pour tirer aux oiseaux. E. PASQUIER, Lettres, XVII, 4. — Mon IV
HART
laquais, que j'avoye envoyé... quérir en mon logis m a harquebuse. L A R I V E Y , la Constance, III, 1.
On dit aussi arquebute. — J'ay esté salué par mocquerie le soir devant m a porte de 50 ou 60 coups d'arquebute. CALVIN, Discours d'adieu aux ministres (IX, 892). — Le capitaine Sainct Aubin... fut blessé d'un coup d'arquebute tout au travers du col. A M B R . P A R É , Introd., ch. 24. — Qui est le capitaine qui se voudra hazarder à la mercy de leurs arquebuttes? E. PA S Q U I E R , Recherches, VI, 8.
Harquebuserie. Arquebuserie. — Les flancs des bataillons ne sont communément armez que d'harquebuserie. L A N O U E , Disc, polit, et milit., XXII, p. 508.
(Prononc). — Il descouvroit dens les vergiers la harquebouzerie ennemie. M O N L U C , Commentaires, L. I (I, 56). — La harquebuzerie espai-gnolle tiroict de furie. ID., ib. (I, 95). — Dèz que m a harcquebuzerie tira, ilz s'arrestarent. ID., ib., L. I (1,169).
Harquebutier, Harquebouzier. Arquebusier. — Bref que chacun de vous à son estât regarde, Le halebardier tienne au poing sa halebarde, La picque le piquier, et le harquebutier Couché plat sur le ventre exerce son mestier. R O N S A R D , Poèmes, L. I, Harangue du duc de Guise (V, 28). — Ils ont voulu que S. Barbe, laquelle ils avoyent faicte la saincte des harque-bouziers, prist par mesme moyen la charge de repousser les coups desdicts tonnerres et foudres. H. E S T I E N N E , Apol pour Her., ch. 38 (II, 310). Harquebuziere. — J'ay pour casemater rendu
m a main pioniere... Et pour forcer la brèche encore harquebuziere. B O Y S S I È R E S , Prem. Œuv., 25 r°. Harquebutterie. Arquebuserie. — Et es
toient les maisons de la ville assez près des murailles ou les Suisses avoient mis toute leur harquebutterie. F L E U R A N G E , Mém., ch. 36 (G., Hac-quebuterie).
Harquebnzade (H.D. T. 1564).— 1559. L'on les prend [les thons] en l'isle de Gades... avec un grand rumeur de voix et de tabourins, et force harquebuzades. M A T H É E , trad. de DIOSCORIDE, 129 a (Vaganay, Pour l'hist. du franc, moderne).
Harre, v. Harer. Harry, exclam. — Ce petit paillard tousjours
tastonoit ses gouvernantes cen dessus dessouz, cen devant derrière, harry bourriquet. R A B E L A I S , I, 11. — Arry avant, dist Rhizotome, je n'y pen-sois par mon ame plus. ID., IV, 52.
Harse, Harseleur, Harsonnier, v. Harce, Harceleur, Harçonnier.
Harsoir, v. Hersoir. Hart. Lien d'osier, de bois pliant. — Or
n'avoient ilz plus de corde pour attacher leur bat-teau, et à ceste cause prirent de franc osier verd, le plus long qu'ilz peurent trouver, qu'ilz tordirent et en feirent une hard, dont ilz attachèrent leur batteau. A M Y O T , Daphnis et Chloé, L. II, 27 v°. — Chacun de ton bois emporte, Et sans avoir nul égard, Bon ou mauvais on fagote Gar-roté dans une hart. V A U Q U E L I N D E L A F R E S N A Y E , les Foresteries, II, 7. — Soudain de hars d'osier qu'à propos ils trouvèrent Le viennent garroter. BAÏF, Eglogues, 9 (III, 52).
Paille tordue. — Et vient faire une grosse hart De feurre sec pour en feu mettre L'arbre et le lieu auquel a part Le nid de laigle povoit estre. H A U D E N T , Apologues d'ÉsoPE, I, 160.
29
i9 —
HASARD
Corde. — Car vieille hard ne se peult tordre. G. COLIN BÛCHER, Poésies, 195.
(Spécialement). Corde servant à pendre, à se pendre. — J'avois un jour un vallet de Gas-congne... Sentant la hart de cent pas à la ronde. M A R O T , Epistres, 29. — Allez vous pendre, et vous mesmes choisissez arbre pour pendages, la hart ne vous faudra mie. R A B E L A I S , V, Prologue. — Crates disoit que l'amour se guerissoit par la faim, sinon par le temps : et à qui ces deux moyens ne plaisoyent, par la hart. M O N T A I G N E , II, 12 (II, 230). — Les Egyptiens... defendoyent sur peine de la hart que nul eust à dire que Sera-pis et Isis leurs dieux eussent autres fois esté hommes. ID., ib. (II, 259).
Hasard. Danger, risque. — Il [Barberousse] se noya en soy baignant en un fleuve. Dont tout son exercite fut bien désolé, et demoura la chrestienté en grand hazart. L E M A I R E D E B E L G E S , Schismes et Conciles, 3e part. (III, 339). — Et tant de gens de bien ne seroient en hazart De venir perdre icy et l'honneur et la vie. D u B E L L A Y , les Regrets, 95. — II ne se voit soumis au périlleux hazard D'avoir le cors navré pour gaigner le rempart D'une ville ou d'un fort. B E R E A U , Eglogues, 3. — Ce merchand feust non seulement l'origine de tout, mais aussi l'exécuteur, ayant eu le cœur, pour le venger, de mettre en hasard et sa femme et son fils. M O N L U C , Commentaires, L. I (I, 205). — Je puis dire avoir marché en plusieurs hazards d'un pas bien plus ferme, en considération de la secrette science que j'avois de m a volonté et innocence de mes desseins. M O N T A I G N E , II, 5 (II, 49). — Le philosophe Pyrrho, courant en mer le hazard d'une grande tourmente, ne presentoit à ceux qui estoyent avec luy à imiter que la sécurité d'un porceau qui voyageoit avecques eux. ID., II, 12 (II, 221). — Aucuns [orges] se font en l'automne, mais c'est avec hazard d'estre tués par le prochain froid. O. D E S E R R E S , Théâtre d'agric, II, 4. — Retourne vers Esther ; et luy di de m a part Qu'aujourd'huy sa patrie est au dernier hazard. M O N T C H R E S T I E N , •Aman, III, p. 261. — La captive Eglise, Qui à sa délivrance (aux despens des hazards) M'appelle, m'animant de ses trenchans regards. A U B I G N É , les Tragiques, 1 (IV, 30). Se mettre au hazard. Courir le risque. — Estant
ouvertement descendu en contention avec Thu-cydides, et s'estant mis au hazard à qui feroit bannir son compagnon du ban de l'ostracisme, il le gaigna sur luy et le chassa de la ville. A M Y O T , Périclès, 14.
Prendre le hazard de. Se hasarder à. — Il pensa bien que ce seroit chose fascheuse que de le déclarer au roy : mais neantmoins se confiant à la grande amour et affection paternelle qu'il por-toit à son filz, il prit le hazard un jour de luy dire que la maladie de son filz n'estoit autre chose que amour. ID., Démétrius, 38. Au hazard de. E n mettant en danger. — Il vou
loit que je réparasse une si grande faulte à l'ha-sart de mon honneur. M O N L U C , Commentaires, L. VII (III, 272). — Il ne pouvoit estre ny juste ny courtois, au hazard de celuy auquel il s'estoit preste. M O N T A I G N E , II, 27 (III, 107). — Les médecins jouent à l'hazard de nos vies. C H O L I È R E S , 2e Matinée, p. 69. Hasard. Danger que l'on court à la guerre, ba
taille. — Jérusalem estoit assiégée par Titus, prince de diverse religion, allant aux hazards et dangers comme un simple soldat. Sat. Mén., Harangue de M. d'Aubray, p. 240. — Il [le flatteur] habille en martyr le bourreau des fidelles... Il faict vaillant celuy qui n'a veu les hazards, Stu
dieux Pennemy des lettres et des arts. AUBIGNÉ, les Tragiques, II (IV, 75). De hazard. Par hasard. — De hazard j'advisay
ledict Pierre Gilles. J. L E B L O N D , trad. de TH. Mo-R U S , l'Isle d'Utopie, L. I, 3 r°.
(Prononc). — Il avoit couru beaucoup d'hasard pour son service. M O N L U C , Commentaires, L. III (II, 137). — L'acquisition et emploiteest si difficile, la débite encores plus malaisée et davantage à l'hazard. C H O L I È R E S , 2e Matinée, p. 84, — Quand l'esprit est en doubte, il faut suivre l'hazard. — C'est grand témérité prendre l'hazard pour guide. P. M A T T H I E U , Clytemnestre, II, p. 17. — Prédictions... non faictes à l'hazard. CHARR O N , les Trois Veritez, I, 8. — Les choses ne vont point à l'hazard et à l'adventure. ID., ib., I, 9.— L'homme n'a point esté faict à l'hazard et par cas d'adventure. ID., Discours chrestiens, 1, 11. — C'est assez parlé de cest empereur... qui fut cause de l'hasard de la battaille de Ravanne. BRANTÔME, Cap. estr., l'Empereur Maximilien (l, 80). — A l'hasard des harquebuzades et des zagayes des Mores. ID., ib., le Marquis dei Gouast (I, 201).— A l'hazard de leurs vies. ID., Cap. franc., l'Admirai de Bonnivet (III, 62). — Puisqu'il desiroit ce petit heur à l'hasard de son sang, la fortune estoit bien peu courtoise et fort contraire de le luy reffuser, ID., Couronnels franc. (V, 331). — Je désirerais fort... que j'eusse une bonne plume... Toutesfois, telle qu'elle est, je m'en vais l'employer à l'azard, ID., des Dames, part. I, Disc. 2, Catherinede Mi-dicis (VII, 333).
Hasarder. (Trans.). Exposer [à un danger, à un malheur]. — La beauté l'hazarda à trois malheurs. C H O L I È R E S , 5e Matinée, p. 206.
(Intrans.). Livrer bataille. — A ceste cause, donner bataille s'appelle hazarder tant en nostre langue comme en la latine et la grecque. BUDÉ, Instit. du prince, ch. 37.
Se hasarder de. Se hasarder à. — Le vent et l'air de leur nuyre n'ont garde, Beste et serpent je tiens ; nul ne s'hazarde De leur toucher. MARG. D E N A V . , les Marguerites, Comed. du Désert (II, 189).
(Prononc). — A u cœur de celle Qui tant souvent à m e gueter s'azarde. P H . B U G N Y O N , En-tasmes de Phidie et Gelasine, sonn. 42. — Le roy manda plusieurs foys à M M . de Barbazieux et de Montpezat d'hazarder une trouppe d'hommes pour aller brusler iceulx molins d'Auriole. MONL U C , Commentaires, L. I (I, 110). — Il ne doibt pas s'hasarder à toutes chozes et à toutes heurtes, ID., ib., L. III (II, 3 0 ) . — A voir comment nature entreprint de garder Celuy que la fortune entre-print d'azarder. A U B I G N É , Poés. div., 5 (III, 221). — Ils n'osoient s'hazarder à sortir du boscage, CL. G A U C H E T , le Plaisir des champs, VHyver, Chasse du loup, p. 323. — A m a n s'hazarde à tout, A m a n l'espouvantail Des princes persiens, P. M A T T H I E U , Aman, II, p. 50. — Ceux qui par-loyent d'hazarder leur canon à quelque siège. AUB I G N É , Hist. univ., XI, 13. — Pour empescher l'ennemy d'hasarder le combat. ID., Lettres et Mém. d'Estât, 14 (I, 222).
Hasardeur (subst.). Celui qui joue aux jeux de hasard. — Encore suis de maint autre mestier... Pescheur, pipeur, hasardeur, escrimeur. Anc. Poés. franc., I, 37. — Ne vueilles point estregour-mant, Joueur de dez, ne hasardeur. Ib., III, 34»-— Pour éviter donc ce grant mal, J'ay tant fait vers mes hasardeurs Qu'ilz sont tous clercz et entendeurs Que de tout ce qu'ilz gaigneront Jamais rien n'en restitueront. E. D A M E R V A L , LW.
— il
— 451 — HASTE 1
!e la Deablerie, 22 b (G.). — Les autres [fers] sont >our les joueurs et hazardeurs. B. D E L A GR I S E , rad. de G U E V A R A , l'Orloge des princes, II, 32. — jes maistres doivent garder et séparer leurs dis-àples, qu'ilz ne soient joueurs ny hazardeurs. D., ib., II, 39. — (A la cour). Vous y verrez ha-.ardeurs, maquereaux, Gens enchanteurs, devins, it desloyaulx. J. B O U C H E T , Epistres morales du Traverseur, II, 2. — N'entretenez en bourgs, citez ie villes Ceulx qui mestier font de plaisances rilles, Comme azardeurs qui font les triumphans. ;D., ib., II, vi, 8. Trompeur, imposteur? — Grand troupeau et
richeur est appelle ainsi comme d'ung croche-,eur, hasardeur et larron. Contred. de Songecreux, 102 r° (G.). — Le haut-tonnant... Encor devint in azardeur toreau, Qui, galoppant par la frater-îelle eau, Ravit joieux l'Agenoride belle. B U T T E T , 'Amalthee, 12, p. 199. Celui qui se hasarde. — Tous les folz et hazar-
ieurs ne viennent pas à leur fin. M A R G . D E N A V . , leptam., 3. (Adj.). Qui joue aux jeux de hasard. — Gens
îazardeurs ont en leur regard dé. C R É T I N , Poésies, l Molinet. Dangereux. — M a Muse... Qui contre l'obli ha-
lardeur, Epiant de loin ta grandeur, Te grave ores cette écriture. B U T T E T , le Sec. livre des Vers, Ode 2. ' Hasardeusement. Témérairement. — Et con-cludz d'exposer hazardeusement m a personne. .RAVIERES, les Merveilles descouvertes près la ville 'd'Authun (G.). — Qui m'a fait plus hazardeusement mettre la plume au papier, espérant que toute ma témérité seroit couverte et effacée par vostre debonnaireté. E. P A S Q U I E R , Lettres, 1, 17. Au hasard. — Ils ne sont capables ny de chas-
tier ses fautes, ny de le voir nourry grossièrement comme il faut, et hasardeusement. M O N T A I G N E , I, 25 (I, 186). Par hasard. — Je continuay mon chemin, qui
hazardeusement se rencontra en une rue où le noir manteau de l'obscurité ne peut estre si dominant que je n'apperçusse quantité de testes portant bois. Var. hist. et litt., VI, 259. Dangereusement. — Ayant passé fort hazar
deusement son armée... il séjourna tout un jour pour un peu refreschir ses gens. A M Y O T , trad. de DIODORE, XVII, 12. Hasardeux (subst.). Celui qui joue aux jeux de hasard. — Similiter publicis blasphematoribus pipeux et hasardeux non débet dari. 1508. M E N O T , Caresme de Tours (J. N È V E , Rev. du XVIe siècle, iVII, 117). — Le Hazardeux, Trois dez au poing pour tout mon passe-temps, Quinze sur dix, et sur huyt faire seize... C'est m o n souhait. Anc. Poés. franc., I, 314. (Adj.). Hardi, téméraire. — Personnage hasar
deux oultre mesure et hardy sans discrétion es périls de la guerre. A M Y O T , Pélopidas (G.). — D u Mayne, tu n'es donc moins vailhant que rassis... Moins heureux qu'hazardeux, et moins fier que trectable. L. P A P O N , Pastorelle, III, 1. — J'ay desjà esté hasardeux, Il faut qu'encore je poursuive, Et que je meure ou que je vive. J E A N G O DARD, les Desguisez, IV, 1. — Voylà le grand service que fit le Mediçnm, et despuis peu à peu en fit d autres et se fit signdler pour bon capitaine et hasardeux. B R A N T Ô M E , Cap. este, le Marquis de Marignan (I, 293). Faire de l'hasardeux. Agir en téméraire. —
Wand un roy faict tant de l'hasardeux et du chenal léger, il n'est pas possible qu'il n'y arrive une
fois en sa vie quelque faute ou disgrâce de fuite ou d'autre erreur. ID., Cap. estr., dom Philippe, roy d'Espaigne (11,12).
Hasçare. Havre. — L'ambassadeur d'Angleterre à la Porte avoit fait recevoir par les has-çares et ports de mer des consuls pour les marchands anglois. A U B I G N É , Hist. univ., XIV, 27.
Haschee. Peine, supplice. — Le dyable m'avoit attachée, Et maintenant en se haschée A son tourment suis restablie. Anc. Théâtre franc., III, 65.
Hascher, v. Hacher.
Hasle bouline. Mauvais matelot. — On treuve fort peu de bons mariniers, et on ne treuve que trop de hasle boulines, c'est à dire de ceux qui tirent sur les cordages. E. BI N E T , Merv. de nat., p. 114 (G., Compl., Haie bouline).
Hasler 1 et 2, v. Haler 1 et 3.
Hasleux. Qui dessèche, qui flétrit. — Le printemps de ceste année fut fort sec et hasleux, avec un vent de bize qui dessechea la terre. H A T O N , Mém., an 1567 (G., Haleux). — L'automne fut bien froid et hasleux. ID., ib., an 1575 (G.). — Le temps s'adonna à une froidure seiche et hasleuse. ID., ib., an 1580 (G.). Hasmal, mot hébraïque. Métal étincelant au
milieu du feu. — Les ardentes veues Regardent préparer un throsne dans les nues, Tribunal de triomphe en gloire appareillé, U n regard de hasmal, de feu entortillé. A U B I G N É , les Tragiques, III (IV, 141). Hastaire (hastarius). Soldat armé d'un javelot
ou d'une pique. — Principes ou princes estoit le second rent du bataillon des Romains, le premier estoit des hastaires, le second des princes, et le tiers des triaires. E T . D E LA P L A N C H E , trad. des cinq prem. liv. des Annales de TACITE, L. I, 40 r°, note marginale.
Haste 1 (hasta). Bâton.— Aucuns... usoyent de crochetz de fer et hastes ferrées, affin que, se tirans près aucunes navires des ennemys, montassent en icelles. DEROZIERS, trad. de D I O N CASSIUS, Hist. rom., L. L, ch. 79 (176 r°). Bois, manche. — Frapper du bout de la haste
de sa faux. B E R O A L D E D E V E R V I L L E , le Moyen de parvenir, Enseignement (1, 100).
Lance. — [Antoine] avec prudence et art nous délivra de la tyrannie de César plus que ne fit l'haste de Decius ne l'espée de Brutes. D E R O ZIERS, trad. de D I O N CASSIUS, Hist. rom., L. X L V I , ch. 60 (117 r°).
Dans les deux phrases suivantes, le mot haste
Haschure. Lambrequin. — Le premier à dextre portoit lescu et heaulme de Portugal, tymbré dun dragon saillant hors dune couronne dor aux haschures ou manteletz de drap dor fourrez dermines. L E M A I R E D E B E L G E S , Pompe funéralle de Phelipes de Castille (IV, 251-252). — Laultre à senestre fut Anthoine de Croy seigneur de Toul portant le heaulme dAustriche tymbré dun monceau de plumes de paon blanches en une couronne dor a tout les haschures ou manteletz de veloux cramoisy fourrez dermines. ID., ib. (IV, 255-256).
Hasle. Lumière du soleil. — D u soleil cependant la chaleur jà cuisante, Approchant du midy, se monstre plus ardente, Et le hasle drillant se void de toutes pars Ondoyer comme l'eau sur les seigles espars. C L . G A U C H E T , le Plaisir des champs, l'Esté, les Moissons, p. 127.
HASTE 2 — 452 —
semble désigner le foudre de Jupiter. — Au revers d'icelles [médailles] vous est représenté un Jupiter au milieu de quatre elemens, tenant d'une main sa haste. THEVET, Cosmogr., X, 16. — Le simulachre de Jupiter... lequel tenoit de sa main droicte une haste. ID., ib., XVI, 14. Haste 2. A haste. En hâte, vite. — Je vous
suppli' vouloir d'une joyeuse face Ces vers forgez à haste en vos mains recevoir. RONSARD, Pièces retranchées, Poèmes (VI, 194). — Le diable... veut précipiter du haut en bas tout à coup ceux qui essayent de monter trop à haste es cieux. L E LOYER, Hist. des Spectres, VII, 14. (Prononc). — Le roy l'avoit envoyé quérir à
I'haste. BRANT Ô M E , Cap. estr., le Mareschal d'Es-trozze (II, 251).
Hastement. Mouvement rapide. — Qui sont comme battements de cœur et hastements de pouls. A M Y O T , De la tranquillité de l'ame et repos de l'esprit, 16. Hastereau. Sorte de grillade. — Eschinees aux poys. Hastereaux. Fricandeaux. R A B E L A I S , IV, 59. — Ils mangeoient... fricandeaux, hastereaux, caillettes. ID., V, 26.
Hastier. Chenet portant les broches à rôtir. — Vingt-quatre brocques à rôtir de diverses grandeurs... huit paires de hattiers. Inventaire de Guillaume Arthus (G. Beaurain, Rev. des Et. rab., X, 90). — Et ces landiers à double pié, Ces hatiers, ces pale et tourtière, Ces deux poiles. BAÏF, Passetems, L. I (IV, 246). — En peu de' temps... Fut proprement dressée une belle cuisine. Les hastiers sont de bois, et contre un troncq couché Se dresse le charbon et le bois bien séché. CL. G A U C H E T , le Plaisir des champs, le Printemps, Divers plaisirs, p. 17. — Aussi n'est ce pas la le principal rouet qui fait aller le resort des broches et hastiers de nostre cuisine. P H . D E M A R N I X , Differ. de la Relig., I, m , 3. Hastif. Urgent. — Si avons advisé estre plus expédient de nous depescher deulx que de retarder pour eulx nostre entreprinse qui est si hastive et a si grand besoing de célérité. SE Y S S E L , trad. d'AppiEN, Guerres civiles, IV, 2. — Escripvez hardyment... Et ne craignez que fasse ostension De vostre escript a personne qui vive, Pour souffrir mort. — La chose est elle hatifve? — A ung mallade qui souffre mal terrible Lattante est grefve. M I C H E L D'AMBOISE, Complainctes de l'Esclave Fortuné, 40 r°.
Pressé, impatient. — Quand nous serons has-tifs, que nous serons tous bouillans, que nous jetterons nos complaintes à la volée... c'est comme si nous voulions arracher Dieu de son siège. CA L VIN, Serm. sur le liv. de Job, 27 (XXXIII, 339). — Les hommes de leur naturel sont hastifs et impatiens, en sorte que nous voudrions que Dieu nous monstrast tous les jours à l'œil ce qu'il veut faire ID., ib., 81 (XXXIV, 250). — Moyse fut fasche, voyant qu'ils avoyent anticipé, qu'ils avoyent esté trop hastifs. ID., Serm. sur le Deuter., 16 (XXVI, 63). Hastifere (hastifer). Soldat portant un javelot ou une pique. — Il y a eu pour la garde Vulcan Qui a tousjours tresbien gardé le camp, Accompagné d'un nombre d'hastiferes Pour résister a tous ces mortifieras. J. B O U C H E T , Epistres familières du Traverseur, 122. Hastille. Tranche de porc rôtie, — Luy mesmes fist les nopces à belles testes de mouton bonnes hastilles à la moustarde. R A B E L A I S , II, 31
— Il n'estoit tué pourceau en tout le voisinage dont il n'eust de la hastille et des boudins ID III, 41. " "' Atilles. — Item une frixure de porceau et toutes
les atilles pour six prébendes. Vers 1500. Ste Croix. Arch. Vienne (G., Atilles). Peut-être Atilles est-il un mot différent de hastille. Godefroy le traduit par boudins, andouilles, dépouilles d'un porc nouvellement tué.
Faut-il voir dans la phrase suivante un emploi burlesque du m ê m e mot? — Dividant gironique-ment le fil du crespe merveilleux, enveloppant les atilles des cerveaux mal calfretez. La Cresmephi-losophale, dans les Œuv. de Rabelais, III, 283. Hastivet, dimin. de hastif. — C'est Vert-Janet. Est-il bon? Non, Car il est par trop hastivet. Ane Poés. franc., I, 277. Hastiveté. Rapidité, promptitude. — La ha-tifveté et legiereté de recroistre. Jard. de santé, I, 105 (G.). — Les nobles satyres de ces montaignes... mont maintesfois poursuivie par telle hastiveté que je ne trouvoye moyen devader leur force et violence, sinon en m e mussant en la par-fondeur des bois et des tailliz prochains. LEMAIHE D E B E L G E S , Illustr., I, 25. — Lancre signifioit tardiveté, et le daulphin hastiveté. G. TOKY, Champ fleury, L. III, 43 r°. — Picrochole à grande hastiveté passa le gué de Vede. RABELAIS, I, 28, — Luy qui mourait de faim, de hastiveté grande, Dispos à toutes mains ravissoit la viande. RONS A R D , Hymnes, L. I, Hymne de Calays et de Zethés (IV, 177). — Il est dit que les anges voilent, c'est à dire qu'il y ha une telle hastiveté en eux qu'ils ont tousjours la main sur nous quand il nous en sera besoin. CALVIN, Serm. sur le liv. de Daniel, 24 (XLI, 574).
Promptitude excessive, hâte excessive, précipitation. — Ceste vertu est totalement ennemie de précipitation, de folle hastiveté et de inconsi-deration. L E M A I R E D E B E L G E S , la Couronne Margaritique (IV, 79). — Se les advocatz par hastiveté ont mal allégué et mauvaisement. Contred, de Songecreux, 104 v° (G.). — Il n'y ha nulle doute que Moyse encores ne reproche obliquement aux enfans de Ruben et de Gad ceste hastiveté trop grande. CALV I N , Serm. sur le Deuter., 16 (XXVI, 64). — Ce n'est pas sans cause que l'Escriture insiste tant à corriger nostre hastiveté, veu qu'il nous est tant difficile de faire cest honneur à Dieu qu'il besogne à sa façon, et non pas à nostre appétit. ID., Lettres, 3379 (XVIII, 437). — La hastiveté se donne elle mesme la jambe, s'entrave et s'arreste. M O N T A I G N E , III, 10 (IV, 128).
Hastiviaulx (boutons). — Les gros boutons hastiviaulx. Anc, Poés. franc., IV, 271.
Hastivité. Promptitude, hâte. — Ceste place se gaigna par la hastivité de laquelle je usay. M O N L U C , Commentaires, L. IV (II, 293).
Hâte excessive, précipitation. — Si du premier coup j'eusse esté si bouillant que d'escrire contre eux, combien que je n'eusse fait que mon devoir, toutesfois quelque chagrin eust possible eu couleur de m'arguer de trop grande hastivité. CALVIN, Contre les libertins, ch. 4. — Ceste impatience là ou hastivité trop grande est tenter Dieu, comme si nous le voulions desfier et entrer en combat avec luy. ID., Serm. sur l'Epitre aux Corinthiens, i (XLIX, 628). Hastrel, v. Hatrel. Hatier, Hatif, v. Hastier, Hastif. Hatrel. Cou. — Estranglé par le hastrel,
B. D A M E R V A L , Liv. de la Deablerie, 66 b (G., Hate-rel). — Fust pour sa trahison hocqué par le hatrel. A. M O R I N , Siège de Boul, quatr. 34 (G., Ho-chier). Hattier, v. Hastier.
Haubelon, v. Houbelon.
Haubergeon. Le mot se trouve employé pour désigner des cuirasses de l'antiquité. — Les Cas-piens, couverts d'un haubergeon espais faict de poil de chèvre, portoient arcs de canne. SALIAT, trad. d'HÉRODOTE, VII, 67. — Cettuy cy d'un bras fort va son coup deslachant Dessus le haubergeon. A M . J A M Y N , Iliade, XIII, 28 r°. On donne aussi ce nom à un vêtement de
femme, sorte de corsage, de camisole. — Ung au-berjon de satin jaune avec des passemains d'argent doré foré de trelis jaune. Ung auberjon de vellours noir decouppé non cosu avec sa forrure. 1580. Inv. de Magallonne du Port, p. 119 (Gay, Gloss. archéol). (Prov., avec le sens habituel). — [Gargantua]
vouloyt que maille à maille on feist les hauber-geons. RABELAIS, I, 11. — Cestuy acte engendre quelque aultre membre, de cestuy là naist un aultre, comme maille à maille est faict le auber-geon. ID., III, 42. On écrit aussi haut bregeon. — Je fais espieux,
haches, espées, Haut bregeons. Anc. Poés. franc., 1,80. Haubergeonnier. Celui qui fait des hauber-
geons. — Ce qui encores fait appeller hauber-geonniers les faiseurs de chemises de mailles. F A U CHET, Origines des dignitez, II, 6. Celui qui porte un haubergeon. — Ces guerriers
hanbergeonniers ou feudataires de loriques avoient sous eux d'autres nobles, lesquels, n'es-tans pas en aage de servir avec le haubert, portoient les escus ou targes de leurs seigneurs. ID., ib. Haubergerie 1, mot collectif. Hauberts, ceux qui portent des hauberts. — Soit or ouy, tant par mer que par terre, Le doulx recort des faictz de bergerie, Tendans au bruit de grant haubergerie. LEMAIRE D E B E L G E S , les Chansons de Namur (IV, 294). Haubergerie 2. Logement. — François ont eu par laboureurs la bière... Par bergeretz haubergerie maie. L E M A I R E D E B E L G E S , les Chansons de Namur (IV, 305). Haubert 1. On emploie ce mot pour désigner une
armure de l'antiquité. — Il ny avoit ne escu ne haulbert qui peust résister et soustenir leffort de lasarisse ou picque macédonienne. G. D E S E L V E , Huict Vies de P L U T A R Q U E , Paul Emile, 114 v°. Fief de haubert. Fief de chevalier. — N'est loi
sible aussy aux gentilshommes tenans fiefs de haubert soffrir le dict exercice [de la religion réformée]. M O N L U C , Lettres, 126 (V, 6). (Proverbe). — Grégoire de Tours... représente
le haubert faict de mailles joinctes et passées l'une dans l'autre, dont vient le proverbe, maille à maille se faict le haubert. F A U C H E T , Origines des dignitez, II, 6. Haubert 2, v. Aubert. Haubin, v. Hobin. Haubriaux. Gain, profit. — M. de la Tri-
mouille arriva en cette ville, venant de la part de sa Majesté, envoyé exprès vers le seigneur de «aP, gouverneur du chasteau et ville d'Amboise, pour communiquer avec luy de certaines affaires,
HAULSAIRE
attendu qu'il estoit bruit qu'il avoit intelligence avec l'ennemi. Je ne sais si c'estoit pour y attraper quelques haubriaux, ou s'il vouloit retenir la place jusques a pleine recompense, et faire sa bourse comme les autres. J. V A U L T I E R , Hist. des chos. fait, en ce roy., p. 327 (G.).
Haudain. Sorte de gomme. — La décoction de la g o m m e qui est dicte caudne ou haudain. Jard. de santé, 1, 269 (G.).
Haudi. Lassé. — Qui trouvera goust à telles viandes, qu'il ne les espargne pas. De nous, nous en sommes si saouls et si haudis que nous avons perdu l'envie de plus en taster. L'ESTOILE, Mém., 2e part., p. 619, Champollion (G.).
Haudir. Hennir. — Veit aussi ung cheval du pays des Asturcones... estre transfiguré en espèce de cynge... et en lieu de haudir chantoit, cest à sçavoir quil haudissoit plus hault quil navoit accoustumé. M I C H E L D E T O U R S , trad. de S U É T O N E , VI, 215 r°.
Haudraghe. Instrument pour nettoyer les fossés, les cours d'eau, etc. — Une haudraghe. 1517. Béthune (G.).
Haudree (?). — Si deffaut y avoit et que les denrées ne fussent bonnes et loyaux, lesdits maire et eschevins pourront prendre du pain jusqu'au nombre et valeur de cinq haudree, chascun pain couper en deux et donner pour Dieu. 1507. Prév. de Beauquesne (G.).
Hauguignolu. — Mais manger faut une hottée De charbons rouges comme feu, Et puis danser la tricotée Et demander hauguignolu. Anc. Poés. franc., I, 159. Note de Montaiglon : le gui de l'an neuf.
Hauguineur, v. Hoguineur. Hauhau. Cri.— Les hardes ça et là s'escartent
par le fort, Fuyantes le hauhau qui plus en plus est fort. C L . G A U C H E T , le Plaisir des champs, l'Esté, Chasse du loup, p. 157.
Haulbert, Haulbin, v. Haubert 1, Hobin.
Hanlcelevier. Levier servant à soulever les canons. — Chargeoirs, escovillons, boullets de fer, haulceleviers, boute feu, corde a feu, un com-bleau. xvie s. (G., Hausselevier).
Hauldez. Estrade. — Environ le milieu du-dict eschauffault... y avoit assiz un hauldez de la haulteur d'un pié ou plus, ou l'on montoit deux marches, lequel hauldez et marches... estoyent couvers d'un grand drap de pié de drap d'or frizé. Sacre et couronn. de Cath. de Méd., 2 r° (G., Haut-dois).
Haulsaire. Fier, hardi. — (A Bayard). Pieux triumphant vertueux champion... Qui de tes mains dardeur aigre eschauffees Acquis de Mars les triumphans trophées, En rapportant ton braz dextre et haulsaire Rougy du sang de Lespaigne adversaire. Pièces attribuées à L E M A I R E D E B E L G E S (IV, 363).
Hautain, arrogant, téméraire. — Se de luy em-pescher Voye et chemin il estoit nécessaire, Pour luy monstrer qu'il fait trop du haulsaire. Anc. Poés. franc., VI, 135. — Et le lisant en la prose verrez Ce que j'ay dit contre un tas de haulsaires, D u sainct honneur des dames adversaires. J. B O U C H E T , Epistres familières du Traverseur, 122. — U n estourdy, glorieux et haulsaire S'est en m o n nom efforcé de le faire, Et pour cuider m o n honneur supprimer, A bien ausé le tout faire imprimer. ID., ib., 127. — Ung h o m m e a tout mal faire prompt, Lasche, couart, portant superbç
53 —
HAULSECOL — 454 —
front, Fier, arrogant, violent et haulsaire, Pillart, meurtrier, de vertuz adversaire. ID., Epistres morales du Traverseur, II, m , 4. — Et comme donc ung prince a son désir Pourra conseil obtenir salutaire D'un h o m m e fol, iracund et haulsaire. ID., ib., II, v, 12. — E n soustenant par leurs vouloirs haulsaires Le faulx party de tous ses adversaires. ID., ib., II, vi, 4. — Celuy qui a la fortune adversaire Doit abaisser son courage haulsaire. A M Y O T , Comment il faut lire les poètes, 9.
Haulsecol, v. Haussecou. Haulse compaire. — Une chacune desdictes
dames portera en lune de ses mains ung gerule et baston de festin, que les Romains appellent au-jourdhuy ung haulse compaire. G. T O R Y , Champ fleury, L. II, 29 r°. Cohen comprend : alza compare, hausse [le verre], compère.
Haulsement, v. Haussement.
Haulsepied. Marchepied. — (Fig.). Cela leur fut comme un haulsepied et montoir pour parvenir à grands grades et à bien grands biens. S' JU LIEN, Mesl. histor., p. 396 (G., Haussepié).
Haulser, Haulseree, v. Hausser, Hausseree.
Haulseur. Hauteur. — Les chaussées des-quelz [étangs] nous pourrons... faire haulser de tel haulseur que bon nous semblera. 21 mars 1503. Arch. Meurthe (G., Hausseur).
Hault, Haultain, Haultainement, Haul-taineté, v. Haut, Hautain, Hautainement, Hau-taineté.
Haultbois. Le mot est employé pour désigner un instrument de musique de l'antiquité, assimilé à l'instrument moderne. — Lysander... s'en retourna avec chants de triumphe au son des flustes et haultsbois devers la ville de Lampsaque. A M Y O T , Lysandre, 11.
(Jeu de mots). Jouer des haults bois. Abattre les bois de haute futaie. — Ruinant les obscures fo-restz... jouant des haulx boys, et praeparant les sièges pour la nuict du jugement. R A B E L A I S , III, 2. — U n enfant de la matte... s'adressa... à un gentil-homme, grand seigneur, qui sçavoit fort bien jouer des haults-bois : luy remonstrant le dommage qu'il se faisoit, et à tout le pays, de faire couper indifféremment tous ses chesnes. G U I L L . B O U C H E T , 15e Seree (III, 124).
(Prononc). — L'aubois... sonnoit aux deuil et convoy des trespassez. A M Y O T , Que signifioit ce mot Et, 21.
Haultelisseur. Celui qui fait des tapisseries de haute lisse. — Filetier, haultelisseur, bourge-teur, sayeteur ny autre quelconque, exerceant semblables styles. 1600. Placard des archid. (G.).
Haultelissier. Celui qui fait des tapisseries de haute lisse. — Les haultelissiers, les tissotiers, les velotiers. R A B E L A I S , I, 24. — Les orfèvres, lapidaires, brodeurs... veloutiers, tapissiers et aultelissiers. ID., I, 56. Haultement, Haultesse, v. Hautement, Hau-tesse.
Haulteure. Hauteur. — Tout egualé sera tertre et haulteure. V A S Q U I N P H I L I E U L , trad. de P É T R A R Q U E , L. IV, Triomphe d'Eternité ou de Divinité. Haultier. Lieu élevé. — Par les basses parties de la ville leaue flue : et aux haultiers, ou l'eau ne peut monter, ilz ont des cisternes. J. L E B L O N D , trad. de T H . M O R U S , l'Isle d'Utopie, L. II, 38 r°.
Haultiere, Hauteur, éminence. — Et arriva
a ung moulin a vent qui est une haultiere si près du lieu ou estoient les Angloys et Françoys que ilz pouvoient veoir l'ung l'aultre. B O U C H A R D , Chron. de Bret., 174 c (G., Hautiere).
Hautlouer, v. Hautlouer.
Haumer. Frapper. — Elle s'est rebecquée, Haumant dessus son dos comme sur un cheval! T R O T E R E L , les Corrivaux, IV, 2.
Haumussé, v. Aumussé.
Haurachan. Ouragan. — Une tempeste et bourrasque si violente que les Indiens d'Uraba nommoient haurachan. L E L O Y E R , Hist. des Spectres, VIII, 10. — Je croiroy qu'autres-fois le vent de cers qui règne en la Gaule Aquitanique aurait esté autant violent et impétueux que les haurachans. ID., ib. Hausagerie. Arrogance. — Hz [les Bourguignons] furent conseillez par leurs voisins, des-quelz ilz estoyent aymez et bien vouluz, pource quilz vivoient avec eux simplement et de leur propre labeur, sans outrage, sans hausagerie et sans tyrannie... quilz dévoient avoir recours à layde divin. L E M A I R E D E B E L G E S , Illustr., III, 2 (II, 389). Haussaige. Excès, violence. — Un individu
veut par manière de haussaige faire bdsier le cul d'un pot a une hostesse. 1530. Lille (G.).
Haussaigier. Traiter avec violence, maltraiter. — U n individu traigne et hausaige ung povre h o m m e portant une muse. 1514. Lille (G.). — Un individu a haussaigié deux cordeliers passans dans la rue. 1533. Lille (G.). Violer. — U n individu paie m 1. d'amende pour
avoir de soir, estant yvre, hausaigié une fille, dont pour le crisme il s'estoit fait purgier par la court espirituelle de Tournay. 1540. Lille (G.).
Hausequeue. Porte-queue, caudataire. — Nos diacres et sousdiacres, qui servent à messire Jean prestolant de pincemes ou eschanssons... et de nausequeues. P H . D E M A R N I X , Differ. de la Relig., Il, i, 20.
Hausse. Ce qui sert à hausser. — Toucher n'y puis sans guyde ou haulce avoir. CRÉTIN, A Honorât de la Jaille, p. 216. — En vos girons n'ont pas les hausses ; Aussi n'ont garde d'y venir, Car ils gasteroient là leurs chausses. Ane Poés. franc., V, 20. '
La hausse qui baisse. Sorte de jeu. — Aussi fut-il trouvé jouant par humilité avec un enfant à un jeu qui s'appelle la bascule ou la hausse qui baisse. H. E S T I E N N E , Apol. pour Her., ch. 34 (II, 204).
Haussebec. Action de lever la tête en signe de dédain. — [Amycus] D'un haussebec le moque, et secoua la teste, Qu'un tel mignon osoit attendre sa tempeste. R O N S A R D , Hymnes, L. II, Hymne de Pollux et de Castor (IV, 287). — Tu seras tous les jours des médisans moqué D'yeux et de hausse-becs et d'un branler de teste. ID., Amours de Marie, Elégie à son livre (I, 126). — Et lors deux surveillans, qui parler m'entendirent, Avec un haussebec ainsi m e respondirent : ... Ou tu es un athée, ou quelque bénéfice Te fait ainsi vomir ta rage et ta malice. ID., Continuation du Discours des misères de ce temps (V, 341).— Haussebec. Mocqueur, défilant, ridicule, injurieux, contemp-tible. M. D E L A P O R T E , Epithetes, 205 r°. — Kour-toés etranjier, toê ki d'un pront haussebêk sou-loês déprizér nautre langu" é naus ékris. BAÏF, Etrenes de poezie fransoêze, Aus lizeurs (V, 327).
Avec un hausse-bec un chacun le broquarde. P. D E B R A C H , Poèmes et Meslanges, Monomachie de David et de Goliat. — Tu ne dédaignes point d'un haussebec de teste N y d'un sourcy hagard des petits la requeste. R O N S A R D , Amours diverses, A N. de Neufville (I, 346). — Que les hérétiques, libertins et athées et adherens des hérétiques en fassent le hausse-bec tant qu'ils voudront, si ne sçauroient-ils rien dire qui... empesche la dévotion chrestienne. L E L O Y E R , Hist. des Spectres, VI, 9. — Va, qu'un jour puisse-te, faite d'Amour esclave, Aimer qui te rudoyé, et qui d'un sourcy grave Superbe te repousse, et vange desdaigneux Avec un haussebec ce mespris de mes vœux. D u MAS, Lydie, p. 11. Moquerie. — Lupolde... escoutant les hausses-
bec et admiratives d'Eutrapel, le babil duquel il craignoit et experimentoit assez mal advanta-geusement, jetta sa fluste et guiterne bas. D u FAIL, Contes d'Eutrapel, 19 (I, 255). Haussebequer. Regarder avec dédain. — Et
désormais le colosse pipeur Pour sa hauteur ne fait simplement peur Qu'au simple sot, et non à l'homme sage Qui haussebeque et mesprise l'ouvrage. R O N S A R D , Poèmes, L. I, la Salade (V, 79). Haussechasuble. Porte-chasuble. — Des plus
malotrus d'entr'eux ont fait des diacres et sous-diacres, haussechasubles, mirecalibistres, portero-gatons. P H . D E M A R N I X , Differ. de la Relig., II, i,20. Haussecou. Haussecol. — La raine Elisa
beth... se vint jetter à genoux devant son espoux, qui n'avoit encores que le haussecou et le corce-let. AUBIGNÉ, Hist. univ.,Yl, 6. Amyot donne le mê m e nom à une pièce ana
logue de l'armure antique. — Son habillement de teste estoit d'un fer reluisant comme argent pur et fin... le haulsecol de mesme. Alexandre, 32. Hausse-cul. Sorte de tournure. — Il y a de ces
culs (qu'aucunes plus honnestes appelent hausse-culs) qui sont fort précieux : car plusieurs sont faicts de drap de soye, aucuns aussi de toile d'argent. H. ES T I E N N E , Dial. du lang. franc, ital., I, 273. Haussement. Fait de s'élever. — Regorge-
mens, haussemens, enfleures d'eaux. P O N T U S D E TYARD, Nat. du monde, 64 r° (G., Compl.). Hausse. — La huictiesme [cause de cherté] est
le haussement du pris des monnoyes. Var. hist. et litt., VII, 148. — Voilà les huict causes les principales de nostre cherté, avec lesquelles nous pourrons mettre le haussement du pris des monnoyes. Ib., VII, 178. — D u salaire des serviteurs ne se peut dire autre chose que de tascher à le rendre le plus petit qu'on pourra, pour la conséquence du haussement tousjours préjudiciable au mesnager. O. D E S E R R E S , Théâtre d'agric., I, 6. Haulsement de temps. Action de boire beaucoup.
— Par cestuy excessif haulsement de temps advint au ciel nouveau mouvement de titubation. RABELAIS, IV, 65.
Haussenais. Action de hausser le nez, la tête en signe de dédain. — Ah ! faut-il supplier, et d'un branler de teste, D'un haussenais souffrir un rebut deshonneste? R I V A U D E A U , Aman, V, p. 129. Hausser. Élever, construire. — Je te promets
et mon vœu sera tel Qu'à ton sainct nom j'haus-seray un autel. J E A N D E L A T A I L L E , Mort de Paris Alexandre. Relever. — Le marquis... s'inclinant devant
HAUSSEREE
Sa Magesté pour luy faire la révérence, le roy le haussa, l'embrassa et le recuyllit avec grandes caresses. B R A N T Ô M E , Cap. estr., le Marquis dei Gouast (I, 209). — (Au sens moral). La musique excite et resveille l'ame, délecte les sens et leurs organes, hausse les esprits melancholiques et déprimez contre terre. L E L O Y E R , Hist. des Spectres, VIII, 3.
Hausser les tables. Desservir. — Ilz trouvèrent le disner prest : et estants les tables haulsées, chascun s'en alla armer. Amadis, II, 21. — Puis estans les tables haulsées, eulx deux vindrent au lieu propre ou Esplandian avoit fait si long somme. Ib., V, 1. — Ces seigneurs et dames... trouvèrent les nappes mises, et les servit on en toute manificence. Puis estans les tables haulcées commença le bal. Ib., V, 44.
Hausser la main. Prêter appui à, soutenir, seconder. — Ce grand capitan eut pour lieutenant à sa compagnie de cent hommes d'armes dom Diego de Quignones, qui luy haussa bien la main en ses combatz et en ses victoires, et de vray luy fut bon et brave lieutenant. B R A N T Ô M E , Cap. estr., Diego de Quignones (I, 137).
Hausser le menton à. Maltraiter. Voir Menton. Hausser le temps. Boire beaucoup. — Voicy du
gourd piot à une aureille Avec des aulx, oignon-netz et bon pain, Tout appétit ; donc, en ce lieu serein, De pioter faisons raige et merveille... Haulsons le temps. Anc Poés. franc., I, 241. — Comment Pantagruel haulse le temps avecques ses domesticques. R A B E L A I S , IV, 65 (titre). — Nous en veismes douze autres banquetans souz une fueillade, et beuvans en belles et amples re-tumbes vins de quatre sortes... et nous fut dit qu'ils haulsoient le temps selon la manière du lieu, et qu'en ceste manière Hercules jadis haulsa le temps avec Atlas. ID., V, 21. — Si le temps est bas, je le hausse E n bien beuvant, voire du bon. Anc. Poés. franc., I, 77. — Et ce pourveu qu'on n'aille plus à R o m m e Haulser le temps et boire à l'abandon. Ib., VI, 177. — Le roy, voyant bien qu'il avoit haussé le temps, luy demande en riant : C o m m e sçais-tu que c'est du vin grec que tu as beu?... GUI L L . B O U C H E T , lre Seree (I, 11). — Finalement l'empereur fut contrainct de laisser hausser le temps aux bons biberons, comm' ilz avoient accoustumé. B R A N T Ô M E , Cap. estr., Charles Quint (I, 31). •Se hausser de propos. Parler avec plus de force.
— Le seigneur duc, prenant en mal ceste parole, comme trop brave et témérairement proférée, et se haulsant de propous. R A B E L A I S , IV, 11.
(Prononc). — Le cardinal Armelyn y cuyda laisser le chappeau, sans un de ses amis qui l'haussa avecqu' une corde de bas en haut. B R A N T Ô M E , Cap. estr., M. de Bourbon (I, 271). — Voir le 1er alinéa.
Hausseree. Chemin de halage. — Enlever toutes choses qui empeschent qu'on ne puisse sûrement naviguer, de faire faire les haulserees de la largeur portée pas les edits. Oct. 1515 (G.). — Faire les auxerees sur les bords et chantiers desd. rivières. 1545. Lett. de Fr. Ier (G.). — Et semblablement tous arbres et autres choses em-peschans les bords et chantiers desdites rivières, jusques a la largeur de dix huit pieds que doivent estre les haulserees d'icelles pour haller et poner a col contremont lesdits bateaux par lesdites rivières. 31 déc 1559 (G.). — Empeschans tant les cours desdites rivières que les chemins et haulserees d'icelles. Ib. (G.). — Nettoyage du lit de la rivière et hausserees. 1583 (G.). Halage. — A Joseph de l'Espoir, esperrent, de-
5 —
HAUSSERET
mourant es forsbourgs de Meung, pour passer les mariniers et marchans tirans l'auceree des challans passant par lad. rivière, vml. 1.1507 (G.).
Hausseret ? — Paires de gantelletz et de hausserez. 1557. Péronne (G.).
Haussenre. Hauteur. — Nous rencontrâmes... des moulins à eau, qui ne reçoivent l'eau que par une goutiere de bois qui prend l'eau au pied de quelque haussure. M O N T A I G N E , Journ. de voyage, p. 115. — Aucunes [rues] vont encore se relevant contremont en autres haussures. ID., ib., p. 198.
Haussier. Sorte de mentonnière couvrant le cou et le bas du visage. — 1562. Feront lesd. maistres armuriers et heaulmiers toutes sortes de harnoys pour armer l'homme, comme corse-letz, corps de cuiresse, haussiers, tassettes, bras-sarts, ganteletz, harnoys de jambes, habillemens de teste. Stat. des armuriers et heaulmiers de Paris (Gay, Gloss. archéol). Élévation. — Bien souvent la matière ny le
sens ne désirent pas telle hausseure de voix, et principalement les narrations et pourparlers des capitaines, conseils et délibérations es grandes affaires, lesquelles ne demandent que parole nue et simple. R O N S A R D , Franciade, Préface de 1587.
Haut. Grand. — Faisant venir son filz, Archi-damus... de l'aage environ de quinze ans... plus hault et plus fort que nul autre garçon de son aage. A M Y O T , De l'esprit familier de Socrates. Haute heure. Heure avancée, tard. Il est haute
heure. Il est tard. — Et arrivèrent devers César à haulte heure de nuict. S E Y S S E L , trad. d'AppiEN, Guerres civiles, II, 5. — Celle mesme nuict, estant desja haulte heure... fut ouye une grande mélodie. ID., Guerres civiles, L. VI extrait de P L U T A R Q U E , ch. 4. — Desja estoit si haulte heure que Nascian (ayant chanté sa messe) se pourmenoit. Amadis, III, 3. — Or estoit il desja haulte heure, et faisoit un chault le plus extrême qu'il estoit possible. Ib., III, 8. — Elle s'endormit jusques à qu'il féust haulte heure. Ib., III, 9. — Les tables estoient couvertes pour le disner, car il estoit desja haulte heure. Ib., V, 27. — Quand ce vint sur le matin... il s'endormit si serré qu'il estoit desja haulte heure que lon ne le pouvoit esveiller. A M Y O T , trad. de D I O D O R E , XVII, 12. — Parmenion... s'approchant de son lict l'appella deux ou trois fois par son nom, tant qu'il l'esveilla, et luy demanda comment il dormoit ainsi si haulte heure. ID., Alexandre, 32. — Il dormit un matin plus haute heure qu'il n'avoit accoustumé. ID., Dicts des anc. roys, Philippe père d'Alexandre, 27. — II estoit fort haute heure, et le soleil bien haut Pour la saison si douce estoit ardant et chaud. D E S PORTES, Angélique, p. 362. — M. du Fossé... priera le seigneur de Fanfreluchon prendre son disner avec luy, attendu... qu'il est des-ja fort haute heure. D u FAIL, Contes d'Eutrapel, VI (I, 128). — S'il dormoit ainsi haut' heure, que telle estoit sa coustume et tel son naturel quand il estoit à la cour ; mais quand il estoit à la guerre... il estoit moins endormy que le moindre soldat des siens. B R A N T Ô M E , Disc sur les duels (VI, 479). — Les observations que fit l'empereur... furent cause qu'il estoit haute heure quand il vint à la sale du Soleil, où le couvert estoit. B E R O A L D E D E V E R V I L L E , Voyage des princes fortunez, p. 715. — L'admirai ne put partir de nuict comme il désirait, estant haute heure avant de pouvoir apaiser ceux qui demandoyent de l'argent sur le point de se battre. A U B I G N É , Hist. univ., V, 16. — Il fut haute heure avant que l'un des douze les veint appeller. ID., ib,, XIV, 23.
Haute matinée. A une heure avancée du matin. — Alexandre... dormit si profondément et si haute matinée, que Parmenion fut contraint d'entrer en sa chambre... pour l'esveiller. MONT A I G N E , I, 44 (1,372).
Tardif, qui se trouve tard dans l'année. Caresme haut, v. Caresme. Haut aage, v. Aage. Haute vieillesse. Vieillesse très avancée. — En
grande breveté il se vente, et ne veult estre medi-cin estimé, si depuys l'an de son aage vingt et huictieme jusques en sa haulte vieillesse il n'a vescu en santé entière. R A B E L A I S , IV, Prologue. De haute elle, v. Aile. Haut or. Or pur. — (Fig.). Car l'Escripture est
la touche où l'on treuve Le plus hault or. Et qui veult faire espreuve D'or quel qu'il soit, il le convient toucher A ceste pierre, et bien près l'approcher De l'or exquis, qui tant se faict paroistre Que, bas ou hault, tout autre faict congnoistre. M A R O T , Epistres, 42.
H aulx habitz. Riches habits. — Veulx tu mieulx estre batue et molestée en haulx habitz que estre aymee en simple et vulgaire couleur? P. D E C H A N G Y , Instit. de la femme chrest., 1,16.
Haute jaunisse, v. Jaunisse. Haut. Fier. — Pour Bradamante ou la haute
Marphise, Sœur de Roger, il m'eut, possible, prise. L O U I S E L A B É , Elégies, 3. — Ces gens [les Rochel-lois]... sont haults de cœur, et souvent variables envers leur prince souverain. T H E V E T , Cosmogr., XIV, 4. Haut à la main. A qui l'on tient la bride haute?
— Elle [une haquenée] va doulcement... Baulte à la main et très bien embouschée, Tire à la bride et passe largement. Anc. Poés. franc., VIII, 335.
Fier, hautain, arrogant, indocile, intraitable. — Voluntiers j'eusse prins aultre voye si le roy Li-suart eust voul uy entendre : mais il s'est monstre tousjours si hault à la main que, quelque remons-trance que nous ayons fait mettre en avant par noz ambassadeurs... il n'en a tenu compte. Amadis, IV, 19. — Quoy voyans esleurent un dentre eux par commune voix plus robuste, plus saige et hault à la main pour leur conducteur. Du FAIL, Propos rustiques, A u lecteur. — Parquoy Numa pensant bien que ce n'estoit pas petite ne légère entreprise que de vouloir addoulcir et renger à vie pacifique un peuple si hault à la m d n , si fier et si farouche, il se servit de l'aide des dieux. AMYOT, Numa, 8. — Le peuple estoit encor fier et hault à la main. ID., Solon, 19. — Le peuple, qui estoit devenu hault à la main depuis la victoire de Marathon, et qui vouloit que toutes choses entièrement dépendissent de luy. ID., Aristide, 1. — N e soyez point mocqueur, ne trop haut à la main, Vous souvenant tousjours que vous estes humain. R O N S A R D , Instit. pour l'adolescence du roy (V, 353). — La noblesse y est grande et fort haulte a la main. M O N L U C , Lettres, 102 (IV, 312). — Le père d'Alenas roy de Thessalie le rebutoit et le rudoyoit pource qu'il estoit hault à la main et superbe. A M Y O T , De l'amitié fraternelle, 21. En Gambre y a un roy si hault à la main qu'il ne veult amitié ny alliance de personne. THEVET, Cosmogr., III, 1. — Ces chevaliers [de Rhodes) ont bien esté de tout temps si haults à la main (observans la promesse qu'ils font à leur profession) que jamais ils n'ont voulu traicter paix ny faire trefve quelconque avec les ennemis de la religion chrestienne. ID., ib., VII, 5. — Les Gaulois. .. sont... querelleux, haults à la main. FAUC H E T , Antiquitez, 1, 5. — Qui fut une moquerie si
45
dignement couverte que femme haut à la main et rebrassee qu'elle fust, ne s'advança désormais s'enquérir des affaires communes et publicques. Du FAIL, Contes d'Eutrapel, 33 (II, 173). — Je romps paille avec celuy qui se tient si haut à la main : comme j'en cognoy quelqu'un qui plaint son advertissement s'il n'en est creu : et prend à injure si on estrive à le suivre. M O N T A I G N E , III, 8 (IV, 14). — Car qu'un h o m m e tout seul range dessous le frain Tant de peuples guerriers ainsi hauts à la main... C'est ton œuvre pour vray, puissant Moteur du monde. M O N T C H R E S T I E N , Aman, II, p. 244. — Il estoit haut à la main et prompt à la vengeance. B R A N T Ô M E , Cap. estr., Charles de L'Aunoy (1, 229). — Tous deux furent... braves et vaillans, et hautz à la main, et peu endurans. ID., ib., M. de Bourbon (I, 289). — M. de Lautrec estoit trop haut à la main, et... vouloit imperier trop outrecuydement. ID., ib., André Doria (II, 39). Haut (subst.). Hauteur, éminence. — C o m m e
noz gens furent sur ung petit hault près de la ville, d'où on descouvroit tous les feux. M O N L U C , Commentaires, L. II (I, 380). — A la minuit nostre artillerie feust mise sur ung petit hault vis à vis de la porte. ID., ib., L. V (II, 444). — Il commanda qu'on se mist en ordre sur un petit haut, pour oster aux ennemis la veue d'un vallon. L A NO U E , Disc, polit, et milit., X X V I , 3, p. 776. — On aperceut sur un haut vers ledit Poictiers nombre de cavdlerie. ID., ib., p. 784. De son haut. En pied. — Il vist le pourtraict de
feu M. l'admirai, tout de son haut et fort au naturel. B R A N T Ô M E , Cap. franc., V'Admiraide Chastillon (IV, 326). Haut du four. Heure avancée. — Et resveront
quelques fois vers le hault du jour. R A B E L A I S , Pantagr. Prognost., ch. 6. — Quand le hault du jour aura adoulcy le temps, on pourra tailler les vignes. C O T E R E A U , trad. de C O L U M E L L E , XI, 2. — Sus le hault du jour feut par Xenomanes monstre de loing l'isle de Tapinois. R A B E L A I S , IV, 29. — Sur le hault du jour, ainsi comme il estoit en sa chambre à se reposer avec sa femme, et que lon apprestoit son soupper. A M Y O T , Vertueux faicts des femmes. Micca et Megisto. — Nous n'avons accoustumé de vaquer à telles observations, sinon au commancement ou pour le moins au hault du jour, et à l'entrée et au milieu du moys. ID., Demandes des choses romaines, 38. — Nous nous mettons encor' à chasser aux oiseaux Qui sur le haut du jour, de rameaux en rameaux Viennent pour s'abreuver. CL. G A U C H E T , le Plaisir des champs, l'Esté, Divers plaisirs, p. 171. Haut de l'âge. Age avancé, vieillesse. —- Il s'ar-
moit de patience, songeant en luy-mesme qu'il falloit porter la pénitence de la follie qu'il avoit faite d'avoir sus le haut de son âge prins une fille si jeune d'ans. D E S PÉRIERS, NOUV. Récr., 6. S'enfuir au haut. S'enfuir. — Après que les vol-
leurs eurent pillé et desrobé tout ce qu'il avoit, s'enfuirent au hault et au loing. P H . D'ALCRIPE, la Nouvelle Fabrique, p. 156. Gagner le haut. Partir, s'enfuir. — Son advis
est qu'elle doibt le haut Gaigner, si elle veut se garder de Regnaud. BOYS S I È R E S , Sec. chant d'ARiosTE, p. 32. Voir Gaigner. Prendre le haut. Partir. — Car faillant aujour
d'hui à nous prendre d'assault, Dès demain vous verrez qu'ils en prendront le hault. Ane. Poés. franc., VI, 325. Haut (adv.). Aller haut. Lever haut les pieds. —
Et ny avoit cheval, tant rude fust il et allast tant haut et incommodément qu'il pust, qui luy fist
HAUTAIN
jamais perdre l'estrieu. BRANTÔME, Vie de François de Bourdeille (X, 39).
Haut le pied. Rapidement, vite. — Il équipe six canons montez à double, et les mène haut le pied aussi viste que ses hommes. A U B I G N É , Hist. univ., XIV, 25. Porter haut. Aller fièrement. — Les jeunes gar
çons qui commencent a monter a cheval, quand ilz sentent leur cheval porter un peu plus haut, ne serrent pas seulement les genoux, ains se prennent a belles mains a la selle. S' F R A N Ç O I S D E SALES, Amour de Dieu, XI, 18.
Faire haut. Tirer trop haut. — Les croquans... tirèrent et sans passer l'œil à la mire ; pourtant presque tous firent haut. A U B I G N É , Hist. univ., XIV, 15.
Plus haut. Plus. — Mais advisez d'une nourrice ; Plus hault d'ung enfant ne nourrit. Anc. Poés. franc., IX, 137. — Qui est la femme Qui ne vous dira maintenant Que plus hault d'ung si est infâme...? Ib., IX, 139. — Jamais ne souffrit avoir plus hault de trois cohortes en la cité sans chasteaulz, tentes et pavillons. M I C H E L D E T O U R S , trad. de S U É T O N E , II, 70 r°. — Jamais ne garde-ray chevalier (que j'aye à mon povoir) plus hault d'une nuict sans le faire mourir. Amadis, III, 6. — Par laquelle loy il estoit ordonné que nul privé peust tenir en propriété plus hault de cinq cens arpens de terre. G. D E S E L V E , Huict Vies de P L U T A R Q U E , Camille, 28 v°. — Esplandian... et les aultres chevaliers... feirent serment de jamais n'arrester en lieu plus hault d'une nuyt qu'ilz ne l'eussent trouvée. Amadis, V, 44. — Il ne sçauroit avoir plus hault de trente ans qu'elle est morte. B R A N T Ô M E , Cap. franc., M. de Montpensier (V, 5).
A haut. En haut. — Vous plaist-il que nous montions à hault? Var. hist. et litt., IX, 152.
(Prononc). — Il a beau entasser Les palmes, les trophez à l'haut d'une montagne. P. M A T THIEU, Vasthi, II, p. 25. — Les roys... Sont comme grands sapins plantez sur l'haute masse D'un mont precipiteux. ID., Aman, 1, p. 14. — Le soleil reposant de l'aube entre les bras, Qui d'un tain rousoyant redore l'haut Athlas. ID., ib., II, p. 27.
Hautaigne, v. Hautain. Hautain. Haut. — Ouyr la marine flotter
Contre la rive, ou des roches haultaines Ouyr tomber contre val les fontaines. M A R O T , Eglogue au roy. — Antres, et vous fontaines, De ces roches hautaines Qui tombez contre-bas D'un glissant pas. R O N S A R D , Odes, IV, 4. — Qui n'avisa de Pair les ragions hautaines Presque en pleurs se noyer? BAÏF, Poèmes, L. VII (II, 364). — Ces humeurs transcendentes m'effrayent, comme les lieux hautains et inaccessibles. M O N T A I G N E , III, 13 (IV, 282). — A u batesme de Crist on vit du ciel hautain Sur le chef d'iceluy le Saint Esprit descendre. A U B I G N É , la Création, IX (III, 390).
Profond. — A un fourmy jadis escheut Qu'en beuvant en une fontaine En danger d'estre noyé cheut Dedans une eau assez haultaine. H A U D E N T , Apologues «TESOPE, I, 171.
Haut, élevé (en parlant du son). — La n'ot on rien que plaisance et liesse, D u bruit hautain le haut ciel en resonne. L E M A I R E D E B E L G E S , la Concorde des deux langages, lre part. (III, 112). — Démétrius, qui estoit celuy de tous les crieurs qui avoit la meilleure et plus haultaine voix. G. D E S E L V E , Huict Vies de P L U T A R Q U E , Timoleon, 106 v°. — Je m e trouvay de liesse si pleine... Que commençay louer a voix haultaine Celuy qui feit pour moy ce jour au monde. Rymes de P E R N E T T E
SI —
HAUTAINEMENT
DU GUILLET, p. 18. — Leotychidas... envoya devant sur un vaisseau léger un herault ayant la voix forte et haultaine. A M Y O T , trad. de DIODORE, XI, 8. — Souventefois mes voisines pro-cheines Apres moy crient, disant à voix hau-teines, Laodamie, de quoy te peut servir A si grand dueil et peine t'asservir? CH. FONTAINE, les XXI Epistres CTOVIDE, Ep. 13, p. 244. — Thrasybulus... crioit après ceulx qui s'en vouloyent aller : car il avoit, à ce que lon dit, la voix plus forte et plus haultaine qu'homme qui fust en toute la ville d'Athènes. A M Y O T , Alcibiade, 26. — Des sistres d'erain, d'argent et d'or, qui rendirent un son bien clair et hautain. L O U V E A U , trad. d'ApuLÉE, XI, 3. — Resonnance. Mélodieuse, douce, musicale, haute ou hautaine. M. D E LA P O R T E , Epithetes, 354 r°. — Le maistre du lieu luy envoya dire qu'il moderast un peu sa voix, car il l'avoit haultaine et forte. A M Y O T , D U trop parler, 21. — [Un lion] par la force et grosseur de ses membres et un rugissement hautain et espouvan-table, attirait à soy la veue de toute l'assistance. M O N T A I G N E , II, 12 (II, 202). — Que Jupiter te confonde, très meschant coq, avec ceste tienne ennuieuse voix si hautaine ! F. B R E T I N , trad. de LU C I E N , le Songe ou le Coq, 1. — (Fig.). Tous le confessent estre prince des philosophes, et à voix haultaine le appellent divin Platon. B. D E L A GRISE, trad. de G U E V A R A , l'Orloge des princes, II, 28.
(En parlant de la hauteur divine ou de la hauteur du rang). — Quand Dardanus... veit le roy Jasius constitué en si hautaine gloire et resplen-dissance... il en eut dueil et envie à merveilles. L E M A I R E D E B E L G E S , Illustr., 1, 14. — Là demou-ray (non pas sans souspirer) Toute la nuyct : ô Vierge treshaultaine, Raison y eut. M A R O T , Epistres, 1. — Or chacun est certain Que le grand Dieu hautain A fait cest enfant naistre De son peuple juif. M A R G . D E NAV., les Marguerites, Adorât, des trois roys (II, 100). — A moy, Qui nymphe suis de hautein parentage. C H . F O N TAINE, les XXI Epistres d'OviDE, Ep. 5, p. 92. — Sa condition [de la divinité] est trop hautaine, trop esloignée et trop maistresse pour souffrir que noz conclusions l'attachent et la garrottent. M O N T A I G N E , II, 12 (II, 279). — Combien est l'Immortel admirable et hautain, Combien sont grands les faicts de sa puissante main. A U B I G N É , la Création, XIII (III, 430).
Haut moralement, intellectuellement. — N y ha il donques aucun qui désire dentendre de nous quels et combien grans sont les guerdons et mérites de ceste emprise? Certes ilz sont les plus hautains et les plus amples de tous autres. L E M A I R E D E B E L G E S , Schismes et Conciles, 2e part. (III, 286). — Levez un peu vos espritz de terriene pensée en contemplation haultaine des merveilles de nature. R A B E L A I S , III, 18. — Si j'ay du bruit, il n'est mien, Je le confesse estre tien, Dont la science hautaine Tout altéré m e trouva, Et bien jeune m'abreuva De l'une et l'autre fontaine. R O N S A R D , Pièces retranchées. Odes, A Jean Dau-rat (VI, 96). — Il supportait les fortunes molestes Patiemment, tirant d'un cœur hautain A u but d'honneur, et non au bien mondain. ID., Epitaphe de M. d'Annebault (V, 267). — C'est pourtant un grand heur que d'aimer hautement, Car un esprit divin tend aux choses hautaines. D E S P O R T E S , Diane, L. I, Plainte. — U n stoïcien... dit qu'il a laissé d'estre épicurien pour cette considération entre autres qu'il trouve leur route trop hautaine et inaccessible. M O N T A I G N E , II, 11 (II, 127). — Lisez le fait hautain de ceste noble dame. M A R I E
D E R O M I E U , l'Excellence de la femme. — La vie de M. Regulus, ainsi grande et hautaine que chascun la cognoist. M O N T A I G N E , III, 7 (IV, 3).
Hautain (subst.). Sorte de vigne. — Ces vignes treillees appellees es Cevennes de Vivarets hau-taignes, ainsi dites pour leur hauteur, ont quelque conformité avec les hautains qu'on void le long de la rivière de Loire, au pays d'Anjou, en Pied-mont, en Italie, et ailleurs. O. D E SERRES, Théâtre d'agric, III, 4.
Hautainement (H. D. T. 1559). Hautement. — 1520. Ayant desja par long temps usé de son auctorité envers les subjectz haulteinement. SE Y S S E L , trad. de T H U C Y D I D E , VI, 10 (201 r°).
Fièrement. — Il le descrit parlant bravement et haultainement. A M Y O T , Comment on se peut louer soy-mesme, 5.
Haut (adv.). — Il ne nous faut pas abandonner l'action comme une lyre qui seroit trop hautainement montée, mais il la faut un peu relascher. In., Si l'homme d'aage se doit encore mesler des affaires publiques, 18.
Hautaineté. Hauteur, noblesse. — Par haul-taineté de lignaige, estes mis au plus hault de l'arbre de noblesse. Anc. Poés. franc., XII, 57.
Hauteur, orgueil. — Quelque chemin exempt et d'ambition et de danger, qui soit entre haul-taineté de cueur et deshonneste flaterie. ET. DE LA P L A N C H E , trad. des cinq prem. liv. des Annales de TACITE, L. IV, 142 v°. — Hautaineté de cœur, orgueil, obstination. A N T . D U M O U L I N , trad. de J. D'INDAGINE, Astrologie naturelle, p. 249. — [Les Cosseiens] perseverans encore en leur haultaineté et fierté de courage, ne s'estonnerent point pour le bruyt de la prouesse des Macédoniens. A M Y O T , trad. de D I O D O R E , XVII, 25. — [Afin] que Martius contre son naturel fust contraint de s'humilier et abaisser la haultdneté et fierté de son cueur. ID., Coriolan, 18. — La fierté et haultaineté de Martius l'empeschoit de caresser ceulx qui le pouvoyent honorer et avancer. ID., Compar. d'Alcibiade et de Coriolan, 5. — Le comm u n peuple... mesurant tousjours la grandeur du courage à la haultaineté et fierté des paroles, Tin-citoit à n'espargner point la noblesse. ID., Marius, 9. — Pompeius le filz, par une arrogance et haultaineté importune, vouloit punir ceux qui se retiraient de l'armée de mer. ID., Caton d'Utique, 55. — Pour leur rabattre un peu la hautaineté de cœur que la prospérité leur apporte. ID., Comment on pourra discerner le flatteur d'avec l'amy, 28. — Les orages et tempestes se piquent contre l'orgueil et hautaineté de nos bastimens. MONTAIGNE, 1,18 (I, 80). — La hautaineté ou orgueil. S* F R A N Ç O I S D E S A L E S , Lettres, 930 (XVI, 97).
Haut bregeon, v. Haubergeon. Haut-cornu. — (Fig.). Les Alpes haut-cornues
D'estranges tremblemens, s'esbranlerent esmeues. 1583. VIRGILE, 46 b (Vaganay, Deux mule mots).
Hautein, v. Hautain. Hautement. Haut (adv.). — Olympe est une
montagne si hautement eslevee que les habitans d'icelle l'appellent ciel. M. D E L A POR T E , Epithetes, 288 v°. — Ainsi se fait le grand soleil pa-restre D'autant petit que plus on le voit estre Hautement levé dans les cieux Pour éclairer en ces bas lieux. A M . J A M Y N , Œuv. poet., L. IV, 181 r°. — L'eschaffaut paroissoit hautement eslevé. M O N T C H R E S T I E N , la Reine d'Escosse, V, p. 108. — Quelque diligence qu'on y mette, si ne le peut-on faire monter [le fenouil] guières plus
— 4E
hautement que de quatre à cinq pieds. 0. D E SERRES, Théâtre d'agric, VI, 11. A haute voix, d'une voix haute. — Luy estoit
leue quelque pagine de la divine Escripture haul-tement et clerement. R A B E L A I S , I, 23. — Feut... ouie une voix de quelqu'un qui haultement appelloit Thamous. ID., IV, 28. En haut lieu. — Plusieurs princes d'Asie et
d'Europe... se reputoient bienheureux davoir son alliance. Et à ceste cause il maria presques tous ses enfants hautement. L E M A I R E D E B E L G E S , Illustr., 1,19. — II... maria haultement la damoy-selle de Dannemarc Amadis, V, 28. — Elle s'amoura ferventement de luy [du roi]. Et quand la feste fut cessée... il luy estoit impossible de penser à autre chose sinon à son amytié qu'elle avoit mise si hautement. L E M A Ç O N , trad. de BOCCACE, Decameron, X, 7. — Aimer hautement, C'est perdre son espoir et son entendement, La grandeur et l'amour ne vont jamais ensemble. P. M A T T H I E U , Clytemnestre, II, p. 7. Haute pièce. Haute mentonnière fixée à la
partie supérieure du plastron de la cuirasse. — 1558. Harnois d'acier de double trempe, batu, blanc et bruni, tous accomplitz de toutes pièces de heaumes avec les pennaches, visières, mentonnières et barbutes, gorgeraines, jaserans, colliers, hautes pièces, avant bras, ganteletz. Rom. d'Alec-tor, fol. 79 (Gay, Gloss. archéol). Hautesse. Hauteur (au sens matériel). —
Quand elle veit la hautesse et corpulence, force et beauté d'Hercules, qui estoit géant... elle accorda à son père... ce quelle avoit tousjours refusé de tout autre homme : cestasavoir destre alliée par mariage avec le preux Hercules. L E M A I R E D E BELGES, Illustr., I, 9. — D u vin sur lautel res-pandu si grande portion et infusion de lumière sesleva et resplendit, quelle passa oultre la haul-tesse du temple jusques au ciel. M I C H E L D E TOURS, trad. de S U É T O N E , II, 90 v°. — Nully for-tifloit maison ou chasteau par haultesse de grosse muraille. Trad. de B O C C A C E , Flammette (1537), ch. v, 67 v°. — Ses cornes donc prisa Pour leur force et haultesse, Ses jambes desprisa Pour leur seiche maigresse. C O R R O Z E T , Fables «Z'ESOPE, 36. — Du ciel la haultesse profonde. D u B E L L A Y , Sonnets divers, 33, édit. Chamard, II, 282. — Ton corps, qui, de taille et mesure, Se jette en moyenne hautesse. C H . F O N T A I N E , les Ruisseaux de Fontaine, p. 85. — Qui voudrait figurer la romaine grandeur En ses dimensions, il ne luy faudroit querre, A la ligne et au plomb, au compas, à Pequerre, Sa longueur et largeur, hautesse et profondeur. D u B E L L A Y , Antiquitez de Rome, 26. — Le nom d'Ascension... ne signifie-il pas que Jésus Christ soit bougé d'un lieu à l'autre? Ils le nient, pource qu'à leur semblant, par la hautesse est seulement notée la majesté de son empire. CALVIN, Instit., IV, xvn, 27. Sommet, cime. — A u summet et haultesse des
arbres. Jard. de santé, 1,8 (G.). — E n ses summi-tés et haultesses a un fruict délié et subtil. Ib., I, 149 (G). Noblesse de l'apparence. — Que j'aime la sa
gesse De ses discours, qui raviroient les dieux, Et la douceur de son ris gracieux, Et de son port la royale hautesse ! D E S P O R T E S , Diane, I, 26. Hauteur divine. — Dieu, qui voulus le plus
hault ciel laisser, Et ta haultesse en la terre ab-baisser. M A R O T , Chants divers, 18. — Il y a un Dieu Seigneur de tous : car ceste hautesse ne peut souffrir de compagne. Trad. de B U L L I N G E R , la Source d'erreur, 1, 6, p. 76. — Mon Seigneur, ta
H A U T E S S E
haultesse Je veulx célébrer sans cesse. MAROT, Ps. de David, 35. — Ce seroit une chose trop desraisonnable, que leur prééminence vausist quelque chose pour abbaisser la haultesse de Dieu. C A L VIN, Instit., III, p. 153. — Le Seigneur doibt recueillir ses fidèles au repoz de son Royaume... les exalter en sa haultesse. ID., ib., XVII, p. 817. — Tout le monde est comme une image vive en laquelle Dieu desploye sa vertu et sa hautesse. ID., Serm. sur le cantique d'Ezechias, 1 ( X X X V , 535). — Cognoissant l'incompréhensible haultesse de Dieu. E. P A S Q U I E R , Monophile, L. I (II, 752). — Salomon preschant la hautesse infinie de Dieu, dit que tant luy que son Filz est incompréhensible. CALVIN, Instit. (1560), II, xiv, 7. — Je veux (ô Souverain) célébrant ta hautesse, Maint psalme te chanter. D E S P O R T E S , PS. de David., 9.
Hauteur du rang. — Cestoit un beau jeu de Fortune, de voir eslever bergers si soudain à hautesse royale. L E M A I R E D E B E L G E S , Illustr., 1, 44. — Les sages et vertueuses dames ont en plus grande recommandation leur chasteté que les trésors et hautesses des princes. L E M A Ç O N , trad. de B O C C A C E , Decameron, 1, 5. — Il est dangereux aux roys et aux princes que la haultesse en laquelle ilz sont eslevez ne leur esbloisse les yeux. CALVIN, Lettres, 1636 (XIV, 342). — (A Cléo-pâtre). L'ample thresor, l'ancienne richesse Que Vous nommez, tesmoigne la hautesse De vostre race. J O D E L L E , Cleopatre, III (I, 131). — Mais en louant ainsi sa royale haultesse, Je craindrois d'offenser sa grande humilité. D u B E L L A Y , les Regrets, 178. — Vous direz (et je confesse Que vous direz vérité) Que m a basse qualité N'égale vostre hautesse. ID., Jeux rustiques, Chanson (V, 82). — Ainsi la brave hautesse D u prince qui m'est si doux, La beauté, la gentilesse S'elevent par dessus tous. R. B E L L E A U , la Bergerie, lre Journ., Chant des nymfes de la Meuse (I, 41). — La haultesse de leur estât [des princes] expose et met leur vie en la veue de tout le monde. A M Y O T , Œuv. morales de P L U T A R Q U E , Epistre au roy. — Dieu a haussé d'une humble petitesse U n berger simple en royale hautesse. V A U Q U E L I N D E L A F R E S N A Y E , Pour la monarchie de ce royaume.
Hauteur morale et intellectuelle. — Ilz eussent non seulement combatu, mais fouldroyé le reste du monde pour ce jour : auquel fut veue la hautesse de cueur de maintz chevaliers. M A R O T , Epistres, 4. — En icelle escriture il monstra... la hautesse de son éloquence et la profondité de sa sapience. B. D E LA GRISE, trad. de G U E V A R A , l'Orloge des princes, I, 36. — C'est chose indigne de la platonique hautesse et socratique gravité. D E S A U T E L S , Amoureux repos, A sa Sainte. — Où sont les ailes par lesquelles nous puissions voler jusques à une telle hautesse et si infinie, que de comprendre la majesté de Dieu? CAL V I N , Serm. sur le Deuter., 46 (XXVI, 432). — Pericles... prit... une grandeur et hautesse de courage et une dignité de langage ou il n'y avoit rien d'affetté, de bas, ny de populaire. A M Y O T , Périclès, 5. — Minerve aussi passe toute déesse Pour son esprit d'excellente hautesse. A M . J A M Y N , ŒUV. poet., L. IV, 203 r°. — Le peuple thebain... n'eut pas le cœur de prendre seulement les balotes en main, et se départit l'assemblée louant grandement la hautesse du courage de ce personnage [Ëpaminon-das]. M O N T A I G N E , I, 1 (I, 5).
Grandeur du pouvoir. — Sa laideur et sa petitesse [d'une pierre] N'empesche pourtant la hautesse De sa force et de sa valeur. R. B E L L E A U , les Amours des Pierres précieuses, la Pierre d'aron-delle (II, 238).
59 —
HAUTEUR — 460 —
Perfection de la beauté. — Dois je essayer à louer ce beau corps...? Certes ouy, monstrant par m a foiblesse Que l'on ne peult atteindre à sa haultesse. M A R O T , le Corps féminin, édit. Guiffrey, II, 283.
Orgueil, présomption. — L'homme de sa haultesse et presumption s'abaisse voluntairement soubz les plus viles créatures de la terre. C A L V I N , Instit., I, p. 4. — Je requiers seulement que, se démettant de toute folle amour de soymesme et de haultesse et ambition... il se contemple au miroir de l'Escriture. ID., ib., II, p. 53. — Il reprima l'orgueil de Thyr par les Egiptiens : la hautesse des Egiptiens par les Assyriens : l'insolence des Assyriens par les Caldeens : l'outrecuidance de Babylon par les Medois et Perses. ID., ib., XVI, p. 781. — Nous prions le Seigneur quil luy vueille donner esprit dhumilité et mansuétude, corrigeant la haultesse et folle presumption quil a. ID., Lettres, 397 (XI, 403). — Nous avons une telle hautesse en nous qu'un chacun voudrait s'eslever par dessus ses prochains. ID., Serm. sur le Deuter., 35 (XXVI, 303). — (Polyphème à Galatée). Je crein toy seule, à toy seule j'abaisse, M e tapissant, de mon cœur la hautesse. BAÏF, Eglogues, 8 (III, 50).
(Nom honorifique). — Je mettray peine de plus en plus à ce que Vostre Haultesse [Marguerite d'Autriche] apperçoive doresnavant que la resplendeur des biens que vous m e faictes esclarcist les ténèbres de mon rude esperit. L E M A I R E D E B E L G E S , Lettres (IV, 377). — S'il y a rien, prince de hault pouvoir, Qui par deçà face mal son devoir De recevoir ta haultesse honorée, Ce ne sera que m a plume essorée. M A R O T , Epistres, 15. — Madame, si j'estoys digne que vostre Haultesse se peut abbaisser de penser à moy. M A R G . D E NAV., Heptam., 70. — C'est à toy, roy, d'honorer Les vers et les décorer Des presens de ta hautesse. R O N S A R D , Odes, I, 1. — Grand prélat, quand je suis prest de me présenter Devant vostre hautesse. BAÏF, Passetems, L. III, A u cardinal de Lorraine (IV, 329).
(Prononc). — Oyez qu'il dit : O indicible hautesse... Voz jugementz sont incompréhensibles. M A R G . D E NAV., les Marguerites, Miroir de l'ame pécheresse (I, 66). — Scyan estoit si grand tant pour son haultesse comme pour la grand puissance qu'il se nommoit soy mesme empereur. D E R O ZIERS, trad. de D I O N CASSIUS, Hist. rom., L. LVII, ch. 122 (253 r"). — Elle attend la promesse De la divine et admirable haultesse. M A R G . D E N A V . , Dern. Poés., les Prisons de la reine de Nav., p. 278. Hauteur. Droits seigneuriaux, juridiction. — A la conservation des souveraineté, hauteur, prééminences et droits que nous avons, et nous appartiennent en nostre comté et pays d'Artois. Ord. de Charles Quint, 23 juin 1530 (G.). — Les-dits notaires ne pourront bailler acte ou attestations a quelque partie que ce soit, pour choses qui concerneront nos hauteurs, droits et prééminences. Ord. touch. les not., 14 oct. 1531 (G.). — Pour toutes causes emprises par eux touchant nostre domaine, hauteur et seigneurie. Ordonn. de la gouvern. d'Arras, art. 183 (G.). — Chose qui tourne ou peut tourner au grand préjudice de la levée des tailles et aydes dudit Artois, foulle du commun peuple contribuable a icelles, et diminution de droits et hauteurs de Sa Majesté illec. Placard de D.-L. deRequesens, 15 févr. 1576 (G.).
(Prononc). — E n regardant la haute hauteur D u ciel, qu'est ce que tu contemples? M A R G . D E NAV., les Marguerites, Comed. de la Nativ. de
J. C. (II, 25). — De la céleste hauteur elles sont messagères. P. M A T T H I E U , Vasthi, I, p. 12.
Haut-gourdier. Brigand? — N'est-ce pas, dis-je, grand cas... que tant de bons matois, banqueroutiers, saffraniers, désespérez, hauts-gour-diers et forgueurs, tous gens de sac et de corde, se soyent jettez si courageusement, et des premiers en ce sainct party...? Sat. Men., Harangue de M. de Lyon, p. 123. Hautime, superlatif formé par plaisanterie.
Très haut. — (A Baïf). Bravime esprit, sur tous excellentime, Qui mesprisant ces vanimes abois, As entonné d'une hautime voix De sçavantieurs la trompe bruyantime. D u B E L L A Y , Sonnets divers, 39, édit. Chamard, II, 286.
Haut-levé. D'un style élevé, sublime. — La grandeur de m o n sujet désire une diction magnifique, une phrase haut-levee. D u BA R T A S , lre Se-maine, Advertissement.
Hautlouer. Louer hautement, grandement. — Plusieurs gens... parlent incessamment de luy [Louis XI], de ses faicts, de ses dicts, et le hault louent jusques aux cieulx. SEYSSEL, Hist. de Louys XII, p. 79. — Plusieurs cytoiens de Berye vindrent au camp, qui haultlouoient Pyrrhus jusques aux cieulx. ID., Successeurs d'Alexandre, IV, 8. — Il seroit bien serviteur trop meschant, Qui maintenant espargneroit son chant Pour hault louer tes bontés et tes dons. M A R G . DE NAV., les Marguerites, Comed. du Désert (II, 249). — A un autre qui hautlouoit grandement la harangue d'un orateur. 1549. M A C A U L T , 19 (Vaganay, Deux mille mots). — Ce que je dy de la langue latine, je l'entens aussi bien dire de la langue grecque et toute autre telle que ces opiniastres langars vouldront haut-louer pardessus la fran-çoyse. T A H U R E A U , Oraison au roy (II, 195). — Je souhaitterois que ne fissiez si bon marché de vostre plume à hault-louer quelques uns que nous sçavons notoirement n'en estre dignes. E. PASQUIER, Lettres, I, 8. — Les hommes argives qui se trouvèrent entour Biton et Cleobis hault louèrent le bon vouloir de telz enfans. SALIAT, trad. d'HÉRODOTE, I, 31. — Lesquels [vers] ayans lors esté publiquement prononcez par Solon, ses amis incontinent se prirent à les hault-louer. AMYOT, Solon, 8. — L'ancien Caton respondit un jour à quelques uns qui haultlouoyent un personnage hazardeux oultre mesure et hardy sans discrétion es perilz de la guerre, qu'il y avoit grande différence entre estimer beaucoup la vertu et peu sa vie. ID., Pélopidas, 1. — Caton... l'admonesta [Métellus] doulcement et modereement, jusques à le prier à la fin et luy haultlouer sa maison de ce qu'elle avoit tousjours suyvy le party du Sénat. ID., Caton d'Utique, 26. — Je ne veux point d'un corbeau faire un cygne, N y hault-louer celuy qui est indigne. J E A N D E L A TAILLE, Hymne à Madame. — Les ambassadeurs thraciens consolans Archileonide, mère de Brasidas, de la mort de son fils, et le haut-louans jusques à dire qu'il n'avoit point laissé son pareil. M O N T A I G N E , I, 41 (I, 352). — Philopoemen, à ceux qui hault-louoyent le roy Ptolomaeus de ce qu'il durcissoit sa personne tous les jours à l'exercice des armes : Ce n'est, dit-il, pas chose louable à un roy de son aage de s y exercer. ID., II, 28 (III, 117). — On haut loue dom Jean, vray foudre de la guerre. Du BARTAS, la Lepanthe, p. 414. •— Il ne seroit paravanture pas trop mal séant à un pauvre soldat qui, n'ayant rien, s'est acquis par les armes mérite et moyen de vivre, de ne sortir hors les limites de prouesse, et la haut louer, comme les artisans font leur art.
— 461 — HAVET
LA N O U E , Disc, polit, et milit., X, p. 241. — L'empereur voulant recognoistre et récompenser de si braves soldatz, il les fit venir devant tout le camp et les haut loua. B R A N T Ô M E , Rodomontades espai-gnolles (VII, 45). — Le président Magistri reprocha à tous leur clémence pernicieuse, haut louant le roi Philippes Auguste, lequel pour un jour, disoit-il, avoit fait brusler 600 Albigeois. A U B I GNÉ, Hist. univ., II, 12.
Se haultlouer. Se louer hautement. — Chose que j'ay voulu déduire en passant, afin de couper la broche aux estrangers de se haut-louer dessus nous. E. PASQUIER, Recherches, 1,7. — Vous, qui faites profession de poésie, sçavez combien les poëtes s'en font accroire, quand il est question de se haut-louer. ID., Lettres, VIII, 10. — A l'ouïr se haut-louer et raconter ses sens, literature, et preud'hommie, et expérience. D u FAIL, Contes d'Eutrapel, 24 (II, 45). Haut-tonnant (subst.). — Baste : je n'iray
pas, et si j'y vay, le fouldre De l'haut tonnant m'esclatte, et m'amenuise en poudre. P. M A T THIEU, Vasthi, II, p. 45. — A m a n qui se bande Contre l'haut-tonnant. ID., Aman, II, p. 32. Havaner, pour Abonner. Peiner. — Elle tirait
le vin, et parce qu'elle avoit trop havane à le tirer, elle lascha un gros pet. N I C O L A S D E T R O Y E S , le Grand Parangon, 7. Hâve 1. Terne, vitreux. — Son teint estoit
plombé, ses yeux hâves et creux. R O N S A R D , Hymnes, L. II, Hymne de Pollux et de Castor (IV, 279). — Son poil estoit hideux, son œil hâve et profond. ID., Contin. du Discours des misères de ce temps (V, 346). — La langue seiche, noire et aride, regard hâve et hideux, la face palle et plombine. AMBR. P A R É , XXIV, 1. — Les yeux hâves et ternis, sa face meurtrie de coups, pasle et décolorée. S' FRANÇOIS D E SALES, Sermons recueillis, 29 (IX, 278). Sombre. — A u fond du val farouche et hâve.
La Font, perill, 17 r° (G.). Hâve 2. Avide. — Mais ta main de harpye et
tes griffes trop hâves Nous gardent bien d'avoir les espaules si braves, Riblant, comme larrons, des bons saincts immortels Chasses et corporaulx, calices et autels. R O N S A R D , Response à quelque ministre (V, 413). — [Junon] Marâtre qu'elle estoit son Hercule aleta, Qui hâve goulûment sa mammelle teta. BAÏF, le Premier des Météores (II, 2 ' ) - — [Que] Les milans charongniers et les goulus corbeaux Souillent leurs hâves becs dans tes maudits boyaux. ID., Poèmes, L. III (II, 125). — Et Venus, quittant sa place, Put de ce monstre gracieux Assez long temps ses hâves yeux. ID., ib., L. VI (II, 309). — Je louray Dieu de m a fortune, Sans que hâve je l'importune, Taschant sans fin de la doubler. ID., Passetems, L. V (IV, 445). — Puis ses enfans avoyent toutes sucées, Hâves de laict, ses mammelles laittees. A M . JAMYN, Œuv. poet., L. V, 258 r°. — U n soing et une faim hâve Suivent tousjours l'or qui croist. Luc DE LA P O R T E , trad. d'HoRACE, Odes, III, 16. — Loing du conflict des brigues-dignitez, De cours-saires d'honneurs, aux espaves trop larges, Oyze-leurs de finance hâves aprez les charges. L. P A PON, Meslanges, II, 145. Ardent. — Ja les tourtres es bois de leur nie se
souviennent, Ja hâves bec à bec les colombes se tiennent. R O N S A R D , Elégies (IV, 384, var. 1567).
Havé. Amaigri, décharné. — Ceux qui be-songnent en ce métal [le mercure] sont tous cassez et havez. T H E V E T , Cosmogr., VIII, 10. — Co m m e
pourrait une fidèle amante voir tant de tourmens en celuy qu'elle ayme plus que sa vie, sans en devenir toute transie, havee et desséchée de douleur? S* F R A N Ç O I S D E SALES, Amour de Dieu, V, 5.
Havee. Action de prendre avidement. — Tandis l'oiseau se plaignant devant son nid passe et repasse, Et ne craint pas pieteux mourir pour sa chère couvée, Qui en fin avecqueluy du serpent souffre la havee. BAÏF, Poèmes, L. II (II, 63).
Morceau que l'on prend. — La femme apporte à boire et à manger, et Colin boit, et elle dit : Avant, Colin, à ceste havee, Entendez à ceste besoigne. Anc. Théâtre franc., I, 244. — Si tost que les pastez sont cuys... Chascun en prengne sa havee Tant qu'il se bruslele palays. Act. des Apost., vol. I, 146 b (G.). — L'examen est donc contraire à ceste stupidité qui est en beaucoup de gens, quand ils viendront [à la sainte table] prendre comme une havee. CALVIN, Serm. sur l'Epitre aux Corinthiens, 18 (XLIX, 808). — (Fig.). En voyci d'une autre cuvée : Il ne démordra sa havee. BAÏF, le Brave, III, 1.
Ce que peuvent contenir les deux mains. — Pour m u y de pommes et poires sera seulement pris nu d. 1. avec havee, laquelle avee est tant que l'on peut prendre du fruit a deux mains. Avril 1575. Orl. (G.). Ce que l'on a à dire. — Car le monde aime brief-
veté, Court sermon et longue disnée, Et pour ce suis entalenté D'en dire à deux coups m a havée. Anc. Poés. franc., XII, 149.
Havement. Avidement. — Non oêzeaux devo-rans (ingrate progenie) Regardans avemant l'or jaune exagitant. T A I L L E M O N T , la Tricarite, p. 33. — Sa gueule [d'un loup] estoit de sang havement altérée. A M . J A M Y N , ŒUV. poet., L. I, Poème de la chasse, 75 r°. — C o m m e loups furieux ne man-geans que chair crue, A qui la foule immense au courage est accrue Quand ils ont sur les monts un grand cerf déchiré : Ils le rongent soudain havement dévoré. ID., Iliade, XVI, 76 r°. — Et les douleurs terribles De l'infâme Tithye, à qui paist un vautour Le foye renaissant havement à Pentour. J. D E C H A M P - R E P U S , Ulysse, V, p. 69. — (Fig.). U n petit pourrisseur havement s'attacha Dans la jambe à Salel, qui subit l'arracha. G R E VIN, Venins, I, 13 (G.).
Ardemment. — Tout ainsi les colombelles... Havement se vont baisant. R O N S A R D , Odes, II, 7. — Les tourtourelles jasardes, Le bec au bec, havement S'entre-vont baisant tremblardes. BAÏF, les Amours de Meline, L. II (I, 70).
Havet. Croc, crochet. — Les gensdarmes approchèrent et combatirent main a main cruellement, et pour mieulx advenir l'un a l'aultre avoient grans croez et havetz de fer tenans a chaynes, qu'ils gictoient d'une nef en l'autre, et les attachoient ensemble pour eulx mieulx def-faire et desconfire. J. B O U C H E T , la Noble dame, 143 v° (G.). — Ses diables estoient tous capparas-sonnez de peaulx de loups, de veaulx et de béliers, passementees de testes de mouton, de cornes de bœufz, et de grands havetz de cuisine. R A B E L A I S , IV, 13. — Je fais havetz pour cueiller meures. Anc. Poés. franc., I, 74. — Lysander ce pendant les assaillit aussi par mer... tirant en mer avec des mains et havetz de fer les vaisseaux qui estoient à l'ancre le long de la coste. A M Y O T , trad. de D I O D O R E , XIII, 33. — U n certain prescheur... leur présenta... un hom m e masqué, ayant les yeux flamboyans, un gros bec crochu, des dens de sanglier, les ongles aussi crochus, tenant un havet faict d'une estrange façon. H. E S T I E N N E , Apol
HAVIR 1 — 462 —
pour Her., ch. 36 (II, 246). — (Fig.). Accrochant tous ces titres et prérogatives de l'Eglise de Dieu aux havets de leurs crosses, mitres, tyares et bonnets croisés. P H . D E M A R N I X , Differ. de la Relig., I, h 2- . . . . . .
Fourchette ou pince pour saisir les viandes. C'est peut-être aussi le sens du mot dans l'exemple de Rabelais cité plus haut. — Plusieurs d'entre les catholiques ont fait preuve de leur suffisance à se servir dextrement de ce havet pour tirer des bonnes lippées de la marmite catholique papalle. ID., ib., I, i, 6.
Havir l. Brûler, dessécher.— La gelée havit les bourgeons des vignes et les fruits des arbres. F A U C H E T , Antiquitez, IV, 17. — Infecte bouche, et dont l'aer veut havir La belle fleur que tu n'as peu ravir. D u M A S , Œuvres meslees, p. 107. — Le feu ne sera trop proche, D'autant qu'il le haviroit Plustost qu'il ne le cuiroit. Var. hist. et litt., I, 369.
Se havir. Se dessécher. — Il seroit à craindre que la plante... se havist, estants les racines es-chauffees, à raison de la seicheresse de la terre, pour estre lasche et mal liée. L A B O E T I E , trad. de la Mesnagerie de X E N O P H O N , ch. 24.
Havissant. Qui brûle, qui dessèche. — Hasle. Sec, brûlant, noir, basanné, havissant. M. D E L A P O R T E , Epithetes, 204 v°. Havi. Brûlé, desséché. — Quelques morceaux
De merles, de lapins et de mipigeonneaux : Qui estoient tout bruslez et havis par mesgarde. FR . H A B E R T , trad. d'HoRACE, Satyres, II, 8, Paraphrase. — Il n'y a point de meilleur moyen pour mettre les mauvaises herbes tout dessus à fleur de terre, ny pour les faire havies par les chaleurs. L A B O E T I E , trad. de la Mesnagerie de X E N O P H O N , ch. 23. — Désert. Solitaire... havi, brûlé. M. D E LA P O R T E , Epithetes, 145 v°. — Esté. Chaleureux, ardent... havi. ID., ib., 167 r°. — Quand le pain est petit, il se brusle par la crouste, et demeure mal cuit au dedans, par l'obstacle de la crouste havie. GUILL. B O U C H E T , 34e Seree (V, 54). — Lors avenant ou que le pain est bruslé en sa superficie, la crouste havie empeschant l'intérieur de se cuire, ou que le pain ne se cuit presque rien, demeurant en paste. O. D E S E R R E S , Théâtre d'agric, VIII, 1.
? Le trentiesme [jour d'août] les estoilles qui sont es espaules de Virgo sont havies et cachées. COTEREAU, trad. de COLUMELLE, XI, 2.
Havir 2. Dévorer avidement. — Le paon est de grand entretien et nourriture, goulu et havissant sa pasture. LIEBAULT, Mais, rust., 1, 19 (G.). Havissement. Prononciation sèche, rude ? —
De peur que le havissement des deux lettres proférées l'une après l'autre rende la voix rude donnant peine a la bouche pour decoupper le mot en deux respirations. AB . MATTHIEU, Dev. de la lang. franc., p. 24 (G.). Havot. Sorte de mesure de grain. — 300 ra-
zieres, ung havot et demy quarreau de fourment. 1620. Rapp. de la seigneurie de Lambersart (G.).
Havre. (Prononc). — Et lors qu'il pensoit prendre L'havre de ses labeurs. P. M A T T H I E U , Clytemnestre, V, p. 70.
Hay, exclam, pour envoyer ou pour repousser. — Qui ne peult à ung molin, hay à l'autre. C R É TIN, A Molinet, p. 269. Hay avant, v. Avant, 1.1, p. 423, col. 1. — N'en
pouvoir plus hay avant, v. Haye 3. Hayage. Redevance due pour la maison qu'on
habite. — Avec le droit du hayage du Hay de la dicte ville d'Evreux. Texte de 1526 (G., Haiage).
H a y e 1, v. H aie.
H a y e 2. Sorte de danse. — Les hayes d'Aile-maigne frisques, Passe piedz, bransles, tourdions, M A R O T , Temple de Cupido. — Pour danser haye de Bretaigne Et les passepié d'Allemaigne. ID., Epistres, 57. — Les hayes. R A B E L A I S , V, 33 ms.
H a y e 3. Région ? — Patrocle le second ruant sur l'adversaire Ne fit en vain sortir sa lance de sa main, Mais frapa Sarpedon dans la haye du sein O ù le cœur sage et ferme ensemble se ramasse. A M . J A M Y N , Iliade, XVI, 86 r°.
H a y e 4, exclam., v. Avant, 1.1, p. 423, col. 1, Pouvoir haye avant. Pouvoir avancer facile
ment. — Il n'y a harnois ni chevaux chargés qui puissent haye avant en montant la dite coste. 1545. Arch. Meuse (G., Compl.).
N'en pouvoir plus hay avant. N'en pouvoir plus. — Frippelippes, tes rudes coups M'ont si bien galle et secous Et par derrière et par devant, Que je n'en puis plus hay avant. C H . FONTAINE, Complainte et testam. de F. Sagouyn (G.). Le rapprochement avec l'exemple précédent justifie l'explication donnée par Godefroy, et rend inutile la correction que je proposais au t. I, p. 423, col. 2.
Hayer i, v. Haier. Hayer 2. Haïr. — Ilz m'ont hayé d'une hayne
injuste. S1 F R A N Ç O I S D E SALES, Controverses, Avant-propos.
Hayette, v. Haiette.
Haynance. Haine. — Par cest troublement le remembrement se convertit en oubliance, l'entendement en ignorance et la voulenté en non-chaillance ou haynance. C H A M P I E R , l'Ordre de chevalerie, 47 v° (G.).
Hayne, Hayneur, Hayneux, v. Haine, Haineur, Haineux.
Hayo. Sorte de bateau. — Il n'y aura celuy de la terre qui avecques nasselles, barques... hayos... ne les aille secourir. L E L O Y E R , Hist. des Spectres, IV, 17.
Hayre 1, v. Haire 1.
Hayre 2 (?). — Quant j'ay eu veu ton euvre septénaire De bien dicter tenant sept dons en hayre. J. B O U C H E T , Epistres familières du Traverseur, 21.
Hayt, Hayter, v. Hait, Haiter.
Hayure (?). — O n escharte une hayure de bois a X L s. la mesure. 1542. S4 Orner (G, Haieure).
Hazaque. — Et luy vestirent [àParis] une ha-zaque, cestadire un habillement presque de tel sorte que les Turcz le portent à présent, tout batu en or à figures de pourpre, avec la ceinture de mesmes. L E M A I R E D E B E L G E S , Illustr., I, 43.
Hazard, v. Hasard. Hazardement. — E n ces songes profonds où
flottoit m o n esprit, U n h o m m e par la main hazardement m e prit, Ainsi qu'on pourroit prendre un dormeur par l'oreille, Quand on veut qu'à mi-nuict en sursaut il s'esveille. R É G N I E R , Sat. 10.
Hazarder, Hazardeur, v. Hasarder, Hasardeur.
Hazardier. Celui qui joue aux jeux de hasard. — Joueurs de dez et hazardiers Sont quant et eulx le plus souvent. Anc. Poés. franc., XII, 65.
Hazart, v. Hasard.
Hazegaye, v. Azagaie.
— 463 — HEBERGE
Hazeter, terme de jeu. — De ne jouer ne haze-ter les festes et dimanches aux jeux de palmes, tamis ou aultres a paine de 10 liv. 15 juill. 1566. Douai (G., Haseter). — Item l'on defîend... d'y admettre aucuns estrangiers en la dicte maison pour jouer ou hazetter aux jeux de cartes ou dez. 1602. Regl1. de police pour la ville d'Estaires (G., Haseter). Hazeteur. Joueur. — Et ne donneront argent
aux yvrognes, oyseux, belitres, hazeteurs. 7 oct. 1531. Placard touchant les monnoyes (G., Hase-teury — item l'on deffend aussi a tous manans et habitans de la dite ville de ne tenir en leur maison des joueurs ou hazetteurs soit de cartes ou de dez. 1602. RegV-. de police pour la ville d'Estaires (G., Haseteur). Hazier. Branchage. — Car en entrant en un
boys pour chercher A. se saulver, il [un cerf] y encourut mort, Car ne le peust de ses cornes percher, Tant de hazier estoit tyssu et fort. H A U D E N T , Apologues d'EsoPE, 1,147. Heaulme 1. Coiffer son heaume. S'enivrer. —
Je suis allé à la maison De vostre Alix, où l'ay trouvée Dés l'heure assez bien abbreuvee : Car j'ay bien conneu au respondre Que, de crainte de se morfondre, Elle avoit coiffé son heaume. JODELLE, Eugène, III, 1. Heaume est signalé comme mot démodé. —
Heaume aussi a il esté banni? — Ouy, des premiers. H. ESTIENNE, Dial. du lang. franc, ital, 1, 347-348. — D'un heaume, luy fut appris un armet, une bourguignotte, un accoustrement de teste. Du FAIL, Contes d'Eutrapel, 33 (II, 159). — Ce que nos anciens appellerent heaume, on l'ap-pella sous François Ier armet, nous le nommons maintenant habillement de teste. E. PA S Q U I E R , Recherches, VIII, 3. (Prononc). 1° h muette. — Qui peut froisser de
Mars le corselet et l'heaume. P. M A T T H I E U , Vasthi, I, p. 19. — Je te baille l'honneur de l'estoc et de l'heaume. ID., Aman, V, p. 119. Cf. trois exemples de J. de Boyssières dans l'alinéa suivant.
2° eau formant deux syllabes. Cf. le 1er alinéa. — Par quoy s'on veult le bras de Mars estandre En lieu loingtain, si dessoubz son heaulme II a le sens de le sçavoir entendre. Anc. Poés. franc., VI, 146. — Et ce pasteur veult qu'on forge heaulmes... Et ce pasteur est tresvindicatif. G R I N G O R E , l'Espoir de paix (I, 176). — U n enfant m'oster mon royaume 1 Je ne dois pas porter heaume S'il n'est mis en cent mille parts. M A R G . D E NAV., les Marguerites, Ador. des trois roys (II, 109). — Il le frappa au plus hault du pennage De son heaume : et puis de grand courage Doubla le coup. SALE L , Iliade, IV, 66 r°. — Je sçais faire saulce à bro-chetz... Dresser lance, forger heaume. Anc. Poés. franc., I, 75. — Et nonobstant que sans lance et heaulme Tu as conquis ce libéral royaulme. FERRY JULYOT, lre part., 23, A Luquin de Valim-berg. — Ce roy, bien que PAnglois troublast tout son royaume, Jamais qu'à contre-cœur n'affu-bloit le heaume. BAÏF, Poèmes, L. II (II, 92). — A l'entour de sa temple horriblement sonna Le pot de son heaume, au choquer qu'il donna. A M . JAMYN, Iliade, XV, 68 r°. — N y corcelets ferrez, ny targues, ny heaume, N y chevaux, ny soudards ne gardent son royaume. R O N S A R D , Bocage royal, 1" part. (ni, 196). — Ayant tant fréquenté de peuples estrangers... Porté si longuement sur la teste l'heaume. J. D E BO Y S S I È R E S , Secondes Œuvres, 22 r°. — En beuvant de ceste eau il avoit laissé cheoir L'heaume de son chef
qu'il nepouvoit r'avoir. ID., ib., 48 r°. — Et sur le mesme fleuve Où son heaume estoit de rechef il s'espreuve... A r'avoir son armet. ID., ib., 50 r°. — [Sacripant] Met l'heaume en sa teste et au cheval la bride. ID., ib., 58 v°. — Nourrissant en son ame un désir éternel D'y voir florir l'olive et rouiller le heaume. B E R T A U T , Disc. fun. sur la mort de Catherine de Medicis.
Heaulme 2. Barre du gouvernail. — Cap en houlle. Desmanche le heaulme. Accapaye. R A B E LAIS, IV, 20. — Plante le heaulme... Amure bâbord. Le heaulme soubs le vent. ID., IV, 22.
Heaulme. Coiffé d'un heaume. — Pleust aus dieux que les hommes sceussent quandt il fault estre heaulme et quandt non. FOSSETIER, Cron. Marg., VI, vi, 12.
Surmonté d'un heaume. — Consequemment marchoient quatre chevaliers deux à deux portant chacun ung escu heaulme et tymbré des quatre quartiers du roy defîunct. L E M A I R E D E B E L G E S , Pompe funéralle de Phelipes de Castille (IV, 251).
De la nature d'un heaume. — Cabasset. Mo-rionné, luysant... heaume. M. D E L A P O R T E , Epithetes, 60 r° et v°. Heaumees (cerises), v. Heaumier. Heaumier. Sorte de cerisier. — Cœurs sont assez grosses... par aucuns, sans grande raison, appellees aussi cerises heaumees, et leurs arbres heaumiers. O. D E S E R R E S , Théâtre d'agric, VI, 26.
Hebdomade (ê6So(j.âç, -âSoç). Semaine. — De rester vifz nous seroit impossible U n hebdomade. Epistre du Lymosin, dans les Œuv. de Rabelais, III, 278. — Dont advint, en succession de quelques hebdomades, qu'il en devint jalous comme un tigre. R A B E L A I S , III, 28.
Période. — Car un esprit bien prompt Umbre et ténèbre rompt, Entendant ses aubades, Qui chantent Christ venu A u temps que contenu Est en ses ebdomades. M A R G . D E NAV., les Marguerites, Ador. des trois roys (II, 99). — Ils con-vindrent ensemble que six d'entr'eux exhorte-royent par hebdomade, savoir est un chacun de six en six semaines, les dimanches seulement. P A LISSY, Recepte véritable, p. 107. — Chacun temps vault cinquante deux ans, et a quatre hebdomades, qui contiennent chacune treize ans. T H E VET, Cosmogr., XXII, 17.
Hebdomadier. Celui qui, dans un couvent ou un chapitre, est de semaine pour faire l'office et y présider (G., Compl.). — Syndic des hebdoma-diers et choristes de l'église cathédrale de Peri-gueux. 1566. Arch. Dordogne (G. Compl.). — Quatre maisons des hebdomadiers. 1579. Maisons dépend, du chap. de St Lazare. Arch. Saône-et-Loire (G. Compl.).
Hebene, Hebenin, v. Ebene, Ebenin. Héberge. Habitation, logement. — Près d'ycelluy chasteau ont construyt, faict et frasty plusieurs herberges et maisons. 9 oct. 1529. Arch. Yonne (G.). — (Pour jouer le Mystère de la Passion). Et que mettez les herberges au jeu Distinctement, et chacune en son lieu, Tant que congnoistre on puisse ceulx qui jouent. J. B O U C H E T , Epistres familières du Traverseur, 92. — Ils nous ont pris aussi les mots qu'il est vraysemblable que nous ayons de nos Gaulois : comme héberge ou herberge. H. E S T I E N N E , Precellence, p. 282. — Seulement serait-il expédient de faire paroistre quelque peu d'acheminement pour l'héberge, puys que, comme j'ay apperceu, Sa Sainteté l'affectionne bien outre. S' F R A N Ç O I S D E SALES,
HEBERGEMENT — 464 —
Lettres, 128 (XII, 29). — Il m'est advis que je vous voy des-ja en nostre petite vilette et en mon petit héberge. ID., ib., 396 (XIII, 283).
Prendre son héberge. Se loger. — Chez ledit Prince ilz prindrent leur héberge. B O U R D I G N É , Pierre Faifeu, ch. 47.
Hébergement. Action d'héberger, de loger. — On avoit donné ordre d'accommoder Pabbaye de S. Julien de Tours, pour l'hébergement de la Cour de Parlement. E. P A S Q U I E R , Lettres, XIII, 11. — Et nommons encores presbytaires les maisons destinées pour l'hébergement des curez. ID., Recherches, III, 1. — (Fig.). Jaçoit qu'il soit plusieurs foys retourné Cerchant tousjours du cueur l'hébergement. G. C O L I N B Û C H E R , Poésies, 5.
Hébergement. Habitation, logement. — Chascun tyra vers son hébergement Pour dedans litz faire reposement. M I C H E L D ' A M B O I S E , Propos fantastiques, 3. — A u povre hébergement O u il est né. B. A N E A U , Chant natal. — Je suis un chevalier estrange qui quiers hébergement. Amadis, I, 14. — A grand regret Te voy laisser ce mien hébergement. M I C H E L D ' A M B O I S E , le Ris de Democrite, ch. 14. — Les choses luy succédèrent si à propos qu'il prit d'emblée le fauxbourg du Portereau, qui estoit un hébergement fort commode pour ses gens. E. P A S Q U I E R , Lettres, IV, 20. — Ayant par ces moyens asseuré la ville, il en fit... deux demeures, dont l'une fut appellée la vieille et haute... et la basse ville, du depuis hébergement ordinaire tant des prélats et seigneurs que du commun peuple. ID., ib., XII, 10. — M. de Vitry se transporte en l'hostel de Cossé, hébergement de Bussi. ID., ib., XVII, 2. — Les premiers n'ayans eu soing de la maison de Dieu, ains en faisant un hébergement de chevaux, Dieu aussi n'eut soing de la leur. ID., Recherches, III, 10. — (Fig.). Les sciences et disciplines changent de domicile et hébergement selon la diversité des saisons. ID., Lettres, I, 5. — Jamais ne soit, Amour, que je n'ayme et n'adore Celle de qui les yeux sont ton hébergement. BAÏF, l'Amour de Francine, L. II (I, 176). — Nul ne peut plus seurement juger de la beauté des femmes que les hommes, au cœur desquels leur amour fait son hébergement. E. P A S Q U I E R , Colloques d'Amour, 3 (II, 798). — Nostre cerveau est composé de trois ventricules, dont le premier, siège de l'imaginative, occupe la partie devancière : au second, qui est celuy du milieu, se loge le jugement : et celuy qui est en derrière, qu'ils appellent le cerebelle, l'he-bergement de nostre mémoire. ID., Recherches, VIII, 8.
Bail. — Vous serez là... non point comme si je vous vendoye la terre : mais je vous fay comme un hébergement à temps, que vous serez là comme un granger sous son maistre. CA L V I N , Serm. sur le Deuter., 93 (XXVII, 316). — C o m m e un seigneur, quand il baillera quelque terre en hébergement (qu'on appelle), il se réservera quelque censé, quelque hommage, pour monstrer que le bien procède de luy. ID., ib., 145 (XXVIII, 246). Héberger (intrans.). Loger, se loger, habiter, séjourner. — Ce que facilement il creut, et pour celle nuict herbergea avecques le meunier. R A B E LAIS, I, 30. — Galaor fut d'advis de herberger pour la nuict auprès de la fontaine. Amadis, III, 6. — Et puis irons voir tes étables O ù ton bestail vient héberger. BAÏF, Eglogues, 18 (III, 101). — Il se vient présenter un grand lion affreux, Le plus fort et massif, le plus espouventable Qui jamais hebergeast au Taure inhospitable. R. G A R N I E R ,
Hippolyte, 174. — Quand, rebroussant chemin, tout chaud, Phlegon héberge Chez le Cancre brus-lant. D u B A R T A S , lre Semaine, 4e Jour, p. 201. L'autre presque tousjours héberge dans la boue Des estangs engourdis. ID., ib., 5e Jour, p. 220. Geste princesse hebergeoit au royaume de Bourgongne avec Theodoric E. P A S Q U I E R , Recherches V, 16. — Celle nuict les sœurs habergerent en celle' abbaye en une chambre assez mal disposée. Le levain du calvinisme, p. 211 (G., Herbergier). — (Fig.). L'ambition extraordinaire, meurdriere de tous les Estats, n'hebergeoit lors en son cerveau. E. P A S Q U I E R , Recherches, III, 12. — Laissons ce mot de singerie à ceux qui, par occasion, sous deux narrations fabuleuses, voulurent représenter l'infirmité qui herberge en nous. ID., Lettres XVIII, 3. On trouve souvent la forme primitive herberger
soit dans l'emploi intransitif (voir ci-dessus), soit dans l'emploi transitif ou réfléchi. — Car on m'a dit... Que tu n'as point où ton doy herberger. B O U R D I G N É , Pierre Faifeu, ch. 44. — Pour soy herberger celle nuict. R A B E L A I S , I, 38. — Nous avons aussi le verbe héberger ou herberger. H. EST I E N N E , Precellence, p. 282.
On dit aussi aberger, haberger, (Voir le premier alinéa). — Puis que en ce monde aucun remède na Dieu qui tout fait et commandé a Bien aberger luy plaise son ame. L E M A I R E D E BELGES, Exploration de Pitié (IV, 180). — Aberges povres pèlerins. Anc. Poés. franc., Il, 241. — Des chasteaux en Espaigne N'aberge en toy. D E S PÉRIERS, les Quatre princesses de vie huntaine (I, 116).
(Prononc. : h aspirée). — Bruit se héberge icy : quand il s'habitua, Sur le plus haut cartier son palais situa. BAÏF, Passetems, L. III (IV, 351).— La marmoteine II pria le vouloir loger... Elle accorda le héberger. ID., les Mimes, L. III (V, 168). Hebergere. — Je concludz... Que je ne seray plus vostre homme, Ne vous plus nostre mesna-gere. Vous estes grande hebergere D'avoir tous les ans douze enfans. Anc Théâtre franc., I, 61.
Hébergeur. Qui héberge. — Hospital. Fondé, charitable, aumosnier, commun, hébergeur, i. logeur. M. D E L A P O R T E , Epithetes, 213 r°.
Hebergier. Celui qui héberge. — (Fig.). Comme est le lys, selon Saincte Escripture, Environné d'espineuse hebergier : Aussi Marie est entre la closture Des filles, non asservye au danger Ou loy commune les entend obliger. CRÉTIN, Chant royal. Édit. Chesney : espineux héberger.
Hebetation. État d'une personne hébétée. — [Dieu] veult souvent sa gloire apparoistre en l'he-betation des saiges. R A B E L A I S , III, 43.
Hebeter. Affaiblir. — Comme si le chant des coqs hebetast, amolist et estonnast la matière et le boys du suzeau. R A B E L A I S , IV, 62. Hebeté. Émoussé, affaibli. — Par iceux sacre-
mens... il [Dieu] se manifeste à nous selon quil est donné à nostre sens hebeté de le pouvoir co-gnoistre. CALVIN, Instit. (1560), IV, xiv, 6. Anéanti. — Ostant ceste emplastre, laquelle d
avoit long temps portée, il se trouva qu'il avoit perdu cest œil et la veue, son action estant hébétée pour avoir esté l'œil long temps sans exercice. GUILL. B O U C H E T , 19* Seree (III, 233).
Hebetitude. État de ce qui est émoussé, affaibli. — Pour ce fault preveoir et préméditer les biens et les maulx, comme en l'entendement célérité, tardité, simplicité, malignité, hebetitude. P. D E C H A N G Y , De l'office du mary,ch. 2.
— 465 — HELAS
Hébétude (hebetudo). Faiblesse d'esprit, sottise. — Et marchoient avec elle [glotonnie] inepte joye, trop parler, ebetude, immundicité et yvresse. J. B O U C H E T , Triumphes de la noble dame, 124 r° (G., Compl.). — Ce qui avoit semblé nyai-seté et hébétude desprit nestoit aultre chose fors constance et immobilité a lencontre des passions. G. D E SELVE, Huict Vies de P L U T A R Q U E , Fabius, 46 r°. — Lors que je suis en m a secrète estude, Disant à Dieu m a trop grand hébétude. J. B O U CHET, Epistres familières du Traverseur, 94. — Chascun dit mal de Testât ou estude Qu'il a laissée, et par son hébétude II hait tous ceulx qui suyvent cest estât. ID., Epistres morales du Traverseur, 1,2. — Ignorance, et hébétude, avec négligence de sçavoir. B U D É , Instit. du prince, ch. 2. Hebrieu. Hébreu. — (Adj.). Icy David, le
grand prophète hebrieu, Nous chante et dit quel est ce puissant Dieu. M A R O T , PS. de David, Au roy. — Ainsi nous le tesmoigne le capitaine et philosophe hebrieu Moses. R A B E L A I S , III, 8. — A fin que l'on te prise De cœur entier, comme le peuple hebrieu Libre le feit. R. B E L L E A U , la Bergerie, 2e Journ., Chant de triomphe (II, 38). — Ou chantant des rois des louanges, Ou du grand Dieu, le roy des anges, Apres le roy prophète hebrieu. BAÏF, les Mimes, L. I (V, 41). — Les premiers sont anciens, juges du peuple hebrieu. A U B I G N É , les Tragiques, III (IV, 138). — C'est pourquoy Dieu maudit les roys du peuple hebrieu. ID., ib., V (IV, 205). — (Subst.). Il n'y a nulle doubte que les passages que cite l'Apostre en l'Epistre aux Hebrieux n'appartiennent au seul Dieu. CALVIN, Instit., IV, p. 222. — Le mot qu'ont les Hebrieux pour signifier pénitence signifie conversion. ID., ib., V, p. 303. — Pour ceste occasion défendoient les Hebrieux que, l'année que l'homme estoyt marié, il n'allast poinct à la guerre. M A R G . D E NAV., Heptam., 70. — Je vous donne pour vos estreines L'amour chanté par un Hebrieu. R O N SARD, Odes, V, 8. — Remarquant de louable envie Des grands héroïnes la vie Es vieux Ebrieux, Romains et Grecs. BAÏF, Poèmes, L. VIII (II, 384). — Il a de tels propos les Hebrieux estonné. P. D E BRACH, Monomachie de David et Goliat. — Bref, que le sang fumeux ruisselle de la gorge Des Hebrieux massacrez et çà et là regorge. M O N T C H R E S TIEN, Aman, 1, p. 242. Hébreu, langue hébraïque. — Les belles grandes
librairies en grec, latin, hebrieu. R A B E L A I S , I, 53. (Adj.). Hébraïque. — Je ne parle point des loix
hebrieues, mais du droit romain. M m e s D E S ROCHES, Secondes Œuvres, Dialogue de Placide et Severe. (Prononc). — Dans les exemples en vers, on
voit que ieu ne forme qu'une syllabe. Hec 1. Crochet. — Gons a hecz pour les cres-
teaulx des murailles. 1519. Béthune (G.). Hec 2, v. Hic.
Hécate. Centaine. — Je brusle avecq' mon ame et mon sang rougissant Cent amoureux son-netz donnez pour mon martire, Si peu de mes langueurs qu'il m'est permis d'escrire, Souspirant un hecate, et mon mal gémissant. A U B I G N É , le Primtems, I, 96. Hécatombe (masc). — Là ou Xerxes feit son grand hécatombe, Sacrifiant pour un jour mille bœufz. L E M A I R E D E B E L G E S , Epistre du roy à Hector de Troye (III, 84). — Et s'il faut qu'en un jour dessus ces autels tombe A l'honneur d'un faux Dieu maint souef hécatombe. D u B A R T A S , Judith, 1, p. 351.
Hecqueur. Celui qui coupe du bois. — Hec-queur de bois. 1552. Valenciennes (G.).
Hectique (ÉXTIXÔÇ, continu). — Il se fera une fièvre hectique, ainsi nommée pource qu'elle est stable et difficile à guérir. A M B R . P A R É , X X , i, 2. — Osman, malade d'une fiebvre ectique, et tout le corps de l'armée se sentant de sa teste, fut d'ad-vis d'eslongner ses forces des Perses. A U B I G N É , Hist. univ., X, 19.
Étique. — 1544. Chasse pensers qui te rendent hectique. J. M A R T I N , trad. de S A N N A Z A R , Arcadie, 56 v° (Vaganay, Rev. des Et. rab., IX, 308). — L'ame d'un home endebté est toute hectique et discrasiée. R A B E L A I S , III, 23. — L'un devient goûteux, l'autre hectique. R O N S A R D , Pièces retranchées, Odes (VI, 65). — Navré de vos beaux yeux, je freine languissant, Sec, ectique et perclus, les trames de m a vie. R. B E L L E A U , la Bergerie, 2e Journ., Baisers (II, 102). — 1585. Le trop de sec rend l'homme ectique et sec. P. T H E -VENIN, dans la Sepmaine de D u B A R T A S , 127 (Vaganay, Pour l'hist. du franc, moderne). — Mandu-cage, devenant comme ectique de sa playe, fut conseillé d'employer Lansac et Rochepot... pour, avec un saufconduit du duc de Mayenne, pouvoir changer d'air. A U B I G N É , Hist. univ., VIII, 18. Hectoride. Descendant d'Hector. — Icy sera
tenu l'empire par l'espace De trois cens ans entiers sous Phectoride race. 1583. VIRGILE, 96 b (Vaganay, Deux mille mots). Hedart. Sorte de cheval léger. — Vous avez
tant de sagectes et d'arcz, De pallefroys, de cour-cyers et hedarts Que c'est assez pour assaillir les Turcz. J. D ' A U T O N , Chron., 66 v° (G.). — Tant sur courciers, chevaulx legiers, hedars, CRÉTIN, Compl. sur la mort de Guill. de Bissipat, p. 52. — Mais moy monté sur le gentil hedard De charité, luy feit passer sa gloire. J. B O U C H E T , Triumphes de la noble dame, 11 r° (G.).
(Adj.). Rapide. — La nobles souldars, Serviteurs de Mars, Sur 'courciers hedars Ardans com' lyepars, Leurs bons corps monstrerent. J. M A R O T , Voy. de Venise, 95 r° (G.). — Grison fuz hedard Qui garrot et dart Passay de vistesse. CL. M A R O T , Épitaphe du cheval de Vuyart. — Il se peut que, dans ces vers de Cl. Marot, grison soit adjectif, et que hedard, substantif, signifie cheval léger.
Hedymythe, mot forgé au moyen de rjo-jç, agréable, et (J.06OÇ, parole. — Quand nous voulons parler d'un donneur de belles paroles, ou donneur d'eau bénite de cour, nous disons, C'est un chres-tologue : ou, C'est un caloncythe : ou, C'est un hedymythe. H. E S T I E N N E , Dial. du lang. franc, ital, II, 209. Hegronneau. Héronneau. — Hegronneaux,
foulques, aigrettes, ciguoingnes. R A B E L A I S , I, 37. Helas. Ce mot n'exprime pas toujours la tris
tesse. — Que chacun dance, Helas ! d'un joyeux cœur. M A R G . D E NAV., les Marguerites, Chansons spirituelles (III, 145). — Changeons en verd nostre noir, Et pour le voir Saillons en vie éternelle ; Car par son zèle, Helas ! avons pouvoir. EAD., ib. (III, 147). — Helas ! qui est ceste femme qui sort? L A RIVEY, le Morfondu, IV, 7.
(Subst.). Le grand helas. Le grand malheur. — Mais ce luy est bien le grand helas, quand elle est assaillie d'une suite de trente ou quarante mots qui sont ainsi semblables. H. E S T I E N N E , Precellence, p. 67. Le petit helas, nom donné à une sorte de danse.
R A B E L A I S , V, 33 ms.
IV 30
HELBOT — 466 —
Las reste encore quelque temps variable. — Hee lasse, amour usoit desja en moy... de crude-lité qui oncques ne fut ouye. Trad. de BOCCACE, Flammette (1537), ch. i, 9 r°.
Helbot. Sorte de boisson. — Deux tonneaux de helbot. 1563. S* Orner (G.).
Helenin. D'Hélène, digne d'Hélène. — Couleur cyprine, un visage helenin Sous teint rusé, sous un semblant bénin. V A U Q U E L I N D E LA F R E S N A Y E , les Foresteries, II, 4. — Beauté... nym-phale, helenine, virginale. M. D E L A P O R T E , Epithetes, 47 r°. Helepolide (ÉXÉnoXtç, qui prend les villes). —
Balistes, scorpions, et autres machines bellicques repugnatoires et destructives des helepolides. RA B E L A I S , III, Prologue.
Helequin. Génie malfaisant, démon. — Dan-gier, Envie, Maie-Bouche Sont tout par tout faulx helequins. Anc Poés. franc., III, 224.
Héliades ('HXià8sç, filles d'Hélios). — Où estes-vous, maistresses Héliades? Anc. Poés. franc., XI, 98.
Helique (éXtxciç, qui se recourbe). — Par-faicte fut si haulte architecture, O ù entaillant toute lineature, Y fueilla d'or a corroyés heliques. M A U R I C E S C È V E , Délie, 418. — Avec mignonne base et fueilleux chapiteau Gentement encongné d'helique voluteau. ID., Microcosme, L. III, p. 93.
Helle, v. Aile.
Hellend. Élan. — Cecy me fait souvenir du pied d'hellend, duquel plusieurs font si grand cas, spécialement luy attribuans la vertu de guarir de l'epilepsie. A M B R . P A R É , Disc, de la licorne, 19.
Helops (ëXo p et êXo^, lat. : elops et helops, esturgeon). — Helops, qui est un poisson de goust fort délicieux et plaisant. C O T E R E A U , trad. de Co-L U M E L L E , VIII, 16.
Helvenacie (helvenaca vitis, vigne à sarment rampant). — Celsus faict un tiers rane des vignes qui sont de grand rapport seulement, comme celles qu'on appelle helvenacies. C O T E R E A U , trad. de C O L U M E L L E , III, 2.
Helvole (helvolus). — Il y a une aultre sorte de vignes dictes helvoles, qui sont de couleur violet. C O T E R E A U , trad. de C O L U M E L L E , III, 2.
Helxine (éXÇiVn, pariétaire). — Helxines, peta-sites. R A B E L A I S , III, 50.
Hématite (H. D. T. Ambr. Paré). — 1559. La pierre hématite, nommée vulgairement lapis, est très cognue de tous. M A T H É E , trad. de DIOSCORIDE, 502 b (Vaganay, Pour l'hist. du franc, moderne).
Hembourg, v. Hambour.
Hemee. Bataille. — Ça, seigneurs, a la départie, Chascun de vous se mecte en point, Car certes je ne doubte point Que nous n'ayons grosse hemee. Act. des Apost., vol. I, 49 a (G.).
Hemicraine (fnuxpow'a). Migraine. — Encores pourrions nous particularizer des ischies, hernies, hermicraines, par ceste raison pythagorique. R A BELAIS, IV, 37.—Hemieraines. Vous les appeliez migrdnes, c'est une douleur comprenente la moytié de la teste. R A B E L A I S , L. IV, Briefve déclaration. — Migraine (pour micrainé), maladie de teste, hemicranie, rin<xpaîva, suivant lequel mot il fauldroit dire hemicraine; ou, suivant l'autre plus usité, %sxpavt'a, on devroit dire hemicranie. H. E S T I E N N E , Conformité, Mots françois pris du
grec, p. 215. — Nous usons de ces remèdes... es douleurs de teste, hemicranies, epilepsies. A M B R PARÉ, XXV, 33.
Hémicycle (H. D. T. 1557). — 1547. On dict que Bérose de Chaldée inventa l'hémicycle, ou demyrond cave en un quarré. J. MARTIN, trad. de V I T R U V E , Archit., 132 a (Vaganay, Pour l'hist. du franc, moderne).
Hemiole (rijucSXtoç, qui est dans le rapport de trois à deux). — Et fut la musique serrée en la mesure plus que de hemiole. RABELAIS, V, 24.
Hemiplexie. Hémiplégie. — L'hemiplexie, c'est a dire l'entreprise de la moitié du corps. J. L I E B A U L T , Secr. de medee, 148 v° (G., Compl.).
Hemispere. Hémisphère. — Les bons facteurs du gallique hemispere. M A R O T , Complaintes, 5. — Basse planète, à Penvy de ton frère... Tu vas lustrant l'un et l'autre hemispere. M A U R I C E SCÈVE, Délie, 282. — L'homme... se délibère... Voyageant tournoyer tout ce grand hemispere. ID., Microcosme, L. II, p. 50. Hémisphérique (H. D. T. 1576). —1551. Fi
gure hémisphérique. O R O N C E FINE, Sphère du monde, 17 v° (G., Compl.).
Hémitritée (ruwpiTaîoç). — Les [fièvres humorales] composées sont plusieurs, la demy tierce ou hémitritée. A M B R . P A R É , X X , i, 8. — Des
fièvres humoralles composées, et premièrement de Phemitritée. ID., X X , i, 32 (titre). — Parla guérison d'une espèce de fièvre qu'il appelle hémitritée. T A B O U R O T D E S A C C O R D S , les Bigarrures, Des faux sorciers.
Hemorrhoïdal (H. D. T. Ambr. Paré). — 1559. Les veines hemorrhoïdales. M A T H É E , trad. de DIOS C O R I D E , 45 b (Vaganay, Pour l'hist. du franc, moderne).
Hemorrhoïde (adj.). Hemorrhoïdal. — Autour d'iceluy sont certaines veines nommées he-morrhoïdes. A M B R . P A R É , I, 15.
Hemorrolsse (adj. fém.). [Femme] qui a des hémorrhoïdes. — La Cananée vint pressée de l'affliction de sa fille ; la femme hemorroïsse pour recevoir la santé. S* F R A N Ç O I S D E SALES, Sermons recueillis, 48 (X, 82). — (Subst.). Plusieurs s'approchent de Nostre Seigneur : les uns pour l'ouïr, comme Magdeleine ; les autres pour estre guéris, comme Phemorroïsse. ID., Amour de Dieu, Vil, 3.
Henille. — Les henilles de Gaïetan. RABELAIS, II, 7. Sainéan pense que le mot pourrait être une variante d'anille, béquille, pris au figuré. Hennin. — Sur tout les accoustremens de
teste des dames estoient estranges. Car elles por-toyent de hauts atours sur leurs testes, de la longueur d'une aulne ou environ, aiguz comme clochers, desquels dependoyent par derrière de longs crespes a riches franges, comme estandars. Ce prescheur avoit ceste façon de coiffure en tel horreur que la plupart de ses sermons s'addressoyent a ces atours des dames : avec les plus véhémentes invectives qu'il pouvoit songer, sans espargner toute espèce d'injure dont il se pouvoit souvenu1
et dont il usoit et debaquoit à toute bride contre les dames usans de tels atours, lesquels il nom-moit des hennins, P A R A D I N , Ann. de Bourg-, p. 760 (G.).
Henouard, v. Hanouard. Henricus, Henri. Monnaie d'or frappée sous
Henri II. — Voyez cy argent content... Ce disoit monstrant son esquarcelle pleine de nouveaulx
— 467 — H E R B E
henricus. RABELAIS, IV, 6. — De mille henris d'or et de pois, J'en faits tel conte que de pois. FORCADEL, ŒUV. poet., p. 157.
Henteur, v. Hauteur.
Heouse, mot provençal. Yeuse. — Ce que voyons es lauriers, palmes, chesnes, heouses. R A BELAIS, III, 49. — Chesnes verts ou eouses nommez en latin ilices. B E L O N , Remontrances d'agriculture, p. 39 (Sainéan, Rev. du XVIe siècle, V, 66). Heptagonne (adj.). Heptagonal. — En figure
heptagonne. R A B E L A I S , V, 42.
Heptaphone (éitrdiçtDvoç, qui répète sept fois le son). — Le porticque dit heptaphone, en Olym-pie. RABELAIS, V, 1.
Heptasyllabique. Qui répercute sept syllabes. — Entre les antiques on remarque deux lieux par excellence où l'écho estoit heptasyllabique. T A B O U R O T D E S A C C O R D S , les Rigarrures, 1,16. Her. Seigneur. — Cria tout hault : hers, par
grâce, peschez le. R A B E L A I S , I, 2.
Héraclès (?). — Tant de nuicts qui nous font les heracles hurler. 1574. P E R R I N , à 4 (Vaganay, Deux mille mots). Héraclien. — Le nénufar, surnommé héra-
clien. Du PINET, trad. de PLINE, II, 333 (Vaganay, Deux mille mots). Héraclitique. Triste comme Heraclite. — Qui
sera aussi tant héraclitique qui ne s'esclatte de rire...? H. ESTIENNE, Apol. pour Her., ch. 34 (II, 195). (Subst.). Écrit conforme à l'humeur d'Hera
clite. — Je fais là un héraclitique Et un discours philosophique, Puis je conclus qu'aiant gousté Des hommes l'imbécillité, Tu pleures sur la créature. AUBIGNÉ, le Primtems, III, 22. Heraclitizant. Pleurant comme Heraclite. —
Ensemble eulx, commença rire maistre Janotus, à qui mieulx mieulx, tant que les larmes leurs ve-noient es yeulx... En quoy par eulx estoyt Demo-crite heraclitizant et Heraclyte democritizant représenté. RABELAIS, I, 20. Heraise, v. Herese 1. Herasser, v. Harasser.
Heraulté. Proclamé par le héraut. — Aussi estoit ceste dame d'honneur De hault estât he-raultée en greigneur, Voyant fleurir ses enfans auprès elle. Anc. Poés. franc., VI, 167. Héraut. (Prononc). — Nous avons sceu en la
fin pourquoy lherault de Berne nestoit point retourné parla. CALVIN,Lettres, 1746 (XIV, 544). — L'héraut ira criant d'une bruyante voix. P. M A T THIEU, Aman, II, p. 50. — Il ne voulut jamais recevoir ny ouyr l'héraut de l'empereur. B R A N TÔME, Disc, sur les duels (VI, 456). Herbade. Herbe. — La feront nayades Et les
oreades, Dessus les herbades, Aubades, gambades, De joye eschauffees. L E M A I R E D E B E L G E S , le Temple d'Honneur et de Vertus (IV, 194). _ Herbage. Herbe. — A ceste [déesse] les anciens offraient sacrifices à fin qu'elle print garde aux herbages qui naissoient aux champs. B. D E LA GRISE, trad. de G U E V A R A , l'Orloge des princes, 1,12. Légume. — Ilz leur envoyoient des poulets, des
œufs, des herbages, des fruicts, et aultres menues denrées de leur mesnaige. L'HOSPITAL, Reform.
de la Justice, 6* part. (V, 243). — Le médecin Antigone... luy ordonnoit l'abstinence de vin, vivre d'herbages. F. B R E T I N , trad. de L U C I E N , le Menteur, 8. — Les femmes du royaume de Naples... de tous temps ont mieux aimé avoir le ventre de bureau que de velours, c'est à dire manger fruits, herbages et autres choses de mauvais suc... que manger viande de bonne nourriture, pour espargner, estre braves et bien accoustrees. A M B R . P A R É , XIX, 15. — Varron dit qu'on appelloit ainsy anciennement une façon de pastis-serie ou de farce où l'on mettoit plusieurs sortes d'herbages et de viandes. Sat. Men., 2e Advis de l'Imprimeur.
(Prononc). — Car premier il créa l'arbre avecques son fruyt, Semblablement l'arbage et la plante il construit. A U B I G N É , la Création, II (III, 339). Herbagerie. Composition d'herbes faite par
magie. — Faire enchantement et herbageries. D u VERD.,DJV. Zep.,p. 79 (G.). Herbageux. Herbeux. — Es champs humides
et herbageux. C O T E R E A U , trad. de C O L U M E L L E , L. I, Préface. — Pourquoy vas-tu frapant Des traits plus allumez de la roide tempeste L'Her-monien coupeau, ou bien l'innocent faiste De Pherbageux Carmel? D u B A R T A S , Judith, IV, p. 393. — Sera-ce aux monts ombrageux De Thessalie, où Penee Par les vallons herbageux Fait une course obstinée? R. G A R N I E R , la Troade, 1146. De la nature des herbes. — De vouloir recher
cher chacun simple herbageux, Cette carrière est longue, où entrer je ne veux. A U B I G N É , la Création, VI (III, 364).
Herbal. Relatif aux herbes. — C o m m e Hercules fut exstimé jadis Par son povoir et immense puissance... Le vieil Chiron par sa science her-bale. M I C H E L D'AMBOISE, Epitaphes, 137 v°.
Qui arrose les prés. — Ruysseaux herbaux, ou que soit vicinaux servans pour l'arrousement des possessions des particuliers, seront bien deue-ment entretenus par ceux qui s'en aydent et servent. Coust. d'Aouste, 1588, p. 389 (G.).
Herbault. Chien basset. — Frère Jan hannis-soit du bout du nez comme prest à... monter dessus, comme herbault sus paouvres gens. R A B E LAIS, IV, 52.
(Fém.). Herbaude. (Fig.). F e m m e furieuse. — Cela fut trouvé bon... et vont trouver les femmes, qui encores se combattoyent. Et en ce combat y avoit des herbaudes dun costé et dautre, qui faisoyent rage de frapper. D u FAIL, Propos rustiques, ch. 9, p. 72.
Herbe. Légume. — Je treuve (de là me partent) Le garçon de Chrêmes, portant Herbes, comme épinards et bettes. D E S PÉRIERS, l'An-drie, II, 2. — L'artichot et la salade, L'asperge et la pastenade Et les pepons tourangeaux Me sont herbes plus friandes Que les royales viandes Qui se servent à monceaux. R O N S A R D , Odes, III, 24. — Ceulx qui desroboyent des fruicts ou des herbes en un jardin estoyent tout aussi sévèrement punis comme les sacrilèges ou comme les meurtriers. A M Y O T , Solon, 17. — Ce jardinier avoit de coutume de m e mener tous les matins à la prochaine ville, chargé de toutes sortes d'herbes. L O U V E A U , trad. d'ApuLÉE, IX, 9. — Ils n'osoyent pas gouster seulement de l'huile, mais man-geoyent les herbes toutes crues, ou bien bouillies avec du sel et de l'eau. CALVIN, Serm. sur la première à Timothee, 32 (LUI, 385). — [Un jardinier]
HERBE
avoit transporté en une petite logette couverte force artichaus, chous, létues, espinars, cicorée et autres herbes qu'il avoit cueillis. M O N T A I G N E , Journ. de voyage, p. 126. — U n jeune conseiller de Paris... interrogé de ce somptueux et superbe souper, dit que le tout s'estoit assez bien porté, s'il y eust eu des asperges. Mais il eut pour res-ponce que ce n'estoit comme à Paris, où il y avoit abondance de cornes, dont issent et proviennent icelles herbes. D u FAIL, Contes d'Eutrapel, 31 (II, 130). — Si vous aviez veu... les laictues et autres herbes que moy mesmes ay semées, vous ne m e parleriez de vostre vie de rentrer en telle et si pesante charge. ID., ib., 35 (II, 224). — Si vous mettez en terre des cornes de bélier, il y viendra des asperges... E n son païs... il y avoit abondance de cornes, dont proviennent ces herbes. GUILL. B O U C H E T , 23e Seree (IV, 27). — [Plantes] petites et basses sont herbes, qui... sont de trois sortes : grenaiges, sçavoir bleds de diverses espèces et légumes, 2. herbes potagères, 3. herbes saladieres et aigres. C H A R R O N , Discours chrestiens, II, 9.
Herbe au charpentier, Herbe au chien, v. Charpentier, Chien. Herbe aux ladres. — Je ne veux oublier aussi à
vous dire... que l'herbe véronique... apporte gue-rison aux ladres : et qu'à ceste cause on l'appelle l'herbe aux ladres. GU I L L . B O U C H E T , 36e Seree (V, 122). Herbe de Mailherne. Sorte d'herbe vénéneuse.
— Tout poyson se peut bien manier seurement, Mays l'herbe de Mailherne on ne peut autrement D u bout du doyt toucher qu'escarre se soyt faicte Au menbre, tant elle est de sa nature infecte. A U BIGNÉ, la Création, VI (III, 366). Herbe nervale (nervalis, plantain). — Et le bai
gnera-on en eau où on aura fait bouillir herbes nervales. A M B R . P A R É , Disc, de la mumie, 8. Herbe nostre-dame. — Par le moien de la graine
d'orvalle ou toute-bonne, qu'en Languedoc l'on appelle herbe nostre dame. O. D E S E R R E S , Théâtre d'agric, VIII, 5. Herbe aux pouilleux. — Herbe aux pouilleux,
en latin staphisagria, veut estre en bonne terre cultivée et arrousee. O. D E S E R R E S , Théâtre d'agric, VI, 15.
Herbe aux pulces. — Herbe aux pulces... espan-due par la chambre, en chasse les pulces. ID., ib. Herbe à la royne. Tabac. — Si vous prenez de la
nicotiane, ou herbe à la royne (qu'aucuns maintenant appellent petun). G U I L L . B O U C H E T , 25e Seree (IV, 114).
Herbe sainct Jehan, n o m donné à diverses plantes. — As tu point de l'herbe sainct Jehan? Sotties, II, 188.
Herbe au soleil. — Quelque sympathie a l'herbe au soleil avec la passe-rose, par monter fort hautement. C'est une espèce de heliotropon appellee aussi viresoli, d'autant que sa fleur regarde tous-jours le soleil. O. D E S E R R E S , Théâtre d'agric, VI, 12.
Herbe aux ligneux. — Herbe aux tigneux, peta-sites en latin... est bonne contre la peste. ID., ib., VI, 15.
Herbe du Turc, herbe-au-Turc. — Quelques bouillons communs de l'eringium et herbe du Turc.. m'ont semblé également faciles à prendre et inutiles en opération. M O N T A I G N E , III, 13 (IV, 245). — Herbe-au-Turc, appellee aussi hermole, aime terre sablonneuse et sèche. O. D E S E R R E S , Théâtre d'agric, VI, 15. Présenter l'herbe, expression proverbiale latine :
herbam porrigere, s'avouer vaincu. — Que ceux qui s'estudient à sonder les secrets de nature m e
monstrent que tel pouvoir peut estre naturel aux hommes, je leur presenteray l'herbe, afin que j'use du proverbe ancien, et m e confesseray leur vaincu. L E L O Y E R , Hist. des Spectres, II, 6.
(Prononc). — Toy qui laisse dedans ton pré Pourrir l'harbe par nesgligence. Anc. Poés. franc II, 67.
Herbe. Herbeux. — Trois grands chesnes verds... Ombrageoient tout son front de leurs branches courbées, S'espanchant çà et là jusqu'aux rives herbees. N U Y S E M E N T , ŒUV. poet., 68 r°.
De l'herbe. — C'est tout au rebours de l'instinct du cheval entier, qui suit la cavalle ou le fraix herbe. B E R O A L D E D E V E R V I L L E , Voyage des princes fortunez, p. 260.
Herbee. Herbe. — (Fig.). La bonne hacquenée romaine va bien souvent s'esbaudir par les pas-tures des anciens hérétiques et se paistre de leur herbee. P H . D E M A R N I X , Differ. de la Relig., I, v, 5,
Herbegerie. Habitation. — Aussi ne vous devez vous adventurer de vuider hors de voz repaires et herbegeries, ny aussi séjourner en icelles, si vous nestes premièrement eertiorez de la tempeste ou sérénité future. LEMAIRE DE B E L G E S , Illustr., I, 22.
Herbeiiler, v. Herbiller,
Herbelette, dimin d'herbe. — Pour eulx vestir de sumptueux habiz, Yver, esté, sans cueillir herbelettes Pour sustenter les ouailles nettelettes. G R I N G O R E , les Folles Entreprises (I, 65). — Sur les herbelettes. L E M A I R E D E B E L G E S , le Temple d'Honneur et de Vertus (IV, 196). — Nous sommes, las, vos brebis rudelettes... Et ne povons exaulcer nos eslettes N e vivoter parmy les herbelettes, Si vostre amour de lis et violettes Quelque petite umbre ne nous envoie. ID., Oraison à la Vierge (IV, 329). — Les autres bestelettes Qui sont céans, vivans des herbelettes. ID., 2e Epistre de l'Amant verd (III, 35). — Entre nous, pouvres femmelettes, Avons bien quelque expériance, Et con-gnoissons les herbelettes Ainsi qu'edx. MARG. DE NA V . , le Mallade (édit. Leroux de Lincy et Mon-taiglon, IV, 15). — Sous ceste menue herbelette Gist la plus gentille belette Et la mieux faisant son devoir Que damoiselle eust sceu avoir. MELIN D E S4 G E L A Y S , Epitaphe d'une belette (I, 53). — Allon sur les herbelettes... Deviser de nostre amour. T A H U R E A U , Mignardises amoureuses (II, 98). — Les troupeaux N'oseraient pas paître les herbelettes Si près d'un lieu sacré aux ninfeletes. V A U Q U E L I N D E L A F R E S N A Y E , les Foresteries, 1,3.
— De ses dois et mains blanchetes Arrousant les herbeletes. ID., ib., 1,10. — Le vingtiesme d'avril, couché sur l'herbelette, Je vy, ce me sembloit, en dormant, un chevreuil. R O N S A R D , Amours de Marie (1, 135). — Sus, debout, allon voir l'herbelette perleuse. ID., ib. (1, 147). — Les bois, les champs et les prez, Couverts de verte herbelette, Estoyent par tout diaprez De mainte et mainte fleurette. J O D E L L E , les Amours, Chanson (II, 79). — Herbe... Le dim. Herbette et Herbelette. M. DE L A P O R T E , Epithetes, 208 v°. — A peine il com-mençoit, pressé de somne, estendre Ses membres harassez sur l'herbelette tendre. Du BARTAS, 1" Semaine, 6e Jour, p. 274. — U n petit pré carré plein de mille fleurettes, Qui se meslent parmy les autres herbelettes, Justement l'environne. U. G A U C H E T , le Plaisir des champs, le Printemps, Beaujour, p. 6. — Là le char se retient entre mille fleurettes Esparses largement parmy les herbelettes. ID., ib., Songe, p. 39.' — Escoutez mon dis-
4(
— 469 — H E R B I S
cours, qui coule en la façon Que la pluye tombant va sur le foin s'espandre, Et la rosée encor sur Pherbelete tendre. D u B A R T A S , 2e Semaine, 3e Jour, la Loy, p. 347, — Aux plus petites herbelettes... ne deffaillent leurs beautez et vertus particulières. CHASSIGNET, le Mespris de la vie, Préface, p. 14. — La biche... se va paissant en toute seureté d'herbelettes et de fleurs. E. PA S Q U I E R , Recherches, VII, 8. — C o m m e parmy les fleurs et l'herbelette tendre La vipère se coule. D u M A S , Lydie, p. 9. — Paissez, troupeau chéri, l'herbelette nouvelle. ID., ŒUV. meslees, p. 97. Herber. Nourrir d'herbe. — Au fleuve de Tracie et au palud de Stirmanie, de l'erbe de tri-bulus, qui croist en iceulx paludz et fleuve, sont les chevaux herbez et nourris. Jard. de santé, I, 477 (G.). — Un veau de laict qui n'est encores herbe. Du PINET, trad. de P L I N E , XXVIII, 16 (G.). S'herber. S'étendre sur l'herbe. — Elle s'estoit
là herbee soubz la saulsaye. R A B E L A I S , I, 6. Herbergaige, nom d'un cens payé sur la propriété. — En herbergaige et argent 58 sols 1 denier. 21 juillet 1612. Mortagne (G.). Herberge, Herberger, v. Héberge, Héberger. Herberie, mot collectif. Herbes, plantes. — Le basilic... requiert... d'estre souvent arrousé, plustost sur le chaud du jour qu'en la frescheur du matin ne du soir, contre le commun naturel de toute herberie. O. D E S E R R E S , Théâtre d'agric, VI, 11. Légumes. — La plus grande gabelle qui fut
lors à Rome estoit imposée sur l'herberie qui s'y vendoit. O. D E SER R E S , Théâtre d'agric, VI, 1. — Gardés vous de prendre trop de jardin à cultiver : ains faites-le justement de capacité convenable à vostre famille, pour, à suffisance, la fournir d'herberie. ID., ib. — Paroissans les premières douceurs du printemps, la porte sera ouverte à l'ensemencement de toute sorte d'herberie et po-tagerie, pour le remplage des jardins d'esté. ID., ib., VI, 7. — En cest endroit se servant de l'adresse du jardinier, qui n'arrouse jamais l'herberie, qu'en la nécessité. ID., ib., VI, 27. — [Le chanvre] radoucit et renouvelle la terre, à la grande utilité de l'herberie désirant terre neufve. ID., ib., VI, 29. Marché aux légumes. — Au deffaut du jardinage,
il falloit mettre la main à la bourse pour aller à la boucherie ou à l'herberie achepter de pitance. Du PINET, trad. de PLINE, XIX, 4 (G.).
Herbide. D'herbe. — De couleur herbide. Jard. de santé, I, 347 (G.). Herbier 1. Botaniste. — Plusieurs herbiers... ont dict eupatoire estre pantagruelion saulva-giné. RABELAIS, III, 49. — Pour l'entretenement des pescheurs, oyseleurs, veneurs et herbiers qu'il voulut estre expressément employez au pour-çhas des bestes et plantes estrangeres de toutes les parties du monde. B E L O N , Nat. des oys., Au roy (G.). * Herboriste. — Visitoient les bouticques des
drogueurs, herbiers et apothicaires. R A B E L A I S , I, 24. Herbier 2, mot collectif. Herbes. — J'entre-voy tes cheveux d'espès herbiers couvers, Je voy ton corps nageant, sans tache ni froissure, Contre un chesne arresté, qui tranchoit d'avanture Le travers de ce fleuve. T A H U R E A U , A Ch. Belot (IL 173). v
Herbage. — Ainsi que le faucon espiant son gibier, Musse sous le rivage ou dedans un herbier,
Fond de roide secousse. R. B E L L E A U , les Amours des Pierres précieuses, l'Améthyste (II, 168).
Herbiere. Fanon des ruminants. — Devant eux touchoyent des bœufz noirs, qui tous vous avoyent un col gros et gras... le pied gros et court, et chacun l'herbiere pendant jusque sur les genoux. A M Y O T , Hist. Mthiop., L. III, 32 r°. — Ilz l'assomment et escorchent [une vache]... ilz luy taillent les cuisses, l'eschine, les espaules et l'herbiere. SALIAT, trad. d'HÉRODOTE, II, 40. Gosier de certains oiseaux. — Tous oyseaux
n'ont pas le jabot ou se reçoivent les viandes, avant entrer au gosier, les uns comme les autres. Car quelques uns n'en ont point, mais pour ce défaut nature leur a baillé un gosier moult large et ample, qui est ce qu'on appelle l'herbiere. B E L O N , Nat. des oys., I, 11 (G.).
Gorge, gosier (par plaisanterie). — Rase ta barbe bien et beau, Et ne te fie en la barbière Qu'elle ne coppe ton herbiere. Anc. Poés. franc., II, 221. — Il nous faut boire de la bière; Cela nous refroidist l'herbiere. Ib., VII, 77. Herbiller. Brouter de l'herbe, paître. —
[Adonis] Osoit lancer les sangliers aux dents croches... Brisoit leur voye, erres, route et passages ; Les espioit herbeillans es gaignages. PASSERAT, Adonis (I, 22). — De là la trouppe passe Pour se jetter aux champs, où ayant herbillé, Et du bout du boutoir çà et là vermillé, Il rentre dans le fort. CL. G A U C H E T , le Plaisir des champs, l'Automne, Chasse du sanglier, p. 230.
Herbilleur. Celui qui coupe de l'herbe. — Se li messiers trouve erbilleurs ou erbilleresses es blés, soilles et secourjon, après le deffense faite par le majeur et presens eschevins, cascun est a l'amende de xn deniers cambresis. 1507. Prév. de Beauquesne (G.). — Ont les mayeur et esche-vins... droit... d'establir ung messier qui doibt prester serment de justement et fidèlement exercer son office, qui a pouvoir de prendre et arrester tous chariots et charrettes, charuanspar faux chemins et sentiers, bestes, herbilleurs et tous aultres es cas deppendans dudit office de messier. Coust. de la ville de Buissy (G.).
(Fém.). Herbilleresse. Cf. le 1er exemple. — Défense aux herbilleresses de vendre leurs bottes d'herbes senon derrière l'église de S. Nicollas. 1563. Béthune (G.). Herbis. Herbage, prairie, pâturage. — Les
simples aigneaulx et brebis, Paissans dessus les vers herbis, Bessent la teste contre terre. GRIN G O R E , les Folles Entreprises (I, 71). — Je sçay bien mener mes brebis Aux fontaines et beaux herbis. M A R G . D E NAV., les Marguerites, Chansons spirituelles (III, 149). — Je ne quiers pas (ô bonté souveraine) Deux mille arpentz de pastiz en Tou-raine, Ne mille beufs errants par les herbis Des montz d'Auvergne. M A R O T , Eglogue au roy. — Et toy, des bois habitant la frescheur, Dont trois cents beufz de nayve blancheur Paissent de Cee aux plantureux herbiz. P E L E T I E R D U M A N S , L. I des Georgiques, p. 50. — Regardant çà et là au milieu des herbis S'il pourroit aviser quelque nouvelle plante. G R E V I N , Pastorale, p. 194. — Et tousjours d'herbe espaisse emplir tes gras herbis, De toreaux ton estable, et ton parc de brebis. R O N S A R D , Eclogues, 3 (III, 407). — N'as-tu pas veu, Bellot, machotter les brebis L'herbe demi-brulee, au milieu des herbis? R. B E L L E A U , la Bergerie, lie Journ. (I, 184). — Maintenant je diray la fable Du sot cheval et misérable Qui sa force ne cognoissoit : Que le cerf, avec l'avantage De sa ramure, d'un gangnage, Leur commun herbis,
HERBISTE
dechassoit. BAÏF, les Mimes, L. III (V, 166). -C'est au berger à mener aux herbis Ses gras moutons, ses camuses brebis. V A U Q U E L I N D E LA F R E S N A Y E , Sat. franc., L. III, A M. de Choisy. — Jà la troupe soigneuse Des autres pastoureaux ont laissé les herbis. CL. G A U C H E T , le Plaisir des champs, le Printemps, Eclogue, p. 92. — Il faut... Au dieu Faune faire offrande, Soit qu'il vueille des herbis La brebis, Soit qu'un cabrit il demande. Luc D E L A P O R T E , trad. d'HoRACE, Odes, I, 4. — Ni par les gaulois herbis Croissent grasses mes brebis. ID., ib., III, 16. — Nulle contagieuse engeance Y nuit au troupeau par l'herbis. ID., ib., Epodes, 16. — Souventesfois le dieu tire-sagette Par les fleuris herbis Esperonné d'amour, menoit d'Admete Pascager les brebis. P. M A T T H I E U , Cly-temnestre, II, p. 12. — Parmi les vers herbis la brebis esgaree... Ne sçait de quel chemin elle doit faire chois. C H A S S I G N E T , le Mespris de la vie, sonn. 404.
(Mot collectif). Herbes. — Fontaine, à tout jamais ta source soit pavée Non de menus gravois, de mousses, ny d'herbis : Mais bien de mainte perle à bouillons enlevée, De diamans, saphirs, turquoises et rubis. R O N S A R D , Sonnets pour Hélène, L. II, Stances pour la fontaine d'Hélène (I, 334).
Herbiste. Celui qui connaît les plantes médicinales. — Puis se présente la belle et riche ville de Montpeslier... Ce en quoy elle est plus recom-mandable sont les estudes de médecine et de chirurgie, et pour les simples qui y sont à commandement : de laquelle sortent des plus naturels et asseurez herbistes qui soient paraventure au monde. T H E V E T , Cosmogr., XIV, 8.
Herboriste. Médecin qui soigne au moyen des herbes. — Le père... y envoia du commencement quelques herboristes, lesquels... promirent faire en sorte qu'en bref elle recouvrirait sa santé ; mais ils s'y travaillèrent en vain. A u moyen de quoy le bon homme y envoia depuis plusieurs fameux et excellens médecins qui n'y firent non plus que les premiers. L A R I V E Y , trad. des Facétieuses Nuits de S T R A P A R O L E , XIII, 9.
(Adj.). — Quand l'herboriste main l'effeuille [l'ellébore]. J. D U C H E S N E , le Grand Miroir du monde, L. V, p. 180.
Herbosisien. Celui qui connaît les plantes médicinales. — Le sçavez-vous mieulx qu'un médecin Qui est grand herbosisien? A ne Théâtre franc., I, 282. Herbracon. Partie d'une charrette. — Les her-
bracons et esprettes des carettes. 1541. Lille (G.). Herceler, v. Harceler.
Herchelee. Réunion. — La fricassée crostyl-lonee des antiques modernes chansons par une herchelee des plus memoriaulx et ingénieux cerveaux de nostre armée. Rouen. 1604 (G.).
Hercher, Herchié, v. Herser. Herciscande, v. Famille herciscande. Hercueil. Arcueil. — Quand ma nymphe vien
dra de Paris à Hercueil. PASSERAT, Sonet (1,170). Herculée (herculeus). Digne d'Hercule. —
Mais si vostre vertu ne desment vostre face, Qui montre à son aspect une herculée audace. P. D E BRACH, Imitations, Olimpe, 66 v°. Herculéen (mal). Épilepsie. — Il avoit une maladie... nommée mal sainct, ou herculéen, et vulgairement mal caduque. MICHEL D E TOURS, trad. de SUÉTONE, I, 21 r°.
Herculien. D'Hercule. — Toutes les gestes herculiennes. MIC H E L D E TOURS, trad. de SUÉTONE, Proesme.
Herculéen. — Force. Puissante, vertueuse... herculienne. M. D E LA PORTE, Epithetes, 179 r°. Herculiane (pierre). — Une bien grosse pierre
siderite, c'est à dire ferriere, aultement appellee herculiane... Nous vulgairement l'appelions ay-mant. RABELAIS, IV, 62. Herculin. D'Hercule. — Le vin n'est poinct
de ces mauvais breuvages Qui beus par trop font faillir les courages : J'ay, quand j'en boy, le courage herculin. J. L E H O U X , Chansons du Vau de Vire, I, 71. Vigoureux ? — Je suis si ennuyé que je suis en
nuyeux, Mon avril herculin ne s'enflame. 1599. LASPHRISE, 141 (Vaganay, Deux mille mots). Herdier. Pâtre. — Ils prennent des herdiers
pour garder chaque espèce de bestes à son particulier. R E M A C L E M O R Y D U RONCHAMP, Cabinet historial, p. 156 (G., Herdier 3).
Herdoyer. Harceler. — II suffisoit les her-doyer et costoyer par maniera que par ou ils passeraient ne trouvassent nuls vivres. Hist. de Louis III, duc de Bourbon, p. 57 (G., Hardier 1).
Herdre. S'attacher. — Et qu'a l'orme baise-nue Qui l'assiette plus conue Fut aux co-lombs citadins, Herdit la gent escaillee : Et par la mer sur-cqulee Peureux nagèrent les dains. Luc D E L A P O R T E , trad. d'HoRACE, Odes, I, 2. Hers. Attaché. — Quelquefoys un loup devoura
Une brebis totallement, Fors un oz qui luy de-moura Hers au gosier. H A U D E N T , Apologues d'EsoPE, I, 47.
Hère i. H o m m e de rien, pauvre hère, pauvre diable. — Il te faudra d'un habit haillonneux Vestir ton corps, il faudra prendre guerre, A coups de poing te battre contre un herre, Et t'ac-coster seulement d'un porcher. R O N S A R D , Poèmes, L. I, Paroles de Calypso (V, 68). — Il semble que nos prédécesseurs ayent tourné en dérision ce mot de her, quand ils ont dict (ce qui se dit encores aujourd'hui) C'est une hère, ou, Il fait du hère. H. E S T I E N N E , Dial. du lang. franc, ital., p. 91-92. — Quoy ! pense-t-il me desniaiser Quant il m e parle d'espouser Sa fille, dont je n'ay que faire? Croit-il que je sois quelque haire Et que je ne connoisse pas Qu'elle est pour moy d'un lieu trop bas Et de trop basse race née? J. GOD A R D , les Desguisez, V, 5. — Quoy! celuy qui commande en ce monde et aux cieux Yroit-il sans habit, comme ferait un herre? G U Y D E TOURS, Souspirs amoureux, L. III (I, 69).
Pauvre. — Mesme s'elle estoit laide, ignorante et haire, Elle aura de l'orgueil. Var. hist. et litt., IX, 75.
Sorte de jeu de cartes. (Fig.). Jouer au hère. Faire le pauvre. — Il me dit... qu'il avoit mis telle police à la première armée du Tiers Parti qu elle ne fouleroit point le peuple. De faict je croy que les généraux des finances et des vivres ont eu beau loisir d'y jouer dés le matin au hère et au mal content. A U B I G N É , Sancy, 1,4.
Confus, interdit. — Et demeurarent courtz et hères et braez. B R A N T Ô M E , Cap. franc., le Mareschal de Biron (V, 136). r
Hypocrite? (Sens proposé par Sainéan). — w n'entrez pas, hypocrites bigotz... Haires, cagott, caffars empantouflez. R A B E L A I S , I, 54.
Mauvais cheval. — Le lendemdn, quand fut temps de partir, Et à chascun leurs chevaulx départir, Faifeu congnut son hère emmy l'estame.
4:
— H E R E G E
Hereditallement. Héréditairement. — Vous avez le remède présent en vostre jardin de bonnes herbes, desquelles la vertu vous demeure quasi hereditallement de père en filz. D u FAIL, Propos rustiques, ch. 4, var., p. 32 et 121.
Semblant n'en fist, mais, comme sage et stable, A demandé qui tel hère leur donne. B O U R D I G N É , Pierre Faifeu, ch. 47. — (Montaiglon attribue le même sens à hayre dans le passage suivant) : Les gresses de porc privé, de porc sauvage, de bouc, de bedouaut, de regnard, de cerf, de cheval mo-reau, pommelé, qui soit hayre. Anc. Poés. franc., IV, 275. L'explication est douteuse. Animal auquel on a coupé la queue. — Coup-
per leur fault, comme à ung haire, La queue près du Cul. R. D E C O L L E R Y E , Satyre pour les habitans d'Auxerre. — [Un bailli] avoit en sa maison quelques animaux apprivoisez, entre lesquelz estoit un regnard qu'il avoit fait nourrir petit, et luy avoit-on couppé la queue, et pour ce on l'ap-pelloit le hère. D E S P É R I E R S , NOUV. Récr., 29. — Il tira si vertueusement qu'il s'arracha la queue, qui demeura dans la sourisiere, et s'enfuit le cour-taut à travers une court... et les gens de rire et courir après le hère de rat. P H . D'ALCRIPE, la Nouvelle Fabrique, p. 158. Insuffisant, trop court. — D'autres paouvres
fatz et sotz pensoient que leur histoire seroit manque et haire, si elle n'estoit décorée et allongée d'une grand' crue et suite de motz. B R A N TÔME, Rodomontades espaignolles (VII, 118). Sans désirs, sans passions. — L'expérience nous
faict voir qu'une telle esmotion se maintient bien souvent soubs des habits rudes et marmiteux : et que les haires ne rendent pas tousjours hères ceux qui les portent. M O N T A I G N E , II, 33 (III, 154). (Dans un sens libre). — U n e jeune Corinthiace...
laquelle regardoit mon pauvre haire esmoucheté. RABELAIS, II, 14.
L'expression haire esmoucheté est burlesque-ment employée dans le passage suivant. — Et Diogenes Laertius, et Theodorus Gaza, et Argy-ropile, et Bessarion, et Politian, et Budé, et Las-caris, et tous les diables de sages fols : le nombre desquels n'estoit assez grand, s'il n'eust esté re-centement accreu par Scaliger, Brigot, Cham-brier, François Fleury, et ne sçay quels autres tels jeunes haires esmouchetez. R A B E L A I S , V, 18. Hère 2, v. Haire 3. Hereder. Hériter. — Car Edouard le tiers
d'Ysabel filz... Disoit le règne a luy appartenir, Et qu'il devoit a luy seul obvenir, C o m m e du sang de France le plus proche, Et d'hereder capable, sans reproche. J. B O U C H E T , Epistres familières du Traverseur, 1. Posséder un héritage. — Et en l'aymant, l'avoir
et posséder, Le possédant en jouyr tout à plain, C'est es haulx cieulx avec Crist hereder. ID., Labyr. de fort., 90 v° (G.). — Que vous puissez avec luy hereder Lassus es cieulx en la gloire éternelle. ID., Epistres morales du Traverseur, II, ix, 2. Hereditable. Apte à hériter. — De Jehan
douziesme ne soys hereditable, Car le dyable l'oc-cist villainement. G R I N G O R E , l'Espoir de paix (I, 180). Heredital. Héréditaire. — Et montrer ledit
titre de roi très chrestien lui estre non seulement heredital, mais comme propre et peculier. G U I L L . BRIÇONNET, Remontr. au pape Jules II (G.). — Viconte heredital de Hotot. 11 juill. 1549. Arch. Orne (G.). — Sur les fons sacrez ce roy tint Ton père, qui son nom en print, Et qui fait preuve en sa jeunesse, Outre le cueur heredital, Que quasi ce nom est fatal Et pour addresse et pour prouesse. J O D E L L E , Chant sur la naissance de Henry de Lorraine (II, 173). — Je vai cerchant (long temps y a) l'Itale, M o n vrai païs et terre hereditale. D E S M A S U R E S , Enéide, I, p. 28.
Hérédité. Héritage. — [Auguste] ordonna qu'on payast la vingtiesme partie des hereditez et des donations lesquelles fussent laissées après la mort. D E R O Z I E R S , trad. de D I O N CASSIUS, Hist. rom., L. LV, ch. 112 (228 r°). —[Tibère] ne vouloit accepter les hereditez qui luy estoyent délaissés par ses parens. ID., ib., L. LVII, ch. 121 (249 v°). — Il donna l'hérédité de Patuleius, riche chevalier romain... à M. Servilius. E T . D E LA P L A N C H E , trad. des cinq prem. liv. des Annales de TA C I T E , L. II, 73 v°. — Les enfans héritiers s'assemblèrent pour adviser à exécuter le testament de leur père, lequel estoit tant excessif en ses legs que, si de point en point on l'eust voulu suivre, c'est chose toute asseurée qu'il eust excédé l'hérédité. L A R I V E Y , trad. des Facétieuses Nuits de S T R A P A R O L E , XII, 4. — Il fault nécessairement de deux choses l'une, ou que l'hérédité soit sol-vable, ou insolvable. L'HOSPITAL, Reformat, de la Justice, Ie part. (V, 305). — Et trouve bon et utile à ramentevoir en noz jours l'exemple de P. Sexti-lius Ruffus, que Cicero accuse pour avoir recueilly une hérédité contre sa conscience. M O N T A I G N E , II, 16 (III, 6). — On prioit l'héritier de vouloir rendre l'hérédité à tel ou tel. E. P A S Q U I E R , Lettres, X I X , 13. — Si j'avois envie de m e rejecter au lacz et r'empestrer dans les liens d'un second mariage... je prendrais plus tost un mari que non pas une hérédité. B R A N T Ô M E , des Dames, part. II (IX, 652). — J'ordonne et je veux qu'on prenne sur m a totale hérédité l'argent qu'en pourra valoir l'impression. ID., Testament (X, 127).
Herediter (hereditare). (Trans.). Recevoir en héritage. — Auguste... concéda à aucunes femmes que peussent herediter plus de vingt cinq mil. D E ROZIERS, trad. de D I O N CASSIUS, Hist. rom., L. LVI, ch. 115 (233 v°). — Tibère... hereditoit ce que luy estoit délaissé. ID., ib., L. LVII, ch. 122 (256 v°). Posséder en héritage. — Amyables hommes
seront ceulx qui herediteront la terre et qui vivront en tranquilité de paix. Hist. de la Toison d'or, II, 106 a (G.).
(Intrans.). Herediter en. Recevoir en héritage. — [Caligula] après leur mort hereditoit en tous leurs biens. D E R O Z I E R S , trad. de D I O N CASSIUS, Hist. rom., L. LVIII, ch. 124 (265 v°). Haerediter à, m ê m e sens. —• Que d'eulx ilz veis-
sent naistre lignaige raportantethaereditant... aux mœurs de leurs pères et mères. R A B E L A I S , 111,48.
Herege. Hérétique, sorcier. — C'est autant comme si vous estiez des sorciers et ireges qui fissiez vos conjurations et vos charmes. C A L V I N , Serm. sur le Deuter., 135 (XXVIII, 128). — Je laisse encores ceux qui y meslent leur Ave Maria, pensans par tels menus fatras invoquer vraye-ment Dieu comme il le demande. Mais telle manière de gens sont bien loin de la vraye invocation de Dieu : ce sont hereges et sorciers qui ne peuvent oublier leurs vieilles superstitions diaboliques. ID., Serm. de la Pentecoste, 4 (XLVIII, 652). — Ce n'est point ainsi qu'il faut prier Dieu, de dire trois ou quatre fois, Nostre Père qui es es deux, et le repeter et marmoter souvent. Tous ceux qui le font sont comme sorciers et hereges. ID., ib. (XLVIII, 653). — Faux monnoyeur, sorcier, he-reige. Plais, dev. des supposts du S. de la Coquille (G.). Cf. Herese 1.
HEREMITAINS
Heremitains, nom d'un ordre religieux. — Moines de Premonstré, Heremitains ou Guilarmi-tains. PH. D E MARNIX, Differ. de la Relig., I, iv, 5.
Heremitique. D'ermite. — Façon de vivre heremitique. G. PARADIN, Cron. de Sav., p. 252 (G.).
Heremyte, v. Eremite.
Herese i. Hérétique, sorcier. — Des herèses, et comment ilz font dérision de la foy. GRINGORE, les Folles Entreprises (I, 126). — Des motz de nostre langaige vulgaire, les aulcuns sont hon-nestes de soy a proférer, et leur significat est tresdeshonneste, comme homicide, heraise, boute-feu, larron. P. F A B R I , l'Art de Rhétorique, L. I, p. 118. — Les herezes ont devyé la foy catho-licque, et destruist les citez... et tué beaucoup d'enfans. ID., ib., p. 168. — Tu m'as rescript que je te dye se les hereses chevauchent le ballay reallement. ID., ib., p. 198. — Las! tu mourus comme herese en publicque, Plain toutesfois de la foy catholicque. M A R O T , Epit. de Berquin, édit. Guiffrey, III, 112. — Les sots bergiers que contre toute lectre Ont dict du parc mainte herese sentence Sont mesdisans. ID., Vers inéd., chant 24.
Herese 2. Hérésie. — L'herese mutine Qui reveilhe les feus des troubles assoupis. L. P A P O N , Pastorelle, 1,1. — Apprés avoir foulé ces hereses mutines. ID., ib., I, 2.
Heresien. Hérétique. — D'Aumale de cueur sainct, dont les prières sonnent, Et les armes font feu sur les hereziens. L. P A P O N , Pastorelle, III, 2. — Aux re-seditions de ces heresiens. ID., ib., IV, 2. Hereticquant. Pratiquant l'hérésie. — Here-ticques damnés, hereticques clavelés, hereticques plombés, et bref hereticques hereticquans en toute sorte d'heresie. P H . D E M A R N I X , Differ. de la Relig., I, v, 12.
Heretier. Héritier. — La semence de la parolle de Dieu prent racine et fructifie en ceux la seulement lesquelz le Seigneur par son élection éternelle a prédestiné pour ses enfans et heretiers du royaulme céleste. CA L V I N , Instruction et Confession de foy de Genève (XXII, 46). — En leurs testamens mandoient à leurs heretiers et enfans que chacun an offrissent de leurs propres biens fort grans sacrifices. B. D E L A GRI S E , trad. de G U E V A R A , l'Orloge des princes, III, 12. — Ceux que nostre Seigneur retire de la condition universelle des hommes, pour les faire heretiers de son royaume. CALVIN, Instit. (1560), III, x x m , 10. — Il a espouzé l'héretiere de Montesquiou. M O N L U C , Commentaires, Préambule (I, 15). — Toute ceste belle kyrielle des festes à doubles et simples bas-tons est elle pas la fille et heretiere légitime de toutes les festes des payens? P H . D E M A R N I X , Differ. de la Relig., I, v, 6. — L'aisné Frideric, heretier du royaume. A U B I G N É , Hist. univ., II, 31. Hérétifique. Qui fait des hérétiques. — II
avoit estudié èsdictes langues grecque et latine, qui de long temps ont esté estimées luthérani-fiques et hérétifiques. H. E S T I E N N E , Apol pour Her., ch. 29 (II, 149). Hérétique. Impie. — Et d'avantage calum-nierent encore le philosophe Anaxagoras... disans qu'il estoit hérétique, mescreant, et mal sentant des dieux. A M Y O T , trad. de D I O D O R E , XII, 10. Herette (?). — Pine de bois a trois herettes
employée et servant a mettre les araignes du sra-met, 1511. Béthune (G.).
Hereux. Pauvre, misérable, désolé. — De quatre mois est l'esté chaleureux, Et tout autant dure hyver le hereux. A M Y O T , De la création de l'ame, 31. — A u mois plus froid de l'an, que la neige espandue Tenoit en toutes parts l'air et les champs hereux. G. D U R A N T , ŒUV. poet., 15 v°. —• La campagne estoit déserte, hereuse et affreuse, les villes pleines de ruines. D u VA I R , Adieu au Parlement de Provence en 1616, p. 894. Hereze, Herezien, v. Herese 1, Heresien.,
Hergne 1 et 2, Hergner, Hergneux 1, v, Hargne 1 et 2, Hargner, Hargneux.
Hergneux 2, v. Hernieux.
Hergnieux, v. Hargneux.
Hergoté. Qui a des ergots, des ongles. — Ceux qui sont retroussez et herigottez sont bons à faire limiers. D u FourLLOux, Ven., ch. 3 (G.). — Chien. Abboyant, fidèle... hergoté. M. D E LA PORTE, Epithetes, 81 r° et v°.
Hericbon, v. Hérisson.
Heriçonner, v. Herissonner.
Heriditaire. Héréditaire. — Et regnoit son filz Cleomenes, non pour grande v%rtu qui en luy fust, mais seulement par droit heriditaire. SALIAT, trad. d'HÉRODOTE, V, 39.
Herignee, v. Araignée.
Herigot, v. Harigot.
Herigotté, v. Hergoté.
Herile (herilis, de maître). — Puissance... herile double, sçavoir des seigneurs sur les esclaves, des maistres sur leurs serviteurs. CHARR O N , Sagesse, 1, 44. Hérissement. Fait de se hérisser. — Des he-
rissemens d'horreur et des tremblemens. AMYOT, Du premier froid, 21.
Hérisser (intrans.). Se hérisser. — Je n'ay poil sur le chef qui d'effroy ne hérisse. R. GARNIER, Antigone, 1596. — Mes cheveux estonnez hérissent en m a teste. A U B I G N É , les Tragiques, I (IV, 42). — Sa barbe et ses cheveux de fureur hérissèrent. ID., ib., IV (IV, 190).
(Prononc. : h muette). — Ni voir d'un pan le plumage hérissé. O. D E M A G N Y , Dern. Poés., p. 39. — C o m m e un lion frisé quand sa fureur s'hérisse. P. M A T T H I E U , Aman, III, p. 76. — Ma perruque s'hérisse. ID., Clytemnestre, I, p. 5.
Hérisson. (Prononc). 1° h muette. —N'est-ce pas aussi chose admirable de l'hérisson de mer? PALISSY, Recepte véritable, De la ville de forteresse, p. 117. — J'apperçoy l'hérisson. Du BARTAS, 1" Semaine, 6e Jour, p. 264. — Un citoyen de Cyzique acquit jadis réputation de bon mathématicien, pour avoir appris la condition de l'hérisson. M O N T A I G N E , II, 12 (II, 191). — Autres se servent des peaux d'hérisson. O. D E SERRES, Théâtre d'agric, IV, 8. — La propriété,., de l'hérisson à pressentir les vens. C H A R R O N , Sagesse, 1, 34. ,
2° Herichon. — U n loup tendant devourer et menger U n herichon. H A U D E N T , Apologues d'ÈsoPE, II, 127. — Le herichon venoit souvent a poindre Ceste couleuvre. ID., ib., II, 130.
Herissonnement. Fait de se hérisser. — Elle sent... un petit frisson et horripilation ou herissonnement en tout le corps. A M B R . P A R É , XVIU, 5. — Luy survient un tremblement et herissonnement par tout le corps. L I E B A U L T , Mais, rust., p. 153 (G.).
— 4'
Herissonner (trans.). Hérisser. — Commença a herissonner son poil et grinser les dents. D. Florès de Grèce, f° 120 (La Curne). — Parquoi on est moins tiré en admiration qu'en merveilleux efroi, qui herissonne grandement les entrés illec. NOGUIER, Hist. tolos., II, 156 (G.). — [Un sanglier] De poil dressé ses cuisses herissonne. D E S MASURES, Enéide, X, p. 539. — Il fait craquer ses dents, sa barbe il herissonne. D u B A R T A S , 2e Semaine, 1er Jour, les Artifices, p. 136. — Qui ne voit que l'hyver ores par sa froidure Herissonne les bois et flestrit la verdure? J. D U C H E S N E , le Grand Miroir du monde, L. II, p. 41.
(Intrans.). Se hérisser. — Avec Yver, qui tremble et qui frissonne, Et dont le poil tout chenu herissonne. M A R O T , L. II de la Metamorph. (III, 202). — Le vent alloit ça et là, et a faict herissonner le poil de mon corps. C A L V I N , Serm. sur le liv. de Job, 16 (XXXIII, 197). — Les cheveux herissonnerent de crainte en la teste. 1570. Disc. sur le desbord, du Rhône (G.). — Et de frayeur le poil luy herissonne. BAÏF, Poèmes, L. IV (II, 181). — Chams, bois en tout endroit, Mons, vaux, rivières, prés herissonnent de froid. ID., ib., L. IX (II, 410). — Les chams dorez ne le recréent, Alors que plus blonde Ceres Fait heriçonner ses forets. ID., Passetems, L. III (IV, 343). — Elle a veu... Ses champs herissonner de picques menassantes. R. GARNIER, Antigone, 798. Il est possible que dans une partie de ces
exemples le réfléchi soit omis devant l'infinitif dépendant d'un autre verbe.
Se herissonner. Se hérisser. — Quand il est cour-roussé, il se herissonne, faisant dresser son poil. BELON, Singularitez, II, 22 (G.). — Le chien du commencement se herissonnant commença à tonner et à japper contre l'éléphant. D u P I N E T , trad. de PLINE, VIII, 40 (G.). — U n champ de fer comblé d'épées nues Se herissonne autour d'eux. D E S MASURES, Enéide, XII, p. 655. — S'il doit avoir tempeste ou impression d'air, il [le trèfle des prés] s'herissonne et dresse ses fueilles. M. D E L A P O R T E , Epithetes, 406 r°. — Dessus les cuissots pendans [d'une armure] se herissonnoyent deux batailles De piques, haches et dards et de corselets et d'es-cailles. BAÏF, Poèmes, L. II (II, 67). — U n porc-espy... Porte mainte flèche qui pique... Qu'en se herissonnant.il lance Contre qui vient luy faire offense. ID., les Mimes, L. III (V, 168). — Quand on lisoit quelque chose de la saincte Escriture devant luy, il se herissonnoit, se souslevoit et se tourmentoit. A M B R . P A R É , X IX, 32.
Herissonnant. Hérissé, se hérissant. — Les bataillons serrez herissonnans de pointes Se choquent furieux. R. G A R N I E R , Cornelie, 1677. Herissonne. Hérissé. — Le chastaignier defîend
son fruict dedans une manière d'escaille herisson-née. B. D E LA GRISE, trad. de G U E V A R A , l'Orloge des princes, II, 11. — Il avoit... le poil roux et si herissonne qu'il eust esté malaisé à festonner. Amadis, II, 19. — Elle avoit les cheveulx tous blancs de grand vieillesse, et si herissonnez qu'il sembloit d'une droite hure. Ib., III, 2. — Fleury... le print par la herissonnée barbe. A. SEVIN, trad. de BOCCACE, le Philocope, L. II; 55 r°. — Son vestement estoit d'une grand peau d'ours : sur laquelle pendoient les cheveux longs, blancz et fort herissonnez. Ib., V, 37. — Tu es tout herissonne, tout hallebrené, tout lanterné. R A B E L A I S , V, 7. — Lacan thion... n'est (selon qu'aucuns l'estiment) une certaine espèce de chardon de montagne, moussu en tout le circuit de son fruict herissonne. MA T H É E , trad. de D I O S C O R I D E , 252 b (Vaga-uay, Pour l'hist. du franc, moderne). — Desja
HERITAGE
venant herissonne L'hyver de froid environné, S'en va la plaisante verdure De l'esté, qui si peu nous dure. V A U Q U E L I N D E L A F R E S N A Y E , Idillies et Pastorales, I, 79. — U n merveilleux et dangereux sanglier, lequel estoit tout herissonne. L O U V E A U , trad. d'ApuLÉE, VIII, 1. — Le palais neuf estoit sur la colline Herissonne de paille romuline. D E S M A S U R E S , Enéide, VIII, p. 428. — Le champ de fer de piques est au large Herissonne. ID., ib., XI, p. 590. — Deux vieilles, dont la tresse estoit toute chenue... Ont le lict nuptial trois fois environné : Puis d'un charme à sous-voix l'ayant empoisonné... D'un parler enroué, d'un poil herissonne, Respondant l'une à l'autre ont dit telles paroles. R O N S A R D , Elégies, Discours (IV, 139). — Tousjours d'un air gresieux les champs herissonnez N'ont aux chaudes moissons leurs espics esgrenez. R. G A R N I E R , Porcie, 1213. — U n lion eschaufé tire de sa tanière Son col herissonne d'une horrible crinière. ID., ib., 1502. — N y le cerf, ny le sanglier herissonne de poils n'espouven-teroit pas le happelopin. F. B R E T I N , trad. de L U CIEN, Du cercheur de repue franche, 51. — Le marron porte une taye molle, Pour emmantellement la taye un cuir tané, Le cuir un feutre espais, pic-quant, herissonne. D u B A R T A S , 2e Semaine, 2e Jour, les Colomnes, p. 281. — Les uns... ont les cheveux herissonnez et crespelus. L E L O Y E R , Hist. des Spectres, IV, 11.
Heritable. Héréditaire. — Anselbert sénateur de Romme... fut le premier marquis heritable du Saint Empire sur Lescault... Arnould, second marquis heritable du Saint Empire sur Lescault, eut un filz n o m m é Arnulphus. L E M A I R E D E B E L G E S , Illustr., III, 3 (II, 431).
Héritage. Propriété foncière, terre, domaine. — Quand un h o m m e riche met entre les mains d'un laboureur aucun héritage, il... luy dit comme il doit l'héritage gouverner et entretenir. B. D E L A GRIS E , trad. de G U E V A R A , l'Orloge des princes, 11, 37. — Il y eut... à Arimino un marchant fort riche en héritages et deniers contens. L E M A Ç O N , trad. de B O C C A C E , Decameron, VII, 5. — Je n'avois pas soubhetté d'avantage, Sinon d'avoir un petit héritage Dedans lequel j'eusse un jardin plaisant. F R . H A B E R T , trad. d'HoRACE, Satyres, II, 6. — Il achepta un heritaige, ou il s'en alla demorer, et vivre du revenu d'icelluy. B U D É , Instit. du prince, ch. 52. — Les héritages estoient venuz à vil pris, pour la grand' multitude des vendeurs. E T . D E L A P L A N C H E , trad. des cinq prem. liv. des Annales de TA C I T E , L. V, p. 186. — Que d'eulx ilz veissent naistre lignaige reportant et haereditant non moins aux mœurs de leurs pères et mères que à leurs biens meubles et haeri-taiges. R A B E L A I S , III, 48. — Quand ilz apper-ceurent aucun héritage bien entretenu, cultivé et labouré : ilz prindrent par escrit le nom de celluy à qui il appartenoit. SALIAT, trad. d'HÉRODOTE, V, 29. — Terme, qui vault aultant à dire comme borne, est le dieu des confins, auquel ilz sacrifient en public et en privé sur les confins des héritages. A M Y O T , Numa, 16. — [L'eau] à travers les terres labourables et les héritages plantez d'arbres, s'alla descharger en la mer. ID., Camille, 3. — Il vouloit que lon acquist des héritages et maisons ou il y eust plus à semer et à pasturer que non pas à balier et à arrouser. ID., Caton le Censeur, 4. — Touchant du revenu qu'ils reçoivent des héritages [lat. ex agris] et possessions, qu'en pourroy-je plus dire que ce que j'en ay desja dit...? C A L V I N , Instit., IV, v, 19. — O bien-heureux celuy qui peut user son âge E n repos, labourant son petit
73
HERITAIRE — 474 —
héritage! RONSARD, Poèmes, L. II, Disc, au cardinal de Chastillon (V, 182). — [Calvin] n'eut jamais maison ni héritage, ni ne se mesla de trafique ni négociation quelconques. TH. D E BÈZE, Vie de Calvin. — Pour acquérir un héritage con-tigu et qui attouchoit au sien. C. D. K. P., trad. de GELLI, Discours fantastiques de Justin Tonnelier, Disc. V, p. 155. — On ne fiche point tant de paux à Pentour des héritages que lon veult enfermer de palissade... comme l'amitié nous promet de refuge et de secours, quand elle est bien es-prouvee. A M Y O T , De la pluralité d'amis, 3. — Il en avoit desjà parlé pour moy, et espérait qu'il me la ferait donner, avec plus de dix mille francs d'argent sec, sans les maisons, héritages, bagues et joyaux. LARIVEY, les Jaloux, 1,1. — J'ay un héritage où il n'y a point de fontaines. PALISSY, Discours admirables, Des eaux et fontaines, p. 136. — Non seulement voudroy-je fouiller dedans les fos-sez de mes héritages, mais aussi par toutes les parties de mes champs. ID., ib., De la marne, p. 341. — Il y en avoit plusieurs [fossés] entre les deux armées, faits pour la séparation des héritages. L A N O U E , Disc, polit, et milit., XXVI, 3, p. 787-788. — Quelques héritages bien cultivés y remarquèrent ils aussi, comme tesmoignans que leurs propriétaires avoient là emploie leurs temps, sans s'amuser à questionner avec leurs voisins. O. D E SERRES, Théâtre d'agric, Conclusion. — Ils se jouoient d'une gaule, faisoient semvlant de se pourmener au long de leurs héritages. AUBIGNÉ, Faeneste, 1, 2.
(Proverbe). — Service n'est pas héritage, Si comme on dit communément. Anc. Poés. franc., IV, 33. — J'ay perdu, servant, mes requestes ; Service n'est pas heritaige. Ib., VII, 213.
(Fém.). — Que les anciennes héritages soyent conservées. L. L E R O Y , trad. des Politiques d'ARISTOTE, II, 5. — Pol, tu voudrais acheter l'héritage De ton voisin, et vrayment tu es sage : Mais ton voisin ne veut la vendre ainsi. BAÏF, Passetemps, L. IV (IV, 403). Heritaire. Héritier (G.). — Ne soubstiens plus ton heritaire Contre justice, et fais le taire. SAGON, Epist. à Marot (G.). Hérite. Hérétique. — Parquoy convient avoir vers Dieu recours, Considérant guerre et choses hérites Venir au monde et par noz démérites. GRINGORE, le Elazon des hérétiques (I, 329). — (Note des éditeurs.) La variante, harite, pourrait faire penser que hérite qualifie les maux qui viennent comme par héritage. Voir Hériter (à la fin). Heritel. Héréditaire. — Droits heritels. Acte de 1542 (G., Héritai). Heritellement. Héréditairement. — Vous avez le remède présent en vostre jardin, de bonnes herbes, desquelles la vertu vous demeure quasi heritellement de père en filz. Du FAIL, Propos rustiques, p. 4. Hériter (trans.). Recevoir en héritage. — En icelle ancienne loy se souffrait non seulement que les prestres eussent femmes et enfans, mais encores que les enfans succédassent aux temples et héritassent les bénéfices. B. D E LA GRISE, trad. de GUEVARA, l'Orloge des princes, I, 23. — Si les princes guerroyers et cruelz comme toy héritassent les vies de ceulx que ils tuent pour augmenter et alonger leurs vies. ID., ib., 1, 33. — Les Perses... ne se marioyent que pour avoir enfans qui héritassent leurs biens. ID., ib., I, 40. — Ils heritoyent l'honneur et dignité de la part des
pères. ID., ib., II, 3. — Comme il mourust et laissa deux enfans, le second hérita le royaume. ID., £J,, II, 19. — Nous ordonnons et commandons que si un père avoit plusieurs enfans, que le plus vertueux hérite les biens et richesses. ID., ib., II, 32. — Les enfans des princes doivent hériter royaumes, et... les enfans des grans seigneurs espèrent hériter grans estatz. ID., ib., II, 37. — Mais les benings hériteront la terre. MAROT, PS. de David, 26. Obtenir de droit. — Nul, quel qu'il soit, n'a le
ciel hérité, Si par vertu il ne l'a mérité. R. DE COLLERYE, Complainctes, 4. Faire héritier. — Ceulx qui estoient daucuns
héritiers povoient selon leurs nobles coustumes mettre le nom de ceulx qui les avoient héritez. MICHEL D E TOURS, trad. de SUÉTONE, III, 110 r°.
— Je suis de toy grandement esmerveillé... pourquoy tu déshérites ton aisné et plus grand filz, pour hériter le puisné et plus petit. B. DE LA GRISE, trad. de GUEVARA, l'Orloge des princes, II, 39. Mettre en possession. — Car ce n'estoit mye
droit de déshériter un roy chrestien... et hériter ung bastard. B O U C H A R D , Chron. de Bret., 113 a (G.). Hériter qqn de qqch. Laisser en héritage qqch à
qqn. — Le bon Anthoine Pie... me donna son noble empire... en m'heritant des jardins de Vul-canus pour mon passetemps. B. DE LA GRISE, trad. de GUEVARA, l'Orloge des princes, II, 16. — (Fig.). Tulles... T'a hérité de parfaicte éloquence. CRÉTIN, A Jaques de Bigue, p. 206. Donner héréditairement, de père en fils, qqch à
qqn. — (A l'Éternité). Tu n'as pas les humains favorisez ainsi, Que tu as héritez de peine et de souci, De vieillesse et de mort qui est leur vray partage. RONSARD, Hymnes, L. II, Hymne de l'Éternité (IV, 162). Hériter qqn de. Le mettre en possession de, lui
donner. — Quant le vray Dieu de sa grâce me hérite D'ung si hault roy comme celluy de France. J. M A R O T , Voyage de Gènes, 27 r° (G.). — O tous deux bienheurez qui telz filtres méritent. Leurs engins, leurs vertuz de gloire les héritent. LEMAIRE D E BELGES, Epitaphe en manière de dialogue (IV, 320). — Parquoy de loz sans mérites me hérites. CRÉTIN, A Honorât de la J aille, p. 217. Estre hérité de. Recevoir en héritage ou autre
ment. — De mes biens... Celluy en doibt estre seul hérité Qui en a part et a tout mérité. HE-ROET, la Parfaicte amye, L. I, p. 23. — Tu as mérité D'estre sans fard de tout los hérité. J. BOUCHET, Epistres familières du Traverseur, 17. — Et si n'estoit que tu es hérité Par Genius de toute vérité, J'accuserais de vaine flaterie Ta doulce lettre, ou bien de mocquerie. ID., ib., 33. — 0 douces seurs que tant j'ay regrettées, De plus grand eur soyez vous héritées. CH. FONTAINE, les XXI Epistres d'OviDE, Ep. 11, p. 216. Être doué de. — Veu les vertes dont estes
hérité, A vous louer je le veulx prendre en tache Sur tous humains. R. D E COLLERYE, Rondeaux, 54.
(Intrans.). Hériter à qqn. Hériter de qqn. -- w roy Alexandre... n'eut nulz enfans qui luy héritassent de ses biens. B. D E LA GRISE, trad. de GUEVARA, l'Orloge des princes, I, 47. — Leur héritant [à ses ancêtres] es biens de fortune. N. DE M O N T R E U X , 1er Liv. des Bergeries de Juliette, Journ. V, 254 v°. Hériter à qqch. Recevoir qqch en héritage.
L'empereur Marc Aurele fut marié à une fille 1 d'Antonius Pius... laquelle... hérita à l'Empire.
— 475 — HERODE
B. DE LA GRISE, trad. de GUEVARA, l'Orloge des princes, 1,1. S'hériter. Être transmis par héritage. — La
mort est un hoirier qui par succession Alternativement de père en filz s'hérite. CHA S S I G N E T , le Mespris de la vie, sonn. 275. Hérité. Possédant des biens. — Les riches et
ceulx qui se sentoyent bien héritez haïssoyent l'edict pour leur avarice. A M Y O T , Tiberius Grac-chus, 9. — Ayant esté gouverneur du païs, comme le mieux hérité seigneur. F A U C H E T , Antiquitez, XI, 8. (Prononc). — La guerre et les maux Que nous
voyons si grands et anormaux Régner partout, et dont chacun harite, Viennent de nous et nostre démérite. G R I N G O R E , le Blazon des hérétiques (I, 329, var.). Héritier (adj.). Héréditaire. — Permutations
héritières. 2 janv. 1530. Arch. Finist. (G.). Herle, v. Harie. Hermaphrodisie. Harmaphrodisme. — Her-
maphrodisie est double nature du sexe. J O U B E R T , Gr. chir., p. 593 (G.). Hermaphrodit. Hermaphrodite. — (Fig-)-
Ceux-là sont de vrais roys Qui sur leurs passions establissent des loix... Non les hermaphrodits (monstres effeminez). A U B I G N É , les Tragiques, II (IV, 91). Hermaphroditique. De l'homme et de la
femme. — On sçait que les ténèbres de mariage sont et obscures et fascheuses, voire que l'accouplement hermaphroditique ne nous abandonne que sur le grabat d'un chagrin et ennuy. C H O LIÈRES, 5e Matinée, p. 198. — A u lieu d'entendre à la luite hermaphroditique, ce sera un tousseur, un cracheur, un rechigné. ID., 7e Matinée, p. 256. Herme 1. Désert, abandonné, inculte.— Ilz ne
povoient pas avoir grande quantité [de vivres] du costé de la terre, pourtant quelle estoit la plus part demeurée inculte et herme, pour raison de la guerre. SEYSSEL, trad. d'AppiEN, Guerre libyque, ch. 5. — Cherchay les pas de ceste fere heureuse Par tout lieu herme et non accoustumé. V A S Q U I N PHILIEUL, trad. de P É T R A R Q U E , L. II, sonn. 52. — Ah Sophonisbe, un peu ton cœur referme (Luy dis je alors), Cartage des mains nostres Trois fois est cheute, et à la parfin erme. ID., ib., L. IV, Du triomphe d'Amour, ch. 2. — Lieux hermes et non cultivez. Du PINET, trad. de P L I N E , X X V , 8 (G.). — Il estime rhamnus estre une certaine ronce qui croist et rampe par terre es lieux hermes. ID., trad. du Commentaire sur Dioscoride, 1, 102 (G.). — Guyse, fils des preuves, qui ne vont respirantz, Comme dit l'herezie, a se faire tyrants, Ains à l'honneur de Dieu, de l'Eglise et du prince, A la protection de cette herme province. L. P A P O N , Pastorelle, IV, 1. — De si petite part, D'estroicte portion de terre qui soit herme, Pourveu qu'au bord des eaus, en un solage ferme, Il soit umbré dun orme ou d'un chesne plus haut, Bergers, nous voyla bien, c'est plus qu'il ne nous faut. ID., io., V, 1. — Des règnes divisés les peuples sont destruicts, Désertes les cités, monts vagues, pleines hermes. ID., ib. En herme. A l'état d'abandon. — Le lieu où
souloit estre l'abbaye de Cluny... demoura longtemps en solitude et (comme on dit) en herme. o* JULIEN, Mesl. histor., p. 520 (G.). Herme 2. — Le zephyre et mon herme double
[latin : geminus Pollux] Par les bruits de P^Egaee trouble Me porteront au sein du port. Luc D E L A PORTE, trad. d'HoRACE, Odes, III, 29.
H e r m e 3. Peut-être pour herpe, liard. — Aux mendians qui vont par le chemin Sans porter croix d'aulbert, ne pied, ne herme, Je veulx es-cripre dedans mon parchemin Que je leur donne m a blesse et salverne. Anc. Poés. franc., V, 152. Hermétique (pierre). — Il luy donna un co-
lier fait de quatre pierres hermétiques supportées de cristal. B E R O A L D E D E V E R V I L L E , Voyage des princes fortunez, p. 377.
Hermicraine, v. Hemicraine.
Hermier 1. Inculte.— Tous les terroirs tant hermiers, bois, landes, que de culture. 1609. Arch. H. Pyr. (G.). Hermier 2. Curer. — Fauder et hermier de
faulx et ratel une rivière. 1524. Lille (G.).
Herminer. Orner d'hermine. — Ceux de la Jousseliniere, descendus de mesme tige, ont depuis hermine leur lion. A U B I G N É , Sa Vie à ses enfants (I, 49).
Herminette, dimin. d'hermine. — Ilz surmontaient les dangereux rochers... pour trouver les gistes et tanières des escuireaux faitiz, des belles martres... et blanches herminettes. L E M A I R E D E B E L G E S , Illustr., 1, 21.
Hermitage. Solitude, désert. — Nous ne voyons pas seulement un hom m e qui approche de ceste saincte ville. Ce n'est qu'un hermitage et solitude à Pentour. D u VA I R , Médit, sur les lament. de Jeremie, ch. 1. Hermital. Des ermites. — Ces prestres pres-
cheurs de mensonges en l'isle hermitale, tiennent pour asseuré, et le font accroire, que ces beaux dieux pierreux leur révèlent les choses futures. T H E V E T , Cosmogr., XI, 7. Ermite. — Madame, soyés secourable Aulx
pauvres frères hermytaulx. Sotties, III, 92. Hermitesse, fém. d'hermite. — Là sont belles
et joyeuses hypocritesses, chattemitesses, hermi-tesses. R A B E L A I S , IV, 64. Hermitillon, dimin. d'hermite. — Et y a copie
de petitz hypocritillons, chattemitillons, hermi-tillons. R A B E L A I S , IV, 64. Hermitresse. F e m m e ermite. — Une povre
hermitresse. FOSSETIER, Cron. Marg., 1, 109 v° (G.). Hermodate (êpnoSâxTuXov). Sorte de plante mé
dicinale. — Hermodates, c'est une herbe ou croist a l'environ de sa racine une manière de choses rondes, lesquelles choses sont proprement appel-lees hermodates. Le Grant herbier, n° 234 (G., Compl.). — En lieu du sabin on prendra de la pouldre de hermodacte bruslée. A M B R . P A R É , V, 21. — Les trochisques de myrrha, les hermo-dattes. ID., XVIII, 42. — Les hermodattes tirent principalement [le flegme] des jointures. ID., XXV, 6.
Hermytal, v. Hermital. Hernekeur. Faiseur de harnais. — Herne-
keur de la Vasne. 1573. Valenciennes (G., Har-nascheur).
Herner, v. Esrener. Hernie. (Prononc). — Il prétend guérir l'her
nie. C H O L I È R E S , 4e Matinée, p. 133. — Je croy que son hernie en eut peu avorter. ID., ib., p. 164.
Hernieux. Celui qui a une hernie. — Dictes en autant à un verolé, à un goutteux, à un hernieux. M O N T A I G N E , III, 13 (IV, 250).
Herode. Aussi fier qu'un roy Herode._ — La
HERODIEN — 476 —
dame m e veit sur le gourt, Gay et gaillard, selon la mode ; Elle m'appelle brief et court ; J'entre gayment dedans sa court Aussi fier qu'ung roy Herode. R. D E C O L L E R Y E , Monologue du Résolu. Herodien. Semblable à Hérode. — Qui sont
ces orgueilleux damnables, sinon gens herodiens pleins de sacrilèges, lesquels s'attribuent la gloire de Dieu? Trad. de B U L L I N G E R , la Source d'erreur, 1,23, p. 304.
Heroe, v. Héros.
Heroé. Héroïque. — Reçois, prince heroé, reçois, cœur généreux, Ce jeune advancoureur. J. D E B O Y S S I È R E S , Sec. Œuv., 34 v°.
Heroïc, v. Héroïque.
Heroïde (nou>U, -tSoç). Héroïne. — Et n'ay jamais eu désir qu'il conferast m a beauté à ces anciennes heroïdes, Pénélope, Arête et Theane. F. B R E T I N , trad. de L U C I E N , Sur les images, 1.
Heroin, dérivé de héros. — Et nourrissoit l'Es-culape heroin, A tous maux médecin. 1579. G. L E F E V R E , 40 b (Vaganay, Deux mille mots).
(Adj.). De héros. — Heroine grâce. Entrée de Henry II à Rouen, 61 r° (G.). Héroïque. (Prononc. : h aspirée). — A l'heure
Lancelot, en prose héroïque, Monstroit de nos majeurs la fureur poétique. V A U Q U E L I N D E LA F R E S N A Y E , Art poet., II, p. 74.
(Sans e final). — Aussi commandèrent que nul lequel pour estre en seurté s'en fuyst au temple heroic de César feust banny ne despouillé. DEROZIERS, trad. de D I O N CASSIUS, Hist. rom., L. XLVII, ch. 63 (131 r°).
Heroizer. Diviniser. — Et les filles de Mémoire Ont heroizé ta gloire. L E C A R O N , Poésies, à Ronsard.
Se heroizer. Se rendre héroïque. — Ces trop brusques mouvans, Dont l'ardeur, se couvrant d'une valleur hardie, Se cuyde heroizer par audace estourdie. L. P A P O N , la Constance (SuppL, P- «). Heronde, v. Aronde. Heronnier. Qui chasse le héron. — Faucon...
Gentil, passager... hairronnier. M. D E L A P O R T E , Epithetes, 172 v°. Maigre comme la jambe du héron. — Et si m'a
faict la cuysse heronniere, L'estomac sec, le ventre plat et vague. M A R O T , Epistres, 29. — U n moyne un jour jouant sus la rivière, Trouva la vieille en lavant ses drapeaux, Qui luy monstre de sa cuisse heroniere U n feu ardant. ID., Epigrammes, 253. — Le tout conclud fut à poincte affilée, Maulgré Até, la cuisse heronniere. R A B E L A I S , I, 2. — Le ventre besacier, la cuisse heronniere. J O D E L L E , Sonnet sur les beautez d'une garse (II, 341). — Quant à la beste, elle est de couleur d'une belette, ayant... les jambes gresles et minces, les cuisses heronnieres. A M B R . P A R É , Discours de la licorne, 4. — Fesse petite et cuisse heronniere. V A U Q U E LIN D E LA F R E S N A Y E , Satyres franc., L. IV, Du naturel des femmes. — Et de ton flanc l'embon-poinct, Qui à sa jambe boufle La cuisse heroniere joinct. Luc D E L A P O R T E , trad. d'HoRACE, Epodes, 8. — D'autres les ont si gresles et menues et si héronnières, qu'on les prendrait plustost pour des fleutes que pour cuisses et jambes. B R A N T Ô M E , des Dames, part. II (IX, 274). Heronniere (subst.). F e m m e qui a les jambes
maigres et longues. — Adieu, la belle heronniere. M A R O T , Gracieux adieux aux dames de Paris, édit. Guiffrey, III, 120.
Héros. O n écrit souvent heroes au pluriel sous l'influence du grec et du latin. — La béatitude des heroes et semidieux. R A B E L A I S , I, 13. — Les anges, les heroes, les bons daemons. ID., III, 21, — Comment le bon Macrobe raconte à Pantagruel le manoir et discession des heroes. ID., IV, 26 (titre). — E n ceste obscure forest... est l'habitation des daemons et heroes. ID., IV, 26. — Au vieil temps, que l'enfant de Rhée N'avoit la terre dedorée, Les heroes ne dédaignoient Les chiens qui les accompagnoient. R O N S A R D , Gayetez, 5, édit. de 1623 (VI, 344). — Les heroes chevale-reux De la race desquels vous estes. BUTTET, k Prem. liv. des Vers, Ode 6. — Mais au beau milieu de si clairs heroes Henri flamboie, découvert les joues Sous s%i visière. ID., le Sec. liv. des Vers, Ode 1. — Ces heroes s'en vont au temple, se hâtant. ID., Epithalame. — Fault avoir temples dans les villages, dédiez tant aux dieux qu'aux heroes. L. L E R O Y , trad. des Politiques d'ARISTOTE, VII, 12. — Ce bon père pitoyable Nous laissa de justes loix, Et les heroes pour rois Dessus la terre habitable. M m e s D E S R O C H E S , Ode 5.
O n emploie m ê m e heroe au singulier, sous l'influence du pluriel heroes. — Puis que je sen jà l'heur que m'a promis Par son conseil l'heroe des amis, L'esprit errant du grand Protesilas. PONTUS D E T Y A R D , Erreurs amoureuses, L. III, sonn. 24. Heroe. Héroïque. — Et pour ce faire obédience
aurez Vertuz heroe. J. B O U C H E T , Epistres morales du Traverseur, I, 9.
(Prononc). — L'héros Tyrinthien quy, d'un bras vigoureux, Defeit et surmonta tant de monstres affreux. Anc. Poés. franc., III, 73. — Telle troupe d'héros, l'eslite de la Grèce, Accom-paignoient Jason d'un cœur plein d'allégresse. R O N S A R D , Hymnes, L. I, Hymne de Calays et de Zethés (IV, 168). — Ce preux seigneur de Guise, Dont la vertu par armes s'est acquise Le nom d'héros et du rempart françois. ID., Pièces retranchées, Hymnes (VI, 157). — Pour desseigner que leur puissance est morte Si quelque héros ne leur tient la main forte. ID., Poèmes, L. I, A Jeandela Peruse (V, 37). — Lors en f râpant sa cuisse ainsi l'héros Asie, Gémissant de despit, Jupiter injurie. A M . J A M Y N , Iliade, XII, 5 r°. — L'héros Autome-don et le vaillant Alcime. ID., ib., XXIV, 231 r°. — Voicy l'héros françois qui t'apporte la paix. BO Y S S I È R E S , Prem. Œuv., 6 v°. — Suscitant quelque héros qui valeureux deschire Et les fers et les ceps dans lesquels il souspire. Du BARTAS, 2e Semaine, 3e Jour, les Capitaines, p. 479. — Quels délices de voir trépigner flanc à flanc, En cercle, tout le long des hauts murs, un long rang De dames et d'héros. ID., ib., 4e Jour, la Magnificence, p. 385. — Courage, ô grand Henry : anchre icy ta pensée : O brave «héros, poursuy la cure commencée. ID., Cantiques de la victoire d'Yvry, p. 427.
Herpail, Herpe 1, v. Harpail, Harpe 1. Herpe 2, mot d'argot. Liard. — J'avois de bu
tin deux rusquins et demi menée de rons, deux herpès, un froc et un pied. Var. hist. et litt., VIII, 151. — Il nous coustoit pour le peaux huré deux herpès, c'est à dire deux liards pour coucher. Ib., VIII, 151.—Herpe. Liard. Ib., VIII, 189.
Herpé. Bien articulé. — Une lice qui soit herpee et aye l'eschine large. C H A R L E S IX, la Chasse royale, ch. 12 (G.). — Les reins courbez [d'un chien] et le jarret droit bien herpé signifient la vitesse. M. D E L A P O R T E , Epithetes, 81-82. — Le jarret droit et bien herpé pour la vitesse. E. BINET, Merv. de nat., p. 5 (G., Compl.).
Herpelu, mot d'argot. Liard. — Ils appellent un escu un rougesme... un liard un herpelu. GUILL. BOUCHET, 15e Seree (III, 130).
Herper 1. Ramper. — Serpoullet, qui herpe contre terre. RABELAIS, III, 50. Herper 2, v. Harper 2.
Herpet. Herpès. — Il guerist herpetz et apos-tumes cholériques. Trad. de l'Hyst. des plant, de L. FOUSCH, ch. 68 (G.).
Herpete. Herpès. — La bourse du pasteur cure et guerist les fistules et herpetes. Jard. de santé, I, 353 (G.). — Pustules ou apostumes nommées arpetes. Ib., 365 (G.). Herpeteux. Éruptif. — Ces herpeteuses mala
dies. L. GUYON, Le Miroir de la beauté, II, 80 (G.).
Herprye (?). — Sellions, douzimes, herpryes, harpagiez pour les incendies. 1526. Péronne (G.).
Herquelier, mot dialectal. — Hercule est aussi dépeint tout nud comme un champion. Et de-là les Allemans et quelques paysans de l'Anjou retiennent, je ne sçay par quel moyen, les uns leur hergeiler, et les autres leur herquelier, pour un kaimand et belistre qui va tout nud et mendie son pain. L E LOYER, Hist. des Spectres, VII, 8. Herre 1, v. Hère. Herre 2, v. Erre.
Herseelleur (?). — Amour m'a faict si bien seeller Par tout sans estre herseelleur Que mon estât ne puis celer : Du Puy d'Amours suis le seel-Ieur. Anc. Poés. franc., IV, 262. Herseler, v. Harceler.
Herser. Traîner. — [Diogène] le tournoit [son tonneau], virait, brouilloit, barbouilloit, hersoit, versoit, renversoit. RABELAIS, III, Prologue. Sillonner. — En pointe on voit les grues se ran
ger... Puis en bataille en aigu ordonnée, D'ailes et cris battant Pair, déloger Droit vers midi, et bien loin s'étranger, Hersant le ciel d'une longue trainee. BUTTET, VAmalthee, 243, p. 314. Herchié. Hersé. — (Fig.). Plaisir sera au vieil
mastin De trouver son pastis herchié. Anc. Théâtre franc., I, 310. (Prononc). — Lecquel estoit au dit lieu hier-
chant aucunes terres. 22 avril 1525. Reg. aux publications. Arch. Tournai (G., Compl., Herser). — Un laboureur semoit de la vesche, derrière lequel estoient deux ou trois compagnies de pigeons... lesquels, ainsi qu'il espandoit la semence, ten-doient le bec en haut et la recevoient, de sorte qu'il n'en tomboit aucun grain en la terre. Au moyen de quoy le laboureur fut bien dolent ne trouvant que hercher. PH. D'ALCRIPE, la Nouvelle Fabrique, p. 115. Herset. Variété de pomme. — Les pommes
d'herset, de claguet, de gros œil. LIEBAULT, III, 49 (G., Compl., Claguet). Hersoir. Hier soir. — Vrayement tu es bien
acresté à ce matin : tu mengeas hersoir trop de mil. RABELAIS, I, 25. — Seigneur, hersoir, le ciel desja noircy, Vismes de Dieu anges resplendis-sans. MARG. DE NAV., les Marguerites, Comed. de la Nativ. de J. C. (II, 41). — J'ay toute nuict pensé au propos que vous tenoit ersoir mon frère Florestan. Amadis, III, 5. — Je crains bien que les louanges de la chasse, hersoir récitées, nayent trop incité noz jeunes gens. PASQUIER, Opuscules de PLUTARQUE, p. 109. — Vous ne voulustes pas crier hersoir le roy boit. GUILL. BOUCHET, 4e Seree (I, 147). — Il y en a d'autres que nous mettons
HESPANOL
indifféremment en œuvre, benisson et bénédiction, cil et celuy, hersoir et hier au soir. E. PASQUIER, Recherches, VIII, 37. — Je me trouve aujourd'huy roy d'un puissant royaume, Qui n'avois pas hersoir un petit toict de chaume. MONTCHRESTIEN, la Cartaginoise, II, p. 127. On dit aussi harsoir, arsoir. — Je prins arsoir
en ma ratière Plus de quatre-vingts souriceaux. R. D E COLLERYE, Satyre pour les habitans d'Auxerre. — Le juste dueil remply de fascherie Qu'eustes arsoir par la grand'resverie De l'homme vieil, ennemy de plaisir, M'a mis au cueur un si grand desplaisir Que toute nuyct repos je n'ay sceu prendre. M A R O T , Elégies, 12. — Arsoir tout tard, on luy dit que vous trouviez mal. Amadis, V, 36. — Je vins arsoir en la chambre de m'amie. L E M A Ç O N , trad. de BOCCACE, Decameron, IV, 10. — Avant qu'il m'advint un autre tel inconvénient comme celuy d'arsoir. ID., ib., V, 5. — Arsoir seulement mon frère receut les lettres du roy du gouvernement d'Albe, que luy avez fait donner. MO N L U C , Lettres, 5 (IV, 10). — Je la revy arsoir Toute seule en un coin s'asseoir. MEL I N D E S* GELAYS, trad. d'une Epigramme de MARTIAL (I, 77). — Harsoir en vous couchant vous jurastes vos yeux D'estre plus-tost que moy ce matin esveillee. RONSARD, Amours de Marie (I, 147). — Harsoir en se jouant l'enfant de Cytherée Faisant de tes beaux yeux une flèche acérée, En m'ouvrant l'estomac tout le cœur m'a percé. ID., Elégies, Discours 1 (IV, 14). — Vous faites grand tort à mon maistre. — Moy ! —Vous.— Qui ne suis arrivée Que d'arsoir en ceste contrée. BAÏF, le Brave, II, 4. — Car j'ay veu le soleil aux tresses annelees Sortir, net, pur et beau, des campagnes sallees, Et harsoir, du croissant, qui le beau temps semont, Les cornichons pointus versez en contremont. R. BELLEAU, la Bergerie, 2e Journ., Eclogue sur la guarison d'Amour (II, 44). — J'attachay des bouquets de cent mille couleurs, De mes pleurs arrosez harsoir dessus ta porte. RONSARD, Sonnets pour Hélène, I, 60. — Ils [les oiseaux de proie] ont esté curez Arsoir, et ce matin sur la perche essuierez. CL. GAUCHET, le Plaisir des champs, VHyver, le Vol pour héron, p. 342. — Nous n'avons rien veu et avant arsoir y fusmes jusques après minuit. MONTAIGNE, Lettres (IV, 352). Arsoir se déforme en asseoir. — La servante
trouva le cas au matin, et vint à monsieur luy dire : « Le vilain d'asseoir a planté ses immondani-tez à nostre porte. » B E R O A L D E D E VERVILLE, le Moyen de parvenir, Fantaisie (II, 232). Heruper, v. Hureper. Hesdre. Cèdre. — Aussi leurprofitent les boys des forests portants gland, et le terebinthe, le lentisque, et le hesdre sentant bon. (Latin : odo-rata cedrus). COTEREAU, frad. de COLUMELLE, IX, 4. Hésitation. (Prononc). — Le rencontre m'en offrira le jour quelque autre fois, plus apparent que celuy du midy : et me fera estonner de ma hésitation. MONTAIGNE, I, 10 (I, 51). Hesne, forme dialectale. Chêne. — Que je
pesse monter sur iquest hesne, et que j'en tombe de branque en branque. B E R O A L D E D E VERVILLE, le Moyen de parvenir, Journal (I, 75). Hespagne, Hespagnolizer, v. Espagne, Espa-
gnoliser. Hespaillier, Hespalier, Hespallier, v. Es
palier. Hespanol, v. Espagnol 2.
7 —
HESPERE — 478 —
H'espere. Occident. — Et l'un et l'autre pôle à l'un et l'autre frère Sera obéissant : l'un régira l'Hespere, L'autre le pôle Artic. J. D O R Â T , De la merveilleuse vision de la reine mère (p. 21).
Hesperie. Occidentale. — L'autre [tour] après, Hesperie. R A B E L A I S , I, 53. A esperie. A l'ouest. — Ceux de Gennes présen
tèrent leurs galères à esperie. A U B I G N É , Hist. univ., X V , 10. Het, v. Hait.
Heteroclitocentricallement, mot forgé. — Mouvement de carolle lydique heteroclitocentricallement trépignante. P H . D E M A R N I X , Differ. de la Relig., I, 5, Préface. Heterogenée. Hétérogène. — Nous rejecte-
rons aulcuns des homogenées... et prendrons aucunes choses heterogenées, comme les digressions et retardements. R A M U S , Dialectique, II, 17. — Tout h o m m e de dessein veut de choses tant heterogenées faire un très difficile accord. A U B I G N É , Médit, sur le Ps. 84 (II, 146). — L'affection prei-gnante reserra leurs cœurs à la confidence, comme le froid reserre les choses étérogenées. ID., Hist. univ., II, 17. — La raine se retira dans Agen, où fut despesché le vicomte de Turenne pour traicter avec autres députez ; mais la fraude perpétuelle des uns et la crainte perpétuelle des autres ne peurent rien engendrer de ces natures hétérogé-nées. ID., ib., IX, 2. — Si vous essayez de renforcer vostre corps de pièces heterogenées, c'est comme si vous vouliez grossir vos bras de la chair d'autruy. ID., Lettres de sources diverses, 27 (1,588).
Hetoudeau. Jeune chapon. — Force poulaille courant parmy les cours Et gras chappons qui sont presens en cours, Gros hetoudeaux tendres et bien refaitz. Anc. Poés. franc., VIII, 219. — Feurent roustiz... quatorze cens Ievraux, troys cens et troys hostardes, et mille sept cens hutau-deaux. R A B E L A I S , I, 37. — Je leur fai bonne chère D'un petit hetoudeau nourri de m a façon. FR. H A B E R T , trad. d'HoRACE, Satyres, II, 2, Paraphrase. — Hutaudeaux. Becars. Cabirotz. R A BELAIS, IV, 59. — Deux perdrix et deux cailles, U n connil, quelques hutaudeaux, Cardes, oranges, pigeonneaux, Si j'en puis trouver à bon pris Dessous la porte de Paris. R. B E L L E A U , la Reconnue, IV, 2. — Ce mot aussi hetoudeau est ici, et en quelques lieux voisins, ce qu'ailleurs on appelle chaponneau. H. E S T I E N N E , Precellence, p. 174. — La bécasse couste autant que le haitoudeau. 1583. Grands jours de Troyes (G.). — Non pour en faire des chapons de la grande sorte, ains de la moyenne, pour lès manger en chapponneaux ou estoudeaux durant l'hyver. O. D E S E R R E S , Théâtre d'agric, V, 2. — Est aussi besoin de se haster tant qu'on peut au chaponner des estau-deaux, afin d'avoir des grands chapons. ID., ib. Hetter, v. Haiter. Heuceret. A cheville. — Que nulz ne nulles
ne copece bos sur aultruy que on puist forer d'un tarai heuceret sur l'amende de v soulz. 1507. Prév. de Vimeu (G.). Heuchoir. Plaque de métal servant à garantir
la table. — U n potier d'estain livre trois xn e s de heuchoirs et quatre garde nappes de fin estain. 1501. Béthune (G.). — Six ronds heuchoirs doubles. 1544. Mobil, de la halle de Béthune (G.). Heude (?). — Et leur endommageâmes
presques tous leurs navires, sans la heude qui fut j brullée. P H . D E M A R N I X , Ecrits polit, et histor., p. 281.
Heudry. Pourri. — S'ils [les tombeaux] estoient ouverts, on n'y verrait qu'une pierre suin-teuse, qu'un linge heudry, qu'une teste de mort au crâne descharné. P. D E B R A C H , les Regrets sur la mort d'Aymee, A M. de Nesmond.
Heue. Sorte de bateau. — Que il se puist pour-veoir de heues et autres choses nécessaires pour l'adresse de l'armée qu'il est délibéré de mettre sus. Corresp. de Max. Ier avec Marg. d'Autriche, t. II, p. 136 (G.,Huel).
Heuler, v. Hurler.
Heulet ( ? ) . — Contenant icelle description le nombre des isles ou aires et heulets de marais, la séparation d'icelles. 1er juin 1541. Edit sur le fait des gabelles (G.).
Heur. Chance bonne ou mauvaise. — C'est l'heur de la guerre. Une fois perdre et l'autre gaigner. L E L O Y A L S E R V I T E U R , Hist. de Bayart, ch. 59. — Iceulx je suis d'advis que nous pour-suyvons ce pendent que l'heur est pour nous. RABELAIS, I, 37. — Bref, en fièvre d'amour, espie l'heure et l'heur D'aborder la déesse et luy ouvrir son cœur. R. B E L L E A U , la Bergerie, 2e Journ., Amour ambitieux d'Ixion (II, 21).
Dans le mot composé bonheur, les deux éléments sont encore séparables ; bon peut varier, et heur garde alors son sens général. — Le triste Heraclite... Par son pleurer et plaindre les invite Suyvre le trac de ses humides pleurs : Lequel suy-vant, le chemin des bons heurs Hz trouveront. M I C H E L D ' A M B O I S E , le Pleur de Heraclite, ch. 12, — Ceux qui sont marquez en telle madère sont appeliez joviaux principalement : lesquels usent souvent des bons heurs de fortune. A N T . D U MOULIN, trad. de J. D'INDAGINE, Chiromance, p. 83. — Quatre ou cinq fois (ou plus) toutes les lunes Vous descrirois mes bons eurs ou fortunes. CH. FONTAINE, le Passetemps des amis, p. 284. — L'honneur est deu à tous seigneurs Belliqueux, suyvans nostre sire : Qui par armes et par bons heurs Font que l'ennemi se retire. ID. (1557), Ode 8. — Ces bons heurs tu avois, eulx avoient au contraire Le malheur de n'avoir ta santé plus entière. J. DO-R A T , Sur le deces de Claude de l'Aubespine. — Voyez comme les bons heurs se rassemblent en une personne pour les distribuer par diverses occurrences. B R A N T Ô M E , des Dames, part. 1, Elizabet de Fr., reine d'Esp. (VIII, 3).
Heur. Chance favorable, bonheur. — Cil qui la veoit jouit d'un trèshault heur. M A R O T , Rondeaux, 51. — L'heur d'Hannibal par la fatale main De Scipion, le jeune enfant romdn, Fut destourné. ID., Epistre à M. Danguyen. — Leurs remonstrant par lieux de rhetoricque les misères de ce monde, le bien et l'heur de l'autre vie. RABELAIS, IV, 8. — Ce n'est un petit heur Quand une femme acquiert un dieu pour serviteur. RONSARD, Hymnes, L. II, Hymne de VAutonne (IV, 323). — Il ne jouit pas longuement de l'heur d'avoir esté restitué en sa maison et en ses biens. A M Y O T , Démosthène, 28. — Pompeius mesme re-putoit un grand heur à luy de s'estre rencontré à temps de pouvoir exécuter un tel acte. ID., Pompée, 21. — Et comme un doux regard ne sai quel heur envoie Qui fait que le cœur gay sautele de grand joye. BAÏF, Poèmes, L. II (II, 106). — Je suis devenu tant heureux que je ne changerons mon heur à un royaume. L A R I V E Y , les Esprits,V, 5. — Certains Indiens portoient... au combat contre les Espagnols les ossemens d'un de leurs capitaines, en considération de l'heur qu'il avoit eu en vivant. M O N T A I G N E , I, 3 (1,18). — Rapportant leur heur ou malheur à la raison divine. ID-I
— 479 — HEURE
I, 31 (I, 273). — La plus commune et plus saine part des hommes tient à grand heur l'abondance des enfants : moy et quelques autres, à pareil heur le défaut. ID., I, 40 (I, 342). — Une mort courte, dit Pline, est le souverain heur de la vie humaine. ID., II, 13 (II, 388). — Les philosophes tiennent que le vray heur est quand on participe à vertu. LA N O U E , Disc, polit, et milit., X, p. 247. — Les âmes qui par stupidité ne voyent les choses qu'à demy jouissent de cet heur que les nuisibles les blessent moins. M O N T A I G N E , III, 10 (IV, 137). — Quel heur d'un grand malheur, si ce brutal excez Parvenoit à juger un jour tous noz procez ! A U B I GNÉ, les Tragiques, 1 (IV, 64). Heurder, v. Hourder. Heure. Temps. — E n peu d'heure les nefz
eslongnerent le pays de Grèce. Amadis, II, 1. — Don Quedragant... vint charger le beau Ténébreux, qui luy monstra en peu d'heure comme il sçavoit rendre ce qu'on luy prestoit. Ib., II, 13. — En peu d'heure ilz eslongnerent la coste de la grand Bretaigne. Ib., III, 3. — Bien s'apperceut Frandalo en peu d'heure qu'il n'avoit pas à faire à un enfant, ainsi comme il esperoit, ains à un chevalier hardy aultant qu'un lyon. Ib., V, 19. — Un autre je vy lequel en peu d'heure guarist neuf bons gentils hommes. R A B E L A I S , V, 20. — Et y devenoient clercs et scavans en peu d'heure. ID., V, 30. — La bonne eau se cognoist aussi si elle n'a point de goust... si les pois et légumes y cuisent bien et en peu d'heure. GUILL. B O U C H E T , 2e Seree (I, 65). Minute d'heure. Minute. — Il ne m e laissa pas
dormir une seule minute d'heure. A M Y O T , Hist. Mthiop., L. VI, 64 r°. — Il y en eut aucuns qui n'y peurent pas à peine toucher, ny durer dessus une seule minute d'heure. ID., ib., L. X, 111 v°. — Quand il est arresté, mon enfant, que lon meure, On n'y peut reculer d'une minute d'heure. R. G A R NIER, Hippolyte, 140. — A chasque minute d'heure nous recevons nouvelle obligation d'aymer Dieu. MONTAIGNE, trad. de R. S E B O N , ch. 115. — Je m'en
revay à Caesar. Ses plaisirs ne luy firent jamais desrober une seule minute d'heure, ny destourner un pas des occasions qui se presentoyent pour son aggrandissement. ID., Essais, II, 33 (III, 157). — Il n'y a point tant de minutes d'heures en un an qu'il eut receu de maudissons par jour. C H O LIÈRES, 2e Ap.-disnée, p. 65. Moment d'heure. Moment. — Vous voyez
comme en un moment d'heure nous avons abbatu et mis soubs noz pieds la maison d'Alexandre le grand. A M Y O T , Paul Emile, 27. — Comment est-ce que cela ne se contre-dit et répugne, de dire que également soit eligible et désirable la béatitude d'un moment d'heure que celle d'une éternité...? ID., Contredicts des stoïques, 26. En l'heure que. Au moment où. — A u sixième
jour subséquent Pantagruel feut de retour, en l'heure que par eaue de Bloys estoit arrivé Tri-boullet. RABELAI S , III, 45. Quelque heure. U n jour. — Adieu, fleur de mes
fleurs, Vengeance vous feray quelque heure. J. D O U B L E T , Elégies, 22. D'heure à heure. De temps en temps. — Pour
avoir plus l'accointance de Belle-couleur, il luy faisoit des presens d'heure à heure. L E M A Ç O N , trad. de B O C C A C E , Decameron, VIII, 2. A l'heure l'heure. A u jour le jour. — Mais bien
heureux aussi qui paisible demeure Dans sa basse maison vivant à l'heure l'heure. M O N T C H R E S T I E N , ta Cartaginoise, I, p. 116. A l'heure. Alors. — H o m m e s mortelz ne con-
gnoissoient à l'heure Fors seulement le lieu de leur demeure. M A R O T , L. I de la Metamorph. (III, 161). — Ce qui estoit veine de pierre à l'heure Fut veine d'homme, et soubz son nom demeure. ID., ib. (III, 179). — Et ce jour là à grand'peine on sçavoit Lequel des deux gaigne le prix avoit, Ou de Merlin ou de moy : dont à l'heure Thony s'en vint sur le pré grand'alleure. ID., Eglogue au roy. — Mais le bon dieu Mercure, à l'heure, Par sa pitié le secourut. C O R R O Z E T , Fables d'EsoPE, 114. — Ainsi, après que l'ayeul de mon maistre Hors des combats retirera sa dextre... Dessus le luth à l'heure ton Ronsard Te chantera. R O N S A R D , Amours de Cassandre, Elégie à Cassandre (I, 112). — Elle ne fait semblant alheure De m'aviser comme je pleure. BAÏF, les Amours de Meline, L. I (I, 28). — Alheure je failly, quand pour estre asservie Je perdy de mon gré m a liberté ravie. — ID., l'Amour de Francine, L. II (I, 170). — Les autres... disent que Romulus à l'heure estoit hors de la ville. A M Y O T , Romulus, 27. — Le roy l'ayant ouy parler ne luy respondit rien à l'heure. ID., Thémistocle, 28. — Caesar à l'heure luy respondit si bien que le Sénat s'en contenta. ID., César, 6. — Cent petits Cupidons à l'heure A Pentour de sa cheveleure Branloyent leurs ailerons mollets. R. B E L L E A U , les Amours des Pierres précieuses, l'Agathe (II, 225). — A-tant se tout le Bon-heur, qui à l'heure Entra chez toy pour y faire demeure. R O N S A R D , le Bocage royal, lre part. (III, 264). — Quand les os de tous deus en un tombeau seront, Et sa plainte et la mienne à l'heure cesseront. P A S S E R A T , Quatrains (II, 86). — Le malheur avoit veu mainte tremblante lame Assaillir vostre sein non à l'heure vestu Que des armes d'un cœur armé de sa vertu. B E R T A U T , Discours au roy allant en Picardie, p. 104.
Lors à l'heure. Alors, à ce moment. — L'empereur ne voulut lors à l'heure les admonnester. B. D E LA GRISE, trad. de G U E V A R A , l'Orloge des princes, 11, 35.
Jusques à l'heure. Jusqu'alors. — Jusques à l'heure il n'avoit encore point veu de femme qui fust à son gré digne d'estre aymée. A M Y O T , Hist. Mthiop., L. III, 39 r°.
A l'heure. Sur l'heure, tout de suite, dès ce moment. — Hz vous pourront mettre en avant Cent bons propos, desquelz à l'heure Vous pourrez devenir meilleure. M A R O T , trad. de deux Colloques d'ERASME, 2. — Doubtant que on ne trouvast à l'heure chausses commodes pour ses jambes. R A BELAIS, I, 20. — Elle s'aprocha... bien délibérée. .. de le faire mourir à l'heure. Amadis, V, 9. — Lors appella Amadis, et luy baillant son manteau royal, voulut qu'il le vestist à l'heure. Ib., V, 28. — Il falloit que son cœur fust en roc endurcy, De pouvoir, trop cruel, l'abandonner dnsi... De moy, sans la laisser je fusse mort à l'heure. D E S PORTES, Elégies, L. I, Discours. — [L'Amour] Dépité retranche le cours De son aile, et sans le secours De sa mère, il mourait à l'heure. R. B E L L E A U , les Amours des Pierres précieuses, la Cornaline (II, 233). — Que ferions-nous icy...? Sortons, sortons à l'heure, Afin que nous trouvions plus heureuse demeure. CL. G A U C H E T , le Plaisir des champs, le Printemps, Beaujour, p. 3. A l'heure-à l'heure. Aussitôt, tout de suite, im
médiatement. — Si j'aime autre que vous, ce penser bien humain, Qu'amour si doucement mit jadis en mon ame, S'en parte à l'heure-à l'heure, et ce beau feu, madame, Qui brusle dans mon cœur s'esteigne aussi soudain. O. D E M A G N Y , les Souspirs, sonn. 60. — Mais estant, las, helas ! trop seur Que cet infernal ravisseur L'avoit d'en sa-
HEURE — 480 —
vourer contraincte, A l'heure-à-l'heure en te fa-chant Et tes blondz cheveux arrachant, Ceres, tu redoublois ta plaincte. O. D E M A G N Y , Odes, 1,1. — Je te suppli', Seigneur, qu'à l'heure à l'heure Ta saincte main m e soustienne et sequeure. D E S M A SURE S , David combattant, 523. — Voicy venir le monstre, et à l'heure et à l'heure Les chevaux es-perdus rompent toute demeure. R. G A R N I E R , Hippolyte, 2103. — Et Sandrin, qui s'asseure Que l'escharpe est pour luy, n'attend qu'à l'heure à l'heure O n la levé du may pour la luy apporter. CL. G A U C H E T , le Plaisir des champs, le Printemps, la Festedu village, p. 70. — P u i s chacun àl'instant, sur son cheval monté, Donne un coup de la trompe, afin qu'à l'heure à l'heure Les vallets et les chiens, sans plus faire demeure, Se mettent en chemin. ID., ib., l'Automne, la Chasse du sanglier, p. 232.
Tout a Iheure. Aussitôt. — Il rencontra Euridice sœur de Phila... Si l'espousa tout a Iheure. S E Y S SEL, Successeurs d'Alexandre, IV, 9.
Ast' heure, asteure. A cette heure, maintenant. — Asteure, ô Polynic, pource que je m'avance De t'ensepulturer, tu vois la recompense. BAÏF, Antigone, IV, 3. — Humevent, de frayeur tout blesme, N'a garde asteure de venir. ID., le Brave, II, 5. — Courage là, courage : asteure, c'est asteure Qu'il fault doubler le pas. ID., Poèmes, L. VI (II, 314). — O que la différence est bien grande ast' heure de ce que Pon dict de vous ! M O N L U C , Commentaires, Préambule (I, 8). — Qu'ils ne m e reprochent point les maux qui m e tiennent asteure à la gorge. M O N T A I G N E , II, 37 (III, 206). — La plus-part des compaignies fortuites que vous rencontrez en chemin ont plus d'incommodité que de plaisir : je ne m'y attache point, moins asteure que la vieillesse m e particularise et séquestre aucunement des formes communes. ID., III, 9 (IV, 100). — J'ay des portraits de m a forme de vingt et cinq et de trente cinq ans : je les compare avec celuy d'asteure. ID., III, 13 (IV, 262). — Tout cela est astheure bien changé. B R A N T Ô M E , Cap. estr., Charles Quint (I, 37). — Je faictz astheure fin de ce grand empereur et de ses louanges. ID., ib. (I, 74).
E n ce temps (en parlant du passé). — A stheure la chascun en faisoit compte. M I C H E L D ' A M B O I S E , Complainctes de l'Esclave fortuné, 5 v°. A cette heure, a stheure. Tantôt. — E n ung pro
pos ung amant nest une heure. A stheure chante, maintenant il regrete... A stheure dance, maintenant il marmotte. ID., ib., 12 v°. — Speusippus... fait Dieu certaine force gouvernant les choses, et qu'elle est animale. Aristote, à cette heure, que c'est l'esprit, à cette heure le monde : à cette heure il donne un autre maistre à ce monde, et à cette heure fait Dieu l'ardeur du ciel. M O N T A I G N E , II, 12 (II, 256). Pour stheure la. Alors, en ce temps. — Car il
maymoit plus quaultre créature Qui feust vivante pour stheure la en France. M I C H E L D ' A M B O I S E , Complainctes de l'Esclave fortuné, 24 v°. Pour astheure, asteure, on trouve souvent as-
thure, asture. — Si m a raison en moy s'est peu remettre, Si recouvrer asthure je m e puis, Si j'ay du sens, si plus h o m m e je suis, Je t'en mercie, ô bien heureuse lettre. L A B O E T I E , Sonnets, 11. — Pource que je ne suis pas du païs, et que je n'y feuz jamais que asture-là, je ne sçaurois bien limiter la traicté qu'ilz feirent. M O N L U C , Commentaires, L. IV (II, 314). — Les advertissois que asture se congnois-troient les bons et fidèles sujets du roy. ID., ib., L. VI (III, 117). — Vostre lettre du dernier de novembre n'est venue à moi qu'asthure. M O N TAIGNE, Lettres (IV, 362). — Aussi dict-on que
cela fut cause de sa mort en partie, aveq d'autres subjectz que je ne diray point asture. BRANTÔME, des Dames, part. I, Elizabet de Fr., reine d'Esp. (VIII, 5). — Tu pleures, toy superbe, ast'hureque le pleur Ne profite de rien. D u M A S , Lydie, p. 90. — Tout de ceste mesme façon [Montaigne] s'estii dispensé plusieurs fois d'user de mots inaccoustu-mez, ausquels, si je ne m'abuse, malaisément baillera-t'il vogue : gendarmer, pour braver... asture, pour à cette heure. E. P A S Q U I E R , Lettres, XVIII, l! Desteure. Dès maintenant. — Et desteure pro
met et montre, Combien qu'il soit petit garson, D'estre un jour quelque cas de bon. BAÏF, Devis _ des dieux, 5 (IV, 178).
D'heure. Dès maintenant, vite, promptement. — Si je gaigne d'heure le hault, je vous feray incontinent signe comme je m e trouveray. Amadis, IV, 36. — De la postants la plaine, Allons d'heure à Capoue. F R . H A B E R T , trad. d'HoRACE, Satyres, 1, 5, Paraphrase. — Souventesfois le duc je reconforte, Luy conseillant que d'heure il se déporte D u vain espoir de fléchir à pitié Celle de qui un autre a l'amitié. BAÏF, Poèmes, L. V (II, 242). — L'estonnement qui est généralement en tous nous doit bien inciter un chacun à penser d'heure aux remèdes qui sont propres, pour nous tirer du danger qui nous menace. R É G N I E R DE LA P L A N C H E , Hist. de l'Estat de France, 1, 374. — Je trouve bon que vous vous eclaircissiez d'heure a la meilleure forme qu'il leur sera possible, pour leur faire consentir que cela soit. Lettres missives d'HENRi IV, 9 mars 1604, t. VI, p. 213 (G.).
A temps. — Se Rhodes eust d'heure ouvert son buffet Pour y fournir force munitions, Mieulx en allast. C R É T I N , Chant royal, p. 13. — L'occasion est chauve par devant, Pour demonstrer que qui ne la prend d'heure, De son bien mesme il se va decepvant Et n'est pas digne après qu'on le sequeure. G. C O L I N B Û C H E R , Poésies, 198. — Si je m'en feusse apperceu d'heure, j'y eusse pourveu plustost et mieux. D E S P É R I E R S , Nouv. Récr.,b. — Je vous escris en haste pource que je nay point esté adverty dheure. CALVIN, Lettres, 654 (XII, 96). — Demandant Saladin... combien il y avoit encor de là à Pavie, et s'ilz pourraient arriver d'heure pour y entrer, messire Thorel respondit : Seigneur, vous ne sçauriez arriver d'heure à Pavie, que vous y peussiez entrer. L E M A Ç O N , trad. de B O C C A C E , Decameron, X, 9. — Il y en avoit qui se disoient du party d'Agrippina, le nombre des-quelz estoit en danger de croistre si lon n'y pourveoit d'heure. E T . D E L A P L A N C H E , trad. des cinq prem. liv. des Annales de TACITE, L. IV, 140 v°. — Les sages princes ou gouverneurs de republiques n'ont seulement à regarder sur les affaires du présent : mais aussi aux futurs, et à iceulx par une bonne et prudente conduitte pour-veoir et donner ordre d'heure. L. L E R O Y , trad. des Politiques d'ARISTOTE, V, 4, Commentaire.— Ce terme vous sera bien cher vendeu et à vostre postérité, si vous n'y pourveoyez d'heure. L'Hos-PITAL, Reformation de la Justice, 5e part. (V, 40). — Nostre coq m'a presque totalement ruiné, car a l'endroit ou mon thesor estoit enfouy, il a egra-tigné la terre d'alentour, et si je ne fusse arrive d'heure, tout estoit perdu pour moy. J. D E CA-H A I G N E S , l'Avaricieux, III, 4. — Et n'y eut nul remède qui le peust sauver, pour ne l'avoir pns d'heure. A M B R . P A R É , XXIII, 20. — Le poète peult former de l'enfant qui besguaye La bouche à bien parler, quand d'heure il s'i essaye. G. P. r.> trad. d'HoRACE, Epistres, II, 1. — L'autre advef-tissement est de bien ouyr et recevoir les conseils, les prenans d'heure, sans attendre l'extrémité.
481 HEURER CHARRON, Sagesse, II, 10. — Sans le sentir ils se trouvent engagez en la haine et detestation de leurs peuples, pour des choses fort aisées à éviter s'ils en eussent esté advertis d'heure. ID., ib., III, 3, — Au retour, ne pouvant arriver d'heure en sa garnison, il passa chez une belle et fort honneste et grande dame veufve, qui le convie de demeurer à coucher léans. B R A N T Ô M E , des Dames, part. II (IX, 8). De grand heure. De bonne heure. — Marius et
Catulus furent diligents et meirent leurs gens en ordonnance subtilement de grand heure, pour surprendre les Cimbres. L E M A I R E D E B E L G E S , Illustr., III, 1 (II, 335). Grand'heure. Heure avancée, tard. — Estant ja
grand'heure, ses disciples vindrent à luy, disans : Ce lieu est désert et est desja haute heure, renvoyé les, a fin qu'ilz s'en aillent aux villages et bourgades à l'environ, et qu'ilz achètent des pains, car ilz n'ont que manger. CALVIN, Bibl. franc., Ev. Marc, 6 (LVII, 103). Haute heure, v. Haut. A bonne heure. De bonne heure. — La condi
tion (dist Panurge) m'est quelque peu dure. J'y consens toutesfois... Protestant desjeuner demain à bonne heure, incontinent après mes songeailles. RABELAIS, III, 13. — A bonne heure le matin le laboureur s'estoit tresbien confessé. ID., IV, 47. A bonne heure, à la bonne heure. Heureusement.
— Comme Dieu vous a inspirée, madame, à y remédier à bonne heure, il nous aydera aussi de venir au bout de nostre entreprinse. M O N L U C , Lettres, 50 (IV, 126). —• Adieu, donne la main, va-t'en à la bonne heure. R O N S A R D , le Bocage royal, lre part. (III, 224. — Allez, mes compagnons, marchez à la bonne heure. Et ne retournez point que la Grèce ne pleure La mort de maint grand duc. M O N T C H R E S T I E N , Hector, II, p. 27. De bonne heure. Heureusement. — Fauste tu es
et crée de bonne heure, Mais garde toy quen la fin tu ne pleure. M I C H E L D'AMBOISE, Descript. de Fort., 83 v°. En bonne heure. Heureusement. — Je m e veulx
marier. — En bonne heure soit, dist Pantagruel. RABELAIS, III, 7. — En bonne heure de vous rencontrée, [santé] sus l'instant soit par vous asseree. In., IV, Prologue. — En bonne heure feirent voile au vent grec levant. ID., IV, 1. — L'oraige m e semble critiquer et finir en bonne heure. ID., IV, 22. — Couvre nous et enveloppe d'une nue, afin que descendions en bonne heure. F. B R E T I N , trad. de LUCIEN, les Fugitifs, 25. En la maie heure, à la mauvaise heure. Malheu
reusement. — A présent viens de Turquie, ou je fuz mené prisonnier lors qu'on alla à Metelin en la maie heure. R A B E L A I S , II, 9. — O Phèdre ! ô pauvre Phèdre ! hé qu'à la mauvaise heure Tu as abandonné ta natale demeure ! R. G A R N I E R , Hip-polyte, 415. De belle heure. Tôt, promptement. Voir Beau,
1.1, p. 526, col. 2. Il n'est encore nulle heure. Il n'est que minuit?
— Si luy dit madame l'abesse : Monsieur, il est temps de vous retirer en vostre chambre et vous aller coucher. — Comment coucher, dit-il, madame, il n'est pas temps, il n'est encore nulle heure. NICOLAS D E T R O Y E S , le Grand Parangon, ou.
Chercher onze heures à midy. Chercher midi à quatorze heures. — Nos hérétiques se moquent à gorge ouverte de toutes ces allégations, disans que tout cela n'est que cercher onze heures à midy. PH. D E M A R N I X , Differ. de la Relig., II, i, 18. Oultre heure. A u delà de l'heure, trop tard. — IV
L'oysiveté des délicates plumes... Souventesfois oultre heure et sans propos Entre ses drapz m e détient indispos. M A U R I C E S C È V E , Délie, 100. L'heure est venue de me plaindre. Sorte de danse.
RABELAIS, V, 33 ms.
L'heure vient. Sorte de danse. ID., ib. Unes heures. Un livre d'heures. — Au kalen-
drier d'unes heures. MELIN DE S1 GELAYS, Quatrains, 17 (titre). Heure. (Prononc). — Chanton donc sa cheve
lure, De laquelle amour vainqueur Noua mille rets à l'heure Qu'il m'ensorcela le cœur. RONSARD, Pièces retranchées, Odes (VI, 52). — Oyseau à la creste pourprée... Trompeté des feux du soleil, Qui te perches à la mesme heure Qu'il plonge en mer sa cheveleure. R. BELLEAU, les Amours des Pierres précieuses, la Pierre du coq (II, 236). — C o m m e un mesme soleil de ses rais en mesme heure Durcit le mol bourbier et fond la cire dure. D u B A R T A S , Judith, II, p. 363. — [Holopherne] mort ne trouve à ceste heure U n pouce de gazon pour toute sépulture. ID., ib., VI, p. 416. — L'imprimeur qui voulut faire une Rigarrure Mit un visage tel que je porte à cette heure A u front de ce livret, que fort jeune je fis. T A B O U R O T D E S A C C O R D S , les Rigarrures, en tête du Livre I. — Voir plus haut asthure pour astheure.
Heure î, v. Heurer. Heure 2. Où sont marquées les heures. — Cadran. Horlogeux, rond, juste, heure. M. D E LA P O R T E , Epithetes, 61 r°.
Qui a lieu à heures fixes. — Service ecclésiastique. Divin, matinal... solennel, mortuaire,heure. ID., ib., 377 r°. Astreint à des obligations à heures fixes. —
Chanoine. Reiglé ou régulier, otieux, prebendé, sujet, heure. ID., ib., 73 r°. — Moine. Reiglé, solitaire... heure. ID., ib., 269 r°.
Heurer. Douer de telle ou telle destinée, rendre heureux ou malheureux. — Jupiter, qui t'appreste Son tonneau de malheurs, le panche sur ta teste, Et, prodigue, à ton mal les verse à grans monceaux, Tournant la gueulle en bas du chetif des vaisseaux Qu'il a, deux des deux pars sur le sueil de sa porte, Dont il puise ses dons, heu-rant en double sorte Les humains, comme il veut, ou mal ou bien heureux. BAÏF, Poèmes, L. III (II, 118).
Rendre heureux, favoriser. — Mais de ta clairté dorée J'espère immortalité : Puis que par fatalité M a muse est de toy heurée. L E C A R O N , Odes, 41 r°. — Et dès que l'homme au portrait de sa face Heureusement sur la terre il moula, Duquel l'esprit presque au sien égala, Heurant ainsi sa plus prochaine race. J O D E L L E , Contr'amours, 3 (II, 92). — Et seul tu m'as heure Quand plus mon fait estoit désespéré. R O N S A R D , le Bocage royal, 2e part. (III, 330). — Si le ciel jaloux de mon envie Par si beau changement ne veut heurer m a vie. G. D U R A N T , ŒUV. poet., 24 v°.
Heurer de. Rendre heureux par, favoriser de. — Quelcun trouvera bien estrange, Et ridera son front, de quoi J'heure Paschal d'une louange Dont heureux se tiendrait un roi. R O N S A R D , Bocage de 1554 (VI, 359).
Heurer qqn de. Lui donner le bonheur de. — O bienheureux, que l'Amour tant heura D'avoir chanté la beauté qui dora De nostre tempz la plombeuse ignorance. L E C A R O N , Poésies, Au seigneur Pasquier, 67 r°. Estre heure de. Avoir reçu le bonheur de. — Cel
luy qui suyt la court, s'il n'est heure des cieux D'y pouvoir demeurer librement et sans peine, 31
H E U R E T T E
Sent dedans chacun nerf et dans chacune veine Couler de jour en jour ung traict malicieux. O. D E M A G N Y , les Souspirs, sonn. 128. Heure. Heureux, rendu heureux, favorisé. —
Très illustre, très haulte, très excellente et très heuree dame et princesse. 1521. Pap. d'Et. de Granvelle, I, 125 (G.). — Priant celluy qui les âmes heurées Faict triumpher aux maisons syde-rées. M A R O T , Epistres, 3. — L'entrée estoit large, grande et ouverte, Qui promettoit aux passans vie heurée. M I C H E L D ' A M B O I S E , trad. de F R E -GOSO, le Ris de Democrite, ch. 1. — Denizot se vante heure D'avoir oublié sa terre, Et passager demeuré Trois ans en vostre Angleterre. R O N SARD, Odes, V, 3. — Plus grande est la peine Que l'outrageux sort Aux amis ameine, Que de l'ami mort N'est la joye grande, Alors qu'en la bande Des esprits heurez... Quitte se voit estre Des maux endurez. J O D E L L E , Cleopatre, IV (1,144). — EU' tire à soy, comme forme première Qui a des deux l'immortelle lumière, Toutz les objecte de son regard heurez. L E C A R O N , Sonetz, 62. — Ze-phire... Qui vante au sein... De l'heuree chaste moitié Une frecheur. P H . B U G N Y O N , Chant pane-gyr., p. 112. — Par ainsi ton cueur Et m o n ame heurée Vivront sans langueur E n joye asseuree. O. D E M A G N Y , Odes, II, 142. — Vous qui (heurez du ciel) aurez veu de Boyssières, Vantez-vous d'avoir veu le soleil de clairté Qui tire son païs de toute obscurité. GO R R I E R , Sonnet liminaire dans les Trois. Œuvres de J. de Boyssières.
Favorable, qui donne le bonheur. — Cette lumière nouvelle L'aspect aura plus heure Que l'autre chienne cruelle Qui l'Icaride pucelle Suy-vit au ciel azuré. D E S A U T E L S , Façons lyriques, VII, 33.
Précieux, salutaire. — C'est une pierre en effectz si heurée Qu'il ny a chose entre mainte merveille Trouvée moins et plus fort désirée. M I C H E L D'AMBOISE, trad. de F R E G O S O , le Ris de De
mocrite, ch. 4. Heurette, dimin. d'heure. — J'iray la dans
une petite heurette. S* F R A N Ç O I S D E SA L E S , Lettres, 1009 (XVI, 251).
Heureux. (Prononc). — 1° (trois syllabes) : Telle qui autrefois Avoit en grand langueur faict ses couches d'un mois, Les faict sans s'arrester, heureuse et sans peine. A U B I G N É , les Tragiques, V (IV, 205). • 2° (hureux) : O très hureulx commencement !
P. D U V A L , Moralité à six personnages, p. 153. — Tels lez ureus Médichis... Auz ampereurs sont même konjoéins. BAÏF, Étrénes de Poézie fran-soêze. A la Reine mère (V, 308). — Puisses aus déséins Ureus ke fês mètre fin, Tirant du danjér Nautre nêf abonpaûrt. ID., ib. (V, 313). — O b i e n hureux roys d'avoir eu de telz serviteurs! M O N LUC, Commentaires, Préambule (I, 12). — J'ay esté des plus hureux et des mieux fortunés hommes qui... ayent pourté les armes. ID., ib., L. I (I, 85). — Longue et hureuse vie. M O N TAIGNE, Lettres (IV, 328, 332). Heurt 1, v. Hurt 1. Heurt 2, v. Hurt 2. Heurt 3. Chemin, sentier. — D'icelle borne suivant un heurt ou sentier entre ladite chastelle-nie de Beaumont et la seigneurie d'Auxi... et d'icelle borne jusqu'à une autre borne estant sur ledit heurt ou sentier. 7 mars 1547. Aveu de la terre de Beaumont-le-Bois. Arch. Loiret (G., Hourt 1). — Costoyant ledict grand fossé à main droicte aux usaiges et pasturaiges de S. Germain,
482 —
ou il y a quelque apparence de heurt, et selon ledit heurt vers la fosse du costé de ladicte ville. 1552. Lett. (G., Compl., Heurt 2). — A l'alligne-ment dudict hurt. Ib. Heurtage. Droicture de heurtage. Droit d'an
crage. — Droicture de queages, heurtages, lavages de glux. 22 mai 1583. Arch. Seine Inf. (G.). — Droiture de pescherie et de heurtage en la rivière de Seine des deux costés d'icelle. 1609. Arch. Seine Inf. (G.).
Heurte 1, v. Hurte.
Heurte 2, ancienne pièce d'armoiries. — Je ne vous diray rien des guses, heurtes, ogoesses, volets, guipes et plates de gelliot, si non que ce sont des termes barbares, que je ne voy point dans la pratique, et qui ne sont point en usage dans le blason. L E L A B O U R E U R , Origin. des arm., p. 225 (G.),
Heurté. Bonheur. — Quelle est l'heurté qui si douve m'abreve? V A U Q U E L I N D E LA FRESNAYE, les Foresteries, II, 4.
Heurtement, Heurter, v. Hurtement, Hurter.
Heurteur (adj.). Qui heurte. — Agneau ou Aigneau. Doux, folastre, jeune, heurteur. M. DE L A P O R T E , Epithetes, 12 r°. — Bélier. Edenté, cos-seur, bellant... heurteur. ID., i6.,48r°. — Corne... recourbée, droite, heurteuse. ID., ib., 95 r°.
(Subst.). Celui qui heurte. — Holà, hau! — Entrez. — Je vouldrois Rencontrer en beaucoup d'endroictz De telz portiers que cestuy-cy. — Et moy de tels heurteurs aussi. M A R O T , la Vierge repentie, édit. Guiffrey, II, 252.
Heurteure. Coup. — J'auray donc la teste armée, M o n seigneur, de peur des heurteures. Act. des Apost., I, 49 a (G.).
Heurtevent, v. Fils. Heurtis. Heurt. — Heurtis de chevaux. GUILL.
D U B E L L A Y , Prol. des Ogdoades (G.).
Heurtoyant. Qui heurte. — Si n'a elle nombre pour la sixième corne Que de cœur affoiblie et de face plus morne Ne sente une autre vie en son corps se loger, Et de coups heurtoyans des deux costés bouger. M A U R I C E S C È V E , Microcosme, L. I, p. 20.
Heuse. Botte. — Prenez de soucy plaine heuse Et de pensées plain un minot. Anc. Poés. franc., I, 159.
(Terme d'architecture). Sorte de revêtement métallique. — 1512. A Clay Carpentier, paintre, pour avoir paint une heuze portant un pot de lys et les boucquets. — A Vincent Courroyer, paintre, pour avoir faict et livré une tube et le lyz pour le pignon d'entre les deux tourelles servant à ledite heuze. 60 s. Comptes des commis aux honneurs d'Arras (Gay, Gloss. archéol). — 1514. A Gilles Coutelier, paintre, a esté payé pour son salla e d'avoir paint sept heuses assis, sur les combles de la tour et les pinacles faits au bollvercq de le porte d'Arras... A Jehan Robert, fevre, avoir fait une baniere et 4 vergues de heuzes. Arch. Douai (Gay).
Hever. Trouer. — Ung escrignier foeulle et heve le cassis d'une fenestre croisie pour y mettre des voiras. 1517. Béthune (G.).
Hevrelant. Sorte d'auvent. — Nul ne puet faire un hevrelant ne autre ouvrage sur le froc de la ville, quel que il soit, sans le congié de ledite église. 1507. Amiens (G., Huvrelant).
Hexachordon. Instrument à six cordes. — Non seulement elles passent le la de ceste gamme d'un disdiapason tout entier, mais mesmes eues