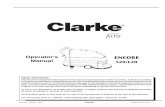Faut-il encore fouiller des sanctuaires ? Réflexions à partir du cas de Mirebeau-sur-Bèze
-
Upload
univ-fcomte -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of Faut-il encore fouiller des sanctuaires ? Réflexions à partir du cas de Mirebeau-sur-Bèze
éditions monique mergoilmontagnac
2012
étudier les lieux de culte de Gaule romaine
Actes de la table-ronde de Dijon18 - 19 septembre 2009
sous la direction d’Olivier de Cazanove et Patrice Méniel
Tous droits réservés© 2012
Diffusion, vente par correspondance :
éditions Monique Mergoil12 rue des Moulins
F - 34530 Montagnac
Tél/fax : 04 67 24 14 39e-mail : [email protected]
ISBN : 978-2-35518-029-3ISSN : 1285-6371
Aucune partie de cet ouvrage ne peut être reproduitesous quelque forme que ce soit (photocopie, scanner ou autre)
sans l’autorisation expresse des éditions Monique Mergoil.
Texte : auteursSaisie, illustrations : idem
Rédaction, mise en pages : Magali Cullin (CNRS, UMR 8546 / USR 3133)Couverture : éd. Monique MergoilImpression numérique : Maury SA
Z.I. des Ondes, BP 235 F - 12102 Millau cedex
— 5 —
Titre courant
Sommaire
IntroductionO. de Cazanove et P. Méniel .................................... 7
Archéozoologie et sanctuaires : quelques développements récentsP. Méniel .............................................................. 10-20
La place des sanctuaires dans l’économie monétaireK. Gruel ............................................................... 21-27
Les offrandes monétaires en Gaule romaine.Quelques réflexions tirées des découvertes d’Oedenburg (Biesheim-Kunheim, Haut-Rhin) et d’Alésia (Alise-Sainte-Reine, Côte-d'Or)L. Popovitch ......................................................... 29-36
Les cultes de la cité des Lingons.L’apport des inscriptionsM.-Th. Raepsaet-Charlier .................................... 37-73
Un siècle d’inventaires des sanctuaires de GauleI. Fauduet, E. Rabeisen, B. Dupéré ..................... 75-83
Faut-il encore fouiller des sanctuaires ?Réflexions à partir du cas de Mirebeau-sur-BèzeM. Joly et Ph. Barral ............................................ 85-94
Le lieu de culte du dieu Apollon Moritasgus à Alésia.Phases chronologiques, parcours de l'eau,distribution des offrandesO. de Cazanove, V. Barrière, F. Creuzenet,H. Dessales, L. Dobrovitch, S. Féret, Y. Leclerc,L. Popovitch, J. Simon, J. Vidal ........................ 95-121
Découvertes inédites réalisées sur le complexe cultuel de La Genetoye à Autun (Saône-et-Loire)Y. Labaune ....................................................... 123-133
Le temple dit «de Janus» à Autun.Recherches sur les élévationsC. Duthu ........................................................... 135-159
Topographie et fonctions religieuses sur l’oppidum de Bibracte et sa périphériePh. Barral, Th. Luginbühl, P. Nouvel ............... 161-179
Premier bilan des recherches sur le sanctuaire desPetits Jardins à Isle-et-Bardais, en forêt domanialede Tronçais (Allier)L. Laüt .............................................................. 181-196
Le sanctuaire de Mercure au sommet du puy de Dôme :le cadre architectural d’un circuit processionnelJ.-L. Paillet, D. Tardy ........................................ 197-207
Du cultuel au profane : essai d'analyse taphonomiqueet spatiale des petits mobiliers du sanctuaire de Corentet de ses abordsM. Demierre, M. Poux ...................................... 209-227
Le complexe religieux des Vaux-de-la-Celle àGenainville (95) : nouvelle proposition de phasagedu sanctuaire d’après les dernières fouillesD. Vermeersch (coll. M. Chupin) ...................... 229-243
Les sanctuaires de la cité des Convènes : un étatde la questionJ.-L. Schenck-David ......................................... 245-260
ConclusionJ. Scheid ............................................................ 261-263
— 6 —
Titre courant
Auteurs
Philippe Barral : Université de Franche-Comté - UMR 6249 laboratoire Chrono-Environnement, Besançon ; [email protected]
Vivien Barrière : UMR 6298 ARTeHIS, Dijon ; [email protected]
Olivier de Cazanove : Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne - Institut d’art et d’archéologie - UMR 7041 ArScAn ;[email protected]
Fabienne Creuzenet : UMR 6298 ARTeHIS, Dijon ; [email protected]
Matthieu Demierre : Université de Lausanne - Université Lumière Lyon 2 ; [email protected]
Hélène Dessales : ENS - UMR 8546 AOROC, Paris ; [email protected]
Laure Dobrovitch : Service régional de l’archéologie de Bourgogne, Dijon ; [email protected]
Benoît Dupéré : Inrap Centre - Île-de-France ; [email protected]
Carine Duthu : Université de Bourgogne, Dijon ; [email protected]
Isabelle Fauduet : CNRS, USR 3225 Maison de l’archéologie et de l’ethnologie, Nanterre ;[email protected]
Sophie Féret : Service régional de l’archéologie de Bourgogne, Dijon ; [email protected]
Katherine Gruel : CNRS, UMR 8546 AOROC, Paris ; [email protected]
Martine Joly : Université Paris-Sorbonne - Institut d’art et d’archéologie - UMR 8167, Paris ;[email protected]
Yannick Labaune : Service archéologique de la Ville d’Autun - UMR 6298 ARTeHIS, Dijon ; [email protected]
Laure Laüt : Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne - UMR 8546 AOROC, Paris ; [email protected]
Yann Leclerc : UMR 5607 Ausonius, Pessac ; [email protected]
Thierry Luginbühl : Université de Lausanne ; [email protected]
Patrice Méniel : CNRS, UMR 6298 ARTeHIS, Dijon ; [email protected]
Pierre Nouvel : Université de Franche-Comté - UMR 6249 laboratoire Chrono-Environnement, Besançon ;[email protected]
Jean-Louis Paillet : CNRS, USR 3135 IRAA
Laurent Popovitch : Université de Bourgogne - UMR 6298 ARTeHIS, Dijon ; [email protected]
Matthieu Poux : Université Lumière Lyon 2 - UMR 5138 MOM, Lyon ; [email protected]
Élisabeth Rabeisen : CNRS, UMR 6298 ARTeHIS, Dijon ; [email protected]
Marie-Thérèse Raepsaet-Charlier : Université libre de Bruxelles ; [email protected]
John Scheid : Collège de France ; [email protected]
Jean-Luc Schenck-David : Musée archéologique départemental, Saint-Bertrand-de-Comminges ;[email protected]
Jonathan Simon : Service archéologique de la Ville de Chartres ; [email protected]
Dominique Tardy : CNRS, USR 3135 IRAA ; [email protected]
Didier Vermeersch : Université de Cergy-Pontoise ; [email protected]
Jonhattan Vidal : UMR 6298 ARTeHIS, Dijon ; [email protected]
— 85 —
Faut-il encore fouiller des sanctuaires ? Réflexions à partir du cas de Mirebeau-sur-Bèze (21)
Martine Joly et Philippe Barral
Durant les vingt dernières années, les recherches de terrain, les rencontres scientifiques et les publications consacrées aux sanctuaires en Gaule se sont multipliées et ont largement renouvelé l’approche de ce type de site. La documentation recueillie a apporté nombre de don-nées nouvelles concernant les lieux de culte et la religion gauloise et gallo-romaine. À un moment où l’archéologie française doit se livrer à des choix drastiques, la ques-tion de la pertinence de la fouille de tel ou tel type de site est parfois posée. Qu’en est-il pour les sanctuaires ? L’exemple du site de Mirebeau permet de proposer quelques éléments de réflexion.
Mirebeau se trouve en Bourgogne, à une trentaine de kilomètres au nord-est de Dijon, dans une région de plaines vallonnées, limitée au nord par le plateau de Langres. Cette zone est parcourue par plusieurs affluents de la Saône, la Vingeanne, la Bèze et la Tille. À l’époque antique, la région fait partie de l’extrémité sud-est du ter-ritoire lingon, à proximité de la frontière avec les Éduens au sud-ouest et avec les Séquanes au sud-est. Le site de Mirebeau se situe sur un itinéraire majeur, probablement mis en place durant la période précédant la conquête, qui relie Vesontio-Besançon, chef lieu de la Séquanie, à Andemantunum-Langres, la capitale lingonne (fig. 1).
Les premières découvertes sur le site de Mirebeau remontent au xviiie siècle. En 1719, un bloc de pierre portant une inscription romaine est découvert en remploi dans le château (CIL XIII, 5614 et fasc. 4, p. 74). Il s’agit d’une dédicace qui mentionne des travaux de réparation effectués sur le devant de la scène du théâtre (Le Bohec 2003, p. 141-142).
En 1900, des armes et divers objets (bracelet, monnaies, céramiques…) découverts à la sortie nord-ouest de Mirebeau, au lieu-dit « La Fainotte » (sic), sont interprétés comme des vestiges d’une nécropole gauloise datée, d’après le mobilier, de l’époque de La Tène (Rey 1900 ; Drioton 1920). L’une des épées conservée avec son fourreau fut étudiée ultérieurement (Bulard 1980) et attribuée à un contexte funéraire.
À l’opposé, au sud-est, de l’autre côté de la Bèze, un grand nombre de trouvailles fortuites (en particulier des tuiles estampillées) révèlent, dès le xixe siècle, l’existence d’un camp de la VIIIe légion. À partir de 1964, les photo-graphies aériennes de René Goguey (Goguey 1975) font apparaître peu à peu le plan de cette forteresse militaire.
Au demeurant, il faut attendre le milieu des années 1970 pour que l’étendue et l’importance du site antique de Mirebeau soient mises en lumière. En effet, en 1973, plusieurs clichés aériens pris par R. Goguey révèlent,
pour la première fois, la présence de substructions dans le secteur de La Fenotte où avaient été antérieurement trouvées des armes gauloises. Ces traces de constructions sont identifiées, par comparaison avec d’autres sites notoires de Gaule, comme les vestiges d’un sanctuaire gallo-romain. Deux pôles d’occupation importants sont donc reconnus à ce moment, grâce à leurs plans caracté-ristiques (Goguey 1994, p. 143-144) : au sud-est, sur la rive gauche de la Bèze, un camp militaire romain d’une superficie de plusieurs dizaines d’hectares (Goguey et Reddé 1995) et, au nord-ouest, sur la rive droite de la Bèze, un lieu de culte (Brunaux et al. 1985a). En outre, au centre du village actuel, une partie très mal connue de l’agglomération civile est documentée par quelques trouvailles isolées (Barral et al. 2009).
Historique des recherches dans la zone du sanctuaire et principaux résultats
Entre 1973 et 1976, plusieurs campagnes de photogra-phie aérienne précisent peu à peu le plan et l’extension des vestiges repérés à La Fenotte. Les traces d’occu-pation s’étalent sur au moins huit hectares. Plusieurs constructions sont identifiées (fig. 2) : deux (voire trois) temples de type fanum, une anomalie en forme d’hémi-cycle interprétée comme un théâtre (dont l’existence est d’ailleurs attestée par l’épigraphie), un aqueduc (ou collecteur), une galerie et des bâtiments annexes (Goguey 1994, p. 143-144). Ces différents éléments – des temples, un monument de spectacle (théâtre) et d’autres constructions, des thermes (qui ne sont pas précisément identifiés) – correspondent à la panoplie complète d’un sanctuaire gallo-romain, suivant un modèle élaboré à partir des fouilles de différents sites de Gaule romaine (par exemple Sanxay, Ribemont, Avenches, Barzan, Le Vieil-Évreux…).
Une partie du sanctuaire de Mirebeau fut irrémédiable-ment détruite par la construction d’un collège, en 1977. La zone des temples, pour un temps épargnée, fit l’objet d’une première série de campagnes de fouille entre 1977 et 1981, sous la direction de R. Goguey. Elles confir-mèrent, s’il en était besoin, l’existence d’un sanctuaire antique, composé entre autres de deux fana gallo-romains (fig. 3), l’un attribué à l’époque augustéenne et l’autre aux iiie-ive siècles apr. J.-C. Ces recherches ont, en outre, révélé la présence d’une occupation préromaine, sous la forme de différents mobiliers (armes, céramiques, os
Martine Joly et Philippe Barral
— 86 —
Fig. 1 – Mirebeau-sur-Bèze : localisation (carte P. Nouvel).
Fig. 2 – Mirebeau-sur-Bèze : cliché aérien (R. Goguey, 25 juin 1976) ; interprétation du site en 1976 (R. Goguey, dans Jannet-Vallet 1990, p. 68). 1- fanum augustéen ; 2- fanum tardif ; 3- galerie ; 4- théâtre gallo-romain ; 5- substructions diverses.
Faut-il encore fouiller des sanctuaires ? Le cas de Mirebeau-sur-Bèze (21)
— 87 —
d’animaux). Par analogie avec les découvertes toutes récentes de Gournay (dont les fouilles se sont étalées sur la période 1977-1984 : Brunaux et al. 1985b), l’existence d’un sanctuaire celtique put être émise. Cette hypothèse motiva une nouvelle série de fouilles, entre 1983 et 1986, dirigées par J.-P. Guillaumet (Goguey 1994, p. 143-144).
Elles permirent, grâce à la découverte de structures et de mobilier typique de la fin du ive siècle av. J.-C., de préciser la date de l’installation du lieu de culte laténien. Par ailleurs, une grande tranchée de sondage explo-ratoire permit de recouper l’anomalie hémicirculaire décelée sur certains clichés aériens, qui avait d’abord été interprétée comme un théâtre. Cette anomalie put être reliée à un fossé, dont le tracé fut reconnu sur une vingtaine de mètres. Sa morphologie et le mobilier exhumé de son comblement permirent de l’identifier comme le dispositif de clôture d’un enclos faisant partie du sanctuaire laténien dans sa phase la plus ancienne, implanté à l’ouest de la zone des temples gallo-romains (Barral et al. 2009, p. 551-552). Enfin, un nouveau bâtiment, seulement conservé sous forme de tranchées de récupération de murs, fut découvert au sud-ouest des deux temples. La présence d’une abside à l’une des ses extrémités amena à l’interpréter comme une possible basilique paléochrétienne (fig. 4).
À la suite de cette deuxième série de fouilles, dont l’ampleur reste limitée, l’interprétation du site a, comme on le voit, évolué de façon perceptible. Il devient possible, en particulier, d’affirmer que l’on se trouve en présence de l’un des plus anciens lieux de culte implantés en Gaule indépendante, installé dès La Tène B2 (fin du ive-début du iiie siècle av. J.-C.) et que le site connaît plusieurs cam-pagnes de rénovation durant la période gallo-romaine. Enfin, la présence du bâtiment à abside, interprété comme une basilique paléochrétienne, amène à conclure que le sanctuaire a été christianisé durant l’Antiquité tardive (Goguey 1994, p. 146).
Après 1986, les recherches sur le terrain s’arrêtent. Elles reprennent en 2001, de nouveau provoquées par un important projet urbain portant sur tout le secteur encore non bâti de La Fenotte. Toutefois, par rapport aux années 1970-80, la réglementation au regard des sites menacés par des programmes d’aménagement a évolué favora-blement. Au sein de la zone d’emprise du projet, deux secteurs sont distingués. Le secteur ouest, qui jouxte la zone du sanctuaire, fait l’objet d’une fouille préventive d’urgence, menée en quelques mois, sur une emprise de 5 ha (Mouton et Venault 2005). La zone cultuelle pro-prement dite fit l’objet de plusieurs campagnes de fouille programmée, qui se sont étalées sur la période 2001-2007. L’intégralité de l’emprise du site encore conservée a ainsi été explorée, avec des approches sensiblement comparables (décapages extensifs), ce qui a permis non seulement de dégager le sanctuaire sur une surface de près de 2 ha (Joly et Barral 2007 ; 2008a), mais aussi de recon-naître son environnement sur une large fenêtre (fig. 5). Lors de la fouille de la zone cultuelle, l’appréhension spatiale du gisement a été privilégiée, en raison de son faible potentiel stratigraphique. Un nombre considérable
de structures, la plupart excavées, a été mis au jour (fig. 6). Elles se répartissent entre six étapes d’aménagement et de fonctionnement du sanctuaire, qui se succèdent entre la fin du ive siècle av. J.-C. et la deuxième moitié du iie siècle apr. J.-C. (Joly et Barral 2008a ; fig. 7) :
- La première étape se situe vers 300 à 160 av. J.-C. (LT B2-C2). Le premier espace cultuel (fig. 7-1) com-prend deux parties distinctes accolées : une enceinte au tracé curviligne et un enclos trapézoïdal. L’enceinte, au contour irrégulier, mesure 60 m dans son plus grand axe. Elle est matérialisée par un fossé peu profond, à fonction de délimitation. L’espace interne, qui ne présente aucune trace d’occupation, peut être identifié avec une faible éminence. Contre cette enceinte s’appuie un enclos palis-sadé trapézoïdal, refait à au moins deux reprises dans le courant du iiie siècle et de la première moitié du iie siècle av. J.-C. Seules deux fosses contenant des dépôts de vases peuvent être associées à cet espace, mais le fossé bordant l’enclos palissadé, dans lequel ont été rejetés différents restes d’activité rituelle, renfermait un abondant mobilier de cette période (fibules en bronze, céramiques incluant de nombreux vases miniatures : Joly et Barral 2008b).
- Le passage à l’étape 2 est marqué par des transforma-tions architecturales importantes, qui respectent toutefois le schéma d’organisation initial de l’espace cultuel, en deux parties distinctes. Cette deuxième étape (fig. 7-2)
Fig. 3 – Mirebeau-sur-Bèze : plan du sanctuaire en 1979 (d’après Gallia 41 [1983], p. 400, fig. 6).
Martine Joly et Philippe Barral
— 88 —
débute vers 160 et s’achève durant les années 100 à 80 av. J.-C. Dans le détail, elle peut être scindée en deux « sous étapes » : d’une part, de la fin de LT C2 à LT D1a (vers 160 à 120) et, d’autre part, la LT D1b (120 à 80). Les aménagements architecturaux et dépôts principaux appartiennent à la première période, alors que, semble-t-il, dans les décennies encadrant le passage du iie au ier siècle, les structures semblent peu nombreuses et assez peu remarquables. L’activité du sanctuaire à la charnière iie-ier siècle et durant la première moitié du ier siècle paraît décliner. Lors de cette étape, le système de délimitation du sanctuaire est réaménagé. Une forte palissade remplace le fossé, partiellement comblé, en respectant approxi-mativement son tracé. Cet espace reste vierge de traces d’occupation. Dans le même temps, l’enclos trapézoïdal, reconstruit, connaît un agrandissement et une monu-mentalisation sensibles. Délimité et compartimenté par d’imposantes palissades, il est doté de dispositifs d’entrée (ou de passage). Au total, sa superficie devait approcher
860 m2. Au centre de l’espace principal (de 21 m de large), s’élevait un bâtiment précédé par un compartiment large en moyenne de 6,50 m, qui communiquait avec l’espace central par une poterne.
Dans l’enclos trapézoïdal et aux alentours de celui-ci prennent place de nombreuses fosses et des vestiges de bâtiments en bois et torchis. L’édifice cultuel principal est un bâtiment rectangulaire sur sablières basses, partiel-lement conservé. Les fosses repérées près des bâtiments appartiennent à diverses catégories (fosses d’extraction de matériaux, fosses de rejets, fosses à dépôts). L’une des fosses se distingue à la fois par sa localisation (devant le bâtiment cultuel central) et par son contenu (un dépôt monétaire placé dans deux vases distincts). Datable des années 150-120 av. J.-C. d’après la typologie des céra-miques, ce dépôt est probablement lié à la consécration du sanctuaire rénové. Deux autres dépôts en fosse se caractérisent par une masse importante d’objets divers, peu fragmentés, entassés sans soin apparent : des vases
Fig. 4 – Mirebeau-sur-Bèze : plan du sanctuaire après les fouilles de 1983-1986 (d’après Guillaumet et Barral 1991, p. 194). 1- Monument à abside ; 2- temples gallo-romains ; 3- puits gallo-romain ; 4- structures excavées celtiques ; en hachures : emplacements des dépôts.
Faut-il encore fouiller des sanctuaires ? Le cas de Mirebeau-sur-Bèze (21)
— 89 —
céramiques, dont des séries de pots miniatures, contenant selon toute vraisemblance des offrandes alimentaires, des objets de parure, des monnaies, de l’armement et de l’outillage (Barral et Guillaumet 1994). Les autres fosses renferment de petites séries d’objets métalliques (en géné-ral des éléments de parure, associés à un ou deux autres objets – outil en fer, perle ou bracelet en verre, monnaie de potin). Une dernière catégorie de dépôt est illustrée par une concentration de pièces d’armement en fer (lames et fourreaux d’épée, fers et talons de lance, éléments de ceinture, umbo de bouclier, couvre-joue de casque…) qui portent des traces de mutilation volontaires, retrouvées éparses sur quelques dizaines de mètres carrés, à proximité des deux fosses évoquées ci-dessus. Leur concentration et leur relative dispersion sur une surface réduite indiquent l’existence d’un dispositif ou aménagement initial qui a disparu (fosse peu profonde ; potence ou support ?).
- La troisième étape (fig. 7-3) couvre les années 60/50 à 20/15 av. J.-C. Une nouvelle phase de construction et
d’aménagement débute vers le milieu du ier siècle av. J.-C. Elle se caractérise, d’une part, par le respect de certains éléments du schéma d’organisation antérieur (pérennisa-tion de l’espace réservé de l’enceinte curviligne) et de la localisation du bâtiment cultuel central (à peu de distance du bâtiment principal antérieur) et, d’autre part, par des changements affectant l’architecture des bâtiments. Le bâtiment cultuel et le porche d’entrée sont construits avec des supports en bois de taille imposante. Des alignements de poteaux traduisent également l’érection de nouveaux systèmes de clôture et d’allées processionnelles.
En outre, plusieurs bâtiments rectangulaires ou à pans coupés, fréquemment associés à des puits à eau, se répar-tissent autour de l’aire cultuelle. La morphologie de ces bâtiments, comme les structures et le mobilier qui leur sont associés, suggèrent que cet ensemble correspond à un secteur d’habitat qui se développe à proximité immédiate du sanctuaire. Il n’y a pas de limite perceptible entre ces deux espaces.
Fig. 5 – Mirebeau-sur-Bèze, La Fenotte : plan d’ensemble des vestiges mis au jour entre 2001 et 2007(données Ph. Barral, M. Joly, S. Mouton, S. Venault).
Martine Joly et Philippe Barral
— 90 —
Les principaux vestiges d’activité cultuelle liés à cette étape résident dans de petits édicules à quatre poteaux, de plan carré, associés à des fosses circulaires (en moyenne 1 m de diamètre) systématiquement disposées sur le côté ouest des bâtiments. Ces fosses renfermaient, outre de rares monnaies ou fragments d’amphore, des amas de faune domestique montrant des caractères spécifiques (fréquence des crânes, grandes parties de carcasses…), qui révèlent des pratiques liées à des occasions et évé-nements particuliers (sacrifices, banquets…). Enfin, la découverte d’une fosse superficielle recelant différentes pièces métalliques (umbo de bouclier circulaire, couteau et fibule en fer, bracelet filiforme en bronze…) témoigne de la persistance des dépôts de pièces d’armement.
- La quatrième étape, située entre 20/15 av. J.-C. et 40 apr. J.-C. (fig. 7-4) est caractérisée par une continuité remarquable avec la période précédente. Le respect de l’aire ceinte initialement par un fossé, puis par une palis-sade, semble se maintenir. La clôture définitive du fossé intervient dans la période augusto-tibérienne, époque à partir de laquelle il n’était plus perceptible dans la topographie. Des reconstructions de bâtiments, sans modi-fication perceptible de l’agencement d’ensemble, peuvent être évoquées. Ainsi, un bâtiment carré à forts poteaux peut être identifié comme le probable édifice cultuel de cette étape, d’après son emplacement. Les bâtiments attribuables à cette période sont tous en terre et bois. La pierre fait une apparition timide dans une cave dont les
parois sont habillées de parements en pierre sèche. La présence de la tuile est également attestée, indirectement, par des fragments présents dans des remblais de fosse. L’évolution la plus notable concerne la culture matérielle, mais les transformations touchant les différentes catégo-ries de mobilier ne sont en rien spécifiques de l’activité cultuelle. Elles traduisent la romanisation des formes et des répertoires commune à tous les sites.
- Les étapes 5 et 6 (Fig. 7-5) correspondent à la période allant de 40 à 150 apr. J.-C. La chronologie relative des différentes constructions est difficile à cerner en raison de l’arasement des structures dont seuls subsistent les plans au sol, révélés par les tranchées de récupération. Les principales composantes de la zone cultuelle peuvent toutefois être décrites. Une vaste enceinte polygonale constituée de deux murs parallèles est mise en place. Sa partie orientale a été détruite par les travaux du xxe siècle et on ignore comment elle se refermait de ce côté-ci. Il est possible de restituer une colonnade d’ordre toscan sur le mur interne, à partir du mobilier lapidaire découvert. Elle remplissait vraisemblablement la fonction de péribole et de galerie périphérique munie d’un portique. L’enceinte est subdivisée en deux parties par un mur transversal orienté nord-sud. À l’ouest de ce mur se développe une aire non occupée, qui correspond assez strictement à la zone enclose initialement par l’enceinte fossoyée laté-nienne. À l’est de ce mur prend place un temple de plan carré (A), édifié quasiment au même emplacement que
Fig. 6 – Mirebeau-sur-Bèze, La Fenotte : plan d’ensemble de la zone du sanctuaire(données Ph. Barral, M. Joly ; DAO B. Turina, Ph. Barral).
Faut-il encore fouiller des sanctuaires ? Le cas de Mirebeau-sur-Bèze (21)
— 91 —
Enceinte fossoyée
ETAPE 1 : vers 300 - 160 av. J.-C.
ETAPE 2 : vers 160 - 100/80 av. J.-C.
ETAPE 3 : vers 60/50 - 20/15 av. J.-C.
Enceinte palissadée
0 10 50 m
N
Bâtiments
Palissades
Puits / structure hydraulique
Fosse / trou de poteau
Edifices cultuels
Fosse à dépôt
ETAPE 4 : vers 20/15 av. - 40 ap. J.-C.
ETAPE 5-6 : vers 40 - 150 ap. J.-C.
Galerie
Aqueduc
Temple B
Temple A
Bassin 1
Bassin 2
Fig. 7 – Mirebeau-sur-Bèze, La Fenotte : plans schématiques des étapes successives du sanctuaire(données Ph. Barral, M. Joly ; DAO B. Turina).
Martine Joly et Philippe Barral
— 92 —
les bâtiments cultuels des phases antérieures. Au sud de ce temple se développe un ensemble construit complexe, de plan incomplet, dont la fonction est obscure (ensemble thermal ?). Au nord prennent place un second temple de plan carré (B) et plusieurs petits bâtiments (annexes ?). Enfin, un dernier élément important consiste dans une canalisation souterraine, vraisemblablement alimentée par une source dite de Saint-Simon, localisée à quelques kilomètres, qui contourne l’ensemble du complexe cultuel au nord. Elle a alimenté successivement deux bassins situés à proximité du complexe évoqué plus haut. Le pre-mier bassin, le plus à l’ouest, est aménagé de façon assez fruste, taillé dans le terrain naturel et simplement bordé de dalles calcaires. Le second présente une architecture beaucoup plus soignée (dalles de calcaire blanc, tuyau d’alimentation en plomb, édicule avec décor de petit appareil losangique…).
Le nombre de fosses attribuables à cette étape est très limité, ce qui correspond à un phénomène classique dans les sanctuaires gallo-romains. Les éléments mobiliers, retrouvés en majorité dans des remblais de destruction et dans quelques aménagements de sols conservés, com-prennent des objets de parure et de toilette aux côtés de la céramique, qui occupe la place principale. Une nouveauté notable réside dans l’apparition d’ex-voto sous la forme de plaquettes en bronze à figuration d’yeux, dont une porte une dédicace à Minerve (Joly et Lambert 2005). Deux autres divinités du panthéon gallo-romain (Sucellus et Cernunnos) sont par ailleurs attestées par des découvertes de sculptures dans la zone proche du sanctuaire fouillée en 2001 (Deyts 2004).
Caractérisation du sanctuaire de Mirebeau : légendes et réalités
Au moment où le site est révélé par la photographie aérienne, il est interprété par son inventeur, René Goguey, comme un sanctuaire gallo-romain. Il entre parfaitement dans la typologie alors admise des lieux de culte disposant de temples, souvent à plan centré, de type fanum, d’un théâtre et de constructions annexes dans lesquelles on trouve fréquemment des thermes. Mais les différentes campagnes menées par la suite sur le terrain n’ont cessé de faire évoluer l’image du sanctuaire, tant du point de vue de sa chronologie que de son organisation et, au final, de son statut.
Dès les premières campagnes de fouilles, en 1977-1981, la découverte de mobilier caractéristique, en particulier des pièces d’armement gauloises, laisse pen-ser que l’implantation du lieu de culte a eu lieu avant la période gallo-romaine, mais toutefois après la guerre des Gaules au vu du mobilier numismatique. La question de la relation entre la défaite de 52 av. J.-C. et les dépôts d’armes à Mirebeau est posée (Goguey 1979, p. 205-206). Assez rapidement, l’étude du mobilier découvert durant les campagnes de 1977 à 1981, bénéficiant des acquis tout récents des fouilles de Gournay-sur-Aronde, permet de
préciser la datation du sanctuaire gaulois. Son installation est attribuée à la fin de La Tène ancienne ou au début de La Tène moyenne. Les études typo-chronologiques mettent ensuite en évidence un «vide chronologique de deux siècles» inexpliqué, puis une reprise de l’activité à La Tène finale (Brunaux et al. 1985a, p. 108). Ces conclusions sont tributaires à la fois de la collecte d’objets réalisée lors de ces premières fouilles et de l’état des connaissances sur ces catégories de mobilier au début des années 1980.
En relation avec cette première étape de recherche, la découverte d’une épée gauloise ployée, retrouvée « fichée dans la glaise du substrat au centre de la cella du temple A » (Goguey 1979, p. 202 et fig. p. 199), est interprétée dans le sens d’un rite préalable à la construction du premier temple (temple A) gallo-romain (Goguey 1979, p. 202). En réalité, la présence de cette épée, sans aucun lien avec le temple gallo-romain, s’explique par l’existence, sous le temple, d’une palissade de l’étape 2 constituée de fosses disposées « en chapelets », dont certaines renfermaient du mobilier laténien (mise en évidence dans la fouille de 2002). On a pu d’ailleurs à plusieurs reprises, lors des fouilles 2001-2007, observer la présence de pièces d’arme-ment incorporées dans les fosses d’ancrage de poteaux du sanctuaire laténien, sans que l’on puisse déterminer si elle était intentionnelle ou accidentelle.
Dans les années 1980, de nombreuses similitudes entre les sanctuaires gallo-romains de Mirebeau et de Gournay-sur-Aronde sont également mises en évidence. On insiste en particulier sur la ressemblance entre le temple B de Mirebeau et celui de Gournay, daté de l’époque augustéenne, ces édifices disposant tous deux d’un foyer au centre de leur cella de petite taille (Brunaux et al. 1985a, p. 110). En réalité, R. Goguey, qui a réalisé la fouille du temple de Mirebeau, écrit que le sol de la cella « présente des plaques d’argile rougie par le feu à l’angle nord-ouest et dans la partie centrale, avec amas d’os, fragments d’anse d’amphore, de bracelet et de bague en bronze ». Il précise bien en outre qu’« il ne s’agit pas de foyers organisés, mais vraisemblablement d’offrandes incinérées sur le sol de la cella » (Goguey 1979, p. 185). Malheureusement, ces précisions n’ont pas été retenues par la suite, et c’est l’interprétation mentionnant un temple avec une cella à foyer central qui sera retenue par les archéologues ; elle apparaît même comme une caractéris-tique de l’évolution des sanctuaires à partir de l’époque augustéenne (Bourgeois 1999, p. 42 fig. 31 et p. 172 ; repris par Van Andringa 2002, p. 96).
Les recherches menées dans cette zone en 2003 apportent un certain nombre d’informations déterminantes sur ces sujets. D’une part, aucune trace de structure de combustion n’a été mise au jour dans ce secteur. Les plaques d’argile rougie par le feu repérées par R. Goguey correspondent en fait à des niveaux lenticulaires de fragments rubéfiés de parois en torchis, témoignant de la destruction par le feu de bâtiments de l’étape 3. Ces traces d’incendie ont été repérées à différents endroits du site. D’autre part, on ne dispose d’aucun élément permettant de dater précisément le temple B (dont ne subsistaient aucun
Faut-il encore fouiller des sanctuaires ? Le cas de Mirebeau-sur-Bèze (21)
— 93 —
mur ni aucun sol) et, a fortiori, de l’attribuer à la période augustéenne. Il faut donc abandonner l’hypothèse, aussi séduisante soit-elle, de la présence d’un foyer implanté dans la cella au centre d’un fanum augustéen à Mirebeau.
Une autre erreur à laquelle il faut faire un sort réside dans la supposée basilique paléochrétienne, dont la présence ne reposait que sur l’interprétation hardie d’un plan d’édifice incomplet mais qui présentait l’avantage de s’inscrire pleinement dans le modèle de christianisation des temples païens. Ce plan à abside s’intègre en réalité dans un ensemble qui appartient sans aucun doute au complexe cultuel du Haut-Empire, mais dont la fonction précise reste indéterminée.
En revanche, les fouilles 2001-2007 ont apporté des informations très substantielles sur la structuration du sanctuaire, ses transformations architecturales et l’évolution des pratiques cultuelles. Ces acquis sont en grande partie liés à la pratique des décapages extensifs et des fenêtres d’investigation larges, qui seule permet d’appréhender le site dans toute son ampleur et sa com-plexité. L’un des apports majeurs des recherches récentes concerne la caractérisation de la trajectoire du sanctuaire sur la longue durée. La pérennité du schéma d’organi-sation du lieu de culte initial tout au long de l’existence du sanctuaire, soit environ cinq siècles, figure parmi les éléments clés. Par ailleurs, si le sanctuaire de Mirebeau entre dans la catégorie des sanctuaires laténiens majeurs de l’Est de la Gaule, que l’on se réfère à ses aménage-ments architecturaux, au nombre et à la qualité des dépôts qu’il a livrés ou à sa longévité, il n’en va pas de même du sanctuaire gallo-romain. Celui-ci, en effet, ne présente pas les caractères d’un ensemble cultuel de premier ordre, même s’il apparaît difficile d’apprécier la qualité de ses aménagements et décors architecturaux au vu des rares éléments retrouvés.
Durant les dernières décennies du xxe siècle, le sanctuaire de Mirebeau a figuré en bonne place dans la littérature sur les lieux de culte ou la religion antique en Gaule, pas forcément toujours pour de bonnes raisons.
Il se trouve en effet fréquemment mentionné dans les publications de synthèse pour illustrer des pratiques soi-disant bien attestées en Gaule, mais qui reposent sur des données archéologiques bien ténues. Les références faites à Mirebeau dans la littérature montrent que les vestiges archéologiques sont parfois surinterprétés, au même titre que les textes, afin de correspondre aux schémas théo-riques ou modèles socio-culturels en vogue à un moment donné.
Dans le cas de Mirebeau, ces hypothèses ou interpréta-tions erronées ne résistent pas aux observations acquises au moyen d’une exploration quasi exhaustive du site. Au fil du temps, l’interprétation générale de ce lieu de culte a fortement évolué, toujours à la suite de nouvelles interventions sur le terrain. Il s’agit là d’un point essentiel. Cet exemple montre la nécessité de rompre avec une per-ception ponctuelle, fragmentaire des lieux de culte, fruit d’explorations trop partielles.
Le poids des classifications traditionnelles et des modèles fondés sur des corpus documentaires de piètre qualité, qui servent à élaborer des typologies fragiles, tend aujourd’hui à s’atténuer grâce au renouvellement et à l’accroissement sans précédent des données, issues prio-ritairement (mais pas seulement) des fouilles de quelques grands sanctuaires. L’un des apports des recherches récentes, dont la fouille de Mirebeau est une illustration parmi d’autres, réside dans la mise en évidence de la diversité des organisations, des statuts, des pratiques et des fonctions. Mais les pistes esquissées nécessitent, pour être pleinement développées dans les années qui viennent, un accroissement sensible du corpus des sites bénéficiant d’une documentation de qualité, intégrant notamment des données précises sur l’environnement naturel et le système de peuplement. Il faut donc, encore et de nouveau, fouiller des sanctuaires en privilégiant des approches extensives et pluridisciplinaires, bénéficiant des nombreuses innovations ou des approfondissements méthodologiques récents, tant du point de vue de l’ap-proche des lieux et structures à vocation cultuelle que de l’analyse des vestiges mobiliers associés aux gisements.
Bibliographie
Barral et al. 2009 : Ph. Barral, E. Fovet, M. Joly, S. Mouton-Venault, L. Nuninger, M. Reddé et S. Venault, Mirebeau-sur-Bèze. In : Carte archéologique de la Gaule 21. La Côte-d’Or, Paris 2009, p. 544-566.
Barral et Guillaumet 1994 : Ph. Barral et J.-P. Guillaumet, Un sanctuaire aux confins du pays éduen. Mirebeau-sur-Bèze. In : A. Duval (dir.), Vercingétorix et Alésia, Paris 1994, p. 150-152.
Bourgeois 1999 : L. Bourgeois (dir.), Le sanctuaire rural de Bennecourt (Yvelines). Du temple celtique au temple gallo-romain, Paris 1999.
Brunaux et al. 1985a : J.-L. Brunaux, R. Goguey, J.-P. Guillaumet, P. Méniel et A. Rapin, Le sanctuaire celtique de Mirebeau (Côte-d’Or). In : L. Bonnamour, A. Duval et J.-P. Guillaumet (éd.), Les Âges du Fer dans la vallée de la Saône (viie-ier siècle avant notre ère). Paléométallurgie du bronze à l’âge du Fer. Actes du VIIe colloque de l’AFEAF (Rully, 12-25 mai 1983), Paris 1985, p. 76-111.
Brunaux et al. 1985b : J.-L. Brunaux, P. Méniel et F. Poplin, Gournay I. Les fouilles sur le sanctuaire et l’oppidum (1975-1984), Senlis 1985.
Martine Joly et Philippe Barral
— 94 —
Bulard 1980 : A. Bulard, Sur deux poignards de la fin de l’époque de La Tène, Études celtiques 17 (1980), p. 31-49.Deyts 2004 : S. Deyts, Un Cernunnos et un Sucellus
découverts à Mirebeau-sur-Bèze (Côte-d’Or), Latomus 23/2 (2004), p. 388-393.
Drioton 1920 : C. Drioton, La station de l’âge du fer de Mirebeau et le gué de Mautoche [sic, Mantoche]. In : Association française pour l’Avancement des sciences, 44e session, Strasbourg 1920, p. 544-545.
Goguey 1975 : R. Goguey, Recherches d’archéologie aérienne en Bourgogne, Mém. C.A.C.O. 29 (1974-1975), p. 100 et ph. 14.
Goguey 1979 : R. Goguey, Le sanctuaire gallo-romain de Mirebeau, Mém. C.A.C.O. 31 (1978-1979), p. 169-206.
Goguey 1994 : R. Goguey, Mirebeau, le sanctuaire gallo-romain. In : J. Bénard (dir.), Les agglomérations antiques de Côte-d’Or, Paris 1994, p. 143-146.
Goguey et Reddé 1995 : R. Goguey et M. Reddé (dir.), Le camp militaire de Mirebeau, Mayence 1995.
Guillaumet et Barral 1991 : J.-P. Guillaumet et Ph. Barral, Le sanctuaire celtique de Mirebeau-sur-Bèze. In : J.-L. Brunaux (éd.), Les sanctuaires celtiques et la Méditerranée. Actes du colloque de Saint Riquier (8-11 novembre 1990), Paris 1991, p. 193-195.
Jannet-Vallet 1990 : M. Jannet-Vallet (dir.), Il était une fois la Côte-d’Or. 20 ans de recherches archéologiques, Paris-Dijon 1990.
Joly et Barral 2007 : M. Joly et Ph. Barral, Le sanctuaire de Mirebeau-sur-Bèze (Côte-d’Or) : bilan des recherches récentes. In : Ph. Barral, A. Daubigney, C. Dunning, G. Kaenel, M.-J. Roulière-Lambert (éd.), L’âge du Fer dans l’arc jurassien et ses marges. Dépôts, lieux sacrés et territorialité à l’âge du Fer. Actes du XXIXe colloque international de l’AFEAF (Bienne, 5-8 mai 2005), Besançon 2007, p. 55-72.
Joly et Barral 2008a : M. Joly et Ph. Barral, Du sanctuaire celtique au sanctuaire gallo-romain : quelques exemples du nord-est de la Gaule. In : D. Castella et M.-F. Meylan Krause (dir.), Topographie sacrée et rituels. Le cas d’Aventicum, capitale des Helvètes. Actes du colloque international d’Avenches, 2-4 novembre 2006, Bâle 2008, p. 217-228.
Joly et Barral 2008b : M. Joly et Ph. Barral, avec la coll. de C. Mauduit, La vaisselle du sanctuaire de Mirebeau-sur-Bèze (Côte-d’Or) : faciès et évolution des corpus (iiie s. av. J.-C.-iie s. apr. J.-C.). In : L. Rivet et S. Saulnier (éd.), Actes du congrès de la SFECAG de L’Escala-Empuries (2-4 mai 2008), Marseille 2008, p. 361-380.
Joly et Lambert 2005 : M. Joly et P.-Y. Lambert, Un ex-voto dédié à Minerve trouvé sur le sanctuaire de Mirebeau-sur-Bèze (21), RAE 53 (2005), p. 233-237.
Le Bohec 2003 : Y. Le Bohec, Inscriptiones latinae Galliae Belgicae, 1. Lingones. Les inscriptions de la cité des Lingons : inscriptions sur pierre, Paris 2003.
Mouton et Venault 2005 : S. Mouton et S. Venault, Le site de La Fenotte à Mirebeau-sur-Bèze (21) : un cas d’habi-tat en périphérie d’un camp militaire de type romain tardo-républicain. In : S. Fichtl (dir.), Hiérarchie de l’habitat rural dans le nord-est de la Gaule à La Tène moyenne et finale, Archéologia Mosellana 6 (2005), p. 239-274.
Rey 1900 : Note de M. F. Rey sur des découvertes archéologiques faites récemment à Mirebeau, lue par M. F. Daguin, Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France 1 (1900), p. 196-201.
Van Andringa 2002 : W. Van Andringa, La religion en Gaule romaine, Paris 2002.