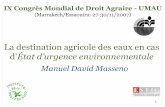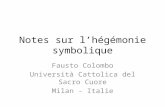Rapports d'entraide technique chez des petits producteurs agricoles de Colonia Caá-Guazú (Argentine)
Évaluation de l’imprégnation au plomb d’une population rurale utilisant les eaux usées à des...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Évaluation de l’imprégnation au plomb d’une population rurale utilisant les eaux usées à des...
L’essentiel de l’informationscientifique et médicale
www.jle.com
Montrouge, le 04/10/2010
S.El Kettani
Vous trouverez ci-après le tiré à part de votre article en format électronique (pdf) :Évaluation de l’imprégnation au plomb d’une population rurale utilisant les eaux usées à des fins
agricoles dans la région de Settat au Maroc
paru dansEnvironnement Risques Santé, 2010, Volume 9, Numéro 5
John Libbey Eurotext
Ce tiré à part numérique vous est délivré pour votre propre usage et ne peut être transmis à des tiers qu’à des fins de recherches personnelles ou scientifiques. En aucun cas, il ne doit faire l’objet d’une distribution ou d’une utilisation promotionnelle, commerciale ou publicitaire.
Tous droits de reproduction, d’adaptation, de traduction et de diffusion réservés pour tous pays.
���������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
��������������
�����������
� � � �
��������������������������������������������
http://www.john-libbey-eurotext.fr/fr/revues/sante_pub/ers/sommaire.md?type=
text.html
Le sommaire de ce numéro
© John Libbey Eurotext, 2010
Évaluation de l’imprégnationau plomb d’une populationrurale utilisant les eaux uséesà des fins agricoles dans la régionde Settat au MarocRésumé. Objectifs : cette enquête a été entreprise pour apprécier l’imprégnation saturninechez une population rurale, utilisant les eaux usées en agriculture. Méthodes : l’étude aconcerné 215 sujets, 116 appartenant à deux douars utilisant les eaux usées brutes enagriculture et 99 appartenant à un douar témoin qui n’utilise pas les eaux usées. Chaquepersonne consentante a bénéficié d’un examen clinique complet avec recueil de renseigne-ments anamnestiques et de prélèvements sanguins et urinaires. Le plomb sanguin et urinairea été dosé par ICP-MS (inductively coupled plasma mass spectrometry, spectrophotométriede masse couplée à une source de plasma induite par haute fréquence). Résultats : lesvaleurs du plomb sanguin sont respectivement au niveau de la population exposée etau niveau de la population non exposée de 50,4 ± 27,5 μg/L et de 48,0 ± 21,8 μg/L.La différence est non significative. Les valeurs sont plus élevées chez les personnes de sexemasculin. Cela est significatif au niveau de la PNE (p = 0,0001). Elles sont plus élevées auniveau des âges extrêmes. Elles ne sont pas influencées significativement par le tabagisme nil’œnolisme. La prévalence d’une plombémie anormale (supérieure à 100 μg/L) est significati-vement plus élevée (p = 0,017) au niveau de la population exposée. Si ces plombémies anor-males sont légèrement plus fréquentes chez les utilisateurs de khôl, elles ne s’accompagnentd’aucune complication potentielle telle que l’anémie ou l’atteinte rénale ou neurologique.Les valeurs du plomb urinaire sont respectivement au niveau de la population exposée et auniveau de la population non exposée de 4,7 ± 5,2 μg/L, et de 5,3 ± 3,4 μg/L. La différenceest non significative. Conclusion : l’imprégnation au plomb observée en milieu rural à Settatchez cette population est proche, voire inférieure à celle de plusieurs pays. Des mesurespréventives s’imposent, en insistant sur la surveillance, l’éducation sanitaire, l’utilisation dekhôl exempt de plomb et surtout sur le traitement adéquat des eaux usées avant leur rejetdans le milieu récepteur, a fortiori si leur réutilisation agricole est envisagée.
Mots clés : eaux usées ; Maroc ; plomb ; risque ; sang ; urine.
AbstractEvaluation of the lead burden of a rural population that uses wastewater foragricultural purposes in the region of Settat, MoroccoObjectives: This investigation was undertaken to assess the lead burden of a rural populationthat uses wastewater for agriculture in the province of Settat. Methods: The study covered215 subjects, 116 living in two rural douars (mean age: 29.2 ± 20.2 years) that used waste-water for agriculture and 99 in another douar that does not use its wastewater (mean age:31.4 ± 19.1 years). Each person who agreed to participate received a complete clinicalexamination that included the collection of historical information, especially past diseases,occupation, and exposure to wastewater. Blood and urine samples were taken, and bloodand urinary lead levels assessed by ICP-MS (inductively coupled plasma mass spectometry).Results: The mean blood lead level in the exposed population was 50.4 ± 27.5 μg/L and in theunexposed population, 48.0 ± 21.8 μg/L. This difference was not significant (p = 0.44). Valueswere significantly higher among boys and men (p = 0.0001). They were also higher at thelowest and highest ages. They were not significantly influenced by smoking or drinking alco-holic beverages. The prevalence of an elevated blood lead level (100 μg/L) was significantly
doi:10
.168
4/ers.20
10.038
0
SAÏD EL KETTANI1
CHAMS EDDOHA KHASSOUANI2
WAFAA FENNICH3
EL MOSTAPHA AZZOUZI4
BOUCHAIB ACHAB5
YVES MAURAS6
1 Cabinet de médecineinterne
11 Bd SkirejSettat
BP 1325Maroc
<[email protected]><[email protected]>
2 Centre Antipoisonet de pharmacovigilanceRue Lamfedel Cherkaoui
Rabat InstitutsMadinate Al Irfane
BP 6671Rabat 10100
Maroc<[email protected]>
3 Cabinet de neurologieRésidence Laaroussi N°1Avenue Mohammed V
Appartement 1SettatMaroc
<[email protected]>4 Laboratoire d’analyses
biomédicales97, Bd Mohammed V
SettatMaroc
<[email protected]>5 Université Hassan 1er
Faculté des scienceshumaines
Unité de statistiqueComplexe universitaireRoute de Casablanca
Settat 26000Maroc
Article original
Environnement, Risques & Santé – Vol. 9, n° 5, septembre-octobre 2010 419����������������������������
Tiré
à par
t au
teur
higher (p = 0.017) in exposed population, that is, 7.8% compared with only 1.0% in theunexposed population. These elevated blood lead levels were not accompanied by anemia,kidney disease or neurological disorders. On the other hand, bone risk was significantly morefrequent. The urinary lead value for the exposed population was 4.7 ± 5.2 μg/L and for theunexposed population, 5.3 ± 3.4 μg/L. The difference was not significant (p = 0.38). Conclu-sion: The prevalence of elevated blood lead levels was significantly higher in the populationusing wastewater in agriculture, compared with the unexposed population (p = 0.017). Thelead burden observed in the rural environment of Settat was close to or even lower than that inother countries. Preventive measures are essential, as well as monitoring, medical education,the use of lead-free kohl, and especially adequate treatment of the wastewater before itsdischarge into the environment, especially if agricultural re-use is considered.
Key words: blood; lead; Morocco; risk; sewage; urine.
Dans plusieurs régions du monde, affectées par la pénu-rie en eau, les eaux usées brutes sont réutilisées à des
fins agricoles [1]. Au Maroc, cette pratique, réalisée de manièrecourante, est très ancienne à la périphérie de grandes villes del’intérieur pourvues d’un réseau d’assainissement. Cette situationest la résultante de plusieurs facteurs :
– rareté croissante de l’eau d’irrigation ;– exacerbation de la sécheresse ;– intensification agricole ;– coût élevé des engrais industriels ;– découverte de la valeur nutritive des eaux résiduaires ;– acceptation socioculturelle de cette pratique.Ainsi, environ 70 millions de mètres cubes d’eaux usées
brutes sont utilisés chaque année en agriculture sans précautionsanitaire pour irriguer une superficie de plus de 7 000 hectaresde cultures diverses : cultures fourragères, cultures maraîchères,grandes cultures, arboriculture… L’irrigation des culturesmaraîchères avec les eaux usées brutes est interdite auMaroc, mais cette interdiction n’est pas toujours respectée [2].Les risques sanitaires inhérents à cette pratique sont fréquents etdivers [1-10].
Le plomb (Pb) est un métal omniprésent dans l’environne-ment, il est très facilement dissous par des acides faibles conte-nus dans les eaux dites agressives ou dans l’alimentation.L’alimentation est la source la plus importante en ce quiconcerne les apports de plomb chez l’homme. La deuxièmesource est constituée par la pollution atmosphérique provenantdes poussières industrielles et du rejet des gaz d’échappementdes automobiles [11-13]. Au Maroc, à ces causes communes,s’ajoutent des causes particulières, comme l’utilisation plus fré-quente d’essence avec additif au plomb et d’ustensiles de cuisineavec glaçure à base de galène, et celle, comme en Asie, de remè-des et de cosmétiques contenant du plomb, notamment le khôl.
Le plomb métal est un élément cumulatif. Sa toxicité à longterme s’exerce essentiellement sur le système nerveux et le rein[11, 12]. Une grande variabilité clinique est observée [12].Le plomb interagit au niveau de la synthèse de l’hème, à diffé-rents niveaux, entraînant une anémie sidéroblastique, avec ousans hémolyse, avec la présence d’hématies à granulations baso-philes en grand nombre [11, 12]. Dans ce contexte, il est bienconnu que les carences en calcium, en fer et en zinc peuvent
contribuer à augmenter la quantité de plomb absorbée, et celade manière plus importante lorsque le sujet est à jeun. Ainsi, ilest recommandé de rechercher et de corriger toute carence mar-tiale ou calcique en cas d’intoxication ou d’exposition au plomb[4, 14, 15]. L’atteinte neurologique est classique. Il s’agit d’uneencéphalopathie ou de neuropathies diffuses à prédominancemotrice [16, 17]. L’exposition au plomb induit deux types denéphropathies :
– on peut citer d’abord une néphropathie subaiguë, qui sur-vient précocement après le début de l’exposition. Il s’agit d’unetubulopathie proximale responsable d’une fuite urinaire deprotéines de faibles poids moléculaires (comme la bêta-2-microglobuline, l’alpha-1-microglobuline ou la protéinetransporteuse du rétinol), une enzymurie, une glycosurie, uneaminoacidurie, une hypercalciurie et une hyperphosphaturie. Untel tableau ne s’observe que pour des contaminations massives,correspondant à une plombémie supérieure à 1 500 μg/L. Cepen-dant, des travaux récents ont montré que des signes discretsd’atteinte tubulaire étaient décelables dès 400 μg/L et peut-êtremême en deçà chez l’enfant. Cette atteinte précoce est de bonpronostic, car elle guérit à l’arrêt de l’exposition ;
– le second type de néphropathie induite par le plomb esttardif : il s’observe après 10 à 30 ans d’exposition au plomb,pour des plombémies d’au moins 600 μg/L. L’atteinte est, dansce cas, tubulointerstitielle et glomérulaire. Elle est définitive et,le plus souvent, elle continue de s’aggraver, même après l’évic-tion du risque [6, 11, 12, 16, 18]. Au niveau de l’os, le plombdéplace l’ion Ca ++ du cristal d’hydroxyapatite et y est stocké[8, 11, 12].
Les eaux usées, domestiques et industrielles, en provenanced’usines de fabrication de cristal, d’agroalimentaires, de tanne-ries, de céramique, de textiles et de composants électroniquesde la ville de Settat sont évacuées sans traitement dans l’ouedBou-Moussa. À la sortie de la ville, cet oued traverse les localitésDladla et Boukallou. Le long de son passage, les riverains utili-sent ces eaux pour irriguer des cultures céréalières et fourragères.Des prémices de la contamination de la nappe phréatique ont étédétectées. Ainsi, la concentration moyenne annuelle de plombdans les eaux usées du collecteur final est de 0,52 ± 0,41 mg/Let de 0,074 ± 0,12 mg/L dans les puits de la zone d’étude utiliséspour la consommation humaine [19]. Ces teneurs dépassent les
6 CHULaboratoire
de pharmacologieet de toxicologie
4, rue Larrey49933 Angers
France<[email protected]>
Tirés à part :S. El Kettani
Article reçu le 08 février 2010 ;accepté le 22 juin 2010
S. El Kettani, et al.
Environnement, Risques & Santé – Vol. 9, n° 5, septembre-octobre 2010420����������������������������
Tiré
à par
t au
teur
normes de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) [20],c’est-à-dire les valeurs limites pour le plomb de 10 μg/L pourles eaux destinées à la consommation humaine.
Cette étude se propose d’évaluer l’imprégnation saturnine,ses liens avec l’exposition aux eaux usées utilisées à des finsagricoles et son retentissement. Cette recherche a été réalisée àtravers l’examen clinique et l’évaluation des dosages sanguins eturinaires du plomb par ICP-MS (inductively coupled plasmamass spectrometry, spectrophotométrie de masse couplée à unesource de plasma induite par haute fréquence).
Matériel et méthode
Zone d’étudeSettat est située au nord-ouest du Maroc, à 60 kilomètres au
sud de Casablanca. Son climat est aride à semi-aride. La pluvio-métrie moyenne annuelle est autour de 284 mm. La ville de Settatcompte 120 000 habitants, elle rejette environ 9 000 mètres cubesd’eaux usées par jour. Ces eaux usées non traitées sont réutiliséespour irriguer plus de 400 hectares de terres agricoles.
Population étudiéeIl s’agit d’une enquête transversale comparant une popula-
tion exposée (PE) aux risques encourus par la réutilisation agri-cole des eaux usées, à une population non exposée (PNE). La PEest représentée par les habitants des douars1 Dladla et Boukalloude la commune rurale de Sid-El-Aydi, car ils utilisent l’eau del’oued Bou-Moussa pour l’irrigation des cultures et consommentl’eau de la nappe phréatique sous-jacente. Ces deux douars sontsitués au nord de la ville de Settat. Ils sont également exposés àune forte pollution par les moyens de transports, du fait du pas-sage d’une route nationale importante reliant le nord et le sud duMaroc. Ils sont aussi situés à proximité de l’aéroport de Casa-blanca. La PNE habite au douar Ouled-Afif situé à 20 kilomètresau sud-est de Settat. C’est une localité qui n’a jamais utilisé leseaux usées en irrigation et qui consomme une eau provenantd’une nappe phréatique différente de celle de Sid-El-Aydi. La pol-lution automobile y est plus faible, et la localité est située prèsd’une route secondaire moyennement fréquentée. Ces personnesont les mêmes caractéristiques ethniques, démographiques,socio-économiques et professionnelles. Elles ont également lesmêmes habitudes culinaires et les mêmes pratiques agricoles.Un échantillon d’un tiers de la population dans chaque douar aété aléatoirement choisi en respectant la répartition selon le sexeet les tranches d’âge. Les taux de non-répondants varient entre6,1 et 6,3 %. Les raisons de non-participation sont diverses :absences prolongées du foyer familial, refus de participation ouangoisse lors de la prise de sang. Ainsi, l’étude a concerné215 sujets, 116 appartenant à la PE et 99 à la PNE.
Le recrutement des sujets d’étude a été progressif, selon uneapproche participative et de concertation. Ainsi, la premièreétape a été une explication collective des objectifs de l’étude,de sa méthodologie, de l’accord du ministère de la Santé et deses aspects éthiques. La deuxième étape a consisté en l’invitationpersonnelle de chaque sujet consentant qui a été informé ducaractère confidentiel des renseignements qu’il fournirait, demême que de son droit de refuser de participer ou de se retirerlibrement à tout moment. La troisième étape a consistéen l’enquête proprement dite, avec le recueil des élémentsanamnestiques (données socio-économiques, professionnelles,consommation tabagique, antécédents pathologiques, prisemédicamenteuse, profession et exposition aux eaux usées) etl’examen clinique détaillé, notamment neurologique, avec desmesures anthropométriques et les prélèvements sanguins eturinaires.
Prélèvements et dosage du plombPour le dosage du plomb, 5 mL de sang veineux ont été pré-
levés dans un tube hépariné sous vide. Les urines de 24 heuresont été recueillies dans un bocal sans détergent. Le Pb a été dosépar spectrophotométrie de masse couplée à une source deplasma induite par haute fréquence (ICP-MS) sans minéralisationpréalable au moyen d’un appareil Perklin Elmer Sciex, modèleElan 5 000. Les échantillons, après décongélation, sont dilués au1/10 dans une solution contenant 144 mmol/L d’acide nitrique et165 mmol/L d’europium, avant d’être introduits dans l’appareilpar nébulisation. L’europium sert d’étalon interne. Les solutionsétalons ont été préparées à des concentrations de 125, 250,500 et 1 000 μg/L de Pb par addition de quantités connues àune solution artificielle. Des échantillons de contrôle, Séronorm,sont incorporés dans chaque série de dosages. Le laboratoire depharmacologie et de toxicologie du CHU d’Angers satisfait depuisplusieurs années au contrôle de qualité interlaboratoires organisépar le Robens Institute (University of Surrey, Guildford, Great Bri-tain) pour le dosage du plomb. Au niveau du sang, la limite dedétection (limit of detection, [LOD]), est de 0,3 μg/L et la limitede quantification (limit of quantification [LOQ]) de 10 μg/L. Auniveau des urines, la LOD est de 0,15 μg/L et la LOQ de 5 μg/L.
Un sujet est considéré comme présentant une plombémieanormale lorsque le taux de plomb sanguin est supérieur à100 μg/L.
Détermination de la fonction rénaleLa fonction rénale a été appréciée par la recherche d’une
maladie rénale chronique (MRC). Celle-ci est retenue devant laprésence, depuis au moins trois mois, de l’un des deux élémentssuivants :
– des anomalies de structure ou de fonction du rein se mani-festant par des anomalies histologiques et/ou des marqueursd’atteinte rénale incluant des anomalies sanguines ou urinaires(protéinurie, leucocyturie, hématurie, microalbuminurie chez lediabétique de type 1) ou des anomalies à l’imagerie ;
– un débit de filtration glomérulaire (DFG) inférieur à60 mL/min/1,73 m2 [21]. Pour mieux rendre compte de la rela-tion entre la créatinine plasmatique et la filtration glomérulaire et
1 Douar : type de campement nomade, en particulier au Maghreb,qui, disposé en cercle, permettait de remiser les troupeaux dansl’espace laissé libre au centre de celui-ci.
Évaluation de l’imprégnation au plomb d’une population rurale utilisant les eaux usées à des fins agricoles dans la région de Settat au Maroc
Environnement, Risques & Santé – Vol. 9, n° 5, septembre-octobre 2010 421����������������������������
Tiré
à par
t au
teur
pour tenir compte de la masse musculaire et éviter les erreursliées au recueil urinaire, la clairance de la créatinine a été esti-mée en utilisant les formules de Cockcroft et Gault chez l’adulteet de Schwartz chez l’enfant [6, 22].
Détermination du risque osseux
Le calcium sanguin a été dosé dans le sang veineux, prélevépar vacutainer, dans un tube sec. Le calcium urinaire a étédosé sur les urines de 24 heures, recueillies dans un bocalcontenant de l’acide chlorhydrique, afin d’éviter la précipitationdes sels calciques. Les dosages ont été effectués par spectro-photométrie [23]. Nous considérons qu’un sujet présente un« risque osseux » lorsque le taux de calcémie est inférieur à2,025 mmol/L et/ou lorsque le taux de calciurie est supérieur à7,5 mmol/24 heures [8].
Analyse de l’hémogramme
Le prélèvement a été effectué par ponction veineuse francheavec un tube vacutainer contenant de l’acide éthylène-diamine-tétracétique tripotassique. L’étude de l’hémogramme aété faite par comptage cellulaire pour la numération formulesanguine (NFS), frottis et dénombrement des réticulocytes et deshématies à granulations basophiles. L’analyse de l’hémogrammea été réalisée par un appareil Coulter type JT. Le dosage del’hémoglobine a été effectué par spectrométrie. Un sujet estconsidéré comme présentant une anémie lorsque le tauxd’hémoglobine est :
– inférieur à 11 g/100 mL de sang, s’il s’agit d’un enfant âgéde moins de 12 ans ;
– inférieur à 12 g/100 mL, s’il s’agit d’une personne de sexeféminin âgée de plus de 12 ans ;
– inférieur à 13 g/100 mL, s’il s’agit d’une personne de sexemasculin âgée de plus de 12 ans [4, 24].
Analyse statistique
Pour comparer les moyennes, l’analyse de variance a été uti-lisée. La différence est significative lorsque p est inférieur à 0,05.Pour comparer les répartitions et les prévalences des plombé-mies anormales en fonction de chacune des variables de l’étude,nous avons utilisé l’intervalle de confiance à 95 % (IC 95 %) et letest du χ2 de Pearson. Une association est considérée significa-tive quand les intervalles de confiance sont disjoints ou que lavaleur de p est inférieure à 0,05. Après cette analyse univariée,un modèle de régression logistique non conditionnelle a étéélaboré pour la population exposée, pour déterminer les associa-tions entre la prévalence d’une plombémie anormale (variabledépendante) et toutes les autres variables (variables indépen-dantes). La sélection des variables pour le modèle est réalisée àl’aide de la procédure de sélection pas à pas (stepwise) où lescritères d’entrée et de sortie des variables dans le modèle ontété fixés à 10 %. Pour les analyses simples et les modèles derégression logistique en analyse principale, le seuil de significa-tion statistique a été fixé à 5 % [25]. Les analyses ont été réaliséesà l’aide du logiciel SPSS, version 10.
Résultats
Anamnèse, examen cliniqueet bilan biologiqueLes 116 sujets de la PE sont âgés en moyenne de 29,2
± 20,2 ans, leur sex-ratio M/F est de 0,90. Les 99 sujets de laPNE sont âgés en moyenne de 31,4 ± 19,1 ans, leur sex-ratioM/F est de 0,98. Aucune femme n’est enceinte. Comme le montrele tableau 1, les deux populations sont comparables quantaux variables sociodémographiques et pour la consommationtabagique et œnolique. La répartition des anémies, des MRC etde l’examen neurologique pathologique n’est pas significative-ment différente entre les deux populations. L’analyse hémato-logique des 215 sujets d’étude n’a retrouvé aucun cas avec deshématies à granulations basophiles. L’anémie est hypochromemicrocytaire dans 62,2 % des cas dans la PE et uniquementdans 25 % des cas dans la PNE (différence significative :p = 0,01). Le plus souvent, dans le contexte marocain, uneanémie hypochrome microcytaire est en rapport avec uneanémie ferriprive, plus rarement avec un état inflammatoire [4].L’examen neurologique a relevé que huit personnes, de chaquepopulation d’étude, ont une hyporéflexie rotulienne et/ouachilléenne. Aucune personne ne présente d’encéphalopathie,ni de déficit moteur. Le risque osseux est significativement plusfréquent au niveau de la PE.
Concentrations du plomb dans les urinesLe plomb urinaire n’a été dosé que chez 100 sujets de la PE
et 70 sujets de la PNE. Les valeurs sont respectivement, pour laPE et pour la PNE, de 4,7 ± 5,2 μg/L et de 5,3 ± 3,4 μg/L(p = 0,38). La différence est non significative.
Concentrations du plomb dans le sangLes valeurs du plomb sanguin ont varié respectivement, chez
la PE et chez la PNE, entre 15,7 et 139,2 μg/L, et entre 15,3 et146 μg/L. Les valeurs moyennes du plomb sanguin chez les116 sujets de la PE et les 99 sujets de la PNE, comme rapportéesdans le tableau 2, sont proches. Elles sont respectivement de50,4 ± 27,5 μg/L et de 48,0 ± 21,8 μg/L (p = 0,44). Dans cha-cune des deux populations, les valeurs sont plus élevées chezles personnes de sexe masculin. Cela est constaté de manièresignificative chez la PNE (p = 0,0001). Les valeurs les plusélevées sont enregistrées pour les âges extrêmes.
Prévalence d’une plombémie anormaleLa répartition des participants à l’étude en fonction des
valeurs du plomb sanguin est présentée dans le tableau 3.La prévalence des cas supérieurs à 100 μg/L dans la PE est de7,8 % (IC 95 % : 2,9-12,6 %), alors qu’elle est uniquementde 1,0 % (IC 95 % : -1,0-3,0 %) dans la PNE. La différence estsignificative (p = 0,017).
Au niveau de la PE, aucun effet significatif n’a été observéavec les différents facteurs analysés, à savoir le sexe, les tranches
S. El Kettani, et al.
Environnement, Risques & Santé – Vol. 9, n° 5, septembre-octobre 2010422����������������������������
Tiré
à par
t au
teur
d’âge, le tabagisme et l’œnolisme (tableau 4). En revanche, laprévalence est légèrement plus élevée chez les sujets utilisateursde khôl (p = 0,06).
Recherche de complications potentielles
Toutes les personnes dont l’examen neurologique est anor-mal ont des taux de plombémie et de plombiurie normaux.Aucun examen du frottis des 215 hémogrammes n’a mis en évi-
dence d’hématies à granulations basophiles. La prévalenced’une plombémie anormale n’est pas significativement influen-cée par la présence d’une anémie d’une MRC ni d’un risqueosseux. Tous les sujets avec plombémie anormale ont un examenneurologique normal.
Analyse multivariéeLa régression logistique non conditionnelle a retenu dans son
modèle final, pour la PE, l’utilisation du khôl comme facteur leplus prédictif (tableau 5).
DiscussionLa méthode de dosage du plomb utilisée dans cette étude,
l’ICP-MS, est plus sensible que l’absorption atomique avec ato-misation électrothermique. Elle donne depuis plusieurs annéesdes résultats très reproductibles et est un gage de validité desrésultats [26].
La concentration sanguine du Pb reflète mieux le Pb ingéréou inhalé et le Pb cumulé dans l’organisme essentiellementosseux. C’est la raison pour laquelle elle est préférée au dosageurinaire [11, 12]. Chez l’enfant, des études épidémiologiquesproposent la valeur de 100 μg/L comme valeur seuil, du fait dela neurotoxicité [12, 27, 28]. Un consensus semble se dégagerpour que ce seuil soit appliqué à l’adulte non exposé profession-nellement [11, 12, 29].
La prévalence d’une plombémie anormale (supérieure à100 μg/L) est significativement plus élevée (p = 0,017) au niveaude la population exposée. À côté des eaux usées, cela peut êtrelié à la proximité du grand aéroport de Casablanca et d’un axeroutier important reliant le nord et le sud du Maroc.
La plombémie moyenne (50,4 ± 27,5 μg/L) obtenue danscette étude, en milieu rural à Settat (Maroc), chez une populationutilisant les eaux usées en agriculture, est proche de celle qui estobservée lors d’une étude à Marrakech [30]. Cette dernière acomparé une population exposée aux eaux usées à une popula-tion témoin et a noté des concentrations respectives de52,4 ± 8,2 μg/L et de 14,3 ± 11,6 μg/L (DS), alors que l’étuderéalisée chez des donneurs de sang au Centre de transfusion deRabat a observé une moyenne plus élevée (86,9 ± 42,2 μg/L) [26].
Les valeurs observées à Settat sont proches de celles de l’Ita-lie [31] et de la République tchèque (41 μg/L) [33]. Elles sont plusbasses que celles qui sont observées en France (67 μg/L) [32] etplus élevées que celles qui sont observées en Allemagne (31 μg/L)[29] et aux États-Unis (17 μg/L) [34].
L’utilisation décroissante d’essence plombée et le contrôledes émissions du Pb industriel dans les pays industrialisés aucours des dernières décennies ont entraîné une baisse généraledes concentrations du Pb sanguin. Les exemples d’études allantdans ce sens viennent d’Italie [35], de Suède [36], de Suisse [37],d’Espagne [38], d’Allemagne [28, 39] et des États-Unis [34].
Contrairement à d’autres études, chez les enfants [34, 40] ouchez les adultes [31, 39], nous n’avons pas observé un effet clairde l’âge sur la plombémie. L’augmentation de la plombémie
Tableau 1. Caractéristiques des personnes enquêtées des deuxpopulations d’étude, Settat (Maroc).
Table 1. Characteristics of exposed and unexposed study partici-pants, Settat, Morocco.
Populationexposée
Populationnon exposée
Valeurde p
Total % Total %
Total 116 100 99 100 –
SexeFéminin 61 52,6 50 50,5 0,76Masculin 55 47,4 49 49,5Tranches d’âge3-9 ans 14 12,1 13 13,1 0,3610-19 ans 38 32,8 19 19,220-29 ans 20 17,2 18 18,220-39 ans 7 6,0 12 12,145-49 ans 17 14,7 17 17,250-59 ans 9 7,8 8 8,160 ans et plus 11 9,5 12 12,1Utilisation de khôlAbsente 92 79,3 67 67,7 0,053Présente 24 20,7 32 32,3TabagismeNul 49 42,2 53 53,5 0,18Passif 47 40,5 26 26,3Ancien 8 6,9 8 8,1Actif 12 10,3 12 12,1ŒnolismeAbsent 112 96,6 97 98,0 0,41Présent 4 3,4 2 2,0Examen neurologiqueNormal 108 93,1 91 91,9 0,74Pathologique 8 6,9 8 8,1AnémieAbsente 91 78,4 86 86,9 0,10Présente 25 21,6 13 13,1Maladie rénalechroniqueAbsente 108 93,1 95 96,0 0,36Présente 8 6,9 4 4,0Risque osseux(hypocalcémie et/ou hypercalciurie)Absent 102 87,9 96 97,0 0,014Présent 14 12,1 3 3,0
Évaluation de l’imprégnation au plomb d’une population rurale utilisant les eaux usées à des fins agricoles dans la région de Settat au Maroc
Environnement, Risques & Santé – Vol. 9, n° 5, septembre-octobre 2010 423����������������������������
Tiré
à par
t au
teur
avec l’âge est attribuée essentiellement à un relargage du Pbaccumulé dans les os, phénomène particulièrement net chezla femme après la ménopause [32, 41]. Dans notre étude, la
plombémie des personnes de sexe masculin est plus élevée quecelles de sexe féminin ; cela a également été constaté dansplusieurs pays [29, 31-34, 39].
Le tabagisme n’a influencé ni la plombémie ni la plombiurie,dans notre étude, alors que de nombreuses études [31, 40, 41],ont observé que la plombémie est plus élevée chez les fumeurs,sans que les rôles respectifs du Pb apporté par la cigarette et par lefait de porter la main à la bouche soient clairement déterminés.
Certains facteurs influencent positivement la plombémie :c’est le cas de la consommation d’alcool [31, 39, 40], de l’appar-tenance ethnique (Noirs, Hispaniques), de la prise de fer et defolates [40] et du niveau du Pb dans l’eau de la ville [39], alorsque d’autres facteurs tels que le niveau socio-économique,le niveau de l’éducation, le niveau de l’acide folique dans lesérum [40] et l’hématocrite [39, 40], influencent inversement laplombémie.
Au Canada et aux États-Unis, les prévalences de plombémiesanormales (> 100 μg/L) varient de 4 à 5 % chez les enfants [42].Dans notre étude, chez les enfants âgés de moins de 10 ans, cetteprévalence est de 14,3 % (IC à 95 % : - 4,0 à 32,6).
Tableau 3. Répartition selon la plombémie en μg/L des per-sonnes enquêtées, au niveau des deux populations d’étude,Settat (Maroc).
Table 3. Distribution according to blood lead level in μg/L of studysubjects in the exposed and unexposed populations, Settat,Morocco.
Plombémie Population exposéeNombre : prévalence(IC 95 %)
Population non exposéeNombre : prévalence(IC 95 %)
< 50 76 : 65,5 %(56,9 % à 74,2 %)
62 : 62,6 %(53,1 % à 72,2 %)
50 à 99 31 : 26,7 %(18,7 % à 34,8 %)
36 : 36,4 %(26,9 % à 45,8 %)
≥ 100 9 : 7,8 %(2,9 % à 12,6 %)
1 : 1,0 %(-1,0 % à 3,0 %)
Total 116 99
Tableau 2. Valeurs du Pb (μg/L) dosé chez les sujets enquêtés des deux populations d’étude, Settat (Maroc).
Table 2. Blood lead levels (μg/L) assayed among exposed and unexposed study participants, Settat, Morocco.
Population exposée Population non exposée Valeur de p
Nombre Moyenne ± écart type Nombre Moyenne ± écart type
Total 116 50,4 ± 27,5 99 48,0 ± 21,8 0,44
SexeFéminin 61 47,5 ± 26,1 50 39,9 ± 17,0Masculin 55 (53,9 ± 28,8) 49 56,2 ± 23,2
p = 0,21 p = 0,0001Tranches d’âge3-9 ans 14 57,9 ± 31,8 13 51,0 ± 18,910-19 ans 38 50,4 ± 28,6 19 41,0 ± 20,220-29 ans 20 48,9 ± 28,6 18 49,4 ± 18520-39 ans 7 35,9 ± 11,9 12 37,0 ± 14,345-49 ans 17 51,8 ± 28,4 17 49 ,4 ± 21,050-59 ans 9 40,9 ± 13,4 8 53,0 ± 39,060 ans et plus 11 60,2 ± 28,7 12 58,1 ± 22,1
p = 0,47 p = 0,23Examen neurologiqueNormal 108 50,4 ± 28,0 91 48,1 ± 22,4Pathologique 8 53,7 ± 20,3 8 39,1 ± 9,7
p = 0,74 p = 0,23Maladie rénale chroniqueAbsente 108 48,5 ± 26,9 95 47,1 ± 19,7Stade 1 1 (31,2 ± – 0Stade 2 6 66,3 ± – 4 67,6 ± 53,4Stade 3 1 94,5 ± – 0
p = 0,15 p = 0,065AnémieAbsente 91 51,8 ± 28,0 86 49,6 ± 22,4Présente 25 46,3 ± 2,54 13 37,2 ± 13,7
p = 0,38 p = 0,055
S. El Kettani, et al.
Environnement, Risques & Santé – Vol. 9, n° 5, septembre-octobre 2010424����������������������������
Tiré
à par
t au
teur
Au Canada, plusieurs cas d’intoxication au plomb ont étérapportés directement avec l’utilisation de khôl chez des enfantsou des femmes enceintes. Les structures sanitaires canadiennespréconisent de n’utiliser que du khôl exempt de plomb [42].Dans notre étude, les utilisateurs de khôl ont une prévalence deplombémie anormale, plus élevée que les non-utilisateurs, maisde façon non significative. La vulnérabilité des enfants serait enrapport avec l’ingestion du khôl. En effet, les enfants ont tendanceà se frotter les yeux et à porter leurs doigts contaminés à la bouche,l’absorption intestinale du plomb étant influencée par le type dedérivé ingéré, par le contenu gastrique et par l’âge [42].
Dans notre étude, l’absence d’atteinte rénale chez les sujetsqui ont une plombémie supérieure à 100 μg/L est expliquée parle fait qu’il est admis que cette atteinte n’est pas observée chezles travailleurs exposés qui ont des concentrations sanguines
inférieures à 700 μg/L [6, 18]. Lors de l’atteinte neurologique, lesplombémies sont classiquement supérieures à 1 000 μg/L chezl’adulte et à 800 μg/L chez l’enfant. Plus récemment, des formesmineures accompagnées de troubles psychomoteurs [17, 42] ontété décrites chez l’enfant dès 150 μg/L de plombémie.
Conclusion
Au vu des valeurs guides, les résultats de cette étude sontrassurants aussi bien pour les enfants que pour les adultes.Les concentrations moyennes de Pb sanguin se situent dans l’inter-valle 0-100 μg/L. Aucune manifestation neurologique ou rénalen’a été observée chez les neuf personnes présentant des chiffressupérieurs à la normale. La prévalence de l’hyperplombémie est
Tableau 4. Prévalence (%) des cas à plombémie supérieure à 100 μg/L, au niveau de la population exposée, Settat (Maroc).
Table 4. Prévalence (%) of blood lead levels > 100 μg/L in the exposed population, Settat, Morocco.
Population exposée
Nombre Prévalence (%) Intervalle de confiance à 95 % Valeur de p
Total 9 7,8 2,9 à 12,6 –
SexeFéminin 6 9,8 2,4 à 17,3 0,378Masculin 3 5,5 - 0,5 à 11,5Tranches d’âge3-9 ans 2 14,3 - 4,0 à 32,6 0,80110-19 ans 2 5,3 - 1,8 à 12,420-29 ans 2 10,0 - 3,1 à 23,130-39 ans 0 0 –
40-49 ans 2 11,8 - 3,6 à 27,150-59 ans 0 0 –
60 ans et plus 1 9,1 - 7,9 à 26,1Utilisation de khôlNon 5 5,4 0,8 à 10,1 0,067Oui 4 16,7 1,8 à 31,6TabagismeNul 6 12,2 3,1 à 21,4 0,413Passif 2 4,3 - 1,5 à 10,0Ancien 0 0 –
Actif 1 8,3 - 7,3 à 24,0ŒnolismeAbsent 9 8,0 3,0 à 13,1 0,555Présent 0 0 –
Examen neurologiqueNormal 9 8,3 3,1 à 13,5 0,395Pathologique 0 0 –
AnémieAbsente 8 8,8 3,0 à 14,6 0,428Présente 1 4,0 - 3,7 à 11,7Maladie rénale chroniqueAbsente 8 7,4 2,5 à 12,3 0,603Présente 1 12,5 - 10,4 à 35,4Risque osseuxAbsent 7 6,9 2,0 à 11,8 0,330Présent 2 14,3 - 4,0 à 32,6
Évaluation de l’imprégnation au plomb d’une population rurale utilisant les eaux usées à des fins agricoles dans la région de Settat au Maroc
Environnement, Risques & Santé – Vol. 9, n° 5, septembre-octobre 2010 425����������������������������
Tiré
à par
t au
teur
de 7,8 % pour la PE et de 1,0 % pour la PNE (différence significa-tive : p = 0,017). Ces plombémies anormales sont légèrement plusfréquentes chez les utilisateurs de khôl, mais elles ne s’accompa-gnent ni de troubles neurologiques, ni d’anémie, ni d’atteinterénale, ni de risque osseux. Nous ne pouvons incriminer formelle-ment l’utilisation des eaux usées brutes en agriculture dans cetteaugmentation relative. Il est impératif de rester vigilant, d’instaurerune surveillance régulière et de traiter efficacement les eaux uséesavant leur rejet dans les milieux récepteurs, a fortiori si leur utilisa-tion agricole est envisagée. Une sensibilisation vis-à-vis d’unebonne utilisation de khôl exempt de plomb doit également avoirlieu à l’échelle nationale. ■
Remerciements et autres mentionsCe travail a été réalisé dans le cadre du projet « Écosystème
et santé humaine CRDI/Inra n° 10 0771-0004 ». Il est subven-tionné par le Centre de recherches pour le développement inter-national (CRDI), Ottawa, Canada et la fondation Ford, États-Unis.Nous tenons à remercier la délégation du ministère de la Santéde Settat et le Centre Antipoison, Maroc, pour leur aide logis-tique, ainsi que le laboratoire de toxicologie d’Angers, France,pour la qualité des analyses toxicologiques, de même que toutesles personnes qui ont contribué à cette enquête.
Financement : aucun ; conflits d’intérêts : aucun.
Références
1. FAO. L’irrigation avec des eaux usées traitées. Manuel d’utilisa-tion. Rome : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation etl’Agriculture, 2003.
2. Jemali A, Kefati A. Réutilisation des eaux usées au Maroc. Forumsur la gestion de la demande en eau. Rabat : ministère de l’Agricul-ture, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Administrationdu génie rural; direction du Développement et de la Gestion d’Irri-gation, 2002.
3. El Kettani S, Aichane A, Azzouzi EM. Prévalence de l’asthme chezune population rurale utilisant les eaux usées en agriculture, Settat,Maroc. Lebanese Science Journal 2008 ; 9 : 3-6.
4. El Kettani S, Azzouzi EM. Prévalence de l’anemie chez une popu-lation rurale utilisant les eaux usées à des fins agricoles (Settat,Maroc). Biomatec Echo 2009 ; 3 : 31-8.
5. EL Kettani S. Azzouzi EM. Prévalence des helminthes au seind’une population rurale utilisant les eaux usées à des fins agricolesà Settat (Maroc). Environ Risque Sante 2006 ; 5 : 99-106.
6. El Kettani S, Azzouzi E.M, Benganem M, Soulami K. Prévalencede la maladie renale chronique chez une population rurale utilisantles eaux usées en agriculture à Settat-Maroc. Médecine du Maghreb2007, (151) : 17-24.
7. El Kettani S, Azzouzi EM, Boukachabine K, El Yamani M, MaataA, Rajaoui M. Intestinal parasitosis and use of untreated wastewaterfor agriculture in Settat, Morocco. Eastern Mediterranean HealthJournal 2008 ; 14 : 1435.
8. El Kettani S, Azzouzi EL M, Maata A. Effet de l’utilisation des eauxusées en agriculture sur le metabolisme phosphocalcique chezl’adulte, Settat (Maroc). Journal Marocain des Sciences Médicales2006; Tome XV; N° 4 :15-21
Tableau 5. Régression logistique avec SPSS 10.
Table 5. Logistic regression with SPSS 10.
Variables indépendantes Coefficient β Écart type de β Wald p
Modèle initialConstante -14,1678 53,5577 0,0700 0,7914Tranches d’âge (< 30 versus ≥3 0 ans) 1,4695 1,0157 2,0931 0,1480Sexe (F versusM) 0,2940 0,9553 0,0947 0,7583Tabagisme (actif versus nul, passif et actif) -1,9142 1,5524 1,5205 0,2175Alcool 6,9486 43,1633 0,0259 0,8721Khôl -1,8552 0,9755 3,6167 0,0572Examen neurologique 6,8389 31,6860 0,0466 0,8291MRC -1,0521 1,4130 0,5545 0,4565Risque osseux -,1059 0,9640 0,0121 0,9125Anémie 1,1281 1,1903 0,8983 0,3432Modèle finalConstante -1,6094 0,5477 8,6343 0,0033Khôl -1,2470 0,7152 3,0403 0,0812
Methode Regression binary logistic (Enter) : les résultats sont identiques à la méthode (Backward : LR) ; les valeurs de Exp (B) et 95% CI Lower for Exp(B) Upper sont disponibles dans le fichier SPSS.MRC : maladie rénale chronique.Binary logistic regression method (Enter) results are identical to those of the backward stepwise method (LR) (the values of (Exp (B) and the upper and lowest95% CI are available on the SPSS file).MRC: chronic kidney disease.
S. El Kettani, et al.
Environnement, Risques & Santé – Vol. 9, n° 5, septembre-octobre 2010426����������������������������
Tiré
à par
t au
teur
9. El Kettani S, Azzouzi EM, Maata A. Prévalence de giardia intesti-nalis chez une population rurale utilisant les eaux usées à des finsagricoles à Settat, Maroc. Médecine et Maladies Infectieuses 2006 ;36 : 322-8.10. Glouib K, Charaf B, El Kettani S, Hilali A. Induction des micro-noyaux et indice de la prolifération cellulaire chez la population desMzamza exposée aux eaux usées. Reviews in Biology and Biotech-nology 2006 ; 5 : 31-6.11. Garnier R. Toxicité du plomb et de ses dérivés. Encycl Méd ChirToxicologie-Pathologie professionnelle, 16-007-A-10. Paris : Elsevier,2005.12. Goullé JP. Métaux (Plomb). In : Kintz P, ed. Toxicologie et phar-macologie médicales. Collection Option Bio. Paris : Elsevier Science,1998.13. Ineris. Plomb et ses dérivés. Fiche de données toxicologiques etenvironnementales des substances chimiques. ERIS-DRC-01-25590-ETS-Api/SD-N°00df257.doc. Verneuil-en-Halatte : Ineris, 2003.14. Galacteros F. Méthémoglobinémies et sulfhémoglobinémies. In :Dreyfus B, Breton-Gorius J, Reyes F, Rochant H, Vernant JP, eds.Hématologie. Paris : Flammarion Médecine-Sciences, 1984.15. Benz EJ. Hémoglobinopathies. In : Braunwald E, Fauci A, KasperDL, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL, eds. Harrison, Principes deMédecine Interne. 15e édition. Paris : Flammarion Médecine-Sciences, 2000.16. Todd AC, Wetmur JG, Moline JM, Godbold JH, Levin SM, Lan-drigan PJ. Environmental Health Issues. Environ Health Perspect1996 ; 104(Suppl 1): 00-0017. Baghurst PA, McMichael AJ, Wigg NR, et al. Environmentalexposure to lead and children’s intelligence at the age of sevenyears. The Port Pirie Cohort Study. N Engl J Med 1992 ; 327 :1279-84.18. Roels HA. Controlling the risk of nephrotoxicity in men occupa-tionally exposed to inorganic mercury, lead, or cadmium throughmonitoring biomarkers of exposure. Archives Of Public Health2002 ; 60 : 3-4.19. Kholtei S, Bouzidi A, Bonini M, et al. Contamination des eauxsouterraines de la plaine de Berrechid dans la région de la Chaouia,au Maroc, par des métaux lourds présents dans les eaux usées : Effetde la pluviométrie. Vecteur Environnement 2003 ; 36 : 68-81.20. WHO. Guidelines for drinking-water quality. Geneva : WHO,2004.21. Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé(Anaes). Diagnostic de l’insuffisance rénale chronique chez l’adulte.Paris : Anaes, 2002.22. Baumelou A, Sy M, Izzedine H. Cockcroft ou MDRD : quelleformule choisir ? Séminaires d’uro-néphrologie de La pitié Salpe-trière, janvier 2006.23. Dao HH, Morcau P, Adam A. Métabolisme phosphocalcique. In:Adam A, et al. L’essentiel sur la biologie clinique et la pharmacothé-rapie. Montréal : Edisem ; Maloine, 2003.24. Benchekroun S. L’anémie définition, généralités, classificationphysiopathologique. Espérance Médicale 2000 ; 59 : 117-22.25. Falissard B. Comprendre et utiliser les statistiques dans les scien-ces de la vie. 2e édition. Paris : Masson, 2001.26. Khassouani CE, Allain P, Soulaymani R. Étude de l’imprégnationsaturnine des habitants des la région de Rabat (Maroc). La PresseMédicale 1997 ; 36 : 1714-6.
27. Rosen JF. Adverse health effects of lead at low exposure levels:trends in the management of childhood lead poisoning. Toxicology1995 ; 97 : 11-7.28. Ewers U, Krause C, Wilhelm M. Reference values and humanbiological monitoring values for environmental toxins. Int ArchOccup Environ Health 1999 ; 72 : 255-60.29. Becker K, Kaus S, Krause C, et al. German environmental survey1998 (GerES III) : Environmental polluants in blood of German popu-lation. Int J Hyg Environ Health 2002 ; 205 : 297-308.30. Sedki A. Étude ecotoxicologique et épidémiologique de la conta-mination métallique de deux chaînes trophiques terrestres dans lapalmeraie périurbaine de la zone d’épandage des eaux usées de laville de Marrakech. Thèse, université Cadi Ayyad, faculté des scien-ces Semlalia, Marrakech, Maroc, 1995.31. Alimonti A, Bocca B, Mannella E, et al. Assessment of referencevalues for selected elements in a healthy urban population. Ann IstSuper Sanità 2005 ; 41 : 181-7.32. Mauras Y, Le Bouil A, Allain P, Mariotte N, Tichet J, Autret E.Étude de la plombémie dans une population de 616 sujets desrégions Centre et Pays de Loire. Presse Med 1995 ; 24 : 1639-41.33. Benes B, Spevackova V, Šmid J, et al. The concentration levels ofCd, Pb, Hg, Cu, Zn and Se in blood of the population in the CzechRepublic. Cent Eur J Publ Health 2000 ; 8 : 117-20.34. Needham LL, Barr DB, Caudill SP, et al. Concentrations of Envi-ronmental Chemicals Associated with Neurodevelopmental Effectsin U.S. Population. Neurotoxicology 2005 ; 26 : 531-45.35. Bono R, Pignata C, Scursatone E, et al. Updating about reduc-tions of air and blood lead concentrations in Turin, Italy, followingreductions in the lead content of gasoline. Environ Res 1995 ; 70 :30-4.36. Strömberg U, Lundh T, Schütz A, Skerfving S. Yearly measure-ments of blood lead in Swedish children since 1978: an update focu-sing on the petrol lead free period 1995–2001. Occupat EnvironMedicine 2003 ; 60 : 370-2.37. Wietlisbach V, Rickenbach M, Berode M, Guillemin M. Timetrend and determinants of blood lead levels in a Swiss populationover a transition period (1984-1993) from leaded to unleaded gaso-line use. Environ Res 1995 ; 68 : 82-90.38. Schuhmacher M, Belles M, Rico A, Domingo JL, Corbella J.Impact of reduction of lead in gasoline on the blood and hair leadlevel in the population of Tarragona Province, Spain, 1990-1995. SciTotal Environ 1996 ; 184 : 203-9.39. Wilhelm M, Ewers U, Schulz C. Revised and new referencevalues of some trace elements in blood and urine for human biomo-nitoring in environmental medicine. J Hyg Environ Health 2004 ;207 : 69-73.40. Lee MG, Chun OK, Song WO. Determinants of the Blood LeadLevel of US Women of Reproductive Age. J Am Coll Nutr 2005 ; 24 :1-9.41. Symanski E, Hertz-Picciotto I. Blood lead levels in relation tomenopause, smoking, and pregnancy history. Am J Epidemiol1995 ; 141 : 1047-58.42. Brisson S, Kossowski A. Le khôl, un cosmétique responsabled’intoxications au plomb. Institut national de santé publique duQuébec 2006 ; 17 : 1-7.
Évaluation de l’imprégnation au plomb d’une population rurale utilisant les eaux usées à des fins agricoles dans la région de Settat au Maroc
Environnement, Risques & Santé – Vol. 9, n° 5, septembre-octobre 2010 427����������������������������
Tiré
à par
t au
teur