Etude d'Ezéchiel 18. 1-4, 20-32: une réflexion sur la faute des pères et ses implications pour...
Transcript of Etude d'Ezéchiel 18. 1-4, 20-32: une réflexion sur la faute des pères et ses implications pour...
1
INTRODUCTION GENERALE
Dans cette introduction générale, nous traiterons de la motivation du sujet, de la
justification du choix du texte d’Ezéchiel 18. 1-4, 20-32, de la problématique, de
l’hypothèse, de l’approche méthodologique et de la structure du travail.
1. Motivation du sujet
Le sujet que nous nous proposons de traiter s’intitule : « Etude exégétique
d’Ezéchiel 18. 1-4, 20-32 : une réflexion sur la faute des pères et ses implications
théologiques pour l’Eglise aujourd’hui ».
Deux raisons essentielles ont motivé le choix de ce sujet :
La première réside dans le constat que nous avons fait à partir de certaines
prières prononcées par des chrétiens en Côte d’Ivoire, au cours de séances
d’exorcisme. Dans ces prières, il a été souvent question de confesser les fautes des
ascendants, car, semble-t-il, ce pourrait être les sources des difficultés que
rencontrent les descendants. Les exorcistes préconisent souvent comme solution
définitive aux malheurs engendrés par les fautes présumées des ascendants, la
« rupture » totale d’un certain « cordon ombilical spirituel ». En effet, tout comme le
2
cordon ombilical physique, par lequel le sang et les éléments nutritifs sont véhiculés
de la mère au fœtus, « le cordon ombilical spirituel » serait le moyen par lequel la
malédiction passe des ascendants aux descendants. La rupture de ce dernier, est
donc synonyme de rupture entre l’individu et ses ascendants familiaux1.
Pour plusieurs adeptes de cette pratique religieuse, la rupture du « cordon
ombilical spirituel » n’est pas que spirituelle, elle doit, en effet, se concrétiser, s’il le
faut, par la rupture des relations avec son père ou sa mère ou l’ensemble de la
famille.
Plusieurs textes bibliques sont cités pour justifier cette croyance ; notamment,
Ex 20. 5-6 ; 34. 7 ; Lv 26. 39 et Nb 14. 33. Notons que, la lecture de ces textes révèle
très clairement l’influence du père sur ses descendants, en bien comme en mal, de
sorte que plusieurs chrétiens restent convaincus que, s’ils ont des difficultés de tous
ordres, c’est bien à cause des péchés commis par leurs ascendants.
La deuxième raison qui a motivé le choix de ce sujet est la découverte du
texte d’Ez 18 et de bien d’autres, tels que : Dt 24. 16 ; 2 R 14. 5-6 et Jer 31. 29-30
qui révèlent une autre thèse, qui semble prendre le contre pied de la précédente. En
effet, contrairement aux textes d’Ex 20. 5-6 ; 34. 7 ; Lv 26. 39 et de Nb 14. 33, qui
énoncent la loi de la responsabilité collective, les textes du Dt 24. 16 ; de 2 R 14. 6 ;
de Jer 31. 29-30 et d’Ez 18, eux, exposent la loi de la responsabilité individuelle.
Dorénavant, il n’est plus question que des descendants subissent les conséquences
des péchés de leurs ascendants, et même, qu’ils profitent des bonnes conduites de
ceux-ci.
1 Zacharie A,. ADETOLA, Les origines, couper le cordon ombilical, Abidjan : Mission Ephrata, 2000, p. 10.
Selon ADETOLA, il faut retourner à nos origines afin de nous affranchir de tout ce qui n’est pas à la gloire de
Dieu dans notre vie et qui provient de nos parents, de nos ancêtres, et dont nous avons hérité par le sang dès
notre conception. Il faut connaitre les parents et aussi s’enquérir des implications surnaturelles qui ont
conditionné l’avènement de l’enfant.
3
Nous avions souligné dans les précédentes lignes que plusieurs textes de
l’Ancien Testament révèlent la loi de la responsabilité individuelle, et ils méritent tous
une attention particulière. Mais, le faire dans ce travail, serait comparable à une
aventure dans des généralités. Il fallait donc opérer un choix.
2. Justification du choix du texte d’Ezéchiel 18. 1-4, 20-32
Le choix d’Ez 18. 1-4, 20-32 repose sur le fait qu’Ezéchiel s’adresse au peuple
d’Israël dans un contexte de crise ; où les contemporains du prophète prétendaient
avoir été punis2, à cause du péché des générations précédentes3. Ezéchiel déclare
que Dieu n’agit pas de cette façon-là, mais qu’il tient chaque individu pour
responsable de ses actions. Ceci dit, Ezéchiel, par une argumentation juridique et
casuistique va déconstruire la thèse entretenue par le proverbe4 : « Les pères ont
mangé du raisin vert et les dents des fils ont été agacées » (Ez 18. 2). Et, ensuite, il
va établir nettement la responsabilité individuelle selon laquelle chacun est
responsable de ses propres délits comme il l’est de ses « mérites ». Il n’y a donc
d’héritage ni pour le bien ni pour le mal5.
Le texte d’Ezéchiel présente donc un contenu plus détaillé, avec exemple à
l’appui, de la nouvelle ordonnance. Cela nous donne une plus nette compréhension
de celle-ci. Il est cependant important de noter que c’est avec Jérémie (Jer 31. 30)
que la notion de responsabilité individuelle pénètre l’enseignement prophétique6.
2 L’époque d’Ezéchiel a été particulièrement dure. Les institutions ont disparu dans la tourmente de la chute de
Jérusalem : plus de royauté, plus de temple ni de culte, plus de terre. Dans ces moments aussi dramatiques, surgit
une question : A qui la faute ? 3 D. GUTHRIE et al (sous dir.), Nouveau commentaire biblique, Saint-Légier : EMMAÜS, 1991, p 702
4 Luc-Olivier BOSSET, « Ezéchiel 18, 1-4.20-32 : les pères ont mangé du raisin vert…, » in lire et dire n°46,
2000, p. 15 5 Jésus-Maria ASURMENDI, Le prophète Ezéchiel, Paris : Cerf (cahiers Evangile), 1981, p 40
6 Note de la TOB sur Ezéchiel 18. 4, Paris/Villiers-Le-Bel : Cerf/SBF, 2007, p. 1070
4
Pour ce faire, dans le présent travail, nous prendrons en compte les textes qui nous
aiderons à clarifier le sujet.
La nouvelle ordonnance concernant le rapport entre descendant et ascendant
annoncée par Ezéchiel, et qui semble confronter l’idée de responsabilité collective,
soulève des questions qu’il convient de relever ici.
3. Problématique
Selon Jésus-Maria ASURMENDI, le peuple d’Israël conçoit le groupe comme une
entité réelle qui prend forme en chacun de ses membres7, y compris, en ceux qui
sont à venir8. Ainsi, la communauté est ressentie comme un « tout » physique. Cette
vision de la vie communautaire, énonce, non seulement le rapport de l’individu à la
communauté (rapport qui s’étend à tous les aspects de la vie)9 mais aussi, elle fait
comprendre la solidarité qui lie l’individu à la communauté aussi bien dans la
bénédiction que dans la malédiction.
Si telle est la conception que le peuple d’Israël a de la notion de « personnalité
corporative »10, alors certaines questions méritent d’être posées.
La première est la suivante : la responsabilité individuelle annoncée par
Ezéchiel brise-t-elle la solidarité entre les générations ? Dans le cas contraire, quelle
sorte de relation Ezéchiel établit-il entre responsabilité personnelle et responsabilité
collective ?
7 Jésus-Maria ASURMENDI, Le prophète Ezéchiel, Paris : Cerf (cahiers Evangile), 1981, p 40
8Ibid. Pour les Israélites, en effet, « l’ancêtre porte en lui tous les descendants futurs. Ainsi, l’alliance conclue
avec Noé concerne Noé avec ses fils et ses descendants : « Voici l’alliance que je conclus avec vous et avec vos
descendants après vous… » (Gn 9 : 9 ; cf. Gn 12 : 2, 17 : 7s). La formule « toi et tes descendants » est
caractéristique de cette conception, dans l’A.T, de la solidarité entre le premier ancêtre et ses descendants (cf. Gn
26 : 3 ; 28 : 3 ; 32 : 13). » 9 Ibid.
10 Ibid. p.39
5
La seconde question est : les descendants payent-ils pour les fautes de leurs
ascendants familiaux ? Ou les descendants héritent-ils des fautes et châtiments de
leurs ascendants ?
Et la troisième question, enfin : quelles implications le principe de
responsabilité personnelle met-il en exergue pour les descendants, vis-à-vis de leurs
ascendants ?
Nous croyons que les réponses à ces quelques questions seront d’une aide
appréciable pour les chrétiens d’Afrique en général, et pour ceux de Côte d’Ivoire en
particulier.
4. Hypothèse de travail
L’hypothèse que nous chercherons à vérifier dans la présente étude est la
suivante : Il est vrai que l’influence des ascendants sur leurs descendants est
normale, structurante, pesante parfois, mais ce n’est pas elle qui doit conditionner
l’agir de ces derniers11. Les enfants ne sont pas condamnés à répéter les fautes des
parents et subir les conséquences de ces fautes, car il n’y a pas d’hérédité spirituelle
des fautes et des châtiments12. Les enfants, en effet, sont avant tout créatures de
Dieu avant d’être engendrés des parents. Ils sont donc individuellement
responsables devant Dieu. De ce fait, quiconque se converti au Seigneur ne mourra
point, parce que, non seulement il sera déchargé des fautes de ses parents, mais il
sera aussi libéré de son propre passé. Toutefois, quand même les descendants
souffriraient des conséquences des erreurs des ascendants, sans en être eux-
mêmes coupables, Dieu offre la possibilité d’une vie meilleure.
11
Ibid. 12
L’hérédité spirituelle des fautes et des châtiments signifierait que les parents transmettent spirituellement et de
façon automatique leurs fautes et les conséquences de ses fautes à leurs enfants dès la naissance. Ce
qu’impliquerait qu’il n’y ait aucune possibilité pour les enfants de vivre autrement.
6
Pour permettre aux lecteurs de nous suivre dans notre argumentation, nous
prenons le soin maintenant d’indiquer notre démarche méthodologique.
5. Approche méthodologique et structure du travail
Dans cette étude, nous opterons, parmi tant d’autres méthodes, pour l’exégèse
d’Ez 18. 1-4, 20-32 selon l’approche grammatico-historique. Ainsi, nous articulerons
notre travail selon trois axes de réflexion :
Le premier axe aura trait aux questions d’introduction au livre d’Ezéchiel et à
celles relatives au texte d’Ez 18. 1-4, 20-32 ;
Le deuxième, fera l’exégèse du texte d’Ez 18. 1-4, 20-32 ;
Et dans le troisième axe, nous tenterons de dégager les implications théologiques
des résultats de l’exégèse, pour le chrétien aujourd’hui.
Soulignons que ce travail n’aura aucunement la prétention d’épuiser le sujet
que nous nous proposons d’étudier. Il se veut plutôt une modeste contribution dans
le champ de l’exégèse biblique.
7
CHAPITRE PREMIER :
QUESTIONS D’INTRODUCTION AU LIVRE D’EZECHIEL ET AU TEXTE
D’EZECHIEL 18. 1-4, 20-32
L’objectif de ce chapitre est de poser les bases du commentaire exégétique
qui occupera le chapitre 2. Il traitera par conséquent des questions relatives au livre
d’Ezéchiel, c’est-à-dire les questions d’auteur, d’authenticité et de datation, du
contexte historique, de la structure et des genres littéraires. Il proposera également
l’établissement et la traduction du texte d’Ez 18. 1-4, 20-32
1.1. QUESTIONS D’INTRODUCTION AU LIVRE D’EZECHIEL
1.1.1 Auteur
A des exceptions près (Ez 1.3 et 24.24), l’ensemble du livre d’Ezéchiel est
rédigé à la première personne du singulier, et se présente comme l’œuvre du
8
prophète Ezéchiel13, dont le nom hébreu «yüHezqë´l »14 signifie probablement
« Dieu fortifie »15.
Fils de Buzi, il était d’une famille sacerdotale (Ez 1.3) qui, elle-même, était
issue de la lignée de Tsadoq (cf. 40.46 ; 43.19 ; 44.15-16 ; 1R 2.35), laquelle
remontait à Eléazar, fils d’Aaron, la branche légitime dont le souverain sacrificateur
était issu16. La filiation d’Ezéchiel a donc fait de lui un membre de la noblesse
religieuse, ce qui expliquerait sa présence parmi les exilés de 597 av. J.-C.17 ; alors
que Jérémie, de la lignée d’Itamar, c’est-à-dire des couches moyennes et inférieures
du sacerdoce, était resté à Jérusalem18.
Nous ne savons rien de sa naissance ni de sa mort, mais selon Tidiman, si la
« trentième année » indiquée par le verset 1 du chapitre premier est celle du
prophète lui-même19, cela supposerait qu’il soit né vers 622, donc à l’apogée de la
réforme du roi Josias20.
Ezéchiel a vécu en exil. Il fut installé dans un centre communautaire près de
Nippur appelé Tel-Aviv21, sur le « Grand Canal »22. Et c’est là, au milieu des déportés
13
Christophe, NIHAN, « Ezéchiel », in Introduction à l’Ancien Testament, Genève : Labor et Fides, 2004, pp.
359 14
La forme Ezéchiel est celle de la Vulgate, tandis que le grec présente une leçon intermédiaire : Yézékiel
(Iezekihl) 15
Gleason L., ARCHER, Introduction à l’Ancien Testament, Saint-Légier : EMMAÜS, 1991, p. 410 16
Brian, TIDIMAN, Le livre d’Ezéchiel, tome 1, Vaux-sur-Seine : EDIFAC, 1985, p.19 17
Ibid. En 597 av. J.-C., le souverain Babylonien, Nébucadnetsar, déporte à Babylone Yoyakîn, roi de Juda, et
avec lui, l’élite de l’armée, un bon nombre de prêtres et d’artisans ; aux nombres desquels faisait partie Ezéchiel. 18
Ibid. 19
Des auteurs tels que Gleason Archer et Jésus ASURMENDI adoptent la position que l’indication de 1.1 serait
l’âge du prophète Ezéchiel. En effet, c’est à trente ans que les Lévites, selon Nombres 4.3 commençaient leur
ministère. 20
Brian, TIDIMAN, Le livre d’Ezéchiel, tome 1, op.cit. p.20. cette réforme du roi Josias était marquée par le
retour à la Loi mosaïque et aux valeurs que celle-ci incarnait. 21
A ne pas confondre avec la ville israélienne de notre siècle. Le nom de cette ville paraissait signifiée « colline
des épis ». Cette localité non identifiée se trouvait à proximité du Kebar (1.1 ; 3.15), que l’on rapprochait
autrefois du Habor de 2R 17.6, lieu d’exil d’Ephraïm en Mésopotamie septentrionale. Aujourd’hui, on y voit
plutôt le nâr kabaru (Ez : nehar Kebàr), l’un des nombreux canaux d’irrigation de Babylone, qui passe pour être
le grand canal reliant la ville de Nippur à l’Euphrate. 22
Gleason L., ARCHER, Introduction à l’Ancien Testament, op.cit. Ce canal, le Naru Kabari, ainsi nommé sur
les inscriptions cunéiformes, part de l’Euphrate, en amont de Babylone, et coule vers le sud-est, en direction de
Nippur, sur environ cent kilomètres ; il rejoint l’Euphrate en aval d’Ur, irriguant la plaine alluviale entre ce
dernier fleuve et le tigre.
9
de Juda qu’Ezéchiel reçu son appel prophétique. Ezéchiel est né prêtre, mais il est
devenu prophète23.
Son activité prophétique s’étend, selon les dates données par son livre, entre
593 (1.1-2) et 571 (29.17) av. J.-C24. Cette période est l’une des plus tragiques de
toute l’histoire d’Israël. En effet, elle verra disparaître non seulement les institutions,
mais aussi le royaume de Juda25. Ezéchiel vécut intensément ces événements26,
mais il était chargé d’accomplir une mission.
1.1.1.1. Sa mission
Appelé au ministère prophétique quelques années avant la destruction de
Jérusalem en 587 av. J.-C.27, Ezéchiel fut chargé d’une mission à trois volets.
Premièrement, sa tâche consistait à démontrer que la terre promise et le
sanctuaire de Yahvé seraient enlevés aux Israélites à cause de leurs péchés passés
et présents28. Deuxièmement, il était invité à prêcher que ce jugement inéluctable
devait engendrer chez les exilés, un acte de repentance individuel et non le fatalisme
ou le défaitisme. Troisièmement, enfin, Ezéchiel devait ouvrir les yeux des exilés sur
le fait que, malgré leur situation qui semble sans espoir, il y avait un avenir pour le
peuple porteur des promesses de Dieu29. Cet avenir, affirmait Ezéchiel, devait
23
L., MONLOUBOU, Un prêtre devient prophète : Ezéchiel, Paris : Cerf, Lectio Divina, n° 73, 1972, p.39 24
Jésus-Maria, ASURMENDI, Le prophète Ezéchiel, Paris : Cahier Evangile, n° 38, 1981, p. 6 25
Jésus, ASURMENDI, S. AMSLER, al, Les prophètes et les livres prophétiques, Paris : Desclée, 1985, p. 199 26
Ezéchiel a vécu dans sa propre chair la ruine de son peuple. Ezéchiel perd sa femme « la joie de ses yeux »
(24.15-25), et Dieu lui demande de ne pas prendre de deuil, mais de souffrir en silence. Ainsi, les exilés vont être
privés de ce qui est le plus précieux à leurs yeux : le temple, la ville sainte. Le jour de la chute de Jérusalem, le
Seigneur met Ezéchiel dans l’incapacité de bouger et de parler (3. 25-26a). Il restera ainsi jusqu’au jour où un
rescapé du désastre de Jérusalem arrive en Babylonie pour annoncer aux exilés que la ville est tombée aux mains
des Babyloniens. Tiré de Jésus-Maria, ASURMENDI, Le prophète Ezéchiel, op.cit. p. 44 27
Brian, TIDIMAN, Le livre d’Ezéchiel, tome 1, op.cit. p.27 28
Ibid. 29
Cette espérance est annoncée à la fois avant et après la destruction de Jérusalem : 11.15-21 ; 20.40-44 ; 28.25-
26 ; 34.11-16 ; 36.24 ; 37.12-14.
10
prendre la forme d’une restauration, précédée de la purification des élus et leur
libération de tout penchant pour l’idolâtrie (20.30-38)30.
Ce message de jugement et de restauration, fut le plus souvent communiqué
par Ezéchiel à travers ou associé à des phénomènes, tels que les mimes, les gestes
symboliques et les expériences extatiques. Ces phénomènes vont conduire certains
auteurs, des psychanalystes y compris, à voir en Ezéchiel un homme mentalement
déséquilibré31.
1.1.1.2. Sa personnalité
Ezéchiel était-il un homme anormal qui aurait présenté des signes de
déséquilibre mental ? Cette question a préoccupé plus d’un et donné naissance à
plusieurs hypothèses.
E. C. Broome, à partir des trois premiers chapitres d’Ezéchiel, va
diagnostiquer une catatonie32, c’est-à-dire une manifestation particulière de la
schizophrénie33. Hœlscher, lui, verra dans le mutisme d’Ezéchiel une catalepsie, ou
syndrome caractérisé par la perte momentanée de la contractilité volontaire des
muscles. Pour D. J. Halperin, Ezéchiel aurait été affecté d’un cas plus sévère d’une
pathologie qui serait commune aux exilés34.
Il est vrai que les expériences ou les phénomènes qui accompagnent les
messages d’Ezéchiel laissent perplexe tout lecteur, mais rien ne permet de justifier
l’assertion d’un déséquilibre mental. Howie posera d’ailleurs la question suivante aux
30
Brian, TIDIMAN, Le livre d’Ezéchiel, tome 1, op.cit. p.27 31
Joseph, BLENKINSOPP, Une histoire de la prophétie en Israël, Paris : Cerf, Lectio Divina, n°152, 1993,
p.234 32
Brian, TIDIMAN, Le livre d’Ezéchiel, tome 1, op.cit. p.23 33
Cette maladie est une psychose chronique qui est caractérisée par un manque d’expression dans le visage, un
ralentissement de la parole, un trouble de l’association des idées, la tendance à s’opposer automatiquement à
tout, la répétition indéfinie des mots, l’impulsivité. 34
Daniel I., BLOCK, The book of Ezekiel, chapters 1-24, Grand Rapids: Eerdmans B., NICOT, 1997, p. 11
11
auteurs de l’examen psychiatrique d’Ezéchiel : comment peut-on psychanalyser un
homme mort depuis 2500 ans ?35 Les positions de ces praticiens restent donc des
conjectures.
Notons que les étranges actions d’Ezéchiel suivent souvent l’expression « la
main de Seigneur fut sur moi » (1.3 ; 3.22 ; 37.1). Cela peut signifier de toute
évidence que cet état d’esprit est inhabituel au prophète36. Quand l’Esprit de Dieu
vient sur Ezéchiel, il tombe sur sa face (1.28 ; 9.8 ; 11.13 ; 43.3 ; 44.4), un
tremblement le saisit (12.17ss), et son message s’accompagne de gémissements ou
de soupirs (21. 11)37. Ainsi, loin d’être des symptômes d’une certaine pathologie, les
représentations dramatiques sont des moyens que Dieu utilise pour expliquer, pour
rendre vivant et plus saisissant son message.
1.1.2. Authenticité et datation du livre d’Ezéchiel
1.1.2.1 Authenticité
Avant le début du 20e siècle, la quasi-totalité des critiques rationalistes38
admettaient l’authenticité du livre d’Ezéchiel39. R. Smend, l’une des voix qui
soutenaient cette position dite classique, va déclarer qu’on ne pourrait ôter aucune
partie du livre d’Ezéchiel, sans mettre à mal toute la construction40. G. B. Gray dira
35
Ibid. 36
John, JOB, Une sentinelle à Babylone, une étude du livre d’Ezéchiel, Paris : SATOR, 1985, p. 4 37
Ibid. 38
Abstraction faite du philosophe hollandais Spinoza qui, au 17e siècle, voulu détacher les chap. 40-48 comme
étant inauthentiques. 39
Gleason L., ARCHER, Introduction à l’Ancien Testament, op.cit. p. 411 40
Brian, TIDIMAN, Le livre d’Ezéchiel, tome 1, op.cit. p.43
12
pour sa part qu’« aucun livre de l’Ancien Testament ne se distingue autant que le
sien par des remarques aussi décisives d’unité d’auteur et d’intégrité »41.
Mais, en 1924, Gustav Hœlscher émit la thèse qu’un dixième seulement du
texte serait d’Ezéchiel42 ; le reste serait l’œuvre d’un auteur postérieur, vivant à
Jérusalem et contemporain de Néhémie (440-430 av. J.-C.)43. Six ans plus tard, C.
C. Torrey soutiendra que le livre ne pouvait pas être daté du temps d’Ezéchiel, c’est-
à-dire le 6e siècle av. J.-C44. Il croit plutôt que le livre d’Ezéchiel est un
pseudépigraphe écrit à Jérusalem et qui daterait de 230 av. J.-C45. Seinecke, aura
une position plus radicale que Torrey ; pour lui, le livre aurait été compilé durant la
période maccabéenne46.
En 1932, Hentrich, lui, remettra en cause le lieu d’activité d’Ezéchiel : le
prophète ne serait jamais allé à Babylone47. Messel, en 1945, contrairement à
Hentrich, affirmera qu’Ezéchiel s’adresse bien à des exilés, mais que ceux-ci sont
déjà de retour à Jérusalem vers l’an 40048.
Archer voit deux raisons principales qui auraient conduit ces critiques à
formuler ces différentes thèses. Premièrement, ceux-ci n’admettent pas qu’Ezéchiel
ait prophétisé à la fois la ruine d’Israël et la promesse d’une restauration future49.
Pour eux, en effet, Ezéchiel a été un prédicateur de malheur uniquement et il n’avait
donné aucune lueur d’espoir au peuple en exil. Et pourtant, la quasi-totalité des
prophètes vétérotestamentaires qui ont annoncé la ruine, ont aussi prédit une
41
G. B. GRAY cité par A. GELIN, « Les prophètes de l’époque exilique, Ezéchiel », in A. ROBERT et A.
FEUILLET, sous dir, Introduction à la Bible, tome 1, 2e édition revue et corrigé, Tournai : Desclée & Cie, 1959,
p. 535 42
A. KUEN, sous dir, Nouveau Dictionnaire Biblique révisé et augmenté, Saint-Légier : EMMAÜS, 1992, p.
478 43
Gleason L., ARCHER, Introduction à l’Ancien Testament, op.cit. p. 412 44
Selon Archer, Torrey ne croyait pas à l’historicité de la destruction de Juda par les Babyloniens, ni à une
quelconque captivité de la nation juive à Babylone. Peu d’exégètes furent acquis à sa cause. 45
Ralph H., ALEXANDER, “Ezekiel”, in The Expositor’s Bible Commentary, vol. 6, Grand Rapids : The
Zondervan Corporation, 1986, p.740 46
Roland Kenneth, HARRISON, Introduction to the Old Testament, Peabody: Prince Press, 1999, p. 824. 47
Brian, TIDIMAN, Le livre d’Ezéchiel, tome 1, op.cit. p.4 48
Gleason L., ARCHER, Introduction à l’Ancien Testament, op.cit. p. 412 49
Ibid.
13
restauration50. Deuxièmement, l’on croit détecter dans le langage et les actions
d’Ezéchiel sa situation géographique, qui ne pouvait être que la Palestine et non
Babylone. Les critiques pensent, en effet que les actions symboliques à l’endroit de
Jérusalem et la connaissance détaillée de certains événements qui se sont produits
dans cette ville51 militent en faveur de la thèse que l’auteur se trouvait à Jérusalem
au cours des années précédant la chute finale de la ville en 587 av. J.-C.52. Une telle
supposition fait d’une part, entorse aux indications du texte qui suggèrent que
l’auditoire d’Ezéchiel est bel et bien composé de jérusalémites en exil à Babylone
(1.3 ; 4.7-17 ; 12.11ss, 19 ; 24.2ss)53. D’autre part, la supposition laisse transparaître
les présupposés anti-surnaturels des critiques54. Car, certains événements, tels que
rapportés aux chapitres 8 ; 10.4 ; 11.23 proviennent d’une révélation surnaturelle
accordée par Dieu.
De l’avis de G. A. Cooke (1936), H. H. Rowley (1953) et bien d’autres
critiques55, la thèse d’un auteur postérieur est tout aussi difficile à accepter que les
affirmations du texte lui-même56. En effet, trois indices, au moins, fournis par le livre,
démontrent bien que le prophète Ezéchiel du 6e siècle est l’auteur principal du livre.
Ces indices sont : l’usage de la première personne, le style de l’auteur et le système
de datation. Le troisième indice, c’est-à-dire, le système de datation, fera l’objet d’un
sous-point, compte-tenu de son importance.
50
Ibid. Nous pouvons citer en exemple Amos, Osée, Michée, Esaïe et Jérémie. 51
Au chapitre 8 Ezéchiel décrit le culte idolâtre des anciens dans le temple de Jérusalem ; dans 11.13, il évoque
la mort soudaine de l’un d’entre eux, Pelathia, fils de Benaja ; dans 12.3-12, il décrit la tentative de Sédécias
pour fuir Jérusalem de nuit ; dans 21.18, il dépeint Nébucadnetsar, en route pour Jérusalem, consultant les
présages à un carrefour de chemins ; et dans 24.2, il se réfère à son campement autour des murailles de la ville. 52
Gleason L., ARCHER, Introduction à l’Ancien Testament, op.cit. p. 413 53
Ibid. Il est à noter aussi, selon Archer, les rumeurs des événements relatés ont eu le temps d’atteindre les exilés
de Babylone avant que l’auteur ne rédige son œuvre. 54
Ibid. 55
O. Eissfeldt (1934), L. Dennefield (1946), F. Spadafora (1948), J. Ziegler (1948), A. Lods (1950) et G. Fohrer
(1952) 56
Edward J., YOUNG, An Introduction to the Old Testament, Londres: The Tyndale Press, 1964, p. 243.
14
En ce qui concerne l’utilisation de la première personne, hormis l’apparition à
deux reprises du nom d’Ezéchiel (1.3 ; 24.24), l’auteur emploie tout au long des 48
chapitres du livre, systématiquement la première personne. Cela souligne bien
l’action d’un seul esprit dans la rédaction. Tidiman déduira de ce fait que « refuser la
paternité de l’ensemble à Ezéchiel revient à conclure à un faux volontaire pour une
partie, au moins, des passages à la première personne. »57
Le style de l’auteur parait très homogène dans l’ensemble du livre. Son
penchant pour le détail et la symbolique, son vocabulaire58 et ses tournures59,
reflètent bien la situation d’Ezéchiel. Ce qui fait dire à Lods qu’ « on retrouve partout
le même style, le même esprit très particulier, les mêmes idées »60. A Tidiman de
renchérir : « Non seulement ces faits cadrent mal avec l’hypothèse de plusieurs
rédacteurs, mais on s’imagine difficilement un autre auteur assimilant à ce point le
langage du prophète »61.
Qu’est-ce que le système de datation nous révèle en outre sur la question
d’authenticité et d’unité d’Ezéchiel ?
1.1.2.2. Datation
Très peu de livre dans l’Ancien Testament ont placé un accent particulier sur
la chronologie comme l’a fait Ezéchiel. Quatorze dates se trouvent réparties dans
57
Ibid. 58
Tidiman souligne que May a relevé 47 expressions qui sont caractéristiques à l’auteur, dont plusieurs ne se
trouvent nulle part dans l’Ancien Testament. Par exemple le mot « idole » est employé 40 fois dans le livre, alors
qu’on le trouve que 9 fois ailleurs dans l’A.T. 59
« J’assouvirai ma fureur » (5.13 ; 16.42) et les menaces analogues adressées au « peuple du pays » (12.19 ;
22.29 ; 39.13) ; « Je suis vivant ; oracle du Seigneur » (5.11 ; 14.16, 18, 20 ; etc.) et plus de 50 fois, « vous
saurez que je suis Yahvé ». Ces tournures révèlent la théologie d’Ezéchiel. 60
A. LODS, Histoire de la littérature hébraïque et juive, Paris, 1950, p. 444, cité par Brian, TIDIMAN, Le livre
d’Ezéchiel, tome 1, op.cit. p.46 61
Brian, TIDIMAN, Le livre d’Ezéchiel, tome 1, op.cit. p.48
15
son livre ; et à part la date du v 1 du chapitre premier, qui semble obscure62, la
progression d’Ezéchiel est très logique et témoigne d’une cohérence incontestable63.
Grâce à ce système chronologique et à la découverte de tablettes cunéiformes
contenant les annales babyloniennes et des indications astrologiques64, il est
possible de dater avec exactitude les événements mentionnés par le livre d’Ezéchiel.
Ainsi, nous avons65 :
- Appel d’Ezéchiel : Juin/juillet 593 av. J.-C.
- Début du siège de Jérusalem (24.1) : Décembre/janvier 589/588 av. J.-C.
- Oracles contre les nations païennes : entre avril et juillet 587 av. J.-C.
- Arrivée des premiers réfugiés : janvier 585 av. J.-C.
- Visions d’avenir : Mars/avril 573 av. J.-C.
- Dernier oracle : avril 571 av. J.-C.
Ces dates se répartissent entre la cinquième et la vingt-septième année de
captivité de Yoyakîn (593 et 571 av. J.-C.), qui semblent bien former les dates
extrêmes du ministère d’Ezéchiel. Il est donc aisé de constater que les indications
chronologiques jouent manifestement une fonction structurante des principales
sections du livre. Cela exclut toute fantaisie de la part de l’auteur dans la composition
du livre.
Nous voulons ici affirmer notre adhésion à la position traditionnelle : Ezéchiel du
6e siècle est bel et bien le véritable auteur du livre. Et l’arrangement 66 qui caractérise
62
Il est difficile de savoir à quoi se réfère la « trentième année » mentionnée au v. 1. Mais une tradition
ancienne, qui remonte à Origène, y voit une indication de l’âge du prophète au début de son activité prophétique. 63
Christophe, NIHAN, « Ezéchiel », in Römer Thomas, sous dir, Introduction à l’Ancien Testament, op.cit. p.
362 64
A. KUEN, sous dir, Nouveau Dictionnaire Biblique révisé et augmenté, op.cit. 65
Ralph H., ALEXANDER, « Ezekiel », in The Expositor’s Bible Commentary, vol 6, Grand Rapids: Zondervan
Publishing House, 1986, 741 66
Le prophète qui ne craignait pas de revenir sur un même sujet a repris plusieurs fois certains thèmes
particulièrement importants, provoquant diverses copies. Ezéchiel se présente comme un prédicateur plus attentif
au fond de son message qu’à sa forme, il ne s’est pas privé de revenir sur ses oracles déjà proclamés et parfois
transcrits, afin de les compléter, de les préciser, au risque souvent de les surcharger. Le lecteur doit prendre acte
de ces phénomènes littéraires, sans passer longtemps à les regretter.
16
le livre fait croire à sa rédaction par le prophète lui-même à la fin de sa vie. Nous
déduisons de ce fait que, le lieu de rédaction est sans nul doute la Babylonie, le pays
d’exil du prophète. Depuis sa vocation (593) jusqu’à la vision du temple reconstruit
(573) et le dernier oracle contre l’Egypte (571), Ezéchiel a exercé un ministère d’un
peu plus de vingt ans, dont le sommet est marqué par la prise de Jérusalem en 587
av. J.-C.
1.1.3. Contexte historique
Ezéchiel est né et a exercé son ministère dans un monde d’ébullition politique
et de déchéance sociale et religieuse.
1.1.3.1. Environnement politique
Le contexte politique dans lequel se trouve Ezéchiel est identique à celui de
Jérémie. Il est marqué sur le plan international par les luttes d’influences entre les
grandes puissances (Assyrie, Egypte, Babylone), mais avec une ascendance
indiscutable des Babyloniens sur les autres nations. Babylone, pendant plus de 70
ans, étendra sa domination sur toute la région occidentale67.
En 601 av. J.-C., une bataille oppose l’Egypte et la Babylonie68. Vu l’issue
incertaine de ce conflit, le roi Yoyakîm décide, en dépit du conseil du prophète
Jérémie, de se libérer de la domination babylonienne en s’alliant à l’Egypte69.
Nébucadnetsar, roi de Babylone lança alors une expédition contre Juda et assiège
Jérusalem. En 597 av. J.-C., la ville tombe une première fois aux mains des
67
J. Alberto, SOGGIN, Histoire d’Israël et de Juda, Bruxelles : Lessius, 2004, p. 311 68
Ibid. 69
Ibid. p. 312
17
Babyloniens qui déportent Yoyakîn70 et nomment Sédécias comme roi à sa place.
Une partie de la population, notamment, l’élite administrative et sacerdotale est
déportée à cette occasion71. Ezéchiel fait partie de cette première déportation,
puisque son ministère commence quelques années plus tard en terre d’exil72.
En 589/588 av. J.-C., avec le soutien de l’Egypte, Sédécias va entrer en
révolte ouverte contre les Babyloniens73. La riposte de ces derniers sera
impitoyable : Jérusalem sera prise une seconde fois en 587 av. J.-C. Sédécias est
exécuté et une portion importante de la population déportée. Le Temple, déjà pillé en
597 est, cette fois, entièrement détruite, de même que les murailles de la ville74.
Juda perd définitivement son indépendance et devient une province babylonienne
avec un gouverneur, Guédalia.
Après cette razzia, vint un demi-siècle d’éclipse de Juda : c’est la période
exilique75.
Cette situation politique dramatique va entrainer à sa suite un environnement
social et religieux piteux.
1.1.3.2. Environnement social et religieux
Durant le ministère d’Ezéchiel, les Juifs étaient éparpillés dans trois localités :
Juda, Egypte et Babylonie76. En Egypte, ils étaient des fuyards et des réfugiés77. En
70
Ibid. Yoyakîm, dans des circonstances que nous ignorons meurt pendant le siège et son fils Yoyakîn lui
succéda sur le trône (2 R. 24.8-17 ; 2 Ch. 36.9-10) 71
Ibid. 72
Ibid. 73
Ibid. p. 313 74
L’archéologue Albrigth, cité par Soggin, affirmera que « du point de vu archéologique, le pays était une tabula
rasa » et qu’il ne devait pas y rester plus de 20 000 habitants ; tout au plus il y avait quelques rares communautés
rurales. 75
J. Alberto, SOGGIN, Histoire d’Israël et de Juda, op.cit. p. 317 76
Daniel I., BLOCK, The book of Ezekiel, chapters 1-24, op.cit. p.4 77
Les Juifs d’Egypte se trouvaient à plusieurs endroits : à Migdol, à Daphné, à Memphis, et dans le pays de
Patros (Jer. 44. 1)
18
Babylonie, des exilés déportés de force. Ceux, restés en Juda étaient des petites
gens abandonnés à l’extrême pauvreté. Plus tard, une nouvelle classe de riche va
émerger sur les ruines du pays78, mais, elle va vivre dans l’insouciance et l’arrogance
vis-à-vis de ses frères exilés (11.14-16). Toutefois, les structures sociales et
économiques restèrent inexistantes. « Dans la patrie, sans doute plus qu’ailleurs, l’on
ressentait le traumatisme de l’anéantissement du sanctuaire, de la maison royale, de
l’Etat »79.
Sur le plan religieux, avant la seconde déportation, le syncrétisme avait pris le
dessus. La Pâque et le sabbat qui étaient célébrés en l’honneur de Dieu, sont
désormais délaissés en profit de l’adoration des idoles80. Le temple et tout le pays81
étaient profanés par les pratiques idolâtres (5.11 ; 8 ; 20.7 ; 22.11). Dieu ne pouvait
plus demeurer en présence de tels dénis de sa gloire ; il quitte donc le temple et le
pays, puis laisse l’ennemi les profaner (7.22 ; 9.7 ; 24.21).
1.2. STRUCTURE ET GENRES LITTERAIRES
1.2.1 Structure
Bien que l’architecture générale du livre d’Ezéchiel soit d’une grande
simplicité, tous les commentateurs ne sont cependant pas unanimes, quant il s’agit
d’en distinguer les différentes articulations. Certains divisent le livre en deux grandes
sections (chapitres 1-24 et 25-48), d’autres distinguent trois parties (chapitre 1-24 ;
78
Daniel I., BLOCK, The book of Ezekiel, chapters 1-24, op.cit. p.5 Un certains nombres de personnes avaient
été favorisées par la distribution des terres effectuées par les Babyloniens. 79
J. Alberto, SOGGIN, Histoire d’Israël et de Juda, op.cit. p. 319 80
Ibid. 81
Les montagnes, les collines, et les vallées étaient utilisés pour des rites d’idolâtrie.
19
25-32 ; 33-48), d’autres encore comme Tidiman en distinguent sept parties
disposées en chiasme82. Nous sommes pour notre part d’avis avec les tripartistes,
quoique nous distinguons, dans les parties (1-24) et (33-48) des sous parties.
Ainsi, Ezéchiel fait l’expérience d’une vision grandiose de Yahvé qui fonde son
appel prophétique (1-3) ; il est alors chargé de proclamer à ses compatriotes
l’imminence du jugement divin qui atteindra tous les infidèles du peuple élu (4-24).
Mandatées pour accomplir ce jugement, les nations ne seront pas épargnées :
Ezéchiel annonce leur châtiment (25-32). Mais Jérusalem vient de tomber ; jusque-là
justicier, Dieu se change en sauveur de son peuple qui sera « ressuscité » purifié,
sanctifié et rétabli sur la terre d’Israël (33-37)83. Le livre s’achève alors sur les vastes
perspectives d’un horizon lointain ; d’abord la décisive bataille du peuple de Dieu
affronté à de terribles ennemis (38-39) ; et puis se profile, enfin, la haute silhouette
de la montagne sur laquelle Ezéchiel aperçoit la capitale du peuple de Dieu
renouvelé (40-48).
En parcourant les lignes du livre, à partir de la structure ci-dessus donnée,
nous découvrons, non seulement l’essentiel de l’enseignement du prophète, mais
aussi son génie littéraire.
1.2.2 Genres littéraires
On trouve chez Ezéchiel, une diversité et une richesse littéraires qui sont le
signe de la créativité du prophète. Il use du discours prophétique comme base de
toute son œuvre afin de faire comprendre à ses interlocuteurs la pensée de Dieu sur
leur passé, leur présent et leur futur84. Il manifeste une véritable prédilection pour la
82
Brian, TIDIMAN, Le livre d’Ezéchiel, tome 1, op.cit. p.52 83
Louis, MONLOUBOU, Un prêtre devient prophète : Ezéchiel, op.cit. p.41 84
Brian, TIDIMAN, op.cit. p. 31
20
poésie par la maîtrise de cet art85. Il emploie des énigmes afin de tester la
perspicacité des auditeurs et les amener à réfléchir ; il part des proverbes et dictons
professés par ses compatriotes pour réfuter les idées erronées qui en découlent ; il
use des actes symboliques pour matérialiser devant les exilés les actes divins86.
Le prophète Ezéchiel fait recours à tous ses dons et toutes les ressources
nécessaires pour communiquer son message. S’il est vrai que toutes ces ressources
littéraires font partie de la tradition prophétique israélite, il est tout aussi vrai
qu’Ezéchiel, lui, ne fait pas que les usité il leur donne une ampleur nouvelle87.
Après l’exploration des questions relatives au livre d’Ezéchiel, nous voulons
maintenant considérer celles qui se rapportent au texte d’Ezéchiel 18. 1-4, 20-32.
1.3. QUESTIONS D’INTRODUCTION AU TEXTE D’EZECHIEL 18. 1-4, 20-32
La tâche ici consistera, premièrement à établir le texte d’Ez 18. 1-4, 20-32,
c’est-à-dire, préciser les limites du texte et faire la critique textuelle afin de
reconstruire, autant que possible, le texte hébreu originel. Deuxièmement, il s’agira
de faire la traduction d’Ez 18. 1-4, 20-32, de l’hébreu au français.
85
Comme les autres prophètes, Ezéchiel maitrisait l’art de la poésie. Il fait un excellent usage de la métaphore
(32.17-31) et emploi avec succès le genre « qînâ » (complainte/lamentation). 86
Brian, TIDIMAN, op.cit. p. 33 87
Ibid.
21
1.3.1. Délimitation et critique textuelle d’Ezéchiel 18. 1-4, 20-32
1.3.1.1. Délimitation
Pour délimiter notre texte, nous tiendrons compte des éléments littéraires
suivants : les formules que le prophète Ezéchiel utilise pour entamer et conclure ses
prophéties et le changement de thème aux différentes péricopes.
Tout au long du livre d’Ezéchiel, nous retrouvons des expressions qui sont
caractéristiques au prophète Ezéchiel. Certaines sont utilisées comme formule
d’introduction et de conclusion des oracles qu’il prononce. Citons en exemple celles-
ci : comme formule d’introduction « il y eut une parole du Seigneur pour moi » (3.16 ;
7.1 ; 12.1 ; 14.1 ; 15.1 ; 16.1 ; 17.1 ; 18.1 ; 20.1 ; 24.1 ; 33.1 ; 38.1 ; etc.)88 ; comme
formule de conclusion « Moi le Seigneur j’ai parlé » (5.17 ; 21.22) ; « Alors ils
connaîtront que je suis le Seigneur » (6.14 ; 7.27 ; 12.16 ; 12.20 ; 13.23 ; 25.17) ;
« oracle du Seigneur Dieu » (12.28 ; 15.18 ; 16.63 ; 18.32 ; 24.14 ; 34.31).
Ces tournures constituent les limites de l’oracle prononcé par Ezéchiel au
chapitre 18, ainsi que les textes qui se situent en amont et en aval89. Cela indique
que le chapitre 18, ainsi que les textes qui l’encadrent en amont et en aval, forment
chacun une péricope différente.
Si les formules d’introduction et de conclusion montrent bien que le chapitre
18 forme une péricope complète, il en de même avec les thèmes abordés. En effet,
dans les chapitres 16 et 17, Ezéchiel fait un réquisitoire implacable contre Jérusalem
88
Les textes cités pour souligner les formules d’introduction et de conclusion ne sont pas exhaustifs, ils ne sont
qu’indicatifs. 89
En amont, nous avons les chapitres 16 et 17 qui débutent par la formule « il y eut une parole du Seigneur pour
moi » (16.1 ; 17.1) et s’achèvent respectivement par « oracle du Seigneur Dieu » (16.63) et « Moi, le Seigneur, je
parle et j’accomplis » (17.24). En aval, les chapitre 19 et 20 sont introduits par les expressions « Et toi, entonne
une complainte sur les princes d’Israël » (19.1) et « il y eut une parole du Seigneur pour moi » (20.1) et sont
conclus par celles-ci : « c’est une complainte chantée comme une complainte » (19.14) et « oracle du Seigneur
Dieu » (20.44).
22
et contre le roi ; dans le chapitre 18, il aborde la question de la responsabilité
personnelle ; le chapitre 19 décrit le sort pitoyable du pays et de ses dirigeants ; et
dans le chapitre 20, Ezéchiel met à nu l’infidélité constante d’Israël.
La délimitation de notre péricope faite, nous voulons maintenant entamer la
critique textuelle, qui nous permettra de faire le choix du texte hébreu à traduire et à
interpréter.
Précisons ici que, dans la critique textuelle du chapitre 18 d’Ezéchiel, nous
nous focaliserons sur les passages où se trouve l’émergence du principe de la
responsabilité personnelle, c’est-à-dire les v 1-4 et 20-32. Nous laisserons
volontairement de côté l’argumentation des versets 5-1990 qui présentent un cas
juridique selon le schéma des listes généalogiques de la tradition sacerdotale91.
Toutefois, nous en tiendrons compte dans le commentaire exégétique.
1.3.1.2. Critique textuelle d’Ezéchiel 18. 1-4, 20-32
Nous choisissons d’utiliser l’apparat critique de la Biblia Hebraica
Stuttgartensia (BHS)92 pour repérer les problèmes textuels et les analyser. Nous
procéderons comme suit : nous donnerons le numéro du verset et nous présenterons
successivement les difficultés, selon leur ordre d’apparition dans le texte. Ainsi, nous
avons :
90
Ces versets ne seront pas pris en compte dans la critique textuelle et la traduction. Cependant, dans le
commentaire exégétique, nous y ferons référence. 91
Luc-Olivier, BOSSET, « Ezéchiel 18, 1-4.20-32 : Les pères ont mangé du raisin vert… », Lire et Dire 2000,
p.14 92
Nous utiliserons cette abréviation dans la suite du travail pour indiquer la Biblia Hebraica Stuttgartensia
23
V 2
Le pronom interrogatif -hm qui signifie « Quoi ? Que ? » est suivi dans la
Septante (LXX)93 et la version Syriaque (la Peshita)94, par le groupe de mot grec
uie. avnqrw,pou c’est-à-dire « Fils d’homme » à l’exemple d’Ez 12. 22. Si
l’interpellation « Fils d’homme » concerne le prophète qui reçoit le message de Dieu,
alors sa présence ou son absence ne change en rien la compréhension de la
phrase ; surtout que dans le v 1, le prophète mentionne que c’est à lui que l’oracle
s’adresse « …yl;îae hw"ßhy>-rb;d> yhiîy>w: » « La parole du Seigneur me fut adressée ».
Cette adjonction n’affecte donc pas le sens du texte. Nous conservons cependant la
leçon du Texte Massorétique (TM)95 reproduite par la BHS.
Le groupe de mot ta, ‘~yliv.mo) ‘~T,a; qui signifie littéralement « vous proférant »96
manque dans la LXX. Nous décidons de garder ce groupe de mots car nous
supposons qu’il est attesté par plusieurs autres témoins du texte.
Le groupe de mot tm;îd>a;-l[; « sur la terre » ou « dans le pays » est traduit par la
LXX comme suit : evn toi/j uioi/j « parmi les fils ». Il nous semble que la LXX fait
une interprétation de tm;îd>a;-l[;. Nous gardons la leçon du TM afin d’éviter une
interprétation hâtive.
Wlk.ayOæ (verbe inaccompli qal 3e personne masculin pluriel)97 de lka « ils
mangeront » est traduit par la LXX, la Peshitta et la Vulgate par le verbe e;fagon (aor.
93
Nous utiliserons dorénavant l’abréviation LXX, pour indiquer la Septante. 94
Nous utiliserons dorénavant le terme « Peshitta » pour indiquer la version Syriaque. 95
Nous utiliserons l’abréviation (TM) dans la suite du travail pour indiquer le Texte Massorétique. 96
La particule ta, ne peut pas être traduite parce qu’elle indique tout simplement un complément d’objet 97
Dans la suite du travail, les abréviations suivantes seront utilisées pour les analyses : vb. Pour verbe ; inac.
pour inaccompli ; acc. pour accompli ; pers. pour personne ; masc. pour masculin ; fém. Pour féminin ; sing.
24
ind. actif 3e pers. pl.) de evsqi,w, ce qui correspondrait en hébreu à Wlk.a'ä (vb. acc. qal
3e masc. pl. de lka « ils ont mangé ») comme le propose le texte de Jer 31.29.
Selon Daniel BLOCK, il est d’usage que dans certaines maximes à l’exemple de Job
3. 17 ; Pr 14. 1 ; 19. 24, l’inac. et l’acc. soient souvent interchangeables98. Ainsi,
Wlk.ayOæ « ils mangeront » peut se traduire comme un acc. qal « ils ont mangé »99.
Nous gardons donc la forme inac. qal du verbe lka mais nous le traduirons comme
un acc. qal. Il en sera de même pour le second verbe de la maxime hn"yh,(q.Ti « elles
seront agacées ».
Pour le mot ~ynIßB'h; « les enfants », La Geniza du Caire et peu de manuscrits
hébreux omettent l’article h; comme le texte de Jer 31.29. Dans la construction de la
phrase, ~ynIßB'h; est précédé de yNEïviw> « et les dents », qui est à l’état const., ce qui
suppose que les deux mots sont liés. De ce fait, le second mot qui est au génitif doit
être défini, c’est-à-dire être précédé d’un article. C’est ce que nous avons dans le
TM, nous conservons donc cette leçon du TM.
V 3
Le mot yn"ådoa] « Seigneur » manque dans un manuscrit hébreu et dans la LXX
« première main » ; d’autres manuscrits par contre l’ajoute. L’omission peut se
justifier par le fait que yn"ådoa] précède immédiatement hwI+hy> « Eternel ». Or, au cours
de la lecture, hwI+hy> est toujours lu yn"ådoa] ; garder les deux mots apparait alors
redondant. Mais la présence de hwI+hy> peut aussi signifier une précision du
pour singulier et pl. pour pluriel ; inf. pour infinitif ; const. Pour construit ; partc. pour participe ; prép. pour
préposition ; insép. pour inséparable ; aor. pour aoriste 98
Daniel I., BLOCK, The Book of Ezekiel, chapters 1-24, op.cit. p.557 99
Luc BOSSET pense qu’Ezéchiel utilise l’inacc. Pour donner une valeur actuelle et future au proverbe
25
yn"ådoa] « seigneur » qui parle. En effet, le mot « seigneur » peut faire référence à
l’homme comme à Dieu100. Nous décidons donc de garder le mot yn"ådoa]. Ce problème
textuel se retrouve dans les v 23, 30 et 32, nous ne ferons donc plus mention de
cela.
Le mot lvo±m. (vb. inf. const. qal) « dire un proverbe » pose problème. En effet, la
note propose qu’il faut peut être lire lveÞmo (vb. partc. prés. qal masc. sing.) « disant un
proverbe » au lieu de lvo±m.. Cette leçon se trouve dans la Peshitta et dans les
manuscrits du Targum. D’autres manuscrits par contre le suppriment. Dans la
classification des témoins textuels par ordre d’importance, la Peshitta et le Targum
sont de moindre importance par rapport au Texte Massorétique que nous avons
dans la BHS. Pour ce fait, nous choisissons de conserver la leçon du TM.
V 20
Le mot !wOæ[]B;, littéralement « dans le péché » est, à l’instar du v 19 traduit dans la
LXX par les mots th.n avdiki,an «la méchanceté», « le péché », « l’injustice ».
l’éditeur moderne se pose la question si le sens de th.n avdiki,an correspond
vraiment à !wOæ[]. Puisque nous travaillons sur le TM et non sur celui de la LXX, nous
conservons donc le mot !wOæ[] et le sens qui découlerait du contexte.
Le mot [v'Þr::"Þ ::" pose problème, parce que le point voyelle qames ( ::") n’est placé
sous aucune consonne ; c’est la forme Ketiv c’est-à-dire la forme erronée du mot. La
note propose qu’on le lise comme l’indiquent le Qéré (la forme corrigée du mot), la
100
F. BROWN, S. DRIVER, and C. BRIGGS, The BROWN-DRIVER-BRIGGS Hebrew and English Lexicon,
Peabody: Hendrickson Publishers, 1996, p. 11
26
Geniza du Caire et beaucoup de manuscrits hébreux, c’est-à-dire [v'Þr"h' « la
méchanceté ». Bien que la forme [v'Þr::"Þ ::" figure dans le TM, nous optons cependant
pour la forme correcte.
V 21
Le mot wt'aJox; (nom fém. const. pl. suffixé du pronom suffixe 3e pers. masc. sing.)
pose problème parce que sa forme est erronée (Ketiv), il manque le y « yod »
caractéristique du pronom suffixe 3e pers. masc. sing. La note propose la forme
corrigée du mot (Qéré) wyt'aJox; « ses péchés » que l’on trouve dans la Geniza du
Caire et dans un certain nombre de manuscrits hébreux. Nous optons pour le Qéré.
La particule de négation al{ï « non, ne pas » est précédé du waw conjonctif w>
dans plusieurs manuscrits hébreux, le codex Vaticanus (LXX) et le codex du British
Museum (Peshitta). Nous constatons que l’absence du waw n’a aucune incidence
sur la compréhension du texte. Nous gardons donc la leçon du TM. Ce même
problème est attesté au verset 28, nous le passerons sous silence.
V 22
Al+ (prép. insép. suffixé du pronom 3e pers. masc. sing.) « à lui ou pour lui »
manque dans la LXX « première main » (cf Ez 33. 16). La présence du Al+ est une
forme d’insistance pour indiquer celui à qui les transgressions sont remises. Nous
choisissons de le garder.
27
V 23
Le mot tAmå « mort » est dans un certain nombres de manuscrits hébreux
précédé de la préposition inséparable B., ce qui se traduirait littéralement « dans la
mort ». Si la forme proposée par la note n’existe que dans un certain nombre de
manuscrits, cela suppose que la forme sans la préposition inséparable est attestée
par plusieurs autres témoins dont le TM. Pour cela, nous décidons de garder la
forme attestée par notre texte.
La note révèle que la leçon wyk'Þr"D>mi ( !mi prép. %r,D, nom à l’état const. pl.
suffixé du pronom suffixe 3e pers. masc. sing.) « de ses chemins», « de ses voies »
est douteuse. La LXX, la Peshitta, le Targum et plusieurs autres manuscrits hébreux
proposent la leçon AKår>D:mi (!mi prép. %r,D, nom sing. const. suffixé du pronom
suffixe 3e pers. masc. sing.) « de son chemin», « de sa voie ». La LXX et la Peshitta
ajoutent th/j ponhra/j « la mauvaise» à la leçon AKår>D:mi, ce qui correspondrait en
hébreu à h['r' « mauvaise » ou h['Þv'r> « coupable, méchante » . Au sujet de la
première difficulté, bien que le mot AKår>D:mi soit attesté par plusieurs témoins, nous
décidons de garder la forme au pluriel que nous propose le TM. A propos de la
seconde difficulté, il ne convient pas d’ajouté h['r ou h['Þv'r> . En effet, le caractère
du [v'êr" « méchant » indique bien le type de voie ou d’attitude qu’il adopte.
V 24
lko’K. « comme tout, selon tout ». Dans la Geniza du Caire et dans deux autres
manuscrits hébreux, la prép. insép. K. est remplacée par la prép. insép. B., ce qui
28
donnerait « dans tout, en tout ». la prép. B. à la place du K. ne modifie en rien la
compréhension du texte. Nous gardons le mot avec la prép. K.
Le groupe de mot yx'_w" hf,Þ[]y: , littéralement « il fera et il vivra » manque dans la
LXX « première main » et dans la Peshitta ; d’autres manuscrits par contre l’ajoute.
Bien que la LXX « première main » et la Peshitta soient témoins importants, nous
décidons de conserver la leçon que le TM présente.
Le mot Atq'd>ci « sa justice » est présent dans la BHS sous sa forme erronée
(ketiv). La note propose donc la forme corrigée du mot (Qéré) wyt'Ûqod>ci attestée dans
la Geniza du Caire et dans plusieurs manuscrits. Nous optons pour le Qéré
Le mot AtïaJ'x;b.W « et son péché » est au pluriel dans la LXX, la Peshitta et les
manuscrits du Targum. Nous gardons le mot tel qu’il est dans le TM
V 25
les groupes de mot %r<D<ä !kEßT'yI et !keêT'yI al{å ‘yKir>d:h] sont au pluriel dans la
Peshitta, le Targum ainsi que plusieurs autres manuscrits. Il en est de même au v 29.
Nous conservons la forme au singulier de ces mots comme nous la propose le TM.
Le mot yn"+doa] « Seigneur » est dans la Peshitta, dans plusieurs manuscrits
hébreux, dans la LXX et dans le Targum remplacé par le mot hw"ïhy> « Eternel ». Ce
changement de mot n’affecte aucunement la compréhension de notre texte ; et de
toutes manières, le tétragramme est toujours lu yn"+doa]. Nous gardons donc le mot
yn"+doa]. Cette difficulté est aussi soulignée au verset 29 ; nous n’en ferons donc plus
mention.
29
Le groupe de mot Wnke(T'yI al{ï ~k,Þyker>d: « vos voies ne sont pas droites » est au
singulier dans la LXX. Nous décidons de garder la forme au pluriel proposée par le
TM.
V 26
Le mot ~h,_yle[], littéralement « sur eux », manque dans un manuscrit hébreu, dans
la LXX et dans la Peshitta. Une autre leçon propose qu’il soit supprimé. L’absence de
ce mot pose problème dans la traduction du v 26. En effet, ~h,_yle[] met en exergue
la cause de la mort du juste : l’injustice. Nous maintenons donc le mot ~h,_yle[],
La LXX ajoute au vb. hf'Þ[' « il fit » ceci : evn auvtw/| « en lui ou par lui » ce qui
correspondrait à AB (cf. la Peshitta). cet ajout est peut-être nécessaire pour la
compréhension de la phrase en grec, ce qui n’est pas le cas en hébreu. Nous
n’apporterons pas d’additif.
V 28
Le mot ha,är>YIw: « et il verra » manque dans la LXX « première main » ; d’autres par
contre l’ajoute. Dans le v 28, le mot fait référence à la prise de conscience du
pécheur qui décide de se détourner de ses péchés. Peut-être que dans la traduction,
la LXX a trouvé le mot ha,är>YIw: redondant, puisque celui qui le suit, bWv, contient
aussi l’idée de prendre conscience. Mais la présence de ha,är>YIw: semble être une
insistance sur la prise de conscience de l’individu. Nous maintenons donc ce mot.
Ayðx' (vb qal inf. absolu) est dans la Geniza du Caire et dans plusieurs manuscrits
hébreux écrit de la façon suivante hyOæx' (vb qal inf. absolu). Selon Brown-Driver-Briggs
30
(BDB), les deux formes de l’inf. absolu de hy"x' sont attestées101. Nous maintenons la
forme proposée par le TM.
V 29
Le mot yk;úr"D>h; « ma voie » est attesté tel qu’il est dans le codex de Leningrad.
Mais dans les manuscrits des Editions hébraïques, il n’y a pas de point voyelle sous
la particule interrogative h]. Selon Paul JOÜON, la particule interrogative est
vocalisée pataH (patar) lorsqu’il précède un shewa simple102. C’est ce que le TM
nous propose. Nous gardons le mot tel qu’il est dans le TM.
‘WNk.T'(yI (vb inac. niphal 3e pers. masc. pl. de !kt « être droit, être équitable»). Ce
mot est ainsi écrit dans le codex de Leningrad ; mais ce n’est pas le cas dans les
Editions hébraïques : il n’y a pas de point de redoublement dans la consonne n. Le
point de redoublement dans la consonne n du pronom personnel 3e pers. masc. pl.
WN, s’explique par le fait de l’assimilation du ! (nûn final) du verbe !kt. Le nûn, en
effet, lorsqu’il n’est pas vocalisé et se trouve au milieu d’un mot, il est assimilé ; et le
point de redoublement (daghesh), dans ce cas signale cette disparition de la
consonne. La forme du mot telle que proposée par le TM est correcte, nous la
conservons.
Le mot ~k,Þyker>d: « vos voies » est au singulier dans peu de manuscrits hébreux et
dans la LXX. Nous décidons de conserver la leçon du TM.
101
F. BROWN, S. DRIVER, and C. BRIGGS, The BROWN-DRIVER-BRIGGS Hebrew and English Lexicon,
op.cit. p. 311 102
P. Paul, JOÜON S. J., Grammaire de l’hébreu biblique, Rome : Pontificio Istituto Biblico, 1996, § 102
31
!kE)T'yI (vb inac. niphal 3e pers. masc. sing.). La note propose qu’on lise le mot au
pluriel comme dans plusieurs manuscrits des Editions hébraïques, la Peshitta, le
Targum et la vulgate. La leçon proposée par les Editions hébraïques, la Peshitta et
autres, semble juste si nous considérons ~k,Þyker>d: comme sujet du verbe. Mais il
nous semble que le verbe se rapporte au sujet collectif laeêr"f.yI tyBeä. Si c’est le cas,
cela expliquerait bien la forme au singulier du verbe. Car parfois, l’hébreu emploie le
singulier avec certains noms conçus comme des collectifs103. Notons cependant que
la traduction en français ne peut pas respecter ce type d’accord hébraïque. Nous
gardons la forme au singulier, mais nous le traduirons au pluriel.
V 30
Le mot !kel' « c’est pourquoi» manque dans la LXX « première main ». La
présence de ce mot est importante pour la compréhension du v 30 ; à cause du lien
qu’il établi entre les v 29 et 30. Le v 30 est l’effet ou la conséquence de ce qui est dit
dans la dernière partie du v 29. Nous le conservons donc.
wyk'ør"d>Ki « ses voies ». Ce mot est au singulier dans la LXX. Mais nous le gardons
sous sa forme présentée par leTM.
hy<ïh.yI (vb. inac. qal 3e pers. masc. sing. de hyh) « il sera ». Ce mot est au pluriel
dans la LXX. Dans le texte de la BHS, ce verbe est lié au mot !wO*[' (nom masc. sing.)
« Iniquité » : c’est l’iniquité qui ne sera plus pour eux une pierre d’achoppement, si
les enfants d’Israël s’en détournent. Or, nous savons qu’assez généralement le
103
P. Paul, JOÜON S. J., Grammaire de l’hébreu biblique, op.cit., § 150, p. 458
32
verbe s’accorde en nombre et en genre avec le nom auquel il se rapporte104. Cela
explique, ce pourquoi le verbe est au singulier. Nous le gardons ainsi.
V 31
~B'ê (prép. insép. B. suffixé de la 3e pers. masc. pl.) « en eux, par eux ». La note
propose qu’il faille lire yBiî (prép. insép. B. suffixé de la 1er pers. masc. sing.) « en moi,
par moi » comme dans deux manuscrits de l’Edition hébraïque et de la LXX. Dans le
texte de la BHS, ~B'ê fait référence à ‘~k,y[ev.Pi-lK' « toutes vos transgressions ». ~B'ê
ne peut donc pas être remplacé par yBiî. Nous maintenons donc le mot ~B'ê
V 32
Wy*x.wI) WbyviÞh'w> « revenez donc et vivez » ; ce groupe de mot manque dans la LXX
« première main », certains manuscrits l’ajoute. Le nombre de témoin qui atteste
l’absence du groupe de mot est très insignifiant, même s’il s’agit du texte grec
supposé originel. Nous conservons donc ce groupe de mot.
1.3.2. Traduction du texte d’Ezéchiel 18. 1-4, 20-32 et notes de traduction
Pour éviter toute confusion entre les notes de bas de page et les notes de
traduction, nous proposons de discuter ces dernières dans un paragraphe qui suivra
la traduction du texte hébreu en français.
104
Ibid.
33
1.3.2.1. Traduction du texte d’Ezéchiel 18. 1-4, 20-32
V1 : La parole de l’Eternel me fut adressée en ces mots (a) :
V 2 : « Qu’avez-vous à professer (a) ce proverbe sur la terre d’Israël : (b) les pères
ont mangé des fruits non mûrs (d) et les dents des enfants ont été agacées» ?
V3 : Par ma vie ! Oracle du Seigneur, l’Eternel ! Vous ne professerez (a) plus encore
ce proverbe en Israël.
V4 : Car (a) toutes les âmes (b) sont à moi ; l’âme du père comme l’âme du fils,
toutes deux (c) sont à moi. C’est l’âme qui pèche qui mourra.
V20 : C’est l’âme qui pèche qui mourra. Le fils ne portera pas l’iniquité du père, ni (a)
le père l’iniquité du fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant
sera sur lui.
V21 : Mais (a) le méchant qui se détourne (b) de tous ses péchés qu’il a commis, et
qui observe toutes mes lois, qui accomplit ce qui est juste et droit, il ne mourra pas, il
vivra certainement (c)
V22 : Toutes les transgressions qu’il a commises seront oubliées (a), et il vivra à
cause (b) de la justice qu’il a pratiquée.
V23 : Est-ce que vraiment je prends plaisir à la mort du méchant ? Oracle du
Seigneur, l’Eternel ! N’est-ce pas plutôt à ce qu’il se détourne des ses voies et qu’il
vive ?
V24 : Mais si le juste se détourne de sa justice et commet l’iniquité, conformément à
toutes les abominations que pratique le méchant : peut-il les commettre et vivre ? (a)
De toutes les bonnes œuvres qu’il avait faite, on ne s’en souviendra plus. Mais il
mourra à cause de son infidélité et de son péché.
34
V25 : Vous dites (a) : « la voie du Seigneur n’est pas juste. » Ecoutez donc, maison
d’Israël : est-ce ma voie qui n’est pas juste ? N’est-ce pas vos voies qui ne sont pas
justes ?
V26 : Si (a) le juste se détourne de sa justice et commet l’iniquité, il mourra ; et c’est
à cause de l’iniquité qu’il a commise qu’il mourra.
V27 : Mais si le méchant se détourne de l’iniquité qu’il avait commise et pratique la
justice et le droit, celui-là fera vivre son âme.
V28 : S’il prend conscience (a) et se détourne de toutes les transgressions qu’il a
commises, il vivra certainement et il ne mourra pas.
V29 : Mais la maison d’Israël dit : « la voie du Seigneur n’est pas juste ». Est-ce ma
voie qui n’est pas juste, maison d’Israël ? N’est-ce pas vos voies qui ne sont pas
justes ?
V30 : C’est pourquoi, je jugerai chacun de vous, selon vos voies, maison d’Israël ;
oracle du Seigneur, l’Eternel ! Revenez et détournez-vous donc de toutes vos
transgressions. Ainsi, l’iniquité ne sera plus pour vous une ruine.
V31 : Repoussez loin de vous toutes vos transgressions par lesquelles vous avez
péché et faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Et pourquoi mourriez-
vous, maison d’Israël ?
V32 : Ainsi, je ne prends pas plaisir dans la mort de celui qui meurt ; oracle du
Seigneur, l’Eternel. Revenez donc et vivez !
35
1.3.2.2. Notes de traduction
V 1
(a) le groupe verbal rmoªale « dire ou pour dire » est un inf. const. et peut se traduire
par le partc. prés. français « en disant », « disant », « en ces mots » ou être
remplacé tout simplement par « : » (deux points). Nous avons choisi de le traduire
par « en ces mots à cause du discours direct qui suit juste après.
V 2
(a) le verbe que nous avons traduit par «professer » est en réalité un partc. actif qal
masc. pl. ‘~yliv.mo) qui se traduit littéralement par « professant ». Le participe actif
indique une activité et peut s’employer de façons très diverses. Ainsi, il peut faire
référence au temps présent qu’au temps passé. Ici nous avons choisi de le faire
référer au temps présent, parce que le proverbe dont il est question dans ce verset 2
est toujours en cours, donc d’actualité.
(b) ici nous avons remplacé l’inf. const. rmoªale « dire ou pour dire » par les deux
points « : ».
(d) rs,Bo désigne collectivement tous les fruits non mûrs105.
V 3
(a) lvo±m. dA[ª ~k,øl' hy<‚h.yI)-~ai ce groupe de mot peut se traduire littéralement comme
suit «s’il sera pour vous encore professé …» ; cette traduction est trop lourde. Il
nous semble que l’idée qui s’y dégage est celle-ci : « vous verrez si ce proverbe
sera encore professé ». Tout en gardant l’idée nous avons simplifié la tournure
en disant tout simplement « vous ne professerez plus encore ce proverbe…»
105
N. Ph. SANDER et I. TRENEL, Dictionnaire Hébreu-Français, Genève : Slatkine Reprints, 2005, p. 72
36
V 4
(a) !hEÜ (particule interjective) se traduit littéralement par «voici que » ou « certes ».
Mais nous avons décidé de le traduire par « car » afin de coordonner les versets 3 et
4 et de souligner la raison pour laquelle le proverbe ne devra plus être répété.
(b) le mot vp,n< signifie à la fois « souffle », « vie », « âme », « être animé »,
« personne », « appétit », « désir », « émotion », « passion », nous l’avons traduit
par « âme » dans le sens de la personne tout entière (cf. Lv 7. 20-21, 27 ; 20. 6 ; 22.
3)106.
(c) hN"hE+-yli ce groupe de mot peut être traduit par « celles-là sont à moi ». Mais nous
l’avons traduit par « toutes deux sont à moi » parce que hN"hE+-yli fait référence à la
fois à l’âme du père et à l’âme du fils.
V 20
(a) !Beêh; !wOæ[]B; ‘aF'yI al{Ü ‘ba'w> ba'ªh' !wOæ[]B; aF'äyI-al{ !Beú « le fils ne portera pas l’iniquité
du fils et le père ne portera pas l’iniquité du fils ». Afin d’éviter la répétition de la
défense permanente «‘aF'yI al » et de rendre la phrase un peu plus brève, nous
avons remplacé l’expression par « ni »
V 21
(a) nous avons traduit le waw consécutif w> par « mais » pour exprimer l’opposition
entre la dernière idée émise par le verset 20 « la méchanceté du méchant sera sur
lui » et l’idée abordée par le verset 21.
(b) ‘bWvy" (verbe inac. qal 3e pers. masc. sing.) « il détournera » est traduit par « il se
détourne » parce que c’est le temps qui convient à la condition en français.
106
Brian, TIDIMAN, Le livre d’Ezéchiel, tome 1, op.cit. p.230
37
(c) nous avons traduit hy<ßx.yI hyOðx' par «il vivra certainement » parce que l’infinitif
absolu hyOðx' a un sens emphatique.
V 22
(a) avec le verbe à l’inac. niphal, le groupe de mot Wrßk.Z"yI al{ï se traduit littéralement
« ils ne seront pas rappelés », pour dire « on ne s’en souviendra plus » ou « ils
seront oubliés ».
(b) hy<)x.yI) hf'Þ['-rv,a] Atïq'd>ciB. ce groupe de mot se traduit littéralement comme suit
«par sa justice qu'il a pratiquée, il vivra ». Une telle traduction est lourde et a besoin
d’être améliorée. Ici, la préposition « par » joue le rôle de complément circonstanciel
de cause ; c’est pourquoi nous l’avons traduit par « à cause de ».
V 24
(a) yx'_w" hf,Þ[]y: littéralement, ces verbes peuvent être traduit comme suit : «il fera et il
vivra ? ». Nous avons amélioré cette traduction par ceci : « peut-il les commettre et
vivre ? ». Le pronom personnel masc. pl. « les » fait référence aux abominations.
V 25
(a) ~T,§r>m;a]w: est un verbe acc. qal suffixé de la 2e pers. masc. pl. et préfixé d’un waw
consécutif. La présence du waw consécutif, devrait nous amener à traduire le verbe
au futur « vous direz ». Mais la phrase est construite dans un discours direct, le futur
ne convient donc pas. C’est pourquoi nous l’avons traduit par « vous dites ».
V 26
(a) la conjonction « si » indique ici, l’introduction d’une hypothèse dont la réalisation
est tout autant possible que l’hypothèse du méchant qui meurt à cause de ses
fautes.
38
(b) ~h,_yle[] (l[; prép. suffixé de la 3e pers. masc. pl.) marque la position « sur, au-
dessus, au-delà », mais aussi le but et le motif « pour, à cause de, en faveur de ».
V 28
(a) ha,är>YIw: , littéralement, « et il voit » ou « et il reconnait ». Dans la phrase il a le sens
de reconnaitre ses fautes ou prendre conscience de ses fautes.
Conclusion partielle
Au terme de ce premier chapitre, nous pouvons retenir que le prophète Ezéchiel
(6e siècle av. J.-C.) est l’auteur du livre qui porte son nom. Le lieu de rédaction est la
Babylonie, le pays d’exil du prophète. Selon le système de datation du livre, Ezéchiel
a exercé un ministère d’un peu plus de vingt ans (593 et 571 av. J.-C. constituent
respectivement le point de départ et la fin de son ministère), pendant la période la
plus tragique de toute l’histoire d’Israël. Cette période est qualifiée de tragique, parce
qu’elle a été marquée par la disparition des institutions et du royaume de Juda.
En ce qui concerne l’authenticité du livre, nous affirmons notre adhésion à la
thèse traditionnelle qui défend que l’arrangement soigné qui caractérise le livre fait
croire que sa rédaction est l’œuvre du prophète lui-même à la fin de sa vie.
Rappelons que l’hypothèse que nous cherchons à vérifier est la suivante :
bien vrai que l’influence des ascendants sur les descendants est pesante, ce n’est
pas elle qui doit conditionner l’agir de ces derniers. Les enfants ne sont pas
condamnés à répéter les fautes des parents et subir les conséquences de ces fautes
Il est donc possible de rompre la « chaîne » en ayant un comportement différent de
39
celui de la génération précédente, parce que nous sommes individuellement
responsables devant Dieu de nos actions et de notre conduite. Cette hypothèse
semble bien se vérifier dans le premier chapitre ; dans le sens où la traduction en
français du texte d’Ezéchiel 18. 1-4, 20-32 révèle en substance que personne ne
portera les péchés d’un tiers. Chacun récolte ce qu’il a semé, soit bon, soit mauvais.
En outre, la justice de Dieu suit l’évolution d’une vie.
Dans le second chapitre, nous chercherons à voir plus en détail, les vérités
contenues dans notre texte d’Ez 18. 1-4, 20-32.
40
CHAPITRE DEUXIEME :
COMMENTAIRE EXEGETIQUE D’EZECHIEL 18. 1-4, 20-32
Le chapitre 18 du livre d’Ezéchiel se classe parmi les célèbres de l’A.T à
cause de sa grande contribution au développement de la théologie vétéro-
testamentaire107. En effet, ce chapitre présente, par une argumentation très détaillée,
le principe de la responsabilité individuelle, qui fut énoncé déjà dans le livre du
Deutéronome (Dt 24. 16).
Dans le livre d’Ezéchiel, le chapitre 18 est l’aboutissement d’une longue
polémique entre Dieu et son peuple. Ezéchiel, prenant le parti de Dieu, avait à faire
face à des contestataires qui avaient l’esprit torturé par l’idée qu’ils souffraient par la
faute de leurs ancêtres (cf. Lm 5.7) au point d’en faire un proverbe108 : « les pères
ont mangé des fruits non mûrs et les dents des enfants ont été agacées » (v 2). Dans
ce proverbe réside toute l’exaspération des exilés, las de s’entendre toujours
reprocher des fautes commises par leurs ascendants (cf. Ex 20. 5). La catastrophe
de 587 av. J.-C., les exilés ne s’en sentent pas responsables109. Leur exil leur
107
Brian, TIDIMAN, Le livre d’Ezéchiel, tome 1, op.cit. p.230 108
Ibid. 109
Luc-Olivier, BOSSET, « Ezéchiel 18, 1-4.20-32 : les pères ont mangé du raisin vert…, » op.cit. p. 14
41
apparaît comme une action arbitraire de Dieu. Si Dieu est juste, comment pourrait-il
laisser le fils souffrir à cause de la faute de son père ?
Attaquant le problème de front, Ezéchiel part du proverbe (v 1-4), pour
aborder le rapport entre les générations successives (v 5-18), pour élaborer une
doctrine de la responsabilité personnelle (v 19-20) et pour démontrer que Dieu prend
plaisir, plus que tout, à voir l’homme vivre (v 30-32).
2.1. CONTESTATION DE LA TRANSMISSION AUTOMATIQUE DE LA
FAUTE/CHATIMENT D’UNE GENERATION A L’AUTRE ET ANNONCE DU
PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE PERSONNELLE (Ez 18. 1-4, 20)
2.1.1. Réfutation du proverbe erroné (Ezéchiel 18. 1-3)
Le chapitre s’ouvre sur la formule du prophète « yl;îae hw"ßhy>-rb;d> yhiîy>w: » «La
parole de l’Eternel me fut adressée… » qui indique clairement l’origine de la parole
(elle vient de l’Eternel), ainsi que le devoir qui incombe à Ezéchiel d’annoncer l’oracle
du Seigneur.
L’oracle commence avec une question de l’Eternel aux exilés qui exprime son
indignation: «laeÞr"f.yI tm;îd>a;-l[; hZ<ëh; lv'äM'h;-ta, ‘~yliv.mo) ‘~T,a; ~k,ªL'-hm; »
« Qu’avez-vous à professer ce proverbe sur la terre d’Israël… » (v 2).
L’indignation de Dieu est à propos d’un dicton bien précis (hZ<ëh; lv'äM'h; ) entretenu
par les enfants d’Israël en exil, celui qui dit que « les pères ont mangé des fruits non
mûrs et les dents des enfants ont été agacées».
42
Que signifie ce proverbe ? Les fruits verts (rs,boê) que les pères ont mangés,
représentent les péchés personnels commis par ceux-ci ; et les dents agacées des
enfants (`hn"yh,(q.Ti ~ynIßB'h; yNEïviw>) signifient que les enfants souffrent ou subissent les
conséquences des péchés des parents110. Ainsi, les enfants ou les descendants ne
seraient pas responsables des difficultés et des souffrances qu’ils vivent ; ils les
« hériteraient » de leurs parents ou de leurs ascendants familiaux. Les interlocuteurs
d’Ezéchiel conçoivent leur exil comme la conséquence des péchés passés de leurs
parents.
Le présent proverbe était déjà familier en Palestine, comme le montre Jérémie
31.29 ; les captifs l'avaient sans doute apporté de là avec eux. Mais il y a une légère
différence entre Jérémie et Ezéchiel dans l’utilisation du dicton. Les verbes du
proverbe rapporté par Ezéchiel sont à l’inaccompli «Wlk.ayOæ » « ils mangeront »,
«hn"yh,(q.Ti » « elles seront agacées », contrairement à Jérémie qui les rapporte à
l’accompli. L’inaccompli indique habituellement une action inachevée ou une action
future111. Ce qui suggèrerait une sorte de mécanisme dont aucune génération
présente ou future ne peut se défaire. Génération après génération les ascendants
continueront à commettre l’iniquité et leurs descendants immanquablement seront
victimes des conséquences produits par l’iniquité, sans que ces derniers n’aient de
possibilité de rompre la chaîne du mal. Nous pouvons bien comprendre l’indignation
de Dieu face à ce proverbe qui engendre un fatalisme dangereux112 et qui met en
cause sa justice, sa sagesse et son amour.
PREVOST Jean-Pierre fait remarquer que le proverbe entretenu par les exilés
a des racines très profondes et repose sur une double conviction de la part 110
Thomas H., LEALE, « Ezekiel, Chapters XII – XXIX », in The Preacher’s Complete Homiletic Commentary,
n°18, Grand Rapids: Baker Books House, 1996, p. 192 111
Paul, JOÜON, Grammaire de l’hébreu biblique, op.cit., § 113, p. 301 112
Brian, TIDIMAN, Le livre d’Ezéchiel, tome 1, op.cit. p. 231
43
d’Israël113. Il y a d’abord la conviction d’une solidarité nationale en tout. Le destin
collectif l’emporte sur la destinée individuelle. On est solidaire dans le bien comme
dans le mal. Il y a là quelque chose d’admirable sans doute, mais on arrive aussi à
des impasses, comme celle de lier le destin des générations aux fautes du passé114.
Cette théorie de la solidarité est ancienne et se rattache à la tradition théologique qui
se dégagerait du décalogue :
« Tu ne te feras pas d'idole, ni rien qui ait la forme de ce qui se trouve au ciel là-haut, sur terre ici-bas ou dans les eaux sous la terre. 5 Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux et tu ne les serviras pas, car c'est moi le SEIGNEUR, ton Dieu, un Dieu jaloux, poursuivant la faute des pères chez les fils sur trois et quatre générations - s'ils me haïssent - 6 mais prouvant sa fidélité à des milliers de générations - si elles m'aiment et gardent mes commandements. » (Exode 20. 4-6) (TOB)
Par ailleurs, ce proverbe reflète une autre conviction, qu’on peut appeler la
théorie de la rétribution115. Dans la mentalité d’Israël, une conduite morale bonne
devait mener à une destinée morale heureuse, tandis que l’inverse, un agir moral
mauvais entraînerait nécessairement le malheur. Quelques proverbes bibliques
illustreront bien cette théorie de la rétribution :
« Qui marche dans l'intégrité marche en sécurité, mais celui qui suit des voies
tortueuses sera puni… La crainte du SEIGNEUR accroît les jours, mais les années
des méchants seront raccourcies.» (Proverbes 10. 9, 27)
«Le méchant recueille un salaire décevant, une récompense est assurée à qui
sème la justice.» (Proverbes 11. 18).
On pourrait continuer les citations indéfiniment, tellement l’idée de rétribution,
c’est-à-dire celle d’un Dieu qui récompense ou punit selon qu’on agit bien ou mal,
traverse toute la Bible. Dans un pareil contexte, dès qu’un malheur survient, on
113
Jean-Pierre, PREVOST, Pour lire les prophètes, Outremont/Paris : Novalis/Cerf, 1995, p. 151 114
Ibid. 115
Ibid.
44
cherche à trouver un coupable ou une faute qui soit la cause du malheur. C’est toute
la problématique, notamment du livre de Job, où le héros doit se débattre de toutes
ses forces contre la théorie de ses amis, qui essaient d’expliquer ou de justifier les
souffrances de Job en ayant recours à la théorie de la rétribution116. Telle est donc
la problématique qui amène Dieu à faire des mises au point.
La réponse de Dieu à cette conception est très énergique et sans appel, parce
qu’il y va de sa relation avec son peuple : « Par ma vie ! Oracle du Seigneur,
l’Eternel ! Vous ne professerez plus ce proverbe en Israël. ». Dieu, non seulement
réfute la pensée véhiculée par le proverbe, mais il affiche aussi son intention d’y
mettre un terme, et il en fait le serment : « Par ma vie ! ».
2.1.2. Annonce du principe de la responsabilité personnelle (Ez 18. 4, 20)
A la suite de sa déclaration assermentée, qui montre bien son intention de
mettre fin au proverbe, l’Eternel énonce deux vérités fondamentales.
La première est : « toutes les âmes sont à moi ; l’âme du père comme l’âme
du fils, toutes deux sont à moi. ». Par cette première vérité, l’Eternel déconstruit
d’une part, l’illusion entretenue par le proverbe : « celle qui est de croire que Dieu ne
verrait les hommes que comme une grande foule indifférenciée dans laquelle le fils
resterait agglutiné à son père »117. Et d’autre part, il montre l’absolue égalité de
chaque individu devant lui. Cette égalité est soulignée par la double utilisation de la
préposition inséparable K./K.118 «!BEßh; vp,n<ïk.W ba'²h' vp,n<ôK.», littéralement, « Comme
l’âme du père et comme l’âme du fils ». Parce que Dieu en est le créateur, toutes les
116
Ibid. 117
Luc-Olivier, BOSSET, « Ezéchiel 18, 1-4.20-32 : les pères ont mangé du raisin vert…, » op.cit. p. 15 118
Ibid.
45
vies lui appartiennent individuellement. De ce fait, la prérogative lui revient d’énoncer
le principe qui met chaque âme devant ses propres responsabilités.
La seconde vérité est : «… c’est l’âme qui pèche qui mourra. » (v 4b). Bien
que le fils et le père soient, sur le plan biologique liés l’un à l’autre, ils sont
cependant, pour Dieu, deux personnes différentes et distinctes. Ainsi, face à Dieu, le
pécheur ne doit assumer que les conséquences de ses propres actes.
«… c’est l’âme qui pèche qui mourra. » cette phrase qui fonde la seconde
vérité, n’est pas à comprendre comme une condamnation qui foudroierait
instantanément le coupable. Elle implique la possibilité de la mort physique comme
conséquence ultime du péché119. En effet, la notion de mort «twm», tout comme celle
de la vie «hyx» que nous retrouvons le long du texte d’Ez 18, ne sont pas à
comprendre strictement comme la mort et la vie physiques. Ces termes recouvrent
des dimensions plus larges.
Pour l’Israélite, la mort physique n’est que la dernière étape des réalités qui
s’inscrivent dans le terme « twm » (mort). Avant, se déroule toute une série
d’événements qui le rapprochent ou l’éloignent de cette mort physique. La maladie,
le malheur, par exemple, sont considérés comme le début de la mort120.
De même, il y a différents degrés de vie. Tous ne vivent pas avec le même
degré d’intensité. Les biens matériels, les moyens de subsistance forment un
ensemble d’importance capitale pour évaluer la vie. Qui peut assurer correctement
sa subsistance par son travail ou ses biens, peut affirmer qu’il vit. Qui fait partie
d’une communauté forte, d’une famille unie et prospère, peut aussi affirmer qu’il
vit121.
119
Luc-Olivier, BOSSET, « Ezéchiel 18, 1-4.20-32 : les pères ont mangé du raisin vert…, » op.cit. p. 15 120
Jésus-Maria ASURMENDI, Le prophète Ezéchiel, op.cit. p. 42 121
Ibid.
46
D’autre part, la vie était intimement liée au culte122. Celui-ci est indispensable
pour la vie et la survie, dans le sens qu’il met en rapport l’individu et la divinité. Le
Dieu d’Israël est source de vie ; il est la source de vie du peuple, parce que c’est lui
qui l’a formé (cf. Ez 16). Dans le culte, on reconnaît ce fait et on se met en rapport
avec celui qui est la source de cette vie, le Seigneur. On va au temple pour chercher
le Seigneur et voir sa face. C’est dans la relation avec Dieu que la vie atteint son
degré d’intensification maximum. Le pécheur donc, parce qu’il s’est détourné de la
relation avec Dieu est mort, bien qu’il soit un homme vivant. « Le méchant est celui
qui vit sans vivre »123.
En mettant en rapport ce qui précède et la seconde vérité ci-dessus
mentionnée, il se dégage que l’âme qui pèche peut être considérée comme morte
parce que subissant la maladie ou un malheur quelconque ou parce que n’étant plus
en relation avec Dieu. Mais précisément, les exilés n’avaient plus la possibilité
d’entrer en rapport avec leur Dieu, avec la source de leur vie : il n’y avait plus ni
temple, ni sacrifice, ni ville sainte, ni terre. Ils avaient tout perdu et étaient en terre
étrangère : « Nos révoltes et nos péchés sont sur nous, nous pourrissons à cause
d’eux. Comment pourrions-nous vivre ? » (Ez 33. 10). Les exilés se plaignent à Dieu
de cette situation de non-vie, mais avec l’idée qu’ils en sont victimes. Et Dieu de
répondre : chacun est et sera responsable de lui-même. « … le fils ne portera pas
l’iniquité du père, ni le père l’iniquité du fils. La justice du juste sera sur lui et la
méchanceté du méchant sera sur lui.» (v 20). Pour accentuer le refus du fatalisme
qui découle du proverbe, Ezéchiel use de la défense permanente ou de l’interdiction
122
Ibid. 123
Luc-Olivier, BOSSET, « Ezéchiel 18, 1-4.20-32 : les pères ont mangé du raisin vert…, » op.cit. p. 15
47
permanente124 ( aF'äyI-al{) ; ce qui souligne bien qu’il n’y a d’ « héritage » ni pour le
bien ni pour le mal. Si tel est le cas, quel est alors le sens d’Exode 20. 5-6 qui
semble, de prime abord, souligner l’ « héritage » dans le mal comme dans le bien ?
Selon KEIL, la clé de la compréhension d’Exode 20. 5-6 se trouve dans le rôle
que joue la préposition inséparable l. qui précède « ya")_n>fol.» (Littéralement, pour
ceux qui me haïssent) dans la syntaxe de la phrase125. Pour lui en effet, la
préposition l. ne doit pas être prise comme le complément du nom «!wO‚[] » (iniquité),
mais comme la préposition « chez » dans un sens relationnel. Ainsi, «ya")_n>fol.» ne se
réfèrerait pas seulement aux pères, mais aux pères et aux enfants de la troisième et
de la quatrième génération. Si «ya")_n>fol.» devrait se référer aux pères uniquement, il
aurait fallu accoler la préposition inséparable l. à «tboôa' » (pères). Le sens
relationnel de la préposition inséparable l. est à voir aussi dans le groupe verbal
«yb;Þh]aol. » (pour ceux qui m’aiment). Il se dégage donc de cette analyse que la
punition ou la grâce se perpétue, quand les descendants persévèrent dans l’attitude
des ancêtres. Nous pouvons donc comprendre le choix de traduction de la TOB
«Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux et tu ne les serviras pas, car c'est moi le SEIGNEUR, ton Dieu, un Dieu jaloux, poursuivant la faute des pères chez les fils sur trois et quatre générations - s'ils me haïssent - mais prouvant sa fidélité à des milliers de générations - si elles m'aiment et gardent mes commandements. »
Cette lecture démontre qu’Ezéchiel n’est pas en porte-à-faux avec la pensée
d’Ex 20. 5-6. Au contraire, le discours d’Ezéchiel et l’idée du Décalogue sont
124
La défense s’exprime au moyen de l’inaccompli précédé d’une négation. Lorsque l’inaccompli est précédé
par la particule négative al, elle exprime une interdiction permanente. Précédé de la particule la, l’inaccompli
exprime une interdiction ponctuelle (cf. J. WEINGREEN, Hébreu biblique, méthode élémentaire, p. 83) 125
C. F. KEIL and F. DELITZSCH, Commentary On The Old Testament, The Pentateuch, vol. 1, Peabody:
Hendrickson Publishers, 1996, p. 397
48
compatibles et complémentaires126. Celui du Décalogue met l’accent sur la solidarité
entre les générations, tandis que celui d’Ezéchiel insiste sur la responsabilité
personnelle. Le premier énonce que le même sort sera réservé au père et au fils
dans la mesure où ce dernier ne rompt pas avec le comportement de son père ; ce
que le discours du prophète ne fait que confirmer, tout en soulignant qu’il n’y a pas là
de fatalité, qu’il est possible de rompre la chaîne en ayant un comportement différent
de celui de la génération précédente.
Pour aider ses compatriotes exilés à bien comprendre la pensée du
Décalogue, Ezéchiel se sert d’un argument casuistique (v 5-18) qui présente la
manière dont la justice de Dieu est administrée. Trois générations d’une même
famille sont présentées127 : un père juste (vv 5-9), un fils injuste (vv 10-13), et un
petit-fils juste (vv 14-18).
Ezéchiel commence par exposer le cas du représentant de la première
génération qu’il qualifie de juste «qyDI_c; » (vv 5-9). Selon BLOCK, l’adjectif «qyDI_c; »,
dans la pensée d’Ezéchiel, se réfère fondamentalement au comportement qui est
conforme aux normes, plus précisément aux normes contenues dans l’alliance de
YHWH128. Ezéchiel précise concrètement le sens «qyDI_c; » en dressant une liste de
ce qui est à faire et de ce qui est à éviter. Cette liste, Ezéchiel la compose en puisant
à la fois dans le Décalogue, le code de l’alliance (Ex 20-24), le code de sainteté (Lv
17-26), et le Deutéronome129.
126
Note sur Ezéchiel 18 de la Bible d’étude version du Semeur 200, Cléon d’Antran : Excelsis, 2001, p. 1184 127
Brian, TIDIMAN, Le livre d’Ezéchiel, tome 1, op.cit. p. 234 128
Daniel I., BLOCK, The book of Ezekiel, chapters 1-24, op.cit. p. 570 129
Brian, TIDIMAN, Le livre d’Ezéchiel, tome 1, op.cit. p. 233
49
Ce qui est à faire Ce qui est à éviter
- il rend le gage reçu pour dette ;
- il donne son pain à l'affamé ;
- il couvre d'un vêtement celui qui
est nu ;
- il détourne sa main de l'injustice ;
- il rend un jugement vrai entre les
hommes ;
- il chemine selon mes lois ;
- il observe mes coutumes,
agissant d'après la vérité.
- il ne mange pas sur les
montagnes130 ;
- il ne lève pas les yeux vers les
idoles de la maison d'Israël ;
- il ne déshonore pas la femme de
son prochain ;
- il ne s'approche pas d'une femme
en état d'impureté ;
- il n'exploite personne ;
- il ne commet pas de rapines ;
- il ne prête pas à intérêt ;
- il ne prélève pas d'usure.
Ezéchiel conclu cet ensemble de choses à faire et de choses à ne pas faire,
en déclarant que cette manière d’agir est conforme aux lois et coutumes prescrits par
le Seigneur (v 9). Ainsi, « le juste, pour Ezéchiel, est l’homme qui vit selon la loi de
Dieu en nageant à contre-courant dans une société aux mœurs culturelles, sociales
et sexuelles dégénérées »131. Dans la suite de son argumentation, Ezéchiel utilise la
liste ci-dessus établie comme la norme à partir de laquelle les représentants des
deux autres générations sont jugés.
Dans les vv 10-13 Ezéchiel fait succéder au cadre de droiture et de justice, un
cadre de violence et de sang «~D"_ %pEåvo #yrIßP'-!Be ». Pour qualifier l’attitude du fils,
Ezéchiel n’emploie pas le terme «[v'r' » «méchant » qui est le contraire de «qyDI_c; », il
130
C’est la participation aux banquets célébrés en l’honneur des divinités des hauts-lieux. 131
Ibid. p. 234
50
utilise plutôt l’adjectif «#yrIßP' » «féroce, violent ». Ailleurs, le terme «#yrIßP' » est usité
pour désigner soit les animaux prédateurs (Es 35. 9), soit les bandits et les voleurs
(Ez 7. 22), soit un homme violent en général (Dan. 11. 14 ; Ps. 17. 4). Mais ici,
Ezéchiel lui donne une définition personnelle132 : le «#yrIßP' » c’est le meurtrier
« ~D"_ %pEåvo», celui qui répand le sang, celui qui ne tient pas compte du caractère
sacré de la vie humaine. Ezéchiel présente les actions du fils comme diamétralement
opposées à celles du père juste (vv 11-13). Tandis que le père dans toutes ses
actions cherche à préserver la vie humaine et à défendre le droit des pauvres, le fils,
lui, ôte la vie, exploite le malheureux et commet toutes les abominations évitées par
son père. Le fils rejette donc consciemment la loi de Dieu et mène une vie totalement
dissolue.
Le représentant de la troisième génération, le petit-fils, prend place dans un
cadre familial affecté par la mauvaise conduite du père133 (son éducation et
l’exemple de son père, dont il ne pouvait rien sortir de bon). Mais celui-ci exerce la
liberté de choix que Dieu lui a donnée et se dissocie de la conduite de son père «!hE)K'
hf,Þ[]y: al{ïw> ha,§r>YIw: ». Il est jugé malgré sa situation défavorisée, selon la norme déjà
établie dans les vv 5-9. Il n’y a aucune recherche de circonstances atténuantes, ni
aucun assouplissement de la norme134. Les éléments de la liste sont chez le petit-fils
les mêmes que ceux de son père, tandis que leur ordre est le même que chez son
grand-père135.
Les sentences prononcées à l’issue de chaque vie sont les suivantes : le père
et le petit-fils vivront, et aucune malédiction divine ne pèsera sur eux ; Dieu ne leur
132
Daniel I., BLOCK, op.cit. p. 576 133
Brian, TIDIMAN, op.cit. p. 234 134
Ibid. 135
Ibid.
51
imputera pas les actes qui leur échappent. Mais le fils, lui, mourra certainement à
cause du choix qu’il a fait de vivre consciemment à contre-courant des lois de Dieu.
Le but d’Ezéchiel dans l’exposition de ces cas est de démontrer, d’une part
que l’attitude de la génération précédente ne détermine pas forcement celle de la
génération future, et d’autre part que Dieu n’impute pas à une génération les actes
qui échappent à celle-ci. Le proverbe du v 2 reçoit donc une réfutation qui est sans
appel. TIDIMAN souligne un exemple dans l’histoire d’Israël qui témoigne de la thèse
ci-dessus citée : Josias n’a pas été sanctionné pour les méfaits de Manassé, et il
n’est nulle part reproché à Ezéchias d’avoir engendré un tel fils136.
Toute l’argumentation casuistique d’Ezéchiel nous fait comprendre que les
Israélites exilés se trouvent dans cette situation difficile, parce qu’eux-mêmes ont
participé aux dispositions perverses de leurs parents ; ils en sont autant
responsables que leurs pères. Ils pouvaient, à l’instar du représentant de la troisième
génération, renoncer aux attitudes iniques de leurs parents, vivre en conformité à la
loi de Dieu, et bénéficier de la miséricorde et de la grâce de celui-ci.
Après avoir contesté la vision d’une transmission automatique de la
faute/châtiment d’une génération à l’autre, et énoncé le principe de la responsabilité
individuelle, Ezéchiel développe la thèse que la justice de Dieu suit l’évolution d’une
vie (v 21-29).
136
Ibid. p. 233
52
2.2. LA JUSTICE DE DIEU SUIT L’EVOLUTION D’UNE VIE (Ezéchiel 18. 21-29)
La question qui se pose est celle-ci : Dieu décide-t-il de la vie de chaque être
humain une fois pour toute ? Le bien ou le mal commit dans le passé détermine-t-il
définitivement le sort d’une personne ?
Les exilés de Babylone répondent à cette question par l’affirmative et trouvent
que le contraire serait d’ailleurs de l’injustice (v 25, 29). Ezéchiel, lui, contrairement à
ses compatriotes, déclare que la justice de Dieu vis-à-vis d’une personne est fonction
de sa vie.
2.2.1. Dieu juge l’Homme selon ses œuvres (Ezéchiel 18. 21-24)
Ezéchiel développe le principe de la justice de Dieu au fil de la vie, selon un
angle légèrement différent ; il ne parle plus du châtiment qui résulte de la faute des
parents, mais la sanction méritée à cause de ses propres péchés. Le prophète
semble amener progressivement ses auditeurs à se détourner des fautes des
parents et à considérer les leurs.
Pour ce faire, Ezéchiel évoque, dans un premier temps, le cas d’un pécheur
qui se détourne (‘bWvy" ) sincèrement de tous ses péchés, se réconcilie avec Dieu et
agit dorénavant selon les principes de Dieu. Soulignons ici l’importance du verbe
«bWv » qui signifie littéralement « retourner, revenir, se tourner, se diriger »137. Dans
un sens physique, le verbe fait référence au fait de revenir au point de départ (Gn 8.
9 ; 15. 16) ou de changer de direction (Gn 14. 7)138. Dans un sens moral et spirituel,
137
Willen A., VANGEMEREN sous dir, Dictionary of Old Testament Theology & Exegesis, vol. 4, Grand
Rapids : Zondervan Publishing House, 1997, p. 56 138
Ibid.
53
« bWv» est un terme central pour parler à la fois de l’apostasie et de la repentance. Il
désigne l’apostasie lorsque l’on se détourne de Dieu pour se tourner vers le mal (Ez
18. 24) ; il désigne la repentance lorsque l’on se détourne du mal pour revenir à
Dieu. La repentance est donc perçue à la fois comme le mouvement qui éloigne du
mal que celui qui porte vers Dieu. C’est ce double mouvement qu’accomplit le
pécheur présenté par Ezéchiel au v 21 («le méchant qui se détourne de tous ses
péchés qu’il a commis, et qui observe toutes mes lois, qui accomplit ce qui est juste
et droit…»). Comme réponse à ce double mouvement, Dieu annonce que cet homme
vivra certainement (hy<ßx.yI hyOðx') (v 21)139
. Non seulement il sera épargné de la mort,
mais aussi l’Eternel lui assure que « toutes les transgressions qu’il a commises
seront oubliées, et il vivra à cause de la justice qu’il a pratiquée. » (v 22). Voilà une
réponse qui est bien contraire à la pensée fataliste et déterministe des exilés !
Dieu explique cette décision comme une vérité fondamentale qui est liée à sa
nature140 : Est-ce que vraiment je prends plaisir à la mort du méchant ? Oracle du
Seigneur, l’Eternel ! N’est-ce pas plutôt à ce qu’il se détourne des ses voies et qu’il
vive ? (v 23). Par cette question rhétorique qui fait nécessairement appel à une
réponse négative, Dieu se présente comme le Dieu qui ne peut pas laisser le péché
d’un non repentant impuni, mais ce n’est pas de gaieté de cœur qu’il le châtie. Il
châtie non pour que le pécheur meure, mais pour qu’il abandonne ses mauvaises
voies et qu’il vive. La BST141 dit dans ce sens que : « ce qui réjouit Dieu ; c’est la
repentance et le retour du pécheur à lui, car cela lui permet de faire ce qui lui tient le
plus à cœur : accorder la vie. La vie est un don de Dieu. Elle est sa création, elle est
son désir, elle est son plaisir ». Dieu se présente ainsi, non seulement comme un
139
Un infinitif absolu avec un sens emphatique. Ezéchiel met ici en relief la vie dont bénéficie le pécheur
repentant 140
Habtu, TEWOLDEMEDHIN, « Ezéchiel », op.cit. p. 1020 141
Note de The Bible Speaks Today cité par Habtu, TEWOLDEMEDHIN, « Ezéchiel », op.cit. p. 1020
54
Dieu juste, mais aussi un Dieu de miséricorde et de grâce142. Ce nouveau regard que
Dieu donne de lui au peuple en exil est assurément pour le guérir de sa dépression
et de son désespoir143. Les portes d’un futur radieux peuvent s’ouvrir devant ce
peuple à condition qu’il se repente de ses péchés et qu’il recherche la voie de Dieu.
Ezéchiel décrit ensuite le cas opposé : un homme juste qui se détourne de sa
justice et qui commet l’iniquité (v 24). Dieu pose alors la question si cet homme doit
continuer à vivre. La réponse est sans ambiguïté : il mourra. Toutes les bonnes
œuvres qu’il avait pu accomplir, ne constitueront pas une immunité pour l’exempter
de la sentence de Dieu. D’ailleurs toute sa justice sera oubliée.
Tout ce qui précède révèle bien que dans la vie de chaque personne, un acte
négatif passé n’hypothèque jamais de manière définitive son présent et son avenir ;
à condition qu’il se détourne de tous ses péchés et regarde à Dieu144 (v 21-22) ;
aussi, un acte positif passé ne garanti ni le présent ni le futur. L’Eternel rejette ainsi
les notions d’accumulation et de moyenne des mérites et fautes des personnes. Ainsi
donc, Dieu ne juge l’homme ni en fonction de ce qu’il sait de son passé, ni de ce qu’il
peut supposer de son avenir. Pour lui, seul importe le présent, c’est-à-dire là où
l’homme se trouve maintenant145 : celui qui se convertit se sauve ; celui qui se
pervertit meurt.
Ce second principe développé par Ezéchiel ne croise pas l’assentiment du
peuple en exil, qui proteste vigoureusement que «…la voie du Seigneur n’est pas
juste » (v 25).
142
Thomas H., LEALE, « Ezekiel chapters XII – XXIX », in The Preacher’s Complete Homiletic Commentary,
Lamentations – Ezekiel, vol. 31, Grand Rapid: Baker Books, 1996, p. 204 143
Daniel I., BLOCK, The book of Ezekiel, chapters 1-24, op.cit. p. 583 144
Luc-Olivier, BOSSET, « Ezéchiel 18, 1-4.20-32 : les pères ont mangé du raisin vert…, » op.cit. p. 16 145
Ibid.
55
2.2.2. Réponse d’Ezéchiel à la contestation du principe de la rétribution
individuelle par le peuple (Ezéchiel 18. 25-30a)
La protestation du peuple révèle à quel point la pensée des exilés est dominée
par le fatalisme et le déterminisme de sorte que, tout effort de l’Eternel à les ramener
à la juste compréhension de ses principes est battu en brèche.
« …la voie du Seigneur n’est pas juste » «yn"+doa] %r<D<ä !kEßT'yI al{ï » ; le verbe
«!kEßT'yI » de cette phrase est à l’inac. Niphal146 3e pers. masc. sing. et signifie « être
pesé, être réglé, juste ». Ce verbe se rapporte au groupe de sujet « la voie du
Seigneur » « yn"+doa] %r<D<ä», qui a le sens de « la manière d’agir du Seigneur, les
actions du Seigneur, le comportement du Seigneur». Nous observons ici que les
exilés soumettent à leur jugement la manière d’agir du Seigneur. Ils pensent que
l’attitude du Seigneur vis-à-vis du pécheur repentant et vis-à-vis du juste qui se
détourne de sa justice pour vivre dans le péché (v 21-24) n’est pas juste. Les actions
du Seigneur sont jugées non conformes à ses propres prescriptions ou du moins,
elles sont jugées non conformes à la compréhension que les exilés ont eux-mêmes
des prescriptions de Dieu.
Ce jugement semble faire transparaître la pensée immergée des exilés. Ceux-
ci, nous semble-t-il, croient que le pécheur doit « mourir » parce qu’il ne peut
aucunement se détourner de ses péchés pour vivre dans la droiture, et le juste doit
« vivre » parce qu’il persévérera assurément dans ses voies. Car les attitudes du
pécheur et celles du juste seraient déterminées à l’avance par les actions des
ascendants familiaux et bien plus, par le Seigneur qui visite la malédiction ou la
bénédiction des parents sur les enfants. Une telle pensée se voit justement ébranlée
146
Le niphal est la voie passive de la forme simple de la conjugaison hébraïque.
56
lorsque le Seigneur affirme dans les v 21-24 que sa justice vis-à-vis d’une personne
est fonction de sa vie. Les exilés, face à cette contradiction de point de vue
théologique, se considèrent à la merci d’un Dieu capricieux dont les actions sont
imprévisibles et arbitraires147 et ils s’écrient : « …la voie du Seigneur n’est pas
juste ».
La réaction de Dieu à l’accusation des compagnons d’exil d’Ezéchiel est
directe et se présente sous une tournure interrogative : « Ecoutez donc, maison
d’Israël : est-ce ma voie qui n’est pas juste ? N’est-ce pas vos voies qui ne sont pas
justes ? ». Dieu rétorque donc qu’il agit de façon parfaitement juste ; ce sont plutôt
les attitudes et les pensées de la maison d’Israël qui ne sont pas droites. Pour
attester que toute son œuvre repose sur un équilibre et une équité parfaite148,
l’Eternel réaffirme dans les v 26-28 le principe selon lequel sa justice est fonction de
l’évolution d’une vie, de la disposition morale du cœur.
L'intelligence de cette vérité si claire, prouve bien que les auditeurs du
prophète étaient eux-mêmes entraînés dans une fausse direction. Autrement il y
aurait harmonie entre leur marche et celle de Dieu. Le constat est plutôt que les
interlocuteurs d’Ezéchiel s'opiniâtrent dans leur attitude dogmatique rigide (v 29).
C'est pourquoi l’Eternel ne peut que confirmer le jugement qu'il vient de porter sur
leur état moral : «C’est pourquoi, je jugerai chacun de vous, selon vos voies, maison
d’Israël ; oracle du Seigneur, l’Eternel ! » (v 30a).
Ici, la stratégie rhétorique et le ton de la discussion changent149. La
déclaration commence par la particule adverbiale « •!kel'» « c’est pourquoi », ce qui
dénote une conséquence, une décision prise à cause d’un fait dument établi. Ce fait,
c’est que la façon d’agir et de penser des exilés n’est pas correcte. Pour ce faire, il
147
Daniel I., BLOCK, The book of Ezekiel, chapters 1-24, op.cit. p. 585 148
Brian, TIDIMAN, Le livre d’Ezéchiel, tome 1, op.cit. p. 236 149
Daniel I., BLOCK, The book of Ezekiel, chapters 1-24, op.cit. p. 587
57
ne s’agit plus de chercher à convaincre par un argument logique, il s’agit maintenant
de prendre une décision ferme afin de trancher une fois pour toute cette question.
Ainsi, le principe de la rétribution personnelle est maintenu et il sera appliqué150. La
seule alternative qui s’offre au pécheur pour échapper à la destruction et à la mort,
c’est de se détourner de ses péchés et venir au Seigneur. C’est d’ailleurs, pour
l’Eternel, un ardent désir de voir le pécheur se détourner du péché et vivre, car
l’Eternel ne cherche qu’à transmettre la vie.
2.3. DIEU CHERCHE A TRANSMETTRE LA VIE (Ezéchiel 18. 30b-32)
Toute l’argumentation juridique et casuistique d’Ezéchiel vise, d’une part à
ôter de la pensée des exilés le visage d’un Dieu capricieux, terrifiant et lointain, et
d’autre part à faire découvrir un autre visage de Dieu : celui qui nous le révèle
comme cherchant à transmettre la vie.151 Cependant, la vie que Dieu cherche à
transmettre passe nécessairement par la repentance et le renouvellement intérieur.
2.3.1. Appel à la repentance et au renouvellement intérieur (Ezéchiel 18.
30b-31)
Si le péché et l’injustice des exilés plongent leurs racines dans la mise en
doute de l’amour et la sagesse de Dieu (Ez 18. 29), la solution qu’Ezéchiel présente
150
Le mot «vyai’ » «chacun » fait ressortir encore l'idée de la responsabilité individuelle qui a fait le fond de tout
le discours d’Ezéchiel. 151
Ibid.
58
est la repentance (bWv), dont il distingue deux aspects152. Le premier aspect se
dégage de l’impératif hiphil « ‘Wbyvi’h'», le pécheur doit se détourner de toutes ses
actions de rébellion (v 30-31a) pour que le péché ne soit plus un obstacle « lAvk.mi»
ou une barrière entre Dieu et lui-même. Le deuxième aspect est l’acte de repentance
qui débouche sur un renouvellement intérieur caractérisé par un cœur nouveau et un
esprit nouveau « x:Wråw> vd"Þx' bleî ~k,²l' Wfï[]w:». Le second aspect de la repentance fait
appel à deux termes qu’il convient de considérer de plus près : «ble » et «x;Wr ».
Le premier terme, «ble », dans l’A.T, est généralement traduit par « cœur »,
«esprit», mais aussi «poitrine » et «conscience»153. Bien que le champ sémantique
de ce terme soit large, il est à noter que, le plus souvent, les auteurs
vétérotestamentaires l’emploient dans un sens métaphorique pour faire référence
soit au siège physique et spirituel de l’être humain, soit à tout l’être intérieur154. « ble»
est donc perçu comme le siège des émotions, le siège de l’intellect, et le siège de la
volonté. C’est le centre de l’être, là où la personne est face à elle-même, avec ses
sentiments, sa raison et sa conscience, et où elle assume ses responsabilités en
posant ses choix décisifs, ouvert ou non à Dieu155.
Le second terme, «x;Wr » a aussi un champ sémantique très large ; il peut
signifier aussi bien : « vent », « souffle », « haleine », « respiration », « air »,
« âme », « vie », « passion », « volonté », « esprit »156. Dans le livre d’Ezéchiel,
« x;Wr » est employé 46 fois (dont 32 dans les chapitres 1-24, un dans les chapitres
152
Brian, TIDIMAN, Le livre d’Ezéchiel, tome 1, op.cit. p. 236 153
Willen A., VANGEMEREN sous dir, Dictionary of Old Testament Theology & Exegesis, vol. 2, Grand
Rapids: Zondervan Publishing House, 1997, p. 749 154
Ibid. 155
Jean-Yves, LACOSTE, sous dir, Dictionnaire critique de théologie, Paris : Quadrige/PUF, 1998, p. 26 156
Willen A., VANGEMEREN sous dir, Dictionary of Old Testament Theology & Exegesis, vol. 3, Grand
Rapids: Zondervan Publishing House, 1997, p. 1073
59
25-32 et 13 dans les chapitres 33-39)157. Des 46 emplois de «x;Wr », 12 concernent le
vent, 23 se réfèrent à Dieu et 11 concernent l’homme (dont le verset 31 du chapitre
18)158. Hans Wolff propose qu’on entende par « hv'_d"x] x:Wråw>» du v 31, « la volonté
nouvelle et persévérante » en vue de l’action, et non l’ « esprit nouveau »159. Car
selon lui, le terme «x;Wr » correspond rarement à ce que nous appelons « esprit » et
qui se réfère au siège de la connaissance, des activités intellectuelles160.
C’est à ces conceptions qu’Ezéchiel fait référence lorsqu’il invite les exilés à
se faire un cœur nouveau et une volonté nouvelle. Les exilés sont donc conviés à
abandonner leur obstination à croire qu’ils sont victimes de la situation chaotique
dans laquelle ils se trouvent. Ils doivent reconnaitre qu’ils en sont aussi
responsables, puis à revenir en toute humilité à Dieu afin de recevoir miséricorde.
Ces décisions, c’est dans le « ble» que cela se décide, car c’est en son cœur que
l’homme se décide ou non pour Dieu (Dt 6. 5s) ; et elles s’accomplissent grâce à une
volonté soutenue et persévérante.
De l’avis de Katheryn P. DARR, ce second aspect de la repentance est unique
dans le livre d’Ezéchiel, dans le sens que le prophète demande aux exilés de se faire
eux-mêmes un cœur nouveau et un esprit nouveau161. C’est un commandement, et
l’emploi de l’impératif «~k,²l' Wfï[]w » « Faites-vous » le démontre bien. Or, Ailleurs le
cœur nouveau et l’esprit nouveau sont présentés comme un don de Dieu (11. 19-20 ;
36. 26). Alors, le prophète Ezéchiel serait-il en train de supposer dans le v 31b une
quelconque capacité d’auto-transformation des exilés ?
157
Daniel, LYS, “Rûach” le souffle dans l’Ancien Testament, Paris : PUF, 1962, p. 121 158
Ibid. 159
Hans Walter, WOLFF, Anthropologie de l’Ancien Testament, Genève: Labor et Fides, 1974, p. 41 160
Ibid. 161
Katheryn Pfisterer, DARR, The Book Of Ezekiel, Introduction, Commentary, and Reflections, in The New
Interpreter’s Bible, vol. VI, Nashville: Abingdon Press, 2001, p. 1264
60
Daniel Block pense pour sa part que le commandement de se faire un cœur
nouveau et un esprit nouveau doit être prit dans un sens rhétorique162. L’emploie de
l’impératif ne signifie pas qu’Ezéchiel croit ses compatriotes capables d’auto-
transformation morale et spirituelle. Il demande plutôt aux exilés de se tourner vers
Dieu et de laisser leurs cœurs et leurs volontés être renouvelés par Dieu. Ezéchiel
ne change donc pas de doctrine, mais il souligne la disposition de cœur avec
laquelle le pécheur doit s’approcher de Dieu. « Dieu ne peut agir que si l’homme Le
laisse entrer »163.
2.3.2. Dieu désire bénir (Ezéchiel 18. 32)
La volonté de la grâce du Seigneur envers l’homme pécheur, annoncé au v
23, puis réitéré au v 28, est une fois de plus soulignée au v 32, en guise de
conclusion de l’oracle. Cette insistance souligne bien que le désir du créateur, c’est
de communiquer la vie et la vie en abondance. C’est pourquoi, face à l’obstination du
peuple en exil, Dieu pose la question suivante : «`lae(r"f.yI tyBeî WtmuÞt' hM'l'îw> » «Et
pourquoi mourriez-vous, maison d’Israël ? » (v 31b). Pourquoi la maison d’Israël doit-
elle mourir, lorsque Dieu se présente à elle comme un Dieu juste, aimant et
compatissant ? Pourquoi le peuple en exil doit-il mourir, lorsque le Seigneur lui-
même prend le soin de montrer le chemin qui donne accès à sa faveur ? « Revenez
donc et vivez ! », voilà le chemin qui conduit sûrement à la vie et qu’il faut suivre.
Cet appel « Revenez donc et vivez ! » fait aussi écho à la souffrance du cœur
d’un père aimant qui désire ardemment voir ses enfants revenir à lui et vivre de
manière juste dans sa communion.
162
Daniel I., BLOCK, The book of Ezekiel, chapters 1-24, op.cit. p. 588 163
Luc-Olivier, BOSSET, op.cit., p. 16
61
Conclusion partielle
Ezéchiel, dans le contexte de la ruine de Jérusalem et de l’exil, est confronté à
des problèmes concernant la responsabilité de l’homme et la justice de Dieu. Il
propose des solutions nouvelles, et il explique longuement sa position avec le souci
de convaincre, dans un passage à la fois casuistique dans la méthode et prophétique
dans son intention164.
Comment s’exercent la responsabilité des hommes et la justice de Dieu ?
Sommes-nous condamnés à payer pour nos ascendants familiaux ? Sommes-nous
définitivement liés par les solidarités qui nous unissent à notre famille et à nos
groupes sociaux ? Sommes-nous prisonniers de notre passé ? Ces questions
permanentes de l’humanité se perçoivent en filigrane dans le texte où Ezéchiel
affirme fortement que chaque personne est à tout instant responsable de ses propres
actes en face de Dieu, quel que soit le groupe auquel elle appartient, quelle que soit
son attitude antérieure, qu’il l’a fait classer parmi les bons ou les mauvais165. En
outre, chaque vie se joue à chaque instant ; rien n’est perdu définitivement pour
personne et rien n’est aussi définitivement gagné. La dignité de l’homme et sa liberté
se trouvent ainsi pleinement reconnues.
Cependant, notons avec Jean-Pierre PREVOST que la position d’Ezéchiel ne
résout pas tous les problèmes.
« D’abord, pour ce qui est de la théorie qu’il essaie de réfuter, disons que le problème n’est résolu qu’à moitié. Si le prophète a bien démontré l’affranchissement des générations l’une par rapport à l’autre dans la justice comme dans l’injustice, il maintient cependant la théorie de la rétribution dans toute sa rigueur. L’injustice ne peut mener qu’à la mort et la justice, à la vie. Peut-être bien, mais l’affirmation inverse est-elle vraie ? Chaque fois qu’on rencontre la mort, faut-il conclure à l’injustice ? Et à la justice, chaque
164
Jean, BRIERE, Raymond, CASTANIE, et al, Les prophètes, Ezéchiel, Les lamentations, Ecouter la Bible,
n°9, Limoges : Desclée de Brouwer/Droget-Ardant, 1977, p. 66 165
Ibid.
62
fois qu’on est en présence de la vie ? (...) Il y a aussi un danger à vouloir tout comptabiliser : si on s’en tient strictement au schéma chronologique présenté par le prophète, il semble qu’une injustice de dernière heure puisse effacer toute une vie de justice (vv 24-26). La question surgit alors : est-ce que Dieu juge chacun selon toutes ses œuvres, ou seulement selon les derniers choix qu’il aurait effectués dans sa vie ? Une telle perspective ne risque-t-elle pas d’engendrer la peur et de paralyser la liberté, cette liberté que le prophète entend précisément réhabiliter ?»166
D’autre part, soulignons qu’Ezéchiel ne rompt pas complètement avec la
responsabilité collective, car il continue de penser l’avenir d’Israël en termes de
peuple. La vision des ossements desséchés (Ez 37) envisage la vie nouvelle non
pas d’individus mais d’un peuple. Il y a plutôt cohabitation de la responsabilité
collective et de la responsabilité personnelle, mais avec un accent plus particulier sur
la responsabilité personnelle : C’est l’âme qui pèche qui mourra (Ez 18. 4, 20).
L’hypothèse que nous avons énoncée dès le départ se vérifie ici aussi. Pour
rappel, nous disions que, même si l’influence du père sur son fils est normale,
structurante, pesante, mais ce n’est pas elle qui doit conditionner l’agir du fils. Les
enfants ne sont pas condamnés à répéter les fautes des parents et subir les
conséquences de ces fautes, car il n’y a pas d’hérédité spirituelle des fautes et des
châtiments167. Nous sommes individuellement responsables devant Dieu de nos
actions et de notre conduite. Et il est donc possible de rompre la chaîne de la
malédiction en ayant un comportement différent de celui de la génération précédente
et être l’objet des bénédictions de Dieu.
De ces résultats de l’exégèse, nous pouvons soutenir qu’à ce stade-ci de
notre mémoire, notre hypothèse se vérifie pleinement. L’intérêt de ce travail résidant
aussi dans la transmission des résultats de nos recherches au corps de Christ en
166
Jean-Pierre, PREVOST, Pour lire les prophètes, op.cit. p. 149-152 167
L’hérédité spirituelle des fautes et des châtiments signifierait que les parents transmettent spirituellement et
de façon automatique leurs fautes et les conséquences de ses fautes à leurs enfants dès la naissance. Ce
qu’impliquerait qu’il n’y ait aucune possibilité pour les enfants de vivre autrement.
63
Afrique, en général, et au corps de Christ en Côte d’Ivoire, en particulier, nous allons,
dans le troisième chapitre, rechercher les possibilités d’application des
enseignements découverts à partir du travail d’exégèse.
64
CHAPITRE TROISIEME :
IMPLICATIONS D’EZECHIEL 18. 1-4, 20-32 POUR L’EGLISE AUJOURD’HUI
Au regard de l’analyse exégétique du texte d’Ezéchiel 18. 1-4, 20-32, nous
pouvons affirmer sa richesse à tout point de vue. En cela, elle pourrait contribuer
d’une manière significative à éclairer l’un des problèmes qui se posent à l’Eglise
africaine, plus particulièrement à l’Eglise en Côte d’Ivoire : celui de la transmission
automatique des fautes/châtiments d’une génération à l’autre. A l’instar d’Ezéchiel, il
nous faut répondre à ce problème théologique afin que les chrétiens d’aujourd’hui
vivent pleinement leur liberté en Christ Jésus.
Notons, cependant que ce chapitre n’aura pas la prétention de répondre à
toutes les questions que pose le problème de la transmission automatique des
fautes/châtiments d’une génération à l’autre. Nous nous limiterons à répondre à
celles-ci : y a-t-il une hérédité spirituelle des fautes et des châtiments ? En d’autres
termes, les descendants sont-ils condamnés à répéter les fautes de leurs
ascendants ? Les descendants sont-ils condamnés pour les fautes de leurs
ascendants ? Quelle ouverture le principe de responsabilité personnelle donne-t-elle
aux descendants vis-à-vis de leurs ascendants ? Quelle est l’importance de l’œuvre
65
de rédemption de Christ pour les descendants, vis-à-vis des fautes de leurs
ascendants ?
Pour y arriver, nous nous attellerons dans un premier temps, à souligner très
clairement la réponse d’Ezéchiel à la question de la transmission automatique des
fautes/châtiments ; ensuite, nous relèverons les différentes tendances qui se
dégagent de l’avis des chrétiens, au sujet de la transmission automatique des
fautes/châtiments ; aussi, nous porterons un regard critique sur chacune de ces
tendances. Enfin, nous ferons des propositions dans le but d’aider à freiner la
prolifération de conceptions théologiques incorrectes parmi les chrétiens.
3.1. TRANSMISSION AUTOMATIQUE DES FAUTES/CHATIMENTS D’UNE
GENERATION A L’AUTRE : REPONSE D’EZECHIEL
Face à la conception fataliste des exilés dont l’expression visible était le
proverbe pernicieux du v 2, Ezéchiel donne trois réponses :
3.1.1. Il n’y a pas d’hérédité spirituelle des fautes/châtiments
«…le fils ne portera pas la faute du père ni le père la faute du fils ; la justice du
juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. » (Ez 18. 20) (TOB).
Nous disions dans le commentaire exégétique que cette déclaration de Dieu souligne
bien qu’il n’y a d’hérédité ni pour le bien ni pour le mal. Cette vérité indéniable est
renforcée dans l’argumentation d’Ezéchiel par l’usage de l’interdiction permanente
«aF'äyI-al{ » d’une part, et d’autre part, par la présentation des représentants de trois
66
générations (Ez 18. 5-18). L’exposé qu’Ezéchiel fait de la vie de chaque représentant
démontre que le fils injuste n’a pas hérité de la vie juste du père et le petit-fils non
plus, n’a hérité de la vie injuste de son père. Le petit-fils au contraire, malgré le
mauvais exemple de son père, a su se démarquer des dispositions perverses de ce
dernier et vivre une vie qui soit conforme aux prescriptions de Dieu (vv 14-18). En
outre, les jugements que l’Eternel prononce à l’issu de chaque vie (vv 9, 13, 17)
révèlent aussi qu’il n’impute pas à une génération les actes qui échappent à celle-ci.
Ainsi donc, nous pouvons conclure avec Ezéchiel qu’il n’y a pas d’hérédité
spirituelle des fautes/châtiments. En d’autres termes, il n’y a pas de transfert ou de
communication directe des fautes des ascendants, par un quelconque moyen, aux
descendants. Aussi, les descendants ne sont pas condamnés pour les fautes de
leurs ascendants familiaux. Si les enfants devraient hériter des fautes de leurs
parents et en être condamnés, alors il ne devrait y avoir aucune possibilité de
conversion, de changement. Tout serait à l’avance déterminé et le fatalisme règnerait
en maître.
Toutefois, le manque d’hérédité spirituelle ne signifie aucunement qu’il n’y
aurait pas d’influence du comportement des parents et des fautes de ceux-ci sur
leurs enfants. La réalité, c’est que les erreurs des ascendants peuvent avoir des
conséquences qui s’étendent sur ceux qui ne les ont pas commises. La présence
des Israélites à Babylone est le signe que les exilés ont été influencés par les
dispositions perverses de leurs parents. Ils n’en ont pas simplement été influencés,
ils ont eux-mêmes pris part à ces dispositions perverses. C’est pourquoi Ezéchiel
s’est attelé à leur faire accepter leur responsabilité personnelle dans le malheur qui
les a atteint (vv 21-24).
67
3.1.2. Responsabilité personnelle
La responsabilité personnelle n’est pas mise en exergue par Ezéchiel
simplement pour souligner la culpabilité des exilés, bien que celle-ci soit prise en
compte. Ezéchiel met bien plus l’accent sur la possibilité - puisqu’il n’y a ni fatalisme
ni déterminisme - de rompre la chaîne de malédiction, qui atteint les générations
futures, parce que celles-ci contribueraient à l’allongement de cette chaîne. Ezéchiel
nous rappelle que, si les erreurs de nos ascendants familiaux peuvent avoir des
conséquences qui s’étendent sur plusieurs générations, cela ne reflète pas la volonté
de Dieu. Cette réalité est dans l’ordre des choses de ce monde 168: c’est le principe
de causalité. Selon J. S. MILL, la causalité se réfère à « l’antécédent ou l’ensemble
d’antécédents dont le phénomène appelé effet est invariable et inconditionnellement
le conséquent »169. Ce principe signifie que tout acte posé par une personne du fait
de ses choix, peut entrainer des effets positifs ou négatifs, et qui ne résultent pas
forcement d’une intervention divine. Heureusement ou malheureusement, ces effets
peuvent atteindre d’autres personnes que celles qui en sont les causes. Le désir de
Dieu, c’est que tout être humain fasse le choix du bien afin que les conséquences
soient heureuses pour lui et ses descendants. C’est pourquoi il déclare en Dt 30. 19b
ceci : « c'est la vie et la mort que j'ai mises devant vous, c'est la bénédiction et la
malédiction. Tu choisiras la vie pour que tu vives, toi et ta descendance » (TOB).
Dans le cas où les ascendants d’un individu ont fait des choix négatifs qui ont
entrainé des conséquences toutes aussi négatives ; la responsabilité de ce dernier
n’est pas d’avoir commis cette erreur d’hier dont il subit les conséquences, mais sa
responsabilité est d’y mettre fin et de commencer une vie qui soit conforme aux
168
Luc-Olivier, BOSSET, op.cit. p. 20 169
Gilles, FERREOL, sous dir, Dictionnaire de sociologie, 2e édition revue et augmentée, Paris : Armand
Colin/Masson, 19952, pp. 15-16
68
prescriptions de Dieu170. Et cette responsabilité commence par une réponse
favorable à l’appel à la conversion.
3.1.3. Appel à une réelle conversion
Le principe de la solidarité collective, tel que perçu par les contemporains
d’Ezéchiel rendait le salut des justes improbable et impossible, puisque ces
innocents doivent payer les fautes de leurs pères et celles de leurs compatriotes.
Ezéchiel, par son message, libère ceux qui sont tentés de s’abandonner au
fatalisme, en leur montrant le chemin de la miséricorde et de la liberté : la
conversion.
Ezéchiel conçoit la conversion comme un double mouvement qui, d’une part
éloigne du péché, et d’autre part porte vers Dieu. Ainsi, le premier mouvement doit
obligatoirement conduire le pécheur à s’éloigner, à la fois, des dispositions perverses
entretenues par ses ascendants, qui ont sans doute façonnées son environnement
familial, et de ses fautes personnelles. Le second mouvement doit ensuite, amener
le pécheur repentant à se tourner vers Dieu et à laisser son cœur et sa volonté être
renouvelés par lui. Au bout de ce double mouvement se trouvent la miséricorde, la
grâce et la vie : « Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il
observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas.
Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées ; il vivra, à cause de la
justice qu'il a pratiquée. » (vv 21, 22). Non seulement l’Eternel lui pardonne
totalement ses péchés et les oublies, mais aussi, il lui accorde une nouvelle vie qui
ne dépend ni du passé ni de l’avenir, mais du présent. La condition qui est posée de
façon implicite au pécheur qui reçoit la grâce de Dieu, c’est la fidélité dans les
170
Luc-Olivier, BOSSET, op.cit. p. 20
69
nouvelles dispositions que Dieu lui offre par le renouvellement de son cœur et de son
esprit (v 31).
Dans le chapitre 36 d’Ezéchiel, où il est question de la restauration et de la
régénération du peuple d’Israël, le prophète présente les nouvelles dispositions dont
bénéficie le pécheur repentant (le cœur nouveau et l’esprit nouveau), comme un don
surnaturel de Dieu, une transformation qui sera accomplie par l’Esprit de Dieu. Se
situant dans la lignée des prescriptions rituelles du Lévitique171, Ezéchiel les dépasse
et laisse entrevoir une nouvelle ère, la nouvelle alliance. Pour la plupart des
prophètes de l’A.T, l’Esprit est associé étroitement au « serviteur de Yahvé » (cf. Es
42. 1), et avec lui le don (du cœur nouveau ; de l’esprit nouveau) devient le signe de
l’âge messianique (Es 44. 3 ; 59. 19-21 ; Ez 39. 29 ; Jl 3. 1-5 ; Ac 2. 4ss)172.
Dans la nouvelle alliance, ce renouveau est accompli par le Saint-Esprit sur la
base de l’œuvre de rédemption de Jésus-Christ, mais aussi sur la condition de la
conversion. Il est important de noter que la conversion dans la nouvelle alliance
prend aussi en compte le double mouvement qui était exigé au pécheur dans
l’ancienne économie : se détourner de tous ses péchés (cf. Rom 2. 5-10 ; 2 Co 12.
21) et venir à Dieu (cf. 1 Th 1.9 ; Ac 14. 15 ; 15. 19 ; 1 Pi 2. 25)173. Il existe,
néanmoins, une nuance entre la conversion sous l’ancienne économie et celle de la
nouvelle économie. Sous la nouvelle alliance, la conversion a un sens initiatique,
c’est-à-dire que, c’est par la conversion qu’une personne entre, pour la toute
première fois, en relation avec Dieu par Jésus-Christ. En ce sens, elle concerne
davantage les peuples non Juifs qui n’avaient pas le privilège de la relation
particulière qu’Israël avait avec Dieu. Sous l’ancienne alliance, la conversion
171
« Je ferai sur vous une aspersion d'eau pure et vous serez purs ; je vous purifierai de toutes vos impuretés et
de toutes vos idoles. » (v 25). 172
Brian, TIDIMAN, Le livre d’Ezéchiel, tome 1, op.cit. p.144 173
T. Desmond, ALEXANDER & Brian S., ROSNER, sous dir, Dictionnaire de théologie biblique, Cléon
d’Antran : Editions Excelsis, 2006, p. 866
70
s’adressait, par contre, à un peuple qui était déjà en relation avec Dieu. Dans ce
sens, la conversion prend plus la connotation de repentance.
Lorsque le double mouvement de la conversion est accompli, le croyant peut
bénéficier pleinement des nombreux bienfaits de l’œuvre de rédemption du Christ.
3.1.4. Bénéfices d’une réelle conversion
Evoquons ici trois bénéfices pour le pécheur repentant.
Le premier bénéfice dont jouit le pécheur repentant, c’est la justification.
Selon Henri BLOCHER, la justification « est l’acte forensique174 de Dieu par lequel il
déclare le pécheur en règle avec sa justice, quitte des peines qu’il méritait et reçu
favorablement dans la présence divine, à cause du Christ en qui cet homme a mis sa
foi »175. De cette définition se dégage trois privilèges pour le pécheur repentant :
- Le premier privilège est le fait que le pécheur repentant, malgré ses
péchés, est acquitté par Dieu sur la base de la mort expiatoire de Jésus-
Christ. Le pécheur repentant est déclaré juste et reçoit « pour rien »176 le
pardon de tous ses péchés (Rom 3. 23-25 ; Ac 13. 39 ; Lc 18. 14), ainsi
que la liberté vis-à-vis du pouvoir asservissant du péché.
- Le deuxième privilège est que, par la satisfaction pénale substitutive
accomplie par Christ à la croix, le pécheur repentant est épargné de toutes
les peines et de la malédiction de la loi qu’il méritait (Gal 3. 10-14).
- Le troisième enfin, est que le pécheur repentant est accueilli dans la
communion avec Dieu, maintenant, puis en plénitude dans le règne à venir
(Rom 5. 1s).
174
Décision du juge siégeant en son tribunal (de for, tribunal) 175
Henri, BLOCHER, La doctrine du péché et de la rédemption, Vaux-sur-Seine : EDIFAC, Didaskalia, 2000,
pp. 286-287 176
Ibid. p. 286
71
Les privilèges ci-dessus mentionnés ne transparaissaient-ils pas déjà, dans
l’appel à la conversion que l’Eternel a adressé aux exilés ? Ezéchiel, par la
déclaration suivante, ne pointait-il pas du doigt aussi, les réalités à venir ?
«Quant au méchant, s'il se détourne de tous les péchés qu'il a commis, s'il garde toutes mes lois et s'il accomplit le droit et la justice, certainement il vivra, il ne mourra pas. 22 On ne se souviendra plus de toutes ses révoltes, car c'est à cause de la justice qu'il a accomplie qu'il vivra. 23 Est-ce que vraiment je prendrais plaisir à la mort du méchant - oracle du Seigneur DIEU - et non pas plutôt à ce qu'il se détourne de ses chemins et qu'il vive ? » (Ez 18. 21-23) (TOB)
Si l’ancienne économie prévoyait de telles dispositions de grâce pour le
pécheur repentant, combien plus la nouvelle économie ?
Le second bénéfice dont jouit le pécheur repentant et justifié est la
régénération, aussi appelée nouvelle naissance. Le pécheur repentant, après avoir
été acquitté par grâce ne peut continuer à croupir dans l’asservissement de ses
penchants mauvais. Dieu le libère non seulement de la responsabilité de ses actes
coupables, mais il est aussi délivré de la servitude de sa nature et ses dispositions
mauvaises. Dans ce sens, J. Murray dira que par la régénération Dieu « change
l’homme tout entier dans son cœur, ses dispositions, inclinations, désirs, motifs,
intérêts, ambitions et desseins » 177. Notons que ce renouveau n’est effectif que dans
notre esprit et notre cœur (Ez 36. 26). Il ne modifie pas pour le moment, l’état de
notre chair qui reste portée vers le mal (Rom 7. 18 ; 8. 7)178. Nous attendons la
rédemption de notre corps (Rom 8. 23), pour l’heure nous sommes en voie de
transformation. Les effets de la régénération sont progressifs, mais la régénération
elle-même ne l’est pas179.
177
J. MURRAY cité par Henri, BLOCHER, La doctrine du péché et de la rédemption, Vaux-sur-Seine :
EDIFAC, Didaskalia, 2000, p. 264 178
J.-M., NICOLE, Précis de doctrine chrétienne, Nogent-sur-Marne : Institut Biblique de Nogent, 19985, pp.
194-195 179
Ibid. p. 195
72
Le troisième bénéfice, enfin, est la sanctification. La sanctification est
envisagée dans l’Ecriture sous deux aspects : la sanctification de principe et la
sanctification progressive180. L’on entend par sanctification par principe, le fait que
dès l’instant où tout être humain accepte le salut de Christ, il appartient au Dieu saint
et devient donc saint. Cette sainteté n’est pas le caractère spécial d’une élite de
croyant, mais la position commune de tous ceux qui ont fait l’expérience de la
régénération181. Cependant, bien que le pécheur repentant soit bénéficiaire d’une
telle position de sainteté, il lui reste beaucoup à faire. Il faut qu’il soit débarrassé des
vestiges de son ancienne nature, et pourvu des qualités requises pour le service de
son Seigneur : c’est la sanctification progressive. C’est ce qui justifie les nombreuses
exhortations aux saints, à rechercher la sanctification, sans laquelle nul ne verra le
Seigneur, à devenir saints dans toute leur conduite, à être davantage sanctifiés (Héb
12. 14 ; 1Pi 1. 15 ; Apoc 22. 11).
Tous ces bénéfices ci-dessus mentionnés, font du pécheur repentant une
nouvelle personne, une nouvelle créature. Ses péchés sont pardonnés et oubliés ; il
n’est plus sous le coup des malédictions qu’il méritait, parce que Christ s’est fait
malédiction, pour que lui, il soit bénédiction (Gal 3. 13) ; sa nature et ses dispositions
mauvaises sont transformées ; il devient dorénavant capable d’obéir à la volonté de
Dieu ; il est déclaré saint et toutes ses aspirations tendent vers la sainteté. Par tous
ces bénéfices, l’apôtre Paul n’a-t-il pas raison de déclarer que « Si quelqu'un est en
Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées ; voici,
toutes choses sont devenues nouvelles. » (2 Co 5. 17).
Il ressort de ce qui précède que, dans l’ancienne alliance et bien plus dans la
nouvelle, l’Eternel offre le privilège à tout être humain d’être libéré, non seulement
des dispositions perverses de sa nature pécheresse, mais aussi des dispositions
180
Ibid. p. 207 181
Ibid. 208
73
perverses issues de son environnement socio-familial et des malédictions qui y sont
attachées. Sous la nouvelle alliance, le chrétien, celui qui jouit de tous les bienfaits
de l’œuvre de rédemption de Christ, est donc par nature une personne libre. Libre,
des péchés des parents et de ses propres péchés ; libre, des malédictions qui
pesaient sur ses parents et sur lui-même - du fait de sa participation aux dispositions
qui attirent la malédiction - parce que Christ a porté ses malédictions et a transformé
son cœur et ses dispositions.
La réponse d’Ezéchiel à la question de la transmission automatique des
fautes/châtiments est prophétique, en ce sens qu’elle met à nu un mécanisme
humain qui se retrouve encore dans nos attitudes aujourd’hui. Comment réagissons-
nous, lorsque nous sommes confrontés à un problème touchant à la vie d’un groupe
dont nous faisons partie : famille, pays, ethnie, Eglise, etc.
3.2. TRANSMISSION AUTOMATIQUE DES FAUTES/CHȂTIMENTS D’UNE
GENERATION A L’AUTRE : TENDANCES ACTUELLES
A l’exemple des contemporains d’Ezéchiel qui avaient développé des pensées
propres à eux-mêmes, au sujet de la transmission des fautes/châtiments d’une
génération à l’autre, les chrétiens d’aujourd’hui se forgent aussi des conceptions à
propos du même sujet. Ces conceptions semblent avoir pour fondement, soit
l’expérience du vécu, soit une compréhension superficielle ou partielle des textes
bibliques.
L’analyse des propos tenus par certains chrétiens et par des serviteurs de
Dieu, dans les prières, dans les prédications et dans les discussions, semble mettre
74
en lumière trois tendances à propos de la transmission des fautes /châtiments des
ascendants aux descendants. Outre, ceux qui pensent que les descendants peuvent
subir les conséquences des fautes des parents, mais qu’ils peuvent cependant y
échapper182 ; il y a ceux qui croient qu’il n’y a aucun rapport entre les souffrances
des descendants et les fautes des ascendants ; il y a aussi ceux qui conçoivent
qu’immanquablement les descendants subissent les fautes des ascendants.
3.2.1. Il n’y a aucun rapport entre les souffrances des descendants et les
fautes des ascendants
La première tendance concerne ceux qui pensent qu’en réalité il n’y a aucun
rapport entre les souffrances des descendants et les fautes de leurs ascendants ;
chacun n’est responsable que pour soi. Cette position prend appui sur la
radicalisation de l’enseignement d’Ezéchiel au sujet de la responsabilité
personnelle183. Pour les tenants de cette position le message d’Ezéchiel est clair :
« l'âme qui pèche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père,
et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la
méchanceté du méchant sera sur lui. » (Ez 18. 20) D’autre part, il existe dans la
présente conception, un lien entre la responsabilité individuelle et l’individualisme au
sens moderne du mot ; c’est-à-dire, le fait que l’individu moderne soit seul face à lui-
même, face à sa destinée. Cela, parce qu’il s’aurait affranchi de la tutelle de la
famille, de la collectivité. De ce fait, l’individu ne peut aucunement accuser ses
ascendants d’être la base de ses malheurs. Il est le seul responsable des difficultés
182
Cette conception a déjà fait l’objet d’un commentaire dans la première partie de ce chapitre (3.1.1.). Nous
adhérons pleinement à cette conception. 183
D. GUTHRIE, J.A., MOTYER, et al, sous dir, Nouveau commentaire biblique, Saint-Légier : EMMAÜS,
19914, p. 702
75
qu’il rencontre. Il doit donc les assumer et trouver par lui-même les solutions à ses
propres malheurs.
S’il est vrai que cette tendance exclu d’emblée l’idée d’hérédité spirituelle des
fautes/châtiments, elle brise cependant la relation entre l’individu et la communauté ;
entre la responsabilité collective et la responsabilité personnelle. Rappelons ici que,
le prophète Ezéchiel par son enseignement sur la responsabilité individuelle, ne
supprime pas la responsabilité collective. Il montre plutôt que, les Israélites sont
collectivement et individuellement responsables devant le Seigneur184. Ainsi, autant
la responsabilité personnelle dénonce l’illusion qui pousse à condamner les autres
sous prétexte que l’on est soi-même innocent, autant la responsabilité collective, elle,
met en garde l’individu sur ses choix et sur les conséquences que ces choix
pourraient avoir sur la collectivité.
En outre, il ne faut surtout pas perdre de vue qu’Ezéchiel fait face à une crise
due à une conception erronée de la responsabilité collective. Conception qui donne
plus d’importance au destin collectif qu’à la destinée individuelle. Le but du prophète
était donc de corriger cette pensée erronée en mettant l’accent sur la responsabilité
personnelle. Ne pas tenir compte de ce contexte peut donc conduire à des
conclusions trop radicales. L’ensemble du livre d’Ezéchiel nous invite d’ailleurs à une
position équilibrée vis-à-vis de la responsabilité collective et la responsabilité
personnelle (cf. Ez 36 ; 40-48).
184
Habtu, TEWOLDEMEDHIN, « Ezéchiel », op.cit. p. 1019
76
3.2.2 Les descendants subissent immanquablement les fautes de leurs
ascendants
La seconde tendance rassemble ceux qui pensent qu’immanquablement les
descendants, même chrétiens, subissent les conséquences des péchés des
ascendants familiaux. Les tenants de cette position justifient leur conviction à partir
des témoignages qui découlent des expériences de certains chrétiens, comme en
témoigne ce qui suit :
« Prenons comme exemple le cas d’un homme pour qui rien ne marche, ni dans son travail, ni dans un commerce quelconque. Cet homme devient chrétien (est né de nouveau) mais rien ne marche pour lui. Quand il examine la vie de son père, il voit que pour celui-ci non plus rien n’a jamais marché ; il en est de même pour son grand-père. Même en ce qui concerne la scolarité, cet homme constate que ses frères et lui, après une ou deux années à l’université, ont du arrêter. Il est évident que c’est un problème de sang, spirituellement parlant. Et cela lui a été transmis par le cordon ombilical. C’est pour cette raison que le cordon ombilical doit être coupé. »185
Ce témoignage révèle la condition d’une personne, avant et après sa
conversion. Le constat est qu’il n’y a aucune différence, en ce qui concerne sa
situation sociale, entre sa vie de non chrétien et sa vie de chrétien (rien ne marche).
La conclusion que Zacharie ADETOLA tire du constat est que les difficultés
rencontrées par cette personne devenue chrétienne, lui ont été transmises par ses
ascendants familiaux (grand-père et père) par le biais du sang spirituel. Cette
personne verra donc cesser ses difficultés, lorsque le moyen de transmission du
sang spirituel, c’est-à-dire le « cordon ombilical spirituel », sera coupé. Ainsi, même
après la conversion, aussi longtemps que le « cordon ombilical spirituel »186 ne sera
185
Zacharie A,. ADETOLA, Les origines, couper le cordon ombilical, op.cit. p. 14 186
Le cordon ombilical spirituel se présente comme le canal qui maintien le « flux » de l’hérédité, de la
malédiction.
77
pas coupé, la malédiction demeurera sur le descendant187. Pour rompre le « cordon
ombilical spirituel », il faut, selon ADETOLA, à toute personne née de nouveau,
s’informer sur les origines de ses ascendants afin de connaître les influences
négatives qui proviendraient de ces derniers, et dont il a hérité par le sang, dès sa
naissance188. Il lui faut aussi s’enquérir des implications surnaturelles qui ont
conditionné et/ou suivi sa naissance189. Selon ADETOLA, la récolte de ces
informations est capitale parce que, « bien souvent, des personnes sont en proie à
de graves difficultés dans certains aspects de leur vie, à cause de situations qui leur
sont inconnues mais dont elles ont hérité et qui datent de plusieurs
générations… »190.
Il apparaît évident que Zacharie ADETOLA soutient l’idée d’une hérédité
spirituelle de la malédiction, donc de la culpabilité, puisqu’il n’y a pas de malédiction
sans cause (cf. Pr 26. 2). Il affirmera sans ambages que « par [le cordon ombilical]
nous héritons des influences surnaturelles auxquelles sont assujettis les parents et
les ascendants en général »191. Cette lecture des choses est en porte-à-faux avec la
réponse d’Ezéchiel qui rejette l’idée d’une quelconque hérédité des fautes et des
187
Zacharie A,. ADETOLA, op.cit. 188
ADETOLA, dans les pages 8, 10 à 17 de son ouvrage, nous instruit sur le type de renseignement qu’il faut
avoir sur les ascendants. Il s’agit pour le descendant de savoir qui est son père, qui est sa mère. Ont-ils réussi ?
Ont-ils pu avoir une vie accomplie ? Sont-ils des personnes exemplaires ? Le descendant a-t-il hérité d’un trait
de caractère du père ou de la mère ?
Il s’agira aussi pour le descendant de s’informer des influences négatives qui sont en rapport avec les pays
d’origines des parents et de son pays de naissance. En effet, pour ADETOLA, les influences négatives peuvent
être en rapport avec les pays d’origine et de naissance. Pour étayer son affirmation, ADETOLA donne l’exemple
suivant : « Prenons le cas d’un enfant né en Grande Bretagne, de mère Egyptienne et de Père Français. Il est sous
l’influence du côté de son père de l’esprit de la divination très présent en France. (…) L’héritage maternel
apportera à cet enfant une sensibilité à l’occultisme. La rébellion et l’orgueil britanniques influenceront à leur
tour l’enfant. » (p. 11) 189
Ici aussi, ADETOLA donne un exemple du type de pratique spirituel occulte qui se fait au cours de la
naissance et qui nécessite la rupture du « cordon ombilical spirituel » : « …dans certaines cultures, lorsqu’une
femme est à la maternité, les vieux de la famille attendent dehors. Dès qu’elle accouche, ils récupèrent le
placenta et rentrent chez eux où ils possèdent un autel avec des fioles d’huile dédiée à des divinités. Ces vieux
déposent sur cet autel le placenta après avoir versé de l’huile. Cette huile est versée sur l’autel pour consolider
l’alliance avec les cieux. (…) Quand le cordon ombilical de l’enfant est coupé, il en reste un bout qui sèche et
tombe. Les vieux de la famille vont au village avec ce bout. Ils prononcent sur cela des incantations et dédient
l’enfant aux divinités familiales, lui transmettant ainsi les problèmes de la lignée, à commencer par ceux du père
et de la mère, ce qui constitue « l’héritage spirituel » » (p. 9) 190
Zacharie A,. ADETOLA, op.cit. p. 13 191
Ibid. p. 8
78
châtiments. En effet, si l’on devrait hériter spirituellement des fautes et des
châtiments, alors le salut des descendants devrait être improbable et impossible,
puisque ces innocents devraient payer les fautes de leurs pères. Dans ce cas, le
message de conversion deviendrait donc illusion.
A notre avis, il faut plutôt parler d’influence de la faute/châtiment. Les
descendants vivant dans un environnement familial où les choix moraux et les
pratiques spirituelles sont contraires aux principes bibliques établit par Dieu, peuvent
être affectés par le mauvais exemple de leurs parents et reproduire ces fautes192. Du
coup, les fautes des parents sont perpétuées ainsi que les conséquences qui les
accompagnent193. D’autre part, il est aussi possible que les descendants soient tout
simplement victimes des fautes de leurs parents194, dans ce cas, non plus, il ne faut
parler d’hérédité. Reconnaissons que face à la complexité de certains problèmes que
nous subissons, une tentation existe qui est de nous laisser ronger par un sentiment
diffus d’impuissance et de soumission195. Ce faisant, nous nous laissons aller à faire
l’amalgame entre la volonté de Dieu et ce que nous vivons au quotidien. D’un tel
amalgame peut naître l’idée que ce qui nous arrive vient de Dieu. Le message
d’Ezéchiel se présente d’ailleurs comme un puissant correctif : « dédiviniser » un
processus que le proverbe populaire se chargeait d’attribuer à Dieu196 (cf. Ez 18. 2).
Contrairement à la conception d’hérédité spirituelle des fautes/châtiments, la
conception d’influence des fautes/châtiments offre la possibilité aux descendants de
192
Selon Ruthe, REINHOID, « un enfant subit l’influence de son milieu, de sa famille, de ses parents et de ses
frères et sœurs. Il est confronté aux pensées, aux sentiments, aux actions et aux valeurs de ses proches, et
enregistre toutes sortes d’impression. ». Citation tirée de Ruthe, REINHOID, Structure de la personnalité, à la
recherche de son identité, Bâle : EBV, 1994, p. 20 193
C’est cette pérennisation des actions des parents qui, selon la traduction de la Bible TOB d’Ex 20. 5, entraine
la malédiction sur les générations futures : «Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux et tu ne les serviras pas,
car c'est moi le SEIGNEUR, ton Dieu, un Dieu jaloux, poursuivant la faute des pères chez les fils sur trois et
quatre générations - s'ils me haïssent - » 194
A l’exemple des enfants qui ont des parents ivrognes et dont l’avenir est hypothéqué à cause des
conséquences de l’ivrognerie. 195
Luc-Olivier, BOSSET, op.cit. p. 17 196
Ibid.
79
bénéficier du salut de Dieu, si ceux-ci acceptent de se convertir. Par les bénéfices de
la conversion, mentionnés plus haut, le descendant converti est affranchi des fautes,
des dispositions perverses et des malédictions entretenues par son environnement
socio-familial197. Il n’y a donc plus de raison que le chrétien cherche encore un
quelconque affranchissement spirituel des fautes et des dispositions perverses de
ses parents. Le faire, c’est remettre en cause la justification, la régénération et la
sanctification du chrétien. C’est aussi créer l’incertitude et le doute dans l’esprit du
chrétien, quant à l’efficacité de l’œuvre de Christ dans sa vie ; surtout, lorsque celui-
ci n’a pas la possibilité de trouver toutes les informations concernant ses parents,
ses ancêtres, et les circonstances qui ont entouré sa naissance198. C’est tout
simplement reconduire le chrétien sous le joug de l’esclavage.
Il est donc inconvenant d’utiliser les difficultés qui se présentent aux croyants
pour justifier une quelconque hérédité des fautes/châtiments et de rendre pénible la
responsabilité de rupture qui incombe au croyant. Il convient de savoir que les
difficultés du croyant peuvent avoir plusieurs sources, qui exigent le discernement et
une responsabilité adaptée.
Rappelons d’abord que le chrétien, bien qu’il soit par nature une personne
libre, il doit, cependant devenir ce qu’il est déjà en Christ199. En effet, comme dit plus
haut, le chrétien issu d’un environnement familial où les choix moraux et les
pratiques spirituelles sont contraires aux principes bibliques établit par Dieu, peut
avoir développé des attitudes200 et des habitudes qui le maintiennent dans les
197
Christ nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour ; en
lui nous sommes délivrés, nos péchés sont pardonnés (Col 1. 13-14) 198
Que ferait un enfant haïtien qui se convertit quelques années après le tremblement de terre du 12 janvier 2010,
et qui aurait perdu toute sa famille au cours de ce tremblement de terre ? 199
J.-M., NICOLE, Précis de doctrine chrétienne, op.cit. p. 208 200
L’attitude est définie par beaucoup de psychologues comme une supposition ou une croyance à laquelle on est
fermement attaché, généralement acquise dans un climat émotionnel et, par conséquent, chargée de fortes
composantes affectives.
80
pratiques des parents et les conséquences qui s’y attachent. Il doit donc se
débarrasser de ces attitudes et habitudes, et se revêtir de celles que Dieu exige.
Dans la pratique, cela se réalise lorsque le chrétien examine constamment
ses habitudes, ses pensées, ses motivations, etc. à la lumière de la parole de
Dieu201. Lorsque, par cette discipline spirituelle, le chrétien découvre que ses
habitudes sont contradictoires à celles que la Bible l’invite à adopter ; il doit consentir
l’effort, avec l’aide de l’Esprit Saint202, d’abandonner les anciennes habitudes et de
vivre selon les prescriptions de Dieu.
Il convient aussi de se souvenir que, les ennemis de nos âmes, Satan et ses
suppôts n’ont aucun intérêt à voir le chrétien prospérer dans la voie de la justice. Ils
peuvent être auteurs de plusieurs difficultés dans la vie du chrétien. L’une des
activités de Satan à l’encontre des chrétiens est bien la persécution. Il le fait de
manière variée : il peut troubler le sommeil des enfants de Dieu par des cauchemars,
retarder, voire empêcher la réalisation des projets des enfants de Dieu (1 Th 2. 18 ;
Ac 17. 13). Le malin peut même détruire les biens et les réalisations des enfants de
Dieu203. D’autre part, la Bible nous fait savoir que beaucoup de cas de maladie et
d’infirmité sont l’œuvre de Satan.
201
Selon A. KUEN, dans son ouvrage intitulé « Laissez-vous transformer » parut en l’an 2000 aux éditions
Emmaüs, (p. 183) l’un des moyens de réalisation de la transformation exigé au chrétien est la contemplation de
la gloire de Dieu. Contempler est une action qui implique tout notre être : volonté (de s’arrêter, de prendre du
temps), raison (qui analyse) et sentiment (de bien-être, de joie de bonheur). La gloire de Dieu se reflète sans
aucun doute en Christ et nous pouvons le connaitre aujourd’hui qu’à travers le miroir de la parole de Dieu. Le
chrétien doit donc prendre le temps de lire et relire dans une attitude de contemplation la parole de Dieu afin de
se laisser imprégner de l’image qu’elle nous présente de Jésus, de sa manière d’agir et de parler, de ses
motivations, de ses relations avec le Père et avec les hommes, etc. Le chrétien qui contemple ainsi le Christ,
s’ouvre à son influence et ne peut rester tel qu’il est, il doit devenir autre, semblable à Christ. 202
Le chrétien, bien qu’aillant la volonté de faire ce que Dieu veut, ne peut cependant, de ses propres forces
changer d’habitude. Il pourra le faire que dans un abandon total à la force que lui communique la grâce
bienveillante de l’Esprit de Dieu. La prière est un moyen essentiel pour le chrétien d’exprimer son abandon et de
bénéficier de la grâce du Saint-Esprit. 203
André, KOUADIO, La démonologie et le combat spirituel, cours dispensé à la FATEAC et à l’IBACY, 2009,
p. 13
81
L’apôtre Paul, parlant de son infirmité, dit : « il m’a été mis une écharde dans la chair,
un ange de Satan pour me souffleter et m’empêcher de m’enorgueillir »204 (2 Co 12.
7). L’exemple le plus frappant, c’est sans nul doute, la situation de Job. Pour ce
patriarche, non seulement Satan avait détruit ses biens matériels, mais aussi ses
enfants, puis sa santé (Job 2-3).Tout ceci nous montre combien Satan est capable
de persécuter injustement les enfants de Dieu.
Également, le chrétien ne doit pas perdre de vue le fait que, sa vie terrestre
n’échappe pas aux dures réalités auxquelles nos sociétés, particulièrement les
sociétés africaines, font face aujourd’hui : pauvreté, échec scolaire, chômage,
problèmes de santé, etc. Face à ces défis, le chrétien ne doit pas trouver
indubitablement leurs causes en une personne, en particulier en ses ascendants ; il
doit plutôt s’armer de courage et s’engager résolument au travail.
Oublier les desseins de l’ennemi, ainsi que les réalités de notre monde, peut
conduire à une mauvaise appréciation des sources des difficultés que rencontre le
chrétien, et croire que celles-ci sont le fait d’une hérédité des fautes/châtiments.
Plusieurs difficultés du chrétien sont inhérentes, soit à sa vie chrétienne, soit à son
appartenance à une société donnée.
En conséquence de tout ce qui précède, nous parvenons à la conclusion
suivante : la liberté du chrétien d’aujourd’hui, vis-à-vis de la conception de l’hérédité
spirituelle des fautes/châtiments, ainsi que du piège, qui consiste à faire
204
Selon Issiaka, COULIBALY, « 2 Corinthiens », in Commentaire biblique contemporain, Marne la Vallée :
Farel, 2008, p. 1522, l’expression « écharde dans la chair » supporte trois grandes interprétations :
- une souffrance physique : une maladie dont aurait souffert l’apôtre ;
- une souffrance théologique : Paul n’arrive pas à gagner les Juifs à l’évangile ;
- une souffrance apostolique : les oppositions constantes à l’apostolat paulinien
Nous optons pour la première interprétation, sachant tout de même qu’aucune hypothèse n’est entièrement
satisfaisante, en raison de la pudeur de l’apôtre Paul qui, ne voulant pas parler de lui-même, utilise un langage
ambigu.
82
automatiquement le lien entre toute difficulté de la vie présente et les fautes des
ascendants familiaux, passe, dès la conversion, par un accompagnement pastoral
sérieux soutenu par une solide éducation chrétienne.
3.3. PLAIDOYER POUR UN ACCOMPAGNEMENT PASTORAL SERIEUX ET UNE
EDUCATION CHRETIENNE ADEQUATE
3.3.1. Accompagnement pastoral
L’emploi des termes « accompagnement pastoral » au lieu de « relation
d’aide » ou de « cure d’âme », est simplement une question de convenance. Ces
termes, bien que donnant des images différentes, indiquent fondamentalement
l’assistance spirituelle et morale qui vise à aider une personne à sortir des difficultés
qu’elle traverse.
3.3.1.1. Raisons d’un accompagnement pastoral
Deux raisons fondent ce plaidoyer pour l’accompagnement pastoral du
chrétien, et cela, dès sa conversion.
La première raison est le fait que toute personne qui vient à Christ, est une
personne marquée. Marquée, par son environnement socio-familial et par ses
propres expériences religieuses, spirituelles, sentimentales, etc. Cette personne est
non seulement marquée, mais, elle est aussi en lutte avec tous les problèmes
83
afférents à son environnement et à ses expériences. C’est donc, une personnalité
complexe et chargée qui vient à Christ pour bénéficier, d’une part, de la vie éternelle,
gracieusement offerte, et d’autre part, pour obtenir la libération de tout ce qui fait
entrave à son plein épanouissement. Une telle personne, a plus que tout, besoin
d’un accompagnement pastoral.
Par l’accompagnement pastoral, le chrétien pourra prendre conscience du
poids et de l’impact que son environnement socio-familial et religieux a sur lui. Il
pourra aussi faire la différence entre les dispositions, les habitudes et attitudes
iniques issues de sa vie avant Christ dont il doit se séparer, et les dispositions,
habitudes et attitudes nouvelles qui sont offertes et exigées en Christ.
L’accompagnement pastoral l’aidera aussi à faire la part des choses, en ce qui
concerne les difficultés dues aux péchés des parents, les difficultés liées à sa vie
chrétienne ou à sa vie terrestre et sa responsabilité face à chacun de ses problèmes.
Enfin, l’accompagnement pastoral aidera, surtout le chrétien, à jouir pleinement de
tous les bénéfices et privilèges que sa relation avec Christ lui permet d’avoir.
La seconde raison se dégage du constat que nous faisons à propos de la
pratique de l’accompagnement pastoral en général dans l’Eglise en Côte d’Ivoire. Le
constat, est qu’il y a une carence de suivi spirituel du chrétien205. En général, le suivi
spirituel semble se résumer à un entretien qui se déroule juste après l’engagement
verbal de celui ou de celle qui prétend avoir fait l’expérience de la rencontre
personnelle avec Jésus-Christ ; ou à des séances de prière, de jeûne et de
délivrance206. Bien que ces actions soient importantes et utiles pour le chrétien, elles
renferment, cependant, des lacunes et des faiblesses207.
205
Colette, KANGA, Réflexion sur la pratique de la relation d’aide dans nos églises : enjeux et perspectives,
mémoire de maîtrise présenté à la Faculté de Théologie Evangélique de l’Alliance Chrétienne d’Abidjan, 2006,
p. 56 206
Ibid. p.46 207
Ibid.
84
Selon Colette KANGA, ces lacunes sont de trois ordres : un présupposé de la
possession démoniaque, un déficit de l’écoute et une pratique de la théorie des liens
ancestraux208. En ce qui concerne le présupposé de la possession démoniaque, le
danger, c’est de voir en tout problème, qu’il soit d’ordre physique, moral, sentimental
ou spirituel, une possession démoniaque. Un tel regard n’est ni équilibré ni biblique
et cela limite tout le processus de l’accompagnement pastoral à la délivrance209.
Cependant, toute conception qui ignorerait ou qui nierait l’importance de la
délivrance dans le processus de l’accompagnement pastoral, n’est pas non plus
acceptable. En effet, les esprits impurs peuvent effectivement être à la base d’un
problème physique, moral, sentimental, etc. L’enjeu ici, c’est le discernement.
Le déficit d’écoute, qui est la seconde lacune, est dû, le plus souvent, au
manque de temps des conseillers spirituels et au fait que le chrétien est plus ou
moins réduit à appliquer les recommandations du conseiller, après un temps
d’écoute relativement court. La troisième lacune, enfin, est le fait que toute la
responsabilité des difficultés du chrétien semble se focaliser sur les liens ancestraux.
Certes, les fautes des ascendants familiaux peuvent avoir des conséquences
dramatiques sur leurs descendants, mais il demeure important de rendre le chrétien
attentif à ses propres péchés et à sa responsabilité, qui est de rompre définitivement
d’avec les dispositions perverses de ses ascendants. Et, cela passe par la
repentance et la conversion sincères.
Ces deux raisons mises ensemble, montrent que l’absence ou le déficit
d’accompagnement pastoral sérieux, peut être à la base d’un déficit de croissance
spirituelle du chrétien. La déficience de l’accompagnement pastoral est aussi cause
de la confusion qui envahit l’esprit du chrétien, qui face aux difficultés, recherche
208
Ibid. p. 57 Nous recommandons la lecture du mémoire de maîtrise de Cotte KANGA pour les informations
plus détaillées de la pratique de l’accompagnement pastoral dans nos églises. Les analyses de KANGA sont
fondées sur une enquête réalisée dans plusieurs églises et auprès de plusieurs leaders spirituels. 209
Ibid.
85
leurs causes et les solutions, souvent là où il ne faut pas. Du sérieux donc de ce
ministère, dépend en grande partie, la délivrance, l’équilibre et la maturité spirituelle
du chrétien.
Pour que l’accompagnement pastoral soit sérieux et réponde vraiment aux
besoins des chrétiens, cela exige une formation et une pratique adéquate.
3.3.1.2. Formation et pratique de l’accompagnement pastoral
Il nous parait évident, à cause de l’ampleur des difficultés, des besoins et de la
complexité de la personnalité de ceux qui viennent à Christ, que la formation pour le
ministère de l’accompagnement pastoral est nécessaire et doit concerner l’ensemble
de la communauté chrétienne. Ainsi, les pasteurs, les conseillers en
accompagnement pastoral et l’Eglise dans son ensemble doivent être formés210. Si la
formation du pasteur pour l’accompagnement pastoral paraît fondamentale, celle des
conseillers spirituels et de l’ensemble des fidèles est nécessaire. En effet, le pasteur
à lui seul, ne pourra jamais répondre aux besoins de tous les fidèles. Il faut donc des
conseillers spirituels qui pourront aider et suppléer le pasteur. Aussi, la formation de
l’ensemble des fidèles favorisera un environnement d’entraide, d’encouragement et
de soutien mutuel211, indispensable pour la croissance harmonieuse du chrétien. Cet
environnement pourra être le socle du suivi spirituel et de la maturité spirituelle, ainsi
que le lieu des premières solutions aux difficultés et questionnements du chrétien.
Pour aider les autres, cela ne s’improvise pas ; c’est une tâche complexe et
délicate qui exige une formation solide et adéquate. Pour cela, il faut que la formation
210
Ibid. p. 89. Selon Colette KANGA, plusieurs conseillers en accompagnement pastoral n’ont jamais reçu une
formation adéquate pour aider à exercer ce ministère. Ce manque de personnel qualifié engendre des frustrations
ou pousse certaines personnes à refuser tout simplement d’être entretenues par des conseillers non qualifiés. 211
La formation de l’ensemble des fidèles doit pouvoir aboutir à la mise en place de petits groupes de partage et
de prière où l’on développe l’écoute mutuelle, le partage des expériences chrétiennes et l’assistance mutuelle.
86
en accompagnement pastoral prenne en compte les techniques de
psychothérapie212, les principes bibliques, la conception du monde africaine et la
connaissance de l’environnement socio-religieux africain213. Dans le cas contraire, se
sera donné libre cours à l’improvisation et à l’incompétence qui entraineront des
effets négatifs sur la croissance du chrétien.
Il est aussi important que la formation des différentes composantes de l’Eglise
intègre une démarche efficace. Nous proposons à l’instar de Colette KANGA214 une
démarche composée de quatre éléments215 : l’écoute, l’encouragement,
l’accompagnement et la prière.
L’écoute est essentielle dans le processus de l’accompagnement pastoral.
Elle est à notre avis, la porte par laquelle l’on a accès à la vie de celui ou celle qui a
besoin d’aide, le nouveau chrétien notamment. C’est aussi la clé qui permet de
comprendre les difficultés et leurs causes. L’écoute donne à l’autre la possibilité de
retrouver sa liberté d’être, et d’avoir l’assurance d’être accueilli et aimé216. Lorsque le
conseiller spirituel, par l’écoute a cerné le besoin de l’autre, il doit pouvoir
l’encourager. De l’avis de CRABB et ALLENDER217, l’encouragement est le type
d’expression qui motive le chrétien à progresser même quand la vie est difficile.
L’encouragement, c’est ce qui incite à agir, à engager sa responsabilité personnelle
212
Les études développées par la psychologie et la psychanalyse, particulièrement la psychanalyse freudienne,
sur les fonctions psychiques et mentaux de l’homme, nous informent sur la complexité de celui-ci et nous
révèlent que certaines dépressions constatées chez des personnes ne sont pas seulement spirituelles, elles peuvent
être d’ordre psychique. Plusieurs techniques à cet effet, ont été mises en place pour apporter solution à ces
problèmes. Et, la connaissance de ces théories et techniques thérapeutiques peut être utile au conseiller spirituel
pour établir le bon diagnostique du mal être. Cependant, soulignons avec Colette KANGA qu’il ne s’agira pas
pour le conseiller spirituel de se servir des résultats des recherches faites dans le domaine de psychothérapie
séculière tels quels. Il devra les étudier et les transformer afin de leur donner un contenu biblique. 213
Karl GREBE et Wilfred FON, dans leur ouvrage intitulé « Religion traditionnelle africaine et relation
d’aide », Abidjan : CPE, 2000, p. 3, pensent que le conseiller en accompagnement pastoral doit connaître
intimement la conception du monde de celui qu’il conseille, afin de comprendre ses problèmes et ses tentations.
Il doit, en outre avoir une connaissance parfaite des caractéristiques essentielles à la lumière des Ecritures, afin
de connaitre les emprises de Satan et de pouvoir les briser. 214
Colette, KANGA, op.cit. p. 96 215
Nous adhérons pleinement à cette méthodologie. 216
Colette, KANGA, op.cit. p. 97 217
Lawrence, CRABB & Dan, ALLENDER, L’encouragement, avoir un impact durable sur la vie d’autrui,
Québec : La Clairière, 1994, p. 2
87
pour agir autrement. Sans ce sursaut intérieur, il n’y a aucune chance de voir une
situation changée.
L’encouragement seul, cependant, peut ne pas suffire pour conduire le
chrétien de l’immaturité à la maturité, du problème à la solution. Certains problèmes
nécessitent plus que l’écoute ou de simples conseils. Il est donc nécessaire
d’adjoindre l’accompagnement. L’accompagnement exige beaucoup de temps
disponible ; c’est un processus dans lequel le conseiller doit s’engager avec plus de
patience et d’amour jusqu’à ce que le problème soit résolu218. Nous proposons ici le
modèle d’accompagnement pastoral développé par Lawrence CRABB219 qui, à notre
sens, peut s’avérer très efficace pour le suivi pastoral des chrétiens. CRABB
développe cette stratégie à sept niveaux220.
Le premier niveau de l’accompagnement pastoral est d’identifier les
sentiments qui font problème. Le but initial du conseiller est de mettre le doigt sur les
émotions qui font éventuellement problème. En effet, du point de vue de CRABB les
sentiments offrent une perspective initiale nécessaire pour aider le conseiller à
remonter à la racine du problème du chrétien accompagné221. Il faudra par exemple,
essayer d’identifier si le problème est l’anxiété, le ressentiment, la culpabilité, le
désespoir, ou dans le cadre de notre sujet, le sentiment d’être victime des fautes des
parents. Ce but initial doit couvrir tous les domaines de la vie du chrétien : famille
(mariage, enfants, parents, frères et sœurs), travail, l’activité sexuelle, la religion, ce
qui se rapporte à l’église, l’éducation, l’argent, etc.
218
Coltte, KANGA, op.cit. p. 104 219
Lawrence, CRABB, Approche biblique de la relation d’aide, Guebwiller : LLB, 19882, pp. 171-189
220 L’accompagnement pastoral à sept niveaux proposé par CRABB n’est pas une approche toute faite et
mécanique. Cette approche invite le conseiller à établir des relations dont les interactions varient selon les
tempéraments, les problèmes, la personnalité du chrétien qui a besoin du suivi spirituel. 221
Il nous semble que le texte d’Ez 18 que nous étudions nous donne un exemple de ce que les sentiments
peuvent aider à remonter à la racine du problème. Le proverbe proféré par les exilés (Ez 18. 2) était l’expression
de leur sentiment d’exaspération à l’idée qu’ils étaient victime de leur situation d’exil. Partant de ce proverbe ou
de ce sentiment, Ezéchiel est remonté jusqu’à la racine du problème.
88
Une fois que les sentiments qui font problèmes sont identifiés, le conseiller
doit diriger, dans le second niveau, son attention sur les comportements ou les buts
erronés qui ont été développés suite aux expériences qui ont entrainé les sentiments
négatifs . La connaissance du but, permettra au conseiller de déterminer une série
de présuppositions ou de pensées sur lesquelles se fondent le comportement du
chrétien accompagné222. C’est le troisième niveau de l’accompagnement pastoral.
Au quatrième niveau, le conseiller cherchera d’une part, à convaincre le
chrétien accompagné que, quelque part, sa pensée est erronée et, d’autre part à
présenter de façon persuasive l’itinéraire biblique propre à satisfaire ses besoins
personnels. C’est de loin le travail le plus difficile du conseiller223. En effet, les
présupposées auxquelles l’on est fermement attaché ne cèdent pas facilement
devant de nouvelles façons de penser, fussent-elles bibliques. Un accompagnement
pastoral profond requiert beaucoup plus qu’une simple identification des fausses
pensées et l’affirmation des solutions bibliques. Pour réussir cette étape difficile
CRABB esquisse quelques suggestions susceptibles de changer la pensée erronée
en pensée juste224 :
- D’abord, le conseiller doit identifier où la fausse pensée a été reçue.
Quand le chrétien qui est accompagné voit qu’un concours particulier de
222
Rapportons ici un exemple donné par CRABB et qui illustre bien l’affirmation ci-dessus faite. « Un homme
d’âge moyen, lorsqu’on lui demanda de préciser ses plus anciens souvenirs, rappela le suivant :
Le client : J’étais un gamin de quatre ou cinq ans. Mon père rentra à la maison accablé, ce qui n’était
pas exceptionnel, car il était un buveur invétéré. Il nous annonça qu’il avait été renvoyé de son travail, et ma
mère se mit à hurler : « Tu ne vaux rien, et tu ne feras jamais rien de bon ! »
Le conseiller : Qu’avez-vous ressenti alors ?
Le client : Je ressentais la colère, l’épouvante, toutes sortes de choses…Mais je me souviens que j’ai dit
à maman que papa était gentil, qu’il trouverait du travail et paierait nos factures. Mais il ne fit jamais.
Devenu adulte, cet homme avait pris l’habitude d’aller d’un emploi à l’autre. Au premier signe de
difficulté, il développait des réactions de vive anxiété qui lui fournissaient une raison d’éviter un échec potentiel.
Son souvenir ancien donnait la clé de son comportement. Par les paroles de sa mère, il avait appris que la raison
d’être ou la valeur personnelle dépendait entièrement du succès dans le travail. De l’exemple de son père, il avait
appris à redouter les conséquences désastreuses de l’échec. Son comportement orienté était bloqué sur la voie du
succès par la crainte de l’échec. L’émotion qui en résultait était l’anxiété. ». L’absence d’accompagnement
pastoral pouvait faire conclure que cet homme hériterait l’instabilité dans le travail de son père. 223
Lawrence, CRABB, Approche biblique de la relation d’aide, op.cit. p. 180 224
Ibid. pp. 181-182
89
circonstances a été à l’origine de sa croyance actuelle, celle-ci devient
moins rigide. Il est à même de voir que sa source peut ne pas être
infaillible
- Ensuite, il faut que le conseiller encourage l’expression des émotions qui
touchent à la croyance. Le conseiller sensible réfléchira sur les émotions
qu’il décèle lorsque les hypothèses de base de l’aidé sont discutées.
Quand celui-ci se sentira compris, il se détendra et considèrera d’une
manière moins défensive la validité de sa pensée.
- Enfin, le conseiller doit soutenir l’aidé lorsqu’il envisage de changer ses
hypothèses. Renoncer à une hypothèse à laquelle on a été longtemps
attaché est en soi un processus qui menace la sécurité. En effet, l’aidé est
conscient qu’accepter la pensée juste implique qu’il doit reconsidérer ses
habitudes. Le conseiller doit donc apporter encouragement et soutien (cf. 1
Th 5. 14)225.
Lorsque l’aidé reconnaît l’erreur de son ancienne hypothèse et tente de saisir
la nouvelle manière de penser, alors le quatrième niveau est atteint226.
Le cinquième niveau comprend l’affermissement et l’engagement à agir sur la
base de la pensée biblique apprise. Cette démarche est critique, parce que la
pensée juste est fragile227. Le changement de comportement ne jaillira pas
automatiquement du changement de pensée. Il y a là un besoin d’engagement ferme
et constant même quand les sentiments sont contredits par le comportement. A ce
225
CRABB propose une technique pour soutenir l’aidé à maintenir la volonté d’accomplir la pensée biblique. Il
suggère à celui ou celle qui est aidé de rédiger sur une petite carte sa fausse hypothèse et, sur une autre carte, les
hypothèses bibliques opposées. L’aidé doit porter en tout temps les cartes sur lui. Chaque fois qu’il est troublé
(sentiment de culpabilité, de ressentiment ou d’anxiété), il est invité à relire les deux cartes et de se repasser la
phrase biblique (p. 183). Il est vrai que la technique peut être jugé trop mécanique, mais elle semble promouvoir
l’obéissance à ce que réclamait l’apôtre Paul : « Que tout ce qui est vrai… soit l’objet de vos pensées » (Phil 4.
8). 226
Lawrence, CRABB, op.cit.p. 183 227
Ibid.
90
niveau ce n’est pas ce que l’on ressent qui doit contrôler le comportement, mais ce
que l’on pense228. L’accompagnement pastoral ne peut pas progresser au-delà de
ce point tant que l’aidé ne s’est pas engagé lui-même à vivre conformément à ce qu’il
a reconnu être vrai, indépendamment de ce qu’il ressent229.
Le sixième niveau est la continuation du cinquième niveau, c’est-à-dire,
prévoir et mettre en pratique un comportement selon la Bible. Il s’agit ici de prévoir
ou vérifier ce que l’aidé fera différemment, maintenant que sa pensée est
transformée. Le troisième et quatrième niveau (identifier la pensée qui fait problème
et préciser la pensée biblique) ne deviennent partie intégrante de la personne que si
celle-ci ne commence par agir en fonction de ces niveaux. C’est à ce niveau que
peut se définir la croissance chrétienne. CRABB en donne une définition:
« [La croissance spirituelle est] le processus par lequel les données appréhendées par la pensée consciente pénètrent dans la pensée réfléchie, où les hypothèses de base sont profondément ancrées. Passer d’une simple adhésion à la vérité à un accord plus profond avec la vérité dépend du comportement conforme à la vérité. Paul fait allusion à ces deux étapes progressives de celui qui veut saisir la vérité, lorsqu’il exhorte Timothée à persévérer dans les choses qu’il « a apprises » (démarche 1) « et reconnues certaines » (démarche 2).»230.
Le septième niveau, enfin, est d’identifier les sentiments contrôlés par le Saint-
Esprit. Le conseiller doit chercher à savoir si l’aidé fait l’expérience du sentiment
merveilleux de croissance spirituelle qui fait suite au renouvellement de l’intelligence
(niveau 4), à l’engagement (niveau 5) et à l’obéissance (niveau 6).
228
Le chrétien peut avoir envie de pécher. Il sait, cependant que, ce qui est vrai, c’est qu’il a été racheté par Dieu
pour vivre la sainteté. Ce qui doit le contrôler en ce moment, ce n’est pas ce qu’il ressent, mais ce qu’il sait de sa
vie en Christ. 229
Selon CRABB, c’est à ce niveau que la confession du péché semble le plus appropriée. Non seulement le
comportement coupable (exemples : les péchés de la chair, les compromissions morales, etc.) doit être confessé,
mais aussi les émotions (rancune, amertumes, haines, etc.) et les pensées erronées (croire que Dieu est injuste,
croire qu’il n’a pas été suffisant pour répondre aux besoins). 230
Lawrence J., CRABB, op.cit. p.185-186
91
Le modèle d’accompagnement pastoral développé ci-dessus est aussi
présenté sous forme de diagramme par CRABB231 :
Niveau 1 : identifier les sentiments qui
font problème
Niveau 7 : identifier les sentiments
contrôlés par l’Esprit
Niveau 2 : identifier le comportement qui
fait problème
Niveau 6 : prévoir et mettre en pratique
un comportement selon la Bible
Niveau 3 : identifier la pensée qui fait
problème
Niveau 5 : engagement ferme
Niveau 4 : préciser la pensée biblique
Enseigner
Tout au long des sept étapes de ce modèle d’accompagnement pastoral, le
conseiller doit avoir en idée que l’élément principal qui doit être changé chez le
chrétien accompagné, c’est l’ensemble des croyances en rapport avec les besoins
liés à la raison d’être et la sécurité232.
La prière est, en plus de l’écoute, de l’encouragement et de
l’accompagnement, indispensable. Elle doit d’ailleurs jalonner tout le processus
d’accompagnement pastoral. Car sans la dépendance totale à Dieu dans la prière,
tous les efforts risquent de s’avérer vains. La prière est le lieu où l’intelligence et le
comportement du chrétien sont soumis à la puissance recréatrice et rénovatrice de
231
Ibid. p. 189 232
Ibid. p. 171
92
Dieu233. Soulignons que l’accompagnement pastoral est aussi un combat spirituel
contre l’emprise de Satan234, contre l’emprise des expériences socio-familiales et
personnelles passées du chrétien. Et la prière se présente comme une arme
puissante pour remporter la victoire sur tout ce qui fait entrave au plein
épanouissement du chrétien.
Nous voulons donc, à ce stade de notre cheminement plaider pour une prise
en charge spirituelle et pastorale du chrétien, dès son premier contact avec la
communauté chrétienne. Car, cette prise en charge est déterminante pour la
libération du chrétien des dispositions perverses acquises dans son passé, et des
difficultés ou malheurs qui s’y attachent. Elle est aussi essentielle pour que le
chrétien puisse s’approprier totalement des bénéfices de la rédemption afin de
devenir en tout, ce qu’il est déjà en Christ.
Devenir ce qu’on est déjà en Christ, implique fatalement aussi que
l’accompagnement pastoral soit soutenu par d’une éducation chrétienne adéquate.
233
Ibid. p. 110 234
L’accompagnement peut déboucher sur des séances de délivrance, dans le cas où la situation qui se présente
est le fait des esprits impurs.
93
3.3.2. Education chrétienne235
3.3.2.1. Définition du terme « éducation chrétienne »
Qu’entendons-nous par éducation chrétienne ?
Selon E. COON, l’éducation chrétienne est le « processus qui consiste à
communiquer la Parole écrite de Dieu grâce à la puissance du Saint-Esprit dans le
but de mener les hommes au Christ et de les former en Christ »236. William GRAVES
dira dans le même sens que, « l’éducation chrétienne englobe tout l’enseignement
biblique depuis la proclamation jusqu’à la vie dans la foi. »237 Il ressort de ces
définitions que, pour COON et GRAVES, l’éducation chrétienne englobe à la fois
l’évangélisation et la formation en Eglise.
Pour André K. KOUAKOU, bien que l’Eglise ait deux principaux ministères :
amener les hommes à Christ et les former en Christ, le terme éducation chrétienne
concerne, cependant, la formation en Eglise. Il dira dans cette optique que :
« l’éducation [chrétienne] doit viser à apprendre aux croyants le modèle de
comportement suivant les principes bibliques »238. Nous adhérons pleinement à cette
définition de l’éducation chrétienne. Pour nous donc, l’éducation chrétienne est
l’enseignement de la parole de Dieu dans le but d’équiper chaque chrétien à mieux
connaître Jésus, à grandir à sa ressemblance et à le servir plus efficacement.
235
Le présent mémoire n’a pas pour objectif de traiter en long et en large la question de l’éducation chrétienne.
Nous ne ferons donc pas de proposition de plan d’éducation chrétienne ni de méthodes pédagogiques. Nous nous
limiterons à en souligner l’importance pour la maturité du chrétien et pour jouir pleinement de la grâce en Jésus-
Christ. Pour une étude approfondie sur le sujet de l’éducation chrétienne, nous recommandons le mémoire de
maîtrise de Koffi KOUAKOU, L’éducation chrétienne au sein de l’Eglise Protestante Evangélique CMA de
Côte d’Ivoire de 1930 à nos jours, 1999, 101p. 236
Roger E., CONN, cité par Koffi, KOUAKOU, L’éducation chrétienne au sein de l’Eglise Protestante
Evangélique CMA de Côte d’Ivoire de 1930 à nos jours, mémoire de maîtrise présenté à la Faculté de Théologie
Evangélique de l’Alliance Chrétienne d’Abidjan, 1999, p.1 237
William W., GRAVES, cité par Koffi, KOUAKOU, op.cit. p. 2 238
André Kouadio, KOUAKOU, Les ministères dans les églises protestantes d’Afrique francophones, thèse de
doctorat 3e cycle présentée à l’université des Sciences Humaines de Strasbourg, 1980, p. 244
94
L’éducation chrétienne est donc l’œuvre complémentaire à l’évangélisation qui
permet à l’Eglise de réaliser entièrement sa mission de faire des disciples (cf. Mat
28. 19-20). Si cette seconde phase de faire des disciples manque, cela peut avoir
des conséquences dramatiques pour le chrétien lui-même, et pour l’ensemble de la
communauté chrétienne. C’est ce qui préoccupe Paul M. LEDERACH239 lorsqu’il
déclare :
« La proclamation de l’évangile se trouve au cœur même de la tâche missionnaire, une proclamation qui permet la création de nouvelles communautés. Dans beaucoup d’églises, l’évangélisation a longtemps été une priorité. Faire des disciples doit cependant aller de pair avec enseigner ce que Jésus à prescrit. Mettre en avant l’un des aspects du dernier commandement de Jésus au détriment de l’autre, c’est mettre en danger à la fois la croissance et la santé de l’église. »
Il appartient donc à l’Eglise d’assumer sa fonction d’éducation de ses
membres, afin qu’il n’y ait pas de contradiction entre les conceptions que le chrétien
se fait de la volonté de Dieu et celle révélée dans les Ecritures. Souvenons-nous que
les contemporains d’Ezéchiel n’ont pas échappé à ce piège, bien qu’ils aient été
bénéficiaires d’un système d’éducation religieux rigoureux, qui avait pour objectif la
transmission fidèle de la volonté de Dieu de génération en génération240.
239
Paul M., LEDERACH, « Enseigner dans l’assemblée » in Les cahiers de Christ seul, 1982, p. 7 240
Jacques, BRIEND, Michel, QUESNEL, La vie quotidienne aux temps bibliques, Paris : Bayard, 2001, p. 101
L’éducation religieuse se faisait en famille. Tout le livre du Deutéronome repose sur la nécessité d’une
transmission des lois et coutumes mosaïques pour chaque génération, ce qui ne peut se faire que par les parents
(cf. Dt 4. 10). Voici la mission qui était assignée aux parents : « Mes paroles que voici, vous les mettrez en vous,
dans votre cœur, vous en ferez un signe attaché à votre main, une marque placée entre vos yeux. Vous les
apprendrez à vos fils en les leur disant quand tu resteras chez toi et quand tu marcheras sur la route, quand tu
seras couché et quand tu seras debout; tu les inscriras sur les montants de porte de ta maison et à l'entrée de tes
villes, pour que vos jours et ceux de vos fils, sur la terre que le SEIGNEUR a juré à vos pères de leur donner,
durent aussi longtemps que le ciel sera au-dessus de la terre. » (Dt 11. 18-21)
95
Combien fortiori, le chrétien africain, qui en général, est tributaire d’un environnement
socio-religieux dont la conception de Dieu et de la relation à lui, n’est pas toujours
compatible à celle qu’enseigne l’Ecriture241.
3.3.2.2. Education chrétienne et réalisation de la nouvelle identité
L’éducation chrétienne se situe entre la justification et la sanctification242 ;
entre la justification et la maturité. L’éducation chrétienne est le véhicule, le moyen
qui permet de devenir ce qu’on est déjà en Christ. Elle permet à chaque chrétien de
formuler en paroles et en actes sa réponse à Dieu243.
L’initiative vient de Dieu. C’est lui qui sauve et accepte l’être humain tel qu’il
est. C’est lui qui le libère de l’emprise de toutes dispositions impures et des difficultés
qui s’y attachent. C’est aussi lui qui ouvre le chemin de la vie et de la bénédiction.
Cependant, celui qui est bénéficiaire de cette grâce de Dieu, doit se l’approprier
totalement. Et c’est l’éducation chrétienne, c’est-à-dire, l’enseignement systématique
de la parole de Dieu, adapté à chaque étape de la croissance du chrétien qui
favorise ce cheminement. Elle donne au chrétien d’élaborer des gestes, des paroles,
des attitudes qui répondent effectivement à l’appel à être de Dieu244.
Sans une éducation chrétienne sérieuse et solide donc, devenir ce que le
chrétien est déjà dans son union avec Christ, risque d’être incomplète ou risque
241
Karl GREBE et Wilfred FON, op.cit. p. 3 « la plupart des chrétiens africains ont grandi dans des cultures
intimement liées à la religion du groupe ethnique auquel ils appartiennent. Chacune de ses religions a ses points
particuliers. Mais elles s’accordent toutes sur des points essentiels, tels que l’essence du monde, l’existence et
l’éloignement de Dieu, le rôle joué par les esprits et les puissances mystiques et la manière dont l’homme entre
en rapport avec son monde et avec Dieu. » 242
Claude Henri, VALLOTTON, Le sens spirituel de la formation en Eglise, Paris : L’Harmattan, 2000, p. 43 243
Ibid. 244
Ibid. p. 45 cet appel exige une manière d’être face à Dieu, à soi-même et aux autres et ensuite une mise en
œuvre concrète dans la vie quotidienne.
96
d’être déformée ; ce qui constituerait un réel danger pour le chrétien lui-même,
puisque plusieurs dispositions et habitudes perverses pourront demeurer des
« liens » qui le maintiennent dans la continuité des actes répréhensibles de ses
ascendants. L’on peut donc être chrétien et continué à endurer les difficultés liées à
certaines fautes, parce que l’on continu à entretenir ces fautes par des attitudes et
habitudes répréhensibles.
Nous en appelons donc au sens de responsabilité de l’Eglise, surtout des
leaders chrétiens qui ont la charge de conduire le peuple de Dieu. Car, aujourd’hui
encore, dans plusieurs églises, la formation spirituelle des chrétiens est faite de
façon disparate, sans harmonie et sans un cheminement clair245. Souvent, le chrétien
est laissé pour compte, et c’est à lui-même que revient la responsabilité de se former
et de s’orienter dans le vaste monde théologique. Ce monde, qui, pourtant, regorgent
tant de dangers, tant de « prédateurs ». Dans ces conditions, le chrétien ne peut pas
vraiment progresser vers la maturité comme souhaité246. L’un des résultats de cette
situation, c’est la formulation de théologies contradictoires à la théologie biblique,
comme c’est le cas de la théologie de la transmission automatique des
fautes/châtiments d’une génération à l’autre. Un autre résultat est l’état stationnaire
d’enfants spirituels sans mémoire, sans connaissance ni capacité d’agir247, et
totalement dépendant du discours de certains « théologiens », qui prônent des
théologies incorrectes ou tout simplement non bibliques.
245
Koffi, KOUAKOU, op.cit. p. 78 246
Ibid. 247
Ibid. p. 79
97
Conclusion partielle
Le troisième chapitre de notre travail nous permet d’affirmer que le texte
d’Ezéchiel 18. 1-4, 20-32 a contribué considérablement, d’une part, à éclairer la
question de la transmission automatique des fautes/châtiments d’une génération à
l’autre, et d’autre part, à dénouer, même s’il reste partiel, la tension qui existe entre la
responsabilité collective et la responsabilité personnelle.
Nous avons vu que le texte d’Ezéchiel contredit la conception d’hérédité
spirituelle des fautes/châtiments, parce qu’elle supposerait qu’il n’y ait aucune
possibilité de conversion. Or, c’est cette voie que Dieu ouvre pour revenir à lui et
bénéficier de ses bienfaits. Si les descendants n’héritent pas des fautes et des
châtiments des parents, ils peuvent, cependant, subir l’influence des
fautes/châtiments. Cette influence peut les conduire à répéter les fautes des parents
et souffrir des difficultés qui sont reliées à ces fautes. Mais, ils ne sont pas
condamnés à vivre indéfiniment sous cette influence ; ils peuvent en être libérés à
condition qu’ils acceptent de se convertir. Ainsi, si la responsabilité collective peut
entrainer le descendant dans des voies contraires à celles prescrites par Dieu dans
les Ecritures, la responsabilité personnelle, elle, lui donne la possibilité d’y échapper.
Alors, les deux tendances qui se dégagent du contexte religieux en Côte
d’Ivoire, au sujet de la transmission des fautes/châtiments, ne sont pas acceptables.
Car, la première tendance brise la relation qui existe entre responsabilité collective et
responsabilité personnelle. La seconde, même si elle tient compte de la
responsabilité collective et individuelle, elle ne libère pas totalement l’individu qui a
bénéficié de la rédemption de Jésus-Christ. Cette conception a tendance à entretenir
la peur, le doute dans l’esprit du chrétien et à focaliser l’attention de celui-ci sur des
98
fautes ancestrales, à la moindre difficulté. Et pourtant, bien des difficultés du chrétien
sont inhérentes à sa vie chrétienne et à son appartenance à ce monde.
Et même si le chrétien devrait souffrir des conséquences des fautes de ses
parents, sans en être lui-même coupable, là non plus, il n’est pas abandonné à son
sort. Ce que Dieu fait, c’est d’intervenir dans les effets longue durée des fautes des
parents pour y aménager un espace de liberté pour une vie meilleure248.
Pour éviter que ces tendances ne se perpétuent et ne causent davantage de
tort aux chrétiens en Côte d’Ivoire et ailleurs, nous proposons que nos églises
développent une sérieuse prise en charge spirituelle du chrétien, cela dès son
premier contact avec la communauté chrétienne, et qu’elles soient conscientes de
leurs responsabilités dans l’éducation chrétienne des âmes que le Seigneur ajoute à
son Eglise.
248
Luc-Olivier, BOSSET, op.cit. p. 17
99
CONCLUSION GENERALE
Que retenir de toute notre réflexion sur l’étude exégétique d’Ezéchiel 18. 1-4,
20-32 : une réflexion sur la faute des pères et ses implications théologiques pour
l’Eglise aujourd’hui ?
Nous vivons aujourd’hui une spiritualité où le chrétien cherche toujours le sens
de ce qui lui arrive. Dans ce contexte, les bénédictions, encore plus, les difficultés,
ou les malédictions, ont des causes qu’il faut absolument connaitre. Dans le cas où il
s’agit d’une difficulté, souvent trop vite jugé comme une malédiction, les causes
doivent, non seulement être connues, mais, elles doivent être combattues à tout prix.
Malheureusement, cette recherche conduit souvent à des causes qui ne sont pas
toujours justes et à des solutions qui ne sont pas bibliquement fondées. En effet,
plusieurs conclusions sont tirées sur la base d’expériences personnelles de chrétiens
ou sur la base de compréhension superficielle ou partielle de certains textes
bibliques. Le drame, c’est que certaines solutions proposées aux difficultés du
chrétien, sont si enracinées dans la pensée collective des chrétiens que, plusieurs
refusent de s’ouvrir à d’autres vérités, surtout à la vérité de la parole de Dieu. C’est le
cas, par exemple, de cette théologie qui prône insidieusement la conception de
l’hérédité spirituelle des fautes et des châtiments d’une génération à l’autre, et qui
100
invite les chrétiens à couper un certain « cordon ombilical spirituel » pour en être
libéré. Ce « cordon ombilical spirituel » serait en quelque sorte, le canal par lequel le
flux héréditaire de culpabilité et de malédiction passe des ascendants pour atteindre
les descendants. Nous avons vu qu’une telle théologie, non seulement, remet en
cause l’œuvre de rédemption du Christ dans la vie du chrétien, mais, elle entretient
aussi la peur, la confusion et le doute dans l’esprit de ce dernier. En outre, elle
occasionne les discordes dans les familles, voire la dislocation des familles, car la
coupure du « cordon ombilical spirituel » exige souvent, selon les tenants de cette
théologie, une rupture totale des relations avec le reste de la famille qui est
considéré comme maudite.
Le texte d’Ezéchiel 18. 1-4, 20-32, nous a fournit les éléments nécessaires
pour répondre à la conception de l’hérédité spirituelle des fautes et des châtiments.
En fait, il n’y a pas d’hérédité spirituelle des fautes et des châtiments d’une
génération à l’autre ou même des mérites et des bénédictions. Ce qui se passe, c’est
qu’il y a influence des fautes et des châtiments ou des mérites et bénédictions, des
ascendants sur leurs descendants. En effet, les enfants nés dans un environnement
donné, sont influencés positivement ou négativement par l’exemple de vie des
parents. Ceux-ci sont donc capables de reproduire les attitudes positives ou
négatives de l’environnement socio-familial. En cela, les enfants sont, dans le cas
des actions négatives commises par eux-mêmes, coupables et attirent sur eux, les
difficultés ou malédictions qui sont afférentes à ces fautes. Cette idée de
persévérance dans l’attitude des parents est bien soutenue par le texte d’Exode 20.
5-6, qui, pourtant est cité pour soutenir la thèse de l’hérédité spirituelle.
« Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux et tu ne les serviras pas, car
c'est moi le SEIGNEUR, ton Dieu, un Dieu jaloux, poursuivant la faute des pères
chez les fils sur trois et quatre générations - s'ils me haïssent - mais prouvant sa
101
fidélité à des milliers de générations - si elles m'aiment et gardent mes
commandements. »
Cependant, bien que l’influence des ascendants sur leurs descendants soit
pesante, ce n’est pas elle qui doit conditionner l’agir de ces derniers. Ceux-ci sont,
pour chacun, responsable du choix de l’orientation de sa vie. C’est en cela que l’on
perçoit la pertinence du principe de la responsabilité personnelle qu’Ezéchiel défend
tant. Dans le cas où le descendant, malgré le mauvais exemple présenté par son
environnement familial, se détourne des dispositions perverses entretenues par cet
environnement, et se tourne vers Dieu, il bénéficie alors de toute la miséricorde de
Dieu qui le libère de ses fautes et des conséquences de celles-ci. Par ailleurs, quand
le descendant souffrirait injustement des conséquences des erreurs de ses parents,
Dieu, dans sa relation avec lui, ouvre le chemin d’une vie nouvelle, pleine d’espoir.
Il est donc inconvenant d’utiliser les difficultés du chrétien pour justifier
l’hérédité spirituelle des fautes et des châtiments et surtout de faire croire que toutes
ces difficultés sont des malédictions divines dues aux ascendants. Il faut pouvoir
accepter que, toutes les difficultés du chrétien ne soient pas du seul fait des parents.
Satan, les esprits impurs, ainsi que les réalités de notre monde actuelles peuvent en
être les causes. Il faut donc que le chrétien fasse preuve de discernement. Mais,
l’apprentissage du discernement, sur la base de la parole de Dieu ne s’improvise
pas. Elle nécessite, dès la conversion, un accompagnement pastoral sérieux et une
éducation chrétienne solide. Si ces deux ministères de l’Eglise ne sont pas accomplis
correctement, les chrétiens deviennent, le plus souvent immatures et flottant à tout
vent de doctrine.
Dans ce travail, bien que nous ayons défendu la thèse de l’influence des
fautes et des châtiments, nous souhaiterions cependant que d’autres réflexions
continuent à se faire sur le sujet de la faute des pères. En effet, une question reste
102
tout de même posée : s’il est vrai qu’il n’y a pas d’hérédité ni dans le mal ni dans le
bien, est-ce pour autant que Dieu ne se souvienne pas des actions passées des
ascendants pour agir envers leurs descendants, dans le but de les conduire au
salut ? Là où il y a succession du mal, Dieu ne peut-il pas permettre que des
difficultés se présentent aux descendants afin de susciter en eux la conversion ? Là
où le bien abonde, Dieu n’agira-t-il pas dans le but que le bien soit perpétué
génération après génération ?
D’ailleurs, ce désir de Dieu qui est de voir le bien abonder dans toutes les
générations ne transparait-il pas en Exode 20. 5-6, lorsque le mal ne peut prospérer
que sur trois ou quatre générations, par contre, le bien, sur des milliers de
générations249 ? Dieu n’a-t-il pas mémoire du passé en vu du bien des générations
futures ?
249
Emile NICOLE dans son article « La faute des pères », in Théologie Evangélique, vol. 1, n°3, 2002, p. 47,
nous rend attentif à la grâce de Dieu qui défie tout calcul humain, tant la durée dépasse la mémoire humaine.
NICOLE relève la disproportion entre les 3 ou 4 générations de la sanction (à cette échelle on peut encore
compter et suivre une génération) et les 1000 générations de la bienveillance et de la grâce qui défient tout
contrôle (1000 x 25 = 25 000 ans).
103
BIBLIOGRAPHIE
I. OUVRAGES DE REFERENCE
A. Textes et canon de la Bible
ALT, A. et al, sous dir, Biblia Hebraica Stuttgartensia, Stuttgart: Deutsche
Bibelgessellschaft, 1997, I-LV*- 1574p.
Bible d’étude version du Semeur 200, Cléon d’Andran : Excelsis, 2001, 2137p.
Traduction Œcuménique de la Bible, nouvelle édition revue, Paris : Alliance Biblique
Universelle et Cerf, 2007, 1861p.
104
B. Dictionnaires et Grammaires de l’hébreu biblique
1. Dictionnaires
ALEXANDER, T. Desmond, ROSNER, Brian S., sous dir, Dictionnaire de théologie
biblique, Cléon d’Andran : Excelsis, 2006, 1005p.
BROWN, F., DRIVER, S. and BRIGGS, C. The BROWN-DRIVER-BRIGGS Hebrew
and English Lexicon, Peabody: Hendrickson Publishers, 1996, 1184p.
FERREOL, Gilles, sous dir, Dictionnaire de sociologie, 2e édition revue et
augmentée, Paris : Armand Colin/Masson, 1995, 315p.
KUEN A. sous dir, Nouveau Dictionnaire Biblique révisé et augmenté, Saint-Légier :
EMMAÜS, 1992, 1364p.
LACOSTE, Jean-Yves, sous dir, Dictionnaire critique de théologie, Paris :
Quadrige/PUF, 1998, p.
SANDER, N. Ph., et TRENEL, I. Dictionnaire Hébreu-Français, Genève : Slatkine
Reprints, 2005, 811p.
VANGEMEREN, Willen A., sous dir, Dictionary of Old Testament Theology and
Exegesis, vol. 2, Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1997, 1152p.
VANGEMEREN, Willen A., sous dir, Dictionary of Old Testament Theology and
Exegesis, vol. 3, Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1997, 1296p.
VANGEMEREN, Willen A., sous dir, Dictionary of Old Testament Theology and
Exegesis, vol. 4, Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1997, 1322p.
105
2. Grammaire de l’hébreu biblique
JOÜON, Paul, Grammaire de l’hébreu biblique, Roma : Pontifico Istituto Biblioco,
1996, 542p.
II. OUVRAGES D’INTRODUCTION A L’ANCIEN TESTAMENT
ARCHER, Gleason, Introduction à l’Ancien Testament, Genève : Labor et Fides :
2001, 640p.
ASURMENDI, Jean, AMSLER, S. et al, Les prophètes et les livres prophétiques,
Paris : Desclée, 1985, 365p.
HARRISON, Roland Kenneth, Introduction to the Old Testament, Peabody: Prince
Press, 1999, 1325p.
ROBERT, A., et FEUILLET, A., sous dir, Introduction à la Bible : Introduction
générale à l’Ancien Testament, tome 1, 2e édition revue et corrigé, Paris : Desclée,
1959, 880p.
RÖMER, Thomas, Introduction à l’Ancien Testament, Genève : Labor et Fides :
2004, 714p.
YOUNG, Edward J., An Introduction to the Old Testament, Londres: The Tyndale
Press, 1964, 432p.
106
III. THEOLOGIE DE L’ANCIEN TESTAMENT
BLENKINSOPP, Joseph, Une histoire de la prophétie en Israël, Paris : Cerf, Lectio
Divina, n° 152, 1993, 352p.
LYS, Daniel, “Rûach” le souffle dans l’Ancien Testament, Paris : PUF, 1962, 369p.
SOGGIN, J. Alberto, Histoire d’Israël et de Juda, Bruxelles : Lessius, 2004, 517p.
WOLFF, Hans Walter, Anthropologie de l’Ancien Testament, Genève : Labor et
Fides, 1974, 228p.
IV. OUVRAGES TRAITANT D’UN OU DE PLUSIEURS ASPECTS DU SUJET
1. Commentaire exégétique
KEIL and DELITZSECH, Commentary of the Old Testament, Peaboby : Hendrickson
publisher, 1996, 832p.
2. Ouvrages spécifiques au texte d’Ezéchiel 18 : 1-4, 20-32
ALEXANDER, Ralph, “Ezekiel” in The Expositor’s Commentary, vol. 6, Grand
Rapids: Zondervan Publishing House, 1986, pp. 736-996
ALLEN, C. Leslie, Word biblical commentary, Ezekiel 1-19, Dallas: Word books
publisher, 1994, 306p.
ASSURMENDI, Jésus-Maria et al, Les livres des prophètes II, Paris :
Bayard/Centurion, 1999, 339p.
ASSURMENDI, Jésus-Maria, Le prophète Ezéchiel, Paris : Cerf, 1981, 67p.
107
AUVRAY, Paul, Ezéchiel, Paris : Cerf, 1946, 172p.
BLOCK, I. Daniel, The book of Ezekiel, chapters 1-24, Grand Rapids, William B.
Eerdmans, 1997, 887p.
BRIERE, Jean, CASTANIE, Raymond, et al, Les prophètes, Ezéchiel, Les
lamentations, Ecouter la Bible, n°9, Limoges : Desclée de Brouwer/Droget-Ardant,
1977, 121p.
GAEBELIN, Frank E., Expositor’s Bible Commentary, Esaiah-Ezekiel, vol. 6 Grand
Rapids: Zondervan Publishing House, 1986, 996p.
GUTHRIE, D., MOTYER, J.A., et al, sous dir, Nouveau commentaire biblique, Saint-
Légier : EMMAÜS, 19914, 1378p.
JOB, John, Une sentinelle à Babylone, une étude du livre d’Ezéchiel, Paris : Sator,
1985, 103p.
KECK, Leander E., sous dir, The New Interpreter’s Bible, vol. VI, Nashville: Abingdon
Press, 2001, 1612p.
LEALE, Thomas H., « Ezekiel, Chapters XII – XXIX », in The Preacher’s Complete
Homiletic Commentary, n°18, Grand Rapids: Baker Books House, 1996, 506p.
MONLOUBOU, Louis, Un prêtre devient prophète : Ezéchiel, Paris : Cerf, Lectio
Divina, n° 73, 1972, 183p.
PREVOST, Jean-Pierre, Pour lire les prophètes, Outremont/Paris : Novalis/Cerf,
1995, 204p.
TEWOLDEMEDHIN, Habtu, « Ezéchiel », in Commentaire biblique contemporain,
Marne la Vallée : Farel, 2008, 1705p.
TIDIMAN, Brian, Le livre d’Ezéchiel, tome 1, Vaux-sur-Seine : EDIFAC, 1985, 298p.
108
V. PERIODIQUES
BLANCHARD, Thomas, « Le modèle d’Ezéchiel », Fac réflexion, n° 22, 1993, pp. 4-
13
BOSSET, Luc-Olivier, « Ezéchiel 18. 1-4, 20-32 : Les pères ont mangé du raisin
vert… », Lire et Dire, Etude exégétique en vue de la prédication, n°46, 2000/4, pp.
13-21
LEDERACH, Paul M., « Enseigner dans l’assemblée », Les cahiers de Christ seul,
1982, pp.17-28
NICOLE, Emile, « La faute des pères », Théologie Evangélique, Vol. 1, n°3, 2002,
pp. 47-50
VI. AUTRES CONTRIBUTIONS
ADETOLA, Zacharie A, Les origines, couper le cordon ombilical, Abidjan : Mission
Ephrata, 2000, 143p.
BLOCHER, Henri, La doctrine du péché et de la rédemption, Vaux-sur-Seine :
EDIFAC, Didaskalia, 2000, 367p.
BRIEND, Jacques, QUESNEL, Michel, La vie quotidienne aux temps bibliques,
Paris : Bayard, 2001, 235p.
CRABB, Lawrence et ALLENDER, Dan, L’encouragement, avoir un impact durable
sur la vie d’autrui, Québec : La Clairière, 1994, 182p.
CRABB, Lawrence, Approche biblique de la relation d’aide, Guebwiller : 19882, 229p.
GREBE, Karl et FON, Wilfred, « Religion traditionnelle africaine et relation d’aide »,
Abidjan : CPE, 2000, 63p.
109
KANGA, Colette, Réflexion sur la pratique de la relation d’aide dans nos églises :
enjeux et perspectives, mémoire de maîtrise présenté à la Faculté de Théologie
Evangélique de l’Alliance Chrétienne d’Abidjan, 2006, 124p.
KOUAKOU, K. André, La démonologie et le combat spirituel, cours dispensé à la
FATEAC et à l’IBACY, 2009, 33p.
KOUAKOU, K. André, Les ministères dans les églises protestantes d’Afrique
francophones, thèse de doctorat 3e cycle présentée à l’université des Sciences
Humaines de Strasbourg, 1980, 294p.
KOUAKOU, Koffi, L’éducation chrétienne au sein de l’Eglise Protestante Evangélique
CMA de Côte d’Ivoire de 1930 à nos jours, 1999, 101p.
NICOLE, J.-M., Précis de doctrine chrétienne, Nogent-sur-Marne : Institut Biblique de
Nogent, 19985, 349p.
REINHOLD, Ruthe, Structure de la personnalité, Bâle : EBV, 1994, 159p.
VALLOTTON, Claude Henri, Le sens spirituel de la formation en Eglise, Paris :
Editions L’Harmattan, 2000, 175p.
WELLS, Paul, Progresser avec Christ, Paris : La Maison de la Bible, 2000, 200p.
VII. RESSOURCE ELECTRONIQUE
Bible Works 6, 2003, LLC
110
TABLE DES MATIERES
DEDICACE……………………………………………………………………………………i
REMERCIEMENTS…………………………………………………………………………..ii
ABREVIATIONS ET SIGLES……………………………………………………………….v
TRANSCRIPTION DE L’HEBREU BIBLIQUE…………………………………………...vii
INTRODUCTION GENERALE……………………………………………………………..1
1. Motivation du sujet……………………………………………………………………….1
2. Justification du choix du texte d’Ezéchiel 18. 1-4, 20-32…………………………….3
3. Problématique…………………………………………………………………………….4
4. Hypothèse de travail……………………………………………………………………..5
5. Approche méthodologique et structure du travail…………………………………….6
CHAPITRE PREMIER : QUESTIONS D’INTRODUCTION AU LIVRE D’EZECHIE ET
AU TEXTE D’EZECHIEL 18. 1-4, 20-32…………………………………………………..7
1.1. QUESTIONS D’INTRODUCTION AU LIVRE D’EZECHIEL………………………..7
1.1.1. Auteur….………………………………………………………………………………7
1.1.1.1. Sa mission…………………………………………………………………..9
1.1.1.2. Sa personnalité……………………………………………………………10
1.1.2. Authenticité et datation du livre d’Ezéchiel……………………………………….11
1.1.2.1. Authenticité………………………………………………………………..11
1.1.2.2. Datation…………………………………………………………………….14
1.1.3. Contexte historique…………………………………………………………………16
1.1.3.1. Environnement politique…………………………………………………16
1.1.3.2. Environnement social et religieux……………………………………….17
1.2. STRUCTURE ET GENRES LITTERAIRES………………………………………..18
1.2.1. Structure……………………………………………………………………………...18
111
1.2.2. Genres littéraires……………………………………………………………………19
1.3. QUESTIONS D’INTRODUCTION AU TEXTE D’EZECHIEL 18. 1-4, 20-32……20
1.3.1. Délimitation et critique textuelle d’Ezéchiel 18. 1-4, 20-32……………………..21
1.3.1.1. Délimitation………………………………………………………………...21
1.3.1.2. Critique textuelle d’Ezéchiel 18. 1-4, 20-32…………………………….22
1.3.2. Traduction du texte d’Ezéchiel 18. 1-4, 20-32 et notes de traduction…………32
1.3.2.1. Traduction du texte d’Ezéchiel 18. 1-4, 20-32…………………………33
1.3.2.2. Notes de traduction……………………………………………………….35
Conclusion partielle……………………………………………………………………….38
CHAPITE DEUXIEME : COMMENTAIRE EXETIQUE D’EZECHIEL 18. 1-4, 20-
32................................................................................................................................40
2.1. CONTESTATION DE LA TRANSMISSION AUTOMATIQUE DE LA
FAUTE/CHATIMENT D’UNE GENERATION A L’AUTRE ET ANNONCE DU
PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE PERSONNELLE (Ez 18. 1-4, 20)……………41
2.1.1. Réfutation du proverbe erroné (Ez 18. 1-3)………………………………………41
2.1.2. Annonce du principe de la responsabilité personnelle (Ez 18. 4, 20)…………44
2.2. LA JUSTICE DE DIEU SUIT L’EVOLUTION D’UNE VIE (EZ 18. 21-29)……….52
2.2.1. Dieu juge l’Homme selon ses œuvres (Ez 18. 21-24)…………………………..52
2.2.2. Réponse d’Ezéchiel à la contestation du principe de la rétribution individuelle
par le peuple (Ez 18. 25-30a)……………………………………………………………..55
2.3. DIEU CHERCHE A TRANSMETTRE LA VIE (EZ 18. 30b-32)…………………..57
2.3.1. Appel à la repentance et au renouvellement intérieur (Ez 18. 30b-31)………57
2.3.2. Dieu désire bénir (Ez 18. 32)………………………………………………………60
Conclusion partielle………………………………………………………………………..61
112
CHAPITRE TROISIEME : IMPLICATIONS D’EZECHIEL 18. 1-4, 20-32 POUR
L’EGLISE AUJOURD’HUI………………………………………………………………...64
3.1. TRANSMISSION AUTOMATIQUE DE LA FAUTE/CHATIMENT D’UNE
GENERATION A L’AUTRE : REPONSE D’EZECHIEL………………………………...65
3.1.1. Il n’y a pas d’hérédité spirituelle des fautes/châtiments………………………...65
3.1.2. Responsabilité personnelle………………………………………………………...67
3.1.3. Appel à une réelle conversion……………………………………………………..68
3.1.4. Bénéfices d’une réelle conversion………………………………………………...70
3.2. TRANSMISSION AUTOMATIQUE DE LA FAUTE/CHATIMENT D’UNE
GENERATION A L’AUTRE : TENDANCES ACTUELLES……………………………..73
3.2.1. Il n’y a aucun rapport entre les souffrances des descendants et les fautes des
ascendants…………………………………………………………………………………..74
3.2.2. Les descendants subissent immanquablement les fautes de leurs
ascendants…………………………………………………………………………………..76
3.3. PLAIDOYER POUR UN ACCOMPAGNEMENT PASTORAL SERIEUX ET UNE
EDUCATION CHRETIENNE ADEQUATE………………………………………………82
3.3.1. Accompagnement pastoral………………………………………………………...82
3.3.1.1. Raisons d’un accompagnement pastoral………………………………82
3.3.1.2. Formation et pratique de l’accompagnement pastoral………………..85
3.3.2. Education chrétienne……………………………………………………………….93
3.3.2.1. Définition du terme « éducation chrétienne »………………………….93
3.3.2.2. Education chrétienne et réalisation de la nouvelle identité…………..95
Conclusion partielle………………………………………………………………………...97
CONCLUSION GENERALE………………………………………………………………99
BIBLIOGRAPHIE………………………………………………………………………….103
TABLE DES MATIERES…………………………………………………………………110


























































































































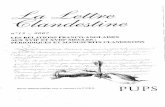


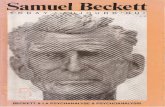


![L'IMMIGRATION HIER, AUJOURD'HUI, DEMAIN [Immigration yesterday, today, tomorrow]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63226acd807dc363600a6f67/limmigration-hier-aujourdhui-demain-immigration-yesterday-today-tomorrow.jpg)




