Entre Symptôme et Pharmakon: penser "aujourd'hui" en France
Transcript of Entre Symptôme et Pharmakon: penser "aujourd'hui" en France
L’Esprit Créateur
Vol. 50, No. 3 Fall 2010
Founding EditorJOHN D. ERICKSON
EditorsMÁRIA MINICH BREWER
DANIEL BREWER
Guest EditorANNE-MARIE PICARD
Associate EditorsSUZANNE RODIN PUCCI
ANNE TOMICHE
For more than fifty years, L’Esprit Créateur has publishedstudies on French and Francophone literature, film, criticism,and culture. The journal features articles representing avariety of methodologies and critical approaches. Exploringall periods of French literature and thought, L’Esprit Créateurfocuses on topics that define French and FrancophoneStudies today.
Editorial Submissions. All editorial queries, submissions, and books for review should be directedto the Editors, Dept. of French and Italian, 260 Folwell Hall, University of Minnesota, 9 PleasantSt. SE, Minneapolis, Minnesota 55455-0194. Essays may be submitted to the Editors in paperformat or by email attachment (in Word) at [email protected]. The essay typescript, double-spaced,including epigraphs, quotations, and footnotes (all of which should be double-spaced) must con-sist of no more than 6,000 words maximum. Essays may be in English or French. Reviews ofbooks dealing with criticism or theory relating to French or Francophone topics, no longer than500 words, are also welcome for consideration by the Editors. Please query before submittingtypescript. Subscriptions ordered by readers submitting typescripts would be appreciated.
For further information, including a complete index of past issues of L’Esprit Créateur and adescription of future issues, visit http://espritcreateur.umn.edu. Additional information is avail-able at http://www.press.jhu.edu.
Forthcoming issues of L’Esprit Créateur:
2010: Fall—Between Symptom and pharmakon: Thinking “Today” inFrance. Anne-Marie Picard, Guest Editor (in press)
We are undergoing an anthropological shift, say French psychoanalysts and philoso-phers, one that allows and requires absolute moral liberty. Does this shift present away for civilization to move beyond its neurotic discontents? Or is this demand todisplay an endless jouissance accompanied by other forms of suffering and contra-dictions? This issue examines how contemporary Francophone culture bears witnessto this crisis within meaning.
Winter—Vichy 2010. Richard J. Golsan, Guest Editor (in press)
This issue will explore the literary and cultural legacies and representations of Vichyin the new century, investigating what the expression the ‘Vichy Syndrome’ meansnow. Topics to be discussed include recent important or controversial novels such asSuite française and Les Bienveillantes, films including Indigènes, recent works ofJorge Semprun, and the politics of memory in contemporary France.
Entre symptôme et pharmakon: penser “aujourd’hui” en France
Guest Editor, Anne-Marie Picard
1 Anne-Marie Picard, “Introduction: Entre symptôme et pharmakon,penser ‘aujourd’hui’ en France”
18 Jean-Pierre Lebrun, “Ce qu’implique l’humanisation”39 Solange Guénoun, “Mélancolie politique, Haine de la démocratie et la
nouvelle pensée de l’émancipation chez Jacques Rancière”53 Anne-Louise Milne, “The Singular Banlieue”70 Marie Darrieussecq, Fiction et anathèmes en France aujourd’hui”
[insert English title]83 Christophe Meurée, “Temps de la résistance: résistance au temps”99 Pauline Vachaud, “D’une ‘poéthique’ contemporaine ou comment ne
pas répondre à l’air du temps”116 Sarah Bélanger-Michaud, “Exil, doute, écriture: actualité du malaise
cioranien”129 Geoffrey Gilbert, “The Sad State of Post-structuralism”
L’Esprit Créateur
Vol. 50, No. 3 Fall 2010
Contents
© 2010 by L’Esprit Créateur. Published for L’Esprit Créateur by The Johns Hopkins UniversityPress.
L’Esprit Créateur (ISSN 0014-0767) is published quarterly in Spring, Summer, Fall, and Winterby The Johns Hopkins University Press, 2715 N. Charles Street, Baltimore, MD 21218-4363.
Periodicals postage paid at Baltimore, Maryland, and at additional mailing offices. POSTMAS-TER: Send address changes to L’Esprit Créateur, The Johns Hopkins University Press, JournalsDivision, 2715 N. Charles Street, Baltimore, MD 21218-4363.
Permissions. No portion of L’Esprit Créateur may be reproduced by any process or techniquewithout the formal consent of the publisher. Copies for personal or internal use may be made onthe condition that the copier pay a fee of $.20 per page through the Copyright Clearance Center,222 Rosewood Dr., Danvers, MA 01970, for copying beyond that permitted by Section 107 or108 of the U.S. Copyright Law. This consent does not extend to other kinds of copying, such ascopying for general distribution, for advertising or promotional purposes, for creating new col-lective works, or for resale. 30014-0767/07 $.20/page. Direct all other permissions requests toPermissions Manager, The Johns Hopkins University Press, 2715 N. Charles Street, Baltimore,MD 21218-4363; or visit www.press.jhu.edu/cgi-bin/permissions.cgi.
Subscriptions. Institutional rate per year is $88; individual rate is $33. For all subscriptionsmailed outside the U.S.A., please add foreign shipping: $7.60 (Canada or Mexico); $11 (outsideNorth America). Single copy rate (current or back issues) is $26 for institutions, $10 for individ-uals. If applicable, please add state taxes or GST. Prepayment is required for shipment. All orders,address changes, and other business correspondence should be addressed to The Johns HopkinsUniversity Press, Journals Division, P.O. Box 19966, Baltimore, MD 21211-0966 (USA); tele-phone (410) 516-6987; fax (410) 516-6968; email [email protected]; or toll free 1-800-548-1784 (US and Canada only). Claims for replacement of missing issues must be received withinthree months of mailing (six months for foreign addresses). All notices of change of addressshould provide both the old and new address.
The paper used in this publication meets the minimum requirements of the American NationalStandard for Information Sciences–Permanence of Paper for Printed Library Materials. ANSIZ39.48-1984.
Introduction :Entre symptôme et pharmakon,
penser « aujourd’hui » en France
Anne-Marie Picard
Le fait indubitable que des personnes, des races, des peuples différents se comportent de manièredifférente dans les mêmes conditions économiques exclut déjà la seule et unique domination desfacteurs économiques. On ne comprend absolument pas comment on peut négliger les facteurspsychologiques là où il s’agit des réactions des créatures humaines vivantes : […] les hommes nepeuvent faire autrement […] qu’apporter dans le jeu leurs motions pulsionnelles originaires, leurpulsion d’autoconservation, leur envie d’agression, leur besoin d’amour, leur aspiration àl’acquisition du plaisir et à l’évitement du déplaisir1.
En France, comme l’a dit une fois Michel Rocard, on transforme les problèmes en symbole2.
AU MOMENT OÙ NOUS ÉCRIVONS ces lignes, le journal LeMonde publie un hors-série intitulé : Sigmund Freud : la révolutionde l’intime, pour marquer le passage des textes freudiens dans le
domaine public. Le journal résume son propos ainsi : « Peut-on aujourd’huidessiner les contours d’un nouveau Freud, ce “conquérant des lumièressombres” (Elisabeth Roudinesco) » pour que « la question de la psyché, dudésir et de l’inconscient redevienne, au même titre que celle du bonheur et dela révolution, une idée neuve dans le monde » ? 3
Le Monde associe paradoxalement les termes psyché, désir, inconscientd’une part, bonheur et révolution, de l’autre. Comme la révolution, lapsychanalyse a toujours, en l’occurrence en France, « suscité de grandsespoirs : n’allait-elle pas en effet nous permettre de réaliser enfin nosidéaux »4? Et pour pallier à ce qui se formule aujourd’hui comme une « crisedes idéaux » ce que d’aucuns appellent « le malaise français », pourquoi pasreconvoquer un « nouveau Freud » ? La psychanalyse semble encore pouvoir« répondre » à cette demande d’utopies. Mais alors que nous sommes entrésdans l’ère « des magistères déclinants »5, comment faire du « neuf », inventerdes idéaux sans les attacher à une idéologie ?
Jacques Lacan formulait trois de ces utopies nées de l’imprégnation dudiscours psychanalytique dans le discours social :
La première, [Lacan] l’appelle la pastorale : accomplir son désir en union avec la nature, sur lemode à chacun sa chacune (ou son chacun). La deuxième, l’autonomie : se faire soi-même sapropre loi. La troisième se réclame de l’authenticité : être enfin soi-même, que certains ont traduitpar « ne pas céder sur son désir » en oubliant que ce désir est inconscient. (D. Lévy 143)
© L’Esprit Créateur, Vol. 50, No. 3 (2010), pp. 1–17
On reconnait ici des utopies actuelles : l’idéal amoureux (hollywoodien), lepaganisme écologiste devenu une nouvelle religion, le « développement per-sonnel » de l’individu qui parvient, dans le discours type « C’est monchoix ! »6, à assumer sa jouissance ; enfin l’expression transparente du désirdu sujet, le langage et la culture étant devenus simplement de la com’7.Danièle Lévy explique :
Ces utopies sont des effets de transfert. Par la compréhension inédite dont la psychanalyse faitpreuve au sujet de l’amour et du désir, et de bien d’autres expériences douloureuses, elle susciteun transfert, c’est-à-dire l’espérance de réaliser le désir sans culpabilité, cette espérance du bon-heur que Freud définit comme « la réalisation des vœux infantiles ». À noter que ces idéaux sontprécisément ceux que nous chantent aujourd’hui les psychothérapies. Mais le sujet en nous peut-il vraiment renoncer à la félicité ? (D. Lévy 143 ; nous soulignons)
La psychanalyse qui fait partie du paysage discursif français comme ce lieuoù les utopies se réaliseraient—un désir sans culpabilité, l’établissementd’une loi « pour moi seul », le tautologique « être » qui serait « soi » —, risquede participer à ce qu’elle dénonce : la tendance humaine à refaire du Un dansla jouissance incestueuse, du re-ligere. S‘ils n’analysent pas le transfert dontleur discipline se fait l’objet, si sortant de leurs cabinets, les psychanalystess’intéressent au lien social, ne risquent-ils pas de transformer plus avantleur discipline en une psychothérapie comme les autres, une idéologie del’autonomie et de l’authenticité comme les autres ?
C’est précisément cette question qui, dans le débat sur le malaise français,oppose depuis quelques années, sociologues, philosophes et psychanalystes.Certains d’entre eux, à la suite du Freud du Malaise dans la civilisation ontconstitué le lien social et son malaise chronique comme objet d’analyse, le« pathologisant » pour prescrire des solutions. Ce débat actuel noue ensembleles termes de notre titre : comme le disait Freud8, la pensée elle-même faitsymptôme quand elle veut tout expliquer, mais les solutions proposées, parl’intellect, fonctionnent comme un pharmakon, un remède pour l’être del’homme malade. À l’inverse de la religion pour qui l’être humain est fonda-mentalement mauvais et donc incapable de s’en sortir seul, Platon, qui le pre-mier utilise le mot en philosophe, pensait que l’être humain peut guérir par sapropre nature sans faire appel à un sauveur extérieur. La pensée, l’intelligencene se défait que difficilement du désir de jouissance : celle du symptôme quiinsiste, du pharmakon9 qui, tel un toxique, calme l’angoisse de l’à-venir, laterreur de notre scandaleuse condition humaine en construisant un systèmeparanoïaque, unificateur et protecteur, une interprétation : une Weltanschauung.C’est dans ce sens que nous l’entendrons : celui d’un principe de plaisir et de
2 FALL 2010
L’ESPRIT CRÉATEUR
répétition qui insiste, hypnotise, calme la souffrance et empoisonne, empêchela pensée en la moulant dans des signifiants-maîtres qui servent une jouissancemasochiste qui barre l’à-venir, cette auto-nomie littérale que Stiegler appelleavec d’autres : individuation.
Les termes d’un des débats actuels en France, qui prennent la crise decivilisation comme objet de pensée, sont présentés ici en ouverture de notrenuméro de L’Esprit Créateur. Les textes-panorama de Jean-Pierre Lebrun etde Solange Guenoun nous permettront de donner les grandes lignes de ladisputatio.
En 2002, à l’initiative de Jean-Pierre Lebrun qui l’interroge, le psychana-lyste Charles Melman affirmait dans L’Homme sans gravité : la santé men-tale relève aujourd’hui d’une harmonie non plus avec l’Idéal mais avec unobjet de satisfaction. Nous serions passés, disaient les co-auteurs du livreinitiateur de ce débat, d’une culture fondée sur le refoulement des désirs, etdonc la névrose, à une autre qui recommande leur libre expression et promeutla perversion. Les deux psychanalystes font alors cette hypothèse : les immensesprogrès de la civilisation sont en train de créer une économie psychique où serévèle d’abord un consensus social sur les comportements et une morale nou-velle. Et si nous sommes tous d’accord, plus de rebelles ou de marginaux etdonc plus de subversion. Sommes-nous donc ainsi en train de vivre une« véritable mutation anthropologique» qui permettrait une liberté totale desmœurs ? Celle-là même que Freud, en 1929, appelait de ses vœux pour sortirla civilisation de son « malaise » névrotique ? Les auteurs se demandent alorss’il y a là progrès pour la civilisation, lorsque cette exhibition exigée d’unejouissance perpétuelle apporte d’autres formes de souffrances et d’impossi-bilités, de « nouveaux symptômes » : fin du désir, dépression et mélancolie,« envies de rien », violences et passages à l’acte délinquants. Ou serait-ce,comme le pensent d’autres, que nous sommes aujourd’hui « plus sujets » etdonc « plus perdus » devant la complexité du monde ? En contrepoint de laréflexion de Lebrun, Solange Guenoun nous fera part des critiques dont a faitl’objet cette application de la psychanalyse au lien social (taxé d’autoritarismeou d’apolitisme), critiques de la part de la sociologie (Alain Ehrenberg) et dela philosophie (Jacques Rancière) : la nécessité de penser « aujourd’hui » enFrance en passant par le discours sur la « crise » ne serait-il pas un cache ? Dequoi cette rhétorique serait-elle alors le nom ? « En empruntant le détour parla pensée de l’émancipation du philosophe Jacques Rancière », elle renvoiealors « dos à dos le discours psychopathologique sur le malaise et le discourssociologique qui le dénonce, et met en évidence leur collusion consensuelle.
VOL. 50, NO. 3 3
ANNE-MARIE PICARD
En s’interrogeant sur les maîtres-mots de ce débat—‘crise’, ‘malaise’,‘égalité’, ‘démocratie’—et sur ‘l’obscur objet de la haine’ qui s’y manifeste »(voir Guenoun, plus loin). S’appuyant sur les difficultés spécifiques, rencon-trés au quotidien dans l’urgence de sa pratique d’analyste, ce que Jean-PierreLebrun reformule ici pour nous sont des hypothèses de travail qui permettrait,dit-il, d’« inventer comment soutenir la contradiction entre légitimité démocra-tique et travail de l’humanisation ». À nos lecteurs de juger de l’utilitéheuristique des notions dégagées par les deux parties.
À la suite de ces formulations de la « crise du lien social », nous proposonsdes constats critiques qui agenceront et interrogeront ce qui, dans la sonorité,la syntaxe, la grammaire (conscientes et inconscientes) de la France contem-poraine fait effet de sens, se joue d’une créativité au bord de la crise, c’est-à-dire la bordant et la dépassant. Par des réflexions à la croisée de plusieurschamps—psychanalyse, philosophie, littérature et études culturelles—, noustentons par ce numéro de faire l’effort, comme nous y invite Solange Guenoun,« pour ne pas se laisser saisir par l’effroi du présent »10, en prenant « ses dis-tances avec toutes ces violences polémiques qui, loin de clarifier les enjeuxpolitiques, contribuent au contraire à tisser la toile intello-médiatique de ladomination ? » (Guenoun).
Avant de laisser la parole à nos collaborateurs, arrêtons-nous sur deux deces polémiques pour les resituer dans l’erre du temps français : le livre deMichel Onfray qui a tenté (ô malheur !) de déboulonner l’image du pèrefondateur de la psychanalyse ; l’accusation portée contre l’écrivain MarieDarrieussecq (qui l’analyse ici) d’avoir « commis un plagiat psychique ».Dans l’après-coup à ce crime de « lèse-authenticité », elle nous fait l’honneurd’apporter, dans ce numéro, un éclaircissement critique et historique de larelation de l’Occident à la fiction.
Penser sans les maîtresOn l’aura compris, la psychanalyse reste un discours vivant en France. On
sait bien (mais quand même…) qu’elle ne promet pas un jardin de roses. Elleconstitue un savoir critique sur la jouissance du UN, la tentation religieuse,fondamentaliste qui, dans nos murs, promet un retour du sauveur, un retour auparadis illusoire du roman familial. Elle tente d’extirper le névrosé hors dumythe pour le mettre à la « bonne » place, là où il sera manquant : place del’universelle et scandaleuse condition humaine, où lui seront rappelés l’ir-représentable de la différence des sexes, la vitesse du temps imparti à la vie,la mort comme horizon... Elle n’apporte pas de bonnes nouvelles en effet !Régulièrement ainsi, s’agit-il en France à la fois de convoquer et de brûler
4 FALL 2010
L’ESPRIT CRÉATEUR
Freud, Lacan et Dolto sur les pages-titres des hebdomadaires. Signe que sonmessage fait toujours scandale, que ses « prophètes de malheur » sont encorevivants ? Que leur message, réifié en utopie, se trouve toujours et encore con-fronté à une réalité forcément décevante ? Ce pauvre Freud brûlé depuislongtemps ailleurs sur l’autel de l’idéologie triomphante de l’évaluation quan-titative… Si la psychanalyse est scandaleuse, qu’elle a bel et bien disparucomme problématisation de la subjectivité moderne dans la plupart des paysoccidentaux, tout en faisant son apparition ailleurs, c’est qu’elle doitdemeurer une entreprise de décroyance, pour l’individu qui se soumet à sontravail, pour la culture qui accepte de se faire travailler par elle, d’entendre saleçon : l’éthique du sujet comme manque-à-être. Le malaise français,proposions-nous, ne viendrait-il pas de cette insatisfaction provoquée par le« message » freudien ?
Le brûlot du philosophe Michel Onfray11 qui a, tout récemment, fait lesgrands titres et les débats houleux des plateaux de télévision, ne dit-il pas,comme un symptôme, cet appel resté sans réponse de la part du père de lapsychanalyse ? Donnons quelques extraits :
Freud ne s’est pas contenté de créer un monde magique, il y a conduit nombre de personnes et asouhaité y faire entrer l’humanité toute entière, sans exception, insultant les délurés qui serefusaient à prendre son théâtre pour le monde vrai, les traitant de névrosés, de malades, derefoulés ayant mille choses à se reprocher dans la boue épaisse de leur vie psychique12
On y trouvera également le reproche suivant, très… parlant : « Freud affirmequ’à l’origine de toute pathologie se trouve toujours un abus sexuel du pèresur son enfant dans ses plus jeunes années » (Le Point 78) ; « ces fictionsdangereuses sorties du cabinet du Docteur Freud détruisent les relationsentretenues par les enfants avec leur père » (Le Point 80).
Présenté comme un gourou fou, pervers, menteur, incestueux, antisémiteet carrément tueur de patientes, le fondateur de la psychanalyse n’aurait inventécette discipline, nous dit Onfray, que pour excuser ses fautes à ses propresyeux. Faisant ainsi de la psychanalyse, une religion qui ne pourrait que repro-duire du même (la névrose freudienne)—on sait pourtant combien cette ques-tion de l’auto-analyse du père fondateur a été travaillée par Freud et sesdisciples eux mêmes—, Onfray illustre l’impasse d’un discours« philosophique » qui ne fait de la philosophie qu’une émanation symptoma-tique et pharmacologique de son auteur. Si l’énoncé et l’énonciateur font UN,ce dernier cherchant un pharmakon consolateur à sa souffrance dans le lan-gage, toute écriture, toute pensée s’apparentera au délire. Onfray délirant surle « délire » supposé de Freud : où est alors le savoir critique ? N’est-ce pas
VOL. 50, NO. 3 5
ANNE-MARIE PICARD
alors l’excitation, avec ses points d’exclamations, qui domine dans le style duphilosophe, alors qu’il déboulonne un de ses anciens maîtres à penser13 ? Unpère idéal qui aurait fait défaut ? On ne peut reprocher à quiconque de vouloirdéfaire ce qui chez les disciples a pu devenir une sacralisation de la paroled’un maître. Mais alors ne faudrait-il pas démonter le fonctionnement mêmede cette sacralisation plutôt que d’y participer soi-même en faisant unehagiographie à l’envers, en effaçant les traces du doute, de la recherche desens dans le langage, traces pourtant bien lisibles du cheminement duthéoricien de la psyché : doutes, questionnements, autocritiques, appels auxpatients et aux analystes à venir, hommes et femmes, relectures, sont là bienprésents dans les rééditions. N’est-ce pas plutôt le défaut d’exégèse du texte,sa lecture littérale qui tend à le rendre sacré et intouchable ? On est loin enFrance, et ceci grâce à Lacan, d’avoir succombé à cette littéralité du textefreudien. Peut-être faudrait-il s’interroger alors sur la sacralité du textelacanien chez certains analystes…
La psychanalyse apparaît en Europe au moment où la science et ses idéauxprennent le pas, difficilement, sur les superstitions et les religions instituéestout en ne proposant aucunement, comme l’énonce clairement Freud en 1925,une vision unifiée du monde.
une Weltanschauung est une construction intellectuelle qui résout de façon homogène tous lesproblèmes de notre existence à partir d’une hypothèse qui commande le tout, où par conséquentaucun problème ne reste ouvert et où tout ce à quoi nous nous intéressons trouve sa place déter-minée. Il est aisé de comprendre que la possession d’une telle vision fasse partie des désirs idéauxdes hommes. Si l’on y croit, on peut se sentir assuré dans la vie, savoir ce vers quoi on doit tendre,comment on peut placer de la façon la plus appropriée ses affects et ses intérêts. (Freud, « XXXVe
conf…» 211)
Proposer une Weltanschauung serait en effet « refaire » de la croyance, dure-ligieux, là où le savoir psychanalytique pose la division de l’humain, sujetpris entre deux ordres de réalité hétérogènes, l’ours et la baleine des processusprimaires et secondaires, de la jouissance et du langage, de la Loi sym-bolique. Tel est le risque encouru lorsqu’on oublie que la psychanalyse, aucontraire de la philosophie, ne nous dit pas ce que nous devons faire. C’estau nom même de ce manque-à-être-tout-un qui cause le désir que la jouissancedu névrosé est critiquable : une jouissance incestueuse (en ce qu’elle lepousse à vouloir faire UN avec le monde), voue le sujet au culte narcissiquede l’enfant merveilleux, l’abîmant alors dans la répétition du symptôme. Cri-tiquer cette jouissance qui fait du UN dans la fidélité au passé, qui fabriquede la Weltanschauung avec de l’illusion moïque, c’est tenter de sauvegarder
6 FALL 2010
L’ESPRIT CRÉATEUR
un espace de jeu pour le sujet, un lieu où la croyance peut se métamorphoseren savoir au nom de l’Autre, l’espèce humaine, là où aujourd’hui au con-traire, insiste la peur de l’étrangeté de l’autre et le cocooning sur soi et safamille, se répète le présent éternel de l’imaginaire. Ce présent qui est sansaucun doute une des émanations de ce que l’historien Jacques Baynacappelle, dans un des derniers numéros de la revue Débat, la « société de fic-tion », cette matrice (matrix) décrite dans son fonctionnement tentaculaireainsi :
La société de fiction se présente comme une formidable accumulation de valeurs sans valeur.Aucun domaine, aucune sphère, rien n’échappe à un mouvement de dévaluation du réel quiaffecte tout et n’épargne personne. Valeurs individuelles et valeurs collectives, valeurs morales etvaleurs sociales, valeurs artistiques et valeurs économiques, valeurs fiduciaires et valeurs finan-cières, toutes sont dupliquées, puis contrefaites, enfin dévalorisées. Dans l’univers de contrefaçonqu’est la société de fiction, il n’est jusqu’à l’espace et au temps auxquels des substituts fictifsn’aient ravis leur statut de réalité [ … ]. Le temps est la matière première de toute sociétéhumaine, et le rapport de celle-ci à celui-là définit mieux que toute la nature de chacune. Tempslinéaire de la horde primitive, temps circulaire de la société paysanne, temps de travail de lasociété industrielle, temps libre de la société utopique, ces temps sont révolus dans la société defiction. Le « temps réel » est sa dimension essentielle, sa vérité, sa réalité. Condition sine qua nonde l’existence de la société de fiction, le « temps réel » n’est pas une fiction, c’est la fiction. Mèredes autres fictions et dure mère qui les englobe toutes, le « temps réel » n’est en fait que lepseudonyme frauduleux de l’instantanéité et l’alias dolosif du présent. C’est-à-dire qu’il n’existepas, le présent n’étant rien d’autre que le lieu sans lieu où sans cesse passé et futur tangentent sansjamais se recouper […]. L’instant n’a ni durée ni vie, et le présent non plus, qui est sommationd’instants. La fugacité est leur nature même, l’inexistence leur être achevé, l’irréalité leur sensunique14.
Au-delà de la souffrance du symptôme borderline et le pharmakon, quioffre la jouissance immédiate d’une consommation toxique et auto-maternantequi, même s’ils calment l’angoisse et la peur, laissent le sujet sans ad-venir,la parole pleine de l’analysant qui fabrique du symbolique, qui fait du neufdans la langue, de la signification là où il n’y avait que du sens sans queue nitête, fonctionne comme celle de l’historien pour une culture : « Marquer unpassé », dit de Certeau15, « c’est faire une place au mort », à la mort, à lajouissance de l’Un, et « redistribuer l’espace des possibles » pour un vivantqui pourra alors ek-sister (être hors de la jouissance incestueuse, re-ligieuse).C’est bien dans la langue, qui est toujours inscription à partir d’un corpsvivant, que le sujet trouve d’abord sa place, qu’une culture renouvelle sesmythes, se confronte aux idéaux morts du passé, à ce qu’on appelle « les tra-ditions ». Comment ce discours de l’ad-venir Autre peut-il s’entendre dansnotre « société de fiction » que Baynac définit comme cette « société de
VOL. 50, NO. 3 7
ANNE-MARIE PICARD
l’attente du retour du Temps perdu », société « négationniste du passé » qui« renie d’avance le futur et se complaît dans un déni de grossesse historique »qui « ne porte rien qu’elle-même ». Notre « société de la fin de l’histoire,société aboutie, indépassable et achevée » (Baynac 79) ne peut-elle que sereproduire éternellement, reproduire le même jusqu’à la fin des temps ? Quereste-t-il d’autre à cet assujet ? S’émouvoir, se plaindre, en appeler au Pèresymbolique, celui que l’écrivain néo-zélandaise Janet Frame appelait TheRed-Cross God ?16
« La tradition et les formations d’idéal du passé opposent, pendant untemps, une résistance aux impulsions issues d’une nouvelle situationéconomique » disait Freud (« XXXVe Conférence », 239). Ainsi, s’attaquantaux idoles, l’athéologie de Michel Onfray17 clame avec l’air du temps—commeson symptôme, c’est-à-dire sans le savoir—qu’il n’y a plus de royauté, que lepère symbolique est mort. D’autres, en toute connaissance, proclament aussi lafin de l’hétérologie, de la place tierce de l’Autre transcendant, s’en plaignant ous’en réjouissant : les maudits soixante-huitards, qui voulaient interdire d’inter-dire18 auraient-ils donc gagné ? Jean-Pierre Lebrun disait avec le philosopheMarcel Gauchet
que nous avons quitté, au cours de ces deux dernières décennies, un modèle de société où la placed’extériorité—l’hétéronomie—était inscrite soit parce qu’elle était en conformité avec le modèlepolitico-religieux de la transcendance, soit parce que, bien que ce modèle fût âprement combattuet même déjà en déclin, cette place restait néanmoins encore inscrite, vu que son empreinte con-tinuait à persister suffisamment dans le collectif. Aujourd’hui, l’estompement de cette dernières’est accompli, l’arrachement à la structure religieuse du lien social s’est réalisé, et nous sommesdès lors passés—sans rupture apparente, presque insensiblement—à un fonctionnement collectifqui s’est émancipé de toute référence à une position d’extériorité signant ainsi ce que d’aucunsont appelé « l’acte de décès de la société hiérarchique »19.
[…] Si d’emblée la lecture de l’organisation sociale ne reconnaît plus comme allant de soil’existence d’une place Autre, toute position qui prétendrait relever de cette place et s’en légitimerse trouve évidemment devenue obsolète. Mais dans un second temps, c’est tout discernemententre des places différentes—qui impliquerait toujours quelque asymétrie et qui risquerait de cefait, d’induire une hiérarchie—qui se voit invalidé. Cette fin de l’hétéronomie n’est pas pourautant synonyme d’anomie, car c’est un autre régime de la vie collective qui est en train de seconstituer sous nos yeux, celui de l’autonomie précisément20.
Sans hiérarchie de « valeurs », dans une autonomie qui l’excède, pas étonnantalors que le sujet se sente seul devant la complexité du monde. C’est, dit lapsychanalyse, que le sujet n’est plus assigné à une place par un père (incar-nant la Loi symbolique) dont la position même serait d’emblée (comme autre-fois) garantie par la structure patriarcale. Que le père réel fût violent oualcoolique, peu importait en effet : il était le père ! Ne reste aujourd’hui
8 FALL 2010
L’ESPRIT CRÉATEUR
« que » le père réel. Mais ce père qui ne nous assigne à aucune placepréétablie, ne peut tenir tout seul comme tel (comme le rappelle Marc-Léopold Lévy), sa place se fonde de ce qu’en dit la mère, de la place qu’il tientdans son discours. D’où la rage du fils Onfray ? Penser/parler pour soi,auto-nomos, tout en soutenant la place du père comme réel, comme homme,sans la mère pour le faire : telle est sans doute la difficulté. En effet, une foisdémontée la statue du Commandeur Freud (ou celle de tous les maîtres àpenser), ne reste qu’un pauvre père réel, émouvant et touchant, incapable,défectueux qui aurait cessé, en ne nous assignant à aucune place, de nous direce que nous devons être, ce que nous devons espérer. N’est-ce pas ce que lesujet réclame à corps perdu et à cris (et certains de ses analystes avec lui),entre symptôme et pharmakon ? Une façon de soutenir ce père (dans un au-delà de la mère toute-puissante), pour que s’ouvre un chemin hors de lacomplexité du monde, hors de la solitude et de ce désarroi qui vient avecl’autonomie, de l’angoisse qui accompagne la liberté ? Car s’il n’y a plus dePère symbolique, comment soutenir le rapport entre le langage et la vérité ?Tout risquerait de devenir fiction ?
L’intime dans la transparence obligée
Tout récit est une forme qui ne rend compte du chaos du temps que par un accord tacite entrel’expérience humaine et la parole, accord qui se complexifie de tout ce qui a été écrit avant. Ainsiles catégories esthétiques de la mimesis et de la représentation ne sont plus opérantes comparéesà celles de figure et de structure : un texte littéraire n’imite rien, il creuse dans la langue un espacequi n’existait pas avant lui.
Nous dira plus loin, dans ce numéro de L’Esprit Créateur, Marie Darrieussecq.Parce qu’elle est d’abord un travail dans la langue, sur la langue, pour que
s’approche le mi-dire de la vérité, c’est aujourd’hui en France, la littératurequi fait les frais de la mort (annoncée, désirée ?) de l’Autre tiers, le déboulon-nage de l’Auteur ayant été décrété, on s’en souvient, par les « jeunes » marx-istes, anticolonialistes d’après-guerre (après la défaite, la collaboration et larépression impérialiste). (Voir la contribution de Geoff Gilbert à ce numéro.)Ce n’est plus aujourd’hui « l’auteur » du texte, mais l’écrivain (en chair et enos numérique) qui est mis au devant de la scène médiatique pour devenir unproduit comme les autres, c’est-à-dire un objet pour la pulsion scopique, unsujet à l’émotion21.
L’accusation dont a été victime l’écrivain Marie Darrieussecq22 (qui lasitue ici dans notre Histoire philosophique et littéraire) d’avoir commis un« plagiat psychique » en écrivant avec pudeur le deuil impossible d’une mère
VOL. 50, NO. 3 9
ANNE-MARIE PICARD
dans son livre, Tom est mort, alors qu’elle n’avait pas (on croit rêver) connula mort d’un enfant, participe de cette machinerie de la société de fiction. « Leréel » du sujet ne peut y avoir droit de cité que s’il est transparent, c’est-à-direl’expression directe d’une expérience vécue, un témoignage, comme si lelangage était en prise directe avec le réel. Est-ce parce que le journal intimeest devenu « blog » offert à la lecture de tous ? Que l’intimité est devenueimpossible, prise « dans le Réseau comme le moustique à la lampe ? »demandent Robert Damien, Paul Mathias car, sur Internet :
Toutes les traces, tous les chemins mènent à nous et forment une topographie numérique,repérable et analysable, de laquelle on peut déduire la continuité d’un comportement, anticiper laconduite et prévoir les choix.
« On » ? Le problème est bien là. Qui peut le savoir puisqu’il n’est plus de Dieu pour sonderles cœurs et les reins, puisque tous nos flux existentiels sont absorbés par des machines anonymeset prolixes ? Qui peut prendre connaissance de ces données de notre sensibilité, dont elles gardentdes traces paradoxalement indélébiles ? Et comment garder le secret de nos pérégrinationsinformationnelles ? […] Le monde pris dans les réseaux d’Internet devient potentiellementtyrannique, même si la tyrannie est pour le moment encore douce. Nous sommes à la merci d’unmaître moins personnel que machinique, d’un maître anonyme disais-je ailleurs23.
Même si l’étymon latin de témoin, c’est terstis, le tiers, le savoir postulé parle « témoignage » n’est plus dans l’Autre (et donc toujours tronqué), il doitêtre aujourd’hui disponible par tout un chacun : ne suffit-il pas de « poster »une photo sur Internet avec sa légende pour déclarer son identité, sous laforme non plus d’un « j’y étais » mais d’un « j’y suis », garant de la vérité.Après Christine Angot (et Hervé Guibert avant elle), Catherine Millet24 (etquelques autres), n’est-ce pas en fin de compte ce qui est demandé aujourd’huià « la littérature » (le mot semble quasiment désuet) ? De devenir la légended’une expérience de vie, la version dolosive d’un vécu qui se doit de provo-quer, le scandale ayant remplacé les avant-gardes ? Choquer, étonner,apporter du « neuf », c’est nourrir d’« authenticité » la gueule vorace de « lasociété de fiction ». Ce que Marie Darrieussecq nomme ici l’« effet perversde la pratique autofictive », « un certain courant de l’autofiction refusa[n]ttoute place à l’écriture d’imagination », Jean-Pierre Lebrun le commenteraitpeut-être en proposant que c’est effectivement à partir de la structure per-verse et de sa théorie du langage que la société demande des comptes auxécrivains.
Rappelons avec le psychanalyste que Lacan, au début de son séminaire surLe Transfert, resitue la perversion comme une structure clinique qui ayant savaleur, s’en trouve à ce titre « délestée de son appréhension habituellementpéjorative » :
10 FALL 2010
L’ESPRIT CRÉATEUR
Si la société entraîne, par son effet de censure, une forme de désagrégation qui s’appelle lanévrose, c’est en un sens contraire d’élaboration, de construction, de sublimation disons le mot,que peut se concevoir la perversion quand elle est produit de la culture. Et le cercle se ferme, laperversion apportant des éléments qui travaillent la société, la névrose favorisant la création denouveaux éléments de culture25.
Ceci, continue Lebrun,
pour entendre que la ‘valeur’ de la perversion est effective, car en interpellant la façon dont lemodèle hiérarchique d’hier a pu mortifier le symbolique, elle le somme en quelque sorte deprendre la mesure de ce qu’au-delà de leur effet mortifiant, les mots doivent toujours néanmoinsrester au service du vivant. (« Une perversion ordinaire » 229, nous soulignons)
L’autofiction, genre privilégié en France depuis les années 8026, annonceraiten cela la perversion voyeuriste et exhibitionniste des reality-shows danslesquels, on le sait bien pourtant, il n’y a de « reality » que ce qui est montéen studio, le story-telling fabriquant un effet de réalité qui, en fin de compte,ne contient plus que « des lambeaux de réel comme ce yaourt censé contenirdes vrais morceaux de vrais fruits » (Baynac 79). Même si, comme le dit icide façon similaire Marie Darrieussecq, « du vrai-réel-de-l’autre avec despetits bouts d’authenticité dedans, nous ne pouvons rien savoir », on l’aurabien sommée, elle, de dire quel « morceau de vrai fruit » dans Tom est mort ?La perversion qui produit la question a déjà la réponse : si ce n’est pas auto-biographique, le vrai fruit est ailleurs : il n’a pu qu’être piqué dans « le vécu »d’une autre !
Savoir/vérité/authenticité/expérience/langage/écriture : autant de syno-nymes dans une langue ainsi transformée en simple « expression d’un vécu »,ce dernier mot élevé au rang de signifiant maître dans l’idéologie de la trans-parence. Nulle « parole » d’un sujet pris avec l’interdit, l’autocensure, maisun décodage de l’émotion à traduire dans une novlangue qui n’admet aucunglissement métaphorique ou métonymique, un mal-à-dire. N’est-il pas toutsimplement question, dans cette idéologie de la transparence, de demander àla langue non pas de signifier mais de re-présenter son objet ? N’est-ce pasalors un des symptômes de ce que Jean-Pierre Lebrun appelle « la perversionordinaire » : « si, pour le névrosé, tout objet se présentait sur fond d’absence(« castration »), pour le pervers, en revanche, il s’agit d’exhiber en perma-nence ce qui, ordinairement, se trouve dérobé »27 ? On le voit bien : l’expé-rience non racontable sur un plateau de télévision en quelque secondes chronone passe pas la rampe du montage : elle ne fait pas « vraie ». « Le faux n’estplus un moment du vrai, c’est le vrai qui est un moment du faux en attendantque le vrai soit entièrement faux » (Baynac 79). La machine médiatique ne
VOL. 50, NO. 3 11
ANNE-MARIE PICARD
peut ennuyer, demander au spectateur d’attendre le sens, ne serait-ce qu’à lafin de la phrase. « L’émotion » seule nourrit la fiction de la transparence : ellere-présente et s’adresse à un sujet sans inconscient et sans doute, sans lapsus.Le spectateur avive ainsi son excitation par des morceaux de chair arrachésaux « stars » de l’écran (écrivains, intellectuels compris) sans que celles-ci,d’ailleurs, semblent aucunement entamées par le sacrifice (toujours joyeux)dont elles se font les victimes, les pharmaka . Si le sacrifice semble sansexpiation, c’est qu’il s’agit de payer de sa personne (de son masque) dans leseul but de vendre un produit. Ainsi si la littérature disparaît, comme travaild’écriture (du névrosé ?), jeux de glissements du signifiant sur le signifié (etnon sur le référent), c’est qu’on lui demande de faire simple et concis, de« tenir sa langue » sous peine, pour l’écrivain, d’être considéré comme « uncharlatan » : un auteur de fiction après tout, disait Platon critiquant Homère,est comme « ces poètes qui ne voient les choses que d’après les mots »28.
« Un romancier n’est pas (et ne prétend pas être, et ne veut pas être) unhistorien, ni un autobiographe. Il se situe à un autre endroit du langage et dela parole. Et il dit aussi la vérité, il témoigne aussi de l’expérience humaine »(Darrieussecq). Cet « aussi » qui défend les mots de la littérature semble biendouloureux pour ceux d’entre nous qui sommes encore lecteurs de (vrais)livres ! Que l’écrivain ait à se défendre de la sorte d’écrire sans faire de lacom’, refusant d’être situé dans une arène où il ne lui sera demandé qu’unechose : d’apporter sur un plateau un lambeau de « réel » croustillant, c’est-à-dire forcément traumatique. Cet « alias dolosif du présent » dont parlaitBaynac, le « vivant » du pervers de Lebrun, n’est-ce pas ce que la jouissancedu sujet de la société de fiction réclame dans son fauteuil ? D’être nourri dutrauma de l’autre pour ressentir, avec ces petits coups de réel, qu’il ex-iste untant soit peu au-delà de la matrice, obtenant, par là, ce que Marc-LéopoldLévy appelle « un gain d’être » ?
Aux bords du malaise« Qu’en est-il aujourd’hui du désir et de l’intimité dans un monde panop-
tique ? » se demande ainsi Christophe Meurée ici avec les œuvres de Jean-Philippe Toussaint, un des « rares » écrivains, dont la trilogie asiatique (Fairel’amour, Fuir et La Vérité sur Marie) « met en scène l’envahissement de lasphère privée par le temps monumental, où le regard ne peut qu’être l’intru-sion de l’Autre, viol de l’intimité ». Ce n’est alors qu’en fonction d’une« reconfiguration de la temporalité subjective (l’un des principaux ressorts del’intrigue de Faire l’amour), que cette sphère intime ne peut qu’être recon-struite et redéfinie ». Ainsi, les critiques, lecteurs, écouteurs du monde, qui ont
12 FALL 2010
L’ESPRIT CRÉATEUR
accepté de démêler l’hypothèse d’un « malaise » demande à l’Autre (écrivainset cinéastes) de reformuler la problématique avec ses armes propres (Meurée,Pauline Vachaud, Anne-Louise Milne) afin d’accomplir une critique heuris-tique qui puisse faire sortir la pensée même du symptôme de « la crise ». Pourqu’une critique soit créatrice de ce lieu Autre, un lieu qui permette l’inventiond’un futur (d’un ailleurs autrement), elle doit se faire historiographe,repenser, dans un mouvement rétroactif, les idéologies et les croyancespassées : les vieilles idoles de la French Theory pour Geoff Gilbert ; l’accu-sation de fictionner le trauma et d’en amoindrir la charge d’affect pour MarieDarrieusseq qui retrace les débats houleux sur la mimesis chez Platon etAristote, et montre cette longue méfiance occidentale à l’égard de l’écriturepoétique ; Sara Danièle Bélanger-Michaud qui nous redonne à lire l’œuvre deCioran, parce qu’elle s’avère contemporaine dans son inactualité même car« elle résonne aujourd’hui, plus que jamais peut-être, comme une tentativelittéraire d’exprimer, par ses symptômes, un Zeitgeist ou une économiepsychique moderne tissée autour d’un malaise existentiel, historique et spirituelprincipalement ». L’écriture, si elle peut être pensée comme une sublimationratée pour le névrosé, une « production symptomatique », se soutient égale-ment dans « sa dimension pharmaceutique ». C’est ainsi à « une plongée àl’intérieur de la créativité de la crise propre à l’écriture cioranienne », quenous invite Bélanger-Michaud, qui interroge « autant ses symptômes que seseffets pour la pensée littéraire et la culture contemporaines ». Ainsi, PaulineVachaud nous montrera que « dans le champ de la littérature contemporained’expression française, un certain nombre d’auteurs mettent en œuvre ungeste singulier », ce qu’elle appelle une « responsabilité de la forme » qui « nerelève ni des impératifs moraux auxquels la littérature a pu se subordonner, nide l’autonomisation de la forme littéraire où la création ne vaudrait que pourson entière liberté—où l’œuvre serait « sans gravité », pour reprendre l’expres-sion de Charles Melman et de Jean-Pierre Lebrun.
C’est en travaillant les bords de la société de fiction, là où se confrontent« des voix socialement marquées », d’un côté les voix marginales et, del’autre, « la voix du consensus médiatique », que la lecture des œuvres deFrançois Bon, Marie Depussé, Maryline Desbiolles, Nicole Malinconi,Jacques-Henri Michot et Jane Sautière, permet à Pauline Vachaud de suggérerque s’élabore aussi dans la littérature d’aujourd’hui « une éthique de l’écriturespécifique » ; ce qui apportera de l’eau au moulin de Marie Darrieussecq enson appel. Le type de rapport qui s’y noue à l’autre et au réel semble alorsménager « une voie tierce, entre l’ordre du symptôme et les jouissances dupharmakon ». C’est l’espoir que fondent aussi Geoff Gilbert avec l’œuvre de
VOL. 50, NO. 3 13
ANNE-MARIE PICARD
Stéphane Beaud et Anne-Louise Milne qui se penche sur « l’invisibilité » desmarges de la société française que sont ces lieux de bannissement appelésbanlieues. C’est par ce bord que cette dernière entre dans la contemporanéitéfrançaise : « what might be involved in enabling other facets and figures oflife on the periphery to become visible ? » se demande-t-elle avec deuxœuvres de fiction : le roman de Jean Rolin, La Clôture, et le film de ClaireDenis, 35 Rhums. En proposant l’analyse de ces deux œuvres, mais surtoutaprès avoir historicisé l’approche du « problème des banlieues », Milne nousinvite, comme Gilbert, à ouvrir, à décloisonner les catégories critiques qui ont,jusqu’à maintenant, dominé les études dites « postcoloniales », un champencore inconnu en France.
C’est en effet seulement en ce printemps 2010, avec la publication du livrede Jean-François Bayart, Les Etudes postcoloniales (Karthala, 2010), les tra-ductions de In Other Worlds (Routledge, 2005) et de Can the SubalternSpeak ? ([1988] Columbia UP, 2010) de Gayatri Spivak et Colonialism inQuestion: Theory, Knowledge, History de Frederick Cooper (U of CaliforniaP, 2005) que vont se faire connaître en France les apports anglo-saxons dansun domaine considéré jusqu’à aujourd’hui comme ayant « peu de valeurajoutée »29 après les formulations proposées dans les années 50-60 parCésaire, Senghor, Fanon et Sartre. Par exemple, la collection critique dirigéepar Nicolas Bancel, Ruptures postcoloniales : les nouveaux visages de lasociété française (La Découverte) met en débat les déconstructions desidéologies coloniales accomplies dans les universités américaines (avec Saïd,Spivak, Bhabha) et ce qui apparait en France, chez bien des intellectuels et despolitiques, comme « une injonction à la repentance, une menace pour l’uniténationale » ; ceci au moment précis et paradoxalement où reviennent au« pays natal » les théories des auteurs cités plus haut auxquels il faudra ajouterles noms d’Albert Memmi et bien sûr d’un Foucault et d’un Derrida améri-cains. Il s’agit alors pour les lecteurs français qui s’y collent enfin de travaillerce qui reste un « impensé » : un imaginaire de la « race » et de « l’indigène »(Jeannelle 6). Ainsi, pour Anne-Louise Milne, « in France today the figure ofla banlieue condenses much of what is associated with the “crisis” of con-temporary society: racial strife and related inequities that are the legacy of thecolonial past; the collapse in familial structures and, more broadly, generalised“indiscipline”; unemployment and cultural insularity ». A partir d’une étudede l’ubiquité du terme banlieue dans le discours journalistique de tous bords,et critiquant la réification atemporelle et abstraite de la « crise des banlieues »qui entraine son « invisibilisation », l’auteur replace, comme une de sescaractéristiques, ces « performances de l’urgence » dans l’histoire du XXe
14 FALL 2010
L’ESPRIT CRÉATEUR
siècle. Geoffrey Gilbert soutient cette critique du processus de réification,d’anhistoricité sur laquelle, d’après lui, s’est appuyée la constitution imagi-naire de ce que l’on a appelé la French Theory, un champ de savoir et demétaphores parvenues aujourd’hui à une impasse autant « affective, intel-lectuelle qu’institutionnelle » car « it is about a structure of feeling in whichthe idea of theory has served a particular function ». En prenant en compte ladimension historique (« a history of the alignment and thus of the impasse andthe affect, in which the construction of “French theory” involved quite par-ticular disengagements with the world »), l’émergence du poststructuralismetextuel pourra se complexifier d’être pensé dans ses relations avec lesreprésentations de l’Algérie et le travail de la revue Tel Quel. Ancrées surleurs conditions d’émergence historique, celles de la décolonisation, d’autresprocédures théoriques, suggère Gilbert, pourront, avec Pierre Bourdieu, êtreidentifiées afin de penser l’Histoire contemporaine d’une France désormaismulticulturelle sur « a solid affective ground where theorisation and living canbe held tight together, where thought must be worldly » (Gilbert). N’est-ce pasen effet ce qui de l’altérité de l’autre, sous le chapiteau protecteur de laRépublique, pourra être pensé dans sa radicalité mais sans effroi, sans lacrainte d’un retour du refoulé religieux, qui permettrait de faire glisser lessignifiés du désir d’un vivre ensemble sous ces signifiants-maitres : MALAISE,CRISE, SYMPTOME ET PHARMAKON ?
The American University of Paris
Notes
1. « XXXVe Conférence : sur une Weltanschauung », Nouvelles Conférences d’introduction àla psychanalyse (Paris: Gallimard), 239.
2. Alain Ehrenberg, « Arrêtons les conflits inutiles », Les Tribunes de la santé, 22 (2009), 149.3. Citation tirée de http://boutique.lemonde.fr/boutique/product_info.php?manufacturers_id=
&products_id=462 (visité le 12 juillet 2010).4. Voir Danièle Lévy, « La Canne de Freud et autres moments de colère », Che Vuoi ? revue
de psychanalyse, « L’Erre de la jouissance », 29 (2008): 143.5. Claude Imbert, « Le Vatican dans l’orage », Le Point, 1961 (15 avril 2010), 7.6. Titre d’une émission de télévision du service public, France 3 (d’où le scandale provoqué
et sa suppression) qui tentait d’imiter de façon plus soft certains talk-shows américains oùdes personnes se font juger, huer ou applaudir pour les « choix » qu’elles ont fait dans leurvie, des « choix » qui étaient bien plus anodins que ceux qui sont théâtralisés à la télévisionaméricaine ; la perversité du système faisant de toute façon, de ces « choix », un branding,une réification identitaire, qui peut ainsi être livrée en pâture à un public hystérisé, jouissantd’être situé à la place du « bien pensant », exprimant par le lynchage médiatique une loimorale qui… n’a plus cours. C’est bien en effet l’animateur et le panoptikon télévisuel seulsqui organisent ces exécutions publiques et non la société. Dans la vie du pharmakos (tellela victime expiatoire de l’Antiquité grecque), c’est bien évidemment des conséquencesréelles qui se produisent de s’être fait mettre à cette place pour quelques dollars.
VOL. 50, NO. 3 15
ANNE-MARIE PICARD
7. Abrégé pour « communication ».8. « [A]nimisme sans actions magiques » fondé sur la « surestimation de la magie du mot »,
« croyance que les processus réels du monde suivent les chemins que notre pensée veut leurassigner » (Freud 221), la pensée elle-même est en son origine fondée sur un fantasme detoute-puissance, l’intelligence qui cherche à tout expliquer est alors d’abord une façon de« pallier à l’angoisse du réel » (expression de Marc-Léopold Lévy, communication privée ;dans ce qui suit les références indiquant simplement le nom du psychanalyste, directeur del’Ecole de psychanalyse laïque, sont du même ordre).
9. Voir Jacques Derrida, La Pharmacie de Platon, republié à la suite de Platon, Phèdre (Paris:Flammarion, 2006). Pour le philosophe, pharmakon désigne l’écriture, à la fois remède etpoison, car comme le précisera Bernard Stiegler, elle est « ce qui remédie aux failles de lamémoire et ce qui affaiblit cette mémoire » (Stiegler, Prendre soin, tome 1, De la jeunesseet des générations [Paris: Flammarion, 2008], 19). Le pharmakon revisité par Stieglerdésigne d’abord l’ambivalence : « L’étude philosophique du pharmakon (à la fois remèdeet poison) montre que toute société est addictive, qu’il y a de bonnes et de mauvaises addic-tions, qu’il y a même des addictions nécessaires, et que tout est jeu ». Voir Bernard Stiegler,« Questions de pharmacologie générale : il n’y a pas de simple pharmakon », Psychotropes,3-4, 13 (De Boek Université), 27-54.
10. Selon l’expression de Dominique Baqué, L’Effroi du présent : figurer la violence (Paris:Flammarion, 2009), citée par Solange Guénoun.
11. Le philosophe a en effet décrété par son titre Le Crépuscule d’une idole, l’affabulationfreudienne (Paris: Grasset, 2010).
12. Cité par le magazine Le Point qui a fait sa couverture de la sortie « événement » de ce livre :Emile Lanez, « Onfray déboulonne Freud », Le Point, 1961 (15 avril 2010), 74.
13. En effet Onfray avait songé en 2006 devenir analyste (confié au Magazine Elle, cité parEmile Lanez, 73).
14. Jacques Baynac, « La Société de fiction », Le Débat, 157 (2009): 78.15. « D’une part, l’écriture joue le rôle d’un rite d’enterrement ; elle exorcise la mort en l’in-
troduisant dans le discours. D’autre part, elle a une fonction symbolisatrice ; elle permet[…] de se situer en se donnant dans le langage un passé, et elle ouvre ainsi au présent unespace propre : “marquer” un passé, c’est faire une place au mort, mais aussi redistribuerl’espace des possibles, déterminer négativement ce qui est à faire, et par conséquent utiliserla narrativité qui enterre les morts comme moyen de fixer une place aux vivants ». Michelde Certeau, L’Ecriture de l’histoire (Paris: Gallimard, 1975), 118.
16. Janet Frame, Faces in the Water (1961) (London: Virago P, 2009), 13.17. Qui a publié Traité d’athéologie (Paris: Grasset, 2005), best-seller où il s’en prenait aux
monothéismes et exprimait surtout sa détestation de ce qu’il a subi, enfant, dans les pen-sionnats catholiques.
18. Selon un des slogans écrits sur les murs en mai 68 : « Il est interdit d’interdire ». Pour uneélaboration de cette idée de mai 68 comme « meurtre du père », voir le livre fameux d’uncertain André Stéphane (pseudonyme de deux analystes de renom, Béla Grunberger etJanine Chasseguet-Smirgel), L’Univers contestationnaire (Paris: Payot, 1969), ré-édité chezIn-Press sous leurs vrais noms en 2004). Voir aussi les livres de Gérard Mendel, La Révoltecontre le père (Paris: Payot, 1968), Le Conflit de générations (Paris: Payot, 1969). Onpourra consulter également la longue étude datant de 1970 de Philippe Beneton et JeanTouchard, « Les Interprétations de la crise de mai-juin 1968 », Revue française de sciencepolitique, 3 (1970): 503-44, disponible en ligne, http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfsp_0035-2950_1970_num_20_3_393237.
19. Expression de Marcel Gauchet, La Religion dans la démocratie (Paris: Gallimard, 1998).Voir également son livre sur cette idée, La Démocratie contre elle-même (Paris: Gallimard,2002), et Pierre Rosanvallon et al., France: les révolutions invisibles (Paris: Calmann-Lévy,1998).
20. Jean-Pierre Lebrun, « Une perversion ordinaire », La Clinique lacanienne, 9 (2005): 222-23.
21. Voir Bernard Stiegler, La Télécratie contre la démocratie (Paris: Flammarion, 2006).
16 FALL 2010
L’ESPRIT CRÉATEUR
22. Auteur récemment, chez P.O.L., de Rapport de police (2010), Le Musée de la mer (2009),Précisions sur les vagues (2008), Tom est mort (2007), Zoo (2006), Le Pays (2005), Le Bébé(2002), Bref Séjour chez les vivants (2001).
23. Damien R. et Mathias P., Présentation, « Dossier : Internet et la société de contrôle : le piège? » Cités/3, 39 (2009): 10. Les auteurs décrivent ces « traces » laissées, ces inscriptionsindélébiles de notre singularité, traduisibles en algorithmes : « Chacun de nous possède sesodeurs, ses sueurs, ses humeurs. Désormais s’y ajoutent nos sécrétions numériques quiavouent, à travers nos comptes bancaires, nos achats, nos appels, nos visites, nos naviga-tions, la spécificité de nos préférences, l’originalité de nos attractions, la continuité de noschoix. Elles racontent, pour qui en saura exprimer la singulière alchimie, une personnalitéstatistiquement inscrite dans les nœuds de circulation et les carrefours de nos déplacementsnumériques et réticulaires. Le récit de ce que nous sommes se compose ainsi par nous maistout autant sans nous. Nous ne sommes plus les narrateurs privilégiés de notre devenir,notre vérité est pour ainsi dire exsudée par le travail algorithmique des innumérablesmachines que mobilisent nos pratiques réticulaires » (Damien, Mathias 9). Voir égalementYves Charles Zarka, dir., Critique des nouvelles servitudes (Paris: PUF, 2007).
24. Particulièrement, leurs « livres-choc » (expression désormais consacrée par la publicité),L’Inceste (Paris: Stock, 1999) et La Vie sexuelle de Catherine M. (Paris: Seuil, 2001)respectivement.
25. Jacques Lacan, Le Transfert, Le Séminaire VIII (Paris: Le Seuil, 1991), 43 (noussoulignons).
26. Que Serge Doubrovsky définissait le premier comme « Fiction d’événements et de faitsstrictement réels : si l’on veut autofiction, d’avoir confié le langage d’une aventure à l’aven-ture du langage, hors sagesse et hors syntaxe du roman, traditionnel ou nouveau », Fils(Paris: Gallimard, 1977), 4e de couverture. Citons les précurseurs de ce qui se voulait uneécriture méta-autobiographique en connaissance de la cause inconsciente : Robbe-Grillet,Le Miroir qui revient (1985), Enfance de Nathalie Sarraute (1983), mais surtout GeorgesPerec, qui, tragiquement, pour parler la perte de ses parents par la Shoah, s’est confronté,plus qu’un autre, au travail de la vérité à l’œuvre dans le labeur de l’autobiographe. DansW ou le souvenir d’enfance (Paris: Gallimard, 1993), Perec mettait à jour l’impossiblesavoir, l’indicible inconscient « qui a déclenché » l’écriture. Le livre d’Hervé Guibert quimet en scène la mort de Michel Foucault et son propre sida, À l’ami qui ne m’a pas sauvéla vie (Paris: Gallimard, 1990), a été le déclencheur du voyeurisme médiatique et a sansdoute provoqué un appel d’air pour le genre. Il faudrait évidemment situer cette trans-formation du roman (lieu de naissance de l’individu moderne) en « auto-roman » dans leparadigme d’une anthropologie de la littérature.
27. Charles Melman (entretiens avec Jean-Pierre Lebrun), L’Homme sans gravité : jouir à toutprix (Paris: Denoël, 2002), 4e de couverture.
28. Darrieussecq, citant Platon.29. Bayart cité par Jean-Louis Jeannelle, dossier « Le Postcolonial en débats », Le Monde des
livres (24 avril 2010): 6.
VOL. 50, NO. 3 17
ANNE-MARIE PICARD
Ce qu’implique l’humanisation
Jean-Pierre Lebrun
DANS SON DERNIER OUVRAGE, L’Homme Moïse et la religionmonothéiste, Freud écrit : « Le passage de la mère au père caractériseune victoire de la vie de l’esprit sur la vie sensorielle, donc un progrès
de la civilisation car la maternité est attestée par le témoignage des sens tandisque la paternité est une conjecture, est édifiée sur une déduction et sur unpostulat »1. C’est donc bien dans ce passage de la perception immédiate parles sens à l’aperception médiate du raisonnement logique et de la capacitéréflexive que Freud a situé l’essence même du progrès de la culture et de lacivilisation. Dans le retour à Freud que Lacan a initié, ce dernier n’a fait quedémontrer comment ce consentement à perdre l’immédiat des sens coïncidaitavec notre aptitude au langage et se retrouvait dans la réalité psychique d’unchacun, mis en place par les interdits de l’inceste et du meurtre, le premierimpliquant la distance d’avec l’immédiat, le second tirant conséquence del’impossible de son retour. La Chose—das Ding chez Freud—est perduecomme telle et dès lors structuralement inaccessible, et la mère, de structure,en occupe la place.
Cette distance d’avec la Chose qu’implique, au sens psychanalytique,l’interdit de l’inceste est souvent méconnue, réduite par exemple aux aspectsjuridiques de cet interdit, alors que celui-ci n’a, en fin de compte, d’autrefonction que de rendre présent à chacun qu’il est nécessaire de perdre lajouissance de l’immédiateté saturante pour pouvoir parler. On ne parle pas labouche pleine !
Pour le grand linguiste qu’était Émile Benveniste, le langage est « laforme la plus haute d’une faculté inhérente à la condition humaine, la facultéde symboliser », et c’est à ce titre qu’il faut discerner d’emblée le langagehumain de la communication animale. Car l’humanisation implique le langagecomme mise en œuvre de la faculté de symboliser, et ceci suffit déjà pour nepas réduire le langage à la communication, contrairement à ce qui est souventvulgarisé aujourd’hui. Ce discernement reste crucial, car il implique ce qu’ona coutume d’appeler un saut épistémologique, autrement dit un changementde registre, définitoire de ce qu’il faut appeler l’espèce humaine.
Voilà pourquoi dans toutes les sociétés humaines, il faut perdre la jouissancede la mère, parce que l’humanisation implique que l’être parlant perde latotalité qui y est attachée, pour ouvrir la voie du désir humain. Ce dernier nes’entend que comme prenant son origine dans le manque, dans la négativité
© L’Esprit Créateur, Vol. 50, No. 3 (2010), pp. 18–38
que suppose la faculté du langage entendue comme la mise en œuvre de ladialectique de la présence et de l’absence : par les mots, ce qui est absent peutêtre rendu présent, et à cause des mots, la présence—toute présence—ne serajamais plus que truffée de l’absence.
Voilà pourquoi l’interdit de l’inceste avec la mère, quoique universel, ne faitpas l’objet d’une loi écrite : simplement parce qu’il fonde la Loi de notre espèce.Avant même de désigner l’accomplissement sexuel avec la mère, l’incestedésigne ce qui n’aurait pas consenti à la perte de la présence pleine, ce quin’aurait pas intégré l’absence, ce qui se serait dispensé de la négativation.
En ce sens, l’appareil psychique de l’être humain s’avère strictementdépendant de son aptitude à appréhender le manque et implique la capacité dedifférer la satisfaction, condition nécessaire à ce que s’inscrive la temporalité.Notons également que la logique du don et sa triple obligation de donner,recevoir et rendre, caractéristique et condition du lien social humain, ainsi quel’a mise en évidence Marcel Mauss dans son célèbre Essai sur le don (1924),va dans le même sens et suppose elle aussi cette perte d’immédiat2. C’est encela que nous pouvons avancer que l’interdit de l’inceste apparaît bien commel’invariant anthropologique de l’humus humain.
Rappeler ces quelques propos essentiels qu’enseigne la psychanalyse n’aici d’autre but que de nous interroger sur le devenir de ces traits constitutifsde la condition humaine dans nos sociétés actuelles. Car il apparaît commeévident que les sociétés humaines, chacune à sa manière et depuis bienlongtemps, se sont donné la charge de les transmettre.
Patriarcat et humanisationAinsi, par exemple, si nous relisons l’Orestie d’Eschyle, nous y voyons la
succession de deux meurtres, celui d’Agamemnon par son épouse Clytem-nestre et celui de Clytemnestre par leur fils commun, Oreste. C’est successive-ment l’enjeu de la première tragédie, Agamemnon, et de la deuxième, lesChoéphores.
La plupart des commentateurs semblent avoir ignoré un point précis,pourtant déterminant et crucial. Ils conviennent en effet du caractère incon-gru de l’argumentation utilisée pour justifier ou non de poursuivre et con-damner Oreste comme le préconisent les Érinyes, déesses vengeresses, ou enrevanche, de l’acquitter, lui qui a obéi à Apollon en tuant sa mère pour vengerson père. Il s’agit en effet dans le troisième volet de la trilogie, de l’inventionpar Athéna du tribunal qui permettra aux arguments des deux partis de sedéployer et de laisser l’aréopage trancher, en allant même jusqu’à prévoirqu’en cas de nombre identique de votes, ce sera à Athena en personne de
VOL. 50, NO. 3 19
JEAN-PIERRE LEBRUN
trancher : ce serait à elle de faire ainsi pencher la balance d’un côté plutôtque de l’autre à partir de son seul caillou, dit, depuis, caillou de Minerve.D’où d’ailleurs, la balance comme emblème du Droit et de la Justice deshommes.
Ce qui est donc incongru, c’est le point sur lequel achoppe l’argumenta-tion (Jacqueline de Romilly parle à son propos de « discussion inattendue etmême inopportune »3) : de qui l’enfant est-il d’abord l’enfant ? De la mère oudu père ? Ce point est déterminant, car ce serait son propre sang qu’Oresteaurait versé, alors que Clytemnestre n’aurait fait que verser le sang de sonépoux, autrement dit, d’un étranger. Les crimes ne seraient donc pas de lamême gravité, ceci justifiant qu’Oreste soit à son tour sévèrement puni.
Apollon qui a prescrit à Oreste d’accomplir son acte, conteste la perti-nence de cette échelle des crimes. Il déclare même légitime celui d’Oreste,puisque ce dernier n’aurait que vengé l’assassinat de son père. L’acte meur-trier d’Oreste ne serait donc qu’une simple riposte au crime de Clytemnestre,donc d’aucune gravité supplémentaire. C’est pour justifier cette positionqu’Apollon argumente très précisément à propos de la notion de crime desang. C’est pour définir celui-ci qu’il faut savoir de quel parent l’enfant estd’abord l’enfant : de la mère ou du père ?
La réponse donnée dans la tragédie d’Eschyle à cette question est claire :c’est le père, et cela permet dès lors de récuser l’argumentation des Érinyes,puisqu’il n’y aurait plus de lien plus prégnant entre Clytemnestre et Oreste ;ce dernier n’aurait seulement que rendu le coup fatal et une nouvellevengeance n’aurait plus besoin d’être réclamée.
La formulation de la réponse ne peut pourtant que paraître stupéfiante ànos oreilles acquises à la modernité et à la place reconnue depuis aux femmes :« ce n’est pas la mère qui enfante celui qu’on nomme son enfant : elle n’estque la nourrice du germe en elle semé. Celui qui enfante, c’est l’homme quila féconde ; elle, comme une étrangère, sauvegarde la jeune pousse—quanddu moins les dieux n’y portent point atteinte »4. Voilà comment l’argumentdes Érinyes se voit battu en brèche : en effet, ce n’est pas seulement avec lamère qu’il y a lien de sang, mais tout autant avec le père, puisque que l’enfantest d’abord et de manière prépondérante, l’enfant du père. Donc aucune dif-férence de gravité des meurtres qui puisse autoriser et justifier une escaladedans le crime. De plus, venger le père n’en apparaît que plus légitime.
On comprend pourquoi le juriste Johan Jakob Bachofen, dans son célèbreouvrage Le Droit maternel, a présenté l’Orestie d’Eschyle comme la descrip-tion dramatique de la lutte entre le matriarcat déclinant et le patriarcatascendant et finalement vainqueur.
20 FALL 2010
L’ESPRIT CRÉATEUR
Pour l’helléniste Jacqueline de Romilly, cet argument est néanmoinsdéroutant. François Ost, juriste et philosophe, dans son analyse remarquablede l’Orestie qu’il lit comme la tragédie de l’invention de la Justice humaine,qualifie cette argumentation de « théorie extravagante, courante semble-t-ildans l’Antiquité, qui suppose que la mère, à l’instar des “mères porteuses” neserait que la nourrice du germe en elle semé, de sorte que celui qui enfante,c’est l’homme qui la féconde » 5. Pour le psychanalyste André Green, l’argu-mentation d’Eschyle constitue « un étrange propos, si contraire aux enseigne-ments de la nature »6.
Nous pouvons cependant lire dans cette argumentation de l’Orestie uneindication majeure qui semble avoir échappé à tous ces commentateurs par-ticulièrement pointus. Pour ce faire, revenons sur le propos d’Apollon. Cedernier avance : « ce n’est pas la mère qui enfante celui qu’on nomme sonenfant. » Entendons bien, il n’est pas dit : ce n’est pas la mère qui enfante sonenfant, mais celui qu’on nomme son enfant. La traduction littérale du versserait « une mère n’est pas celle qui engendre celui qui est appelé son enfant ».Autrement dit, c’est le fait d’être appelé l’enfant—donc l’appartenance aulangage—qui légitime la prévalence donnée au père ; si le père est prévalent,c’est parce que l’enfant humain est toujours déjà—en tout cas virtuellement—inscrit dans le langage, qu’il n’est pas seulement réel. Lire les choses ainsipermet d’identifier que ce n’est pas tant le père qui supplante la mère, mais lanomination, le langage. Puisque bien sûr, la paternité—un père contrairementau géniteur—n’est possible qu’avec le langage, à tel point d’ailleurs, que danscertains cas, la nomination suffit à faire du père.
Ce déplacement d’accent—du père au langage—est évidemment d’uneimportance cruciale par rapport à notre question initiale, d’abord parce qu’ilrestitue la raison pour laquelle, dès la société grecque, l’enfant est d’abordl’enfant du père, ensuite, parce qu’il permet de faire apparaître très clairementles deux dérives possibles. Une première, celle du patriarcat, qui, en donnantl’importance au père que l’on sait, occulte que le père n’avait une telleimportance que parce qu’il était le moyen de mettre en place la prévalence dulangage, autrement dit d’assurer l’humanisation ; c’était eu égard à cette fonc-tion qu’il était et reste important et non en soi. Mais aussi une seconde dérive,celle de la postmodernité, qui en se débarrassant à juste titre du patriarcat, secroit du même coup libérée de tout père sans prendre en compte le travailnécessaire à l’humanisation qui lui était attaché7.
Ce que précisait déjà Eschyle, c’est donc qu’en donnant la priorité au pèreet en introduisant la dissymétrie entre le père et la mère, c’était la spécificitéhumaine de l’aptitude au langage qui était mise en place. Il fallait que le père
VOL. 50, NO. 3 21
JEAN-PIERRE LEBRUN
coiffe la mère pour transmettre l’organisation langagière et pour assurer laprévalence de la faculté de symboliser. C’est d’ailleurs aussi bien cequ’Athéna résume en un seul vers à la fin du texte : « Le dieu de la parole,Zeus, l’a emporté ».
Il s’agit donc de percevoir que la prévalence du père n’est qu’au servicede la condition langagière de l’espèce humaine. Nous pouvons dès lors sup-poser que le patriarcat n’a été que le moyen qu’avaient trouvé nos ancêtrespour assurer la transmission de notre condition de parlêtre, ceci avec tous lesexcès et abus qui s’y sont trouvés attachés. Mais de la même façon, puisquela modernité a initié la fin du patriarcat, nous pouvons l’entendre de deuxfaçons différentes : soit comme la fin de ce même patriarcat, soit comme lafin de la prévalence reconnue au langage et à la Loi de l’espèce. Nous pou-vons évidemment penser que les conséquences ne seront pas les mêmessurtout au moment où la modernité aura atteint l’intimité d’un chacun—ceque nous appellerons avec d’autres la postmodernité—car si cette confusionopère, si la prévalence du langage est jetée avec le père du patriarcat, c’esttout le travail de la culture et de l’humanisation qui risque de s’en trouver misà mal.
En écho à l’évocation de ce danger, comment ne pas être sensible à cettetraduction récente de l’Orestie, faite par Olivier Py8, directeur du théâtre del’Odéon à Paris, dans laquelle on voit précisément disparaître cette référenceà la nomination :
Ainsi Apollon de préciser :
Ce n’est pas la mère qui enfante l’enfant :Elle n’est que la terre fécondée.Ce qui donne la vie, c’est la semence du père.Elle héberge la pousse qui germeQuand les dieux le veulent (109).
Malgré le fait qu’Olivier Py ait intitulé sa préface à sa nouvelle traduction« une épopée de la parole » et qu’il n’ait de cesse d’insister, dans son com-mentaire, sur la confiance que fait l’auteur de l’Orestie à la parole (« pourEschyle, nous dit-il, la puissance des mots peut arrêter la violence de l’image »,ou encore « L’homme d’Eschyle a droit à la parole ») son évitement detraduire qu’en évoquant l’enfant, il s’agit de « celui qu’on nomme l’enfant »(Les Euménides, vers 658) est significatif de la confusion actuelle et pourraitbien être révélatrice de l’indigence symbolique qui nous menace aujourd’hui.
Les Grecs savaient donc déjà très bien que pour faire appartenir un enfantà l’humanité, il fallait intégrer la dissymétrie qu’implique le fonctionnement du
22 FALL 2010
L’ESPRIT CRÉATEUR
langage et, pour ce faire, légitimer une place prévalente. Que Bachofen ait faitde l’Orestie le moment d’instauration du patriarcat ne doit pas pour autant nousfaire prendre la vessie pour la lanterne. C’est bien la transmission de l’aptitudeau langage qui, en fin du compte, est l’enjeu, et non le patriarcat. C’est ainsique les sociétés humaines se sont organisées jusqu’à la modernité : elles se sontlégitimées de la loi du père pour mettre en place la loi du langage. C’est ainsique le modèle théologico-politique patriarcal a soutenu l’humanisation. Nonsans revers, car en laissant se confondre nécessité du patriarcat et nécessité del’humanisation, il a légitimé l’ensemble des préjugés qu’entraînait le patriarcat,aussi bien la mise au silence des femmes par le phallocentrisme, que les avatarsde la servitude volontaire et de la soumission aveugle à l’autorité.
C’est cet enchevêtrement que la modernité et la démocratie ont mis à nu.En prétendant à la prévalence de l’autonomie au détriment de l’hétéronomie,la modernité suppose la possibilité de définir par soi-même les normes de sonexistence et donc de se libérer des contraintes venues d’ailleurs, de l’Autresubstantiel, en l’occurrence divin. Ainsi la modernité peut être lue comme uneréaction salutaire à l’absolutisme théologique qui trouvait son expressionexacerbée dans l’idée d’une puissance divine. La modernité en ce sens estrationnelle, scientifique et réhabilite la curiosité théorique dépréciée par lesPères de l’Église. Et ce sera à la charge de la démocratie de réaliser cet objec-tif dans le champ de la vie politique.
Le lien social a donc été traversé par un changement très profond impli-quant la substitution du discours de la science à celui de la religion commemodèle de l’organisation de la vie collective. Les conséquences de cette trans-formation sont doubles : d’une part, c’est à un changement de paradigme quenous avons à faire, d’autre part, la profondeur de ce changement a misquelques siècles pour s’accomplir effectivement jusqu’à atteindre l’intime dechaque membre de la société, dite alors postmoderne.
Modernité et umanisationPour saisir la structure de cette mutation du lien social, nous nous sommes
référés aux célèbres paradoxes de Bertrand Russell issus de sa réflexion sur lathéorie des ensembles9. En passant d’un théologico-politique à la modernitédémocratique, tout se passe comme si nous avions abandonné un mode defonctionnement qui disposait de la consistance en même temps que de l’incom-plétude pour nous organiser selon un régime qui privilégie la complétude etl’inconsistance.
En mettant en évidence « la classe des classes qui ne s’appartiennent paselles-mêmes », l’auteur des Principia mathematica énonçait un principe de
VOL. 50, NO. 3 23
JEAN-PIERRE LEBRUN
limitation interne à l’organisation d’un système symbolique. Il faisait apparaîtrequ’il fallait choisir entre un système consistant et incomplet et un systèmecomplet et inconsistant. Il faut entendre ici consistant dans le sens mathéma-tique du terme, c’est à dire sans contradiction logique interne.
Ainsi en est-il, par exemple, de la phrase bien connue selon laquelle « tousles Crétois sont des menteurs ». Si nous considérons qu’Épiménide qui laprononce est lui-même un Crétois, il faut en tirer la conclusion qu’il est unmenteur. Mais alors, quelle valeur a encore la phrase qu’il vient d’énoncer ?Prendre en compte ce fait qu’Épiménide est crétois conduit à devoir déclarerla formule inconsistante. Au contraire, en ne se posant pas de question sur sonorigine, en traitant Épiménide comme mis en place d’exception, la formula-tion devient consistante, sans contradiction logique interne.
Autrement dit, ce que ce type de paradoxes a fait émerger, c’est que nousfaisions forcément un choix entre un ensemble consistant mais qui impliquel’incomplétude, puisqu’un de ses éléments doit en être exclu (Épiménide nepeut être un menteur lorsqu’il prononce la formule), ou un ensemble completmais qui est alors frappé d’inconsistance, dans lequel des vérités peuvent secontredire radicalement (Épiménide est un menteur selon la formule, mais iln’est pas un menteur quand il l’énonce). Choix forcé, donc, selon ce que nousenseignent la logique moderne et son étude des paradoxes, entre incomplétudeet consistance d’une part, ou complétude et inconsistance de l’autre.
Signalons surtout que pour Russell, on ne peut complètement quitter unsystème incomplet et consistant, même s’il faut reconnaître l’existence d’uneautre possibilité logique. Ceci rejoint d’ailleurs la capacité de langage quispécifie notre espèce, puisque celle-ci précisément suppose l’incomplétude,comme l’interdit de l’inceste nous le rappelle à chacun. Ou encore, lethéorème d’incomplétude de Gödel, qui démontre qu’aucun système nepourra jamais générer toutes les vérités de la théorie des nombres sans être, enmême temps, inconsistant.
Désormais, donc, les deux voies—celle de l’incomplétude et celle del’inconsistance—deviennent des voies qu’il est possible d’emprunter. Il s’ensuitqu’il devient possible de lire la modernité comme le choix de la contraintelogique qui, à partir de la science et en rupture avec la religion, autorise ladestitution de l’exception souveraine et, conséquemment, celle de l’ordresocial organisé à partir d’elle.
C’est dès lors ainsi que nous pouvons lire la mutation que nous traversons :le passage d’une société hiérarchique—donc consistante mais incomplète—àune organisation sociale égalitaire qui, au contraire, prétend à la complétude,mais au prix de l’inconsistance. Une telle mutation de l’organisation collec-
24 FALL 2010
L’ESPRIT CRÉATEUR
tive n’a été possible que parce que nous nous sommes émancipés de latranscendance religieuse. À cet égard, nous ne pouvons que rejoindre MarcelGauchet dans sa description de ce qu’il nomme la sortie de la religion :
Que veut dire sortie de la religion ? Pas seulement le recul des croyances, mais comme arrache-ment à la structuration religieuse des sociétés. Car la religion, dans la plénitude du terme, ce n’estpas seulement un système de convictions, c’est une manière d’être des communautés humaines.On peut parler en ce sens-là de sociétés religieuses ; le lien social lui-même, le pouvoir politique,la forme du collectif sont constitués par le religieux. Progressivement sur cinq siècles, l’Occidentest sorti de ce monde-là—c’est le fond de ce qu’on appelle la modernité10.
Et c’est d’ailleurs bien parce qu’on s’est affranchi de la place de l’exceptionroyale qui figurait l’exception divine, qu’a pu advenir la démocratie. Rappelonssuccinctement ce que fut le trajet de la démocratisation. La cité chrétienne deSaint Augustin présentait un monde consistant et ordonné. Chaque chose avaitsa place et rien ne remettait en question la solidarité entre les différents étagesdu monde : famille, gouvernement, pouvoir spirituel, etc. Bien sûr ce bel édi-fice devait affronter des difficultés au niveau de la réalité, des faits, mais rienne le menaçait au niveau du droit. La modernité a fait apparaître qu’un telmonde était une construction, un montage, une fiction. Le monde que nousnous représentons est dès lors apparu comme dépourvu de la légitime consis-tance qu’il revendiquait jusque là. Et l’histoire de notre ralliement à lamodernité n’aura été que celle de la remise en question lente et progressivemais radicale de cette consistance. La pyramide organisée hiérarchiquementne reposait que sur un leurre, une illusion, celle de l’extériorité radicale d’unAutre substantiel, en l’occurrence de Dieu. Une fois cette illusion—et cequ’elle emportait, soit l’existence non discutable d’une place d’exceptionabsolue—démasquée, nous nous sommes retrouvés face à un système quiavait perdu ce qui lui donnait sa consistance.
Mais pendant que se poursuivait le « combat » pour nous débarrasser del’exception, nous avons continué à reconnaître son existence, donc à con-sidérer qu’on se trouvait dans un monde toujours organisé par l’incomplétude.Ce n’est que lorsque nous sommes parvenus à vraiment nous émanciper de latranscendance substantielle, lorsque les acteurs se sont libérés de toutehétéronomie, lorsque toute référence au religieux s’est trouvée reléguée à laseule sphère privée, c’est alors—et alors seulement—que nous avons accom-pli le plan d’immanence deleuzien, que nous avons basculé dans un mondesans extériorité, organisé implicitement de manière complète et inconsistante.Ceci sans bien prendre la mesure de ce que nous nous étions aussi débarrassésdu transcendantal11.
VOL. 50, NO. 3 25
JEAN-PIERRE LEBRUN
Postmodernité et humanisationC’est au terme du parcours que nous venons de décrire que nous situons
le moment de « catastrophe »—au sens que donne le mathématicien RenéThom à ce mot—qui signe la mutation inédite de l’ « être ensemble » danslaquelle nous sommes aujourd’hui emportés. C’est ce changement de régimesymbolique qui bouleverse notre vision du monde et nos subjectivités dansleur intimité la plus profonde. Nous ne pouvons plus aujourd’hui compter surnotre manière traditionnelle d’avoir été ensemble—impliquant l’incomplé-tude et la consistance mais du même coup aussi la légitimité de la place del’exception—pour organiser la vie collective.
Notre représentation de la décision, par exemple, en est devenue radicale-ment différente. Il allait en effet de soi que c’était à partir de cette positiond’extériorité qu’une décision légitime pouvait être prise. Pour le dire demanière imagée, il allait de soi que l’autorité et le commandement venaientd’en haut—c’est d’ailleurs ce qui nous fait évoquer à ce propos un régimesymbolique essentiellement vertical ou pyramidal. Aujourd’hui on estime, aucontraire, que la décision finale doit émerger d’une confrontation des avis,d’une discussion entre les protagonistes, après des échanges entre tous lesinterlocuteurs. On se retrouve donc dans un régime symbolique horizontal oude réseau. Ce n’est plus ce qui est à l’extérieur qui a la préséance, c’est latotalité de l’ensemble lui-même qui doit avoir le dernier mot. Ce dont rendbien compte l’abandon du concept d’universel pour celui de global ou demondial, le passage de l’universalité à la mondialisation.
Jusqu’à récemment, la légitimité « d’un ordre » ne faisait que peu dedoute, pour autant qu’elle vienne de la place d’exception, de ce lieu detranscendance. Et si l’on contestait sa pertinence, le conflit éventuel qui enrésultait supposait l’existence des deux places, celle d’où cela commande etcelle d’où ça obéit et conteste. Ce qui signait bien et l’incomplétude et la consis-tance. Aujourd’hui, la légitimité d’une décision n’est bien souvent reconnueque si elle a obtenu l’accord de presque tous les partis en présence, que sitoutes les interactions pouvant être affectées par celle-ci ont été soigneuse-ment explorées. Ce qui suppose évidemment que se soient exprimés les avisles plus contradictoires, mais qu’aussi tous les interlocuteurs aient été—fût-cevirtuellement—consultés. Ce qui signe l’inconsistance et la complétude.
C’est donc toute la vie collective qui, de ce fait, a basculé. Elle ne sesoutient plus d’un ordre préétabli qui transmet des règles, mais d’un ordreémergeant des partenaires eux-mêmes. On voit l’intérêt de cette mutation : lesacteurs sont supposés s’impliquer, ils ne sont plus seulement des assujettis. Ilspeuvent davantage s’engager comme sujets, et le savoir propre à chacun peut
26 FALL 2010
L’ESPRIT CRÉATEUR
contribuer à la réalisation du projet collectif. Mais on doit aussi constater lesdifficultés nouvelles qui surgissent : comment en effet ne pas en conclure quetout ce qui est transmis par la tradition s’avère désormais sans intérêt, est tou-jours déjà périmé ? Et comment concilier tous les avis singuliers, forcémentdifférents ? Comment faire pour que tous les particularismes marchent deconcert ? Dans un tel régime, l’autofondation et l’individualisme prévalentnaturellement.
L’individualisme qu’on dit caractériser nos sociétés doit en effet êtrecompris comme une conséquence de cette mutation et non, ainsi qu’on lecroit souvent, comme sa cause. Dans un collectif où l’avis de chacun estindispensable pour obtenir une légitimité consensuelle, où l’on dénie la diffi-culté de ne plus avoir d’autorité légitimée par la représentation du collectiflui-même, on est conduit à laisser les rennes du pouvoir aux mains des seulsindividus. Ce qui, pour le moins, fera évidemment surgir à répétition les con-flits d’intérêts.
Dans une tel modèle de vie collective, quelle place reste-t-il pour que sub-siste au moins l’asymétrie si celle-ci est évidemment susceptible de rappeleraussitôt la hiérarchie décriée ? Et sans pouvoir se référer à une place d’excep-tion et la faire fonctionner en toute légitimité, comment soutenir encore unquelconque mouvement collectif ?
Les conséquences de ce changement sont donc radicales et elles con-cernent la vie quotidienne dans son intimité la plus irréductible. S’il fallait enconvaincre le lecteur, je renverrais aux images du frontispice du Léviathan deHobbes et de la lithographie de Escher intitulée Relativité (1953) que repren-nent dans leur ouvrage les juristes François Ost et Michel van de Kerchove12.Dans l’édition originale du Léviathan de Hobbes publié en 1651, un frontis-pice représentait un personnage allégorique mi-homme, mi-dieu qui dominaitl’entièreté du monde ; il symbolisait le pouvoir sans partage, supposant uneperspective unique déterminant toute perception possible. Par contre, l’illustra-tion de Escher, intitulée Relativité, montre un dessin où s’enchevêtrent troismondes, chacun logique dans sa perspective propre mais absurdes dans leurassemblage. Autrement dit, l’image du Léviathan évoque bien la pyramideimpliquant l’ordre et la hiérarchie ; celle de Escher, le réseau et l’impossibi-lité logique de faire exister simultanément les lois de la pesanteur dans lestrois mondes à la fois.
La légitimité démocratiqueCette évolution qui nous a aujourd’hui atteints dans notre intimité peut
bien sûr être mise en relation avec le mot d’ordre qui, selon Tocqueville,
VOL. 50, NO. 3 27
JEAN-PIERRE LEBRUN
définit l’essence de la société moderne : « l’égalité des conditions ». Cetteégalité qu’il appelle le fait générateur, le principe dont tout le reste se déduit,s’est aujourd’hui répandue dans la société tout entière, et l’une des difficultésnouvelles qu’elle a entraînée comme effet inattendu, c’est l’impossibilité dechoisir, car choisir suppose un pas de plus que de se satisfaire de mettre toutsur le même pied.
En fait, aujourd’hui nous espérons—parfois sans trop nous l’avouer—queles connaissances rationnelles viendront nous prescrire ce que nous avons àfaire, et ainsi nous éviter d’avoir à choisir. Nous pourrions ainsi renouer avecce qu’il faudrait alors appeler un naturalisme éclairé. Il n’y aurait qu’à tirerles conséquences des données recueillies comme le fait, par exemple, unordinateur lorsque l’enseignant y encode ses cotes d’examens et que s’endéduisent aussitôt les échecs et les réussites des élèves. Ainsi donc, si laméthode peut s’avérer efficace dans certains cas, il faut bien reconnaître qu’aubout du compte, tout ne pourra jamais se régler ainsi. Il restera toujours à fairedes choix. Il faudra toujours s’excepter pour décider.
Mais à notre époque, comme tous les repères s’équivalent, ils s’annulentmutuellement : une opinion peut aujourd’hui être d’emblée battue en brèchepar une autre, un avis est susceptible d’être aussitôt contré, un savoir peutimmédiatement en susciter un autre qui ira dans le sens inverse. Et par rapportà cette pluralité des interprétations possibles, tout se passe comme si nousn’arrivions plus à choisir, parce que nous ne pouvons plus accepter qu’il faillechoisir, c’est à dire accorder une prévalence, autrement, dit établir unehiérarchie, réaliser un ordonnancement. Choisir est devenu depuis que noussommes atteints dans notre fonctionnement intime par cette mutation du liensocial, comme incongru, une tâche désormais désuète, sauf à considérer lechoix comme le simple équivalent d’un marché à faire. Or choisir suppose,par définition, de consentir à perdre... ce qui n’a pas été choisi. Pourquoiperdre quoi que ce soit si le choix peut être évité ?
Nous voilà donc autrement asservis par notre vœu d’égalité démocratiquepourtant bien légitime. Avec le principe de l’égalité démocratique des condi-tions, ç’en est fini de l’inégalité de nature qui organisait la prévalence dumaître sur le valet. Désormais, valet et maître vont exister tous deux sur fondd’égalité, humainement parlant.
Mais ce serait aller trop vite, bien sûr, que de croire qu’il suffit de déclarerl’égalité des conditions pour que celle-ci soit réalisée ! La démocratie signe lafin de l’aristocratie et donc de ce qui faisait tenir ensemble la société jusquelà, le pouvoir que sécrétait l’inégalité des conditions, l’influence diffuseque certaines familles exerçaient de ce fait sur le reste de la société. Pour
28 FALL 2010
L’ESPRIT CRÉATEUR
Tocqueville, la démocratie est venue défaire le lien social qui était ainsiorganisé et elle a été contrainte de le reconstruire, mais autrement. Tout pou-voir d’un homme sur un autre, fondé sur la force, sur le prestige hérité, oumême sur celui issu des qualités personnelles, est désormais irrésistiblementérodé : dans l’état social démocratique, l’influence individuelle est à bannir.Les individus sont désormais séparés, placés les uns à côté des autres, sanslien commun qui les retienne : c’est la nature-même de la démocratie que dese constituer ainsi ! Et c’est pourquoi il faut garantir et réorganiser le « vivreensemble », ce que Tocqueville a appelé le pouvoir social, autrement dit lepouvoir de la société sur elle-même.
On comprend que dans ce nouveau type de lien qui récuse en soi l’in-égalité, alors que celle-ci est partout d’abord effective, ledit pouvoir socialqui a la charge de programmer l’égalité sera nécessairement très important.Mais où sera logé ce pouvoir dans la démocratie, puisqu’il n’est évidem-ment plus question qu’il puisse occuper une place de surplomb qui signeraitla persistance de l’Ancien Régime théologico-politique ? De plus, l’égalitédes conditions entraîne la fin des influences individuelles, donc aussi bienla fin de l’influence morale et intellectuelle de telle ou telle personne deréférence. Pour Tocqueville, ce à quoi dès lors se réfère l’homme démocra-tique, c’est le jugement du public, l’opinion. Et on voit bien la difficulté :comment continuer à vouloir l’égalité tout en prenant en compte que pourla réaliser, il faut un pouvoir qui la mette en place, voire qui veille à lagarantir, donc toujours une inégalité ! Telle est, pourrions-nous dire, lepoint de contradiction du système désormais exacerbé que nous vivons auquotidien.
La crise actuelle des repères semble donc être la conséquence des modifi-cations extrêmement profondes de nos conditions d’existence, mais aussi, etmême surtout, de ce que l’égalité des conditions prescrite par la volontédémocratique prétend aujourd’hui s’accomplir partout effectivement, jusquedans l’intimité d’un chacun. Désormais, plus question de pouvoir siégerlégitimement à une place plus haute que les autres, plus question de se référerspontanément à une place prépondérante... Néanmoins, et c’est bien là la dif-ficulté, il reste vrai que la différence des places continue d’exister, voire qu’unpilote s’impose, simplement parce qu’une équipe, pour réussir à bien fonc-tionner, doit la plupart du temps être dirigée, même si dans certains cas—quirestent relativement rares et alors souvent précaires—la collégialité peut venirà bout des problèmes journaliers.
Nous voilà donc pris en tenaille entre d’une part, les exigences de lalégitimité démocratique qui veut à juste titre l’égalité des conditions et d’autre
VOL. 50, NO. 3 29
JEAN-PIERRE LEBRUN
part, les contraintes de l’humanisation qui continuent à exiger que la dis-symétrie et la différence des places soit au programme, simplement parce quela condition langagière l’exige.
Une indigence de l’humanisationTout ceci semble engendrer aujourd’hui une grande confusion ; il s’ensuit
fréquemment une paralysie dommageable de l’action collective. Tout se passecomme si notre lien social n’arrivait plus à transmettre les contraintes del’humanisation ou, en tout cas, n’arrivait plus à le faire avec suffisamment deprégnance. C’est en ce cas que nous parlerons d’indigence de l’humanisation,c’est à dire lorsque les contraintes que nous avons reconnues comme relevantdes invariants anthropologiques ne sont plus à l’ordre du jour. De ce fait, notresociété postmoderne, prise dans la contradiction entre la légitimité démocra-tique et les lois du langage, dénie souvent celles-ci et se retrouve alors en dif-ficulté pour transmettre les conditions de l’humanisation.
Or, comme nous l’avons déjà évoqué, il est nécessaire de renoncer àl’immédiat pour pouvoir intégrer les processus langagiers. Mais que voyons-nous dans notre société postmoderne ? Un ensemble de productions technolo-giques qui visent à fournir des réponses de plus en plus immédiates ! Que cesoit le téléphone portable, l’image télévisuelle ou encore le culte de l’urgence,tout va plutôt dans le sens de récuser la nécessité de renoncer à l’immédiat. Àtel point d’ailleurs que les mécanismes de court-circuit par le passage à l’actesemblent devenus des caractéristiques de l’individu contemporain. Tout ettout de suite semble bien être le slogan implicite de la plupart des demandes—des exigences—d’aujourd’hui !
Nous sommes plutôt passés sous la tyrannie de l’immédiat. Or le culte del’urgence peut être lu comme une forme d’accomplissement incestueuxpuisqu’il tend à abolir la négativité qu’implique toute temporalité.
Prenons quelques exemples : lorsque le marché offre sa panoplie toujourscroissante d’objets à consommer, prêts à davantage satisfaire le sujet, l’in-satisfaction structurelle qui marque toujours le sujet de la parole devient demoins en moins acceptable ; de ce fait, se renforce plutôt la tendance à récusertout ce qui ne procure pas la jouissance saturante et immédiate.
Lorsque le droit se voulant d’abord science juridique, et se subordonnant,pour ce faire, aux avancées de la science et aux progrès des techniques, secontente d’enregistrer les pratiques, et renonce ainsi implicitement à sadimension tierce. Laissant dominer l’idée qu’il suffit de parvenir à concilierdes intérêts singuliers pour assurer le lien social, il évite soigneusementd’encore signifier la part que chacun doit perdre pour vivre ensemble.
30 FALL 2010
L’ESPRIT CRÉATEUR
Lorsque l’exigence de la transparence imprègne l’attente à l’égard du poli-tique, la dimension de représentation et l’irréductible part d’ombre qu’elleimplique ont de moins en moins de place pour faire entendre leur bien fondé.
Lorsque la paternité est repérable via la carte génétique, disparaît que cettepaternité implique la conjecture, voire la croyance ; elle devient en revanchecertitude au même titre que la maternité. En fait, à y regarder de plus près, lachose n’est pas aussi simple, mais le fait est désormais acquis dans l’opinion :la paternité n’est plus incertaine.
Lorsque la techno-science permet le changement de sexe ou la procréationhors milieu naturel, telle une fécondation in vitro ou une grossesse dansl’utérus d’une mère porteuse, nous sommes de plus en plus invités à croireque tout est devenu possible, voire le deviendra ; implicitement, l’impossible,le réel, ce qui échappe à la maîtrise, n’ont plus leur place.
Les exemples pourraient être multipliés à l’infini : presque tout, dans notresociété contemporaine, porte à croire que nous sommes débarrassés de l’in-contournable négativité que la psychanalyse13 a identifiée comme la carac-téristique même de l’humain. Ainsi, ce progrès de civilisation qu’indiquaitFreud et que Lacan a corrélé à notre aptitude au langage pourrait être passé demode, voire frappé définitivement de péremption.
Devons-nous davantage préciser ce que ceci implique comme changementpar rapport à ce qui était mis en scène dans la trilogie d’Eschyle ? Là où le tra-vail de la culture insistait sur l’humanisation par la fonction langagière et,pour ce faire, sur la prévalence à accorder—abusivement—au père, tout sepasse comme si le concret de notre évolution technologique nous amenait defacto à récuser cette prévalence et redonnait alors l’avantage au maternel, luirendant en quelque sorte la prévalence naturelle qu’elle avait perdue de par lepatriarcat. Ainsi s’accomplirait la confusion délétère de la seconde dérive quenous avons déjà évoquée : confondre fin des contraintes de l’humanisation etfin du patriarcat.
Les effets sur l’économie psychiqueC’est dans le contexte de cette dérive que vont alors se loger les effets sur
l’économie psychique des sujets. Rappelons que cette dérive n’est nullementinéluctable mais qu’elle est plutôt la suite logique de ce que les changementsont opéré sans que l’on ne s’aperçoive—que l’on ne veuille s’apercevoir—avec précision de leurs implications. Quels sont en effet, par exemple, les con-séquences d’un tel changement sur le statut de l’enfant ?
Que se passe-t-il pour l’enfant quand les contraintes de l’humanisation nesont plus prises en charge par le social que comme des vœux pieux ? Quand
VOL. 50, NO. 3 31
JEAN-PIERRE LEBRUN
nous quittons le monde patrocentré sans prendre acte de ce que c’était aussi lamodalité par laquelle s’installait la prévalence du langage, et qu’il s’ensuitque c’est alors spontanément le maternel qui reprend le dessus ? Que se passe-t-il quand l’enfant ne se réfère plus qu’à la mère ?
Dans une note adressée à Jenny Aubry, écrite en octobre 1969, Lacan dis-tinguait déjà deux formes différentes du symptôme : nous pouvons les mettreen rapport avec les effets du changement dont nous essayons de rendrecompte :
le symptôme de l’enfant se trouve en place de répondre à ce qu’il y a de symptomatique dans lastructure familiale. Le symptôme, c’est là le fait fondamental de l’expérience analytique, sedéfinit dans ce contexte comme représentant de la vérité. Le symptôme peut représenter la véritédu couple familial, c’est là le plus complexe, mais aussi le plus ouvert à nosinterventions. L’articulation se réduit de beaucoup quand le symptôme qui vient à dominerressortit à la subjectivité de la mère. Ici, c’est directement comme corrélatif d’un fantasme quel’enfant est intéressé. […] Il devient l’objet de la mère, et n’a plus de fonction que de révéler lavérité de cet objet. L’enfant réalise14 la présence de […] l’objet a dans le fantasme15.
Dans la suite de son propos, Lacan parle de la façon dont en ce cas, celas’organise pour la mère, mais il ne dit rien de ce que cela impliquera—d’avoirainsi réalisé la présence de l’objet a—pour l’enfant. Forcément, il ne dira riennon plus de ce que cela impliquera pour l’adulte ainsi organisé en référence àla seule subjectivité maternelle.
Or, nous soutiendrons volontiers que c’est à de tels sujets que nous avonsaujourd’hui de plus en plus souvent à faire, autrement dit, à des adultes dontl’enfance s’est constituée sur le mode de ne ressortir qu’à la seule subjectivitéde la mère plutôt qu’à celle du couple parental. Quelles sont les implicationsde ce mode de structuration ? Qu’il s’agit moins en ce cas d’un enfant phallusque d’un enfant objet !
Si, dans un tel contexte, les mères traitaient aujourd’hui l’enfant davan-tage comme objet plutôt que comme phallus, cela ne sera pas sans con-séquences, puisque ceci implique d’emblée la disparition de la référence à latiercéité16 ; et si celle-ci ne va plus spontanément de soi, cela déplace l’axe dela clinique. Quel est alors le type d’économie psychique qu’on retrouverachez un adulte qui a été ainsi l’objet de la mère ?
Nous l’avons baptisée perversion ordinaire, voire mère-version, et plusrécemment économie de l’arrière pays17, parce qu’il s’agit de réinterroger ceque certains psychanalystes, avant Lacan, appelaient le préœdipien. Cettenotion pourrait spontanément évoquer l’idée d’une maturation, alors qu’ils’agit en fait d’un changement radical d’économie. On ne passe pas du
32 FALL 2010
L’ESPRIT CRÉATEUR
préœdipien à l’œdipien par maturation ; il y a une traversée à faire pour pou-voir mettre en place l’économie du signifiant et du désir—habituellementtributaire de l’appui trouvé dans le travail de la culture et du lien social.
Or, ce à quoi nous assistons, c’est à une sorte de glissement d’uneéconomie à prévalence œdipienne—économie du désir—vers ce que nousappelons cette économie de l’arrière pays - économie de la jouissance. Il s’en-suit que la prévalence du langage n’a plus pour ces sujets la force qu’elle avaithier, le rapport à la parole n’a plus la même tenue, le même poids. Entendons-nous bien : il ne s’agit pas de dire qu’il n’y a plus cette prévalence, mais quela façon dont elle est appropriée par chacun est plus lâche ; de ce fait, le pacteinstitué par la parole ne constitue plus de la même façon qu’hier, la référencespontanée.
À la fin de son travail sur la sexualité féminine, en 1931, Freud faisaitremarquer que la période préœdipienne était bien plus longue chez la fille quechez le garçon, et pour décrire le préœdipien, il évoquait la civilisation minoé-mycénienne, qui était présente avant la civilisation hellénique classique—en1871, Schliemann découvre Troie, en 1875, Mycènes, et révèle par là-même,que le monde grec classique a une préhistoire. Utilisant cette image, Freudécrit :
La pénétration dans la période de pré-Œdipe de la petite fille nous surprend comme, dans un autredomaine, la découverte de la civilisation minoé-mycénienne derrière celle des grecs. Tout ce quitouche au domaine de ce premier lien à la mère m’a paru si difficile à saisir analytiquement, siblanchi par les ans, vague, à peine capable de revivre, comme soumis à un refoulement particulière-ment inexorable18.
Autrement dit, Freud soutient que le préœdipien chez la fille est beaucoupplus long, et qu’il n’est même pas certain qu’elle en sorte, tandis que chez legarçon, il est très vite refoulé et disparaît sans laisser de traces. Si on suit cetexte, on peut dire qu’avant l’Œdipe, il n’y a donc pas rien, mais il y a l’arrièrepays d’un lien exclusif à la mère.
En l’absence de la légitimité qui nous caractérise désormais quant à l’in-tervention paternelle du temps du patriarcat, il y a toutes les raisons de penserque la persistance du préœdipien de Freud puisse atteindre autant les garçonsque les filles d’abord et que cela n’aide nullement les filles à quitter la préva-lence de ce lien. Autrement dit, la subjectivité de notre époque pourrait biens’avérer désormais recouvrir la prévalence de cette économie de l’arrièrepays.
Il nous faut alors expliciter comment cela fonctionne dans une telleéconomie. Celle de la névrose banale patrocentrée qui sévissait à Vienne au
VOL. 50, NO. 3 33
JEAN-PIERRE LEBRUN
début de la psychanalyse, nous la connaissons relativement bien, nous con-naissons les contradictions habituelles auxquelles, en ce cas, nous avons àfaire ; mais comment s’organise un fonctionnement qui ne ressortit que de lasubjectivité maternelle ?
Ce qui importe, c’est de nous apercevoir que derrière le fonctionnementsymbolique, il y a un fonctionnement purement réel—cela a toujours été le cas,mais aujourd’hui, c’est devenu fréquent que ce fonctionnement constituel’horizon préférentiel—et que si l’on s’en tient à un tel fonctionnement—nécessairement archaïque—, il empêche, il bloque l’ouverture vers la ternarité.
Ceci n’entraîne pas pour autant la négation de l’enfant comme futur sujet,comme dans la psychose, mais bien plutôt la promotion d’un désir d’enfantcomme objet réalisant la complétude maternelle. Ceci se corrèle quasiautomatiquement avec l’expulsion du sexuel, déclaré dès lors traumatisant—grâce au mécanisme du démenti, ayant un effet forclusif—avec le rejet d’unpère comme homme de la mère.
L’enfant n’a plus dès lors à être confronté à l’énigme du couple. On pour-rait, par boutade, avancer que nous n’avons plus affaire qu’à une procréationpaternellement assistée. Un homme n’est plus nécessaire que comme breloquefonctionnelle. Et ce qui s’en suit, c’est que toute la curiosité infantile se voittuée dans l’œuf. C’est le ressort même du questionnement, et donc de lapensée, qui en est alors atteint.
Ce qui est pourtant exigé d’un enfant, c’est d’avoir toujours à faire le tra-vail psychique de se détacher, de se séparer d’avec les figures parentales. Etl’on peut très bien avancer qu’un sujet n’arrive à se détacher de ses figuresque s’il rencontre le point de non rapport de ces deux géniteurs. C’est pourcela que le point d’origine, de Nuit sexuelle, comme l’appelle Pascal Quignard19,doit être rencontré. Car ce point-trou atteste de ce que la place que j’ai àoccuper existe comme point zéro, comme place vide dans le grand Autre. Sije n’ai à faire qu’à une double parenté, ce que consacre précisément le termede parentalité aujourd’hui en vogue en Europe, rien ne garantit l’enfant de nepas avoir à faire qu’à deux éducateurs, qu’à un covoiturage éducatif !
Pour reprendre les termes de Freud, l’effet de tout cela, c’est bien d’allerà l’encontre des « facteurs qui habituellement agissent pour obtenir l’abandonde l’objet maternel si intensivement et si excessivement aimé. » Dans cetunivers, l’enfant n’a plus qu’un prénom, le sujet y sera comme sans nompropre20, voire sans nom, il sera donc comme laissé dans le noir.
Dans cette économie de l’arrière pays, le sujet est absorbé par l’Autredont il ne s’est pas vraiment individué. Et c’est cette absence de séparation quiva faire le lit de ce qui s’appellera son addiction. Le terme d’addiction qui
34 FALL 2010
L’ESPRIT CRÉATEUR
fleurit aujourd’hui pour décrire un ensemble de pathologies qu’il serait diffi-cile de ne pas lier à l’excès de consommation, est un terme du droit romainqui signifiait : contrainte par corps (réel) de celui qui n’a pas payé sa dette(symbolique).
Nous soutiendrons que c’est à cet endroit précis que la subjectivité denotre époque noue alors préœdipien et néolibéralisme. Il n’est pas possible eneffet de ne pas rapprocher le glissement vers la prévalence de cette économiede l’arrière pays avec le développement de l’économie libérale sans freinauquel nous assistons.
Dans son ouvrage à cet égard éclairant, le politologue Benjamin Barber,conseiller de Bill Clinton, après avoir insisté sur l’évolution du capitalismeproductiviste vers un capitalisme consumériste, indique que la cage d’acier dela modernité, dont parlait Max Weber, s’est vue aujourd’hui remplacée par le« piège à singe » :
une petite boîte contenant une grosse noix est fixée à un poteau solidement planté. On ne peutattraper la noix que par un unique petit trou dans la boîte, conçu pour laisser la passer la pattetendue de l’animal. Il est assez facile pour le singe d’entrer sa patte dans la boîte, mais, une foisla noix saisie, il ne peut plus la retirer. Il est bien sûr évident pour tout le monde (sauf pour lesinge) qu’il lui suffit pour se libérer de lâcher son trophée. Néanmoins d’habiles chasseurs ontdécouvert qu’ils pouvaient ainsi conserver leur proie pendant des heures, voire des jours entiers,car le singe ne lâchera pas la noix. Il préférera mourir (et meurt souvent)21.
Ainsi l’absence de possibilité de lâcher l’objet se retourne en addiction.L’évacuation de la négativité fera que le sujet sera addicté à son objet quelqu’il soit. C’est alors la congruence entre ce que Lacan désignait de l’enfantgénéralisé22 pour caractériser notre société, et le ressort du capitalismeconsumériste que l’on voit ainsi organiser ce que nous pouvons appeleraujourd’hui la subjectivité de notre époque, à savoir la subjectiviténéolibérale, celle qui intériorise psychiquement le modèle du marché. « L’in-fantilisation a pour but d’inciter les adultes à la puérilité, et de préserver cequ’il y a d’enfantin chez les enfants qui essaient de grandir, tout en leurdonnant le “pouvoir adulte” de consommer » (Barber 114).
Les sujets ainsi produits par notre époque sont invités à rester engluésdans l’Autre. Il s’ensuit que le désir qui les constitue pourtant restera souventdans les limbes, non encore advenu, et donc sans sublimation possible maisaussi de ce fait sans accès à l’altérité commune. Il s’ensuit un mouvementd’emballement où l’unification du multiple—ce que Bernard Stiegler appellel’esprit du capitalisme23 ne pouvant plus s’opérer par la contrainte à la culture,autrement dit par le haut, elle ne peut plus être qu’atteinte à moindres frais par
VOL. 50, NO. 3 35
JEAN-PIERRE LEBRUN
le bas. Mais, sans la perte de l’immédiat qui arrime le sujet dans le manque,cette unification du multiple n’est plus qu’un ersatz, et c’est alors l’entouse-ment de pseudo-sujets dans une société troupeau—avec son cortège de con-signes, de slogans, de mots d’ordre et d’empêchements qui tiennent lieud’interdits—qui est au programme, avec le fantôme d’un totalitarisme soft quin’a même plus besoin d’une idéologie pour se soutenir et asservir la masse.Car un tel fonctionnement permet de substituer à l’énergie libidinale, la seulesatisfaction des tendances pulsionnelles. Dès lors, la prescription à lajouissance peut même se faire passer pour l’avènement d’un homme nouveau.
Ainsi émerge dans le quotidien de nos pratiques un ensemble de questionsnouvelles, car il s’agit de savoir comment faire face à cette subjectivité con-temporaine, comment se situer pour réintroduire la fonction de la castrationdans le discours24. Car ces sujets ainsi organisés psychiquement dans la seuleéconomie de l’arrière-pays, croyant faire une opération simple, se retrouventen fait entraînés dans une logique archaïque qui leur échappe.
ConclusionLa mutation du lien social dans laquelle nous sommes emportés entraîne
en toute logique un moment de déculturation et d’indigence, car les con-traintes de l’humanisation ne sont plus transmises via les structures sociales ;chacun se trouve ainsi laissé à lui-même pour identifier ce qui fait invariantanthropologique. Cette indigence peut être estimée transitoire et n’est nulle-ment inéluctable. Encore faut-il ne pas se laisser distraire de la difficulté parles sirènes néolibérales, car celles-ci, comme nous l’avons vu, peuvent fairealliance subtile et prégnante avec les forces qui détournent plutôt des exigencesqu’implique l’investissement symbolique. Encore faut-il ne pas entériner nosaveuglements face au réel !25 Il est donc à craindre que, comme au débarque-ment de Normandie, les premières vagues générationnelles soient les plusdurement touchées.
Il n’y a cependant aucune raison de penser que ce nouveau défi, s’il estpris en compte pour ce qu’il est, ne puisse pas constituer un progrès possible.La fin du patriarcat autorise des nouvelles voies jusqu’ici maintenuessoigneusement fermées : le pluralisme, la parole des femmes, le féminin dansle social... Rien ne sert de se satisfaire de s’être débarrassés des contraintesd’hier ; il s’agit en revanche de soutenir dans un même mouvement celles quicontinuent d’exister—la légitimité de la différence des places—et les nou-velles—la légitimité démocratique—qui nous ouvrent des voies inédites. Ànous de prendre la mesure de notre division entre ces deux légitimités, à nousde relever le défi ! Ceci ne s’impose pas avec l’évidence espérée ; ceci exige
36 FALL 2010
L’ESPRIT CRÉATEUR
un supplément de penser qui n’en est que plus tributaire de ce que nous nenous contentions pas de cette indigence des processus d’humanisation ; ceciimplique par contre que soient clairement et rationnellement identifiés lesmécanismes complexes qui nous déterminent aujourd’hui. Nous espérons yavoir ici quelque peu contribué.
Psychanalyste à Namur, Belgique
Notes
1. Sigmund Freud, L’Homme Moïse et la religion monothéiste (Paris: Gallimard, 1986), 213.2. Voir à ce propos Alain Caillé, Anthropologie du don (Paris: Desclée de Brouwer, 2000) et
Jacques Godbout, Ce qui circule entre nous, donner, recevoir, rendre (Paris: Seuil, 2007).3. Jacqueline de Romilly, L’Orestie d’Eschyle (Paris: Bayard, 2006).4. Eschyle, Les Euménides (1935) (Paris: Les Belles Lettres, 2004), 155, vers 602-607.5. François Ost, « L’Orestie ou l’invention de la Justice », Raconter la loi, aux sources de
l’imaginaire juridique (Paris: Odile Jacob, 2004), 91.6. André Green, Un œil en trop (Paris: Éditions de Minuit, 1969), 93.7. Ce discernement est ce qui est méconnu sinon dénié par les critiques qui nous sont parfois
faites directement comme celle de déclinisme nostalgique (Ehrenberg) ou indirectement ense référant à ce qui serait notre haine de la démocratie (Rancière). L’ennui, c’est qu’en sedébarrassant ainsi de la difficulté spécifique que désormais nous rencontrons au quotidien—que ce soit dans la clinique de la vie institutionnelle ou dans celle des sujet en difficultés—,ils ne contribuent guère ni à prendre la mesure des enjeux, ni à être à la hauteur de ce quiest pourtant un vrai défi : inventer comment soutenir la contradiction entre légitimitédémocratique et travail de l’humanisation. Voir plus loin dans notre texte.
8. Eschyle, L’Orestie, Olivier Py, trad. et préface (Arles: Actes-Sud papiers, 2008).9. Nous ne faisons en cela que suivre l’enseignement de Lacan. Nous aurions pu ici tout aussi
bien nous référer à son célèbre schéma de la sexuation. Voir Jean-Pierre Lebrun, La Per-version ordinaire (Paris: 2007, Denoël).
10. Marcel Gauchet, « La Laïcité a gagné mais elle a changé de sens ! », L’Histoire, 289 (2004):81.
11. Il faudrait ici introduire une distinction de taille entre société européenne et nord-américainequ’avait déjà très bien perçue Tocqueville. Ce dernier en effet, constatait que, dans la sociéténord-américaine, la place de surplomb à laquelle autorisait la religion continuait de fonc-tionner. C’est en Europe que la démocratie l’a perçue comme ce dont il fallait impérative-ment se libérer. Il faut tenir compte de cette différence qui est cruciale pour l’analyse quenous faisons ici.
12. François Ost et Michel Van de Kerchove, De la pyramide au réseau, pour une théoriedialectique du droit (Bruxelles: Publication des Facultés universitaires St Louis, 2002).
13. Et pas qu’elle, mais nous pourrions avancer et soutenir qu’elle en a établi les coordonnéesd’une manière congruente avec les exigences de la science.
14. Le terme est souligné dans la lettre manuscrite et en italiques dans la transcription desAutres écrits.
15. Jacques Lacan, « Note sur l’enfant », Autres écrits (Paris: Seuil, 2001), 373.16. C’est ainsi que nous nous rapprocherions des thèses de Paul Yonnet. Pour ce dernier, il y a
un ensemble de conséquences à prendre en compte de ce que l’enfant est devenu la plupartdu temps un enfant du désir, non du désir sexuel, mais du désir d’enfant ! C’est alors latiercéité qui évidemment disparaît dans l’œuf ! Voir Paul Yonnet, « L’Avènement del’enfant du désir », Études (2010): 43-52.
17. Jean-Pierre Lebrun, « Une économie de l’arrière-pays », Che Vuoi ? revue de psychanalyse,29 (2008): 121-34.
VOL. 50, NO. 3 37
JEAN-PIERRE LEBRUN
18. Sigmund Freud, « Sur la sexualité féminine (1931) », La Vie sexuelle (Paris: PUF, 1969),144.
19. Pascal Quignard, La Nuit sexuelle (Paris: Flammarion, 2007).20. Rappelons ce que Lacan avançait dans ses écrits à propos du nom propre : « Le signifiant
S( ) est comme tel imprononçable, mais non son opération, car elle est ce qui se produitchaque fois qu’un nom propre est prononcé ». Jacques Lacan, Écrits (Paris: Seuil, 1966),819.
21. Benjamin Barber, Comment le capitalisme nous infantilise (Paris: Fayard, 2007), 75.22. Jacques Lacan, « Discours de clôture des journées sur les psychoses chez l’enfant (1968) »,
Autres écrits (Paris: Seuil, 2001), 369.23. Bernard Stiegler, Mécréance et discrédit, vol. 3, L’Esprit perdu du capitalisme (Paris:
Galilée 2006).24. Guy Lérès, « Démensonges », Essaim, 12 (2004): 171.25. Michel Foessel et Olivier Mongin, « Introduction », « Les Impensés de l’économie », Esprit
(2010): 35-44.
38 FALL 2010
L’ESPRIT CRÉATEUR
Mélancolie politique, Haine de la démocratieet la nouvelle pensée de l’émancipation chez
Jacques Rancière
Solange M. Guénoun
L’EMBALLEMENT DU DISCOURS sur « La Crise » de l’automne2008, dont les étals obèses des librairies parisiennes portent encore lepoids, est d’abord ce symptôme d’encre et de papier observable par
tout un chacun, et auquel ce « papier » contribue, de fait et de structure. Maiscette dissémination affolée qui court sous le signifiant « crise » fonctionneaussi comme un remède/poison, un Pharmakon. Censé traiter la chose dite« crise », l’usage inflationniste du terme n’a fait qu’accroître le malaise. Lacrise, quelles crises? titrait l’un de ses innombrables ouvrages, passant enrevue toutes les crises en cherchant à établir leurs interconnexions1. Néanmoins,penser « aujourd’hui » en France passe par ce discours incontournable sur« La Crise », et exige cette traversée du flux intello-médiatique ininterrompuqu’elle a pu susciter. Afin de comprendre, au-delà de cette rhétorique de lacrise, de quoi cet excès est le nom, et de quelle difficulté à dire et à penser, iltémoigne.
Car quelque chose semble être arrivé, comme le changement d’un certain« ton » de l’époque. Le sens d’une rupture, d’une fin de règne, corroboré parnombre de chercheurs, qui travaillent depuis quelques décennies au croise-ment de plusieurs disciplines, et qui voient tout d’un coup leurs travaux con-firmés2. Un échantillon de ces analyses intello-médiatiques figure dansRegards sur la crise: réflexions pour comprendre la crise...et en sortir, com-posés de dix-huit entretiens diffusés sur France Culture avec des intellectuelsde tous bords, invités à réfléchir à la crise de l’automne 20083. Si l’effer-vescence intellectuelle suscitée par le sentiment d’une rupture y est palpable,ce qui domine plutôt, c’est la conscience aiguë et douloureuse, des désastresqui se sont accumulés et conjugués dans tous les domaines. Chez tous cespenseurs on peut lire en effet l’abandon définitif de l’illusion d’un change-ment global et l’incertitude quant à la forme que pourrait prendre ce futur del’émancipation. Sans compter un profond sentiment d’impuissance face à ladispersion et à la désorganisation des forces de résistance. Ailleurs, certainsrestent franchement sceptiques et ne voient dans cette crise, comme dans biend’autres avant elle, qu’une « méthode de gouvernement »4. Concept-écran,perverti par les discours des pouvoirs, « la crise » aura été surtout l’occasion
© L’Esprit Créateur, Vol. 50, No. 3 (2010), pp. 39–52
d’une nouvelle rhétorique du changement, qui aura cyniquement récupéré àson bénéfice toutes les critiques les plus radicales du système capitaliste aux-quelles les medias avaient pourtant largement fait écho. Si bien que l’événe-ment est devenu un « anti-événement », où « ce qui aurait pu avoir lieu n’apas eu lieu »5.
Le malaise, quels malaises ?Ce qui frappe néanmoins avant tout, c’est la médicalisation du langage de
la crise, véhiculée certes par l’étymologie du terme même, mais renforcée parles modes discursifs dominants. Ainsi pour le philosophe Jacques Rancière,
le terme même de ‘crise’ reste dans la métaphore médicale, comme si seule la médecine desexperts avait une chance d’être efficace. Or pour moi les formes industrielle et financière de criseexistent assurément, mais la crise en tant que situation globale et explication politique, non. Lacrise, c’est la vision globale imposée par les gouvernements pour se réserver la mesure du possi-ble. La réalité est celle des rapports de force, des luttes qui déplacent les limites de ce possible6.
En effet, en amont, depuis une décennie, c’était la psychopathologisation desdifficultés contemporaines qui dominait. Une clameur persistante invoquaitdéjà un « malaise »—malaise de la culture, de la civilisation, de la subjectiva-tion, de la démocratie, et de bien d’autres choses encore. On ne cessait d’eninventorier les nouveaux symptômes, et d’avancer la grave hypothèse d’unemutation7. Mutation anthropologique pour Marcel Gauchet, due à une crise del’échange symbolique comme organisateur du social, et qui incriminait entreautres l’individualisme contemporain8. Mutation de la cité, devenue « perverse »pour Dany-Robert Dufour, effet de la « religion libérale » et du triomphe de lamarchandise. Cette religion aurait affecté non seulement l’économie psychique,mais aussi l’organisation de la Cité et le langage, devenu cette novlanguetechnique communicationnelle qui empêche de penser. Mutation de l’économiepsychique pour Charles Melman, due à la « déliquescence » du grand Autre.Pour Melman, on serait sorti d’une économie névrotique du désir, et c’est unprogrès, une libération, mais pour entrer dans une « nouvelle économiepsychique » à l’issue encore plus grave, celle de « l’homme sans gravité »9.On serait passé du premier « malaise » dans la culture décrit par Freud,attribué à l’excès du refoulement, à un deuxième malaise, malaise dans la sub-jectivation, quand aucune « fonction paternelle » ne vient plus à la fois inter-dire et garantir en même temps l’accès au désir. Puisqu’interdire la présencesaturante de l’immédiat, du corps, de la mère (l’inceste) c’est permettre unesubjectivation désirante qui passe par le manque. Melman déplore ainsi lepassage d’une économie psychique « patrocentrée » à une économie appuyée
40 FALL 2010
L’ESPRIT CRÉATEUR
sur la « mère innombrable » où le sujet se retrouve sans centre et sans gravité(La Nouvelle Économie 12). Or pour Melman après Lacan, on n’a que le bâtondu symbolique à coincer dans la gueule du « crocodile-trou-Mère-Réel » pourqu’elle ne vous dévore pas. Par ailleurs, cet affaiblissement du symbolique sesignale par un « désinvestissement général à l’égard des grands textes fonda-teurs de notre culture » qui « nous ont servi pendant des milliers d’années degrand Autre, c’est-à-dire de lieu organisé par le langage » (La NouvelleÉconomie 52), le marxisme étant l’un de ces derniers textes.
Mutations anthropologique et psychique donc sous l’effet d’une « vérité »dont on ne veut toujours rien savoir : « Dieu est mort ». Pour Melman, « avoireffectivement pris la mesure du fait que le ciel est vide, aussi bien de Dieu qued’idéologies de promesses, de références, de prescriptions, et que les individusont à se déterminer eux-mêmes, singulièrement et collectivement » est unprogrès considérable (L’Homme sans gravité 19). Mais c’est une « Vérité »difficile à accepter, comme en témoigne l’exacerbation des fanatismes en toutgenre qui tente de l’étouffer. Une vérité qui est alors actée, agie, dans toutesces haines qui suintent des corps individuels et collectifs. Une vérité que l’onnie, en substituant à la vacuité insupportable des cieux, le « divin marché »,et sa tyrannie. Plutôt laisser les mécanismes pervers des injonctions à jouirs’incruster au plus intime de l’être que d’affronter les affres du vide, du rien.Quant aux sciences et aux technologies elles semblent s’être bien arrangéesavec la disparition du « grand Autre », puisqu’elles en occupent la place, sansen jouer la fonction. Au contraire, certaines flattent la promesse de maîtriseabsolue des corps et des langages, et d’autres servent, souvent contre leur gré,tous les biopouvoirs de politique-police gestionnaire des populations. PourJean-Pierre Lebrun, ce monde que la science promet se fait au détriment denotre condition d’être parlant, c’est-à-dire désirant et manquant, souffrantautant des nouvelles pathologies (toxicomanies, états-limites, somatisationsmultiformes) que des phénomènes de société (exclusion, racisme, sectes, vio-lences dans tous les domaines)10.
Tous ces savoirs et langages s’accordent néanmoins sur un symptômequasi-universel, à double face : d’un côté, désymbolisation, misère du sym-bolique, défaut ou carence du symbolique ; de l’autre, une société affranchiedu religieux, qui « exhibe » la jouissance sexuelle là où auparavant, ce quidominait, c’était la loi du désir, le manque et son sujet divisé, soutenu d’unréférent Autre. Le constat de cette hubris postmoderne, ce « monde sanslimite » que Jean-Pierre Lebrun fut l’un des premiers à analyser, dès 1997, faitl’unanimité. Une analyse qui suppose une homologie de structure entre lamutation de l’économie psychique et celle du lien social, entre le libéralisme
VOL. 50, NO. 3 41
SOLANGE M. GUÉNOUN
des mœurs, qui promeut le style de vie hédoniste, et le libéralismeéconomique, fondé sur la compétition généralisée.
Dans La Société du malaise, livre qui sort au moment de clore notre étude,Alain Erhenberg s’en prend sévèrement à cette description de problèmessocio-économiques et politiques, en termes médicaux, psychanalytiques,psychologiques et psychiatriques. Pour lui ce serait le symptôme même àtraiter, car la « santé mentale constitue un nouveau jeu de langage permettantde parler et d’agir », de traiter les « phénomènes généraux de la vie collective,ceux qui relèvent à la fois de la cohésion sociale et de la signification de cequi arrive, c‘est-à-dire de la cohérence sociale »11. C’est devenu « le langagecontemporain, la forme d’expression obligatoire non seulement du mal-être etdu bien-être, mais aussi de conflits, de tensions ou de dilemmes d’une viesociale organisée en référence à l’autonomie, prescrivant des façons de dire etde faire aux individus » (Erhenberg 17). Ainsi la référence au jeu de langageinauguré par Freud—la référence au malaise—est un jeu nocif qui participede cette construction d’une société du malaise. Puisque la psychanalyse dulien social n’apporte selon lui aucune « information sur l’état du monde »mais contribue à la « diffusion d’un jeu de langage qui fait de la souffrancepsychique non seulement une souffrance d’origine sociale, mais encore un testde la valeur de nos relations sociales » (Erhenberg 238). Erhenberg résumeainsi tout ce discours psychopathologique : « Toute cette rhétorique se ramèneà une proposition : les personnalités sont aujourd’hui plus désorganisées àcause d’une accélération de la dynamique d’individualisation qui n’est plustempérée ni par la coercition sociale qui tenait les individus ni par le conflitqui les structurait » (Erhenberg 235).
Cette analyse serait-elle le dernier épisode d’une passe d’armes entresociologie et psychanalyse, la énième guerre des disciplines, ou bien s’agit-ild’autre chose ? De politique par exemple. Pour Erhenberg, la « thèse de lacrise de l’ordre symbolique et de la désinstitutionnalisation appartient à l’anti-libéralisme français » (Erhenberg 254). C’est cette forme de« déclinologie qui célèbre un passé idéalisé qui n’a jamais existé et un ritueld’exorcisme du présent » (Erhenberg 256). Le travail de Marcel Gauchet nerelèverait ainsi que d’une « philosophie républicaine de l’individualisme »(Erhenberg 239). Et la philosophie politique sous-jacente à la psychanalyse dulien social qui n’y « voit que déliaison sociale », serait également « républi-caine et antilibérale » (Erhenberg 238). Alors que les problèmes bien réelsderrière cette plainte sont le problème politique, de la justice et des inéga-lités », et celui « sociologique » de l’institution de significations sociales »(Erhenberg 246). Pour Erhenberg, s’il y a malaise, il est consubstantiel à la
42 FALL 2010
L’ESPRIT CRÉATEUR
démocratie depuis la Révolution française, avec cette opposition récurrente etindépassable entre société et individu, entre dépendance et autonomie. Quantà la souffrance des individus c’est tout simplement pour lui celle, inévitable,due à la compétition de l’économie libérale.
Rancière s’accorderait dans un premier temps avec Erhenberg et sadénonciation de la doxa psychanalytique qui d’un côté dénonce les effetscatastrophiques sur la subjectivité de l’oubli des lois du langage, et de l’af-faiblissement du symbolique. Et de l’autre, incrimine le libéralismeéconomique dans l’illimitation des jouissances, établissant un parallèle entrel’économie psychique interne et l’économie libérale externe. Car sous saradicalité apparente, en fait, elle rejoindrait toute la doxa « républicaine » quicherche à rétablir l’ « autorité » à l’école et partout ailleurs. Alors que ceuxqui sont accusés de trop jouir et de consommer n’en ont guère les moyensmatériels ! Loin d’une illimitation des appétits de l’homo democraticus (quidésigne en général ceux qui sont au bas de l’échelle économique), ce sontplutôt les limites réelles, les privations, les inégalités d’accès aux biens deconsommations qu’il faut souligner. C’est même l’impossible satisfaction quiest la norme plutôt que l’illimitation des jouissances interdite à la majorité etdont quelques uns seulement profitent.
Mais pour Rancière toutes ces herméneutiques, que ce soit cette volonté depenser les difficultés ou les pathologies du « lien social », ou leur dénonciationsociologique, sont des manières de se substituer à une pensée et à une actionpolitiques. Plus gravement peut-être elles en accomplissent l’éclipse, puisqueles sciences humaines ou les sciences sociales sont nées au XIXe siècle pré-cisément pour contrôler le désordre de la démocratie, de l’individu qui met endanger la cohésion sociale. Dans le meilleur des cas, ces sciences n’offrentqu’une doublure descriptive de la réalité. Car le scandale insupportable de ladémocratie comme processus politique, c’est en effet de révéler la contingenceabsolue de toute domination. La démocratie conçue non comme forme degouvernement, forme de société ou style de vie, mais comme ce qui remet enquestion tout fondement, toute autorité, tout référent, soit une an-archie.
Aucune réconciliation n’est donc possible entre cette conception de l’éga-lité émancipatrice chez Rancière et les effets cliniques de l’égalité psychique, de« l’égalitarisation des jouissances » que Melman constate (L’Homme sansgravité 139). Si l’idéal de l’égalité est louable, il est voué à l’échec car « l’égalitéqui nous paraît un mot d’ordre éminemment humaniste et de progrès, l’égalitéest un vœu de mort ! » Vouloir l’égalité, c’est rêver de « se débarrasser du désiret de réaliser l’entropie de la machine, c’est-à-dire le moment où il n’y a plusaucune différence entre les éléments ». L’asymétrie, l’inégalité est ce qui permet
VOL. 50, NO. 3 43
SOLANGE M. GUÉNOUN
l’organisation du désir puisque « c’est parce que l’autre semble posséderl’objet qui a l’air de le satisfaire que cet objet va devenir celui de mon désir »(La Nouvelle Économie 90-91). Par conséquent sauver la distance, l’écart avecl’objet, c’est sauver le désir et son sujet.
Mais pour Rancière, c’est surtout maintenir le sujet en état de minoritésous l’effet de cet Autre, signifiant inégalitaire par excellence, figure de la dis-symétrie qui fait le jeu de l’ordre, de l’économie psychique ou libérale. C’estl’Autre, cette figure éthique d’un rapport originaire fondateur, qu’il descenden flammes chez Jean-François Lyotard et sa notion du sublime.
La mélancolie postmoderne, quels deuils ? En effet pour Rancière, ce qu’on a appelé « postmodernité » et à laquelle
on associe en général la société du « sans limite », la démocratie comme illim-itation des désirs de l’homo democraticus, n’a été qu’une pensée radicaleétiolée sous l’effet d’un deuil impossible du marxisme. Une mélancolie post-moderne où percolait une « haine de la démocratie » et qui distillait unmalaise chronique qui nous mithridatisait contre toute velléité de changement.Rancière va donc consacrer plus d’une décennie à la critique à la foispolémique et théorique de ces mots-valises que sont « postmodernité »,« modernité », en démontant toutes ces idéologies et scénarios de la moder-nité qu’on pense à partir de la coupure en amont qu’aurait représenté la Révo-lution française ou en aval, celle que représenterait « Auschwitz ». Idéologiesqui se fondent sur une conception téléologique de l’histoire puisque modernitéet postmodernité sont pensées comme des époques historiques et identifiées àl’histoire politique moderne, alors qu’il faudrait séparer l’histoire politiquemoderne de l’histoire de l’art et de la philosophie. Par ailleurs, la crise de la« modernité » comme crise de l’art et de la politique, comme échec de la poli-tique et de l’art d’émancipation, repose en fait sur une conception de la poli-tique comme lutte contre l’État et les institutions. Alors que pour Rancière :« La politique, en effet, ce n’est pas l’exercice du pouvoir et la lutte pour lepouvoir. C’est la configuration d’un espace spécifique, le découpage d’unesphère particulière d’expérience, d’objets posés comme communs et relevantd’une décision commune, de sujets reconnus capables de désigner ces objetset d’argumenter à leur sujet »12. Politique et esthétique fabriquent chacun dansleur sphère et pour des objectifs différents, un « partage du sensible », desdonnées sensibles évidentes, des formes a priori de l’expérience sensible dumonde, de leur distribution et configuration. Par conséquent, s’en prendre à lamélancolie postmoderne comme deuil du marxisme, c’est dénoncer toutes lespensées pathétiques de l’impensable, de l’irreprésentable, toutes les drama-
44 FALL 2010
L’ESPRIT CRÉATEUR
turgies de la « fin »—de l’art, de la politique, de l’histoire. C’est récuser toutesles coupures radicales, tout événement fondateur qui couperait le temps entreun avant et un après et où la politique serait pensée à partir d’un modèlesacrificiel (du corps du roi par exemple). C’est enfin dénoncer toute pensée dela dette obscure à un premier Autre, tous ces sacrifices immémoriaux auxfigures du grand Autre qui répugnent au philosophe.
Car il n’est point besoin de chercher la radicalité moderne comme Lyotardle fait dans « l’expérience sublime de la grandeur, de la puissance ou de lapeur » (Malaise dans l’esthétique 130). L’avant-garde ne devrait pas avoirpour tâche celle que lui assigne Lyotard, de témoigner indéfiniment d’un« désastre originel », de la misère originaire de l’esprit, de la détresse del’infans, de sa dépendance à l’égard de la Chose (freudo-lacanienne), de l’in-conscient, de la loi de l’Autre. Rancière critique férocement cette conceptionde l’art qui transforme la politique en deuil interminable, à partir d’unecontre-lecture délibérée du sublime chez Kant. Il lui oppose la conception del’esthétique comme nouvelle configuration d’un monde sensible commun,d’une communauté esthétique libre, sensible, égalitaire qu’il extrait de sa lec-ture de Kant et de « l’état esthétique » de Schiller et de son « libre jeu »(Malaise dans l’esthétique 25). L’état esthétique ouvre en effet selon lui un« sensorium paradoxal qui éloigne à la fois des formes sensibles de l’expé-rience ordinaire et du sensorium de la domination : il s’agit d’une suspension,d’une dissociation radicale autant de la faculté cognitive de l’entendement, dela raison, que de la faculté réceptrice, passive, de la sensibilité qui impose sesobjets de désir » (Malaise dans l’esthétique 48). Ce jeu esthétique pose doncla liberté et l’égalité du sentir. Existence sensible libre et égale qui ne renvoiedonc pas aux formes politiques de l’Etat, mais qui est porteuse du « germed’une nouvelle humanité, d’une nouvelle forme individuelle et collective devie » (Malaise dans l’esthétique 48). Si l’on veut saisir cette conception d’une« nouvelle humanité », encore faut-il comprendre ce que Rancière entend par« égalité » et par « démocratie ».
La démocratie, quelles démocraties ? En effet ces termes, au sens apparemment évident, ne sont que des
« homonymes » chez Rancière. Ils acquièrent chez lui un contenu radicale-ment autre et entrent, de fait, en violente opposition avec tous les autres dis-cours sur la démocratie. Comme il l’énonce lui-même clairement : « tous lesauteurs, vivants ou morts qui font aujourd’hui l’actualité de la pensée dudissensus » (c’est-à-dire Arendt, Lyotard, Badiou, Agamben ou Milner) « onten commun une certaine idée du consensus comme démocratie, c’est-à-dire
VOL. 50, NO. 3 45
SOLANGE M. GUÉNOUN
comme l’égalité arithmétique de Platon, le régime du mélange indistinct ouindifférent »13. Alors que lui, Rancière, a décidé, contrairement à tous, de con-cevoir la « démocratie comme l’opposé du consensus » soit le dissensus. Pourentendre ce parti pris singulier, unique, il est préférable de laisser Rancièredéfinir, en ses termes, ce qu’il entend par « démocratie » et par « politique »afin de réduire les malentendus dus à la difficulté de ces concepts nouveaux.Ainsi pour Rancière, « la démocratie n’est ni une forme de gouvernement niun style de vie sociale, elle est le mode de subjectivation par lequel existentdes sujets politiques »14 (La Mésentente 139). C’est
l’ordre des corps qui définit les partages entre les modes du faire, les modes d’être et les modesdu dire, qui fait que les corps sont assignés par leur nom à telle place, à telle tâche; c’est un ordredu visible et du dicible qui fait que telle activité est visible et que telle autre ne l’est pas, que telleparole est entendue comme du discours et telle autre comme du bruit. (La Mésentente 52)
Tel est l’étrange langage de Rancière, qui nous rend les mots de « démocratie »et de « politique » totalement méconnaissables. Dès lors, pour le philosophe,le diagnostic du « malaise » est le suivant : la démocratie est un pharmakon,« le nom commun d’un mal et du bien qui la guérit »15. A la fois remède—ilfaut plus de « démocratie », c’est-à-dire plus de politique dissensuelle—etpoison, désordre consubstantiel à la démocratie, mais qui est perçu commemaladie de la démocratie et dénoncé comme le sans-limite, de l’individualismehédoniste débridé. Par conséquent, toutes ces symptomatologies de « l’excèsde vitalité démocratique » sont en fait anti-démocratiques puisque la « bonnedémocratie » est cette « forme de gouvernement et de vie sociale apte àmaîtriser le double excès d’activité collective ou de retrait individuel inhérentà la vie démocratique » (La Haine de la démocratie 14).
La haine de la démocratie, quelles haines ?Au diagnostic des experts pour lesquels la démocratie « comme forme de
vie politique et sociale, est le règne de l’excès », Rancière oppose son para-doxe, son « scandale de la démocratie ». Ce pavé qu’il lance à la tête de tousles intellectuels (ex-révolutionnaires ou militants de gauche) qui ont défiguré,reconfiguré, le mot de démocratie pour lui faire dire le contraire. De FrançoisFuret à Jean-Claude Milner, la démocratie n’est plus en effet ce qu’onopposait au totalitarisme, mais la forme d’un terrorisme inhérent à la « révo-lution démocratique » (La Haine de la démocratie 20). La défense du« libéralisme », de la bonne démocratie des droits de l’homme et des libertésindividuelles passe donc par la dénonciation de la « mauvaise démocratieégalitaire et collectiviste » (La Haine de la démocratie 23). La dénonciation
46 FALL 2010
L’ESPRIT CRÉATEUR
de la démocratie européenne et de ses penchants criminels passe par le retourdu « nom juif » pour Jean-Claude Milner comme le nom de ce qui résiste àl’illimitation de la démocratie européenne « criminelle », fondée surAuschwitz, c’est-à-dire sur l’extermination du seul peuple porteur du principede la filiation et de la transmission.
De 1978 à 2003, en passant par l’affaire Heidegger des années 1980 etl’intrusion des signifiants « juifs » et « Shoah » dans la philosophie (avecnotamment le Heidegger et les « juifs » de Lyotard), Rancière vise sansrelâche l’antidémocratisme de l’intelligentsia française ex-révolutionnaire, ex-militante. Que l’antidémocratisme soit l’effet d’une conversion au libéralismefrançais (Furet), au « nom juif » (Milner) ou aux « droits de l’inhumain », del’Autre (Lyotard), le résultat est le même : une même haine de la démocratieconçue comme nouveau totalitarisme, comme contre-révolution intellectuelle,dont « l’instrument principal » a été l’exercice du pouvoir par FrançoisMitterrand et la conversion des élites socialistes au libéralisme (Momentspolitiques 212).
L’égalité, quelles égalités?Empruntant lui-même, avec ironie, le paradigme psychopathologique du
« malaise », Rancière en inverse les termes : ce sont les médecins-experts quisont malades et non leurs patients. Le seul malaise à diagnostiquer est cettedéfense maladive « des démocraties » contre « la démocratie » dissensuelle.Les experts rivalisant de complexité analytique pour offrir un « traitementmédical de l’opinion ». Mais ironise Rancière, « dans une thérapie il n’y a pasde démocratie : c’est le médecin qui sait ce qui est bon pour le malade »(Moments politiques 213). Le problème pour les experts en malaise, c’est queles citoyens qui exercent leur jugement et leurs droits ne se considèrent pascomme malades. En revanche, ils se demandent peut-être, après Rancière, quidonc soignera les médecins de leur maladie démocratique imaginaire ? Lemalaise est réel et consubstantiel à la démocratie, à son scandale, puisqu’ellemet en évidence la contingence absolue de toute domination, de tout pouvoir,l’anarchie de toute « politique ». Et qu’elle met en avant le pouvoir égal dessans-parts, des sans-titres, des sans-privilèges qui veulent participer auprocessus politique et décider des objets communs dont il faut débattre.
Ainsi le malaise identifié par Rancière, s’il s’inscrit dans le jeu de langage,dans la matrice inaugurée par Freud, en subvertit le contenu. Le sujet de la sub-jectivation politique, de l’interlocution égalitaire, est celui d’une « désincor-poration littéraire », d’un « animal littéraire » dont le corps est en relation« sensible » aux signifiants extérieurs, coupé de l’objet de connaissance comme
VOL. 50, NO. 3 47
SOLANGE M. GUÉNOUN
de l’objet de désir, sujet non désirant, non soumis aux lois de l’inconscient, nonsexué, coupable d’aucun crime (symbolique ou non) et redevable d’aucunedette. Ni psychanalyse, ni sociologie, ni anthropologie, ni ontologie n’y donnentaccès puisqu’il est une fiction, une construction poético-pragmatique, fondéesur le paradigme « sensible » de l’Incarnation et de sa suspension.
Car la démocratie est cet acte, ce processus où le présupposé de l’égalitéest « vérifié » dans une « incarnation » mise en scène, « actée », qui manifestecette sortie du corps vécu, concret, et l’assomption d’un « corps qui objecte »dans une parole, dans une interlocution politique. Cette égalité présupposéeentre les sujets parlants est précisément ce qui est nié par le partage inégalentre ceux qui parlent et possèdent le logos et ceux qui parlent mais qu’onn’entend guère sinon comme pathos qui les renvoie à leur « nature », à leurcorps d’esclave, peuple, femme ou étranger, à leurs cris et plaintes. Pourpenser le partage inégal qui préexiste à la prise de parole même, Rancière metainsi à contribution autant Aristote, avec sa distinction entre logos (la raison)et phonè (la voix) (Politiques, I, 1253 a 9-18), que Platon et sa révulsiondevant le « gros animal populaire » (République Livre VI).
Les « animaux littéraires » sont égaux si on entend la « littérarité » commecette condition de l’animal littéraire qui est saisi par des mots, des idées, qui ledétournent de son destin « naturel », celui prescrit par sa naissance, son pays,sa profession, sa classe, son sexe etc. Animal littéraire qui va se mettre à croireà des mots comme « liberté » ou « égalité », et vouloir les vérifier, c’est-à-direles « incarner » dans un corps qui entre en relation « imaginaire » avec ses mots,qui est cette relation à leur réalité matérielle, « sensible » (sens et signification).Ces mots introduisent un écart entre son corps et sa pensée, entre ce que cecorps était supposé faire et ce qu’il peut en faire, ouvrant la possibilité d’unchangement de son monde perceptible, qui le libère et en fait égal à tout autre,sujet « sensible », sujet parlant et pensant. C’est cette capacité pour quiconque,pour l’ouvrier par exemple, même ignorant l’art et ses théories, de « laisser sonregard et son esprit s’évader du travail de ses mains » (Moments politiques219) : dissociation entre main et regard qui en fait un « esthète » capabled’apprécier la beauté d’un paysage, ou encore qui lui permettra d’interromprele partage du temps (entre nuit-repos et jour-travail) pour s’adonner à ce qu’iln’était pas censé faire : à la poésie, à la philosophie, aux discussions avecd’autres (c’est là la thèse même de son ouvrage sur La Nuit des prolétaires).
Quels pharmaka ? démocratie ? communisme ?Imaginer la fiction d’une « communauté esthétique libre », d’un universel
sensible, égalitaire, n’empêche pas d’en reconnaître les prodromes dans la
48 FALL 2010
L’ESPRIT CRÉATEUR
réalité. Comme, par exemple, dans « La Crise ». Car l’un des effets les plusinattendus de « la crise » fut sans doute sa construction « philosophique »forte comme moment de rupture par les penseurs de la radicalité politique.Pour Alain Badiou en effet, c’est une « crise historique » qui, depuis vingt ans,marque la fin d’un règne hégémonique du capitalisme des suites de l’effon-drement du bloc soviétique16. De même pour Jacques Rancière, l’aspect« inédit » de la crise actuelle est dans ce « coup d’arrêt de l’utopie capitalistequi a régné sans partage pendant les vingt années qui ont suivi la chute del’empire soviétique : l’utopie de l’autorégulation du marché et de la possibi-lité de réorganiser l’ensemble des institutions et des relations sociales, deréorganiser toutes les formes de vie humaine selon la logique du libremarché »17. Mais il reste encore beaucoup à faire pour transformer la crise en« événement » au sens philosophique où l’entend Alain Badiou, c’est-à-direcomme « quelque chose qui fait apparaître une possibilité qui était invisibleou même impensable. L’événement n’est pas par lui-même la création d’uneréalité : il est la création d’une possibilité, il ouvre une possibilité »18.L’événement est quelque chose qui aide la pensée et l’action, qui exige deuxchoses : d’un côté, « un grand effort idéologique, théorique, philosophique,dans tous les secteurs ». Et de l’autre, « des expérimentations politiques diver-sifiées, ramifiées par le biais d’associations, de tentatives politiques nou-velles, d’expérimentations locales » (Badiou, « L’Événement ‘crise’ » 21). Ilfaut donc chercher, penser, expérimenter, si l’on veut que la crise devienneselon Rancière, ce momentum, ce « déplacement des équilibres et l’instaura-tion d’un autre cours du temps » (Moments politiques 226). Travailler pour le« futur de l’émancipation », voulant dire pour lui, très précisément, travaillerpour « le développement autonome de la sphère du commun créée par la libreassociation des hommes et des femmes qui mettent en œuvre le principeégalitaire » (Moments politiques 231-32).
Les « possibles » ouverts par cette « crise historique » sont notammentlisibles dans l’intense activité éditoriale autour de Marx et du marxisme19. Sil’activité exégétique et les études universitaires se poursuivent comme d’habi-tude avec certes un peu plus d’ardeur, quelque chose de nouveau est apparu :la relance de l’ « Idée du communisme » par Alain Badiou et Slavoj Zizek, afinde penser les conditions d’une « alternative globale à la domination du capitalo-parlementarisme » (Badiou) et d’une « réforme radicale de la structure mêmede la démocratie représentative »20 (Zizek). Une « hypothèse » de travail autourde laquelle s’affairent quelques « grands noms » de la radicalité philosophiqueà dominante française, anglo-américaine et européenne. Tous convaincus quele mot « communisme » conserve encore « une valeur affirmative et positive »,
VOL. 50, NO. 3 49
SOLANGE M. GUÉNOUN
en dépit de son usage politique et historique au XXe siècle et de son associa-tion à « diverses formes de terreur » (L’Idée communiste 10) ; pouvoir penserpar exemple un « commun » sans le –isme (Jean-Luc Nancy), et sans « com-munistes » (Rancière). Si bien que cette « Idée » du communisme a plutôt faitl’effet d’un « spectre » philosophique, théorique21.
Pour l’instant, l’ « hypothèse de confiance » est de mise. Rancière pense eneffet qu’on commence à sortir de la doxa contre-révolutionnaire des années1980 et 1990 et que « les générations nouvelles se sentent à nouveau prochesde ce qui s’est passé dans [sa] génération [des années 1960-1970], aussi bienau plan philosophique que politique » (Moments politiques 211). Et pourpartager ce moment d’optimisme, on pourrait même penser que Rancière a étépartie prenante de ce changement d’atmosphère. Même si, comme il le dit lui-même, quelques « traders » ont fait en quelques mois ce que des décennies dethéorie et de militantisme n’ont guère réussi à faire, à savoir donner un coupd’arrêt à l’utopie capitaliste. Mais cette perception du changement de « ton fon-damental », d’un nouvel « air » utopique-révolutionnaire que certains humentavec avidité, est-elle l’effet éphémère d’un emballement conceptuel, d’un vœupieux, ou l’amorce d’une réelle désintoxication d’une atmosphère plombée oùtout espoir de changement s’était étiolé ? Notons néanmoins, en passant, quedans le nouveau vacarme autour de « l’Idée communiste », Rancière sembleavoir cédé sur son désir et renoncé à son maître-mot « démocratie », sous cer-taines conditions bien entendu, pour enfourcher l’hypothèse de Badiou.
Serait-on alors enfin sorti du « courant éthique » que Rancière avait décriten 2004, où esthétique et politique s’étaient dissous22 ? Ce serait uneexcellente nouvelle pour tous ceux qui aimeraient qu’on mette un peu de côtéle discours hyperbolique sur la Shoah, et le paradigme victimaire des années1990 (devenu depuis les années 1990 le « paradigme victimo-mémoriel »), àla source d’effets pervers désastreux. Et tous ceux qui souhaitent égalementqu’on déleste un peu l’atmosphère des querelles franco-françaises autour del’universel, querelles abstraites et calamiteuses, agrégées autour du « nomjuif », ou querelles sur l’irreprésentable, sur la loi de Moïse et de l’interdit dela représentation. Mais faut-il rêver et demander l’impossible ?
Car penser le présent de la pensée radicale en France, ici et maintenant,c’est d’abord s’étonner devant cette scène franco-française, parisienne, quin’a aucun équivalent dans le monde, où s’affrontent des intellectuels qui sedisent tous athées et matérialistes et qui, cependant, renouvellent, de part etd’autre, des paradigmes d’origine religieuse—« incorporation » pour Badiou,« incarnation » pour Rancière, « juif d’étude » pour Milner—, et réactivent,qu’ils le veuillent ou non, l’antique partage entre Moïse et Saint-Paul23. Duel
50 FALL 2010
L’ESPRIT CRÉATEUR
à mort entre ceux que Jean Birnbaum a appelé récemment les « Maoccidents »et ceux qu’on pourrait appeler les « MaoPauliniens ». Notamment Badiou etsa réactualisation désastreuse de la « fable » paulinienne, non soumise aux« procédures de vérité » rigoureuses de son système philosophique24. Or laviolence historique de cette fable, et de sa réactivation présente sont un faitacquis, que la prose truculente du philosophe Slavoj Zizek brandit sous nosyeux. Pour Zizek en effet, quand Paul affirme,
« Il n’y a ni Grecs, ni Juifs, ni hommes ni femmes... », cela ne signifie pas que nous composonstous une seule et heureuse famille humaine, non, cela veut plutôt dire qu’il existe un grand clivageentre toutes ces identités particulières, rendant finalement celles-ci nulles et non avenues : « il n’ya ni Grecs, ni Juifs, ni hommes ni femmes...il y a seulement les chrétiens et les ennemis du chris-tianisme ! » Ou, comme nous aurions à le dire aujourd’hui : il y a seulement ceux qui combattentpour l’émancipation et leurs adversaires réactionnaires—le peuple et les ennemis du peuple25.
La conclusion, quelles conclusions ?Tel est donc pour nous ici le partage intellectuel fondamental, irréductible,
d’un certain « présent » de la pensée en France. Quand on tente de prendre encompte les maîtres-mots consensuels de « crise » et de « malaise », associésà la critique du « libéralisme » et de la « démocratie » afin d’en faire despoints d’interrogations. Mais dans le cercle de ces signifiants (crise—malaise—mélancolie—haine—démocratie—égalité), ce qui se cherchaitpeut-être à se dire, n’était-ce pas plutôt la question de la violence ? Penserl’ « aujourd’hui », en France ou ailleurs, n’est-ce pas d’abord faire l’effortpour ne pas se laisser saisir par « l’effroi du présent », de ses violences sansfin, qui continuent à nous terroriser et à nous fasciner, souvent à notre corpsdéfendant26 ? N’est-ce pas également vouloir prendre ses distances avec toutesces violences polémiques qui, loin de clarifier les enjeux politiques, con-tribuent au contraire à tisser la toile intello-médiatique de la domination ?
Haine de la psychanalyse chez certains, haine de la démocratie chezd’autres, haine et ressentiment partout, chez tous, c’est cela qui fait symptômepour nous dans tous ces discours sur le malaise et sur la crise. Pour Rancière,c’est une « violence symbolique » qui se fonde sur une éthique. Le dissensusest en effet pour lui ce qui permet de traiter symboliquement la violence,d’« institutionnaliser un tort et une altérité qui peuvent être discutés » afind’éviter la « vraie » guerre27. Mais dans cette pensée du présent en France,c’est l’excès verbal qui l’emporte et l’objet de la haine qui demeure fonda-mentalement « obscur ».
Université du Connecticut
VOL. 50, NO. 3 51
SOLANGE M. GUÉNOUN
Notes
1. Eric Toussaint, Damien Millet, La Crise, quelles crises (Bruxelles: Éditions Aden, 2010).2. Voir par exemple les travaux de Dany-Robert Dufour, notamment Le Divin marché (Paris:
Éditions Denoël, 2007) et La Cité perverse : libéralisme et pornographie (Paris: Denoël,2009).
3. Regards sur la crise (Paris: Hermann Editeurs, 2009).4. « La Crise comme méthode de gouvernement », Lignes, 30 (2009).5. Véronique Bergen, « À la lisière de ce qui n’a pas eu lieu et de l’événement », Lignes, 30
(2009): 47.6. Moments politiques (Paris: La Fabrique, 2009), 214.7. Symptômes que Rancière décrypte à partir d’une tout autre grille interprétative dans
Chroniques des temps consensuels (Paris: Seuil, 2005).8. Voir Marcel Gauchet, La Démocratie contre elle-même (Paris: Gallimard, 2002) et La Reli-
gion dans la démocratie : parcours de la laïcité (Paris: Gallimard, 1998). Dufour, La Citéperverse.
9. Charles Melman, L’Homme sans gravité (2002) (Paris: Folio, 2005).10. Jean-Pierre Lebrun, Un monde sans limite : essai pour une clinique psychanalytique du
social (Ramonville Saint-Agne: Éditions Erès, 1997) et La Perversion ordinaire (Paris: Édi-tions Denoël, 2007).
11. La Société du malaise (Paris: Odile Jacob, 2010), 18.12. La Mésentente : politique et philosophie (Paris: Galilée, 1995), 37.13. « L’Usage des distinctions », Failles, 2 (2006): 13-14.14. Aux bords du politique (Paris: La Fabrique, 1998), 12.15. La Haine de la démocratie (Paris: La Fabrique, 2005), 15.16. « L’Événement ‘crise’ », entretien du 19 juin 2009 dans Regards sur la crise : une enquête
d’Antoine Mercier (Paris: Hermann, 2009), 9.17. « Communistes sans communisme ? », Moments politiques (Paris: La Fabrique, 2009), 228.18. Dans La Philosophie et l’événement : Alain Badiou avec Fabien Tarby (Paris: Éditions
Germina 2010), 19.19. Voir le dossier dans Le Monde des livres, 5 février 2010.20. Alain Badiou, L’Idée du communisme (Paris: Éditions Lignes, 2009), 6.21. Voir Jean Birnbaum « Communisme, un spectre philosophique », Le Monde des livres, 5
février 2010.22. « Le Tournant éthique de l’esthétique et de la politique », Malaise dans l’esthétique (Paris:
Galilée, 2004), 145-73.23. Voir Jean-Michel Salanskis, La Gauche et l’égalité (Paris: PUF, 2009), 15-19.24. Voir Yvan Segré, « Controverse sur la question de l’universel. Alain Badiou et Benny
Lévy », Lignes, 30 (2009), 169-206.25. Slavoj Zizek, Après la tragédie, la farce : ou comment l’histoire se répète (Paris: Flam-
marion, 2010), 73. Voir Yan Assman dans Violence et monothéisme (Paris: Bayard, 2010),« la violence inscrite dans la tradition monothéiste s’est réellement transposée dans l’his-toire avec le christianisme et l’islam, qui ne considèrent pas leur Dieu comme un Dieuparmi ou au delà des autres dieux, mais comme l’absolument Unique », et cherchent àsoumettre ou à convertir (158). Alors que Yahvé, « vrai parmi tous les dieux », s’il interditde sculpter des images d’autres dieux, c’est qu’il n’exclut pas leur existence en tant que« faux » dieux, lui étant le « vrai » dieu, l’interdit de représentation séparant ainsi son peupledes autres (158). Un peuple qui vit parmi les autres nations, sans chercher à les soumettreou à les convertir.
26. Voir Dominique Baqué, L’Effroi du présent : figurer la violence (Paris: Flammarion, 2009).27. « Democracy Means Equality », Radical Philosophy, 82 (1997): 36.
52 FALL 2010
L’ESPRIT CRÉATEUR
The Singular Banlieue
Anna-Louise Milne
THREE PRESS CUTTINGS, AND A QUESTION:
When interviewed about Nicholas Sarkozy’s new “grand Paris” initiative that seeks to define theshape of Paris in the twenty-first century, the British architect Richard Rodgers declared that heknows of no other “big city where the heart is so detached from its arms and its legs” by the “stag-gering psychological barrier” between the banlieue and the city.1
In a provocative plea published in the new-look glossy supplement that Le Monde recentlylaunched, Antoine Compagnon, professor at the Collège de France and Columbia University,called for a less defensive attitude to the prospects for the French novel. He invoked translationas the international court of approval that best indicates significant new directions, just as the artmarket discerned the importance of Impressionism and Surrealism, claiming that “sans labanlieue et la francophonie qui le revivifient, le roman français traverserait un passage à vide.”Faïza Guène and Azouz Begag are interesting to readers, he suggested, because they tell of “laréalité française du XXIe siècle,” and that reality is “l’immigration, les ratés de l’assimilation etde l’intégration, l’embrasement des cités, les échecs de l’école.”2
In the context of the political and media furore provoked by the twenty-three-year-old son of thePresident, Jean Sarkozy, when he stood for election as the President of the board responsible forthe management and development of the Défense business district, on the western edge of Paris,attention turned momentarily to Sarkozy’s other son, Pierre, a producer of rap and rap-relatedmusic. Operating under the pseudonym Mosey, he does his business as anonymously as possible,knowing that in la banlieue his real name meets with rage.3
What is going on behind the singular designation of “la banlieue”?Sociologists and historians would probably reply quite rightly that this
question should be passed over, rejected for the lack of engagement itexpresses with the vast disparity in social and economic situations hidden bythe catch-all media figure of la banlieue. But if we are going to ask how weare to think “today” in France, then media figures are what we are about.“Aujourd’hui en France” is a product of the mass media; in fact—althoughthis may be an inadvertent allusion for this collective issue of L’Esprit Créa-teur—Aujourd’hui en France is the title of a daily newspaper, the regional re-branding of Le Parisien, the daily paper that has played such a significant rolein constituting “Paris” and “la banlieue” as figures in the popular imagination.Admittedly, I am presuming that to “think” today we need first to “figure”today, which means to say that our “object” has no self-evidence and mustrather be approached as our construction. In other words, somewhere in the
© L’Esprit Créateur, Vol. 50, No. 3 (2010), pp. 53–69
background of the question of how to think “today” in France is the fore-ground of this collective endeavour, hereby instantiated, of “thinking” inFrance, and “à partir de la France,” today. We cannot avoid the question ofwhat sort of processes our thinking draws on today, and relatedly what sort ofdisciplinary and institutional consequences they have. In short, when we tryto think about la banlieue today, we have also to think about who we do thatthinking with and via what sort of interdisciplinary and social associations andnetworks. But before scare quotes proliferate scarily, let us return to thefigures of “today” and “la banlieue” and consider their rhetoricity, which isalso their density.
The notion of la banlieue really started to figure as a topos in Frenchjournalism from the 1920s on, when the postwar housing shortage promptedthe wildfire development of unregulated property deals in the still largelyrural areas around the city, generating the social and economic conditionsthat would lead to the durable installation of a red belt of Communist polit-ical representation around Paris. From the off, the term was associated withproblems of security, skirmishes between the sparse police forces and theuncountable, shifty local elements, always more numerous and less discern-able in their shady similarity than expected. Reports from la banlieue havelong turned around faits divers: sensationalist stories of children left to burnin wooden shacks in the interwar years, or more recently of rodeos and ter-rified residents. This local “colour” jostles for attention alongside moremurky investigation into semi-clandestine organisations operating underforeign command, first Soviet-backed and now linked with internationalterrorism. Like its sister-term of la ceinture rouge or red belt, which waslaunched by the Communist Paul Vaillant-Couturier, but then popularisedprimarily by the mainstream, right-leaning press, la banlieue was bran-dished at regular intervals in dailies such as the Le Temps and Le PetitParisien all through the 1920s and into the 1930s, although it was almostnever used before the early 1930s by the Communist paper L’Humanité,which was, at least initially, rigidly indifferent to territorial factors thatcrossed the dynamics of class conflict.
La banlieue was, therefore, at that time very much a construction of con-servative Republicanism, anxious in the face of urbanisation and industriali-sation, and all too ready to condense into one figure the dangers preying onthe Republic. So we find the following type of reports in a piece entitled “Ilfaut assurer la sécurité de la banlieue,” dating from 1927, which begins byregretting the numbers of police deployed in the Paris region and then takesthe reader into the spaces of “non-droit”:
54 FALL 2010
L’ESPRIT CRÉATEUR
Nous gravissons l’une des ruelles-égout. De droite et de gauche s’érigent des cubes de plâtre, debois, de torchis, de carton ou de tôle affaissés les un sur les autres comme des arbres couchés parl’ouragan. [… ] Tout près, une femme fait cuire des poivrons sur un feu de bois. Des enfants laregardent et se grattent la tête, sérieux, comme le sont les enfants de l’autre côté de l’Europe. Ettout ce clan parle une langue sonore qui évoque les rues infectes et gracieuses d’un port duLevant. […] Toute cette matière humaine s’est écoulée, en un clin d’œil. […] Et, tandis que nousquittons ce septième cercle de l’enfer, autour d’une des villes du monde les plus civilisées, noussongeons, malgré nous, à ces villes d’Orient remplies de palaces dernier cri. Vous en franchissezles portes fleuries et aussitôt c’est le vide absolu. Pas une maison, pas un arbre: le désert. Et gareà celui qui traverse sans escorte ces solitudes infestées de brigands.4
The language is less exalted today, but the same structures prevail. In advanceof the regional elections in 2010, Sarkozy has recently been “de retour en ban-lieue,” as phrased by Le Parisien in an expression that indicates the very spe-cific nature of this journey, framed by the headline “Sécurité,” while a pieceon the facing page of the same newspaper about transport provision in thevery same area of Seine-Saint-Denis prefers the notion of “le Grand Paris,”introduced under the heading “Projet de loi.”5 There is little change in therhetorical work accomplished by Le Parisien, then. But the tendencies aremuch more widespread, even if they often appear to owe their articulation toa more careless formulation or an ironic spin. Thus in the satirical newspaperLe Canard enchaîné, Jean-François Jullien reviewing three books on “la ban-lieue” published in the wake of the deaths of two teenagers by electrocutionunder police pursuit, which sparked the devastating riots of November 2005,gives as a runner for his article: “Philosophes et sociologues se castagnentautour des feux mal éteints de la banlieue: ravages de l’inculture et du lan-gage, ou excès de chômage et crise sur le ghetto?”6 We’re juggling with thesame tropological configurations: the ill winds of economic decline beatdown on the ghetto like the storm that flattens the rabbit warren of provisionalinhabitations; the effects of linguistic atrophy ravage the population like thefleas on the heads of the “serious”—read “mute”—children of the zone. Butmore significantly, Jullien ends his piece by defining “deux Francesétrangères” and reiterating the question of one local man: “Pourquoi,demande un philosophe, président d’association, ne nous sommes-nous pascomportés avec Bouna et Zyed (tués dans un transformateur de Clichy)comme avec ‘nos’ enfants ?” Julliard replies: “Peut-être parce que ‘nos’enfants (ceux des quartiers ordinaires) ne fuient pas la police quand ils n’ontrien à se reprocher.” The scare quotes are firmly in place around “nosenfants,” but what about “quartiers ordinaires”? There the assumption of anorm that is transgressed is left to achieve its work of implication; Bouna and
VOL. 50, NO. 3 55
ANNA-LOUISE MILNE
Zyed are named, picked out against the formless background of “unordinarydistricts,” like the woman cooking her peppers in the unspeakable slums, butthey are equally drowned in the “beyond” of la banlieue, or more exactly inthe indistinction that overwhelms the beyondness of “beyond.” My question,then, is the following: what sort of alterity is imagined between the terminal“beyondness” of unnamed “unordinariness,” which seeps through like“matière humaine” between all structuring oppositions, and the presumptionof familiarity and individuality indicated by “Bouna” and “Zyed,” pinned-upon the front pages of the newspapers in the same way that writer Jean Rolindescribes a murdered Bulgarian prostitute Ginka Trifonova as the object of“un des ces élans de compassion sans lendemain (et sans obligation de la partde l’acheteur) dont l’‘opinion publique’, en France, est coutumière, et qui setraduit notamment, dans les medias, par l’usage exclusive du prénom de lavictime”?7 And how does that difficult operation of holding in one frame theclose-up on two grinning young faces and the panoramic shot of the “lesquartiers” compare with the sure unified focus of “our” children: “our” chil-dren recognisably safe in “our” neighbourhoods.
Recognition is precisely what is at stake here, both in the sense of “recog-nising” a child by counting him or her within one’s “état civil,” thereby actingwithin the province of the law and ensuring the ordered reproduction of thecommunity, but also in the more transformative sense where the process ofrecognition can impinge on the subject, prompting him or her to know again,differently. The comments made by Nicolas Sarkozy, then Minister of theInterior, to Le Parisien around the same time as Jullien’s article, reveal some-thing of the interference between these two rival modes of recognition: “J’aitoujours dit qu’il y avait les casseurs d’un côté, les étudiants et lycéens del’autre. Je ne fais pas d’amalgame […]. On me dit : Faites la différence entrecasseurs et lycéens. Mais elle est impossible à faire. Ils ont le même âge etsont habillés de la même façon.” Here the lip service paid to difference in labanlieue is so casual that it is perhaps the unfamiliar face of the contemporary“lycéen” lurking in the undifferentiated mass of “les jeunes” that is “recog-nised” in its uncomfortable capacity to provoke, as if the problem lay not somuch with the marginal category “casseur” as with the new faces of all theothers.8 Of course, the comments are patently contradictory: Sarkozy’s wordsare getting ahead of him, as happens in Jean Pagès’s text slightly differentlyin 1929 with its desert of solitude that is also infested, the roads that are“infectes” yet also gracious. The point is that the topos holds together thenotion of multiplicity and of the uncountable, or of difference and the indis-cernible: the multiple is always too multiple; the Other doesn’t stay within its
56 FALL 2010
L’ESPRIT CRÉATEUR
parameters, and the alarming challenge of proliferation is thus better absorbedin the homogenising category of “human matter” or “les jeunes à capuchon.”
Jacques Rancière has explored a similar rhetorical structure via MichelRocard’s infamous declaration “La France ne peut pas accueillir toute lamisère du monde,” a declaration that resurfaced recently, provoking contro-versy once more, which in itself reveals how much remains at stake in demar-cating the “good” from the “bad” where immigration—and immigrationpolicy—is concerned.9 Rancière homes in on precisely this distinction, iden-tifying the implicit demarcation of “le propre” and “l’impropre” within thefigure of “la misère,” but insisting on the absence of any properties to under-pin this distinction separating what France can and can’t accommodate.Rather than a positive category to substantiate what is inadmissible, Rocard’sdeclaration announces an “improper” category: an Other that is not merelydifferent, but also indiscernible or invisible, because it is composed of a mul-tiplicity of properties that do not hold together, that do not share any “laws.”In other words this Other owes its identity, not to the fact of being foreign toFrance, but instead because it cannot even be brought into a relation of dif-ference to the law. The part of the “misery of the world” that cannot be accom-modated is a heterogeneous combination of economic migrants, politicalrefugees, people who have lived and worked for years in France, their chil-dren currently registered in French schools... All these forms of alterity aregrouped into one, “les clandestins,” which comes to stand as an objective cat-egory but which owes its unity to a media construction of fear. Thus Rancière:
la loi objective ce qui était jusqu’ici le contenu d’un sentiment, connu sous le nom de sentimentd’insécurité. Ce sentiment avait déjà la propriété de convertir en un seul et même objet de peurune multitude de groupes et de cas qui causent à divers lieux à diverses parties de la population :lycéens à problèmes, petits délinquants, trafiquants de drogue, travailleurs en surnombre, fonda-mentalistes religieux, etc. Or ce que fait la loi, c’est de transformer cet Un du sentiment en Un duconcept. Et c’est sans doute cela qui est le principe de ce que l’on nomme consensus : cette con-vertibilité entre l’objet du sentiment et l’objet de la loi.10
The production of consensus functions, therefore, both by giving a blanketname to a heterogeneous ensemble, and by not naming the community thatfeels secure in the properties it holds in common, that is, in the contractual andconsensual basis for life within la cité that means that words such as “ordi-nary” and the recognition of “our” children need no further explanation. Thelatter are presupposed, held implicitly in the place of the universal—after all,“children don’t run away from the police unless...”—while the former, thechildren of the districts that are unordinary, are subsumed by two totalising
VOL. 50, NO. 3 57
ANNA-LOUISE MILNE
regimes of visibility: the identifiable other—Bouna, Zyed—who are otherenough to confirm their otherness, and the homogenising frame that is noteven perceived as such by prevailing consensus.11
In other words there is something else going on between the emblematicface and the singularising misery, something else that is only acknowledgedas what cannot be admitted, something that is not recognised. Moreover, Iwant to argue that the same discursive structure also obtains around la ban-lieue. Or, to put it another way, there is something else also lurking in mythree press cuttings quoted at the beginning of this article.
The neglected organ is most obvious in the first example from architectRichard Rodgers. He recycles the well-worn notion of the city as a naturaltotality, but deems the body broken. The terms of his organic construction areall the more striking, though, given that the traditional conception of the rela-tion between Paris and the rest of the country is that of the head to the body.Rodgers’s observation of a psychological barrier between heart and bodystrangely lacks a location, or a mind that it could occupy.
Antoine Compagnon’s banlieue has a different sort of deformity, althoughhe is undoubtedly more self-conscious in his polemical intent to decapitateParis. “Move over” is what he is saying to his “contemporains,” or at least“cessez de vous lamenter….” He does so by playing on his transatlantic stance.La banlieue and immigrant life is “today’s” France, he claims, when seen fromthe other side of the Atlantic. But this attempt to displace the reference of Franceand French literature onto la banlieue does something odd, answering Rocard’s“good sense” with the opposite affirmation that, today, France is the misery ofthe world. Moreover, the good readers of French literature, the ones who readout of discernment and not preconditioning, the ones who decide what shouldbe translated, read it to know this misery. The equivocation about who stands tolearn from reading Faïza Guène and her fellow sisters of the cités is already evi-dent in the ubiquitous pronoun “on” of the article: “on lit des romans pour com-prendre l’autre.” But this equivocation becomes even more apparent in the shiftin perspective from the external transatlantic point of view to the internal posi-tion, signified in archetypal Parisian reference to the intra muros:
Il nous faudrait, dit-on, des romans cosmopolites, de la littérature transnationale. Oui, mais nonpas au sens des marques globales, Nike ou Zara, plutôt au sens où le global est à notre porte, oùle transnational est intra-muros, ou de l’autre côté du périphérique. Les livres en français que lemonde a envie de lire sont des récits qui expriment, platement ou avec plus de flamboyance, laréalité française ou francophone du terrain. On n’ignore pas que la France d’aujourd’hui, c’estl’immigration, les ratés de l’assimilation et de l’intégration, l’embrasement des cités, les échecsde l’école. Aussi est-ce ce que l’on veut comprendre.12
58 FALL 2010
L’ESPRIT CRÉATEUR
The effort to resist the totalising structure of global trademarks is important.Moreover, even if he allows the market forces of publishing to be the finalarbiter, Compagnon is evidently alive to what is at stake in crossing frontiersand wants to harness that estrangement. The affirmation that the reality ofFrance has wholeheartedly decamped beyond le périphérique gives form to adetermined optimism, but this “reality” and more particularly the “terrain” or“ground” where the essential is encountered are no less figures of differenceheld together only by virtue of an implied consensus: the yoking together ofthe heterogeneous categories of Francophonie and la banlieue should leave usin no doubt, or Guène and Begag, who have to be looked at from a very par-ticular position in order to share any features with each other.13 To put itanother way, and leaving to one side the radical differences in texture and con-text between writing from de-colonised countries, “beur” fiction and Begag’swide-ranging activities and intellectual production, the assumption of a seam-less parentage between the ex-colonies and la banlieue imposes an analyticalframework that is increasingly questioned in post-colonial studies.
The idea of la banlieue as the colonised other of the capital city does havea certain, perhaps deceptive, self-evidence. Fund of cheap labour for the capital-intensive centre, industrial powerhouse for the nation during the whole of thetwentieth century, home to large communities of people of immigrant origin,the city’s hinterland looks like a dependent state populated by a foreignmultitude cooking up non-hegemonic writing along with their peppers. Thisassociation between banlieue and colony has figured large in the rhetoricalconstitution of this “territory,” starting in the mid-1920s when the spectre ofbarbarian hordes was frequently invoked and explicitly associated withMoroccans who were then at war against the protectorate regime that Francehad imposed on the country. But operating in the shadow of this dark-skinnedspectre is a hugely complex set of aspirations and associations that cut acrossa straightforward narrative of la banlieue as space of cultural or racial stig-matisation and consequence of capitalist surplus. One of the key challengesfor “thinking” today in France, or “à partir de la France,” is surely to experi-ment with new articulations of this terrain that do not just continue to map thepatterns of alienation as undifferentiated, pathological constants—“de l’autrecôté du périphérique.”
But let’s not forget Pierre and Jean Sarkozy and the last of those press cut-tings, where what is striking is the implied “cordon sanitaire” between thegood “business” done in the business quarter of La Défense and the bad“bizniz” done under a pseudonym in la banlieue, It is precisely the connec-tions whereby business and bizniz might reveal their affinities, between and
VOL. 50, NO. 3 59
ANNA-LOUISE MILNE
across different frontiers of centrality and marginality, that need investigation,both as an affirmation of a political project and as an intellectual endeavour.What I want to contend with is the improper possibility that circulatesbetween the city and its other, unsettling the mapping of the city and its otherin the process. I’m interested in those possibilities that sunder the totalisingopposition of centre and periphery, or France and misery. In other words howcan we see the potential openness of the city that ghosts the different phasesof its closure and entrenchment? I propose to start by dwelling on a couple ofrecent works that begin in the realm of the faits divers but thicken the story inways that are gently “improper,” not claiming counter-hegemonic causticity,but finding new territory within the form of the novel or the standard feature-film format which produces a different visibility in and for la banlieue. Thetwo works are Jean Rolin’s La Clôture and Claire Denis’s 35 Rhums.14
Transport systemsBoth Rolin and Denis are intimately engaged with how bodies move,
everyday, in the millions, across and around the “staggering psychologicalbarrier” of le périphérique; both also imagine a body condemned to die withinthe space of this barrier. Hunched across the tracks somewhere between thePlaine Saint-Denis and the Gare du Nord, the Antillean RER driver (JuliethMars-Toussaint) of Denis’s film is possibly a closet homosexual, certainly alonely man, but we know nothing more of how he actually killed himself norhow his body was transported to its unprepossessing resting-place. Rolin’sprostitute, Ginka Trifonova, is also abandoned, victim of multiple stabwounds, on the grassy border of the road, rue de la Clôture, that runs alongthe edge of the Gare de l’Est tracks in Paris. These deaths are banal, and nei-ther Denis nor Rolin do anything to suggest that they carry a story, or thestory. But they are not fully assimilated either by the possibilities for a politi-cised sociology, which both Denis and Rolin allow to figure in the densely andvariously populated territory within which their work moves.
This staging of politicised social science in the face of racial and sexualmisery is also not “the” story though. In Denis’s film in particular the apparentlyanecdotal nature of the incursion into a “theory” of and for France todayresults in a cumbersome scene that lingers strangely in its unresolved con-frontation. The lead character, 20-year-old Joséphine (Mati Diop), is giving apresentation in front of her classmates at the fac on Third World debt. She isupbraided by the professor (Stéphane Pocrain), of African or Antillean origin,for her pedantry, an accusation which bears little relation to the snippet of theexposé that we hear, after which the scene breaks into a series of show-piece
60 FALL 2010
L’ESPRIT CRÉATEUR
declarations: the professor intones a classic saw of French academic method-ology—“on vous apprend à construire une argumentation”—while anotherstudent quotes the radio and a third quotes Frantz Fanon, talking directly tothe camera as if his “invitation à relire Fanon” suddenly breaks out of the fic-tion of this classroom and is addressed as much to the viewer as to the largelyblack fictional student body imagined in what is a probable evocation of theParis VIII-Saint-Denis campus. Denis has said that the reference to Fanon wasmotivated only because she had been told during the preparation of the filmthat Fanon’s ideas were no longer relevant for thinking today, a view withwhich she disagrees.15 The traces of her interest in questions relating to racialstigmatization, which are more prevalent in some of her earlier work, are def-initely there to be seen in other moments of 35 Rhums: in the composition ofthe university class, in the decision to represent the group of RER drivers asall of Antillean origin, as well as in the suggestion of some sort of broadercommunity linking the disaffected anthropology students of northern Parisand the RATP employees and taxi drivers that constitute Joséphine’s homemilieu via the shared intention to go to a particular concert, never named, atthe culture park of La Villette. But, like the plea for Fanon in the classroom,these traces fill out the film without becoming its focus. Fanon should be read,of course, but the film moves on.
Rolin too moves on. His idiosyncratic project of reading Napoleonic his-tory from the point of view of the boulevard Ney, a destitute strip of the innerroad around Paris that borders the upper reaches of the 18th and 19tharrondissements, which, in his characteristically elliptical way, is also aboutwriting about “le boulevard qui relie la porte de Saint-Ouen à la ported’Aubervilliers, mais du point de vue présumé du maréchal Ney,” dispatchesany scientific pretensions with a mere glancing reference to the “chercheursen sciences sociales” who have set up their laboratory within the facilities ofthe Villette culture park and who as good as witnessed the murder of GinkaTrifonova.16 No further need is felt to expand on the irony of this powerless“observation” of a brutal murder. But nor is there any strong implication thatthis strange novelistic project has a better purchase than social science onfactors determining the condemnation to violence and possibly death of thevictims of economic migration and sexual commerce. That is not the claimthis article intends to make either. Rather, what is important is the very pre-cise inconclusiveness that characterises both Denis and Rolin’s work.
Both start with an observer occupying an unlikely vantage point. Denistreats us to a long, beautifully modulated sequence of trains travelling back-wards and forwards across the perimeter of the city, the sense of inward and
VOL. 50, NO. 3 61
ANNA-LOUISE MILNE
outward movement confused by the fact that the gazing subject, Lionel, thebenign father figure of the film (Alex Descas), is standing somewhere downon the tracks, though the camera roves knowingly across the network of lines,surveying the smooth complexity of the intersections in this vast transport net-work. The sequence begins with the film titles but continues long beyond,gradually constituting itself as the primary object of our contemplation, build-ing one layer of life upon another as we see bodies and faces illuminatedthrough train windows, faces reflected in the glass past bodies rubbing upagainst one another with the rocking of the train, and behind the trains, thewindows in the buildings that look down onto the tracks, themselves drawninto possible mobility, like great ocean liners, by the flow of the trains.Indeed, the building where the re-composed “family” of father and daughter,plus would-be surrogate mother and contender to be future son-in-law, namedNoé as if in anticipation that his role is to keep them all afloat, live in theirindividual “rabbit hutches” is a typically understated evocation of Le Cor-busier’s famous characterisation of modern high-rise buildings as “paque-bots,” their inhabitants gently adrift. The tactile reality of the everyday sur-faces of ordinary life—the rough walls in the staircase down to the garage, thewarmth of soup drunk from a thermos—is rendered by the lingering sensuousattention applied to them, which enables a gradual amplification towardssomething more fleetingly abstract. Thus at the very end of the openingsequence the rear lights of the last RER train preserve their functionality whilebeginning to morph into two haunting red eyes that return Lionel’s gaze. Theyfall just short of strong symbolism though, gliding discreetly across the screenin a way that primarily underscores the autonomy of their movement.
Rolin also favours a brooding gaze to open his novel, evoking the samesense of inscrutable knowing that characterises the taciturn Lionel through anironic staging of the all-powerful eye trained through the telescope of a riflein a fantasy of the lone gunman able to transform the course of history, or theflow of traffic, from a position of near invisibility. Rolin’s narrator eschewsthis knowledge, however; it remains only a possible position, and thereforeonly a possible form of knowledge: “s’il était équipé d’un fusil à lunette aumagasin garni de balles à haute vélocité, et pour peu qu’il sache s’en servir”(Rolin 12). But the text nonetheless announces a quiet gravitas similar to thatof Lionel, with the hint of historical significance—“quelques heures avant lafin du XXe siècle, l’homme se tient debout, un peu en retrait, une cigarettecalée entre deux doigts de la main gauche” (Rolin 12—counterbalanced bythe time it takes to smoke a cigarette, which is also the time piece that deter-mines the sequences of contemplative observation in 35 Rhums.17 The ciga-
62 FALL 2010
L’ESPRIT CRÉATEUR
rette that moves between mouth and the air does not just slow the pace ofobservation though, opening up an abeyance that holds the hard-edged shiftinto the new century at one remove; it also figures the porosity of the subjectin space whose inner eye operates in continuity with his or her outer eye, cre-ating an intimate but unspecified bond between the anonymous flow of trainsand the domestic and familial dramas of individuals, mulled over while smok-ing. The rhythm of inhalation and exhalation creates the sort of porosity nec-essary to span the disjunction between the fait divers of “Bouna et Zyed” andthe hypostatisation of “les quartiers” which engulf their constituent parts.
Indeed, Rolin’s strange reversible project of writing about Napoleonic his-tory from the point of view of contemporary urban blight, or contemporaryurban blight from the point of view of a Napoleonic Marshal, needs to beunderstood as something like this rhythm of inhalation and exhalation, albeitin a performance that flaunts its unlikeliness. Taking its lead from the randomassociation of street names with particular locations, or rather from the mis-match that comes to characterise this association once contemporary realityhas effaced any trace of the original motivation for choice of street name, LaClôture sketches a transient pattern of connections between the epic narrativeof the Russian campaign and the tussles for territory on the northern front ofle périphérique, between Ney’s combination of ambition and desperation andthe affective and physical violence that often lurks in the lives of those ekingout an existence in the precarious spaces under and around a major road inter-section at the edge of a global city. The weaving together of Ney’s story withthat of a Congolese asylum seeker Lito, who works as a security guard, isloose. The possibility of reading Lito’s attempts to adjust his position withinthe Congolese armed forces to Kabila’s arrival in power in the light of Ney’svacillations is kept open, but never explicitly pursued. The mapping of thebattle of Waterloo onto the terrain of the traffic intersection at La Chapelleremains farfetched, and the noting of dates—“le jour où commence le passagede la Berezina par les restes de la Grande Armée—le 24 novembre—, jeretrouve Lito à la station Strasbourg-Saint-Denis”—stops short of implyingany significance to this patterning (Rolin 199). But the connections hangthere, fusing their quotidian ordinariness and their epic potential, thereby sug-gesting alternative logics to postcolonial history, which it might be our task toinvestigate, but which can perhaps be grasped only in terms of Rolin’s incon-gruity, which makes his subject position exactly unlike any other.18
The only moment when these possible connections gain a suggestion ofnecessity occurs via the medium of Gérôme’s painting of Ney’s execution,itself displaced to the periphery of Graves Art Gallery in Sheffield, England.19
VOL. 50, NO. 3 63
ANNA-LOUISE MILNE
Rolin’s narrator travels to Sheffield to study the painting and observesGérôme’s interest in the imprecise, dirty form of the wall against which theMarshall was shot, remarking that this is the part of the canvas where thepainter’s interest in the subject matter takes over from any concern with meet-ing the expectations of his clients. In the presence of this wall marked by impe-rial graffiti, and the litter of what looks like cigarette butts in the foreground ofthe painting but must be the charges used to kill Ney, the text seems to inviteus to conclude that art has anticipated the reality of the boulevard Ney. Thusthe promise of meaning, in its undoing, is made good by the informe of thepainting, as if the dislocation of late-industrial society were already containedwithin the destiny of the likes of Ney and his class (Rolin 233-34). But hisattention to the painting of Ney’s execution is quickly diverted by an unlikelyphoto by a society photographer, Dorothy Wilding, of a certain Rhoda MadgeBeasely, which Rolin’s narrator describes at greater length, claiming its utterlyenchanting effects in such a way that the moment of grace experienced throughthe chance encounter with this image far outweighs the satisfaction found indiscovering a materialisation of his project in Gérôme’s wall. As a culminationof the whole project of La Clôture, the orchestration of the contemporary—“letrottoir,” “le mur [...] griffé d’autre part de deux tags”—and the imperial—“quant au maréchal, drapé dans les plis d’un manteau noir de coupe civile, sacravate blanche de noceur mouchetée de sang”—is curiously understated, andany displacement of historical significance operated through this conflation iscurbed by the sentimentality of the narrator held rapt by the “minor” workdepicting the “adorable head” of a nubile Rhoda Madge Beasley.20
Indeed, Rolin’s fascination with Rhoda Madge calls far more to mindRoland Barthes’s account of the simultaneous experience of presence (“ça aété”) and absence (the “‘n’être plus’ of the subject”) that is the power of thephoto than it does the collapse of narrative coherence in modern painting: “Ilest impossible de voir ce portrait sans s’éprendre aussitôt de Rhoda MadgeBeasley” (Rolin 235). Moreover the encapsulation of her spellbinding appealin the word “adorable” echoes in its very “bêtise” the trace of the lover’s inca-pacity to say anything about the loved one’s qualities in Barthes’s Fragmentsd’un discours amoureux: “De cet échec langagier, il ne reste qu’une trace: lemot ‘adorable’ (la bonne traduction de ‘adorable’ serait l’ipse latin: c’est lui,c’est bien lui en personne).”21 The risk here is, of course, one of sentimental-ity, a risk only reinforced when we learn that Rhoda Madge was in fact killedthree years later in a car crash. The same risk also hovers over the flashes ofdetail given of Marshall Ney, particularly when he is described as acceptingthe offices of a priest in advance of his execution because he lacked perhaps
64 FALL 2010
L’ESPRIT CRÉATEUR
the self-assurance to refuse: “on sait combien il en est dépourvu [de l’assur-ance], une fois descendu de son cheval” (Rolin 204). But Rolin’s text fullyassumes this susceptibility, this willingness to entertain a certain pathos;more, it locates in that susceptibility an access to another experience of inter-subjectivity, which resonates interestingly with some of the more provocativenotions in Barthes’s late work. Sentimentality is, for Barthes, a key figure forthe affirmation of the subject’s incomparability, a weak affirmation, or anaffirmation of a certain weakness: an “émoi” in which the subject gives in tothe evidence of an emotion that concerns only and exclusively him or her-self.22 No generalisation of this authority is possible, and Barthes’s insistenceon the impossibility of sharing the power of the photo of his mother as ayoung girl is now canonical. Rolin comes at the specificity of the emotionobliquely, telling his reader that Rhoda Madge’s photo will inevitably leave ussmitten, and assuming our empathy with Ney. But these invitations to findourselves in this self-evidence—in the “c’est ça” of Rolin’s enthusiasm—areso incongruous that they cannot but remain lettre morte for us, subsisting asremainders that unsettle, and that resist any dialectical reversal.
Sentimentality is a reproach that could also easily be addressed to Denis’sfilm: in comparison with some of her earlier works, there is here a distinctsoftening of the tone. Ostensibly a drama of a young woman setting herselffree of her sole parent, her father, against the background of the well-docu-mented difficulties for young people of colour to benefit from the educationsystem in France and thereby “emancipate” themselves collectively from their“origins,” the film is marked by the almost total absence of violence or rup-ture, whether from a family or social structure. Joséphine does beat on thedoor of the man we presume becomes her husband, who does make the claimthat nothing will now ever be the same, and these events do follow an unex-pected evening in a deserted African restaurant during which Lionel danceswith the beautiful “Patronne” in one of the film’s most hauntingly sensualscenes. But these events fail to connect seamlessly enough to offer a con-vincing narrative of the daughter’s desire for her father, repressed and dis-placed onto “the boy next door.” It is as if Denis wants to sap the drama ofpatriarchal authority from within, not to announce its defunctness or theadvent of a culture deprived of the impetus for rebellion, but rather to forgetthe institution of the Father, and the Family, in order not to reduce the incom-parability of the relation constructed here.23
The scene in which the dutiful daughter assuages her father’s hangover isperhaps the most charged in this respect: as he strokes her hands while tellingher to be free, the possibilities for that caress, which is both affectionate and
VOL. 50, NO. 3 65
ANNA-LOUISE MILNE
desiring, both exploratory and a little perfunctory, unfold without condensinginto a determinable dynamic, despite the fact that the roles for the familialdrama of breaking away are clearly in place. A similar claim could be made forthe handling of the rum glass in the supposed ritual that gives the film its title,where the notion of a particular community with its particular practices—thedowning of 35 shots of rum in one evening—is suspended before us, but ulti-mately never substantiated: perhaps Lionel made the whole thing up, and whenhe acts it out there is no community present to confirm its sameness. But toexpand the focus from the familial through the communitarian to the scope ofthe city, it is once more the pressure of a hand that communicates the force thatholds together while remaining detached. Lionel’s hand again, now handlingthe lever that controls the speed of the RER train in a gesture that is neithergrasping nor casual, but simply quite sure and deft, a gesture of responsibilitystudied with similar precision by the camera. In contrast to the much-discusseddematerialisation of space associated with fast suburban networks, the focusfor Denis is the small, reliable movements of the driver within the train, whoseplace in driving the mass circulation of a global city is gently affirmed.24
His mobile rings: a message from “Jo” announcing briefly her late arrivalhome, and the palpable sense of their complicity suffuses across his face, asif it were lit up by the back light of the phone as part of a continuous skin thatholds them, Joséphine and himself, somewhere in the vast expanse of the cityand its hinterland, together. Some of the key vehicles of the derealisation oflife—the train, the mobile, the non lieu of the no-man’s land between city andsuburb—thus re-appear as bearers of vital connections, not constituting astructure or a collectivity as such, but effecting or supporting a mode of beingtogether, in a time of dislocation.
This mode of being together eschews the various conflicts—familial(father/daughter), ethnic (excluding majority/dependent minority) and terri-torial (Paris/banlieue)—that might produce something like an inter-subjectivedialectic. And of course Denis’s film is no more a “banlieue film” than Rolin’snovel would be generally recognised as “postcolonial fiction.”25 Indeed, per-haps some of their importance lies precisely in the challenge they make to cat-egories of this sort, a challenge that disables any attempt to measure degreesof relative dispossession, or, alternatively, markers of authentic cultural iden-tification, as a means of determining inclusion within the notion of “la ban-lieue” or the “postcolonial.” These works’ relation to space is quite contin-gent, though not negligible. Rolin’s forcing of the disreputable Boulevard Neyinto the heart of Napoleonic history is echoed lightly by Denis when thecamera alights on the Paris road sign for the rue de la Guadeloupe, a trace of
66 FALL 2010
L’ESPRIT CRÉATEUR
imperialist self-congratulation that is here the indifferent background for amoment of peace in the day of a woman taxi driver of Antillean origin. Thedeployment of these street names fails to effect the sort of reversal that wouldhave Paris become its Other, say Guadeloupe. Instead the taxi moves rela-tively indifferently through space, casually criss-crossing the “staggering bar-rier” as do the trains and the people they carry, but not in such a way that thisapparent “border crossing” carries the corrosive, critical potential that tends toget emphasised by postcolonial theorists focusing on hybridity, syncretictransformation, and diasporic mobility. Here the symbiotic relation betweencentre and periphery, and by extension the idea that they are constitutivelyrelated to one another, is trivially the case, part of the ordinary ecology ofeveryday life in and around Paris.
But if the ordinariness of shuttling back and forth disarms a mode of crit-icism that seeks to disrupt our categories of thought and analysis, it does notleave us indifferent. On the contrary, the short but suspensive passages—“letemps d’une cigarette”—that give their rhythm to both Denis and Rolin’swork create an opening in the fabric of life, allowing the vast complexity ofspecific trajectories to flood the ordinariness with their extraordinariness, thatis, with their authority, their capacity to move, and the émoi they produce.Rancière describes something like this “ordinaire-extraordinaire” as “une cer-taine expérience d’exil qui commence dans cette expérience de la languepropre comme langue étrangère” (Rancière 196). He relates this exile to arecognition of the “quasi autre,” a recognition that is both a self-reflexivere-cognising and an acknowledgement of the other who is not other enough tobe the foil for one’s sameness: “celui qu’on ne peut pas renvoyer ‘chez lui’parce qu’il est ici chez lui” (Rancière 196). It is this “quasi other” that think-ing in France today needs to accommodate, rather than perpetuate the singu-larising fatality of la banlieue.
University of London Institute in Paris
Notes
1. Angelique Chrisalfis, “After the Pompidou, can Rodgers transform the secret, shabbydivided side of Paris?”, The Guardian, 12 March 2009.
2. Antoine Compagnon, “Dans notre monde de plus en plus global, à quoi ressemblera leroman de l’avenir,” Le Monde (Le Magazine), 5 March 2009. See note 11 below for infor-mation relating to Faïza Guène and Azouz Begag.
3. “Pendant ce temps, Pierre Sarkozy fait du rap,” Le Monde, 21 October 2009.4. Jean Pagès, “Il faut assurer la sécurité de la banlieue,” Le Petit Parisien, 27 November 1927.5. Nathalie Schuck, “Sarkozy de retour en banlieue,” and Béatrice Houchard, “Les Députés
s’emparent du Grand Paris,” Le Parisien, 24 November 2009.
VOL. 50, NO. 3 67
ANNA-LOUISE MILNE
6. Jean-François Julliard, “Clichés sous bois,” Le Canard enchaîné, 29 March 2006.7. Jean Rolin, La Clôture (Paris: P.O.L., 2002), 37.8. “Nicolas Sarkozy face aux lecteurs du Parisien/Aujourd’hui,” Le Parisien, 29 March 2006.9. This article is not directly concerned with the veracity of the different accounts of Rocard’s
“phrase,” but the polemic is to be noted for what it reveals of the on-going attempts to estab-lish a reliable political language for and concerning immigration. Rocard himself was ener-getic in denouncing the supposed distortion of his declaration in a column published in LeMonde on August 24, 1996, where he rejected any suggestion that his government of 1989had pursued a policy on immigration that would be formalised in the Pasqua laws of 1993.He claimed that his sentence had been truncated and taken out of context, adding that hehad been speaking to the Comité inter-mouvements auprès des évacués [the Cimade], a keyorganisation for the defence of migrants, when he first made the following declaration: “LaFrance ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais elle doit savoir en prendrefidèlement sa part.” A recent piece in Le Monde diplomatique, following further efforts toexonerate Rocard on the occasion of the fiftieth anniversary of the Cimade in September2009, reveals, however, that he had also and more emphatically made the comment onprimetime television—on the 7pm news show with Anne Sinclair on TF1, on a Sundayevening, in front of millions of viewers. The video of this interview leaves no doubt that hisdeclaration and associated comments translate a hard-line position on “illegal” immigration,with no “rider” about “faithful responsibility” added as a caution. See Thomas Deltombe,“‘Accueillir toute la misère du monde,’ Michel Rocard, martyr ou mystificateur?”, LeMonde diplomatique, 30 September 2009 (http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2009-09-30-Rocard) (accessed 19 July 2010).
10. “Inadmissible” in Aux bords du politique (1998) (Paris: Seuil, 2004), 185-86. Rancière’sdiscussion of the expression “toute la misère du monde” makes no mention of the seminalcollective publication steered by Pierre Bourdieu, La Misère du monde (Paris: Seuil, 1993),despite the fact that this project’s effort to make visible the very specific nature of individ-ual sufferings—“les misères de position”– bears significant resemblance to what Rancièrehere describes as the “cette différence à soi des corps parlants” (Rancière 196). The limitednature of Rancière’s engagement with Bourdieu’s thinking in the context of these essays isevident in the following piece on the “dis-identification” provoked within the polity by the“events” in Algeria, where Rancière assimilates Bourdieu and Sartre: “La guerre y apparaîtcomme un langage et un langage qui dit la vérité d’un processus historique. Et ce proces-sus de vérité est assimilé à un système défini des rapports entre le même et l’autre: le peuplearraché à son identité par l’oppression coloniale devient dans la lutte l’autre de cettealtérité.” In contrast to these positions, Rancière is interested in this piece in the fissure pro-voked within “French” identity by the “différence à soi” that was apprehended in a recog-nition of what forcibly removed from the space of politics: Algerian protestors whosebodies were uncounted (Rancière 202-20).
11. Judith Butler’s recent work Frames of War: When Is Life Grievable (London: Verso 2009)is a provocative reflection into how frames or “perceptual categories” structure modes ofrecognition and their implications for “politically consequential affective dispositions suchas horror, guilt, righteous sadism, loss and indifference” (Butler 24, and following).
12. Compagnon, 5 March 2009.13. Faïza Guène (b. 1985) is the author most notably of Kiffe kiffe demain (2004) and Du rêve
pour les oufs (2006), two works which reflect her personal experience of growing up in afamily of Algerian origin in the suburb of Bobigny to the north-east of Paris. Azouz Begag(b. 1957), also of Algerian origin, grew up in the 1960s in a housing project in the suburbsof Lyon where his parents had immigrated at the very end of the 1940s with the intentionof living only briefly in France. He is a prolific novelist (Le Gone de Chaâba [Paris: Seuil,1986] and Béni ou le Paradis privé [Paris: Seuil, 1989] are his first and perhaps best knownworks), a professor of economics and sociology (CNRS and Paris IV University). He alsoheld a governmental position under Dominique de Villepin, from which he resigned beforesupporting François Bayrou in his presidential campaign in 2007. For a useful interviewwith Begag in English, see Alec Hargreaves, Sites, 8:2 (2004): 9-20.
14. Jean Rolin, La Clôture (Paris: P.O.L., 2002) and Claire Denis, 35 Rhums (2009).
68 FALL 2010
L’ESPRIT CRÉATEUR
15. This information is revealed in James Williams, “Romancing the Father in Claire Denis’s35 Shots of Rum,” Film Quarterly, 98:2 (2009): 44-50, the first in-depth critical assessmentof this film and an important contribution to thinking about Denis’s later work. I am verygrateful to James Williams for having shared this work with me for the very significantinsights into the film it provides.
16. The French text reads: “Ginka Trifonova avait vécu les dernières semaines de son existence,puis s’était fait assassiner, à deux pas et presque sous les yeux d’un groupe de chercheursen sciences sociales installés dans les anciens locaux de la halle aux cuirs, sur le territoiredu parc de la Villette.” (Rolin 37) The additional information that a school for circus artsalso lies right nearby where Ginka Trifonova had died deflects the barb directed at socialscience, giving it the appearance of being tossed out by Rolin’s narrator, almost inconse-quentially; the social scientists ultimately just sit alongside the rank and file of thepériphérique, who are all witnesses and actors in this non-drama.
17. This opening passage in the novel also operates the same careful detailing of the space ofle périphérique that characterises Denis’s opening sequence of suburban trains, substitutinga predictable panorama of high-rise concrete towers with the precise naming and placing ofspecific buildings just as Denis subverts the generic train shot which signifies purely as thecrossing of a frontier without giving any depth to that frontier, as we see for example inKassovitz’s La Haine (1995), by staying with the complexity and variety in the movementof the trains. In both cases, the abstraction into which this detail dissolves thus remainsvibrant with the possibility of specific forms re-emerging.
18. The only acknowledgement I have come across of the oddity of Rolin’s project in this novelappears in another odd novel, François Bon’s recent Incendie au Hilton, where he offers thefollowing cryptic but suggestive description of “cette écriture à la fois minutieuse et nour-rie de la présence et des signes d’une humanité en bascule, et inquiète: un roman d’aven-ture, dans notre vie meme” (Paris: Albin Michel, 2009), 123.
19. Jean-Léon Gérôme, Le 7 décembre 1815, 9 heures du matin (1868).20. It is interesting in this respect to compare Rolin’s dispatching of the “modernity” Gérôme’s
painting with Bataille’s treatment of Manet’s painting of an execution from the same year,L’Exécution de l’Empereur Maximilien (1868). For Bataille the under-determined groupingof the victims and the soldiers in this painting, crossed with the opaque surface effect of thecloud of gunpowder, is a decisive intervention, marking the moment of the “destruction ofthe subject” whereby the conventional majesty of history painting is transfigured into a newsecret, silent sovereignty, that of art (Manet [1955] [Paris: Skira, 1994], 43).
21. Roland Barthes, Fragments d’un discours amoureux (Paris: Seuil, 1977), 27.22. See “L’Obscène de l’amour,” Fragments 207-211, and La Préparation du roman: cours et
séminaires au Collège de France (1978-1979 et 1979-1980, Nathalie Léger, éd. (Paris:Seuil, 2003), 127-29.
23. This claim paraphrases Barthes’s principle in La Chambre claire when writing about thephoto of his mother: “ne jamais réduire le sujet que j’étais, face à certaines photos, au sociusdésincarné, désaffecté, dont s’occupe la science. Ce principe m’obligeait à ‘oublier’ deuxinstitutions: la Famille, la Mère” (La Chambre claire 115). James Williams adds a usefulbackground to this claim in his account of the “virtual primal scene” of Yasujiro Ozu’s 1949classic, Late Spring, which shadows Denis’s film as a deeply personal and quite secretiveintertext (Williams 48-49). While not particularly emphasising the personal intertext,Nikolaj Lübecker’s also points to a similar process of “accommodation of social forms andlaws” (Williams 50). See “The Dedramatization of Violence in Claire Denis’s I Can’tSleep,” Paragraph, 30:2 (2007): 17-33).
24. Denis’s interest in RER drivers reflects, of course, one of the social groups whose effort to drawattention to the specificity of working conditions and the fabric of life built around them hasbeen most exacerbated, resulting in some of the most entrenched periods of industrial action inFrance in recent years. See Paul Virilio on the dematerialisation of space (L’Espace critique[Paris: Christian Bourgois, 1984]). Concerning the Parisian banlieue more specifically, seeFrançois Maspero, Les Passagers du Roissy-Express (Paris: Éditions du Seuil, 1990).
25. The genre of the “banlieue” film is probably most often exemplified by Kassovitz’s LaHaine (1995), but also of “generic” status is La Trilogie urbaine (2007) by Malik Chibane.
VOL. 50, NO. 3 69
ANNA-LOUISE MILNE
Fiction in the First Person or Immoral Writing
Marie Darrieussecq
WE KNOW THAT A PRIMORDIAL judgment weighs upon fiction: thecondemnation pronounced by Plato.
Despite “an awe and love of Homer” he has had “from [his] earliestyouth,” Plato feels he must address this strict rule required in a just city: thecomplete “rejection of imitative poetry”—in other words, fiction.1 Whichspeaks, he says, in the place of “those who have gone to war”: the real people,who have suffered in their flesh, who actually know the weight of words andthe burden of the dead. 2,400 years ago, the idea that fiction could present avision of reality as accurate as—or even truer than—a factual account wasalready subversive.
I am a writer of metaphors, and of fiction; indeed, I have no choice. I writewith familial mantras that are like damnations, but above all, I write with myimaginaire: my imaginary. If there is a particular strength to my fiction, whichhas been described as “empathetic,” it is that this writing offers a textual locusof identification. It’s astonishing, the power of the real-effect, which can pro-voke confusions, sensitivities, and outbursts, even the accusation of “psychicplagiarism” in the case of my latest novel, Tom is Dead.2 This accusationsprang from the idea that to write in the first person about a period of mourn-ing, one must have endured such an ordeal oneself. Otherwise, this narrativeis of necessity usurped, or even copied outright. As if fiction were never any-thing but the plagiarism of a factual account.
In slipping into the fictional skin of Tom’s mother, in searching for thataria’s voice, if I was thinking of a real person, it was my own mother, eventhough the story I invent in Tom is Dead has nothing to do with us. My books,and especially this one, are almost always—and deliberately—fiction. As ithappens, the violent polemic that followed the publication of this novel inFrance compelled me to make public certain autobiographical facts to justifymy having written a work from my imaginaire.
There have been several attacks recently in France against other first-person novels described as “extreme fiction.” In 2007, Pierre-EmmanuelDauzat accused Jonathan Littell of “plagiarizing the dead” and “plagiarizingthe Nazis” for The Kindly Ones.3 In late 2009, Claude Lanzmann accusedYannick Haenel of usurpation and plagiarism because the novelist presentedhis own version of a historical figure, Jan Karski (interviewed by Lanzmannin Shoah), and did so by speaking for the character of Karski in a fictitious
© L’Esprit Créateur, Vol. 50, No. 3 (2010), pp. 70–82
monologue.4 In March of 2010, Régis Jauffret’s usual publisher decided notto publish his latest novel, Sévère, because this fictional monologue resem-bled “too closely” a sensational news item involving a well-known banker.5
There again, the first-person novel was either too true, or too untrue. Thisform of fiction, albeit a traditional one, seemed to be upsetting the contempo-rary practice of reading, which has become confused with the exercise oflegality and morality.
All this led me to reflect on the status of fiction nowadays, so long afterPlato. In our times, truth is all the rage, a truth identified with the Good. Whatseems to be disappearing is the very possibility of reading and understandingwhat a novel is.
Plato and imitation, or on the origins of terror in literatureFor Plato, objects in the real world are already copies of an Idea. Thus the
bed made by a craftsman is a copy of the Idea of a bed. Fiction is a copy of acopy, one “thrice removed” from truth. For poets “cannot make true existence,but only some semblance of existence.”6 Morally, this is intolerable; politi-cally, it is dangerous: we no longer know who is speaking, and we are moved,according to Plato, by fictional narratives that distract us from our duties.Since we cannot regulate the imitative power of fiction, we must get to theroot of the evil by banishing the authors, especially the good ones. A “goodpoet,” says Plato, is precisely someone who has no need to know what he’stalking about to write about it. This dangerous talent is tailor-made to deceivehonest people—and children, adds Plato.
Homer is then put on trial: has he “in private or public life” led armies inwar, cured men of illnesses, governed cities, he who in his work speaks ofthese things as if he were familiar with them? No. And what’s more, there isno evidence that, during his lifetime, he was a mentor to people, and that theyvalued him for his teaching. In short, Homer was not able “to educate andimprove mankind” because he did not possess knowledge and was “a mereimitator.”7 Able to create a perfect simulacrum of what he has neither expe-rienced nor been familiar with, he is a charlatan, like all authors of fiction,those poets who see things only through “words and phrases.” Fiction pandersto unmanly conduct in the citizenry, behavior “that is the part of a woman”(Plato X, 369, 376). Through its misleading imitation, fiction inspires theshedding of tears over false sorrows, whereas, thanks to philosophy, a goodman “who has the misfortune to lose his son or anything else which is mostdear to him” can remain master of himself in the Stoic fashion.8 Tragedy, inparticular, “allows the sympathetic element to break loose because the sorrow
VOL. 50, NO. 3 71
MARIE DARRIEUSSECQ
is another’s” and depletes the strength we need for our real misfortunes (PlatoX, 377). “The imitator,” concludes Plato, still speaking about fiction, “has noknowledge worth mentioning of what he imitates. Imitation is only a kind ofplay or sport” (Plato X, 371).
Reproaching fiction writers for doing what they know how to do, forimagining without necessarily knowing, or experiencing… You’d think suchaccusations had long since gone out of fashion. These days, apparently, no oneattacks the mode of fictional representation as such anymore. The suspicionof usurpation, however, continues to express itself via a phantasm such as“psychic plagiarism,” which prolongs the Platonic accusation: through othermeans (to which I will return), the objective is still to set norms and boundariesfor fiction.9 Fundamentally frivolous, a usurper and plagiarist: that is, in fine,the novelist.
The most reprehensible usurpation, for Plato, is the fictitious narrative inthe first person. When Homer contents himself with remaining Homer, i.e.when he “never conceals himself” behind the voices of his characters, Platoconsiders his third-person narratives tolerable. He gives as an example thispassage from The Iliad: “And he prayed all the Greeks, but especially the twosons of Atreus, the chiefs of the people.” Commentary: “The poet is speaking[here] in his own person; he never leads us to suppose that he is anyone else.But in what follows he takes the person of Chryses, and then he does all thathe can to make us believe that the speaker is not Homer, but the aged priesthimself” (Plato III, 93, 92). The Iliad and The Odyssey are condemned in theirentirety because of speeches in the first person.
And now Plato rewrites for us, in the third person—which is to say, legit-imately—the priest’s entire monologue! “In this way the whole becomessimple narrative” (Plato III, 94). The idea is still to replace a text withanother, more acceptable one.10 The worst offenders are fictive passages inthe first person dealing with grief. “And we must beg Homer and the otherpoets not to be angry if we strike out these and similar passages.”11 For these“psychic plagiarisms” before their time demoralize brave citizens: “notbecause they are unpoetical, or do not please the ears of most people, butbecause the more poetic [fictive] they are, the less appropriate they are forthe ears of boys and men who must be free, and ought to fear slavery morethan death” (Plato III, 83).
So, hardly has the first literary critic described the field of literature thanhe invents its double, censorship; its methods, disgrace and terror; and itscorollary, propaganda. “We must remain firm in our conviction that hymns tothe gods and praises of famous men are the only poetry which ought to be
72 FALL 2010
L’ESPRIT CRÉATEUR
admitted into our State” (Plato X, 378). An attempt to circumscribe fictionthat doesn’t leave much literature left there.
Aristotle, the “feeling of humanity,” and the first personUnlike Plato, Aristotle praises the imaginary. The poet should work out his
play, to the best of his power, with appropriate gestures: “For if their naturalpowers are equal, those who are actually in the emotions are the most con-vincing; he who is agitated blusters and the angry man rages with the maxi-mum of conviction.”12 It goes without saying that what Aristotle called mime-sis was the height of psychic plagiarism.
The Poetics cannot really be called prescriptive. Aristotle defines anddescribes, and never condemns. “Especially,” he says, “since it is the modernfashion to carp at poets” (Aristotle XVIII, 71). (This was in 330 B.C.E.) Be ita tragedy or an epic poem, what he praises in fiction is that it inspires “a feel-ing of humanity.” Delicate to translate, shifting slightly in meaning in differentpassages, this idea consists basically of compassion for human suffering.13 Fic-tion will thus be judged (but not solely) by its capacity to unleash this “feelingof humanity,” best awakened by situations our moralizing critics would find, atthe very least, shocking: “When for instance brother kills brother, or son father,or mother son, or son mother—either kills or intends to kill, or does somethingof the kind, that is what we must look for” (Aristotle XIV, 51).
But—the right-thinking among us will protest—have the authors experi-enced these dreadful situations? Aeschylus, Sophocles, Euripides: did theyeven take the victims into account? Yes, I dare say they did. Because it isthanks to them that we still suffer with Antigone, with Oedipus, withClytemnestra, with Medea. It is true that nowadays, Euripides would beaccused of plagiarizing Sophocles, and Sophocles, Aeschylus.
I! I! I! shout the characters—mourning sisters, incestuous sons, mothersmurdered or bathed in tears. Fiction, for Aristotle, is the “as if.” He says soseveral times: “In constructing the plots [the fiction] and completing the effectby the help of dialogue the poet should, as far as possible, keep the scenebefore his eyes [through imagination]. Only thus by getting the picture asclear as if he were present at the actual event, will he find what is fitting,” forthe poet “should always seek what is inevitable or probable,” thus assuringthat his audience will share fully in the startling “surprise” of tragic recogni-tion, for “through pity and fear it effects relief to these and similar emotions”(Aristotle, XVII, 65; XV, 57; XVI, 63; VI, 23). This shock of recognition,taking us out of ourselves, allows us to embrace a larger “feeling of human-ity,” the only way to understand another person.
VOL. 50, NO. 3 73
MARIE DARRIEUSSECQ
The novel, for me, is the continuation of that mimesis. And I am quite con-vinced that imagination is in fact a form of humanism. Aristotle has praise forhysteria, praise for those who know how to invent lives for themselves andtake on fictional characters: “And that is why poetry needs either a sympa-thetic nature or a madman, the former being impressionable and the latterinspired” (Aristotle XVII, 65).
Because what is important here is not to have experienced an emotion inorder to express it, but to find a way of expressing it that speaks to all of us:“A poet’s object is not to tell what actually happened but what could andwould happen either probably or inevitably” (Aristotle IX, 35). Mimesis doesnot copy the suffering of a particular individual; on the contrary, it invents astory based on common ground, with typical characters, who will later takeon the Christian personae of the Mater Dolorosa, the Madeleine, the Judas, orthe Prodigal Son.
But why “imitate” instead of writing true-life narratives, which we knowcan also speak to all of us? Aristotle answers this question at the very begin-ning of the Poetics. After defining mimesis as that which distinguishes humanbeings from animals—no more, no less—and allows their young to learnvaluable lessons, Aristotle explains that the sight of real suffering is too diffi-cult to bear. And yet, we must still have some idea of it in order to experiencethe feeling of humanity, and by studying “accurate likenesses of things whichare themselves painful to see, obscene beasts, for instance, and corpses,” wecan learn—to our horror—that “we enjoy looking at” them (Aristotle IV, 15).
Aristotle’s Poetics relies in its entirety on the distinction between the real(unbearable) and fiction (whose imitative role allows us specifically to bearthe real world). It would be against nature to delight in the sight of real suf-fering, but the “natural” pleasure we take in violent tales has a pedagogicalfunction based on catharsis, a purgation of libidinal energy. Those who todayspeak of crime in criticizing a ‘pedophilic’ novel, for example, would do wellto read the Poetics, in which Aristotle never confuses a phantasm with theacting out of a fantasy. On the contrary, the representation of the phantasmwould allow one to avoid acting it out: fiction civilizes; it dissuades anddiverts us from the orgiastic horrors of reality.
Morality and fictionBy downplaying the poet’s duty to startle and amaze, Aristotle’s com-
mentators have skewed his literary criteria in a moral direction. For Aristotle,a character’s behavior should exhibit verisimilitude, and the internal necessityof the narrative depends on a seemingly logical sequence of events. With the
74 FALL 2010
L’ESPRIT CRÉATEUR
advent of medieval scholasticism, psychological plausibility gave way tomoral credibility, what a character ought to do, while internal necessitybecame moral necessity, how the story ought to turn out. This reading shiftsthe Aristotelian pedagogical principle that fiction is intended to form soundjudgment to an ethical plane: fiction must be edifying. And it is, in fact, freeto invent, whereas History is subject to the painful necessity of sticking to thefacts. This is a fundamental point: the factual narrative cannot lecture us, sothat becomes the duty of fiction.
The quality of fiction today is judged less by literary criteria than by themoral standard of what a human being ought to do. Since the writer has (sup-posedly) free rein when piecing together a plot, the ‘responsible artist’—whenfaced with the insanity, amorality, and incoherence of History—will offer usnothing that is not edifying.14 But there is some confusion at work here: whereasthe historiographer attempts to hew a coherent narrative from brutal reality, theauthor of fiction would have to put his supposed freedom to good use by skill-fully producing a morally satisfying story from the facts.15 In other words: a fic-tion that tells the Truth in the sense that, improving on a recital of those facts, itwould offer an ethical imitation of the world. Let us leave the real to History;fiction will offer us the Ideal. It would then become a bad thing indeed to enjoya piece of ‘immoral’ fiction… As bad as actually doing something bad.
When it tries to “perform a direct historical or sociological function,” fic-tion abdicates its power, according to Paul Ricœur. The great purpose of fic-tion is to distinguish itself from the past catalogued by the historiographer—and to establish a “quasi-past,” an equivalent of the past in fiction, which maythus liberate “possibilities buried in the actual past.”16 A past in which thenotion of “fictive experience,” in the first person, plays a part.17 Ricœur’sentire œuvre rests on an analysis of narrative that explains the human expe-rience in the light of multiple narratives: a “fragile compromise,” it’s true, butone that can be considered without passion or opposition. Ricœur selects fromhistory events that are “uniquely unique,” a “memory of the horrible” in which,he says, fiction has an important role. There is room for fiction and the imagi-nation between the “purely emotional retort that would dispense us from think-ing the unthinkable,” and History, which “would dissolve the event in expla-nation.” Fiction “gives eyes to the horrified narrator”: it allows us to look,when to witness would crush us. “Either one counts the cadavers or one tellsthe story of the victims”: the imaginary is a gate into History, and a necessityfor memory.18 Without the epic legacy of fictional narratives, “the unforget-table” would be forgotten.19 Thus Ricœur never places any limits on fiction, beit in terms of “themes,” the “unspeakable,” or the narrative point of view.
VOL. 50, NO. 3 75
MARIE DARRIEUSSECQ
The concepts of miming and representation are largely outmoded in con-temporary art, but not—for essentially commercial reasons—in filmmaking,and hardly at all in literature.20 Moralizing critics seek refuge these days insupposed limits, around a sanctification of personal pain delivered throughconventional but contradictory pronouncements: pain cannot be imitated; imi-tating pain is immoral; to write a novel in the first person is to fail in repro-ducing the authentic cry of the autobiography. Plato’s anathema is still inforce, against first-person fiction as the very root of troubling subjectivity.And so, according to Camille Laurens, to have earned the right to take onserious subjects in the first person, “the author, in the pink of health and thebosom of a happy family,” must have first “paid the debt” of suffering. Shespecifies the themes she considers off-limits: AIDS, cancer, concentrationcamps, and even—yes—death.21 Following this logic, any real experiencecould deny the author’s right to a novel, perceived as ‘less true’ than lived lifeor even as usurping it.22
Autobiography, however, is no less ‘imitative’ of reality—if one insists onusing that term—than is the novel: the moi, the self, is a fiction, and to writedown one’s life is to “compose a persuasive simulacrum in writing.”23 Auto-fiction is a “fiction of strictly real events and facts.”24 Every narrative is aform that brings order out of chaos thanks only to a tacit agreement betweenhuman experience and human speech, an agreement complicated by every-thing that has already been written. Thus the aesthetic categories of mimesisand representation are no longer operative, as opposed to those of figure andstructure: a literary text imitates nothing, it carves into language a space thatuntil then did not exist. Indeed, ‘stories’ do not exist before their formulation.Ricœur repeats this all through Time and Narrative: “Fiction does not illus-trate a pre-existing phenomenological theme; it actualizes the universal mean-ing of this theme in a singular figure.”25 And yet many people still wish tobelieve that fiction imitates a singular (his)story: that’s thinking upside down.
The ‘fiction/autobiography’ confusion at work in an attack like the oneprotesting “psychic plagiarism” seems to me a perverse effect of the practiceof autofiction, as if one of its avatars were refusing pointblank to countenancethe writing of imagination. This avatar, largely abetted by newspaper critics,tips autofiction toward autobiography, thereby forgetting the—relativelyrecent—etymology of the word. In autofiction, there is fiction, not bio, as wellas the suggestion of an automatism founded initially on the psychoanalyticalprinciple of free association, à la Doubrovsky.
In my doctoral dissertation I defined autofiction, in a non-exclusive way,as a practice in which words invent life, in the first person of an author-
76 FALL 2010
L’ESPRIT CRÉATEUR
narrator and in his/her name, with studied effects of improbability meant pre-cisely to underline what a text is—including an autobiographical text—withregard to lived experience.26 The Divine Comedy would be the model here,while other examples would include the books of Blaise Cendrars and HervéGuibert (“Only phony things happen to him,” remarked Foucault). It is first-person writing, therefore, une écriture du “je,” that lays claim to a status bothautobiographical and imaginary.
For Käte Hamburger, the pivotal element in the separation between fictionand factual narrative is precisely the first-person pronoun: the I. The first-person novel is in no way different from autobiography: it offers the pretense(Schein) of an autobiography, by positing a fictitious “I-Origin.”27 Well, ‘tomimic’ an assertion seems to pose a strange problem for many literarythinkers. As though the fictional monologue, that literary practice older thanPlato, could only be apprehended morally.28
What distinguishes Tom is Dead from a lived narrative? Nothing, actually,unless it’s the explicit word novel on the front cover… and the absence of allbiographical or onomastic byplay. My heroine is not me, but definitely some-one else, an imaginary other. Rimbaud’s “I is another” has always been, eversince Truismes, my vision of fiction and my way of writing.29 So having tostake my claim now to a right to fiction, and even a right to a character, per-plexes me no end.
Fiction in the first person seems to anger certain readers as much as ifthey’d been deceived. In this form, the referential illusion can be so strong, infact, and the identification so powerful, that the reader—to use Plato’s par-lance—becomes temporarily “enslaved” to it and then irritated with theauthor (who is quite often confused with the narrator). “We react to these fic-tions as we would have reacted to real experiences,” writes Freud after read-ing Schnitzler’s The Prophecy. “By the time we have noticed the trick it isalready too late, the author has achieved his goal, but I maintain that he hasnot achieved an untarnished success. A feeling of dissatisfaction leaves uswith a kind of grudge against the attempted deceit.”30 And after reading TheStranger by Camus, Sarraute spoke of “the emotion to which we utterly aban-don ourselves”: “We can’t help feeling a certain resentment: we’re annoyedwith him for having led us astray for too long.”31
The imagination exists for real, as a force of the mind. The imaginationdoes not imitate the world; it creates an artifact, a textual equivalent, trans-fusible in language into our skulls. For when it comes to someone-else’s-really-real with little bits of true stuff inside, we’ll never know a thing. Theaudacity of the imaginative writer who smuggles text across the border
VOL. 50, NO. 3 77
MARIE DARRIEUSSECQ
between brains, this melding of the imagination and the first person, willalways strike the defenders of literature-as-reflection as an illegal act.
The fictive first person is one of the exploratory areas of literature. As such,producing a form that cannot be distinguished from a lived narrative, it upsetscategories which, no longer in force, mutate into moral condemnations.32 As if,in criticism, every conflict should be resolved through the more or less loudlyproclaimed exclusion of one or the other genre, way of writing, or writer.
A novelist is not (and does not claim to be, and does not want to be) a his-torian or an autobiographer. The novelist’s place in common language and lit-erary expression is elsewhere. And the novelist also tells the truth, also bearswitness to the human experience. Tom is Dead, narrated by one Mrs. Winterliving in Australia, never claimed to be an autofiction or a game with my biog-raphy. On the contrary: it is also because I am not impinging on the privatelife of those close to me (or my own) that I feel infinitely more true, and free,in fiction and the imaginary, and even in fantasy.
Literature was never made to save the world, but to describe it in passing,in passing through it, in presenting it for a fresh viewing, through hithertounopened windows. To describe it not in its “reality,” but in all its realities:the novel must create a world, said Hermann Broch, in order to account forthe world. And it’s precisely because it must be, not a mirror, but “the mirrorof all visions,” that “no human action should be withheld from it.”33
We’ve known at least since Sarraute and The Age of Suspicion that a nar-rator is an instance just as problematic as any character. Why are we even talk-ing about illicit narrators today? For Sarraute, the only crime, in literature, isto have neither a grand plan nor an original way of looking at things. Shequotes Flaubert: “The deepest obligation of the novelist is to discover some-thing new, while the worst crime would be to repeat previous discoveries.”34
Writing a useless book, a book that seeks nothing: that’s what’s bad in litera-ture. Because literature renders justice neither as judge nor as historian.
In praise of imaginary skinsIt is forbidden to write by slipping into someone else’s skin! Do not
imagine other lives, other worlds, other dreams, other nightmares! “Webreathe dereliction of duty in through our pores.” [Poésies I] The Songs ofMaldoror are first-person fiction purporting most unconvincingly to be anautobiography.35 The narrator, alternating blithely between I and he, remem-bers “having lived for half a century, as a shark, in the undersea currents thathug the coast of Africa.” Isidore Ducasse, in the skin of Lautréamont, orMaldoror, or an octopus or a louse, watches the debauched antics of a hair
78 FALL 2010
L’ESPRIT CRÉATEUR
from God’s head, pines for an amphibian, and couples with a female shark: “Iwas facing my first love!” “It was all real, what happened that summerevening.” And the last sentence of the Songs: “Go and see for yourself, if youdon’t believe me.” If anyone ever actually read Lautréamont, that jollyclassic of assigned reading in school would be sold in a plain paper wrapper,like Robbe-Grillet’s controversial last novel. Because besides coitus withsharks, the Songs feature the rape and torture of little girls, and goody-goodychildren driven to suicide. Isidore Ducasse, that murderer.
Are there ethical limits to speaking out in fiction? The subtitle of JaneEyre, published in 1848, says it is “an autobiography,” and this first-personnovel, full of magnificent Sturm und Drang, has plenty of pathetic deaths andmadness. Would this subtitle be a provocation today? Is it forbidden to writefictitiously about suffering in the first person? Is it forbidden to write aboutmisfortune in a monologue novel? And in epistolary literature? Must wereproach Guilleragues for having been so believable, in his Letters of a Por-tuguese Nun, that these wrenching supplications were taken for real letters?
In The Red Crown, the narrator, who introduces himself autobiographi-cally as Bulgakov, is visited by his brother Kolya, who’s been killed by abursting shell during the civil war. “If he’s wearing the crown, that means he’sdead. And there he was, talking, moving his lips sticky with blood!”36 Thisindecent autofiction no doubt cried out for censure: Bulgakov’s brother, thereal Kolya, in real life, was still alive! Should Bulgakov be denied this hallu-cinatory expression of his fraternal terror? Stalin was on the job: immoral, notrealistic enough, politically suspect. All those who by the millions had losttheir brothers and sons in real life—did this book insult them, or hold out itshand to them? And how does one explain the fact that years later in the SovietUnion, this narrative became the symbol of murdered literature, the literaturewhose lips, somehow, still move?37
Yes, it’s safer this way: fratricidal terrors, fictitious mourning, phantasmsof death, and unlived novels must be forbidden. Fiction in the first person, thatimmoral falsehood of the imaginary, must be outlawed… because it mightspeak to human beings.
When people ask me where my ideas come from (a recurrent question),their tone is one of either admiration—That’s some imagination you have!—or reproach—That’s some imagination you have! Changing oneself into asow, imagining that one’s husband vanishes or one’s son dies, especially whenone is a woman, a wife and mother, is illicit imagination.
And yet, everyone thinks about such things. Everyone dreams or hasnightmares about changing skins, about the death of loved ones. A novel is a
VOL. 50, NO. 3 79
MARIE DARRIEUSSECQ
phantasm that has no other acting out except writing. A novelist is someonewho finds words for his or her phantasms, to the bitter end. It’s not the nov-elist’s ideas that should occasion any astonishment, but perhaps the stubborn-ness required, and the patience. Write? Why? If there’s anything ‘bad’ in lit-erature, perhaps it’s to shy away beforehand, to recoil from the phantasm, andbe afraid of it.
Tomb of a Young Person is the title of a sculpture by Louise Bourgeois.“These attentive pillars,” she has said, “express fear, a kind of protective exor-cism for the health of my children.” I wrote Tom is Dead in the same spirit ofexorcism. And the why of my writing, of my personal witchcraft, is nobodyelse’s business. “Exorcism is a healthy thing. Cauterizing, burning in order tocure. It’s like pruning trees. That’s my talent. I’m good at all that.”38
Affiliation?
Notes
1. Plato, The Republic, Benjamin Jowett, trans. (New York: Vintage Books, 1991), book X,360, 361, 378. “Poetry” is contrasted not with prose, by Plato, but with assertive discourseand philosophy (theirs is “an ancient quarrel”), and with history by Aristotle, whose twogreat examples of poetry are the epic and tragedy.
2. Marie Darrieussecq, Tom est mort (Paris: P.O.L., 2007); Tom is Dead, Lia Hills, trans. (Mel-bourne: Text Publishing, 2009).
3. Pierre-Emmanuel Dauzat, Holocauste ordinaire: histoires d’usurpation—extermination, lit-térature, théologie (Paris: Bayard, 2007), 63, 72.
4. Yannick Haenel, Jan Karski (Paris: Gallimard, 2009).5. Régis Jauffret, Sévère (Paris: Le Seuil, 2010).6. Plato, X, 36, 363.7. Plato, X, 367, 368. In 380 B.C.E. writers were already being judged according to their pri-
vate life.8. Plato, X, 373-74. See also the beginning of III.9. Camille Laurens, “Marie Darrieussecq ou le syndrome du coucou,” Revue littéraire, 32
(September 2007). The author expounds on her “feeling of having [her] identity stolen.”10. Octave Mannoni, “Le Besoin d’interpréter,” Clefs pour l’imaginaire ou l’autre scène (Paris:
Le Seuil, 1969), 203. This provocative article considers Faurisson’s rewriting of Lautréa-mont and Rimbaud, as well as the mechanisms of censorship intended to replace the liter-ary text with another text considered “more satisfying for one reason or another.”
11. Plato, III, 83. This in regard to the lament of Thetis at the death of her son Achilles.12. Aristotle, Poetics, W. Hamilton Fyfe, trans. (Cambridge: Harvard U P, 1960), XVII, 65.13. See the notes of J. Hardy on this point in Aristotle, Poétique, J. Hardy, trans. (Paris: Galli-
mard, 1996), 147.14. The reproof is aimed at Littell by Dauzat.15. On this point see the thoughtful article by Rüdiger Bubner, “Historiographie et littérature,”
in Christian Bouchindhomme and Rainer Rochlitz, Temps et récit de Paul Ricœur en débat(Paris: Cerf, 1990), 39-55. With regard to the role of chance in factual and fictional narra-tives, Bubner emphasizes how dangerous it would be to read fiction according to the samecriteria we apply to History: “In that case comprehension would be guided by morality, andthe universality of literary creations would be melded insensibly into the concrete characterof historiography.”
80 FALL 2010
L’ESPRIT CRÉATEUR
16. Paul Ricœur, Temps et récit, 3 vols. (Paris: Le Seuil, 1983-85), 3:278. Time and Narrative,3 vols., Kathleen McLaughlin and David Pellauer, trans. (Chicago: U of Chicago P, 1984-88), 3:192.
This is precisely what Jonathan Littell did in The Kindly Ones. The narrator, an execu-tioner who has survived a serious head wound, is haunted by visions of past murders andthose yet to come, and living in ruins he can no longer distinguish from his nightmares. Heshows us his war with a hallucinatory power that does not undermine but strengthens ourknowledge of the Second World War. “Without fiction, memory dies,” Jorge Semprun hassaid about this novel.
17. Ricœur, TR, 2:129; TN, 2:86.18. Ricœur, TR, 3:273; TN, 3:187-88. Ricœur’s observations will be developed by Pierre Vidal-
Naquet in Les Juifs, la mémoire et le présent (Paris: Le Seuil, 1995).19. Ricœur, TR, 3:274; TN 3:188.20. Perhaps because writers are artists whose material belongs to everyone: language and nar-
rative. It’s difficult to “unhook” reading from representation.21. “We can predict that the future will bring a host of novels in the first person—but not auto-
biographical ones, oh no!—in which the narrator will struggle with cancer, AIDS, concen-tration camps, death, in an orgy of terrifying detail, while the author, in the pink of healthand the bosom of a happy family, perched on books by Hervé Guibert or Primo Levi, theirpages all heavily annotated in fluorescent marker, will get off on and get others off on suf-fering for which he has not yet paid the debt” (Laurens). Following this reasoning, only amurderer can write that he has killed, and only a victim can write about her pain: all of fic-tion falls to pieces as a genre.
22. Pain today is sanctified, therefore religious. And I am resolutely in favor of a secularapproach to History and the novel.
23. Ricœur, TR, 2:25; TN, 2:13.24. Serge Doubrovsky, Fils (Paris: Éditions Galilée, 1977), jacket copy.25. Ricœur, TR, 3:193; TN, 3:134.26. Marie Darrieussecq, Moments critiques dans l’autobiographie contemporaine: l’ironie
tragique et l’autofiction chez Serge Doubrovsky, Hervé Guibert, Michel Leiris et GeorgesPerec, Diss. Université Paris VII 1997.
27. Käte Hamburger, Logique des genres littéraires, Pierre Cadiot, trans. (Paris: Le Seuil,1986). [Hamburger’s Logik der Dichtung was first published in 1957. Marilynn Rose’s Eng-lish translation, The Logic of Literature, published in 1973, was based on the revisedsecond German edition (1968); Cadiot’s translation was based on the third edition of 1977.—Translator’s note.] The difference between a fictional narrative in the third person and anassertive narrative in the third person can be seen and heard; if you consider the verbaltenses used by a fictional narrator in the third person, for example, you wind up with indi-rect discourse. In the first-person novel, however, such markers are no longer apparent.According to Hamburger, the invention of “emanation-points of thought” is the sign andseal of fiction, which reproduces nothing less than the work of consciousness. See alsoDorrit Cohn, Transparent Minds: Narrative Modes for Presenting Consciousness in Fiction(Princeton: Princeton U P, 1984), on the question of the pronoun as “check point” betweenfiction and factual discourse.
28. Pretend, feign, simulate: the critical vocabulary reveals a tendency to compare fiction, anaesthetic category, with a lie, a moral category. Thus Ricœur says that the first-person novel“simulates a memory, which is in truth fictitious” (TR, 2:134; TN, 2:89). Gérard Genetteuses the same tone: the first-person novel is “an act of language that mimics an assertion,all the while announcing that its distinguishing characteristic is fiction.” Fiction et diction(Paris: Le Seuil, 1991), 44-45; Fiction and Diction, Catherine Porter, trans. (Ithaca: CornellU P, 2009).
29. Marie Darrieussecq, Truismes (Paris: P.O.L., 1996); Pig Tales, Linda Coverdale, trans.(New York: The New P, 1997).
30. Sigmund Freud, “The Uncanny,” The Standard Edition of the Complete Works of SigmundFreud, 24 volumes, James Strachey et al., ed. (London: The Hogarth P and the Institute ofPsychoanalysis, 1953-74), 17:219-56.
VOL. 50, NO. 3 81
MARIE DARRIEUSSECQ
31. Natalie Sarraute, L’Ère du soupçon (Paris: Gallimard, 1956), 27; The Age of Suspicion:Essays on the Novel, Maria Jolas, trans. (New York: W. W. Norton, 1963).
32. For a more complete narratological analysis, see my article “L’autofiction, un genre passérieux,” Poétique, 107 (1996): 369-80. If we’re guided by the criteria established by KäteHamburger, autofiction would be—like all first-person novels—a “feigned statement ofreality”: it mimes an act of language, in this case autobiography, which runs counter to thewhole tradition of autobiographical “sincerity.” Writers of autofictions who do not contentthemselves with narrating their lives (I’m thinking in particular of Hervé Guibert) oftensend all paratext packing and go elsewhere, rendering null and void any mimetic logic. Aswe know, neither the pretense of Hamburger nor the early works of a Philippe Lejeune, [anacademic specializing in autobiography —Translator’s note] could completely explainautofiction, which has latched onto this feigned “I” precisely in order to escape all suchcategorization.
33. Hermann Broch, Création littéraire et connaissance, Albert Kohn, trans. (Paris: Gallimard,1966), 241.
34. Sarraute, L’Ère du soupçon, 79.35. “If you insist, what book—I ask you—what modern novel, what mongrel cross between
autobiography and fiction, could ever be more lived than the screams and lamentations ofthis tortured soul?” Léon Bloy, Belluaires et porchers [Gladiators and swineherds] (Cabris:Éditions Sulliver, 1997), 64.
36. Mikhail Bulgakov, “The Red Crown,” The Terrible News: Russian Stories from the YearsFollowing the Revolution (London: Black Spring P, 1990).
37. This is one of Mandelstam’s most famous verses: “You didn’t take from me these lips, stillmoving.” From the last line of “Prison Poem #11”: “You Stripped Away the Sea...”
38. Marie-Laure Bernadac, Louise Bourgeois (Paris: Flammarion, 1992), 54.
82 FALL 2010
L’ESPRIT CRÉATEUR
Temps de la résistance : résistance au temps
Christophe Meurée
À Ginette Michaux
Le roman contemporain est inintéressant dans la mesure où il a affaire au temps et non à la durée,réclamant la hâte du lecteur (le timing du consommateur, plutôt), au lieu de la temporalité dilatéeà l’extrême qu’est la bienveillance d’autrui.
Richard Millet, L’Opprobre
Entre s’étendre et se lever, entre les lèvres qui disent la parole et la parole, il y a une pause, unscintillement qui divise et déchire : moi. Je n’en ai pas encore fini avec moi.
Octavio Paz, « L’Assiégé », Liberté sur parole
LA VOLONTÉ D’ÉCHAPPER au temps n’est pas un symptômed’aujourd’hui. La littérature enregistre, à la manière d’une radiogra-phie continue, les mutations et malaises qui animent (sinon agitent)
nos cultures et civilisations occidentales1. Le phénomène de suspension tem-porelle dans le roman—souvent dénoncé depuis Proust, trop rarement analysépour lui-même—se présente comme un exemple de résistance à ce que l’onperçoit comme une accélération du flux temporel. Depuis Proust, cependant,l’on peut constater un déplacement et une radicalisation des malaises. À partirde 1945, en effet, le sujet humain se trouve pris en un étau qui l’enserre par lehaut comme par le bas. Du côté du passé, la catastrophe des camps représenteune double contrainte incompossible : une impossibilité de mémoire et untrop-plein de la mémoire. L’avenir quant à lui n’a d’autre horizon qu’unecatastrophe qui répéterait Hiroshima, d’une façon ou d’une autre (unetroisième guerre mondiale, une catastrophe écologique, toutes apocalypsesqui, au contraire de celles qui ont précédé, tiendrait en la main de l’hommelui-même).
À ceci s’ajoute enfin la menace pesant sur le désir qui étouffe le présent.En effet, la jouissance à tout crin compresse désormais de manière latérale ladernière possibilité pour le sujet d’étendre son champ temporel. Le présentismes’était accentué en réaction à la difficulté de conjuguer le désir au passé ou aufutur. L’hédonisme réduit cependant l’extension du temps subjectif puisque lesujet est amené à jouir dans l’immédiateté, toujours plus rapidement et à unrythme toujours plus soutenu. Une posture en deçà du désir se caractérise parune impossibilité d’intégrer le Symbolique. Outre la condition langagière del’homme, l’on néglige souvent l’inscription dans une condition temporelle
© L’Esprit Créateur, Vol. 50, No. 3 (2010), pp. 83–98
propre. Un temps à soi, en quelque sorte, qui, hélas, aujourd’hui, est bienmalmené. Je soutiens l’hypothèse selon laquelle le passage (imaginaire, fan-tasmatique, romanesque) par un temps suspendu est devenu une nécessitépour pouvoir relancer un temps propre qui serait celui du désir. Toutefois,dans un monde où le temps semble bouché de toutes parts, que dire des résur-gences de cette sensation quasi mystique du sentiment océanique qui parsè-ment la littérature contemporaine ?
À cet égard, l’œuvre de Jean-Philippe Toussaint, dont on connaît le succèscroissant à l’échelle planétaire2, nous paraît tout à fait exemplaire du malaisedans la culture dont procèdent ces résurgences. Depuis les premières œuvresoù Monsieur, par exemple, ôtait « sa montre pour reprendre son souffle uninstant »3, les personnages toussanctiens n’ont eu de cesse de maintenir unrapport paradoxal au temps : d’une part, ils le fuient comme la peste et d’autrepart, ils prennent plaisir à faire corps avec son cours. Débrouiller ce paradoxepeut nous conduire à expliciter la marche du désir telle qu’elle se configurechez l’écrivain né en 1957.
L’œil du temps, le regard du tempsL’on sous-estime ou l’on méconnaît souvent la place essentielle occupée
par la question du temps dans le déploiement du désir et dans la formation del’identité. Et pourtant, à notre époque, comment encore ignorer ce qu’unrythme effréné de vie comporte de dangers au point que le sujet, tout bonne-ment, y craque de plus en plus souvent ? Comme l’a démontré BernardStiegler4, l’ère industrielle et ses conséquences (dont l’idéologie capitaliste)ont considérablement modifié notre rapport à la chronologie, toujours plusprésente, toujours plus pressante, sinon pressée d’en finir. L’impossibilité dese reconnaître dans le mouvement chronologique à échelle mondiale que nulne peut plus nier (des importuns rappels à l’ordre du téléphone portable auxécrans animés qui jonchent nos parcours, en intérieur comme en extérieur) seconjoint à la difficulté grandissante de conserver le temps nécessaire pourdésirer. Culture de l’immédiateté, du « prêt-à-jouir » comme on dit du prêt-à-porter, culture de la vitesse et des distances abolies : tous ces constats sont onne peut plus justes ; cependant, la réalité des drames psychiques qui se tra-ment dans leurs coulisses doivent encore faire l’objet d’études rigoureuses (ceque l’on ne prend que trop rarement le temps de faire, et pour cause).
Si tous les textes de Toussaint s’ouvrent sur un événement (ou une con-crétion d’événements), tous dénotent aussi une tension vers l’inachèvementperpétuel de l’existence des personnages et une acceptation de cet inachève-ment. Les personnages toussanctiens veillent en effet à se prémunir des
84 FALL 2010
L’ESPRIT CRÉATEUR
assauts de la réalité lorsqu’elle s’autorise des incursions par le biais d’événe-ments non programmés ou, pis, tout à fait programmés mais à l’insu des per-sonnages. Il s’agit dès lors de s’extraire du mouvement trop agité du mondeen vue de préserver son désir. L’événement n’a en effet, pour ces personnages,de cesse de rappeler l’approche de l’échéance fatale de la mort ou, plus large-ment, de la fin. Depuis La Salle de bain, les narrateurs toussanctiens fontmontre d’une distance prise avec toute forme de repère chronologique. Ainsi,dans le roman de 1985, le narrateur se dira avoir « vingt-sept, bientôt vingt-neuf ans » à deux reprises5.
Dans le triptyque asiatique constitué de Faire l’amour, de Fuir et de LaVérité sur Marie6, c’est à la fin de l’amour qui unit Marie et le narrateur quel’on fait face. À force de manœuvres dilatoires, le narrateur du triptyques’échine à contourner l’inéluctable7. « Mais combien de fois avions-nous faitl’amour ensemble pour la dernière fois ? Je ne sais pas, souvent. Souvent… »(FA 16). Toutefois, dès l’incipit de Faire l’amour, la rupture semble bien êtreune décision prise de son propre chef. Comment comprendre dès lors cettevolonté d’en finir et surtout, comment savoir l’objet de cette volonté : en finiravec quoi ?
Dans leur chambre d’hôtel où le décalage horaire leur ôte le sommeil, lenarrateur et Marie font l’amour avec violence, dans le seul but d’atteindre unejouissance libératrice.
[N]ous continuions de nous aimer dans l’obscurité de cette chambre d’hôtel, quand j’entendissoudain un minuscule déclic derrière moi, et, dans le même temps, la pénombre de la chambrefut envahie par une clarté bleutée d’aquarium, silencieuse et inquiétante. Sans la moindre inter-vention extérieure, et dans un silence d’autant plus surprenant que rien ne l’avait précédé et rienne le suivit, le téléviseur s’était allumé de lui-même […]. Aucun programme n’avait été initialisé,aucune musique ni aucun son ne sortait du récepteur, seulement une image fixe et neigeuse quiaffichait sur l’écran un message sur fond bleu dans un imperceptible grésillement électroniquecontinu. You have a fax. Please contact the central desk. (FA 34-35)
Cette scène8 sera à l’origine de l’errance du narrateur durant l’ensemble duroman et peut être considérée comme la matrice du triptyque. Par l’entremisedu fax, la relation sexuelle qui prenait des allures de pugilat devient tout àcoup impossible car le monde extérieur et ses exigences se rappellent ausouvenir du narrateur. Le champ visuel de celui-ci est subitement happé, con-traint à s’arracher à son intimité, si l’on suit la définition que donne GérardWajcman de ce terme : « une fenêtre ouverte au sujet et fermée à l’Autre »9.« Mais, malgré l’intensité brûlante de mon désir, je fus anéanti par cet incident,et, fixant avec hébétude ce message silencieux sur l’écran, je fus incapable de
VOL. 50, NO. 3 85
CHRISTOPHE MEURÉE
poursuivre un instant de plus notre étreinte. » (FA 35) Le narrateur du trip-tyque asiatique de Toussaint revivra la même scène à trois reprises : outre lefax, un téléphone portable l’interrompt alors qu’il se prépare à aimer Li Qidans un train entre Pékin et Shanghai (Fuir) et un autre coup de téléphonevient mettre un terme à sa nuit d’amour avec une autre Marie à Paris (LaVérité sur Marie). Dans Fuir, le narrateur développe en ce sens une théoriesur sa propre peur du téléphone. « J’avais toujours plus ou moins su incon-sciemment que cette peur du téléphone était liée à la mort—peut-être au sexeet à la mort—mais, jamais avant cette nuit, je n’allais avoir l’aussi implacableconfirmation qu’il y a bien une alchimie secrète qui unit le téléphone et lamort. » (Fuir 44) Et en effet, l’auteur du coup de fil n’est autre que Marie quilui apprend la mort de son père10. Mais dans Faire l’amour, la mort quisurvient est davantage menace de mort à l’endroit du désir.
L’intrusion de l’Autre dans l’intimité pèse au même titre qu’un événementannonciateur de mort, autrement dit d’un rappel du temps qui passe11. Letemps, par le biais de cet avertissement télévisuel, sature les champs du visi-ble et de l’audible. Le claquoir de la chronologie (toute décalée fût-elle, entreParis et Tokyo12) coupe net le désir. D’emblée Marie se sent trahie et estimeque le narrateur s’est interrompu pour « lui voler la jouissance » (FA 36).Plutôt que d’éprouver une quelconque responsabilité dans ce vol, le narrateurse sent plutôt joué13 et s’écarte de la scène pour se rendre dans la salle de bain.
Je n’avais pas allumé la lumière en entrant dans la pièce, et deux sources de clarté contradictoiresvenaient se disputer la relative obscurité des lieux, la lueur bleutée de l’écran du téléviseur […]et la fine raie dorée de la veilleuse au sol de la penderie qui s’était allumée automatiquement surmon passage dans le couloir. Je devinais à peine les traits et les contours de mon visage dans legrand miroir mural placé au-dessus du lavabo. (FA 36-37)
Certes, les narrateurs toussanctiens sont abonnés à leur absence de reflet.Toutefois, en ce cas précis, c’est le jeu de lumières spontanées et comme ani-mées d’une volonté propre qui lui soustrait sa propre figure. Le panoptismede Bentham est aujourd’hui devenu une réalité, ce qui conduit le sujet à vivreen spectacle permanent. « Le monde est omnivoyeur, mais il n’est pasexhibitionniste—il ne provoque pas notre regard. Quand il commence à leprovoquer, alors commence aussi le sentiment d’étrangeté »14. Chez Toussaint,à l’évidence, l’étrangéisation de l’« omnivoyeurisme » exhibitionniste romptla possibilité de la reconnaissance de soi et de la reconnaissance de son désir.En spectacle, il est rigoureusement impossible de préserver la moindreintimité. Dans un monde panoptique, le sujet devient transparent, une trans-parence qui au regard de l’Autre n’est que tache aveugle. De plus, l’on
86 FALL 2010
L’ESPRIT CRÉATEUR
pourrait dire que le panoptisme se double d’un « panchronisme ». Le rythmeimprimé au spectacle est en effet, de surcroît, peu adapté à la vie du sujetdésirant en ceci qu’il vise uniquement à la coordination à l’échelle planétairede la vie des individus.
Chez Lacan, le regard doit toujours être suppléé par un temps, si infimesoit-il, qui est le temps logique. Or, dans le monde de la réaction instantanée,ce temps est supprimé.
Le temps pour comprendre peut se réduire à l’instant du regard, mais ce regard dans son instantpeut inclure tout le temps qu’il faut pour comprendre. Ainsi, l’objectivité de ce temps vacille avecsa limite. Seul subsiste son sens avec la forme qu’il engendre de sujets indéfinis sauf par leurréciprocité, et dont l’action est suspendue par une causalité mutuelle à un temps qui se dérobesous le retour même de l’intuition qu’il a objectivée15.
L’avertissement de la réception du fax comme la veilleuse qui s’illumine neconstituent plus un point lumineux, une source de regard, un œil, une ocelle,parce qu’ils investissent tout l’espace disponible et, comme la scène dans lasalle de bain l’indique, le narrateur n’est plus l’objet des regards que le mondetechnologique pose sur lui, mais le scotome de ces regards : il n’est pas vu, ilne se voit pas. Le « regard par moi imaginé au champ de l’Autre » dont parleLacan16 n’autorise plus la schize, puisqu’il est un regard sans œil. Le narra-teur revient dans la chambre mais Marie le repousse une fois de plus.
Et il n’y eut soudain que des 3 sous mes yeux, trois 3 qui apparurent dans mon champ de vision,3.33 a.m. que je vis brusquement clignoter devant moi sur le cadran du radioréveil, trois 3 enchiffres rouges de cristaux liquides finement pointillés qui me fixaient dans la pénombre de latable de nuit. Mais où étais-je ? (FA 40)
Force est de constater que la marque du temps s’octroie également les qualitésd’un regard, de par l’emploi métaphorique du verbe « fixer ». Qu’il s’agissede la scène du fax, de la veilleuse qui s’allume ou d’autres choses, ce n’estplus un regard qui donne corps au sujet, lui rend consistance, c’est unedemande d’être vu qui la lui ôte. Car la diversion que procure le monde tech-nologique est chronophage, c’est un constant et lancinant appel à être regardéen lequel déconsiste le sujet en tant que personne. Pis, c’est un rappel àl’ordre des priorités : l’objet, la mission réifiante subsumant toute contingencepersonnelle ou désirante.
La scène érotique de la chambre d’hôtel avait été perturbée par le manqued’amour qui régnait entre les deux personnages et en effet, c’est au condi-tionnel que le narrateur expose ce qui aurait pu avoir lieu pour qu’une com-munion extatique les eût parcourus dans leur étreinte.
VOL. 50, NO. 3 87
CHRISTOPHE MEURÉE
J’aurais pu me jeter sur elle pour embrasser ses joues, son visage et ses tempes, arracher seslunettes de tissu et la regarder dans les yeux, ne fût-ce qu’un instant, échanger un regard et secomprendre, communier avec elle dans cette détresse que l’exacerbation de nos sens aiguisait[…] et nous nous serions sans doute perdus, en sueur, inconscients de nous-mêmes […]. (FA 31,je souligne)
La nécessité de l’inconscience témoigne d’un intime qui se doit d’échapperà la conscience. Toutefois, les yeux étaient indispensables au désir17. Car dansl’œil réside le moment de comprendre, de conclure, de consister. L’instantanéitédu regard ne pallie pas la durée de l’œil, miroir où peut se dérouler la relationde reconnaissance réciproque que Lacan juge essentielle à la détermination duje18. C’est donc un regard sans œil qui fixe la place du narrateur et le défigure.De même que Marie, affublée d’un masque de nuit de la Japan Airlines, lesomme et le juge sans lui offrir un regard. Le narrateur, ne pouvant comptersur aucun appui de regard—pas même le sien—perd la possibilité de recon-naître son propre désir, sa dépendance à l’objet de son désir. L’immédiatetéempêche littéralement l’écart temporel nécessaire au processus de subjectiva-tion, entre la naissance du sujet au passé et le moment présent de la certitude(le fameux « Wo es war, soll Ich werden »).
Le « je », sujet de l’assertion conclusive, s’isole par un battement de temps logique d’avec l’autre,c’est-à-dire d’avec la relation de réciprocité. Ce mouvement de genèse logique du « je » par unedécantation de son temps logique propre est assez parallèle à sa naissance psychologique. Demême que, pour le rappeler en effet, le « je » psychologique se dégage d’un transitivisme spécu-laire indéterminé, par l’appoint d’une tendance éveillée comme jalousie, le « je » dont il s’agit icise définit par la subjectivation d’une concurrence avec l’autre dans la fonction du temps logique.(Lacan, Écrits I 206)
Car le je, pour consister, ne peut se réduire à une surface autorisant le rebondde la réciprocité ; c’est en ce sens que Lacan a bâti sa théorie du temps logique,soulignant que l’interdépendance des sujets ne constitue qu’un moment duprocès de subjectivation, au même titre que le retour sur soi de la conclusion.Deux temps, deux regards : le je regardé doit aussi remonter à la source (àrebours, après coup) de ce qui le regarde pour exister en tant que sujet.
Depuis Freud, l’on sait que la dynamique temporelle vécue par tout sujetse défend de la linéarité chronologique (les concepts d’après-coup, d’incon-scient zeitlos, la structure de la mémoire, etc. en témoignent). À partir dudébat avec Romain Rolland que Freud relate dans Malaise dans la culture, lepère de la psychanalyse parvient à glisser d’une intuition sur le plan de la per-ception de la temporalité, le sentiment océanique (« Sentiment […] d’un lien
88 FALL 2010
L’ESPRIT CRÉATEUR
indissoluble, d’une appartenance à la totalité du monde extérieur »19) qui est,selon l’écrivain français, le sentiment de l’éternité, à un tableau de symptômesvalables pour la société occidentale de son époque. Freud rappelle, à cetégard, que les limites du moi n’offrent jamais aucune stabilité tout au long del’existence. Il associe donc le sentiment océanique à ce mode d’accomplisse-ment du principe de plaisir selon lequel « on néglige de différencier le moid’avec les objets et ceux-ci les uns d’avec les autres » (Freud, Malaise 44)20.Pour que le sentiment océanique apparaisse, il est primordial qu’il puisses’inscrire dans le symbolique. « La sensation d’éternité se nourrit de la pléni-tude des expériences du temps. Plus le vécu se temporalise, plus le sujet aspireà la durabilité. L’intensité de la conscience du temps réactive le souvenirdiffus d’un temps suspendu, d’un temps qui ignorait le temps »21.
Le narrateur de Faire l’amour, sorti de la chambre comme repoussé—révulsé ?—par le temps, gagne enfin la piscine nichée au sommet de la tourhôtelière. Ses déambulations ont lieu dans le noir, hors de toute atteinte dupanoptisme lumineux et du panchronisme. La métaphore aquatique que rendla piscine, comparée à toute une série de milieux liquides à la limite de lasolidification (« apparence de plomb fondu, de mercure ou de lave »), con-tribue à l’effet d’alentissement du temps dont le narrateur fait l’expérience(FA 45). Le rapport de hauteur qui sépare l’eau de la piscine de l’eau de la merpermet de dessiner une cartographie de l’immensité dans laquelle le narrateurse sent à l’image d’un point infinitésimal perdu (ou, plus justement, retrouvé)dans l’univers, tant géographique que temporel. C’est cette conscience de lafragilité et de la petitesse de l’existence au sein de l’infini de l’univers quiconfère au narrateur la sensation d’être à la fois au cœur du temps et auxprises avec son envers. L’errance géographique prend des proportionsgigantesques, géographiquement aussi bien que temporellement.
Vue de haut pendant la nuit, la terre semble parfois retrouver quelque chose de sa nature d’ori-gine, davantage en accord avec l’état sauvage de l’univers primitif, proche des planètes inhabitées,des comètes et des astres perdus dans l’infini des espaces cosmiques, et c’était cette image queTokyo donnait d’elle-même à présent derrière la baie vitrée de la piscine, celle d’une villeendormie au cœur de l’univers […]. Je regardais l’immense étendue de la ville derrière la baievitrée, et j’avais le sentiment que c’était la terre elle-même que j’avais sous les yeux, dans sacourbe convexe et sa nudité intemporelle, […], et j’eus alors fugitivement la conscience de maprésence à la surface de la terre, impression fugace et intuitive qui, dans le douceâtre vertigemétaphysique où je vacillais, me fit me représenter concrètement que je me trouvais à l’instantquelque part dans l’univers. (FA 46-47, je souligne)
Comme le dit André Green, « le temps où ça se passe n’est pas le temps où çasignifie »22, car tout présent contient une part de non vécu. Le sujet, lorsqu’il
VOL. 50, NO. 3 89
CHRISTOPHE MEURÉE
est à la merci de l’événement, tend à se réapproprier symboliquement celui-ci(comme dans le célèbre jeu de la bobine23) : l’événement ne peut jamais êtreinséré dans la trame de l’existence du sujet que par son énonciation, sa « re-présentation ». Le temps de la représentation du temps est l’écart à soi-mêmede la désubjectivation, nécessaire et constitutive de toute subjectivation ;l’acte d’énonciation, comme l’ont remarqué de nombreux linguistes etphilosophes (Benveniste, Guillaume, Ortigues, Derrida, Agamben24), supposeune mise à distance de soi à soi, puisque le sujet se projette dans un « moi, iciet maintenant » purement symbolique ; la temporalité s’engendre donc dansl’acte d’énonciation, quoique, paradoxalement, dans un temps qui rompt lecours linéaire du temps. L’immédiat, par contre, mine le procès de la symbo-lisation et empêche le caractère traumatique de l’événement d’être intégrédans l’existence et le devenir du sujet (alors, en ce cas, l’événement trauma-tique fait incessamment retour, parce qu’il n’a jamais pu faire sens). Il s’avèrepar conséquent impossible de supporter l’adhérence à soi-même que l’immé-diateté propre au monde d’aujourd’hui suppose.
Dans Faire l’amour, l’errance, prise dans un écart de soi à soi, va pro-gressivement autoriser le narrateur à faire corps avec l’écoulement même dutemps (qui n’offre plus de rapport avec le temps chronologique), c’est-à-dire,pour l’exprimer par les mots mêmes du narrateur, « au rythme quasimentimmobile du temps qui passe quand on en prend la mesure » (FA 83). Ce corpsà corps lui permet non seulement de se trouver présent à lui-même, mais ausside prévoir ce qui reste à venir (et que le roman confirmera par la suite). L’étatque traverse le narrateur du roman s’étire entre une abolition totale de ce quiconstitue le cadre de son existence et un renouveau qui prend sa source dansune communion avec l’écoulement du temps. Le narrateur recouvre une posi-tion subjective qui l’arrache à la réification que la marque du temps universel,relayé par les machineries de toutes sortes, lui faisait subir. Le sujet doit fairecorps avec le temps en tant que passage, mais non selon une cadence qui nelui est pas propre. « L’analyse ne peut avoir pour but que l’avènement d’uneparole vraie et la réalisation par le sujet de son histoire dans sa relation à unfutur », affirme Lacan25. La consistance du sujet repose sur l’opacité qui le faitentrer dans le champ de l’Autre autrement que comme un point aveugle.
Je pressentis alors que la terre allait à nouveau se mettre à trembler, comme lorsque nous étionsrentrés à l’hôtel quelques heures plus tôt […]. Et, jouissant de ce point de vue imprenable sur laville, je me mis alors à l’appeler de mes vœux, ce grand tremblement de terre tant redouté, souhai-tant qu’il survînt à l’instant devant moi […] et fît tout disparaître sous mes yeux, réduisant làTokyo en cendres, en ruines et en désolation, abolissant la ville et ma fatigue, le temps et mesamours mortes. (FA 48-49, je souligne)
90 FALL 2010
L’ESPRIT CRÉATEUR
La raison regimbe à ce genre de préfigurations anticipatives de l’avenir.Toutefois, ce qui a lieu ici est une mise en perspective qui déroute le tempslinéaire et relance le désir. Le désir d’éternité paraît au premier abord releverde la répétition mortifère qui interfère avec la perspective du devenir. La com-pulsion de répétition est certes mortifère en son principe de réitération de lajouissance, mais elle produit, à chacune de ses apparitions, un reste hors dutemps linéaire qui insiste et nourrit le désir.
L’inconscient—que Freud a qualifié de zeitlos, suivi en ces termes parLacan—reflète la permanence du désir dont l’objet est rivé dans un tempshors du temps. Le temps ne peut gagner en densité (cette densité qui n’existetout simplement pas dans l’inconscient freudo-lacanien) qu’à mesure del’appropriation ou de la réappropriation du symbolique.
Notre représentation du temps assigne aux événements des existences qui s’ordonnent dans latemporalité, tandis que les processus inconscients laissent les événements psychiques dansl’insistance de ce qui ne cesse pas […]. En ce temps qui ne passe pas s’accomplissent en effetdes événements qui ne cessent pas. L’expression […] paraît ici la mieux adaptée pour désignerdes événements qui ne finissent pas, qui n’ont pas de terme et qui ne deviennent pas passés, maisqui ne demeurent pas immobiles et identiques pour autant. Ces événements continuent […] de setransformer dans la logique des processus inconscients, alors même qu’ils n’obéissent pas auxlois d’un temps qui passe ou qu’ils échappent à l’épreuve de réalité26.
Tout en tension vers l’autre, l’individu se réfugie et s’exaspère dans le même,exaspération qui insiste dans le présent du vécu, dans la densité du temps,injectant du synchronique dans le diachronique.
C’est dans l’écart creusé entre le Même et l’Autre que surgit la dimension propre du tempshumain dans le mouvement du désir, comme fondement de l’identité par l’altérité. La matrice dutemps identifiant s’entend ainsi comme tension de l’altérité dans l’identité, dans l’ouverture d’unécart irréductible qui empêche toute coïncidence du sujet avec lui-même et qui le précipite enavant, à faire le pas du pas encore. (Le Poulichet 32)
Si l’orientation temporelle subjective est d’emblée multiple, il faut compren-dre le parcours subjectif comme une masse de temporalités virtuelles enattente d’actualisation. Dans la temporalité contemporaine où le passé estinsoutenable, le futur déjà programmé (de l’horaire trépidant à la fin dumonde) et le présent saturé d’un rythme à la limite de l’inhumanité, le sujetest conduit à se réapproprier l’essence virtuelle de l’existence. Le désir peutet doit renaître dans ces moments de résistance. La vision cataclysmique etprophétique apporte au narrateur un profond apaisement (FA 50), parce que lasensation dont il fait l’expérience lui ouvre « des perspectives illimitées » (FA
VOL. 50, NO. 3 91
CHRISTOPHE MEURÉE
50-51). Plutôt que de craindre un avenir sombre (ce que la vision d’un grandtremblement de terre provoquerait raisonnablement chez tout individu), lenarrateur se découvre en face d’un devenir qui lui apparaît comme parfaite-ment harmonieux.
Suspendant le temps et pressentant l’avenir, le narrateur vise à rétablir lefutur antérieur essentiel à la subjectivation. « Car tout ce dont le sujet peuts’assurer, dans cette rétrovisée, c’est venant à sa rencontre l’image, elleanticipée, qu’il prit de lui-même en son miroir »27. L’harmonie repose sur unepulsion rythmique dont le narrateur découvre inopinément la possibilité. Lekairos, le moment opportun est saisi grâce à une opération de désubjectivationqui correspond au caractère « atopique » que Lieven Jonckheere associe àl’intime28.
J’avais fini par me déprendre de moi, mes pensées procédaient de l’eau qui m’entourait, elles enétaient l’émanation, elles en avaient l’évidence et la fluidité, elles s’écoulaient au gré du tempsqui passe et coulaient sans objet dans l’ivresse de leur simple écoulement, […] et je pensais, maisc’était déjà trop dire, non, je ne pensais pas, je faisais maintenant corps avec l’infini de mes pen-sées, j’étais moi-même le mouvement de la pensée j’étais le cours du temps. (FA 51-52, jesouligne).
En réalité, Marie contemple au moment même où lui s’y tenait les derniersétages de l’hôtel et il lui a semblé le reconnaître ; la communion qui n’a paseu lieu dans la chambre se déploie donc avec retard, après-coup, à l’insu dunarrateur qui est à cet instant en pleine déprise subjective et entré dans uneronde cénesthésique. Marie rouvre les yeux, en quelque sorte, au moment oùle narrateur devient un sujet, une personne. Le narrateur, parce qu’il est libérédu souci de son devenir, peut se laisser emporter par le devenir qui s’offre àlui. D’un avenir bouché, dépourvu d’espoir, tel qu’il nous est présentéd’emblée à l’incipit du roman, la trame romanesque se retrouve commerelancée par ce moment de libération que vit le narrateur. Certes, son histoireavec Marie est sur le point de s’achever, mais elle n’en finit pas, en mêmetemps, de se reprendre ; sont ainsi dépassées toutes les bornes logiques etrationnelles qui conditionnent l’existence en société. L’ignorance devientalors connaissance ; l’impossible, possible.
Car le tremblement de terre prophétisé aura bien lieu, quelques pages plusloin, au terme de la traversée nocturne et vagabonde accomplie par Marieet le narrateur qui se sont retrouvés à la réception de l’hôtel où chacun,séparément, était venu chercher le fameux fax. L’importance de cette secousseest incontestable : elle confirme la « menace » qui plane et qui demeureinnommée (FA 38), permet la reprise de la relation sexuelle là où elle avait été
92 FALL 2010
L’ESPRIT CRÉATEUR
abandonnée et scelle dans le même temps la rupture des amants. Toutefois,contrairement à la première prédiction, elle n’a pas l’ampleur attendue. Enréalité, il s’agit plutôt de l’ampleur métaphorique qui est confirmée, puisqu’àla première s’est superposée, durant la nuit d’errance du couple, une secondeprédiction : « cette neige me paraissait être une image du cours du temps […]et, dans l’impuissance immense que je ressentais à ne pouvoir empêcher letemps de passer, je pressentis alors qu’avec la fin de la nuit se termineraitnotre amour » (FA 70-71). Le tremblement de terre demeurera associé à larupture, tant pour Marie que pour le narrateur qui, à chacune des ses évoca-tions, perdront leurs moyens. La conscience de la rupture ne viendra pourtantau narrateur que lorsqu’il verra Marie apparaître puis disparaître sur les moni-teurs vidéo des caméras de surveillance du musée où elle se prépare à exposerses collections. S’opère alors un retour sur l’univers panoptique : l’écran quiviole l’intimité de l’autre renvoie le narrateur au viol de sa propre intimité aumoment de l’arrivée du fax, quelques heures plus tôt. Il devient subitementlui-même ce regard dépourvu d’yeux.
C’est le temps de la simultanéité des signifiants (« la synchronie signi-fiante », Lacan, Séminaire XI 55), qui s’oppose (en apparence) à la diachroniede la métaphore. Chez Toussaint, le monde technologique est celui de la syn-chronie signifiante qui paralyse le désir et le maintient dans la seule jouis-sance. La synchronie n’est pas perçue autrement que comme mortifère (demême que la jouissance), comme en témoignent les exemples des fax, influxlumineux ou autres coups de téléphone. Dans l’univers technologique, tousles ici et maintenant se valent et se confondent. Le sujet se trouve donc abolipar la brutalité de l’incursion dans son intimité et se voit objectalisé. Le sujetnarrateur éprouve le besoin de se dégager de l’impasse de la synchronie pourretrouver une diachronie qui lui permette de reprendre corps.
La brusquerie dans laquelle la relation de Marie et du narrateur ainévitablement évolué est symptomatique de l’impossibilité de donner letemps au désir de se déployer ; la brusquerie est marque de la jouissanceimmédiate, sans désir, sans identité, aussi anonyme que le narrateur dont lestraits sont brouillés dans le miroir (la fatigue, les effets de l’âge, les jeux delumière) ou que Marie revêtue de son masque oculaire. L’anonymat est eneffet le gouffre dans lequel sombre le désir : il n’y a plus de place pour lamétaphore ni pour le temps personnel (la personne se distinguant de l’individupar le processus de la reconnaissance).
La résistance a donc lieu dans le double mouvement de la réappropriationdu temps personnel et de la métaphore. À l’expérience de la fuite du temps
VOL. 50, NO. 3 93
CHRISTOPHE MEURÉE
panoptique s’adjoint le transport illégal d’acide chlorhydrique, qu’il est indis-pensable de soustraire au regard. Et comment s’y prend le narrateur ? Il procèdecomme dans La Lettre volée de Poe, en baladant l’acide au vu et su de tous, dansun flacon d’eau oxygénée. Le flacon, c’est le grain de sable qui grippe lesrouages de la machine trop bien huilée de la simultanéité du panoptisme et dupanchronisme. L’incipit de Faire l’amour est pour le moins explicite :
J’avais fait remplir un flacon d’acide chlorhydrique, et je le gardais sur moi en permanence, avecl’idée de le jeter un jour à la gueule de quelqu’un. Il me suffirait d’ouvrir le flacon […], de viserles yeux et de m’enfuir. Je me sentais curieusement apaisé depuis que je m’étais procuré ce flaconde liquide ambré et corrosif, qui pimentait mes heures et acérait mes pensées. Mais Marie sedemandait, avec […] inquiétude […], si ce n’était pas dans mes yeux à moi, dans mon propreregard, que cet acide finirait. Ou dans sa gueule à elle, dans son visage en pleurs depuis tant desemaines. […] Non, je ne crois pas, Marie, et, de la main, sans la quitter des yeux, je caressaisdoucement le galbe du flacon dans la poche de ma veste. (FA 11-12, je souligne)
Le narrateur songera plusieurs fois par la suite à son précieux flacon, àchaque fois que la pression du regard s’accentue. Devant le comptoir de laréception, les questions pressent le narrateur : « Se pouvait-il que personne nenous eût envoyé de fax cette nuit ? Mais alors, pourquoi avais-je quitté pré-cipitamment la chambre en pleine nuit ? Et l’acide, me disais-je, où se trou-vait le flacon d’acide chlorhydrique à présent ? » (FA 55-56). Indissoluble-ment, la déambulation dans l’hôtel jusqu’à la piscine est une conséquence del’arrivée du fax, tout autant que l’acide correspond à l’intervalle logique quiles lie. Le flacon joue comme un surplus, un objet excédentaire passéd’ailleurs en contrebande à la douane japonaise, qui a pour propriété depouvoir non seulement aveugler mais aussi et surtout anéantir le regard. Leflacon se déplace de manière clandestine comme la possibilité de faire cesserle regard qui renvoie sans cesse au temps qui passe et auquel il faut sesoumettre. Ainsi, précisément avant l’extase atemporelle, le narrateur est tour-menté par un débat intérieur dont l’enjeu le dépasse.
Plusieurs images de cauchemar me hantaient, fragments de visions récentes qui surgissaient dansdes éclairs fugitifs de ma conscience, fulgurances hallucinées qui se déchiraient dans deséblouissements de rouge et d’ombres noires : moi nu dans les ténèbres de la salle de bain quijetais de toutes mes forces l’acide chlorhydrique à la gueule du miroir pour ne plus voir monregard, ou moi encore, plus calme et beaucoup plus inquiétant, le flacon […] à la main, regardantle corps dénudé de Marie étendu sur le lit […], son visage bandé par les lunettes de soie, moi quiluttais intérieurement, et qui, dans […] un hurlement, me détournant d’elle, aspergeais la baievitrée de la chambre d’une giclée d’acide qui bouillonnait sur le verre et se mettait à crisser et àfumer autour du cratère dans la mélasse gluante de verre fondu et boursouflé qui dégoulinait surla vitre en longues traînées sirupeuses et noirâtres. (FA 42-43)
94 FALL 2010
L’ESPRIT CRÉATEUR
Irrépressiblement porté vers Marie, le narrateur l’appelle depuis Kyoto29 ;ce simple coup de fil fait ressurgir en lui tout ce qui le lie à Marie, à com-mencer par « la violence des sentiments » (FA 167) qui aspire son identité, sesrepères spatiaux et temporels, aussi bien qu’il fait ressurgir l’acide chlorhy-drique de la poche de manteau où il reposait. Le narrateur repart alorsimmédiatement pour Tokyo et se rend au Contemporary Art Space de Shina-gawa pour y retrouver Marie. Cependant, ce n’est bien entendu pas Mariequ’il y retrouvera (aucun rendez-vous n’est fixé et il est tard) mais l’illusionfugitive de Marie sur les moniteurs vidéo comme pour reprendre la relation làoù la rupture avait fait sens.
Marie était là. Ce ne fut pas à proprement parler une hallucination, car la scène eut lieu en dehorsde toute représentation visuelle, mais dans un registre purement mental, dans un éclair fugitif dela conscience, comme si j’appréhendais la scène d’un seul coup sans en développer aucune descomposantes potentielles, […] scène qui restait en quelque sorte prisonnière de la gangue d’indé-cidabilité des infinies possibilités de l’art et de la vie, mais qui, de simple éventualité—même sic’était la pire—pouvait devenir la réalité d’un instant à l’autre. Marie, dis-je à voix basse, Marie.[…] J’avais peur. […] Il n’y avait personne. Je voulus refermer le flacon d’acide chlorhydrique,mais je ne trouvais pas le bouchon. (FA 177-78)
Le narrateur cherche ensuite un refuge et décide, subitement, de verser l’acidesur une fleur qu’il ne parvient pas à identifier (mais qui possède certains traitscommuns avec Marie). L’on retrouve ici la forme de l’œil au naturel30,puisque la fleur qui brille dans l’obscurité se situe exactement dans des« sous-bois ocellés de lumière de lune. […] Il ne restait plus rien, qu’uncratère qui fumait dans la faible lumière du clair de lune, et le sentimentd’avoir été à l’origine de ce désastre infinitésimal. » (FA 179) Plutôt que des’attaquer réellement au symbolique (le regard de Marie, le sien propre), lenarrateur s’en prend symboliquement au réel. Or, le geste de verser de l’acidesur la fleur se donne comme une possibilité de rétablir la diachronie par lamétaphore. Comme le dit Lacan à partir de Freud, « rien ne peut être saisi, nidétruit, ni brûlé, sinon de façon, comme on dit, symbolique, in effigie, inabsentia » (Lacan, Séminaire XI 60).
Pour recréer l’espace et le temps intimes indispensables au désir, dans unmonde où la synchronie panoptique et panchronique règne en maître, où lesujet est devenu prévisible et transparent, où le réel est imaginé prévisible, ilest impératif de pénétrer dans le champ du regard de l’Autre autrement quecomme un scotome. Toussaint préconise la réponse de l’incalculable au cal-culable : la métaphore, l’acte gratuit, l’isolement hors du regard et du temps,
VOL. 50, NO. 3 95
CHRISTOPHE MEURÉE
etc. Puisque le tracé des limites entre l’atopie de l’Autre et l’atopie de l’intimeest par définition infaisable, il reste au sujet toussanctien l’option d’exposerl’atopie dans l’impossibilité même de sa localisation et de son appréhension.
Si les personnages toussanctiens ont l’habitude de se rendre imperméableà la réalité et à ses règles (notamment le savoir-vivre, qu’ils jugent ineptes),ils ressentent également un manque fondateur qui régule l’orientation de leursexistences de papier vers un avenir incertain qui pourrait éventuellement lecombler. Mais le manque obscurcit l’avenir dont les attentes se condensentautour de la perte et il appesantit le passage du temps. L’objet du désir, chezToussaint, prend donc tout uniment des allures d’ennemi intime.
Ce qui est insupportable […], dans le manque, c’est la durée, c’est l’horizon vide qu’il laissedevant soi, c’est de savoir qu’il demeurera aussi loin que l’on puisse imaginer. Quoi que l’onfasse, on est désormais confronté en permanence avec un adversaire sur lequel nous n’avonsaucune prise, car le manque, par nature, se dérobe au combat et le diffère à l’infini, nousempêchant à jamais de nous délivrer des tensions que nous accumulons en pure perte pour levaincre31.
De même que le narrateur toussanctien, la littérature d’aujourd’hui con-voie avec elle ce petit flacon d’acide chlorhydrique qui renverse, le tempsd’un maintenant infinitésimal, l’ordre imposé par l’Autre totalitaire, panop-tique et panchronique, lui rendant une dimension humaine. Au sujet deprocéder au choix des armes et de son ennemi intime, à lui de rétablir—par sarésistance—la balance entre l’œil, le regard et le temps.
Université du Québec à Montréal
Notes
1. La métaphore de la littérature comme radiographie de la réalité provient des travaux menésà l’Université catholique de Louvain sous la direction de Ginette Michaux et de Pierre Piret.Je me réfère ainsi aux travaux de Henri Rey-Flaud ou de Ginette Michaux, qui démontrentque le texte littéraire n’est jamais une étude de cas mais un discours « qui fixe le rapport dusujet à l’Autre », Henri Rey-Flaud, L’Éloge du rien : pourquoi l’obsessionnel et le perverséchouent là où l’hystérique réussit (Paris: Seuil, 1996), 102. Voir aussi Ginette Michaux,De Sophocle à Proust, de Nerval à Boulgakov : essai de psychanalyse lacanienne(Toulouse: Érès, 2008), 21-30.
2. Il est l’auteur francophone le plus lu au Japon, par exemple.3. Jean-Philippe Toussaint, Monsieur (Paris: Minuit, 1986), 64.4. La Technique et le temps, 3 vols. (Paris: Galilée, 1994-2001).5. Jean-Philippe Toussaint, La Salle de bain (Paris: Minuit, 1985), 15 et 123.6. Jean-Philippe Toussaint, Faire l’amour (Paris: Minuit, 2002), dorénavant abrégé FA ; Fuir
(Paris: Minuit, 2005) ; La Vérité sur Marie (Paris: Minuit, 2009).7. Marie se protège du temps qui passe autant que son compagnon (FA 161).8. Quelques années avant la même scène dans le film de Sofia Coppola, Lost in Translation.
96 FALL 2010
L’ESPRIT CRÉATEUR
9. Gérard Wajcman, « Intimate Extorted, Intimate Exposed », R. Estes Jr., trad., S : Journal ofthe Jan Van Eyck Circle for Lacanian Ideology Critique, 1 (2008), 66 (ma traduction).
10. L’appel de La Vérité sur Marie aura la même portée puisque sa compagne (dont il est à cemoment de l’histoire séparé) l’appellera à l’aide alors que Jean-Christophe de G. vient des’écrouler chez elle (il n’en réchappera d’ailleurs pas).
11. Il n’est d’ailleurs pas insensé de rapporter le temps chronologique au domaine de l’Autre ;Ricœur associait d’ailleurs, dans son concept de « temps monumental », la figure du tempschronologique à la figure de l’autorité. Paul Ricœur, « Entre le temps mortel et le tempsmonumental : Mrs. Dalloway », Temps et récit II (Paris: Seuil, 1984), 192-212. Les pointsde congruence entre langage et temps chronologique sont d’ailleurs, à l’évidence, très nom-breux. Il serait cependant par trop fastidieux d’en entreprendre l’énumération et la démon-stration ici.
12. L’on apprendra plus tard qu’en réalité, « le fax avait été expédié de Paris à dix-neuf heuresvingt, ce qui était une heure normale pour envoyer un fax (même si cela avait été une heuredésastreuse pour nous qui l’avions reçu) » (FA 67). La nature temporelle du fax est appuyéepar le fait qu’il s’avérera contenir des horaires.
13. Le narrateur soupçonne d’ailleurs Marie de lui avoir demandé de l’accompagner dans sonpériple japonais pour une raison—qu’il qualifie de perverse—de mise en valeur : « elle cou-verte d’honneurs, de rendez-vous et de travail, entourée d’une cour de collaborateurs,d’hôtes et d’assistants, et moi sans statut, dans son ombre, son accompagnateur en somme,son cortège et son escorte » (FA, 25-26). Autrement dit, le voyage japonais était le prétextede renvoyer le narrateur en passe de la quitter à son absence d’identité sociale, de « statut ».
14. Jacques Lacan, Séminaire XI : les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse (Paris:Seuil, 1973), 88.
15. Jacques Lacan, « Le Temps logique et l’assertion de certitude anticipée », Écrits I (Paris:Seuil, 1966), 203-04.
16. Lacan, Séminaire XI, 98.17. Dans le triptyque, les yeux sont supposés les dépositaires du savoir (« leurs yeux le
savent »—FA 14), ce savoir qui suscite le désir.18. Lacan, Écrits I, 211.19. Sigmund Freud, Le Malaise dans la culture (Paris: PUF, 1995), 6.20. Pour le dire vite, Freud désavoue ici l’absence de limites (contraire au principe de réalité).21. Bernard Chouvier, « Freud et l’intemporel », in Bernard Chouvier et René Roussillon, dir.,
La Temporalité psychique : psychanalyse, mémoire et pathologies du temps (Paris: Dunod,2006), 164.
22. André Green, Le Temps éclaté (Paris: Minuit, 2000), 45.23. Le petit-fils de Freud s’adonnait à un jeu consistant à faire disparaître une bobine sous un
meuble pour ensuite l’en faire ressurgir par une traction exercée sur le fil attaché à labobine ; l’enfant accompagnait ses mouvements de sons caractéristiques, que l’on pouvaitaisément interpréter comme les mots allemands fort et da (« parti » et « voilà »). C’est à lasuite de l’observation de ce jeu que Freud a identifié la répétition d’un traumatisme (ici,les absences de la mère de l’enfant, mimées par les allers-retours de la bobine) commeprocessus de réappropriation symbolique des contraintes extérieures immaîtrisables,autrement dit le principe de réalité qui cantonne le principe de plaisir et ajourne la satisfac-tion. Sigmund Freud, « Au-delà du principe de plaisir », Essais de psychanalyse, AndréBourguignon (Paris: Payot et Rivages, 2001), 58-62.
24. Voir Giorgio Agamben, Ce qui reste d’Auschwitz (Paris: Payot, 1999-2003), 132-35.25. Jacques Lacan, « Fonction et champ de la parole et du langage », Écrits I, 300.26. Sylvie Le Poulichet, L’Œuvre du temps en psychanalyse (Paris: Payot, 2006), 48.27. Jacques Lacan, « Subversion du sujet et dialectique du désir » in Écrits II (Paris, Seuil,
1966), 289.28. Lieven Jonckheere, « The Politics of “Atopia of the Intimate” in Contemporary Art : The
View from Lacanian Psychoanalysis (Response to Gérard Wajcman) », S : Journal of theJan Van Eyck Circle for Lacanian Ideology Critique, 1 (2008): 78-99.
29. Une fois à Kyoto chez son ami Bernard, le narrateur, malade mais loin de Marie et dutumulte de la civilisation technologique (dans une atmosphère traditionnelle japonaise,
VOL. 50, NO. 3 97
CHRISTOPHE MEURÉE
d’ailleurs, n’étaient l’occidentalité de Bernard, son téléphone et son fax), coupé du monde,réitère, de manière mineure, l’expérience de la piscine de l’hôtel. Sa maladie devient pourlui savoureuse ou, mieux : « une fatalité, un luxe, une expérience » (FA 151). La fatalitédevient un luxe.
30. La figure de l’ocelle est extrêmement présente dans l’œuvre de Toussaint. Toutefois, elles’oppose très ostensiblement à un panoptisme technologique, puisqu’elle concerne desombres dans La Salle de bain (62) ou un tronc d’arbre dans Autoportrait (à l’étranger)(Paris: Minuit, 2000), 32.
31. Jean-Philippe Toussaint, La Télévision (Paris: Minuit, 1997), 113.
98 FALL 2010
L’ESPRIT CRÉATEUR
D’une « poéthique » contemporaine, ou comment ne pas répondre à l’air du temps
Pauline Vachaud
S’IL EST DIFFICILE DE NIER que notre ère contemporaine tombesous le joug d’une « perversion ordinaire »1, cette dynamique, pourprédominante qu’elle soit, n’est peut-être pas absolue. Dans le champ
de la littérature française notamment, chez des auteurs comme François Bon,Marie Depussé, Maryline Desbiolles, Nicole Malinconi2, Jacques-HenriMichot et Jane Sautière, un geste singulier se fait jour, qui détone eu égard auconsensus actuel. En remotivant à leur manière la proposition barthésienned’une « morale de la forme »3, ces auteurs ne travaillent pas l’écriture commeune entreprise dégagée de toute considération morale, un lieu de pure libertéaccordée aux impératifs postmodernes ; néanmoins, s’il est une éthique del’écriture chez eux, elle ne s’appuie pas non plus sur un système normatifdésormais obsolète, dont on sait les nombreux écueils. Parce que leur travailconstitue un engagement spécifique dans la pratique de la langue—où leslieux du Réel et de l’Autre ne sont pas déniés mais assumés au fondementmême de la création—, il semble qu’une troisième voie puisse se tenir entrel’« asphyxiante culture »4 d’antan et les jouissances obligées d’aujourd’hui.
Une littérature « déconcertante »À suivre les récentes analyses de William Marx5, il faudrait admettre que,
depuis que la littérature française est entrée dans un processus d’autonomisa-tion, elle aurait non seulement signé ses adieux au réel, mais aussi à elle-même. D’autant plus depuis le « dogme » de la « négativité »6 déployé parexemple chez Mallarmé, Blanchot et Derrida, le champ littéraire françaisserait donc déterminé par « le détachement par rapport au réel » (Marx, Entre-tien 49) et par l’épuisement de la littérature en elle-même—la solution del’engagement n’ayant eu « qu’un temps et […] n’a[yant] pas réussi à modifierde façon notable le grand récit de l’histoire littéraire [française] où l’autono-mie constitue toujours le modèle dominant » (Marx, Entretien 48). Contraire-ment à la littérature anglophone qui « a toujours gardé un pied dans le réel »,avec une figure du « poète » qui « a gardé un rôle social et politique », lalittérature, en France, serait « retranchée de tout contact avec le monde »(Marx, Entretien 53). Dès lors, à l’image de ce qui serait le lot de l’« hommesans gravité »7 d’aujourd’hui, la littérature française, par la liberté qu’elles’est donnée, aurait en retour à subir une crise profonde.
© L’Esprit Créateur, Vol. 50, No. 3 (2010), pp. 99–115
Dans un tel contexte, il semble pourtant qu’un certain nombre de textescherchent à refonder la place de la littérature : dans C’était toute une vie etPrison de François Bon8, Dieu gît dans les détails et Là où le soleil se tait deMarie Depussé9, C’est pourtant pas la guerre de Maryline Desbiolles10,Hôpital silence et Vous vous appelez Michelle Martin de Nicole Malinconi11,Un ABC de la barbarie de Jacques-Henri Michot12, et Fragmentation d’unlieu commun de Jane Sautière13, un rapport au monde et au sujet serait renoué,mais depuis l’héritage critique de la modernité14.
Généralement, ces titres ne sont guère connus, aussi est-il nécessaire de lesprésenter brièvement. Ainsi, Prison est fondé sur la reprise de textes produitspar des détenus lors d’ateliers menés par l’auteur à la prison de Draguignan,quand C’était toute une vie, dans la même veine, est écrit à partir de textesproduits par un public socialement marginalisé (chômeurs, errants, toxico-manes…). Dès les premières pages de C’était toute une vie, on peut relever unexemple particulièrement radical de cette écriture depuis la voix de l’autre :
On avait ce tutoiement.Elle avait explicitement écrit : « jai des choses tres importante a te communiquer et je voudraisque tu larrange afin que ce soit lisable. »On peut marcher jusqu’au fond de l’abîme, et les difficultés au bout du compte l’emporter survous-même. Alors une vie n’est pas seulement la somme de témoignages contradictoires, mais untrès grand silence, sur ce qui apparaît comme une solitude complexe : à chacun de nous elleprésentait un visage, et la somme de ces visages ne suffit pas à la reconstruire.Elle avait écrit : « si j’en parle et si je reagie. c’est que jai vue de mes yeux la soufrance des pauvresqui n’avait que cette alternative pour ne plus penser ni au au chomage ni cest Stage a la con qui fontBaiser le taux de chomeur. allez demander au jeune lodevois leur revenue paye au RMI. pour ne passouffrir. » On est dans une petite ville ordinaire, n’importe laquelle et le bilan du gâchis de tout unâge est terrible. C’est cela qu’il faut voir, comme voient les peintres. Partir à la rencontre de ce visageest une tâche qu’on a pu percevoir comme ne laissant pas répit de s’y soustraire. […] C’était sur trois feuilles lignées déchirées d’un cahier format écolier, au stylo-bille bleu, dans uneenveloppe à mon nom, glissée sous la porte de la bibliothèque un soir après la fermeture. Elleavait aussi écrit, explicitement : « tu sais ecrire tu me comprend fait un Article. pour lodeve pourmoi. pour le Mal que jai. »On est devant la tombe, on a les trois feuilles dans son sac, et on se dit qu’on ne saura pas. Quece qu’il y a de savoir dans écrire ne tient pas à la maîtrise des mots et comme on les arrange, maisà une autre expérience, du corps et des yeux, du souffle, où c’est elle-même qui est devant. Qu’onne saura pas, parce qu’on n’est pas allé où, elle, elle est allée. On se dit qu’on n’osera pas, parcequ’il y a ceux qui restent, et que même sa voix à elle, et ses mots, ceux qu’elle nous a laissés,donnés en propre sur les feuilles de cahier, les mots qu’on ne détourne pas mais dont on veuthonorer le dépôt, raviveraient trop la perte absolue. (C’était toute une vie 8-10)
De la même manière, C’est pourtant pas la guerre est nettement ancré dansune expérience réelle et a été déterminé par un projet spécifique : pour Mary-
100 FALL 2010
L’ESPRIT CRÉATEUR
line Desbiolles, il s’agissait de rencontrer dix habitants d’un quartier « diffi-cile » de la banlieue de Nice (« l’Ariane »), et de proposer une écriture àpartir de ces voix « confiées »15. Cette écriture avec l’autre, le titre même del’ouvrage en est redevable, puisque la formule est empruntée à Mme Andrée,la voix sur laquelle s’ouvre le texte :
C’est pourtant pas la guerre. Elle prononcera plusieurs fois cette phrase, sur le même ton, elle quia connu la guerre, celle de 40 : elle était une petite fille en 1940, difficile de croire qu’elle aitjamais été une fille : elle a une voix de vieux soudard, et encore moins une petite fille, son visageest à présent couvert de rides, une peau épaisse de tortue, plissée à mort, vous savez mon âge ?me demande-t-elle en me regardant, et droit dans les yeux est une formule assez bâclée pour direqu’elle enfonce son regard dans le mien, ses yeux bleus, presque féroces qui voudraient peut-êtreme faire peur, j’essaie de minimiser pour lui être agréable, de ne pas dire ce qui me vient à l’esprit,200 ans ? 160 ? j’avais 11 ans en 1940, faites le compte. C’est pourtant pas la guerre, dira-t-elleà chaque fois qu’on entendra claquer des pétards ou brailler un peu fort. (C’est pourtant 9)
Avec Dieu gît dans les détails et Là où le soleil se tait, on retrouve làencore une écriture essentiellement fondée sur le recueil de voix : les voix des« fous » de l’asile La Borde dans Dieu gît dans les détails et, pour Là où lesoleil se tait, les voix d’un certain nombre de marginaux ayant croisé lechemin de l’auteur16—les détenus de Fresnes et de la Santé, la « folle »Laurence, les deux « clodos de vocation » (Là où le soleil 161) Henry etBilly… Un chapitre de Dieu gît dans les détails (« Fatigue »), met clairementen scène cette prégnance des mots de l’autre :
Un jour j’accompagnai Etienne au cimetière de Cour-Cheverny où il voulait déposer un bouquetd’œillets, sur la tombe de son copain Jésus. Mais il avait économisé sur les fleurs, pour s’offrirun lait-fraise, et il errait, perdu entre les tombes. Comment donc s’appelait Jésus ? Comme on netrouvait pas, il a déposé les œillets sur la tombe de Jacques en me disant : « Au fond, c’est pareil,c’était quelqu’un, aussi. » Jacques dont le corps était creusé par l’âme, avec des yeux brûlants. Ildisait, « cela au moins je l’ai noté. »« Tout à l’heure en sortant du château, j’me suis trouvé dégonflé sur mes jambes. Pas gonflé, mêmesur mes jambes. J’avais reçu la mort avant, dans ma chambre. Vous voyez ce que ça fait, la mort,sur vous ? Quand vous recevez des ondes dans les yeux et puis qu’ça vous égare complètement.Il faut avoir la force de résister à ça.Les yeux, ça les détourne de la tête, l’esprit et tout, et puis ça dégonfles les jambes après.C’est la fatigue qui fait ça. On sait que ça nous appartenait, la mort. Vous vous êtes ressentisquelquefois à plat sur vos jambes ? »Jacques m’a fait ce cadeau ; un jour sur deux, en silence, je l’utilise. Quand les amis, amicaux,insistent. « Tu es un peu déprimée, non, en ce moment ? » « Non, pas vraiment, ce n’est pas lemot. » Je ne leur dis pas : « Non, moi, ce sont les jambes qui se dégonflent».« Vous vous êtes ressentis quelquefois à plat, sur vos jambes, et sur vos genoux ? ça vous l’a faitquelquefois ? Jamais ? » (Dieu gît 117-18)
VOL. 50, NO. 3 101
PAULINE VACHAUD
À l’instar du reste du corpus, Hôpital silence et Vous vous appelezMichelle Martin ancrent aussi l’écriture dans l’écho de voix autres. DansHôpital silence, il s’est agi de « rassembler les mots perdus de l’hôpital »(Hôpital silence 62) gynécologique où l’auteur fut longtemps assistantesociale. On y retrouve alors la voix des soignants :
« Pour venir si tard, c’est qu’elles s’en foutent ».« Elles mentent et vous croyez ce qu’elles racontent ».« Il faudrait toutes les stériliser ».« Elles n’ont pas besoin d’ouvrir les jambes si souvent ».Elle dit qu’elle a peur. L’infirmière répond : « Ça, ma fille, vous n’aviez qu’à y penser plus tôt ».(Hôpital silence 87-88)
Et celle des patientes :
« On va le décrocher, par le nombril ? »« On ouvre le ventre et on le prend ? »« On met une ventouse ? »« Je croyais qu’on allait m’endormir ».« L’eau salée, c’est ça qui tue le bébé ? »« Est-ce qu’on coupe le cordon ? »« Est-ce qu’il vit, quand il sort ? » (Hôpital silence 88)
Quant à Vous vous appelez Michelle Martin, ce récit de la rencontre et deséchanges entre Nicole Malinconi et Michelle Martin (la compagne de MarcDutroux17, incarcérée à la prison de Namur), une formule résume bien un deses ressorts essentiels : « Des mots de vous qui me feraient écrire » (Vous vousappelez 21).
Concernant Fragmentation d’un lieu commun selon une dynamique trèsproche de ce que propose Hôpital silence, il est évoqué des scènes marquantesde la prison où l’auteur a longtemps exercé comme éducatrice spécialisée, etmet en œuvre un travail de « greffe » des mots recueillis : « Peut-être suis-jevotre greffe, là où s’inscrit la procédure ; là aussi où l’on sauve de la peau ?Le scripteur et le transfert de peau. Les deux » (Fragmentation 9).
Enfin, Un ABC de la barbarie, s’il ne s’écrit pas à partir des voix mar-ginales mais depuis la voix dominante du consensus médiatique, « flot »(ABC 14) rance entamé par la « mobilisation »18 de citations littéraires,philosophique, artistiques…, il ne constitue pas moins un « bréviaire desbruits » 19 qui témoigne lui aussi d’une attention toute particulière aux voixdu monde20, comme le manifeste notamment cette page extraite de la section« P » :
102 FALL 2010
L’ESPRIT CRÉATEUR
Présidents de tous les … Cf. Réconciliations nationalesPrésidents en pleine forme Cf. Quadras, Saint-PèreP.D.G. sous les verrous : incarcéré ce matin pour corruption active et passive, détourne-ments de fonds, faux en écriture et recel d’abus de biens de sociaux, Richard P., qui a reçudans la journée de nombreux témoignages de sympathie, s’apprête—alors que rien, dansson éducation, ne l’y a préparé—à passer sa première nuit en prisonPrésidentiablesPressionsPrêt(e) à tout pour réussirPrétendants piaffant d’impatience, se bousculant au portillon, etc.Prétentions exorbitantes
Pétrarque disait : « Je ne veux pas que mon lecteur comprenne sans effort ce que je n’aipas sans effort écrit moi-même. » Sans doute ne faut-il pas voir dans cette phrase une affirma-tion d’élitisme ésotérique. Bien au contraire : cette phrase nous dit que poésie est le nomde la chance donnée à un lecteur, engagé dans la vertigineuse précipitation prosodique oudans les empâtements de la polysémie, de poser son temps en travers du temps et de pren-dre momentanément, dans l’épaisseur ralentie du déchiffrement, l’initiative sur le temps.
(Christian Prigent, À quoi bon encore des poètes ?)Primaires à droite ?Prime aux sortantsPrime time (ABC 157)
Bien sûr, l’ensemble n’est pas complètement homogène. Le point communentre ces différents textes ne réside pas dans le genre mis en œuvre, puisquesont représentées tant la prose documentaire ou testimoniale que la poésieexpérimentale, et il ne réside pas non plus dans le type de voix relayées, dansla mesure où nous avons affaire et aux voix marginales et à la voix dominante.De plus, s’il y a convergence entre ces textes, ce n’est pas à partir d’une déci-sion des auteurs de participer à tel ou tel courant, telle ou telle école. Lerecoupement est avant tout un effet de lecture : nous assumons l’hypothèseselon laquelle cet ensemble refonde le statut de l’écriture, dans une voie qui neressortirait ni de l’autonomie mortifère ni du retour au monde par des formesdésormais caduques. Ainsi, malgré les singularités respectives de ces textes, untrait fondamental les réunit : tous engagent l’écriture dans un processusd’écoute, comme mise en œuvre de la résonance de la voix de l’autre dans lavoix du sujet écrivant. Cette dynamique, au fond, n’est pas nouvelle : elleconstitue même le ressort de toute littérature. Cependant, ce qui est intéressantchez les auteurs retenus, c’est qu’ils la mettent au premier plan, selon certainschoix formels irréductibles à d’autres types d’écriture déjà connus.
En cela, ils semblent bien participer de ce que Dominique Viart et BrunoVercier nomment la littérature « déconcertante »—opposée aux littératures« consentantes »—, car ce qu’ils mettent en œuvre relève de catégoriespropres, et ne transige pas avec les effets de mode :
VOL. 50, NO. 3 103
PAULINE VACHAUD
À côté des littératures consentantes, qui n’ont d’autre préoccupation que de réussir un bel objetou de faire un bon « coup » éditorial, s’élabore une littérature plus déconcertante. Elle ne cherchepas à correspondre aux attentes du lectorat mais contribue à les déplacer. […] Loin du commerceet de l’artisanat, c’est une littérature qui se pense, explicitement ou non, comme activité critique,et destine à son lecteur les interrogations qui la travaillent. […] Elle écrit là où le savoir défaille,là où les formes manquent, là où il n’y a pas de mots—ou pas encore21.
En effet, le geste commun à tous ces textes—le relais de textes allogènes—neconsiste pas à pratiquer un détournement ludique ou désabusé, ce qui par-ticiperait des élans de la postmodernité ; inversement, il ne s’agit pas non plusde rendre à l’écriture une fonction de porte-parole missionnaire, ce qui recon-duirait le mouvement de la littérature engagée traditionnelle. S’il y a travailintertextuel, c’est au sens large qu’il faut l’entendre : il n’est pas question demettre en œuvre une littérature close sur elle-même, mais de travailler lalangue d’où qu’elle vienne. Et si la plupart de ces auteurs font place aux voixdes exclus, ce n’est pas pour se prévaloir d’être « la voix des sans voix ». Àrebours de cette conception émissaire de la littérature, il s’agirait plutôt d’ac-tualiser la « contre-règle éthique » proposée par Roland Barthes—« ne jamaisprêter sa voix » : « On prête beaucoup sa voix, en général, à ceux qui ne par-lent pas : les enfants, les fous, les opprimés. La Voix se prête beaucoup—onpourrait en tirer une contre-règle éthique et peut-être politique : ne jamaisprêter sa voix, que jamais la voix ne soit un organe procurateur »22. Nous yreviendrons, mais avançons d’emblée que les textes en question ne sont pasau service de l’autre, à qui l’on donnerait la parole. Selon un altruisme plusstructurel qu’affectif ou idéologique, ce qui les occupe est une fidélité aufondement hétérologique du langage23. Le centre de gravité de la création,pour ces auteurs, est la place de l’autre inhérente à tout acte langagier.
À ce titre, on touche ce en quoi, au niveau générique, cette littérature est« déconcertante ». En effet, si ces textes manifestent une dimension littéraire,ce n’est pas dans leur degré de fictionnalité, puisque tous (ou presque)investissent une voix subjective « réelle »24, traversée par la résonance de voixtout aussi « réelles ». En cela, l’écriture polyphonique mise en œuvre se dis-tingue de ce que la forme romanesque travaille depuis longtemps : « Non, plusde roman, mais le dispositif même des voix qui nomment la ville et tâchent des’en saisir »25. Pour autant, ils ne relèvent pas non plus du strict documentaireou de l’autobiographie, car le travail formel dont témoigne, à des degrésdivers, l’ensemble de ces œuvres, n’est pas réductible aux codes du documentet du récit de soi : notons ainsi la forme de l’abécédaire et les jeuxtypographiques privilégiés par Michot, le choix récurrent de l’inventaire chezFrançois Bon, le fragment allégorique chez Jane Sautière, ou encore, chez
104 FALL 2010
L’ESPRIT CRÉATEUR
Marie Depussé, le travail de la nouvelle, parfois très proche du poème enprose. D’autre part, ce en quoi ces écritures dépassent le cadre des formesdocumentaire et autobiographique, c’est que le propos, l’histoire, l’énoncéimportent moins que l’acte d’énonciation. Parce qu’il s’agit avant tout demettre en jeu certaines voix du monde telles qu’elles résonnent pour le sujetde l’écriture, le travail polyphonique n’est pas seulement une modalité quiviendrait accompagner le récit : c’est la clé de voûte même de l’écrit.
Ainsi, pour inscrire ces textes dans une catégorie générique commune, ilfaut recourir à une terminologie adaptée à la nouveauté formelle qu’ils met-tent en œuvre : cette littérature « subjonctive »26 mais non fictionnelle, nousproposerons alors de la désigner « recueil testimonial à valeur littéraire ».
Responsabilité de la formeLa spécificité de cet ensemble de textes réside donc dans l’alliance subtile
qu’ils opèrent entre composition littéraire exigeante et attention à un certainétat du monde actuel. Et si cette alliance subtile peut être nommée « responsa-bilité de la forme », c’est parce que la préoccupation sociale se joue avanttout dans un travail énonciatif, quand, en retour, la création formelle ne seréduit pas à sa seule dimension esthétisante. Le geste éthique se révèle dansl’engagement d’un dire polyphonique—plus qu’il ne se discerne par tel ou telénoncé explicite—et la forme, non gratuite, est investie d’une teneur éthique.
Pour déplier les modalités de l’engagement polyphonique mis en œuvrepar les textes retenus, il faut d’abord souligner que cette écriture « poéthique »est déterminée par un rapport très précis au réel. Chez la plupart des auteursen question, en effet, dire le monde—plutôt que l’inventer—, c’est être con-fronté à l’impossible27. Écrire, pour eux, c’est s’engager dans une « épuisanterelance du monde, qui sans cesse retombe »28. Ainsi, alors même que FrançoisBon est souvent considéré comme un des hérauts du fameux « retour au réel »dont témoignerait la littérature actuelle, lui-même dit ne pas connaître « d’in-stance pure de réel, indépendante par exemple du statut de narration et du dis-positif de forme »29. En cela, il assume explicitement l’héritage d’Heideggerselon lequel on ne peut que « cheminer vers notre pauvreté au monde », ou« progresser vers une présentation du monde comme problème »30. De lamême manière, chez Nicole Malinconi, le réel a beau être une préoccupationmajeure, il n’empêche que c’est justement depuis son silence irréductiblequ’il est abordé—ce en quoi il se distingue d’ailleurs de la « réalité » :
Quand je dis écrire à partir de la réalité : c’est l’extérieur, le tangible, là où nous sommes, les con-tingences…, nos vies, les torsions de nos vies. C’est cela qui me donne envie d’écrire. Mais çane suffit pas, parce que ce ne serait alors qu’un « reportage » ou un travail journalistique. Il y a
VOL. 50, NO. 3 105
PAULINE VACHAUD
quelque chose d’autre qui se met à l’œuvre, ce que j’appelle la quête du réel ou le rapport au réel,le réel étant pour moi ce qui jamais ne s’atteint, qui échappe tout le temps. […]. [Les mots] nedisent jamais juste, ne disent jamais tout—dire, c’est déjà avoir perdu quelque chose de la choseque l’on voudrait dire31.
C’est encore, d’une autre façon, ce qu’on retrouve chez Maryline Desbiolles,puisque, dit-elle, si elle lit des livres—et partant, sans doute, si elle en écrit,« [c’est] non pas tant pour comprendre quelque chose du monde—croire quela littérature éclaire le monde, c’est […] de la démagogie –, mais pour pou-voir supporter cette noirceur, ou cette obscurité du monde, ou cette choseincompréhensible qu’est le monde »32. Quant à Marie Depussé, la référence àLacan est si prégnante dans son travail que cette « épuisante relance dumonde » à laquelle s’essaie la littérature dans une bataille perdue d’avance luiest évidemment très familière.
Ainsi, chez tous ces auteurs, on relève bien une tension entre « l’indicible[qui] entoure »33 et la nécessité d’écrire malgré tout, ce qu’une formule deFrançois Bon condense assez justement pour qu’on la retienne : « Il mesemble qu’est devant nous un monde qui se refuse, quand il nous est vital dele nommer, d’ajouter au corps écrit ce qui le représente »34.
Plus précisément, dans les textes qui nous occupent, le « désir de l’impossi-ble »35 assume de s’exprimer par la voie de la « référencialité »36—où le rap-port au monde est déterminé par la référence intertextuelle. Alors qu’il est debon ton, aujourd’hui, de considérer cette « inter-diction » du réel comme unfaux problème, un tabou à lever—un simple mauvais souvenir du structuralismeet de « l’ère du soupçon »—, cette littérature persiste à ancrer le « désir » de réeldans le travail des voix qui le recouvrent. En cela, s’il s’agit de mettre en jeu ungeste intertextuel (au sens large), ce n’est pas comme lieu où la littératuretournerait radicalement le dos au monde, mais comme un moyen particulière-ment conséquent, eu égard au caractère irreprésentable du réel, pour investirl’une des seules réalités que le langage puisse toucher—le langage lui-même.
La manière dont l’écriture répond à « l’appel du réel »37 peut certesprendre plusieurs formes, mais, dans le corpus retenu ici, le recueil des voixreste le tour le plus évident ; et s’il retiendra notre attention plus que les autres,c’est qu’il met en jeu un degré supplémentaire de responsabilité formelle. Eneffet, dire le réel par les voix qui le tissent, ce n’est pas seulement inscrire lacréation dans une éthique du ce réel, c’est aussi mettre en avant une éthiquede l’a/Autre. Cette place fondamentale de l’autre au cœur d’écriture, une for-mule de Marie Depussé l’explicite clairement : « Écrire, dit mon ami Frédéric,c’est entendre des voix. J’ajouterais, c’est écrire ce que vous dictent les voix »(Là où le soleil 162). Et la définition de l’artiste selon Katherine Mansfield
106 FALL 2010
L’ESPRIT CRÉATEUR
reprise par Michot pour qualifier le ressort de l’ABC va dans le même sens :« Tout artiste se coupe une oreille et la cloue sur sa porte, afin que les autresviennent crier dedans » (Michot, De l’entaille 9).
Cependant, selon la manière dont est repris le discours de l’autre, la partde l’altérité sera plus ou moins importante. Le principe hétérologique a beauêtre au fondement de l’ensemble des textes qui nous intéressent, tous ne mani-festent pas un même rapport à l’autre. Selon qu’ils privilégient des procédésharmoniques (où la voix citante et les voix citées sont intimement mêlées38),ou des procédés contrapuntiques (où la distinction des voix prime sur leurfusion39), les contours de l’autre sont plus ou moins marqués.
Ainsi, chez Marie Depussé, Nicole Malinconi et Jane Sautière, la tendanceest résolument contrapuntique. C’est par la distance de discours rapportésnettement démarqués (discours directs et indirects) que la voix de l’autre estintégrée, et si la voix du « je » se déroule en fonction des mots de l’autre, c’estselon une distinction des places qui permet de maintenir toute l’altérité del’autre, de l’accueillir en tant que tel plutôt que de le tirer vers le Même. ChezJane Sautière, cette distance est certes avant tout au fondement de son éthiqueprofessionnelle, mais on peut tout autant dire qu’elle constitue le principepoétique de Fragmentation d’un lieu commun : « La distance. Il faut qu’ongarde la distance, laisser place à ce qu’on va entendre. Parce que soi et l’autre,ce n’est pas à confondre » (Fragmentation 37).
Laisser à chacune des voix en présence leur indépendance et insister surleur singularité, quelle que soit la proximité affective en jeu entre les énon-ciateurs, cela permet d’éviter le travers « soi-autriste »40 des « champions del’Autre » réprouvé par Renaud Camus :
L’autre est tellement autre en effet, telles sont ses réserves d’altérité, et celle de la langue sonalliée, qu’il peut très bien servir d’agent du Même […] et de prête-nom pour ses entreprises.D’aucuns, parmi les “inconditionnels”, sans doute, ont un si fort amour de l’autre qu’ils ne rêventque d’une chose, être semblables à lui, qu’il soit semblable à eux, que rien ne les sépare, qu’ilssoient absolument les mêmes, fondus dans le Pareil au Même. Telle est leur passion de l’étrangerqu’ils n’aspirent à rien tant qu’à le dépouiller de son étrangèreté (sic).De même que le statut de vaincu, d’humilié, d’offensé, de victime—au moins comme site pour laparole, comme lieu d’émission du discours—, est l’objet d’une compétition aussi vive, sinon plus,que le statut de vainqueur, au point que c’est à qui aura le plus souffert, sera le plus à plaindre, enaura le plus vu ; de même se dispute-t-on farouchement le titre de champion de l’Autre, comme leplus précieux des balcons d’où parler (et bien plus souvent d’où faire taire) (Camus, Syntaxe 48-49).
De cette altérité admise comme telle, Vous vous appelez Michelle Martin estalors un exemple particulièrement significatif. Dès l’ouverture, l’auteur rap-pelle que les échanges dont ce texte est le fruit n’ont pas été tenus « d’une
VOL. 50, NO. 3 107
PAULINE VACHAUD
seule voix »41. Et par la suite, elle explicite bien ce en quoi être l’autrui dequelqu’un, c’est avant tout être réductible à une pleine compréhension, rester« inconnu » : « vous que je rencontre pour la première fois, que je regarde enme demandant ce que je ferais à votre place, en prison pour trente ans, en medisant qu’il n’y a peut-être rien à dire devant l’inconnu d’autrui, que vous êtesen train de devenir mon autrui » (Vous vous appelez 32).
Du reste, il faut souligner que l’écriture de ce livre a beau s’être développéeà partir d’un certain nombre de rencontres et de longues conversations—letexte est profondément redevable à la parole d’un autre—c’est pourtant la« non-rencontre » qui le détermine42. La relation d’altérité, en assumant ladifférence radicale, ne s’inscrit donc pas dans la complaisance ou la com-plicité, et s’il est une fidélité intransigeante, elle touche à la vérité des motsrecueillis plus qu’à la volonté même de Michelle Martin43.
À partir d’une même prise en compte de l’autre en tant qu’autre, le choixcontrapuntique, chez Marie Depussé, relève d’une responsabilité un peudifférente. Dans Dieu gît dans les détails plus particulièrement, maintenir ladifférence des voix, c’est en effet une manière de restituer une singularité etune articulation qui tranchent avec l’aliénation redoutable des hallucinationsdélirantes et l’indistinction des « hurlements44 » qui font le quotidien de LaBorde. Rendre une voix à ceux qui « [ont] payé le prix, avec leur voix, leurinaccessible détresse, pour être là » (Dieu gît 95), c’est donc, en partie dumoins, la raison d’être des formes très conventionnelles de discours rapporté.Et s’il ne s’agit pas nécessairement de compenser ce rapport entre la folie etles voix—en excès ou en défaut –, toujours est-il que l’existence d’« unevoix », singulière, distincte et articulée est considérée comme un bord contrelequel s’appuyer : « Comme s’il fallait qu’on entende une voix, dans lesheures, pour les supporter » (Dieu gît 18).
Quant à Un ABC de la barbarie, il met en œuvre un dispositif assez com-plexe, mais, en ce qui concerne l’abécédaire en lui-même, il n’est pas anodinque le traitement du « nauséeux consensus » (De l’entaille 6) diffère de celuides « titres, pincées et plages » (ABC 14) littéraires, philosophiques, artis-tiques… Insister sur l’anonymat de la voix doxique et ne pas la marquercomme discours rapporté, c’est manifester son emprise—aliénation du resteaccentuée par la forme verticale de la litanie. Au contraire, parce que lesdiverses citations qui viennent « aérer » le « déferlement du tintouin » (ABC14) sont démarquées par l’usage de l’italique, que ces citations sont toujoursaccompagnées de leur source et qu’elles se déploient de manière horizontale,c’est bien par la voie contrapuntique qu’elles sont intégrées. Ici encore,l’éthique de la distinction semble donc l’emporter.
108 FALL 2010
L’ESPRIT CRÉATEUR
Enfin, chez Maryline Desbiolles, on peut noter une plus grande hésitationentre écriture contrapuntique et tendance harmonique. Comparativement auxautres textes évoqués jusqu’ici, le traitement des voix fait plus souvent l’objetd’un tissage subtil, en ménageant une plus grande part à l’indécidabilité énon-ciative. Néanmoins, il reste remarquable que le choix contrapuntique estjustement privilégié pour rendre compte des voix dont le « je » se dit le plusproche, comme dans la dernière section de l’ouvrage (« Dixième voix »), oùle « je » insiste tout particulièrement sur ses affinités avec son interlocutrice45
alors même que l’écriture privilégie une nette distinction des voix.En somme, chez ces auteurs, faire le choix du contrepoint ce n’est pas nier
que « je est un autre »—à lui-même –, mais c’est mettre en avant que je n’estpas l’autre et insister sur la nécessité de la différence pour qu’un échangepuisse avoir lieu.
En revanche, chez François Bon, malgré la présence de certains effets dedistinction, une grande proximité prévaut entre la voix du « je » et les voixrelayées. La forme la plus évidente de cette homogénéisation est alorsl’hybridation énonciative :
Celui qui n’avait qu’un pantalon trouve abri dans un squat et quémande encore son tabac, per-sonne ne le supporte parce qu’il n’a pas de tabac et parle trop et de trop près, et s’il voulait repar-tir à Metz ou pas, des histoires de place en voiture puisque cheveux hérissés avait un camion etdevait s’en aller dans l’île de Ré, s’éloigner de la ville, ses quais et son port, avec les immensitésde pins à traverser droit au long de l’Atlantique invisible si on descendait vers l’Espagne, ou viteles marches de montagnes et plateaux si on coupait vers le centre après Libourne, ou l’autoroutecomme une saignée indifférente si simplement on remontait vers Paris pour changer là et repar-tir au-dessus vers l’est ou le nord : pour un motif futile titrait Sud-Ouest, mais une place en voiturequand on n’a plus de chaussettes et le même pantalon qui a traversé cinq semaines ou sept dedétention puis la rue à la sortie, une place en voiture demandée dans les étages sombres d’unsquat : l’île de Ré ce n’était pas complètement la route de Metz mais déjà quitter le squat, laprison et la ville, et plus rien, une vie qui s’arrête, et le grand corps maigre allongé rue desDouves. (Prison 16-17)
On peut aussi relever les nombreux échos syntaxiques et lexicaux entre lavoix écrivante et les voix recueillies. Même si la voix de François Bon tendmalgré tout à se démarquer en tant qu’elle radicalise l’emploi de tel ou telprocédé, « parce que les mots ne sont plus dans leur arrangement ordinaire,mais tirés avec excès jusque près de leur déchirure » (Bon, Impatience 11)46,il demeure qu’elle partage avec les voix relayées une langue simple dans sesconstituants, ainsi qu’une forte tendance à l’oralisation. En outre, une desraisons pour lesquelles Prison et C’était toute une vie mettent en œuvre unrapport à la voix de l’autre « harmonique »—plus, peut-être, que dans les
VOL. 50, NO. 3 109
PAULINE VACHAUD
autres textes de l’auteur—c’est que les textes relayés, dans leur ensemble, ontété produits en ateliers d’écriture, selon des propositions chères à l’auteurdans sa propre pratique d’écrivain47. Dès lors, l’homophonie qui se dégage deces deux textes n’est pas seulement due à la résonance des voix sociales dansla langue de l’auteur. Elle est aussi impliquée par le fait que les textes produitsen ateliers sont informés par des marques scripturaires amplement privi-légiées par Bon.
À orienter le travail polyphonique vers une telle homogénéité cependant,où l’effet harmonique ne veut pas dire accord de principe ni relation har-monieuse mais proximité énonciative et stylistique, c’est alors l’altérité mêmede l’autre qui est entamée. Pour autant, si cette fusion des places touchel’altérité des voix relayées eu égard à la voix de Bon, cela ne signifie pas qu’ily ait assimilation ni récupération de ces voix par une convention littérairepréformée, reconnaissable—de l’ordre du « Même ». En effet, le point dejonction entre voix du « je » et voix relayées—la violence d’une langue « horsde toute convention et partage »48—maintient un rapport d’altérité malgrétout : non pas entre le « je » et son objet, donc, mais entre la langue du livreet le lecteur. En pratiquant une écriture qui s’écarte tant d’une certaine idée dela langue littéraire que des usages de la langue commune—puisqu’il s’agit decreuser « au plus obscur de là où naît le langage »49—, Bon travaille finale-ment une poétique de l’ « inadhérence»50, une écriture-limite qui relève de la« langue étrangère »51. S’il n’est pas de division fondamentale entre la voixdu « je » et la voix de l’autre, cette division est bien présente dans le rapportdu livre à son lecteur (au premier abord du moins), inscrivant l’altérité aucœur de l’écrit. En cela, l’infidélité faite à la voix de l’autre n’est pas trahi-son ; elle vaut en regard de l’exigence d’« inouï » qui, finalement, permettrade mieux « faire entendre » cet autre :
On ne connaît le réel qui se vit qu’en écoutant le réel qui se dit. C’est ce qu’ont bien comprisPierre Bourdieu et son équipe en restituant tels quels les entretiens rassemblés dans La Misère dumonde. Mais il ne suffit pas de recueillir des paroles, encore faut-il les faire entendre. Or, enlittérature, faire parler un exclu comme un exclu, c’est risquer de ne pas le faire entendre : ilressemble à sa caricature, son discours ne produit que du même et de l’attendu, son dire est tou-jours ramené à du déjà-dit : il est enfermé dans son accent, sa parlure, ses lieux communs. La pra-tique d’écriture de François Bon produit au contraire un effet d’inouï et dispose à l’écoute d’uneparole inédite. (Viart, François Bon 30)
Altérité de la voix de l’autre par un choix contrapuntique ou altérité du texteadressé au lecteur, ainsi s’énonce donc, dans les textes retenus ici, l’éthiquede l’autre, selon un travail avant tout énonciatif, du dire plus que du dit.
110 FALL 2010
L’ESPRIT CRÉATEUR
Ainsi, parce que François Bon, Marie Depussé, Maryline Desbiolles,Nicole Malinconi, Jacques-Henri Michot et Jane Sautière écrivent dansl’écoute des voix du monde et, plus particulièrement, les voix silencieuses desexclus ou la voix doxique que l’on n’entend pas parce qu’on l’entend trop, ilsœuvrent à une littérature ouverte, non soumise à telle conception de la formelittéraire où le souvenir des maîtres inhiberait la création de voies nouvelles.Pour autant, ils ne témoignent pas moins d’une pratique exigeante de lalangue, non délestée de toute préoccupation éthique. Fonder l’écriture surl’« inter-diction » du réel et sur le ressort hétérologique du langage, c’estadmettre certaines déterminations élémentaires envers lesquelles la rechercheformelle engage sa responsabilité. Ainsi, entre les normes d’antan auxquellesse soumettait la création (l’ensemble des déterminations morales formant« symptôme ») et l’espace autonomisé des libertés actuelles où la littératurevirerait à l’épuisement—en préférant sa jouissance propre et le mouvement du« pharmakon »—, les textes évoqués ici proposeraient une voie tierce : niordre du symptôme ni joies du pharmakon et ses revers, mais responsabilitéformelle, grâce à laquelle la littérature française contemporaine renouerait sesliens avec le monde.
Et si cette démarche n’est pas réductible à un simple retour à l’engage-ment ni même à la « morale de la forme » barthésienne, c’est que l’exigenceéthique, pour ces auteurs, n’autorise qu’après-coup une certaine libération.S’il est un engagement, chez eux, il est d’abord et avant tout à considérercomme fidélité aux structures fondamentales du langage. En quelque sorte, ils’agit de mettre en œuvre un rapport au langage très proche des propositionslacaniennes—où assumer la part du « Réel » et la part de « l’Autre » en jeudans l’acte langagier induit une éthique singulière, qui ne relève ni de l’en-gagement religieux, ni de l’engagement idéologique. Et c’est pourquoi, dureste, cette éthique de l’autre ne relève pas de la conception lévinassienne(aux accents métaphysiques52) ni de la « bouillie pour les chats » fustigée parAlain Badiou (L’Éthique 47)53, comme avatar prédominant du consensus.Parce qu’elle s’appuie sur la structure langagière, c’est bien une altérité d’ordrelogique qu’elle met en jeu, ou pour le dire avec les termes de Jean-PierreLebrun, une « transcendance immanente » (La Perversion ordinaire 138).
Université Stendhal Grenoble III
Notes
1. Voir Jean-Pierre Lebrun, La Perversion ordinaire : vivre ensemble sans autrui (Paris:Denoël, 2007).
VOL. 50, NO. 3 111
PAULINE VACHAUD
2. Nicole Malinconi est certes un auteur belge ; les deux ouvrages qui nous intéresseront iciayant été publiés dans des maisons d’édition françaises, nous nous autoriserons cependantà les convoquer dans leur appartenance au champ français.
3. Roland Barthes, « Qu’est-ce que l’écriture ? », Le Degré zéro de l’écriture, suivi de Nou-veaux Essais critiques (1953) (Paris: Seuil, 1972), 11-17.
4. Voir Jean Dubuffet, Asphyxiante culture (Paris: Minuit, 1986).5. Voir William Marx, L’Adieu à la littérature : histoire d’une dévalorisation, XVIIIe-XXe
siècle (Paris: Minuit, 2005).6. « Épuiser l’adieu », entretien avec William Marx, Devenirs du roman, collectif (Paris:
Inculte/Naïve, 2007), 52.7. Voir Charles Melman, entretiens avec Jean-Pierre Lebrun, L’Homme sans gravité : jouir à
tout prix (Paris: Denoël, 2002).8. Lagrasse: Verdier, respectivement 1995 et 1997.9. Paris: POL, respectivement 1993 et 1998.
10. Paris: Seuil, 2007. 11. Paris: Minuit, 1985 (édition de référence ici Bruxelles: Labor, 1996) et Paris: Denoël, 2008. 12. Marseille: Al Dante/Niok, 1998. 13. (Paris : Verticales / Le Seuil, 2003). 14. Ce dont témoigneraient certaines littératures actuelles, ce serait en effet leur inscription
« dans le soupçon » et leur manière de « continue[r] d’en faire l’expérience », DominiqueViart, « Filiations littéraires », Écritures contemporaines 2, États du roman contemporain,Dominique Viart, Jan Baetens, dir. (Paris-Caen: La Revue des lettres modernes, 1999), 136.
15. « il ne s’agit pas de confession mais de don, les paroles me sont confiées afin que j’en fassebon usage, les paroles sont un ballot de linge que je prends sous mon bras » (C’est pourtant24).
16. Là où le soleil se tait n’est pas réductible à cette dynamique, mais c’est la dimension quenous retiendrons ici.
17. Pédophile tristement célèbre, dont les crimes ont ébranlé la Belgique dans les années 1990.18. Selon un terme cher à l’auteur, emprunté à Brecht, voir Jacques-Henri Michot, De l’entaille
(Lyon: Horlieu, 2000), 16 : « il s’agit bien de ce que Brecht appelait “la mobilisation descitations” (qu’il faut entendre à la fois comme guerre et comme mise en mouvement). »
19. Sous-titre de l’ouvrage.20. Précisons que le cadre dans lequel prend place cet abécédaire est fictionnel, ce en quoi ce
texte diffère des autres évoqués jusqu’ici. Donné comme le projet inachevé d’un certainBarnabé B., édité par ses deux amis François B. et Jérémie B., Un ABC déploie toute unedimension fictive dans un appareil de notes mi-érudit mi-romanesque.
21. Dominique Viart, Bruno Vercier, La Littérature française au présent : héritage, modernité,mutations (Paris: Bordas, 2005), 10-11. Pour une définition plus précise des littératures« consentantes », voir 8-10.
22. Roland Barthes, « Journal Moisson—La Voix », « Inédits », R/B Roland Barthes, Cataloguede l’exposition présentée au Centre Pompidou, Galerie 2, 27 novembre 2002-10 mars 2002,Marianne Alphant, Nathalie Léger, dir. (Paris: Seuil, Centre Pompidou, Imec, 2002), 181.
23. C’est ce que, avec Mikhaïl Bakhtine notamment, nous pouvons nommer l’aliénation con-stitutive de l’acte langagier : parler, c’est être situé dans une langue commune et n’y avoirplace que relativement aux mots d’autrui : « Aucun membre de la communauté ne trouvejamais des mots de la langue qui soient neutres, exempts des aspirations et des évaluationsd’autrui, inhabités par la voix d’autrui. Non, il reçoit le mot par la voix d’autrui, et ce moten reste rempli. Il intervient dans son propre contexte à partir d’un autre autrui, pénétré desintentions d’autrui. Sa propre intention trouve un mot déjà habité » (Mikhaïl Bakhtine, « LeDiscours dans le roman », cité par Tzvetan Todorov, Mikhaïl Bakhtine, le principedialogique, suivi de Écrits du cercle de Bakhtine (Paris: Seuil, 1981), 77).
Pour revenir à la référence psychanalytique, rappelons que cette dimensionhétérologique est, d’une certaine manière, un des ressorts fondamentaux des élaborationslacaniennes. C’est ainsi (notamment), que l’on peut appréhender la notion de Grand Autre :« au-delà des représentations du moi, au-delà aussi des identifications imaginaires, spécu-laires, le sujet est pris dans un ordre radicalement antérieur et extérieur à lui, dont il dépend
112 FALL 2010
L’ESPRIT CRÉATEUR
même quand il prétend le maîtriser. […] Ce qui constitue pour le sujet l’ordre autre auquelil se réfère […], c’est le langage lui-même. Ainsi l’Autre, à la limite se confond avecl’ordre du langage. » Roland Chemama, « Autre », in Roland Chemama et Bernard Van-dermersch, dir., Dictionnaire de la psychanalyse (Paris: Larousse-Bordas, 1998), 39.
24. À ce propos, notons que la « fiction philologique » en jeu dans Un ABC n’est pas si éloignéequ’on pourrait le croire de l’investissement subjectif de la voix écrivante en jeu dans lesautres textes. Si le dispositif est fictionnel, il s’avère que l’invention des trois personnages(Barnabé B., François B. et Jérémie B., les trois compères censés avoir œuvré à la consti-tution d’ Un ABC) participe d’une conception spécifique du sujet chez Michot : à l’instardes hétéronymes de Pessoa, Barnabé, François et Jérémie sont en fait, pour Michot, autantde manières d’actualiser le caractère divisé du sujet ainsi que la ligne de fiction parlaquelle il cherche à se dire.
25. François Bon, Impatience (Paris: Minuit, 1998), 23. Une phrase de Prison explicited’ailleurs bien ce geste : « j’évoquerai la brûlure des mots recueillis et ce qu’ils disent », 28.
26. Pour reprendre une formule de Roland Barthes référant à la littérature du discours rapporté,Mythologies (1957) (Paris: Seuil, 1970), 210.
27. Selon une appréhension du réel qui hérite, d’une certaine manière, de la fameuse proposi-tion lacanienne : « Le Réel, c’est l’impossible », autrement dit « ce qui ne cesse pas de nepas s’écrire », Jacques Lacan, Encore (Paris: Seuil, 1975), 76.
28. Pierre Michon, Le Roi vient quand il veut : propos sur la littérature, Agnès Castiglione, dir.(Paris: Albin Michel, 2007), 63.
29. François Bon, « Une famille d’écriture ? », entretien avec Frédéric Châtelain pour la revueScherzo, 1999, site personnel de François Bon, http://www.tierslivre.net/arch/itw_Scherzo.html, page consultée le 15-11-2009.
30. « Plus étrangement pour moi, c’est les cours de 1927 de Heidegger qui m’ont été un des filsles plus riches, en particulier pour l’approche logique de cette opposition dynamique de ladiction allant vers le monde, et du monde résistant y compris par une représentation quenous seuls construisons. Il dit : cheminer vers notre pauvreté au monde, ou bien : progresservers une présentation du monde comme problème. », François Bon, « Une famille d’écri-ture ? ».
31. Entretien accordé par l’auteur, 11-10-2008.32. Entretien accordé par l’auteur, 15-12-2008. 33. Marie Depussé, entretien accordé par l’auteur, 14-09-2008.34. François Bon, « Sortir du roman », entretien avec Jean-Claude Lebrun pour L’Humanité,
1998, site personnel de François Bon, http://www.tierslivre.net/arch/itw_Lebrun.html, pageconsultée le 15-11-2009.
35. « La littérature est catégoriquement réaliste, en ce qu’elle n’a jamais que le réel pour objetde désir […] Elle est tout obstinément irréaliste ; elle croit sensé le désir de l’impossible. »,Roland Barthes, Leçon inaugurale de la chaire de sémiologie littéraire du Collège deFrance, prononcée le 7 janvier 1977 (Paris: Seuil, 1978), 23.
36. Tiphaine Samoyault, L’Intertextualité : mémoire de la littérature (Paris: Nathan Université,2001), 83.
37. Philippe Forest, Le Roman, le réel et autres essais (Nantes: Cécile Defaut, 2007), 8.38. Selon une importation, dans le champ littéraire, du terme musical dont nous retenons ici le
principe homophonique—c’est-à-dire une combinaison où prime l’accord des voix entreelles, dans un système de composition verticale.
39. Selon le même type d’importation d’une terminologie musicale vers le domaine littéraire :le contrepoint privilégie l’indépendance des voix, dans un système de composition hori-zontale.
40. « Soi-mêmisme dans les personnes, soi-autrisme dans les civilisations et parmi les nations :ici comme là “le divers décroît”—comme si le Même et ses agents avaient partout la maingagnante. », Syntaxe ou l’autre dans la langue, et autres conférences (Paris: POL, 2004),38.
41. « Peut-être avez-vous confondu la confiance réciproque des mots avec la connivence, avecparler d’une même voix, d’un même avis. Vous préfériez ne retenir que la connivence, vousauriez comme oublié que nous n’avons pas parlé d’une seule voix. » (Vous vous appelez 12).
VOL. 50, NO. 3 113
PAULINE VACHAUD
42. « Ce livre [Au fond des ténèbres de Gitta Sereny] n’est pas une enquête, c’est le récit d’unerencontre, qui m’a terriblement bouleversée, parce que j’y retrouvais, après avoir écrit monlivre Michelle Martin, exactement la même non-rencontre. Elle lui pose la question [à FranzStangl, le commandant de Treblinka], en fait, de la reconnaissance de sa responsabilité, etlui répond par la description d’actes ou de faits comme si ceux-ci ne l’engageaient pas, dansune parole qui, alors, ne l’engage pas. », Entretien accordé par l’auteur, 11-10-2008.
43. Michelle Martin n’a pas donné son accord pour la publication du livre.44. Voir notamment Dieu gît : « Heureusement, il y a les surprises. Roger passe son long visage
noirci par on ne sait quel feu d’enfer, et regarde curieusement sous le nez ceux qui atten-dent. Des chats se battent. Quelqu’un hurle dans la cour. Personne ne bouge. Ici, on traduitles hurlements, comme une langue familière. Des dizaines d’oreilles écoutent, traduisent, etquelquefois plusieurs se précipitent en même temps. Ou un seul, à qui le hurlement étaitdestiné. Ou personne. Ah, c’est Françoise, elle hurle beaucoup, en ce moment » (35-36).
45. « Nous sommes dans le même temps. Nous sommes de part et d’autre de la table, mais noussommes dans le même temps. Il aura sans doute fallu les neuf autres voix pour que j’arriveà entendre celle-ci, non pas comme moi-même, non pas comme ma sœur, mais comme monexacte contemporaine. Ce n’est pas si courant. Pas toujours dans l’amitié, pas même dansl’amour. Nous sommes dans le même temps. Je n’ai pas vécu, loin s’en faut, ce qu’elle avécu, je n’habite pas où elle habite, mais nous sommes dans le même temps » (C’est pour-tant pas la guerre 119).
46. Dans son contexte, cette formule définit l’enjeu du texte théâtral, mais il semble qu’onpuisse aisément l’appliquer à la langue de Bon dans son ensemble.
47. Voir notamment la proposition d’écriture à partir d’images fixes (Prison 64 et C’était touteune vie 18-19), poétique éminemment liée à la forme de l’inventaire. Voir aussi la rechercheproprement langagière à laquelle Bon engage les participants des ateliers (« j’avais proposéqu’on aille regarder au plus profond qu’on puisse dans l’intérieur du mot » [Prison 95]), cequi constitue un des fondements de sa propre démarche.
48. C’était toute une vie 15. Le « je » a beau manifester ses réticences eu égard à une écriturepuisée dans une « zone obscure et violente »—du moins dans le cadre des ateliers—, c’estpourtant bien, nous semble-t-il, ce type d’élan qu’il met lui-même en œuvre.
49. C’était toute une vie 15.50. Pour reprendre un terme par lequel Renaud Camus qualifie la syntaxe : « [E]lle n’est pas du
côté de la ressemblance, de la similitude, de l’adéquation, du Même ; mais de la distance aucontraire, de l’écart, de l’étrangèreté, du jeu. Érection d’une loi étrangère à celui qui parle,ou qui pense, tiers au sein de tout échange, elle est une inadhérence à l’expression, auphénomène, au sujet ; une sortie de soi pour aller voir, comme dit Ponge, comme ça fait dudehors. » (Syntaxe 56).
51. Voir Dominique Viart, François Bon. Étude de l’œuvre 29 : « François Bon trahit-il ce qu’ilprétend exprimer ? Non, car la recherche d’une “autre langue” permet au contraire detoucher au plus intime du réel. […] Cette forme de langage hybride n’existe évidemmentdans aucune couche sociale : encore une fois, nous sommes très loin de tout réalisme. Etpourtant c’est du réel qu’il ne cesse d’être question, des univers du chômage, de la banlieue,de la prison, des provinces déshéritées… Mais, pour le faire voir de façon nouvelle,François Bon invente cette “langue étrangère” au cœur de la langue, selon le principe misau jour par Proust et commenté par Deleuze dans Critique et clinique ».
52. Voir notamment Totalité et infini (La Haye: M. Nijhoff, 1961) et les analyses qu’en pro-posent Alain Badiou dans L’Éthique : essai sur la conscience du mal (Caen: Nous, 2003),46 : « Il faut […] que le phénomène d’autrui (son visage) soit l’attestation d’une altérité rad-icale que cependant il ne contient pas à lui seul. Il faut que l’Autre, tel qu’il m’apparaît dansle fini, soit l’épiphanie d’une distance à l’autre proprement infinie, dont le franchissementest l’expérience originaire. Ce qui veut dire que l’intelligibilité de l’éthique impose quel’Autre soit en quelque manière porté par un principe d’altérité qui transcende la simpleexpérience finie. Ce principe, Lévinas l’appelle le “Tout-Autre”, et il est bien évidemmentle nom éthique de Dieu. »
53. Pour plus de précisions, voir notamment le chapitre II « L’Autre existe-t-il ? », 41-54 :« Disons que Lévinas est le penseur cohérent et inventif d’une donnée qu’aucun exercice
114 FALL 2010
L’ESPRIT CRÉATEUR
académique de voilement ou d’abstraction ne peut faire oublier : sortie de son usage grec(où elle est clairement subordonnée au théorique), et prise en général, l’éthique est une caté-gorie du discours pieux. […] Que peut donc devenir cette catégorie si on prétend supprimer,ou masquer, sa valeur religieuse, tout en conservant le dispositif abstrait de sa constitutionapparente (“reconnaissance de l’autre”, etc.) ? La réponse est claire : de la bouillie pour leschats. Du discours pieux sans piété, du supplément d’âme pour gouvernements incapables,de la sociologie culturelle substituée, pour les besoins de la prédication, à feu la lutte desclasses. […] Il se pourrait bien que, détachée de la prédication religieuse qui lui conféraitau moins l’ampleur d’une identité “révélée”, l’idéologie éthique ne soit que le dernier motdu civilisé conquérant : “Deviens comme moi, et je respecterai ta différence” » (47-49).
VOL. 50, NO. 3 115
PAULINE VACHAUD
Exil, doute, écriture :actualité du malaise cioranien
Sara Danièle Bélanger-Michaud
CEUX QUE NANCY HUSTON appelle les « auteurs négativistes »dans son essai Professeurs de désespoir1 constituent de nos jours, unpeu partout en Occident, une certaine norme littéraire. Le paysage
littéraire français ne fait pas exception ; qu’on pense à l’auteur « pessimiste »peut-être le plus connu : Houellebecq. Ce vent lourd, oppressant, qu’onressentait déjà au XIXe siècle, nous venant de Schopenhauer principalement,souffle d’une façon plutôt continue depuis lors. Mais cet héritage schopen-hauerien ne surgit pas, lui non plus, des réflexions isolées d’un seul espritsombre. Cette orientation de la pensée émerge d’une lente transformationdans l’économie du savoir et du pouvoir. Le bouleversement des structurespolitiques et religieuses, amorcé dès l’époque des Lumières, conduit peu à peuà un certain effritement des vecteurs traditionnels de sens à partir desquels ilétait naguère possible de se situer, d’occuper une place précise dans le mondeet les institutions qui l’organisent. Entre autres, la liquidation progressive dela dimension du sacré et le malaise existentiel qui en émane imposent dereformuler, d’un point de vue laïc, les contenus et les rôles des structuressignifiantes traditionnelles. La littérature qu’on dira pessimiste—et que cer-tains vont jusqu’à qualifier de nihiliste—se révèle un des symptômes de cestransformations. Elle impose une mise en évidence des effets relatifs à la pertedes contenus métaphysiques associés à une vision du monde régie par latranscendance ; elle met l’accent sur le vide, spirituel, existentiel, qui nousaffecte, autant à l’échelle du particulier que de l’universel.
Comme on l’a mentionné, Houellebecq fait partie de ce grouped’écrivains qui représentent le malaise propre au Zeitgeist de la « post-modernité ». Olivier Bardolle souligne à ce sujet dans La Littérature à vif :« Il annonce la couleur, qui sera assurément pâle et blême, comme l’époque[…] comme cette lueur projetée sur des centaines de milliers de visages rivésà leur ordinateur. Pâle et blême comme le sont ces multitudes de dépressifs enmanque d’amour, d’anxieux en quête de sens, d’exaspérés de tous poils quihantent les cabinets de psychothérapeutes »2. Et de fait, il y a bel et bien chezHouellebecq une velléité ou une prétention à témoigner de l’esprit d’uneépoque, à représenter un passage historique, voire à retracer les « mutationsmétaphysiques »3 qui l’affectent. C’est dans cet esprit qu’on peut penser que
© L’Esprit Créateur, Vol. 50, No. 3 (2010), pp. 116–128
son impulsion à documenter en quelque sorte « l’esprit du temps »—mêmes’il le fait dans la fiction—se rapproche de celle d’une série d’auteurs jouantun peu le rôle de chroniqueurs de leur propre époque. Qu’on pense à Mon-taigne, à Voltaire, à Rousseau, à Balzac, à Flaubert, et plus près de nous àCioran, cet expatrié roumain—qu’on qualifiera plus justement d’exilé oud’apatride—ayant cherché (et réussi) à s’inscrire dans la tradition desmoralistes français qui ont cherché à donner une voix, littéraire, philosophique,à un certain Zeitgeist.
Cioran, au contraire de Houellebecq qu’on a souvent retrouvé, depuis unedizaine d’années, à l’avant-scène du grand spectacle littéraire français, n’ajamais été pleinement actuel, n’a surtout jamais été à la mode ou au « goût dujour intellectuel ». Et c’est précisément cette inactualité qui fait de l’œuvre deCioran celle d’un contemporain. En effet, pour Agamben, la contemporanéitése définit par cette inactualité même :
Celui qui appartient véritablement à son temps, le vrai contemporain, est celui qui ne coïncide pasparfaitement avec lui ni n’adhère à ses prétentions, et se définit, en ce sens, comme inactuel ; maisprécisément pour cette raison, précisément par cet écart et cet anachronisme, il est plus apte queles autres à percevoir et à saisir son temps4.
Outre la profondeur et l’acuité de l’œuvre de Cioran, prenant pour objetsprivilégiés l’histoire et la métaphysique, c’est probablement ce décalage etcette préférence certaine pour une vie en retrait, à l’abri du monde dans samansarde, ce « cachot de pensée » dirait Thomas Bernhard, qui, paradoxale-ment, fournissent à sa pensée une part de son actualité ou de son éternellepérennité. La nature et le statut de son œuvre, qui se situe aux limites de laphilosophie et de la littérature, demeurent, aujourd’hui encore, inclassables,malgré toutes les entreprises critiques et la somme des interprétations aux-quelles elles ont donné lieu. Chose certaine : elle témoigne, d’une façonsombre, parfois pessimiste, voire négative, d’un Zeitgeist qui est encore engrande partie le nôtre, et ce, d’une façon tout à fait pénétrante. C’est la raisonpour laquelle Cioran reste aujourd’hui encore on ne peut plus pertinentlorsqu’il s’agit de penser notre époque. Si le « contemporain est celui quireçoit en plein visage le faisceau de ténèbres qui provient de son temps »(Agamben 29), nous est contemporain celui qui nous renvoie en plein visagece faisceau de ténèbres qui illustre notre propre temps. Plus que plusieurs deces auteurs (dont Onfray, Ferry, Houellebecq) préférés des médias et qui enviennent ainsi à occuper une surface respectable de la scène culturelle etintellectuelle française, Cioran a réussi à décrire quelque chose de notreépoque, à témoigner de nos malaises, ou plutôt à produire une réflexion symp-
VOL. 50, NO. 3 117
SARA DANIÈLE BÉLANGER-MICHAUD
tomatique des questions et des maux—existentiels, historiques, méta-physiques—desquels nous ne sommes toujours pas parvenus à nous débarrasser.Puisque sa réflexion produit un effet ambigu et que son écriture en est une quisoulage et qui empoisonne à la fois, qui ressasse, rumine, évacue un peu, peut-être, les angoisses d’une époque qui sont les siennes et aussi les nôtres, sonœuvre sera traitée dans sa dimension « pharmaceutique », c’est-à-dire penséecomme un pharmakon.
Si un auteur comme Houellebecq semble ressentir assez fortement la« nécessité d’une dimension religieuse » tout en demeurant lui-même a-religieux—paradoxe qui n’est certainement pas resté aux portes du XXIe
siècle, qui demeure éminemment contemporain donc—Cioran a, quelquesdécennies plus tôt, porté et reproduit dans son œuvre ce tiraillement, et il l’afait probablement plus intensément que nul autre. Il écrit dans ses Cahiers :« J’aurai connu jusqu’à la satiété le drame religieux de l’incroyant. La nullitéde l’ici, et l’inexistence de l’ailleurs, … écrasé par deux certitudes »5. Ce para-doxe religieux, symptomatique de notre contexte d’effritement de la dimen-sion du sacré, ponctue son œuvre, chacun de ses textes en est marqué. On s’ybute dans La Tentation d’exister entre autres où il écrit : « sur moi je ne sensque trop les stigmates de mon temps : je ne puis laisser Dieu en paix ; avecles snobs, je m’amuse à rabâcher qu’Il est mort, comme si cela avait unsens »6. Et un peu plus loin :
Rappelez-vous [plutôt] le mot de Flaubert : « Je suis un mystique et je ne crois à rien. » J’y voisl’adage de notre temps, d’un temps infiniment intense, et sans substance. Il existe une volupté quiest nôtre : celle du conflit comme tel. Esprits convulsifs, fanatiques de l’improbable, écartelésentre le dogme et l’aporie, nous sommes aussi prêts à bondir en Dieu par rage que sûrs de n’ypoint végéter.N’est contemporain que le professionnel de l’hérésie, le rejeté par vocation, à la fois vomissureet panique des orthodoxies. Naguère, on se définissait par les valeurs auxquelles on souscrivait ;aujourd’hui, par celles que l’on répudie. Sans le faste de la négation, l’homme est un pauvre, unlamentable « créateur », incapable d’accomplir sa destinée de capitaliste de la culbute, d’amateurde krash (Cioran, Précis 890).
On trouve un élément de contemporanéité certain dans l’attitude négatrice dupenseur, de l’hérétique, qui se garde bien de proposer quoi que ce soit et quiainsi échappe à cette catégorie des « prophètes » à laquelle appartiennent tousceux qui souscrivent à des partis pris, des croyances, des dogmes. Nier, c’estne pas adhérer ; et être contemporain, c’est précisément, pour Cioran, ne pasadhérer à son époque, à son économie de pensée, à son Zeitgeist. Mais nier,c’est en même temps se situer dans le cadre de ce que l’on nie, c’est tenirjusqu’à un certain point à ce à quoi on s’oppose. Il écrit à ce sujet : « Nier,
118 FALL 2010
L’ESPRIT CRÉATEUR
nous en convenons, c’est affirmer à rebours. Il y a cependant quelque chosede plus dans la négation, un supplément d’anxiété, une volonté de se singu-lariser et comme un élément antinaturel. »7 Un « je nie donc je suis » participeà une forme d’individuation anxieuse, à une façon de s’inscrire quelque partsans adhérer pour autant. Cette attitude de pensée qui se transforme parfois enpose sociale est familière à l’Occident depuis quelques décennies déjà et ellereste actuelle dans la mesure où la singularité reste une valeur prédominanteet la négation demeure un des moyens privilégiés pour y parvenir.
À la différence de la négation, qui est une inscription à rebours ou àrebrousse-poil, le doute, comme position subjective, apparaît à première vueplus ou moins inactuel, en ce qu’il semble désincarné, flottant, sans ancrageprécis.
L’affirmation et la négation ne différant pas qualitativement, le passage de l’une à l’autre estnaturel et facile. Mais une fois qu’on a épousé le doute, il n’est ni facile ni naturel de revenir auxcertitudes qu’elles représentent. On se trouve alors paralysé, dans l’impossibilité de militer pourquelque cause que ce soit ; bien mieux, on les refusera toutes, et, au besoin, on les ruinera, sansdescendre dans l’arène. Le sceptique, au grand désespoir du démon, est l’homme inutilisable parexcellence. Il ne se prend, il ne se fixe à rien ; la rupture entre lui et le monde s’accuse avecchaque événement et avec chaque problème qu’il lui faut affronter (Cioran, La Chute 1108).
Le sceptique existe et pense en retrait. Il ne descend pas dans « l’arène » ; sondésengagement le place à l’écart du cirque médiatique où on nous brosse desmodes intellectuelles, où on tente de nous représenter l’ « ère du temps ». Lesceptique est de toute façon trop inactuel en apparence pour être constitué enspectacle ; il en représente un peu le résidu plutôt, une sorte de tache in-assimilable. Effectivement, en tant que « principe destructeur d’essence con-ceptuelle », et parce qu’il ne s’exprime pas en vertu de circonstances, decroyances, de principes ou de partis pris extérieurs à lui-même, le doutesemble extérieur à tout, presque autonome, donc peu actuel. Cioran en parlecomme d’un « piétinement », comme d’une « torsion de l’intellect sur lui-même » (Cioran, La Chute 1098). Mais douter implique de dépasser la néga-tion ou la négativité, « valeur » proprement contemporaine s’il en est. En tantque renversement de l’affirmation et de la négation, le doute implique un rejetradical de ce qui est, par quoi on sous-entend la somme d’opinions et decroyances qui constitue notre capital vital ou « capital de mensonges ». Encela, le doute représente une forme d’exil, une séparation fondamentaled’avec ce qui nous entoure.
Extérieur à tout en raison de cette posture intellectuelle et subjective par-ticulière, Cioran ne résiste pourtant pas à cet acte d’inscription de soi que
VOL. 50, NO. 3 119
SARA DANIÈLE BÉLANGER-MICHAUD
représente l’écriture, ou plus spécifiquement le fait de publier les mouve-ments de sa pensée, ses angoisses et ses doutes. « Publier ses tares pouramuser ou exaspérer! Une barbarie à l’égard de notre intimité, une profana-tion, une souillure. Et une tentation » (Cioran, La Tentation 881). C’estd’ailleurs un peu cette tentation pour la souillure qui fournit à sa pensée sapérennité, son éternelle actualité, malgré son inactualité apparente, malgré leretrait du monde que cette pensée s’impose. En fait, toute sa productiontextuelle se révèle symptomatique d’un malaise à la fois inscrit temporelle-ment et historiquement et dissocié d’un contexte extérieur dans la mesure oùil concerne le rapport presque transhistorique, particulier, qu’un individuentretient—ou cherche à entretenir—avec la transcendance, avec ce quidépasse l’immédiateté, la contingence, la continuité, l’immanence. Ce malainsi que le discours qu’il produit apparaissent donc en même temps actuelset inactuels. Cioran met d’ailleurs tout en œuvre pour se rendre étranger, pourproduire cette inactualité par un retrait volontaire : « J’essaie de m’arracher àtout, de m’élever en me déracinant ; pour devenir futiles, nous devons coupernos racines, devenir métaphysiquement étrangers » (Cioran, La Tentation888). Il endosse radicalement sa situation d’exilé—émigré dans le temps, lelieu, la langue—parce qu’elle constitue un écho à cette étrangeté quasi gnos-tique ressentie intérieurement. Et l’écriture est une des formes que revêt cetteétrangeté, puisque, comme Sylvie Jaudeau le mentionne dans Cioran ou ledernier homme :
Le travail d’écriture, en vertu de cette loi que « toute conquête objective suppose un reculintérieur », condamne à la distance. Il exige un dédoublement de soi et une vigilance quiimpliquent à la fois séparation d’avec soi et éloignement du monde. L’écriture comme la con-science est exil. Conscience au second degré, elle suppose un retrait de la vie, selon les deuxacceptions du mot : isolement et abolition de la vie8.
Rejeté par vocation, celle qu’il se donne en choisissant d’écrire notamment,Cioran se crée tout un parcours qui obéit à sa propre logique, celle de l’exilou de l’étrangeté, et dont les éléments—retrait du monde, esthétique etéthique du doute, interrogations métaphysiques, enregistrements des maux etdes pensées—s’imbriquent les uns dans les autres et produisent une toiletissée des multiples recoupements entre le symptomatique et le pharmaceutique.
Explorer quelques-uns de ces recoupements entre les points saillants de sapensée, qui constituent aussi ses conditions de possibilité en quelque sorte,implique de s’intéresser principalement au rapport existant entre l’exil, ledoute—tous deux subis autant que choisis—et ultimement l’écriture, qui enproduit un discours. C’est dire que l’exil et le doute se correspondent dans la
120 FALL 2010
L’ESPRIT CRÉATEUR
mesure où tous deux impliquent chez Cioran un refus ou une incapacité às’engager et à s’inscrire dans un lieu, un temps donné. Après avoir endossé lesprincipes nationalistes d’une idéologie ayant marqué au fer rouge l’histoire duXXe siècle—le national-socialisme—Cioran adopte l’attitude inverse : leretrait, le désengagement, le doute généralisé. En choisissant d’émigrer enFrance, il s’inflige un déracinement qui n’est pas simplement géographique,mais aussi, plus fondamentalement, linguistique, puisqu’il se convertira aufrançais comme langue d’écriture. Et de toute façon, pour lui, « on n’habitepas un pays, on habite une langue. Une patrie, c’est cela et rien d’autre »9.L’exil est un exercice d’étrangeté, un des plus radicaux qui soient. Cioran,parlant de l’exilé : « Va-t-il s’essayer à un autre idiome ? Il ne lui sera pas aiséde renoncer aux mots où traîne son passé. Qui renie sa langue, pour en adopterune autre, change d’identité, voire de déceptions. Héroïquement traître, ilrompt avec ses souvenirs et, jusqu’à un certain point, avec lui-même »(Cioran, La Tentation 854). La souffrance, le déracinement, le deuil, la pertede soi sont des thèmes récurrents au sein de ce qu’on appelle la « littératurede l’exil » ; surtout lorsqu’il est question d’un exil forcé, entraîné par la guerreou des circonstances socio-économiques intolérables. Dans le cas de Cioran,l’exil n’est pas contraint, il est choisi. Et dans le contexte de sa pensée, choisirla France, ce n’est pas autant adopter un lieu qu’un non-lieu. L’exil devientune façon de se dépouiller de ses contenus, de se déposséder de soi, et en cela,il acquiert une dimension mystique particulière. Ce qu’il souligne d’ailleurs :
Il n’est point aisé de n’être de nulle part, quand aucune condition extérieure ne vous y contraint.Le mystique lui-même n’atteint au dépouillement qu’au prix d’efforts monstrueux. S’arracher aumonde, quel travail d’abolition! L’apatride, lui, y parvient sans se mettre en frais, par le con-cours—par l’hostilité—de l’histoire. Point de tourments, de veilles, pour qu’il se dépouille detout ; les événements l’y obligent. En un certain sens, il ressemble au malade, lequel, comme lui,s’installe dans la métaphysique ou la poésie sans mérite personnel, par la force des choses, parles bons offices de la maladie. Absolu de pacotille ? Peut-être, encore qu’il ne soit pas prouvé queles résultats acquis par l’effort dépassent en valeur ceux qui dérivent du repos dans l’inéluctable(Cioran, La Tentation 856).
L’exilé, au sens que lui attribue Cioran, est conçu comme un apatride ; c’estdire que même s’il change de pays, de langue, il n’adopte pas autant un nou-veau lieu qu’un « nulle part », il n’adopte pas autant une nouvelle langue qu’ilabolit l’ancienne, et s’abolit un peu lui-même au passage afin de se rendremétaphysiquement étranger. Et de fait, cette étrangeté métaphysiquerecherchée apparaît comme le prolongement d’un sentiment gnostique initial,un sentiment de non-coïncidence. L’esprit gnostique ressent son existence
VOL. 50, NO. 3 121
SARA DANIÈLE BÉLANGER-MICHAUD
comme une brisure, comme une séparation d’avec une plénitude originelle ; ilse pense à partir de la chute, dans le monde, dans le temps, dans l’individua-tion douloureuse, dans la conscience qui n’est autre que non-coïncidence,séparation, dédoublement. Cioran avoue fréquemment avoir été soumis,depuis l’enfance, à toute une gamme du mal-être : mélancolie, ennui, nostal-gie, désespoir, angoisse, anxiété. Toutes ces tonalités affectives négativespourraient être considérées comme les symptômes d’un autre mal, un mal pre-mier peut-être, qui n’advient pas avec la conscience mais qui proviendraitd’une « région préthéorique » : soit un mal de solitude, ressenti radicalement,absolument. Cette solitude dérive d’un rejet, d’une chute, d’une rupture, etelle est double, individuelle et cosmique. « Être jeté dans ce monde, incapablede s’y adapter, détruit par ses propres déficiences ou exaltations, indifférentaux aspects extérieurs—fussent-ils sombres ou éclatants—pour demeurer rivéà son drame intérieur, voilà ce que signifie la solitude individuelle. »10 La soli-tude cosmique procède quant à elle de la « sensation de l’abandon de cemonde, d’un néant objectif » (Cioran, Sur les cimes 52). Les deux formes desolitude se combinent, se fusionnent pour former un mal plus grand, pluslourd, plus insurmontable. Et il va sans dire que ce vécu préthéorique d’unmal qu’on associe, d’un point de vue théorique, à une séparation ontologique,appartient à la pensée gnostique.
Comment situer l’exil au regard de cette solitude fondamentale, dans lecadre de ce mal qui se condense et finit par se constituer en vision dumonde ? On peut penser que l’exil, qui n’est pas contraint mais recherché,semble conduit ou déterminé par ce mal antérieur, cette solitude première etdernière, ce sentiment gnostique—en cela, il en représente le symptôme.Parce qu’il exacerbe aussi ce sentiment gnostique, il devient peut-être égale-ment une sorte de remède étrange, dont il n’est pas certain qu’il soit orientévers la cure. Dans son cas, il s’agit d’aviver ou d’envenimer ce dont on nepeut ou ne veut guérir. La solitude et l’exil se correspondent dans la mesureoù le sentiment de solitude individuel, existentiel, est lié, dans ce contexteprécis, à une chute, donc à un exil qu’on qualifiera de cosmique ou de méta-physique. Pour Cioran, il ne s’agit pas vraiment de combler cette solitude,mais de l’attiser, de se l’imposer plus fortement en émigrant et en se retirantdans sa mansarde, et de là, de la tenir pour un trait subjectif, de la travailleren esthète, d’en faire la condition de possibilité, l’objet et le sujet de l’im-pératif d’écriture. C’est la raison pour laquelle il est possible d’avancer quela solitude comme mal et que l’exil comme réponse—entre symptôme etthérapeutique ambiguë—coïncident dans une économie de pensée ayant unevaleur littéraire, existentielle et métaphysique.
122 FALL 2010
L’ESPRIT CRÉATEUR
Comme on l’a laissé entendre, entre l’exil physique, linguistique,psychologique et l’exil qu’on qualifie de métaphysique, un rapport presquesymétrique se crée. Et tous ces traits ou attitudes que Cioran accumule con-stituent, dans leur ensemble et d’une façon radicale, la figure de l’apatride—qu’on parle du refus du monde et de ses institution, de la conversion linguis-tique, du désengagement politique et social, de l’enfermement dans le« cachot d’écriture », ou d’éléments plus intérieurs encore, tels que le senti-ment gnostique de la chute, la solitude (individuelle et cosmique), le tiraille-ment à l’égard du divin ou du sacré. Ces traits font partie d’un mêmeengrenage dont la cohérence interne est renforcée par cet ingrédient incon-tournable qu’est le doute et qui devient, dans la pensée cioranienne, un pré-supposé absolu ou encore un paradigme qui s’applique à toutes les sphères—intellectuelle, existentielle, littéraire, religieuse. Le doute procède d’un refusde ce qui est « ancré », d’un refus des fondements et des certitudes. On lecomprend dans ce passage :
Il faut se figurer un principe autodestructeur d’essence conceptuelle, si l’on veut comprendre leprocessus par lequel la raison en vient à saper ses assises et se ronger elle-même. Non contentede déclarer la certitude impossible, elle en exclut encore l’idée, elle ira même plus loin, ellerejettera toute forme d’évidence, car les évidences procèdent de l’être, dont elle s’est décrochée ;et ce décrochage engendre, définit et consolide le doute (Cioran, La Chute, 1099).
Le doute est la seule assise qui reste à la pensée après que toutes les autresaient été évacuées ; elle équivaut en un sens à l’aporie élevée en principe. Ledésengagement ou le repli constitue la base, négative, du doute conçu commerapport au monde, à soi, au divin. C’est entre autres ce déracinement de lapensée comme fondement négatif qui permet d’associer le doute à l’exil, dele percevoir comme son prolongement. À l’instar de l’exil, le doute apparaîtcomme une sorte de piétinement sur un socle mouvant, un piétinement dansl’inconfort, un arrachement aux îlots de certitude qui fonctionnent comme desfondements de sens. En effet, l’incapacité à s’inscrire dans un lieu (physiqueou métaphysique) fait écho à cette autre incapacité que constitue le doute,l’incapacité à s’inscrire dans des certitudes et à en faire des bases grâce aux-quelles la pensée se bâtit en une tour dans le but d’atteindre quelque chose deprécis ou d’imprécis—que ce soit un savoir, une sagesse, une œuvre, une foi.La tour de pensée que Cioran construit est destinée à saper continuellementses fondements. Elle s’écrase autant qu’elle s’élève. Elle est précaire plutôtque stable. Elle ressemble, au final, à un amas de ruines précaire où à cettereprésentation par Bruegel de la Tour de Babel, cette construction décatie,sans structure, menaçant de crouler sous son propre poids.
VOL. 50, NO. 3 123
SARA DANIÈLE BÉLANGER-MICHAUD
De la même façon qu’on peut considérer qu’un sentiment de solitude pre-mier, d’essence gnostique, détermine l’exil tel qu’il représente la solitudeassumée au point de devenir une quête, le doute—que Cioran décrit commeune méthode devenue maladie, comme une armature intellectuelle qui devientà la longue un ferment subjectif—apparaît aussi à l’inverse comme un mal quise transforme en un destin. Au lieu de tenter de s’en guérir, de s’en délivrer,il s’agit de le cultiver comme une méthode, de transformer la fatalité en destinassumé, en principe, en moteur de la pensée. Pour Cioran, on devient scep-tique parce qu’on y était prédestiné :
La certitude s’instaurerait-elle sur terre et supprimerait-elle dans les esprits toute trace decuriosité et d’anxiété, que rien ne serait changé pour le prédestiné au scepticisme. Lors mêmequ’on démolirait ses arguments un à un, il n’en resterait pas moins sur ses positions. Pour l’endéloger, pour l’ébranler en profondeur, il faudrait s’attaquer à son avidité de vacillations, à sa soifde perplexités : ce qu’il cherche, ce n’est pas la vérité, c’est l’insécurité, c’est l’interrogation sansfin. L’hésitation, qui est sa passion, son aventure, son martyre escompté, dominera toutes sespensées et toutes ses entreprises. Et lui qui balance autant par méthode que par nécessité, ilréagira néanmoins comme un fanatique : il ne pourra sortir de ses obsessions ni, à plus forteraison, de lui-même. Le doute infini le rendra paradoxalement prisonnier d’un monde fermé(Cioran, La Chute 1109).
Les balancements, hésitations, tiraillements du sceptique relèvent donc de lanécessité autant qu’ils constituent une méthode de pensée. En ce sens, le doutepeut se penser comme un mal qui se poursuit ou se pourchasse. En fouillantdans la pharmacie de Cioran, on ne trouve aucun antidote au scepticisme ; ledoute étant lui-même un pharmakon, un concept vicieux, hautement ambigu,qui consacre la fusion entre l’effet du poison et le rôle du remède.
Comme on l’a lu dans l’extrait précédent, le doute—même s’ilreprésente un rejet des certitudes et, en cela, commande une certaine ouver-ture—court le risque, puisqu’il est aussi une maladie, de se transformer endogme et de rendre le sceptique prisonnier de son propre monde tissé d’in-certitudes. Cette recherche d’insécurité, cette « avidité de vacillations »,même provenant de la maladie (ou encore la provoquant) n’est pas pourautant stérile. Elle permet de remuer des idées, des interrogations, des con-cepts qui n’ont jamais été que provisoirement, ponctuellement, résolus, sansêtre tenté de fermer ou d’arrêter le mouvement de la pensée en pondantquelques convictions ou certitudes. Le doute a un statut incertain dans lamesure où son mouvement tiraillé, sa « soif de perplexité » mêmes, con-stituent des facteurs d’ouverture qui, paradoxalement, ont pour effet unenfermement. C’est dire que le doute produit un mouvement plutôt « spi-ralesque », qui aspire et qui isole plus radicalement encore, au point où il
124 FALL 2010
L’ESPRIT CRÉATEUR
culmine en un exil sur ou en soi-même. Le doute suit la même logique quel’exil, entre symptôme et pharmakon, également entre soulagement et intox-ication. Aussi vicieux l’un que l’autre, le doute et l’exil sont redoublés dansla pensée cioranienne, ils sont ce par quoi le malaise originel poursuit sapropre nécessité interne et tente de se soulager en s’exacerbant. Combinés,l’exil et le doute conduisent à une claustration de pensée ressemblant à uneforme d’ascèse intellectuelle (également existentielle et spirituelle si onprend en compte ses objets de réflexion) dont l’issue escomptée, étant donnéles termes en présence, ne peut vraisemblablement pas être la révélation. Ilne s’agit pas d’accéder à une vérité, même si, en apparence, on prépare leterrain pour cette révélation qui n’est pas vraiment désirée. Comme dansl’ascèse qui précède la plupart des expériences mystiques, on remarque uncertain travail d’anéantissement, une tentative de saper ses propres fonde-ments, d’attenter à la « fiction du moi », pour aller au-delà des puresapparences. Ce mouvement n’est pourtant jamais achevé, il est le circuitdésespérant duquel la pensée ne s’extirpe pas.
C’est que le doute n’est pas approfondissement mais stagnation, vertige de la stagnation… Aveclui, impossible de cheminer et d’aboutir ; il est rongement et rien d’autre. Lorsqu’on s’en croit leplus éloigné, on y retombe, et tout recommence. Il faut qu’il explose pour que l’on puisses’engager dans la voie de l’émancipation. Sans cet éclatement qui doit pulvériser jusqu’auxraisons les plus légitimes de douter, on s’éternise dans le malaise, on le cultive, on évite lesgrandes résolutions, on se ronge et on se complaît à se ronger11.
Dans ce vertige de la stagnation qui consacre l’emprise du doute, lemalaise domine. Exil et doute se conjuguent sur le mode de la perpétuation del’inconfort. Le mouvement de la pensée se cultive par l’ascèse tout enescamotant la tentation du salut qui achève. Le salut représenterait une guéri-son ultime, une résolution sans ambiguïté qui adviendrait en mettant fin àcette culture du malaise, à cette rumination devenue, de vertige en vertige, lemode d’être prégnant. Les seuls remèdes dont dispose Cioran appartiennentau pharmakon dont Derrida relève le statut hautement ambivalent : « cette« médecine », ce philtre, à la fois remède et poison, s’introduit déjà dans lecorps avec toute son ambivalence. Ce charme, cette vertu de fascination, cettepuissance d’envoûtement peuvent être—tour à tour ou simultanément—béné-fiques et maléfiques »12. Le pharmakon est cette thérapeutique à deux tran-chants, dont on ne peut présager de l’effet ou de l’issue, qui semble en plushabitée par l’ubris, cette démesure dont on peut dire qu’elle est le lot deCioran, s’abîmant dans son ivresse du doute, s’appliquant à aviver sa maladie.Derrida : « Cette douloureuse jouissance, liée à la maladie tout autant qu’à son
VOL. 50, NO. 3 125
SARA DANIÈLE BÉLANGER-MICHAUD
apaisement, est un pharmakon en soi. Elle participe à la fois du bien et du mal,de l’agréable et du désagréable » (Derrida 87). Cioran explique très suc-cinctement dans ses Cahiers : « Il n’y a pas de remède ici-bas pour le mal dontje souffre, il n’y a que des poisons pour le rendre plus actif et intolérable »(Cioran, Cahiers 72). L’écriture est un de ces poisons ; étant aussi le phar-makon par excellence dans la réflexion derridienne. Si elle parvient àsoulager, elle le fait en grattant et irritant au passage les maux, doutes,angoisses, dont elle représente l’expression, la transposition, dont elle est latraduction et donc, en tant que telle, soumise au mouvement de la différance.Il écrit : « tous mes « écrits » manquent d’aisance. C’est le malheur de ceuxqui écrivent peu, qui n’écrivent pas comme ils respirent. Auteur par accident,car je ne prends la plume que pour me libérer d’une oppression momentanée »(Cioran, Cahiers 55). La pulsion d’écriture chez Cioran est indépendante dela volonté de produire une « œuvre » (Cioran, Cahiers 62), elle prend sasource dans ce mal qui le tenaille et se vit, de l’aveu même de Cioran, commeune thérapeutique :
J’écris pour me débarrasser d’un fardeau ou tout au moins pour l’alléger. Si je n’avais pas pum’exprimer, je me serais livré à plus d’un excès. Le philosophe subjectif part de ce qu’il sent, dece qu’il vit, de ses caprices et de ses troubles. On peut objectiver ce qu’on éprouve, on peut lemasquer. Pourquoi le ferais-je ? Ce que j’ai ressenti au cours des années s’est mué en livres etc’est comme si ces livres s’étaient écrits d’eux-mêmes. […] Écrire est la grande ressource quandon n’est pas un habitué des pharmacies, écrire, c’est se guérir. […] Formuler, c’est se sauver,même si on ne gribouille que des insanités, même si on n’a aucun talent. Dans les asiles d’aliénés,on devrait fournir à chaque pensionnaire des tonnes de papier à noircir. L’expression commethérapeutique (Aveux et anathèmes 1746).
L’écriture, véritablement, apaise, mais, si on reprend et applique la formulederridienne, elle est « liée à la maladie tout autant qu’à son apaisement » dansla mesure où elle triture le mal par un mouvement de réduplication, qui restenéanmoins toujours plus ou moins raté parce que différant. Cette différance,cet intervalle qui accompagne l’écriture est lui aussi ambigu, « pharma-ceutique ». D’une part, négatif, il répète, à un niveau littéraire, cette non-coïncidence qui constitue en grande partie le malaise existentiel et spirituelqui occupe Cioran. Ce qui, par moments, fait réaliser à Cioran la faillite deson rapport à l’écriture :
Je ne suis pas un écrivain, je ne trouve pas les mots à ce que je ressens, à ce que j’endure. Le« talent », c’est la capacité à combler l’intervalle qui sépare l’épreuve et le langage. Pour moi, cetintervalle est là, béant, impossible à remplir ou à escamoter. Je vis dans une tristesse automatique,je suis un robot élégiaque (Cioran, Cahiers 70).
126 FALL 2010
L’ESPRIT CRÉATEUR
D’autre part, l’intervalle non comblé entre l’« épreuve » et le « langage »s’avère plutôt positif : il implique la transformation, le travestissement et ledéplacement de l’affect ou du mal dans une autre sphère, la sphère littéraire,et dès lors permet une sortie partielle hors de ce cachot de la pensée auquelconduisent le doute et l’exil. Bref, l’écriture qui se révèle soulagement etintoxication est bel et bien un pharmakon.
Ainsi donc, la pensée, l’expérience et l’écriture cioraniennes se déclinententre symptôme et pharmakon. Cet amalgame particulier, qui nous interpelleencore aussi fortement aujourd’hui, apparaît comme le symptôme d’unmalaise spirituel, cette « grande trouvaille moderne » (Cioran, Le MauvaisDémiurge 1226) selon Cioran, et en même temps, comme sa cure ou sontraitement ambigu. Le doute et l’exil se trouvent au cœur du mal-être qui sedécline entre angoisse, solitude, mélancolie et sentiment d’étrangeté, ilsreprésentent aussi les mécanismes par lesquels ce mal-être devient une sorted’expérience intérieure, et est approfondi dans l’inconfort existentiel, l’in-quiétude spirituelle, l’ascèse intellectuelle. Cette œuvre, dont l’aspectinachevé se révèle entre autres dans le fait qu’elle se décline en aphorismes,reste inachevable, aporétique, dans la mesure où, au départ symptôme d’unmal, elle se constitue en pharmakon et reste figée dans cette forme qui, essen-tiellement ambivalente, n’admet aucune résolution. La pensée brisée qui nousest donnée à lire correspond à une fragmentation plus fondamentale : « quandnous n’avons pas un but vers lequel convergent tous nos actes, nous n’aimonsque la pensée discontinue, brisée, à l’image de notre vie volée en éclats »(Cioran, Cahiers 157).
Cette position oscillatoire entre symptôme et pharmakon signifie, dans cecontexte cioranien, que ce qui nous est livré dans ses textes est autant uneméthode de pensée, de quête, d’ascèse, qu’une maladie de la pensée, un foyerdes tourments que ressent l’apatride qui, paradoxalement, par son retrait par-tiel, ressent d’autant plus nettement les marques et les symptômes de cetteabstraction qu’on appelle « l’esprit du temps ». La relative prolifération desétudes critiques de l’œuvre cioranienne à laquelle on assiste depuis une quin-zaine d’années témoigne en quelque sorte des réverbérations de sa réflexionsur les préoccupations contemporaines, qui reflètent un inconfort existentielet spirituel certain. C’est dire que Cioran, cet « exilé dans le temps », estaujourd’hui actuel malgré lui ; son malaise faisant écho au nôtre. La pro-fondeur, la densité de même que la charge philosophique de cette œuvre, dece malaise traduit en une somme de textes, nous invitent à dépasser les symp-tômes fades du Zeitgeist tels que l’habituelle crise de la quarantaine, la sur-charge sexuelle ou le cynisme généralisé, thèmes chers à plusieurs écrivains
VOL. 50, NO. 3 127
SARA DANIÈLE BÉLANGER-MICHAUD
français contemporains (Houellebecq en tête de liste). Cioran nous invite surses traces, dans le sillage de son venin, à nous détruire ou nous guérir eningurgitant le remède ambigu—le pharmakon—que constituent ses textes.
Université de Montréal
Notes
1. Nancy Huston, Professeurs de désespoir (Paris: Actes Sud, 2004). 2. Olivier Bardolle, La Littérature à vif : le cas Houellebecq (Paris: Esprit des péninsules,
2004), 56.3. Michel Houellebecq, Les Particules élémentaires (Paris: J’ai lu, 2000), 8.4. Giorgio Agamben, « Qu’est-ce que le contemporain ? », Nudités (Paris: Payot et Rivages,
2009), 24.5. Emil Cioran, Cahiers 1957-1972 (Paris: Gallimard, 1997), 66.6. Emil Cioran, La Tentation d’exister, Œuvres (Paris: Gallimard, 1995), 889.7. Emil Cioran, La Chute dans le temps, Œuvres (Paris: Gallimard, 1995), 1097.8. Sylvie Jaudeau, Cioran ou le dernier homme (Paris: José Corti, 1990), 83.9. Emil Cioran, Aveux et anathèmes, Œuvres (Paris: Gallimard, 1995), 1651.
10. Emil Cioran, Sur les cimes du désespoir, Œuvres (Paris: Gallimard, 1995), 52.11. Emil Cioran, Le Mauvais Démiurge, Œuvres (Paris: Gallimard, 1995), 1226-27.12. Jacques Derrida, « La Pharmacie de Platon », La Dissémination (Paris: Seuil, 1993), 87.
128 FALL 2010
L’ESPRIT CRÉATEUR
The Sad State of Post-structuralism
Geoffrey Gilbert
TO THINK TODAY IN FRANCE is to give the present moment a his-tory which must of necessity be arbitrary. Today in France began inBritain in 1993, for me. This history is more than arbitrary insofar as
it engages with some kinds of symptom and blockage in the present which arekey for ways in which some people think, today. France, as a site of theory,became a problem for me around 1993; I wanted France to be the place oftheory, of what we then called post-structuralism. I think that many of us stillhope for something like this from France, but—as this essay will try toexplain—that hope is aligned with a certain failure of worldiness. The wish-ful construction of French theory (a construction which happens to a certainextent within institutions in France and to a certain extent within institutionsof the Anglophone academy) is to some extent wilful denial of relationsbetween France and other parts of the world, the replacement of France in theworld with a place of theory. The sadness—the sad state of poststructuralismwhich this essay will chart—measures both the loss of the world attendant onthe construction of theory, and the fears of its heavy return.
I began to think about this question in 1993 when I was writing about Wyn-dham Lewis, the British modernist writer and painter. In 1931, he had just pub-lished Hitler, his apology for National Socialism. Partly to escape the conse-quences of this act, he set out immediately for the Maghreb, for the Frenchterritories of North Africa. According to Filibusters in Barbary, his account ofthe trip, he planned to travel in search of the Berber nomads of the WesternSaharah, a group who had successfully resisted domination by colonial power.He initially identifies his authorship with this position of dissidence.
But he soon discovers that this project is impracticable. “No European, Idiscovered to my extreme astonishment, is able to set foot upon these forbid-den sands and steppes.” He is forced to stop “short of this line of dissidence.”1
Cultural identity has interrupted the possibility of material identification. Thetrope of identification persists: Lewis continues to speak of himself asnomadic, mobile, evasive of consolidated structures of power, but in theprocess the Berber people have disappeared, de-materialised. In a furtherrevealing move, Lewis aligns his authorship with Lyautey, the ex-Governer ofthe protectorate of Morocco. Lyautey’s policy was to use the mobile systemsof power within the territories he policed, rather than to introduce centralisedstructures of government. For Lewis, “he had the secret, better than any eng-
© L’Esprit Créateur, Vol. 50, No. 3 (2010), pp. 129–143
lish [sic] administrator, of ‘colonization’” (Lewis 141), because he left“everything scrupulously just as he found it” (Lewis 143). There was, Iwanted to suggest in 1993, a significant identity of project between Lewis’stwo books of 1931-32. The dematerialised nomadism of the author is the onlyposition available outside the established totalitarianism to which he submit-ted in Hitler. This nomadism evades power, while leaving it in place.
It is clear that, after Hitler, Lewis’s was not going to be the dominantmodel for modernist writing. That situation, of course, has continued: Joycerepresents the “successful” route experimental writing took through the poli-tics of the twentieth-century; Lewis marks the disaster, as the archetypal “fas-cist modernist.”2
But if we think about the Lewis of Filibusters in Barbary, the situationbecomes more complex. The terms in which Joyce was celebrated in the post-structuralist readings of Joyce that were developed in France from the 1960sonwards, and which determined much of the appeal of Joyce for theory in themid 1990s, are distinctly parallel to the terms that materialise around Lewis inNorth Africa. For Blanchot, in a work translated in 1994, Joyce exemplifiesthe “space of literature,” a deterritorialised mobility opposed to the “pagan”rootedness of “culture.’”3 As one critic summarised in 1994: “Joyce expandsthe universe of his language beyond any boundary yet defined,”4 and thatexception or excess is not related to any particular boundary, but to all bound-aries. The space of literature, as celebrated in Joyce, is outside culture, in thespace of a de-materialised nomadism (and this is sometimes guaranteed byJoyce’s own “condition of exile”: for Julia Kristeva, in work written in 1988and translated in 1991, “James Joyce had to be [a] foreigner”5). In 1994,building upon Hélène Cixous and Kristeva (as well as Gilles Deleuze andFélix Guattari), Rosi Braidotti generalized a definition of “nomadic subjec-tivity” to give body to this mode of critique as escape: “The nomadic style isabout transitions and passages without predetermined destinations or losthomelands. The nomad’s relationship to the earth is one of transitory attach-ment and cyclical frequentation; the antithesis of the farmer, the nomad gath-ers, reaps, and exchanges but does not exploit.”6
This textual condition, an écriture of nomadism, was defined by an ideal-isation that is also an etherialisation. It placed the nomad subject absolutelyoutside the settled fields of conceptuality or power, where no material nomadcould ever exist. This Joycean condition, the doubling of the nomad by textu-ality, was in danger of resembling that of Lewis as he moves from Hitler toBarbary, implying an equation rather than an opposition between Joyce andLewis.
130 FALL 2010
L’ESPRIT CRÉATEUR
The historical condition for this odd equation includes the rise of struc-turalism to institutional legitimacy—perhaps even to hegemony—in France inthe period after the second world war.7 With the promotion of Lévi-Strauss’swork to a model for the study of literature, politics, and history, come appar-ently contingent effects. Primary among these is the marginalization ofAfricanist anthropology, including, centrally, the political anthropology ofsub-Saharan Africa by Georges Balandier.8 Balandier suggests that the con-tingent effect of the choice of structuralism—the turning away from Africa—may be systematic. Dealing with deep and equilibrated structures, structural-ist ethnography has only one mode for registering the kinds of evidence thatthe struggles for decolonisation present: a kind of elegiac fatalism or mourn-ing of lost traditions.
This distancing of structuralism—from Africa in general and from Alge-ria in particular, involved in a war of independence from France from 1954 to1962—is over-determined by institutional logics. For François Dosse, “struc-turalism” finds its definition through a battle for leadership of an oppositionalacademy, against the idea of Sartrean commitment, against the existentialMarxism which informed—problematically—some of the terms in which theindependence movements in Algeria were imagined. In 1995, Kristin Rossnoted that there were two academic-political discourses that defined them-selves around the term “new man” in the fifties and sixties: the “new man” ofstructuralism (the absent subject of supervening structures), corresponds neg-atively with the “new man” of Algerian nationalism, with its call for existen-tial marxist wholeness as a motor of revolution.9 Intellectual and institutionaltrajectories prevent any resolution between these two terms.
On that structuralist ground, broken from Africa, the post-structuralistmodels (where post-structuralism, as has been widely noted, is a term nativeonly to the Anglophone field of theory) of textuality that would inform thevalorisation of Joyce were constructed. The genesis of these models can beseen through the journal Tel Quel, founded in 1960. This is one of the journalswhich brought together the range of writers that defined French theory for meand others in Britain and the USA (Derrida, Barthes, Foucault, Kristeva, andCixous write there, as do Bataille and Genette, and Lacan and Althusser areregularly cited).10 The journal aligns their work with a body of literary writ-ing (contemporary writers like Phillipe Sollers, the virtual editor of the jour-nal, and an alternative “canon” of writing, prominently including Joyce) inrelation to which the notion of écriture would be defined. Its title, and the quo-tation from Nietzsche (“je veux le monde, et je le veux tel quel”) which standsas epigraph in the early years of the journal, place it squarely in opposition to
VOL. 50, NO. 3 131
GEOFFREY GILBERT
the Sartrean position of the committed intellectual. In 1960, this stance wasread as a programmatic separation of the concerns of the journal—and its ideaof écriture—from engagement with the war in Algeria.11
Read outside all notions of representation The theorist who first defines the model of textuality which Tel Quel prop-
agates isn’t Barthes or Derrida, but Michel Foucault. Sollers reviews his bookon Raymond Roussel in the most positive terms: “His Roussel […] is the mostexplosive critical book of these last years. One almost wants to call it TheBirth of Critique [Naissance de la critique].”12 Roussel’s work, producedbetween 1910 and 1932, is a methodical and unhinged excavation of theFrench language. Foucault’s book is a careful exposition of Roussel’s variousprocesses and a theoretical adumbration of the thoughts on language implicitin it: of the way in which stories are born from the “disease of language.” Fou-cault stresses that the productivity of this language comes from its refusal ofrepresentation. It “doesn’t want to double the reality of another world, but, inthe spontaneous doublings of language, it wants to discover an unsuspectedspace, and to cover it with things never yet said.”13 He is rigorous in denyingthat reference has any place either in a decoding of these texts or in the theo-ries of language that can be developed from it.
The two texts to which Foucault gives most time in his book have paral-lel titles: Impressions d’Afrique (1910), and Nouvelles Impressions d’Afrique(1932). It’s clear that we can’t decode these books as‘really having Africa astheir referent, as representing Africa. Roussel travelled widely, but he sug-gests, parenthetically, in his posthumous “manual,” Comment j’ai écrit cer-tains de mes livres (1935), that “from all my travelling I have never got any-thing for my books.” But something significant happening here: “Africa” is anon-arbitrary name for the studied disavowal of reference. Foucault himselfbecomes caught in this same pattern: citing the words which do not referbrings him into the play of geographical difference. Having defined the“tropological space” of an early text, he contrasts it with Impressionsd’Afrique. “The same slightly monotonous voice as in the youthful narratives,the same words, precise, tense and flat. Yet it seems to me that it’s no longerthe same language speaking, that Impressions [d’Afrique] was born on anotherverbal continent” (Foucault 42). This “other continent” has no referent ofcourse, but the name for the refusal of reference is “Africa.”
This pattern makes some sense in relation to debates about the French lan-guage within French colonisation. For some the language was taken to bearthe Enlightenment principles that informed the imperial project in Algeria. To
132 FALL 2010
L’ESPRIT CRÉATEUR
become part of France was available to all: those North Africans whorenounced Islam and learned French were called ‘evolué(e)s’ [evolved],14 andsome measure of citizenship was available to them. The French language per-forms this evolution. But this opening to assimilation—bringing Algeriawithin France, within its language—was also the site of substantial anxietiesin the metropolitan centres of France. It invoked anxieties about a “reversecolonisation,” with a wresting of the language from its origins, anxieties aboutFrance’s being, in Roussel’s period, expansionist and therefore like Ger-many,15 or, in Foucault’s, France’s being to Algeria as Germany was to Franceduring the occupation. The post-structuralist supplementation of referencemay be doubled already by an “impression of Africa,” an anxious mark left onthe ideal of the language by the attempted incorporation of a dissident Africa.
Something may resonate in the uncontrollable ironies of Sollers’s praise.Hailing this book as the Naissance de la critique, he refers to Foucault’s otherbook of the same year, Naissance de la clinique. That text describes the move-ment away from openly barbaric systems of treatment towards a more subtledisciplinary technique. Might the post-structuralist dogma about non-referen-tial textuality have its own disciplinary effects?
In 1970 Pierre Guyotat published his second novel, Éden, Éden, Éden.16
His first novel, Tombeau pour cinq cent mille soldats (1965), had come to theattention of Tel Quel. He began to attend their colloquia and to publish occa-sionally in the journal. Éden, Éden, Éden is his programmatic Tel Quel novel,a perfectly theoretical fiction. It is an extraordinary text: a continuous streamof prose in which a series of fluids and body parts, loosely connected withsociologically-particular bodies (a butcher, soldiers, male and female prosti-tutes, dogs) are placed in relations of sex and torture. It illustrates perfectlythe kinds of theory—of the pulsional drives of the semiotic, of the relationsbetween desire, revolution, and language—that Tel Quel is interested in at thismoment (which opens perhaps its most sustained period of interest in Joyce).
Guyotat gives an interview to Tel Quel on the publication of the book inwhich he explains the workings of the text.17 He wrote it first as a relativelystraightforward narrative, then he rewrote a texte sauvage, whose subtext isalways “my other hand is masturbating,” then a third draft formalised the tex-tual relations produced by this second, scandalous, process.
In accordance with the theories of the journal at this time, this textualprocess bears political weight. “EEE was written according to my gradualalignment with communism, and also with the ideas of Tel Quel” (Guyotat,“Réponses” 28). He places the “scientificity” of his text in relation to Derrida,
VOL. 50, NO. 3 133
GEOFFREY GILBERT
Barthes, and Sollers in order to stress that this its politics do not operatethrough representation: “EEE should be—must be—read outside all notionsof representation” (28). This claim accords with the notion of politics that hadinformed the journal. The editorial in the May 1968 issue of Tel Quel wascalled “La révolution ici maintenant” (the revolution here now), where thehere and now are taken to refer to the present of textual production (asopposed to the there and then of the activity on the streets of Paris). The edi-torial argues that to ignore the “specific level” defined by a theory of signifi-cation is to be guilty of “theoretical regression” and deviance.18 This argumentstarts to realize the disciplinary ironies of Sollers’ naissance de la critique,shadowing the ironic confinement involved in substituting a “revolution ofthe word” for the activities of subjects.
The interviewer (Thérèse Réveillé), however, points to what appears to bea representational substrate to Guyotat’s novel beneath its fully theorisedspace of signification. Its gestures take place in a desert space, populated byparts of the bodies of soldiers; there is a clear difference in the colours of theskins of the male prostitutes and some of the other characters; some phrasesin the novel approach the Tamacheck dialect. Réveillé asks about the relationbetween text and world.
At least on the surface this relation is the direct product of a biographical fact—not randomchance, but historical constraint: military service and the war in Algeria. […] I crossed thoseregions part of the time as a semi-slave (second class citizen, subject to the whims of the officers,to the point of interrogation and imprisonment), partly as a ‘nomad’, as non-citizen of the terri-tory I crossed. […]
Which goes to show that I didn’t take either background color or ethnographic documents asthe basis of my text, from these journeys, but rather a mobility [motricité]. (Guyotat 30)
A non-accidental historical context motivates a textual space—somethingwhich burgeons towards the possibility of representation—which is thenturned into the “nomadic” principle of non-representational textuality (the‘motricité’ or pulsion of desire in textuality). The revolutionary politics whichthis text avows are directly produced from the disavowal of Algeria as refer-ence,19 and the sequent dispersal of the principle of Algeria throughout textu-ality. Here again we have a structuring of the idea of “revolutionary textuality”around the studied—theorised—denial of a posited representation of Algeria.
Mania and melancholiaKristin Ross, in Fast Cars, Clean Bodies: Decolonization and the Re-
ordering of French Culture, related the project of structuralism to Algerian
134 FALL 2010
L’ESPRIT CRÉATEUR
revolutionary nationalism, and in doing so pointedly marked the impossibil-ity of politics for high structuralism.
Structuralists would argue (and did) that by suppressing “man” they were not suppressing“real men.” They were suppressing the mask, the image that concealed bourgeois domination;they were concerned mainly with “man” as an ideological myth, a philosophical concept with aparticular theoretical function. In this way structuralism avoids ambiguity. But what of those his-torical situations where “man” has actual political effects, where it constitutes a political demand?Structuralist Marxism must ignore those situations (as it ignored Africa) where “man” becomes arallying cry; it avoids ambiguity at the price of being nothing more than a theory of representa-tion. The distance separating the new structural man from Fanon’s new man is the distance sep-arating “equilibrium” from”dialectic.” […] Science could have nothing to do with revolutionaryaction (Ross 63)
In the surpassing of structuralist equilibrium in “revolutionary textuality,”what has happened to the form of this problem? The text has taken the placeof revolutionary action, it incorporates it through etherialising it, denying it asrepresentational ground. As we get closer to 1993, this non-material incorpo-ration of the dead subject—Algeria, man, revolutionary action—produces themelancholia of post-structuralism.
Julia Kristeva was a member of the Tel Quel editorial committee from1967. Her 1988 book, Strangers to Ourselves opens with a “Tocatta andFugue for the Foreigner.” This designation is explicated in a way whichshould now be familiar.
Tocattas and Fugues: Bach’s compositions evoke to my ears the meaning of an acknowledgedand harrowing otherness that I should like to be contemporary, Because it has been brought up,relived, disseminated, inscribed in an original play being developed, without goal, without bound-ary, without end. An otherness barely touched upon and that already moves away. (Kristeva 3)
This is a work of ethics, calling, within the difficulties of contemporarynationalism, for a recognition of foreignness, a difference from the self thatKristeva wishes to promulgate and disseminate. We should all becomenomadic foreigners to ourselves in order to “lighten” the burden of the experi-ence of the consolidated differences between particular groups. We can recog-nise here the theories of textuality developed in Tel Quel. The non-dialecticaldifference incarnated for theory in écriture (Joyce is again a point of referencefor Kristeva) now figures “foreignness”, an ethical principle of subjectivity.
There are several moments in Kristeva’s text when a vision of the ethicsof foreignness comes into contact with representations of particular foreign-ers; something of the worldliness of this thought is tested there. In thesemoments, this ideal being takes the form of an impatient imperative. For
VOL. 50, NO. 3 135
GEOFFREY GILBERT
example, she asserts that “The foreigner is the one who works” (Kristeva 17).This is a way of asserting a transferable quality, which can take root every-where because it is not tied to anywhere in particular. At the time of her writ-ing, there was disproportionate unemployment in France among people ofNorth-African origin. So she adds a corrective adjustment:
With the second generation, it is true, it happens that these demons for work slacken. As adefiance of industrious parents, or an inevitably excessive aping of native behaviour, the childrenof foreigners are often and from the very start within the code of dolce vita, slovenliness, andeven delinquency. Many “reasons” are given for that, of course. (Kristeva 18)
That’s the end of the paragraph, and the subject. These “children of for-eigners” have slid away from their ideal state. None of the “reasons” whichKristeva puts in scare quotes—presumably sociological and political—aresufficient to quiet her evident impatience with their failure.
This moment glancingly contacts North Africa (see Kristeva 9 for anotherexample). But again, it is in the systematic disavowal of a relation of the posi-tion of foreignness to the Maghreb that her idea of foreignness is completed.Discussing Camus’s L’Étranger, she notes:
The strangeness of the European begins with his inner exile. Mersault is just as, if not more,distant from his conationals as he is from the Arabs. At whom does he shoot during the imporoushallucination that overcomes him? At shadows, whether French or Maghrebian, it matters little—they displace a condensed and mute anguish in front of him, and it grips him inside. (Kristeva 26)
For Kristeva, by stifling his own foreignness Mersault consolidates it andexpresses it in a murder of which he is not the agent. The condensation of thisunmanaged foreignness has nothing to do, for Kristeva, with the scene, whichengages the improperly immobile categories of French or Arab. The Maghreb“matters little” for Kristeva, but it is through this indifference, by emptying outthe space which it appears to occupy, that a space is made for the foreignnesswhich she promotes. At the same time, Algeria is insistently indicated, to beconstantly re-translated into the psychic-ethic drama of the ideal foreigner.
In an interview given in 1993, shortly after the English publication ofStrangers to Ourselves, Kristeva extrapolates policy from these ethics. Shesuggests that we need a “good image of the nation,” a “self-assurance,” inorder to support the “grafting of other cultures from outside France.”20 Shesees some hope in the image of nations within the European community, andrefers to her participation in a televised discussion on “the European mental-ity.” The interviewer asked her about whether there were representatives fromNorth Africa or Turkey:
136 FALL 2010
L’ESPRIT CRÉATEUR
No, it was on the European community. There were already plenty of problems with eachperson speaking his or her own language, with simultaneous translation; it was necessary to do itwith one idea, which was “Europe.” And there was some money from the European community.Though there should be similar programs for the Mediterranean. I think very much that, aftersome consolidation, a Europe should address the question, “What is going on in the Mediter-ranean?” And then enlarge the Community into the Maghreb. (Kristeva, 180)
The recognition of “foreignness” as something ici maintenant to be managedtheoretically within the subject, rather than a worldly relation with material posi-tions, has led to an identificatory leap. This is Kristeva as James Joyce as Wynd-ham Lewis as General Lyautey, doubling etherialised foreigness as a mode ofcolonisation. My observation is not that her solution is wrong, but that it is moti-vated by the history of theory, of trying to establish a place of theory in France.
Around 1993 we could see, within a particular brand of post-structuralistpost-colonial thought, a continuing failure to grapple with this history, withsimilarly symptomatic result.21 The failure is evident, and the symptoms atwork, in one article from a Yale French Studies special issue on exile andFrancophone writing. It deals with the work of Isabelle Eberhardt, theGenevan-born Russian woman who, at the beginning of the twentieth century,century, lived as a man in Algeria and Morocco, penetrating deeply into theSaharah and into the intimate spaces of Maghrebin life. Eberhardt’snomadism is “concommitant with her vocation as a writer”22; a significantequation is made between her textuality and her mode of living.” “By inter-twining oral and written literary materials and incorporating indigenousethnographical and anthropological elements into her fiction, Isabelle deterri-torialized, in the sense made familiar by Deleuze and Guattari, the content ofher writing completely and radically” (Abdel-Jaouad 116).
Deterritorialisation, nomadism, and foreignness are made “familiar” bytheory, turned into a textuality that doubles the nomad, and is aligned with thatof Joyce, and of Joyce’s characters. The article is subtitled “Portrait of theArtist as a Young Nomad.” Further, this Joycean nomadics is presented as anancestor and a model for a literature of decolonisation: “Isabelle was anancestor to at last three generations of Maghrebian Francophone writers”(Abdel-Jaouad 117). This form of writing is idealised as the appropriate modefor contemporary writers in Algeria in which to respond to and evade the his-tory of colonisation. Tel Quel textuality moves into the Maghreb; part of Eber-hardt’s journeying was done at least under the protection of, and probably inthe service of, Lyautey’s colonial administration.23
We have moved past the “mourning” of structuralism, which gains its com-pleted consciousness—the science of man—at the cost of the death of his
VOL. 50, NO. 3 137
GEOFFREY GILBERT
agency. I suggested that this mourning is inaugurated in a turning away, awayfrom Africa, away from the event, rendering both as an exterior to knowledge.If, for Freud, mourning is characterised by the assembly of the lost object, put-ting it together in order to put it away, melancholia does not know what it haslost. The agency outside cannot be the real revolution, but it disseminateswildly through the space of non-representational textuality, of writing withoutboundaries and limits. Algeria, in some significant cases becomes the name forthe dead subject that plays through French textuality, for the impossibility ofreferent in the revolution of the word. Nomadism—the happy fugue of Kris-teva’s foreigner—is the manic mode of subjectivity that shadows that death.
The disenchantment of the worldIn 1993, that is where I was blocked. Theory “in France” was a thrilling
space, endlessly foreign, but its happiness could not be brought to bear on theworld, did not indicate a world in which people could responsibly live. It wasshadowed by a painful return of a repressed representation of material historyand material relations. In many ways, the despondent search for the nextFrench theorist seems still locked into this same logic. The work of KristinRoss suggests that the whole problematic has an inaugural scene: the failureto bring a relation to bear between the “new man” of structuralism (the deathof the subject) and the “new man” of North African independence move-ments. There is a figure she does not discuss—Pierre Bourdieu, the sociolo-gist whose career began with structuralist ethnographic work in Algeria at thetime of the French-Algerian war—who seemed well placed to intervene intothis blockage.
Bourdieu moved beyond the structuralist model for two reasons. Firstly, ithad no way of registering the situation that surrounded and enabled ethnogra-phy as a science:
however great the effect of respectability and encouragement that can be induced, unconsciouslyrather than consciously, by the fact that a problem or a method comes to be constituted as highlylegitimate in the scientific field, this could not completely obscure for me the incongruity andeven absurdity of a study of ritual practices conducted in the tragic circumstances of war. Thiswas brought home to me again recently when I rediscovered some photographs of stone jars, dec-orated with snakes and intended to store seed-corn; I took these photographs in the course of fieldwork in the Collo region, and their high quality, although I had no flash gun, was due to the factthat the roof of the house into which they were built had been destroyed when the occupants wereexpelled by the French army.24
The clarity of structuralist consciousness depends here on an under-analysed point of view, articulated with a colonial war.
138 FALL 2010
L’ESPRIT CRÉATEUR
Secondly, it became clear to Bourdieu that the problem with completingstructuralist analysis didn’t lie primarily in the difficulty of understanding oneculture from the position of another, but rather in the relation between theoryand praxis. Culture coheres for theory in a different way than it does for theagents who inhabit it:
One of the practical contradictions of scientific analysis of a practical logic lies in the paradoxi-cal fact that the most coherent and also most economical model, giving the simplest and most eco-nomical account of the whole set of facts observed, is not the principle of the practices which itexplains […]; or—which amounts to the same thing—that practice does not imply—or ratherexcludes—mastery of the logic which is expressed within it. (Bourdieu, Logic 11)
Thus Bourdieu moves beyond structuralism in two ways: through ananalysis of habitus, the practical logic through which individuals successfullyinhabit and negotiate their culture; and by aiming to understand the positionthe theorist—the sociologist or the ethnographer—occupies.
Habitus offers a place for the subject within objectified structures. Thehistory of the particular agent informs her capacity to act successfully in herparticular field, to negotiate it as well as to internalise it; and in acting, cul-tural structures are reproduced or transformed. The focus has changed radi-cally from structuralism. Individuals are not the empty products of structure;their actions register and reproduce their own conditions. This space for thesubject has at least the horizon of freedom: there is no properly theoreticalreason why any action should not be possible for any individual.
But while theory leaves a place for freedom, in each of Bourdieu’s analyseshabitus appears as radically straitened. The potentially creative interactionbetween habitus and structure in each case collapses to a described determinism,the perfect reproduction of structures. While the near circular relationship of nearperfect reproduction is only a particular case of the possible, in each case, this isthe result at which his analyses arrive. This closure is often seen as a problem:that for all the ambition of his theory, his practice relapses, as one critic puts it“into a reproductive schema within which actors circulate like so many ghostshaunting the healthy operation of the structures they served” (Dosse 2:311).
In The Logic of Practice, Bourdieu’s fullest statement of general socio-logical theory, he reprints, as an appendix, his early essay “The KabyleHouse,” which he admits “remains within the limits of structuralist thought”(Boudieu, Logic 316-17 n1). There is no priority given to the subjects of prac-tice here. The essay’s inclusion might be taken to acknowledge the identity ofhis new position and the structuralism from which it claims to emerge. Thisessay comes from the period of his fieldwork in Algeria during the revolu-
VOL. 50, NO. 3 139
GEOFFREY GILBERT
tionary war; one of its earlier places of publication is in the collection Alge-ria, 1960. It is accompanied there by a long and wonderful essay called “TheDisenchantment of the World.” There, the coherence of the structures of exis-tence is seen as subtended by a formal disenchantment. The field of meaningsgenerated in the Kabyle house is no longer adapted to the conditions withinwhich the house is situated; its meanings do not work in the structures of colo-nial government, in relation to the strategic land laws introduced by theFrench, within the new modes of economics which have developed in theindustrial centres. The meanings stabilised in the structuralist analysis of theKabyle House are not reflected in the world.25
This dislocation of meaning from the world is what generates the disen-chantment of Bourdieu’s title, a disenchantment that functions as a furtherhorizon for habitus. It is the lived experience of the death of the subject, theexperience of reduction to your sociological objectification, the experience ofthe practical impossibility of the theoretical promise of freedom due to themournful supervention of structures in analysis and in historical eventuality.Disenchantment is one side of this experience, one affect that causes structuralposition to appear, as an affect, within consciousness. The other side is alsoarticulated in Bourdieu’s early work in Algeria, for example in the followingpassage in which he defines “colonial traditionalism”:
ways of behaviour which in appearance had remained unchanged were really endowed with avery different meaning and function, because of the fact that they were now set in relation to atotally new frame of reference. The veil and the chechia, for example, had been in the traditionalcontext mere vestimentary details endowed with an almost forgotten significance, simple ele-ments of an unconsciously devised system of symbols. In the colonial situation, however, theytake on the function of signs that are being consciously utilized to express resistance to the for-eign order and to foreign values.26
This formulation, where traditions “take on the function of signs that arebeing consciously utilized,” neither ascribes agency fully to the inhabitor of thetradition—it isn’t exactly her consciousness—nor overwrites the subjectentirely—it isn’t just the consciousness of the ethnographic observer. Rather, theidea of revolutionary consciousness is built into objectification, in the form of anaffect. Consciousness of the very death of the subject is shared between the sub-ject and ethnographer as affect and appeal. It gathers its meaning both from thecolonial situation and from the revolutionary future which that appeal demands.
The inclusion of the “Kabyle House” essay within The Logic of Practicemarks an acknowledgement that the horizon of freedom theoretically avail-able to habitus will be practically denied. But it also indicates that disen-
140 FALL 2010
L’ESPRIT CRÉATEUR
chantment will be registered as an appeal or a demand within the construc-tions of knowledge. This may be a resolution of the relation between the struc-turalist “new man” and the “new man” of the event; but it resolves it only inappealing to worldly relations within which knowledge can be made to matter.This is the sad, sane alternative, it seems to me, to the position of theory thatdeveloped from an Anglophone organisation of post-structuralism out of the“révolution ici maintenant” moment.
In 1993, La Misère du monde was published under Bourdieu’s direction.27
It aimed to study “the major foundations of petty-bourgeois misery or, moreprecisely, of all petty misery, all the limitations placed on freedom, on wishes,on desires, which encumber life with worries, disappointments, restraints, fail-ures, and also, almost inevitably, with melancholia and ressentiment”; and itconnected this social suffering to the “recent demands of non institutionalisedforms of protest.” 28 The book consists in the most part of transcriptions ofinterviews with a series of individuals—often recent immigrants—in a varietyof states of unhappiness. The very limited sociological apparatus surroundingeach case simply doubles this construction: it demonstrates the inevitabilityand the predictability of their disenchantment. Such sociological generalisa-tions as frame and occasionally interrupt this document in disaster refer to themanagement of symbolic violence in the interview, to ways in which theoppression experienced by these interviewees is in danger of being reinforcedin the interview situation. Thus the work responds to the second of Bourdieu’spost-structuralist imperatives: it objectifies the position of the observer. Theseinterviews are potentially crushing for their objects and troubling for the soci-ologist. Instead of being theorised or corrected for, that affect was transmitted.It was taken out into the culture that contains and produces this misery, asworldly urgency and challenge and relation. This politics of post-structuralknowledge is sane and appropriate, a result of Bourdieu’s having managedacceptably the passage between the history of his thought and its worldliness(as instanced in its engagement with French-Algerian relations). The objectifi-cation here—the death of the subject—is not traversed wildly by a manic andnomadic textual energy, nor is it an act of mourning which produces a cleansedbut merely theoretical consciousness; it is heavy, cultural, sad.
This version of 1993 opens up a route to the present moment, to today inFrance, that enables me to live and think here. Since Bourdieu’s death in2002, his post-structuralist work has been continued in a range of modes,which are not receiving a great deal of attention beyond France and to whichI shall simply gesture here. La France invisible (2006) is a study of contem-porary precarity, of the modes of living which are hidden behind the numbers
VOL. 50, NO. 3 141
GEOFFREY GILBERT
that claim to represent them. It acknowledges its debt to La Misère du mondein supporting the ambition to allow writing to connect local nodes in the prob-lems of how to articulate living and thinking together (and also a changingscene for the funding of social research in France that makes a project on thescale of La Misère du monde difficult to imagine).29 In 2004 Stéphane Beaud,one of the editors of La France invisible, published, with “Younes Amrani,”a text called Pays de malheur, which is difficult to classify.30 The bookemerges from emails Amrani sent to Beaud after having read Beaud’s brilliantaccount of the failure of education reforms.31 Recognition of himself within asociological objectification leads here to affects (including, clearly, consoli-dated disillusionment), which are held in place by conversation—a series ofemails and telephone calls and meetings over a year. The process constitutesa sociological auto-analysis and a social relation. Like Bourdieu’s work inAlgeria, it establishes a solid affective ground where theorisation and livingcan be held tight together, where thought must be worldly. Amrani can objec-tify his own position and transmit the affects attendant on his own unfreedom,as an appeal to readers and challenge to the thought of France today.
The American University of Paris
Notes
1. Wyndham Lewis, Filibusters in Barbary: Record of a Visit to the Sous (London: Graysonand Grayson, 1932), viii-ix.
2. I have written about the agon between Lewis and Joyce in “Words, Flies, Jews, Joyce, Joint:Wyndham Lewis and the Unpublishing of Obscenity,” Critical Quarterly, 86:4 (2004): 1-21. A fuller history is given by Scott Klein, The Fictions of James Joyce and WyndhamLewis: Monsters of Nature and Design (Cambridge: Cambridge U P, 1994). On Lewis as“fascist modernist,” with careful attention to Hitler, see Frederic Jameson, Fables ofAggression: Wyndham Lewis, the Modernist as Fascist (Berkeley: U of California P, 1979);Andrew Hewitt, “Wyndham Lewis: Fascism, Modernism, and the Politics of Homosexual-ity,” ELH, 60:2 (1993): 572-44.
3. Maurice Blanchot, The Infinite Conversation (1969), Susan Hanson, trans. (Minneapolis: UMinnesota P, 1993).
4. David Spurr, “Myths of Anthropology: Eliot, Joyce, Lévy-Bruhl,” PMLA, 109:2 (1994): 278.5. Julia Kristeva, Strangers to Ourselves (1988), Leon S. Roudiez, trans. (New York: Har-
vester Wheatsheaf, 1991), 21.6. Rosi Braidotti, Nomadic Subjects: Embodiment and Sexual Difference in Contemporary
Feminist Theory (New York: Columbia U P, 1994), 25. For a critique of the use ofmetaphors of nomadism in Deleuzean and other theories of textuality, see Christopher L.Miller, “The Postidentitarian Predicament in the Footnotes of A Thousand Plateaus:Nomadology, Anthropology, and Authority,” Diacritics, 23:3 (1993): 6-35. For a material-ist corrective to tropes like those of Braidotti, see Wolfgang Weissleder, “Introduction,” inThe Nomadic Alternative: Modes and Models of Interaction in the African-Asian Desertsand Steppes, Wolfgang Weissleder (The Hague: Mouton, 1978), xiii-xiv.
7. In this rapid historical sketch I draw heavily on François Dosse, History of Structuralism, 2vols (1991-92), Deborah Glassman, trans. (Minnesota: U Minnesota P, 1997).
142 FALL 2010
L’ESPRIT CRÉATEUR
8. By Balandier, see Sociologie actuelle de l’Afrique noire: dynamique des changements soci-aux en Afrique centrale (Paris: PUF, 1955); on Balandier, see Sally Folk Moore, “ChangingPerspectives on a Changing Africa: The Work of Anthropology,” in Africa and the Disci-plines, Robert H. Bates, V. Y Mudimbe, and Jean O’Barr, eds. (Chicago: U Chicago P,1993), 18-23.
9. Kristin Ross, Fast Cars, Clean Bodies: Decolonization and the Reordering of French Cul-ture (Cambridge: MIT, 1995), ch. 4.
10. For a useful overview of and selection from Tel Quel, see Patrick ffrench and Roland-Fran-cois Lack, The Tel Quel Reader (London: Routledge, 1998). One effect of reading throughTel Quel, or through ffrench and Lack’s selection, is to note how much material in the jour-nal indicates directions which “theory” in the Anglophone academy does not follow.
11. See “Déclaration,” Tel Quel, 1 (1960): 3.12. Phillipe Sollers, “Logicus Solus,” Tel Quel, 14 (1963): 50.13. Michel Foucault, Raymond Roussel (1963) (Paris: Folio, 1992), 25.14. Virginia Thompson and Richard Adloff, The Western Saharans: Background to Conflict
(London: Croom Helm, 1980), 186; for histories which consider French ideals in relation tocolonial practice and decolonizing resistance, see Mahfoud Bennoune, The Making of Con-temporary Algeria, 1830-1987: Colonial Upheavals and Post-Independence Development(Cambridge: Cambridge U P, 1988); and Abdullah Laroui, The History of the Maghreb: AnInterpretive Essay (1970) (Princeton: Princeton U P, 1977).
15. For a contemporary British reading of this set of affects, see for example Stephen H.Roberts, The History of French Colonial Policy, 1870-1925 (1929) (London: Frank Cass,1963), 3-33.
16. Pierre Guyotat, Eden, Eden, Eden (Paris: Gallimard, 1970). 17. Pierre Guyotat, “Réponses” (interview with Thérèse Réveillé], Tel Quel, 43 (1970): 27-34.18. “La Révolution ici maintenant,” Tel Quel, 34 (1968), 4. This manifesto was signed by sev-
enteen members of the collective, including Sollers and Kristeva. The positioning. in 1968and in commemorations since, of revolution within theory, against the worldiness of actionon the streets in Paris, and beyond it in the wider struggles of post-colonialism, is critiquedbrilliantly in Kristin Ross, May ’68 and its Afterlives (Chicago: U Chicago P, 2002).
19. That politics is expressed directly in the essays by Barthes, Sollers, and Leiris about the cen-sorship of the novel, published with the first edition, and reprinted in subsequent Gallimardeditions.
20. Julia Kristeva and Scott L. Malcomson, “Foreign Body: A Conversation with Julia Kristevaand Scott L. Malcomson,” Transition, 59 [ns 3:1] (1993): 177.
21. For a useful critique of this, see the work of Alain Boureau.22. Hedi Abdel-Jaouad, “Isabelle Eberhardt: Portrait of the Artist as a Young Nomad,” Yale
French Studies, 83 (1993): 93-94.23. See Laura Rice, ‘“Nomad Thought’: Isabelle Eberhardt and the Colonial Project,” Cultural
Critique, 17 (1990-91): 151-76.24. Pierre Bourdieu, The Logic of Practice (1980), Richard Nice, trans. (Cambridge: Polity,
1992), 3.25. Pierre Boudieu, “The Disenchantment of the World,” Algeria 1960 (1963), Richard Nice,
trans. (Cambridge: Cambridge U P, 1979), 1-94.26. Pierre Bourdieu, The Algerians (1958), Alan C. M. Ross, trans. (Boston: Beacon P, 1962),
156.27. Pierre Bourdieu, ed., La Misère du monde (Paris: Seuil, 1993).28. Pierre Bourdieu and Loïc Wacquant, An Invitation to Reflexive Sociology (Chicago: U
Chicago P, 1992).29. Stéphane Beaud, Joseph Confavreux, and Jade Lingaard, eds, La France invisible (Paris: La
Découverte, 2008).30. Younes Amrani and Stéphane Beaud, Pays de malheur: un jeune de cité écrit à un sociologue
(Paris: La Découverte, 2004). The text is difficult to classify partly because some new fictionin France is approaching a similar mode. See François Bon, Daewoo (Paris: Fayard, 2004).
31. Stéphane Beaud, 80% au bac … et après:les enfants de la démocratisation scolaire (2002)(Paris: La Découverte, 2003).
VOL. 50, NO. 3 143
GEOFFREY GILBERT































































































































































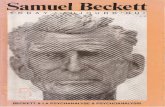






![« Penser l’histoire politique au Québec avec Pierre Bourdieu : précisions conceptuelles et défis pratiques [Éditorial] », Bulletin d’histoire politique, vol. 22, no 2, hiver](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6334521da1ced1126c0a445a/-penser-lhistoire-politique-au-quebec-avec-pierre-bourdieu-precisions-conceptuelles.jpg)

