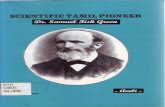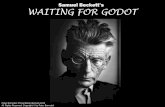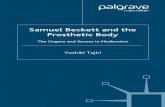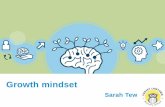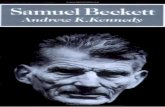ENTROPIE ET "ELAN VITAL" CHEZ SAMUEL BECKETT. 1996. in: Samuel Beckett Today/Aujourd'hui, N° 4....
Transcript of ENTROPIE ET "ELAN VITAL" CHEZ SAMUEL BECKETT. 1996. in: Samuel Beckett Today/Aujourd'hui, N° 4....
æ.§fr).,s .,::::.....:::..:,:l:i
.:J'','l'iia"*W,.:
,æ-'Ær=*t,
Samuel BeckettOU
.:.::.:.
..rltl,:iiiri:.lrl,, ;llrtl. , .. ,rrlr. .:et;â:r r",#*
Wtll#ffi
RD'HUIil
BECKETT & LA PSYGHANALYSE & PSYCHOANALYSIS
ENTROPIE ËT ELAN VITAL CHEZ BECKETT
L. Une littérature sans éthique?Au cours d'un des entretiens qu'il a eus avec Samuel Beckett, CharlesJuliet lui a demandé si une littérature sans éthique est concevable. Becketta répondu çomme suit:
Ce que vous dites est juste. Mais les valeurs morales ng sont pasaccessibles. Et on ne peut pas les définir. Pour les déf,rnir, il faudraitprononcer unjugement de valeur, ce qui ne se peut. C'estpourquoije n'aijamais été d'accord avec cettg notion de théâtre de l'absurde.Car là, il y a jugement de valeur. On ne peut même pas parler duvrai. C'est ce qui fait partie de la détresse. Paradoxalement c'est parIa forme que I'artiste peut trouver une sorte d'issue. En donnantforme à I'informe. Ce n'est peut-être qu'à ce niveau qu'il y auraitune affirmation sous-jacente.
(Iuliet, 27-28)
Non seulement Beckett se distancie du théâtre de l'absurde, avec lequelil est si souvent identifié, mais qui plus est, il s'en distancie en raison ducaractère éminemment nihiliste de ce genre littéraire. Affirmer que rienn'a de sens, c'est déjà donner un sens. Dire que rien ne vaut la peined'être entrepris, c'est déjà un jugement de valeur. Beckett reproche auxphilosophes de l'absurde que, pour eux, les choses sont tout aussi clairesque pour les apôtres de la morale. En revanche, lui-même semble vouloirs'abstenir de tout jugement de valeur. I[ ne s'agit pas là de nihilisme,mais d'une prudence poussée à l'extrême. Dès lors la question se pose:Samuel Beckett, étaiçil vraiment nihiliste?
2. Bthique et vision du monde2.1. Le nihilisme est généralement associé au pessimisme mais ces deuxattitudes face à la vie ne vont pas nécessairement de pair étant donné quele nihilisme rejette les valeurs alors que le pessimisme nie touteespérance. Le nihilisme est une attitude éthique, tandis que le pessimismeest un credo métaphysique.
2.2. Que sont des "valeurs"? Formellement, uns valeur se traduit par uneobligation ou par une interdiction. Elle prescrit ce qu'il convient de faire
t25
ou de pas faire dans une situation donnée. Le contenu de ces préceptes
dépend toutefois de ce qu'il est possible d'entreprendre ou d'éviter, car
la réalité fixe des limites à ces impératifs. Dans des sociétés codifiées, lavision du monde collective ou mythique remplace I'expérience et elle sertde repère lorsqu'il s'agit de déterminer ce que I'on peut ou non chercherà atteindre.
2.3. Une oeuvre littéraire peut, elle aussi, véhiculer une visiotr du monde
et les personnages peuvent évoluer au sein d'un univers qui a ses propres
lois. Dans de pareils cas, la dimension éthique de l'oeuvre (qu'elle soitapparente ou sous-jacente) dépend à son tour de cette vision du monde.Si l'oeuvre de Beckett contient pareille vision du monde, c'est-à-dire unmonde avec ses impasses, ses menaces et ses échappatoires, nous serions
tenus de nous en occuper lors de notre recherche de l'éthique de Beckett.
2.4. Question: Telle est la raison pour laquelle je pose les questions dans
cet ordre: y a-t-il une structure dans le monde fictif de Becketi et à quoiressemble-t-e11e? Qu'est-ce qui est réalisable et qu'est-ce qui ne l'est pas?
Et surtout: quel malheur peut y être évité? Ensuite, je me demande:quelles sont les valeurs contenues dans 1'oeuvre de Beckett et pourquoine peuvent-elles être rendues sous forme d'impératifs et d'interdits, mais
seulement insinuées par la forme?
2.5. Textes étudiés: Si la spécificité de l'éthique beckettienne a jusqu'àprésent échappé à I'attention de I'exégèse, cela tient surtout au fait que
la critique littéraire a négligé 1'essai Le monde et Ie pantalon (1945). Cetopuscule contient cependant des indications très claires concernant laconception du monde que Beckett a mise au point pendant sa périodemûre. De plus, ce texte représente la somme des démarchesphilosophiques que Beckett a entreprises dans ses romans Murphy (1938)
el Watt (écrit entre l94l et 1944). De ce fait, Le monde et le pantalonpeut être considéré comme un point culminant dans le développement de
Samuel Beckett. Mais avant d'aborder la lecture dt Monde et lePantalon, nous tenterons, dans la première partie de cet article, de
déceler les idées-forces qui, dans Murphy el Watt, préfigurent les
assertions éthiques contenues dans Le monde et le pantalon.
3. "Quid pro quo" - La formule du monde de MurphyMurphy passe ses journées dans un berceau, auquel il se laisse attacheret dont le balancement ininterrompu lui procure un intense sentiment de
bien-être. Soudain, son ataraxie est perturbée par les cris d'un colporteur.
126
Le passage suivant nous donne une indication concernant le monde de ceroman:
Quelque part un coucou, ayant sonné entre vingt et trente, devinti'écho d'un cri de marchand ambulant. L'écho se tut, le cri se
rapprocha, entra dans l'impasse et Murphy entendit: Quid pro quo!
Quid pro quo! C'étaient des choses qu'il n'aimait pas. Elles leretenaient dans le monde dont elles faisaient partie et dont lui osaitespérer qu'il ne faisait pas partie.
(Minuit, 5; Weidenfeld, 5-6)
Quid pro quot estune expression qui rappelle à Murphy la présence d'unmonde auquel il veut échapper. Elle donne à entendre que tout gains'accompagne d'une perte. Beckett laisse transparaître ce principe jusquedans 1es moindres détails du roman. Nous nous confinerons à l'exemplesuivant: lorsque le tuteur spirituel de Murphy, le mathématicien Neaiy,confie au bon vivant Wylie sa passion pour une certaine Miss Counihan,ce dernier se met à philosopher:
L'humanité, dit Wylie, est un puits à deux seaux. Pendant que I'undescend pour être rempli, l'autre monte pour être vidé.Ce que Mademoiselle Counihan me fera gagner, dit Neary, si je t'aibien compris, le non-Mademoiselle Counihan me le fera perdre,Très heureusement exprimé, dit V/ylie.Il n'y a pas de non-Mademoiselle Counihan, dit Neary.Il y en aura, dit Wylie.
(Minuit, 47-48; Weidenfeld, 37)
L;e qaid pro quo est la formule du monde (dans le sens de la"Weltformel" recherchée par le physicien Werner Heisenberg) deMurphy. On pourrait également la considérer comme la loi du manquetoujours pareil à lui-même. Elle régira désormais I'univers fictif deBeckett. Sa formulation la plus prégnante se trouvera quinze ans plus tarddans la réplique de Pozzo:
Les larmes du monde sont immuables. Pour chacun qui se met àpleurer, quelque part un autre s'arrête. Il en va de même du rire. Nedisons donc pas de mal de notre époque. Elle n'est pas plusmalheureuse que la précédente. N'en disons pas de bien non plus.N',en parlons pas'
(En anendant Godot, 44-45)
r27
C'est pour échapper à cette loi implacable de l'équilibre que Murphyexplore son intériorité et se lie d'amitié avec les aliénés. c'est dansf intériorité de Murphy que se produit ce que Leibniz appelait lafulguration (Monadologie, § 47). C'est ici que, sans cesse, de nouvellesformes sont créées et de nouveaux mondes sont conçus (weidenfeld,65-66). ce que Murphy ressent lors de la descente dans son propre espritpeut sans réserve être traduit en termes bergsoniens (Beckett s'étaitfamiliarisé avec la pensée de Bergson, étant donné qu'il l'avait traitéedans ses cours au Trinity college): dans l'intimité de sa vie intérieure,Murphy entre en contact aveç l'élan vital. Cependant, force est deremarquer que, dans l'univers romanesque de Murphy, ce devenirincessant ne se voit valorisé que dans la mesure où il ne quitte pas rasphère de I'intériorité et qu'il n'achève pas sa poussée vers l'être.
Les emprunts à l'enfer de Dante dans la description de cette couchecréatrice de I'esprit sont facilement reconnaissables; nombre d'exégètesl'ont déjà constaté. Il convient cependant également de remarquer quel'équation que Beckett établit entre le principe du devenir et une donnéemythologique représenrant le mal (l'enfer) est typique d'une visiongnostique du monde. Les gnostiques tenaient la création pour l'oeuvred'un ange rebelle et la rédemption par Ie christ comme le retour au dieuoriginel, jusqu'alors inconnu, et que l'on appelaille père Inconnu. Cerachat du monde impliquerait la purification de tout ce qui est terrestre.2Beckett était familier des gnostiques, comme en témoignent l'allusionfaite à la doctrine gnostique du dieu inconnu dans Dream of Fair tomiddling women3 et les nombreux renvois à la gnose (notamment ausystème de Basilide) dans watt et L'Innommable.4 L'afrtnité <le Beckettavec les gnostiques s'explique par son désir de pureté, qui se manifesteentre autres dans son attitude tourmentée envers la sexualité. cependant,en raison de sa passion pour l'art, Beckett, en tant que créateur, nepouvait s'empêcher de s'identifier avec le principe créateur du monde,donc précisément avec ce principe que les gnostiques tenaient poursatanique. or, pareil flirt avec le satanisme n'est pas sans poser desproblèmes à un homme qui, ayant été éduqué dans la plus puré traditionprotestante, est tourmenté par la peur de faire partie des damnés.5 c'estpeut-être pour cette raison-là que les idées d'incarnation et de naissanceperdront, dans les oeuvres ultérieures à Murplry, peu à peu leur aspectterrifiant. L'idée que la fuite hors de ce monde n'est pas inéluctables'articule déjà dans le roman Murphy, non pas dans le destin duprotagoniste, mais dans celui de son amie Celia, qui, après la mort deMurphy, rejoint le petit monde auquel elle appartenait, entourage certesmédiocre et grivois, mais que le narrateur décrit avec une telle iendressequ'il laisse entrevoir la possibilité d'un certain bonheur ici-bas.
t28
4. Entropie et élan vital dans WafiDans la plupart des commentaires, le roman Watt est considéré comme1'histoire d'un fou. Nous ne mettrons pas en question cette interprétation,pour autant qu'elle ne prétend pas être plus qu'une lecture au premierdegré. La question qui se pose est de savoir si l'unique but de Beckettétait de donner une description détaillée de la vie intérieure d'un malademental. Comme nous pouvons le constater clairement dans Murphy, pourBeckett la folie consiste à entrer en con[act avec la force créatrice del'Être. Dans En attendanr Godot, Estragon dit: "Nous naissons tous fous.
Quelques-uns le demeurent" (113). La folie de Beckett est celle dunouveau-né, qui ressent encore en lui, dans toute leur violence, les forcescréatrices de l'univers. C'est pour cette raison que la soi-distant folie deWatt doit être abordée avec circonspection.
Dans son approche symbolique de l'oeuvre de Beckett, AldoTagliaferri a remarqué que le nom de la plupart des personnages deBeckett commence par un M (47). Cette cons[atation n'est pas sans
intérêt pour la compréhension de Watt. Dans Ie "'W" de Watt, si l'on yregarde de plus près, il ne s'agit pas d'une exception: du point de vuepurement graphique, le "W" de Watt est un M renversé. Si nousremplaçons le W par un M, le nom du protagoniste devient "Mat". Enancien français, ce mot signifie "fou", et en italien*matto" a la mêmeacception. Le terme mat comporte une particularité qui pourrait expliquerce que Beckett entend par la folie: le Mat est en effet également le nomdu vingt-deuxième et dernier arcane du tarot (dont il reste une trace dans
le jeu de cartes actuel sous forme dufou ou du joker). Cette carte montreun vieil homme qui est muni d'un bâton et qu'un lynx mord à la jambegauche. Or, il y a dans le roman nombre de renvois à cet icône, tels quela mention d'un certain Mat le boiteux (Minuit, 111; V/eidenfeld, 102)
et 1'apparition d'une longue série de personnages qui ont tous été mordusà la jambe. Ces éléments attestent que Beckett a dû penser à cette carte.Or, dans la symbolique du tarot, le Mat signifie la fin du cycle de vie etle retour at en soph (c'est-à-dire l'infini) des cabalistes, le principecréateur de tout Etre; en termes théologiques: Dieu (Wirth, 47).8t, eneffet, Mr Knott est une figure quasi-divine. La scène du chien qui doitmanger les rogatons de Mr Knott avant le coucher de soleil présente uneressemblance frappante avec Lévitique 22,29-30, qui fixe les préceptesconcernant le sacrifice de reconnaissance. La présence de motifs de mortau cours du voyage de Watt vers la maison de Mr Knott, ainsi que lesmotifs de naissance et de fécondité lors de son départ,6 nous laissesupposer que le lieu de l'action, en I'occurrence la maison de Mr Knott,est situé en dehors du temps et de l'espace: il s'agit de la mort, maiségalement du lieu où se déroule la création, le plérôme ou le plein-être
t29
originel des gnostiques. La question est maintenant de savoir comment,dans la mythologie beckettienne, la création s'accomplit.
A un moment donné, Arthur, un autre domestique de Mr Knott,raconte l'histoire d'un savant qui croit avoir découvert dans un fermierécossais un génie arithmétique et qui le présente devant une commissionscientifique. Au moment où Arthur raconte cette histoire, les personnages
de cette farce sont physiquement présents. Ils disparaissent aussitôtqu'Arthur cesse de parler. Watt demande à Arthur pourquoi il a arrêtési brusquement son récit, et le narrateur répond:
Car si Arthur s'arrêta au milieu de son histoire, et se tut, ce n'estpas vraiment qu'il fût las de son histoire, car il ne l'était pas
vraiment, c'est qu'il éprouvait le désir de revenir t...1 à la maisonde Monsieur Knott, à ses mystères, à sa fixité. [...] Car un endroitet un seul, 1à où était Monsieur Knott, avait l'étrange propriété depouvoir, ayant d'une telle poussée poussé l'âme dehors, la rappelerà lui, d'un tel appel.
(Minuit, 206; Weidenfeld, 198-199)
Tout comme dans Murphy, nous trouvons ici l'opposition entre le centreet la périphérie, entre I'intériorité et I'extériorité: Arthur éprouve le faitde parler comme "être poussé vers l'extérieur" et le fait de s'arrêter deparler comme "être attiré". Selon toute vraisemblance, ce passage est
l'évocation littéraire de ce qui est appelé en théologie le "sermooperatorius", le verbe qui se concrétise, qui devient monde et qui figuredans diverses cosmogonies comme l'instrument de la création. Ce motifest cependant articulé en des termes qui sont typiques de la philosophiebergsonienne: Bergson considérait l'évolution comme le résultat d'uneforce de propulsion et les concrétisations successives de cette dernièrecomme le résultat d'un affaiblissement, voire d'une régression de cettepoussée initiale. Beckett se distingue de Bergson et la réplique d'Arthuren est un exemple frappant en ce que chez lui l'évolution (élan vital) et
l'entropie ont la mêmeforce, ce qui rend toute évolution impossible. Lequid pro quo, qve nous avons déjà rencontré dans Murphy, engendre en
fin de compte un stâtu quo qui se répète sans cesse. Au début, il n'yavait rien (en anglais, Knott se prononce ,?o/); ensuite, quelque chose voitle jour (l'univers d'Arthur), mais ce monde est à son tour détruit. Leprocessus de la genèse du monde s'arrête là où il a commencé: par lenéant.
En résumé, nous pouvons affirmer que dans Wattla formule du quidpro quo trouve une articulation plus précise, à savoir comme oppositionentre l'élan vital et I'entropie. Mais il y a plus: dans Watt, le monde de
130
Mr Knott, avec ses domestiques, est structuré de façon binaire. Wattn'est, en effet, qu'un des nombreux employés de maison qui se
succèdent. Le narrateur nous fait savoir par Arsène, le valet qui introduit'Watt, que dans la maison de Mr Knott il n'y a que deux sortes de valets(Minuit, 60; 'Weidenfeld, 59): les uns sont grands, osseux et présententdes jambes en cerceau; les autres sont petits, ventrus et ils ont les jambestournées vers I'extérieur. Cette opposition morphologique va de pair avecune divergence quant à la vision du monde, comme en témoigne lepassage suivant: lorsque Watt demande à Arthur pourquoi il a tout à coupinterrompu son histoire, ce dernier répond par le biais du narrateur quece fut par ce "qu'il éprouvait le désir de revenir t...1 à la maison deMonsieur Knott, à ses mystères, à sa fixité" (Minuit, 260; Weidenfeld,199). Pour Arthur, qui fait partie des valets petits et corpulents, lamaison de Mr Knott est un endroit où règne ia fixité. Watt, par contre,qui est grand et mince, ne perçoit qu'un changement ininterrompu: lacage d'escalier est tantôt longue et étroite, tantôt courte et large. Auregard de rW'att, le physique de Mr Knott se modifie continuellement: ilest tantôt grand, gros et pâle aux cheveux foncés; tântôt petit, blond età la peau rose, tantôt petit et aux cheveux foncés, etc. Le passage
célèbre, selon lequel, dans la maison de Mr Knott, tout n'était "qu'alléeet yenLte" (V/eidenfeld l3l-132, Minuit 136) ne reflète, à vrai dire, quele point de vue de V/att. Après avoir entendu Arthur dire qu'il se sentaitattiré par la fixité qui règne dans la maison de Knott, Watt répond par lebiais du narrateur: "Fixité n'est pas le terme qu'il [: Watt] auraitemployé" (Minuit, 207 ; Weidenfeld, 199).
Outre l'opposition entre l'entropie et l'élan vital, qui détermine larelation entre la maison de Mr Knott et le monde extérieur, il existe doncune seconde opposition, à savoir celle entre la perception d'immobilitéet la perception de mouvement. Dans I'univers intérieur de Beckett, il ya deux sujets, deux visions des choses. Cette dualité préfigure unantagonisme qui se concrétisera dans les couples ultérieurs (Vladimir etEstragon, Ham et Clov, Bim et Bom). Force est d'ajouter à cette liste lesfrères Bram et Geer van Velde, dont I'essai Le monde et Ie pantalon feral'éloge.
5. "Le monde et le pantalon" Art et innocenceDans Ze monde et le pantalor, Beckett a donné à sa vision binaire
du monde une formulation plus dramatique. Ce texte a paru en 1946.Ily est question de l'art des frères Bram et Geer van Velde. Il est, sommetoute, assez insolite de consacrer un essai à deux frères, d'autant plusqu'ils n'avaient jamais organisé d'exposition conjointe (ils ne I'ont faitqu'après la parution dt Monde et le pantalon).
131
IIs pratiquaient Ia peinture abstraite à une époque où il étaitcommunément admis que les artistes peignant de façon abstraite n'étaientpas figuratifs parce qu'ils ne comprenaient pas leur artisanat.
Dans son essai, Beckett réfute tous les arguments invoqués contrel'art non figuratif. Dans son plaidoyer en faveur de l'art abstrait, ilavance l'argument suivant: I'art authentique ne peut être figuratif, étantdonné que la réalité change sans cesse, et que le changement ne peut êtrereprésenté.
Le 'réaliste' suant devant sa cascade et pestant contre les nuages, n'apas cessé de nous enchanter. Mais qu'il ne vienne plus nousemmerder avec ses histoires d'objectivité et de choses vues. Detoutes les choses que personne n'a jamais vues, ses cascades sontassurément les plus énormes.
(28)
Beckett fait preuve du zèle de l'iconoclaste: ce que représente l'artfiguratif n'est pas représentable. Une cascade peinte ou Ie célèbre jetd'urine de Paulus Potter sont peut-être techniquement parfaits, mais cestableaux ne riment à rien, étant donné que l'on ne peut pas fixer lemouvement en une image. Outre cette considération philosophique, ilexiste une autre raison pour laquelle Beckett a horreur de l'art figuratif,mais il ne la révèle qu'en passant: étant donné que le monde et tout cequ'il contient ne sont que de piètres reflets de I'élan vital originel, lareprésentation de cette réalité est une entreprise inutile et mêmerépréhensible. Dans une de ses conversations avec Georges Duthuit,Beckett dit que le plus grand mérite des tableaux de Bram van Velde estqu'ils ne font pas penser à quelque chose qu'un homme ait pu voir. Lepassage suivant, qui couvre de ridicule la critique d'art traditionnelle,nous explique pourquoi cela est si important pour Beckett:
Sauraient-ils tracer I'arc-en-ciel sans l'aide d'un compas? Prêter, quedis-je, donner du relief au cul d'un cheval emballé, sous la pluie? Jene leur ai jamais demandé.
(40)
Ce que Beckett insinue ici, c'est non seulement que, pour I'amateur d'artau sens traditionnel du terme, la représentation des parties luisantes d'uncheval emballé sous la pluie est le comble de la maîtrise artistique, maiségalement qu'en tout état de cause la réalité n'a guère plus à nous offrir!Ailleurs (38), Beckett avait déjà fait savoir expressément que tous les
r32
éléments dans un tableau qui renvoient à des choses réelles ne sont quedes "échantillons de perdition".La question se pose dès lors de savoir quelle peut être pour Beckettl'origine d'une oeuvre d'aft, si nous nous passons de tout motif concret(telles des choses du monde extérieur). Pour Beckett, l'esthétique des artsplastiques se résume comme suit:
Il n'y a pas de peinture. Il n'y a que des tableaux. [...]. Tout cequ'on peut en dire, c'est qu'ils traduisent, avec plus ou moins depertes, d'absurdes et mystérieuses poussées vers I'image, qu'ils sontplus ou moins adéquats vis-à-vis d'obscures tensions internes.
(re-20)
Selon Beckett, l'art est le résultat d'obscures tensions internes qui tententde devenir des images. Pour lui, la création d'une image est le résultatd'une poussée vers l'extérieur. Nous avons déjà rencontré ce motif dansI'analyse de Watt (voir le discours d'Arthur). Dans Le monde et lepantalon, Beckett nous montre en vertu de quel processus métaphysiquecette poussée devient une oeuvre d'art.
Tant chez Abraham van Velde que chez Geer nous avons affaire àf incarnation. Tous deux entrent dans une dimension: chez Bram, il s'agitde l'espace, alors que chez Geer, c'est le temps. Tous deux observentI'autre dimension à partir de la leur et les retombées de cette perceptionse retrouvent dans leur tableaux. Au sujet de Bram van Velde, Beckettécrit:
A. van Velde peint l'étendue. [...]. Nous avons affaire chezAbraham van Velde à un effort d'aperception si exclusivement etfarouchement pictural que nous autres, dont les réflexions sont touten murmures, ne le concevons qu'avec peine, ne le concevons qu'en[...] Ie plaçant dans le temps. Espace et corps, achevés, inaltérables,arrachés au temps par le faiseur de temps, à I'abri du temps (quipassait sa journée dans le Sacré-Coeur pour ne plus avoir à levoir?), voilà ce qui vaut bien Barbizon et le ciel de la Pérouse.
(25,26,33)
Pour pouvoir représenter l'espace, il faut se mettre au coeur du temps et"arrêter le compteur":
La chose immobile dans lç vide, voilà enfin la chose visible, l'objetpur. Je n'en vois pas d'autre. La boîte crânienne a le monopole decet article. C'est là que parfois le temps s'assoupit, comme la roue
133
du compteur quand la dernière ampoule s'éteint. C'est là qu'oncommence enfin à voir, dans le noir. Dans le noir qui ne craint plus
aucune aube. Dans le noir qui est aube et midi et soir.(2e)
Geer van Velde fait le contraire: Beckett dit de lui qu'il représente letemps.
G. van Velde peint la succession. [...]. Celui-ci au contraire, est
entièrement tourné vers le dehors, vers le tohu-bohu des choses dans
la lumière, vers le temps. Car on ne prend connaissance du tempsque dans les choses qu'il agite, qu'il empêche de voir. [...]. C'estla représentation de ce fleuve où, selon le modeste calculd'Héraclite, personne ne descend deux fois.
(33,34)
Le processus métaphysique qui est la condition pour pouvoir représenterle temps (c'est-à-dire Ia succession) est caractérisé, de façon paradoxale,comme le fait d'entrer dans I'espace. Geer van Velde se rend dans
l'espace et devient à ce point agité qu'il ne perçoit plus que les contoursdéliquescents des choses.
D'après Beckett, il n'y a que deux choses que l'on puisse
représenter, à savoir: le temps en tant que tel ou l'espace en tânt que tel.Cette dualité fait penser aux deux points de vue qui ont été développésdans Watt: Arthur n'y percevait que fixité, tandis que pour Watt, il n'yavait que changement. L'on peut se demander si ces deux modes
d'incarnation (entrer dans le temps ou dans I'espace) ont encore une autresignification que la perception respective de l'immobilité ou dumouvement. Beckett déclare:
Qu'est-ce qui leur reste, alors, de représentable, s'ils renoncent àreprésenter Ie changement? Existe-t-il quelque chose, en dehors duchangement, qui se laisse représenter? Il leur reste, à l'un la chosequi subit, la chose qui est changée; à l'autre la chose qui inflige, lachose qui fait changer. Deux choses qui, dans le détachement, I'unedu bourreau, l'autre de la victime, où enfin elles deviennentreprésentables, restent à créer. Ce ne sont pas encore des choses.
Cela viendra. En effet.(Le-20)
La chose qui subit est l'espace; la chose qui inflige est le temps. Lepremier est conçu comme victime, le second comme bourreau.
t34
L'opposition que nous avons trouvée dans Watt entre la perceptiond'immobilité et la perception de changement semble donc être encorrélation avec la dualité du bourreau et de la victime. Dans Enatîendanî Godot, les noms mythiques de Cain et d'Abel apparaîtront.Dans la symbolique biblique, Cain, l'agriculteur, représente le statique.alors qu'Abel, le berger, est le prototype du nomade.
Nous pouvons déjà tirer la conclusion suivante: la dualité du quidpro quo a donné lieu à une série de dichotomies plus nuancées, telle ladualité de l'entropie et de 1'élan vital; de la rigidité et du changement; dutemps et de I'espace; et elle a été poussée à bout dans I'opposition entrele bourreau et la victime. Par la représentation de ces deux formes,Beckett a jeté les bases de son oeuvre ultérieure, où figurent des couplesde protagonistes (Vladimir et Estragon, Ham et Clov, Nag et Nell).
Mais Beckett écrit: Ce ne sont pas des choses. Tant qu'ils restentisolés l'un de l'autre dans des tableaux, bourreau et victime ne sont pas
de vraies choses. Iis se trouvent soit dans le temps, soit dans l'espace,mais ils ne sont pas dans le flot des événements. La réalité n'existe que1à où 1e temps et l'espace se rejoignent. Et c'est là aussi que commencela tragédie, car le bourreau et la victime s'y trouvent face à face. Leroman Molloy, dont les premières lignes ont été écrites au cours de l'été1947, commence par l'entrée de deux messieurs dans une forêt; un seuld'entre eux en sortira. Dans le roman du même nom, Molloy devient unassassin, suite à un accès irrationnel de la phobie d'être touché. Charyéde I'enquête, le détective privé Moran, bien qu'il n'ait jamais rencontréMolloy, entre dans une telle affinité mentale avec ce dernier qu'il finitpar se rendre à son tour coupable d'un crime de sang.
Il existe une autre raison pour laquelle Le monde et le pantalonmérite une plus grande attention. Face à un univers où tout gain entraîneune perte, parce qu'il est régi par des forces à ce point contraires quel'un (: Caïn) est forcé d'éliminer l'autre (: Abel), I'on serait tenté dese laisser séduire par la morale du bouddhisme ou de Schopenhauer. Celasignifierait que nous fuirions le monde et que nous rechercherions unendroit en dehors du temps et de I'espace afin d'éviter que nous nedevenions à notre tour bourreau ou victime. Un endroit au delà de laculpabilité et de la douleur, et que, comme nous I'enseignent lesphilosophies du renoncement, nous devrions chercher en nous-mêmes.Or, chez Beckett, c'est la tendance inverse qui est à l'oeuvre: une pulsionde f intérieur vers l'extérieur, de I'intériorité vers le monde. A ceci prèsque ce penchant à l'incarnation n'est pas accompli, mais qu'il s'arrête à
mi-chemin. I1 ne débouche pas sur le monde, mais dans une oeuvre d'artqui, en ce qui concerne sa genèse métaphysique, ne se meut que dans uneseule dimension, soit 1'espace, soit le temps.
135
C'est précisément ce caractère unidimensionnel de 1'oeuvre d'art quifait qu'elle échappe au quid pro quo et qu'elle constitue un gain. Ici,1'éian vital prend 1e dessus sur I'entropie. Le monde et le pantalon est leseul texte de Beckett qui ne traite pas d'un échec. Dans les tableaux deBram et Geer van Velde, une infime partie de la folie que nous voyonssévir dans l'enfer de Murphy est transposée dans le monde, où elle donnelieu à la jouissance et exceptionnellementpas aussitôt à une douleur toutaussi grande. Mais cette innocence de l'oeuvre d'art (abstraite) constitueégalement son caractère irréel. Les choses produites par Bram et Geer"restent à créer", comme en témoigne la citation ci-dessus. Quelle est lasignif,rcation que Beckett donne ici au mot "créer"? Puisqu'il ne peut enaucun cas s'agir de la création artistique (les tableaux existent déjà), il nepeut être question que de l'acception biblique de ce terme. Beckett utilisela création biblique comme une métaphore et accentue ainsi l'irréalité del'oeuvre d'art (abstraite) en la qualifiant de non-créée. Il en ressort entout cas qu'il compare I'artiste à Dieu. Si nous nous souvenons qu'ilrejette résolument I'art figuratif, nous pouvons également déduire de cettecomparaison que Beckett attend de l'artiste qu'il crée des objets d'unetelle originalité qu'il puisse être comparé au Dieu créateur lui-même, etque ses oeuvres ne soient pas une imitation de la création de celui-ci. Si,selon Beckett, les oeuvres de Bram et Geer sont comparables à lacréation, cela tient seulement au malheur qu'elles véhiculent. PourBeckett, l'art authentique contient tous les ingrédients qui donnent à Iavie son goût amer. De ce fait, il devient le miroir de la réalité, non pasdans le sens d'une illustration, mais en tant qu'évocation des forces quifont de la réalité achevée (c'est-à-dire la "création") un bain de sang.
Au début de cette étude, nous nous sommes demandés pour quelleraison Beckett tenait la formulation explicite de valeurs pour impossible.Nous y voyons à présent plus clair: il m'est impossible d'élaborer desimpératifs éthiques, étant donné que le monde est ainsi structuré que toutbonheur va de pair avec un malheur de la même ampleur et que toutrayon de lumière engendre quelque part une ombre. Par Ia suite (voir2.4), nous nous sommes interrogés sur ce qui est réalisable et ce qui nel'est pas dans le monde de Beckett, et ce afin de trouver un point derepère dans notre recherche des valeurs implicites de l'oeuvre. Ce quin'est pas réalisable, c'est le fait de demeurer dans l'enfer de Murphy,puisque le penchant à l'incarnation est un fait. Le fait d'être incarné posecependant un problème, car il me force à décider si je veux devenirbourreau ou victime. Il ne reste que l'incarnation infinie, le devenir-monde qui ne devient jamais monde.
136
6. Le motif comme signal d'une valeurLes personnages de Beckett réagissent à l'impératif à consonancekantienne "tu peux vivre car tu dois vivre" en traînant les pieds tânt quefaire se peut devant la porte donnant sur la vie. Il est probable qu'unepareille ambivalence, qui découle du fait de devoir vivre, mais de ne pas
le pouvoir, constitue la force motrice de l'oeuvre de Beckett. Du pointde vue stylistique, pareille pulsion est réalisée par le motif.T
Chez Beckett, les motifs traduisant le caractère invivable de ce
monde sont légion. C'est ce qui incite de nombreux commentateurs à
qualifier la conception de la vie de Beckett par des termes tels que"ennui", "douleur" et "dépression" (nous pensons entre autres au
commentaire de Alvarez). La biographie de Beckett nous apprend, qu'aucours de la seconde guerre mondiale il s'est engagé dans la résistancefrançaise, alors qu'il était Irlandais, et que sa mère, une femme fortunée,ne demandait pas mieux que de le dorloter chez elle. Ce fait prouvequ'en tant que persona prarîica (dans le sens de B. Croce) Beckett n'étaitpas défaitiste. Je ne veux pas trop m'étendre sur les motifs hostiles à lavie chez Beckett (son soi-disant pessimisme a fait I'objet de commentairestellement nombreux qu'ils ne peuvent que nuire à son oeuvre) et je mecontenterai donc d'une brève énumération. D'abord, il y a les motifs de
la souillure, qui sont essentiellement d'ordre scatologique. Ensuite, il ya 1e motif de Cain et Abel, qui est devenu de plus en plus important àpartir de 1946.
Mais l'adhésion à la vie, que Beckett ne peut mettre en avant sans
faire preuve de mauvaise foi, se traduit, à son tour, par des motifs et se
manifeste dès iors sur le plan formel.
7. La fonction du motif vestimentaireRevenons ar Monde et le pantalon, dont le titre insolite provient de1'histoire du tailleur que Beckett met en préambule à son exposé.
LE CLIENT: Dieu a fait le monde en six jours, et vous, vous n'êtespas foutu de me faire un pantalon en six mois.LE TAILLEUR: Mais, monsieur, rcgardez le monde, el regardezvotre pantalon.
T. Adorno (299) nous signale qu'il s'agit d'une blague juive8 et il se faitqu'elle correspond entièrement à la conception juive de la vie. Une des
caractéristiques de la théologie juive est que I'homme y est considérécomme partenaire de Dieu, et qu'à ce titre il lui est autorisé de critiquerle créateur de l'univers. Pourquoi Beckett, qui était d'origine protestante,était-il fasciné par cette blague au point de la mettre à deux reprises dans
137
son oeuvre (une seconde version plus élaborée se trouve dans Fin departie)? I1 existe certains points communs entre l'esprit de l'histoire dutailleur et la problématique de Beckett. Toutefois, Beckett ne considèrepas l'artiste comme étant le partenaire de Dieu, mais comme son rival.Or, la blague, considérée en soi, permet de donner ce sens conflictuelaux rapports entre I'homme et Dieu. Par ailleurs, Beckett était commeobsédé par le motif du vêtement.
Chez Beckett, la tenue vestimentaire représente la matérialité. Avantde mourir, Murphy erre à travers le parc et enlève un à un ses
vêtements. En entrant dans la maison de Mr Knott, Watt enlève sonmanteau, ce qui est considéré par Arsène, le valet, comme un geste
chargé d'une grande signification. Les considérations d'Arsène à ce sujetlaissent entrevoir que ce geste est égal au décès:
Tout est racheTé, largement. Car le voilà arrivé. Il ose même ôterson chapeau, et déposer ses sacs, sans appréhension. Rendez-vouscomptel 11 ôte son chapeau sans appréhension, déboutonne sonmanteau [...].
(Minuit, 41; Weidenfeld, 44)
En théologie, la mort se conçoit, en effet, comme un rachat. En quittantla maison de Mr Knott, Watt remet son manteau. Dans ce roman, ils'agit d'un événement qui ne va pas de soi, comme il ressort du fait que
le narrateur en profite pour faire une description de deux pages dumanteau, du chapeau et des chaussures de V/att. La tenue vestimentairede Mr Knott varie sans cesse et une grande attention y est accordée. Lafaçon dont Mr Knott traite ses chaussures est à la fois significative et
amusante. Lorsqu'il veut les mettre, il se met à l'affût, s'en approchecomme un chat de sa proie et les saisit alors tout à coup. En laçant une
chaussure, iI tient l'autre entre les dents ou la maintient plaquée au sol
avec le pied, de peur qu'elle ne s'enfuie. Etant donné leur caractèreéminemment organique dans I'univers beckettien, les vêtements sontprédisposés à devenir une métaphore de I'incarnation. Et vu que Beckettconsidère l'oeuvre d'art comme une incarnation, il est fort probable que
le pantalon dans l'histoire du tailleur fait office de métaphore de l'oeuvred'art.
Les habits nous permettent d'être dans le monde et parmi les gens.
Si nous lisons l'histoire du tailleur à la lumière de la vision de Beckettsur les vêtements comme incarnation, nous constatons qu'elle véhicule unjugement de valeur bien précis: le processus de la naissance est plusimportant que le fait d'être né; notre façon d'être dans le monde est plusimportante que le monde en tant que tel.
138
Nous retrouvons la façon dont il convient d'être-dans-le-monde dansune image étonnante que Beckett a offerte dans un des entretiens avecCharles Juliet:
I1 faut être 1à - index pointé en direction du dessus de la table - etaussi - index pointé vers le haut - à des millions d'années lumière.En même temps [...] La chute d'une feuille et la chute de Satan,c'est la même chose. (silence) Merveilleux non? La même chose
t...1.(37)
Cette tension entre Ie monde et les forces créatrices qui l'ont engendré(l'enfer de Murphy) et que nous avons rencontrée dans le motif de lanaissance infinie (ou différée) est exprimée par Beckett dans cette citationcomme étant simultanément absence et présence, à la fois engagement etlucidité extrême. Il existe une homologie entre cette déclaration etl'univers romanesque de Murphy: l'opposition entre I'intériorité créatriceet la réalité est ici articulée comme la tension entre le monde et unendroit infiniment éloigné où le véritable drame métaphysique, qui se
reflète dans les événements les plus insignifiants sur terre, s'accomplit.Le fait que Beckett cite la chute de Satan comme exemple de pareilprocessus métaphysique conflrrme, une fois encore, que Beckett associeI'endroit du devenir avec la damnation. L'affinité avec cet événementoriginel est la condition préalable à la création artistique, mais l'artistene peut pas s'y attarder. Il se voit contraint de retourner au monde. Vuesous cet angle, l'oeuvre de Samuel Beckett tend vers l'affirmation de lavie, non que celle-ci vaille la peine d'être vécue, mais parce que lespersonnages de Beckett, n'ayant le choix qu'entre deux sortes d'enfer,entre malédiction et perdition, ne peuvent opter que pour ce qui leursemble le moindre mal. C'est à juste titre que, dans son article "WhatBeckett Teaches Me", Martin Esslin qualifie l'éthique beckettienne de"minimaliste". Mais il faut également avoir à l'esprit que cette retenuetrouve son origine dans la conscience aiguë des dérapages terrifiants quiguettent toute entreprise humaine. Sous cet aspect, la recherche solitairede Beckett rejoint, comme nous l'apprend Adorno,e la dimensionhistorique.
Ralph BisschopsBruxelles
139
2.
-') .
4.
1.
NOTES
En français: quoi pour quoi? et ceci pour cela.
Pour un bon aperçu des tendances gnostiques, voir R.M. Grant, Gnosticismand Early Christianiry (Oxford UP, 1959) et Gnosticism, an Anthology(London, 1961).
"[...] and the tilted brain flooded no doubt with radiance come streaming downfrom the all-transcending hiddenness of the all-transcending super-essentiallysuperexisting super-Deity" (Dream of Fair to middling Women, l7).
Nous avons traité du rapport entre Beckett et les gnostiques de façon pluscirconstanciée dans notre ouyrage Die Metapher als Wertsetzung: Novalis,Ezechiel, Beckett (Frankfurt am Main: Peter Lang, 1994),285-360.
Dans Dream of Fair to middling Women,le chagrin de Belacqua suite au départde sa bien aimée Smeraldina-Rima est très vite supplanté par "the much greateraffliction of being a son of Adam and cursed with an insubordinate mind" (5).
A la gare, Watt se trouve derrière une porte qui est brutalement ouverte dupied par un poinçonneur et il tombe par terre. Pour qu'il reprenne conscience,on déverse sur lui un seau de bave (symbole de la souillure). Un voyageur, quis'appelle Miller Cacagueute (Cac$aced Miller également u, ryÀbob d"souillure), s'agenouille à côté de Watt, glisse sa main sous la tête de ce dernieret reste pendant un bon moment dans cette position. Ceci fait penser à la façondont on s'occupe de nouveau-nés, Par ailleurs, le roman est à plusieurs égardsconstruit de façon cyclique. Ceci fait supposer que la toute première scène(l'accouchement de Mrs Nixon) renvoie à la fin du livre (le départ).
7. Voir Paul Hadermann, Thema, motief, martjs, dans Prolegomena tot eenmotievenstudie, publié par M. Vanhelleputte et Léon Somville @ruxelles,1984).
Ludo Abicht a repris cette blague dans son anthologie de I'humour et de lasagesse juifs: Humor, vrijheid enwijsheid van de joden (Anvers-Baarn,1992).
Cf. Versuch, das Endspiel zu yerstehen. Selon Adorno, Beckett se réfère àAuschwitz, mais il adopte par rapport à la Shoah la seule attitude concevableen art, notamment le refus catégorique d'utiliser ce thème pour créer des effetsthéâtraux.
OETIVRES CIIEES
Adorno, T., Versuch, das Endspiel zu yerstehen, dans Noten qtr Literatur(Suhrkamp Taschenbuch).
140
5.
6.
8.
9.
Alvarez, Al, Beckett (London: Fontana P, 1992; seconde édition).Beckett, Samuel, Dream of Fair to middling Women (New York: Arcade Publishing,
1992; édition posthume; le manuscrit date de 1932).
-, Murphy (London: Pan Books, 1963).
-, Murphy, traduit par Alfred Péron en collaboration avec l'auteur (Paris: LesEditions de Minuit, 1965; première édition chez Bordas en 1947).
-, Watt (Paris: Oiympia P, 1958), écrit entre I94l et 1944, réédité par GroveWeidenfeld, New York, 1959.
-, Watt (Paris: Les Editions de Minuit, 1968).
-, Proust and Three Dialogues with Georges Duthult (London: John Calder, 1987).
-, Mercier et Camier (Paris: Les Editions de Minuit, 1970; achevé en 1945).
-, Molloy (Paris: Les Editions de Minuit, 1951).
-, Malone meurt (Pafis: Les Editions de Minuit, 1951).
-, L'Innommable (PaÀs: Les Editions de Minuit, 1953).
-, En attendant Godot (Paris: Les Editions de Minuit, 1952).
-, Fin de Panie (Paris: Les Editions de Minuit, 1957).
-, Le monde et le pantalon (Paris: Les Editions de Minuit, 1989; la premièreversion a paru dans Cahier d'Arts $945-19461 sous le titre Z a peinture des vanVelde ou Le monde et le pantalon).
Esslin, Martin, "What Beckett Teaches Me: His Minimalist Approach to Ethics",in Beckett in the 1990s (Samuel Becken Todoy/Aujourd'hui 2, Amsterdam1993), 13-20.
Juliet, Charles, Rencontre ayec Samuel Beckett (Editions Fata Morgana, 1986).Leibnitz, Monadologie (Paris, 1956).Tagliaferri, Aldo, Beckett et la surdétermination lixéraire @aris: Payot, 1977).Wirth, Oswald, Le tarot des imagiers du Moyen-Age (Pais, 1977).
t4l