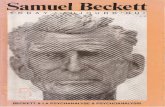L'IMMIGRATION HIER, AUJOURD'HUI, DEMAIN [Immigration yesterday, today, tomorrow]
-
Upload
paris-sorbonne -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of L'IMMIGRATION HIER, AUJOURD'HUI, DEMAIN [Immigration yesterday, today, tomorrow]
54 Administrotion
derr lo in
;Roger CAROUR
Les problèmes de l ' immigrat ion sont plus que jamaisd'actual i té. Vous êtes, Monsieur le Professeur, Présidentde f ' lnst i tut de Recherches " lmmigrat ion et Société1.R.1.S. et à ce t i t re vous les connaissez bien.
La faible natal i té en France a, sans aucun doute, uneinf luence sur la vague d' immigrat ion que nous constatonsdepuis 1945. D' ic i à l 'an 2O2O, la populat ion d 'Af r iqueaura doublé et atteindra 1 mil l iard 300 mil l ions, alors quecel le de I 'Europe sera prat iquement la.mêmequ'aujourd'hui . Boumedienne a déclaré, i l y a quelquesannées : "un jour des mi l l ions d 'hommes qui t teront lespart ies méridionales du monde pour fa i re i r rupt ion dans
Gérard-Francois DUMONT :
Les phénomènes migratoires ne sont pas- indépendants de l 'évolut ion démogra-
phique des pays. Prenons I 'exemple dela France : e l le a été, au XIX' s iècle, lepremier pays européen, et prat iquementle seul, à être une terre d' immigration. AuXX' siècle, el le a été la principale terred' immigration en Europe si I 'on exclut lesmigrations inter-al lemandes.
L'évolut ion démographique de la Franceexplique cette spécif ici té. La fécondité abaissé en France dès la f in du XVl l l "s iècle ; e l le a été au XIX's iècle extrême-ment faible par rapport aux autres payseuropéens. Depuis que les recensementsprocèdent au comptage des étrangers(1851), les chif fres mettent en évidence une progressionconstante en dépit du nombre important de natural isa-t ions. 380.000 en 1851, le nombre des étrangers at te intle mi l l ion en 1881. Des étrangers jeunes, de sexe mascu-
La montée des déséqui l ibres démo!raphiques
' Professeur à I'Univêrsité de PARIS-SORBONNE depuis 19a8, Garard-Fraôçois Dumoni a dirigé pendant dix ans 19 séminairE d'AlfredSauvy eu Collèg€ de France et publié un€ clizaine dg livros concernânt l économie, la sociologis et la démographie.
L ' i rTlrTr igrot ion hier, ctuiourd' htr i ,
lnterview du professeur Gércrrd-Frcrnçois DUMONT*
menéepar Roger CAROUR,Préfet honoraire
En réservant pour la f in de I 'entret ien certains problèmespart icul iers. je voudrais avoir votre sent iment surquelques aspects importants de I ' immigrat ion :
les espaces accessibles de I 'hémisphère nord à larecherche de leur survie". Alain Minc, de son côté, a écri tqu'entre une Europe en pleine décadence démogra-phique et les pays du Sud de la Méditerranée, le phéno-mène du déversoir est inévi table".
L'avert issement est clair.Quel les réf lexions vous inspire-t- i l ?
l in pour la plupart, viennent'occuper lesemplois en expansion ou délaissés parles Français : cette immigration résultenotam ment du ralent issement de
' I 'accroissement naturel de la populat ion.Ces premiêrs ï lux d ' immigrés du XlX"siècle. vont s 'accélérer après' la guerrede {914-18" la France ayant été ampu-tée dV.300.000 hommes jeunes par lapremière guerre mondiale. Le recense-ment de 1931 évalue les étrangers à2.715.000, soit 6,58 "/" de la populat ionde la France. La cr ise économique de1931 et des années suivantes va mar-quer un arrêt dans cette évolution crois-sante. Puis avec le renouveau écono-mique de I 'après-guerre, I ' immigration vareprendre, notamment dans les années1956-1965. L 'économie de ces années
manque de main-d'oeuvre car l 'évolut ion de la populat ionactive correspond alors à la faible natal i té des années193F-40. Entre 1935 et 1940, en ef fet , le nombre dedécès en France étai t supér ieur au nombre de nais-
î
lnleruiew du professeur Gérord-Fronçois DUMONT 55
sances. Pour fa i re face au développement économiquedes années 60, la France a eu une pol i t ique assez larged' immigrat ion en sus de I ' immigrat ion l iée aux rapatr iés.
En ce qur concerne l 'âvenir, i l y a une véri table "montée desdéséquil ibres démographiques". J 'ai imaginé cette expres-sion "/a montée des déséquilibres démographiques", pourle t i tre d'un l ivre écri t notamment avec Alfred Sauvy et paruen 1984. Je crois effect ivement que l 'un des facteurs fonda-mentaux d'évolut ion des décennies en cours est I ' intensitéet la variabi l i té des f lux démographiques. Tout déséquil ibreest susceptible d'entraîner des phénomènes de compensa-t ion. Entre d'une part la France et I 'Europe et d'autre partI 'Afr ique, nous constatons des évolut ions complètementdivergentes. J'ai appelé la Méditerranée "le grand lac desdéséquilibres démographiqued' parde qu'il faut bien com-prendre que ce n'est plus une mer. Ël lel 'était sans doute i ly a 20 siècles quand i l fal lai t ? mois à un navire pour la par-courir de part en part. Aujouid'hui, on peut faire I 'al ler etretour d'Alger dans la journée en avion. La Méditerranéeest devenue un lac avec, sur ses berges, des populat ionsqui évoluent dif féremment.
On peut constater que toute une part ie de la France viei l l i t ,le recensement de 1990 le confirme et met en évidence ladépopulat ion de centaines de cantons ruraux.
Au contraire, i l y a une croissance démographique signif ica-t ive dans les pays dits du Sud. Les terres en fr iche qui sonten train de se développer dans certaines régions-vi ; rgt-s ix départements ont enregistré un solde naturelnégat i f de 1982 à 1990- sont suscept ib les d 'at t i rer despopulat ions du sud à la recherche de terres plus faci les àcult iver : mais en fait , ce sont les zones urbaines qui ont lapréférence des immigrants. l l est certain aujourd'hui que lesdifférences démographiques entre les pays du Nord et duSud ont déjà amorcé des mouvements migratoires. Nousévoquons la Méditerranée qui est proche de la France maisc'est vrai également par exemple entre le Mexique et lesEtats-Unis.
Par ai l leurs, i l faut rester serein face à ces problèmes.Quand. dans votre question, vous évoquez l 'évolut ion de lapopulat ion de l 'Afr ique, nul ne sait vraiment ce qu'el le sera.Les project ions démographiques dépendent des hypo-thèses retenues dont seul I 'avenir dévoi lera la val idité.En part icul ier en ce qui concerne I 'Afr ique, le développe-ment du SIDA, les r isques d'endémies que I 'on avait crujuguler peuvent venir contredire certaines projections assezélevées admises jusqu'à aujourd'hui.
R.C. :
Sur 1 mi l l iard d 'habi tants, même si le SIDA en détrui t 10millions, ce qui n'est pas un "détaif, il en restera 990 mil-l ions.
G.F.D. :
Peut-être, mais pour le moment, la croissance du SIDA enAfrique se trouve favorisée pâr Oe mauvaises condit ionssani ta i res. On ne peut malheureusement totalementexclure I 'hypothèse d'une remontée des taux de mortal i té
dans certaines régions. Si la croissance démographique aété aussi importante dans le monde depuis le début du XlX"siècle, c'est grâce à la baisse des taux de mortal i té. Maison a déjà constaté des périodes de régression de la baissedu taux de mortal i té, par exemple, à Madagascar, et à unmoindre degré en U.R.S.S. ou en Roumanie. Aujourd'hui , i lfaut b ien reconnaître que nos instruments de mesure del 'évolut ion démographique en Afr ique Noire et en Afr iquesub-saharienne sont assez l imités. Nous raisonnons encoreessent ie l lement à part i r de I 'Enquête Mondiale sur laFécondité real isée sous l 'égide des Nations-Unies. Et cetteenquête par sondage n'a pu estimer que 7 pays d'Afr iqueNoire parmi 38 pays en voie de développement. l l n 'existepas d'état-civi l suff isamment f iable en Afr ique pour discer-ner avec précision les évolut ions.
R.C. :
Paral lèlement à l ' lNSEE, on m'a indiqué que la natal i té enAfrique et même en Algérie, dans le Maghreb, avait baissé.Ceci dit, dans ces pays, la fécondité en est encore à quatreou cinq enfants par femme alors qu'en Europe el le estentre 1 el2,1,29 pour I ' l ta l ie, 1,8 pour la France.
G-F.D. :
Ce que vous dites èn ce qui concerne I 'Afr ique du Nord estvrai . Son terr i to i re a été longtemps administré par laFrance. On peut considérer que les pays du Maghreb ontun état-c iv i l re lat ivement f iable et valablê. LAfr ique sub-saharienne n'en est pas là. S' i l est vrai que I ' indice synthé-t ique de la fécondité a diminué ces dernières années dansle Maghreb, i l subsiste encore un écart du simple au tr ipleentre le Nord et le Sud. Nous sommes bien dans un désé-qui l ibre démographique.
R.C. :
D'après les project ions que vous indiquez, en I 'an 2020, lapopulat ion de I 'Algérie et du Maroc aura doublé.
G.F. D. :
Les chif fres sont extrêmement simples quand on compareà la France. En 1954 la France eçt deux.fois plus peupléêque les trois pays du Maghreb (42,8 mil l ions contre 21,9).Aujourd'hui, en 1990, on peut est imer que la populat ion dela France est à peu près équivalente à celle du Maghreb(56,5 millions contre 58 milliohs). Ên 202$ dans trente-cinqans, si les choses se prolongent ainsi, les trois pays duMaghreb, avec 103,6 mil l ions d'habitants, pourraient êtreprès deux fois plus peuplés que la France. On pourrai tdonc voir s ' inverser, en I 'espace d'à peine trois générations,le rapport de 1 à 2.
R.G. :
Le oroblème est b ien là. . .
G.F. D. :
Le problème n'est pas seulement là dans cette dif férencede quanti té de ressource humaine entre la France et le
56 Administration
Maghreb, mais pe.ut-être surtout dans la structure despopulat ions. La France pourrait avoir -ceteris paribus-deux fois moins d 'habi tants que le Maghreb mais avecune composi t ion par âge viei l le alors que le Maghrebaurai t une populat ion deux fois plus nombreuse que la
Les grands facteurs
M. le Professeur, je vous remercie de cet exposé histo-r ique qui est for t intéressant. Je voudrais vous poserd'autres quest ions. On par le beaucoup des f lux migra-toires et on tente, par dif férents moyens, de les contrôler.Pensez-vous que ce soi t possible lorsque nous consta-tons des décalages aussi importants dans les popula-t ions des pays ? ""
-
G-F. D. : "
l l faut d'abord bien se rappeler ce qu'est un f lux migra-toire : c 'est un déplacement de populat ion d'un terr i toire àun autre. Pour pouvoir contrôler, pour ut i l iser votre terme,'des f lux migratoires, i l faut en connaître les causes af inde déterminer les possibi l i tés d 'act ion sur ces causes.Nous parlerons après, si vous voulez, du problème posépar le contrôle en aval. Mais le contrôle en amont, c 'estremédier aux causes.
L'histoire, à cet égard enseigne qu' i l y a toujours t ro isfacteurs suscept ib les de déclencher des mouvementsmigratoires : le facteur économique, le facteur pol i t ique etle facteur démographique. Ces trois facteurs peuventjouer séparément mais peuvent aussi s'addit ionner.
Le facteur économique d'dbord : i l consiste en le faitque des personnes qui n 'ont pas, là où el les habi tent ,des condit ions de vie satisfaisantes vont chercher ai l leursdes condit ions de vie qu'el les espèrent meil leures.
Deuxième facteur, le facteur pol i t ique : à part i r dumoment où des habitants d'un terr i toire se sentent mena-cés dans leur l iberté de penser et d 'agir ou dans leurl iberté rel ig ieuse, là encore i ls vont vers d 'autres terr i -toires. L'émigration protestante l iée à la révocation deI 'Edit de Nantes est inscri te dans l 'histoire de France. Ona encore à I 'espri t ce qui s'est passé dans le Golfe èn1990, mais pour remonter encore à quelques années,près de 2 mil l ions d' lraniens ont fui parce qu' i ls ne sou-haitaient pas rester dans le'régime de Khomeiny.Je n'ai pas cité de déséquil ibres économiques, mais i lssont nombreux. On peut ci ter un banal exemple, le casdes Français qui vont habiter en France, mais près deGenève parce qu' i ls souhaitent travai l ler dans cette vi l leoù i ls ont des condi t ions économiques mei l leures. Cetexemple, local et marginal, est symbolique d'un déséqui-l ibre économique.
Enfin, la troisième cause des migrations internationales,ce sont les déséqui l ibres démographiques dont nousvenons de parler. F
France mais avec une structure d 'âge jeune.
R.C. :
Ce qui aggravera encore la s i tuat ion . . .
de f lux migratoire
Les trois causes ci tées peuvent s 'addi t ionner et i l y a unexemple extrêmement intéressant, celui de I 'ex-Saharaespagnol . l l y a vers ce terr i to i re une migrat ion qui arépondu a la fo is à la cause économique, à la causedémographique et à la cause pol i t ique. Vous vous rappe-lez que le Roi Hassan l l a orgair isé en 1975 la "marcheverte" pour bien montrer à I 'ensemble du monde que I 'ex-Sahara espagnol étai t part ie intégrante de la nat ionmarocaine. A part i r de ce moment- là, une migrat ion d 'uncertain nombre d'habitants du Royaume s'est faite versce Sud marocain. On voit i rès bien là que les trois causesont joué. D'une part des Marocains sont al lés dans leSud parce que le gouvernement leur a offert des condi-t ions économiques leur la issant espérer d 'amél iorer leurniveau de vie par rapport à leurs condit ions de vie anté-r ieures. D'autre part , ce gouvernement marocain aencouragé et organisé cette migration vers le Sud parcequ' i l s 'agissait de bien montrer que le Sud du Maroc étaitpart ie intégrante de la nation marocaine. Enfin, de toutefacon I 'ex-Sahara espagnol étai t te l lement peu peupléqu' i l n'y avait aucun doute que cette migration réponde àdes causes démographiques.
Donc, en amont, s i I 'on veut dans I 'avenir minorer lesphénomènes migratoires, cela suppose d'éviter ce tr ipledéséqui l ibre économique, pol i t ique et démographique.Or, aujourd'hui , on ne peut que constater que ce tr ip ledéséqui l ibre est présent et d 'abord en Méditerranée.Donc, la solut ion au problème des migrat ions supposed'abord le développement des pays du Sud. l l est évidentque si le Sud ne se développe pas, certains'de ses habi-tants feront tout pour al ler dans le Nord chercher desmoyens de survie.
R.C. :
Je me'permets de vous arrêter M. le Profe.sseur. EnAfrique du Nord partexemple, dans les dix à vingt annéesqui viennent, i l y aur{20 mil l ions d'habitants supplémen-taires, jeunes et par conséquent, aptes à t ravai l ler .Comment pourra-t-on leur donner du travai l dans leurpays d'origine ?
G-F. D. :
A cet égard, I 'exemple de I 'Asie est éclairant. l l faut biencomprendre d'abord que le travai l ne se donne pas, i l seprend. Ce sont les hommes eux-mêmes en étant entre-prenant qui créent le travai l . Ce ne sont pas seulementles gouvernements, même si leurs pol i t iques écono-miques ont des effets sur la capacité d'entreprendre. Ona I 'exemple d'un certain nombre de pays dont la situation
I
lnterview du professeur Gérord-Fronçois DUMONT 57
démographique ef f rayai t le monde i l y a quarante-cinqans. l l y a quarante-cinq ans, personne n'aurai t misé unfranc. une l ivre ou un dol lar sur la renaissance écono-mique de I 'Al lem'agne et du Japon, sur la croissance deTaiwan, de la Corée du sud ou de Singapour, etc. . . Pourévoquer un pays beaucoup plus proche de nous, i l y a unsiècle et demi le monde ent ier croyai t que la Suisse étai tun pays surpeuplé, d 'a i l leurs dépourvu de ressourcesnaturel les, qui a l la i t rester pauvre le restant de ses jours.Or la Suisse a trouvé grâce à son travai l et à son imagi-nat ion les moyens de son développement économique-
La maîtr ise des courants migratoires se s i tue enamont
Evi ter des migrat ions suppose Oon - le développementéconomique des terr i toires. C'est vrai également pour lesmigrat ions internes. Vous n'évi tez pas à I ' intér ieur de laFrance des migrat ions internes si vous n 'avez pas unaménagement du terr i to i re pour favor iser le développe-ment économique des régions défavor isées. Au niveaupol i t ique c 'est la même chose. Quand je disais en débutdes années 80 que si un intégr isme ou une var iété detotal i tar isme s' instal le dans un pays d'Afr ique et notam-ment d 'Afr ique du Nord, cela déclenchera inévi tablementdes déplacements migratoires, cela paraissai t provoca-teur. On sai t maintenant ce qui s 'est passé en 1990 entreI 'Algér ie et la France.
Donc la solut ion du problème de la maîtr ise des courantsmigratoires dans I 'avenir est en réal i té en amont, ce quine veut pas dire qu' i l n'y a pas d'act ion possible en aval.La maîtr ise des courants migratoires en aval , ce sonttous les out i ls "pol ic iers" de contrôle des front ières, decontrôle des populat ions. El le dépend également du faitqu' i l existe ou non des si tuat ions qui jouent le rôled'aimant vis-à-vis de certaines populat ions' Par exemple,la France a créé un système de protection sociale part i-cul ièrement développé et dont bénéf ic ie la populat ionrésidente. Ce système de protection sociale joue danscertains cas le rôle d 'a imant à I ' immigrat ion car i l fauttoujours se rappeler que les " té léphones arabes" mar-chent très vite. l l est évident que même si un pays met enplace des outi ls eff icaces de contrôles de frontières, i l nepeut cependant pas mettre un pol icier derr ière chaquepersonne qui passe à I 'aéroport de Roissy ou à celui deMarsei l le. L'act ion en amont est donc la plus essentiel lesi I 'on veut rendre les frontières moins perméables
R.C. :
J 'entends bien, mais n'étant pas industr iel vous n'avezpas à créer une entrepr ise en Afr ique du Nord' Quel lesolut ion voyez-vous pour donner du travai l à ces vingtmi l l ions de jeunes qui sont en général peu qual i f iés oupas quali f iés du tout et qui se trouveront dans une situa-t ion extrêmement dif f ici le ?
G-F. D. :I
Le premier problème, c 'est que I 'homme, comme lemontre I 'h istoire, est créateur de r ichesses si r ien nevient entraver son esprit entreprenant. A I 'occasion d'un
séjour pr ivé en Algér ie i l y a quelques années, j 'avais puconstater combien ce pays avai t a lors un système écono-mique qui étouffai t I ' in i t iat ive indiv iduel le. certains dir i -geants en étaient d 'a i l leurs conscients, mais i l y avai t t ropde pesanteurs.Ce qui est vrai pour la France est vrai dans les autrespays ; pour permettre à des jeunes de créer des entre-pr ises et des emplois i l faut un système économique quiencourage les in i t iat ives. Vous posez la quest ion fonda-mentale du développement du t iers monde et de la facondont le Nord peut aider ces peuples à se développer ' l lfaut d 'abord être humble en la mat ière, ne pas croire quele Nord peut exporter d 'un seul coup ses mei l leures réus-si tes économiques qui sont le résul tat de plusieursdécennies de développement. l l faut cohsidérer plusieursréal i tés avant de bien définir la méthode de coopérationavec le t iers-monde la plus propice à son développe-ment.
Les pays du Sud n'ont aucun intérêt à se séparer de cequi est leur pr incipale r ichesse, la ressource humaine.'Certes, certains pays du Sud ont la chance d'avoir égale-ment du pétrole ou du gaz mais leur grande r ichesse dupays c 'est la ressource humaine. Donc la quest ion qui sepose au Sud est de t rouver des pol i t iques qui permettentde mieux employen cette ressource humaine. Le Sud estdans la s i tuat ion pour moi du créateur d 'entrepr ise. l lcomprend un ensemble de pays en voie de développe-ment qui doivent créer une économie suff isante. EnFrance un créateur d 'entrepr ise qui monte sa propreaffaire ne réussi t que s ' i l bénéf ic ie de consei ls et d 'unenvironnement favorable.Un entrepreneur qui arr iverait à créer une entreprise exnihito est une exception. l l n'y parvient que s' i l trouve desmoyens f inanciers, des consei ls. . . Suivant cet exemple,les pays du Nord devraient se mettre dans la situation deconsei l lers à la disposi t ion des pays du Sud pour lesaider à créer et développer leur économie. Car on nepeut pas imposer à des pays qui ont chacun leur proprehistoire et leurs spéci f ic i tés un modèle obl igatoire destructures économiques. Par contre on doit absolumentles consei l ler en mat ière f inancière, en mat ière tech-nique, pour leur propre développement.
R.C. :
Oui, le Japon a eu une pbl i t ique- dif férente. Le Japon amécanisé son industr ie e\ [ n 'a pas importé de main-d'oeuvre. Par contre i l a favorisé la construction d'usinesdans d'autres pays notamment en Corée, à Taiwan et y asous-traité des produits ; aujourd'hui ces pays possèdentdes usines et fabr iquent eux-mêmes des produi ts f in is.C'est le cas de I 'automobi le, de I ' informat ique parexemple.
A I ' inverse en Europe et en France notamment, nousn'avons pas construit d'usines en Algérie. Nous avons aucontraire importé de la main-d'æuvre algérienne, main-d'ceuvre peu quali f iée, que ce soit pour I 'automobile, pourle bât iment par exemple. En Algér ie nous n'avons pasfavor isé la créat ion d ' industr ies. N'est-ce-pas un pro-blème qrii aurait été mal étudié et peut-être mal comprispar les pays occidentaux ?
58 Administration
G-F. D. : .
Votre quest ion évoque di f férents éléments. En ce quiconcerne le Japon, vous avez peut-être sauté un peurapidement la phase première. Dans cette phase. leJapon s 'eçt dé\veloppé sur son propre terr i to i re, ce n 'estque dans une phase seconde ef fect ivement qu' i l a sous-trai té dans un certain nombre de pays les tâches, je dirai ,les moins nobles de l 'économie. Deuxièmement, dans lefai t qu'un certain nombre d'entrepr ises ont fa i t appel àdes travai l leurs immigrés, i l y a notamment des raisonsf iscales. Les entrepr ises f rançaises dans les années50-60 étaient dans une si tuat ion où le coût de la main-d'oeuvre immigrée étai t moins cher que le coût de I ' inves-t issement capi ta l is t ique dans des machines plus perfor-mantes, pour des raisons de réglementat ions f iscales, depossibi l i tés d 'amort issement gt des problèmes de plus-values, etc. . . En fai t , les por lv,oirs pol i t iques ont sans
L ' intégrat ion
R.C. :
Nous avons évoqué des problèmes généraux mais t rèsimportants. Voulez-vous que nous passions à un autrestade de notre interview.. . Que pensez-vous de I ' intégra-t ion des étrangers que le gouvernement f rançais se pré-occuoe actuel lement de favor iser ?
G-F. D. :
En tout état de cause, I ' intégrat ion est un impérat i fd 'équi l ibre d 'une société. De quels avantages bénéf ic ieaujourd'hui la France ? De la paix c iv i le, de la démocrat iequi est le moins mauvais système à I 'except ion de tousles autres comme le disai t Churchi l l , de la l iberté. Jepense que tous ceux qui sont en France souhai tent cont i -nuer à bénéficier de ces atouts qui n'ont pas été réal isésen un jour mais qui sont le produi t h istor ique de lamarche vers la l iberté et la démocratie. Aujourd'hui, I ' inté-grat ion est indispensable : i l est évident que si , sur unmême terr i to i re, i l y a des communautés qui s 'opposentet qui n'acceptent pas un universel commun et un mini-mum de valeurs communes pour v ivre ensemble, dessituations confl ictuel les à I ' intérieur du terr i toire sont prô-bables.
L' intégration est indispensable pour éviter, soit , du côtédes immigrés, des att i tudes qui entraînent des r isques denon intégration, soit , du côté des européens, des phéno-mènes de rejet . Les r isques de la non- intégrat ion desimmigrés s'appellent r isque de repl iement sur des règlesde vie qui ne correspondent pas aux codes qui régissentta société, r isque d'ut i l isat ion d 'enclaves comme desrefuges en cas d ' infract ion, de dél i ts, voire de cr imes,sent iment d 'être rejeté par la société qui les entouremême lorsque leur intégrat ion étai t un s igne de leuradhésion à cette société -comme dans le cas des Harkispar exemple- incompréhension que I 'on soit al lé les cher-cher pour travai l ler dans un pays qui ne fait même pas
doute raisonné à court terme en s 'abandonnant par t ropà cette drogue qu'est I ' inf lat ion. On connai t b ienI 'exemple de I 'entrepr ise automobi le f rançaise qui a l la i trecruter des Kabyles ou des Marocains sur place et quiavai t décidé que dans un vi l lage, i l f a l la i t recruter 15hommes dont un seulement par le f rançais. Pour el le i ls 'agissai t uniquement d 'une main-d'ceuvre exécutant destâches réoét i t ives.Le quinzième suff isai t pour commander aux quatorze. l lne faut quand même pas exagérer I ' importance démogra-phique de ces migrat ions organisées par les entrepr isesfrançaises. l l est évidemment assez di f f ic i le de les éva-luer mais le nombre de migrat ions volontairement organi-sées par les entrepr ises f rançaises al lant chercher desbras en Afr ique est en fai t minor i ta i re par rapport auxautres migrat ions.C'est d 'a i l leurs en faveur de cette main-d'oeuvre que lesaides au retour ont été les plus eff icaces.
des étrangers
I 'ef for t de leur enseigner sa langue.. . Du côté des euro-péens, la non- intégrat ion pourrai t se t raduire par desphénomènes qui n 'apparaissent pas souhai tables : aban-don des imrôeubles ou éloignement des quart iers oÙlogent les immigrés, ce qui renforce encore les r isquesd'enclaves. recherche d'écoles ne comportant pas unpourcentage trop élevé d'enfants d ' immigrés, considéré àtort ou à raison comme source d 'échec scolaire, refusd'essayer de comprendre. la mental i té des populat ionsimmigrées, donc de contr ibuer à son accul turat ion. Onvoi t t rès bien que s ' i l y a une opposi t ion de cul ture entredes populat ions nat ionales et des populat ions immigrées,cela débouche sur des phénomènes de xénophobieinévi table avec des r isques de conf l i ts entre communau-tés.
C'est la raison pour laquel le les coûts humains, sociaux,voire pol i t iques de la non- intégrat ion seraiènt te ls queI ' intégrat ion devrai t être un impérat i f de notre pol i t ique.Cet impérati f a f ini par apparaître dans les discours pol i-t iques mais la distance entre ces discours et ' leur traduc-t ion concrète Semble encore longue. Qu'est-ce qui peutconcour. i r : à I ' intégrat ion ? D'ab'ord la langue. C'estFernand Braudel quj d isai t : " la France c 'est d 'abord àBO "/" la langue françàise'I . - .La Fîance n'a pas sufl isamment enseigné la langue fran-caise aux immigrés. Les enfants de parents étrangersbénéf ic ient t rop peu du sout ien scolaire dont i ls auraientbesoin pour pouvoir apprendre la langue françaisecomme i ls souhai teraient I 'apprendre, parce que leursparents par la ient espagnol , portugais, arabe et qu' i lsn 'étaient pas dans un moule. Le système éducat i f amême choisi une voie contraire, avec le système dit desL.C.O. langues et cul tures d 'or , ig ine, qui partai t sansdoute de bons sent iments, mais qui est un système à lafois de décul turat ion et de créat ion de di f férence. Dedéculturat ion, parce que ce système conduit par exempleà enseigner la culture arabe à des enfants de Berbèresde (abyl ie.
lnterview du professeur Gérord-Fronçois DUMONT 59
Deuxièmement, cela peut consister parfois à une certaineheure à couper une classe en deux ; ceux qui vont avoirdes act iv i tés d 'évei l . en f rançais, et ceux qui vont àI 'enseignement 'd i t de langue et de cul ture d 'or ig ine.Donc, on montrai t t rès bien aux élèves dans une classed'école pr imaire qu' i l y avai t une front ière, une sorted'apartheid temporaire entre ceux dont les parents sontor ig inaires de la France et les autres. Depuis 1989, ceconstat qui s 'af f rontai t au "refus de voir" semble êtredavantage apparu au grand jour. Mais la réglementationde ce système qui est contraire à I ' intégrat ion reste lemême.
Un autre aspect de I ' intégrat ion ,concerne les temmesd'origine étrangère. Lbs aider à ceite intégration passeégalement par I 'a lphabét isat ion parce Qu'el les sont sou-vent encore en retard à cqt égard par rapport auxhommes, puis par une format ion à l 'économie sociale etfami l ia le. l l existe nombre d'organismes sociaux enFrance suscept ib les de développer davantage de tel lesactions.
L ' intégrat ion passe également par un autre moyen, la v ieassociat ive. Mais j 'a imerais vous donner un exempleque je connais en tant que vice-président d 'une associa-t ion qui se consacre à enseigner la langue française dansle monde du travai l . Nous recevons pour ce fa i requelques subsides du Fonds d'Act ion Sociale, dans lamesure où nos stagiaires sont de nat ional i té étrangère.Mais nous n'avons aucun moyen pour apprendre lalangue française à des personnes de nat ional i té f ran-çaise, même si ce sont des natural isés de fraîche date etqui , en fa i t , ne connaissent pas le f rançais. Cet exemplemet bien en évidence I ' insuff isance des moyens mis enoeuvre pour apprendre le f rançais à des gens qui le sou-hai tent . Un autre out i l d ' intégrat ion est le service nat ionalqui méri terai t un exposé à lu i seul , avec le problèmenotamment des accords f ranco-algér iens de 1983 ; i l nefaut jamais oubl ier que I 'une des missions importantes duservice national 'est de contr ibuer à réal iser I ' intégrationde tous les f rançais.
Dernier élément enf in, la quest ion du logement. La pol i -t ique du logement a souvent consisté à concentrer dansdes l ieux uniques des populat ions déracinées, ce qui nepouvai t absolument pas faci l i ter leur intégrat ion. "Dreuxn'est qu'un symbole.
R.C. :
Mais les Français ne veulent pas y demeurer. C'est la for-mat ion des ghettos que les gouvernements n 'ont pu évi-ter mais que le gouvernement actuel est décidé à com-battre.
G-F. D. :
l l faut bien constater que les pol i t iques urbaines des dif-férents gouvernements ont c r ibué à créer le phéno-mène des ghettos. De même el les ont créé des ghet-tos à I ' intér ieur de ta société f rançaise. A part i r dumoment où vous faites un ensemble de 4000 HLM pourdes français considérés comme des cas sociaux, c 'est
aussi grave que de faire 4000 HLM pour des immigrés.Automat iquement, vous les isolez sur un terr i to i re donnépour évi ter leur intégrat ion, surtout quand vous avez enplus une pol i t ique, une réglementat ion générale du droi tde la construct ion qui ne faci l i le pas la souplesse deI 'aménagement.
R.C. :
l l n 'en demeure pas moins que le problème de I ' intégra-t ion soulève un point t rès dél icat . l l y a une "bonne" inté-grat ion des personnes qui peuvent être ut i les au pays etune autre forme d' intégrat ion, cel le des gens qui neseront jamais ut i les. Comment les départager, c 'est extrê-mement di f f ic i le.
l l y a eu en France, par exemple, en 1989, 61.000demandes d'asi les pour des raisons pol i t iques. EnAl lemagne la même année i l y en a eu 121.000, c 'est-à-dire prat iquement le double, et la progression ne semblepas s'arrêter. Or, plus de 80 "/" de ces demandes d'asi lespol i t iques ont été refusées pour des raisons valables.
G-F. D. :
La réponse technique, vous la connaissez, c 'est cel lequ'ont employé depuis des décennies le Canada et lesEtats-Unis. Ce sont des réglementat ions de contrôle str ictde I ' immigrat ion avec des systèmes de quota par pays.La réponse technique, el le est là. A ce sujet j 'ai été trèssurpr is de l i re dans un grand quot id ien f rancais, un art ic lesur I ' intégrat ion des immigrés qui se pasSait , paraî t - i l , defaçon idéale au Canada mais à aucun moment I 'ar t ic le nerappelai t les cr i tères quant i tat i fs et qual i tat i fs régissantI 'entrée des i fnmigrés.
RC.:
l l y a, c 'est vrai , un système de quota aux Etats-Unis, nonseulement le quota que vous indiquez mais égale 'mentpour les écoles; a lors qu'en France cela n 'existe pas. Onpeut c i ter des écoles de la région par is ienne où i l y a 80à 90 % d' immigrés. Comment voulez-vous que les i 0 %ou 20 "/" qui restent ...
G-F. D. i ,
A Paris, i l y a plusieurs dizai\aes d'écoles primaires où lepourcentage des enfants de parents de national i té étran-gère est supérieur à 50 Y"-
R.G.:
Peut-on établ i r un quota ? Peut-on enlever les enfantsqui se t rouvent dans le 18' ou le 20' et les envoyer dansune école du 1 6è ? Çela paraît impossible.
G-F. D. :
C'est ce que font les Etats-Unis, non sans de grandesrésistances, le système dit du "busing". Mais ce systèmen'est certainement pas exportable tel quel- D'ai l leurs, lessystèmes de quota tels que pratiqués aux Etats-Unis et
60 Administration
au Canada ne correspondent pas à notre tradit ion répu-bl icaine. Je ne vois pas la France instaurer ni aujourd'huini demain une tel le pol i t ique d' immigrat ion. De même,bien qu'gn puisse concevoir de f re iner de nouvel les arr i -vées, i l est absolument in imaginable de prendre desbateaux et des avions et de les charger de 4 mi l l ionsd'étrangers qu'on renverrai t dans leur pays. Reste àmettre en oeuvre I 'une des forces de la société francaisedans le passé, sa capacité d' intégration. Car, bien qu' i l yai t des minor i tés act iv istes soutenues f inancièrement ett ravai l lées parfois par des pays étrangers en plus oumoins mauvaise relat ion avec la France, mes mult ip lesrencontres avec des populat ions immigrées met en évi-dence qu'en général cel les-ci souhai tent s ' intégrer. Bienentendu, el les.souhai tent 4ussi pouvoir conserver leurpart icular isme de même qs' i l=y a des part icular ismesentre les Alsaciens, les Bretons ou les Basques enFrance. Mais la basede I ' intégration, c'est d'amener tousles habitants du pays à accepter un universel communqui leur permet de vivre ensemble, en bonne entente, surun même terr i toire. Accélérer I ' intégration, c'est aff irmerla volonté de cette intégration et mettre tout en ceuvrepour la réal iser au niveau de la formation des femmes, auniveau de l 'école, au niveau des associat ions, au niveaudu service nat ional .
L'avenir de la société et tout simplement de la démocra-t ie, au sens plein du terme, en dépend.
Une méconnaissance dommageable des vér i -tables données
R.C. :
En admettant qu' i l existe pour la France "une capaci téd' intégration" puisqu'on ne peut intégrer tout le monde, laquest ion se pose de savoir s i la France est encore unpays d' immigration ?
G.F. D. :
Les 52 mi l l ions de Français de I 'hexagone ne peuventintégrer sur 551.000 m'? les cinq mil l iards d'habitants dela planète. l ls ne peuvent, selon I 'expression du PremierMinistre Michel Rocard, "accuei l l i r toute la misère dumonde". Mais pour ceux dont i l est acquis qu' i ls contini.re-ront de résider dans I 'hexagone, i l le faut.
C'est la clé des l ibertés de demain.
R.C. :
Donc la France est encore une terre d' immigration ?
G.F. D. :
C'est évident. Mais I ' insuff isance de I ' informat ion surcette quest ion est regret table. La France est encore uneterre d ' immigrat ion. l l est évident qu' i l y a des regroupe-ments fami l iaux, des réfugiés pol i t iques, des personnesautor isées à venir t ravai l ler en France et aussi des c lan-dest ins. La France n'a jamais cessé d'être une terred' immigrat ion contrairement à ce que semblent af f i rmercertains chif fres off iciels. En effet, sur cette question, ona présenté aux Français, involontairement sans doute etsans mauvaises intent ions des chi f f res qui manifeste-ment ne ref létaient pas la réal i té. En 1974, leGouvernement a décidé de fermer les f ront ières.
Et, depuis 1974, ont été publ iés de nombreux documentsoff iciels, émanant par exemple du Ministère des Financesqui , dans la rubr ique solde migratoire, indiquaient "zéro",sous prétexte que les f ront ières étaient fermées. Parexemple, le volume "Démographie et Société" sur " lasi tuat ion démographique de la France en 1988", publ iépar I ' l .N.S.E.E. en ju i l let 1990, af f iche pour 1985, 1986 et1987 un solde migratoire évalué à"2éro". l l est extrême-ment dangereux, comme nous al lons le rappeler,d 'annoncer des chi f f res dont tout le monde sai t qu' i ls sontinexacts. Ne serai t - i l pas préférable de mettre "N.D."c'est-à-dire "non disponible". Cette méconnaissance desvéritables données entraîne le développment de tous lesfantasmes. A part i r du moment qu' i l n 'y a pas de réfé-rence ou d'est imat ion f iable que I 'on puisse ci ter , onlaisse le champ l ibre à des hommes pol i t iques pourmettre en avant les chif fres les plus fantaisistes.
l l convient de s 'at te ler enf in à cet te quest ion, comme je lesuggère depuis de nombreuses années, en se penchantvér i tablement sur la mise en place d'out i ls de mesurepermettant d' informer les Français de façon sereine et laplus sérieuse possible sur les mouvements migratoires.Aujourd'hui , i l faut b ien reconnaître que nous sommesdans une sorte de broui l lard. Prenons les premiers résul-tats du recensement de 1990.
L' l .N.S.E.E., dont on ne peut nier la qual i té des travaux, amis en évidence, dans le bul let in l .N.S.E.E. "Pr.emière"de ju in 1990, l 'évolut ion de la populat ion métropol i ta ineen isolânt ce qui est parfaitement connu compte-tenu denotre état-civi l , les haissances et les décès. Et puis resteune dif férence que |\N.S.E.E. aff iche dans une colonnedénommée "solde" sans déf in i t ion. L ' insuff isance deconnaissance des phénomènes est extrêmement dom-mageable. C'est vrai tant pour les migrat ions internesque pour les migrations internationales.
Le Code de la Nat ional i téR.C.:
Autre problème sur lequel j 'a imerais avoir votre sent i -ment- Convient- i l de modif ier le Code de la National i té oufaut-il le laisser dans son état actuel ?
G-F. D. :
l l est bien de votre part de poser cette question, et peut-êtce dangereux de ma part d'y répondre. El le a donnélieu à tel lement de débats pol i t iques ou le plus souventpol i t ic iens qui ont complètement détourné les véri tables
t
lnterview du prolesseur Gêrord-François DUMONT 6t
questions qu'on se fait forcément cri t iquer quand on traitece problème.
La quest ion pr incipalè, c 'est de savoir ce qu'est la nat io-nal i té, si la national i té a des attr ibuts, avant de savoir s ' i lfaut réformer ou non le Code actuel . Quels sontaujourd'hui les at t r ibuts de la nat ional i té f rancaise ? l l y ale droit de vote, la garantie de ne pas être expulsé, et lal iberté d 'être embauché sans être t i tu la i re d 'une carte.Voilà à mon sens ce que sont aujourd'hui les trois attr i-buts jur id iques de la nat ional i té- Peut-être pourrai t -onentrevoir un quatr ième attr ibut, la possibi l i té de bénéficierdu système de protect ion sociale de la France. Maisl 'évolut ion des textes, et notamment la décis ion duConsei l Const i tut ionnd du 21 janvirer 1990, met en évi-dence qu' i l semblerai t qu'en la màière, le droi t du solentraîne le droit à la protection sociale quel le que soit lanational i té. Les attr ibuts de-la national i té francaise.sontrelat ivement l imi tés. Avant de par ler d 'un problème, i létait indispensable de le définir.
Deuxième question : quel est en fait le rôle de la natural i-sation ? On peut entrevoir deux possibi l i tés de définit ionde la natural isat ion. On peut considérer qu' i l faut d'abordnatural iser les indiv idus pour qu' i ls s ' intègrent ; la natura-l isat ion est alors jugée comme une condit ion nécessaireà I ' intégrat ion, ce qui ne s igni f ie pas qu'el le soi t suf f i -sante. A I 'opposé on peut au contraire considérer que lanatural isat ion est un brevet d 'assimi lat ion, c 'est-à-direqu'on n 'accorderai t la natural isat ion qu'à part i r dumoment où les personnes sont considérées comme suff i-samment intégrées pour avoir la volonté de vivre avecI 'ensemble de la communauté.
Tant qu'on n 'aura pas répondu à ces deux quest ionspréalables : quels sont les attr ibuts véri tables de la natio-nal i té f rancaise, qu'est-ce qui d ist ingue quelqu'un qui a lanational i té francaise de quelqu'un qui ne I 'a pas ? Et queldoit être le rôle de I 'accès à la national i té francaise dansnotre déf in i t ion'sociale ? on ne pourra pas discuter aufond de la réforme du code de la national i té et définir pré-cisément ce qu'el le pourrait être. Mais je vous ai promisde ne pas esquiver votre question. Examinons en touteobject iv i té et en toute séréni té ce qu'est aujourd'hui leCode de la National i té française.
Premier constat, c 'est un droit extrêmement complexe.La comparaison du Code de la National i té française parrapport à des codes étrangers soul igne cette réal i té : i l a161 art ic les contre 18 en Suède. Et, en plus de ces 161art icles, i l y a de très nombreux textes annexes et notam-ment des disposit ions qui sont appl icables à certains ter-r i to i res et pas à d 'autres. l l y a en outre un certainnombre d'autres conventions, cel le avec le Vietnam oucelle avec la Tunisie par exemple. Pour quel le raison est-i l aussi complexe ? Parce que notre droit de national i tés 'est construi t en fonct ion d 'une évolut ion histor igue etnotamment la décolonisation. On pourrait dire aujourd'huique le droi t de la nat ional i té,est à géométr ie var iableselon Jes zones géographiques, ceci pour des raisonshistoriques- En tout état de cause, cette complexité estpréjudic iable à une bonne informat ion dans un paysdémocratique et just i f ierait une réforme.
Deuxième élément, on natural ise des personnes sans lesinformer qu'on leur donne la nat ional i té f rançaise, envertu de I 'ar t ic le 44. En outre. au moment de la déclara-t ion des naissances, la nat ional i té des naissances nedonne pas l ieu à une déclarat ion. On ne sai t pas s iI 'enfant qui naî t est Francais ou ne I 'est pas. Tout celadonne I ' impression d 'un droi t qui n 'est pas sûr de lu i ,de son bon droi t , qui a en quelque sorte "peur de sonombre" . Passons sur les décis ions qui paraissent régu-l ièrement au journal of f ic ie l où on vous par le des"NAT. REl. EFF. LlB." , s ig les évidemment incompréhen-sibles déjà pour le Français déjà natural isé, encore plusincompréhensible pour celui qu'on est en t ra in de natura-l iser. Une formulat ion c la i re, précise et af f ichée de lanational i té est donc un objecti f souhaiiable. En tout étatde cause, i l faut clari f ier I ' information. On peut même sedemander, et là. je vais peut-être fa i re réagir v ivementcertains de vos lecteurs, si certaines des formulations dudroi t f rançais de la nat ional i té respecte - les droi ts deI 'homme. Le respect des droits de I 'homme, c'est en effetde n'accorder la national i té qu'à des gens qui le souhai-tent, en les informant qu'on leur accorde la national i té. LeCode actuel ne respecte pas cette règle de juste transpa-rence. comme s' i l se sentait "honteut ' .
Trois ième constat object i f et incontestable comme lesdeux précédents, c'est un droit qui prête à la fraude. l lsuff i t d' interroger les dif férents maires de France. Raressont les maires de communes qui n 'ont pas, un jour ouI 'autre, fa i t un mariage dont i ls devinaient à l 'évidencequ' i l s 'agissait d'un mariage de complaisance, ayant pourseul object i f de permettre I 'acquis i t ion de la nat ional i téfrançaise par le conjoint ou la conjointe souhaitant béné-f icier de certains avantages matériels. Face à ces réal i-tés, que personne ne peut dément i r , quel que soi t le pointde vue d'où on se place, le droi t de la nat ional i té serévèle complexe, honteux, et souvent abusé. On ne peuthonnêtement nier qu' i l est nécessaire d 'apporter desremèdes aux trois handicaps cités ci-dessus. La réformede I 'acquisit ion de la national i té doit viser au l ibre choix,et à la suppression des mariages de complaisance quiconduisent, rappelons le, à un véri table traf ic humain, àce qu'on pourrait appeler une sorte de prosti tut ion admi-nistrat ive. c'est également une porte faci l i tant le terro-r isme internatisnal.Le souci que,nous devons avoir de la just ice doi tconduire à réformer le Codç. J'ai évoqué cette questionavec des praticiens du Minis' tère de la Justice. Certains,bons professionnels de la just ice, sincères, vont jusqu'àdire que le quart des mariages mixtes entre français etétrangers seraient des mariages de complaisance.Certains mêmes évoquent le pourcentage du t iers, ce quireprésenterait jusqu'à 5.000 mariages de complaisanceen France par an. 11 faut véri tablement revenir aux prin-c ipes de la démocrat ie. Nul n 'est censé ignorer la lo i ,mais nul ne peut être bien informé de la loi si el le est tropcomplexe. La just ice entre les dif férents habitants d'unterr i toire suppose d'empêcher le dévoiement du droit dela national i té constaté aujourd'hui. C'est pourquoi, malgréles remous que cette question a suscités, je ne peux queconstater 'gue ne pas réformer le code de la national i téentraîne le maint ien d' injust ices et n'est pas conforme aurespect des droits de I 'homme.
é2 IS lanvier l lgr - N" ' lso Administrotion
Les pays de la C.E.E. doivent élaborer unepol i t ique commune
R.C. :
Je vous remercie, je suis certain que nos lecteurs appré-cieront la c lar té et I 'honnêteté de votre posi t ion. Pensez-vous que les pays de la communauté européennedevraient avoir une pol i t ique commune face à ces pro-blèmes ?
G.F. D. :
Là encore, les fa i ts mettent en évidence qu' i l est indis-pensable que{es pays de {a communauté européenneaient une pol i t ique comnitne. Prenons un exemplerécent. D'après les est imat ions sur I ' immigrat ion turqueen France, cette présence semble part icul ièrement forteen Alsace et en Franche-Comté. Ce n'est pas parhasard. Cela résul te du Jai t qu'un certain nombre de turcsqui étaient venus i ravai l ler en Al lemagne se sont t rouvésdans des si tuat ions qui les ont condui ts à chois i r de t ra-verser la f ront ière f rançaise. Le t ra i té de Rome organisela l ibre c i rculat ion des hommes à I ' intér ieur du terr i to i reeuropéen, cela suppose inévi tablement une pol i t iquecommune face à ces problèmes. La nécessi té de cettepol i t ique commune sera plus faci lement comprise parI 'ensemble des pays d 'Europe aujourd'hui qu'hierpuisqu'aujourd'hui I 'ensemble de ces pays d 'Europe sontdésormais des pays d ' immigrat ion, a lors qu' i l y aquelques décennies, certains pays d 'Europe étaientencore des pays d ' immigrat ion et d 'autres des paysd'émigrat ion, l ' l ta l ie par exemple. Aujourd'hui cet te pol i -t ique commune est indispensable. Et d 'a i l leurs, quand onexamine dans le détai l l 'évolut ion des pol i t iques d ' immi-gration des dif férents pays d'Europe, on constate que laplupart d 'entre eux, au cours de la décennie 80 onl ren-torcé les moyens de maîtr iser les f lux migratoires. LaFrance est prat iquement le seul pays qui en soi t resté austatu quo.
R.C. :
M. le Professeur, je crois que nous avons évoqué denombreux problèmes. Avez-vous d'autres observations àformuler ou d'autres problèmes que vous.désireriez irai-ler ?
Les stat ist iques
G.F. D. :
Je tenais ef fect ivement à ce que nous évoquions, commepoint important, le problème des stat ist iques de I ' immi-grat ion.Cela est tout-à-fai t essent ie l .
R.C:
Les stat ist iques du Ministère de l ' lntér ieur sont di f fé-rentes de cel les de l ' lNSEE.. .
G.F. D. :
Ces di f férences conf i rment combien nous n'avons pascréé les out i ls dont nous avons besoin pour connaître lesmouvements migratoires. l l est impérat i f de développerces out i ls .Tant que nous n'en disposerons pas, toutes les divaga-t ions des discours pol i t iques sont possibles et le pro-blème cont iendra des zones d'ombre qui feront qu'onn'arr ivera absolument pas vers la solut ion. Et enf in, der-nier point , i l se pose une quest ion l iée à I ' immigrat ion,c 'est le pro.blème du viei l l issement de la populat ion f ran-çarse.
Cette évolut ion condui t à I ' interrogat ion suivante : unpays viei l l issant a-t- i l les capaci tés et la volonté d ' intégrerdes populat ions étrangères ?Et c 'est là, je crois l 'une des pr incipales inquiétudes quenous pouvons avoir . Certes le v ie i l l issement de la popula-t ion a, b ien entendu, et aura des conséquences écono-miques, des conséquences sociales mais i l aura peut-être également des conséquences morales sur l 'étatd 'espr i t des populat ions. l l est à crairrdre, s i I 'on n 'yremédie pas, que la société f rançaise ne parvienne pas àtrouver le dynamisme et I 'espr i t de jeunesse permettantd ' intégrer des populat ions venues de sphàes socio-cul-turel les dif férentes.
R.G. :
Je vous remercie, M. le Professeur, d 'avoir réponbu aussiclairerhelnt à mes questions : votre interview sera un despoints for ts de notrê numé-1o sur I ' immigrat ion.
![Page 1: L'IMMIGRATION HIER, AUJOURD'HUI, DEMAIN [Immigration yesterday, today, tomorrow]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022705/63226acd807dc363600a6f67/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: L'IMMIGRATION HIER, AUJOURD'HUI, DEMAIN [Immigration yesterday, today, tomorrow]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022705/63226acd807dc363600a6f67/html5/thumbnails/2.jpg)
![Page 3: L'IMMIGRATION HIER, AUJOURD'HUI, DEMAIN [Immigration yesterday, today, tomorrow]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022705/63226acd807dc363600a6f67/html5/thumbnails/3.jpg)
![Page 4: L'IMMIGRATION HIER, AUJOURD'HUI, DEMAIN [Immigration yesterday, today, tomorrow]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022705/63226acd807dc363600a6f67/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: L'IMMIGRATION HIER, AUJOURD'HUI, DEMAIN [Immigration yesterday, today, tomorrow]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022705/63226acd807dc363600a6f67/html5/thumbnails/5.jpg)
![Page 6: L'IMMIGRATION HIER, AUJOURD'HUI, DEMAIN [Immigration yesterday, today, tomorrow]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022705/63226acd807dc363600a6f67/html5/thumbnails/6.jpg)
![Page 7: L'IMMIGRATION HIER, AUJOURD'HUI, DEMAIN [Immigration yesterday, today, tomorrow]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022705/63226acd807dc363600a6f67/html5/thumbnails/7.jpg)
![Page 8: L'IMMIGRATION HIER, AUJOURD'HUI, DEMAIN [Immigration yesterday, today, tomorrow]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022705/63226acd807dc363600a6f67/html5/thumbnails/8.jpg)
![Page 9: L'IMMIGRATION HIER, AUJOURD'HUI, DEMAIN [Immigration yesterday, today, tomorrow]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022705/63226acd807dc363600a6f67/html5/thumbnails/9.jpg)