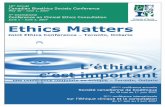recueil des actes administratifs - Département des Bouches ...
Éthique et épistémologie des nanotechnologies. I) Cartographie critique des approches existantes....
-
Upload
univ-lyon3 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Éthique et épistémologie des nanotechnologies. I) Cartographie critique des approches existantes....
Version générée par les auteurs d’un article paru en deux volets dans Techniques de l’Ingénieur : (1) Sacha Loeve & Xavier Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : cartographie critique des approches existantes », TI n° RE244, (2015). (2) Sacha Loeve & Xavier Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : pour une approche centrée sur les objets », TI n° RE245 (2015). Le présent manuscrit présente les deux volets réunifiés, révisés et remis en page à partir de leurs versions avant publication respectives. http://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/genie-industriel-th6/ingenierie-et-responsabilites-42598210/ethique-et-epistemologie-des-nanotechnologies-cartographie-critique-des-approches-existantes-re244/ http://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/genie-industriel-th6/ingenierie-et-responsabilites-42598210/ethique-et-epistemologie-des-nanotechnologies-pour-une-approche-centree-sur-les-objets-re245/
1
Éthique et épistémologie des nanotechnologies Pour une approche centrée sur les objets Sacha Loeve et Xavier Guchet
Résumé : Les nanosciences et nanotechnologies (NST) ont été placées très tôt sous le signe d’une volonté politique d’intégrer, en amont, la question de leurs « enjeux éthiques et sociétaux ». Dans ce contexte, les démarches d’« accompagnement » des technosciences par les sciences humaines et sociales (SHS) se sont multipliées, et diverses approches de l’éthique des NST ont été proposées. Après une décennie d’implication des SHS, un bilan s’impose. Cet article propose une cartographie raisonnée des différentes démarches d’accompagnement des NST par les SHS quant à leur problématisation du questionnement éthique, et en indique les insuffisances et les limites. Il soutient notamment que les développements technoscientifiques concrets des NST et les questions de valeurs qu’ils suscitent doivent être mieux articulés. L’éthique des NST demande en effet de remettre en question le partage entre la neutralité des objets et la moralité des usages. Les NST nous poussent par conséquent à une sorte de nouvelle « révolution copernicienne », nous faisant passer d’une situation où le sujet est le seul être moral à une situation où les objets entrent de plain-pied dans le champ de la philosophie morale. On propose pour cela une approche centrée sur les objets qui s’efforce d’articuler le questionnement éthique avec une analyse épistémologique des nano-objets comme objets techniques. On montrera comment cette démarche technologique (d’épistémologie des techniques) permet de renouveler le questionnement éthique sur des terrains à chaque fois singuliers. La démonstration se fera sur la base de quatre cas concrets de nano-objets, conceptualisés comme des « objets relationnels » : les machines moléculaires artificielles, les nanovecteurs de médicament, la bio et l’éco-toxicologie des nanoparticules, et les biomarqueurs pour la médecine personnalisée. Abstract : From an early stage, nanoscience and nanotechnology (NST) have been associated with a political will to integrate upstream the question of their “ethical and societal implications”. In this context, the involvment of the social and human sciences (SHS) has given way to a great variety of approaches to NST ethics. After a decade of SHS involvement, it is time for an appraisal. This article seeks to critically map the different approaches of SHS involvement in NST with regard to their problematization of ethical issues and to identify their shortcomings and limitations. It is argued that concrete technoscientific NST developments and the concerns with the values that they generate should be better articulated. The ethics of NST calls to question the division between the neutrality objects and the morality of uses. NST lead us therefore to a new kind of “Copernican revolution”, taking us from a situation where the subject is the only moral being to a situation where objects fully enter in the field of moral philosophy. For this, we propose an object-centred approach that seeks to articulate ethical questioning with an epistemological analysis of nano-objects as technical objects. We show how this technological approach (in the sense of an epistemology of technics) can renew ethical questioning on several singular fieldworks. The demonstration will be based on four case studies of nano-objects, conceptualized as “relational objects”: artificial molecular machines, drug nanocarriers, bio and eco-toxicology of nanoparticles, and biomarkers for personalized medicine.
Sommaire
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03 1. Des partis pris. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 1.1. Ethique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04
1.1.1. Définition minimale de l’éthique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05 1.1.2. Ethique descendante et éthique ascendante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05 1.1.3. Notre approche de l’éthique des techniques : valuation et évaluation. . . . . . . . . . 05
1.2. Nanosciences et nanotechnologies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06 1.2.1. Une distinction contestable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06 1.2.2. Sur un plan épistémologique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06 1.2.3. Sur un plan éthique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08 1.2.4. Récapitulatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09
2. Ethique ou politique des nanotechnologies ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09 2.1. Intégrer l’éthique : une volonté politique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09 2.2. Un contexte de transformation des rapports science/société . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.2.1. Du modèle linéaire aux approches participatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2.2.2. Une exigence de réflexivité de l’innovation… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2.2.3. …trustée par des « études d’impact » insuffisantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.3. Des motifs peu « éthiques » ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2.3.1. Une innovation en mal d’acceptabilité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2.3.2. Un climat de « peur de la peur » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 2.3.3. Une économie de la promesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 2.3.4. Un besoin stratégique de normalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.4. Comment relancer la réflexion éthique ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 3. Cartographie critique des approches existantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 3.1. L’éthique-vérité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.1.1. Ethique-vérité du Fait scientifique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 3.1.1.1. L’argument du déficit de connaissances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 3.1.1.2. Les études de perception . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.1.2. Ethique-vérité de la Valeur morale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 3.1.2.1. Des valeurs sacralisées mais pourtant relatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 3.1.2.2. L’éthique spéculative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 3.1.2.3. L’évaluation éthique des visions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 3.1.2.4. L’éthique-vérité interactionniste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3.1.3. Critique des éthiques-vérité : par delà faits et valeurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 3.1.3.1. Des éthiques de la distance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 3.1.3.2. Des nanos on ne fait pas usage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 3.1.3.3. Des trajectoires d’innovation non linéaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 3.1.3.4. Une division du travail déresponsabilisante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 3.1.3.5. Les NST ne produisent pas des faits mais des objets porteurs de valeurs . . . . 26
3.2. L’éthique-politique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 3.2.1. Caractéristiques générales et typologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.2.1.1. Caractéristiques générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 3.2.1.2. L’éthique-politique procédurale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 3.2.1.3. L’éthique-politique expérimentale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 3.2.1.4. L’éthique-politique ontologique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3.2.2. Par-delà sujet et objet : politiques des artéfacts et éthiques du design . . . . . . . . . 31 3.2.2.1. Politiques des artéfacts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 3.2.2.2. Ethiques du design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 3.2.2.3. Approches intégratives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
3.3. Conclusion sur les approches existantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 4. Pour une éthique de terrain centrée sur les objets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 4.1. Faire entrer les objets en morale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 4.2. Machines moléculaires artificielles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
4.2.1. Le mythe de la nanomachine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 4.2.1.1. Nanomachines et grands discours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 4.2.1.2. Nanomachines et politique de recherche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
4.2.2. Les machines moléculaires en pratique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 4.2.3. Leçons d’éthique des machines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
4.2.3.1. Ni dieux ni esclaves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 4.2.3.2. Décentrer notre rapport aux objets techniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 4.2.3.3. Prendre soin des relations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
4.3. Nanovecteurs de médicaments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 4.3.1. De la « magic bullet » au nano-arsenal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 4.3.2. Un problème de balistique ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 4.3.3. Des négociations complexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
4.3.3.1. Le rôle du milieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 4.3.3.2. Des stratégies militaires aux tactiques de contact . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
4.3.4. Vers une approche oïkologique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 4.3.5. Bilan provisoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
4.4. Bio et éco-toxicologie des nanoparticules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 4.4.1. Vers un référentiel commun : l’objet relationnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
4.4.2. Du cycle de vie au choix de vie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 4.4.2.1. Les difficultés de l’évaluation de la toxicité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 4.4.2.2. Intégrer les valeurs dans la définition des objets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
4.4.3. Dépasser l’analyse des bénéfices-risques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
4.5. Médecine personnalisée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 4.5.1. Le biomarqueur : définition et problèmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
4.5.1.1. Le biomarqueur comme objet technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 4.5.1.2. Les difficultés de la validation des biomarqueurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
4.5.2. Le cas de l’EGFR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 4.5.3. Le biomarqueur comme objet-trace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
4.5.3.1. D’altération en altération . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 4.5.3.2. Les deux sens de la personne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Version générée par les auteurs d’un article paru en deux volets dans Techniques de l’Ingénieur : (1) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : cartographie critique des approches existantes », TI n° RE244, 2015. (2) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : pour une approche centrée sur les objets », TI n° RE245, 2015. Le présent manuscrit présente les deux volets réunifiés, révisés et remis en page à partir de leurs versions avant publication respectives.
3
Introduction
Quel rapport peut-il y avoir entre une échelle de grandeur – le nanomètre – et un ques-tionnement éthique ? Certes, les ruptures de propriétés rendues possibles par l’accès à l’échelle nanométrique promettent de nouvelles applications. Certaines existent déjà : nanoparticules pour améliorer les performances des matériaux ou les propriétés optiques des cosmétiques, des encres et des plastiques. Celles-ci posent des problèmes de toxicité et d’écotoxicité. Dans ce cas, pourquoi en appeler à la réflexion éthique, et ne pas se contenter d’étendre le champ de compétence des approches existantes d’analyse et de gestion des risques ? D’autres applications sont attendues pour demain : composants électroniques moléculaires pour des ordinateurs plus petits et plus rapides, nanosondes permettant de concevoir des tests diagnostiques sensibles à la molécule près, médica- ments ciblés, capteurs-actionneurs miniaturisés pour la dépollution, etc. La plupart de ces recherches en sont encore au stade des nanosciences, désignant la recherche en amont sur les propriétés de la matière à l’échelle nanométrique. Leurs applications – les nanotechnologies – seront transférées à l’industriel dans un futur plus ou moins lointain selon leur maturité et leur potentiel économique. Or, si celles-ci sont susceptibles de poser des questions d’éthique, en quoi ces questions sont-elles spécifiques aux nanotechnologies ? Les divers champs de l’éthique appliquée (éthique des technologies de l’information, bioéthique, éthique environnementale, etc.) ne sont-ils pas suffisamment équipés pour s’en emparer ? Enfin, certaines applications font l’objet d’anticipations préfigurant un futur encore lointain : électronique ambiante, interfaces homme-machine, organes artificiels, nano-robots… La « nano-éthique » relèverait alors essentiellement d’une approche d’anticipation des impacts futurs. Or, en se focalisant sur des applications à venir, et par conséquent sur des impacts qui ne sont pas encore avérés et relèvent du domaine de la spéculation, ne risque-t-on pas de passer à côté d’enjeux éthiques bien actuels et qui concernent le présent de la recherche ?
Le présent dossier s’efforce par conséquent d’aborder l’éthique des nanosciences et nanotechnologies (NST) autrement qu’en se focalisant sur l’étude des applications et de leurs impacts « potentiels ». Plutôt que de considérer comme « naturelle » et allant de soi la « demande » d’éthique des NST, il présente celle-ci comme une construction témoignant d’une volonté politique. Il affirme que cette construction doit être à la fois critiquée et saisie comme une opportunité pour repenser à nouveaux frais la pratique de l’éthique des technologies.
Ce caractère de « construction » ne fait pas forcément de l’éthique des NST un « artéfact » qui viendrait se surimposer à une réalité factuelle et bien circonscrite. La spécificité des NST, c’est qu’elles n’en ont pas. En effet, rien ne désigne les NST comme un nouveau domaine clairement défini des sciences fondamentales en amont, ni comme une « technologie » particulière identifiable par ses domaines d’application dans l’industrie. Les critères d’une caractérisation – plutôt que d’une définition – des NST sont à chercher ailleurs, sur un double plan : sur le plan des stratégies politiques, et sur celui de la diversité des objets de laboratoire. En effet, d’une part les NST sont à appréhender comme une construction de politique de recherche, une expérimentation collective intégrant un assemblage hétérogène de savoirs et de pratiques issues de la recherche fondamentale comme de la recherche applicative et des sciences humaines et sociales (SHS). D’autre part, cet assemblage ne produit pas simplement des « faits objectifs » qui se verraient traduits dans un deuxième temps en applications utiles, mais des objets individualisés et multifonctionnels, dont la recherche en NST – toutes disciplines comprises – contribue à déterminer la valeur selon des critères qui sont – ou devraient être – sujets à délibération. En assumant son caractère de construction, l’éthique participe aux processus d’agencement des différentes composantes d’une technoscience aux contours mouvants.
Version générée par les auteurs d’un article paru en deux volets dans Techniques de l’Ingénieur : (1) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : cartographie critique des approches existantes », TI n° RE244, 2015. (2) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : pour une approche centrée sur les objets », TI n° RE245, 2015. Le présent manuscrit présente les deux volets réunifiés, révisés et remis en page à partir de leurs versions avant publication respectives.
4
Il ne s’agit donc pas pour nous d’élaborer un éthique spécifique aux NST – une « nano-éthique » en ce sens, qui viendrait prendre place aux côtés des spécialités existantes de l’éthique appliquée (comme il existe une bioéthique, une neuro-éthique, etc.) – mais plutôt de considérer les NST comme un terrain propice à renouveler l’éthique des technologies en l’articulant de manière serrée à une approche de philosophie des techniques centrée sur les objets de laboratoire1.
Pour mieux situer notre approche, il nous faudra d’abord passer en revue approches existantes de l’éthique des NST. Cet état des lieux se veut aussi impartial que possible mais il n’est pas neutre pour autant ; il est solidaire de certains partis pris. La première partie les explicite. Elle fournit une définition minimale de « l’éthique » et explique notre refus de baser notre approche sur la distinction entre « nanosciences » et « nanotechnologies » ; s’y trouve rejetée la division du travail entre l’épistémologie, qui étudierait la fabrique des « faits » des nanosciences, et l’éthique, qui s’attacherait aux applications et aux valeurs susceptibles de guider leurs usages, une fois les faits et les objets constitués. La seconde partie dresse le paysage des transformations de la politique de recherche et d’innovation permettant de comprendre ce qui motive l’intégration des « enjeux éthiques et sociétaux » dans les programmes de recherche en NST. La troisième partie propose un état des lieux des modes de problématisation de l’éthique des NST et émet un certain nombre de critiques. Après une décennie d’implication des SHS dans les projets en NST, les développements technoscientifiques concrets des NST et les questions de valeurs qu’ils suscitent restent insuffisamment articulés. Au fur et à mesure que seront précisées les limites des approches existantes, une voie alternative se dessinera. Elle sera mise en pratique dans la quatrième partie. Celle-ci consiste à articuler éthique et épistémologie des NST sur l’étude du mode d’existence des nano-objets, en prenant en compte le détail de leur fonctionnement, leurs processus matériels et conceptuels de design, les pratiques concrètes auxquelles ils donnent lieu et les valeurs qu’ils incorporent, suscitent et requièrent.
1. Des partis pris 1.1. Éthique 1.1.1. Définition minimale de l’éthique
Notre premier parti pris concerne la définition et la pratique de l’éthique. Notre pratique de l’éthique des techniques relève d’une démarche d’intervention qui se donne pour tâche d’aider les acteurs à identifier les conflits de valeurs et à augmenter leur capacité à argumenter, à structurer et à renforcer leurs prises de position.
Dans son acception la plus large – et que nous adoptons – l’éthique est synonyme de « réflexion morale ». C’est d’ailleurs ce qu’indique son étymologie, qui renvoie à la notion de « mœurs » (ethos en grec, mores en latin). Les mœurs sont des « comportements évaluateurs », c’est-à-dire des comportements porteurs de valeurs ou qui procèdent de systèmes de valeurs. Ces comportements sont eux-mêmes susceptibles d’une évaluation, c’est-à-dire d’un jugement de valeur les qualifiant comme bons ou mauvais, justes ou injustes, etc.
Pratiquer l’éthique n’est pas professer dogmatiquement une valeur suprême ou une notion absolue du bien ou du mal – notions éminemment variables en fonction des époques et des sociétés. Ce n’est pas chercher à imposer une « morale » au sens populaire du terme. « La vraie morale se moque de la morale », disait Pascal. Non, l’éthique a plutôt pour finalité de
1 Cette articulation fera l’objet des développements de la quatrième partie du présent dossier.
Version générée par les auteurs d’un article paru en deux volets dans Techniques de l’Ingénieur : (1) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : cartographie critique des approches existantes », TI n° RE244, 2015. (2) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : pour une approche centrée sur les objets », TI n° RE245, 2015. Le présent manuscrit présente les deux volets réunifiés, révisés et remis en page à partir de leurs versions avant publication respectives.
5
nous aider à renforcer notre aptitude à justifier, argumenter et structurer nos prises de position en valeurs et nos décisions, en recourant éventuellement (mais non obligatoirement) à des théories morales. Celles-ci, classiquement, sont l’utilitarisme, l’éthique du devoir, l’éthique des vertus ou du care2 . Il s’agit de traditions de pensée qui offrent des modèles d’argumentation morale différents selon ce sur quoi elles font porter l’évaluation morale : sur les conséquences des actes (utilitarisme), sur le respect de règles universelles (éthique du devoir), sur la qualité des agents (éthique de la vertu), ou sur les liens affectifs et sociaux (éthique du care).
1.1.2. Éthique descendante et éthique ascendante
Même si nous ne nous interdisons pas des références à telle ou telle théorie morale, notre pratique de l’éthique des techniques ne consiste toutefois pas à appliquer de manière top-down, ou « descendante », des doctrines préexistantes (celles de la bioéthique ou de telle théorie morale par exemple) aux usages qu’il convient de faire de tel ou tel produit des nanotechnologies. Notre approche n’est pas davantage bottom-up, c’est-à-dire qu’elle ne consiste pas seulement à mettre en évidence les normes et les valeurs éthiques sous-jacentes, implicites, des acteurs de la recherche et du développement des nanotechnologies. Chacune de ces deux approches a en effet ses limites : la première est normative (elle porte sur « ce qui doit être »), mais les normes n’y sont pas produites sur la base d’une analyse détaillée des pratiques de laboratoire et de conception des objets « nano », ce qui se traduit par l’incompréhension des chercheurs en nanotechnologies, qui ne se sentent pas concernés par les normes produites ; la seconde est attentive aux détails des pratiques et des objets, mais elle ne dit pas la norme ; elle reste descriptive, ce qui se traduit par une certaine insatisfaction chez ceux qui attendent justement des philosophes qu’ils éclairent les décideurs et les acteurs du débat public.
1.1.3. Notre approche de l’éthique des techniques : valuation et évaluation
L’approche que nous proposons veut précisément éviter l’alternative entre évaluation éthique « descendante » et évaluation éthique « ascendante ». Pour ce faire, notre démarche s’inspire de la distinction proposée par le philosophe John Dewey entre deux processus : celui de valuation, d’une part, désignant une attitude par lequel un acteur signifie son attachement à quelque chose ; et le processus d’évaluation, d’autre part, démarche réflexive permettant d’articuler un jugement de valeur et de le mettre en pratique3. On distinguera donc les significations morales intuitives liées à la valuation et les représentations morales réflexives ou jugements de valeur que nous formons sur les nanotechnologies par l’évaluation des valuations initiales4. Une fois opéré ce travail d’évaluation, nous pouvons former de nouvelles représentations. Celles-ci, à leur tour, seront susceptibles de constituer de nouvelles valeurs implicites incorporées dans la conception même des objets. Ces nouvelles valuations devront, si nécessaire, être de nouveau explicitées par l’enquête et soumises à une évaluation. Le processus de valuation-évaluation est cyclique. Il engage notre expérience en tant qu’êtres moraux et sociaux mais aussi en tant qu’humains participant d’une nature sans cesse reconfigurée par la technique. C’est pourquoi ce travail exige une articulation étroite entre la 2 Consulter par exemple CANTO-SPERBER (M.) et OGIEN (R.). – La philosophie morale. Presses universitaires de France (2004). 3 DEWEY (J.). – La théorie de la valuation (1939). Tracés. Revue de Sciences humaines, n° 15, p. 217-228. http://traces.revues.org/833 (page consultée le 24 mai 2014) (2008). 4 Pour un exposé différent de la même approche, voir aussi BENSAUDE-VINCENT (B.) et NUROCK (V.). – Éthique des nanotechnologies. In E. HIRSCH, Traité de bioéthique, tome I : Fondements, principes, repères. Éditions érès, p. 355-369 http://www.cairn.info/traite-de-bioethique-1--9782749213057-p-355.htm (page consultée le 05 avril 2015) (2010).
Version générée par les auteurs d’un article paru en deux volets dans Techniques de l’Ingénieur : (1) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : cartographie critique des approches existantes », TI n° RE244, 2015. (2) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : pour une approche centrée sur les objets », TI n° RE245, 2015. Le présent manuscrit présente les deux volets réunifiés, révisés et remis en page à partir de leurs versions avant publication respectives.
6
philosophie morale et l’épistémologie, la philosophie des sciences et des techniques5. Enfin cet aller-retour constant entre intuitions et réflexions doit permettre aux jugements de valeur d’être toujours révisables et de ne pas être érigés en dogmes.
Le travail proprement normatif d’évaluation ne vise pas l’acceptation sociale ni le consensus. Il cherche à construire des représentations morales qui serviront de référence pour l’élaboration des normes en situation irréductible de pluralité de valeurs, voire de conflit de valeurs. L’éthique telle que nous la concevons concerne donc la question « comment faire monde commun ? » Les normes sont justement ce qui permet de vivre ensemble et de faire monde commun en condition – constitutive de toute société démocratique – de pluralisme des valeurs (de « ce à quoi on tient »). En cela, nous ne séparons pas totalement l’éthique de la politique (bien que l’action politique soit légitimement sujette à des types d’évaluation autres qu’éthiques). Enfin, la réflexion sur le sens et les directions souhaitables d’un point de vue moral ne vise pas à élaborer un consensus acceptable mais à affiner les positions sur des questions délicates.
1.2. Nanosciences et nanotechnologies 1.2.1. Une distinction contestable
Le second parti pris que nous adoptons est le refus de baser l’analyse sur la distinction entre nanosciences et nanotechnologies, la première désignant la recherche en amont sur les propriétés de la matière à l’échelle nanométrique, et la seconde, les applications en aval. On ne partira donc en aucun cas de l’épistémologie des nanosciences pour aller vers l’éthique des nanotechnologies, considérées comme applications des premières. Nous utiliserons pour cette raison l’acronyme NST pour « nanosciences-et-nanotechnologies », ou alors nous parlerons d’objets et d’applications « nano » particuliers.
Ce choix de ne pas prendre pour acquise la distinction entre nanosciences et nanotechnologies mérite quelques explicitations. Nous savons combien cette distinction est tenace dans les discours des chercheurs, et particulièrement des chercheurs français. Cela tient selon nous à deux facteurs : premièrement, à la structuration encore très disciplinaire de la formation et du recrutement des chercheurs en France (un chercheur français est le plus souvent soit chimiste, soit biologiste, soit physicien, etc.) ; deuxièmement, à une réticence des chercheurs à l’impératif qui leur est fait de s’engager dans des recherches à fort potentiel applicatif et donc économique (impératif utilitaire identifié un peu rapidement à « technologie »). Nous ne voulons pas dire que la distinction entre science et technique doit être généralement rejetée a priori. Il n’est pas question de nier les différences culturelles, professionnelles, pratiques, ou institutionnelles qui existent, par exemple, entre un physicien des particules et un ingénieur en génie civil. En revanche, dans le domaine des NST, il existe de bonnes raisons de ne pas prendre pour acquise la distinction entre nanosciences et nanotechnologies. Ces raisons relèvent d’enjeux tout autant épistémologiques qu’éthiques.
1.2.2. Sur un plan épistémologique
La distinction nanosciences/nanotechnologies reconduit le modèle linéaire « science-en-amont-d’où-applications-en-aval ». Or dans le domaine des NST ce schéma est davantage l’exception que la règle. La conception (ou le « design », selon le terme en vigueur) d’objets « nano » tels que, par exemple, des machines moléculaires ou des boîtes quantiques n’est pas, le plus souvent, dictée par une visée applicative immédiate. Mais cela ne fait pas de ces objets des objets de science fondamentale, par opposition à des objets de technologie qui seraient,
5 Cette articulation sera déployée sur un certain nombre de terrains dans la quatrième partie du présent dossier.
Version générée par les auteurs d’un article paru en deux volets dans Techniques de l’Ingénieur : (1) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : cartographie critique des approches existantes », TI n° RE244, 2015. (2) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : pour une approche centrée sur les objets », TI n° RE245, 2015. Le présent manuscrit présente les deux volets réunifiés, révisés et remis en page à partir de leurs versions avant publication respectives.
7
quant à eux, forcément utilitaires. Une boîte quantique associant une transition de spin à une photo-émission, ou encore une machine moléculaire couplant une oxydoréduction à un mouvement réversible, peuvent être considérées comme de véritables objets techniques, même s’ils ne sont pas « socialisés » dans des usages (autres que ceux qu’en ont les chercheurs dans leur laboratoire). Contrairement à ce qu’on apprend le plus souvent (en classe de philosophie par exemple), « technique » n’est pas forcément synonyme d’« utilité » et de « moyen pour une fin ». De plus, « techno-logie » (technè + logos) signifie aussi production de connaissances de la technè ou par la technè, et non simplement application de savoirs déjà constitués par telle ou telle science fondamentale6. La science théorique n’a pas le monopole de la production de connaissances. Même si les NST impliquent de « vrais » scientifiques (comme elles impliquent des SHS, des politiques, des citoyens, etc.), ceux-ci se revendiquent rarement sinon jamais « nanoscientifiques », mais plutôt physiciens, chimistes ou biologistes « faisant des nanotechnologies ». Autrement dit, avec les NST, scientifiques comme ingénieurs font essentiellement du design d’objet.
La nouveauté pertinente des nano-objets se situe donc avant tout sur un plan technologique. Ce qui est nouveau, ce n’est pas le fait que les NST travaillent dans un contexte d’application (c’était déjà le cas de la science et de l’ingénierie des matériaux7 ; ou encore de la science des surfaces des années 1970, par exemple, qui est un rejeton de la microélectronique). Ce n’est pas non plus le fait qu’elles travaillent à l’échelle nanométrique (c’est le cas de la chimie depuis toujours). C’est le fait que les NST participent à faire advenir des objets individualisés définis comme « nano-objets » par leurs fonctionnement à l’échelle nanométrique, donc définis technologiquement, et ceci indépendamment de leur utilité dans des applications. « Fonctionnement » n’est pas synonyme d’« utilité »8 – pas plus qu’« usage » n’est synonyme d’« application ». Ainsi un même nano-objet peut tout autant se prêter à un usage scientifique (revisiter telle question issue des sciences fondamentales) que technologique (servir de « démonstrateur » pour une « preuve de principe » visant à établir une possibilité technique) ou industriel (optimiser les performances d’un procédé existant) : le partage n’est pas entre nanosciences en amont et nanotechnologies en aval. Même quand l’objet dont on s’occupe est déjà engagé dans des développements commerciaux (comme les nanovecteurs, les nanosondes, les biomarqueurs ou les matériaux nanostructurés), les nano-objets sont justement des objets dont on ne peut jamais dire que l’état des connaissances les concernant est exhaustif quand ils sortent du laboratoire, de sorte qu’il n’y aurait plus qu’à les « mettre en application »9. C’est en cela que réside leur dimension d’usage, car il y a précisément « usage » d’une technique quand celle-ci n’est pas réductible à la finalité qu’on lui a assignée.
Cela ne signifie pas qu’il n’y a pas dans les NST certaines approches plus fondamentales (par exemple, l’étude des gaz quantiques à deux dimensions) et d’autres dont la visée applicative est plus évidente (les cages moléculaires pour encapsuler des médicaments, par exemple). Mais cela signifie
i) Que les nano-objets ne se laissent pas répartir « naturellement » dans l’une ou l’autre de ces catégories. Ainsi les gaz quantiques 2D constituent-ils un phénomène déterminant pour le comportement des semi-conducteurs développés par l’industrie de la
6 LOEVE (S.). – About a definition of nano: how to articulate nano and technology? Hyle – International Journal for Philosophy of Chemistry, vol. 16(1), pp. 3-18 (2010). http://www.hyle.org/journal/issues/16-1/loeve.pdf (page consultée le 12 avril 2013) 7 BENSAUDE-VINCENT (B.). – The construction of a discipline: Materials science in the United States. Historical Studies in the Physical & Biological Sciences, 31(2), p. 223-248 (2001). 8 SIMONDON (G.). – Du mode d’existence des objets techniques. Aubier, Paris [1958] (1989). 9 GWINN (M.R.) et VALLYATHAN (V.). – Nano-particles: health effects – pros and cons. Environmental health perspectives, 114(12), pp. 1818 (2006).
Version générée par les auteurs d’un article paru en deux volets dans Techniques de l’Ingénieur : (1) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : cartographie critique des approches existantes », TI n° RE244, 2015. (2) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : pour une approche centrée sur les objets », TI n° RE245, 2015. Le présent manuscrit présente les deux volets réunifiés, révisés et remis en page à partir de leurs versions avant publication respectives.
8
microélectronique10 ; quant aux cages moléculaires, elles servent de modèles pour la compréhension des interactions « invité-hôte » en biologie11. L’objet réputé « fondamental » a donc aussi un potentiel applicatif, de même que l’objet « applicatif » a un potentiel fondamental.
ii) Qu’aucun critère habituel permettant de définir une science fondamentale ne suffit à définir spécifiquement les « nanosciences » en amont : nouveau paradigme, recherche d’une théorie unificatrice, découverte d’une « région » inexplorée du réel – l’échelle moléculaire était explorée depuis longtemps (certes pas de la même manière). L’absence d’application d’une recherche ne suffit pas à la définir comme démarche de science fondamentale. Les « nanos » ne constituent pas une discipline scientifique nouvelle, mais un ensemble multidisciplinaire aux contours mouvants. Les multiples disciplines rassemblées sous le label « nanosciences » existaient toutes avant l’essor des NST dans les politiques de recherche : science des surfaces, physicochimie des particules fines, physique mésoscopique, chimie supramoléculaire, biophysique, spintronique, computation quantique, etc. Dans chacun de ces champs, des visées fondamentales existent, mais elles ne suffisent pas à définir l’ensemble des « nanos » comme une recherche fondamentale. Enfin, une échelle de grandeur n’a jamais défini une science (on ne parle pas, par exemple, de « microsciences »).
iii) Symétriquement, qu’aucun critère des sciences appliquées ne suffit à définir les « nanotechnologies » en aval. Les nanotechnologies ne se définissent pas par des visées applicatives spécifiques pour des secteurs industriels précis. Des visées applicatives précisent existent, mais elles ne fournissent pas de critère général pour définir les nanotechnologies dans leur ensemble. Le potentiel applicatif des nanotechnologies est transversal, non spécifique, non délimité dans l’espace et dans le temps. Aucune filière industrielle en particulier n’est le « driver » des NST.
1.2.3. Sur un plan éthique
La distinction nanosciences/nanotechnologies sert aussi d’alibi éthique. Bien souvent, quand un chercheur affirme faire des nanosciences et non des nanotechnologies, c’est pour sous-entendre que ses objets sont « neutres en valeur » puisqu’ils n’ont pas d’usage, et que c’est par conséquent aux industriels et aux politiques de prendre leurs responsabilités. L’argument de « l’objet neutre en valeur » permet de déléguer la responsabilité en postulant une répartition claire et bien définie des formes de responsabilité moulée sur des fonctions sociales préétablies12 (voir section 3.1.3.4). En effet, du point de vue des sujets de la recherche, on peut clairement distinguer des scientifiques, des technologues, des ingénieurs, des industriels, des citoyens, des SHS, des politiques, etc. ; tous poursuivent des finalités différentes, même si des recouvrements peuvent exister. Du point de vue – qui nous intéresse plus particulièrement – des objets, tous ces acteurs ajoutent des dimensions ou des modes d’existence (cognitifs, pratiques, prospectifs, sociaux, politiques…) aux nano-objets : tous font d’une manière ou d’une autre du « design d’objet » dans la mesure où ils façonnent l’existence publique et le sens social des nano-objets.
Comme on le verra, le centrage de l’analyse sur les objets permet de décloisonner cette répartition rigide des responsabilités et des attributions de valeur là où la distinction nanosciences/nanotechnologies verrouille en grande partie ces questionnements. 10 GARDNER (C.L.). – The quantum hydrodynamic model for semiconductor devices. SIAM Journal on Applied Mathematics, vol. 54(2), pp. 409-427 (1994). 11 DESIRAJU (G.R.). – Chemistry beyond the molecule. Nature, vol. 412, n° 6845, p. 397-400 (2001). 12 LACOUR (S.), LOEVE (S.), LAURENT (B.), ALBE (V.), DELEMARLE (A.), BARTENLIAN (A.) et LANONE (S.). – Deliberating Responsibility: A Collective Contribution by the C’Nano IdF Nanoscience & Society Office. Foundations of chemistry. Vol. 15, p. 1-23 (2015).
Version générée par les auteurs d’un article paru en deux volets dans Techniques de l’Ingénieur : (1) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : cartographie critique des approches existantes », TI n° RE244, 2015. (2) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : pour une approche centrée sur les objets », TI n° RE245, 2015. Le présent manuscrit présente les deux volets réunifiés, révisés et remis en page à partir de leurs versions avant publication respectives.
9
1.2.4. Récapitulatif
D’un point de vue épistémologique, la distinction entre nanosciences et nanotechnologies empêche de prendre en compte le mode d’existence de nombreux nano-objets, qui ne se laissent pas classifier ainsi. D’un point de vue éthique, cette distinction sert souvent d’alibi pour soustraire les recherches non directement applicatives à tout débat.
Il convient par conséquent de rejeter la division du travail entre l’épistémologie, qui étudierait la fabrique des objets des nanosciences, et l’éthique, qui s’attacherait aux applications et aux valeurs susceptibles de guider leurs usages, une fois les faits et les objets constitués.
Nous allons maintenant dresser le paysage des transformations de la politique de recherche et d’innovation permettant de mieux comprendre ce qui motive l’intégration des « enjeux éthiques et sociétaux » dans les programmes de recherche en NST.
2. Éthique ou politique des nanotechnologies ? 2.1. Intégrer l’éthique : une volonté politique Les NST semblent se démarquer des précédentes vagues technologiques par leur effort explicite d’intégration des aspects éthiques en amont, dès le stade de la recherche en laboratoire. Une partie des budgets des programmes de financement de la recherche en NST est ainsi consacrée à leur « accompagnement » par les SHS. De 2006 à 2012, la National Nanotechnology Intitative états-unienne (NNI) a alloué 35 millions de dollars aux recherches ELSI (Ethical, Legal and Societal Impacts), soit 2,1 % de son budget sur cette période. En France, le programme de financement de l’Agence nationale de la recherche (ANR) pour les nanotechnologies (PNANO, devenu P3N puis P2N) comportait initialement un volet « impacts » consacrés aux « aspects éthiques, sociétaux et sanitaires », et le Centre de Compétence Cnano Île-de-France finance des recherches et entreprend des formations en SHS au sein d’un axe « Nanosciences et Société ». À cette intégration des recherches en SHS s’ajoutent les initiatives de débat public prises par certains États tels la Grande-Bretagne ou la France et la production institutionnelle de « guides de bonnes pratiques » (OCDE13, CE14, NIA 15) et autres « ethical toolkits » (EU16), ainsi que des normes de « soft law » (ISO TC 229, AFNOR X457). La multiplication de ces initiatives peut donc laisser penser que les NST font l’objet d’une demande d’éthique dûment relayée par les pouvoirs publics afin que chercheurs et innovateurs puissent l’intégrer dans leurs pratiques. Ainsi peut-on lire par exemple que « la convergence de la technique avec le monde du vivant et l’humain est naturellement porteuse
13 OECD WORKING PARTY ON NANOTECHNOLOGY. – Planning Guide for Public Engagement and Outreach in Nanotechnology. ©OECD http://www.oecd.org/sti/biotech/49961768.pdf (page consultée le 12 avril 2013) (2012). 14 COMMISSION EUROPEENNE. – Code of Conduct for Responsible Nanosciences and Nanotechnologies Research. Recommandation CE n° 424 http://ec.europa.eu/nanotechnology/pdf/nanocode-rec_pe0894c_en.pdf (page consultée le 12 avril 2013) (2008). 15 NANOTECHNOLOGY INDUSTRIES ASSOCIATION, ROYAL SOCIETY, INSIGHT INVESTMENT. –Responsible NanoCode. ©Insight Investment, Royal Society, Centre for Process Innovation, Nanotechnology Industries Association http://www.nanoandme.org/downloads/The Responsible Nano_Code.pdf (page consultée le 12 avril 2013) (2008). 16 PAVLOPOULOS (M.), GRINBAUM (A.) et BONTEMS (V.). – Toolkit for Ethical Reflection and Communication. EU ObservatoryNano. © Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA). All rights reserved. http://www.nanopinion.eu/sites/default/files/toolkit_full_final_22jun2010.pdf (page consultée le 3 mars 2013) (2010).
Version générée par les auteurs d’un article paru en deux volets dans Techniques de l’Ingénieur : (1) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : cartographie critique des approches existantes », TI n° RE244, 2015. (2) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : pour une approche centrée sur les objets », TI n° RE245, 2015. Le présent manuscrit présente les deux volets réunifiés, révisés et remis en page à partir de leurs versions avant publication respectives.
10
de questions variées qui touchent parfois les fondements mêmes de la nature humaine »17. Or cette demande d’éthique n’a rien de naturel ni d’évident. Elle ne repose pas sur un contenu spécifique et intrinsèque aux NST, pas plus qu’elle n’émane spontanément d’un public qui existerait en soi. L’injonction éthique des NST n’émane pas de la société. Elle procède d’une volonté politique. Réfléchir sur l’éthique des NST requiert donc d’interroger cette volonté politique en tant que telle. Quel en est le contexte et quels sont les motifs de son émergence ?
2.2. Un contexte de transformation des rapports science/société Pour le politique, les NST sont perçues comme représentatives d’un certain nombre de transformations récentes du régime de production des savoirs. 2.2.1 Du modèle linéaire aux approches participatives
Ainsi les NST témoigneraient-elles de la fin du « modèle linéaire » de recherche et d’innovation ou « modèle du pipeline » (figure 1) : des découvertes scientifiques sont faites en amont avant d’être implémentées dans des applications qui sont ensuite manufacturées par l’industrie dont les produits atteignent finalement les consommateurs, situés en aval du pipe-line. « Science finds, Industry applies, Man conforms », proclamait le slogan de l’Exposition universelle de Chicago en 1933.
Figure 1. Modèle linéaire d’innovation ou « modèle du pipeline » Cette vision datée, contestable et contestée – notamment par les travaux sociologiques du courant STS (Sciences-Techniques-Sociétés) –, serait en passe de se voir supplantée par un nouveau régime que certains appellent le « Mode 2 »18, et d’autres la « Société de la
17 BOTTERO (J.-Y.), GROGNET (J.-M.) et LAURENT (L.). – « Nanotechnologies : promesses et débats ». Techniques de l’Ingénieur, NM 8005 (dossier « Nanosciences: concepts, caractérisation et aspects sécurité) (2013), p. 7. 18 GIBBONS (M.), LIMOGES (C.), NOWOTNY (H.), SCHWARTZMAN (S.), SCOTT (P.) et TROW (M.). – The New Production of Knowledge. The Dynamics of Science and Research in Comtemporary Societies. Sage, Londres (1994). NOWOTNY (H.), SCOTT (P.) et GIBBONS (M.). – Repenser la science. Belin, Paris (2003).
Version générée par les auteurs d’un article paru en deux volets dans Techniques de l’Ingénieur : (1) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : cartographie critique des approches existantes », TI n° RE244, 2015. (2) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : pour une approche centrée sur les objets », TI n° RE245, 2015. Le présent manuscrit présente les deux volets réunifiés, révisés et remis en page à partir de leurs versions avant publication respectives.
11
connaissance »19 : un modèle dans lequel les divers acteurs de la société entretiennent un dialogue permanent avec les acteurs de l’innovation pendant tout le processus, et non seulement au terme de la chaîne de valeur. D’où les mots d’ordre à la mode tels que « upstream public engagement » (« engagement du public en amont »), « inclusion des parties prenantes », « innovation participative », « innovation responsable », ou encore l’idée de « co-construction de la science et de la société » issue des sociologies de l’innovation. Présentés comme participatifs, ces nouveaux modèles succèdent à trois décennies d’initiatives de « maîtrise sociale des techniques » déployées dans le cadre du gouvernement représentatif par des instances telles que le Bureau d’évaluation technologique du Congrès des États-Unis (OTA pour Office of Technological Assessment, 1972-1995) ou l’OPECST en France (Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et techniques : délégation interparlementaire sénateurs/députés assistée par des commissions d’experts crée en 1983). La création de l’OPECST répondait au souhait du Parlement d’apprécier en toute indépendance les décisions du gouvernement sur les grandes orientations scientifiques et techniques des politiques publiques. On parlait alors de « mécanismes de contrôle du progrès scientifique et technologique » passant tout autant par la commission d’expertises scientifiques in-dépendantes que par l’exercice de l’influence des élus. Le relatif déclin de ces approches tient à des raisons conjoncturelles très différentes en Europe et aux États-Unis. Aux États-Unis, pendant la « Révolution Gingrich » de 1994 qui voit les deux Chambres gagnées par les Républicains, l’évaluation technologique est jugée « inutile », « dépensière » et trop « sociale ». L’OTA est brusquement fermé. En Europe, l’évaluation technologique existante est jugée au contraire trop peu « sociale », au sens où elle n’est pas assez participative (l’OPECST par exemple, se borne à articuler la médiation des élus et l’expertise scientifique). Ce sont en partie les limites de ces approches qui ont donné lieu aux méthodologies actuelles. Au moment où l’OTA est fermé au milieu des années 1990, le Rathenau Institute fait renaître l’évaluation technologique aux Pays-Bas (au départ sur des questions liées aux impacts de l’informatisation de la société). Il ne vise plus à éclairer les politiques publiques sur les enjeux sociaux et économiques des choix scientifiques et techniques, mais à impliquer la société aux choix scientifiques et techniques en l’aidant à se former une opinion politique sur ces sujets. On parle alors pendant un temps « d’évaluation politique des technologies » (Political Technological Assessment). Aujourd’hui, c’est l’approche d’« Évaluation con-structive des technologies » (CTA pour Constructive Technology Assessment) qui prévaut aux Pays-Bas sur le sujet des NST. Il s’agit d’impliquer une large diversité d’acteurs et de parties prenantes dans l’ensemble du processus sociotechnique de « design » des nanotechnologies pour élargir le répertoire de ses significations – comprenant l’imaginaire, les discours d’accompagnement, les représentations, etc. – et « co-construire » les directions prises par la recherche et l’innovation. Il ressort de ce rapide tour d’horizon de ces nouvelles approches (plus si nouvelles maintenant) que les SHS ont été parties prenantes des transformations du rapport science/société et des politiques de recherche et d’innovation afférentes. Certains des auteurs ayant promu le Mode 2 et la société de la connaissance, par exemple sont directement impliqués dans la politique de recherche européenne. Au-delà des influences directes, un certain nombre des outils d’analyse et même de critique des SHS se sont vus intégrés à la politique de recherche des NST ou au moins à son discours officiel. À ce titre, il convient de mentionner la notion d’« innovation réflexive » issue des travaux du sociologue allemand Ulrich Beck dans les années 1980.
19 NORDMANN (A.) (dir.) et HIGH LEVEL EXPERT GROUP. – Converging Technologies for the European Knowledge Society, © European Commission, Bruxelles http://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/ntw-report-alfred-nordmann_en.pdf (page consultée le 6 mai 2013) (2004).
Version générée par les auteurs d’un article paru en deux volets dans Techniques de l’Ingénieur : (1) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : cartographie critique des approches existantes », TI n° RE244, 2015. (2) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : pour une approche centrée sur les objets », TI n° RE245, 2015. Le présent manuscrit présente les deux volets réunifiés, révisés et remis en page à partir de leurs versions avant publication respectives.
12
2.2.2. Une exigence de réflexivité de l’innovation…
Dans un ouvrage qui fit date20, Beck défendait la thèse selon laquelle nos sociétés étaient en train de s’engager dans une phase « réflexive » de la modernisation. Celui-ci entendait par « modernisation réflexive »21 un processus historique par lequel nos sociétés s’emploient à redéfinir les valeurs et les finalités qui les constituent à travers la manière dont elles se saisissent de la question du risque. Dans les sociétés engagées dans cette « seconde mo-dernité », le risque, affirmait Beck, n’est plus à situer en dehors de la sphère du quotidien et de la vie sociale, mais contrairement à l’ancienne « fortune », il est à situer à l’intérieur de celle-ci. Le risque s’identifie désormais à une production endogène de nos sociétés. Celles-ci ne se définissent-elles plus par le seul partage des biens mais aussi par le partage des risques, et par les nécessaires arbitrages politiques et moraux qu’il requiert. À travers la question des risques, affirmait Beck, « nos sociétés se confrontent à elles-mêmes » comme communautés politiques, d’où la dimension réflexive du processus qu’il caractérisait. Dans cette nouvelle phase réflexive de la modernisation, la science n’a plus affaire à une nature indépendante, mais à ses propres productions. Ainsi le terme d’« environnement » ne désigne plus simplement « la nature », extérieure au social ; il inclut les effets induits par nos modes de vie. Au terme de cette analyse, Beck appelait de ses vœux le développement d’un type de recherche technico-scientifique capable d’intégrer d’emblée la question de ses effets potentiels sur la société (environnement compris). Or les nanotechnologies se sont justement construites comme programme de recherche en intégrant d’emblée la question des effets qu’elles sont susceptibles de produire sur la société, l’environnement et la santé. Les NST semblent donc relever de la démarche de recherche-innovation réflexive que préconisait Beck ; d’une démarche qui s’efforcerait d’articuler la prise en compte des effets potentiels de la technoscience et la réflexion politico-morale sur les finalités et les valeurs que requiert le partage des risques qu’elle induit. Voilà qui aurait de quoi réconcilier souci de l’éthique et volonté politique, du moins en apparence… et, comme nous allons le voir, en apparence seulement. 2.2.3. …trustée par des « études d’impact » insuffisantes
Dans les pratiques, cette exigence de réflexivité de l’innovation s’est surtout traduite par le développement des « études d’impact ». Ces études d’impact transposent aux NST l’approche des programmes ELSI (Ethical, Legal and Societal Impacts ou Implications) qui avaient pris leur essor avec le Projet Génome Humain dans les années 1990. Or elles souffrent d’une limitation majeure : en séparant la recherche en NST de ses « impacts » ou « implications », elles séparent la prise en compte de leurs effets potentiels de la réflexion sur les valeurs qui président aux programmes de recherche et orientent les pratiques de design des NST. Les études d’impact se focalisent prioritairement sur les conséquences des applications et de leurs usages potentiels. Elles reposent ainsi sur le schéma classique « neutralité des objets scientifiques et techniques versus moralité des usages ». Or, ce schéma, qui exige que les faits scientifiques et les objets techniques soient déjà constitués pour que l’évaluation éthique puisse intervenir, cantonne l’éthique dans l’après-coup. L’éthique reste par conséquent en situation de secondarité et d’extériorité par rapport à la technique. Loin de susciter une réelle mise en réflexivité de l’innovation où l’on prendrait « le temps d’hésiter ensemble »22, les études d’impact véhiculent limage mécaniste et déterministe d’un front d’innovation à l’avancée inéluctable dont il s’agit d’anticiper les répercussions, les
20 BECK (U.). – La société du risque. Sur la voie d’une autre modernité [1986]. Champs, Paris (2008). 21 Ou encore « scientificisation réflexive », succédant à la « scientificisation simple ». 22 STENGERS (I.). – Une autre science est possible ! Manifeste pour un ralentissement des sciences. La découverte, Paris (2013).
Version générée par les auteurs d’un article paru en deux volets dans Techniques de l’Ingénieur : (1) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : cartographie critique des approches existantes », TI n° RE244, 2015. (2) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : pour une approche centrée sur les objets », TI n° RE245, 2015. Le présent manuscrit présente les deux volets réunifiés, révisés et remis en page à partir de leurs versions avant publication respectives.
13
usages et les mésusages pour minimiser les risques et de maximiser les bénéfices. Dès lors, on peut difficilement affirmer que les programmes ELSI appliqués aux NST nous aient fait faire un seul pas en dehors du modèle linéaire. Au mieux, lorsque ces études d’impact sont proactives, elles enjolivent le schéma linéaire de boucles de rétroaction censées permettre de piloter l’innovation pour l’aiguiller dans des directions plus « acceptables » (figure 2).
Figure 2. Modèle linéaire-rétroactif d’innovation et de gouvernance « responsable » des NST23. ELSI : Ethical, Legal and Societal Impacts ; HSE : Health, Safety, Environment ; CTA : Constructive Technological Assessment. 2.3. Des motifs peu « éthiques » ? La volonté de prendre en compte les « dimensions éthiques » des NST procède de motifs qui n’ont pas grand-chose à voir avec un réel souci de réflexion morale. 2.3.1. Une innovation en mal d’acceptabilité sociale
L’intégration des SHS vise bien souvent à faciliter l’acceptabilité des NST par « le » public. Pour se faire accepter, il faut que les NST apparaissent « éthiquement correctes », c’est-à-dire conformes aux valeurs jugées majoritaires dans nos sociétés (droits de l’homme, santé, libertés individuelles, vie privée, intégrité, etc.). Dans cette optique, les « dimensions éthiques » sont mobilisées comme des instruments de communication et d’acceptabilité plutôt conformistes, sans même envisager la possibilité que les NST puissent être porteuses de valeurs nouvelles ou alternatives24. 23 KEARNES (M.) et RIP (A.). – The emerging governance landscape of nanotechnology. In S. Gammel, A Lösch et A. Nordmann (eds), Jenseits von Regulierung : Zum politischen Umgang in der Nanotechnologie. Akademische Verlagsgesellschaft, Berlin (2009). 24 ÅM (H.). – « Don’t make nanotechnology sexy, ensure its benefits, and be neutral » : Studying the logics of new intermediary institutions in ambiguous governance contexts. Science and Public Policy vol. 40(4), pp. 466-478 (2013).
Version générée par les auteurs d’un article paru en deux volets dans Techniques de l’Ingénieur : (1) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : cartographie critique des approches existantes », TI n° RE244, 2015. (2) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : pour une approche centrée sur les objets », TI n° RE245, 2015. Le présent manuscrit présente les deux volets réunifiés, révisés et remis en page à partir de leurs versions avant publication respectives.
14
Remarquons que l’on parle toujours, à propos des NST, d’« acceptabilité » sociale ou d’« acceptation » par le public, mais jamais d’« adoption » ou d’« adoptabilité » des NST. Or, dire qu’une technologie est « acceptable », c’est simplement considérer quelle n’est pas empêchée dans sa diffusion ; cela ne signifie pas quelle ait été adoptée ou quelle soit adoptable. Adopter, c’est s’engager dans une relation qui modifie tant l’adoptant que l’adopté. C’est pourquoi seule l’adoption crée l’adoptabilité alors que l’acceptabilité crée l’acceptation, c’est-à-dire la simple diffusion sans changement qualitatif de la relation acceptant/accepté. « Adopter » suppose une attitude de reconnaissance mutuelle et une activité de construction de valeurs ; « accepter », une attitude passive dans laquelle les valeurs n’interviennent que sur un mode négatif : il s’agit au mieux d’éviter les « dérives » (par exemple les atteintes à la vie privée), mais non de travailler à l’émergence de nouveaux biens. Si rien ne va mal, c’est que tout va bien. L’approche par l’acceptabilité sociale est donc critiquable au moins pour trois raisons : pour son conformisme, pour son manque d’ambition et pour son appréhension purement négative du rapport aux valeurs. 2.3.2. Un climat de « peur de la peur »
L’intégration des SHS et en particulier des « études de perception » est motivée par une volonté de surmonter par avance les réticences du public. En témoigne le leitmotiv de « la débâcle des OGM » qui revient sans cesse dans les rapports officiels sur les NST. Faute d’intégrer les dimensions éthiques et sociales en amont, on exposerait les NST au même sort que les OGM, celui d’un rejet massif par un public forcément ignorant, irrationnel et craintif. Or, définir ainsi a priori « le » public est contestable. Qui a peur des nanos ? Dominique Vinck, sociologue, affirme que
« les seules craintes manifestes, dans cette situation, sont celles des scientifiques eux-mêmes, lesquels ont peur de la peur du public. Ils s’imaginent que les opposants ou les récits de science-fiction comme celui de Michael Crichton feront paniquer le public. Ils voient de la nanophobie dans la moindre question posée »25.
Arie Rip, professeur de technology assessment à Twente aux Pays-Bas, parle même de « nanophobia-phobia »26. Or, à terme, ces discours finissent par détruire effectivement la confiance voire même à susciter la peur qu’ils voulaient initialement combattre en « rationalisant » la perception du risque. 2.3.3. Une économie de la promesse
Le souci affiché par les politiques scientifiques pour le questionnement éthique peut se comprendre en référence à ce que les sociologues Luc Boltanski et Eve Chiapello ont appelé « le nouvel esprit du capitalisme »27. Reprenant une thèse de Max Weber, Boltanski et Chiapello appellent « esprit du capitalisme » l’idéologie que ce dernier doit nécessairement produire s’il veut gagner l’assentiment de ceux qui sont nécessaires à son développement. Cette idéologie doit répondre à trois questions cruciales : comment offrir aux individus dont on recherche l’adhésion des perspectives suffisamment enthousiasmantes ? Comment leur garantir une sécurité suffisante pour eux ainsi que pour leurs enfants ? Comment leur assurer que leur adhésion contribue à la réalisation d’un bien commun et satisfait à des exigences morales ?
25 VINCK (D.). – Les Nanotechnologies. Idées reçues, Le Cavalier Bleu, Paris (2009), p. 80. 26 RIP (A.). – Folk Theories of Nanotechnologists. Science as Culture, 15(4), 349-365 (2006). 27 BOLTANSKI (L.) et CHIAPELLO (E.). – Le nouvel esprit du capitalisme. Gallimard, Paris (1999).
Version générée par les auteurs d’un article paru en deux volets dans Techniques de l’Ingénieur : (1) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : cartographie critique des approches existantes », TI n° RE244, 2015. (2) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : pour une approche centrée sur les objets », TI n° RE245, 2015. Le présent manuscrit présente les deux volets réunifiés, révisés et remis en page à partir de leurs versions avant publication respectives.
15
Or ces trois questions sont précisément celles qui sous-tendent la mise en discussion des NST : il s’agit en effet d’entretenir toute une économie de la promesse portant sur les applications futures des NST, susceptibles d’offrir aux individus des perspectives enthousiasmantes. Ces perspectives sont même supposées illimitées puisque les nano-technologies, définies comme « enabling technologies » (technologies potentialisantes), sont censées déboucher sur des possibilités d’application dans un nombre illimité de secteurs industriels ; il s’agit par ailleurs de s’assurer que le développement des NST se fera dans un contexte de science « responsable », soucieuse de préserver les conditions d’existence des générations futures, par une évaluation systématique des risques « potentiels » inhérents à leur développement. Il s’agit enfin de s’assurer que les NST se développeront dans le souci des valeurs morales et de la justice sociale. Aujourd’hui, il est en définitive possible de dire de la technoscience ce que Boltanski et Chiapello, après Weber, disent du capitalisme : il faut de puissantes raisons morales pour y adhérer. L’activité scientifique telle quelle est discutée dans l’espace public n’est plus ordonnée à la seule production du vrai et/ou de l’efficace ; elle est constitutivement ordonnée à des questions d’éthique, de responsabilité sociale et d’idéal politique. Cette situation est particulièrement caractéristique des NST depuis une dizaine d’années, elle peut même définir la manière dont elles insistent dans l’espace public depuis le lancement des grands programmes nationaux en nanotechnologies. 2.3.4. Un besoin stratégique de normalisation
Enfin, l’éthique se trouve embarquée dans le mouvement actuel de normalisation des processus d’innovation, qui ne concerne évidemment pas que les NST mais constitue pour celles-ci un enjeu stratégique. Les états leaders des nanotechnologies sur le marché de demain seront ceux qui auront su réaliser le meilleur compromis entre régulation et innovation ; ce seront ceux qui auront su se constituer force de proposition en matière de normes et de standards de caractérisation adaptés. Ainsi, les démarches de « responsabilité sociétale des entreprises » (RSE) et les normes ISO (International Standard Organisation) fournissent-elles des étalons de comparaison et d’évaluation des acteurs économiques leur permettant d’afficher une attitude responsable qui leur procure un avantage sur le marché. Leur rôle est essentiellement de stabiliser et de structurer un marché encore émergent tout en facilitant le management des risques et en améliorant la perception qu’en ont les consommateurs. C’est dans ce contexte que doivent être resitués le foisonnement des approches de « soft law », tels les « codes de conduite » et autres guides de « bonnes pratiques », ainsi que le mot d’ordre de l’« innovation responsable » qui encadre le débat sur l’éthique des NST dans les instances européennes. Il s’agit avant tout de régulations par et pour le marché. Même si le champ de la RSE et les injonctions à « rendre des comptes » qui lui sont associées constituent des leviers d’action pour d’autres parties prenantes que les clients, fournisseurs et actionnaires, ces normes sont prescrites sur une base volontaire, non réglementaire, et n’obligent que si elles sont citées par le marché auquel s’adresse un acteur de l’innovation sur la chaîne de valeur. Or, le marché, quand tout va pour le mieux, peut certes bien procurer de l’optimisation économique, mais non nécessairement de la légitimité éthique.
2.4. Comment relancer la réflexion éthique ? Il n’y a décidément pas d’évidence de l’éthique dans le cas des NST. Cela ne signifie pas qu’il n’y a aucune discussion éthique sincère sur les NST chez les chercheurs, les citoyens, les politiques, les médecins, les philosophes, etc. Toutefois, quelles que soient les motivations
Version générée par les auteurs d’un article paru en deux volets dans Techniques de l’Ingénieur : (1) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : cartographie critique des approches existantes », TI n° RE244, 2015. (2) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : pour une approche centrée sur les objets », TI n° RE245, 2015. Le présent manuscrit présente les deux volets réunifiés, révisés et remis en page à partir de leurs versions avant publication respectives.
16
des individus, à un niveau collectif, ce sont d’autres préoccupations, liées principalement à la question de l’acceptabilité sociale des nanotechnologies, qui prévalent. Anticiper les « impacts » des applications futures, c’est faire comme si ces applications allaient nécessairement advenir, que les nanotechnologies sont notre futur et qu’il s’agit seulement d’en réguler la marche28. Pour les chercheurs en SHS, cela équivaut à « se laisser prendre au piège d’une recherche vouée à faire du contrôle social », écrivent Bernadette Bensaude-Vincent et Vanessa Nurock.
« Aux côtés des sociologues mobilisés comme experts en opinion publique, on attend trop souvent des éthiciens qu’ils jouent le rôle d’ingénieurs du moral, pour « monitorer » le développement des nanotechnologies. Ici encore, on peut se demander dans quelle mesure la « nanoéthique » peut encore procéder de la réflexion éthique »29.
Loin de devoir décourager ou pousser au cynisme, ce constat est peut-être un préalable nécessaire à l’engagement d’une réflexion éthique novatrice et plus ambitieuse. Dès lors, comment s’y prendre pour reposer les questions éthiques des NST à nouveaux frais ? Dans la suite de ce dossier, on établira une cartographie raisonnée des principaux types de postures éthiques adoptées face aux NST. Pour chacune de ces approches, on se demandera comment est défini ce qui fait « problème éthique » et quel mode d’intervention est assigné à l’éthique dans son articulation au scientifique et au politique. On proposera une critique de chacune de ces postures afin d’affiner notre approche. Ce travail critique nous permettra d’esquisser une voie alternative de problématisation et de pratique de l’éthique des NST passant, paradoxalement, par l’épistémologie : une éthique de terrain centrée sur les objets « nano » considérés comme des « êtres du monde » définis par leurs relations (voir section 4). Cette voie est résolument philosophique mais elle revendique une pratique non strictement spéculative de la philosophie – il s’agit plutôt de militer pour une philosophie formulant ses problèmes au plus près des pratiques de recherche, des objets de laboratoire et de leurs processus de design. Une « philosophie de terrain » en somme.
3. Cartographie critique des approches existantes L’état des lieux que nous proposons se base sur la typologie établie par le sociologue Brice Laurent dans son ouvrage Les politiques des nanotechnologies30. Les modes d’intervention de l’éthique des NST sont principalement de deux types, explique-t-il : l’« éthique-vérité » et l’« éthique-politique ». Précisons qu’il ne s’agit pas ici d’effectuer une revue de littérature, pas plus qu’un examen des théories éthiques. Un tel examen demanderait une discussion elle aussi théorique, ou méta-éthique, et nous sortirions du sujet des NST. Il s’agit de passer en revue les différentes approches de l’éthique sur le terrain des NST, c’est-à-dire ses modalités d’intervention dans l’espace de mise en discussion publique des NST.
3.1. L’éthique-vérité L’éthique-vérité « s’appuie sur la séparation entre les faits scientifiques et techniques, qu’il serait nécessaire d’établir rationnellement dans un premier temps, et les valeurs et principes
28 NORDMANN (A.). – If and then: a critique of speculative nanoethics. Nanoethics, 1(1), pp. 31-46 (2007). 29 BENSAUDE-VINCENT (B.) et NUROCK (V.), op. cit., 2010. 30 LAURENT (B.). – Les politiques des nanotechnologies. Pour un traitement démocratique d’une science émergente. Editions Charles Léopold Mayer, Paris (2010).
Version générée par les auteurs d’un article paru en deux volets dans Techniques de l’Ingénieur : (1) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : cartographie critique des approches existantes », TI n° RE244, 2015. (2) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : pour une approche centrée sur les objets », TI n° RE245, 2015. Le présent manuscrit présente les deux volets réunifiés, révisés et remis en page à partir de leurs versions avant publication respectives.
17
éthiques, qui devraient ensuite être mobilisés pour s’assurer de la bonne intégration de la science dans la société »31. L’éthique-vérité est structurée sur la distinction classique entre les faits (ce qui est, et que détermine la science) et les valeurs (ce qui doit être, et qu’évalue l’éthique). Au sein de l’éthique-vérité, nous distinguons deux postures : l’« éthique-vérité du Fait scientifique » et l’« éthique-vérité de la Valeur morale »32. 3.1.1. Éthique-vérité du Fait scientifique
Avant de débattre de ce qui doit être, il faut établir un état de l’art le plus exhaustif possible de ce qui est. Il convient donc de trier les faits et les fantasmes et attendre que « les faits soient faits » : telle est la posture de ce que nous appelons « éthique-vérité du Fait scientifique ». 3.1.1.1. L’argument du déficit de connaissances
Ce qui fait « problème éthique » pour cette approche, c’est essentiellement un déficit de connaissances et un défaut d’ajustement de l’information diffusée au public. La « solution » consiste alors à réduire l’incertitude, c’est-à-dire à faire avancer les connaissances scientifiques et à combler le manque de connaissance du public en lui communiquant « la bonne information » (claire, transparente, adaptée). Dans ce schéma, la solution au problème éthique, c’est la science. Le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) en fournit un exemple dans son rapport de 200633. S’alarmant d’une « déconnexion entre les discours et la réalité », il plaide pour que soit constitué et diffusé un nécessaire socle de connaissances fondamentales qui, d’après lui, fait défaut. Trop préoccupée d’applicabilité immédiate, la recherche en NST serait en manque de recherche fondamentale ; quant au public, il serait en manque d’informations claires le rendant capable d’exercer son « consentement libre et éclairé ». Dans cette optique, l’incertitude est une anomalie. Il est en effet anormal que des applications soient commercialisées avant que soient acquises les connaissances fondamentales dont elles devraient nécessairement et normalement procéder – c’est donc aux chercheurs de prendre leurs responsabilités, définies d’abord comme devoir de connaissance. Quant au public, il souffre lui aussi de l’incertitude induite par l’engagement trop précoce du débat – celui-ci portant sur des promesses bien plus que sur des réalités. Le fait – bien étonnant au demeurant – que le CCNE se rapproche d’une telle posture tient certes en partie à sa vocation, qui concerne les questions éthiques liées à la santé humaine : comment, en effet, ne pas s’inquiéter du manque de connaissance patent des effets des produits « nano » sur la santé ? Cela, nous pouvons raisonnablement l’accorder. Ce qui en revanche fait défaut dans l’avis du CCNE, c’est une analyse des processus de production d’ignorance propres aux NST. On peut en effet soutenir qu’une certaine ignorance est produite par les applications (pour lesquels les standards de caractérisation ne sont pas aussi exigeants que ceux de la recherche en laboratoire), entretenue par la propriété intellectuelle (noms de fantaisie, protection des savoir-faire), reproduite par le vide réglementaire et le « clair-obscur normatif » de la soft law34, et enfin encouragée par l’économie de la promesse, qui détourne systématiquement vers le futur l’attention des acteurs de la mise en discussion des NST.
31 LAURENT (B.). op. cit., 2010, p. 111. 32 « Fait » et « Valeur » prennent ici des majuscules pour marquer leur caractère hypostasié. 33 COMITÉ CONSULTATIF NATIONAL D’ÉTHIQUE. – Questions éthiques posées par les nanosciences, les nanotechnologies et la santé. Avis n° 96 http://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/publications/avis096.pdf (page consultée le 7 mai 2013) (2006). 34 LACOUR (S.) (ed.). – La régulation des nanotechnologies : Clair-obscur normatif. Larcier, Paris (2010).
Version générée par les auteurs d’un article paru en deux volets dans Techniques de l’Ingénieur : (1) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : cartographie critique des approches existantes », TI n° RE244, 2015. (2) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : pour une approche centrée sur les objets », TI n° RE245, 2015. Le présent manuscrit présente les deux volets réunifiés, révisés et remis en page à partir de leurs versions avant publication respectives.
18
Le modèle du déficit présuppose que l’ignorance est première sur la science, que l’avancée des sciences réduit systématiquement l’ignorance, et qu’elle augmente mécaniquement la confiance du public dans la recherche. Il a été critiqué par toute une sociologie des rapports entre la science et ses publics35. Il a été montré qu’il n’y a pas de corrélation stricte entre niveau de connaissance et niveau de confiance. Ce n’est pas parce qu’on en sait plus qu’on est plus confiant. Faire ou ne pas faire confiance suppose des raisons, non des connaissances uniquement36. Les opposants aux nanotechnologies, en l’occurrence, sont loin d’être des ignorants. Ils sont très bien documentés37. Par ailleurs, l’idée que l’avancée des connaissances réduit systématiquement l’ignorance est remise en question par certains aspects épistémologiques des NST elles-mêmes. Ainsi les recherches en bio- et éco-toxicologie des nanoparticules (voir section 4.4) ne réduisent pas l’incertitude, mais la circonscrivent. En posant une question précise, portant sur tel type de toxicité pour tel nanomatériau, sous telle forme et sur une cible précise, etc., elles contribuent à délimiter plus précisément les contours et les modalités de tout ce qu’on ne connaît pas ; elles précisent l’incertitude, mais ne la réduisent pas. Si dans ce schéma, la solution au problème éthique, finalement, c’est la science, pourquoi alors parler d’éthique ? Parce que la connaissance complète et certaine des risques « réels » se fait immanquablement attendre. Or, en attendant Godot, il faut bien communiquer ! Pour ce faire, ce sont souvent les chercheurs en SHS qui sont enrôlés comme des sortes de « vulgarisateurs augmentés », censés être capable d’adapter le supposé discours-vrai des NST aux perceptions supposées du grand public. D’où la floraison des « études de perception », compléments indispensable des « études d’impact ». 3.1.1.2. Les études de perception
On peut dire des études de perception qu’elles cherchent à superposer deux « images » : d’un côté, l’image que le « public » a des NST ; de l’autre, l’image que les NST ont des attentes du public, les fameuses « attentes sociétales » (figure 3). On inculque ainsi aux scientifiques quelques rudiments sur la psychologie des foules et l’imaginaire38, et au public quelques rudiments de science ; entre les deux, on mobilise les SHS pour réaliser ces fameuses « études sur la perception sociétale des nanotechnologies » 39. Celles-ci visent en quelque sorte à mesurer l’écart entre les deux images afin les ajuster au mieux. Il s’agit d’analyser et d’améliorer la perception du message des experts par le public, de lever les « barrières cognitives » pour dissiper les craintes, ou encore d’« améliorer la confiance accordée aux instances gouvernementales de contrôle et de protection (…) susceptibles de réduire les préoccupations concernant les nanotechnologies »40. On ne sort pas de l’acceptabilité sociale.
35 BONNEUIL (C.). – Les transformations des rapports entre sciences et société en France depuis la Seconde Guerre mondiale : un essai de synthèse. Sciences, médias et société, 56, pp. 15-40 http://sciences-medias.ens-lyon.fr/article.php3?id_article=56 (page consultée le 1er juin 2014) (2004). IRWIN (A.) et WYNNE (B.) (ed.). – Misunderstanding science? The public reconstruction of science and technology. Cambridge University Press (2004). 36 LOEVE (S) et NORMAND (M). – How to trust a molecule? The case of cyclodextrins entering the nanorealm. In T. ZÜLSDORF, C. COENEN, A. FERRARI et al. Quantum engagements: social reflections of nanoscience and emerging technologies. IOS / Akademische Verlagsgesellschaft, Heidelberg (2011) pp. 195-216. 37 VINCK (D). op cit., 2009, pp. 81-84. 38 GRINBAUM (A.). – Barrières cognitives dans la perception des nanotechnologies. Réalités industrielles, mai 2007, pp. 47-53 (2007). 39 SIEGRIST (M.), KELLER (C.), KASTENHOLZ (H.), FREY (S.) et WIEK (A.). – Perception des dangers des nanotechnologies par les experts et les profanes. Environnement, risques et santé, 6(5), pp. 331-332 (2007). 40 SIEGRIST (M) et al., op. cit. 2007, p. 332.
Version générée par les auteurs d’un article paru en deux volets dans Techniques de l’Ingénieur : (1) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : cartographie critique des approches existantes », TI n° RE244, 2015. (2) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : pour une approche centrée sur les objets », TI n° RE245, 2015. Le présent manuscrit présente les deux volets réunifiés, révisés et remis en page à partir de leurs versions avant publication respectives.
19
Figure 3. Schéma des « études de perception ». Cette éthique de la vérité témoigne donc d’une conception pour le moins paradoxale de la vérité. Sous couvert de volonté de vérité est recherchée une normalisation des perceptions sociétales de la technoscience visant à mieux la faire accepter : d’un côté, corriger les « fausses perceptions » que le public en a ; de l’autre, prôner une recherche « éthiquement correcte », c’est-à-dire en conformité avec les valeurs jugées les plus consensuelles de nos sociétés. 3.1.2. Éthique-vérité de la Valeur morale
L’autre versant de l’éthique-vérité recouvre, sous ses diverses variantes, la position traditionnelle de l’éthique philosophique : on ne peut dériver ce qui doit être de ce qui est sous peine de commettre ce que la philosophie morale nomme le « sophisme naturaliste »41. Ce n’est pas le fait – l’énoncé des propriétés objectives de ce qui est – qui doit dire la norme, mais la valeur morale. Notons que cette position amène souvent les philosophes à soutenir que les enjeux sanitaires et les questions de risque sont des questions scientifiques et techniques hors du champ de l’éthique proprement dite (notre position, on le verra, est plus nuancée). 3.1.2.1. Des valeurs sacralisées mais pourtant relatives
Cette éthique-vérité de la Valeur morale peut consister en un discours de dénonciation des « dérives » qui va de l’éthique conservatrice américaine à la Francis Fukuyama, voyant dans les nouvelles technosciences des menaces pour la « Nature humaine »42, aux diatribes de
41 MOORE (G.E.). – Principia Ethica (1903). PUF (1997). 42 FUKUYAMA (F.). – La fin de l’Homme. Les conséquences de la révolution biotechnologique. Folio, Paris (2004).
Version générée par les auteurs d’un article paru en deux volets dans Techniques de l’Ingénieur : (1) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : cartographie critique des approches existantes », TI n° RE244, 2015. (2) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : pour une approche centrée sur les objets », TI n° RE245, 2015. Le présent manuscrit présente les deux volets réunifiés, révisés et remis en page à partir de leurs versions avant publication respectives.
20
l’association grenobloise libertaire Pièces et Main d’œuvre, dénonçant le projet totalitaire des « nécrotechnologies »43. On trace alors d’avance une frontière entre ce qui est acceptable ou inacceptable en vertu d’une Valeur suprême, transcendante et sacralisée – l’Humain avec un grand « H » ou la Nature avec un grand « N ». Or, ces valeurs supposées absolues sont éminemment variables en fonction des époques, des cultures et même des orientations politiques. B. Laurent note par exemple qu’aux États-Unis, la ligne de partage entre éthique conservatrice et éthique libérale ressort très nettement face aux modalités inédites de transformation du vivant humain prônées publiquement par le fameux – ou tristement célèbre – rapport NBIC (Nano-Bio-Info-Cogno) commandité en 2002 par la National Science Foundation (NSF) et le Department of Commerce (DoC)44. Ce rapport fit miroiter l’idée d’une « convergence technologique » à l’échelle nanométrique au service de « l’augmentation des performances humaines » via toute une batterie de techniques appliquées au vivant humain (interfaces cerveau-machine, implants neuronaux, organes artificiels, etc.). Or, un éthicien conservateur, par exemple, soutiendra que toute augmentation des performances doit être refusée au nom de la dignité humaine, Valeur absolue qu’il faut préserver à tout prix. Un éthicien libéral affirmera que c’est le « consentement éclairé » qui prime : une fois l’individu disposant des informations adéquates sur une technique, libre à lui de décider ou non de l’utiliser, à condition qu’elle ne nuise pas à la liberté ou à l’autonomie d’autrui. L’augmentation des performances individuelles est alors jugée acceptable dans le cadre du consentement éclairé, mais discutable dans le cas où des parents décideraient d’augmenter les performances de leurs enfants (qui ne sont pas des sujets pleinement autonomes et susceptibles d’exercer un jugement éclairé). Qu’il s’agisse de dignité humaine ou d’équité, notons que l’argumentation n’est nullement spécifique aux NST. Elle se contente d’en appeler à des concepts de philosophie morale très généraux et déjà bien établis, par exemple, dans le champ de la bioéthique. D’une manière générale, les valeurs absolues – les « Valeurs » – sont polarisantes. Au risque de paraître trop schématique, disons que la mouvance libertarienne dominante du transhumanisme, qui prône l’utilisation des technologies convergentes pour améliorer l’espèce humaine, refuse l’idée d’une Nature humaine au profit d’une conception de l’homme comme perfectibilité indéfinie, typique de la pensée progressiste des Lumières : l’homme s’est toujours fabriqué lui-même en s’arrachant à la nature ; sa seule nature est de ne pas en avoir. À l’opposé, les conservateurs définissent l’homme par une Nature immuable et intangible. Il s’agit là de deux grands récits anthropologiques (portant sur l’essence de l’humain) qui s’affrontent, idéologie contre idéologie, sans laisser aucune place à une épistémologie des technologies convergentes. Le mode d’existence des objets ne compte pas, il est hors du champ de la discussion éthique. 3.1.2.2. L’éthique spéculative
En résonance avec l’imaginaire des robots, cyborgs et autres « humains augmentés », la nano-éthique qualifiée de « spéculative »45 se focalise sur ce qu’elle identifie comme des possibles futurs. Pourquoi la ranger du côté des éthiques de la Valeur (substantialisée) ? Dans la mesure où son futurisme est encore une manière de mettre à distance le présent des NST, dont les faits sont jugés trop peu significatifs pour pouvoir se prêter à l’évaluation éthique. Cette
43 PIÈCES ET MAINS D’ŒUVRE. – Aujourd’hui le nanomonde. Nanotechnologies : un projet de société totalitaire. Éditions L’Échappée (2008). 44 ROCO (M.C.) et BAINBRIDGE (W.S.) (eds). – Converging Technologies for Improving Human Performance : Nanotechnology, Biotechnology, Information technology and cognitive science. NSF/DOC-sponsored report, National Science Foundation (2002). http://www.wtec.org/ConvergingTechnologies/1/NBIC_report.pdf (page consultée le 12 juillet 2013). 45 NORDMANN (A.). – If and then: a critique of speculative nanoethics. Nanoethics, 1(1), pp. 31-46 (2007).
Version générée par les auteurs d’un article paru en deux volets dans Techniques de l’Ingénieur : (1) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : cartographie critique des approches existantes », TI n° RE244, 2015. (2) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : pour une approche centrée sur les objets », TI n° RE245, 2015. Le présent manuscrit présente les deux volets réunifiés, révisés et remis en page à partir de leurs versions avant publication respectives.
21
étique au futur fait sienne le discours selon lequel les nanotechnologies n’en sont qu’à l’aube de leur développement ; imaginons-les dans quelques décennies… Or ce discours des nanotechnologies comme « technologies émergentes » est martelé à l’identique depuis plus d’une décennie déjà ! Comme si l’éthique était incapable de trouver prise sur des réalités en devenir, et devait les projeter « touts faits » dans le futur pour analyser leurs impacts et les discuter « en valeur ». Même si l’éthique spéculative intervient de manière proactive en anticipant à long terme par des scénarios les effets d’applications plus ou moins futuristes, elle reste encore paradoxalement, cantonnée dans l’après coup. En projetant des objets et des applications techniques « toutes faites » dans le futur, elle semble avoir besoin que la technologie soit déjà constituée pour pouvoir intervenir : son évaluation se fait au « futur antérieur ». Notre argument n’est pas que l’éthique spéculative est fausse parce que spéculative (sous-entendu : « fictive »), mais qu’elle demeure inadéquate tant que ses spéculations se fondent sur le même schéma que les études d’impact qui se veulent les plus « terre-à-terre » : le schéma de secondarité et d’extériorité de l’éthique par rapport à la technique. 3.1.2.3. L’évaluation éthique des visions
L’éthique des « visions » (vision assessment) peut être comprise comme une éthique spéculative qui, contrairement à l’éthique futuriste, réfléchit et assume sa dimension spéculative46. Elle affirme en effet que les visions du futur et leur arrière-fond métaphysique (les conceptions du monde, du vivant et de l’humain qu’elles supposent) sont plus importants à évaluer que les faits techniques proprement dits47. Il peut s’agir des fantasmes de maîtrise absolue du monde jusque dans ses détails atomiques les plus infimes… ou encore des rêves d’autocréation de l’humain : n’acceptant plus la finitude de sa condition – le fait d’être né et d’avoir à mourir –, il envisagerait de se fabriquer lui-même comme il fabrique ses machines, par exemple en s’immortalisant dans des mémoires informatiques, dans l’attente que les nanomachines du futur lui refassent un corps à son image… Dans ce cas, le discours éthique ne dialogue pas avec la technique, mais avec l’imaginaire et les représentations culturelles au sein desquelles elle émerge – que la technique contribue ou non à matérialiser ces aspirations. Car il n’importe guère alors de savoir si ces visions sont réalisables et si les pratiques concrètes des NST les corroborent. Science et technique sont d’abord des œuvres de pensée alimentées par les rêves les plus fous : voler, visiter la Lune, recréer la vie, vaincre la distance, le temps, la résistance de la matière, etc. Ces rêves, à long terme, influeraient bien plus sur le destin de l’humanité que telle ou telle réalisation technique. « L’essence de la technique n’est rien de technique », dit Heidegger48. Elle est métaphysique. Bien que cohérente et légitime, cette posture n’est pas tout à fait la nôtre. Elle présente l’inconvénient de favoriser un certain désintérêt quant au « mode d’existence » des objets des NST (pour parler à la manière de Gilbert Simondon49), qu’elle maintient dans un statut d’insignifiante neutralité : ce ne sont pas les réalisations techniques qui sont intéressantes, mais les rêves qu’on leur fait porter. Or les réalités techniques peuvent parfois dépasser la fiction. Ne serait-ce qu’à ce titre, elles méritent qu’on s’y intéresse aussi pour elles-mêmes.
46 GRUNWALD (A.) et GRIN (J.) (eds). – Vision Assessment: Shaping Technology in 21st Century Society. Towards a Repertoire for Technology Assessment. Springer, Heidelberg (2000). 47 DUPUY (J.-P.) (entretien avec). – D’Ivan Illich aux nanotechnologies. Prévenir la catastrophe ? Revue Esprit, http://www.esprit.presse.fr/archive/review/article.php?code=13958 (page consultée le 10 juin 2013) (février 2007). 48 HEIDEGGER (M.). – « La question de la technique ». In M. Heidegger, Essais et conférences, Gallimard, Paris, pp. 9-48 (1958). 49 SIMONDON (G.). op. cit., 1958.
Version générée par les auteurs d’un article paru en deux volets dans Techniques de l’Ingénieur : (1) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : cartographie critique des approches existantes », TI n° RE244, 2015. (2) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : pour une approche centrée sur les objets », TI n° RE245, 2015. Le présent manuscrit présente les deux volets réunifiés, révisés et remis en page à partir de leurs versions avant publication respectives.
22
Cela n’implique pas nécessairement une vision « technisciste », mais aussi un regard attentif aux valeurs qu’elles portent, suscitent et requièrent. Les modes d’intervention de l’éthique opposant la Valeur au fait se caractérisent par leur volonté de maintenir une certaine extériorité vis-à-vis des acteurs de la recherche et du développement des NST, soit de peur de « se compromettre », soit parce que « garder ses distances » est vu à tort ou à raison comme une condition sine qua non de l’exercice du sens critique. Cette question de la « bonne distance » est en effet capitale pour nos disciplines des SHS : celles-ci sont constamment amenées à s’interroger sur le sens à donner à l’« ac-compagnement » des technosciences dans lequel elles sont embarquées. Mais le problème des éthiques de la Valeur morale est qu’elles considèrent cette question de la « bonne distance » comme tranchée d’avance, présupposée par la critique morale. Or on pourrait se demander si cette « bonne distance » ne pourrait pas être produite dans et par la réflexion morale, en interaction avec les acteurs scientifiques et techniques. 3.1.2.4. Éthique-vérité interactionniste
Nous pouvons classer parmi les éthiques-vérité de la Valeur morale le discours s’alarmant du « retard » de la réflexion éthique sur les avancées des NST50. Cette fois-ci, l’éthique n’est pas dite intervenir trop tôt, mais jamais assez tôt. Ainsi le Nanoethics Group de Patrick Lin, à l’Université polytechnique de Californie, définit-il l’éthique des NST comme une entreprise de « rattrapage continuel »51 . B. Laurent qualifie cette approche d’« éthique-vérité interactionniste » : il faut assurer un suivi permanent de la R&D pour être en mesure de réagir le plus rapidement possible lorsque l’avancée des techniques fait émerger de nouvelles questions.
Pour cette approche, même s’il est souhaitable d’anticiper les enjeux, il faut en dernière instance que les faits scientifiques et techniques soient constitués, c’est-à-dire que les applications soient là, pour pouvoir s’assurer, à partir d’une évaluation de ces faits, du consentement éclairé des individus, ou, à l’échelle des sociétés, de la juste répartition des risques et des bénéfices des NST (ce que les théories morales appellent questions de « justice » ou d’« équité »). 3.1.3 Critique des éthiques-vérité : par-delà faits et valeurs
3.1.3.1 Des éthiques de la distance
On l’aura compris, éthique-vérité du Fait scientifique et éthique-vérité de la Valeur morale ne s’opposent qu’en apparence. Toutes deux sont des éthiques de la distance. La première prône l’examen objectif des faits comme prise de distance face aux opinions subjectives et à l’irrationalité supposée des « fantasmes » ; la seconde prône des valeurs très générales qui permettent de maintenir les faits à distance pour pouvoir les juger moralement. La différence est simplement que l’une défend les vertus de la « bonne information » nécessaire au débat tandis que l’autre se place du côté de la « Valeur » qu’elle oppose au fait. Les deux types d’éthique-vérité reposent donc sur le même schéma de bipartition faits/valeurs52. Faits et valeurs restent en position d’extériorité et d’exclusion mutuelle. Dans
50 SINGER (P.), MNYUSIWALLA (A.) et DAAR (A.S.). – « Mind the gap »: science and ethics in nanotechnology. Nanotechnology, vol. 14, R9-R13 (2003). http://www.jcb.utoronto.ca/people/publications/nanotechnology_paper.pdf (page consultée le 13 juillet 2013). 51 ALLHOFF (F.), LIN (P.), MOORE (J.), WECKERT (J.) et ROCO (M. C.). – Nanoethics: The Ethical and Social Implications of Nanotechnology. Wiley, London (2007). 52 Pour une critique méta-éthique de la distinction faits/valeurs concernant, en particulier, le champ de l’économie, voir PUTNAM (H.). – The collapse of the Fact/Value Dichotomy, and Other Essays. Harvard University Press (2002).
Version générée par les auteurs d’un article paru en deux volets dans Techniques de l’Ingénieur : (1) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : cartographie critique des approches existantes », TI n° RE244, 2015. (2) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : pour une approche centrée sur les objets », TI n° RE245, 2015. Le présent manuscrit présente les deux volets réunifiés, révisés et remis en page à partir de leurs versions avant publication respectives.
23
le cas de l’éthique-vérité dite « interactionniste », qui entend évaluer en temps réel le développement des nanotechnologies, la distinction faits/valeurs est même recréée en permanence au fur et à mesure que la technologie avance. D’où le dilemme du « trop tôt/trop tard » sur lesquelles buttent constamment ces approches. Mieux connu sous le nom de dilemme de Collingridge53, celui-ci énonce que les conséquences sociales d’une technologie ne peuvent être prédites avant que celle-ci ne se soit suffisamment développée ; or, une fois la technologie largement développée, il devient beaucoup plus difficile et surtout beaucoup plus coûteux d’en modifier le cours. Lorsqu’on peut encore agir, c’est sans connaissance de cause, mais lorsqu’on sait, il est trop tard pour agir. L’éthique intervient donc soit trop tôt (sans connaissance suffisante), soit trop tard (sans pouvoir d’agir). L’éthique spéculative tente de résoudre ce dilemme en faisant comme si les faits étaient faits « dans le futur » pour évaluer leurs conséquences sociales « potentielles » ; l’éthique interactionniste cherche plutôt à intervenir au bon moment, ni trop tôt, ni trop tard, en « monitorant » l’émergence de la technologie « en temps réel ». Ce faisant, la première détourne son attention du temps de la décision, le présent, où s’élaborent continuellement les choix scientifiques et techniques, tandis que la seconde se retrouve à courir après les faits. Dans les deux cas, l’éthique reste (en quelque sorte constitutivement) à la traîne. Or n’est-il pas absurde de vouloir considérer le dilemme de Collingridge comme un « problème à résoudre » ?54 Celui-ci ne nous rappelle-t-il pas simplement que le futur est contingent, que le passé est conditionnant, et que, malgré cela, le temps de l’action et du choix est le présent, aussi insaisissable soit-il ? Ce n’est que pour une approche focalisée sur l’anticipation des conséquences futures que cette caractéristique fondamentale du temps social, la contingence, devient un dilemme et un facteur de paralysie de l’éthique. Quelle que soit la ligne de pensée adoptée par les éthiques-vérité, celles-ci déploient toujours en un processus en deux étapes : primo, les scientifiques produisent des faits ; deuxio, une fois la bonne information dispensée, les principes éthiques, dont la définition est l’affaire des théories morales et des éthiciens, peuvent entrer en jeu. Ce schéma d’opposition faits/valeurs (ou objet/sujet, ou moyens/fins, ou science/opinion…) suppose d’admettre une division du travail tranchée entre NST et SHS : aux premières la production des faits scientifiques et techniques ; aux secondes l’évaluation des usages en société. Le périmètre d’intervention de l’éthique est donc circonscrit par avance aux applications des NST et à leurs usages industriels ou commerciaux. Cette division du travail entre science et éthique est contestable pour plusieurs raisons, que nous allons maintenant énoncer. 3.1.3.2. Des nanos, on ne fait pas usage
Dans leur mode d’existence au laboratoire, le caractère « nano » d’un objet se définit moins par sa taille nanométrique que par les relations entre différents ordres de grandeur dont l’objet à l’échelle nanométrique constitue le pivot ou le point médian. Par exemple, une molécule déposée sur une surface pour y être manipulée par la pointe d’un microscope à effet tunnel (STM pour Scanning Tunnelling Microscope) n’est pas en soi un nano-objet indépendamment du système expérimental qui permet de l’adresser ; les seules propriétés physiques et chimiques ne suffissent pas à définir cette molécule comme un nano-objet. Ce qui fait de cette molécule un nano-objet individuel, c’est la relation active qu’elle instaure entre l’échelle subatomique des propriétés quantiques intrinsèques (par exemple, l’organisation des états électroniques de la molécule) et l’échelle macroscopique ; entre ce qui la compose et ce dans quoi elle est. La molécule est en effet connectée à deux objets
53 COLLINGRIDGE (D.). – The social control of technology. Pinter (1980). 54 C’est l’argument que défend NORDMANN (A.). – A forensics of wishing: technology assessment in the age of technoscience. Poiesis & Praxis, vol. 7, n° 1-2, p. 5-15 (2010).
Version générée par les auteurs d’un article paru en deux volets dans Techniques de l’Ingénieur : (1) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : cartographie critique des approches existantes », TI n° RE244, 2015. (2) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : pour une approche centrée sur les objets », TI n° RE245, 2015. Le présent manuscrit présente les deux volets réunifiés, révisés et remis en page à partir de leurs versions avant publication respectives.
24
macroscopiques, la pointe et la surface ; la surface stabilise la molécule (elle fait décohérer ses états quantiques) et la pointe la stimule (par exemple, lui injecte des électrons). Plus que la taille en soi, « nano » désigne donc cette zone intermédiaire entre deux modes de comportement de la matière qui vont pouvoir être corrélés. C’est dans cette corrélation entre plusieurs ordres de grandeur (le plus petit et le plus grand que l’objet) que réside le pouvoir d’action et de perception qui est offert à l’échelle nanométrique. Les nano-objets sont des objets relationnels. Cette définition des nano-objets par les relations, sur laquelle nous reviendrons amplement dans la quatrième partie, ne signifie pas simplement que les objets « ont » des relations avec ce qui n’est pas eux (d’autres objets, l’environnement, la société par exemple). À ce compte, toute réalité matérielle devrait être dite relationnelle et nous n’aurions rien gagné. Le nano-objet est relationnel non pas au sens trivial où il est en relation avec d’autres entités du monde, mais au sens où il est constitué par ses relations – la relation n’est pas ce qui arrive à l’objet une fois qu’il existe, elle est ce qui constitue l’objet lui-même. Comme dit Simondon, l’objet relationnel n’est pas l’être en relation mais l’être de la relation55. Or, dans la plupart des applications existantes, le caractère relationnel du « nano » se perd – ou plutôt, c’est la participation des usagers à ce caractère relationnel qui se perd. C’est déjà le cas avec bien des technologies dont le fonctionnement matériel nous est imperméables, comme la microélectronique ; mais la situation atteint un paroxysme avec les nanotechnologies. Des nanos, nous ne faisons pas usage. Les composants nanométriques sont confinés dans des objets plus grands et maintenus hors de portée des usagers qui n’ont aucune prise, ni intellectuelle, ni pratique, sur la technologie « nano ». Ils ont à faire à des ordinateurs, à des panneaux solaires, à des frigidaires, des déodorants ou des jus de fruit. Du point de vue de l’usage quotidien, l’aspect « nano » importe peu. Il est même fait pour être caché. Il n’est montré que dans le discours marketing qui enrobe le produit – si tant est que l’industriel le souhaite. Autrement dit, l’utilisateur n’est en contact avec l’aspect « nano » que par le halo de promesses et de risques qui auréole l’image publique des NST. Pour cette raison, la seule attention aux usages ne permet pas d’appréhender les significations éthiques et sociales des nanotechnologies. 3.1.3.3. Des trajectoires d’innovation non linéaires
Le schéma des « technologies émergentes » suppose une constitution progressive des faits scientifiques et techniques des NST qui se traduirait dans un second temps par des applications sujettes à évaluation éthique. Or ce schéma maintient le présupposé d’une temporalité linéaire de l’innovation (assortie au mieux de boucles de rétroaction) (voir section 2.2.1). Ce présupposé se heurte au caractère en réalité bourgeonnant de l’innovation des NST. Contrairement aux images véhiculées par les feuilles de route qui cherchent à planifier l’innovation, les NST n’avancent pas sur un front d’innovation déferlant de la science vers la société. Leurs trajectoires d’innovations sont buissonnantes, elles vont littéralement dans tous les sens sans aller forcément dans un sens en particulier. Ainsi, certains nano-objets tels que les nanoparticules et les nanotubes de carbones ont connus des usages industriels nombreux sous les noms respectifs de « particules ultrafines » et de « carbone filamenteux » avant de susciter l’essor de domaines de recherche académique les faisant apparaître comme des nouveautés pleines de promesses. D’autres, comme les machines moléculaires (section 4.2) existent et fonctionnent dans les conditions du laboratoire, mais n’ont guère de débouché applicatif envisagé à court et moyen terme. Ou encore, l’électronique moléculaire a connu plusieurs vies depuis les années 1950 dans les marges de
55 SIMONDON (G.). – L’individuation à la lumière des notions de forme et d’information [1964, 1989]. Millon (2005).
Version générée par les auteurs d’un article paru en deux volets dans Techniques de l’Ingénieur : (1) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : cartographie critique des approches existantes », TI n° RE244, 2015. (2) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : pour une approche centrée sur les objets », TI n° RE245, 2015. Le présent manuscrit présente les deux volets réunifiés, révisés et remis en page à partir de leurs versions avant publication respectives.
25
l’industrie microélectronique avant de devenir un domaine phare des NST dans les années 200056. L’électronique moléculaire a donné lieu à divers types de développement applicatifs (méthodes de dopage ionique des semi-conducteurs, composés d’intercalation pour les batteries, électronique plastique) sans jamais à parvenir à réaliser son grand rêve : la mise au point d’ordinateurs fonctionnant avec des molécules plutôt qu’avec des cristaux solides comme le silicium. Enfin certains objets, comme les nanoparticules de dioxyde de titane, mènent des « doubles vies » : ils ont simultanément une carrière industrielle (catalyse, peinture, revêtements) et académique (optique quantique, opto-électronique), qui souvent, s’ignorent, parfois s’enrichissent d’interactions mutuelles et souvent imprévisibles. La grande diversité des trajectoires des nano-objets rend donc difficilement généralisable une séquence linéaire allant du laboratoire de recherche fondamentale à la société en passant par l’industrie. L’effet de linéarisation de l’innovation nanotechnologique ne relève pas d’une quelconque dynamique cumulative de la technologie, mais de ses discours de promotion et de programmation de la recherche. Dans ce cas, définir l’éthique soit comme « démarche anticipatrice » (éthique spéculative, 3.1.2.3) soit comme entreprise de « rattrapage continuel » (éthique interactionniste ; 3.1.2.4) paraît bien dérisoire. Ces approches se représentent en effet le développement des nanotechnologies certes comme incertain et imprévisible, mais ce toujours selon une temporalité unilinéaire et cumulative. Or cette temporalité n’est pas celle de la technologie que ces approches éthiques prétendent évaluer. 3.1.3.4. Une division du travail déresponsabilisante
La division du travail entre science et éthique selon la séquence « production des faits > intervention des valeurs » se traduit par un modèle de répartition des responsabilités conforme au modèle linéaire critiqué plus haut. Or, cette division du travail s’avère non seulement inadéquate, mais aussi déresponsabilisante. Elle repose sur un mécanisme de délégation de la responsabilité : du scientifique aux industriels, d’un industriel à un autre le long de la chaîne de production, des producteurs aux distributeurs, etc., jusqu’aux consommateurs (encadré 1).
Chacun se repasse le mistigri. Ce discours de délégation de responsabilité implique que si problème éthique il y a, il ne peut intervenir que dans l’utilisation de ce qu’un autre acteur fait de ce qu’on lui fournit. L’objet « nano » est considéré comme un simple moyen, neutre, dont personne n’assume la responsabilité en dehors de la fin qu’il lui assigne spécifiquement. Pourtant, c’est cet objet qui circule et qui fait le lien entre les acteurs et les
56 MODY (C.M.) et CHOI (H.). – The Long History of Molecular Electronics: Microelectronics Origins of Nanotechnology. Social Studies of Science, vol. 39, 11-50. http://www.owlnet.rice.edu/~Cyrus.Mody/MyPubs/Molecular%20Electronics.pdf (page consultée le 11 juin 2013) (2009)
Encadré 1 – Le discours classique de délégation de la r esponsabilité
— Chercheur : « J’ai participé à la synthèse de cette nanoparticule, mais je ne suis aucunement responsable de la manière dont elle est utilisée par les industriels ». — Industriel A : « Mon entreprise incorpore cette nanoparticule dans un matériau et le fournit à l’entreprise B, qui l’utilise comme brique technologique dans son produit final. Je suis responsable de la santé de mes employés et de l’observation des normes de sécurité en vigueur dans les procédés industriels de mon unité de production. Mais je ne suis pas responsable des pratiques de l’industriel B ». — Industriel B : « Mon entreprise produit et commercialise le produit contenant ce matériau nanostructuré, qui a passé avec succès tous les tests de sécurité. Si un consommateur l’utilise de manière anormale, je n’en suis aucunement responsable. Après tout, il/elle a librement choisi d’acquérir ce produit ».
Version générée par les auteurs d’un article paru en deux volets dans Techniques de l’Ingénieur : (1) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : cartographie critique des approches existantes », TI n° RE244, 2015. (2) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : pour une approche centrée sur les objets », TI n° RE245, 2015. Le présent manuscrit présente les deux volets réunifiés, révisés et remis en page à partir de leurs versions avant publication respectives.
26
milieux de l’innovation, un objet relationnel donc. Mais ces relations ne sont pas considérées comme devant relever de l’évaluation éthique. Cette démoralisation du lien peut sembler banale. Elle n’est nullement spécifique aux NST. Néanmoins, elle traduit un évitement du défi que représentent les NST pour nos systèmes sociotechniques d’innovation : celui de faire entrer les objets en responsabilité pour faire admettre, avec eux, les liens entre les acteurs des systèmes d’innovation dans le champ de l’évaluation éthique. Par ailleurs, la séparation entre les faits constitués par les scientifiques et les valeurs définies par les éthiciens revient à considérer, comme le remarque à juste titre B. Laurent, que « les individus qui ne sont ni scientifiques ni éthiciens n’ont qu’à attendre le résultat des travaux de ces experts pour prendre une décision individuelle (dans la vision libérale) ou bien suivre les normes édictées par les éthiciens (dans la vision conservatrice) »57. Cela montre à quel point la dichotomie faits/valeurs fait obstacle à la nécessité de concevoir des formes collectives de responsabilité dans le souci du monde commun. 3.1.3.5. Les NST ne produisent pas des faits mais des objets porteurs de valeurs
Enfin, les NST ne produisent pas de purs « faits » indifférents aux valeurs : il ne s’agit pas en effet pour elles d’élaborer ou de tester des théories explicatives de tel ou tel aspect de la nature, mais de faire émerger des phénomènes inédits et de les contrôler. La question n’est pas de déterminer quels sont les faits qui confirment ou infirment tel ou tel énoncé scientifique, mais de développer des moyens d’action, de corrélation des ordres de grandeur et de détection à l’échelle nanométrique : coupler un spin et une photoémission pour tenter de contrôler l’un par l’autre, accélérer, ralentir ou dévier des électrons, fonctionnaliser des nanoparticules pour qu’elles s’autoassemblent de telle ou telle manière, coupler un mouvement moléculaire et la modification macroscopique d’un matériau, etc. La connaissance n’est pas ce qui valide une hypothèse théorique préalable ; la connaissance s’identifie au contrôle des phénomènes58. Même les connaissances toxicologiques sont vues comme des outils potentiels pour une nanomédecine qui apprendrait à les contrôler. Les nanos ne sont pas une « technologie » au sens où elles sont de la science (logos) « traduite » en applications. Même sans applications, elles sont une « technologie » au sens où elles mettent en jeu de nouvelles relations à la matière qui passent par une articulation opératoire et cognitive des opérations entre ordres de grandeur. En tant que connaissance des opérations, elles relèvent de la « technologie » au sens original du terme, celui de logos de technè59. Et ce n’est pas parce tel ou tel projet de recherche « nano » n’a pas d’application qu’il relève de « science fondamentale » au même titre que la physique des particules ou la cristallographie. Même sans application, les nanos sont fondamentalement technologiques parce qu’elles se préoccupent essentiellement de mise au point et de connaissance de schémas techniques d’articulation entre ordres de grandeur. On ne peut donc s’appuyer sur le partage entre la science et son application pour mettre en discussion les enjeux éthiques des NST. Il convient au contraire de corréler les modes d’existence technologiques des objets NST et leurs modes d’existences sociaux en une même question : celle du mode d’existence des objets des NST en tant qu’objets relationnels. De surcroît, l’intérêt de ce concept d’objet relationnel pour caractériser les nanotechnologies réside dans son caractère pluraliste : les relations constitutives du nano-objet sont bien sûr d’ordre physico-chimique, mais il n’y a aucune raison valable d’exclure de
57 LAURENT (B.). op. cit., 2010, p. 124. 58 BENSAUDE-VINCENT (B.), LOEVE (S.), NORDMANN (A.) et SCHWARZ (A.). – Matters of interest : the objects of research in science and technoscience. Journal for general philosophy of science, vol. 42(2), p. 365-383 (2011). 59 CARNINO (G.). – Les transformations de la technologie: du discours sur les techniques à la «techno-science». Romantisme, 150(4), 75-84.
Version générée par les auteurs d’un article paru en deux volets dans Techniques de l’Ingénieur : (1) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : cartographie critique des approches existantes », TI n° RE244, 2015. (2) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : pour une approche centrée sur les objets », TI n° RE245, 2015. Le présent manuscrit présente les deux volets réunifiés, révisés et remis en page à partir de leurs versions avant publication respectives.
27
la définition de l’objet des relations d’ordre axiologique, c’est-à-dire relevant de choix de valeurs. Cette posture peut surprendre dans la mesure où elle semble violer un sacro-saint principe de la science moderne, à savoir qu’un objet scientifique exclut de sa définition tout ce qui touche à la sphère des valeurs morales, sociales, idéologiques etc. Ne ruine-t-on pas la science elle-même en prétendant définir conceptuellement les nano-objets comme des objets relationnels saturés de valeurs autres que mesurables ? Notre proposition consiste à soutenir que les objets de technoscience doivent être considérés comme des objets multidimensionnels : les valeurs font partie intégrante de leur « mode d’existence » au laboratoire, elles ne sont pas extérieures au registre de connaissance et d’action du scientifique. Parmi ces valeurs, on peut repérer :
- des valeurs techniques : veut-on privilégier le rendement ou la fiabilité, l’automaticité ou l’interactivité, la reproductibilité ou l’exceptionnalité, la précision ou la diffusion ?
- des valeurs esthétiques : par quelles modalités rendre sensible (son, image, toucher, etc.) les objets et les processus « nano » situés en deçà du visible60 ?
- des valeurs concernant l’idée de nature et du rapport technique/nature61 : par exemple, cherche-t-on à rivaliser avec la nature (comme les chimistes motivés par des « défis de synthèse ») ? A la dompter, à l’améliorer, à la réparer, à la faire fructifier ? Considère-t-on la nature comme un « ingénieur indépassable » dont il s’agirait de s’inspirer, comme dans les pratiques biomimétiques62 ? la nature n’est pas un concept strictement descriptif ou ontologique, c’est aussi un concept axiologique, voire moral ;
- des concepts de machine, eux aussi chargés de valeurs ; ainsi le paradigme de la « nanomachine » peut-il signifier soit un objet technique transparent, entièrement connu, fonctionnalisé et maîtrisé, soit une source de surprise et d’imprévisible complexité, soit l’objet d’un dialogue avec l’environnement à l’échelle nanométrique63.
Dans les pratiques de design elles-mêmes, le rapport aux nano-objets engage donc déjà des valeurs qui font l’objet d’arbitrages et de choix dès l’élaboration des objets en laboratoire. Ce ne sont certes pas des valeurs en soi « éthiques » mais ce ne sont pas non plus des propositions strictement scientifiques : ce sont des « valuations » à expliciter et à confronter dans et par des évaluations éthiques (section 1.1.3). L’activité de production de tels objets porteurs de valeur est très différente de l’activité de production de faits scientifiques. Classiquement, un « fait » scientifique est obtenu au terme d’une activité de « purification » 64 des phénomènes qui sépare la contribution de la nature non humaine et les contributions de la subjectivité, des valeurs et de la culture. Les pratiques des NST tentent au contraire de les associer le plus étroitement possible. Elles ne produisent donc pas des « faits » proprement dits, mais des objets fonctionnalisés dont elles contribuent à déterminer la valeur, des « mixtes de nature et d’humain », selon la formule de G. Simondon. Devant les impasses de l’éthique-vérité, il convient donc d’expérimenter des approches dans lesquelles l’éthique puisse se construire et intervenir par-delà le partage des faits et des valeurs.
60 LOEVE (S.). – Les nanotechnologies comme question esthétique ? In Sauvageot A., Bouju X., Marie X., (éds) Images & Mirages @Nanosciences. Regards croisés. Paris, Hermann, pp. 201-212 (2011). 61 WICKSON (F.). – Narratives of nature and nanotechnology. Nature Nanotechnology, vol. 3, pp. 313-315. http://www.academia.edu/4195514/Narratives_of_Nature_and_Nanotechnology (page consultée le 13 juillet 2013) (2008). 62 BENSAUDE-VINCENT (B.). – A Cultural Perspective on Biomimetics, in Anne George (ed.), Advances in Biomimetics, InTech, http://www.intechopen.com/articles/show/title/a-cultural-perspective-on-biomimetics (page consultée le 13 juillet 2013) (2011). 63 BENSAUDE-VINCENT (B.) et GUCHET (X.). – Nanomachine : One word for three different paradigms. Technê , Research in Philosophy & Technology, vol. 10, 71–89 http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/35/07/23/PDF/02BBV.pdf (page consultée le 13 juillet 2013) (2007). 64 LATOUR (B.). – La science en action. Introduction, à la sociologie des sciences. La découverte, Paris (2005).
Version générée par les auteurs d’un article paru en deux volets dans Techniques de l’Ingénieur : (1) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : cartographie critique des approches existantes », TI n° RE244, 2015. (2) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : pour une approche centrée sur les objets », TI n° RE245, 2015. Le présent manuscrit présente les deux volets réunifiés, révisés et remis en page à partir de leurs versions avant publication respectives.
28
3.2. L’éthique-politique Aux éthiques-vérités, B. Laurent oppose un second type de problématisation et d’intervention de l’éthique des NST, celui des « éthiques-politiques ». 3.2.1. Caractéristiques générales et typologie
3.2.1.1. Caractéristiques générales
S’il est vrai que l’éthique se préoccupe du « bien vivre ensemble », toute éthique ou philosophie morale, même la plus individualiste, recèle une dimension politique, qu’il s’agisse de promouvoir un modèle de société ou de le contester. Dans le champ des NST, on appelle « éthique-politique » les approches qui n’admettent pas la dichotomie des faits et des valeurs, de la science et de la société. Les éthiques-politiques reposent donc sur l’idée que ni les faits ni les valeurs ne sont donnés au départ, qu’il ne s’agit pas de deux sphères de réalité indépendantes qu’il faudrait articuler après coup. Le constat liminaire conduisant aux éthiques-politiques est que nous sommes, avec les NST, en situation d’incertitude généralisée. Incertitudes de connaissance, d’abord : compte tenu de la démultiplication des relations qui caractérisent les objets nano et leur confèrent leur propriétés, les faits ne sont jamais complètement faits et l’on peut toujours s’attendre à voir ces objets manifester des propriétés inattendues. C’est au demeurant ce qui sous-tend les problématiques touchant la biotoxicologie et l’écotoxicologie des NST, nous y reviendrons. Incertitudes de développement, ensuite, quant aux trajectoires industrielles et sociales possibles des nano-objets. Incertitudes quant aux valeurs, enfin : pour l’éthique-politique, les valeurs ne constituent plus un cadre de référence donné d’avance et susceptible de faire d’emblée consensus. Sauf à se limiter à un répertoire à la fois succinct et monotone, auquel personne ne trouvera rien à redire certes, mais qui n’éclaire pas grand-chose (principe de non-malfaisance, respect de la dignité humaine, etc.), il n’est pas possible d’établir à l’avance une liste d’items satisfaisant la démarche d’interrogation des valeurs et des finalités des NST. Dans les éthiques-politiques, les valeurs ne sont pas portées par des principes généraux, inva- riablement réaffirmés et tenus pour indiscutables : elles doivent être explicitées. Un autre des aspects caractéristiques des éthiques-politiques est qu’elles refusent de s’en tenir à l’évaluation des coûts-bénéfices, c’est-à-dire au calcul d’utilité. On pourrait dire qu’elles organisent plutôt des démarches de valuation au sens où J. Dewey emploie ce terme65. En effet, pour Dewey, il faut distinguer le fait d’évaluer quelque chose selon un rapport fin-moyens (les moyens sont-ils adéquats à la finalité recherchée ? La valeur de la chose est instrumentale : elle est un moyen pour une fin) et le fait de valuer, c’est-à-dire de signifier un attachement à quelque chose – cette chose étant alors tout autant un moyen qu’une fin. Dewey entendait en effet montrer qu’il est utile pour la théorie éthique de la valeur de relativiser la distinction fin/moyen (ou la distinction fin en soi / fin pour autre chose) : une fin peut aussi servir de moyen pour une autre fin sans pour autant perdre sa valeur de fin en soi ; réciproquement, un moyen, s’il est un objet de valuation, peut aussi avoir une valeur en lui- même. Les éthiques-politiques se focalisent d’abord sur la valuation au sens où elles visent à replacer la discussion collective sur les valeurs – ce à quoi nous tenons – dans l’horizon d’une réflexion plus générale sur le type de monde que nous voulons. Les éthiques-politiques mettent l’accent sur le monde associé aux NST et à leur « faire monde ». Les NST y sont considérées non comme une source de moyens-utiles-en-vue-de mais comme une puissance
65 DEWEY (J.), op. cit., 1939.
Version générée par les auteurs d’un article paru en deux volets dans Techniques de l’Ingénieur : (1) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : cartographie critique des approches existantes », TI n° RE244, 2015. (2) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : pour une approche centrée sur les objets », TI n° RE245, 2015. Le présent manuscrit présente les deux volets réunifiés, révisés et remis en page à partir de leurs versions avant publication respectives.
29
de production d’êtres nouveaux, lesquels noueront avec d’autres êtres du monde des relations non nécessairement prévisibles (c’est ce que l’on appelle « faire monde »). Ainsi, pour reprendre le rapport du Comité d’éthique du CNRS, le COMETS, de 200666, le question-nement sur les valeurs dans les NST consiste à « s’interroger sur le type de rapports que l’on souhaite instaurer entre ces trois pôles fondamentaux de notre civilisation que sont la nature, la technique et la culture ». L’association VivAgora, qui organise depuis 2005 des débats sur les NST visant à mettre en politique les choix scientifiques et techniques, illustre cette démarche. Il ne s’agit pas en effet pour l’association de promouvoir une recherche « éthiquement correcte » ou « socialement acceptable », mais de rendre aux citoyens la capacité de peser sur les choix scientifiques et techniques, de décider collectivement de ceux qui ont de la valeur à leurs yeux, et ainsi de choisir le type de monde dans lequel ils veulent vivre. Sur cette base, il est possible de distinguer trois grandes démarches relevant de l’éthique-politique. 3.2.1.2. Éthique-politique procédurale
On estime bien souvent qu’à défaut de pouvoir se mettre d’accord sur des contenus – ce que nous avons appelé les Valeurs avec un « V » majuscule, des définitions consensuelles du Juste ou du Bien – il est toujours possible de s’accorder sur les règles que tout débat doit respecter. La théorie de la justice (ou de l’équité) de John Rawls, par exemple, comporte un aspect procédural essentiel, mobilisé comme un instrument de lutte contre les inégalités67 ; les éthiques de la discussion ou de « l’agir communicationnel » comme celles de Jürgen Habermas68 ou de Karl-Otto Apel69, qui comportent à leur base une affirmation de la pluralité des valeurs, incluent aussi des aspects de « formalisme procédural ». Précisons que ni la théorie rawlsienne ni les éthiques de la discussion ne sont en aucun réductibles à une « éthique procédurale ». L’éthique procédurale au sens où nous l’employons ici désigne davantage un écueil de l’éthique-politique qu’une posture revendiquée comme telle. La référence à la conception rawlsienne de l’équité et aux éthiques de la discussion se justifie cependant dans la mesure où celles-ci trouvent des applications dans le débat public. Faisant l’hypothèse, plutôt raisonnable, qu’il n’y a pas de raison a priori de supposer l’existence d’un système de valeurs partagées par tous, l’approche procédurale de l’éthique des NST vise ainsi l’accord sur les modalités du débat, comme l’implication du plus grand nombre possible de parties prenantes, la transparence, l’impartialité, etc. La limite de l’éthique-politique procédurale tient au fait que les contenus de la recherche et développement en NST sont pris comme des « occasions » plutôt que comme la matière même de la réflexivité : peu importent les objets et les relations qu’ils nouent et qu’ils portent, seule compte la qualité des procédures de délibération. Même si de telles approches représentent un acquis indéniable en matière de « mise en démocratie » (puisqu’elles amènent à constamment se demander « qui défend quels intérêts », « qui est en droit de dire la norme », etc.), elles buttent sur le problème de la prise en compte explicite du non humain, c’est-à-dire des êtres (artificiels ou naturels) non doués de parole mais avec lesquels les humains font pourtant société70. Pour caricaturer, l’éthique procédurale nous ramène souvent à une situation
66 COMETS. – Enjeux éthiques des nanosciences et nanotechnologies. CNRS http://www.cnrs.fr/comets/IMG/pdf/10-ethique-nanos.pdf (page consultée le 09 aout 2013) (2006). 67 RAWLS (J.). – Théorie de la justice [1971]. Éditions du Seuil (1987). 68 HABERMAS (J.). – Notes programmatiques pour fonder en raison une éthique de la discussion [1983]. Morale et communication. Éditions du Cerf, pp. 63-130 (1986). 69 APEL (K.-O.). – Éthique de la discussion. Éditions du Cerf (1994). 70 HOUDART (S.) et THIERY (O.) (éds). – Humains non humains. Comment repeupler les sciences sociales ? La découverte (2001).
Version générée par les auteurs d’un article paru en deux volets dans Techniques de l’Ingénieur : (1) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : cartographie critique des approches existantes », TI n° RE244, 2015. (2) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : pour une approche centrée sur les objets », TI n° RE245, 2015. Le présent manuscrit présente les deux volets réunifiés, révisés et remis en page à partir de leurs versions avant publication respectives.
30
où l’on délibère pour savoir si on délibère et qui délibère… sans savoir plus très bien de quoi on délibère. Parce que éthiques-politiques procédurales privilégient le « qui » par rapport au « quoi », elles peinent à stabiliser les objets de la valuation pour les rendre disponibles à l’évaluation normative. Nous ne nions certes pas qu’un certain procéduralisme soit bien évidemment indispensable aux débats publics : il faut formuler des règles ; pas de débats sans un minimum de procédures, même si un débat réussi est aussi un débat qui sait remettre en cause les procédures. Pour récapituler, l’éthique-politique procédurale fait porter son attention sur l’état de la réflexivité dans les collectifs humains mais elle court-circuite la référence au contenu de ce qui est en discussion. Elle demeure incomplète car elle manque de prise sur toute la population non humaine des êtres de la nature et de la technique qui entrent aussi dans la composition de nos sociétés. C’est pourquoi l’attention sur les bonnes procédures en matière de débat public ne saurait suffire. Elle doit être complétée et enrichie par d’autres approches. 3.2.1.3. Éthique-politique expérimentale
L’éthique-politique qualifiée d’« expérimentale » (en référence à une certaine vision de l’expérimentation en sciences de la nature, celle de la philosophie pragmatiste) s’appuie sur la méthode des scénarios pour explorer les dimensions multiples d’un problème en passant par une mise en récit permettant à une pluralité de valeurs de s’exprimer. À rebours des éthiques-vérité centrées sur les applications potentielles des NST, c’est-à-dire sur la valeur-utilité, l’éthique-politique expérimentale organise des démarches d’invention en domaine moral. Il faut distinguer le scénario comme feuille de route (roadmap) et le scénario comme fiction : le premier est un outil de planification et de pilotage de la recherche ; le second a pour vocation de permettre aux acteurs et aux parties prenantes de questionner les dimensions morales et les visions du monde associées à la recherche et à ses développements pour faire émerger des conflits de valeurs. La feuille de route a une fonction proactive, elle vise à donner un cadre aux acteurs des NST, à les inciter à inscrire leurs stratégies dans un horizon temporel défini, à l’intérieur duquel ils doivent remplir des objectifs précis. Le scénario de l’éthique politique expérimentale a une toute autre fonction : il s’agit plutôt de construire une expérience de pensée, par exemple, « vivre avec une puce dans le cerveau », « détecter les maladies avant qu’elles ne surviennent », etc71. L’expérimentalisme en éthique consiste en somme à construire une expérience bien faite en domaine moral, sur le même principe que les expériences des sciences de la nature : en raisonnant « toutes choses égales par ailleurs », il s’agit de construire les valeurs comme des faits observables donnant lieu à examen. Une limite des éthiques-politiques expérimentales tient cependant au fait que celles-ci restent centrées sur des « situations d’application ». Elles ne font finalement que transposer notre rapport utilitaire à la technique « au futur » au lieu de le questionner et, partant, elles courent le risque de retomber sur les apories de l’éthique spéculative mentionnées plus haut (section 3.1.2.2). 3.2.1.4. Éthique-politique ontologique
Ce que B. Laurent appelle « éthique-politique ontologique », c’est-à-dire l’éthique qui concerne les manières d’être et de devenir des objets, est sans doute la plus confidentielle des éthiques-politiques mises en œuvre au sujet des NST, toutefois elle est à nos yeux la plus prometteuse. Comme on le verra dans la quatrième partie, notre « philosophie de terrain » s’y rattache jusqu’à un certain point.
71 BARBEN (D.), FISHER (E.), SELIN (C.) et GUSTON (D.H.). – Anticipatory Governance of Nano-technology : Foresight, Engagement, and Integration. In E. Hackett et al. (eds). Handbook of Science and Technology Studies, MIT Press, Cambridge, pp. 979-1000 (2008).
Version générée par les auteurs d’un article paru en deux volets dans Techniques de l’Ingénieur : (1) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : cartographie critique des approches existantes », TI n° RE244, 2015. (2) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : pour une approche centrée sur les objets », TI n° RE245, 2015. Le présent manuscrit présente les deux volets réunifiés, révisés et remis en page à partir de leurs versions avant publication respectives.
31
L’éthique-politique ontologique est une éthique en prise avec les objets et les pratiques de laboratoire. Elle consiste à arrimer la réflexion sur les valeurs et les finalités des NST à la prise en compte du design des objets « nano » – c’est-à-dire aux caractéristiques technologiques de ces objets. Plus précisément, B. Laurent parle d’une éthique du « faire advenir »72 : du point de vue de l’éthique-politique ontologique en effet, la discussion éthique ne porte pas sur des objets dont les caractéristiques seraient déjà fixées, figées par le travail des scientifiques ou les procédés industriels ; le débat contribue à redéfinir l’objet, à lui conférer de nouvelles caractéristiques (comme par exemple le « safety by design »73). Bref, ce qui compte comme objet est construit dans la démarche même questionnement éthique. C’est en ce sens qu’il s’agit de co-construction. L’intérêt de cette approche ontologique en éthique tient à l’attention portée aux relations – les objets « nano » y sont en effet définis par le type de relations qu’ils peuvent de nouer avec d’autres êtres du monde ; l’éthique-politique ontologique met en avant une ontologie, non des substances, mais des relations. Toutefois, cette ontologie n’est pas toujours explicitée comme telle dans les démarches de l’éthique-politique. Cette explicitation est au contraire au cœur de notre programme de « philosophie de terrain centrée objet », elle en situe l’originalité. 3.2.2. Par-delà sujet et objet : politiques des artéfacts et éthiques du design
Nous considérons donc comme insuffisantes les deux postures de l’éthique-vérité (celle du Fait scientifique et de la Valeur morale) et l’éthique-politique dans sa variante procédurale (et dans une moindre mesure, dans sa variante expérimentale). Au fond, ces approches perpétuent une séparation métaphysique que toute la philosophie essaie de remettre en question depuis le début du XXe siècle : celle du sujet et de l’objet. Ces éthiques tiennent en effet pour une évidence que seuls les sujets peuvent être soumis à une évaluation morale. En effet, la technique appartient traditionnellement au règne des moyens et la morale au règne des fins. Les objets demeurent à l’extérieur du champ de la philosophie morale. Il est vrai que certains êtres non-humains sont récemment entrés dans le champ de la philosophie morale alors qu’ils en étaient auparavant exclus. On pense ici aux animaux ou aux écosystèmes, qui ont donné naissance à deux nouvelles branches de l’éthique appliquée : l’éthique animale et l’éthique environnementale. Toutefois, les objets techniques n’ont pas connu ce sort : ils sont restés soit exclus du champ de l’éthique, soit relégués au statut de moyens ; seuls les usages que nous (c’est-à-dire nous « les sujets ») faisons de nos objets techniques sont supposés relever d’une réflexion de type éthique. En bref, les deux grandes postures éthiques adoptées vis-à-vis des NST acceptent comme une évidence le partage entre la neutralité des objets et la moralité des usages. C’est ce partage que nous voudrions remettre en question. Ce diagnostic mérite cependant d’être nuancé. Ces dernières précisions seront l’occasion d’examiner encore quelques candidats pour une éthique-politique ontologique des NST et de mettre en évidence leurs limites. 3.2.2.1. Politiques des artéfacts
Dès les années 1980, des philosophes comme Langdon Winner74 et toute la mouvance SCOT (« Social construction of technology »)75 se sont employés à montrer que – pour reprendre le 72 LAURENT (B.). op. cit., 2010, p. 134. 73 KELTY (C.). – Beyond implications and applications: the story of « safety by design ». Nanoethics, vol. 3, pp. 79-96. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11569-009-0066-y (page consultée le 09 aout 2013) (2009). 74 WINNER (L.). – Do artifacts have politics? Daedalus, Vol. 109, n. 1 (Modern Technology: Problem or Opportunity?), p. 121-136 (1980). 75 WILLIAMS (R.) et EDGE (D.). – The social shaping of technology. Research policy, vol. 25, n. 6, p. 865-899 (1996).
Version générée par les auteurs d’un article paru en deux volets dans Techniques de l’Ingénieur : (1) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : cartographie critique des approches existantes », TI n° RE244, 2015. (2) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : pour une approche centrée sur les objets », TI n° RE245, 2015. Le présent manuscrit présente les deux volets réunifiés, révisés et remis en page à partir de leurs versions avant publication respectives.
32
titre d’un célèbre article de L. Winner – « les artéfacts ont une politique ». La « politique des artéfacts » désigne selon Winner la manière dont l’invention, la conception et l’arrangement des objets techniques ou d’un système technique dans son ensemble opèrent comme des mécanismes permettant de régler les affaires sociales et politiques d’une communauté sociopolitique dominante (ou qui cherche à assoir sa domination grâce aux techniques). Pour Winner, les objet techniques favorisent ou requièrent des types particuliers de groupements sociopolitiques. Cependant, la politique des artéfacts obéit chez Winner à une normativité politique et sociale donnée qu’elle vient renforcer, non à une normativité intrinsèquement technique. Ainsi a-t-il été objecté, non sans raison, à Winner, que toute son argumentation visant à montrer que « les artéfacts ont une politique » pouvait se résumer à l’affirmation bien plus banale selon laquelle « la politique a des artéfacts »76, c’est-à-dire se donne des moyens techniques pour gouverner. Comme le dit Bruno Latour, si on considère que les « gendarmes couchés » (les ralentisseurs routiers) ne sont que des gendarmes faits de béton et non de chair et d’os (et de loi !), c’est que l’on n’a rien compris à la technique ; on lui assigne alors un rôle de simple substitut non-humain d’une médiation humaine qui accomplirait une fonction identique77. Or selon Latour, les techniques expriment bien autre chose qu’un simple transfert des fins humaines dans des moyens matériels ; elles constituent une expérience de l’altérité par laquelle le présent de l’interaction sociale se trouve toujours partiellement déphasé par rapport à lui-même, branché sur des rythmes, des espaces et des temps autres qui introduisent de l’inactualité dans le collectif. A la différence des sociétés de babouins, où le collectif est entièrement actualisé dans chacune des interactions sociales, par les techniques, nos sociétés ne sont plus tout à fait contemporaines d’elles-mêmes78. Ce décalage à soi est constitutif de l’humain. Il n’en demeure pas moins que dès que l’on remet en question l’image de l’humain « tout fait » (avec sa subjectivité, ses valeurs, ses projets) manipulant des objets inertes laissant inchangée sa qualité de sujet, les objets techniques prennent bien d’autres modes d’existence que celui de l’ustensilité. Ils sont plus réduits à des moyens neutres au service de fins humaines. 3.2.2.2. Éthiques du design
La question des valeurs mises en jeu dans la conception technique a été placée au centre des préoccupations de « l’éthique du design »79 et de la méthodologie du value-sensitive design (« conception sensible aux valeurs », VSD)80. Se développant d’abord dans le domaine de l’informatique, le VSD a récemment donné lieu à des propositions dans le domaine des nanotechnologies81. Le VSD se concentre sur l’intégration proactive des valeurs morales dans la conception, la réalisation et le développement technologiques. Il repose sur l’hypothèse selon laquelle la technique prescrit voire même produit des comportements. La technologie façonne ainsi le répertoire moral de l’existence humaine. Le VSD se déploie généralement selon une méthode en trois étapes : 1) une analyse conceptuelle des valeurs en jeu dans un processus de conception spécifique (par exemple, l’informatique met en tension les valeurs de
76 JOERGES (B.). – Do politics have artefacts? Social studies of science, vol. 29, n. 3, p. 411-4311 (1999). 77 LATOUR (B.). – La fin des moyens. Réseaux, vol. 18, n. 100, p. 39-58 (2000). 78 LATOUR (B.). – Une sociologie sans objet ? Remarques sur l'interobjectivité. Sociologie du Travail, vol. 36, n. 4 (Travail et cognition), p. 587-607 (1994). 79 VERBEEK (P.-P.). – Materializing morality. Design ethics and technological mediation. Science, Technology & Human Values, vol. 31, n. 3, p. 361-380 (2006). 80 FRIEDMAN (B.). – Value-sensitive design. Interactions, vol. 3, n. 6, p. 16-23 (1996). 81 TIMMERMANS (J.), ZHAO (Y.) et VAN DEN HOVEN (J.). – Ethics and nanopharmacy: Value sensitive design of new drugs. NanoEthics, vol. 5, n. 3, p. 269-283 (2011).
Version générée par les auteurs d’un article paru en deux volets dans Techniques de l’Ingénieur : (1) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : cartographie critique des approches existantes », TI n° RE244, 2015. (2) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : pour une approche centrée sur les objets », TI n° RE245, 2015. Le présent manuscrit présente les deux volets réunifiés, révisés et remis en page à partir de leurs versions avant publication respectives.
33
vie privée et de liberté) ; 2) une enquête empirique sur les évaluations des parties prenantes à l’égard de la technologie en question (quelles valeurs importent en priorité pour eux ?) ; 3) une évaluation de la manière dont telle ou telle conception peut promouvoir ou empêcher l’intégration de telle ou telle valeur-clé. Cependant, le VSD a été critiqué pour son incapacité à traiter de problèmes explicitement normatifs, tels que les possibles critères de hiérarchisation des valeurs et le problème du choix entre différentes valeurs concurrentes82. Autrement dit, l’approche du VSD a une dimension axiologique forte mais une dimension normative faible. Pour le formuler dans les concepts que nous empruntons à Dewey, le VSD fournit sans doute une méthode adéquate permettant de produire techniquement des « objets de valuation », c’est-à-dire pour passer des valeurs « évaluées » aux valuations incorporées dans la conception des fonctions techniques, mais non pour juger normativement des objets de valuation, c’est-à-dire pour passer des valuations intuitives aux évaluations réflexives. Notons au passage qu’un argument identique peut être formulé au sujet d’autres démarches d’éthique-politique ontologique, telles que l’approche « safety by design », qui vise à évaluer et à intégrer dans la conception des nano-objets la valeur de sûreté en matière de risques toxicologiques83. Pour passer de la valuation à l’évaluation, on peut difficilement échapper aux conflits de valeurs et à la mise en discussion des différentes préférences morales. Par ailleurs, le VSD s’intéresse à la dimension morale de la technologie exclusivement du point de vue de l’usage. Plus précisément, il s’attache à la manière dont la conception conditionne spécifiquement l’utilisation sociale d’une technologie. Le value-sensitive design parvient certes à combler le fossé qui sépare les caractéristiques techniques des valeurs éthiques, mais il ne fournit aucune prise sur les valeurs en jeu dans les usages qui ne peuvent être anticipés dans la conception en amont, comme c’est le plus souvent le cas pour les NST. En effet, la plupart du temps les objets « nano » ne sont pas conçus pour des utilisations spécifiques ; il s’agit de technologies génériques, irréductibles à leurs usages, et ne possédant pas de corrélation analytique stricte entre caractéristiques technologiques et type d’utilisation, structure fonctionnelle et utilité. Or les enjeux éthiques des NST, on l’a déjà dit, ne sont pas réductibles aux questions que pose leur utilisation pour des applications. Les relations au monde que nouent les nano-objets débordent la sphère de l’usage à la fois dans l’espace et dans le temps : dans l’espace, les nano-objets nouent des relations avec d’autres ordres de grandeur, avec le vivant, avec les écosystèmes et les objets macroscopiques, relations qui débordent la seule sphère de perception et d’action directe des humains ; dans le temps, ces relations concernent à la fois les directions de recherche, les processus de production, les trajectoires des objets et leur devenir après usage. Enfin, le VSD met exclusivement l’accent sur les valeurs morales censées être les mieux partagées : principalement la justice, le bien-être, les droits de l’homme, la vie privée, la confiance, le consentement éclairé, la responsabilité, etc. Or les nanotechnologies recèlent des dimensions de valeur qui ne sont pas toutes strictement morales – valeurs techniques, biologiques, esthétiques, etc. – mais qui sont pourtant à prendre en compte dans la pratique de l’éthique des NST comprise au sens où nous l’avons définie, à savoir comme souci du monde commun en condition de pluralité irréductible des valeurs – pluralité qui prend ici une dimension non seulement socioculturelle mais aussi ontologique : dans le cadre d’une éthique-politique ontologique, il ne s’agit plus seulement de se demander quelles normes il convient d’adopter pour faire coexister des valeurs différentes selon les cultures et les groupes sociaux, mais aussi quelles normes il convient d’adopter pour faire cohabiter des valeurs
82 MANDERS-HUITS (N.). – What values in design? The challenge of incorporating moral values into design. Science and Engineering Ethics, vol. 17, n. 2, p. 271-287 (2011). 83 KELTY (C.). op. cit., 2009.
Version générée par les auteurs d’un article paru en deux volets dans Techniques de l’Ingénieur : (1) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : cartographie critique des approches existantes », TI n° RE244, 2015. (2) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : pour une approche centrée sur les objets », TI n° RE245, 2015. Le présent manuscrit présente les deux volets réunifiés, révisés et remis en page à partir de leurs versions avant publication respectives.
34
appartenant à des registres ontologiquement distincts et construire un monde commun vivable, pensable et désirable. Pour récapituler, le VSD s’avère insuffisant pour élaborer une éthique des NST car 1) il met l’accent sur la description et l’intégration des valeurs dans la conception au détriment de l’évaluation dans sa dimension normative et réflexive et échoue ainsi à adresser les questions de choix de société en matière technologique. Autrement dit il est « downstream » plutôt que « upstream » : il se préoccupe d’intégrer dans la conception des valeurs constituées et de préférence consensuelles ; 2) il est centré sur l’usage plus que sur les objets ; 3) il se préoccupe des valeurs morales et manque la pluralité ontologique des valeurs. 3.2.2.3. Approches intégratives
Mentionnons enfin que la prise en compte des valeurs dans les processus de design des NST élargis – tout autant en amont (aux choix de R&D), en temps réel (aux pratiques de laboratoires), et en aval (aux usages et aux effets non prévus dans la conception) – fait l’objet d’approches plus inclusives que le VSD, comme NAME (Network Approach for Moral Evaluation)84 ou STIR (Socio-Technical Integration Research)85. Ces approches, très variées dans leurs modes et leurs échelles d’implémentation, ont comme point commun d’intégrer des chercheurs en SHS dans les laboratoires en NST pour interroger les choix effectués quotidiennement dans les pratiques de laboratoire et transformer ainsi les actes de routine en choix réflexifs ; ceux-ci se retrouvent à leur tour intégrés dans les directions de recherche et dans les modes de conception des objets. Si les « humanistes embarqués » contribuent ainsi à l’avènement de nouveaux êtres intégrant des valeurs hétérogènes formulées par une grande diversité de « valuateurs » (de parties prenantes), il reste encore à montrer en quoi ces approches sont capables de faire émerger des valeurs et des enjeux normatifs inédits susceptibles d’éclairer les choix de société. Il reste encore à prouver que ces approches intégratives feront mieux que l’approche VSD stricto sensu quant à leur capacité à articuler les dimensions descriptives de la valuation et les dimensions normatives de l’évaluation. 3.3. Conclusion sur les approches existantes
Dès le début de leur émergence en tant que politique de recherche, les NST ont été placées sous le signe d’une volonté d’articulation des développements scientifiques et technologiques d’un côté, et de leurs « enjeux éthiques et sociétaux » de l’autre. Devenues « réflexives », nos sociétés n’admettent plus en effet les partages trop commodes entre science et opinion, experts et profanes : c’est à une pluralisation des sources autorisées de l’expertise et de la parole publique sur les technosciences que l’on a assisté, ainsi qu’à une mise en discussion généralisée, dans des arènes dédiées, de la science et des scientifiques, sommés d’être « responsables » et de rendre des comptes au public. En Europe, cette articulation entre science et société a été même envisagée comme le moyen d’expérimenter en grandeur réelle de nouvelles manières de fabriquer des normes collectives86. Désormais, c’est manifestement à travers les sciences et les techniques que nos sociétés entendent questionner leurs valeurs et tentent d’inventer de nouveaux modes de régulation sociale.
84 VAN DE POEL (I.). – How should we do nano-ethics? A network approach for discerning ethical issues in nanotechnology. NanoEthics, vol. 2, n. 1, p. 25-38 (2008). 85 CONLEY (S.N.). – Engagement agents in the making: On the front lines of socio-technical integration. Science and engineering ethics, vol. 17, n. 4, p. 715-721 (2011). 86 NORDMANN (A.) (dir.) et HIGH LEVEL EXPERT GROUP. – Converging Technologies for the European Knowledge Society, op. cit. 2004.
Version générée par les auteurs d’un article paru en deux volets dans Techniques de l’Ingénieur : (1) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : cartographie critique des approches existantes », TI n° RE244, 2015. (2) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : pour une approche centrée sur les objets », TI n° RE245, 2015. Le présent manuscrit présente les deux volets réunifiés, révisés et remis en page à partir de leurs versions avant publication respectives.
35
Dans ce contexte, les démarches « d’accompagnement » des technosciences par les SHS se sont considérablement diversifiées durant la décennie écoulée. Pourtant, il n’est pas sûr que les principales démarches de cet « accompagnement » des NST par les SHS aient articulé de façon satisfaisante les développements technoscientifiques concrets et les questions de valeurs que ces développements suscitent. Force est de constater qu’après une décennie de volonté politique d’impliquer les SHS dans les projets en NST (avec financements conséquents à la clé), le bilan est plutôt mitigé. Dans sa cartographie raisonnée des différentes démarches « d’accompagnement » des NST par les SHS, nous avons pointé les mérites mais surtout les limites de chacune de ces approches de l’intervention et de la problématisation éthique. Ces approches se distribuent en définitive selon le partage entre l’éthique-vérité (celle du Fait scientifique et de la Valeur morale) et l’éthique-politique dans sa variante procédurale, mais aussi expérimentale. Les éthiques-vérité perpétuent l’opposition des faits et des valeurs alors que les NST la brouillent, car elles ne produisent pas des faits scientifiques traduits dans un second temps en applications techniques, mais des objets porteurs de nouvelles relations au monde tant sur un plan physico-chimique que sur le plan axiologique, celui des valeurs et des représentations guidant l’action. Les éthiques-politiques des NST, qui refusent de fonder l’évaluation éthique sur des faits et des valeurs donnés au départ, sont plus prometteuses. Cependant, la majorité de leurs approches actuelles se focalisent principalement sur les usages des NST pour des finalités applicatives, reléguant ainsi les objets au statut de moyens. Même si les approches les plus ambitieuses de l’éthique-politique ontologique considèrent que fins et moyens sont co-construits et qu’elles entendent même participer à cette co-construction, ces approches restent encore prisonnières de la séparation métaphysique du sujet et de l’objet. Dans le volet final de cet article, nous essaierons d’aller plus loin en proposant une approche originale permettant de renouer les défis technoscientifiques des NST d’un côté et la question axiologique des valeurs et des finalités de la recherche et de l’innovation de l’autre. Nous aimerions montrer comment la décision d’en passer par une « épistémologie des techniques », c’est-à-dire une analyse du mode d’existence des nano-objets sur des terrains à chaque fois singuliers, permet de renouveler le questionnement éthique.
4. Pour une éthique de terrain centrée sur les objets 4.1. Faire entrer les objets en morale Les deux grandes postures éthiques adoptées vis-à-vis des NST – l’éthique-vérité et l’éthique-politique – acceptent comme une évidence le partage entre « neutralité des objets » et « moralité des usages ». Ces approches ont en commun de perpétuer le clivage métaphysique du sujet et de l’objet. Elles tiennent en effet pour évident que seuls les sujets peuvent être soumis à une évaluation morale. Les objets sont soit maintenus à l’extérieur du champ de la philosophie morale, soit relégués au statut de moyens au service des fins humaines. C’est ce partage que nous voulons remettre en question ici. Alors que les animaux et les écosystèmes sont désormais inclus dans le champ de la philosophie morale et que par conséquent les éthiques appliquées ne sont plus stricto sensu des éthiques anthropocentriques, les objets techniques n’ont pas connu ce sort. Certes, il y a bien une éthique des techniques institutionnalisée à l’échelle internationale, avec ses approches diversifiées, ses colloques et ses revues. Mais contrairement à l’éthique animale et à l’éthique environnementale, qui ont intégré dans leurs débats une pluralité de « centrages » possibles, l’éthique de techniques est toujours majoritairement centrée sur les sujets.
Version générée par les auteurs d’un article paru en deux volets dans Techniques de l’Ingénieur : (1) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : cartographie critique des approches existantes », TI n° RE244, 2015. (2) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : pour une approche centrée sur les objets », TI n° RE245, 2015. Le présent manuscrit présente les deux volets réunifiés, révisés et remis en page à partir de leurs versions avant publication respectives.
36
En proposant de centrer la réflexion éthique sur les objets eux-mêmes, nous considérons les nanotechnologies comme l’occasion d’accomplir une sorte de nouvelle « révolution copernicienne », nous faisant passer d’une situation où le sujet est le seul être moral à une situation où les objets entrent de plain-pied dans le champ de la philosophie morale. Nous aimerions montrer dans le volet final de ce dossier comment la décision d’en passer par une « épistémologie des techniques », c’est-à-dire une analyse du mode d’existence des nano-objets comme « objets relationnels » sur des terrains à chaque fois singuliers, permet de renouveler le questionnement éthique. La démonstration se fera sur la base de quatre cas concrets de nano-objets élaborés en recherche et/ou en développement industriel : les machines moléculaires artificielles (section 4.2), les nanovecteurs de médicament (4.3), la bio- et l’éco-toxicologie des nanoparticules (4.4), et les biomarqueurs pour la médecine personnalisée (4.5). 4.2. Machines moléculaires artificielles Depuis le début des années 1990, des chimistes sont capables de synthétiser des machines moléculaires (encadré 2, figure 5), des physiciens de les immobiliser sur une surface et de les manipuler individuellement sous la pointe du microscope à effet tunnel (STM pour Scanning Tunneling Microscope), et des biophysiciens de manipuler et de modéliser le fonctionnement mécanochimique des « machines moléculaires naturelles » que sont pour eux les protéines. Lors de nos recherches, nous nous sommes rendus dans des laboratoires pour mener des entretiens in situ auprès de chercheurs travaillant dans le domaine des machines moléculaires87 . Nous voulions qu’ils nous parlent de leurs pratiques pour tenter de comprendre quels rapports de connaissance et de valeur ces chercheurs entretiennent, dans leur pratique, à ces objets – dans les termes de Dewey, comment ils les « valuent »88. Le premier constat qui s’est imposé à la suite de ces entretiens fut celui d’une déconnection entre d’un côté, les « grands discours » des NST (ceux des promesses d’application, des feuilles de route, de la spéculation orientée vers le futur), de l’autre les « petits récits techniques » (les récits des chercheurs nous racontant la genèse de leurs objets et les problèmes rencontrés en pratique)89. Face à ce constat, il ne s’agissait pas – surtout pas – de se contenter d’opposer les faits et les valeurs sur le mode de l’éthique-vérité (section 3.1) ; il s’agissait plutôt de mettre en tension les valeurs des grands discours et les valeurs des petits récits techniques en passant par une épistémologie de ces pratiques et des objets qu’elles engagent. 4.2.1. Le mythe de la nanomachine
4.2.1.1. Nanomachines et grands discours
Comment ces grands discours font-ils intervenir le thème « nanomachine » et, inversement, comment ces dernières se prêtent-elles à cette mobilisation par le discours spéculatif orienté-futur ? En premier lieu, les machines moléculaires semblent incarner l’idéal de domination de la nature véhiculé par les grands discours des nanotechnologies. Grâce à elles, nous
87 La liste des laboratoires visités figure dans les annexes. 88 DEWEY (J.), op. cit., 1939. 89 LOEVE (S.). – Ceci n’est pas une brouette. Grands et petits récits des nanotechnologies. In S. Houdart et O. Thierry (éds.), Humains non humains. Comment repeupler les sciences sociales, Paris, La découverte, pp. 208-220 (2011).
Version générée par les auteurs d’un article paru en deux volets dans Techniques de l’Ingénieur : (1) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : cartographie critique des approches existantes », TI n° RE244, 2015. (2) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : pour une approche centrée sur les objets », TI n° RE245, 2015. Le présent manuscrit présente les deux volets réunifiés, révisés et remis en page à partir de leurs versions avant publication respectives.
37
deviendrons (enfin) « maîtres et possesseurs de la nature » 90 en changeant radicalement les modes de conception technologiques. Il s’agit en effet de rien de moins que de faire table rase de l’approche qui a prévalu pendant d’innombrables millénaires: celle qui consistait, du silex au silicium, à « découper » la matière pour y « tailler » nos outils, nos matériaux et nos pièces de machines, et que les discours des nanos regroupent sous les termes de « fabrication descendante » (top-down), soustractive, ou encore « technologie en vrac » ou « en gros » (bulk technology). Les nanotechnologies proposent au contraire aux ingénieurs une technologie de fabrication ascendante (bottum-up), additive, moléculaire : il s’agit de recommencer à zéro pour nous libérer des limites physiques que les matériaux opposent encore à nos projets ; de partir des « briques élémentaires » de construction de la matière (atomes et molécules), et de les recombiner à volonté pour élaborer des structures fonctionnelles aux propriétés et comportements spécifiés dès l’échelle moléculaire. Les machines moléculaires ne sont évidemment pas les seuls objets concernés par l’approche bottum-up mais elles incarnent de manière emblématique l’idéal de maîtrise de la matière que véhicule cette approche : au lieu de construire des machines avec des matériaux déjà constitués, il s’agit de constituer directement la matière en machines, de « machiner » la matière pour la mettre à notre service dès l’échelle moléculaire. Deuxièmement, les grands discours des NST se caractérisent par l’exténuation de la différence entre nature et artifice. Cette distinction, affirme-t-on, appartiendrait à l’histoire ancienne. Son brouillage s’opère dans deux sens : artificialisation de la nature (l’ADN est un programme, la polymérase un photocopieur, le ribosome un assembleur, les mitochondries des centrales de production d’énergie biologique, etc.) ; naturalisation de la technique (les nanotechnologies sont « naturelles », leur fonctionnement et leur évolution est inscrite dans la nature). Tout est artifice, et tout est nature. Cela revient au même car c’est la possibilité de faire une distinction qui ne fait plus sens. Là encore, les machines moléculaires illustrent parfaitement ce discours : parce qu’elles désignent aussi bien les biomolécules naturelles qui font fonctionner notre métabolisme (les protéines) que des objets artificiels synthétisés en laboratoire, elles semblent annihiler toute possibilité de distinguer entre nature et artifice. Enfin les machines moléculaires évoquent l’imaginaire futuriste du « nano-robot ». C’est ainsi qu’elles émergent dans le best-seller qui popularisa la grande vision des nanotechnologies avant qu’elle ne soit reprise dans les politiques officielles, Engins de création d’Eric Drexler, (1986, traduit en français en 2005)91. Mi science-fiction mi science sérieuse, le livre se présente comme un essai anticipation, mais avec une volonté de se fonder sur une base scientifique et de convaincre une audience aussi large que possible (du côté des scientifiques comme du public et des politiques). S’y trouve prophétisée et – bien que l’auteur s’en défende – promue l’avènement d’une technologie de rupture appelée « manufacture moléculaire » : la production de n’importe quel produit (des hamburgers aux ordinateurs) par des nanomachines capables de manipuler la matière atome par atome, les « assembleurs moléculaires universels ». À la fois machines et molécules, ces assembleurs sont décrits comme des nanorobots. Drexler les imaginait – et plus tard, les modélisait92 – sur un double
90 Selon la célèbre formule de DESCARTES (R.). – Discours de la méthode, 1637, partie VI. « Au lieu de cette philosophie spéculative, qu’on enseigne dans les écoles, on peut en trouver une pratique, par laquelle connaissant la force et les actions du feu, de l’eau, de l’air, des astres, des cieux et de tous les autres corps qui nous environnent, aussi distinctement que nous connaissons les divers métiers de nos artisans, nous les pourrions employer en même façon à tous les usages auxquels ils sont propres et ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. » Descartes dit « comme maître et possesseur de la nature », car pour lui le seul « maître de la nature », c’est Dieu. 91 DREXLER (E.K.). – Engins de création. L’avènement des nanotechnologies, [1986]. Vuibert, Paris (2005). 92 À l’aide d’outils informatiques de mécanique moléculaire et de chimie computationelle, dans son ouvrage de 1992 destiné à un public plus exclusivement scientifique : DREXLER (E.K.). – Nanosystems : Molecular Machinery, Manufacturing, and Computation. Wiley Interscience (1992).
Version générée par les auteurs d’un article paru en deux volets dans Techniques de l’Ingénieur : (1) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : cartographie critique des approches existantes », TI n° RE244, 2015. (2) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : pour une approche centrée sur les objets », TI n° RE245, 2015. Le présent manuscrit présente les deux volets réunifiés, révisés et remis en page à partir de leurs versions avant publication respectives.
38
modèle, biologique et technologique. Côté biologique, les assembleurs seraient inspirés des ribosomes de la cellule vivante (qui assemblent les protéines à partir des « instructions » de l’ARN messager transcrit du code génétique) ; côté technologique, ils seraient conçus sur le modèle des chaînes d’assemblage automatisées de nos usines modernes. Ces nano-robots programmables seraient basés sur des structures carbonées, comme le vivant, mais cristallines plutôt qu’organiques, et donc plus rigides (une caractéristique qui inspira le titre du beau roman de Neal Stephenson, L’âge de diamant93). Avec les assembleurs moléculaires, affirme Drexler, nous deviendrions capables de « remodeler notre monde ou de le détruire »94. En effet, pour que la manufacture moléculaire soit efficace et compétitive, les assembleurs universels devront être capables de s’autorépliquer à la demande ; mais ils pourraient aussi s’autorépliquer sauvagement, échapper à notre contrôle et absorber tous les atomes de carbone disponibles, mettant ainsi fin à toute forme de vie biologique sur Terre. C’est le fameux scénario du « grey goo » (gelée grise). Un nouvel âge d’or – une société d’abondance radicale95 – était donc annoncé, en même temps qu’un danger apocalyptique, une catastrophe sans précédent. Mi-science, mi-fiction, Engins de création se présentait surtout comme un programme de politique de recherche. Drexler y affirme en effet que le problème n’est pas de savoir si les nanotechnologies moléculaires allaient advenir, mais de savoir quand elles allaient advenir. Il fallait donc s’y préparer sur un plan scientifique et technique comme sur un plan éthique et social afin de maîtriser leur développement et s’assurer qu’il soit utilisé à bon escient. Les machines moléculaires condensent et symbolisent donc toute les grandes thématiques de l’imaginaire populaire qui sera associé aux NST : l’effacement de la frontière entre le naturel et l’artificiel, la maîtrise absolue de la nature, la victoire sur la résistance de la matière, le déterminisme linéaire de l’évolution technique, le thème du robot se révoltant contre ses créateurs, et enfin l’évocation simultanée d’un âge d’or et d’une apocalypse. 4.2.1.1. Nanomachines et politique de recherche
Nées dans la science-fiction avant de se matérialiser dans les laboratoires, les machines moléculaires et leur imaginaire associé ont joué un rôle important dans la planification des politiques de recherche des NST, et ce même après la marginalisation de Drexler. Ses visions étaient non seulement jugées trop peu crédibles ou trop effrayantes, elles étaient surtout incompatibles avec la nécessité d’attirer des industriels, et en particulier les poids lourds de la microélectronique. En effet pour Drexler, la microélectronique fait encore partie de l’« ancienne » technologie, top-down, avec laquelle son programme de manufacture moléculaire devait rompre. Après avoir attiré l’attention des politiques, en en particulier d’Al Gore, Drexler fut donc soigneusement décrédibilisé par la communauté scientifique et mis à l’écart du processus de construction de la politique de recherche états-unienne en nanotechnologies. Les NST sont ainsi nées aux États-Unis de la migration des machines moléculaires de la science-fiction aux politiques de recherche officielles pendant les années 1990, et de leur association avec une myriade d’autres objets qui allaient être qualifiés de « nano » : les particules fines devenaient les « nanoparticules », les matériaux les « nanomatériaux », la physique mésoscopique la « nanophysique », etc. Tout en se voulant plus crédibles et pragmatiques, ces politiques de recherche avaient besoin d’un discours visionnaire, mobilisateur : c’est le rôle que joue la machine moléculaire. Là où Drexler, cependant, voulait
93 STEPHENSON (N.). – L’âge de diamant [1995]. Rivages/Futur, Paris (1996). 94 DREXLER (E.K.). – op. cit., 2005, p. 18. 95 DREXLER (E.K.). – Radical abundance: How a revolution in nanotechnology will change civilization. Public Affairs (2013).
Version générée par les auteurs d’un article paru en deux volets dans Techniques de l’Ingénieur : (1) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : cartographie critique des approches existantes », TI n° RE244, 2015. (2) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : pour une approche centrée sur les objets », TI n° RE245, 2015. Le présent manuscrit présente les deux volets réunifiés, révisés et remis en page à partir de leurs versions avant publication respectives.
39
commencer la « révolution nano-industrielle » par la rupture technologique des machines moléculaires, dans les programmes de recherche officiels les machines moléculaires servent plutôt de télos pour un développement incrémental des nanotechnologies : les machines moléculaires montrent la voie. Elles suggèrent ce vers quoi les nanotechnologies doivent s’efforcer de tendre. En témoigne la feuille de route de Mihail C. Roco, architecte en chef du plus grand – et du premier – programme de financement au monde des NST, la US-NNI (National Nanotechnology Initiative). La roadmap de Roco (figure 4) voit survenir quatre générations successives de nanoproduits, ordonnées selon un mouvement téléologique qui va des structures passives et peu individualisées vers des structures actives de plus en plus autonomes avec intégration croissante des fonctions – de plus en plus « machine » donc.
Figure 4. Roadmap de Mihail Roco : les quatre générations de nanoproduits96
- La première génération, les « nanostructures passives », rassemble les nanoproduits déjà présents sur le marché, essentiellement les polymères, les composites, les nanoparticules et les matriaux nanostructurés. Notons toutefois que la plupart de ces objets n’ont pas attendu l’essor des NST dans les politiques de recherche pour donner des usages industriels. Il s’agit donc d’une réinscription du passé dans un présent lui-même défini par son inscription dans un futur… que les générations suivantes doivent permettre de présentifier.
- La seconde génération de nanoproduits est celle des « nanostructures actives ». Une nanostructure est dite « active » quand elle « change d’état pendant son opération »97 .
96 ROCO (M.C.) et RENN (O.). – Nanotechnology and the need for risk governance. Journal of Nanoparticle Research, vol. 8, n° 2 http://www.nsf.gov/crssprgm/nano/reports/jnr_nanorisk_preprint.pdf page consultée le 12 septembre 2013) (2006), p. 4. 97 ROCO (M.C.) et RENN (O.). – op. cit., 2006, p. 4.
Version générée par les auteurs d’un article paru en deux volets dans Techniques de l’Ingénieur : (1) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : cartographie critique des approches existantes », TI n° RE244, 2015. (2) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : pour une approche centrée sur les objets », TI n° RE245, 2015. Le présent manuscrit présente les deux volets réunifiés, révisés et remis en page à partir de leurs versions avant publication respectives.
40
L’activité peut être physico-chimique ou biologique ; les objets mentionnés dans cette seconde vague sont encore à peu près identifiables à des objets existants en recherche et/ou développement : vecteurs de médicaments avec sondes de reconnaissance moléculaire pour médecine ciblée ; nano-transistors CMOS (métal-oxyde complémentaires, autrement dit les transistors actuels de la microélectronique, mais « nano ») et post-CMOS (nouveaux designs de transistors, comme ceux basés sur l’électronique moléculaire) ; nanocomposants électro-mécaniques (amplificateurs, senseurs, actuateurs, …).
- Dans la troisième génération, « systèmes de nanosystèmes », les nanostructures actives sont censés faire système, coordonner leurs processus d’assemblage et de fonctionnement pour s’organiser hiérarchiquement : chaque nano-objet devenant machine ou partie d’une machine. Les nanostructures prennent du relief, elles deviennent 3D. La « robotique » (nanométrique ou macroscopique utilisant des composants nanométrique ? Cela n’est pas précisé) y côtoie les « biosystèmes évolutifs ». Se contentant d’accumuler des mots clés aussi évocateurs que crypto-techniques (« assemblages guidés », « réseaux 3D »), la feuille de route laisse ses destinataires s’imaginer toutes sortes d’hybridations entre des nanochoses qui font des choses en système…
- Enfin, la quatrième génération signe l’aboutissement de cette évolution téléologique : avec les « nanosystèmes moléculaires », tout est entièrement fonctionnalisé, « by design » (à façon), « chaque molécule a une structure spécifique et joue un rôle différent » ; ces nanosystèmes moléculaires « s’auto-assemblent à façon à des échelles multiples », comme le vivant. Les objets concernés sont volontairement laissés dans le flou (« fonctions émergentes »). En revanche, les « nanoscale machines » (machines à l’échelle nanométrique) sont mentionnées dans l’article précité au titre de cette quatrième génération.
Ainsi, plus on avance dans la temporalité que projette la roadmap, plus les objets sont spéculatifs, difficiles à définir et à identifier. Ce faisant, la dernière génération, tout en étant la plus spéculative, connote clairement une machinerie moléculaire. Son nom, « nanosystèmes moléculaire », reprend d’ailleurs les expressions que privilégiées par Drexler98. La roadmap de Roco, instrument-clé des politiques de recherche et de la « grande vision » de la US-NNI, identifie donc, bien qu’obscurément, et dans un flou artistique délibéré, le nano-objet du futur à une « machine moléculaire ».
Même si, sept ans après (l’article cité date de 2006), la feuille de route est déjà obsolète (aucun dispositif pouvant prétendre s’approcher des « systèmes de nanosystèmes » n’ayant été commercialisé à ce jour), cela montre à quel point les nanomachines font figure d’attracteur dans la construction de l’imaginaire qui sous-tend la politique de recherche des NST. Dans ces grands discours visant à structurer l’horizon d’attente de la nanoR&D, la machine moléculaire joue le rôle de nano-objet par excellence, d’idéal-type. Au lieu d’expliquer ce que sont et ce que font les nanotechnologies, il suffit de montrer une image de machine moléculaire : engrenages, moteurs, véhicules, robots moléculaires – voilà qui suffit à signifier de manière condensée ce dont sont capables les nanotechnologies99. La machine moléculaire est ici une métaphore, un signe, un attracteur, un mythe mobilisateur.
98 Pour qui les « vraies » nanotechnologies devaient être « moléculaires » (bottum-up). Quant à « nanosystèmes », c’est le titre de l’ouvrage plus technique de Drexler (Nanosystems : Molecular Machinery, Manufacturing, and Computation. op. cit., 1992). 99 Ainsi les modèles visuels animés d’essieux et de roulements moléculaires produits par Drexler sont-ils demeurées des images-phares de la communication des nanotechnologies bien après la marginalisation de ce dernier.
Version générée par les auteurs d’un article paru en deux volets dans Techniques de l’Ingénieur : (1) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : cartographie critique des approches existantes », TI n° RE244, 2015. (2) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : pour une approche centrée sur les objets », TI n° RE245, 2015. Le présent manuscrit présente les deux volets réunifiés, révisés et remis en page à partir de leurs versions avant publication respectives.
41
4.2.2. Les machines moléculaires en pratique
Au laboratoire, les machines moléculaires ne se laissent pas définir par ces grands discours. Les considérations d’applicabilité et d’utilité interviennent peu dans les pratiques de design mises en œuvre par les chercheurs. La plupart des chimistes synthétiseurs de molécules-machines rencontrés sur le terrain avouent même se reconnaître assez peu dans le label « nano », qu’ils trouvent racoleur. Ils l’utilisent majoritairement pour les demandes de financement, peu pour parler de leurs pratiques. En revanche, ils tiennent à la notion de « machine » et de « machine moléculaire » : elle fait sens pour eux indépendamment des grands discours futuristes des nanos.
Qu’est-ce qu’une machine moléculaire ? C’est une molécule à laquelle sont associées une ou plusieurs fonction(s) (cinétique ou électronique par exemple) déclenchée(s) par un signal (électronique, photonique, chimique, etc.). Le concept de « fonction » est actuellement un important sujet de discussion en philosophie des sciences (et de la biologie surtout) et en philosophie des techniques100. Chez les chercheurs travaillant dans le domaine des machines moléculaires artificielles, la notion de fonction est certes éminemment plastique ; c’est un « objet-frontière »101, une notion que les scientifiques de différentes disciplines utilisent sans la définir précisément. Mais cela n’empêche pas l’épistémologue d’en lister les usages et d’en évaluer la cohérence.
Le concept de fonction a premièrement un sens chimique, celui de potentialité de liaison sélective : « fonction hydroxyle », « fonction amine », etc. Toute molécule peut se lier sélectivement à certaines molécules et pas à d’autres. « Fonctionnaliser » un objet moléculaire, c’est le prédisposer à se lier sélectivement à d’autres fragments. Par extension, fonction a pris un sens technologique, mais qui s’inscrit dans la continuité de son sens chimique : une « fonction » mécanique est d’abord une mode de liaison, un nouveau type de liaison en chimie, ni liaison covalente, ni liaison faible, ni liaison hydrogène ou liaison ionique, mais liaison mécanique ; celle, par exemple, qui existe entre deux anneaux moléculaires entrelacés (on parle d’un caténane : de catena, chaîne). Plus généralement, on pourra définir la fonction comme dynamique ou opération d’une structure : une liaison mécanique autorise de nouveaux degrés de liberté, de nouvelles opérations potentiellement contrôlables (rotations, translations). Dès lors, d’autres opérations, et donc d’autres fonctions sont possibles : fonctions mécaniques, mais aussi électroniques (transférer un électron), optiques (émettre un photon), magnétiques (inversion du spin), etc. Ces fonctions ne son pas des « finalités » mais des schémas de fonctionnement.
Le concept de « fonction » d’une machine moléculaire se décline donc sur un spectre d’usages plus ou moins spécifiques aux structures considérées. Indice de leur relative cohérence, aucun de ces usages ne réduit la notion de fonction à un sens purement intentionnel ou utilitaire. La fonction d’une machine moléculaire ne se confond pas avec la notion commune de finalité (ce à quoi sert la machine) ni avec celle d’utilité (l’accord intersubjectif sur le caractère bénéfique d’une finalité donnée pour une communauté donnée). Comme nous allons le montrer, la fonction d’une machine moléculaire ne se définit pas par une relation fin/moyen mais par une relation objet individuel/milieu associé.
100 Voir par exemple GAYON (J.) et DE RICQLÈS (A.) (dir.). – Les fonctions : des organismes aux artéfacts. Presses Universitaires de France, Paris (2010). HOUKES (W.) et VERMAAS (P) – Technical functions: On the use and design of artefacts. Springer, Dordrecht (2010). 101 STAR (S.L.) et GRIESEMER (J.R.). – Institutional ecology, ‘translations’ and boundary objects: Amateurs and professionals in Berkeley’s Museum of Vertebrate Zoology, 1907-39. Social Studies of Science, vol. 19, n 3, p. 387-420 (1989).
Version générée par les auteurs d’un article paru en deux volets dans Techniques de l’Ingénieur : (1) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : cartographie critique des approches existantes », TI n° RE244, 2015. (2) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : pour une approche centrée sur les objets », TI n° RE245, 2015. Le présent manuscrit présente les deux volets réunifiés, révisés et remis en page à partir de leurs versions avant publication respectives.
42
Figure 5. Schéma de fonctionnement d’une « pirouette moléculaire » ou « [2]catenane-bascule » (swinging [2]-catenate). Source : Laboratoire de chimie organo-minérale (LCOM), Université de Strasbourg, 1994.
Encadré 2 – fonctionnement d’une pirouette molécula ire
La « pirouette moléculaire » ou « [2]caténane-bascule » réalisée par l’équipe de Jean-Pierre Sauvage au laboratoire de chimie organo-minérale (LCOM) à Strasbourg, est une des premières machines moléculaires à avoir été synthétisée102. Un caténane est une molécule constituée de plusieurs anneaux entrelacés unis par une liaison non chimique, mais mécanique. La molécule-machine change de conformation par simple oxydation/réduction de la solution chimique. Son fonctionnement est basé sur la chimie de coordination, c’est-à-dire sur la modification des affinités entre un ion métallique et des molécules organiques organisées autour de l’ion par « liaison de coordination » (symbolisée par les lignes en pointillés). Ici, les anneaux sont organisés (« coordinés ») autour d’un ion cuivre. Selon que cet ion soit oxydé (perte d’un électron, en rouge) ou réduit (gain d’un électron, en bleu), il n’a pas la même affinité avec l’un ou l’autre des fragments de l’anneau (symbolisés par les couleurs bleu et rouge). Cu(I) est dit « tétra-coordiné » : il se lie de préférence à 4 atomes d’azote (N) (liaison de tétra-coordination symbolisée par les pointillés bleus) ; une fois la solution oxydée, l’ion cède un électron et devient Cu(II), penta-coordiné (5 points de coordinations). Or les deux fragments colorés en bleu n’offrent à Cu(I) que 4 points de coordination. L’assemblage devient donc énergétiquement instable (l’ion « a trop d’énergie »). Au bout de quelques minutes en moyenne après l’oxydation, une partie de la molécule bascule de 180°, jusqu’à entourer l’ion de 5 points de coordinations et permettre un rééquilibrage des charges électriques par formation d’un complexe penta-coordiné
102 ANELLI (P.L.), SPENCER (N.) et STODDART (J.F.). – A molecular shuttle. Journal of the American Chemical Society, vol. 113, pp. 5131-5133 (1991). SAUVAGE (J.-P.), LIVOREIL (A.) et DIETRICH-BUCHECKER (C.-O.). – Electrochemically triggered swinging of a [2]-catenate. Journal of the American Chemical Society, vol. 116, pp. 9399-9400 (1994).
Version générée par les auteurs d’un article paru en deux volets dans Techniques de l’Ingénieur : (1) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : cartographie critique des approches existantes », TI n° RE244, 2015. (2) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : pour une approche centrée sur les objets », TI n° RE245, 2015. Le présent manuscrit présente les deux volets réunifiés, révisés et remis en page à partir de leurs versions avant publication respectives.
43
stable : l’ion Cu (II) entouré de 5 atomes de N (liaison de penta-coordination symbolisée par les pointillés rouge). Inversement, en réduisant la solution, Cu(II) redevient Cu(I). Il tend alors à retrouver (en quelques secondes) l’état initial le plus stable, celui où il est entouré de 4 atomes N (liaison de tétra-coordination symbolisée par les pointillés bleus). Le fonctionnement est réversible, mais la direction du mouvement n’est pas connue ni contrôlée. Les chimistes n’ont pas de moyen direct de savoir ce qui se passe entre les deux stations. La molécule-machine se définit comme un « bistable rédox » : elle passe d’un état stable à un autre, mais sans directionalité privilégiée. Elle ne peut donc produire aucun travail : elle est une « machine », mais en aucun cas un « moteur », affirment les chimistes.
Qu’est-ce qui définit la molécule de la figure 5 comme une « machine » ? C’est qu’elle est fonctionnalisée pour accomplir individuellement (et non seulement statistiquement, comme dans une réaction chimique classique) un mouvement cohérent et de grande amplitude lors d’une modification de certains paramètres de son environnement. Ces paramètres, non schématisés sur la figure 5, sont pourtant décisifs pour la compréhension du processus, car ce sont eux qui constituent le « milieu associé de fonctionnement » définissant la molécule comme un individu technique, c’est-à-dire une machine (pour reprendre ici la conceptualité de Simondon103). L’individu technique « machine moléculaire » est toujours individu en relation à son milieu associé, et non individu en soi. Ce milieu associé est à comprendre comme étant à la fois cause et effet du fonctionnement de la machine moléculaire ; individu et milieu sont n relation de causalité réciproque. Le milieu est cause dans la mesure où c’est le mouvement brownien (l’agitation thermique) qui « conduit » aléatoirement la molécule à explorer toutes les configurations possibles jusqu’à se stabiliser sur la plus favorable énergétiquement. Le milieu est effet car le rééquilibrage énergétique des potentiels de la solution résulte ou est en tout cas est médiatisé par les changements de conformation des molécules. Non seulement molécule-machine et milieu (la solution, sa température, son état énergétique global) sont en relation de causalité réciproque, mais ils ne sont pas définissables l’un sans l’autre. Même si, au départ, il y a des molécules, et il y a un environnement physico-chimique, le milieu associé est plus et autre que l’environnement : il désigne les paramètres de ce qui dans cet environnement va devenir condition de fonctionnement l’individu technique ; de même la machine moléculaire est plus et autre que la molécule : elle est la molécule individualisée par une fonction, c’est-à-dire par un schème de fonctionnement. Le schème de fonctionnement est à la fois relation objet/milieu (relation horizontale) et relation entre ordres de grandeurs (relation verticale) : entre l’échelle microphysique et quantique des électrons et échelle macroscopique et molaire des conditions globales qui caractérisent la solution (température, pression, temps de réaction, potentiels énergétiques, etc.). Il faudrait même définir le schème de fonctionnement comme relation entre ces deux relations. Pour résumer, milieu associé et individu technique (machine) se constituent l’un par l’autre ; la « fonction » est leur trait d’union, leur corrélation dans et par un schème de fonctionnement.
C’est donc cette démarche d’individualisation fonctionnelle de la molécule qui la définit comme une machine (un individu technique défini par sa relation à son milieu associé). Pour pousser plus avant cette approche d’individualisation fonctionnelle, les chercheurs s’emploient aussi à adresser les molécules individuellement à l’aide du microscope à effet tunnel (STM). Au lieu d’oxyder une solution liquide contenant des populations de millions de molécules-pirouettes, ils déposent ces molécules sur une surface sous vide, excitent l’une d’entre elles seulement avec la pointe du STM, et mesurent sa réponse. La molécule-machine n’est plus « en liberté » dans une solution liquide mais à l’interface solide/vide, où elle prend place à la jonction surface/pointe du STM. Le STM déclenche le fonctionnement par
103 SIMONDON (G.). op. cit., 1958.
Version générée par les auteurs d’un article paru en deux volets dans Techniques de l’Ingénieur : (1) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : cartographie critique des approches existantes », TI n° RE244, 2015. (2) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : pour une approche centrée sur les objets », TI n° RE245, 2015. Le présent manuscrit présente les deux volets réunifiés, révisés et remis en page à partir de leurs versions avant publication respectives.
44
impulsion électronique, en injectant (ou en arrachant) à la molécule un quantum d’énergie défini. Il s’agit littéralement de se connecter à la molécule et de mesurer directement l’opération de cette molécule individuelle plutôt que d’une moyenne statistique de ces molécules (comme c’est le cas pour l’électrochimie en solution). S’engager sur cette voie consiste, comme le dit le chimiste Jean-Pierre Sauvage, à introduire la molécule dans un « dispositif » qui va permettre non seulement d’adresser la molécule, mais de « s’adresser » à elle, de lui « parler ». Mais les chercheurs se sont vite rendus compte que la molécule-machine fonctionnant sur surface ne pouvait pas être la même que la molécule-machine fonctionnant en solution chimique. En effet, le nouvel environnement (l’interface cristal/ultravide à très basse température) modifie son comportement. Il doit donc être pris en compte comme un nouveau milieu associé de la nanomachine. Sans milieu associé, pas de machine moléculaire. Comme le disent les chercheurs du laboratoire de photochimie moléculaire (LPPM) à Orsay, « la surface fait partie de la nanomachine ». Ceux-ci travaillent donc, au moins dans un premier temps, avec des molécules plus simples pour leur faire faire de la mécanique et de l’électronique moléculaire. C’est le cas du biphényle de la figure 6.
Figure 6. Biphényle bistable adressé et manipulé au microscope à effet tunnel sur surface de silicium. Source : LPPM, Université Paris-sud Orsay, 2007.
Une fois déposée sur la surface, la molécule est en décohérence : elle perd le caractère partiellement indéterminé de la localisation de ses atomes (« elle perd sa quanticité » résume le physicien Christian Joachim). On peut alors déterminer cette localisation et assigner aux atomes des cordonnées spatiales. Ce nouveau dispositif (la surface, mais aussi les très basses températures qui « gèlent » le mouvement brownien, et l’ultravide qui protège l’échantillon des impuretés) participe donc à l’individualisation de la molécule. Il constitue un nouveau milieu associé de fonctionnement. Lorsque les chercheurs approchent du biphényle la pointe du STM et lui injectent des électrons, le biphényle « switche » comme un interrupteur : la molécule est excitée ; elle a trop d’énergie ; elle casse une de ses liaisons chimiques avec la surface de silicium, pivote sur la liaison restante et refait une liaison au niveau de son autre
Version générée par les auteurs d’un article paru en deux volets dans Techniques de l’Ingénieur : (1) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : cartographie critique des approches existantes », TI n° RE244, 2015. (2) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : pour une approche centrée sur les objets », TI n° RE245, 2015. Le présent manuscrit présente les deux volets réunifiés, révisés et remis en page à partir de leurs versions avant publication respectives.
45
lobe aromatique104. Ce nouveau milieu associé permet donc aux chercheurs de faire de l’électronique ou de la mécanique avec les molécules, et de la mécanique classique… ou presque, puisqu’en effet les chercheurs se sont aperçus que la molécule passait par un état transitoire, métastable, où elle n’est ni dans l’état A ni dans l’état B. Par ailleurs, entre le moment de l’excitation et la réponse de la molécule, il y a un laps de temps qui n’est pas prévisible de manière déterministe. Le chimiste Gwénaël Rapenne résume ainsi la situation : « imaginons que vous avez un moteur : vous l’allumez, mais vous ne pouvez pas savoir exactement quand il va démarrer ni dans quel sens il va tourner ». Autrement dit, même si la molécule est individualisée comme un objet classique, elle se comporte encore partiellement comme un objet quantique présentant des superpositions d’états et des événements probabilistes.
L’échelle nanométrique est donc une échelle intermédiaire, une zone de transition entre comportements purement quantiques et comportements purement classiques. Elle n’est pas seulement un « espace » qui serait compris a priori entre telle et telle borne, par exemple entre 0.1 et 100 nanomètres, comme le disent les définitions officielles, qui sont de pure convention. L’échelle « nano » doit plutôt être comprise comme l’échelle pertinente à laquelle des processus quantiques et classiques peuvent être couplés dans une relation de l’objet individuel et de son milieu de fonctionnement. Comme beaucoup d’objets des NST (nanoparticules, cavités quantiques, fils moléculaires…), la molécule bistable que nous avons décrite corrèle des ordres de grandeurs différents et fait communiquer des structures et des opérations qui ne communiquent pas naturellement.
On assiste donc à l’émergence de nouvelles relations entre les projets humains et les processus matériels, mais aussi à l’instauration de nouvelles relations au sein même des processus et des structures matérielles, entre différentes échelles mises en communication par un schème de fonctionnement déterminé. Ici, la nanomachine (qui mesure quelques angströms) est connectée par son milieu associé à deux objets macroscopiques, la pointe (une petite aiguille que l’on peut tenir avec une pince) et la surface (un morceau de cristal que l’on peut saisir entre ses doigts). Ce qui permet à l’objet de s’individualiser comme une machine, c’est-à-dire d’avoir un fonctionnement dans un milieu associé, c’est précisément cette mise en communication des ordres de grandeur : ici l’échelle subatomique, quantique, plus petite que la molécule, et l’échelle macroscopique, plus grande que la molécule. La nanomachine n’est donc pas la molécule isolée, mais le système surface/molécule/STM. Une molécule individuelle est donc ce que nous appelons un « objet relationnel » : non pas seulement un objet en relation à ce qui n’est pas lui, mais un objet défini et constitué par ses relations à autre que lui.
4.2.3. Leçons d’éthique des machines
« Soit, dira-t-on, mais quelles sont les ap-pli-ca-tions ? » Est-ce là tout ce que sont ces fameuses machines moléculaires ? Mais à quoi s’attendait-on ? L’étude épistémologique des machines moléculaires nous fait justement comprendre que l’éthique des nanotechnologies ne se réduit pas à une évaluation des applications. Elle questionne aussi la valeur des attitudes culturelles que nous adoptons vis-à-vis des objets techniques.
104 RIEDEL (D.), MAYNE (A.), DUJARDIN (G.), BELLEC (A.), CHIARAVALOTTI (F.), CRANNEY (M.) et LAPASTIS (M.). – Probing the movements of a single molecule, Plein Sud, spécial recherche 2008-2009, p. 74-79. http://www.pleinsud.u-psud.fr/specialR2008/en/08_Probing_the_movements_of_a_single_molecule.pdf (page consultée le 28 août 2013) (2008).
Version générée par les auteurs d’un article paru en deux volets dans Techniques de l’Ingénieur : (1) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : cartographie critique des approches existantes », TI n° RE244, 2015. (2) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : pour une approche centrée sur les objets », TI n° RE245, 2015. Le présent manuscrit présente les deux volets réunifiés, révisés et remis en page à partir de leurs versions avant publication respectives.
46
4.2.3.1. Ni dieux ni esclaves
Les machines moléculaires sont de véritables objets techniques (définis par des schèmes de fonctionnement) mais elles ne sont pas créées en vue d’une application précise (et il en va de même pour de nombreux objets des NST). Il est donc difficile de les évaluer en fonction d’une finalité extra-technique. Cependant, que nous soyons si étonnés devant le fait que des chercheurs puissent consacrer autant de temps et d’efforts à faire exister des objets techniques dénués d’utilité pratique n’est-il pas révélateur de notre incapacité à accorder un statut et une valeur propre aux objets techniques ? Les humains sont généralement pris d’effroi lorsque l’on détruit des œuvres d’art ou que l’on brûle des livres : pourquoi n’en irait-il pas de même des objets techniques ? Un objet technique n’est pas seulement défini par son utilité du moment, il s’inscrit dans un devenir, il est un support de transmission de la mémoire sociale, il conserve les différents actes d’invention qui l’ont rendu possible. Bref, il charrie un contenu de réalité humaine qui doit être appréhendé, compris et respecté par ce que Simondon appelle une « culture technique ». Pour rendre possible une telle « culture technique », il faudrait parvenir à traiter les objets techniques autrement que comme des esclaves ou comme des dieux.
Or, quand elle s’intéresse aux techniques, l’éthique philosophique traditionnelle se contente le plus souvent d’appliquer des théories morales déjà constituées aux réalités techniques. Ces dernières sont alors réduites à un simple ensemble neutre de moyens dont il s’agit d’évaluer les usages en fonction des fins que telle ou telle théorie morale permet de considérer comme légitimes. En mettant l’accent sur ce que l’on peut obtenir (ou perdre) avec la technique, on fait ainsi l’impasse sur la question de sa valeur intrinsèque. On retrouve alors le présupposé « neutralité des objets versus moralité des usages » critiqué plus haut.
Inversement, d’autres conceptions présupposent une « essence » de la technique105 (une valeur intrinsèque, donc) dont chaque artéfact serait une incarnation. Cette position est partagée par deux extrêmes. D’une part, il y a ceux qui voient dans la technique une menace « par essence » pour l’Homme, la Nature ou la Vie. On retrouve alors ce que nous avons appelé « l’éthique-vérité de la Valeur sacralisée » (section 3.1.2.). D’autre part, il y a ceux qui, comme les transhumanistes, célèbrent les promesses de dépassement des limites naturelles dont l’évolution technique serait porteuse, là encore « par essence ». Comme le dit Simondon, on reste alors dans le cadre d’une « philosophie de la puissance humaine à travers les techniques, non d’une philosophie des techniques » 106.
Ni dieux ni esclaves ! Ainsi Simondon déplorait-il le fait que notre culture comporte « deux attitudes contradictoires envers les objets techniques : d’une part, elle les traite comme de purs assemblages de matière, dépourvus de vraie signification, comportant seulement une utilité. D’autre part, elle suppose que ces objets sont aussi des robots et qu’ils sont animés d’intentions hostiles envers l’homme, ou représentant pour lui un permanent danger d’agression, d’insurrection. Jugeant bon de conserver le premier caractère, elle veut empêcher la manifestation du second et parle de mettre les machines au service de l’homme, croyant trouver dans la réduction en esclavage un moyen sûr d’empêcher toute rébellion » 107.
On retrouve ici presque à la lettre l’évocation mythique de la nanomachine telle que Drexler la met en scène avec ses nanorobots108 : à la fois esclaves absolus – puisque l’homme leur a
105 HEIDEGGER (M.). op. cit., 1958. 106 SIMONDON (G.). op. cit., 1958, p. 126. 107 SIMONDON (G.). op. cit., 1958, pp. 10-11. 108 DREXLER (E). op. cit., 1986.
Version générée par les auteurs d’un article paru en deux volets dans Techniques de l’Ingénieur : (1) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : cartographie critique des approches existantes », TI n° RE244, 2015. (2) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : pour une approche centrée sur les objets », TI n° RE245, 2015. Le présent manuscrit présente les deux volets réunifiés, révisés et remis en page à partir de leurs versions avant publication respectives.
47
délégué toutes les tâches impliquant un rapport de travail à la matière109 – et périls absolus pour l’homme et pour la vie – à moins que l’homme, comme le recommande Drexler, se donne les moyens techniques et sociaux de parvenir à un contrôle sans faille de ses nouveaux nano-esclaves.
Or, l’attention portée au mode d’existence de ces machines moléculaires nous engage à cultiver de toutes autres attitudes éthiques dans notre relation aux réalités techniques. Certes, ces attitudes ne concernent pas exclusivement les machines moléculaires (ni même les seules nanotechnologies), mais ces nano-objets, par leur statut de réalités techniques non utilitaires, sont particulièrement propices à révéler ces nouvelles attitudes éthiques. Plutôt que de nous engager à une maîtrise absolue des processus matériels et à un dépassement des limites naturelles, ces objets nous engagent à prendre en considération les contraintes des milieux associés qui leurs confèrent individualité, stabilité et ouverture aux projets humains. Plutôt que de nous engager à régner en maîtres absolus sur une population d’esclaves, ils nous engagent à cultiver une attitude de soin et d’attachement aux objets techniques, à ce qui s’opère à travers eux, mais aussi entre eux.
« Loin d’être le surveillant d’une troupe d’esclaves, écrit Simondon, l’homme est l’organisateur permanent d’une société des objets techniques qui ont besoin de lui comme les musiciens ont besoin du chef d’orchestre. Le chef d’orchestre ne peut diriger les musiciens que parce qu’il joue comme eux, aussi intensément qu’eux, le morceau exécuté ; il les modère ou les presse, mais est aussi modéré et pressé par eux ; en fait, à travers lui, le groupe des musiciens modère et presse chacun d’eux, il est pour chacun la forme mouvante et actuelle du groupe en train d’exister ; il est l’interprète mutuel de tous par rapport à tous. Ainsi l’homme a pour fonction d’être le coordinateur et l’inventeur permanent des machines qui sont autour de lui. Il est parmi les machines qui opèrent avec lui »110. Nous touchons ici à un point de la pensée du philosophe-technologue qui s’avère
capital pour notre propos : il s’agit non seulement de ne plus considérer l’éthique comme extérieure aux techniques ; et non seulement de traiter notre relation aux réalités techniques comme un enjeu de valeur intrinsèque et non de simple utilité, (c’est-à-dire de valeur pour autre chose). Il s’agit également de considérer que les relations des réalités techniques entre elles méritent d’entrer dans le champ de la réflexion éthique.
4.2.3.2. Décentrer notre rapport aux objets techniques
Touchant notre rapport aux objets techniques, Simondon fait une comparaison audacieuse entre le « misonéisme » (le refus du nouveau) et la xénophobie. On criera au scandale : comment comparer le mauvais accueil que nous réservons aux nouvelles machines et la situation insupportable que nous faisons vivre aux étrangers dans nos sociétés ? L’idée que la machine est victime de xénophobie n’est pourtant pas une simple métaphore à l’emporte-pièce. Simondon parle réellement de la machine comme d’une étrangère mal-aimée. Il la compare fréquemment à l’étranger rejeté par la culture officielle et dominante.
« La culture se conduit envers l’objet technique comme l’homme envers l’étranger quand il se laisse emporter par la xénophobie primitive. Le misonéisme orienté contre les machines n’est pas tant la haine du nouveau que le refus de la réalité étrangère. Or, cet être étranger est encore humain, et la culture complète est ce qui permet de découvrir l’étranger comme humain. De
109 Et il faut rappeler ici que « robot » est à l’origine un terme des langues slaves qui signifie « travail servile ». Cf. ČAPEK (K.). – RUR : Les Robots Universels de Rossum, in J.-C. Heudin, Robot Erectus. Paris, Science eBook (2012). 110 SIMONDON (G.). op. cit., 1958, pp. 11-12.
Version générée par les auteurs d’un article paru en deux volets dans Techniques de l’Ingénieur : (1) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : cartographie critique des approches existantes », TI n° RE244, 2015. (2) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : pour une approche centrée sur les objets », TI n° RE245, 2015. Le présent manuscrit présente les deux volets réunifiés, révisés et remis en page à partir de leurs versions avant publication respectives.
48
même, la machine est l’étrangère ; c’est l’étrangère en laquelle est enfermé de l’humain, méconnu, matérialisé, asservi, mais restant pourtant de l’humain » 111.
Simondon ne veut en aucun cas dire qu’un être humain peut être mis sur le même plan qu’une machine ; en revanche, ce qui rend comparable la situation que nous faisons aux étrangers et celle que nous faisons à nos machines, c’est que dans l’un et l’autre cas, un contenu de réalité humaine est méconnu, méprisé, occulté. Simondon explique le « misonéisme » envers les machines par la « coupure artificielle entre la construction et l’utilisation ». Il déplore la manière dont nous faisons usage des objets techniques, dans l’ignorance et le mépris de leur fonctionnement mais aussi des actes humains d’invention puis de construction techniques : au fond, dans le rejet des machines, c’est encore l’humain qui est rejeté. Intégrer culturellement les machines, c’est être capable de les appréhender non plus comme une réalité étrangère à l’homme, mais comme des êtres qui contiennent de la réalité humaine. Dans cette tâche, la philosophie a un rôle à jouer, « analogue à celui qu’elle a joué pour l’abolition de l’esclavage et l’affirmation de la valeur de la personne humaine » 112. Comprendre que la machine est autre que l’homme mais n’est pas étrangère à la réalité humaine ; comprendre qu’elle n’est pas à proprement parler un alter ego mais qu’elle n’est pas non plus une réalité coupée du monde des significations : telle est la vocation de la culture en matière technologique. Or « l’étranger n’est plus étranger, mais autre, lorsqu’il existe des êtres étrangers non seulement par rapport au sujet qui juge, mais aussi par rapport à d’autres étrangers » 113. Autrement dit, l’étranger cesse d’être un étranger pour devenir un autre humain, quand je peux voir fonctionner objectivement la relation qu’il établit avec d’autres étrangers, qui sont non seulement des étrangers pour moi mais aussi des étrangers pour lui. Si je reste enfermé dans la relation spéculaire qui s’établit entre l’étranger et moi, si je le juge depuis mon propre point de vue, je ne peux pas vraiment échapper à la xénophobie. Je reconnais l’étranger comme alter ego quand j’accepte de décentrer mon regard et d’introduire un tiers qui vient briser la relation spéculaire entre lui et moi. La relation devient alors objective pour moi en devenant relation non pas entre lui et moi, mais entre lui et un tiers. De même, un sujet enfermé dans une relation binaire avec la machine ne peut pas la connaître selon son être véritable. Une culture qui intègre la machine doit commencer par objectiver la relation à la machine en la décentrant par rapport à l’humain. L’homme ne peut comprendre l’être de la machine qu’en objectivant la relation technique, c’est-à-dire en voyant fonctionner non pas la relation entre la machine et lui, mais la relation entre elle et les éléments de son milieu de fonctionnement ou d’autres machines. La culture ne peut comprendre la machine qu’en renonçant à envisager la relation homme-machine du seul point de vue de l’homme. Elle doit opérer un décentrement, un changement de perspective qui objective la relation technique. Elle doit par conséquent abandonner tout préjugé anthropocentrique dans sa description de la relation homme-machine. 4.2.3.3. Prendre soin des relations
Simondon précise qu’opérer ce décentrement suppose aussi de nouer avec les objets techniques des liens affectivo-émotifs. Selon lui, un rapport « net et non aliéné » aux objets techniques ne peut pas se situer uniquement au seul plan des représentations rationnelles ; il ne peut pas être purement cognitif. Il ne peut pas non plus se situer au niveau d’une communauté partageant des intérêts pratiques ou économiques communs ; il ne peut pas être
111 SIMONDON (G.). op. cit., 1958, p. 9. 112 SIMONDON (G.). op. cit., 1958, p. 9. 113 SIMONDON (G.). op. cit., 1958, p. 147.
Version générée par les auteurs d’un article paru en deux volets dans Techniques de l’Ingénieur : (1) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : cartographie critique des approches existantes », TI n° RE244, 2015. (2) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : pour une approche centrée sur les objets », TI n° RE245, 2015. Le présent manuscrit présente les deux volets réunifiés, révisés et remis en page à partir de leurs versions avant publication respectives.
49
purement utilitaire. C’est prioritairement au niveau de l’affectivo-émotivité, sous les représentations rationnelles de la science et sous les visées pratiques, que peut s’instaurer un tel rapport aux objets techniques. Ce lien affectivo-émotif peut prendre différentes formes : pour les objets d’usage fonctionnant à notre échelle d’appréhension du monde, ce rapport peut être une forme d’amitié. Cela ne signifie pas qu’il faille entretenir un rapport d’amitié d’égale intensité avec n’importe quel objet technique. Car encore faut-il que l’objet soit disposé à susciter l’amitié. Ce que Simondon appelle l’« objet fermé » – la boîte noire aguicheuse mais opaque, verrouillée et rapidement obsolète – est un objet qui suscite le mépris parce qu’il méprise l’utilisateur. Faire preuve de « culture technique », c’est aussi comprendre que nombres d’objets sont asservis par des normes communautaires qui les aliènent autant qu’il les rendent aliénants, et ne pas faire porter systématiquement la faute sur la « Technique universelle » ou « l’essence » de la technique. Pour les techniques fonctionnant à d’autres échelles que la nôtre, ce rapport affectivo-émotif prend la forme d’un sentiment de participation aux processus du monde. Le contraire d’une telle attitude n’est plus le mépris mais l’indifférence généralisée, la désaffection émotive. Pour Simondon, une technique est d’ailleurs susceptible de susciter une participation affectivo-émotive d’autant plus puissante qu’elle nous met en relation avec des phénomènes d’ordre de grandeur plus distants de l’ordre de perception et d’action humaines :
« L’affectivité et l’émotivité, multiformes, apportent leur pouvoir de rayonnement et leur dimension de participation collective aux instruments et aux objets techniques, particulièrement lorsque ces derniers mettent l’homme en communication avec des ordres de grandeur inusités, selon l’infiniment grand et l’infiniment petit, ou bien avec des forces et des réalités restées jusqu’à ce jour intangibles et mystérieuses »114.
Ce parallèle, à première vue surprenant, entre relations affectivo-émotives et relations entre ordres de grandeur permet de porter un tout autre regard sur les nanotechnologies : plutôt que d’y voir des perspectives de « potentialisation » tous azimuts d’objets utilitaires, une conversion du regard peut permettre d’y déceler des modes inédits de confrontation à la matière, c’est-à-dire une manière de coupler des habiletés humaines et des processus naturels à des échelles inaccessibles jusque-là, une manière de rendre commensurables des ordres de grandeur jusqu’à présent incommensurables. Les machines moléculaires inaugurent de nouveaux rapports entre l’homme et la matière qui passent par de nouveaux rapports entre les ordres de grandeur des processus matériels eux-mêmes. Toute la réalité matérielle est faite d’atomes et de molécules, mais jamais, auparavant, nous n’avions pu interagir avec des molécules individuelles. On ne peut pas opérer un tel décentrement de l’éthique sans apprendre à « aimer » ces curieux objets de laboratoire qui inaugurent des modes inédits de confrontation à la matière. N’est-ce pas d’ailleurs le plus bel enseignement que nous a transmis le « terrain » : que les chercheurs « aiment » leurs molécules ? Ces chercheurs lient leur carrière à ces objets, s’efforcent de les soutenir et de les accompagner dans l’existence en leur inventant des destinées. Car les nano-objets n’existent pas entièrement par eux-mêmes : ils existent par la valeur qu’on leur accorde et par celle qu’on accorde à leurs relations au monde et à d’autres objets. Mais Simondon va plus loin. La force de son argumentation est de soutenir que cette amitié pour les objets techniques ne doit pas rester de l’ordre de l’intime, du privé : elle doit se risquer à définir de nouvelles formes d’amitiés publiques et de vertus politiques, s’exposer sur l’agora, trouver place dans le monde commun. En ce sens, les chercheurs ont des
114 SIMONDON (G.). – Psychosociologie de l technicité [1961-1962], in G. Simondon, Sur la technique. Paris, Presses Universitaires de France, pp. 27-130 (2014).
Version générée par les auteurs d’un article paru en deux volets dans Techniques de l’Ingénieur : (1) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : cartographie critique des approches existantes », TI n° RE244, 2015. (2) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : pour une approche centrée sur les objets », TI n° RE245, 2015. Le présent manuscrit présente les deux volets réunifiés, révisés et remis en page à partir de leurs versions avant publication respectives.
50
obligations morales envers les objets techniques, et « aimer » les nano-objets techniques ne signifie pas qu’il faille accepter ou rendre acceptable n’importe quelle application des nanotechnologies, bien au contraire : qui dit nouveaux rapports de valeur (et non seulement de connaissance ou d’utilité) dit nouvelles obligations. Pour reprendre cet ensemble d’idées dans le langage de Dewey, les nano-objets émergent non pas d’une étude détachée et objective des « faits » naturels, mais de processus de valuation115. Le processus de valuation se distingue à la fois de l’évaluation purement rationnelle et de la valorisation purement marchande. Valuer quelque chose, c’est chérir (prizing) et prendre soin (caring for), le porter dans l’existence pour finalement travailler à l’émergence de nouvelles valeurs, qui pourront ensuite être évaluées, c’est-à-dire être rendues publiques, testées, expérimentées, exposées sur l’agora, et participer à leur tour à l’émergence de nouvelles valuations. Un processus de causalité récurrente lie donc les valuations affectivo-émotives et les valeurs débattues (les évaluations). Or les valeurs, pour une philosophie pragmatiste comme celle de Dewey, ne relèvent pas exclusivement du sub- jectif ou des représentations enfermées dans la tête des individus : elles s’exposent dans des actions, factuelles, observables, dans des modes de comportement, « des comportements valuateurs »116. La valeur n’est pas donnée au départ par opposition au fait qui lui, existerait indépendamment de tout acte de valuation (ce qui pour un fait technique, serait d’ailleurs un non-sens). Le domaine des fins (les valeurs explicitées et débattues) et celui des moyens (les objets techniques mis au service de ces valeurs) se constituent l’un par l’autre au cours du processus de valuation. L’éthique centrée sur les objets porte donc bien sur les valeurs – ou plutôt sur l’émergence des valeurs, c’est-à-dire sur les valuations –, mais elle n’a pas à attendre que « les faits soient faits » pour ne s’intéresser qu’aux applications. La tâche de l’éthicien de terrain est alors celle de participer à rendre ces valuations conscientes, publiques, et partageables dans un dialogue constant avec les chercheurs comme avec les objets. Par exemple, les chercheurs disent « parler avec des molécules », et être motivés avant tout par cela. Fascinant ! Mais d’autres qu’eux peuvent-ils « parler à des molécules » ? Et que leurs diront-elles ? Leurs diront-elles la même chose que ce qu’elles disent aux chercheurs ? La question, un fois devenue publique, n’est plus seulement de savoir ce que les scientifiques ou les industriels vont faire de ces machines moléculaires, mais c’est aussi celle de savoir quel genre d’attitude culturelle et de « comportement valuateur » ces objets requièrent de nous. En démultipliant et en étendant la relation émotivo-affective aux objets au-delà des laboratoires, le but n’est pas de créer du consensus, mais au contraire de travailler à l’émergence et à la formulation d’une pluralité de valeurs. 4.3. Nanovecteurs de médicaments La vectorisation des médicaments est un champ de recherche et d’application très actif à la jonction des nanotechnologies et de la pharmacologie117. Il s’agit de fonctionnaliser des nano-objets (micelles, liposomes, fullerènes, nanotubes, nanoshells, nanoparticules magnétiques, dentrites, capsides de virus…) pour acheminer de manière ciblée un principe actif (molécule médicamenteuse, gène, protéine, anticorps, ou mode d’action physique…) et le libérer de manière contrôlée sur son site d’action (organe, tissu cellule, récepteur…).
115 DEWEY (J.), op. cit., 1939. 116 Rappelons que le grec « pragmata », qui donne son nom au pragmatisme, signifie à la fois « les choses » et « les affaires », les affaires publiques. 117 VAUTHIER (C.) et COUVREUR (P.). – « Nanotechnologies pour la thérapeutique et le diagnostic ». Techniques de l’ingénieur, n° NM 4 010. (2008).
Version générée par les auteurs d’un article paru en deux volets dans Techniques de l’Ingénieur : (1) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : cartographie critique des approches existantes », TI n° RE244, 2015. (2) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : pour une approche centrée sur les objets », TI n° RE245, 2015. Le présent manuscrit présente les deux volets réunifiés, révisés et remis en page à partir de leurs versions avant publication respectives.
51
Le principal objectif des systèmes de délivrance ciblée est d’améliorer l’index thérapeutique des médicaments (le ratio dose curative / dose maximale tolérée). En effet, en augmentant la concentration du principe actif sur le site d’action relativement à celle contenue dans les tissus sains, il devient possible d’augmenter la dose administrée pour des effets secondaires moindres ou équivalents – ce qui présente notamment un intérêt particulier pour améliorer la délivrance des anti-cancéreux, molécules hautement toxiques. Il s’agit d’une application phare des NST. Très populaire et peu controversée, la vectorisation des médicaments est, pour cette raison, souvent mise en avant pour donner une image positive des nanotechnologies et faciliter leur acceptabilité publique. En quoi consistera une approche d’éthique de terrain pour les nanovecteurs ? La relation entre discours et pratiques est ici très différente de celle qui prévaut sur le terrain des machines moléculaires. La pratique de l’éthique de terrain sera donc, elle aussi, différente. En effet, loin d’être déconnectés, discours et pratiques semblent ici pleinement convergents, en phase car massivement orientées par un recours constant à des métaphores militaires (encadré 3)118.
118 BENSAUDE-VINCENT (B.) et LOEVE (S.). – Metaphors in Nanomedecine : The Case of Targeted Drug Delivery. NanoEthics, vol. 7, n° 3, pp. 1-17 (2013).
Encadr é 3 – Métaphores militaires : quelques titres évocateurs
Titres d’articles comportant des métaphores militaires (en gras) classés grosso modo de la littérature la plus « grand public » à la littérature la plus « spécialisée » :
- New attack on cancer with nano-weapon, The Times; - Nanoparticle “smart bomb” formed by bee venom may harbour cancer cure, Asian News
International; - “Smart Bomb” Nanoparticle Strategy Impacts Metastasis, San Diego Univ. Newsletter; - Nanomissiles à retardement, Journal de l’Univ. Laval; - A new tiny but deadly nano-weapon against cancer, Surrey University Newsletter; - Taking the fight into the enemy’s territory, Munich University News; - “Guided Missilles” or “Guided Micelles”?, JYI.org; - Nano weapons join the fight against cancer, Technology Review MIT; - Stealthy nanoparticles attack cancer cells, Technology Review MIT; - New nano weapon against cancer - Gold nanoparticles with branching polymers could
attack tumors in multiple ways, Technology Review MIT; - Magic Nano-Bullets: Advances in nano-technology could make drug delivery far more
accurate and effective, Scientific American; - Gold “nano-bullets” shoot down tumours, New Scientist; - Cancer Therapeutics: nano tumor killer , Nature; - Nanostructured Surfaces to Target and Kill Circulating Tumor Cells while Repelling
Leukocytes, Journal of Nanomaterials; - Quantum Dots: nano-tin soldiers, Nature Materials Asia; - Micelles on target, Nature Nanotechnology; - Nanomedicine: Silence the target, Nature Nanotech.; - Magnetic nano-particles hit the target, Nat. Nanotech; - Sizing up target with nanoparticles, Nat. Nanotech.; - Drug delivery: One nanoparticle, one kill, Nat. Mat.;
Version générée par les auteurs d’un article paru en deux volets dans Techniques de l’Ingénieur : (1) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : cartographie critique des approches existantes », TI n° RE244, 2015. (2) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : pour une approche centrée sur les objets », TI n° RE245, 2015. Le présent manuscrit présente les deux volets réunifiés, révisés et remis en page à partir de leurs versions avant publication respectives.
52
Il s’agira alors, non pas de critiquer tout recours aux métaphores (les chercheurs les utilisent car elles guident leurs pratiques et leur donnent sens), mais de puiser dans les potentiels de ces recherches pour proposer d’autres métaphores qui soient à la fois heuristiques sur un plan épistémologique (riches en intuitions permettant un meilleur design des objets) et porteuses d’autres valeurs sur un plan éthique (véhiculant d’autres représentations du corps, de la pathologie, de la guérison et de l’acte thérapeutique). 4.3.1. De la « magic bullet » au nano-arsenal
Les recherches en NST pour la vectorisation de médicaments sont souvent présentées comme une percée de plus sur le front de la « guerre contre le cancer ». De manière très traditionnelle, elles recourent à la veille image de la pathologie comme entité bien localisée qu’il faut cibler et shooter. Les nouveaux nanomédicaments sont décrits comme des « missiles thérapeutiques », des « nano-bullets » ou encore des « bombes intelligentes » (smart bombs) menant des « attaques ciblées » qui minimisent les « dommages collatéraux », etc. Toutes ces expressions reprennent l’image de la « magic bullet » (« balle magique ») de Paul Ehrlich. Surnommé le « chasseur de microbes », ce célèbre médecin allemand du début du vingtième siècle utilisait l’affinité entre récepteurs cellulaires et molécules de synthèse pour colorer spécifiquement les bacilles responsables de telle ou telle infection (l’Allemagne était alors leader mondial de la production de colorants). Les microbes devenaient alors visibles au microscope et il devenait possible, en recourant à la même stratégie de reconnaissance moléculaire, de tester des molécules de synthèse qui auraient des effets létaux spécifiquement sur tel ou tel type de bacille infectieux. En ciblant aléatoirement des centaines de tissus infectés avec plusieurs centaines de molécules chimiques, Ehrlich parvint en 1910 à isoler une molécule efficace contre la syphilis, le Salvarsan. Cet exploit signait moins la naissance de la « conception rationnelle » (rational design) des médicaments que celle, bien plus empirique, du « criblage de médicaments » (drug screening), cette
- Targteting cancer with ‘smart bombs’: equipping plant virus nanoparticles for a ‘seek and destroy’ mission, Nanomedicine;
- Nanomedicine-based cancer-targeting: a new weapon in an old war, Nanomedicine; - Nano Delivers Big: Designing Molecular Missiles for Cancer Therapeutics,
Pharmaceutics; - Guided Molecular Missiles for Tumor-Targeting Chemotherapy-Case Studies Using the
Second-Generation Taxoids as Warheads, Accounts of Chemical Research; - Targeted Single-Wall Carbon Nanotube-Mediated Pt(IV) Prodrug Delivery Using Folate
as a Homing Device, ACS Journal; - Targeted Killing of Cancer Cells in Vivo and in Vitro using EGF-Directed Carbon
Nanotube-Based Drug Delivery, ACS Nano; - Delivery of molecular payloads with magnetic porous silicon chaperones, Dalton
Transactions; - Stealth liposomes and tumor targeting: one step further in the quest for the magic bullet,
Clinical Cancer Research; - Targeting Anti-Epileptic Drug Therapy Without Collateral Damage: Nanocarrier-Based
Drug Delivery, Epilepsy Currents; - Battling with environments: drug delivery to target tissues with particles and functional
biomaterials, Therapeutic Delivery; - Silver nanoparticles: the powerful nanoweapon against multidrug-resistant bacteria,
Journal of Applied Microbiology; - Materializing sequential killing of tumor vasculature and tumor cells via targeted
polymeric micelle system, Journal of Controlled release
Version générée par les auteurs d’un article paru en deux volets dans Techniques de l’Ingénieur : (1) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : cartographie critique des approches existantes », TI n° RE244, 2015. (2) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : pour une approche centrée sur les objets », TI n° RE245, 2015. Le présent manuscrit présente les deux volets réunifiés, révisés et remis en page à partir de leurs versions avant publication respectives.
53
approche consistant à tester de larges banques de molécules candidates sur des cohortes de cibles potentielles, et qui fit le succès de l’industrie pharmaceutique du XXe siècle. Néanmoins, le concept de magic bullet devint une sorte d’idéal-type orientant les efforts de recherche vers un dépassement de l’approche combinatoire du criblage119. Il s’agissait en effet d’aller vers des « drugs by design » : des systèmes moléculaires spécifiquement conçus et optimisés pour être ajustés à leur cible. L’idéal devint presque réalité avec la production des anticorps monoclonaux dans les années 1970, puis avec le concept des « microsphères » comme véhicules potentiels pour délivrer une molécule directement à l’intérieur d’une cellule120. Plus récemment, les NST ont à nouveau ressuscité la quête de la magic bullet avec leurs « missiles thérapeutiques » équipés de « revêtements furtifs » (stealth coating) et de « ligands de ciblage » (targeting ligands) analogues à des « têtes chercheuses » (homing devices)121. Il serait un peu rapide de considérer ces métaphores comme de simples outils de communication à destination du grand public tant elles sont d’usage courant dans les articles de revues spécialisées. Il serait tout aussi rapide de les considérer comme des écarts de langage, des mésusages purement verbaux. On devrait à notre sens les considérer comme des « actes de langage » au sens du philosophe John Austin122. Les actes de langage sont des énoncés « performatifs » plutôt que « constatifs » : ils visent moins à décrire la réalité qu’à la modifier, à l’informer au sens de lui donner forme. Autrement dit, ces métaphores ont une fonction opératoire. Comme l’affirme la biologiste et philosophe Evelyn Fox-Keller, « en sciences, les métaphores font beaucoup plus que modifier notre perception du monde. En plus de diriger l’attention des chercheurs, elles guident leurs activités et leurs manipulations matérielles »123. Les métaphores ont une fonction performative. Elles orientent les choix de recherche et les pratiques de design des objets. Elles renseignent aussi sur les valeurs implicites qui sous-tendent ces choix. 4.3.2. Un problème de balistique ?
Les stratégies de conception des nanovecteurs de médicaments semblent bien, à première vue, s’apparenter à un problème de balistique : il s’agit de contrôler l’acheminement du vecteur sur sa cible. Le problème est divisé en trois opérations : charger, cibler, délivrer. La première opération, charger ou encapsuler, requiert la conception d’un véhicule ou container dont les caractéristiques doivent obéir au cahier des charges suivant : - la taille doit être proportionnée à celle des voies de passage des barrières biologiques à
franchir ; dans le réseau sanguin, le nano-véhicule doit par exemple être assez gros pour ne pas passer à travers l’endothélium vasculaire des tissus sains mais assez petit pour passer à travers l’endothélium dilaté des tissus cancéreux ;
- le taux d’encapsulation (le nombre moyen de molécules médicamenteuses piégées dans le nano-container pendant son assemblage) doit être assez élevé pour que le gain d’efficience thérapeutique ne soit pas annulé par une trop faible « force de frappe » (payload) ;
- stabilité : le véhicule doit résister à la bioérosion ;
119 STREBHARDT (K.) et ULLRICH (A.). – Paul Ehrlich’s magic bullet concept: 100 years of progress. Nature Reviews Cancer, vol. 8, pp. 473-480 (2008). 120 KRAMER (P.A.). – Albumin microspheres as vehicles for achieving specificity in drug delivery. Journal of Pharmaceutical Sciences, vol. 63, pp. 1646-1647 (1974). 121 GABIZON (A.A.). – Stealth liposomes and tumor targeting : one step further in the quest for the magic bullet. Clinical Cancer Research, vol. 7, pp. 243-54 (2001). 122 AUSTIN (J.L.). – Quand dire c’est faire. Éditions du Seuil, Paris (1970). 123 FOX KELLER (E.). – Expliquer la vie. Modèles, métaphores et machines en biologie du développement. Gallimard, Paris (2004).
Version générée par les auteurs d’un article paru en deux volets dans Techniques de l’Ingénieur : (1) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : cartographie critique des approches existantes », TI n° RE244, 2015. (2) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : pour une approche centrée sur les objets », TI n° RE245, 2015. Le présent manuscrit présente les deux volets réunifiés, révisés et remis en page à partir de leurs versions avant publication respectives.
54
- biocompatibilité : le matériau doit être non toxique et suffisamment soluble pour éviter toute accumulation indésirable ; c’est le cas par exemple des lipides, constituant naturel des surfaces cellulaires, que l’on peut faire s’auto-assembler en nanosphères ou nanocapsules124 ;
- biodégradabilité : le véhicule doit pouvoir être dégradé et/ou évacué une fois sa mission accomplie.
Pour cibler, c’est-à-dire guider la trajectoire de la capsule à travers le corps, un ensemble de techniques chimiques et physiques est mobilisé. Une des stratégies les plus répandues consiste à attacher au véhicule des ligands moléculaires correspondant spécifiquement aux récepteurs de la cible. Ce sont les fameuses « têtes chercheuses » chimiques (homing ligands). Il est aussi possible d’utiliser des forces physiques pour guider le véhicule de l’extérieur (par exemple, le faire passer dans une artère gauche plutôt que dans une artère droite) ou le retenir dans la zone ciblée. Des nanoparticules superparamagnétiques d’oxyde de fer peuvent ainsi être alignées comme les wagons d’un petit train et guidées par application d’un champ magnétique. L’interaction avec le champ magnétique permet aussi d’imager en temps réel la progression des nanoparticules dans l’organisme par Résonance magnétique nucléaire (RMN) ; on obtient alors un dispositif dit de « théranostique », combinant la thérapeutique avec un suivi diagnostique en temps réel de la progression du traitement. Délivrer : la dernière opération de cette stratégie militaire est la libération de la charge. La charge peut être un principe actif (une molécule cytotoxique), mais aussi une molécule biologique (gène, peptide), ou encore un mode d’action physique. Par exemple, en inversant par RMN la polarité d’un champ magnétique à haute fréquence appliqué à des nanoparticules d’oxyde de fer, on provoque une hyperthermie qui va nécroser les tissus cancéreux du milieu environnant les nanoparticules (la RMN est ainsi utilisée à la fois comme moyen d’observation et d’action). Il existe encore bien d’autres stratégies de guidage, de détection et de déclenchement à la demande de la charge létale. Par exemple, la lumière pulsée en proche infrarouge (fréquence à laquelle la lumière traverse les tissus) va faire se dissoudre une nanoparticule d’or et libérer les principes actifs qu’elle contient. D’autres dispositifs sont activables par ultrasons ou rayons X. Comme ces nano-véhicules sont contrôlables et activables à la demande de l’extérieur, certains chercheurs, comme la biophysicienne Florence Gazeau (laboratoire Matière et Systèmes Complexes, Université Paris Diderot), n’hésitent pas à parler de « nano-robots ». Cette expression désigne ici un système asservi plutôt qu’une machine autonome qui échapperait à ses créateurs. Mais on peut aussi comparer les dispositifs théranostiques à des drones : suivis sur un écran de contrôle, ils sont commandés et déclenchés à distance. Enfin ces objets sont souvent baptisés « nanoplateformes » car ils combinent une multitude de fonctionnalités (détection, ciblage, pharmaco-activité et agents stimuli-réponse pour activer ces fonctions), intégrées sur un même nano-objet. Ces métaphores militaires s’avèrent donc tout à fait suggestives et performatives : on peut effectivement parler de ces objets en termes de « nano-armes » conçues comme telles. Toutefois, elles ne rendent possible qu’une description superficielle, et occultent un certain nombre d’aspects clés du fonctionnement des nanomédicaments. 124 COUFFIN (A.-C.) et DELMAS (T.). – Vecteurs lipidiques en tant que nanomédicaments. Techniques de l’ingénieur, n° J 2310 (2013).
Version générée par les auteurs d’un article paru en deux volets dans Techniques de l’Ingénieur : (1) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : cartographie critique des approches existantes », TI n° RE244, 2015. (2) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : pour une approche centrée sur les objets », TI n° RE245, 2015. Le présent manuscrit présente les deux volets réunifiés, révisés et remis en page à partir de leurs versions avant publication respectives.
55
4.3.3. Des négociations complexes
4.3.3.1. Le rôle du milieu
En mettant un scène un jeu de stratégie opposant deux acteurs, le nanomissile et sa cible, la vision militaire occulte le rôle d’un troisième joueur dont nous avions déjà pu constater l’importance sur le terrain des machines moléculaires : le milieu. En effet, un nanovecteur n’est jamais rivé sur sa cible, indifférent à tout ce qui l’entoure à la manière d’un missile à tête chercheuse. La rencontre avec sa cible, si elle a lieu, se fait souvent au terme d’un parcours erratique, hasardeux et semé d’embûches à travers les vaisseaux sanguins, les tissus interstitiels et les milieux intracellulaires125. À travers ce parcours il doit échapper à un certain nombre de « pièges » comme le fait d’être évacué par un mécanisme de clearance, phagocyté par un macrophage ou recouvert par des protéines du milieu qui font de lui un objet biologiquement différent126. Il est donc capital de prendre en compte l’interaction entre nano-objets et biomolécules du milieu127. La métaphore balistique figure l’image d’un projectile lancé à travers un espace neutre et homogène alors que le milieu biologique est complexe, hétérogène, dynamique et évolutif ; la métaphore du missile fait comme si la nanoplateforme pouvait « reconnaître » sa cible et la traquer alors que son parcours est aléatoire, et son mode d’action stochastique. Qu’est-ce qui explique le simplisme de cette métaphore ? C’est en partie le fait que les nanovecteurs sont d’abord testés in vitro, pour des raisons à la fois épistémiques (simplicité) et éthiques (épargner les animaux), et introduits in vivo dans un deuxième temps. Or les manipulations in vitro font abstraction de la complexité des milieux biologiques. L’efficacité thérapeutique du nanomédicament dépend en réalité moins des propriétés matérielles intrinsèques des nanoparticules que de leur interaction avec des milieux biologiques peuplés d’innombrables acteurs. Les approches qui ont fait le succès – partiel – des nanosystèmes de délivrance ciblée au cours de la dernière décennie en témoignent. Le chimiste Patrick Couvreur distingue trois générations de nanovecteurs128. Les vecteurs dits de « première génération » sont dépourvus de revêtement « furtif ». Ils se font donc marquer par les opsonines (des protéines marqueurs du « non-soi ») et phagocyter par les macrophages de Kupffer, qui les acheminent vers le foie. Or, cette capture par les défenses biologiques n’est pas forcément interprétée comme un échec. Cela a notamment permis de concentrer l’anti-cancéreux doxorubicine vers le foie tout en atténuant sa toxicité cardiaque, ce qui permettrait d’améliorer l’efficacité du traitement du carcinome hépato-cellulaire. Ici, « l’ennemi » ou la « défense » biologique, devient un « allié », un passeur. Dans ce cas, le vrai vecteur, c’est le macrophage. Doxorubicin Transdrug®, ou Livatag®‚ est actuellement en phase III, 30 ans après sa synthèse sur la paillasse ; une première série d’essais cliniques avait été menée mais elle avait été interrompue en 2008, en raison de l’apparition d’une toxicité pulmonaire plus forte que prévue. La toxicité pulmonaire avérée n’ayant pas été suivie par une augmentation du taux de mortalité, les essais ont donc repris avec Livatag®‚ considéré comme un traitement de la dernière chance après échec des traitements précédents. Les nanovecteurs de « seconde génération » sont tapissés d’un revêtement de polyéthylène glycol (PEG). On dit qu’ils sont « peguilés » : le PEG forme un nuage de chaînes hydrophiles autour de la nanoparticule qui repousse pendant un temps l’adsorption des opsonines et donc l’action des macrophages. Ces vecteurs peguilés sont dits « furtifs » 125 NICHOLS (J.W.) et BAE (Y.H.). – Odyssey of a cancer nanoparticle: from injection site to site of action. Nano Today, vol. 7, pp. 606-618 (2012). 126 LYNCH (I.) et DAWSON (K.A.). – Protein-nanoparticle interactions. Nano Today, vol. 3, pp. 40-47 (2008). 127 MINARD (P.) et DESMADRIL (M.). – Création par évolution dirigée de biomolécules reconnaissant des nano-objets. Techniques de l’ingénieur, n° NM 4 200 (2007). 128 COUVREUR (P.) et VAUTHIER (C.). – Nanotechnology: intelligent design to treat complex disease. Pharmaceutical research, vol. 23, pp. 1417-1450 (2006).
Version générée par les auteurs d’un article paru en deux volets dans Techniques de l’Ingénieur : (1) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : cartographie critique des approches existantes », TI n° RE244, 2015. (2) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : pour une approche centrée sur les objets », TI n° RE245, 2015. Le présent manuscrit présente les deux volets réunifiés, révisés et remis en page à partir de leurs versions avant publication respectives.
56
(stealth). Or contrairement à un missile, le but de la peguilation n’est pas de traverser comme une flèche les défenses ennemies, c’est au contraire de prolonger le temps de résidence des nanovecteurs dans le milieu sanguin afin de maximiser leur probabilité d’absorption dans les tissus cancéreux. Cette pénétration tire parti de l’effet d’augmentation de la perméabilité et de la rétention (EPR pour Enhanced Permeability and Retention effect). L’EPR est le phénomène par lequel la tumeur prend possession des voies de signalisation de l’angiogenèse pour se « brancher » sur le réseau sanguin et lymphatique préexistant ; ce faisant, elle provoque une inflammation des cellules endothéliales des parois des vaisseaux sanguins ; les cellules de l’endothélium se disjoignent et deviennent plus perméables, ce qui permet à la tumeur de capter l’oxygène et les nutriments nécessaires à sa croissance ; l’effet EPR offre ainsi un moyen aux nanoparticules pour imprégner lentement les sites tumoraux. Il s’agit donc moins d’une stratégie de fonctionnalisation du vecteur que d’une tactique qui consiste à tirer parti de la « force » (ou de l’astuce) de l’adversaire. Les nanovecteurs dits de « troisième génération » sont décorés par des ligands de ciblage. Or contrairement à ce que suggère l’image du missile à tête chercheuse, ces ligands de reconnaissance moléculaire ne pointent pas forcément vers un récepteur de la cible. Ils ciblent parfois une « molécule-relais », permettant au nanovecteur de franchir une barrière biologique. Par exemple, pour permettre à des nanosphères de chitosan de traverser la barrière hémato-encéphalique et délivrer des peptides au cerveau, on les décore avec l’anticorps spécifique du récepteur de la transferrine129. Ici encore, le milieu biologique offre un passeur potentiel avec lequel le nanovecteur va nouer une alliance temporaire. 4.3.3.2. Des stratégies militaires aux tactiques de contact
La fonction de la capsule n’est pas seulement de transporter une charge (payload) ; elle joue avant tout un rôle de protection : d’une part, elle protège les milieux biologiques de la virulence de la molécule pharmaco-active ; d’autre part elle protège la substance active elle-même des protections immunitaires de l’organisme – cette fonction est d’ailleurs cruciale si l’on veut transporter des gènes ou des protéines, qui sont des molécules fragiles et facilement dénaturées. Il s’agit donc de protéger une substance fragile durant son trajet dans l’organisme. Plutôt qu’une arme d’assaut, on a donc affaire à un système caractérisé par un réglage fin de plusieurs mécanismes de protection mutuelle. Certes, la protection ne nous fait pas quitter le registre de la guerre. Cependant, elle introduit de la tactique plutôt que de la stratégie. La stratégie est la mise en œuvre d’un plan élaboré en amont du terrain. La stratégie prétend à une vue totalisante et domine le terrain. La tactique épouse le terrain et en suit les circonvolutions. La tactique a aussi rapport avec le tact, ce toucher qui n’est pas une préhension mais une sensibilité dans la communication, un sens de la distance minimale qu’il s’agit d’introduire dans une interaction de proche en proche, en « close contact ». Au lieu de l’arme de destruction, la métaphore du diplomate pourrait être plus adéquate au nanovéhicule : le nanovecteur doit négocier, faire preuve de tactique et de tact, saisir des occasions (kaïros) ; il ne doit pas tout détruire sur son passage mais négocier des alliances en garantissant la préservation de l’intégrité des milieux qu’il traverse et modifie éventuellement au passage. Enfin la cible elle-même n’est pas ce récepteur passif censé être « impacté » par la charge létale. On l’a vu dans le cas de l’EPR, où l’adressage se fait tout simplement en tirant parti d’un stratagème déployé par la tumeur pour accaparer une partie du flux sanguin.
129 AKTAS (Y.), YEMISCI (M.) et ANDRIEUX (K.) et al. – Development and brain delivery of chitosan-PEG nanoparticles functionalized with the monoclonal antibody OX26. Bioconjugate chemistry, vol. 16, n° 6, p. 1503-1511 (2005).
Version générée par les auteurs d’un article paru en deux volets dans Techniques de l’Ingénieur : (1) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : cartographie critique des approches existantes », TI n° RE244, 2015. (2) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : pour une approche centrée sur les objets », TI n° RE245, 2015. Le présent manuscrit présente les deux volets réunifiés, révisés et remis en page à partir de leurs versions avant publication respectives.
57
L’image d’un projectile qui vient frapper la cible néglige le fait que la cellule ciblée constitue pour le nanovéhicule un nouveau milieu d’interaction qui vient reconfigurer son identité. Ainsi, une des raisons pour lesquelles les nanovecteurs de « troisième génération » (fonctionnalisés par des ligands de reconnaissance moléculaire) ne tiennent pas leurs promesses à l’heure actuelle, est que ces nano-objets synthétiquement décorés par des molécules de ciblage sont biologiquement « re-décorés », c’est-à-dire re-fonctionnalisés par le milieu biologique environnant. C’est ce que les toxicologues appellent la couronne protéique (protein corona). La formation de ce manteau de protéines n’avait pas été anticipée au départ. Or celui-ci modifie ce que « voit » la cellule. Florence Gazeau affirme que « la cellule voit la corona, un objet modifié qu’on ne connaît pas. La cellule ne sait pas lire cet objet. Mais la particule magnétique a sa vie dans la cellule, dans son organisme, elle va faire son boulot, et va avoir une activité, seulement, on ne la comprend pas de l’extérieur ». La cellule ne voit donc pas les « clés » qui sont censées rentrer dans ses « serrures ». Elle est mise en contact avec un « message » biologique qu’elle « lit » autrement. Or pour répondre à ce problème, il faut prendre en compte ce que « voit » la cible, et se décentrer du point de vue centré sur le seul dispositif devant l’atteindre. On pourrait dire également que le nanovecteur est parfois « agent secret » : il infiltre des milieux difficiles d’accès, manipule les interactions entre les acteurs de ces milieux et adopte leurs codes. Toutefois, il lui faut aussi se faire reconnaître par la « cible ». Il ne s’agit donc pas seulement de camouflage et de furtivité, mais aussi de reconnaissance sélective : il faut faire en sorte que le nanovéhicule passe inaperçu de certains acteurs biologiques mais puisse être reconnu par d’autre ; que la cellule ciblée puisse « lire » le message biochimique qui lui est adressé. La cible offre donc un point de vue ouvrant sur des interactions inconnues, un point de vue singulier sur le médicament dont il faut tenir compte. Il faut donc apprendre à parler le langage de la cible pour lui adresser le bon message. Enfin la métaphore du missile représente la nano-plateforme idéale comme une « machine cartésienne »130: un assemblage entièrement fonctionnalisé de partes extra partes (parties extérieures les unes aux autres) transparent à l’ingénieur, où chaque partie est assignée à l’accomplissement d’une fonction. Or le comportement in vivo des nanoparticules implique plus que l’accomplissement des fonctions pour lesquelles elles sont designées au départ. De par leur taille et leur surface spécifique (fort ratio surface/volume, nombre important d’atomes de surface par rapport aux atomes du cœur), la plupart des nanoparticules présentent une forte réactivité à leur environnement local. Elles sont transformées par leurs interactions avec le milieu vivant tout au long de leur parcours dans l’organisme131. Elles acquièrent alors une « identité biologique » différente de leur « identité synthétique » originale. Ainsi de nombreuses études se consacrent désormais à comprendre les différences entre les identités in vitro et in vivo des nanoparticules132.
130 BENSAUDE-VINCENT (B.) et GUCHET (X.). – Nanomachine: One word for three different paradigms. Technê, Research in Philosophy & Technology, vol. 10, 71-89, (2007) http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/35/07/23/PDF/02BBV.pdf (page consultée le 13 juillet 2013). 131 LOWRY (G.V.), GREGORY (K.B.), APTE (S.C.) et LEAD (J.R.). – Transformations of Nano-materials in the Environment. Environmental Science and Technology, vol. 46, pp. 6893-6899 (2012). LARTIGUE (L.) et al. – Biodegradation of Iron Oxide Nanocubes: High-Resolution In Situ Monitoring. ACS Nano, vol. 7, pp. 3939-3952 (2013). 132 MONOPOLI (M.P.), WALCZYK (D.) et CAMPBELL (A.) et al. – Physical-chemical aspects of protein corona : relevance to in vitro and in vivo biological impacts of nanoparticles. Journal of the American Chemical Society, vol. 133, p. 2525-2534 (2011). LUNDQVIST (M.), STIGLER (J.) et CEDERVALL (T.) et al. – The evolution of the protein corona around nanoparticles : a test study. ACS nano, vol. 5, pp. 7503-7509 (2011). LARTIGUE (L.), WILHELM (C.) et SERVAIS (J.) et al. – Nanomagnetic sensing of blood plasma protein interactions with iron oxide nanoparticles : impact on macrophage uptake. ACS nano, vol. 6, pp. 2665-2678 (2012).
Version générée par les auteurs d’un article paru en deux volets dans Techniques de l’Ingénieur : (1) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : cartographie critique des approches existantes », TI n° RE244, 2015. (2) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : pour une approche centrée sur les objets », TI n° RE245, 2015. Le présent manuscrit présente les deux volets réunifiés, révisés et remis en page à partir de leurs versions avant publication respectives.
58
Pour récapituler, la métaphore balistique du « nanomissile » est très limitée : elle occulte le rôle du milieu tout au long du trajet du nano-objet dans l’organisme, produit des illusions de contrôle (souvent déçues) et limite finalement le potentiel de la technique. 4.3.4. Vers une approche oïkologique
Peut-on alors proposer un autre cadrage métaphorique qui tienne compte des interactions avec le milieu ? Avec la philosophe Bernadette Bensaude-Vincent et la biophysicienne Florence Gazeau, nous avons proposé un cadre « oïkologique », en référence à oïkos (« maison », racine grecque commune de « écologie » et « économie »)133. L’oïkologie a comme métaphore principale l’économie domestique. Nous la définissons comme un art du ménagement plutôt que du management des performances, des risques et des bénéfices. Il consiste à « domestiquer » autant que possible la maladie tout en « ménageant sa demeure » pour faire en sorte que ses habitants fassent « bon ménage ». Mettons maintenant en contraste les valeurs et les représentations que véhiculent les deux systèmes de métaphores (tableau 1). Tableau 1 - Valeurs véhiculées par les deux cadrages métaphoriques examinés
Représentations : Métaphore militaire Métaphore oïkologique
du corps
Espace neutre, cartésien, transparent et homogène qu’il faut traverser pour atteindre une cible ; Terrain d’opération vu depuis un écran radar.
Multiplicité de niches écologiques reliées par de multiples modes d’interaction et de confinement ; milieux opaques, inégaux, surpeuplés et hétérogènes.
de la pathologie Entité localisée à éradiquer. Singularité relationnelle à domestiquer.
de la santé
Etat de bien être résultant de l’absence ou de la destruction de l’entité pathologique.
Réhabiter son corps malade. Processus d’apprentissage et d’adaptation à la nouvelle condition induite par la maladie. Pas de retour à l’innocence biologique.
des dispositifs thérapeutiques Missile ciblant un ennemi. Diplomates négociant des compromis.
de l’acte thérapeutique
Jeu de stratégie opposant deux acteurs : le médicament et la cible.
Jeu tactique impliquant une multitude d’acteurs à ménager et dont il faut orchestrer les relations à chaque moment du parcours.
du nano-objet
Entité transparente entièrement finalisée et sous contrôle car conçu par un projet humain (en vertu du postulat selon lequel tout ce qui est fabriqué est entièrement connu).
Etre de relation défini par ses interactions (exemple : la couronne protéique).
de la recherche toxicologique
Science de l’analyse des risques ; détour nécessaire pour assurer le « développement responsable » des nanotechnologies en lui « sacrifiant » une partie du budget de recherche.
Science majeure des interactions nano-bio-éco-socio ; principal domaine de convergence entre science, technologie et société à l’échelle moléculaire.
FADEEL (B.), FELIU (N.) et VOGT (C.) et al. – Bridge over troubled waters : understanding the synthetic and biological identities of engineered nanomaterials. Wiley Interdisciplinary Reviews : Nanomedicine and Nanobio-technology (2013). 133 LOEVE (S.), BENSAUDE-VINCENT (B.) et GAZEAU (F.). – Nanomedicine metaphors: From war to care. Emergence of an oecological approach. NanoToday, vol. 8 (2013).
Version générée par les auteurs d’un article paru en deux volets dans Techniques de l’Ingénieur : (1) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : cartographie critique des approches existantes », TI n° RE244, 2015. (2) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : pour une approche centrée sur les objets », TI n° RE245, 2015. Le présent manuscrit présente les deux volets réunifiés, révisés et remis en page à partir de leurs versions avant publication respectives.
59
Dans le cadre de la métaphore balistique, le corps est représenté comme un espace transparent, homogène et isotrope que le nanomissile doit traverser pour atteindre sa cible. La métaphore oïkologique figure au contraire le corps comme un espace habité, différencié et accidenté, un écosystème ou une multiplicité de niches écologiques en interaction. Avec la métaphore militaire, la nanoparticule est représentée comme un dispositif transparent et sous contrôle car conçu selon un projet humain en vertu du postulat contestable selon lequel ce qui est fabriqué par l’homme est entièrement connu de lui ; dans le cadre oïkologique, la nanoparticule est conçue comme un être de relation défini par ses interactions. Dans la vision militaire, l’acte thérapeutique est représenté comme un jeu de stratégie à deux acteurs : le médicament et la cible. Dans la vision oïkologique, on a affaire à une multitude d’acteurs qu’il s’agit de ménager et dont il faut orchestrer les relations et interactions de proche en proche, avec tact, et à chaque moment du parcours. Les nanovecteurs n’y sont plus des missiles furtifs mais des diplomates. Dans la vision militaire, il s’agit tourner les dispositifs thérapeutiques contre les barrières qui se dressent entre le corps sain et la cible pathogène. Dans la vision oïkologique, il s’agit de rechercher la santé à travers des techniques qui permettent de ré-habiter et d’apprivoiser son corps malade en domestiquant – autant que faire se peut – la pathologie.
D’une manière générale, la métaphore oïkologique permet de reconceptualiser les nanoparticules comme des entités relationnelles : leurs interactions in vivo avec les milieux biologiques ne sont plus considérées comme des effets secondaires ou des obstacles, mais comme une caractéristique de leur mode d’existence et comme une condition de leur fonctionnement. Par exemple, la protein corona ne serait plus à considérer uniquement comme un obstacle ou un dysfonctionnement, mais aussi comme une opportunité permettant de jouer sur les réponses immunitaires de l’organisme et d’apprendre à parler la langue des cellules, qui est moléculaire. Les deux types de cadrages métaphoriques influencent donc tout autant les processus de design des nano-objets thérapeutiques que les valeurs qu’on leur associe, et qui ont trait aux représentations du corps, de la pathologie et des actes de soin à notre époque, celle d’une notre médecine de plus en plus technologique, tiraillée entre le réductionnisme des modèles d’ingénieur et la nécessité de composer avec la complexité d’un corps biologique affirmant plus que jamais son caractère multiple et indomptable. 4.3.5. Bilan provisoire
Passer par une analyse fine du mode d’existence de l’objet « nanovecteur » comme objet relationnel nous a permis de critiquer les métaphores militaires de la nanomédecine, et ce non pas de l’extérieur (de manière purement idéologique, en opposant de nobles Valeurs à de funestes faits), mais de l’intérieur, en prenant le parti des objets. Ce faisant, nous sommes passés de la valuation couramment admise à son évaluation : les valeurs majoritaires sous-jacentes à la conception et à l’utilisation des nanovecteurs (valeurs militaristes et mécanistes) ont été explicitées puis critiquées. Cette explicitation et cette critique, cette évaluation donc, ont fait émerger des incohérences qui ne rentraient pas dans ce cadre d’explication et de valuation. Il nous est apparu qu’un autre système métaphorique, oïkologique donc, permettait justement de valuer positivement tout ce qui échappe au cadre antérieur. Cette évaluation (ou critique des valuations) est elle-même sujette à débat : elle exprime des préférences que tous ne partageront pas, mais qui devront le cas échéant être explicitées et défendues. On voit donc que l’éthique technologique centrée sur les objets n’est pas « pour » ou « contre » telle ou telle application. Son rôle est plutôt d’éclairer les choix individuels et collectifs en montrant comment différentes valeurs s’incorporent à différents designs d’objets. À travers ce travail de pluralisation des métaphores, l’éthique centrée sur les objets permet ainsi de pratiquer une éthique expérimentale (section 3.2.1.3) sans passer par des scénarios d’anticipation et retomber dans les impasses de l’éthique de type spéculative (section 3.1.2.2).
Version générée par les auteurs d’un article paru en deux volets dans Techniques de l’Ingénieur : (1) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : cartographie critique des approches existantes », TI n° RE244, 2015. (2) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : pour une approche centrée sur les objets », TI n° RE245, 2015. Le présent manuscrit présente les deux volets réunifiés, révisés et remis en page à partir de leurs versions avant publication respectives.
60
Il ne s’agit plus de projeter des scénarios mettant en scène des applications potentielles comme si elles étaient réalisées au futur, mais plutôt de déceler les potentiels tels qu’ils existent au présent. L’approche est de plus ontologique (section 3.2.1.4) au sens où elle participe à faire advenir de nouveaux êtres porteurs de relations à soi, aux autres et au monde qui ne sont pas complètement prévisibles. Enfin elle est politique (3.2) au sens où elle permet de mettre en évidence la manière dont les valeurs orientent la fabrique des objets tout en donnant des prises sur ce processus. Il s’agit alors d’élargir le répertoire des possibles et des souhaitables des programmes de recherche afin de transformer activement les pratiques. En particulier, cette approche milite pour une requalification beaucoup plus ambitieuse de la toxicologie (évoquée dans la dernière ligne du tableau 1). En effet, la nanotoxicologie aujourd’hui est trop souvent considérée comme un détour nécessaire et vexant auquel on « sacrifie » quelques pourcents du budget de recherche pour assurer le « développement responsable » des nanotechnologies, c’est-à-dire leur acceptabilité par le public. Dans une politique de recherche oïkologique pleinement assumée, la nanotoxicologie deviendrait la science des interactions entre nanoparticules artificielles et milieux biologiques et écosystémi-ques. Elle ne serait plus un détour, mais se verrait requalifiée comme l’axe central à partir duquel orchestrer la convergence des sciences et techniques à l’échelle moléculaire. 4.4. Bio- et écotoxicologie des nanoparticules 4.4.1. Vers un référentiel commun : l’objet relationnel
Les propriétés relationnelles qui définissent les nano-objets justifient tout autant l’intérêt cognitif qu’on leur porte que les risques qu’ils font craindre. La mise en avant des comportements inhabituels et des propriétés de surface sous-tend également les débats sur la toxicologie et l’éco-toxicologie de certains nano-objets, notamment les nanoparticules (une nanoparticule est un petit solide inorganique, ou un cristal le plus petit qui soit ; c’est un objet intermédiaire entre la molécule et le solide). Car l’effet des nanoparticules sur la santé humaine et sur l’environnement dépend notamment de leur capacité à se lier sélectivement à d’autres entités présentes dans leur environnement. En deux mots, si les NST sont intéressantes, et si leurs objets soulèvent des problèmes toxicologiques bien spécifiques, c’est qu’un objet nano est défini avant tout par ses relations, par sa capacité à se lier sélectivement à ce qui n’est pas lui. L’objet « nano » est un objet relationnel, c’est-à-dire non seulement un objet en relation avec d’autres entités du monde (ce qui est trivial), mais un objet constitué par ses relations. Les nano-objets présentent un triple intérêt en tant qu’objets relationnels (figure 7). - D’une part ils se caractérisent par l’importance de leur surface spécifique, c’est-à-dire
par leur capacité à se lier plus ou moins spécifiquement à ce qui n’est pas eux. La surface n’est plus seulement la limite de l’objet, elle est une interface qui modifie son comportement. C’est ce que l’on peut appeler la dimension « horizontale » de l’objet relationnel. Elle est inter-objective, elle concerne les relations entre objets.
- D’autre part, l’échelle nanométrique n’est pas un niveau ultime de réalité à partir duquel les autres niveaux pourraient être déduits, c’est un domaine de transition entre l’ordre de grandeur des atomes décrit de manière privilégiée par les lois de la physique quantique, et l’ordre de grandeur méso- ou macroscopique, décrit de manière privilégiée par les lois de la physique statistique ou de la physique classique. Cette échelle relationnelle permet de coupler des propriétés appartenant aux ordres de grandeur plus petits et plus grands que le nano-objet considéré. C’est ce que l’on peut appeler la dimension « verticale » de l’objet relationnel. Elle est multi-scalaire, elle concerne les relations en échelles.
Version générée par les auteurs d’un article paru en deux volets dans Techniques de l’Ingénieur : (1) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : cartographie critique des approches existantes », TI n° RE244, 2015. (2) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : pour une approche centrée sur les objets », TI n° RE245, 2015. Le présent manuscrit présente les deux volets réunifiés, révisés et remis en page à partir de leurs versions avant publication respectives.
61
- Enfin, les nano-objets traversent les frontières entre science et société, nature et artifice, vivant et non-vivant. Non seulement ils se modifient en fonction des milieux qu’ils traversent mais ils en modifient les frontières. C’est ce que l’on peut appeler la dimension « transfrontalière » de l’objet relationnel. Cette dimension, inter-normative, fait se rencontrer et se confronter des systèmes de normes et de valeurs hétérogènes (vitales, sociales, culturelles, …). Ce caractère transfrontalier fait notamment du laboratoire, aujourd’hui, une interface complexe et un nœud d’interactions entre nature (relations de l’humain à ce qui n’est pas lui) et société (relations sociales, éthiques, économiques, culturelles, politiques des humains entre eux), entre pouvoir (et responsabilité !) de l’homme sur la matière et pouvoir (et responsabilité !) de l’homme sur l’homme.
Figure 7. Les trois dimensions du nano-objet comme objet relationnel
L’objet nano, objet relationnel : voilà à première vue une caractérisation plus consistante que celle, plus ou moins conventionnelle, formulée en fonction de la taille (La norme ISO TS 27687, par exemple précise simplement qu’un objet « nano » est un objet dont au moins une dimension est à la nanoéchelle, s’étendant approximativement de 1 nm à 100 nm). L’attention portée aux relations est par ailleurs susceptible de mieux instrumenter les débats publics. En effet, force est de constater que les conditions d’un débat fructueux ne sont toujours pas réunies – l’issue décevante du débat piloté par la Commission Nationale du Débat Public en 2009-2010 en témoigne. D’un côté en effet, on a un public qui, à force d’être renvoyé à l’image d’une masse réticente dont il faut lever l’inertie, tend à devenir
Version générée par les auteurs d’un article paru en deux volets dans Techniques de l’Ingénieur : (1) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : cartographie critique des approches existantes », TI n° RE244, 2015. (2) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : pour une approche centrée sur les objets », TI n° RE245, 2015. Le présent manuscrit présente les deux volets réunifiés, révisés et remis en page à partir de leurs versions avant publication respectives.
62
effectivement méfiant, de plus en plus convaincu que les ficelles sont tirées par les industriels et que les jeux sont de toute façon déjà faits – la prévention contre la science, ce que certains appellent « l’antiscience », a au demeurant gagné du terrain ces dernières années. D’un autre côté, des scientifiques qui, dans leur laboratoires, se livrent à des activités dont ils ne voient pas toujours le rapport avec la suspicion dont ils sont l’objet – eux aussi tendant alors à devenir méfiants vis-à-vis du public. Entre les deux, point de compréhension possible. On en voit les raisons : pour qu’un débat porte ses fruits, encore faut-il que les questions scientifiques et technologiques d’un côté, les questions des finalités de la recherche et des valeurs qu’elle engage d’un autre côté, puissent se formuler dans un référentiel commun, dans un langage partagé. Or c’est loin d’être le cas. Bien souvent en effet, les positions se crispent entre d’un côté des chercheurs qui essayent d’expliquer ce qu’ils font dans le détail (par exemple lorsqu’ils manipulent des molécules sur une surface, section 4.2.2), et d’un autre côté des citoyens qui s’en remettent à un corpus de valeurs établies, de principes généraux qui n’indiquent pas toujours la voie à suivre pour réguler les recherches. L’incommensurabilité des deux référentiels est patente. Le concept d’« objet relationnel » peut alors fournir ce référentiel commun et ce langage partagé : un objet ressaisi du point de vue de ses relations, c’est d’une part un objet que le scientifique peut décrire avec précision, en indiquant par exemple comment il fonctionnalise des surfaces en vue de telle ou telle propriété intéressante, en indiquant aussi, au vu de sa structure surfacique, comment il se liera sélectivement à telle ou telle autre entité ; mais un objet ressaisi du point de vue de ses relations, c’est aussi un objet que l’on peut appréhender sous l’angle des valeurs qu’il engage, c’est-à-dire autrement que comme un simple moyen en vue de certaines fins posées au départ. 4.4.2. Du cycle de vie au choix de vie
Tout au long de son cycle de vie, depuis la fabrication jusqu’au déchet, le nano-objet se trouvera pris dans des relations qui modifieront ses propriétés. Tel est l’enjeu majeur des études de toxicologie et d’éco-toxicologie des nanoparticules : parvenir à caractériser ces relations de manière suffisamment précise et complète pour anticiper au maximum le comportement des objets nano sur l’ensemble de leur cycle de vie. 4.4.2.1. Les difficultés de l’évaluation de la toxicité
Sur le plan épistémologique, se focaliser sur les relations qui définissent le nano-objet tout au long de son cycle de vie ne va pas cependant sans poser problème : en effet, ces relations ne sont pas entièrement anticipables, au sens où il n’est pas possible d’en établir par avance le décompte exhaustif ; elles sont, de plus, non totalisables : l’objet « nano » et les effets qu’il est susceptible de causer sont toujours plus que la somme des différents paramètres considérés pour intégrer ces relations. C’est ce que souligne un rapport de l’ex-Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (AFSSET), rendu public en mars 2010134. Ce rapport a pour but d’examiner quatre scénarios d’exposition à des nanomatériaux manufacturés : - des chaussettes antibactériennes contenant des nano-particules d’argent ;
134 AGENCE FRANCAISE DE SECURITE SANITAIRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU TRAVAIL. – Avis relatif à l’évaluation des risques liés aux nanomatériaux pour la population générale et dans l’environnement. Saisine n° 2008/005, Avis de l’AFSSET du 15 mars 2010 (2010). http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/104000168/0000.pdf (page consultée le 8 septembre 2013).
Version générée par les auteurs d’un article paru en deux volets dans Techniques de l’Ingénieur : (1) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : cartographie critique des approches existantes », TI n° RE244, 2015. (2) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : pour une approche centrée sur les objets », TI n° RE245, 2015. Le présent manuscrit présente les deux volets réunifiés, révisés et remis en page à partir de leurs versions avant publication respectives.
63
- un ciment qui contient des nanoparticules de dioxyde de titane dotées de propriétés autonettoyantes (du TiO2 sous une de ses formes cristallines, dite « anatase ») ;
- un lait solaire qui contient des nanoparticules de dioxyde de titane qui absorbent les ultra-violets (le TiO2 sous forme cristalline « rutile ») ;
- un ingrédient silice destiné à être incorporé dans du sucre de table (pour ses propriétés antimottantes, c’est-à-dire limitant l’agglomération des particules).
Notons au passage que le choix de ces nanomatériaux dans le rapport de l’AFSSET n’est pas un hasard : la France participe en effet au programme lancé par l’OCDE de cinquante-neuf tests sur quatorze matériaux nanostructurés, où elle parraine les essais de sécurité pour le TiO2 (en partenariat avec l’Allemagne), la silice (en partenariat avec l’Union Européenne) et contribue aux tests pour l’argent. Le rapport commence par rappeler que les nanoparticules, lorsqu’elles pénètrent dans les organismes, ont des propriétés d’absorption, de distribution, de métabolisme et d’excrétion différentes de celles de substances équivalentes « classiques » (y compris de même composition chimique), dont les effets sont mieux connus. Il affirme cependant que les effets de toxicité des nanoparticules sur les organismes sont dus principalement à leur composition chimique, mais couplée à leur réactivité de surface. Les effets associés à la taille des nanoparticules sont l’augmentation de la réactivité de surface, l’augmentation de la solubilité, la libération possible d’ions métalliques très réactifs, et la possible production d’espèces réactives oxygénées associée à des transferts d’électrons très rapides, cause de stress oxydant si elle se produit dans un organisme. Les nanoparticules peuvent interagir et interférer avec des constituants cellulaires. L’existence d’un risque de dysfonctionnement de la division cellulaire, notamment, a été documenté par certaines études : l’absorption par endocytose de nanoparticules de silice dans une cellule aboutirait à la formation d’agrégats de protéines aberrants provoquant l’inhibition de la réplication et de la transcription de l’ADN135. Si des cas de génotoxicité sont donc observés pour des matériaux particuliers de forme « nano » particulière dans des conditions particulières, il n’est cependant pas possible de tirer de conclusions générales quant à la génotoxicité des nanoparticules, les données étant à l’heure actuelle en nombre insuffisant pour pouvoir établir des corrélations significatives136. Il convient par conséquent de procéder à des études de toxicologie et d’écotoxicologie toujours plus spécifiques, prenant en compte non seulement la composition chimique et la dose (les études toxicologiques commencent en général par administrer des concentrations élevées avant de déterminer des seuils pertinents), mais aussi la taille, la forme, la structure cristalline, les propriétés de surface, la charge de surface, la solubilité, l’adhésion et le type de matrice dans lequel le nanomatériau est intégré. Au problème du foisonnement des paramètres pertinents (59 selon l’OCDE !) s’ajoute un problème épistémique plus préoccupant encore : celui de l’interdépendance des paramètres. Comme l’explique Michel Boissière, chimiste toxicologue dans l’équipe Biomatériaux pour la santé (BioSan) à l’Université de Cergy-Pontoise, même une notion aussi basique que celle de dose est dépendante des caractéristiques physico-chimiques des nanoparticules. En effet, classiquement, la dose est exprimée par la masse, ou par la concentration massique (c’est-à-dire la masse par unité de volume). Or plus la matière est finement divisée, plus sa surface spécifique augmente pour une même masse par volume. Ainsi le fait de modifier le diamètre des particules va modifier le nombre de particules par unité de concentration : à concentration massique égale, il y a dix fois plus de particules de 10
135 CHEN (M.) et VON MIKECZ (A.). – Formation of nucleoplasmic protein aggregates impairs nuclear function in response to SiO2 nanoparticles. Experimental cell research, vol. 305, pp. 51-62 (2005). 136 GONZALEZ (L.), LISON (D.) et KIRSCH-VOLDERS (M.). – Genotoxicity of engineered nanomaterials: A critical review. Nanotoxicology, vol. 2, pp. 252-273 (2008).
Version générée par les auteurs d’un article paru en deux volets dans Techniques de l’Ingénieur : (1) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : cartographie critique des approches existantes », TI n° RE244, 2015. (2) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : pour une approche centrée sur les objets », TI n° RE245, 2015. Le présent manuscrit présente les deux volets réunifiés, révisés et remis en page à partir de leurs versions avant publication respectives.
64
nanomètres que de particules de 200 nanomètres dans une suspension. Avec le nombre de particules, c’est aussi la surface spécifique qui va augmenter. Or c’est la surface spécifique réelle qui détermine la dose effective à laquelle est exposé un échantillon biologique – et encore cela est-il insuffisant : dans un test in vitro, l’exposition effective dépendra aussi des propriétés de décantation et de solubilité de la dispersion à laquelle on expose une culture de cellules. À cela s’ajoute le fait qu’il est parfois difficile de détecter et de mesurer la concentration des nanoparticules dans des matrices composites complexes, lesquelles affectent la mobilité et les propriétés de surface des nanoparticules. Il n’existe donc pas, à l’heure actuelle, d’expression adéquate de la dose indépendamment du type de nanomatériau, du mode d’exposition et de la cible biologique considérée. La dose est soit tenue par convention comme un paramètre indépendant (cas de la dosimétrie dite « nominale »137), auquel cas cela ne dit pas grand-chose de son influence sur la toxicité ; la dose renseigne alors davantage sur les conditions d’expérimentation de tel ou tel test que sur sa pertinence quant aux effets observés ; soit l’expression de la dose est modulée en fonction d’autres paramètres (dosimétrie « effective »), tels que la nature du nanomatériau considéré, sa taille et sa surface spécifique (mais encore faut-il avoir des tailles uniformes et des particules mono-disperses), auquel cas il est impossible d’établir des seuils pertinents ayant une validité générale. Par ailleurs, les études de toxicologie sont faites sur l’animal, des rongeurs surtout, et le cas échéant sur des cellules humaines in vitro : se pose alors le problème de l’extrapolation des résultats à l’humain. Si les études de biotoxicologie se multiplient depuis deux ou trois ans, les études d’écotoxicologie restent quant à elles peu nombreuses. Le rapport de l’AFSSET pointe les difficultés : d’abord, il est très difficile de tenir le compte exhaustif des produits commercialisés contenant des nanomatériaux. Jusqu’à très récemment, il n’y avait pas d’obligation réglementaire à ce sujet, les industriels n’étaient pas soumis à l’obligation de les déclarer. Un changement a certes été amorcé avec le décret 232 de 2012, instaurant la déclaration obligatoire Rnano. Celle-ci vise à assurer un recensement et une traçabilité des nanomatériaux et de leurs données toxicologiques dans les chaînes de production. Mais la notion de « substances à l’état nanoparticulaire », forgée par les services juridiques du Ministère de l’écologie à la suite du Grenelle de l’environnement, sur laquelle se base la déclaration Rnano, est loin d’être claire138. Cette définition normative, absente du vocabulaire juridique international, ne coïncide que partiellement avec la classification des entités « nano » établie par l’ISO. À leur tour, ces définitions, ISO et Rnano, ne correspondent que
137 LISON (D.) et THOMASSEN (L.C.J.) et al. – Nominal and effective dosimetry of silica nanoparticles in cytotoxicity assays. Toxicological Science, vol. 104, pp. 155-162 (2008). 138 Voici la définition réglemnetaire d’une « substance à l’état nanoparticulaire » : « Substance fabriquée intentionnellement à l’échelle nanométrique contenant des particules [« fragment de matière possédant des contours physiques bien définis »] non liées [c’est-à-dire des substances incorporées intentionnellement dans un mélange dont elles sont susceptibles d’être extraites ou libérées « dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d’utilisation »] ou sous forme d’agrégat [« particule constituée de particules fortement liées ou fusionnées »] ou sous forme d’agglomérat [amas de particules ou d’agrégats faiblement liés dont la surface externe globale correspond à la somme des surfaces de ses constituants individuels], dont une proportion minimale des particules, dans la distribution des tailles en nombre, présentent une ou plusieurs dimensions externes se situant entre 1 nm et 100 nm. Cette proportion minimale peut être réduite dans des cas spécifiques lorsque cela se justifie pour des raisons tenant à la protection de l’environnement, à la santé publique, à la sécurité ou à la compétitivité. Elle est précisée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture, de la santé, du travail et de l’industrie. Par dérogation à cette définition, les fullerènes, les flocons de graphène et les nanotubes de carbone à paroi simple présentant une ou plusieurs dimensions externes inférieures à 1 nm sont à considérer comme des substances à l’état nanoparticulaire ». MINISTERE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ENERGIE. Eléments issus des déclarations des substances à l’état nanoparticulaire, Rapport d’étude 2014.
Version générée par les auteurs d’un article paru en deux volets dans Techniques de l’Ingénieur : (1) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : cartographie critique des approches existantes », TI n° RE244, 2015. (2) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : pour une approche centrée sur les objets », TI n° RE245, 2015. Le présent manuscrit présente les deux volets réunifiés, révisés et remis en page à partir de leurs versions avant publication respectives.
65
partiellement aux multiples définitions mobilisés par les scientifiques selon leur discipline. La définition Rnano exclut notamment les nanoparticules et matériaux fabriqués de manière non intentionnelle, or la définition de cette « intentionnalité » est floue. De plus elle a eu pour effet d’inclure – sans l’avoir voulu – une foule de substances dont on ne pensait pas qu’elles relevaient des nanomatériaux (de grosses molécules, telles que pigments, enrobages, conservateurs, engrais et produits phytopharmaceutiques). Certains fabricants semblent avoir des difficultés à assurer la traçabilité des nanomatériaux dans les produits finis et ils ne sont pas toujours sûrs que ce qu’ils produisent relève du label « nano ». Enfin, de nombreux industriels ne disposent pas de l’équipement et des savoir-faire de caractérisation dont disposent les laboratoires de recherche – ou ne jugent pas opportun d’y investir. Une autre difficulté va nous retenir ici : les études de toxicologie portent le plus souvent sur le nanomatériau « entrant », or un nanomatériau intégré dans un produit n’a pas forcément le même comportement que le nanomatériau initial. Le cas est analogue à celui de la différence entre « identité synthétique » et « identité biologique » des nanoparticules introduites dans des organismes vivants (section 4.3.3.2), sauf qu’elles sont ici introduites dans des matériaux artificiels. Or les nanoparticules introduites volontairement dans un matériau ne sont pas nécessairement les mêmes que celles qui sont susceptibles d’être effectivement relarguées par le matériau. Le rapport de l’AFSSET mentionne par exemple une étude portant sur l’évaluation de l’impact d’une nanocharge dans un produit fini soumis à vieillissement139. Le produit est constitué d’une couche externe de vernis, d’une strate fine de fibre de verre mélangée avec une résine qui contient des nanotubes de carbone, et d’un polystyrène. L’étude a consisté à comparer deux produits presque identiques, l’un contenant des nanotubes de carbone, l’autre non. Après ponçage et perçage, les tests n’ont révélé aucune différence. Dans les deux cas, des nanoparticules sont émises mais elles proviennent essentiellement du vernis. Les enseignements de cette étude sont les suivants : un relargage de nanoparticules peut se faire sans que des nanoparticules soient introduites expressément dans le processus de fabrication ; la problématique de l’émission de nanoparticules n’est pas spécifique aux entrants « nano » mais concerne toutes les parties du produit (ici le vernis) ; l’identification des dérivés issus des entrants « nano » dans les composants relargués peut être très difficile ; ces dérivés ont toutes les chances d’être éloignés et/ou très différents de l’entrant « nano ». Autrement dit, la question des risques toxicologiques ne peut pas être traitée par réduction du complexe au simple, par analyse séparée des différents paramètres. Elle réclame une approche attentive au fait que le comportement de l’objet durant l’ensemble de son cycle de vie n’est pas déductible des seules fonctions que les concepteurs lui auront attribuées ; ce comportement dépend du type de relations que l’objet aura à son environnement, dans la fabrication, dans l’usage, dans sa dégradation, etc. Autrement dit, il ne suffit pas de s’assurer des caractéristiques du produit « nano » sur le papier, lors de sa conception, pour qu’il soit « safe » ; c’est là la limite de l’approche « safety by design »140. Il faut porter son attention sur l’objet lui-même, sur son devenir, sur les agencements dans lesquels il peut entrer et qui vont lui conférer des propriétés non prévues au départ. Il convient par conséquent d’étudier le comportement du produit sur l’ensemble de son cycle de vie, du berceau à la tombe, en prenant en compte les processus de production industrielle (les études de toxicité des nanotubes de carbone par exemple ont montré que cette toxicité, quand elle est avérée, peut s’expliquer par des impuretés générées dans le processus de fabrication), l’utilisation du produit (ce qui va notamment déterminer le mode
139 LE BIHAN (O.) et SCHIERHOLZ (K.). – Evaluation des émissions de nanoparticules à partir d’un produit fini : étude de faisabilité. Actes du Congrès français sur les aérosols, Paris (14-15 janvier 2009). 140 KELTY, op. cit, 2009.
Version générée par les auteurs d’un article paru en deux volets dans Techniques de l’Ingénieur : (1) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : cartographie critique des approches existantes », TI n° RE244, 2015. (2) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : pour une approche centrée sur les objets », TI n° RE245, 2015. Le présent manuscrit présente les deux volets réunifiés, révisés et remis en page à partir de leurs versions avant publication respectives.
66
d’exposition : inhalation, ingestion, pénétration par voie cutanée), son usure, son vieillissement et sa destruction lorsqu’il devient un déchet. Mais cela suffit-il ? Les études de toxicologie et d’éco-toxicologie, pour être complètes, devraient porter sur tel ou tel produit spécifique ; non pas sur « le nano-argent » par exemple, mais sur tel produit précis, par exemple des chaussettes antibactériennes de telle marque contenant des nanoparticules d’argent produites et intégrées au textile de telle manière. En d’autres termes, faire porter l’attention sur les relations qui définissent le nano-objet sur l’ensemble de son cycle de vie reviendrait à constituer un catalogue de tous les objets nano, étudiés de manière approfondie sous l’angle de leurs relations possibles avec leur environnement. Or à la lettre, c’est impossible. Ce serait, de plus, assumer une situation de dispersion pure et simple. Que ce programme soit ou non satisfaisant pour un toxicologue, il ne peut que décevoir les attentes du public. Une réflexion sur le sens, les valeurs et les finalités de la recherche réclame en effet un élargissement en généricité, au-delà du simple catalogue qui juxtapose les cas particuliers. 4.4.2.2. L’intégration des valeurs dans la définition des objets
Pour effectuer cet élargissement et consolider le référentiel commun, encore faut-il disposer d’un concept d’« objet » adéquat. Il nous faut donc affiner davantage notre concept d’objet relationnel. Dans Forme et objet, le philosophe Tristan Garcia141 distingue le concept d’« objet » de celui de « chose ». La distinction est certes classique en philosophie : elle consiste souvent en un éloge de la chose révélant les qualités du monde au détriment de l’objet, conçu comme face-à-face du sujet (ob-jet : « jeté contre », Gegenstand) et/ou réduit à une représentation appauvrie (une somme de propriétés)142. Ce qui nous importe est que Garcia opère cette distinction d’une manière telle qu’elle réintroduit la question des valeurs dans l’objet. Ce traité de « métaphysique orientée-objet » qu’est Forme et objet articule deux visions antagonistes mais complémentaires du réel : la vision formelle et la vision objectale. La première considère les choses : les choses sont formellement « n’importe quoi » ; le monde des choses selon Garcia est un monde ontologiquement plat, sans valeur, sans hiérarchie, où tout se vaut et où « n’importe quoi est quelque chose » : une idée, même absurde, un dieu ou une rognure d’ongle sont également des choses ; elles n’ont rien à voir entre elles ; les choses sont indéterminées, « non-relationnelles », seules au monde, chacune d’elles existe séparément dans le monde, que Garcia définit comme « la forme », le contour ou le négatif de chaque chose. La chose est le règne de l’indétermination et de l’indifférence. Il en va tout autrement des objets : l’objet est une chose qui est dans une autre chose ; l’objet est toujours déjà pris dans des échanges, dans des valeurs, dans des sociétés, dans des temporalités (dans d’autres choses qui sont aussi des objets selon la théorie de Garcia). L’objet, ce sont les choses ensemble ; parce qu’ils sont les uns dans les autres, les objets s’entredéterminent, s’accumulent et s’intensifient. Avec les objets, le monde a un relief, des valeurs, des intensités (des relations plus ou moins fortes). Cependant, l’objet reste « formellement » une chose, ce qui l’empêche de s’absolutiser (d’être réduit à ses déterminations objectives : le monde plat des choses est, dit Garcia, la « chance » de l’objet, sa capacité à être toujours autre chose que ses déterminations objectives). Garcia veut en effet éviter deux conceptions philosophiques de l’objet : - l’objet comme substance définie par une essence fixe, absolue, déterminée et identique
à elle-même (ce qu’il appelle « le compact » : l’être « bouclé sur lui-même », identité pure) ;
141 GARCIA (T.). – Forme et Objet. Un traité des choses. PUF, Métaphysiques (2011). 142 HEIDEGGER (M.). – « La chose », Essais et conférences, Gallimard, Tel, pp. 194-223 (1958).
Version générée par les auteurs d’un article paru en deux volets dans Techniques de l’Ingénieur : (1) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : cartographie critique des approches existantes », TI n° RE244, 2015. (2) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : pour une approche centrée sur les objets », TI n° RE245, 2015. Le présent manuscrit présente les deux volets réunifiés, révisés et remis en page à partir de leurs versions avant publication respectives.
67
- l’objet comme représentation découpée sur un flux de vecteurs qui ne trouve jamais d’arrêt, de butoir, de consistance ; l’objet comme fixation provisoire et illusoire d’un devenir qui lui échappe (altérité pure).
Pour éviter ces deux conceptions extrêmes, Garcia propose la solution suivante : l’être de l’objet réside dans la différence entre « ce qui est la chose » et « ce que la chose est », c’est-à-dire entre ce qui entre dans la composition de l’objet et ce dans quoi il entre. On pourra aisément appliquer cette définition à l’objet « nanoparticule » dès lors qu’elle sort des conditions strictement contrôlées du laboratoire : « ce qui est la chose », c’est sa composition, sa forme cristalline, ses caractéristiques physico-chimiques intrinsèques qui dépendent à leur tour d’objet plus petits : électrons, objets quantiques, etc., bref tout ce qui entre dans la chose ; « ce que la chose est » c’est tout ce dans quoi la chose entre : la matrice dans laquelle elle est intégrée, ses relations avec d’autres choses, mais aussi : ses usages, les valeurs dont elle est investie, et les préoccupations qu’elle suscite. L’objet « nanoparticule » consiste à la fois dans la différence et dans les relations entre ce qui entre dans la nanoparticule et ce dans quoi la nanoparticule entre (et l’on pourrait aussi retraduire cette définition dans les concepts de Simondon, en termes multiscalaires d’ordres de grandeur : la nanoparticule s’individue dans et par une relation entre plus petit et plus grand qu’elle). Il y a donc toujours une différence entre le comportement du nano-objet défini par ce qui entre dans sa composition et le comportement du nano-objet défini par ce dans quoi il entre : or nous voulons justement affirmer que le nano-objet est cette relation, laquelle inclut des valeurs. L’intégration des valeurs dans la définition de l’objet est capitale : si, d’un point de vue physique, les relations horizontales entre les objets et les relations verticales entre les ordres de grandeur peuvent aller à l’infini, ou se démultiplier indéfiniment, du point de vue des valeurs, rien n’interdit de décider de donner plus d’importance (ou d’intensité) à telle ou telle relation plutôt qu’à une autre et stopper ainsi la prolifération incontrôlée des relations. Par exemple, même si l’on ne sait pas tout des effets biologiques et environnementaux du nano-argent, on peut considérer que l’on en sait assez pour prendre une décision : par exemple interdire le nano-argent dans les textiles où il est utilisé comme dispositif anti-odeur (les particules seront forcément relarguées après quelques lavages, et introduites dans le circuit des eaux usées : biocide notoire, le nano-argent risquerait notamment de causer des dommages aux bactéries des stations de traitement des eaux usées) ; plutôt concentrer les études toxicologiques sur son utilisation dans les pansements d’hôpital et les cathéters, où il est utilisé comme antiseptique pour prévenir les infections. L’argument est simple : en prenant position, on ne trahit pas l’objet, mais on reconfigure et on stabilise son réseau de relations. Ainsi considéré, l’objet « nano » devient un véritable analyseur de nos comportements, de nos usages et de notre réflexivité environnementale. Se préoccuper des liens que nos objets tissent entre nous et le monde, entre nous et la nature, et des liens que les objets tissent entre eux, telle serait la posture éthique à laquelle pourrait nous introduire la nanotoxicologie, au-delà du simple traitement coûts/bénéfices qui en est le plus souvent fait dans les approches classiques d’évaluation de gestion des risques. Autrement dit, le mode d’existence de l’objet « nano » réclame d’aller plus loin que le rapport de l’AFSSET : les questions de toxicologie forcent nos sociétés à se penser elle-même à partir du type de rapport qu’elles ont à la matière, dans un contexte où nous devons assumer que nous ne pouvons pas disposer d’une connaissance exhaustive des effets générés par nos modes de confrontation à la matière. Dans ce contexte où l’insuffisante connaissance n’est pas un déficit susceptible d’être comblé, et où de nouvelles propriétés, de nouveaux comportements des objets peuvent toujours se manifester, il devient nécessaire de faire des choix, de décider ce qui mérite d’être développé, d’être mieux compris, au détriment de ce qui fait moins sens pour l’avenir de nos sociétés – par exemple, il ne serait pas absurde de décider qu’il est socialement préférable d’aller vers des systèmes de dépollution des eaux plutôt que
Version générée par les auteurs d’un article paru en deux volets dans Techniques de l’Ingénieur : (1) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : cartographie critique des approches existantes », TI n° RE244, 2015. (2) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : pour une approche centrée sur les objets », TI n° RE245, 2015. Le présent manuscrit présente les deux volets réunifiés, révisés et remis en page à partir de leurs versions avant publication respectives.
68
vers des chaussettes antibactériennes. L’éthique intervient précisément à partir du moment où des choix engageant le collectif sont nécessaires. La démarche scientifique d’analyse et de prévention des risques est de plus en plus nécessaire mais elle est de moins en moins suffisante si elle n’est pas accompagnée et animée par une préoccupation d’ordre moral à l’égard de nos objets. En ce sens, l’objet nano « fait monde » – de par son mode d’existence relationnel, il soulève ainsi des questions de portée morale et politique. Dans quel monde souhaitons-nous vivre ? L’objet nano doit par conséquent être considéré comme un être du monde à part entière, destiné à être pris dans une chaîne indéfinie de relations dont les effets ne peuvent pas être complètement anticipés. Les questions de nanotoxicologie nous poussent donc à faire porter l’attention sur les relations qui permettent de ressaisir les objets « nano » comme des êtres du monde et non comme de simples moyens. Cependant, on peut se demander si, pour aller jusqu’au bout de cette approche, il ne faut pas appréhender leur faire-monde par-delà la seule question des risques-bénéfices. 4.4.3. Dépasser l’analyse du risque-bénéfice
La toxicologie est généralement présentée comme une science de l’analyse des risques dont le rôle est d’accumuler des données destinées, dans un deuxième temps, à une gestion des risques prise en main par le régulateur. Or le cas des nanotechnologies montre combien cette séparation entre traitement scientifique et traitement politique des risques toxicologiques est contre-productive. En effet, les décisions politiques sont constamment reportées sous prétexte que les données sont encore en nombre insuffisant – et elles sont le plus souvent reportées au bénéfice des démarches de normalisation par le marché (section 2.3.4). Ainsi, au lieu de chercher à faire entrer de force les résultats de la nanotoxicologie dans le carcan du risque-bénéfice, on pourrait se demander si cette discipline ne gagnerait pas à être valorisée comme une science de l’écologie des relations plutôt que comme une science du risque : science des relations entre nanoparticules et milieux biologiques et/ou écosystémiques, entre inorganique et organique, milieu intérieur et milieu extérieur, mais aussi entre questions de fait et questions de valeur. Le problème est tout autant politique qu’épistémologique. D’un côté, les études toxicologiques demeurent souvent rivées à la singularité des cas. Elles portent sur tel effet de telle nanoparticule sur tel organisme modèle dans telles conditions, choisies en fonction de leur capacité à modéliser une situation d’exposition déterminée : par exemple critique ou normale, dans l’air ou dans l’eau, etc. De l’autre, elles sont soumises dans l’optique de la régulation à un cadrage risque/bénéfice très général, dont le formatage statistique induit un effet d’aplanissement de la singularité des cas et de la diversité des intérêts – « risque/bénéfices : oui mais pour qui ? », doit-on objecter : pour l’usager volontaire, pour l’usager involontaire, pour le patient, pour l’industriel, pour le travailleur, pour le distributeur, pour le politique, pour tel biotope, pour telle espèce ? Parler de risque-bénéfice en général est trompeur. La contradiction est donc la suivante : d’un côté, un idéal de réduction de l’incertitude ; de l’autre, des connaissances qui délimitent l’incertitude, mais ne la réduisent nullement. D’un côté, une trop grande singularité des cas ; de l’autre, une trop grande généralité du cadre. Or c’est cette contradiction que la notion d’objet relationnel pourrait venir lever. Elle pourrait amener à développer une conception de la singularité des cas toxicologiques comme autant de configurations de « relations qui importent ». Elle permettrait aussi de considérer la diversité des intérêts – les risques et les bénéfices « pour qui ? » – non comme ce qui vient nécessairement « fausser » l’objectivité de la recherche, mais comme ce qui « est entre nous » : l’intérêt, c’est l’être-entre (inter-esse). Il s’agirait alors
Version générée par les auteurs d’un article paru en deux volets dans Techniques de l’Ingénieur : (1) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : cartographie critique des approches existantes », TI n° RE244, 2015. (2) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : pour une approche centrée sur les objets », TI n° RE245, 2015. Le présent manuscrit présente les deux volets réunifiés, révisés et remis en page à partir de leurs versions avant publication respectives.
69
de se donner les moyens de transformer des questions de valeur en questions de fait, c’est-à-dire en protocoles adressables, « do-able » par des méthodes scientifiques ; et, réci-proquement, détecter les « faits de valeurs », les faits qui importent, au lieu de viser une illusoire réduction de l’incertitude. Pour la réalisation de la première exigence, les outils conceptuels et opérationnels existent, tels le « value-sensitive design » ou le « safety by design » (section 3.2.2.2), mais ils demandent à être complétés par des approches plus normatives adressant explicitement les conflits de valeur. L’hypothèse que nous faisons est donc que le concept d’objet relationnel est plus pertinent que l’analyse des risques. C’est effectivement aux relations qu’il faut s’intéresser si l’on veut articuler les questions technico-scientifiques et les questions de valeurs, dans le but de proposer un référentiel commun et un langage partagé. Toutefois, ce concept d’objet relationnel est peut-être encore trop large, les mailles du filet sont trop grosses. Il apparaît alors nécessaire de déterminer davantage le concept d’objet relationnel, de le pluraliser, afin d’attraper des enjeux peut-être plus fins et moins généraux que les risques-bénéfices pour « la » société. Ce référentiel commun et ce langage partagé pourraient prendre la forme d’une sorte de cartographie des différents sens de l’objet relationnel : le nanovecteur de médicament avait déjà fourni un type convaincant d’objet relationnel, l’objet oïkologique ; là où les machines moléculaires ont fait voir l’importance des dimensions relationnelles des nano-objets dans leur fonctionnement même, les nanoparticules engagent à faire varier l’intensité de ces relations en fonction de choix de valeurs ; enfin un autre objet nano souscrit à un concept encore différent de l’objet relationnel : il s’agit des biomarqueurs, objets phares de la médecine dite « personnalisée » qui a été érigée ces dix dernières années en nouvel horizon des politiques de santé à l’échelle internationale. Examinons cela. 4. 5. Médecine personnalisée 4.5.1. Le biomarqueur : définition et problèmes
Un biomarqueur, qu’il soit physiologique ou moléculaire (polymorphisme génétique, présence d’une ou plusieurs protéine(s) ou métabolite(s), …), est défini comme une donnée biologique pouvant être corrélée de façon statistiquement significative à un processus biologique (survenue d’une pathologie, développement de cette pathologie, récidive, bonne ou mauvaise métabolisation d’un médicament, …) et pouvant servir d’aide au diagnostic, au pronostic et/ou à la décision thérapeutique.
L’identification, la caractérisation et la validation des biomarqueurs apparaissent d’ores et déjà comme stratégique pour les systèmes de santé des pays développés. En effet, ces systèmes sont aujourd’hui confrontés à des défis considérables : - le vieillissement des populations et le fait que beaucoup de maladies posant des
problèmes épineux de santé publique sont aujourd’hui des maladies chroniques, c’est-à-dire des maladies dont on ne guérit pas à proprement parler et avec lesquelles il faut apprendre à vivre ;
- le coût très élevé de la recherche et développement dans l’industrie des médicaments, devenu un frein à l’innovation – ainsi, le nombre de nouvelles molécules enregistrées par l’autorité de régulation aux États-Unis, la Federal Food and Drug Administration (FDA), a chuté de 56 en 1996 à 21 en 2010143 ;
- le taux d’attrition élevé des molécules candidates en phases II et III des essais cliniques, alors que des sommes importantes ont déjà été investies ; ces taux d’échec
143 SWINNEY (D.C.) et ANTHONY (J.). – How were new medicines discovered ? Nature reviews Drug discovery, vol. 10, n° 7, p. 507-519 (2011).
Version générée par les auteurs d’un article paru en deux volets dans Techniques de l’Ingénieur : (1) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : cartographie critique des approches existantes », TI n° RE244, 2015. (2) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : pour une approche centrée sur les objets », TI n° RE245, 2015. Le présent manuscrit présente les deux volets réunifiés, révisés et remis en page à partir de leurs versions avant publication respectives.
70
élevés s’expliquent notamment par la nature des maladies en jeu – il s’agit le plus souvent de maladies multifactorielles, impliquant plusieurs gènes, dont la complexité se traduit par l’apparition de résistances aux médicaments ; ces mécanismes de résistance rendent un grand nombre de molécules inefficaces144 ;
- l’inefficacité voire la toxicité d’un certain nombre de médicaments sur un grand nombre de patients ; on estime ainsi à environ 3,5 % le pourcentage des hospitalisations annuelles dues aux effets indésirables des médicaments, aussi bien en Amérique du Nord qu’en Europe145. Des biomarqueurs pour le pronostic (permettant d’identifier des patients à risque pour
certaines pathologies), pour le diagnostic précoce, ou encore en vue de « stratifier » (classifier) les patients en fonction de leur capacité à bien ou mal répondre à des traitements (ce que l’on appelle la pharmacogénétique), permettraient de répondre à ces défis. Tel est du moins l’objectif affiché des politiques de santé qui ont inscrit la médecine personnalisée, ou médecine des biomarqueurs, parmi leurs priorités stratégiques146. 4.5.1.1 Le biomarqueur comme objet technique
On considère ici le biomarqueur moléculaire comme un objet technique au sens où : - d’une part, le biomarqueur est technologiquement constitué : il faut beaucoup de
techniques pour identifier, caractériser et valider un biomarqueur : techniques d’acquisition de données à très haut débit, comme les séquenceurs d’ADN de nouvelle génération, les biopuces et les microarrays (beaucoup de ces techniques utilisent des procédés à l’échelle nanométrique), mais aussi : des algorithmes de biostatistique et de bioinformatique pour le traitement de ces données, pour leur stockage et leur moissonnage dans des bases de données ;
- d’autre part, les biomarqueurs validés en routine clinique ont vocation à être les supports d’interventions médicales, à des fins de pronostic, de diagnostic ou de thérapie. En supportant ainsi l’action, ils souscrivent à une compréhension minimaliste de la technique, définie comme médiation de l’action humaine sur la nature ;
- enfin, la médecine personnalisée est appréhendée comme un des domaines d’application des nanobiotechnologies147 ; celles-ci pourraient en effet contribuer à améliorer les dispositifs de diagnostic moléculaire pour affiner la découverte de biomarqueurs et contribuer à une meilleure délivrance des thérapies dites « person-nalisées » par le biais notamment des nano-plateformes théranostiques (section 4.3.2).
144 ACCENTURE. – The Pursuit of High Performance through Research and Development. Understanding Pharmaceutical Research and Development Cost Drivers (2007). www.accenture.com/Microsites/rdtransformation/Documents/PDFs/Accenture_In_Pursuit_of_High_Performance.pdf (rapport consulté en ligne le 4 octobre 2013). 145 ETUDE EMIR. – Effets indésirables des Médicaments : Incidence et Risque, http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/EMIR.pdf (page consultée le 4 octobre 2013). 146 GOUVERNEMENT DU QUEBEC. – Communiqué de lancement du Projet Partenariat pour la Médecine Personnalisée en Cancer, Fevrier 2013 (2013) http://communiques.gouv.qc.ca/gouvqc/communiques/GPQF/Fevrier2013/15/c5969.html (page consultée le 5 octobre 2013). FEDERAL FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. – Biomarker Qualification Program (2012) http://www.fda.gov/Drugs/DevelopmentApprovalProcess/DrugDevelopmentToolsQualificationProgram/ucm28076.htm (page consultée le 5 octobre 2013). VERNANT (J.-P.). – Recommandations pour le troisième Plan Cancer. Rapport à la Ministre des affaires sociales et de la santé et à la Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche (2009) http://www.sante.gouv.fr/publication-du-rapport-final-sur-le-bilan-du-plan-cancer-2009-2013,13463.html (page consultée le 5 octobre 2013). 147 JAIN (K.K.). – Role of nanobiotechnology in developing personalized medicine for cancer. Technology in Cancer Research and Treatment, vol. 4, pp. 645-650 (2005).
Version générée par les auteurs d’un article paru en deux volets dans Techniques de l’Ingénieur : (1) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : cartographie critique des approches existantes », TI n° RE244, 2015. (2) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : pour une approche centrée sur les objets », TI n° RE245, 2015. Le présent manuscrit présente les deux volets réunifiés, révisés et remis en page à partir de leurs versions avant publication respectives.
71
5.1.2 Les difficultés de la validation des biomarqueurs
Le biomarqueur moléculaire peut donc être appréhendé comme un objet technique. Mais de quel genre d’objet technique s’agit-il ? Pour en saisir le sens, il convient de regarder plus en détail quel type d’information livre un biomarqueur. Cet examen peut se faire en prêtant attention aux difficultés qu’il y a à valider un biomarqueur.
Ces difficultés se révèlent particulièrement épineuses lorsqu’on passe d’une approche par « gène candidat » (consistant à identifier un gène d’intérêt et à tester une hypothèse unique sur ce gène unique) à une approche de type « génome entier », consistant à accumuler des données sur un très grand nombre de gènes et à faire tourner des algorithmes de biostatistique et de bioinformatique pour faire apparaître des corrélations significatives (sous forme de pics statistiques).
À l’heure actuelle, les grandes études d’association (appelées GWAS, genome wide association studies) ont permis de mettre en évidence certaines corrélations intéressantes entre variants génétiques et réponses à des médicaments, mais dans l’ensemble, les résultats sont mitigés148. Très peu de résultats ont été obtenus sur des corrélations entre variants génétiques et maladies. Les biomarqueurs prédictifs de la survenue de maladies restent un défi149, sinon une promesse s’avérant difficile à tenir. Les biomarqueurs aujourd’hui validés sont pour l’essentiel des biomarqueurs pharmacogénétiques, par exemple, le biomarqueur du « métabolisateur rapide » ou celui de « métabolisateur lent » de médicaments. Les marqueurs génétiques les plus utilisés en recherche sont les Single Nucleotide Polymorphisms (« polymorphisme base nucléique simple ») ou SNPs (prononcer « snips »). Les SNPs sont des mutations ponctuelles entraînant la possibilité d’un nucléotide alternatif en un endroit de la séquence d’ADN. Chacun d’entre nous est porteur d’environ trois millions de SNPs. Certains variants génétiques se retrouvent chez un grand nombre d’individus et sont appelés SNPs communs, d’autres au contraire sont des SNPs rares voire orphelins. Or, les variants génétiques qui contribuent à l’explication du phénotype pathologique sont pour beaucoup des mutations rares, voire très rares : on ne les trouve que chez quelques patients. Les variants communs, que l’on trouve chez de nombreux patients, n’expliquent qu’une faible part des phénotypes150. Il est par conséquent difficile de monter en généralité et de mettre au point un test qui soit suffisamment significatif pour servir d’aide à la décision thérapeutique en clinique. Des biomarqueurs ont certes pu être identifiés dans plusieurs études portant sur une pathologie déterminée, mais ces biomarqueurs ne sont pas nécessairement les mêmes d’une étude à l’autre. Des pics statistiques ont été mis en évidence, mais ils n’impliquent pas forcément les mêmes loci d’une étude à l’autre (un locus est fragment d’ADN sur un chromosome)151. Par ailleurs, des biomarqueurs ont pu être corrélés à des pathologies très différentes, sans rapport entre elles sur le plan physiopathologique152 : il apparaît par conséquent impossible d’utiliser ces biomarqueurs dans la routine clinique, à des fins de diagnostic. Dans le cas des cancers, l’hétérogénéité et la mutabilité des tumeurs entraînent souvent des phénomènes de résistance aux traitements et rendent difficile la mise au point de thérapies ciblées153. Enfin, même dans les cas où des corrélations sont identifiées et validées 148 DELPECH (M.). – L’identification des biomarqueurs. Revue du Rhumatisme, vol. 78, pp. 161-164 (2011). 149 VAIDYANATHAN (G.). – Redefining Clinical Trials : the Age of Personalized Medicine, Cell, vol. 148, pp. 1079-1080 (2012). 150 GARCHON (H.-J.) et DIEUDE (P.). – Les biomarqueurs en génomique : comment cela fonctionne-t-il ? Revue du Rhumatisme, vol. 78, 165-168 (2011). 151 DURRETT (R.) & al. – Intratumor Heterogeneity in Evolutionary Models of Tumor Progression. Genetics, vol. 188, pp. 461-77 (2012). 152 VERWEIJ (J.), DE JONGE (M.), ESKENS (F.) et SLEIJFER (S.). – Moving molecular targeted drug therapy towards personalized medicine : Issues related to clinical trial design. Molecular Oncology, pp. 1-8 (2012). 153 VENTOLA (C.L.). – Pharmacogenomics in Clinical Practice. P&T, vol. 36, pp. 412-416, 419-422, 450 (2011).
Version générée par les auteurs d’un article paru en deux volets dans Techniques de l’Ingénieur : (1) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : cartographie critique des approches existantes », TI n° RE244, 2015. (2) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : pour une approche centrée sur les objets », TI n° RE245, 2015. Le présent manuscrit présente les deux volets réunifiés, révisés et remis en page à partir de leurs versions avant publication respectives.
72
(notamment des corrélations variants génétiques/réponses à des médicaments), ces corrélations n’ont généralement pas une valeur universelle : leur validité a souvent une forte composante géographique et ethnique, ce qui soulève une importante question éthique154.
En résumé, il est rare que l’identification, la caractérisation et la validation d’un variant génétique puisse conduire à une décision clinique de type « go – no go » (oui ou non). Identifier de bons biomarqueurs conduit à améliorer les probabilités, non à la certitude pour tel ou tel patient. D’autres altérations moléculaires peuvent être impliquées et entraîner un phénomène de résistance à des traitements. Cela est très fréquent dans les cancers : le génome tumoral est en effet instable, polymorphe, et hautement résilient ; il mute en permanence ; le cancer est de plus en plus appréhendé comme un processus de type darwinien qui multiplie les variations et accroît ainsi son adaptabilité – et donc sa résistance aux médicaments. Un biomarqueur renvoie par conséquent toujours à d’autres biomarqueurs, qui peuvent, le cas échéant, à un moment ou à un autre, affecter sa fonction prédictive, diagnostique, pronostique ou pharmacogénétique. L’objet « biomarqueur » doit être appréhendé comme un système de renvoi indéfini d’altération moléculaire à altération moléculaire, de variation à variation. Un exemple tiré de l’oncologie permettra de se faire une idée plus précise de cela.
4.5.2 Le cas de l’EGFR
Le récepteur du facteur de croissance épidermale (epidermal growth factor receptor, EGFR) est un récepteur protéique présent à la surface des cellules (figure 8).
Figure 8. Voies de signalisation de l’EGFR
154 HUNT (M.L.) et KREINER (M.J.). – Pharmacogenetics in Primary Care : The Promise of Personalized Medicine and the Reality of Racial Profiling. Culture, Medicine and Psychiatry, vol. 37, pp. 226-235 (2013).
Version générée par les auteurs d’un article paru en deux volets dans Techniques de l’Ingénieur : (1) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : cartographie critique des approches existantes », TI n° RE244, 2015. (2) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : pour une approche centrée sur les objets », TI n° RE245, 2015. Le présent manuscrit présente les deux volets réunifiés, révisés et remis en page à partir de leurs versions avant publication respectives.
73
L’EGFR est impliqué dans plusieurs « voies de signalisation » intracellulaires, c’est-à-dire qu’il active des cascades de « signaux » (d’interactions entre protéines) qui activent l’accomplissement de certaines fonctions de la cellule. L’EGFR comporte deux domaines, un domaine extra-cellulaire et un domaine intra-cellulaire (« domaine kinase ») localisés de part et d’autre de la membrane de la cellule. La fixation des facteurs de croissance sur le domaine extra-cellulaire induit une modification dans le domaine intra-cellulaire ; cette modification active à son tour plusieurs voies de signalisation. Une mutation de l’oncogène v-erb-B, qui encode une version tronquée de l’EGFR, favorise la croissance déréglée des cellules et par conséquent les cancers.
L’EGFR apparaît ainsi comme une cible thérapeutique d’intérêt dans le cas des patients dont les tumeurs sur-expriment l’EGFR (on trouve à la surface des cellules tumorales un nombre de récepteurs du facteur de croissance bien supérieur à la normale). L’inhibition de l’activité du récepteur peut cibler soit le domaine extra-cellulaire (la partie du récepteur située à la surface extérieure de la cellule) sur laquelle viennent se fixer les facteurs de croissance (l’action inhibitrice se fait en empêchant les facteurs de croissance de venir se fixer sur le récepteur), soit le domaine intra-cellulaire, le domaine kinase situé dans la cellule (l’action inhibitrice consiste alors à empêcher une réaction chimique appelée trans-phosphorylation, ce qui a pour effet de bloquer toute une cascade d’autres réactions et in fine l’activation des différentes voies de signalisation).
Il existe actuellement des anticorps monoclonaux qui agissent au niveau du domaine extra-cellulaire et des inhibiteurs de tyrosine kinase qui agissent au niveau du domaine intra-cellulaire. Ces traitements sont prescrits chez les patients qui sur-expriment l’EGFR dans plusieurs cancers, par exemple les cancers du poumon à petites cellules ou encore les cancers colorectaux métastatiques. Or ces traitements peuvent être rendus inefficaces par l’existence d’autres mutations génétiques155. Ainsi, la mutation du gène qui code pour l’une des protéines intervenant dans l’une des voies de signalisation activées par l’EGFR, la protéine RAS (codée par le gène KRAS), entraîne-t-elle une résistance à l’un des anticorps monoclonaux. Le gène muté code en effet pour la protéine uniquement dans sa conformation activée : la voie de signalisation reste par conséquent toujours ouverte. La mutation d’une autre protéine, sur une autre voie de signalisation (la protéine PTEN), se traduit également par une résistance aux traitements anti-EGFR. Le point important est que l’efficacité des anti-EGFR chez les patients qui ne présentent aucune de ces deux mutations n’est pas absolument garantie pour autant : cela reste encore de l’ordre de la probabilité. D’autres mutations peuvent encore entrer en jeu et affecter l’efficacité des traitements…
En d’autres termes, l’identification d’un biomarqueur d’intérêt pour prendre une décision thérapeutique (dans le cas présent, sur-expression d’EGFR, KRAS muté, PTEN mutée) ne signifie pas que l’on sort du probabilisme pour entrer dans le domaine de la certitude individuelle : on est plutôt conduit à rechercher indéfiniment des nouveaux biomarqueurs.
4.5.3 Le biomarqueur comme objet-trace
4.5.3.1. D’altération en altération
La situation est encore compliquée par le fait qu’on ne peut pas espérer remonter, depuis la masse des altérations moléculaires qui constituent un profil biologique individuel, jusqu’à du
155 CHRETIEN (A.S.). – Marqueurs prédictifs de réponse aux anticorps monoclonaux anti-EGFR dans le cancer colorectal métastatique. Exemple d’analyse intégrée de marqueurs multiples, thèse pour le diplôme d’Etat de Docteur en Pharmacie, soutenue le 8 novembre 2011 à l’Université Henri Poincaré Lille I (2011) http://docnum.univ-lorraine.fr/public/SCDPHA_T_2011_CHRETIEN_ANNE-SOPHIE.pdf (page consultée le 6 octobre 2013).
Version générée par les auteurs d’un article paru en deux volets dans Techniques de l’Ingénieur : (1) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : cartographie critique des approches existantes », TI n° RE244, 2015. (2) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : pour une approche centrée sur les objets », TI n° RE245, 2015. Le présent manuscrit présente les deux volets réunifiés, révisés et remis en page à partir de leurs versions avant publication respectives.
74
non-altéré originaire. Les génomes des individus diffèrent entre eux par un très grand nombre de petites variations et altérations. Toutefois, on ne peut conclure que ces altérations sont du dérivé par rapport à une situation non altérée originaire. Un gène dit « sauvage », par opposition à un gène muté, n’est pas un gène-origine dans l’existence de l’individu. La médecine personnalisée signifierait précisément la fin d’un certain type de raisonnement médical fondé sur la définition de la norme comme standard, comme moyenne, comme étalon à partir duquel des écarts peuvent être identifiés – raisonnement que le philosophe Georges Canguilhem voyait encore puissamment à l’œuvre dans la médecine technoscientifique de son temps156.
La situation, déjà compliquée, se révèle alors absolument complexe si l’on tient compte du fait que pour les maladies multifactorielles, le problème de l’origine est le plus souvent insoluble. On ne sait pas quand a commencé le processus pathologique ; on est toujours dans du déjà commencé, dans du déjà altéré. Une maladie comme Alzheimer, multifactorielle s’il en est, est constitutivement en défaut d’origine. En somme, la médecine fondée sur les biomarqueurs est une médecine pour laquelle l’étiologie des maladies se perd dans un ensemble indéfini et ouvert d’altérations moléculaires, renvoyant les unes aux autres, sans qu’il soit possible d’en faire jamais le décompte exhaustif. Ce défaut d’origine constitutif de la vie, cette structure de renvoi de déjà-altéré à déjà-altéré qui définit le biomarqueur, cette impossibilité d’appréhender les processus vitaux à partir d’un événement premier que l’on pourrait rendre à nouveau présent dans la connaissance, les philosophes Jacques Derrida et Emmanuel Lévinas avaient proposé de les ressaisir sous le concept de la « trace »157. La médecine fondée sur les biomarqueurs ne cherche pas à restituer un événement originaire, mais plutôt à suivre la série indéfinie des altérations moléculaires qui sont venues s’ajouter les unes aux autres durant la vie du patient.
On voit ainsi qu’on est loin du fantasme véhiculé par les discours d’accompagnement les plus hype de la médecine personnalisée : faire descendre dans les molécules toute l’histoire de l’individu, retrouver au niveau moléculaire l’intégralité de l’histoire du patient, c’est-à-dire tout ce qui lui est arrivé, tous les événements survenus dans sa vie. Il s’agit plutôt de suivre pas à pas, de trace en trace, de biomarqueur en biomarqueur, la mémoire qui s’est inscrite dans ces mécanismes moléculaires.
Le cas du cancer est emblématique de cette distinction entre histoire et mémoire : considérer les tumeurs comme des processus évolutionnaires, en transformation permanente (ainsi qu’on le fait maintenant), revient à les envisager comme des phénomènes mémoriels plutôt que sous l’angle des événements qui arrivent à l’individu. Le cancer se constitue, en quelque sorte pour son propre compte, une espèce de mémoire des thérapies et évolue en conséquence, par adaptation : l’intervention thérapeutique doit découler de la capacité à suivre littéralement « à la trace » cette mémoire en construction continuelle, plutôt qu’à identifier une altération inaugurale qui aurait déclenché la cancérogenèse. 4.5.3.2 Les deux sens de la personne
Cette brève étude épistémologique du biomarqueur nous a permis d’esquisser un nouveau sens de l’objet « nano » comme objet relationnel : l’objet-trace, objet relationnel dans la mesure où il constitue un système indéfini de renvoi de trace à trace. Il convient alors d’en déployer la valeur pour la régulation éthique des sciences et des techniques, en montrant par exemple que définir le biomarqueur comme « trace » permet de surmonter la tension qui
156 CANGUILHEM (G.). – Le Normal et le pathologique [1943], Paris, PUF, (1966). 157 DERRIDA (J.). – De la grammatologie. Paris, Les éditions de Minuit (1967). LEVINAS (E.). – La trace de l’autre, in E. Levinas, En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger. Paris, Vrin, [1949], pp. 261-282 (2006).
Version générée par les auteurs d’un article paru en deux volets dans Techniques de l’Ingénieur : (1) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : cartographie critique des approches existantes », TI n° RE244, 2015. (2) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : pour une approche centrée sur les objets », TI n° RE245, 2015. Le présent manuscrit présente les deux volets réunifiés, révisés et remis en page à partir de leurs versions avant publication respectives.
75
insiste dans les discours d’accompagnement de la médecine personnalisée, et qui risque d’en fragiliser l’édifice : tension entre, d’un côté, une approche « personnalisée » de la maladie et des traitements au niveau moléculaire, c’est-à-dire, au fond, à un niveau très « impersonnel » si l’on définit la personne avant tout par sa capacité à s’emparer subjectivement de sa propre situation, et à lui donner un sens (puis-je vraiment me ressaisir comme « personne » au niveau de mes caractéristiques moléculaires ?) et, d’un autre côté, les attentes de patients qui veulent d’abord que la médecine s’occupe de leurs difficultés concrètes, à la fois psychologiques, familiales, sociales, professionnelles, etc. Le défaut d’articulation entre ces deux sens du « personnel », entre le personnel-moléculaire et le personnel-subjectif, risque fort de créer des malentendus et in fine des frustrations chez les patients.
L’hypothèse esquissée ici est qu’en prêtant attention au biomarqueur comme objet-trace, il est possible de mieux articuler ces deux sens du « personnel ». Ce point est actuellement en cours d’étude et fera l’objet d’un nouveau programme de recherche sur les conceptions de la « personne » dans la médecine personnalisée. Contentons-nous de souligner, au terme de cette étude, que le questionnement éthique sur ce qu’est et sur ce que doit être la personne de la médecine personnalisée passe par un questionnement épistémologique sur le mode d’existence des objets de la médecine personnalisée : le biomarqueur comme objet-trace.
Conclusion
Les nanosciences et nanotechnologies ont été placées très tôt sous le signe d’une volonté politique d’intégrer, en amont, la question de leurs « enjeux éthiques et sociétaux ». Dans ce contexte, les démarches « d’accompagnement » des technosciences par les SHS se sont multipliées, et diverses approches de l’éthique des NST ont été proposées. Dans ce dossier, nous avons dressé le bilan de près d’une décennie d’implication des SHS dans l’accompagnement de la recherche et de l’innovation en NST. Nous avons proposé une cartographie raisonnée des différentes démarches d’accompagnement des NST par les SHS en ce qui concerne leur problématisation du questionnement éthique. Nous avons soutenu que les développements technoscientifiques concrets des NST et les questions de valeurs qu’ils suscitent devaient être mieux articulés.
Nous avons voulu ensuite aller plus loin en proposant une approche originale permettant de renouer les défis technoscientifiques des NST et la question axiologique des valeurs et des finalités de la recherche et de l’innovation. Nous avons pour cela introduit un concept d’objet technique susceptible de favoriser cette articulation entre enjeux techno-épistémologiques et enjeux axiologiques : le concept d’objet relationnel.
Nous avons précisé que ce concept ne pouvait être opératoire qu’à la condition de ne pas fonctionner comme un nouveau mantra, une sorte de mot-valise commode et applicable sans autre précision à tous les cas concrets. Si le nanovecteur de médicament et le bio-marqueur de la médecine personnalisée souscrivent tous deux au concept d’objet relationnel, ce n’est toutefois pas dans le même sens. De cette pluralisation du concept d’objet relationnel dépendra sa valeur heuristique, sa puissance de questionnement des objets de laboratoire et des enjeux de valeur qu’ils soulèvent. Une « philosophie de terrain » est ainsi une philosophie pour laquelle les concepts ne précèdent pas les objets mais les suivent pour les accompagner vers le monde commun. Les concepts doivent encaisser l’hétérogénéité des objets. À cette condition seulement, selon nous, la philosophie peut contribuer utilement à une meilleure articulation entre vie, technique et société.
Version générée par les auteurs d’un article paru en deux volets dans Techniques de l’Ingénieur : (1) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : cartographie critique des approches existantes », TI n° RE244, 2015. (2) S. Loeve & X. Guchet, « Ethique et épistémologie des nanotechnologies : pour une approche centrée sur les objets », TI n° RE245, 2015. Le présent manuscrit présente les deux volets réunifiés, révisés et remis en page à partir de leurs versions avant publication respectives.
76
Annexes Normes, standards et réglementations cités :
ISO TC 229 Comité technique nanotechnologies. AFNOR X457 Commission de normalisation nanotechnologies. ISO TS 27687:2008 Nanotechnologies – Terminologie et définitions relatives aux nano-
objets – Nanoparticule, nanofibre et nanofeuillet. Décret n°2012-232 du 17 février 2012 relatif à la déclaration annuelle des substances à l’état nanoparticulaire pris en application de l’article L. 523-4 du code de l’environnement – JO n° 0043 du 19 février 2012, page 2863, texte n°4, NOR: DEVP1123456D. Liste des laboratoires visités :
Machines moléculaires artificielles : - Laboratoire de Chimie Organo-Minérale (LCOM), Université de Strasbourg
http://www-chimie.u-strasbg.fr/~lcom/Recherche/machines.html - Groupe Nanosciences Moléculaires de l’Institut des Sciences Moléculaires d’Orsay.
Laboratoire de PhotoPhysique Moléculaire (LPPM), Université Paris Sud Orsay http://www.ismo.u-psud.fr/spip.php?rubrique31
- Laboratoire d’Electrochimie Organique et de Photochimie Redox (LEOPR), Université Joseph Fourrier Grenoble http://www.ujf-grenoble.fr/recherche/chimie-biologie-sante/laboratoires/departement-de-chimie-moleculaire-1445462.htm
- Groupe Nanosciences (GNS) du Centre d’Elaboration des Matériaux et des Systèmes (CEMES), Toulouse, http://www.cemes.fr/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=216<emid=43
Nanovecteurs de médicaments : - Institut Galien, Université Paris Sud
http://www.umr-cnrs8612.u-psud.fr/ - Laboratoire Matière et Systèmes Complexes (MSC), Université Paris Diderot
http://www.msc.univ-paris-diderot.fr/spip.php?rubrique81&lang=fr - Nanomedicine Lab, London School of Pharmacy
http://www.nanomedicinelab.com/people-and-purpose-2/purpose/ Bio- et écotoxicologie des nanoparticules : - Equipe de Recherche sur les Relations Matrice Extracellulaire-Cellule (ERR-MECe).
Université de Cergy-Pontoise http://errmece.u-cergy.fr/?page_id=137
- Physiopathologie de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO). Université Paris Est Créteil Val-de-Marne http://www.imrb.u-pec.fr/poles/pole-1-regeneration-fonctionnelle-et-bio-therapies /equipe-n-4-j-boczkowski-physiopathologie-de-la-bronchopneumo-pathie-chronique-obstructive-et-autres-consequences-respiratoires-de-l-inha-lation-de-particules-de-l-environnement–297653.kjsp
Médecine personnalisée : - Institut Gustave Roussy, UMR 981 : Biomarqueurs prédictifs et nouvelles stratégies
moléculaires en thérapeutique anticancéreuse http://www.gustaveroussy.fr/fr/page/umr-981-biomarqueurs-_3280
- Institut Cochin, Département Développement, Reproduction et Cancer http://cochin.inserm.fr/Departements/gd