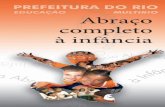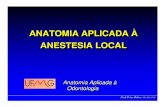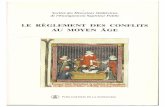•DUMONT G., 2009. Une nécropole d’époque mérovingienne à Pont-à-Celles/Viesville, Cella,...
Transcript of •DUMONT G., 2009. Une nécropole d’époque mérovingienne à Pont-à-Celles/Viesville, Cella,...
1
Une nécropole d’époque mérovingienne à Pont-à-Celles/Viesville
Gaëlle Dumont, Centre de Recherches archéologiques de l’Université libre de Bruxelles
(CReA) – Service de l’Archéologie du Ministère de la Région wallonne en province de
Hainaut
Depuis juin 2004, une zone d’une centaine d’hectares située sur les communes de
Pont-à-Celles/Viesville et Pont-à-Celles/Luttre est réservée à l’installation d’une zone
d’activité économique mixte. Étant donné la proximité du vicus de Liberchies et le riche
potentiel archéologique de la région, des investigations archéologiques sont indispensables.
La première d’entre elles a été menée par le Centre de Recherches archéologiques de
l’Université libre de Bruxelles (CReA) et le Service de l’Archéologie du Ministère de la
Région wallonne en province de Hainaut entre août 2005 et décembre 2006, et a porté sur
quatre parcelles où du matériel mérovingien avait été récolté en prospection1.
1. Le contexte archéologique
De nombreuses traces d’occupation humaine ont été mises en évidence à proximité du
site (fig. 1). L’abondance de silex récoltés en prospection laisse supposer une occupation
préhistorique. On connaît également des objets isolés remontant à l’Âge du Fer, pour la
plupart découverts au siècle dernier2, mais c’est à l’époque romaine que le peuplement se
densifie dans la région, autour de la chaussée Bavay-Cologne qui conduit au vicus de
Liberchies, situé à moins de 2 km au nord-est de la nécropole. Sur le territoire de Viesville, de
nombreuses découvertes monétaires témoignent de l’implantation humaine3.
L’époque médiévale est nettement moins bien connue : une nécropole mérovingienne
aurait existé à Luttre, mais aucune information n’est disponible à son propos4. Les ruines
Nous tenons à remercier Mr Philippe Saerens pour nous avoir signalé le site et pour son aide. 1 Pont-à-Celles, 7e Div., Sect. A, n° 336, 337, 338 et 339. Coord. Lambert 152,916 est/131,641 nord. 2 Un poignard du Hallstatt final provenant de Luttre (DE LOË, 1937, p. 235-236 ; DE LAET, 1979, p. 498-500 ; MARIËN, 1989, p. 28-30) et des objets en os découverts à Viesville (EECKMAN et GILOT, 1893, p. 60 ; SCHUERMANS, 1895, p. 413). 3 CHOTIN, 1866, p. 186 ; DELFORGE, 1996 ; DELFORGE, 1997, p. 5-6 ; GAILLY , 1978, p. 17 ; KAISIN, 1901, p. 232 ; Séances Mons, 1858-1859, p. 9 ; Séances Mons, 1861-1862, p. 31 ; THIRION, 1967, p. 166-167 ; THIRION, 1972, p. 101 ; Topographie, 1866, p. 49 ; VAN BASTELAER, 1888, p. 183 ; VAN BASTELAER, 1891, p. 579 ; VANDER ELST, 1868, p. 23. 4 VAN BASTELAER, 1888, p. 183.
2
d’une fortification médiévale édifiée dans le centre de Viesville étaient encore visibles au
XVII e siècle au moins5.
2. Les vestiges romains
Une tombe à incinération d’époque romaine se trouvait au sud-est de la nécropole
mérovingienne, un peu à l’écart de celle-ci (fig. 2 et 3). Le mobilier, qui peut être daté du IIIe
siècle ap. J.-C., comporte six récipients en céramique et quatre en verre, ainsi qu’un grand
clou en fer et trois fragments de tuiles.
Il faut également signaler la présence d’objets romains dans certaines tombes
mérovingiennes : une femme portait un collier de perles sur lequel était enfilé un antoninien
en argent de Philippe II, percé en médaille6 (fig. 4). Dans une autre tombe se trouvait une
fibule circulaire émaillée décorée de petits carrés rouges et bleus, ornés chacun d’un damier
noir et blanc (fig. 5). Enfin, le collier passé au cou d’une défunte comportait une anse
delphiniforme récupérée sur une aryballe romaine (fig. 6).
3. La nécropole mérovingienne
a. L’organisation générale (fig. 2)
La nécropole est installée sur un versant orienté au sud, dominant le village actuel de
Viesville. Cette disposition est tout à fait habituelle, la plupart des cimetières mérovingiens se
situant sur une hauteur visible depuis l’habitat7.
On y dénombre 145 inhumations, mais il faut tenir compte de l’érosion qui a fait
disparaître un nombre indéterminé de sépultures, surtout dans la moitié sud du site.
L’ensemble s’inscrit dans un espace quadrangulaire qui couvre une superficie de 2500 m²
environ. Aucune trace de délimitation n’a été repérée, mais les limites étant relativement
claires, on peut émettre l’hypothèse que le cimetière était ceint d’une palissade ou d’un fossé
qui ont complètement disparu dans l’érosion, voire d’une haie qui n’a pas laissé de traces.
5 Séances Mons, 1861-1862, p. 31 ; KAISIN, 1901, p. 232 ; Topographie, 1866, p. 49 ; CHOTIN, 1866, p. 186 ; PINCHART, 1848-1850, p. 13. 6 Identifié par Johan Van Heesch, Cabinet des Médailles, Bibliothèque royale de Belgique, Bruxelles. 7 KOCH, 1996, p. 727 ; DURAND, 1988, p. 154 ; BELLANGER et SEILLIER, 1982, p. 10 ; PÉRIN, 1967, p. 7 ; PÉRIN, 1972a, p. 24.
3
Les sépultures sont orientées selon un axe général nord-est/sud-ouest (la tête toujours
au sud-ouest), organisées en rangées lâches et irrégulières. Elles ne se recoupent dans aucun
cas, ce qui laisse penser qu’elles étaient signalées en surface par un dispositif quelconque,
dont nous n’avons aucune idée8.
b. Les cercueils
Tous les défunts ont été inhumés dans des cercueils, eux-mêmes déposés dans une
fosse rectangulaire aux extrémités et aux angles arrondis. L’humidité du sol et le jus de
décomposition des cadavres ont imprégné et colmaté les planches des cercueils, dont les
traces sont visibles sous la forme de traces brun foncé ou noires.
Deux catégories de cercueils ont été observées : les cercueils monoxyles (c'est-à-dire
taillés dans un tronc d’arbre) et les cercueils faits de planches assemblées par un système de
tenons et mortaises ou de chevilles, plus rarement par des clous ; la plupart des cercueils
assemblés sont déposés sur deux traverses (fig. 7). Il faut en outre mentionner quatre cas de
cercueils doubles, c'est-à-dire deux contenants emboîtés l’un dans l’autre (fig. 8). Le cercueil
interne est toujours un coffre assemblé, tandis que le contenant externe peut être monoxyle ou
assemblé.
Des vestiges du couvercle peuvent être partiellement conservés, mais leur mode de
construction n’a pu être déterminé ; il est probable que les cercueils monoxyles étaient
couverts par l’autre moitié du tronc, les autres possibilités étant un couvercle plat, en bâtière
ou trapézoïdal.
Des échantillons de bois encore bien conservés ont été prélevés sur 25 cercueils, leur
identification a montré que l’essence utilisée était le chêne9.
Chaque type de cercueil, qu’il soit monoxyle, assemblé ou double, est utilisé
indifféremment pour les adultes et les enfants, de sexe masculin et féminin.
Les deux types sont représentés en proportions pratiquement égales10, mais il frappant
de constater que les cercueils monoxyles sont surtout concentrés dans la moitié nord-est de la
nécropole, tandis que les cercueils assemblés sont plutôt présents dans la moitié sud-ouest et
8 Le plus vraisemblable est que les fosses étaient rebouchées par les déblais de creusement, la terre excédentaire formant un tertre sur la tombe. 9 Analyse par Christophe Buydens, bio-ingénieur. 10 45 cercueils monoxyles (et 10 douteux) et 46 cercueils assemblés (et 2 douteux), auxquels il faut ajouter 38 cercueils trop mal conservés que pour être déterminés.
4
le long des bordures nord et sud ; on n’observe toutefois pas de séparation nette, et les
imbrications entre les deux zones sont nombreuses (fig. 9). Il serait tentant de voir dans cette
répartition une évolution chronologique, mais seule l’étude du matériel permettra de
confirmer cette hypothèse.
c. Les restes humains
En raison de l’acidité et de l’humidité du sol, les matières organiques ont
complètement disparu : les os les plus importants (crânes et membres) ne sont plus conservés
que sous la forme de silhouettes argileuses. Toute observation d’ordre anthropologique est
donc exclue, ce qui nous prive d’informations telles que l’âge, le sexe et les pathologies, mais
aussi la façon dont le cadavre a été déposé dans la tombe et les rites funéraires.
L’âge et le sexe ont par conséquent dû être déterminés à l’aide d’autres critères : ainsi,
les cercueils dont la longueur n’excède pas 140 cm ont été attribués à des enfants, et ceux qui
varient de 160 à 167 cm à des adolescents ou à des adultes de petite taille (fig. 10). Comme
cela a déjà été observé sur d’autres sites, les enfants sont sous-représentés, surtout en regard
de ce que devait être la mortalité infantile à cette époque11 : probablement que, moins
profondes, elles ont disparu dans l’érosion.
Quant au sexe, il est déduit du mobilier funéraire : on considère comme typiquement
masculines les armes et les aumônières portées à la ceinture, les femmes se reconnaissant à
leur parure. Les récipients en céramique, verre, bois et métal, les boucles de ceinture, les
monnaies, les forces et les couteaux se retrouvent indifféremment dans les tombes masculines
et féminines. On compte à Viesville 51 hommes et 55 femmes, les 39 sépultures restantes
contenant du matériel « mixte » ou non identifiable, voire pas de matériel du tout (fig. 11).
d. Le mobilier
1. Le mobilier masculin
Les armes en fer constituent l’essentiel des offrandes déposées dans les sépultures
masculines. Les plus fréquentes sont les haches (fig. 12) et les lances (fig. 13), nettement plus
rares sont les boucliers12 (fig. 14), qui sont systématiquement accompagnés d’une épée et de
11 LOHRKE, 2004, p. 20 ; SASSE, 1986, p. 57 ; ALENUS-LECERF, 1978, p. 6. 12 Relativement rare dans les nécropoles mérovingiennes, on le retrouve dans trois tombes à Viesville.
5
son fourreau parfois orné d’appliques en alliage de cuivre ; l’épée peut également être
présente sans le bouclier13 (fig. 12). Des flèches complètent parfois l’armement, mais aucune
trace d’arc ou de carquois n’a été identifiée (fig. 12).
L’aumônière – bourse en tissu ou en cuir attachée à la ceinture – est un attribut
masculin largement répandu. Elle est munie d’un fermoir allongé en fer aux extrémités
courbes et d’une petite boucle et contient divers ustensiles tels que briquets en fer et silex,
pinces à épiler et monnaies (fig. 12 et 15).
2. Le mobilier féminin
Les femmes s’identifient à leur parure, qui peut être abondante et variée : fibules de
formes diverses, en argent ou en alliage de cuivre (fig. 16 et 17), boucles d’oreille en argent
(fig. 18), bracelet en alliage cuivreux ou formé d’un enfilage de grosses perles en pâte de
verre (fig. 19). Le bijou le plus courant est le collier de perles, en ambre ou en pâte de verre
(fig. 20)14.
Le costume des femmes se caractérise également par une multitude d’objets reliés à la
ceinture par une lanière de cuir ou de tissu. La fonction de ces objets est variable : utilitaire,
décorative ou symbolique ; certains – tels que les perles (fig. 8), les anneaux (fig. 16), les clefs
et les fusaïoles – sont typiquement féminins, tandis que d’autres – couteaux, forces, peignes –
peuvent également être associés aux hommes.
3. Le mobilier mixte
Certaines catégories d’objets se retrouvent aussi bien dans les tombes masculines que
féminines. Il s’agit par exemple des monnaies15, des peignes en os (dont ne subsistent que les
rivets en fer) et surtout des boucles de ceinture. Ces dernières sont très fréquentes, qu’elles
soient en potin, en alliage cuivreux ou en fer. Elles peuvent posséder un ardillon droit,
tronconique ou scutiforme16 et être accompagnées de deux ou trois rivets assortis, ornant le
13 C’est le cas dans huit tombes. 14 Ils sont composés de 5 à 163 perles (une quarantaine en moyenne) mélangeant dans la plupart des cas ambre et pâte de verre très colorée, dans des proportions variables: il n’y a en général pas plus d’une dizaine de perles en ambre par collier, mais dans quelques cas exceptionnels elles sont majoritaires. 15 Dans les tombes masculines, les monnaies font partie du contenu de l’aumônière, tandis que dans les tombes féminines elles sont déposées sur la poitrine ou à proximité du crâne. 16 En forme de bouclier.
6
ceinturon (fig. 21 et 22). Les plaques-boucles, extrêmement fréquentes au VIIe siècle, ne sont
ici que très faiblement représentées, et sont de type très précoce (fig. 23).
Les ustensiles tels que les forces (ciseaux) en fer et surtout les couteaux sont assez
répandus, souvent attachés à la ceinture ou suspendu au bout d’une cordelière.
La céramique est l’offrande la plus fréquemment répandue, les tombes pouvant
contenir de un à cinq vases (fig. 8, 16, 24 et 25), le plus souvent déposés au pied du cercueil.
Les formes et les décors sont variés et doivent encore être étudiés en détail : les récipients
biconiques (fig. 26), majoritaires, voisinent avec les vases à panse globulaire (fig. 24), les
cruches (fig. 25) et les vases à col droit ; il faut également noter la présence assez importante
de céramique sigillée (fig. 12, 16 et 24).
Par contre, les seaux en bois avec anse et cerclages en fer sont relativement rares17 (fig.
8, 24 et 25), tout comme la verrerie (fig. 16, 27, 28 et 29).
e. Les tombes privilégiées
La plupart des fouilles de nécropoles mérovingiennes ont mis en évidence des tombes
privilégiées appartenant à des personnages importants au sein de la communauté. Les indices
pour reconnaître ces tombes sont multiples18 : mise en exergue de la tombe au sein du
cimetière, soin apporté à l’élaboration de la tombe, et bien entendu richesse des offrandes
funéraires (tant en quantité qu’en qualité).
À Viesville, les quatre cercueils doubles relèvent de cette volonté de mise en valeur,
non seulement par le soin apporté à la construction du cercueil, mais également par les
dimensions appréciables et le mobilier qui a été déposé dans la sépulture (seau en fer, verrerie,
dépôt multiple de céramiques, bijoux et armement). D’autres tombes se distinguent par leurs
dimensions hors normes, tant en surface qu’en profondeur, ou bien par l’abondance et la
qualité de leur mobilier. Il est intéressant de constater que dans la plupart des cas ces tombes
sont creusées à proximité l’une de l’autre et appartiennent à un homme et à une femme.
f. Datation
La datation des tombes mérovingiennes repose sur l’étude du matériel, ce qui suppose
que celui-ci soit « lisible », et par conséquent restauré. Étant donné que ce n’est pas encore le
17 Six tombes en ont livré un exemplaire. 18 YOUNG, 1986, p. 70-73 ; AMENT, 1986, p. 44 ; ROOSENS, 1973, p. 397.
7
cas pour Viesville, et en attendant une étude complète, notamment de la céramique, on ne
proposera ici qu’une datation générale.
Nous nous référons à la typochronologie établie par René Legoux, Patrick Périn et
Françoise Vallet19, élaborée grâce au traitement par permutation matricielle de 1200 tombes
réparties sur 70 cimetières situés entre la Lorraine et la Basse-Normandie, les datations
absolues (terminus post quem) étant fournies par les monnaies, voire la dendrochronologie
lorsque c’était possible20. Nous en utilisons les codes et les dénominations, ainsi que les
phases chronologiques, qui se succèdent comme suit : protomérovingien (PM : 440/450 à
470/480), mérovingien ancien 1 (MA1 : 470/480 à 520/530), mérovingien ancien 2 (MA2 :
520/530 à 560/570), mérovingien ancien 3 (MA3 : 560/570 à 600/610), mérovingien récent 1
(MR1 : 600/610 à 630/640), mérovingien récent 2 (MR2 : 630/640 à 660/670) et mérovingien
récent 3 (MR3 : 660/670 à 700/710).
Après un premier examen du matériel de Viesville, une conclusion s’impose : dans
aucun cas on ne trouve de matériel postérieur au MA3, toutes les tombes sont donc à situer au
VIe siècle. En outre, aucun objet typique du VIIe siècle, tels que plaques-boucles
damasquinées, grandes fibules rondes à umbo central ou fibules ansées symétriques n’est
présent.
Conclusion
Les fouilles de la nécropole mérovingienne de Viesville constituent une nouvelle étape
dans la connaissance du peuplement ancien dans la région de Pont-à-Celles ; en effet,
jusqu’ici, c’était surtout l’époque romaine – avec le vicus de Liberchies et les fortifications du
Bas-Empire à « Brunehaut » et aux « Bons-Villers » – qui était bien connue.
Le site était déjà occupé à l’époque romaine, comme en témoigne la tombe à
incinération. Toutefois, aucune autre tombe romaine n’a été repérée, et il est peu probable que
le cimetière mérovingien ait complètement oblitéré une nécropole antérieure. Quelques objets
19 LEGOUX et al., 2004. 20 Il faut toutefois souligner les limites de cette approche : la nécropole de Viesville se situe en marge de l’aire géographique concernée par cette typochronologie, le système est parfois trop rigide et doit être affiné à l’aide de typologies plus précises ou plus adaptées à la région étudiée. Enfin, il est tentant de dater les objets individuellement, or ce sont les combinaisons d’objets dans une tombe qui permettent de la situer dans le temps de façon fiable. Toutefois, le recours à cette typochronologie est valable si on veut proposer une première datation.
8
romains, ramassés probablement pour leur caractère curieux, ont été déposés dans certaines
tombes mérovingiennes.
La nécropole mérovingienne, qui compte 145 sépultures, a sans doute connu une
occupation relativement courte, comme le laissent penser l’homogénéité de son organisation
et du mobilier déposé dans les tombes. Un premier survol du matériel nous situe au VIe siècle,
avec quelques indices plaidant pour la première moitié du siècle.
Nous ne savons pas où se situait l’habitat lié au cimetière, mais il est probable qu’il
correspondait plus ou moins au centre du village actuel (en effet, l’habitat se développe en
général en fond de vallée21) ; nous ignorons également si la nécropole appartenait à une seule
ou à plusieurs communautés.
L’étude de l’organisation de la nécropole et des structures constituait une première
étape. Il est maintenant nécessaire de disposer du matériel restauré : en effet, pour que la
compréhension du site soit complète, il manque un certain nombre d’informations –
essentiellement chronologiques – que seul le mobilier pourra nous fournir : les datations
précises de chaque tombe permettront non seulement d’affiner la chronologie générale du site,
mais également de mettre en évidence une chronologie relative entre les sépultures et
éventuellement de dégager plusieurs phases d’utilisation. On pourra également attribuer une
valeur chronologique à des éléments qui ne sont pas datables en eux-mêmes, comme les types
de cercueils ou leurs dimensions. L’étude de la céramique, quant à elle, apportera bon nombre
de nouvelles informations sur les productions régionales et sur leur circulation.
Bibliographie
ALENUS-LECERF J., 1978. Le cimetière mérovingien de Hamoir. II. Étude, Bruxelles
(Archaeologia Belgica, 201), p. 11-12.
AMENT H., 1986. Tombes privilégiées de l'époque mérovingienne en Rhénanie. In : DUVAL
Y. et PICARD J.-Ch. (ed.), L'inhumation privilégiée du IVe au VIIIe siècle en occident. Actes
du colloque tenu à Créteil les 16-18 mars 1984, Paris, p. 43-45.
21 VERSLYPE, 2002, p. 44.
9
ANSIEAU C., DENIS M. et DUMONT G., 2006, La nécropole mérovingienne de Pont-à-
Celles/Viesville : premiers résultats (Ht.), Chronique Archaeologia Mediaevalis, 29, Gand.
ANSIEAU C., DENIS M. et DUMONT G., 2007. Pont-à-Celles/Viesville : nécropole
mérovingienne. Premiers résultats, Chronique de l’archéologie wallonne, 14, p. 65-66.
ANSIEAU C. et DUMONT G. (sous presse). Pont-à-Celles/Viesville : nécropole
mérovingienne. Suite et fin de la fouille, Chronique de l’archéologie wallonne, 15.
BELLANGER G. et SEILLIER Cl., 1982. Répertoire des cimetières mérovingiens du Pas-de-
Calais, Arras (Bulletin de la Commission départementale d'histoire et d'archéologie du Pas-
de-Calais, n° spécial), p. 10.
CHOTIN A.-G., 1866. Études étymologiques et archéologiques sur les noms des villes,
bourgs, villages, hameaux, forêts, lacs, rivières et ruisseaux de la Province du Hainaut,
Tournai.
DE LAET S. J., 1979. Prehistorische kulturen in het Zuiden der Lage Landen, Wetteren.
DELFORGE A., 1996. Un sesterce de Gordien III (238-244) trouvé à Viesville (arr. Charleroi,
prov. Hainaut), Cercle d'Études numismatiques. Bulletin trimestriel, 33, p. 58-59.
DELFORGE A., 1997. Découverte d’un sesterce de Gordien III à Viesville, Cella, 69, p. 5-7.
DE LOË A., 1937. Musées royaux d'Art et d'Histoire à Bruxelles. Belgique ancienne.
Catalogue descriptif et raisonné. III. La période romaine, Bruxelles.
DIERKENS A., 1986. La tombe privilégiée (IVe-VIII e siècles) d'après les trouvailles de la
Belgique actuelle. In : DUVAL Y. et PICARD J.-Ch. (ed.), L'inhumation privilégiée du IVe au
VIIIe siècle en occident. Actes du colloque tenu à Créteil les 16-18 mars 1984, Paris, p. 47-56.
DURAND M., 1988. Cimetières et habitats : l'émergence du village au sud-est du département
de l'Oise. In : Actes des VIIIe Journées internationales d'archéologie mérovingienne de
Soissons (19-22 juin 1986), Amiens (Revue archéologique de Picardie, 3-4), p. 153-160.
10
EECKMAN A. et GILOT F., 1893. Guide du visiteur dans le Musée archéologique et
paléontologique de Charleroi classé suivant l’ordre chronologique établi dans ce Musée,
Documents et rapports de la Société paléontologique et archéologique de l’arrondissement
judiciaire de Charleroi, 19, p. 37-78.
GAILLY R., 1978. La chaussée romaine Bavay – Tongres – Cologne. Traces et découvertes
en Hainaut, Bulletin de la Société de Recherche historique et folklorique de l’entité de
Seneffe, 4, p. 15-20.
KAISIN M., 1901. Rapport de la fouille faite aux Bons-Villers à Liberchies, Documents et
rapports de la Société paléontologique et archéologique de l’arrondissement judiciaire de
Charleroi, 25, p. 223-286.
KOCH U., 1996. Die Menschen und der Tod. In : Die Franken. Wegbereiter Europas. Vor
1500 Jahren. König Chlodwig und seine Erben, Mannheim – Mayence, p. 723-737.
LEGOUX R., PÉRIN P. et VALLET Fr., 2004. Chronologie normalisée du mobilier funéraire
mérovingien entre Manche et Lorraine, s. l. (Bulletin de liaison de l'Association française
d'Archéologie mérovingienne, hors-série).
LOHRKE B., 2004. Kinder in der Merowingerzeit. Gräber von Mädchen und Jungen in der
Alemannia, Rahden (Freiburger Beiträge zur Archäologie und Geschichte des ersten
Jahrtausends, 9).
MARIËN M. E., 1989. Aperçu de la période hallstattienne en Belgique. In : OTTE M. et
ULRIX -CLOSSET M., La civilisation de Hallstatt, bilan d'une rencontre, Liège, 1987, Liège
(Études et Recherches archéologiques de l'Université de Liège, 36), p. 9-32.
PÉRIN P., 1967. Les Ardennes à l'époque mérovingienne, Études ardennaises, 50, p. 1-46.
PÉRIN P., 1972a. Les caractères généraux des nécropoles mérovingiennes de la Champagne
du Nord et de Paris, Septentrion, 3, p. 23-36.
11
PÉRIN P., 1987. Des nécropoles tardives aux nécropoles du Haut-Moyen Âge. Remarques sur
la topographie funéraire en Gaule mérovingienne et à sa périphérie, Cahiers archéologiques,
35, p. 9-30.
PINCHART A., 1848-1850. Seconde notice sur des antiquités gallo-romaines trouvées dans le
Hainaut, Mémoires couronnés et mémoires des savants étrangers, publiés par l'Académie
royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, 23.
PROOS H. P., 1993. Grafkuilvolume als indicator van rijkdom en status in merovingische
rijengrafvelden ? In : DRENTH E. et al. (red.), Het tweede leven van onze doden.
Voordrachten gehouden tijdens het symposium over het grafritueeel in de pre- en
protohistorie van Nederland op 16 mai 1992 te Amersfoort, Amersfoort (Nederlandse
archeologische rapporten, 15), p. 41-51.
ROOSENS H., 1973. Siedlung und Bevölkerungsstruktur im Spiegel merowingischer
Gräberfelder. Zu den jüngsten Ergebnissen der Reihengräberforschung in Belgien. In : PETRI
Fr. (éd.), Siedlung, Sprache und Bevölkerungsstruktur im Frankenreich, Darmstadt (Wege der
Forschung, 49), p. 383-399.
SASSE B., 1986. Demographisch-soziale Untersuchungen an frühmittelalterlichen
Frauengräbern im Bereich der Reihengräberzivilisation. In : AFFELDT W. et KUHN A. (ed.),
Frauen in der Geschichte VII, Interdisziplinäre Studien zur Geschichte der Frauen im
Frühmittelalter. Methoden – Probleme – Ergebnisse, Düsseldorf (Geschichtsdidaktik. Studien
Materialen, 39), p. 56-87.
SCHUERMANS H., 1895. Découvertes d’antiquités en Belgique, Westdeutsche Zeitschrift für
Geschichte und Kunst, 14, p. 412-418.
Séances Mons, 1858-1859. Bulletin des Séances du Cercle archéologique de Mons.
Séances Mons, 1861-1862. Bulletin des Séances du Cercle archéologique de Mons.
THIRION M., 1967. Les trésors monétaires gaulois et romains trouvés en Belgique, Bruxelles
(Cercle d’Études numismatiques. Travaux, 3).
12
THIRION M., 1972. Le trésor de Liberchies. Aurei des Ier et IIe siècles, Bruxelles.
Topographie, 1866. Topographie des cinq cantons de l’arrondissement de Charleroi,
Documents et rapports de la Société paléontologique et archéologique de l’arrondissement
administratif de Charleroi, 1, p. 29-66.
VAN BASTELAER D.-A., 1888. Les cimetières francs dans l’arrondissement de Charleroi,
Documents et rapports de la Société paléontologique et archéologique de l’arrondissement
judiciaire de Charleroi, 16, p. 179-210.
VAN BASTELAER D.-A., 1891. Petite chronique des découvertes archéologiques faites dans
l’arrondissement de Charleroi, Documents et rapports de la Société paléontologique et
archéologique de l’arrondissement judiciaire de Charleroi, 17, p. 575-581.
VANDER ELST P.-C., 1868. Assemblée générale. Séance du 6 août 1866, Documents et
rapports de la Société paléontologique et archéologique de l’arrondissement administratif de
Charleroi, 2, p. 19-25.
VERSLYPE L., 1996. La représentation des modes d'inhumation dans les aires funéraires
mérovingiennes. Méthodologie et étude critique d'un cas hennuyer : la nécropole de Rebaix.
In : LODEWIJCKX M. (ed.), Archaeological and Historical Aspects of West-European
Societies. Album Amicorum André Van Doorselaer (Acta Archaeologica Lovaniensia
Monographiae, 8), Louvain, p. 301-319.
VERSLYPE L., 2002. Pagus Hainoensis : réflexion sur l'apport des sources archéologiques à
l'étude des structures territoriales mérovingiennes, Annales du Cercle royal d'Histoire et
d'Archéologie d'Ath et de la Région et musées athois, 58, p. 7-100.
VERSLYPE L., 2003. À la vie, à la mort. Considérations sur l'archéologie et l'histoire des
espaces politiques, sociaux et familiaux mérovingiens. In : NOËL R. et al. (ed.), Au-delà de
l'écrit. Les hommes et leurs vécus matériels au Moyen Âge à la lumière des sciences et des
techniques. Nouvelles perspectives. Actes du Colloque international de Marche-en-Famenne.
13
16-20 octobre 2002, Louvain-la-Neuve (Typologie des sources du Moyen Âge occidental,
hors-série), p. 405-460.
YOUNG B. K., 1986. Quelques réflexions sur les sépultures privilégiées, leur contexte et leur
évolution surtout dans la Gaule de l'est. In : DUVAL Y. et PICARD J.-Ch. (ed.), L'inhumation
privilégiée du IVe au VIIIe siècle en occident. Actes du colloque tenu à Créteil les 16-18 mars
1984, Paris, p. 69-88.