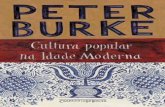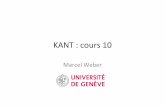De l'Angleterre à la France. Métaphysiques des moeurs chez Burke. Colloque international sur les...
Transcript of De l'Angleterre à la France. Métaphysiques des moeurs chez Burke. Colloque international sur les...
PAGE 13
DE L’ANGLETERRE À LA FRANCE.
MÉTAPHYSIQUES DES MŒURS CHEZ BURKE
On aurait tort de réduire la critique de la Révolutionfrançaise menée par Burke à une rhapsodie d’argumentsécrite dans le feu de l’action n’ayant pour seule idéedirectrice qu’une tentative de condamnation et dedélégitimation d’une situation politique radicalementnouvelle. La dimension polémique des Reflections offreégalement la défense et la promotion d’un système anglais,marqué par la préséance d’un droit coutumier, qui donne uneimportance politique réelle aux mœurs. L’étymologie latinede mos offre à ce titre une piste de réflexion : ce termesignifie tant la coutume comprise comme usage et commetradition que le droit coutumier compris comme Lex nonscripta, c’est-à-dire comme légitimation non-statutaire depratiques effectives.
Dans cette perspective, saisir la signification desmœurs au sein de ce contexte polémique implique d’analyserles raisons de la critique burkienne ainsi que leursconséquences sur un plan théorique. Si les événements de1789 semblent être l’expression d’une radicale nouveautésur la scène politique, l’insistance portée sur ce dont ilsapparaissent être la négation implique par conséquentd’étudier en priorité la conception juridique et politiquequi est, selon Burke, mise en péril.
Toutefois, parler de métaphysiques des mœurs souligne unedimension supplémentaire à l'antagonisme posé entre cesdeux systèmes : la découverte d’un aspect spéculatifcaractéristique permettant de les identifier et deconstater que l’affrontement idéologique excède la sphèrepolitique. Les mœurs ne peuvent se laisser restreindre à unrôle seulement juridique ; la nature de leur dimensionnormative signifie tout autant une mentalité à l’œuvre,c’est-à-dire une organisation solidaire entre descomportements et des institutions.
Partir de l’Angleterre pour aller vers la France, c’estentreprendre un parcours qui nous fasse comprendre une
PAGE 12
réalité à partir d’un point de vue extérieur. Loin deconstituer un obstacle nous empêchant de saisir ce que laRévolution française offre de nouveau dans son élaborationd’un système de mœurs, une telle partialité du regardconstitue bien plutôt l’occasion de mieux comprendre lesenjeux de l’antagonisme ainsi établi. La critique del’abstraction propre aux Droits de l’homme1 ne peut secomprendre indépendamment de la défense du systèmecoutumier de la Common Law ; le discrédit porté sur lafausseté de l’universel doit s’articuler à une promotion dela force prescriptive de l’histoire dans la légitimation dudroit.
Le système moral anglais, expression de la Common LawMœurs et droit coutumier partagent un trait
fondamental : leur caractère non-écrit. Dans le systèmejuridique de la Common Law, les lois se divisent en effeten deux espèces : la Lex Scripta et la Lex non-Scripta :
Les lois de l’Angleterre peuvent facilement être divisées en deux espèces, c’est-à-dire la LexScripta, la loi écrite, et la Lex non Scripta, la loi non-écrite. Comme nousle montrerons après, bien que toutes les lois du Royaume soientprésentes par écrit dans des monuments ou des mémoires, toutes netrouvent pas leur origine dans l’écriture ; certaines de ces lois ontobtenu leur force par une coutume ou un usage immémoriaux, et ces loissont proprement appelées Leges non Scriptae, lois non-écrites ou coutumes2.
Les coutumes se voient ainsi comprises dans la secondecatégorie, celle des lois ayant obtenu leur force (c’est-à-dire le principe normatif) par un usage immémorial. Plusieurs1 « Les “droits” dont nous parlent ces théoriciens ont tous le même caractère absolu ; et autant ils sont vrais métaphysiquement, autant ils sont faux moralement et politiquement. » Edmund Burke, « Réflexions sur la Révolution deFrance », texte établi et traduit par Pierre Andler, préface et annotation de Philippe Raynaud, Réflexions sur la Révolution de France : Suivi d'un choix de textes de Burke sur la Révolution. Paris : Hachette Littérature, 1989, p. 76 (dorénavant : Réflexions).2 « The Laws of England may aptly enough be divided into two Kinds, viz. Lex Scripta, the written Law: and Lex non Scripta, the unwritten Law: For although(as shall be shewn hereafter) all the Laws of this Kingdom have some Monumentsor Memorials thereof in Writing, yet all of them have not their Original in Writing; for some of those Laws have obtain'd their Force by immemorial Usage or Custom, and such Laws are properly call'd Leges non Scriptae, or unwritten Laws or Customs. » (Traduction personnelle), in Matthew Hale, History of the Common Law, Texte établi par Charles M. Gray, Chicabo, University of Chicago Press, 1971, p. 3 (dorénavant : History).
PAGE 13
traits du droit coutumier anglais peuvent déjà êtresoulignés ; si les mœurs, au sens commun, secaractérisaient par un usage hérité et reconduit depratiques, cette continuité coutumière, dans son acceptionjuridique, se voit érigée au rang de principe delégitimation : la coutume devient loi non-écrite parce qu’elleexprime un comportement, une organisation locale ounationale qui, par sa longévité, était éligible d’une telleratification. Mais, contrairement à ce qu’on pourraitcroire, Leges Scriptae comme Leges non Scriptae étaient toutes deuxinscrites dans des registres ; ce qui les distingueconcerne l’origine de leur légitimation, la source danslaquelle elles puisent leur force de loi. Cette distinctionexprime ainsi deux régimes complémentaires de normativiténous permettant de comprendre le rapport du droit aux mœurs; un régime historique d’une part, caractérisé par ladatation, par l’inscription écrite d’une décision, et unrégime anhistorique d’autre part, dont le mouvementcaractéristique consiste à repousser l’origine des us etcoutumes, à la comprendre de jure comme antérieure auxregistres et à l’écriture : en bref, à assigner les mœurs,les comportements normatifs à une temporalité sans repèrechronologique délimité3.
C’est sur cette base que nous pouvons comprendrel’immémorialité, concept au cœur de la pensée juridiqueanglaise au XVIIe et XVIIIe siècles. Considérer l’originedes mœurs et, par extension, des Leges non Scriptae, commeimmémoriales, c’est ipso facto leur prêter une forceprescriptive et une autorité supérieure aux décisionsprésentes, susceptibles d’être irréfléchies ouinsuffisamment pesées par rapport au poids du passé. Àpremière vue, on aurait ici une caractérisation abstraitede la dimension métaphysique des mœurs, où l’argument del’immémorialité interviendrait pour légitimer toute coutumedont l’origine déborderait un cadre historique précis. Ellerenvoie toutefois dans l’esprit de Burke et des Common-3 « […] les fondations de nos lois coutumières présentes sont au-delà d’un registre mémorable marquant quelconque commencement, et il en était déjà de même lorsque les conquérants Normands les trouvèrent dans le royaume d’Angleterre. », Edward Coke, « Préface du VIIIe Report », texte établi par Steve Sheppard The Selected Writings and Speeches of Sir Edward Coke, vol.1, Indianapolis, Liberty Fund, 2003, p. 767, Traduction personnelle (dorénavant : Reports)
PAGE 12
Lawyers dont il s’inspire à une conception plus concrète etplus fondamentale pour penser le politique, l’AncienneConstitution :
Notre réforme la plus ancienne est celle de la Grande Charte. Vousverrez en les lisant avec quelle diligence sir Edward Coke, cet oraclede notre droit, ainsi que tous les grands légistes qui l’ont suivijusqu’à Blackstone, se sont appliqués à mettre en lumière l’anciennetéde nos libertés. Ils ont voulu démontrer que notre Grande Charte,celle du roi Jean, se rattachait à une autre Charte datant d’HenriIer, et que l’une et l’autre ne faisaient que réaffirmer les lois envigueur dans le royaume à une époque plus ancienne encore4.
Concept politique, l’Ancienne Constitution apparaît à lafrontière entre le mythe anhistorique et le faithistorique. En effet, elle est à la fois apparentée à laGrande Charte ratifiée en 1215, mais lui est égalementantérieure ; référent mobile, son assignation à un momentdonné peut, en droit, tomber dans un processus derégression à l’infini. Cependant, elle sert d’argumentmajeur pour penser la continuité de coutumes immémorialesdonnées au sein d’un corps, lui-même immémorial. Dans cetteperspective, la fonction normative des mœurs comprises dansle droit pourra différer en fonction des lecturespartisanes qui en seront faites. La ratification de laMagna Carta incarne ce moment particulier où le pouvoirroyal concède des libertés suite à une pression exercée parles barons. Deux grandes lectures de cet événementparticulier ont eu lieu dans l’histoire constitutionnelleanglaise : la première, tory, percevrait ce geste royalcomme l’affirmation d’un pouvoir qui, parce qu’il étaitdéjà en place, doit persister et primer dans l’organisationpolitique ; la seconde, whig, comprendrait cet événementcomme le recul du roi devant une assemblée de baronsconsidérée comme un proto-Parlement – un recul signifiantcomme par avance la nécessité de la prédominance desChambres sur l’instance royale. Ce qu’il nous faut retenirde ces deux lectures, c’est la dimension anachronique duregard porté sur le passé et sur l’immémorial, livrantainsi une certaine compréhension des mœurs, du droit
4 Edmund Burke, Réflexions, ouvr. cit., p. 40.
PAGE 13
coutumier et de leur continuité historique permettant lajustification de revendications partisanes présentes.
Ainsi, la métaphysique des mœurs anglaise suppose,conformément au caractère non-écrit de la coutume, unefondation immémoriale sujette à des interprétationspartisanes multiples. Ces considérations impliquent unautre présupposé : celui d’une continuité des mœurs, d’unepersistance d’un contenu moral donné – présupposénécessaire pour penser la pertinence de l’héritage du passépour le présent. Cette conception peut s’incarnerthéoriquement dans ce que Burke appelle philosophie de l’analogie,méthode ou doctrine qu’il s’efforce de distinguer d’unesuperstition d’antiquaire :
Aussi, dans cet État où les choses se font suivant la marche de lanature, les parties améliorées ne sont-elles jamais entièrementnouvelles, ni les parties conservées entièrement caduques. Manifestéede cette façon et pour ces raisons, la fidélité que nous témoignons ànos aïeux ne s’inspire d’aucune superstition d’antiquaire, mais d’unephilosophie de l’analogie5.
Faire de l’origine immémoriale des mœurs leur sourceprescriptive comporte le danger d’une subordination desbesoins présents aux décisions passées ; dans cetteperspective, la superstition d’antiquaire transcriraitcette posture consistant à glorifier la sagesse du passépour elle-même. Toutefois, une telle lecture manquerait uneautre dimension essentielle des mœurs au regard du droitcoutumier : son adaptation constante aux circonstances :
En considérant la nature des lois en général, qui se sontaccommodées aux conditions, aux exigences et aux commodités du peuple,par qui et pour qui elles sont faites, et comme ces exigences etcommodités se développent insensiblement parmi le peuple, à denombreuses reprises il se trouve une variation insensible des lois6.
5 Ibid., p. 40.6 « From the Nature of Laws themselves in general, which being to be accommodated to the Conditions, Exigencies and Conveniencies of the People, for or by whom they are appointed, as those Exigencies and Conveniencies do insensibly grow upon the People, so many Times there grows insensibly a Variation of Laws », Matthew Hale, History, ouvr. cit., IV, Traduction personnelle, p. 39.
PAGE 12
Constitutives d’une histoire par l’articulation del’immémorial, du daté et du présent, les mœurs suivent enmême temps un cours naturel, une « marche de la nature »selon laquelle elles ne sont jamais nouvelles, nitotalement caduques. Autrement dit, la philosophie del’analogie comprend une double signification ; analogie,d’une part, entre les cas passés et les cas présents afinde prendre la bonne décision (ce qui permet d’expliquerl’éloge de la jurisprudence comme « science suprême7 » dela part de Burke) et d’autre part, entre le cours de lanature et le processus d’adaptation des mœurs. Lapersistance de mœurs jugées immémoriales pour le présents’explique ainsi par leur capacité à varier insensiblementà travers le temps, leur permettant de répondre à desbesoins toujours nouveaux.
À partir de cette métaphysique des mœurs fondée surl’analogie, il est désormais possible de saisir plus enprofondeur l’antagonisme institué par Burke entre laRévolution française et le système politique et juridiqueanglais. La force adaptative des mœurs ouvre en effet surune pensée de la réforme :
Nous souhaitions à l’époque de la Révolution, comme nous souhaitonsencore aujourd’hui, ne devoir tout ce que nous possédons qu’àl’héritage de nos aïeux. Nous avons eu grand soin de ne greffer sur levieux tronc de notre patrimoine aucun scion qui ne fût point de lanature de l’arbre originaire. Toutes les réformes que nous avonsfaites jusqu’à ce jour se sont inspirées de ce même principe de laréférence au passé ; et j’espère et suis même persuadé que toutescelles qui pourraient être entreprises à l’avenir seront prudemmentconduites par analogie avec les précédents, l’autorité et l’expériencedu passé8.
Le principe de l’analogie, permettant de saisir lemouvement naturel des mœurs dans l’histoire, apparaîtégalement opératoire pour corréler décision politique etexpérience du passé. La prudence et l’excellence de l’hommed’État consisteront dans son aptitude à mettre en balance
7 « La jurisprudence […] avec tous ses défauts, ses redondances et ses erreurs, n’en constitue pas moins le recueil de la raison de tous les siècles,où se conjuguent les principes originaires de la justice et la variété infiniedes intérêts humains » Edmund Burke, Réflexions, ouvr. cit., p. 120-121.8 Edmund Burke, Réflexions, ouvr. cit., p. 220.
PAGE 13
la pertinence de la sagesse ancestrale avec les nécessitésdu monde nouveau, c’est-à-dire dans sa capacité à réformertout en conservant9. Rien d’étonnant à ce que la pensée d’unerefonte intégrale du gouvernement, excluant toute réformeau profit de « constructions expérimentales »10, fasseapparaître aux yeux de Burke la Révolution française commeun « chaos étrange » ou une « monstrueuse tragi-comédie11 ».
Critique de la dimension spéculative de la Révolution française
Afin de saisir le nerf de la critique burkienne, il estnécessaire de repartir sur le terrain anglais des idéespour y puiser une compréhension plus profonde du pouvoirdes mœurs. Ce serait une erreur de croire en l’uniformitédes thèses touchant le système moral promu par Burke et lesCommon-Lawyers ; bien au contraire, les attaques de Hobbescontre Coke au XVIIe siècle autour du concept de raisonartificielle témoignent de cette hétérogénéité des points de vue:
Le roi en tant que tel ne peut juger d’aucune affaire […] elle doitêtre décidée et jugée dans une cour de justice, selon la loi et lacoutume d’Angleterre. […] Il est bien vrai que Dieu avait doté SaMajesté d’une science excellente et de grands dons naturels, mais SaMajesté n’est pas savante dans les lois de son royaume d’Angleterre,et des causes qui concernent la vie ou l’héritage ou les biens ou lafortune de ses sujets ne doivent pas être décidées par la raisonnaturelle mais par la raison artificielle et le jugement du droit,lequel droit est un art qui exige une longue étude et beaucoupd’expérience avant qu’on puisse arriver à la connaître12.
9 « Réformer tout en conservant, c'est une autre affair. Quand on veut garderce qu'un établissement ancien présente d'utile, et bien adapter aux partiesconservées ce qu'on y introduit de nouveau, il est besoin d'un espritvigoureux, d'une attention soutenue, de ces divers talents qui permettent lescomparaisons et les combinaisons, enfin de toutes les ressources d'uneintelligence fertile en expédients […] », Edmund Burke, Réflexions, ouvr. cit.,p. 215.10 Ibid, p. 161.11 « Tout bien considéré, la révolution française est la plus étonnante quisoit jamais survenue dans le monde […] Tout paraît hors de nature dans cechaos étrange où la légèreté le dispute à la férocité et où tous les crimes semêlent indistinctement à toutes les folies. Comment cette monstrueuse tragi-comédie n'inspirerait-elle pas tour à tour, et parfois même tout ensemble, lessentiments les plus opposés ? », Ibid, p. 13.12 Edward Coke, Reports, XII, ouvr. cit., p. 1373.
PAGE 12
La raison artificielle incarne ainsi une constructioncollective et historique, de nature jurisprudentielle,développée progressivement par la sagesse des siècles etcontenant virtuellement toutes les décisions passées. Sonimportance est double : elle promeut, à nouveau, la forcedes mœurs et de la coutume en les incarnant dans uneélaboration théorique et devient, au nom de cette autoritémorale, une source d’opposition contre l’instance royale.La connaissance du processus accumulatif et adaptatif desmœurs ne peut être atteinte que par des experts ; laprudence du Roi, aussi grande soit-elle, est à ce titrenon-éligible et incapable d’émettre une décision valide surle cours complexe du droit coutumier. C’est précisément surle rôle imparti au souverain que porte la défensehobbesienne de la raison naturelle :
Quand un long usage acquiert l’autorité d’une loi, ce n’est pas lalongueur du temps écoulé qui fait son autorité mais la volonté dusouverain signifiée par son silence (le silence en effet est parfoisl’indice d’un consentement) ; et cet usage ne reste loi qu’aussilongtemps que le souverain garde le silence à son sujet. Parconséquent, si le souverain impliqué dans un litige relatif à un pointde droit, fonde sa position, non sur sa volonté présente, mais sur leslois antérieurement faites, la durée écoulée ne sera pas opposable àson droit, et le litige devra être jugé selon l’équité13.
Hobbes désarticule longévité de la coutume et forceprescriptive ; la puissance des mœurs ne tient dès lorsplus de sa nature propre, mais du silence du souverain àson sujet – silence qui demeure un signe de sa volonté.Dans cette perspective, la décision présente du souverainse substitue au poids de l’histoire. Au sens propre commeau sens figuré, la raison naturelle relève de l’abstraction; elle opère une abstraction du passé, dans la mesure oùelle s’en détache et peut potentiellement en nier lecontenu, et elle est elle-même de nature abstraite, opérantsur le droit et la politique à partir de principesmétaphysiques et spéculatifs. Héritier de cettepolémique14, partisan de la raison artificielle, Burkesemble ainsi reprendre les arguments des Common-Lawyers13 Thomas Hobbes, Léviathan, Ch.XXVI, Texte établi et traduit par François Tricaud, Paris, Dalloz, 1999, p. 478.
PAGE 13
pour critiquer la Révolution française. Aussi vrais soient-ils, l’application de droits abstraits à la sphèrepolitique est dangereuse et dommageable15.
À ce titre, la Déclaration des droits de l’homme et ducitoyen de 1789 incarne le paradigme d’une décisionpolitique datée promouvant des droits abstraits – paradigmeaux antipodes de l’héritage des libertés civiles anglaises,fruits d’un long processus historique. C’est à l’occasiondu succès de cette « révolution complète » que Burke envient à s’interroger à nouveau sur la puissance des mœurset leur rapport à la loi :
Quant à ces institutions de jacobinisme, de régicide et d’athéisme,on ajoute un système de mœurs coordonnées, un homme pensant ne peutplus se refuser à croire que c’est à l’humanité entière qu’on en veut.Les mœurs sont plus importantes que les lois. C’est d’elles que leslois dépendent. La loi nous atteint, mais seulement dans quelquesmoments et par quelques points. Les mœurs, semblables à l’air que nousrespirons, agissent sur nous d’une manière constante, uniforme,insensible ; elles nous irritent, ou nous calment ; nous corrompent,ou nous purifient ; nous exaltent, ou nous dépriment ; nous polissent,ou nous rendent grossiers. Elles donnent à notre vie entière leurforme et leur couleur, selon qu’elles sont bonnes ou mauvaises, ellesaident la morale, la remplacent ou la détruisent16.
Le succès d’un système politique, qu’il soit hérité ouradicalement novateur, dépend de son adéquation, de sacoordination à un système moral particulier. La natureabstraite de la loi, en partie liée à sa rationalité,implique une distance avec les individus qu’elle régit ;seules les mœurs, parce qu’elles sont omniprésentes depuisnotre naissance, nous façonnant et nous dirigeant, peuventexercer une puissance suffisante pour maintenir et nous
14 « These propositions may all be found in the writings of Coke, Davies and Hale, as well as in those of Burke. In the three former they depend unmistakably on the notion of custom, and if Burke owed any debt at all to preceding generations, the foundations of his thought were laid at the end of the sixteenth century, when the common lawyers learned to define their law as custom in opposition to written law », J.G.A Pocock, The Ancient Constitution and the Feudal Law : English historical thought in the Seventeenth Century, Cambridge, Cambridge University Press, 1987 p. 36.15 Edmund Burke, Réflexions, ouvr. cit., p. 76.16 Edmund Burke, « Lettre sur une paix régicide » in Réflexions, ouvr. cit., p. 557.
PAGE 12
conformer à un gouvernement donné. La dimensionmétaphysique des mœurs prend ici une nouvelle signification: le lexique convoqué ici relevant d’une théorie desclimats prend sens au sein d’une analogie avec les mœurs.Autrement dit, le vocabulaire physique est utilisé pourrendre aux causes morales leur force souveraine dans lecours de notre existence et de la vie des États. Si le parifrançais a ainsi pu réussir, c’est parce qu’il est parvenu,de ce point de vue, à intégrer dans les cœurs l’esprit dela loi plutôt que sa lettre.
Il serait toutefois imprudent de penser que cetteadéquation entre mœurs et système politique puisse aisémentse réaliser. Aux yeux de Burke, le caractère précieux dudroit coutumier anglais en témoigne : seul un travailpatient de l’histoire semble permettre la conformité desdeux sphères. En découle la conception burkienne de l’État,pensé comme association « non seulement entre les vivants,mais entre les vivants et les morts et tous ceux qui vontnaître » – association pensée « dans toute perfection »17.Si c’est par l’intermédiaire d’une pensée de la réformeprudente et progressive que le gouvernement britannique apu rester en accord avec la variation insensible etincessante des mœurs, comment expliquer une réussitesimilaire à partir d’une révolution radicale desinstitutions ?
Pour répondre à un tel problème, la démonstrationprolifique de Burke peut se résumer en trois argumentsprincipaux : la promotion d’une nouvelle forme demerveilleux, l’instrumentalisation de l’éducation etl’espoir d’une coïncidence entre la forme de la loi et laforme de l’entendement. Dans la mesure où la révolutionimplique, dans le cas français, le bouleversement de toutel’économie sociale et politique de l’Ancien Régime, il esten effet nécessaire qu’un nouveau gouvernement moral desindividus vienne à jour pour s’adapter aux circonstances et17 « L'État est une association dans toute science, une association dans toutart, une association dans toute vertu et dans toute perfection. Et comme il nesuffit même pas d'un grand nombre de générations pour permettre à une telleassociation d'atteindre à ses fins, elle devient une association non seulemententre les vivants, mais entre les vivants et les morts et tous ceux qui vontnaître », Edmund Burke, Réflexions, ouvr. cit., p.122-123.
PAGE 13
leur permettre de se déployer. C’est dans les écrits deRousseau que Burke pense trouver la diffusion d’unenouvelle mythologie adéquate à la situation française ; leGenevois, ayant pris conscience que « le merveilleux de lamythologie païenne avait perdu depuis longtemps sonefficace », s’efforça ainsi de produire un nouveaumerveilleux, celui « de la vie, des mœurs, des caractèreset des situations extraordinaires, d’où peuvent naître, enmatière politique et morale, le nouveau et l’insolite »18.Autrement dit, la promotion d’un merveilleux issu duquotidien, tel qu’il a pu être véhiculé dans Julie ou la NouvelleHéloïse (1761), a pu préparer le cœur des hommes auchangement politique et susciter en eux de l’enthousiasmeau moment de la Révolution. Dans cette perspective, lamythologie rousseauiste a constitué pour Burke unepropédeutique efficace pour préparer la population à unchangement radical ; elle a permis d'insuffler dans lesmœurs contemporaines un goût pour la nouveauté.
Si elle est nécessaire, l’élaboration d’une nouvelleforme de merveilleux est toutefois insuffisante pourréaliser une solidarité complète entre les mœurs et legouvernement français naissant. L’instrumentalisation del’éducation apparait dès lors comme le moyen permettantcette jonction. Si l’auteur de l’Émile ou de l’éducation est denouveau la cible principale des attaques de Burke19, c’estparce qu’il exprime de manière paradigmatique l’entreprisede « régénération de la constitution morale du genrehumain » menée par les révolutionnaires. Cette régénérationdes mœurs, viciée bien plus que bénéfique, se voit motivéepar l’insistance portée sur une tendance humaine : cellequi nous dispose à être emporté par la vanité. Enpromouvant duperie, théâtralité et divertissement perpétuel– le mot d’ordre des nouveaux hommes d’État étant pourBurke de faire en sorte que le peuple soit constamment enaction pour le détourner progressivement de ses occupationsordinaires – la stratégie éducative était à même de mener
18 Ibid., p. 218-219.19 Edmund Burke, Lettre à un membre de l'Assemblée nationale, Texte établi et traductionrévisée de François-Louis Thibault de Ménonville par Patrick Thierry, Paris, Fayard/Mille et une nuits, 2012, p. 218-219 (dorénavant : Lettre à un membre).
PAGE 12
à bien son projet, celui d’une mise en correspondance entrela nature du gouvernement et la nature des individus :
Si vos maîtres ont recommandé un système d’éducation faux etthéâtral, c’est parce que leur système de gouvernement est de la mêmenature. Les deux systèmes se conviennent parfaitement entre eux, et nepeuvent convenir chacun à aucun autre20.
Une telle éducation du peuple, dont le terminus ad quemdevait idéalement consister dans l’approbation duchangement radical de l’instance étatique, nécessitaittoutefois l’intervention d’un facteur supplémentaire :celui d’une falsification de l’histoire. Afin que lepatriotisme puisse relever du merveilleux, tout doute ettoute ambiguïté touchant sa nature et ses origines doiventêtre exclus. L’histoire falsifiée d’un nouveau système morala ainsi pour rôle d’assurer l’obéissance des sujets parl’intermédiaire d’un récit auquel ces derniers peuvents’identifier et l’idolâtrer comme tel ; cette histoireconstitue elle aussi une propédeutique à l’assimilationtotale d’un contenu coutumier inédit :
Tout ce que l’histoire présente de traits vrais ou controuvés, etqui paraissent douteux sous le rapport du patriotisme ; embarrassants,sous celui de la morale ; inexplicables aux yeux de la raison ;atroces à ceux de l’humanité ; tout cela est soigneusement recueillipar les révolutionnaires, et pour former une suite d’exemples destinésà l’instruction de leurs enfants21.
Dans la mesure où « l’exemple est l’école deshommes »22, il est inévitable que les figures érigées enmodèles, aussi sanglantes ou immorales soient-elles, soientreconnues telles qu’elles sont présentées aux enfants.L’inversion délibérée des valeurs23 permet ainsi ladestruction du système moral précédent, et ce que Burken’hésite pas à présenter comme une paix régicide est promu, a
20 Ibid., p. 49.21 Burke, « Lettre sur une paix régicide » in Réflexions, ouvr. cit., p. 557.22 « L'exemple est l'école des hommes ; ils n'apprennent rien que là. », Ibid.,p. 569.23 « Tout était calcul ; tout était institution. On n’a négligé aucun desmoyens mécaniques propres à soutenir cet incroyable système de perversité etde vices. Les plus grandes passions, l’amour de la patrie, l’amour de lagloire, ont été débauchées et transformées », Ibid., p. 557.
PAGE 13
contrario, comme la libération salutaire d’une servitude.L’institution méthodique de ces différents élémentsmodifiant progressivement la nature du système moralfrançais est ainsi parvenue à l’objectif visé par lesrévolutionnaires, celui d’une coïncidence entre la forme dela loi et la forme de l’entendement :
Avant la révolution française, les annales de tous les sièclesn’offraient pas un seul exemple d’une révolution complète : celle-ci sembleavoir étendu son influence jusque sur la constitution de l’entendement humain ; ellepossède en elle-même ce caractère particulier, et en cela elleressemble absolument à ce que dit lord Verulam des opérations de lanature : “qu’elle était parfaite dès son commencement, non seulementdans ses éléments et ses principes, mais encore dans tous ses membreset dans tous ses organes”. Le système de la morale française présenteun modèle unique et inconnu jusqu’à ce jour, tel que quiconquel’admirera lui deviendra semblable au même instant : mille exemplesprouvent uniformément cette vérité24.
Contrairement à la Glorious Revolution de 1688 qui a eu pourobjet, selon Burke, « de conserver nos anciennes etincontestables lois et libertés, et cette ancienneconstitution du gouvernement qui est leur seulesauvegarde25 », c’est-à-dire de retrouver la significationoriginelle de l’esprit des lois et des mœurs anglaises, laRévolution française présente l’exemple d’une « révolutioncomplète », où l’emprunt d’un vocabulaire astronomique nesignifie plus le retour à un état donné mais lebouleversement de l’ordre établi26. À sa manière, Burkelutte contre la thèse d’une création ex nihilo du nouveaugouvernement français ; celle-ci ne fut permise qu’au prixde l’élaboration au préalable d’un système de mœurs qui
24 Burke, « Lettre à un noble lord », in Lettre à un noble lord » in Réflexions, ouvr. cit., p. 469.25 Burke, Réflexions, ouvr. cit., p. 39.26 « À l'origine, le mot « révolution » était un terme d'astronomie (…) Dansson usage scientifique, il gardait son sens latin précis de mouvement régulierde rotation des astres, régi par des lois, et, puisqu'on le savait hors del'influence humaine et dès lors inéluctable, il ne se caractérisaitcertainement ni par la nouveauté ni par la violence (…). Rien ne pouvait doncêtre plus éloigné de l'acception originelle du mot révolution que l'idée quihabita et obséda tous les acteurs révolutionnaires, à savoir : être les agentsd'un processus qui signifie la fin certaine d'un ordre ancien et donnenaissance à un monde nouveau », Hannah Arendt, De la révolution, Paris, Folio,2013, p. 59-60.
PAGE 12
puisse lui être adéquat. La promotion de l’artifice27,caractéristique de cette constitution morale, doit êtretoutefois différenciée de la raison artificielle ;contrairement à cette dernière, l’artifice français nes’élabore pas sur l’histoire, mais sur sa négation.L’instauration d’un nouveau calendrier en est symptôme, quimarque de manière chronologique la rupture avec l’ordreancien.
L’analyse burkienne semble aboutir à un paradoxe : celuid’une élaboration d’un nouveau système moral marqué non parla continuité, mais par la rupture. Comment penser desmœurs sans histoire ? Ce problème est intimement lié ànotre intitulé initial : comment penser la spécificité decette métaphysique des mœurs – métaphysique ici en raison deson fondement rationnel et spéculatif ? Quels critères nouspermettraient de dépasser ce constat d’une contradictio inadjecto afin de saisir ce qui est réellement à l’œuvre dansce modèle inédit ?
Fiction anticipatrice : Révolution française et métaphysiquelaputienne des mœurs
Le malaise de Burke face au spectacle de la Révolutionfrançaise participe d’un problème plus général, celui de ladifficulté à penser un système moral qui obéisse à unprincipe autre que l’analogie. Précédemment, l'origine desmœurs, jugée immémoriale, les présentait comme toujoursdéjà là ; or, dans le cas français, c’est la rupture et nonplus la continuité qui instaure un régime de normativité.Si c’est par l’élaboration de nouvelles mœurs que lesrévolutionnaires ont pu établir une structure politiqueinédite, comment en saisir le fonctionnement opératoire ?
Saisir un habitus qui puisse exprimer une cohérencetotale entre les esprits, les institutions politiques etles nouvelles mœurs français c’est, si nous suivons laméthode déployée par Panofsky, trouver une force formatrice
27 « Il faut qu'ils fassent de l'homme une créature de l'artifice, fardée desentiments théâtraux et qui n'est bon à être vu qu'à la lumière deschandelles, et dans la distance convenable. », Burke, Lettre à un membre, p. 48.
PAGE 13
d’habitudes déployée entre plusieurs canaux de transmission28, laquellefonctionne à partir d’un modus operandi, c’est-à-dire àpartir d’une manière particulière de procéder. L’imaginaireinvoqué par Burke est à ce titre précieux ; il identifie eneffet l’action des révolutionnaires au caractère desLaputiens, habitants d’une île fictive dans les Voyages deGulliver de Jonathan Swift :
De ce pays d’où a disparu tout numéraire, personne ne dirait quec’est le même dans lequel le ministre actuel des Finances a pudécouvrir il y a peu quatre-vingts millions sterling en espèces. À levoir tel qu’il se présente aujourd’hui, qui ne croirait pas qu’il setrouve depuis quelque temps sous la tutelle des savants académiciensde Laputa et de Balnibarbi29 ?
Bien qu’elle soit la seule mise en correspondanceexplicite entre Révolutionnaires français et Laputiensacadémiciens, cette proposition constitue un point dedépart nous permettant de voir que les procédés etreprésentations mentales français sont, tels que Burke lesdécrit, essentiellement laputiens. Pour Swift, deux traitsprincipaux leur sont propres : l’amour pour la spéculationet pour l’arithmétique30. Affichant un clair rejet pour lessens, le comportement laputien expose en même temps unepathologie aux accents familiers ; leur maladresse touchant
28 Voir à ce titre la postface de Pierre Bourdieu pour l'ouvrage de Panofsky,Architecture gothique et pensée scolastique, Paris, Les Editions de Minuit, 1967, p. 151-152 : « en employant pour désigner la culture inculquée par l’école le conceptscolastique d’habitus, M. Erwin Panofsky fait voir que la culture n’est passeulement un code commun, ni même un répertoire commun de réponses à desproblèmes communs, ou un lot de schémas de pensée particuliers etparticularisés, mais plutôt un ensemble de schèmes fondamentaux, préalablementassimilés, à partir desquels s’engendrent, selon un art de l’inventionanalogue à celui de l’écriture musicale, une infinité de schèmes particuliers,directement appliqués à des situations particulières ».29 Burke, Réflexions, ouvr. cit., p. 168-169.30 « Il paraît que ces êtres ont l'esprit tellement absorbé par d'intensesspéculations, qu'ils sont incapables de tenir ou d'écouter une conversation,si l'on ne tient pas en éveil par quelque attouchement leur organe du parlerou de l'ouïe Ma connaissance des mathématiques m'aida grandement à mefamiliariser avec leurs idiotismes, qui sont très souvent tirés de cettescience […] », Jonathan Swift, « Les Voyages de Gulliver », III, Ch.2, texteétabli et traduit par Emile Pons, Oeuvres, Emile Pons, Bénédicte Lilamand,Jacques et Maurice Pons (éds), Paris, Gallimard, 1965, p. 168-172(dorénavant : Gulliver)
PAGE 12
les choses réelles et quotidiennes apparaît proportionnelleà leur habileté à maîtriser les raisonnements abstrus :
Leurs maisons sont très mal bâties, les murs de travers, sans aucunangle droit dans un appartement ; la cause de ce défaut réside en leurmépris pour la géométrie pratique ; ils rejettent celle-ci commevulgaire et artisanale, mais ils donnent à leurs maçons desinstructions bien trop compliquées pour leur entendement, ce qui estcause de mille erreurs. Et, s’ils font preuve d’intelligence sur lepapier, s’ils manient bien la règle, le crayon et le compas à pointes,je puis dire que, dans la vie de tous les jours, je n’ai jamais vu desgens si maladroits, gauches et incapables, ni d’esprits plus lents, etplus hésitants sur toutes les questions qui ne sont pas demathématiques ou de musique. (...) Ils sont absolument incapablesd’imagination, de fantaisie ou d’invention, et n’ont même pas dansleur langue de mots pour désigner ces réalités ; leur pensée vit dansun monde réduit à deux sciences ; elle ne saurait en sortir31.
Ainsi, la différence flagrante entre une virtuosité dansl’ordre de la géométrie théorique et spéculative et uneincapacité à concrétiser cette connaissance dans l’ordrepratique, qu’il s’agisse d’une hésitation concernant lesmesures à entreprendre dans la construction d’un bâtimentou des directives inutilement complexes données aux maçons,permet le rapprochement avec une considération burkienne :la force d’une vérité métaphysique est proportionnelle àson degré d’applicabilité à la sphère pratique. À lamaladresse pratique inhérente à la population laputienne,Swift y adjoint une curiosité, qui va constituer la pierrede touche de l’analogie établie entre Révolutionnairesfrançais et Académiciens laputiens :
Mais ce que j’admirais le plus, et qui, à vrai dire, me semblaitinconcevable, c’était leur intérêt passionné pour les problèmesd’actualité et pour la politique. Ils voulaient tout savoir desaffaires publiques et tranchaient les questions administratives,s’acharnant à défendre pied à pied les thèses de leur parti. J’aid’ailleurs observé la même tendance chez les mathématiciens que j’aiconnus en Europe, bien que je n’aie pu voir ce qu’avaient de commun lascience du gouvernement et celle des nombres. Ces gens-là se figurent-ils peut-être que, de même qu’un grand cercle ne se divise pas en plusde degrés qu’un petit, de même on peut régenter et administrer toutela Terre sans avoir besoin de plus de qualités que pour manœuvrer etfaire tourner une boule ? Je retrouve plutôt sous cette manie un vice
31 Swift, Gulliver, p. 172-173.
PAGE 13
commun à tous les hommes ; ce qui éveille le plus notre intérêt, cequi nous passionne, c’est précisément le sujet qui nous convient leplus mal, tant à cause de notre nature que de notre formation32.
Décrivant cette curiosité paradoxale des Laputiens,consistant à être passionné par ce qui leur convient lemoins (à savoir la politique et l’actualité), Swift se faitmoraliste : le cas Laputa n’est que l’exemplarisation d’unvice commun à tous, celui d’être attiré précisément par le sujet qui nousconvient le moins, problème tributaire aussi bien de notrenature propre que de l’éducation reçue. Dans cetteperspective, le système éducatif proposé par lesRévolutionnaires, cherchant à faire la publicité de lavanité et du vice, ne vient que redoubler et exacerbercette partie spécifique de la nature humaine, marquée parl’écart et l’inadéquation entre compétences et intérêts. Àpartir de cet imaginaire swiftien, nous sommes désormais enmesure de comprendre en quoi les révolutionnaires françaissont proprement laputiens :
Les constructeurs français - mettant au rebut tout ce qui existaitavant eux et décidés, comme les dessinateurs de leurs jardins, à toutmettre de niveau - se proposent de donner à tous les corpslégislatifs, celui de la nation comme ceux des subdivisions locales,trois bases distinctes : l’une géométrique, à savoir la baseterritoriale ; l’autre arithmétique, à savoir la base de la population; la troisième financière, à savoir la base de la contribution […] Lesanciennes divisions du pays étaient fixées par les accidents del’histoire et par les mouvements de va- et-vient de la propriété et dela souveraineté. Ces limites ne correspondaient, c’est certain, àaucun système prédéterminé ; et elles présentaient des inconvénients.Mais c’étaient des inconvénients auxquels l’usage avait apporté desremèdes, et l’habitude faisait qu’on les prenait en patience. Mais cesquadrillages successifs, cette disposition en ordres et sous-ordresqui relève des systèmes d’Empédocle et de Buffon et non de la penséepolitique, comporteront nécessairement une multitude d’inconvénientsnouveaux et auxquels les habitants ne sont pas habitués33.
La controverse entre raison naturelle et raisonartificielle développée précédemment se retrouve ici dansune discussion touchant la source de la légitimité : doit-elle résider dans un principe de prescription lié à unsystème juridique coutumier, ou peut-elle résulter d’un32 Swift, Ibid., p. 173.33 Burke, Réflexions, ouvr. cit., p. 221.
PAGE 12
calcul issu des pouvoirs de la raison, où les principes dugouvernement relèveraient d’une méthode déductive partantd’axiomes pour aboutir à des conclusions pratiques ? PourBurke, les révolutionnaires français ont pris le parti dela démonstration euclidienne au détriment del’immémorialité des institutions. En suivant nos hypothèsesde départ, il doit y avoir une étroite corrélation entre lanature du régime politique et celle du système moralcensé ; autrement dit, quadrillages successifs duterritoire et mathématisation de la politique doivents’appuyer, pour être effectifs à titre d’habitus, sur unmodus operandi adéquat. Si, dans le cas anglais, ce dernierpouvait s’apparenter au principe d’analogie, il semble icis’accorder à la raison au sens de calcul : un calcul quiest aussi bien méthode opératoire permettantl’instrumentalisation de l’éducation que forme dereprésentation particulière du monde (le jardind’entendement français). Autrement dit, le calcul compriscomme modus operandi permet d’articuler le procédéd’élaboration d’un nouveau système moral à son résultat :l’instauration de « l’âge des sophistes, des économistes etdes calculateurs34 ».
Inévitablement, cette présentation du système moralfrançais comme laputien amorce un conflit entre deuxreprésentations de la politique et de l’histoire. Lacritique d’un apport prédominant de l’arithmétique et del’abstraction en politique se dédouble, chez Burke, d’unedéfense et illustration du principe d’analogie :
Et ce qui attache les citoyens à l’ensemble de ce territoire, demême qu’aux noms de ses anciennes provinces, c’est un corps de vieuxpréjugés et d’habitudes qu’on ne peut guère fonder en raison - et nonles propriétés géométriques de sa configuration. Le pouvoir de Pariset sa prééminence maintiendront certainement, tant qu’ils dureront,une sorte d’union entre ces diverses républiques, toutes soumises à lamême pression. Mais pour les raisons que je vous ai exposées, je nepense pas que cette prépondérance puisse durer bien longtemps35.
L’architecture morale et politique française, construiteà partir d’une diffusion progressive et calculée de34 Ibid., p. 96.35 Ibid., p. 253.
PAGE 13
l’artifice, était vouée pour Burke à disparaître. Semblableà cet édifice laputien imaginé par un « génial architecte »dont la construction irait du toit aux fondations36,l’entreprise révolutionnaire, bien que « complète etparfaite en son genre », est essentiellement infondée :elle s’aveugle sur la nature des liens qui cimentent etfont prospérer des mœurs données. Jamais la nouvelleconfiguration géométrique d’un territoire ne pourraprétendre remplacer l’héritage des « anciennes provinces »ainsi que le corps doxologique de préjugés et d’habitudesspécifiant un caractère local ou national donné. Prudencepolitique et innovation radicale s’affrontent ainsi ànouveau en duel à partir de 1789, où deux métaphysiques desmœurs se déploient dans toute leur force tout en étantfoncièrement irréconciliables. Le « terrain solide de laconstitution anglaise », sédimenté par la sagesse des âgespassés, donnant aux mœurs toute leur force prescriptive,doit éviter selon Burke de trop contempler les entreprisesrévolutionnaires, bondissant « à l’assaut du ciel » :l’insularité britannique doit poursuivre son ancrage dansl’histoire, sous peine de devenir, à son tour, une nouvelleLaputa.
Valentin D'Agnano ENS de Lyon
Bibliographie
Arendt Hannah, De la révolution, Paris : Folio, 2013.Burke Edmund, Réflexions sur la Révolution de France : Suivi d'un choix
de textes de Burke sur la Révolution. Paris : Hachette Littérature,1989.
Burke Edmund, Lettre à un membre de l'Assemblée nationale : sur laRévolution française et Rousseau. Fayard/Mille et une nuits, 2012.
Burke, Edmund, The Works of the Right Honourable Edmund Burke(12 vol), Hard Press, 2006.
Coke Edward, The Selected Writings and Speeches of Sir Edward Coke,ed. Steve Sheppard (Indianapolis : Liberty Fund), 2003.
36Swift, Gulliver, ouvr. cit., p. 190.
PAGE 12
Ganzin Michel, La pensée politique d'Edmund Burke, Paris :Librairie générale de Droit et de Jurisprudence, 1972.
Hale Matthew, History of the Common Law, The LawbookExchange, 2014.
Hobbes Thomas, Léviathan, traduit, annoté et comparé autexte latin par François Tricaud, Paris, Dalloz, 1999.
Hobbes Thomas, Dialogue entre un philosophe et un légiste desCommon-Laws d'Angleterre, Paris : Vrin, 1990.
Panofsky Erwin, Architecture gothique et pensée scolastique,Postface de Pierre Bourdieu, Paris : Les Editions deMinuit, 1967.
Pocock J.G.A, The Ancient Constitution and the Feudal Law : EnglishHistorical Thought in the Seventeenth Century, Literary Licensing,LLC, 2011.
Swift Jonathan, Oeuvres, Paris : Gallimard, 1965.