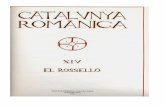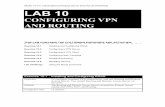Introduction - La « légende noire » de Robespierre : un portrait toujours réactualisé
Connor S., "La statuaire privée", dans G. Andreu-Lanoë et Fl. Morfoisse, Sésostris III, pharaon...
Transcript of Connor S., "La statuaire privée", dans G. Andreu-Lanoë et Fl. Morfoisse, Sésostris III, pharaon...
villede +
lilll
L'exposition « Sesostris Ill, pharaon de legende »
est organisee par le Palais des Beaux-Arts de la Ville de Lille avec la collaboration exceptionnelle du musee du Louvre et en partenariat avec l'universite de Lille 3. Elle est reconnue d'interet national par le ministere de la Culture et de la Communication I Direction generale des patrimoines I Service des musees de France et beneficie a ce titre d'un soutien financier exceptionnel de l'Etat.
I.: exposition est realisee grace au soutien du Conseil Regional Nord-Pas de Calais et de Lille Metropole. Elle a ete rendue possible grace au mecenat principal de la Fondation Credit Mutuel Nord Europe et de GDF SUEZ.
Le catalogue est realise grace au mecenat de la Fondation Credit Mutuel Nord Europe.
Comite d'honneur Fleur Pellerin Ministre de la Culture et de la Communication Martine Aubry Maire de Lille Daniel Percheron President du conseil regional du Nord-Pas de Calais Jean-Luc Martinez President-directeur du musee du Louvre Damien Castelain President de Lille Metropole Marion Gautier Adjointe au maire, deleguee a la culture Bruno Girveau Directeur du Palais des Beaux-Arts de Lille et du musee de !'Hospice Comtesse
1! .11 UHrtl• t&aliti •Fratrrnitl
Rf PUBLIQ.UE f RAN<;AISE
• •
Commissariat general Fleur Morfoisse Conservateur Antiquites et Arts decoratifs, Palais des Beaux-Arts de Lille
Guillemette Andreu-Lanae Conservateur general et directrice honoraire du departement des Antiquites egyptiennes, musee du Louvre
Commissariat de « Voyage au bout de la vie - Wolfgang Laib & Antony Gormley »
Regis Cotentin, charge de la programmation contemporaine, Palais des Beaux-Arts de Lille
Commissariat de « Revelateur[s] d'Egypte: archeologie et photographie au 19e siecle »
Jean-Marie Dautel, charge du fonds photographique, Palais des Beaux-Arts de Lille
Comite scientifique de 1' exposition Simon Connor, docteur en egyptologie de l'Universite libre de Bruxelles Didier Devauchelle, professeur d'egyptologie a l'universite Charles-de-Gaulle Lille 3, UMR 8164 HALMA-IPEL, Lille Marcel Maree, Assistant Keepe1~
Department of Ancient Egypt and Sudan, The British Museum, Londres Lilian Pastel, maftre de conferences a l'universite Lumiere-Lyon 2, Lyon Pierre Tallet, maftre de conferences a l'universite Paris W- Sorbonne, Paris Harco Willems, professeur d'egi;ptologie a l'Universite ca tholique de Louvain
G"'DP ..S~ez.
SE:SOSTRIS Ill
PHARAON DE LEGENDE
Sous la direction de
Fleur Morfoisse et Guillemette Andreu-Lanoe
Avec la collaboration de Clement Pouwels
· snoeck
Sommaire
20 SESOSTRIS Ill
8
11 Preteurs
12 Remerciements
13 Auteurs
14 Avant-propos des commissaires Fleur MORFOISSE et Guillemette ANDREU-LANOE
15 la collection de l'lnstitut de papyrologie et d'egyptologie de lille (IPEL) Did ier DEVAUCHELLE
17 Carte d'Egypte
18 Chronologie
22 le regne de Sesostris Ill Pierre TALLET
LE PHARAON ET SES SU]ETS
34 les portraits royaux de Sesostris Ill Rita FREED
48 la place des reines et des princesses Wolfram GRAJETZKI
60 la statuaire privee Simon CONNOR
72 la societe egyptienne a la fin du Moyen Empire Guillemette ANDREU-LANOE
86 la litterature a la fin du Moyen Empire Bernard MATHIEU
ARCHITECTURE MONUMENTALE ET URBANISME
96 le complexe pyramidal de Sesostris Ill a Dahchour Dieter ARNOLD, Adela OPPENHEIM et lsabel STUNKEL
108 le complexe funeraire de Sesostris Ill a Abydos JosefWEGNER
114 le paysage monumental de la vallee du Nil sous le regne de Sesostris Ill Lilian POSTEL
132 la ville d'EI-lahoun a la fin du Moyen Empire Claire SOMAGLINO
140 la ville de Ouah-Sout JosefWEGNER
242 REVELATEUR[S] D'EGYPTE
L'EGYPTE ET LE MONDE EXTERIEUR
144 Les relations exterieures : Nubie, Proche-Orient, Sina'i Pierre TALLET
156 Les fouilles du site de Mirgissa/lqen Brig itte GRATIEN
164 Les cimetieres de Mirgissa Patricia RIGAULT
170 Les echanges entre I'Egypte et le Proche-Orient Genevieve PIERRAT-BONNEFOIS
MONDE DES DIEUX, MONDE DES MORTS
188 Abydos et le culte d'Osiris Marcel MAREE
198 Les tombes de particuliers, a travers l'exemple de Deir ei-Bersha Harco WILLEMS
210 Le mobilier funeraire des particuliers Fleur MORFOISSE
LA POSTERITE DE SESOSTRIS
228 La divinisation posthume de Sesostris Ill en Nubie Khaled EL-ENANY
232 Sesostris, figure de legende dans la litterature grecque et demotique Ghislaine WIDMER
236 Les metamorphoses litteraires de Sesostris Clement POUWELS
244 Deux recettes pour realiser des photographies de monuments Jean-Marie DAUTEL
246 Theodule Deveria (I•' juillet 1831 - 25 janvier 1871), l'egyptologue faiseur d'images Elisabeth DAVID
252 D'une vision esthetique a la precision documentaire : quand la photographie s'alliait a l'egyptologie Nicolas LE GUERN
258 VOYAGE AU BOUT DE LA VIE
260 Voyage au bout de la vie - Wolfgang Laib & Antony Gormley Reg is COTENTIN
274 LISTE DES CEUVRES
297 BIBLIOGRAPHIE GENERALE
9
LA STATUAIRE PRIVEE
SIMON CONNOR
Le regne de Sesostris Ill voit le developpement d'un vaste repertoire statuaire prive, a l'usage des differents degres de l' elite et de l' administration. Cette tradition se poursuivra tout au long de la fin du Moyen Empire. Le choix des contextes d'installation, des dimensions, des materiaux et des ateliers est revelateur du statut du personnage represente. Tout est mis en ceuvre pour signifier la proximite des dignitaires avec le roi et, en ce qui concerne les niveaux intermediaires de la societe, pour emprunter l' apparence des hauts fonctionnaires.
Contextes et fonctions
Durant l' Ancien Empire, la statuaire privee semble avoir ete essentiellement reservee au domaine funeraire, dissimulee dans le serdab des mastabas. La statue du defunt servait d'hypostase terrestre, destinee a abriter le ka, et beneficiait des offrandes deposees devant la stele fausse-porte. Des le debut du Moyen Empire, ces figures sortent de l' ombre du serdab et sont installees, de maniere visible, dans la chapelle funeraire, a l'interieur de niches amenagees dans les murs. Les statues de particuliers font egalement leur apparition dans les temples. L' acces aux temples divins demeure privilegie : on y retrouve presque exclusivement les representations du souverain et des hauts dignitaires. Les personnages de rang plus modeste placent leurs effigies dans les temples funeraires des rois des dynasties precedentes, ainsi que dans les sanctuaires dedies a des dignitaires divinises, tels qu'Heqaib a Elephantine (fig. 1 et 3) ou Isi a Edfou. Steles et statues sont egalement presentes dans les petites chapelles cenotaphes en briques crues dressees en un lieu particulier, !'Esplanade du Grand Dieu a Abydos, promontoire qui surplombe le chemin de procession menant du temple d'Osiris au tombeau du dieu.
60 - SESOSTRIS lil
FIG 1 -Statue du gouverneur d'tiE§phantine lmeny-seneb, sanctuaire d'Heqaib a tlephantine, 12• dynastie, n?gne d'Amenemhat Ill.
D'apres le repertoire conserve, la statuaire privee reste relativement exceptionnelle durant la premiere moitie du Moyen Empire, jusqu'a Amenemhat II. C' est a partir de Sesostris II et surtout de Sesostris m que l' on assiste a son developpement considerable, a differents niveaux de la hierarchie, pour les membres de la cour et hauts dignitaires, fonctionnaires de rang intermediaire, artisans, personnages remplissant des professions domestiques et meme des individus apparemment depourvus de titre de fonction (fig. 2).
Cette augmentation de la production de statuaire privee est comparable a celle du repertoire royal : a !'inverse de ses deux predecesseurs, Sesostris Ill nous est connu par plusieurs dizaines de statues (plus de soixante-dix ont ete identifiees). La fonction performative de !'image egyptienne ne suffit pas a expliquer cet accroissement soudain. Les facteurs peuvent etre en partie economiques, une periode faste permettant de nombreux efforts places clans des programmes de construction et d' enrichissement de monuments. Cette large production a pu etre provoquee egalement par la necessite de diffuser !'image du souverain. Un nouveau programme politique peut etre soutenu par un vaste programme sculptural charge de sens : un message ideologique, exprime par une physionomie inhabituelle, marquee et marquante, des statues imposantes qui menacent et rassurent en meme temps, souvent de grande taille et realisees clans des materiaux
symboliquement connotes. Le grand nombre des statues et cette nouvelle physiono-mie sont un moyen de manifester I' autorite, la puissance et l'intransigeance de la politique de Sesostris m. De meme que la statuaire sert de moyen d' expression
La stat uaire priv ee
FIG 2- Tete d'homme, 12' dynastie, regnes de Sesostris I I-III. Chicago, Oriental Institute, A 105180.
pour l'ideologie du souverain, elle est de plus en plus employee, des Sesostris Ill, pour materialiser le statut des particuliers. I.:abandon des grands tombeaux prives1 s' accompagne en effet d' une modification des moyens d' expression du pouvoir. Tout au long de la fin du Moyen Empire, le statut des dignitaires transparaitra de maniere manifeste a travers plusieurs caracteristiques : les dimensions de la piece, le choix du materiau, le degre de qualM de sa facture, son contexte d'installation. Ces criteres apparaissent fortement lies aux titres portes par l'individu dans les inscriptions hieroglyphiques gravees sur le pilier dorsal, la base ou le siege de la statue.
FIG 3- Evocation du sanctuaire d'Heqaib a la fin de son developpement, au cours de la 13' dynastie.
LE PHARAON ET SES SUJETS- 61
FIG 4- Buste d'homme, Paris, musee du Louvre, DAE, E 10445, (02uvre no 26, p. 275) regne de Sesostris Ill.
62- SESOSTR ISTll
FIG 5- Tete de l'un des colosses debout de Sesostris Ill. Le Caire, Musee egyptien, CG42011.
Le roi et les dignitaires
Tout au long du Moyen Empire, la physionomie officielle du souverain est generalement adoptee pour la representation des particuliers, a tel point qu'un fragment de visage depourvu de coiffure pourrait parfois appartenir autant a une sculpture royale qu'a une statue privee. Ceci est particulierement vrai pour les effigies de hauts dignitaires, dont la facture egale la qualite des statues royales (fig. 4).
La statuaire des personnages plus modestes, quant a elle, semble etre le produit d' autres ateliers, ainsi que nous le verrons plus loin. Le chapitre consacre au portrait royal a mis en evidence la remarquable expressivite de la plupart des statues de Sesostris III, qui melent un corps d' athlete a un visage sec, travaille, autoritaire et intransigeant. Cette physionomie, porteuse d'une ideologie tres forte, pousse a l' extreme les tendances stylistiques des regnes precedents : les gran des oreilles, la moue de la bouche, 1' austerite et la hauteur de r expression. A cote de ces nombreuses statues, quelques effigies du souverain le dotent d'un visage moins marque, dont les traits font de toute evidence reference aux souverains de la premiere partie de la 12e dynastie2 (fig. 10). Chez les particuliers, hormis quelques exceptions, on ne retrouve guere le visage dur, si reconnaissable, de Sesostris Ill. D' apres le repertoire conserve, la plupart des statues privees datables de son regne suivent plut6t le modele du visage « archai:sant », comme si l' expressivite si chargee de sens des statues au visage « marque » leur etait peu accessible.
Seules quelques statues conservees montrent des dignitaires dotes du visage expressif de Sesostris Ill. La plus representative est celle
La s tatuair e priv ee
du gouverneur d'Elephantine Heqaib IP (fig. 6). La comparaison entre cette statue et les colosses debout de Sesostris Ill decouverts a Karnak4 (fig. 5) est des plus eloquentes. Il semble me me que l' effigie du gouverneur soit le produit des ateliers royaux. Plus grande que nature, elle fait partie des plus larges formats connus pour un particulier au Moyen Empire. On y reconnait la meme structure du visage, allonge, dote de sillons nasolabiaux et de cernes profonds, les oreilles decollees, le menton en avant, les arcades sourcilieres plongeantes au niveau des tempes, les memes grands yeux globuleux, les paupieres lourdes et mi-closes, les canthus tres pointus. La bouche est large, les levres fines et ciselees, la levre inferieure retroussee, les commissures legerement relevees - trait rare parmi les statues de Sesostris Ill. Enfin, autre caracteristique inhabituelle, on retrouve sur ces statues des sourcils graves en « epi de ble »,qui descendent sur les tempes presque jusqu' aux canthus exterieurs. Les jambes possedent les memes marques et details, avec des mollets muscles et des genoux naturalistes. Tout porte a croire que la statue du gouverneur Heqaib II appartient a la meme production que les colosses de Sesostris Ill a Karnak. Seulle torse du gouverneur differe de celui du souverain, pour des raisons ideologiques : le roi apparait dote d'un corps muscle, svelte et puissant, qui s'accorde avec !'impression de severite et de grandeur qui doit s'en
FIG 6- Statue du gouverneur d'Eiephantine Heqaib 11, sanctuaire d'Heqaib a tlephantine, 12' dynastie, regne de Sesostris Ill
LE PHARAON ET SES SU ) ETS- 63
FIG 7- Statue du tresorier Khentykhetyemsaf-seneb, debut 13' dynastie, provenance Abousir (7) Le Caire, Mu see egyptien, CG 408.
degager, tandis que celui du gouverneur manifeste les signes de l'age, avec une poitrine pendante. Les colosses du roi sont tailles dans le granit, materiau qui provient des memes gisements que la granodiorite dans laquelle est sculptee la statue du gouverneur, installee a Elephantine, c'est-a-dire a proximite des carrieres. I! est clair que les memes sculpteurs ont du travailler aux quatre monuments. Faute de vestiges d'un atelier de sculpture, on ne peut identifier 1' en droit ou ils ont ete executes, a proximite du gisement ou sur le site de destination des statues. Ces artisans de haut niveau peuvent aussi avoir ete itinerants et avoir ete employes a la fois a Thebes et a Elephantine. On peut enfin expliquer la qualite royale de la statue d'Heqaib II par une eventuelle implication du gouverneur clans des travaux royaux a Assouan. Profitant de la presence des artisans royaux, il pourrait avoir fait realiser par leurs soins, peut-etre sur l' offre du souverain, une statue de gran de taille a son effigie, tout en suivant avec exactitude le modele du visage royal, afin de !'installer clans le sanctuaire local.
Les statues realisees pour le successeur du gouverneur d'Elephantine Heqaib II, Imeny-seneb, sont en revanche loin d'atteindre le meme degre de qualite clans leur facture (fig. 1). Pour sa propre effigie5
, Imeny-seneb a souhaite faire echo a celle placee par son pere dans sa chapelle : toutes deux sont de dimensions egales, montrent l'homme clans la meme position et portant la meme tenue. Le traitement de la poitrine semble s'inspirer des chairs molles d'Heqaib, bien que de maniere figee. On retrouve le long visage ovale, les sillons partant des narines et des commissures des levres, les grands yeux cernes. I..:execution des traits est cependant maladroite. La bouche est ici grima~ante, les levres trop geometriques, les sillons trop profonds. Les stries de la permque irnitent celles de la coiffure d'Heqaib, mais au lieu des elegantes ondulations horizontales et des
64- SESOSTRIS Ill
FIG 8- Statue du gouverneur Ouahka Ill, provenance Gaou ei-Kebir. Turin, Museo Egizio, 4265
stries verticales suivant les courbes du volume, nous observons ici un quadrillage peu heureux. C' est visiblement la statue de son pere qui a servi de mode le a celle d'Imeny-seneb. Ce dernier n' a pas eu acces aux sculpteurs royaux, mais a des artisans probablement locaux, qui irnitent les productions des ateliers de la Residence, sans pour autant ma1triser leur savoir-faire. Le meme Imeny-seneb fait sculpter une statue de son pere6 en suivant toujours le modele physionomique de Sesostris m. Comme la precedente, elle trahit une facture quelque peu mall1abile et presque caricaturale: les sillons sont profonds et maladroitement integres clans le visage, les yeux asymetriques et trop grands, les paupieres lourdes, bref, tous les traits propres au visage royal, accentues pour rendre reconnaissable le rapprochement avec le souverain.
Quelques autres pieces montrent des individus dotes des traits de Sesostris Ill. Citons une tete en quartzite conservee a Bmxelles7
(ceuvre n° 30, notice p. 71) et un torse en calcaire du musee de Berlin8
. Les deux statues presentent le long visage aux joues creuses, les pommettes saillantes, les sillons nasolabiaux profonds et les arcades sourcilieres massives du souverain, ainsi que les grands yeux aux canthus etires, cernes de paupieres mi-closes. Elles portent la longue perruque ondulee caracteristique des regnes de Sesostris Ill et Amenemhat Ill. Une autre ceuvre du musee du Louvre9 (fig. 4), moins abimee, figure un homme coiffe d'une perruque tripartite archaisante10 et dote du long visage marque et severe du souverain, a la lippe amere. Les sourcils sont ici en relief et ont le meme contour que sur les statues en granit de Sesostris IIPl, suivant de pres le contour de I' ceil et descendant jusqu'a la hauteur du canthus exterieur.
La statue du gouverneur Ouahka Ill (fig. 8), decouverte dans la necropole de Qaou el-Kebir12
; a elle a us si ete datee du regne de
Sesostris m, en raison de sa physionomie marquee. C' est plutot de !'extreme fin de la 12• dynastie ou du debut de la 13• qu'il convient de l'attribuer. Plus grande que nature, taillee dans un calcaire indure, la statue represente le dignitaire assis, coiffe d'une perruque longue, lisse, aux retombees pointues. Bien que le martelement des traits du visage trouble sa lisibilite, le haut degre de facture de la sculpture permet une comparaison avec la statuaire royale. Au premier coup d' ceil, c' est en effet a Sesostris m que font penser les yeux severes. L'austerite des traits est accentuee par les coups portes a la statue et qui la defigurent. Il semble en fait, d' apres la commissure droite conservee, que les levres dessinaient non pas une lippe amere, a la maniere de Sesostris m, mais le sourire propre aux statues du debut de la 13• dynastie. Les grands yeux en amande sont dotes de canthus tres pointus et surmontes de lourdes paupieres, tandis que les paupieres inferieures sont a peine suggerees. Chez Sesostris m, en revanche, l' ceil, globuleux, est veritablement encastre entre les deux paupieres, l'inferieure particulierement gonflee. Le menton de la statue de Turin parait avoir ete long et lourd, autre caracteristique des statues des premiers regnes de la 13• dynastie13. La forme de la coiffe confirme cette datation. Sous Sesostris m, la perruque aux retombees pointues est generalement striee et ondulee. Ici, ample et lisse, son bord inferieur dessine une ligne presque horizontale avant de se terminer en courbe aux pointes a la base du cou. Les exemples les mieux conserves de cette physionomie et de cette coiffure sont les statues du Tresorier Khentykhetyemsaf-seneb14 (fig. 7), du grand intendant Gebou15 et du surveillant des conflits Res16
, qui montrent elles aussi toutes les caracteristiques stylistiques du debut de la 13• dynastie.
La majorite des sculptures privees contemporaines de Sesostris Ill affichent en realite les traits austeres mais moins travailles du visage des statues << archaisantes » du souverain- ce qui les rend parfois difficiles a distinguer des pieces des deux regnes precedents.
FIG 10- Statue de Sesostris Ill, Paris, musee du Louvre, DAE, E 12960 (oeuvre no 7, notice p. 128-130).
FIG 9- Buste d'une statue de dignitaire, provenance Dahchour, mastaba n' 19, au nord de la pyramide de Sesostris Ill. Amsterdam, Allard Pierson Museum, 15.350.
La s tatuair e pri v ee
Le buste du musee Allard Pierson d'Amsterdam17 (fig. 9), par exemple, a le meme visage ovale aux joues pleines, les yeux globuleux, les arcades sourcilieres saillantes, la bouche boudeuse d' Amenemhat II et Sesostris II, geometrique, aux commissures tombantes, la levre inferieure protuberante. La forme de la perruque, apparue au milieu de la 12• dynastie, finement striee et ondulee, montre sous Sesostris Ill des retombees sur les clavicules tres obliques et pointues. Des bouclettes sont representees de maniere geometrique au-dessus du front et sur le bord inferieur de la coiffe. La meme perruque et le meme visage aux joues pleines se retrouvent sur une serie de statues, vraisemblablement de la meme epoque18
(fig. 12 et 13). Une autre coiffure courante est la perruque longue, striee horizontalement au-dessus du front, rejetee derriere les epaules19. Les statues feminines revelent egalement le meme visage, coiffe d'une perruque tripartite20 ou hathorique21
.
A 1' exception d'Heqaib II cite plus ha ut, les particuliers sont repn§sentes avec un corps svelte, la poitrine haute et ferme, la musculature discrete, la taille haute. Ils portent le plus souvent le pagne-shendjyt, mais on voit se developper !'usage du pagne long, noue au-dessus du nombril (fig. 11 et 14). Empese, il donne a 1' abdomen un aspect legerement plus renfle que sur les statues portant un pagne court. Ce pagne, le plus couramment represente en statuaire apres Sesostris Ill, montera progressivement sur la poitrine et se gonflera de plus en plus au cours du Moyen Empire tardi£, pour atteindre une forme veritablement bombee au milieu de la 13• dynastie.
Le pouvoir et les apparences
La mise en serie des centaines de statues privees du Moyen Empire tardif permet de relever les liens entre les titres portes par les personnages et leurs representations.
LE PHARAON ET SES SUJETS- 65
FIG 11 -Statue anonyme, Paris, musee du Louvre, DAE, A 77, (oeuvre no 25, p. 275).
66 - SESOSTRIS lll
FIG 12- Statue d'un denomme Antef, Berlin Agyptisches Museum and Papyrussammlung, AM 12485.
Il apparait que ni les positions et gestuelles des personnages, ni leurs attributs, vetements et coiffures ne refletent un statut precis. Seules quelques parures semblent l' apanage de certaines fonctions : le collier-shenpou ou le plastron des grands-pretres de Ptah22 (ceuvre no 27, p. 275). Hormis ces elements, tous les costumes peuvent etre portes par les differents membres de l' elite. Si certaines tendances sont visibles sur les steles (pagne long pour le proprietaire de la stele, pagne court pour les personnages secondaires), elles ne se refletent guere clans la ronde-bosse. Ce man que de diversite s' explique : quel que soit le rang du personnage, il arbore la meme tenue, se tient clans les memes positions et execute les memes gestuelles, qu'il soit ministre, fonctionnaire de rang intermediaire, majordome, gouverneur provincial ou artisan. Le principal est avant tout d' avoir l' air important. Au sein de sa chapelle, la statue represente logiquement le personnage le plus eminent inhume clans la tombe, figure sur les parois du naos ou sur les stE-les placees clans la niche. Dans la cour d'un temple ou d'un sanctuaire, ce meme personnage voudra apparaitre aussi remarquable que ses semblables, ses predecesseurs et ses collegues. Il est done logique que l' apparence empruntee ne reflete pas un statut particulier: elle revelera necessairement le rang le plus eleve. La distinction hierarchique au sein des dignitaires se traduit plutot par le contexte qui entoure la sculpture, ses dimensions, le materiau clans lequel elle est taillee et la qualM de sa facture. Les hauts dignitaires ont acces aux cours des temples divins, clans lesquelles ils installent des statues de grandes et moyennes dimensions, en materiaux nobles (quartzite, granodiorite23,
grauwacke, calcaire indure) et d'une facture proche de celle que l'on retrouve sur la statuaire royale contemporaine, ce qui suggere qu'ils pouvaient faire appel aux memes sculpteurs. Les individus de rang plus modeste, quant a eux, doivent generalement se contenter de figures de petit format placees clans leurs chapelles funeraires, clans les cenotaphes ou encore les sanctuaires dedies aux personnages divinises
FIG 13- Buste anonyme, Londres, British Museum, EA 848.
(souverains, gouverneurs « sanctifies » et ancetres). Ces statuettes sont rarement en materiaux nobles ; la ma-jorite est plutot en pierre tendre : calcaire24
,
La statuaire privee
serpentinite et steatite25, beaucoup plus faciles et rapides a tailler.
Notons que certains materiaux, tels que la steatite et la serpentinite, peuvent acquerir l' apparence des pierres << nobles )) reservees aux hauts dignitaires, la cuisson de ces materiaux leur conferant une durete et une couleur qui les rapprochent de celles du quartzite, de la granodiorite ou de la grauwacke. Le style empeche neanmoins de les confondre. Les effigies des hauts dignitaires se referent directement a celles du souverain ; elles semblent provenir des memes ateliers. En revanche, la statuaire des membres moins eleves de l'elite temoigne d'une execution plus sommaire, d'une facture souvent moins reguliere et moins soignee, ce qui la rend d' ailleurs plus difficile a dater. La plupart du temps de petite taille et en materiaux tendres, elle requiert un degre de competence moins eleve de la part des sculpteurs. Plusieurs ensembles stylistiques sont identifiables. Ces pieces font visiblement l' ob jet d'une production particuliere, peut-etre regionale.
Au moyen des titres etales clans les inscriptions de la statue, comme par le choix de materiaux prestigieux et le recours aux ateliers royaux, qui leur fournissent des statues dont la physionomie s'inspire de celles du souverain, les hauts dignitaires manifestent leur allegeance et leur proximite avec le monarque. Quant aux membres des niveaux plus modestes de l' elite, c' est par mimetisme vis-a-vis de ces hauts personnages qu'ils cherchent a exprimer un rang eleve : ils adoptent les memes types statuaires (positions et gestuelles), les memes costumes et perruques, et, quand ils n'ont pas les moyens (ou l'autorisation ?) d'acquerir une statue clans un materiau prestigieux, ils recherchent l' emploi de roches qui peuvent en imiter l' aspect. Ces images ne refletent pas la fonction precise des individus qu' elles representent ; elles ont en revanche
LE PHARAON ET SES SUJETS - 67
le pouvoir d'exprimer un statut important et d'accorder dans l'Audela un rang privilegie a leurs titulaires, en servant d'intermediaires entre les hommes et le monde divin. La tradition instauree par les contemporains de Sesostris III d'une vaste production statuaire, tant royale que privee, impose son style aux regnes suivants. Les dynasties 13 a 17 connaitront certes une evolution stylistique qui leur est propre, mais ponctuee de retours permanents aux modeles de ce tte phase de l'histoire egyptienne. Sesostris III restera de toute evidence la reference a laquelle voudront se referer tous ses successeurs.
NOTES
A la fin du Moyen Empire, que I' on fa it commencer avec le regne de Sesostris Ill, les pra tiques funeraires changent. Mastabas et hypogees disparaissent apres son regne. Les chapelles abritant st€les et statues sont desormais construites en briques crues, edifiees au -dcssus des puits menant a une ou plusieurs chambres sepulcrales. Les statues Louvre E 12961 (ceuvre n" 7, notice p. 128 a 130), Munich As 7110 (SCHOSKE, 1995, p. 54, fig. 33) et Baltimore WAM 22.115 (STEINDORrr, 1946, n" 30, p. 23, pi. 5). Plut6t que « juveniles ))' il faut sans doute, comm e le suggere B. Fay, voir dans les visages de la statue Medamoud et certainement aussi de celle de Baltimore, des portra its« archa·isants )),
en reference aux premiers rois de la 12' dynastie (FAY, 1996, p. 61) . Statue decouverte da ns le sanctuaire d'Heqaib a Elephanti ne, dans une chapelle-naos dediee au gouverneur. HABACHI, 1985, n" 17, p. 48, pi. 50-57. Le Caire CC 42011, 42012 et Louqsor ). 34 (EVERS, 1929, 11, pi. 80-82 ; WILDUNG, 1984, p 200-201, fig. 175). HABACHJ, 1985, n' 21, p. 51, pi. 61-67. Ibid., n' 27, p. 53-54, pi. 73-76.
7 Bruxelles MRAH E. 6748. 8 Berlin, AM 119-99 (WiLDUNG, 2000, p. 186, n" 80) . 9 Paris E 10445 (DELANGE, 1987, p 124-125). 10 Ce type de perruque porte par un homme est plut6t propre a la premiere moitie du Moyen
Empire. Tci, cependan t, on reconnait les epaisses striations horizontales au -dessus du front, plus caracteristiques des contemporains de Sesostris Jl et Ill.
11 Voir notamment la tete de Sesostris Jll trouvee a Abydos (Londres BM 608, ceuvre n' 3, p. 274) . 12 Turin 4265 (STECKEWEH ET STEINDORFF, 1936, p. 15-46; MELANDRI, 2011). Un fragment d'une autre
statue du meme personnage est pnesentc dans cette exposi tion (ca t. n" ?) . Ce gouverneur doit etre di£ferencie de Ouahka (!"'), fils de Henou, et Ouahka (!!), fi ls de He tepou, proprietaires de deux des trois grands hypogees de Qaou e i-Kebir, da tes du mi lieu de la 12' dynastie (CRAJETZKI, 1997, p. 60-61) . La statue dont il est ici question, qui repnesente O uahka (Ill ), fils de Neferhotep, a ete retrouvee dans la chapelle de Ouahka 1" . Notons qu'un autre gouverneur de Qaou ei-Kebir, Nemtynakht, a depose une table d'offrandes dans la tom be de Ouahka 11 (PETRIE, 1930, pi. 17). 11 apparait done courant, comme dans le sanctuaire d 'H eqaib a Elephantine, que les gouverneurs du Moyen Empire tardif insta llent des monuments dans les chapelles de leurs anc€tres, peut-€tre en hommage aux fondateurs de leur lign€e, en m€me temps que moyen de legitimation de leur pouvoir.
13 Toutes ces caracteristiques se retrouvent en effet sur la statue d ' Amenemhat V dont le buste est conserve a Vienne As 37 (FAY, 1988), ainsi qu e celles qu e l'on peut attribuer a Sobekhotep 1"', par comparaison avec les reliefs de ce meme souverain d€couverts a M€damoud
68 - SESOSTR IS Ill
FIG 14- Groupe familial du gouverneur Oukhhotep IV. Le Caire, Mu see egyptien, CG 459.
14 Le Caire CC 408 (BORCHARDT, 1925, p. 20, pi. 67; W1LDUNG, 1984, p. 18, fig. 9). 15 Copenhague AOIN 27 QoRGENSEN, 1996, p. 188) . 16 Richmond 65-10 (FRANKE, 1984, dossie r n" 393; MAREE, 2009, p. 38, n. 29) . 17 Amsterdam 15.350. La s tatue provient probablement des ruines du mastaba n' 19 de la
necropole longeant au sud le complexe funcraire de Sesostris Ill a Dahchour (MORGAN, 1895, p. 35, fig. 72) . SeLil le buste est presente au musee Allard Pierson. j. de Morgan mention ne nCanmoins plusieurs autres fragments de la meme statue. Linscription, incon1plt~te, ne don ne ni le nom ni le titre du personnage. Le mat€riau (granodiorite) et les modestes din1ensions (40 centimetres de haut) pourraient correspondre a la representation de tout dignitaire, a I' exception du vizir, en raison de I' absence du collier-shenpou.
18 Vienne A 1277 (\lien ne, 1994, p. 192, n' 214), Londres BM 848 (en depot a Bale, WiESE, 2001, n' 26), Berlin AM 11626 (Hildesheim, 2006-2007, n' 245, p. 242), AM 12485 (FISCHER, 1996b, p. 111, n . 3), New York 22 .1.201 (Licht- Nord, fou illes MlvlA 1920-1921). Voir aussi la sta tue assise du grand intendant Khentikhetyour (Rome, Museo Barracco 11, SiST, 1996, p. 38-42) et le groupe statuaire du gouverneur Oukhhotep IV (Boston 1973 .87, ceuvre n" 34, notice p. 70).
19 Nota mment le groupe s tatuaire du gouverneur Oukhhotep IV, decouvert dans la tom be de ce dernie r a Meir (Le Caire CC 459, BoRCHARDT, 1925, p. 51-52, pi. 76). Voi r aussi Chicago, Field Museum A. 10580, Louvre A 77 (DELANGE, 1987, p. 89-90), Vienne AS 35 (SErPEL, 1992, n" 57, p. 186-188).
20 Boston 67.9 (FISCHER, 1996b, p 15, n. 22), Is tanbul 10368 (Bon-IEMER, 1978, pi. 8), Leipzig 6017 (KRAUSPE, 1997, p. 42 -43), Londres UC 16657 (TROPE et a/ , 2005, n' 18, p. 23), New York 08.202.7 (FISCHER, 1996b, p. 15, n. 22; peut-etre fragment de la meme statue que Boston 20.1195, REISNER, 1923, n" 34) .
21 Le Caire CC 381 e t 382 (reine Nefe ret, epouse de Sesostris ll ; EVERS, 1929, I, pi. 72-75), Hanovre 1970.17 (WILDUNG, 2000, n" 65, p. 141 et 185).
22 Voi r statue du Louvre A 47 (ceuvre n" 27, p. 275). 23 Le gran it rose reste quanta lui, sauf quelques rares exceptions, r€serv€ au souverain. 24 Voir groupe statuaire de Senpou, chef de service du bureau du ravitaillement (Pa ri s,
Louvre E 11573, D ELANGE, 1987, p. 144-147), s tatue assise de l'echanson (?) du gouverneur Khnoumnakht (Bruxelles E. 8257, DE PlJITER ET I<.ARLSHAUSEN, 1992, p. 62, 67, 174, pi. 2).
25 Voir s tatues du directeur du temple Senousret (Le Caire CC 481, BoRCHARDT, 1925, p. 62-63, pi. 80), d'Imeni\adi (Le Caire CC 462, ID., p. 54, pi. 77), du suiva nt Ankhou (sanctuaire d'Heqaib, HABACHI, 1985, n" 71, p. 94-95, pi. 166-167), de l'intendant Montouiia (Bale Lg Ae OC 1, Bale, 1997, p. 74, no 41) ou du brasseur Renefsenebdag (Berlin AM 10115, ceuvre n" 36, notice p. 82).
Tete d'une statue colossale de Sesostris Ill
Quartzite
H. 45; L. 34,3; pr. 43,2 cm
12• dynastie, regne de Sesostris Ill, vers 1872-1854 av. J.-C.
Provenance inconnue
Achat (W. Rockhill Nelson Trust, 1962)
Kansas City, Nelson-Atkins Museum of Art, 62-1 1
CEuvre exposee no 4
Cette tete colossale fait partie d'une serie de statues en quartzite de Sesostris Ill, dont au moins trois autres exemplaires, preserves a Copenhague, Hildesheim et New York, sont connus. D'apres leurs dimensions, il se peut que ces fragments appartiennent aux statues assises au nom du meme souverain conservees au British Museum de Londres, qui proviennent du Delta oriental (Tell Nabasha et Tell elMoqdam). Lun de ces colosses a ete usurpe par Osorkon II, aussi n' est-il pas certain qu'ils aient ete originellement installes sur ces sites. Les statues royales du Moyen Empire ont en effet pour la plupart ete reutilisees et deplacees a de nombreuses reprises au cours de l'Antiquite. Le quartzite, pierre dure reservee a la statuaire du sommet de l' elite, perm et, par son grain homogene, un modele subtil, sans necessite d'avoir recours a des procedes graphiques pour representer les traits du souverain. La tete de Kansas City est certainement l'un des exemples les plus acheves du portrait expressif de Sesostris Ill. Le visage long et emacie, les pommettes saillantes, les levres fines et pincees aux commissures tombantes, les yeux globuleux enserres dans d' epaisses paupieres, les plis et rides qui marquent la peau ne montrent pas un homme age, soucieux et fatigue, mais un roi autoritaire, sec, majestueux et avise, sentiment qui devait etre renforce par la musculature ferme du corps auquel cette tete etait associee.
Simon Connor
BIBL. PM VIII , no 800-494-100.
LABOURY, 2009, p. 184, pi. 6. RUSSMANN, 2001, p. 35, fig. 22. WARD et FIDLER, 1993, p. 112 pi. 24. ALDRED, 1970, p. 42, note 66
LE PHARAON ET SES SUJETS - 43
Tete de Sobekhotep Jer, anciennement attribuee a Sesostris Ill
Calcaire ocre; traces de peinture noire et blanche pour les yeux
H. 27,5 ; L. 25 ; pr. 30,7 cm
13• dynastie, regne de Sobekhotep 1•r Sekhemre-Khoutaouy
Provenance inconnue
Paris, musee du Louvre, en depot au musee de Besanc;:on,
0.890.1 .65 CEuvre exposee no 6
Cette tete en calcaire, probablement fragment d'un sphinx, a ete attribuee a Sesostris Ill en raison de ses grandes oreilles et des plis qui marquent son visage. C' est sans doute plutot a un souverain du debut de la 13• dynastie qu'il fa ut I' attribuer. Ces traits s' observent en effet sur plusieurs portraits de cette period e . A la difference des effigies de Sesostris Ut notons la bouche aux commissures relevees, le menton cane et prognathe, deux profondes depressions partant des ailes du nez et surtout une ride verticale profonde au milieu du front, caracteristiques que I' on retrouve a l'identique sur trois tetes de statues osiriaques de couvertes a Medamoud conservees au Louvre, au musee du Caire et a Beni Suef. Ces statues de nature architecturale font vraisemblablement partie du meme programme de construction qu'un porche edifie sur le site par Sobekhotep I•'. Les reliefs de ce souverain montrent les memes traits que sur les trois tetes osiriaques, de meme que sur la statue de Besanc;:on . On y reconnait le meme sourire amuse, les oreilles demesurees, les sourcils suggeres par le mode le de I' arcade sourciliere, le nez viril mais court les narines ecartees, le philtrum marque, le menton prognathe, les pommettes en relief les yeux grands, en amande, delimite par des paupieres aux !ignes sinueuses. La reference au portrait de Sesostris Ill reste toutefois manifeste. Ce dernier demeure le modele suivi par les souverains de la fin du Moyen Empire.
Simon Connor
46 - SESOSTRIS lli
BIBL. PM VIII, no 800-493-300.
PARALLELE DAVIES, 1981, p. 18, note 67.
EXP. Berlin, 2000, p. 181, n° 31. Paris, 1998, p. 41-42, n° 94. Besanr;on, 1990, p. 148-149, n° 214.
Statue du brasseur Renefsenebdag avec sa fille Ibia
Steatite
H. 33,6; I. 1 0,5 ; pr. 19,3 cm
Fin 12•-13• dynastie
Probablement Elephantine (Assouan)
Berlin, Agyptisches Museum, AM 10115
CEuvre exposee no 36
Assis sur un siege, sa fille Ibia debout contre sa jambe droite, le brasseur Renefsenebdag est represente vetu du pagne long noue sous la poitrine caracteristique de la fin du Moyen Empire. Malgre son titre d' apparence modeste, il do it appartenir a un rang privilegie de la societe, capable d'acquerir une statue pour habiter sa chapelle funeraire ou un sanctuaire. Linscription, adressee aux divinites d'Elephantine, rend probable son origine clans le sanctuaire d'Heqaib. La couleur et la durete de la pierre evoquent l' apparence du quartzite, pierre noble reservee normalement a la statuaire du souverain et des hauts dignitaires. Il s'agit pourtant d'un materiau tendre au grain tres fin, la steatite, couramment utilisee pour la sculpture des niveaux inferieurs de 1' elite car facile et rapide a tailler. La cuisson de cette pierre permet en effet de lui conferer une durete et une couleur proches de celles des roches nobles : brunnoir (comme la granodiorite) ou rouge orange (comme le quartzite) selon le mode de cuisson. Lusage d'un tel procede offre ainsi a un certain nombre de personnes l'opportunite d'obtenir une statue qui presente l'apparence de celles du sommet de la hierarchie. Cette statuette montre les caracteristiques stylistiques du vaste corpus de figures en steatite du Moyen Empire tardif : une surface douce et brillante a 1' aspect gras, une quasi -absence de details graphiques precis. Eloignee de la statuaire royale contemporaine, il est difficile de la dater avec precision.
Simon Connor
82 - SESOSTRIS Ill
BIBL. PM VIII, no 801-404-100 FINNEISER, dans PRIESE, 1991, no 40, p. 62-63. JUNGE, dans HABACHI, 1985, p. 131, note 170. VANDIER, 1958, p. 24 1, 243, 279, 58 1. ROEDER. 1913, p. 148, 209.
EXP. Berlin, 2000, p. 185, no 74.
Sceau I figurine du scribe des recrues Sehetepibre
lvoi re
H. 4; I. 2 ; ep. 3,8 cm
Fin 12•-13• dynastie
Egypte
Collection privee
CEuvre exposee no 44
Cette figurine en ivoire represente un homme clans une position courante a la fin du Moyen Empire : assis en tailleur, mains a plat sur les cuisses, vetu d'un pagne long qui reduit la moitie de son corps a un volume geometrique. Cette forme statuaire a ete adoptee pour cet objet afin de permettre de l'utiliser comme sceau, la tete pouvant etre maintenue entre deux doigts et la large base ovale servant de support a une inscription, a la maniere des scarabees de la meme epoque. Les signes l'identifient comme le scribe des recrues Sehetepibre, fils de Senebtisy, << vivant a nouveau ».
L'expression « vivant a nouveau >> inscrite apres le nom apparait de maniere caracteristique a la fin de la 12e et surtout de la 13° dynastie, datation confirmee par le style du vetement, de la perruque et des traits du visage, avec de grands yeux aux canthus pointus, surmontes de lourdes paupieres. Malgre ses petites dimensions, J'objet montre beaucoup de finesse clans le rendu des volumes, le poli de la surface et la gravure des details. Ce sont la des caracteristiques de la sculpture de ce materiau precieux qu' est l'ivoire, relativement rare pour les figurines humaines a cette periode (voir ainsi les pieces Louvre N 3892, fig. 12, p. 80 ; New York MMA 15.3.263 et Turin 3045) . La piece elle-meme est d'un type relativement peu courant, dont quelques autres exemples sont presentes clans cette exposition (ceuvres n° 46 et 57, p. 276 et 277) . Il est difficile de savoir clans quel contexte ce type de figurine a ete retrouve, probablement clans une tombe, en tant qu'objet « precieux >> a emporter clans l'Au-dela, identifiant son proprietaire pour l' eternite.
Simon Connor
LE PHARAON ET SES SU) ETS- 85
Monument funeraire en forme de naos
Statuette en steatite; naos en calcaire
H. du naos: 12; L. 9 cm
13• dynastie
Provenance inconnue (collection Drovetti), probablement Abydos
Turin, Museo Egizio, Cat 3082 RCGE 5534 CEuvre exposee no 259
Un homme, entoure de deux femmes, se tient de bout dans un naos en calcaire. Linscription qui se deroule sur le cadre du naos et sur sa base adresse une offrande a Osiris, seigneur d' Abydos, pour le ka des trois personnages. Les signes, graves d'une main rapide sur un calcaire jaune de qualite grossiere, sont particulierement malaises a decrypter. Il semble que le personnage central se nomme Iouiou et porte le titre, relativement modeste, de « gardien de la salle >>, qui va de pair avec la modestie des materiaux utilises. Ses partenaires sont, d'apres !'inscription, sa mere et sa femme. Une table d' offrandes, sculptee dans le me me bloc que le naos, fait face aux figures. La statuette appartient au type classique du repertoire des niveaux inferieurs de 1' elite au Moyen Empire tardif. Elle est sculptee dans un materiau facile a tailler, la steatite, qui peut acquerir 1' aspect des pierres nobles (granodiorite, grauwacke) au moyen d'une cuisson en atmosphere reductrice. Lhomme est represente vetu du pagne long des dignitaires ; queUe que soit sa fonction reelle, il apparait comme le personnage principal du monument et de la chapelle funeraire ou cenotaphe dans laquelle il etait place. Le pagne monte jusque sur la poitrine et gonfle son abdomen, caracteristiques stylistiques de la premiere moitie de la 13• dynastie. Figure dans la position de priere, il porte les bras tendus devant lui, mains a plat contre son pagne, tandis que les deux femmes, selon les cri teres canoniques de 1' epoque, montrent une attitude plus passive, les bras le long du corps, mains a plat sur les hanches.
Simon Connor
BIBL. PM VIII, n' 801-402-590. DON A DONI ROVER I AM. et al., 1988b, p. 84. CURTO, 1984, p. 104 (avec fig.). VANDIER, 1958, p. 610, pi. 83. EVERS, 1929, pi. 4, fig. 42.
EXP. Milan, 2007, p. 257.
MONDE DES DTEUX , MO N DE DES MORTS- 197
Tete d'une reine
Gneiss anorthositique
H. 9,8 cm; H. originelle estimee: 16,5 cm
12• dynastie, probablement regne d'Amenemhat Ill
« Trouvee a Saqqara »;collection Frederic Cailliaud, 1822
Paris, Bibliotheque nationale de France, 24/Cailliaud 1822.1
CEuvre exposee no 22
I.;uraeus qui se dresse sur le front de cette figure en gneiss la designe comme une representation de reine. Ce buste appartenait a une sphinge, comme l'indique la criniere leonine sur l' epaule droite. Le style de la sculpture, avec ses grands yeux etires en amande cemes de paupieres epaisses, ses arcades sourcilieres au modele prononce, ses joues pleines, ses oreilles demesurees au lobe marque d'un bouton, designe le regne d' Amenemhat III. Ceci s' accorde avec le raffinement de la coiffure hathorique (perruque formee de deux meches epaisses retombant sur les epaules en deux volutes) de la souveraine, finement striee et ondulee. Le gneiss n' est utilise qu' exceptionnellement au Moyen Empire, tant a cause de l' acces malaise des carrieres, en Nubie, a une trentaine de kilometres dans le desert a l' ouest de l' actuelle Abou Simbel, qu' en raison de l' extreme durete du materiau, au grain tres fin, qui requiert un long travail et un savoir-faire particulierement developpe. La rarete de l' emploi de cette pierre permet de suggerer une association de cette statue avec la tete du musee de Beyrouth (DGA 27574), egalement presentee clans cette expos1t1on (ceuvre no 23, p. 275). Les dimensions et le style concordent. Bien que la tete du roi, vraisemblablement Amenemhat Ill, soit trop fragmentaire pour que l' on puisse restituer la forme de la statue, il est envisageable qu'un sphinx du souverain ait servi de pendant, afin de composer une paire avec celui de la reine.
Simon Connor
58 - SESOSTRIS Ill
BIBL. PM VIII , n' 801 -485-550. FAY, 1996, p. 57, 68, pi. 93. FISCHER, 1996b, p. 11 5, note 22. VANDIER, 19S8, p. 609, pi. 74. EVERS, 1929, pi. 76.
EXP. Bruxelles, 2006, p. 290, n• 176.