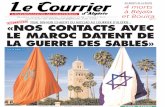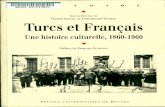Conceptualiser l'asymétrie structurelle de l'écosystème de guerre
Transcript of Conceptualiser l'asymétrie structurelle de l'écosystème de guerre
MARTIN BOLLE
Conceptualiser l'asymétrie structurelle de l'écosystème
de guerre Projet de thèse développé
Martin Bolle
19/03/2014
Résumé du projet
L'objectif principal du projet est de penser la guerre comme un espace. Pour se faire, l'auteur propose de redéfinir le concept d'asymétrie tel qu'il est employé pour désigner les guerres
contemporaines. Assumer la spatialité du concept d'asymétrie, et celle du concept de guerre, revient ainsi à rattacher cette étude à la lignée de la géostratégie. Cette étude étant une polémologie
philosophique, une investigation philosophique sur la nature de la guerre, il s'agit aussi de définir une telle polémologie et d'établir les bases de cette dernière. Il s'agit de constater que le militaire se pense lui-même, est doté d'une autonomie pratique et conceptuelle. En vue de comprendre cette
autonomie pratique du militaire, il s'agit de comprendre son autonomie conceptuelle. Cette autonomie conceptuelle est due à un système de savoirs, d'arts militaires que nous pouvons définir
comme constituant ensemble l'art de la guerre, la production de la guerre. Le but du philosophe serait alors de faire l'épistémologie de ces savoirs-produire en vue de déterminer ce qu'est la guerre.
Ces arts militaires produisent un espace, l'appréhende, le reproduise en vue de le maitriser. Dés lors, l'objectif premier de cette étude est de déterminer ce qu'est cet espace appréhendé. L'appréhension
de l'espace étant nécessaire pour l'art de la guerre, il s'agit de concevoir que son savoir ou son art central n'est autre que la géographie. Ainsi, le second objectif consiste à déterminer le système de cet art de la guerre comme structuré par la géographie militaire. Cette importance de l'espace est
présente dans la plupart des traités militaires mais est pleinement assumé par la géostratégie. Enfin, le dernier objectif du projet consiste à penser les systèmes d'armes par et pour lesquels l'art de la guerre se déploie. Le militaire peut ainsi être conçu comme le double système d'arts et d'armes
produisant l'espace de guerre.
Chacun de ces objectifs peut ainsi représenter un axe de la réflexion sur la guerre. Le problème de l'asymétrie permettrait d'aider à leur compréhension mutuelle. D'abord, il permet de définir l'espace de la guerre comme un système spatial, un écosystème. Tout système est structuré par des
communications au sens de canaux par lesquels circulent une information, ce qui forme le système. L'information de l'écosystème de guerre est ainsi, le ravitaillement, l'économie de la guerre.
L'asymétrie consiste alors en l'opposition du détournement et de la sécurisation des communications par lesquelles circule le ravitaillement. Dans ce cadre peut aussi être pensé le problème de la cybersécurité, l'informatique structurant les armées modernes. La cybersécurité, et la sécurité en
général, relève ainsi de la guerre asymétrique. C'est l'appréhension de l'espace et l'art de la guerre donc, qui est modifiée par cette considération, suivant qu'il s'agisse de détourner ou de sécuriser.
Nous serions passés du champ (de bataille) à l'espace de combat, du battlefield au battlespace. L'asymétrie est ainsi un problème géostratégique.
Ainsi, nous pouvons voir différents dispositifs et stratégie concernant cette asymétrie autour de laquelle semblent tourner les guerres contemporaines pouvant ainsi être dites asymétriques. Il ne
s'agit pourtant pas de réserver le problème de l'asymétrie aux guerres actuelles, ce problème étant déjà celui de la guérilla, de la piraterie et de l'insurrection, bien que ces cas relève davantage de la dissymétrie : opposition de l'attaque et de la défense, d'un plus fort et d'un plus faible. Il s'agit ainsi
de dire que l'asymétrie n'est pas réductible à la dissymétrie et se pose même pour des armées d'importances égales. L'intérêt du problème de l'asymétrie est toutefois de montrer comment le
politique et le militaire peuvent interagir et, le second, prendre son indépendance par rapport au premier, mettant en question le concept de guerre en tant que concept politique.
Présentation d'un projet de polémologie philosophique
a) Présentation de l'auteur
Je suis Martin Bolle, doctorant en philosophie à l'Université Libre de Bruxelles depuis
novembre 2013. Mon mémoire de Master avait pour titre Conceptualiser la politique comme une continuité ; à partir de l'historiographie de Carl Schmitt. L'auteur de référence de mon travail était
donc Carl Schmitt. Je présentais les thématiques de ses Dictature et Théologie politique dans son œuvre. Je reste influencé par son intérêt général pour la guerre en tant que décision politique, et dans les nomos de la Terre et Théorie du partisan, pour les transformations de l'espace par la
technologie militaire et pour le combattant « irrégulier ». Ces deux derniers ouvrages peuvent rattacher Schmitt à la géopolitique classique ; dans le nomos, il fait référence à des auteurs clefs de
cette école : Mahan, Mackinder et Ratzel. Ainsi, je veux approfondir cette pensée par la thématique de la géostratégie. Je travaille ainsi sur un matérialisme géographique, en tant que chercheur associé d'ETOPIA, centre de réflexion des écologistes francophones belges.
J'ai participé, lors de mon Master, à deux travaux ayant la guerre pour objet : le premier, Croisade et
Jihad, comparait les différences de légitimation des guerres saintes dans l'Europe Occidentale et le Monde Musulman au Moyen-âge. Le second, Critique de « L'organisation pirate » était la lecture critique d'un ouvrage intitulé L'organisation pirate. Il s'agissait de rattacher au problème de la
piraterie ceux du crime organisé et du mercenariat. Mon partenaire, dans ces travaux, était Florent Verbruggen ayant réalisé, pendant son Master en éthique, un mémoire sur le problème des Sociétés
Militaires Privées (SMP ou PMS) et le mercenariat, posant la possibilité de l'extériorité de la guerre du domaine politique. Les problèmes de la privatisation du militaire et de la conception ac tuelles des soldats comme des professionnels et des officiers comme managers, me conduit à faire en cours
du soir un Master Complémentaire en management à la Solvay Brussels School de l'ULB.
Mon but est de penser la guerre. J'ai ainsi entamé avec Juliette Lafosse, doctorante travaillant sur la question du Droit international lors de la Première Guerre mondiale, une lecture du De la guerre de Clausewitz. La guerre est protéiforme, et plus encore en tant que guerre irrégulière, asymétrique ou
révolutionnaire. Penser la guerre comme cet espace créé par le militaire et le problème de l'asymétrie serait, ainsi l'occasion d'une polémologie philosophique.
b) Polémologie philosophique : épistémologie praxéologique du militaire
Nous désignons, par polémologie philosophique, une étude philosophique de la guerre. Cependant, pour penser la guerre, il faut constater que celle-ci est pensée par son producteur : le
militaire. Le militaire a, ainsi, une autonomie conceptuelle qui serait surtout celle d'un système de savoirs que l'on peut désigner du nom d'arts militaires ou, pris de manière globale, d'art de la guerre. Ce système ayant pour but de produire la guerre, étant sa production, le terme d'art pour le désigner
est pertinent. Il est à noter que le savoir architectonique, celui vers lequel les autres convergent, de ce système est la stratégie, l'art de conduire les armées. Le concept d'art de la guerre désigne
d'ordinaire ce savoir spécifique. Mais, nous pensons, en raison de la participation des autres savoirs ou arts militaires à la production de la guerre, qu'il s'agit, tout en lui reconnaissant sa fonction architectonique, d'en faire un art parmi les autres et ne pouvant former sans eux l'art de la guerre en
tant que tel. L'autonomie conceptuelle de l'art de la guerre explique pourquoi nous pensons ce dernier comme la base d'une investigation philosophique ayant la guerre pour objet. Une question se
pose alors concernant cette polémologie philosophique : serait-elle une épistémologie ou une praxéologie du militaire ? La question se pose en raison que les savoirs nécessaires à la pratique militaire sont des savoir-faire pour l'essentiel, des sciences expérimentales ou opérationnelles.
Chacun de ces savoirs permet d'appréhender la guerre, afin d'orienter son évolution, de la produire.
De ce point de vue, leur étude, orientée vers leur produit, la guerre, serait une épistémologie. Cependant, ce savoir, en se représentant la guerre, participe à sa production. De ce point de vue, ces savoirs sont des arts, des savoir-produire, et non des sciences, savoir en tant que tel ; ne serait-ce
que par l'imprévisibilité de l'espace de guerre empêchant une connaissance « objective » optimale de ce dernier. Étudier ces arts serait étudier les différents aspects praxéologiques de l'art de la guerre
en vue d'une praxéologie globale sur ce dernier. Cette connexion de la production, l'art de la guerre, et du produit, la guerre, fait de la polémologie philosophique tant une praxéologie qu'une épistémologie, et donc une épistémologie praxéologique du militaire.
c) L'état de l'art Notre recherche s'inspire de l’œuvre de Carl Schmitt, surtout du nomos de la Terre et de la Théorie du partisan. Dans le premier, Schmitt s'inscrit dans la réflexion géopolitique de Mahan,
Mackinder et Ratzel dont il fait mention. Dans sa Théorie du partisan, Carl Schmitt développe la question d'une technique, surtout militaire, créatrice d'espace et, ainsi, de politique. Ce dernier
ouvrage est centré sur le problème de la guérilla mettant en cause le rapport entre guerre et politique et la division entre guerre et paix. Cette articulation de la guerre et de la politique était aussi présente dans sa thématique de la décision politique de ses Dictature, Théologie politique et, plus
précisément avec ses Doctrine de la constitution et Concept de politique1. Le nomos de la Terre semble toutefois donner un ancrage spatial à cette décision, raison pour laquelle notre attention
porte surtout sur le Schmitt autour de cette œuvre. Cette décision, ainsi, détermine l'étendue du concept de guerre, mais aussi celle du concept de crime comme le montre le recueil de Hans Magnus Enzensberger, Politique et Crime. Guerre et crime sont ainsi deux concepts politiques. Ce
lien entre guerre, technique et politique est établi par les penseurs de la technique et de la guerre allemands comme Martin Heidegger, Oswald Spengler, Ernst Jünger et Erich Ludendorff, général et
théoricien de la guerre totale. Ce dernier est influencé par Carl Von Clausewitz, penseur militaire incontournable avec son traité
De la Guerre ayant inspiré Raymond Aron. Clausewitz thématise ce que nous appelons dissymétrie, l'opposition de la défense et de l'attaque2. Il ne faut pas non plus négliger l'influence d'Henri-
Antoine Jomini et de son Précis de l'art de la guerre. Clausewitz et Jomini ont, tous les deux, assisté à la guérilla contre Napoléon. Ce mode de combat non frontal non frontal a toujours existé
mais n'a reçu ses lettres de noblesse qu'au 18e siècle, en tant que « guerre de partisans ». Bien que
plusieurs cas d'asymétrie (guérilla, piraterie, terrorisme, insurrection...) fassent intervenir des acteurs non liés à des États, cette guerre de partisans, voire la « course » des corsaires, montre que
les armées étatiques utilisent aussi des méthodes de détournement. Le 19e siècle a vu l'intérêt croître pour ce mode de combat au travers du phénomène de la guérilla, mais aussi dans le cadre de la contre- insurrection des entreprises coloniales face aux résistances autochtones. Au 20e, au
contraire, des Européens, tels Thomas Edward Lawrence, s'intéressent à l'insurrection pour la soutenir. La guerre froide encourage l'asymétrie, tant dans son versant de guérilla que dans celui de
la contre- insurrection. Schmitt écrit ainsi la Théorie du partisan et le général André Beaufre, Les guerres révolutionnaires. L'asymétrie devenant norme, des Américains, tel Andrew Mack en 1975, parlent de « guerre asymétrique ».
Cette appellation de « guerre asymétrique » est critiquée par Frédéric Gros et Gérard Chaliand,
préférant celles d'« état de violence » ou de « guerre irrégulière ». Et, en effet, cette appellation désigne la généralisation de pratiques « irrégulières », impliquant des problèmes éthiques pour
1 Nous n'appelons pas ces derniers livres par leurs titres français habituels de Théorie de la constitution et
notion de politique, assez inexact. Kervegan, commentateur reconnu de Schmitt, semble aussi de cet avis.
2 C.VON CLAUSEWITZ, De la guerre, trad. de l'allemand par D.NAVILLE, ed. Minuit, coll. Arguments,
Paris, p.62.
lesquels le Just and Unjust Wars de Michael Walzer est la référence. Nous préférons, toutefois, le concept d'asymétrie à celui d'irrégularité, ou de révolutionnaire, en raison de sa référence spatiale plus pertinente pour comprendre le concept de guerre. Les problèmes de la régularité, d'ordre
davantage éthique et juridique, ou de la révolution, plus politique, sont ainsi pour nous secondaires. Cet espace militaire d'une Guerre hors limite devenu trouble est étudié par les officiers chinois Qiao
Liang et Wang Xiangsui. Sur ce point de la spatialité, nous nous référons aussi aux Vitesse et politique de Paul Virilio, mettant en avant le lien entre la guerre et la ville, et Mille Plateaux de Gilles Deleuze et Félix Guattari définissant les espaces de la machine de guerre et de l'appareil
d’État. Dans la lignée des deux derniers, nous citons L'organisation pirate de Rodolphe Durand et Jean-Pierre Vergne et Les chasses à l'homme et Théorie du drone de Grégoire Chamayou définissant
l’État comme appareil de chasse aux humains. Ces différents auteurs nous permettrons ainsi d'approfondir les problèmes de géostratégie. Dans ce même mouvement, Frédéric Gros s'intéresse au problème de la sécurité dans ses Etats de violence et Le Principe Sécurité ; le dernier livre
faisant une réflexion foucaldienne autour de la biosécurité3 nous conduisant à penser un écosystème de guerre et une asymétrie portant sur les communications.
L'intérêt pour les rapports entre guerre et politique n'est pas nouveau, ni entre technique et espace, de même que pour la guérilla ou la piraterie. Notre nouveauté serait de traiter la notion d'asymétrie
hors des contextes contemporains et de l'éthique militaire pour la lier à celui de la structure de la guerre conçue comme écosystème. A ce nouveau traitement, s'ajoute aussi la volonté de la création
d'une polémologie philosophique réinterrogeant les problèmes géostratégiques à partir d'une réflexion sur les arts militaires et les systèmes d'armes produisant cet écosystème.
d) Précisions sur l'environnement de travail
Je suis rattaché au centre de recherche en philosophie (PHI) de l'ULB comprenant des spécialistes de différentes périodes de l'Histoire de la philosophie et de ses domaines : esthétique, phénoménologie, sciences et techniques, religion, droit et politique. Le problème de la guerre étant
pluridisciplinaire, je leur demanderai conseil suivant l'angle considéré. Le centre est dirigé par mon promoteur, Thomas Berns, professeur de philosophie politique de l'ULB et de l'Université de Liège.
Il enseigne ainsi dans les Facultés de Philosophies et Lettres et des Sciences Politiques et Sociales de l'ULB. Il a proposé que Christian Olsson, professeur de l'Institut des Etudes européenne-IEE de l'ULB, fasse partie de mon comité d'accompagnement. L'intérêt de celui-ci pour les problèmes de
sécurité internationale en fait un connaisseur avisé de la guerre asymétrique. En lien avec l'IEE, j'ai été mis en contact avec Christophe Wasinski, autre chercheur en relations internationales. Ses
études sur la légitimation de la guerre, les discours la rendant possible, et la géopolitique, en font un interlocuteur de poids pour mes recherches. J'entrerai aussi, dans ce cadre, en relation avec Christian Vandermotten, professeur de géographie politique de l'ULB. Lors de l'élaboration du
projet de thèse, je suis entré en correspondance, sous recommandation de Gilbert Hottois, professeur de philosophie de la technique de l'ULB, avec Jean Marsia, ancien directeur DEAO de
l'Ecole Royale Militaire. Jean Marsia avait entamé une thèse sur les questions de l'apprentissage de la pratique militaire, faisant écho avec mes préoccupations épistémologiques. Ce dernier m'a mis en contact avec Jean-Michel Sterkendries, chef du département d'étude des conflits (COST) de l'ERM.
Ce dernier m'a proposé son aide pour des questions de techniques militaires. J'ai pu aussi entrer en contact avec Carl Ceulemans, professeur de l'ERM sur les questions d'éthique militaire. Mon étude
philosophique ne pourra que se retrouver enrichie par ce contact avec le monde académique militaire. Il s'agira aussi, dans ce cadre, de fréquenter la Bibliothèque Universitaire de la Défense à Evere, dont les ouvrages sur l'Histoire, la technologie et la théorie militaires me seront d'une aide
précieuse. Ces professeurs de l'IEE et de l'ERM pourront être d'un grand secours pour une conceptualisation de la guerre comme écosystème et sur la question centrale de l'asymétrie
3 F.GROS, Le Principe Sécurité, ed. Gallimard, coll. NRF Essais, Paris, p.173.
Description du projet de recherches
a) Objectifs de la recherche
Notre ambition est de créer les bases d'une polémologie philosophique dans la lignée de la
géostratégie, de création d'espaces par le militaire, et portant sur le problème des guerres asymétriques. Les conflits armés contemporains sont, en effet, parfois appelés guerres
asymétriques. La guerre asymétrique concerne une généralisation de tactiques non frontales dans la guerre et, avec cette généralisation, l'implication accrue de combattants « irréguliers » (terroristes, pirates, trafiquants de drogues...). Cette guerre asymétrique s'oppose ainsi à une guerre
« classique » symétrique, où la bataille, mode de combat frontal, est la norme. Les tactiques non frontales existent aussi dans ce type de guerre, cette grande guerre, mais e ntre deux batailles ou
sièges, en tant que petite guerre ou guérilla, où à côté comme guerre coloniale. Ainsi, ces guerres coloniales peuvent être pensées comme guerres asymétriques, montrant que le phénomène n'est pas nouveau. Ce concept de guerre asymétrique désigne ainsi la guerre révolutionnaire telle que la
thématisait, à son époque, le général Beaufre. La question des combattants irréguliers, non tout à fait militaires, ou paramilitaires, pose ainsi le problème de l'étendue du concept de guerre.
Notre objectif principal est donc de penser le concept spatial d'asymétrie afin de définir le concept politique de guerre. Le concept de guerre, en effet, comme le concept de crime, est un concept
politique : c'est une décision politique qui en détermine l'étendue. Ce qui confirmerait l'adage clausewitzien : la guerre est la politique poursuivie par d'autres moyens. Telle est donc la raison
pour laquelle nous nous intéressons à ce problème de l'asymétrie ; asymétrie structurelle comme nous le verrons. L'asymétrie étant un concept spatial, notre premier objectif intermédiaire est de définir la guerre comme un espace, un système spatial, un écosystème donc. Cet espace est certes
déterminé par la politique, mais il est surtout produit par le militaire, conférant à ce dernier une autonomie tant conceptuelle que pratique. Ainsi, on pourrait penser une guerre indépendante de la
politique, une guerre sans État. Ce qui permettrait d'inverser le propos de Clausewitz, dans la lignée de Michel Foucault : la politique serait un espace de guerre poursuivi par d'autres moyens. Ainsi, notre second objectif intermédiaire est de montrer la production de cet espace par le militaire, l'art
de la guerre. Comme nous l'avons déjà vu, l'étude de l'art de la guerre, et donc des arts militaires, est l'objet d'une polémologie philosophique. Cet art de la guerre est l'ensemble de des arts militaires.
Cependant ces arts nécessitent pour produire d'agents et de techniques, un système d'arme. Notre troisième objectif intermédiaire est de penser ce système d'armes, participant à l'organisation des forces armées et permettant ainsi à l'art de la guerre de produire l'espace de guerre en tant que tel.
Le militaire serait ainsi un double système de savoirs et d'armes produisant l'écosystème de guerre.
b) Objectif intermédiaire premier : l'espace
Notre premier objectif intermédiaire est de penser la guerre en tant qu'espace produit.
Comme nous le verrons, la question spatiale est fondamentale aussi bien pour le système de savoirs de l'art de la guerre que pour le système technique et organisationnel d'armes. La question de
l'espace traversera ainsi toute notre réflexion. En concevant la guerre comme espace, nous refusons sa définition comme action. L'action en tant que telle fait partie de la guerre en tant qu'elle la fait, la produit, et concerne donc davantage les questions de l'art de la guerre et du système d'armes.
Cependant, c'est l'action même qui, en la produisant, montre le caractère spatial de la guerre. En raison du fait que la guerre est un espace produit, il s'agit donc déjà de dire quelques mots sur la
production, bien que la description des objectifs suivants développera cette question. L'art de la guerre n'a pas pour objectif de créer un espace mais de vaincre un adversaire se situant à un certain endroit ou de tenir tel endroit contre un adversaire, même potentiel ; il s'agit ici du problème de
l'attaque et de la défense, la dissymétrie. Cependant, si le but de l'art de la guerre n'est pas de
produire un espace, il a pour effet de le produire et ne peut que s'y rappor ter. Ainsi, nous pouvons constater que les armées contemporaines se divisent en Armes portant une référence spatiale : Terre, Mer et Air. A celles-ci peut s'ajouter une composante médicale posant le problème de la définition
du corps biologique comme territoire à investir, à conquérir, à exploiter ou à détruire.
Ce problème médicale pose la question de la nature de cet espace de guerre : cet espace même si source de danger, de désolation, d'horreur, de mort et de destruction, n'est pas un espace géométrique mais un espace vivant, un écosystème. Cette vie de l'espace de guerre explique notre
appellation d'écosystème mais aussi notre pensée selon laquelle l'art le plus central de l'art de la guerre est la géographie et non la géométrie. Cependant, en tant qu'écosystème, cet espace n'est pas
seulement vivant mais aussi systémique : il s'agit d'un système spatial. Cette nature systémique se comprend par sa production : le système des arts militaires se déployant à l'aide d'un système d'armes. Mais, avant de revenir à ce double système du militaire, il s'agit de définir un système. En
soi, tout corps peut être défini comme système, chose formée par une information circulant à l'aide de communications. Ces communications, au sens de voies ou connexions, structurent ainsi le
système. Il serait erroné de réduire les communications aux seules télécommunications ou langage (même corporel) qui ne sont que des canaux, communications parmi les autres. L'information est ce qui circule par ces communications, donnant forme à un système. Il ne s'agit donc pas de réduire
l'information à des données, mais à élargir cette notion aux conditions de formation d'un système. Ce qui permet à cet écosystème de se former, c'est le ravitaillement, en vivres, matériels, matériaux,
messages, êtres vivants, hommes... En gros, l'information de l'écosystème de guerre est l'économie de la guerre. Cette information devant venir du politique, nous pouvons voir que la politique même peut être considérée comme un écosystème, ainsi que sa continuité avec l'espace de guerre qu'elle
contribue à informer. Par l'information et les communications, la guerre serait vraiment un espace politique continué par d'autres moyens matériels.
Cependant, ces problèmes des communications et de l'information nous permettent de comprendre ce que nous entendons par asymétrie. Si la dissymétrie est l'opposition entre l'attaque et la défense,
l'asymétrie concerne les communications en tant que telles. Les communications étant la structure d'un système, nous pouvons en déduire que l'asymétrie est une asymétrie structurelle. A l'instar de la
dissymétrie, l'asymétrie est une opposition, cependant elle n'est pas celle de l'attaque et de la défense ou de la force et de la faiblesse mais du détournement et de la sécurisation des communications. Nous avouons nous inspirer des Seven Pillars of Wisdom de Lawrence mais une
telle vision semble visible chez Che Guevara dans son traité sur la guérilla et nous pouvons traiter dans ce sens, indépendamment de son existence historique, la figure de Robin Hood. Insurrection et
contre- insurrection sont souvent les deux pôles d'une guerre asymétrique poussant la dissymétrie à son extrémité et pouvant ainsi être dites dissymétrique. Cependant, on pourrait supposer que si deux armées devaient être de forces égales, elles privilégieraient aussi de nos jours cette action sur les
communications. Il ne s'agit pas de considérer que celui qui détourne est plus faible que celui qui sécurise, même si la faiblesse matérielle ou en effectifs peut conduire à favoriser le détournement en
vue de s'emparer du matériel adverse. La contre- insurrection elle-même a besoin de « désinformer » l'insurrection, de la couper de tous ses moyens d'information, de détourner son ravitaillement. Ainsi les deux pôles de l'asymétrie ne sont pas identiques à l'insurrection et à la contre-insurrection, bien
qu'un insurgé ou défenseur ait plus tendance à détourner et un contre-insurgé, occupant, colon ou attaquant à sécuriser. Ainsi, le détournement ne se réduirait pas à l'insurrection ou à la défense et la
sécurisation à la contre- insurrection et à l'attaque, l'asymétrie à la dissymétrie. L'asymétrie interroge ainsi le problème des communications mais, par là, aussi le lien entre guerre
et politique. En effet, les communications de l'espace politique peuvent être détournée et leur sécurisation déjouées. De ce point de vue de l'asymétrie, c'est alors la politique qui devient un
espace de guerre continué. Si l'on songe que plus elle se rapproche de la ville, une guérilla se fait clandestine et la contre- insurrection policière, c'est la différence entre guerre et crime qui est
interrogée ; le crime organisé deviendrait de ce point de vue une forme de guérilla. Bien que leurs buts ne soient pas principalement politiques, piraterie, banditisme et crime organisé deviennent des problèmes militaires potentiels de part leur action sur les communications. Ceci pose aussi la
question du caractère policier de l'Etat et de sa nature comme appareil de capture ou de chasse à l'homme si l'on suit Gilles Deleuze, Félix Guattari et Grégoire Chamayou. En dehors de ce
problème de l'Etat, nous pouvons aussi penser le lien possible entre la guerre et la ville : la nécessité d'une information du système de guerre peut expliquer la création de routes, chemin de fer, ponts, lignes télégraphiques, satellites... en bref de communications par le militaire, communications qui,
une fois sécurisée et la paix retrouvées, peuvent servir de base à la formation d'une ville ou d'un écosystème politique. De ce point de vue, la politique et le commerce seraient vraiment espaces de
guerre continués, expliquant leurs liens possible avec le militaire et l'espace de guerre qu'il produit. Le militaire en tant que producteur d'espace serait bien plus autonome par rapport à la po litique que l'adage clausewitzien pouvait donner à le croire.
c) Deuxième objectif intermédiaire : l'art de la guerre
Le fait que la guerre est produite nous conduit à parler de sa production, du système de savoir-produire, d'arts militaires qu'est l'art de la guerre. Cet art est d'ailleurs l'objet central de la
polémologie philosophique que nous avons proposé plus haut. Le concept d'art de la guerre renvoie d'ordinaire à la stratégie, la conduite des armées. Cette conduite concernant la guerre dans son
ensemble, la considérer comme art de la guerre en général est tout à fait compréhensible. Cependant, la stratégie n'est pas le seul art militaire : nous pouvons parler de la tactique, des arts martiaux, de l'Histoire militaire, de la géographie, de la gestion des ressources, du droit et de
l'éthique militaire, de la médecine ou du génie. L'art du combat du simple soldat participe aussi à son échelle à la production de la guerre. En tant qu'art de la conduite des armées, il faut toutefois
reconnaître à la stratégie son caractère architectonique, synthétique de l'ensemble. La stratégie serait ainsi une praxéologie générale. Elle semble ainsi être ce qui permet aux différents arts militaires de communiquer et de faire ensemble un système. La stratégie serait bien la structure du système de
l'art de la guerre dans son ensemble si l'on se contentait de considérer le but de cet art : vaincre ou ne pas être vaincu par l'adversaire. L'art de la guerre consiste ainsi en une sorte de commerce de
destruction réciproque avec cet adversaire, mais a pour effet de produire l'espace de guerre en général. La question est de savoir comment l'art de la guerre le produit.
Nous avons déjà souligné que l'art de la guerre produit la guerre avec le système d'armes, cependant, avant de parler de ce dernier, il s'agit de connaître la condition de son utilisation :
l'appréhension de l'espace. Ceci est la raison de notre développement préalable de la question de l'espace, au point précédent, participant donc à notre projet polémolo gique. La production de l'écosystème de guerre n'est, en effet, possible qu'en appréhendant ce dernier. Il s'agit de connaître le
terrain, de l'étudier. L'art militaire central, la structure véritable de l'art de la guerre n'est donc pas la stratégie qui en serait le sommet, mais la géographie. La géographie a ainsi deux fonctions
concomitantes : la topologie et la cartographie. Il s'agit d'étudier le lieu et se le représenter, le reproduire. Par la reproduction de l'espace, les décisions d'ordres stratégique et tactique deviennent possibles ; on peut établir les plans de guerre, de campagne et des opérations, déterminer les
ressources disponibles et nécessaires, les communications à établir, comprendre comment certaines guerres ont été gagnées ou perdues... La géographie est ainsi l'art militaire central. La stratégie
actuelle a évoluée en géostratégie, prenant en compte la création d'espace par le militaire. En raison de la base géographique de l'art de la guerre, on pourrait alors définir toute stratégie co mme ayant été géostratégique, ou tactique, géotactique, mais cette définition d'une s tructure géographique de
l'art de la guerre nous semble suffisante pour appréhender l'espace produit.
Si la structure de l'art de la guerre est la géographie et son sommet la stratégie, il s'agit toutefois de voir comment les autres arts militaires s'articulent autour d'elles pour former l'art de la guerre. En
faisant abstraction de la stratégie et de la géographie, il faut reconnaître l'importance centrale de l'art du combat. Si, la guerre est un espace de combat (battlespace), l'art martial est donc central. En vue de combattre, des armes sont créés. Ces armes ont une portée et un impact, un recul et un poids pour
leur porteur. Il faut donc apprendre leur maniement et coordonner les individus pour qu'ils combattent ensemble, fassent corps. D'autres techniques et outils sont ainsi créés pour soutenir le
combattant. Nous reviendrons plus sur ce problème de la technique au point suivant concernant le troisième objectif intermédiaire visant l'étude du système d'arme. Il est indéniable qu'une telle étude, de même que celle de l'espace, fasse partie de l'art de la guerre et ainsi de la polémologie que
nous cherchons à faire. Il s'agit surtout ici de penser le maniement de ce système d'armes. L'art martial concernant la plus petite unité, c'est à dire le soldat en tant qu'individu, une attention
particulière doit lui être donnée. Ainsi, un langage même stratégique peut s'inspirer de cet art martial et ses variantes, comme de l'escrime. Un dernier point qui concerne aussi le système d'armes, et peut-être d'une manière plus centrale encore, est la question de l'interaction du corps
vivant avec ces techniques ; le corps vivant faisant lui-même partie du système d'armes. Cette présence du corps à intégrer à ce système explique un intérêt pour le corps médical militaire
pouvant être une composante à part entière d'une armée à côté des composantes Terre, Mer et Air. Il s'agit d'en faire une arme pouvant en intégrer d'autres. La connaissanc e militaire en médecine, en particulier de l'anatomie, s'explique aussi par la volonté de détruire le corps biologique de son
ennemi. Il n'est ainsi pas étonnant que, dans le cinéma asiatique du moins, un spécialiste d'arts martiaux soit aussi médecin. Penser la connivence entre art martiaux et stratégie n'est pas inutile.
Les arts militaires renvoient aussi au problème de l'instruction militaire. En tant que savoir-produire, ces arts sont enseignés aux soldats. Cependant, ces arts pluriels témoignent auss i des
spécialisations au sein des corps armés : la stratégie est réservée aux chefs des armées, certains savoirs plus techniques, comme l'électronique, aux sous-officiers. Plus une armée grandit, plus des
composantes non guerrières se développent : la logistique et le Renseignement par exemple. Cependant, on peut considérer que du simple soldat à l'officier, une instruction militaire commune doit être donnée. Cette instruction apprend au soldat quels que soient son grade ou sa fonction à être
conforme à son grade et à sa fonction et à réagir en fonction de ceux des autres soldats, même ennemis. Cette instruction est ainsi une forme de sémiotique, d'apprentissage d'un régime de signes
auquel le soldat doit se conformer. Ce régime de signes est ainsi un système de coordonnée où le militaire peut se situer et déduire son comportement suivant d'autres signes : suivant tel terrain, utiliser tel équipement par exemple. En raison du fait que l'art de la guerre est tout de même une
action de destruction réciproque, la reconnaissance du terrain et de l'adversaire est importante. Le but du Renseignement est ainsi de connaître le régime de signe de l'adversaire permettant aux
stratèges de réagir. En bref, si la structure communicationnelle de l'art de la guerre est la géographie, ce régime de signes en est l'information.
Pour conclure, il s'agit de parler du problème de l'asymétrie. Détournement et sécurisation, nous l'avons vu, ne sont pas réservés respectivement à l'insurrection et à la contre- insurrection. La plupart
des guerres actuelles peuvent être considérés comme asymétriques vu l'importance de la problématique des communications. A l'instar d'André Beaufre par rapport à une supposée généralisation des guerres révolutionnaires, il s'agit plutôt de dire que la plupart des armées ont
intégré une composante révolutionnaire ou asymétrique, dans le cadre qui nous concerne. La stratégie et le régime de signe d'une armée moderne n'est pas la même que celle d'un groupe
d'insurgés, de terroristes, de trafiquants de drogues ou de pirates. Souvent, l'ennemi n'a même aucune instruction militaire préalable. La difficulté pour différencier le combattant du non combattant est ainsi accrue, surtout en ville. Ainsi, il s'agit de penser d'autres organisations voire, au
mieux, d'autres stratégies, tactiques et opérations, modifiant la donne des guerres contemporaines interrogeant la définition même de ce qu'est la guerre. Nous avons, lors du point précédent, ébauché
le lien entre la guerre et la ville. Le fait que les militaires, aujourd'hui, se conçoivent comme des professionnels et leurs officiers, comme des managers, l'origine militaire des outils de management
ainsi que la privatisation du militaire, interroge le lien possible entre guerre et commerce, voire l'évolution de l'art de la guerre.
d) Le système d'armes
Le régime de signes de l'art de la guerre participe à l'organisation du militaire, de même que le système d'armes lié à ce régime de signes ; le militaire est ce double système d'arts et d'armes. C'est ce double système qui produit l'écosystème de guerre. La fonction d'un soldat, en plus de son
art de prédilection, est déterminé par l'arme (même non létale) qu'il manie, surtout si elle nécessite la participation de plusieurs soldats (tel une arme d'artillerie lourde). Nous l'avons vu, une arme a
une portée, un impact et un poids. Il oblige celui qui la manie à certains comportements individuels ou collectifs. Le système d'armes, en tant que tel, ne se résume pas à un armement spécifique mais à un tout comprenant l'arme ou les armes, celui ou ceux qui les manipulent et un jeu de techniques
connexes en vue de cette manipulation. Ces armes et techniques ainsi agissent sur l'espace, le mesure, permettent à l'art de la guerre de se déployer et modifie cet art. C'est par ce système que
l'art de la guerre peut produire la guerre. Ces outils ont, ainsi un impact sur le système de savoirs militaires agissant réciproquement sur et au travers du système d'armes. Des outils sont nécessaires pour observer la conduite de la guerre, pour la mesurer, des véhicules pour l'informer et la traverser.
Divers dispositifs ainsi amplifient les sens et les forces, modifient les corps individuels et collectifs (in)formé pour attaquer ou défendre, détourner ou sécuriser.
Le soldat est ainsi intégré dans un système d'armes qu'il intègre aussi de son côté. Tout système d'armes est ainsi, dans une certaine mesure, plus ou moins intégré. Le système d'armes pose ainsi la
question de l'interaction homme-machine et de la figure composite du cyborg. L'adaptation du corps biologique, même animal (le cheval en tant que destrier) au système d'armes induit une
transformation de ce corps. Le système d'arme agissant sur l'organisation des belligérants, il s'agit de comprendre comment il est intégré à même les Corps de l'armée et aux corps biologiques. Cette mutation des corps biologiques et organisationnels par le double système militaire pourrait
expliquer l'analogie de l'art de la guerre avec la médecine, mais aussi les modifications du rapport des corps à l'espace et, par là, la création d'un espace de guerre. Dans une guerre asymétrique, dont
l'un des exemples les plus frappants est la première guerre du Golfe, il s'agit de traiter la force armée comme un corps biologique dont il faut identifier les centres nerveux et les détruire. Et ceci doit être fait aussi bien dans le cas d'une contre- insurrection ou d'une insurrection et même entre
armées égales. Telle est la raison pour laquelle, même si insurrection et contre-insurrection en sont les pôles fréquents, nous parlons plus de guerre asymétrique que de dissymétrique et refusons de
réduire l'asymétrie à une dissymétrie extrême. Le problème du système d'armes posant celui de l'interaction de systèmes différents, explique la
raison de notre intérêt pour la cybernétique dont les concepts ont modifié notre perception du monde contemporain et de la guerre même. Parler d'écosystème, comme nous le faisons, revient à
penser comment des systèmes différents peuvent interagir. La cybernétique comme sciences des systèmes autorégulés tentait d'expliquer l'interaction de systèmes différents. La pensée de la figure du cyborg, d'origine militaire, est l'un des produits de cette pensée cybernétique. Le développement
de l'informatique et des problèmes de cybersécurité de même. Le problème actuel de la sécurité concerne la protection de la circulation d'un flux, d'une information, même clandestine. Le
problème de cette sécurité est donc celle de l'asymétrie. C'est de ce type de sécurité que fait partie ce que nous nommons cybersécurité, faisant partie des guerres asymétriques. L'omniprésence de l'informatique, dans certaines armées du moins, explique le caractère vitale de la cybersécurité et
donc dans les guerres asymétriques. L'interaction homme-machine des systèmes d'armes est souvent aidée, de nos jours, suivie par des ordinateurs. Les drones posent d'ailleurs ce problème, même si la
distance de l'homme et de la machine est distendue jusqu'à la rupture, renvoyant à d'autres conceptions de l'espace de guerre. Cette évolution technologique pourrait expliquer le passage d'un
champ (de bataille) à un espace de combat, d'un battlefield à un battlespace. Les considérations géostratégiques sont ainsi considérables : le système d'armes modifie le rapport à l'espace. Il s'agit ainsi de comprendre comment ce rapport peut être modifié pour comprendre comment un espace de
guerre peut-être produit.
e) Plan du travail Nous allons, dans une première année, voir comment la guerre pourrait être un écosystème.
Nous nous baserons ainsi sur Gilbert Simondon sur les concepts de système, information et communications, appartenant à la cybernétique. Le Principe sécurité de Frédéric Gros nous aidera à
montrer le lien entre communications et (cyber-)sécurité. Enfin, nous définirons avec Clausewitz et Jomini les concepts de symétrie, dissymétrie et asymétrie. La lecture des auteurs américains sur la guerre asymétrique nous permettra de montrer les continuités et les ruptures des guerres
contemporaines avec celles que ces deux théoriciens majeurs décrivent. Nous tenterons ainsi de mettre au point notre conception d'une asymétrie structurelle.
Dans, un deuxième temps, nous redéfiniront l'art de la guerre comme le système des arts militaires producteur d'espace et centré sur l'espace. Concernant ce système de savoirs, nous nous inspirerons
de la lecture de Christophe Wasinski au sujet de la pensée stratégique et celle d'Yves Lacoste pour qui la géographie, ça sert d'abord à faire la guerre. Ceci nous permettra de penser l'épistémologie
militaire nécessaire pour appréhender ce système et la guerre en général. Nous aurons ainsi les bases de notre polémologie philosophique. Ainsi, nous rédigerons la première partie de notre travail.
Dans un troisième temps, nous étudierons la question du système d'armes et des organisations belligérantes qu'elles déterminent, ainsi que, sous un angle militaire, la figure du cyborg du
Manifeste de Donnah Haraway. Ce choix nous semble pertinent vu notre intérêt pour la cybernétique, en ce qui concerne son influence et ce que ses concepts permettent de penser. Nous lierons cette figure à la Guerre hors limite et à une lecture de Mille Plateaux à la lumière du livre de
Grégoire Chamayou, la Théorie du drone. En raison des liens entre le militaire et l'industrie, nous penserons également l'armée du point de vue du « management » et, ainsi, le rapport de la guerre
avec son économie, son information, de l'armée avec l'Etat et l'industrie, et enfin les possibilités de privatisation du militaire et d'une guerre sans État. Nous pourrons ainsi revoir la ligne de partage entre la guerre et le crime et entre les espaces de guerre et politique, ainsi que la place de l'asymétrie
qui traverse ces différents espaces.
Enfin, nous rédigerons l'ensemble de la thèse en faisant la synthèse de nos recherches.