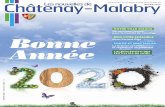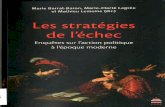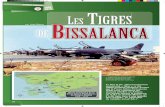Les obscénités de la philosophie: éclaircissements sur les "Éclaircissements" de Bayle
Avant juin, les rues de mai. Étude de cas sur les manifestations en faveur de la mobilité urbaine...
Transcript of Avant juin, les rues de mai. Étude de cas sur les manifestations en faveur de la mobilité urbaine...
77Tavares, F. M. M. & Roriz, J. H. R. 2015. « Avant juin, les rues de mai. Étude de cas sur les manifestations en faveur de la mobilité urbaine dans la ville de Goiânia. » Brésil(s). Sciences humaines et sociales 7, mai : 77-101.Article reçu pour publication en janvier 2015 ; approuvé en mars 2015.
Avant juin, les rues de mai.Étude de cas sur les manifestations en faveur
de la mobilité urbaine dans la ville de Goiânia
Francisco Mata Machado Tavares et João Henrique Ribeiro Roriz1
En 2013, la scène politique brésilienne a découvert de nouvelles formes de contestation sociale qui constituent pour les sciences politiques de ce pays des objets d’étude fort intéressants. L’étude de cas présentée
dans cet article porte sur le Frente de Luta do Transporte Público [Front de lutte pour les transports publics – FLTP] dans la ville de Goiânia et s’inscrit dans ce large contexte. Il s’agissait, au départ, de répondre à une question : quelle attitude les activistes observés ont-ils adoptée face aux normes et aux pratiques institutionnalisées du gouvernement et des partis2 ?
Toutefois, des impasses d’ordre politique et scientifi que que nous détaillerons plus loin nous ont conduits à redéfi nir la thématique et la méthodologie de cette recherche. Notre question a été reformulée de la manière suivante : comment le FLTP s’est-il organisé et de quelle façon ce mouvement a-t-il fait face aux dispositifs de coercition pénale de l’État au cours de la période s’étendant de mai 2013 à juin 2014 ? Notre analyse s’articule autour de trois axes principaux : le rapport entre le cas étudié ici et les tensions d’ordre colonial qui opposent les régions centrales du Brésil (situées au Sud-Est) aux zones périphériques comme le
1. Francisco Mata Machado Tavares est professeur de sciences politiques à la Faculté de sciences sociales de l’Université fédérale de Goiás (UFG). João Henrique Ribeiro Roriz est docteur en droit international et professeur de sciences politiques à la Faculté de sciences sociales de l’Université fédérale de Goiás (UFG).
2. Cette recherche a été réalisée dans le cadre du PROLUTA – Projet d’études sur l’activisme social et les luttes anti-régime – lié au Centre de recherches en Amérique latine et en politique comparée de l’Université fédérale de Goiás. Les auteurs tiennent à remercier les boursiers et boursières ainsi que les bénévoles participant à ce projet. Ils remercient, en particulier, le boursier Ian Caetano de Oliveira, chargé de la collecte des données et de l’élaboration de la chronologie de la trajectoire du FLTP. Nous remercions également les deux rapporteurs anonymes de la revue Brésil(s) pour les commentaires et les suggestions apportés.
78
LES MOBILISATIONS DE JUIN 2013
Centre-Ouest (i) ; le rapport entre le FLTP et les autres mouvements ou partis en ce qui concerne, notamment, la cohésion de ces manifestations ou l’élaboration de leurs revendications (ii) ; le rapport entre le FLTP et l’État, en particulier lorsque ce dernier déploie son arsenal coercitif et pénal-répressif (iii).
Avant d’exposer le cheminement de ce travail afi n de répondre à la question posée plus haut, il convient de délimiter son inscription thématique et théorique dans le champ universitaire des sciences politiques.
Les sciences politiques contemporaines ont largement tendance, notamment aux États-Unis et dans les pays, comme le Brésil, où « l’université se rapproche à grands pas du modèle américain » (Feres Jr. 2000, 98), à s’organiser autour de trois domaines théoriques et méthodologiques.
En premier lieu, on peut affi rmer que l’université et son institutionnalisation sont avant tout marquées par l’infl uence d’un lignage politique et philosophique qui va du libéralisme anglais à Weber avant de déboucher sur le courant néo-institutionnaliste, en particulier dans sa version du choix rationnel3. Ce courant de pensée tend à considérer les individus comme des unités d’analyse préférentielles, le modèle téléologique d’action comme le schéma explicatif du comportement d’acteurs politiquement actifs, l’État comme principal théâtre des rapports politiques et la domination/coercition comme essentielle au contenu sémantique de la catégorie du pouvoir. Quant aux techniques de recherche, les très nombreuses études de ce courant préfèrent souvent les réalités quantifi ables et recourent très largement aux statistiques et à la collecte de données empiriques de base par le biais, notamment, des surveys ou enquêtes. Ce champ d’étude off re de nombreux avantages : compréhension de la logique parlementaire ; caractérisation des partis, gouvernements et systèmes politico-électoraux ; description des mouvements tactiques ou stratégiques des acteurs internes dans le champ politique ; production de données de base ; élaboration de pronostics fi ables à court terme. On constate en revanche son insuffi sance lorsqu’il s’agit, notamment, d’identifi er les origines de ces préférences ; de normaliser des stratifi cations et des inégalités ; d’interpréter des crises de régime. Ajoutons en outre qu’il pousse à l’isolement épistémique et méthodologique des sciences politiques.
Un second courant, largement institutionnalisé et très spécialisé quoique moins infl uent que celui que nous venons d’évoquer, peut être associé à la vaste sphère sémantique de l’idée néo-républicaine de démocratie participative. Il considère que le peuple ou les sujets collectifs similaires constituent le principal objet d’analyse, avant les individualités dotées de préférences fondamentales. La référence en termes de philosophie politique provient ici de la longue tradition héritée de Rousseau et illustrée, de manière plus contemporaine, par des chercheurs tels que Carole Pateman (1970). L’État représente encore un point essentiel dans la compréhension de la politique, mais le jeu électoral,
3. À propos des versions du nouvel institutionnalisme en sciences politiques, voir Hall & Taylor (2003).
79
AVANT JUIN, LES RUES DE MAI
propre à la démocratie représentative, cède du terrain face à des objets d’étude associés à une conception plus vaste et plus intense de la souveraineté populaire comme les plébiscites, les référendums et les forums que l’État ouvre à la participation de la société civile, à l’exemple des expériences brésiliennes de budgets participatifs et d’organisation de conférences et de conseils. L’un des avantages scientifi ques de cette conception réside dans la mise en évidence de la faible identifi cation entre les gouvernants et les gouvernés dans les États libéraux démocratiques et de l’émergence dans le champ de la politique et du pouvoir d’expressions sociales irréductibles à la grammaire des débats électoraux ou à celle des partis politiques. Ses principales limites résident dans sa diffi culté à défi nir des termes aussi polysémiques que le peuple, le bien commun ou l’intérêt public ; dans son rapport tendu avec la réalité du pluralisme ; dans sa tendance à normaliser le caractère équitable des espaces de décision ouverts à une plus vaste participation ; ainsi que dans le peu de sensibilité qu’il manifeste à l’origine structurelle de certains confl its (Young 2001). Il existe dans les études sur la démocratie participative un pluralisme, voire un éclectisme, dans les techniques de recherches adoptées qui oscillent entre les interprétations théoriques et les études empiriques guidées par la quantifi cation.
Le troisième courant est celui qui s’est largement imposé depuis la fi n du XXe siècle grâce à une croissance exponentielle de son prestige et de sa pertinence (Bohman 1998). Il s’agit de l’ensemble des études abordant la circulation des fl ux de communication dans la sphère publique et leur infl uence respective sur le système étatique. Le délibérationnisme hérité de Habermas constitue la principale référence en matière de philosophie politique de ce courant dont la démarche analytique est guidée par l’ambition de dépasser le paradigme du sujet. Aussi, ses discours, son langage, ses arguments et ses actes de paroles acquièrent une primauté sur les subjectivités – qu’elles soient individuelles ou collectives – dans les études politiques. S’agissant des techniques de recherche, on observe un progrès de cette ligne de pensée depuis ses origines dans les études reconstructives, clairement philosophiques (Habermas 2003), jusqu’à des travaux plus récents, de nature principalement empirique (Steenbergen et al 2003). L’un des principaux mérites scientifi ques de la démocratie délibérative réside dans son aptitude à détecter l’origine et la formation des préférences politiques ; dans l’identifi cation d’un champ non étatique, informel et politiquement pertinent ; ainsi que dans l’extension aux sciences politiques des contributions philosophiques associées au contexte du « tournant linguistique ». Les principaux défauts de cette manière d’aborder la politique proviennent de ses bases habermassiennes, au sein desquelles est établie une séparation entre le travail et l’interaction non défi nie dialectiquement ; d’une certaine myopie face aux confl its structuraux associée à une « tendance à présenter les confl its comme une pathologie qui doit être éliminée » (Miguel 2012, 100) ; ainsi que
80
LES MOBILISATIONS DE JUIN 2013
d’une attribution intrinsèque au genre humain d’un mode de vie spécifi que à la bourgeoisie du XIXe siècle (Tavares 2013).
Le travail que nous présentons ici se distingue des trois champs hégémoniques que nous venons d’évoquer. Il est orienté vers d’autres perspectives, moins communes mais très prometteuses, pour aborder des phénomènes comme les manifestations organisées par le FLTP à Goiânia, par le Movimento Passe Livre [Mouvement pour le ticket gratuit – MPL] à São Paulo, par l’Assembleia Popular Horizontal [Assemblée populaire horizontale] à Belo Horizonte, par le Fora Cabral [Cabral dehors] à Rio de Janeiro et par le Bloco de Luta pelo Transporte Público [Bloc de lutte pour les transports publics] à Porto Alegre. Ils ont tous adopté des voies moins institutionnalisées et moins reconnues dans le champ des sciences politiques qui ont tendance à se concentrer sur des objets nettement identifi és. João Freres Jr. (2000) les défi nit comme des « thèmes tabous », du fait de leur faible occurrence dans les articles et les ouvrages consacrés à ce domaine.
Selon ces perspectives (nombreuses et très distinctes les unes des autres), la politique se comprend à partir des dynamiques sociales confl ictuelles. Elles ne sont pas considérées comme un problème à éliminer comme c’est le cas dans la démocratie délibérative. Les rapports antagonistes, selon ces approches, ne se réduisent pas à des règles et des logiques électorales et ne se synthétisent pas plus qu’elles ne se résolvent dans des processus de décision participatifs. Pour recourir à un terme unique, puisé chez Machiavel, le « tumulte » est, fondamentalement, partie prenante de la politique4. Les grèves illégales, les guérillas, les séquestrations des responsables publics, les manifestations massives dans les rues, les boycotts et les regroupements entre partis ou les mouvements sociaux dont la stratégie vise la faillite – plutôt que la gestion – des régimes juridico-politiques possèdent tous, à la lumière de ces approches, une quintessence politique sans être pour autant considérés déviants ou pathologiques.
Ces études ne placent pas l’État ou la sphère publique au centre de la politique mais les confl its sociaux. Les unités d’analyse sont les collectivités en lutte, comme les classes, les groupes sexuels ou ethniques, les colonisés et les subalternes. Les bases de leur philosophie politique sont diverses et variées, incluant des infl uences souvent disparates voire contradictoires. Elles vont des écrits de Marx et des marxistes jusqu’aux théories sociales contemporaines, notamment socialistes, féministes, radicales, anarchistes, agonistes, anticolonialistes, recognitives5 ou critico-réfl exives.
4. Comme on peut le lire dans l’un des passages les plus connus de l’auteur : « J’affi rme que ceux qui condamnent les tumultes advenus entre les nobles et la plèbe blâment ce qui fut la première cause de la préservation par Rome de sa liberté […] » (Machiavel 1996 [1531], I, 4, 196-197).
5. Pour être précis : les luttes par la reconnaissance (Kampf um Anerkenung) semblent mieux adaptées au modèle délibérationniste. Quant aux luttes pour la reconnaissance (Kampf des Anerkennens), elles s’inscrivent dans ce registre. À propos de cette diff érenciation, voir Renault (2010).
81
AVANT JUIN, LES RUES DE MAI
Dans l’ensemble des cas, l’axe directeur est constitué par l’accent mis sur le confl it politique qui apparaît et s’exprime en dehors des institutions, en particulier contre l’État, ou encore sur les formes de protestation reconnues comme valides et légitimes. Les principaux avantages de ces diverses manières d’étudier la politique – au sein desquelles notre recherche puise ses concepts et ses constructions théorétiques, logiques et interprétatives – résident dans l’identifi cation des crises de régime, au-delà des crises de gouvernement ; dans la formulation de pronostics à long terme ; dans la possibilité de dépasser l’isolement de la politique par rapport aux autres champs ; dans sa capacité, au-delà de la sévérité critique de ses recherches, à proposer des conclusions plus solides et plus complètes. Sa plus grande lacune réside dans sa diffi culté à considérer les méandres institutionnels et dans sa capacité restreinte à élaborer des pronostics à court terme. En ce qui concerne leurs techniques de recherche, les travaux appartenant à ce courant se révèlent aussi éclectiques que pluriels, incluant des études quantitatives autant que le recours à des techniques comme celle de la recherche participative.
Menée dans un cadre, peu exploré quoique très vaste, qui se situe en marge de la triade néo-institutionnalisme, délibérationnisme et néo-républicanisme, la présente recherche propose une contribution aux études portant sur l’institutionnalisation, dans le champ des sciences politiques, d’un programme tourné vers l’analyse des diverses formes de l’activisme contemporain. Nous partons ainsi de la critique formulée par le philosophe Costas Douzinas qui, évoquant les manifestations disséminées mondialement à partir de la crise de 2008, estime que « les sciences politiques établies, obsédées par les machinations des gouvernements, des partis et de leurs responsables, ne parviennent pas à comprendre ces mouvements et les rejettent en considérant qu’ils ne sont pas politiques » (Douzinas 2013, 134-135). Cet article, en eff et, vient s’ajouter à d’autres travaux qui étudient la politique brésilienne sous le prisme des actions contestataires menées dans les rues, en particulier celui des répertoires et des formes d’actions suivis à partir de 2013, à l’exemple de Bringel (2013), qui cherche à dépasser les limites des interprétations habituelles en identifi ant ce qu’il appelle leur « myopie ».
Après avoir posé le problème de la recherche et de son inscription dans le champ des sciences politiques, on peut présenter la démarche suivie ici. Nous aborderons d’abord les impasses d’ordre politique et méthodologique qui ont conduit à dévier du cheminement initialement prévu afi n de redéfi nir la problématique centrale, le type d’enquête et les techniques de recherche adoptées. Nous décrirons ensuite la trajectoire du FLTP dans la période comprise entre mai 2013 et juin 2014. Enfi n, nous exposerons la dynamique de l’action du FLTP durant les manifestations et son rapport avec la coercition et la persécution pénale de l’État.
82
LES MOBILISATIONS DE JUIN 2013
De la recherche sur les limites aux limites de la recherche : impasses politiques et méthodologiques de l’étude du FLTP à Goiânia
L’objectif initial de notre recherche était de comprendre l’attitude des activistes du FLTP qui ont appelé aux manifestations dans les rues de Goiânia (État de Goiás) en 2013 face à l’institutionnalisme d’État. Nous souhaitions atteindre un certain nombre d’objectifs spécifi ques : une cartographie des origines, de l’organisation, de la liste des revendications, des liens avec les institutions et les partis, de la composition à partir d’autres mouvements ou groupes, du processus d’autonomisation politique, des formes de communication (en particulier les nouvelles technologies de l’information) et du répertoire des actions politiques du FLTP avant, pendant et après les manifestations menées entre mai et septembre 2013 (i) ; une identifi cation de la manière dont les activistes du FLTP perçoivent les modes institutionnalisés de participation publique et les réponses formulées faces à leurs revendications ponctuelles (ii) ; ainsi que la production de données empiriques qualitatives de base sur le profi l socioculturel des activistes du FLTP (iii).
Nous avons mis en œuvre, avant de l’abandonner au milieu de son application, la technique de recherche consistant à réaliser des entretiens poussés avec les activistes. En outre, nous devions constituer des groupes de réfl exion réunissant des membres du FLTP. Les données empiriques fournies par ces enquêtes devaient servir de base à notre analyse avant d’être interprétées théoriquement afi n d’atteindre les objectifs que nous rappelions plus haut.
Une succession d’évènements imprévus, qui ont éclaté alors que nous allions parvenir au terme de notre rapport de terrain, nous a contraint à redéfi nir de manière signifi cative l’objet de notre enquête ainsi que la démarche méthodologique adoptée. Une opération de police, menée conjointement par le Service de renseignement et par la Brigade de répression des actions criminelles organisées (DRACO) de la police civile de l’État de Goiás, a pris de court à la fois les sources et les chercheurs impliqués dans le travail universitaire en question. Cette opération, baptisée « 2,80 » en référence à l’augmentation du prix du service public des transports urbains dans la ville de Goiânia, a été lancée à l’aube du 23 mai 2014, dans le but d’appréhender, d’envoyer en prison préventive et de poursuivre plusieurs militants du FLTP. À cette occasion, les autorités policières ont accordé des interviews aux médias locaux en profi tant de la grande visibilité que le sujet avait atteint au niveau régional afi n d’annoncer, de manière insistante et emphatique, que de nouvelles arrestations auraient lieu les jours suivants.
Le profond impact de cette action sur les membres du FLTP nous a obligé à revoir plusieurs aspects de notre recherche. Les autorités policières, sous prétexte d’enquêter sur des individus ayant commis des délits, ont saisi des brochures,
83
AVANT JUIN, LES RUES DE MAI
des comptes rendus de réunions, des déclarations politiques, des textes programmatiques, des articles universitaires et tout type de matériel permettant une compréhension détaillée de l’organisation, des revendications et du profi l des participants aux manifestations en faveur du respect des recommandations légales préconisant la modicité des tarifs des transports urbains dans la ville de Goiânia. Dans ce contexte, il devenait éthiquement inconvenant de manipuler des bases de données incluant des enregistrements qui contenaient les témoignages et les déclarations d’activistes. Le fait de rendre public ou simplement accessible un tel corpus pouvait entrainer un risque pour la sécurité des sources interrogées et des chercheurs et chercheuses qui risquaient de voir leur matériel utilisé à charge par la police. Aussi, avons-nous choisi d’interrompre nos entretiens avec les participants aux manifestations de 2013 et opté également pour le choix, scientifi quement assumé, de ne pas utiliser les témoignages déjà recueillis.
L’action coercitive a certes produit des eff ets sur les sources de notre enquête mais également sur les chercheurs impliqués dans ce travail. Notamment parce que l’un des activistes contre qui a été lancé un mandat d’arrêt préventif puis qui a été arrêté, Ian Caetano de Oliveira, est titulaire d’une bourse d’étude dans le cadre de notre projet de recherche PROLUTA-UFG. En eff et, une somme importante d’informations stockées physiquement – sous forme d’archives constituées de brochures, d’œuvres graphiques et de textes académiques sur les mouvements sociaux – ainsi qu’un ordinateur dont le disque dur contenait du matériel empirique devant être utilisé pour ce travail universitaire, ont été confi squés par la police. En défi nitive, à la veille d’établir des conclusions, ce travail s’est avéré irréalisable du fait ses possibles eff ets pour la sécurité des sources et des chercheurs et du handicap majeur que constituait cette saisie des données et la mise en détention d’un boursier en charge de certaines tâches fondamentales.
Au regard des faits que nous évoquons, il s’est avéré impératif de modifi er radicalement notre type de recherche. Nous avons donc opté pour un travail conçu comme assez objectif et recourant aux techniques de la recherche participante, plus spécifi quement de la recherche-action. Soulignons que, dans un contexte où le matériel réuni avait été partiellement confi squé par les autorités policières et où un membre de notre équipe se trouvait incarcéré, la seule manière de poursuivre cette investigation scientifi que résidait dans l’intervention sur la réalité, afi n de rétablir les conditions mêmes dans lesquelles puisse se mener un travail universitaire de nature plus orthodoxe.
Ainsi, à partir de ces arrestations, de ces poursuites et de ces mandats d’arrêt, les auteurs de ce travail se sont retrouvés politiquement impliqués à l’intérieur même du sujet de leur recherche et engagés par des liens et des responsabilités auprès des acteurs de cet activisme qui n’avait été jusque-là qu’un objet d’analyse. L’un d’entre nous a rejoint le collectif d’avocats qui sont intervenus en faveur de
84
LES MOBILISATIONS DE JUIN 2013
la libération des militants incarcérés tout en s’engageant au sein des négociations politiques, de l’élaboration de documents publics ou encore de réunions avec les dirigeants des divers mouvements et partis. Le second coauteur s’est également impliqué dans une participation active à des rassemblements, des réunions et des assemblées. Nombreux ont été les boursiers et les bénévoles du PROLUTA-UFG qui ont suivi une trajectoire similaire6.
À partir de cette nouvelle orientation de notre mode de recherche, pour les raisons évoquées, il a été nécessaire de reformuler la problématique principale de ce travail. La recherche-action, nous ne l’ignorons pas, est orientée au gré de paramètres de validation et de justifi cation particuliers, selon une diff érenciation ainsi défi nie :
Les chercheurs conventionnels ont un souci d’objectivité, de distance et de contrôle. Les tenants de la recherche-action se préoccupent de pertinence, de changement social et d’une validité mise à l’épreuve dans l’action par des intervenants qui y engagent leur responsabilité. (Brydon-Miller, Greenwood & Maguire 2003, 25)
Nous avons en outre adopté la thèse de Marx (1843) selon laquelle une conduite scientifi que critique doit être compatible avec la formule considérant que « rien n'empêche notre critique de prendre position en politique, de faire la critique de la politique, de s'associer aux luttes réelles, voire de s’identifi er à ces luttes ».
En analysant les enquêtes policières et les documents juridiques, tout en prenant part à de très nombreuses réunions, assemblées et rassemblements, nous avons amassé un très solide matériel empirique qui, sous un prisme analytique et théorétique adéquat, nous a permis d’apporter des réponses valides à nos questions sur les modèles d’interaction entre le FLTP et le monde juridique et politique, à la lumière des trois courants de pensée décrits dans notre introduction.
La recherche-action que nous décrivons ici est donc une étude de cas centrée sur la trajectoire du FLTP entre mai 2013 et juin 2014. Nous avons adopté le courant épistémologique et méthodologique représenté par Bent Flyvbjerg, qui considère que cette manière de mener les sciences sociales permet l’identifi cation des « cygnes noirs » qui sous-tendent les pratiques poppériennes de réfutabilité. En outre, selon les mots de l’auteur, « il est bon de rappeler l’idée de Th omas Kuhn selon laquelle une discipline sans un nombre signifi catif d’études de cas minutieusement conduites est une discipline sans production systématique d’exemplaires, or une discipline sans exemplaires est une discipline ineffi cace. Les sciences sociales ont tout à gagner de la multiplicité des études de cas » (Flyvbjerg 2006). Nous avons ainsi considéré que l’étude de cas n’était pas seulement
6. Les actions en question ont reçu un soutien institutionnel. Une assemblée universitaire, réunissant près de 250 professeurs et élèves de la Faculté de sciences sociales de l’UFG et dirigée par le directeur du département, a décidé à l’unanimité la suspension d’une partie des activités universitaires (y compris les cours) pour que chacun puisse participer aux rassemblements publics en faveur de la libération des prisonniers politiques.
85
AVANT JUIN, LES RUES DE MAI
avantageuse pour la préparation d’autres recherches ou en tant que prélude à des travaux comparatifs, mais qu’elle revêtait aussi une valeur intrinsèque en tant que méthode de recherche en sciences politiques.
L’analyse du cas étudié nous a permis, comme nous allons maintenant le relater, de parvenir à trois découvertes contrintuitives – des « cygnes noirs » – correspondant à la réfutation des généralisations communément admises selon lesquelles les manifestations de juin 2013 au Brésil auraient débuté à São Paulo (i), les mouvements de 2013 auraient connu une explosion nihiliste ou anomique (ii) et les mécanismes constitutionnels propres à la démocratie libérale auraient constitué, à Goiânia, un cadre favorable à la notion, défi nie par Robert Dahl, de contestation politique (iii). Avant d’aborder de front ces questions, nous proposons ici un récit historique des principaux épisodes impliquant le FLTP entre mai 2013 et juin 2014.
Jours de lutte : récit et périodisation des manifestations en faveur des transports publics dans la ville de Goiânia entre mai 2013 et juin 2014
Le Front de lutte pour les transports publics est un mouvement social implanté dans la vie de Goiânia et dans son agglomération. Ce groupe est composé, dans sa majorité, de jeunes étudiants de l’université ou du secondaire. Parmi ses membres, on compte des militants ne participant à aucune autre forme associative, des activistes impliqués dans d’autres mouvements sociaux et des membres des partis ou des organisations politiques situés à la gauche de l’opposition au Gouvernement fédéral. Idéologiquement, le FLTP s’inscrit à gauche de l’échiquier politique et réunit de nombreux adhérents qui se réclament de tendances très diverses, depuis les diff érentes variantes du marxisme jusqu’à des conceptions autonomistes et libertaires.
Le terrain social sur lequel intervient le FLTP est situé dans une agglomération qui compte près de 2,4 millions d’habitants et affi che, selon le coeffi cient de Gini – qui s’élève à 0,65 –, le taux d’inégalité le plus important d’Amérique latine, à la dixième place dans le monde (Serodio 2012). La capitale de la région, Goiânia, connaît depuis plusieurs années une croissance intense et désorganisée et, selon Borges (2014), a des taux de criminalité très élevés (28e rang mondial pour les taux d’homicide pour 10 mille habitants). Il s’agit en outre d’une ville qui souff re de problèmes structuraux dans ses services de transports publics et où la préférence est largement accordée à l’automobile individuelle. Goiânia est la ville du Brésil où le nombre d’automobiles par habitant est le plus élevé, avec une voiture pour 1,6 habitants (Oliveira 2009). Le maire de la ville, Paulo Garcia, est affi lié au Parti des travailleurs (PT) et gouverne une coalition incluant le Parti du mouvement démocratique brésilien (PMDB). Le gouverneur de l’État du Goiás,
86
LES MOBILISATIONS DE JUIN 2013
Marconi Perillo, est membre du Parti de la social-démocratie brésilienne (PSDB). C’est dans ce contexte que le mouvement que nous étudions évolue et agit. Sa première revendication est l’amélioration de la qualité du service public des transports en commun de la ville et la baisse de ses tarifs. Sa principale tactique consiste à manifester dans les rues. Le récit chronologique de ces actions et de leurs développements progressifs est indispensable pour analyser l’objet de notre recherche.
Le 8 mai 20137 s’est tenu le premier rassemblement offi ciellement convoqué par le FLTP, connu alors comme le Frente de Lutas Contra o Aumento [Front de lutte contre l’augmentation]. La manifestation avait immobilisé la circulation pendant plusieurs heures. Elle avait réclamé la venue d’un représentant de la Compagnie métropolitaine des transports en commun (CMTC), l’organisation en charge du transport public dans l’agglomération de Goiânia, afi n de lui remettre une liste de revendications. La répression policière a progressivement monté en puissance du fait de l’arrivée de troupes de plus en plus lourdement armées et de l’augmentation de la pression exercée pour que les manifestants libèrent la voie publique. Après d’intenses négociations, une responsable de la CMTC s’est présentée et a pu s’exprimer au micro de la voiture sonorisée qui accompagnait la manifestation.
Le 16 mai 2013, un rassemblement s’est mis en marche le long de l’artère principale de la ville, l’avenue Anhanguera, en direction d’un important dépôt d’autobus situé sur une place nommée place A. L’intention des activistes était de débattre avec la population du problème des transports. Ils n’ont toutefois pas pu atteindre ce but puisqu’avant même l’arrivée de la manifestation, le dépôt avait été vidé et qu’un cordon avait été établi par la police pour l’isoler. La tension a atteint son comble lors du premier aff rontement, particulièrement violent, entre activistes et policiers. Plusieurs personnes ont été blessées, des gaz lacrymogènes ont été employés, des grenades non létales lancées et, en dernière instance, des tirs à balles réelles ont été employés. La répercussion dans la presse a été très importante. La date de cette manifestation correspondait à la réunion de la Chambre délibérative des transports en commun (CDTC), l’organisation en charge de statuer sur l’augmentation des tarifs. La réunion a été annulée et repoussée au 21 mai 2013.
À cette date, précisément, une nouvelle manifestation s’est réunie devant les portes du palais Pedro Ludovico, le siège du gouvernement de l’État, où devait
7. À l’exception de la manifestation du 20 juin 2013, nous n’avons pas indiqué le nombre des participants. Nous avons opté pour ce choix car il n’existait pas d’accord minimum entre les données fournies par les journalistes, la police et les activistes. De la même façon, il n’y a pas de méthodologie claire et transparente permettant le relevé de ce type d’information pour les manifestations de Goiânia. On estime, pour les démonstrations antérieures au 20 juin, une présence oscillant entre 200 (selon les estimations les plus restrictives présentées par la police militaire) et 3 000 manifestants (selon les versions les plus optimistes transmises par les activistes et les journalistes). Les observations eff ectuées par les chercheurs et chercheuses du PROLUTA-UFG indiquent que les manifestations réunissaient en moyenne des attroupements répartis sur environ 200 mètres de longueur, occupant la largeur de l’une des voies des plus grandes avenues de la ville.
87
AVANT JUIN, LES RUES DE MAI
se tenir la réunion de la CDTC8. Il était prévu que la rencontre soit ouverte, en respect du principe de gestion démocratique de la ville, au nom de la participation de la population telle qu’elle est défi nie dans l’article 2, paragraphe 2 de la loi 10.257/2011 connue comme Statut de la ville. Après de longues négociations, un groupe de trois personnes a fi nalement été autorisé à pénétrer dans le bâtiment. Contrairement à ce que pouvaient attendre les autres manifestants réunis dans la rue, ces trois activistes ont été maintenus dans le palais du gouvernement sans pouvoir accéder à la réunion de la CDTC. L’augmentation des tarifs a été annoncée ce jour-là.
Le 28 mai 2013, le rapport entre les autorités policières et les manifestants s’est modifi é du fait d’un accroissement important de la répression contre les activistes. Un cortège est parti de la place de l’Université où sont regroupées plusieurs instances de l’Université fédérale de Goiás (UFG) et de l’Université catholique (PUC Goiás). Les manifestants ont défi lé jusqu’au dépôt de la place de la Bible, qui relie les quartiers centraux et périphériques de la ville. La manifestation se déroulait de nuit et, une fois encore, le dépôt d’autobus avait été vidé et isolé par les forces policières. Il y a eu de nouveaux aff rontements beaucoup plus sérieux que les précédents. Les militaires ont eu recours à la cavalerie et au peloton de choc. De très nombreux activistes se sont réfugiés dans les dépendances de la Faculté de droit de l’UFG, dans l’enceinte de l’université. Il a fallu plusieurs heures d’encerclement policier avant d’obtenir la possibilité d’une sortie négociée des manifestants.
Le 30 mai 2013 s’est tenu, à Goiânia, sur cette même place de l’Université, le congrès de l’Union nationale des étudiants (UNE). En arrivant dans la ville, le président de cette organisation, à l’époque Daniel Iliescu (du Parti communiste brésilien), a critiqué les manifestants ayant participé au rassemblement deux jours plus tôt. Depuis l’aéroport où il débarquait, il a accordé une interview dans laquelle il condamnait publiquement les tactiques qui adaptent leur logique directement en fonction de l’actualité, comme l’usage de masques9. Le congrès
8. L’organisme en question est composé, exclusivement, d’élus et de représentants de l’appareil bureaucratique d’État. Aucune participation n’est accordée à la société civile. Sa composition actuelle est la suivante : Eduardo Alexandre Zaratz Vieira da Cunha (président de la CDTC et secrétaire d’État de la Région métropolitaine de Goiânia), Paulo de Siqueira Garcia (maire de Goiânia), Luiz Alberto Maguito Vilela (maire d’Aparecida de Goiânia), Misael Pereira de Oliveira (maire de Senador Canedo), Humberto Tannús Júnior (président de l’Agence goianaise de régulation, contrôle et supervision des services publics – AGR), Ubirajara Alves Abbud (président de la CMTC), Patricia Pereira Veras (secrétaire municipale pour la circulation, les transports et la mobilité à Goiânia), Nelcivone Soares de Melo (secrétaire municipal pour le développement urbain durable de Goiânia), Talles Barreto (député de l’État).
9. Depuis le sous-commandant Marcos, de l’EZLN, suivi par les militants de Seattle en 1999 lors de la réunion de l’OMC et de Gênes en 2001, jusqu’aux innombrables autres occasions qui ont suivi, l’usage de masques est devenu une partie intégrante du paysage des protestations, en tant que moyen d’éviter les représailles de l’État, de cultiver une nouvelle esthétique activiste et de protéger les militants contre les eff ets directs des gaz toxiques utilisés par les pouvoirs publics. Notons que les autorités policières des bataillons de choc ont toujours eu recours à ce type d’artifi ce dans le monde entier, utilisant des casques et des masques. Il s’agit donc davantage d’une tentative d’égalisation des conditions entre les agents de l’État et la société civile que d’une tactique unilatérale ou adoptée par cette dernière de manière disproportionnée.
88
LES MOBILISATIONS DE JUIN 2013
présidé par Iliescu avait bénéfi cié, pour sa réalisation, d’un généreux fi nancement de la part du gouvernement de l’État de Goiás, en charge aussi de la police militaire. La profonde diff érenciation entre l’activisme de gauche du XXIe siècle et les mouvements paraétatiques de la période Lula-Dilma, au cours de l’histoire récente du Brésil, apparaissait à cette occasion de la manière la plus claire qui soit.
Dans ce contexte de manifestations chaque fois plus tendues, le mois de juin 2013 allait être celui de la propagation massive dans tout le pays de mobilisations très largement suivies. Cette vague de contestation et de mobilisation sociale survenait en même temps que l’organisation dans le pays de la Coupe des confédérations par la FIFA. Une cartographie du réseau Facebook établie par Sérgio Amadeu et Tiago Pimentel pour la ville de São Paulo, montre que, jusqu’au 13 juin, alors que la capitale pauliste avait déjà connu trois rassemblements publics au sujet des transports, ce thème et celui de la violence policière constituaient les revendications les plus souvent débattues dans le cadre des échanges relatifs aux manifestations sur ce media social (Pimentel & Silveira 2013). Il s’agissait là du début des Journées de juin ou, plus prudemment encore, des « évènements de juin » (Singer 2013). Les manifestations qui, en mai, avaient agité des villes comme Natal, Porto Alegre et Goiânia, parvenaient, un mois plus tard, dans les rues de capitales telles que Rio de Janeiro, São Paulo et Belo Horizonte. L’insurrection, en gestation dans les régions périphériques du pays, atteignait enfi n le centre économique du Brésil.
Le 6 juin 2013, à Goiânia, un nouveau rassemblement a été organisé. Les activistes se sont dirigés vers le centre opérationnel de l’organisme responsable de la coordination des horaires et des fl ux des autobus urbains. À nouveau la tension a monté entre la police et les manifestants qui ont été contraints de se réfugier à l’intérieur de l’Institut fédéral, une institution publique d’enseignement supérieur.
Le 19 juin 2013, la veille de la plus importante manifestation organisée à Goiânia, l’augmentation du tarif des transports a été suspendue, le prix du ticket revenant ainsi à sa valeur antérieure. Ce revirement d’une politique tarifaire publique était la première victoire du mouvement.
Le 20 juin 2013, la ville de Goiânia connaissait l’un des plus importants rassemblements publics de son histoire, comparable seulement aux épisodes de Diretas Já pour les élections libres (1984) et Fora Collor pour la destitution du président Fernando Collor de Mello (1992). Environ 50 000 personnes ont défi lé dans le centre de la ville au cours d’une après-midi aux allures de jour férié informel où les commerces, les écoles et les organisations publiques avaient suspendu leurs activités. Ce rassemblement avait été convoqué par le FLTP quelques jours plus tôt, après une réunion préparatoire tenue le 19 juin qui avait rassemblé environ 90 personnes et où avaient été précisés les détails des revendications et l’itinéraire de la marche.
89
AVANT JUIN, LES RUES DE MAI
Cette démonstration atteignit une dimension inédite, elle défendit des revendications très diversifi ées et ne respecta pas les paramètres qui avaient été défi nis la veille. Les policiers militaires distribuaient des fl eurs aux passants. On pouvait y voir diverses bannières de nature contradictoire10, des masses humaines défi lant dans des directions disparates et une profonde hostilité contre les activistes impliqués dans les premiers rassemblements. Des militants de partis de l’opposition de gauche, jusqu’alors acceptés sans heurt au sein des défi lés, se sont retrouvés victimes d’agressions. L’itinéraire établi, qui prévoyait à l’origine de se terminer devant l’Assemblée législative, a été remplacé par un trajet sans signifi cation politique qui s’achevait dans un quartier résidentiel aisé, appelé Secteur Bueno ne comptant aucune représentation gouvernementale mais de nombreux bars et boîtes de nuit où une grande partie des manifestants sont allés terminer leur journée. Quelques groupes minoritaires restés fi dèles aux décisions adoptées se sont dirigés vers l’Assemblée législative, où ils ont été la cible des troupes de choc et de la police montée. On a compté plusieurs blessés.
À partir du 20 juin, considérant que la situation était à la fois inédite et confuse, le FLTP décida d’engager une série de débats internes. Ils débouchèrent sur un élargissement de ses revendications, notamment sur la mobilité urbaine entendue d’une façon plus générale sans insister davantage sur la question des tarifs. À cette occasion, le mouvement, abandonnant son nom de Front de lutte contre l’augmentation, fut rebaptisé Front de lutte pour les transports publics.
Le 27 septembre 2013 ont été prévues deux manifestations simultanées organisées, respectivement, par les professeurs du service public municipal et par le FLTP. Le 3 octobre 2013 a eu lieu un rassemblement, moins suivi, qui s’est à nouveau terminé par l’encerclement par la police militaire des activistes réfugiés dans la Faculté de droit de l’UFG.
L’année 2013 s’est achevée par la conquête, formellement du moins, de la gratuité des transports pour les étudiants dans l’agglomération de Goiânia. Cette mesure, toutefois, était soumise à un accord entre le gouvernement de l’État et les mairies en vue de la répartition du coût de cette décision entre les budgets respectifs de ces diverses instances. La législation en matière de politique publique de gratuité des transports pour les étudiants n’a été défi nitivement adoptée que l’année suivante.
En 2014, les rassemblements publics qui ont suivi l’annonce d’une nouvelle augmentation des tarifs revendiquaient principalement le retour à une politique publique appelée Ganha tempo (Gain de temps), permettant aux usagers des transports urbains d’eff ectuer trois trajets d’autobus avec un seul ticket à condition
10. Il y a avait, par exemple, ceux qui réclamaient la réduction de la charge tributaire du « secteur productif » et ceux qui exigeaient plus d’impôts pour les entrepreneurs. Certains critiquaient l’homophobie, alors que d’autres brandissaient des banderoles clamant « Ronaldo, tu dis que la Coupe du Monde ne se fait pas avec des hôpitaux mais avec des stades. Je te dis : le sexe se fait avec des femmes, pas avec des travestis. »
90
LES MOBILISATIONS DE JUIN 2013
de ne pas dépasser un temps global de deux heures et demie. Cette mesure avait été abandonnée à la suite d’une décision judiciaire obtenue par les entreprises concessionnaires. Les autres revendications soutenues par les manifestants concernaient l’amélioration de la qualité des transports, l’application immédiate du projet de gratuité pour les étudiants ainsi que l’abandon de ses limitations et des conditions qu’il imposait.
Le 6 février, une manifestation pacifi que a été dispersée par la cavalerie et les troupes de choc de la police militaire. Une fois encore, les activistes se sont réfugiés dans l’Université fédérale de Goiás d’où ils ne sont sortis qu’après des négociations entre leurs avocats et les forces de l’ordre qui assiégeaient à nouveau les manifestants. Les 13 et 26 février et le 8 mars 2014, le FLTP organisa de nouveaux rassemblements.
Après l’annonce d’une nouvelle hausse des tarifs, le 15 avril 2014, le FLTP et d’autres organisations ont mis en place une Journée de lutte. Six rassemblements avaient été programmés mais seulement deux d’entre eux ont eu lieu en plus de l’immobilisation d’un dépôt menée spontanément par des usagers des transports. Le 9 mai 2014, une autre manifestation s’est terminée par le saccage de plusieurs autobus par des individus non identifi és. Le 21 mai s’est tenu encore un rassemblement alors que les conducteurs de bus préparaient eux-mêmes l’organisation d’une grève. Les tensions face aux policiers et la présence de plus en plus nombreuse de policiers militaires en civil ont marqué tous les évènements de cette période.
Au cours de l’année 2014, de très nombreuses mobilisations sont venues s’ajouter aux rassemblements organisés par le FLTP. Dans plusieurs dépôts de Goiânia et de son agglomération, on a assisté à des révoltes spontanées – sans ligne politique ni planifi cation préalable – provoquées par les retards et l’insuffi sance des transports. Dans ce contexte, des autobus ont été détruits et plusieurs dépôts fermés. La question des transports en commun et de l’absence de toute voie de dialogue entre la municipalité, l’État et les usagers ont gagné une nouvelle dimension et sont devenues un thème central de l’agenda public de la ville, dans le cadre d’une rébellion civile incontrôlée et très large. La multiplication des révoltes spontanées remettait en cause, plus que jamais, les compétences des responsables du service public des transports en commun urbains ainsi que l’insuffi sance reconnues de leurs eff ectifs.
Le 13 mai 2014, comme nous l’avons déjà évoqué, a été menée l’opération policière « 2,80 ». Trois activistes, âgés de 18 à 19 ans, ont été arrêtés à leur domicile à six heures du matin par des hommes vêtus de noir et cagoulés (une panoplie très similaire à celle des militants adeptes des stratégies du black block). Les jeunes hommes ont été menottés (en contradiction avec l’article 11/STF de la Jurisprudence) et conduits au commissariat. Après y avoir enregistré leurs dépositions, ils ont été menés en prison. Parmi les preuves criminelles
91
AVANT JUIN, LES RUES DE MAI
recueillies à leur domicile fi gurait un livre publié par les éditions Boitempo, des instruments de musique, des affi ches et des brochures de mouvements comme celui de mai 1968 en France, et plusieurs ordinateurs portables. Les jeunes étaient accusés d’avoir saccagé un autobus, mais tout ce que l’enquête policière pouvait faire valoir à leur encontre était le témoignage d’un militaire retraité qui exerçait la charge de « gérant de la sécurité et des risques » dans une entreprise de transports. Dominium, comme dans les derniers jours de l’Empire romain, semblait conditionné par les actions d’Imperium.
L’un des prisonniers politiques, l’artiste graphique Heitor Vilella, 19 ans, étudiant en sciences de l'information et de la communication à l’UFG, était accusé d’incitation au crime pour avoir confectionné des tracts et des affi ches contre l’augmentation des tarifs des transports. Ian Oliveira, 19 ans également, était accusé d’avoir participé à une manifestation au cours de laquelle un bus aurait été incendié le 9 mai 2014. Le jeune homme se trouvait précisément ce jour-là à l’Institut de sciences politiques de l’Université de Brasília, où il présentait un travail universitaire dans le cadre du 2e Symposium national « Démocratie et inégalités ». Le troisième jeune incarcéré, João Marcos, est un lycéen qui a eu 18 ans en avril 2014 et qui participe, comme de très nombreux camarades de son école, à des manifestations. Un mandat d’arrêt contre un quatrième étudiant nommé Tiago, inscrit à l’UFG, n’a pas pu être exécuté car les autorités policières n’ont pas réussi à le localiser. Dans les documents émis par l’enquête de police, les activistes étaient décrits comme « subversifs » – un vocabulaire étranger au droit national depuis la fi n de la dictature militaire – et le FLTP était considéré comme une « organisation criminelle ».
Ces évènements ont suscité l’indignation de la société civile de Goiânia, en particulier parmi les mouvements sociaux et les intellectuels. L’Ordre des avocats du Brésil (OAB) a exigé des explications sur les incarcérations et a plaidé le respect des droits fondamentaux des détenus. Le président de l’UFG s’est présenté au commissariat de police et, quelques jours plus tard, il a été reçu par le président du tribunal de justice11 en demandant à ce que le cas soit abordé dans le respect de la légalité et de la constitutionalité. Une vaste assemblée, dans la soirée du samedi 25 mai, a réuni plus de 300 personnes dans l’auditorium de la Faculté des sciences de l’éducation de l’UFG. Tout l’éventail politique de la gauche s’y est montré solidaire et uni contre les partis du gouvernement (PT, PMDB et PSDB), la police militaire, la police civile, les procureurs et le pouvoir judiciaire. Un document contre la criminalisation des mouvements sociaux a été unanimement approuvé par une collectivité constituée d’intellectuels indépendants, d’anarchistes, de maoïstes, de trotskistes, de stalinistes, de
11. L’un des auteurs de ce texte a participé à cette réunion. Il y a également observé la présence du juge auxiliaire de la présidence du tribunal et d’un lieutenant-colonel de la police militaire.
92
LES MOBILISATIONS DE JUIN 2013
théologiens de la libération, d’adeptes de Luís Carlos Prestes12 ou de l’autogestion, etc. En quelques heures, plus de deux mille signatures de soutien venues du monde entier étaient réunies13.
Le mardi 27 mai, une manifestation massive a réaffi rmé, à nouveau, l’unité de la gauche politique de Goiânia et gagné les rues de la ville en direction du tribunal de justice14. Le jeudi 29 mai au matin, un nouveau rassemblement s’est tenu dans le centre de la ville, rejoint par les professeurs de l’agglomération. Les manifestants exigeaient la libération immédiate des détenus, qui n’eut lieu qu’au soir du 29 mai. Ces deux manifestations se sont déroulées sans heurt entre les forces de police et les participants parmi lesquels fi guraient les directeurs des départements de l’UFG, des membres de l’OAB et des personnalités publiques locales.
Cette aff aire a gagné une grande visibilité dans la presse locale. Son traitement oscillait entre l’expression d’une image négative des prisonniers politiques et leurs portraits élogieux décrivant leur cursus universitaire et leurs habitudes quotidiennes. Les changements de ton suivaient le cours des adhésions aux manifestations et aux soutiens exprimés sur les réseaux sociaux.
Cet épisode est particulièrement éclairant dans la mesure où, d’une façon peu commune dans l’histoire récente du pays, une mairie responsable du service des transports, des entrepreneurs du secteur, la police militaire, la police civile, les procureurs et le pouvoir judiciaire ont agi de manière coordonnée et effi cace pour appréhender préventivement des militants d’un mouvement social15.
La suite de notre article cherche à tirer des conclusions à partir de la succession d’épisodes exposée dans cette étude de cas, afi n de souligner les limites de trois généralisations ou conjectures communes à la pratique des sciences politiques
12. Luís Carlos Prestes qui a dirigé l’une des plus importantes révoltes militaires des années 1920 connue comme celle des « lieutenants » a ensuite participé à l’opposition contre Getúlio Vargas et a été l’un des fondateurs du Parti communiste brésilien (Ndt).
13. Le contenu de cette note peut être consulté à l’adresse suivante : http://passapalavra.info/2014/05/95539 (consulté le 22 juin 2014).
14. Le juge auxiliaire de la présidence du tribunal, accompagné d’un lieutenant-colonel de la police militaire, a reçu une commission constituée des proches des prisonniers et de leurs avocats. À cette occasion a été remis le document public mentionné ci-dessus. L’un des auteurs de ce travail était présent au cours de cette réunion.
15. Dans le cadre des procédures pénales, la prison préventive ne peut être prononcée que dans des situations très exceptionnelles. À la diff érence de la garde à vue, par exemple, elle n’a pas de limite fi xe de durée et peut être poursuivie indéfi niment, tandis qu’est menée l’instruction criminelle. Le Tribunal suprême fédéral (STF), a considéré qu’en tout état de cause ce type d’emprisonnement de précaution ne peut pas dépasser 81 jours, une période de toute façon beaucoup plus longue que toutes les autres formes d’emprisonnement avant condamnation. Dans le cas que nous étudions, il existe une particularité qui éveille l’attention : si les jeunes avaient été condamnés aux plus lourdes peines encourues pour tous les crimes dont on les accusait, ils ne seraient pas restés ainsi incarcérés en régime clos. En somme, au cours de la simple enquête sur les crimes supposés, ils se trouvaient déjà dans une situation plus lourde que dans l’hypothèse de la plus sévère des condamnations. Ces circonstances ont été, à plusieurs reprises, considérées comme abusives par le STF. Une enquête informelle réalisée auprès des activistes, avocats et chercheurs spécialistes des mouvements sociaux semble indiquer qu’il s’agit là de la première délivrance d’un mandat d’arrêt préventif contre des militants depuis les évènements de juin 2013.
93
AVANT JUIN, LES RUES DE MAI
au Brésil, en ce qui concerne leur analyse des manifestations organisées à partir de 2013.
Conclusions partielles : trois « cygnes noirs » identifi és dans cette étude de cas
Le récit chronologique présenté plus haut permet d’élargir l’éventail cognitif des sciences politiques. En premier lieu, parce que l’analyse du cas étudié concerne une succession d’évènements sociaux et politiques qui s’inscrivent intrinsèquement dans une logique contemporaine du pays. Il s’agit en outre d’un cas qui nous permet d’identifi er très clairement la signifi cation de l’activisme et des manifestations publiques dans un cadre politique. Les travaux analysant des objets comme le comportement électoral, les jeux législatifs, les coalitions de gouvernement, les espaces participatifs ou les débats informels dans la sphère publique rencontreraient certaines diffi cultés pour expliquer, par exemple, l’apparition de la politique publique de la gratuité des transports dans l’agglomération de Goiânia. Autrement dit, les luttes sociales menées dans les rues sont aussi pertinentes, dans les limites des sciences politiques – qui ont encore tendance à les mésestimer –, que dans les domaines où elles sont plus volontiers étudiées, à l’image de la sociologie politique et de l’anthropologie.
En outre, le cas que nous étudions démontre que l’analyse des rapports de forces dans le Brésil contemporain, même selon la stricte défi nition wébérienne de l’autorité ou de l’infl uence sur la machine de l’État, ne peut pas être décomposée comme un débat cohérent entre les diff érents partis institutionnalisés du pays. Il est possible, en revanche, d’identifi er, au-delà des frontières du champ politico-institutionnel, des pressions et des revendications organisées qui défi ent les bases sur lesquelles s’accordent les partis du régime. Les cycles de protestations populaires, comme dans le cas que nous présentons ici, permettent souvent de mettre en lumière les solidarités entre les acteurs du champ politique (par exemple le PT, le PSDB, le PMDB, etc.) pour défendre leur pré carré lorsqu’il se retrouve menacé16. Selon les mots de Bourdieu :
16. À São Paulo, la police commandée par le gouverneur Geraldo Alckmin (PSDB) s’est illustrée dans la répression contre les manifestants pacifi ques organisés en faveur d’une politique publique des transports, revendiquée auprès du maire Fernando Haddad (PT), si bien que le dirigeant municipal n’est apparu en public qu’au cours d’une unique occasion pendant les manifestations de juin, précisément depuis le palais des Bandeirantes, siège du gouvernement de l’État, lorsqu’il a annoncé la réduction des tarifs aux côtés du gouverneur. À Porto Alegre, la police commandée par le gouverneur Tarso Genro (PT) a perquisitionné le domicile d’activistes du Parti des luttes et du socialisme (PSTU) et de la Fédération anarchiste gaúcha (FAG), en saisissant des brochures et des textes universitaires, en vue de freiner un mouvement plaidant auprès du maire Fortunati (Parti démocratique travailliste, PDT) pour de nouvelles politiques des transports. À Bahia, les forces policières dont le commandant en chef est le gouverneur Jaques Wagner (PT) se sont assurées que les manifestants pacifi ques soient contenus dans leurs rassemblements contre le maire Antônio Carlos Magalhães Neto (Démocratiques, DEM). Dans tous ces cas, le ministre de la Justice a mis à disposition la force nationale
94
LES MOBILISATIONS DE JUIN 2013
Cette solidarité de tous les initiés, liés entre eux par la même adhésion fondamentale aux jeux et aux enjeux, par le même respect (obsequium) du jeu lui-même et des lois non écrites qui le défi nissent, par le même investissement fondamental dans le jeu dont ils ont le monopole et qu’il leur faut perpétuer pour assurer la rentabilité de leurs investissements, ne se manifeste jamais aussi clairement que lorsque le jeu vient à être menacé en tant que tel. (Bourdieu 1981, 7)
Au-delà de ces éléments, le cas étudié ici, comme nous l’avions anticipé dans nos considérations introductives, permet de formuler trois réfutations – « cygnes noirs » – des conjectures – « généralisations » – communes aux sciences politiques brésiliennes telles qu’elles existent aujourd’hui. Nous les abordons successivement.
Au-delà du géocentrisme du Sud-Est : les origines périphériques des manifestations de 2013
Au centre-ville de Goiânia, précisément entre les deux avenues les plus fréquentées de la ville, s’élève une statue du bandeirante 17 Bartolomeu da Silva, dit Anhanguera, habillé du traditionnel costume du conquistador, fusil à la main. Elle représente sans aucun doute le monument public le plus célèbre et le plus visité de la capitale. Il s’agit d’un « don » off ert en 1942 à la ville par le Centre académique XI de Agosto, l’association des étudiants de la Faculté de droit de l’Université de São Paulo (USP). En quelques mots, il suffi t de rappeler qu’Anhanguera était un bandeirante de São Paulo qui est venu sur le sol du Goiás pour trouver de l’or. Cette expédition avait été fi nancée en grande partie par son gendre, João Leite da Silva Ortiz, le fondateur de Curral del Rey, qui allait devenir la ville de Belo Horizonte. En somme, sur le point central et le plus fréquenté de Goiânia, trône l’image sans équivoque du colon venu du Sud-Est, off erte comme il se doit par la jeunesse étudiante de l’USP.
Selon cette logique coloniale, il n’y a pas à s’étonner que la pensée scientifi que développée dans la région Sud-Est, en particulier à l’Université de São Paulo, s’attache, même sous la plume d’auteurs marxistes ou critiques, à analyser depuis São Paulo – où les choses auraient commencé – des phénomènes comme les manifestations de 2013. André Singer, par exemple, dans un article publié dans
pour intervenir si les gouverneurs des États le jugeaient nécessaire. Il s’agit d’une succession d’évènements qui devrait donner lieu à une minutieuse étude de la part des chercheurs liés au champ des politiques publiques, tant est grande la capacité de coordination qu’ont démontrée les dirigeants politiques appartenant à des forces rivales.
17. Les bandeirantes (de bandeira, compagnie de milice ou militaire) étaient des aventuriers issus de la colonisation européenne du plateau pauliste qui protégeaient les colons des attaques indigènes ou s’aventuraient dans les terres intérieures (en direction de l’actuel Minas Gerais et plus loin) à la recherche d’amérindiens susceptibles d’être réduits en esclavage puis, à partir de la fi n du XVIIe siècle, d’or. En dépit de leurs exactions, ils sont considérés comme les pères fondateurs de la province de São Paulo (Ndt).
95
AVANT JUIN, LES RUES DE MAI
la New Left Review et traduit en portugais dans la revue Novos Estudos – CEBRAP, aborde les manifestations de 2013 selon une chronologie ainsi établie :
Les évènements se sont divisés en trois phases qui ont chacune duré une semaine. Le bouillonnement a été provoqué par une petite fraction, certes méritante, de la classe moyenne, en organisant des mobilisations strictement circonscrites à la ville de São Paulo les 6, 10, 11 et 13 juin.[…]Après le début de la Coupe des confédérations (le 16 juin), São Paulo perd son rôle central, et les villes devant accueillir les matchs (Brasília, Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte et Rio de Janeiro) deviennent le point nodal des protestations. (Singer 2013, 24-26)
Un autre penseur lié au courant critique, Plínio de Arruda Sampaio Júnior, professeur à l’Université de l’État de São Paulo à Campinas (Unicamp), a déclaré que « les manifestations ont débuté à São Paulo et se sont généralisées dans tout le Brésil, dans une réaction des masses face aux débordements et aux décisions arbitraires des gouvernants » (Sampaio Jr. 2013).
Il n’est pas besoin d’une grande sophistication méthodologique ni d’une recherche empirique particulièrement poussée pour admettre que les manifestations de 2013 se sont diff usées de Natal à Porto Alegre, de Porto Alegre à Goiânia et de Goiânia à São Paulo, dans un enchaînement où les rassemblements organisés d’une ville à l’autre s’infl uençaient mutuellement par le biais des réseaux sociaux (notamment Facebook) et des pages Web de certains activistes (à l’exemple du site « Passa palavra »). Sur sa page Internet, par exemple, le MPL de São Paulo reproduisait, le 23 mai 2013, un compte rendu tiré du site « Passa palavra » relatant les manifestations de Goiânia, suivi d’une déclaration de soutien de la part du mouvement pauliste.
Il faudrait une enquête plus fouillée pour estimer combien la méconnaissance de l’origine géographique des manifestations exprime une « identité dominante » par la « négation totale de l’autre » (Santos 2006, 250). L’hypothèse semble probable dans un pays comme le Brésil où le processus historique a déterminé en particulier « les conditions pour que le colonialisme externe soit remplacé par le colonialisme interne, et le pouvoir colonial par le colonialisme du pouvoir » (Santos 2006, 248).
On peut ainsi tirer de cette étude de cas un premier bénéfi ce scientifi que, la réfutation phatico-historique des récits relatés par le géocentrisme du Sud-Est à propos des manifestations de 2013 au Brésil.
La thèse d’une fragmentation nette et irrémédiable des luttes politiques menées dans les rues en juin 2013 n’a pas plus de consistance. À Goiânia, du moins, les choses ne se sont pas déroulées ainsi, comme nous proposons maintenant de le montrer.
96
LES MOBILISATIONS DE JUIN 2013
La cohésion comme règle dans les manifestations de rue entre mai 2013 et juin 2014 dans la ville de Goiânia
Des auteurs reconnus de sciences politiques au Brésil ont critiqué les manifestations de 2013 comme étant une cacophonie de revendications ou de bannières imprécises, voire contradictoires. L’auteur le plus représentatif de cette lecture des événements a été Wanderley Guilherme dos Santos. Il a rédigé de très nombreuses tribunes d’opinion sur le mode suivant :
Somme toute, la voix de la rue n’existe pas, il n’y a que des cris. Ce n’est pas les banderoles peintes qui ont poussé les premières foules dans la rue, elles ont surgi quelque temps après les défi lés, en quête du pourquoi de ces manifestations. En soi, l’amélioration générale de la santé publique ou de l’éducation n’entraîne pas le déplacement de dizaines de milliers de manifestants. Quant à la réforme politique, même les banderoles n’en pipent mot. […] Aujourd’hui, les manifestations sont constituées, outre des indécrottables téméraires et naïfs qui prétendent leur donner des airs de légitimité, de groupes anomiques de jeunes assez aisés, de groupes néonazis et pré-fascistes, d’organisations nihilistes nationales et internationales, auxquels s’ajoutent les gangs habituels de voleurs et de bandits. (Santos 2013)
Le cas que nous avons étudié ici permet de réfuter la généralisation déjà évoquée comme relevant d’un mélange de géocentrisme du Sud-Est (les caractéristiques propres à Rio de Janeiro sont élevées au statut de modèles d’analyse des manifestations en général) et de pétrifi cation d’un moment précis et circonstancié des actions de 2013 et 2014. Comme nous l’avons vu dans la chronologie exemplaire de Goiânia, c’est seulement le 20 juin 2013 qu’a été constatée une multitude contradictoire et désorientée de revendications, d’acteurs et de tactiques. Au cours de toutes les autres occasions, en particulier lors de la manifestation pour la libération des prisonniers politiques en 2014, c’est la cohésion, la concentration et l’unité entre des forces politiques aussi vastes que diverses qui a caractérisé les défi lés dans les rues. En partant d’une analyse minutieuse et détaillée de chacune des manifestations organisées à Goiânia, il semble raisonnable de supposer qu’un phénomène similaire ait pu se dérouler à Rio de Janeiro, où les grandes manifestations de l’avenue Rio Branco ont pu être organisées grâce à des mouvements inclusifs, démocratiques et déterminés quant aux revendications qu’ils exprimaient, comme les mouvements Ocupa Câmara [Occupe la Chambre], Fora Cabral et la Greve dos Garis [Grève des éboueurs].
La thèse d’une explosion anomique des manifestations, quoiqu’il en soit, demande à être démontrée au moyen d’études capables de produire des enquêtes couplées à des séries annuelles – à l’exemple de la présente étude – sur l’ensemble des rassemblements qui se sont tenus au moins dans les rues des capitales d’État du Brésil. Ce que le présent travail a accompli à Goiânia doit
97
AVANT JUIN, LES RUES DE MAI
être reproduit à une échelle nationale, avant d’acquérir la légitimité scientifi que nécessaire pour soutenir les idées évoquées.
La citation d’un auteur élogieux vis-à-vis des institutions démocratiques et représentatives du pays, nous donne l’occasion d’évoquer la troisième découverte de ce travail, relative à la nature non polyarchique de la scène politique actuelle dans l’agglomération de Goiânia. Nous terminerons sur ce point nos conclusions.
L’absence de polyarchie : signes de fermeture du régime politique à Goiânia
Les manifestations qui se sont déroulées à Goiânia entre mai 2013 et 2014 ont été, dans leur quasi-totalité, pacifi ques. Les épisodiques actes de vandalisme se sont presque toujours produits au cours des révoltes spontanées sans direction politique. Le mouvement que nous étudions ne se défi nit pas du tout, dans ses objectifs, comme un groupe anti-régime ou révolutionnaire. En revanche, ses revendications portent essentiellement sur l’application de normes juridiques déjà instituées, comme la modicité des tarifs, la qualité du service public, la libre manifestation d’opinions et la gestion participative de la ville. Avant même de revendiquer de nouveaux droits – ce qu’ils font dans une moindre mesure –, ces activistes se limitent à solliciter l’application de la législation de la part des pouvoirs publics. À Goiânia et dans sa région, leurs revendications contestataires pourtant limitées suffi sent toutefois à les faire basculer dans l’insécurité.
Au cours de son travail en tant qu’avocat des prisonniers politiques, l’un des auteurs de cet article a été pris de cours par le nombre d’appels téléphoniques reçus quotidiennement (entre 120 et 150 par jour). La quasi-totalité de ces appels provenaient d’étudiants ou de dirigeants de mouvements ou de syndicats. Ils témoignaient tous de la même inquiétude exprimée en ces termes : « Maître, pouvez-vous me dire si mon nom est cité dans une des enquêtes policières et s’il existe une chance que je sois le prochain sur la liste des personnes arrêtées ? » Confrontées aux arrestations d’étudiants, des dizaines de personnes quittaient la ville en toute hâte. La tension semblait incontrôlable.
Même le collectif d’avocats, constitué de cinq personnes, parmi lesquelles un membre du conseil fédéral de l’OAB, ne pouvait pas se déplacer dans les dépendances du tribunal de justice sans une escorte de quatre policiers militaires qui établissaient autour de lui un cercle étroit en l’accompagnant dans chacun de ses pas, suite à la décision d’un lieutenant-colonel. Une autre avocate a vu son domicile mis sous étroite surveillance et a été obligée de déménager provisoirement.
98
LES MOBILISATIONS DE JUIN 2013
Comme nous l’avons vu plus haut, presque toutes les manifestations depuis mai 2013 avaient été pacifi ques, ce qui n’a pas empêché une progressive répression policière. Les poursuites pénales donnant lieu à la saisie de livres, brochures et instruments de musique et à la détention de jeunes âgés de 18 et 19 ans ont reçu l’aval de l’État dans son ensemble, c’est-à-dire du pouvoir exécutif, du pouvoir judiciaire et des procureurs et ont été passées sous silence par les parlementaires.
Comme nous l’avons montré, l’État et la municipalité n’ont jamais reçu les manifestants. Il n’existe donc pas non plus de mécanismes institutionnels, au-delà des élections tous les quatre ans, qui soient tournés vers la participation sociale et le traitement des revendications ou des aspirations exprimées au sein des sphères publiques de la ville.
En outre, on observe une militarisation inhabituelle de la scène politique de l’État. Depuis l’administration scolaire, qu’elle suit en raison de ses rapports avec les mouvements sociaux, la police militaire exerce un ensemble de fonctions toujours plus importantes et éloignées de la liste des compétences que lui reconnaît la Constitution de la République. L’État a été la cible d’un Incident de déplacement de compétence déposé au Tribunal suprême de justice (STJ) par le bureau du procureur général de la République, en raison de l’ineffi cacité de ses institutions (police, procureurs et pouvoir judiciaire) dans l’enquête sur les assassins récidivistes de sans-abri dans l’agglomération de Goiânia qui n’avait débouché ni sur une inculpation ni sur un procès.
Il semble pourtant raisonnable de suggérer qu’à Goiânia, où l’État qualifi e les manifestants de « subversifs » et leur mouvement social d’« organisation criminelle », où il se livre à des intimidations contre des avocats, des intellectuels et des dirigeants de mouvements sociaux, il n’existe rien de comparable à ce que Robert Dahl défi nit comme « la possibilité d’exercer son opposition au gouvernement, de former des organisations politiques [et] de s’exprimer sur les questions politiques sans craindre de représailles de la part du gouvernement [...] » (Dahl 2012, 41). Les critères d’inclusion et de libéralisation sur lesquels pèsent la réalité du suff rage universel et la prévision formelle d’un régime constitutionnel et démocratique, ne se vérifi ent pas, ipso facto, à Goiânia et dans sa région. C’est ce qu’indique la succession d’épisodes anticonstitutionnels de répression que nous avons évoqués ici, et qui touchent toutes les sphères du gouvernement. À partir de cette conclusion partielle, de nouvelles études sur le sujet doivent désormais être menées.
Il est en eff et important d’établir un programme de recherches, dans le cadre des sciences politiques critiques, qui chercherait à enquêter sur les rapports eff ectifs de domination qui sous-tendent les institutions contemporaines à Goiânia, capables de faire taire manu militari les manifestations de toutes les voix dissonantes face à celle des élites politiques qui gèrent les institutions
99
AVANT JUIN, LES RUES DE MAI
de l’État. Découvrir la vérité des rapports de force sous-jacents et prévalant sur le « genre sans corps » (Marx 2005) que représente la formalité juridico-constitutionnelle s’avère une tâche urgente et essentielle pour analyser comme il se doit les relations politiques actuelles dans la région.
Traduit du portugais par Simon Berjeaut
Références bibliographiques
Bohman, James. 1998. « Th e Coming of Age of Deliberative Democracy. » Th e Journal of Political Philosophy 6 (4): 400-425. Disponible sur : http://pages.uoregon.edu/koopman/courses_readings/phil123-net/publicness/bohman_delib_dmcy.pdf (consulté le 27 mars 2015).
Borges, Fernanda. 2014. « Goiânia é a 28a Colocada em Ranking das Cidades mais Violentas do Mundo. » G1, 24 mars. Disponible sur : http://g1.globo.com/goias/noticia/2014/03/goiania-e-28-colocada-em-ranking-das-cidades-mais-violentas-do-mundo.html (consulté le 17 juin 2014).
Bourdieu, Pierre. 1981. « La représentation politique. Élements pour une théorie du champ politique. » Actes de la recherche en sciences sociales 36-37: 3-24.
Bringel, Breno. 2013. « Miopias, sentidos e tendências do levante brasileiro de 2013. » Insight Inteligência 62: 42-53. Disponible sur : http://insightnet.com.br/inteligencia/?page_id=48 (consulté le 20 février 2015).
Brydon-Miller, Mary, Davydd Greenwood & Patricia Maguire. 2003. « Why Action Research? » Action Research 1 (1): 9-28. Disponible sur : http://www.civitas.edu.pl/pub/nasza_uczelnia/projekty_badawcze/Taylor/Brydon-Miller.pdf (consulté le 27 mars 2015).
Dahl, Robert A. 2012. Poliarquia: participação e oposição. São Paulo: EDUSP [éd. originale (1971) : Polyarchy: Participation and Opposition. New Haven: Yale University Press].
Douzinas, Costas. 2013. « Athens Uprising. » European Urban and Regional Studies 20 (1): 134-138. Disponible sur : http://core.ac.uk/download/pdf/11305000.pdf (consulté le 27 mars 2015).
Feres Jr., João. 2000. « Aprendendo com os Erros dos Outros: O que a História da Ciência Política Americana tem para nos Contar. » Revista de Sociologia e Política 15: 97-110, nov. Disponible sur : http://www.scielo.br/pdf/rsocp/n15/a07n15.pdf (consulté le 27 mars 2015).
Flyvbjerg, Bent. 2006. « Five Misunderstandings about Case-Study Research. » Qualitative Inquiry 12 (2): 219-245, avril.
100
LES MOBILISATIONS DE JUIN 2013
Habermas, Jürgen. 2003. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. Vol. I. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro [éd. française (1997): Droit et démocratie. Entre faits et normes. Paris : Gallimard].
Hall, Peter A. & Rosemary C. R. Taylor. 2003. « As três versões do neo-institucionalismo. » Lua Nova 58: 193-224.
Keane, John. 1975. « On Tools and Language: Habermas on Work and Interaction. » New German Critique 6: 82-100, automne.
Machiavel, Nicolas. 1996. Discours sur la première décade de Tite-Live. Œuvres traduites sous la dir. de Christian Bec. Paris : Robert Laff ont [éd. originale (1531) : Machiavelli, Niccolò. Discorsi di Niccolò Machiavielli sopra la prima deca di Tito Livio. Firenze : Bernardo di Giunta.]
Marx, Karl. 1843. « Marx to Ruge. » (Letters from the Deutsch-Französische Jahrbücher) Kreuznach, sept. Disponible sur : http://www.marxists.org/archive/marx/works/1843/letters/43_09.htm (consulté le 11 janvier 2013).
Marx, Karl. 2005. A Crítica da Filosofi a do Direito de Hegel. São Paulo: Boitempo. [Éd. française (1927) : « Contribution à la Critique de la philosophie du droit de Hegel. » In Oeuvres philosophiques traduites par J. Molitor. Paris : A. Costes. Éd. originale (1844) : « Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. » Deutsch-französische Jahrbücher, fév.]
Miguel, Luis Felipe. 2012. « Democracia e Sociedade de Classes. » Revista Brasileira de Ciência Política 9: 93-117, sept.-déc.
Oliveira, Mariana. 2009. « 15 das maiores cidades têm um veículo para cada 2 habitantes. » G1, 2 nov. Disponible sur : http://g1.globo.com/Noticias/Carros/0,,MUL1361733-9658,00-DAS+MAIORES+CIDADES+TEM+UM+VEICULO+PARA+CADA+DOIS+HABITANTES.html (consulté le 12 juin 2014).
Pateman, Carole. 1970. Participation and Democratic Th eory. Cambridge (UK): Cambridge University Press.
Pimentel, Tiago & Sérgio Amadeu da Silveira. 2013. « Cartografi a de Espaços Híbridos: as manifestações de junho de 2013. » Disponible sur : http://interagentes.net/?p=62 (consulté le 20 juin 2014).
Renault, Emmanuel. 2010. « Taking on the Inheritance of Critical Th eory: Saving Marx by Recognition? » In Th e Philosophy of Recognition: Historical and Contemporary Perspectives, dirigé par Hans-Christoph Schmidt am Busch & Christopher F. Zurn, 241-256. Lanham (MD): Lexington Books.
Sampaio Jr., Plínio de Arruda. 2013. « Jornadas de Junho e Revolução Brasileira. » Interesse Nacional 6 (23): 57-66, oct.-déc. Disponible sur : http://interessenacional.uol.com.br/index.php/edicoes-revista/jornadas-de-junho-e-revolucao-brasileira (consulté le 27 mars 2015).
Santos, Boaventura de Sousa. 2006. A gramática do tempo: para uma nova cultura política. São Paulo: Cortez.
Santos, Wanderley Guilherme dos. 2013. « Anomia Niilista. », 26 juil. Disponible sur : http://www.valor.com.br/cultura/3211228/anomia-niilista (consulté le 19 juin 2014).
101
AVANT JUIN, LES RUES DE MAI
Serodio, Guilherme. 2012. « Brasil é 4° País mais Desigual de América Latina e Caribe, diz ONU. » Valor, 21 août. Disponible sur : http://www.valor.com.br/internacional/2797634/brasil-e-4 (consulté le 10 juin 2013).
Singer, André. 2013. « Brasil, junho de 2013: classes e ideologias cruzadas. » Novos Estudos – CEBRAP 97: 23-40.
Steenbergen, Marco R., André Bächtiger, Markus Spörndli & Jürg Steiner. 2003. « Measuring Political Deliberation: a Discourse Quality Index. » Comparative European Politics 1: 21-48. Disponible sur : http://content.csbs.utah.edu/~burbank/steenbergen2003.pdf (consulté le 27 mars 2015).
Tavares, Francisco Mata Machado. 2013. « Para Além da Democracia Deliberativa: uma crítica marxista à teoria política habermasiana. » Th èse de doctorat. Belo Horizonte : Université fédérale de Minas Gerais. Disponible sur : http://marxismo21.org/estado-e-democracia (consulté le 18 juin 2014).
Young, Iris Marion. 2001. « Activist Challenges to Deliberative Democracy. » Political Th eory 29 (5): 670-690.