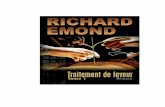Le peuple kurde - identité nationale et divergences politiques. Entretien avec Martin van Bruinessen
Il y a quelque chose à dire en faveur de la honte (Entretien avec Alain Finkielkraut)
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Il y a quelque chose à dire en faveur de la honte (Entretien avec Alain Finkielkraut)
Cahiers d’Études Lévinassiennes, n°7, 2008
267
Il y a quelque chose à dire en faveur de la honte
Alain Finkielkraut et Gilles Hanus
Ci-dessous la reprise, revue et corrigée par les auteurs, d’une conférence d’Alain Finkielkraut, précédée par une introduction de Gilles Hanus, le 17 mai 2007, et de la séance de dialogue qui s’en est ensuivie entre Alain Finkielkraut et Gilles Hanus le 11 juillet 2007, dans le cadre des séminaires de l’Institut d’Études Lévinassiennes.
GILLES HANUS
Dans les entretiens « À voix nue » qu’Alain Finkielkraut a eus avec Benny Lévy, le thème de la honte apparaît à quelques reprises. Le lecteur sent qu’il est le lieu d’un écart, voire d’un différend entre les deux penseurs, mais cet écart n’est pas explicité. Alain Finkielkraut questionne Benny Lévy à propos du Meurtre du Pasteur1, dont il évoque l’une des notions importantes : celle de « l’empire du Rien », qui donne son titre à la quatrième et dernière partie du livre. Pour tenter d’expliciter cette notion, il se réfère à notre situation présente et distingue à partir d’elle deux formes de la honte : l’une est éphémère, vouée à disparaître, l’autre est « constitutive de l’humain »2.
Je voudrais essayer de dire ce qui pointe derrière la différence d’accent que suggèrent, sans la déployer, ces entretiens, en me demandant en quel sens la honte est-elle constitutive de l’humain. Pour ce faire, je reviens à Lévinas, qui est le point de croisement, de rencontre entre Alain Finkielkraut et Benny Lévy.
La honte apparaît de façon significative dans le chapitre IV d’Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, intitulé « La substitution » et, plus précisément, dans la troisième section de ce chapitre, consacrée au « soi ». Lévinas y aborde le soi dans l’horizon de la création, en marquant sa distance avec la tradition philosophique comme telle. En effet, « [L]es philosophes ont toujours voulu penser la création en termes d’ontologie, c’est-à-dire en 1 LÉVY (Benny), Le meurtre du Pasteur, Paris, Grasset-Verdier, 2002. 2 FINKIELKRAUT (Alain), LÉVY (B.), Le livre et les livres, Lagrasse, Verdier, 2006, p. 136-137.
Alain Finkielkraut et Gilles Hanus
268
fonction d’une matière préexistante et indestructible. »3 Lévinas cherche à penser autre chose, la création hors ontologie, c’est-à-dire hors ce toujours-déjà-là qui se donne ici comme principe : l’être. Hors l’ontologie, à distance de la philosophie, cela signifie aussi dans la proximité d’un geste qui, par moments, éclôt au cœur de la philosophie elle-même.
Ce que Lévinas appelle subjectivité, c’est le Même, catégorie par excellence de l’ontologie parménidienne, mis en question dans son activité, dans sa puissance, par l’autre et virant, sous le coup de cette mise en question, en pour-autrui. Le sujet comme lieu d’un transfert, d’un déplacement du conatus, de l’effort pour persévérer dans son être, à une altération qui prend la forme d’une assignation : « La subjectivité comme l’autre dans le même – comme inspiration – est la mise en question de toute affirmation ‘pour soi’, de tout égoïsme renaissant dans cette récurrence même. (La mise en question qui n’est pas une mise en échec !) La subjectivité du sujet est la responsabilité ou l’être-en-question en guise d’exposition totale à l’offense, dans la joue tendue vers celui qui frappe. »4 La source de cette dernière formule, dont Lévinas ne saurait ignorer les résonances chez certains de ses lecteurs, est pré-philosophique. Il s’agit d’un verset tiré des Lamentations (3, 30) : « Tendre la joue à celui qui frappe, et être rassasié de honte. »
Une fois de plus, le geste de Lévinas vise à rappeler le premier mot, qui est biblique. On peut mettre au compte de l’ironie le fait de ramener le lecteur chrétien à une source plus ancienne que celle qu’il croit identifier, et qu’il ignore généralement. L’ironie résiderait alors dans la mise en question de l’universalité catholique : ce que vous entendez ici ne renvoie pas à vos textes, mais à d’autres versets, que vous n’entendez plus – mouvement inverse de celui d’une certaine lecture chrétienne qui ne voudrait voir dans les textes prophétiques de la Torah que figures ou préfiguration. Le passage insiste sur la passivité du sujet : « Mais passivité qui ne mérite l’épithète d’intégrale ou d’absolue que si le persécuté est susceptible de répondre du persécuteur. Le visage du prochain dans sa haine persécutrice peut, de par cette méchanceté même, obséder pitoyable – équivoque ou énigme que sans
3 LÉVINAS (Emmanuel), Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, rééd. Paris, Le livre de poche, 1990, p. 174. 4 Ibid., p. 176.
Il y a quelque chose à dire en faveur de la honte
269
se dérober, seul le persécuté privé de toute référence […] est à même de supporter. Subir par autrui, n’est patience absolue que si ce ‘par autrui’ est déjà ‘pour autrui’. Ce transfert […] est la subjectivité même. ‘Tendre la joue à celui qui frappe et être rassasié de honte’, dans la souffrance subie demander cette souffrance (sans faire intervenir l’acte que serait l’exposition de l’autre joue), ce n’est pas tirer de la souffrance une vertu magique quelconque de rachat, mais dans le traumatisme de la persécution passer de l’outrage subi à la responsabilité pour le persécuteur et, dans ce sens, de la souffrance à l’expiation pour autrui. »5
Par-delà l’ironie, il faut se demander si le pré-philosophique ne se laisse pas déborder par ce au service de quoi il est mobilisé : la pensée du sujet comme otage, entendue comme pensée éthique en lieu et place de la pensée ontologique. Autrement dit, le déploiement de sa philosophie ne menace-t-il pas le premier mot d’effacement ?
On peut faire sentir les enjeux de cette mise à l’épreuve assez simplement : qu’est-ce qui va l’emporter ici ? La lecture saducéenne de Lévinas (ou lecture basse), ou bien la lecture inspirée, laissant souffler au cœur des formules du philosophe le vent de crise dont parle l’avant-propos à L’au-delà du verset6 et qui apparaît ici au détour de quelques notes de bas de page ? À quelles conditions cette dernière peut-elle l’emporter sur la première ?
Faisons l’épreuve sur la notion de honte, en nous arrêtant sur le verset cité par Lévinas. À ses yeux, ce verset suggère l’assomption de la souffrance d’autrui au sein même de la souffrance qu’il m’inflige, le passage est de ma souffrance à la sienne – « Tendre la joue à celui qui frappe et être rassasié de honte. »
Que dit le verset, pris dans son contexte ? « Yiten lemakehou le'hi, yisba be'herpa. » Dans les versets qui précèdent, il est question d’une immense souffrance, vécue comme un abandon de la part de Dieu, et qui aboutit au désespoir. Verset 18 : « Vaomar avad nits'hi veto'halti meHachem » – « Et j’ai dit : ma force est perdue, je n’ai plus d’espérance en l’Éternel. » (trad. Segond) Le commentaire que fait Rachi de tout ce passage se noue autour
5 Ibid., p. 175-176. 6 Cf. LÉVINAS (E.), L’au-delà du verset, Paris, Minuit, 1982, p. 9.
Alain Finkielkraut et Gilles Hanus
270
du verset 21, qui contredit ce que nous venons de lire au verset 18. Voici ce verset : « Zot achiv el-libi, 'al-ken o'hil » – « Ceci est revenu vers mon cœur, c’est pourquoi j’espère. » (Nous traduisons.) Après que mon cœur se fut dit : « Toute possibilité venue de Dieu est abolie », j’ai pensé ceci (zot) dans mon cœur et j’ai espéré. Quelle est cette pensée (zot) ? Selon Rachi, c’est celle qui est exprimée dans les versets 22 à 39 – et c’est de cet ensemble que Lévinas a extrait un verset sur la honte.
On assiste effectivement dans ce passage à un transfert, à un mouvement du désespoir vers autre chose, dont le noyau se trouve dans le verset 20 tel que Rachi le lit. Le voici : « Zakhor tizkor vetchyoa'h 'alai nafchi. » Le commentaire de Rachi articule deux lectures de ce verset. D’abord la lecture « littérale » ; son sens est le suivant : « Mon âme se souvient (‘zakhor tizkor’ est un hébraïsme : le deuxième verbe est à la troisième personne du singulier féminin, le sujet est donc ‘mon âme’, rejeté à la fin de la phrase) de ce qui m’arrive (ou de ce qui m’est arrivé) et elle s’affaisse, elle est abattue. » Cela, c’est la crise. C’est peut-être, par ailleurs, la honte : mon âme est abattue sur moi ('alaï). À cette lecture littérale, Rachi articule une deuxième lecture, qui est celle du Midrach : ce dernier entend « tizkor » comme une deuxième personne du futur ; « Tu te souviendras », Toi, Dieu. Rachi explicite : je sais qu’à la fin Tu te souviendras (ou que Tu finiras par te souvenir) de ce qui m’a été fait, mais mon âme est abattue de devoir attendre que Tu te souviennes.
Ici, le glissement s’effectue de « mon âme », de ma souffrance, à « Toi », mon Dieu. Le pchat disait : il n’y a plus rien à attendre de Dieu. Le Midrach dit, au même lieu : Tu te souviendras. Passage de moi à Toi, mais ce n’est pas le toi que Lévinas mettait en avant. Dans l’articulation du pchat et du Midrach, ce qui est signifié, c’est le rétablissement d’un rapport à Dieu là où ce rapport semblait pouvoir s’abolir. Transformation, dans la lettre même du verset, du malheur en épreuve, c’est-à-dire en un événement qui vise celui qui le vit dans son existence même. Réveil du sujet, entendu comme « adresse de l’Absolu »7. Mais ce retournement, ce renversement, ce « virement inattendu », pour reprendre les termes de Lévinas dans « Être
7 LÉVY (B.), Le meurtre du Pasteur, op. cit., p. 317.
Il y a quelque chose à dire en faveur de la honte
271
juif »8, n’est pas dialectique. Il s’y agit, sous l’événement tragique, de retrouver le prophétique, exprimé au verset 31 : « Car mon Seigneur ne rejette pas à jamais » (nous traduisons), Il revient de Sa colère.
Qu’est-ce alors que la honte ? L’occasion d’un retour à son lieu propre, à partir de l’expérience du non-lieu, de l’expérience de n’être pas là où il faudrait. Ainsi la honte d’Adam se manifeste-t-elle face à la question que Dieu lui adresse : « Où es-tu ? » Te tiens-tu en ton lieu ? Avant, pourtant, Adam était nu, mais n’en concevait pas de honte. Qu’est-ce qui a changé ? Textuellement, le rapport d’obédience à ce qui lui a été ordonné. Hors l’obédience, la nudité provoque la honte ; elle ne le fait pas dans le cadre de ce rapport à la parole de Dieu à moi adressée.
La honte serait donc l’expérience du hors-lieu, du hors-jeu, à partir d’où retourner. Mais le retour n’est nullement garanti. La honte peut être vécue comme un simple sentiment. À ce titre, elle peut préluder à la contrition, à cette attitude qui consiste à habiter la conscience de sa faute, à n’en plus pouvoir sortir : la puissance de retournement de la honte a disparu, reste le remords ou les regrets qui rongent. Ou encore, on peut, comme Genet selon Sartre, opposer au sentiment de honte un autre sentiment, celui de l’orgueil – qui perd gagne ! Il s’agit d’inverser imaginairement, magiquement la honte en son contraire et, pour ce faire, d’intérioriser la honte en la transmuant en fierté : Genet se fait traiter de voleur ? Qu’importe, il sera le Voleur.
Les versets décrivent une autre scène : au moment crucial où Joseph était sur le point de céder aux avances de la femme de Putiphar, le Midrach rapporte qu’il a vu l’image (iqonin) de son père Jacob. Que signifie cette « apparition », cette image ? Au moment où Joseph va agir comme s’il était seul, comme s’il n’était que ce jeune homme soucieux de sa beauté (« Je ne descends de personne, dit le Kean de Sartre, je monte. »), l’image de son père lui rappelle qu’il est un fils, le fils de Jacob précisément. Ce souvenir provoque la fuite. Et cette fuite est décisive aux yeux du Midrach, qui l’associe à la sortie des Hébreux d’Égypte, comme le rappelle Benny Lévy dans Le logos et la lettre9. En quoi ? Elle ramène le sentiment de honte à la
8 LÉVINAS (E.), « Être juif », repris dans Cahiers d’Études Lévinassiennes, n° 1 (Lévinas, le temps), 2002, p. 103. 9 Cf. LÉVY (B.), Le logos et la lettre, Lagrasse, Verdier, 1988, p. 127.
Alain Finkielkraut et Gilles Hanus
272
lettre : « C’est pourquoi l’homme abandonne son père et sa mère et se lie à sa femme » – et non à la femme de l’autre. Retour du sentiment à la lettre qui empêche la fuite dans l’imaginaire et qui rend la contrition inutile… Ce que montre Sartre, et que souligne Benny Lévy dans Le nom de l’homme, c’est que c’est l’impossibilité de retrouver sa propre filialité qui explique la fuite orgueilleuse de Genet, aux antipodes de la fuite fondatrice de Joseph10.
Alors oui, il y a quelque chose à dire en faveur de la honte : elle est le lieu critique d’une alternative. Adossée à la lettre, elle offre l’occasion d’une naissance à soi, d’un retour en son lieu, dans lequel la honte n’a plus lieu d’être ; dépouillée de la lettre, comme sentiment, elle risque de s’inverser en orgueil ou de favoriser une contrition stérile. Autrement dit, la honte, loin d’être ontologique, est le nom d’une possibilité hénologique, le lieu d’une révélation qui en appelle à l’étude en vue d’expliciter ce qui s’est révélé.
En quoi la honte est-elle constitutive de l’humain ? Si l’humanité de l’homme réside dans sa capacité à restaurer ce qu’il a détruit, alors la honte peut être l’occasion d’une telle restauration. En ce sens, elle est le lieu d’une possibilité adamique fondamentale.
ALAIN FINKIELKRAUT
« Il y a quelque chose à dire en faveur de la passivité » : cette phrase de Novalis citée par Jean Wahl figure en exergue du premier chapitre d’Autrement qu’être ou au-delà de l’essence. Je crois pour ma part, à la lecture de Lévinas, qu’il y a quelque chose à dire en faveur de la honte, même si ce quelque chose ne va pas aussi loin pour moi que l’interprétation lévinassienne du verset des Lamentations : « Tendre la joue à celui qui frappe et être rassasié de honte. » « Responsabilité pour le persécuteur », « expiation pour autrui », je vois dans ces expressions littéralement terrorisantes, une ivresse, une hubris, un emportement de la pensée, un lyrisme hyperbolique – et je tâcherai de rester sobre. Ce qui, je le dis tout de suite, me situera hors de l’alternative entre restauration et contrition.
« On conviendra aisément qu’il importe au plus haut point de ne pas être dupe de la morale » : c’est la phrase sur laquelle s’ouvre Totalité et Infini, 10 Cf. LÉVY (B.), Le nom de l’homme, Lagrasse, Verdier, 1984, p. 65.
Il y a quelque chose à dire en faveur de la honte
273
le premier grand livre de Lévinas. On en conviendra d’autant plus aisément que ce qui constitue la sensibilité moderne comme moderne, c’est précisément le souci de ne pas être dupe, la volonté de ne jamais s’en laisser accroire. Le moderne n’est pas naïf, il n’est pas né de la dernière averse. Nous autres modernes, nous ne sommes pas bêtes, la crédulité n’est pas notre fort, nous sommes des êtres de défiance et non des êtres de foi. Nous ne prenons rien pour argent comptant, nous savons que les apparences sont trompeuses et que la vérité n’est pas gaie. Nous expliquons le haut par le bas. Maxime pour maxime, nous préférons celles, dissolvantes, des moralistes à celles, édifiantes, des prédicateurs. Les illusions perdues : telle est pour nous la trajectoire ou la biographie du vrai. Et à cet égard, La Rochefoucauld est notre premier maître – La Rochefoucauld le grand réducteur, La Rochefoucauld et son impitoyable « ne… que ». « Ce qu’on nomme libéralité n’est le plus souvent que la vanité de donner, que nous aimons mieux que ce que nous donnons. » « L’humilité n’est souvent qu’une feinte soumission dont on se sert pour soumettre les autres. » Et La Rochefoucauld systématise : « Toutes les vertus de l’homme se perdent dans l’intérêt, comme les fleuves dans la mer. L’intérêt parle toutes sortes de langues, et joue toutes sortes de personnages, même celui du désintéressé. »11 Notre système politique, le régime libéral, est issu de ce travail de démolition du saint et du héros. Il est né sur les ruines des deux grandes vertus classiques, la magnanimité grecque et l’humilité chrétienne. Le libéralisme consiste en effet, c’est sa définition ontologique, à faire avec ce qu’on a. Alors que la conception traditionnelle ordonnait l’organisation politique aux fins supérieures de la vie humaine, c’est sur le fondement bas, mais sûr, du besoin, de l’intérêt, du désir par chacun de préserver son être et d’améliorer sa condition que le libéralisme table. « Fondement bas mais sûr », c’est une expression de Pierre Manent12. Pourquoi « sûr » ? Parce que les hommes sont en désaccord sur la loi supérieure ou sur le contenu de la vie bonne alors qu’ils ont en commun l’aspiration à persévérer dans leur être et à mener une vie confortable. Au fond, les hommes se tuent au nom de Dieu, mais ils aiment la vie et ils ont peur de mourir. Alors au lieu de tout faire descendre de Dieu qui les divise, c’est de la vie, ou du désir de vie qui les unit, qu’il faut partir. Voilà ce que dit le libéralisme ; et la démystification 11 LA ROCHEFOUCAULD, Maximes, passim. 12 MANENT (Pierre), Les Libéraux I, Paris, Hachette Pluriel, 1986, p. 13.
Alain Finkielkraut et Gilles Hanus
274
de la morale ne s’est pas arrêtée là. « L’esprit est toujours la dupe du cœur » – cette formule, cette maxime extraordinaire de La Rochefoucauld a été prolongée et amplifiée par les grandes philosophies du XIXe siècle. Celles-ci, en effet, déplacent l’être véritable de l’homme et le soustraient à la juridiction de la conscience. C’est, comme le montre Clément Rosset, Schopenhauer qui le premier a posé comme absolu le conditionnement des fonctions intellectuelles par les fonctions affectives. L’intellect est subordonné à la volonté, l’esprit vient en second, il importe donc de déchiffrer ses énoncés, de les percer à jour pour comprendre ce qui véritablement s’y trame. Et Clément Rosset en conclut que Schopenhauer n’est pas comme il le croyait lui-même le dernier des philosophes classiques, mais le premier des philosophes généalogistes13. Marx, Nietzsche et Freud s’engouffrent dans la brèche et ils font du discours philosophique un discours d’abord interprétatif et de l’interprétation une herméneutique du soupçon. « Il importe au plus haut point de ne pas être dupe de la morale » : que ce soit au nom de la volonté de puissance, de l’être social ou du psychisme inconscient, tous trois, Nietzsche, Marx et Freud, portent le doute au cœur de la conscience. Or la première surprise que réserve la pensée de Lévinas est celle-ci : il renoue – et de quelle manière ! – avec le désintéressement ; c’est un concept crucial, notamment d’Autrement qu’être ou au-delà de l’essence. Mais il n’est pas dupe – et l’on pourrait même dire qu’il combat la généalogie et les pensées du soupçon sur leur propre terrain : celui de l’origine, celui de la mise à nu.
Le discours de Lévinas, c’est une des raisons de son charme, est un récit, le récit inlassablement repris d’une expérience fondatrice. Autrement dit, il ne fait pas la morale, ce qui est en effet impossible à une époque qui ne veut pas être dupe de la morale ; il érige l’éthique en philosophie première, ce qui est une tout autre paire de manches. Autrement dit, son registre n’est pas prescriptif, mais narratif et descriptif. Il n’énonce pas de règle, il dégage la signification éthique du rapport humain. L’éthique, dont son œuvre ne cesse de nous entretenir, n’est pas quelque chose qui s’ajoute à la relation intersubjective pour la corriger, pour l’orienter, pour la purifier, pour la rendre meilleure, elle est constitutive de la relation elle-même. Et d’ailleurs Lévinas ne dit rien sur les valeurs, il est délibérément et même
13 Cf. ROSSET (Clément), Schopenhauer, philosophe de l’absurde, Paris, P.U.F., 1967, p. 33.
Il y a quelque chose à dire en faveur de la honte
275
exclusivement factuel, il en appelle à l’expérience ou à la mémoire de tout un chacun. Lire Lévinas, c’est faire l’expérience d’une reconnaissance ; c’est à cet égard une expérience indissolublement philosophique et romanesque. Donc jamais Lévinas ne prêche, jamais il ne juge : il raconte une histoire à fleur de peau. La morale, c’est quelque chose qui nous arrive, elle se glisse en nous, elle nous échoie à notre corps défendant. L’ego vaquait à ses affaires, gérait consciencieusement son temps, suivait sa pente sur la voie que lui traçait son intérêt ses convictions, ses convoitises, et puis soudain, l’autre, volens nolens, le concerne.
On sait que chez Lévinas, c’est le visage d’autrui qui opère le miracle de cette désorientation. L’éthique dont nous parle Lévinas est une déroute. Le visage n’est pas simplement l’assemblage d’un front, d’un nez, d’une bouche, d’yeux, etc. qui composent un portrait. Il est bien sûr tout cela, mais ce qui le constitue comme visage, répète infatigablement Lévinas, c’est sa nudité. Le visage est nu, d’abord au sens où il est abstrait, il n’est jamais réductible à l’image qu’il offre. Le visage n’est pas une image. Ce que Lévinas appelle le visage, c’est la manière dont l’autre se présente, dépassant l’idée de l’autre en moi, perçant sa forme, débordant l’image plastique qu’il me laisse ; et donc, au fond, le visage est nu parce qu’il est réfractaire à la catégorie, parce qu’il tranche sur toute forme et tout contexte. Mais la nudité du visage signifie aussi son dénuement, sa fragilité, l’extrême vulnérabilité de l’autre, exposée à la souffrance et à la mort. Transcendance et mortalité. « Le visage, écrit Lévinas, est seigneurie et le sans défense même. »14 Au fond, que dit le visage quand je l’aborde, offert à mon regard ? Il est désarmé, il est à bout portant et en même temps, ce visage sans protection, sans sécurité, est aussi celui qui m’ordonne « tu ne tueras point ». Il est toute faiblesse et toute autorité quand il s’élève face à moi. Ce n’est pas une apparition que je peux enclore dans l’enceinte de mes représentations. Le visage, autrement dit, s’arrache au spectacle qu’il offre pour donner, même muet, quelque chose à entendre. C’est une voix, une voix de fin silence qui dit « tu ne tueras pas », selon les mots de Ricœur commentant Lévinas : « Chaque visage est un Sinaï qui interdit le meurtre. »15 L’interdit procède d’une phénoménologie qui s’offre à la 14 LÉVINAS (E.), « La proximité de l’autre », Altérité et transcendance, Fontfroide le Haut, Fata Morgana, 1995, p. 114. 15 RICŒUR (Paul), Soi-même comme un autre, Paris, Points-Seuil, 1996, p. 388.
Alain Finkielkraut et Gilles Hanus
276
reconnaissance du lecteur : il y a l’interdit et il y a le fait d’être interdit. L’interdit, le premier grand interdit, naît de cet événement, de cette inhibition soudaine. Si le visage ne faisait irruption dans l’ordre phénoménal de l’apparaître, l’homme serait au même titre que les autres êtres un conatus essendi, un être persévérant dans son être. Mais précisément, il n’est pas un être parmi les êtres. Le visage l’éveille, interrompt la spontanéité sans circonspection de sa naïve persévérance. Il était innocent, il ne l’est plus ; il découvre brutalement, traumatiquement ce qu’il y a de nocence dans son innocence – nocere, en latin, veut dire nuire, endommager, léser, faire du tort. Il n’est plus une force qui va. Et cette rupture n’est pas une chute, un châtiment, une expulsion du paradis, c’est au contraire une entrée dans l’humanité. Au commencement est l’excuse. « Je me demande, dit Lévinas, s’il n’y eut jamais discours au monde qui ne fût pas apologétique, si le logos comme tel n’est pas apologie, si la première conscience de notre existence est une existence de droit, si elle n’est pas d’emblée conscience de responsabilités, si d’emblée nous ne sommes pas accusés au lieu d’entrer confortablement et sans demander pardon dans le monde comme chez soi. »16 Ce qui signe l’apparition de l’humain sur la terre, ce n’est pas la liberté, ce n’est pas la raison, ce n’est pas le travail, c’est, dit Lévinas, la honte.
Oui, la honte. Lévinas est un philosophe de la honte. Tout son effort philosophique est d’inquiéter l’ontologie par une « hontologie ». L’accueil d’autrui, écrit Lévinas, est ipso facto la conscience de mon injustice, la honte que la liberté éprouve pour elle-même et la crainte pour ce que son exister même peut comporter de violent17. Au fond, la présence d’autrui est ce qui met en question la légitimité naïve de la liberté. Cela veut dire que la théorie ne commence pas avec la théorie. La philosophie est émotion avant d’être philosophie. La première pensée d’autrui n’est pas une pensée sur autrui, c’est la honte devant autrui. La honte comme éveil, peut-être même faudrait-il dire réveil, de l’être, passage de l’être à l’impossibilité d’être et de se répandre naïvement dans l’être en toute quiétude, en toute brutalité. La honte comme scrupule d’être, en effet, comme être sans oser être, comme être sur la pointe des pieds. La honte est donc une découverte et cette découverte se fait, bien sûr, sans avoir été préméditée. La honte dont nous 16 LÉVINAS (E.), Quatre lectures talmudiques, Paris, Minuit, 1968, p. 175. 17 Cf. LÉVINAS (E.), Totalité et Infini, rééd. Paris, Le livre de poche, p. 82-83.
Il y a quelque chose à dire en faveur de la honte
277
entretient Lévinas n’est pas un choix, une décision, un acte de volonté, c’est un empourprement et nul ne choisit de rougir.
Sans doute peut-on mimer, imiter, simuler le désintéressement, mais la rupture de l’intéressement, aussi fragile, aussi fugitive soit-elle, n’est à la discrétion de personne, elle advient, elle frappe, elle déroute, elle n’est pas un déguisement, elle est l’effet ou la trace du dégrisement du moi par le visage. Le mot dégrisement est constamment employé par Lévinas et c’est un mot capital, parce qu’il appartient traditionnellement au vocabulaire du soupçon, et au fond Lévinas, ici généalogiste paradoxal, arrache ce terme à l’herméneutique du soupçon et le retourne contre elle. Les non-dupes, pour parler comme Lacan, voient la persévérance dans l’être derrière le paravent de la morale, et Lévinas voit l’humain derrière la persévérance dans l’être. Autrement dit, il creuse, et ce n’est donc pas l’au-delà qui fait l’objet des recherches de ce philosophe de la transcendance, mais l’en deçà : en deçà de la volonté, plus originelle ou plus constitutive que celle-ci, il y a la honte. La morale ne vient pas après, elle vient avant. Le bien, dit Lévinas, ne s’offre pas à la liberté, le bien est un saisissement, et il a cette phrase très saisissante elle-même : « Nul n’est bon volontairement. »18 C’est une des phrases-clés d’Autrement qu’être ou au-delà de l’essence. Et c’est une réponse tout à la fois à la sagesse idéaliste des Anciens et à la sagesse suspicieuse des Modernes. Bien sûr, c’est une réponse à Platon : nul n’est méchant de son plein gré19. Pour Platon, il n’y a pas de différence entre le Bien bénéfique et le Bien moral. Or le commun est obnubilé par la fausse opposition du Bien personnel et du Bien moral ; cette ignorance, selon Platon, est le fondement de tout acte injuste, et c’est pourquoi il peut dire que tel acte n’est pas volontaire, quand bien même son auteur agirait en pleine conscience de son injustice. Sujétion, donc, de la volonté à la connaissance : s’il savait, il agirait autrement. La sagesse des Modernes a renversé la proposition, si bien, d’ailleurs, qu’elle nous est très difficilement compréhensible. La prédominance de la volonté sur l’intellect, l’intellect au service de la volonté : voilà la source de la psychologie moderne.
Or Lévinas dit : nul n’est bon volontairement. Autrement dit, il ne choisit pas entre la primauté de l’intellect sur la volonté et la subordination
18 LÉVINAS (E.), Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, op. cit., p. 25. 19 Cf. par exemple, Ménon, 77d, et Gorgias, 468a-b.
Alain Finkielkraut et Gilles Hanus
278
de l’intellect à la volonté ; il affirme l’antériorité, la préséance de la rencontre du visage sur l’un et sur l’autre. Au fond, la conscience et l’inconscient perdent simultanément la première place. À ce stade, et pour bien mesurer la portée de ce que j’ai appelé, peut-être de manière un peu risquée, cette hontologie, je crois que la comparaison avec Sartre peut être très éclairante.
Sartre est, en effet, le grand phénoménologue de la honte, qui est un thème central de L’être et le néant puisque c’est par une description de la honte que s’ouvre la partie consacrée au pour autrui. Les descriptions de Sartre sont très belles : « […] la honte est un frisson immédiat qui me parcourt de la tête aux pieds sans aucune préparation discursive. »20 Sartre fait l’analyse de ce frisson, il dit que ce qui s’éprouve dans ce frisson, c’est une relation du moi avec lui-même : j’ai découvert par la honte un aspect de mon être, mais cette découverte, je ne la fais pas tout seul ; la honte, dans sa structure première, est honte devant quelqu’un. Par l’apparition même d’autrui, je suis mis en mesure de porter un jugement sur moi-même comme sur un objet, car c’est comme objet que j’apparais à autrui. La philosophie de Sartre dans L’être et le néant est, comme celle de Lévinas dans Totalité et Infini, romanesque. L’être et le néant offre au lecteur que son sous-titre « Essai d’ontologie phénoménologique » intimide, d’être un livre rempli d’exemples et de saynètes. Il y a évidemment la très célèbre danse du garçon de café, et puis il y a cette autre petite scène : imaginons que j’en sois venu, par jalousie, par vice, à coller mon oreille contre une porte et à regarder par le trou de la serrure. Sartre dit : quand je fais cela, il n’y a pas de moi pour habiter ma conscience. Rien à quoi je puisse rapporter mes actes pour les qualifier, je fais ce que j’ai à faire. Aucune vue transcendante, dit encore Sartre, ne confère à mes actes un caractère de donné sur quoi puisse s’exercer un jugement. Or, voici que j’entends des pas dans le corridor : on me regarde et à ce moment-là, évidemment, la honte survient. Ma liberté m’échappe, elle est un objet donné. Au fond, il suffit qu’autrui me regarde pour que le moi, soudain, habite la conscience, l’habite et l’alourdisse en quelque sorte. Il suffit qu’autrui me regarde pour que je sois ce que je suis et c’est ce qui conduit Sartre à écrire : s’il y a un autre, j’ai un dehors, j’ai une nature. « Ma chute originelle c’est l’existence de l’autre. »21 Sous le regard 20 SARTRE (Jean-Paul), L’être et le néant. Essai d’ontologie phénoménologique, rééd. Paris, Gallimard (Tel), 1976, p. 266. 21 Ibid., p 302.
Il y a quelque chose à dire en faveur de la honte
279
d’autrui, je reçois soudain un être qui est ce qu’il est, qui me fige, qui me pétrifie – et l’on dit bien en effet : pétrifié de honte. La honte est l’étrange expérience de la pétrification et il faut suivre cette réflexion jusqu’au bout, parce qu’elle signifie que plus profonde, plus originelle que la honte d’être pris sur le fait, il y a tout simplement la honte d’être ou la découverte de soi comme être dans la honte. La honte telle que Sartre en décrit l’expérience m’englue dans l’être, elle ferme les issues, elle conjure mon pouvoir d’arrachement. Elle n’est donc pas d’abord le sentiment d’être tel ou tel objet répréhensible, mais en général d’être un objet, c’est-à-dire de me reconnaître dans cet être dégradé, dépendant et figé que je suis pour autrui.
Je peux à présent établir la comparaison : Sartre, c’est autrui comme regard qui fait honte, et la honte est l’expérience brutale d’une objectivation de soi ; Lévinas, c’est autrui comme visage qui fait honte, et la honte est au contraire le moment de la subjectivation. Avant la honte, en l’absence de la honte, je ne suis pas sujet, je coïncide avec moi-même, il n’y a pas de fissure, il n’y a pas de béance dans l’être que je suis, je suis un bloc, un en-soi, dirait-on dans le langage de Sartre, mais pas une chose, pas une pierre pour autant – ou alors une pierre qui roule, a rolling stone. Cet en-soi, en effet, n’est pas inerte, il bouge, il avance, il se répand, il se déploie, il marche en dormant. « Spontanéité de somnambule », dit Lévinas, force qui va22 – c’est l’expression, empruntée à Victor Hugo, qui revient sans cesse. Donc, sous l’effet du visage, le bloc d’être que je suis se brise ; il y avait moi, et il y a maintenant moi et moi. Je ne suis plus un mais deux en un, c’est-à-dire sujet. Je vois mon être, naturellement envahissant, bruyant, de l’extérieur. La souveraine identification de moi avec soi est irrémédiablement mise en cause. La honte m’a dénaturalisé, la honte m’a tiré du sommeil, le sommeil de l’injuste. J’étais moi-même et seulement moi-même, me voici humain, c’est-à-dire inhibé, empêché, timide.
Ce qui se découvre à Sartre dans l’angoisse : la non-coïncidence de soi avec soi, se découvre chez Lévinas dans la honte. Se révèle ainsi non la liberté, ni l’annulation de la liberté, mais en quelque sorte son investiture. « La différence qui bée entre moi et soi, je cite Lévinas dans Humanisme de l’autre homme, la non coïncidence de l’identique est une foncière non
22 LÉVINAS (E.), Totalité et Infini, op. cit., 1990, p. 186.
Alain Finkielkraut et Gilles Hanus
280
indifférence aux autres hommes. »23 La honte est donc simultanément sortie de l’innocence et accès à l’existence morale, et la pensée de Lévinas nous plonge ainsi dans un climat qui n’est pas celui, classique, traditionnel, du péché originel, mais pas non plus celui, rousseauiste, de l’innocence originelle de l’homme. La honte est en effet mauvaise conscience, mais cette mauvaise conscience ne se résout pas, ne se fige pas simplement en conscience du mal, elle est très exactement saisissement par le bien. Saisissement par le bien et non bonté originelle.
Rousseau, on le sait, célèbre, sous le nom d’amour de soi, l’état antérieur à la disjonction, à la rupture du soi, ce qui le conduit à une solution originale du problème du mal, dont les immenses effets se font et se feront encore longtemps sentir. On connaît la première phrase de L’Émile : « Tout est bien sortant des mains de l’Auteur des choses, tout dégénère entre les mains de l’homme. »24 Cela veut dire que Dieu est dégagé de toute responsabilité du mal et que c’est l’homme qui est déclaré responsable. Mais le même Rousseau affirme que l’homme est innocent, que sa constitution est libre de tout péché, qu’il n’y a pas en lui de corruption radicale – et c’est ce thème qui lui vaudra la persécution de l’Église.
Il y a un paradoxe : Dieu n’est pas coupable et l’homme est originellement innocent. Comment va-t-il s’en sortir ? Et bien, c’est Cassirer qui l’a montré25, Rousseau résout ce dilemme – et là vous reconnaîtrez l’ambiance même de notre modernité – en plaçant la responsabilité à un endroit où jamais on ne l’avait cherchée avant lui, en créant en quelque sorte un nouveau sujet à qui il fait porter la responsabilité, l’imputabilité : ce sujet n’est pas l’homme isolé, mais la société humaine. Rousseau invente, si j’ose dire, la société comme sujet d’imputabilité. Ce qui veut dire que le jour où la société inégalitaire s’écroulera, pour faire place à une nouvelle communauté politique, ce jour-là, l’homme se sera lui-même délivré du mal, l’heure de la libération aura sonné. C’est de Rousseau que date le « tout est politique » –
23 LÉVINAS (E.), Humanisme de l’autre homme, rééd. Paris, Le livre de poche, p. 108-109. 24 ROUSSEAU (Jean-Jacques), L’Émile, in : Œuvres complètes, Paris, Gallimard, Pléiade, 1969, p. 245. 25 Cf. CASSIRER (Ernst), « L’unité chez Rousseau », Pensée de Rousseau, Paris, Points-Seuil, 1984, p. 51.
Il y a quelque chose à dire en faveur de la honte
281
expression que l’on trouve d’ailleurs presque telle quelle sous sa plume26 – c’est-à-dire l’idée que la morale relève en dernière instance de la politique et qu’il revient à la politique de résoudre les problèmes humains par l’éradication du mal. Or, nous dit toute l’œuvre de Lévinas, il importe au plus haut point de ne pas être dupe de la politique. Sauf à servir d’alibi, celle-ci ne peut jamais me décharger de mon investiture – cette investiture de la liberté, ce saisissement par le bien. Il n’y a pas de solution du drame humain par changement de régime, telle est la leçon que ce lecteur de Vassili Grossman tire des désastres politiques du XXe siècle. Et c’est sans doute l’apologie nazie de la force vitale et du Lebensraum qui a conduit la pensée de Lévinas à cette grande mise en question de l’être par la honte.
Mise en question qui se traduit aussi par une très inattendue refondation de la civilité. En effet, l’épreuve de la catastrophe de la civilisation a fait de Lévinas, contre Rousseau, le philosophe de la civilité, cette chose si superficielle, si frivole en apparence. Au nom d’une nouvelle éthique – l’éthique de la spontanéité qu’il nous a léguée – Rousseau dénonce le mensonge de la civilité. Je cite un passage bien connu du Discours sur les sciences et les arts : « Sans cesse la politesse exige, la bienséance ordonne ; sans cesse on suit les usages, jamais son propre génie. On n’ose plus paraître ce qu’on est ; et dans cette contrainte perpétuelle, les hommes qui forment ce troupeau qu’on appelle société, placés dans les mêmes circonstances feront tous les mêmes choses si des motifs plus puissants ne les en détournent. On ne saura donc jamais à qui l’on a affaire : il faudra, pour connaître son ami, attendre les grandes occasions, c’est-à-dire attendre qu’il n’en soit plus temps, puisque c’est pour ces occasions mêmes qu’il eût été essentiel de le connaître. »27 Lévinas, à l’inverse, voit la honte, ou le vestige, le murmure de la honte à l’œuvre dans la civilité. Il la célèbre donc, au moment même, d’ailleurs, où il remplace le mot « éthique » par celui de « sainteté », comme une merveille, comme un miracle. « Bonjour – je cite Lévinas – comme bénédiction et comme disponibilité pour l’autre homme […] Cela ne veut
26 Cf. ROUSSEAU (J.-J.), Les Confessions, livre neuvième, in : Œuvres complètes, I, Gallimard, Pléiade, 1959, p. 404 : « J’avois vu que tout tenoit radicalement à la politique, et que, de quelque façon qu’on s’y prit, aucun peuple ne seroit jamais que ce que la nature de son Gouvernement le feroit être ; ainsi cette grande question du meilleur Gouvernement possible me paroissoit se réduire à celle-ci. » 27 ROUSSEAU (J.-J.), Discours sur les sciences et les arts, rééd. Paris, Garnier-Flammarion, 1971, p. 42.
Alain Finkielkraut et Gilles Hanus
282
pas dire encore : quelle belle journée. Cela exprime : je vous souhaite la paix, je vous souhaite une bonne journée, l’expression de celui qui se soucie d’autrui. Elle porte tout le reste de la communication, elle porte tout le discours. »28
Au moment même où il dit qu’il se défait du mot grec « éthique » pour le remplacer par celui plus exigeant, et même hyperbolique, de « sainteté », il rencontre la courtoisie. « Ah mais c’est très bon, dit-il, faire passer l’autre avant moi, ce petit élan de courtoisie, c’est un accès au visage. » Je dois dire que si tout cela m’apparaît aujourd’hui en toute clarté, si je peux faire cette lecture, cette relecture de Lévinas en suivant le fil de la honte, si je suis conduit à faire cette lecture « hontologique », c’est peut-être, c’est sans doute parce que nous traversons aujourd’hui une crise de la honte. Les incivilités montent, la muflerie prospère, les comportements éhontés se multiplient, la réserve, la pudeur, l’inhibition, le scrupule ne sont plus de mise, notamment à l’école. Si crise de l’école il y a, c’est avant tout une crise de la honte. Et l’on peut être conduit à se dire que cette crise est peut-être terminale, car la honte n’est pas vraiment un sentiment démocratique. Elle arrête la liberté, elle est conscience d’une dissymétrie entre moi et l’autre. La question est de savoir si, dans la démocratie, il y a place pour des émotions non-démocratiques. Ce qui définit l’homme qui se définit par les Droits de l’homme, c’est qu’il ne demande pas pardon. Et puis, il est si facile, si tentant, si automatique aujourd’hui d’échapper à la honte en faisant honte à la société.
Mais on ne peut s’en tenir à ce diagnostic. La hontologie à laquelle nous invite Lévinas doit se raffiner encore et, si besoin est, en quittant Lévinas. Je voudrais, pour finir, revenir à l’expérience ou à l’épreuve fondamentale, fondatrice de cette vie dont Lévinas nous dit lui-même qu’il l’a passée entre « le pressentiment et le souvenir de l’horreur nazie »29.
Je voudrais vous parler d’un livre de Sebastian Haffner : Histoire d’un Allemand, qui est le récit de ce qu’était la vie en Allemagne en 1933 et dans les années qui ont suivi la prise du pouvoir par Hitler. Je parlerai du moment où Sebastian Haffner termine ses études. Il doit, comme son père, devenir magistrat et il est convoqué à Juterborg, une ville de garnison dans 28 POIRIÉ (François), Emmanuel Lévinas. Qui êtes-vous ?, Lyon, La manufacture, 1987, p. 92. 29 LÉVINAS (E.), Difficile liberté, rééd. Paris, Le livre de poche, 1997, p. 406.
Il y a quelque chose à dire en faveur de la honte
283
le sud de la Marche de Brandebourg. Il y a là un camp pour les référendaires, où une saine vie communautaire, la pratique des sports de combat et une éducation idéologique doivent préparer tous ces jeunes gens aux tâches qui les attendent dans leur carrière de juges allemands.
Lorsqu’il reçoit sa convocation, Sebastian Haffner est pris d’un accès de rage, il est furieux, il est hors de lui, mais en même temps il ne peut pas refuser. Il se rend donc dans ce camp et il connaît là une expérience effrayante, en ceci que c’est une expérience heureuse. « Une espèce de bonheur, dit Sebastian Haffner, s’épanouit dans ces camps, qui est le bonheur de la camaraderie. »30 Et ce bonheur peut devenir un des plus terribles instruments de la déshumanisation. C’est tout l’art des nazis que « […] d’avoir submergé les Allemands de cet alcool de la camaraderie […], il les y ont noyés jusqu’au delirium tremens. »31 Haffner prolonge l’analyse : « La camaraderie dispense l’homme de toute responsabilité pour lui-même, devant Dieu et sa conscience […] Sa conscience ce sont ses camarades : elle l’absout de tout tant qu’il fait ce que font les autres. »32 La camaraderie est ainsi fatale à la pensée, car elle n’admet que les seuls schémas collectifs de l’espèce la plus triviale. Elle est aussi fatale à la délicatesse. Le premier domaine de la vie individuelle qui ne se laisse pas si facilement réduire à la camaraderie, c’est l’amour. Or la camaraderie dispose contre lui d’une arme, l’obscénité : « Chaque soir au lit, à la dernière ronde, on lâchait des obscénités, c’était une sorte de rituel […] Loin de susciter désir et plaisir, ces obscénités visaient à rendre l’amour aussi repoussant que possible, à le rapprocher des fonctions digestives, à en faire un objet de dérision. »33 La camaraderie, autrement dit, est le tribunal redoutable, implacable, qui fait honte à la civilisation. La « décivilisation » à l’œuvre là n’est pas un retour à l’état sauvage ou un soudain déchaînement des pulsions barbares, elle est le produit d’une certaine sorte de honte.
Le témoignage de Haffner est confirmé par le livre de Christopher Browning sur le 101e bataillon de réserve de la police allemande, qui a participé à la solution finale en Pologne. Ce sont Des hommes ordinaires – c’est 30 HAFFNER (Sebastian), Histoire d’un Allemand. Souvenirs 1914-1933, trad. fr. Brigitte Hébert, Arles, Actes-sud, 2003, p. 416. 31 Ibid., p. 417-418. 32 Ibid., p. 420. 33 Ibid., p. 423.
Alain Finkielkraut et Gilles Hanus
284
le titre du livre de Browning traduit par Elie Barnavi – en ce sens que ce ne sont pas des fanatiques ; ce ne sont pas non plus des jeunes gens, on ne leur a pas lavé le cerveau. Ils sont policiers, ce sont des quarantenaires, ils sont en Pologne et, tout d’un coup, ils reçoivent l’ordre de rafler les 1800 Juifs du village de Josefow. Seuls les Juifs en âge de travailler doivent prendre le chemin du camp de Lublin, les autres, femmes, vieillards et enfants doivent être abattus sur place sans autre forme de procès. Le commandant du bataillon expose à ses hommes la mission sanglante dont ils sont chargés et à quoi rien dans leurs biographies professionnelles ne les avait préparés – c’est un bataillon ordinaire de la police de Hambourg, ce ne sont pas des SS. Et il leur fait cette proposition inouïe : « S’il en est parmi les plus âgés qui ne se sentent pas capables de participer à cette opération, qu’ils quittent les rangs. »34 Lui-même, d’ailleurs, ne quittera pas les rangs et il fera tout en pleurant, en sanglotant. Mais une douzaine d’hommes seulement sur cinq cents réagissent et profitent de l’aubaine. Et toute la question de Browning, c’est : pourquoi seulement une douzaine d’hommes sur cinq cents ?
Ce qui joue, outre l’effet de surprise, c’est avant toute chose l’esprit de corps, l’identification de tout homme à ses frères d’armes, le refus de paraître lâche ou « dégonflé ». Qui oserait, déclare un policier, perdre la face devant tout le monde ? Tout le monde : les camarades, le tribunal des camarades, ce tribunal qui absout chacun de tout ce qu’il fait tant qu’il fait ce que font les autres, et qui le condamne quand il est tenté de se démarquer, de se distinguer, de faire autre chose. Pour le dire avec les mots d’Haffner, ce policier n’est pas seulement asservi, il est encamaradé, c’est bien pire. L’asservissement fait mal, l’encamaradement fait honte, et c’est en cela qu’il est pire. En l’occurrence, il fait honte aux policiers du Bataillon 101 de leurs défaillances possibles et de la honte qu’ils pourraient éprouver devant la perspective de tuer à bout portant des êtres sans défense.
Il y a donc, comme l’a bien vu Rousseau, une mauvaise honte. Rousseau décrit, à plusieurs reprises dans son œuvre, des moments ou des cas de mauvaise honte. Il est évidemment très difficile de passer des exemples que je viens de citer aux cas qui tourmentent Rousseau. Ces derniers sont bien entendus bénins, inoffensifs, insignifiants par rapport à ce que décrivent 34 BROWNING (Christopher), Des hommes ordinaires. Le 101° bataillon de réserve de la police allemande et la solution finale en Pologne, trad. fr. Elie Barnavi, Paris, Les Belles Lettres, 1994, p. 81.
Il y a quelque chose à dire en faveur de la honte
285
Haffner et Browning ; mais ils valent par le dispositif psychique qu’ils révèlent et que Rousseau saisit avec tout à la fois une sincérité et une perspicacité absolument extraordinaires.
Il y a tout d’abord, dans le deuxième livre des Confessions, le célèbre épisode du ruban volé. Le jeune Rousseau, qui est adolescent, vole un ruban couleur de rose et d’argent. Il ne le cache pas et donc on le retrouve. Que dit-il alors ? Il dit que c’est Marion, la cuisinière de la maison où lui-même était employé, qui l’a dérobé. On la fait venir et il la charge effrontément. Il dit que ce souvenir lui pèse, qu’il a beaucoup de mal à le raconter, mais pourquoi ? Que s’est-il passé en lui ? Voici son récit : « Quand je la vis paraître, mon cœur fut déchiré, mais la présence de tant de monde fut plus forte que mon repentir. Je craignais peu la punition, je ne craignais que la honte ; mais je la craignais plus que la mort, plus que le crime, plus que tout au monde […] L’invincible honte l’emporta sur tout, la honte seule fit mon impudence. »35 Et puis, il y a un épisode, moins célèbre et plus tardif, qui est raconté dans les Rêveries du promeneur solitaire. Rousseau est déjà un auteur reconnu, nous sommes en 1757, il vit chez le marquis et la marquise d’Épinay, et c’est la fête du maître de maison. Jeux, spectacles, feux d’artifice, rien ne manque. Après le dîner, les convives vont prendre l’air dans une avenue. « On tenait, dit Rousseau, une espèce de foire. On dansait, les messieurs daignèrent danser avec les paysannes, mais les dames gardèrent leur dignité. On vendait là des pains d’épices. Un jeune homme de la compagnie s’avisa d’en acheter pour les lancer l’un après l’autre au milieu de la foule, et l’on prit tant de plaisir à voir tous ces manants se précipiter, se battre, se renverser pour en avoir que tout le monde voulut se donner le même plaisir. Et les pains d’épices de voler à droite et à gauche, et filles et garçons de courir, s’entasser, s’estropier. Cela paraissait charmant à tout le monde, je fis comme les autres par mauvaise honte. »36 Dans son très beau livre Largesse, Starobinski revient sur le geste du jeune homme en disant qu’il a des antécédents, qu’il répète un geste très ancien, le geste qu’il a vu maintes fois s’accomplir à la sortie des églises, aux grandes fêtes ou lors des mariages et des baptêmes : la foule, alors se précipitait pour ramasser des
35 ROUSSEAU (J.-J.), Les Confessions, rééd. Paris, Gallimard (Folio-classiques), 1973, p. 127. 36 ROUSSEAU (J.-J.), Rêveries du promeneur solitaire, rééd. Paris, Gallimard (Folio), 1972, p. 160.
Alain Finkielkraut et Gilles Hanus
286
dons annoncés par le cri rituel de « largesse »37. Largesse princière – tout ce que Rousseau hait, tout ce contre quoi il a édifié son système, puisqu’il dit : Je hais la servitude comme la source de tous les maux du genre humain. Son discours sur l’inégalité est une généalogie du mal, ce qui, je l’ai dit tout à l’heure, l’a amené à réintroduire en politique l’absolu dont les libéraux avaient voulu faire l’économie. Le même Rousseau que cette largesse princière ne pouvait que dégoûter est amené à « faire comme les autres par mauvaise honte ». Et ce phénomène est admirablement analysé par Julie dans La Nouvelle Héloïse : « Tel vaincrait les tentations qui succombe au mauvais exemple, tel rougit d’être modeste et devient effronté par honte et cette mauvaise honte corrompt plus de cœurs honnêtes que les mauvaises inclinations. »38
La mauvaise honte, je crois que c’est la brûlure intime de Rousseau, c’est son remords, c’est sa faiblesse et c’est, selon moi, dans ce tourment si personnel que s’enracine sa grande antithèse entre l’homme de la nature, voué au seul amour de soi, et l’homme de l’homme, dévoré par l’amour-propre. Ce que La Rochefoucauld confond sous le nom d’intérêt, Rousseau l’oppose. L’amour-propre, ce n’est pas l’amour de soi, c’est la perte de soi dans l’autre. Et s’il décrit avec une telle sévérité l’homme social, toujours hors de lui, ne sachant vivre que dans l’opinion des autres et tirant de leurs seuls jugements le sens de sa propre existence, c’est qu’il a vécu en lui-même et sur lui-même, constamment, les ravages de cette aliénation. Et je dirais qu’à l’heure même où il nous incombe de nous soustraire à l’ensorcellement maléfique par le dogme rousseauiste de l’innocence ou de la bonté originelle de l’homme, nous lui sommes infiniment redevables de sa description de la mauvaise honte, car elle nous invite à l’approfondissement et aussi à une vigilance accrue. Il n’y a pas de solution aux problèmes humains, rien n’est jamais joué. Être homme, c’est être le théâtre d’un affrontement entre la honte et la honte.
« Ma liberté n’a pas le dernier mot, je ne suis pas seul », écrit Lévinas39. Mais il dit aussi en substance : ma responsabilité pour l’autre n’a pas le dernier mot – car nous ne sommes pas deux, d’emblée il y a le tiers. « Le 37 STAROBINSKI (Jean), Largesse, Paris, Gallimard, 2007, p. 11. 38 ROUSSEAU (J.-J.), La Nouvelle Héloïse, in : Œuvres complètes, t. II, Paris, Gallimard, Pléiade, 1964, p. 300. 39 LÉVINAS (E.), Totalité et Infini, op. cit., p. 103.
Il y a quelque chose à dire en faveur de la honte
287
tiers est autre que le prochain, mais aussi un autre prochain, mais aussi un prochain de l’Autre et non pas simplement son semblable. »40 Avec le tiers sonne l’heure de la comparaison, de la pesée, de l’objectivation, de la problématisation. « De la responsabilité au problème – telle est la voie »41, dit encore Lévinas. Mais cet itinéraire lui-même doit être problématisé à la lumière de la mauvaise honte. Il y a un autre tiers que le prochain du prochain, il y a le qu’en dira-t-on. Lévinas affirme que le tiers me regarde dans le visage d’autrui, mais il oublie l’instance tierce qui me regarde regarder autrui et me laisse ou non libre de répondre à son appel. La phénoménologie lévinassienne ne fait aucune place au phénomène de l’imitation. Or ce que l’expérience totalitaire nous rappelle cruellement, c’est que le visage d’autrui est à la merci du regard des autres, que la délicatesse est à la merci de la camaraderie, que l’investiture de la liberté par le Bien est à la merci de la pression collective, bref que la honte est à la merci de la honte.
Fragilité de l’élection, puissance du mimétisme : entre la honte subjectivante et la honte objectivante, l’humanité tient à un fil.
GILLES HANUS
Mes questions vont s’organiser en trois grandes séries : la première concernera Sartre et Lévinas, la seconde concernera ce que vous avez appelé la crise de la honte et la réhabilitation de la civilité réalisée, à vous en croire, par Lévinas ; la dernière, enfin, concernera la distinction de la bonne et de la mauvaise honte.
Commençons par Sartre et Lévinas : selon vous, la différence entre ces deux penseurs est-elle simplement d’ordre phénoménologique ? J’explicite ma question : vous avez bien rappelé que la honte, chez Lévinas, est événement de la subjectivation, alors qu’elle est événement de l’aliénation chez Sartre. Cependant, pour Sartre comme pour Lévinas, l’apparition d’autrui est un fait absolu qui m’arrache à ce qu’on pourrait appeler mon existence immédiate. Il y a une différence de vocabulaire frappante dans les descriptions de chacun d’eux, en même temps qu’une grande proximité. Lévinas décrit la déroute du sujet sûr de son droit à l’existence ; Sartre, lui, 40 LÉVINAS (E.), Autrement qu’être, op. cit., p. 245. 41 Ibid., p. 251.
Alain Finkielkraut et Gilles Hanus
288
parle de « décentration ». Les deux penseurs soulignent, dans des phrases dont il n’est pas toujours évident d’établir avec certitude la paternité si on les extrait de leur contexte, que l’apparition d’autrui révèle la transcendance. Sartre, comme Lévinas, parle de l’apparition d’autrui comme ouvrant une relation non réciproque, asymétrique : « […] par le regard d’autrui, je fais l’épreuve concrète qu’il y a un au-delà du monde. Autrui m’est présent sans aucun intermédiaire comme une transcendance qui n’est pas la mienne. Mais cette présence n’est pas réciproque : il s’en faut de toute l’épaisseur du monde pour que je sois, moi, présent à autrui. »42 On pourrait énumérer ainsi un grand nombre de ressemblances.
Si l’on se penche par exemple sur les termes centraux de visage et de regard, que l’on a coutume – et c’est bien entendu justifié jusqu’à un certain point – d’attribuer respectivement à Lévinas et à Sartre, on se heurte à une véritable difficulté : à lire les textes, cette distinction se complique terriblement. Dès 1939 par exemple, Sartre se livre à des descriptions phénoménologiques du visage, dans ce magnifique texte intitulé justement « Visages », où il dit que le visage, c’est « la transcendance visible »43, formule frappante sous sa plume. Lévinas, de son côté, indique à plusieurs reprises que ce qu’il y a de visage dans le visage, si j’ose dire, c’est le regard. Dans Liberté et commandement, par exemple, Lévinas dit clairement : « Cette façon, pour un être, de percer sa forme, qui est son apparition, est concrètement son regard, sa visée. »44 Donc ce qu’il y a de visage dans le visage, ce qui déformalise le visage, ce qui fait que le visage n’est pas cette masse de chair avec ses orifices, etc., c’est le regard. Ma remarque, ou ma question, est donc la suivante : je ne nie évidemment pas la différence entre Sartre et Lévinas, mais j’aimerais savoir quel est le lieu de cette différence et est-ce que, selon vous, c’est uniquement une différence d’ordre phénoménologique ?
ALAIN FINKIELKRAUT
Je ne sais pas si c’est une différence d’ordre phénoménologique, mais je crois que c’est une différence capitale et qui demeure, malgré les résonances 42 SARTRE (J.-P.), L’être et le néant, op. cit., p. 309. 43 SARTRE (J.-P.), « Visages », rééd. in : Cahiers d’Études Lévinassiennes, n° 5 (Lévinas-Sartre), 2006, p. 195. 44 LÉVINAS (E.), Liberté et commandement, rééd. Paris, Le livre de poche, 1999, p. 49.
Il y a quelque chose à dire en faveur de la honte
289
que vous avez très justement soulignées ; les résonances n’annulent pas la différence.
Quand Sartre parle de « transcendance visible », c’est au sens où mon visage m’échappe, me déborde, excède l’idée que j’en ai : « Je le porte en avant de moi comme une confidence que j’ignore »45. Je me sens à peu près en forme, je ne pense pas particulièrement à moi, je suis plongé dans mes pensées, lorsque quelqu’un que je rencontre me dit : « Et bien, dis donc, tu as l’air fatigué ! » Et voici, par cette phrase anodinement indiscrète, ma libre conscience rabattue sur mon moi douloureux. Les photographies aussi sont des moments souvent difficiles d’aliénation de la liberté dans l’image. On ignore sans cesse qui l’on est et pourtant, ce que l’autre voit, c’est évidemment soi-même. Pour Sartre, en un mot, le visage n’est pas le privilège d’autrui. D’ailleurs – on peut le dire aussi en faveur de Sartre – c’est une difficulté de la pensée de Lévinas : il va tellement loin dans la dissymétrie que, au fond, le visage, c’est toujours l’autre – mais j’en ai forcément un, moi ; et puis l’autre et moi, nous lisons Lévinas, alors qui sommes-nous ? Sommes-nous tous deux le moi qui lit Lévinas, ou est-ce que nous sommes l’autre ? Dans quelle position peut-on lire Lévinas ? Et si tout le monde le lit comme moi, alors l’altérité, c’est quoi ? C’est qui ? Il y a là un vrai problème.
Quand Lévinas dit que le visage me regarde, il joue avec la polysémie admirable de la langue française : il me regarde, donc il me concerne. Le visage me regarde, cela veut dire : ce qui ne me regarde pas me regarde. Il me regarde et, dès lors qu’il me regarde, je suis concerné et je ne peux pas faire comme si je n’étais pas concerné, je ne peux pas vraiment passer mon chemin. Je passe mon chemin, mais il me regarde quand même. La responsabilité en moi procède de la rencontre du visage. Ce n’est pas la conflictualité qui est première, c’est la responsabilité. J’irais jusqu’à dire que dans la pensée de Lévinas, la honte joue, au moins partiellement, le rôle tenu dans la pensée de Sartre par l’angoisse. C’est dans l’angoisse, dit Sartre, que je prends acte de ma liberté, au fond c’est dans l’angoisse que je constate que je ne suis pas au sens d’un être qui coïncide avec son être. Pourquoi cette réflexion est-elle angoisse ? Parce que, comme l’écrit Michel Haar commentant Sartre, la conscience découvre alors « […] que rien, aucune 45 SARTRE (J.-P.), « Visages », art. cit., p. 192.
Alain Finkielkraut et Gilles Hanus
290
force, autorité ou pouvoir dans le monde, l’assurance d’aucune loi physique, morale ou sociale, aucune décision antérieurement prise, ne peut la protéger contre son propre pouvoir de nier et de se nier elle-même. ‘Rien’ alors ne la sépare du rien qu’elle est. »46 Je suis toujours séparé de mon passé, séparé de mon caractère, et donc je suis libre ; mais je ne peux compter sur rien, je ne peux pas compter sur ce que j’ai été pour réussir ce que j’ai à faire aujourd’hui : c’est ainsi que l’angoisse découvre le néant, et donc la non coïncidence de l’être avec lui-même. Et bien pour Lévinas, cette prise de conscience, cette prise de conscience de la conscience, si j’ose dire, se fait dans la honte. Mais évidemment, tout change, le paysage n’est pas le même. Je ne coïncide pas avec moi-même, mais cette non coïncidence est la non indifférence à l’égard des autres hommes47.
D’où la place, chez Lévinas, pour un concept qui n’existe pas chez Sartre, un concept qui, d’ailleurs, dérange notre dualisme spontané : le concept d’investiture. Sartre a du mal – il a essayé toute sa vie – à se défaire d’une opposition trop rigide entre la liberté et l’aliénation : soit je suis libre, soit je suis aliéné, d’où le problème très difficile d’une liberté commune, d’une liberté à plusieurs. Pour Lévinas, la question ne se pose pas en ces termes. Il peut bien sûr y avoir toutes les formes de l’aliénation, de l’oppression, de la dépendance, de la sujétion, et il donne beaucoup d’importance à toutes ces réalités : l’homme peut tomber en esclavage, c’est ce qui lui fait dire que la liberté n’est pas héroïque, qu’elle peut même être manipulée et que donc, ce qui lui reste, c’est la possibilité de retarder, d’ajourner sa propre trahison. La retarder, l’ajourner, l’empêcher à travers des institutions. Il y a chez Lévinas, penseur, dit-on, de la sainteté, une grande lucidité et un éloge tout à fait prosaïque de l’institution comme telle. Lévinas n’ignore rien des pièges et des horreurs de l’aliénation, mais il refuse de s’en tenir à cette opposition et il y a chez lui ce concept d’investiture de la liberté, qui résonne de manière tout à fait originale. Dans la honte, ma liberté n’est pas aliénée, arrachée par l’autre, elle est investie par l’autre. Je ne suis pas sûr qu’il y ait l’équivalent de cette investiture chez Sartre. Je crois que le point de départ est phénoménologique mais que les conséquences se font sentir dans tous les domaines de l’existence. 46 HAAR (Michel), La philosophie française entre phénoménologie et métaphysique, Paris, P.U.F., 1999, p. 45. 47 Cf. supra, note 23.
Il y a quelque chose à dire en faveur de la honte
291
GILLES HANUS
Je ne pensais pas aux conséquences lorsque j’ai posé ma question. Je les admets toutefois ; mais je m’interrogeais, quant à moi, sur l’avant, je pensais à ce que Lévinas appelait le pré-philosophique. Lévinas dit explicitement que la description que Sartre fait de l’apparition d’autrui est remarquable mais qu’elle s’arrête trop tôt48. De fait, Sartre s’arrête au point où Lévinas déploie ce qui donne sa singularité à son mouvement de pensée et que l’on pourrait résumer à l’aide d’une phrase de Totalité et Infini : « Le visage, encore chose parmi les choses, perce la forme qui cependant le délimite. Ce qui veut dire concrètement : le visage me parle et par là m’invite à une relation sans commune mesure avec un pouvoir qui s’exerce, fût-il jouissance ou connaissance. »49 La différence entre la description de Sartre et celle de Lévinas réside en ceci que pour Lévinas, le visage me parle, qu’il m’adresse un commandement, que, dans le visage que je vois, qui s’offre à ma vision, j’entends des voix – donc, en un mot, dans le fait que, face au visage, je vois des voix, fait qui renvoie au verset50 et non à la description phénoménologique. En langage lévinassien, si vous voulez, on appellerait cela le dépassement du phénoménologique par l’éthique ; en langage paradigmatique, le langage des lectures talmudiques, on appellerait cela le « vent de crise », l’inspiration du langage philosophique par le sensé biblique, qui produit dans le logos philosophique des effets d’hyperbole, des effets de débordement. Autrement dit – et vous l’avez très clairement rappelé – le visage, chez Lévinas comme chez Sartre, est le lieu d’une révélation ; mais chez Lévinas, cela signifie qu’il est le lieu d’un commandement, d’une assignation, d’une investiture, alors que chez Sartre, la révélation est une révélation au sens strictement phénoménologique de dévoilement. Le visage d’autrui, chez Sartre, m’apprend ma vulnérabilité, ma faiblesse, alors que selon Lévinas, il m’ordonne la responsabilité, la non indifférence. Ma question est la suivante : phénoménologiquement, qui a raison ? Chez qui pouvons-nous nous reconnaître ? Est-il sûr que cela soit chez Lévinas, comme vous le disiez ? Avons-nous fait l’expérience du commandement dans le visage d’autrui ? Lévinas lui-même semble en douter, qui écrit, dans En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, que les grandes « expériences » 48 Cf. LÉVINAS (E), Humanisme de l’autre homme, op. cit., p. 63. 49 LÉVINAS (E.), Totalité et Infini, op. cit., p. 215-216. 50 Cf. Exode 20, 15.
Alain Finkielkraut et Gilles Hanus
292
de notre vie n’ont jamais été à proprement parler vécues – et à ce moment de son texte, il se réfère à la Torah et plus précisément à l’épisode du buisson ardent51. Peut-on comprendre le prolongement lévinassien de l’analyse sartrienne sans recourir à la source qui donne son souffle à ce prolongement ?
ALAIN FINKIELKRAUT
Le visage parle. C’est le visage qui me fait entendre le « tu ne tueras point ». L’interdit, c’est d’abord pour moi le fait d’être arrêté, d’être inhibé, d’être interdit par le visage. Le visage provoque en moi une inhibition salutaire. Je trouve cette analyse admirable. Elle procède, en effet, du sensé biblique, mais elle a aussi une force de persuasion proprement phénoménologique. Autrement dit, nous entendons des résonances bibliques dans le texte de Lévinas et en même temps, nous voyons l’interdit naître du visage lui-même. Vous disiez tout à l’heure que le visage selon Sartre m’apprend ma vulnérabilité, ma faiblesse ; le visage selon Lévinas m’apprend sa vulnérabilité, sa faiblesse. Il me fait honte de ma force. Nous sommes donc dans le registre de la phénoménologie et soit on peut penser que cette phénoménologie n’a de sens qu’adossée à la Bible, soit on peut penser que la Bible elle-même reçoit de la description de Lévinas une sorte d’investiture phénoménologique. Et j’en reste à cette hésitation principielle.
GILLES HANUS
Passons donc à la deuxième série de questions à propos de la crise de la honte et ce que vous avez appelé la réhabilitation de la civilité par Lévinas. Vous avez lié (en quittant d’ailleurs Lévinas sur ce point, puisque vous avez donné des exemples dans d’autres textes, d’autres expériences) la civilité et la honte. La honte, dites-vous, me rappelle à l’investiture, elle me ramène à la timidité de l’humain, que j’oublie dans ma persévérance à être. En un mot, disiez-vous, la honte ouvre l’humanité. Ma question porte sur le sens de cette formule : si la honte me rappelle à l’investiture, si elle me réinvestit, en quelque sorte, n’est-ce pas parce qu’au fond, j’ai toujours déjà été investi
51 Cf. LÉVINAS (E.), En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, rééd. Paris, Vrin, 1988, p. 211.
Il y a quelque chose à dire en faveur de la honte
293
ou élu ? Ma question, autrement dit, est la suivante : la honte ouvre-t-elle l’humanité ou la restaure-t-elle ?
ALAIN FINKIELKRAUT
Qu’entendez-vous par « restaurer » ?
GILLES HANUS
Vous dites que la honte ouvre l’humanité, en tant qu’elle me fait découvrir mon investiture. J’interroge cette formule parce qu’après tout, la honte peut très bien produire sur moi les effets que décrit Sartre. Loin de me ramener miraculeusement à mon humanité, la honte peut entraîner une réaction d’orgueil ; elle peut me ramener au pouvoir que je veux avoir sur l’autre parce qu’il a du pouvoir sur moi, et donc au conflit qui est quand même, je crois, l’expérience la plus quotidienne que nous faisons d’autrui, avant le « tu ne tueras pas » dans son visage.
Ne pourrait-on pas dire que si la honte a un rapport avec l’humanité, c’est en tant qu’elle me ramène à mon humanité, que j’avais oubliée dans ma persévérance à être ? Autrement dit, encore : est-ce que l’être, c’est le mal, comme l’écrit Lévinas dans Le temps et l’autre ?
ALAIN FINKIELKRAUT
Disons que si j’en reste aux descriptions de Lévinas, c’est par la honte que j’accède à l’humanité, donc ce n’est pas une restauration.
Le charme de l’œuvre de Lévinas, je l’ai dit, vient du fait que c’est une philosophie narrative, une philosophie qui nous raconte quelque chose, puisque précisément, l’éthique relève de la catégorie de l’événement. Elle nous tombe dessus. C’est justement la grande surprise des êtres soupçonneux, démystificateurs, non dupes que nous prétendons être. L’éthique, ce n’est pas toute une série de maquillages, de mascarades ou d’artifices dissimulant des convoitises – non ! L’éthique, ça vous tombe dessus, ça vous arrive. Et c’est de cet événement qui, au fond, a peut-être toujours déjà eu lieu, que Lévinas ne cesse de nous entretenir. Qu’est-ce que la honte ? C’est une liberté qui se détache d’elle-même. Donc Sartre est le philosophe de la liberté, une liberté dont il voudra toute sa vie faire quelque chose d’autre que sa propre affirmation – et il aura du mal. Lévinas est le philosophe de la liberté honteuse, mais au commencement, malgré tout, si
Alain Finkielkraut et Gilles Hanus
294
l’on veut bien suivre l’ordonnancement du récit, au commencement est la liberté. Je suis libre, je vis, et tout d’un coup, je suis dégrisé ; et il n’y a d’humanité que dans cet éveil, ce réveil. Alors, restauration ? Peut-être le mot réveil peut-il introduire la restauration ; je dors, je dors debout, je suis un somnambule, et tout d’un coup, je sors du sommeil de l’être. Ma liberté ne sait plus quoi faire d’elle-même ; et c’est quand ma liberté ne sait plus quoi faire d’elle-même que je suis humain.
Alors pourquoi ? Je peux maintenant essayer de répondre brièvement à la question que je posais au début. Pourquoi en suis-je venu à tenter cette lecture-là de Lévinas ? Pourquoi le concept de honte, très présent mais qui m’avait, si j’ose dire, laissé tranquille dans mes lectures précédentes, m’a sauté au yeux au point que je réorganise la pensée de Lévinas autour de ce concept ? Sans doute du fait de ce que j’ai appelé cette crise de la honte, sans doute parce qu’il me semble vivre de plus en plus entouré de forces qui vont, entouré de somnambules ; sans doute parce que tout d’un coup je me dis : cette honte est fragile. Qu’elle soit constitutive de l’humanité même, on en a des preuves par la multiplication des comportements où elle fait défaut, où précisément on se conduit, on agit comme si l’on était seul – et cela aussi on le retrouve chez Lévinas, dans Difficile liberté : « Est violente toute action où l’on agit comme si l’on était seul à agir. »52 Un peu plus loin, il dit : « Autrui n’est pas seulement connu, il est salué. »53 On n’est pas obligé de saluer autrui tout le temps, cela se faisait autrefois dans les promenades, un petit coup de chapeau ; cette politesse est sans doute périmée, mais il y a une manière d’être comme si autrui n’existait pas, dont nous savons qu’elle est la violence même. Que la honte soit constitutive de l’humain, je le répète, j’ai été amené à le penser, et donc à relire Lévinas en ces termes, dans la mesure où je la voyais disparaître et où je voyais toujours plus de ces glorieuses spontanéités de vivant, dont parle Lévinas. L’humanité, restauration ou instauration, je ne saurais le dire, mais on peut se dire, en tout cas, que l’humanité n’est jamais acquise, qu’il y a des circonstances sociales et technologiques qui provoquent des comportements inhumains en ce simple sens où l’on agit comme si l’on était seul à agir.
52 LÉVINAS (E.), Difficile liberté, op. cit., p. 18. 53 Ibid., p. 20.
Il y a quelque chose à dire en faveur de la honte
295
GILLES HANUS
Un petit mot encore sur cette question de la honte, du commencement et de la liberté. Vous dites : on est une liberté, une force qui va, et puis la honte survient et, avec elle, la découverte, insoupçonnée, de mon investiture. « L’existence en réalité, écrit Lévinas, polémiquant avec Sartre dans Totalité et Infini, n’est pas condamnée à la liberté, mais est investie comme liberté, la liberté n’est pas nue. »54 Elle ne commence pas comme cela, toute seule, il y a quelque chose d’antérieur, il y a précisément, dit-il dans certains textes, une orientation vers le bien antérieure à la liberté de choisir entre bien et mal. C’est un point important, et c’était ce genre de passages qui inspirait ma question sur la honte : est-ce que la honte est l’une des occasions, parmi d’autres, de se souvenir de cette investiture ou est-ce, comme vous semblez le dire, l’expérience privilégiée de cette investiture ?
ALAIN FINKIELKRAUT
Il faudrait analyser les termes dans le sens que, à chaque fois, le contexte leur donne. Il est clair que chez Lévinas, il s’agit d’un saisissement par le Bien. C’est aussi l’une des surprises de cette œuvre, pourtant à ce point marquée par l’horreur du vingtième siècle, que de nous expliquer qu’à la limite, on n’a pas le choix. Le Bien nous saisit, que nous le voulions ou non. La liberté de choisir est postérieure à ce saisissement par le Bien. Il y a une orientation qui est née de la rencontre du visage et qui fait que je ne peux pas me dérober à cette investiture. Alors bien sûr, que je ne puisse pas me dérober, cela ne veut pas dire que je ne me déroberai pas, mais cela veut dire qu’il y a cette empreinte en moi, dit Lévinas. Et en ce sens, encore une fois, la honte est instauratrice de l’humain : c’est par là, c’est par cette émotion que j’accède au visage et que se révèle ce que Lévinas appelle l’investiture ou l’élection de la liberté. Il y a chez Lévinas un passage de la liberté pure à la liberté élue ou investie. Mais il faut bien commencer par la liberté pure.
GILLES HANUS
C’est par l’expérience de la honte que, selon vous, j’accède au visage. Dans les descriptions de Lévinas, il semble pourtant bien que ce soit par le visage que j’accède à l’expérience de la honte. Il y a là une des ambiguïtés que je signalais 54 LÉVINAS (E.), Totalité et Infini, op. cit., p. 83.
Alain Finkielkraut et Gilles Hanus
296
tout à l’heure. Est-ce que c’est le visage d’autrui qui me révèle ma liberté investie ou est-ce ma liberté investie, en tant que précisément je l’investis et donc je ne l’oublie pas, qui me permet d’accéder au visage d’autrui ?
ALAIN FINKIELKRAUT
Je vois bien l’enjeu de cette discussion et on ne va pas en terminer ce soir, nul n’aura le dernier mot ; mais ce qui me paraît important chez Lévinas, c’est la critique de l’innocence. Par la honte, je sors de l’innocence et c’est en sortant de l’innocence que j’accède à l’existence morale : l’innocence est nocence. Quand je suis innocent, en fait je suis nocent, et là dessus nous pourrions nous rejoindre, car seul accède au visage celui « qui a imposé une règle sévère à sa propre nature ». Ainsi les mitsvot sont-elles définies par Lévinas comme l’ensemble des prescriptions nées de la conscience aiguë de la nocence de l’innocente liberté. Et Lévinas renvoie dos à dos le thème rousseauiste de la liberté originelle et le thème du péché originel. Quand je constate que je ne suis pas innocent, ce n’est pas le moment où je deviens pécheur, c’est le moment où j’accède à l’existence morale. Certes, il cite Pascal, mais le climat de son œuvre n’est pas pascalien. Le scrupule d’être, c’est la moralité même. Quand je prends conscience que mon innocence est nocence, je deviens humain. Cette critique de la nocence qu’il y a dans l’innocence, dans la spontanéité, dans le simple fait de vivre, me paraît une idée d’une force absolument extraordinaire.
GILLES HANUS
Nous allons passer au troisième moment, à propos de la distinction de la bonne et de la mauvaise honte. La bonne honte, c’est, selon votre exposé, la honte lévinassienne telle que vous l’avez décrite, c’est-à-dire cette honte qui est l’événement d’une subjectivation ; et puis la mauvaise honte, illustrée, à partir du livre de Sebastian Haffner et de celui de Browning, par la description de l’encamaradement, serait ce sentiment qui fait que, lorsque je suis dans un groupe de camarades, je n’ose pas me singulariser. J’aurais honte, précisément, de ressentir la honte subjectivante. La mauvaise honte serait donc ce moment où le sentiment de communion prend le dessus, où il s’agit d’en être, d’appartenir au groupe, de ne pas perdre la face. À l’inverse, la bonne honte serait la honte singularisante qui invite à voir le visage. Ma question porte sur le lien entre ces deux formes de la honte : comment
Il y a quelque chose à dire en faveur de la honte
297
passe-t-on de l’une à l’autre, ou comment peut-on expliquer que la bonne honte puisse s’abîmer, s’inverser en mauvaise honte ?
ALAIN FINKIELKRAUT
C’est une question terrible. Cette expression de « mauvaise honte », je ne l’ai pas inventée, c’est Rousseau qui l’emploie à plusieurs reprises dans Les Confessions, dans les Rêveries du promeneur solitaire, dans La Nouvelle Héloïse, et ce sont d’ailleurs à chaque fois les occasions des aveux les plus difficiles de Rousseau, les choses terribles qu’il a faites, non pas par perversité, non pas par cruauté, mais par mauvaise honte.
J’ai trouvé que ce thème rousseauiste était très éclairant et qu’en tout cas il obligeait à une analyse plus fine. On ne pouvait pas en rester simplement à cette thématique de la honte, d’autant plus que j’ai donné, en effet, des exemples de mauvaise honte à propos d’expériences bien plus effrayantes que les péchés véniels dont Saint Preux ou dont le pauvre Jean-Jacques ont pu se rendre coupable. Cette mauvaise honte, c’est précisément ce qu’analysent Sebastian Haffner dans Histoire d’un allemand ou Christopher Browning dans Des hommes ordinaires. Il est vrai que j’ai arrêté là mon interrogation. J’ai voulu confronter la honte et la mauvaise honte, d’abord pour deux raisons.
La première, c’est que je suis, comme d’autres, insatisfait par le traitement que Lévinas donne de la question du tiers. Le tiers, c’est un peu le deus ex machina, alors cela donne des résultats tout à fait passionnants ; mais pendant toute l’œuvre on est deux, et puis tout d’un coup, il y a ce moment, à la fin d’Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, où intervient le tiers. Et cela conduit Lévinas à une grande réhabilitation de tous les édifices qu’il avait ébranlés, la philosophie notamment, qui n’est plus amour de la sagesse, mais sagesse de l’amour : il faut modérer l’amour, parce qu’il faut réfléchir, se demander sans cesse qui a fait quoi à qui. Le tiers oblige à la réflexion, donc l’émotion morale ne suffit pas ; la morale n’est pas seulement émotion, elle est problématisation. Les choses seraient simples si nous n’étions que deux, Lévinas a raison. Mais on ne peut pas résoudre aussi simplement la question de la pluralité humaine. On doit aussi prendre acte de l’existence de surmois monstrueux. Lévinas remplace l’idée de surmoi par la transcendance du visage, au-dessus de moi. Mais il y a aussi la voix des ancêtres et/ou la voix du groupe, de la collectivité, du tiers agglutiné. J’ai dit que nous entrions dans une crise de la honte : la honte peut être oubliée, on peut faire comme
Alain Finkielkraut et Gilles Hanus
298
si les autres n’existaient pas, agir comme si l’on était seul, et on le fait de plus en plus avec ce que la technologie nous permet. Mais il faut aller plus loin et se demander si cette crise ne témoigne pas d’un changement de régime de la honte. Ainsi, l’école.
J’ai sous les yeux un texte de Rabbi Hayyim de Volozhyn que Lévinas nous a fait connaître : L’âme de la vie55. On y trouve cette réflexion sur un passage de la Michna : « Sans crainte, point de sagesse. » Pourquoi la crainte devrait être préalable à la sagesse ? Réponse de Hayyim de Volozhyn : « L’écriture compare la Torah au produit de la récolte, et la crainte à une grange dans laquelle on les entasse et on les conserve. La crainte de Dieu est la grange dans laquelle la sagesse de la Torah se conserve. Si l’on ne prend pas soin, au préalable, de préparer la grange de la crainte, l’abondante moisson de la Torah gît à même le sol, exposée au piétinement du bœuf et de l’âne, et s’abîme. »56
C’est une extraordinaire manière de décrire la situation de l’enseignement ou de la transmission aujourd’hui. Il n’y a pas de crainte, la crainte a disparu et, dès lors, la moisson gît à même le sol, exposée au piétinement du bœuf et de l’âne, et s’abîme. Pour le dire avec une certaine solennité, ce ne sont pas les valeurs républicaines qui sont aujourd’hui en crise, c’est beaucoup plus fondamental : c’est le fondement même de l’être-enseigné, que les Grecs appelaient l’aidôs et dont je vois un équivalent dans cette phrase de la Michna. On ne peut donc pas simplement en rester au constat de l’oubli ou de l’éclipse de la honte. Et là il faut lire Hannah Arendt, « La crise de l’éducation ». Elle observe que l’autorité du professeur ne va plus de soi et qu’une autre autorité, bien plus tyrannique, se met en place – celle du groupe : « Si l’on se place du point de vue de l’enfant pris individuellement, on voit dès lors qu’il n’a aucune chance de se révolter ou de faire quelque chose de sa propre initiative. Il ne se trouve plus dans la situation d’une lutte inégale avec quelqu’un qui a certes une supériorité absolue sur lui, mais il se trouve bien plutôt dans la situation par définition sans espoir de quelqu’un appartenant à une minorité réduite à une personne, face à l’absolue majorité de tous les autres. Affranchi de l’autorité des
55 VOLOZINE (Rabbi Haïm de), L’âme de la vie, trad. fr. Benjamin Gross [1986], rééd. Lagrasse, Verdier poche, 2006. 56 Ibid., p. 308.
Il y a quelque chose à dire en faveur de la honte
299
adultes, l’enfant n’a pas été libéré mais soumis à une autorité bien plus effrayante, vraiment tyrannique, la tyrannie de la majorité. »57 Voilà ce que dit Hannah Arendt. Ce sont les pairs qui ont le pouvoir de faire honte. La honte n’a pas disparu, elle s’est déplacée.
Alain Finkielkraut est professeur à l’École Polytechnique, écrivain et l’un des fondateurs de l’Institut d’Études Lévinassiennes. Derniers livres parus : La querelle de l’école (sous la direction d’Alain Finkielkraut, Stock, 2007) et, en collaboration avec Rony Brauman, La Discorde. Israël-Palestine, les Juifs, la France (Mille et une nuits, Fayard, 2006).
57 ARENDT (Hannah), La crise de la culture, trad. de l’anglais sous la direction de Patrick Lévy, rééd. Paris, Gallimard (Folio-essais), 1989, p. 233.